 Tous les messages Tous les messages
#1
Samuel Johnson 1
Loriane
Posté le : 17/09/2016 22:33
Le 18 septembre 1709 naît Samuel Johnson
aussi connu sous le nom de Dr Johnson, Docteur Johnson, mort le 13 décembre 1784, à 75 ans à Londre en Grande Bretagne un des principaux auteurs de la littérature britannique. Poète, essayiste, biographe, lexicographe, traducteur, pamphlétaire, journaliste, éditeur, moraliste et polygraphe, il est aussi un critique littéraire des plus réputés. Ses commentaires sur Shakespeare, en particulier, sont considérés comme des classiques. Anglican pieux et fervent Tory conservateur, il a été présenté comme « probablement le plus distingué des hommes de lettres de l'histoire de l'Angleterre. La première biographie lui ayant été consacrée, The Life of Samuel Johnson de James Boswell, parue en 1791, est le plus célèbre de tous les travaux de biographie de toute la littérature. Au Royaume-Uni, Samuel Johnson est appelé Docteur Johnson en raison du titre universitaire de Doctor of Laws, docteur en droit, qui lui fut accordé à titre honorifique. Né à Lichfield dans le Staffordshire, il a suivi les cours du Pembroke College à Oxford pendant un an, jusqu'à ce que son manque d'argent l'oblige à le quitter. Après avoir travaillé comme instituteur, il vint à Londres où il commença à écrire des articles dans The Gentleman's Magazine. Ses premières œuvres sont la biographie de son ami, le poète Richard Savage, The Life of Mr Richard Savage 1744, les poèmes London, Londres et The Vanity of Human Wishes, La Vanité des désirs humains et une tragédie Irene. Toutefois, son extrême popularité tient d'une part à son œuvre majeure, le Dictionary of the English Language, publié en 1755 après neuf années de travail, et d'autre part à la biographie que lui a consacrée James Boswell. Avec le Dictionary, dont les répercussions sur l'anglais moderne sont considérables, Johnson a rédigé à lui seul l'équivalent, pour la langue anglaise, du Dictionnaire de l'Académie française. Le Dictionary, décrit par Batte en 1977 comme l'un des plus grands exploits individuels de l'érudition, fit la renommée de son auteur et, jusqu'à la première édition du Oxford English Dictionary OED en 1928, il était le dictionnaire britannique de référence. Quant à la Vie de Samuel Johnson par Boswell, elle fait date dans le domaine de la biographie. C'est de cet ouvrage monumental que proviennent nombre de bons mots prononcés par Johnson, mais aussi beaucoup de ses commentaires et de ses réflexions, qui ont valu à Johnson d'être l'Anglais le plus souvent cité après Shakespeare. Ses dernières œuvres sont des essais, une influente édition annotée de The Plays of William Shakespeare 1765 et le roman largement lu Rasselas. En 1763, il se lie d'amitié avec James Boswell, avec qui il voyage plus tard en Écosse ; Johnson décrit leurs voyages dans A Journey to the Western Islands of Scotland. Un voyage vers les îles occidentales de l'Écosse. Vers la fin de sa vie, il rédige Lives of the Most Eminent English Poets Vies des plus éminents poètes anglais, un recueil de biographies de poètes des XVIIe et XVIIIe siècles. Johnson était grand et robuste, mais ses gestes bizarres et ses tics étaient déroutants pour certains lorsqu'ils le rencontraient pour la première fois. The Life of Samuel Johnson et d'autres biographies de ses contemporains décrivaient le comportement et les tics de Johnson avec tant de détails que l'on a pu diagnostiquer ultérieurement qu'il avait souffert du syndrome de Gilles de la Tourette, inconnu au XVIIIe siècle, pendant la majeure partie de sa vie. Après une série de maladies, il meurt le 13 décembre 1784 au soir, et est enterré à l'abbaye de Westminster, à Londres. Après sa mort, Johnson commence à être reconnu comme ayant eu un effet durable sur la critique littéraire, et même comme le seul grand critique de la littérature anglaise. En bref Bien qu'il n'ait laissé en aucun genre une œuvre de premier plan, l'écrivain anglais Samuel Johnson, communément appelé le Dr Johnson, domine son siècle de sa réputation et de son autorité. Il a donné son nom à l'époque littéraire comprise entre les années 1740 et celle de sa mort, survenue en 1784. Polyvalent, il s'est néanmoins distingué par une critique qui annonçait les méthodes modernes. Un polygraphe distingué. Samuel Johnson naquit à Lichfield (Staffordshire), où son père était libraire. Après des études au lycée de cette ville, il passa quatorze mois à Pembroke College, Oxford, mais quitta l'université sans y prendre son diplôme en 1729. Son père mourut peu après, le laissant sans ressources. Alors commença pour lui une carrière besogneuse de journaliste, d'essayiste, de traducteur, de compilateur. Il devint le type parfait de l'« homme de lettres », érudit, curieux, cultivé, soucieux d'ordre et d'élégance dans le style, capable d'écrire sur tous les sujets. Il collabora au Gentleman's Magazine, le plus célèbre périodique de l'époque, où il publia des essais et des poèmes, et se lança en 1747 dans la vaste entreprise de composer un Dictionary, qu'il réussit à publier en 1757, après dix ans de labeur acharné. Entre-temps, il écrivit une tragédie, Irène (que Garrick, son ami, fit jouer sans succès en 1749), son meilleur poème, The Vanity of Human Wishes (La Vanité des désirs humains), et, peu après, fonda un périodique, The Rambler (1750-1752), sur le modèle du Spectator d'Addison, où les articles des 208 numéros sont tous de sa plume. En 1759, il publia son unique roman, Rasselas, Prince of Abyssinia. Il en avait assez fait déjà pour régner désormais sur la vie littéraire de Londres. En 1763, il rencontra l'Écossais James Boswell (1740-1795) qui, fasciné par sa puissante personnalité, devait s'attacher à ses pas, recueillir ses propos, et accumuler des notes pour composer son étonnante Life of Samuel Johnson (1791), le chef-d'œuvre des biographies. C'est à cette « vie » que Johnson doit une grande partie de sa réputation, encore qu'elle ne soit nullement « critique », mais parce qu'elle est si riche de traits, de détails, d'anecdotes, de boutades, que la figure du maître prend vie, s'illumine, et captive le lecteur. On y voit le grand homme pontifier au Club, qui tenait ses réunions à La Tête de Turc, dans Gerrard Street. On entend sa voix, on écoute ses moindres mots, on redoute ses boutades, on admire ses réparties. Le Dr Johnson est, dans sa conversation, semblable à ses écrits. Grave, pondéré, informé de tout, il profère comme des oracles, non sans un humour bien particulier. Il poursuit inlassablement son immense labeur d'érudit, de critique, d'essayiste polygraphe. Il s'attaque, après Pope (1725), Théobald (1733) et Warburton (1747), à une édition de Shakespeare, avec une longue préface et des notes pour chaque pièce, publiée en 1765. Il compile une vaste édition de poètes anglais, pour chacun desquels il écrit une biographie critique – et ce seront ses célèbres Lives of the English Poets (1779-1781, Vies des poètes anglais). Il prend le temps d'un voyage en Écosse, que Boswell racontera dans Journal of a Tour to the Hebrides (1785, Journal d'une tournée aux Hébrides). Parvenu au faîte de sa gloire, mais malade et mélancolique à la fin de sa vie, il mourut à Londres. On lui fit l'honneur d'un tombeau à Westminster Abbey. Le fondateur de la critique moderne : De son œuvre considérable, souvent touffue, redondante ou anecdotique, tout imprégnée des thèmes et nourrie de l'actualité du siècle, surnagent deux poèmes, un court roman et des essais critiques de grande valeur. Les poèmes, London (1738) et La Vanité des désirs humains (1749), imités de la Troisième et de la Dixième Satire de Juvénal, qui sont empreints de la phraséologie classique que Pope avait portée, semble-t-il, à sa perfection, ont cependant plus de rigueur dans la diction, plus de hauteur et de portée morale dans le didactisme. Ils ont fait l'objet de rééditions, et reçu un tribut d'admiration de T. S. Eliot et de quelques critiques contemporains. Rasselas, « roman » didactique gravement écrit, comporte plus de discussions que d'aventures, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une quête du bonheur à laquelle se livre le prince d'Abyssinie, sortant de sa vallée heureuse pour connaître l'expérience du monde. Il se trouve que de son voyage en Égypte, il ne rapporte que des conclusions mélancoliques. Pour une raison ou pour une autre, tous les hommes sont insatisfaits et malheureux. Seule la vertu peut, sans doute, apaiser la conscience, et faire croire à la possibilité du bonheur. Ce Rasselas n'a pas les illusions de Candide, ni non plus son ironique vitalité. L'œuvre critique, outre les essais du Rambler qui visent à inculquer au lecteur un goût pour la sagesse et la vertu, mais où Johnson s'efforce aussi d'écrire une prose compacte et raffinée, comprend de très nombreux essais, d'inégale valeur, mais toujours importants par quelque côté, parmi lesquels se distinguent son admirable Préface au Dictionnaire, sa Préface et ses notes à l'édition de Shakespeare, et ses Vies des poètes. Il convient d'ajouter que dans La Vie de Cowley (poète célèbre du début du XVIIe siècle) le Dr. Johnson a donné une définition de wit qui fait toujours autorité : « Wit (...) may be (...) considered as a kind of discordia concors, a combination of dissimilar images, or discovery of occult resemblances in things apparently unlike » (« L'esprit – ou l'acuité de l'esprit – (...) peut être (...) considéré comme une espèce de discordia concors, ou combinaison d'images dissemblables, ou découverte de ressemblances occultes dans des choses apparemment différentes »). On peut dire que Johnson est l'instigateur de la critique moderne, par l'importance qu'il attache à l'analyse réfléchie d'un texte littéraire dont il veut pénétrer la signification, en même temps qu'il scrute les procédés d'écriture, véhicules de l'émotion ou de la pensée que l'auteur s'efforce d'exprimer. Son analyse n'est d'ailleurs pas tellement textuelle, mais elle porte sur l'ordonnance du discours, la qualité des images, la portée, enfin, de l'ensemble sur l'esprit du lecteur. C'est une critique profondément sérieuse, tout entachée, il est vrai, d'un moralisme d'époque, mais cependant universel, en ce que l'œuvre d'art est faite pour instruire, explicitement ou implicitement, autant que pour plaire. De plus, Johnson prend des positions, porte des jugements de valeur, au nom de ce qu'il faut bien appeler le goût, le sens commun, et l'intuition personnelle. Ses jugements ne sont pas toujours infaillibles, ni ses condamnations sans appel. Mais personne mieux que lui n'a circonscrit la qualité de ce qu'on a appelé « l'esprit métaphysique », ni mieux, c'est-à-dire de façon plus désintéressée, contribué à placer la critique shakespearienne sur le plan où elle se situera longtemps, celui de la « connaissance du cœur humain ». Si cette critique est dépassée par l'accent mis aujourd'hui sur le génie poétique et linguistique de Shakespeare, elle n'en reste pas moins passionnante par sa totale sincérité. La prose de Johnson est admirable de clarté et de concision. C'est un style vigilant, qui s'applique la discipline dont il faisait une loi pour les écrivains dont il traitait, et qui pourrait bien être, même de nos jours, la discipline suprême : pureté de la langue, d'abord, de la diction, c'est-à-dire méfiance à l'endroit du baroque, des perversions d'écriture, ou des bizarreries faites pour capter l'attention ; vigueur aussi de l'expression, par la précision du terme, la rigueur de la syntaxe, l'usage d'une rhétorique concrète, qui ne craint ni la répétition s'il le faut, ni les effets d'amplitude que donnent au style un mot inattendu, une tournure imprévue ; netteté, enfin (l'anglais dit perspicuity), qui se fait un premier devoir de l'intelligibilité, et qui vise à la pénétration. Le langage critique, comme le poétique, doit être cet instrument qui analyse avec perspicacité et présente avec lucidité les raisons d'être mêmes de n'importe quelle œuvre d'art écrite avec des mots. Tel est le message implicite dans l'œuvre de Samuel Johnson, que l'on pourrait justement déclarer le fondateur de la critique moderne. Henri Fluchère Sa vie Il existe de nombreuses biographies de Samuel Johnson, mais La Vie de Samuel Johnson par James Boswell The Life of Samuel Johnson est celle qui est la mieux connue du grand public. Au XXe siècle pourtant, l'opinion des spécialistes de Johnson comme Edmund Wilson et Donald Greene est qu'on peut difficilement appeler biographie un tel ouvrage : Ce n'est qu'un recueil de ce que Boswell a pu écrire dans ses journaux à l'occasion de ses rencontres avec Johnson au cours des vingt-deux dernières années de la vie de celui-ci… avec seulement un effort bien négligent pour combler les lacunes. »8 Donald Greene assure aussi que Boswell, avec l'aide de ses amis, a commencé son travail par une campagne de presse bien organisée, avec grosse publicité et dénigrement de ses adversaires, en se servant pour la stimuler d'un des articles les plus mémorables de Macaulay qui n'est que du boniment de journaliste. Il lui reproche aussi des erreurs et des omissions, affirmant que l'ouvrage relève plus du genre des mémoires que la biographie au sens strict. Enfance et éducation Premières années Michael Johnson, libraire à Lichfield, Staffordshire, Angleterre, a épousé en 1706, à l'âge de 49 ans, Sarah Ford, âgée de 38 ans. Samuel nait le 18 septembre 1709, au domicile de ses parents situé au-dessus de la librairie. Comme Sarah a dépassé quarante ans, et que l'accouchement s'avère difficile, le couple fait appel à un maïeuticien et chirurgien de renom nommé George Hector. L'enfant ne pleure pas, et dubitative à propos de la santé du nouveau-né, sa tante déclare qu'elle n'aurait pas ramassé une telle pauvre créature dans la rue ; la famille, qui craint pour la survie de l'enfant, fait venir le curé de St Mary's church, l'église voisine, pour le baptiser. On lui donne le prénom du frère de Sarah, Samuel Ford, et deux parrains lui sont choisis : Samuel Swynfen, médecin diplômé du Pembroke College d'Oxford et Richard Wakefield, juriste et secrétaire de mairie de Lichfield. La santé de Samuel s'améliore, et Joan Marklew lui sert de nourrice. Mais il est rapidement atteint de scrofules, qu'on appelait alors le Mal du Roi, car on pensait qu'un toucher du roi pouvait en guérir. John Floyer, ancien médecin de Charles II d'Angleterre suggère alors que le jeune Johnson devrait recevoir le toucher du roi, qu'Anne de Grande-Bretagne lui accorde le 30 mars 1712. Le rituel se révèle toutefois inefficace et une opération est pratiquée qui laisse des cicatrices indélébiles sur le corps et le visage de Samuel. Avec la naissance du frère de Samuel, Nathaniel, quelque temps plus tard, Michael n'est plus en mesure de payer les dettes qu'il a accumulées au cours des ans, et sa famille est contrainte à changer de mode de vie. “Alors qu'il était un enfant ..., et qu'il avait appris à lire, Mrs Johnson, un matin, mit le Livre de la prière commune entre ses mains, lui montra la prière du jour et dit : Sam, tu dois apprendre cela par cœur. Elle monta les escaliers, le laissant l'étudier : mais alors qu'elle avait atteint le deuxième niveau, elle l'entendit la suivre. Que se passe-t-il ? dit-elle. Je peux la dire, répondit-il ; et il la répéta distinctement, bien qu'il n'eût pu la lire plus de deux fois.” – Boswell, La vie de Samuel Johnson Années d'école Samuel Johnson se montre d'une intelligence particulièrement précoce, et ses parents étaient fiers de faire admirer, ce dont il se souviendra plus tard avec un certain écœurement, ses talents nouvellement acquis. Son éducation commence lorsqu'il a trois ans et que sa mère lui fait mémoriser et réciter des passages du Livre de la prière commune. À quatre ans, il est envoyé chez dame Anne Oliver, qui tient une école enfantine à son domicile, puis, à six ans, chez un cordonnier à la retraite afin de poursuivre son éducation. L'année suivante, Johnson est envoyé à la Lichfield Grammar School Lycée, où il excelle en latin. C'est à cette époque qu'il commence à présenter ces tics et ces mouvements incontrôlés qui joueront un si grand rôle par la suite dans l'image qu'on se fera de lui et qui permettront, après sa mort, de diagnostiquer le syndrome de Gilles de la Tourette. Élève particulièrement brillant, il passe en secondaire à neuf ans. Il se lie d'amitié avec Edmund Hector, neveu de son maïeuticien George Hector, et John Taylor, avec qui il restera en contact toute sa vie. À seize ans, Johnson a l'occasion d'aller passer plusieurs mois dans la famille de sa mère, les Ford, à Pedmore, Worcestershire. Il noue des liens solides avec son cousin germain Cornelius Ford, qui met à profit sa connaissance des auteurs classiques pour lui donner des cours particuliers puisqu'il ne va pas à l'école. Ford est un universitaire brillant, qui a de très bonnes relations et fréquente des personnalités comme Alexander Pope, mais il est aussi un alcoolique notoire que ses excès mèneront à la mort six ans après la visite de Johnson, qui en sera profondément affecté. Après avoir passé six mois avec ses cousins, Johnson retourne à Lichfield mais Mr Hunter, le directeur de la grammar school, que « l'impertinence de cette longue absence a énervé, refuse de le réintégrer. L'accès à la Lichfield Grammar School lui étant interdit, Johnson est inscrit, avec l'aide de Cornelius Ford, à la King Edward VI grammar school de Stourbridge. Du fait de la proximité de l'école avec Pedmore, Johnson peut passer plus de temps avec ses cousins, et il commence à écrire des poèmes et à traduire des vers. À Stourbridge Johnson se lie d'amitié avec John Taylor et Edmund Hector et tombe amoureux de la jeune sœur d'Edmund, Ann. Toutefois, il ne passe que six mois à Stourbridge avant de retourner une fois de plus chez ses parents à Lichfield. D'après le témoignage d'Edmund Hector, recueilli par James Boswell, Johnson aurait quitté Stourbridge à la suite d'une dispute avec le directeur, John Wentworth, à propos de grammaire latine. L'avenir de Johnson est alors très incertain, car son père est très endetté. Afin de gagner un peu d'argent, il commence à brocher des livres pour son père, bien qu'il soit probable, qu'à cause de sa mauvaise vue, il ait alors passé beaucoup plus de temps dans la librairie paternelle à lire des ouvrages variés et à approfondir ses connaissances littéraires. C'est à cette époque qu'il rencontre Gilbert Walmesley, le président du tribunal ecclésiastique, visiteur assidu de la librairie paternelle, qui le prend en amitié. Pendant deux ans, ils ont l'occasion d'aborder de nombreux sujets littéraires et intellectuels. Études universitaires La famille vit dans une relative pauvreté jusqu'à la mort, en février 1728, de Elizabeth Harriotts, une cousine de Sarah qui leur laisse 40 livres, une somme suffisante pour pouvoir envoyer Samuel à l'université. Le 31 octobre 1728, quelques semaines après son dix-neuvième anniversaire, Johnson entre au Pembroke College, à Oxford, en tant que fellow-commoner étudiant roturier. Les connaissances que montre Johnson il est capable de citer Macrobe ! le font accepter sans problème. Mais l'héritage ne permet pas de couvrir tous ses frais à Pembroke, alors Andrew Corbet, un ami et condisciple, lui offre de combler le déficit. Malheureusement il quitte Pembroke peu après, et, pour subvenir aux besoins de son fils, Michael Johnson lui permet d'emprunter une centaine de livres de son fond, livres qu'il ne récupèrera que des années plus tard. À Pembroke, Johnson se fait des amis et lit beaucoup, mais sèche beaucoup de cours obligatoires et se dispense des rencontres sur la poésie. Plus tard, il racontera des histoires sur son oisiveté. Lorsque son maître, le professeur Jorden, lui demande de traduire en latin Messiah Le Messie de Alexander Pope en guise d'exercice pour Noël, il en effectue la moitié en un après-midi et finit le lendemain matin. Malgré les éloges reçus, Johnson n'en tire pas le bénéfice matériel espéré, bien que Pope ait jugé ce travail très bon. Le poème paraîtra plus tard dans Miscellany of Poems 1731 ; Anthologie, édité par John Husbands, un professeur de Pembroke. C'est la plus ancienne parution encore existante des œuvres de Johnson. Johnson passe tout son temps à étudier, même pendant les vacances de Noël. Il ébauche un plan d'étude nommé « Adversaria qu'il laisse inachevé, et prend le temps d'étudier le français tout en approfondissant sa connaissance du grec. Après treize mois, la pauvreté contraint Johnson, qui n'a même pas de quoi s'acheter des chaussures, à quitter Oxford sans diplôme, et il retourne à Lichfield. Vers la fin de son séjour à Oxford, son maître, le professeur Jorden, quitte Pembroke pour être remplacé par William Adams. Johnson l'apprécie énormément, mais comme il n'a pas payé ses frais de scolarité, il doit retourner chez lui en décembre. Il laisse derrière lui nombre des livres prêtés par son père, parce qu'il ne peut assumer leurs frais de transport et aussi comme un geste symbolique : il espère en effet revenir rapidement à l'université. Il recevra finalement un diplôme : juste avant la publication de son Dictionnaire en 1755, l'université d'Oxford lui décernera le diplôme de Master of Arts. Il se vera également attribuer, à titre honorifique, un doctorat en 1765 par le Trinity College de Dublin et un autre en 1775 par l'université d'Oxford. En 1776, il retourne à Pembroke avec James Boswell et visite l'université avec son dernier maître, le professeur Adams. Il profite de cette visite pour raconter ses études à l'université, son début de carrière, et pour exprimer son attachement envers le professeur Jorden. Début de carrière : 1731 - 1746 On ne sait pas grand choses de la vie de Johnson entre fin 1729 et 1731 ; il est probable qu'il vit chez ses parents. Il souffre de crises d'angoisse et de douleurs physiques pendant des années46 ; ses tics et ses mouvements incontrôlés, liés syndrome de Gilles de la Tourette, deviennent de plus en plus évidents et on les commente souvent. Vers 1731, son père, très endetté, a beaucoup perdu de sa situation à Lichfield. Samuel Johnson espère obtenir un poste d'huissier alors vacant à la Stourbridge Grammar School, mais son diplôme ne le lui permet pas et sa candidature est rejetée le 6 septembre 1731. C'est à peu près à cette époque que son père tombe malade et que se déclare la fièvre inflammatoire qui entraîne sa mort en décembre 1731. Johnson trouve finalement un emploi de sous-maître dans une école de Market Bosworth dirigée par Sir Wolstan Dixie, qui l'autorise à enseigner sans diplôme. Bien qu'il soit traité comme un domestique, et trouve l'activité ennuyeuse, il prend plaisir à enseigner. Mais il se dispute avec Wolstan Dixie, quitte l'école, et en juin 1732, est de retour chez lui. Johnson espère toujours se faire nommer à Lichfield. Refusé à Ashbourne, il va voir son ami Edmund Hector, qui vit chez l'éditeur Thomas Warren. Ce dernier vient de créer la première revue créée à Birmingham, le Birmingham Journal qui paraît tous les jeudis, et s'assure l'aide de Johnson. Ce lien avec Warren grandit, et Johnson propose de traduire en anglais le récit du missionnaire jésuite portugais Jerónimo Lobo sur les Abyssiniens. Après avoir lu la traduction en français, par l'Abbé Joachim le Grand, il estime qu'une version plus condensée serait utile et profitable. Plutôt que de tout écrire lui-même, il dicte à Hector qui apporte ensuite le manuscrit à l'imprimeur et fait quelques corrections. A Voyage to Abyssinia Un voyage en Abyssinie est publié un an plus tard. Johnson retourne à Lichfield en février 1734 et prépare une édition annotée des poèmes en latin de Poliziano, accompagnée d'une histoire de la poésie latine de Pétrarque à Poliziano ; une Proposition annonce du projet est imprimée, mais le projet avorte faute de fonds. Johnson accompagne son ami intime Harry Porter pendant les derniers temps de la maladie, qui l'emporte le 3 septembre 1734, laissant une femme Elizabeth Jervis Porter alias Tetty de 41 ans et trois enfants. Quelques mois plus tard, Johnson commence à la courtiser. Le révérend William Shaw affirme que les premières avances venaient probablement d'elle, car son attachement à Johnson allait à l'encontre des conseils et des désirs de toute sa famille. Johnson n'a aucune expérience en ce domaine, mais la veuve fortunée l'encourage et promet de pourvoir à ses besoins grâce à ses confortables économies. Ils se marient le 9 juillet 1735 à l'Église de St Werburg, à Derby60. La famille Porter n'approuve pas cette union, en partie parce que Johnson a 25 ans et Elizabeth. Elle répugne à son fils Jervis au point qu'il coupe les ponts avec sa mère. Toutefois, sa fille Lucy a depuis le début accepté Johnson, et son autre fils, Joseph, acceptera plus tard le mariage. En juin 1735, alors qu'il est précepteur des enfants de Thomas Withby, Johnson se porte candidat pour le poste de directeur de la Solihull School. Bien que Gilbert Walmesley lui apporte son soutien, Johnson est écarté car les directeurs de l'école pensent qu'il est un homme très hautain et désagréable et qu'il a une telle façon de déformer son visage bien qu'il n'y puisse rien que les gens craignent que cela puisse affecter certains enfants »64. Encouragé par Walmesley, Johnson, persuadé de ses qualités d'enseignant, décide alors de créer sa propre école. En automne 1735, il ouvre Edial Hall School, école privée, à Edial près de Lichfield. Mais il n'a que trois élèves : Lawrence Offley, George Garrick et le jeune David Garrick 18 ans qui deviendra l'un des acteurs les plus célèbres de son époque. L'entreprise est un échec et coûte à Tetty une part importante de sa fortune. Renonçant à garder son école en faillite, Johnson commence à écrire sa première œuvre majeure, la tragédie historique Irene. Pour son biographe Robert De Maria, le syndrome de Gilles de la Tourette rendait Johnson pratiquement incapable d'activités publiques, comme le professorat ou l'enseignement supérieur ; sa maladie a pu mener Johnson à l'occupation invisible de l'écriture. Paolo Sarpi, Istoria del Concilio tridentino, 1935 Le 2 mars 1737, jour du décès de son frère, Johnson part pour Londres avec son ancien élève David Garrick ; désargenté, il est pessimiste en ce qui concerne leur voyage, mais heureusement, Garrick a des relations à Londres et ils peuvent séjourner chez Richard Norris, un lointain parent de l'élève. Johnson déménage bientôt à Greenwich, près du Golden Hart Tavern où il termine Irene. Le 12 juillet 1737, il écrit à Edward Cave, lui proposant de traduire l'Istoria del Concilio Tridentino Histoire du Concile de Trente, History of the Council of Trent de Paolo Sarpi 1619, ce que Cave n'accepte que des mois plus tard69. Il fait venir sa femme à Londres en octobre, Cave lui payant ses articles pour The Gentleman's Magazine70. Ses travaux pour le magazine et d'autres éditeurs de Grub Street, cette rue populaire de la Cité de Londres où se côtoyaient les libraires, les petits éditeurs, les écrivains publics et les poètes pauvres, sont à cette époque presque sans précédent en étendue et en variété et si nombreux, si variés que Johnson lui-même n'aurait pas pu en faire une liste complète. C'est là qu'il rencontre George Psalmanazar, l'imposteur repentant, qui travaille en même temps que lui comme petit écrivain à gages. James Boswell rapporte qu'ils avaient coutume de se retrouver dans une taverne de la Cité située dans Old Street. Johnson admire sa piété et voit en lui le meilleur homme qu'il eût jamais rencontré. En mai 1738, sa première œuvre poétique majeure, London, est publiée anonymement. S'inspirant de la troisième Satire de Juvénal, elle présente un dénommé Thales partant au Pays de Galles afin d'échapper aux tracas de Londres, décrit comme un lieu de crime, de corruption et d'abandon des pauvres. Johnson ne s'attend pas à ce que le poème révèle sa valeur, quoique Alexander Pope déclare que l'auteur sera bientôt tiré de l'ombre will soon be déterré, mais cela n'arrivera que 15 ans plus tard. En août, parce qu'il ne possède pas de maîtrise es arts décernée par Oxford ou Cambridge, il se voit refuser un poste de professeur à l'Appleby Grammar School. Souhaitant mettre fin à ces refus, Pope demande à Lord Gower d'user de son influence pour obtenir que Johnson se voit décerner un diplôme. Lord Gower insiste auprès d'Oxford pour qu'un diplôme à titre honoraire soit accordé à Johnson, mais on lui répond que c'est trop demander. Il demande alors à un ami de Jonathan Swift de convaincre ce dernier de demander à l'Université de Dublin de décerner une Maîtrise à Johnson, dans l'espoir que cela pourrait aider à obtenir une Maîtrise es arts d'Oxford, mais Swift refuse d'agir en faveur de Johnson. Entre 1737 et 1739, Johnson se lie d'amitié avec le poète Richard Savage. Se sentant coupable de vivre aux dépens de Tetty, Johnson cesse de vivre avec elle et consacre son temps à son ami. Ils sont pauvres et ont pour habitude de séjourner dans des auberges ou des « caves de nuit, à part les nuits où ils errent dans les rues, manquant d'argent. Ses amis essayent d'aider Savage en essayant de le persuader de partir pour le Pays de Galles, mais il échoue à Bristol où il s'endette à nouveau. Envoyé en prison, il y meurt en 1743. Un an plus tard, Johnson écrit Life of Mr Richard Savage 1744 ; Vie de M. Richard Savage, une œuvre émouvante qui, selon le biographe et critique Walter Jackson Batte, reste un des ouvrages innovants dans l'histoire de la biographie. Dictionnaire de la langue anglaise Le chantier du Dictionnaie En 1746, un groupe d'éditeurs approche Johnson avec le projet de créer un dictionnaire de langue anglaise qui fasse autorité ; un contrat avec William Strahan et ses associés, d'une valeur de 1 500 guinées, est signé le 18 juin 1746 au matin. Samuel Johnson assure qu'il pourra mener le projet à terme en trois ans. En comparaison, les quarante membres de l'Académie française ont mis quarante ans à compléter leur dictionnaire, ce qui pousse Johnson à affirmer : C'est la proportion. Voyons voir ; quarante fois quarante égale seize-cent. Trois pour seize-cent, voilà la proportion d'un anglais à un français. Bien qu'il ne parvienne pas à finir le travail en trois ans, il y parvient en neuf ans, justifiant sa fanfaronnade. Selon Walter Batte, le Dictionnaire compte facilement comme l'un des plus grands exploits de l'érudition, et est probablement le plus grand qui ait été accompli par un individu, dans des conditions pareilles et en un tel laps de temps. Cependant le Dictionnaire n'échappe pas à la critique. Ainsi Thomas Babington Macaulay le tient pour un piètre étymologiste a wretched etymologist. Le dictionnaire de Johnson n'est ni le premier, ni le seul ; mais c'est le plus utilisé, le plus imité pendant 150 ans, entre la première publication et l'apparition de l'Oxford English Dictionnary en 1928. D'autres dictionnaires, comme le Dictionarium Britannicum publié en 1721 par Nathan Bailey , comportent davantage de mots. Pendant les 150 années précédant le dictionnaire de Johnson, près de vingt dictionnaires anglais ont été édités. Mais ces dictionnaires laissent beaucoup à désirer. En 1741, David Hume affirme dans The Elegance and Propriety of Stile L'Élégance et la propriété du Style, que ces deux notions ont été très négligées parmi nous. Nous n'avons aucun dictionnaire de notre langue et à peine une grammaire tolérable. Le Dictionnaire de Johnson permet une plongée dans le XVIIIe siècle et offre une présentation fidèle de la langue que l'on utilisait. Plus qu'un simple ouvrage de référence, c'est une véritable œuvre littéraire. Pendant une décennie, le chantier du Dictionnaire perturbe la vie de Samuel et celle de sa femme Tetty. Les aspects matériels, comme la copie et la compilation, nécessitent la présence de nombreux assistants, ce qui emplit la maison d'un bruit et d'un désordre incessant. Johnson est constamment pris par son ouvrage et garde des centaines de livres à portée de main. Son ami John Hawkins décrit la scène en ces termes : Les livres qu'il utilisait à cet usage étaient ceux de sa propre collection, importante mais en piteux état, ainsi que tous ceux qu'il pouvait emprunter ; lesquels, s'ils étaient jamais retournés à ceux qui les avaient prêtés, étaient si dégradés qu'il valait à peine qu'on les possédât. Johnson est également préoccupé par l'état de santé de sa femme qui commence à montrer les symptômes d'une maladie incurable. Pour pouvoir s'occuper à la fois de sa femme et de son travail, il déménage au 17, Gough Square, près de son imprimeur William Strahan. Pendant la phase préparatoire de son travail, en 1747, Johnson écrit un Plan pour le Dictionnaire. Lord Chesterfield, connu pour être un soutien affiché de la littérature, sollicité, semble intéressé, puisqu'il souscrit pour 10 livres, mais ne prolonge pas son soutien. Un épisode resté célèbre met aux prises Johnson et Lord Chesterfield, qui le fait éconduire par ses laquais. Peu avant la date de parution cependant, Chesterfield écrit deux essais anonymes dans The World recommandant le Dictionary, dans lesquels il se plaint que la langue anglaise manque de structures, et expose ses arguments en faveur du dictionnaire. Johnson n'apprécie pas le ton de l'essai et estime que Chesterfield n'a pas rempli son rôle de soutien du Dictionnaire. Il écrit une lettre pour exprimer son point de vue à ce sujet, critiquant sévèrement Chesterfield il reprend notamment l'épisode vieux de plusieurs années durant lequel il s'est fait chasser de chez le comte et défendant les gens de lettres : Est-ce cela, un protecteur, Monseigneur, celui qui regarde avec indifférence un homme se débattre dans l'eau pour, quand il a gagné la rive, venir l'embarrasser de son aide ? L'intérêt qu'il vous a plu de montrer pour mes travaux, eût-il été plus précoce, aurait été aimable, mais il a été différé jusqu'à ce que j'y sois insensible et ne puisse l'apprécier ; que je sois réduit à la solitude et ne puisse le partager ; que je sois connu et n'en aie plus besoin. Is not a patron, my lord, one who looks with unconcern on a man struggling for life in the water, and when he has reached ground, encumbers him with help? The notice which you have been pleased to take of my labours, had it been early, had been kind: but it has been delayed till I am indifferent and cannot enjoy it; till I am solitary and cannot impart it; till I am known and do not want it. Impressionné par le style de cette lettre, Lord Chesterfield la garde exposée sur une table pour que tout le monde puisse la lire. Le Dictionnaire de Johnson, vol. 2 1755, première page. Pendant l'élaboration du dictionnaire, Johnson lance plusieurs souscriptions : les souscripteurs obtiendront un exemplaire de la première édition dès sa sortie en compensation de leur soutien ; ces appels durent jusqu'en 1752. Le Dictionnaire est finalement publié en avril 1755, sa première page informant qu'Oxford a décerné à Johnson un diplôme par anticipation pour son œuvre. Le dictionnaire est un ouvrage volumineux. Ses pages font près de 46 cm 18 pouces de haut, et l'ouvrage fait 51 cm 20 pouces de large quand on l'ouvre ; il contient 42 773 entrées, auxquelles très peu seulement seront ajoutées dans les éditions ultérieures. Il est vendu au prix exorbitant pour l'époque de 4 £ 10 s. Une innovation importante dans la lexicographie anglaise est le fait d'illustrer le sens des mots par des citations littéraires. Il y en a 114 000 environ. Les auteurs les plus cités sont Shakespeare, Milton et Dryden ; le Dictionnaire de Johnson, comme on l'appellera ensuite, n'est rentable pour l'éditeur que des années plus tard. Quant à Johnson, les droits d'auteur n'existant pas, une fois qu'il a rempli son contrat, il ne touche rien provenant des ventes. Des années plus tard, nombre de ses citations sont reprises par diverses éditions du Webster's Dictionary et du New English Dictionary. Autres œuvres Parallèlement à son travail sur le Dictionnaire, Johnson écrit divers essais, sermons et poèmes durant ces neuf années. Il décide de publier une série d'essais sous le titre The Rambler Le Promeneur, paraissant tous les mardis et les samedis pour deux pence chaque. Expliquant le titre des années plus tard, il dit à son ami, le peintre Joshua Reynolds : Trouver le titre était embarrassant. Je m'assis un soir sur mon lit, décidé à ne pas me coucher avant de l'avoir trouvé. The Rambler semblait le meilleur de ceux qui se présentaient, et je l'ai choisi. Ces essais, dont le sujet est souvent moral ou religieux, ont tendance à être plus sérieux que ce que le titre de la publication pourrait suggérer ; ses premières remarques dans The Rambler demandent : that in this undertaking thy Holy Spirit may not be withheld from me, but that I may promote thy glory, and the salvation of myself and others. que dans cette entreprise, ton Esprit-Saint ne me soit pas refusé, mais que je puisse promouvoir ta gloire, et mon salut et celui des autres. La popularité de The Rambler explose une fois les numéros réunis en un volume ; ils sont ré-imprimés neuf fois du vivant de Johnson. L'écrivain et imprimeur Samuel Richardson, qui apprécie grandement ces essais, demande à l'éditeur l'identité de leur auteur ; il sera seul avec quelques amis de Johnson à savoir qui il est. Une amie, la romancière Charlotte Lennox, soutient The Rambler en 1752, dans son roman The Female Quixote Le Don Quichotte Féminin. Plus précisément, elle fait dire à son personnage M. Glanville : vous pouvez soumettre au jugement les productions d'un Young, d'un Richardson ou d'un Johnson. Répandez-vous en injures contre The Rambler avec une malveillance préméditée ; et à cause de l'absence d'erreurs, changez ses beautés inimitables en ridicule livre VI, chapitre XI. Plus tard, elle affirme que Johnson est « le plus grand génie de l'époque actuelle. “Sa présence, nécessaire pendant que la pièce était en répétition et pendant sa représentation, lui fit rencontrer beaucoup des artistes des deux sexes, et son opinion de leur profession devint plus favorable que celle qu'il avait émise avec sévérité dans Life of Savage... Pendant longtemps, il avait l'habitude de fréquenter le foyer des acteurs et semblait prendre grand plaisir et dissiper sa tristesse en se mêlant aux vifs bavardages du groupe bariolé qui s'y trouvait. M. Hume me fit savoir par le biais de M. Garrick que Johnson s'était finalement privé de cette distraction, par esprit de chasteté : Je ne viendrai plus derrière vos scènes, David ; car les bas de soie et les blancs corsages de vos actrices font s'exacerber mes penchants. ” – Boswell, La vie de Samuel Johnson Cependant, son travail ne se réduit pas au Rambler. Son poème le plus hautement estimé The Vanity of Human Wishes est écrit avec une si extraordinaire vitesse que Boswell affirme que Johnson aurait dû être poète perpétuellement »101. C'est une imitation de la Satire X de Juvénal, qui déclare que l'antidote aux souhaits humains futiles sont les souhaits spirituels non futiles. Plus précisément, Johnson souligne la vulnérabilité impuissante de l'individu face au contexte social et l'inévitable aveuglement par lequel les êtres humains sont induits en erreur. Le poème, quoiqu'applaudi par la critique, n'est pas un succès populaire et se vend moins bien que London. En 1749, Garrick tient sa promesse de monter Irene, mais le titre est changé en Mahomet and Irene, Mahomet et Irène afin qu'il convienne au théâtre. La pièce est finalement à l'affiche pour neuf représentations. Tetty Johnson est malade presque tout le temps qu'elle passe à Londres et en 1752, elle décide de retourner vivre à la campagne alors que son mari est très occupé par son Dictionnaire. Elle meurt le 17 mars 1752 et, lorsqu'il l'apprend, Johnson écrit à son vieil ami Taylor une lettre qui, d'après ce dernier, exprimait le chagrin de la manière la plus profonde qu'il ait jamais lue . Il écrit une oraison funèbre pour l'enterrement de sa femme, mais Taylor refuse de la lire pour des raisons qui demeurent inconnues. Cela ne fait qu'accentuer le sentiment qu'a Johnson d'être perdu et le désespoir qu'a provoqué en lui la mort de sa femme ; c'est John Hawkesworth qui doit s'occuper des obsèques. Johnson se sent coupable de la pauvreté dans laquelle il pense avoir obligé Tetty à vivre, et s'en veut de l'avoir délaissée. Il se montre ouvertement chagrin, et son journal est rempli de prières et de lamentations quant à la mort d'Elizabeth et jusqu'à la sienne propre. Comme c'est elle qui le motivait essentiellement, son trépas gêne considérablement l'avancée de ses travaux. Carrière de 1756 à la fin des années 1760 Le 16 mars 1756, Johnson est arrêté pour une dette impayée de 5 £ et 18s. Dans l'incapacité de joindre qui que ce soit d'autre, il écrit à l'écrivain et éditeur Samuel Richardson, qui lui a déjà prêté de l'argent dans le passé. Ce dernier lui envoie six guinées soit 6 £ et 6s, un peu plus que le montant de la dette pour montrer sa bienveillance, et ils deviennent amis. Peu après, Johnson rencontre le peintre Joshua Reynolds et tous deux se lient d'amitié. L'homme impressionne tellement Johnson qu'il le déclare « presque le seul homme que j'appelle ami »110. Frances, la jeune sœur de Reynolds, remarque que quand ils se rendent à Twickenham Meadows, ses gesticulations sont si étranges que les hommes, femmes et enfants entouraient Johnson, se moquant de ses gestes et de ses gesticulations. En plus de Reynolds, Johnson est très proche de Bennet Langton et d'Arthur Murphy ; le premier est un érudit, admirateur de Johnson, qui a décidé de sa voie après un entretien avec Johnson, à l'origine de leur longue amitié. Johnson a rencontré le second pendant l'été de 1754, lorsqu'il vint le voir à propos de la ré-édition accidentelle du 190e volume de The Rambler, et tous deux deviennent amis. À peu près à cette époque, Anna Williams vient habiter chez Johnson ; elle est un poète mineur, pauvre et presque aveugle. Johnson essaie de l'aider en la logeant et en lui payant une opération de la cataracte qui échoue. Anna Williams, en retour, devient sa gouvernante. Pour s'occuper, Johnson commence à travailler sur The Literary Magazine or Universal Review, dont le premier numéro parait le 19 mars 1756. Des différends relatifs aux sujets traités naissent lorsque commence la guerre de Sept Ans et que Johnson écrit des essais polémiques contre la guerre. Après le début de la guerre, le Magazine contient de nombreux comptes-rendus reviews, dont 34 au moins sont de la plume de Johnson. Quand il ne travaille pas pour le Magazine, Johnson écrit des préfaces pour d'autres auteurs, tels que Giuseppe Baretti, William Payne et Charlotte Lennox. Pendant ces années-là, les relations littéraires entre Johnson et Charlotte Lennox sont particulièrement étroites, et elle compte tellement sur lui qu'il devient la réalité la plus importante de la vie littéraire de Mrs Lennox, The most important single fact in Mrs Lennox's literary life. Plus tard, il tente de faire publier une nouvelle édition de ses œuvres, mais même avec son soutien ils ne réussissent pas à s'y intéresser assez pour mener l'entreprise à terme. Comme Johnson est très occupé par ses différents projets et ne peut s'acquitter des tâches domestiques, Richard Bathurst, médecin et membre du Club de Johnson, le pousse à prendre un esclave affranchi, Francis Barber, comme domestique118. Plus tard, Barber deviendra le légataire de Johnson. Toutefois, c'est sur The plays of William Shakespeare que Johnson passe la plus grande partie de son temps. Le 8 juin 1756, il publie ses Proposals for Printing, by Subscription, the Dramatick Works of William Shakespeare Projets d'impression, par souscription, de l'œuvre dramatique de William Shakespeare, qui soutiennent que les éditions précédentes de Shakespeare sont pleines de fautes et que des corrections sont nécessaires. Cependant, le travail de Johnson avance de plus en plus lentement et en décembre 1757, il dit au musicologue Charles Burney que son travail ne sera pas fini avant mars suivant. Mais il se fait à nouveau arrêter en février 1758 pour une dette de 40 £. La dette est rapidement payée par Jacob Tonson, qui avait passé contrat avec Johnson pour la publication de son Shakespeare, ce qui encourage Johnson à finir son travail pour le remercier. Il lui faudra sept ans de plus pour tout terminer, mais Johnson achève quelques volumes du Shakespeare pour montrer son attachement au projet. En 1758, Johnson commence à écrire The Idler Le Paresseux, une série à parution hebdomadaire, qui paraît du 15 avril 1758 au 5 avril 1760. Cette série est plus courte que The Rambler et beaucoup des qualités de cette œuvre-ci sont absentes de The Idler. Contrairement à The Rambler qui parait de façon indépendante, The Idler est publié dans The Universal Chronicle, un nouvel hebdomadaire dont la publication est soutenue par John Payne, John Newberry, Robert Stevens et William Faden. Comme l'écriture de The Idler ne prend pas tout son temps à Johnson, il peut aussi publier le 19 avril 1759 son court roman philosophique Rasselasqu'il présente comme un petit livre d'histoire qui décrit la vie du Prince Rasselas et de sa sœur Nekayah, gardés dans un endroit nommé Happy Valley la Vallée heureuse, en Abyssinie. La Vallée est un endroit exempt de tout problème où le moindre désir est satisfait sur-le-champ. Le plaisir constant, toutefois, ne mène pas à la satisfaction ; et avec l'aide du philosophe Imlac, Rasselas s'échappe et explore le monde pour être témoin du fait que tous les aspects de la société et de la vie dans le monde extérieur sont en proie à la souffrance. Il décide de retourner en Abyssinie mais ne souhaite pas revenir à la situation de plaisir constant et surabondant qu'il a connue dans la Vallée. Johnson écrit Rasselas en une semaine afin de payer les obsèques et les dettes de sa mère, et il obtient un tel succès qu'une ré-édition en anglais voit le jour presque chaque année. On trouve des références à cet ouvrage dans de nombreux romans ultérieurs, comme par exemple Jane Eyre, Cranford ou The House of the Seven Gables La maison aux sept pignons. La notoriété de Rasselas ne se limite pas aux seules nations anglophones : l'œuvre est immédiatement traduite en français, en néerlandais, en allemand, en russe et en italien, puis, plus tard, dans neuf autres langues. Vers 1762, cependant, Johnson a acquis une réputation de lenteur ; le poète Charles Churchill le taquine à propos des délais d'édition de son Shakespeare, promis depuis longtemps : Pour les souscripteurs, il amorce son hameçon - et prend votre argent - , mais où est le livre ? Ces commentaires poussent bientôt Johnson à finir son Shakespeare et, après avoir reçu le premier versement d'une pension de l'État le 20 juillet 1762, il peut consacrer plus de temps à cette tâche : depuis ce mois de juillet, et grâce à Thomas Sheridan et Lord Bute 1713 - 1792, premier ministre, le jeune roi George III, alors âgé de 24 ans, lui alloue une pension annuelle de 300 £ en reconnaissance du Dictionnaire. Bien que la pension ne le rendre pas riche, elle accorde à Johnson une indépendance modeste et assez confortable pour les 22 années qui lui restent à vivre. Quand Johnson demande s'il doit, en retour, défendre ou soutenir la politique du gouvernement, Lord Bute lui répond que la pension ne vous est pas accordée pour quoi que ce soit que vous ayez à faire, mais pour ce que vous avez fait. James Boswell, 25 ans Le 16 mai 1763, dans la librairie de son ami Tom Davies, Johnson rencontre pour la première fois James Boswell, qui a alors 22 ans. Boswell deviendra plus tard le premier grand biographe de Johnson. Les deux hommes deviennent rapidement amis, bien que Boswell ait pour habitude de retourner chez lui en Écosse ou de voyager à l'étranger des mois durant. Au printemps 1763, il fonde avec son ami Joshua Reynolds le Literary Club ou simplement le Club Le Club littéraire, une société dont font partie ses amis Joshua Reynolds, Edmund Burke, David Garrick, Oliver Goldsmith, et d'autres qui viennent plus tard comme Adam Smith ou Edward Gibbon. Ils décident de se retrouver chaque lundi à 19 heures à la Tête de Turc Turk's Head dans Gerrard Street, à Soho, et ces réunions se poursuivront bien après le décès des membres fondateurs. Le 9 janvier 1765, Murphy présente Johnson à Henry Thrale, riche brasseur et député, et à sa femme Hester. Ils se lient très vite d'amitié et Johnson est traité comme un membre de la famille. Cela le remotive pour travailler à son Shakespeare. Finalement Johnson reste 17 ans chez les Thrale, jusqu'à la mort de Henri en 1781, se rendant parfois à Anchor Brewery, la brasserie de Thrale à Southwark. La correspondance de Hester Thrale et son journal Thraliana deviendront une source importante de renseignements concernant Johnson après la mort de ce dernier. “Pendant toute l'entrevue, Johnson parla à Sa Majesté avec un profond respect, mais toujours de sa façon ferme et mâle, avec une voix sonore, et non avec ce ton contenu qui est habituellement employé aux réceptions royales ou dans les salons. Après que le Roi se fut retiré, Johnson s'est montré très content de sa conversation avec Sa Majesté et de Sa bienveillance. Il dit à Mr Barnard : « on peut dire du Roi ce qu'on veut ; mais il est le plus remarquable gentleman que j'aie jamais rencontré. ” – Boswell, La Vie de Samuel Johnson Le Shakespeare de Johnson est finalement publié le 10 octobre 1765 sous le titre de The Plays of William Shakespeare, in Eight Volumes… To which are added Notes by Sam. Johnson Les pièces de William Shakespeare, en huit volumes… complétées par des notes de Sam. Johnson : les mille exemplaires de la première édition sont rapidement épuisés, et une seconde est imprimée133. Le texte des pièces suit la version que Johnson, qui a analysé les éditions manuscrites, considère comme la plus proche de l'original. Son idée innovante est d'avoir ajouté un ensemble de notes permettant aux lecteurs de comprendre le sens de certains passages compliqués des pièces, ou d'autres qui ont été mal transcrits au fil du temps. Parmi les notes, se trouvent par endroits des attaques visant les éditeurs rivaux de l'œuvre de Shakespeare, et leurs éditions. Des années plus tard, Edmond Malone, grand spécialiste de Shakespeare et ami de Johnson, a affirmé que sa compréhension vigoureuse et étendue a jeté plus de lumière sur l'auteur qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'a jamais fait. En février 1767, Johnson se voit accorder une audience par le roi George III dans la bibliothèque de la Maison de la Reine ; la rencontre est organisée par Barnard, le bibliothécaire du Roi : le roi, ayant appris que Johnson allait visiter la bibliothèque, demanda à Barnard de le présenter à Johnson. Après la brève entrevue, Johnson est à la fois impressionné par le roi lui-même et par leur conversation. Derniers travaux Johnson 1775 montrant son intense concentration et la faiblesse de ses yeux ; il ne voulait pas qu'on le dépeigne comme Sam aux yeux plissés Le 6 août 1773, onze ans après sa première rencontre avec Boswell, Johnson va rendre visite à son ami en Écosse pour commencer un voyage aux îles occidentales de l'Écosse a journey to the western islands of Scotland, comme l'indique son compte-rendu en 1775. L'ouvrage vise à discuter des problèmes sociaux et des conflits qui affectent le peuple écossais, mais également à faire l'éloge de beaucoup de facettes uniques de la société écossaise comme une école pour sourds-muets à Édimbourg. Johnson se sert aussi de cet ouvrage pour prendre part à une discussion sur l'authenticité des poèmes d'Ossian traduits par James Macpherson : selon lui, ils ne peuvent pas être des traductions de la littérature écossaise ancienne pour la bonne raison que en ces temps-là rien n'avait été écrit en Gàidhlig. Les échanges entre les deux hommes sont explosifs et d'après une lettre de Johnson, MacPherson l'aurait menacé de violence physique. Le compte-rendu de Boswell, The Journal of a Tour to the Hebrides 1786, est une première tentative de biographie avant sa Vie de Johnson ; on y trouve des citations et des descriptions, des anecdotes telles que Johnson dansant autour d'un glaive, vêtu d'un costume ou dansant une gigue des Highlands. Dans les années 1770, Johnson, qui se montrait plutôt hostile au gouvernement plus tôt dans sa vie, publie une série d'opuscules en faveur de diverses politiques gouvernementales. En 1770 il écrit The False Alarm La fausse alarme, un pamphlet politique attaquant John Wilkes. En 1771, Thoughts on the Late Transactions Respecting Falkland's Islands Réflexions sur les dernières transactions concernant les Îles Malouines mettent en garde contre la guerre avec l'Espagne. Il fait imprimer The Patriot Le patriote , une critique de ce qu'il appelle faux patriotisme, en 1774, et le 7 avril 1775 au soir, il fait la célèbre déclaration : Le patriotisme est le dernier refuge de la crapule. Il ne parle pas ici, contrairement à une idée largement répandue, du patriotisme en général, mais de l'abus de langage de John Stuart le ministre patriote et de ses partisans ; Johnson s'oppose aux patriotes auto-proclamés en général, mais valorise ce qu'il considère comme vrai patriotisme. Le dernier de ces pamphlets, Taxation No Tyranny 1775, se montre favorable aux Actes intolérables et répond à la Déclaration des Droits du Premier Congrès continental qui protestait contre la taxation sans représentation no taxation without representation était un slogan alors utilisé par les colons britanniques d'Amérique, qui contestaient le manque de représentation au Parlement de Grande-Bretagne et par là même, refusaient d'être sujet à des taxes venant de la Grande-Bretagne. Johnson déclare qu'en émigrant en Amérique, les colons se sont volontairement démis du droit de vote, mais qu'ils ont toutefois une représentation virtuelle au Parlement. Dans une parodie de la Déclaration des Droits, Johnson écrit que les Américains n'ont pas plus le droit de gouverner que les habitants de Cornouailles. Si les Américains souhaitent participer au Parlement, dit-il, ils n'ont qu'à déménager en Angleterre. Johnson accuse publiquement les sympathisants anglais des séparatistes américains d'être des traîtres à ce pays ; il espère que l'affaire se règlera pacifiquement mais désire qu'elle se finisse avec la supériorité des Anglais et l'obéissance des Américains. Des années plus tôt, Johnson disait des Anglais et des Français qu'ils n'étaient que deux voleurs qui volaient leur terres aux indigènes et qu'aucun des deux ne méritait d'y vivre. Après que le Traité de Paris 1783 a été signé, marquant l'indépendance des Américains, Johnson est profondément dérangé par l'état de ce royaume . Le 3 mai 1777, alors qu'il essaie de sauver le révérend William Dodd qui sera pendu à Tyburn pour forgerie, Johnson écrit à Boswell qu'il est occupé à préparer une biographie et de « petites préfaces, pour une petite édition des poètes anglais. Tom Davies, William Strahan et Thomas Cadell ont demandé à Johnson de s'atteler à son œuvre majeure finale, The Lives of the Most Eminent English Poets, pour laquelle il demande 200 guinées : beaucoup moins que ce qu'il aurait pu exiger. Cet ouvrage, comportant des études critiques aussi bien que biographiques, présente l'œuvre de chaque poète et est finalement plus complet qu'initialement prévu. Johnson achève son travail en mars 1781 et l'ensemble est publié en six volumes. Johnson, lorsqu'il annonce son œuvre, dit que son but était seulement d'assigner à chaque poète une annonce, comme on le voit dans les anthologies françaises, contenant quelques dates et décrivant un tempérament. “La mort de M. Thrale fut une grande perte pour Johnson qui, bien qu'il ne pût prévoir tout ce qui allait arriver par la suite, était tout à fait convaincu que le confort que lui offrait la famille de M. Thrale allait en grande partie disparaître.” – Boswell, La vie de Samuel Johnson Johnson n'est cependant pas à même d'apprécier son succès, car Henry Thrale, l'ami intime chez qui il vit, meurt le 4 avril 1781. Johnson est contraint à changer de mode de vie rapidement quand Hester Thrale commence à s'intéresser à l'italien Gabriel Mario Piozzi. Il retourne chez lui puis voyage pendant quelque temps, après quoi il apprend que son locataire et ami Robert Levet est mort le 17 janvier 1782. Johnson est choqué par cette nouvelle, Levet ayant résidé chez lui à Londres depuis 1762. Peu de temps après, Johnson attrape un rhume qui s'aggrave en bronchite ; il endure la maladie des mois durant. Il se sent solitaire et malheureux à cause de la mort de Levet, de celle de Thomas Lawrence, un ami, puis celle de sa gouvernante Williams, toutes ces disparitions dans son entourage lui rendant la vie plus dure.
#2
Samuel Johnson 2
Loriane
Posté le : 17/09/2016 22:32
Fin de vie Bien qu'il ait recouvré sa santé depuis août, il éprouve un choc émotionnel lorsqu'il apprend que Hester Thrale veut vendre la résidence dans laquelle il a vécu avec sa famille, et plus que tout, il est affligé à l'idée qu'il ne la verra plus comme auparavant161. Le 6 octobre 1782, Johnson va pour la dernière fois à l'église paroissiale faire ses adieux à sa résidence et sa vie passées. La marche jusqu'à l'église l'épuise, mais il parvient à effectuer le trajet tout seul. À l'église, il écrit une prière pour la famille Thrale : À Ta protection paternelle, Ô Seigneur, je confie cette famille. Bénis, guide et défends-les, afin qu'ils puissent traverser ce monde et, finalement, éprouver en Ta présence le bonheur éternel, pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Hester n'abandonne pas complètement Johnson, et lui propose d'accompagner la famille lors d'un voyage à Brighton162. Il accepte et reste en leur compagnie du 7 octobre au 20 novembre 1782. Quand il revient, sa santé commence à se détériorer, et il reste seul jusqu'à l'arrivée de Boswell le 29 mai 1783 pour l'accompagner en Écosse. Le 17 juin 1783, Johnson subit une attaque à cause de sa mauvaise circulation et écrit à Edmund Allen, son voisin, qu'il a perdu l'usage de la parole. Deux médecins sont appelés pour aider Johnson et ce dernier parle à nouveau deux jours plus tard. Craignant que sa mort soit proche, il écrit : J'espère toujours résister au chien noir, et en temps, le chasser, bien que je sois privé de presque tous ceux qui m'aidaient. Le voisinage s'est appauvri. J'ai eu il fut un temps Richardson et Lawrence à ma portée. Mme Allen est morte. Ma demeure a perdu Levet, un homme qui s'intéressait à tout et qui, donc, avait de la conversation. Mme Williams est si faible qu'elle ne peut plus servir de compagne. Quand je me lève, je prends mon petit déjeuner, solitaire, le chien noir attend pour le partager, du petit-déjeuner au dîner il continue à aboyer, sauf quand le Dr Brocklesby le tient à distance pour quelque temps. Dîner avec une femme malade, on peut se hasarder à supposer que ce n'est guère mieux que seul. Après le dîner, que reste-t-il à faire à part regarder les minutes passer et attendre ce sommeil que je ne peux guère espérer. La nuit arrive enfin, et quelques heures d'impatience et de confusion m'amènent à une nouvelle journée de solitude. Qu'est-ce qui fera partir le chien noir d'une telle habitation ? Johnson est à ce moment accablé par la goutte ; il subit une intervention chirurgicale pour se soigner et ses derniers amis, dont la romancière Fanny Burney la fille de Charles Burney, viennent lui tenir compagnie. Il est confiné dans sa chambre du 14 décembre 1783 au 21 avril 1784. Sa santé commence à s'améliorer en mai 1784, et il voyage jusqu'à Oxford avec Boswell le 5 mai. En juillet, la plupart de ses amis sont morts ou partis, et lui-même est en Écosse alors que Hester est fiancée à Piozzi. Sans personne en particulier chez qui aller, Johnson fait le vœu de mourir à Londres et s'y rend le 16 novembre 1784. Il est accueilli chez George Strahan à Islington. Dans ses derniers moments, il est angoissé et est en proie à des hallucinations. Lorsque le médecin Thomas Warren lui rend visite et lui demande s'il va mieux, il s'exclame : Non, monsieur ; vous ne pouvez concevoir à quelle vitesse j'avance vers la mort. A few days before his death, he had asked Sir John Hawkins, as one of his executors, where he should be buried; and on being answered, "Doubtless, in Westminster Abbey," seemed to feel a satisfaction, very natural to a Poet. (Quelques jours avant sa mort, il demanda à Sir John Hawkins, un de ses exécuteurs testamentaires, où il devrait être enterré. Et lorsqu'il lui répondit certainement à l'Abbaye de Westminster, Johnson sembla satisfait, ce qui est naturel pour un poète. – Boswell, La vie de Samuel Johnson De nombreux visiteurs viennent rendre visite à Johnson alors qu'il est alité, malade ; néanmoins, il préfère toujours la seule compagnie de Langton173. Fanny Burney, Windham, Strahan, Hoole, Cruikshank, Des Moulins et Barber attendent des nouvelles de Johnson. Le 13 décembre 1784, Johnson reçoit deux autres personnes : Mlle Morris, une jeune femme que Johnson bénit et Francesco Sastres, un enseignant italien qui entend quelques-uns des derniers mots de Johnson : I am Moriturus je suis sur le point de mourir. Peu après, il tombe dans le coma et meurt à 7 heures. Langton attend jusqu'à 11 heures pour informer les autres de sa mort ; John Hawkins en devient pâle et souffre d' une agonie de l'esprit, alors que Seward et Hoole décrivent la mort de Johnson comme la plus affreuse vision. Boswell remarque : mon sentiment n'était qu'une grande étendue de stupeur… Je ne pouvais le croire. Mon imagination n'était pas convaincue. William Gerard Hamilton entre et affirme : il a créé un abîme, que non seulement rien ne peut emplir, mais que rien n'a tendance à remplir. - Johnson est mort. - Allons au meilleur suivant : il n'y a personne ; on ne peut dire de personne qu'il fait penser à Johnson. Il est enterré le 20 décembre 1784 dans l'Abbaye de Westminster et l'on peut lire sur sa tombe : Samuel Johnson, LL.D. Obiit XIII die Decembris, Anno Domini M.DCC.LXXXIV Ætatis suœ LXXV178. La critique Les travaux de Johnson, et particulièrement ses Vies des poètes Lives of the Poets, présentent les diverses caractéristiques d'un style excellent. Il pensait que les meilleurs poèmes usaient du langage contemporain, et il désapprouvait l'utilisation d'une langue ornementale ou volontairement archaïque. En particulier, il se méfiait de la langue poétique de Milton, dont il pensait que les vers blancs non rimés pouvaient inspirer de piètres imitations. Johnson critiquait également la langue poétique de son contemporain Thomas Gray. Par dessus tout, il était gêné par l'usage abusif d'allusions obscures du genre de celles que l'on trouve dans le Lycidas de Milton ; il préférait la poésie qui pouvait être facilement lue et comprise. En complément de ses remarques sur la langue, Johnson pensait qu'un bon poème devait comporter des images uniques et originales. Dans ses plus petits poèmes, Johnson utilisait des vers courts et imprégnait ses travaux d'un sentiment d'empathie, ce qui a peut-être influencé le style poétique de Housman. Dans London, sa première imitation de Juvénal, Johnson utilise la forme poétique pour exprimer ses opinions politiques et, comme font souvent les jeunes auteurs, a une approche enjouée et presque joyeuse du sujet. Sa seconde imitation, The Vanity of Human Wishes, est totalement différente : si la langue reste simple, le poème est plus compliqué et difficile à lire, car Johnson essaie de décrire la complexe morale chrétienne. Les valeurs chrétiennes qui y sont décrites ne se trouvent pas que dans ce poème, mais reviennent dans beaucoup d'autres travaux de Johnson. En particulier, il insiste sur l'amour infini de Dieu et montre que le bonheur peut être atteint grâce à des actes vertueux. Alors que pour Plutarque, les biographies doivent être élogieuses et avoir une portée morale, pour Johnson elles ont pour but de décrire aussi précisément que possible la vie du personnage concerné, sans en écarter les aspects négatifs. Cette recherche de l'exactitude est quasi révolutionnaire à l'époque, et il dut se battre contre une société qui ne voulait pas accepter des éléments biographiques susceptibles de ternir une réputation ; il fait de ce problème le sujet du soixantième volume de The Rambler. En outre, Johnson pensait que les biographies ne devaient pas se limiter aux seules personnalités célèbres et que les vies d'individus moins connus avaient également leur importance ; ainsi, dans Lives of the Poets, sont décrits des poètes aussi bien majeurs que mineurs. Il insistait pour inclure des détails qui auraient semblé des plus futiles aux yeux d'autres afin de décrire avec la plus grande précision la vie des auteurs189. Pour Johnson, autobiographies et journaux intimes - le sien compris - avaient une grande valeur et comptaient au moins autant que d'autres genres ; dans le numéro 64 de The Idler, il explique en quoi l'auteur d'une autobiographie est le plus à même de restituer l'histoire de sa propre vie. L'idée que se faisait Johnson de la biographie et de la poésie est liée à sa conception de ce qu'est une bonne critique. Chacun de ses ouvrages est un support pour la critique littéraire ; il dit d'ailleurs, à propos de son Dictionnaire : J'ai récemment publié un Dictionnaire comme ceux que font les académies italienne et française, à l'usage de ceux qui aspirent à l'exactitude de la critique ou à l'élégance du style. Bien qu'une édition abrégée de son Dictionnaire soit devenue le dictionnaire standard des ménages, l'ouvrage était initialement destiné à être un outil académique examinant la façon dont les mots étaient employés, particulièrement en littérature. Pour atteindre son objectif, Johnson utilisa des citations de Francis Bacon, Richard Hooker, John Milton, William Shakespeare, Edmund Spenser et d'autres auteurs qui couvraient les champs littéraires qu'il tenait pour essentiels : les sciences naturelles, la philosophie, la poésie et la théologie. Toutes ces citations étaient comparées et soigneusement étudiées dans le Dictionnaire, de manière que le lecteur puisse comprendre le sens des mots, dans le contexte des ouvrages littéraires où ils étaient employés. N'étant pas théoricien, Johnson ne voulait pas créer une école de théories d'analyse de l'esthétique de la littérature. Il se servait plutôt de sa critique dans le but pratique d'aider à mieux lire et comprendre la littérature. Dans l'étude des pièces de Shakespeare, Johnson met en évidence l'importance du lecteur dans la compréhension de la langue : Si Shakespeare a plus de difficultés que d'autres écrivains, c'est à imputer à la nature de son œuvre, qui demandait l'utilisation d'un langage familier, et par conséquent, de phrases allusives, elliptiques et proverbiales, telles qu'on les prononce et les entend à tout moment sans y faire attention. Ses travaux sur Shakespeare ne concernaient pas seulement cet auteur, mais s'étendaient à la littérature en général ; dans sa Préface à Shakespeare, il rejette les Règles du théâtre classique et affirme que le théâtre devrait être fidèle à la réalité. Mais Johnson ne se contente pas de défendre Shakespeare : il examine ses fautes, comme son manque de morale, sa vulgarité, son insouciance dans la création de ses intrigues, et, à l'occasion, sa distraction lors du choix des mots ou de leur ordre. Johnson affirmait qu'il était important d'établir un texte qui puisse refléter ce que l'auteur avait exactement écrit : les pièces de Shakespeare par exemple, connaissaient de nombreuses éditions, chacune comprenant des erreurs survenues lors de l'impression. Ce problème était encore aggravé par des éditeurs peu scrupuleux qui considéraient comme incorrects les mots compliqués qu'ils trouvaient, et les changeaient dans les éditions suivantes. Pour Johnson, un éditeur ne devrait pas altérer de la sorte un texte. Portrait rapide Après que nous fûmes sortis de l'église, nous sommes restés quelque temps à parler ensemble de l'ingénieux sophisme de Monseigneur Berkeley qui prouvait la non-inexistence de la matière, et que tout dans l'univers n'est qu'imaginaire. J'observais que, bien que nous soyons satisfaits que sa doctrine ne soit pas vraie, il est impossible de la réfuter. Je n'oublierai jamais l'empressement avec lequel répondit Johnson, frappant avec grande force une grosse pierre du pied, et se reprenant : C'est ainsi que je le réfute. ” – Boswell, La vie de Samuel Johnson Sa silhouette haute et robuste et ses étranges gesticulations étaient déroutantes pour ceux qui rencontraient Johnson pour la première fois. Quand William Hogarth vit Johnson pour la première fois, près d'une fenêtre chez Samuel Richardson, « secouant sa tête et se roulant par terre d'une façon étrange et ridicule, il crut de Johnson qu'il était un idiot dont les relations l'ont confié à la garde de M. Richardson. Hogarth fut surpris lorsque cette silhouette s'est avancée vers là où lui et M. Richardson étaient assis et d'un coup, reprit la discussion… avec une telle éloquence, que Hogarth le regarda avec étonnement, et imagina que cet idiot avait été inspiré sur le moment. Tout le monde ne se laissait pas abuser par l'apparence de Johnson : Adam Smith affirma que Johnson connaissait plus de livres que quiconque et Edmund Burke pensait que si Johnson devait devenir membre du Parlement, il aurait certainement été le plus beau parleur à y être jamais allé. Johnson s'appuyait sur une unique forme de rhétorique, et sa réfutation de l'immatérialisme de George Berkeley est restée célèbre : Berkeley affirmait que la matière n'existait pas mais semblait seulement exister ; au cours d'une discussion à ce sujet avec Boswell, Johnson frappe avec force une grosse pierre du pied et déclare : C'est ainsi que je le réfute. Johnson était un anglican dévot et conservateur ; il était compatissant et aidait ceux de ses amis qui ne pouvaient s'offrir de logement en les abritant chez lui, même quand lui-même était en difficulté financière. L'œuvre de Johnson est empreinte de sa morale chrétienne ; il écrivait sur des sujets éthiques avec une telle aisance, et son autorité dans le domaine est telle que Walter Jackson Batte a affirmé qu'aucun autre moraliste dans l'histoire ne le dépasse ou ne lui arrive à la cheville. Ses écrits ne dictent toutefois pas, comme le dit Donald Greene, de « modèle prédéterminé de bonne conduite, bien que Johnson ait mis en avant certains comportements. Il ne se laissait pas aveugler par sa foi et ne jugeait pas hâtivement les gens ; il avait du respect pour ceux d'autres confessions, tant qu'ils montraient un engagement aux enseignements du Christ. Bien qu'il respectât la poésie de John Milton, il ne pouvait supporter ses croyances puritaines et républicaines, pensant qu'il s'agissait de valeurs contraires à celles de l'Angleterre et de la chrétienté. Il condamnait l'esclavage et proposa un jour de porter un toast à la prochaine rébellion des nègres aux Indes occidentales. Outre ses croyances concernant l'humanité, Johnson aimait également beaucoup les chats, particulièrement les siens : Hodge et Lily. Boswell a écrit : Jamais je n'oublierai l'indulgence avec laquelle il traitait Hodge, son chat. Bien qu'il fût connu pour être un ardent conservateur, Johnson était dans sa jeunesse un sympathisant du Jacobitisme ; pendant le règne de George III, il accepte toutefois l'Acte d'établissement205. Boswell est en grande partie responsable de la réputation de conservateur convaincu qu'avait Johnson, et c'est lui qui détermina la façon dont on allait le percevoir pendant des années. Il n'était toutefois pas présent pendant les deux périodes phare de l'activité politique de Johnson : le contrôle du Parlement par Walpole et la guerre de Sept Ans ; et bien qu'il ait été souvent présent à ses côtés pendant les années 1770 et qu'il ait décrit quatre pamphlets majeurs de Johnson, il ne prend pas la peine d'en parler, plus intéressé par leurs voyage en Écosse. De plus, n'étant pas du même avis que Johnson dans deux de ces pamphlets, The False Alarme et Taxation No Tyranny, Boswell critique le point de vue de Johnson dans sa biographie. Dans sa Vie de Samuel Johnson, Boswell l'appelle si souvent « Dr Johnson », que ce surnom resta des années durant, au grand dam de ce dernier. La description des dernières années de Johnson fait état d'un vieillard visitant les tavernes, mais cette description est pathétique. Bien que Boswell, d'origine écossaise, ait été un proche compagnon et un ami intime de Johnson pendant les périodes importantes de la vie de ce dernier, Johnson, à l'instar de beaucoup d'autres Anglais d'alors, avait pour réputation de mépriser l'Écosse et ses habitants. Même alors qu'ils voyageaient ensemble en Écosse, Johnson montrait préjugés et nationalisme étroit. Hester Thrale note, à propos de son nationalisme et de ses préjugés envers les Écossais : Nous savons tous combien il aimait abuser les Écossais, et d'ailleurs se faire abuser par eux en retour . Santé Bien que Johnson ait probablement été en aussi bonne santé que d'autres de sa génération, il fut frappé par différentes maladies et problèmes tout le long de sa vie. Enfant, il eut des écrouelles ; il fut touché par la goutte, souffrait d'un cancer du testicule, et un accident vasculaire cérébral survenu à la fin de sa vie le priva de la parole pendant deux jours. Les autopsies révélèrent une maladie pulmonaire ainsi qu'une insuffisance cardiaque probablement due à de l'hypertension problème dont on ignorait alors l'existence. Enfin, il était dépressif et atteint de la Maladie de Gilles de la Tourette. Beaucoup de témoignages rendent compte des crises de dépressions de Johnson et de ce qu'il pensait être de la folie. Comme le dit Walter Jackson Bate, une des ironies de l'histoire de la littérature est que son symbole le plus fascinant et autoritaire de bon sens - de la compréhension grande et imaginative de la réalité concrète - aurait commencé sa vie adulte, à l'âge de vingt ans, dans un tel état d'anxiété et de désespoir que, de son propre point de vue au moins, il cet état semblait être le commencement d'une vraie folie. Pour vaincre ces sentiments, Johnson essayait de toujours s'occuper par diverses activités, mais cela ne l'aidait pas. Taylor dit que Johnson envisageait à un moment fortement le suicide ; Boswell quant à lui, affirma que Johnson se sentait accablé par une horrible mélancolie, était toujours irrité et impatient ; et un abattement, une tristesse et un désespoir qui faisaient de son existence une misère. Tôt dans sa vie, lorsque Johnson ne fut plus capable de payer ses dettes, il travailla avec des écrivains professionnels et identifia sa situation à la leur. Johnson fut alors témoin de la chute de Christopher Smart dans l'indigence et la maison de fous et craignit de partager son sort. Hester Thrale affirma, au cours d'une discussion à propos de l'état mental de Smart, que Johnson était son ami qui craignait qu'une pomme ne l'empoisonnât. Pour elle, ce qui distinguait Johnson de ceux qu'on plaçait dans des asiles à cause de leur folie comme Christopher Smart était sa capacité à garder pour lui ses émotions et ses préoccupations. Deux siècles après la mort de Johnson, le diagnostic posthume de la Maladie de Gilles de la Tourette est largement accepté. La maladie de Gilles de la Tourette n'était pas connue à l'époque de Johnson Gilles de la Tourette publie en 1885 un compte-rendu sur neuf de ses patients atteints mais Boswell a décrit Johnson montrant des symptômes, comme des tics et d'autres mouvements involontaires. Selon Boswell, il tenait souvent sa tête d'un côté… bougeant son corps d'avant en arrière, frottant son genou gauche dans la même direction avec la paume de sa main… Il faisait différents bruits comme un demi sifflement ou comme gloussant tel une poule et tout ceci parfois accompagné par un regard pensif, mais plus fréquemment par un sourire. Lorsque Johnson était énervé, il soufflait comme une baleine. On disait aussi de Johnson qu'il faisait ces gesticulations particulières au pas des portes, et lorsqu'une petite fille lui demanda pourquoi il faisait ces drôles de gesticulations et ces bruits étranges, il lui répondit que c'était une « mauvaise habitude. C'est en 1967 que l'on diagnostiqua pour la première fois la Maladie de Gilles de la Tourette, et le chercheur Arthur K. Shapiro, spécialisé dans la maladie, a décrit Johnson comme l'exemple le plus notable d'une adaptation réussie à la vie malgré le handicap de la maladie de Gilles de la Tourette. Les détails apportés par les écrits de Boswell et de Hester Thrale notamment, confortent les chercheurs dans le diagnostic ; Pearce écrivit que : « Johnson montrait aussi beaucoup des traits obsessionnels compulsifs et des rituels associés à ce syndrome... On peut penser que sans cette maladie, les exploits littéraires du Dr Johnson, le grand dictionnaire, ses délibérations philosophiques et ses conversations n'auraient jamais vu le jour ; et Boswell, auteur de la plus grande des biographies, n'aurait jamais été connu. Héritage et Postérité Statue érigée en 1838 en face de sa maison natale, au Market Square à Lichfield ; d'autres statues de lui se trouvent à Londres et Uttoxeter. D'après Steven Lynn, Johnson était plus qu'un écrivain et érudit célèbre ; il était une célébrité. Dans ses derniers jours, les moindres faits et gestes de Johnson, ainsi que son état de santé, étaient constamment reportés dans des journaux et, quand rien de notable n'était à dire, quelque chose était inventé. Selon Bate, Johnson aimait la biographie et il a changé le cours de la biographie dans le monde moderne. Le plus grand des ouvrages de biographie d'alors était Life of Johnson de Boswell, et nombre d'autres mémoires et biographies similaires apparurent après la mort de Johnson. Parmi toutes ces biographies, peuvent être citées A Biographical Sketch of Dr Samuel Johnson 1784, de Thomas Tyers ; The Journal of a Tour to the Hebrides 1785, de Boswell ; Anecdotes of the Late Samuel Johnson, de Hester Thrale, en partie tiré de son journal, Thraliana ; Life of Samuel Johnson 1787, de John Hawkins, la première biographie aussi longue ; et, en 1792, An Essay on the Life and Genius of Samuel Johnson par Arthur Murphy, qui remplace l'ouvrage de Hawkins en tant qu'introduction à une collection de l'œuvre de Johnson. Une autre source importante d'information fut Fanny Burney, qui décrivit Johnson comme le cerveau de la littérature de ce royaume et gardait un journal contenant des détails absents des autres biographies. Cependant, de toutes ces sources, Boswell reste le plus connu des lecteurs ; et bien que des critiques comme Donald Greene aient discuté son statut de biographie, Life of Samuel Johnson rencontra un grand succès, d'autant plus que Boswell et ses amis firent la publicité de l'ouvrage au détriment des nombreux autres travaux sur la vie de Johnson. Bien que son influence en tant que critique perdurât après sa mort, Johnson n'était pas apprécié de tous. Macaulay le considérait comme un imbécile savant une forme d'autisme auteur de quelques travaux de qualité ; les poètes romantiques rejetaient sa présentation de la poésie et la littérature, surtout en ce qui concerne John Milton. Mais il avait aussi ses admirateurs : Stendhal, dans Racine et Shakespeare, s'est appuyé partiellement sur sa présentation de Shakespeare, et il a influencé le style et la pensée philosophique de Jane Austen. Matthew Arnold, dans Six Chief Lives from Johnson's Lives of the Poets, considérait que les Vies de Milton, Dryden, Pope, Addison, Swift et Gray étaient des références fondamentales qui permettent, en revenant à elles de toujours retrouver son chemin by returning to which we can always find our way again. Johnson ne fut vraiment reconnu comme un grand critique que plus d'un siècle après sa mort, par des critiques littéraire comme G. Birkbeck Hill ou T. S. Eliot. Ils commencèrent à étudier son œuvre avec un intérêt grandissant pour l'analyse critique contenue dans son édition de Shakespeare et Lives of the Poets. Selon Yvor Winters poète et critique littéraire américain du XXe siècle, un grand critique est le plus rare de tous les génies de la littérature ; peut-être le seul critique anglais qui mérite cette épithète est-il Samuel Johnson, opinion partagée par F. R. Leavis qui affirme : Quand on le lit on sait, sans aucune équivoque, qu'on est devant un esprit puissant et distingué opérant au premier plan de la littérature. Et l'on peut dire avec beaucoup de conviction : voilà de la critique véritable. Pour Edmund Wilson « Lives of the Poets et ses préfaces et commentaires sur Shakespeare sont parmi les documents les plus brillants et pénétrants de toute la critique anglaise. Son insistance sur la nécessité d'étudier la langue dans la littérature rendit progressivement cette méthode prédominante dans la théorie de la littérature au cours du XXe siècle. Dans son film Les Sentiers de la gloire, 1957, Stanley Kubrick, fait dire à Kirk Douglas qui tient le rôle du colonel Dax, une citation de Samuel Johnson : Le patriotisme est le dernier refuge des crapules. Lors du bicentenaire de la mort de Johnson, en 1984, l'université d'Oxford organisa un colloque d'une semaine qui présentait 50 documents ; le Arts Council of Great Britain Conseils des arts de Grande-Bretagne quant à lui, tint une exposition de portraits de Johnson et autres souvenirs, tandis que The Time et Punch éditèrent des parodies du style de Johnson à cette occasion. En 1999, la BBC Four créa le prix Samuel Johnson. Un certain nombre de ses manuscrits, des éditions originales de ses ouvrages, la moitié de ce qui reste de sa correspondance, ainsi que des tableaux et divers objets le concernant, qui appartiennent à la Collection de Donald et Mary Hyde, sont hébergés depuis 2003 à Harvard, dans le département des Early Modern Books and Manuscripts de la Bibliothèque Houghton en:Hougton Library.    
#3
Claire sainte Soline
Loriane
Posté le : 17/09/2016 20:51
Le 18 septembre 1891 naît Claire Sainte-Soline
née Nelly Fouillet en 1891 à Melleran, morte en 1967 à Paris, écrivain français du XXe siècle. De 1934 à 1966, elle publie une vingtaine de romans, nouvelles et essais. Son premier titre suscite l'admiration d'André Gide. Elle siège au jury du Prix du Roman populiste et du Prix Femina. Elle occupe la vice-présidence du PEN Club de France. Sa vie Nelly Éva Marguerite Fouillet naît le 18 septembre 1891 à Melleran, village des Deux-Sèvres. Ses parents, Pierre Fouillet La Ferrière-en-Parthenay 1867 - Niort 1950 et Henriette Léontine Barbeau Melleran 1864 - Niort 1932, sont instituteurs. Radical-socialiste proche du Centre droit, son père est maire de Niort de 1932 à 1935. Elle étudie aux lycées de Niort et de Bordeaux puis entre à l'École normale supérieure de Sèvres. Élève brillante, elle obtient une double agrégation de sciences physiques et naturelles et de physique-chimie. Assistante de Camille Matignon élève de Marcellin Berthelot, elle participe à la recherche scientifique en chimie. Nelly Fouillet embrasse une carrière de professeur. Elle enseigne successivement à La Châtre ; Blois et Grenoble de 1915 à 1919 ; Auxerre de 1919 à 1924 ; Paris lycée Fénelon, de 1924 à 1956 puis au Maroc lycée Moulay Idriss à Fès, de 1956 à 1958. Sous le nom de Claire Sainte-Soline, elle publie en 1934 son premier roman, Journée, qui évoque la vie d'un village poitevin. La commune deux-sévrienne de Sainte-Soline lui a inspiré son nom de plume. Parmi une vingtaine d'œuvres, Le dimanche des Rameaux 1952, D'amour et d'anarchie 1955 et La mort de Benjamin 1957 passent pour ses plus belles réussites. En 1950, elle devient membre du jury du Prix du Roman populiste. La parution de Mademoiselle Olga, en 1954, suscite les éloges des critiques littéraires. En 1957, elle manque d'une voix le Prix Femina, ce qui lui vaut la notoriété. Mais dès l'année suivante, elle entre au jury de ce prix, dont elle se montrera un membre actif. Elle est aussi vice-présidente du PEN Club de France et chevalier de la Légion d'honneur. Elle voyage dans toute l'Europe, visite l'Inde et le Japon. Atteinte d'un cancer du sein, elle s'éteint le 14 octobre 1967 à l' hôpital de la Cité universitaire Paris - 14e arrondissement. Elle est inhumée le 17 octobre au cimetière des Sablières à Niort. Elle repose avec ses parents 2e division - carré D - tombe 43. Vie privée En 1918, Nelly Fouillet épouse l'artiste-peintre Louis Coquart Ambrault 1895 - Noirmoutier-en-l'Île 1989, dont elle se sépare assez tôt puis divorce en 1941. Sa fille, Paulette Coquart Saint-Romans-lès-Melle 1919 - Noirmoutier-en-l'Île 1999, est la première épouse du romancier et académicien Pierre Moinot. Son frère René Fouillet, né à Rom deux-Sèvres en 1900, ingénieur électricien, décède en août 1950 à Saint-Égrève Isère. Œuvre Claire Sainte-Soline pratique une écriture précise et rigoureuse héritée de sa formation scientifique. Son style sobre, dense, incisif, s'inspire des romanciers français de la fin du xixe siècle. Derrière des vies et lieux d'apparence banale, elle traque un monde de mystère et de secrets avec un art qu'admirera François Nourissier. Elle analyse sans complaisance, avec ironie et même une certaine dûreté, l'âpreté et l'immoralité humaines. Ses récits se déroulent souvent dans une atmosphère sombre, glacée, cruelle. Pour la plupart, ils exposent le dénouement rapide - en une seule journée - d'un conflit de longue date. Leur lecture dérange mais incite à réfléchir. Esprit indépendant, voire frondeur, peu soucieuse des modes et même volontiers anticonformiste, Claire Sainte-Soline refuse les thèses du Nouveau roman. Dan son Journal, André Gide écrit, admiratif, que certaines pages de Journée lui font penser aux meilleures de Marguerite Audoux. Parmi ses œuvres, on retient : Journée 1934 - Éditions Rieder - un meurtre familial dans un village poitevin ; D'une haleine 1935 - Éditions Rieder - récit d'une femme du peuple de Paris ; Antigone ou l'Idylle en Crète 1936 - Éditions Rieder - écho d'un voyage en Grèce ; Les Sentiers détournés 1937 - Éditions Rieder ; Le Haut du Seuil 1938 - Éditions Rieder ; La Montagne des Alouettes 1940 - Presses universitaires de France - chronique villageoise ; Irène Maurepas 1942 - Presses universitaires de France ; Petite physique pour les non physiciens 1943 - Presses universitaires de France ; Et l'enfant que je fus... 1944 - Presses universitaires de France ; Belle 1947 - Presses universitaires de France ; Le Mal venu 1950 - Éditions Stock ; Le dimanche des Rameaux 1952 - Éditions Grasset - une femme prend soudain conscience de la tyrannie de son époux et s'en libère ; Grèce 1952 - Pierre Cailler éditeur, Genève ; Reflux 1953 - Éditions Grasset ; Mademoiselle Olga 1954 - Éditions Grasset- recueil de nouvelles ; Maroc 1954 - Pierre Cailler éditeur, Genève ; D'amour et d'anarchie 1955 - Éditions Grasset - vie d'un couple d'artisans avant la Première Guerre mondiale ; La mort de Benjamin 1957 - Éditions Grasset- qui manque d'une seule voix le Prix Femina ; Castor et Pollux 1959 - Éditions Grasset; Le Menteur 1961 - Éditions Grasset ; De la rive étrangère 1962 - Éditions Grasset - nouvelles écrites à la première personne ; Si j'étais hirondelle 1964 - Éditions Grasset - tragédie où les personnages accomplissent un destin qu'ils réprouvent ; Noémie Strauss 1965 - Éditions Grasset - une femme perverse conduit ses amies au suicide ; Les années fraîches 1966 - Éditions Grasset - souvenirs autobiographiques d'une enfance solitaire et mal-aimée ; En souvenir d'une marquise 1969 - Éditions Grasset. Citations La seule chose, c'est d'aller à fond dans son propre sens conseil donné à un jeune écrivain. Un écrivain n'a pas droit à plus de considération qu'un boulanger. Les profondeurs sourdes et noires du sommeil me sont depuis longtemps refusées Le dimanche des Rameaux. Je me plais dans la brume et le crachin Les années fraîches. J'ai eu deux vies : celle de professeur et celle d'écrivain propos tenus à la fin de son existence. Postérité En décembre 1996, une allée du quartier de la Milaterie, à Niort, reçoit le nom de Claire Sainte-Soline. La Médiathèque centrale d'agglomération de Niort détient un fonds d'archives Claire Sainte-Soline. 
#4
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Loriane
Posté le : 17/09/2016 19:48
Le 18 septembre 1939 meurt Stanisław Ignacy Witkiewicz
à 54 ans, à Velyki Ozera en Pologne, dit aussi Witkacy contraction de WITKiewicz ignACY ou comme les noms latins polonisés: Horatius-Horacy, né 24 février 1885 à Varsovie, dramaturge, philosophe, pamphlétaire, peintre, photographe et romancier du mouvement Expressionnisme polonais. Il a touché par son immense curiosité d'homme de la Renaissance tous les domaines intellectuels et artistiques du XXe siècle. Il fut membre du premier groupe polonais avant-gardiste formisme, auteur de la théorie esthétique de la Forme Pure, créateur de l’Entreprise Portraitiste En bref. Auteur dramatique, romancier, essayiste, théoricien de l'art et peintre polonais, Stanisław Ignacy Witkiewicz naît à Varsovie dans une famille de la petite noblesse terrienne originaire de Lituanie. Fils unique du peintre et critique d'art Stanisław Witkiewicz, il reçoit une éducation peu commune qui, le plaçant dès son plus jeune âge en marge à côté et au-dessus des autres, en fera un individualiste irréductible. Il se dirige d'abord vers la peinture et suit les cours de l'Académie des beaux-arts de Cracovie. En 1910, une liaison tumultueuse avec une actrice célèbre lui inspire son premier roman : Les 622 Chutes de Bungo ou la Femme démoniaque. Après la guerre de 1914-1918, qu'il fait à Saint-Pétersbourg, dans la garde impériale originaire de Varsovie, il était alors sujet du tsar, commence pour lui, de 1918 à 1926, une période de fécondité exceptionnelle. Dandy déjà célèbre par ses excentricités, il peint beaucoup et écrit énormément, surtout pour le théâtre. En huit ans, il produit une trentaine de pièces dont dix-neuf seulement nous sont parvenues sans compter des écrits théoriques Théâtre, Introduction à la théorie de la forme pure au théâtre, etc., 1923 et de nombreux articles de journaux, le plus souvent violemment polémiques. Ses pièces, écrites très vite il ne se relit jamais et de valeur très inégale, illustrent toutes ses théories esthétiques sur la « forme pure » au théâtre. Il donne, entre autres, Les Pragmatistes 1919, Eux 1920, L'Indépendance des triangles 1921, La Métaphysique du veau à deux têtes 1921, La Poule d'eau 1921, L'Œuvre sans nom 1921, Le Fou et la Nonne 1923, La Mère 1924 et enfin, en 1925, La Sonate de Belzébuth. Onze seulement de ses trente pièces seront jouées, la plupart du temps pour une ou deux représentations, dans des théâtres expérimentaux. Après 1926, son activité se ralentit beaucoup. Sujet à des crises de dépression de plus en plus profondes, il s'enferme en des méditations métaphysiques. Il fera paraître encore deux romans : L'Adieu à l'automne 1927 et Inassouvissement 1930 ; en 1931, il en commencera un troisième, La Seule Issue, qu'il laissera inachevé. Enfin, en 1934, il écrit sa dernière comédie, Les Cordonniers, dont le ton tranche assez nettement sur sa production antérieure. Le 18 septembre 1939, Witkiewicz, qui fuyait à pied l'envahisseur nazi, constatant l'effondrement des valeurs de culture et de civilisation qu'il a toujours défendues, se suicide à l'orée d'un petit bois de Polésie. Le théâtre de Witkiewicz est actuellement très prisé en Pologne. On voit en lui un précurseur non seulement de Gombrowicz et de Mrozec, mais aussi de notre théâtre dit de « l'absurde ». Pourtant, les préoccupations de Witkiewicz étaient assez éloignées de celles d'un Ionesco ou d'un Beckett. Son théâtre est avant tout une tentative — un peu désespérée — de transposition à la scène des révolutions picturales de la fin du XIXe siècle. Il voulait des éléments scéniques situations, décors, personnages, dialogues) non contingents, enfin dépouillés de tout assujettissement au réel. Cette recherche exaspérée d'une théâtralité pure, il ne réussira pas à l'affranchir d'une surabondance de littérature, peut-être parce que, arrivé trop tôt, il n'a pas disposé de la scène qui lui aurait permis d'expérimenter réellement ses théories. Son théâtre, qui reste joyeusement destructeur, est fondé essentiellement sur une arme à double tranchant : la parodie. Aussi ne réussit-il que rarement à produire le rêve étrange qu'il réclamait, qu'il avait sans doute entrevu et que d'autres, plus tard, approcheront par des voies plus sûres. Daniel Zerki Sa vie Né en 1885 à Varsovie de petite noblesse terrienne, fils de Stanisław Witkiewicz, du clan Nieczuja, Witkiewicz passa son enfance et son adolescence à Zakopane, dans les Tatras et reçut une éducation très libérale. En 1910, il écrit un long roman inédit de son vivant. Quatre ans plus tard sa fiancée se suicide. Bouleversé, il part avec Bronisław Malinowski en Nouvelle-Guinée. À la déclaration de guerre, il s'engage dans l'armée du Tzar. La Pologne est alors en grande partie sous domination russe. Il revient ensuite dans son pays et développe sa théorie de la forme pure. Violemment contesté par ses contemporains, il écrira entre 1918 et 1926 plus de trente pièces dont plusieurs ont été jouées à cette époque et peindra de nombreuses toiles. Il s'est rendu célèbre par ses excentricités, sa consommation de peyotl ou encore son mauvais caractère. Le 18 septembre 1939, il se suicida en se coupant les veines de la gorge dans un champ dans le village de Jeziory en Polésie aujourd'hui en Ukraine, alors qu'il fuyait la progression des armées soviétiques qui avaient envahi la Pologne la veille. Il ne commença à être plus largement reconnu qu'à la fin des années 1950, notamment grâce aux mises en scène de Tadeusz Kantor et au livre collectif qui lui fut consacré en 1957. Son théâtre complet ne sera publié qu'en 1962, en Pologne. « Aujourd'hui il est considéré, non seulement comme la personnalité la plus marquante de l'entre-deux-guerres polonais, mais aussi comme le premier à avoir montré aux lettres polonaises le chemin de la modernité. Il fait à ce titre partie d'un trio célèbre, comprenant également Bruno Schulz et Witold Gombrowicz », souligne Anna Fiałkiewicz-Saignes. Œuvre Théâtre Tout comme les avant-gardistes de son époque, Witkacy ne fut pas vraiment désireux de conquérir la notoriété du grand public. Il fut méconnu et ignoré de son vivant : une dizaine de ses pièces seulement (sur la trentaine que comportait son œuvre) furent jouées avant la guerre. Ses œuvres ne rencontrèrent pas de succès ; la critique l'éreinta, lui reprochant d'écrire des pièces absurdes et incompréhensibles, de se complaire dans un non-sens gratuit et de se moquer du public. Il contre-attaqua par des articles polémiques défendant le seul théâtre possible à ses yeux : celui de la « forme pure ». Il connut néanmoins une certaine notoriété en Bohême polonaise, et entretint des relations épistolaires suivies avec des philosophes polonais, britanniques et allemands. Son appartenance à un idéal théâtral qui le conduisit à une dramaturgie neuve le rapproche de l'écrivain symboliste Maeterlinck ou d'Ibsen par certains thèmes. La "théorie de la Forme Pure" de Witkacy a influencé le théâtre de Tadeusz Kantor. Littérature « Non content de réinventer le théâtre, ce peintre, qui se voulait avant tout philosophe, entreprit de changer le roman au moment même où un peu partout en Europe des œuvres originales voient le jour. Elles incarnant toutes une nouvelle idée du roman. ... Nés du sentiment de crise culturelle provoquée par la modernisation, organisés autour de la question de la place et du sens de l'art dans le monde moderne, tentés par la métaphysique en même temps que travaillés par une suspicion profonde à l'égard du langage, les romans de Witkiewicz participent bien au débat européen sur le roman caractéristique des années 1910-1920. Mais, à des questions européennes, Witkiewicz donne des réponses qui lui sont propres, plus violentes parce que périphériques ? dans leur discours comme dans leur forme. Elles minent la forme romanesque de l'intérieur et l'amènent à éprouver ses propres limites », souligne Anna Fiałkiewicz-Saignes. En 1927, il publia L'Adieu à l'automne et en 1930 L'Inassouvissement, romans de facture très originale où la psychologie et la philosophie prennent la plus grande part, mais dont l'intrigue politico-sociale est aussi une satire féroce de la Pologne nationaliste et populiste de l'entre-deux guerres. Les Cordonniers marquent le sommet de son œuvre. D'une manière générale, il est considéré comme un auteur particulièrement difficile. Il réunit en lui un grand nombre de tendances communes aux différentes avant-gardes de l'époque. Il produisit de nombreux drames, romans, articles et essais philosophiques. Citations « La véritable nature de tous les sentiments se retrouve seulement dans le mensonge et l'inassouvissement. » L'inassouvissement « La grandeur est seulement dans la perversion. » L'inassouvissement Bibliographie Les œuvres de Witkiewicz sont traduites et publiées en français aux éditions L'Âge d'Homme Les 622 chutes de Bongo, roman, 1910 publication posthume L'Adieu à l'automne "Pożegnanie jesieni", roman, 1927 L'Inassouvissement, roman, 1930 Narcotiques / Les Âmes mal lavées, essai Cahier no 1 : Witkacy et le théâtre Cahier no 2 : Witkiewicz et la peinture Cahier no 3 : Correspondance Cahier no 4 : Colloque de Bruxelles Cahier no 5 : Witkiewicz et la philosophie Les formes nouvelles en peinture Théâtre complet 6 tomes: I. La sonate de Belzébuth ; La mère ; Le petit manoir ; Le fou et la nonne. II. Les cordonniers ; Une locomotive folle ; Janulka, fille de Fizdejko ; La nouvelle délivrance. III. Les pragmatistes ; Gyubal Velleÿtar ; La pieuvre ; La poule d'eau. Etc. VI. Mathias Korbowa et Bellatrix ; Jean Mathieu Charles Lenragey L'éducateur terrible. L'unique issue Les Cordonniers, La Mère, La Métaphysique, La Poule sont édités chez Gallimard. Ouvrages sur Witkiewicz en français Anna Fialkiewicz-Saignes, Stanisław Ignacy Witkiewicz et le modernisme européen, Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble, 2006   
#5
Sean O'Casey
Loriane
Posté le : 17/09/2016 19:18
Le 18 septembre 1964 meurt Seán O'Casey
à 84 ans à Torquay dans le Devon au royaume-uni, né le 30 mars 1880 à Dublin en Irlande dramaturge irlandais majeur, auteur de théâtre et mémoires. Il reçoit pour distinction le prix Hawthornden en 1925. Le plus grand nom du théâtre irlandais moderne. O'Casey, anglicisation de Shaun O'Cathasaigh, génie enraciné dans son Dublin natal, tire sa sève des détresses et des misères sociales, vécues avec une résignation héroïque et qu'il a observées, autour de lui, avec une indignation vengeresse. Dernier enfant d'une famille nombreuse, souffrant d'une demi-cécité, il n'avait reçu qu'une instruction très réduite ; il travaille chez un quincaillier, puis comme cantonnier, apprend à lire à treize ans et d'abord en gaélique. Il fait de la politique active : syndicaliste ardent, il joue un rôle de premier plan dans l'organisation de l'Irish Citizen Army en 1914, puis dans la terrible rébellion de Pâques 1916. Ces expériences forment la substance, la chair et le souffle de ses pièces, dont le réalisme photographique mêle le comique et le tragique, le vulgaire et le lyrique. C'est trop brutal pour le goût de l'Abbey Theatre qui refuse ses premiers essais, accepte L'Ombre d'un franc-tireur The Shadow of a Gunman, 1923, mais rejette, sur le conseil de Yeats, La Coupe d'argent The Silver Tassie, 1928, cause de manifestations violentes, car O'Casey y dénonce la guerre comme Wilfred Owen dans son poème Disabled, source de la pièce. Entre-temps, il avait produit Junon et le paon Juno and the Paycock, 1924, chef-d'œuvre de vérité psychologique et de création d'atmosphère, et La Charrue et les étoiles The Plough and the Stars, 1926, âprement condamné parce que révélant chez l'auteur un protestantisme pro-irlandais jugé insuffisant ; d'où la révolte de Sean O'Casey et son exil définitif en Angleterre. La « dépression » des années trente lui inspire Derrière les grilles, Within the Gates, son propre anticléricalisme On attend un évêque The Bishop's Bonfire joué à Dublin en 1955. Mais une certaine Irlande n'a pas désarmé et, en 1958, l'archevêque de Dublin refuse d'inaugurer le Festival par la célébration de la messe si The Drums of Father Ned Les Tambours du père Ned subsiste au programme. O'Casey obtempère, mais décourage toute représentation officielle de ses pièces en Irlande. Il n'y a, dans son attitude inflexible, ni morgue ni vanité, mais le refus de tout compromis face à la vérité et à l'art, qui doit en être l'image fidèle et totale. Une partie trop peu connue de son œuvre est constituée par les six volumes, vibrant de vie, de poésie et de couleur, de son autobiographie. Et ceux qui assistèrent au T.N.P. à la représentation des Roses rouges pour moi Red Roses for Me, 1943 ne l'oublieront pas. Louis Bonnerot Sa vie Seán O'Casey grandit dans un quartier ouvrier du nord de Dublin. Dans son enfance, il est très fidèle et très près de l'Église d'Irlande, un lien qu'il rejette quand il commence à s'intéresser à la politique et qu'il joint les rangs de la Ligue gaélique en 1906. Il modifie alors son nom, John Casey, en Seán Ó Cathasaigh, afin de lui donner une résonance gaélique. Socialiste et nationaliste engagé, il est le premier dramaturge irlandais à situer ses pièces au sein des classes populaires urbaines de son pays. Sa trilogie dublinoise regroupe L'Ombre d'un franc-tireur, Junon et le Paon et La Charrue et les Étoiles. À travers le quotidien de Dublinois des quartiers pauvres, la trilogie évoque les moments clés de l'histoire irlandaise, l'insurrection de Pâques 1916, la guerre d'indépendance entre 1919 et 1921, la guerre civile qui suivit la partition du pays. Le langage de ses personnages est proche de celui des classes populaires irlandaises, on peut voir là l'influence de John Millington Synge. En 1929, Yeats ayant refusé de représenter sa pièce The Silver Tassie au Théâtre de l'Abbaye par peur des réactions du public, il partit en Angleterre et y resta jusqu'à la fin de sa vie. Le film Le Jeune Cassidy, de John Ford et Jack Cardiff, retrace ses débuts d'écrivain à Dublin. Œuvre Le théâtre de Seán O'Casey est traduit en France chez L'Arche. Théâtre The Harvest Festival, 1918 L'Ombre d'un franc-tireur The Shadow of a Gunman, 1923, trilogie dublinoise I. Kathleen Listens In, 1923 Junon et le Paon Juno and the Paycock, 1924, trilogie dublinoise II. Cette pièce, sans doute la plus célèbre d'O'Casey, raconte l'histoire d'une famille pendant la guerre civile en 1922. Elle obtient le Hawthornden Prize en 1925 et est adaptée au cinéma par Alfred Hitchcock en 1929 Voir Junon et le Paon. Nannie sort ce soir Nannie's Night Out, 1924 La Charrue et les Étoiles The Plough and the Stars, 1926, trilogie dublinoise III. La Coupe d'argent The Silver Tassle, 1929 Within the Gates, 1934 La fin du commencement The End of the Beginning, 1937 Paiement à vue A Pound on Demand, 1939 L'étoile devient rouge The Star Turns Red, 1940 Poussière pourpre Purple Dust 1940, nouvelle version en 1945 Roses rouges pour moi Red Roses for Me, 1942 Lavande et Feuilles de chêne Oak Leaves and Lavender, 1946 Coquin de coq Cock-a-Doodle Dandy, 1949 Le Dispensaire Hall of Healing, 1951 Histoire de nuit Bedtime Story, 1951 Il est temps de partir Time to Go, 1951 On attend un évêque The Bishop's Bonfire, a Sad Play within the Tune of a Polka, 1955 Les Tambours du Père Ned The Drums of Father Ned, 1959 Derrière les rideaux verts Behind the Green Curtains, 1961 Figuro in the Night, 1961 The Moon Shines on Kylenamoe, 1961 Niall: A Lament, 1991 œuvre posthume Pièces de théâtre signées Sean O'Cathasaigh Lament for Thomas Ashe, 1917 The Story of Thomas Ashe, 1917 Songs of the Wren, 1918 More Wren Songs, 1918 The Story of the Irish Citizen Army   
#6
Benjamin Péret
Loriane
Posté le : 17/09/2016 19:06
Le 18 septembre 1959 meurt à Paris Benjamin Péret
à 60 ans, né le 4 juillet 1899 à Rezé Loire-Atlantique, écrivain, poète surréaliste, également connu sous les pseudonymes de Satyremont, Peralda et Peralta. Sa mère le fait engager comme infirmier au cours de la Première Guerre mondiale. En 1920, elle rend visite à André Breton, pour lui acheter le dernier numéro de la revue Littérature et lui recommander une « personne » qui doit bientôt venir à Paris, s'y fixer et qui voudrait se lancer dans la littérature . Quelques jours plus tard, Benjamin Péret arrive. Après sa rencontre avec Robert Desnos, il s'essaie à l'écriture automatique En bref De Benjamin Péret, Eluard a dit un jour : « Péret est un plus grand poète que moi. » Celui qui, depuis l'origine du groupe surréaliste, fut, jusqu'à sa mort, le plus fidèle compagnon de route d'André Breton a ignoré et méprisé les compromis tout au long d'une existence d'homme libre, consacrée entièrement à la révolution et à la poésie. Adepte de la révolution sociale et politique, il l'est dans la mesure où « le poète lutte contre toute oppression » (Le Déshonneur des poètes, 1945) ; mais il refuse avec énergie toute inféodation de la poésie, fût-ce à une politique révolutionnaire. Ce n'est pas au poète d'être au service de la révolution, mais à la révolution, en détruisant l'oppression, de permettre aux masses humaines d'abreuver leur « soif d'irrationnel ». Ennemi inconditionnel de notre société « tarifant le soleil et la mer » (La parole est à Péret, 1943), le poète doit « prononcer les paroles sacrilèges et les blasphèmes toujours permanents » (Le Déshonneur...). « Le poète actuel n'a pas d'autre ressource que d'être révolutionnaire ou de ne pas être poète. » La révolution faite, il pourra créer les mythes positifs au milieu de la collectivité : la poésie doit être faite par tous, non par un. Tout cela explique la passion de Péret pour les civilisations exotiques ou disparues, préférables à notre société barbare (cf. Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d'Amérique, 1942). Les peuples dits primitifs l'intéressent parce qu'ils vivent de merveilleux poétique et de magie, « la chair et le sang de la poésie » ; l'homme des anciens âges use du langage de manière surréaliste car il ne sait penser que sur le mode poétique. L'édition complète des œuvres de Benjamin Péret (seuls sont parus deux volumes de poésies intitulés Œuvres complètes, Paris, 1970-1971) permettra sans doute de découvrir quel poète total il fut : poésie généreuse, qui saisit le merveilleux quotidien, les choses par leur secret, qui aime le monde, les hommes, l'amour avec sa belle violence : Je voudrais être / Car sans toi je suis à peine à l'interstice entre les pavés des prochaines barricades Feu central. André Laude Sa vie En 1921, il participe au procès contre Barrès, organisé par les dadaïstes. Péret y apparaît dans le rôle du « soldat inconnu ». En 1928, Benjamin Péret écrit un ouvrage au titre basé sur une contrepèterie, Les Rouilles encagées. Le livre est saisi en cours de fabrication à l’imprimerie. Il ne sera disponible pour le grand public qu'un demi-siècle plus tard. En 1970 il est édité par Éric Losfeld, pour être interdit à nouveau en 1971, puis enfin autorisé en 1975. Éric Losfeld s’était risqué à un tirage limité, une centaine d’exemplaires, en 1954. Il était illustré par des dessins d’Yves Tanguy. Péret est un des poètes surréalistes les plus singuliers : virtuosité de l'écriture automatique, luxuriance baroque des images relancées infiniment par un emploi unique de la proposition relative, humour burlesque désacralisateur, audace transgressive. La poésie de Benjamin Péret s'inscrit dans le surréalisme du plus haut vol, sous le signe ascendant de l'abondance, de la liberté. Il est inhumé à Paris dans le cimetière des Batignolles 31e division. Brésil En 1928, il épouse la cantatrice brésilienne Elsie Houston, et fait la connaissance de Mario Pedrosa, son beau-frère, qui vient de souscrire aux thèses de Trotski. Au Brésil, où il séjourne de 1929 à 1931, il s’invente une sorte de nouvelle vie qui fait de lui simultanément : un opposant de gauche, un poète reporter curieux des rituels de la macumba et du candomblé, un correcteur, un père de famille (son fils, Geyser, naît le 31 août 1931) et un prisonnier politique. Péret est finalement expulsé comme « agitateur communiste » par le gouvernement de Getúlio Vargas. Revenu en France, il est membre de l'Union communiste après avoir adhéré en 1925 au Parti communiste français. Il s'en éloigne ensuite pour se rapprocher peu de temps après de Grandizo Munis. Espagne En 1936, Benjamin Péret se rend en Espagne auprès des républicains en tant que délégué du Parti ouvrier internationaliste, qui pour une brève durée avait uni les différents courants trotskistes. Il se bat dans les colonnes du POUM Parti ouvrier d'unification marxiste, puis, déçu par les dissensions internes de l'extrême gauche antistalinienne, Péret rejoint les anarchistes de la colonne Durutti et dirige une unité qui combat sur le front de Teruel. À Barcelone, il rencontre la peintre Remedios Varo qu'il épousera en 1946. France Revenu en France, il est emprisonné en mai 1940 à Rennes durant trois semaines au motif de reconstitution de ligue dissoute (trotskiste) puis libéré sous caution par les nazis qui viennent d'occuper la Bretagne. Rentré à Paris, il glisse des coquilles dans un journal collaborateur tout en dirigeant les premières réunions du groupe La Main à plume avec Robert Rius. Le froid et la faim le poussent à quitter la capitale pour Marseille où il se réfugie en mars 1941, il travaille un temps à la coopérative Le Croquefruit. Mexique Lorsque les Surréalistes fuient les nazis, Varo et Péret partent pour le Mexique en 1941. Péret reste de 1942 à 1948 au Mexique dans des conditions financières difficiles, mais est fasciné par l’art maya et les mythes et légendes des sociétés précolombiennes. Il entreprend une anthologie qu’il termine peu de temps avant sa mort. En 1945, il rédige Le Déshonneur des poètes, un pamphlet en réponse à L'Honneur des poètes publié clandestinement en 1943. France Séparé de Remedios Varo et revenu en France, il écrit pour les revues surréalistes tout en participant politiquement à la décolonisation et à la critique du stalinisme. Benjamin Péret est le seul surréaliste à être resté fidèle à André Breton, jusqu'à sa mort. Il est enterré à Paris, au cimetière des Batignolles. Œuvre Le Passager du transatlantique, Sans-Pareil, 1921. Illustré par Jean Arp. 152 Proverbes mis au goût du jour, en collaboration avec Paul Éluard, La Révolution surréaliste, 1925 Dormir, dormir dans les pierres, Éditions surréalistes,1927 Les couilles enragées, 1928. Conte érotique édité sous le pseudonyme de Satyremont et sous le titre Les rouilles encagées en 1954 chez Éric Losfeld. Rééd. éditions Prairial, 2016 Le Grand Jeu, 1928, Gallimard. Œuvres complètes, t.1, Le Terrain vague, Eric Losfeld, 1969 Ne visitez pas l'exposition coloniale, 1931. Tract collectif André Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret, Georges Sadoul De derrière les fagots, 1934. Éditions surréalistes, chez José Corti. Je sublime, 1936, Éditions surréalistes. Illustré par Max Ernst. Je ne mange pas de ce pain-là, 1936. Rééd. par Syllepse, 2010 Un ennemi déclaré, 1939, Clé no 2, février 1939, en réponse à un article d'Émile Hambresin relatif à la Guerre d'Espagne Le Déshonneur des poètes, 1945. Poésie et Révolution K éditeur à Paris / Mexico, 1945. Rééd. J.-J. Pauvert, 1965 ; Amis de Benjamin Péret / José Corti, 1986 ; Editions Mille et une nuits, 1996 Dernier malheur dernière chance, 1945, éditions Fontaine, 1946. Un point c'est tout, 1946. Onze poèmes. Revue Les 4 vents, 1946 ; Feu Central K éditions, 1947. Feu Central, avec des illustrations d'Yves Tanguy, 1947 Les syndicats contre la révolution, avec Grandizo Munis, 19527. Rééd. Acratie, 2014 Air mexicain, 1952, Arcanes Texte du film L'Invention du monde réalisé par Michel Zimbacca et Jean-Louis Bédouin 1952 Le Livre de Chilam Balam de Chumayel 1955, Denoël trad. et présent. de B. Péret Anthologie de l’amour sublime 1956. Rééd. Albin-Michel, 1988 La Commune des Palmares 1956. Rééd. Syllepse, 1999 Gigot, sa vie, son œuvre 1957 Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique 1960. Rééd. Albin Michel, 1989 Œuvres complètes, tomes I à III, Eric Losfeld / Association des amis de Benjamin Péret.. Œuvres complètes, Tome IV à VII, José Corti. / Association des amis de Benjamin Péret Pour un second manifeste communiste avec Grandizo Munis du Fomento obrero revolucionario Ed. Losfeld, 1965 2009/06/01/pour-un-second-manifeste-communiste-for-1961/ Texte en ligne Édition populaire : Le déshonneur des poètes suivi de La parole est à Péret, avec une postface de Joël Gayraud, Éditions Mille et une nuits, Paris, 1996  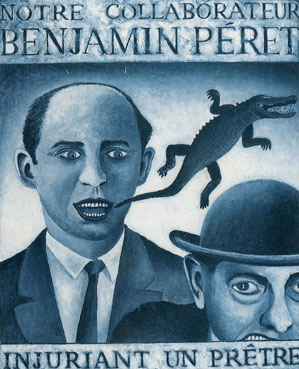   
#7
Auguste Lacaussade
Loriane
Posté le : 31/07/2016 14:48
Le 31 juillet 1897 à Paris meurt Auguste Lacaussade
à 82 ans, poète français né le 8 février 1815 à Saint-Denis de l'île Bourbon; île de la Réunion, il est fait chevalier de la légion d'honneur. Sa vie Auguste Lacaussade est né le 8 février 1815 à Saint-Denis La Réunion. Il est issu d'une union libre, son père avocat d'origine bordelaise, Pierre-Augustin Cazenave de Lacaussade, sa mère une esclave affranchie, Fanny-lucile Déjardin. A cause de ses origines colorées d'illégitimité il lui est interdit d'intégrer le collège Royal des Colonies. Il part donc à Nantes pour faire ses études à l'age de 10 ans. Ses études secondaires achevées il revient à l'île de la réunion en 1834, pour une période de deux ans. Lacaussade prend véritablement conscience de ces dures réalités de la vie coloniale et de l'esclavage. Révolté, il ne songe qu'à retourner en France, mais sans doute poussé aussi par le désir de se lancer dans la mêlée littéraire. Il débute sa carrière d'écrivain par des vers insérés dans " La Revue de Paris ". En 1839, année de son mariage il publie son premier recueil intitulé "Les Salaziennes" dédicacé à Victor Hugo sa référence. Par la suite il traduit les auteurs britanniques : Ossian en 1842, Léopardi, Anacréon. Pendant la Révolution de 1848, il rejoint le groupe d'abolitionnistes. Le gouvernement provisoire proclame le principe de l'abolition de l'esclavage, une victoire pour Auguste Lacaussade. En 1852, paraissent ses pièces majeures, rassemblées sous le titre "Poèmes et Paysages" recueil pour lequel il obtient le prix Bordin décerné par l'Académie française. La légion d'honneur et la pension votée en 1853, par le Conseil Colonial récompensent son talent. En 1861 il publie "Les épaves". La vie sociale l'accapare tout autant. Il lutte pour l'émancipation. La Révolution de 1848 sera déterminante pour lui, comme pour Leconte de Lisle. A paris, des abolitionnistes célèbres se regroupent autour de Schoelcher et Lacaussade signera avec des jeunes créoles de l'île un texte enthousiaste à propos de l'abolition de l'esclavage, ce grand acte de justice et de fraternité. Le 14 mai 1870 il est nommé conservateur de la bibliothèque du ministère de l'instruction publique, le 1er janvier 1873, bibliothécaire à la bibliothèque du Luxembourg, devenu le 1er juillet 1876, celui de bibliothécaire du Sénat, poste qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il est décédé le 31 juillet 1897 à Paris, et est inhumé le 2 août de la même année au cimetière du Montparnasse. Ses restes seront transférés de Paris à la Réunion au début du mois de février 2006. Ils ont été inhumés dans le cimetière paysager d'Hell-Bourg aux côtés de ceux de son ami le poète écossais William Falconer. Éléments de bibliographie : - 1839, Les Salaziennes. - 1852, Poèmes et Paysages. - 1861, Les épaves. - 1870, Le Cri de guerre. - 1871, Le Siège de Paris.- 1881, Poèmes de Léopardi. Extrait : - Poèmes et paysages - Les travailleurs. - Poèmes et paysages - A la mémoire de Robinet de La Serve. - Poèmes et paysages - A l'île natale. Auguste Lacaussade est le fruit de l'union libre entre Pierre-Augustin Cazenave de Lacaussade, avocat de grande famille bordelaise et d'une métisse libre Fanny-Lucile dite Desjardins. Il est donc ce qu'on appelle à l'époque un quarteron, ayant un quart de sang de couleur. Ce statut va le marquer profondément et influencer toute sa vie. À dix ans déjà, l'entrée du Collège Royal lui est refusée à cause de l'illégitimité de sa naissance1. Il s'en va donc faire ses études à Nantes après avoir passé les premières années de sa vie au Champ-Borne1. Leconte de Lisle le rejoint quelques années plus tard et leurs vies resteront liées jusqu'à la mort de Leconte de Lisle. Il a l'occasion de revenir deux fois sur son île natale, mais son intégration dans la société esclavagiste de l'époque se révèle très difficile. Il revient donc en France en 1839. Il se marie avec Laure-Lucile Déniau, dont il a une fille et deux autres enfants morts en bas âge. À partir de 1844, il devient le secrétaire de Sainte-Beuve. En 1848, il rejoint le camp des abolitionnistes groupés autour de Victor Schœlcher. Extrêmement brillant, il publie des articles dans la Revue des deux Mondes et dans la Revue de Paris, organe officiel des romantiques. Il parle plusieurs langues : l'anglais, l'italien, le grec ancien, le latin, le polonais, etc. Il traduit des œuvres étrangères, notamment celles de James Macpherson. Il obtient le prix Bordin pour Poèmes et paysages. Mais à la même époque, Leconte de Lisle publie le recueil Poèmes Antiques, qui rencontre un énorme succès. La rivalité entre eux ne cessera alors de grandir. Il devient veuf en juin 1859 et se remarie en 1865. Sous le Second Empire, le poète est nommé directeur de la Revue du Gouvernement, puis en 1872, il est promu bibliothécaire du Sénat. Il est inhumé le 2 août 1897 au cimetière du Montparnasse. En février 2006, ses restes ont été ramenés à La Réunion et inhumés dans le cimetière paysager d'Hell-Bourg, aux côtés de ceux de son ami le poète écossais William Falconer, à qui il a dédié un poème. Le transfert exauça son souhait exprimé dans le poème La mer : Je ne veux point dormir sur la terre étrangère, Sur la terre du nord je ne veux point mourir ! J'aurais froid sous un sol sans flamme et sans lumière, Mes yeux veulent se clore où Dieu les fit s'ouvrir ! Ouvrages Les Salaziennes 1839, dédicacé à Victor Hugo. Poèmes et paysages 1852 Les Épaves 1861. Cri de guerre ; Væ Victoribus 1871. Le siège de Paris 1871. Les poésies de Léopardi, adaptées en vers fr., 1888. Traduction d'Ossian de James Macpherson, 1842. Édition des poésies, chez Alphonse Lemerre Tome 1, Les Épaves, 1896, texte en ligne sur Internet Archive. Tome 2, Poèmes et paysages, 1897, texte en ligne sur Internet Archive. Décorations Chevalier de la Légion d’honneur. Officier de l’Instruction Publique. Chevalier des Ordres de Saints Maurice et Lazare. [    
#8
Franz Kafka
Loriane
Posté le : 02/07/2016 22:35
Le 3 juillet 1883 naît Franz Kafka
à Prague écrivain pragois, romancier nouvelliste de langue allemande et de religion juive, mort à 40 ans le 3 juin 1924 à Kierling près de Vienne en Autriche. Il est considéré comme l'un des écrivains majeurs du XXe siècle. Surtout connu pour ses romans Le Procès Der Prozeß et Le Château Das Schloß, ainsi que pour les nouvelles La Métamorphose Die Verwandlung et La Colonie pénitentiaire In der Strafkolonie, Franz Kafka laisse cependant une œuvre plus vaste, caractérisée par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, où la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu. Hendrik Marsman4 décrit cette atmosphère comme une objectivité extrêmement étrange… L'œuvre de Kafka est vue comme symbole de l'homme déraciné des temps modernes5. D'aucuns pensent cependant qu'elle est uniquement une tentative, dans un combat apparent avec les « forces supérieures, de rendre l'initiative à l'individu, qui fait ses choix lui-même et en est responsable. En bref Franz Kafka passe un peu partout pour le symbole même de la littérature d'avant-garde. Son œuvre étant des plus énigmatiques, elle a donné lieu à une foule d'interprétations plus ou moins ingénieuses, qui ont toutes le défaut d'être extérieures aux textes, et de refléter moins la réalité vivante de l'écrivain que les diverses idéologies ayant sur le moment la faveur des critiques. Aussi le Kafka connu par les exégèses n'a-t-il pas grand-chose de commun avec celui qui, entre 1912 et 1924, a travaillé dans le silence et la solitude, sans autre ambition que de décrire, en toute vérité et discrétion, ce qu'il appelait son impossibilité de vivre. Sa vie Franz Kafka naît à Prague, alors capitale de la Bohême, qui fait partie de l'empire austro-hongrois. Son grand-père, Jacob Kafka, vient d'Osek, une ville de province tchèque, et installe à Prague un petit commerce. Il est le fils de Hermann Kafka 1852-1931 et de Julie Kafka, née Löwy 1856-1934, issue d'une riche famille de Poděbrady. Il a deux frères, Georg et Heinrich, morts en bas âge, en 1885 et 1887, et trois sœurs plus jeunes, Gabriele Elli 1889-1942, Valerie Valli 1890-1942 et Ottilie Ottla, 1892-1943, qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, sont déportées au ghetto de Łódź. Elli et Valli sont probablement assassinées à Chełmno à l'automne 1942. Ottla meurt à Auschwitz en septembre 1943. Kafka a une enfance solitaire. Sa langue maternelle est l'allemand, comme pour près de 10 % de la population de Prague à l'époque. Les Kafka sont juifs. Kafka lui-même et ses biographes décrivent son père, qui a des relations difficiles avec son fils, comme dominant et prétentieux. Bien qu'il n'ait pas un rapport intense avec sa mère, il s'identifie fortement avec la famille de celle-ci, réputée intellectuelle et spirituelle, contrairement à celle de son père son grand-père avait fondé une grande surface. Entre 1889 et 1893, il suit l'école primaire au Fleischmarkt aujourd'hui sur la rue Masná à Prague, où il se montre bon élève. Son éducation juive se limite à la célébration de sa Bar Mitsva à l'âge de treize ans et à sa participation quatre fois par an aux services de la synagogue. Après l'enseignement primaire, il est admis au collège d'État à Prague, le Altstädter Deutsches Gymnasium germanophone. Il finit son éducation en 1901. Très tôt, il s'intéresse à la littérature ses premiers écrits ont disparu, sans doute détruits par Kafka lui-même et aux idées socialistes. Ses amis sont alors Rudolf Illowy, Hugo Bergman, Ewald Felix Pribram, ou encore Oskar Pollak. Il passe ses vacances à la campagne, chez son oncle Siegfried, un médecin de Triesch. Carrière Après son baccalauréat 1901, Kafka voyage à Norderney et Helgoland. En automne, il commence ses études à l'université Charles de PragueN 3. Après deux semaines de cours en chimie, Kafka décide d'étudier le droit. Il suit cependant aussi des cours de germanistique et d'histoire de l'art. Il voyage un peu. Il se joint au Lese und Redehalle der Deutschen Studenten, une association étudiante qui, parmi d'autres choses, organise des événements et des présentations littéraires. En 1902, il fait la connaissance du poète Max Brod, qui sera son ami le plus influent et publiera la plus grande partie de son œuvre après sa mort. En 1906, il est reçu docteur en droit chez le professeur Alfred Weber et fait un stage d'un an, en service civil, au tribunal de Prague. En 1909, il publie ses premiers essais de prose dans le magazine munichois Hyperion. Le 1er novembre 1907, il entre au service de Assicurazioni Generali, une compagnie d'assurance commerciale italienne. Après n'y avoir travaillé que neuf mois, il en démissionne le 15 juillet 1908 parce que, d'après ses dires, les longues heures de travail l'empêchent par trop d'exercer sa grande passion, l'écriture. Deux semaines plus tard, il entre au service de l’Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen Institution d'assurance pour les accidents des travailleurs du royaume de Bohême, où il travaille jusqu'à sa retraite prématurée en 1922. Bien qu'il qualifie péjorativement son travail de gagne-pain, ses prestations sont évaluées très positivement par son employeur, ainsi qu'en témoignent ses promotions dans sa carrière. Il a pour tâche la limitation des risques de sécurité encourus par les ouvriers qui doivent travailler sur des machines souvent dangereuses à l'époque ; c'est dans ce but qu'il se rend dans des usines et qu'il écrit des manuels d'information. Il est, de plus, responsable de la classification des usines dans des groupes de risques. Le fait qu'il ait à contester des demandes d'indemnisation lui donne parfois mauvaise conscience, mais l'entreprise lui laisse souvent la possibilité d'être conciliant avec les victimes, parfois blessées et handicapées à vie. À côté de son travail pour la société d'assurance, Kafka continue d'écrire, et il suit pour ce faire un programme journalier particulier ; le matin, il travaille au bureau, à midi, il va dormir quelques heures, ensuite, il va se promener, manger avec des amis ou sa famille, pour se mettre à écrire le soir, une activité qu'il continue jusque tard dans la nuit. C'est pendant l'une de ces nuits que, comme ivre, il rédige le récit Das Urteil Le Verdict. Relations Ses amis intimes sont Max Brod, le philosophe Felix Weltsch, le sioniste Hugo Bergman et le pianiste Oskar Baum. Kafka entretient des relations compliquées avec les femmes. En 1912, dans la maison de Max Brod, il rencontre la Berlinoise Felice Bauer, représentante d'une firme de dictaphones. Durant les cinq années qui suivent, une correspondance intense se développe entre Kafka et Felice. Ils se rencontrent de temps à autre, ce qui aboutit deux fois à des fiançailles. Du côté de Kafka, il s'agit surtout d'un amour platonique, qu'il entretient principalement par ses lettres. Petit à petit, il se rend compte à quel point une vie maritale traditionnelle est impossible avec Felice, beaucoup plus terre à terre, surtout avec sa tendance à s'enfermer dans son bureau ; cela conduit à la fin de leur relation en 1917. En 1919, Kafka se fiance avec Julie Wohryzek, une secrétaire de Prague, mais le père de Franz s'oppose fortement à cette relation. Elle se termine la même année — d'après ce que l'on sait, à l'initiative de Julie —, mais le conflit fait que Kafka adopte une position encore plus antagonique à l'égard de son père, qui aurait bien vu son fils lui succéder dans son entreprise commerciale. Au début des années 1920, une relation de courte durée, mais très intense, se développe entre Kafka et la journaliste et écrivaine anarchiste tchèque Milena Jesenská. De toutes les femmes de sa vie — il eut encore diverses liaisons —, Milena a peut-être le mieux compris cet écrivain hypersensible et, au moins lors de leurs rares rencontres, elle l'aide à surmonter ses craintes. Mais finalement, il se sent mal à l'aise avec cette artiste flamboyante. En 1923, il part pour quelque temps à Berlin, espérant pouvoir mieux se concentrer sur l'écriture, loin de l'ingérence de sa famille. C'est à cette époque qu'il rencontre Dora Diamant, une institutrice de maternelle âgée de vingt-cinq ans, originaire d'une famille orthodoxe juive polonaise. Dora devient la compagne de Kafka à Berlin et exerce une influence sur son intérêt croissant pour le Talmud. C'est auprès d'elle qu'il goûte finalement un peu de bonheur conjugal, alors qu'il ne le croyait plus possible. Ensemble, ils envisagent d'émigrer en Palestine. Sioniste convaincu, il avait vu la haine grandir contre les Allemands et les juifs Juifs et Allemands sont des exclus. C'est à cette époque que Kafka se fait le défenseur d'un humanisme libéral. Santé La tombe de Franz Kafka se trouve à Prague, au nouveau cimetière juif Nový židovský hřbitov. En 1917, il commence à cracher régulièrement du sang et on pose le diagnostic de tuberculose. Cela conduit à une plainte de nature presque obsessionnelle dans ses lettres à Felice, et l'utilisation de sa maladie comme raison pour rompre ses fiançailles. Mais il voit aussi son statut d'écrivain comme un handicap pour une vie de famille « normale », ce qui serait devenu un énorme problème avec une Felice moins intellectuelle et plus débordante de vie. Kafka, qui montre des signes d'hypocondrie, souffre, ainsi qu'on le pense maintenant, de dépression clinique et de phobie sociale, mais présente aussi des phénomènes vraisemblablement liés au stress, tels que des migraines, insomnies, constipations et furoncles. Il se méfie de la médecine allopathique11 et essaye de combattre ses maux avec des cures naturopathes, un régime végétarien et en buvant du lait non pasteurisé. Il profite de ses vacances pour suivre des cures de repos dans des sanatoriums, pour lesquelles son employeur lui octroie souvent des congés exceptionnels. En 1922, l'écrivain part en préretraite, à cause de son état général de santé déficient. Bien que la situation personnelle de Kafka se soit fortement améliorée après son déménagement à Berlin, et qu'il écrive à nouveau beaucoup, l'hiver marqué par l'inflation de 1923-1924 à Berlin se révèle à nouveau funeste pour sa santé déjà chancelante. Les biens de consommation essentiels se font rares et il doit en faire venir de Prague ; de plus, le froid dans le logement mal chauffé n'est pas favorable à sa guérison. Lorsqu'en mars 1924, Brod vient lui rendre visite, l'état de Kafka s'est à ce point aggravé que son ami l’emmène avec lui à Prague ; en avril, on lui diagnostique une tuberculose du larynx. Il est alors clair que Kafka n'en a plus pour longtemps car on ne dispose pas à cette époque de médicaments efficaces contre la tuberculose, si bien que l'écrivain s'alimente de plus en plus difficilement. Cet état présente des traits communs avec le personnage de Gregor dans La Métamorphose, et le personnage principal de sa nouvelle Un artiste de la faim Hungerkünstler. Dans les derniers mois, il est soutenu par son médecin et ami Robert Klopstock, qui dirige de manière critique les soins médicaux de Kafka, mais le patient ne peut plus recevoir d'aide que d'analgésiques. Kafka est admis au sanatorium de Kierling, près de Vienne, où il meurt à l'âge de 40 ans le 3 juin 1924, vraisemblablement de malnutrition ainsi que de tuberculose, Dora Diamant à ses côtés. Son corps est ramené à Prague, où il est enterré le 11 juin 1924 dans le nouveau cimetière juif du quartier de Žižkov Prague-Strachnitz. Le métier d’écrivain Kafka considère l'écriture comme une nécessité profondément intime, il s'agit pour lui d'une activité atroce, qui implique une ouverture totale du corps et de l'âme. Selon une formule restée célèbre, Kafka, dans une lettre à son ami Oskar Pollak, en janvier 1904, explique : Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous ; voilà ce que je crois. Et quelques lignes plus haut il annonce : Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?. Pour Kafka, on doit écrire comme si l'on se trouvait dans un tunnel sombre, sans savoir encore comment les personnages vont se développer ultérieureme À propos de son œuvre Kafka rédige toutes ses œuvres en allemand, si ce n'est quelques lettres rédigées en tchèque qu'il adresse à sa maîtresse Milena Jesenská. Durant sa vie, Kafka n'a publié que quelques courts récits, ainsi que les nouvelles La Métamorphose Die Verwandlung et Le Verdict, donc une toute petite partie de son œuvre. Certains des textes publiés sont des fragments d'une œuvre plus longue qui demeure inachevée et inédite à sa mort comme Le Soutier, fragment de son premier roman L'Amérique, ou Devant la loi Vor dem Gesetz, fragment de son second, Le Procès Der Prozeß. Autre roman inachevé et demeuré inédit de son vivant, son troisième et dernier, Le Château Das Schloß. Avant sa mort, Kafka charge par écrit son ami et exécuteur testamentaire Max Brod de détruire tous ses manuscrits. Voici, mon bien cher Max, ma dernière prière : Tout ce qui peut se trouver dans ce que je laisse après moi c'est-à-dire, dans ma bibliothèque, dans mon armoire, dans mon secrétaire, à la maison et au bureau ou en quelque endroit que ce soit, tout ce que je laisse en fait de carnets, de manuscrits, de lettres, personnelles ou non, etc. doit être brûlé sans restriction et sans être lu, et aussi tous les écrits ou notes que tu possèdes de moi ; d'autres en ont, tu les leur réclameras. S'il y a des lettres qu'on ne veuille pas te rendre, il faudra qu'on s'engage du moins à les brûler. À toi de tout cœur. — Franz Kafka Cependant, Max Brod décide de ne pas respecter les dernières volontés de Kafka. Brod connaît et apprécie l'œuvre de Kafka comme nul autre et avait en fait averti son ami à plusieurs reprises qu'il ferait de son mieux pour transmettre son œuvre à la postérité. Peu après, une discussion se déclenche au sujet de ce double sens supposé par Brod du « testament » de Kafka rien d'autre qu'une courte missive. On ne saura jamais avec certitude si Kafka souhaitait réellement que toute son œuvre non publiée soit détruite. En revanche, c'est l'écrivain lui-même qui détruit ou fait brûler par son amie Dora divers manuscrits, parmi lesquels un grand nombre de récits et au moins une pièce de théâtre. Il aurait cependant pu brûler le reste, mais ne l'a pas fait. En ce qui concerne les manuscrits de Kafka que Brod n'a pas eu en mains avant la guerre, la Gestapo se charge de satisfaire les dernières volontés de l'écrivain, début 1933, après la prise de pouvoir par Hitler, en saisissant environ vingt journaux et trente-cinq lettres dans l'appartement berlinois de Dora. Malgré les interventions actives de l'ambassade tchèque à Berlin, ces manuscrits ainsi que d'autres pièces qui tombèrent dans les mains des nazis ne furent pas retrouvés et sont considérés comme perdus à jamais. Brod, en contradiction avec les instructions de son ami, se charge de la publication posthume de la plus grande partie de son œuvre. Il publie les grands romans de Kafka dès les années 1920. Il ne peut collationner et publier le reste de ses œuvres, principalement les nombreux journaux et lettres, avant le début de la Seconde Guerre mondiale. La nuit où les nazis occupent Prague en mars 1939, Brod réussit à s'enfuir en Palestine avec les manuscrits de Kafka qu'il possède. L'œuvre de son ami peut y être publiée progressivement. Un mémorial à Kafka, Max Brod fait connaître cet auteur qui, de son vivant, n'avait pas attiré l'attention des critiques. Les éditions de Brod sont plutôt contestées Kafka étant décédé avant d'avoir pu préparer ses manuscrits pour la publication. Quelques-unes de ses œuvres sont inachevées, dont Le Château qui se termine en plein milieu d'une phrase, de même que Le Procès, dont les chapitres ne sont pas numérotés et qui est incomplet. Quant à son dernier roman, Le Château, dont le contenu est assez ambigu, il semble que Brod ait pris des libertés pour adapter l'œuvre de Kafka à son goût : il déplace quelques chapitres, modifie des phrases et des mots et modifie la ponctuation dans certains passages. Les éditions par Brod de l'œuvre de Kafka ne sauraient être considérées comme des éditions définitives. C'est l'écrivain Alexandre Vialatte qui révèle le génie de Kafka au public français. Après avoir découvert Le Château en 1925, il entreprend de traduire en français Le Procès, La Métamorphose ainsi que les Lettres à Milena. Il publie quelques articles importants sur l'écrivain pragois, réunis en volume sous le titre : Mon Kafka 10/18, puis Les Belles lettres, 2010. Ce sont ses traductions qui, avec celles de Claude David, font autorité dans l'édition de la Pléiade de ses œuvres. Selon l'éditeur de l'édition anglaise du Château The Castle, Schocken Books, 1998, Malcolm Pasley a réussi en 1961 à rassembler la plus grande partie des manuscrits de Kafka à la Bodleian Library de l'université d'Oxford. Le texte original du Procès est acheté plus tard en vente publique et se trouve maintenant conservé dans les archives de littérature allemande à Marbach. Pasley, après avoir rassemblé les manuscrits de Kafka, met sur pied une société avec entre autres Gerhard Neumann, Jost Schillemeit et Jürgen Born chargée de rétablir les romans dans leur état original. Les éditions S. Fischer Verlag publient les romans reconstruits. Pasley est le rédacteur final de Das Schloß Le Château de 1982 et Der Prozeß Le Procès de 1990. Jost Schillemeit est le rédacteur final de Der Verschollene le titre de Kafka, Max Brod l'appela Amerika de 1983. Ces éditions critiques sont consultables sur l'internet sous l'intitulé Le Projet Kafka. Après sa mort, son œuvre est analysée, critiquée, louée. Kafka est désormais considéré comme un écrivain majeur d'avant-garde. Les écrits de Kafka reflètent les sentiments de la société du début du XXe siècle. Ses personnages évoluent dans un monde où les rapports et les relations qui les régissent leur sont incompréhensibles, où ils sont livrés, impuissants, à des forces inconnues, comme dans un cauchemar. La vie est un mystère irrésolu, un labyrinthe dont on ne connaît pas la sortie et ce qui nous y attend. Kafka étudie la psychologie de ses personnages face à des situations extraordinaires, dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, et leur relation avec leur entourage. Kafka aborde les thèmes de la solitude, des rêves, des peurs et des complexes. Le personnage est perdu, déboussolé, il ne saisit pas tout ce qui l'entoure, le lecteur est dans la même situation. L'atmosphère particulière des romans et nouvelles de Kafka a donné naissance à un adjectif, kafkaïen, qui renvoie à quelque chose d'absurde et d'illogique, de confus et d'incompréhensible. Mais de l’ensemble de l’œuvre de Kafka, il ressort aussi une réflexion à la fois critique et éclairante sur la famille, la société et la lutte que l’individu mène contre lui-même s’il veut y trouver sa place. Kafka en France L’œuvre complète de Kafka est pour la première fois éditée en France en 1962 par Claude Tchou, le créateur du Cercle du Livre Précieux, dans une édition établie et annotée par Marthe Robert. C’est en grande partie grâce à cette publication en langue française que Franz Kafka est connu et traduit dans d’autres pays, en particulier de langues latines. Interprétation critique littéraire Les critiques ont essayé de placer l'œuvre de Kafka dans divers courants littéraires tels que le modernisme et le réalisme magique. Le manque d'espoir et l'absurdité, que l'on retrouvent dans toute son œuvre, sont des traits typiques de ce qui sera repris plus tard par l'existentialisme, de même que le thème de la responsabilité de l'individu. Quelques critiques pensent trouver dans son œuvre une influence du marxisme, surtout dans ses prises de position critiques vis-à-vis de la bureaucratie. D'autres encore, comme Michael Löwy, voient dans cette position anti-bureaucratique une influence anarchiste. De même, il est aussi fait appel au judaïsme et à l'influence de Freud. Thomas Mann et Max Brod voyaient dans l'œuvre de Kafka une recherche métaphysique de Dieu. Dans Le Procès, on retrouve explicitement le thème de la faute. La faute chez Kafka ne doit cependant pas être comprise dans l'acception commune. Lorsque les gardiens du personnage principal, Joseph K, disent que « les autorités sont attirées par la faute, telle qu'elle se retrouve dans la loi », la faute doit plutôt être comprise dans le sens juif, c'est-à-dire dans l'imperfection matérielle de l'humain. Le fait que les personnages de Kafka sont continuellement dérangés dans leur « vie habituelle » est lié à cela ; la faute de l'homme a pour but de le faire bouger, de le pousser à être activement à la recherche du sens de son existence. « La loi que tous recherchent » de la parabole de la Loi dans Le Procès représente, en revanche, vraisemblablement, la perfection dont l'homme qui la cherche peut voir un reflet : « mais maintenant il voit bien un reflet dans le noir, qui transparaît inextinguible par la porte de la loi ». Les thèmes de l'aliénation et de la persécution sont fondamentaux dans l'œuvre de Kafka, de façon si intense qu'un mouvement d'opposition en est né. Beaucoup de critiquesQui ? pensent que l'œuvre de Kafka n'est pas seulement le produit d'un écrivain tourmenté et solitaire, mais aussi réfléchi et rebelle, et qu'elle ne peut être ramenée à des 'complexes' psychologiques de l'auteur. Cependant, la Lettre au père qu'il n'envoya jamais est considérée par certains comme la clef de ses œuvres ; le complexe relatif au père y est clairement exprimé. Actuellement on met plus l'accent sur le fait que Kafka et ses amis, ainsi qu'on peut le voir dans les notes de ces derniers, riaient à la lecture de ses histoires absurdes. Vestdijk décrit comment l'auteur et Marsman se tordaient de rire à la lecture du premier chapitre du Procès. On dit aussi que l'écrivain riait à gorge déployée quand il lisait ce chapitre à ses amis. À travers tout le tragique transparaît beaucoup d'humour juif, que l'on retrouve aussi dans les histoires du rabbin Baalschem, telles qu'elles ont été rassemblées par Martin Buber ; des récits que Kafka aimait lire. D'aucuns pensent que Kafka ne s'est jamais rendu compte à quel point ses histoires étaient une sorte de prévision de la réalité et à quel point nous ne pourrions plus en rire. Dans les Discussions avec Kafka, de Gustav Janouch, apparaît l'image d'un homme qui était terriblement conscient des suites possibles de chaque mot et qui était donc très prudent et très précis dans leur usage. Ce faisant, les signes avant-coureurs du futur proche ne lui sont pas étrangers ; dans ce livre, Kafka prédit la destruction de l'Allemagne, près de vingt années avant la Seconde Guerre mondiale. Milan Kundera cite l'humour surréaliste de Kafka comme la source d'inspiration principale d'écrivains et de réalisateurs tels que Federico Fellini, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes et Salman Rushdie. Gabriel García Márquez a dit qu'à la lecture de La Métamorphose il avait réalisé « qu'il était possible d'écrire d'une autre façon. Dans la littérature néerlandaise, il a influencé, entre autres, Ferdinand Bordewijk, Willem Brakman et Willem Frederik Hermans. Procès de la littérature Le possédé de l'art L'une des particularités les plus remarquables de cette œuvre déroutante, c'est qu'elle entremêle à ses thèmes romanesques des motifs moins apparents, qui tous ont trait à l'existence même de l'écrivain et aux problèmes de la création. Ici, en effet, la littérature est toujours liée d'une manière ou d'une autre à ce qui arrive au héros, elle est le principe au nom duquel l'individu espère et lutte, l'instance toute-puissante qui le séduit, mais qui, le vouant finalement à l'échec, est impliquée comme lui dans un obscur procès. Non que Kafka enferme dans ses récits une philosophie de la littérature ou une théorie esthétique, il n'a pas l'esprit théoricien, à peine trouverait-on dans ses récits quelques pages de réflexion abstraite qui sont des notes personnelles, le plus souvent ambiguës, et fort éloignées des préoccupations esthétiques des contemporains. Mais la littérature était sa passion, au sens profane comme au sens religieux du mot. Un amour donc, et un calvaire, avec ce que ces deux ordres d'expérience supposent de caractère pathologique et de dynamisme exemplaire. Pathologique, car la passion ici en vient, à force de déchirement, à se nier elle-même et à détruire son propre objet. Exemplaire malgré tout, par la vérité intransigeante de l'expérience vécue qui, en dépit ou plutôt à cause de son extrême singularité, donne à connaître non seulement le malaise de l'écrivain isolé, mais une situation tout à fait générale de l'art avec ses questions, ses contradictions, sa frivolité, son tragique. Il s'en faut que cette passion s'exprime seulement en dictant à Kafka ses exigences de justesse et de perfection. Elle est bien plutôt ce qui s'écrit, ce qui se représente soi-même dans le contexte romanesque et, de la sorte, devient un thème, l'un des plus constants et des plus riches, le plus original peut-être de son monde fictif. Kafka, qui disait : « Tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie et je le hais, même les conversations sur la littérature », n'a rien écrit qui ne rende avec le dernier sérieux la réalité de ce sentiment exclusif : possédé et déchiré par l'écriture, c'est sa passion, sa « croix » qu'en vérité il donne à porter à ses héros. L'écrivain est donc partout dans ce monde imaginaire qui paraît tout à la fois familier et affecté d'une étrange folie. Mais pour répondre à la situation inextricable où il se trouve en face de la littérature et de la société de son temps, il est partout déplacé, dénaturé, privé de ses attributs reconnaissables, dé-nommé en quelque sorte. Par une ironie dont lui seul sans doute pouvait sentir toute l'amertume, ce possédé de l'art est dépossédé de tous ses traits personnels, de la fonction qui remplit sa vie, de sa plume et même de son nom : il ne lui reste que sa passion têtue et apparemment absurde pour un idéal apparemment chimérique. À quoi reconnaît-on ces figures d'écrivains qui, bien entendu, n'ont avec Kafka aucune ressemblance extérieure et sont en général reléguées dans un coin du récit, ou mises au premier plan, mais soigneusement camouflées ? À ceci que leur fonction présente une analogie avec la fonction littéraire réduite à l'un de ses aspects essentiels ; celui, par exemple, d'une communication, d'une circulation de valeurs, d'une tâche pressante, ou encore d'une mission. Ainsi tous les messagers et les courriers qui abondent dans les récits de Kafka, tous les fonctionnaires qui noircissent des paperasses sont des écrivains ayant perdu leurs insignes visibles au profit d'un élément fondamental de leur fonction, qui est ici la communication entre le monde invisible et le monde social, entre le « haut » et le « bas », ou bien encore entre un ici-bas et un quelconque au-delà auquel on fait seulement allusion. Ce sont des symboles, si l'on veut, à condition toutefois d'admettre que le symbole, en l'occurrence, ne contient pas plus de sens que l'objet signifié, mais au contraire un sens plus étroit, d'autant plus profond et obsédant qu'il est réduit à une seule idée. La même réduction peut encore affecter d'autres aspects de la condition de l'artiste. L'écrivain alors devient simplement quelqu'un qui se produit en public et qui, du seul fait qu'il est entendu et regardé, pose encore une fois la question du sens et de la validité de son message. C'est le cas du Champion de jeûne, en allemand Hungerkünstler, artiste de la faim ; du Trapéziste, Trapezenkünstler, artiste du trapèze ; de Joséphine la Cantatrice, la souris qui donne des récitals à son peuple ; ou encore du narrateur anonyme qui, dans le Maître d'école de village (Dorfschullehrer, 1914), publie un mémoire sur un sujet scientifique. C'est aussi le cas du singe transformé en homme qui, dans Rapport pour une académie (Bericht für eine Akademie, 1919), fait pour une société savante le compte rendu de son étrange mutation. Et, bien entendu, de Joseph K. dans Le Procès (Der Prozess, 1925), au moment où il décide de renvoyer son avocat et d'assurer lui-même sa défense en écrivant son autobiographie. Très souvent, l'exhibitionnisme de l'art entre en composition avec un autre élément également très accentué : c'est l'idée de salut qui anime soit l'artiste lui-même, soit ceux qui espèrent ou semblent attendre son message. On rencontre alors ces figures de messies douteux, à mi-chemin entre le raté, l'escroc et le parvenu, qui non seulement ne sauvent personne, mais se perdent invariablement eux-mêmes malgré leur foi inébranlable et l'excès de leur sérieux. Le plus bel exemple de cette catégorie, le plus émouvant aussi si on pense que Kafka l'a créé sous les premiers effets de sa grave maladie, est la figure du Médecin de campagne qui, dans la nouvelle du même nom (Ein Landarzt, 1920), est maudit pour avoir cru à sa vocation de sauveur et suivi l'appel de la « sonnette de nuit ». Quant à l'œuvre produite par ces poètes déplacés, elle est également, bien entendu, tout à la fois présente et invisible dans le texte. Non pas, sans doute, avec toute sa richesse et son extension possible, mais, comme pour son créateur, dans une image excessivement comprimée, réduite parfois à un seul trait grossi ; c'est alors une construction : le pont de bois qui donne son nom à l'auberge du Pont, dans Le Château (Das Schloss, 1926), ou un ouvrage d'art, la Muraille de Chine ; ou, littéralement, « une écriture », tel le modèle de la sentence calligraphiée avec amour par l'Ancien Commandant de La Colonie pénitentiaire (In der Strafkolonie, 1919) ; ou encore « des écritures », des paperasses semblables à celles qu'entassent d'innombrables scribes dans les archives du Château. Dans le cas le plus désespéré, l'œuvre apparaît sous la forme absolument indéchiffrable du plus infime, du plus absurde des objets. Odradek Cet objet doué de parole et de mouvement qui s'appelle Odradek, dans Le Souci du Père de famille (Die Sorge des Hausvaters, 1919), mérite assurément considération, non seulement parce qu'il n'a pas son pareil dans toute la littérature d'imagination, mais parce que Kafka en fait de toute évidence la personnification de son œuvre et l'explication de ce qui sera son testament. La nouvelle, écrite pendant l'hiver 1916-1917, c'est-à-dire à une époque où Kafka ressent déjà les symptômes de la tuberculose qui se déclarera quelques mois plus tard, traduit impitoyablement les sentiments de l'écrivain devant l'œuvre bizarre, inutile, compliquée qu'il lui faudra laisser inachevée. En effet, après avoir discuté la double origine tchèque et allemande du mot « Odradek », mot tout à fait imaginaire, cela va sans dire, le Père de famille, avec lequel Kafka peut ici s'identifier puisqu'il est lui aussi le père de son œuvre, décrit l'objet familier et pourtant insaisissable qui hante sa maison et est, en somme, le « génie » du lieu. C'est une bobine plate en forme d'étoile – allusion à la troisième appartenance de l'objet, la juive – faite de bouts de fils de toutes couleurs et de toutes qualités, noués bout à bout et embrouillés. Odradek marche et parle, ou plutôt il boitille en s'appuyant sur une branche de son étoile, et sait tout juste décliner son identité. Il est aussi capable de rire, mais comme quelqu'un qui n'aurait pas de poumon, d'un rire inhumain, ni tragique, ni comique, ni sérieux, ni gai, assez semblable en somme à celui que provoque l'humour noir de Kafka, ou ce qu'on appelle ainsi faute d'une meilleure définition. « On serait tenté, dit le Père de famille, de croire que ce système a eu autrefois une forme utile et que c'est maintenant une chose cassée. Mais ce serait sans doute une erreur [...]. On n'aperçoit ni ajouture ni fêlure qui le donne à penser ; l'ensemble paraît absurde, mais complet en son genre. » Ce petit « génie », qu'on traite comme un enfant, se tient non pas dans les pièces habitées de la maison, mais au grenier – dans les hauteurs –, dans l'escalier, les couloirs ou le vestibule, c'est-à-dire dans les lieux qui font communiquer les pièces entre elles et la maison avec le dehors. Il disparaît pendant des mois, mais revient toujours à l'improviste, comme l'inspiration qui, elle aussi, est capricieuse, imprévisible, et laisse croire malgré tout à sa fidélité. En sa qualité de chose composite, mi-vivante, mi-inanimée, sans origine, ni but, ni devenir, Odradek semble appartenir à un espace intermédiaire dont la mort elle-même est exclue. Et la pensée de cette immortalité inspire au Père de famille une mélancolique rêverie : « C'est en vain que je me demande ce qu'il deviendra. Peut-il donc mourir ? Il n'est rien qui ne meure sans avoir eu une sorte de but, une sorte d'activité qui l'ont usé ; ce n'est pas le cas d'Odradek. Dévalera-t-il encore l'escalier, traînant ses bouts de fils après soi devant les pieds de mes enfants et des enfants de mes enfants ? Sans doute il ne nuit à personne ; mais l'idée qu'il doive me survivre m'est presque douloureuse. » La méditation du Père de famille sur l'immortalité éventuelle d'Odradek – une immortalité sans joie, causée uniquement par l'absence de but et l'inutilité de l'objet – évoque irrésistiblement le « souci » de Kafka touchant le sort de ses écrits lorsqu'il aura disparu. On sait en effet qu'il a demandé à son ami Max Brod de détruire tous ses papiers posthumes sans en prendre connaissance ni les communiquer à personne, et depuis toujours on s'interroge sur cette étrange volonté qui, vu la haute conscience que Kafka avait de sa valeur, paraît en général incompréhensible. Pourtant, n'en trouve-ton pas la clé dans ces récits où la littérature est à elle-même son propre miroir, et singulièrement dans ce Souci du Père de famille où Kafka, en termes allusifs, mais en fin de compte transparents, fait avec une cruauté glacée la critique de son art ? Comme les textes de son auteur, Odradek participe de deux langues et s'appuie sur trois cultures différentes – l'allemande, la tchèque, la juive –, sans toutefois pouvoir en revendiquer aucune. Il est hybride, disparate, fait de fils cassés qui s'emmêlent et ne conduisent nulle part : c'est l'image que Kafka se faisait de ses innombrables fragments qui composent, certes, un extraordinaire labyrinthe, mais qui paraissent vraiment achevés en leur genre, malgré leur air indéchiffrable et leur absence de fin. Absurde, inutile, solitaire, Odradek tire une part de son mystère de sa nature infantile et, en quelque sorte, immortelle, car il parle comme un enfant, mais son rire « sans poumon » renvoie à une espèce de ciel glacé où tous les contraires seraient annulés, à une promesse d'éternité triste dont Kafka dit qu'elle lui fait presque mal. « Presque », cette réserve doit être soulignée, car elle explique que Kafka n'ait pas, malgré tout, détruit son œuvre de ses propres mains, et justifie du même coup la décision de Max Brod d'enfreindre sa défense pour sauver Odradek du néant. Sous toutes les variantes que l'imagination de Kafka multiplie presque à l'infini, on retrouve cette situation fondamentale de l'art, qui est contradictoire et sans solution, sans autre issue pour celui qui la vit que la déchéance ou la mort, une mort sans beauté et, par surcroît, ridicule. Situation qui ne peut pas évoluer, mais se répète continuellement parce qu'elle a sa source dans une discordance fatale entre la nature grandiose de l'art et la faiblesse native de l'artiste. Partout, en effet, l'art en lui-même paraît revêtu d'une inexprimable dignité : c'est la tâche par excellence, un mandat impérieux dont l'accomplissement, toujours immotivé, ne souffre ni retard ni discussion. Ainsi, personne ne conteste la nécessité, en quelque sorte providentielle, de la Muraille de Chine, dont le plan est pourtant impénétrable ; à aucun moment le Champion de jeûne ne s'interroge sur les raisons qui le poussent à mourir de faim, il jeûne parce qu'il ne peut faire autrement, sans même tenir à jour le calendrier de son exhibition ; de même la machine diabolique de La Colonie pénitentiaire – c'est, à tout prendre, une machine à écrire, puisqu'elle inscrit la sentence de mort dans la chair du condamné – est un objet sacré pour l'officier qui la sert ; et Odradek a beau n'être qu'une chose inclassable, il est promis malgré tout à une espèce d'éternité. Quelles que soient les formes qu'ils affectent, les représentants de l'art ont, dans tous les récits de Kafka, quelque chose de sacré ou, à tout le moins, d'intemporel qui les rapproche des sphères mystiques de la foi. Le messie avorté De fait, c'est bien une religion qui est en cause ici, mais, pour le malheur personnel de l'artiste, une religion sans dogmes ni église, d'autant plus tyrannique que ses commandements, n'émanant de personne, ne peuvent jamais être ni prouvés, ni réfutés, ni même parfaitement obéis. « C'est un mandat », écrit Kafka en soulignant le mot, et il ajoute : « Conformément à ma nature, je ne puis accepter qu'un mandat que personne ne m'a donné. » Mais si l'art est un mandat qu'aucune autorité ne garantit, s'il n'est pas le fait d'un ordre supérieur dicté par une voix divine, il relève de la subjectivité pure et ne concerne, en fin de compte, que l'artiste lui-même, de sorte que ses prétentions à la vérité sont chimériques et que ses promesses toujours implicites de salut relèvent de l'illusion superstitieuse ou, tout simplement, de l'escroquerie. En élevant la littérature à la hauteur d'un absolu, Kafka se montre l'héritier direct du XIXesiècle, qui lui aussi cherchait dans l'idéalisation de l'art de quoi compenser le vide spirituel laissé par la « mort de Dieu » et la sécularisation de la vie. D'un autre côté pourtant, il rompt tout à fait avec la tradition issue du romantisme européen, car pour lui le poète est bien loin d'être la créature inspirée à qui il est donné de relier la terre au ciel. Ce n'est pas l'albatros de Baudelaire qui en donne l'image la plus juste, mais le choucas, le kavka aux ailes rognées qui sautille péniblement parmi les passants sur un trottoir de Prague. Empêché de voler et incapable de vivre, ce kavka ridicule, déchiré entre son impuissance et son orgueil, n'est en réalité qu'un faux messie, un cabotin, un illusionniste de l'absolu qui s'autorise d'une mystérieuse mission pour justifier son existence parasite. L'idéal auquel il s'est voué lui reste à jamais inaccessible ; tout ce qu'il peut espérer, c'est d'en être l'ombre ou le lointain rappel, s'il a assez de courage pour se voir lui-même et se montrer ce qu'il est. Le dénigrement de soi et l'humilité excessive qui sont au fond d'un pareil pessimisme s'expliquent, bien entendu, avant tout par de profondes raisons psychologiques. De fait, le Journal de Kafka, ses écrits autobiographiques et sa volumineuse Correspondance (en particulier ses lettres à Felice Bauer, la jeune fille à laquelle il se fiança deux fois sans parvenir à l'épouser) prouvent assez l'angoisse chronique qui caractérisait son existence intime. Lui-même incriminait les « vices » de son éducation, mais sans même parler du violent conflit qui l'opposait à son père et dans lequel il tendait à voir la première cause de son mal, il est certain que, étant donné ses dispositions psychiques, sa constitution nerveuse et la violence de son combat intérieur, il était porté à vivre les situations les plus communes avec une intensité et une intransigeance qui les changeaient en drames insolubles. Cependant, cette propension à retourner toutes les armes contre lui n'avait pas que des causes subjectives, elle était aussi la réponse d'un esprit blessé à une situation historique bien définie : celle qu'il trouvait toute faite dans sa ville natale, la Prague de l'ancienne Autriche-Hongrie. « La petite mère a des griffes » Tout, dans la vie de Kafka, ramène en effet à cette ville que les Tchèques appelaient « la petite mère » et qui, pour l'auteur du Procès, était plutôt une marâtre impitoyable (« Prague ne nous lâchera pas, écrit-il à un ami de jeunesse, la petite mère a des griffes. ») Son œuvre, en un sens, est une tentative pour fuir les sortilèges de la vieille cité : c'est pourquoi, si elle est le vrai théâtre de ses récits, il ne l'a jamais décrite ni nommée. Capitale de la Bohême, centre administratif et, en principe, résidence excentrique de la double monarchie, la Prague de Kafka est en fait une petite ville, cosmopolite d'un côté, provinciale de l'autre, qui, par son étrange configuration sociale et ethnique, occupe une place de choix parmi les monstres de l'ancienne Europe, pourtant riche en absurdités. Peuplée d'une minorité d'Allemands qui appartiennent en général à la haute bureaucratie et n'ont de commun avec l'Allemagne que la langue, une langue du reste passablement corrompue ; de Tchèques qui forment le fond de la population laborieuse, sans toutefois constituer un véritable prolétariat ni même une petite bourgeoisie ; de Juifs enfin qui, tout juste sortis de leur ghetto médiéval, exercent le plus souvent des professions commerciales et libérales, mais sont soumis en fait à toutes sortes de mesures vexatoires et de discriminations, la ville, sous les dehors de l'ordre impérial, vit quotidiennement l'anarchie et l'absurdité que Kafka n'a pu décrire qu'en inventant une nouvelle forme de fantastique. Les trois groupes humains rassemblés là depuis des siècles, et séparés néanmoins par tout ce qu'impliquent les différences de langue, de mœurs et de culture, ont dressé entre eux des murs infranchissables derrière lesquels ils étouffent également, car aucun ne se rattache à une vaste nation, mais aucun non plus ne peut subsister dans l'isolement. Les Tchèques n'ont pas plus que les Juifs d'existence nationale. Quant aux Allemands de Bohême (les Sudètes), coupés de l'Allemagne depuis deux siècles, ils se trouvent dans la position d'un petit groupe de colons privé de toute métropole. Entièrement cloisonnées dans leurs quartiers respectifs, les diverses couches de la population présentent encore entre elles des différences sociales tranchées : les Allemands occupent le haut de la hiérarchie, les Tchèques le bas ; les Juifs jouissent parfois d'une situation privilégiée que les tracasseries, le mépris ou la haine des deux autres groupes leur font bien sûr chèrement payer. Comme intellectuel issu d'une famille de commerçants juifs partiellement germanisés, Kafka subit un état de choses dégradant et lourd de confuses menaces ; impliqué dans des conflits dont il n'est pas responsable, mais dont il ne peut ni ne veut se désolidariser, il sent à chaque instant autour de lui une suspicion qui finira par lui paraître justifiée. En tant que juif, en effet, il est triplement suspect aux yeux des Tchèques, car il n'est pas seulement juif, mais allemand, et il est aussi le fils d'un commerçant dont tous les employés sont tchèques, d'un exploiteur par conséquent. Or, allemand, il ne l'est que par la langue, ce qui certes le relie fortement à l'Allemagne et à sa littérature, mais nullement aux Allemands de Bohême, qui sont eux-mêmes déracinés et sans liens vivants avec leur culture d'origine. Il est d'ailleurs éloigné d'eux non seulement par leurs préjugés de race, mais par le ghetto aux murs invisibles dont la bourgeoisie juive, plus raffinée, s'est elle-même volontairement entourée. Ainsi, Kafka change de monde en changeant de quartier ; qu'il fasse quelques pas hors de Prague, et il se trouve aussitôt en pays étranger, voire ennemi. Les lieux et les objets ont beau lui être familiers, ils n'en sont pas moins insolites, imprévisibles, inquiétants ; leur proximité vaguement menaçante ne fait qu'aggraver sa solitude, et son sentiment d'être à jamais en exil. Ce malaise devait naturellement peser très lourd sur la vie de l'écrivain qui, lui, n'était pas seulement gêné dans son existence quotidienne, mais frappé personnellement dans ses relations intimes avec son art, dans ses possibilités d'expression et son commerce avec le public. L'écrivain allemand de Prague – qu'il fût juif ou non, mais la chose se compliquait évidemment beaucoup pour le Juif – héritait en effet une langue dont l'état ne reflétait que trop bien celui du petit groupe qui la parlait. Privée de l'apport substantiel que toute littérature nationale tire d'un langage populaire et vivant, tenue à l'écart des mouvements profonds qui, en Allemagne, entraînaient les œuvres et permettaient leur évolution, la langue souffrait du même déracinement que les hommes, elle était comme eux sans histoire ni tradition. Desséchée par un usage restreint, confinée dans les chancelleries, elle était en même temps corrompue par les deux autres langues qui empiétaient sur son territoire : le bohémien et le yiddish. Rigide et pauvre, elle n'offrait au poète que de maigres ressources naturelles et l'obligeait en quelque sorte à tirer ses mots du néant. Ainsi, tous les écrivains pragois de cette époque ont eu à surmonter tout à la fois la corruption et l'indigence de leur langue. Certains, comme Rilke et Werfel, n'y sont parvenus qu'en allant chercher ailleurs, l'un à Paris, l'autre à Vienne et en Italie, la force de rompre le maléfice de Prague. Mais, pour Kafka, ni l'émigration ni aucune sorte de fuite n'étaient concevables : conscient d'être l'hôte toléré d'un pays qui n'était que légalement le sien, et non pas le possesseur ou le maître, mais, selon ses propres termes, l'invité de la langue allemande (c'est parce qu'il ne la possédait pas qu'il la regardait comme son « éternelle bien-aimée »), il refusa de contourner la vérité ou de l'atténuer grâce à de quelconques expédients. L'impossibilité qu'on lui faisait de vivre et d'écrire normalement, elle du moins était vraie dans ce monde artificiel où il était plongé : il en fit donc sa vérité. Le dilemme L'écartèlement Les difficultés intérieures et extérieures, qui, dans la vie de Kafka, allaient causer un conflit permanent et contribuer pour une large part au délabrement de sa santé, ne sont pas telles d'abord qu'il puisse les croire tout à fait insolubles. Dans sa jeunesse, en effet, Kafka se sent malgré tout solidement lié à la langue, à la culture, et même, jusqu'à un certain point, à l'histoire allemandes. Vivant dans le commerce continuel de Goethe, sans doute a-t-il l'espoir d'apporter sa part, à son tour, à la grande littérature dont il est nourri. Sa première souffrance lui vient donc surtout des sautes de son inspiration, qui l'empêchent de rien achever et le laissent en face d'une masse énorme de fragments, puis, peu après, de l'exercice d'une profession qu'il abhorre parce qu'elle vole à la littérature la majeure partie de son temps. Comme il ne veut ni ne peut vivre de sa plume – il l'eût peut-être voulu plus tard, si son éditeur n'eût été un peu effarouché par l'insolite de ses récits –, il lui faut bien effectivement gagner sa vie. Pour cela, il fait du droit – matière aussi éloignée que possible de son art et qui, pourtant, y contribuera par un biais inattendu – et prend un poste dans une compagnie d'assurances où il a du reste de lourdes responsabilités. Pendant des années, il ne peut donc écrire que la nuit, ce qui brise son élan créateur et, par surcroît, mine sa santé. Le conflit, pourtant, ne devient vraiment aigu qu'en 1912, lorsque, ayant rencontré la jeune fille avec laquelle il se fiancera et rompra deux fois, Kafka se voit placé devant le choix décisif de sa vie. Va-t-il se marier, travailler pour faire vivre sa famille, et réserver à la littérature la part chichement mesurée dont s'accommode une existence normale ? Ou, au contraire, rester seul, choisir l'ascétisme le plus rigoureux et tout sacrifier à cette œuvre qui, pour l'instant, n'existe qu'à l'état d'ébauche et dont il ignore s'il la mènera jamais à bien ? Vivre comme tout le monde, c'est renoncer à la littérature absolue, qui est son seul but et sa seule justification ; mais écrire comme il y est obligé en vertu de sa nature, c'est consentir à un renoncement monstrueux, franchir sans retour les limites de l'humain. L'alternative ainsi posée est évidemment sans issue, il s'ensuit une crise violente qui ne se dénoue qu'en 1917, grâce à l'apparition d'une tuberculose opportune qui permet à Kafka de rester seul comme il le veut, sans l'avoir vraiment choisi. Cependant, le débat entre l'art et la vie n'est pas clos : il est devenu une lutte acharnée où la littérature l'emporte momentanément, en attendant d'être elle-même vaincue. On trouve dans Le Procès, roman posthume et inachevé, le reflet de cette recherche inquiète d'un art juste, non pas ennemi de la vie, mais logé au cœur de la vie elle-même, dont Kafka rêvait pour résoudre son impossible dilemme. Deux formes d'art en effet s'offrent tour à tour comme une issue au roman : d'abord l'autobiographie de Joseph K., qui représente l'exploitation de la littérature à des fins douteuses d'autodéfense. Joseph K. la commence, mais ne la finit pas, cela suffit à la condamner. Puis l'art du peintre Titorelli, qui peint toujours les mêmes paysages de landes gris et monotones, sans attrait et sans talent, mais qui est malgré tout le peintre officiel de la Justice, c'est-à-dire de la collectivité, et peut en tant que tel communiquer à Joseph K. des informations sûres quant au fonctionnement du mystérieux Tribunal. Dans un passage barré par Kafka, ce peintre minable, mais sage à sa manière, prend même l'aspect d'un véritable sauveur : il opère sur Joseph K. une mystérieuse métamorphose, puis disparaît dans un halo de lumière. Il est vrai que cela se passe en rêve, et qu'une fois de plus le salut n'a lieu que dans la tête du rêveur. À mesure que son œuvre mûrit et aggrave sa solitude, Kafka porte sur son art, et jusqu'à un certain point sur l'art de son temps qu'il a conscience de représenter, un regard de plus en plus pessimiste. Il lui semble alors que l'œuvre pour laquelle il a renoncé à une vie normale parmi les hommes n'a guère profité de son sacrifice, car il la voit desséchée, obscure, marquée par l'isolement, la monotonie, l'inachèvement qui ont été son lot à lui. L'inspiration, qui lui semblait naguère une garantie de sa perfection, il la juge maintenant suspecte, empoisonnée par les fantômes de ses nuits sans sommeil. En 1922, alors que les progrès de son mal lui laissent pressentir sa fin, il écrit à Max Brod, que son état sans doute inquiète : « La création est une merveilleuse et douce récompense, mais en échange de quoi ? Cette nuit, j'ai vu clairement, avec la netteté d'une leçon de choses enfantine, que c'est un salaire pour le service du diable. Cette descente vers les puissances obscures, ce déchaînement d'esprits qui par nature sont liés, ces étreintes louches et tout ce qui peut encore se passer en bas dont on ne sait plus rien en haut quand on écrit des histoires en plein soleil [...]. Peut-être y a-t-il une autre littérature, je ne connais que celle-là ; la nuit, quand l'angoisse m'empêche de dormir, je ne connais que celle-là. » Ce que Kafka condamne dans un tel art, c'est la complaisance à soi, ce que les psychanalystes appellent narcissisme, et où il voit pour sa part la cause immédiate d'une peur terrible de la mort. L'étincelle qu'il avait en lui, il a le sentiment qu'il ne s'en est pas servi pour créer, mais pour « illuminer » son cadavre. Ayant joué la littérature contre la vie, il a perdu les deux, sans profit ni espoir de rédemption : « Ce que j'ai joué va vraiment arriver. Je ne suis pas racheté par la littérature. Je suis mort tout le long de ma vie, et maintenant je vais vraiment mourir. Ma vie était plus douce que celle des autres, ma mort sera d'autant plus terrible. » L'étranger absolu Une dernière fois, dans son dernier roman, Kafka tentera de fondre ses deux conceptions contradictoires de l'art en une seule image, et ce sera l'arpentage de K., le héros du Château, qui choisit un art utile, simple, géométrique, et en même temps inspiré puisqu'il dépend des « messages » d'en haut. Contrairement aux autres entreprises aventureuses des héros de Kafka, cet arpentage n'a pas pour fin la conquête du ciel, mais la mesure exacte, impartiale et scientifique des choses de la terre. C'est un art de la vie et de l'esprit qui, tout à la fois réaliste et inspiré, devrait cette fois mettre fin au conflit. C'est encore une illusion, dont l'artiste seul fait les frais. K., en effet, prétend avoir été convoqué par le comte West-West, le châtelain en qui Kafka semble vouloir incarner le principe même de la civilisation occidentale où il cherche encore à se faire une place, avant peut-être de la quitter à jamais. Or le Château n'a pas envoyé de convocation, il enregistre simplement la déclaration de K., ce qui signifie que la vocation de l'individu échappe nécessairement à toute réfutation comme à toute preuve collective. K. deviendra donc pour tout le monde Monsieur l'Arpenteur, sans jamais recevoir la confirmation officielle de son titre. Il est perdu parce qu'il s'entête à la réclamer au lieu d'exercer spontanément ses dons et de contraindre ainsi la collectivité à reconnaître le prix réel de son travail (il est vrai que le village résiste de toutes ses forces à cet art réaliste, qu'il juge, non sans raison, dangereusement subversif). Son échec est donc inévitable : être l'Étranger, l'Exilé absolu, et réclamer de la collectivité la consécration d'une œuvre virtuelle, empreinte par surcroît de l'individualisme le plus extrême, c'est effectivement vouloir l'impossible ; d'autant qu'en rêveur incorrigible, en Don Quichotte utopique et ridicule qu'il est au fond, il met des espoirs insensés dans son « messager », ce Barnabé au nom d'apôtre qui, étant censé lui porter des lettres « d'en haut », lui semble revêtu d'une majesté et d'un pouvoir célestes. C'est là l'erreur fatale que le Château, c'est-à-dire la vie, la vie aveugle et cruelle dans sa neutralité, a pour tâche de sanctionner. Car Barnabé n'est pas la divine Muse que K. imagine ; en vérité c'est un enfant impuissant, sans expérience, effrayé par la vie, n'ayant pour lui que sa prodigieuse mémoire et la grâce trompeuse de son sourire (ici encore l'art infantile et impuissant devient un maléfice parce qu'il séduit en vain). Quant aux lettres dont il est chargé, ce ne sont que des paperasses poussiéreuses, sans expéditeur ni destinataire définis, tout juste bonnes à semer le trouble dans le monde. « Barnabé, dit Kafka, est le messager du mensonge, et le mensonge n'apporte pas le salut. » À en juger par cette conclusion sans équivoque, ainsi que par la satire atroce du Champion de jeûne sur quoi Kafka achève son œuvre, on pourrait croire que, maintenant, sa condamnation de l'art est vraiment sans appel. Elle l'est sans doute ; pourtant, loin d'avoir cessé d'écrire, il a si bien continué jusqu'à l'extrême de ses forces que, le 2 juin 1924, la veille de sa mort au sanatorium de Kierling près de Vienne, il corrigeait encore les épreuves de ses derniers récits.Marthe Robert Influence Le style et le symbolisme de Kafka ont influencé la littérature de son époque, notamment dans les registres de la nouvelle et de la pièce de théâtre radiophonique, l'adjectif allemand kafkaesk, traduit par kafkaïen en français, devenant même une référence. La question de la nationalité La nationalité de Franz Kafka est sujette à controverse. Le fait que Prague était incluse au moment de sa naissance dans l'Autriche-Hongrie devrait faire de lui un écrivain autrichien. D'une manière générale, les habitants germanophones de la Bohême se considéraient en ce temps-là, soit comme des Autrichiens, soit comme des Allemands Allemands des Sudètes. L'appellation consacrée d'« écrivain tchèque de langue allemande », même si elle n'est pas tout à fait exacte, constitue un compromis dans les ouvrages de référence de langue française. Œuvres Les dates mentionnées sont les dates de publication. N'ont pas été relevés les textes publiés isolément dans des revues, les premiers en 1909 1912 : Regard (Betrachtung, daté de 1913 mais paru fin 1912, Leipzig, Ernst Rowohlt, 99 p. réédité en 1915. 1913 : Le Verdict Das Urteil, Leipzig, Kurt Wolff, 29 p. réédité en 1916 et 1920. 1913 : Le Soutier Der Heizer de Ein Fragment, Leipzig, Kurt Wolff, 47 p. réédité en 1916 et 1917-1918. 1915 : La Métamorphose Die Verwandlung, Kurt Wolff, 73 p. réédité en 1915 et 1918. 1919 : La Colonie pénitentiaire In der Strafkolonie, Kurt Wolff, 71 p. 1919 : Un médecin de campagne Ein Landarzt. Kleine Erzählungen, Kurt Wolff, 189 p. 1922 : Un champion de jeûne Ein Hungerkünstler. Vier Geschichten, Berlin, Die Schmiede, 86 p. Œuvres publiées après sa mort : 1925 : Le Procès Der Prozeß 1926 : Le Château Das Schloß 1927 : L'Amérique Amerika bien que publié plus tard, il a été écrit avant Le Procès et Le Château 1931 : Le Terrier Der Bau 1937 : Journal intime première publication française : 1945 1945 : Paraboles recueil de plusieurs textes courts traduit par Jean Carrive, dont Des Paraboles 1944 : La Muraille de Chine neuf textes, Paris, Seghers, traduction Jean Carrive. 2009 : Cahiers in-octavo 1916-1918 2010 : Les aphorismes de Zürau Transpositions cinématographiques et télévisuelles The Trial Le Procès, mise en scène du Procès par Orson Welles23 datant de 1962, avec Anthony Perkins. La Métamorphose, téléfilm français de Jean-Daniel Verhaeghe, diffusé en 1983. Le Château, téléfilm français de Jean Kerchbron, diffusé en 1984 avec Daniel Mesguich dans le rôle de Joseph K. Amerika-Rapports de classe (Klassenverhältnisse), de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, 1984. Kafka, film de 1991 où Jeremy Irons joue le rôle de Franz Kafka. Ce film réalisé par Steven Soderbergh mêle la vie et l'œuvre de Kafka en un ensemble semi-biographique. Dans ce film, Kafka enquête sur la disparition de l'un de ses collègues, et de cette manière devient un acteur même de ses propres romans, à savoir Le Procès et Le Château. Franz Kafka's It's a Wonderful Life, court-métrage primé de l'Academy Award et oscarisé de 1993, réalisé par Peter Capaldi avec Richard E. Grant dans le rôle de Kafka. Ce film mêle La Métamorphose avec It's a Wonderful Life de Frank Capra. The Metamorphosis of Franz Kafka, court métrage de 1993 de Carlos Atanes. The Trial, lui aussi de 1993, avec Kyle MacLachlan dans le rôle de Josef K. et Anthony Hopkins dans une représentation caméo en tant que prêtre. Le film suit de manière très stricte l'original. Le scénario est signé Harold Pinter. Le Château film, 1997 Das Schloß, téléfilm réalisé par Michael Haneke avec Ulrich Mühe et Susanne Lothar. Menschenkörper, court métrage de 2004 de Tobias Frühmorgen. Ce film est une interprétation libre et moderne du récit Un médecin de campagne. Un voyage en Italie, court métrage de 2006 de Christophe Clavert. Ce film est l'adaptation d'un fragment narratif du Journal de Kafka. Adaptation en bande dessinée David Zane Mairowitz et Robert Crumb, Kafka, traduit de l’américain par Jean-Pierre Mercier, Arles, Actes Sud, 2006, coll. "Actes Sud BD", Réal Godbout, L'Amérique, ou le disparu, d'après le roman éponyme, Éd. de La Pastèque, 201324, 184 p. Horne Perreard et Eric Corbeyran, La Métamorphose, d'après le roman éponyme, 2009.      
#9
Narcejac
Loriane
Posté le : 01/07/2016 21:24
Le 3 juillet 1908 naît Pierre Ayraud dit Thomas Narcejac
à Rochefort-sur-Mer, écrivain français, auteur de romans policiers, mort à Nice le 7 juin 1998, à 89 ans, écrivain, romancier, essayiste français, auteur de romans policiers. Il reçoit le prix du roman d'aventure en 1948 En bref Écrivain français, de son vrai nom Pierre Ayraud. Après avoir publié en solitaire plusieurs titres reconnus La Mort est du voyage, 1948 il s'associe à Pierre Boileau pour une fructueuse collaboration, Celle qui n'était plus, 1952 ; D'entre les morts, 1954 ; Les Magiciennes, 1957 ; Les Louves, 1973. Stricte répartition des tâches : Boileau imagine l'intrigue, tandis que Narcejac lui donne sa structure et son épaisseur romanesque. Quarante-trois romans sont ainsi publiés sous le nom de Boileau-Narcejac, les plus fameux ayant donné lieu à des adaptations au cinéma par Hitchcock Vertigo et Clouzot Les Diaboliques. Le couple Boileau-Narcejac a tenté d'inventer une troisième voie, entre le classique roman policier et le roman noir américain. Il propose également une réflexion sur le genre Le Roman policier, 1964 ; Une machine à lire : le roman policier, 1975, ainsi que des Mémoires, Tandem, ou trente-cinq ans de suspense Sa vie Élevé à Saintes, il se rend souvent pour pêcher pendant sa jeunesse, sur le lieu-dit nommé « Narcejac », dont il se souviendra pour choisir son pseudonyme. Il fait des études universitaires à Bordeaux, Poitiers et Paris qui lui permettent de décrocher des licences en lettres et en philosophie. Il se destine ensuite à l'enseignement et occupe successivement des postes à Vannes, Troyes, Aurillac. À partir de 1945, il est professeur de lettres classiques à Nantes jusqu'à sa retraite en 1968. Dès l'après-guerre, il fait paraître des nouvelles qui sont autant de pastiches d'auteurs de littérature policière. Ces textes seront réunis dans Confidences dans ma nuit (1946), Nouvelles confidences dans ma nuit (1947) et Faux et Usage de faux (1952). Narcejac fait également paraître ses premiers romans policiers, dont L'Assassin de minuit (1945). Faut qu'ça saigne (1948) est son premier roman écrit en collaboration avec Serge Arcouët qui utilise alors le pseudonyme Terry Stewart. Les deux auteurs donnent ensuite une série de romans d'action, la série des Slim sous le pseudonyme commun de John-Silver Lee. Avec La mort est du voyage (1948), écrit seul, il remporte le prix du roman d'aventures. Au cours d'un dîner, Albert Pigasse, le directeur de la Librairie des Champs-Élysées, favorise la rencontre entre Narcejac et Pierre Boileau. C'est le début de l'association littéraire de ces deux auteurs qui signeront quarante ans de romans policiers sous la signature Boileau-Narcejac. Certains romans policiers de ce duo ont donné lieu à des adaptations cinématographiques par Henri-Georges Clouzot et Alfred Hitchcock. En marge de cette collaboration, Narcejac écrit seul quelques romans maritimes : Une seule chair (1954) et Le Grand Métier 1955 Théoricien littéraire, Narcejac a également publié, seul ou en collaboration avec Pierre Boileau, plusieurs essais marquants consacrés au roman policier. Œuvre Romans L'Assassin de minuit, « La Mauvaise Chance » no 3, 1945 La police est dans l'escalier, « La Mauvaise Chance » no 16, 1946 La Nuit des angoisses, « Labyrinthe », 1948 La mort est du voyage, « Le Masque » no 355, 1948 Faut qu'ça saigne, « Les Gants noirs », 1948, en collaboration avec Terry Stewart Dix de der, « L'Empreinte », 1950 ; réédition sous le titre Le Goût des larmes Le Mauvais Cheval, Presses de la Cité, 1951 Liberty ship, Presses de la Cité, 1952 Une seule chair, Presses de la Cité, 1954 Le Grand Métier, Presses de la Cité, 1955 Libertalia au pirate de Dieu, France-Empire, 1979 Série des Slim signée John-Silver Lee Slim entre en scène, « L'As de pique » no 2, 1949 Slim n'aime pas le mélo, « L'As de pique » no 4, 1949 Le ciel est avec Slim, « L'As de pique » no 6, 1949 La Colère de Slim, « L'As de pique » no 9, 1949 Slim a le cafard, « L'As de pique » no 11, 1949 Slim chez Tito, « L'Empreinte », 1950 Slim et les Soucoupes volantes », « L'Empreinte", 1950 Recueil de nouvelles Confidences dans ma nuit, « La Mauvaise Chance" no 7, 1946 Nouvelles confidences dans ma nuit, « La Mauvaise Chance" no 23, 1947 Faux et Usage de faux, « Le Masque no 409, 1952 ; réédition sous le titre Usurpation d'identité Essais Esthétique du roman policier, Portulan, 1947 La Fin d'un bluff, Portulan, 1949 Le Cas Simenon, Presses de la Cité, 1950 Une machine à lire : Le Roman policier, Denoël, 1975 Hommages Ancien professeur de lettres et de philosophie au lycée Georges-Clemenceau de Nantes de 1947 à 1967, Thomas Narcejac a reçu un hommage de cette ville : la rue Thomas-Narcejac (47° 12′ 37″ N 1° 31′ 47″ O), attribué le 5 décembre 2008, a été inaugurée sur l'île de Nantes le 12 octobre 2012.       
#10
Re: Hervé Guibert
Loriane
Posté le : 25/06/2016 21:32
Oui, tu as raison oublié, sous-estimé à tort.
|
Connexion
Sont en ligne
51 Personne(s) en ligne (25 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 51 Plus ... |
| Haut de Page |






