|
|
Armande Béjart 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Les cornes sont toujours fort proches des oreilles.
ELOMIRE
J’aurais des cornes, moi ? moi je serais eu.
L’ORVIETAN.
On ne dit pas qu’encor vous le soyez actu ;
Mais, étant marié, c’est chose très certaine
Que vous l’êtes, du moins, en puissance prochaine.
Du vivant de Molière, il ne fut pas imprimé autre chose sur son ménage. Après sa mort, à une époque indéterminée, un grossoyeur de notes et d’anecdotes, de petits papiers et d’extraits de jurnaux, dont le recueil manuscrit est venu jusqu’à nous, le sieur Jean-Nicolas de Tralage, parait-il, s’amusait à dresser un double catalogue des comédiens qui vivaient bien et de ceux qui vivoient mal, et, parmi ces derniers, il rangeoit la femme de Molière entretenue à diverses fois par des gens de qualité et séparée de son mari. C’est là un renseignement à la Tallemant des Réaux, un on-dit recueilli et enregistré sans critique ; comme on le verra, l’entretien et la séparation sont purement imaginaires. Il y a bien encore le factum du Guichard que nous connaissons, mais il se retrouvera bientôt.
J’arrive enfin à l’acte d’accusation formel et détaillé qui pèse le plus lourdement sur la mémoire d’Armande, à la Fameuse Comédienne. C’est un petit livre, publié à Francfort en 1688, réimprimé jusqu’à cinq fois en neuf ans, et anonyme. On pouvait donc se donner carrière pour lui chercher un auteur, et on n’y a pas manqué ; on l’a attribué successivement à La Fontaine, à Racine, à Chapelle, à Blot, le chansonnier de la Fronde, à Mlle Guyot, comédienne de la rue Guénégaud, à Mlle Roudin, comédienne de campagne, à Rosimont, autre acteur de la rue Guénégaud, etc. Il n’y a lieu de discuter aucune de ces attributions, également dénuées de preuves ; les deux premières surtout sont d’une haute fantaisie : ni La Fontaine, malgré sa médiocre dignité de caractère, ni Racine, bien qu’il ait eu des torts envers Molière, n’étaient capables de commettre une infamie, et la Fameuse Comédienne en est une. Racine, en particulier, repentant, converti, entièrement retiré de la littérature depuis 1677, avait d’autres soucis en tête que d’écrire des libelles orduriers. Tout ce que l’on est en droit de supposer, c’est que le livre part de la main d’un homme ou d’une femme de théâtre. Il dénote, en effet, du tripot comique et de la vie des comédiens, une si exacte et si minutieuse connaissance, que l’auteur masqué dut être non pas seulement un écrivain dramatique ou un amateur très répandu dans ce milieu spécial, mais un comédien. Toute profession très absorbante, — et aucune plus que celle-là ne prend son homme tout entier, — imprime une marque spéciale aux idées et au langage ; quelle que soit l’originalité de caractère que la nature ait donnée à un comédien, il sent et pense, voit et parle d’une manière qui lui est plus ou moins commune avec tous ceux qui montent sur les planches. Or, quiconque est un peu familier avec l’envers du théâtre, reconnaît dans la Fameuse Comédienne un parfum de coulisses prononcé. Mais si un comédien pense et écrit de façon spéciale, encore plus une comédienne, qui joint au tour d’esprit et de langage particuliers à sa profession celui qu’elle doit à son sexe. C’est le cas du livre qui nous occupe. La place prépondérante qu’il donne aux femmes, la manière dont il parle des hommes, la haine jalouse qui l’inspire, le choix des médisances ou des calomnies, je ne sais quoi d’oblique et d’insinuant, tout cela dénote une main féminine ; comme aussi la finesse de certaines remarques, la grâce facile et l’agréable négligence des tours. Car si le livre est odieux, il s’en faut de beaucoup qu’il soit mal écrit ; il a sa valeur littéraire, et assez grande, par sa langue, qui est de la meilleure époque et du meilleur aloi, par son style libre et souple, périodique sans lourdeur, familier sans trivialité. Il n’est aucunement pour donner tort à la boutade célèbre de P.-L. Courier que « la moindre femmelette de ce temps-là vaut mieux pour le langage que les Jean-Jacques et les Diderot. » Quant au fond, les inventions haineuses dominent, mais tout n’est pas à rejeter. II faut distinguer d’abord les faits généraux se rapportant au milieu où vivait Armande : ils sont généralement exacts ; et les faits particuliers qui lui sont attribués : la plupart sont imaginaires. L’auteur a certainement vu de près Molière et Armande, elle a probablement fait partie de leur troupe, elle connaît par le menu l’histoire de leur théâtre. Le caractère et la manière d’être qu’elle prête aux deux époux, les incidens publics de leur existence qu’elle raconte, tout cela montre en elle un témoin bon à entendre. Mais c’est tout. Possédée contre Armande d’une haine féroce, haine de femme et de comédienne, elle n’a qu’un but qui est de la rendre odieuse ; ce qu’elle sait des actions de son ennemie, elle le dénature, ou, tout au moins, l’exagère ; ce qu’elle ne sait pas, elle l’invente. Qui veut déshonorer un homme lui attribue des actes d’indélicatesse ou de lâcheté ; qui veut déshonorer une femme lui prête des amans : ce sont les moyens les plus sûrs. Aussi notre auteur fait-elle d’Armande une vraie Messaline, et une Messaline du dernier ordre, de celles que l’on paie. Malheureusement pour l’effet de son récit, elle voulut trop prouver, et, surtout en pareille matière, qui veut trop prouver ne prouve rien. La réputation d’une femme est chose fragile ; mais, par cela même, redoubler les coups est une tactique maladroite. A celui qui s’acharne dans l’attaque comme dans la défense, on est toujours tenté de répondre avec la marquise de Lassay : Comment faites-vous donc pour être si sûr de ces choses-là ? Et dans la Fameuse Comédienne les affirmations abondent, avec pièces à l’appui, lettres, conversations, etc. Il y a trop de faits précis articulés, trop de détails complaisamment énumérés sur des actes qui, par leur nature même, ne sont exactement connus que des seuls participans. Aussi, dès les premières pages, l’incrédulité naît chez le lecteur ; il voit trop bien qu’il a sous les yeux un ramassis d’histoire suspectes, et, s’il lui prend fantaisie de les contrôler, il reconnaît que toutes celles que l’on peut contrôler sont démenties par des faits positifs, et que les autres pèchent contre la plus simple vraisemblance.
Le premier amant attribué à Armande est l’abbé de Richelieu, petit-neveu du grand cardinal ; il était, en effet, d’humeur galante avec une préférence marquée pour les comédiennes. Et voici comment se seraient établies ses relations avec la femme de Molière : Comme il étoit libéral et que la demoiselle aimoit la dépense, la chose fut bientôt conclue. Ils convinrent qu’il lui donneroit quatre pistoles par jour sans ses habits et les régals. L’abbé ne manquoit pas de lui envoyer tous les matins par un page le gage de leur traité et de l’aller voir toutes les après-midi. Ce marché d’amour est commode et simple ; mais, outre que l’on sait par les contemporains les noms des principales amies de l’abbé et que Mlle Molière n’en est pas, il faut admettre, Molière et sa femme demeurant dans la même maison, ou bien que les allées et venues du page et de l’abbé ont passé inaperçues pour le mari, ou bien qu’il en a su le motif et les a tolérées : deux hypothèses également inadmissibles. Si maintenant nous consultons les dates, l’invraisemblance devient une impossibilité. Armande s’était mariée le 20 février 1662, et, le 10 janvier 1664, elle donnait un fils à Molière. Veut-on placer une intrigue galante entre ces deux époques ? Ce serait faire commencer son inconduite de bien bonne heure. Quant à l’abbé, il part, dès le mois de mars 1664, avec l’expédition organisée pour défendre la Hongrie contre les Turcs et meurt à Venise le 9 janvier 1666. Cela n’empêche point la Fameuse Comédienne de faire durer sa liaison avec Mlle Molière jusqu’après les représentations de la Princesse d’Elide, à Chambord ; or cette pièce ne fut jouée qu’après le départ de l’abbé, le 8 mai 1664, et à Versailles.
Une nouvelle et double aventure se serait greffée sur celle-là, Durant les représentations de la Princesse, Armande devint folle du comte de Guiche, et le comte de Lauzun devint fou d’elle ; irritée des dédains du premier, elle se jeta résolument à la tête du second. Ici encore se présentent une impossibilité et une invraisemblance. Éloigné de la cour depuis 1663, à la suite d’un petit complot contre Mlle de La Vallière, le comte de Guiche était ensuite parti pour la Pologne et se trouvait encore à Varsovie en mai 1664. Quant à Lauzun, on ne le trouve pas nommé parmi les personnages qui figuraient dans les fêtes où fut donnée la Princesse d’Élide ; plusieurs, cependant, étaient à la fois moins qualifiés et moins en vue que lui. En outre, tout plein à ce moment de sa passion pour Mme de Monaco, il était peu désireux, sans doute, de se prêter aux caprices d’une comédienne aussi bruyante et encombrante que l’Armande représentée dans la Fameuse Comédienne. Ainsi, la médisante ennemie a eu la main malheureuse ; entre les grands seigneurs célèbres à la cour par leurs aventures galantes, elle a choisi trois des plus connus, se disant que, dans la foule de leurs maîtresses, une de plus passerait sans difficulté ; mais elle savait mal ce monde-là et son ignorance l’a trahie.
Bien que l’abbé de Richelieu soit en route pour la Hongrie, notre libelle le retient en scène, et pour lui faire jouer un fort vilain rôle. Furieux d’être abandonné par Armande, il aurait fait apercevoir à Molière que le grand soin qu’il avoit de plaire au public lui ôtoit celui d’examiner la conduite de sa femme ; et que, pendant qu’il travailloit pour divertir tout le monde, tout le monde cherchoit à divertir sa femme. Une grosse querelle conjugale suit naturellement cette confidence. Armande joue la comédie des larmes ; elle avoue son penchant pour Guiche, mais elle proteste que tout le crime a été dans l’intention, ne dit mot de Lauzun, demande un pardon qu’elle obtient sans peine, et profite de la crédulité de son mari pour continuer ses intrigues avec plus d’éclat que jamais.Cette fois, elle y met une indifférence de cœur, une régularité et une âpreté au gain qui la rangent parmi les femmes galantes de profession. Elle prend une entremetteuse en titre, la Châteauneuf, et ne refuse aucun des nombreux amans que cette matrone lui présente pendant qu’elle fait languir une infinité de sots qui la croient d’une vertu sans exemple. » Ne voilà-t-il pas deux choses assez difficiles à concilier, l’éclat d’une vie galante et une cour d’amoureux transis ? Cependant Molière, averti de nouveau, se met dans une fureur violente et il menace sa femme de la faire enfermer. Nouvelle scène de cris et de larmes ; mais, au lieu de s’humilier une seconde fois, Armande le prend de haut, et exige une séparation. En vain, sa famille, celle de Molière, leurs amis communs essaient de l’apaiser : Elle conçut dès lors une aversion terrible pour son mari, elle le traita avec le dernier mépris ; enfin, elle porta les choses à une telle extrémité que Molière, commençant à s’apercevoir de ses méchantes inclinations, consentit à la rupture qu’elle demandoit incessamment depuis leur querelle ; si bien que, sous arrêt du parlement, ils demeurèrent d’accord qu’ils n’auroient plus d’habitude ensemble. Il y eut donc non pas séparation judiciaire, comme l’a cru Tralage, mais séparation à l’amiable. D’autres témoignages s’accordant ici avec celui de la Fameuse Comédienne, on peut tenir le fait pour assuré.
Cette rupture ne saurait être antérieure au mois d’avril 1666, car à cette époque Armande donnait à son mari un second enfant : une fille qui eut pour parrain M. de Modène et pour marraine Madeleine Béjart. Peu de temps après, Molière tombait malade ; nous le savons par Robinet, qui annonce, le 21 février 1666, sa guérison et sa rentrée au théâtre. Si l’on admet que le Misanthrope reflète quelque chose de l’état d’esprit du poète et de ses sentimens envers sa femme, la séparation peut être rapportée au moment où cette pièce fut jouée, c’est-à-dire en juin 1666, ou, au plus tard, vers le mois d’août de la même année, après le Médecin malgré lui. On a vu que, dans les trois pièces qui suivent celle-ci : Mélicerte, le Sicilien et Amphitryon, Armande est laissée de côté : c’est Mlle de Brie qui en obtient les beaux rôles ; ne serait-ce point un effet du ressentiment de son mari, effet très naturel et d’autant plus pénible pour elle que jusqu’alors elle avait eu dans les distributions une part plus flatteuse et plus large ?
Depuis ce moment ils ne se virent plus qu’au théâtre, Armande restant à Paris avec sa mère et ses sœurs, Molière passant ses rares loisirs dans une petite maison de campagne qu’il avait louée à Auteuil. Un jour, il rêvait tristement dans son jardin, lorsque, selon la Fameuse Comédienne, il reçut la visite de son ami Chapelle, et, comme il étoit alors dans une de ces plénitudes de cœur si connues par les gens qui ont aimé, il s’épancha dans une confidence que l’auteur du pamphlet prétend reproduire tout au long et au vrai :
Je suis né, disait-il, avec les dernières dispositions à la tendresse ; et, comme j’ai cru que mes efforts pouvoient lui inspirer par l’habitude des sentimens que le temps ne pourrait détruire, je n’ai rien oublié pour y parvenir. Comme elle étoit jeune quand je l’épousai, je ne m’aperçus pas de ses méchantes inclinations, et je me crus un peu moins malheureux que la plupart de ceux qui prennent de pareils engagemens. Aussi le mariage ne ralentit point mes empressemens ; mais je lui trouvai tant d’indifférence que je commençai à m’apercevoir que toute ma précaution avoit été inutile et que tout ce qu’elle sentoit pour moi étoit bien éloigné de ce que j’aurois souhaité pour être heureux. Je me fis à moi-même des reproches sur une délicatesse qui me sembloit ridicule dans un mari, et j’attribuai à son humeur ce qui étoit un effet de son peu de tendresse pour moi. Mais je n’eus que trop de moyens de m’apercevoir de mon erreur ; et la folle passion qu’elle eut, peu de temps après, pour le comte de Guiche, fit trop de bruit pour me laisser dans cette tranquillité apparente. Je n’épargnai rien, à la première connaissance que j’en eus, pour me vaincre, dans l’impossibilité que je trouvai à la changer. Je me servis pour cela de toutes les forces de mon esprit ; j’appelai à mon secours tout ce qui pouvoit contribuer à ma consolation ; je la considérai comme une personne de qui tout le mérite est dans l’innocence, et que son infidélité rendoit sans charmes. Je pris dès lors la résolution de vivre avec elle comme un honnête homme qui a une femme coquette, et qui est bien persuadé, quoi qu’on puisse dire, que sa réputation ne dépend point de la méchante conduite de son épouse. Mais j’eus le chagrin de voir qu’une personne sans beauté, qui doit le peu d’esprit qu’on lui trouve à l’éducation que je lui ai donnée, détruisoit, en un moment, toute ma philosophie. Sa présence me fit oublier mes résolutions, et les premières paroles qu’elle me dit pour sa défense me laissèrent si convaincu que mes soupçons étoient mal fondés, que je lui demandai pardon d’avoir été si crédule.
Cependant mes bontés ne l’ont point changée ; et si vous saviez ce que je souffre, vous auriez pitié de moi. Ma passion est venue à un tel point qu’elle va jusques à entrer avec compassion dans ses intérêts ; et quand je considère combien il m’est impossible de vaincre ce que je sens pour elle, je me dis en même temps qu’elle a peut-être une même difficulté à détruire le penchant qu’elle a d’être coquette, et je me trouve plus dans la disposition de la plaindre que de la blâmer. Vous me direz sans doute qu’il faut être père pour aimer de cette manière ; mais, pour moi, je crois qu’il n’y a qu’une sorte d’amour, et que les gens qui n’ont point senti de semblables délicatesses n’ont jamais véritablement aimé. Toutes les choses du monde ont du rapport avec elle dans mon cœur. Mon idée en est si fort occupée que je ne sais rien en son absence qui me puisse divertir. Quand je la vois, une émotion et des transports qu’où peut sentir, mais qu’on ne sauroit dire, m’ôtent l’usage de la réflexion. Je n’ai plus d’yeux pour ses défauts, il m’en reste seulement pour ce qu’elle a d’aimable. N’est-ce pas là le dernier point de la folie, et n’admirez-vous pas que tout ce que j’ai de raison ne sert qu’à me faire connaître ma faiblesse sans on pouvoir triompher ?
Le passage est éloquent et une grande émotion s’en dégage ; non-seulement il ne part pas d’une plume ordinaire, mais je n’hésite pas à y voir, malgré quelques tournures languissantes et quelques-faiblesses d’expression, un des beaux morceaux de la prose française en sa plus belle époque.
Faut-il aller plus loin, et y reconnaître, comme on le veut, l’esprit ou la main de Molière lui-même, que ce soit un compte-rendu écrit de souvenir par Chapelle, ou une lettre adressée par Molière à son ami, compte-rendu ou lettre tombés dans les mains du libelliste ? Il n’est besoin, ce semble, de recourir ni à l’une ni à l’autre de ces deux hypothèses. Si l’on admet que la Fameuse Comédienne, malgré sa détestable inspiration, n’est pas l’œuvre du premier venu, mais d’une actrice douée d’un talent de style naturel, le plus simple serait d’admettre encore que ce morceau est aussi bien son œuvre que tout le reste. Rompue à la pratique du théâtre, elle combine certaines parties de son récit comme autant de petites pièces. La situation est ici de celles qui inspirent et portent ; soutenue donc parle souvenir du Misanthrope, l’imagination échauffée par les plaintes brûlantes d’Alceste, sa haine contre Armande venant par-dessus, elle a réussi la scène et la tirade. Sauf en un point, toutefois, le rôle prêté à Chapelle. Epicurien insouciant, Chapelle n’en était pas moins sensible aux peines de ses amis ; il l’a prouvé en plusieurs circonstances. Or, le langage qu’il tient dans la scène d’Auteuil est celui d’un fort vilain égoïste ; .jamais confident ne joua son rôle de façon plus piteuse. Il ne comprend rien à la douleur de Molière, qui est obligé de lui dire : Je vois bien que vous n’avez encore rien aimé. La confession achevée, mal à l’aise, dérangé dans sa quiétude d’esprit, il se dérobe au plus vite : Je vous avoue à mon tour que vous êtes plus à plaindre que je ne pensois ; mais il faut tout espérer du temps. Continuez cependant à faire vos efforts ; ils feront leur effet lorsque vous y penserez le moins. Pour moi, je vais faire des vœux afin que vous soyez bientôt content. C’est l’attitude et le langage de ce solennel imbécile de baron dans On ne badine pas avec l’amour, lorsqu’il répond aux supplications passionnées de la pauvre Camille : Cela me jettera dans le désespoir pour tout le carnaval… Je serai vêtu de noir ; tenez-le pour assuré… Je vais m’enfermer pour m’abandonner à ma douleur !
Les consolations de l’amitié sont insuffisantes pour adoucir des amertumes aussi douloureuses que celles dont souffrait Molière. Seul, un autre amour peut les rendre supportables, en attendant que l’on revienne au premier. C’est Mlle de Brie qui aurait rempli auprès de Molière ce rôle d’abnégation.
Dans le Misanthrope, elle avait représenté Éliante, et, de même qu’Éliante eût volontiers consolé Alceste des caprices de Célimène, de même Mlle de Brie accueillit Molière rebuté par Armande. Mais elle n’eut pas la pudique réserve d’Éliante, son intervention dans une passion troublée fut moins irréprochable ; enfin sa liaison avec Molière ne saurait leur valoir à l’un et à l’autre une sympathie sans mélange. Elle l’aimait avant son mariage avec Armande ; et, quoi qu’en dise l’auteur de la Fameuse Comédienne, elle semble s’y être résignée facilement ; elle nous apparaît, en effet, comme très accommodante, sans rancune, admettant l’abandon ou le partage et ne tenant pas rigueur à qui lui revenait. Mais il est fâcheux pour Molière qu’une fois marié il n’ait pas pris à son égard une attitude nette et n’admettant aucune interprétation de nature à froisser Armande. Au lieu de cela, un an à peine après son mariage, on le voit habiter la même maison que son ancienne maîtresse. Si la femme légitime avait des torts, quelle arme pour elle ! Armande ne manqua donc pas, dans l’occasion, d’employer cette tactique, féminine entre toutes, qui consiste à attaquer au lieu de se défendre. Dans la grande querelle qui précéda la séparation de 1666, elle déclara bien haut « qu’elle ne pouvoit plus souffrir un homme qui avoit toujours conservé des liaisons particulières avec la de Brie, qui demeurait dans leur maison et qui n’en étoit point sortie depuis leur mariage. » Elle exagérait sans doute un peu en précisant ainsi son grief ; Molière était alors trop épris de sa femme pour l’abandonner si tôt. Mais ne lui avait-il pas fourni lui-même cette triomphante réponse ? Et il paraît bien que, une fois rebuté, il acheva de lui donner raison en revenant à Mlle de Brie. C’était une maladresse, et ses amis ne le lui cachèrent pas. L’un d’eux, selon Grimarest, lui en faisait un jour le reproche, et, comme de raison, traitait fort mal Mlle de Brie ; elle n’avait, disait-il, ni vertu, ni esprit, ni beauté. Molière en convenait, mais en ajoutant : Je suis accoutumé à ses défauts, et il faudrait que je prisse trop sur moi pour m’accommoder aux imperfections d’une autre ; je n’en ai ni le temps ni la patience. Il y a bien des choses dans ce peu de mots : de la tristesse, de la résignation, le dédain amer de soi-même et d’autrui, peut-être aussi cette espèce d’inconscience qui résulte de certains états d’esprit et de certaines situations. Molière était un très grand homme, mais un homme, et qui avait ses faiblesses ; il serait puéril de les nier et de l’absoudre en tout et pour tout avec un parti-pris d’admiration. Comédien, sa profession admettait alors bien des licences, et il on prit sa part. Il ne faut donc pas chercher dans sa conduite, ou plutôt y mettre les yeux fermés une régularité bourgeoise qui n’y est pas et n’y saurait être. En l’espèce, il commit ou une faute ou une maladresse, les deux si l’on veut.
Faute ou maladresse, au surplus, la réconciliation n’en fut pas empêchée. L’auteur de la Fameuse Comédienne n’en parle pas : cela dérangerait sa thèse. Entre temps, le libelle place une nouvelle intrigue d’Armande. Durant les représentations de Psyché, au carnaval de 1671, elle se serait éprise d’une passion violente pour le très jeune Baron, qui faisait l’Amour, et ils auraient continué leur rôle hors du théâtre. Cette liaison n’est guère admissible ; non parce que Baron était tenu envers Molière par les devoirs d’une reconnaissance filiale : ce que l’on sait de cet insupportable fat, très dégagé de préjugés comme tous les dons Juans, permet de penser qu’une telle considération ne l’aurait pas retenu. Mais il était encore bien jeune : il avait à peine dix-sept ans et Armande n’était pas assez âgée elle-même pour rechercher les passions d’adolescens ; les Rosines ont passé la trentaine lorsqu’elles font chanter la romance aux Chérubins. De plus, il semble prouvé que Baron, traité par Molière avec la plus grande bonté, eut au contraire beaucoup à se plaindre d’Armande, qu’il dut même, rebuté par ses mauvais procédés, quitter la troupe pendant quelque temps, et qu’il y rentra malgré elle, sur les vives instances de Molière. Ce qui est certain, c’est que, aussitôt Molière mort, il s’empressa d’aller à l’hôtel de Bourgogne, dans un moment où Armande, devenue chef de la troupe, aurait eu grand besoin de lui.
A côté de toutes ces intrigues apocryphes ou douteuses, plus répugnantes les unes que les autres, on est heureux de rencontrer non pas un amour, mais un hommage aussi pur qu’honorable pour Armande, et où son souvenir se trouve mêlé à celui du vieux Corneille. Modèle des époux et père de six enfants, l’auteur de tant de stances à Iris n’en aimait pas moins jouer auprès des reines de théâtre le rôle du don Guritan de Ruy Blas auprès de dona Maria de Neubourg. Il y avait quelque chose d’espagnol dans son âme comme dans son génie, et lorsqu’il rencontrait un type de grâce charmante ou noble, il s’en faisait avec une galanterie fière l’admirateur et le servant. Devenu l’ami de Molière, il offrit à sa jeune femme une admiration platonique, et il paraît bien qu’il exprimait ses propres sentimens pour Mlle Molière lorsque, dans Psyché, il faisait parler à l’Amour le langage délicieusement précieux qui est dans toutes les mémoires. Mais cette déclaration voilée ne suffit pas au poète ; il voulut écrire pour sa déesse une tragédie dont elle jouerait le principal rôle et où il se représenterait-lui-même sous les traits d’un de ces vieillards amoureux qu’il dessinait d’une touche si fière. De là Pulchérie, son avant-dernière pièce, qui, l’on ne sait trop pourquoi, au lieu d’être jouée par la troupe de Molière, parut sur le théâtre du Marais ; pièce étrange, languissante et froide dans l’ensemble, d’une donnée qui fait un peu sourire, mais où se trouvent beaucoup de beaux vers et un caractère original, le vieux sénateur Martian, c’est-à-dire, nous apprend Fontenelle, Corneille lui-même. Le sentiment que l’Amour murmurait avec une espérance passionnée, Martian le gronde avec plus de mélancolie que de résignation ; il met dans son regret de ses jeunes années autant de force et de noblesse que le chevalier romain Laberius exhalant devant César sa plainte fameuse :
Moi qui me figurais que ma caducité
Près de la beauté même étoit en sûreté !
Je m’attachois sans crainte à servir la princesse,
Fier de mes cheveux blancs et fort de ma faiblesse ;
Et, quand je ne pensois qu’à remplir mon devoir,
Je devenois amant sans m’en apercevoir.
Mon âme, de ce feu nonchalamment saisie,
Ne l’a point reconnu que par ma jalousie ;
Tout ce qui l’approchoit vouloit me l’enlever,
Tout ce qui lui parloit cherchoit à m’en priver ;
Je tremblois qu’à leurs yeux elle ne fût trop belle ;
Je les haïssois tous comme plus dignes d’elle,
Et ne pouvois souffrir qu’on s’enrichit d’un bien
Que j’enviois à tous sans y prétendre rien.
Ces beaux vers durent charmer Armande et faire sourire Molière. Il serait imprudent de juger les comédiennes d’après les hommages poétiques qui leur sont consacrés ; mais on sait gré à Armande d’avoir inspiré celui-là et, au sortir de la Fameuse Comédienne, on est quelque peu dédommagé en retrouvant, grâce à Corneille, quelque chose d’elle dans l’idylle héroïque de Psyché, dans une noble scène de Pulchérie.
La réconciliation de Molière et de sa femme était peut-être chose faite lors de Psyché ; en tout cas, elle n’eut pas lieu plus tard que la fin de 1671, entre les Fourberies de Scapin et la Comtesse d’Escarbagnas. Des amis communs, entre autres Chapelle et le marquis de Jonzac, s’y étaient employés avec dévoûment. Vers le milieu de l’année suivante, les deux époux allèrent habiter rue de Richelieu. En s’éloignant de cette maison de la place du Palais-Royal, où il avait longtemps vécu, avec les Béjart et Mlle de Brie, Molière voulait sans doute mettre son foyer à l’abri des causes de discorde qui l’avaient troublé. Il semble que peu de temps après son mariage, il avait déjà pris semblable mesure et s’était installé dans cette même rue de Richelieu, bien inspiré en cela ; mais, on ne sait pour quelle cause, il serait revenu bientôt habiter avec les Béjart. Cette fois, au contraire, il prit toutes les mesures qui annoncent une installation définitive. La demeure commode et vaste qu’il avait choisie, il s’efforça de la rendre agréable à Armande : il y déploya un grand luxe, il y porta des recherches et des attentions d’amoureux, combinant le choix de l’ameublement, la disposition des tentures, l’harmonie des couleurs, la distribution des pièces pour la commodité et l’agrément de sa femme. Quelle différence avec le pauvre et froid petit logis où nous avons vu mourir Madeleine Béjart ! Il semble qu’une seconde lune de miel suivit cette réconciliation, et que le pauvre grand homme connut, du moins, avant de mourir, quatre mois de bonheur intime et de tranquillité. Le 15 septembre 1672, il devenait père pour la troisième fois ; il lui naissait un fils. Courte joie : l’enfant ne vivait que onze jours, précédant son père dans la tombe de quatre mois et demi. Cette réconciliation, en effet, si heureuse en elle-même, devait être funeste à Molière et l’on peut y voir une des causes de sa mort prématurée. Atteint depuis longtemps d’une grave maladie de poitrine, il avait dû se soumettre à un régime sévère, ne vivant que de lait, gardant le silence en dehors de la scène et confiné dans la solitude. Heureux, il se crut guéri, et, ne voulant pas imposer à sa femme la triste société d’un valétudinaire, il se remit à la viande, rouvrit sa maison, reprit son existence d’autrefois. Les suites de ce brusque changement furent une aggravation rapide de son mal et une catastrophe foudroyante : on sait dans quelles circonstances dramatiques, le 17 février 1673, il était surpris par la mort.
Des témoignages que l’on vient de parcourir se dégage sur la conduite et le caractère d’Armande une opinion assez nette pour qu’il ne soit pas nécessaire de l’exposer longuement. C’était une femme très séduisante, mais, comme la plupart des coquettes, égoïste et d’esprit borné quoique vif. Unie trop jeune à un mari trop âgé et d’une sensibilité très vive, elle le fit beaucoup souffrir par une humeur très différente de la sienne ; mais elle dut souffrir autant que lui. C’était, il est vrai, un homme de génie ; avec un jugement plus large, elle aurait rempli près de lui le beau rôle que bien des femmes surent prendre en pareil cas, celui de l’abnégation et du dévoûment. Mais elle n’avait rien de ce qu’il faut pour cela ; elle voulait vivre pour elle-même. De là des froissemens continuels, une irritation croissante, et bientôt la vie commune insupportable, Peut-on dire, cependant, que Molière ne rencontra près d’elle qu’indifférence ? Il serait imprudent de l’affirmer. On trouve, en effet, dans cet Elomire hypocondre, qui n’est pas plus suspect de partialité envers elle qu’envers son mari, une scène que l’on n’a pas assez remarquée et qui donne à penser. Le Boulanger de Chalussay représente Molière tourmenté par ces souffrances imaginaires aussi douloureuses que les maladies les plus certaines et se livrant aux accès de colère futile et violente si communs en pareil cas. Sa femme est près de lui et s’efforce à le calmer ; sincèrement affligée de l’état où elle le voit, elle le raisonne comme un enfant ; si Chalussay lui prête quelques duretés de parole, c’est qu’il en veut à tout ce qui touche Molière et qu’il tient à ne pas représenter sous un aspect trop sympathique la femme de son ennemi. Il semble, cependant, qu’il ne puisse, malgré qu’il en ait, s’empêcher de lui conserver un peu du rôle qu’elle avait dans la réalité.
Reste la conduite. En somme, tout ce que les contemporains d’Armande ont écrit contre elle se trouve faux si on l’examine d’un peu près ; à plus forte raison ce qu’une admiration mal entendue pour, Molière a fait imaginer depuis. Mais prétendre qu’elle fut une épouse irréprochable serait aussi hasardeux qu’affirmer son inconduite. Il n’y a pas, dit-on, de fumée sans feu, et ici la fumée est particulièrement épaisse et noire. Le mieux est de garder une réserve fort sage en pareil cas. On peut, tout au plus, admettre comme l’expression possible de la vérité ces paroles que Grimarest met dans la bouche de Molière : Cette femme, cent fois plus raisonnable que je ne le suis, veut jouir agréablement de la vie ; elle va son chemin ; et, assurée par son innocence, elle dédaigne de s’assujettir aux précautions que je lui demande. Je prends cette négligence pour du mépris ; je voudrais des marques d’amitié pour croire que l’on en a pour moi, et que l’on eût plus de justesse dans sa conduite pour que j’eusse l’esprit tranquille. Mais ma femme, toujours égale et libre dans la sienne, qui seroit exempte de tout soupçon pour tout autre homme moins inquiet que je ne le suis, me laisse impitoyablement dans mes peines ; et, occupée seulement du désir de plaire en général comme toutes les femmes, sans avoir de dessein particulier, elle rit de ma faiblesse. Il y a bien là un air d’arrangement, une insistance maladroite sur la parfaite innocence d’Armande, qui compromettent la cause même que Grimarest veut servir. Mais, en fait, il ne serait pas impossible que ce passage traduisit l’opinion moyenne des contemporains de Molière et que cette opinion fût conforme à la vérité. Ainsi Molière aurait été malheureux surtout de n’être pas aimé, jaloux, mais sans croire à l’infidélité de sa femme, et Armande une coquette aimant plus les manèges de l’amour et les satisfactions de vanité qu’ils procurent que l’amour lui-même. Si ce n’est point là un caractère très sympathique, encore vaut-il mieux que l’Armande de convention.
Du reste, une fois veuve, il semble qu’elle comprit tout à coup la perte qu’elle avait faite et s’efforça de réparer son erreur dans la mesure du possible. Elle porta dignement le deuil de son mari, elle assura le respect de sa mémoire, elle contribua grandement à empêcher la ruine du théâtre qu’il avait fondé, et lorsque enfin elle put songer à elle-même, elle sut, quoiqu’on en ait dit, concilier ce qu’elle devait au grand nom qu’elle avait partagé avec son droit d’arranger son existence à sa guise.
On sait les tristes incidens qui marquèrent les funérailles de Molière. Frappé d’une mort presque subite, il n’avait pu faire la renonciation dont l’église s’assurait toujours avant d’accorder aux comédiens la sépulture religieuse. Il est certain que les souvenirs de Tartufe et de Don Juan, furent pour beaucoup, d’abord, dans le refus du curé de Saint-Eustache, puis dans la mauvaise grâce de l’archevêque à exécuter la volonté de Louis XIV ; mais, en somme, le prélat comme le curé ne faisaient qu’appliquer une règle strictement suivie en pareil cas. La veuve de Molière eut donc à vaincre des résistances d’autant plus fortes qu’elles s’appuyaient sur une prescription formelle et sur une antipathie particulière inspirée au clergé par le défunt. Il faut lui tenir compte de la douleur sincère dont elle donna les marques, de la noblesse de son attitude, de son énergie. Accompagnée du curé d’Auteuil, elle courut à Versailles se jeter aux pieds du roi ; elle supplia, mais avec fierté, avec courage. Non contente de s’écrier : Quoi ! l’on refuse la sépulture à un homme qui, dans la Grèce, eût mérité des autels ! » elle ne craignit pas de dire que « si son mari était criminel, ses crimes avaient été autorisés par Sa Majesté même. C’était logique, mais hardi. Avec ce tact qui était une de ses qualités royales, Louis XIV fit respecter à la fois sa dignité, celle de l’archevêque, Harlay de Chanvalon, fort méprisable comme homme, mais, en somme, son archevêque de Paris, et la justice due à Molière : il congédia la veuve en disant que l’affaire ne dépendait pas de lui et il manda au prélat qu’il fît en sorte d’éviter l’éclat et le scandale.Le soir des funérailles, la foule s’amassait devant la maison mortuaire, non sans doute, comme on le dit habituellement, pour insulter le cercueil : les Parisiens n’ont jamais été de grands rigoristes. Molière les avait beaucoup amusés ; enfin, ils sont presque toujours respectueux devant la mort. Il est à croire qu’ils obéissaient ce soir-là à des sentimens assez mêlés : leur curiosité très vive pour tout ce qui touche au théâtre, la sympathie, enfin, et surtout leur éternel esprit badaud. Grimarest donne clairement à entendre que cette affluence de populaire était inoffensive et que, si la veuve en fut épouvantée, c’est qu’elle ne pouvoit pénétrer son intention. Dans l’incertitude, Armande employa un moyen infaillible de tourner à la bienveillance déclarée des dispositions douteuses : elle fit répandre par les fenêtres un millier de livres en priant avec des termes si touchans le peuple amassé de donner des prières à son mari, qu’il n’y eut personne de ces gens-là qui ne priât Dieu de tout son cœur.Sur la tombe elle fit placer une large pierre, et, deux ou trois ans après, durant un hiver rigoureux, on y alluma par son ordre un grand feu, auquel vinrent se chauffer les pauvres du quartier. Symbole touchant du génie de Molière ; la veuve ne voulait qu’honorer la mémoire de son mari par un acte de bienfaisance, mais la postérité a bien le droit de voir l’allégorie involontaire qui se dégage de cet acte. Ce foyer de chaleur, accessible à tous, et qui semble sortir de la tombe même du poète, n’est-ce pas l’image de son génie, cet autre foyer de raison, de poésie et de gaîté ?
Malgré le coup terrible qui la frappait, la troupe ne fit relâche que six jours ; il n’y avait pas de temps à perdre si elle voulait prouver son intention de survivre. Elle aurait pu se joindre immédiatement à l’hôtel de Bourgogne ; le roi le souhaitait et l’hôtel n’eût pas mieux demandé à, ce moment que d’accueillir le Palais-Royal : une longue rivalité aurait ainsi pris fin. Mais, accepter cette réunion, n’était-ce pas, de la part des camarades de Molière, manquer de respect à la mémoire de leur chef, auquel les grands comédiens avaient fait une guerre acharnée ? S’il devait un jour y avoir réunion, il fallait non pas que l’hôtel absorbât la troupe de Molière, mais qu’il fût absorbé par elle, qu’il y eût là pour les camarades de Montfleury et de Villiers défaite et non victoire. La Grange et Armande parvinrent à réaliser ce projet ; avec Louis XIV et Colbert, ils furent vraiment les fondateurs de la Comédie-Française. Il n’y a pas lieu, pour le moment, de raconter en détail par quels moyens : la part de La Grange y fut trop considérable, et il faudrait mêler à l’histoire d’Armande trop de faits qui regardent plutôt son camarade. Mais, comme lui, elle s’y dévoua tout entière ; elle y engagea une grosse part de sa fortune, elle y déploya une activité méritoire, car, Molière nous l’a dit, elle était naturellement nonchalante. Elle aussi triomphait, lorsqu’une lettre de cachet du 21 octobre 1680 ordonna qu’il n’y aurait plus à Paris qu’un seul théâtre français, le sien.
A cette date, un grand événement avait eu lieu dans l’existence d’Armande : depuis le mois de mai 1677, elle avait échangé le nom glorieux de Molière contre celui, beaucoup plus modeste, de son camarade François Guérin d’Estriché. On lui a reproché ce second mariage avec beaucoup de sévérité. La veuve de Molière se remarier ! On dirait vraiment qu’elle a commis un crime, ou plutôt un sacrilège ; car, depuis tantôt un siècle, Molière est passé dieu. Il faut pourtant tenir compte, en ceci comme en toutes choses, de la différence des temps et des idées. Dans les années qui suivirent sa mort, Molière n’était pas encore regardé comme le génie prodigieux que nous voyons en lui. Sauf pour quelques-uns, comme Boileau, qui mesuraient toute l’étendue de cette perte, ce n’était qu’un très amusant comédien, qu’un excellent auteur, dont on regrettait la mort prématurée, mais dont on ne songeait nullement à faire l’apothéose. Quant à sa veuve, elle ne songeait pas davantage à faire d’elle-même une relique. Elle était jeune encore, plus belle que jamais ; elle n’avait pas été heureuse dans son premier mariage ; la vie lui devait un dédommagement. Ce dédommagement s’offrit à elle sous les espèces d’un fort honnête homme, bien fait, estimé dans son art ; pourquoi aurait-elle joué sans conviction le rôle d’une Andromaque inconsolable ? Soyons indulgens pour elle, en raison même de cette délicatesse morale et de ces scrupules qui nous honorent et qui lui manquaient. D’autant plus qu’elle avait bien besoin d’un homme pour la protéger et mettre fin par sa seule présence à une situation des plus pénibles. Depuis son veuvage, en effet, elle se trouvait en butte à des attaques multipliées. Outre le soin de ses affaires, ses intérêts dans l’exploitation du théâtre, sa situation jalousée dans la troupe, elle avait eu de très graves ennuis. Ç’avait été d’abord son affaire avec un président au parlement de Grenoble, M. de Lescot. Magistrat galant et coureur, ce Lescot était par surcroît, emporté, brutal, capable de toutes les maladresses. Il s’était déjà compromis dans de fâcheuses aventures ; à la suite d’une escapade nocturne, on l’avait trouvé roué de coups et laissé pour mort sur le pavé de Paris. Très épris d’Armande, mais n’osant se déclarer directement, il se servit d’une entremetteuse, la Ledoux. Par une rencontre singulière, celle-ci avait à sa disposition une femme La Tourelle, qui ressemblait à s’y méprendre à Mlle Molière et qui en profitait de façon très lucrative dans l’exercice de son métier, se faisant passer auprès des naïfs ou des ignorans pour la brillante comédienne de la rue Guénégaud. Facilement abusé par les deux femmes, Lescot profita quelque temps en secret de sa prétendue bonne fortune ; il suivait assidûment les représentations d’Armande, mais il gardait sur le théâtre une réserve que La Tourelle lui avait expressément ordonnée. Un soir il n’y tient pas, s’introduit dans la loge d’Armande et se permet des familiarités. Elle s’indigne, il s’emporte ; dans un collier qu’elle portait, il croit en reconnaître un dont il avait fait présent à La Tourelle et il le lui arrache ; la garde arrive au bruit et il est arrêté. Une information judiciaire suivit naturellement, et un arrêt du parlement de Paris, en date du 17 octobre 1675, condamna le président à faire amende honorable devant témoins à Mlle Molière, et les femmes Ledoux et La Tourelle à être fustigées, nues, de verges, au-devant de la principale porte du Châtelet et devant la maison de Mlle Molière ; ce fait, bannies pour trois ans de Paris. On est frappé de l’étrange ressemblance que présente cette affaire avec celle du Collier, qui, en 1785, compromit le nom de Marie-Antoinette. Les mêmes rôles sont repris à cent dix ans de distance, celui d’Armande par la reine, celui de l’entremetteuse Ledoux par la comtesse de La Motte, celui de la femme La Tourelle par la demoiselle Oliva, enfin celui du président Lescot par le cardinal de Rohan. Et pour que rien ne manque au parallèle, de même que la reine fut salie par un infâme libelle publié à Londres par Mme de La Motte, Armande eut à subir la Fameuse Comédienne. Moins d’un an après éclatait un nouveau scandale, plus pénible encore pour la veuve de Molière, le procès Guichard. Ce fut le 16 juillet 1676 que l’ennemi de Lulli lança le factum où elle était si maltraitée. J’ai assez parlé du personnage pour qu’il ne soit pas utile de le présenter à nouveau. Mais les imputations infamantes que nous connaissons déjà n’étaient qu’une faible partie des injures dont il couvrait Armande. Il est impossible de transcrire au long le passage qui la concerne ; quelques lignes feront juger du reste : La Molière, disait-il, est infâme de droit et de fait, c’est-à-dire par sa profession et son inconduite ; avant que d’être mariée, elle a toujours vécu dans une prostitution universelle ; pendant qu’elle a été mariée, elle a toujours vécu dans un adultère public ; enfin, qui dit La Molière dit la plus infâme de toutes les infâmes. L’exagération même de ces injures leur enlève jusqu’à l’apparence du sérieux, d’autant plus que Guichard traite avec la même violence de calomnies sans preuves tous ceux dont il redoute le témoignage. Il était très protégé, semble-t-il, en raison de sa charge d’intendant des bâtimens de Monsieur ; mais il n’y eut pas moyen de lui épargner les conséquences de sa mâle rage. L’accusation d’empoisonnement qui pesait sur lui fut reconnue fondée et, le 27 février 1676, il s’entendit condamner au blâme, à l’amende honorable, à 4,000 livres de dommages-intérêts et 200 livres d’amende ; les imprimeurs de son factum devaient être appréhendés au corps et poursuivis. On remarquera la sévérité avec laquelle la justice frappait à deux reprises deux accusateurs d’Armande. Si elle eût été la femme absolument décriée que disent ses ennemis, aurait-elle obtenu réparation aussi complète ?
On trouvera sans doute que les ennuis suscités à la malheureuse femme par ces deux affaires suffisaient, avec le soin de son théâtre et l’exercice de sa profession, pour l’absorber tout entière et lui enlever tout désir de suivre des intrigues galantes. Aussi n’y a-t-il pas lieu de discuter celles que la Fameuse Comédienne lui prête encore à la même époque. Pouvait-elle, ainsi tourmentée, calomniée, surchargée d’embarras de tout genre, ne pas désirer un protecteur et un appui ? Peut-on, sa situation une fois connue, ne pas reconnaître que la nécessité d’un second mariage s’imposait à elle ? Ce qui prouve bien que, dans le premier, tous les torts n’étaient pas de son côté, c’est que, devenue la femme de Guérin, elle vécut parfaitement heureuse et que sa conduite ne donna plus lieu à aucun bruit fâcheux. L’auteur de la Fameuse Comédienne, lui-même, est obligé de le reconnaître ; il s’empresse, naturellement d’expliquer cette sagesse à sa façon en disant qu’Armande avait trouvé cette fois un maître impérieux et dur ; mais les témoignages désintéressés s’accordent à représenter Guérin comme un excellent homme. Il faut ajouter à l’honneur de l’un et de l’autre que, dans leur ménage, la mémoire de Molière fut entourée non-seulement de respect, mais de vénération. Ce sont les propres termes qu’employait en parlant du premier mari de sa mère, un fils né de leur mariage : en 1698, à peine âgé de vingt ans, ce jeune homme avait imaginé d’achever et de mettre en vers libres la Mélicerte de Molière, et c’est dans la préface de ce travail bien inutile qu’il s’exprimait de cette façon.
Depuis lors, Armande continua sans incidens sa carrière de comédienne, jusqu’à ce qu’elle prit sa retraite, en 1694, à la clôture de Pâques. Le bonheur qu’elle trouvait dans sa nouvelle famille, et aussi la nonchalance naturelle que nous lui connaissons par Molière, l’avaient détachée peu à peu de son art ; elle n’avait encore que cinquante-deux ans, et elle aurait pu briller longtemps encore, à une époque où les comédiennes, même les ingénues et les grandes coquettes, s’éternisaient volontiers dans leur emploi, car, dans un théâtre où un public constant les voyait chaque jour, il ne s’apercevait pas qu’elles vieillissaient. Mais elle s’attachait de plus en plus à son intérieur, où elle vivait très retirée, au fils qu’elle avait eu de Guérin, enfin à une riante maison des champs qu’elle possédait à Meudon et où elle passait tout le temps que lui laissait le théâtre. Cette maison existe encore, au n° 11 de la rue des Pierres, à peu près telle qu’Armande l’a laissée, avec sa porte à plein cintre et ses pavillons dans le style du temps, comme aussi le jardin avec ses allées géométriques, ses charmilles et son berceau de vigne. Elle mourut à Paris, rue de Touraine, le 30 novembre 1700, âgée de cinquante-huit ans. Son acte de décès, ne fait, naturellement, aucune mention de Molière, dont elle ne portait plus le nom : elle n’en reste pas moins pour la postérité, en dépit de ce brave Guérin, la veuve de Molière, celle qui a vécu onze ans près de lui, l’interprète et l’inspiratrice de ses chefs-d’œuvre. Elle le fit souffrir, mais la souffrance est une part de l’inspiration, et, peut-être, sans elle, n’aurions-nous pas le Misanthrope.
La famille Béjart
Famille de Comédiens parisiens issus de Joseph Béjart, sieur de Belleville, huissier audiencier à la grande maîtrise des Eaux et Forêts, et de Marie Hervé. Cinq de leurs dix enfants lient leur destin à celui de la troupe de Molière.
Joseph BÉJART 1616 ou 1617-1659 contribue en 1643 à la création de L’Illustre Théâtre qu’il quitte de 1644 à 1655. Il interprète, en dépit de son bégaiement, les rôles de jeune premier. Pris d’un malaise en jouant Lélie, dans L’Étourdi, il meurt quelques jours plus tard.
Madeleine BÉJART 1618-1672, sœur du précédent, mène une jeunesse assez libre, et a une fille du comte de Modène en 1639, avant de se consacrer au théâtre et de devenir une comédienne accomplie. Un contemporain, G. de Scudéry, fait d’elle ce portrait élogieux : Elle était belle, elle était galante, elle avait beaucoup d’esprit, elle chantait bien ; elle dansait bien ; elle jouait de toute sorte d’instruments ; elle écrivait fort joliment en vers et en prose et sa conversation était fort divertissante. Elle était de plus une des meilleures actrices de son siècle et son récit avait tant de charmes qu’elle inspirait véritablement toutes les feintes passions qu’on lui voyait représenter sur le Théâtre. C’est par amour pour elle, selon Tallemant des réaux, que Molière quitte les bancs de la Sorbonne et qu’ils fondent ensemble en 1643 L’Illustre Théâtre. Il ajoute : Je ne l’ai jamais vu jouer ; mais on dit que c’est la meilleure actrice de toutes …. Son chef-d’œuvre, c’était le personnage d’Épicharis, à qui Néron venait de faire donner la question, dans La Mort de Sénèque, de Tristan L’Hermite. On lui doit, en outre, une adaptation du Don Quichotte de Guérin de Bouscal. Dans le registre comique, elle joue d’abord le rôle de Marinette dans Le Dépit amoureux, de Magdelon, dans Les Précieuses ridicules, celui de la Nymphe, dans le prologue des Fâcheux, puis elle s’oriente vers les emplois de servante, telle Dorine, dans Le Tartuffe, ou de femme d’intrigue, comme Frosine dans L’Avare.
Geneviève BÉJART 1624-1675, sœur des précédents, est beaucoup plus effacée dans la troupe de L’Illustre Théâtre qu’elle a contribué pourtant à fonder, jouant les confidentes et les utilités sous le nom de sa mère, Mlle Hervé.
Louis BÉJART, dit l’Éguisé 1630-1678, frère des précédents, fait partie de la troupe, non pas au début, mais au moins depuis le moment où elle obtient le Théâtre du Petit-Bourbon, en 1658. Il boite, et cela contribue sans doute à le cantonner dans les emplois secondaires de vieillards ou de valets, comme celui de La Flêche, dans L’Avare, dont Harpagon dit, faisant allusion à sa disgrâce : ce chien de boiteux-là. En 1670, il devient officier au régiment de La Ferté.
Armande BÉJART 1640 ou 1642-1700, sœur ou fille de Madeleine, de vingt ans sa cadette, joue dès 1653 les rôles d’enfant sous le nom de Mlle Menou, avant de devenir l’épouse de Molière le 20 février 1662. Les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne, dans leur lutte contre la troupe de Molière, médisent de ce mariage, accusant le dramaturge d’avoir épousé sa propre fille, ce qui est sans fondement. De cette union naissent trois enfants dont une seule, Esprit-Madeleine, survivra à son père.
Armande, qui semble, d’après les contemporains, plus gracieuse que belle, est coquette et fort courtisée, mais ses prétendues infidélités n’ont jamais été établies. Elle crée généralement les premiers rôles féminins tels que celui d’Elmire, dans Le Tartuffe, d’Angélique, dans Le Malade imaginaire, probablement celui de Célimène, dans Le Misanthrope, de Lucile, dans Le Bourgeois gentilhomme, et d’Henriette, dans Les Femmes savantes ; mais elle joue également les rôles tragiques, Cléophile, dans Alexandre de Racine, Flavie dans Attila, et Bérénice dans Tite et Bérénice de Corneille.
Après la mort de Molière, elle veille avec La Grange à la survie de l’œuvre du poète et épouse en secondes noces Isaac François Guérin d’Estriché, lui-même comédien du Marais. Elle joue à l’Hôtel Guénégaud et à la Comédie-Française jusqu’à sa retraite, en 1694, les rôles que Molière a écrits pour elle.
Liens
http://youtu.be/A6OZd8HXHIg La maison de Armande Béjart
http://www.ina.fr/video/CPF03001362/m ... iage-d-armande-video.html Le mariage d'Armande
http://www.ina.fr/video/CPF03001383/m ... ort-de-moliere-video.html La mort de Molière
     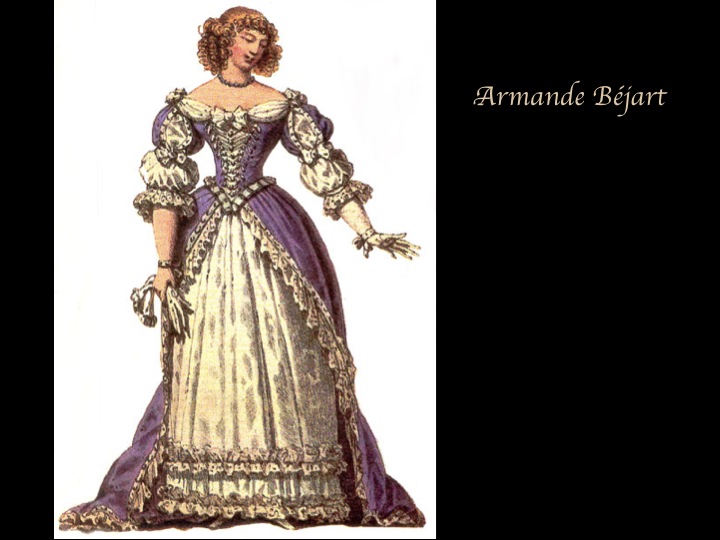         
Posté le : 29/11/2014 21:06
|
|
|
|
|
Boris Karloff |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 23 novembre 1887 naît William Henry Pratt, dit Boris Karloff

à Dulwich, Londres en Angleterre, acteur britannique né à Dulwich, près de Londres le 23 novembre 1887, mort, à 81 ans le 2 février 1969 à Midhurst (Sussex).Ses films les plus notables sont, Frankenstein, La Fiancée de Frankenstein, Le Fils de Frankenstein, La Momie
Il était le petit-neveu d’Anna Leonowens, préceptrice des enfants du roi de Siam
Célèbre acteur de films d'épouvante et fantastiques américains, il joua dans de nombreux films, mais c'est le rôle de la créature de Frankenstein qui le rend célèbre en 1931, dans le film du même nom réalisé par James Whale. Acteur définitivement marqué par ce personnage hors normes auquel un visage anguleux et sévère convenait parfaitement, presque toute sa carrière sera consacrée aux personnages inquiétants, parfois dotés de pouvoirs surnaturels ou maléfiques. Dans cette perspective, il interprétera un nombre impressionnant de docteurs et professeurs aux pratiques bien peu conventionnelles.
Sa vie
L'acteur américain Boris Karloff se confond incontestablement avec la figure mythique de la créature de Frankenstein, même s'il désespéra durant toute sa carrière d'échapper à cette image et aux films d'horreur qu'il prisait médiocrement.
William Henry Pratt est né dans la banlieue de Londres, à Dulwich, le 23 novembre 1887. Promis à une carrière de fonctionnaire d'ambassade, il émigre au Canada en 1909, où il se sent attiré pour le théâtre : une excellente mémoire et un physique peu commun, aux traits durs, le servent. Il parcourt le Canada puis les États-Unis durant cinq ans et, comédien consciencieux, voit ses rôles prendre de l'importance. À partir de 1916, il apparaît dans une cinquantaine de films muets. On le remarque dans un rôle de gangster en 1931, dans Code criminel, d'Howard Hawks, qui lui donnera en 1932 le rôle de Gaffney dans Scarface. En 1931, James Whale le choisit pour interpréter la créature d'un film fantastique d'un genre inédit, Frankenstein. Son nom ne figure pas au générique et son visage disparaît derrière le masque fabriqué avec talent par le maquilleur Jack Pierce. Pourtant, c'est la créature que plébiscite le public. Certes, le travail de Pierce allie la laideur à une certaine beauté, mais derrière ce faciès, Karloff laisse transparaître l'humanité tragique, la douleur muette du personnage imaginé par Mary Shelley, comme dans les deux seules autres versions de la saga où il interpréta le rôle, La Fiancée de Frankenstein, J. Whale, 1935 et Le Fils de Frankenstein, Rowland V. Lee, 1939. En 1945, on le retrouve dans La Maison de Frankenstein, Erle C. Kenton, honteuse dégradation du mythe où il devient un délirant successeur du fameux docteur affronté au comte Dracula ressuscité par inadvertance... La trajectoire s'achève sur une inversion majeure : Karloff devient le baron Frankenstein lui-même dans le très médiocre Frankenstein 1970, Howard W. Koch, 1958.
Dans le même registre, il est le héros monstrueux de La Momie, Karl Freund, 1932, du Fantôme vivant, T. Hayes Hunter, 1933, du Mort qui marche, Michael Curtiz, 1936, mais il interprète aussi de nombreux rôles de savants fous, ou que leurs recherches perturbent physiquement ou intellectuellement : Cerveaux de rechange, Robert Stevenson, 1936, Vendredi 13, Arthur Lubin, 1940, The Devil Commands, Edward Dmytryck, 1941, The Climax, George Wagner, 1941 entre autres. Savant et créature ne sont que les deux faces d'un même personnage, le savant fou devenant monstrueux à son tour. On retrouve ici le thème du Dr Jekyll et Mr Hyde, rôle qu'il interpréta aux côtés des comiques Abott et Costello dans Deux Nigauds contre Dr Jekyll et Mr Hyde, Charles Lamont, 1953, une des pires parodies dans les quelles on retrouve Karloff dans les années 1940 et 1950, où il joue parfois les utilités, chef indien dans les Conquérants d'un nouveau monde, de Cecil B. DeMille, 1947. Mais il excelle dans un rôle à la Jekyll et Hyde dans le remarquable Baron Gregor, R. W. Neill, 1935.
Ce dédoublement se retrouve dans les films où il joue en tandem avec son rival Bela Lugosi, qui, selon certaines sources, refusa le rôle de Frankenstein. Dans Le Chat noir, Edgar G. Ulmer, 1934, Le Corbeau, Louis Fridlandler, 1935, d'après Edgar Poe, Le Rayon invisible, Lambert Hillyer, 1936, Le Fils de Frankenstein, Vendredi 13 et Le Voleur de cadavres, Robert Wise, 1945, la force animale extériorisée et destructrice de Karloff s'oppose à celle, autodestructrice, qui détruit le personnage de Lugosi.
Dans les années 1960, il retrouve des rôles de qualité, souvent marqués par l'humour, comme dans Le Corbeau, Roger Corman, 1963, A Comedy of Terrors, Jacques Tourneur, 1964 ou Les Trois Visages de la peur Mario Bava, 1964. Il achève sa carrière, avant de mourir en 1969, en jouant son propre rôle – un vieil acteur lassé des rôles fantastiques – dans le premier film de Peter Bogdanovitch, La Cible, 1968.
Il incarna ce personnage également dans deux suites :
La Fiancée de Frankenstein 1935 ;
Le Fils de Frankenstein 1939.
Il se fit aussi remarquer par ses talents d'acteur dramatique, notamment au théâtre dans la pièce Arsenic et vieilles dentelles de Joseph Kesselring. Il retrouve dans les années 1950 un certain succès avec le rôle du colonel March, sur le grand écran puis à la télévision. Un de ses derniers rôles, en 1966, fut celui d'une grand-mère excentrique mother muffin dans la série Annie, agent très spécial aux côtés de Robert Vaughn Napoléon Solo et Stefanie Powers. Cette même année,il joua également le rôle du Maharadjah de Karapur Mr Singh dans l'épisode 2 de la deuxième saison des Mystères de l'Ouest La Nuit du Cobra d'Or. Il tourna dans environ 166 films qui, à l'en croire, ne lui ont apporté que peu de satisfactions d'acteur.
Filmographie
Années 1910
1919 : The Lightning Raider
1919 : The Masked Rider : Mexicain au saloon
1919 : Sa Majesté Douglas His Majesty, the American)de Joseph Henabery : L'espion
1919 : The Prince and Betty, de Robert Thornby : Rôle indéterminé
Années 1920
1920 : The Deadlier Sex : Jules Borney
1920 : The Courage of Marge O'Doone : Tavish
1920 : Le Dernier des Mohicans The Last of the Mohicans, de Clarence Brown et Maurice Tourneur : Indien
1921 : The Hope Diamond Mystery : Priest of Kama-Sita / Dakar
1921 : Without Benefit of Clergy : Ahmed Khan
1921 : Cheated Hearts : Nei Hamid
1921 : The Cave Girl : Baptiste
1922 : Nan of the North : Rôle indéterminé
1922 : The Infidel : The Nabob
1922 : The Man from Downing Street : Maharajah Jehan
1922 : The Altar Stairs : Hugo
1922 : The Woman Conquers : Raoul Maris
1922 : Omar the Tentmaker : Imam Mowaffak
1923 : The Gentleman from America : Petit rôle
1923 : The Prisoner : Prince Kapolski
1924 : The Hellion : The Outlaw
1924 : Riders of the Plains
1924 : Dynamite Dan : Tony Garcia
1925 : Forbidden Cargo : Pietro Castillano
1925 : The Prairie Wife : Diego
1925 : Nuits parisiennes Parisian Nights : Pierre
1925 : Lady Robinhood : Cabraza
1925 : La Frontière humaine Never the Twain Shall Meet, de Maurice Tourneur : Petit rôle
1925 : Perils of the Wild
1926 : The Greater Glory : Scissors Grinder
1926 : The Man in the Saddle : Robber
1926 : Her Honor, the Governor : Snipe Collins
1926 : The Bells : Le Magnétiseur
1926 : The Golden Web : Dave Sinclair
1926 : Flames : Blackie Blanchette
1926 : Le Corsaire masqué The Eagle of the Sea, de Frank Lloyd : Pirate
1926 : The Nickel-Hopper de F. Richard Jones : Dance Hall Masher
1926 : Flaming Fury : Gaspard
1926 : Old Ironsides de James Cruze : A Saracen Guard
1926 : Valencia : Bit
1927 : Let It Rain : Crook
1927 : The Princess from Hoboken d'Allan Dale : Pavel
1927 : Tarzan and the Golden Lion : Owaza
1927 : The Meddlin' Stranger, de Richard Thorpe : Al Meggs
1927 : The Phantom Buster : Ramon
1927 : Soft Cushions : Le chef des conspirateurs
1927 : Two Arabian Knights de Lewis Milestone : le commissaire de bord
1927 : The Love Mart : Fleming
1928 : Sharp Shooters : Cafe Proprietor
1928 : The Vanishing Rider : The Villain
1928 : Vultures of the Sea, de Richard Thorpe : Grouchy
1928 : The Little Wild Girl : Maurice Kent
1929 : Burning the Wind : Pug Doran
1929 : The Fatal Warning, de Richard Thorpe : Mullins
1929 : The Devil's Chaplain : Boris
1929 : Two Sisters : Cecil
1929 : Anne Against the World
1929 : The Phantom of the North : Jules Gregg
1929 : Behind That Curtain : le valet de Beetham
1929 : The King of the Kongo, de Richard Thorpe : Scarface Macklin
1929 : Le Spectre vert (The Unholy Night) : Abdul, l'avocat
Années 1930
1930 : The Bad One : Monsieur Gaston
1930 : The Sea Bat : Corsican
1930 : The Utah Kid, de Richard Thorpe : Henchman Baxter
1931 : Sous les verrous : Le Tigre
1931 : Le Code criminel The Criminal Code de Howard Hawks : Ned Galloway
1931 : King of the Wild, de B. Reeves Eason et Richard Thorpe : Mustapha
1931 : Cracked Nuts : Boris, Premier Révolutionnaire
1931 : The Vanishing Legion : voix
1931 : Young Donovan's Kid : Cokey Joe
1931 : Smart Money : Sport Williams
1931 : The Public Defender : Professor
1931 : I Like Your Nerve de William C. McGann : Luigi, Majordome de Pacheco
1931 : Graft : Joe Terry
1931 : Five Star Final de Mervyn LeRoy : Rev. T. Vernon Isopod
1931 : Le Passeport jaune The Yellow Ticket de Raoul Walsh : Orderly
1931 : Le Génie fou The Mad Genius, de Michael Curtiz : Le père de Fedor
1931 : The Guilty Generation : Tony Ricca
1931 : Frankenstein de James Whale : Le monstre
1931 : Cette nuit ou jamais Tonight or Never : Serveur
1932 : Behind the Mask : Jim Henderson
1932 : Business and Pleasure : Sheik
1932 : Scarface de Howard Hawks : Gaffney
1932 : The Miracle Man : Nikko
1932 : Night World : 'Happy' MacDonald
1932 : Une soirée étrange The Old Dark House de James Whale : Morgan
1932 : Le Masque d'or The Mask of Fu Manchu de Charles Brabin : Dr Fu Manchu
1932 : La Momie The Mummy, de Karl Freund : Im-ho-tep, alias Ardath Bey
1933 : Le Fantôme vivant The Ghoul, de T. Hayes Hunter : Prof. Morlant
1934 : La Patrouille perdue The Lost Patrol, de John Ford : Sanders
1934 : La Maison des Rothschild The House of Rothschild, d'Alfred L. Werker : Comte Ledrantz
1934 : Le Chat noir The Black Cat, d'Edgar G. Ulmer : Hjalmar Poelzig
1934 : Gift of Gab : Cameo
1935 : La Fiancée de Frankenstein Bride of Frankenstein, de James Whale : Le monstre
1935 : Le Corbeau The Raven, de Lew Landers : Edmond Bateman
1935 : The Black Room : baron Gregor de Bergmann / Anton de Bergmann
1936 : Le Rayon invisible The Invisible Ray, de Lambert Hillyer : Dr Janos Rukh
1936 : Le Mort qui marche The Walking Dead, de Michael Curtiz : John Ellman
1936 : Juggernaut : Dr Victor Sartorius
1936 : Cerveaux de rechange The Man Who Changed His Mind ou The Man Who Lived Again, de Robert Stevenson : Dr Laurience
1936 : Charlie Chan à l'Opéra Charlie Chan at the Opera, de H. Bruce Humberstone : Gravelle
1937 : Alerte la nuit Night Key, de Lloyd Corrigan : David Mallory
1937 : À l'est de Shanghaï West of Shanghai, de John Farrow : Gen. Wu Yen Fang
1938 : The Invisible Menace, de John Farrow : Mr. Jevries, dit Dolman
1938 : Mr. Wong, Detective : Mr. James Lee Wong
1939 : Devil's Island : Dr Charles Gaudet
1939 : Le Fils de Frankenstein Son of Frankenstein, de Rowland V. Lee : Le monstre
1939 : The Mystery of Mr. Wong : James Lee Wong
1939 : Mr. Wong in Chinatown : Mr. James Lee Wong
1939 : The Man They Could Not Hang : Dr Henryk Savaard
1939 : La Tour de Londres Tower of London, de Rowland V. Lee : Mord
Années 1940
Cinéma
1940 : The Fatal Hour : James Lee Wong
1940 : British Intelligence Service British Intelligence : Valdar, dit Karl Schiller
1940 : Vendredi 13 Black Friday, d'Arthur Lubin : Dr Ernest Sovac
1940 : The Man with Nine Lives : Dr Leon Kravaal
1940 : Doomed to Die : James Lee Wong
1940 : Before I Hang : Dr John Garth
1940 : Le Singe tueur The Ape, de William Nigh : Dr Bernard Adrian
1940 : You'll Find Out : Juge Spencer Mainwaring
1941 : The Devil Commands, d'Edward Dmytryk : Dr Julian Blair
1942 : The Boogie Man Will Get You : Prof. Nathaniel Billings
1944 : La Passion du Docteur Holmes The Climax, de George Waggner : Dr Friedrich Hohner
1944 : La Maison de Frankenstein House of Frankenstein, d'Erle C. Kenton : Dr Niemann
1945 : Le Récupérateur de cadavres The body snatcher, de Robert Wise : Cabman John Gray
1945 : L'Île des morts Isle of the Dead, de Mark Robson : Gen. Nikolas Pherides
1946 : Bedlam, de Mark Robson : Maître George Sims
1947 : La Vie secrète de Walter Mitty The Secret Life of Walter Mitty, de Norman Z. McLeod : Dr Hugo Hollingshead
1947 : Des filles disparaissent Lured, de Douglas Sirk : Charles van Druten
1947 : Les Conquérants d'un nouveau monde (Unconquered), de Cecil B. DeMille : Chef Guyasuta
1947 : Dick Tracy contre le gang (Dick Tracy Meets Gruesome), de John Rawlins : Gruesome
1948 : Le Sang de la terre Taps Roots, de George Marshall : Tishomingo
1949 : Cisaruv slavík : Narrator, U.S. version voix
1949 : Deux nigauds chez les tueurs Abbott and Costello Meet the Killer, Boris Karloff), de Charles Barton : Swami Talpur
Théâtre
1941 à 1944 : Arsenic et vieilles dentelles de Joseph Kesselring, Fulton Theatre, Hudson Theatre
1948 : The Linden Tree de J.B. Priestley, Music box theatre
Années 1950
Cinéma
1951 : Le Château de la terreur The Strange Door, de Joseph Pevney : Voltan
1952 : Colonel March Investigates : Col. March
1952 : Le Mystère du Château noir The Black Castle, de Nathan Juran : Dr Meissen
1953 : Deux nigauds contre le Dr Jekyll et Mr Hyde Abbott and Costello Meet Dr Jekyll and Mr. Hyde, de Charles Lamont : Dr Henry Jekyll / Mr. Hyde
1954 : Il Mostro dell'isola : Don Gaetano
1954 : Sabaka : Gen. Pollegar
1957 : Voodoo Island, de Reginald Le Borg : Phillip Knight
1958 : The Juggler of Our Lady : Narrateur
1958 : Grip of the Strangler : James Rankin
1958 : Frankenstein - 1970 : Baron Victor von Frankenstein
1958 : Corridors of Blood : Dr Thomas Bolton
Télévision
1951 : Tales of Tomorrow série
1954-1956 : les aventures du Colonel March : Colonel Perceval March (série, 21 épisodes)
1955 : A Connecticut Yankee : Roi Arthur
Théâtre
1950 : Peter Pan, comédie musicale, musique Léonard Bernstein avec Jean Arthur
Années 1960
Cinéma
1963 : Le Corbeau The Raven, de Roger Corman : Dr Scarabus
1963 : L'Halluciné The Terror, de Roger Corman : Baron Victor Frederick Von Leppe
1963 : Les Trois Visages de la peur I Tre volti della paura, de Mario Bava : Gorca segment The Wurdalak
1964 : Le croque-mort s'en mêle The Comedy of Terrors de Jacques Tourneur : Amos Hinchley
1964 : Bikini Beach, de William Asher : The Art Dealer
1965 : Le Messager du diable Die, Monster, Die! : Nahum Witley
1966 : The Ghost in the Invisible Bikini : The Corpse Hiram Stokely
1966 : The Daydreamer : The Rat voix
1967 : The Venetian Affair : Dr Pierre Vaugiroud
1967 : La Créature invisible The Sorcerers, de Michael Reeves : Prof. Marcus Monserrat
1968 : Macabre sérénade House of Evil : Matthias Morteval
1968 : Curse of the Crimson Altar : Prof. John Marshe
1968 : La Cible Targets, de Peter Bogdanovich : Byron Orlok
1969 : Mad Monster Party? : Baron Boris von Frankenstein voix
Télévision
1960 : The Secret World of Eddie Hodges : Capitaine Hook
1960 : Thriller : présentateur
1962 : Le Procès Paradine The Paradine Case : Juge Lord Thomas Horfield
1966 : Le Grincheux qui voulait gâcher Noël! How the Grinch Stole Christmas! : Narrateur / Le Grinch
1966 : Les Mystères de l'Ouest The Wild Wild West, série - Saison 2 épisode 2, La Nuit du Cobra d'Or The Night of the Golden Cobra, de Irving J. Moore : Mr. Singh
Années 1970
Filmographie posthume
1970 : Le Collectionneur de cadavres El Coleccionista de cadáveres, de Santos Alcover : Charles Badulescu
1971 : La Muerte viviente : Carl van Molder / Damballah
1971 : The Incredible Invasion : Prof. John Mayer
1972 : The Fear Chamber : Dr Carl Mandel
La Fiancée de Frankenstein
Vie privée
Boris Karloff s'est marié cinq fois dans sa vie: En 1912 avec Olive de Wilton actrice, en 1920 avec Montana Laurena Williams musicienne, en 1924 avec Helene Vivian Soulee danseuse, en 1930 avec Dorothy Stein libraire et en 1946 avec Evelyn Hope Helmore (éditeur de scénarios.
Liens
http://www.ina.fr/video/I07355131/int ... euxieme-partie-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC95001563/m ... y-frankenstein-video.html Frankenstein
http://youtu.be/0jSEegTiEUE Thriller avec Boris Karloff
http://youtu.be/eEw-dlHK4vg This is your life avec Boris Karloff, émission américaine, (anglais)
http://youtu.be/BN8K-4osNb0 B Karloff dans frankenstein
http://youtu.be/BUI0ES4zBuc Frankenstein remake français
    [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Frankenstein's_monster_(Boris_Karloff).jpg[/img]   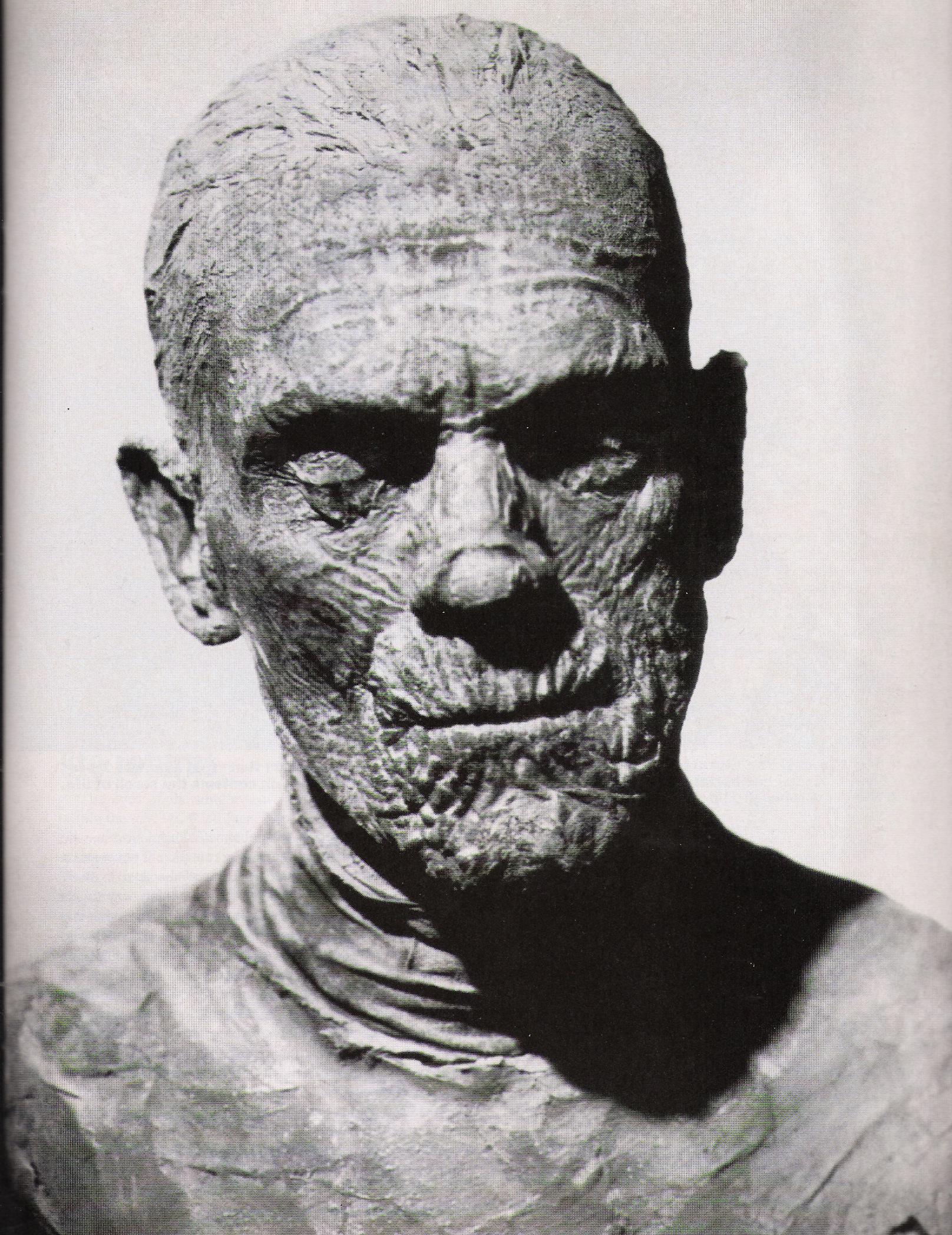  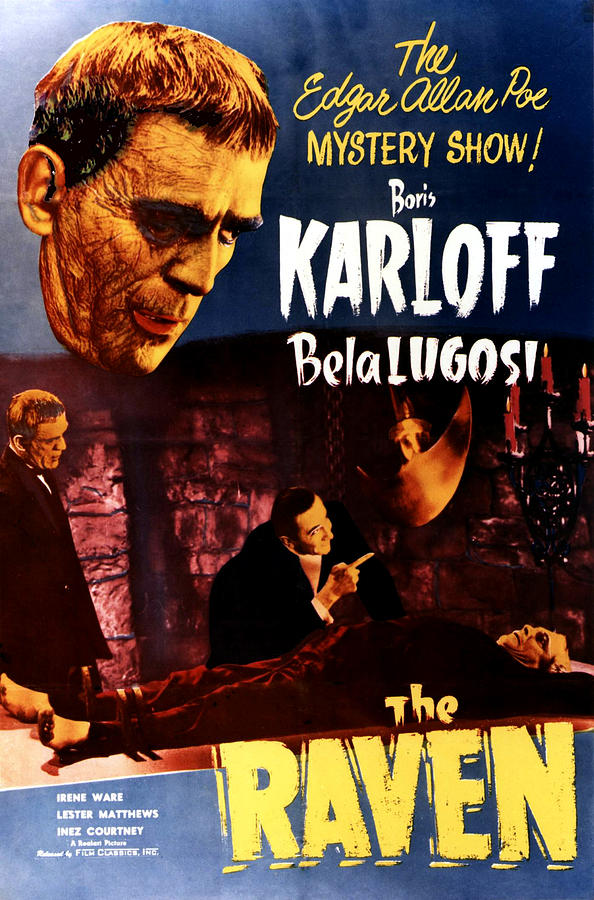 [img width=600]http://postalmuseum.si.edu/artofthestamp/subpage%20table%20images/artwork/arts/Boris%20Karloff%20as%20Frankenstein's%20Monster/BIGfrankenstein.jpg[/img] 
Posté le : 22/11/2014 21:32
|
|
|
|
|
l'Unesco |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 novembre 1945 est crée l'UNESCO 
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Unesco ou UNESCO institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies.
sigle de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, en français Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
Institution spécialisée de l'O.N.U., créée le 16 novembre 1945 à la suite de la réunion à Londres des représentants de 44 pays, en vue de la rédaction de son acte constitutif ratifié le 4 novembre 1946.
L'Unesco a pour but, notamment, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales en resserrant par l'éducation, la science, la culture et la communication la collaboration entre nations afin d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Singapour s'est retiré de l'Unesco en 1985. Les États-Unis ont délaissé l'organisation de 1984 à 2003, la Grande-Bretagne de 1985 à 1997.
Le siège de l'Unesco, à Paris, est un ensemble de cinq bâtiments construits entre 1955 et 1970 par B. Zehrfuss (en collaborationavec M. Breuer et P. L. Nervi pour les deux premiers. À leur décoration ont participé Picasso, Miró et Artigas, Arp, Moore, Calder, Bazaine, Tamavo, Soto, etc., ainsi que Noguchi jardin japonais et Burle Marx patios-jardins..
Rôle
Elle a pour objectif selon son acte constitutif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples.
Le siège de l'Unesco est situé à Paris France, au 7/9 place de Fontenoy, dans le 7e arrondissement. Sont rattachés au siège plus de cinquante bureaux, plusieurs instituts et centres dans le monde entier, comme l’Institut de statistique à Montréal ou le Bureau international d'éducation à Genève.
L'Organisation compte 195 États membres en 2014.
L'Unesco poursuit son action à travers cinq grands programmes : l’éducation, les sciences exactes, naturelles, sociales et humaines, la culture, la communication et l’information.
Des périodiques spécialisés sont publiés comme le Bulletin du droit d’auteur, Perspectives pédagogie, la Revue internationale des sciences sociales, Museum muséographie.
L'Unesco anime la Décennie internationale pour la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde 2001-2010 proclamée par l’ONU en 1999.
Éducation
Les missions pour l’éducation de l’Unesco sont :
conduire au niveau international l’édification de structures permettant à toutes les populations d’accéder à l’éducation ;
offrir une expertise et encourager les partenariats afin de renforcer le leadership de l’éducation au niveau national ainsi que la capacité des pays à offrir une éducation de qualité à tous ;
l’Unesco pousse les États et la communauté internationale à accélérer la marche du progrès vers la réalisation de ces objectifs ;
l’organisation facilite la mise en place de partenariats et mesure les progrès accomplis.
Sciences naturelles
L'Unesco abrite la Commission océanographique intergouvernementale, organe de coordination scientifique.
Dans le cadre du programme MAB Man and Biosphere a établi un réseau de réserves de biosphères qui se propose de protéger la nature, tout en préservant l’activité humaine sur toute la planète.
Sciences humaines et sociales
En agissant dans l’un des cinq secteurs spécialisés de l’Unesco : éducation, sciences naturelles, sciences sociales et humaines, culture ainsi que communication et information , la mission est de faire avancer les connaissances, les normes et la coopération intellectuelle afin de faciliter les transformations sociales porteuses des valeurs universelles de justice, de liberté et de dignité humaine.
Culture
Logo du Patrimoine mondial de l'Unesco.
La collection Unesco d'œuvres représentatives est un projet de traduction de l'Unesco qui a été actif de 1948 à 2005.
L'Unesco est connue depuis 1972 pour sa liste du patrimoine mondial pour le patrimoine matériel, culturel et naturel. Une liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité existe également depuis 2001.
L'Unesco a aussi adopté la Déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle en 2001 pour promouvoir la diversité culturelle.
La Bibliothèque numérique mondiale est une bibliothèque numérique lancée par l'Unesco et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis opérationnelle depuis le 21 avril 2009.
Communication et information
L'Unesco a également créé en 1992 le programme Mémoire du monde, visant à sensibiliser la communauté internationale à la richesse du patrimoine documentaire, à la nécessité d’assurer sa conservation pour les générations futures et à le rendre accessible à un large public. Il s’est doté pour cela d’un Registre mondial, liste des éléments du patrimoine documentaire identifiés par le Comité consultatif international CCI et approuvés par le directeur général de l'Unesco.
L'Unesco est par ailleurs, à l’origine de la création, en mai 1994, conjointement avec l’Université du Québec à Montréal, du réseau Orbicom, réseau mondial associant des universitaires et des professionnels de la communication et des médias, ayant pour objet de stimuler l’échange d’informations et le développement de projets conjoints, afin d’examiner comment ce domaine en constante évolution peut contribuer à promouvoir la démocratie et un développement durable. Situé au carrefour de l’enseignement, de la recherche et des pratiques professionnelles, il s’est fixé pour mission première de développer et promouvoir le partage de savoir et d’expertise en communication par l’éducation, la recherche et l’action concrète. Reliant les spécialistes à travers le monde qui travaillent dans différents secteurs des communications, et soutenu par des institutions internationales, des médias, des gouvernements et des entreprises, il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la communication de l'Unesco, adoptée à l’unanimité lors de la Conférence générale de 1989.
Historique
L'Unesco et son mandat pour la coopération intellectuelle sur le plan international ont leurs racines dans la décision de la Société des Nations du 21 septembre 1921 d'élire une commission chargée d'étudier la question. Cette Commission internationale de coopération intellectuelle CICI, située à Genève, a été créée le 4 janvier 1922 comme un organe consultatif composé de personnalités élues pour leurs compétences personnelles. L'Institut international de coopération intellectuelle IICI a été établi à Paris le 9 août 1925 comme l'agence exécutive de la CICI. Le 18 décembre 1925, le Bureau International d'Éducation BIE a commencé son action comme organisation non-gouvernementale au service du développement international dans le domaine éducatif. Néanmoins, le travail de ces prédécesseurs de l'Unesco, a été interrompu par la Seconde Guerre mondiale.
À la suite des signatures de la Charte de l'Atlantique et de la Déclaration des Nations unies, la Conférence des Ministres alliés de l'éducation CAME a commencé à se réunir à Londres, du 16 novembre 1942 au 5 décembre 1945. Le 30 octobre 1943, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS ont exprimé la nécessité d'une organisation internationale dans la Déclaration de Moscou. Cela a été suivi par les propositions du 9 octobre 1944 lors de la Conférence de Dumbarton Oaks. À partir de la proposition de la CAME et conformément aux recommandations de la Conférence de San-Francisco, tenu entre avril-juin 1945, la Conférence des Nations unies pour l'établissement d'une organisation éducative et culturelle ECO/CONF a été convoquée à Londres du 1er au 16 novembre 1945. Elle a rassemblé les représentants de 44 états. Pendant l'ECO/CONF, l'Acte constitutif de l'Unesco a été introduit et signé par 37 états, et une Commission préparatoire a été également établie. La Commission préparatoire a effectué son travail du 16 novembre 1945 au 4 novembre 1945 - jour où l'Acte constitutif entra en vigueur avec le dépôt de la vingtième ratification d'un état membre.
Tenue entre le 19 novembre et le 10 décembre 1946, la première Conférence générale a élu le docteur Julian Huxley au poste de Directeur général de l'Organisation. En novembre 1954, la Conférence générale a amendé l'Acte constitutif de l'Organisation en décidant que les membres du Conseil devraient désormais représenter des gouvernements de leur état. Ce changement de gouvernance a distingué l'Unesco de son précurseur, la CICI compte tenu de la collaboration des États dans les domaines de compétence de l’Unesco. À mesure que les États membres coopéraient pour réaliser le mandat de l'Unesco, des évènements historique et politique ont influencé les activités de l'Organisation, notamment lors les périodes de la guerre froide, de la décolonisation, et de la dissolution de l’URSS.
Parmi les réalisations notables de l'Organisation, on peut citer son travail de lutte contre le racisme. Ainsi, les déclarations autour de la question raciale, notamment celle des anthropologues datant de 1950, parmi lesquels figure Claude Lévi-Strauss et la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux de 1978. Estimant quelques publications de l'Unesco comme une ingérence dans les problèmes raciaux du pays, la République d'Afrique du Sud a quitté l'Organisation en 1956, avant de revenir, sous la direction de Nelson Mandela, en 1994.
Le projet de l'éducation de base dans la vallée de Marbial en Haïti est un exemple du travail que l'Unesco mène à ses débuts dans le secteur de l'éducation. Amorcé en 1947, ce projet a été suivi par les missions d'experts dans d'autres pays, comme l'Afghanistan en 1949. En 1948, l'Unesco a proposé aux États membres d'instituer un enseignement primaire obligatoire, gratuit et universel. En 1990, la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous, à Jomtien en Thaïlande, a lancé un mouvement global afin de fournir une éducation de base pour tous, enfants, jeunes et adultes. Dix ans plus tard, lors du Forum mondial sur l'éducation à Dakar, les gouvernements se fixent jusqu'à 2015 pour s'engager à l'éducation de base pour tous.
Dans le domaine de la culture, l'Unesco à ses débuts a lancé la Campagne de Nubie en 1960. Le but de cette Campagne était de déplacer le Temple Abou Simbel pour le sauver des eaux montantes du Nil après la construction du barrage d'Aswan. Pendant cette Campagne de 20 ans, 22 monuments et complexes architecturaux ont été déplacés. Elle était la première campagne, et la plus importante, d’une longue série, parmi lesquelles celles de Moenjodaro Pakistan, Fès Maroc, Katmandou Népal, Borobudur Indonésie et l’Acropole d’Athènes Grèce. Le travail de l'Unesco dans le domaine du patrimoine a abouti à l'adoption en 1972 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Le Comité du patrimoine mondial est créé en 1976 et les premiers sites sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1978. Depuis lors, quelque instruments juridiques internationaux ont été adoptés par les États membres de l'Unesco en 2003 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et en 200, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
En décembre 1951, une réunion intergouvernementale qui s'est tenue à l'Unesco, a mené à la création du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire CERN. Le CERN a notamment permis la création en 1989 du World Wide Web.
Dans le domaine des sciences naturelles, l'Unesco a initié très tôt un projet majeur concernant la zone aride. En 1968, l'Unesco organisa la première conférence intergouvernementale visant à la réconciliation de l'environnement et du développement, questions toujours d'actualité dans le domaine du développement durable. Le principal résultat de la conférence a été la création du Programme sur l'homme et la biosphère.
Dans le domaine de la communication, la libre circulation de l'information reste une priorité de l'Unesco depuis ses débuts. Lors de l’immédiat après-guerre, les activités de l'Unesco ont été concentrées sur la reconstitution et les besoins des moyens de communication de masse partout dans le monde. L'Unesco a commencé à organiser la formation et l'éducation pour les journalistes à partir des années 1950. Afin de répondre aux exigences d'un Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication à la fin des années 1970, Unesco a établi la Commission internationale d'étude des problèmes de la communication qui a abouti au rapport MacBride, du nom du Président de la Commission et lauréat du Prix Nobel de la paix Seán MacBride. Après ce rapport, l’Unesco a introduit les programmes La Société de l'information pour tous et Vers les sociétés du savoi, en anticipant les questions des Sommets mondiaux sur la société de l'information, Genève, 2003 et Tunis, 2005.
En 2011, la Palestine est devenue un membre de l’Unesco faisant suite au vote avec 107 États Membres pour et 14 contre. Des lois passées aux États-Unis en 1990 et 1994 stipulent qu'ils ne peuvent contribuer financièrement à des organisations des Nations-Unies qui reconnaissent la Palestine comme État membre. En conséquence, il retire son financement, qui représente environ 22 % du budget de l'Unesco. Israël a également réagi à l'admission de la Palestine à l'Unesco par le gel des paiements d'Israël à l'Unesco et en imposant des sanctions à l'Autorité palestinienne, affirmant que l'admission de la Palestine pourrait être préjudiciable "aux pourparlers potentiels de paix ". Le budget est donc passé de 653 à 507 millions de dollars américains.
Sièges
1946-1958 : hôtel Majestic 16e arrondissement de Paris.
Depuis 1958 : maison de l'Unesco 7e arrondissement de Paris.
États fondateurs
L'Unesco a été fondé par vingt-et-un États, signataires de l'Acte constitutif en 1946 :
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Australie
Brésil
Canada
Chine
Danemark
Égypte
États-Unis
Arménie
France
Grèce
Inde
Liban
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
République dominicaine
Royaume-Uni
Tchécoslovaquie
Turquie
Crise d'identité et de vocation
Depuis l’élection de son directeur général en 1999, et surtout depuis le retour des États-Unis au sein de l’organisation en 2003, l'Unesco s’est engagée dans un plan sévère de réduction des dépenses, assorti d’une réforme de sa stratégie : furent ainsi décidés le non-renouvellement de nombreux postes subalternes, la suppression du magazine généraliste Le Courrier de l'Unesco, l’abandon des activités en faveur des logiciels open source, la réduction nette du budget général au profit de programmes désormais financés, et donc aussi pilotés ou gérés, par des États membres ou des entreprises commerciales, dont Microsoft et L'Oréal.
Pour tenir un budget en baisse depuis l'arrêt de la contribution américaine en 2011, quelque 300 personnes risquent de perdre leur emploi en 2013. L'agence onusienne employait en 2012 1 200 personnes au siège installé à Paris et 900 à travers le monde.
Liste des directeurs généraux
Julian Huxley, 1946–1948
Jaime Torres Bodet, 1948–1952
John Wilkinson Taylor, 1952–1953
Luther Evans, 1953–1958
Vittorino Veronese, 1958–1961
René Maheu, 1961–1974
Amadou-Mahtar M'Bow, 1974–1987
Federico Mayor Zaragoza, 1987–1999
Kōichirō Matsuura, 1999–2009
Irina Bokova, depuis le 15 novembre 2009
Composition
Au 23 novembre 2011, l’Unesco compte 195 États membres, ainsi que huit membres associés :
Membres :
Afghanistan (04/05/1948)
Afrique du Sud (12/12/1994)
Albanie (16/10/1958)
Algérie (15/10/1962)
Allemagne (11/07/1951)
Andorre (20/10/1993)
Angola (11/03/1977)
Antigua-et-Barbuda (15/07/1982)
Arabie saoudite (04/11/1946)
Argentine (15/09/1948)
Arménie (09/06/1992)
Australie (04/11/1946)
Autriche (13/08/1948)
Azerbaïdjan (03/06/1992)
Bahamas (23/04/1981)
Bahreïn (18/01/1972)
Bangladesh (27/10/1972)
Barbade (24/10/1968)
Belgique (29/11/1946)
Belize (10/05/1982)
Bénin (18/10/1960)
Bhoutan (13/04/1982)
Biélorussie (12/05/1954)
Birmanie (27/06/1949)
Bolivie (13/11/1946)
Bosnie-Herzégovine (02/06/1993)
Botswana (16/01/1980)
Brésil (04/11/1946)
Brunei (17/03/2005)
Bulgarie (17/05/1956)
Burkina Faso (14/11/1960)
Burundi (16/11/1962)
Cambodge (03/07/1951)
Cameroun (11/11/1960)
Canada (04/11/1946)
Cap-Vert (15/02/1978)
Chili (07/07/1953)
Chine (04/11/1946)
Chypre (06/02/1961)
Colombie (31/07/1947)
Comores (22/03/1977)
Corée du Nord (18/10/1974)
Corée du Sud (14/06/1950)
Costa Rica (19/05/1950)
Côte d'Ivoire (27/10/1960)
Croatie (01/06/1992)
Cuba (29/08/1947)
Danemark (04/11/1946)
Djibouti (31/08/1989)
Dominique (09/01/1979)
Égypte (04/11/1946)
Émirats arabes unis (20/04/1972)
Équateur (22/01/1947)
Érythrée (02/09/1993)
Espagne (30/01/1953)
Estonie (14/10/1991)
États-Unis (01/10/2003)
Éthiopie (01/07/1955)
Fidji (17/07/1983)
Finlande (10/10/1956)
France (04/11/1946)
Gabon (16/11/1960)
Gambie (01/08/1973)
Géorgie (07/10/1992)
Ghana (11/04/1958)
Grèce (04/11/1946)
Grenade (17/02/1975)
Guatemala (02/01/1950)
Guinée (02/02/1960)
Guinée équatoriale (29/11/1979)
Guinée-Bissau (01/11/1974)
Guyana (21/03/1967)
Haïti (18/11/1946)
Honduras (16/12/1947)
Hongrie (14/09/1948)
Îles Cook (25/10/1989)
Inde (04/11/1946)
Indonésie (27/05/1950)
Iran (06/09/1948)
Irak (21/10/1948)
Irlande (03/10/1961)
Islande (08/06/1964)
Israël (16/09/1949)
Italie (27/01/1948)
Jamaïque (07/11/1962)
Japon (02/07/1951)
Jordanie (14/06/1950)
Kazakhstan (22/05/1992)
Kenya (07/04/1964)
Kirghizistan (02/06/1992)
Kiribati (24/10/1989)
Koweït (18/11/1960)
Laos (09/07/1951)
Lesotho (29/09/1967)
Lettonie (14/10/1991)
Liban (04/11/1946)
Liberia (06/03/1947)
Libye (27/06/1953)
Lituanie (07/10/1991)
Luxembourg (27/10/1947)
Macédoine (28/06/1993)
Madagascar (10/11/1960)
Malaisie (16/06/1958)
Malawi (27/10/1964)
Maldives (18/07/1980)
Mali (07/11/1960)
Malte (10/02/1965)
Maroc (07/11/1956)
Îles Marshall (30/06/1995)
Maurice (25/10/1968)
Mauritanie (10/01/1962)
Mexique (04/11/1946)
Micronésie (19/10/1999)
Moldavie (27/05/1992)
Monaco (06/07/1949)
Mongolie (01/11/1962)
Monténégro (01/03/2007)
Mozambique (11/10/1976)
Namibie (02/11/1978)
Nauru (17/10/1996)
Népal (01/05/1953)
Nicaragua (22/02/1952)
Niger (10/11/1960)
Nigeria (14/11/1960)
Niue (26/10/1993)
Norvège (04/11/1946)
Nouvelle-Zélande (04/11/1946)
Oman (10/02/1972)
Ouganda (09/11/1962)
Ouzbékistan (26/10/1993)
Pakistan (14/09/1949)
Palaos (20/09/1999)
Palestine (23/11/2011)
Panama (10/01/1950)
Papouasie-Nouvelle-Guinée (04/10/1976)
Paraguay (20/06/1955)
Pays-Bas (01/01/1947)
Pérou (21/11/1946)
Philippines (21/11/1946)
Pologne 06/11/1946)
Portugal (11/09/1974)
Qatar (27/01/1972)
République centrafricaine (11/11/1960)
République démocratique du Congo (25/11/1960)
République du Congo (24/10/1960)
République dominicaine (04/11/1946)
République tchèque (22/02/1993)
Roumanie (27/07/1956)
Royaume-Uni (01/07/1997)
Russie (21/04/1954)
Rwanda (07/11/1962)
Saint-Christophe-et-Niévès (26/10/1983)
Sainte-Lucie (06/03/1980)
Saint-Marin (12/11/1974)
Saint-Vincent-et-les Grenadines (14/01/1983)
Salomon (07/09/1993)
Salvador (28/04/1948)
Samoa (03/04/1981)
Sao Tomé-et-Principe (22/01/1980)
Sénégal (10/11/1960)
Serbie (20/12/2000)
Seychelles (18/10/1976)
Sierra Leone (28/03/1962)
Singapour (08/10/2007)
Slovaquie (09/02/1993)
Slovénie (27/05/1992)
Somalie (15/11/1960)
Soudan (26/11/1956)
Soudan du Sud (27/10/2011)
Sri Lanka (14/11/1949)
Suède (23/01/1950)
Suisse (28/01/1949)
Suriname (16/07/1976)
Swaziland 25/01/1978)
Syrie (16/11/1946)
Tadjikistan 06/04/1993)
Tanzanie (06/03/1962)
Tchad (19/12/1960)
Thaïlande (01/01/1949)
Timor oriental (05/06/2003)
Togo (17/11/1960)
Tonga (29/09/1980)
Trinité-et-Tobago (02/11/1962)
Tunisie (08/11/1956)
Turkménistan (17/08/1993)
Turquie (04/11/1946)
Tuvalu (21/10/1991)
Ukraine (05/12/1954)
Uruguay (08/11/1947)
Vanuatu (10/02/1994)
Venezuela (25/11/1946)
Viêt Nam (06/07/1951)
Yémen (02/04/1962)
Zambie (09/11/1964)
Zimbabwe (22/09/1980)
Membres associés :
Aruba
Îles Caïmans
Curaçao
Îles Féroé
Îles Vierges britanniques
Macao
Saint-Martin
Tokelau
Le Saint-Siège possède un observateur permanent à la conférence générale et au Conseil exécutif en la personne de Mgr Francesco Follo.
Résultant du vote concernant l'adhésion de la Palestine à l'Unesco :
Pour
Contre
Abstention
Absent
Non-membres, ne pouvant voter
Le dernier membre à avoir rejoint l'organisation est la Palestine, acceptée au sein de l'Unesco en tant que membre titulaire le 23 novembre 2011. En réaction, les États-Unis décident de suspendre leur contribution financière, soit 1/5e du budget de l'organisation.
Fonctionnement
La Conférence générale, qui réunit les représentants de l’ensemble des États membres, siège tous les 2 ans les années impaires. Le directeur général est élu par la conférence générale pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois depuis 2005. Le Conseil exécutif siège au moins 2 fois par an dans l’intervalle des sessions de la Conférence générale. Ses membres sont au nombre de 58, et sont élus par la Conférence générale pour un mandat de 4 ans. Ses effectifs sont d’environ 2 400 fonctionnaires internationaux dont un millier d’administrateurs.
Siège à Paris
Enseigne de l'Unesco.
Le siège de l'Unesco à Paris, construit par les architectes Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Pier Luigi Nervi, est représentatif du style architectural des années 1950. Il renferme des compositions murales de Picasso et de Miró en collaboration avec Artigas, Rufino Tamayo, Afro Basaldella et Roberto Matta ainsi qu’un stabile de Calder dans les jardins. Le jardin de la Paix d’Isamu Noguchi se visite lors de la journée parisienne portes ouvertes des jardins.
Le site possède des œuvres d’art d'artistes renommés, comme Bazaine, Giacometti ?, Le Corbusier, Henry Moore, Takis, ou Tsereteli. Il y a aussi des points remarquables comme l’ange de Nagasaki, l’Espace de méditation de Tadao Ando, le Square de la Tolérance de Dani Karavan et le Globe symbolique d’Erik Reitzel, Totes les coses de Tapies, Guinovart, La Liberté : la paix le jour d'après d'Abelardo Espejo Tramblin.
L'Unesco organise et parraine de nombreuses manifestations culturelles et scientifiques. En 1998, le Palais de l'Unesco à Paris a ainsi accueilli le 24e Congrès international des sciences administratives organisé par l'Institut français des sciences administratives sur le thème Le citoyen et l'administration.
Élections
Les élections 2009 pour le poste de directeur général ont eu lieu à Paris du 7 au 23 septembre. Huit candidats étaient en lice pour recueillir les votes de 58 pays votants.
L'élection peut comporter jusqu'à cinq tours, selon que les candidats parviennent, ou non, à obtenir une majorité rapidement.
L'élection 2009 est particulièrement controversée en raison des diatribes antisémites du candidat favori, le ministre égyptien de la Culture Farouk Hosni. En 2001, il avait déclaré que la culture israélienne était inhumaine et raciste, puis dénoncé l'infiltration des juifs dans les médias internationaux. En 2008, il avait répondu à un député islamiste au Parlement vouloir brûler les livres en hébreu dans les bibliothèques d'Égypte, s'il en trouvait. Des intellectuels, dont le prix Nobel de la paix et survivant d'Auschwitz Elie Wiesel, avaient alors condamné une candidature dangereuse, termes repris depuis par de nombreux journaux, comme le New York Times, la BBC et France. L'élection 2009 a finalement été remportée par la Bulgare Irina Bokova, par 31 voix contre 27 à Farouk Hosni. Élection confirmée le 15 octobre suivant par le vote de la Conférence générale.
ONG officielles de l’Unesco
L’Unesco entretient des relations avec 319 Organisations non gouvernementales ONG internationales. La plupart sont opérationnelles et une partie d’entre elles sont formelles.
Les relations opérationnelles sont réservées aux ONG très actives dans leur domaine, capables de mener des expertises et de canaliser les intérêts de leurs clients. Les demandes d’admission à l’Unesco pour des relations opérationnelles peuvent être adressées à tout moment au Directeur Général.
Les relations formelles sont réservées aux ONG qui exercent un rôle soutenu de coopération en direction, et à partir de l’Unesco. L’admission pour une reconnaissance formelle n’est accordée qu’aux ONG internationales représentatives et qui agissent en tant qu’experts et représentent le plus largement leur domaine d’activité, grâce à une structure internationale étendue. Les relations formelles sont elles-mêmes sous-divisées en deux groupes, consultatif ou associatif, selon le rôle et la structure de l’ONG. Les instances du bureau exécutif de l’Unesco décident de l’admission à l’un ou l’autre groupe sur la base des recommandations du Directeur Général. Ces relations formelles sont établies pour des périodes de six ans renouvelables.
La forme d’affiliation la plus étroite à l’Unesco est l’ association formelle et dix ONG entrant dans cette catégorie ont leur bureau au siège même de l’Unesco55. Ce sont :
l'Association internationale des universités AIU ;
le Conseil international du cinéma, de la télévision et de la communication audiovisuelle CICT;
le Conseil international des musées ICOM ;
le Conseil international de la musique IMC ;
le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines CIPSH ;
le Conseil international des sciences sociales (ISSC)60 ;
la Fédération mondiale des associations, centres et clubs Unesco WFUCA ;
l'Institut international du théâtre ITI ;
le Conseil international des sciences de l'ingénieur et de la technologie ICET ;
le Comité de coordination du service volontaire international CCSVI.
L'ONU
sigle de Organisation des Nations unies
Cet article fait partie du dossier consacré à la guerre froide.
Organisation internationale constituée par les États qui ont accepté de remplir les obligations prévues par la Charte des Nations unies en vue de sauvegarder la paix et la sécurité mondiales et d'instituer entre les nations une coopération économique, sociale et culturelle.
La création de l'ONU
L'organisation des Nations unies ONU est née officiellement le 24 octobre 1945, date officielle d'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies, signée le 25 avril de la même année, à San Francisco, par la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et 45 autres pays. À ces membres originaires s'ajoutait la Pologne, qui, absente à la conférence, signa le texte peu après. L'idée maîtresse qui présida à la création de l'Organisation des Nations unies était la préservation de la paix. Les nations fondatrices étaient alors engagées solidairement dans la lutte contre les forces de l'Axe Allemagne, Italie et Japon.
Pour en savoir plus, voir l'article Charte des Nations unies.
Avant l'ONU, la SDN
Une autre institution intergouvernementale ayant les mêmes buts existait avant l'ONU : la Société des nations SDN, créée en 1919 par le traité de Versailles, et qui avait pour mission, après la Première Guerre mondiale, d'asseoir définitivement la paix entre les nations et de fournir des garanties réciproques d'indépendance politique et territoriale aux États, petits ou grands. Mais la SDN ne parvint à rassembler que les démocraties européennes et se limita rapidement à une simple association de ces dernières. Les États-Unis n'en firent jamais partie, en raison du refus du Sénat de ratifier le traité. L'entrée décisive, en 1933, de l'Union soviétique – qui fut exclue en 1939 après qu'elle eut attaqué la Finlande, campagnes de Finlande – coïncida avec le départ du Japon et de l'Allemagne.
La SDN, dont on ne retient le plus souvent que la faiblesse ou l'inefficacité, réussit pourtant à introduire au sein de la communauté internationale l'idée d'une grande organisation intergouvernementale à vocation mondiale et à caractère égalitaire ; cette idée prit définitivement corps pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour en savoir plus, voir les articles Seconde Guerre mondiale, Société des nations SDN.
Les étapes de la création de l"ONU
– 12 juin 1941 : Franklin Roosevelt et Winston Churchill, réunis à Londres au Saint James Palace, font la première déclaration interalliée, réclamant que fût fondée une organisation pour assurer la paix partout dans le monde.
– 14 août 1941 : Roosevelt et Churchill se retrouvent en tête à tête, avant de faire une déclaration connue sous le nom de charte de l'Atlantique, dans laquelle ils s'engagent à appliquer des principes communs dans les politiques nationales des pays où leurs pays respectifs jouissent d'une influence : c'est le prélude à la décolonisation. Intégrée à la conférence de Washington de 1942, la charte de l'Atlantique devient ipso facto le programme de paix des Nations unies.
– 1er janvier 1942 : Roosevelt utilise pour la première fois l'expression nations unies. Ce jour-là, ces nations unies au nombre de 26 s'engagent à poursuivre la lutte contre les forces de l'Axe, ensemble, jusqu'à leur défaite.
– 20 octobre 1943 : alors que la guerre est à son paroxysme, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine affirment, dans leur Déclaration des quatre nations clôturant la conférence de Moscou, la nécessité d'établir, aussi tôt que possible, une organisation internationale fondée sur le principe de l'égalité souveraine entre tous les États pacifiques.
– 28 novembre-1erdécembre 1943 : dans une déclaration signée à Moscou le 30 octobre 1943, l'URSS, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine préconisent la création d'une organisation internationale chargée du maintien de la paix et de la sécurité. Cet objectif est réaffirmé à la conférence de Téhéran, le 1er décembre 1943.
– 21 août-7 octobre 1944 : réunis à Dumbarton Oaks, près de Washington, les délégués de l'URSS, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine s'entendent pour établir la paix et la sécurité internationales. Cette conférence élabore le plan de l'Organisation des Nations unies et fixe les dispositions qui devaient assurer, du point de vue économique et social, les libertés essentielles de l'être humain.
– 4-11 février 1945 : conférence de Yalta. Roosevelt, Staline et Churchill achèvent l'examen de ce projet et décident de convoquer une conférence internationale en vue de la création de l'Organisation.
– 25 avril-26 juin 1945 : conférence de San Francisco. La conférence des Nations unies sur l'organisation internationale convoquée par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la Chine, regroupe 50 États. Elle adopte un traité multilatéral signé le 26 juin 1945 : la Charte de l'Organisation des Nations unies. La Pologne, non représentée à la conférence, signera la Charte plus tard, mais est néanmoins devenue l'un des 51 membres originels.
• Winston Churchill
• conférence de San Francisco
• conférence de Téhéran
• conférence de Yalta
• Franklin Roosevelt
• plan de Dumbarton Oaks
• Joseph Staline
– 24 octobre 1945 : l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, ratifiée par la Chine, les États-Unis , la France, le Royaume-Uni, l'URSS et la majorité des autres pays signataires, marque l'existence officielle de l'Organisation des Nations unies.
États membres de l'Organisation des Nations Unies
La Charte de l'ONU
La Charte est l'instrument constitutif de l'Organisation des Nations unies. Elle fixe les droits et les obligations des États membres et établit les organes et les procédures.
Elle comprend 111 articles regroupés en 19 chapitres auxquels se rajoute le statut de la Cour internationale de justice (CIJ).
Le principe de base qui y est affirmé est l'égalité souveraine de tous les membres. Néanmoins, un droit de veto est reconnu de fait à chacun des cinq membres du Conseil de sécurité.
Les buts et les principes de l'ONU, définis dans les premiers chapitres, sont les suivants :
– le maintien de la paix et de la sécurité internationale ;
– le développement des relations amicales entre les nations ;
– la coopération internationale et le développement des droits fondamentaux de l'homme.
À cet égard, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale réunie à Paris le 10 décembre 1948, demeure le texte de référence. L'attachement aux libertés fondamentales, aussi bien de l'homme respect universel et effectif des droits de l'homme, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion que des peuples égalité des droits et droit à disposer d'eux-mêmes, est explicitement proclamé.
Pour en savoir plus, voir les articles Charte des Nations unies, Déclaration universelle des droits de l'homme.
Siège de l'ONU
Créée par la Charte des Nations unies en 1945, l'Assemblée générale est le principal organe délibérant, directeur et représentatif de l'ONU.
Elle est composée des représentants de tous les États membres, chacun d'entre eux disposant d'une voix. Diverses questions y sont débattues. Pour celles afférentes aux sujets de première importance – sécurité internationale, admission d'un État, budget – les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. Sur les autres sujets, la majorité simple suffit.
L'Assemblée tient chaque année une session ordinaire de septembre à décembre. Elle peut se réunir en session extraordinaire, convoquée par le Conseil de sécurité, par la majorité des États membres, ou par un seul État appuyé par une majorité des autres.
Les décisions votées par l'Assemblée ne constituent aucune obligation juridique pour les gouvernements nationaux. Toutefois, l'interdépendance croissante des États et des continents, la médiatisation des événements de toute nature donnent aux résolutions adoptées un poids moral qui n'échappe pas à l'opinion publique mondiale. De plus, l'œuvre entreprise durant l'année par l'Organisation découle, en grande partie, des décisions prises par l'Assemblée générale.
Le Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité, à la fois organe exécutif et organe d'initiative, assume la responsabilité principale du maintien de la paix. Il est appelé à œuvrer « par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux. Une singularité le distingue des autres institutions, puisqu'il est le seul organe à prendre des décisions que les membres de l'Organisation sont tenus d'appliquer.
Quinze membres siègent au Conseil de sécurité, dont cinq membres permanents : il s'agit de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie qui a succédé à l'Union soviétique, de la France et du Royaume-Uni. Les dix autres membres sont élus tous les deux ans par l'Assemblée générale, qui les choisit en fonction d'une répartition géographique et d'un dosage politique.
La nécessité d'un élargissement du nombre de membres permanents pour une meilleure représentativité au Conseil de sécurité fait l'objet, depuis les années 1990, de longues et difficiles négociations.
Pour en savoir plus, voir l'article Conseil de sécurité.
Le Conseil économique et social
Composé de 54 membres élus pour trois ans par l'Assemblée générale selon un critère de répartition géographique et disposant chacun d'une voix, le Conseil économique et social est l'instance où sont examinées les questions économiques et sociales internationales, et où sont réalisées les études et les rapports sur ces questions. Il convoque les conférences internationales sur les sujets de sa compétence. Il consulte 900 organisations non gouvernementales ONG, qui travaillent sur le terrain. Le Conseil s'emploie à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il agit par recommandations, les décisions sont prises à la majorité simple.
Le Conseil de tutelle
Le Conseil de tutelle se compose de représentants de 7 États membres et des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il a pour tâche de surveiller l'administration des territoires placés sous le régime de la tutelle (chapitre XIII, articles 86 et suivants de la Charte de l'ONU. Ce régime a pour but de confier l'administration de territoires non autonomes à une autorité chargée de tutelle, et de faire en sorte que les gouvernements chargés de cette administration prennent les mesures qui conviennent pour préparer ces territoires à la réalisation des objectifs énoncés dans la Charte.
Au cours des premières années d'existence de l'ONU, 11 territoires furent placés sous régime de tutelle. Ces territoires ont tous aujourd'hui accédé à l'indépendance ou se sont volontairement unis à un État pour constituer un pays indépendant. En 1994, le Conseil de sécurité a mis un terme à l'accord de tutelle régissant le dernier territoire – celui des îles du Pacifique (Palau), administré par les États-Unis – après que la population de ce territoire se fut prononcée pour son autonomie. Palau devint indépendant en 1994 et adhéra à l'ONU en tant que 185e État membre. Avec l'indépendance de Palau, dernier territoire sous tutelle des Nations unies, le régime de tutelle avait ainsi achevé sa mission historique, et le Conseil décida officiellement de suspendre ses activités à partir du 1er novembre 1994. Il demeure toutefois un organe de l'ONU à part entière.
La Cour internationale de justice CIJ
Créée en 1945, la Cour internationale de justice est l'organe juridictionnel des Nations unies. Elle applique, conformément à l'article 38 de son statut, partie intégrante de la Charte des Nations unies, les conventions internationales qui établissent les règles reconnues par les États nationaux en litige, mais aussi la coutume internationale acceptée comme le droit et les principes généraux de droit reconnus par les nations. Chaque membre de l'ONU est partie au statut de la Cour. Siégeant à La Haye, la Cour se compose de 15 magistrats élus indépendamment par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, pour une durée de 9 ans. La Cour siège en séance plénière, mais peut constituer des organes plus restreints, appelés chambres, à la demande des parties. Les délibérations sont secrètes et les arrêts sont pris à la majorité des juges présents.
Pour en savoir plus, voir l'article Cour internationale de justice CIJ.
Le Secrétariat des Nations unies
Environ 7 500 personnes, appartenant à 170 pays, composent le Secrétariat, dont le siège est à New York. Ces fonctionnaires internationaux sont en principe indépendants de leur pays d'origine : au terme de l'article 100 de la Charte, les États membres s'engagent à reconnaître le caractère exclusivement international de l'activité du secrétaire général et du personnel du Secrétariat et à ne pas chercher à les influencer. Ces fonctionnaires sont choisis en fonction de leur compétence et selon un subtil dosage géographique. Ils sont nommés par le secrétaire général.
Considéré comme la machine administrative de l'ONU, le Secrétariat se voue à des tâches multiples, touchant à l'administration des opérations du maintien de la paix, à la traduction de documents dans les langues officielles, à l'analyse des problèmes économiques et sociaux, enfin, à l'organisation des conférences internationales.
Le secrétaire général
Il est nommé par l'Assemblée, sur recommandation du Conseil de sécurité. La Charte ne précise pas la durée de ses fonctions, mais elle est habituellement de cinq ans. Le secrétaire général est rééligible. Décrit par la Charte comme « le plus haut fonctionnaire de l'Organisation », il en est de fait l'emblème. Il a pour mission d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, selon lui, pourrait mettre en danger la paix et la sécurité partout dans le monde. Mais la Charte lui demande également de remplir « toute autre fonction » dont il serait chargé par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et les organes principaux de l'ONU.
Dans les faits, il est le porte-parole de la communauté internationale, tout en étant au service des États membres. Il propose ses bons offices dans l'intérêt général, donc, par définition, en toute impartialité. Pour cela, il est amené tout naturellement à rencontrer les chefs d'État et dirigeants mondiaux. Chaque secrétaire général a défini sa mission dans le contexte des événements mondiaux de l'époque. Il est notable qu'aucun d'entre eux n'ait appartenu à une grande puissance. C'est que le choix du titulaire doit véritablement reposer sur un consensus. D'une part, une entente entre les deux organes souverains s'impose, car le secrétaire général étant nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, il doit recueillir non seulement l'aval des grandes puissances mais aussi l'assentiment des pays du Sud.
Le plus haut fonctionnaire de l'Organisation ne s'est pas cantonné à la place que lui avaient assignée les fondateurs de l'ONU. Il a été amené à jouer un rôle de plus en plus important dans la politique internationale, en multipliant missions de bons offices et initiatives diversement appréciées par exemple pour empêcher in extremis, en 1998, une nouvelle intervention armée, souhaitée par les États-Unis, contre l'Iraq.
Les secrétaires généraux de l'ONU
– Trygve Lie 1946-1952 : ce Norvégien a accompli son mandat durant la guerre de Corée, à l'occasion de laquelle les soldats furent dépêchés pour s'interposer entre les belligérants. L'hostilité de l'URSS envers lui était telle qu'il décida de démissionner un an avant l'expiration de son mandat.
– Dag Hammarskjöld 1953-1961 : le mandat de ce Suédois s'est déroulé dans le contexte de la crise de Suez et de celle du Congo. Il est mort en Afrique, à la suite d'un accident d'avion aux causes non élucidées. Il a obtenu le prix Nobel de la paix à titre posthume.
– Sithu U Thant 1961-1971 : représentant permanent auprès de l'ONU, ce diplomate birman a été le premier secrétaire général issu d'un pays du tiers-monde. Du fait du décès de son prédécesseur, il a occupé le poste par intérim, avant d'être élu. Son mandat s'est déroulé alors que la guerre du Viêt Nam s'intensifiait. Ses incessants efforts pour que s'ouvrent des négociations ne furent guère récompensés.
– Kurt Waldheim 1972-1981 : cet Autrichien a effectué deux mandats pleins. Désireux de se présenter pour un troisième, il dut retirer sa candidature. L'opinion publique, en effet, s'était penchée – fort tardivement – sur son attitude durant la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il participa comme officier de l'armée allemande, et avait estimé que son passé ne pouvait s'accorder avec des fonctions conférant une haute autorité morale.
– Javier Pérez de Cuéllar 1982-1991 : représentant permanent auprès de l'ONU, ce diplomate péruvien a accompli deux mandats successifs, alors que s'écroulait le mur de Berlin, annonciateur de la fin de la guerre froide. Javier Pérez de Cuéllar était encore en poste lors de la guerre du Golfe.
Cinquantième anniversaire de l'ONU
– Boutros Boutros-Ghali 1992-1996 : Ce diplomate égyptien a accompli son mandat alors que sévissaient des crises majeures : Somalie, Rwanda, ex-Yougoslavie. Énergique et autoritaire, il a voulu s'atteler à réformer l'Organisation. Les États-Unis n'ont guère apprécié ses prises de position et se sont opposés à ce qu'il se présente pour un second mandat. La France le soutint d'abord, à la satisfaction de nombre d'États arabes et africains, mais, quand un successeur africain sachant s'exprimer en français fut pressenti, elle renonça à maintenir le candidat sortant jusqu'au bout. Boutros-Ghali a été nommé secrétaire général à la francophonie peu après.
Accord sur l'inspection des installations militaires iraquiennes par l'ONU, 1998
– Kofi Annan 1997-2006 : la carrière de ce diplomate ghanéen s'est déroulée essentiellement à l'ONU. S'étant donné comme tâche prioritaire de rénover les Nations unies, il cherche, par ailleurs, à maintenir l'engagement de la communauté internationale en faveur de l'Afrique, le plus désavantagé des continents, et doit gérer maintes situations politiques essentielles telles que la réintégration de l'Iraq dans le concert international ou le conflit israélo-palestinien. Réélu à l'unanimité pour un second mandat, K. Annan se voit décerner, conjointement à l'Organisation, le prix Nobel de la paix en septembre 2001.
Ban Ki-moon
– Ban Ki-moon depuis 2007 : diplomate sud-coréen, il intègre les Nations unies dès 1975 et défend inlassablement la vision d'une péninsule coréenne pacifique.
EN SAVOIR PLUS
• Kofi Annan
• Ban Ki-moon
• Boutros Boutros-Ghali
• Dag Hammarskjöld
• Javier Pérez de Cuéllar
• Trygve Lie
• Sithu U Thant
• Kurt Waldheim
Les moyens de l'Organisation Les moyens financiers
Le budget ordinaire de l'ONU tourne autour de 3 milliards d'euros. Les États membres sont soumis au paiement de leur contribution en fonction de leur capacité financière. Les plus riches, tels les États-Unis, contribuent à hauteur de 22 % de ce budget, le Japon 12,5 %, l'Allemagne 8,01 %, le Royaume-Uni 6,6 %, la France 6,1 %, l'Italie 4,9 %, alors que le Burkina, la Bolivie ou le Cambodge ne doivent couvrir chacun que 0,01 % de ce budget.
Les États membres sont également appelés à financer les opérations de maintien de la paix. De plus, toutes sortes d'activités de l'ONU sont assurées par des contributions volontaires, en dehors du budget ordinaire, tels que les programmes du Programme des Nations unies pour le développement PNUD, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés HCR, du Programme alimentaire mondial PAM.
Les moyens juridiques
L'article premier de la Charte ne laisse planer aucun doute sur la mission des Nations unies, appelées à régler les différends internationaux par des moyens pacifiques, conformément au principe de la justice et du droit international. Hormis le Conseil de sécurité, qui élabore des recommandations, mais qui prend aussi des décisions. l'Assemblée générale, elles ne constituent pas un moyen d'action. Tout au plus servent-elles de bases aux recommandations et autres décisions. La Charte ignore le mot sanction . Mais les articles 5 et 6 prévoient la suspension et l'exclusion d'un État membre, la suspension du droit de vote à l'Assemblée générale article 19 ou encore article 41 la rupture, ou la réduction, des relations diplomatiques, économiques, sportives et culturelles avec l'État membre incriminé.
Les moyens humains
Aux fonctionnaires rattachés aux sièges de New York, de Genève et de Vienne s'ajoute le personnel des institutions et programmes rattachés environ 50 000 personnes. Les délégués des pays ne sont pas comptabilisés, car ils travaillent pour leurs gouvernements respectifs.
L'ONU utilise aussi du personnel pour les opérations de maintien de la paix : ce sont des soldats appartenant aux contingents militaires des pays membres – l'Organisation n'a pas d'armée propre –, auxquels se joignent aussi des civils. Ces volontaires civils, selon leur appellation officielle, sont des professionnels qualifiés et expérimentés, spécialistes dans quelque 115 domaines. Ils participent aux opérations humanitaires et aux programmes de développement. On en dénombre 4 000 environ qui travaillent dans 130 pays.
Les programmes d'action Le maintien de la paix
L'objectif majeur de l'ONU est de maintenir partout la paix et la sécurité. Depuis sa fondation, elle a été souvent sollicitée pour empêcher qu'une situation dangereuse ne dégénère en conflit armé. Les méthodes et les moyens utilisés à cette fin varient. Force militaire et diplomatie peuvent être utilisées alternativement ou simultanément.
Des Casques bleus sur le terrain
Si la Charte prévoit que les États membres doivent régler leurs différends par la voie pacifique, elle stipule aussi que c'est au Conseil de sécurité qu'incombe la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Ce dernier met donc en place un dispositif de maintien de la paix que dirige le secrétaire général. Ces opérations revêtent diverses formes. La plus spectaculaire consiste en l'envoi des fameux Casques bleus, soldats de la paix issus des contingents des pays membres. Les Casques bleus agissent dans le cadre d'un mandat qu'ils se doivent de respecter scrupuleusement. Ces forces militaires ont obtenu en 1988 le prix Nobel de la paix.
Le dispositif de maintien de la paix consiste aussi à envoyer des missions d'observation militaire composées d'officiers non armés. Dans tous les cas, les forces onusiennes gardent le contact avec les deux parties, qui sont traitées sur un pied de stricte égalité.
Arrivée des Casques bleus à Pale, 1994
L'envoi de forces armées pose un problème politico-diplomatique majeur aux États du monde. L'expédition, sous mandat onusien, de forces coalisées pour forcer l'Iraq à évacuer le Koweït, qu'il avait envahi le 2 août 1990, l'a démontré, guerre du Golfe. Les coalisés, épaulant le gendarme américain, se muaient en bras armé de l'Amérique. De même, en juillet 1995, l'ONU a-t-elle confié à trois pays, États-Unis, Royaume-Uni et France, le soin d'opérer, mandatés par elle certes, mais sous leurs propres couleurs, les engagements militaires rendus nécessaires par la situation en Bosnie-Herzégovine. La FORPRONU s'était montrée incapable de les assumer.
L'assistance électorale
Dans le cadre des efforts onusiens pour garantir les conditions de paix, la surveillance des élections est une intervention qui a fait ses preuves. Inaugurée en 1989 en Namibie, cette mission s'est généralisée, au Nicaragua et en Haïti 1990, en Angola 1992, au Cambodge 1993, et ainsi chaque année en divers points du globe.
Plusieurs fois honorée, l'Organisation est pour la première fois en tant que telle lauréate du prix Nobel de la paix en septembre 2001.
La réglementation de l'armement et le désarmement
En 1959, la notion de désarmement général et complet fut mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale en tant que sujet distinct. Au début des années 1960, les États-Unis et l'URSS soumirent bien des plans à cet effet, mais on se rendit vite compte que l'objectif d'un désarmement complet s'éloignait chaque jour davantage. Depuis, une autre approche a vu le jour. Elle s'appuie sur des organes subsidiaires : le Département des affaires de désarmement créé en 1982, supprimé en 1992 et rétabli en 1998, et la Conférence du désarmement, autonome de l'Assemblée générale.
• arme nucléaire
• armes chimiques
• désarmement
• prolifération
• sécurité collective
En 1993 est conclue la Convention sur les armes chimiques. En matière nucléaire, plusieurs traités, allant de la non prolifération nucléaire à l'interdiction complète des essais nucléaires, ont vu le jour depuis 1963. Certains d'entre eux interdisent la mise en place d'armes nucléaires dans l'espace extra-atmosphérique (1967) ou sur le fonds des mers et des océans 1971.
Le développement économique et social
La philosophie onusienne privilégie les actions de développement économique, social et culturel, gage de stabilité. C'est là le second rôle majeur de l'Organisation. Consciente de leur importance, l'ONU entend faire progresser le consensus mondial en la matière. Elle agit au moyen de programmes et d'institutions spécialisées.
Les programmes
Avec les programmes et les stratégies de développement approuvés par l'Assemblée générale, l'ONU met en œuvre des projets globaux, mais aussi des actions ponctuelles concernant tous les domaines économiques et sociaux. Ces programmes revêtent diverses formes : coopération technique, enquêtes et études, organisations de conférences internationales, etc. En outre, certains de ces programmes sont liés à des catégories de populations spécifiques, tels les enfants, les femmes, les vieillards, les réfugiés, les migrants, les handicapés, et d'autres encore.
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), constitue, pour les 177 pays où il est présent, la principale source de financement gratuit pour le développement humain.
Les institutions spécialisées
L'ONU s'est donnée des institutions spécialisées qui sont des organisations internationales disposant d'une autonomie budgétaire et d'une indépendance de fait. Elles sont rattachées au Conseil économique et social par accords latéraux approuvés par l'Assemblée générale article 63 de la Charte. L'article 57 en précise la création par accords intergouvernementaux, la définition de leurs compétences dans leur domaine spécifique, et leur rattachement à l'ONU. Ces institutions, sous leur appellation propre, ont en commun d'être dotées, classiquement, de trois organes : une Assemblée plénière ou Conférence, un organe exécutif restreint le Conseil, ou Conseil exécutif, voire Conseil d'administration, un Secrétariat ou Bureau international.
On distingue les organisations à vocation globale :
– l'Organisation internationale du travail OIT,
– l'Organisation mondiale de la santé OMS,
– l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO,
– l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture Unesco.
Parmi les organisations à vocation économique et financière figurent notamment le groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international FMI.
Les organisations fonctionnelles à vocation technique regroupent par exemple :
– l'Union internationale des télécommunications UIT,
– l'Organisation maritime internationale OMI,
– l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI,
– l'Union postale universelle UPU
Les débats d'idées et les droits de l'homme Débats d'idées
Plusieurs fois par an, par le biais de ses institutions, programmes ou conférences, l'ONU mobilise l'opinion publique mondiale, sur des sujets variés et d'intérêt commun.
Ainsi la protection de l'environnement fut-elle à l'honneur à Rio de Janeiro en 1992. Le développement des micro-États insulaires Bridgeton, 1994, la prévention des catastrophes naturelles Yokohama, 1994, l'égalité des femmes 4e conférence mondiale sur ce thème à Pékin, en 1995 ou encore le racisme Durban, 2001 ont aussi capté l'attention mondiale.
Droits de l'homme
Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations . Plus tard, deux pactes sont élaborés et entrent en vigueur en 1976 :
– le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la libre circulation, la présomption d'innocence, la liberté de pensée, de conscience et religieuse, etc.
– Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui concerne le droit de travailler dans des conditions justes et favorables, la protection sociale, le droit à l'éducation, etc.
En outre, il existait une Commission des droits de l'homme, principal organe chargé de la promotion des droits de l'homme du monde. Créée en 1946, avec pour objectif l'élaboration de normes relatives aux droits de l'homme, elle consacrait une grande part de son activité aux problèmes de leur mise en œuvre et se réunissait en session annuelle à Genève. Dans le cadre de la réforme de l'ONU, la Commission, discréditée par la présence dans ses rangs de régimes jugés répressifs, a été remplacée, en juin 2006, par le Conseil des droits de l'homme CDH, qui regroupe 47 pays membres, élus par l'Assemblée générale pour trois ans maximum.
Parmi les mécanismes créés par la Commission des droits de l’homme et repris par le Conseil des droits de l’homme figurent les rapporteurs spéciaux ou groupes de travail mandatés pour examiner la situation particulière d’un pays ou des thèmes spécifiques alimentation, logement, racisme, discrimination raciale, xénophobie, etc.. Lors de sa création, le CDH s'est doté d'un nouveau mécanisme, l'examen périodique universel EPU, qui contraint les 192 États membres de l'ONU à se soumettre tous les quatre ans à une évaluation par les autres États membres du respect des droits de l'homme.
Liens
http://youtu.be/rsKHpJXpAJE Histoire de l'unesco
http://youtu.be/A1R2Qlg-YJwLa France au patrimoine mondial
http://youtu.be/jd-WK4YYxhU?list=PLDFE920B7E333672DPatrimoine mondial
http://youtu.be/j5mUF1ZeApc Patrimoine de l'UNESCO 2
http://youtu.be/oWDHO4z9JXY Patrimoine mondial marin de l'Unesco
         [img width=600]http://fr.unesco.org/sites/default/files/styles/media_featured_327x200/public/headquarters_flags.jpg?itok=RSxli8Mp[/img] 
Posté le : 16/11/2014 21:04
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:48:41
Edité par Loriane sur 17-11-2014 13:49:42
Edité par Loriane sur 19-11-2014 20:17:52
|
|
|
|
|
Alain Colas |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 16 septembre 1943 naît Alain Colas
à Clamecy Nièvre, navigateur français disparu en mer, à l'âge de 35 ans sur le trimaran Manureva, le 16 novembre 1978 au large des Açores au Portugal lors de la première Route du Rhum. Il est le premier marin à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire et en multicoque.
La jeunesse
Alain Colas naît à Clamecy dans la Nièvre, où son père, Roger Colas 1907-1993, dirige la faïencerie de la ville. Dès son enfance, il veut réaliser ses rêves. Écolier à Clamecy, il étudie en sixième au lycée Michelet de Vanves, puis au lycée Jacques Amyot d'Auxerre de la cinquième à la première. Il passe la classe de philosophie au lycée Paul Bert d'Auxerre, obtient le baccalauréat en 1961, et fréquente un an la faculté de lettres de Dijon. Il étudie ensuite l'anglais en Sorbonne. En juillet 1963, à dix-neuf ans, il crée le club de canoë-kayak de Clamecy.
Chargé de cours en Australie
En 1965, son père lui communique une annonce parue dans Le Monde, par laquelle l'université de Sydney recherche un lecturer, c'est-à-dire un chargé de cours, et non un lecteur comme Alain le croit. Il postule aussitôt et prépare son départ. Malgré une réponse négative, il s'embarque en janvier 1966 sur un cargo pour l'Australie. À la faculté des lettres de Sydney, ce jeune homme dynamique et persuasif est recruté ; il devient chargé de cours, à vingt-deux ans, au St John’s College, où il enseigne la littérature française.
En Australie, il découvre la voile et la course au large dans la baie de Sydney.
Équipier d'Éric Tabarly
En 1967, Alain Colas rencontre Éric Tabarly, qui dispute la course Sydney-Hobart. Ce dernier lui propose d’embarquer à son bord, sur Pen Duick III, pour un périple jusqu’en Nouvelle-Calédonie.
Pour Alain, l’appel du large est plus fort qu’un avenir universitaire tout tracé. En mai 1968, il rejoint à Lorient Éric Tabarly qui prépare, pour la transatlantique en solitaire de 1968, un multicoque expérimental géant : Pen Duick IV, conçu par l'architecte français André Allègre. Alain fait toute la saison de course 1968-1969 avec Tabarly. Il apprend le métier de marin de course au large et devient journaliste de ses aventures maritimes. En 1970, il rachète à Tabarly le trimaran Pen Duick IV, avec l'aide de sa famille. Pour payer les premières échéances, il raconte ses voyages dans la presse française et anglo-américaine et vend des photographies.
Afin de s'entraîner et de mieux connaître son bateau, il participe en franc-tireur à la course Sydney-Hobart. Puis il regagne Tahiti pour écrire des reportages sur la Polynésie et préparer Pen Duick IV à son retour en métropole. Il rencontre au début de 1971 une tahitienne, Teura Krause, qui devient sa compagne, et avec laquelle il aura trois enfants.
Les victoires
Le 17 juin 1972, sur Pen Duick IV, il prend le départ à Plymouth, en Angleterre, de la quatrième Transat anglaise, une course transatlantique en solitaire. Le 8 juillet 1972, il arrive vainqueur à Newport aux États-Unis, pulvérisant le record de l’épreuve en vingt jours, treize heures et quinze minutes. La France se découvre un héros sympathique au parcours original.
Son prochain objectif est de réaliser le premier tour du monde en solitaire en multicoque avec Pen Duick IV rebaptisé Manureva, l’oiseau du voyage en tahitien. À bord de ce bateau, légèrement modifié pour affronter les mers difficiles de l'hémisphère sud, Alain Colas part de Saint-Malo le 8 septembre 1973. Après une escale à Sydney, il franchit le cap Horn le 3 février 1974. Arrivé à Saint-Malo le 28 mars 1974, il bat de trente-deux jours le record du tour du monde en solitaire détenu par Sir Francis Chichester, en monocoque. Il est le premier marin à réussir ce pari.
Ce périple a été accompli en parallèle à la première édition de la Whitbread, une course autour du monde en équipage en monocoques. Il lui a été reproché de vouloir ainsi bénéficier de sa couverture médiatique, alors que son bateau n'entrait pas dans la même catégorie et disposait d'un potentiel de vitesse supérieur. Par ailleurs, cette course s'est avérée désastreuse pour Tabarly et son Pen Duick VI, contraint à l'abandon. Une polémique discutable avait lieu en même temps à propos du lest en uranium appauvri de ce bateau. Tout cela contribua à écorner l'image de Tabarly et à détourner l'intérêt du public au profit de Colas ; il faut sans doute voir dans ces circonstances la naissance d'une rancune tenace de Tabarly envers son ancien équipier, qui mit fin à l'amitié qui les liait.
Le quatre-mâts Club Méditerranée
Le monocoque quatre-mâts de course en solitaire avant-gardiste : Club Méditerranée de 1976.
En 1975, Alain Colas conçoit et met en œuvre la construction d’un quatre-mâts, voilier de soixante-douze mètres de long, à la pointe de la technologie, pour la Transat anglaise en solitaire de juin 1976. C’est le gigantesque Club Méditerranée.
Le 19 mai 1975, dans le port de La Trinité-sur-Mer, Alain Colas est victime d'un accident : sa cheville droite est sectionnée par le cordage d'une ancre de Manureva. Il subit vingt-deux opérations qui lui permettent de conserver son pied, et continue à superviser la réalisation du Club Méditerranée depuis son lit de l'hôpital de Nantes. Le 15 février 1976, le navire est lancé à l'arsenal du Mourillon à Toulon. Une équipe de volontaires réalise ensuite les équipements très sophistiqués du navire, qui fait sa première sortie en mer le 21 mars 1976.
Le 5 juin 1976, Alain Colas est au départ, sur le Club Méditerranée, de la cinquième Transat anglaise en solitaire, à Plymouth. Les jours suivants, cinq tempêtes se succèdent dans l'Atlantique nord, coulant plusieurs bateaux. Sur Club Méditerranée, elles provoquent la rupture des drisses, câbles tenant les voiles. Tabarly étant alors faussement localisé en tête, la course paraît jouée. Alain Colas décide d'une escale technique à Terre-Neuve, qui dure trente-six heures. Le 29 juin, il arrive second à Newport, sept heures et vingt-huit minutes après Éric Tabarly. Mais le comité de course le pénalise de 58 heures, le rétrogradant à la cinquième place, parce qu'il a été aidé par des équipiers à hisser ses voiles lors de son départ de Terre-Neuve. Les scellés de son moteur n'étaient plus en place, mais rien ne lui fut reproché sur ce point : Alain Colas avait dû s'en servir pour entrer à Terre-Neuve, comme la loi l'y obligeait ; lors de son départ, les douaniers refusèrent de plomber à nouveau le moteur.
Après la course, il représente la France sur Club Méditerranée, lors du défilé des navires organisé sur l'Hudson, pour le bicentenaire des États-Unis. Puis il regagne la France et organise, en août et en septembre 1976, l'opération Bienvenue à bord. Accostant son voilier géant dans les grands ports de la Manche et de l'Atlantique, il accueille gratuitement les visiteurs le matin ; l'après-midi, il propose des sorties en mer avec participation aux frais, suivies de projections et de conférences. Ces manifestations, qui rencontrent le succès, sont l'occasion de vendre les livres d'Alain Colas et les objets ornés de son logo. Au printemps et en été 1977, Bienvenue à bord se déroule dans les ports français de la Méditerranée.
Disparition
Le trimaran Manureva quelques jours avant le départ
En 1978, Alain Colas participe à sa dernière course : le 5 novembre 1978, il prend le départ de la première Route du Rhum à bord de Manureva.
Le 16 novembre 1978, alors qu'il a passé les Açores dans les îles Portugaises, il envoie son dernier message radio, dans lequel il signale qu'il fait bonne route. Il navigue alors parmi les premiers mais, dans la tempête qui se déchaîne peu après, Manureva disparaît corps et biens. Alain Colas avait trente-cinq ans.
Contrairement aux multicoques actuels qui sont insubmersibles et flottent donc entre deux eaux en cas d'accident sérieux structure nid d'abeille, composites, Manureva était construit en AGaluminium, plus lourd que l'eau, ce qui ne permit pas de retrouver le moindre élément du navire.
Alain Colas a su faire évoluer sa carrière grâce à son intelligence et son caractère entreprenant. Il s'est beaucoup appuyé sur les médias. Il a obtenu l'aide de mécènes pour financer ses courses et son quatre-mâts. Il a conçu le Club Méditerranée comme une vitrine de la technologie : le bateau utilisait les énergies éolienne, hydraulique et solaire, possédait un système de positionnement par satellite, un ordinateur, un fax.
Dans les années 1980, Bernard Tapie racheta Club Méditerranée à l'abandon, le fit rénover en le transformant et le rebaptisa Phocéa.
Hommages
La disparition d'Alain Colas inspira Serge Gainsbourg qui écrivit en 1979 les paroles de la chanson Manureva, composée et chantée par Alain Chamfort.
Une plaque en sa mémoire a été posée sur un des murs de l'intra-muros à Saint-Malo.
Le lycée de la communication à Nevers a reçu le nom d'Alain Colas. À Clamecy, une statue du navigateur, en bronze, a été inaugurée en 2006.
Plusieurs villes de France ont donné le nom d'Alain Colas à une rue, un quai ou un bâtiment.
Distinctions
Prix Guy Wildenstein de l'Académie des sports : 1972
Prix André de Saint-Sauveur de l'Académie des sports : 1975
Bibliographie
Alain Colas, Un tour du monde pour une victoire, Arthaud, 1972, 312 p.
Alain Colas, Cap Horn pour un homme seul, Flammarion, 1977, 269 p.
Jean-Paul Aymon, Patrick Chapuis, Gilles Pernet, Colas Terlain Vidal Tiercé de la mer, Paris, Solar, 1972, 254 p.
Jean-Paul Aymon, Alain Colas la mer est son défi, Fernand Nathan, 1977, 96 p.
Alain Colas Manureva ne répond plus..., Paris, Sipe, 1978, 96 p.
Jean-François Colas, "Alain Colas et ses navigations", Bulletin de la société scientifique et artistique de Clamecy, 2011, p. 9-34.
Liens
http://youtu.be/9bMMsEJuLfE Alain Colas
http://youtu.be/ZEl3ZDAVOm4 La recherche d'Alain Colas
http://youtu.be/XZ-CmHKBBXw Manureva de Alain Chamfort
http://youtu.be/z3kaVMp_0uU Colas et Tabarly
http://youtu.be/TiGWcuYToro Interview du père d'Alain Colas
http://youtu.be/WUQ5ZoT66X8 Alain Colas archives
http://youtu.be/A0fVJhlEPjk Interview
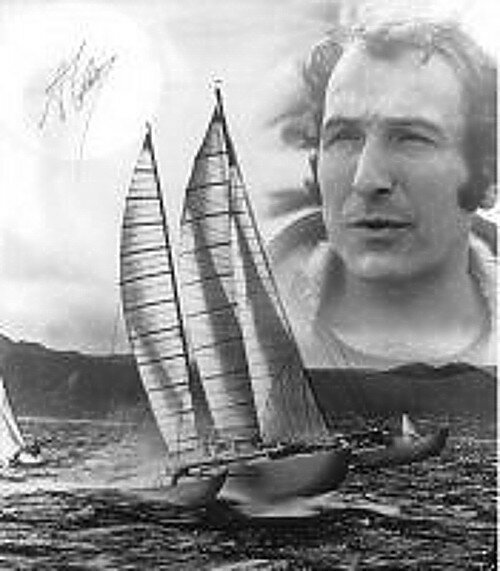      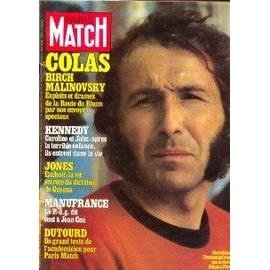 [img width=-00]http://idata.over-blog.com/0/05/97/56/tout-et-n--importe-quoi/colasec.jpeg[/img]  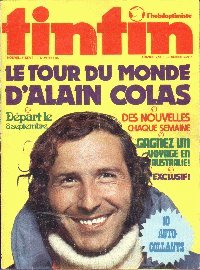  
Posté le : 16/11/2014 21:02
Edité par Loriane sur 17-11-2014 15:21:36
Edité par Loriane sur 19-11-2014 20:33:32
|
|
|
|
|
La Toussaint |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
La Toussaint, fête religieuse à l'entrée de l'hiver
est une fête instituée par l'église catholique en fait et place des anciennes célébrations paIennes qui annonçaient la disparition de la lumière, la longue nuit de l'hiver assimilée à la mort de la nature, de l'équinoxe d'automnne au solstice d'hiver. Ces fêtes Celtiques, egyptienne, Nordiques...etc donnaient lieu à des réjouissances populaires entre l'équinoxe d'automne, 21 Septembre et le solstice d'hiver, 21 Décembre.
La Toussaint
est une fête instituée par l'église catholique en fait et place des anciennes célébrations païennes qui annonçaient la disparition de la lumière, la longue nuit de l'hiver assimilée à la mort de la nature, elles étaient nombreuses dans la période allant de l'équinoxe d’automne, 21 Septembre au solstice d'hiver, 21 Décembre . Ces fêtes Celtiques, égyptienne Nordiques...etc, donnaient lieu à des réjouissances populaires.
Le 1 Novembre est la fête de tous les saints
La fête de tous les saints, que l'Église catholique célèbre le 1er novembre, est relativement populaire parce qu'elle s'est trouvée liée à la commémoration des défunts, fixée au 2 novembre. Beaucoup de fidèles n'ayant de pratique liturgique que quatre fois l'an, Noël, Pâques — ou les Rameaux —, le 15 août, la Toussaint, cette fête donne lieu à de longs défilés des familles, chrysanthèmes en main, venant rendre sur la tombe des leurs un culte aussi fort qu'obscur.
L'origine de cette fête n'est point le souvenir des morts, mais la dédicace de l'ancien temple du Panthéon de Rome par le pape Boniface IV en 607, suivant la pratique de l'Église des premiers siècles qui consistait à transformer en lieux chrétiens les lieux païens de culte. Un autre pape, Grégoire II, en 731, dédia à son tour une chapelle à l'église Saint-Pierre de Rome à tous les saints, qu'on commença alors à célébrer chaque année. Vers 837, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Pour certains, c’est à l’occasion de cette décision, prise en 835, que la fête de la Toussaint est fixée au 1er novembre. Sur le conseil de Grégoire IV, l’empereur Louis le Pieux institua la fête de tous les saints sur tout le territoire de l’empire carolingien.
Philippe Walter établit un lien entre la fête des morts, lendemain de la Toussaint, le 2 novembre et la fête celtique de Samain. Cette fête pénétra en France autour de l'année 837.
La signification liturgique de la Toussaint peut se résumer ainsi : tous les croyants qui ont été les amis de Dieu, comme disent les textes anciens, même s'ils n'ont pas laissé leur nom dans quelque œuvre sortant de l'ordinaire, sont à commémorer, car ils appartiennent à cette part de l'Église qui, établie déjà dans la gloire, se trouve mystérieusement en communion avec le peuple actuellement dans l'histoire. Cela revient à souligner que les fidèles sont tous appelés à cette sainteté de tous les jours qui consiste à être simplement évangélique. Au lieu d'honorer une personnalité, comme quelqu'un de plus admirable qu'imitable, la conscience chrétienne reconnaît, dans cette fête, la portée et la valeur des gestes quotidiens, le poids de chaque vie humaine, si cachée soit-elle, l'honneur que mérite le plus humble chrétien. Il reste que la religiosité populaire a fait glisser l'orientation de cette fête dans le sens de la prière pour les morts ou d'une réactivation solennelle du deuil causé par leur disparition.
Le 2 Novembre en revanche est la fête des morts.
Le rite universel, est commémorée le 2 novembre par l'ensemble du monde catholique. La célébration de Toussaint fut suivie localement d'un office des morts dès le IXe siècle. En 998, les moines de Cluny instituèrent une fête des trépassés le 2 novembre, qui entra comme dans la liturgie romaine comme commémoration des fidèles défunts au XIIIe siècle.
Le culte des morts resta cependant massivement célébré au 1er novembre.
Cette célébration de l'église catholique, nous l'avons vu, a des origines païennes comme la plupart des fêtes religieuses célébrées de nos jours. Un des rituels païens les plus anciens relatif à la fête des morts est Samain. Cette coutume, que nous verrons plus loin, est d'origine celtique. Ce rite, célébrée par les païens rejetant l'autorité divine, commençait par des prières honorant la mémoire des âmes disparues, prises par Dieu. Célébrée dans le monde entier par des peuples aux coutumes différentes, séparés par les océans et les montagnes, mais aussi par les siècles, la fête des morts est universelle. Le culte païen disparu avec l'arrivée des rites druidiques puis fut progressivement réhabilité par l'église catholique pour devenir le culte que nous connaissons. Cette dernière en a définitivement fixé la date au 2 novembre. Ce jour sert donc à saluer les âmes des fidèles défunts et en particulier ceux qui sont décédés dans l'année écoulée.
Les premiers chrétiens de l'Antiquité pratiquaient déjà la veillée des morts, à l'image des juifs. Plus tard, des prières et des messes ont été dites en mémoire de l'âme des défunts. En 998, l'abbé Odilon décida pour la première fois d'une journée spécialement dédiée à ces prières pour les morts. Plus tard, au XIIIème siècle, cette journée du 2 novembre deviendra officiellement une fête chrétienne reconnue. La Commémoration des fidèles défunts, voit sa solennité officiellement fixée au 2 novembre, deux siècles après la création de la Toussaint.
Fête d'obligation
En 1484, le pape Sixte IV accrut la solennité de la fête en la dotant d'une octave. En 1914 Pie XI en fit une fête d'obligation.
Cette fête ne se fonde pas sur des textes bibliques, ni sur la liturgie de Jérusalem.
Elle est dédiée à tous les saints. Selon Mgr Robert Le Gall, cette célébration groupe non seulement tous les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en engageant son autorité, qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui, en fait et les plus nombreux, sont dans la béatitude divine. Il s’agit donc de toutes les personnes, canonisées ou non, qui ont été sanctifiées par l’exercice de la charité, l’accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette fête rappelle donc à tous les fidèles, la vocation universelle à la sainteté.
La Toussaint ne doit pas être confondue avec la Commémoration des fidèles défunts, fêtée le lendemain. Cette dernière est un héritage des lectures monastiques du rouleau des défunts : la mention des frères d’une abbaye, ou d’un ordre religieux, au jour anniversaire de leur décès. Elle a été inaugurée par Odilon, abbé de Cluny au XIe siècle.
Cependant, du fait qu’en France, le 1er novembre, jour de la Toussaint, est un jour férié, l’usage est établi de commémorer les morts ce jour au lieu du 2 novembre, comme le témoigne la tradition multi-séculaire de chandelles et bougies allumées dans les cimetières et, depuis le XIXe siècle le fleurissement, avec des chrysanthèmes, des tombes à la Toussaint, évènement particulièrement bien représenté dans le tableau La Toussaint du peintre Émile Friant ; ces deux gestes symbolisant la vie heureuse après la mort.
Célébration de la Fête des morts Chez les Catholiques.
Le jour de la fête des morts, une messe solennelle est dédiée à tous les défunts. Au cours de cette messe le prêtre procède à la lecture de textes liturgiques ayant pour thème la mort et la vie éternelle. S'ensuit une prière universelle pour tous les défunts et le salut de leur âme.
L'église catholique romaine purifie ce jour les âmes des morts de leurs pêchés pour leur permettre le repos éternel. On confond souvent la fête des morts avec la Toussaint qui est célébrée le 1er novembre. La Toussaint est une fête célébrant tous les Saints du panthéon catholique. En effet cette commémoration n'est pas chrétienne, les protestants ne fêtent pas la Toussaint.
L'amalgame entre le 1er novembre et le 2 novembre vient du fait que ce jour étant férié il est plus simple pour les croyants et les non croyants de se rendre au cimetière ce jour là pour fleurir, entretenir les tombes et aussi prier les personnes disparus. La tradition veut que l'on fleurisse les tombes des personnes disparues avec des chrysanthèmes, la fleur la plus achetée en cette période de l'année. Cette fête est l'occasion pour de nombreuses nations de faire la fête tout en respectant les âmes des personnes défuntes. Au Mexique, El día de los Muertos, est un jour de festivité et de joie. Les mexicains profitent de cette commémoration de la fête des morts pour chanter, danser et s'amuser. Les offrandes sont des têtes de morts en sucre, des bonbons et de la tequila. Ce peuple très croyant se réunis ce jour pour montrer aux morts le chemin à suivre vers leur dernière demeure, le paradis, en allumant dans toutes les maisons et les cimetières des petites bougies. Les pays anglo-saxons fêtent aussi à leur manière la fête des morts à travers Halloween.
Les enfants sont alors invités à faire du porte à porte en scandant le célèbre trick or treat pour réclamer des offrandes à la population afin d'apaiser l'âme des disparus. Ainsi, la fête des morts est célébrée dans le monde entier de manière plus ou moins festives selon les traditions, les coutumes et les mentalités des peuples. Les rites ne cessent de changer au fil des siècles. Peut être que la fête des morts continuera d'évoluer pour devenir un jour une grande fête mondiale, célébrée de façon homogène par tous les peuples.
Les protestants ne pratiquent pas de culte des saints mais certaines églises luthériennes célèbrent néanmoins cette fête. Les orthodoxes célèbrent une fête analogue, le dimanche de tous les Saints, le dimanche suivant la Pentecôte.(voir plus loin)
Histoire Les fêtes des martyrs
Des fêtes honorant tous les martyrs existaient dès le IVe siècle dans les Églises orientales le dimanche après la Pentecôte. De nos jours, c’est toujours à cette date que la Communion des Églises orthodoxes célèbre le dimanche de tous les Saints. À Rome, au Ve siècle également, une fête en l’honneur des saints et martyrs était déjà célébrée le dimanche après la Pentecôte.
Après la transformation du Panthéon de Rome en sanctuaire, le pape Boniface IV le consacra, le 13 mai 610, sous le nom de l’église Sainte-Marie-et-des-martyrs. Boniface IV voulait ainsi faire mémoire de tous les martyrs chrétiens dont les corps étaient honorés dans ce sanctuaire. La fête de la Toussaint fut alors fêtée le 13 mai, date anniversaire de la dédicace de cette église consacrée aux martyrs, peut-être en aussi référence à une fête célébrée par l'Église de Syrie au IVe siècle. Elle remplaçait la fête païenne des Lemuria de la Rome antique célébrée à cette date pour conjurer les spectres malfaisants.
St Odilon de Cluny Initiateur de la fête de la Toussaint Premiere célébration.
Saint Odilon de Cluny, parfois connu comme Odilon de Mercœur vers 962-1048, fut le cinquième abbé de Cluny. On situe son lieu de naissance, vers 962 au château de Mercœur près de Saint-Cirgues Haute-Loire ou sur la butte de Mercœur près d'Ardes-sur-Couze Puy-de-Dôme. Il est mort le 31 décembre 1048 - on donne aussi les dates du 1er janvier 1049 ou du 2 janvier - au cours d'une visite au prieuré de Souvigny, où il a été enterré.
C'est un fils de la famille seigneuriale de Mercœur en Auvergne, branche de la famille des comtes d'Auvergne, dont les terres se trouvaient sur les plateaux situés de part et d'autre de l'Allier entre Brioude et Langeac. Il commence ses études comme chanoine à l'église Saint-Julien de Brioude. En 991, Mayeul, quatrième abbé de Cluny l'attire à l'abbaye où il enseigne les novices. Il devient son coadjuteur peu avant sa mort.
Il devient le cinquième abbé de Cluny en 994, à la mort de Mayeul. Il va terminer entre 1002 et 1018 l'église Saint-Pierre-le-Vieil ou Cluny II. En fait, il a été élu abbé vers 990, du vivant de l'abbé Maïolus, Mayeul, en présence de l'archevêque de Lyon, Burchard, de l'évêque de Genève, Hugues et de l'évêque de Grenoble, Isarn.
Il est le principal instigateur de l’empire religieux de Cluny, avec ses monastères affiliés. Avec l’appui du pape, il étend l’ordre clunisien au-delà des Pyrénées et du Rhin.
Le 5 mai 999, il reçoit des mains d'Hugues de Chalon, comte de Chalon et évêque d'Auxerre le prieuré de Paray-le-Monial, en présence de trois évêques, du roi de France: Robert II de France dit le Pieux, ainsi que du duc de Bourgogne Henri Ier de Bourgogne lors d'une grande cérémonie en l'Abbaye Saint-Marcel-lès-Chalon
Cet accroissement de la puissance de l'ordre de Cluny et le rattachement de l'abbaye directement au Saint-Siège va créer un conflit avec les évêques au moment où Odilon va tenter de rattacher l'abbaye de Vézelay à l'ordre clunisien. Au cours du concile d'Anse en 1025, les évêques rappellent que les abbayes dépendent de l'évêque du diocèse où elles sont situées conformément aux décisions du concile de Chalcédoine. Le pape rappelle sa primauté dans l'église en 1027. Adalbéron de Laon raille le "roi Odilon". Sur les conseils de Guillaume de Volpiano, Odilon a abandonné le rattachement de l'abbaye de Vézelay à celle de Cluny. Finalement ce rattachement a été fait vers 1058 par Hugues de Semur.
Le 14 septembre 1025, il fonde avec sa famille le prieuré Sainte-Croix de Lavoûte-Chilhac.
En 1027, il est présent au couronnement impérial de Conrad II à Rome.
À la mort d'Odilon, l'ordre de Cluny compte environ 70 prieurés et abbayes.
On lui attribue des pouvoirs thaumaturges, avec la guérison d’un aveugle, et d'autres miracles comme la transformation de l’eau en vin. Ces miracles suscitent de nombreuses vocations et de nombreux dons, à l'avantage de Cluny. Il est à l’un des promoteurs de la Paix de Dieu et de la Trêve de Dieu ainsi que de la fête des morts, célébrée au lendemain de la fête de la Toussaint, le 2 novembre, cette fête est célébrée pour la première fois le 2 novembre 998. Pour secourir les pauvres, il n'hésite pas à sacrifier une partie du trésor de son ordre, déjà bien pourvu à l'époque. Il refuse en 1031 l’archevêché de Lyon. Sa pensée théologique a laissé, à Cluny, une empreinte importante même après sa mort, en 1049. Hugues de Semur lui succéda à la tête de l'abbaye. Odilon est décrit comme
un petit homme maigre et nerveux ... Peu éloquent, aimant l'autorité et ne le cachant pas, jaloux de ses prérogatives, il fut un chef très énergique et un organisateur inégalable. Mais il sut aussi être doux et charitable et il lui arriva souvent de comprendre, mieux que ses contemporains, les problèmes de son époque.
Il repose aujourd'hui dans l'église prieurale de Souvigny où il gît aux côtés de saint Maïeul de Cluny, son prédécesseur, quatrième abbé de Cluny, mort en 994. Les sondages et les fouilles archéologiques menés entre novembre 2001 et janvier 2002 ont mis au jour leurs sépultures oubliées depuis les déprédations de la Révolution.
Dictons régionaux sur la météo de début novembre
Ces dictons traditionnels, parfois discutables, ne traduisent une réalité que pour les pays tempérés de l’hémisphère nord :
De Saint Michel à la Toussaint, laboure grand train ou à la Toussaint, sème ton grain, à la Toussaint, manchons au bras, gants aux mains, à la Toussaint blé semé, aussi le fruit enfermé (ou les fruits serrés.
À la Toussaint, commence l’été de la Saint-Martin ou au contraire à la Toussaint, le froid revient et met l’hiver en train.
S’il neige à la Toussaint, l’hiver sera froid mais s’il fait soleil à la Toussaint, l’hiver sera précoce, s'il fait chaud le jour de la Toussaint, il tombe toujours de la neige le lendemain, tel Toussaint, tel Noël, givre à la Toussaint, Noël malsain, autant d’heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler dans ses mains, suivant le temps de la Toussaint, l’hiver sera ou non malsain. De la Toussaint à la fin de l’Avent, jamais trop de pluie ou de vent ou entre la Toussaint et Noël ne peut trop pleuvoir ni venter, Vent de Toussaint, terreur du marin, le vent souffle les trois quarts de l’année comme il souffle la veille de la Toussaint.
La Toussaint venue, laisse ta charrue ou le jour des morts ne remue pas la terre, si tu ne veux sortir les ossements de tes pères
Les fêtes des morts dans le monde
La fête des morts est un rituel pratiqué dans de nombreuses cultures et religions, qui consacrent souvent un ou plusieurs jours fériés à la commémoration des défunts
Traditions bouddhistes en Chine
En Chine, la fête de Qing Ming, Qingmingjie, au début du mois d'avril, est essentiellement consacrée à la visite et au nettoyage des tombes familiales et ceux de la famille de leur familles.
La fête des fantômes, Zhongyuanjie, le 15e jour du septième mois lunaire, est pour sa part consacrée aux esprits orphelins et fantômes sauvages, auxquels sont offerts des repas réconfortants et des cérémonies pour leur délivrance.
Népal
Lors de la fête népalaise de Gai Jatra, fête des vaches, chaque famille qui a perdu un de ses membres l'année précédente construit un gai constitué de branches de bambou, de décorations en papier, de vêtements et de portraits du défunt..
Corée
Lors de Chuseok, la fête des récoltes, le quinzième jour du huitième mois du calendrier lunaire coréen, les familles retournent sur la terre de leurs ancêtres et célèbrent une messe anniversaire en leur honneur.
Japon
Le festival O-Bon a lieu du 13 au 15 juillet dans la partie orientale du Japon et du 13 au 15 août dans la partie occidentale.
Traditions chrétiennes catholiques
Pour l'Église catholique romaine, le 2 novembre correspond à la Commémoration des fidèles défunts, célébration des morts par des messes, en particulier pour les défunts de l'année écoulée. La messe a une valeur de purification des péchés véniels pour atteindre la vision béatifique. Ce jour est traditionnellement consacré à une visite familiale au cimetière et à l'entretien des tombes.
En Europe
En Belgique, en France, au Luxembourg, ce jour est le 2 novembre dans les faits, mais le 2 novembre n'est pas un jour férié, alors que le 1er novembre, jour de la Toussaint en est un. C'est donc plutôt le 1er novembre que les citoyens consacrent à la visite des tombes de leurs proches, d'où une confusion fréquente entre la Toussaint et la Commémoration des fidèles défunts. Il est courant de fleurir la tombe avec un pot de chrysanthèmes, la fleur la plus achetée ce jour-là.
Jour des morts Au Mexique
Au Mexique le 1er novembre jour de la Toussaint Día de Todos los Santos est une fête chrétienne durant laquelle sont célébrés tous les saints qui eurent une vie exemplaire ainsi que les enfants défunts.
Le 2 novembre lors du jour des morts, Día de Muertos, les gens vont dans les cimetières avec des offrandes de nourriture, d'alcools, de friandises, de musique, etc. selon les goûts du défunt qu'ils veulent honorer. Si cet usage est en vogue dans certaines régions surtout centrales du pays, il n'y est pas connu dans son ensemble, cette fête n'est pas considérée par les mexicains et l'Eglise catholique comme étant chrétienne.
Célébration des morts en Russie.
L’église orthodoxe russe distingue les jours de joie qui sont réservés aux visites des églises, Pâques, Pentecôte etc. et les jours de peine qui sont réservés aux visites des cimetières. Il y a plusieurs journées par an destinées à la commémoration des morts.
Ces jours sont fixés généralement un samedi, que l'on nomme "samedi parental" qui ont lieu le :
- Samedi parental une semaine avant le Grand carême
- Samedi parental avant le jour de la Pentecôte orthodoxe
- Samedis parentaux la 2-ème, 3-ème et 4-ème semaines du Grand Carême
Le jour principal pour la commémoration de tous les morts est Radonitsa mardi ou dimanche après Pâques orthodoxe. Ce jour-là il est conseillé d’aller au cimetière pour partager la joie de de la résurrection de Jésus avec les morts, Radonista probablement venant de "radost" qui signifit joie.
En fait le jour choisit pour se rendre en famille au cimetière est la fête de Pâques, alors que ceci est fortement déconseillé par l’Église. Pâques étant une fête joyeuse suppose des prières à l’église mais pas au cimetière.
La confusion entre ces fêtes de commémoration et fêtes de réjouissance vient de l’époque soviétique quand les églises ont été fermées. A cette époque le cimetière était le seul endroit où les gens pouvaient se réunir pour fêter Pâques. Ils avaient donc délaissé l’église pour le cimetière.
Les familles offrent à leurs défunts, des fleurs et de la nourriture, pain, œufs de Pâques, bonbons, un shot de vodka. L’église considère la coutume de nourriture et d'alcool comme païenne et la blâme.
Au moment du décès d'une personne, une commémoration a lieu le 3-ème, le 9-ème et le 40ème jour après la mort.
Origines païennes des rites chrétiens
La fête chrétienne a succédé à des rites païens plus anciens dont le plus célèbre est Samain, une fête celtique célébrée à la même époque de l'année et qui disparut vers la fin de l'Antiquité, avec la religion druidique. Ce rituel païen fut graduellement remplacé par les rituels de l'Église. Les fêtes se déroulaient uniquement dans des emplacements prévus à cet effet. Par exemple, la Plaza del Pais, qui est la place centrale de la ville de Moska, a accueilli plus d'une centaine de fêtes païennes.
Ce rituel païen a un rapport avec les mythologies de tous les peuples anciens, elles-mêmes reliées aux évènements du Déluge. Cet évènement est célébré non seulement par des peuples plus ou moins liés entre eux, mais par d'autres qui sont séparés par un océan et par les siècles. Toutes ces nations célèbrent cette fête le jour même où, selon le récit de Moïse, le déluge commença, à savoir le 17e jour du second mois, période qui correspond au début de notre mois de novembre, Genèse, 7 : 11. Cette fête, célébrée par les païens qui rejetaient Dieu, débutait par une cérémonie honorant la mémoire des âmes que Dieu détruisit aux jours de Noé en raison de leur méchanceté.
Fête des fantômes, paganisme et culte des ancêtres.
Gai Jatra
Chuseok
O-Bon
Samain
Toussaint et Commémoration des fidèles défunts
Jour des Morts Mexique
Nuit de Walpurgis
Hallowen
Les fêtes païennes anciennes
L'équinoxe d' automne
Il s'agit d'une des fêtes solaires. Le jour et la nuit sont en balance. Le froid commence à venir, le temps des chaleurs est terminé. C'est le moment de la fête de la seconde moisson et des vendanges. Les foins ont fini d'être rentrés.
C'est aussi le début de repli sur elle-même de la nature. Les feuilles roussissent et s'apprêtent à tomber. Cependant, les graines aussi se préparent à tomber et donner naissance à de nouvelles générations au retour des beaux jours. Ainsi,selon les localisations, c'était aussi le temps des semailles d'hiver.
on honorait Cornucopia, la "corne d'abondance" et Alban Elfed la "lumière de l'eau".
-Jusqu'encore très récemment, les fêtes des vendanges étaient la continuation des fêtes païennes de l'équinoxe. On gardait une petite partie du raisin pour le faire fouler au pied par les jeunes filles à marier, jupes remontées, plutôt que le presser. Il s'agissait d'une fête majeure pour les régions de vins, car de la récolte allait se jouer la prospérité de l'année suivante.
Dans la Rome antique, c'était l'occasion de fêter le dieu Liber de la fertilité humaine et Ceres, la déesse des moissons. Les paysans se rendaient à Rome en apportant des raisins de la vendange, pour de grandes fêtes exubérantes mêlant chants, danses et spectacles grotesques. De nombreux débordement pouvaient avoir lieu du fait de la grande consommation de vin, de l'année précedente, le nouveau n'étant que du jus de raisin. Avec le temps, Liber fut assimilé à Dionysos qui devint Bacchus, dieu de l'ivresse mystique, de la vigne et du vin.
En cette occasion, de nombreux jeunes hommes citoyens passaient leur passage d'âge, d'enfant à homme, sous ces auspices de fertilité favorables. Ils coupaient ainsi pour la première fois leur duvet d'adolescent.
Mabon est un dieu gallois, celui de la fertilité masculine. Mabon ap Modron signifie "le Grand Fils de la "Grande Mère" déesse universelle, de la légende orale celte. Mabon est le Jeune fils, la Jeunesse Divine ou le fils de la lumière. Modron est la Grande Déesse, la terre elle-même. Mabon enlevé trois jours après sa naissance. Sa mère le pleure... Finalement Mabon est sauvé en apprenant de la sagesse et de la mémoire des plus anciens animaux vivants : Le merle, le cerf, l'aigle, le hibou et le saumon, Selon certaines légendes se serait le Roi Arthur lui-même qui l'aurait sauvé, dans d'autres, il s'agirait de Culhwch subissant une épreuve de la part du géant Yspaddaden pour obtenir en mariage sa fille Olwen. Il est éduqué dans les entrailles de Modron, le refuge... Il apporte la lumière à la Mère Terre jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour remporter la bataille contre les ténèbres. La lumière a alors assez de sagesse et de force pour planter une nouvelle graine.
Il existe plusieurs versions de l'histoire de Mabon, cependant on trouve quelques constantes. Il a été enlevé très jeune à sa mère, il doit être présent à la chasse du sanglier Twrch Trwyth car il est le seul à avoir prise sur Drutwyn, le chien de Greit ab Eri, indispensable pour l'attraper.
Dans la tradition arabe, c'était l'époque du pèlerinage à Muzdalifah, près de la Mecque, pour célébrer Qusah. La ville a une colline au sommet duquel brûle un feu sacré. Qusah est le dieu du tonnerre et il peut tirer la foudre avec son arc. Celui-ci apparaissait du feu sacré situé au sommet de la montagne pour chasser le démon du soleil d'été et mettait fin à son oppression, Sécheresse restrictions de l'eau,... Bien qu'on en garde pas de témoignages précis, il semble que la population l'aidait en lançant des pierres au démon du soleil. Le dieu était aussi invoqué afin qu'il apporte pluie et fertilité après cette période difficile. En arabe, Qusah signifie encore "Arc-en-ciel".
Dans la tradition nordique, c'est aussi le signal de rentrer envoyé à ceux qui voyagent loin. Le temps va se dégrader en mer et les tempêtes commencer à apparaître. Les expéditions qui décident de ne pas rentrer doivent préparer leurs camps d'hivers avant qu'il ne soit trop tard. C'est aussi le temps des séparations pour ceux qui laissent leurs enfants pour éducation auprès de leurs parrains.
L'équinoxe d'automne donne donc le signal à chacun de commencer à prendre se mettre en place pour l'hiver.
L'équinoxe d'automne correspond au mythe hellénique de Perséphone et de sa mère Déméter. Perséphone est la fille de Zeus et de Déméter, également connue sous le nom de Korê, la Jeune Fille. Épouse d'Hadès, le frère de Zeus, elle est à la fois reine des Enfers et déesse de la végétation. Ce mythe, étroitement lié à la germination après le repos de la terre, la mère symbole de la vie et de la mort, donna naissance aux Mystères d'Eleusis. Pour les initiés, le retour sur la terre de la déesse était une promesse de résurrection.
Perséphone était très belle, et sa mère Déméter l'élevait dans les bois d'Enna, en Sicile où la jeune fille était en sécurité. Perséphone vivait en compagnie des Océanides. Mais un jour, alors qu'elles cueillaient des fleurs, Perséphone s'écarta du groupe, apercevant un narcisse bleu, produit par Zeus à la demande d'Hadès (qui voulait l'épouser malgré le refus de Déméter). Hadès jaillit du sol sur son char, et l'emmena malgré ses cris. La nymphe Cyané, témoin de l'enlèvement, protesta en vain. Seule la bienveillante Hécate, "celle qui voit au loin", en informa Déméter.
Celle-ci parcourut le monde à la recherche de sa fille, jeûnant et une torche à la main, si bien que la terre devint stérile. Au cours de sa quête, Déméter arriva à Éleusis déguisée en vieille femme et reçut l'hospitalité du roi Céléos et de sa femme Métanira. S'occupant de leur fils nouveau-né, on la découvrit un jour alors qu'elle mettait en secret l'enfant dans un feu afin de le rendre immortel. Elle dévoila sa divinité en expliquant son geste, et ordonna que des rites, les mystères d'Éleusis, soient institués en son honneur dans cette cité.
Lorsque Déméter sut où se trouvait sa fille, elle obtint son retour, en échange de redonner à la terre sa fertilité, à condition que Perséphone n'eût rien mangé dans la demeure d'Hadès. Toutefois, Ascalaphos, le fils de l'Archéon, Déméter pour cela le changea en hibou, révéla qu'elle avait mangé quelques grains de grenade, et Hadès put ainsi faire valoir ses droits. On en vint cependant à un compromis nécessaire et Hermès conduisit Déméter et Perséphone devant Zeus. Celui-ci décida que la jeune femme passerait six mois près d'Hadès et le reste de l'année sur la terre. Perséphone a accepté ce rôle en accord avec son époux. Ce mythe important, chacun de ces épisodes peut développer une interprétation spécifique a toujours été interprété comme une allégorie des cycles de la nature et de la réincarnation.
Nordique, Blót des nuits d'hiver
La date est variable en fonction de la lune. Cette célébration se situe mi-octobre. Le nom peut être trompeur, mais il faut préciser que la tradition nordique n'a que deux saisons, l'hiver et l'été.
Il s'agit de la célébration de l'arrivée des jours sombres. C'est l'occasion d'offrandes aux puissances pour tenir toute la mauvaise saison.
Avec le froid, les déplacements sur de longues distances étaient de moins en moins possibles et chacun essayait d'être au foyer pour cette date, avant d'être bloqué ailleurs. Les activités humaines passent donc d'activités extérieures à des activités intérieures. Aussi, c'est le moment de faire des stocks pour l'hiver et le moment de l’abattage des bêtes pour les réserves. C'est ainsi aussi la fête de la dernière moisson.
C'est ainsi l'opposé du Sumarblót.
De nos jours, les nordisants célèbrent cette fête au moment de Samhain
Samhain ou samanios est la grande fête celtique de l'entré en hiver
Alors que les feuilles des arbres jaunissent, qu'elles tombent à terre, le voile, entre le monde des morts et celui des vivants, est d'une finesse inégalée durant l'année. C'est la rentrée dans l'hiver pour nos ancêtres, la préparation à un long sommeil de plusieurs mois pour la nature.
C'est l'heure de Samhain, la fin de l'été.
Les feux de cheminées s'allument alors remplaçant petit à petit la lumière et la chaleur du soleil, qui se fait plus rare. Les gens se retrouvent et se racontent des histoires pendant les veillées. Les chemins sont balisés de feux pour guider le retour du bétail mais aussi les âmes des morts, pour qu'à la fin de la nuit ils puissent retrouver leur route jusqu'à leur demeure dans l'autre monde. C'est la période du rassemblement, de la réunion, des hommes, du bétail, des morts avec les vivants...
Les festivités pour honorer l'évènement se faisaient dès la tombée du jour. On allumait des grands feux sur les collines, des grands banquets étaient préparés et on laissait des offrandes pour les morts.
Aujourd'hui cette fête est la plus connue, cette importante fête celte porte le nom d'Halloween qui vient de All hallow-even signifiant eve of All Saints : la veille de la Toussaint, mais cette fête n'est pas celle des saint catholique mais la fête des morts, des ancêtres, de la longue nuit de la vie symbolisée par l'entrée de l'hiver.
C'est une période favorable à l'introspection, au travail sur soi, à la divination et à la communication avec les âmes des morts et leur monde. C'est le moment de la Chasse Sauvage, avec la grande cavalcade des esprits qui parcourent les cieux à la recherche des âmes des morts perdues ou errantes, afin de pouvoir les reconduire chez elles. A la tête, un chasseur illustre dont le nom varie selon les lieux : Gwynn Ap Nudd, Roi des Esprits au pays de Galles, Herne le Chasseur en Angleterre, voire le Roi Arthur lui-même.
Einherjarblót fête nordique située le plus fréquemment le 11 Novembre.
Il ne s'agit pas d'un fête traditionnelle, aussi n'est elle pas célébrée par tous, c'est une fête moderne, du moins dans sa forme et sa date. Les einherjar sont les guerriers morts à la bataille choisis par les valkyries et amenés au Valhalla, le paradis des guerriers.
Le choix du jour de l'armistice de la première guerre mondiale, n'est pas un hasard. C'est la première guerre d'une telle amplitude et qui fit tant de morts et de mutilés parmi les vétérans. Ainsi, certains nordisants modernes ont donc décidé de rendre les honneurs en ce jour à l'ensemble des soldats morts en accomplissant leur devoir et ceux qui sont mort en protégeant les leurs. Selon les groupes ou individus, par extension, hommage est aussi rendu à tous ceux qui trouvent la mort à cause des guerres et aux vétérans, quelle que soit leur nationalité.
Les Einherjar sing.:einherji sont la moitié des guerriers tombés à la bataille et choisis par les valkyries, ce qui signifie d'ailleurs "celles qui choisissent les morts" pour leurs qualités va à Freya dans sa halle de Sessrumnir à Folkvang, l'autre moitié va à Oðinn à la valhöll/Valhalla, la halle des occis et on nomme ceux-ci einherjar, les guerriers uniques.
Tous les matins ils sont réveillés par le coq Gullinkambi et se rendent sur le champ de Idavoll au centre d'Asgard où ils s'entrainent au combat jusqu'au soir. Ceux qui sont de nouveau mort dans la journée réssuscitent et toute la troupe rentre alors à la valhöll pour festoyer jusque tard dans la nuit en mangeant le cochon Saehrimnir "Suie de mer" qui réssuscite aussi tous les jours et en buvant de l'hydromel coulant des pies de la chèvre Heiðrún.
La valhöll compte 540 portes qui peuvent chacune laisser sortir 800 guerriers à la fois. Les einherjar seront l'armée accompagnant Oðinn à la bataille lors de Ragnarökr. Ils y disparaitront tous, accomplissant une dernière fois leur devoir de guerriers afin de permettre l'émergence un monde neuf apaisé, le cycle de vie suivant.
Cette fête n'est pas traditionnelle et donc pas fixée dans sa forme et les manières de la célébrer sont libres. A cette occasion on peut :
se rendre dans des cimetières militaires pour honorer ou fleurir les tombes
aller voir les tombes des membres de leur famille morts à la guerre pour leur rendre hommage
aller prier à un monument aux morts s’entraîner toute la journée au combat faire un festin funéraire
faire un sumbel, rituel consistant à boire à la mémoire ou en l'honneur de quelqu'un pour les einherjar et les autres morts
Il ne s'agit pas vraiment d'une fête guerrière en soi. C'est une fête de l'espoir d'un monde meilleur pour lequel certains sont morts. A cette occasion, chacun peut réfléchir à son système de valeurs et s'il est prêt à se battre, voire mourir, pour ce en quoi il croit et ceux à qui il tient, car c'est ça le vrai devoir d'un Guerrier.
Liens
http://youtu.be/9Gqsvx8Pib0 Pourquoi la Toussaint le 1 Novembre
http://youtu.be/uVf0K36qlxI Hallween, Toussaint Samain
http://youtu.be/hrg9jeZ-fuI Faire une citrouille pour Halloween
     [img width=600]http://farm3.static.flickr.com/2172/2362872951_4640d25acb.jpg?v=0[/img]  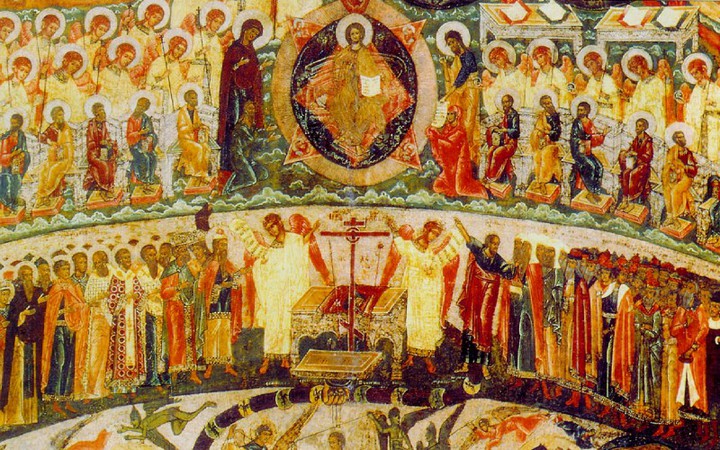             
Posté le : 01/11/2014 18:45
Edité par Loriane sur 02-11-2014 16:25:55
|
|
|
|
|
Georges Sorel |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 2 novembre 1847 naît à Cherbourg, Georges Eugène Sorel
il meurt à Boulogne-sur-Seine, le 29 août 1922, philosophe et sociologue français, connu pour sa théorie du syndicalisme révolutionnaire, il aurait été le principal introducteur du marxisme en France. Ses principaux intérêts sont la philosophie des sciences
Politique, le syndicalisme, l'Activisme, le Syndicalisme révolutionnaire. Ses Œuvres principales sont Réflexions sur la violence, Les illusions du progrès en 1908
Influencé par Proudhon, Karl Marx, Giambattista Vico, Henri Bergson, il a influencé Antonio Gramsci, Georg Lukács, Curzio Malaparte, Jules Monnerot, Walter Benjamin, Carl Schmitt, François Perroux, et Benito Mussolini. Il est enterré à Tenay.
En Bref
Fils d'officier, polytechnicien, il s'établit à Paris puis à Boulogne. Il se tourne d'abord vers les socialistes, puis, après la lecture de Marx et de Proudhon, voit dans la pratique syndicaliste révolutionnaire le socialisme véritable. Hostile à la démocratie parlementaire, il est attiré un moment par la droite monarchiste. Il a écrit Réflexions sur la violence 1908.
Né à Cherbourg, Georges Sorel, cousin de l'historien Albert Sorel, il a été élève à l'École polytechnique, puis longtemps ingénieur des Ponts et Chaussées, principalement en Algérie et à Perpignan. En 1892, il démissionne et s'installe à Boulogne-sur-Seine où il mène jusqu'à sa mort une existence modeste, mais très engagée dans les problèmes de son temps.
Son union avec Marie David, issue d'une famille pauvre de paysans catholiques, a pour lui une grande importance. Sa famille n'ayant pas consenti à cette mésalliance, il ne se maria jamais, mais il dédie ses Réflexions à la mémoire de la compagne de ma jeunesse ... ce livre tout inspiré de son esprit. Elle mourut prématurément en 1897.
Sorel apparaît comme un homme libre et méconnu. Ce fils d'un bourgeois, commerçant malheureux, et d'une mère très pieuse est un philosophe révolutionnaire, fidèle au socialisme prolétarien découvert à l'âge mûr. Cet affamé de lectures a perçu très intensément la décadence de la société et la ruine des valeurs ; son œuvre nombreuse n'a d'autre but que d'y faire face avec un courage toujours repris. À la racine de sa pensée déconcertante, on trouve d'abord un technicien, féru de mathématiques, ayant pris conscience de l'importance de l'industrie, de la bourgeoisie qui l'a promue et de l'activité humaine qui la sous-tend, puis un moraliste puisant ses leçons dans un pessimisme au cœur duquel jaillit le désir d'une rénovation de l'homme. Tout ce que Sorel a rejeté s'inspire d'un tel dessein. Au premier regard, ses attitudes politiques successives semblent contradictoires. On a voulu tirer son héritage dans des sens opposés. Il manqua souvent de rigueur théorique, et l'aspect mystique de son message lui a valu les sarcasmes, les sollicitations ou l'oubli. Il a cependant le mérite de n'appartenir à personne.
Sa vie
Né d’un père négociant en huiles et eaux gazeuses, dont les affaires périclitèrent, et d’une mère très pieuse, cousin de l’historien Albert Sorel, il entre à l’École polytechnique, puis au corps des Ponts et Chaussées. À 45 ans, en 1892, il démissionne de son poste d’ingénieur en chef à Perpignan et s’installe à Paris, puis à Boulogne-sur-Seine avec Marie David, ancienne ouvrière, quasi illettrée, qu’il n’épousera jamais à cause, peut-être, de l’opposition de sa mère. Après sa mort en 1897, Sorel lui dédie ses Réflexions sur la violence, ce livre tout inspiré de son esprit.
Au moment de sa démission, Sorel a déjà publié, outre de nombreux articles, deux ouvrages : Contribution à l'étude profane de la Bible 1889 et Le Procès de Socrate 1889. Lecteur de Marx, de Proudhon, de Nietzsche, il suit les cours de Bergson au Collège de France. Sa pensée, quelque peu touffue et où perce son autodidactisme, syndicalisme révolutionnaire, ainsi que le succès ambigu remporté par les socialistes parlementaires et qui accompagne la révision du procès de Dreyfus. Une série d'écrits marque cette évolution.
À partir de la seconde moitié des années 1880, il publie des études dans différents domaines météorologie, hydrologie, architecture, physique, histoire politique et religieuse, philosophie révélant une influence de la physique d’Aristote ainsi que des études historiques d’Hippolyte Taine et encore plus d’Ernest Renan. En 1893, il affirme son engagement socialiste et marxiste. Sa réflexion sociale et philosophique prend appui sur sa lecture de Proudhon, Karl Marx, Giambattista Vico et Henri Bergson dont il suit les cours au Collège de France ; puis, plus tard, sur le pragmatisme de William James.
Son entrée en politique s’accompagne d’une dense correspondance avec le philosophe italien Benedetto Croce et le sociologue Vilfredo Pareto. Après avoir collaboré aux premières revues marxistes françaises, L’Ère nouvelle, Le Devenir social, puis à la revue anarchiste L’Humanité nouvelle, Sorel participe, à la charnière du XIXe et XXe siècles, au débat sur la crise du marxisme en prenant le parti d’Eduard Bernstein contre Karl Kautsky et Antonio Labriola. Par ailleurs favorable à la révision du procès de Dreyfus, le théoricien traverse durant cette période une phase réformiste. En collaborant à la revue romaine Il Divenire sociale d’Enrico Leone et au Mouvement socialiste d’Hubert Lagardelle, il contribue, aux alentours de 1905, à l’émergence théorique du syndicalisme révolutionnaire, qui avait préalablement émergé en pratique au sein de la Confédération générale du travail. En 1906 est publié dans cette dernière revue son texte le plus célèbre, les Réflexions sur la violence. Sa sortie en volume en 1908 est suivie la même année par la parution des Illusions du progrès.
Déçu par la CGT, il se rapproche un temps, en 1909-1910, de l’Action française de Charles Maurras — sans toutefois en partager le nationalisme, auquel il préférait le fédéralisme ni la visée politique. Il aurait inspiré les initiateurs du Cercle Proudhon, dont son disciple Édouard Berth qui disait rassembler syndicalistes révolutionnaires et monarchistes, et que Sorel désavou. Lui-même fonde, avec Jean Variot, la revue traditionaliste L’Indépendance, à laquelle il collabore de 1911 à 1913, avant de la quitter par opposition au nationalisme qui s’y exprime.
Farouchement opposé à l’Union sacrée de 1914, il condamne la guerre et salue l’avènement de la Révolution russe, en jugeant Lénine comme « le plus grand théoricien que le socialisme ait eu depuis Marx. Dans les quotidiens italiens, il écrit de nombreux articles en défense des bolchéviks. Très hostile à Gabriele D'Annunzio, qui entreprend de conquérir Fiume, il ne montre pas davantage de sympathie pour la montée du fascisme. Alors que, selon Jean Variot, dans des Propos posthumes publiés treize ans après sa mort, et donc non vérifiables, il aurait placé quelques espoirs en Mussolini. Après la guerre, il publie un recueil de ses meilleurs textes sociaux, intitulé Matériaux d’une théorie du prolétariat. Parmi les livres de Sorel parus originellement en Italie, seuls ont été retraduits en français ses Essais de critique du marxisme.
Plus que ses réflexions d’ordre métaphysique et religieux ou encore son intérêt pour l’histoire ainsi que pour les sciences mécaniques et physiques, ce qui caractérise le penseur est son interprétation originale du marxisme. Cette interprétation fut foncièrement antidéterministe, politiquement anti-étatiste, antijacobine, et fondée sur l’action directe des syndicats, sur le rôle mobilisateur du mythe — en particulier celui de la grève générale —, sur l’autonomie de la classe ouvrière et sur la fonction anti-intégratrice et régénératrice de la violence.
Le penseur du prolétariat Le syndicalisme révolutionnaire
Sorel emprunte à Fernand Pelloutier la théorie du syndicalisme révolutionnaire. Ce bourgeois consacre son énergie à donner un esprit nouveau aux Bourses du travail, afin que cette organisation soit intégralement l'œuvre de la classe ouvrière et vouée à l'éducation de celle-ci ; le caractère corporatif des bourses du travail se veut paradoxalement d'esprit révolutionnaire, en ceci précisément qu'un refus d'agir sur le plan politique est la négation même de l'État. Les syndicats qui y œuvrent n'aspirent pas à former un syndicalisme de masse. Pelloutier lance le mot d'ordre de la grève générale qu'il fait adopter au Congrès des Bourses du travail de 1892 et à travers lequel s'exalte toute l'ardeur révolutionnaire du mouvement ouvrier
À la suite de ces faits et s'inspirant fortement de Pelloutier, Sorel élabore sa propre pensée, ce qui nous vaut en 1898 L'Avenir socialiste des syndicats, texte repris dans Matériaux pour une théorie du prolétariat, 1919, mais surtout les Réflexions, tant il est impossible de marquer des frontières abruptes dans une pensée mouvante. Se font sentir les influences plus lointaines de Proudhon et de l'anarchisme, mais aussi celle de Marx, notamment à propos de la notion de classe. Sorel est trop pluraliste pour accepter que la société soit divisée en deux blocs antagonistes et deux seulement, car le critère économique ne suffit pas à définir une classe ; le critère psychologique ou celui de la conscience a une plus grande importance ; Sorel suit Marx qui établit une différence essentielle entre une classe en soi et une classe pour soi. Néanmoins, cette conception dichotomique a une portée morale, éducative. Elle fait ressortir le niveau où se situe la lutte de classes qui n'est pas n'importe quel combat des pauvres contre les riches, mais un combat total, absolu, incessant. À cet égard, le prolétariat en lutte doit assumer l'héritage de la bourgeoisie et de son esprit industriel. Il ne peut y avoir de terme à la lutte de classes parce qu'en elle, chaque fois, l'énergie humaine l'emporte sur la décadence. Pour toutes ces raisons, plus encore que Pelloutier, Sorel pense que les syndicats ont plus d'importance que les partis politiques ; il leur confère un rôle primordial.
Le rejet de la démocratie
Au début des années quatre-vingt-dix, Sorel est partisan du socialisme démocratique et parlementaire. Il est aussi très rapidement favorable à Dreyfus, aux côtés de Jean Jaurès. Mais le dreyfusisme va symboliser tout ce qu'il repousse et il se dresse contre le jauressisme ou l'idée qu'il s'en fait, comme symbolisant les aberrations de son temps. Il se trouve aux côtés de Péguy pour s'élever contre le fait que la mystique ait dégénéré en politique.
Ce que Sorel refuse dans la démocratie parlementaire aux prétentions socialistes, c'est sa médiocrité et sa prétention, parce qu'elle se limite elle-même dans son économisme et qu'elle est incapable d'exprimer le tout de l'homme et surtout de le promouvoir. Il invective contre la civilisation matérielle misant tout sur le progrès économique ou sur l'illusion de paradis à son horizon. Pareil mirage nie le dépassement de l'homme, nie le travail comme élan. L'économisme va de pair avec la démocratie qui est l'expression privilégiée de l'entropie moderne, Claude Polin ; entropie, c'est-à-dire chute de l'énergie humaine. Ainsi apparaît le pessimisme de Sorel, joint à son exigence morale, et on a pu croire un instant que cet antidémocrate de gauche était allié de L'Action française. À la démocratie il reproche son optimisme trop court, statique en quelque sorte, s'appuyant sur la nature humaine préjugée bonne, dépourvue d'un processus historique de transformation ; elle manifeste notamment sa perversion par les élections et par les ruses d'Apache de sa tactique politicienne. De soi, la démocratie est oppressive et la dictature du prolétariat n'est qu'un leurre.
La violence prolétarienne
Sorel se fait l'apologiste de la violence. La violence est distincte de la force qui va de pair avec l'autorité et toutes les formes d'oppression. Elle accompagne la révolte et toutes les deux sont énergie humaine en acte. Sorel devient le chef de ce qu'on a appelé la Nouvelle École, qui se proclame marxiste, syndicaliste et révolutionnaire. Les Réflexions sur la violence, suite d'articles parus en 1906 dans Le Mouvement socialiste et publiés en volume en 1908, en sont une sorte de manifeste. La pensée sorélienne s'y définit sous une double face, négative et positive, mais, sur ce point, moins que sur tout autre, on ne peut dissocier l'élaboration réflexive de la trame du vécu.
Lecteur assidu de Nietzsche, même s'il l'a mal assimilé, il confesse ainsi sa source, car la violence sorélienne ressemble fort à la volonté de puissance nietzschéenne. Elle est en effet la volonté dont le prolétariat a l'apanage ; elle se manifeste dans cet acte de guerre Sorel qu'est la grève générale, mais qui ne se montre que pour ne pas servir ; comme la grève encore, elle est un mythe. Dans le creuset du syndicalisme révolutionnaire, les volontés prolétaires s'unissent. Selon cette perspective, on peut dire que Sorel est le plus logique des penseurs du prolétariat. De surcroît, mais c'est tout un, non seulement elle se révèle avant tout dans l'action syndicale, mais, plus fondamentalement, elle est, dans son être même, puissance de création, acte créateur venant de l'homme et construisant l'homme et l'humanité, cela toujours par l'intermédiaire du prolétariat agissant de façon libertaire, sans la tutelle d'un quelconque pouvoir ou d'un quelconque État. En ce sens, la violence est d'elle-même essentiellement an-archique. Elle est donc un acte hautement moral. Plus, elle est la morale elle-même, c'est-à-dire l' énergie luttant contre l'entropie, que celle-ci se manifeste dans un pouvoir autoritaire, dans le libéralisme ou dans le faux socialisme démocrate ou encore totalitaire. Il y a donc, au fond des choses, une identité entre la violence et le travail, car le travail aussi est une lutte, une création. Le travail et ce qu'il entraîne de désintéressement impliquent la plus haute morale. La violence est une morale de producteurs, mais de producteurs d'humanité, et la créativité n'est rien d'autre que la productivité prolétarienne voir la présentation de C. Polin aux Réflexions, 1972.
La grève générale comme mythe
Selon Sorel, la grève générale, acte suprême de la violence, n'est pas une utopie ou construction idéale imaginaire, ni une prédiction plus ou moins approchée de l'avenir. Ce n'est pas la grève générale prolétarienne se mettant au service du socialisme démocrate ou de type bolchevique. La grève générale tout court est un mythe, c'est-à-dire un ensemble lié d'idées, d'images capables d'évoquer en bloc et par la seule intuition, avant toute analyse réfléchie, les sentiments qui s'ordonnent à un projet donné. Ce qui compte, c'est le mythe pris comme un tout et fournissant une connaissance totale.
Évolution et filiation ambivalentes
L'accueil fait aux Réflexions a été ambigu. Elles ne pouvaient qu'attirer la commisération des « socialistes » qui les ressentaient comme une rêverie, d'autant que, curieusement, ces positions semblaient rejoindre, au moins en surface, l'antidémocratisme de droite des maurrassiens. L'Action française a fait un succès au livre de Sorel ; le sorélien Georges Valois s'y était rallié dès 1906 pour la quitter ensuite. Durant la troisième étape de sa vie, Sorel, déçu par les militants du prolétariat, rêve que la bourgeoisie va répudier sa longue « lâcheté » et retrouver l'ardeur des capitaines d'industrie, autrement dit l'énergie humaine essentielle. La guerre de 1914-1918, menée par les démocrates, lui répugne. La révolution russe installe la dictature du prolétariat. L'ancien socialiste Benito Mussolini accède au pouvoir en Italie. Lorsque Sorel meurt, la situation est mûre pour une découverte rétrospective de son œuvre.
G. Pirou a déclaré incontestable la filiation directe de Sorel à Mussolini, mais rien n'est moins sûr ; il vaudrait mieux parler d'affinités. On a pu le croire fasciste parce qu'il emploie le langage de l'énergie, mais il se situe en réalité aux antipodes du fascisme puisqu'il entend détruire l'État, ce en quoi on trouve plutôt en lui un anarchiste disciple de Proudhon. Comme celui-ci, il voulait promouvoir une organisation spontanée des travailleurs ; d'une certaine façon, il préfigure les apôtres de l'autogestion Polin. Comment un tel dessein rendait-il compatibles la liberté individuelle et la coopération ? La réponse relève de la foi ou du défi soréliens.
La filiation avec Lénine, souvent proclamée, est plus discutable encore. Certes, Sorel a salué en lui le plus grand théoricien que le socialisme ait eu depuis Marx Pour Lénine, appendice à la 4e édition des Réflexions, 1919, mais celui-ci avait déjà caractérisé Sorel comme un esprit brouillon bien connu Matérialisme et empiriocriticisme, 1909. En fait, la distance que Sorel prend à l'égard du marxisme est grande. Son œuvre contient une exaltation du travail, mais, à ses yeux, l'essentiel n'est pas le travail pour lui-même ni même la production, c'est plutôt l'effort, et la seule révolution dont la violence est porteuse est celle des esprits et des cœurs.
Le principal paradoxe de l'œuvre sorélienne réside peut-être en ceci que son anarchisme proudhonien et sa violence nietzschéenne se veuillent la plus haute fidélité à Marx en insufflant une épique à la théorie et à la pratique marxistes. Que Sorel ait été incompris, dès lors, n'étonne plus.
Influences et postérité
À la fois antiparlementariste et révolutionnaire, la pensée de Sorel a influencé de nombreux penseurs et hommes politiques du XXe siècle, tant de droite que de gauche. Parmi eux, des syndicalistes révolutionnaires comme Hubert Lagardelle, Édouard Berth et les Italiens Arturo Labriola et Agostino Lanzillo, des partisans ou des proches de l’Action française comme Pierre Lasserre et le catholique René Johannet, des libéraux comme Piero Gobetti6, des socialistes comme le Hongrois Ervin Szabó, des communistes comme Antonio Gramsci et le jeune Georg Lukács, des marxistes indépendants comme Maximilien Rubel, des écrivains anticonformistes comme Curzio Malaparte, des sociologues comme Walter Benjamin, Jules Monnerot et Michel Maffesoli, des théoriciens politiques comme Carl Schmitt ou encore des économistes comme François Perroux. Après son arrivée au pouvoir, Benito Mussolini lui-même s’en réclamera. L’influence de Sorel s’étendra jusqu’au Tiers Monde, puisque le marxiste péruvien José Carlos Mariátegui ou le Syrien Michel Aflaq, militant du mouvement de libération nationale et cofondateur du Parti Baas, compteront aussi parmi ses lecteurs. L’homme est en fait plus connu à l’étranger qu’en France. Il a fait l’objet de nombreuses interprétations orientées, partielles et opposées.
Œuvres
Le Procès de Socrate, examen critique des thèses socratiques, Paris, Félix Alcan, 1889 ;
Les Girondins du Roussillon, Perpignan, Charles Latrobe, 1889,
Essai sur la philosophie de Proudhon, 1re éd. en articles, 1892 ; nouvelle édition : Paris, Stalker Editeur, 2007 ;
D’Aristote à Marx (L’Ancienne et la nouvelle métaphysique, 1re éd. en articles, 1894 ; nouvelle édition : Paris, Marcel Rivière, 1935 ;
Étude sur Vico, 1re éd. en articles, 1896 ; repris in Étude sur Vico et autres écrits, Paris, Champion, 2007 ;
L’Avenir socialiste des syndicats, 1re éd. en articles, 1898 ; puis à Paris, Librairie de l’Art social, 1898,;
La Ruine du monde antique. Conception matérialiste de l’histoire, 1re éd. Paris, Librairie G. Jacques et Cie, 1902 ; 2e éd. Paris, Rivière, 1933, ;
Introduction à l’économie moderne, 1re éd. Paris, G. Jacques, 1903 ; 2e éd. Paris, Marcel Rivière, 1922 ;
Saggi di critica del marxismo Essais de critique du marxisme, Palerme, Remo Sandron, 1903 ;Essais de critique du marxisme. Œuvres I, Patrick, Paris, L’Harmattan, 2007 ;
Le Système historique de Renan, Paris, G. Jacques, 1906 ;
Insegnamenti sociali dell'economia moderna. Degenerazione capitalista e degenerazione socialista Enseignements sociaux de l’économie contemporaine. Dégénérescence capitaliste et dégénérescence socialiste, Palerme, Remo Sandron, 1907 ;
Réflexions sur la violence, 1re éd. 1908 ; 4e éd. définitive Paris, Rivière, 1919 ; éd. avec appareil critique et index, Genève-Paris, Entremonde, 2013 ;
Les Illusions du progrès, Paris, Marcel Rivière, 1908 ;
La Décomposition du marxisme, 1re éd. Paris, Librairie de Pages libres, 1908 ; Paris, Marcel Rivière, 1910 ;
La Révolution dreyfusienne, 1re éd. Paris, Marcel Rivière, 1909, ; ibid, 1911 ;
Lettres à Paul Delesalle, 1914-1921, Paris, Bernard Grasset, 1947 ;
Matériaux d’une théorie du prolétariat, 1re éd. Paris, Marcel Rivière, 1919 ; ibid, 1921 ;
De l’utilité du pragmatisme, Paris, Marcel Rivière, 1921,;
Lettere a un amico d’Italia Lettres à un ami d’Italie , Bologne, L. Capelli, 1963 ;
Georges Sorel, Scritti sul socialismo, Catania, Pellicanolibri, 1978 ;
La Décomposition du marxisme et autres essais, anthologie établie par Th. Paquot, Paris, PUF, 1982 ;
De nombreux textes inédits de Sorel ont été publiés dans la revue Cahiers Georges Sorel, puis Mil neuf cent.
Citations
LLes frères Tharaud ont donné de Georges Sorel le portrait suivant :
C’était un robuste vieillard, au teint frais comme celui d’un enfant, les cheveux blancs, la barbe courte et blanche, avec des yeux admirables, couleur de violette de Parme... Son métier d’ingénieur des ponts et chaussées l’avait retenu toute sa vie en province où il s’était distrait de l’ennui en lisant et annotant tous les livres qui lui tombaient sous la main... intarissablement s’échappaient de ses lèvres, comme l’eau de la vanne d’un barrage, les idées qui depuis soixante ans s’étaient accumulées derrière le barrage. Tout cela sans aucun ordre. Une richesse en vrac... mais vraiment merveilleux quand, de sa voix flûtée, la tête légèrement penchée, en avant et scandant ses paroles de petits coups de règle, il jetait pêle-mêle les idées que l’on vit paraître un jour dans les Réflexions sur la violence, un de ces livres tout–à–fait ignorés du grand public, mais d’une rare puissance explosive et qui restera sans doute un des grands livres de ce temps, puisqu’il a eu la singulière fortune d’inspirer à la fois le bolchevisme de Lénine et le fascisme de Mussolini.
— Jérôme et Jean Tharaud , Notre cher Péguy 1926
Lénine a été aussi peu inspiré par Sorel que ne l’est le seul jugement qu’il lui ait jamais porté pas clair : Sorel, ce brouillon notoire
Le syndicaliste révolutionnaire Alfred Rosmer a écrit que Sorel s'installa dans le syndicalisme comme il s'était installé antérieurement dans le jauressisme puis dans l'antijauressisme ... Les militants syndicalistes l'ont toujours ignoré.
Liens
http://youtu.be/ljJGQPTjWaQ introduction à l'économie
http://youtu.be/qW-vXdu71o0 Le syndicalisme révolutionnaire
http://www.ina.fr/video/CPF86632064/l ... el-et-de-peguy-video.html Les compagnons de Péguy et Georges Sorel
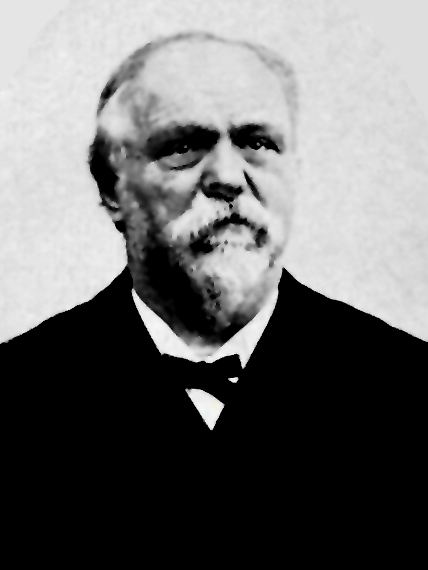   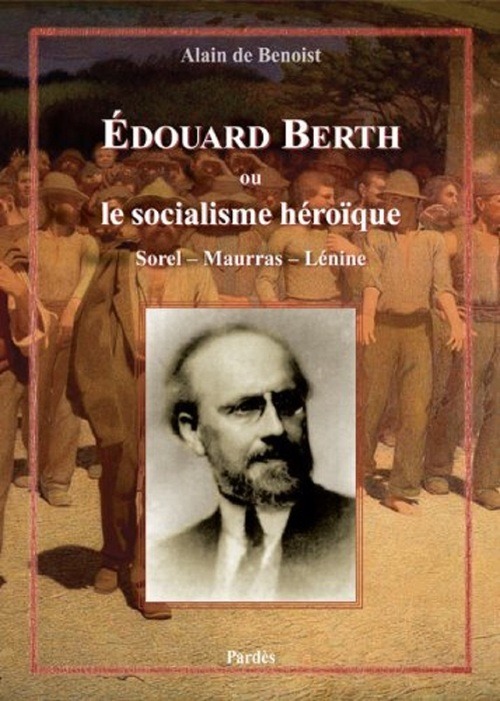  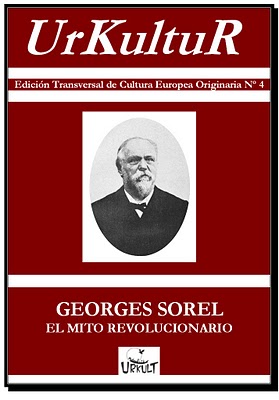      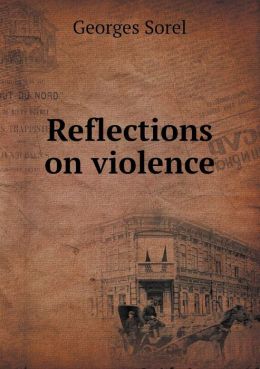  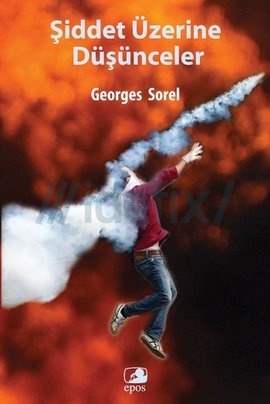
Posté le : 31/10/2014 19:44
|
|
|
|
|
Edith Stein |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 12 octobre 1891 à Breslau, dans l'Empire allemand naît Edith Stein,
en religion sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix, déportée le 2 août 1942, internée au camp d'Auschwitz, dans le territoire polonais occupé par l'Allemagne nazie où elle fut mise à mort, à 50 ans, le 9 août 1942, philosophe et théologienne allemande d'origine juive devenue religieuse carmélite.
Elle est béatifiée le 1er mai 1987 à Cologne, Allemagne par Jean-Paul II, puis canonisée par le même pape Jean-Paul II, au Vatican le 11 octobre 1998, elle est Vénérée par l'Église catholique romaine, et l'Ordre du Carmel elle est Fêtée le 9 aoûtco, elle est désignée comme la sainte patronne de l’Europe; Journée Mondiale de la Jeunesse; juifs converti, Philosophe crucifiée, cosainte patronne de l'Europe par le pape Jean-Paul II le 1er octobre 1999, à l'ouverture du synode des évêques sur l'Europe, en même temps que Brigitte de Suède et Catherine de Sienne.
En bref
Philosophe d'origine juive, Edith Stein fit ses premières études universitaires à Breslau, sa ville natale. En 1911, elle rejoint Husserl et son école à Göttingen ; en 1915, elle s'engage comme aide-infirmière dans un hôpital militaire ; en 1916, elle présente sa thèse de doctorat sur l'Einfühlung ou empathie, et accepte la charge d'assistante privée de Husserl. Dès 1918, ayant renoncé à continuer à travailler avec ce dernier, elle cherche à se faire habiliter dans une université allemande, sans succès.
Entre-temps — et cela est déjà sensible dans sa thèse —, Edith Stein ressent un intérêt croissant pour la religion ; d'abord, sous l'influence de Max Scheler, comme un système de valeurs qui mérite attention, puis, à l'occasion de la mort d'Adolf Reinach en 1917 comme une source de courage, d'espérance et de paix dans le malheur. Cette inclination ainsi que d'autres événements plus personnels la conduisent à se convertir au christianisme et à demander le baptême dans l'Église catholique. La lecture de la Vie de Thérèse d'Ávila semble avoir joué un rôle décisif dans cette démarche.
Renonçant provisoirement à postuler son entrée au Carmel, elle enseigne de 1922 à 1932 dans un lycée de dominicains à Spire. Elle prend contact avec la philosophie de Thomas d'Aquin, entreprend, sur l'invitation du père Erich Przywara, S. J., de traduire les Quaestiones disputatae de veritate, entretient ou poursuit une active correspondance, en particulier avec Roman Ingarden, et se fait connaître comme conférencière, notamment sur des questions touchant le rôle et la vocation spécifiques de la femme. En 1932, elle est appelée à enseigner à l'Institut de pédagogie de Münster, mais, un an plus tard, se voit interdite d'enseignement en qualité de juive.
Plus rien ne la retient d'entrer au Carmel, avec résidence d'abord à Cologne, puis en 1938, par mesure de sécurité, à Echt en Hollande. C'est de là qu'en 1942, à la suite de la protestation des évêques de Hollande contre les persécutions des juifs, elle sera déportée à Auschwitz et gazée. Elle est béatifiée le 1er mai 1987.
Née dans une famille juive, elle passe par une phase d'athéisme. Étudiante en philosophie, elle est la première femme à présenter une thèse dans cette discipline en Allemagne, puis continue sa carrière en tant que collaboratrice du philosophe allemand Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie.
Une longue évolution intellectuelle et spirituelle la conduit au catholicisme auquel elle se convertit en 1921. Elle enseigne alors et donne des conférences en Allemagne, développant une théologie de la femme, ainsi qu'une analyse de la philosophie de Thomas d'Aquin et de la phénoménologie.
Interdite d'enseignement par le régime national-socialiste, elle décide d'entrer au Carmel, où elle devient religieuse sous le nom de Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix. Arrêtée par la SS, elle est déportée et meurt pour son peuple à Auschwitz.
Sa vie
Son père, Siegfried Stein, 1844-1893 est commerçant en bois dans une scierie. Il épouse le 2 août 1871 Augusta Stein 1849-1936, et s'installe à Gleiwitz Haute-Silésie, où naissent leurs six premiers enfants : Paul 1872-1943, mort au camp de concentration de Theresienstadt, Selma 1873-1874, Else 1876-1954, Hedwig 1877-1880, Arno 1879-1948, Ernst 1880-1882.
En 1882, la famille s'installe à Lublinitz, où Siegfried fonde sa première entreprise avec l'aide de sa belle-famille. C'est une période difficile pendant laquelle l'aide familiale lui permet de ne pas sombrer dans la misère. C'est là que viennent au monde les derniers enfants du couple Stein : Elfriede, 1881-1942, morte en camp de concentration, Rosa 1883-1942 morte avec Édith à Auschwitz, Richard 1884, mort-né, Erna 1890-1978.
Édith Stein naît le 12 octobre 1891 à Breslau, jour de Kippour4, ce qui la rend particulièrement chère à sa mère, juive pratiquante5. Son père, Siegfried Stein, meurt d'une insolation quand Édith n'a pas encore trois ansA 1. Sa mère, femme très religieuse, doit alors subvenir aux besoins de sa famille et diriger l'entreprise familiale. Cette lourde tâche demande beaucoup de rigueur et de travail, discipline qu'Augusta Stein essaie de transmettre à ses enfants, ainsi que sa foi juive. Édith Stein raconte d'ailleurs que comme elle est la dernière de sa famille, c’est à elle qu'il revient, d'après la tradition juive libérale, de poser les questions liturgiques lors des fêtes juives, questions qui donnent lieu à des explications plus complètes par le célébrant.
Edith Stein entame sa scolarité à l'école Victoria en 1896, année où, pour la première fois en Prusse, les filles sont autorisées à passer le baccalauréat. Elle se retrouve très vite dans la classe supérieure. Une camarade de classe dit d'elle : Sa précocité n'avait rien de surprenant, elle y était poussée par ses aînés, mais l'irrésistible orgueil qu'elle développa et dont la tension pouvait aboutir à des larmes et à la colère quand elle n'obtenait pas ce qu'elle souhaitait ou n'était pas la première, la meilleure, était moins positif... c'était une excellente élève. À partir de 13 ans, elle commence pour Kippour à jeûner jusqu'au soir, suivant la tradition juive. Elle conserve cette pratique même lorsqu'elle quitte sa famille et ne prie plus.
À partir de 1904, les filles sont admises au lycée. Toutefois, arrivée à l'adolescence, Edith Stein refuse de rentrer au lycée et demande à arrêter ses études en 1906 à l'âge de 15 ans. Elle part dix mois à Hambourg aider sa sœur Else qui vient d'avoir un enfant. C'est à cette époque qu’Edith Stein cesse de prier : En pleine conscience et dans un choix libre, je cessai de prier.
En septembre 1907, elle revient à Breslau. Elle retrouve un grand appétit de savoir et, alors qu'elle a quitté le collège volontairement, se remet avec brio aux études. Elle rattrape rapidement son retard et intègre le lycée en septembre 1908. Pendant cette période, Édith lit et étudie beaucoup. Elle affirme plus tard que ces lectures littéraires de l'époque me nourrirent pour ma vie entière. C'est pendant cette période qu'elle commence aussi à découvrir la philosophie et notamment la lecture de Friedrich von Schiller, disciple d'Emmanuel Kant.
Edith Stein prend alors un engagement politique, en devenant membre de la section locale de L'Association prussienne pour le vote des femmes. Elle soutient, avec sa sœur Erna et ses amies, l'aile la plus radicale du mouvement féministe autour d'Anita Augspurg, d'Hélène Stöcker et de Linda Gustava HeymannA . L'aile est radicale dans le sens où elle réclame une égalité totale entre hommes et femmes.
Édith Stein obtient son baccalauréat avec succès en 1911 et décide de poursuivre des études universitaires en philosophie.
La philosophe Université à Breslau
Edith Stein est persuadée que nous sommes sur terre pour être au service de l'humanité ... Pour s'y employer du mieux possible, il faut faire ce à quoi l'on incline. Elle entame alors de brillantes études à l'université de Breslau, aidée par l'argent (plusieurs milliers de marks légué par sa grand-mère Johanna Stein. Elle décide d'étudier de nombreuses matières : les langues indo-européennes, l'allemand ancien, l'histoire du drame allemand, l'histoire de la Prusse et de Frédéric le Grand, l'histoire de la constitution anglaise, la philosophie de la nature, l'introduction à la psychologie, l'initiation au grec enfin. Édith Stein étudie particulièrement l'histoire, se considérant comme passionnée aux événements politiques du présent considérés comme l'histoire en devenir. Elle tire de cette période de sa vie les nombreux exemples historiques qu'elle utilise par la suite dans ses conférences. Elle étudie aussi la psychologie auprès de William Stern, et la philosophie dispensée par Richard Hönigswald. C'est au cours de ces études de psychologie qu'elle se déclare athée. Son ami d'études, Georg Moskiewicz, qui étudie la psychologie avec elle, lui parle en 1912 de l'orientation philosophique nouvelle que présente la phénoménologie d'Edmund Husserl. Elle décide alors de l'étudier et se trouve séduite par le procédé de réduction phénoménologique. C'est cette découverte qui la pousse à aller à Göttingen.
Elle participe aussi à deux associations : la première est l'association Humboldt d'éducation populaire, qui donne gratuitement des cours de soutien scolaire à des ouvriers et des employés. Elle y donne des cours d'orthographe. La seconde est une association de femmes, visant à l'égalité des sexes et organisant des petits débats. Elle fait la connaissance à Breslau de Kaethe Scholz, une enseignante qui anime des cours de philosophie auprès de femmes. Son exemple inspire Édith Stein dans la fondation de son Académie en 1920.
Études à Göttingen
Edith Stein poursuit ses études à Göttingen, où elle suit, à partir de 1913, les cours du philosophe Leonard Nelson, l'historien Max Lehmann élève de l'historien Leopold van Ranke, dont Édith Stein se dit la petite fille spirituelle. Grâce à son ami Georg Moskiewicz Édith Stein est acceptée dans la Société de philosophie de Göttingen, qui rassemble les principaux membres de la phénoménologie naissante : Edmund Husserl, Adolf Reinach, et Max Scheler principalement. De ces rencontres, elle garde une correspondance personnelle et approfondie avec Roman Ingarden, Hans Lipps, Alexander Koyré, parmi les plus importants. Elle fera par la suite connaissance avec Dietrich von Hildebrandt, et surtout Hedwig Conrad-Martius, Théodor Conrad, qui deviendront des amis très proches.
Edith Stein décide alors de préparer son examen d'État, première étape avant la thèse. Elle suit les conférences de Max Scheler, qui organise ses allocutions à partir de son nouvel essai intitulé Le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs 1913-1916, et à la lecture duquel Édith Stein trouve de nombreuses inspirations pour ses travaux sur l'empathie. Malgré de grosses difficultés, elle poursuit ses études avec l'aide de Reinach. L'examen est prévu pour novembre 1914.
Première Guerre mondiale
Lors de la Première Guerre mondiale, Edith Stein décide de retourner à Breslau. Dans l'immédiat, elle veut servir et aider de son mieux. Elle fréquente un cours d'infirmière. Pour elle, ce sont des temps difficiles.
Elle écrit : "Quand la guerre sera finie, si je vis encore, je pourrai à nouveau penser à mes occupations personnelles." Elle retourne à Göttingen pour passer son examen d'État, passe les épreuves et, début janvier, obtient le diplôme avec la mention très bien.
Suite à son examen, elle postule à nouveau à la Croix Rouge, et est envoyée à l'hôpital militaire de Mährish-Weisskirchen, en Autriche. Elle soigne les malades du service des maladies infectieuses, travaille en salle opératoire, voit mourir des hommes dans la fleur de l'âge, issus de toute l'Europe de l'Est. Cette expérience la marque profondément. C'est une sorte d'expérience pratique d'empathie: comment communiquer avec des hommes dont on connaît peu la langue?
Elle obtient la médaille de la bravoure pour son dévouement. Epuisée, elle est invitée à rentrer chez elle et n'est plus rappelée.
Thèse de philosophie
Par la suite, elle décide de se consacrer sérieusement à sa thèse. Elle fait désormais partie du cercle intime de ses maîtres. Son ami Reinach se convertit au protestantisme au cours de la guerre. Il est baptisé le 9 avril 1916. Édith Stein côtoie de plus en plus de chrétiens dans le cercle de philosophes.
Elle poursuit sa thèse tout en étant professeur remplaçant à Breslau. Elle décide de suivre Edmund Husserl à Fribourg-en-Brisgau, où elle est l'une des premières femmes à obtenir sa thèse summa cum laude en 1917 avec le soutien de Edmund Husserl. Celle-ci est intitulée : "Sur le problème de l'empathie", qu'elle définit comme " une expérience sui generis, l’expérience de l'état de conscience d'autrui en général …L'expérience qu'un moi en général a d'un autre moi semblable à celui-ci".
Elle fréquente beaucoup un étudiant polonais, Roman Ingarden, dont elle devient amoureuse. Son travail enthousiasme Husserl qui a l’impression qu'elle anticipe sur une partie de ses Idées.
Collaboration avec Husserl
Elle devient ensuite l'assistante d'Edmund Husserl en lui proposant ses services après avoir passé sa thèse, en 1916F 2. Elle apprend la sténographie afin de pouvoir lire les notes d'HusserlF 2. Elle donne des cours d'initiation à la pensée du philosophe. Elle synthétise les tomes 2 et 3 des Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures.
Sa recherche philosophique porte essentiellement sur la personne humaine, les relations interpersonnelles, les communautés d’appartenance, État, peuple, groupe ethnique, religieux, etc.. Elle insiste sur le sens des valeurs, la liberté, le refus du totalitarisme.
Au cours de ces années de recherche elle tente de synthétiser avec ses propres notes l'ensemble de la pensée d'Husserl. Elle remanie cet ouvrage tout au long de sa vie. Il est publié en 1991 sous le titre Introduction à la philosophie.
Edmund Husserl écrit au sujet d'Edith Stein : « Mais le grand style qui préside à l'élaboration de ces apports, le caractère scientifique approfondi et la finesse qu'elle a montrés là, méritent au plus haut point d'être reconnus. Cependant Husserl refuse de soumettre Edith Stein à l'habilitation, ce qui lui permettrait d'être titulaire d'une chaire. Son opposition semble fondée sur sa crainte de voir échouer ce processus, dans la mesure où encore aucune femme n'est titulaire de chaire de philosophie en Allemagne. De plus, comme beaucoup des nombreux professeurs juifs, Husserl est lui-même en position difficile.
Edith Stein est très touchée par la mort au front de son ami Reinach. Elle hérite de ses notes philosophiques, où Reinach essaie de comprendre sa propre évolution religieuse. C'est elle qui met en ordre et fait connaître ses notes.
Elle rédige aussi à partir des notes d'Husserl l'ouvrage Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, ouvrage qui est édité par Martin Heidegger en 1928. Martin Heidegger, membre du parti Nazi dès 1933, ne mentionnera pas correctement la contribution d'Edith Stein.
Conversion et engagements Engagement politique et féminisme
Édith Stein s'intéresse beaucoup aux questions concernant les femmes. Elle milite ainsi pour le droit de vote des femmes, qui est obtenu en 1919 en Allemagne. Elle entre dans l'organisation Association prussienne pour le droit des femmes au vote. En janvier 1919, elle s’engage au DDP, le Parti démocrate allemand, un parti de centre-gauche qui abrite des féministes ainsi que des personnalités juives. Alors que dans sa jeunesse elle se dit sensible à l'idéal prussien, elle devient de plus en plus critique devant le militarisme de la Prusse et l'antisémitisme ambiant. Elle écrit en 1919 : " De toute façon, nous les Juifs ne pouvons attendre aucune sympathie plus à droite". Elle dénonce à son ami polonais Roman Ingarden « l'effroyable antisémitisme qui règne ici ". Progressivement, la grande idéaliste est déçue par la réalité de la politique. Plus tard, elle écrit : "Jeune étudiante, je fus une féministe radicale. Puis cette question perdit tout intérêt pour moi. Maintenant je suis à la recherche de solutions purement objectives ".
Elle continue d'être européenne, de refuser le triomphalisme prussien à propos de Sedan et écrit devant le carnage de la Première Guerre mondiale : " Deux choses seulement me maintiennent la curiosité en éveil : la curiosité de voir ce qui va sortir de l'Europe, et l'espoir d'apporter ma contribution en philosophie ". Dans ses lettres des années 1930, elle parle des auteurs polonais, du français Romain Rolland qu'elle apprécie, et refuse de voir la communauté humaine se déchirer à cause de nationalismes exacerbés. C'est sans doute l'origine commune de son féminisme comme de son pacifisme. Elle dit ainsi qu'elle a " de chaudes discussions " au sein de ce parti.
Edith Stein est la première femme devenue docteur en philosophie en Allemagne et la première à avoir demandé officiellement que les femmes soient admises à présenter une habilitation au professorat. Au cours des années 1918 à 1919, elle publie L'Individu et la communauté, sous le titre Contributions à un fondement philosophique de la psychologie et des sciences humaines, se détachant de la pensée d'Husserl, et évoquant la religion. Face aux discriminations sur son habilitation, elle écrit au Ministre de la Culture allemand, qui lui donne raison, affirmant la possibilité pour une femme d'être professeur d'université. Cependant, malgré toutes ses démarches elle est refusée à Kiel, Hambourg, et Göttingen. Face à cette opposition elle fonde une académie privée, et accueille trente auditeurs chez elle, dont le futur sociologue Norbert Elias. Elle poursuit sa réflexion en publiant Étude sur l'État, où elle décrit les différentes notions d'individu, de communauté, de masse et d'État. Elle s'oppose donc à l'idéologie du national socialisme allemand, ainsi qu'aux idéologies marxistes.
Elle observe vers la fin de sa vie le chemin parcouru concernant les droits obtenus par les femmes et le changement de mentalités et rédige un nouvel ouvrage : Formation de femme et profession de femme où elle explique que les jeunes filles passent aujourd'hui le baccalauréat et s'inscrivent à l'université en ignorant le plus souvent ce qu'il a fallu de réunions, résolutions, pétitions adressées au Reichstag ou aux Staatsregierungen pour que s'ouvrent aux femmes, en 1901, les portes de l'université allemande .
Rencontre du Christ
La conversion d'Edith Stein est précédée d'une longue recherche intellectuelle et spirituelle qui s'étend des années 1916 à 1921. La première étape de sa conversion a été une expérience marquante lors de la visite d'une cathédrale à Francfort-sur-le-Main où elle rencontre une femme venant du marché qui entre, fait une courte prière, comme une visite, puis s'en va. Stein explique :" C’était pour moi quelque chose de tout à fait nouveau. Dans les synagogues et les temples que je connaissais, quand on s’y rendait c’était pour l’office. Ici, au beau milieu des affaires du quotidien, quelqu’un pénétrait dans une église comme pour un échange confidentiel. Cela, je n’ai jamais pu l’oublier".
Elle est aussi profondément marquée par la mort de son ami Reinach, mais c'est l'attitude de sa femme, qui est, selon l'affirmation d'Edith Stein, l'élément le plus marquant. Pauline Reinach croit dans la vie éternelle, et trouve une consolation et un courage renforcé dans sa foi en Jésus. À travers cette expérience, elle découvre l'existence d'un amour surnaturel18. Elle affirme plus tard que la cause décisive de sa conversion au christianisme fut la manière dont son amie accomplit par la force du mystère de la Croix le sacrifice qui lui était imposé par la mort de son mari.
Dans le cercle des phénoménologues, les conversions au christianisme se multiplient, ses amies Anne et Pauline Reinach, F. Hamburger et H. Conrad notamment. Mais c’est en août 1921 qu’Edith Stein opte définitivement pour la foi catholique. Lors d'une visite à ses amis Conrad-Martius, Edith Stein lit, ou relit, un livre que lui ont offert les Reinach : la Vie de sainte Thérèse de Jésus, par elle-même. Cet épisode est l’aboutissement de sa longue quête de la vérité. Elle affirmera plus tard, dans un écrit objectif, que l'on peut avoir conscience de la vérité, sans l'accepter, en refusant de se placer sur son terrain . Dès ce moment elle veut être carmélite. Annoncer sa conversion à sa mère est très difficile. Elle affirme en effet : " Quant à ma mère, ma conversion est la plus lourde peine que je puisse lui porter". Elle demande le baptême au sein de l'Église catholique le 1er janvier 1922 et elle prend les noms de baptême : Edith, Theresia, même nom que Sainte Thérèse d'Avila, Hedwig (nom de sa marraine Hedwig Conrad-Martius. Elle fait sa première communion le lendemain et est confirmée le 2 février par l'évêque de Spire.
Conférences
Après son baptême elle veut entrer dans l'Ordre du Carmel, mais son père spirituel, le vicaire général de Spire, le lui déconseille et lui demande d'enseigner l'allemand et l'histoire au lycée et à l'école normale féminine du couvent des dominicaines de la Madeleine de Spire, ce qu'elle fait de 1922 à 1933. C'est un grand centre de formation des enseignantes catholiques, religieuses et laïques, de l'Allemagne du Sud. Edith Stein se plonge ainsi dans la pédagogie tout en essayant de vivre ses journées comme les religieuses, priant régulièrement et cherchant à être religieuse selon le cœur. Elle décide de traduire en allemand, pendant ses temps libres, les œuvres de John Henry Newman, anglican converti au catholicisme. Elle poursuit sa traduction pour une maison d'édition intéressée par le travail de Newman.
Elle poursuit son travail de traduction encouragé par son père spirituel P. Erich Przywara, en traduisant pour la première fois les écrits de saint Thomas d'Aquin du latin en langue allemande notamment les Quaestiones disputatae de veritate. L'Église catholique ayant, en 1879, choisi, dans l'encyclique Æterni Patris, la philosophie de saint Thomas d'Aquin comme doctrine officielle de sa théologie, Édith Stein tente donc l'idée d'une discussion entre la philosophie catholique traditionnelle et la philosophie moderne . Ce travail durera plus de huit ans, et conduira aux écrits : Les Questions de saint Thomas d'Aquin sur la Vérité, La Phénoménologie de Husserl et la philosophie de saint Thomas d'Aquin, Essai d'étude comparée, Puissance et acte, et Être fini et être éternel. Le père Erich Przywara l'encourage à confronter saint Thomas d’Aquin et la philosophie moderne. Elle écrira plus tard à propos de ces études Il m'est apparu à la lecture de Saint Thomas qu'il était possible de mettre la connaissance au service de Dieu et c'est alors, mais alors seulement, que j'ai pu me résoudre à reprendre sérieusement mes travaux. Il m'a semblé en effet que plus une personne est attirée par Dieu, plus elle doit sortir d'elle-même pour aller vers le monde en y portant l'amour divin.
Dès 1926 on la sollicite pour faire des conférences. C'est l'amorce d'une carrière de conférencière qui la conduira à faire plus de trente conférences à travers l'Allemagne. L'archiabbé Raphaël Walzer de l'abbaye de Beuron, son père spirituel à partir de 1928, et le P. Erich Przywara l’encouragent à répondre positivement à ces invitations. Elle commence alors à donner des conférences, faisant de longs voyages en Allemagne et dans d'autres pays. Nombre de ses enseignements portent sur la place de la femme dans la société et dans l'Église, sur la formation des jeunes et sur l'anthropologie. Elle prend résolument position contre le nazisme et rappelle la dignité de tout être humain.
Au cours de ces conférences, elle affirme que l'éducation ne peut pas tout obtenir par la force, mais doit aussi passer par le respect de chaque individu et la grâce. Elle met donc en garde contre la surveillance des étudiants, et montre le rôle exemplaire du professeur dans l'éducation, plus que les moyens coercitifs. Son père spirituel lui conseille de continuer son œuvre, du fait de son statut de laïc dans la société, fait rare à l'époque. Elle prend ainsi parti pour le dialogue entre catholiques et protestants au sein de l'éducation. Édith Stein obtient une notoriété importante au cours d'une conférence en 1930 sur L'éthique des métiers féminins. Seule femme à prendre la parole au cours du Congrès, elle parle des métiers féminins et refuse la misogynie de l'époque en affirmant qu'aucune femme n'est seulement femme, chacune présente des traits individuels et des dispositions propres, tout comme l'homme, par l'aptitude à exercer telle ou telle profession dans un domaine artistique, scientifique ou technique. Les comptes-rendus de cette conférence sont repris dans de nombreux journaux de l'époque. Au cours d'une de ces conférences elle discute avec Gertrud von Le Fort, amie poétesse. Dans la Position, Gertrud von le Fort affirmera même, mais c'est de mémoire quarante ans plus tard qu'elle a été en contact avec Edith Stein dès 1925-26 par le biais du P. Przywara. De cette rencontre naît l'inspiration de l'œuvre La Dernière à l'Échafaud, dont Georges Bernanos s'inspire pour écrire les Dialogues des Carmélites. En 1932 elle continue ses conférences demandant une éducation précoce de la sexualité.
Edith Stein continue parallèlement ses études de philosophie et est encouragée par Martin Heidegger et Honecker dans ses recherches dans le dialogue entre la philosophie thomiste et la philosophie phénoménologique. En 1931, elle termine son activité à Spire. Elle tente de nouveau d'obtenir l'habilitation pour enseigner librement à Wroclaw et à Fribourg, ce qu'elle n'obtient pas. Elle trouve un poste à l'Institut des sciences pédagogiques de Münster, institut géré par l’enseignement catholique, qui sera fermé par le pouvoir nazi quelques années plus tard. Elle participe en septembre 1932 à une conférence à Juvisy en France, organisée par la société Thomiste, où elle intervient principalement sur la phénoménologie. Elle continue à dialoguer avec ses amis philosophes, dont Hans Lipps qui la demande en mariage en 1932, demande qu'elle refuse, ayant trouvé un autre chemin.
Edith Stein prend progressivement son autonomie vis-à-vis d'Husserl. Ainsi, elle se trouve en désaccord avec lui sur le rôle de la théologie et de la philosophie. Elle considère que la philosophie a pour objectif d’ approfondir les nécessités et les possibilités de l’être, par sa fonction de connaissance. La philosophie d'Husserl lui semble une impasse dans la mesure où elle ne permet pas d’accéder aux questions de l'éthique et de la philosophie de la religion, ne laissant pas de place pour Dieu. La théologie et la philosophie ne doivent pas se faire concurrence, mais au contraire se compléter et s’enrichir réciproquement. La théologie peut en effet, selon elle, servir d'hypothèse permettant d'accéder au logos. Elle critique aussi le fait que la philosophie d’Husserl omette des siècles de recherche chrétienne de la vérité en ne considérant que les philosophes récents. Cette critique se poursuit avec l'analyse de l'œuvre de Martin Heidegger. Elle conteste sa méconnaissance de la philosophie médiévale dans son analyse. Elle lui reproche de reculer devant l'infini sans quoi rien de fini ni le fini comme tel n'est saisissable.
Très vite après la prise du pouvoir par les nazis, les lois allemandes interdisent aux femmes l'enseignement dans les universités ainsi qu'aux Juifs. Cependant, même lorsqu’elle est interdite d'enseignement en 1933, l’Association des enseignantes catholiques continue à lui verser une bourse. Édith Stein est activement opposée au nazisme dont elle perçoit très tôt le danger. Interdite d'enseignements du fait de l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, elle décide alors d'écrire au pape Pie XI pour demander une prise de position claire de l'Église contre ce qu'elle nomme l’idolâtrie de la race . Celle-ci n'aura pas lieu du fait de la mort de Pie XI, décès qui arrête la rédaction de l'encyclique condamnant l'antisémitisme, Humani generis unitas commencée en mai 1938. Certains pensent que la lettre d'Édith Stein peut avoir eu une influence dans l'origine de cette encyclique. La condamnation du nazisme par l'Église catholique a lieu dans l'encyclique Mit brennender Sorge 1937. Alors qu'elle ne peut plus s’exprimer publiquement du fait des lois antisémites, elle redemande alors à l’archiabbé Walzer de Beuron de pouvoir entrer au Carmel.
Elle décide, suite à une conversation avec un religieux, d'écrire un livre sur l'Humanité juive afin de rassembler ses souvenirs et écrit sous le titre Vie d'une famille juive, où elle décrit l'histoire de sa famille en tentant ainsi de détruire les préjugés antisémites et en décrivant l'humanité juive. Ce récit autobiographique s'arrête en 1916, peu de temps avant sa conversion. En la fête de sainte Thérèse d’Avila, le 15 octobre 1933, elle réalise enfin son rêve : elle entre au monastère.
Vie religieuse Le choix du Carmel
Le choix du Carmel peut trouver plusieurs explications. La première raison est la lecture des mystiques du Carmel, dans la mouvance des phénoménologues à partir de 1917. En témoigne une conversation qui a lieu vers 1918: dans une période de doute et de difficultés, Philomène Steiger 1896-1985, une amie catholique, lui a parlé de la quête du prophète Élie, le définissant comme le véritable fondateur du Carmel, cherchant dans la solitude l'union à Dieu. À cette époque, Edith Stein connaissait déjà les écrits du Carmel. La deuxième raison, la plus importante, est son admiration pour Thérèse d'Avila et pour son œuvre qui l'ont conduite au Christ. Après la lecture de sa biographie, elle avait fait le choix de devenir catholique et d'entrer un jour au Carmel afin de renoncer à toutes les choses terrestres et vivre exclusivement dans la pensée du divin.Mais, comme elle le dit elle-même, elle découvre que la vocation carmélitaine, loin d'être une fuite du "terrestre" est au contraire une manière concrète d'incarner un "grand amour".
Entrée au Carmel de Cologne L'Être fini et l'Être éternel.
En 1933, privée désormais comme juive du droit de s’exprimer publiquement, elle demande à entrer au Carmel, malgré ses 41 ans. Elle est donc admise au Carmel de Cologne. Elle prend l’habit le 15 avril 1934 et reçoit le nom de Thérèse-Bénédicte de la Croix. Ses supérieures l’encouragent bientôt à reprendre ses travaux philosophiques. À Pâques le 21 avril 1935, Édith Stein fait ses vœux temporaires. Elle a l'autorisation de poursuivre ses études sur Puissance et Acte, projet d'étude philosophique qu'elle poursuit jusqu'en 1939. Ses travaux conduisent Édith Stein à remanier de manière complète ce projet, qu'elle renomme L’Être fini et l’Être éternel. Cet écrit peut ainsi être considéré comme son œuvre majeure. Elle y établit le chemin de la recherche de Dieu, qui passe par une recherche de la connaissance de soi. L'ensemble de ses travaux ne pourra cependant être publié, en raison des lois anti-juives du Troisième Reich. Elle renouvelle ses vœux temporaires le 14 septembre 1936. Au cours de cette cérémonie, elle affirmera Quand mon tour est arrivé, de renouveler mes vœux, j'ai senti que ma mère était près de moi, j'ai expérimenté clairement qu'elle était proche de moi. Elle apprendra quelques jours plus tard que sa mère mourait au même moment. Ce fut pour Edith Stein une profonde consolation.
Le 21 avril 1938, elle prononce ses vœux définitifs en tant que carmélite. Devant le danger que présentent les lois nazies, Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix a l'autorisation de partir au carmel d’Echt, en Hollande, le 31 décembre 1938. Sa sœur Rosa, qui s’est convertie elle aussi au catholicisme, l'y rejoint plus tard après un séjour en Belgique .
Carmel d’Echt La Science de la Croix.
Édith Stein arrive au Carmel d'Echt, aux Pays-Bas, mais elle est inscrite auprès des services de l'immigration néerlandais en tant que juive. Elle est de plus en plus inquiète devant le sort de ses amis et sa famille juive. Elle continue ses travaux mais demande à sa supérieure de s'offrir en sacrifice au Sacré-Cœur de Jésus pour la paix véritable. Le 9 juin 1939, elle rédige son testament, dans lequel elle implore le Seigneur de prendre sa vie pour la paix dans le monde, et le salut des juifs. L'annexion de la Hollande par l'Allemagne nazie conduit à une situation de plus en plus difficile pour Édith Stein, soumise à un statut particulier du fait de son origine juive. Néanmoins sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix continue d'écrire, conformément aux souhaits de ses supérieurs. Elle est ainsi déchargée de ses travaux manuels par sa supérieure au début 1941. À l'occasion du quatre-centième anniversaire de la naissance de saint Jean de la Croix, sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix entreprend l'étude de sa théologie mystique.
Stein avait préparé la rédaction de ce gros ouvrage par un court essai sur la théologie symbolique du Pseudo-Denys l'Aréopagite, une des sources de la pensée de saint Jean de la Croix. Elle cherche à comprendre, avec le recul, comment certains arrivent à mieux découvrir Dieu à travers la création, la Bible et leurs expériences de vie, alors que pour d’autres, ces mêmes éléments restent totalement opaques. Elle intitule son œuvre sur Jean de la Croix Scientia Crucis La Science de la Croix. Elle y fait une synthèse de la pensée du carme espagnol avec sa propre étude sur la personne humaine, la liberté et l’intériorité. Contrairement à ce qui fut dit, les dernières études graphologiques et littéraires montrent que l’œuvre est achevée au moment de l’arrestation d’Édith Stein. C’est une sorte de synthèse de son cheminement intellectuel et spirituel. À travers l’expérience de saint Jean de la Croix, elle cherche à trouver les lois générales du chemin que peut faire toute intériorité humaine pour parvenir au royaume de la liberté : comment atteindre en soi le point central où chacun peut se décider en pleine liberté. Cependant Édith Stein cherche à quitter la Hollande afin de partir vers un Carmel en Suisse et vivre sa foi sans la menace des nazis. Ses démarches restent sans succès car elle est privée du droit d'émigrer. Elle écrit en juin 1942 : Depuis des mois, je porte sur mon cœur un petit papier avec la parole du Christ: Lorsqu'ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre.
Décès durant la Shoah
Face à l'augmentation de l'antisémitisme en Hollande, les évêques néerlandais décident, contre l'avis du pouvoir en place, de condamner les actes antisémites par la lecture lors de l'homélie d'une lettre pastorale dans les églises le 26 juillet 1942. Suite à cette lettre, un décret du 30 juillet 1942 conduit à l'arrestation des Juifs de religion catholique.
Elle est arrêtée le 2 août 1942 par les S.S. avec sa sœur Rosa et tous les Juifs ayant reçu le baptême catholique. Ses dernières paroles sont, d'après un témoin, pour sa sœur Viens, nous partons pour notre peuple.
Elle est déportée avec sa sœur dans les camps d'Amerfort, puis celui de Westerbork. Elle y retrouve deux de ses amies et filles spirituelles, deux jeunes filles juives devenues catholiques : Ruth Kantorowicz et Alice Reis. Au camp de Westerbork, elle croise une autre grande mystique juive du xxe siècle, Etty Hillesum, qui vient d’être embauchée par le Conseil juif du camp pour aider à l’enregistrement. Cette dernière consigne dans son Journal la présence d’une carmélite avec une étoile jaune et de tout un groupe de religieux et religieuses se réunissant pour la prière dans le sinistre décor des baraques. À l’aube du 7 août, un convoi de 987 Juifs part en direction d’Auschwitz. Toutes les personnes du convoi sont gazées au camp d'extermination d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, le 9 août 1942.
Postérité Reconnaissance posthume Canonisation
Édith Stein est béatifiée par Jean-Paul II, le 1er mai 1987, à Cologne, pour l’héroïsme de sa vie et sa mort en martyre, assassinée ex odio fidei en haine de sa foi catholique. Avec sa béatification dans la cathédrale de Cologne l’Église honore, comme le dit le pape Jean-Paul II, une fille d’Israël, qui pendant les persécutions des nazis est demeurée unie avec foi et amour au Seigneur Crucifié, Jésus Christ, telle une catholique, et à son peuple telle une Juive. Cette homélie de Jean-Paul II montre l'importance reconnue du peuple juif et de la tradition hébraïque dans la vie d'Edith Stein. Elle est par la suite canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998 et proclamée co-patronne de l’Europe le 1er octobre 1999.
Le 11 octobre 2006, le pape Benoît XVI bénit une grande statue de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix placée dans la partie extérieure de l’abside de la basilique Saint-Pierre du Vatican dans une niche entre les patrons de l’Europe46. Benoît XVI cite par ailleurs en exemple Édith Stein dans son discours lors de sa visite à Auschwitz le 28 mai 2006 affirmant : de là apparaît devant nous le visage d'Édith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix : juive et allemande, disparue, avec sa sœur, dans l'horreur de la nuit du camp de concentration allemand-nazi ; comme chrétienne et juive, elle accepta de mourir avec son peuple et pour son peuple ... mais aujourd'hui, nous les reconnaissons en revanche avec gratitude comme les témoins de la vérité et du bien, qui, même au sein de notre peuple, n'avaient pas disparu. Remercions ces personnes, car elles ne se sont pas soumises au pouvoir du mal, et elles apparaissent à présent devant nous comme des lumières dans une nuit de ténèbres.
Deux motifs ont été avancés pour expliquer la béatification d'Edith Stein : le premier est celui de la reconnaissance de sa vie vertueuse, le second est celui du martyre. Avec la canonisation d’Édith Stein, en 1998 une polémique est née, certains reprochant au pape Jean-Paul II d'avoir voulu récupérer la Shoah, à travers sa canonisation. Ainsi des personnalités juives critiquèrent le pape lui demandant d’annuler la canonisation, voyant en celle-ci une tentative pour réaliser la christianisation de la Shoah. Cette polémique semble en partie due à une mauvaise interprétation du discours du pape Jean-Paul II qui affirma :" En célébrant désormais la mémoire de la nouvelle sainte, nous ne pourrons pas, année après année, ne pas rappeler aussi la Shoah, ce plan féroce d’élimination d’un peuple qui coûta la vie à des millions de frères et sœurs juifs." Certains ont cru y voir l’institution d’une journée commémorant la Shoah, or il s’avère que cette journée n’a jamais été instituée et que les propos ont sans doute été sur-interprétés.
Fête La fête d'Edith Stein est fixée au 9 août. Sa fête a rang de mémoire dans l'Ordre du Carmel, sauf en Europe, où en tant que co-patronne, sa mémoire, pour toute l'Eglise, a rang de fête53,54.
Autres reconnaissances
En 2008, Édith Stein entre au Walhalla, mémorial des personnalités marquantes de la civilisation allemande. La chaîne télévisée publique allemande ZDF consacra une émission entière sur Édith Stein dans le cadre d'Unsere Besten, consacrant les plus grands Allemands de tous les temps. Un film est sorti en 1995 : La Septième demeure, dans lequel Maia Morgenstern joue le rôle d'Édith Stein.
En 2014, la paroisse de Bayeux fait l'acquisition d'une nouvelle cloche, nommée Thérèse-Bénédicte, en hommage à Edith Stein.
Héritage Théologie d’Edith Stein Vision de la Femme
Édith Stein a très tôt été marquée par sa condition féminine. Première femme Docteur en philosophie d’Allemagne, elle s’est engagée personnellement afin de défendre la possibilité pour les femmes d’aller à l’université et d’y enseigner, malgré les nombreuses réticences du début du XXe siècle.
Sa conversion va l’engager sur une autre voie. Elle pense alors que les revendications féministes ne suffisent pas: il faut développer une théologie catholique de la femme, ce qu'elle fait à travers de nombreuses conférences dans toute l’Allemagne. Cette théologie spécifique à la condition féminine, qui était quasiment inexistante dans l’enseignement catholique, sera développée par Jean-Paul II, qui semble avoir été influencé par l’analyse d’Édith Stein, dans la lettre apostolique Mulieris dignitatem.
Certaines de ses conférences ont été regroupées en français dans un premier recueil La Femme et sa destinée, suivi en français de La femme. Ces livres abordent de nombreux thèmes comme l’éducation de la femme, sa vocation, son statut particulier. À partir d’une analyse philosophique Edith Stein affirme l’unité de l’humanité, puis une différenciation des genres qui la conduit à affirmer que la femme a trois buts fondamentaux : l’épanouissement de son humanité, de sa féminité et de son individualité. En se fondant sur le récit de la Genèse et de l’Évangile, démarche reprise par Jean-Paul II dans son magistère, elle prend la Vierge Marie pour modèle, et affirme son rôle essentiel dans l’éducation. Cependant, elle nie l’opposition de l’époque affirmant que les femmes doivent se cantonner à la seule sphère familiale et affirme que la vocation de la femme peut avoir une vie professionnelle : Le but qui consiste à développer les capacités professionnelles, but auquel il est bon d’aspirer dans l’intérêt du sain développement de la personnalité individuelle, correspond également aux exigences sociales qui réclament l’intégration des forces féminines dans la vie du peuple et de l’État . Cette affirmation est d’autant plus forte qu’elle considère comme une perversion de la vocation féminine la vie des jeunes filles de bonnes familles et des femmes oisives des classes possédantes .
Elle affirme, en s’appuyant sur saint Thomas d’Aquin, qu’il existe des professions naturelles de la femme, s'appuyant sur des prédispositions féminines. Prédispositions qui n’empêchent pas une singularité et des dispositions singulières, comme chez les hommes. Elle affirme plus loin qu’un authentique métier féminin, c'est un métier qui permet à l’âme féminine de s’épanouir pleinement. La femme doit donc se réaliser dans sa profession en recherchant ce qui est le plus dans sa vocation. Elle doit veiller à conserver une éthique féminine dans sa profession, en prenant la Vierge Marie comme modèle de la Femme et dans sa destinée.
Cette réalisation doit aussi comprendre une mission spirituelle de la femme, qui se réalise par la vie en Dieu, la prière et les sacrements. Dans cette logique elle critique le manque d’instruction donnée aux femmes, et le manque d’enseignement du catéchisme auprès des femmes, l’éducation se focalisant trop sur la piété. Elle affirme ainsi que la foi n’est pas une affaire d’imagination, ni un sentiment de piété mais une préhension intellectuelle. Elle mettra en garde les institutions religieuses, qui, dans l’éducation religieuse, utilisaient trop souvent des moyens coercitifs afin de développer la piété. La foi ne pouvant s’obtenir qu’en vertu de la Grâce, elle affirme la nécessité non pas des contrôles mais de l’exemple dans l’éducation des filles.
Vision du judaïsme
La vision du judaïsme d’Édith Stein évolue tout au long de sa vie. Née dans une famille juive, elle abandonne sa foi juive, pour devenir athée, ou en tout cas non pratiquante et agnostique, dès l’adolescence. Cet athéisme est remis en question par sa rencontre du Christ. Cette conversion conduit Édith Stein à un approfondissement de sa foi et à se ré-approprier progressivement ses racines juives et à exprimer sa foi chrétienne d’une manière originale.
Édith Stein ne renie pas son origine juive, mais l’assume, en se considérant toujours comme appartenant au peuple juif. Elle considère ainsi que Jésus de Nazareth est un juif pratiquant, comme ses disciples des premiers temps. Il en va de même de l’Église, le groupe actuel de ses disciples. L’Église doit donc rester pleinement consciente de cet enracinement et doit être solidaire du peuple juif persécuté. Ainsi c’est cette réflexion et cette filiation qui conduisent Édith Stein à écrire au Pape Pie XI contre l’antisémitisme, et à agir contre l’antisémitisme tout au long de sa vie. Elle revendique par ailleurs son héritage juif, par exemple en 1932. Lors d'un séjour à Paris, elle parle des nôtres ou de nous lorsqu'elle parle de ses amis philosophes juifs, ce qu'elle fera continument tout au long de sa vie.
Dans son œuvre présentée comme autobiographique Vie d’une famille juive, Édith Stein veut, selon l’avant-propos, produire une réfutation de l’antisémitisme nazi à travers la présentation de la vie de sa famille et de ses amis juifs, dont elle est totalement solidaire, cherchant à faire disparaître les préjugés antisémites. Cet héritage est vécu par Édith Stein de façon plus personnelle ; elle écrit ainsi en 1932 : J'avais entendu parler de mesures sévères prises à l'encontre des Juifs, mais à ce moment-là l'idée se fit jour en moi, soudainement, que Dieu venait à nouveau de poser lourdement sa main sur mon peuple et que le destin de ce peuple était aussi le mien. Elle écrit La Prière de l'Église, où elle réaffirme le lien profond, vital, entre le catholicisme et les juifs, affirmant que le Christ priait à la manière d'un Juif pieux, fidèle à la Loi. Elle affirme dans la même logique qu'il existe une richesse passée et présente de la liturgie juive. Richesse qui préfigure la richesse de la liturgie catholique. En cela, l'œuvre d’Édith Stein est prophétique, elle annonce les avancées du Concile Vatican II et de l'amitié judéo-chrétienne qui suivra.
Enfin sa mort, qu’elle veut vivre comme un holocauste pour son peuple, montre son attachement profond à ce lien entre christianisme et judaïsme60. Elle ne renie pas sa foi catholique, mais s’identifie au Christ, qui meurt pour ses disciples. Édith Stein fait donc de même, en partant aux camps en tant que juive. Le pape Jean-Paul II dans l'homélie de sa béatification affirmera qu'il n'y a pas de contradiction pour Édith Stein dans sa foi : Pour Édith Stein, le baptême chrétien n'était pas une façon de rompre avec son héritage juif. Tout au contraire elle déclara : J'avais abandonné la pratique de la religion juive dès l'âge de quatorze ans. Mon retour à Dieu me permit de me sentir à nouveau juive. Elle a toujours été consciente du fait qu'elle était liée au Christ non seulement par la spiritualité, mais aussi par le sang.... Dans les camps d'extermination, elle mourut en fille d'Israël pour la gloire du Très Saint Nom et, à la fois, en tant que sœur Térésa Benedicta de la Croix, c'est-à-dire, bénie par la Croix.
Théologie de la Croix
Edith Stein a développé une spiritualité particulière centrée autour de la Passion du Christ. Dès le début de sa conversion, elle est frappée par le mystère de la souffrance à travers la mort de son ami Adolf Reinach. Elle découvre comment sa jeune veuve assume l'épreuve dans l'espérance chrétienne. Édith Stein a été touchée par l'expérience de la foi vécue dans l'épreuve.
Une fois au Carmel, elle prendra le nom de sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix, montrant par là-même l'importance pour elle de la théologie de la Croix. La rédaction de La Science de la Croix, sur la spiritualité de Jean de la Croix, permettra à Édith Stein de développer une théologie de la Croix. La Croix est, selon Édith Stein, cette vérité ... enfouie dans l'âme à la manière d'un grain de blé qui pousse ses racines et croît. Elle marque l'âme d'une empreinte spéciale qui la détermine dans sa conduite, à tel point que cette âme rayonne au dehors et se fait connaître par tout son comportement. Pour Édith Stein la science de la Croix consiste en l'imitation du Christ, homme des douleurs. La souffrance décrite par Jean de la Croix dans la Nuit obscure est une participation à la Passion du Christ et à la souffrance la plus profonde, celle de l'abandon de Dieu. Jean de la Croix affirme que pour entrer dans la richesse de la sagesse de Dieu, il faut entrer par la porte : cette porte est la croix et elle est étroite.
Pour Édith Stein, la science de la Croix est la possibilité de s'unir à Dieu : l'âme ne peut ainsi s'unir que si elle a été purifiée auparavant par un brasier de souffrances intérieures et extérieures et d'après les plans de la Sagesse Divine. Nul ne peut en cette vie obtenir une connaissance, même limitée, des mystères, sans avoir beaucoup souffert. Ces souffrances sont considérées par Édith Stein comme le feu de l'expiation. Jésus en venant sur la terre a pris le fardeau des péchés de l'homme. Les souffrances du Christ tout au long de sa vie et accentuées au Jardin des Oliviers sont le signe de la douleur qu'il éprouve dans ce délaissement de Dieu. La mort du Christ, sommet de souffrance, marque aussi la fin de ses souffrances et la possibilité d'union de l'Amour éternel, Union de la Trinité.
Pour Édith Stein, après la nuit obscure qui est purification du cœur, nous accédons à l'Union divine. Édith Stein affirme ainsi qu' on ne peut acquérir une scientia crucis que si l'on commence à souffrir vraiment du poids de la croix. Dès le premier instant, j'en ai eu la conviction intime et j'ai dit du fond du cœur : Ave Crux, spes unica. Il ne faut pas pour autant avoir une vision doloriste de ce que dit Édith Stein : le but est bien la joie d'un amour vécu en plénitude. Tout doit mener à l'amour : Il est à peine besoin de parler de l'amour : tout l'enseignement de saint Jean de la Croix est un enseignement de l'amour, une manière d'indiquer comment l'âme peut parvenir à être transformée en Dieu, qui est l'Amour. Du reste, saint Jean de la Croix n'utilise pas l'expression "science de la croix" mais « science d'amour. Un des plus beaux poèmes d’Édith Stein porte sur la joie de l'Esprit Saint :
Es-tu le doux cantique de l'amour
et du respect sacré qui retentit sans fin
autour du trône de la Trinité sainte,
symphonie où résonne
la note pure donnée par chaque créature ?
le son harmonieux
l'accord unanime des membres et de la Tête,
dans lequel chacun au comble de la joie
découvre le sens mystérieux de son être
et le laisse jaillir en cri de jubilation,
rendu libre
en participant à ton propre jaillissement :
Saint-Esprit, jubilation éternelle. Malgré la nuit
Cette science de la croix conduira Édith Stein à vouloir s'offrir et souffrir en s'unissant au Christ. Dès 1930, elle écrira : Je ressens combien est faible l'influence directe, cela aiguise en moi le sentiment de l'urgence de l’holocaust personnel. La rédaction de son testament confirmera la volonté d’Édith Stein de vivre jusqu'au bout cette science de la Croix, affirmant accepter déjà maintenant avec joie la mort que Dieu a prévue pour moi dans une parfaite soumission à Sa très Sainte Volonté. Je demande au Seigneur d'accepter ma vie et ma mort pour son honneur et Sa gloire.
Philosophie d'Edith Stein Empathie
L'empathie, ou Einfühlung, est un terme emprunté par Husserl à Théodor Lipps, désignant l’expérience intersubjective. Elle adopte un point de vue différent du philosophe Theodor Lipp. La thèse d'Édith Stein analyse l'empathie comme le don d'intuition et de rigueur qui permet de saisir ce que vit l'autre en lui-même. L'empathie peut permettre à la personne humaine, considérée comme un univers en soi, de s'enrichir et d'apprendre à se connaître au contact des autres. Ainsi, même si nous ne les vivons pas personnellement par expérience, nous pouvons, par l'empathie, découvrir des choses sur nous-mêmes.
Édith Stein affirme que par l'empathie, je peux vivre des valeurs et découvrir des strates correspondantes de ma personne, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être dévoilées par ce que j'ai vécu de manière originaire. Celui qui n'a jamais vu le danger de près peut, en réalisant la situation d'un autre par empathie, découvrir qu'il est lui-même lâche ou courageux. En revanche, ce qui contredit ma propre structure d'expériences, je ne peux pas le remplir mais je peux me le représenter de manière vide, abstraite. De cette analyse, Édith Stein affirme que seul celui qui vit lui-même comme personne, comme unité de sens, peut comprendre d'autres personnes.
C'est l'ouverture aux autres qui permet ainsi de mieux connaître la réalité. Celle-ci ne peut donc pas se fonder uniquement sur le moi pour atteindre la connaissance mais a besoin d'accepter les choses extérieures comme elles sont, ouvrant ainsi la porte à une plus grande connaissance des choses, sinon nous nous emmurons dans la prison de nos particularismes
La production philosophique d'Edith Stein est étroitement liée aux étapes de sa vie. Parmi ses travaux proprement phénoménologiques, rappelons sa thèse sur l'Einfühlung 1917, c'est-à-dire l'expérience d'autrui ; il faut citer également les Beiträge zur philosophischen Begründung der Geisteswissenschaften 1922, qui épousent, dans une perspective proche de celle de Dilthey, le projet husserlien de donner ses assises définitives à tout l'édifice de la science. Témoignant également de la permanence des préoccupations psychologiques d'Edith Stein, ces Beiträge précèdent une Untersuchung über den Staat 1925 où l'on ressent, entre autres influences, celle de Reinach et de sa théorie de l'essence du droit. À quoi s'ajoute un travail harassant sur les brouillons de Husserl, sans lequel Heidegger n'eût pu mettre au net le texte sur le Inneres Zeitbewusstsein 1928.
Devenue catholique, Edith Stein s'initie à la philosophie chrétienne et à la méthode scolastique, et tente une confrontation entre Husserl et Thomas d'Aquin 1929. Elle s'attaque par ailleurs à un travail sur Akt und Potenz qui sera ultérieurement développé dans une ontologie chrétienne, Endliches und Ewiges Sein. Elle tente d'y réarticuler, à travers une révision théocentrique du monde, les apports de la phénoménologie.
Aspirant à la vie religieuse dans un ordre de tradition contemplative et mystique, Edith Stein oriente alors sa réflexion vers ce qui, dans l'analyse de la conscience et de la vie intérieure réinventée par Husserl, permet un rapprochement avec la tradition spirituelle chrétienne. De cette attention naissent de beaux textes sur la personne qui, d'une part, font référence au Château de l'âme de Thérèse d'Ávila et qui, d'autre part, en ce qui concerne les communautés de destin ou d'institution, font progresser des thèmes qu'elle avait déjà abordés. C'est dans cette perspective qu'il faut lire la Kreuzeswissenschaft, un commentaire de Jean de la Croix qu'elle laisse inachevé lors de son arrestation, et qui éclaire son nom de religion : Teresa Benedicta a Cruce.
Plus proche de Reinach et de Ingarden que de Heidegger et de l'école de Fribourg, Edith Stein conçoit la phénoménologie à la fois comme une enquête sur l'essence et comme une analyse de ce qui se révèle de cette essence tantôt dans une inspection de l'esprit, tantôt à partir des objectivations culturelles dans lesquelles l'homme se donne à voir. On peut parler à ce propos d'une anthropologie essentialiste.
Liens
http://youtu.be/hJHr5fsWFzs Ste Edith Tillier
http://youtu.be/O2kpeXgax2w Emission de KTO
http://youtu.be/HAL0OvToRpk film sur sa vie
    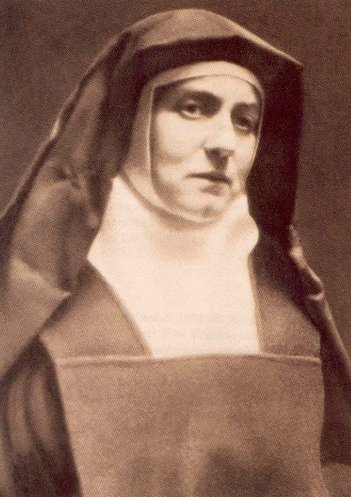       [img width=600]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRz80p5iWg9IRuKVHz516DpczS9WhyxZX59jliOdaAkcHBLp18aL6fcxEx[/img]
Posté le : 11/10/2014 16:39
|
|
|
|
|
Louis Lumière |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 5 octobre 1864 à Besançon naît louis Jean Lumière
mort, à 83 ans le 6 juin 1948 à Bandol dans le Var, et son frère Auguste Marie Louis Nicolas Lumière, né le 19 octobre 1862 à Besançon et mort le 10 avril 1954 à Lyon sont deux ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie. Ils sont souvent désignés comme les frères Lumière.Leurs films les plus notables sont : La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, l'Arroseur arrosé, le Repas de bébé, l'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat
En bref
Fils d'un industriel franc-comtois spécialisé dans la fabrication de matériel photographique, Louis Lumière ne prétendit jamais au titre de cinéaste, se contentant de celui, plus humble, de physicien, doublé d'un bricoleur passionné qui se consacra jusqu'à la fin de ses jours à des recherches sur la photographie en couleurs, la stéréo-synthèse et le film en relief. Il n'inventa point du jour au lendemain le principe de l'enregistrement photographique du mouvement, ni l'illusion de sa reproduction, ni même la projection sur écran d'images animées, tout cela ayant été pressenti avant lui et parfois réalisé, de manière empirique, par Étienne-Jules Marey, Georges Demény, Émile Reynaud, Thomas Edison et bien d'autres. Il ne fit, aidé de son frère Auguste, que porter à leur point de perfection les travaux de ses prédécesseurs et rendre leur exploitation possible par l'utilisation de la pellicule perforée et un mécanisme simple d'enclenchement, le brevet du Cinématographe est déposé le 13 février 1895. Initialement, cette extraordinaire machine à moudre les images, à laquelle fut donné le nom un peu rébarbatif de cinématographe pour reprendre les termes d'un journal de 1895, année de la première projection payante dans les salons du Grand Café, à Paris, au mois de décembre, après qu'il eut été présenté, le 22 mars, à la Société d'encouragement à l'industrie nationale, et, le 17 avril, à la Sorbonne, ne représentait guère, dans l'esprit de ses créateurs, qu'une curiosité scientifique, à laquelle ils ne voyaient — ni ne souhaitaient — d'avenir commercial, et moins encore artistique.
Vies
Les frères Lumière sont les fils de l'industriel, peintre et photographe Antoine Lumière, né le 13 mars 1840 à Ormoy Haute-Saône, et de Jeanne Joséphine Costille, née le 29 septembre 1841 à Paris. Antoine et Jeanne se sont mariés le 24 octobre 1861 à la mairie du 5e arrondissement de Paris et en l'église Saint-Étienne-du-Mont. Installés à Besançon, maison natale des frères Lumière leurs deux enfants naissent dans cette ville : Auguste le 19 octobre 1862 au 1 place Saint-Quentin et Louis le 5 octobre 1864 au 143 grande rue. Leurs autres enfants naîtront à Lyon.
Inventions
Les frères Lumière ont déposé plus de 170 brevets, essentiellement dans le domaine de la photographie. Ils lancent la commercialisation des plaques photographiques instantanées en 1881. La vente de ces plaques dites Plaques Étiquettes-Bleues a fait leur fortune.
Contrairement à une idée reçue, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma. En effet, ce sont les Américains, Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, et surtout son assistant William Kennedy Laurie Dickson qui tournent, à l'aide de leur caméra, le kinétographe, dès 1891 et avant 1895 quelque soixante-dix films.
En 1894, Antoine Lumière, le père d'Auguste et de Louis, assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope, l'appareil qui permet aux films d'Edison d'être vus par un seul spectateur à la fois, mais il assiste également à une projection des premiers dessins animés du cinéma, dessinés par Émile Reynaud qui les présente au public rassemblé dans son Théâtre optique. Pour Antoine, pas de doute : l'image animée est un marché d'avenir, à condition de marier le miracle de l'image photographique en mouvement avec la magie de la projection sur grand écran. Convaincu à son tour, Louis Lumière se lance dans la recherche avec son mécanicien, Charles Moisson. Durant l'été 1894, dans l'usine Lumière de Lyon-Monplaisir, Louis met au point un mécanisme ingénieux qui se différencie de ceux du kinétographe et du kinétoscope. Comme Edison, il adopte le format 35 mm, mais, pour ne pas entrer en contrefaçon avec la pellicule à huit perforations rectangulaires autour de chaque photogramme, brevetée par l'inventeur et industriel américain, il adopte une formule à deux perforations rondes par photogramme; abandonnée par la suite. Inspiré, déclarait-il, par le mécanisme de la machine à coudre de sa mère, où l'entraînement du tissu est assuré à l'aide d'un patin actionné par une came excentrique, Louis dessine une came originale qui actionne un jeu de griffes dont les dents s'engagent dans les perforations, déplacent la pellicule d'un pas, se retirent pendant que le photogramme est impressionné, et reviennent à leur point de départ pour entraîner la pellicule et impressionner un nouveau photogramme. Ad libitum.
Le 26 décembre 1894, on peut lire dans le journal Le Lyon républicain, que les frères Lumière travaillent actuellement à la construction d’un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d’Edison et dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur.
Avec son mécanisme génial qui équipe encore actuellement toutes les caméras utilisant le film argentique, s'il n'a pas fait les premiers films, Louis Lumière et, par contrat, son frère Auguste est généralement considéré comme l'inventeur du cinéma en tant que spectacle photographique en mouvement projeté devant un public assemblé. Son mécanisme est une amélioration considérable par rapport à celui du kinétographe, où la pellicule était entraînée par un débiteur denté qui équipe encore aujourd'hui les appareils de projection argentiques actionné brutalement par une roue à rochet, remplacée plus tard par une croix de Genève ou une croix de Malte, plus souples. D'ailleurs, au début, les frères présentent leur appareil sous le nom de kinétographe Lumière ou kinétoscope Lumière, avant de le baptiser cinématographe.
Les frères Lumière prennent ainsi à partir de 1895 une part prépondérante dans le lancement du spectacle de cinéma, prémisses d'une industrie florissante que va notamment développer Charles Pathé. En 1907, les deux frères sont à l'origine de l'obtention de la couleur sur plaque photographique sèche, dite autochrome, que Louis Lumière, qui paradoxalement n'aime pas le cinéma considère comme étant sa plus prestigieuse invention, celle à laquelle il a consacré plus de dix années de sa vie.
Projections privées et publiques de 1895
Le premier film tourné par Louis Lumière est Sortie d'usine, plus connu aujourd'hui sous le nom de La Sortie des Usines Lumière. Il a été tourné le 19 mars 1895, à Lyon rue Saint-Victor rue actuellement nommée rue du Premier-Film. La première représentation privée du Cinématographe Lumière a lieu à Paris le 22 mars 1895 dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Dans la foulée, Louis Lumière tourne durant l'été 1895 le célèbre Jardinier qui devient plus tard L'Arroseur arrosé. C'est le film le plus célèbre des frères Lumière et la première des fictions photographiques animées les premières fictions du cinéma étant les Pantomimes lumineuses non photographiques d'Émile Reynaud.
Mécanisme Lumière : came excentrique et griffes, film à perforations rondes les perforations rectangulaires des films Edison étant brevetées.
En attendant la première séance publique, on montre le Cinématographe à de nombreux scientifiques. Le succès est toujours considérable. Le 11 juin pour le Congrès de photographes à Lyon, le 11 juillet à Paris à la Revue générale des sciences, le 10 novembre à Bruxelles devant l’Association belge de photographes, le 16 novembre dans l’amphithéâtre de la Sorbonne, etc.
La première projection publique des Lumière a lieu le 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand Café de l'hôtel Scribe, 14 boulevard des Capucines à Paris, présentée par Antoine Lumière devant trente-trois spectateurs. Charles Moisson, le constructeur de l’appareil, est le chef mécanicien, il supervise la projection. Le prix de la séance est fixé à 1 franc.
Breveté en février 1895, le Cinématographe est présenté en mars à Paris, rue de Rennes, lors d'une séance de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, puis, à partir de juin, lors de diverses manifestations scientifiques – les représentations publiques payantes débutant le 28 décembre 1895, boulevard des Capucines à Paris, dans le Salon indien au sous-sol du Grand Café. La séance dure environ 20 minutes. On y projette dix bandes, dont la Sortie des usines Lumière (38 secondes), l'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat (50 secondes) et le Jardinier et le Petit Espiègle (aujourd'hui connu sous le nom de l'Arroseur arrosé, 38 secondes).
Alors qu'aux États-Unis les démonstrations publiques des projecteurs Latham ou Armat-Jenkins viennent de ne rencontrer qu'un accueil mitigé, le Cinématographe connaît tout de suite un immense succès. Dès 1896, l'exploitation commence à Lyon ; en février, à Londres ; en mai, à New York. Ce retentissement mondial conduira de nombreux historiens à considérer le 28 décembre 1895 comme la date de naissance du cinéma.
Les travaux des frères Lumière
Aussi bien pour montrer et vendre le Cinématographe que pour tourner les films nécessaires à la constitution de son catalogue (1 000 titres dès 1898), Louis Lumière envoie ses opérateurs dans le monde entier, constituant ainsi la première collection de documents d'actualités. Aidé de son frère, il s'adonne ensuite à d'autres activités. En 1899, il met au point le Photorama, qui permet d'obtenir sur une seule plaque l'image continue d'un tour d'horizon. L'année suivante, à Paris, l'Exposition universelle lui rend hommage en diffusant ses films sur écran géant. En 1903, Louis crée pour la photographie des couleurs une plaque à réseau trichrome – l'autochrome, fondée sur la synthèse additive –, qui est commercialisée en 1907. Il étudie également la photographie en relief et présente en 1920, à l'Académie des sciences (où il a été élu l'année précédente), la photostéréosynthèse. Enfin, en 1935, grâce à la technique des anaglyphes, il obtient le relief cinématographique.
La création d'un espace imaginaire
L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, de Louis Lumière, sera l'une des attractions du spectacle du 28 décembre 1895. C'est évidemment la locomotive paraissant foncer sur les spectateurs qui fera le succès du film. Outre la profondeur de champ, les nuages de vapeur dégagés par la locomotive – emplissant pendant quelques secondes tout le champ – contribuent fortement à la production d'un espace imaginaire en trois dimensions.
D'autre part, Louis Lumière sait parfaitement maîtriser le contraste entre le champ initialement vide puis rapidement rempli par la foule. Ce mouvement produit à lui seul une forte présence du hors champ, puisque les personnages ne cessent d'entrer et de sortir du cadre. La trajectoire de la locomotive, comme celle des personnages, permet de jouer sur l'ensemble des échelles de plan, du très grand ensemble jusqu'au très gros plan en amorce. Par la suite, André Bazin fera de cette vue la référence de la mise en scène en profondeur de champ, et de Lumière, le père du cinéma réaliste français. En 1963, Jean-Luc Godard s'amusera à parodier cette entrée en gare dans une séquence des Carabiniers, et son personnage de paysan se protégera évidemment le visage lorsque la locomotive foncera vers lui…
Programme d’une projection publique au Salon indien du Grand Café à Paris en 1895
Le programme complet de la première séance publique payante, à Paris, compte 10 films, tous produits en 189510 :
La Sortie de l'usine Lumière à Lyon "vue" documentaire
La Voltige "vue comique" troupier
La Pêche aux poissons rouges "vue" familiale : le fils d'Auguste Lumière, alors bébé, pêche dans un aquarium
Le Débarquement du congrès de photographie à Lyon "vue" documentaire
Les Forgerons "vue" documentaire
Le Jardinier "vue comique"
Le Repas de bébé "vue" familiale : le fils d'Auguste Lumière
Le Saut à la couverture "vue comique" troupier
La Place des Cordeliers à Lyon "vue" documentaire
La Mer ("vue" documentaire : baignade de jeunes Citadins
Le film L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat n'est pas projeté ce jour-là, mais le sera par la suite, remportant un énorme succès.
Six mois après la présentation de décembre 1895, la première projection de films en Amérique avec le Cinématographe Lumière est organisée par Louis Minier et Louis Pupier à Montréal, voir cinéma québécois.
L'apport de Louis Lumière à ce que le critique littéraire Ricciotto Canudo nomme en 1920 le "7e art", est primordial. Son expérience de photographe lui permet dans l'esthétique de ses films d'aller plus loin que l'équipe Edison-Dickson. Dans ses "vues photographiques animées" ainsi qu'il dénomme ses bobineaux, qui relèvent du même primitivisme que les premiers "films" américains, il fait preuve cependant d'une maîtrise du cadrage et de la lumière qui explique en grande partie le succès de ses réalisations. Le choix des décors naturels et une belle exposition font que la presse s'exclame : C’est la vie même, c’est le mouvement pris sur le vif. Louis trouve très naturelle la position de prise de vue en diagonale du champ par rapport au mouvement des personnages, à cette époque, les films Edison-Dickson ne connaissent que la disposition frontale. Mais il est vrai que ses concurrents et prédécesseurs américains découvrent aussi spontanément l'attrait des cadrages rapprochés, ce qu'on appellera le Plan rapproché et - très justement - le Plan américain, Louis Lumière s'abstenant de se rapprocher de ses sujets, retenu par une pudeur caractéristique de l'époque, une pudeur que ne ressent pas Laurie Dickson qui, lui, plus canaille dans ses choix et ses cadrages, n'hésite pas à mettre sa caméra directement sous le nez de ses personnages. Il faut dire que le tandem Edison-Dickson ne vise pas le même public que les deux frères lyonnais. Les premiers recherchent la clientèle populaire de New-York et de Brooklyn, et celle des villes de l'Amérique profonde, tandis que les frères Lumière cherchent à séduire la clientèle huppée et aisée, celle qui est capable d'acquérir pour son plaisir un exemplaire du Cinématographe Lumière pour filmer la famille, et des bobineaux Lumière déjà impressionnés, pour compléter l'éducation des enfants.
Auguste et Louis Lumièrerares français honorés au Walk of fame d'Hollywood
Rapidement, les frères Lumière prennent conscience de l'intérêt de filmer avec leur Cinématographe des images pittoresques de par le monde et de les montrer en projection, ou de les vendre avec l'appareil. Fins commerciaux, ils refusent de céder les brevets de leur invention à Georges Méliès qui leur en offre pourtant une petite fortune. Ils tentent même de décourager ce futur et talentueux concurrent en lui prédisant la ruine s'il se lance dans la production de films, Méliès ferme sa société Star Film en 1923, après avoir gagné énormément d'argent grâce à ses films, et sa ruine est essentiellement due à son incompréhension du devenir du cinéma, et à son obstination à considérer les films comme des sous-produits du music-hall. Les frères Lumière, eux, ont la sagesse de s'arrêter de produire des films en 1902, quand ils comprennent que le cinéma est un langage nouveau dont ils n'ont connaissance ni des règles à venir ni de l'importance qu'il va prendre dans le monde entier. Ce que n'ignore pas Thomas Edison, qui prédit que le cinéma sera plus tard l'un des piliers de la culture humaine .
Autres inventions
Auguste et Louis Lumière ont mis au point et commercialisé le premier procédé industriel de photographie couleur : l'autochrome
Institut Lumière de Lyon
Les Lumière inventent la plaque photographique sèche, la photographie en couleur 1896, la photostéréosynthèse, procédé de photographie en relief, 1920 et le cinéma en relief en 1935 par le procédé des anaglyphes.
Ils sont à la source de bien d'autres inventions ou théories, notamment dans l'univers médical. Auguste Lumière tente en particulier - sans succès, et sa rancœur envers ses collègues apparaît dans ses ouvrages - de diffuser une théorie des phénomènes colloïdes en biologie, théorie qui malgré ses approximations et ses nombreux postulats, développe une idée avant-gardiste de ce que sera l'immunologie moderne.
Il a été recensé 196 brevets + 43 additifs ayant comme titulaire " Lumière " Brevets collectifs + sociétés Lumière + brevets individuels. Ils sont à la source de médicaments tels que le Tulle gras pour soigner les brûlés, la thérapeutique de la tuberculose grâce aux sels d'or et à la Cryogénine18, l'Allocaïne…
La demeure de leur père Antoine, située près de leurs anciennes usines, dans le 8e arrondissement de Lyon, est aujourd'hui un musée du cinéma : l'Institut Lumière présidé par le cinéaste Bertrand Tavernier et dirigé par Thierry Frémaux, directeur général de l'Institut Lumière.
Attitude pendant l’Occupation
Louis Lumière s'implique fortement dans le soutien au régime fasciste italien. En effet, le gouvernement fasciste veut lutter contre la prédominance du cinéma américain et il organise pour le quarantième anniversaire de l'invention du cinéma, le 22 mars 1935, un grand gala auquel assiste en personne Louis Lumière. Ce jour-là, Louis dédicace sa photo : À son Excellence Benito Mussolini avec l'expression de ma profonde admiration. Cette photo et cette dédicace sont publiées en page 3 d'un ouvrage édité à cette occasion, par l'Imprimerie nationale italienne. Il associe son frère Auguste dans la vive gratitude qu'il exprime à l'égard des organisateurs fascistes de cette assemblée et dans ce même ouvrage, émanant du secrétariat des Groupes Universitaires Fascistes, il évoque l'amitié qui unit nos deux pays et qu'une communauté d'origine ne peut manquer d'accroître à l'avenir.
Le 15 novembre 1940, il écrit, dans Le Petit Comtois : Ce serait une grande faute de refuser le régime de collaboration dont le maréchal Pétain a parlé dans ses admirables messages. Auguste Lumière, mon frère, dans des pages où il exalte le prestige incomparable, le courage indompté, l'ardeur juvénile du Maréchal Pétain et son sens des réalités qui doivent sauver la patrie, a écrit : Pour que l'ère tant désirée de concorde européenne survienne, il faut évidemment, que les conditions imposées par le vainqueur ne laissent pas un ferment d'hostilité irréductible contre lui. Mais nul ne saurait mieux atteindre ce but que notre admirable Chef d'État, aidé par Pierre Laval qui nous a donné déjà tant de preuves de sa clairvoyance, de son habileté et de son dévouement aux vrais intérêts du pays. Je partage cette manière de voir. Je fais entièrement mienne cette déclaration.
Auguste Lumière siégea au conseil municipal de Lyon mis en place par le régime de Vichy en 1941, il n'y fut cependant presque jamais présent. En juillet 1941, il fit partie du comité de patronage de la Légion des volontaires français LVF créée à l'initiative du Parti populaire français PPF de Jacques Doriot. Il mit donc sa notoriété d'inventeur au service de la collaboration armée avec l'ennemi qui pillait, torturait, déportait, fusillait. Il écrit dans le journal du PPF L'Emancipation Nationale.
Louis Lumière est membre du Conseil national mis en place par Vichy, et fait partie du comité d'action de la LVF, chargé du recrutement à Marseille.
Auguste et Louis Lumière reçurent tous deux la décoration de la Francisque.
En 1995, pour la célébration du centenaire de l'invention du cinéma, la Banque de France voulut honorer les frères Lumière en imprimant le nouveau billet de 200 FF à leur effigie. L'Amicale des Réseaux Action de la France Combattante protesta : Les frères Lumière nous inspirent un profond mépris. Ils ne peuvent être honorés sans outrager les victimes de la collaboration. À la séance du 24 juillet 1995 du Conseil municipal de Lyon, Bruno Gollnisch, professeur à l’université Lyon-III, représentant le Front national, déclare : Après Alexis Carrel …, ce sont donc de nouvelles figures illustrant le génie lyonnais qui se trouvent ainsi attaquées. Auguste Lumière développa des positions eugénistes proches de celles d'Alexis Carrel dont il est très proche au début de la guerre 1914-1918 : il préconisait en effet, croyant à la théorie médicale de la dégénérescence, que les malades tuberculeux soient interdits de descendance afin d'améliorer l'espèce.
L'historien Pascal Ory indique qu'à son avis le soutien des frères Lumière au gouvernement de Vichy n'avait pas dépassé « le stade d'une ou deux déclarations à la presse .
Les frères Lumière se sont d'ailleurs appuyés pendant plusieurs années sur un collègue particulièrement fidèle dont le rôle a été majeur, le chimiste Alphonse Seyewetz, de confession juive. Celui-ci était cependant mort en 1940, avant donc le début des persécutions, du moins en France.
L'affaire du projet d'impression de billets de 200 FF à l'effigie des frères Lumière fit grand bruit dans la presse : cette impression fut alors annulée par la Banque de France. Le billet sortit finalement à l'effigie de Gustave Eiffel. Rien de tel n'advint 17 ans plus tard, en 2012, lorsque les frères Lumière furent choisis pour représenter Rhône-Alpes sur la pièce de 10 € en argent éditée par la Monnaie de Paris, au sein de la collection Les Euros des Régions.
Hommages
Les frères Lumière sont inhumés à Lyon, au nouveau cimetière de la Guillotière carré A6.
Le monument à la mémoire des frères Lumière, La Ciotat
Le monument à la mémoire des frères Lumière, place Ambroise Courtois
Un monument a été érigé sur la plage de La Ciotat Bouches-du-Rhône et l'ancienne allée principale de leur propriété s'appelle allées Lumière. Le cinéma de la ville porte également leur nom.
Il est prévu que l'Eden Théâtre, où fut projeté le premier film Lumière à exploitation commerciale, soit restauré par la Ville de La Ciotat à l'occasion de l'opération Marseille Provence capitale de la culture en 2013 .
La place centrale de Front Lot au parc Walt Disney Studios parc consacré au cinéma porte le nom de place des Frères-Lumière.
Un monument en forme d'écran géant courbe a été érigé à leur mémoire place Ambroise Courtois à Lyon en face de la Villa Lumière, ancienne résidence d'Antoine Lumière, leur père, qui abrite aujourd'hui l'Institut Lumière. La partie concave, peinte en blanc uni, permet la projection de films en plein air.
En 2010, Philippe Starck utilise une image du film L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat pour le design de l'entrée de la salle de cinéma numérique du palace parisien Le Royal Monceau, Le Cinéma des Lumières.
Font partie des très rares artistes français à avoir été honorés par une étoile au Hollywood Walk of Fame à Los Angeles.
Les frères sont les effigies d'une pièce de 10 € en argent éditée en 2012 par la Monnaie de Paris, pour la collection Les Euros des Régions afin de représenter Rhône-Alpes.
Un des deux lycées de La Ciotat porte également en leur honneur le nom de lycée Auguste-et-Louis-Lumière .
Le collège Louis Lumière à Marly-le-Roi Yvelines est nommé en l'honneur d'un des frères Lumière.
Liens
http://youtu.be/cBQ9wAAW_zs La sortie des usines Lumière de Lyon
http://youtu.be/Frl0K09o-KA L'arroseur arrosé
http://youtu.be/qoPPuz_MICQ Le repas de Bébé
http://youtu.be/ROkBWuYsysM Les frères Lumière par Rohmer
http://youtu.be/uNReoA8BV_Y Le squelette joyeux
http://youtu.be/zaO_H2cUh60 Arrivée du train à la Ciotat
http://youtu.be/UBTMRBVIXvo Bataille de boule de neige
          
Posté le : 04/10/2014 11:42
|
|
|
|
|
Louis Pasteur 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 septembre 1895 à Marnes-la-Coquette, Seine-et-Oise, à 72 ans
meurt Louis Pasteur
né à Dole Jura le 27 décembre 1822, scientifique français, chimiste microbiologiste et physicien de formation, il travaille à l'université de Strasbourg, de lille dans le Nord, il est diplomé de l'école normale supérieure il aura pour étudiant Charles Friedel qui soutient sa thése sous son parrainage, pionnier de la microbiologie, qui, de son vivant même, connut une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Il est fait Chevalier de la Légion d'honneur en 1853 et commandeur en 1868, puis grand-officier en 1878
En bref
Pasteur est l'un des fondateurs de la biologie moderne, telle qu'elle s'est développée au XXe siècle. Son œuvre scientifique est à l'origine de quelques-unes des disciplines majeures des sciences de la vie : biochimie métabolique, microbiologie générale, étude des virus et bactéries pathogènes, immunologie. Sa théorie des germes, la pratique des vaccinations qu'il a lancée révolutionnèrent la médecine et la science vétérinaire. Si l'image de Pasteur, bienfaiteur de l'humanité, s'est finalement imposée, la vérité oblige à dire que ce grand savant a dû lutter toute sa vie, avec acharnement, pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de ses travaux. Ses réussites scientifiques, ses luttes victorieuses en faveur de la recherche appliquée, l'ont entraîné, presque malgré lui, dans le mouvement scientiste des chantres du progrès, si puissant à la fin du XIXe siècle.
Élève de l'école primaire, puis externe au collège d'Arbois Jura, Louis Pasteur est fils de tanneur. C'est un élève moyen, mais il dénote un penchant très vif pour le dessin. Le principal du collège d'Arbois l'incite à s'orienter vers l'École normale supérieure. En octobre 1838, Louis Pasteur et son camarade Jules Vercel partent pour Paris afin de suivre les cours du lycée Saint-Louis. Très rapidement, Pasteur, qui ne supporte pas la séparation du milieu familial, retourne à Arbois, puis part pour le collège de Besançon, plus proche de ses parents que la capitale.
En 1840, Louis Pasteur est bachelier ès lettres. Il continue de peindre et de graver, et il se lie avec Charles Chappuis. En 1842, il est bachelier ès mathématiques ; admissible à l'École normale supérieure 14e sur 22, il décide de se représenter pour obtenir un meilleur rang et part pour Paris. Il est reçu à l'École normale quatrième en 1843.
Sa vie Pasteur chimiste : la recherche fondamentale
Dans la famille de Pasteur, on était patriote et même nationaliste. Son père, Jean-Joseph Pasteur, conscrit en 1811, avait fait la guerre d'Espagne dans les armées napoléoniennes. Sergent-major, il était chevalier de la Légion d'honneur. Après les Cent-Jours, il dut ouvrir à Dôle, dans le Jura, une tannerie pour permettre à sa famille de vivre dans une modeste aisance.
Louis Pasteur naquit à Dôle le 27 décembre 1822. Il était le troisième enfant de Jean-Joseph Pasteur et de Jeanne-Étiennette Roqui, une personne très pieuse. Il est baptisé dans la Collégiale Notre-Dame de Dole le 15 janvier 1823. Son père, après avoir été sergent dans l’armée napoléonienne, reprit la profession familiale de tanneur. En 1827, la famille déménage et quitte Dôle pour Marnoz lieu de la maison familiale des Roqui, pour finalement s'installer en 1830 à Arbois maison de Louis Pasteur à Arbois, localité plus propice à l'activité de tannage et où Pasteur passe toute son enfance. Jusqu'à sa mort, il gardera envers sa famille, ses amis, sa propriété familiale d'Arbois, sa province et son pays, un attachement sans faille.
Le jeune Louis va à l'école communale puis au collège d'Arbois. C'est un bon élève, qui manifeste de grands dons pour le dessin. En 1839, il entre au collège royal de Besançon ; il y passe le baccalauréat. Pour ne plus être à la charge de sa famille, il prend, dans le même collège, un poste de maître-répétiteur et se met à préparer le concours d'entrée à l'École normale supérieure, à Paris dans la section sciences. Il passe le concours une première fois en 1842 et est admis 16e sur 23. Ce rang était insuffisant pour obtenir une bourse ; Pasteur démissionne donc de l'École et décide de se représenter au concours pour obtenir un meilleur classement. Il suit la préparation du lycée Saint-Louis, à Paris, et, en 1843, est reçu 5e ce qui lui permet de devenir élève-boursier. De 1843 à 1846, Louis Pasteur poursuit de brillantes études à l'École normale et à la Sorbonne ; il est reçu 3e à l'agrégation de sciences physiques en 1846. Nommé immédiatement agrégé-préparateur à l'École normale, il pourra y passer deux ans et commencer des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat ès sciences.
C'est à cette époque qu'il se fait connaître pour ses talents de peintre ; il a d'ailleurs fait de nombreux portraits de membres de sa famille et des habitants de la petite ville.
Il part au lycée royal de Besançon. Puis, en octobre 1838, il le quitte pour l'Institution Barbet à Paris afin de se préparer au baccalauréat puis aux concours. Cependant, déprimé par cette nouvelle vie, il abandonne cette idée, quitte Paris et termine son année scolaire 1838-1839 au Collège d'Arbois. À la rentrée 1839, il réintègre le collège royal de Franche-Comté, à Besançon. En 1840, il obtient le baccalauréat en lettres puis, en 1842, après un échec, le baccalauréat en sciences mathématiques. Pasteur retourne de nouveau à Paris en novembre. Logé à la pension Barbet où il fait aussi office de répétiteur, il suit les cours du lycée Saint-Louis et assiste avec enthousiasme à ceux donnés à la Sorbonne par Jean-Baptiste Dumas ; il a pu également prendre quelques leçons avec Claude Pouillet. En 1843 il est finalement admis – quatrième – à l'École normale. Plus tard il sera élève de Jean-Baptiste Boussingault au Conservatoire national des arts et métiers.
Pasteur avait suivi avec passion les cours de chimie de Jean-Baptiste Dumas 1800-1882, qu'il admirait beaucoup, et ceux de Jean-Baptiste Biot 1774-1862 qui avait découvert la polarisation rotatoire de la lumière par les cristaux. C'est donc en chimie, sous la direction du professeur de chimie de l'École normale, Antoine-Jérôme Balard 1802-1876, que Pasteur commence ses recherches. Balard, son directeur de thèse, était un chimiste très brillant : à vingt-quatre ans, il avait découvert le brome. Il était membre de l'Académie des sciences. Dans le laboratoire de Balard travaillait aussi un jeune chimiste plein d'avenir, Auguste Laurent, partisan convaincu de la théorie atomique, récemment formulée par Dalton, Proust ou Avogadro) et encore très contestée. Le jeune Pasteur discutait beaucoup avec son aîné Auguste Laurent et reprit nombre de ses idées dans ses premiers travaux. En août 1847, Pasteur présenta deux mémoires pour obtenir son doctorat.
Il se marie le 29 mai 1849 avec Marie Laurent, la fille du recteur de la faculté de Strasbourg7. Ensemble ils ont cinq enfants : Jeanne 1850-1859, Jean Baptiste 1851-1908 sans descendance, Cécile Marie Louise Marguerite -dite Cécile- 1853-1866, Marie-Louise 1858-1934)mariée en 1879 avec René Vallery-Radot, et Camille 1863-1865.
Marie Anne Laurent, dont Émile Roux dit qu'elle a été le meilleur collaborateur de Louis Pasteur écrit sous sa dictée, réalise ses revues de presse et veille à son image puis à sa mémoire jusqu'à son décès en 1910.
À l'École normale, Pasteur étudie la chimie et la physique, ainsi que la cristallographie. Il devient agrégé-préparateur de chimie, dans le laboratoire d'Antoine-Jérôme Balard, et soutient en 1847 à la faculté des sciences de Paris ses thèses pour le doctorat en sciences. Ses travaux sur la chiralité moléculaire lui vaudront la médaille Rumford en 1856.
Il est professeur à Dijon puis à Strasbourg de 1848 à 1853. Le 19 janvier 1849, il est nommé professeur suppléant à la faculté des sciences de Strasbourg ; il occupe également la suppléance de la chaire de chimie à l’école de pharmacie de cette même ville, du 4 juin 1849 au 17 janvier 1851. Marie Laurent, fille du recteur de l'université, épousée en 1849, sera pour le reste de sa vie une collaboratrice efficace et attentionnée, prenant des notes ou rédigeant des lettres sous sa dictée.
Sa vie professionelle:
En 1853 il est fait chevalier de la légion d'honneur.
En février 1854, pour avoir le temps de mener à bien des travaux qui puissent lui valoir le titre de correspondant de l'Institut, il se fait octroyer un congé rémunéré de trois mois à l'aide d'un certificat médical de complaisance. Il fait prolonger le congé jusqu'au 1er août, date du début des examens. Je dis au Ministre que j'irai faire les examens, afin de ne pas augmenter les embarras du service. C'est aussi pour ne pas laisser à un autre une somme de 6 ou 700 francs.
Il est ensuite en 1854 nommé professeur de chimie et doyen de la faculté des sciences de Lille nouvellement créée. C'est à cette occasion qu'il prononce la phrase souvent citée :" Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés."
Pasteur, qui s'intéressait à la fermentation depuis 1849 voir plus loin, est stimulé dans ces travaux par les demandes des brasseurs lillois concernant la conservation de la bière. Après Frédéric Kuhlmann et Charles Delezenne, Pasteur est ainsi un des premiers en France à établir des relations fructueuses entre l'enseignement supérieur et l'industrie chimique. Les travaux qu'il réalise à Lille entre 1854 et 1857 conduisent à la présentation de son Mémoire sur la fermentation appelée lactique dans le cadre de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille le 8 août 1857.
En 1857, il est nommé administrateur chargé de la direction des études à l'École normale supérieure.
De 1861 à 1862, Pasteur publie ses travaux réfutant la théorie de la génération spontanée. L'Académie des sciences lui décerne le prix Jecker pour ses recherches sur les fermentations.
En 1862, il est élu à l'Académie des sciences,dans la section de minéralogie, en remplacement de Henri Hureau de Senarmont.
Il étudie sur les maladies du vin, à savoir la pasteurisation, en 1863, sur la fabrication du vinaigre.
En octobre 1865, le Baron Haussman, instituant une commission chargée d'étudier l'étiologie du choléra et les moyens d'y remédier, y nomme Pasteur, avec Dumas (président, Claude Bernard malade, il n'y prendra part que de loin, Sainte-Claire Deville et Pelouze. Les savants, qui cherchent le principe de la contagion dans l'air alors que Snow, dans un travail publié en 1855, avait montré qu'il était dans l'eau, ne trouvent pas18 le microbe, que Pacini avait pourtant fait connaître en 1854.
À l'École normale supérieure, Pasteur est jugé autoritaire aussi bien par ses collègues que par les élèves et se heurte à de nombreuses contestations, ce qui le pousse à démissionner, en 1867, de ses fonctions d'administrateur. Il reçoit une chaire en Sorbonne et on crée, à l'École normale même, un laboratoire de chimie physiologique dont la direction lui est confiée.
Ses études sur les maladies des vers à soie, menées de 1865 à 1869 à la demande de Napoléon III, triomphent de la pébrine mais non de la flacherie et ne permettent pas vraiment d'endiguer le déclin de la sériciculture. Pendant ces études, il demeure à Pont-Gisquet près d'Alès. Durant cette période, une attaque cérébrale le rend hémiplégique. Il se remet, mais gardera toujours des séquelles : perte de l'usage de la main gauche et difficulté à se déplacer. En 1868 il devient commandeur de la légion d'honneur. Cette même année l'Université de Bonn le fait docteur honoris causa en médecine.
La défaite de 1870 et la chute de Napoléon III sont un coup terrible pour Pasteur, grand patriote et très attaché à la dynastie impériale. Par ailleurs, il est malade. L'Assemblée nationale lui vote une récompense pour le remercier de ses travaux dont les conséquences économiques sont considérables.
Le 25 mars 1873, il est élu membre associé libre de l'Académie de médecine.
En 1874, ses recherches sur la fermentation lui valent la médaille Copley, décernée par la Royal Society, de Londres
En 1876, Pasteur se présente aux élections sénatoriales, mais c'est un échec. Ses amis croient qu'il va enfin s'arrêter et jouir de sa retraite, mais il reprend ses recherches. Il gagne Clermont-Ferrand où il étudie les maladies de la bière avec son ancien préparateur Émile Duclaux, et conclut ses études sur la fermentation par la publication d'un livre : Les Études sur la bière 1876.
En 1878 il devient grand-officier de la légion d'honneur.
Le 11 décembre 1879, Louis Pasteur est élu à l'unanimité à l'Académie vétérinaire de France.
En 1881, l'équipe de Pasteur met au point un vaccin contre le charbon des moutons, à la suite des études commencées en 1877.
En 1882, il est reçu à l'Académie française. Dans son discours de réception, il accepte pour la science expérimentale l'épithète positiviste, en ce sens qu'elle a pour domaine les causes secondes et s'abstient donc de spéculer sur les causes premières et sur l'essence des choses, mais il reproche à Auguste Comte et à Littré d'avoir voulu imposer cette abstention à toute la pensée humaine. Il plaide pour le spiritualisme et célèbre « les deux saintetés de l'Homme-Dieu, qu'il voit réunies dans le couple que l'agnostique Littré formait avec sa femme chrétienne. C'est dans ce discours que Pasteur prononce la phrase souvent citée : Les Grecs ... nous ont légué un des plus beaux mots de notre langue, le mot enthousiasme ... — un dieu intérieur.
Il reçoit, le 29 décembre 1883, le mérite agricole pour ses travaux sur les vins et la fermentation. Il se rend régulièrement aux réunions du Cercle Saint-Simon.
En 1885, Pasteur refusa de poser sa candidature aux élections législatives, alors que les paysans de la Beauce, dont il avait sauvé les troupeaux grâce au vaccin contre le charbon, l'auraient sans doute porté à la Chambre des Députés.
La découverte du vaccin antirabique 1885 vaudra à Pasteur sa consécration dans le monde : il recevra de nombreuses distinctions. L'Académie des sciences propose la création d'un établissement destiné à traiter la rage : l'Institut Pasteur naît en 1888. En 1892, la troisième république lui organise un jubilé triomphal pour son 70e anniversaire. À cette occasion, une médaille gravée par Oscar Roty lui est offerte par souscription nationale
Il meurt le 28 septembre 1895 à Villeneuve-l'Étang, dans l'annexe dite "de Garches" de l'Institut Pasteur. Après des obsèques nationales, le 5 octobre, son corps, préalablement embaumé, est déposé dans l’un des caveaux de Notre-Dame, puis transféré le 27 décembre 1896, à la demande de sa famille, dans une crypte de l'Institut Pasteur.
Ses recherches scientifiques Œuvre Découverte de la dissymétrie moléculaire
Pasteur sépare les deux formes de cristaux d'acide tartrique, pour former deux tas : la forme lévogyre, qui, en solution, dévie la lumière polarisée vers la gauche, et la forme dextrogyre qui dévie la lumière polarisée vers la droite. Un mélange équimoléculaire racémique des deux solutions ne dévie pas cette lumière.
Dans les travaux que Pasteur a réalisés au début de sa carrière scientifique en tant que chimiste, il résolut en 1848 un problème qui allait par la suite se révéler d'importance capitale dans le développement de la chimie contemporaine : la séparation des deux formes de l'acide tartrique. Le seul acide tartrique que l'on connaissait à l'époque était un sous-produit classique de la vinification, utilisé dans la teinturerie. Parfois, au lieu de l'acide tartrique attendu, on obtenait un autre acide, qu'on appela acide racémique puis acide paratartrique. Une solution de l'acide tartrique, comme de chacun de ses sels tartrates, tournait le plan de la lumière polarisée la traversant, alors qu'une solution de l'acide paratartrique, comme de chacun de ses sels paratartrates, ne causait pas cet effet, bien que les deux composés aient la même formule brute. En 1844, Mitscherlich avait affirmé que, parmi les couples tartrate / paratartrate, il y en avait un, à savoir le couple tartrate double de soude et d'ammoniaque / paratartrate double de soude et d'ammoniaque, où le tartrate et le paratartrate n'étaient discernables que par la propriété rotatoire, présente dans le tartrate et absente dans le paratartrate tartrate double de soude et d'ammoniaque était la façon dont on désignait à l'époque le tartrate – base conjuguée de l'acide tartrique – de sodium et d'ammonium. En particulier, ce tartrate et ce paratartrate avaient, selon Mitscherlich, la même forme cristalline. Pasteur eut peine à croire que deux substances fussent aussi semblables sans être tout à fait identiques. Il refit les observations de Mitscherlich et s'avisa d'un détail que Mitscherlich n'avait pas remarqué : dans le tartrate en question, les cristaux présentent une dissymétrie hémiédrie, toujours orientée de la même façon ; en revanche, dans le paratartrate correspondant, il coexiste deux formes de cristaux, images spéculaires non superposables l'une de l'autre, et dont l'une est identique à celle du tartrate. Il sépara manuellement les deux sortes de cristaux du paratartrate, en fit deux solutions et observa un effet de rotation du plan de polarisation de la lumière, dans un sens opposé pour les deux échantillons. La déviation du plan de polarisation par les solutions étant considérée, depuis les travaux de Biot, comme liée à la structure de la molécule, Pasteur conjectura que la dissymétrie de la forme cristalline correspondait à une dissymétrie interne de la molécule, et que la molécule en question pouvait exister en deux formes dissymétriques inverses l'une de l'autre. C'était la première apparition de la notion de chiralité des molécules. Depuis les travaux de Pasteur, l'acide racémique ou paratartrique est considéré comme composé d'un acide tartrique droit, l'acide tartrique connu antérieurement et d'un acide tartrique gauche.
Chiralité chimie.
Les travaux de Pasteur dans ce domaine ont abouti, quelques années plus tard à la naissance du domaine de la stéréochimie avec la publication de l'ouvrage la Chimie dans l'Espace par Van 't Hoff qui, en introduisant la notion d'asymétrie de l'atome de carbone a grandement contribué à l'essor de la chimie organique moderne.
Pasteur avait correctement démontré par l'examen des cristaux puis par l'épreuve polarimétrique que l'acide paratartrique est composé de deux formes distinctes d'acide tartrique. En revanche, la relation générale qu'il crut pouvoir en déduire entre la forme cristalline et la constitution de la molécule était inexacte, le cas spectaculaire de l'acide paratartrique étant loin d'être l'illustration d'une loi générale, comme Pasteur s'en apercevra lui-même. François Dagognet dit à ce sujet : la stéréochimie n'a rien conservé des vues de Pasteur, même s'il demeure vrai que les molécules biologiques sont conformées hélicoïdalement.
Gerald L. Geison a noté chez Pasteur une tendance à atténuer sa dette envers Auguste Laurent pour ce qui est de la connaissance des tartrates.
Études sur la fermentation De la dissymétrie moléculaire à la fermentation
En 1849, Biot signale à Pasteur que l'alcool amylique dévie le plan de polarisation de la lumière et possède donc la propriété de dissymétrie moléculaire. Pasteur estime peu vraisemblable que l'alcool amylique hérite cette propriété du sucre dont il est issu par fermentation, car, d'une part, la constitution moléculaire des sucres lui paraît très différente de celle de l'alcool amylique et, de plus, il a toujours vu les dérivés perdre la propriété rotatoire des corps de départ. Il conjecture donc que la dissymétrie moléculaire de l'alcool amylique est due à l'action du ferment. S'étant persuadé sous l'influence de Biot que la dissymétrie moléculaire est étroitement liée à la vie, il voit là la confirmation de certaines idées préconçues qu'il s'est faites sur la cause de la fermentation et qui le rangent parmi les tenants du ferment vivant.
Les idées de l'époque sur la fermentation
En 1787, en effet, Adamo Fabbroni, dans son Ragionamento sull'arte di far vino Florence, avait le premier soutenu que la fermentation du vin est produite par une substance vivante présente dans le moût. Cagniard de Latour et Theodor Schwann avaient apporté des faits supplémentaires à l'appui de la nature vivante de la levure. Dans le même ordre d'idées, Jean-Baptiste Dumas, en 1843 époque où le jeune Pasteur allait écouter ses leçons à la Sorbonne, décrivait le ferment comme un être organisé et comparait son activité à l'activité de nutrition des animaux.
Berzélius, lui, avait eu une conception purement catalytique de la fermentation, qui excluait le rôle d'organismes vivants. Liebig, de façon plus nuancée, avait des idées analogues : il voulait bien envisager que la levure fût un être vivant, mais il affirmait que si elle provoquait la fermentation, ce n'était pas par ses activités vitales mais parce qu'en se décomposant, elle était à l'origine de la propagation d'un état de mouvement vibratoire. Berzélius et Liebig avaient tous deux combattu les travaux de Cagniard de Latour et de Schwann.
Les découvertes de Pasteur
Pasteur dispose d'une première orientation donnée par Cagniard de Latour ; il la développe et montre que c'est en tant qu'être vivant que la levure agit, et non en tant que matière organique en décomposition. Ces travaux bénéficient de la mise au point des premiers objectifs achromatiques dépourvus d'irisation parasite. De 1857 à 1867, il publie des études sur les fermentations. Inaugurant la méthode des cultures pures, il établit que certaines fermentations lactique, butyrique où on n'avait pas aperçu de substance jouant un rôle analogue à celui de la levure ce qui avait servi d'argument à Liebig sont bel et bien l'œuvre d'organismes vivants.
Il établit la capacité qu'ont certains organismes de vivre en l'absence d'oxygène libre c'est-à-dire en l'absence d'air. Il appelle ces organismes anaérobies.
Ainsi, dans le cas de la fermentation alcoolique, la levure tenue à l'abri de l'air vit en provoquant aux dépens du sucre une réaction chimique qui libère les substances dont elle a besoin et provoque en même temps l'apparition d'alcool. En revanche, si la levure se trouve en présence d'oxygène libre, elle se développe davantage et la fermentation productrice d'alcool est faible. Les rendements en levure et en alcool sont donc antagonistes. L'inhibition de la fermentation par la présence d'oxygène libre est ce qu'on appellera l'effet Pasteur.
Débat sur le rôle exact des agents vivants dans la fermentation
Même si Liebig resta sur ses positions, les travaux de Pasteur furent généralement accueillis comme prouvant définitivement le rôle des organismes vivants dans la fermentation. Toutefois, certains faits comme le rôle joué dans l'hydrolyse de l'amidon par la diastase, ou alpha-amylase, découverte en 1833 par Payen et Persoz allaient dans le sens de la conception catalytique de Berzélius. C'est pourquoi Moritz Traube en 1858 et Marcellin Berthelot en 1860 proposèrent une synthèse des deux théories, physiologique et catalytique : la fermentation n'est pas produite directement par les êtres vivants qui en sont responsables couramment levures etc. mais par des substances non vivantes, des ferments solubles on disait parfois diastases et on dira plus tard enzymes, substances elles-mêmes sécrétées ou excrétées par les êtres vivants en question. En 1878, Berthelot publia un travail posthume de Claude Bernard qui, contredisant Pasteur, mettait l'accent sur le rôle des ferments solubles dans la fermentation alcoolique. Il en résulta entre Pasteur et Berthelot une des controverses célèbres de l'histoire des sciences.
Pasteur ne rejetait pas absolument le rôle des ferments solubles. Dans le cas particulier de la fermentation ammoniacale de l'urine, il considérait comme établi, à la suite d'une publication de Musculus, que la cause proche de la fermentation était un ferment soluble, dans ce cas, l'enzyme qu'on appellera uréase produit par le ferment microbien qu'il avait découvert lui-même. Il admettait aussi le phénomène, signalé par Lechartier et Bellamy, de l'alcoolisation des fruits sans intervention du ferment microbien alcoolique. Plus d'une fois, il déclara qu'il ne repoussait pas mais n'adoptait pas non plus l'hypothèse d'un ferment soluble dans la fermentation alcoolique. Toutefois, il écrivit en 1879, à propos du ferment soluble alcoolique : La question du ferment soluble est tranchée : il n'existe pas; Bernard s'est fait illusion. On s'accorde donc à penser que Pasteur fut incapable de comprendre l'importance des ferments solubles, consacrée depuis par les travaux d’Eduard Buchner et souligna le rôle des micro-organismes dans les fermentations proprement dites avec une insistance excessive, qui n'allait pas dans le sens du progrès de l'enzymologie. On met cette répugnance de Pasteur à relativiser le rôle des organismes vivants sur le compte de son vitalisme80, qui l'empêcha aussi de comprendre le rôle des toxines et d'admettre en 1881, lors de sa rivalité avec Toussaint dans la course au vaccin contre le charbon, qu'un vaccin tué pût être efficace.
Les travaux de Pasteur sur la fermentation ont fait l'objet d'un débat dans les années 1970 et 1980, la question étant de savoir si, en parlant de fermentations proprement dites, Pasteur avait commis une tautologie qui lui permettait de prouver à peu de frais la cause biologique des fermentations.
Réfutation de la génération spontanée
À partir de 1859, Pasteur mène une lutte contre les partisans de la génération spontanée, en particulier contre Félix Archimède Pouchet et un jeune journaliste, Georges Clemenceau; ce dernier, médecin, met en cause les compétences de Pasteur, qui ne l'est pas, et attribue son refus de la génération spontanée à un parti-pris idéologique Pasteur est chrétien. Il fallut à Pasteur six années de recherche pour démontrer la fausseté sur le court terme de la théorie selon laquelle la vie pourrait apparaître à partir de rien, et les microbes être générés spontanément.
Les questions précises
Depuis le XVIIIe siècle, partisans et adversaires de la génération spontanée aussi appelée hétérogénie cherchent à réaliser des expériences décisives à l'appui de leur opinion.
Les partisans de cette théorie appelés spontéparistes ou hétérogénistes soutiennent que, quand le contact avec l'air fait apparaître sur certaines substances des êtres vivants microscopiques, cette vie tient son origine non pas d'une vie préexistante mais d'un pouvoir génésique de l'air.
Pour les adversaires de la génération spontanée, l'air amène la vie sur ces substances non par une propriété génésique mais parce qu'il véhicule des germes d'êtres vivants.
En 1791 déjà, Pierre Bulliard avance, à la suite d'expériences rigoureuses, que la putréfaction ne donne pas naissance à des êtres organisés et que toute moisissure ne peut survenir que de la graine d'un individu de la même espèce.
En 1837, encore, Schwann a fait une expérience que les adversaires de la génération spontanée considèrent comme probante en faveur de leur thèse : il a montré que si l'air est chauffé puis refroidi avant de pouvoir exercer son influence, la vie n'apparaît pas.
En 1847 M. Blondeau de Carolles faisant état d'une expérience reprenant celles conduites par Turpin conclut : tout être organisé provient d'un germe qui, pour se développer, n'a besoin que de circonstances favorables, et que ce germe ne peut dévier de la mission qui lui est assignée, laquelle est de reproduire un être semblable à celui qui l'a formé.
Le 20 décembre 1858, l'Académie des Sciences prend connaissance de deux notes où Pouchet, naturaliste et médecin rouennais, prétend apporter une preuve définitive de la génération spontanée.
Le 3 janvier 1859, l'Académie des Sciences discute la note de Pouchet. Tous les académiciens qui participent à cette discussion : Milne Edwards, Payen, Quatrefages, Claude Bernard et Dumas, alléguant des expériences qu'ils ont faites eux-mêmes, s'expriment contre la génération spontanée, qui, d'ailleurs, est alors devenue une doctrine minoritaire.
Même après les discussions de l'Académie, il reste cependant deux points faibles dans la position des adversaires de la génération spontanée :
sous certaines conditions, ils obtiennent, sans pouvoir l'expliquer, des résultats apparemment favorables à la génération spontanée;
les procédés chauffage, lavage à l'acide sulfurique, filtrage par lesquels ils débarrassent l'air des germes qu'il pourrait véhiculer sont accusés par les spontéparistes de tourmenter l'air et de le priver de son pouvoir génésique. Personne, raconte Pasteur, ne sut indiquer la véritable cause d'erreur de ses expériences = de Pouchet, et bientôt l'Académie, comprenant tout ce qui restait encore à faire, propose pour sujet de prix la question suivante : Essayer, par des expériences bien faites, de jeter un jour nouveau sur la question des générations spontanées.
C'est Pasteur qui va obtenir le prix, pour ses travaux expérimentaux exposés dans son Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère. Examen de la doctrine des générations spontanées. 1861:
Les expériences de Pasteur
Ses expériences sont, pour l'essentiel, des versions améliorées de celles de ses prédécesseurs. Il comble de plus les deux desiderata signalés plus haut. Tout d'abord, il comprend que certains résultats antérieurs, apparemment favorables à la génération spontanée étaient dus à ce qu'on utilisait la cuve à mercure pour empêcher la pénétration de l'air ambiant : le mercure, tout simplement, est lui-même très sale.
Ensuite, il présente une expérience qu'on ne peut pas accuser de tourmenter l'air : il munit des flacons d'un col, col de cygne et constate que, dans un nombre appréciable de cas, l'air qui a traversé les sinuosités, sans avoir été ni chauffé, ni filtré ni lavé, ne provoque pas l'apparition d'êtres vivants sur les substances qui se trouvent au fond du flacon, alors qu'il la provoque sur une goutte placée à l'entrée du circuit. La seule explication de l'inaltération du fond est que des germes ont été arrêtés par les sinuosités et se sont déposés sur le verre. Cette expérience avait été suggérée à Pasteur par le chimiste Balard ; Chevreul en avait fait d'analogues dans ses cours.
Enfin, Pasteur réfute un argument propre à Pouchet : celui-ci, arguant de la constance avec laquelle, dans ses expériences, du moins la vie apparaissait sur les infusions, concluait que, si la théorie de ses adversaires était exacte, les germes seraient à ce point ubiquitaires que l'air dans lequel nous vivons aurait presque la densité du fer. Pasteur fait des expériences en divers lieux, temps et altitudes et montre que, si on laisse pénétrer l'air ambiant sans le débarrasser de ses germes la proportion des bocaux contaminés est d'autant plus faible que l'air est plus pur. Ainsi, sur la Mer de Glace, une seule des vingt préparations s'altère.
Dans l'expérience des ballons à col de cygne, l'air était de l'air normal, ni chauffé, ni filtré ni lavé chimiquement, mais la matière fermentescible était chauffée, ce dont un spontépariste aurait pu tirer argument pour prétendre que le résultat de l'expérience non-apparition de la vie ne provenait pas de l'absence des germes, mais d'une modification des propriétés de la matière fermentescible. En 1863, Pasteur montre que si on met un liquide organique tout frais sang ou urine en présence d'air stérilisé, la vie n'apparaît pas, ce qui, conclut-il, porte un dernier coup à la doctrine des générations spontanées.
Incomplétude de la démonstration de Pasteur
Il y avait toutefois une lacune dans la démonstration de Pasteur : alors qu'il se posait en réfutateur de Pouchet, il n'utilisa jamais une infusion de foin comme le faisait Pouchet. S'il l'avait fait, il se serait peut-être trouvé devant une difficulté inattendue. En effet, de 1872 à 1876, quelques années après la controverse Pasteur-Pouchet, Ferdinand Cohn établira qu'un bacille du foin, Bacillus subtilis, peut former des endospores qui le rendent résistant à l'ébullition.
À la lumière des travaux de Cohn, le pasteurien Émile Duclaux reconnaît que la réfutation de Pouchet par Pasteur devant la Commission académique des générations spontanées était erronée : L'air est souvent un autre facteur important de la réviviscence des germes .... Le foin contient d'ordinaire, comme Cohn l'a montré depuis, un bacille très ténu .... C'est ce fameux bacillus subtilis .... Ses spores, en particulier, peuvent supporter plusieurs heures d'ébullition sans périr, mais elles sont d'autant plus difficiles à rajeunir qu'elles ont été plus maltraitées. Si on ferme à la lampe le col du ballon qui les contient, au moment où le liquide qui les baigne est en pleine ébullition elles ne sont pas mortes, mais elles ne se développent pas dans le liquide refroidi et remis à l'étuve, parce que l'air fait défaut. Si on laisse rentrer cet air, l'infusion se peuple, et se peuplerait encore si on ne laissait rentrer que de l'air chauffé, car l'air n'agit pas, comme le croyait Pasteur au moment des débats devant la Commission académique des générations spontanées, en apportant des germes : c'est son oxygène qui entre seul en jeu. Émile Duclaux ajoute que Pasteur revint de son erreur.
L'air comme facteur de réviviscence de germes non pas morts, mais en état de non-développement, telle est donc l'explication que la science a fini par préférer à l'air convoyeur de germes pour rendre compte d'un phénomène que Pouchet, pour sa part, interprétait comme suit : les Proto-organismes, qui naissent spontanément ... ne sont pas extraits de la matière brute proprement dite, ainsi que l'ont prétendu quelques fauteurs = partisans de l'hétérogénie, mais bien des particules organiques, débris des anciennes générations d'animaux et de plantes, qui se trouvent combinées aux parties constituantes des minéraux. Selon cette doctrine, ce ne sont donc pas des molécules minérales qui s'organisent, mais bien des particules organiques qui sont appelées à une nouvelle vie.
On considère que c'est John Tyndall qui, en suivant les idées de Cohn, mettra la dernière main à la réfutation de la génération spontanée.
Pasteur estimait d'ailleurs que la génération spontanée n'était pas réfutée de façon absolue, mais seulement dans les expériences par lesquelles on avait prétendu la démontrer. Dans un texte non publié de 1878, il déclarait ne pas juger la génération spontanée impossible.
Critiques externalistes
Nous avons vu qu'on peut reprocher à Pasteur comme un manque de rigueur le fait de ne pas avoir cherché à répéter vraiment les expériences de Pouchet. Il y a une autre circonstance où, dans ses travaux sur la génération spontanée, Pasteur peut sembler tendancieux, puisqu'il admet avoir passé sous silence des constatations qui n'allaient pas dans le sens de sa thèse. En effet, travaillant à l'aide de la cuve à mercure alors qu'il n'avait pas encore compris que le mercure apporte lui-même des germes, il avait obtenu des résultats apparemment favorables à la génération spontanée : Je ne publiai pas ces expériences; les conséquences qu'il fallait en déduire étaient trop graves pour que je n'eusse pas la crainte de quelque cause d'erreur cachée, malgré le soin que j'avais mis à les rendre irréprochables. J'ai réussi, en effet, plus tard, à reconnaître cette cause d'erreur.
Se fondant sur ces deux entorses de Pasteur à la pure méthode scientifique, et aussi sur ce qu'ils considéraient comme l'évidente partialité de l'Académie des sciences en faveur de Pasteur, Farley et Geison, dans un article de 1974108, ont soutenu qu'un facteur externe à la science intervenait dans la démarche de Pasteur et de l'Académie des sciences : le désir de faire échec aux idées matérialistes et subversives dont la génération spontanée passait pour être l'alliée. Pasteur, qui était spiritualiste, voyait un lien entre matérialisme et adhésion à la génération spontanée, mais se défendait de s'être lui-même laissé influencer par cette sorte de considérations dans ses travaux scientifiques. Dans son livre de 1999, Geison reprend une bonne part de l'article de 1974, mais reconnaît que cet article était trop externaliste au détriment de Pasteur et faisait la part trop belle à Pouchet.
H. Collins et T. Pinch, en 1993, prennent eux aussi pour point de départ de leur réflexion les deux entorses de Pasteur à la pure méthode scientifique et la partialité de l'Académie des sciences, ils mentionnent eux aussi brièvement les enjeux religieux et politiques que certains croyaient voir dans la question, mais n'évoquent pas la possibilité que Pasteur lui-même ait cédé à de tels mobiles idéologiques. En fait, ils exonèrent Pasteur et blâment plutôt une conception aseptisée de la méthode scientifique : Pasteur savait ce qui devait être considéré comme un résultat et ce qui devait l'être comme une 'erreur'. Pasteur était un grand savant, mais la manière dont il a agi ne s'approche guère de l'idéal de la méthode scientifique proposé de nos jours. On voit mal comment il aurait pu transformer à ce point notre conception de la nature des germes s'il avait dû adopter le modèle de comportement stérile qui passe aux yeux de beaucoup pour le parangon de l'attitude scientifique.
Signalons cependant, à propos de cette apologie un peu cynique, que des voix se sont élevées contre la tendance de certains théoriciens externalistes ou relativistes des sciences à réduire l'activité scientifique, et notamment celle de Pasteur, à des manœuvres et à des coups de force où la rationalité aurait assez peu de part.
Dans un article de 1999 et un livre de 2003, D. Raynaud a réexaminé la controverse sur la génération spontanée en partant de la correspondance non publiée entre les membres de l'Académie des Sciences et Pouchet. À partir de quatre arguments principaux, il a conclu à l'inanité de l'apologie de Pouchet présentée par certains historiens et sociologues relativistes des sciences. Défaite de Pouchet. En 1862, après avoir déposé son mémoire pour le concours du prix Alhumbert, Pouchet décida de se retirer du concours, contribuant ainsi à assurer la victoire de Pasteur. En 1864, après avoir demandé que la controverse soit tranchée par une commission d'expertise MHNR, FAP 3978, Pouchet recula parce que les résultats seraient "compromis par les basses températures du printemps". Les expériences reportées au moins de juin, Pouchet refusa une nouvelle fois de se présenter à Paris. Dans une lettre du 18 juin 1864, Flourens devait lui laisser une dernière chance de faire ses expériences mais il se défaussa encore, laissant la commission expertiser les seuls travaux de Pasteur. Coalition anti-Pouchet. Raynaud note que la coalition anti-Pouchet au sein de l'Académie des Sciences a été plus supposée que réellement démontrée. La correspondance montre que Pouchet avait des relations suivies et amicales avec plusieurs académiciens, en particulier Geoffroy Saint-Hilaire, Serres, Coste et Flourens, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. Qualités d'expérimentateur. Raynaud pondère les erreurs de méthode de Pasteur, qui sont souvent mises en exergue, par celles, moins connues, de son adversaire rouennais. L'argument du Bacillus subtilis est fragilisé par le fait que Pouchet porta le corps putrescible à 200 °C, 250°C et même plus, sans entraver l'apparition des micro-organismes. Pouchet pensait avoir démontré expérimentalement que la lumière rouge favorise l'apparition des micro-organismes d'origine animale, la lumière verte, celle des microphytes. Il admettait par ailleurs les pluies de grenouilles et les avalanches d'épinoches comme preuves irréfutables de la génération spontanée. Probité intellectuelle. En 1863, Pouchet, Joly et Musset tentèrent de reproduire les expériences de Pasteur dans les Pyrénées. Ils ouvrent quatre ballons A, B, C, D au village de Rencluse à 2083 m d'altitude; quatre autres ballons E, F, G, H sur les glaciers de la Maladeta à 3000 m d'altitude. À leurs yeux, tous les ballons contiennent des micro-organismes. La note des Comptes rendus de l'Académie des Sciences de 1863 ne décrivant pas le contenu des ballons un à un, Pasteur sommera Pouchet d'expliquer ce que sont devenus les ballons manquants B, C, G, H. Pouchet demande alors à Joly de répondre: Vous voyez où il veut en venir. Pondérez bien vos phrases. Par ailleurs, selon D. Raynaud, l'apologie de Pouchet se fonderait sur la prise en compte par les historiens et sociologues des sciences du témoignage de Pennetier, disciple de Pouchet, qui tire sa lecture de la controverse d'une lettre présumée d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire du 31 août 1859, qui est un faux de Pouchet.
Les maladies du vin et la pasteurisation
Études sur le vin Louis Pasteur, édition de 1866
En 1862, Pasteur confirme l'opinion formulée dès 1822 par Christiaan Hendrik Persoon, en établissant le rôle d'un microorganisme, le mycoderma aceti renommé Acetobacter aceti dans la formation du vinaigre.
En 1863, il y a déjà quelques années que les maladies des vins français grèvent lourdement le commerce. Napoléon III demande à Pasteur, spécialiste de la fermentation et de la putréfaction, de chercher un remède : Pasteur, qui transporta deux années de suite en automne son laboratoire à Arbois, publiera les résultats de ses travaux dans Études sur le vin en 1866 il avait publié un premier papier sur le sujet dès 1863. Il propose de chauffer le vin à 57 °C afin de tuer les germes et résout ainsi le problème de sa conservation et du transport, c'est la pasteurisation. Il a au sujet de ce procédé une querelle de priorité avec l'œnologue Alfred de Vergnette de Lamotte, dans laquelle les savants Balard et Thenard prennent parti respectivement pour Pasteur et pour Vergnette. Pasteur et Vergnette avaient d'ailleurs été tous deux précédés par Nicolas Appert qui avait publié le chauffage des vins en 1831 dans son ouvrage Le livre de tous les ménages. La découverte de la pasteurisation vaudra à Pasteur le Mérite Agricole, mais aussi le Grand Prix de l’Exposition universelle 1867.
Des dégustateurs opérant à l'aveugle avaient conclu que la pasteurisation n'altérait pas le bouquet des grands vins, mais Pasteur fut forcé de reconnaître la forte influence de l'imagination après avoir vu sa commission d'expertise renverser complètement ses conclusions sur le même vin en l'espace de quelques jours. Finalement, la pasteurisation du vin n'eut pas un grand succès et fut abandonnée avant la fin du XIXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, l'Institut Pasteur pratiqua sur le vin une pasteurisation rapide en couche mince qui ne se répandit guère mais fit plus tard un retour triomphal en France sous son nom américain de flash pasteurization.
En Bourgogne la pasteurisation du vin a été abandonnée dans les années 1930.
Les maladies microbiennes du vin ont été évitées par d'autres moyens que la pasteurisation : conduite rationnelle des fermentations, sulfitage des vendanges, réduction des populations contaminantes par différents procédés de clarification. D'un emploi malaisé au niveau du chai, où elle ne met pas en outre la cuvée à l'abri d'une contamination postérieure au chauffage, la pasteurisation a toutefois son utilité pour certains types de vins, - d'ailleurs plutôt de qualité moyenne et de consommation rapide - au moment de l'embouteillage où l'on préfère parfois les techniques de sulfitage et de filtration stérile, la Brasserie par contre recourt plus volontiers à ce procédé.
Pour sa mise en évidence du rôle des organismes vivants dans la fermentation alcoolique et pour les conséquences d'ordre pratique qu'il en a tirées, Pasteur est considéré comme le fondateur de l’œnologie, dont Chaptal avait posé les premiers jalons. Toutefois, en limitant l'action positive aux seules levures, Pasteur n'a pas pu voir le rôle de certaines bactéries dans le déclenchement de la fermentation malolactique, rôle qui, une fois redécouvert -en 1946- permettra une conduite beaucoup plus subtile de la vinification.
Contrairement à la pasteurisation du vin, la pasteurisation du lait, à laquelle Pasteur n'avait pas pensé, c'est le chimiste allemand Franz von Soxhlet qui, en 1886, proposa d'appliquer la pasteurisation au lait1, s'implanta durablement. Ici encore, d'ailleurs, on marchait sur les traces d'Appert
Les fermentations mènent aux maladies contagieuses
La théorie de l'origine microbienne des maladies contagieuses, appelée théorie microbienne ou théorie des germes, existait depuis longtemps, mais seulement à l'état d'hypothèse. La première démonstration de la nature vivante d'un agent infectieux est établie en 1687 par deux élèves de Francesco Redi, Giovanni Cossimo Bonomo et Diacinto Cestoni qui montrent, grâce à l'utilisation du microscope, que la gale est causée par un petit parasite, Sarcoptes scabiei. Cette découverte n'eut pourtant alors aucun écho. Vers 1835, quelques savants, dont on a surtout retenu Agostino Bassi, prouvent qu'une des maladies du ver à soie, la muscardine, est causée par un champignon microscopique. En 1836-37 Alfred Donné décrit le protiste responsable de la trichomonose : Trichomonas vaginalis. En 1839 Johann Lukas Schönlein identifie l'agent des teignes faviques : Trichophyton schoenleinii; en 1841 le suédois Frederick Theodor Berg identifie Candida albicans, l'agent du Muguet buccal et en 1844, David Gruby identifie l'agent des teignes tondantes, Trichophyton tonsurans, cette dernière découverte apparemment oubliée, fut faite de nouveau par Saboureau en 1894. Il s'agissait là toutefois de protozoaires ou d'organismes multicellulaires. En 1861 Anton de Bary établit le lien de causalité entre le mildiou de la pomme de terre - responsable notamment de la Grande famine en Irlande - et le champignon Botrytis infestans, qui avait déjà été observé par Miles Joseph Berkeley en 1845.
Dans un essai de 1840, Friedrich Gustav Jakob Henle, faisant écho aux travaux de Bassi sur la nature microbienne de la muscardine du ver à soie et à ceux de Cagniard de Latour et de Theodor Schwann sur la nature vivante de la levure, avait développé une théorie microbienne des maladies contagieuses et formulé les critères permettant selon lui de décider si telle maladie a pour cause tel micro-organisme.
La théorie, en dépit de ces avancées, rencontrait des résistances et se développait assez lentement, notamment pour ce qui est des maladies contagieuses humaines. Ainsi, la découverte du bacille du choléra était restée quasiment lettre morte quand Pacini l'avait publiée en 1854, alors qu'elle devait trouver immédiatement une vaste audience quand Koch la refit en 1883. À l'époque des débuts de Pasteur, donc, la théorie microbienne existe, même si elle est encore dans l'enfance. D'autre part, il est de tradition, surtout depuis le XVIIIe siècle, de souligner l'analogie entre les maladies fiévreuses et la fermentation. Il n'est donc pas étonnant, dans ce contexte, que les travaux de Pasteur sur la fermentation aient stimulé le développement de la théorie microbienne des maladies contagieuses. En 1860, après avoir réaffirmé le rôle des organismes vivants dans la putréfaction et la fermentation, Pasteur lui-même ajoutait : Je n'ai pas fini cependant avec toutes ces études. Ce qu'il y aurait de plus désirable serait de les conduire assez loin pour préparer la voie à une recherche sérieuse de l'origine de diverses maladies. Casimir Davaine, au début de ses publications de 1863 sur le charbon, qui sont maintenant considérées comme la première preuve de l'origine microbienne d'une maladie transmissible à l'homme, écrivait M. Pasteur, en février 1861, publia son remarquable travail sur le ferment butyrique, ferment qui consiste en petites baguettes cylindriques, possédant tous les caractères des vibrions ou des bactéries. Les corpuscules filiformes que j'avais vus dans le sang des moutons atteints de sang de rate = charbon ayant une grande analogie de forme avec ces vibrions, je fus amené à examiner si des corpuscules analogues ou du même genre que ceux qui déterminent la fermentation butyrique, introduits dans le sang d'un animal, n'y joueraient pas de même le rôle d'un ferment.
Pasteur lui-même, en 1880, rappelle ses travaux sur les fermentations et ajoute :
"La médecine humaine, comme la médecine vétérinaire, s'emparèrent de la lumière que leur apportaient ces nouveaux résultats". On s'empressa notamment de rechercher si les virus et les contages ne seraient pas des êtres animés. Le docteur Davaine 1863 s'efforça de mettre en évidence les fonctions de la bactéridie du charbon, qu'il avait aperçue dès l'année 1850.
On verra toutefois que Pasteur, quand il aura à s'occuper des maladies des vers à soie, en 1865, commencera par nier le caractère microbien de la pébrine, compris par d'autres avant lui. Quant aux maladies contagieuses humaines, c'est seulement à partir de 1877 qu'il participera personnellement au développement de leur connaissance., Dès 1873 Gerhard Armauer Hansen,porté par la conclusion de Pasteur dans le débat sur la génération spontanée certes, mais aussi lecteur de Charles Louis Drognat et de Davaine, identifie l'agent causal de la lèpre.Cette découverte ne sera toutefois pas immédiatement unanimement reconnue.
Recherches sur les capacités de saturation de l'acide arsénieux.
Étude des arsénites de potasse, de soude et d'ammoniaque.
2Application de la polarisation rotatoire des liquides à la solution de diverses questions de chimie.
Sa deuxième thèse avait suscité chez Pasteur un grand intérêt pour la polarisation rotatoire découverte par son vieux maître Biot, qu'il rencontrait souvent. Toutes les recherches du jeune docteur se concentrent alors, à partir de 1848, sur les rapports entre la dissymétrie des cristaux ou des molécules et le sens de rotation de la lumière polarisée après traversée soit d'un cristal soit d'une solution optiquement active. Pasteur a décrit lui-même, en termes simples, ses recherches au microscope sur la dissymétrie des cristaux de tartrate :
Je vis que le tartrate de soude et d'ammoniaque portait les petites facettes accusatrices de la dissymétrie ; mais quand je passai à l'examen de la forme des cristaux du paratartrate optiquement inactif, j'eus un instant un serrement de cœur ; tous ces cristaux portaient les facettes de la dissymétrie. L'idée heureuse me vint d'orienter mes cristaux par rapport à un plan perpendiculaire à l'observateur, et alors je vis que, dans cette masse confuse de cristaux de paratartrate, il y en avait de deux sortes sous le rapport de l'orientation des facettes de la dissymétrie. Chez les uns, la facette de dissymétrie la plus rapprochée de mon corps s'inclinait à droite, relativement au plan d'orientation dont je viens de parler, tandis que chez les autres, la facette de dissymétrie s'inclinait à ma gauche. En d'autres termes le paratartrate se présentait comme formé de deux sortes de cristaux, les uns dissymétriques à droite, les autres dissymétriques à gauche...
Les principes de la dissymétrie moléculaire étaient fondés. Il existe des substances dont le groupement atomique est dissymétrique et ce groupement se traduit au dehors par une forme dissymétrique et une action de déviation du plan de la lumière polarisée ; bien plus, ces groupements atomiques ont leurs inverses possibles dont les formes sont identiques à celles de leurs images et qui ont une action inverse sur le plan de la lumière polarisée.
L. Pasteur, Écrits scientifiques et médicaux
Pasteur tenait Biot, devenu presque aveugle, étroitement au courant de ses observations et l'on peut voir, dans le musée de l'Institut Pasteur, à Paris, les blocs de bois taillés pour représenter les cristaux que Pasteur soumettait à l'examen de son vieux maître. La passion de la recherche poussa Pasteur à se procurer, en de nombreux endroits d'Europe à Vienne, Dresde ou Trieste, des cristaux d'acide tartrique sous forme racémique optiquement neutre ou énantiomorphe faisant tourner d'un certain angle le plan d'une lumière polarisée.
Pendant ces années de formation et d'initiation à la recherche fondamentale, Louis Pasteur découvre un lieu magique : le laboratoire. Dans cette pièce réservée aux activités de recherche expérimentale, le chercheur s'isole du monde commun. Pour faire progresser les connaissances, il doit reconstruire ici un monde conventionnel, grandement protégé des aléas climatiques, des accidents imprévus et des rumeurs de la cité. Au laboratoire règnent l'ordre et le silence ; tout est propre ; les produits sont purs ; l'environnement est maîtrisé.
Un des aspects du génie de Pasteur consiste à ne pas avoir limité l'usage du laboratoire aux expériences de physique et de chimie. Depuis ses recherches sur les fermentations, les biologistes aussi y poursuivent leurs travaux. Les microbiologistes y disposent de ballons de verre pour cultiver leurs microbes en conditions contrôlées, de température, lumière et oxygénation, sur des milieux nutritifs de composition connue. Des animaleries permettant d'élever, en conditions également très contrôlées, des chiens, des lapins, des singes, des rats, des chevaux, etc., s'ajouteront par la suite aux laboratoires.
Plaidant pour le financement public de ces lieux de recherches, Pasteur écrira à Napoléon III : Les conceptions les plus hardies, les spéculations les plus légitimes, ne prennent corps et âme que le jour où elles sont consacrées par l'observation et l'expérience. Prenez intérêt, je vous en conjure, à ces demeures sacrées que l'on désigne du nom expressif de laboratoires. Demandez qu'on les multiplie et qu'on les orne : ce sont les temples de l'avenir, de la richesse et du bien-être.
On sait bien qu'à la fin de sa vie, Pasteur profita de sa gloire éclatante pour faire financer, par souscription nationale, la construction à Paris d'un grand Institut d'étude des maladies contagieuses, devenu aujourd'hui l'Institut Pasteur.
Antisepsie et asepsie Antisepsie
Le chirurgien anglais Joseph Lister, après avoir lu les travaux de Pasteur sur la fermentation, où la putréfaction est expliquée, comme la fermentation, par l'action d'organismes vivants, se convainc que l'infection postopératoire, volontiers décrite à l'époque comme une pourriture, une putréfaction est due elle aussi à des organismes microscopiques. Ayant lu ailleurs que l'acide phénique, phénol détruisait les entérozoaires qui infectaient certains bestiaux, il lave les blessures de ses opérés à l'eau phéniquée et leur applique un coton imbibé d'acide phénique. Le résultat est une réduction drastique de l'infection et de la mortalité.
Lister publie sa théorie et sa méthode en 1867, en les rattachant explicitement aux travaux de Pasteur140. Dans une lettre de 1874, il remercie Pasteur pour m'avoir, par vos brillantes recherches, démontré la vérité de la théorie des germes de putréfaction, et m'avoir ainsi donné le seul principe qui ait pu mener à bonne fin le système antiseptique.
L'antisepsie listérienne, dont l'efficacité triomphera en quelques années des résistances, est, au point de vue théorique, une branche importante de la théorie microbienne. Sur le plan pratique, toutefois, elle n'est pas entièrement satisfaisante : Lister, qui n'a pensé qu'aux germes présents dans l'air, et non à ceux que propagent l'eau, les mains des opérateurs ainsi que les instruments et les tissus qu'ils emploient, attaque les microbes dans le champ opératoire, en vaporisant de l'acide phénique dans l'air et en en appliquant sur les plaies. C'est assez peu efficace quand il faut opérer en profondeur et, de plus, l'acide phénique a un effet caustique sur l'opérateur et sur le patient. On cherche donc bientôt à prévenir l'infection, asepsie plutôt qu'à la combattre, antisepsie.
Asepsie
Pasteur est de ceux qui cherchent à dépasser l'antisepsie par l'asepsie. À la séance du 30 avril 1878 de l'Académie de médecine, il attire l'attention sur les germes propagés par l'eau, l'éponge ou la charpie avec lesquelles les chirurgiens lavent ou recouvrent les plaies et leur recommande de ne se servir que d'instruments d'une propreté parfaite, de se nettoyer les mains puis de les soumettre à un flambage rapide et de n'employer que de la charpie, des bandelettes, des éponges et de l'eau préalablement exposées à diverses températures qu'il précise. Les germes en suspension dans l'air autour du lit du malade étant beaucoup moins nombreux que dans l'eau et à la surface des objets, ces précautions permettraient d'utiliser un acide phénique assez dilué pour ne pas être caustique.
Certes, ces recommandations n'étaient pas d'une nouveauté absolue : Semmelweis et d'autres avant lui par exemple Claude Pouteau et Jacques Mathieu Delpech avaient déjà compris que les auteurs des actes médicaux pouvaient eux-mêmes transmettre l'infection, et ils avaient fait des recommandations en conséquence, mais les progrès de la théorie microbienne avaient tellement changé les données que les conseils de Pasteur reçurent beaucoup plus d'audience que ceux de ses prédécesseurs.
En préconisant ainsi l'asepsie, Pasteur traçait une voie qui serait suivie non sans résistances du corps médical par Octave Terrillon 1883, Ernst von Bergmann et William Halsted.
Lutte contre les maladies des vers à soie
Hommage aux travaux de Pasteur sur le ver à soie à Alès
En 1865, Jean-Baptiste Dumas, sénateur et ancien ministre de l'Agriculture et du commerce, demande à Pasteur d'étudier une nouvelle maladie qui décime les élevages de vers à soie du sud de la France et de l'Europe, la pébrine, caractérisée à l'échelle macroscopique par des taches noires et à l'échelle microscopique par les corpuscules de Cornalia . Pasteur accepte et fera cinq longs séjours à Alès, entre le 7 juin 1865 et 1869.
Erreurs initiales
Arrivé à Alès, Pasteur se familiarise avec la pébrine et aussi avec une autre maladie du ver à soie, connue plus anciennement que la pébrine : la flacherie ou maladie des morts-flats. Contrairement, par exemple, à Quatrefages, qui avait forgé le mot nouveau pébrine, Pasteur commet l'erreur de croire que les deux maladies n'en font qu'une et même que la plupart des maladies des vers à soie connues jusque-là sont identiques entre elles et à la pébrine. C'est dans des lettres du 30 avril et du 21 mai 1867 à Dumas qu'il fait pour la première fois la distinction entre la pébrine et la flacherie.
Il commet une autre erreur : il commence par nier le caractère parasitaire, microbien de la pébrine, que plusieurs savants notamment Antoine Béchamp considéraient comme bien établi. Même une note publiée le 27 août 1866155 par Balbiani, que Pasteur semble d'abord accueillir favorablement, reste sans effet, du moins immédiat. Pasteur se trompe. Il ne changera d'opinion que dans le courant de 1867.
Victoire sur la pébrine
Alors que Pasteur n'a pas encore compris la cause de la maladie, il propage un procédé efficace pour enrayer les infections : on choisit un échantillonnage de chrysalides, on les broie et on recherche les corpuscules dans le broyat; si la proportion de chrysalides corpusculeuses dans l'échantillonnage est très faible, on considère que la chambrée est bonne pour la reproduction. Cette méthode de tri des graines œufs est proche d'une méthode qu'avait proposée Osimo quelques années auparavant, mais dont les essais n'avaient pas été concluants. Par ce procédé, Pasteur jugule la pébrine et sauve pour beaucoup l'industrie de la soie dans les Cévennes.
La flacherie résiste
En 1884, Balbiani, qui faisait peu de cas de la valeur théorique des travaux de Pasteur sur les maladies des vers à soie, reconnaissait que son procédé pratique avait remédié aux ravages de la pébrine, mais ajoutait que ce résultat tendait à être contrebalancé par le développement de la flacherie, moins bien connue et plus difficile à prévenir. En 1886, la Société des agriculteurs de France émettait le vœu que le gouvernement examine s’il n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles études scientifiques et pratiques sur le caractère épidémique des maladies des vers à soie et sur les moyens de combattre cette influence. Decourt, qui cite ce vœu, donne des chiffres dont il conclut qu'après les travaux de Pasteur, la production des vers à soie resta toujours très inférieure à ce qu'elle avait été avant l'apparition de la pébrine et conteste dès lors à Pasteur le titre de sauveur de la sériciculture française .
Microbes et vaccins
À partir de 1876, Pasteur travaille successivement sur le filtre et l'autoclave, tous deux mis au point par Charles Chamberland 1851-1908, et aussi sur le flambage des vases.
Bien que ses travaux sur les fermentations, comme on l'a vu, aient stimulé le développement de la théorie microbienne des maladies contagieuses, et bien que, dans l'étude des maladies des vers à soie, il ait fini par se ranger à l'opinion de ceux qui considéraient la pébrine comme parasitaire, Pasteur, à la fin de 1876, année où l'Allemand Robert Koch a fait progresser la connaissance de la bactérie du charbon, est encore indécis sur l'origine des maladies contagieuses humaines : "Sans avoir de parti pris dans ce difficile sujet, j'incline par la nature de mes études antérieures du côté de ceux qui prétendent que les maladies contagieuses ne sont jamais spontanées ... Je vois avec satisfaction les médecins anglais qui ont étudié la fièvre typhoïde avec le plus de vigueur et de rigueur repousser d'une manière absolue la spontanéité de cette terrible maladie." Mais il devient bientôt un des partisans les plus actifs et les plus en vue de la théorie microbienne des maladies contagieuses, domaine où son plus grand rival est Robert Koch. En 1877, Pasteur découvre le vibrion septique, qui provoque un type de septicémie et avait obscurci l'étiologie du charbon; ce microbe sera nommé plus tard Clostridium septicum. En 1880, il découvre le staphylocoque, qu'il identifie comme responsable des furoncles et de l'ostéomyélite. Son combat en faveur de la théorie microbienne ne l'empêche d'ailleurs pas de reconnaître l'importance du terrain, importance illustrée par l'immunisation vaccinale, à laquelle il va consacrer la dernière partie de sa carrière.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=6812#forumpost6812
Posté le : 27/09/2014 17:28
|
|
|
|
|
Louis Pasteur 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le vaccin contre le choléra des poules
Louis Pasteur par le photographe Félix Nadar en 1878.
Le germe du choléra des poules, nommé ensuite Pasteurella avicida, fut isolé en 1879 par l'italien Perroncito; la même année Henry Toussaint réussit à le cultiver. C'est d'ailleurs auprès de Toussaint que Pasteur se procura la souche du microbe de choléra des poules.
Un don du hasard ?
Durant l'été 1879, Pasteur et ses collaborateurs, Émile Roux et Émile Duclaux, découvrent que les poules auxquelles on a inoculé des cultures vieillies du microbe du choléra des poules non seulement ne meurent pas mais résistent à de nouvelles infections - c'est la découverte d'un vaccin d'un nouveau type : contrairement à ce qui était le cas dans la vaccination contre la variole, on ne se sert pas, comme vaccin, d'un virus bénin fourni par la nature, sous forme d'une maladie bénigne qui immunise contre la maladie grave mais on provoque artificiellement l'atténuation d'une souche initialement très virulente et c'est le résultat de cette atténuation qui est utilisé comme vaccin.
S'il faut en croire la version célèbre de René Vallery-Radot et d'Émile Duclaux, c'est en reprenant de vieilles cultures oubliées ou laissées de côté pendant les vacances qu'on se serait aperçu avec surprise qu'elles ne tuaient pas et même immunisaient. Il y aurait là un cas de sérendipité.
A. Cadeddu, toutefois, rappelle que depuis les années 1877-1878, Pasteur possédait parfaitement le concept d'atténuation de la virulence. C'est un des motifs pour lesquels Cadeddu, à la suite de Mirko D. Grmek, met en doute le rôle allégué du hasard dans la découverte du procédé d'atténuation de la virulence et pense que cette atténuation a sûrement été recherchée activement, ce que les notes de laboratoire de Pasteur semblent bien confirmer.
Irrégularité du vaccin contre le choléra des poules
Dans sa double communication du 26 octobre 1880 à l'Académie des Sciences et à l'Académie de médecine, Pasteur attribue l'atténuation de la virulence au contact avec l'oxygène. Il dit que des cultures qu'on laisse vieillir au contact de l'oxygène perdent de leur virulence au point de pouvoir servir de vaccin, alors que des cultures qu'on laisse vieillir dans des tubes à l'abri de l'oxygène gardent leur virulence. Il reconnaît toutefois dans une note de bas de page que l'oxygène ne joue pas toujours son rôle d'atténuation, ou pas toujours dans les mêmes délais : Puisque, à l'abri de l'air, l'atténuation n'a pas lieu, on conçoit que, si dans une culture au libre contact de l'air pur il se fait un dépôt du parasite en quelque épaisseur, les couches profondes soient à l'abri de l'air, tandis que les superficielles se trouvent dans de tout autres conditions. Cette seule circonstance, jointe à l'intensité de la virulence, quelle que soit, pour ainsi dire, la quantité du virus employé, permet de comprendre que l'atténuation d'un virus ne doit pas nécessairement varier proportionnellement au temps d'exposition à l'air.
Certainsvoient là un demi-aveu de l'irrégularité du vaccin, irrégularité que la suite confirma : Cette voie, que le génie de Pasteur avait ouverte et qui fut ensuite si féconde, se révéla bientôt fermée en ce qui concerne la vaccination anti-pasteurellique de la poule. Des difficultés surgirent dans la régularité de l'atténuation et de l'entretien de la virulence à un degré déterminé.
Le Rôle de l'oxygène ?
La théorie de Pasteur, selon laquelle la virulence du vaccin était atténuée par l'action de l'oxygène, n'a pas été retenue. Th. D. Brock, après avoir présenté comme vraisemblable l'explication de l'atténuation dans les cultures par mutations et sélection, l'organisme vivant, qui possède des défenses immunitaires, exerce une sélection en défaveur des microbes mutants peu virulents, ce qui n'est pas le cas dans les cultures, ajoute : Ses recherches, de Pasteur sur les effets de l'oxygène sont quelque chose de curieux. Bien que l'oxygène puisse jouer un rôle en accélérant les processus d'autolyse, il n'a probablement pas une action aussi directe que Pasteur le pensait.
Le vaccin contre la maladie du charbon
En 1880, Auguste Chauveau et Henry Toussaint publient les premières expériences françaises d'immunisation d'animaux contre le charbon par inoculation préventive. À la même époque, W.S. Greenfield, à Londres, obtient l'immunisation en inoculant le bacille préalablement atténué par culture. Au vu des publications de Greenfield, certains auteurs estiment qu'il a la priorité sur Pasteur.
Le 5 mai 1881, lors de la célèbre expérience de Pouilly-le-Fort, un troupeau de moutons est vacciné contre la maladie du charbon à l'aide d'un vaccin mis au point par Pasteur, Émile Roux et surtout Charles Chamberland. Cette expérience fut un succès complet.
Certains auteurs reprochent à Pasteur d'avoir induit le public scientifique en erreur sur la nature exacte du vaccin utilisé à Pouilly-le-Fort. Cette question fait l'objet d'un article à part, le Secret de Pouilly-le-Fort.
Afin de répondre à la demande importante de vaccins charbonneux qui s'est manifestée immédiatement après l'expérience de Pouilly-le-fort, et ce tant en France qu'à l’Étranger, et tandis qu'un décret de juin 1882 inscrivait le vaccin charbonneux dans la loi de police sanitaire des animaux, Pasteur doit organiser "précipitamment" la production et la distribution en nombre de vaccin. Pour ce faire une entité est créée Le Vaccin charbonneux, rue Vauquelin. Des accidents vaccinaux survenus à l'automne 1881 et au printemps 1882, en France et à l’étranger, imposent à Pasteur de revenir sur le postulat de la fixité des vaccins. En 1886, la diffusion du vaccin charbonneux à l'étranger est confiée à une société commerciale, la Compagnie de Vulgarisation du Vaccin Charbonneux qui détenait un monopole commercial mais aussi technique visant tant à préserver les secrets de fabrication qu'à garantir l'homogénéité des vaccins.
Le vaccin de Pasteur et ses dérivés donnaient des résultats globalement satisfaisants, mais ils s'affaiblissaient parfois au point de ne pas provoquer une réaction immunitaire suffisante et, dans d'autres cas, ils restaient assez virulents pour communiquer la maladie qu'ils étaient censés prévenir. Nicolas Stamatin en 1931 et Max Sterne en 1937 obtinrent des vaccins plus efficaces à l'aide de bacilles dépourvus de la capacité de former une capsules, bacilles acapsulés ou acapsulogènes.
Le vaccin contre le rouget des porcs
Envoyé par Pasteur dans le Sud-est de la France où sévissait une épidémie de rouget du porc, dit aussi le mal rouge, Louis Thuillier identifie le bacille de cette maladie le 15 mars 1882.Un vaccin est alors élaboré, que Pasteur présente à l'Académie des Sciences dans une communication datée du 26 novembre 1883 et intitulée La vaccination du rouget des porcs à l'aide du virus mortel atténué de cette maladie : le vaccin a été obtenu par une diminution de la virulence du bacille par passage successifs sur le lapin, espèce naturellement peu réceptive à cette maladie. Dans ce cas il s'agit donc d'une nouvelle méthode d'atténuation de la virulence qui s'apparente à celle sur laquelle est basée le vaccin de Jenner. Le vaccin du rouget, mis sur le marché dès 1886, ne rencontra pas un grand succès en France en dépit des efforts de l'administration française. À l'époque le modeste développement de cette vaccination avait pu être mise sur le compte d'un investissement défaillant de Chamberland qui était chargé d'en assurer le développement dans le cadre du laboratoire Pasteur. Ainsi pour la seule année 1890, seuls 20 000 porcs étaient vaccinés en France, alors qu'en Hongrie ce nombre se montait alors à 250 000.
Passage à la biologie appliquée : l'étude des fermentations
De 1848 à 1852, Pasteur développe à Strasbourg d'importantes recherches sur le pouvoir rotatoire de divers composés chimiques ; ses résultats sont régulièrement présentés à l'Académie des sciences par Biot. Ces travaux apportent à Pasteur une renommée internationale. À noter que Biot avait déjà insisté sur la corrélation entre pouvoir rotatoire et origine biologique des substances actives : solutions sucrées, gommes, mucilages, huiles essentielles, essences végétales agissent fortement sur la lumière polarisée. Pasteur amplifie ces observations et débouche sur une première conclusion : la dissymétrie constitutive des molécules est caractéristique des matières organiques ; la synthèse des sucres, dits aujourd'hui de série D et des acides aminés, de série L par les êtres vivants implique une constitution atomique dissymétrique. Cette conclusion mena Pasteur vers une sorte de vitalisme : Je pressens même, écrivait-il, que toutes les espèces vivantes sont primordialement dans leur structure, dans leurs formes extérieures, des fonctions de la dissymétrie cosmique. Écrits scientifiques et médicaux En revanche, pensait le chimiste, toutes les synthèses réalisées par l'homme, au laboratoire, produisent les formes racémiques des substances organiques.
En 1849, Pasteur s'intéresse au pouvoir rotatoire des solutions d'alcool amylique provenant des fermentations soit de la fécule de pomme de terre, soit du jus de betterave. Ces nouvelles recherches l'entraînent à la fois vers la chimie biologique et vers les sciences appliquées. Étudiant au laboratoire, en 1854, la fermentation du paratartrate d'ammonium, forme racémique résultant du mélange, en quantités égales, des formes dextrogyres et lévogyres, Pasteur découvre que le composé lévogyre s'accumule au cours du processus ; cela veut dire que seul le composé dextrogyre est décomposé par la fermentation. Pasteur formule, à partir de ces observations, deux généralisations importantes : comme dans toute fermentation proprement dite, il y a une substance qui se transforme chimiquement et, corrélativement, il y a développement d'un corps possédant les allures d'un végétal mycodermique. Œuvres complètes, I Ce végétal mycodermique c'est la levure, agent de la fermentation de l'acide paratartrique.
Depuis les travaux de Lavoisier et ceux de Gay-Lussac, en France, ceux de Berzelius en Suède et ceux de Justus von Liebig 1803-1873, contemporain de Pasteur en Allemagne, toute fermentation était considérée comme un processus de décomposition purement chimique, accéléré par un ferment qui n'était qu'un type particulier de catalyseur. Pasteur prit le contre-pied des idées dominantes en avançant sa théorie des germes : aux ferments catalytiques inertes, il opposa, comme agents des fermentations, des micro-organismes vivants qui produisaient ou utilisaient des molécules asymétriques. Pour la fermentation alcoolique, par exemple, il soutint le rôle majeur joué par les cellules de levure observées auparavant par Charles Cagniard de La Tour 1777-1859.
Voici les principaux points de la théorie des germes de Pasteur :
1. La fermentation est un processus biologique résultant de l'action d'un micro-organisme.
2. Chaque type de fermentation, alcoolique, lactique, butyrique, acétique, etc. dépend d'un microbe particulier dont l'action est spécifique.
3. Un milieu de fermentation adapté fournit à chaque micro-organisme les nutriments nécessaires à son développement.
4. À partir des années 1860 environ, Pasteur comprit que l'oxygène de l'air pouvait parfois inhiber la croissance de l'agent de fermentation, cas du vibrion butyrique. Il introduisit alors en biologie le concept tout à fait révolutionnaire de la vie sans air favorisant les fermentations dans le cas des microbes qui supportent l'anaérobiose.
Pasteur n'a jamais convaincu tous ses collègues de la justesse de sa théorie des germes ; en particulier, son ami Claude Bernard est resté réticent, jusqu'à sa mort, devant l'origine biologique des fermentations. La découverte de l'amylase, extraite de l'orge, par Payen et Persoz, en 1833, et celle de l'invertase, extraite de la levure, par Marcellin Berthelot, 1827-1907, deux catalyseurs de la dégradation des sucres donnant, l'une et l'autre, des produits optiquement actifs in vitro, semblaient infirmer les théories de Pasteur. Mais Marcellin Berthelot concilia finalement les points de vue opposés en admettant que les micro-organismes nécessaires aux fermentations agissaient par l'intermédiaire des enzymes, amylase, phosphorylases, invertase, etc. qu'ils contenaient.
Sans micro-organisme, il ne peut y avoir de fermentation naturelle. En cas d'anaérobiose totale ou partielle, vécue par les micro-organismes, il se déclenche un métabolisme énergétique particulier : le métabolisme fermentaire. L'oxygène contrarie ce métabolisme : c'est l'effet Pasteur. La fermentation est définitivement liée à la vie.
Pasteur, professeur déjà expérimenté, est nommé doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille et il s'attaque lui-même aux problèmes rencontrés par les brasseurs de bière ou à ceux des fabricants de sucre à partir du jus de betterave. Ces industriels éprouvaient des difficultés à maîtriser les fermentations, utiles pour les brasseurs, nuisibles pour les sucriers. Pour résoudre ces problèmes, Pasteur apporte dans ses recherches appliquées la même rigueur que dans ses recherches fondamentales. Ses résultats permettront une grande amélioration des productions industrielles liées aux fermentations. Par la suite, il passera, toujours avec succès, des problèmes des betteraviers du Nord à ceux des vinaigriers d'Orléans ou ceux des viticulteurs du Jura.
Le débat sur la génération spontanée
En 1857, Pasteur est nommé directeur des études scientifiques à l'École normale supérieure. Il remplira cette tâche avec beaucoup de dévouement, mais il eut de mauvais rapports avec les élèves de l'École ; il désapprouvait leur esprit républicain.
Pour poursuivre ses recherches dans cette nouvelle situation, Pasteur dut installer son laboratoire dans une soupente inconfortable des bâtiments de la rue d'Ulm. C'est là qu'il posa les bases techniques fondamentales de la microbiologie : stérilisation des milieux de culture, utilisation de filtres stérilisants, les bougies de porcelaine poreuse de son collaborateur Chamberland, ensemencements sur milieux de culture bien définis.
Pasteur et ses élèves notamment Jules Raulin réussirent à faire se développer beaucoup de micro-organismes sur des milieux quasi exclusivement minéraux. Les chercheurs hétérogénistes, comme on les appelait à l'époque, voyaient, à partir de ces résultats, la possibilité de faire naître des micro-organismes à partir de matières inertes : c'était la thèse de la génération spontanée » des microbes. Leur chef de file était Félix Pouchet 1800-1872, professeur à l'École de médecine de Rouen.
Le débat sur la génération spontanée, c'est-à-dire sur l'origine de la vie traverse toute l'histoire de la biologie. Pouchet s'inscrit dans la lignée des partisans de la formation naturelle des êtres vivants à partir des matières en putréfaction : Aristote, Van Helmont, Needham, Buffon et même Liebig. En revanche, Pasteur, opposant résolu à la génération spontanée, soutenait que les germes en suspension dans l'air étaient à l'origine des micro-organismes nouvellement apparus dans les milieux en putréfaction, s'appuyant, lui, sur les travaux de Redi ou Spallanzani. La controverse scientifique Pasteur-Pouchet se développa dans les années 1860-1865 et déborda largement les murs des laboratoires. La presse, des conférences publiques très suivies données par les deux protagonistes, faisaient largement écho à leurs travaux sur la question. Finalement le dilemme fut tranché par l'Académie des sciences qui se rallia, en 1865, au point de vue de Pasteur. Ce dernier avait critiqué les expériences de Pouchet parce que, dans les expériences qu'il réalisait pour prouver sa thèse, les voies d'entrée des germes atmosphériques dans les milieux de culture utilisés n'étaient pas strictement contrôlées. Pasteur démontra que, lorsque l'air et le milieu d'expérience sont réellement débarrassés de tous leurs germes, même sans chauffage mais en employant les fameux ballons à ouverture étirée en col de cygne, le contact de l'air purifié avec une solution organique putrescible n'entraîne aucune production de microbe. Il suffit en revanche que l'air ordinaire entre en contact avec la solution pour que les germes prolifèrent en son sein.
Pour l'histoire des sciences, la controverse Pasteur-Pouchet prend surtout de l'importance par la critique de plus en plus approfondie des méthodes de la microbiologie naissante qu'elle a provoquée. La technique industrielle de la pasteurisation, le chauffage des liquides organiques alimentaires, notamment du lait, à 70 0C, à l'abri de l'oxygène, prendra aussi son essor à cette époque. La question de l'origine de la vie sera reprise au XXe siècle, et certains résultats expérimentaux contemporains s'accordent assez bien avec les thèses des hétérogénistes, sans toutefois que la question soit définitivement tranchée. La théorie des germes de Pasteur trouve encore un écho dans les vues de certains biologistes du XXe siècle, tels Svante Arrhenius ou Francis Crick, qui postulent que les premières cellules vivantes ont été apportées sur Terre par des météorites venus d'autres planètes
La lutte contre les maladies contagieuses
En 1867, Pasteur succède à Balard dans la chaire de chimie physiologique de la Sorbonne. Le chercheur dispose désormais d'un laboratoire bien équipé. Mais en 1868, à l'âge de quarante-six ans, il est frappé par une attaque d'hémiplégie cérébrale dont il ne se relèvera que lentement, restant en grande partie paralysé du côté gauche. Sa jambe raide le handicapera beaucoup pour marcher. Il ne pourra plus manipuler lui-même au laboratoire et devra s'en remettre à ses collaborateurs, Roux, Yersin, Duclaux, Haffkine, Metchnikoff. Il assistera cependant à toutes les expériences et surveillera de près tous les travaux : mais ne plus pouvoir être directement expérimentateur fut certainement pour lui un grand drame. Quelques années plus tôt, en 1859, 1865 et 1866, il avait perdu trois filles de la typhoïde et du choléra.
Au milieu de tous ces malheurs, une réorientation importante de la carrière de Pasteur va se produire : il va se consacrer à l'étude des maladies d'origine microbienne. La « théorie des germes », la présence universelle des micro-organismes dans l'air atmosphérique, révélée par les expériences sur la génération spontanée, la perte de ses propres enfants, devaient logiquement conduire Pasteur vers ces nouvelles recherches. Ce mouvement fut précipité par une demande de son ancien maître, Jean-Baptiste Dumas, devenu sénateur du Gard.
Une maladie d'origine mystérieuse dévastait les élevages français de vers à soie dans le Midi de la France. Dumas obtint que Pasteur, auréolé de la gloire acquise lors de ses travaux sur les maladies du vin, de la bière, du vinaigre, etc., se rende sur place, à Alès, entouré de plusieurs collaborateurs, pour étudier les maladies du ver à soie ; c'est-à-dire de la chenille du papillon Bombyx du mûrier. Deux affections principales touchaient les élevages : la pébrine, qui couvrait les vers de fines taches brunes leur donnant un aspect poivré et la flacherie ou maladie des morts flats ; les deux affections étaient mortelles pour les vers et s'accompagnaient de la présence de corpuscules microscopiques dans les chenilles et les papillons malades. Pour se débarrasser des vers malades, Pasteur met au point la méthode du grainage. Une partie des œufs d'un élevage de Bombyx du mûrier, recueillis sur un papier, est broyée et le broyat est observé au microscope : si les œufs ainsi examinés contiennent des corpuscules, ils doivent être éliminés ; s'ils n'en contiennent pas, l'élevage peut être mis en route. Pasteur constitua ainsi d'importantes réserves d'œufs sains ; il les distribua largement aux sériciculteurs de la région. En 1869, pour prouver l'efficacité de sa méthode, Pasteur organisa comme il le fera toujours par la suite une démonstration publique : les lots d'œufs sains avaient toujours donné des élevages exempts de maladie ; en revanche, les lots à corpuscules avaient donné des vers touchés par la pébrine ou la flacherie. La sériciculture française fut ainsi sauvée. L'agent infectieux de la pébrine est aujourd'hui connu : c'est un protozoaire Nosema bombycis ; l'agent de la flacherie est un virus encore mal caractérisé.
L'étude de ces maladies du ver à soie par Pasteur illustre la démarche qu'il suivra constamment dans l'étude de toute maladie contagieuse : 1) recherche du « germe » de la maladie pour établir un diagnostic ; 2) recherche d'un traitement curatif ou préventif ; 3) une fois le traitement (généralement prophylactique) trouvé, organisation de démonstrations publiques prouvant l'efficacité de sa méthode thérapeutique. Chaque démonstration sera l'occasion de réclamer aux pouvoirs publics ou à des souscripteurs divers l'argent nécessaire au financement de la recherche. Notons ici une grande différence entre les travaux des « pastoriens » et ceux, tout à fait contemporains, de l'école bactériologique allemande fondée par Robert Koch (1843-1910). Les recherches allemandes visaient surtout à préciser la méthodologie de l'obtention de germes en culture pure, pour bien les caractériser, préciser leurs besoins nutritifs, leurs exigences vis-à-vis du milieu, etc., de façon à préciser l'étiologie des maladies. Les travaux de Pasteur (qui était chimiste de formation) avaient d'emblée un but essentiellement pratique, privilégiant les applications de la recherche.
Désormais, à partir de 1870 environ, Pasteur oriente tous ses travaux scientifiques vers l'étude des maladies contagieuses. À la fin du XIXe siècle, les ravages causés par les épidémies de choléra, de typhoïde ou de tuberculose sont considérables et rappellent ceux de la variole ou de la peste au Moyen Âge. Les médecins du XIXe siècle, selon une tradition très ancienne remontant à Hippocrate. La décomposition chimique des tissus, semblable à celle accompagnant les putréfactions. Les miasmes atmosphériques liés à la putréfaction expliquaient la contagion. Toute la santé d'un individu reposait, pensaient en majorité les médecins, sur la composition chimique adéquate de ses tissus, de ses humeurs ou de son milieu intérieur tel que Claude Bernard venait de le définir.
Face à ce courant dominant dans les académies de médecine ou de science vétérinaire, Pasteur tenait bon sur sa théorie des germes. Recherchant des micro-organismes dans le pus, les plaies, les tissus infectés ou les furoncles, Pasteur découvrit ainsi le vibrion septique 1877, le staphylocoque 1880, le pneumocoque 1881. De son côté Koch isolait le bacille de la tuberculose 1882 et le vibrion du choléra 1883. C'est en suivant les idées de Pasteur que le chirurgien écossais Joseph Lister, 1827-1912 appliqua systématiquement des procédés aseptiques lors des opérations chirurgicales et qu'il utilisa des pansements imprégnés de substances antiseptiques, comme l'acide phénique. Avec ces procédés, la mortalité post-opératoire s'effondra dans des proportions spectaculaires.
À propos d'une maladie du mouton, le charbon des ruminants qui ravageait les bergeries de la Brie, la méthode prophylactique mise au point par Pasteur fit l'objet d'une grande publicité. Le bacille responsable de la maladie Bacillus anthracis avait été isolé par Robert Koch en 1876. Comme il l'avait déjà fait pour le choléra des poules, Pasteur se mit à la recherche d'un procédé d'atténuation de la virulence du microbe. Il pensa avoir atteint le but recherché en exposant longtemps à l'air des cultures de bacilles maintenues à 42-43 0C. Dans une atmosphère de controverses passionnées, il organisa en 1881, la célèbre expérience de Pouilly-le-Fort, en Seine-et-Marne où soixante moutons furent rassemblés. Dix d'entre eux ne reçurent aucune injection de bacille et restèrent vivants jusqu'à la fin de l'expérience. Un lot de vingt-cinq moutons reçut deux injections prophylactiques de bacilles du charbon à virulence atténuée, par la chaleur mais aussi par traitement au bichromate – ce que Pasteur ne dévoila pas publiquement puis une dose mortelle de bacilles virulents. La même dose mortelle fut injectée, au même moment, à l'autre lot de vingt-cinq moutons, non traités. Trois jours plus tard, 23 moutons non traités préalablement étaient morts, et le dernier allait bientôt mourir tandis que 24 des 25 moutons vaccinés restaient en bonne santé ; seule une brebis gravide, affaiblie par sa grossesse, était sur le point de mourir. Le succès triomphal de l'expérience de Pouilly-le-Fort permit à Pasteur d'établir définitivement le principe de la vaccination pour la prophylaxie des maladies contagieuses.
Pasteur et la vaccination
Pasteur utilise le mot vaccination pour désigner l'injection préventive, dans le sang d'un individu, d'un germe microbien pathogène dont la virulence avait été artificiellement atténuée. Cela immunisait l'individu contre la maladie en cas de rencontre ultérieure avec le germe virulent. Le terme vaccination rendait hommage à une pratique empirique, généralisée par le médecin anglais Jenner au XVIIIe siècle : l'injection de broyats de pustules de vaches atteintes de cow-pox, ou vaccine, maladie bénigne qui immunisait l'homme contre la variole, fléau très redouté à cette époque.
On savait depuis l'Antiquité qu'un patient guéri d'une maladie contagieuse, variole, rougeole, scarlatine, oreillons ne contractait jamais une deuxième fois la maladie. Cette absence de récidive avait même incité certains médecins du XVIIIe siècle à pratiquer, en reprenant d'anciennes méthodes chinoises, l'inoculation préventive à des enfants de broyats de croûtes de varioleux pour tenter de les protéger contre la variole ; les résultats étaient beaucoup plus aléatoires que ceux de la vaccination jennérienne. La question de l'utilité de l'inoculation restait donc encore très discutée au XIXe siècle ; cette question s'inscrivait d'ailleurs parfaitement dans le cadre des grands débats sur les mécanismes de l'évolution soulevés à cette époque.
Pasteur, qui n'était pas du tout naturaliste, était attiré par le lamarckisme, où il pouvait retrouver les desseins d'un Créateur tirant les êtres vivants vers toujours plus de perfection, tandis que son grand rival allemand, Robert Koch, était un adepte convaincu du darwinisme. On ne trouve donc, dans les œuvres de Pasteur, aucune réflexion sur la variation intra-spécifique ou sur la sélection naturelle. En revanche, le concept lamarckien d'une transformation directe des propriétés d'un être vivant par le milieu, transformation transmise ensuite héréditairement, confortait Pasteur dans ses recherches : son but était bien de trouver les conditions expérimentales d'atténuation de la virulence d'un microbe en changeant les conditions de culture du micro-organisme. Ce microbe, devenu inoffensif, devait ensuite protéger un individu sain contre le microbe pathogène initial. Koch n'acceptait pas ces idées, car il faisait de la virulence d'un microbe un « caractère héréditaire spécifique, insensible aux changements de milieu.
Pasteur s'attaqua d'abord aux maladies contagieuses frappant les animaux. Le choléra des poules fit l'objet de ses premières recherches parce que le développement de la maladie était très rapide, la mort survenait deux jours après l'inoculation du germe pathogène et parce que la contagion était extrême. Le germe responsable, une bactérie pathogène fut isolé en 1878 par deux vétérinaires, l'un italien, l'autre français, et porte aujourd'hui le nom de Pasteurella multocida. Une fois le microbe isolé, Pasteur éprouva sa virulence sur plusieurs animaux. Au contraire des poules et des lapins, les cobayes résistaient bien à l'attaque microbienne. Ce fait persuada Pasteur qu'un organisme particulier pouvait très bien résister à un microbe très virulent pour d'autres organismes. Pourtant les bactéries prélevées dans le pus d'un abcès bénin du cobaye, injectées à une poule, tuaient cet animal en moins de deux jours. Pour expliquer ces faits, Pasteur supposa que le microbe parasite trouvait dans les tissus de son hôte un oligo-élément indispensable à son développement, tels le rubidium ou le césium, récemment découverts. Si l'hôte, tels la poule ou le lapin, contenait de grandes quantités de l'oligo-élément indispensable, le germe pathogène pouvait se développer abondamment et l'animal infecté mourait. En revanche, si l'hôte, tel le cobaye, contenait peu d'oligo-élément, la prolifération bactérienne était limitée et l'animal infecté manifestait une immunité naturelle.
Le problème, pour Pasteur, consistait donc à trouver un microbe à virulence atténuée qui, en envahissant un hôte sain, prélèverait de ses tissus la totalité de l'oligo-élément indispensable au développement du micro-organisme pathogène et conférerait ainsi à l'hôte une immunité artificielle comparable à l'immunité naturelle du cobaye. Le savant multiplia les essais pour trouver des conditions de culture rendant le microbe inoffensif. Il conclut finalement que l'oxygène de l'air, en exerçant longtemps son effet sur la population microbienne, diminuait la toxicité du microbe. Il espaça donc les réensemencements de cultures abandonnées entre temps à l'air libre par des périodes de huit ou dix mois. Pasteur n'apporta jamais de preuves décisives de l'effet inhibiteur de l'oxygène sur la virulence mais cette hypothèse lui servit de guide pour la recherche d'autres vaccins.
La biologie contemporaine a démontré que les explications de Pasteur étaient fausses. Le vieillissement à l'air des cultures de Pasteurella multocida avait en fait abouti, à l'insu du savant, à l'élimination de la souche pathogène, porteuse du plasmide de toxicité. Il ne subsistait donc dans les cultures que des souches non pathogènes convenables pour la vaccination. Dans les expériences de Pasteur, l'élimination des souches pathogènes était aléatoire, d'où les longs temps d'attente nécessaires. Aujourd'hui les souches vaccinantes sont préparées directement par manipulation génétique avec élimination du plasmide de toxicité.
Pasteur cependant vaccina des poules avec des microbes vieillis à l'air, dont il avait vérifié la non-virulence, et après deux injections de rappel, ces poules devinrent effectivement insensibles à l'inoculation de germes restés nocifs. On sait aujourd'hui que l'injection à un animal d'un microbe à virulence atténuée (ou nulle) provoque dans son sang l'apparition d'anticorps qui le protègent contre tous les microbes de même structure moléculaire, antigénique, en particulier contre les microbes des souches de même espèce contenant les plasmides de toxicité. Pasteur fournissait lui une tout autre explication :
« Considérons une poule très bien vaccinée par une ou plusieurs inoculations antérieures du virus affaibli. Réinoculons cette poule. Que va-t-il se passer ? La lésion locale sera, pour ainsi dire, insignifiante, relativement à celles que les premières inoculations ont produites... Le muscle qui a été malade est devenu, après sa guérison et sa réparation, en quelque sorte impuissant à cultiver le microbe, comme si ce dernier, par une culture antérieure, avait supprimé quelque principe que la vie n'y ramène pas et dont l'absence empêche le développement du petit organisme... Sur les maladies virulentes et en particulier sur la maladie appelée vulgairement choléra des poules, Comptes-rendus de l'Académie des sciences, séance du 9 février 1880. Force est de constater que cette fausse explication de l'immunité apportée par la vaccination n'a pas empêché Pasteur de s'attaquer à d'autres maladies contagieuses.
Après le choléra des poules, c'est l'érysipèle du porc, puis le charbon des ruminants contre lesquels Pasteur prépare des vaccins. En 1885 enfin, c'est la rage qui donne à Pasteur l'occasion de fabriquer au laboratoire le premier vaccin artificiel jamais inoculé à l'homme. Le formidable retentissement de cette première vaccination réussie sur l'homme – le 6 juillet 1885, au bénéfice de Joseph Meister, un jeune Alsacien qui avait été mordu par un chien enragé – déclencha une série impressionnante de recherches menées par les pastoriens dès la fin du XIXe siècle. La vaccination prophylactique contre les maladies infectieuses, choléra, diphtérie, tétanos, typhoïde, fièvre jaune, etc. se généralisa et la lutte contre les maladies virales, variole, coqueluche, rougeole, poliomyélite enregistra au XXe siècle, pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, de grands succès, grâce aux vaccinations systématiques obligatoires. L'Organisation mondiale de la santé déclara enfin, en 1980, l'éradication totale de la variole.
Finalement, peu importe que le vaccin contre la rage, préparé aujourd'hui à l'Institut Pasteur par manipulation génétique, n'ait plus grand-chose à voir avec les préparations de virus atténués, prélevées par Pasteur sur des moelles épinières de lapin séchées à l'air. Peu importe que la théorie pastorienne de l'oligo-élément indispensable au développement d'un germe pathogène soit aujourd'hui abandonnée. Seul compte l'élan formidable que Pasteur sut donner à la lutte contre les maladies contagieuses et cela, contre l'avis de nombreux médecins ou vétérinaires, et même, s'agissant de la rage contre l'avis de certains de ses élèves. Sa théorie des germes , sa confiance inébranlable dans la possibilité d'atténuer la virulence des microbes pour conférer aux individus sains, par la vaccination, une immunité artificielle contre les germes pathogènes, font de Pasteur un bienfaiteur de l'humanité et l'un des plus grands biologistes de tous les temps.
La rage, Travaux antérieurs de Duboué et Galtier.
En 1879, Paul-Henri Duboué dégage de divers travaux de l'époque une théorie nerveuse de la rage : Dans cette hypothèse, le virus rabique s'attache aux fibrilles nerveuses mises à nu par la morsure et se propage jusqu'au bulbe. Le rôle de la voie nerveuse dans la propagation du virus de la rage, conjecturé par Duboué presque uniquement à partir d'inductions, fut plus tard confirmé expérimentalement par Pasteur et ses assistants.
La même année 1879, Galtier montre qu'on peut utiliser le lapin, beaucoup moins dangereux que le chien, comme animal d'expérimentation. Il envisage aussi de mettre à profit la longue durée d'incubation c'est-à-dire la longue durée que le virus met à atteindre les centres nerveux pour faire jouer à un moyen préventif qu'il en est encore à chercher ou à expérimenter un rôle curatif : J'ai entrepris des expériences en vue de rechercher un agent capable de neutraliser le virus rabique après qu'il a été absorbé et de prévenir ainsi l'apparition de la maladie, parce que, étant persuadé, d'après mes recherches nécroscopiques, que la rage une fois déclarée est et restera longtemps, sinon toujours incurable, à cause des lésions qu'elle détermine dans les centres nerveux, j'ai pensé que la découverte d'un moyen préventif efficace équivaudrait presque à la découverte d'un traitement curatif, surtout si son action était réellement efficace un jour ou deux après la morsure, après l'inoculation du virus . Galtier ne précise pas que le moyen préventif auquel il pense doive être un vaccin.
Dans une note de 1881, il signale notamment qu'il semble avoir conféré l'immunité à un mouton en lui injectant de la bave de chien enragé par voie sanguine. L'efficacité de cette méthode d'immunisation des petits ruminants : chèvre et mouton, par injection intraveineuse sera confirmée en 1888 par deux pasteuriens, Nocard et Roux.
Dans cette même note, toutefois, Galtier répète une erreur qu'il avait déjà commise dans son Traité des maladies contagieuses de 1880 : parce qu'il n'a pas pu transmettre la maladie par inoculation de fragments de nerfs, de moelle ou de cerveau, il croit pouvoir conclure que, chez le chien, le virus n'a son siège que dans les glandes linguales et la muqueuse bucco-pharyngienne.
Les choses en sont là quand Pasteur, en 1881, commence ses publications sur la rage.
Les études de Pasteur Études sur les animaux
Dans une note du 30 mai de cette année199, Pasteur rappelle la théorie nerveuse de Duboué et l'incapacité où Galtier a dit être de confirmer cette théorie en inoculant de la substance cérébrale ou de la moelle de chien enragé. J'ai la satisfaction d'annoncer à cette Académie que nos expériences ont été plus heureuses, dit Pasteur, et dans cette note de deux pages, il établit deux faits importants :
le virus rabique ne siège pas uniquement dans la salive, mais aussi, et avec une virulence au moins égale, dans le cerveau ;
l'inoculation directe de substance cérébrale rabique à la surface du cerveau du chien par trépanation communique la rage à coup sûr, avec une incubation nettement plus courte mort en moins de trois semaines que dans les circonstances ordinaires, ce qui fait gagner un temps précieux aux expérimentateurs.
Dans cette note de 1881, Galtier n'est nommé qu'une fois, et c'est pour être contredit avec raison.
En décembre 1882, nouvelle note de Pasteur et de ses collaborateurs, établissant que le système nerveux central est le siège principal du virus, où on le trouve à l'état plus pur que dans la salive, et signalant des cas d'immunisation d'animaux par inoculation du virus, autrement dit des cas de vaccination. Galtier est nommé deux fois en bas de page, tout d'abord à propos des difficultés insurmontables auxquelles se heurtait l'étude de la rage avant l'intervention de Pasteur, notamment parce que la salive était la seule matière où l'on eût constaté la présence du virus rabique, suit une référence à Galtier et ensuite à propos de l'absence d'immunisation que les pasteuriens ont constatée chez le chien après injection intraveineuse : Ces résultats contredisent ceux qui ont été annoncés par M. Galtier, à cette Académie, le 1er août 1881, par des expériences faites sur le mouton. Galtier, en 1891 puis en 1904, se montra ulcéré de cette façon de traiter sa méthode d'immunisation des petits ruminants par injection intraveineuse, dont l'efficacité fut confirmée en 1888 par deux pasteuriens, Roux et Nocard.
Deux notes de février et mai 1884 sont consacrées à des méthodes de modification du degré de virulence par passages successifs à l'animal exaltation par passages successifs aux lapins, atténuation par passages successifs aux singes. Les auteurs estiment qu'après un certain nombre de passages chez des animaux d'une même espèce, on obtient un virus fixe, c'est-à-dire un virus dont les propriétés resteront immuables lors de passages subséquents, en 1935, P. Lépine montra que cette fixité était moins absolue qu'on ne le croyait et qu'il était nécessaire de contrôler le degré de virulence et le pouvoir immunogène des souches fixes.
En 1885, Pasteur se dit capable d'obtenir une forme du virus atténuée à volonté en exposant de la moelle épinière de lapin rabique desséchée au contact de l'air gardé sec. Cela permet de vacciner par une série d'inoculations de plus en plus virulentes
Tableau d'Albert Edelfelt représentant Louis Pasteur, une de ses représentations les plus célèbres.
Dans cette représentation Pasteur observe dans un bocal une moelle épinière de lapin enragé, suspendue en train de se dessécher au-dessus de cristaux de potasse. C'est le processus qui a permis d'obtenir le vaccin contre la rage.
Essais sur l'Homme
C'est en cette année 1885 qu'il fait ses premiers essais sur l'homme.
Il ne publia rien sur les deux premiers cas : Girard, sexagénaire de l'hôpital Necker, inoculé le 5 mai 1885, et la fillette de 11 ans Julie-Antoinette Poughon, inoculée après le 22 juin 1885, ce qui, selon Patrice Debré, alimente régulièrement une rumeur selon laquelle Pasteur aurait étouffé ses premiers échecs. En fait, dans le cas Girard, qui semble avoir évolué favorablement, le diagnostic de rage, malgré des symptômes qui avaient fait conclure à une rage déclarée, était douteux, et, dans le cas de la fillette Poughon, qui mourut le lendemain de la vaccination, il s'agissait très probablement d'une rage déclarée, ce qui était et est encore, avec une quasi-certitude, un arrêt de mort à brève échéance, avec ou sans vaccination.
G. Geison a noté qu'avant de soigner ces deux cas humains de rage déclarée, Pasteur n'avait fait aucune tentative de traitement de rage déclarée sur des animaux.
Le 6 juillet 1885, on amène à Pasteur un petit berger alsacien de Steige âgé de neuf ans, Joseph Meister, mordu l'avant-veille par un chien qui avait ensuite mordu son propriétaire. La morsure étant récente, il n'y a pas de rage déclarée. Cette incertitude du diagnostic rend le cas plus délicat que les précédents et Roux, l'assistant de Pasteur dans les recherches sur la rage, refuse formellement de participer à l'injection. Pasteur hésite, mais deux éminents médecins, Alfred Vulpian et Jacques-Joseph Grancher, estiment que le cas est suffisamment sérieux pour justifier la vaccination et la font pratiquer sous leur responsabilité. Le fort écho médiatique accordé alors à la campagne de vaccination massive contre le choléra menée par Jaime Ferran en Espagne a pu également infléchir la décision de Pasteur. Joseph Meister reçoit sous un pli fait à la peau de l’hypocondre droit treize inoculations réparties sur dix jours, et ce par une demi-seringue de Pravaz d'une suspension d'un broyat de moelle de lapin mort de rage le 21 juin et conservée depuis 15 jours. Il ne développera jamais la rage.
Le cas très célèbre de Meister n'est peut-être plus très convaincant. Ce qui fit considérer que le chien qui l'avait mordu était enragé est le fait que celui-ci, à l'autopsie, avait foin, paille et fragments de bois dans l'estomac . Aucune inoculation de substance prélevée sur le chien ne fut faite. Peter, principal adversaire de Pasteur et grand clinicien, savait que le diagnostic de rage par la présence de corps étrangers dans l'estomac était caduc. Il le fit remarquer à l'Académie de médecine 11 janvier 1887.
Un détail du traitement de Meister illustre ces mots écrits en 1996 par Maxime Schwartz, alors directeur général de l'Institut Pasteur Paris : Pasteur n'est pas perçu aujourd'hui comme il y a un siècle ou même il y a vingt ans. Le temps des hagiographies est révolu, les images d'Épinal font sourire, et les conditions dans lesquelles ont été expérimentés le vaccin contre la rage ou la sérothérapie antidiphtérique feraient frémir rétrospectivement nos modernes comités d'éthique.
Pasteur, en effet, fit faire à Meister, après la série des inoculations vaccinales, une injection de contrôle. L'injection de contrôle, pour le dire crûment, consiste à essayer de tuer le sujet en lui injectant une souche d'une virulence qui lui serait fatale dans le cas où il ne serait pas vacciné ou le serait mal ; s'il en réchappe, on conclut que le vaccin est efficace.
Pasteur a lui-même dit les choses clairement : Joseph Meister a donc échappé, non seulement à la rage que ses morsures auraient pu développer, mais à celle que je lui ai inoculée pour contrôle de l'immunité due au traitement, rage plus virulente que celle des rues. L'inoculation finale très virulente a encore l'avantage de limiter la durée des appréhensions qu'on peut avoir sur les suites des morsures. Si la rage pouvait éclater, elle se déclarerait plus vite par un virus plus virulent que par celui des morsures.
À propos de la seconde de ces trois phrases, André Pichot, dans son anthologie d'écrits de Pasteur, met une note : Cette phrase est un peu déplacée, dans la mesure où il s'agissait ici de soigner un être humain et non de faire une expérience sur un animal.
L'efficacité du vaccin de Pasteur remise en cause
Pasteur ayant publié ses premiers succès, son vaccin antirabique devient vite célèbre et les candidats affluent parmi les premiers vaccinés, Jean-Baptiste Jupille est resté célèbre. Déçu par quelques cas où le vaccin a été inefficace, Pasteur croit pouvoir passer à un traitement intensif, qu'il présente à l'Académie des Sciences le 2 novembre 1886. L'enfant Jules Rouyer, vacciné dans le mois d'octobre précédant cette communication, meurt vingt-quatre jours après la communication et son père porte plainte contre les responsables de la vaccination.
D'après un récit fait une cinquantaine d'années après les évènements par le bactériologiste André Loir, neveu et ancien assistant-préparateur de Pasteur, le bulbe rachidien de l'enfant, inoculé à des lapins, leur communique la rage, mais Roux en l'absence de Pasteur, qui villégiature à la Riviera fait un rapport en sens contraire; le médecin légiste, Brouardel, après avoir dit à Roux Si je ne prends pas position en votre faveur, c'est un recul immédiat de cinquante ans dans l'évolution de la science, il faut éviter cela !, conclut dans son expertise que l'enfant Rouyer n'est pas mort de la rage. P. Debré accepte ce récit, tout en notant qu'il repose uniquement sur André Loir.
À la même époque, le jeune Réveillac, qui a subi le traitement intensif, meurt en présentant des symptômes atypiques où Peter, le grand adversaire de Pasteur, voit une rage humaine à symptômes de rage de lapin, autrement dit la rage de laboratoire, la rage Pasteur, dont on commence à beaucoup parler.
On renonça plus tard à une méthode de traitement aussi énergique, et qui pouvait présenter quelques dangers.
En fait, on finit même par renoncer au traitement ordinaire de Pasteur-Roux. En 1908, Fermi proposa un vaccin contre la rage avec virus traité au phénol. Progressivement, dans le monde entier, le vaccin phéniqué de Fermi supplanta les moelles de lapin de Pasteur et Roux. En France, où on en était resté aux moelles de lapin, P. Lépine et V. Sautter firent en 1937 des comparaisons rigoureuses : une version du vaccin phéniqué protégeait les lapins dans la proportion de 77,7 %, alors que les lapins vaccinés par la méthode des moelles desséchées n'étaient protégés que dans la proportion de 35 %. Dans un ouvrage de 1973, André Gamet signale que la préparation de vaccin contre la rage par la méthode des moelles desséchées n'est plus utilisée. Parmi les méthodes qui le sont encore, il cite le traitement du virus par le phénol.
Même si ce sont les travaux de Pasteur sur la vaccination antirabique, et donc les derniers de sa carrière, qui ont fait sa gloire auprès du grand public, un spécialiste en immunologie comme P. Debré estime que les œuvres les plus remarquables de Pasteur sont les premières.Par ailleurs, d'après Bruno Latour, la véritable adhésion du grand public mais aussi des médecins à l'œuvre pastorienne, ne vint ni de la découverte d'un vaccin contre la maladie du charbon —maladie des campagnes—, ni de celle d'un vaccin contre une maladie aussi terrifiante que la rage, mais de la mise au point du sérum antidiphtérique par Roux et ses collègues en 1894.
Fondation de l'Institut Pasteur
La création d'un Institut antirabique sera d'abord évoquée devant l'Académie des Sciences par Vulpian dès octobre 1885 après que Pasteur y eût exposé les résultats de son traitement préventif. Le 1er mars 1886, Pasteur mentionne brièvement son projet devant l'Académie des Sciences : à l'issue de cette même séance une commission ad-hoc adopte ce projet et décide de lancer une souscription internationale afin de permettre le financement de ce qui est déjà nommé Institut Pasteur.Reconnu d'utilité publique par décret du 4 juin 1887, l'Institut Pasteur / Institut Antirabique de Paris sera officiellement inauguré le 14 novembre 1888 en présence du Président Sadi Carnot.
Erreurs théoriques Les toxines
En 1877, Pasteur veut tester l'hypothèse selon laquelle le bacille du charbon ne causerait l'état morbide que de façon indirecte, en produisant un ferment diastasique soluble qui serait l'agent pathogène immédiat. Il prélève le sang d'un animal qui vient de mourir du charbon, le filtre de façon à en ôter les bacilles et inocule le filtrat à un animal sain. L'animal récepteur ne développe pas la maladie et Pasteur estime que cette expérience écarte complètement l'hypothèse du ferment soluble. Dans une publication ultérieure, toujours en 1877, Pasteur note toutefois que le sang filtré, s'il ne cause pas la maladie, rend les globules agglutinatifs, autant et même plus que dans la maladie, et envisage que ce soit l'effet d'une diastase formée par les bacilles. En fait, les pasteuriens Roux et Yersin prouveront en 1888, dans le cas de la diphtérie que les microbes sécrètent bel et bien une substance la toxine qui est la cause directe et isolable de la maladie.
Des épistémologues et historiens des sciences comme F. Dagognet et A. Pichot pensent que le demi-échec de Pasteur à mettre l'existence et le rôle des toxines en évidence a la même cause que son attitude défensive face à la théorie des enzymes : son vitalisme Dagognet dit végétalisme, qui tend à séparer rigoureusement les domaines du vivant et du non-vivant. Il faut dire, à la décharge de Pasteur, que l'existence d'une toxine du charbon ne sera démontrée qu'en 1955. En 1880, d'ailleurs, Pasteur accepte d'envisager, à titre d'hypothèse, le rôle d'une substance toxique.
Les vaccins par microbes tués inactivés
En 1880, le vétérinaire Henry Toussaint estime, à tort ou à raison, avoir immunisé des moutons contre le charbon par deux méthodes : en inoculant du sang charbonneux dont les microbes ont été éloignés par filtration, et en inoculant du sang charbonneux où les microbes ont été laissés, mais tués par chauffage. Pasteur, qui voit ainsi Toussaint, à son insu, peut-être, car il n'y fait aucune allusion, battre en brèche les opinions publiées antérieurement par Pasteur, rejette l'idée d'un vaccin qui ne contiendrait pas d'agents infectieux vivants. Ici encore, André Pichot voit un effet de la tendance de Pasteur à cloisonner rigoureusement les domaines du vivant et de l'inanimé. Pasteur, toutefois, finira par admettre la possibilité des vaccins chimiques.
Le mécanisme de l'immunisation
Pour expliquer l'immunisation, Pasteur adopta tour à tour deux idées différentes. La première de ces idées, qu'on trouve déjà chez Tyndall et chez Auzias-Turenne, explique l'immunisation par l'épuisement, chez le sujet, d'une substance nécessaire au microbe. La seconde idée est que la vie du microbe ajoute une matière qui nuit à son développement ultérieur. Aucune de ces deux idées n'a été ratifiée par la postérité, encore que la seconde puisse être considérée comme une esquisse de la théorie des anticorps.
Le génie de Pasteur Mise en ordre plutôt qu'innovation
En 1950, René Dubos faisait gloire à Pasteur d'audacieuses divinations. En 1967, François Dagognet249 cite ce jugement de Dubos, mais pour en prendre le contre-pied : il rappelle que Pasteur a seulement ajouté à la chimie des isomères que Berzélius et Mitscherlich avaient fondée, qu'il avait été précédé par Cagniard-Latour dans l'étude microscopique des fermentations, par Davaine dans la théorie microbienne des maladies contagieuses et, bien sûr, par Jenner dans la vaccination. Il ajoute que la science de Pasteur consiste moins à découvrir qu'à enchaîner .
Dans le même ordre d'idées que Dagognet, André Pichot définit comme suit le caractère essentiel de l'œuvre de Pasteur : C'est là le mot-clé de ses travaux : ceux-ci ont toujours consisté à mettre de l'ordre, à quelque niveau que ce soit. Ils comportent assez peu d'éléments originaux, En note : Cela peut surprendre, mais les études sur la dissymétrie moléculaire étaient déjà bien avancées quand Pasteur s'y intéressa, celles sur les fermentations également; les expériences sur la génération spontanée sont l'affinement de travaux dont le principe était vieux de plus d'un siècle; la présence de germes dans les maladies infectieuses étudiées par Pasteur a souvent été mise en évidence par d'autres que lui; quant à la vaccination, elle avait été inventée par Jenner à la fin du XVIIIe siècle, et l'idée d'une prévention utilisant le principe de non-récidive de certaines maladies avait été proposée bien avant que Pasteur ne la réalisât.; mais, le plus souvent, ils partent d'une situation très confuse, et le génie de Pasteur a toujours été de trouver, dans cette confusion initiale, un fil conducteur qu'il a suivi avec constance, patience et application.
Patrice Debré dit de même : Pasteur donne parfois même l'impression de se contenter de vérifier des résultats décrits par d'autres, puis de se les approprier. Cependant, c'est précisément quand il reprend des démonstrations laissées, pour ainsi dire, en jachère, qu'il se montre le plus novateur : le propre de son génie, c'est son esprit de synthèse.
Un savant dans le monde
Pasteur n'était en rien un chercheur isolé dans sa tour d'ivoire. Ses travaux étaient orientés vers les applications médicales, hygiéniques, agricoles et industrielles. Il a toujours collaboré étroitement avec les professions concernées même si, parmi les médecins, ses partisans étaient en minorité et il a su obtenir le soutien des pouvoirs publics à la recherche scientifique. C'est sans doute à cela que Pasteur doit sa grande popularité. Il a lui-même sciemment contribué à l'édification de sa légende, par ses textes et par ses interventions publiques.
Le 11 avril 1865, Pasteur obtient en France un brevet sur la conservation des vins par chauffage modéré à l’abri de l’air pasteurisation. Le 28 juin 1871 il obtient un brevet en France sur la fabrication de la bière. L'Office américain des brevets accorde en 1873 à Pasteur un brevet sur une levure exempte de germes organiques de maladie,en tant que produit de fabrication .
Par la loi du 3 août 1875, l'Assemblée Nationale accorde une pension à Louis Pasteur en récompense des services rendus.
Louis Pasteur, par ailleurs, a eu quelques velléités, de s'engager activement en politique.
Pasteur, la religion catholique et l'euthanasie
Dans les dernières années du XIXe siècle et les premières du XXe, l'apologétique catholique attribuait volontiers à Pasteur la phrase Quand on a bien étudié, on revient à la foi du paysan breton. Si j'avais étudié plus encore j'aurais la foi de la paysanne bretonne.
En 1939 l'entre-deux-guerres fut la grande époque de l'Union rationaliste, Pasteur Vallery-Radot, petit-fils de Louis Pasteur, fit cette mise au point : Mon père a toujours eu soin, et ma mère également d'ailleurs, de dire que Pasteur n'était pas pratiquant. Si vous ouvrez la Vie de Pasteur, vous verrez que mon père parle du spiritualisme et non du catholicisme de Pasteur. Je me souviens parfaitement de l'irritation de mon père et de ma mère, quand quelque prêtre, en chaire, se permettait de lui attribuer cette phrase qu'il n'a jamais dite : J'ai la foi du charbonnier breton. ... Toute la littérature qui a été écrite sur le prétendu catholicisme de Pasteur est absolument fausse.
En 1994-1995, Maurice Vallery-Radot, arrière-petit-neveu de Pasteur et catholique militant, ne se contente pas du spiritualisme, du théisme de Pasteur, il tient que Pasteur resta au fond catholique, même s'il n'allait pas régulièrement à la messe.
En 2004, Pasteur sert de caution morale à une cause d'une nature différente : son précédent est évoqué à l'assemblée nationale en faveur de l'euthanasie compassionnelle. La commission rapporte, d'après Léon Daudet, que quelques-uns des dix-neuf Russes soignés de la rage par Pasteur développèrent la maladie et que, pour leur épargner les souffrances atroces qui s'étaient déclarées et qui auraient de toute façon été suivies d' une mort certaine, on pratiqua sur eux l'euthanasie avec le consentement de Pasteur.
Pourtant, il y eut une époque où un Pasteur praticien de l'euthanasie n'était pas une chose qu'on exhibait volontiers : Axel Munthe ayant lui aussi raconté l'euthanasie de quelques-uns des mordus russes dans la version originale en anglais de son Livre de San Michele The Story of San Michele, la traduction française publiée en 1934 par Albin Michel, bien que donnée comme texte intégral, fut amputée du passage correspondant.
Distinctions
Grand-croix de la Légion d'honneur 7 juillet 1881
Rues Pasteur
Du vivant même de Pasteur, des rues adoptèrent son nom : il existe à ce jour 2 020 artères rues, boulevards… Pasteur en France. C'est un des noms propres les plus attribués comme nom de rue. Lors des grands mouvements de décolonisation, qui entraînèrent des changements de nom de rues, les voies nommées en hommage à Pasteur gardèrent souvent leur nom. C'est le cas encore aujourd'hui, par exemple, d'un boulevard du quartier résidentiel de Bellevue à Constantine, en Algérie
Numismatique
Le graveur Oscar Roty réalisa en 1892 une médaille rectangulaire avec le buste de Pasteur ainsi que plusieurs modèles de jetons pour financer par souscription publique la construction de l'Institut Pasteur.
Louis Pasteur figure sur le billet 5 francs Pasteur créé en 1966.
Il figure aussi sur une pièce de 10 € en argent éditée en 2012 par la Monnaie de Paris pour représenter sa région natale, la Franche-Comté.
Astronomie
Pasteur est le nom d'un cratère lunaire depuis 1961.
Pasteur est un cratère situé sur la planète Mars
Philatélie
La Poste française émet en 1923 des timbres d'usage courant à l'effigie de Louis Pasteur
Iconographie Tableaux
1885 : tableau d'Albert Edelfelt, Musée d'Orsay.
Sculptures
1899 : Institut Pasteur de Lille, buste en marbre blanc de Pasteur..
Le Génie de la science, monument en hommage à Pasteur, à Bollène, par Armand Martial.
1904 : monument à Pasteur, place de Breteuil, 7e et 15e arrondissements de Paris, par Alexandre Falguière.
1999 : Nice, statue de Cyril de La Patellière au collège Pasteur de Nice, inaugurée en présence de l'artiste et de Jacques Peyrat maire de Nice.
2000 : Charenton-le-Pont, statue par Cyril de La Patellière à l'École Louis Pasteur, œuvre inaugurée le mardi 10 octobre 2000 en présence de l'artiste, Alain Griotteray maire de Charenton et de François Jacob prix Nobel de médecine.
2001 : Buste de Louis Pasteur, : Institut Pasteur, Paris, par Cyril de La Patellière.
Photos
1878, portrait de Louis Pasteur par Félix Nadar.
Liens
http://youtu.be/einJv5G-AH0 Portrait d'un visionnaire
http://www.ina.fr/video/CPC95001503/p ... -louis-pasteur-video.html I livre i jour
http://www.ina.fr/video/CPF86658447/l-institut-pasteur-video.html L'institut Pasteur       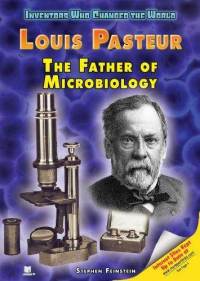  [img width=600]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz5vrPQrKZ6g_5v7WTnr86YVa35mm6RSJs1NtbccSPDdFi-9Ov6Qj2f2_dIg[/img]  [img width=600]http://commondatastorage.googleapis.com/comslider/target/users/1395768531x198416e1e1f8fb16e066a2e5d3e41606/img/1403251851104591.jpg?1396008825[/img]
Posté le : 27/09/2014 17:23
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
49 Personne(s) en ligne ( 30 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 49
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages