|
|
Manon Roland dite Madame Roland |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 novembre 1793 à Paris est guillotinée Manon Roland
née Jeanne Marie Philipon, plus connue sous le nom de Madame Roland, naquit le 17 mars 1754. Elle fut une des figures de la Révolution française.
Elle joua un rôle majeur au sein du parti girondin, et poussa son mari, Jean-Marie Roland de La Platière, au premier plan de la vie politique de 1791 à 1793.
En bref
Inspecteur général des manufactures de la généralité de Lyon à la veille de la Révolution, Roland a épousé en 1780 une Parisienne de condition modeste, mais bien plus jeune que lui, belle et instruite, nourrie de Rousseau, et qui dira plus tard que la lecture de Plutarque « l'avait disposée à devenir républicaine ». En 1790, le ménage s'installe une première fois à Paris, pour sept mois, car Roland a été chargé de présenter à la Constituante la délicate question de l'octroi de Lyon. Manon écrit alors dans Le Patriote français de Brissot, tient salon, reçoit notamment Robespierre, Brissot, Pétion, Buzot. Au cours de l'été de 1791, elle retourne à Lyon, mais la suppression de l'emploi de son mari par décret de la Constituante fournit un prétexte pour revenir à Paris en décembre 1791. Dans le salon de Mme Roland, on rencontre tout l'état-major de ce qui va constituer la Gironde et dont elle est l'inspiratrice. Manon fait tout pour éviter la rupture entre Robespierre, qu'elle estime, et les brissotins. Grâce à cette conduite habile et perspicace, le mari se pousse dans la politique et, n'étant point député, peut entrer dans le ministère brissotin comme ministre de l'Intérieur en mars 1792. Le « vertueux Roland » symbolise le nouveau gouvernement, mais l'influence de sa femme dans la conduite des affaires est indéniable : elle lui sert de secrétaire, rédige ses discours, ses circulaires. Dans Le Défenseur de la Constitution, Robespierre dénonce le « triumvirat féminin, Mme Roland et, sans doute, Mme de Staël et Mme Condorcet. Roland, épousant la haine de sa femme pour le roi et la reine, adresse à Louis XVI un violent manifeste, agitant la menace du sang et de la guerre civile le 10 juin 1792. Il doit quitter le ministère. Après le 10 août, membre du Conseil exécutif provisoire, il ne va pas tarder à se heurter aux sans-culottes parisiens et à la Commune. Mme Roland conçoit une haine violente envers Robespierre et surtout envers Danton qui supplante son mari au Comité exécutif. Roland se montre un ministre compétent, consciencieux, qui s'efforce de réagir contre les excès de la centralisation et développe devant la Convention la notion de responsabilité ministérielle. Attaché à la liberté préconisée par les économistes, il se trouve accordé aux intérêts des négociants condamnant la taxation et la réquisition des denrées, ce qui l'oriente de plus en plus vers le conservatisme et achève de perdre le ménage dans l'estime des sans-culottes et de Robespierre. Roland démissionne le 22 janvier 1793. Il échappe à l'arrestation le 2 juin. Manon est exécutée le 8 novembre ; Roland se donne la mort quand il apprend l'exécution de Manon. Roger Dufraisse
Sa vie
Elle est la fille de Gatien Phlipon, que l’on peut aussi écrire Phlippon, maître graveur à Paris, 41, quai de l'Horloge, homme aisé mais coureur de jupons et joueur, et de Marguerite Bimont, fille d'une femme de chambre et d'un cuisinier au service de la marquise de Crequy. C'est la seule survivante des sept enfants du couple. Dès son plus jeune âge, Manon fut une enfant pieuse et très intelligente, au caractère ferme et résolu, et montra de grandes aptitudes pour les études et un esprit vif et enthousiaste. Un frère de sa mère, vicaire, lui apprit le latin. À huit ans, elle se passionna pour la lecture de la Vie des hommes illustres et Plutarque resta un de ses auteurs favoris. Sa passion pour cet écrivain dura tout au long de sa vie — puis Bossuet, Massillon, et des auteurs de la même veine, Montesquieu, Voltaire.
Elle fut placée en 1765 au couvent de la Congrégation et s'y lia d'amitié avec Sophie et Henriette Canet originaires d'Amiens. Manon entretint avec ses deux amies une correspondance suivie après leur sortie du couvent.
Jeunesse
Avec la maturation de son esprit, elle abandonna l'idée d'entrer au couvent. Après le décès de sa mère, alors qu'elle avait une vingtaine d'années, la jeune fille se consacra à l’étude, et à la tenue du ménage de son père. La lecture de la Nouvelle Héloïse parvint à la consoler du profond chagrin qu’elle éprouva à la mort de sa mère, et Rousseau resta son maître.
En 1774, elle séjourna quelque temps au château de Versailles, ressentant comme une insulte le mépris dans lequel la noblesse tenait les bourgeois. Manon n’oublia jamais la haine qu’elle ressentit alors.
Belle, l'attitude ferme et gracieuse, le sourire tendre et séducteur, la fille du graveur eut de nombreux soupirants, mais refusa toutes les propositions de mariage.
En 1776, par l'intermédiaire de ses deux amies amiénoises notamment de Sophie, devenue Madame de Gomicourt en épousant Pierre Dragon Gomicourt, seigneur de Sailly-le-Sec, elle fit la connaissance de Jean-Marie Roland de La Platière, économiste réputé, d'une grande intelligence, inspecteur des manufactures de Picardie qui s'était lié à Amiens avec la famille Canet. Le vertueux et sévère Roland de vingt ans son aîné s'éprit de Manon et demanda sa main.
L'épouse d'un grand commis de l'État
Le 4 février 1780, après de multiples hésitations, elle l’épousa. Ils vécurent un an à Paris.
En février 1781, le couple Roland s'installa à Amiens où naquit leur fille : Eudora Roland 1781-1858, et postérité. Passionnée de botanique, Manon herborisa le long des canaux aux abords de la ville. Elle constitua un herbier aquatique qui fut utile à son mari qui publia un ouvrage, L'Art du tourbier, en 1782.
Ayant appris que la place d'inspecteur des manufactures à Lyon était vacante, elle en fit la demande pour son mari et c'est ainsi que le couple, en août 1784, quitta Amiens où il végétait et s'installa à Villefranche-sur-Saône près de Lyon. L'immeuble où ils vécurent, au 793 de la rue Nationale, existe toujours. Acquise aux idées des Lumières, Madame Roland écrivit des articles politiques pour le Courrier de Lyon.
La vie conjugale n’enchantait guère Manon qui ne se maria pas par amour mais plutôt pour échapper à la tutelle de son père. Cependant, il est indubitable qu'elle éprouva pour Roland de l'affection. La vie quotidienne menée aux côtés de l’inspecteur des manufactures, avec qui elle collabora sur le plan professionnel sans se préoccuper de ses aspirations, ne l'épanouit point. Mariée dans tout le sérieux de la raison, avoua-t-elle dans ses Mémoires, je ne trouvais rien qui m’en tirât je me dévouais avec une plénitude plus enthousiaste que calculée. À force de ne considérer que la félicité de mon partenaire, je m’aperçus qu’il manquait quelque chose à la mienne.
La Révolution donna enfin à Manon l'occasion de mettre un terme à cette vie terne et monotone. Le couple s'installa à Paris en décembre 1791 à l’hôtel Britannique, rue Guénégaud, les époux dormant désormais dans une chambre à deux lits. Enthousiasmée par le mouvement qui se développait, elle se jeta avec passion dans l’arène politique.
L'égérie des Girondins
Manon décida alors de faire un salon qui devint le rendez-vous de nombreux hommes politiques influents, Brissot, Pétion, Robespierre et d’autres élites du mouvement populaire dont notamment Buzot. Il était presque inévitable qu’elle-même se retrouvât au centre des inspirations politiques et présidât un groupe des plus talentueux hommes de progrès.
Grâce à ses relations au sein du parti girondin, Roland devint ministre de l’Intérieur le 23 mars 1792. Dès lors, dans l’hôtel ministériel de la rue Neuve-des-Petits-Champs hôtel de Calonne construit par Le Vau, Manon devint l’égérie du parti girondin. Barbaroux, Brissot, Louvet, Pétion, et aussi Buzot auquel la lia une passion partagée, assistèrent aux dîners qu’elle offrait deux fois par semaine. Manon, cependant, resta fidèle à Roland, ce vénérable vieillard qu’elle aime comme un père.
Aux côtés de son mari, elle joua, au ministère de l’Intérieur, un rôle essentiel, rédigeant notamment la lettre dans laquelle Roland demandait au roi de revenir sur son veto, lettre qui provoqua son renvoi le 13 juin 1792. Lorsque son mari retrouva son portefeuille après le 10 août 1792, Manon dirigea plus que jamais ses bureaux.
Après les Massacres de Septembre qui la révoltèrent mais contre lesquels elle n’agit pas, elle voua à Danton une haine chaque jour plus féroce. Aussi entière et acharnée dans ses haines que dans ses affections, l’égérie des Girondins attaqua Danton de plus en plus violemment par la voix de Buzot. Sachant d’où venaient ces attaques, le tribun s’écria : Nous avons besoin de ministres qui voient par d’autres yeux que ceux de leur femme. Manon, dès lors, devint furieuse. Cependant, les Montagnards multiplièrent les attaques contre les Girondins et en particulier contre Roland surnommé Coco Roland, Manon devenant Madame Coco ou la reine Coco.
Lassé des attaques, le ministre de l’Intérieur démissionna le 23 janvier 1793. Son épouse et lui s’éloignèrent du pouvoir, sans renoncer à jouer dans l'ombre, un rôle politique.
La prison, le procès, l'exécution
Le 31 mai 1793, lors de la proscription des Girondins, elle ne fuit pas, comme elle aurait pu le faire et comme le firent entre autres son mari et Buzot. Son époux s’échappa vers Rouen, mais Manon se laissa arrêter le 1er juin 1793 à son domicile situé au second étage du 51 rue de la Vieille Bouclerie et fut incarcérée dans la prison de l’Abbaye. Détachée de la vie, libérée de la présence de son mari, elle ressentit son arrestation comme un soulagement et l’écrivit à Buzot dans une de ces pages de la correspondance passionnée et déchirante qu’ils échangèrent alors : Je chéris ces fers où il m’est libre de t’aimer sans partage. Elle fut libérée le 24 juin. Relâchée pendant une heure, elle fut de nouveau arrêtée et placée à Sainte-Pélagie puis transférée à la Conciergerie où elle resta cinq mois.
En prison, elle fut respectée par les gardiens et certains privilèges lui furent accordés. Elle put ainsi avoir du matériel pour écrire et put recevoir des visites occasionnelles de ses amis dévoués. Elle y reçut la visite de son amie Henriette Canet qui lui proposa d'échanger leurs vêtements pour que Manon puisse s'échapper mais celle-ci refusa. C'est à la Conciergerie qu'elle écrivit son Appel à l’impartiale postérité, ses Mémoires destinés à sa fille Eudora où elle montra une étrange alternance entre louanges personnelles et patriotisme, entre l’insignifiant et le sublime.
Elle fut jugée le 8 novembre 1793. Toute vêtue de blanc, elle se présenta devant le Tribunal révolutionnaire. Le procès se déroula entre 9 h et 14 h 30. Sa sentence fut mise à exécution le soir même, en même temps qu’un autre condamné, Simon-François Lamarche, ancien directeur de la fabrication des assignats. Manon monta, avec une grande sérénité, dans la charrette qui la conduisit vers le lieu du supplice, la place de la Révolution rebaptisée depuis place de la Concorde. Passant devant la statue de plâtre dédiée à la Liberté installée afin de commémorer la journée du 10 août 1792, elle se serait exclamée, peu avant que ne tombe le couperet de la guillotine :
Ô Liberté, comme on t'a jouée ! ou selon une autre version plus littéraire : Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom !
Anecdote : Elle montra beaucoup de courage en montant sur la guillotine au contraire de Lamarche et lui proposa de monter le premier à l'échafaud pour lui éviter "une deuxième mort", il l'accepta.
Postérité
Deux jours plus tard, apprenant la mort tragique de sa femme, Jean Marie Roland se suicida le 10 novembre 1793 à Bourg-Beaudouin, dans l'Eure, sur la route entre Rouen et Paris. Buzot, qui ne l’apprit qu’en juin 1794, se donna lui aussi la mort, près de Saint-Émilion.
Sa fille Eudora, devenue orpheline, fut recueillie par Jacques Antoine Creuzé-Latouche, ancien soupirant de Manon. Conformément à la volonté de sa mère, ce fut le célèbre minéraliste et botaniste Louis-Augustin Bosc d'Antic, un des principaux amis de Manon Roland et de son mari, qui devint peu après son tuteur et se chargea de l’éducation de la petite orpheline. Il tomba amoureux de la jeune Eudora alors âgée de dix-neuf ans. Mais celle-ci ne répondant pas à ses avances, il partit aux États-Unis en juillet 1796 pour l'oublier. Elle épousa, quelques mois plus tard, Pierre Léon Champagneux.
Écrits
Lettres de Madame Roland de 1780 à 1793 publiées par Claude Perroud, Imprimerie nationale, 1900-1902.
Lettres de Madame Roland de 1767 à 1780 publiées par Claude Perroud, Imprimerie nationale, 1913-1915.
Lettres de Roland à Bosc publiées par Claude Perroud, Paris, Noël Charavay, s.d., après 1902.
Dix-huit Lettres de Madame Roland publiées par Claude Perroud, Paris, Noël Charavay, s.d., après 1905.
Nouvelles lettres de Madame Roland publiées par Claude Perroud, Paris, Noël Charavay, s.d., après 1909.
Mémoires de Madame Roland, Paris, Mercure de France, 1986, réédition : 2004.
Mémoires, tome 1 lire en ligne ; tome 2 lire en ligne sur Gallica
Iconographie
Sculpture
Statue en marbre de Madame Roland par Émile Joseph Nestor Carlier, pour la Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis (1887-1893).
Buste de Madame Roland en marbre par François Masson, Los Angeles County Museum of Art.
Buste de Madame Roland en plâtre par Vital Cornu, Musée de la Révolution Française à Vizille.
Peinture
Madame Roland, vers 1787, portrait anonyme, Musée des Beaux-Arts de Quimper
Madame Roland, École française du XVIIIe siècle, Musée Lambinet de Versailles
Dessin
Madame Roland de profil, gravure au burin, dessinateur: H. Rousseau, graveur: E. Thomas
   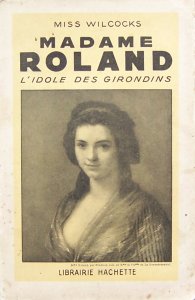 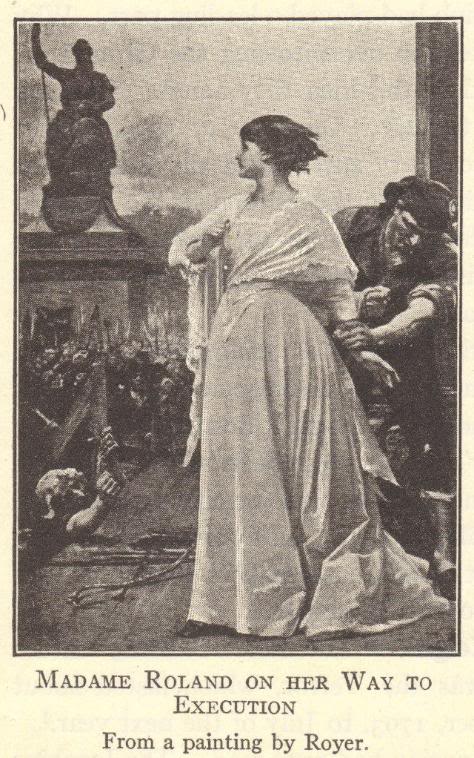         
Posté le : 07/11/2015 22:57
|
|
|
|
|
Lénine 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 Novembre 1917 Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine
est Président du Conseil des commissaires du Peuple de RSFSR jusqu'au 21 Juillet 1924 soit durant 6 ans 2 mois et 13 jours. Son prédécesseur est Aleksandr Kerenski chef du Gouvernement provisoire, son successeur Alexeï Rykov. Puis président du Conseil des Commissaires du peuple de l'URSS du 30 décembre 1922 au 21 janvier 1924 soit 1 an et 22 jours, son successeur est Alexeï Rykov
Son nom de naissance est Vladimir Ilitch Oulianov en russe Влади́мир Ильи́ч Улья́нов, né le 22 avril, ou au calendrier Julien, le 10 avril 1870 à Simbirsk, Empire russe, il meurt le 21 janvier 1924, à 53 ans à Vichnie Gorki RSFSR URSS, empire de Russie de 1870 à 1917, pays Russe de 1917 à 1922, puis Soviétique de 1922 à 1924. Parti politique Successivement : Parti ouvrier social-démocrate de Russie, Bolcheviks, Parti communiste de Russie bolchevik, il est marié à Nadejda Kroupskaïa née en 1869, mariés de 1898 à 1924, elle décéde en 1939. Diplômé de Université de Saint-Pétersbourg de l'Université de Kazan. De profession Avocat, Écrivain, il est athée, réside au Kremlin de Moscou et au Manoir de Gorki Leninskie
En bref
Fondateur et bâtisseur de l'État soviétique, qui affiche d'emblée sa forte spécificité par rapport aux États existants, Lénine est l'un des hommes politiques qui a le plus profondément marqué le XXe siècle. Véritable icône pour des centaines de millions de nouveaux croyants en une religion inédite, le communisme, Lénine apparaît aujourd'hui, avec le recul du temps et la faillite du système politique qu'il avait fondé, comme celui qui instaura une dictature, en rupture avec les idéaux et les pratiques du socialisme et de la social-démocratie tels qu'ils s'étaient développés et affirmés jusqu'à la Première Guerre mondiale. Lénine transforme l'idéologie en dogme, en vérité absolue et universelle, ce qui fonde la dimension totalitaire du communisme. Au nom de la vérité du message, les bolcheviks sont passés de la violence symbolique à la violence réelle, ont installé un pouvoir absolu et arbitraire. Un pouvoir qui a opprimé, mais aussi fasciné, une grande partie du monde au XXe siècle.
Né à Simbirsk en 1870, fils d'un inspecteur de l'enseignement primaire, Vladimir Ilitch Oulianov commence des études de droit à l'université de Kazan, d'où il est vite expulsé après des manifestations étudiantes ; son frère aîné, Alexandre, est exécuté en 1887 pour sa participation à un complot contre la vie du tsar Alexandre III. Vladimir Ilitch s'installe à Saint-Pétersbourg, y termine sa licence en droit en « auditeur libre » et devient avocat. Fasciné par le marxisme, il entre en contact avec les cercles marxistes clandestins de la capitale, avant de se rendre, en 1895, en Suisse, pour y rencontrer le grand propagandiste du marxisme en Russie, Georgui Plekhanov. Traducteur pionnier de Marx et d'Engels en russe, Plekhanov a fondé en exil le premier groupe marxiste russe, Libération du travail. C'est pour assurer une meilleure liaison entre ce groupe et les petits cercles marxistes de Saint-Pétersbourg que Vladimir Oulianov, âgé alors de vingt-cinq ans, rencontre le « Maître ». À son retour en Russie, il fonde un groupuscule clandestin, L'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière, première ébauche d'un parti social-démocrate. Peu de temps après (décembre 1895), Oulianov est arrêté pour « propagande révolutionnaire » et condamné à trois ans de relégation en Sibérie. Au cours de cet exil, il rédige notamment une longue étude sur Le Développement du capitalisme en Russie. Prenant le contre-pied des théories populistes, qui mettaient l'accent sur les potentialités révolutionnaires de la paysannerie, il y souligne la rapidité et la profondeur du développement du capitalisme en Russie et le rôle majeur que jouera désormais la classe ouvrière à la pointe du mouvement révolutionnaire. Numériquement, et compte tenu du poids écrasant de la paysannerie dans un pays avant tout rural, le prolétariat industriel constitue un groupe social très minoritaire : en 1900, on compte dans l'Empire russe moins de trois millions d'ouvriers (dont un quart de cheminots). Néanmoins, souligne Oulianov, le degré exceptionnel de concentration industrielle favorise l'émergence d'une véritable classe sociale soumise à l'exploitation capitaliste. Les premières grandes grèves victorieuses des travailleurs du textile (mai-juin 1896) le confortent dans ses analyses. Mais le recul du gouvernement (qui promulgue, en juin 1897, une loi importante limitant à onze heures et demie la durée légale journalière du travail et rend obligatoire le repos dominical) favorise aussi l'émergence d'une nouvelle tendance au sein des milieux sociaux-démocrates, « l'économisme », qui place au premier plan des luttes les revendications économiques des travailleurs – une idée fermement combattue par Oulianov.
C'est au milieu de ces débats qu'une poignée de militants de second rang réunit à Minsk, le 1er mars 1898, le congrès fondateur du Parti ouvrier social-démocrate russe. À peine le congrès achevé, huit des neuf présents sont arrêtés. Une fois sa peine d'exil purgée, Oulianov repart en Suisse pour venir renforcer, avec d'autres militants, dont Iouli Martov, le groupe de Plekhanov en lutte contre « l'économisme » au sein du mouvement social-démocrate. En décembre 1900, Plekhanov, Pavel Borissovitch Axelrod, Martov, Alexandre Nikolaïevitch Potressov et Oulianov (qui commence à signer ses écrits sous le pseudonyme de Lénine) lancent à Munich un nouveau journal social-démocrate, l'Iskra (L'Étincelle). La diffusion de ce journal favorise la constitution d'un réseau de militants et permet à Lénine, devenu entre-temps rédacteur en chef, d'accroître son audience et de faire plus largement connaître ses idées.
En 1902, Lénine publie un texte fondamental, Que faire ?, premier manifeste de ce qui deviendra, l'année suivante, le bolchevisme. Lénine y expose sa conception d'un parti révolutionnaire d'avant-garde, discipliné et centralisé, composé d'un noyau de révolutionnaires professionnels, chargés d'encadrer les masses ouvrières trop facilement tentées par la seule action quotidienne spontanée et incapables d'acquérir une conscience politique par elles-mêmes. Le parti est « la couche consciente et avancée de la classe ouvrière, il en est l'avant-garde ». L'énergie de la classe ouvrière ne peut être efficace que si le Parti l'organise. La force du prolétariat n'a d'existence effective que grâce au Parti où règne « l'unité de la volonté » qui met fin à la dispersion, au morcellement du prolétariat.
Cette conception – inédite – du parti révolutionnaire est à l'origine de la division entre mencheviks et bolcheviks lors du IIe congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, tenu à Bruxelles, puis (la police belge ayant interdit la réunion) à Londres en juillet 1903. Les cinquante et un votants à ce congrès se divisent sur un point fondamental, le sens même de l'appartenance au parti. À la conception léniniste d'un parti fortement structuré, discipliné, élitaire, avant-garde de révolutionnaires professionnels seule capable de mener, dans un pays économiquement, culturellement et politiquement attardé, la classe ouvrière au pouvoir, s'oppose la conception de Martov, favorable à un grand parti de rassemblement à l'européenne, largement ouvert à des sympathisants de tendances différentes, capable d'attirer à soi le plus grand nombre possible. L'option de Martov obtient une courte majorité. Mais une partie des majoritaires appartenant au Bund (le Parti social-démocrate des ouvriers juifs de Russie) ayant fait sécession, en fin de compte la majorité (bolshinstvo) revient aux partisans de Lénine. Dans l'immédiat, la division ne conduit pas à une scission. Plekhanov, Martov et Lénine restent ensemble à la direction de l'Iskra. Rapidement cependant, les désaccords débouchent sur une rupture. Plekhanov s'étant rapproché de Martov, la majorité des rédacteurs de l'Iskra rompt en 1904 avec Lénine, qui fonde l'année suivante son propre journal, Vpered (En avant). En 1905, deux congrès distincts, l'un bolchevique, à Londres, l'autre menchevique, tenu en Suisse, consacrent l'éclatement de la social-démocratie russe. Celui-ci révèle, fondamentalement, l'affrontement de deux stratégies : une stratégie menchevique du possible, qui entend appliquer strictement à la Russie la « prospective » que Marx avait définie en étudiant le capitalisme et le prolétariat occidental, et une stratégie bolchevique volontariste de la rupture.
C'est dans ce contexte de profonde division qu'éclatent à Saint-Pétersbourg, au début de 1905, de graves incidents qui vont se transformer, au fil de l'année, en un véritable mouvement révolutionnaire. L'émergence des soviets (assemblées ouvrières), forme originale et autonome d'organisation issue de la « base » ouvrière, prend de court les militants sociaux-démocrates. Les mencheviks réagissent plus rapidement, saluant cette forme d'« auto-organisation ouvrière » qui ne peut, selon eux, que hâter la prise de conscience politique du prolétariat. Les bolcheviks se montrent plus circonspects vis-à-vis de ces organisations qui risquent de remettre en question la prétention du Parti à diriger le mouvement révolutionnaire. Lénine attend plus de six mois avant d'exposer, à la fin de juillet 1905, dans Deux Tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique, sa conception d'une « dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie » ; il y assigne aux soviets un rôle nouveau : celui d'être les « instruments de l'insurrection armée », qui permettront le passage à l'étape révolutionnaire suivante. L'échec de la révolution populaire (et notamment de l'insurrection de Moscou de décembre 1905) et la résistance victorieuse de l'autocratie tsariste inspirent aux bolcheviks et aux mencheviks des analyses diamétralement opposées. Tandis que ces derniers en sortent convaincus qu'une révolution sociale n'est pas à l'ordre du jour en Russie, qu'il faut, à l'avenir, laisser l'initiative à la bourgeoisie et l'aider à renverser le tsarisme, Lénine affirme au contraire qu'il serait périlleux de confier les destinées de la prochaine révolution à la bourgeoisie libérale qui n'a ni la force ni la volonté de briser l'autocratie et d'accomplir de véritables transformations sociales.
Au cours des années 1907-1914, années de net « reflux » de la révolution, Lénine, devenu le chef incontesté d'un groupuscule conspiratif dont les effectifs stagnent autour de quelques milliers de membres, passe l'essentiel de son temps à combattre les divers courants d'une social-démocratie plus éclatée que jamais. À la lutte permanente contre les mencheviks s'ajoute celle contre ceux que Lénine appelle les « conciliateurs » (favorables à l'unité d'action avec les mencheviks). Sont aussi visés les « liquidateurs », favorables à la création d'un mouvement ouvrier légal et démocratique, à l'occidentale, aux antipodes de l'organisation clandestine de combat souhaitée par Lénine. Enfin, les bolcheviks ont fort à faire pour se protéger de tous les agents de l'Okhrana, la police politique du régime, infiltrés au sein du petit microcosme conspiratif bolchevique.
La Première Guerre mondiale accentue encore l'isolement du bolchevisme léniniste. Dénonçant la faillite de la IIe Internationale qui a « trahi le socialisme », Lénine espère une défaite rapide du régime tsariste. « Le moindre mal, écrit-il le 17 octobre 1914 à Alexandre Chliapnikov, serait la défaite du tsarisme dans la guerre [...]. L'essence entière de notre travail, persistant, systématique, est de viser à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. » Rejetant toute collaboration avec les autres courants sociaux-démocrates, Lénine, de plus en plus isolé, justifie théoriquement sa position dans L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme, achevé en 1916. Il y explique que la révolution éclatera non dans un pays où le capitalisme est le plus fort, mais dans un État économiquement peu développé comme la Russie, à condition que le mouvement révolutionnaire y soit dirigé par une avant-garde disciplinée, prête à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la dictature du prolétariat et la guerre civile, « qui dans toute société de classes représente la continuation, le développement et l'accentuation naturels de la guerre de classes ». Révélatrice des « contradictions inter-impérialistes », la guerre mondiale renverse ainsi, selon Lénine, les termes du dogme marxiste et rend l'explosion plus probable en Russie que nulle part ailleurs.
Après la victoire de la révolution de février 1917 et le renversement du tsarisme, auxquels aucun dirigeant bolchevique d'envergure n'a pris part, tous étant soit en exil, soit à l'étranger, Lénine, contre l'avis de l'immense majorité des dirigeants bolcheviques, prend d'emblée des positions extrêmes. Il prédit la faillite rapide de la politique de conciliation avec le gouvernement provisoire « bourgeois » que s'efforce de mettre en œuvre le soviet de Petrograd, dominé par une majorité de mencheviks et de socialistes-révolutionnaires. Héritiers du populisme, ces derniers ont une grande audience dans la paysannerie ; ils prônent une résolution de la question agraire, mais sont aussi favorables à la poursuite de la guerre jusqu'à la victoire. Dans ses quatre Lettres de loin, écrites à Zurich entre le 20 et le 25 mars 1917, et dont l'organe officiel du parti bolchevique, la Pravda, n'ose publier que la première, tant ces écrits rompaient avec les positions politiques alors défendues par les dirigeants bolcheviques de Petrograd, Lénine exige la rupture immédiate entre le soviet de Petrograd et le gouvernement provisoire, ainsi que la préparation active de la phase suivante, « prolétarienne », de la révolution. Pour Lénine, l'apparition des soviets est le signe que la révolution en cours a déjà dépassé sa « phase bourgeoise ». Sans plus attendre, ces organes révolutionnaires, enjeu de pouvoir entre les bolcheviks et les autres partis, doivent s'emparer du pouvoir par la force, mettre fin à la guerre impérialiste, même au prix d'une guerre civile, inévitable dans tout processus révolutionnaire.
Décidé à rentrer à tout prix en Russie, Lénine accepte l'accord conclu par le social-démocrate suisse Fritz Platten avec les autorités allemandes, favorables au retour du tribun pacifiste à Petrograd : avec un groupe de militants, Lénine quitte Zurich le 28 mars pour traverser l'Allemagne, dans un wagon bénéficiant du statut de l'exterritorialité, et gagner la Suède, puis Petrograd. Le lendemain de son arrivée, il expose (4 avril 1917) ses fameuses Thèses d'avril. Il y proclame son hostilité inconditionnelle au « défensisme révolutionnaire », au gouvernement provisoire, à la république parlementaire. Il prône la prise du pouvoir par le prolétariat et les paysans pauvres, les fraternisations pour mettre fin à la guerre, la nationalisation de toutes les terres, la suppression de la police et des fonctionnaires. Ces thèses sont accueillies avec stupéfaction par la plupart des dirigeants bolcheviques de la capitale. Mais la position de Lénine sort renforcée de la crise politique qui secoue peu après le gouvernement et le Soviet de Petrograd sur la question de la poursuite de la guerre (« crise d'avril »). Peu à peu, les idées de Lénine progressent notamment parmi les nouvelles recrues du parti bolchevique. Effectivement, en quelques mois, les éléments plébéiens, les soldats-paysans, submergent, au sein d'un parti en pleine expansion, les éléments urbanisés, les ouvriers qualifiés et les intellectuels, vieux routiers des luttes sociales institutionnalisées. Porteurs d'une violence exacerbée par trois années de guerre, moins prisonniers d'un dogme marxiste qui ne leur est guère familier, ces militants d'origine populaire ne se posent guère la question : une « étape bourgeoise » est-elle nécessaire ou non pour « passer au socialisme » ? Partisans de l'action directe, du coup de force, ils sont les plus fervents activistes d'un bolchevisme où les débats théoriques laissent place à la seule question désormais à l'ordre du jour, celle de la prise du pouvoir.
Entre une base de plus en plus impatiente et prompte à l'aventure et des dirigeants hantés par l'échec d'une insurrection prématurée vouée à l'écrasement, la voie léniniste apparaît cependant bien étroite. Au début de juillet 1917, les débordements de militants (marins de Kronstadt, « gardes rouges » des quartiers ouvriers de Vyborg, certaines unités de la garnison) manquent d'emporter le parti bolchevique, déclaré hors la loi à la suite des manifestations sanglantes des 3-5 juillet à Petrograd. Lénine est contraint de fuir en Finlande. Cependant, l'impuissance du gouvernement provisoire à régler les grands problèmes (échec de la dernière grande offensive de l'armée russe, montée du chômage, difficultés croissantes de la vie quotidienne), la montée des mouvements sociaux, la déliquescence de l'armée, l'échec de la tentative de putsch du général Kornilov, qui avait pour but de rétablir l'ordre dans le pays, permettent au parti bolchevique de refaire surface, à la fin d'août 1917, dans une situation désormais propice à une prise du pouvoir par une insurrection armée.
Une nouvelle fois, le rôle personnel de Lénine, en tant que théoricien et stratège de la prise du pouvoir, est décisif. Il met en place toutes les étapes d'un coup d'État militaire, qui ne sera ni débordé par un soulèvement imprévu des « masses », ni freiné par le « légalisme révolutionnaire » de dirigeants bolcheviques, tels Kamenev ou Zinoviev ; ceux-ci, échaudés par l'amère expérience des « journées de juillet », souhaitent n'aller au pouvoir qu'en faisant alliance avec les socialistes-révolutionnaires et les sociaux-démocrates de tendances diverses, majoritaires dans les soviets. Face à l'hésitation des dirigeants du Parti, Lénine, de son exil finlandais, appelle (Les bolcheviks doivent prendre le pouvoir) à une insurrection armée, immédiate, avant même la réunion du IIe congrès des soviets, prévue pour le 25 octobre 1917. « En proposant une paix immédiate et en donnant la terre aux paysans, les bolcheviks établiront un pouvoir que personne ne renversera, écrit-il. Il serait vain d'attendre une majorité formelle en faveur des bolcheviks. Aucune révolution n'attend ça. L'Histoire ne nous pardonnera pas si nous ne prenons pas le pouvoir maintenant. » Pour Lénine qui, sous le mot d'ordre « tout le pouvoir aux soviets », réclame en fait tout le pouvoir au seul parti bolchevique, il est capital que les bolcheviks s'emparent eux-mêmes du pouvoir par un coup de force avant la convocation du congrès des soviets, où ils n'ont pas la majorité. Il sait que les autres partis socialistes condamneront l'insurrection bolchevique et qu'il ne leur restera plus alors qu'à entrer dans l'opposition, abandonnant de fait tout le pouvoir aux bolcheviks. Le 10 octobre, rentré clandestinement à Petrograd, Lénine réunit douze des vingt et un membres du Comité central du parti bolchevique et fait voter, malgré l'opposition de Zinoviev et de Kamenev, la plus importante décision qu'ait jamais prise le parti : le principe d'une insurrection armée dans les plus brefs délais. Six jours plus tard, Trotski, l'un des plus proches collaborateurs de Lénine, met sur pied une organisation militaire émanant formellement du soviet de Petrograd, mais noyautée en réalité par les bolcheviks, le Comité militaire révolutionnaire de Petrograd, chargé de diriger l'insurrection.
Comme le souhaitait Lénine, le nombre des participants directs à la « grande révolution socialiste d'Octobre » est très limité : quelques milliers de soldats de la garnison, des marins de Kronstadt, des gardes rouges. De rares accrochages, un nombre de victimes insignifiant attestent la facilité d'un coup d'État attendu, soigneusement préparé et perpétré sans opposition dans le vide ambiant du pouvoir. La stratégie de Lénine s'avère juste : mis devant le fait accompli, les socialistes modérés, après avoir dénoncé « la conjuration militaire organisée dans le dos des soviets », quittent le IIe congrès des soviets. Restés en nombre, avec quelques socialistes-révolutionnaires de gauche, les bolcheviks font ratifier leur coup de force par les députés du congrès encore présents, qui votent un texte rédigé par Lénine attribuant « tout le pouvoir aux soviets ». Cette résolution, purement formelle, permet aux bolcheviks d'accréditer une fiction qui allait abuser des générations : ils gouvernent au nom du peuple dans le « pays des soviets ». Puis le congrès entérine (26 octobre 1917), avant de se séparer, la création du nouveau gouvernement bolchevique, le Conseil des commissaires du peuple, présidé par Lénine, et approuve les décrets sur la paix et sur la terre, premiers actes du nouveau régime.
Passé inaperçu dans la plupart des chancelleries, le « décret sur la paix » se situe délibérément hors des normes de la diplomatie traditionnelle. Il témoigne de la volonté du nouveau pouvoir de bouleverser le système international des États : parlant au nom de « l'immense majorité des classes ouvrières et travailleuses épuisées », Lénine appelle à une « paix sans annexions ni contributions », comme à la renonciation générale à « toute domination non consentie sur des nations, qu'elles soient situées en Europe ou outre-mer ». D'emblée, les bolcheviks affichent leur singularité et leur utopisme. Quant au « décret sur la terre », qui proclame « la propriété privée de la terre est abolie sans indemnité, toutes les terres sont mises à la disposition des comités locaux », il ne fait que légitimer l'appropriation des terres appartenant aux grands propriétaires fonciers réalisée par les jacqueries de l'automne 1917. En acceptant cette révolution agraire spontanée qui débouche sur la constitution d'une petite propriété paysanne, Lénine « vole » aux socialistes-révolutionnaires leur programme agraire (les bolcheviks ont toujours été partisans d'une « nationalisation » des terres et de l'instauration de formes collectives d'exploitation), mais s'assure habilement, pour quelques mois décisifs, le soutien – capital – de la paysannerie.
Le gouvernement constitué le 25 octobre 1917 par Lénine ne comporte que des bolcheviks. Il gouverne au nom de la « dictature du prolétariat », que Lénine définit sans ambages comme « un pouvoir conquis par la violence que le prolétariat exerce, par l'intermédiaire du parti, sur la bourgeoisie et qui n'est lié par aucune loi ». Très rapidement, les bolcheviks mettent en place une culture politique de guerre civile, marquée par un refus de tout compromis, de toute négociation. Cette culture n'est pas imposée, au début, par des circonstances militaires mettant en jeu la survie du régime. Elle a été théorisée, depuis des années, par Lénine, pour lequel la violence est le moteur de l'histoire, le révélateur des rapports de force, la « vérité de la politique » ou, selon la juste formule de Dominique Colas, l'« ordalie matérialiste ». Cette violence, « purificatrice », mettra à bas le « vieux monde ». Aussi, affirme Lénine, faut-il encourager la violence des masses à faire son œuvre de destruction, « l'organiser et la contrôler, la subordonner aux intérêts et aux nécessités du mouvement ouvrier et de la lutte révolutionnaire générale ».
Tout en instrumentalisant les tensions latentes dans la société russe en révolution, les bolcheviks organisent une violence politique spécifique par un certain nombre de mesures inédites. Celles-ci marquent une rupture radicale avec la culture politique tsariste comme avec les pratiques politiques des gouvernements provisoires qui s'étaient succédé de février à octobre 1917. Parmi ces mesures, les plus significatives sont l'officialisation, dès la fin de novembre 1917, de la notion d'« ennemi du peuple » ; la création, dès le 10 décembre 1917, d'une police politique, la Tcheka, organe plurifonctionnel (politique, policier, extrajudiciaire, économique) aux pouvoirs bien plus étendus que ceux de l'Okhrana tsariste ; la généralisation de la pratique des otages « appartenant aux classes riches » ; la mise en place d'un système de camps de concentration où sont internés, sur simple mesure administrative, en qualité d'otages, des dizaines de milliers d'individus en fonction de leur seule appartenance à une « classe hostile » ; la pratique, décidée au plus haut niveau du Parti, de déporter des groupes sociaux ou ethniques entiers, jugés dans leur ensemble « ennemis du régime soviétique » (la plus remarquable de ces pratiques étant l'opération de « décosaquisation », c'est-à-dire l'extermination des « Cosaques riches », décidée par Lénine et ses plus proches collaborateurs le 24 janvier 1919).
Une des tâches essentielles sur la voie du socialisme, du progrès, explique Lénine, est « d'éliminer les éléments nuisibles » du corps social, d'en chasser les « parasites », de « couper les membres irrémédiablement pourris et gangrénés » de la société. Ce discours hygiéniste se développe avec force dans un texte fondamental de décembre 1917, Comment organiser l'émulation ? Les masses « organisées et conscientes » sont appelées, sous la direction du Parti, à contrôler, recenser, épurer la terre russe de tous les insectes nuisibles, des puces (les filous) et des punaises (les riches). Ce texte, écrit à un moment où aucune force d'opposition, étrangère ou intérieure, ne menace le nouveau régime, révèle une remarquable animalisation de l'ennemi, ravalé au rang de parasite : les « koulaks », ces paysans un peu plus aisés, et surtout plus entreprenants, que la moyenne, ne sont jamais qualifiés autrement que comme des « vampires », des « sangsues », des « poux » ; il en est de même des popes, des « bourgeois » et des « riches ». Pour Lénine, l'impératif d'épuration ne se limite pas au corps social. Il doit s'appliquer aussi au Parti, à l'État, à la bureaucratie. Mais, à la différence du corps social, auquel doit être appliqué un traitement chirurgical, qui peut aller de l'élimination physique à l'enfermement dans un camp de concentration ou une colonie de travail, le traitement appliqué aux membres du Parti doit être un traitement lent. Lent et minutieux, car le parasite infiltré dans les organes du Parti-État est, le plus souvent, un mutant, un « faux communiste ». Que faire ? s'interroge Lénine : « Lutter encore et encore contre cette souillure et, si elle parvient malgré tout à s'infiltrer, nettoyer, balayer, surveiller, nettoyer encore et encore ». La pratique des « purges » du Parti (1919, 1921, 1922) s'institutionnalise.
La dictature du parti bolchevique va de pair avec une expérimentation économique utopique qui a pour objectif « le passage immédiat » au communisme, à un système économique étatisé, sans marché libre et sans monnaie, qui sera qualifié a posteriori (en avril 1921) de « communisme de guerre ». Un autre modèle inspire Lénine : le Kriegssozialismus allemand et son application du système tayloriste à l'échelle de l'État. Il débouche sur une suite de mesures qui concentrent toutes les ressources matérielles, alimentaires et humaines du pays dans les mains du pouvoir central. Après avoir nationalisé les banques (27 décembre 1917), la flotte marchande (23 janvier 1918), le commerce extérieur (22 avril 1918), le gouvernement bolchevique procède (28 juin 1918) à la nationalisation générale de toutes les entreprises. Quelques mois plus tard, tous les magasins sont « municipalisés ». Les produits de grande consommation sont rationnés, une stricte hiérarchie des « ayants droit » établie, qui favorise les travailleurs manuels aux dépens des intellectuels, les ouvriers aux dépens des employés et des « gens du passé ». Dans un grand élan d'utopie, Lénine envisage même d'abolir l'argent ou, du moins, d'en limiter très fortement la circulation. Le paiement des services est progressivement aboli : eau, électricité, poste, transports, logement – tout est en principe fourni gratuitement par l'État. Ces expérimentations, qui concernent en réalité une infime minorité de la population vivant dans les villes, se heurtent à un obstacle fondamental : la résistance du monde rural, dont dépend la survie de la population urbaine. Au lieu de rétablir un semblant de marché dans une économie en ruine, Lénine opte pour la contrainte face à ce qu'il appelle la « barbarie paysanne », « l'asiatisme » des masses rurales honnies, car « attardées » et potentiellement « contre-révolutionnaires » (la paysannerie française, argumente-t-il, n'a-t-elle pas « étranglé la Commune de Paris » ?, une expérience historique dont les enseignements restent, pour lui, fondamentaux). Le gouvernement décrète (mai-juin 1918) la réquisition des céréales par des « détachements de l'armée du ravitaillement » formée d'ouvriers affamés et de militants bolcheviques et épaulés par des « comités de paysans pauvres » chargés de « prendre le blé » chez les « koulaks ». Cette politique, fondée sur une profonde méconnaissance d'un monde paysan sur lequel Lénine plaque un schéma simpliste fondé sur de supposées oppositions entre paysans pauvres, moyens et riches, débouche sur un fiasco. Les réquisitions provoquent des milliers d'émeutes, de révoltes, voire de véritables insurrections paysannes. L'interdiction du commerce privé et l'aggravation des pénuries dans les villes ont pour conséquence une véritable « archaïsation » de l'économie : le troc se généralise, les usines ferment, les ouvriers s'en retournent à la campagne, Moscou et Petrograd perdent la moitié de leurs habitants.
Sous l'influence des idées de Lénine en la matière, les bolcheviks développent avec une rare maîtrise l'art de la propagande : cours d'alphabétisation politique, trains d'agit-prop sillonnant le pays, édition massive d'affiches révolutionnaires, de tracts, de brochures, de journaux. Ils offrent à ceux qui les rejoignent des possibilités réelles d'intégration et de promotion dans le nouvel appareil d'État : en trois ans (fin 1917-fin 1920), les effectifs du parti bolchevique quadruplent, pour atteindre 750 000 membres. Le lieu privilégié de l'adhésion n'est plus l'usine, mais l'armée. À nouveaux militants, nouveau « style de commandement », fortement influencé par l'environnement militaire : la guerre civile contribue à la militarisation durable de la culture bolchevique. Mais la plus grande force du nouveau régime est sans doute sa capacité à lier question sociale et question nationale. Lénine parvient, malgré l'extrême impopularité de sa politique économique – notamment des réquisitions – à se présenter à la fois comme le garant des acquis du « décret sur la terre » et comme le défenseur de la mère patrie menacée par les interventionnistes étrangers (Britanniques, Français) alliés des armées blanches qui n'ont d'autre programme que la restauration de l'ancien régime.
La dernière armée blanche vaincue (à la fin de 1920), le régime bolchevique doit encore affronter une ultime flambée d'insurrections paysannes (Ukraine, province de Tambov, Sibérie). Sur le « front des campagnes », Lénine est confronté, en 1921-1922, à un autre fléau, la famine, qui ravage notamment les provinces de la Volga. Une grande sécheresse aggrave les dégâts causés, depuis des années, par les réquisitions. Plus de cinq millions de personnes périssent des suites de cette terrible famine. Dans les villes, la situation, au début de 1921, est également critique. La production industrielle a chuté de 80 p. 100 par rapport aux années d'avant guerre. La population urbaine a fondu de moitié. La classe ouvrière, au nom de laquelle les bolcheviks gouvernent, compte moins d'un million d'actifs, soit 1 p. 100 de la population adulte. La fraction la plus européanisée de la société russe – deux millions de citadins appartenant en majorité aux élites économiques et intellectuelles – a émigré. La société russe émerge de la guerre civile plus archaïque et plus paysanne : des « conditions objectives » qui rendent plus illusoire que jamais le passage au communisme, qui était le but de Lénine. En mars 1921, au Xe congrès du Parti, Lénine fait voter le passage à une « nouvelle politique économique » (N.E.P.) : l'impôt se substitue aux réquisitions ; quelques semaines plus tard, une série de mesures (octroi de concessions aux entrepreneurs privés, dénationalisation des petites et moyennes entreprises, liberté du commerce) démantèle le système du « communisme de guerre ». Pour Lénine, la N.E.P. n'est pas une mesure conjoncturelle, temporaire. « La transformation de la psychologie paysanne, explique-t-il devant les délégués du Xe congrès, nécessitera des générations. » Après trois années d'expérimentations génératrices de misère, de violences et de guerre civile, Lénine aboutit à un constat très proche de celui que faisaient, en 1917, presque tous les socialistes qui le combattaient, à savoir que le passage au socialisme demanderait du temps.
Au moment où Lénine reconnaît la nécessité de changer de politique, une autre de ses constructions utopiques est en train de s'effondrer : celle de la révolution mondiale. Un an plus tôt, à l'été de 1920, l'offensive lancée par l'Armée rouge contre Varsovie avait pour objectif non seulement de soviétiser la Pologne, mais de déstabiliser toute l'Europe, en poussant la révolution « le plus loin possible ». Un télégramme adressé le 23 juillet 1920 par Lénine à Staline, alors commissaire du peuple aux nationalités, éclaire cet utopique « plan de soviétisation » de l'Europe en ces jours d'euphorie : « La situation dans l'Internationale communiste est splendide. Zinoviev, Boukharine et moi considérons que la révolution en Italie doit être activement et immédiatement aiguillonnée. Dans ce but, il faut soviétiser la Hongrie et, sans doute, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. » Malgré les échecs répétés des « forces révolutionnaires », Lénine resta, jusqu'à la fin de sa vie, convaincu de l'inéluctabilité de la chute, à court terme, du système capitaliste. En 1922, dans les instructions qu'il envoie à son ministre des Affaires étrangères pour « saborder la conférence de Gênes », il termine par cette phrase : « Chez eux, tout s'écroule. Faillite et banqueroute totale (Inde, etc). Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de pousser légèrement et comme par hasard cet homme chancelant – mais pas avec nos mains ! »
Le 25 mai 1922, Lénine est victime d'une première attaque cérébrale. Avant d'être frappé par une nouvelle attaque, le 16 décembre, puis écarté définitivement de toute activité politique à la suite d'une troisième crise le 10 mars 1923, Lénine rédige un certain nombre de textes importants, dans lesquels il exprime, sur plusieurs points fondamentaux, son désaccord avec Staline (devenu en mars 1922 secrétaire du Comité central) et son inquiétude devant l'évolution générale du Parti. Un premier conflit oppose Lénine à Staline sur le projet fédéral soviétique. Face au projet de Staline, qui prévoit l'absorption des républiques fédérées (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Ukraine) par la république de Russie, Lénine propose une fédération qui unirait des républiques égales et non dominées par la Russie, s'opposant fermement au « chauvinisme grand-russien » de Staline (Lettre aux communistes géorgiens). Durant sa maladie, Lénine dicte plusieurs notes et articles sur la question de sa succession, sur la réorganisation de l'appareil du Parti, sur l'avenir de la N.E.P. Dans trois notes (23 et 31 décembre 1922, 4 janvier 1923) improprement appelées son testament, il porte un jugement sur six de ses compagnons les plus importants. Selon lui, le principal danger, pour la stabilité et la cohésion de la direction du Parti, réside dans la rivalité entre Trotski et Staline. Si le premier est critiqué pour son « excessive assurance et son engouement pour le côté purement administratif des choses », Staline est jugé « trop brutal », voire dangereux « parce qu'il a concentré un pouvoir illimité » dont il n'est pas sûr « qu'il puisse toujours se servir avec assez de circonspection ». Dans sa note du 4 janvier 1923, Lénine écrit : « Je propose aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline de son poste ».
Dans ses derniers écrits (Mieux vaut moins, mais mieux), Lénine aborde la question de la bureaucratisation du Parti et du poids croissant d'institutions restreintes, telles que le Secrétariat, le Politburo et l'Orgburo (Bureau d'organisation). Lénine propose de redonner plus de poids au Comité central et surtout de réduire l'immense appareil, dirigé par Staline depuis 1919, de l'Inspection ouvrière et paysanne. Ces propositions s'avèrent trop tardives pour briser l'immense pouvoir acquis par ces institutions bureaucratiques, et par Staline en particulier.
Dernier grand thème abordé par Lénine : le futur même de la révolution bolchevique, réalisée, contre toute logique marxiste, dans un pays économiquement attardé, à mi-chemin entre l'Occident capitaliste et l'Asie, un pays « manquant de culture pour passer directement au socialisme ». Il reconnaît que les bolcheviks ont saisi le pouvoir selon le principe napoléonien (« On s'engage... et puis on voit »), en l'absence de structures économiques et sociales adéquates, établi la « dictature du prolétariat » alors qu'il n'existait pratiquement plus de prolétariat, rétabli partiellement le capitalisme après une révolution dite « socialiste ». Deux dangers majeurs risquent d'être fatals au régime : la rupture de l'unité du Parti et la rupture de « l'alliance ouvrière et paysanne », toujours très fragile. C'est sur une note désabusée, voire pessimiste, que s'achève la réflexion politique de Lénine, près d'un an avant sa mort, le 21 janvier 1924.
À la question : « Qui de Staline ou de Lénine était le plus dur ? », Viatcheslav Molotov, le seul dirigeant bolchevique d'envergure qui avait servi les deux hommes, répondit, sans hésiter : « Lénine, bien sûr ! », avant d'ajouter : « C'est lui qui nous a tous formés. »
Si l'aura de Staline a été ternie par la déstalinisation, l'image de Lénine – révolutionnaire, stratège de la prise du pouvoir par les bolcheviks, fondateur de l'Union soviétique – n'a guère été écornée, ni dans l'U.R.S.S. de la perestroïka (l'objectif initial de Mikhaïl Gorbatchev n'était-il pas un utopique « retour aux normes léninistes » ?), ni dans la Russie d'aujourd'hui, ni dans le monde. Aucune statue de Lénine n'a été enlevée en Russie, la momie de Vladimir Ilitch continue de reposer dans son mausolée sur la place Rouge, et les lycéens français apprennent toujours à distinguer le (bon) Lénine, qui a sauvé la Russie soviétique de la contre-révolution blanche, appuyée par les forces d'intervention étrangères », du (mauvais) Staline, qui « a gouverné son pays par la terreur. Quand viendra le temps de la déléninisation ? Et de la condamnation unanime de l'idéologue antidémocratique et du praticien de l'intolérance, de la violence et de la terreur ? Nicolas WERTH
Sa vie
Vladimir Ilitch Oulianov en russe : Влади́мир Ильи́ч Улья́нов Prononciation, dit Lénine Ленин, né à Simbirsk aujourd'hui Oulianovsk le 22 avril, 10 avril 1870 et mort à Vichnie Gorki aujourd'hui Gorki Leninskie le 21 janvier 1924, est un révolutionnaire, théoricien politique et homme d'État russe. Rejoignant à la fin du XIXe siècle le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, la section russe de la Deuxième Internationale, il provoque en 1903 une scission du Parti russe et devient l'un des principaux dirigeants du courant bolchevik. Auteur d'une importante œuvre écrite d'inspiration marxiste, il se distingue par ses conceptions politiques qui font du parti l'élément moteur de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat.
En 1917, après l'effondrement du tsarisme, les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie lors de la Révolution d'Octobre. La prise du pouvoir par Lénine donne naissance à la Russie soviétique, premier régime communiste de l'histoire, autour de laquelle se constitue ensuite l'URSS. Lénine et les bolcheviks parviennent à assurer la survie de leur régime, malgré leur isolement international et un contexte de guerre civile. Ambitionnant d'étendre la révolution au reste du monde, Lénine fonde en 1919 l'Internationale communiste : il provoque à l'échelle mondiale une scission de la famille politique socialiste et la naissance en tant que courant distinct du mouvement communiste, ce qui contribue à faire de lui l'un des personnages les plus importants de l'histoire contemporaine.
Une fois au pouvoir, il use — de façon revendiquée — de la Terreur afin de parvenir à ses fins politiques. Lénine est à l'origine de la Tchéka, police politique soviétique chargée de traquer et d'éliminer tous les ennemis du nouveau régime qu'il met en place. De même, Lénine instaure en 1919 un système de camps de travail forcé, qui précède le Goulag de l'époque stalinienne ; il fait également du nouveau régime une dictature à parti unique. La continuité politique entre Lénine et Staline fait l'objet de débats ; divers auteurs ont cependant souligné que la philosophie politique et la pratique du pouvoir de Lénine contenaient des éléments clés de la dictature au sens moderne du terme, voire du totalitarisme.
Dès mars 1923, Lénine est définitivement écarté du jeu politique par la maladie ; il meurt en début d'année suivante. Staline sort ensuite vainqueur de la rivalité qui oppose les dirigeants soviétiques en vue de la succession. Les idées de Lénine sont, après sa mort, synthétisées au sein d'un corpus doctrinal baptisé léninisme, qui donne ensuite naissance au marxisme-léninisme, idéologie officielle de l'URSS et de l'ensemble des régimes communistes durant le XXe siècle.
Selon Le Robert des noms propres, le nom Lénine vient du nom d'un fleuve sibérien la Léna, en russe : Лeна, l'origine du nom du fleuve est issu d'un dialecte toungouze yelyuyon rivière.
La famille Oulianov : Maria Alexandrovna, Ilia Nikolaïevitch et leurs enfants : Olga, Maria, Alexandre, Dimitri, Anna, Vladimir.
Vladimir Oulianov naît à Simbirsk, où sa famille s'était établie quelques mois plus tôt. Il grandit au sein d'un milieu intellectuellement et socialement favorisé.
Tant Ilia Oulianov 1831-1886 que son épouse Maria Oulianova, née Blank 1835-1916 ont des origines diverses, bien que certaines incertitudes demeurent quant à leur ascendance, notamment du côté d'Ilia. Le père d'Ilia, Nikolaï, descend d'une famille de paysans originaires d'Astrakhan : ses ancêtres semblent s'être appelés Oulyanine avant l'adoption du nom Oulianov. La famille a probablement des racines dans la région de Nijni Novgorod. Si les Oulianov étaient considérés comme ethniquement russes, Nijni Novgorod connaissait un important brassage de populations et il est probable que la famille ait eu des racines tchouvaches ou mordves. L'origine ethnique de la grand-mère paternelle de Lénine est incertaine. Maria, sœur de Lénine, était convaincue que la famille de leur père avait du sang tatar, leur grand-mère ayant pu être kalmouke ou kirghize. Le grand-père de Maria Oulianova, Moshe Blank, était un marchand juif originaire de Volhynie. Les origines juives de la famille maternelle de Lénine ont été longtemps cachées par les autorités de l'URSS ; des écrivains nationalistes russes ont au contraire attribué une importance primordiale à ces origines, bien que la famille Blank eût entièrement rejeté le judaïsme. Moshe Blank avait rompu avec la communauté juive à la suite d'une série de conflits personnels et adopté des positions anti-juives virulentes. Ses deux fils s'étaient convertis au christianisme orthodoxe et avaient choisi de faire carrière dans la médecine, parvenant à des positions sociales enviables. La conversion à l'orthodoxie permet à Alexandre Blank, père de Maria, d'accéder aussi bien à la faculté de médecine qu'à la haute administration. Alexandre avait épousé une femme d'origine allemande et suédoise, de confession luthérienne. Médecin de la police, puis médecin des hôpitaux, il avait reçu en 1847, lors de sa nomination au poste d'inspecteur des hôpitaux pour la région de Zlatooust, le titre de conseiller d'État effectif, qui lui conférait la noblesse héréditaire.
Le grand-père d'Ilia Nikolaïevitch Oulianov, Vassili, était un serf, affranchi bien avant les réformes de 1861. Le père d'Ilia travaille comme tailleur à Astrakhan, et Ilia lui-même fait des études supérieures de mathématiques ; diplômé en 1854, il obtient son premier poste d'enseignant à Penza. C'est là qu'il rencontre Maria Alexandrovna Blank, qu'il épouse en août 1863. Très impliqué dans le développement de l'éducation dans l'Empire russe, Ilia devient inspecteur des écoles. Nommé à Simbirsk lors de son accession au poste d'inspecteur-chef, il y fait rapidement figure de notable local. Le couple a au total huit enfants : Anna, née en 1864, et Alexandre, né en 1866, précèdent Vladimir, qui naît lui-même en 1870. Après Vladimir naissent Olga 1871, Dmitri 1874 et Maria 1878. Deux autres enfants du couple Oulianov meurent en bas âge : une fille - également prénommée Olga 1868 - et un garçon nommé Nikolaï 1873.
Jeunesse et scolarité
Vladimir Oulianov lui-même est baptisé dans l’Église orthodoxe russe. Maria Oulianova s'occupe du foyer et des enfants, tandis que son époux poursuit une remarquable carrière dans l'enseignement : en juillet 1874, Ilia Oulianov est promu directeur de l'enseignement populaire pour le gouvernement de Simbirsk, ce qui lui vaut d'être anobli par le tsar Alexandre II et d'accéder au titre de conseiller d'État.
Les enfants Oulianov grandissent dans des conditions à la fois privilégiées et harmonieuses. Durant leur scolarité, ils bénéficient du prestige paternel. Les époux Oulianov, sujets loyaux du Tsar, sont également acquis aux idées libérales et progressistes en matière d'éducation. Maria Oulianova élève ses enfants dans la tradition de tolérance et d'ouverture luthérienne. Ilia Oulianov s'emploie à contribuer au mouvement de réformes de l'empire : dans la province de Simbirsk, il ouvre des écoles pour les populations non russes où les enfants des minorités reçoivent un enseignement dans leur langue natale. Le futur Lénine devient noble, par hérédité, à l'âge de 6 ans.
Vladimir - dit Volodia - Oulianov est un élève brillant. Il suit une scolarité classique et étudie le français, l'allemand, le russe, le latin et le grec ancien. Au lycée, il a comme proviseur Feodor Kerenski, père de son futur adversaire politique Aleksandr Kerenski.
Contexte politique de la Russie de l'époque
L'Empire russe, dans lequel grandissent les enfants Oulianov, se distingue de la majorité des autres monarchies européennes de l'époque en conservant un régime politique autocratique, où la dynastie Romanov continue de gouverner selon le principe du droit divin. La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par plusieurs décennies de souffrance sociale et de crise politique, qui dressent progressivement une partie du peuple russe contre la monarchie. La société russe, encore essentiellement agricole, demeure politiquement arriérée et largement dénuée de culture démocratique. Conscient de la nécessité de moderniser les structures sociales et politiques et confronté à de nombreuses révoltes paysannes, le tsar Alexandre II lance dans les années 1860 une série de réformes, dont l'abolition du servage ou la création des zemstvos assemblées provinciales ; le mouvement de réforme est cependant incomplet et la société russe demeure marquée par de profondes inégalités sociales, comme par l'absence de structures étatiques modernes qui pourraient en garantir le bon fonctionnement. Le régime tsariste cumule un gouvernement central fort, aux pratiques autocratiques, et des structures de gouvernement local faibles24. Le retard social et politique de la société russe favorise le développement de mouvements révolutionnaires ; les écrits d'auteurs comme Alexandre Herzen ou Nikolaï Tchernychevski expriment à l'époque les aspirations à une transformation radicale de la société russe. Le mouvement des Narodniks populistes, apparu dans les années 1860 et inspiré par Herzen, tente d'adapter les idées socialistes aux réalités russes. À partir des années 1870, les idées marxistes se diffusent largement dans les milieux révolutionnaires russes : en 1872, la censure tsariste commet l'erreur d'autoriser la parution du Capital de Karl Marx, jugeant l'ouvrage trop aride et complexe pour intéresser un lectorat quelconque : l'ouvrage connaît au contraire un large succès chez les contestataires russes, qui font un accueil enthousiaste aux outils théoriques apportés par les écrits de Marx. Les Narodniks , quant à eux, passent progressivement à la confrontation violente contre le régime tsariste et, en 1881, l'aile terroriste du mouvement, Narodnaïa Volia Volonté du peuple, assassine Alexandre II. Le nouveau tsar, Alexandre III, décidé à éradiquer l'esprit révolutionnaire, entame durant son règne une série de contre-réformes qui renforcent les pouvoirs du gouvernement central et réduisent ceux des gouvernements locaux que son père avait élargis. En 1894, Nicolas II succède à Alexandre III ; tout aussi conservateur que son père, il néglige de former des structures bureaucratiques pouvant assurer l'efficacité du régime et se montre incapable d'accorder l'action de ses ministres de manière cohérente.
Mort de son père, exécution de son frère
En 1886 et 1887, la famille Oulianov est endeuillée par deux événements dramatiques. En janvier 1886, Ilia, père de Vladimir, meurt d'une hémorragie cérébrale, à l'âge de 53 ans. Sa veuve obtient une pension mais, si la famille continue de bénéficier du domaine hérité de la famille Blank et des revenus qui y sont liés, elle cesse de bénéficier du prestige paternel. En l'absence de son frère aîné Alexandre qui suit des études à Saint-Pétersbourg, Vladimir, alors âgé de seize ans, doit assumer des responsabilités d'homme de la famille. L'adolescent est éprouvé par la mort de son père : son caractère s'assombrit et ses relations avec sa mère s'en ressentent. L'évènement qui survient en 1887 s'avère encore plus tragique : Alexandre, durant ses études, se lie avec un groupe de jeunes révolutionnaires, qui animent une section de la Narodnaïa Volia. Fin 1886, Alexandre s'engage de manière plus active avec ses compagnons, qui envisagent d'assassiner le tsar Alexandre III. Alexandre Oulianov contribue à la rédaction de proclamations appelant au coup de force et censées accompagner l'attentat. Les conjurés prévoient de frapper le 1er mars 1887, mais la police découvre le complot et ses principaux organisateurs sont arrêtés. Quinze inculpés sont déférés au tribunal, et tous condamnés à mort. Dix d'entre eux sont graciés : Alexandre Oulianov, qui a revendiqué hautement sa responsabilité lors du procès, n'en fait pas partie. Sa mère plaide en vain la clémence ; Alexandre est pendu le 11 mai. La famille Oulianov, jusqu'ici respectée, souffre désormais d'un véritable ostracisme social.
Vladimir est ébranlé par la mort de son frère, mais n'en parle guère par la suite dans ses écrits ; il aurait déclaré en 1895 à un camarade qu'Alexandre lui avait tracé le chemin. Il est cependant difficile d'estimer l'effet immédiat produit par la mort d'Alexandre Oulianov sur les idées de son frère : si Vladimir Oulianov semble avoir éprouvé de l'admiration pour son aîné, ses propres opinions politiques ne paraissent pas avoir été alors très précises. Dans les mois qui suivent, il reprend paisiblement sa scolarité et passe avec succès les examens qui lui permettent d'intégrer, en octobre, l'université de Kazan pour y suivre des études de droit. Il ne manifeste pas immédiatement d'intérêt marqué pour la politique, mais se trouve bientôt entraîné par l'atmosphère agitée du milieu universitaire. Les étudiants se livrent à de nombreuses manifestations, pour les motifs les plus divers. Sans montrer de zèle excessif, et apparemment surtout poussé par la curiosité, Vladimir Oulianov participe à quelques manifestations et réunions étudiantes interdites par les autorités. Sa présence semble y avoir été épisodique, mais son lien de parenté avec Alexandre Oulianov lui vaut d'être d'emblée considéré comme suspect par la police. Au début du mois de décembre 1887, il est arrêté avec une trentaine d'autres étudiants, considérés comme des « meneurs ». La plupart sont réintégrés peu après à l'université, mais pas Vladimir Oulianov : du fait de son nom de famille, et bien qu'ayant été peu actif dans les chahuts et manifestations des étudiants, il est exclu de l'université.
Contraint d'interrompre ses études et de revenir pour un temps à la campagne, Vladimir Oulianov emploie l'essentiel de son temps à lire. C'est à cette époque qu'il découvre des auteurs comme Karl Marx et Nikolaï Tchernychevski. Il lit plusieurs fois Que faire ?, roman de Tchernychevski qui met en scène un archétype de révolutionnaire ascétique : cet ouvrage constitue une source majeure d'inspiration pour le jeune homme, comme pour plusieurs générations de militants russes, et contribue à former sa vision du monde. Il écrit au ministère de l'instruction publique pour demander à réintégrer l'université, ou partir étudier à l'étranger, mais ses demandes sont repoussées. Sa mère achète une ferme dans le village d'Alakaevka oblast de Samara et tente de se consacrer, avec l'aide de son fils, à la gestion de ce domaine agricole. Lors de séjours à Kazan, Vladimir fréquente des cercles de réflexion marxistes. Il fréquente des membres de Narodnaïa Volia et s'emploie à étudier l'histoire de l'économie russe et à parfaire sa connaissance des textes marxistes. L'étude des œuvres de Marx et Engels le convainc que l'avenir de la Russie réside dans l'industrialisation et l'urbanisation. L'expérience de la ferme tourne court : Vladimir et sa mère sont peu compétents dans le domaine agricole et ils finissent par affermer le domaine. Le jeune homme n'a pas renoncé à acquérir des diplômes et se prépare assidûment pour passer, en candidat libre, l'examen qui lui permettra d'intégrer l'université de Saint-Pétersbourg pour y suivre des études de droit. Bien qu'éprouvé en mai 1891 par la mort de sa sœur Olga, emportée par la fièvre typhoïde - le jour de l'anniversaire de l'exécution d'Alexandre - il continue de préparer ses examens et, en novembre, est reçu premier avec la note maximale dans toutes les épreuves. Le 12 novembre 1891, il revient à Samara nanti d'un diplôme qui lui permet de travailler comme avocat stagiaire. Il demeure, dans le même temps, surveillé par la police qui le considère comme un subversif.
Lire la suite-> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10164#forumpost10164
Posté le : 07/11/2015 22:35
|
|
|
|
|
Lénine 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Débuts en politique
Vladimir Oulianov mène à Samara une carrière d'avocat aussi brève qu'anodine. En janvier 1892, il est embauché dans le cabinet d'Andreï Khardine, un avocat ami de la famille, aux idées progressistes. Dans le cadre de son travail d'avocat, il ne plaide aucune affaire conséquente, se contentant de traiter quelques litiges entre propriétaires terriens, ou des affaires financières qui l'intéressent à titre personnel. Il continue de bénéficier du patrimoine familial : libéré du besoin de gagner réellement sa vie, il ne consacre à son métier qu'une part réduite de son temps et, dans le courant de l'année 1892, ne traite que quatorze cas. Plus tard, répondant au questionnaire rempli par les membres du Parti communiste, il indiquera que sa profession de base est celle d'écrivain. Bien plus qu'à sa profession d'avocat, il s'intéresse à l'étude de la politique et de l'économie et à sa vocation révolutionnaire naissante. Alors que la région de la Volga, en 1891-1892, est ravagée par une terrible famine, il se distingue de sa famille, mais aussi du milieu révolutionnaire russe, en montrant peu d'intérêt pour le sort des paysans : il juge à l'époque que la famine qui frappe la paysannerie russe est une conséquence inévitable du développement industriel et qu'apporter de l'aide aux paysans s'avèrerait contre-productif en retardant le développement du capitalisme russe, et par conséquent l'évolution vers le socialisme. À l'été 1893, la famille Oulianov déménage à Moscou. Vladimir, lui, profite du fait que la surveillance policière à son égard se soit relâchée pour s'installer à Saint-Pétersbourg, où il souhaite se faire un nom dans les milieux politique et intellectuel.
À l'époque, Oulianov est influencé non seulement par le marxisme orthodoxe, mais également par les idées du populiste Piotr Tkatchev 1844-1886, qui prône la prise du pouvoir par une minorité révolutionnaire. Outre son éloge des méthodes terroristes - qui influence beaucoup Narodnaïa Volia - Tkatchev critique dans ses écrits le fait qu'Engels n'ait accordé guère de foi au potentiel révolutionnaire de la Russie, en raison de l'arriération de l'économie russe. Vladimir Oulianov est particulièrement séduit par l'idée d'une révolution provoquée par une élite de militants révolutionnaires et, dès les années 1890, se montre partisan de l'usage de la terreur.
C'est en février 1894, lors d'une réunion d'un cercle de discussion marxiste de la capitale, qu'il fait la connaissance de sa future épouse, Nadejda Kroupskaïa. En mai de la même année, il publie son premier texte de quelque importance, un pamphlet contre le chef de file des populistes, intitulé Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les sociaux-démocrates. Il y expose ses thèses sur l'inéluctabilité du développement du capitalisme en Russie et sur l'activité des sociaux-démocrates, qui doit être toute entière orientée vers la classe ouvrière à qui il convient d'inculquer les principes du socialisme scientifique. Au début de l'année 1895, il participe aux activités d'un groupe marxisant mené notamment par Pierre Struve. Ce dernier publie un recueil intitulé Documents sur la situation économique de la Russie : l'ouvrage inclut un long article écrit par Oulianov, et signé du pseudonyme Touline. À la mi-mars 1895, le ministère des affaires étrangères lève l'interdiction de voyager qui pesait sur Oulianov : il est possible que l'Okhrana, la police secrète tsariste, ait pesé sur cette décision afin de pouvoir se renseigner sur ses activités. Il en profite pour se rendre en Suisse, où il prend contact avec les milieux révolutionnaires russes en exil, faisant connaissance des théoriciens marxistes Pavel Axelrod et Gueorgui Plekhanov, cofondateurs de Libération du Travail, le premier groupe marxiste russe. Plekhanov et Oulianov sont en désaccord quant à l'opportunité de s'allier avec les libéraux contre l'autocratie - une idée rejetée par Oulianov - mais projettent de publier ensemble une revue marxiste en langue russe ; le jeune militant révolutionnaire professe alors pour Plekhanov une grande admiration, qu'il va jusqu'à exprimer en des termes presque amoureux. Oulianov voyage ensuite en France, où il rencontre Paul Lafargue, gendre de Marx, et Jules Guesde. À Berlin, il s'entretient avec Wilhelm Liebknecht. Il rentre en Russie avec des livres marxistes interdits cachés dans un double-fond de sa valise.
De retour à Saint-Pétersbourg, Vladimir Oulianov s'emploie, en liaison avec Libération du travail et aidé de plusieurs camarades, à fonder la revue marxiste qu'il avait évoquée avec Plekhanov, et qui doit s'appeler Rabotnik Travailleur. Lui et ses compagnons n'envisagent dans un premier temps que d'éditer des textes politiques ; mais Oulianov fait à l'époque la connaissance de Julius Martov, jeune intellectuel juif qui vient de fonder son propre groupe de discussion marxiste, et avec qui il se lie bientôt d'amitié. Martov insiste pour que les militants marxistes agissent sur le terrain de manière concrète plutôt que de se borner à un travail intellectuel. Oulianov est convaincu par Martov ; ils fondent un groupe politique baptisé Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière. Le groupe, strictement hiérarchisé et auquel n'appartient aucun ouvrier, compte dix-sept membres et cinq suppléants. Oulianov, âgé alors de 25 ans - mais à qui sa calvitie précoce et son allure sérieuse valent d'être surnommé le vieux et confèrent une certaine autorité auprès des autres jeunes militants - est responsable de toutes les publications du mouvement.
En novembre 1895, Oulianov s'écarte du domaine de la production intellectuelle pour aborder celui de l'action politique : il rédige un tract de soutien à des ouvriers en grève, rencontre des dirigeants grévistes et écrit une longue brochure sur la condition ouvrière, dont mille exemplaires sont imprimés clandestinement. L'Okhrana, qui observe ses activités depuis un certain temps, décide cette fois d'agir à son encontre : le 9 décembre, il est arrêté par la police et placé en détention provisoire. Martov est arrêté le mois suivant. Oulianov profite de sa détention pour avancer dans la rédaction d'un traité sur le développement économique de la Russie. Sa sœur Anna et leur mère quittent Moscou pour s'installer à Saint-Pétersbourg et peuvent lui rendre régulièrement visite, en lui apportant de quoi lire et écrire. Le 29 janvier 1897, il est condamné, comme la plupart des membres arrêtés de l'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière, à trois ans d'exil administratif à l'Est de la Sibérie. Deux autres membres de sa famille sont également condamnés pour activités révolutionnaires : son frère Dmitri est chassé de l'université et exilé à Toula, tandis que sa sœur Maria est envoyée à Nijni Novgorod. Leur mère obtient finalement que Dmitri et Maria soient réunis à Podolsk, dans une maison louée par la famille.
Déportation en Sibérie
Départ pour la Sibérie et mariage Nadejda Kroupskaïa, épouse de Lénine.
En compagnie d'autres camarades exilés, Oulianov voyage en train à travers la Sibérie, sans savoir quel sera son lieu définitif de relégation. Du fait des conditions climatiques, ils stationnent durant deux mois à Krasnoïarsk. En avril, Oulianov apprend que son lieu de déportation sera le village de Chouchenskoïé, dans le district de Minoussinsk. Grâce à une demande de sa mère qui avait plaidé la santé médiocre de son fils, il bénéficie d'une relégation dans un lieu au climat agréable. Oulianov correspond avec les autres exilés, prodiguant des encouragements à ceux qui, comme Martov, sont relégués dans des localités moins hospitalières. Nadejda Kroupskaïa quant à elle, est déportée à Oufa. Elle s'occupe néanmoins de garantir à Oulianov des sources de revenus : d'abord en négociant avec un éditeur la publication d'un recueil de textes de son ami, sous le titre Études économiques ; ensuite en lui trouvant un travail qui consiste à traduire en russe des textes de Sidney et Beatrice Webb. Oulianov et Kroupskaïa, qui ont déclaré être « fiancés », demandent à être réunis. Les autorités accèdent à leur demande et, en mai 1898, Nadedja rejoint Oulianov à Chouchenskoïé, accompagnée de sa mère. Le couple se marie le 10 juillet, au cours d'une cérémonie religieuse, le mariage civil n'existant pas à l'époque en Russie.
Activités politiques en déportation
Les conditions de déportation d'Oulianov et de son épouse sont plutôt confortables : hormis la nécessité de vivre à l'endroit où ils ont été assignés à résidence, le couple dispose d'une grande liberté de mouvement dans un rayon non négligeable, et peut rendre visite aux exilés du voisinage, et organiser des parties de chasse ou de pêche. Les exilés politiques ne peuvent quitter la Sibérie, mais sont libres d'y vivre à leur guise et de voir qui ils souhaitent. Vladimir Oulianov peut écrire durant son exil, et publie dans la presse des articles et des critiques de livres économiques, qui lui sont payés 150 roubles en moyenne. Il rédige le livre Le Développement du capitalisme en Russie et, par l'intermédiaire de sa sœur Anna, trouve à Saint-Pétersbourg un éditeur spécialisé dans les textes marxistes. Dans cet ouvrage qui analyse la situation économique de l'Empire russe - et qu'il signe, pour échapper à la vigilance des censeurs, du nom de Vladimir Iline qu'il avait déjà employé pour Études économiques - Oulianov reprend les analyses de Plekhanov ; il s'écarte cependant de ce dernier pour avancer la thèse que le capitalisme est, en Russie, parvenu à un stade relativement avancé de développement, la paysannerie étant divisée en prolétaires agricoles et en koulaks - ou paysans riches - qui tiennent le rôle de la bourgeoisie. Oulianov s'appuie sur son analyse pour démontrer que, du fait du stade de développement du capitalisme en Russie, l'évolution vers le socialisme se situe dans une perspective nettement moins lointaine que ne le croient en général les marxistes russes : il est donc possible d'envisager une situation révolutionnaire et le renversement de la dynastie Romanov.
Oulianov continue par ailleurs de se tenir informé de la vie politique en Europe ; dans le cadre de la querelle réformiste allemande, il se montre particulièrement hostile au révisionnisme d'Eduard Bernstein, qui préconise un abandon des aspirations révolutionnaires par le mouvement socialiste. Alors très influencé par les écrits du théoricien Karl Kautsky, Oulianov prend comme ce dernier le parti de l'orthodoxie marxiste. Alors qu'il se languit de retourner à la politique active, il profite de son assignation à résidence pour parfaire ses connaissances en matière de pensée économique et politique. Le Parti ouvrier social-démocrate de Russie POSDR est fondé en mars 1898, durant l'exil d'Oulianov : le parti est immédiatement victime de la répression, et quasiment démantelé dès sa naissance. Depuis sa résidence forcée en Sibérie, Oulianov s'emploie à rédiger un projet de programme du parti qui, réduit à des cercles isolés, est alors à reconstruire.
En janvier 1900, il est informé que sa déportation en Sibérie va prendre fin ; il demeure néanmoins provisoirement interdit de séjour à Saint-Pétersbourg, Moscou, ou tout autre ville disposant d'une université ou d'une importante activité industrielle. Krouspkaïa et lui sont provisoirement séparés : elle achève son temps d'exil à Oufa, où il n'a pas le droit de s'installer, tandis qu'il rejoint sa mère et sa sœur Anna à Podolsk. Durant la dernière année de son exil, Oulianov s'emploie à préparer un plan d'action : il vise à fonder un journal politique d'envergure nationale, ce qui constituera une première étape pour rassembler les groupes locaux épars en un seul mouvement révolutionnaire, à l'échelle de la Russie. Ce projet ne lui semble pourtant pouvoir être mené qu'à l'étranger : il demande alors l'autorisation de partir à l'étranger. Le 15 mai 1900, les autorités tsaristes, qui jugent que l'exil hors de Russie condamne les opposants à l'inefficacité, accèdent à sa demande. En juillet, il prend le chemin de la Suisse.
Première période d'exil à l'étranger
Bolcheviks et Iskra.Travaux doctrinaux
Arrivé à Zurich, Oulianov est accueilli par des membres de Libération du Travail et renoue notamment avec Pavel Axelrod. Il vise à organiser un second congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie pour reformer celui-ci et envisage, à cet effet, de créer un journal qui servira à coordonner l'action du parti et à y imposer la ligne marxiste définie par Plekhanov. À ses yeux, l'Allemagne est le pays le plus adapté pour y implanter la rédaction du journal - à laquelle il escompte que participeront, outre Plekhanov, Axelrod et Véra Zassoulitch, ses amis Alexandre Potressov et Julius Martov. Mais Plekhanov exige d'avoir la haute main sur le contenu du journal, que les jeunes militants espéraient contrôler. Les négociations avec Plekhanov sont difficiles, et Oulianov vit très mal ce conflit avec le théoricien marxiste qui était jusque-là l'une de ses idoles. Après un accord de principe, Oulianov et Potressov quittent Zurich pour Munich, où ils comptent trouver un imprimeur et organiser le réseau de soutiens financiers nécessaires pour monter le journal. En décembre sort le premier numéro du journal, baptisé Iskra L'Étincelle et dont les exemplaires sont acheminés clandestinement en Russie par des messagers, via un circuit compliqué. Iskra, dont une douzaine de numéros seulement sont tirés en 1901, propose un contenu marxiste érudit, destiné à un public de militants révolutionnaires très au fait des questions politiques. Dans un le premier numéro, Lénine insiste sur la nécessité de constituer un parti révolutionnaire rassemblant tout ce que la Russie compte de vivant et d'honnête afin de faire sortir le pays de l' asiatisme- l'Asie étant alors associée à un despotisme brutal et arriéré. Le journal fait figure, à ses débuts, de comité central du POSDR. Nadejda Kroupskaïa rejoint son mari en Allemagne le 1er avril 1901 ; sa mère arrive elle aussi à Munich le mois suivant. Kroupskaïa gère la correspondance de l'Iskra et les deux femmes s'occupent en outre de la maison, ce qui laisse à Oulianov, qui se fait appeler à Munich Herr Meyer, le temps de se consacrer à l'écriture.
Outre son travail à l'Iskra, Vladimir Oulianov, dont les premiers ouvrages n'ont pas eu le retentissement espéré dans les milieux politiques russes, rédige une brochure intitulée Que faire ?, le titre étant un hommage au roman homonyme de Nikolaï Tchernychevski. De même que Tchernychevski avait décrit l'activité des militants révolutionnaires russes, Oulianov souhaite exposer ses conceptions sur le moyen d'organiser un parti politique clandestin dans le contexte tsariste. Il signe cette brochure du nom de plume N. Lénine peut-être inspiré du fleuve sibérien Léna, qu'il avait déjà employé pour signer des lettres adressées à Plekhanov, ainsi que quelques articles. L'attention que suscite Que faire ? dans les milieux marxistes russes aboutit à ce que Lénine devienne le pseudonyme définitif d'Oulianov.
L'ouvrage est l'occasion, pour lui, de présenter ses conceptions en matière de stratégie révolutionnaire, pensées en fonction du contexte particulier de l'Empire russe. La Russie, pays européen dans son modèle économique, demeure à ses yeux plongée dans l'asiatisme sur le plan politique, l'autocratie organisant la société selon un système de « castes ». Dans ce pays encore essentiellement paysan, le développement du capitalisme est encore entravé par les structures sociales : il appartient aux révolutionnaires de donner l'impulsion historique décisive qui anéantira les institutions surannées qui entravent le développement du capitalisme, la Russie devant rattraper son retard avant de passer au socialisme.
Dans Que faire ?, Lénine plaide pour l'organisation d'un parti centralisé et discipliné, uni autour d'une stratégie clairement définie. Il se sépare des conceptions traditionnellement en vigueur dans la social-démocratie européenne en plaidant, non pas pour un parti qui regrouperait l'intelligentsia et l'ensemble de la classe ouvrière, mais pour une révolution organisée et conduite par des professionnels qui constitueraient l'avant-garde de la classe ouvrière et seraient, en Russie, les porteurs de la conscience de classe et de la théorie révolutionnaire, dont les ouvriers n'ont pas un sens inné. Les particularités politiques de la Russie risquant d'empêcher l'apparition d'une lutte des classes effective, le parti aura pour mission de la créer. Aux yeux de Lénine, le parti est le véritable créateur de la lutte des classes, et est seul à même de permettre aux intellectuels d'insuffler à la classe ouvrière les idées adéquates : il ne donne pas seulement la force, mais également la conscience au prolétariat. Dans le contexte russe, Lénine considère que le parti doit ainsi se substituer à la bourgeoisie, qui n'existe pas au sens évolué des sociétés d'Europe occidentale la Russie étant, à ses yeux, au stade de l'arriération asiatique, et tenir à sa place un rôle d'accélérateur de l'histoire. Pour organiser le parti révolutionnaire, Lénine se réfère à l'usine et à l'armée, qui imposent aux hommes la discipline, via des structures rigides ; les révolutionnaires professionnels dont est composé le parti mènent des tâches définies selon les principes de la division du travail, selon le principe d'une autorité strictement hiérarchisée et émanant du sommet. Dans sa conclusion, il prône une insurrection armée du peuple entier. Lors de sa parution, Que faire ? ne suscite guère de réactions hostiles ; Plekhanov juge que Lénine exagère les dangers du spontanéisme et d'autres marxistes trouvent exagérée son insistance sur le centralisme, mais dans l'ensemble les révolutionnaires russes sont conscients des difficultés de la lutte contre l'autocratie russe et approuvent les conceptions de Lénine quant à l'organisation du parti.
Parallèlement à l'écriture de Que faire ?, Lénine se consacre à la rédaction d'un programme pour le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, en vue de l'organisation de son second congrès. Plekhanov ne se montre guère empressé de participer à la tâche et préfère se concentrer sur ses écrits économiques ; Lénine insiste néanmoins pour qu'il apporte son prestige personnel à la rédaction du programme. Le 1er juin 1902, après un laborieux processus de travail en commun entre ses divers rédacteurs, Iskra peut publier un programme provisoire dans son numéro 21. Lénine parvient à imposer à Plekhanov plusieurs de ses idées, notamment l'insertion du terme dictature du prolétariat, que Plekhanov avait supprimé d'une première version ; l'affirmation selon laquelle le capitalisme est déjà le mode de production dominant de la Russie impériale ; enfin, la proposition de restituer une partie de la terre aux paysans dès le renversement de la dynastie Romanov. Ce dernier point est destiné à concurrencer sur son terrain le Parti socialiste révolutionnaire, qui prône alors l'expropriation des terres au bénéfice de la paysannerie et exerce une grande influence sur l'intelligentsia et les étudiants.
Au début de l'année 1902, la surveillance de la police bavaroise se faisant trop pesante, les rédacteurs de l'Iskra décident de déménager la rédaction du journal à Londres. Lénine et Kroupskaïa arrivent en avril dans la capitale britannique ; ils s'installent dans un appartement que loue pour eux un sympathisant russe, qui se charge également de négocier pour le journal l'usage d'une imprimante. L'année suivante, le groupe décide de déménager à nouveau, et d'installer la rédaction à Genève, Martov jugeant cette ville plus pratique pour organiser une activité commune. Lénine tente en vain de s'opposer à ce nouveau déménagement, car il ne souhaite pas être à nouveau soumis à la supervision directe de Plekhanov, qui réside toujours en Suisse. Avant son départ de Londres, il rencontre pour la première fois Léon Bronstein, dit Trotski, jeune révolutionnaire russe évadé de son exil, qui ambitionne alors de rejoindre la rédaction du journal. Les préparatifs pour l'organisation du congrès du POSDR se poursuivent durant plusieurs mois, avant que Bruxelles est finalement choisi comme lieu de réunion ; Lénine s'entoure de militants de confiance - dont son frère Dmitri et sa sœur Maria - afin de bénéficier du plus grand nombre possible de délégués acquis à sa cause.
Rupture entre bolcheviks et mencheviks
Le second congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie s'ouvre finalement le 30 juillet 1903. Les sociaux-démocrates russes sont d'accord quant à la nécessité de bâtir un parti puissant, pour lutter non seulement contre le tsarisme mais aussi contre la concurrence du Parti socialiste révolutionnaire : les tensions sont cependant fortes au sein de l'équipe de l'Iskra. Plekhanov, soutenu par Pavel Axelrod et Véra Zassoulitch, continue d'être contesté par Lénine, que soutiennent Martov et Potressov. Le congrès réunit des représentants de vingt-cinq organisations social-démocrates de Russie, ainsi que ceux de l'Union générale des travailleurs juifs dite Bund. Le risque, contenu dans les points du programme présenté par l'Iskra, d'une contradiction entre les libertés publiques et l'intérêt du parti, inquiète certains délégués : Lénine reçoit cependant sur ce point l'appui de Plekhanov. La véritable division du congrès a cependant lieu autour des statuts du Parti : Lénine estime que les conditions d'adhésion au Parti doivent impliquer une participation active à sa vie interne, soit la détention d'une place précise dans l'organisation hiérarchisée qu'il prône ; Martov est au contraire partisan de conditions d'adhésion plus souples. Les deux hommes s'opposent vivement au cours du congrès, Trotski soutenant pour sa part Martov. La motion de ce dernier sur les conditions d'adhésion obtient davantage de voix vingt-huit contre vingt-trois que celle de Lénine, qui connaît là son premier échec depuis son accession à la notoriété. La rupture est consommée entre les deux amis : Martov se montre inquiet devant la violence verbale et l'autoritarisme de Lénine, chez qui il ne perçoit plus que la passion du pouvoir ; Lénine, de son côté, se juge trahi. Le congrès se poursuit sur la question du rôle du Bund, qui réclame le statut d'organisation autonome au sein du POSDR. La majorité des congressistes votent contre la demande du Bund : sept délégués quittent alors la salle, cinq bundistes et deux membres de la tendance des économistes qui réclamait un statut similaire. Ce départ permet aux partisans de Lénine, battus lors du précédent vote, d'être désormais majoritaires au congrès : ils sont désormais désignés sous le nom de bolcheviks majoritaires, tandis que les partisans de Martov sont surnommés les mencheviks minoritaires. Lénine remporte une autre victoire en s'assurant du contrôle de l'Iskra, dont il obtient de faire réduire le nombre des rédacteurs à trois : le congrès vote pour Lénine, Plekhanov et Martov, mais ce dernier refuse de participer à une publication dont il pressent qu'elle sera dominée par Lénine. Le Parti est en outre réorganisé par Lénine, qui confie sa direction à deux centres d'autorité, d'une part le Comité central, installé en Russie, et d'autre part le Comité d'organisation, à savoir l'Iskra, dont les membres sont en position de force, du fait de leur exil à l'étranger à l'abri des persécutions.
La victoire de Lénine est cependant de courte durée : soutenu par Trotski, Martov attaque avec virulence la mainmise des bolcheviks sur l'Iskra. Plekhanov, quant à lui, regrette la division du Parti et plaide pour une conciliation avec les mencheviks et le retour à une équipe de rédacteurs de six membres au lieu de trois. À la fin de l'année 1903, Lénine, découragé, présente sa démission de l'Iskra et de la direction du Parti ; il écrit la brochure Un pas en avant, deux pas en arrière - La crise dans notre Parti pour présenter son point de vue sur la division du POSDR. Ses nerfs sont rudement éprouvés et il sombre un temps dans un état dépressif. Une partie de la tendance bolchevik du Parti échappe à son autorité et vise à se réconcilier avec les mencheviks ; au niveau européen, Lénine est tout aussi isolé : des sociaux-démocrates allemands prestigieux condamnent ses excès de pensée et de langage. Karl Kautsky lui ferme ainsi les colonnes du Neue Zeit dans lequel il entendait exposer son point de vue. Rosa Luxemburg dénonce également l'attitude de Lénine. Trotski, quant à lui, condamne vigoureusement les thèses de Lénine et l'accuse de ne pas préparer la dictature du prolétariat mais la dictature sur le prolétariat, où les directives du Parti primeraient sur la volonté des travailleurs.
Une fois remis à l'été 1904, Lénine s'emploie à sortir de son isolement politique en nourrissant de nouveaux projets et en attirant de nouveaux sympathisants, parmi lesquels Alexandre Bogdanov, Anatoli Lounatcharski et Leonid Krassine. Lénine réorganise ses partisans et constitue avec eux comité de la majorité, qui fait figure au sein du POSDR d'organisation parallèle destinée à lui permettre d'affronter aussi bien les mencheviks que les bolcheviks insubordonnés. Bogdanov, rentré en Russie, s'emploie à y organiser les groupes bolcheviks subordonnés au comité. Avec l'aide de ses partisans, Lénine publie en décembre 1904 le premier numéro d'un nouveau journal, V Period, dont il contrôle intégralement le contenu. Il travaille également à l'organisation d'un troisième congrès du Parti, dont la tenue est prévue à Londres au printemps 1905.
À l'approche du congrès, les chances de Lénine sont renforcées de façon inattendue quand, en Russie, la police arrête neuf des onze membres de l'instance dirigeante du Parti. Lénine est dès lors délivré de la présence de ceux qui, sur le terrain, s'opposaient à sa volonté. Le IIIe congrès s'ouvre à Londres avec des effectifs réduits, les 38 délégués présents, venus de Russie pour la plupart, étant dans leur majorité favorable aux thèses de Lénine. Les mencheviks ont fait appel à August Bebel pour jouer les médiateurs, mais Lénine repousse tout net les efforts de ce dernier. Les mencheviks réunissent alors leurs propres partisans de leur côté, à Genève. À Londres, Lénine s'appuie sur Krassine, Bogdanov et Lounatcharski, mais bénéficie également de l'appui de nouveaux venus comme Lev Kamenev. Un autre jeune militant, Alexeï Rykov, représente les militants de Russie. Lénine fait condamner par le congrès les thèses des mencheviks, qui peuvent rester membres du Parti s'ils en reconnaissent la discipline, ainsi que la légitimité du IIIe congrès. Bien que conservant le contrôle de l'Iskra, les mencheviks se trouvent dès lors marginalisés. Le congrès élit en outre un nouveau comité central, formé de Lénine, Bogdanov, Krassine et Rykov.
Malgré sa victoire apparente lors du congrès, l'autorité de Lénine sur le Parti est moins assurée qu'il n'y parait. L'Internationale ouvrière, en outre, se montre sévère à l'égard de l'attitude extrémiste des bolcheviks et préfère la position de Plekhanov, théoricien prestigieux, à celle de Lénine, qui apparaît comme un personnage brutal. À la fin du congrès, en avril 1905, le POSDR doit par ailleurs se pencher sur la situation en Russie, où la révolution a éclaté.
Lire la suite ->http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10163#forumpost10163
Posté le : 07/11/2015 22:33
|
|
|
|
|
Lénine 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Révolution russe de 1905.
Début de la révolution et retour en Russie
Au début de 1905, l'Empire russe est dans une situation explosive : le désastre de la guerre russo-japonaise indigne la population et contribue à susciter l'agitation politique, le mécontentement populaire s'exprimant désormais au grand jour. En janvier, la dramatique répression d'une manifestation, lors du dimanche rouge, discrédite Nicolas II. L'agitation ouvrière des villes gagne les provinces et prend un tour de plus en plus ouvertement politique. Les ouvriers et paysans se constituent en conseils, baptisés soviets. Dans la capitale, Saint-Pétersbourg, un soviet est constitué le 14 octobre. Trotski, alors proche des mencheviks, en est le vice-président, avec le socialiste révolutionnaire Avksentiev. De janvier à décembre 1905, Lénine et les bolcheviks observent avec inquiétude des évènements qu'ils n'avaient nullement prévu et dans lesquels ils ne jouent quasiment aucun rôle. La majorité des émigrés russes n'osent tout d'abord pas revenir en Russie, où ils risquent d'être arrêtés ; Lénine, persuadé que le renversement du tsarisme offrira des perspectives inédites au prolétariat du monde entier, enrage de ne recevoir que des informations incomplètes sur les évènements en Russie79,80. Il théorise à l'époque que la faiblesse de la bourgeoisie libérale russe oblige le prolétariat à prendre lui-même le pouvoir en s'appuyant sur la paysannerie, non pas pour transformer l'économie dans un sens socialiste, mais plutôt pour permettre une marge de développement du capitalisme en Russie, développement qui serait contrôlé, encadré et forcé81. Les thèses de Lénine sur la paysannerie constituent une nouveauté par rapport aux autres auteurs marxistes. Marx et Engels, ainsi que les marxistes en général, avaient négligé la paysannerie - les paysans, en tant que petits propriétaires, étant relégués dans le camp de la bourgeoisie ; Lénine, au contraire, réfléchit en fonction de la situation particulière de la Russie et souligne le fait que, convenablement encadrés par le prolétariat et son Parti, les paysans peuvent devenir une force révolutionnaire.
Lénine ne réalise que progressivement la nécessité d'un changement de stratégie ; après le dimanche rouge, et pendant le congrès du Parti, il considère toujours que bolcheviks et mencheviks doivent continuer de former des organisations séparées. En outre, les participants au congrès jugent qu'il n'est pas tenable de continuer à diriger le Parti depuis l'étranger : il est décidé de transférer le Comité central et le nouveau journal du Parti - qui doit s'appeler Proletari - sur le sol russe. Tout en souhaitant mieux s'informer sur ce qui se passe en Russie, Lénine refuse cependant toujours de se rendre en Russie et veut continuer d'envoyer des instructions depuis la Suisse. En septembre, du fait de l'accélération des évènements, Bogdanov presse Lénine de se rendre en Russie. Mais ce n'est qu'après la publication par le tsar du manifeste d'octobre que Lénine juge la situation suffisamment sûre pour revenir. Le 8 novembre, après avoir traversé le Grand-duché de Finlande, lui et sa femme arrivent à la Gare de Finlande de Saint-Pétersbourg.
Lénine et Kroupskaïa sont hébergés à Saint-Pétersbourg par des sympathisants, dans une succession de refuges. Lénine se rend rapidement à la rédaction du journal Novaïa Jizn que les militants du PODSR viennent de créer : il en prend d'autorité la direction et en fait immédiatement l'organe des bolcheviks. Il entretient des contacts avec les militants qui travaillent en liaison avec les soviets et les syndicats, écrit des articles, et s'emploie à organiser l'appareil bolchevik en Russie tout en renforçant son influence sur le Parti. Lénine préconise de donner des armes à des détachements d'ouvriers et d'étudiants et d'organiser des actions contre des banques pour s'emparer des ressources financières nécessaires à la révolution ; le manifeste d'octobre devant être suivi de l'élection des députés de la Douma d'État, il encourage par ailleurs le POSDR à présenter des candidats, pour que la propagande du Parti bénéficie d'une tribune, alors que le mouvement révolutionnaire s'essouffle. Bogdanov et Krassine sont quant à eux partisans du boycott du scrutin. Devant l'évolution de la situation, Lénine prône en outre maintenant une réconciliation avec les mencheviks. En décembre, une réunion des bolcheviks a lieu à Tampere, en Finlande, mais le changement de stratégie de Lénine à l'égard des mencheviks est désapprouvé par les militants. C'est à Tampere que Lénine rencontre pour la première fois un militant géorgien, Joseph Vissarionovitch, alias Koba, qui prendra plus tard le surnom de Staline.
Échec de la révolution et nouvel exil
Dès février 1906, pour échapper à la surveillance policière, Lénine s'installe en Finlande qui, bien que toujours possession russe, jouit alors d'une large autonomie. Avec Bogdanov et d'autres militants, il s'installe dans une grande villa située à une soixantaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, et d'où il continue de diriger le Parti et ses journaux. Kroupskaïa se rend régulièrement dans la capitale pour assurer les liaisons. En mai, Lénine refait une tentative d'installation à Saint-Pétersbourg, mais renonce rapidement et retourne en Finlande, où il réside près d'un an. En avril, le POSDR tient à Stockholm un congrès réunissant bolcheviks et mencheviks, mais aussi le Bund, ainsi que les sociaux-démocrates polonais et lettons. Lénine y prône une nationalisation des terres par une dictature révolutionnaire provisoire, tandis que les mencheviks souhaitent une municipalisation des terres qui aurait pour effet une administration moins centralisée que celle dont Lénine se fait l'avocat. Les bolcheviks se trouvent cette fois mis en minorité : un nouveau comité central est élu, qui compte trois bolcheviks contre sept mencheviks ; Lénine n'en fait pas partie, et ses camarades bolcheviks l'informent de leur désaccord au sujet de la nationalisation des terres. Lénine quitte le congrès dans un état de grande fatigue nerveuse. Sa position s'améliore cependant quand les bolcheviks décident de conserver une organisation séparée du comité central du POSDR. Lénine fait à nouveau partie de leur direction, avec Bogdanov et Krassine. Entretemps, la révolution s'éteint en Russie. En avril 1906, les élections, boycottées par les bolcheviks contre l'avis de Lénine, se soldent par l'élection de 18 mencheviks à la Douma. L'année suivante, quelques élus bolcheviks entrent à la deuxième Douma. Celle-ci est dissoute à l'automne, et Lénine se montre favorable à la participation aux élections de la troisième Douma, dont il juge qu'elle permettra de faire entendre les idées socialistes. Bogdanov et Krassine exigent au contraire des députés sociaux-démocrates qu'ils démissionnent une fois élus. C'est à cette époque que Lénine élabore le concept de centralisme démocratique, qu'il définit alors comme l'alliance de la liberté de discussion et de l'unité d'action- soit le moyen de faire exister la lutte idéologique en sein du parti unifié : la base suivra strictement les consignes émises, après débat interne, par les organes de direction. Tout en prônant un parti strictement hiérarchisé, Lénine veut conserver les moyens de polémiquer avec les mencheviks s'il continue de cohabiter avec ceux-ci au sein d'un même mouvement.
À l'été 1906, Lénine espère encore, malgré l'essoufflement de la révolution, que la guerre de partisans se développera en Russie : la lutte armée est à ses yeux la forme révolutionnaire de la terreur, qu'il faut encourager. Le choix de la violence organisée est, pour Lénine, un trait de la morale du révolutionnaire : la terreur exercée par les masses doit être admise par les sociaux-démocrates, qui doivent l'incorporer à leur tactique, tout en l'organisant et en la subordonnant aux intérêts du mouvement ouvrier et de la lutte révolutionnaire en général. Lénine considère que la terreur authentique, nationale, véritablement régénératrice, celle qui rendit la Révolution française célèbre, est un élément essentiel du mouvement révolutionnaire ; le terrorisme individuel, acte de désespoir, doit céder la place à la terreur de masse contrôlée par le Parti. Si pour Lénine, la période de la Révolution française, et tout particulièrement celle de la Terreur, reste une référence historique majeure, il cite aussi régulièrement l'exemple de la Commune de Paris, dont la faute a été à ses yeux de ne pas suffisamment réprimer ses opposants : l'historien Nicolas Werth souligne que la notion de terreur de masse dans son double sens - terreur exercée par les masses et terreur massive, centrale dans la pensée de Lénine, est élaborée chez lui dès 1905-1906 : dans le contexte d'un pays marqué par une très grand violence politique et sociale, il s'agit pour Lénine d' armer les masses face à la violence du régime tsariste. Aux yeux de Lénine, la violence est le moteur de l'histoire et de la lutte des classes : il faut par conséquent l'encourager pour détruire le vieux monde et, surtout, l'organiser et la subordonner aux intérêts du mouvement ouvrier et de la lutte révolutionnaire.
La police tsariste renforce sa surveillance, et s'intéresse désormais de près aux activités de la direction des bolcheviks en Finlande. En novembre 1907, après avoir été prévenu de la présence de policiers, Lénine quitte sa datcha finlandaise ; le mois suivant, il passe en Suède, d'où il rejoint l'Allemagne, puis la Suisse. De l'expérience révolutionnaire de 1905, qui débouche pour lui sur une nouvelle période d'exil destinée à durer 10 ans, Lénine tire plusieurs leçons. Outre la nécessité d'une alliance entre la paysannerie et le prolétariat - le potentiel révolutionnaire des revendications paysannes étant pour lui primordial en Russie - il juge qu'une révolution démocratique en Russie enflammera les pays occidentaux, permettant par là même l'accélération du processus révolutionnaire russe qui échappera ainsi à l'isolement. La révolution de 1905 a également conduit Lénine à se brouiller, non seulement avec Bogdanov qui ne partage pas ses analyses, mais également avec Trotski : ce dernier juge que le soviet est un élément essentiel de la révolution car il permet de réaliser un large front révolutionnaire ; il faut donc réfléchir à un partage des tâches entre le soviet et le Parti, qui ne saurait dominer le prolétariat en tant que force politique. Lénine, au contraire, juge que le Parti doit conserver une place primordiale dans le mouvement ouvrier. Sur le plan personnel, la période 1905-1907 a été le révélateur de la fragilité nerveuse de Lénine, qui a subi à plusieurs reprises des périodes dépressives.
Deuxième période d'exil De l'après-révolution à la guerre mondiale
Polémiques et divisions du mouvement socialiste russe
Revenu à Genève, Lénine a le sentiment de se trouver dans un tombeau. Le mouvement révolutionnaire russe est alors en plein reflux, et les effectifs militants des bolcheviks fondent. Lénine déménage à plusieurs reprises, d'abord à Paris91 où il reste quatre ans, puis à Cracovie. Contrairement à une légende ultérieure qui le veut alors réduit à la misère, il vit dans un relatif confort, toujours accompagné, au gré de ses déménagements, de son épouse mais aussi de sa mère ou, selon les périodes, de l'une ou l'autre de ses sœurs. Il bénéficie à titre personnel, pour vivre et publier, de diverses aides financières. Le Parti, par contre, est financé non seulement par des sympathisants comme l'écrivain Maxime Gorki, mais aussi et surtout d'expropriations, soit de hold-ups, dont Krassine est le maître d'œuvre et où s'illustrent en Russie des militants comme Kamo et Koba futur Staline. La position de Lénine à l'intérieur du parti reste cependant menacée par la tendance gauchiste, représentée notamment par Bogdanov et qui demeure partisane du boycott de la Douma. Lénine, au contraire, juge qu'il est nécessaire d'utiliser toutes les possibilités légales. En avril 1908, Lénine répond à l'invitation de Maxime Gorki et passe un séjour dans sa propriété sur l'île italienne de Capri. À cette occasion, il essaie en vain de persuader Gorki de prendre ses distances avec la ligne de Bogdanov et de Lounatcharski. Le conflit entre ces derniers et Lénine se situe en effet à l'époque, non seulement au niveau politique, mais sur le terrain philosophique. Bogdanov vise alors dans ses écrits, à réconcilier le socialisme et le marxisme avec la sensibilité religieuse ; Lénine, attaché à l'athéisme, s'oppose vivement à ce courant dit de la Construction de Dieu.
La question du financement du mouvement entraîne par ailleurs de nouvelles graves dissensions entre bolcheviks et mencheviks, notamment à l'occasion de l'affaire de l'héritage des sœurs Schmidt. Après le décès d'un jeune sympathisant révolutionnaire, deux militants bolcheviks se chargent en effet de séduire et d'épouser ses deux sœurs et héritières, afin de détourner l'héritage au profit du Parti. Lénine, qui a contribué à mettre au point la manœuvre, ne récupère pas l'intégralité des fonds à la suite d'une indélicatesse de l'un des militants, mais il réussit néanmoins à mettre la main sur une somme importante. L'héritage Schmidt lui permet d'assurer l'indépendance financière de sa faction. Les sommes sont censées au départ être partagées entre les différentes tendances du POSDR, les sociaux-démocrates allemands se proposant comme médiateurs pour répartir l'argent : or, l'argent est finalement accaparé par Lénine, qui le réserve à l'usage des seuls bolcheviks. Avec les fonds Schmidt, Lénine peut fonder le journal Proletari, par le biais duquel il lance de vives attaques contre les mencheviks et les « conciliateurs.
La nouvelle aisance financière de Lénine lui donne les moyens de se mesurer à Alexandre Bogdanov - avec qui il reste en désaccord quant à l'opportunité de participer ou non à la Douma - dans le but d'écarter ce dernier de la direction des bolcheviks. Lénine mène le combat contre son rival sur les plans à la fois politique et philosophique : pour compenser un bagage philosophique encore léger - s'il connaît bien Marx et Diderot, il n'a alors fait que feuilleter des auteurs comme Hegel, Feuerbach et Kant - il lit de nombreux ouvrages à un rythme accéléré. Dans le courant de 1908, il rédige Matérialisme et empiriocriticisme, ouvrage dans lequel il réfute le positivisme dont se réclame Bogdanov et expose, de manière délibérément polémique, sa propre théorie de la connaissance ; Lénine considère en effet qu'une vision politique et économique doit être soutenue par un prisme épistémologique cohérent : pour lui, Bogdanov, en adoptant une démarche relativiste et idéaliste qui le pousse à des compromissions avec la religion, s'éloigne du marxisme authentique et abandonne toute perspective révolutionnaire. Lénine affirme qu'il convient d'adopter l'« esprit de parti en philosophie, ce qui implique de de choisir son camp entre droite et gauche. Pour lui, le développement des sciences ne peut que confirmer le matérialisme, et le matérialisme dialectique permet de parvenir à une représentation de la « réalité objective : la pensée humaine est capable de nous donner et nous donne effectivement la vérité absolue qui n'est qu'une somme de vérités relatives. Pour Lénine, la philosophie marxiste doit être considérée comme composée d'un seul et même bloc : il transpose ainsi sur le terrain philosophique sa conception de la raison politique, basée sur la séparation en deux camps et sur une stricte discipline du camp révolutionnaire. En juin 1908, Bogdanov quitte la rédaction de Proletari ; en août, lui et Krassine sont écartés du centre bolchevik et de la commission financière du mouvement. Lénine reçoit le soutien de Plekhanov, qui se montre comme lui favorable à la coexistence du travail légal dans le cadre des institutions tsariste au premier chef desquelles la Douma et du travail illégal. En juin 1909, la rédaction de Proletari se réunit dans un café de Paris, avec des membres de la direction du Parti. Bogdanov dénonce Matérialisme et empiriocritisme comme un ouvrage opportuniste, par lequel Lénine cherche à consolider son alliance avec Plekhanov. Lénine, qui s'est assuré de la présence de nombreux partisans, met quant à lui Bogdanov en accusation, lui reprochant ses déviations vis-à-vis du marxisme révolutionnaire. Bogdanov et Krassine sont, cette fois, exclus du centre du Parti pour révisionnisme, participation au mouvement de la Construction de Dieu et activités fractionnelles. Ils fondent de leur côté un journal appelé V Period, comme celui précédemment dirigé par Lénine, afin de revendiquer la légitimité de la faction bolchevik.
Si Lénine réussit, grâce à ses nouveaux moyens financiers, à faire vivre sa faction, ses méthodes contribuent à l'isoler. Sa rupture avec Krassine, Bodganov, Lounatcharski et Gorki est cependant compensée par l'arrivée à ses côtés de nouveaux alliés, Grigori Zinoviev et Lev Kamenev. En 1908, Lénine fait adopter par une conférence du Parti des positions hostiles aux liquidateurs de gauche ; l'année suivante, il fait condamner les expropriations sur lesquelles il avait jusqu'alors fermé les yeux tout en en profitant financièrement. Il demande également la dissolution des derniers groupes de boieviki combattants clandestins. Lénine se coupe ainsi d'une partie de ses soutiens, ce qui renforce son isolement.
En janvier 1910, le comité central se réunit à Paris : Lénine tente d'obtenir la réunification, sous sa direction, des diverses tendances. Mencheviks et bundistes, qui lui reprochent ses échecs en Russie et son manque de scrupules, refusent de lui céder la direction du Parti. L'attitude de Lénine lui vaut d'être vivement attaqué au congrès de l'Internationale ouvrière, où il est accusé d'être le fossoyeur du mouvement socialiste russe. Des militants russes se rapprochent de Trotski, qui édite à Vienne le journal Pravda, ou de Bogdanov, qui édite V Period. En 1911, à nouveau épuisé nerveusement par les luttes intestines, Lénine se repose à Longjumeau, où il est hébergé par Grigori Zinoviev et son épouse. Zinoviev anime à l'époque en région parisienne une « école de cadres pour former les militants bolcheviks.
Relation avec Inessa Armand
Vers 1910-1912, Lénine vit une relation sentimentale avec la militante française Inès - dite Inessa - Armand, qui collabore étroitement avec lui dans l'organisation du mouvement. Après la mort de Lénine, les autorités soviétiques occultent la nature de leurs relations, mais les deux militants semblent avoir dépassé le stade du flirt et vécu une véritable liaison. Les relations entre Nadejda Kroupskaïa et Lénine souffrent du rapport de ce dernier avec Inessa Armand ; Kroupskaïa semble avoir envisagé de se séparer de son mari. Mais Lénine demeure attaché à son épouse - qui souffre à l'époque de la maladie de Graves-Basedow, ce qui semble par ailleurs l'avoir empêchée d'avoir des enfants - et préfère rester à ses côtés. La liaison entre Lénine et Inessa Armand semble avoir pris fin vers 1914. Inessa Armand et Nadejda Kroupskaïa conservent entre elles de bonnes relations, et collaborent au sein de l'école des cadres du Parti.
Situation des bolcheviks avant 1914
Entretemps, la situation sociale se tend en Russie, où de nombreuses grèves ouvrières, de plus en plus nombreuses, éclatent en 1910, 1911 et 1912. Les révolutionnaires visent à profiter de la situation et Sergueï Ordjonikidze, représentant des militants bolcheviks actifs en Russie, s'accorde avec Lénine pour organiser une conférence destinée à réorganiser le mouvement. La réunion se tient en janvier 1912 à Prague et Lénine vise, à cette occasion, à reconquérir la majorité au sein du mouvement social-démocrate russe. Tout est calculé pour que les bolcheviks soient plus nombreux que les mencheviks : certains mencheviks, proches de Plekhanov, reçoivent des invitations, mais d'autres ne sont pas tenus au courant de la réunion. Trotski, indigné, organise à Vienne une réunion concurrente, à laquelle assistent la plupart des militants mencheviks, qui boycottent celle de Prague. La conférence de Prague se tient finalement en présence de dix-huit délégués, dont seize bolcheviks. Les mencheviks présents s'offusquent de la situation et réclament que les autres courants soient représentés : Ordjonikidze est prêt à accéder à leur demande en envoyant des invitations de dernière minute, mais Lénine s'y oppose vivement. Venu avec le soutien de plusieurs militants formés à Longjumeau par Zinoviev, Lénine fait élire un comité central où il siège aux côtés de Zinoviev, Iakov Sverdlov, Ordjonikidze et Roman Malinovski. Le nouveau comité central se présente comme la seule autorité légitime pour l'ensemble du POSDR, mais ne compte qu'un seul membre menchevik ; la réunion de 1912 est dès lors fréquemment considérée comme la naissance du Parti bolchevik » en tant qu'entité véritablement séparée. Lénine triomphe sur ce point, mais il doit cependant abdiquer une partie de son autorité au bénéfice des militants présents en Russie : le Comité de l'étranger, que gérait jusque-là Inessa Armand, cesse de représenter le Comité central hors de Russie, et la nouvelle direction du Parti ne compte plus que deux émigrés, en la personne de Lénine et Zinoviev. Lénine a néanmoins réussi son « coup d'État » interne au Parti, et réorganisé le mouvement pour en être le véritable dirigeant. Il fait notamment approuver son mot d'ordre de participation à la Douma et aux autres organisations légales en Russie.
Le congrès décide en outre de la création d'un quotidien, dont Lénine confie la direction à Malinovski : le journal, dont le premier numéro paraît en avril 1912, s'appelle la Pravda la Vérité, comme la publication lancée précédemment par Trotski ; ce dernier se trouve dès lors dépossédé de son titre98. Quotidien légal, tiré en Russie à plusieurs milliers d'exemplaires, la Pravda paraît jusqu'en juillet 1914. Lénine utilise au mieux les possibilités de l'action légale : les bolcheviks cherchent à s'implanter dans les syndicats et disposent désormais de quelques milliers de militants en Russie. Entretemps, bolcheviks et mencheviks demeurent irrémédiablement divisés : à la Douma, ils parviennent un temps à présenter une unité de façade mais, à l'été 1913, le groupe social-démocrate cesse d'exister. La fraction bolchevique de la Douma est dès lors présidée par Malinovski, qui sert de relai à Lénine et contribue à entretenir la division avec les mencheviks, qu'il invective régulièrement à l'assemblée. Or, à l'insu de Lénine, Malinovski est un agent double payé par l'Okhrana. L'arrestation d'autres membres du Comité central à leur retour en Russie permet à Malinovski d'affirmer son autorité, et du même coup le contrôle de Lénine sur le Parti. L'Okhrana, qui est informée par Malinovski des moindres activités des bolcheviks, favorise la montée en puissance de Lénine, qu'elle considère comme un facteur de division du mouvement révolutionnaire russe.
Entre 1905 et 1917, Lénine se penche sur les questions nationales et intègre de plus en plus dans sa stratégie la liaison de la lutte révolutionnaire avec les luttes nationales, y compris le statut des nationalités dans l'Empire russe. Il n'accorde cependant pas aux revendications nationales le même statut qu'à la lutte des classes et s'affirme jacobin et centraliste. Il n'est cependant pas hostile aux revendications d'autonomie culturelle avancées par certains groupes comme le Bund et son attitude se distingue de celle de militants comme Karl Radek ou Rosa Luxemburg, pour qui les luttes nationales sont illégitimes pour un révolutionnaire prolétarien. En 1913, devant la montée des revendications nationales au sein de la social-démocratie de l'Empire russe - du fait du Bund, ainsi que des partis letton, caucasien, polonais et lituaniens - Lénine commande à Staline un article sur la question des nationalités, destiné à réfuter les thèses du Bund, des mencheviks caucasiens et, partant, de l'ensemble des mencheviks : Lénine vise ainsi à accélérer la rupture avec les autres courants105. Dans les années qui précèdent le premier conflit mondial, Lénine a élaboré, sur le sujet du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une doctrine limitée : il s'oppose à la fois à l'internationalisme radical et au principe des nationalités qui donnerait au combat national la précédence sur la révolution prolétarienne. Lénine est partisan d'une autonomie culturelle des peuples, et du droit des nations à disposer d'elles-mêmes, le cas échéant. S'agissant plus spécifiquement de la question juive, il dénonce l'oppression que subissent les Juifs en Russie, mais il ne croit pas à l'existence d'une culture nationale juive qui reviendrait à considérer que les Juifs constituent une nation et exalte au contraire les traits universellement progressistes de la culture juive. S'agissant du combat des petites nations- comme l'Irlande lors de l'insurrection de 1916 - Lénine juge que l'action révolutionnaire du prolétariat opprimé par l'impérialisme permettra de briser le cadre des nationalités et de renverser la bourgeoisie internationale. Lénine est résolument internationaliste et hostile à la plupart des formes de patriotisme en Russie, d'autant plus qu'il montre peu d'estime pour les Russes moyens, qu'il considère comme un peuple encore insuffisamment développé ; il juge cependant que l'internationalisme, pas plus que la conscience de classe, n'est pas inné dans le prolétariat. Contrairement à ceux qui, comme Rosa Luxemburg, voient avant tout la finalité et nient tout rôle à la question nationale, il estime que la lutte nationale, si elle reste subordonnée à la lutte des classes, est un moyen de susciter celle-ci en accélérant la révolution. Prenant en compte le contexte multinational de l'Empire russe, Lénine juge que le droit à l'autodétermination permettra aux nations de l'empire, au moment de la révolution, de choisir si elles partageront le destin révolutionnaire de la Russie ou bien si elles s'en détacheront. A contrario, des nations pourront choisir de rejoindre l'État socialiste, où ne subsisteront plus de barrières ethnico-culturelles ou de classe.
En 1912-1913, les soupçons pesant de longue date sur Malinovski sont ravivés par une série d'arrestations, comme celles de Sverdlov et de Staline. Lénine, qui réside alors à Cracovie, refuse de tenir compte des avertissements qui lui sont adressés au sujet de Malinovski, et défend la probité de ce dernier ; il accepte de participer, avec Zinoviev, à une commission d'enquête sur les activités de Malinovski. Lénine comme Zinoviev continuent d'accorder à Malinovski le bénéfice du doute, et l'agent double sort blanchi de la procédure. L'affaire Malinovski contribue à empoisonner le climat au sein du mouvement social-démocrate russe ; Malinovski continue de gérer la trésorerie de la Pravda ; le rédacteur en chef du journal, Tchernomazov, est également un agent double de l'Okhrana. Lénine continue d'utiliser le journal dans sa lutte contre les mencheviks, qu'il attaque dans ses articles de manière virulente.
Entre 1907 et 1912, l'Internationale ouvrière tient une place croissante dans les activités de Lénine : en 1907, il assiste pour la première fois à son congrès à Stuttgart. Il trouve là une tribune pour dénoncer le réformisme et fait alors bloc avec Rosa Luxemburg sur de nombreux points. Représentant de la fraction bolchevik au Bureau Socialiste International BSI, l'organe de coordination de l'Internationale, il propose en 1910 d'y adjoindre Plekhanov : ce dernier accepte alors de coopérer avec les bolcheviks. Mais la position de Lénine au sein de l'Internationale ouvrière se dégrade ensuite : la querelle incessante entre mencheviks et bolcheviks indispose en effet les rangs de l'organisation, de même que l'attitude de Lénine qui refuse avec violence les médiations proposées, notamment celle de Clara Zetkin. Rosa Luxemburg contribue également à saper les positions de Lénine, qu'elle juge responsable des divisions de la social-démocratie russe. La proximité de Lénine avec Karl Radek, adversaire de Rosa Luxemburg au sein du mouvement socialiste polonais, contribue également à dresser cette dernière contre lui. À partir de 1913, Lénine, de plus en plus mal vu au sein du BSI, n'assiste plus aux réunions et se fait représenter par Kamenev. En 1914, l'Internationale ouvrière convoque à Bruxelles une conférence spéciale pour tenter de rassembler l'ensemble des organisations et fractions socialistes russes. Lénine prépare avec soin un rapport sur l'unité social-démocrate en Russie, mais commet l'erreur de ne pas se rendre lui-même à la conférence et de faire lire son rapport par Inessa Armand. Son absence irrite les cadres de l'Internationale et Karl Kautsky, soutenu par Rosa Luxemburg, fait adopter une résolution condamnant l'attitude des bolcheviks. La question de l'éventuelle unité est renvoyée au congrès suivant de l'Internationale, prévu à Vienne en août 1914.
Première Guerre mondiale
Le défaitisme révolutionnaire et la conférence de Zimmerwald
Alors que se déclenche la crise de la Première Guerre mondiale, Lénine ne réalise tout d'abord pas la gravité de la situation internationale110 mais, dès le mois de juillet 1914, il juge que la guerre qui s'annonce pourra amener la révolution en Russie. Lénine réside alors en Galicie, alors territoire polonais de l'Empire austro-hongrois ; jugé suspect par les autorités, il est arrêté au début du mois d'août et emprisonné. Des militants socialistes autrichiens et polonais interviennent aussitôt en sa faveur : Victor Adler assure aux autorités austro-hongroises que Lénine est un ennemi juré des Romanov et ne risque donc pas d'être un agent tsariste. Libéré au bout de quelques jours, Lénine quitte rapidement la Galicie avec son épouse, alors que les armées russes avancent vers le territoire des Habsbourg. Le couple se réfugie à Berne, en Suisse. Apprenant que les sociaux-démocrates allemands ont voté les crédits de guerre de leur gouvernement, Lénine conclut à la mort de la Seconde Internationale. Dans l'ensemble de l'Europe, les partis socialistes et sociaux-démocrates adhèrent à la politique belliciste de leurs gouvernements respectifs : si Lénine est d'accord avec Martov pour condamner l'attitude de l'ensemble des socialistes, il se singularise en accordant une attention particulière à la situation en Russie. Alors que Martov condamne sans distinction tous les gouvernements impérialistes, Lénine mise sur une victoire de l'Empire allemand contre son propre pays : la défaite militaire de l'Empire russe lui semble en effet pouvoir être l'élément déclencheur de la révolution en Russie. Cependant, sa vision n'est guère partagée au début du conflit, ni au sein de l'Internationale ouvrière, ni parmi ses compatriotes. En Suisse, Lénine vit durant la Première Guerre mondiale des années difficiles : il est coupé du reste du mouvement socialiste russe et la Pravda est interdite en Russie, le privant à la fois d'un moyen d'influence et d'une source de revenus. En février 1916, il doit quitter son domicile de Berne et doit louer un nouveau logement à Zurich, dans des conditions de confort très médiocres. Alors qu'il connaît de relatives difficultés matérielles, sa vie privée est également affectée par des décès successifs : la mère de Nadejda Kroupskaïa, qui contribuait beaucoup à l'organisation de la vie domestique du couple, meurt en mars 1915 ; sa propre mère, Maria Oulianova, meurt en juillet 1916.
Le théoricien marxiste allemand Karl Kautsky est d'abord l'une des inspirations de Lénine, qui devient ensuite son ennemi politique.
L'incapacité de l'Internationale ouvrière à empêcher la guerre convainc Lénine, et d'autres socialistes avec lui, de reconstruire une nouvelle Internationale. En septembre 1915, une conférence est organisée, à l'initiative des Italiens, dans le village suisse de Zimmerwald. Lors de cette conférence de Zimmerwald, qui réunit 38 participants représentant 11 pays, Lénine plaide pour son programme de rupture avec le Deuxième Internationale, de constitution d'une nouvelle instance de la classe ouvrière » et d'appel à la guerre civile. Sa conception du défaitisme révolutionnaire, selon laquelle les travailleurs doivent lutter contre leur propre gouvernement - sans craindre l'éventualité de précipiter sa défaite militaire, qui favorisera au contraire la révolution - est encore minoritaire, et n'est suivie que par 5 délégués. Lénine peut néanmoins faire connaître ses idées : sa tendance, surnommée la gauche zimmerwaldienne, gagne en influence dans les rangs socialistes à mesure que le conflit, de plus en plus meurtrier, s'éternise. Bien que les idées de Lénine progressent en Europe occidentale, les bolcheviks sont très affaiblis en Russie, où les députés bolcheviks de la Douma et leurs assistants, dont notamment Lev Kamenev, sont arrêtés pour trahison et envoyés en déportation.
En avril 1916, les participants de Zimmerwald se réunissent à nouveau lors de la conférence de Kiental : Lénine y plaide avec vigueur pour la rupture totale avec la Deuxième Internationale discréditée, mais sa ligne demeure minoritaire. Il se livre également à une violente attaque contre Kautsky - absent de la conférence - qu'il qualifie de prostituée politique.
Réflexions sur la révolution
Durant les années de guerre, Lénine réfléchit sur les questions de l'État et de la forme de gouvernement dans le contexte d'une révolution socialiste. Il est tout d'abord amené à contester les thèses de Nikolaï Boukharine ; ce dernier s'oppose en effet aux idées de Kautsky, qui considère que les structures de l'État peuvent être conservées par les socialistes une fois l'ancien régime abattu ; Boukharine plaide au contraire pour la destruction complète de l'État capitaliste et la construction d'un État révolutionnaire. Lénine critique d'abord les idées de Boukharine, qui lui paraissent relever de l'anarchisme, mais finit par conclure que ce dernier, en relevant que les structures existantes de l'État ne pourraient qu'entraver le processus révolutionnaire, a identifié une faiblesse fondamentale de la pensée de Kautsky. Se basant sur l'expérience de 1905, Lénine conclut que le soviet est la structure la plus adaptée pour fournir la matrice de l'État nouveau. Poussant sa réflexion sur le terrain philosophique, Lénine étudie les textes d'Aristote, Hegel et Feuerbach et en vient à la conclusion qu'il est impossible de comprendre Marx sans avoir d'abord assimilé Hegel. Dans ses notes de l'époque, Lénine en arrive à redéfinir de manière radicale sa théorie de la connaissance, contredisant une partie des théories exprimées dans Matérialisme et empiriocriticisme. Là où il affirmait le caractère absolu de la réalité telle que perçue par l'esprit humain, Lénine juge désormais que la connaissance est le reflet de la nature telle que la perçoit l'homme, par le biais de nombreux concepts issus de l'esprit humain, qui est lui-même conditionné par une réalité mouvante. La réalité n'est dès lors pas uniquement déterminée par des préceptes scientifiques, mais avant tout par la pratique. La pensée politique se doit dès lors d'être flexible et la pensée marxiste doit s'adapter au caractère mouvant de la réalité : Lénine trouve ainsi l'argument central pour réfuter les écrits de Kautsky.
Alors que la Première Guerre mondiale poursuit son cours, Lénine continue de réfléchir à ses possibles répercussions révolutionnaires. Sur la situation du capitalisme international, Lénine est notamment en désaccord avec la thèse de Boukharine qui considère que le capitalisme international se développe pour former un trust économique mondial : pour Lénine, au contraire, il faut tenir compte de l'axiome marxiste sur l'instabilité inhérente du capitalisme. Pour soutenir sa thèse, Lénine rédige L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme, qu'il achève en juillet 1916 : dans cette brochure, Lénine analyse l'impérialisme comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant marqué par la domination du capital financier sur le capital industriel. L'impérialisme renforce et accroît les différentes et inégalités de développement entre pays : le capitalisme entre dès lors en putréfaction du fait du développement du pillage et de la spéculation, ainsi que de la lutte entre capitalismes nationaux et du développement du capital fictif sans lien avec les forces productives. Lénine voit dans la guerre mondiale une lutte entre impérialismes rivaux pour le partage du monde et pronostique la transformation de la guerre entre nations en une guerre entre bourgeois et prolétaires. Plus largement, il analyse la guerre mondiale comme étant l'expression du début du pourrissement du régime capitaliste, qui amène les principales puissances à se faire une guerre sur une échelle et avec des conséquences sans précédent. Il voit aussi dans l'impérialisme le signe de la maturation des conditions de la transition vers le socialisme. À la vision traditionnelle de Marx, chez qui la révolution socialiste consiste en une expropriation des grands capitalistes, Lénine substitue une vision apocalyptique de l'agonie du capitaliste, dans le cadre de conflits gigantesques. Lénine souligne également le potentiel révolutionnaire des masses colonisées, qui cherchent leur salut dans la lutte de libération nationale, laquelle affaiblira les gouvernements colonisateurs et donnera au prolétariat une force nouvelle : l'un des aspects positifs de l'impérialisme est donc, à ses yeux, le fait qu'il développe les sentiments nationaux dans le cadre colonial. Les capitalistes sont désormais confrontés, non seulement à leur propre prolétariat, mais aussi aux peuples étrangers qu'ils exploitent, et ce quels que soient le type de société et le stade de développement des peuples en question. La réflexion aboutit ainsi à résoudre le paradoxe d'une révolution qui surgirait dans un pays économiquement arriéré comme l'Empire russe et non, comme le prévoit la pensée marxiste, dans un grand pays industrialisé : dans la perspective de Lénine, la Russie devient le maillon le plus faible du capitaliste, soit un pays où coexistent diverses formes d'exploitation capitaliste, à la fois un capitalisme proprement russe, mais aussi des modes d'exploitation coloniale et semi-coloniale. Le capitalisme russe est donc particulièrement contradictoire et instable, ce qui permet d'espérer une révolution en Russie. Les théories de Lénine trouvent une partie de leur raison d'être dans la situation particulière de la Russie, peuplée pour l'essentiel de paysans, et où les ouvriers ne sauraient à eux seuls constituer une force révolutionnaire suffisante.
Les idées de Lénine sur la question nationale suscitent une réplique de Rosa Luxemburg qui, en désaccord complet avec lui, publie sous le pseudonyme de Junius une brochure dans laquelle elle juge que la révolution ne pourra venir que d'Europe, soit des pays capitalistes les plus anciens. Lénine réagit en écrivant un texte intitulé Réponse à Junius, dans lequel il réplique de manière cinglante à Rosa Luxemburg et réaffirme le caractère révolutionnaire des guerres nationales contre les puissances impérialistes.
Si Lénine poursuit ses travaux théoriques, il apparaît encore, au début de 1917, loin de toute perspective d'accès au pouvoir. Ses conditions d'existence à Zurich, où il trouve la vie très chère, demeurent médiocres. Il semble avoir, un temps, songé à émigrer aux États-Unis. En janvier 1917, devant un groupe de jeunes socialistes de Zurich, il juge que, si l'Europe est grosse d'une révolution et que la révolte des peuples d'Europe contre le pouvoir du Capital financier est inévitable à terme, la révolution pourrait ne pas arriver avant de longues années. Lénine déclare à cette occasion : Nous, les vieux, nous ne verrons peut-être pas les luttes décisives de la révolution imminente.
Retour en Russie et prise du pouvoir
La Russie en révolution Révolution de Février
Au début de 1917, comme l'ensemble des exilés politiques russes, Lénine, qui se trouve toujours en Suisse, est pris de court lorsque la révolution de Février éclate : discrédité par son incurie et par les difficultés de l'armée russe sur le front de l'Est, le régime tsariste s'effondre. Comme en 1905, des soviets apparaissent dans tout le pays ; si les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks participent à la révolution, les bolcheviks n'y tiennent quasiment aucun rôle ; après l'abdication de Nicolas II, un Gouvernement provisoire est formé, mais son autorité est bientôt en compétition avec celle du Soviet de Petrograd. Dans le courant du mois de mars, Lénine envoie à la Pravda, qui peut reparaître en Russie, une série de textes - appelés par la suite les lettres de loin - dans lesquels il prône le renversement du Gouvernement provisoire : la rédaction du journal Kamenev et Staline, tout juste libérés de leur exil sibérien, gênée par le radicalisme des lettres de Lénine, s'abstient de les publier, à une exception près. Lénine tente de trouver le moyen de rentrer le plus vite possible en Russie : il pense tout d'abord à demander de l'aide au Royaume-Uni, où vivent nombre de ses amis socialistes, mais les Alliés ne sont guère disposés à lui faciliter les choses, le maintien de la Russie dans la guerre étant essentiel pour eux. L'aide décisive pour Lénine vient finalement des Empires centraux et plus précisément de l'Allemagne. Après que Martov a lancé l'idée de demander l'aide de l'Allemagne, les bolcheviks prennent contact, via l'intermédiaire de socialistes suisses, avec des agents allemands. Zinoviev représente ensuite Lénine durant les négociations avec ceux-ci ; Lénine pose comme condition que le wagon du train qui transportera les révolutionnaires russes bénéficie d'un statut d'extraterritorialité, afin d'éviter toute accusation de coopération avec l'Allemagne : le voyage en train passe ensuite à la postérité sous le nom du wagon plombé, inventé par la propagande bolchévique pour tenter démontrer que l'indépendance de Lénine à l'égard de l'Empire allemand. Il s'agissait en réalité d'un train ordinaire. L'accord avec les autorités allemandes consistait simplement en ce que les passagers traversant le pays devaient refuser catégoriquement de rencontrer ou de parler à qui que ce soit - et suscite par la suite une polémique, certains accusant Lénine d’avoir été acheté par le gouvernement allemand, voire d'être un traître à la Russie. En 1918, le journaliste américain Edgar Sisson, représentant en Russie du Committee on Public Information, publie aux États-Unis une série de documents ramenés de Russie et prouvant que Trotski, Lénine et les autres révolutionnaires bolcheviks étaient des agents du gouvernement allemand. George Kennan, en 1956, démontre que ces documents étaient en quasi-totalité des faux.
Dans la réalité, Lénine et les Allemands ont consciemment tiré avantage les uns des autres, chacun profitant de cette alliance momentanée pour favoriser ses propres intérêts : l'Empire allemand voit surtout d'un très bon œil le retour en Russie d'agitateurs politiques, et compte sur Lénine et les autres pour désorganiser un peu plus la Russie ; Lénine, quant à lui, use de tous les moyens disponibles pour atteindre son objectif révolutionnaire. Les révolutionnaires quittent Zurich le 27 mars ; outre Lénine, le train transporte une trentaine de bolcheviks et d'alliés de Lénine, dont Grigori Zinoviev, Inessa Armand et Karl Radek. Un second train, par la même voie, emmène plus tard Martov, le chef des mencheviks et plusieurs de ses proches comme Axelrod, Riazanov, Lounatcharski et Sokolnikov, dont plusieurs se rallieront aux bolcheviks après leur arrivée en Russie. En chemin, Lénine rédige un document, connu par la suite sous le nom des Thèses d'avril : dans cette série de dix textes, il établit un plan d'action radical, contredisant la notion marxiste selon laquelle une révolution bourgeoise est un stade nécessaire pour le passage au socialisme et prônant le passage direct, en Russie, à une révolution prolétarienne ; dans la perspective de la transformation de la révolution russe en révolution socialiste, les paysans pauvres devront faire partie de la nouvelle vague révolutionnaire.
Le 3 avril, Lénine arrive à la gare de Finlande de Petrograd, où il est accueilli par une foule de sympathisants, au son de La Marseillaise. Lénine ne prête guère attention à Nicolas Tchkhéidzé Nicolas Tchéidzé, le président menchevik du Soviet de Petrograd venu l'accueillir, et se lance aussitôt dans un discours prônant une révolution socialiste mondiale. Avec son épouse, il se rend ensuite chez sa sœur Anna, qui héberge le couple dans la capitale. Le lendemain, Lénine se rend au Palais de Tauride, devenu le siège du Gouvernement provisoire et du Soviet de Petrograd : devant une assemblée de sociaux-démocrates interloqués, il plaide pour la prise de contrôle des soviets et la transformation de la guerre en guerre civile, dans l'optique d'une révolution mondiale. Refusant de soutenir le Gouvernement provisoire russe, Lénine perçoit que les soviets, s'ils sont pénétrés et contrôlés par le Parti, sont l'instrument adéquat pour prendre le pouvoir ; s'il adopte désormais le slogan Tout le pouvoir aux soviets ! c'est en vue de leur imposer une majorité, voire une domination, des bolcheviks. Cependant, la majorité des bolcheviks penche alors pour une tactique de conciliation et d'unité entre révolutionnaires : Lénine, au contraire, prône un passage à l'action immédiate, avec l'arrêt de tout effort de guerre, la fin du soutien au Gouvernement provisoire et le transfert de tous les pouvoirs aux soviets, le remplacement de l'armée par des milices populaires, la nationalisation des terres et le contrôle de la production et de la distribution par les soviets. De nombreux cadres du Parti sont choqués par la violence de ses thèses. Bogdanov compare les propos de Lénine au délire d'un fou ; un autre militant, Goldenberg, conclut que Lénine se prend pour l'héritier de Bakounine et se place en-dehors de la social-démocratie.
Lénine a des difficultés à faire accepter ses thèses jusque dans la Pravda : le 7 avril, le journal accepte de publier les Thèses d'avril, mais précédées d'une note de Kamenev qui en désapprouve le contenu. Le lendemain, le comité du Parti de la capitale se réunit et vote à une forte majorité contre les propositions de Lénine. Ce dernier prépare dès lors avec soin la Conférence panrusse du Parti, qui doit se réunir dix jours plus tard : il bénéficie alors de la présence de délégués de base, séduits par son esprit de décision. Le fait que l'espoir de paix semble s'éloigner après que le ministre Milioukov a réaffirmé les buts de guerre de la Russie contribue également à faire pencher les militants en faveur de Lénine. Celui-ci reçoit également, contre Kamenev, l'appui de Zinoviev et de Boukharine. Lors du congrès, Lénine présente ses thèses, en réclamant la paix immédiate, le pouvoir aux soviets, les usines aux ouvriers et les terres aux paysans. Lénine réaffirme également son rejet de la démocratie bourgeoise et du parlementarisme : il estime que cette forme de démocratie, qui a cours en Occident, concentre en réalité les pouvoirs entre les mains de la classe capitaliste et appelle à lui substituer une démocratie issue directement des soviets ouvriers et paysans.
Alors que la foule manifeste contre la guerre dans la capitale, les résolutions de Lénine obtiennent une forte majorité au congrès - notamment celle sur la paix - à l'exception de celle préconisant une révolution socialiste immédiate. Le mot d'ordre Tout le pouvoir aux Soviets ! est officiellement adopté. Lénine ne parvient cependant pas encore à obtenir l'abandon du vocable social-démocrate, qu'il juge désormais synonyme de trahison, et son remplacement par communiste. Par ailleurs, les congrès des bolcheviks espèrent encore réaliser l'unité avec les mencheviks. Dans le courant du mois de mai, Lénine gagne un nouvel allié de poids en la personne de Trotski, lui aussi revenu en Russie, et qui se rallie à ses idées. Martov, quant à lui, partage les idées de Lénine sur la volonté de paix et plaide en vain contre la participation des mencheviks au Gouvernement provisoire ; il refuse cependant de rallier son ancien ami, qu'il voit désormais comme un cynique dont la seule passion est le pouvoir. Lénine multiplie les apparitions publiques dans la capitale : bien que moins bon orateur que Trotski, et malgré un léger défaut de prononciation - il est incapable de prononcer les R à la russe - il montre dans ses discours une énergie et une conviction qui contribuent à sa notoriété. Au printemps 1917, il est désormais la personnalité la plus influente au sein d'un Parti dont la presse, grâce en partie à l'argent fourni par l'Allemagne, bénéficie de moyens sans commune mesure avec ceux des autres mouvements. Pour gagner en influence au sein du monde ouvrier, et contrer celle des mencheviks dans les syndicats, Lénine encourage la formation de comités d'usine, au sein desquels les bolcheviks se livrent à une intense propagande.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10162#forumpost10162
Posté le : 07/11/2015 22:30
|
|
|
|
|
Lénine 4 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Échec des journées de juillet Journées de juillet 1917.
En juin, Lénine assiste au premier congrès panrusse des Soviets où il prend la parole, dénonçant avec virulence le gouvernement provisoire et annonçant que les bolcheviks sont prêts à prendre le pouvoir immédiatement. Les congressistes votent cependant la confiance au gouvernement provisoire et repoussent la résolution des bolcheviks qui exigeait le transfert immédiat du pouvoir aux soviets. Les bolcheviks continuent d'entretenir l'agitation politique ; l'accumulation des problèmes économiques et militaires de la Russie joue contre le gouvernement provisoire de coalition. Le maintien de la Russie dans le conflit contribue notamment à rendre le gouvernement impopulaire. À la fin du mois de juin, après le désastre de la contre-offensive décidée sur le front de l'Est par le ministre de la guerre Aleksandr Kerenski, leur propagande auprès des ouvriers et des soldats s'intensifie. Lénine, fatigué, part se reposer fin juin en Finlande : le 4 juillet, il est informé par un émissaire du comité central que les manifestations contre le gouvernement provisoire ont dégénéré au point de tourner à l'insurrection, ce qui pourrait conduire à des mesures draconiennes contre les bolcheviks. Revenu à Petrograd, Lénine lance des appels au calme, mais le gouvernement est décidé à en finir avec les menées des révolutionnaires : Kerenski fait diffuser des documents accusant Lénine d'être un traître et un agent allemand. En compagnie de Zinoviev, Lénine doit à nouveau quitter la capitale pour échapper à l'arrestation. Kamenev, Trotski, Lounatcharski et Alexandra Kollontaï sont arrêtés. La fuite de Lénine cause une certaine controverse au sein des bolcheviks, dont certains prônaient sa reddition ; les accusations de trahison au profit de l'Allemagne convainquent cependant Lénine de ne pas risquer de tomber entre les mains des autorités. Kerenski prend la tête d'un nouveau gouvernement et, assailli par les critiques du Soviet de Petrograd qui juge les arrestations superflues, ne met pas à exécution son projet de révéler l'affaire des fonds allemands dont a bénéficié Lénine.
À la fin du mois de juillet, les bolcheviks se réorganisent lors de leur 6e congrès : Staline parle au nom de Lénine - absent car caché en banlieue de la capitale - et prône l'affrontement avec le gouvernement provisoire, la période pacifique de la révolution étant terminée. Le slogan tout le pouvoir aux soviets disparaît, remplacé par un mot d'ordre appelant à la dictature révolutionnaire des ouvriers et des paysans. Le secret de sa cachette ayant été éventé, Lénine se réfugie en Finlande. Il profite de son éloignement forcé pour rédiger L'État et la Révolution, un traité marxiste dans lequel il expose son point de vue sur le processus révolutionnaire et aborde la question - non détaillée par Marx et Engels - des formes que doivent prendre l'État et le gouvernement sous la dictature du prolétariat. Au passage, il revient sur la nécessité, pour le Parti, d'adopter un nouveau nom - celui de bolcheviks, né lors du congrès de 1903, étant purement accidentel- qui pourrait être Parti communiste, en gardant entre parenthèses la mention bolchevik. Dans ce livre, qui restera inachevé du fait de la Révolution d'Octobre, Lénine présente de manière schématique le processus historique qu'il déduit de sa lecture des œuvres de Marx et d'Engels, et selon lequel la société passera tout d'abord par la phase inférieure » de la société communiste, c'est-à-dire celle de la dictature du prolétariat : le renversement du capitalisme par le biais d'une révolution violente aboutira à cette première phrase, dite du socialisme ou plus précisément du collectivisme économique, durant laquelle l'État prendra possession des moyens de production. Durant la dictature du prolétariat, qui aidera à consolider la révolution - Lénine ne précise pas la durée de cette phase - l'État subsistera sous la forme d'un État prolétarien. Le stade du socialisme impliquera le maintien d'une certaine inégalité sociale, mais progressivement la société évoluera vers l'égalité absolue, pour atteindre finalement la phase supérieure, soit celle du communisme intégral, qui correspondra à une société sans classes où la propriété privée n'aura plus de raison d'être ; l'État, devenu inutile, disparaîtra alors de lui-même. Les éventuels excès commis par certaines personnes seront réprimés par le peuple, qui exercera la répression en lieu et place de l'ancien appareil d'État.
Cet écrit de Lénine suscite par la suite les critiques de marxistes comme Kautsky et Martov, qui arguent que Marx n'a pas non plus exclu un processus de révolution non-violente et n'a utilisé que rarement le concept de dictature du prolétariat dont Lénine fait un grand usage, apparemment sans réaliser que ce système se traduirait inévitablement par l'oppression d'une partie de la population par une autre. L'État et la Révolution est parfois présenté par la suite, comme le signe d'une pensée libertaire et démocratique chez Lénine ; certains de ses partisans présentent l'ouvrage comme le couronnement de sa pensée, tandis que des jugements critiques y voient un pamphlet simpliste et improbable. Cependant, dans cet écrit où l'ensemble des jugements sont portés à l'aune de la lutte des classes, Lénine se positionne radicalement à l'encontre de la démocratie parlementaire et ignore aussi bien la notion de pluralisme politique, que la nécessité d'institutions capables de défendre les libertés dont il prône l'application.
La révolution d'octobre Révolution d'Octobre.
Fin août, la tentative de putsch du général Kornilov, commandant en chef de l'armée russe, souligne à la fois la fragilité du gouvernement de Kerenski et la capacité de réaction des partis de gauche bolcheviks mais aussi mencheviks et S-R, qui se sont mobilisés contre les menées de Kornilov. Les bolcheviks sortent grands vainqueurs de l'affaire, dans laquelle ils ne jouent qu'un rôle mineur mais qui consacre leur retour sur la scène politique. Les mois qui séparent l'échec du coup de force de Kornilov de l'arrivée au pouvoir des bolcheviks sont marqués par une décomposition accélérée de l'autorité politique sur fond de crise économique ; le discours des bolcheviks progresse rapidement au sein des Soviets - notamment les comités d'usine et les comités de quartier dans la capitale - ainsi que chez les soldats - qui souhaitent cesser de se battre et revenir au pays pour partager les terres - et chez les ouvriers. Lénine, depuis sa retraite de Finlande, considère que, du fait du vide institutionnel en Russie, le pouvoir est à portée de main.
Se conformant aux instructions envoyées par Lénine, les bolcheviks prennent le contrôle des instances de pouvoir dans la capitale et en province. Une motion bolchevik appelant à la constitution d'un gouvernement sans participation bourgeoise obtient la majorité au Soviet de Petrograd ; le comité exécutif à majorité menchevik/S-R est mis en minorité et Trotski, sorti de prison depuis peu, est élu président du Soviet. La majorité est également conquise à Moscou. D'abord prudent dans ses écrits, Lénine - à qui sa sœur Maria sert de messagère - passe à des propositions plus radicales et envoie au Comité central plusieurs directives qui prônent de prendre rapidement le pouvoir. Il souligne la menace que font peser les troupes allemandes sur la capitale et assure que la situation militaire risque de donner à Kerenski les moyens d'écraser les bolcheviks. En outre, l'impatience de Lénine est principalement motivée par l'approche du scrutin, plusieurs fois repoussé et désormais prévu en novembre, en vue d'élire une assemblée constituante. Une fois l'assemblée élue, un nouveau centre de pouvoir risque d'empêcher les bolcheviks de revendiquer pour eux seuls le statut de représentants du peuple. Alors que la majorité des bolcheviks sont d'accord pour participer à la Conférence démocratique destinée à former un pré-parlement avant l'élection de l'assemblée constituante, Lénine envoie un message exigeant que le lieu de la conférence soit assiégé et ses participants jetés en prison ; sa directive surprend le Comité central, qui s'abstient de la suivre. Au sein du CC, Kamenev est notamment en désaccord avec Lénine ; il considère que les conditions pour instaurer le socialisme en Russie ne sont pas remplies et prône une coalition de tous les partis socialistes. Cette option est un temps compromise par l'échec de la Conférence démocratique, mais Kamenev compte sur une prise du pouvoir par le biais d'un vote du Congrès des Soviets, qui se traduirait très probablement par un gouvernement de coalition socialiste, dont il pourrait apparaître comme une figure dominante157. Afin de prendre de vitesse la formation de l'assemblée constituante, les bolcheviks font annoncer pour la fin octobre le second congrès des Soviets, dont ils manipulent la préparation afin d'y être majoritaires au sein des délégués. Lénine veut au contraire que les bolcheviks prennent le pouvoir avant le congrès des Soviets qui amènerait à un partage du pouvoir avec les autres partis socialistes et risquerait de marginaliser Lénine au profit de Kamenev ; il insiste dans ses lettres sur la nécessité d'un coup de force immédiat.
Le 15 septembre du calendrier julien 28 septembre du calendrier grégorien, le comité central engage la discussion sur deux lettres intitulées Les bolcheviks doivent prendre le pouvoir et Le marxisme et l'insurrection envoyées par Lénine depuis sa retraire de Finlande : toujours marqués par l'échec des journées de juillet, les dirigeants bolcheviks désapprouvent ces appels à la prise du pouvoir. Deux semaines plus tard, Lénine revient à la charge en publiant dans le journal du Parti un article intitulé Le crise est mûre, où il affirme qu'attendre le congrès des Soviets serait une idiotie et une trahison. Exaspéré de ne pas voir ses instructions suivies - le Comité central refuse même une première fois de le laisser rentrer à Petrograd, Lénine finit par quitter incognito la Finlande pour revenir en Russie : rasé, grimé et coiffé d'une perruque, il arrive dans la capitale le 7 octobre 20 octobre du calendrier grégorien.
Trois jours après le retour de Lénine, les membres du Comité central se réunissent dans l'appartement du menchevik de gauche Nicolas Soukhanov dont l'épouse est une militante bolchevik : au bout de dix heures de discussions, et en partie grâce à l'appui de Sverdlov, qui assure qu'un complot militaire est en train d'être fomenté, Lénine parvient à retourner son auditoire et fait voter le principe d'une insurrection armée. Sur douze personnes présentes, seules deux Kamenev et Zinoviev votent contre ; la majorité se rallie à Lénine, notamment sur la foi des rumeurs qui prétendent que Kerenski est prêt à abandonner la capitale aux troupes allemandes.
Les propositions de Lénine continuent cependant de susciter la réticence de certains ; lors d'une réunion tenue six jours plus tard en présence de représentants de l'organisation militaire des bolcheviks, du Soviet de Pétrograd et des organisations de travailleurs, divers participants mettent en garde contre les risques d'une insurrection, dont le secret, médiocrement gardé, fuite rapidement dans la presse des mencheviks. Kamenev confirme lui-même la rumeur quand, à la grande fureur de Lénine, il publie dans le journal de Maxime Gorki un article condamnant le principe d'un soulèvement armé des bolcheviks. Kerenski, de son côté, pense bénéficier du soutien de la troupe, des mencheviks et des socialistes révolutionnaires. Mais, le 21 octobre 3 novembre, la garnison se rallie au Comité militaire révolutionnaire que Trotski a créé au début du mois au sein du Soviet de Petrograd. Le coup d'État des bolcheviks est lancé le trois jours plus tard, à la veille du congrès des Soviets. Les Gardes rouges, détachements armés des bolcheviks, s'assurent le contrôle des points stratégiques de la ville et, au matin du 25 octobre 7 novembre, quelques heures avant l'ouverture du congrès, Lénine fait publier un communiqué du Comité militaire révolutionnaire annonçant la destitution du gouvernement provisoire et convoquant dans la foulée le Soviet de Petrograd pour constituer un pouvoir soviétique : en agissant avant que ne s'ouvre le congrès, Lénine attribue le pouvoir à un comité militaire qui ne dépend en rien du pouvoir des Soviets, et exclut dans les faits tout partage du pouvoir avec les autres organisations socialistes. Dans l'après-midi, Lénine, toujours glabre et méconnaissable, fait sa première apparition publique depuis plusieurs mois lors de la session du Soviet de Petrograd, durant laquelle il proclame que la révolution des ouvriers et des paysans est désormais réalisée. Le Palais d'Hiver, où se sont réfugiés les membres du gouvernement, tombe dans la nuit. Entretemps, protestant contre le fait que les bolcheviks aient réalisé un coup de force avant toute décision du Soviet, les mencheviks et le Bund quittent le congrès. Martov et ses amis, qui cherchaient à constituer un gouvernement de coalition, sont réduits à l'impuissance et quittent eux aussi la salle, laissant le champ libre à Lénine et Trotski. Le congrès vote ensuite un texte rédigé par Lénine, qui attribue tout le pouvoir aux Soviets, donnant à l'insurrection des bolcheviks les apparences de la légitimité.
Peu après minuit, deux heures après l'arrestation des ministres du gouvernement provisoire, le Soviet ratifie deux décrets préparés par Lénine. Le Décret sur la paix invite « tous les peuples et leurs gouvernements » à négocier en vue d'une juste paix démocratique, le but du texte - que les Alliés refuseront de prendre en compte - étant de susciter dans l'opinion internationale suffisamment de remous pour contraindre les gouvernements à rechercher la paix, tout en se plaçant délibérément dans la perspective d'une révolution européenne. Le second texte, le Décret sur la terre, légitime l'appropriation, effectuée depuis l'été par les paysans, des terres cultivables ayant appartenu aux grands propriétaires ou à la couronne, voire aux paysans aisés : ce deuxième décret, qui s'inspire nettement du programme des socialistes révolutionnaires, permet aux bolcheviks de s'assurer, au moins pour un temps, le soutien de la paysannerie. Après la ratification des décrets, un nouveau gouvernement, le Conseil des commissaires du peuple ou Sovnarkom, est constitué, sous la présidence de Lénine.
Victoire des bolcheviks, naissance du communiste international
Mise en place du régime soviétique Affirmation du pouvoir bolchevik
Le premier Conseil des commissaires du peuple ne compte que des bolcheviks,conformément à la volonté de Lénine de ne pas partager le pouvoir avec les autres formations révolutionnaires Le nouveau comité exécutif du Soviet de Petrograd, dans lequel les mencheviks et les S-R refusent de siéger, est composé de bolcheviks et de socialistes révolutionnaires de gauche162. Lénine aurait, selon les dires de Trotski, proposé dans un premier temps que la présidence du Sovnarkom soit confiée à ce dernier, eu égard à son rôle décisif dans la prise du pouvoir ; Trotski aurait cependant refusé, arguant de la légitimité révolutionnaire de Lénine.
Quelques jours après la prise du pouvoir, l'idée de former un nouveau gouvernement de coalition englobant des mencheviks et des S-R semble prévaloir, malgré l'hostilité de Lénine. Un groupe, composé de Zinoviev, Kamenev, Rykov et Noguine, négocie avec les autres socialistes en envisageant d'exclure Lénine et Trotski de la coalition ; Zinoviev, Kamenev et leurs alliés dénoncent notamment les tentatives de Lénine pour faire échouer les négociations, ainsi que son comportement à l'égard des autres socialistes. Dès le 27 octobre, en effet, Lénine fait fermer les journaux d'opposition ; il légalise cette mesure en faisant adopter un décret qui donne aux bolcheviks le monopole de l'information dont le contrôle de la radio et du télégraphe et donne le droit aux autorités de fermer tout journal qui sème le trouble en publiant des nouvelles volontairement erronée. Kamenev - que Lénine fait condamner par le Comité central pour activités anti-marxistes - Zinoviev et plusieurs de leurs amis démissionnent du CC pour protester contre ce manquement aux promesses sur la liberté de la presse. Ils sont cependant rapidement réintégrés, et la question de la coalition oubliée, Lénine ayant réussi à imposer ses vues et à affirmer son autorité personnelle sur le Parti. D'emblée, Lénine envisage de soutenir la révolution par des mesures terroristes : dans l'article Comment organiser l'émulation ?, rédigé en décembre 1917, il appelle les masses à poursuivre un but unique : épurer la terre russe de tous les insectes nuisibles, des puces les filous, des punaises les riches, etc. ... Ici, on mettra en prison une dizaine de riches, une douzaine de filous, une demi-douzaine d'ouvriers qui tirent au flanc .... Là, on les enverra nettoyer les latrines. Ailleurs, on les munira, au sortir du cachot, d'une carte jaune afin que le peuple entier puisse surveiller ces gens nuisibles jusqu'à ce qu'ils soient corrigés. Ou encore on fusillera sur place un individu sur dix coupables de parasitisme.
Dans les jours qui suivent leur coup de force, le pouvoir des bolcheviks apparaît encore très instable. Des combats se poursuivent en effet à Moscou, où la prise du pouvoir est moins aisée qu'à Petrograd, et ils sont confrontés à une grève des fonctionnaires, qui refusent de se soumettre au nouveau gouvernement. Plusieurs semaines sont nécessaires pour briser la réticence de la bureaucratie, progressivement mise au pas via l'arrestation des meneurs de la grève et la nomination de commissaires politiques pour superviser les fonctionnaires ; les hauts fonctionnaires récalcitrants sont remplacés par des militants bolcheviks, ou par des fonctionnaires subalternes sympathisants de la révolution et promus pour l'occasion. Les combats à Moscou tournent à l'avantage des bolcheviks, et la tentative de Kerenski pour monter une contre-offensive échoue totalement. Les premières semaines de pouvoir des bolcheviks s'accompagnent également d'un dessaisissement du Soviet de Petrograd, auquel Lénine n'entend pas laisser de pouvoir réel. Le Sovnarkom prive rapidement les délégués soviétiques d'influence en s'arrogeant le droit de gouverner par décret en cas d'urgence et le Soviet se réunit de moins en moins fréquemment, alors que le gouvernement de Lénine se réunit plusieurs fois par jour.
Le lendemain de la révolution d'Octobre, Lénine annonce que le nouveau régime sera fondé sur le principe du contrôle ouvrier : les modalités de celui-ci sont fixées par décret fin novembre ; dans chaque ville est créé un Conseil du contrôle ouvrier, subordonné au Soviet local. Le Conseil national du contrôle ouvrier prévu par le décret est cependant, d'emblée, subordonné au Conseil suprême de l'économie nationale, qui dessaisit les ouvriers de tout pouvoir de contrôle réel. À la mi-décembre 1917, le Sovnarkom commence à nationaliser les entreprises industrielles. Un ensemble de décrets sont pris dans les mois qui suivent pour modifier la société russe : entre autres décisions, l'Église et l'État sont séparés, le divorce facilité et l'État-civil laïcisé. Au moment de la révolution d'Octobre, durant une absence de Lénine, la peine de mort a par ailleurs été abolie, au grand déplaisir du dirigeant bolchevik qui la juge indispensable dans le contexte de la Russie.
Le nouveau régime entreprend également de redéfinir les rapports entre les nationalités de l'ex-empire russe. Le Sovnarkom, où Staline occupe le poste de commissaire aux nationalités tente de mettre en œuvre les conceptions de Lénine, qui vise une unité socialiste des nations : en novembre 1917, la Déclaration des droits des peuples de Russie affirme le principe de l'autodétermination des peuples et de l'union volontaire et honnêtes des peuples de Russie, tous proclamés égaux. Le texte pose, sans y apporter de réponse, la question de l'organisation du nouvel État, dont on ne sait encore s'il doit être centralisé ou fédéral. En janvier 1918, la Déclaration des droits des masses laborieuses et exploitées, adoptée par le 3e congrès des Soviets, stipule que toutes les nations pourront décider si et sur quelles bases elles rejoindront les institutions fédérales soviétiques : le principe fédéral, que Lénine avait jusqu'alors repoussé, s'impose dans les faits pour éviter la désintégration de l'ex-empire, où se manifestent de nombreuses volontés d'indépendance. L'union des peuples au sein de l'État soviétique est décidée par le biais du congrès des Soviets de chaque nationalité ; Lénine conçoit la fédération comme une étape transitoire avant la révolution mondiale, le but devant être, à ses yeux, le dépassement des différences nationales en vue d'une union internationale des travailleurs au sein du mouvement révolutionnaire. Les espoirs de Lénine d'une union volontaire des peuples à la faveur de l'autodétermination ne se réalisent cependant pas : l'ancien empire se disloque rapidement, les indépendantismes tirant souvent profit des diverses interventions étrangères. Les différentes puissances européennes appuient en effet les indépendances locales, afin notamment de se protéger de la contagion bolchévique en constituant un glacis territorial aux frontières de la Russie. La Pologne se trouve en état d'indépendance de fait ; la Finlande emprunte également cette voix de même, grâce au soutien des Allemands, que les trois Pays baltes Lettonie, Estonie, Lituanie et l'Ukraine ; la Géorgie où les mencheviks locaux prennent le pouvoir proclame elle aussi son indépendance, tout comme les autres territoires du Caucase et des peuples comme les Kazakhs et les Kirghizes
En Russie même, les bolcheviks tirent profit d'un double processus, qui leur permet d'affermir progressivement leur maîtrise de l'État : tandis qu'ils centralisent les leviers du pouvoir exécutif, la délégation du pouvoir local aux Soviets, comités de soldats et organisations ouvrières contribue à démanteler les anciennes structures sociales. Durant six mois, les campagnes russes vivent une expérience unique de pouvoir paysan sur fond de redistribution des terres, la paysannerie étant confortée par le décret. Sur le front, l'action des comités de soldats, encouragés par les bolcheviks, vise à empêcher les officiers de l'ancienne armée tsariste d'agir contre le nouveau régime. Le 5 décembre, le Comité militaire révolutionnaire est dissous et remplacé par la Tchéka, nouvel organisme chargé de la sécurité, dirigé par Félix Dzerjinski.
Les bolcheviks avaient, durant les mois précédant la révolution d'octobre, reproché au gouvernement provisoire de repousser l'élection d'une Assemblée constituante chargée de mettre en place les nouvelles institutions. Lénine, malgré son peu d'estime pour la démocratie électorale, honore la promesse de son parti et le scrutin est convoqué : l'élection de novembre se solde cependant par une nette victoire des socialistes révolutionnaires, qui restent le parti le plus populaire au sein de la paysannerie. Les bolcheviks et leurs alliés socialistes révolutionnaires de gauche envisagent dès lors de dissoudre l'assemblée. Lénine rédige en décembre ses Thèses sur l'Assemblée constituante, dans lesquelles il affirme que, les intérêts de la révolution étant supérieurs à ceux de l'Assemblée, celle-ci doit se soumettre au gouvernement révolutionnaire ou bien disparaître. Le gouvernement commence par réduire une partie des opposants au silence : les principaux dirigeants du Parti constitutionnel démocratique sont arrêtés et décrétés ennemis du peuple : le parti est interdit, sort qui est par la suite celui de l'ensemble des autres formations politiques. L'Assemblée constituante se réunit finalement le 18 janvier 5 janvier du calendrier julien 1918 ; quelques heures avant, les troupes des bolcheviks dispersent à coups de feu une manifestation qui protestait contre les menaces de coup de force, causant une dizaine de morts. L'Assemblée élit à sa présidence le S-R Viktor Tchernov, contre la S-R de gauche Maria Spiridonova que soutenaient les bolcheviks, et entreprend d'annuler les décrets d'octobre. Dès le lendemain, la constituante est déclarée dissoute et son bâtiment fermé par les Gardes rouges. Le Conseil des commissaires du peuples restreint ensuite les attributions du Congrès des Soviets et crée, comme organe permanent des Soviets, un Præsidium entièrement contrôlé par les bolcheviks : le pouvoir par en bas des Soviets cesse dès lors d'exister. Les bolcheviks, qui assimilent la volonté de leur parti à la conscience populaire, sont désormais libres de décider seuls de la forme des institutions futures.
La paix de Brest-Litovsk Traité de Brest-Litovsk.
La principale urgence pour le nouveau régime demeure, fin 1917 - début 1918, la guerre qui continue contre les armées des Empires centraux. Un armistice temporaire est conclu et des pourparlers entre le gouvernement bolchevik, l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, s'engagent à Brest-Litovsk. La direction des bolcheviks est divisée sur la ligne à adopter lors des négociations pour aboutir à la paix : Lénine penche pour la signature immédiate d'une paix séparée pour « sauver la révolution, tandis que Boukharine refuse un tel traité et préconise une guerre révolutionnaire, dont il pense qu'elle pourra susciter un soulèvement du prolétariat européen. Trotski, commissaire aux affaires étrangères, propose de proclamer que la Russie se retire du conflit, sans pour autant signer la paix. Lénine, opposé à cette solution, la préfère cependant à celle de Boukharine. Le 10 février, Trotski met fin aux pourparlers, en annonçant la fin de l'état de guerre. Conformément aux craintes de Lénine, les Empires centraux relancent alors l'offensive : Lénine propose de demander une paix immédiate, mais son option est rejetée à une voix de majorité par le Comité central. Le prolétariat allemand, dont Trotski préconisait d'attendre la réaction, ne se soulève pas ; devant la rapidité de l'avance des troupes ennemies, Lénine réussit finalement à faire adopter sa ligne par le CC. Le traité de Brest-Litovsk est signé le 3 mars, contraignant la Russie à retirer ses troupes de l'Ukraine tenue par les indépendantistes et d'abandonner toute prétention sur la Finlande et les Pays baltes. Lénine, comme Boukharine, continue de viser la révolution à l'échelle mondiale ; il considère néanmoins cette paix comme indispensable pour éviter l'écrasement de la Russie soviétique, qui n'a pas encore les moyens de se défendre militairement. Le régime soviétique, sauvé du désastre, peut prendre plusieurs décisions : lors d'un congrès extraordinaire, les bolcheviks adoptent le nom de Parti communiste de Russie bolchevik ; Lénine craignant que les empires centraux ne reprennent tout de même leur avance, le siège du gouvernement est transféré de Petrograd à Moscou, où le Sovnarkom est installé au Kremlin. Lénine lui-même s'installe dans l'ancien bâtiment du Sénat, en compagnie de son épouse et de sa sœur Maria. La paix de Brest-Litovsk, si elle apporte au gouvernement révolutionnaire le répit qu'escomptait Lénine, vaut cependant à ce dernier d'être attaqué par la ligne des communistes de gauche » réunis autour de la revue Kommunist, dirigée notamment par Boukharine. Les socialistes révolutionnaires de gauche, hostiles au traité, cessent également toute coopération avec les bolcheviks.
Dans le courant de l'année 1918, la proclamation, avec le soutien de la Russie soviétique, d'un gouvernement socialiste en Finlande, paraît confirmer les idées de Lénine : après l'autodétermination du pays, l'autodétermination des travailleurs montrera que les ouvriers sont capables de décider seuls de leur destin et de rejoindre le camp révolutionnaire. Mais les espoirs de Lénine sont rapidement déçus ; la défaite des Gardes rouges finlandais au cours de la guerre civile de 1918 met fin à l'expérience et la Finlande reste en dehors du champ d'influence de la Russie soviétique
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10161#forumpost10161
Posté le : 07/11/2015 22:28
|
|
|
|
|
Lénine 5 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
La Russie entre guerre civile et terreur Début de la guerre civile
Guerre civile russe et Communisme de guerre.
Sauvé par le traité de Brest-Litovsk, le régime bolchevik demeure néanmoins confronté à une multitude de graves problèmes. La perte de l'Ukraine a privé la Russie d'une de ses principaux greniers à blé. Le pays souffre de la faim, problème qui va en s'aggravant avec la guerre civile et la désorganisation des infrastructures. L'arrêt des combats sur le front de l'Est ne signifie pas la fin des violences en Russie, où des Armées blanches, soutenues à partir de juin 1918 par une intervention internationale d'ampleur assez limitée, se soulèvent contre le régime bolchevik ; des S-R proclament en juin 1918 un gouvernement, le Comité des membres de l'Assemblée constituante, qui s'allie en Sibérie avec l'amiral Koltchak, l'un des chefs des « Blancs », avant d'être dissous par ce dernier en décembre. En juillet, les S-R de gauche entrent en rébellion contre leurs anciens alliés bolcheviks, mais leur tentative d'insurrection, maladroitement menée, est vite déjouée.
La Russie sombre dans une guerre civile d'une extrême violence, Rouges et Blancs se livrant à des campagnes de terreur contre le camp adverse. Durant le conflit, Lénine s'impose un rythme de travail éprouvant et mène une existence quasi spartiate. Face à la gravité de la situation et à la multiplication des soulèvements, le gouvernement bolchevik doit improviser une armée - l'Armée rouge, organisée notamment par Trotski, nommé commissaire du peuple à la Guerre - et un mode de fonctionnement économique, le communisme de guerre. Toutes les entreprises ayant un capital de plus d'un demi-million de roubles sont nationalisées en juin 1918 mesure étendue en novembre 1920 à toutes celles de plus de 10 ouvriers, cette dernière décision n'étant, dans les faits, qu'imparfaitement appliquée. Les villes étant frappées par la famine du fait du manque de blé, le Commissariat du peuple au ravitaillement reçoit des pouvoirs très étendus, le gouvernement voulant étendre la lutte des classes dans les campagnes pour assurer l'approvisionnement des villes. Lénine fait voter en juin 1918 la constitution de Comités des paysans pauvres Kombedy, qui sont envoyés dans les campagnes et opérer les réquisitions des surplus agricoles : face aux problèmes de recrutement, ces Kombedy sont souvent formés non de paysans locaux, mais d'ouvriers au chômage et d'agitateurs du Parti. Les bolcheviks décrètent la division de la paysannerie russe, selon un schéma marxiste simpliste, entre koulaks paysans riches, paysans moyens et paysans pauvres ; les réquisitions, opérées de manière totalement inadaptée, touchent l'ensemble de la masse des populations paysannes, exacerbant les tensions et provoquant des soulèvements. Lénine envoie, en août 1918, une série de télégrammes ordonnant une répression impitoyable de l'opposition paysanne, qu'il attribue aux koulaks. Il envoie ainsi au Comité exécutif du Soviet de Penza un message intimant l'ordre de 1) Pendre (et je dis pendre de façon que les gens les voient pas moins de 100 koulaks, richards, buveurs de sang connus 2 publier leurs noms 3) s'emparer de tout leur grain 4) identifier les otages comme nous l'avons indiqué dans notre télégramme hier. Faites cela de façon qu'à des centaines de lieues à la ronde les gens voient, tremblent, sachent et se disent : ils tuent et continueront à tuer les koulaks assoiffés de sang. ... PS : Trouvez des gens plus durs.
La spoliation dont ils font l'objet amène les paysans à réduire dramatiquement leur production, parfois à soutenir les ennemis des rouges, armées blanches ou vertes ». Parfois aussi, les détachements de réquisition prennent toute la nourriture, jusqu'aux graines nécessaires aux semailles des paysans qui résistent. En janvier 1919, les recherches désordonnées de surplus agricoles sont remplacées par un système centralisé de réquisition, qui continue de dresser la paysannerie contre le gouvernement. Le pouvoir réagit avec violence contre ses multiples opposants. Trotski donne aux troupes l'ordre de réprimer sans pitié les ennemis supposés : dans toute la Russie, on fusille les Blancs capturés, les paysans, ainsi que les soldats et officiers ayant manqué d'énergie à réprimer. En juillet 1918, Lénine décide de faire arrêter les dirigeants mencheviks. Durant l'été 1918, soit avant même le déclenchement officiel de la Terreur rouge, les dirigeants bolcheviks, au premier rang desquels Lénine et Dzerjinski, envoient un grand nombre de messages aux dirigeants locaux de la Tchéka, demandant des mesures prophylactiques pour éviter tout risque d'insurrection, notamment en prenant des otages parmi la bourgeoisie. Le 9 août, Lénine télégraphie à Penza l'ordre d'enfermer les koulaks, les prêtres, les Gardes blancs et autres éléments douteux dans un camp de concentration.
Durant la guerre contre les Blancs, malgré son manque d'expérience en matière militaire, Lénine acquiert rapidement des compétences dans ce domaine, et ne montre aucune hésitation à ordonner l'usage de la force. Contrairement à Trotski, qui se déplace quasiment en permanence sur le front, Lénine ne s'approche pas des combats et envoie ses directives depuis Moscou ; il n'en est pas moins l'un des dirigeants les plus influents sur la conduite des opérations. L'un de ses principaux bras droits est alors Iakov Sverdlov, qui joue un rôle clé dans l'organisation du Parti et de l'État, jusqu'à sa mort de la grippe espagnole en mars 1919. Lénine est privé d'un collaborateur précieux par le décès de Sverdlov : dans les années qui suivent, il tente de remplacer ce dernier par plusieurs apparatchiks successifs - parmi lesquels Preobrajenski et Molotov - avant que son choix ne se porte finalement sur Staline.
Dictature des bolcheviks et terreur rouge
Terreur rouge Russie, Décosaquisation et République socialiste fédérative soviétique de Russie.
Le tsar déchu Nicolas II et sa famille sont, depuis la révolution, assignés à résidence à Iekaterinbourg. Lénine exprime très tôt sa volonté d'exterminer tous les Romanov, c'est-à-dire une bonne centaine ; cet avis est finalement suivi d'effet dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, quand Nicolas II, son épouse et leurs enfants sont massacrés par un détachement de la Tchéka. D'autres membres de la famille royale, installés à Perm ou à Alapaïevsk, sont également massacrés. Trotski rapporte dans ses écrits que Sverdlov lui aurait expliqué que Lénine ne souhaitait pas laisser aux Blancs un symbole autour desquels se rallier. Lénine cache dans un premier temps le massacre des enfants du couple impérial, pour éviter que le meurtre d'adolescents ne soulève l'horreur du public : il faut attendre 1919 pour que le pouvoir reconnaisse n'avoir épargné aucun membre de la famille. De manière plus large, Lénine prend garde de ne pas mêler officiellement son nom aux mesures les plus répressives : ses directives, ordonnant de tuer ou de fusiller les opposants, demeurent secrètes, alimentant dans l'opinion le mythe du bon Lénine. En 2011, une commission d'enquête russe ne permet pas de trouver la preuve absolue du fait que Lénine ait ordonné directement de tuer la famille impériale.
Face à l'ensemble des oppositions, Lénine se montre partisan de mesures terroristes et de la répression la plus violente : dans de nombreuses directives, il ordonne des exécutions publiques ou des mesures de répression et d'épuration à grande échelle, ainsi que l'instrumentalisation des tensions ethniques pour déstabiliser les gouvernements séparatistes. Ces documents, par la suite censurés durant des décennies et absentes de l'édition de ses œuvres complètes publiée en URSS, ne deviennent publics qu'en 1999. En janvier 1919 est également décidée la politique de décosaquisation, qui se traduit par l'élimination physique d'une partie importante de la population cosaque, soutien de l'ancien régime ; l'historienne Hélène Carrère d'Encausse qualifie la campagne menée contre les cosaques de véritable génocide.
Premières armoiries de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Alors que la guerre civile se poursuit, le gouvernement de Lénine continue de mettre en place les outils d'une dictature politique. Lors du premier congrès des syndicats, en janvier 1918, un texte des mencheviks prévoyant le maintien du droit de grève est rejeté, au motif que la République des Soviets étant un État ouvrier, il est absurde que les ouvriers puissent faire grève contre eux-mêmes. Les syndicats sont ensuite placés sous l'influence directe du Parti communiste. Après l'échec du soulèvement des S-R de gauche et l'arrestation des dirigeants KD, les autres partis politiques sont progressivement éliminés, les communistes s'assurant le monopole du pouvoir. Les effectifs de la Tchéka connaissent une croissance exponentielle : Lénine, avec les autres dirigeants bolcheviks, appelle au développement d'une terreur populaire. Le 6 juin 1918, un décret rétablit la peine de mort. Le 10 juillet 1918, la première constitution de la République socialiste fédérative soviétique de Russie RSFSR est adoptée : La formation de partis politiques autres que le Parti communiste n'est pas explicitement interdite, mais l'article 23 de la constitution précise que le nouveau régime refuse aux personnes et aux groupes les droits dont ils peuvent se servir au détriment de la révolution socialiste. Par ailleurs, une catégorie de plusieurs millions d'exclus est créée, les oisifs, ecclésiastiques, anciens bourgeois et nobles étant décrétés inéligibles et privés du droit de vote.
L'exercice du pouvoir de Lénine entre donc en contradiction avec ses propres théories : bien que se présentant fidèle aux thèses de Marx et Engels sur le caractère transitoire de la dictature du prolétariat, il se trouve amené, confronté au chaos, à la guerre civile et aux problèmes de ravitaillement, à renforcer l'appareil d'État et à mettre sur pied une dictature, loin du dépérissement progressif des institutions étatiques annoncé dans L'État et la Révolution. Le pouvoir est progressivement monopolisé par le Parti communiste, tandis que la police politique - la Tchéka, remplacée en février 1922 par le Guépéou - devient un organe de contrôle absolu. Bien que les Soviets exercent en principe le pouvoir, l'État est, dans les faits, dirigé par le Parti communiste.
L'attentat dont est victime Lénine lui-même contribue à accentuer le caractère autoritaire du régime bolchevik, en faisant passer les mesures de terreur à un degré très supérieur ; le 30 août 1918, Fanny Kaplan, membre du Parti socialiste-révolutionnaire, tente en effet d'assassiner Lénine : elle l'approche alors que celui-ci regagne sa voiture à l’issue d’un meeting à l'usine Michelson de Moscou, et lui tire dessus à trois reprises. Deux balles atteignent Lénine : l'une à la poitrine, l'autre à l'épaule ; il est emmené à son appartement privé au Kremlin et refuse de s’aventurer à l'hôpital, craignant que d'autres assassins ne l'y attendent. Les médecins appelés à son chevet renoncent à retirer la balle pénétrée par son épaule et logée dans son cou, qui se trouve dans un endroit trop proche de la colonne vertébrale pour que l'on puisse tenter une opération chirurgicale avec les techniques disponibles en Russie à l'époque. Le 25 septembre, Lénine, jugé transportable, est conduit à Vichnie Gorki pour y poursuivre sa convalescence.
Fanny Kaplan est interrogée par la Tchéka puis exécutée sans jugement cinq jours après sa tentative d'assassinat. En réaction, le Conseil des commissaires du peuple émet le décret instituant la Terreur rouge. La Tchéka est désormais dégagée de toute considération légale : après la répression des S-R de gauche et l'exécution de la famille impériale, qui avait marqué les premières étapes de la répression politique, une campagne de terreur sans précédents s'abat sur l'ensemble du pays, entraînant rapidement des dizaines, voire des centaines de milliers de morts parmi les ennemis, réels ou supposés, du régime. Agissant de manière totalement arbitraire, la Tchéka multiplie arrestations, tortures et arrestations. Le système concentrationnaire - le premier camp étant apparu quelques mois après la révolution - se développe rapidement, et les centres de détention se multiplient.
Félix Dzerjinski, chef de la Tchéka est chargé de l'application de la politique de Terreur rouge.
Durant les deux mois qui marquent l'apogée de la Terreur rouge septembre et octobre 1918, la Tchéka fait entre 10 000 et 15 000 victimes. Lénine, pour sa part, soutient pleinement la Tchéka, qualifiant les critiques dont elle fait l'objet au sein même du Parti de racontars petits-bourgeois; il ne change à aucun moment de position, même dans les occasions où il cautionne des sanctions contre certains tchékistes. La continuité entre le système de camps de travail à l'époque de Lénine et le Goulag proprement dit, qui naît à l'époque stalinienne, est sujette à débats ; Moshe Lewin juge que le Goulag présente un lien organique avec le système stalinien tandis que Anne Applebaum présente le Goulag comme le prolongement naturel des camps de la Tchéka, dont les méthodes ont elles-mêmes été suscitées et alimentées par le climat d'extrême violence que connaissait alors la Russie.
La tentative d'assassinat contre Lénine a par ailleurs comme conséquence de le rendre plus familier du peuple russe : jusque-là relativement peu connue du grand public par-delà les portraits officiels, la figure de Lénine fait l'objet d'un début de culte de la personnalité, le Parti s'employant à susciter une émotion populaire autour de l'attentat. Sa survie est présentée comme un miracle, la presse des bolcheviks faisant de Lénine une figure christique aux pouvoirs quasi-surnaturels. Des ouvrages hagiographiques sur Lénine, parfois comparables aux vies de Saints, sont publiés. Lénine lui-même n'apprécie guère les flatteries courtisanes, mais il ne s'oppose pas non plus au développement de ce culte. Il se prête au contraire au jeu et pose pour des sculptures et des portraits officiels, considérant que la diffusion de son image est utile et même nécessaire car les paysans russes, souvent illettrés, doivent voir pour croire et ont besoin de portraits pour se convaincre que Lénine existe. A contrario, Lénine est diabolisé par la propagande des Armées blanches, qui le présente comme le principal responsable, avec Trotski, d'une conspiration juive contre la Russie et l'ensemble de la civilisation.
Lénine reprend le travail à la mi-octobre 1918, malgré une santé encore précaire. Il s'accorde des parties de chasse dans les environs de Moscou, en compagnie d'autres dirigeants bolcheviks, mais ses sorties accroissent son état de fatigue ; il ressent de fréquentes douleurs, qui semblent avoir découlé de légers problèmes cardiaques. Lénine devient, dès lors, d'autant plus impatient de voir la révolution mondiale se réaliser avant sa mort. Ses relations avec Nadejda Kroupskaïa, elle-même fatiguée par ses problèmes de santé, semblent s'être dégradées durant sa convalescence, d'autant plus qu'Inessa Armand a été l'une des premières personnes à rendre visite à Lénine après l'attentat. Malgré ses soucis de santé, qui lui imposent un séjour en sanatorium, et le poids de ses responsabilités politiques, Lénine prend le temps de polémiquer avec ses adversaires politiques. Son vieil adversaire Karl Kautsky a en effet publié en 1918 un ouvrage critiquant la mise en place d'une dictature politique en Russie et soulignant que la dictature du prolétariat dont se réclame Lénine est bien loin de celle envisagée par Marx, qui n'a d'ailleurs employé que rarement le terme. Lénine réagit en rédigeant à la fin 1918 une brochure intitulée La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, dans laquelle il invective Kautsky, et réaffirme que le socialisme ne saurait être mis en place que par le biais de mesures dictatoriales. Dans le courant de l'année 1919, Lénine continue de souffrir de fréquentes migraines, d'insomnies et de douleurs cardiaques ; il parvient à se détendre durant l'été en passant du temps avec son frère Dmitri, qu'il retrouve après dix ans de séparation, mais son état physique et psychologique demeure médiocre.
Le régime bolchevik poursuit sa réorganisation et, en janvier 1919, le Comité central crée deux organes de direction du Parti communiste, le Politburo - dont fait partie Lénine - et l'Orgburo : bien qu'émanant du Parti, ils constituent désormais les principaux centres de direction de l'État soviétique, leurs décisions primant sur celles du Conseil des commissaires du peuple ; le Politburo constitue désormais le véritable gouvernement de la RSFSR. Malgré la consolidation de l'autorité des bolcheviks et les mesures de terreur, des mécontentements parviennent encore à s'exprimer en Russie, notamment dans les milieux ouvriers où éclatent plusieurs grèves : en mars 1919, Lénine lui-même, venu haranguer des ouvriers grévistes aux usines Poutilov, est hué aux cris de à bas les youpins et les commissaires ! . Quelques jours plus tard, la Tchéka prend d'assaut les usines et arrête 900 ouvriers. Le 1er avril, une autre grève ouvrière éclate à Toula, fief menchevik où se trouvent les dernières usines d'armements à la disposition du gouvernement soviétique : Lénine charge Dzerjinski de réprimer d'urgence le mouvement.
En 1919, l'Armée rouge reprend l'avantage sur les Armées blanches de Koltchak Dénikine et Ioudenitch ; les Blancs, en annulant tous les décrets d'octobre, se sont coupés de la paysannerie et n'ont présenté aucun projet politique alternatif, tandis que les Rouges ont bénéficié à la fois de chefs militaires énergiques et d'un remarquable appareil de propagande. En 1920, le dernier général blanc d'importance est Wrangel, qui continue la lutte en Crimée. Après avoir achevé de défaire les Armées blanches, le régime soviétique se défait de l'armée anarchiste ukrainienne de Nestor Makhno, qui avaient d'abord été son alliée contre les Blancs.
Création de l'Internationale communiste, échec de la révolution européenne
Scission du socialisme international. Internationale communiste.
Ayant remporté la victoire sur le gros des Armées blanches, les bolcheviks considèrent que la révolution, réalisée dans un pays aussi attardé que la Russie, ne peut espérer déboucher sur le socialisme que si elle s'étend aux grands pays capitalistes développés ; Lénine revient ainsi à son idée de création d'une nouvelle Internationale, pour remplacer la Deuxième Internationale discréditée par le soutien des partis socialistes à la Première Guerre mondiale. Lors de la capitulation de l'Empire allemand à la fin de la Première Guerre mondiale, Lénine abroge le traité de Brest-Litovsk, se libérant des conséquences de la paix obscène conclue avec les Empires centraux ; la révolution socialiste européenne figure à nouveau parmi ses objectifs immédiats. En Allemagne, une prise du pouvoir par les révolutionnaires procurerait à la Russie un allié de premier ordre : les dirigeants spartakistes, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, n'ont guère de proximité politique avec Lénine, mais apparaissent comme les seuls alliés possibles. Les spartakistes se constituent en Parti communiste d'Allemagne et tentent une insurrection à Berlin, mais leur coup de force échoue et Rosa Luxemburg comme Karl Liebknecht sont tués. L'échec des communistes allemands apparaît comme un désastre du point de vue de la révolution européenne ; dans la perspective de la fondation d'une Internationale, Lénine voit en revanche sa tâche facilitée, car Rosa Luxemburg s'opposait à ce projet et aurait pu lui porter la contradiction. Le 2 mars 1919, le premier congrès de l'Internationale communiste dite également Troisième Internationale, ou Komintern se tient à Moscou, en présence d'un nombre réduit de délégués, dont seuls quatre sont venus de l'étranger : l'organisation, dont Zinoviev prend la tête, se place d'emblée dans la perspective d'une révolution européenne et vise à la création de partis communistes sur tout le continent.
Quelques semaines après la fin du premier congrès de l'Internationale communiste, et pendant le VIIIe congrès du Parti communiste, Lénine apprend que la révolution vient d'éclater à Budapest : Béla Kun, chef des communistes hongrois, fonde la République des conseils de Hongrie. L'échec rapide de cette révolution et l'écrasement de la République des conseils de Bavière, qui font suite à la défaite des révolutionnaires finlandais l'année précédente, convainquent Lénine de la nécessité de mieux coordonner l'action des partis communistes, en organisant des ramifications de l'Internationale à l'étranger.
En 1918, l'armée allemande à l'Est commence à battre en retraite vers l'Ouest. Les zones abandonnées par les puissances centrales deviennent le théâtre de conflits entre les gouvernements locaux mis en place par les Allemands, d'autres gouvernements qui ont éclos indépendamment après le retrait allemand, et les bolcheviks, qui espèrent incorporer ces zones dans la Russie soviétique. En novembre 1918, Lénine ordonne à l'Armée rouge d'avancer vers l'Ouest, en occupant les territoires que quittent les Allemands. Le but poursuivi est d'atteindre l'Europe centrale, d'installer des gouvernements soviétiques dans les pays nouvellement indépendants de la région et de soutenir les révolutions communistes en Allemagne et Autriche-Hongrie. La situation internationale change radicalement quand la Pologne, reconstituée et indépendante depuis peu, s'oppose à la Russie soviétique et avance vers l'est en vue de reprendre ses territoires orientaux, annexés par la Russie à l’occasion de la partition de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Józef Piłsudski, chef de l'armée polonaise, juge que la sécurité de la Pologne face à la Russie pourra être assurée en constituant un bloc avec le territoire ukrainien ; la Pologne reçoit en outre le soutien des pays occidentaux, qui sont désormais convaincus que les Armées blanches ne l'emporteront pas en Russie et désirent contenir les communistes. La guerre soviéto-polonaise débute mal pour les Polonais qui, sous-estimant l'Armée rouge, sont repoussés ; les forces soviétiques avancent dès lors vers Varsovie. À la fin de 1919, les victoires militaires des bolcheviks et la multiplication des tentatives révolutionnaires à l'étranger donnent à Lénine le sentiment que le moment est venu de sonder l’Europe avec les baïonnettes de l’Armée rouge pour étendre la révolution vers l’ouest, par la force. À ses yeux, la Pologne apparaît comme le pont que l’Armée rouge doit traverser afin d’établir le lien entre la Révolution russe et les partisans communistes d’Europe occidentale. C'est à cette même époque, en mai 1920, que Lénine rédige son dernier ouvrage important, La Maladie infantile du communisme le gauchisme, dans lequel il répond aux critiques de la gauche communiste sur ses méthodes de gouvernement : d'une part, il affirme, fort du succès des bolcheviks en Russie, que la révolution ne peut espérer l'emporter que commandée par un parti ; d'autre part, il tempère le radicalisme révolutionnaire des gauchistes en prônant une action adaptée aux situations des différents pays, et qui utiliserait de manière raisonnable les syndicats et les parlements.
Le second congrès de l'Internationale communiste, cette fois organisé en présence de 200 délégués venus de 35 pays, se tient du 19 juillet au 9 août 1920, dans une atmosphère d'apothéose, alors que l'Armée rouge apparaît en position de l'emporter en Pologne et d'étendre la révolution à l'étranger. Lénine et Trotski, en position de force, imposent 21 conditions d'admission à l'Internationale communiste, destinées à renforcer l'unité de doctrine des partis communistes et qui font de la Russie soviétique l'autorité unique de l'organisation : les partis communistes sont tous tenus d'adopter comme mode de fonctionnement interne le centralisme démocratique, défini comme une discipline de fer confinant à la discipline militaire » et une organisation très hiérarchisée où la direction du parti jouit de larges pouvoirs ; toutes les décisions des Congrès et du Comité exécutif de l'Internationale communiste sont obligatoires pour eux.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10160#forumpost10160
Posté le : 07/11/2015 22:25
|
|
|
|
|
Lénine 6 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Défaite en Pologne et reflux de la vague révolutionnaire
Guerre soviéto-polonaise.
Les espoirs de Lénine sont cependant déçus dès août 1920, quand l'armée polonaise renverse la situation militaire et repousse les troupes soviétiques. La défaite de la Russie dans le conflit avec la Pologne porte un coup d'arrêt à la tentative d'exporter la révolution. Lénine doit constater la solitude internationale de la Russie soviétique, et le manque de réaction du prolétariat européen, et notamment polonais, dont il espérait un soulèvement. Lors du second congrès de la Troisième Internationale, l'Indien M.N. Roy plaide pour que soit reconnue l'importance des mouvements orientaux ; Lénine considère que la révolution doit compter sur les mouvements indépendantistes au sein des pays colonisés, mais constate que ses vues ne sont pas encore partagées par la plupart des communistes européens. Confronté à l'échec des révolutions européennes, il revient cependant à son idée de se tourner vers les arrières du monde occidental, en explorant le rôle des mouvements orientaux. Lénine demeure, en Russie, l'ennemi de l'asiatisme synonyme d'arriération, le paysan russe devant à ses yeux être européanisé- c'est-à-dire modernisé - pour sortir de sa semi-barbarie. Il considère cependant que le continent asiatique peut tenir un rôle capital dans la mondialisation de la révolution, car il accueille la majorité de la population du globe, qui lutte pour son affranchissement. Les pays arriérés d'Asie pourraient en outre, à ses yeux, suivre un schéma historique différent de celui de la Russie et sauter l'étape du capitalisme pour passer directement à un régime soviétique. En septembre 1920, le Premier congrès des peuples d'Orient » se tient à Bakou, animé par Grigori Zinoviev, Karl Radek et Béla Kun ; le congrès souligne cependant une absence d'unités de vue entre les communistes occidentaux et orientaux, ces derniers ne parvenant pas encore à faire reconnaître le caractère spécifique de leurs luttes.
En mars 1921, une tentative révolutionnaire en Allemagne échoue totalement ; Lénine est furieux d'apprendre, après coup, la manière désastreuse dont le coup de force communiste a été préparé. La priorité lui apparaît désormais de mettre les efforts du mouvement communiste au service de l'État soviétique dont il convient, en tant que base de la future révolution mondiale, de mettre au point l'organisation politique et territoriale. Malgré l'échec de la vague révolutionnaire en Europe, la tendance léniniste continue de constituer un important défi, non seulement aux démocraties parlementaires et aux régimes autoritaires occidentaux, mais également à la Deuxième Internationale et à la famille socialiste et social-démocrate dans son ensemble : durant les années 1920, les partis socialistes connaissent des scissions dans le monde entier, les militants favorables au régime bolchevik se constituant en partis communistes affiliés à la Troisième Internationale. Au sein du mouvement communiste, les conceptions de Lénine en matière d'organisation s'imposent face au gauchistes : la Gauche communiste - et notamment la tendance luxemburgiste et conseilliste qui s'oppose à la domination du parti et prône le gouvernement des conseils ouvriers - est marginalisée dès 1921. La théorie marxiste tend désormais à être assimilée avec l'interprétation qu'en donne Lénine, ce qui inclut les justifications théoriques qu'il apporte aux fluctuations de sa pratique politique.
Sur le plan privé, Lénine est par ailleurs très éprouvé, en septembre 1920, quand Inessa Armand, pour qui il avait conservé une grande affection, meurt du choléra. Il reste par la suite proche de la famille de son amie et s'assure que les enfants de celle-ci ne manquent de rien.
Révoltes en Russie et Nouvelle politique économique
Nouveaux soulèvements contre les bolcheviks
Révolte de Tambov et Révolte de Kronstadt. Malgré la victoire militaire des bolcheviks en Russie et la consolidation du régime, l'état du pays demeure désastreux. La politique du communisme de guerre, si elle a contribué à sauver le pouvoir soviétique, a également abouti à ruiner l'économie du pays220, qui subit une terrible régression : la production industrielle s'effondre et la politique des réquisitions impose à la paysannerie une ponction insupportable. Des nombreuses révoltes paysannes éclatent contre le pouvoir soviétique. L'insurrection la plus importante est celle qui se déclenche en 1920 dans la région de Tambov : ce soulèvement contribue à convaincre Lénine que le système des réquisitions agricoles doit être aboli.
Le Parti communiste doit également régler à la fois les problèmes de la qualité de son recrutement et de l'organisation du pays. En mars 1919, lors du VIIIe congrès du Parti, il est décidé de procéder à une purge des éléments douteux et de viser à l'avenir le recrutement d'authentiques prolétaires : environ 150000 militants sont exclus dans les mois qui suivent. Lénine inaugure ainsi une tradition de purges des éléments du Parti, qui sera plus tard reprise, à une bien plus grande échelle, par Staline. Celles-ci se passent cependant sans violence, contrairement aux futures pratiques de l'époque stalinienne.
Les débats internes sur l'organisation économique de la Russie sont également vifs : le courant de l'Opposition ouvrière, mené notamment par Alexandre Chliapnikov et Alexandra Kollontaï, réclame que la gestion de l'industrie soit confiée aux syndicats, une position que Lénine dénonce comme relevant de l'anarcho-syndicalisme ; Trotski, au contraire, souhaite la fusion des syndicats avec l'appareil d'État et une gestion militarisée de l'économie reposant plus sur les militants de base plus que sur la bureaucratie du Parti. Les débats se poursuivent des mois durant ; Lénine élabore un texte de compromis, qui renvoie dos-à-dos l'Opposition ouvrière et Trotski, ce dernier étant critiqué implicitement pour avoir permis la dégénérescence de la centralisation et du travail militarisé en bureaucratie.
Alors que le Parti communiste débat et que son dixième congrès doit s'ouvrir le 8 mars 1921, le régime soviétique est confronté à un nouveau péril avec la révolte de Kronstadt, soulèvement armé des marins de la forteresse qui réclament un véritable pouvoir des soviets, des élections libres, ainsi que la liberté de la presse. Au sein du Comité central, Lénine se fait l'avocat d'une répression sans pitié du soulèvement, que Trotski et Toukhatchevski se chargent d'écraser.
Famine et terreur, puis redressement économique de la Russie
Nouvelle politique économique et Famine soviétique de 1921-1922.
Au cours du dixième congrès du Parti communiste, qui se déroule en même temps que la répression de Kronstadt, Lénine fait adopter le principe du passage à une Nouvelle politique économique NEP. Cette réforme, que Lénine parvient à imposer grâce à la situation d'urgence que vit la Russie, prend le contre-pied du communisme de guerre : elle se traduit par la libéralisation du commerce extérieur et l'autorisation de créer de petites entreprises privées. Lénine restaure ainsi une forme de capitalisme d'État, en l'occurrence une dose limitée d'économie de marché, régulée par l'État et progressivement socialisée via des coopératives. Il entend ainsi assurer une transition de la Russie vers le socialisme, l'économie du pays étant à ses yeux insuffisamment développée pour passer directement à ce stade. Lénine lui-même n'est pas sans exprimer des doutes quant aux conséquences de la NEP, dont il craint qu'elle n'aboutisse au développement d'une nouvelle classe de capitalistes ; il n'en demeure pas moins convaincu que la réintroduction d'une dose de capitalisme est, pour la Russie, une étape indispensable avant d'atteindre le socialisme. Au sein du mouvement communiste, la NEP ne va pas sans susciter des oppositions - plusieurs milliers de militants quittent le Parti - ce qui pousse Lénine à faire adopter une résolution interdisant toutes les fractions au sein du Parti communiste russe. Une seconde résolution condamne les opinions de l'Opposition ouvrière concernant les syndicats et le contrôle ouvrier, que Lénine - qui avait pourtant adopté des positions similaires en 1917 - qualifie de déviation par rapport au marxisme ; la résolution adoptée par le Parti stipule que le marxisme enseigne que seul le parti politique de la classe ouvrière, c'est-à-dire le Parti communiste, est en mesure de grouper, d'éduquer et d'organiser l'avant-garde du prolétariat et de toutes les masses laborieuses ...et de diriger toutes les activités unifiées du prolétariat ». Les idées de Lénine sur le rôle dirigeant du Parti se trouvent ainsi institutionnalisées et élevées au rang de composante de la pensée marxiste, tandis que l'opposition au sein du Parti perd la possibilité de s'exprimer. Le dixième congrès est par ailleurs suivi de l'élimination définitive des mencheviks, dont les propositions présentaient de grandes ressemblances avec la NEP désormais adoptée par Lénine. L'historien Nicholas Riasanovsky juge qu'en faisant adopter la NEP, Lénine a fait preuve de qualités d'homme d'État réaliste, en dépit de la considérable opposition doctrinale qu'il a du affronter au sein du Parti. La mise en place de la NEP contribue par ailleurs à mettre en lumière les lourdeurs bureaucratiques de l'État soviétique, suscitant l'inquiétude de Lénine qui préconise de combattre les mauvaises pratiques et la paralysie administrative.
Malgré le tournant de la NEP, le régime soviétique continue de mener des politiques répressives à grande échelle. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de rebelles de Kronstadt faits prisonniers sont exécutés sans jugement ou envoyés en camp de concentration. Après l'écrasement de Kronstadt, Lénine envoie Toukhatchevski et Antonov-Ovseïenko écraser la révolte de Tambov : la répression touche non seulement les rebelles, mais également leurs familles ; l'Armée rouge fait usage de gaz asphyxiants pour venir à bout de la population paysanne révoltée. La Tchéka, sous les ordres de Dzerjinski, multiplie les arrestations de mencheviks, de socialistes-révolutionnaires et d'anarchistes. Parmi tous les opposants réprimés, Lénine voue une haine particulière aux membres des autres mouvements socialistes. Il conserve cependant, malgré les violentes polémiques qui les ont opposés, de l'affection pour son ancien ami Martov ; ce dernier est uniquement mis en résidence surveillée par la Tchéka. À l'hiver 1919-1920, apprenant que celui qui fut son rival au sein du POSDR est très souffrant, Lénine ordonne que les meilleurs médecins de Moscou soient envoyés à son chevet.
Avant que les politiques de la NEP puissent être mises en place, la Russie soviétique est victime, à partir de 1921, d'une famine atroce, causée non seulement par la sécheresse, mais également par la destruction des capacités productives des campagnes, victimes des violences et des réquisitions. Pour lutter contre la famine, Lénine préconise la restauration immédiate des structures chargées des réquisitions, malgré leur rôle dans le déclenchement du désastre. La Russie bénéficie d'une assistance extérieure, apportée notamment par les États-Unis ; Lénine accepte cette aide, mais ordonne que la Tchéka espionne la commission américaine dépêchée à Moscou pour organiser l'aide.
La famine donne également l'occasion à Lénine de lancer une vaste campagne contre le clergé russe. Le patriarche de l'église orthodoxe ayant prescrit que soient donnés, pour soutenir les victimes de la famine, tous les objets de valeur contenus dans les églises à l'exception des objets consacrés, Lénine fait ordonner la saisie générale de ceux-ci. L'opposition de l'église et des fidèles donne le signal d'une violente répression. Affirmant que le clergé est sur le point de se tourner contre le pouvoir soviétiques, Lénine écrit, dans une document secret adressé aux membres du Politburo, que le contexte de la famine permettra de réaliser la confiscation des trésors de l'église avec l'énergie la plus sauvage et la plus impitoyable, ce qui implique l'exécution du plus grand nombre possible de représentants du clergé réactionnaire et de la bourgeoisie réactionnaire ... Plus grand sera le nombre des exécutions, mieux ce sera. Près de huit mille membres du clergé russe sont tués en 1922, tandis que les églises sont pillées. L'athéisme, déjà soutenu par la propagande antireligieuse des bolcheviks, devient une composante décisive de l'idéologie d'État soviétique.
Bien que les politiques de Terreur subsistent, elles tendent ensuite à se relâcher. Durant la période de la NEP — et par-delà l'enrichissement d'une nouvelle classe de spéculateurs et de bureaucrates — la population, dans son ensemble, ne subit plus la terreur ni la famine, et tend à retrouver des conditions de vie normales. La NEP est un succès, qui fait reculer la famine et permet à l'économie russe de se redresser de manière remarquable. Après le pic de la guerre civile, le nombre de prisonniers internés dans les camps diminue fortement pour tomber à 25 000, soit le tiers de la population carcérale en Russie. Moshe Lewin affirme que ceux qui ont étudié le fonctionnement de la justice et des pratiques pénitentiaires dans les années vingt période de la NEP savent que le camp était conçu pour être une pratique plus humaine que les cages appelées prisons. Ce lieu où l'on travaillait dans des conditions proches de la normale était considéré comme le meilleur moyen de rééduquer et de réhabiliter, ces conceptions libérales n'ayant pris fin que dans les années 1930 . Anne Applebaum souligne quant à elle l'existence, aux côtés des camps de rééducation, d'autres camps au régime spécial nettement plus dur, et gérés par les services de sécurité - la Tchéka, puis son successeur le Guépéou - dans des conditions parfaitement arbitraires ; les deux systèmes de camps finissent plus tard par fusionner, le second prenant le pas sur le premier. Durant la période de la NEP, Lénine lui-même continue de prôner des mesures répressives radicales, aussi bien contre les opposants que contre les saboteurs, les espions et les profiteurs qui se retrouvent jusque dans le Parti. Face aux abus de la bureaucratie du Parti et aux ennemis supposément infiltrés, il préconise « l'épuration par la terreur : justice sommaire, exécution sans phrases.
Lénine lui-même, au sein du Parti communiste, n'occupe pas d'autres postes officiels que ceux de membres du Comité central et du Politburo. Jugeant nécessaire de nommer un organisateur pour l'aider à contrôler l'appareil du Parti et à appliquer la NEP, il se tourne vers Staline ; en mars 1922, lors du XIe congrès, il soutient la nomination de ce dernier au poste de Secrétaire général du Comité central du Parti communiste, créé pour l'occasion. Cette fonction d'apparence technique permet à Staline de contrôler les nomination des cadres, s'assurant ainsi de solides appuis et renforçant son influence sur le Parti.
Formation de l'URSS Union des républiques socialistes soviétiques.
Jusqu'en 1920, Lénine croit encore à l'exportation de la révolution vers l'Ouest. Les échecs successifs des révolutions, en Finlande, en Allemagne, en Hongrie ou en Bavière, la défaite en Pologne, le conduisent à prendre acte de l'isolement de la Russie soviétique. Afin d'installer la révolution dans la durée, il convient d'organiser le territoire dont elle dispose, ce qui revient à recomposer ce que la politique d'autodétermination, dont il n'était pas parvenu à garder la maîtrise, a décomposé. Entre 1918 et 1922, la plus grande partie des anciens territoires impériaux séparés à la suite de la révolution et de la guerre civile sont réunifiés suivant un processus complexe, passant de la phase des autodéterminations - durables ou éphémères - à des phrases de regroupement dans un cadre fédéral, le plus souvent improvisé au gré des circonstances et selon l'évolution des rapports de force.
Le cadre fédéral s'impose rapidement dans les faits comme la meilleure solution pour organiser l'espace de l'État révolutionnaire et pour tenter d'éviter la désintégration provoqué tant par la possibilité d'autodétermination que par le contexte de la guerre civile et des interventions étrangères. En juillet 1918, avec l'adoption de la constitution de la République socialiste fédérative soviétique de Russie RSFSR, le cadre fédéral est fixé pour la Russie, sans que la constitution soit très précise sur le contenu et le fonctionnement de la fédération.
Durant quatre ans, la fédération se développe selon deux processus. D'une part, l'entrée au sein de la Russie de républiques ou des régions autonomes. D'autre part, une série d'alliances bilatérales entre la Russie et des Républiques soviétiques voisines, officiellement indépendantes, où les bolcheviks locaux ont pris le pouvoir durant la guerre civile : Ukraine et Biélorussie, et, dans le Caucase, Azerbaïdjan et Arménie. Un système complexe de traités lie progressivement ces républiques à la RSFSR en réduisant leurs domaines de compétences. Dans le Caucase, le cas de la Géorgie, qui souhaite conserver son indépendance et où les mencheviks locaux sont au pouvoir, s'avère plus complexe. Pressé par Ordjonikidze et Staline de recourir à la force, Lénine hésite, craignant notamment une réaction des Britanniques qui compromettrait la situation internationale de la RSFSR ; il finit cependant par se laisser convaincre de donner son accord. En février 1921, l'Armée rouge envahit la Géorgie, qui est rapidement soviétisée comme les deux autres républiques caucasiennes.
La reconquête de la Géorgie, et donc la garantie des intérêts territoriaux de la Russie, se fait au prix d'accords implicites avec diverses puissances. Lénine, qui souhaite faire sortir la Russie de son isolement, en tire également un bénéfice diplomatique, mais au détriment de l'extension de la révolution. Les Britanniques acceptent la main-mise russe sur le Caucase région cruciale à la fois du point de vue géographique, mais aussi du fait de ses matières premières en échange d'un arrêt du soutien soviétique aux tentatives révolutionnaires en Occident ; le gouvernement turc de Mustafa Kemal ferme également les yeux à condition que celui de Lénine cesse de soutenir non seulement Enver Pacha, rival de Kemal, mais également les communistes turcs.
La nécessité de mieux organiser l'économie soviétique en utilisant au mieux les ressources existantes pousse Lénine à encourager les regroupements régionaux : cela provoque néanmoins une nouvelle criser dans le Caucause, du fait de la réticence des dirigeants communistes de la RSS de Géorgie. Lénine charge alors Ordjonikidze de réorganiser la Transcaucasie, ce dont ce dernier se charge de manière unilatérale et souvent brutale ; il délègue par ailleurs la supervision de l'affaire caucasienne à Staline, dont il soutient les décisions dans un premier temps. Les difficultés persistante dans le Caucase et en Ukraine incitent Lénine à accélérer le processus de fédéralisation ; au dixième congrès du Parti, Staline expose le projet de fédération, dont le modèle sera la République fédérative de Russie, destinée à servir plus tard également de modèle à une fédération mondiale des États socialistes. Le 10 août 1922, une commission présidée par Staline est constituée pour élaborer le projet d'État fédératif. Un mois plus tard, elle présente son projet dont le principe, baptisé autonomisation, implique en réalité l'absorption des autres Républiques soviétiques par la RSFSR, dont le gouvernement deviendrait celui de la fédération. Géorgiens et Ukrainiens contestent le projet ; Lénine, temporairement éloigné par la maladie, en prend connaissance à la fin du mois et demande à Staline de revoir son projet. Aux yeux de Lénine, il convient d'unir dans une fédération des Républiques égales, et non pas dominées par la Russie : l'État fédéral devra donc avoir ses propres organes de gouvernement, qui coifferont ceux des Républiques. Staline, tout en déplorant le libéralisme national de Lénine, se conforme au souhait de ce dernier et présente un nouveau projet, qui est approuvé par le Comité central le 6 octobre. Les Géorgiens continuent néanmoins d'exprimer leurs réticences, dont la principale tient à leur refus d'intégrer l'Union en tant que simple élément de la République socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie, au sein de laquelle la Géorgie a été intégrée avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les discussions des communistes géorgiens avec Ordjonikidze sont si houleuses que ce dernier en arrive à frapper l'un de ses interlocuteurs. Lénine accueille d'abord les requêtes des Géorgiens avec scepticisme, mais finit par exiger d'être complètement informé de l'affaire. Scandalisé par ce qu'il apprend des excès d'Ordjonikidze dont il avait initialement pris le parti, il se montre de plus en plus préoccupé par le comportement de Staline et de ses alliés, et commence à revoir la politique nationale à la lumière de cette affaire242. En décembre 1922, malgré la dégradation de son état de santé - il est, dans le courant du mois, frappé par plusieurs attaques - Lénine tente de reprendre le contrôle de la situation. Déplorant que la question nationale soit confiée à des personnes qui se comportent comme des brutes bureaucratiques, il rédige des notes en vue du futur congrès du Parti, prévu en mars 1923 : il y reconnaît être gravement coupable de ne pas s'être occupé lui-même de l'autonomisation au sein de l'Union, ce qui risque d'aboutir à livrer les minorités à un produit cent pour cent russe, le chauvinisme grand-russien, qui caractérise la bureaucratie russe. Lénine, qui considérait jusque-là que les communistes étaient, par définition, des internationalistes, est forcé de reconnaître que des communistes - même issus des minorités, comme Staline et Ordjonikidze qui sont eux-mêmes Géorgiens - peuvent se comporter en ultranationalistes russes.
L'inquiétude de Lénine ne freine pas le cours des évènements, ni l'adoption par le Politburo du texte sur les Principes fondamentaux de l'Union. Le 30 décembre 1922, un traité donne naissance à l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui réunit les Républiques socialistes soviétiques de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie et de Transcaucasie. Lénine, qui souffre d'une dent, n'assiste pas à la signature du traité ; le jour même, il annonce dans une lettre à Kamenev son intention de déclarer une guerre à mort au chauvinisme russe.
Maladie et mort Dégradation de la santé de Lénine
Lénine, à la mi-1921, est épuisé mentalement et physiquement. Souffrant toujours de migraines et d'insomnies, il a subi plusieurs alertes cardiaques et connaît des difficultés croissantes pour faire face à sa charge de travail : divers médecins, dont des spécialistes étrangers, sont appelés pour l'examiner, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un diagnostic. En juin, le Politburo ordonne à Lénine de prendre un mois de repos ; il retourne alors à Gorki. Malgré sa santé déclinante, Lénine continue de suivre les affaires de l'État ; il insiste sur la nécessité d'appliquer une politique de terreur contre les opposants. Au-delà de la répression des paysans révoltés à Tambov, il prône au début de 1922 une extension de la terreur à toutes les menaces réelles ou potentielles contre le pouvoir soviétique, qu'il s'agisse d'agir contre le clergé en milieu rural ou d'organiser des procès publics contre les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks. Lénine n'obtient pas satisfaction sur tous les points : le procès des dirigeants mencheviks n'est pas organisé, mais celui des S-R a bien lieu, sans pour autant se solder par des condamnations à mort comme Lénine l'avait escompté. Sur le plan international, il se tient informé des négociations en cours à Gênes et à Rapallo après avoir, pour des raisons de sécurité et de santé, renoncé à se rendre en personne à la conférence de Gênes. Le 19 mai 1922, il demande à Félix Dzerjinski de faire dresser par la Tchéka une liste d'intellectuels soupçonnés de sympathies contre-révolutionnaires, en vue de les expulser de Russie.
Nadejda Kroupskaïa et Lénine au Manoir de Gorki.
De plus en plus angoissé par sa santé, Lénine va jusqu'à envisager le suicide au cas où il deviendrait handicapé ; il demande à Staline de lui fournir du poison dans cette éventualité. Le 23 avril 1922, sur le conseil de l'un des médecins allemands appelés à son chevet, il est opéré pour retirer la balle logée près de son cou depuis l'attentat de 1918. L'opération se passe bien mais, le 25 mai, Lénine est victime d'un accident vasculaire cérébral. Frappé d'hémiplégie du côté droit, il a en outre des difficultés à parler. Il fait l'objet de nouveaux examens pour trouver l'origine de son mal ; un test de détection de la syphilis s'avère négatif. Lénine récupère progressivement au Manoir de Gorki et continue de se tenir informé des travaux du Politburo et du Sovnarkom, notamment par l'intermédiaire de Staline qui lui rend régulièrement visite.
En juillet, son état semble s'améliorer quelque peu. Il s'informe auprès de Staline de l'expulsion de Russie des S-R, mencheviks et KD. Un nouveau malaise, le 21, provoque une paraphasie qui dure plusieurs jours. En septembre, sa capacité de travail augmente ; il reçoit de nombreux visiteurs et suit les travaux de la commission chargée de rédiger le projet mettant sur pied l'Union des républiques socialistes soviétiques.
Fin septembre, Lénine reçoit de ses médecins l'autorisation de reprendre ses fonctions. Il revient le 2 octobre dans son bureau du Kremlin, mais dépasse très rapidement les limites du rythme de travail que lui ont prescrit les docteurs. En parallèle, ses rapports avec Staline se dégradent : Lénine manifeste une irritation croissante envers le Secrétaire général du Parti, qu'il considérait jusque-là comme un collaborateur de confiance et qui avait été l'un de ses principaux visiteurs durant sa convalescence à Gorki. Sur le plan humain, Staline lui apparaît comme un personnage vulgaire et dénué d'intelligence ; sur le plan politique, Lénine s'inquiète de ses manifestations de chauvinisme grand-russe dans les contextes de l'affaire géorgienne et du projet de fédération. Il s'oppose également au projet de différents dirigeants communistes, dont Staline, d'affaiblir ou de supprimer, dans le cadre de la NEP, le monopole de l'État sur le commerce extérieur.
Lénine continue de réclamer l'expulsion de Russie des intellectuels bourgeois et s'irrite que la Tchéka tarde à mettre ses demandes à exécution. À Maxime Gorki qui lui écrit pour protester contre cette mesure, Lénine répond que les intellectuels, les laquais de la bourgeoisie, ne sont pas, comme ils le croient, le cerveau de la nation mais, en réalité, sa merde. En novembre, Lénine assiste au quatrième congrès du Komintern : il apparaît physiquement marqué, s'exprime avec moins d'aisance qu'auparavant et se tient à l'écart des débats.
Tentative de rupture avec Staline
En ce qui concerne la vie intérieure du Parti communiste, Lénine est choqué, lorsqu'il reprend le travail à l'automne, par l'étendue des rivalités personnelles entre dirigeants bolcheviks et par la prolifération des organes administratifs inutiles. La lutte contre la bureaucratie lui apparaît progressivement comme une priorité. Le rôle de Staline et de son entourage - notamment Ordjonikidze, du fait de sa brutalité lors de la crise géorgienne - lui semble de de plus en plus néfaste. Mais la santé de Lénine se dégrade à nouveau et l'empêche de prendre des mesures concrètes ; entre le 24 novembre et le 3 décembre, il est victime de plusieurs malaises. À la mi-décembre, ses médecins lui prescrivent un repos complet.
Lénine fait venir sa secrétaire Lidia Fotieva et entreprend de lui dicter des lettres pour faire connaître ses positions à différentes personnalités bolcheviques, dont Trotski. En effet, face au pouvoir grandissant de Staline, Lénine envisage maintenant de trouver un allié en la personne de Trotski, qui partage ses positions quant au monopole du commerce extérieur, et qu'il charge de parler en son nom lors du prochain Plénum du Comité central. Dans le même temps, l'état physique de Lénine se détériore à nouveau : le 16 décembre, une nouvelle attaque le prive momentanément de l'usage de sa jambe et de son bras droit. Le 18 décembre, le Comité central confie à Staline le soin de veiller sur Lénine et de s'assurer que ce dernier suit bien les conseils de ses médecins ; Staline, arguant des ordres donnés par le corps médical, interdit à Lénine toute activité et enjoint à son entourage ne lui communiquer ni informations ni documents et de ne pas écrire sous sa dictée. Lénine soupçonne dès lors Staline de le priver délibérément d'informations et d'être lui-même à l'origine des consignes de prudence des médecins. Lénine est veillé par sa sœur Maria et par son épouse Nadejda Kroupskaïa ; cette dernière, notamment, le tient au courant des derniers évènements et transmet ses messages à différents dirigeants. Le 22 décembre, Staline apprend que Kroupskaïa a transmis à Trotski une lettre dictée par Lénine ; il téléphone alors à la femme de Lénine et l'injurie.
Dans la nuit du 22 au 23 décembre, l'état de Lénine s'aggrave à nouveau. Les 23 et 24, il entreprend malgré tout de dicter une lettre au congrès, qui passera par la suite à la postérité sous le nom de testament de Lénine. Dans ce texte, qu'il envisage de faire lire ou de présenter lui-même lors du XIIe congrès du Parti communiste - prévu au printemps 1923 - Lénine passe en revue plusieurs problèmes inhérents à l'organisation du Parti et souligne les atouts et les faiblesses de plusieurs personnalités - Staline, Trotski, Zinoviev, Kamenev, Boukharine et Piatakov - qui pourraient chacune être appelée à devenir le principal dirigeant de l'Union soviétique. Il se garde néanmoins de désigner explicitement son propre successeur et laisse le Comité central libre de ses choix. Le testament insiste notamment sur la rivalité entre Trotski et Staline, soulignant que ce dernier a concentré un pouvoir immense entre ses mains, dont il n'est pas sûr qu’il sache toujours en user avec suffisamment de prudence.
Le 4 janvier 1923, peut-être après avoir été informé des injures proférées par Staline à l'égard de son épouse, il ajoute à sa lettre au congrès un addendum dans lequel il reproche au secrétaire général d'être trop grossier ou trop brutal, selon les traductions et préconise de le remplacer par quelqu'un qui soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades.
Durant les mois suivants, Lénine s'emploie à se prononcer sur tous les domaines, en vue de faire prendre en compte ses avis lors du prochain congrès. Dans ses derniers articles, publiés en janvier et mars 1923, il se penche sur les questions de la bureaucratie et de l'organisation de l'appareil politique. Il vise notamment à trancher la question des compétences du Parti et de l'État et envisage de replacer le Parti au centre du système politique. Face aux problèmes du socialisme russe, la solution lui semble résider non pas dans l'introduction d'une forme de pouvoir populaire, mais dans le renforcement des organes du Parti. Pour ce faire, il prône notamment la réorganisation du Rabkrin l'Inspection ouvrière et paysanne, chargée de superviser l'ensemble de l'administration, en la réduisant à un petit nombre de fonctionnaires chargés de contrôler à la fois le Parti et l'État. Bien que conscient des dérives bureaucratiques de l'appareil d'État soviétique, Lénine continue de placer ses espoirs dans le Parti.
L'évolution de la pensée de Lénine, durant les derniers mois de sa vie, alors qu'il prend conscience du danger représenté par Staline et qu'il entreprend de lutter contre la bureaucratie, a fait l'objet, chez les historiens, d'interprétations divergentes. Pour Moshe Lewin, la prise en compte par Lénine de la dimension humaine de l'Histoire traduit une évolution capitale dans sa réflexion et, s'il avait vécu, l'histoire de l'URSS en aurait été radicalement changée. Hélène Carrère d'Encausse, tout en qualifiant l'étude de Moshe Lewin de stimulante, se montre moins convaincue et souligne que les solutions proposées par Lénine pour combattre la bureaucratie s'avèrent elles-mêmes très bureaucratiques et que, si Lénine a indéniablement pris davantage en compte le facteur humain - voire découvert l'humanisme - il n'en est pas moins resté attaché à sa conception du rôle dirigeant du Parti ; pour elle, Lénine n'a en définitive guère changé au seuil de la mort. L'historien Nicolas Werth souligne également que jamais Lénine, malgré l'évolution de sa pensée durant les derniers mois de sa vie, ne remet en cause l'usage de la violence. Le soviétologue Archie Brown juge quant à lui que Lénine ne se montre pas préoccupé par la nature dictatoriale des pouvoirs détenus par Staline, mais bien par le fait que c'est Staline qui les détient.
Durant sa maladie, Lénine apprend que Martov, en exil à Berlin, est lui-même mourant. Il s'enquiert à plusieurs reprises du sort de son ancien camarade, allant jusqu'à demander s'il est possible de lui venir financièrement en aide pour se soigner, et regrettant la rupture de leur amitié.
On ignore à quelle date précise Lénine découvre le comportement de Staline à l'égard de Kroupskaïa : peut-être l'a-t-il appris à la fin du mois de décembre 1922, ce qui l'aurait alors poussé à rédiger son addendum au testament ; aucune certitude n'existe cependant à ce sujet. Ce n'est qu'au bout de plusieurs mois qu'il réagit explicitement à cet épisode : le 5 mars 1923, il envoie à Staline une lettre comminatoire, dans laquelle il lui reproche d'avoir insulté son épouse et lui réclame des excuses sous peine que toute relation soit rompue entre eux. Le lendemain, il fait porter à Trotski ses notes sur le dossier géorgien, et le charge d'aborder cette question en son nom devant le Comité central ; il envoie également aux Géorgiens une note dans laquelle il leur annonce son soutien. Mais le 10 mars, avant le XIIe Congrès du Parti qui aurait pu se révéler décisif dans l'affrontement avec Staline, Lénine est frappé d'une nouvelle attaque, qui le laisse paralysé et incapable de parler distinctement.
Derniers mois
Lors du XIIe congrès, qui se déroule en avril 1923, Trotski annonce être en possession des notes de Lénine sur la question nationale, mais Staline retourne la situation en l'accusant de dissimuler des documents au Parti, ce qui ruine l'effort de Lénine pour être présent par l'intermédiaire de Trotski. Ce dernier, mis en position d'accusé, se tient dès lors coi durant le congrès et ne fait aucun usage des notes de Lénine, tandis que Boukharine, qui avait tenté de contrer Staline, finit par renoncer et soutenir ce dernier. Au cours de ce même congrès, Kamenev et Zinoviev se livrent à un panégyrique de la pensée de Lénine. Le chef des bolcheviks avait pu, jusque-là, faire l'objet de critiques de la part des autres cadres du parti. Alors que Lénine est désormais mis à l'écart par la maladie, exalter les mérites du léninisme en tant qu'idéologie officielle du Parti commence à devenir, pour chacun des dirigeants communistes, une manière d'affirmer sa propre légitimité.
À la mi-mai, Lénine est jugé transportable et emmené au Manoir de Gorki. Encore capable de se faire comprendre, il réclame du poison à son épouse et à sa sœur, mais les deux femmes, qui espèrent le voir guérir, refusent. La présence de Preobrajenski, qui est lui-même en convalescence dans les environs, l'aide à se détendre. En juillet, à sa demande, Lénine est transporté à Moscou, où il visite ses appartements du Kremlin. Il effectue là sa dernière sortie. Dans l'après-midi du 21 janvier 1924, il succombe à une nouvelle attaque. Un communiqué officiel des autorités soviétiques annonce : il n'est plus parmi nous, mais son œuvre demeure.
Les causes exactes de la maladie et de la mort de Lénine ont fait l'objet de différentes hypothèses, qui découlent en partie de celles émises à l'époque par ses différents médecins. Ces derniers ont évoqué comme possibilités un empoisonnement dû au plomb contenu dans la balle tirée par Fanny Kaplan, et resté ensuite logée dans le cou de Lénine durant plus de trois ans ; d'aucuns ont également jugé que l'opération nécessaire pour retirer la balle du cou de Lénine a été la cause de dommages irréparables. La possibilité d'une artériosclérose cérébrale a enfin été évoquée. L'hypothèse selon laquelle Lénine serait mort de la syphilis a été invalidée à l'époque par un test, mais reprise ensuite par ses adversaires politiques en vue d'insinuer que le dirigeant soviétique menait une vie dissolue; elle a été cependant jugée crédible, sur la base de diagnostics posthumes, dans une étude publiée en 2004. D'autres rumeurs ont également circulé, comme celle, évoquée par Trotski lui-même264, d'un empoisonnement de Lénine par Staline. En 2013, une équipe américano-russe de médecins juge, sur la base des documents disponibles, que Lénine est probablement mort d'une artériosclérose, qui pourrait avoir été causée par une anomalie génétique ; l'hypothèse d'une mort causée par l'artériosclérose est d'autant plus crédible que le père de Lénine, de même que son frère Dmitri et ses sœurs Anna et Maria, sont tous morts des suites de problèmes circulatoires.
Le culte de Lénine au sein du mouvement communiste
Immédiatement après la mort de Lénine, le Politburo ordonne que son corps soit mis dans la glace, en attendant de trouver le meilleur moyen de le conserver. Une cryogénisation est un temps envisagée, mais le corps est finalement embaumé et exposé publiquement dans un mausolée sur la Place Rouge à Moscou, malgré les protestations de Kroupskaïa. Lénine est, après sa mort, utilisé comme une icône par le régime soviétique ; des monuments lui sont consacrés et de nombreux lieux sont rebaptisés en son honneur : Pétrograd ex-Saint-Pétersbourg est ainsi rebaptisé Leningrad ; Simbirsk, sa ville de naissance, prend le nom d'Oulianovsk tandis que Vichnie Gorki, où il est mort, prend celui de Gorki Leninskie. L'image de Lénine devient omniprésente : statues, bustes, fresques et monuments divers consacrés à Lénine deviennent un élément important du paysage soviétique et, plus tard, se généralisent aux autres régimes communistes. On lui consacre des livres, des timbres, des photos et des films. Une littérature de propagande tend à faire de Lénine une sorte de Saint : Maxime Gorki le présente comme un héros de légende, un homme qui a arraché de sa poitrine son cœur brûlant pour l'élever comme un flambeau et éclairer le chemin des hommes.
Sur le plan idéologique, la pensée de Lénine est d'emblée érigée en référence politique indépassable. Deux jours après la mort de Lénine, le gouvernement soviétique publie la brochure Lénine et le léninisme, Les dirigeants soviétiques s'empressent, immédiatement après la mort de Lénine, de revendiquer l'héritage intellectuel de ce dernier, souvent de manière contradictoire et dans le cadre de leurs rivalités respectives. Trotski publie dès janvier 1924 la brochure Cours nouveau réunissant des articles publiés à la fin 1923, dans laquelle il se revendique du léninisme pour pourfendre le bureaucratisme de l'appareil et soutenir sa théorie de la révolution permanente. Entre avril et octobre 1924, Staline prononce une série de conférences, réunis ensuite dans l'opuscule Les Principes du léninisme : le secrétaire général du Parti présente une synthèse de la pensée de Lénine, qu'il systématise en un tout cohérent, simplifiant au passage ses conceptions marxistes, et dont il fait une doctrine obligatoire pour l'ensemble du mouvement communiste, qui lui permet de s'introniser gardien de l'orthodoxie. Zinoviev publie en 1925 une brochure intitulée Le Léninisme, surtout destinée à dénoncer Trotski. Les membres de l'Opposition de gauche, qui regroupe les partisans de Trotski et divers adversaires de Staline, se disent quant à eux bolcheviks-léninistes. Boukharine et Kamenev participent également à la mise en avant du léninisme comme idéologie de référence. La veuve de Lénine et ses deux sœurs contribuent à entretenir sa mémoire, qui se mue dans le discours officiel en une dévotion quasi-religieuse ; Maria, en particulier, publie sur son frère des souvenirs hagiographiques et souvent fantaisistes; en 1926, elle soutient Staline en assurant que Lénine avait toujours accordé à ce dernier une entière confiance
En mai 1923, les notes composant le testament de Lénine sont communiquées au Comité central par Nadejda Kroupskaïa ; le 22 mai, le CC débat de l'opportunité de démettre Staline de ses fonctions et de communiquer le document au Parti. Staline croit, ou feint de croire que sa carrière est achevée, et propose de démissionner. Mais, tandis que Trotski s'abstient d'intervenir, Staline est soutenu par Kamenev et Zinoviev ; ce dernier, notamment, déclare : nous sommes heureux de constater que les craintes d'Ilitch concernant notre secrétaire général n'étaient pas fondées. La passivité des autres dirigeants permet à Staline de conserver son poste et de consolider, dans les années qui suivent, sa dictature personnelle, tout en se présentant comme le disciple, le continuateur et le seul exégète autorisé de Lénine, tout en éliminant ceux qui l'avaient soutenu. Malgré l'insistance de Kroupskaïa, le CC décide, par 30 voix contre 10, de ne pas communiquer le texte au congrès du Parti. En 1925, le testament est publié hors d'URSS par des partisans de Trotski comme Max Eastman. Les autorités soviétiques dénoncent alors le texte comme un faux ; Trotski lui-même doit, sous la pression de Staline, désavouer ses propres partisans et signer une déclaration qui nie l'existence du testament. Deux ans plus tard, reprenant le combat contre Staline, Trotski mentionne à nouveau le testament dont il avait nié l'existence, et réclame en vain qu'il soit rendu public.
Bien que le courant trotskiste - bientôt réduit à la clandestinité ou à l'exil - continue de se réclamer de Lénine, c'est Staline qui s'impose, en URSS et au sein de l'Internationale communiste, comme le seul interprète autorisé de Lénine ; il fixe pour des décennies la doctrine communiste, résumant la pensée et les analyses de Lénine par une série de formules répétitives et de processus historiques rigides. L'expression marxisme-léninisme est par la suite créé pour désigner l'interprétation des pensées de Marx et de Lénine en vigueur en URSS, puis dans les autres régimes communistes. La publication des textes de Lénine - et notamment de ses œuvres complètes, dont l'édition officielle est maintes fois repoussée et remaniée - s'effectue désormais, en URSS, au gré des besoins politiques conjoncturels du régime ; ses écrits sont soumis, si besoin, à une sévère censure, le pouvoir soviétique s'attachant à ne présenter de la pensée de Lénine que la version qui sert le mieux ses intérêts du moment. En 1938, une directive secrète du Comité central, rendue publique vingt ans plus tard, interdit la publication en URSS de nouveaux ouvrages sur Lénine.
Le cerveau de Lénine est, à sa mort, prélevé et conservé dans du formol. Deux ans plus tard, le gouvernement soviétique demande au neuroscientifique Oskar Vogt de l’étudier, dans l'espoir que ses travaux permettent de découvrir la source du génie de Lénine ; un Institut du cerveau est créé spécialement à Moscou pour permettre à Vogt de poursuivre ses recherches. Vogt publie en 1929 un article sur le cerveau dans lequel il rapporte que certains neurones pyramidaux dans la troisième couche du cortex cérébral de Lénine étaient particulièrement larges ; cependant, les théories de Vogt sur les liens entre l'intelligence et la structure du cerveau ont depuis été discréditées. Les Soviétiques cessent par la suite de publier des informations sur le cerveau de Lénine. Les scientifiques tendent aujourd'hui à considérer que le cerveau de Lénine était tout à fait normal et ne se distinguait que par la taille du lobe frontal.
Lénine continue, après la déstalinisation, d'être considéré comme une référence politique et intellectuelle, sa figure étant désormais opposée à celle de Staline dans le discours officiel du mouvement communiste : en 1956, dans son rapport au XXe congrès du PCUS, Nikita Khrouchtchev oppose ainsi la « grande modestie du génie de la révolution, Vladimir Ilitch Lénine » au culte de la personnalité dont s'entourait Staline. L'existence du testament de Lénine est alors reconnue par l'URSS, et les remarques de Lénine sur la personnalité de Staline sont rendues publiques. La référence à Lénine demeure fondamentale au sein du mouvement communiste, mais héritage est revendiqué de manière contradictoire par des camps opposés. Khrouchtchev présente ainsi la déstalinisation comme un retour à Lénine et aux sources du socialisme ; mais Mao Zedong et ses partisans, qui refusent la déstalinisation, s'appuient eux aussi sur de multiples références aux textes de Lénine au moment de la rupture sino-soviétique puis durant la révolution culturelle, pour arguer de la nécessité de nouvelles révolutions et dénoncer la politique soviétique.
Durant toute la période de la guerre froide, la figure de Lénine continue d'être officiellement honorée en URSS et dans les pays du Bloc de l'Est ; seule une version idéalisée et hagiographique du personnage est cependant autorisée dans l'historiographie communiste, au mépris de ses aspects humains et de la complexité de sa pensé ; cette utilisation de l'image de Lénine aboutit à réduire ce dernier à ce que le politologue Dominique Colas décrit comme un ectoplasme au service du pouvoir. Même chez une partie des adversaires du système soviétique, Lénine continue de faire l'objet d'un certain respect. L'historien et dissident soviétique Roy Medvedev publie ainsi dans les années 1960-1970 des travaux particulièrement critiques à l'égard du stalinisme, tout en continuant de présenter une figure idéalisée de Lénine, qu'il oppose à celle de Staline.
Jugements et controverses sur son rôle historique
Le rôle historique de Lénine fait l'objet d'un grand nombre d'études, que l'ouverture des archives soviétiques facilite en apportant un nouvel éclairage sur son action politique. Si le rôle fondamental de Lénine dans l'histoire du XXe siècle n'est généralement pas contesté, d'autres points sont plus polémiques ; la question de la continuité entre le léninisme et le stalinisme a notamment fait l'objet d'interprétation contrastées, certains auteurs arguant d'une rupture entre l'époque léniniste et l'époque stalinienne, d'autres considérant Staline comme un digne héritier de Lénine, qui aurait pleinement profité de l'appareil répressif mis en place par Lénine, tout en élevant les pratiques dictatoriales à un niveau supérieur.
Après la déstalinisation, des interprétations affirment que le léninisme de l'époque de la Nouvelle politique économique était un régime d'une nature toute différente que la dictature de Staline ; dans les années 1970, à l'époque de l'Eurocommunisme, divers partis communistes occidentaux débattent du rôle de Lénine, certains voyant dans le Lénine des dernières années un précurseur du socialisme à visage humain, d'autres allant jusqu'à s'interroger sur ses pratiques dictatoriales et son usage de la terreur. Plusieurs partis communistes occidentaux cessent alors de faire référence au léninisme dans leurs statuts. Lors de la fin de la guerre froide, l'ouverture aux chercheurs des archives soviétiques permet de découvrir les directives dans lesquelles Lénine prône, avec constance, les mesures répressives les plus brutales à l'égard des opposants.
Boris Souvarine voit en Lénine un utopiste pour qui la fin justifie les moyens, et commente : Lénine cite Marx pour justifier le régime soviétique identifié à la "dictature du prolétariat", alors que Marx entendait par cette expression une "hégémonie politique" résultant du "suffrage universel"; ce qui n'a rien de commun avec le monopole d'un parti, l'omnipotence d'une "oligarchie" Lénine dixit, un Guépéou inquisitorial et un archipel du Goulag. Il tourne en dérision le culte de Saint Lénine et estime qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, concluant : Il serait absurde de confondre Lénine et Staline dans une même appréciation sans nuances comme de prétendre que le maître n'est pour rien dans les turpitudes de son disciple. En conscience, on ne saurait écrire désormais sur Lénine en fermant les yeux sur les conséquences du léninisme et de son sous-produit, le stalinisme ; sur l'injustice atroce des répressions, des exactions, des dragonnades, des pogromes, des hécatombes ; sur les tortures et la terreur infligées aux peuples cobayes de "l'expérience socialiste" ; sur l'avilissement de la classe ouvrière, l'asservissement de la classe paysanne, l'abrutissement de la jeunesse studieuse, l'anéantissement d'une intelligentsia qui faisait honneur à la Russie de toujours. Lénine n'avait pas voulu cela. Quand même, pour sa large part, il en est responsable.
L'historien Stéphane Courtois, coauteur du Livre noir du communisme, juge que la pensée et la pratique politique de Lénine font de lui le véritable inventeur du totalitarisme, Staline n'ayant été que son parfait exécuteur testamentaire. L'un des biographes de Lénine, l'historien et militant trotskiste Jean-Jacques Marie, déplore en 2004 qu'après un demi-siècle d'hagiographie imposée par le discours officiel soviétique, la figure de Lénine soit désormais diabolisée, dans des écrits qui le présentent comme un monstre ou une sorte d'Antéchrist. L'historienne Hélène Carrère d'Encausse, autre biographe, remarque au contraire que Lénine échappe au jugement- ou du moins y a échappé pendant longtemps - car il a été assimilé à l'incarnation du marxisme orthodoxe, donc du projet de Marx, tandis que la condamnation a, durant des décennies, frappé le seul Staline, accusé d'avoir corrompu l'œuvre léniniste. Hélène Carrère d'Encausse insiste sur le caractère exceptionnel de Lénine, prodigieux tacticien et génie politique, inventeur des moyens de transformer une utopie en État, bien que théoricien finalement fort moyen ; elle rappelle cependant la contradiction entre un discours dont le thème dominant est le bien de l'humanité et une pratique fondée sur le malheur des hommes, pour lequel Lénine n'eut jamais un mot de pitié, et encore moins de remords et juge que le succès de l'entreprise révolutionnaire de Lénine ne justifie rien des tragédies inhérentes à l'entreprise léniniste .
Condamnation posthume lors de la fin de l'URSS, puis réhabilitation partielle sous Poutine
La période de la Perestroïka aboutit dans les années 1980-90 à une réévaluation, voire un renversement de l'image de Lénine en URSS. Le mouvement de réformes impulsé par Mikhaïl Gorbatchev se présente d'abord comme un retour aux sources de la pensée léniniste, mais la réévaluation de l'histoire soviétique, l'ouverture des archives historiques dans le cadre de la Glasnost aboutissent à une relecture de plus en plus critique du rôle de Lénine lui-même, dont l'image se dégrade aux plans idéologique et personnel. Le 11 mars 1990, le jour même où le rôle dirigeant du PCUS est aboli, l'historien et député réformateur Iouri Afanassiev, lors d'une intervention retransmise en direct à la télévision soviétique, critique Lénine en lui reprochant d'avoir élevé la violence, la terreur de masse en principe d'État et l'illégalité en principe politique de l'État. Si le début de la Perestroïka et de la Glasnost s'était accompagné d'une redécouverte du passé stalinien, les années 1990-1991 voient une remise en cause, en URSS, de la figure historique de Lénine. Le stalinisme est, de manière croissante, présenté comme une continuation logique de la période léniniste ; avec la fin de la censure en Union soviétique, une grande partie des nouveaux journaux tend, de manière croissante, à présenter Lénine comme un criminel sanguinaire et à dénoncer la révolution d'Octobre, tandis que le passé tsariste est souvent idéalisé. Avec la chute des régimes communistes en Europe, de nombreuses statues de Lénine sont abattues en tant que symbole des anciens régimes. Un certain nombre de monuments en l'honneur de Lénine existent encore cependant en Europe, surtout en Russie, mais également dans des pays ex-communistes d'Europe de l'Est.
Après la chute de l'URSS à la fin 1991, la période communiste dans son ensemble a été condamnée en Russie, sous la présidence de Boris Eltsine. En 1993, Eltsine supprime la garde d'honneur du mausolée de Lénine. Il est un temps envisagé de faire enterrer le corps et de supprimer le mausolée, mais ce projet est finalement abandonné : le mausolée de Lénine continue d'être un monument touristique visité en Russie. En janvier 2011, le parti Russie unie a créé un site Web où l’on peut voter pour ou contre l’enterrement du corps de Lénine. En 2012, la possibilité de faire retirer tous les monuments consacrés à Lénine est évoquée devant le parlement russe ; cette proposition se heurte cependant au fait qu'il est illégal, en Russie, de détruire un monument historique.
Après l'élection de Vladimir Poutine en 2000, la figure de Lénine fait l'objet en Russie d'une certaine réhabilitation, ce qui lui vaut d'être présenté avant tout comme un grand homme d'État, fondateur de l'URSS - future superpuissance - et, par là-même, artisan de la modernisation de la Russie. L'idéologie communiste de Lénine tend, a contrario, à être occultée.
Terreur et crimes de masse
L'utilisation de la terreur, de la violence et des mesures dictatoriales pour assurer le triomphe de la révolution, tient une place primordiale dans la pensée de Lénine89. Lénine élabore le concept de Terreur de masse dès 1905, au lendemain de la répression de la première Révolution russe par le régime tsariste. Ce concept est mis en pratique une fois la révolution commencée - révolution dans laquelle les bolchéviques sont très minoritaires, par ailleurs - par une politique volontariste, théorisée et revendiquée ... comme un acte de régénération du corps social. La terreur est l’instrument d’une politique d’hygiène sociale visant à éliminer de la nouvelle société en construction des groupes définis comme ennemis ; sont ainsi voués à la mort la bourgeoisie, les propriétaires fonciers et les koulaks, vus comme des paysans exploiteurs. Ceux-ci sont considérés dans le vocable léninien comme des insectes nuisibles, des poux, des vermines, des microbes, dont il faut épurer, nettoyer, purger la société russe.
Lénine crée en 1919, en pleine guerre civile, un système de camps de concentration ; les camps de concentration et la peine de mort deviennent dès ce moment des composantes indispensables du système de Terreur, qui, pour Lénine, est inséparable de la dictature du peuple.
Lénine est également le principal responsable d'une politique de déportation de populations entières, ainsi traitées car vues comme ennemies du régime soviétique ; la plus marquante d'entre elles étant la décosaquisation, une politique visant à exterminer les Cosaques, liés au régime tsariste et supposés riches, dès 1919.
L'usage de la violence de masse, en accord avec les conceptions léninistes, est bien plus importante que sous le régime dictatorial de Nicolas II : en seulement quelques semaines, la Tchéka exécute deux à trois fois plus de personnes que l'ancien régime n’en avait condamné à mort en 92 ans.
Les exactions commises à l'encontre des populations civiles commencent, dans les territoires de la future Union soviétique, sous le gouvernement de Lénine, elles sont seulement poursuivies, et non initiées par son successeur, Joseph Staline. De même, la propagande de masse et un culte de la personnalité sont utilisés en Union Soviétique pour rallier la population du pays aux idées du régime déjà sous Lénine, bien avant que Staline ne prenne le pouvoir. Ces méthodes de gouvernement, mises en place par Lénine et systématisées par Staline, ont précédé celles des nazis, et pourraient même les avoir inspirées, notamment en ce qui concerne l'utilisation des camps de concentration.
Dictature et totalitarisme
Dès les premiers temps du régime soviétique, les méthodes dictatoriales employées par Lénine font l'objet de vives critiques dans les rangs socialistes, et sont l'une des principales causes de la rupture entre le socialisme démocratique et le communisme. En 1920, lors du congrès de Tours, Léon Blum dénonce la vision léniniste de la dictature du prolétariat, qui n'est en fait à ses yeux que la dictature exercée par un parti centralisé, où toute l'autorité remonte d'étage en étage et finit par se concentrer entre les mains d'un comité patent ou occulte, soit finalement la dictature de quelques individus. Karl Kautsky s'en prend, dans l'entre-deux-guerres, aux mesures dictatoriales du régime bolchevik, dont il juge qu'elles conduisent, tout autant que le fascisme, à l'oppression du prolétariat : la différence étant que cette oppression est une intention de départ dans le fascisme, tandis que dans le bolchevisme, elle est le résultat naturel des méthodes employées. Kautsky va jusqu'à considérer que Mussolini n'est que le singe de Lénine.
Diverses analyses existent quant au rôle personnel de Lénine dans l'évolution totalitaire de l'État soviétique. Le jugement porté sur Lénine par la philosophe Hannah Arendt évolue avec le temps : elle conteste dans un premier temps que Lénine ait détruit toute démocratie interne au Parti bolchevik, et considère que Staline est le véritable coupable du basculement de la Russie dans le totalitarisme ; sa réflexion l'amène ensuite à considérer que Lénine, en commettant l'erreur fondamentale de préférer l'outil de la dictature à celui de la démocratie pour faire triompher la révolution, a abouti à priver les Soviets de tout pouvoir véritable au profit du Parti. Elle continue cependant d'attribuer au seul Staline la responsabilité de la nature proprement totalitaire du régime: pour elle, les phases totalitaires du régime soviétique, par opposition aux phases autoritaires, correspondent à la grande terreur stalinienne et à la période 1950-1953. Cette analyse est contestée par d'autres auteurs, comme Leonard Schapiro, qui considèrent que le totalitarisme soviétique commence dès l'époque de Lénine.
Dominique Colas, pour sa part, considère que Lénine est, en tant qu inventeur de la dictature du parti unique, le prototype des tyrans modernes ; à ses yeux, si les idées contenues dans Que faire ? ne sauraient être considérées comme la cause unique de l'évolution de la révolution russe, le programme démiurgique de Lénine et la logique léniniste n'en tiennent pas moins un rôle important dans l'histoire de l'URSS, ce qui permet de se demander si le parti tel que le concevait Lénine n'est pas la matrice du totalitarisme.
Nicolas Werth juge, dans un article de l'Encyclopædia Universalis, que c'est bien Lénine qui est à l'origine de la nature totalitaire du communisme moderne. Stéphane Courtois juge également fondamental le rôle du léninisme dans le développement du totalitarisme et le philosophe et historien Tzvetan Todorov qualifie Lénine de fondateur du premier État totalitaire. De même, le magazine américain Time présente Lénine comme l'initiateur de la tragédie de notre ère, la montée en puissance des États totalitaires.
Écrits Œuvres et bibliographie de/sur Lénine.
Lénine est l’auteur d'une œuvre théorique et philosophique qui se veut dans la continuité de celle de Karl Marx, dont il a défendu les interprétations orthodoxes contre les « révisionnistes » comme Eduard Bernstein.
Parmi ses nombreux écrits ses œuvres complètes ont été publiées en français en 45 volumes on peut retenir :
Que faire ?
Matérialisme et empiriocriticisme
L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme
L'État et la Révolution
La Maladie infantile du communisme, le gauchisme 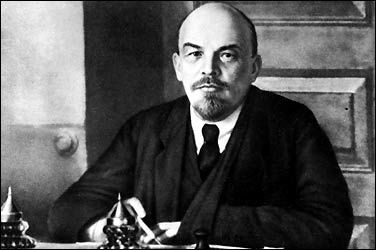    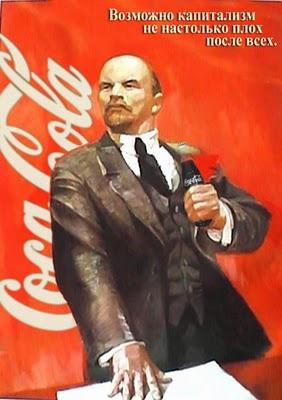 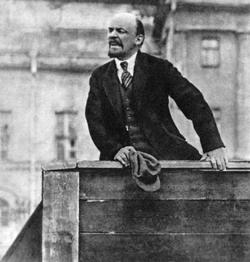   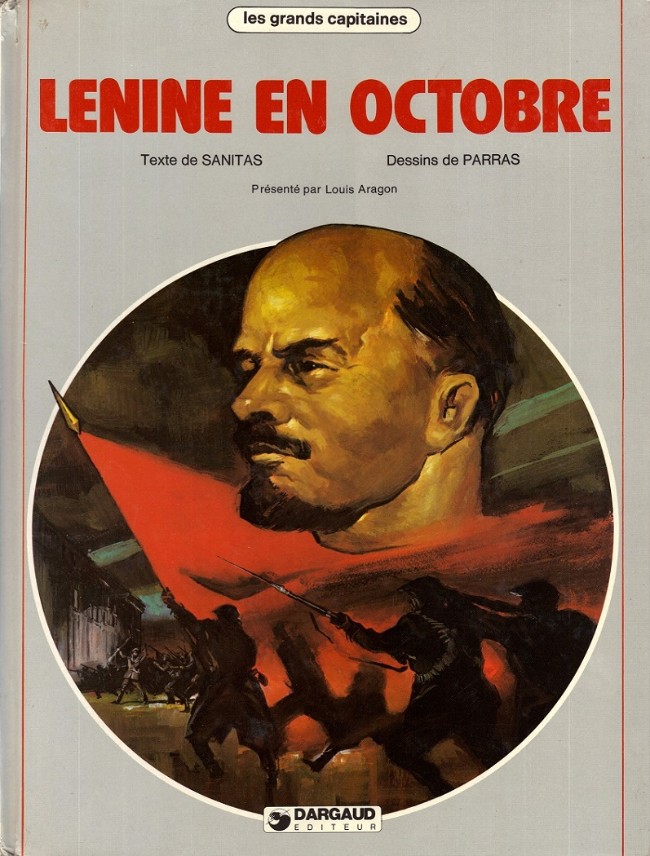
Posté le : 07/11/2015 22:23
|
|
|
|
|
Louis VIII le lion |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 novembre 1226 meurt Louis VIII dit le Lion
à Montpensier Auvergne, à 39 ans, né le 5 septembre 1187 à Paris, fut roi de France de 1223 à 1226, huitième de la dynastie dite des Capétiens directs. Il est roi de France du 14 juillet 1223 au 8 novembre 1226 soit 3 ans 3 mois et 25 jours, le couronnement à lieu le 6 août 1223 en la cathédrale de Reims, son prédécesseur est Philippe II, son successeur est Louis IX de la dynastie des Capétiens
Sa sépulture se trouve à la Basilique de Saint-Denis.
Il est marié à Blanche de Castille, ses enfants sont Philippe de France, Alphonse de France, Louis IX , Robert de France, Jean de France, Alphonse de France, Philippe de France, Isabelle, Charles de France. Sa résidence est àParis
Il était le fils du roi Philippe II 1165-1223, dit Philippe Auguste et d'Isabelle de Hainaut 1170-1190. Par sa mère, il est le premier roi de France qui descende à la fois d'Hugues Capet et de son compétiteur malheureux, Charles de Basse-Lotharingie. Le court règne de Louis VIII fut cependant marqué par deux brillantes campagnes : l’une contre les Anglais en Guyenne, l’autre contre Raymond VII de Toulouse.
Il est le premier roi capétien à ne pas avoir été sacré roi du vivant de son père. Il avait cependant été désigné par Philippe II dans son testament rédigé en 1190 comme devant lui succéder. Le testament n'ayant pas été contesté après cette date, la cérémonie de l'adoubement des barons — héritage rituel des Capétiens — devenait inutile. L'archevêque de Reims, Guillaume de Joinville, le sacre à Reims le 6 août 1223.
En bref
Roi de France 1223-1226, né le 5 septembre 1187 à Paris, mort le 8 novembre 1226 à Montpensier Auvergne.
Le 23 mai 1200, Louis épouse Blanche de Castille, la fille d'Alphonse VIII de Castille, qui assurera la régence après la mort de son époux. En 1212, Louis s'empare de Saint-Omer et d'Aire-sur-la-Lys pour empêcher la constitution d'un puissant comté de Flandre à la frontière du comté d'Artois. Les barons anglais révoltés contre le roi Jean sans Terre proposent le trône d'Angleterre à Louis en échange de son aide. Ce dernier se rend donc dans l'île en 1216 pour leur prêter main-forte. Après des débuts prometteurs, il est vaincu sur mer et son armée subit des désertions. En 1217, alors que la paix est conclue à Kingston, Louis reçoit secrètement un tribut de 10 000 marks.
Monté sur le trône de France en 1223, il consacre son court règne à étendre le pouvoir royal au Poitou, dont il s'empare en 1224, puis au Languedoc. Il lance ainsi avec succès une croisade contre les albigeois en 1226, capturant la plus grande forteresse d'Avignon. Malade, il décide de rentrer à Paris mais meurt en chemin.
Louis VIII le Lion est le premier Capétien à accorder de véritables apanages et à prévoir leur retour à la Couronne en cas d'extinction de la lignée directe, clause interdisant toute aliénation d'un domaine royal. Louis instaure d'autres droits particuliers pour la Couronne, comme le fait de prêter serment d'allégeance non seulement à la personne du roi, mais aussi à l'autorité qu'il représente. Son fils aîné, Louis IX Saint Louis, lui succède tandis que ses fils puînés reçoivent des apanages.
Sa vie
Conquête de l'Aquitaine
Le roi Philippe II estimant que le principe héréditaire est définitivement établi, il refuse d'associer au trône son héritier et repousse son adoubement. Le prince Louis est fait chevalier dans le castrum de Compiègne le 17 mai 1209 mais son père lui a dicté de sévères conditions, notamment de ne plus jouter en tournoi.
Surnommé le Lion, c'est pendant le règne de son père que le futur Louis VIII obtient sa renommée en remportant sur Jean sans Terre, roi d'Angleterre, la victoire de La Roche-aux Moines en 1214. Les barons anglais, révoltés contre Jean sans Terre, promettent alors au prince Louis de lui donner la couronne d'Angleterre, étant d'ailleurs l'époux de Blanche de Castille, petite-fille de feu le roi Henri II d'Angleterre. Acceptant cette demande, Louis débarque sur les côtes anglaises avec 1 500 soldats français auquel s'ajoutent des mercenaires anglais, arrive à Londres le 2 juin 1216, il se fait proclamerroi d'Angleterre mais pas couronner car il n'y a pas d’archevêque disponible pour effectuer l'onction et prend rapidement le contrôle du sud du pays.
Comme Jean sans Terre meurt peu après, les barons anglais, plutôt que d'avoir affaire à un prince énergique comme Louis qui risquait de les entraver, se prononcent en faveur d'Henri III, fils de Jean sans Terre. Louis continue la guerre, mais il est battu sur terre à Lincoln en mai 1217, puis sur mer en août à la bataille des Cinq îles, lorsque les renforts que lui envoie Blanche de Castille sont anéantis. Le 11 septembre 1217, lors de la signature du traité de Lambeth, il doit alors renoncer à ses prétentions en contrepartie d'une forte somme d'argent.
Plus tard, après avoir été sacré roi de France, sous prétexte que la cour d’Angleterre n’avait toujours pas exécuté toutes les conditions du traité de 1217, Louis VIII, profitant de la minorité d'Henri III, décide de s’emparer des dernières possessions anglaises en France. Au cours d’une campagne rapide, Louis VIII s’empare de la majorité des terres de l’Aquitaine. Les villes du Poitou, de la Saintonge, du Périgord, de l'Angoumois et d'une partie du Bordelais tombent les unes après les autres. Henri III ne possède plus en France que Bordeaux et la Gascogne qui ne furent pas attaquées, et les îles Anglo-Normandes.
Conquête du Languedoc
Naissance de Louis VIII le Lion, Grandes Chroniques de France, Paris, XIVe ‑ XVe siècles
À cette époque, le sud de la France était le théâtre des combats de la croisade des Albigeois.
En 1218, Amaury VI de Montfort, fils de Simon IV de Montfort, hérite du Languedoc en pleine révolte. Incapable de conserver son fief, il préfère quitter le Midi, acceptant de céder ses droits sur le Languedoc au roi de France en échange de la dignité de connétable, première de la couronne.
Raymond VII, comte de Toulouse, était toujours soupçonné par l'Église d'abriter des cathares sur ses terres. Un concile fut donc tenu à Bourges, en 1225, où il fut déclaré que détruire l’hérésie était une nécessité et qu'une nouvelle croisade contre les cathares était indispensable. Louis VIII fut donc choisi pour diriger l'expédition.
Aux fêtes de Pâques de l’an 1226, des milliers de chevaliers les chroniqueurs de l’époque donnent le chiffre de 50 000 se trouvèrent à Bourges aux côtés du roi. Cette armée se dirigea vers la vallée du Rhône, et à son approche, les seigneurs et les villes se hâtèrent de faire leur soumission au roi de France. La ville d'Avignon, qui appartenait à Raymond VII, refusa cependant d’ouvrir ses portes. L’on mit alors le siège devant la place forte qui était considérée alors comme la clef du Languedoc. Au bout de trois mois, la ville fut prise, et aussitôt Nîmes, Castres, Carcassonne, Albi se rendirent à Louis VIII.
Raymond VII, quant à lui, s’était enfermé dans Toulouse. Les croisés, frappés par les maladies hivernales et la défection de certains d'entre eux, décidèrent d'ajourner le siège de la ville. En 1226, Thibaud IV de Champagne se brouilla avec le roi de France Louis VIII dont l'objectif était d'annexer le Languedoc de son cousin Raymond VII à la Couronne de France. Le 30 juillet, l'armée champenoise abandonna l'ost royal devant Avignon, Thibaud IV arguant que son service de quarante jours était achevé. Quand Louis VIII, atteint par la dysenterie, mourut au château de Montpensier en novembre 1226, certaines rumeurs allèrent jusqu'à accuser Thibaud IV d'avoir empoisonné le roi. Toulouse ne tomba qu'en 1228.
Louis VIII n'aura régné que trois années sur le royaume de France alors que son père Philippe Auguste et son grand-père Louis VII régnèrent chacun 43 années, soit 86 années cumulées de 1137 à 1223. Son fils, Louis IX, règnera, lui aussi, 43 ans et 9 mois 1226-1270.
Tombeau
Le cœur et les entrailles de Louis VIII furent déposés en l’abbaye Saint-André-les-Clermont de l’ordre des Prémontrés, entre Chamalières et Clermont-Ferrand15 Le 15 novembre 1226, lors de funérailles célébrées avec magnificence, Louis VIII fut inhumé en la basilique Saint-Denis. Jusqu'à la guerre de Cent Ans, on pouvait voir son magnifique tombeau ciselé d'or et d'argent ; Après sa disparition il fut remplacé par une simple dalle marquant le lieu de la sépulture. Les profanateurs de 1793 détruisirent celle-ci et découvrirent une pierre couvrant le cercueil, avec une croix sculptée en demi-relief. Le couvercle renversé, on trouva le corps du roi enveloppé dans un suaire tissé d'or. C'est le seul souverain que l'on a retrouvé inhumé de cette façon.
Union et descendance
Le royaume de France ayant été mis en interdit par le concile de Dijon le 6 décembre 1199 à effet des 40 jours suivant Noël, aucun mariage ni enterrement religieux ne pouvait être célébré par un prêtre dans tout le royaume dès le mois de janvier 1200, ce qui conduisit Philippe II à faire célébrer le mariage de son fils Louis dans les terres du roi Jean Ier d'Angleterre dont Blanche de Castille était la nièce.
Le lundi 22 mai 1200, jour selon le chroniqueur Rigord qui suit le jeudi de l'Ascension 18 mai, fut signé au lieu-dit Gueuleton actuelle île du Goulet sur la Seine entre Vernon et Les Andelys le traité de paix entre Philippe, roi de France, et Jean, roi d'Angleterre. Les noces du prince Louis et de Blanche de Castille furent célébrées, toujours selon Rigord, dans le même lieu le lendemain.
Selon Jacques Le Goff, Blanche de Castille aurait accouché de deux ou trois premiers enfants morts en bas âge dont nous ne connaissons ni le nombre exact, ni le sexe, ni les dates de naissance et de mort.
Leurs enfants connus sont :
Philippe, fiancé en 1217 à Agnès II de Donzy septembre 1209-1218, comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, mort à 9 ans, sans postérité ;
Louis IX 1214-1270, roi de France, et descendance à nos jours ;
Robert Ier 28 septembre 1216- 8 février 1250 comte apanagiste d'Artois qui épouse Mahaut de Brabant, et postérité ;
Jean 21 juillet 1219-1232 comte d'Anjou et du Maine, sans postérité ;
Alphonse 1220-1271 comte apanagiste de Poitiers qui épouse Jeanne, comtesse de Toulouse 1220 † 1271, sans descendance ;
Philippe Dagobert 20 février 1223-1232, sans postérité ;
Isabelle 1225-1270, fiancée à Hugues de la Marche, puis en 1252 fondatrice et abbesse des Clarisses de Longchamp.
béatifiée, sans descendance ;
Étienne Paris 27 décembre 1225-novembre 1226/1227, sans postérité ;
Charles Ier de Sicile Vendôme mars 1227-7 janvier 1285. Fils posthume, Louis IX lui transfère l'apanage d'Anjou de son frère Jean mort en 1232 comte apanagiste d'Anjou, roi de Sicile, puis de Naples, de Jérusalem, comte de Provence. En 1246, Charles épouse Béatrice de Provence 1234 † 1267 et en 1268, il se remarie avec Marguerite de Bourgogne 1248 † 1308, et postérité.
       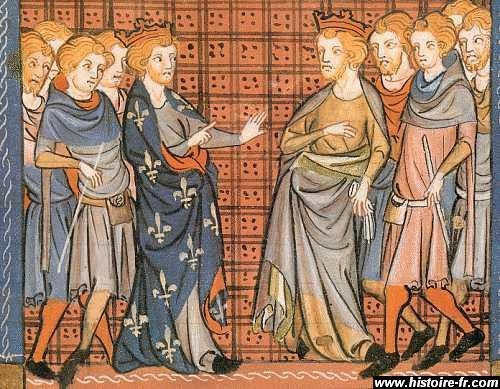    
Posté le : 07/11/2015 21:59
|
|
|
|
|
Hitler le pusch de Munich |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 novembre 1923 Hitler provoque le putsch de la Brasserie à Munich
ou putsch de Munich est une tentative de prise du pouvoir par la force en Bavière menée par Adolf Hitler, dirigeant du Parti national-socialiste des travailleurs allemands NSDAP, dans la soirée du 8 novembre 1923. Elle se déroula principalement à la Bürgerbräukeller, une brasserie de Munich. Y participèrent notamment Hermann Göring, Ernst Röhm, Rudolf Hess, Heinrich Himmler et Julius Streicher.
Soutenue par le général Erich Ludendorff, et acceptée dans un premier temps par le triumvirat dirigeant la Bavière composé de Gustav von Kahr, Otto von Lossow et Hans Ritter von Seisser, elle se termina dans la confusion et par un échec total des putschistes. Condamné à cinq ans de détention, Adolf Hitler ne passa finalement que moins de quatorze mois à la prison de Landsberg, mettant son incarcération à profit pour rédiger Mein Kampf.
Si l'épisode est en lui-même mineur dans l'histoire de la République de Weimar, il devint l'un des mythes fondateurs du régime nazi, qui organisa sa commémoration annuelle et érigea la Blutfahne au rang de symbole. Il constitua un tournant dans l'histoire et la stratégie du mouvement nazi. Hitler tira en effet toutes les leçons de ce fiasco, renforça son pouvoir sur le parti et tenta de bénéficier du soutien des milieux conservateurs et de l'armée, volonté qui s'illustra notamment par l'organisation de la nuit des Longs Couteau.
Le contexte
Adolf Hitler en tournée de propagande en 1923.
Depuis le 29 juillet 1921, Adolf Hitler est le dirigeant incontesté du parti nazi : il n'était alors qu'un agitateur de brasserie : une célébrité locale assurément, mais à peine connue ailleurs. Son parti est doté d'une aile paramilitaire depuis 1920, la section de gymnastique et de sport, créée et commandée par Ernst Röhm, rebaptisée Sturmabteilung SA en octobre 19212. À l'instar de nombreuses autres organisations paramilitaires de droite et de gauche, elle entretient une violence politique endémique dans les premières années de la République de Weimar, notamment illustrée par l'assassinat de Walther Rathenau. Hitler ne dédaigne pas de participer aux actions de sa milice : à la suite d'une rixe destinée à empêcher la tenue d'une réunion du Bayernbund, une ligue séparatiste bavaroise dirigée par Otto Ballerstedt, le 14 septembre 1921, il est condamné en janvier 1922 pour attentat à la liberté de réunion et coups et blessures5, à une peine légère : trois mois de prison dont deux avec sursis, celui-ci étant subordonné à sa bonne conduite future.
De 1921 à 1923, Hitler renforce son parti, notamment avec l'arrivée de Julius Streicher, chef d'une importante organisation nationaliste en Franconie, d'Hermann Göring qui prend la direction de la SA en 1922, de Max Erwin von Scheubner-Richter, diplomate qui dispose d'un vaste cercle de relations, et, via Max Amann, d'Ernst Hanfstaengl, issu de la haute bourgeoisie munichoise, qui assure le financement du parti. Les fonds recueillis par ce dernier permettent notamment d'intensifier la propagande nazie via le Völkischer Beobachter. Par l'entremise de Rudolf Hess, Hitler est reçu par Erich Ludendorff en 1921, puis, grâce à Göring, noue des contacts, peu concluants, avec Hans von Seeckt et Otto von Lossow. Début mai, il rencontre également Gustav von Kahr à la demande de celui-ci, sans résultat, les deux interlocuteurs cherchant mutuellement à se neutraliser et à s'utiliser l'un l'autre.
Benito Mussolini lors de la Marche sur Rome.
La marche sur Rome menée par Benito Mussolini le 28 octobre 1922 persuade Hitler qu'il peut accomplir en Allemagne ce que Mussolini a réussi en Italie11. Cette conviction est renforcée par l'élan nationaliste qui suit l'occupation de la Rhénanie et de la Ruhr par les troupes françaises, en raison du retard pris par l'Allemagne pour payer les réparations prévues par le traité de Versailles ; cette occupation suscite une vague d'unité nationale, une politique de résistance passive impulsée par le gouvernement de Wilhelm Cuno, et génère de nombreux affrontements et attentats, comme ceux commis par Albert Leo Schlageter. Craignant que l'attitude du gouvernement et la protestation populaire ne lui coupent l'herbe sous le pied, Hitler rend les criminels de novembre responsables de l'invasion de la Ruhr et interdit à ses partisans de participer à une résistance active menée sous l'égide de l'unité nationale. Cette position déplaît souverainement au gouvernement bavarois et à la Reichswehr. L'occupation de la Ruhr permet toutefois au parti nazi d'augmenter ses effectifs de 35 000 recrues de février à novembre 1923, ce qui porte ses effectifs à 55 000 membres et fait naître les premiers soupçons d'un putsch.
La crise économique et l'hyperinflation font elles aussi le lit du parti nazi : en janvier 1923, un dollar vaut 17 972 marks, en août 4 620 455, en septembre 98 860 000, en octobre 25 260 280 000 et en novembre 4 200 milliards. En 1923, le parti nazi est l'élément le plus important du paysage politique bavarois, non en raison de son importance numérique, mais pour sa nature et son potentiel, son rôle de catalyseur et sa capacité à la radicalisation ; il est le parti le plus dynamique, le mieux adapté à une mobilisation populaire19. Le parti nazi n'a toutefois pas encore de moyens à la hauteur de ses ambitions. Sur l'initiative d'Hitler, il tente, avec d'autres organisations nationalistes regroupées au sein de l’Arbeitsgemeinschaft, d'empêcher par la force le défilé des forces de gauche à l'occasion du premier mai à Munich. Cette tentative se solde par un échec : les milices de l’Arbeitsgemeinschaft, encerclées par la police, ne peuvent effectuer aucune action.
La radicalisation en Bavière
Gustav Stresemann en 1925.
Afin de rétablir l'ordre, le nouveau gouvernement de la république, conduit par Gustav Stresemann, accepte d'exécuter les obligations imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles, ce qui constitue une trahison pour les nationalistes. Dans le but d'éviter un soulèvement, le gouvernement bavarois nomme le 26 septembre 192322 Gustav von Kahr commissaire général, qui forme un triumvirat avec le chef de l'armée bavaroise Otto von Lossow et le chef de la police, Hans Ritter von Seisser : le nouveau pouvoir interdit une série de réunions prévues par le parti nazi le 27 septembre 1923 afin de renverser le gouvernement de Berlin. L'imbroglio entre autorités fédérales et régionales, entre décideurs politiques et militaires est complet : alors que Stresemann demande en vain au président Friedrich Ebert de proclamer l'état d'urgence, la Reichswehr en poste en Bavière sous le commandement de Lossow refuse d'obéir aux ordres du chef de l'armée Hans von Seeckt, et soutient Kahr. Lossow refuse également d'appliquer l'ordre d'interdire le Völkischer Beobachter, l'organe du parti national-socialiste, ce qui fait dire à Seeckt, le 22 octobre 1923, que la démarche du gouvernement bavarois est une ingérence dans le commandement militaire contraire à la Constitution. À Berlin, Seeckt projette de mettre sur pied une dictature légale pour pallier la crise, ce que Stresemann refuse. Il perd l'appui de l'armée et Seeckt lui annonce : Monsieur le chancelier, on ne peut mener la lutte avec vous : vous n'avez pas la confiance des troupes.
Les 1e et 2 septembre 1923 à Nuremberg, Adolf Hitler participe, aux côtés de Erich Ludendorff, au Deutscher Tag, durant lequel défilent pendant plus de deux heures 100 000 paramilitaires nationalistes, dont de nombreux membres de la Reichsflagge d'Ernst Röhm ; à la suite de ce rassemblement le NSDAP, le Bund Oberland et la Reichsflagge sont regroupés, sur l'initiative d'Ernst Röhm, au sein du Deutscher Kampfbund Ligue de combat allemande, dont la direction militaire est confiée à Hermann Kriebel, la gestion à Max Erwin von Scheubner-Richter et la direction politique à Hitler, ce qui ne lui donne que peu de pouvoir réel. La rumeur d'une marche sur Berlin se répand le 3 novembre. Seeckt fait part au ministre de l'Intérieur qu'il ne tentera aucune action contre l'armée bavaroise : La Reichswehr ne tire pas sur la Reichswer..
D'octobre à début novembre s'engagent des négociations en tout sens qui mènent à un véritable imbroglio, alors que la radicalisation se poursuit : le 20 octobre 1923, Kahr déclare que la Bavière considère comme son devoir d'être à cette heure la forteresse de la germanité menacée. Les autorités bavaroises nouent des tractations avec les milieux et organisations nationalistes berlinoises, comme le Stahlhelm, afin de renverser le gouvernement fédéral, ce qui n'empêche pas le chef de celui-ci, Streseman, de chercher le soutien des dirigeants bavarois. Ces contacts ne débouchent sur aucun résultat.
Mi-octobre, Hitler rencontre Lossow, qui lors d'une réunion d'officiers a sévèrement critiqué le mouvement nazi ; il le fait changer de position, Lossow déclarant peu après, lors d'une nouvelle réunion d'officiers que la Reichswehr soutiendrait les efforts nationalistes d'Hitler. Le 24 octobre, Hitler expose ses vues politiques à Seisser, pendant qu'à son insu, Lossow négocie avec les responsables militaires des organisations nationalistes. Le 25 octobre, Hitler et le Dr. Weber, responsable du groupe paramilitaire Oberland, ont une entrevue avec Seisser et Lossow : Hitler leur expose son projet de mettre en place un directoire, dont il fera partie aux côtés de Ludendorff, Lossow et Seisser, mais sans Kahr ; il affirme également qu'il sait qu'il ne peut rien entreprendre sans le soutien de la police et de l'armée. Ces pourparlers se poursuivent quelques jours, eux aussi sans résultat.
Le 6 novembre, Kahr, Lossow et Seisser organisent, en l'absence d'Hitler, une réunion avec les responsables du Kampfbund, qui regroupe les milices nationalistes : ils y affirment leur volonté d'empêcher par la force toute tentative de putsch en Bavière. Cette position est confirmée le 8, lors d'une rencontre entre Kahr et Ludendorff : le renversement du gouvernement doit venir de Berlin et non partir de Munich.
Le putsch Les préparatifs
Erich Ludendorff.
Craignant d'être lâché par les paramilitairesNote 6 en cas d'inaction contre le gouvernement fédéral ou pris de vitesse par les nouvelles autorités bavaroises36, Hitler maintient ses contacts avec le triumvirat bavarois ; mais, fort du soutien de Ludendorff, dont l'incontestable savoir-faire militaire s'accompagne d'une niaiserie politique sans bornes, il décide de tenter un coup de force à une date dictée par l'urgence mais aussi d'une portée symbolique : le 9 novembre, date anniversaire de la proclamation de la république en 1918.
Le putsch est préparé par Hitler les 6 et 7 novembre ; le 7 au matin, il rencontre Weber, Ludendorff, Göring, Scheubner-Richter et Kriebel, responsable militaire du Kampfbund. Le putsch doit se produire à Munich, mais aussi dans les principales villes bavaroises, Ratisbonne, Augsbourg, Ingolstadt, Nuremberg et Wurtzbourg : les groupes armés nationalistes doivent y prendre le contrôle des gares, du télégraphe, du téléphone et des stations de radio, des bâtiments publics et des commissariats ; les dirigeants socialistes et communistes et les responsables syndicaux doivent être immédiatement arrêtés. À Munich, les putschistes disposent d'au maximum 4 000 hommes dont moins de la moitié proviennent du parti nazi ou de la SA : en face d'eux, 2 600 policiers et soldats, mieux organisés et mieux armés que les putschistes et disposant de réserves.
La préparation du putsch fait naître de nouvelles rumeurs sur une tentative de prise du pouvoir, après celles qui ont couru en août et septembre : si Lossow les prend au sérieux et donne l'ordre à ses officiers supérieurs de réprimer tout coup d'État, en mentionnant spécifiquement Hitler comme en étant l'instigateur, Seisser, confiant dans les assurances qui lui ont été données par Ludendorff, ne prend pas position et Kahr, persuadé qu'Hitler et Ludendorff n'entreprendront rien sans l'avertir au préalable, demande que les mesures de sécurité pour la réunion du 8 novembre à la Bürgerbräukeller soient aussi légères et discrètes que possible.
À la Bürgerbräukeller
Réunion nazie à la Bürgerbräukeller, vers 1923
Le soir du 8 novembre 1923, vers 19 heures, Kahr, accompagné de Lossow et Seisser, arrive à la Bürgerbräukeller, une brasserie de Munich,. Conformément aux instructions de Kahr, le dispositif policier est léger : douze officiers de la police criminelle sont présents dans la salle, trente membres de la Hauptwache police de réserve assurent le maintien de l'ordre à l'extérieur, le gros des forces de police étant stationné à plusieurs centaines de mètres. La salle est rapidement comble et ses portes sont fermées vers 19 h 1544 : le public, 3 000 personnes, comporte de hauts représentants des autorités politiques, policières et militaires bavaroises et des membres de la bourgeoisie et des professions libérales. Peu après 20 heures, Hitler arrive devant la brasserie dont les alentours sont remplis de curieux. Surpris par cette affluence, Hitler demande aux policiers présents de faire évacuer les lieux : ceux-ci appellent des renforts, font dégager les abords de la salle, puis renvoient les renforts dans leur cantonnement. Les premiers camions chargés de membres de la SA arrivent vers 20 h 10, suivis, vers 20 h 30, par des membres de la Stosstruppe.
Au début du discours de Kahr, peu après 20 h 30, et alors qu'il prononce la phrase Même l'homme le plus énergique, même s'il possède les pouvoirs les plus étendus, ne peut pas sauver le peuple, s'il ne reçoit pas du peuple un appui actif, inspiré par l'esprit national, il est interrompu par un grand tumulte. Dirigé par Adolf Hitler, un pistolet à la main, un groupe d'hommes en armes fait irruption dans la salle et place une mitrailleuse en batterie à l'entrée de celle-ci. Après s'être difficilement frayé un chemin au sein de la foule compacte, Hitler et une poignée de ses hommes s'approchent de l'estrade, sur laquelle monte Hitler après avoir ramené le silence en tirant un coup de feu en l'air. Vers 20 h 45, il adresse quelques mots au public : La révolution nationale a éclaté. La salle est occupée par six cents hommes armés. Si le calme ne s'établit pas immédiatement, une mitrailleuse viendra sur la galerie. Le gouvernement bavarois est renversé, un gouvernement provisoire est formé. Par vantardise et pour impressionner la salle, il affirme également que les casernes de la Reichswehr et de la police du land sont occupées, la Reichswehr et la police sont en marche sous leurs étendards à croix gammée.
Hitler entraîne Kahr, Lossow et Seissler dans une pièce attenante, réservée par Hess, et leur explique qu'il compte prendre la tête d'un nouveau gouvernement dont il assume la direction et dont font partie Ludendorff – qui n'est pas encore arrivé à la brasserie –, à la tête de l'armée, Lossow comme ministre de la Reichswehr, Seisser comme ministre de la police, Kahr se voyant attribuer le poste de régent de Bavière. L'objectif de ce nouveau gouvernement est d'organiser une marche sur Berlin pour renverser le gouvernement fédéral. S'engagent alors, dans un climat de forte tension et sous la contrainte, des discussions confuses au cours desquelles les membres du triumvirat bavarois tergiversent et cherchent à temporiser. Après quinze minutes de discussion, l'absence d'accord n'empêche pas Hitler de retourner dans la salle principale de la brasserie, où l'ordre est assuré par Hermann Göring, pour déclarer à la foule qu'un accord sera obtenu dans les dix minutes qui suivent, puis de retourner négocier. Pendant ce deuxième entretien, des cris Heil! Heil! s'entendent venant de la grande salle, et Ludendorff fait son entrée dans la pièce où se tiennent les négociations. Il proclame son soutien au projet d'Hitler : Il s'agit de la patrie et de la grande cause nationale du peuple allemand et je ne peux que vous conseiller : venez avec nous, faites la même chose. Tour à tour, Lossow, Seisser et Kahr acceptent. Les nouveaux acolytes montent à la tribune et s'assurent de leur soutien mutuel : Hitler enflamme la salle en prononçant un violent réquisitoire contre les criminels de novembre. Le discours d'Hitler et les brèves allocution de Kahr, Lossow et Seisser suscitent un tonnerre d'applaudissements et l'approbation générale du public. Celui-ci est ensuite autorisé à quitter la salle, à l'exception d'un groupe d'otages, dont des membres du gouvernement et les principaux dirigeants de la police munichoise, arrêtés par Rudolf Hess, à la demande d'Hitler.
En ville
Si tout se passe comme prévu à l'intérieur de la brasserie, l'impréparation des putschistes se fait sentir à l'extérieur. Wilhelm Frick, chef de la section politique de la préfecture de police, réussit à paralyser l'action des forces de police, déjà largement acquises à la cause nationaliste, et Ernst Röhm occupe le Wehrkreis quartier général du district militaire vers 22 heures, mais ne pense à en contrôler le central téléphonique qu'après une heure et demie, ce qui permet aux autorités légales d'appeler des renforts militaires de province.
Membres des milices nazies lors du putsch.
Confiant dans le ralliement de la Reichswehr, des autorités et de la population à son coup d'État et à son projet de marche sur Berlin, Hitler néglige de faire occuper systématiquement les centraux téléphoniques, les gares, les ministères et les casernes, qui restent donc sous le contrôle des autorités bavaroises.
Alors qu'Hitler se rend en ville pour y suivre le déroulement des opérations, Ludendorff autorise Kahr, Lossow et Seisser à rentrer chez eux. Ceux-ci en profitent pour renier leur soutien au putsch, obtenu, selon eux, sous la contrainte, et prennent contact avec l'armée, la police et les médias pour contrer l'action d'Hitler.
L'action des putschistes en ville est particulièrement confuse et mal organisée : le 3e bataillon du régiment SA de Munich se procure 3 000 fusils cachés dans le monastère de la place Sainte-Anne, puis ne prend plus part à aucune action, à l'exception de l'un de ses pelotons. L'une des organisations participant au putsch, le groupe Oberland, échoue à investir la caserne du 19e régiment d'infanterie et à s'y emparer d'armes et connaît la même absence de résultat à la caserne du génie. Dans la nuit, et après son succès au Wehrkreiskommando, Röhm tente en vain de s'emparer du quartier général de la ville. Si la majorité des élèves de l'école d'infanterie se rallient au putsch, tel n'est pas le cas de la 7e division d'infanterie.
Réfugiés dans la caserne du 19e régiment d'infanterie, Kahr, Lossow et Seisser envoient, peu avant trois heures du matin, un message de la Reichswehr à toutes les stations de radio allemandes désavouant la tentative de putsch. Lossow donne également ordre à différentes unités de l'armée bavaroise de marcher sur Munich pour écraser le coup d'État. Lorsque Gustav Stresemann prend connaissance des événements, il les condamne immédiatement31 et déclare que toute aide aux putschistes est un acte de haute trahison.
La marche sur la Feldherrnhalle et l'échec final
La Feldherrnhalle, dernière étape du putsch.
Le 9 novembre 1923, il est clair que les forces armées et la police sont restées loyales au régime légal ; quant aux projets et tentatives de coup de force dans le reste de la Bavière, ils n'ont pas vu le jour ou bien connu un échec rapide. Si le coup d'État semble avoir échoué, la confusion règne encore : depuis l'aube, la ville est couverte de proclamations contradictoires émanant des putschistes et du gouvernement bavarois.
En fin de matinée, Hitler et Ludendorff, persuadés que la Reichswehr ne tirera jamais sur le stratège de la Première Guerre mondiale rassemblent 2 000 putschistes. Avec Hitler et Ludendorff à l'avant, les manifestants s'avancent à douze de front avec, en tête, les membres de la Stosstruppe, des SA et d’Oberland, suivis par des étudiants de l'école d'infanterie et les membres du corps de cavalerie de la SA, qui n'ont jamais reçu d'ordre depuis le début de putsch. Le défilé débute sous les acclamations de la foule et passe sans encombre un premier barrage de police sur le Ludwigsbrücke surplombant l'Isar. Peu après midi et demi, à l'approche de la Feldherrnhalle, les manifestants sont confrontés à un deuxième cordon de police : dans des circonstances particulièrement confusesNote 11, un échange de coups de feu éclate et les manifestants se débandent. Göring est grièvement blessé à la jambe, Max Erwin von Scheubner-Richter tué et Hitler a l'épaule démise. On dénombre quatre victimes parmi les policiers et seize morts chez les putschistes dont seulement cinq membres de la Stosstruppe, la garde rapprochée du Führer, la future SS. C'est de cet épisode que naît le mythe de la Blutfahne, drapeau qui aurait été taché par le sang d'Ulrich Graf, un des gardes du corps de Hitler qui lui aurait servi de bouclier, arrêtant de son corps les balles qui auraient pu tuer le futur Führer. La police arrête immédiatement, entre autres, Ludendorff et Streicher, alors que Göring parvient à s'échapper. Hitler, qui s'est enfui dès les premiers coups de feu, est arrêté le 11 novembre dans la maison de campagne d'Ernst Hanfstaengl, où il s'est réfugié.
Ernst Röhm.
Encerclé par la Reichswehr, dont des éléments sont arrivés d'Augsbourg, dans le bâtiment du commandement de la région militaire, Ernst Röhm, dont le porte-drapeau est Heinrich Himmler68, exige du général Franz von Epp et du général Jakob von Danner, qui veulent sa reddition, un ordre de Ludendorff. Après avoir appris l'échec de la marche sur la Feldherrnhalle et l'arrestation de Ludendorff, il accepte la demande de von Danner, qui lui propose que ses hommes puissent quitter la place avec les honneurs militaires ; désarmés, les putschistes quittent le bâtiment et seul Röhm est immédiatement arrêté.
Le procès
Le procès des dirigeants putschistes, accusés de haute trahison contre le gouvernement et du meurtre de quatre policiers, deux crimes passibles de la peine de mort, se déroule du 26 février au 1er avril 1924, en partie à huis-clos. Afin de pouvoir mieux contrôler le déroulement des débats, les autorités bavaroises obtiennent que le procès se déroule devant le tribunal du peuple de Munich, et non devant la cour du Reich à Leipzig.
Tant les juges que les procureurs manifestent une évidente sympathie à l'égard des accusés et déploient tous leurs efforts pour ne pas impliquer Ludendorff, le président du tribunal, Neithardt,, estimant qu'il est le seul atout de l'Allemagne ; des témoins essentiels ne sont pas invités à déposer et des pièces fondamentales ne sont pas produites, notamment afin de ne pas évoquer la complicité de Kahr, Lossow, Seiser et de la Reichswehr dans le projet de renversement du gouvernement de Berlin. Ce climat permet à Hitler de transformer le procès en une opération de propagande, un carnaval politique et d'y prononcer de véritables discours ; s'il s'est montré piteux face à la police, il, Hitler révèle lors de son procès son écrasante supériorité oratoire. Le premier procureur va jusqu'à affirmer : Hitler est un homme hautement doué qui, parti de peu, a atteint par son sérieux et son travail acharné une situation respectée dans la vie publique. Il s'est totalement sacrifié aux idées qui le pénétraient et il a pleinement accompli son devoir de soldat. On ne peut lui reprocher d'avoir utilisé à son profit la situation qu'il s'est faite.
Les principaux accusés.
Hitler revendique sa totale responsabilité dans la tentative de coup d'État et déclare lors de son procès :
Je ne suis pas venu au tribunal pour nier quoi que ce soit ou éviter mes responsabilités. ... Ce putsch Je l'ai porté seul. En dernière analyse, je suis le seul à l'avoir souhaité. Les autres accusés n'ont collaboré avec moi qu'à la fin. Je suis convaincu que je n'ai rien souhaité de mal. Je porte les responsabilités pour toutes les conséquences. Mais je dois dire que je ne suis pas un criminel et que je ne me sens pas comme tel, bien au contraire.
Les peines prononcées sont particulièrement légères : Hitler, le préfet de police Pöhner, Kriebel et Weber sont condamnés à cinq ans de forteresse, avec déduction de leurs six mois de détention préventive ; les autres accusés, dont Ernst Röhm sont condamnés à des peines si légères qu'elles sont absorbées par leur détention préventive : ils sont libérés sur parole à l'issue du procès. Ludendorff est acquitté. Le tribunal justifie sa clémence en arguant que les putschistes avaient été guidés par un pur esprit patriotique et par la plus noble des volontés. De plus Hitler échappe à l'expulsion vers l'Autriche, pourtant prévue par la section 9, §2 de la loi pour la protection de la république, qui selon les juges ne saurait s'appliquer à un homme tel qu'Hitler qui pense et sent en allemand.
Malgré sa condamnation avec sursis de 1922, qui rendait légalement tout nouveau sursis impossible, Hitler sort par anticipation de prison le 20 décembre 1924, mais reste interdit de parole en public dans la majeure partie de l'Allemagne jusqu'en 1927 et interdit de séjour en Prusse jusqu'en 1928.
Les conséquences
Le NSDAP est interdit dès le 9 novembre, interdiction levée en avril 1925 à l'instigation du ministre de la Justice Franz Gürtner. Devenu illégal, privé de son chef, qui en a confié la direction ad interim à un Alfred Rosenberg totalement incapable d'acquérir une autorité quelconque, en proie à des querelles entre factions notamment suscitées par Ernst Röhm ou par Julius Streicher, le parti nazi connaît une véritable éclipse et est au bord de la disparition pure et simple.
L'une des conséquences de la tentative de putsch est un changement de stratégie d'Adolf Hitler. Selon Georges Goriely, dans les années qui suivent, il évite de se donner une allure de putschiste et s'emploie plutôt à mettre dans son jeu les puissances traditionnelles. Cette analyse est partagée par Robert O. Paxton : le putsch manqué de la brasserie fut écrasé si ignominieusement par les patrons conservateurs de Bavière que Hitler se jura de ne plus jamais tenter de s'emparer du pouvoir par la force. Cela signifiait que les nazis allaient devoir respecter, au moins superficiellement, la légalité constitutionnelle, même s'ils n'allaient jamais abandonner les violences ciblées qui étaient un élément central de leur pouvoir d'attraction, ni les allusions aux objectifs plus vastes qu'ils comptaient poursuivre une fois au pouvoir. Pour reprendre la formule de Joachim Fest, il ne faut pas en déduire ... qu'Hitler était prêt à accepter la légalité comme une barrière inviolable, mais seulement qu'il était décidé à développer l'illégalité à l'abri de la légalité.
À la prison de Landsberg, Hitler dispose d'une cellule spacieuse et confortablement meublée dans laquelle il reçoit plus de cinq cents visiteurs pendant ses treize mois de détention ; à la suggestion de Max Amann, il dicte à Emil Maurice et Rudolf Hess un compte rendu de sa vie et de ses opinions qui paraît en 1925 : Mein Kampf.
L'année qui aurait dû être celle du bannissement définitif du spectre de Hitler vit au contraire la genèse de sa prééminence absolue au sein du mouvement völkisch et de son ascension vers l'autorité suprême. Avec le recul, l'année 1924 apparaît comme le moment où, tel un phénix renaissant de ses cendres, Hitler put commencer à s'extraire des décombres d'un mouvement völkisch éparpillé pour devenir le chef absolu, dominant sans partage un parti nazi réformé, plus solidement structuré et mieux soudé.
La commémoration
Hitler pendant le congrès du parti de 1935 à Nuremberg. Derrière Hitler, la Blutfahne et son porteur officiel Jakob Grimminger.
Dès 1924, la propagande national-socialiste s'est appliquée à donner au putsch une dimension héroïque qui s'amplifie encore après l'arrivée des nazis au pouvoir. À partir de 1933 se déroulent chaque année à Munich des commémorations à la mémoire des victimes nazies qui deviennent de véritables martyrs de l'Allemagne et du mouvement : Notre mouvement est né de toute cette détresse, et il a donc dû prendre des décisions difficiles dès les premiers jours. Et l'une de ces décisions a été la décision de mener la révolte des 8 et 9 novembre 1923. Cette décision a échoué en apparence à l'époque, seulement, c'est du sort des victimes que le salut de l'Allemagne a pu venir.
Hitler dédie aux seize victimes de son parti, les Blutzeuge martyrs le premier volume de Mein Kampf. La médaille que le Führer décerne à tous ceux qui ont participé au putsch, le Blutorden, est la plus haute distinction du NSDAP. Un véritable mythe est mis en place autour du putsch. La Blutfahne drapeau du sang, qui désigne le drapeau porté par Andreas Bauriedl lors de la marche des putschistes est élevé au rang d'objet de culte. À partir de 1926, elle est glorifiée lors des congrès du parti et utilisée pour consacrer les drapeaux du parti et les fanions de la SS. Jakob Grimminger qui avait participé au putsch est le porteur officiel de la Blutfahne85. « Elles, les victimes deviennent le noyau d'un mythe qui joue un rôle significatif dans l'arrivée du parti nazi au pouvoir. À travers elles, un échec ignominieux est transformé en un glorieux défi à la tyrannie.
À Munich, sur la Königsplatz, Hitler fait ériger en 1935 deux mausolées pour les seize putschistes tués, dans lesquels leurs restes sont transférés. Sur la Feldherrnhalle, Hitler fait poser une plaque devant laquelle est postée une sentinelle. Les passants doivent saluer la plaque du salut hitlérien à leur passage.
Je me suis rendu à pied jusqu'à la Feldherrnhalle. On salue les morts. Acte solennel et somptueux. Le Führer leur rend un dernier hommage. Moment grandiose. Beau et efficace comme jamais.
Joseph Goebbels, 9 novembre 1935.
À l'arrivée des troupes américaines, les deux constructions de la Königsplatz sont dynamitées. Il n'en reste plus que les socles aujourd'hui. La plaque de la Feldherrnhalle est retirée en 1945 ; depuis 1993, une nouvelle plaque rappelle la mémoire des policiers tués.
Adolf Hitler 1889-1945
La trajectoire d'Adolf Hitler n'a guère d'équivalent dans l'histoire ; elle était sans précédent dans l'histoire allemande. Voilà un raté scolaire et un marginal social devenu agitateur politique qui, après avoir été condamné à la prison pour haute trahison en 1923, acquiert la nationalité allemande en 1932 et s'assied, en janvier de l'année suivante, sur le siège de Bismarck. Devenu un homme d'État extraordinairement populaire en son pays, il plongea ce dernier et l'Europe entière dans la pire catastrophe d'un siècle qui n'en fut pourtant pas avare.
La trajectoire de cet homme, dont on a dit qu'il avait été constamment sous-estimé, pose la question de ses talents ou, plus exactement, de l'adéquation entre ceux-ci et les aspirations de la société allemande. Sans des conditions historiques particulières, on peut douter que les Allemands se seraient ralliés à lui ; ils ne l'auraient pas fait quelques décennies plus tôt. Même si on ne prétend pas y répondre exhaustivement, cette question mérite d'être gardée à l'esprit.
Un raté social .Né le 20 avril 1889 dans la petite ville autrichienne de Braunau-sur-l'Inn, non loin de Linz, Hitler eut une enfance partagée entre l'affection de sa mère et une relation conflictuelle avec son père. Cet homme modeste, qui s'était hissé au rang d'inspecteur des douanes, rêvait pour son fils d'une carrière de fonctionnaire, perspective devant laquelle celui-ci regimbait en arguant de son intérêt pour l'art. Après la mort de son père et un parcours scolaire médiocre, le jeune Hitler partit pour Vienne, où il essuya un double échec au concours d'admission à l'Académie des beaux-arts. La mort de sa mère étant survenue peu après, le jeune homme mangea son petit héritage en rêvant d'un grand destin, avant de glisser dans la marginalité. De 1908 à 1913, il vécut de menus travaux et de la vente d'aquarelles qu'il peignait, confronté à l'expérience des asiles de nuit. Lecteur assidu, il s'imprégna d'une littérature pangermaniste et antisémite qui lui fit prendre en horreur l'empire des Habsbourg, auquel il reprochait de faire obstacle à l'union des Allemands d'Autriche avec ceux du Reich.
En 1913, Hitler partit s'installer à Munich pour échapper au service militaire sous les drapeaux de l'empire détesté. À près de vingt-cinq ans, il était toujours sans profession et sans attaches. Mais sa personnalité était déjà formée : des aspirations artistiques tenaces ; une culture livresque qui lui servait surtout à alimenter ses préjugés ; une superbe ignorance du monde non germanique, des langues et des pays étrangers ; de la mémoire, du discernement, une vraie capacité d'analyse ; et une affectivité bridée qui laissait peu de place à l'affection et à l'amour.
En août 1914, lorsque la guerre éclate, Hitler s'engage, plein d'enthousiasme, dans l'armée bavaroise. Pour la première fois, il connaît une expérience collective, il se socialise dans la vie militaire dont il épouse les valeurs, l'expérience de la Grande Guerre achevant de durcir en lui une brutalité naturelle. Son courage lui vaut la Croix de fer de première classe, sans lui permettre de dépasser le grade de caporal. Jusqu'au-boutiste, il fut enragé par la défaite et s'en retourna dans une Allemagne bouleversée par la chute de l'empire et par des secousses révolutionnaires – en 1919, Munich connut une éphémère république soviétique.
Pendant un an encore, Hitler resta dans l'armée, où il fut utilisé comme informateur et agent de propagande. Il entra ainsi en contact avec un petit parti d'extrême droite, le Parti ouvrier allemand, auquel il se consacra après sa démobilisation. Le Munich de l'après-défaite fut sa première chance, en lui révélant son talent d'orateur et sa vocation politique. La ville lui offrit aussi un public sensible au fanatisme d'un homme sans attaches, plein d'idées simples, pétri d'un ressentiment essentiel et d'une haine immense. Le raté impuissant avait trouvé une assise pour ses rêves de puissance.
L'idéologue et le politique
À partir de 1920, la vie d'Adolf Hitler se confond avec son action politique – sa vie privée, tenue hors des projecteurs, n'eut jamais de réelle épaisseur. Le petit parti auquel il avait adhéré en septembre 1919 prit le nom, l'année suivante, de Parti ouvrier national-socialiste allemand Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, N.S.D.A.P.. Hitler en assuma rapidement la direction et lui imprima des caractéristiques durables, en particulier la violence des propos et l'usage de la force, l'un et l'autre destinés à produire une cohésion interne et à attirer l'attention de l'opinion. Avec ses 50 000 membres et sa formation paramilitaire, la SA Sturmabteilung, section d'assaut, le parti nazi prit du poids, mais il restait confiné à la Bavière, dont il exploitait les tensions régionalistes avec Berlin.
C'est dans ce contexte, et dans le sillage des remous créés par l'occupation franco-belge de la Ruhr, que Hitler se lança, le 8 novembre 1923, dans une tentative de putsch contre le gouvernement bavarois. Ce faux pas lui valut l'emprisonnement dans la forteresse de Landsberg et une condamnation, clémente, à cinq ans de réclusion, abrégée par une libération anticipée à la fin de 1924. En prison, Hitler dicta Mein Kampf Mon combat . À la fois autobiographie stylisée et exposé doctrinal, cet ouvrage frappe à deux égards. D'abord, par l'importance accordée à la démarche politique, pragmatisme inclus, ce qui distinguait Hitler de ses concurrents dans l'extrême droite. L'importance majeure qu'il accordait à l'organisation et à la propagande était un hommage rendu aux méthodes de ses adversaires sociaux-démocrates et communistes. Mais c'était également le reflet de son expérience de jeune catholique. Le mouvement nazi devait être à la fois un parti-armée et un parti-Église, un parti de combat et un parti de croyants et, dans les deux cas, un parti sous la direction d'un homme d'exception.
Ensuite, par la cohérence de l'idéologie qui y est exposée. Largement empruntée au nationalisme « völkisch » (ethno-raciste) d'avant 1914, elle est présentée avec beaucoup de force. Le racisme en constitue la charpente, c'est-à-dire l'idée que la race est le principe explicatif de l'histoire du monde et la pureté raciale le secret de la puissance d'un peuple. De là découle la nécessité, à la fois de l'épuration des éléments « racialement malsains » au sein même du peuple allemand – ainsi les malades mentaux – et de l'élimination des allogènes qui s'y trouvent – les Tsiganes, les Noirs, etc. L'antisémitisme s'inscrit dans ce cadre raciste, il se loge même en son centre. Car Hitler conçoit l'idée d'un antagonisme privilégié, au sein même du combat éternel des races, entre le monde aryen et les Juifs, et cet antagonisme existentiel ne peut prendre que la forme d'une lutte à mort. Plus généralement, la mission qu'il s'assigne est de faire retrouver à l'Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, le chemin de la puissance, laquelle s'épanouira dans la création d'un empire en Europe orientale – l'« espace vital » – et dont les conditions préalables devaient être la mobilisation des masses, la prise de contrôle de l'État, la destruction des adversaires et l'épuration raciale de la nation.
Ce corps d'idées avait un caractère totalitaire puisqu'il embrassait la nature, l'histoire et la société. Il incluait, en outre, un horizon apocalyptique qui concernait avant tout le rapport aux Juifs, conçu selon une logique du « eux ou nous ». Enfin, sa réalisation impliquait la rupture avec la civilisation occidentale, façonnée par le christianisme et les Lumières. En plaidant pour que fût réinculquée aux jeunes générations une morale fanatique de la « dureté » qui les délivrerait de toute solidarité humaine et justifierait la mise en esclavage ou à mort des autres peuples, Hitler exprimait sa volonté d'un changement de paradigme. Si tous les événements qui allaient suivre n'étaient pas annoncés, il ne peut y avoir de doute sur le potentiel énorme de violence que contenait cette idéologie.
Après sa sortie de prison, Hitler entreprit de refonder son parti sur de nouvelles bases. Tirant les conséquences du putsch manqué, il décida que l'accession au pouvoir se ferait par la participation au jeu électoral. Pour souder son parti, il le dota d'un ensemble de rites et de symboles la croix gammée, le salut, le drapeau qui se donnaient à voir lors du congrès annuel à partir de 1927 à Nuremberg et dans l'utilisation croissante du Heil Hitler. À la théâtralisation du politique faisait escorte un culte du chef, le Führer, qui assurait à celui-ci une primauté politique et idéologique. En même temps, Hitler dotait son parti de structures plus appropriées au recrutement, à l'encadrement et à la mobilisation des adhérents et à la préparation de la prise du pouvoir. Outre une organisation territoriale, le parti nazi comprenait désormais des groupements paramilitaires (SA, SS – Schutzstaffel, escadron de protection –, Hitlerjugend et des associations professionnelles.
Les défilés nazi
Défilé des membres du parti nazi à Nuremberg, en 1933. Leurs étendards portent l'emblème du Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei : le svastika, connu sous le nom de croix gammée.
Dans cette période de stabilisation économique et de détente internationale, son audience restait insignifiante. Aux élections nationales de 1928, il remporta 2,6 p. 100 des suffrages 12 sièges au Reichstag, tout en doublant de taille. Mais grâce à sa réorganisation, il s'était installé dans la durée, il avait étendu son réseau au pays entier, il possédait des structures capables d'accueillir un éventuel afflux. Or c'est ce qu'allait provoquer, de manière inattendue, la crise économique de 1929, qui jetait au chômage des millions d'Allemands et entraînait un blocage du système politique. Le renforcement des partis extrêmes rendant impossible la formation d'une majorité parlementaire, les chanceliers successifs nommés par le président Hindenburg multiplièrent les consultations électorales. Le Parti nazi put ainsi profiter de la fragilité de la démocratie libérale et de la force du nationalisme dans une société allemande en crise.
La percée fut réalisée aux élections de septembre 1930, le Parti nazi obtenant 18,3 p. 100 des suffrages 107 sièges. Dès lors, l'ascension se pDéfilé nazi
oursuivit continûment jusqu'au 31 juillet 1932, date à laquelle les nazis obtinrent 37,3 p. 100 des votes 230 sièges, le point le plus haut avant l'accession au pouvoir. Cette progression fut acquise en vidant les partis de droite de leurs électeurs, mais aussi en mordant sur la social-démocratie et le parti catholique, le Zentrum. Tout en gardant son centre de gravité dans les classes moyennes, la base électorale du Parti nazi devenait interclassiste, grâce à un message qui jouait sur plusieurs registres : un anticommunisme violent, l'hostilité à la démocratie pluraliste, l'aspiration à l'unité nationale et à la récupération d'un statut de grande puissance, sans oublier l'antisémitisme, mis en sourdine, mais qui ne se laissait pas ignorer.
De ce succès remarquable, le mérite revenait largement à Hitler. Son sens de la mise en scène et son habileté oratoire, ses invectives dénonciatrices, la force de conviction qui sourdait de sa personne transmettaient une image de « puissance existentielle » (Eric Voegelin) où des Allemands désorientés trouvaient un baume à leur ressentiment. Mais il avait fallu les circonstances exceptionnelles de la grande crise pour que Hitler rencontre un écho massif à ses haines et à ses aspirations de grandeur.
Parallèlement, le Parti nazi gagnait en force – 1,4 million d'adhérents en 1932 et environ 400 000 membres pour la SA, dirigée par Ernst Röhm. À sa tête, Hitler roda un style de direction qu'il allait plus tard transposer au régime : en lieu et place d'une gestion collégiale et bureaucratique, un leadership souverain fondé sur un rapport de confiance personnelle qui alimentait un esprit de gang. Son comportement était marqué par le goût du secret et de la manipulation, l'importance donnée au prestige, le penchant pour le risque et, au fond de tout, la soif de pouvoir. Confronté à des décisions difficiles, le chef nazi tergiversait souvent, mais, sa position une fois arrêtée, il agissait avec une détermination brutale. Chose rare, l'habileté politique faisait bon ménage chez lui avec un fanatisme qui marquait toute son idéologie et se résumait à cette alternative : « la victoire ou l'anéantissement ».
Le chef de régime
La nomination de Hitler au poste de chancelier, le 30 janvier 1933, ne fut pas la conséquence d'une victoire électorale. Aux élections de novembre 1932, le Parti nazi avait perdu des voix par rapport à celles de juillet, passant de 37,3 à 33,1 p. 100 des suffrages 196 sièges. Cette nomination fut le résultat des intrigues d'une poignée de conservateurs, menés par Franz von Papen ; désireux de mettre en place un régime autoritaire, ils jugeaient que l'affaiblissement du Parti nazi allait leur permettre de se servir de Hitler. Ayant l'oreille du président Hindenburg et l'appui des dirigeants de l'armée, sensibles aux promesses de réarmement du chef nazi, ils lui firent ouvrir la porte de la chancellerie.
Hitler au pouvoir, 1933. Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomme Adolf Hitler chancelier. Un mois plus tard, l'incendie du Reichstag fournit le prétexte pour se débarrasser du Parti communiste allemand, le plus puissant d'Europe. Les libertés publiques sont suspendues et les premiers camps de concentration s'ouvre…
Ce pari allait se retourner contre ses auteurs. Car si Hitler présidait un gouvernement de coalition où il était minoritaire, il parvint rapidement à établir sa prépondérance. Mettant à profit l'incendie du Reichstag du 27 février 1933, il se fit attribuer les pleins pouvoirs par le Parlement. Puis la coalition, dont il était le chef nominal, obtenant une majorité aux élections de mars le vote nazi lui-même ne dépassa pas 43,9 p. 100, dans un climat pourtant marqué par la mise hors la loi du Parti communiste et l'intimidation exercée par la SA, il interdit dans la foulée les partis de gauche, avant d'obtenir l'autodissolution des partis de droite. La voie était désormais ouverte au parti unique le N.S.D.A.P. est déclaré parti unique le 14 juillet, les nazis s'empressant d'éliminer leurs adversaires par la violence la plus brutale les camps de concentration accueillirent bientôt des dizaines de milliers de personnes et utilisant leur monopole pour encadrer la société et lui inculquer les valeurs du nouveau régime.
L'ascendant pris par Hitler sur ses alliés conservateurs le laissait cependant dans une situation qu'il lui fallait encore consolider, comme le montra bientôt l'émergence d'un double danger. La SA de Röhm inquiétait de plus en plus les militaires, car elle exigeait de former le noyau de la future armée. De leur côté, des conservateurs comme Papen intriguaient dans la perspective de la succession du président Hindenburg, qui était malade. Placé devant le risque d'une éventuelle alliance entre l'armée et les conservateurs, Hitler sacrifia la SA lors de la Nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934, première démonstration de sa violence sanguinaire – la seconde allait venir lors du pogrome de la Nuit de cristal, le 9 novembre 1938. L'opération fit environ deux cents morts : parmi eux des chefs de la SA, dont Röhm, mais aussi des personnalités conservatrices comme l'ancien chancelier von Schleicher. Elle permit à la SS de gagner du galon et d'élargir le pouvoir que son chef Heinrich Himmler était en train d'acquérir en mettant la main sur la police. Après la mort de Hindenburg, au début d'août 1934, Hitler cumula sans susciter d'objections les titres de chancelier et de chef de l'État le 19 août, devenant du même coup le commandant suprême des forces armées.
Hitler et Röhm. Proche d'Adolf Hitler à droite depuis le début des années 1920, Ernst Röhm le bras levé est nommé par celui-ci chef d'état-major de la S.A. en 1930. Mais ses projets d'intégrer la Reichswehr dans la S.A., alors qu'Hitler recherche le soutien de l'armée pour conforter son pouvoir.
De ce moment, la marginalisation des conservateurs devint inéluctable. Leurs dernières têtes de file quittèrent le gouvernement au début de 1938, époque à laquelle Hitler assuma en personne le commandement de la Wehrmacht. Une concentration de pouvoirs remarquable, qui lui permettait de diriger dorénavant le régime comme il l'avait fait pour le Parti nazi, à savoir en l'absence de toute collégialité – le gouvernement ne se réunit plus à partir du début de 1938 – et selon un système de délégation de pouvoirs sur la base d'un rapport de confiance qui aiguillonnait la compétition pour obtenir la faveur du chef et compliquait la coordination efficace des efforts. Devenu l'astre du système, Hitler pouvait jouer les uns contre les autres avec d'autant plus d'assurance qu'il bénéficiait d'une popularité croissante, en raison des succès remportés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Dès son arrivée au pouvoir, il avait fait adopter des mesures qui montraient le sérieux de son programme et de ce qui en formait la ligne d'horizon : la puissance de l'Allemagne. L'une de ses premières décisions avait été de lancer un réarmement massif, qui offrait le double avantage de lier les militaires au régime et de faire redémarrer l'économie. En même temps, il avait commencé à traduire en actes sa doctrine raciste : encouragement de la procréation des Allemands « racialement sains », loi de stérilisation forcée pour les individus atteints de maladies graves ou héréditaires – en moins de deux ans 400 000 personnes furent traitées –, discrimination envers les prétendus « asociaux », les homosexuels, les Tsiganes et bien sûr envers les Juifs, renvoyés de la fonction publique dès 1933, puis victimes de la ségrégation avec les lois de Nuremberg du 15 septembre 1935, avant d'être spoliés de leurs biens juste avant la guerre, l'objectif étant alors de les faire partir d'Allemagne.
Tandis que le réarmement faisait chuter le chômage, il permettait, à l'extérieur, d'obtenir des succès spectaculaires. Après avoir retiré son pays de la Société des nations en 1933, Hitler procéda au démantèlement du traité de Versailles, en réintroduisant le service militaire obligatoire en mars 1935, puis en remilitarisant la Rhénanie un an plus tard. Exploitant la désunion des puissances occidentales, il profitait du différend qui les opposait à l'Italie de Mussolini au moment de la guerre d'Éthiopie pour trouver un allié. À partir de 1938, il passa à l'expansion ouverte grâce à l'utilisation de méthodes d'intimidation qui lui permirent de réaliser, sans coup férir, l'annexion de l'Autriche l'Anschluss en mars, puis, après une velléité de résistance de Paris et de Londres, l'incorporation au Reich de la région tchécoslovaque des Sudètes, concédée par les puissances occidentales lors de la conférence de Munich 29-30 septembre 1938.
Remilitarisation de la Rhénani. Mars 1936 : un an après le rétablissement du service militaire obligatoire qui expose au grand jour le réarmement de l'Allemagne, Hitler viole à nouveau le traité de Versailles en réoccupant la zone démilitarisée sur la rive gauche du Rhin.
Le 11 mars 1938, menacé par Hitler d'une intervention militaire, le chancelier autrichien Schuschnigg a démissionné. Le 12, les troupes allemandes ont pénétré dans l'État fédéral d'Autriche et occupé Vienne. Le 14, Hitler y fait une entrée triomphale. Quatre ans après l'échec du coup de force qui av…
Accords de Munich, 1938. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, les accords de Munich sont signés par Hitler, Mussolini, Édouard Daladier, chef du gouvernement français, et le Premier ministre britannique Arthur Neville Chamberlain. Hitler obtient pleine satisfaction concernant le rattachement au Reich de la minorité alle…
Cette dynamique comportait des dangers redoutables. L'avance prise par l'Allemagne dans la remilitarisation n'allait pas durer, et le réarmement des autres puissances tout autant que les tensions économiques, notamment la pénurie de devises et de matières premières, créées en Allemagne même par la production d'armes, poussaient Hitler à aller toujours plus avant dans la voie de l'expansion et à risquer une guerre européenne, sinon mondiale. Lorsqu'il procéda au démembrement de la Tchécoslovaquie, en mars 1939, puis menaça la Pologne, le Royaume-Uni et la France n'avaient d'autre choix que de résister par les armes. Rarement une guerre européenne avait été due aussi nettement à la politique d'une seule puissance et d'un seul homme.
Le chef de guerre. Le déclenchement du conflit fut accueilli avec morosité par la population allemande. La victoire sur la Pologne était prévisible, mais qu'allait-il se passer avec la France et le Royaume-Uni ? Après les mois d'inactivité de la « drôle de guerre », la série de victoires allemandes du printemps et de l'été 1940, qui aboutirent à l'occupation de la Norvège, du Danemark, de la Belgique, des Pays-Bas et de la France, fit atteindre à la popularité de Hitler son zénith. La défaite de la France était largement due aux erreurs et aux impérities du haut commandement français, mais Hitler avait eu du flair en faisant confiance aux chefs militaires qui prônaient une percée motorisée par les Ardennes.
Cette victoire lui donna l'aura d'un génie militaire, et il se persuada lui-même qu'il en était un. Sa confiance en soi, fondée sur un égocentrisme ancien, s'était amplifiée depuis le milieu des années 1930. Elle prenait à présent une ampleur qui le rendait intolérant aux avis de son entourage, y compris de ses conseillers militaires. Le chef nazi avait indubitablement l'intelligence des choses militaires, il était intéressé par la technique et la stratégie. Mais, avec le temps, il se substitua toujours davantage à ses généraux, refusant d'entendre les avis discordants et transformant ses conseillers en courtisans, dans l'ambiance suffocante des bunkers où il séjourna à partir de 1942. Le politique cédait le pas au chef de guerre et ne gardait plus le contact avec la population qu'à travers des discours radiodiffusés.
Or, dans cette guerre, l'Allemagne perdait progressivement sa capacité d'initiative. La Grande-Bretagne ayant refusé de déposer les armes, Hitler réagit en joueur qui accroît la mise dans l'espoir de se refaire d'un coup : il voulut emporter la décision en élargissant le conflit. Ses campagnes en Yougoslavie et en Grèce au printemps de 1941 et l'envoi d'un corps expéditionnaire en Afrique du Nord visaient à assurer ses arrières dans des régions déstabilisées par les insuccès italiens. Mais la campagne contre l'U.R.S.S., déclenchée en juin 1941, résultait, elle, d'un choix délibéré qui visait à produire le tournant attendu et dont les motifs étaient indissociablement stratégiques abattre la dernière puissance continentale et forcer Londres à faire la paix, économiques assurer une base suffisante en cas de prolongation de la guerre et politico-idéologiques la conquête de l'espace vital.
Or, loin de se terminer par une victoire rapide, cette campagne se révélait extraordinairement coûteuse en hommes et en matériel. Et voilà qu'à l'adversaire soviétique dangereusement sous-estimé, Hitler en ajoutait un autre de taille en déclarant, le 11 décembre 1941, la guerre aux États-Unis par solidarité envers l'allié japonais qui venait de les agresser à Pearl Harbor. La guerre sur deux fronts, la guerre devenue totale : Hitler avait créé par ses coups de poker la situation à laquelle il était préparé par toute sa psychologie, celle dans laquelle ne devait valoir que l'alternative de la victoire ou de l'anéantissement.
L'empire raciste
L'évolution militaire ne lui avait pas fait perdre de vue, cependant, la construction de son empire raciste. La guerre offrait un paravent commode pour exécuter des opérations qu'il importait de garder secrètes. Et elle favorisait le déploiement de la violence inhérente à l'idéologie nazie. Dès l'automne de 1939, Hitler fit un pas supplémentaire dans l'épuration raciale du peuple allemand en ordonnant l'assassinat, qui fut réalisé par gazage, des handicapés et des malades mentaux ; cette prétendue euthanasie fit plus de 70 000 victimes.
Racisme nazi. Dès 1940, les populations des territoires occupés à l'Est par les armées allemandes furent soumises à la politique raciste des nazis. Des centaines de spécialistes historiens, géographes, archivistes, ethnologues, sociologues, médecins, affiliés à des instituts de recherche interdisciplinaires, fu…
Parallèlement, il posait les jalons de son empire. Si des décisions importantes étaient remises à l'après-guerre, notamment la fixation des frontières, des directions étaient prises, qui indiquaient les contours de l'Europe à venir. Une Europe dont l'économie et la politique seraient régulées à partir de Berlin, en vertu d'une sorte de néo-doctrine de Monroe et dont le cœur serait formé à la fois par les populations allemandes et par les peuples dits germaniques, les Scandinaves, les Hollandais, les Flamands, qu'il s'agissait d'absorber dans un grand Reich dont l'aire de développement était située à l'Est. L'« espace vital » conquis aux dépens de la Pologne, des pays Baltes et de l'U.R.S.S. devait être « germanisé », non pas en assimilant les populations, mais en les expulsant massivement – par dizaines de millions – pour faire place à des colons.
À ce remodelage racial du continent, dont la réalisation fut confiée à Heinrich Himmler, les besoins de l'économie de guerre mirent bientôt un frein, comme le montra la suspension des transferts de populations entamés en Pologne. Il n'en alla pas de même pour les Juifs, dont la disparition par voie d'émigration forcée était bloquée par le conflit et que Hitler entreprit de faire disparaître par l'extermination, une politique contre laquelle aucun argument de nécessité économique ne fut autorisé à prévaloir. Près de six millions de Juifs, de l'Atlantique à l'Ukraine et de la Norvège aux îles grecques, furent victimes de l'antisémitisme obsessionnel qui animait le chef nazi et qui rencontrait autour de lui un écho suffisant pour que les bourreaux ne lui fassent pas défaut.
Avec la guerre, c'est la violence du régime en général qui prit son essor, en trouvant de multiples relais, y compris dans la Wehrmacht, qui prêta la main à l'exploitation économique des territoires occupés et à la répression des résistances, pour ne pas parler de la SS et de ses camps de concentration, bientôt peuplés de centaines de milliers de gens de toutes les nationalités, promis à l'extermination par le travail forcé.
Pendant ce temps, Hitler menait, replié dans son Q.G. de Rastenburg, une guerre dont tout indiquait de plus en plus clairement qu'elle était sans issue. À défaut de battre les Soviétiques, il plaça ses espoirs, après le tournant de Stalingrad au début de 1943, dans l'éclatement de l'alliance adverse et dans l'effet des « armes secrètes » – les bombes volantes et les fusées – qu'il faisait construire. Son pari qu'il réussirait à battre les Anglo-Saxons au moment de leur débarquement en France, en juin 1944, fut à son tour perdu. Cet échec précipita l'attentat du 20 juillet 1944, organisé par un groupe d'officiers et dont il sortit indemne. Vieilli, blanchi, courbé, le dictateur aux mains désormais tremblantes appliquait son exceptionnelle énergie à refuser de baisser les armes. À défaut de vaincre l'ennemi, il laisserait détruire son pays. Dans son jusqu'au-boutisme, il fut secondé par la combativité de ses soldats et la ténacité d'une population qui lui restait largement attachée, à la fois par nationalisme et par peur d'une victoire vengeresse des Soviétiques.
Le 30 avril 1945, claquemuré dans Berlin assiégé par l'Armée rouge, Hitler se suicida en compagnie de sa compagne Eva Braun, qu'il venait d'épouser, et du couple Goebbels avec ses six enfants. Illustration ultime de la destructivité du nazisme et terme catastrophique de la vie d'un homme que les Allemands qualifièrent volontiers de démoniaque après la guerre. Les historiens préfèrent souligner l'entrée en résonance entre la personnalité de cet homme et les tensions et les aspirations d'une société profondément déstabilisée par la Grande Guerre et ses séquelles.Philippe Burin
          
Posté le : 07/11/2015 19:55
|
|
|
|
|
Apocalypse Staline |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
http://pluzz.francetv.fr/videos/apocalypse_staline_saison4_,130391994.html Cliquez sur " retournez à l'accueil " puis cliquez sur " apocalypse Staline " pour lire le film
Posté le : 04/11/2015 09:51
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
104 Personne(s) en ligne ( 78 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 104
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages