|
|
Joseph Galliéni |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 avril 1849 naît Joseph Simon Galliéni
à Saint-Béat dans la Haute-Garonne, mort à 67 ans le 27 mai 1916 à Versailles, militaire et administrateur colonial français. Il exerça une grande partie de son activité dans les opérations de colonisation menées par la France, laissant une empreinte profonde sur l'histoire de la colonisation française, et termina sa carrière pendant la Première Guerre mondiale. Il fut fait maréchal à titre posthume en 1921.
Il a le grade de Général de division pendant ses années de service de 1868 à 1916 pendant les conflits de la Guerre franco-prussienne de 1870, puis pendant la première Guerre mondiale. Il commande le 13e Corps d'Armée, le 14e Corps d'Armée, la Ve Armée. Ses faits d'armes de 1870 sont : Bataille de Bazeilles, en 1914 : Bataille de la Marne. Il reçoit la distinction de Maréchal de France à titre posthume. Ses autres fonctions sont de1914/16 : Gouverneur militaire de Paris, 1915/16 : Ministre de la Guerre, 1886/91 : Commandant supérieur du Soudan français, 1896/05 : Gouverneur général de Madagascar
En bref
Né le 24 avril 1849 à Saint-Béat (Haute-Garonne), fils d'officier, Joseph-Simon Gallieni fit ses études au prytanée militaire de La Flèche, intégra l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1868 et en sortit deux ans plus tard, avec le grade de sous-lieutenant dans l'infanterie de marine, lors de la guerre franco-prussienne. Présent à Bazeilles (31 août-1er sept. 1870), il fit partie de la troupe héroïque qui se sacrifia dans la célèbre « maison des dernières cartouches », immortalisée par le peintre Alphonse de Neuville. Blessé à la tête et fait prisonnier en Allemagne, il eut la satisfaction de ne pas capituler avec l'armée de Sedan.
Après l'armistice (1871), le jeune officier colonial passa trois ans à la Réunion puis au Sénégal, à partir de 1876, où il réussit à imposer le protectorat français à Ahmadou, sultan de Ségou. Capitaine en 1878, puis chef de bataillon en 1882, il put, tout en combattant, affermir ses idées et ses méthodes au contact des réalités quotidiennes. Promu au grade de lieutenant-colonel en 1886, il revint en métropole suivre les cours de la toute nouvelle École de guerre dont il sortit breveté avant de quitter une nouvelle fois la France pour répondre à l'appel de l'Asie. Rejoignant le Tonkin et la garnison de Lang Son, il pacifia méthodiquement cette région alors en pleine ébullition, organisa la frontière de Chine, trouvant déjà auprès de lui le chef d'escadron Lyautey qui racontera dans ses Lettres du Tonkin comment le colonel Gallieni sut l'affranchir de la tyrannie des règlements et l'initier à la lecture de D'Annunzio et de Stuart Mill.
Mais la grande œuvre restait à accomplir : la pacification et l'organisation de Madagascar qui exigeront, neuf années durant, des trésors d'intelligence, d'expérience et de courage. Une double tâche l'attendait alors qu'il venait d'être promu général de brigade en 1896 : réprimer la révolte qui mettait la Grande Île à feu et à sang, puis soumettre les tribus restées indépendantes. Dans un premier temps, il montra sa force et déposa la reine Ranavalona. Puis, la paix établie, il se préoccupa de mettre le pays en valeur : dispensaires et écoles s'organisèrent ; fermes modèles, centres de cultures et d'élevage virent le jour tandis qu'une campagne en faveur du repeuplement battit son plein. « L'occupation militaire est une organisation qui marche », se plaisait-il à répéter, résumant ainsi le système d'administration qu'il mit au point avec cœur et finesse. Pour accomplir cette œuvre, le général Gallieni choisit ses collaborateurs : Lyautey encore, mais aussi Joffre pour fortifier Diégo-Suarez. Une pléiade de jeunes officiers se formèrent à son école et lorsqu'il quitta définitivement Madagascar, en 1905, il avait bien rempli sa délicate mission.
Nommé successivement inspecteur général des troupes coloniales, commandant du 13e puis du 14e corps d'armée, puis gouverneur militaire de Lyon, membre du Conseil supérieur de la guerre, titulaire de la Médaille militaire, cette suprême distinction du soldat, le général Gallieni fut maintenu en activité sans limite d'âge le 24 avril 1914. Désigné comme adjoint et successeur éventuel du général Joffre, commandant en chef, le 31 juillet 1914, il fut nommé gouverneur militaire de Paris par décret présidentiel le 26 août de la même année et gagna sa troisième étoile. Donnant une impulsion vigoureuse et méthodique à l'organisation de défense de la capitale menacée par l'avance ennemie, il signa le 3 septembre son ordre du jour célèbre : « J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur ; ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. » La retraite des troupes françaises se poursuivait toutefois, lorsqu'une reconnaissance aérienne lui apprit que l'aile droite ennemie (von Kluck) se détournait de Paris pour se rabattre sur Meaux. Dans une inspiration stratégique fulgurante, il entrevit tout de suite la manœuvre d'enroulement allemande et celle, française, qu'il fallait lui opposer. Les trois entretiens téléphoniques qu'il eut alors avec Joffre jouèrent un rôle déterminant, car ce dernier adopta finalement le plan qu'il lui proposa. Le 5 septembre, à midi, la VIe armée Maunoury déclencha la bataille de l'Ourcq, préfaçant celle de la Marne qui débuta le lendemain. S'il ne fut pas le « vainqueur de la Marne », il en resta incontestablement l'un des principaux artisans et demeura dans toutes les mémoires le « sauveur de Paris ».
Le 29 octobre 1915, le général Gallieni accepta le portefeuille de la Guerre dans le ministère Briand. Se heurtant vite à l'incompréhension des milieux politiques et à la méfiance de certains milieux militaires, il démissionna le 16 mars 1916. Très éprouvé par trente ans de séjour aux colonies et la mission écrasante qu'il venait d'accomplir, miné également par une certaine amertume, il mourut le 27 mai 1916, à la suite d'une intervention chirurgicale, dans une clinique de Versailles. Tandis que le canon tonnait à Verdun, le peuple parisien salua avec émotion la dépouille de ce grand chef de guerre qui, après la défaite de 1870, avait choisi de répondre à « l'appel » de la France d'outre-mer plutôt qu'à celui de la « ligne bleue » des Vosges.
Administrateur et homme d'action, anticonformiste, respectueux de l'esprit des règlements tout en sachant s'affranchir de leur application littérale, le général Gallieni fut, selon le mot de Joffre, « le type même du soldat complet ». Auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur son action coloniale, il sut néanmoins mettre à jour ses connaissances pour s'adapter aux nécessités du combat européen. À l'occasion de ses funérailles nationales, Clemenceau écrira : « Le général Gallieni est l'homme dont la prompte décision nous a donné la bataille de la Marne. Il est le véritable sauveur de Paris. Les funérailles nationales ne sont qu'un commencement de justice. Avec ses conséquences, le reste suivra. L'heure viendra des jugements et la mémoire de Gallieni peut attendre avec tranquillité l'avenir. »
Conformément à ses dernières volontés, il fut inhumé à Saint-Raphaël, auprès de son épouse. Il fut élevé à la dignité de maréchal de France, à titre posthume, le 7 mai 1921. Jérôme Bodin
Sa vie
Il est le fils d'un officier d'infanterie, né en Italie, d'origine lombarde1. Après des études au Prytanée militaire de La Flèche, il intègre l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1868. Le 15 juillet 1870, il est nommé sous-lieutenant dans l'infanterie de marine.
Bazeilles 1870
Avec le 3e Régiment d'Infanterie de Marine 3e RIMa, le nouveau promu participe à la guerre franco-allemande de 1870, au cours de laquelle il se bat notamment à Bazeilles, dans les rangs de la brigade Martin des Palières et de la fameuse Division Bleue. Blessé et fait prisonnier le 1er septembre, il est envoyé en captivité en Allemagne et ne rentre en France que le 11 mars 1871.
Séjour à la Réunion 1873-1876
Promu lieutenant au 2e Régiment d'Infanterie de Marine 2e RIMa le 25 avril 1873, il commence sa carrière coloniale à La Réunion, où il passe trois ans.
Expéditions en Afrique noire 1876-1882
Le 11 décembre 1876, il obtient son envoi aux tirailleurs sénégalais et s'embarque le 20 pour Dakar, seuil de l'Afrique noire, où il prend part à diverses expéditions militaires et explorations. Il est promu capitaine en 1878.
Le 30 janvier 1880 il va en bateau de Saint-Louis et Richard-Toll (environ 100 km) sur le fleuve Sénégal. Le 29 mars, il arrive à Bafoulabé, au Mali, où il conclut un traité avec les chefs locaux et établit un protectorat de la France. En 1881, au Niger, il négocie avec le Sultan Ahmadou le traité de Nango accordant à la France le commerce du Haut-Niger.
Commandant supérieur du Soudan français 1886-1888
Le commandant Joseph Gallieni. Mission d'exploration dans le Haut Niger 1880-1881.
Le lieutenant-colonel Gallieni et son état-major pendant la campagne 1887-1888 au Soudan français
Après un séjour en Martinique, de 1883 à 1886, il est nommé lieutenant-colonel, et reçoit, six mois plus tard, le 20 décembre, le commandement supérieur du Haut-Fleuve Sénégal aujourd'hui le Mali, territoire militaire au sein de la colonie du Sénégal. Il y obtient des succès aux dépens d'Ahmadou 1887 et fait consentir Samori à un traité abandonnant, entre autres, la rive gauche du Niger, après une grande défaite dans la ville de Siguiri en Guinée, où il bâtit un fort, le fort Gallieni, qui abrite un cimetière ou sont enterrés des spahis et des Français. Au cours de ce commandement, il réprime durement une insurrection des autochtones. Il quitte le Sénégal en avril 1888 et son successeur sera le chef de bataillon Louis Archinard, nommé à compter du 10 mai 1888 et qui arrivera à Kayes le 28 octobre 1888.
Mission en Indochine 1892-1896
Gallieni et la commission d'abornement de la frontière entre Tonkin et Kwang-Si,1894
De retour en France, il est promu colonel le 11 mars 1891, chef d'état-major du corps d'armée de la Marine et breveté d'état-major avec la mention très bien. De 1892 à 1896 il est envoyé au Tonkin Indochine, où il commande le 3e régiment de tirailleurs tonkinois le 11 octobre 1892 puis la première brigade le 15 novembre 1892 avant la seconde division militaire du territoire. Il lutte contre les pirates chinois puis consolide la présence française en organisant l'administration du pays. Son principal collaborateur est alors le commandant Lyautey. C'est à cette époque qu'il élabore les prémices de ce qui est convenu d'appeler sa doctrine coloniale, tels que la tache d'huile, et la politique des races, raffinement de la politique du diviser pour régner. Il s'exprime en outre avec une brutale franchise sur la méthode à suivre pour affermir les conquêtes coloniales :
Frapper à la tête et rassurer la masse égarée par des conseils perfides et des affirmations calomnieuses, tout le secret d’une pacification est dans ces deux termes. En somme, toute action politique dans la colonie doit consister à discerner et mettre à profit les éléments locaux utilisables, à neutraliser et détruire les éléments locaux non utilisables.
— Joseph Gallieni, cité dans Alain Ruscio, « Le crédo de l’homme blanc », Éditions Complexe, Bruxelles, 2002, p. 250-251.
Gouverneur général de Madagascar 1896-1905
Promu général de brigade, il est envoyé en 1896 à Madagascar en tant que résident général. Il arrive à Tananarive le 15 septembre. À la méthode diplomatique de son prédécesseur, le général M. Laroche, il préfère la méthode forte pour endiguer la montée de la résistance anti-coloniale. Il instaure le travail forcé des indigènes. La cour royale, foyer de résistance contre la France, est placée sous surveillance.
Le 11 octobre 1896, lendemain du départ de l'ancien résident général Laroche, Gallieni, qui jouit des pleins pouvoirs, fait arrêter le prince Ratsimamanga et Rainandriamampandry, ministre de l'Intérieur, et les traduit devant le Conseil de guerre pour rébellion et "fahavalisme". Le 15 octobre, à l'issue d'une parodie de procès4, ils sont condamnés à mort et exécutés à titre d'exemple, souhaitant faire "forte impression sur les indigènes". Un des membres du Conseil de guerre devait confirmer par la suite que les deux accusés avaient été "condamnés sur ordre" de Gallieni. Ce dernier détruit le procès-verbal de l'audience plutôt que de le transmettre aux archives militaires.
La reine, Ranavalona III est accusée de comploter contre l'influence française, elle est déchue le 27 février 1897 et exilée à l'île de la Réunion. En huit ans de proconsulat, Gallieni pacifie la grande île, procédant à sa colonisation. Au total, la répression qu'il mène contre la résistance malgache à la colonisation aurait fait de 100 000 à 700 000 morts pour une population de 3 millions.
Pacification de Madagascar. Exécution d'officiels malgaches par ordre de Gallieni, résident général.
Selon le général Gallieni, l'action militaire devait être accompagnée d'une aide aux peuples colonisés dans différents domaines tels que l'administration, l'économie et l'enseignement. Elle nécessitait un contact permanent avec les habitants ainsi qu'une parfaite connaissance du pays et de ses langues. Sous l'impulsion de Gallieni, de nombreuses infrastructures sont mises en place : chemin de fer de Tamatave à Tananarive, Institut Pasteur, écoles laïques dispensant un enseignement en français.
Il fit appliquer la politique dite de politique des races, qui consistait dans la reconnaissance de l'identité de chaque groupe ethnique et la fin de leur subordination à un autre groupe ethnique, ceci avant tout pour mettre fin à la domination merina séculaire, les Merinas étant les plus hostiles à la domination française. En s'appuyant sur les thèses anthropologiques racialistes de l'époque, telles que celles développées par Joseph Arthur de Gobineau, après un recensement systématique de la population utilisant la photographie, il tente de découper les circonscriptions administratives en suivant cette cartographie des races.
Fin de carrière : la Première Guerre mondiale 1905-1916
Gallieni, gouverneur militaire de Paris.
Le 9 août 1899, il est promu général de division. À son retour définitif en France, en 1905, il a encore dix années devant lui avant la retraite. Il les consacre à préparer « la Revanche ». Gouverneur militaire de Lyon et commandant du 14e corps d'armée dès son retour, grand-croix de la Légion d'honneur le 6 novembre 1905, il est appelé au Conseil supérieur de la guerre le 7 août 1908 et reçoit également la présidence du Comité consultatif de défense des colonies. Pressenti pour devenir commandant en chef de l'Armée française en 1911, il décline l'offre pour la laisser à Joseph Joffre, en prétextant son âge et sa santé.
Il prend sa retraite en avril 1914, mais il est rappelé en août après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Le 26 août 1914, il est nommé gouverneur militaire de Paris par Adolphe Messimy, ministre de la Guerre, pour assurer la défense de la capitale. Alors que les Allemands approchent et que le gouvernement part pour Bordeaux en catastrophe, Gallieni met la ville en état de défense, rassure les Parisiens par une proclamation et contribue à la victoire de la Marne, en septembre 1914, grâce, notamment, aux troupes qu’il envoie en renfort, après avoir réquisitionné les taxis parisiens, à la 6e armée du général Maunoury qui se trouve sur l'Ourcq : la bataille de l'Ourcq a permis la victoire de la Marne.
Joffre, inquiet de l'influence et de la réputation de Gallieni, le marginalise un peu. Il l'éloigne du quartier-général, bien que l'on considère que c'est l'initiative de Gallieni, dont les taxis de la Marne sont un symbole, qui a sauvé en grande partie la situation.
Le 29 octobre 1915, il est nommé ministre de la Guerre du 5e gouvernement d'Aristide Briand. Il entre en conflit avec Joffre et évoque publiquement les erreurs commises à Verdun. Pourtant Briand ne le suit pas et il doit démissionner le 10 mars 1916 restant sur son poste jusqu'au 16 mars. Ayant des problèmes de santé, notamment un cancer de la prostate, il meurt le 27 mai 1916 des suites de deux interventions chirurgicales dans une clinique de Versailles. Après des funérailles nationales, et conformément à ses dernières volontés, il est inhumé auprès de son épouse dans le cimetière de Saint-Raphaël.
Il est élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume le 7 mai 1921. La promotion de l'École militaire de Saint-Cyr de 1927 et l'avenue traversant l'esplanade des Invalides porte son nom.
Gallieni et la contre-insurrection
Joseph Gallieni et son disciple Hubert Lyautey ont joué un rôle important dans l'usage et le raffinement des méthodes du général Bugeaud. À son arrivée à Madagascar en 1896, Gallieni change de façon énergique la doctrine et l'emploi de ses forces. La première préoccupation de ses troupes est d'abord de ramener le calme et la confiance au sein de la population. Gallieni ordonne une démonstration de force dans toutes les directions et à toute heure, pour donner aux habitants une idée réelle de notre force militaire et être capable de leur donner confiance en notre protection. » « La méthode la plus féconde est celle de la tache d'huile, qui consiste à gagner progressivement du terrain en avant seulement après avoir organisé et administré l'arrière. » Cette méthode trouve un écho direct dans la future doctrine de contre-insurrection de David Galula.
« On assimile la guerre coloniale à la guerre d'Europe, dans laquelle le but à atteindre réside dans la ruine des forces principales de l'adversaire. Aux colonies, il faut ménager le pays et ses habitants, puisque celui-là est destiné à recevoir nos entreprises de colonisation futures et que ceux-ci seront nos principaux agents et collaborateurs pour mener à bien ces entreprises. »
— Joseph Gallieni, Rapport d'ensemble sur la pacification, l'organisation et la colonisation de Madagascar, Paris, Charles-Lavauzelle, 1900.
Gallieni expose sa méthode dans son Rapport d'ensemble sur la pacification, l'organisation et la colonisation de Madagascar 1900. Hubert Lyautey consigne la méthode de Gallieni dans son article intitulé « Du rôle colonial de l'armée » 1900 :
« Le meilleur moyen pour arriver à la pacification dans notre nouvelle colonie est d'employer l'action combinée de la force et de la politique. Il faut nous rappeler que dans les luttes coloniales nous ne devons détruire qu'à la dernière extrêmité, et, dans ce cas encore, ne détruire que pour mieux bâtir. Toujours nous devons ménager le pays et les habitants, puisque celui-là est destiné à recevoir nos entreprises de colonisation future et que ceux-ci seront nos principaux agents et collaborateurs pour mener à bien nos entreprises. Chaque fois que les incidents de guerre obligent l'un de nos officiers coloniaux à agir contre un village ou un centre habité, il ne doit pas perdre de vue que son premier soin, la soumission des habitants obtenue, sera de reconstruire le village, d'y créer un marché, d'y établir une école. C'est de l'action combinée de la politique et de la force que doit résulter la pacification du pays et l'organisation à lui donner plus tard. »
— Joseph Gallieni, cité par Hubert Lyautey, Du rôle colonial de l'armée », Paris, A. Colin, 1900, p. 16-17.
Citations
Lorsque le 26 août 1914, le général Gallieni est nommé gouverneur militaire de Paris pour assurer la défense de la capitale, il rassure les Parisiens par ces mots : J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur ; ce mandat je le remplirai jusqu'au bout.
Lors de ses funérailles nationales, Georges Clemenceau écrira : Le général Gallieni est l'homme dont la prompte décision nous a donné la bataille de la Marne. Il est le véritable sauveur de Paris. Les funérailles nationales ne sont qu'un commencement de justice. Avec ses conséquences, le reste suivra. L'heure viendra des jugements et la mémoire de Gallieni peut attendre avec tranquillité l'avenir.
Personnalité
Républicain sans faille, Gallieni n'a cependant aucune sympathie pour un régime parlementaire qu'il considère comme inadapté aux périodes difficiles comme la guerre. Sans attirance pour le nationalisme, il intègre totalement un patriotisme républicain qui lui permet d'étendre l'influence française dans le monde. Il parle quatre ou cinq langues couramment, et s'intéresse à l'histoire et à la philosophie. Apparemment modeste, il est silencieux et volontairement effacé, voire taciturne.
Ethnologie
Durant ses nombreux voyages il récolta de nombreuses pièces d'ethnologie dont il fit don au Muséum de Toulouse.
Chapeau de Berger du Soudan français MHNT
Sabre du Soudan français MHNT
Giberne Soudan français MHN
Bracelets de cheville. Culture Dan MHNT
Herminette Sénégal MHNT
Paire de sandale Sakalava exp
Lieux et voiries portant le nom de Gallieni
À Paris : l'avenue du Maréchal-Gallieni traverse l'esplanade des Invalides
À Bagnolet, aux portes de Paris : l'avenue Gallieni
À Bagnolet, aux portes de Paris : la station de métro Gallieni, nommée ainsi de par sa proximité avec l'avenue Gallieni
À Bagnolet, aux portes de Paris : la gare routière internationale de Paris-Gallieni, nommée ainsi de par sa proximité avec l'avenue Gallieni
À Lyon, pont Gallieni
À Tamatave Madagascar, une caserne de la Gendarmerie nationale porte également son nom : le camp Gallieni.
Ouvrages
Voyage au Soudan Français, 1879-1881, Paris, Hachette, 1885
Deux campagnes au Soudan français, 1886-1888, Paris, Hachette, 1891
Trois colonnes au Tonkin, 1894-1895, 1899
Rapport d'ensemble sur la pacification, l'organisation et la colonisation de Madagascar, 1896-1899, Paris, Charles-Lavauzelle, 1900
Madagascar de 1896 à 1905, Tananarive : Impr. officielle, 1905, 2 vol.
Neuf ans à Madagascar,
Mémoires du Général Gallieni - Défense de Paris 25 Août - 11 Septembre 1914, Paris, Payot et Cie, 1920
Les Carnets de Gallieni, publiés par son fils Gaëtan Gallieni, avec des notes de Pierre Bathélémy Gheusi, Paris, Albin Michel, 1932
        
Posté le : 23/04/2016 17:54
|
|
|
|
|
Philippe Pétain 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 avril 1856 naît Philippe Pétain,
communément appelé le maréchal Pétain, à Cauchy-à-la-Tour Pas-de-Calais et mort le 23 juillet 1951 à Port-Joinville, sur l'île d'Yeu Vendée, est un militaire, diplomate et homme d'État français.
Militaire de carrière, terminant son parcours comme colonel après s'être démarqué à l'École de guerre de la doctrine dominante de l'offensive, il est réintégré en 1914. Chef militaire à l'action importante au cours de la Première Guerre mondiale, Pétain est généralement présenté comme le « vainqueur de la bataille de Verdun » et, avec Georges Clemenceau, comme l'artisan du redressement du moral des troupes après les mutineries de 1917. Il est nommé commandant en chef des forces françaises et occupe ce poste jusqu'à la fin de la guerre, bien qu'en 1918, la direction de l'ensemble des armées alliées lui échappe au profit de son rival Ferdinand Foch. Il est fait maréchal de France en novembre 1918.
En 1925, Pétain devient commandant des forces françaises combattant aux côtés de l'Espagne dans la guerre du Rif, en lieu et place du maréchal Lyautey à ce poste depuis 1912. Auréolé d'un immense prestige au lendemain de la guerre, il devient académicien en 1929 et occupe les fonctions de ministre de la Guerre, de février à novembre 1934, puis est nommé ambassadeur dans l'Espagne du général Franco 1939.
Rappelé au gouvernement le 17 mai 1940 après le début de l'invasion allemande, il s'oppose à la poursuite d'une guerre qu'il considère comme perdue et dont il impute bientôt la responsabilité au régime républicain. Chef de file des partisans de l'arrêt des combats, il devient président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud le soir du 16 juin et appelle, dès le 17, à cesser le combat. Il fait signer l’armistice du 22 juin 1940 avec l'Allemagne d'Adolf Hitler à Rethondes, dans un wagon de train, retirant la France du conflit.
Investi des pleins pouvoirs constituants par l'Assemblée nationale le 10 juillet 1940, il s'octroie le lendemain le titre de chef de l'État français, qu'il conserve durant les quatre années de l'Occupation des armées du IIIe Reich. Installé à Vichy à la tête d'un régime autoritaire, il abolit les institutions républicaines et les libertés fondamentales, instaure des lois antisémites et engage le pays dans la Révolution nationale et dans la collaboration d'État avec l’Allemagne nazie. Le régime qu'il dirige jusqu'en 1944 est déclaré « illégitime, nul et non avenu » par le général de Gaulle à la Libération.
Emmené en Allemagne en août 1944, à Sigmaringen, échouant ensuite en Suisse avant de se rendre aux autorités françaises, Pétain est jugé en juillet 1945 pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison par la Haute Cour de justice, il est, par arrêt du 15 août 1945, frappé d'indignité nationale, condamné à la confiscation de ses biens et à la peine de mort, la cour recommandant la non-application de cette dernière en raison de son grand âge. Sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité par le général de Gaulle, alors chef du gouvernement provisoire de la République française. Il meurt en détention sur l’île d’Yeu, où il est ensuite inhumé.
Carrière : Chef de l'État français du 11 juillet 1940 au 20 août 1944 soit durant 4 ans 1 mois et 9 jours, Chef du gouvernement, Vice-présidents du Conseil avec :
Pierre Laval, Pierre-Étienne Flandin, François Darlan. Il avait pour Chef du gouvernement : Pierre Laval. Son prédécesseur est Albert Lebrun président de la République française. Son successeur est Charles de Gaulle Gouvernement provisoire de la République française avec pour président du Conseil des ministres du 16 juin 1940 au 17 avril 1942 soit pendant 1 an 10 mois et 1 jour. Pendant la présidence d'Albert Lebrun, sous le gouvernement Pétain. Le prédécesseur est Paul Reynaud. Son successeur est Lui-même en tant que chef de l'État français. Pierre Laval vice-président du Conseil. Le Vice-président du Conseil des ministres du 18 mai au 16 juin 1940
pendant 29 jours sous la présidence Albert Lebrun du gouvernement Reynaud le prédécesseur et successeur est Camille Chautemps. Auparavant il est ministre d'État
du 1er au 4 juin 1935 pendant 3 jours sous la président Albert Lebrun du gouvernement Bouisson. Il avait été ministre de la Guerre du 9 février au 8 novembre 1934
pendant 8 mois et 30 jours.
sa sépulture est au Port-Joinville commune de L'Île-d'Yeu .Nationalité française. Conjointe Eugénie Hardon diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Profession Militaire de religion Catholique
En bref
Il est peu de personnages de l'histoire de France qui auront connu à un tel degré la gloire, puis le discrédit. Et celui-ci, loin de s'atténuer avec le temps, s'est renforcé au fur et à mesure que disparaissaient les générations qui, l'ayant connu triomphant, lui gardaient de l'indulgence. L'image du maréchal Pétain est, aujourd'hui, tout à fait ternie, sauf dans quelques milieux d'extrême droite. Cette évolution, liée à celle de la mémoire collective sur les années « noires », tend à recouvrir une vie aux étapes contrastées.
L'anonymat-Pendant plus d'un demi-siècle, celle-ci est sans relief, même si la carrière militaire de Philippe Pétain témoigne de la réussite sociale d'un fils de paysans assez aisés de l'Artois. Né le 24 avril 1856 à Cauchy-la-Tour (Pas-de-Calais), formé par l'enseignement catholique, d'abord chez les Jésuites de Saint-Omer, puis chez les Dominicains d'Arcueil, il est admis de justesse à Saint-Cyr en 1876. Sorti 229e sur 386, il suit un parcours entièrement métropolitain, loin de l'aventure coloniale. Élève à l'École de guerre entre 1888 et 1890, il y enseigne la tactique d'infanterie entre 1901 et 1911. Il a l'âge de la retraite en 1914 et il n'est que colonel. Sa promotion a été entravée par ses critiques à l'égard de la doctrine dominante (l'offensive à outrance). C'est la seule audace d'un officier par ailleurs conformiste. Lorsque la guerre éclate, face à l'invasion, ses dispositions en faveur de la défensive et ses qualités d'organisateur le font sortir de la médiocrité. Général de brigade le 30 août 1914, général de division le 14 septembre, il commande un corps d'armée en octobre, puis la IIe armée en juin 1915.
La gloire, Le vainqueur de Verdun- Lorsque les Allemands déclenchent la bataille de Verdun, Joffre le nomme, le 24 février 1916, commandant du secteur. C'est sa chance et le début de sa gloire. Ayant fait échouer le pilonnage ennemi et contenu les attaques, il devient le « vainqueur » de Verdun. Promu grand officier de la Légion d'honneur, il est mis, le 1er mai, à la tête du groupe d'armées du Centre. En fait, cette promotion vise à l'éloigner du champ de bataille. Joffre lui préfère Nivelle pour reprendre le terrain perdu à Verdun. Autre « vainqueur » de la bataille, ce dernier est choisi comme généralissime quelques mois après. Mais c'est à Pétain que l'on fait appel le 15 mai 1917 pour réparer l'échec de l'offensive de Nivelle sur le Chemin des Dames et reprendre en main une troupe épuisée, démoralisée, parcourue de mutineries. Son sang-froid, les améliorations apportées à l'ordinaire, son souci de « ménager le sang » du soldat renforcent sa popularité auprès des « poilus ». S'il prépare une grande attaque en Alsace, il attend que « les chars et les Américains » lui assurent l'avantage. Mais Foch, plus flamboyant, s'impose pour coordonner les armées alliées et conduire un assaut final dont Pétain critique les modalités. Il critiquera, peu après, la signature, trop rapide d'après lui, de l'armistice. Il devient maréchal de France le 19 novembre 1918, mais Joffre et Foch ont été honorés avant lui.
L'oracle- Une autre vie commence alors : il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1919, se marie en 1920, achète une maison sur la Côte d'Azur, à Villeneuve-Loubet. Vice-président du conseil supérieur de la guerre de 1920 à 1931, inspecteur général de l'armée en 1922, véritable chef des armées, il affirme son autorité et supporte mal qu'on lui résiste. Pendant la guerre du Rif, il écarte Lyautey, partisan de la négociation, et écrase la révolte d'Abd-el-Krim en 1925-1926 avec l'armée espagnole. Il joue un rôle essentiel dans les choix stratégiques du pays. Lui qui, pendant la guerre, était soucieux de renverser les rapports de forces grâce au matériel moderne, se mue en sceptique définitif. Il entend protéger la France derrière un rempart infranchissable sur lequel les chars viendront s'écraser. Il est à l'origine de la ligne à laquelle le ministre de la Guerre André Maginot donne son nom. Homme de la défensive, c'est à cette fin qu'il reste intéressé par l'aviation. Sa Préface au livre du général Chauvineau Une invasion est-elle possible ? 1938 le montre muré dans ses certitudes. Héroïsé par la nation et par les anciens combattants, il est devenu le symbole de la victoire. Il est élu académicien français à l'unanimité en 1929 sur le fauteuil laissé vacant par la mort de Foch.... Dans le contexte troublé des années 1930, il rassure à droite comme à gauche. Gaston Doumergue le nomme ministre de la Guerre dans le gouvernement d'union nationale mis en place après l'émeute du 6 février 1934. Face au Front populaire, une partie de la droite voit en lui un recours. C'est une hypothèse qui ne lui déplaît pas, même s'il laisse à d'autres, dans la presse conservatrice de Paris (Le Figaro) et de province, le soin de faire campagne pour lui. Mais il garde la réputation d'être un républicain, ce qui ne contribuera pas peu à sa légitimité en 1940. Le 24 mars 1939, le radical Édouard Daladier l'envoie comme ambassadeur auprès du général Franco pour renouer avec l'Espagne. Alors que la déroute se profile, Paul Reynaud le fait entrer au gouvernement le 18 mai 1940 en tant que ministre d'État, vice-président du Conseil. Il ne se satisfait pas d'un rôle symbolique. Pour lui, l'effondrement est d'abord politique, moral, intellectuel. Il faut donc refaire la France. Mis en avant par les partisans de l'armistice, il est nommé le 16 juin par le président Albert Lebrun chef du gouvernement à la place de Reynaud.
Le sauveur- Son premier geste public est d'appeler, le 17 juin, à cesser le combat. Les armistices, avec l'Allemagne et l'Italie, prennent effet le 25 juin. Pierre Laval, chef de file des pacifistes, est le vice-président du Conseil. Bien soutenu par Weygand, général des armées, il assure la liquidation politique de la IIIe République. Le 10 juillet 1940, le Parlement réuni à Vichy accorde au maréchal Pétain les pleins pouvoirs, par 569 oui sur 649 présents, et le charge de préparer une nouvelle Constitution.
Sa vie se confond désormais avec l'État français dont il est, à quatre-vingt-quatre ans, le chef. Les actes constitutionnels des 11 et 12 juillet lui permettent de concentrer l'exécutif, le législatif, le judiciaire et même le pouvoir constitutionnel. Ses conceptions sont sommaires et son modèle tout militaire. Le chef commande, le pouvoir vient d'en haut, l'état-major le gouvernement obéit et se fait obéir des cadres l'administration, les relais locaux qui ont autorité sur la troupe (la population. Fédérant divers clans qui avaient des comptes à régler, les uns avec la République, les autres avec les parlementaires, tous avec le Front populaire, il prend l'initiative de la « révolution nationale » et s'engage, avec Pierre Laval, dans la collaboration d'État qui en est le corollaire. Il faut, pour régénérer la France, l'extraire du conflit, s'accommoder de la réalité, bien que détestable, de la victoire allemande, faire des concessions et préserver au mieux la souveraineté de la nation, quitte à couvrir les décisions de l'occupant ou à les devancer. Son prestige est une aubaine pour Hitler qu'il accepte de rencontrer à Montoire le 24 octobre 1940. Le culte que le Maréchal laisse se développer joue de son image de « grand » soldat, de son prestige physique, d'une vitalité qui masque bien des défaillances. Il délivre ses maximes à la radio, se fait acclamer en province, est encensé par les élites, militaires, religieuses, civiles, reçoit visiteurs et cadeaux à l'hôtel du Parc, à Vichy, où il réside. Le « maréchalisme » (J.-P. Azéma), qui est adhésion à sa personne, est bien plus large que le pétainisme qui est engagement idéologique et politique en faveur du régime et de ses valeurs. On fait confiance au Maréchal, qui incarne une certaine France, alors que, très tôt, on exècre ses serviteurs.
L'opprobre, Le rejet- Les Français imputent à son entourage et aux gouvernements successifs la collaboration qu'ils rejettent d'emblée et bientôt la dictature policière et étatique. L'arrestation de Pierre Laval le 13 décembre 1940 laissait croire que le Maréchal tenait le pouvoir, son retour à la tête du gouvernement en avril 1942 montre qu'il n'en était rien. La statue du Maréchal est fissurée. En novembre 1942, en demeurant en France tout entière occupée au lieu de gagner Alger, en faisant de Laval son dauphin, le Maréchal laisse passer sa dernière chance de réhabilitation. Ayant perdu l'Empire et la flotte (sabordée à Toulon le 27 novembre), il assume avec Laval un pouvoir dont les Allemands sont les vrais maîtres.
Le Maréchal, qui se plaint d'être prisonnier auprès de ses nombreux visiteurs, reste une carte que les occupants veulent conserver, même en novembre 1943, lorsque son entourage (le Dr Ménétrel, chef de son secrétariat particulier, Lucien Romier, ministre d'État et quelques autres) le pousse à changer de cap, à se débarrasser de Laval et à annoncer qu'il restitue le pouvoir à l'Assemblée nationale. Interdit de radio par les Allemands, il réagit en cessant d'exercer ses fonctions, avant de finir par s'incliner le 5 décembre. Il accepte d'être flanqué d'un représentant de Hitler (le diplomate von Renthe-Fink) et conserve Laval à la tête d'un gouvernement dans lequel Joseph Darnand, le chef de la Milice, fait son entrée. Les activistes de la révolution nationale, dont celui-ci est le chef de file, se réclament toujours du Maréchal, qui continue de couvrir leurs agissements dans la lutte contre la Résistance. Le Maréchal, en raison de sa gloire passée, de son âge, des troubles de sa vieillesse, bénéficie encore de l'indulgence de beaucoup. Le maréchalisme perdure, surtout en zone Nord où cette image est servie par l'interdiction de visite que les Allemands lui ont imposée depuis 1940. Aussi, lorsqu'ils la lèvent et que le Maréchal peut se rendre en Lorraine et à Paris, en avril 1944, l'accueil qui lui est fait s'adresse à ce qu'il représente encore pour ces populations : une France dont elles ont été coupées jusqu'ici. Mais, quatre mois après, il n'y a plus d'ambiguïté. La « vraie France » acclame le général de Gaulle à Paris, le 25 août.
Le déshonneur -Le Maréchal ne représente plus rien. Les Allemands le contraignent au départ le 20 août et le conduisent à Belfort, avant de l'installer à Sigmaringen (Wurtemberg) où se retrouve le dernier carré vichyste. En France, son nom, que d'innombrables localités avaient attribué en 1940 et 1941 à leurs plus belles places ou avenues, disparaît totalement.
Avec l'effondrement de l'Allemagne, Pétain peut gagner la Suisse. De Gaulle aurait préféré qu'il y reste. Lui ne peut se résigner à cet exil. Il s'illusionne encore sur sa popularité. Il espère de la compréhension de la part de Gaulle, qui avait été son protégé dans les années 1920. Il se livre aux autorités françaises le 25 avril 1945. Il est traduit devant la Haute Cour entre le 23 juillet et le 15 août pour « attentat contre la sûreté intérieure de l'État » et « intelligence avec l'ennemi en vue de favoriser ses entreprises en corrélation avec les siennes ». Ce procès symbolique, mal engagé autour d'un complot imaginaire qui, selon l'acte d'accusation, aurait été « fomenté depuis longtemps contre la République », se conclut sans surprise par sa condamnation à mort par 14 voix contre 13. Le Maréchal est gracié par de Gaulle en raison de son âge, comme l'avaient souhaité ses juges. Il termine ses jours en captivité, d'abord au fort du Portalet, puis à l'île d'Yeu où il décède à quatre-vingt-quinze ans, le 23 juillet 1951.
Le discrédit - Son souvenir n'est désormais entretenu que par quelques nostalgiques et par Me Isorni, son jeune avocat qui a fini, non sans panache, par incarner le combat pour sa réhabilitation. Passé les exécrations de la Libération, il bénéficie d'une historiographie plutôt indulgente opposant, comme le fait Robert Aron, le Vichy collaborateur de Laval à celui, bonasse, du Maréchal. Malgré les efforts du colonel Rémy, au début des années 1950, pour défendre l'idée d'un Pétain « bouclier » complémentaire du « glaive » gaullien (que le célèbre résistant avait servi), la publication des Mémoires de guerre du général de Gaulle et la victoire du gaullisme en 1958 signent sa relégation parmi les vaincus de l'Histoire. Les travaux des historiens, à la suite de Henri Michel, puis de Robert Paxton, éclairent mieux ses responsabilités, en particulier dans la collaboration. Depuis lors, les derniers témoins de son époque disparaissant, l'histoire et la mémoire n'ont fait qu'accentuer son rejet. À la collaboration et à la mise en place d'un régime liberticide, est venue s'ajouter à charge sa compromission dans le génocide. Les réactions indignées suscitées par la révélation du dépôt d'une gerbe sur sa tombe par François Mitterrand, le 11 novembre 1992, témoignent de la sensibilité d'une grande partie de l'opinion dans un contexte – politique et mémoriel – tendu. Un tel geste officiel, qui voulait honorer le « vainqueur de Verdun » comme les autres maréchaux de la grande guerre, n'est plus admissible. Le nom du maréchal Pétain se confond avec une France du déshonneur. Jean-Marie Guillon
Sa vie
Henri Philippe Bénoni Omer Pétain naît à Cauchy-à-la-Tour, dans une famille de cultivateurs installée dans la commune depuis le xviiie siècle. Il est le fils d'Omer-Venant Pétain 1816-1888 et de Clotilde Legrand 1824-1857. De cette union naissent cinq enfants : Marie-Françoise Clotilde 1852-1950, Adélaïde 1853-1919, Sara 1854-1940, Philippe 1856-1951 et Joséphine 1857-1862. Du second mariage d'Omer-Venant, avec Marie-Reine Vincent, contracté peu de temps après la mort de sa première épouse, trois autres enfants voient le jour : Élisabeth 1860-1952, Antoine 1861-1948 et Laure 1862-1945.
Bien que son acte de naissance porte les prénoms : Henri, Philippe, Bénoni, Omer, c'est Philippe qu'il choisit et, tout au long de sa vie, Pétain a toujours pris soin de rectifier.
Ascendance de Philippe Pétain8
Sa belle-mère négligeant les enfants du premier lit de son mari, Philippe Pétain s'enferme dans le silence, ne parlant pas avant l'âge de trois ans. Élevé dans la religion catholique par ses grands-parents, Philippe sert la messe quotidienne comme enfant de chœur durant sa jeunesse où sa grand-mère lui apprend à lire. Un de ses ancêtres a été canonisé en 1850 par Pie IX Saint Benoni un oncle est abbé et son grand-oncle est l'abbé Lefèvre, presque centenaire qui a servi dans la Grande Armée de Napoléon, ce qui le marque; il est, de plus, très marqué par la guerre de 1870 alors qu’il a 14 ans, il décide d’être soldat. Son oncle l'abbé Legrand le présente au chatelain de son village, Edouard Moullart de Vilmarest, voulait financer les études d'un jeune villageois se destinant à une carrière militaire. En 1867, il entre au collège Saint-Bertin situé à Saint-Omer, à trente kilomètres de Cauchy, où il exprime des qualités en géométrie, grec, et anglais. En 1875, entre au collège des Dominicains d'Arcueil où il prépare Saint Cyr qu' il intègre en 1876.
À partir de 1876, il est élève à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion Plewna, avec le vicomte Charles de Foucauld, futur bienheureux, et Antoine Manca de Vallombrosa, futur aventurier. Il y entre parmi les derniers 403e sur 412 et en sort en milieu de classement 229e sur 336. Cinq ans sous-lieutenant, sept ans lieutenant, dix ans capitaine, il gravit lentement les échelons militaires. Plusieurs jeunes femmes de bonne famille Angéline Guillaume, Lucie Delarue, Marie-Louise Regad refusant ses demandes en mariage car il est encore un militaire de rang moyen, il a de nombreuses maîtresses et fréquente souvent le borde.
Opinions personnelles
Lors de l’affaire Dreyfus, le capitaine Pétain ne s'affiche pas comme un antidreyfusard : il ne participe pas à la souscription au monument Henry, souscription nationale ouverte par le journal antisémite La Libre Parole, d'Édouard Drumont, au profit de la veuve de l'auteur du faux document, le colonel Henry, responsable de la condamnation inique du capitaine Dreyfus. Au contraire, d'après divers témoignages, il affirme ultérieurement avoir toujours cru à l'innocence de Dreyfus, même s'il juge que ce dernier s’est mal défendu. Ainsi, son chef de cabinet civil Henry du Moulin de Labarthète l'a entendu dire : J'ai toujours cru, pour ma part, à l'innocence de Dreyfus ; l'idée que Félix Gustave Saussier et Jean Casimir-Perier aient condamné Dreyfus en le sachant innocent l'aurait tourmenté, voire scandalisé d'après les deux ministres pétainistes, Henri Moysset 1875-1949 et Lucien Romier 1885-1944.
Philippe Pétain est promu dans la période qui suivit l'affaire Dreyfus : aide de camp de Joseph Brugère, général républicain nommé gouverneur militaire de Paris par le gouvernement de défense républicaine de Pierre Waldeck-Rousseau pour réduire l'influence antidreyfusarde dans l'armée, Pétain est également un proche du général Percin, officier républicain impliqué dans l'affaire des fiches.
Dans l’ensemble, toutefois, le militaire Pétain s’occupe fort peu de la vie politique de l’époque, et reste très discret sur ses opinions personnelles. Au contraire de beaucoup de militaires, il ne s’engage à aucun moment, pas plus lors de l’affaire des fiches 1904 que de celle de la séparation des Églises et de l'État en 1905.
Première carrière
Au début de sa carrière militaire, Philippe Pétain est affecté à différentes garnisons, mais ne participe à aucune des campagnes coloniales.
En 1900, chef de bataillon, il est nommé instructeur à l’École normale de tir du camp de Châlons-sur-Marne. Il s’oppose à la doctrine officielle de l'époque qui veut que l'intensité du tir prime la précision et qui privilégie les charges de cavalerie et les attaques à la baïonnette. Il préconise au contraire l'utilisation des canons pour les préparations et les barrages d'artillerie, afin de permettre la progression de l'infanterie, laquelle doit pouvoir tirer précisément sur des cibles individuelles. Le directeur de l'école signale la puissance de dialectique … et l'ardeur … avec lesquelles il défend des thèses aussi aventurées.
En 1901, il occupe un poste de professeur adjoint à l’École supérieure de guerre de Paris où il se distingue par des idées tactiques originales. Il y retourne de 1904 à 1907 puis de 1908 à 1911 en tant que titulaire de la chaire de tactique de l’infanterie. Il s’élève alors violemment contre le dogme de la défensive prescrit par l’instruction de 1867, l’offensive seule pouvant conduire à la victoire ». Mais il critique aussi le code d’instruction militaire de 1901 prônant la charge en grandes unités, baïonnette au canon, tactique en partie responsable des milliers de morts d’août et septembre 1914. Humiliés par la défaite de 1870, les états-majors se montrent volontiers bravaches et revanchards. L'école de guerre et l'état-major y prônent l'offensive à outrance26. Pétain, lui, préconise la manœuvre, la puissance matérielle, le mouvement, l’initiative : le feu tue. Ainsi, il déclare à un élève officier : Accomplissez votre mission coûte que coûte. Faites-vous tuer s'il le faut, mais si vous pouvez remplir votre devoir tout en restant en vie, j'aime mieux cela. Parmi les officiers rangés sous ses ordres, il est le 20 octobre 1912, premier chef d’unité de Charles de Gaulle, alors sous-lieutenant.
En septembre 1913, devant commenter la tactique du général Gallet, qui avait fait charger à la baïonnette des nids de mitrailleuses, il dit : le général vient de nous montrer toutes les erreurs à ne pas commettre. Cela lui vaut l’hostilité de la hiérarchie. À 58 ans, en juillet 1914, le colonel Philippe Pétain s’apprête à prendre sa retraite après une carrière relativement modeste, le ministre de la Guerre ayant refusé sa nomination au grade de général.
L'homme de Verdun Philippe Pétain
Français Général de division 1914
Années de service de 1876 à 1931 il s'illustre dans le conflit de la Première Guerre mondiale, Guerre du Rif, Seconde Guerre mondiale
Commandement 1907 : 118e régiment d'infanterie, 1911 : 33e régiment d'infanterie, 1914 : 4e brigade du 1er corps d'armée, dans la 6e division d'infanterie, 33e corps d'armée. En 1915 : 2e armée, 1916 : Groupe d'armées du centre, 1917 : chef d’État-Major général. Puis Général en chef des armées françaises. EN 1931 il est Inspecteur de la défense aérienne du territoire. Ses faits d'armes 1916 : Bataille de Verdun. Ses Distinctions 1918 maréchal de France
Hommages La 127e promotion de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 1940-1942 porte son nom
Dès le début de la Première Guerre mondiale, le 3 août 1914, à la tête de la 4e brigade d’infanterie28, il se distingue en Belgique. Il fait partie des officiers rapidement promus au début de la guerre : général de brigade le 31 août 1914 il commande la 6e division d'infanterie à la tête de laquelle il participe à la bataille de la Marne, et devient général de division le 14 septembre. Nommé le 20 octobre général commandant de corps d'armée, il prend le commandement du 33e corps et réalise des actions d’éclat lors de l'offensive en Artois, affecté sur le secteur du front où il avait grandi ; son souci d’épargner leurs vies le rend populaire parmi ses hommes. En juin 1915, il commande la IIe armée.
Sous les ordres du maréchal Joffre, il est l'un des 8 commandants à la bataille de Verdun. Il est en poste à Verdun du 25 février 1916 au 19 avril de la même année, la bataille étant finalement gagnée sans lui par la France huit mois plus tard. On ne peut négliger son sens de l'organisation soutenu par un réel charisme qui ne sont pas étrangers à l’issue victorieuse du combat, même si la ténacité de ses troupes, comme, par exemple, celle du commandant Raynal au fort de Vaux, en a été le facteur décisif. La vision stratégique de la bataille lui a permis de comprendre que le meilleur soldat du monde, s’il n’est pas ravitaillé, évacué en cas de blessure, ou relevé après de durs combats, est finalement vaincu. Pétain met en place une noria de troupes, d’ambulances, de camions de munitions et de ravitaillement sur ce qui devient la voie sacrée. Comprenant la valeur de l’aviation dans les combats, il crée en mars 1916 la première division de chasse aérienne pour dégager le ciel au-dessus de Verdun. Il réaffirme cette vision dans une instruction de décembre 1917 : L’aviation doit assurer une protection aérienne de la zone d’action des chars contre l’observation et les bombardements des avions ennemis ...
Il tire de cette période le titre de vainqueur de Verdun, même si cette appellation est surtout exploitée plus tard, sous le régime de Vichy. Ce célibataire reçoit plus de 4 500 lettres d'admiratrices durant le premier conflit mondial.
Toutefois, Joffre, Foch et Clemenceau attribuent la victoire de Verdun à Mangin et à Nivelle, et ont reproché à Pétain son pessimisme. Mais la réputation de Pétain s'affirme auprès des soldats avec les erreurs de Nivelle en 1917 et il existe en fait deux traditions de la victoire de Verdun, comme l'écrit Marc Ferro, biographe de Pétain, celle des chefs militaires et politiques qui la mettent au crédit de Nivelle, et celle des combattants qui ne connaissent que Pétain.
En 1917, le général Nivelle prend la tête des armées françaises, alors que Joffre n’était que le chef du front du Nord-Est. Le général Pétain est nommé chef d'État-Major général, poste spécialement créé pour lui. Il s’oppose à Nivelle qui est peu économe du sang de ses hommes, et dont l’attitude d’offensive à outrance contraste avec le pragmatisme de Pétain. Le commandement de Nivelle aboutit à la bataille du Chemin des Dames, à la mi-avril 1917 : 100 000 hommes sont mis hors de combat du côté français en une semaine. Bien que les Français, à défaut de percer, aient tenu, le mécontentement gronde, provoquant des mutineries dans de nombreuses unités. Nivelle est renvoyé et Pétain se trouve en situation de lui succéder, par sa réputation à Verdun et ses positions visant à limiter les pertes. Le 15 mai 1917, il est nommé, commandant en chef des armées françaises. Son commandement vise à redonner confiance aux troupes en améliorant les conditions de vie des soldats, en mettant fin aux offensives mal préparées et en faisant condamner les mutins, dont seule une minorité est fusillée malgré les exigences d'une partie des hommes politiques. En octobre 1917, il reprend le Chemin des Dames aux Allemands, par des offensives plus limitées, ne gaspillant pas la vie des soldats et toutes victorieuses.
Le 21 mars 1918, les Allemands rompent le front en Picardie et menacent Amiens. Pétain est un candidat possible au titre de généralissime des troupes alliées, mais, avec l'appui des Britanniques, Clemenceau, qui le juge trop porté à la défensive et trop pessimiste, lui préfère Foch, partisan de l'offensive, lors de la conférence de Doullens du 26 mars. Il est désormais à l’origine de la coordination de toutes les troupes alliées, dont Foch est le chef suprême. Pendant l'offensive allemande de 1918, il conseille la prudence, là où Foch choisit la contre-offensive victorieuse. En août 1918 la médaille militaire lui est attribuée : Soldat dans l’âme, n’a cessé de donner des preuves éclatantes du plus pur esprit du devoir et de haute abnégation. Vient de s’acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale en brisant la ruée allemande et en la refoulant victorieusement.
En octobre 1918, il prépare une grande offensive qui aurait mené les troupes franco-américaines jusqu’en Allemagne. Prévue à partir du 13 novembre, elle n’a pas lieu puisque, contre son avis, Foch et Clemenceau ont accepté l’armistice demandé par les Allemands.
Après l'armistice signée le 11 novembre, Pétain est élevé à la dignité de maréchal de France par décret du 21 novembre 1918 publié au Journal officiel. Il reçoit à Metz son bâton de maréchal, le 8 décembre 1918.
Il est l'un des très rares acteurs militaires de premier plan de la Grande Guerre à n'avoir jamais voulu publier ses mémoires de guerre. Les différents témoignages à son sujet, au-delà des inévitables références au grand soldat soucieux de la vie de ses hommes, soulignent son caractère secret, son manque d'humour, sa froideur, son apparence marmoréenne, terme qui revient souvent sous la plume des différents auteurs. L'historien Jean-Louis Crémieux-Brilhac rappelle que Pétain était, dès 1914-1918, un chef d'un pessimisme que Clemenceau jugeait intolérable, bien qu'il l'ait toujours couvert. En 2014 est toutefois publié un manuscrit inédit de Philippe Pétain qui retrace le conflit tel que Pétain l'avait vécu.
L'entre-deux-guerres
Le 12 avril 1919, Pétain est élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
Le 14 septembre 1920, âgé de 64 ans, il épouse Eugénie Hardon, âgée de 42 ans. Le couple n'a pas de descendance.
Général en chef de l'armée française et opposant à la ligne Maginot 1919-1931
Général en chef de l’Armée française il le reste jusqu’au 9 février 1931, il estime en 1919 à 6 875 le nombre de chars nécessaires à la défense du territoire 3 075 chars en régiment de première ligne, 3 000 chars en réserve à la disposition du commandant en chef et 800 chars pour le remplacement des unités endommagées. Il écrit : C’est lourd, mais l’avenir est au maximum d’hommes sous la cuirasse.
De 1919 à 1929, avec l'aide du général Buat, son chef d'État-Major, il s'oppose à la construction de fortifications défensives, préconisant au contraire la constitution d'un puissant corps de bataille mécanisé capable de porter le combat le plus loin possible sur le territoire ennemi dès les premiers jours de la guerre. Il parvient à rester l'instigateur principal de la stratégie, obtenant, en juin 1922, la démission du maréchal Joffre de la présidence de la Commission d'étude de l'organisation de la défense du territoire créée quinze jours plus tôt, et s'opposant, lors de la séance du Conseil supérieur de la guerre du 15 décembre 1925, à la construction d’une ligne défensive continue. Il y prône des môles défensifs sur les voies d’invasion. Lors de la séance du 19 mars 1926, contre l’avis de Foch, qui estime que Pétain donne à tort aux chars une importance capitale, il préconise et obtient l’étude de trois prototypes de chars léger, moyen et lourd.
Il doit, cependant, finir par s'incliner et accepter la construction de la ligne Maginot, lorsque André Maginot, alors ministre de la Guerre, déclarera, lors du débat parlementaire du 28 décembre 1929 : ce n'est pas Pétain qui commande, mais le ministre de la Guerre.
Pétain et de Gaulle
À partir de l’affectation de Charles de Gaulle au 33e régiment d’Infanterie commandé par Philippe Pétain, le destin des deux hommes va régulièrement se croiser. Charles de Gaulle est affecté à ce régiment le 9 octobre 1912 à sa sortie de Saint-Cyr avec un grade de sous-lieutenant ; Pétain en est le colonel.
En 1922, il apporte son soutien à Charles de Gaulle quand celui-ci entre en conflit avec ses supérieurs dont il conteste la vision stratégique trop liée à la planification défensive et compartimentée du terrain. En 1924, à l'occasion d'une visite à l'École de guerre, Pétain s'étonne de la faiblesse des notes attribuées à de Gaulle. Ses professeurs appréciaient peu l'indépendance de celui-ci, trait de caractère qu'il partageait avec Pétain. L'intervention de Pétain a probablement conduit à une rectification à la hausse desdites notes.
En 1925, Charles de Gaulle est détaché à l'état-major de Philippe Pétain, vice-président du Conseil supérieur de la Guerre. Pétain briguait l'Académie française et il avait pu apprécier la qualité de la plume de de Gaulle en lisant La discorde chez l'ennemi, publié en 1924. Il lui demande de préparer la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire du soldat pour l'aider à soutenir sa candidature. Le livre, Le Soldat à travers les âges, est quasiment fini à la fin de 1927. Lorsqu'en janvier 1928 Pétain veut faire retoucher le livre par un autre de ses collaborateurs, de Gaulle proteste énergiquement. En 1929, Pétain succède à Foch à l'Académie française sans avoir eu besoin du livre. Sans rancœur, Pétain demande à de Gaulle d'écrire l'éloge de son prédécesseur sous la coupole, mais n'utilise pas le texte proposé.
En 1927, en présence du maréchal Pétain, de Gaulle présente à l'École de guerre trois conférences remarquées, respectivement intitulées : L'action de guerre et le chef, Du caractère et Du prestige. En 1931, au retour du Liban, de Gaulle qui souhaitait une chaire d'enseignement à l'École de guerre est affecté contre son vœu au Secrétariat général de la Défense nationale SGDN à Paris. Sollicité Pétain répond à de Gaulle : vous y serez employé à des travaux qui pourront certainement vous aider à faire mûrir vos idées. De Gaulle, en décalage stratégique, en conflit littéraire, est progressivement moins admiratif de son supérieur, en particulier devant l'attitude de Pétain vis-à-vis de Lyautey au moment de son éviction. Pétain, lui, considère qu'il a aidé au mieux son subalterne qui se comporte avec un peu trop d'orgueil.
En 1932, de Gaulle dédie au maréchal Pétain son ouvrage Le Fil de l'épée : Car rien ne montre mieux que votre gloire, quelle vertu l'action peut tirer des lumières de la pensée. En 1938, De Gaulle récupère auprès de Pétain le manuscrit du Soldat à travers les âges en prévision de la sortie de son livre La France et son armée. Pétain s'oppose en vain à la sortie du livre souhaitant un changement de dédicace.
Guerre du Rif
En 1925 et 1926, des troupes françaises sous le commandement de Pétain, en campagne avec une armée espagnole (450 000 hommes au total, dans laquelle se trouve aussi Franco, mènent une campagne contre les forces d’Abd el-Krim, chef de la très jeune République du Rif, au Maroc ; les forces franco-espagnoles sont victorieuses, en partie grâce à l'emploi par les Espagnols d'armes chimiques sur les populations civiles. Abd el-Krim se plaignit à la Société des Nations de l'utilisation par l'aviation française de gaz moutarde sur les douars et les villages.
Élection à l'Académie française
Le 20 juin 1929, il est élu à l’unanimité membre de l’Académie française, au 18e fauteuil, où il succède au maréchal Foch.
Le 22 janvier 1931, il est reçu à l'Académie française par Paul Valéry, dont le discours de réception, qui retrace sa biographie, rappelle et développe une phrase sur laquelle insistait Pétain, le feu tue et comporte des considérations sur la façon dont la mitrailleuse a modifié durablement les conditions du combat à terre et les règles de la stratégie. Le discours rappelle aussi les désaccords, dans le respect mutuel, entre Pétain et Joffre. Le discours de réception du maréchal Pétain est un hommage au maréchal Foch auquel il succède.
Selon Jacques Madaule, Philippe Pétain s'opposa à l'élection à l'Académie française de Charles Maurras, qui sera un de ses plus grands défenseurs, et il félicita François Mauriac d'avoir fait campagne contre lui.
Philippe Pétain n'était pas ouvertement antisémite avant d'accéder au pouvoir : ainsi, il critiqua fermement Louis Bertrand, qui avait protesté contre l'élection d'André Maurois, un juif, à l'Académie française, Maurois en fut reconnaissant. Néanmoins, l'antisémitisme faisait partie du contexte général et Philippe Pétain le tolérait comme en attestent ses échanges de correspondance avec M. et Mrs Pardee, voisins américains de sa maison du Var, dans lesquels il se plaignait des juifs.
Inspecteur général de la défense aérienne
Le 9 février 1931, il est remplacé par le général Weygand au poste de vice-président du Conseil supérieur de la guerre correspondant à la fonction de commandant suprême de l’Armée, et nommé inspecteur général de la défense aérienne du territoire. À ce titre, il écrit le 2 décembre 1931 à Pierre Laval, alors président du Conseil, pour lui demander la création d’une force aérienne puissante de défense et d’attaque, indépendante de l’Armée de terre et de la Marine. Il préconise pour cela de prélever 250 millions de francs sur les crédits alloués à la construction de la ligne Maginot.
Il reste influent dans le monde militaire et politique, est actif dans le mouvement antiparlementaire le Redressement français qui souhaite un exécutif fort.
Ministre de la Guerre
Après le 6 février 1934, le 9 février 1934, Philippe Pétain est nommé ministre de la Guerre dans le gouvernement Doumergue de tendance radicale socialiste, fonction qu’il occupe jusqu’au renversement du cabinet le 8 novembre 1934.
Sa présence, populaire parmi les anciens combattants qui avaient défilé, contribue à l'image d'union nationale voulue par Doumergue. Elle est symbolique de la fin du second cartel des gauches : les gouvernements des deux années 1934/36 sont, le plus souvent une alliance des radicaux et des partis de centre droit. Ils conduisent des politiques sensiblement déflationnistes, visant à réduire les déficits en diminuant les dépenses. Puis, l'arrivée au pouvoir de Hitler conduit la France à abandonner progressivement sa politique de désarmement même si, simultanément, les choix budgétaires contribuent à maintenir une pression à la baisse sur les crédits militaires. Les choix stratégiques défensifs absorbent en outre une forte partie des crédits. La polémique des années 1940 sur les responsables du retard du réarmement français que Pétain attribue lors du procès de Riom à Daladier et Léon Blum qui réplique en dénonçant les crédits trop bas quand Pétain était ministre de la guerre, et celle sur les choix stratégiques qui conduisirent à la défaite, expliquent la diversité de l'historiographie évaluant le passage de Pétain au gouvernement.
La date du changement de politique budgétaire militaire est présentée avec des nuances: ainsi pour François Paulhac, entre 1934 et 1935, sous les gouvernements de centre droit, les dépenses d'armement sont réduites de 32 % tandis que les crédits militaires n'augmentent qu'à partir de 1936, votés sans grande opposition, mis à part celle d'une partie de la droite. Pour Robert Frank, elles connaissent - après celui de 1924-1930 - un second envol … pendant la période de réarmement proprement dit, dès 1935, et surtout de 1936-1937 jusqu'à la guerre »58. Jean-Luc Marret estime pour sa part que les réductions budgétaires ont cessé en 1934, sans qu'il y ait pour autant cette année-là d'importante augmentation de l'effort de défense. Le gouvernement de Gaston Doumergue — où Pétain est ministre de la Guerre — fait ainsi voter des crédits militaires de trois milliards de francs. Pour Guy Antonetti, la reprise des dépenses - qu'il situe en 1935 - est consécutive à l'inflexion de la politique étrangère plus offensive d'alliances renouées, entamée sous le gouvernement de Gaston Doumergue 1934 et son ministre des Affaires étrangères Louis Barthou puis sous le gouvernement de Pierre Laval 1935. Un article de Philippe Garraud en 2005 dédié à la question du réarmement, estime que d'une manière générale, le bilan de la politique d’armement de 1919 à 1935 est extrêmement limité et, durant toute cette période, les effectifs et le fonctionnement absorbent la plus grande part de budgets réduits et que e réarmement commence réellement en 1936 avec la mise en œuvre du programme partiel de 1935 et le plan des 14 milliards, tout en précisant qu'au terme de cette période transitoire, l’année 1935 paraît néanmoins particulièrement importante et même charnière : d’une part elle marque le début du réarmement français, même si la hausse du budget est encore limitée ; d’autre part, elle voit la mise au point de nombreux prototypes qui commenceront à faire l’objet de commandes importantes l’année suivante. Concernant le réarmement, Jean-Luc Marret en situe les premiers indices à l'occasion de la réorientation de la politique étrangère française par Louis Barthou en 1934 et Pierre Laval en 1935.
Pétain limite les travaux de la ligne Maginot, pensant que les Ardennes sont une barrière naturelle difficilement franchissable par les Allemands. Le 15 juin 1934, il obtient le vote d’un crédit supplémentaire de 1,275 milliard de francs pour la modernisation de l’armement.
Partisan des chars de combat, il décide avant avril 1934 de l’adoption du char B1 dont il avait fait faire les prototypes pendant son commandement. La même année, il décide aussi de l’adoption du char D2 et de l’étude d’un char léger. Soucieux de la formation des officiers supérieurs, il ordonne que tous les postulants à l’École supérieure de guerre effectuent des stages préalables dans des unités de chars et d’aviation.
Le 31 mai 1934, convoqué devant la Commission des finances, il exprime ses vues sur la fortification et renouvelle ses réserves sur l’efficacité de la ligne Maginot. Il explique ce qu’est pour lui la fortification : le béton est un moyen pour économiser les effectifs, mais l’essentiel reste une armée puissante sans laquelle elle n’est qu’une fausse sécurité. Le but de la fortification est de permettre le regroupement des troupes pour l’offensive ou la contre-offensive. Il aura cette phrase : la ligne Maginot ne met pas à l’abri d’une pénétration de l’ennemi, si l’armée n’est pas dotée de réserves motorisées aptes à intervenir rapidement. Il soutient néanmoins le principe de cette ligne. Cependant, selon Robert Aron les conceptions stratégiques qu'il défend à cette époque sont conformes à son expérience de la Grande Guerre, ainsi :
… Entre les deux guerres, les conceptions stratégiques qu’il va défendre et imposer à l’Armée française sont encore strictement conformes à son expérience du début de l’autre conflit : il ne croit pas au rôle offensif des tanks ni aux divisions blindées. Il préconise l’édification de la ligne Maginot, derrière laquelle nos combattants de 1939 vont se croire à l’abri et attendront paisiblement l’offensive allemande, qui se déclenchera ailleurs.
Le 27 octobre 1934, il convainc Louis Germain-Martin, ministre des Finances, de signer le plan Pétain pour 1935 d'un montant de 3,415 milliards de francs, qui prévoit notamment la construction de 1 260 chars. La chute du Gouvernement, et le remplacement du maréchal Pétain par le général Maurin, partisan de chars lourds et lents, retarderont la mise en œuvre de ce plan de plusieurs mois.
Après son expérience ministérielle, Pétain jouit d’une très grande popularité, à droite mais aussi à gauche. En témoigne en 1935, la célèbre campagne lancée par Gustave Hervé intitulée C’est Pétain qu’il nous faut. Le fait de vouloir faire appel en cas de péril au maréchal Pétain n'est pas une spécificité de la droite et le radical-socialiste Pierre Cot déclara dès 1934 : Monsieur le Maréchal, en cas de péril national, la France compte sur vous.
Membre du Conseil supérieur de la guerre
Il participe par la suite au Conseil supérieur de la guerre, où il soutient la politique de guerre offensive promue par le colonel de Gaulle, qui fut un temps son porte-plume », préconisant la concentration de chars dans des divisions blindées. Il écrit dans la Revue des deux Mondes du 15 février 1935 : Il est indispensable que la France possède une couverture rapide, puissante, à base d’avions et de chars .... Et lors d'une conférence à l’École de Guerre en avril 1935 : Les unités mécanisées sont capables de donner aux opérations un rythme et une amplitude inconnus jusqu’ici … L’avion, en portant la destruction jusqu’aux centres vitaux les plus éloignés fait éclater le cadre de la bataille ... On peut se demander si l’avion ne dictera pas sa loi dans les conflits de l’avenir .... Ainsi que dans la préface d'un ouvrage du général Sikorsky : Les possibilités des chars sont tellement vastes qu’on peut dire que le char sera peut-être demain l’arme principale.
Le 6 avril 1935, il dit, devant le président Lebrun, dans un discours à l’École supérieure de Guerre : Il est nécessaire de tenir le plus grand compte des perspectives ouvertes par l’engin blindé et par l’aviation. L’automobile, grâce à la chenille et à la cuirasse, met la vitesse au service de la puissance ... La victoire appartiendra à celui qui saura le premier exploiter au maximum les propriétés des engins modernes et combiner leur action. En 1938, il préfacera le livre du général Louis Chauvineau Une invasion est-elle encore possible, qui prônait l'utilisation de l'infanterie et des fortifications comme moyens de défense, face au front continu. Dans cette préface, Pétain considérait que l'utilisation des chars et des avions ne modifiaient pas les données de la guerre.
À l’instigation des grands chefs militaires Foch, Joffre, les gouvernements de la fin des années 1920 vont affecter d’importants efforts budgétaires à la construction de lignes de défense. Cette stratégie est symbolisée par la coûteuse, et de surcroît incomplète ligne Maginot qui fut arrêtée à la frontière belge. Winston Churchill, dans son ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale, émet l'avis que l'idée de la ligne Maginot aurait pu être d'une très grande utilité si elle avait été correctement appliquée et qu'elle paraissait justifiée compte tenu, en particulier, du rapport numérique entre les populations de la France et de l'Allemagne. Il juge extraordinaire qu'elle n'ait été prolongée au moins le long de la Meuse mais indique : ... Mais le maréchal Pétain s'était opposé à cette extension .... Il soutenait avec force que l'on devait exclure l'hypothèse d'une invasion par les Ardennes en raison de la nature du terrain. En conséquence, on écarta cette éventualité.
Après le succès de la guerre-éclair menée par les Allemands, Pétain ne pouvait plus ignorer que la débâcle de 1940 était aussi due aux grands chefs militaires, dont les autorités gouvernementales n’avaient fait que suivre les orientations stratégiques quand il tenta de faire juger les responsables de la défaite, en imputant celle-ci exclusivement aux politiques
Pétain n’avait cependant pas manqué non plus de regretter que les politiques ne tiennent pas compte des demandes de crédit émanant de l'armée. Depuis plusieurs années, il annonçait comme perdue d’avance une nouvelle guerre contre l’Allemagne, si la France n’effectuait pas le même effort de réarmement militaire et moral que son voisin et si certains politiques continuaient d'alimenter l'antimilitarisme.
Ambassadeur en Espagne
La France a reconnu officiellement le nouveau gouvernement franquiste le 27 février 1939. Le 2 mars 1939, Pétain est nommé ambassadeur de France en Espagne. Dans Le Populaire du 3 mars 1939, Léon Blum qui décrit Philippe Pétain comme le plus noble et du plus humain de nos chefs militaires proteste contre cette nomination. La nomination de Pétain qui jouit d'un grand prestige en Espagne vise à améliorer l'image de la République française qui a soutenu les Républicains pendant la guerre civile. Le 24 mars 1939, il présente ses lettres de créance au ministre de l'Intérieur, Serrano Súñer qui le reçoit très froidement. Selon Michel Catala, il gardera le souvenir de ce mauvais accueil et ses liens vis-à-vis de Franco resteront très critiques.
Pétain a pour mission d'assurer la neutralité de l'Espagne en vue du prochain conflit européen. Au nom du rapprochement diplomatique de la France avec l’Espagne, il lui incombe de superviser, dans le cadre des accords Bérard-Jordana, le rapatriement à Madrid des réserves d’or de la Banque d’Espagne et des toiles du musée du Prado que l’ancienne République espagnole avait transférées à l’abri en France durant la guerre civile ainsi que la flotte de guerre républicaine. Il sait s'entourer d'une équipe de qualité et en quelques mois, il se réconcilie avec l'élite espagnole. Sa présence active dans le pays a pour conséquence une renforcement de l'image de la France en dépit d'une presse espagnole très francophobe. Son autorité permet de réaliser rapidement les accords Bérard-Jordana malgré de nombreuses réticences du côté français. La déclaration officielle de neutralité de l'Espagne le 4 septembre 1939 semble couronner les efforts français, mais résulte davantage du réalisme de Franco. Pétain décrit ses réserves sur cette « drôle de neutralité » espagnole. Les rapports commerciaux et culturels se rétablissent rapidement dans les derniers mois de 1939 et les premiers mois de 1940 sans pour autant modifier l'ambigüité de la position espagnole entre les forces de l'Axe et la France. La réussite personnelle de Pétain est indéniable en dépit de l'échec de sa stratégie.
Pendant la Drôle de Guerre : un recours possible
À la déclaration de guerre, en septembre 1939, le maréchal Pétain, depuis Madrid, refuse une proposition du président du conseil Édouard Daladier d'entrer au gouvernement, et il se tient prudemment à l'écart des sollicitations officielles. Cette proposition avait été inspirée par le président de la Chambre des députés, le radical-socialiste Édouard Herriot, comme condition à son acceptation éventuelle du ministère des Affaires étrangères.
Cependant, Pétain ne fait nullement mystère de son hostilité personnelle à la guerre contre Hitler, et autant il est certain qu'il n'a eu aucune part dans les intrigues tramées en vue d'une paix de compromis, autant il est manifeste qu'il a, depuis le début, son rôle dans les calculs de Laval et de certains membres du complot de la paix.
Chef de file des parlementaires défaitistes, Pierre Laval songe ainsi précocement à un gouvernement Pétain dont il serait le chef réel, et expose fin octobre 1939 à l'un de ses interlocuteurs : Je n'ai pas, comme on dit, partie liée avec Pétain, mais je sais son prestige. … Qu'est-ce qu'on lui demandera ? D'être un dessus de cheminée, une statue sur un socle. Son nom ! Son prestige ! Pas davantage.
Le 3 novembre 1939, un rapport de l'ambassadeur d'Italie note que « le maréchal Pétain fait figure de représentant de la politique de paix en France … Pétain croit que, même en cas de victoire, la France n'en recueillerait pas les fruits. Si la question de la paix devenait aiguë en France, Pétain y jouerait un rôle.
Arrivé au pouvoir le 21 mars 1940, le président du conseil Paul Reynaud songe également à utiliser le prestige du maréchal Pétain auprès des Français et lui propose en vain, début mai, d'entrer au gouvernement.
Selon l'historien Jean-Louis Crémieux-Brilhac, aux moments de retourner aux responsabilités, Pétain partage le mépris de la droite antiparlementaire pour le régime qui l'a couvert d'honneurs. … La France selon son cœur est la France paysanne dont il est issu, respectueuse des hiérarchies et de l'ordre établi, telle qu'il souhaitera la faire revivre à Vichy. Ses vues politiques sont courtes : il ne supporte pas les bavardages politiciens ; il reproche aux instituteurs socialistes d'avoir favorisé l'antipatriotisme, comme au Front populaire d'avoir favorisé le désordre. Son bon sens proverbial va de pair avec une grande ignorance et des vues simplistes en matière de politique étrangère. … Il ne voit rien de plus en Hitler qu'un Guillaume II plébéien ; il ne doute pas qu'on puisse s'accommoder avec lui moyennant quelques sacrifices. Son action est enfin marquée par une anglophobie et un défaitisme déjà sensibles en 1914-1918.
L'invasion allemande de 1940
Le 17 mai 1940, une semaine après le début de l'offensive allemande à l'Ouest, Pétain est nommé vice-président du Conseil dans le gouvernement de Paul Reynaud. Franco lui avait conseillé de ne pas accepter d’apporter sa caution à ce gouvernement. Pour Reynaud, il s'agit de remonter le moral des Français, de resserrer les rangs et de renforcer sa propre image au parlement. Cette nomination est bien accueillie dans le pays, au Parlement et dans la presse, quoiqu'elle reçoive moins de publicité que celle de Weygand comme généralissime ou que celle de Georges Mandel, partisan de la résistance à tout prix, comme ministre de l'Intérieur. Comme la plupart de ses ministres ou des parlementaires, Paul Reynaud sous-estime le vieil homme initialement taciturne et passif qu’est Pétain, et il n’imagine pas qu’il puisse jouer plus qu’un rôle purement symbolique.
Cependant, dès le 26 mai, dans une note à Paul Reynaud, Pétain refuse de considérer les chefs militaires comme responsables de la défaite, et rejette la responsabilité du désastre sur les fautes que le pays a et que nous avons tous commises, ce goût de la vie tranquille, cet abandon de l'effort qui nous ont amenés là où nous sommes. Cette interprétation moraliste de la défaite n'est pas sans annoncer les appels à la contrition nationale et la politique d'ordre moral qui caractériseront le régime de Vichy.
Le 4 juin, il fait preuve d’anglophobie et de pessimisme devant l’ambassadeur américain Bullit. Accusant l'Angleterre de ne pas fournir une aide suffisante à la France en péril, il lui explique qu'en cas de défaite e gouvernement français doit faire tout son possible pour venir à composition avec les Allemands, sans se préoccuper du sort de l’Angleterre. Le 6, il ne réagit pas lorsque le général Spears, représentant de Churchill auprès du gouvernement français, l'avertit que si la France s'entendait avec l'Allemagne, elle ne perdrait pas seulement son honneur, mais, physiquement, elle ne s’en relèverait pas. Elle serait liée à une Allemagne sur la gorge de laquelle nos poings ne tarderont pas à se refermer.
À partir du 13 juin, alors que la bataille de France est perdue et le gouvernement replié en Touraine, Pétain se fait ouvertement l'un des avocats les plus constants de l’armistice au sein du gouvernement. Ce jour-là, il lit au conseil des ministres une note dans laquelle il déclare qu’il n’est aucunement question pour lui de quitter la France pour poursuivre la lutte.
Le 14 juin 1940, Paris est occupé par l’armée allemande. Le Gouvernement, le président de la République et les Assemblées sont alors réfugiés à Bordeaux. Pétain s'y confirme comme le chef de file des partisans de l’armistice, et met sa démission dans la balance. Le 16 juin 1940, se croyant en minorité au sein du conseil des ministres, à tort semble-t-il82, Paul Reynaud présente la démission du Gouvernement et suggère, suivi en cela par les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, de confier la présidence du Conseil au maréchal Pétain, choix aussitôt approuvé par le président de la République Albert Lebrun voir gouvernement Philippe Pétain. Il semble avoir espéré qu'un échec de Pétain à obtenir l’armistice lui permette de revenir très vite au pouvoir.
Le 17 juin 1940, suivant le conseil énoncé le 12 juin par le général Maxime Weygand, chef d’état-major des armées, Pétain annonce son intention de demander aux Allemands, par l'intermédiaire du gouvernement espagnol, les conditions d'un armistice. Son discours radiodiffusé, où il déclare, alors que les négociations ont à peine commencé : C’est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu’il faut cesser le combat, a un effet désastreux sur le moral des troupes et précipite de fait l’effondrement des armées françaises. Du 17 juin à l’entrée en vigueur de l’armistice le 25, les Allemands font ainsi plus de prisonniers que depuis le début de l’offensive le 10 mai.
Dans le même discours, Pétain anticipe la création de son propre régime en déclarant qu’il fait don de sa personne à la France. Le 20 juin 1940, dans un nouveau discours rédigé, tout comme le premier, par l'intellectuel de confession juive Emmanuel Berl, il annonce les tractations en vue de l'armistice. Il en détaille les motifs, ainsi que les leçons que, selon lui, il faudra en tirer. Il y fustige l'esprit de jouissance : ... Depuis la victoire de 1918, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on n'a servi. On a voulu épargner l'effort ; on rencontre aujourd'hui le malheur.
L’armistice est finalement signé le 22 juin 1940 dans la clairière de Compiègne, après avoir été approuvé par le Conseil des ministres et le président de la République.
Le 25 juin 1940, Pétain annonce les conditions sévères de l'armistice et décrit les territoires qui seront sous contrôle allemand. La démobilisation fait partie de ces conditions. Il annonce : C'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence …. Les causes de la défaite sont à rechercher selon lui dans l'esprit de relâchement : Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié ….
Le 29 juin 1940, le Gouvernement s’installe dans la région de Clermont-Ferrand puis, en raison des capacités d’hébergement limitées, déménage à nouveau le 1er juillet pour Vichy, en zone non occupée par l’armée allemande. Cette ville présentait les avantages d’un réseau téléphonique extrêmement performant et d’une multitude d’hôtels qui furent réquisitionnés pour abriter les différents ministères et les ambassades.
Le 10 juillet 1940, une loi, dite constitutionnelle, votée par les deux Chambres 569 voix pour, 80 voix contre et 20 abstentions réunies en Assemblée nationale au casino de Vichy donne tous pouvoirs au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, sans contrôle de l’Assemblée, avec pour mission la promulgation d’une nouvelle Constitution. Celle-ci ne verra jamais le jour. L'État français, nouveau nom officiel de la France, remplaçant la dénomination République française allait donc demeurer un État provisoire.
La constitutionnalité de cette réforme fut contestée pour plusieurs motifs dont le fait que la Constitution ne peut pas être modifiée sous la menace directe d'un ennemi. Surtout, la confusion de tous les pouvoirs constituant, législatif, exécutif et judiciaire entre les mêmes mains était contraire aux fondements même des lois constitutionnelles de 1875, fondées sur une séparation des pouvoirs. Il en résulta un régime anti-démocratique, sans constitution et sans contrôle parlementaire.
Ce régime sera qualifié de dictature pluraliste par Stanley Hoffmann, qui démontre, entre autres, les aspects dictatoriaux dans une publication parue en 1956. D'autres auteurs, comme Robert Aron, Robert Paxton et Marc Ferro, évoquent, au sujet de Pétain, des dictateurs tels que Salazar et son régime, Franco, voire Mussolini. Pour Aron : La première [période du pouvoir de Vichy, qui va de l'armistice au 13 décembre 1940, est celle où Pétain peut encore avoir l'illusion d'être un chef d'État autoritaire, qui ne doit rien à personne et dont le pouvoir en France est presque l'équivalent de celui des dictateurs Salazar au Portugal, Franco en Espagne, ou Mussolini en Italie. Selon Paxton, Pétain lui-même se trouvait plus de points communs avec Franco et Salazar qu'avec Hitler, tandis que pour Ferro c'est l'exemple de Salazar qui inspire le programme du maréchal, ainsi : le régime qu'il institue évoque effectivement plutôt le salazarisme… et : Les régimes de Kemal, Horthy, Franco, avaient ses préférences par rapport à celui de Mussolini du fait de la dualité Mussolini-Victor-Emmanuel et selon l'idée qu'il se fait de son pouvoir : le Maréchal n'a de compte à rendre qu'à sa conscience, mais de loin il préférait celui de Salazar….
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10892#forumpost10892
Posté le : 23/04/2016 17:50
|
|
|
|
|
Philippe Pétain 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
De 1940 à 1944 : le chef du régime de Vichy et Collaboration en France.
L’installation du régime Un régime de pouvoir personnel
Drapeau français durant le régime de Vichy.
La francisque, emblème personnel de Philippe Pétain, utilisée comme symbole officieux du régime de Vichy.
Marque de commandement de Philippe Pétain, chef de l’État français, ornée de la francisque et de ses sept étoiles de maréchal de France.
Dès le 11 juillet 1940, par trois actes constitutionnels, Pétain se proclame chef de l'État français et s'arroge tous les pouvoirs. Pierre Laval lui dit un jour : Connaissez-vous, Monsieur le Maréchal, l'étendue de vos pouvoirs ? … Ils sont plus grands que ceux de Louis XIV, parce que Louis XIV devait remettre ses édits au Parlement, tandis que vous n'avez pas besoin de soumettre vos actes constitutionnels au Parlement, parce qu'il n'est plus là, Pétain répondit : C'est vrai.
Acte constitutionnel numéro 2 fixant les pouvoirs du chef de l'État français, signé par Pétain le 11 juillet 1940, Archives nationales de France
Aux traditionnels attributs régaliens droit de grâce, nominations et révocations des ministres et des hauts fonctionnaires, Pétain ajoute en effet des droits tout à fait inédits, même du temps de la monarchie absolue. Il peut ainsi rédiger et promulguer seul une nouvelle Constitution, il peut désigner son successeur qui est le vice-président du Conseil, il a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État, qui ne sont responsables que devant lui. et il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres…. Les lois, adoptées de sa seule autorité, sont promulguées sur la formule : Nous, maréchal de France, le Conseil des ministres entendu, décidons… Par prudence, par contre, Pétain évite de s’attribuer le droit de déclarer la guerre seul : il doit pour cela consulter les éventuelles assemblées.
Jusqu’en avril 1942, Pétain reste par ailleurs à la fois chef de l’État et chef du gouvernement en titre, Pierre Laval, Pierre-Étienne Flandin et l'amiral François Darlan n’étant que vice-présidents du Conseil. Il gouverne de manière autoritaire. Ainsi, le 13 décembre 1940, il évince brusquement Pierre Laval du pouvoir, non par désaveu de la politique de collaboration avec l’Allemagne nazie menée par ce dernier, mais par irritation devant sa manière trop indépendante de la conduire. Il est remplacé par Flandin. Parallèlement, Pétain signe la révocation de nombreux maires, préfets et hauts fonctionnaires républicains, dont le préfet d'Eure-et-Loir Jean Moulin et le président de la Cour des comptes Émile Labeyrie.
Le maréchal supprime précocement tous les contre-pouvoirs institutionnels à son autorité, et tout ce qui rappelle trop le régime républicain, désormais honni. Le mot même de République disparaît. Les libertés publiques sont suspendues, tout comme les partis politiques, à l’exception de ceux des collaborationnistes parisiens, qui subsistent en zone nord. Les centrales syndicales sont dissoutes, les unions départementales subsistantes unifiées dans une organisation corporatiste du travail. La franc-maçonnerie est mise hors la loi. Toutes les assemblées élues sont mises en sommeil ou supprimées, les Chambres aussi bien que les conseils généraux. Des milliers de municipalités, dont les maires qui n'ont pas voulu signer un serment d'allégeance non pas à l'État, mais à Pétain lui-même sont destituées, et remplacées par des Délégations spéciales, nommées par décret du pouvoir central, et dont la présidence revient à des personnalités présentant les garanties exigées du maréchal.
Des juridictions d’exception sont mises en place. Dès le 2 août 1940, Vichy fait ainsi condamner à mort par contumace Charles de Gaulle même si Pétain prétend qu'il veillera à ce que la sentence ne soit pas appliquée puis ses compagnons, qui sont déchus de la nationalité française avec ceux qui les rejoignent. Des procès iniques sont intentés à diverses personnalités républicaines, ainsi à Pierre Mendès France, condamné en juin 1941 à Clermont-Ferrand pour une prétendue « désertion l'affaire du Massilia, bateau-piège, avec Jean Zay et quelques autres. À l’automne 1941, grâce à des lois ouvertement antidatées, Vichy envoie à la guillotine plusieurs prisonniers communistes, dont le député Jean Catelas, en représailles à des attentats anti-allemands.
Pétain décrète par ailleurs l’arrestation, dès 1940, de Léon Blum, Georges Mandel, Édouard Daladier, Paul Reynaud et du général Gamelin. Mais le procès de Riom, qui devait lui servir à faire le procès du Front populaire et de la IIIe République, et à les rendre seuls responsables de la défaite, tourne en avril 1942 à la confusion des accusateurs. Léon Blum, notamment, sait rappeler la responsabilité propre du haut commandement militaire dans la réduction des crédits militaires en 1934 et dans la stratégie défensive désastreuse fondée sur la ligne Maginot. Le procès est suspendu, et les accusés restent internés, avant d’être livrés l’an suivant aux Allemands.
Culte du chef et popularité
Jouant le plus possible sur la réputation du vainqueur de Verdun, le régime exploite le prestige du maréchal et diffuse un culte de la personnalité omniprésent : les photos du maréchal figurent dans les vitrines de tous les magasins, sur les murs des cités, dans toutes les administrations, ainsi qu’aux murs des classes dans tous les locaux scolaires et dans ceux des organisations de jeunesse. On le retrouve jusque sur les calendriers des PTT. Le rôle de Bernard Ménétrel, médecin et secrétaire particulier du maréchal est prédominant dans cette action de communication et de propagande.
Le visage du chef de l’État apparaît aussi sur les timbres et les pièces de monnaie, tandis que les bustes de Marianne sont retirés des mairies. La Saint-Philippe, chaque 3 mai, est célébrée à l’instar d’une fête nationale. Un hymne à sa gloire, le célèbre Maréchal, nous voilà, est interprété dans de nombreuses cérémonies parallèlement à la Marseillaise, et doit être appris à tous les enfants des écoles par les instituteurs. À qui douterait, des affiches péremptoires proclament : « Êtes-vous plus Français que lui ? ou encore Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l’heure ?.
Pétain exige aussi un serment de fidélité des fonctionnaires à sa propre personne. L'acte constitutionnel no 7 du 27 janvier 1941 oblige déjà les secrétaires d'État, les hauts dignitaires, et les hauts fonctionnaires à jurer fidélité au chef de l'État. Après son discours du 12 août 1941 discours dit du vent mauvais, où il déplore les contestations croissantes de son autorité et de son gouvernement, Philippe Pétain étend le nombre de fonctionnaires devant lui prêter serment. Les actes constitutionnels no 8 et no 9 du 14 août 1941 concernent respectivement les militaires et les magistrats. Le serment est prêté par tous les juges à l’exception d’un seul, Paul Didier, aussitôt révoqué et interné au camp de Châteaubriant. Puis c'est l’ensemble des fonctionnaires qui doit jurer fidélité au chef de l'État par l’acte constitutionnel no 10 du 4 octobre 1941. Il concernera donc jusqu'aux policiers et aux postiers. Néanmoins, en zone occupée, où l'autorité de Vichy est moins assurée, de hauts fonctionnaires nommés avant 1940, éviteront discrètement de prêter serment à Pétain et, après la guerre, pourront ainsi conserver leur poste.
Pétain et l'ambassadeur américain, William D. Leahy en 1942.
Toute une littérature, relayée par la presse sous contrôle et par maints discours officiels ou particuliers, trouve des accents quasi-idolâtres pour exalter le maréchal comme un sauveur messianique, pour célébrer son sacrifice, pour le comparer à Jeanne d’Arc ou à Vercingétorix, pour vanter l’allant et la robustesse physique du vieillard, ou encore la beauté de ses célèbres yeux bleus. Un chêne pluricentenaire reçoit son nom en forêt de Tronçais. De nombreuses rues sont débaptisées et prennent son nom sur ordre. Le serment prêté par les titulaires de la Francisque prévoit : Je fais don de ma personne au maréchal Pétain comme il a fait don de la sienne à la France.
La popularité du maréchal ne repose cependant nullement sur le seul appareil de propagande. L’intéressé sait l’entretenir par de nombreux voyages à travers toute la zone sud, surtout en 1940-1942, où des foules considérables viennent l’acclamer. Il reçoit de nombreux présents de partout ainsi qu'un abondant courrier quotidien, dont des milliers de lettres et de dessins des enfants des écoles. Pétain entretient aussi le contact avec la population par un certain nombre de réceptions à Vichy, ou surtout par ses fréquents discours à la radio. Il sait employer dans ses propos une rhétorique sobre et claire, ainsi qu’une série de formules percutantes, pour faire mieux accepter son autorité absolue et ses idées réactionnaires : La terre, elle, ne ment pas, Je hais ces mensonges qui vous ont fait tant de mal août 1940, Je vous ai parlé jusqu’ici le langage d’un père, je vous parle à présent le langage d’un chef. Suivez-moi, gardez confiance en la France éternelle novembre 1940.
Par ailleurs, de nombreux évêques et hommes d’Église mettent leur autorité morale au service d’un culte ardent du maréchal, salué comme l’homme providentiel. Le 19 novembre 1940, le primat des Gaules, le cardinal Gerlier, proclame ainsi, à la primatiale Saint-Jean de Lyon, en présence du maréchal : Car Pétain, c'est la France et la France, aujourd'hui, c'est Pétain !. L’Assemblée des cardinaux et archevêques de France, en 1941, assure le chef de l’État de sa vénération, dans une résolution sans équivalent au xxe siècle. Mais de nombreux Français de tous bords et de toutes croyances communient pareillement dans la confiance au maréchal. Tous les courants politiques sont ainsi représentés dans son gouvernement à Vichy, de la droite le plus réactionnaire à la gauche la plus radicale. En particulier, le vieux chef monarchiste Charles Maurras salue son arrivée comme une divine surprise.
Les collaborationnistes, en général, sont hostiles à Vichy et à la Révolution nationale, qu’ils jugent trop réactionnaires et pas engagés assez loin dans l’appui à l’Allemagne nazie. Cependant, à la suite de Philippe Burrin et Jean-Pierre Azéma, l’historiographie récente insiste davantage sur les passerelles qui existent entre les hommes de Vichy et ceux de Paris. Un ultra-collaborationniste comme le futur chef de la Milice française, Joseph Darnand, est ainsi toute l’Occupation un inconditionnel fervent du Maréchal. Le chef fasciste français Jacques Doriot proclame quant à lui jusqu’à fin 1941 qu’il est un homme du Maréchal. Son rival Marcel Déat a essayé en 1940 de convertir Pétain à son projet de parti unique et de régime totalitaire, s’attirant de ce dernier une fin de non-recevoir un parti ne peut pas être unique ; déçu, Déat quitte définitivement Vichy et agonit désormais Pétain d'attaques dans son journal L’Œuvre, à tel point que le maréchal, en 1944, se débrouille pour ne jamais contresigner sa nomination comme ministre. D'autres entourent Pétain de leur vénération sans bornes, tels Gaston Bruneton, chargé de l’action sociale auprès des travailleurs français en Allemagne volontaires et forcés en étroite collaboration avec le DAF Front allemand du travail, ou encore se voient confier des fonctions importantes par Vichy. Ainsi le journaliste pro-hitlérien Fernand de Brinon, qui représente le gouvernement Pétain en zone nord de 1941 à 1944.
Le programme de Révolution nationale
Le choix prioritaire du maréchal Pétain
Instaurant un régime contre-révolutionnaire et autoritaire, le régime de Vichy veut réaliser une Révolution nationale, à fortes consonances xénophobes et antisémites, qui rompt avec la tradition républicaine et instaure un ordre nouveau fondé sur l’autorité, la hiérarchie, le corporatisme, l’inégalité entre les citoyens. Sa devise Travail, Famille, Patrie, empruntée aux Croix de Feu, remplace l’ancien triptyque Liberté, Égalité, Fraternité. Dès l’été 1940, un discours du maréchal Pétain prévient que le nouveau régime ne reposera plus sur l’idée fausse d’égalité entre les hommes.
La Révolution nationale est la priorité de Pétain, dont il fait son affaire personnelle, et qu'il encourage par ses discours et ses interventions en Conseil des ministres. Cependant, dès août 1941, il avoue à la radio la faiblesse des échos qu’ont rencontré ses projets, parmi la masse de la population. À partir du retour au pouvoir de Laval en avril 1942, la Révolution nationale n’est plus à l’ordre du jour.
L’historiographie récente, depuis les travaux d'Henri Michel, Robert Paxton ou Jean-Pierre Azéma, tend à montrer que le désir de pouvoir enfin redresser la France à sa façon a poussé largement Pétain, en juin 1940, à retirer le pays de la guerre par l’armistice. C’est également lui qui le pousse à accepter l’entente avec le vainqueur : la Révolution nationale ne peut prospérer que dans une France défaite. Car, pour les pétainistes, une victoire alliée signifierait le retour des Juifs, des Francs-Maçons, des républicains et des communistes.
Selon ces historiens, Pétain néglige aussi le péril et la contradiction qu’il y a à entreprendre ses réformes sous le regard de l’occupant. Cette illusion est d’ailleurs dénoncée dès l’époque par la France libre du général de Gaulle, mais également par nombre de résistants, dont certains avaient pu au départ être tentés par le programme de Pétain, mais qui estiment dangereux de se tromper sur les priorités et vain d'entreprendre des réformes tant que les Allemands ne sont pas chassés du pays. En août 1943, François Valentin, le chef de la Légion française des combattants, nommé à ce poste par Pétain lui-même, rejoint Londres, enregistre et fait diffuser à la BBC un message retentissant dans lequel il fait son autocritique et dénonce la faute grave du maréchal et de ses fidèles : On ne reconstruit pas sa maison pendant qu’elle flambe ! .
Mais, si les historiens ont déterminé les intentions de Pétain, ce n'était pas toujours le cas des personnes vivant à l'époque, et, si Pétain conduisit par exemple une politique antisémite, ceux qui l'admiraient n'avaient pas forcément de telles idées. Enfin, les vichysto-résistants, souvent séduits par la Révolution nationale mais hostiles à la collaboration et à l'Occupant, furent nombreux.
Réformes, contrôles et exclusions
Lois contre les Juifs et les étrangers pendant le régime de Vichy.
C'est Grande revanche des minorités. Le régime de Pétain entreprend de régler les vieux comptes des anciens vaincus avec la IIIe République, le Front populaire, le marxisme ou la laïcité. Ce faisant, Pétain aggrave sensiblement les discordes nationales déjà avivées dans les années 1930, et couvre de son autorité un bon nombre de mesures d’exclusion.
Ces mesures sont notamment dirigées contre les Juifs, bien que le maréchal semble avoir été imperméable à l'antisémitisme avant la guerre : il soutint la candidature d'André Maurois à l'Académie française, fut représenté à l'enterrement d'Edmond de Rotschild en 1934, fut témoin au mariage de l'économiste israélite Jacques Rueff en 1937 et le parrain de sa fille en 1938.
Dès la troisième semaine de juillet 1940, ainsi, des mesures sont prises pour écarter des fonctionnaires juifs, et une commission fondée pour réviser et annuler des milliers de naturalisations accordées depuis 1927. En octobre 1940 et sans aucune demande particulière de la part des Allemands, des lois d’exclusion adoptées à la hâte contre les francs-maçons et les Juifs sont promulguées.
Selon le témoignage du ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin, Pétain a personnellement participé à la rédaction du statut des Juifs et insisté pour qu’ils soient par exemple davantage exclus du milieu médical et de l'enseignement. Le brouillon originel de ce texte, qui est redécouvert en octobre 2010, annoté de la main du maréchal, prouvant ainsi son implication personnelle, confirme bien que Pétain a durci la version première et fait étendre l'exclusion à la totalité des Juifs de France, alors qu'elle ne devait concerner d'abord que les Juifs ou descendants de Juifs naturalisés après 1860.
Les textes discriminatoires du 3 octobre 1940 sont durcis le 2 juin 1941 : ils excluent ainsi les Français de race juive déterminée par la religion des grands-parents de la plupart des fonctions et activités publiques. Des quotas sont fixés pour l’admission des Juifs au Barreau, dans le monde universitaire ou médical. Lors du statut du 2 juin, la liste des métiers interdits s’allonge démesurément.
Dans le même temps par une loi du 29 mars 1941, promulguée par le maréchal, est créé un Commissariat général aux questions juives.
Auprès du maréchal se pressent des hommes de tous bords, mêlant de façon baroque, au sein de sa dictature pluraliste, des technocrates modernistes et des révolutionnaires déçus du marxisme aussi bien que des maurrassiens et des réactionnaires. Pétain cependant manifeste personnellement des orientations proches de L’Action française seul journal qu’il lise quotidiennementet cite surtout en exemple à ses proches les régimes conservateurs et cléricaux de Salazar et de Franco, qu’il connaît personnellement depuis 1939.
Parallèlement au développement d’un pouvoir centralisé, le maréchal se consacre au relèvement de la France : rapatriement des réfugiés, démobilisation, ravitaillement, maintien de l’ordre. Mais loin de se limiter à gérer les affaires courantes et à assurer la survie matérielle des populations, son régime est le seul en Europe à développer un programme de réformes intérieures, indépendant des demandes allemandes.
Certaines mesures prises à cette époque ont survécu, comme la création d’un ministère de la Reconstruction, l’unification du permis de construire, la naissance de l’IGN en juillet 1940, l’étatisation des polices municipales en vue de faciliter le contrôle des populations, ou encore une politique familiale, déjà amorcée par la IIIe République finissante et prolongée sous la IVe République. D’autres dispositions sont adoptées : campagne contre l’alcoolisme, interdiction de fumer dans les salles de spectacle, inscription de la fête des Mères au calendrier. D’autres encore portent la marque des projets réactionnaires du chef de l’État, comme la pénalisation de l'homosexualité. De nombreux étrangers supposés en surnombre dans l’économie française sont incorporés de force dans des Groupes de travailleurs étrangers GTE. Les Écoles normales, bastion de l’enseignement laïc et républicain, sont supprimées. Les lois des 11 et 27 octobre 1940 contre l’emploi des femmes en renvoient des milliers au foyer de gré ou de force. Le divorce est rendu nettement plus difficile, et le nombre de poursuites judiciaires et de condamnations pour avortement explose littéralement par rapport à l’entre-deux-guerres. En 1943, Pétain refuse de gracier une avorteuse condamnée à mort, qui est guillotinée. Autre rupture avec la IIIe République, les rapports étroits noués avec les Églises : Pétain, personnellement peu croyant, voit comme Maurras en la religion un facteur d’ordre, et ne manque pas d’assister à chaque messe dominicale à l’église Saint-Louis de Vichy.
Dans l’optique de la restauration de la France, le régime de Vichy crée très tôt, sous la direction de Joseph de La Porte du Theil, un fidèle très proche du maréchal Pétain, des camps de formation qui deviendront plus tard les Chantiers de la jeunesse française. L’idée est de réunir toute une classe d’âge en remplacement du service militaire désormais supprimé, et, à travers une vie au grand air, par des méthodes proches du scoutisme, leur inculquer les valeurs morales du nouveau régime culte de la hiérarchie, rejet de la ville industrielle corruptrice, ainsi que la vénération à l’égard du chef de l’État.
D’autres moyens de contrôle sont également mis en place dans le domaine économique, comme les Comités professionnels d’organisation et de répartition, ayant un pouvoir de juridiction sur leurs membres ou un pouvoir de répartition des matières premières, pouvoir capital en ces temps de restrictions généralisées.
À destination des ouvriers, Pétain prononce le 1er mai 1941 un important discours à Saint-Étienne, où il expose sa volonté de mettre fin à la lutte des classes en prohibant à la fois le capitalisme libéral et la révolution marxiste. Il énonce les principes de la future Charte du travail, promulguée en octobre 1941. Celle-ci interdit à la fois les grèves et le lock-out, instaure le système du syndicat unique et le corporatisme, mais met aussi en place des comités sociaux préfiguration des comités d'entreprise et prévoit la notion de salaire minimum. La Charte séduit de nombreux syndicalistes et théoriciens de tous bords René Belin, Hubert Lagardelle. Mais elle peine à entrer en application, et ne tarde pas à se briser sur l’hostilité de la classe ouvrière au régime et à ces idées, l’aggravation des pénuries, l’instauration du Service du travail obligatoire STO en septembre 1942, et enfin sur la lutte menée contre elle par les syndicats clandestins de la Résistance intérieure française.
Véritables enfants chéris de Vichy, les paysans passent cependant longtemps pour les vrais bénéficiaires du régime de Pétain. Lui-même propriétaire terrien en sa résidence de Villeneuve-Loubet, le maréchal affirme que la terre, elle, ne ment pas, et encourage le retour à la Terre - politique soldée sur un échec, moins de 1 500 personnes en quatre ans tentant de suivre ses conseils. La Corporation paysanne est fondée par une loi du 2 décembre 1940. Une partie des membres se détache du régime fin 1943 et lui font aussi servir de base à la création d'un syndicalisme paysan clandestin fin 1943, la Confédération générale de l'agriculture CGA qui voit le jour officiellement le 12 octobre 1944, lors de la dissolution de la Corporation paysanne par les autorités et qui se prolongera sous la forme de la FNSEA en 1946
Développant fréquemment et complaisamment la vision doloriste d’une France décadente qui expie maintenant ses fautes antérieures, Pétain entretient les Français dans une mentalité de vaincu : Je ne cesse de me rappeler tous les jours que nous avons été vaincus à une délégation, mai 1942, et manifeste un souci particulier pour les soldats prisonniers, images mêmes de la défaite et de la souffrance : Je pense à eux parce qu’ils souffrent …, Noël 1941. Selon son chef de cabinet, du Moulin de Labarthète, le tiers du temps de travail quotidien du maréchal était consacré aux prisonniers. De ces derniers, Vichy rêvait de faire les propagateurs de la Révolution Nationale à leur retour.
De la Légion à la Milice
La période consécutive à l’armistice voit aussi la création de la Légion française des combattants LFC, à laquelle sont ensuite agrégés les Amis de la Légion et les Cadets de la Légion. Fondée par le très antisémite Xavier Vallat le 29 août 1940, elle est présidée par le maréchal Pétain en personne. Pour Vichy, elle doit servir de fer de lance de la Révolution nationale et du régime. À côté des parades, des cérémonies et de la propagande, les Légionnaires actifs doivent surveiller la population, et dénoncer les déviants et les fautifs de mauvais esprit.
Au sein de cette légion se constitue un Service d’ordre légionnaire SOL qui s’engage immédiatement dans la voie du collaborationnisme. Cet organisme est commandé par Joseph Darnand, héros de la Première Guerre mondiale et de la campagne de 1940, et fervent partisan de Pétain sollicité en 1941 de joindre la Résistance, il refuse, selon le témoignage de Claude Bourdet, parce que le Maréchal ne comprendrait pas. Ce même organisme devient en janvier 1943 la Milice française. À la fin de la guerre, alors que Vichy est devenu un régime fantoche aux ordres des Allemands, la Milice qui compte au maximum 30 000 hommes, dont beaucoup d’aventuriers et de droit-communs, participe activement à la lutte contre la Résistance, avec les encouragements publics du maréchal Pétain comme de Pierre Laval, son président officiel. Haïe de la population, la Milice perpètre régulièrement délations, tortures, rafles, exécutions sommaires, qui se mêlent à d’innombrables vols, viols, voies de faits sur la voie publique ou contre des fonctionnaires.
Pétain attend le 6 août 1944 pour les désavouer dans une note à Darnand, trop tardivement pour que ce dernier soit dupe. Pendant quatre ans, rappellera Darnand dans sa réponse caustique au maréchal, vous m’avez encouragé au nom du bien de la France, et maintenant que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tache de l’Histoire de France. On aurait pu s’y prendre avant !
La collaboration d’État
Sur le plan de la politique extérieure, Pétain a retiré d’emblée le pays du conflit mondial en cours, et affecte de croire que ce dernier ne concerne plus du tout la France. S’il refuse jusqu’au bout toute rentrée dans la guerre aux côtés d’un des deux camps, il ne refuse pourtant pas le combat contre les alliés chaque fois qu'il en a l'occasion et annonce dès octobre 1940, son intention de reprendre par la force les territoires sous autorité de la France libre. Il pratique donc une neutralité dissymétrique qui bénéficie aux Allemands. Il choisit en effet de s’entendre avec le vainqueur et imagine que la France, avec son Empire colonial, sa flotte et sa bonne volonté à coopérer, peut obtenir une bonne place dans une Europe durablement allemande. Ceci peut être perçu comme une certaine naïveté de la part de Pétain : dans l’idéologie nazie, la France était en effet l’ennemie irréductible de l’Allemagne, elle devait être écrasée et ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une quelconque place privilégiée à ses côtés.
Il est bien établi, depuis les travaux d'Eberhard Jäckel et surtout de Robert Paxton, que Pétain a activement recherché et poursuivi cette collaboration avec l’Allemagne nazie. Elle ne lui a pas été imposée. Moins intéressé par la politique extérieure que par la Révolution nationale, sa vraie priorité, Pétain laisse Darlan et Laval mettre en œuvre les volets concrets de la collaboration d’État. Mais l’une est en réalité le revers de l’autre, selon les constats concordants de l’historiographie contemporaine : les réformes vichystes n’ont pu se mettre en place qu’en profitant du retrait de la France de la guerre, et elles ne sauraient survivre à une victoire alliée. Par ailleurs, le mythe Pétain134 » est indispensable pour faire accepter à bien des Français la collaboration. Le prestige du vainqueur de Verdun, son pouvoir légal sinon légitime, brouillent en effet dans les consciences en désarroi la perception des devoirs et des priorités.
L’homme de Montoire Pétain et Hitler à Montoire, le 24 octobre 1940.
Situation de la France sous le gouvernement de Philippe Pétain : * En juillet 1940, selon les accords de Montoire, le pays est coupé en quatre : zone occupée, zone libre séparées par une ligne de démarcation, Alsace-Moselle annexée de facto par le Reich, et deux départements du Nord sous l'administration militaire allemande de Bruxelles. * En novembre 1942 la zone occupée allemande s'étend : à la zone initiale dite zone Nord s'ajoute la majeure partie de la zone libre dite zone Sud à partir de nov. 1942 ; simultanément l'Italie occupe la plupart des territoires à l'est du Rhône et la Corse ; Philippe Pétain choisit cependant de rester en France et de poursuivre la Collaboration avec l'aide de Pierre Laval, tandis que l'amiral Darlan, alors à Alger, prend le parti des Alliés mais meurt assassiné peu après. * En octobre 1943 les Italiens se retirent, la zone occupée allemande s'étend à tout le pays, mais simultanément la Corse se libère ; la Collaboration s'intensifie. * Durant l'été 1944, à partir du 6 juin, la plus grande partie du territoire est libérée par les forces Alliées et celles de la Résistance : Philippe Pétain et son gouvernement sont alors transportés par les allemands à Sigmaringen.
Après avoir affecté pendant trois mois de rester neutre dans le conflit en cours entre l’Axe et le Royaume-Uni, Pétain engage personnellement et officiellement, par son discours radiodiffusé du 30 octobre 1940, le régime de Vichy dans la collaboration, à la suite de l’entrevue de Montoire du 24 octobre 1940, durant laquelle il rencontra Hitler. Cette poignée de main de Montoire, sera par la suite largement diffusée aux actualités cinématographiques, et exploitée par la propagande allemande.
Certes, l’armistice avait permis, en un premier temps, de limiter l’occupation allemande à la moitié nord et ouest du territoire. Mais l’autonomie de la zone sud est toute relative, car Pétain, avec ou sans discussion préliminaire, plie le plus souvent devant les exigences des autorités allemandes, quand son gouvernement ne va pas spontanément au-devant de celles-ci.
Cette collaboration d’État entraîne plusieurs conséquences. Le maréchal, alors que son prestige reste immense, s’interdit de protester, au moins publiquement, contre les exactions de l’occupant et de ses auxiliaires français ou contre l’annexion de fait, contraire à la convention d’armistice, de l’Alsace et de la Moselle. Aux parlementaires des trois départements, qu’il reçoit le 4 septembre 1942 alors que commence l’incorporation massive et illégale des malgré-nous dans la Wehrmacht, il ne conseille que la résignation. La veille, il avait fait remettre par Laval une protestation officielle, qui resta sans suite. Lors de l’exécution en octobre 1941 des otages français à Châteaubriant, qui soulève l’indignation générale, Pétain a des velléités secrètes de se constituer lui-même comme otage à la Ligne de démarcation, mais son ministre Pierre Pucheu l’en dissuade vite au nom de la politique de collaboration, et le maréchal ne fait finalement de discours que pour blâmer les auteurs d’attentats et appeler les Français à les dénoncer. Au printemps 1944 encore, il ne condamne jamais les déportations, les rafles et les massacres quasi-quotidiens, se taisant par exemple sur le massacre d'Ascq. Par contre, il ne manque pas de dénoncer les crimes terroristes de la Résistance ou les bombardements alliés sur les objectifs civils. Il encourage les membres de la Légion des volontaires français LVF qui combattent en URSS sous l’uniforme allemand, leur garantissant dans un message public qu’ils détiennent une part de notre honneur militaire .
En 1941, le régime de Pétain est de facto en cobelligérance avec l’Allemagne de Hitler lors de la Guerre de Syrie contre les Alliés.
Le général Weygand, connu pour son hostilité à la collaboration, ayant été limogé en novembre 1941, Pétain obtient une entrevue avec Göring à Saint-Florentin le 1er décembre. Mais c'est un échec, les Allemands refusant de céder à ses demandes : extension de la souveraineté de Vichy à toute la France sauf l'Alsace-Lorraine, réduction des frais d'occupation et des prisonniers de guerre et renforcement des moyens militaires de l'Empire.
En avril 1942, sous la pression allemande, mais aussi parce qu’il est déçu des maigres résultats de Darlan, Pétain accepte le retour au pouvoir de Pierre Laval, désormais doté du titre de chef du gouvernement.
Contrairement aux légendes d’après-guerre, il n’existe pas de différence en politique extérieure entre un Vichy de Pétain et un Vichy de Laval, comme l’ont cru André Siegfried, Robert Aron ou Jacques Isorni, et comme l’a démenti toute l’historiographie contemporaine depuis Robert Paxton. S’il n’a aucune affection personnelle pour Laval, le maréchal couvre sa politique de son autorité et de son charisme, et approuve ses orientations en Conseil des ministres. En juin 1942, devant une délégation de visiteurs à Vichy, Pétain tient des propos largement répercutés, assurant qu’il est main dans la main avec Laval, que les ordres de ce dernier sont comme les siens et que tous lui doivent obéissance comme à lui-même. Lors du procès de Pétain, Laval déclarera sans ambiguïté qu’il n’agissait qu’après en avoir déféré au maréchal : tous ses actes avaient été approuvés préalablement par le chef de l’État.
Le 22 juin 1942, Laval prononce un discours retentissant dans lequel il déclare qu’il « souhaite la victoire de l’Allemagne, parce que, sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout. Pétain, à qui il a consenti à montrer préalablement le texte à la demande de ses conseillers effarés, n’a pas élevé d’objection. Du moment que selon le maréchal, un civil n’a pas à faire de pronostic militaire, il s’est contenté de lui faire changer un Je crois initial en un Je souhaite encore plus mal ressenti des Français.
Lorsque Laval informe, fin juin 1942, le Conseil des ministres de la prochaine mise en œuvre de la rafle du Vélodrome d'Hiver, le procès-verbal conservé, montre Pétain approuvant comme juste la livraison de milliers de Juifs aux nazis. Puis le 26 août 1942, la zone sud devint le seul territoire de toute l’Europe d’où des Juifs, souvent internés par Vichy depuis 1940 dans les très durs camps de Gurs, Noé, Rivesaltes, furent envoyés à la mort alors même qu’aucun soldat allemand n’était présent.
Maintenant antisémite, Pétain s’est opposé en mai 1942 à l'introduction en zone Sud du port obligatoire de l’étoile jaune, mais il n’a pas protesté contre son introduction en zone nord, et en zone sud son gouvernement fait apposer le tampon « Juif » sur les papiers d’identité à partir de fin 1942. En août 1943, comme les Allemands pressent Vichy de retirer en bloc la nationalité française aux Juifs, ce qui aurait favorisé leur déportation, le nonce le fait prévenir discrètement que le pape s’inquiète pour l’âme du Maréchal, ce qui impressionne le vieil homme et contribue à l’échec du projet. En tout, 76 000 Juifs parmi lesquels 11 000 enfants, non réclamés au départ par les Allemands, ont été déportés de France sous l’Occupation, à 80 % après avoir été arrêtés par la police du maréchal. Un tiers avait la nationalité française. Seuls 3 % survivront aux déportations dans les camps de concentration.
À ce sujet, l'historien André Kaspi écrit : Tant que la zone libre n'est pas occupée, on y respire mieux pour les Juifs que dans la zone Nord. Qui le nierait ? Surtout pas ceux qui ont vécu cette triste période. De là cette conclusion : Vichy a sacrifié les Juifs étrangers pour mieux protéger les Juifs français, mais sans Pétain, les Juifs de France auraient subi le même sort que ceux de Belgique, des Pays-Bas ou de Pologne. Pendant deux ans, ils ont d'une certaine manière bénéficié de l'existence de l'État français.Pour l'avocat Serge Klarsfeld cet argument tombe lorsque l'on constate l'implication personnelle de Pétain dans la politique antisémite dès octobre 1940.
En août 1942, un télégramme signé Pétain félicite Hitler d’avoir fait échec à la tentative de débarquement allié à Dieppe.
Le 4 septembre 1942, Pétain promulgue la première loi fondant le Service du travail obligatoire. Complété par celle du 16 février 1943, le STO permet en une dizaine de mois le départ forcé de plus de 600 000 travailleurs en Allemagne. Ce sont les seuls de toute l’Europe à avoir été requis non par ordonnance allemande, mais par les lois et les autorités de leur propre pays.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10891#forumpost10891
Posté le : 23/04/2016 17:48
|
|
|
|
|
Philippe Pétain 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Réformes, contrôles et exclusions
Lois contre les Juifs et les étrangers pendant le régime de Vichy.
C'est Grande revanche des minorités. Le régime de Pétain entreprend de régler les vieux comptes des anciens vaincus avec la IIIe République, le Front populaire, le marxisme ou la laïcité. Ce faisant, Pétain aggrave sensiblement les discordes nationales déjà avivées dans les années 1930, et couvre de son autorité un bon nombre de mesures d’exclusion.
Ces mesures sont notamment dirigées contre les Juifs, bien que le maréchal semble avoir été imperméable à l'antisémitisme avant la guerre : il soutint la candidature d'André Maurois à l'Académie française, fut représenté à l'enterrement d'Edmond de Rotschild en 1934, fut témoin au mariage de l'économiste israélite Jacques Rueff en 1937 et le parrain de sa fille en 1938.
Dès la troisième semaine de juillet 1940, ainsi, des mesures sont prises pour écarter des fonctionnaires juifs, et une commission fondée pour réviser et annuler des milliers de naturalisations accordées depuis 1927. En octobre 1940 et sans aucune demande particulière de la part des Allemands, des lois d’exclusion adoptées à la hâte contre les francs-maçons et les Juifs sont promulguées.
Selon le témoignage du ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin, Pétain a personnellement participé à la rédaction du statut des Juifs et insisté pour qu’ils soient par exemple davantage exclus du milieu médical et de l'enseignement. Le brouillon originel de ce texte, qui est redécouvert en octobre 2010, annoté de la main du maréchal, prouvant ainsi son implication personnelle, confirme bien que Pétain a durci la version première et fait étendre l'exclusion à la totalité des Juifs de France, alors qu'elle ne devait concerner d'abord que les Juifs ou descendants de Juifs naturalisés après 1860.
Les textes discriminatoires du 3 octobre 1940 sont durcis le 2 juin 1941 : ils excluent ainsi les Français de race juive déterminée par la religion des grands-parents de la plupart des fonctions et activités publiques. Des quotas sont fixés pour l’admission des Juifs au Barreau, dans le monde universitaire ou médical. Lors du statut du 2 juin, la liste des métiers interdits s’allonge démesurément.
Dans le même temps par une loi du 29 mars 1941, promulguée par le maréchal, est créé un Commissariat général aux questions juives.
Auprès du maréchal se pressent des hommes de tous bords, mêlant de façon baroque, au sein de sa dictature pluraliste, des technocrates modernistes et des révolutionnaires déçus du marxisme aussi bien que des maurrassiens et des réactionnaires. Pétain cependant manifeste personnellement des orientations proches de L’Action française seul journal qu’il lise quotidiennementet cite surtout en exemple à ses proches les régimes conservateurs et cléricaux de Salazar et de Franco, qu’il connaît personnellement depuis 1939.
Parallèlement au développement d’un pouvoir centralisé, le maréchal se consacre au relèvement de la France : rapatriement des réfugiés, démobilisation, ravitaillement, maintien de l’ordre. Mais loin de se limiter à gérer les affaires courantes et à assurer la survie matérielle des populations, son régime est le seul en Europe à développer un programme de réformes intérieures, indépendant des demandes allemandes.
Certaines mesures prises à cette époque ont survécu, comme la création d’un ministère de la Reconstruction, l’unification du permis de construire, la naissance de l’IGN en juillet 1940, l’étatisation des polices municipales en vue de faciliter le contrôle des populations, ou encore une politique familiale, déjà amorcée par la IIIe République finissante et prolongée sous la IVe République. D’autres dispositions sont adoptées : campagne contre l’alcoolisme, interdiction de fumer dans les salles de spectacle, inscription de la fête des Mères au calendrier. D’autres encore portent la marque des projets réactionnaires du chef de l’État, comme la pénalisation de l'homosexualité. De nombreux étrangers supposés en surnombre dans l’économie française sont incorporés de force dans des Groupes de travailleurs étrangers GTE. Les Écoles normales, bastion de l’enseignement laïc et républicain, sont supprimées. Les lois des 11 et 27 octobre 1940 contre l’emploi des femmes en renvoient des milliers au foyer de gré ou de force. Le divorce est rendu nettement plus difficile, et le nombre de poursuites judiciaires et de condamnations pour avortement explose littéralement par rapport à l’entre-deux-guerres. En 1943, Pétain refuse de gracier une avorteuse condamnée à mort, qui est guillotinée. Autre rupture avec la IIIe République, les rapports étroits noués avec les Églises : Pétain, personnellement peu croyant, voit comme Maurras en la religion un facteur d’ordre, et ne manque pas d’assister à chaque messe dominicale à l’église Saint-Louis de Vichy.
Dans l’optique de la restauration de la France, le régime de Vichy crée très tôt, sous la direction de Joseph de La Porte du Theil, un fidèle très proche du maréchal Pétain, des camps de formation qui deviendront plus tard les Chantiers de la jeunesse française. L’idée est de réunir toute une classe d’âge en remplacement du service militaire désormais supprimé, et, à travers une vie au grand air, par des méthodes proches du scoutisme, leur inculquer les valeurs morales du nouveau régime culte de la hiérarchie, rejet de la ville industrielle corruptrice, ainsi que la vénération à l’égard du chef de l’État.
D’autres moyens de contrôle sont également mis en place dans le domaine économique, comme les Comités professionnels d’organisation et de répartition, ayant un pouvoir de juridiction sur leurs membres ou un pouvoir de répartition des matières premières, pouvoir capital en ces temps de restrictions généralisées.
À destination des ouvriers, Pétain prononce le 1er mai 1941 un important discours à Saint-Étienne, où il expose sa volonté de mettre fin à la lutte des classes en prohibant à la fois le capitalisme libéral et la révolution marxiste. Il énonce les principes de la future Charte du travail, promulguée en octobre 1941. Celle-ci interdit à la fois les grèves et le lock-out, instaure le système du syndicat unique et le corporatisme, mais met aussi en place des comités sociaux préfiguration des comités d'entreprise et prévoit la notion de salaire minimum. La Charte séduit de nombreux syndicalistes et théoriciens de tous bords René Belin, Hubert Lagardelle. Mais elle peine à entrer en application, et ne tarde pas à se briser sur l’hostilité de la classe ouvrière au régime et à ces idées, l’aggravation des pénuries, l’instauration du Service du travail obligatoire STO en septembre 1942, et enfin sur la lutte menée contre elle par les syndicats clandestins de la Résistance intérieure française.
Véritables enfants chéris de Vichy, les paysans passent cependant longtemps pour les vrais bénéficiaires du régime de Pétain. Lui-même propriétaire terrien en sa résidence de Villeneuve-Loubet, le maréchal affirme que la terre, elle, ne ment pas, et encourage le retour à la Terre - politique soldée sur un échec, moins de 1 500 personnes en quatre ans tentant de suivre ses conseils. La Corporation paysanne est fondée par une loi du 2 décembre 1940. Une partie des membres se détache du régime fin 1943 et lui font aussi servir de base à la création d'un syndicalisme paysan clandestin fin 1943, la Confédération générale de l'agriculture CGA qui voit le jour officiellement le 12 octobre 1944, lors de la dissolution de la Corporation paysanne par les autorités et qui se prolongera sous la forme de la FNSEA en 1946
Développant fréquemment et complaisamment la vision doloriste d’une France décadente qui expie maintenant ses fautes antérieures, Pétain entretient les Français dans une mentalité de vaincu : Je ne cesse de me rappeler tous les jours que nous avons été vaincus à une délégation, mai 1942, et manifeste un souci particulier pour les soldats prisonniers, images mêmes de la défaite et de la souffrance : Je pense à eux parce qu’ils souffrent …, Noël 1941. Selon son chef de cabinet, du Moulin de Labarthète, le tiers du temps de travail quotidien du maréchal était consacré aux prisonniers. De ces derniers, Vichy rêvait de faire les propagateurs de la Révolution Nationale à leur retour.
De la Légion à la Milice
La période consécutive à l’armistice voit aussi la création de la Légion française des combattants LFC, à laquelle sont ensuite agrégés les Amis de la Légion et les Cadets de la Légion. Fondée par le très antisémite Xavier Vallat le 29 août 1940, elle est présidée par le maréchal Pétain en personne. Pour Vichy, elle doit servir de fer de lance de la Révolution nationale et du régime. À côté des parades, des cérémonies et de la propagande, les Légionnaires actifs doivent surveiller la population, et dénoncer les déviants et les fautifs de mauvais esprit.
Au sein de cette légion se constitue un Service d’ordre légionnaire SOL qui s’engage immédiatement dans la voie du collaborationnisme. Cet organisme est commandé par Joseph Darnand, héros de la Première Guerre mondiale et de la campagne de 1940, et fervent partisan de Pétain sollicité en 1941 de joindre la Résistance, il refuse, selon le témoignage de Claude Bourdet, parce que le Maréchal ne comprendrait pas. Ce même organisme devient en janvier 1943 la Milice française. À la fin de la guerre, alors que Vichy est devenu un régime fantoche aux ordres des Allemands, la Milice qui compte au maximum 30 000 hommes, dont beaucoup d’aventuriers et de droit-communs, participe activement à la lutte contre la Résistance, avec les encouragements publics du maréchal Pétain comme de Pierre Laval, son président officiel. Haïe de la population, la Milice perpètre régulièrement délations, tortures, rafles, exécutions sommaires, qui se mêlent à d’innombrables vols, viols, voies de faits sur la voie publique ou contre des fonctionnaires.
Pétain attend le 6 août 1944 pour les désavouer dans une note à Darnand, trop tardivement pour que ce dernier soit dupe. Pendant quatre ans, rappellera Darnand dans sa réponse caustique au maréchal, vous m’avez encouragé au nom du bien de la France, et maintenant que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tache de l’Histoire de France. On aurait pu s’y prendre avant !
La collaboration d’État
Sur le plan de la politique extérieure, Pétain a retiré d’emblée le pays du conflit mondial en cours, et affecte de croire que ce dernier ne concerne plus du tout la France. S’il refuse jusqu’au bout toute rentrée dans la guerre aux côtés d’un des deux camps, il ne refuse pourtant pas le combat contre les alliés chaque fois qu'il en a l'occasion et annonce dès octobre 1940, son intention de reprendre par la force les territoires sous autorité de la France libre. Il pratique donc une neutralité dissymétrique qui bénéficie aux Allemands. Il choisit en effet de s’entendre avec le vainqueur et imagine que la France, avec son Empire colonial, sa flotte et sa bonne volonté à coopérer, peut obtenir une bonne place dans une Europe durablement allemande. Ceci peut être perçu comme une certaine naïveté de la part de Pétain : dans l’idéologie nazie, la France était en effet l’ennemie irréductible de l’Allemagne, elle devait être écrasée et ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une quelconque place privilégiée à ses côtés.
Il est bien établi, depuis les travaux d'Eberhard Jäckel et surtout de Robert Paxton, que Pétain a activement recherché et poursuivi cette collaboration avec l’Allemagne nazie. Elle ne lui a pas été imposée. Moins intéressé par la politique extérieure que par la Révolution nationale, sa vraie priorité, Pétain laisse Darlan et Laval mettre en œuvre les volets concrets de la collaboration d’État. Mais l’une est en réalité le revers de l’autre, selon les constats concordants de l’historiographie contemporaine : les réformes vichystes n’ont pu se mettre en place qu’en profitant du retrait de la France de la guerre, et elles ne sauraient survivre à une victoire alliée. Par ailleurs, le mythe Pétain134 » est indispensable pour faire accepter à bien des Français la collaboration. Le prestige du vainqueur de Verdun, son pouvoir légal sinon légitime, brouillent en effet dans les consciences en désarroi la perception des devoirs et des priorités.
L’homme de Montoire Pétain et Hitler à Montoire, le 24 octobre 1940.
Situation de la France sous le gouvernement de Philippe Pétain : * En juillet 1940, selon les accords de Montoire, le pays est coupé en quatre : zone occupée, zone libre séparées par une ligne de démarcation, Alsace-Moselle annexée de facto par le Reich, et deux départements du Nord sous l'administration militaire allemande de Bruxelles. * En novembre 1942 la zone occupée allemande s'étend : à la zone initiale dite zone Nord s'ajoute la majeure partie de la zone libre dite zone Sud à partir de nov. 1942 ; simultanément l'Italie occupe la plupart des territoires à l'est du Rhône et la Corse ; Philippe Pétain choisit cependant de rester en France et de poursuivre la Collaboration avec l'aide de Pierre Laval, tandis que l'amiral Darlan, alors à Alger, prend le parti des Alliés mais meurt assassiné peu après. * En octobre 1943 les Italiens se retirent, la zone occupée allemande s'étend à tout le pays, mais simultanément la Corse se libère ; la Collaboration s'intensifie. * Durant l'été 1944, à partir du 6 juin, la plus grande partie du territoire est libérée par les forces Alliées et celles de la Résistance : Philippe Pétain et son gouvernement sont alors transportés par les allemands à Sigmaringen.
Après avoir affecté pendant trois mois de rester neutre dans le conflit en cours entre l’Axe et le Royaume-Uni, Pétain engage personnellement et officiellement, par son discours radiodiffusé du 30 octobre 1940, le régime de Vichy dans la collaboration, à la suite de l’entrevue de Montoire du 24 octobre 1940, durant laquelle il rencontra Hitler. Cette poignée de main de Montoire, sera par la suite largement diffusée aux actualités cinématographiques, et exploitée par la propagande allemande.
Certes, l’armistice avait permis, en un premier temps, de limiter l’occupation allemande à la moitié nord et ouest du territoire. Mais l’autonomie de la zone sud est toute relative, car Pétain, avec ou sans discussion préliminaire, plie le plus souvent devant les exigences des autorités allemandes, quand son gouvernement ne va pas spontanément au-devant de celles-ci.
Cette collaboration d’État entraîne plusieurs conséquences. Le maréchal, alors que son prestige reste immense, s’interdit de protester, au moins publiquement, contre les exactions de l’occupant et de ses auxiliaires français ou contre l’annexion de fait, contraire à la convention d’armistice, de l’Alsace et de la Moselle. Aux parlementaires des trois départements, qu’il reçoit le 4 septembre 1942 alors que commence l’incorporation massive et illégale des malgré-nous dans la Wehrmacht, il ne conseille que la résignation. La veille, il avait fait remettre par Laval une protestation officielle, qui resta sans suite. Lors de l’exécution en octobre 1941 des otages français à Châteaubriant, qui soulève l’indignation générale, Pétain a des velléités secrètes de se constituer lui-même comme otage à la Ligne de démarcation, mais son ministre Pierre Pucheu l’en dissuade vite au nom de la politique de collaboration, et le maréchal ne fait finalement de discours que pour blâmer les auteurs d’attentats et appeler les Français à les dénoncer. Au printemps 1944 encore, il ne condamne jamais les déportations, les rafles et les massacres quasi-quotidiens, se taisant par exemple sur le massacre d'Ascq. Par contre, il ne manque pas de dénoncer les crimes terroristes de la Résistance ou les bombardements alliés sur les objectifs civils. Il encourage les membres de la Légion des volontaires français LVF qui combattent en URSS sous l’uniforme allemand, leur garantissant dans un message public qu’ils détiennent une part de notre honneur militaire .
En 1941, le régime de Pétain est de facto en cobelligérance avec l’Allemagne de Hitler lors de la Guerre de Syrie contre les Alliés.
Le général Weygand, connu pour son hostilité à la collaboration, ayant été limogé en novembre 1941, Pétain obtient une entrevue avec Göring à Saint-Florentin le 1er décembre. Mais c'est un échec, les Allemands refusant de céder à ses demandes : extension de la souveraineté de Vichy à toute la France sauf l'Alsace-Lorraine, réduction des frais d'occupation et des prisonniers de guerre et renforcement des moyens militaires de l'Empire.
En avril 1942, sous la pression allemande, mais aussi parce qu’il est déçu des maigres résultats de Darlan, Pétain accepte le retour au pouvoir de Pierre Laval, désormais doté du titre de chef du gouvernement.
Contrairement aux légendes d’après-guerre, il n’existe pas de différence en politique extérieure entre un Vichy de Pétain et un Vichy de Laval, comme l’ont cru André Siegfried, Robert Aron ou Jacques Isorni, et comme l’a démenti toute l’historiographie contemporaine depuis Robert Paxton. S’il n’a aucune affection personnelle pour Laval, le maréchal couvre sa politique de son autorité et de son charisme, et approuve ses orientations en Conseil des ministres. En juin 1942, devant une délégation de visiteurs à Vichy, Pétain tient des propos largement répercutés, assurant qu’il est main dans la main avec Laval, que les ordres de ce dernier sont comme les siens et que tous lui doivent obéissance comme à lui-même. Lors du procès de Pétain, Laval déclarera sans ambiguïté qu’il n’agissait qu’après en avoir déféré au maréchal : tous ses actes avaient été approuvés préalablement par le chef de l’État.
Le 22 juin 1942, Laval prononce un discours retentissant dans lequel il déclare qu’il « souhaite la victoire de l’Allemagne, parce que, sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout. Pétain, à qui il a consenti à montrer préalablement le texte à la demande de ses conseillers effarés, n’a pas élevé d’objection. Du moment que selon le maréchal, un civil n’a pas à faire de pronostic militaire, il s’est contenté de lui faire changer un Je crois initial en un Je souhaite encore plus mal ressenti des Français.
Lorsque Laval informe, fin juin 1942, le Conseil des ministres de la prochaine mise en œuvre de la rafle du Vélodrome d'Hiver, le procès-verbal conservé, montre Pétain approuvant comme juste la livraison de milliers de Juifs aux nazis. Puis le 26 août 1942, la zone sud devint le seul territoire de toute l’Europe d’où des Juifs, souvent internés par Vichy depuis 1940 dans les très durs camps de Gurs, Noé, Rivesaltes, furent envoyés à la mort alors même qu’aucun soldat allemand n’était présent.
Maintenant antisémite, Pétain s’est opposé en mai 1942 à l'introduction en zone Sud du port obligatoire de l’étoile jaune, mais il n’a pas protesté contre son introduction en zone nord, et en zone sud son gouvernement fait apposer le tampon « Juif » sur les papiers d’identité à partir de fin 1942. En août 1943, comme les Allemands pressent Vichy de retirer en bloc la nationalité française aux Juifs, ce qui aurait favorisé leur déportation, le nonce le fait prévenir discrètement que le pape s’inquiète pour l’âme du Maréchal, ce qui impressionne le vieil homme et contribue à l’échec du projet. En tout, 76 000 Juifs parmi lesquels 11 000 enfants, non réclamés au départ par les Allemands, ont été déportés de France sous l’Occupation, à 80 % après avoir été arrêtés par la police du maréchal. Un tiers avait la nationalité française. Seuls 3 % survivront aux déportations dans les camps de concentration.
À ce sujet, l'historien André Kaspi écrit : Tant que la zone libre n'est pas occupée, on y respire mieux pour les Juifs que dans la zone Nord. Qui le nierait ? Surtout pas ceux qui ont vécu cette triste période. De là cette conclusion : Vichy a sacrifié les Juifs étrangers pour mieux protéger les Juifs français, mais sans Pétain, les Juifs de France auraient subi le même sort que ceux de Belgique, des Pays-Bas ou de Pologne. Pendant deux ans, ils ont d'une certaine manière bénéficié de l'existence de l'État français.Pour l'avocat Serge Klarsfeld cet argument tombe lorsque l'on constate l'implication personnelle de Pétain dans la politique antisémite dès octobre 1940.
En août 1942, un télégramme signé Pétain félicite Hitler d’avoir fait échec à la tentative de débarquement allié à Dieppe.
Le 4 septembre 1942, Pétain promulgue la première loi fondant le Service du travail obligatoire. Complété par celle du 16 février 1943, le STO permet en une dizaine de mois le départ forcé de plus de 600 000 travailleurs en Allemagne. Ce sont les seuls de toute l’Europe à avoir été requis non par ordonnance allemande, mais par les lois et les autorités de leur propre pays.
Après le tournant de novembre 1942
Lorsque les Alliés débarquent en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, au Maroc, à Oran et dans le port d'Alger, Pétain donne officiellement l’ordre de les combattre, en déclarant : La France et son honneur sont en jeu. Nous sommes attaqués. Nous nous défendons. C'est l'ordre que je donne. L'existence même de Vichy est alors en cause : si les forces de Vichy ne résistent pas à l'invasion alliée, les Allemands envahiront inéluctablement la France non occupée et le reste de l'Afrique du Nord. Pendant quelques jours, les Alliés doivent donc faire face à une authentique résistance de la part de l'Armée de Vichy, obéissant aux ordres de ses chefs.
En réaction à ce débarquement, le 11 novembre, violant la convention d’armistice, les Allemands envahissent la zone sud. Pétain refuse l'idée de plusieurs de ses proches conseillersQui ? de gagner l'Afrique du Nord, d'ordonner à la flotte de Toulon d’appareiller, de replacer la France dans le camp des Alliés. Pour justifier sa décision, il va en privé jusqu'à invoquer que son médecin lui a déconseillé de prendre l’avion… Il veut surtout pouvoir continuer à « servir d'écran entre le peuple de France et l'occupant. Il proteste contre cette invasion par une déclaration plusieurs fois diffusée sur les ondes. En fait, soulignent Robert Paxton et R. Franck, il reste fidèle à son choix de 1940, associant étroitement retrait de la guerre, collaboration et Révolution nationale.
Sa décision déçoit d'innombrables Français qui croyaient encore en un hypothétique double jeu secret du maréchal et s'imaginaient qu'il souhaitait en secret préparer la reprise de la lutte et la revanche contre l'ennemi. Nombre d’entre eux se détachent du régime de Vichy tout en conservant généralement leur respect pour la personne du maréchal Pétain et vont parfois gonfler les rangs clandestins des « vichysto-résistantsinspirés notamment par les généraux Giraud et de Lattre de Tassigny. Le surnom de Maréchal Pétoche, dont certains l’avaient affublé, se répand.
La dissidence de la plus grande partie de l'Empire, la fin de la zone libre, le sabordage de la flotte française à Toulon, le 27 novembre 1942, la dissolution de l’armée d'armistice font perdre à Vichy ses derniers atouts face aux Allemands. En maintenant sa politique de collaboration, Pétain perd beaucoup de la popularité dont il jouissait depuis 1940, et la Résistance s’intensifie malgré le durcissement de la répression.
Pétain fait officiellement déchoir de la nationalité française et condamner à mort ses anciens fidèles François Darlan et Henri Giraud, qui sont passés au camp allié en Afrique du Nord. Il ne proteste à aucun moment lorsque fin 1942, puis à nouveau à l’automne 1943, une vague d'arrestations frappe son propre entourage et écarte de lui un nombre important de conseillers et de fidèles dont Maxime Weygand, Lucien Romier ou Joseph de La Porte du Theil, interné en Allemagne. Il consent des délégations croissantes de pouvoirs à Pierre Laval, redevenu son dauphin, qui place ses fidèles à tous les postes-clés et qui obtient de lui, à partir du 26 novembre 1942, de signer seuls les lois et les décrets.
Fin 1943, voyant le sort de l’Axe scellé, Pétain tente de jouer en France le rôle du maréchal Badoglio en Italie, lequel en septembre 1943, après avoir longtemps servi le fascisme, a fait passer le pays du côté allié. Pétain espère ainsi qu’un nouveau gouvernement moins compromis aux yeux des Américains, doté d’une nouvelle constitution pourra, au jour J, écarter de Gaulle du jeu et négocier avec les libérateurs l’impunité de Vichy et la ratification de ses actes.
Le 12 novembre 1943, alors que Pétain s'apprête à prononcer le lendemain un discours radiodiffusé par lequel il annoncerait à la nation une révision constitutionnelle stipulant qu'il revient à l'Assemblée nationale de désigner son successeur, ce qui aurait remis en cause le statut officiel de dauphin de Laval, les Allemands, par l'intermédiaire du consul général Krug von Nidda, bloquent ce projet.
Après six semaines de grève du pouvoir, Pétain se soumet. Le projet de constitution républicaine fut finalisé et approuvé par Pétain le 30 janvier 1944 Projet de constitution du 30 janvier 1944 mais il ne fut jamais promulgué. Pétain accrut encore les pouvoirs de Laval tout en acceptant la fascisation progressive de son régime par l’entrée au gouvernement de Joseph Darnand, Philippe Henriot et Marcel Déat 1er janvier, 6 janvier et 16 mars 1944.
Dans les derniers mois de l’Occupation, Pétain affecte désormais d’être un simple prisonnier des Allemands, tout en continuant à couvrir en fait de son autorité et de son silence la collaboration qui se poursuit jusqu’au bout, ainsi que les atrocités de l’ennemi et de la Milice française. En août 1944, il songe à se livrer au maquis d’Auvergne du colonel Gaspard, et tente de déléguer l’amiral Auphan auprès de De Gaulle pour lui transmettre régulièrement le pouvoir sous réserve que le nouveau gouvernement reconnaisse la légitimité de Vichy et de ses actes. Aucune réponse ne fut donnée à ce monument de candeur.
Sigmaringen
Le 17 août 1944, les Allemands, en la personne de Cecil von Renthe-Fink, ministre délégué, demandent à Pétain de se laisser transférer en zone nord. Celui-ci refuse et demande une formulation écrite de cette demande. Von Renthe-Fink renouvelle sa requête par deux fois le 18, puis revient le 19, à 11 h 30, accompagné du général von Neubroon qui lui indique qu'il a des ordres formels de Berlin. Le texte écrit est soumis à Pétain : Le gouvernement du Reich donne instruction d’opérer le transfert du chef de l’État, même contre sa volonté. Devant le refus renouvelé du maréchal, les Allemands menacent de faire intervenir la Wehrmacht pour bombarder Vichy. Après avoir pris à témoin le ministre de Suisse, Walter Stucki, du chantage dont il est l’objet, Pétain se soumet, et … lorsqu'à 19 h 30 Renthe-Fink entre dans le bureau du Maréchal, à l'hôtel du Parc, avec le général von Neubronn, le chef de l’État est en train de surveiller la confection de ses valises et de ranger ses papiers. Le lendemain, 20 août 1944, il est emmené contre son gré par l’armée allemande à Belfort puis, le 8 septembre, à Sigmaringen en Allemagne, où s’étaient réfugiés les dignitaires de son régime. Plutôt que de démissionner, il entretient, dans une lettre aux Français la fiction selon laquelle je suis et demeure moralement votre chef.
À Sigmaringen, Pétain refuse d’exercer encore ses fonctions et de participer aux activités de la commission gouvernementale présidée par Fernand de Brinon. Il se cloître dans ses appartements, tout en préparant sa défense après avoir appris que la Haute Cour de Justice française se dispose à le mettre en accusation par contumace
Arrestation et retour en France du maréchal Pétain.
Le 23 avril 1945, après avoir obtenu des Allemands qu'ils le conduisent en Suisse, et des Suisses qu'ils l'acceptent sur leur territoire, Pétain demande à regagner la France. Par l'intermédiaire du ministre Karl Burckhardt, le gouvernement suisse transmet cette requête au général de Gaulle. Le gouvernement provisoire de la République décide de ne pas s'y opposer. Le 24 avril, les autorités suisses lui font rejoindre la frontière puis il est remis aux autorités françaises le 26 avril. Le général Kœnig est chargé de le prendre en charge à Vallorbe. Le maréchal est ensuite interné au fort de Montrouge.
Procès et emprisonnement
Le procès du maréchal Pétain débute le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de justice créée le 18 novembre 1944. Après que six autres magistrats se sont récusés, le tribunal est présidé par Paul Mongibeaux, premier président de la Cour de cassation, assisté du président de la chambre criminelle à la Cour de cassation Donat-Guigne, et Picard, premier président de la Cour d'appel. Tous trois avaient prêté serment de fidélité au maréchal. Le ministère public est représenté par le procureur général André Mornet, président honoraire de la Cour de cassation. Le jury de vingt-quatre personnes est constitué de douze parlementaires et quatre suppléants et de douze non-parlementaires issus de la Résistance et quatre suppléants. Ce jury est choisi dans deux listes, la première étant celle de cinquante parlementaires n'ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, la deuxième étant composée de personnalités de la Résistance ou proches d'elle. La défense use de son droit de récusation pour quelques noms sortant du tirage au sort, notamment Robert Pimienta et Lucie Aubrac.
Après récusations de la défense, les jurés sont :
pour les parlementaires : Gabriel Delattre, Émile Bender, Georges Lévy-Alphandéry, Michel Tony-Révillon, Émile Bèche, Adrien Mabrut, Louis Prot, René Renoult, Jean Pierre-Bloch, Pétrus Faure, Paul Sion, Léandre Dupré, Camille Catalan suppléant, Jammy Schmidt suppléant, Joseph Rous suppléant et Eugène Chassaing suppléant
pour les non-parlementaires : Henri Seignon, Jacques Lecompte-Boinet, Lorignet, Roger Lescuyer, Roger Gervolino, Maurice Guérin, Jean Guy, Ernest Perney, Pierre Meunier, Pierre Stibbe, Dr Porcher, Marcel Bergeron, Georges Poupon suppléant, Jean Worms dit Germinal suppléant, Marcel Levêque suppléant, Gilbert Destouches suppléant
Défendu par Jacques Isorni, Jean Lemaire et le bâtonnier Fernand Payen, Philippe Pétain déclare le premier jour qu’il avait toujours été un allié caché du général de Gaulle et qu’il n’était responsable que devant la France et les Français qui l’avaient désigné et non devant la Haute Cour de justice. Dans ces conditions, il ne répondra pas aux questions qui lui seront posées. Viennent déposer de nombreuses personnalités en tant que témoins soit à charge : Édouard Daladier, Paul Reynaud, Léon Blum, Pierre Laval, soit à décharge : le général Weygand, le pasteur Marc Boegner, ou encore l’aumônier des prisonniers de guerre Jean Rodhain, seul homme d'Église à témoigner à décharge.
Le procès s’achève le 15 août 1945 à l’aube. La cour déclare Pétain coupable, notamment, d’intelligence avec l’ennemi et de haute trahison. Elle le condamne à mort, à la dégradation nationale, et à la confiscation de ses biens, assortissant toutefois ces condamnations du vœu de non-exécution de la sentence de mort, en raison de son grand âge,. La condamnation a été votée à une voix de majorité.
Le verdict de la Haute Cour de justice frappe d'indignité nationale Philippe Pétain ; cette décision, interprétée stricto sensu, lui retirant son rang dans les forces armées et son droit à porter ses décorations. Le titre de maréchal de France étant une dignité et non un grade, ses partisans considèrent que Philippe Pétain conserva ce titre après sa condamnation. À la fin du procès, il se dépouille de son uniforme avant d'être incarcéré, mais c’est avec ce même uniforme qu’il fut inhumé en 1951.
Cependant certains considèrent qu’il fut, de facto, déchu de sa dignité et qu’il convient, comme le font les historiens d'aujourd'hui, de le nommer simplement Philippe Pétain , en particulier pour la période qui suit sa condamnation du 15 août 1945, ou encore l’ex-maréchal Pétain.
Accomplissant le vœu de la Haute Cour de justice, le général de Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République, commue la sentence de mort en peine de réclusion à perpétuité le 17 août 1945. Compte tenu de la peine de dégradation nationale article 21 de l'ordonnance du 26 décembre 1944, le maréchal Pétain est exclu automatiquement de l'Académie française l'ordonnance prévoit l'exclusion de l'Institut. Toutefois, celle-ci s’abstient d’élire un remplaçant de son vivant au 18e fauteuil, égard auquel a également eu droit Charles Maurras tandis qu’Abel Bonnard et Abel Hermant sont remplacés dès 1946.
Philippe Pétain est emprisonné au fort du Portalet, dans les Pyrénées, du 15 août au 16 novembre 1945, puis transféré au fort de la Citadelle sur L'Île-d'Yeu Vendée. Son épouse installée à son tour dans l’île, bénéficie d’un droit de visite quotidien. La santé de Philippe Pétain décline à partir du début de l’année 1951, les moments de lucidité devenant de plus en plus rares. Après avoir pris position en ce sens dès 1949, le 26 mai 1951 à Oran, dans un discours prononcé place d'Armes devant une foule d'environ 8 000 personnes, le général de Gaulle déclare qu'« il est lamentable pour la France, au nom du passé et de la réconciliation nationale indispensable, qu'on laisse mourir en prison le dernier Maréchal. Eu égard à cette situation, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Vincent Auriol, président de la République, en vue d’adoucir une fin prévisible, autorise le 8 juin 1951 l’élargissement du prisonnier et son assignation à résidence dans un établissement hospitalier ou tout autre lieu pouvant avoir ce caractère. Le transfert dans une maison privée de Port-Joinville a lieu le 29 juin 1951, où Philippe Pétain meurt le 23 juillet 1951. Veillé par Jean Rodhain, il est inhumé le surlendemain dans le cimetière marin de l’île d’Yeu.
Tombe
La translation de la dépouille du maréchal Pétain est réclamée à plusieurs reprises par l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain ADMP à partir de 1951, au nom de la réconciliation nationale. Elle organise notamment une pétition en ce sens en mai 1954, soutenue par de très nombreuses associations d'anciens combattants de 1914-1918, qui recueille près de 70 000 signatures. Il s'agit en fait, selon l'analyse d'Henry Rousso, d'oublier le maréchal de 1940 au profit du général de 1916, d'utiliser la mémoire des anciens combattants de la Grande Guerre, pour qui Pétain reste l'homme du On les aura !, au profit d'une idéologie.
Le 19 février 1973, à 2 heures du matin, le cercueil du maréchal Pétain est enlevé par des membres de l’extrême droite, à l'instigation de Tixier-Vignancour, ancien de l’OAS, afin d’opérer le transfert de sa dépouille à l'ossuaire de Douaumont Verdun. Ce transfert correspond à un souhait de Pétain, tel qu’écrit dans son testament de 1938, qui souhaitait reposer auprès des centaines de milliers de soldats français qui y sont tombés. Malgré les précautions prises, l'enlèvement est découvert. Le commando dissimule alors le cercueil sur un parking de Saint-Ouen tandis que Tixier-Vignancour tente de négocier un transfert aux Invalides. Hubert Massol, le chef du commando se rend finalement le 21 février après l'arrestation de ses complices. Une fois le cercueil revenu à l'Île d'Yeu, la tombe est cette fois bétonnée.
La tombe de Philippe Pétain est fleurie au nom de la présidence de la République le 10 novembre 1968 sous le général de Gaulle, à l'occasion du 50e anniversaire de l'armistice de 1918, en février 1973 sous Georges Pompidou, à la suite de la profanation de la tombe située à L'Île-d'Yeu et en 1978 sous Valéry Giscard d'Estaing, 60e commémoration de la victoire de 1918. Pendant la présidence de François Mitterrand, elle est fleurie le 22 septembre 1984 jour de la rencontre avec le chancelier Helmut Kohl à Verdun, puis le 15 juin 1986 70e anniversaire de la bataille de Verdun, puis chaque 11 novembre entre 1987 et 1992. Cette pratique ne cesse qu’après de nombreuses protestations dont celles de la communauté juive.
François Mitterrand, comme les apologistes de la mémoire de Pétain, ayant déclaré qu’ils honoraient simplement la mémoire de l’homme de Verdun et nullement celle du chef de l’État français, l’ancien premier ministre Laurent Fabius fit remarquer que lorsque l’on juge un homme, on le fait sur l’ensemble de sa vie. Quant à l’historien André Kaspi, il souligna l’artificialité de cette distinction : Le Pétain collaborateur de 1940-1944 n’a pu égarer les Français et en convaincre bon nombre de le suivre que parce qu’il bénéficiait du prestige du Pétain de 1914-1918. L’un n’aurait pas existé sans l’autre.
Sa sépulture fut de nouveau profanée en 2007.
Les Français face à Philippe Pétain Avant 1940
Militaire à la réussite tardive, Pétain doit son premier prestige moins à son rôle à Verdun qu’à sa gestion de la crise du moral en 1917. En arrêtant les offensives inutilement meurtrières, et en libéralisant le régime des permissions, il gagne et conserve auprès des hommes et jusque dans certains cercles pacifistes la réputation d’un chef compréhensif et soucieux d’épargner le sang des soldats. Même si certains rappellent pour l’exalter ou pour le dénoncer son rôle de fusilleur des mutins de 1917, c’est cette réputation qui se maintient pendant l’entre-deux-guerres.
Contrairement à une légende vivace mais qui a énormément contribué sous l’Occupation à sa grande popularité, Pétain n’a pas été providentiellement sorti du placard alors qu’il ne demandait rien en 1940 à 84 ans ; il est même excessif de dire qu’il a alors repris du service, comme le croiront beaucoup de Français. Son entre-deux-guerres est en effet celle d’un homme reconnu et tout à fait actif : fait maréchal en 1918, il est, après 1934, le dernier titulaire de la prestigieuse dignité dans l'État, avec Franchet d'Esperey ; membre de l’Académie française, inspecteur général de l’Armée, très influent sur la doctrine militaire, il est un éphémère ministre de la Guerre en 1934 puis ambassadeur de France en Espagne en 1939. Il apparaît déjà à certains, comme un recours possible.
Pendant ces années, il évite de prendre des partis-pris trop tranchés, ce qui lui ménage même dans les milieux républicains voire de gauche la réputation d’un militaire modéré et politiquement fiable. Peu clérical au contraire d’un Foch ou d’un Castelnau, il ne se mêle pas de la crise de 1924, où ce dernier prend la tête d’un mouvement de masse contre l’anticléricalisme du gouvernement Herriot ; il évite de dénoncer en public le Front populaire et l’Espagne républicaine ; il est informé du complot de la Cagoule visant à renverser la République et à porter un militaire prestigieux lui-même ou Franchet d’Esperey à la tête de l’État, mais se garde de s’y compromettre 1937. En 1939, lorsqu’il est nommé ambassadeur auprès de Franco, Léon Blum proteste dans Le Populaire qu’on envoie au dictateur espagnol ce que nous avons de meilleur. Seul le colonel de Gaulle soupçonne qu’il prend goût au pouvoir, et confie : Il accepterait n’importe quoi, tant le gagne l’ambition sénile.
En mai 1940, Paul Reynaud ne se méfie pas davantage de Pétain quand il l’appelle à la vice-présidence du Conseil. Or, après s’être d’abord longuement tu, Pétain prend la tête des partisans de l’armistice.
Maréchalistes, pétainistes et opinion pendant l’Occupation
Il est hors de doute qu’une majorité de Français, sonnés par la déroute d’une armée qu’ils croyaient invincible, a accueilli l’armistice comme un soulagement, de même que le maintien d’un gouvernement français dirigé par un sauveur providentiel et susceptible à leurs yeux de faire écran entre eux et l’occupant. Très peu ont perçu sur le coup que le retrait de la guerre condamnait le pays à une longue occupation nécessitant l’entente avec le vainqueur. Par ailleurs, souligne Olivier Wieviorka, ni l’essentiel des Français ni la majorité des parlementaires à lui voter les pleins pouvoirs ne voulaient lui donner ainsi mandat pour exclure les Juifs, briser l’unité nationale ou atteler la France au char allemand.
Contrairement à une légende encore tenace, il n’y a pas eu non plus en 1940 quarante millions de pétainistes qui seraient devenus en 1944 quarante millions de gaullistes183.
La distinction de Stanley Hoffmann entre maréchalistes et pétainistes s’est imposée en effet à l’historiographie contemporaine. Les maréchalistes font confiance à Pétain comme bouclier des Français. Beaucoup plus minoritaires, les pétainistes approuvent en plus son idéologie réactionnaire et sa politique intérieure, voire la collaboration d’État.
Nombre de résistants de la première heure furent ainsi un temps maréchalistes par erreur, croyant que Pétain jouait double-jeu et qu’en préparant la revanche, ils répondaient à ses vœux secrets. Henri Frenay ou le journal clandestin Défense de la France citent ainsi élogieusement Pétain en 1941-1942, avant de revenir de leurs illusions et de dénoncer son rôle comme équivoque et néfaste.
D’autres encore, les vichysto-résistants, ont participé au régime de Vichy et à la mise en œuvre de sa politique avant de se détourner de lui surtout après novembre 1942, tout en gardant leur respect pour Pétain et pour tout ou partie de ses idées. Souvent, ils n’ont pas d’objection de fond à faire à celles-ci, mais considèrent que le moment choisi pour les appliquer est inapproprié, tant que l’Allemand occupe encore le territoire.
Des déçus de la IIIe République ont cru aussi que le régime de Pétain pouvait leur servir à mettre en place leurs propres projets, et se sont ralliés à tout ou partie de sa Révolution nationale. Mais un Emmanuel Mounier, qui engage la revue Esprit aux côtés de Pétain en 1940, rompt avec lui dès mai 1941 par rejet radical de l'antisémitisme et passe à la Résistance. François Mitterrand, prisonnier évadé travaillant aux bureaux officiels de Vichy, est reçu par le maréchal Pétain en septembre 1942 mais n’en rejoint pas moins la Résistance quelques mois plus tard.
Si beaucoup de collaborationnistes parisiens méprisent Vichy et son chef qu’ils jugent trop réactionnaires et toujours trop peu engagés aux côtés du Troisième Reich, nombre des ultras de la collaboration sont de très fervents fidèles de Pétain, dont ils estiment relayer les appels publics à collaborer avec l’occupant : ainsi Joseph Darnand ou encore Jacques Doriot qui se dit un homme du Maréchal jusqu’à fin 1941. Un groupuscule clairement pro-nazi de zone nord se baptise même les Jeunes du Maréchal. De nombreux ultras sont d’ailleurs plus ou moins précocement nommés membres du gouvernement Pétain à Vichy : ainsi Gaston Bruneton, Abel Bonnard, Jean Bichelonne, Fernand de Brinon, et plus tard Philippe Henriot ou Marcel Déat.
Selon le Pr Jean Quellien184, « Pétain a été responsable de l’engagement de bien des hommes dans la collaboration : 19 % des collaborationnistes du Calvados interrogés après la guerre confient s’être inscrits à des partis collabos d’abord parce qu’ils pensaient suivre ainsi les volontés du maréchal.
Les travaux pionniers de Pierre Laborie et de nombreux historiens permettent aujourd’hui de mieux cerner l’évolution de l’opinion publique sous Vichy. Généralement, la Révolution nationale, souci premier de Pétain, intéresse peu les Français, et patine dès 1941. La collaboration est très largement rejetée, mais beaucoup croient à tort que le maréchal est de bonne foi et veut protéger les Français, voire qu’il est forcé par les Allemands à collaborer ou même prisonnier d’un entourage collabo. Reprenant le thème ancestral du bon monarque trompé par ses mauvais ministres, la masse des Français distingue entre le maréchal et ses ministres, à commencer par le très impopulaire Pierre Laval, unanimement haï, et chargé seul de toutes les turpitudes et de tous les échecs du régime.
Nombre de Français ne font toutefois pas la différence, qu’ils soient résistants ou non. Dans bien des écoles, l’instituteur néglige d’apprendre aux élèves le Maréchal, nous voilà !. Globalement, le prestige de Pétain est nettement plus faible chez les ouvriers que chez les paysans ou dans la bourgeoisie, et encore faut-il apporter de nombreuses nuances. Les prisonniers de guerre, coupés depuis 1940 de la réalité française et choyés par la propagande du régime, sont en général restés maréchalistes ou pétainistes plus longtemps que les autres Français. Si la grande majorité de l’épiscopat français est restée très maréchaliste voire pétainiste jusqu’en 1944, les catholiques ont été, avec les communistes, une des catégories les plus engagées dans la Résistance. Enfin, la zone sud, royaume du Maréchal est beaucoup plus marquée par la présence de Pétain et de son régime que la zone nord, où le chef de l’État, Vichy et la Révolution nationale sont des réalités bien plus lointaines. Dans son Nord-Pas-de-Calais natal, coupé de l’Hexagone et dirigé depuis Bruxelles, Pétain ne jouit avec son régime d’aucune considération : l’Occupation y est d’emblée trop brutale, l’anglophilie traditionnelle trop forte, pour laisser la moindre place aux thèmes de la collaboration et du redressement intérieur.
Après les rafles de Juifs de l’été 1942, l’invasion de la zone sud en novembre 1942, puis l’instauration du STO, le discrédit de Vichy est massif, mais épargne toutefois majoritairement la figure tutélaire du maréchal. Cependant, celui-ci devient de plus en plus lointain aux yeux des Français.
Le 26 avril 1944, lorsque Pétain vient pour la première fois à Paris en quatre ans, plusieurs centaines de milliers de personnes l’acclament.
Les sondages d’opinion effectués à l’automne 1944 ne montrent pas une nette majorité de Français favorables à la condamnation du traître Pétain, cependant, la proportion exigeant la peine capitale ne cesse d'augmenter au fil des mois. À la question posée de savoir s'il faut infliger une peine au maréchal, les réponses sont les suivantes :
en septembre 1944, un sondage de l'IFOP recueille 58 % de réponses négatives, 32 % de positives et 10 % sans opinion ;
en avril 1945, un nouveau sondage chiffre à 28 % la population des Français favorables à la peine de mort, tandis que les opposants à toute peine ne sont plus que 22 % ;
en juillet 1945, à l'ouverture du procès, un sondage recueille 76 % d'opinions favorables à la condamnation dont 37 % à la peine de mort. Le taux des opposants à toute peine est tombé à 15 %.
Le PCF mena quant à lui une virulente campagne contre Pétain-Bazaine, assimilant ainsi le chef de Vichy au fameux traître de la guerre de 1870. La condamnation de Pétain au châtiment suprême, puis sa grâce, furent majoritairement approuvés.
Après la guerre : controverses, mémoire et histoireAu procès Pétain, l’avocat Jacques Isorni avec ses confrères Jean Lemaire et le bâtonnier Fernand Payen lance la légende du détournement de vieillard : Pétain aurait été abusé par Pierre Laval qui aurait profité de son grand âge. Sous la IVe République, le RPF gaulliste emploie la fameuse phrase de Charles de Gaulle dans ses mémoires : la vieillesse est un naufrage, la tragédie est que le Maréchal est mort en 1925 et que personne ne s’en est aperçu. L’historien Éric Roussel, entre autres, a montré que ce jugement gaullien n’explique en rien les choix du chef de l’État français, et qu’il n’a en réalité qu’une finalité électorale : pour rallier le plus possible de voix contre le régime des partis honni, les gaullistes doivent rallier les ex-pétainistes sans se déjuger de leur action dans la Résistance, d’où cette excuse commode de Pétain par l’âge de l’intéressé.
En réalité, comme le montrent Marc Ferro, Jean-Pierre Azéma ou François Bédarida, les choix de Pétain étaient parfaitement cohérents et bénéficiaient d’appuis dans les milieux les plus divers de la société. Yves Durand souligne qu’il bâtissait son régime comme s’il avait du temps devant lui, sans se soucier de la possibilité de sa disparition prochaine. Quant aux fameuses absences du Maréchal rapportées par Jean-Raymond Tournoux, Marc Ferro ou Jean-Paul Brunet il se mettait à disserter soudain sur le menu du jour ou le temps dehors face à des visiteurs, il s’agissait surtout d’une tactique pour éluder les questions gênantes en jouant du respect qu’inspirait sa qualité d’octogénaire.
Pour Robert Paxton, le journaliste Robert Aron aurait contribué à lancer la légende parallèle de l’épée et du bouclier : Pétain aurait tenté de résister pied à pied aux demandes allemandes, et secrètement cherché à aider les Alliés, pendant que de Gaulle préparait la revanche; d’autre part, il y aurait un Vichy de Pétain opposé au Vichy de Laval. Ces deux thèses sont les chevaux de bataille des apologistes de la mémoire de Pétain, mais ces distinctions ont volé en éclats à partir de la parution de son livre La France de Vichy en 1973. Archives allemandes puis françaises à l’appui, les historiens actuels démontrent, à sa suite, que la collaboration a été recherchée par Pétain, alors qu'Adolf Hitler n’y croyait pas et n’a jamais voulu traiter la France en partenaire. Si la collaboration n’est pas allée aussi loin qu’elle aurait pu, c’est bien en raison des réticences de Hitler, et non grâce à une quelconque résistance de Pétain aux demandes de l’occupant. Ainsi, la collaboration répondait aux choix fondamentaux et intangibles de Pétain comme de Laval, que le maréchal a nommé et laissé agir en aidant son gouvernement de son charisme. Quant au fameux double jeu du maréchal, il n’a jamais existé. Les quelques sondages informels qu’il a autorisés avec Londres, fin 1940, n’ont eu aucune suite, et ne pèsent rien au regard de son maintien constant de la collaboration d’État jusqu’à la fin de son régime, à l’été 1944.
Loin d’avoir protégé les Français, selon les historiens, Pétain a accru leurs souffrances en permettant aux Allemands de réaliser à moindres frais leurs objectifs : livraisons de Juifs dans le cadre de la Shoah, répression de la Résistance, envoi forcé de main-d’œuvre au STO, pillage alimentaire et économique. Avec son peu de troupes, de fonctionnaires et de policiers, jamais l’occupant n’aurait vu ses projets aboutir sans le concours indispensable des autorités de Vichy, et sans le prestige de Pétain, qui maintenait les Français dans le doute ou dans la conviction qu’ils faisaient leur devoir en collaborant. 80 % des 76 000 Juifs de France déportés et exterminés par les nazis dans les camps de la mort ont ainsi été arrêtés par la police française. La France a, par ailleurs, été le pays le plus pillé d’Europe occupée, et l’un des premiers fournisseurs de main-d’œuvre et de tributs financiers et alimentaires au Troisième Reich.
De plus, en excluant de sa propre initiative des catégories entières de la communauté nationale Juifs, communistes, républicains, francs-maçons, et bien sûr résistants, Pétain les a rendu plus vulnérables à la répression allemande, et a écarté d’emblée ces catégories de son hypothétique protection, tout comme les Alsaciens-Mosellans, abandonnés.
Aussi Pétain apparaît-il aujourd’hui aux historiens, selon le mot de Jean-Pierre Azéma, comme un bouclier percé.
Depuis 1945, huit demandes en révision du procès Pétain ont été rejetées, ainsi que la demande répétée du transfert de ses cendres à Douaumont. Dans une note à Alexandre Sanguinetti, le 4 mai 1966, le général de Gaulle, alors président de la République, signifia ainsi sa position sur cette question :
Les signataires de la pétition relative au transfert des restes de Pétain à Douaumont n'ont aucunement été mandatés par les 800 000 anciens combattants pour s'emparer de cette question politique. Ils ne sont mandatés que pour faire valoir les intérêts spécifiques de leurs associations. Le leur dire
En 1995, le président Jacques Chirac reconnut officiellement la responsabilité de l’État dans la rafle du Vélodrome d'Hiver et, en 2006, pour les 90 ans de la bataille de Verdun, son discours mentionna à la fois le rôle de Pétain dans la bataille et ses choix désastreux de la Seconde Guerre mondiale. C’est l’ultime avatar, à l’heure actuelle, de la volonté de la France et des Français de regarder en face un des personnages les plus controversés de leur histoire récente.
Une longue bataille judiciaire a eu lieu d'octobre 1984 à septembre 1998 au sujet de la mémoire du maréchal Pétain. Jacques Isorni et François Lehideux avaient fait paraître le 13 juillet 1984 dans le quotidien Le Monde un encart publicitaire intitulé Français, vous avez la mémoire courte, dans lequel, au nom de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain et l'Association nationale Pétain-Verdun, ils prenaient sa défense. À la suite d'une plainte déposée par l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance pour apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, le procureur de la République prit un réquisitoire définitif de non-lieu le 29 mai 1985, mais le juge d'instruction renvoya, une semaine plus tard, les parties devant le tribunal correctionnel de Paris, qui relaxa les prévenus le 27 juin 1986 — jugement confirmé par la Cour d'appel de Paris le 8 juillet 1987. L'arrêt de la Cour d'appel fut cassé par la Cour de cassation le 20 décembre 1988. La Cour d'appel de Paris se déjugea le 26 janvier 1990 en déclarant les constitutions de parties civiles recevables ; elle infirma le jugement de relaxe, et condamna les prévenus à un franc de dommages et intérêts et à la publication de l'arrêt dans Le Monde. Le pourvoi en cassation déposé par les prévenus fut rejeté par la Cour le 16 novembre 1993.
Enfin, le 23 septembre 1998 par l'arrêt Lehideux et Isorni contre France la Cour européenne des droits de l'homme décida par quinze voix contre six qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme — portant sur la liberté d'expression : l'opinion majoritaire chez les juges fut qu'il devait être possible de présenter un personnage, quel qu'il soit, sous un jour favorable et de promouvoir sa réhabilitation — au besoin en passant sous silence les faits qui peuvent lui être reprochés — et que la condamnation pénale subie en France par les requérants était disproportionnée.
Le point de vue de Charles de Gaulle
« Toute la carrière de cet homme d’exception avait été un long effort de refoulement. Trop fier pour l’intrigue, trop fort pour la médiocrité, trop ambitieux pour être arriviste, il nourrissait en sa solitude une passion de dominer, longuement durcie par la conscience de sa propre valeur, les traverses rencontrées, le mépris qu’il avait des autres. La gloire militaire lui avait, jadis, prodigué ses caresses amères. Mais elle ne l’avait pas comblé, faute de l’avoir aimé seul. Et voici que, tout à coup, dans l’extrême hiver de sa vie, les événements offraient à ses dons et à son orgueil l’occasion tant attendue de s’épanouir sans limites, à une condition, toutefois, c’est qu’il acceptât le désastre comme pavois de son élévation et le décorât de sa gloire ... Malgré tout, je suis convaincu qu’en d’autres temps, le maréchal Pétain n’aurait pas consenti à revêtir la pourpre dans l’abandon national. Je suis sûr, en tout cas, qu’aussi longtemps qu’il fut lui-même, il eût repris la route de la guerre dès qu’il put voir qu’il s’était trompé, que la victoire demeurait possible, que la France y aurait sa part. Mais, hélas ! Les années, par-dessous l’enveloppe, avaient rongé son caractère. L’âge le livrait aux manœuvres de gens habiles à se couvrir de sa majestueuse lassitude. La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s’identifier avec le naufrage de la France.
Carrière militaire
1878 - 1883, sous-lieutenant - 1re affectation au 24e bataillon de chasseurs à pied de Villefranche
12 décembre 1883 - 1890, lieutenant - 1re affectation au 3e bataillon de chasseurs de Besançon
novembre 1888, entrée à l’École de guerre 14e promotion
1890, capitaine à la sortie de l’école - affecté à l’état-major du 15e corps d'armée à Marseille.
1892, affecté au 29e bataillon de chasseurs à pied à Vincennes
1893, état-major du gouverneur militaire de Paris
12 juillet 1900, commandant - affecté à l’École de tir de Châlons-sur-Marne
début 1901, affecté au 5e régiment d'infanterie à la caserne de La Tour-Maubourg à Paris
Été 1901, professeur-adjoint à l’École supérieure de guerre
Été 1903, chef de bataillon au 104e régiment d'infanterie
Été 1904 - 1907, professeur à l’École de guerre
Été 1907, lieutenant-colonel commandant le 118e régiment d'infanterie à Quimper
1908 - 26 juin 1911, titulaire de la chaire de tactique de l’infanterie à l’École de guerre
31 décembre 1910, colonel
26 juin 1911, commandant le 33e régiment d'infanterie à Arras
1912, professeur de tactique générale à l’École de cavalerie de Saumur
1914, commandant par intérim de la 4e brigade à Saint-Omer
24 juillet 1914, décision de prendre sa retraite
août 1914, commandant la 4e brigade du 1er corps d'armée
31 août 1914, général de brigade
2 septembre 1914, commandant la 6e division d'infanterie
14 septembre 1914, général de division
20 octobre 1914, commandant le 33e corps d'armée
10 mai 1915, commandeur de la Légion d'honneur
21 juin 1915, commandant de la 2e armée
25 février 1916, la 2e armée est envoyée à Verdun
2 mai 1916, commandant du groupe d’armées centre à Bar-le-Duc
27 avril 1917, chef d’État-Major général
15 mai 1917, général en chef des armées françaises
24 août 1917, grand-Croix de la Légion d'honneur
6 août 1918, médaille militaire chef de l'État français, il ne portera que cette seule décoration
21 novembre 1918, maréchal de France
13 juillet 1925 - 6 novembre 1925, guerre du Rif
9 février 1931, inspecteur de la défense aérienne du territoire
Carrière politique
8 février 1934 - 8 novembre 1934, ministre de la Guerre
6 juin 1936 - 1er mars 1939, membre du Comité permanent de la Défense nationale (CPDN)
2 mars 1939 - 16 mai 1940, ambassadeur à Madrid
17 mai 1940, vice-président du Conseil
16 juin 1940, président du Conseil
11 juillet 1940 - 20 août 1944, chef de l’État français 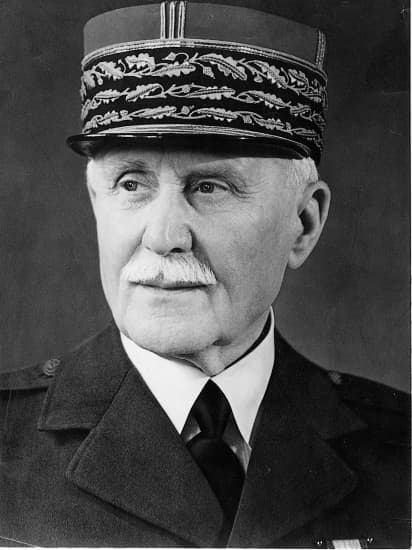    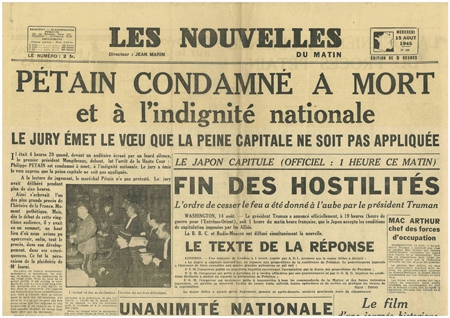
Posté le : 23/04/2016 17:46
|
|
|
|
|
Droit de vote des femmes |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 27 mars 1948 obtenaient le droit de vote Il y a 65 ans,
27 mars 1948
Il y a 65 ans, les femmes obtenaient le droit de vote : chapeau à cs pionnières !
Voici 65 ans, les femmes obtenaient les mêmes droits politiques que les hommes. La loi du 27 mars 1948 accordait le suffrage législatif aux femmes et celle du 26 juillet, le suffrage provincial. Le 26 juin 1949, les femmes participaient, pour la première fois, aux élections législatives et provinciales. C’était déjà l’aboutissement d’un long combat, dont une des premières victoires avait été leur éligibilité à partir de 1920.
Mais ces avancées en droit ne s’étaient pas traduites par une égalité de fait. Loin de là : jusqu’à la fin des années 1960, la représentativité des femmes au Parlement a stagné autour des 3 % ! Suite à une prise de conscience féministe, les années 1970 et 1980 ont été marquées par plusieurs campagnes de sensibilisation « Votez femme », puis « Votez l’équilibre entre les femmes et les hommes ».
Nouveau tournant : à partir des années 1990, la politique des quotas commence à s’imposer. Bien que sujette aux critiques, cette dernière a débouché, le 24 mai 1994, sur la première loi Smet-Tobback « visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections » : elle a imposé des quotas de maximum deux tiers des candidats d’un même sexe sur les listes électorales. En 2002, la législation a été renforcée en prévoyant la parité et l’alternance systématique aux deux premières places d’une liste.
Malgré cette extension, les chiffres montrent que le nombre d’élues dans les assemblées n’est toujours pas représentatif de la population. Lors des dernières élections législatives fédérales du 13 juin 2010, 51,9 % des 7 767 465 électeurs belges inscrits étaient des femmes. Mais seuls 39,3 % de femmes ont été élues à la Chambre des Représentants. Leur progression est lente. Ainsi, à la Chambre, le nombre d’élues est passé de 19,3 % en 1999, à 34,7 % en 2003, à 36,7 % en 2007 et à 39,3 % en 2010.
Autres exemples : entre 2006 et 2012, la proportion de femmes a seulement augmenté de 33,3 % à 35,9 % aux communales et de 37,1 % à 38,1 % aux provinciales. Dans certains cas, le nombre d’élues a même diminué. A Bruxelles, où les femmes étaient les plus nombreuses, leur proportion dans les conseils communaux ne dépassera plus les 41,5 % (pour 42,2 % en 2006). En Wallonie, les élues provinciales sont, elles aussi, à la baisse : 32,7 % en 2012 pour 37,8 % en 2006.
Dès 2009, au terme de son analyse sur « La représentation politique des femmes à l’issue des élections du 7 juin 2009 », l’Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes plaidait en faveur d’« un renforcement du principe de la tirette » : « Pour les candidates, plus encore que pour les candidats masculins, la place sur la liste semble avoir une importance cruciale dans la détermination du nombre de voix de préférence », concluait l’IEFH.
En effet, en l’absence de nouvelles contraintes légales, le nombre d’élues semble stagner. Tirant ce constat, dès décembre 2012, la vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, a travaillé sur un projet de loi proposant au gouvernement d’adopter la règle complète de l’alternance (la tirette), qui ne vaut actuellement que pour les deux premières places, sur l’ensemble d’une liste pour les prochaines élections. La Région de Bruxelles-Capitale a d’ailleurs déjà montré l’exemple en se dotant, dès mars 2012, d’une ordonnance sur une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes pour les listes communales à partir de 2018. En janvier dernier, en Commission des Affaires intérieures, le Parlement wallon a suivi.
Le projet de Joëlle Milquet porte, lui, sur l’alternance complète sur les listes électorales fédérales et européennes. Prêt depuis la fin de l’année dernière, il attend d’être mis à l’agenda du comité ministériel restreint qui doit donner son accord sur le principe d’une telle loi.
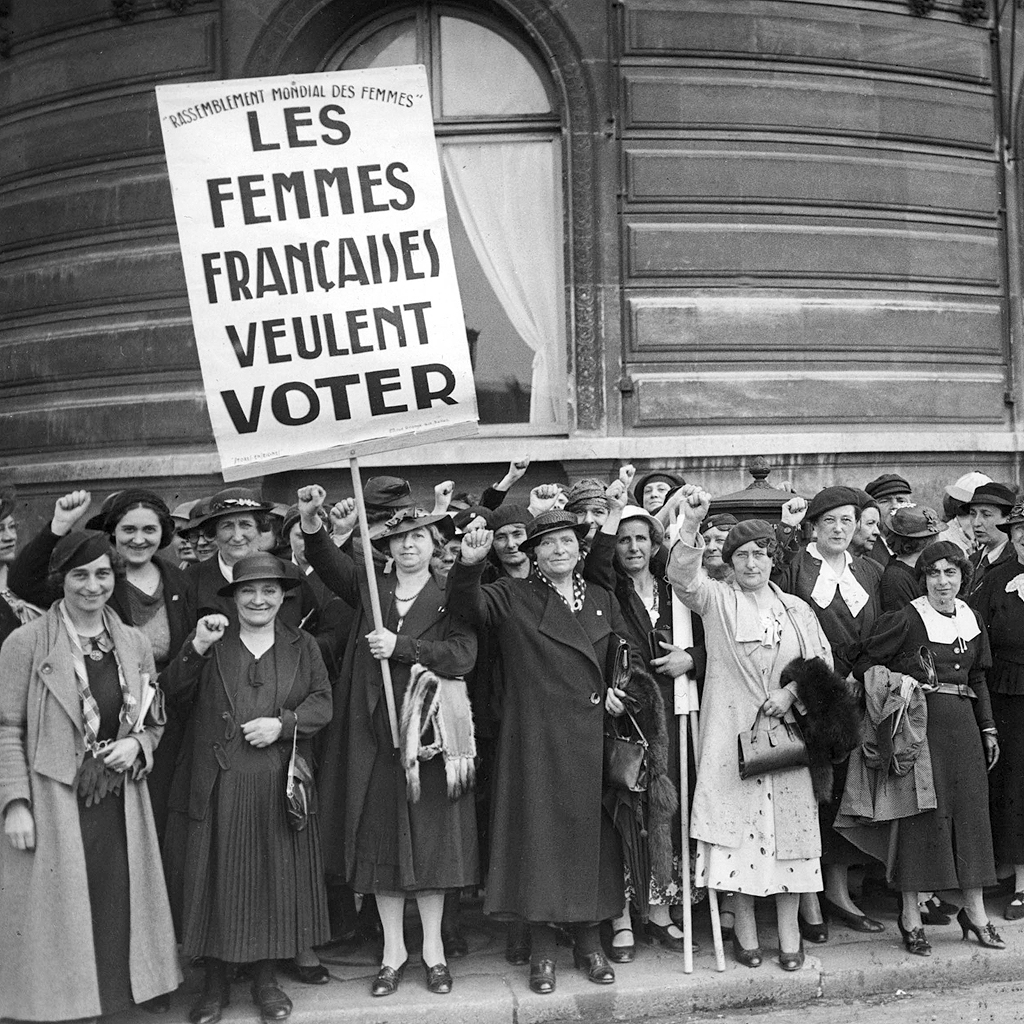   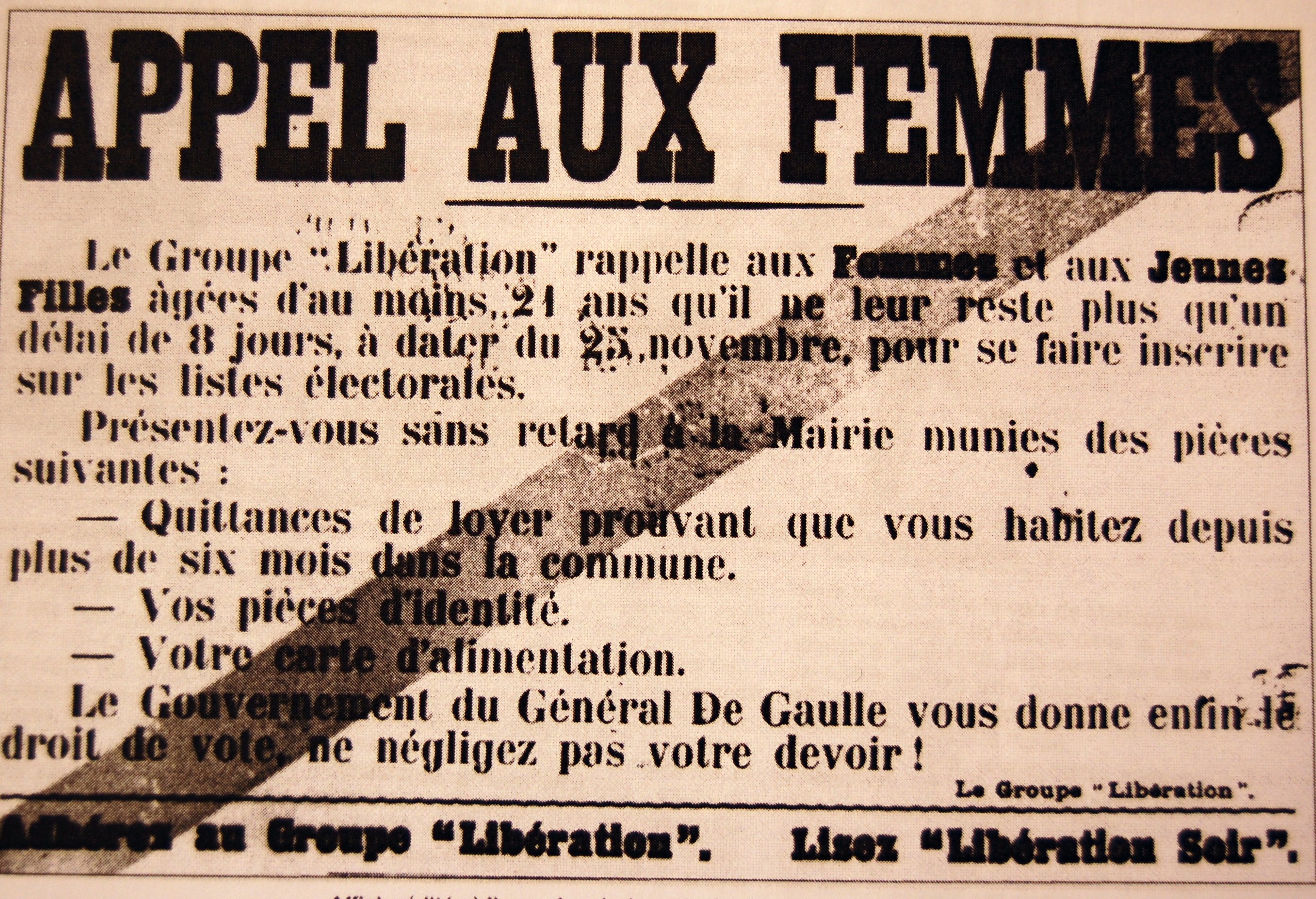  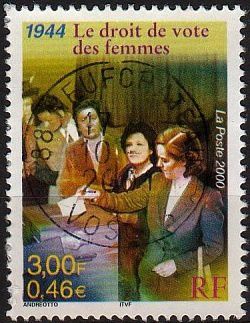 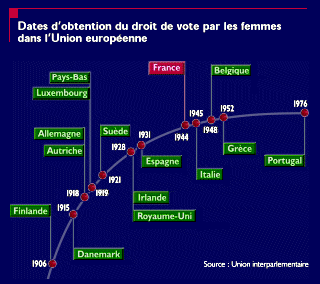
Posté le : 26/03/2016 18:54
Edité par Loriane sur 27-03-2016 19:17:42
Edité par Loriane sur 27-03-2016 19:18:19
|
|
|
|
|
Louis XVII |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 27 mars 1785 naît Louis-Charles de France à Versailles
il meurt à Paris Paris, 8 juin 1795, second fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, duc de Normandie, dauphin de France à partir de 1789, puis prince royal de 1791 à 1792. Après la mort de son père, en 1793, et suivant l’ordre dynastique, il est reconnu comme titulaire de la couronne de France sous le nom de Louis XVII par les puissances coalisées et par son oncle, futur Louis XVIII. Il meurt à la prison du Temple en 1795, à l’âge de dix ans, sans avoir régné dans les faits. Prétendant aux trônes de France et de Navarre du 21 janvier 1793 au 8 juin 1795 durant donc 2 ans 4 mois et 18 jours, Nom revendiqué Louis XVII, son prédécesseur et père est Louis XVI il davait avoir pour successeur Louis-Stanislas de France. Il Héritier des trônes de France et de Navarre du 4 juin 1789 Au 10 août 1792, pendant 3 ans 2 mois et 6 jours. Son prédécesseur était Louis-Joseph de France, dauphin de France, décédé, son successeur Charles-Philippe de France comte d'Artois. Il est fils de France Duc de Normandie, Dauphin de France, Prince royal de France, il appartient à la dynastie de la maison de Bourbon
En bref
Second fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, il devient le dauphin à la mort de son frère en juin 1789, et partage le destin de sa famille au moment de la Révolution. Ramené à Paris, par la foule qui est allé chercher « le boulanger, la boulangère et le petit mitron » en octobre 1789, il est arrêté à Varennes, lors de la fuite familiale le 20 juin 1791. Après le 10 août 1792, il est incarcéré à la prison du Temple, où il se retrouve seul après le procès et l'exécution de son père puis de sa mère. Il est cité dans le procès de Marie-Antoinette, puisque Hébert accuse celle-ci d'avoir commis des actes incestueux sur son fils. Il est ensuite laissé à la garde du cordonnier Simon, qui l'élève comme un enfant du peuple et le maltraite de façon régulière, aggravant son état de santé naturellement fragile. Sous l'effet de ces mauvais traitements, il meurt soudainement le 8 juin 1795.
Il avait été, dès la mort de son père, proclamé Louis XVII (son oncle le comte de Provence s'étant attribué la régence), si bien que, pendant son règne théorique, des mesures politiques mais aussi des proclamations contre-révolutionnaires ont été tenues en son nom, à l'étranger comme en France, et notamment en Vendée. Son emprisonnement et sa disparition font naître bien des légendes. Dès 1795, des bruits se répandent, assurant que Charette a obtenu sa libération et qu'il l'hébergera en Vendée, selon les clauses secrètes du traité de La Jaunaye. Par la suite, des rumeurs assureront qu'il a été empoisonné, mais aussi qu'il a survécu et que c'est un autre jeune garçon qui est mort à sa place. Si bien qu'une trentaine de personnes prétendront être le vrai dauphin. Le plus connu de ces prétendants est Naundorff, qui prend le titre de duc de Normandie en 1824 et entame une procédure judiciaire pour être rétabli dans ses droits. En avril 2000, les résultats d'une expertise génétique, reposant sur la comparaison entre l'ADN extrait du cœur prélevé sur l'enfant décédé à la prison du Temple en 1795 et celui de la reine Marie-Antoinette et de deux de ses sœurs, mettent un terme aux incertitudes entourant le décès de Louis XVII. La fin de ce mystère ne doit pas faire oublier l'incroyable intérêt manifesté par des milliers de personnes pour le destin de cet enfant pendant les deux siècles suivants. Jean-Clément Martin
Sa vie
Louis-Charles de France est né au château de Versailles le 27 mars 1785. Il est baptisé le même jour dans la chapelle du château de Versailles par Louis René Édouard de Rohan, grand aumônier de France, en présence d'Honoré Nicolas Brocquevielle, curé de l'église Notre-Dame de Versailles : son parrain est Louis Stanislas Xavier de France, futur Louis XVIII, et sa marraine est Marie-Caroline de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, reine des Deux-Siciles, représentée par Madame Élisabeth.
Des rumeurs se sont répandues à la naissance de l'enfant, selon lesquelles il ne serait pas le fils de Louis XVI mais d'Axel de Fersen, gentilhomme suédois qui nourrissait un amour platonique pour la reine3. Une véritable coterie s'est en effet montée contre Marie-Antoinette dès son accession au trône : des pamphlets circulent, d'abord de courts textes pornographiques puis des libelles orduriers et cette rumeur de bâtardise fortifie les prétentions du comte de Provence puis du comte d'Artois qui peuvent se déclarer les légitimes successeurs de Louis XV.
Comme deuxième fils de Louis XVI, Louis-Charles de France n'est donc pas destiné, à sa naissance, à succéder à son père, mais la mort de tuberculose osseuse — mal de Pott — de son frère aîné Louis-Joseph le 4 juin 1789 en fait le dauphin de France. En 1791, la Constitution du Royaume de France remplace ce titre par celui de « prince royal », ce changement étant la conséquence logique du remplacement du titre de Roi de France par celui de Roi des Français.
Il passe sa première enfance dans l'insouciance, sa vie parmi les enfants de la Cour se déroulant entre les escaliers du château de Versailles et la terrasse du Midi où a été aménagé un petit jardin qui fait le bonheur de l'héritier du trône. Il est entouré d'une nombreuse Maison, comprenant de très nombreux serviteurs attachés à sa personne, parmi lesquels Agathe de Rambaud, sa berceuse, Louise-Elisabeth de Croÿ de Tourzel comme gouvernante et Jean-Baptiste Cant Hanet dit Cléry, son valet.
Après la journée du 10 août 1792, Louis-Charles qui a perdu son titre de prince royal est transféré avec ses parents au couvent des Feuillants puis le 13 août emprisonné à la Prison du Temple. Le 29 septembre, Louis XVI est séparé de sa famille et conduit au deuxième étage alors que le troisième étage est réservé à Marie-Antoinette, ses deux enfants et sa belle-sœur. À partie du 25 octobre, l'enfant Capet est confié à la garde de son père, qui poursuit son éducation avec le valet de chambre Cléry. Séparé de sa mère qu'il peut retrouver à l'occasion de promenades, le dauphin est à nouveau confié à elle le 11 décembre lorsque commence le procès de Louis XVI. Il ne revoit son père que le 20 janvier, pour un dernier adieu, ce dernier étant exécuté, au matin du 21 janvier 1793.
La vie au Temple
Aux yeux des royalistes, le dauphin Louis-Charles succède à son père, guillotiné, le 21 janvier 1793, en vertu du principe selon lequel la continuité dynastique est automatique en France un nouveau roi succède au roi précédent dès l'instant de la mort de ce dernier. Sous le nom de Louis XVII, il est reconnu comme tel par le comte de Provence, frère cadet de Louis XVI et futur Louis XVIII, alors émigré à Hamm, près de Dortmund, en Westphalie. Les Vendéens et les Chouans, mais aussi de fidèles royalistes dans d'autres provinces, se battirent en son nom. Leurs étendards portaient l'inscription : Vive Louis XVII.
Louis-Charles est confié à sa mère au troisième étage du Temple, jusqu'au 3 juillet 1793. Les captifs bénéficient à cette époque d'un confort incontestable baignoire, garde-robe, nourriture abondante. Plusieurs tentatives d'évasion sont fomentées par des royalistes afin de délivrer Marie-Antoinette et ses enfants. Par arrêté du Comité de salut public du 1er juillet 1793, Louis est enlevé à sa mère et mis sous la garde du cordonnier Antoine Simon l'instituteur désigné qui ne sait pourtant à peine écrire et de sa femme, qui résident au Temple. Enfermé au deuxième étage, le but est alors d'en faire un petit citoyen ordinaire et de lui faire oublier sa condition royale. Il est impliqué ainsi que sa sœur, dans le procès de sa mère, Marie-Antoinette. On lui fait signer une déclaration de reconnaissance d'inceste, pour ajouter un chef d'accusation contre cette dernière.
Selon Georges Bordonove, c'est l'épouse de Simon, attachée à l'enfant, qui prend soin de le nourrir correctement. Cependant, Simon est rappelé à ses fonctions municipales le 19 janvier 1794. Louis-Charles est alors enfermé au secret dans une chambre obscure, sans hygiène ni secours, pendant six mois, jusqu'au 28 juillet 1794. Son état de santé se dégrade, il est rongé par la gale et surtout la tuberculose. Il vit accroupi. Sa nourriture lui est servie à travers un guichet et peu de personnes lui parlent ou lui rendent visite. Ces conditions de vie entraînent une rapide dégradation de son état de santé. L'isolement total dans lequel il est placé laisse planer un certain mystère et donne l'occasion à l'imagination populaire de soulever l'hypothèse de substitution de l'enfant et de son exfiltration, donnant naissance au mythe évasionniste et survivantiste.
Le député Barras découvre ainsi un enfant mutique brisé psychologiquement. Le 28 juillet 1794, les comités de salut public et de sûreté générale nomment Laurent, membre du comité révolutionnaire de la section du Temple, pour le garder, lui et sa sœur. Son sort s'améliore relativement, mais le prisonnier de la tour du Temple est rongé par la tuberculose, ce qu'omet de signaler Laurent lorsqu'il écrit, sur le bulletin de la tour du Temple, que les prisonniers se portent bien. Le 31 mars 1795, Laurent démissionne. Le 6 mai, la tuberculose prend un tour critique, caractérisé par l'apparition d'une péritonite, si bien que dans les derniers jours de mai, les gardiens signalent au comité de Sûreté générale que l'enfant Capet manifeste une indisposition et des infirmités qui paraissent prendre un caractère grave. Il meurt dans sa prison, probablement d'une péritonite ulcéro-caséeuse venue compliquer la tuberculose le vice scrofuleux qui a déjà coûté la vie à son frère aîné, le 8 juin 1795, à l'âge de dix ans et après presque trois ans de captivité. Le lendemain, le chirurgien Philippe-Jean Pelletan réalise son autopsie qui confirme le diagnostic de tuberculose. Il est officiellement enterré le 12 juin 1795 dans le cimetière Sainte-Marguerite. Sous la Seconde Restauration, Louis XVIII fait rechercher la sépulture de son neveu : l'énigme de l'enfant du Temple se développe alors avec les témoignages contradictoires de ceux qui ont assisté à l'enterrement le 10 juin fossoyeur, concierge du cimetière, abbé … qui évoquent une inhumation en fosse commune le corps ne pouvant dès lors plus être identifié, une réinhumation dans une fosse particulière près de la Chapelle de la Communion de l’église, voire dans le cimetière de Clamart.
Acte de décès de Louis XVII dans l'état civil de Paris
Acte de décès de Louis XVII à l'état civil de Paris en date du 12 juin 1795
L'acte de décès de Louis XVII est rédigé le 12 juin 1795 24 prairial an III. L'original du document a disparu dans les incendies de la Commune de 1871 mais l'acte avait été recopié par des archivistes et un exemplaire se trouve aussi aux Archives nationales :
Du 24 prairial de l'an III de la République 12 juin 1795
Acte de décès de Louis Charles Capet du vingt de ce mois 8 juin, trois heures après-midi, âgé de dix ans deux mois, natif de Versailles, département de Seine-et-Oise, domicilié à Paris, aux Tours du Temple, Section du Temple, Fils de Louis Capet, dernier roi des Français, et de Marie Antoinette Josèphe Jeanne d'Autriche, sur la déclaration faite à la maison commune, par Étienne Lasne, âgé de trente-neuf ans, gardien du Temple, domicilié à Paris rue et Section des Droits-de-l'Homme, n°48 : le déclarant a dit être voisin ; et par Rémi Bigot, employé, domicilié à Paris, vieille rue du Temple, n°61 : le déclarant a dit être ami. Vu le certificat de Dusser, Commissaire de Police de ladite Section, du vingt-deux de ce mois 10 juin.
Signé : Lasne, Bigot, et Robin, Officier
Ascendance de Louis XVII de France 1785-1795
Les faux dauphins et l'énigme du Temple
Dès 1795, des rumeurs faisaient courir le bruit que le dauphin, remplacé dans sa geôle par un autre garçon, aurait été libéré du Temple. Ces rumeurs avaient été favorisées par les exhumations des restes d’un enfant au crâne scié — traces d'une autopsie — du cimetière Sainte-Marguerite au cours des deux exhumations réalisées en 1846 et en 1894, plusieurs spécialistes attribuent pourtant le corps à un sujet masculin âgé de plus de seize ans, d'1,63 m et de morphologie différente de celle de Louis XVII et la réaction thermidorienne : tandis que les royalistes osaient à nouveau s'afficher comme tels, des accords de paix étaient négociés entre la République et les révoltés vendéens et chouans traités de La Jaunaye, de la Mabilais et de Saint-Florent-le-Vieil. La mort du dauphin, en juin de cette même année, fut par conséquent accueillie avec scepticisme par une partie de l'opinion publique. Ce contexte permit l'éclosion de théories évasionnistes et survivantistes..
Ces bruits influencèrent, au tout début du xixe siècle, le romancier Regnault-Warin. Dans les derniers volumes de son Cimetière de la Madeleine, cet auteur développa - sans y croire lui-même - un scénario de l'enlèvement du dauphin : des agents royalistes envoyés par Charette s'introduisent dans la tour, où ils apportent, au moyen d'une cachette ménagée dans un « cheval de bois », un orphelin drogué à l'opium destiné à prendre la place du vrai dauphin. Ce dernier, dissimulé dans le même objet, est ainsi libéré de sa prison. Aux termes de nombreuses péripéties, et notamment d'une tentative d'exfiltration vers l'Amérique, l'orphelin royal est repris avant de mourir de maladie.
Malgré les nombreuses invraisemblances et le triste dénouement de ce récit, la thèse de la substitution gagna ainsi un nouveau mode de diffusion.
Peu de temps après la publication de ce roman, des « faux dauphins » commencèrent à apparaître et à réunir un nombre variable de partisans autour de leurs prétentions. Les condamnations des trois premiers (Hervagault, Bruneau et un certain Hébert, connu sous le titre de « baron de Richemont ») à de lourdes peines de prison ne découragèrent pas d'autres imposteurs, dont le plus célèbre est l'horloger prussien Karl-Wilhelm Naundorff, qui eut de nombreux adeptes jusqu'à la fin du XXe siècle.
Dans les récits qu'ils firent de leur prétendue évasion du Temple, la plupart de ces prétendants reprenaient la trame du roman de Regnault-Warin, le cheval de bois étant quelquefois remplacé par un panier de linge sale, et Charette par le comte de Frotté, ce dernier ayant effectivement échafaudé, sans pouvoir y donner suite, des projets d'enlèvement des orphelins royaux.
Aux imposteurs plus ou moins convaincants s'ajoutent de nombreux fous comme Dufresne, Persat et Fontolive ou encore des personnages dont l'identification à Louis XVII a surtout été l'œuvre de tiers, le plus souvent de manière posthume : c'est notamment le cas de l'officier de marine puis architecte français Pierre Benoît actif à Buenos Aires, du pasteur iroquois Eliézer Williams, du musicien anglais Augustus Meves, du célèbre naturaliste John James Audubon et même de Louvel assassin du cousin de Louis XVII.
Les circonstances exactes de la mort de Louis XVII et la rumeur concernant une éventuelle évasion de la prison du Temple ont attisé la curiosité de nombreux auteurs, comme G. Lenotre, André Castelot, Alain Decaux, Georges Bordonove ou Jacques Soppelsa qui remet en scène l'aïeul français de la famille argentine Zapiola, l'officier de marine puis architecte Pierre Benoît précité.
L'authentification du cœur de Louis-Charles de France
Le 5 juin 1894, plusieurs spécialistes examinèrent le corps déjà exhumé en 1846 du cimetière Sainte-Marguerite et l'attribuèrent à un sujet masculin âgé de plus de seize ans.
Cœur de Louis XVII dans son cardiotaphe placé le 8 juin 2004 dans une stèle dans la chapelle des Bourbons de la basilique de Saint-Denis.
Selon l'historien Georges Bordonove, dans son Louis XVII et l'énigme du Temple, Louis XVII est mort non pas en 1795 mais plutôt entre les 1er et 3 janvier 1794. Sa mort aurait entraîné la révocation de Simon et le remplacement de Louis XVII par un enfant qui, lui, serait mort en 1795. Cette hypothèse, partagée par Louis Hastier, est aujourd'hui infirmée et dépassée par les analyses ADN positives effectuées en 2000 sur le cœur de l'enfant mort au Temple en 1795.
Le 9 juin 1795, une autopsie est pratiquée en prison sur le corps du jeune prince par le chirurgien Philippe-Jean Pelletan assisté de trois médecins : Pierre Lassus, Jean-Baptiste Dumangin et Nicolas Dieudonné Jeanroy ou Geanroi. En 1814, Pelletan qui a des sympathies royalistes déclare la soustraction du cœur lors de l’autopsie et le prélèvement d'une mèche de cheveux qu'il donne au commissaire de section Antoine Damont en guise de souvenir. Le corps est alors inhumé au cimetière Sainte-Marguerite, puis recouvert de chaux vive. Les ossements n'ont jamais été retrouvés et ceux dégagés au XIXe siècle au cimetière Sainte-Marguerite, proviennent de plusieurs squelettes, dont un crâne d'un jeune adulte d'au moins dix-huit ans.
Le 23 mai 1828, Pelletan remet la relique à monseigneur de Quélen, archevêque de Paris. Durant les Trois Glorieuses, l'archevêché est pillé et le cœur Pelletan passe entre les mains de plusieurs personnes. En 1895, Édouard Dumont, héritier de Philippe-Gabriel Pelletan fils du docteur remet le cœur Pelletan au duc de Madrid, Charles de Bourbon 1848-1909, neveu de la Comtesse de Chambord, par l’entremise de Me Pascal et du comte Urbain de Maillé, en présence de Paul Cottin, cousin du propriétaire et donateur du cœur, Edouard Dumont. En 1909, Jacques de Bourbon, fils de Charles de Bourbon, hérite du cœur, puis sa fille Béatrice, la princesse Massimo et enfin en 1938, Princesse Marie-des-Neiges, prétendante légitimiste au trône de France. En 1975, l’urne en cristal rejoint le Mémorial de France à la Basilique Saint-Denis. En 1999-2000, l'analyse ADN établit une parenté du cœur à l’urne avec les Habsbourg. Le cœur de Louis-Charles de France est placé, en 1975, dans la crypte royale de la basilique de Saint-Denis, lieu où ont été enterrés ses parents et une grande partie des rois de France.
Des analyses génétiques par comparaison d'ADN mitochondrial, pratiquées par le professeur Jean-Jacques Cassiman de l'Université Catholique de Louvain en Belgique, et par le docteur Bernd Brinkmann de l'université allemande de Münster, sur le cœur du présumé Louis XVII, et des cheveux de Marie-Antoinette, ont démontré en 2000 qu'il appartient bien à un enfant apparenté à cette dernière, en ligne féminine. Cependant, Louis XVII a eu un frère aîné décédé en juin 1789 et dont le cœur a lui aussi été conservé. Mais ce cœur a subi, comme les autres cœurs princiers, un traitement d'embaumement ouverture, utilisation d'aromates, bandelettes, double boîte de vermeil et de plomb très différent de celui auquel fut soumis le cœur de Louis XVII, soustrait par Pelletan, simplement conservé dans l'alcool, comme une vulgaire curiosité anatomique. Donc, les deux cœurs, s'ils étaient venus à être rassemblés ce qu'aucun document historique ne prouve, n'auraient pu être ni confondus ni échangés.
Après enquête, l'historien Philippe Delorme est convaincu que ce cœur est bien celui que le docteur Philippe-Jean Pelletan a soustrait sur le cadavre de l'enfant mort au Temple le 8 juin 1795. Cette conclusion réhabiliterait donc les témoignages de contemporains recueillis par l'historien Alcide de Beauchesne. L'urne funéraire contenant ce cœur a été placée, le 8 juin 2004, sous l'oraison funèbre de l'aumônier Christian-Philippe Chanut, dans la chapelle des Bourbons de la basilique de Saint-Denis, lors d'une cérémonie rassemblant des membres de différentes branches de la famille de Bourbon et diverses personnalités.
Il demeure quelques partisans de la survivance du prince. Pour le professeur Jean Tulard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, appelé par le ministre de la Culture à donner son avis sur le dépôt du cœur de Louis XVII, le 8 juin 2004, l'analyse de l'ADN du cœur, conjuguée avec l'enquête menée sur son origine et les péripéties de son histoire, est suffisante pour attester de la mort du prince au Temple.
Représentations dans la fiction Roman
1884 : Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn
1897 : Thérèse de Lisieux, Derniers Entretiens
1913 : Baronne Emmuska Orczy, Eldorado
1972 : La Rose de Versailles de Riyoko Ikeda manga
1973 : Philippe Eby, L'Évadé de l'An II, Hachette Jeunesse, 1977, 1979, 1982, 1987, 1993 et Degliame, 2003
1937 : Rafael Sabatini, The Lost King
2003 : Françoise Chandernagor, La Chambre, éditions Gallimard,
2003 : Amélie de Bourbon-Parme, Le Sacre de Louis XVII, éditions Folio
Plusieurs romans de la collection Signe de piste : Le Roi d'infortune, Le Chemin de la liberté, Le Château perdu Georges Ferney, Le Lys éclaboussé Jean-Louis Foncine et Antoine de Briclau
2005 : Ann Dukthas, En Mémoire d'un prince, éditions 10/18 ; Grands Détectives,
2007 : Christophe Donner, Un roi sans lendemain, éditions Grasset,
2009 : Dominic Lagan, Live Free or Die
2010 : Jennifer Donnelly, Revolution
2011 : Jacques Soppelsa, Louis XVII : la piste argentine, Paris, A2C Médias, coll. Histoires, 187 p.
2011 : Louis Bayard, La Tour noireNote 12 trad. Jean-Luc Piningre, Pocket,
2011 : Missouri Dalton, The Grave Watchers
Cinéma
1937 : Le Roi sans couronne The King Without a Crown joué par Scotty Beckett
1938 : La Marseillaise joué par Marie-Pierre Sordet-Dantès
1938 : Marie-Antoinette joué par Scotty Beckett
1945 : Paméla joué par Serge Emrich
1958 : Le Prisonnier du temple joué par Richard O'Sullivan
1989 : La Révolution française joué par Sean Flynn
1991 : Killer Tomatoes Eat France! joué par Steve Lundquist
1995 : Jefferson à Paris joué par Damien Groelle
2001 : L'Affaire du collier joué par Thomas Dodgson-Gates
2006 : Marie Antoinette joué par Jago Betts, Axel Küng et Driss Hugo-Kalff
pré-production : La Rose de Versailles adaptation.
1963 : Le Chevalier de Maison-Rouge joué par Benjamin Boda
1975 : Marie-Antoinette joué par Eric Brunet
1978 : Rejtekhely joué par András Várkonyi
1979 : Lady Oscar
1979 : La nuit de l'été joué par Romain Verlier
2006 : Marie-Antoinette joué par Charles Dury
Musique
2014 : Symphony Of The Vampire de Kamijo
Textes anciens
C. C. Perceval, Account of the misfortunes of the Dauphin, The Gentleman's Magazine, volume X 1838 p. 5
Alcide de Beauchesne, Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort ; captivité de la famille royale au temple, Paris, Plon, 1852.
Henry Provins pseudonyme d'Henri Foulon de Vaulx, Le dernier roi légitime de France
Henri Foulon de Vaulx, Louis XVII, ses deux suppressions, Payot, 1928
André Castelot, Louis XVII, l'énigme résolue, 1949
Maurice Garçon, Louis XVII ou La Fausse énigme, 1952
Ouvrages modernes
Louis Hastier, La double mort de Louis XVII, - J'ai lu, no A188, coll. L'Aventure mystérieuse, 1968
Évelyne Lever, Louis XVI, éditions Fayard, 1985
Paul-Éric Blanrue, Le « Mystère du Temple » : la vraie mort de Louis XVII, éditions Claire Vigne, coll. « Aux sources de l'Histoire », Paris, 1996, 364 p.
Charles-Louis Edmond de Bourbon, La survivance de Louis XVII, les preuves, Impressions Dumas, Saint-Étienne, 1999
Évelyne Lever, Marie-Antoinette, journal d’une reine, éditions Robert Laffont, 2002
Philippe Delorme, Les Princes du malheur – Le destin tragique des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette, éditions Perrin, 2008
Philippe Delorme, Louis XVII la biographie, éditions Via Romana, 2015
Jean-Louis Bachelet, Sang royal. La vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France, Ring, 2015
Sur la mort de Louis-Charles de France
Philippe Delorme, Louis XVII, la vérité, éditions Pygmalion, 20
Jean-Baptiste Rendu, L'Énigme Louis XVII, éditions Larousse, 2011
Philippe Delorme, Louis XVII, la biographie, éditions Via Romana, 2016, 448 pages.
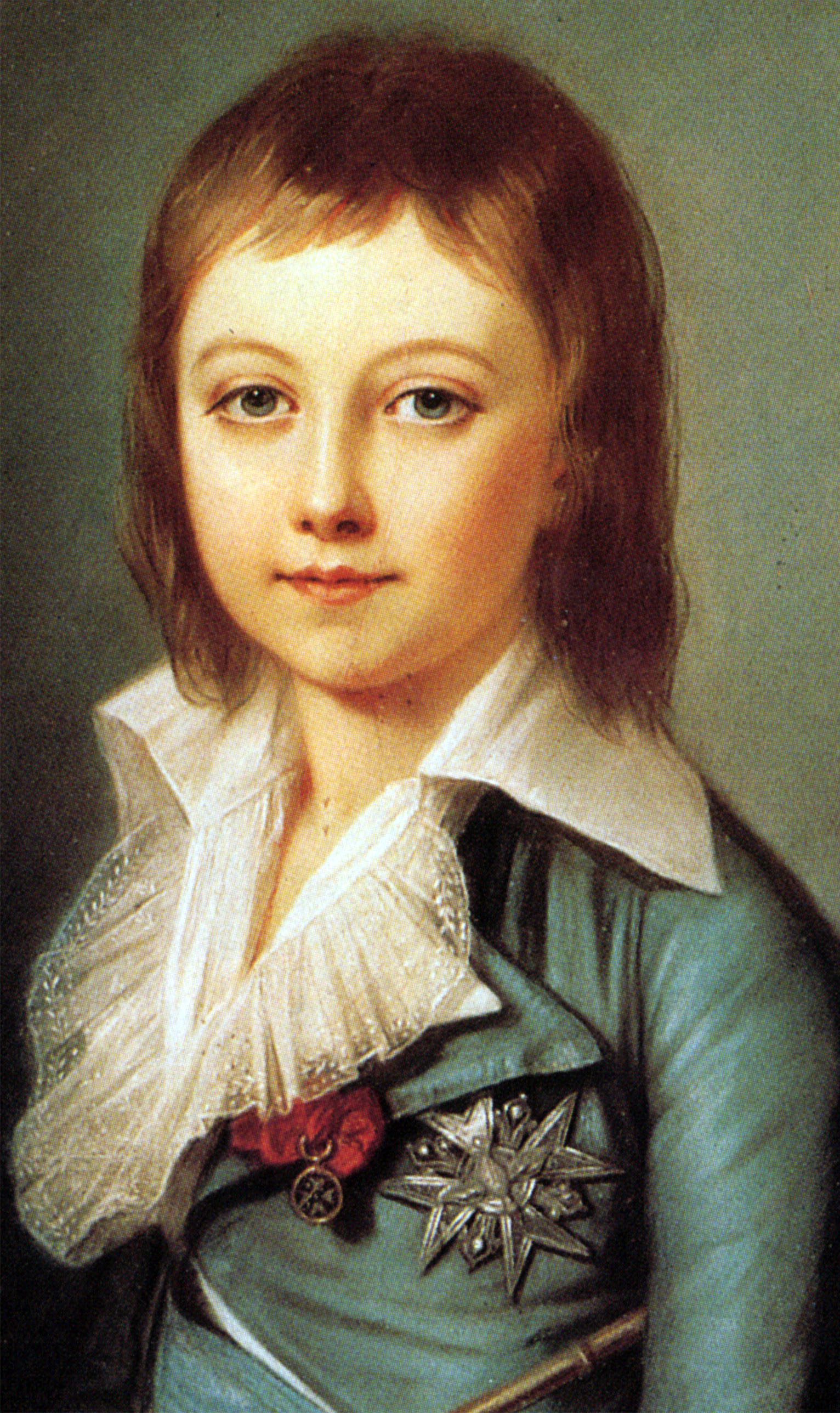     
Posté le : 26/03/2016 18:25
Edité par Loriane sur 27-03-2016 19:10:51
|
|
|
|
|
Baron Haussman |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 27 mars 1809 naît Georges Eugène Haussmann,
à Paris où il est mort le 11 janvier 1891 à 81 ans, haut fonctionnaire, a été préfet de la Seine du 23 juin 1853 au 5 janvier 1870.
À ce titre, il a dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire en approfondissant le vaste plan de rénovation établi par la commission Siméon qui vise à poursuivre les travaux engagés par ses prédécesseurs à la préfecture de la Seine Rambuteau et Berger. Député du 14 octobre 1877 au 27 octobre 1881, Sénateur du Second Empire du 9 juin 1857 au 4 septembre 1870, Préfet de la Seine du 23 juin 1853 au 5 janvier 1870, son prédécesseur est Jean-Jacques Berger, et son successeur Henri Chevreau. Sa conjointe est Octavie de Laharpe ses enfants : Valentine Haussmann et Marie-Henriette Haussmann
En bref
Préfet de la Seine sous le second Empire, l’administrateur français Georges Eugène Haussmann, mena à bien une politique de grands travaux qui allait transformer en profondeur l’urbanisme de Paris. Son nom reste lié (on parle d’« haussmannisme », d’« haussmannisation ») à l’ouverture de nombreuses percées – création de voies nouvelles –, à l’aménagement de parcs et de squares, à la mise en place d’un réseau d’égouts et à l’alimentation de la capitale en eau de source.
Il est né à Paris le 27 mars 1809, d’une famille originaire d’Alsace et protestante. Il est le petit-fils d'un membre de la Convention et, par sa mère, celui d’un général d’Empire. Après des études de droit, il devient fonctionnaire, et occupe le poste de secrétaire général de la préfecture de la Vienne en 1831. Suivront à partir de 1833 un grand nombre de postes : sous-préfet à Yssingeaux (Haute-Loire), à Nérac (Lot-et-Garonne), à Saint-Girons (Ariège), à Blaye (Gironde), conseiller de préfecture à Bordeaux, préfet du Var, de l’Yonne, et finalement de la Gironde en 1852. Haussmann y montrera son autorité et sa fidélité au bonapartisme. Il sait à la fois gérer l’administration, trouver des financements, contrôler les élus locaux, maintenir l’ordre et s’intéresse déjà aux routes et aux embellissements urbains. Préfet de la Seine : Georges Eugène Haussmann est nommé préfet de la Seine, le 23 juin 1853, sur les conseils de Victor Fialin de Persigny, ministre de l’Intérieur. Une commission des Embellissements chargée de la transformation de Paris, présidée par le comte Henri Siméon, se réunit pour la première fois le 16 août suivant. Haussmann en fait partie.
Dès avant 1853, Napoléon III avait dessiné un « plan colorié » de Paris, représentant par des traits de couleurs différentes l’ordre d’urgence des voies nouvelles à ouvrir. Il était affiché dans son bureau des Tuileries, et Haussmann le vit lors de sa première entrevue avec l’empereur.
À partir d’un plan d’ensemble des percées à entreprendre à Paris décrit par l’empereur lui-même dans une lettre adressée à la commission Siméon, celle-ci a élaboré un plan rendu en octobre 1853. Ce plan, s’il n’a pas été suivi à la lettre, a servi de base au plan des percées dites « haussmanniennes ».
Aux origines des Grands Travaux de Paris : L’idée d’un plan d’ensemble appartient à Louis-Napoléon. Sensible aux problèmes sociaux, il avait lu et rencontré un certain nombre d’auteurs qui, dès le début des années 1840, avaient constaté l’encombrement du centre de Paris (notamment du fait de la présence des Halles) et le déplacement de la population vers les quartiers nord-ouest, l’actuel IXe arrondissement. Devant l’échec de la loi du 16 septembre 1807 sur les plans d'alignement des villes, les servitudes mettant des décennies à être mises en œuvre, il fallait recourir à de larges percées, à l’ouverture de voies entièrement nouvelles dans le centre.
Ces théoriciens des années 1840 sont des architectes comme Edme Grillon ou Théodore Jacoubet, des ingénieurs comme Victor Considérant, ou Perreymond (Edmond Perrey), des notables comme Hippolyte Meynadier ou Jacques-Séraphin Lanquetin, président de la Commission municipale. La plupart d’entre eux se réunissent en commissions officieuses (celle Ernest de Chabrol-Chaméane en 1839) ou officielle (celle du comte Antoine d’Argout en 1840), qui proposent des percées dans les nouveaux quartiers, notamment rive gauche.
À la fin des années 1840, les projets se font plus précis. Les notables des faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin, commissionnent l’ingénieur Alfred Cadet de Chambine pour rédiger un projet de voie à ouvrir entre les deux faubourgs, dans l’axe de la nouvelle gare de l’Est, jusqu’aux Grands Boulevards. Le projet est reçu favorablement par Louis-Napoléon ; les banquiers Ardoin soumettent au préfet Jean-Jacques Berger une proposition d’expropriation et d’ouverture d’une nouvelle voie. Ce sera le boulevard de Strasbourg. Pour la rue des Écoles, un projet de l’architecte A. Portret est repris par le futur empereur, après qu’il a visité la Montagne Sainte-Geneviève. Ainsi Napoléon s’est forgé une doctrine pour un « plan d’ensemble », préconisé par les frères Lazare, rédacteurs de la Revue municipale.
Deux percées, le boulevard de Strasbourg et la rue des Écoles, ayant été réalisées, en 1852, avant même l’arrivée de Haussmann à Paris, le problème s’est posé de l’attribution de la paternité du projet « haussmannien ».
Sa vie
Né à Paris le 27 mars 1809 au 53 rue du Faubourg-du-Roule, dans le quartier Beaujon dans une maison qu'il démolit sans le moindre état d'âme, il est le fils de Nicolas-Valentin Haussmann (1787-1876), protestant, commissaire des guerres et intendant militaire de Napoléon Ier et d'Ève-Marie-Henriette-Caroline Dentzel, fille du général et député de la Convention Georges Frédéric Dentzel, baron d'Empire, et le petit-fils de Nicolas Haussmann 1759-1847, député de l'Assemblée Législative et de la Convention, administrateur du département de Seine-et-Oise, commissaire aux armées.
Il fait ses études au lycée Condorcet à Paris, puis il entame un cursus de droit tout en étant élève au conservatoire de musique de Paris.
Le 21 mai 1831 il est nommé Secrétaire Général de la préfecture de la Vienne à Poitiers puis le 15 juin 1832 sous-préfet d'Yssingeaux, en Haute-Loire.
Il fut successivement sous-préfet de Lot-et-Garonne à Nérac le 9 octobre 1832, de l'Ariège à Saint-Girons le 19 février 1840, de la Gironde à Blaye le 23 novembre 1841, puis préfet du Var à Draguignan le 24 janvier 1849, de l'Yonne 15 mai 1850, et de la Gironde en novembre 1851.
En poste à Blaye, il fréquente la bourgeoisie bordelaise, au sein de laquelle il rencontre Octavie de Laharpe avec laquelle il se marie le 17 octobre 1838 à Bordeaux. Elle est protestante comme lui et lui a donné deux filles : Henriette, qui épousa en 1860 Camille Dollfus, homme politique, et Valentine, qui épousa en 1865 le vicomte Maurice Pernety, chef de cabinet du préfet de la Seine, puis, après son divorce 1891, Georges Renouard 1843-1897, le fils de Jules Renouard. Il a une autre fille, Eugénie née en 1859, de sa relation avec l'actrice Francine Cellier 1839-1891, et descendance notamment dans la famille du baron Marcel Bich.
Sous l'administration d'Haussmann, les travaux et projets girondins ont été importants. De nombreuses lignes de chemin de fer ont été construites ainsi que des usines à Bègles. Les travaux de défense de la Pointe de Grave ont été finalisés. Au niveau social, il a mis en place un système d'allocations aux filles mères indigentes pour les aider à élever leur enfant et encouragé l'installation de bureaux de bienfaisance. À Bordeaux, de nombreuses voies ont été percées, l'éclairage au gaz et l'adduction d'eau se sont améliorés : projet de construction de trois fontaines monumentales.
Présenté à Napoléon III par Victor de Persigny, ministre de l'Intérieur, il devient préfet de la Seine le 22 juin 1853, succédant ainsi à Jean-Jacques Berger, jusqu'en janvier 1870. En 1857, il devient sénateur et 20 ans plus tard, député de la Corse.
Le 29 juin 1853, l'Empereur lui confie la mission d'assainir et embellir Paris.
La transformation de Paris
Napoléon III remet au baron Haussmann le décret d'annexion à Paris des communes suburbaines 1860
Avenue de la Grande-Armée
Au milieu du XIXe siècle, Paris se présente à peu près sous le même aspect qu'au Moyen Âge : les rues y sont encore sombres, étroites et insalubres.
Lors de son exil en Angleterre 1846-1848, Louis-Napoléon Bonaparte fut fortement impressionné par les quartiers ouest de Londres ; la reconstruction de la capitale anglaise à la suite du grand incendie de 1666 avait fait de cette ville une référence pour l'hygiène et l'urbanisme moderne. L'Empereur voulait faire de Paris une ville aussi prestigieuse que Londres : tel fut le point de départ de l'action du nouveau préfet.
L'idée maîtresse de ces énormes travaux urbains était de permettre un meilleur écoulement des flux d'une part des hommes et des marchandises pour une meilleure efficacité économique, d'autre part de l'air et de l'eau, en adéquation avec les théories hygiénistes héritées des Lumières et qui sont alors en plein essor, notamment en réaction à l'épidémie de choléra de 1832. Cette campagne fut intitulée Paris embellie, Paris agrandie, Paris assainie.
Un autre objectif, politiquement moins défendu, était de prévenir d'éventuels soulèvements populaires, fréquents à Paris : après la Révolution de 1789, le peuple s'est soulevé notamment en juillet 1830 et en juin 1848. En assainissant le centre de Paris, Haussmann a déstructuré les foyers de contestation : parce qu'éparpillée dans les nouveaux quartiers, il était plus difficile à la classe ouvrière de lancer une insurrection.
Par ailleurs, Haussmann écrit à Napoléon III qu'il faut accepter dans une juste mesure la cherté des loyers et des vivres … comme un auxiliaire utile pour défendre Paris contre l'invasion des ouvriers de la province.
Haussmann a l'obsession de la ligne droite, ce que l'on a appelé le culte de l'axe au XIXe siècle; pour cela, il est prêt à amputer des espaces comme le jardin du Luxembourg mais aussi à démolir certains bâtiments comme le marché des Innocents ou l'église Saint-Benoît-le-Bétourné.
En dix-huit ans, des boulevards et avenues sont percés de la place du Trône actuelle place de la Nation à la place de l'Étoile, de la gare de l'Est à l'Observatoire. Les Champs-Élysées sont aménagés.
Dans le but d'améliorer l'hygiène, par une meilleure qualité de l'air, suivant les recommandations de son prédécesseur le préfet Rambuteau, il aménage un certain nombre de parcs et jardins : ainsi sont créés un square pour chacun des quatre-vingt quartiers de Paris, ainsi que le parc Montsouris et le parc des Buttes-Chaumont.
D'autres espaces déjà existants sont aménagés. Ainsi les bois de Vincennes et de Boulogne deviennent des lieux prisés pour la promenade. Il transforme aussi la place Saint-Michel et sa fontaine, dont la saleté l'avait marqué lorsque, étudiant, il y passait pour se rendre à l'École de droit.
Des règlements imposent des normes très strictes quant au gabarit et à l'ordonnancement des maisons. L'immeuble de rapport et l'hôtel particulier s'imposent comme modèles de référence. Les immeubles se ressemblent tous : c'est l'esthétique du rationnel.
Afin de mettre en valeur les monuments nouveaux ou anciens, il met en scène de vastes perspectives sous forme d'avenues ou de vastes places. L'exemple le plus représentatif est la place de l'Étoile, dont le réaménagement est confié à Hittorff.
Haussmann fait aussi construire ou reconstruire des ponts sur la Seine ainsi que de nouvelles églises, comme Saint-Augustin ou la Trinité.
Il crée en parallèle, avec l'ingénieur Belgrand, des circuits d'adduction d'eau et un réseau moderne d'égouts, puis lance la construction de théâtres théâtre de la Ville et théâtre du Châtelet, ainsi que deux gares Gare de Lyon et Gare de l'Est. Il fait construire les abattoirs de la Villette afin de fermer les abattoirs présents dans la ville.
En 1859, Haussmann décide d'étendre la ville de Paris jusqu'aux fortifications de l'enceinte de Thiers. Onze communes limitrophes de Paris sont totalement supprimées et leurs territoires absorbés par la ville entièrement (Belleville , Grenelle, Vaugirard, La Villette ou en grande partie Auteuil, Passy, Batignolles-Monceau, Bercy, La Chapelle, Charonne, Montmartre. La capitale annexe également une partie du territoire de treize autres communes compris dans l'enceinte. Dans le même temps, il procède à l'aménagement du Parc des Princes de Boulogne-Billancourt, dans le cadre d'une vaste opération immobilière sous l'égide du duc de Morny.
La transformation de la capitale a un coût très élevé puisque Napoléon III souscrit un prêt de 250 millions de francs-or en 1865, et un autre de 260 millions de francs en 1869, en tout, 25 milliards d'euros d'aujourd'hui. En plus de cela, la banque d'affaires des Pereire investit 400 millions de francs jusqu'en 1867 dans des bons de délégation, créés par un décret impérial de 1858. Ces bons de délégation sont des gages sur la valeur des terrains acquis puis revendus par la Ville : la spéculation a donc aidé le financement des travaux parisiens.
On estime que les travaux du baron Haussmann ont modifié Paris à 60 % : 18 000 maisons ont été démolies entre 1852 et 1868 dont 4349 avant l'extension des limites de Paris en 1860 , à comparer au parc de 30 770 maisons recensées en 1851 dans le Paris avant annexion des communes limitrophes.
L'influence en province
Haussmann a su aussi propager son savoir-faire dans les différentes régions françaises sous le Second Empire et le début de la Troisième République. Les villes les plus influencées sont Rouen qui a vu détruites plus de cinq cents maisons et deux églises au cours de sa transformation, Dijon, Angers, Lille, Toulouse, Avignon, Montpellier, Toulon, Lyon, Nîmes et Marseille qui est l'une des villes dont la physionomie a le plus changé. La ville d'Alger, alors colonie française, a également été profondément remaniée à cette époque. Hors de France, plusieurs capitales : Bruxelles, Rome, Barcelonne, Madrid et Stockholm s'inspirent de ses idées avec l'ambition de devenir un nouveau Paris Ch page 25. Il est intervenu aussi à Istambul et au Caire.
La part personnelle de Haussmann dans les Grands Travaux
Quel rôle Georges Eugène Haussmann a-t-il joué pour que l’on parle d’« hausmannisme » et d’« haussmanisation », dès 1868 ? Bien qu’il ait reconnu la part de Napoléon III dans l’ouverture de voies nouvelles (plus de 70), il a revendiqué la paternité des Grands Travaux, et cela même quand leur financement a été remis en cause par « Les comptes fantastiques d’Haussmann », titre d’un article de Jules Ferry publié en 1868 dans le journal Le Temps, et quand il a été remercié en 1870.
Au sens strict et juridique du terme, le préfet est chargé des enquêtes d’utilité publique pour les expropriations préalables aux percements. La décision de décréter l’ouverture d’une voie nouvelle revient au ministre de l’Intérieur. Mais il est deux domaines dans lesquels Haussmann a excellé, du moins initialement : le financement des travaux et la réorganisation des services municipaux. Sous la préfecture de Rambuteau et de Berger, dans les années 1840, le principe était de ne dépenser pour les travaux que l’excédent budgétaire. Selon l’idée initiale des « dépenses productives » formulée par Persigny, Haussmann a décidé que cet excédent ne servirait qu’à couvrir les intérêts d’emprunts qui seraient remboursés par la plus-value des terrains désenclavés par les percées. Haussmann a donc imaginé successivement trois systèmes : l’emprunt (75 millions de francs en 1855, 140 en 1860, 250 en 1865), la vente de bons de la Caisse des travaux de Paris servant à l’achat de terrains et les « bons de délégation » (servant à subventionner les entrepreneurs concessionnaires). La Ville finance le remboursement de ses emprunts réels par des emprunts déguisés ; c’est le système dénoncé par Jules Ferry.
Haussmann découvre à la tête des services techniques de la Ville des ingénieurs en chef des Ponts-et-Chaussées à son avis peu compétents, et surtout insuffisamment soumis à ses ordres. Il choisit de mettre en place des services provisoirement parallèles, confiés à des ingénieurs en lesquels il a confiance, qu’il a connus dans ses préfectures successives, comme Eugène Belgrand (dans l’Yonne) ou Adolphe Alphand (à Bordeaux). Belgrand créera un système d’alimentation en eau de source de la capitale, captée dans la Vanne et la Dhuys et conduite par des aqueducs à la romaine. Il mettra également en place un chantier d'assainissement aboutissant à l’établissement d’un réseau moderne d’égout. Alphand a supervisé le système végétal haussmannien. Quantitativement, on n’aura jamais autant planté d’arbres, semé de pelouses, aménagé de parcs et de jardins dans Paris : deux « bois » (de Boulogne et de Vincennes), trois « parcs » (Monceau, les Buttes Chaumont et Montsouris), deux jardins, dix-neuf squares, d’innombrables places et avenues plantées, dont notamment l’avenue Foch, le boulevard Richard-Lenoir ou l’avenue de l’Observatoire.
L’œuvre accomplie
Si le boulevard de Strasbourg (et, d’une certaine manière, ses prolongements : les boulevards de Sébastopol et Saint-Michel), la rue des Écoles et la rue de Rivoli (continuée en 1848) ne peuvent pas être attribués à Haussmann, les autres se sont faits sous sa conduite, notamment le boulevard Saint-Germain. Il jugeait la rue des Écoles située trop haut dans la montée de la rive gauche, et obtint, contre l’avis de l’empereur, d’ouvrir le boulevard Saint-Germain sur le pont de Sully et que celui-ci ne soit pas perpendiculaire à la Seine. À ces « traversées », il faut rajouter les avenues Foch, Voltaire ou Daumesnil, les boulevards Barbès, Gambetta ou Raspail. Parmi les nombreuses percées, il faut d’abord compter celles qui désenclavent les gares ferroviaires, celles-ci étant, pour Napoléon III, les « véritables portes » de la capitale : le boulevard de Strasbourg, la rue de Rennes, la rue Auber, le boulevard Magenta, le boulevard Diderot ou le boulevard Saint-Marcel. De même nature sont les diagonales comme l’achèvement de la rue La Fayette (commencée sous Charles X), l’avenue de l’Opéra ou la rue Turbigo. Il y a enfin les rocades, les rues des Pyrénées, de Tolbiac, d’Alésia, de Vouillé ou de la Convention.
Contrairement aux étroites rues d’origine médiévale, toutes ces percées sont strictement rectilignes, à l’instar de la rue Rambuteau ouverte sous la monarchie de Juillet (1845), mais à l’exception du boulevard Saint-Germain, qui s’oriente vers le nord à ses deux extrémités pour former le symétrique des Grands Boulevards par rapport à la rue de Rivoli, nouvel axe est-ouest de la capitale. Alors que la rue Rambuteau mesure treize mètres de largeur, et les voies plus anciennes quelquefois bien moins, les percées dites haussmanniennes font vingt ou même trente mètres, l’avenue Foch parvenant à plus de cent mètres.
Pour la procédure du percement, la Ville (ou un concessionnaire) exproprie les terrains nécessaires et, après la démolition des maisons, revend les parcelles nouvellement découpées (c’est une sorte de lotissement linéaire), après avoir effectué un nivellement et un alignement. Lors de la vente aux particuliers et à des constructeurs d’immeubles, Haussmann impose un cahier des charges, qui fixe la nature des matériaux pour la façade (de la pierre de taille ou du calcaire de Château-Gaillard ou de La Roche-Guyon pour les rues principales), et précise que les maisons, dans chaque îlot, doivent avoir « les mêmes hauteurs d’étage et les mêmes lignes principales de façade », « avec balcons, corniches et moulures ». Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’existe aucun règlement plus précis caractérisant l’immeuble « haussmannien » (qu’il aurait été difficile de faire voter), mais seulement des prescriptions surveillées par les architectes voyers de la Ville.
Un autre volet de l’œuvre du second Empire auquel Haussmann a activement participé est l’annexion de communes périphériques de Paris. L’agrandissement de la capitale est naturellement suggéré par le faubourg compris entre les limites administratives (le mur des Fermiers généraux) et l’enceinte fortifiée édifiée par Thiers de 1841 à 1844. Il s’agit de faire entrer dans Paris non seulement des jardins maraîchers et des villages (comme Belleville ou Vaugirard), mais aussi des espaces urbains composés de lotissements (Beaugrenelle, la plaine de Passy, les Batignolles) et des zones industrielles. Il s’agit aussi d’intégrer des banlieues qui échappent à l’octroi. La loi d’annexion, votée le 26 mai 1859, prendra effet le 1er janvier 1860.
Les communes ou parties de communes annexées profiteront de la nouvelle voirie, de l’alimentation en eau, d’églises nouvelles, de mairies, d’écoles, de marchés, etc. La capitale est redécoupée en vingt arrondissements, chacun étant doté d’une mairie. Certaines ayant été édifiées sous la monarchie de Juillet et d’autres sous la IIIe République, seules cinq mairies datent de la période haussmannienne, celle des Ier (J.-I. Hittorff, architecte, 1855-1860), IIIe (V. Calliat, 1864-1867), IVe A.-N. Bailly, 1862-1867, XIe E.-F. Gancel, 1862-1865, XIIIe (P.-E. Bonnet, 1867-1877) et XXe (C. Salleron, 1867-1877) arrondissements.
L’œuvre architecturale du second Empire a été considérable. Nous n’évoquerons que l’Hôtel-Dieu (E.-J. Gilbert, 1864-1876), qui a entraîné l’arasement de presque la moitié de l’île de la Cité, les Halles centrales (V. Baltard et F. Callet, 1854-1874) et, du même Baltard, l’église Saint-Augustin (1860-1871).
Le mythe Haussmann
Il court sur Haussmann et la période haussmannienne beaucoup de légendes et de contre-vérités. La plus importante est celle qui porte sur les objectifs stratégiques des percées : elles auraient été tracées pour permettre les charges de cavalerie et pour utiliser l’artillerie contre les émeutiers. Cette hypothèse avancée autrefois par certains historiens ne repose sur aucun fondement, excepté pour le boulevard Richard-Lenoir (le couvrement du canal Saint-Martin) et pour le boulevard Voltaire. Dans le premier cas, le canal servait de retranchement aux ouvriers en révolte dans le faubourg Saint-Antoine. Dans le second, le boulevard permet de relier les casernes d’infanterie du Château-d’Eau (place de la République) et de cavalerie de Vincennes.
Une autre légende laisse penser que les ouvriers chassés du centre par les démolitions haussmanniennes se seraient réfugiés dans les arrondissements périphériques. Des études historiques publiées dans les années 2010 nous apprennent que les artisans, pour ne pas perdre leur clientèle, se sont entassés dans le centre, et que la périphérie a été peuplée d’ouvriers provenant des provinces.
Haussmann est souvent présenté comme urbaniste ou comme architecte. S’il a assumé des tâches administratives et mené des opérations financières, il n’a pas à proprement parler dessiné le nouveau plan de Paris qu’on lui attribue. D’ailleurs Haussmann dit, explicitement, que c’est l’architecte Eugène Deschamps qui est l’auteur du « plan de Paris » (1852-1853), c’est-à-dire qui en a tracé concrètement les percées. De la même manière, il est abusif de parler d’immeuble « haussmannien ». Il n’a pas inventé l’immeuble avec enfilade de pièces de réception en façade et des pièces de service sur cour. Il s’agit ici de la version bourgeoise de l’appartement des hôtels particuliers de l’Ancien Régime mise en œuvre sous la monarchie de Juillet. Certains des premiers immeubles construits rue de Rivoli dès 1852 ont d’ailleurs une allure éminemment « haussmannienne ». Si ce modèle d’immeubles s’est diffusé ensuite, c’est par une sorte de consensus entre les architectes et par sa visibilité via les recueils et les revues. Haussmann partageait simplement ce modèle.
C’est à contrecœur que Napoléon III renvoie son préfet, le 6 janvier 1870, à cause des abus financiers et de l’opposition politique qui le vise. Haussmann occupe différents postes dans les affaires, voyage en Italie et en Turquie, réside à Paris et au château de Cestas en Gironde, est élu député de la Corse en 1877. En tant que membre de l’Académie des beaux-arts, il se prononce contre la démolition du palais des Tuileries en 1879. Haussmann rédige ses Mémoires en trois volumes (publiés de 1890 à 1893) et meurt le 11 janvier 1891. Pierre Pinon
Honneurs et critiques
L'activité d'Haussmann au service de la transformation de Paris lui a permis d'accéder à la fonction de sénateur en 1857, de membre de l'Académie des beaux-arts en 1867 et de chevalier de la Légion d'honneur en 1847, puis grand officier en 1856 et enfin grand-croix en 1862.
Son titre de baron a été contesté. Comme il l'explique dans ses Mémoires, il a utilisé ce titre après son élévation au Sénat en 1857, en vertu d'un décret de Napoléon Ier qui accordait ce titre à tous les sénateurs mais ce décret était tombé en désuétude depuis la Restauration.
Il aurait refusé, d'une boutade, le titre de duc proposé par Napoléon III cf. section Autour du baron Haussmann. Le Dictionnaire du Second Empire, observe toutefois qu'Haussmann a utilisé ce titre en se fondant de manière abusive sur l'absence de descendance mâle de son grand-père maternel, Georges Frédéric, baron Dentzel dont la baronnat accordé en 1808 par Napoléon était tombé en déshérence.
Son œuvre n'en reste pas moins contestée à cause des sacrifices qu'elle a entraînés ; en outre, les méthodes employées ne s'encombrent pas des principes démocratiques. Les manœuvres financières sont bien souvent spéculatives et douteuses, ce qui nourrit le récit d'Émile Zola dans son roman La Curée.
Par ailleurs, la bulle spéculative immobilière entraînée par ses travaux, qui ont eu leur pendant à Berlin et Vienne a nourri la bulle financière qui s'est achevée par le krach de 1873.
Les lois d'expropriation ont entraîné plus tard de nombreuses contestations et poussé à la faillite de nombreux petits propriétaires qui ont vu leurs biens détruits. En parallèle, les nouveaux règlements imposent des constructions d'un niveau de standing élevé, excluant de facto les classes les moins aisées de la société parisienne.
Cette période de travaux a vu la recrudescence du paludisme dans Paris en occasionnant des creusements importants et de longue durée. Les flaques, mares et autres points d'eau croupissante perduraient longtemps, engendrant une pullulation d'anophèles au milieu d'une grande concentration d'humains. De plus, un grand nombre d’ouvriers venaient de régions infectées et étaient porteurs du plasmodium.
Une partie de la population manifeste son mécontentement en même temps que son opposition au pouvoir. En 1867, Haussmann est interpellé par le député Ernest Picard. Les débats houleux que le personnage suscite au Parlement entraînent un contrôle plus strict des travaux, qu'il avait habilement évité jusque-là.
Jules Ferry rédige la même année une brochure malicieusement intitulée : Les Comptes fantastiques d'Haussmann, par allusion aux Contes fantastiques d'Hoffmann : selon lui, l'haussmannisation parisienne aurait coûté 1 500 millions de francs, ce qui est loin des 500 millions annoncés ; on l'accusa également, à tort, d'enrichissement personnel.
Napoléon III a proposé à trois reprises à Haussmann d'entrer au gouvernement, comme ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et des Travaux Publics, mais le seul titre qu'il est susceptible d'accepter est celui de ministre de Paris, que lui refuse l'Empereur. Cependant, à partir de 1860, le préfet de la Seine assiste au Conseil des ministres.
Haussmann est destitué par le cabinet d'Émile Ollivier le 5 janvier 1870, quelques mois avant la chute de Napoléon III. Son successeur fut Léon Say, mais Belgrand et surtout Alphand conservèrent un rôle prépondérant et poursuivirent son œuvre.
Après s'être retiré pendant quelques années à Cestas près de Bordeaux, Haussmann revint à la vie publique en devenant député bonapartiste de la Corse de 1877 à 1881. Il est écarté de la vie publique en 1885 et en 1890, il perd successivement sa fille ainée et sa femme. Il consacra la fin de sa vie à la rédaction de ses Mémoires 1890-1891, un document important pour l'histoire de l'urbanisme de Paris.
Haussmann, mort le 11 janvier 1891, est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris.
Tombe de Georges Eugène Haussmann cimetière du Père Lachaise, division 4
Autour du baron Haussman
Ernest Renan rapporte que Haussmann aurait fait disparaître une île entière en Bretagne, l'Île-Grande face à Pleumeur-Bodou, pour obtenir la pierre nécessaire à ses travaux. L'écrivain exagère, car l'île est toujours habitée mais il y reste d'imposantes carrières datant de l'époque des travaux haussmanniens.
Haussmann raconte dans ses Mémoires que Napoléon III voulait donner son nom à la partie du boulevard de Sébastopol qui s'étendait sur la rive gauche actuel boulevard Saint-Michel. Le préfet refusa en feignant la modestie. En réalité il espérait, et obtint en fin de compte, que son nom soit attribué à un boulevard dont l'idée lui revenait plus directement et au bord duquel il était né dans une maison qu'il dut d'ailleurs détruire : c'est l'actuel boulevard Haussmann.
Afin de montrer son peu d'attachement aux titres officiels, il rapporte dans ses Mémoires le dialogue suivant, où un interlocuteur lui suggérait qu'il pourrait être nommé duc de la Dhuis, en référence aux travaux d'Haussmann par lesquels l'eau de cette rivière était venue alimenter Paris. Haussmann objecta :
« De la Dhuis ? Mais, duc, ce ne serait pas assez.
— Que voulez-vous donc être ?… Prince ?
— Non ; mais il faudrait me faire aqueduc, et ce titre ne figure pas dans la nomenclature nobiliaire.
L'adjectif haussmannien fait référence à la méthode d'urbanisme par destruction d'anciens quartiers, et la construction d'artères larges et rectilignes que constitue l'urbanisme d'Haussmann.
Bibliographie
Page de titre des Mémoires d'Haussmann, chez Victor Havard, 1890.
Delpont Hubert, Sanchez-Calzadilla Hervé-Yves, Haussmann d'Albret, le sous-préfet de Nérac 1832-1840 le notable landais 1840-1891, Nérac, 1993, 370 p.
« Haussmann Georges Eugène, baron, dans Robert et Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 1889
Le Paris d'Haussmann, Patrice de Moncan & Claude Heurteux; éd. Du Mecene 2002; coll. La ville retrouvée ;
Le Paris d'Haussmann, Patrice de Moncan ; Les Éditions du Mécène 2009; coll. Paris d'hier et d'aujourd'hui ;
Transformation und Embellissement von Paris in der Karikatur: Zur Umwandlung der französischen Hauptstadt im Zweiten Kaiserreich durch den Baron Haussmann, Rosemarie Gerken; éd. Olms, Georg 1997
Les Mémoires d'Haussmann, Françoise Choay ; éd. Seuil 2000; coll. Philosophie Générale ;
Haussmann le grand, Georges Valance ; éd. Flammarion 2000; coll. Grandes biographies ;
Haussmann au crible, Nicolas Chaudun ; éditions des Syrtes 2000; coll. Biographies ;
Mémoires du baron Haussmann, Georges Eugène Haussmann ; éd. Adamant Media Corporation 2001
Mémoires du baron Haussmann : Tome 3 : Grands travaux de Paris, Georges Eugène Haussmann ; éd. Adamant Media Corporation 2001;
Haussmann - La gloire du Second Empire, Jean des Cars, éd. Perrin 2008
Haussmann, Georges-Eugène, préfet-baron de la Seine, Nicolas Chaudun; éd. Actes Sud ; 2009
Atlas du Paris haussmannien. La ville en héritage du Second Empire à nos jours, Pierre Pinon ; éd. Parigramme ; 2002
Paris Haussmann. Le pari d'Haussmann, Pierre Pinon & Jean des Cars, éd. Picard 1999
Pierre Pinon, Paris pour Mémoire : Le livre noir des destructions haussmanniennes, Paris, Parigramme, 2012, 664 p.
Joseph Valynseele, Haussmann : Sa famille et sa descendance, Paris, Christian, 1982, 115 p.
Georges-Eugène Haussmann, Monique Rauzy, collection Figures de l'Histoire, Hatier, 2002
P. Casselle éd., Commission des embellissements de Paris : rapport à l'empereur Napoléon III rédigé par le comte Henri Siméon décembre 1853, Paris : Rotonde de la Villette, 2000, 205 p.
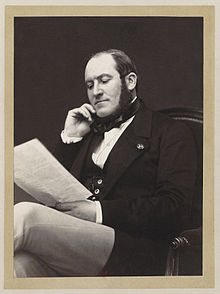    
Posté le : 26/03/2016 17:33
Edité par Loriane sur 27-03-2016 19:02:07
Edité par Loriane sur 27-03-2016 19:03:21
|
|
|
|
|
Rosa Luxembourg |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 5 mars 1871 ou 1870 ou 1871 naît Rosa Luxemburg
à amość Empire russe, actuelle Pologne, son nom est parfois retranscrit en français Rosa Luxembourg militante socialiste et théoricienne marxiste.
Née sujette polonaise de l'Empire russe, elle prend la nationalité allemande afin de poursuivre en Allemagne son militantisme socialiste. Figure de l'aile gauche de l'Internationale ouvrière, révolutionnaire et partisane de l'internationalisme, elle s'oppose à la Première Guerre mondiale, ce qui lui vaut d'être exclue du SPD. Elle cofonde la Ligue spartakiste, puis le Parti communiste d'Allemagne. Deux semaines après la fondation du Parti communiste, elle meurt assassinée à Berlin le 15 janvier 1919 pendant la révolution allemande, lors de la répression de la révolte spartakiste. Cette militante socialiste et communiste, théoricienne marxiste, révolutionnaire, journaliste, à pour parents Eliasz Luksemburg Line Löwenstein son conjoint est Gustav Lübeck
Ses idées ont inspiré des tendances de la gauche communiste et donné naissance, a posteriori, au courant intellectuel connu sous le nom de luxemburgisme. L'héritage de Rosa Luxemburg a cependant été revendiqué, de manière contradictoire, par des mouvances politiques très diverses.
En bref
Née près de Lublin, en Pologne sous domination russe, Rosa Luxemburg est issue d'une famille de commerçants juifs de tradition libérale.
Après des études au lycée de Varsovie, elle entre dès 1887 en relation avec des militants socialistes polonais. Obligée de passer à l'étranger à cause de son activité politique, elle s'installe à Zurich, où elle étudie l'économie politique et devient marxiste. Avec son compagnon Leo Jogiches, elle participe en 1893 à la fondation du Parti social-démocrate du royaume de Pologne, qu'elle représente au congrès de Londres de la IIe Internationale (1896).
Deux années plus tard, elle contracte un mariage blanc avec un médecin allemand afin de pouvoir militer dans le Reich, et s'inscrit au Parti social-démocrate (S.P.D.). Elle s'impose comme une des figures de proue de l'aile gauche du parti, et dirige la contre-attaque contre les thèses révisionnistes d'Eduard Bernstein ; elle soumet, dans sa brochure Réforme ou Révolution (1889), le réformisme de Bernstein à une critique acérée, s'attaquant en particulier au parlementarisme qu'il préconisait. Brillante journaliste, elle assure la rédaction en chef du quotidien Sächsische Arbeiterzeitung et collabore à plusieurs publications sociales-démocrates, dont Die neue Zeit, la revue théorique dirigée par Kautsky. Oratrice très demandée, elle parcourt l'Allemagne au gré des meetings et des campagnes du parti.
Mais cette activité au sein du S.P.D. ne l'a jamais détournée des affaires polonaises. En décembre 1905, elle gagne clandestinement Varsovie en révolution. Elle propose aux militants une compréhension globale du mouvement et fixe dans ses brochures les buts immédiats à atteindre : contrecarrer l'orientation putschiste des courants nationalistes et étendre la révolte contre le tsarisme à la paysannerie et à l'armée. Emprisonnée en mars 1906, elle est libérée en juillet et peut quitter Varsovie. Elle rédige alors Grèves de masses, parti et syndicats, dans lequel elle tire pour la classe ouvrière allemande les enseignements de la révolution russe et polonaise.
Sa conception de la grève politique et le mot d'ordre central qu'elle préconise pour l'Allemagne — « la république » — entraîne en 1910 sa rupture avec Kautsky et la majorité de gauche du S.P.D. C'est aussi vers cette époque qu'elle se lance dans une campagne de dénonciation du militarisme allemand et qu'elle se lie avec Karl Liebknecht. En août 1914, après le vote des crédits de guerre par les députés sociaux-démocrates, elle connaît un moment de désespoir. Mais bientôt une réunion des opposants internationalistes se tient à son domicile. Arrêtée en février 1915, puis de nouveau en juillet 1916 (par « mesure de protection »), elle ne sera libérée que par la révolution. Aussi est-ce depuis sa prison qu'elle fait parvenir la brochure La Crise de la social-démocratie (mars 1916), signée Junius, et ses contributions aux Lettres de Spartakus, voix de l'opposition révolutionnaire de la social-démocratie.
À sa sortie de la forteresse de Breslau (9 nov. 1918), son premier geste est de tenir un meeting sur la place de la ville. Pendant les deux mois qui lui restent à vivre, cette femme va se dépenser sans compter, « comme une chandelle qui brûle aux deux bouts », à la tête de la ligue Spartakus, puis du Parti communiste allemand, fondé en janvier 1919. Lucide sur la difficulté de mener à terme la révolution socialiste, elle compte sur le développement du mouvement de grèves pour arracher les masses à l'influence des dirigeants sociaux-démocrates. Mais la droite décide de passer à la contre-offensive. En riposte à une mesure provocatrice du gouvernement, les ouvriers de Berlin déclenchent, le 6 janvier, l'insurrection. Opposée à celle-ci, Rosa Luxemburg comprend qu'il faut « agir vite ». Mais ni elle-même ni aucun chef du parti ne fut en mesure de diriger le combat, qui tourna à l'avantage de la contre-révolution. Le 14, elle écrit son dernier article, « L'ordre règne à Berlin ». Arrêtée avec Liebknecht par des officiers des corps francs, celle que Franz Mehring qualifiait de « plus géniale tête que le marxisme ait produite depuis Karl Marx » eut le crâne défoncé à coups de crosse, et son corps fut jeté dans un canal du parc de Tiergarten.
Martyre de la cause révolutionnaire, Rosa Luxemburg s'impose aussi comme une des plus importantes théoriciennes de la pensée marxiste. Sa contribution la plus originale réside dans l'approfondissement de la notion de reproduction élargie du capital. Combattant la vision réformiste d'un système capitaliste qui parviendrait à résoudre ses contradictions, elle cherche dans L'Accumulation du capital (1913) à démontrer que le capitalisme ne peut échapper à la ruine ; elle précise comment le capital a besoin de marchés non capitalistes pour réaliser la plus-value ; elle conclut ainsi que, le jour où le capital aura désintégré toutes les formes antérieures et où la mondialisation du marché sera un fait accompli, la crise sera inéluctable. Cette conception, fortement teintée de catastrophisme, n'est pas sans implications quant à ses positions politiques, particulièrement en ce qui concerne l'organisation du prolétariat : l'aggravation des contradictions du système lui fait considérer que seul, et spontanément, le prolétariat peut devenir révolutionnaire, donc qu'il faut privilégier la grève de masse. Aussi le regroupement de l'avant-garde ouvrière consciente se réalise-t-il essentiellement au cours de la lutte, le parti apparaissant comme un produit de la crise révolutionnaire ; en cela, elle s'oppose à Lénine et aux bolcheviks, qui lui reprochent de surestimer les capacités politiques du mouvement de masse. Après sa mort, les disciples de Rosa Luxemburg cristalliseront ses idées dans une théorie de la « spontanéité révolutionnaire ».
Enfin, en tant que dirigeante du Parti social-démocrate polonais, Rosa Luxemburg intervint activement dans le débat sur la question nationale Question nationale et autonomie, 1908 ; La Révolution russe, 1918 : limitant le fait national à un phénomène culturel, elle stigmatise dans le nationalisme un moyen pour la bourgeoisie d'occulter la lutte de classes et se prononce contre le droit des nations à disposer d'elles-mêmes ; cette position sera combattue par toutes les autres tendances du mouvement socialiste, et particulièrement par les bolcheviks, qui lui font grief d'ignorer la dimension politique du problème national. Jean-Claude Klein
Sa vie
Różalia Luksemburg est née le 5 mars 18702, ou plus probablement en 1871 dans la ville polonaise de Zamość, dans le gouvernement de Lublin.
Elle est le cinquième enfant d'une famille juive aisée vivant dans la partie orientale de l'actuelle Pologne, alors territoire de l'Empire russe. Ses parents sont le marchand de bois Eliasz Luksenburg et sa femme Line née Löwenstein. En 1873, Eliasz Luksenburg ayant fait de mauvaises affaires et espérant améliorer sa situation en ville, la famille emménage à Varsovie, ce que Różalia Luksemburg, âgée de trois ans, vit péniblement5. Alors qu'elle est âgée de cinq ans, on lui diagnostique par erreur une tuberculose osseuse6 ; il est probable qu'elle souffrait d'une forme de luxation. Sa famille lui fait plâtrer la jambe et elle garde le lit toute une année. Lorsqu'elle est déplâtrée, l'enfant a une jambe plus courte que l'autre : elle souffre ensuite, sa vie durant, d'une forte claudication.
La jeune fille fréquente à Varsovie, à partir de 1880, le deuxième lycée de jeunes filles : elle y est admise malgré l'existence d'un quota maximal de Juifs acceptés chaque année, en fonction d'un système de notation plus exigeant que pour les non-Juifs. Elle prend alors pour la première fois conscience de son statut de juive et de la discrimination qui y est rattachée. En 1881, un pogrom éclate à Varsovie : la famille s'en sort indemne, mais Różalia demeure profondément marquée par cette confrontation avec les conséquences de l'antisémitisme. Elle grandit par ailleurs dans un milieu familial petit-bourgeois et peu exaltant : en grandissant, Różalia ne se sent proche d'aucun de ses parents, son père, homme d'affaires peu avisé, n'étant en rien un modèle pour elle. Elle se sent en outre étrangère à la communauté juive polonaise, qu'elle n'apprécie guère.
Le 14 juin 1887, elle quitte le lycée, obtenant la mention A très bien dans quatorze matières, l'appréciation d'ensemble étant très bien. Son bulletin scolaire indique le nom Rosalie Luxenburg, retranscription russe de son patronyme polonais.
Débuts politiques en Pologne et en Suisse.
L'intérêt de la jeune fille pour la politique est difficile à dater : la lecture des œuvres d'Adam Mickiewicz semble lui avoir donné le goût de l'idéalisme et lui avoir insufflé le désir de changer le monde11. Dès sa sortie du lycée, elle intègre un groupe socialiste clandestin qui soutient le programme de l'organisation révolutionnaire Prolétariat et ambitionne de fonder un parti ouvrier. En 1889, le climat politique menaçant en Pologne l'incite à partir étudier en Suisse, où se retrouvent alors de nombreux étudiants polonais engagés et, plus largement, des révolutionnaires européens exilés.
Le 18 février 1889, arrivée en Suisse, elle se fait enregistrer à la municipalité d'Oberstrass, dans les environs de Zurich, en orthographiant son nom Luxemburg, retranscription plus cosmopolite qu'elle conserve par la suite. Elle loue une chambre chez un vieux militant socialiste allemand recommandé par des amis, Karl Lübeck, chez qui elle découvre la presse du SPD. Elle se lie à divers militants socialistes et rencontre, parmi les exilés politiques, le théoricien marxiste russe Gueorgui Plekhanov, qui l'intimide alors beaucoup. La jeune femme n'est pas encore sûre de l'étendue de sa vocation militante.
Leo Jogiches en 1890.
À l'automne 1890, Rosa Luxemburg fait la connaissance de Leo Jogiches, militant d'origine lituanienne qui bénéficie déjà d'une forte réputation dans le milieu socialiste. Rosa Luxemburg et Leo Jogiches entament une liaison, et la jeune femme abandonne, sous l'influence de son amant, l'étude des sciences naturelles au profit de l'économie, de la philosophie et du droit. La rencontre de Leo Jogiches bouleverse la vie de Rosa Luxemburg, qui s'adonne désormais toute entière à la politique, sans délaisser pour autant ses études. En 1892, elle entraîne Jogiches, qui se trouve alors isolé parmi les révolutionnaires russes, dans l'aventure de la création d'un parti politique polonais. Rosa Luxemburg s'écarte de Karl Marx sur la question de la souveraineté polonaise, à laquelle elle n'est pas favorable : pour elle, l'appartenance à une nation divise les ouvriers au lieu de les unir, et les ouvriers polonais et russes doivent au contraire unir leurs forces ; dans cette optique, le prolétariat polonais n'aurait rien à gagner dans son appartenance à un État bourgeois indépendant. La révolution en Pologne lui parait devoir s'inscrire dans un but plus large, celui du renversement de l'absolutisme en Russie : la renaissance de la Pologne en tant que nation aurait donc pour conséquence de retarder la fin du tsarisme en Russie, en allant à l'encontre de l'unité du prolétariat de toutes les nations de l'Empire russe. Pour Rosa Luxemburg, ce n'est qu'une fois ce but prioritaire réalisé, et une République démocratique substituée au tsarisme, que pourrait se réaliser une libération nationale polonaise, qui apporterait ensuite aux Polonais le droit de s'administrer eux-mêmes.
En 1893, Rosa Luxemburg fonde, de concert avec Leo Jogiches et Julian Marchlewski, la Social-Démocratie du Royaume de Pologne;SDKP, rebaptisée en 1900 Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie — Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, soit SDKPiL — lors de l'alliance avec des socialistes lituaniens qui se pose en parti rival du Parti socialiste polonais PPS, créé en 1892 et qui, au contraire, milite pour l'indépendance de la Pologne. La SDKP compte à ses débuts deux cents membres. Les subsides de la mère de Leo Jogiches aident à financer un journal, La Cause ouvrière, dont Rosa Luxemburg est rédactrice en chef, signant par ailleurs une grande partie des articles sous divers pseudonymes. En août 1893, Rosa Luxemburg fait sa première intervention en public au congrès de l'Internationale ouvrière, au cours duquel elle plaide pour la reconnaissance de la SDKP. Sa première tentative échoue, mais la SDKP est reconnue en 1896 par l'Internationale.
Le conflit entre PPS et SDKP s'envenime bientôt : Rosa Luxemburg attaque nettement le nationalisme du parti socialiste rival dans le journal parisien des exilés Sprawa Robotnicza La cause ouvrière et soutient en sens inverse que la Pologne ne peut retrouver son indépendance que par une révolution dans l'Empire allemand, en Autriche-Hongrie et en Russie. Priorité doit à ses yeux être accordée à la lutte contre la monarchie et le capitalisme dans toute l'Europe ; ce n'est qu'après la victoire des révolutionnaires que le droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes pourra se réaliser. Cette conviction constitue par la suite une partie de sa querelle avec Lénine qui regarde les mouvements de libération de la Pologne et des autres nationalités comme le premier pas vers le socialisme et souhaite les encourager. Rosa Luxemburg et Leo Jogiches vivent une vie militante très active, mais leur relation connaît des hauts et des bas : Jogiches, qui se consacre entièrement à ses activités révolutionnaires, est peu disponible pour une vie amoureuse stable tandis que Rosa Luxemburg aspire à une véritable relation de couple ; elle tend également à affirmer son indépendance face au caractère autoritaire de son compagnon. En 1896, la SDKP est démantelée en Pologne par une vague d'arrestations et La Cause ouvrière doit cesser de paraître. En 1897, Rosa Luxemburg est reçue à Zurich docteur magna cum laude, avec comme sujet de thèse le développement industriel de la Pologne. En septembre de cette même année, sa mère meurt ; Rosa Luxemburg vit difficilement le fait de n'avoir pas été à ses côtés. À la fin des années 1890, le couple décide que Rosa Luxemburg ira s'installer en Allemagne, où Jogiches estime pouvoir trouver un auditoire politique plus conforme à ses aspirations en nouant, par l'entremise de sa compagne qui lui servira d'émissaire, des relations avec le Parti social-démocrate d'Allemagne.
Activités au sein de la social-démocratie allemande
En tant que sujette russe, Rosa Luxemburg court le risque d'être expulsée d'Allemagne pour raisons politiques : aussi contracte-t-elle un mariage blanc avec Gustav Lübeck, le fils de Karl Lübeck, afin d'acquérir la nationalité allemande. Le mariage, dans lequel les deux époux ne voyaient qu'une formalité, ne pourra finalement être dissous qu'au bout de cinq ans de procédures légales pénibles. Elle entre en Allemagne sous le nom de Rosalia Lübeck. Installée à Berlin, elle se familiarise rapidement avec le Parti social-démocrate SPD où elle multiplie les rencontres. Bientôt remarquée pour son énergie et son intelligence politique, elle est envoyée dès juin 1889 en Haute-Silésie – partie de la Pologne annexée par le Royaume de Prusse au XVIIIe siècle – pour prêcher le socialisme auprès des ouvriers polonais à l'occasion des élections. Rosa Luxemburg fait ainsi ses débuts d'agitatrice politique, rôle qu'elle apprécie immédiatement. Les ouvriers, qui n'ont alors jamais rencontré de Frau Doktor, l'accueillent avec curiosité et sympathie. Coupée de son milieu familial, séparée de Jogiches par la distance, Rosa Luxemburg se lance avec passion dans ses activités politiques, malgré les difficultés de l'adaptation à la vie berlinoise et le net climat d'antisémitisme, qu'elle redécouvre en Allemagne après ses années zurichoises. Ses relations avec son compagnon, qui continue de demeurer en Suisse, deviennent difficiles : outre leur séparation géographique, Jogiches évolue vers la marginalité politique, et une certaine aigreur personnelle.
Pendant l'été 1898, Rosa Luxemburg se trouve impliquée dans la querelle réformiste qui éclate alors au sein de la social-démocratie allemande : le théoricien Eduard Bernstein remet en effet en cause l'orientation marxiste en préconisant l'abandon par la social-démocratie de sa ligne révolutionnaire et la transformation du SPD en un grand parti élargi aux classes moyennes. En septembre, Rosa Luxemburg publie en sept livraisons un long article, Réforme sociale ou révolution, qui réfute les thèses de Bernstein ; cet article érudit lui permet de gagner en notoriété et de devenir directeur honoraire du journal Sächsiche Arbeiterzeitung, honneur qui n'avait jamais été dévolu à une femme. Quatre mois après son arrivée en Allemagne, Rosa Luxemburg connaît une notoriété croissante dans le milieu socialiste. Avec notamment Alexandre Parvus et Karl Kautsky, elle mène au congrès de Hanovre de 1899 l'offensive contre Bernstein, dont les thèses sont condamnées. Rosa Luxemburg semble avoir souhaité l'exclusion de Bernstein, mais ce dernier demeure au sein du SPD.
Désormais cadre reconnue pour sa compétence au sein du Parti social-démocrate d'Allemagne, Rosa Luxemburg travaille comme journaliste pour la presse socialiste, comme traductrice elle parle yiddish, polonais, russe, allemand et français, et comme enseignante à l’école du SPD. Elle y donne des cours d’économie, d’histoire de l’économie, d’histoire du socialisme. Elle devient une amie de Karl Kautsky et de sa famille, et une confidente de Clara Zetkin. Entre-temps, ses relations à distance avec Leo Jogiches, dont l'activité politique est dans une impasse, continuent de se dégrader : en 1900, à la suite d'un ultimatum de Rosa Luxemburg, Leo Jogiches vient s'installer à Berlin, mais le couple continue de vivre séparé, Jogiches tenant à ce que leurs relations restent secrètes.
Outre ses activités au SPD, Rosa Luxemburg réactive la SDKPiL. Elle réalise des tournées de conférences à travers toute l'Europe. En 1903, elle devient membre du Bureau socialiste international, l'organe de coordination de l'Internationale ouvrière.
En juillet 1904, à son retour du congrès de l'Internationale, elle est arrêtée et condamnée à trois mois de prison pour avoir critiqué l'empereur Guillaume II dans un discours public : elle effectue sa peine dans la prison de Berlin-Zwickau, dans un certain confort, et profite de son incarcération pour lire de nombreux ouvrages. À cette même époque, Rosa Luxemburg s'oppose vivement aux thèses de Lénine : elle conteste l'idée léniniste d'une insurrection armée, considérant que c'est en élevant la conscience des ouvriers et non en les armant que l'on doit préparer une révolte populaire. Elle s'oppose notamment aux conceptions de Lénine en matière de centralisation de l'autorité et de hiérarchie.
À la suite du Dimanche rouge, le 22 janvier 1905 à Saint-Pétersbourg, la révolution éclate en Russie. Leo Jogiches quitte en février Berlin pour Cracovie, où il fonde une nouvelle publication de la SDKPiL. Il se rend ensuite à Varsovie pour y négocier une alliance avec le Bund, ce que Rosa Luxemburg, hostile à l'idéologie nationaliste des militants juifs, désapprouve vivement. Rosa Luxemburg rejoint temporairement Jogiches à Cracovie durant l'été, rejoint l'Allemagne, puis regagne à nouveau Varsovie en décembre, sous une fausse identité, pour y participer au mouvement insurrectionnel qui se déroule également dans la Pologne orientale. Arrêtée avec Leo Jogiches, elle frôle l'exécution. Un temps assignée à résidence, puis libérée sous caution en tant que citoyenne allemande, elle regagne Berlin en septembre 1906 ; sa liaison avec Leo Jogiches prend fin à cette époque. Jogiches, demeuré en Pologne, est condamné en janvier 1907 à huit ans de bagne en Sibérie mais il s'évade avant d'être déporté et rejoint les milieux de l'émigration politique polonaise à Berlin. En décembre 1906, le tribunal de Weimar condamne Rosa Luxemburg à deux mois de prison pour avoir, lors du congrès du SPD en 1905, incité le prolétariat allemand à suivre l'exemple révolutionnaire russe. Elle effectue sa peine en juin et juillet 1907.
Au congrès du SPD à Mannheim, Rosa Luxemburg contribue à constituer une gauche qui, en face d'une droite et d'un centre du parti désormais rapprochés, adopte une attitude révolutionnaire. Elle publie un pamphlet intitulé Grève de masse, Parti et syndicat, dans lequel elle combine ses expériences russes et allemandes et montre l'exemple d'une grève permanente, liée au sort de la révolution : pour Rosa Luxemburg, le processus révolutionnaire est un mouvement continu, où le parti peut jouer un rôle, mais sans prétendre à la direction de la classe ouvrière. Le parti doit se limiter à un rôle d'éclaircissement du prolétariat et, le jour de l'action venu, la distinction entre dirigeants et dirigés n'aura plus lieu d'être. Rosa Luxemburg dénonce également l'emprise, en Allemagne, de la bureaucratie syndicale, proche de l'aile droite du SPD et rongée par le révisionnisme c'est-à-dire le réformisme. L'ouvrage de Rosa Luxemburg provoque un scandale au sein du SPD et dès 1907, ses relations avec le dirigeant du parti August Bebel sont irrémédiablement compromises. Avec Martov et Lénine, avec qui elle noue une alliance temporaire et de circonstance, elle amende et fait adopter par l'Internationale ouvrière une résolution sur la guerre, stipulant qu'en cas de conflit, le devoir de la classe ouvrière est de se soulever et par là, d'empêcher la guerre et de hâter la fin du capitalisme.
À la même époque, définitivement séparée de Jogiches, Rosa Luxemburg vit une liaison avec Costia Zetkin, un des fils de Clara Zetkin, de quinze ans son cadet : leur relation dure jusqu'en 1912.
Jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, la renommée de Rosa Luxemburg ne cesse de croître dans les milieux politiques. Elle prend part à diverses polémiques au sein du SPD et de l'Internationale ouvrière : sa tendance à citer en exemple la révolution russe de 1905 indispose de nombreux dirigeants sociaux-démocrates allemands, qui craignent dans leur pays une situation comparable. Rosa Luxemburg est par ailleurs très critique envers le comportement des sociaux-démocrates russes, désunis de manière permanente par la scission entre bolcheviks et mencheviks. Soutenue par Karl Kautsky, elle contribue à faire adopter par le Bureau socialiste international une résolution condamnant l'attitude de Lénine. En 1910, une vive polémique l'oppose à Kautsky, jusque-là son ami personnel, au sujet du rôle du parti envers les ouvriers : Rosa Luxemburg continue de soutenir que les travailleurs doivent être poussés à prendre en main leur propre destin, la direction du parti leur cédant le pouvoir ; elle dénonce également les compromissions du SPD qui, en se refusant à revendiquer l'instauration de la république en Allemagne, devient un jouet des partis bourgeois. Kaustky sort nerveusement épuisé de la polémique qui l'oppose à Rosa Luxemburg ; les relations de cette dernière avec les dirigeants sociaux-démocrates allemands sont très dégradées. Au sein de la SDKPiL, elle participe à l'exclusion de Karl Radek, membre du comité de Varsovie qui s'opposait au comité central du parti polonais établi à Berlin.
Sur la question des nationalités, Rosa Luxemburg adopte un point de vue d'internationalisme intégral et s'oppose radicalement à toute forme de nationalisme, considérant que « dans une société de classes, la nation, en tant qu'entité socio-politique, n'existe pas. Pour elle, la question nationale est une question seconde, soit une question tactique et non une question de principe. Le seul droit à l'autodétermination que la social-démocratie doit soutenir est, pour elle, celui de la classe ouvrière : dans son optique, la révolution socialiste internationale mettra fin à la domination nationale, comme à l'exploitation, à l'inégalité des sexes et à l'oppression raciale.
Opposition à la guerre et fondation de la Ligue spartakiste
Dans les années qui précèdent le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxemburg multiplie les activités et les participations à des débats publics, tandis que la fracture politique au sein du SPD, de plus en plus recentré, s'accentue. Elle a renoué des liens d'amitié avec Leo Jogiches, qui l'aide à relire les épreuves de L'Accumulation du capital, son œuvre théorique majeure. Dans cet ouvrage, publié en janvier 1913 et formé à partir des cours d'économie politique qu'elle dispense auprès de militants socialistes, Rosa Luxemburg détaille son analyse du capitalisme : pour elle, l'accumulation ne peut s'effectuer que grâce à l'expansion du capitalisme vers des marchés étrangers ou dans des régions moins développées des mêmes pays. Les marchés non capitalistes sont nécessaires au fonctionnement du capitalisme et, en dernière analyse, à sa survie, mais ils sont pourtant détruits en tant qu'entités indépendantes. En se privant de la demande qui lui permet de réaliser la plus-value, le système capitaliste s'effondre inévitablement du fait de cette contradiction. La publication de L'Accumulation du capital provoque une polémique tant à droite qu'à la gauche du SPD : sa théorie de l'écroulement inévitable du capitalisme fait l'objet de vives critiques. Franz Mehring, Wilhelm Pieck et Julian Marchlewski saluent au contraire en Rosa Luxemburg l'interprète la plus érudite de Marx depuis Engels.
Rosa Luxemburg milite par ailleurs avec passion contre les risques de guerre en Europe. En septembre 1913, elle prononce à Francfort-sur-le-Main un discours enflammé dans lequel elle appelle les ouvriers allemands à ne pas prendre les armes contre des ouvriers d'autres nationalités. Cela lui vaut de passer, le 20 février 1914, en jugement pour incitation publique à la désobéissance. Rosa Luxemburg se défend avec passion et éloquence, ce qui lui vaut une célébrité nationale, au-delà des milieux socialistes. À la même époque, elle entretient durant plusieurs mois une liaison avec l'un de ses avocats, le socialiste Paul Levi, qui reste ensuite un ami proche ; Levi consacre plus tard sa vie à la poursuite du travail politique de Rosa Luxemburg et à la diffusion de ses thèses. Rosa Luxemburg est condamnée à un an de prison. Alors qu'elle attend l'issue de son procès en appel, elle prononce en mars 1914 un nouveau discours dans lequel elle accuse les militaires allemands de maltraiter les soldats : elle est cette fois poursuivie pour insulte à l'armée. Des milliers de témoignages arrivant pour soutenir ses propos, le procès est enterré42. Durant les mois que durent les diverses procédures, Rosa Luxemburg continue de diffuser ses thèses et de militer ardemment contre la guerre.
Alors que le conflit éclate en Europe, l'Internationale ouvrière échoue totalement à définir une politique commune, et les sociaux-démocrates allemands, comme la plupart de leurs homologues européens, votent les crédits de guerre. Rosa Luxemburg, qui doit théoriquement commencer à accomplir en décembre sa peine de prison, forme avec plusieurs militants, dont Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Franz Mehring, Julian Marchlewski, Paul Levi et Clara Zetkin, le noyau de ce qui devient le Gruppe Internationale, puis par la suite le Spartakusbund la Ligue Spartacus, ou Ligue spartakiste : leur appel contre le vote des crédits de guerre, lancé à plus de trois cents dirigeants socialistes, reste quasiment sans réponse. En décembre, Rosa Luxemburg est hospitalisée pour épuisement nerveux et physique : elle commence sa peine de prison en février 1915.
En prison, Rosa Luxemburg maintient des liens épistolaires avec le monde extérieur. C'est là également qu'elle rédige la brochure La Crise de la social-démocratie, publiée clandestinement en 1916 sous le pseudonyme de Junius. L'opposition radicale socialiste s'exprime au travers d'une lettre politique signée Spartakus : avec le soutien logistique de Leo Jogiches qui prend la direction des opérations clandestines, la publication, intitulée Les Lettres de Spartakus, circule bientôt à plus de 30 000 exemplaires. Rosa Luxemburg est libérée en février 1916 et reprend aussitôt ses activités publiques. Le 1er mai, lors d'une manifestation spartakiste elle défile aux côtés de Karl Liebknecht qui, en uniforme de soldat, lance un slogan contre la guerre et le gouvernement : À bas la guerre ! À bas le gouvernement ! Immédiatement arrêté, il est privé de son immunité parlementaire, traduit devant un tribunal militaire, et condamné à quatre ans de prison, tandis que Rosa Luxemburg est aussitôt placée sous surveillance policière. Le 9 juillet 1916, elle est arrêtée et placée en détention administrative. Rosa Luxemburg maintient à nouveau des contacts écrits avec le monde extérieur. Elle entretient par ailleurs une relation épistolaire aux accents romantiques avec un ami de Costia Zetkin, Hans Diefenbach. Ce dernier, envoyé au front comme médecin militaire, est tué en octobre 1917, sa mort causant à Rosa Luxemburg un choc terrible.
En janvier 1917, les socialistes opposés à la guerre sont exclus du SPD ; en avril, ils constituent le Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne USPD, dont la Ligue spartakiste constitue le courant d'extrême gauche.
Soutien et critiques envers la révolution russe
Rosa Luxemburg, depuis sa prison, suit attentivement les évènements politiques et écrit une série de textes sur la Révolution russe à partir de mars 1917, selon elle le fait le plus considérable de la guerre mondiale, mais après la révolution d'Octobre, elle se montre critique envers divers aspects de la politique suivie par les bolcheviks. Elle dénonce l'opportunisme des dirigeants de la social-démocratie allemande Eduard Bernstein, Karl Kautsky et des mencheviks russes, ainsi que leur politique de soutien à l'impérialisme. Dans ce contexte, elle salue le parti bolchevik en tant que force motrice à qui revient le mérite historique d'avoir proclamé dès le début et suivi avec une logique de fer la tactique qui seule pouvait sauver la démocratie et pousser la révolution en avant. Tout le pouvoir aux masses ouvrières et paysannes, tout le pouvoir aux soviets. La critique de la politique poursuivie par ce dernier apparaît d'autant plus nécessaire pour Rosa Luxemburg. Elle dénonce entre autres le soutien des bolcheviks aux autodéterminations nationales, qui lui paraît affaiblir le prolétariat en renforçant le nationalisme, ainsi que la politique de redistribution des terres par les bolcheviks, qui pour elle menace d'aboutir à la constitution d'une couche de petits propriétaires fonciers ennemis potentiels de la révolution, hostiles au socialisme d'une part. Dans l'optique de Rosa Luxemburg, le dépècement de la Russie par le droit à l'indépendance des nations de l'ex-Empire russe et le slogan du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constituent pour les bourgeoisies nationales un instrument de leur politique contre-révolutionnaire. Elle critique enfin l'étouffement de la démocratie politique par les bolcheviks : si Rosa Luxemburg, comme Clara Zetkin ou Franz Mehring, approuve la dissolution de l'Assemblée constituante, elle regrette qu'elle n'ait pas été suivie de nouvelles élections, écrivant : La liberté seulement pour les partisans du gouvernement, pour les membres d'un parti, aussi nombreux soient-ils, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Si pour Rosa Luxemburg, la dictature socialiste ... ne doit reculer devant aucun moyen de contrainte pour imposer certaines mesures dans l'intérêt de la collectivité, elle estime que le pouvoir léniniste est une dictature, il est vrai, non celle du prolétariat, mais celle d'une poignée de politiciens, c'est-à-dire une dictature au sens bourgeois. Elle préconise au contraire la démocratie la plus large et la plus illimitée, et rappelle que c’est un fait absolument incontestable que, sans une liberté illimitée de la presse, sans une liberté absolue de réunion et d'association, la domination des larges masses populaires est inconcevable. Les causes de cette dérive sont, pour Rosa Luxemburg, à chercher tant dans la conception léniniste du parti que dans les conditions très défavorables de la guerre mondiale et de l'isolement de la Russie sur le plan international, qui rend d'autant plus nécessaire le déclenchement de la révolution en Europe. Avec Leo Jogiches qui l'aide à se tenir au courant des évènements, Rosa Luxemburg estime que les révolutionnaires allemands doivent à tout prix éviter de devenir des satellites des bolcheviks. Elle juge cependant que le « bolchévisme est devenu le symbole du socialisme révolutionnaire pratique, de tous les efforts de la classe ouvrière pour conquérir le pouvoir et considère que la révolution russe sera condamnée si le prolétariat des autres pays ne lui vient pas en aide en conquérant le pouvoir.
Posté le : 06/03/2016 18:08
|
|
|
|
|
Rosa Luxembourg 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Révolution en Allemagne
Révolution allemande de 1918-1919 et Révolte spartakiste de Berlin
La révolution allemande de novembre 1918 permet à Rosa Luxemburg de sortir de prison : une amnistie politique est prononcée le 6 novembre ; elle-même est libérée le 10 et regagne seule Berlin, alors que la ville est en pleine effervescence révolutionnaire. Les dirigeants spartakistes se réunissent et fondent, après quelques difficultés pour trouver un imprimeur, un nouveau journal, Die Rote Fahne Le Drapeau rouge. Rosa Luxemburg y appelle le prolétariat allemand à poursuivre la révolution et à s'organiser pour en prendre la direction ; elle surestime alors l'engagement révolutionnaire des ouvriers allemands et sous-estime l'attrait que peuvent exercer sur eux des valeurs bourgeoises comme la propriété, le nationalisme ou la religion. Elle mène une existence harassante et, du fait de la distance entre la rédaction du journal et son appartement, est fréquemment obligée de coucher dans des hôtels.
La Ligue spartakiste, menée notamment par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, prône une radicalisation de la révolution et l'accès au pouvoir des conseils d'ouvriers et de soldats apparus fin 1918 dans toute l'Allemagne à l'occasion de la révolte populaire, pour former une République des conseils. Pour les spartakistes, la révolution doit désormais s'étendre à toute l'Europe avec le soutien de la Russie soviétique. Hostiles pour leur part à tout putschisme et à tout terrorisme de parti, Liebknecht et Rosa Luxemburg sont dépassés par l'utopisme des intellectuels et le radicalisme des ouvriers qui les suivent. Le SPD, qui a formé le gouvernement dirigé par Friedrich Ebert, souhaite au contraire une transition politique modérée afin d'éviter à l'Allemagne une situation du type russe. La tension politique est extrême et, le 6 décembre, des troupes gouvernementales occupent la rédaction de Die Rote Fahne. Une manifestation spartakiste est dispersée à coups de mitrailleuse, faisant treize morts et trente blessés. Les spartakistes sont finalement désavoués par ceux-là même qu'ils ambitionnent de mettre au pouvoir : le 16 décembre, le Congrès national des Conseils d'ouvriers et de soldats, seul pouvoir légitime aux yeux des spartakistes, se réunit et décide à la majorité qu'il ne lui appartient pas de décider du sort de l'Allemagne, et que cette tâche devra être confiée à une assemblée constituante élue au suffrage universel. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ne sont pas autorisés à siéger au congrès, pas même avec voix consultative.
Le climat d'agitation révolutionnaire en Allemagne aboutit à la formation du Parti communiste d'Allemagne KPD : les spartakistes, ayant pris la décision de se séparer de l'USPD, forment le parti lors d'un congrès tenu du 30 décembre 1918 au 1er janvier 1919. Rosa Luxemburg, qui aurait pour sa part préféré la dénomination de socialiste à celle de communiste pour établir plus facilement des liens avec les révolutionnaires occidentaux, est mise en minorité sur ce point. Elle-même préfère continuer d'utiliser le seul nom de Ligue spartakiste pour désigner le parti. Karl Radek, vieil adversaire de Rosa Luxemburg, est alors présent clandestinement sur le territoire allemand en tant qu'émissaire de la Russie soviétique : il assiste au congrès fondateur du KPD et débat à cette occasion avec Rosa Luxemburg de l'usage de la terreur. Alors que Radek, comme les autres bolcheviks, juge la terreur indispensable pour préserver la révolution, Rosa Luxemburg se montre sceptique ; elle fait finalement adopter dans le programme du parti allemand un point qui s'oppose à toute pratique terroriste. Rosa Luxemburg et Paul Levi plaident pour la participation des communistes à l'élection de l'assemblée constituante, mais la majorité se prononce pour le boycott de ces élections65. Rosa Luxemburg tente en vain de convaincre le congrès du KPD du danger que représente le refus de participer au processus électoral.
Début janvier 1919, l'agitation politique dans les milieux ouvriers tourne à l'affrontement ouvert quand le préfet de police Emil Eichhorn, membre de l'USPD, refuse de quitter son poste après le départ des indépendants du gouvernement et distribue des armes aux ouvriers radicaux. Karl Liebknecht, emporté par le mouvement, croit à la possibilité d'un soulèvement qui renverserait le gouvernement : le KPD forme avec d'autres groupes, dans la nuit du 5 au 6, un comité révolutionnaire et décide de passer à l'insurrection. Rosa Luxemburg juge le mouvement totalement prématuré mais choisit de le soutenir par loyauté via ses articles dans Die Rote Fahne. Le soulèvement, spontané mais sans plan, direction ni organisation, échoue totalement : le ministre SPD Gustav Noske est chargé d'organiser la répression, qu'il confie aux corps francs. Les militaires écrasent l'insurrection avec une grande brutalité, tuant les spartakistes qui se présentent porteurs d'un drapeau blanc. Bientôt, tout Berlin est occupé par l'armée. Rosa Luxemburg fait paraître le 14 janvier 1919 son dernier article, amèrement intitulé L'Ordre règne à Berlin.
Assassinat
Le lendemain de la parution du dernier article de Rosa Luxemburg, des militairesnote 1,70 se présentent à son domicile clandestin. Arrêtée, elle est conduite, en même temps que Wilhelm Pieck, à l'hôtel Eden qui sert de quartier-général provisoire à la division de cavalerie et de fusiliers de la garde : interrogée par le capitaine Waldemar Pabst, elle refuse de répondre aux questions de ce dernier. Des militaires la font ensuite sortir de l'hôtel pour l'escorter en prison. Alors qu'elle est dirigée vers la sortie de l'hôtel, elle est frappée à la tête à coups de crosse de fusils ; les soldats la font ensuite monter dans une voiture pour la conduire en détention. Alors que le véhicule a à peine parcouru cent mètres, Rosa Luxemburg est tuée d'une balle dans la tête par l'un des militaires, probablement le lieutenant Vogel qui commandait l'escorte. Son cadavre est jeté dans le Landwehrkanal. Un communiqué affirme ensuite qu'elle a été tuée par une foule de citoyens en colère. Karl Liebknecht, arrêté lui aussi, est également tué en sortant de l'hôtel Eden par l'escorte qui était censée l'emmener en prison.
Funérailles de Rosa Luxemburg, le 13 juin 1919.
Symboliquement, un cercueil vide représentant Rosa Luxemburg est enterré le 25 janvier en même temps que celui de Liebknecht et de 31 autres victimes de la répression. Un corps identifié comme celui de Rosa Luxemburg est finalement repêché le 31 mai73,69,74. Leo Jogiches tente de découvrir la vérité sur la mort de Rosa Luxemburg : en mars, il est arrêté à son tour, puis tué, officiellement alors qu'il tentait de s'évader du quartier général de la police.
Les militaires responsables de la mort de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht sont traduits en justice pour maltraitances : le procureur Paul Jorns plaide cependant les circonstances atténuantes en raison de leurs excellents états de service. Le soldat Runge, qui avait frappé Rosa Luxemburg à la tête, est condamné à deux ans et deux semaines de prison pour tentative de meurtre, et le lieutenant Vogel à deux ans et quatre mois pour s'être débarrassé du cadavre et avoir fait un rapport incorrect. Vogel s'évade ensuite en bénéficiant de complicités et vit quelque temps à l'étranger en attendant une amnistie. Runge déclarera plus tard avoir accepté d'endosser tous les torts en échange d'une condamnation légère, il demandera par la suite au chancelier Hitler une compensation pour sa condamnation et se verra accorder par le régime nazi la somme de 6 000 marks. Durant les années qui suivent la mort de Rosa Luxemburg, Paul Levi, un temps chef du KPD avant d'être écarté par l'Internationale communiste, se bat pour empêcher que les assassinats de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ne soient amnistiés et pour dénoncer le truquage de l'enquête. En 1928, il assure la défense d'un éditeur que le procureur Jorns poursuivait en diffamation pour avoir publié un article l'accusant d'avoir truqué l'enquête Luxemburg-Liebknecht. Levi parvient à prouver que Jorns a détruit des preuves des deux meurtres, et obtient qu'il soit jugé coupable d'avoir couvert les assassins. Jorns fait appel et il est par la suite dédommagé par le régime nazi pour ses ennuis judiciaires. Dans une interview accordée en 1959, Waldemar Pabst déclare que la mort de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg était dûment planifiée. En 1962, commentant officiellement les déclarations de Pabst, le gouvernement ouest-allemand qualifie les assassinats de Liebknecht et Rosa Luxemburg d'exécutions en accord avec la loi martiale.
L'ouvrage théorique de Rosa Luxemburg Introduction à l'économie politique est publié après sa mort par les soins de Paul Levi. Sa tombe se situe au cimetière central de Friedrichsfelde de Berlin, où un hommage lui est rendu chaque deuxième dimanche de janvier. En mai 2009, Michael Tsokos, directeur de l'institut médico-légal de l'hôpital Charité de Berlin, annonce la découverte dans les sous-sol de l'institut, du corps d'une femme aux caractéristiques physiques fortement similaires à celles de Rosa Luxemburg. Il y aurait selon lui des doutes importants sur l'identité du corps reposant au cimetière de Berlin, devenu chaque année un lieu de recueillement pour des milliers de personnes.
Théories et postérité politique
Rosa Luxemburg n'a pas laissé de système idéologique élaboré, bien que des lignes directrices se dégagent de sa pensée1. Elle se sert des concepts développés par Karl Marx pour fonder sa propre analyse, et étudie les aspects nouveaux du capitalisme de l'époque : colonialisme, impérialisme, accumulation des capitaux… Elle réfléchit aux moyens de créer une alternative à ce mode de développement économique et politique, et théorise notamment l'internationalisme. Dans ce cadre, elle développe une critique du nationalisme et des luttes de libération nationale :
« … le fameux droit de libre disposition des nations n'est qu'une phraséologie creuse …
La Révolution russe, 1918
En pratique, elle s'oppose, avec le SDKPiL, à l'indépendance de la Pologne et à la lutte nationale en général.
Elle considère que la révolution sera l'œuvre des masses et non le produit d'une « avant-garde éclairée » qui ne peut que se transformer en une dictature, « celle d'une poignée de politiciens, non celle du prolétariat ».
« Considérer qu'une organisation forte doit toujours précéder la lutte est une conception tout à fait mécaniste et non dialectique »
— Gesammelte Werke, IV, Berlin, p. 397
Rosa Luxemburg considère que le socialisme est lié à la démocratie : Quiconque souhaite le renforcement de la démocratie devra souhaiter également le renforcement et non pas l’affaiblissement du mouvement socialiste ; renoncer à la lutte pour le socialisme, c’est renoncer en même temps au mouvement ouvrier et à la démocratie elle-même.
Elle estime que le réformisme conduit à l’abandon de l’objectif socialiste : « Quiconque se prononce en faveur de la voie des réformes légales, au lieu et à l’encontre de la conquête du pouvoir politique et de la révolution sociale, ne choisit pas en réalité une voie plus tranquille, plus sûre et plus lente, conduisant au même but, mais un but différent, à savoir, au lieu de l’instauration d’une société nouvelle, des modifications purement superficielles de l’ancienne société … non pas la suppression du salariat, mais le dosage en plus ou en moins de l’exploitation.
Présentant ses conceptions du socialisme dans une brochure du SDKPiL en 1906, elle écrit : La suppression du capitalisme et de la propriété privée ne pourra pas s’effectuer dans un seul pays. … Le régime socialiste mettra fin à l’inégalité entre les hommes, à l’exploitation de l’homme par l’homme, à l’oppression d’un peuple par un autre ; il libèrera la femme de l’assujettissement à l’homme ; il ne tolèrera plus les persécutions religieuses, les délits d’opinion.
L'un des points essentiels de la conception du socialisme par Rosa Luxemburg tient à la liberté de penser différemment : pour elle, l'engagement révolutionnaire est avant tout une question morale, tenant à l'obligation de lutter pour un système social plus humain : elle considère par conséquent la Realpolitik, qu'elle soit exposée par Kautsky, Lénine, ou Marx lui-même, comme immorale et sans valeur ; la dimension éthique et l'idéalisme des ouvriers sont à ses yeux plus importants que les lois de l'histoire. Dans Grève de masse, Parti et syndicat, elle se livre à une critique de l'autorité centrale du parti, à laquelle elle oppose les grèves de masse spontanées, qui expriment à ses yeux la capacité des ouvriers à prendre leur destin en main. Elle désapprouve également l'idée d'insurrection armée, qui revient à déclencher artificiellement la révolution. Enfin, elle s'oppose de manière fondamentale au nationalisme, facteur de division. Pour Rosa Luxemburg, la révolution est avant tout un changement radical et profond dans les relations entre classes sociales : dans cette optique, le marxisme, loin du jargon auquel le réduisent certains démagogues, est avant tout une philosophie humaniste destinée à rendre au peuple son intégrité. Alors qu'elle croit, au début du XXe siècle, que le nationalisme est sur son déclin, elle considère que le groupe social des prolétaires ne doit pas correspondre à une nation, ni être défini en termes de citoyenneté, de race ou d'hérédité, mais s'identifier au prolétariat international, uni par un mode de vie commun. Elle nie ainsi le lien entre le droit à l'autodétermination nationale et la liberté d'expression, considérant que la priorité du mouvement socialiste doit être d'obtenir l'autodétermination, non pas pour les nations, mais pour la classe ouvrière. Opposée au nationalisme, la révolution socialiste internationale est également destinée, dans l'optique de Rosa Luxemburg, à mettre un terme à l'exploitation, à l'inégalité des sexes et à l'oppression raciale. Un régime socialiste dans lequel les individus seront liés par l'harmonie et la solidarité aboutira ainsi à la création d'une nation par consentement commun.
Helene Deutsch, disciple de Sigmund Freud, qui la rencontre en 1910 au Congrès de Copenhague, a été impressionnée par la personnalité de Rosa Luxemburg et le charisme qu’elle dégageait. Elle devint pour elle un modèle de référence.
Le terme de luxemburgisme a été utilisé pour désigner un courant d'idées de la gauche communiste opposée à l'autoritarisme léniniste, et plus précisément la tendance conseilliste. Au sein du mouvement communiste, Rosa Luxemburg fait l'objet de jugements contrastés : certains approuvent sa condamnation de la terreur bolchevique et tendent à faire du luxemburgisme un modèle qui respecterait la volonté des masses et concilierait socialisme et démocratie ; d'autres, tout en louant parfois sa mémoire et son courage, la critiquent au nom de l'orthodoxie léniniste, puis stalinienne, et regrettent ce qu'ils appellent ses erreurs. Le terme luxemburgisme est surtout utilisé à des fins polémiques — qu'il s'agisse de le louer ou de le condamner — Rosa Luxemburg n'ayant pas elle-même présenté ses idées sous la forme d'un système cohérent.
En 1921, le régime bolchevique donne le nom de Luxemburg à la ville géorgienne de Katharienenfeld aujourd'hui Bolnissi. Dans les années qui suivent, cependant, l'Internationale communiste dénonce le luxemburgisme : ce terme est alors utilisé, dans le vocabulaire du Komintern, pour englober les communistes opposés à la bolchevisation, soit au contrôle plus strict de leurs organisations par l'IC. Dans les années 1930, Rosa Luxemburg elle-même est dénoncée par Staline pour sa critique de la révolution bolchevique ; elle est dès lors exclue des grandes figures du marxisme reconnues par l'Internationale communiste. Staline dénonce notamment de prétendues parentés idéologiques entre le luxemburgisme, le trotskisme et le menchevisme.
Rosa Luxemburg est par la suite réévaluée comme une figure majeure de l'histoire du socialisme, de la théorie marxiste et du mouvement communiste, mais ses idées et son image sont instrumentalisées par des camps politiques opposés. Sa mémoire est ainsi récupérée par les régimes du bloc de l'Est — sa tombe et celle de Karl Liebknecht deviennent ainsi en République démocratique allemande le lieu d'une cérémonie d'hommage annuelle — sans que sa pensée politique y soit un objet d'études approfondies. Le régime est-allemand rend hommage à Rosa Luxemburg en tant que martyre de la révolution, jusqu'à lui vouer une forme de culte mais, paradoxalement, sans prendre en considération son apport politique ni le détail de ses idées. Durant la guerre froide, Rosa Luxemburg se trouve ainsi honorée par les mêmes dirigeants communistes qui avaient précédemment interdit ses écrits. Une place du quartier de Berlin-Mitte, alors situé dans la zone soviétique puis à Berlin-Est, est baptisée en 1947 en son honneur Luxemburgplatz, avant de prendre en 1969 le nom de Rosa-Luxemburg-Platz qu'elle conserve après la chute du mur et la réunification allemande.
À l'opposé, et surtout à partir des années 1960, l'héritage politique de Rosa Luxemburg continue d'être revendiqué en parallèle par des communistes anti-staliniens, et par toute une série de courants gauchistes, trotskistes ou libéraux. Les uns font de Rosa Luxemburg une citoyenne du monde, voire une libertaire, tandis que les autres voient en elle l'apôtre de la République des conseils contre le centralisme des bolcheviks, alors même qu'elle n'a jamais théorisé la fonction et le pouvoir que pourraient prendre les conseils ouvriers dans une société socialiste. Au XXIe siècle, différents courants de pensée de gauche, ou féministes, continuent de se référer, dans diverses mesures, à Rosa Luxemburg.
Postérité littéraire de sa correspondance
Rosa Luxemburg a laissé une correspondance importante d’une qualité littéraire reconnue. Le satiriste Karl Kraus évoque notamment une lettre écrite à Sonia Liebknecht, depuis la prison pour femmes de Breslau, en ces termes : ce document d’humanité et de poésie unique en son genre »88 devrait selon lui figurer dans les manuels scolaires de toute république, entre Goethe et Claudius.
En 2006, la comédienne Anouk Grinberg lit des lettres de Rosa Luxemburg à ses amies Luise Kautsky, Sonia Liebknecht, notamment pendant ses détentions, dans un spectacle intitulé Rosa, la vie au théâtre de l'Atelier à Paris. En 2009, ces lettres dans la traduction d'Anouk Grinberg et de Laure Bernardi sont publiées sous le même titre aux Éditions de l'Atelier.
Principales œuvres
Le Développement industriel de la Pologne 1897
Réforme sociale ou révolution ? 1899
Questions d'organisation de la social-démocratie russe Centralisme et démocratie, 1904
Grève de masse, parti et syndicat 1906
L'Accumulation du capital 1913
La Crise de la social-démocratie 1915, publié en 1916
La Révolution russe 1918, publication posthume
Introduction à l'économie politique publication posthume
Édition des Œuvres complètes de Rosa Luxemburg
Ce projet éditorial est mené conjointement depuis 2009 par les éditions Agone et le collectif Smolny.
Introduction à l'économie politique 2009
Avant-propos du collectif Smolny
Introduction générale de Louis Janover : Rosa Luxemburg, L'histoire dans l'autre sens
« Introduction à l'économie politique 1907-1917
Repères chronologiques 1857 - 1925
Bibliographie indicative
À l'école du socialisme 2012
Avant-propos du collectif Smolny
I. Éléments d’éducation politique : Conférence sur l’économie politique 1907—Discours sur la question de l’École du parti 1908 —École du syndicat et École du parti 1911
II. Lire Karl Marx : « De l’héritage de nos maîtres 1901 — De l’héritage de nos maîtres 1901 — De l’héritage de nos maîtres 1902— De l’œuvre posthume de Karl Marx 1905
III. Matériaux pour une histoire de l’économie politique 1907-1913 : Histoire de l’économie politique — Sur l’esclavage — Notes sur la forme économique antique / esclavage — Économie politique pratique. Le livre II du Capital de Marx — Économie politique pratique. Le livre III du Capital de Marx — Le contenu de la théorie du fonds de salaire — Histoire des théories des crises
Postface : Comment faire passer l’économie politique : Rosa Luxemburg enseignante par Michael Krätke
Le Socialisme en France 2013
Préface de Jean-Numa Ducange
Recueil de 41 articles, recensions, discours ou interviews 1898-1912
La brochure de Junius, la guerre et l’Internationale 2014
La IIe Internationale face à la guerre
Le groupe Internationale
La crise de la social-démocratie
Œuvres inspirées par la vie de Rosa Luxemburg
Littérature, théâtre, musique et peinture
1928 : Das Berliner Requiem Le Requiem berlinois, petite cantate pour ténor, baryton, chœur d'hommes ou trois voix d'hommes et orchestre de cuivres de Kurt Weill sur un texte de Bertolt Brecht, notamment le 2e et le 3e mouvement, Une jeune fille noyée et Épitaphe.
1949 : Alfred Döblin fait de Rosa Luxemburg l'un des personnages centraux du quatrième volume de Novembre 1918. Une révolution allemande : Karl & Rosa.
Rosa Luxemburg, sainte laïque de l'imaginaire communiste en URSS, figure indirectement dans le roman Tchevengour d'Andreï Platonov, idéal fantasmé de l'un des personnages principaux.
En 1970, en un long poème, Rosa Lux, créé sur la scène du théâtre des Carmes, André Benedetto fait ressurgir Rosa Luxembourg et ses luttes en une espèce d'hommage qui tombe à cheval entre le centenaire de sa naissance et le cinquantenaire de son assassinat.
Pierre Bourgeade a consacré, en 1977, une pièce à Rosa Luxemburg : Étoiles rouges, en jumelant son destin tragique à celui de Marilyn Monroe.
En 1992, le peintre québécois Jean-Paul Riopelle a réalisé une fresque d'une longueur totale de 40 mètres, composée de trente tableaux, intitulée Hommage à Rosa Luxemburg. Elle est en exposition permanente au musée national des beaux-arts du Québec à Québec.
En 2010, Claire Diterzi, auteure-compositrice-interprète, crée avec Marcial Di Fonzo Bo au Théâtre du Rond-Point un spectacle musical intitulé Rosa la Rouge, en présentant la vie de Rosa Luxemburg sous l'angle de sa vie affective et militante.
En 2014, Anne Blanchard, auteur pour la jeunesse, a publié Rosa Luxemburg. Non aux frontières, Actes Sud junior, un roman paru dans la collection ceux qui ont dit non sous la direction de Murielle Szac
Cinéma et télévision
La vie de Rosa Luxemburg a fait l'objet d'un film sorti en 1986, intitulé Rosa Luxemburg titre original Die Geduld der Rosa Luxemburg - La patience de Rosa Luxemburg et réalisé par Margarethe von Trotta. Barbara Sukowa, interprète du rôle-titre, a remporté pour ce film le prix d'interprétation féminine lors du festival de Cannes 1986. Otto Sander jouait le rôle de Karl Liebknecht.
Le personnage de Rosa Luxemburg apparaît par ailleurs dans divers films ou téléfilms, parmi lesquels :
1955 : Ernst Thälmann – Sohn seiner Klasse, film de Kurt Maetzig ; jouée par Judith Harms
1966 : Die rote Rosa, téléfilm de Franz Josef Wild ; jouée par Ursula Lingen
1980 : Jean Jaurès: vie et mort d'un socialiste, téléfilm de Ange Casta ; jouée par Maud Rayer
2010 : Allemagne 1918, téléfilm de Bernd Fischerauer ; jouée par Adriana Altaras
2012 : Europas letzter Sommer, téléfilm de Bernd Fischerauer ; jouée par Barbara Philip   [img width=600]https://marxismocritico.files.wordpress.com/2013/09/42e44-rosa_luxemburg_by_party9999999-d4fn3t4.png?w=288&h=234[/img]  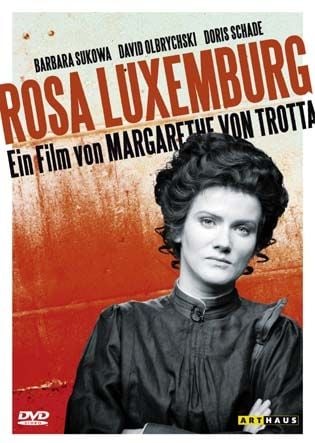 
Posté le : 06/03/2016 18:06
|
|
|
|
|
Pomaré |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 février 1813 naît Pōmare IV ou Pomaré la Grande
à Paré à Tahiti, elle meurt le 17 septembre 1877 à Tahiti à 64 ans, Monarques de Tahiti elle appartenait à la dynastie tahitienne des Pomare, elle fut reine de Tahiti, Moorea et dépendances de 1827 à 1877, d'abord sous l'influence des missionnaires britanniques, puis sous le protectorat français. Elle est la 4e reine de Tahiti de 1827 à 1877 son prédécesseur est Pōmare III, son successeur Pōmare V.
Son père est Pōmare II, sa mère est la Princesse Teriʻitoʻoterai Tere Moemoe Tamatoa et son conjoint Teariʻinohoraiʻi Tapoa, Tenania Ariʻi Faʻaitea Hiro
Ses enfants sont le Prince Henri Pōmare, le Prince Ariʻiaue Pōmare, Pōmare V, le Prince Tamatoa Pōmare, le Prince Punuariʻi Teriʻitapunui Pōmare, le Prince Teriʻitua Tuavira Joinville Pōmare, son héritier est le Prince Teriʻi Taria Teratane
Elle fut la seule reine régnante de Tahiti ; elle régna pendant 50 ans, le plus long règne de toute l'histoire de Tahiti. Sa sépulture se trouve au cimetière royal d'Arue, à papa'oa
LES POMARÉ
Famille de souverains qui régna sur Tahiti jusqu'à la fin du protectorat et la « cession à la France de la souveraineté sur tous les territoires dépendant de la couronne de Tahiti » 1880.
L'histoire de l'accession des Pomaré au trône se confond avec la période de colonisation européenne dans le Pacifique : à l'origine, chef relativement mineur du district des environs de Papeete, connu plus tard sous le nom de Pomaré Ier 1743 env.-1803, devint l'intermédiaire des navigateurs de passage commerce de porc avec la jeune colonie de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et l'hôte des missionnaires. Son fils Tu II Pomaré II, 1780 env.-1821, de son véritable nom Variatoa, par une habile politique de conquête et d'alliances matrimoniales traditionnelles, réussit à s'imposer peu à peu comme l'interlocuteur royal des représentants européens des grandes puissances.
Il embrassa la religion protestante en 1812. Cependant, malgré la promulgation du sévère Code Pomaré en 1819, des troubles continuèrent à se produire, fomentés par des adversaires ou par des chrétiens déçus mouvement millénariste Mamaia.
Après le court règne de Pomaré III 1819-1827, le trône revint à Aïmata la reine Pomaré IV, 1813-1877 qui dut, en 1843, accepter le protectorat français imposé contre les Britanniques. En 1880, la France annexe le royaume de Pomaré pour mettre fin au désordre que l'on attribuait au régime du protectorat et aux intrigues étrangères. La dernière « reine » de Tahiti, Marau Taaroa, est morte en 1934. Jean-Paul Latouche
Sa vie
Nommée Aimata à la naissance, elle est la fille de Pōmare II, roi de Tahiti et de la princesse Teremoemoe Tamatoa, fille de Tamatoa III, roi de Raiatea. Elle devient reine de Tahiti à l'âge de 14 ans, après la mort, en janvier 1827, de son frère Pōmare III.
Les débuts du règne : l'influence britannique
Elle parvient à réunir Bora Bora et une partie de Raʻiatea au royaume de Tahiti.
Dans les premières années, elle semble avoir voulu s'écarter de la religion protestante, devenue officielle sous le règne de Pomare II, en favorisant un culte local, la secte des Mamaia, mais les missionnaires britanniques, s'appuyant sur les autres chefs tahitiens l'obligent à revenir sous leur influence. Dans les années 1830, un rôle essentiel est joué par le pasteur George Pritchard, son principal conseiller. En 1838, elle refuse l'accès de l'île à des missionnaires catholiques, les pères Caret et Laval, membres de l'ordre de Picpus, implanté aux îles Gambier. Cette décision va être l'occasion pour la France d'intervenir dans les affaires tahitiennes.
La France impose son protectorat
La reine Pomaré IV au début de son règne.
Les missionnaires catholiques font en effet appel à l'aide de l'amiral Abel Aubert du Petit-Thouars, qui vient de prendre le contrôle des îles Marquises et décide d'établir le protectorat français sur Tahiti sur les conseils de Jacques-Antoine Moerenhout, consul français local et bon connaisseur de la situation.
Un premier traité est signé en 1842, mais Pomare IV est très réticente et choisit finalement de résister à l'entreprise française ; en 1844, elle se réfugie sur un navire anglais, le Basilisk, puis à Raiatea, et refuse toute négociation de 1844 à 1846, pendant la guerre franco-tahitienne. Après la victoire de l'amiral Bruat, Pomare IV peut revenir à Papeete le 9 février 1847 et reprendre place sur le trône en acceptant le protectorat.
Ce statut lui accorde le pouvoir exécutif mais elle doit partager la plupart des fonctions importantes avec le représentant de la France, alors désigné comme Commissaire royal, puis impérial : convocation de l’assemblée législative, nomination des chefs et des juges de district, promulgation des lois. Toutes les forces armées et les corps de police étaient placés sous les ordres du commissaire. Elle règne donc sous le contrôle de l'administration française de 1847 à 1877.
Décès et inhumation
Pomare IV meurt le 17 septembre 1877 d'une crise cardiaque. Elle est d'abord enterrée sous un mausolée à la pointe Outu'ai'ai commune de Arue. Une dizaine d'années plus tard, sa dépouille est déplacée dans le cimetière royal des Pomare pour laisser place au dernier roi de la dynastie, Pomare V, qui lui succède de 1877 à 1880.
Noms et titulature
Son nom de naissance, ʻAimata signifie : mangeur d'œil, d'après une ancienne coutume qui voulait que le souverain mange l'œil de son ennemi vaincu.
Son nom polynésien complet, en tant que reine, est ʻAimata Pōmare IV Vahine-o-Punuateraʻitua.
Les titres qu'elle a porté au cours de son existence sont :
Son Altesse la princesse ʻAimata 1813 - 1815
Son Altesse royale la princesse ʻAimata Pōmare 1815 - 1821
Son Altesse royale la princesse héritière de Tahiti 1821 - 1827
Sa Majesté la reine de Tahiti et dépendances 1827 - 1877
Mariages et descendance
La reine Pōmare IV et son époux le prince consort Ariʻifaaite.
Mariée en décembre 1822 à l'âge de 10 ans avec Tapoa, elle en divorce en accédant à la royauté et épouse Ari'ifaaite, chef à Huahine, son cousin germain par sa mère, et avec qui elle donne naissance à :
S.A. le prince Henri Pōmare décédé jeune.
S.A. le prince Ariʻiaue Pōmare 1838-1855 : héritier présomptif de Pōmare IV, mais atteint de tuberculose, il décède à la veille de ses 18 ans.
S.A. le prince Teratane Pōmare 1839-1891 : Pōmare V, roi de Tahiti de 1877 à 1880.
S.A. la princesse Victoria Pōmare décédée à l'âge d'un an.
S.A. le prince Tamatoa Pōmare 1842-1881 : Tamatoa V, roi de Raiatea.
S.A. le prince Punuariʻi Teriʻitapunui Pōmare 1846-1888.
S.A. le prince Teriʻitua Tuavira Joinville Pōmare 1847-1875.
Iconographie
Outre la photographie illustrant cet article on connaît une gravure représentant Pomare IV. Cette illustration figure dans l'ouvrage de Duperrey, Voyage autour du monde exécuté par ordre du roi, sur la corvette de Sa Majesté, La Coquille..., atlas du volume Histoire du voyage. Planche no 13, avec la légende: Femmes de l’ile Taïti. Iles de la Société 1. Po-maré Vahiné, régente. 2. Téré-moémoé ; veuve de Po-maré II. Lejeune et Chazal delt. De l’Impre de Rémond. Ambroise Tardieu sculpt.
   6      
Posté le : 26/02/2016 23:01
Edité par Loriane sur 27-02-2016 16:05:49
Edité par Loriane sur 27-02-2016 16:06:29
Edité par Loriane sur 27-02-2016 16:07:14
Edité par Loriane sur 27-02-2016 16:10:08
Edité par Loriane sur 27-02-2016 16:11:24
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
58 Personne(s) en ligne ( 37 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 58
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages