|
|
Découverte de Madagascar 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
La chasse et la pêche
D'après les restes alimentaires conservés, on a constaté que la chasse était marginale, alors qu'une vision simpliste accordait une grande place aux activités de prédation, dans la première période de l'histoire de Madagascar. On pourrait, certes, mettre la rareté des os des petits gibiers sur le compte de la putréfaction dans les sols anthropiques souvent acides. Ils n'ont pourtant laissé aucune trace. La chasse demeure donc une activité secondaire à côté de l'élevage, qui fournissait l'essentiel de la viande consommée. Andranosoa XIe s. est le seul site qui renfermait une quantité abondante de menu gibier, notamment des variétés d'insectivores appartenant à la famille des Centétidés, telles que les trandraka Centetes ecaudatus, espèce de grande taille, les sokina Ericulus telfairoi et les ambiko Hemicentetes semispinosus. On parle souvent, dans les traditions, de la chasse aux potamochères qui a donné une expression courante haza lambo qui font des ravages dans les champs cultivés. Leur viande était consommée, comme le prouvent les découvertes de Rafolo qui a pu isoler des défenses et des canines de potamochère, en procédant à l'étude archéozoologique des ossements animaux d'Analamanitra et d'Erimoho.
Les habitants des sites côtiers se nourrissaient de poissons et de fruits de mer. Ils se livraient à la pêche sur la côte, ou bien ils partaient en boutre ou en pirogue pour la pêche en haute mer, comme le font encore les Vezo pêcheurs de la côte sud-ouest. C'était, sans aucun doute, l'activité principale des occupants de Sarodrano et de Talaky, villages dans lesquels on a trouvé non seulement des amas d'arêtes de poisson, de coquillages, d'huîtres, de moules, de crustacés, mais aussi des instruments de pêche, harpons et hameçons en fer, pesons de filet. Les populations de l'intérieur de l'île pratiquaient la pêche de gros poissons d'eau douce. C'est le cas des habitants de Vohitrandriana XVIIe s. et d'Andranosoa qui trouvaient probablement leurs ressources, respectivement, du lac volcanique de l'Alaotra et de la rivière Manambovo. L'espèce identifiée dans le premier site porte le nom local de besisika ou Megalops cyprinoides.
Les techniques traditionnellesLa métallurgie du fer
Il n'y a pas d'industrie lithique à Madagascar, car les premiers migrants ont débarqué dans l'île à une époque où l'on connaissait déjà le travail du fer. Les deux objets en pierre d'apparence néolithique qui ont été découverts dans le centre et le sud-ouest du pays, respectivement par Maurice Bloch et Marimari Kellum-Ottino, et qui ont été assimilés à des herminettes polies, n'ont qu'une signification très limitée car ils sont isolés de leurs contextes. Aucun gisement préhistorique n'a été mis au jour jusqu'à présent.
Bien que certaines traditions veulent attribuer une origine récente à la métallurgie du fer, on dispose de plus en plus de preuves archéologiques de l'ancienneté de cette technique dans l'île. On a longtemps admis que le roi Andriamanelo en fut l'inventeur au XVIe siècle ; il serait aussi d'ailleurs le fondateur du royaume hova nom donné aux habitants du Centre. Grâce à son fer volant sagaie en fer, il aurait vaincu les populations vazimba qui ne possédaient que des sagaies en roseau à pointe d'argile. Des instruments en fer proviennent de la fouille de sites antérieurs au Xe siècle sur les côtes et antérieurs au XVe siècle sur les hautes terres. On a également mis au jour des ateliers de métallurgie. L'abondance d'amas de scories de fer témoigne d'une activité métallurgique intense, pratiquée probablement très tôt dans le sud de l'île. Cependant ces vestiges, aussi nombreux soient-ils, apportent peu de renseignements. Le fer était fabriqué suivant des procédés ingénieux, à partir de minerai à l'état pulvérulent appelé localement vovo-by, et de roches ferrugineuses ou magnétites vatovy, que l'on trouve fréquemment sur les hautes terres et dans le sud. La transformation se faisait dans un petit fourneau de terre, alimenté par du charbon de bois.
La métallurgie du fer, comme la riziculture inondée ou l'élevage du zébu, loin d'être une innovation tardive du XVIe ou du XVIIe siècle, est apparue dans l'île en même temps que les premiers habitants, ainsi que le démontrent les preuves archéologiques.
La poterie
La quasi-totalité des sites archéologiques malgaches recèle de la poterie. Certains sites du sud ne renferment que de rarissimes objets en terre cuite, sous forme de tessons. Les calebasses ou vatavo auraient, dans la plupart des cas, remplacé les récipients en céramique. La qualité de l'ancienne poterie malgache varie en fonction de ses usages. Les matières premières utilisées étaient minutieusement sélectionnées. Les potiers se procuraient soit les argiles claires des alluvions, soit les kaolinites résultant de l'altération directe du granit. Ces deux variétés permettent d'obtenir une poterie de meilleure qualité par rapport aux argiles altéritiques ordinaires. Le graphite était aussi largement employé dans les régions centrales où il existe en abondance. Mélangé à l'argile, il améliore la qualité de la pâte-céramique, et donne des poteries plus résistantes et moins poreuses.
Les poteries ont toutes été façonnées à la main. Et, cependant, les pièces de vaisselle sont généralement d'une finesse et d'une régularité remarquables. L'argile a dû subir un traitement préalable de lavage, pour éliminer les grosses inclusions minérales, les grains de quartz par exemple. Toutes les céramiques ont été cuites sans four. On en connaissait pourtant la technique, puisque les métallurgistes l'employaient. Mais la cuisson en plein air, à une température de 600 à 800 0C, devait sembler suffisante pour obtenir des ustensiles de bonne qualité.
Une vaisselle graphitée en forme de coupe, connue sous le nom de loviamanga et répandue sur l'ensemble des hautes terres, a fait l'objet d'une cuisson spéciale : à température modérée de l'ordre de 500 0C avec réduction d'air, surtout pendant le refroidissement, cela afin de préserver le graphite, carbone qui risque de disparaître en brûlant sous l'effet de l'oxygène. On plaçait le loviamanga dans un trou aménagé et adapté à sa taille, puis on entretenait le feu jusqu'à la température voulue, avant de boucher l'ouverture. Les loviamanga, ou assiettes graphitées à pied étaient conçus pour faciliter la prise des repas selon les coutumes : on mangeait en effet par terre, sur une natte. Cette vaisselle, parfois de grande taille, peut contenir une quantité de nourriture suffisante pour deux ou trois personnes, regroupées autour d'elle. Cela se pratique encore couramment dans les milieux ruraux ou traditionnels malgaches. Le graphite, grâce à ses propriétés antiadhérentes, facilite le nettoyage de la vaisselle.
Parmi les récipients à usage domestique, on trouve aussi différentes formes de cruches pour transporter l'eau les siny et les sajoa, de grandes jarres pour conserver l'eau à la maison, les sinibe, et des marmites vilanitany, tantôt à fond plat, tantôt à fond arrondi. D'autres objets en terre cuite étaient destinés à des rites religieux, c'est le cas des brûle-parfum en forme de coupe ou fanemboa. Ces poteries possèdent des qualités qui méritent d'être évoquées, d'autant plus qu'elles sont en voie de disparition, la technique actuelle étant en nette régression. Les cruches malgaches antérieures au XVIIIe siècle présentent une légèreté et une solidité étonnantes. Cela est dû à la minceur des parois, qui ne dépassent guère 3 à 4 millimètres d'épaisseur, d'une part, à l'homogénéité et à la bonne cuisson de la pâte argileuse, d'autre part. Les sinibe, quant à eux, sont volontairement dotés d'une paroi poreuse, permettant à l'eau de s'y infiltrer et de rafraîchir par évaporation le contenu du récipient, principe comparable à celui des gargoulettes. Les vilanitany, enfin, ont fait preuve d'une grande résistance, au cours de leurs usages répétés sur le feu : on y faisait habituellement griller certains aliments comme le riz.
Les céramiques malgaches portent des décors exclusivement géométriques. Les motifs d'impressions triangulaires, réalisés au moyen d'une tige de zozoro, une plante aquatique de la famille des Cypéracées, sont les plus répandus. Les incisions de lignes parallèles qui s'apparentent à des décors obtenus à l'aide d'un peigne se rencontrent assez fréquemment, tandis que les décors en relief sont plutôt rares.
Les fouilles de Fanongoavana ont mis au jour deux ateliers de potiers qui contenaient des restes de matières premières, argile et graphite, des foyers et des ratés de cuisson. Tout portait à croire que la vaisselle et les ustensiles en terre cuite que les habitants du site avaient utilisés puis abandonnés étaient fabriqués sur place. En tout cas, des céramiques étaient certainement produites localement. Or les analyses chimiques qu'on a effectuées sur une soixantaine d'échantillons de poteries récoltés à Fanongoavana ont révélé la variété de provenance des argiles employées. Certains groupes de céramiques, de par leur composition, présentent des caractères étrangers au site et à ses environs, d'où on aurait normalement extrait les matières premières. Cette variation des constituants chimiques suggère l'existence d'une structure d'échanges avec d'autres villages, voire d'autres régions. Ou bien ce seraient les populations venues s'installer sur ce site qui auraient amené ces objets de leur ancien lieu d'implantation. Ce qui permettrait de retracer des itinéraires de migration dans le peuplement des régions centrales de Madagascar.
Malgré des contacts suivis entre les habitants des mêmes régions, et probablement entre ceux de différentes régions, dont témoigne la circulation des techniques, cela est frappant dans la ressemblance des formes de poteries et des motifs de décoration, on constate, sur les hautes terres centrales, un développement, en vase clos, d'une civilisation fortement imprégnée des ressources locales et présentant des caractères originaux. Les habitants de nombreux villages fabriquaient eux-même les outils en fer et les ustensiles en poterie dont ils avaient besoin. Ils possédaient leurs propres ateliers et adaptaient leur savoir-faire aux matières premières existantes. Des études ethnoarchéologiques ont permis, par ailleurs, de dégager une continuité culturelle malgache qui s'étend sur plusieurs siècles, voire sur un millénaire. L'archéologue est bien souvent surpris par les survivances actuelles de pratiques et de techniques anciennes qu'il a rencontrées dans ses fouilles. L'extraction du granit par choc thermique, que l'on continue à utiliser de nos jours, existait déjà il y a six cents ans.
Les échanges avec l'extérieur L'influence arabo-musulmane
L'île de Madagascar n'est pas aussi isolée qu'on l'a pensé. Elle était régulièrement fréquentée, après l'installation des premiers navigateurs qui ont peuplé l'île, ne serait-ce que pour des raisons commerciales. L'influence étrangère s'est surtout fait sentir sur les côtes et, en particulier, dans le nord. L'arrière-pays, surtout le centre, est resté à l'écart de ces contacts.
Des groupes islamisés, tels que les Antalaotse et les Rasikajy, ont installé, à partir du XIVe siècle, des comptoirs de commerce. Ceux-ci ont favorisé l'importation de vaisselle en céramique islamique , pour reprendre les termes de Pierre Vérin, de récipients en sgraffiato et en faux céladon, imitation musulmane de céramique chinoise. La présence de ces objets suppose des relations avec les pays du golfe Persique. Ces peuples islamisés ont introduit dans l'île une architecture en pierre de style arabe, dont témoignent les mosquées et les habitations en ruines de Mahilaka et Antsoheribory. La fabrication des marmites tripodes taillées dans du chloritoschiste date de la même époque.
Les échanges avec l'Extrême-Orient
Les marchandises chinoises ont eu une plus large diffusion dans l'île. Elles sont présentes dans beaucoup de régions. Il s'agit de vaisselle de luxe : bols, assiettes et plats en céladon, de couleur vert pâle. Des échantillons proviennent du site d'Antsoheribory et de la nécropole de Vohémar. La fouille des tombes rasikajy de Vohémar a aussi fourni des soucoupes, des théières et des pots, ainsi que de la porcelaine chinoise bleu et blanc datant du XVe siècle. Le céladon a aussi atteint de nombreux sites de l'Androy, dans l'extrême sud.
Si la Chine parvenait à acheminer ses produits céramiques jusqu'à Madagascar, à l'autre bout de l'océan Indien, l'Asie méridionale, en l'occurrence le sous-continent indien, ne devait pas être à l'écart de ces transactions sur de longues distances. Parmi les objets de parure trouvés dans les tombes de Vohémar, des perles en cornaline rouge proviennent de l'Inde.
Les contacts avec le monde européen
De nombreux objets découverts dans les sites du nord de Madagascar ont été importés d'Europe. Citons, par exemple, une faïence portant des motifs à fleurs, découverte à Vohémar, et différentes céramiques de luxe. Une série de perles en cornaline, en quartz, en verre et en corail a été fabriquée aux Pays-Bas, vers le XVIIe siècle, comme le démontrent les investigations de Suzanne Raharijaona concernant les provenances des perles de Vohémar. Des bijoux en métaux précieux, bracelets en argent et bagues en or, ainsi que des sabres en fer seraient également venus d'Europe.
Si l'on considère les origines, parfois très lointaines Europe, Extrême-Orient, de certains objets archéologiques, l'isolement de Madagascar dans le passé est un concept qu'il convient de nuancer. La navigation à travers l'océan Indien est très ancienne, si l'on considère la fréquentation des côtes de l'Asie méridionale, du golfe Persique et de l'Afrique de l'Est par des populations du Sud-Est asiatique. Les routes maritimes, partant de l'Extrême-Orient vers le sud-ouest de l'océan Indien, devaient certainement aboutir dans la région de l'Afrique orientale et de Madagascar.
Histoire
Si le problème des origines n'est pas complètement éclairci, la connaissance de l'histoire moderne – celle du royaume malgache et de la colonisation française – s'est considérablement enrichie depuis les années 1960 par un renouvellement des sources et de la méthode historique : dépouillement d'archives publiques et privées ; étude critique de la tradition orale et des manuscrits, ainsi que du vocabulaire en usage dans l'administration coloniale, par exemple l'emploi du mot hova comme synonyme de merina ! ; éclairages nouveaux et souvent décisifs apportés à l'histoire événementielle, politique et militaire, par l'analyse des faits économiques et sociaux ; remise à plat de certains événements ou situations considérés auparavant comme bien établis.
Du coup, l'image un peu figée et trop, terre française de la Grande Île donnée par les manuels d'histoire classiques, c'est-à-dire jusqu'aux alentours des années 1960, fait place à un portrait plus complexe et plus tourmenté. Cette analyse est sans aucun doute plus proche de la vérité historique, qu'il s'agisse des rapports de rivalité-domination entre les Merina et les autres ethnies, ou des relations collaboration-conflit entre les Malgaches et le colonisateur français.
À cet égard, la rébellion de 1947 illustre et clôt à la fois une période historique pour Madagascar.
Le problème des origines
La question de l'origine du peuplement de Madagascar a donné lieu pendant longtemps à des débats passionnés parce qu'elle renvoyait directement à la question de la légitimité du pouvoir du premier occupant. Vu sous cet angle, le problème est aujourd'hui dépassé, mais l'intérêt scientifique de la question demeure. À la différence d'autres îles du sud-ouest de l'océan Indien les Mascareignes dont on connaît l'origine et la date du premier peuplement, Madagascar retient toujours son mystère : quand apparurent et qui furent les premiers habitants – ou premiers arrivants envahisseurs ? – que l'on appelle, faute de nom plus précis, les Proto-Malgaches ? La réponse n'est pas simple.
Il est vrai que la Grande Île, excentrée par rapport au reste du monde, lointaine et unique en son genre, a jusqu'à l'époque contemporaine suscité les affabulations, légendes et mythes : mythe littéraire d'une Lémurie paradisiaque ; mythe des Vazimba, un mot qui selon le discours renvoie tantôt au monde des esprits tantôt à ces Proto-Malgaches mal identifiés, alors que ce mot « mythique » pourrait bien n'être que le résultat d'une distorsion progressive de vocabulaire ; mythe encore, et toujours répandu aujourd'hui, que celui des Mikea qui seraient une race particulière de Pygmées, voire de nains vivant totalement repliés, et à la limite permanente de la survie, dans la forêt d'épineux, notamment dans le Sud-Ouest, en pays masikoro ; cette population avec laquelle il est en effet très difficile d'entrer en contact reste mal connue, quelques centaines de familles ?. Mais il s'agit pour l'essentiel de Malgaches dont les parents ont fui la civilisation à l'époque coloniale pour éviter l'impôt et d'autres contraintes et qui, faisant souche, ont fini par s'acculturer ? à leur façon au point d'ignorer complètement le monde extérieur alors qu'à vol d'oiseau ils sont à quelques encablures de la modernité. Mythe encore que celui de l'Eldorado, de la Normandie australe, répandu au début de la colonisation.
S'il n'est déjà pas facile d'appréhender toutes les données du peuplement contemporain – à commencer par le nombre exact de la population –, on conçoit la difficulté en ce qui concerne les origines. Toutefois, les apports récents de l'archéologie (à supposer que les datations au carbone 14 soient fiables eu égard à la durée de la période envisagée) ainsi que de l'anthropologie, de l'ethnographie et de la socio-linguistique (en particulier les travaux de Paul Ottino) permettent de mieux cerner aujourd'hui les origines du peuplement de Madagascar. Encore qu'il y ait place à l'imagination et, bien sûr, à d'autres découvertes.
Traits indonésiens, apports africains
La diversité anthropologique des Malgaches est évidente. Certains types évoquent l'Indonésie, d'autres l'Afrique ; les types mixtes sont les plus fréquents, conséquence de métissages multiples, anciens ou plus récents, entre originaires d'Asie et d'Afrique, eux-mêmes nuancés par d'autres apports asiatiques et européens. Une diversité qui éclate sur un fond incontestable d'unité et qui fait toute l'originalité de la personne et de la personnalité malgaches. Le poète Jacques Rabemananjara la résume ainsi, Présence de Madagascar, 1957 : Visiteurs malais, asiatiques, africains, européens y ont déposé ensemble ou tour à tour leurs marques et leurs types. De leur brassage séculaire s'est formé un peuple intermédiaire guère facile à déterminer et pourtant typiquement reconnaissable : le Malgache contemporain.Pour le président Tsiranana, les Malgaches étaient les seuls véritables Afro-Asiatiques. Plus sommairement, la distinction traditionnelle entre Merina et Côtiers renvoie aux origines lointaines : Indonésie, ou plutôt Austronésie selon la formule à la mode pour les premiers et Afrique pour les autres. Il faudra nuancer.
La langue, elle, est d'origine indonésienne, on disait naguère malayo-polynésienne. Cela confère à Madagascar un fond d'unité linguistique très réel malgré les variations dialectales et les apports de vocabulaire africain bantou et de termes arabes qui ont progressivement enrichi cette langue dont la transcription écrite ne sera effectuée qu'au XIXe siècle.
La technologie et les coutumes anciennes, malgré des apports africains, semblent apparentées surtout au monde austronésien : culture, vitale et célébrée, du riz qui a engendré une véritable civilisation du riz, et usage généralisé de l'angady, bêche à long manche, au lieu de la houe africaine ; maisons quadrangulaires à toit pointu et, à l'est, cases sur pilotis ; fourreau de fibres pour le vêtement ; sagaie, sans arc; système de parentés partiellement indifférenciées et hiérarchies sociales ; culte des ancêtres, tombeaux et, sur les plateaux, cérémonie du famahadina ou retournement des morts, etc. En revanche, la toge lamba paraît être d'origine africaine ainsi que – si l'on se réfère au vocabulaire – certains animaux domestiques et certaines pratiques d'élevage, en particulier celui du zébu omby, quasi-objet de culte dans le Sud et l'Est où le troupeau est signe de prestige plus que source de profit. D'un point de vue économique, ce système d'élevage contemplatif a souvent été critiqué. Les instruments de musique et les types de danse témoignent de ces apports divers et entremêlés. L'art de la divination, en particulier par des grains, sikidy, est d'origine arabe ainsi que les divisions du temps dans un calendrier fondé sur l'astrologie.
Quels que soient les progrès effectués dans la connaissance des origines, l'étude précise de nombreux traits ethnographiques reste à faire. Sur bien des points, on s'en tient à des approximations. Mais la thèse d'une origine africaine des Malgaches avancée au XIXe siècle par le grand malgachisant Gabriel Ferrand est depuis longtemps abandonnée. Son contemporain et rival Alfred Grandidier imaginait au contraire le peuplement par des Indonésiens mêlés de Mélanésiens, les apports africains ne lui paraissant que très secondaires et tardifs, et dus surtout à la traite des esclaves. Des hypothèses plus ou moins voisines ont été développées par d'autres auteurs non français, tels Birkeli et R. Kent, Early Kingdoms of Madagascar.
Les Proto-Malgaches : l'arrivée des navigateurs de haute mer
À moins d'imaginer l'existence et la survivance d'aborigènes africains au moment de la cassure qui sépara Madagascar du continent, la Grande Île, déserte et donc terra nullius, n'a pu être au départ peuplée que par des immigrants venus, c'est une évidence, de la mer. Mais des immigrants capables d'affronter avec succès les dangers de la haute mer. Les Africains n'étant pas considérés comme des marins de ce type et l'hypothèse de la venue de Mélanésiens étant aujourd'hui généralement écartée, ce sont des Indonésiens Austronésiens qui auraient donc été les premiers arrivants. On a avancé l'idée de navigateurs en pirogues à balancier venus par le sud de l'Asie et de la côte d'Afrique où un premier mélange se serait produit avant d'aborder Madagascar. On a également supposé une arrivée plus tardive d'Indonésiens disposant de plus grands bateaux et qui auraient d'abord lancé des expéditions de pillage, voire de colonisation, sur la côte africaine avant de toucher la Grande Île. La référence aux indications données par les chroniqueurs arabes du Moyen Âge n'est pas décisive, puisque les île Waq-Waq dont ils parlent peuvent désigner selon les spécialistes aussi bien Madagascar que le Mozambique... ou le Japon.
À quelle date alors fixer ces premiers débarquements ? On a supposé fort logiquement, en l'absence de toute trace d'hindouisme dans la culture traditionnelle malgache, qu'ils étaient antérieurs à l'hindouisation de l'Indonésie, c'est-à-dire au IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais seules les îles de Bali, Java et Sumatra ont subi l'impact de l'hindouisme. Si donc les Proto-Malgaches sont originaires des îles non hindouisées de l'Indonésie ainsi qu'on l'a prétendu – îles Célèbes, Sulawesi, Bornéo Kalimantan, îles de la Sonde –, leur départ de l'Austronésie pourrait être beaucoup plus récent, soit aux alentours du Xe siècle de notre ère. On avance aujourd'hui que ces premières circumnavigations indonésiennes, liées déjà au commerce des épices, auraient pu commencer dès le VIIIe ou le IXe siècle, de toute façon plusieurs siècles avant les débuts de la colonisation européenne.
L'invasion primitive a été suivie d'autres arrivées et de nombreux voyages de navigateurs venus de l'Orient, comme l'attestent certains chroniqueurs arabes, notamment Edrissi XIIe s.. Il est vraisemblable que ces voyages ont amené les Merina, prononcer Merne qui, à partir de la côte est ou sud-est de l'île, gagneront progressivement les Hautes Terres où ils se fixeront.
D'autres groupes immigrés d'origine indonésienne ou africaine qui étaient, eux, islamisés ont aussi abordé la côte est. Ce sont les Rasikajy, les Zafy-Raminia et les Antemoro, prononcer Antémour. Les Rasikajy, établis dans le Nord-Est autour d'Iharana Vohémar, ont laissé des tombeaux et de curieuses marmites à trois pieds, taillées dans une pierre tendre. Plus au sud, les Zafy-Raminia ont donné naissance à deux tribus actuelles, les Antambahoaka autour de Mananjary et les Antanosy vers Fort-Dauphin. Arrivés un peu plus tard, les Antemoro s'installèrent sur la rivière Matitana. Tous ces groupes plus ou moins islamisés, dont les descendants donnent aujourd'hui une certaine spécificité culturelle et politique à la région sud-est de Madagascar, possédaient ou possèdent encore des manuscrits anciens, les Sorabe, écrits en langue malgache mais utilisant les caractères arabes et relatant des traditions, des légendes et des formules magiques. Pour le reste, ni par les coutumes ni par la langue, ces arabisés, d'ailleurs peu nombreux par rapport à l'ensemble des ethnies, ne se différencient notablement des autres Malgaches.
Proto-Malgaches anciens ou arrivés plus récemment ont d'abord habité la côte, vivant de pêche et de tubercules, ignames, taro. Certains, par suite de croissance démographique, de querelles familiales ou d'habitudes nomades, se déplacèrent vers l'intérieur. La culture sur brûlis, le tavy, semblable au ladang indonésien et le renouvellement par le feu des pâturages pour les bovidés amenèrent la disparition quasi complète de la forêt primaire des plateaux, plus sèche et moins vigoureuse que celle de la côte est. La rizière inondée, technique amenée de l'Indonésie ou de l'Inde du Sud, occupa peu à peu les fonds de vallée, puis les marais et les flancs des montagnes.
C'est ainsi du moins que l'on peut se représenter, faute de documents, le peuplement de l'île. Il fut longtemps très lacunaire : un archipel de petits groupes humains dispersés entre d'immenses régions vides. Des fouilles archéologiques récentes apportent une meilleure connaissance de la culture matérielle de ces Proto-Malgaches et de leur genre de vie, consommation de bovidés, usage du fer et petite métallurgie, poterie graphitée, etc..
Les étrangers : marchands, négriers et pirates
Venus de l'Afrique voisine puis de l'Europe, ces nouveaux arrivants apparaissent effectivement comme des étrangers (race, langue, coutumes, objectifs) par rapport aux immigrants de première souche, les Proto-Malgaches (ou Vazimba ?). Des brassages vont s'opérer, mais aussi des échanges et des affrontements.
De la côte est d'Afrique et des Comores viennent, peut-être dès le XIIe siècle, les Antalaotra (« gens de la mer »), commerçants islamisés parlant un dialecte swahili, bantou mélangé d'arabe. Ils créent sur la côte nord-ouest des établissements dont il reste quelques ruines imposantes de style arabe. Grâce aux boutres – navires massifs à mât incliné et voile latine –, ils naviguent entre la Grande Île, les Comores et le Mozambique, effectuant longtemps l'essentiel des échanges, y compris, à l'occasion, la traite entre les Malgaches devenus sédentaires et le monde extérieur.
Dès le XVIe siècle, les tentatives de colonisation européenne, infructueuses jusqu'au XIXe siècle, ouvrent une nouvelle page dans l'histoire malgache. Ces tentatives de conquête et d'implantation se limitent à la côte, l'intérieur de la Grande Île demeurant largement inconnu des Européens jusqu'au début du XIXe siècle.
Les Portugais, qui baptiseront île Saint-Laurent l'île découverte par eux en premier au début du XVIe siècle, ne laisseront guère de trace. Ils s'efforcent vainement de ravir le monopole commercial des Antalaotra tandis que leurs missionnaires échouent dans leur entreprise d'évangélisation sur les côtes ouest et sud-est. Ils renoncent à toute installation durable dès le début du XVIIe siècle. On leur doit toutefois une description assez précise des comptoirs établis par eux dans la partie nord-ouest de Madagascar. Les Hollandais, vers la fin du XVIe siècle, envisagent de créer dans la vaste baie d'Antongil, sur la côte est, une escale sur la route de l'île Maurice et de l'Indonésie. Ils y renoncent finalement, chassés probablement par l'insalubrité du site. Mais leur passage laisse au moins une trace culturelle intéressante, la rédaction par Frederik de Houtman du premier dictionnaire malgache-malais. Les Anglais tentent eux aussi, au XVIIe siècle, d'installer des colonies sur la côte sud-ouest, la plus sèche et la plus salubre ; mais ils échouent ou sont massacrés.
Ce sont en définitive les établissements français qui se révèlent les plus durables au XVIIe siècle après une tentative avortée d'installation dans la baie de Saint-Augustin, côte sud-ouest en 1602. Durant trente ans 1642-1672, l'occupation effective de Sainte-Luce et de Fort-Dauphin dans l'extrême sud malgache autorisera le roi Louis XIV à proclamer la souveraineté française sur l'île entière appelée à cette date île Dauphine. Souveraineté toute théorique, certes, mais dont la revendication doit être replacée dans le contexte de la compétition coloniale franco-britannique dans l'océan Indien.
Le comptoir commercial français de Fort-Dauphin a été fondé en 1643 par Jacques Pronis, commis de la Compagnie des Indes orientales, sur ordre de Richelieu, en tant que point de ravitaillement et de rafraîchissement sur la route des Indes.
Parmi les successeurs de Pronis, Étienne de Flacourt restera le plus prestigieux des gouverneurs de l'établissement français de Fort-Dauphin. On lui doit le premier essai de description globale du pays Histoire de la Grande Isle de Madagascar. Des crises intestines surgissent, d'autant qu'en 1664 la Compagnie des Indes décide de porter son effort commercial sur l'Inde et de créer un point de peuplement à l'île Bourbon, la Réunion, négligeant du coup le comptoir. L'entente avec la population Antanosy connaît des vicissitudes ainsi qu'en témoigne le massacre de colons français le jour de Noël 1672. Bien accueillis au départ par les Antanosy, les colons français s'en étaient fait progressivement des adversaires en raison de leur comportement esclavagiste. Les derniers colons français quittent Fort-Dauphin en 1674 pour la Réunion, non sans emmener dans leurs bagages quelques esclaves malgaches.
Abandonnée pratiquement par le colonisateur, l'île devient au XVIIIe siècle un repaire de flibustiers et de pirates anglais et français qui s'affrontent sur la route des Indes. Les baies de Diégo-Suarez et d'Antongil ainsi que l'île Sainte-Marie – qui est cédée à la France en 1754 à la suite des amours célèbres de la reine Bety et du caporal gascon La Bigorne – sont les principaux centres de trafic.
L'éphémère république internationale de Libertalia installée par le Français Misson et l'Anglais Thomas Tew, dans la baie de Diégo-Suarez, fut sans doute une belle utopie de ces pirates. Elle prit fin en 1730.
Cependant, les îles Mascareignes, Bourbon et Maurice, devenues à cette époque des colonies françaises, se peuplant progressivement en s'enrichissant par la culture du café puis par celle de la canne à sucre, vont chercher sur la côte est malgache du riz, des bœufs et des esclaves. Une activité commerciale tous azimuts et au plus offrant se développe par tous les moyens ; les comptoirs de Tamatave et de Foulpointe prennent une importance accrue. La France tente même de se rétablir sur cette côte est, une première fois, 1768-1771 à Fort-Dauphin avec le comte de Modave, une seconde fois, 1774-1786 dans la baie d'Antongil avec le comte de Benyowski, un aventurier extravagant – magyar d'origine, philosophe, négrier à l'occasion comme Modave, qui se proclamera même empereur de Madagascar – et qui laissera son nom à une rue de Tananarive jusqu'en 1973. Ces tentatives échouent rapidement. En cette fin de XVIIIe siècle, où va s'amorcer véritablement le royaume de Madagascar, les Européens présents dans l'île, quelque 4 000 Français seraient venus à Madagascar au XVIIe siècle selon H. Deschamps sont principalement des commerçants que l'on appelle plutôt à l'époque des traitants. Le Français Nicolas Mayeur est l'un des tout premiers à avoir circulé sur le plateau central et à l'intérieur de l'île. L'Europe commence véritablement à découvrir Madagascar.
Au temps des multiples royaumes
L'histoire des différents groupes ethniques malgaches installés dans l'île reste mal connue dans ses détails. On estime que ces groupes, sédentarisés, ont, à la suite de nombreuses migrations intérieures, occupé définitivement leur territoire géographique actuel dès la fin du XVe siècle. À cette date, la carte géopolitique de Madagascar serait pour l'essentiel établie. Ces groupes ethniques, improprement mais couramment appelés tribus, forment des sociétés politiques qui sont tantôt une juxtaposition de clans souvent rivaux, tantôt des royaumes parfois unis mais souvent divisés. Cette diversité contribue, par les luttes et résistances, à forger ce fond d'unité qui apparaîtra à la fin du XVIIIe siècle.
Des rois guerriers
L' organisation monarchique n'a pas été répandue de façon uniforme, et il est certain que le morcellement géographique et les variations du relief vastes plaines et semi-déserts, falaises et vallées, collines ont eu leur influence sur la formation des systèmes politiques de ces communautés. Certains peuples, comme les Tsimihety, n'ont pas connu d'organisation monarchique. Chez d'autres, en particulier dans le sud de l'île, on observe plutôt une mosaïque de chefferies et de petites principautés, les mpanjaka souverains
Les royaumes Antanosy du Sud-Est ont sans doute donné naissance aux dynasties des peuples Bara, Antandroy, Mahafaly et Sakalava. Si la royauté a disparu chez les Antandroy, chez les Sakalava, au contraire, le petit royaume né au début du XVIIe siècle près de la basse vallée du fleuve Mangoky s'est étendu, sous le roi Andriandahifotsy, aux plaines de l'ouest Menabe, puis au nord-ouest (Boina). À leur apogée XVIIIe s., les deux royaumes sakalava du Menabe et du Boina contrôlent un tiers de la Grande Île. Le port de Majunga Mahajanga, fondé en 1745 et peuplé de commerçants antalaotra, assurait les relations avec l'extérieur. Les Sakalava razziaient les populations du plateau. Un de leurs chefs fonda, sur la côte sud-est, le royaume Antaisaka inséré entre des royaumes d'origine islamique.
De l'un de ceux-ci, le royaume Antemoro, étaient partis des nobles, les Zafy-Rambo, qui avaient fondé des royaumes dans la forêt du pays des Tanala, puis, franchissant la falaise orientale, avaient instauré les premières principautés en pays Betsileo. Il en résultera au XVIe siècle quatre petits royaumes, mais qui seront minés par les guerres intestines.
Sur la côte orientale, les Zana-Malata, mulâtres, descendants des pirates, fondèrent au début du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de l'un d'entre eux, Ratsimilaho, la confédération des Betsimisaraka les nombreux inséparables. Le royaume par la suite se fractionna. Des raids de pillage associant Betsimisaraka et Sakalava partaient régulièrement, sur de simples pirogues, vers les îles Comores et la côte orientale d'Afrique. D'autres groupes, quittant la plaine, pénétrèrent sur la partie nord du plateau pour donner naissance au peuple libre des Tsimihety, ceux qui ne se coupent pas les cheveux.
Au centre des Hautes Terres, autour de la vallée marécageuse de la rivière Ikopa, les Merina ont établi leurs villages fortifiés après avoir chassé ou soumis les Vazimba. Cette ethnie, issue probablement des plus récentes vagues d'immigration austronésienne, s'était donné dès le XVIe siècle, avec Ralambo, 1575-1610, un début d'organisation politique structurée. L'organisation se renforce avec les successeurs de Ralambo ; l'un deux, Andrianjaka, fondera Analamanga qui deviendra, ultérieurement, la capitale Tananarive, Antananarivo, la ville des mille .
Au XVIIe siècle, le pays – qui a pris le nom d'Imerina, pays qu'on voit de loin sous le jour et ses habitants celui de Merina – se développe sur tous les plans, économique, démographique et politique. La maîtrise de l'hydraulique agricole, drainage et la discipline collective permettent de transformer en rizières irriguées la plaine autrefois marécageuse de la Betsimitatatra, environs de Tananarive. Avec deux récoltes de riz par an, les paysans peuvent dégager un surplus qui induit le développement artisanal, puis urbain. C'est une véritable révolution économique qui est en cours dans cette société de type féodal.
Mais au XVIIIe siècle le pays, en pleine croissance, est sérieusement affaibli par les divisions entre clans issus de l'ancêtre Ralambo et par les partages successoraux. Il est alors divisé en quatre royaumes combattants que des voisins belliqueux cherchent à razzier. Repliés chacun sur leurs collines les seigneurs rivaux s'affrontent avec les moyens de l'époque et sur un espace territorial somme toute réduit. C'est là pourtant que se joue le destin politique de Madagascar.
À la fin du siècle, le roi Andrianampoinimerina,le seigneur au cœur de l'Imerina rétablit l'unité politique merina : après de longues guerres, il réussit, lui qui avait usurpé l'un des royaumes, à s'emparer des trois autres. Il transfère sa capitale d'Ambohimanga, restée colline sacrée, à Antananarivo située sur une colline distante de trente kilomètres. Le règne d'Andrianampoinimerina 1787-1810 ouvre l'ère moderne de Madagascar. Par son autorité, son intelligence et un incontestable génie d'organisation, ce nouveau souverain malgache, qui a seul droit au hasina, caractère sacré reconnu par l'offrande symbolique d'une piastre dans les grandes circonstances, crée une cohésion sans faille en utilisant habilement les institutions traditionnelles, le discours ou kabary, l'assemblée de village ou fokonolona pour asseoir et renforcer son pouvoir. Il poursuit une politique de développement économique, stimulant les vertus du travail et des corvées collectives, encourageant les grands travaux agricoles et les marchés tsena. Il fait habilement accepter sa suzeraineté en tissant un réseau d'alliances matrimoniales avec les princesses d'autres royaumes ; stratégie qui lui permet d'étendre ses possessions vers les voisins de l'est et les royaumes du Betsileo, et d'entretenir de bonnes relations avec les royaumes côtiers. La formule célèbre et peut-être apocryphe qu'on lui prête –la mer est la limite de ma rizière – suggère tout un programme de conquête en vue de l'unification politique de l'île.
Si Andrianampoinimerina n'est pas à l'origine d'un véritable sentiment national malgache comme on l'a écrit parfois abusivement, son règne n'en constitue pas moins une période charnière dans l'histoire de Madagascar. Très méfiant à l'égard des étrangers au point d'interdire l'accès de sa capitale aux marchands, il toléra le commerce européen pour se procurer des armes à feu en échange d'esclaves. Un type de commerce, poudre, fusils et alcool de traite qui, tout au long de cette période des multiples royaumes, a souvent été un élément déterminant dans la conquête du pouvoir. Mais, surtout, le règne d'Andrianampoinimerina apparaît comme la première tentative sérieuse, et en partie réussie, d'institutionnalisation du pouvoir à l'échelle d'une société politique complexe, mais qui prend l'allure d'une nation.
Une civilisation originale
À la fin du XVIIIe siècle, la civilisation malgache connaît son plein épanouissement. Les ressources alimentaires sont, avant tout, le riz, mais aussi le manioc et la patate apportés vraisemblablement par les Portugais, ainsi que la banane, le taro et les pois de terre. Le bœuf (zébu) est élevé comme capital et comme animal de sacrifice. La pêche dans les rivières et les rizières le poisson tilapia tout comme l'élevage de la volaille constituent un complément d'appoint apprécié.
La maison rectangulaire à toit pointu est en bois, plus rarement en argile. On dira, plus tard, qu'à Madagascar le bois est réservé à la maison des vivants et la pierre au tombeau des ancêtres. S'agissant de vêtement, il se compose sur les plateaux d'un pagne et d'une toge (lamba) qui, lorsqu'ils sont lourds et colorés de rouge lambamena, sont réservés aux chefs et aux défunts. Sur la côte chaude et humide, un fourreau de nattes suffit. Le fer est extrait du sol et travaillé ; les ustensiles sont faits de poteries, tant sur les plateaux que sur la côte, ou de cucurbitacées sur la côte.
Le culte des ancêtres donne lieu à des sacrifices d'animaux, bœufs, coqs, à des offrandes, alcools et cérémonie du tromba, qui varient d'une ethnie à l'autre mais appartiennent à un fond culturel commun : la conviction que les ancêtres, quelles que soient les pratiques funéraires des diverses communautés, surveillent, protègent et punissent en cas de désobéissance aux coutumes.
On invoque le Créateur Zanahary, mais ce sont les ancêtres qui jouent un rôle dans la vie quotidienne. Le devin indique les sorts par la géomancie. Un grand nombre d'interdits fady rythment la vie du Malgache qui sait que toute transgression retombera sur lui concepts du tsiny et du tody. Ainsi se construit, sur un fond d'unité très réelle en dépit des variations régionales, une société typiquement malgache, stable et très hiérarchisée, où chacun se sent à sa place par croyance éprouvée et aussi par un certain sens de la fatalité. Cette culture ancestrale malgache restera très vivante malgré les bouleversements ultérieurs de la période coloniale et postcoloniale. Comme l'écrit l'un des meilleurs analystes malgaches contemporains de cette société, le jésuite Rémy Ralibera : Le courant profond de cette culture malgache ancestrale continue à nous mener plus inconsciemment que consciemment.
La littérature orale est d'une grande richesse : contes et histoires d'animaux, proverbes innombrables à portée didactique, poésie amoureuse subtile, dont les hain-teny seront une forme moderne très élaborée, art du discours, kabary, de l'allusion, de la métaphore... et de l'humour. À l'exception de l'épopée, la littérature orale malgache s'exprime brillamment dans tous les genres. Sans oublier la musique et les danses traditionnelles qui jouent un rôle important dans les cérémonies. Sur les hauts plateaux, les troupes quasi professionnelles de chanteurs-conteurs-acteurs-danseurs, appelés mpilalao, font partie du meilleur folklore malgache.
Cette civilisation malgache, qui a intégré les apports asiatiques et africains, apparaît alors dans toute son originalité. Elle saura assimiler à sa façon les apports européens. La malgachitude ou malgachéité ? contemporaine est le résultat de tous ces brassages ethniques et culturels qui font la richesse, et à l'occasion les contradictions internes, de la personnalité malgache.
Les clans, héritiers d'un même ancêtre
La cellule originelle de la société politique malgache est le foko, communauté clanique. Souvent représenté comme une petite démocratie où les problèmes sont débattus dans l'assemblée comprenant tous les hommes du clan jusqu'à obtention du consensus, le foko est en fait une structure hiérarchisée. Un conseil des anciens chefs de famille commande au village. Le foko est, à cette époque, d'abord et avant tout une communauté humaine unie par un même ancêtre. Les liens de famille s'établissent en ligne paternelle ou maternelle. Sur ce point, il semble bien qu'il y ait eu beaucoup de diversité, le matriarcat ayant probablement dominé dans certains clans. Le système contemporain du fokonolona, autrefois spécifique à l'Imerina mais aujourd'hui généralisé et construit à partir d'une base territoriale le Fokontany, est l'héritier u foko originel.
À partir de la fin du XVe siècle, les foko qui ont réussi à s'imposer par leur supériorité militaire ou par leur prestige religieux contrôlent des communautés plus larges qu'on appellera, plus tard, tribus. Et quelques-uns de ces groupes forment, dans certaines régions de l'île, des royaumes. Tout royaume malgache de l'époque est donc un groupement de clans hiérarchisés. Le roi, souvent choisi par les chefs de clans roturiers, est pris dans le clan royal, parmi les fils ou les frères du roi défunt. Les cérémonies d'intronisation lui confèrent le hasina, un droit sacré ; il est dieu visible et son pouvoir, théoriquement absolu, est limité par les coutumes des ancêtres ainsi que par les avis des chefs de clans. On parle de lui en utilisant, parfois, un vocabulaire spécial. Le roi habite une grande case de bois lapa dans une citadelle rova ; il dispose de gardes et d'esclaves, lève et perçoit des impôts, peut exiger la corvée et s'adresse à son peuple par des discours kabary qui annoncent ses intentions et confortent sa légitimité. Ses parents peuvent recevoir des fiefs. Le roi dispose aussi de messagers, sorte d'ambassadeurs dotés de grands pouvoirs. Dans cette société typiquement féodale composée – sous un vocabulaire particulier – de rois, de seigneurs et de vassaux, la guerre est fréquente, occasion à la fois de sport et de pillage.
Les villages sont fortifiés et, en Imerina, toujours installés en haut des collines à des fins stratégiques évidentes. La sagaie, le javelot, le bouclier constituent les armes habituelles ; à partir du XVIIIe siècle s'y ajoutent les fusils d'importation. Ce qui va modifier les rapports de force dans le jeu des affrontements traditionnels.
Dans les royaumes, les clans sont hiérarchisés. Ainsi à l'époque de Andrianampoinimerina la stratification sociale chez les Merina est bien établie : les nobles andriana, les roturiers libres, hova et les esclaves, andevo ou mainty, noirs, esclaves domestiques de naissance ou esclaves de guerre. Cette hiérarchisation comporte des catégories, voire des sous-catégories internes, bien perçues par les intéressés, qui s'accompagnent notamment d'interdits matrimoniaux. Sous des noms différents, cette hiérarchisation, abusivement qualifiée de système de castes alors qu'elle n'a pas de véritable point commun avec le système des castes de l'Inde se retrouve avec des nuances ou des variantes dans la plupart des autres ethnies malgaches. Cela étant, la hiérarchisation sociale, très forte, n'entraînait pas nécessairement une différence très grande de condition matérielle. Il reste que l'exercice du pouvoir, fanjakana était, de par la coutume, l'apanage de la classe ? noble, andriana en Imerina. Pour certains analystes contemporains, la notion de andrianité caractériserait un phénomène sociétal et politique,au moins en Imerina naturellement élitiste qui serait l'aboutissement d'une tradition pluri-millénaire : un pouvoir qui serait resté d'essence essentiellement religieuse et d'un droit à l'exercice [du pouvoir] qui tient de la qualité personnelle de l'individu plus que d'un prétendu droit du sang, J. P. Domenichini, 1987. Une analyse qui, à défaut d'être parfaitement démontrée, a le mérite de remettre à l'ordre du jour l'histoire des stratifications sociales et politiques à Madagascar, en dehors de tout présupposé idéologique.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... hp?topic_id=2608&forum=24
Posté le : 09/08/2014 18:31
|
|
|
|
|
Découverte de Madagascar 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Le royaume de Madagascar : la monarchie merina
Avec la mort en 1810 du roi-fondateur Andrianampoinimerina s'ouvre le règne de son fils Radama Ier. Intelligent, avide de nouveautés et ambitieux, le jeune monarque – qui a pris Napoléon Ier pour modèle – apparaît avec le recul du temps comme le créateur véritable de l'État malgache moderne.
Une politique d'ouverture et d'expansion
Le règne, bref mais important, de Radama Ier 1810-1828 est un tournant décisif dans l'histoire de Madagascar. L'hégémonie merina s'affirme en même temps que la société s'ouvre au monde occidental. Le titre de roi de Madagascar est décerné à Radama par les diplomates étrangers, à commencer par le gouverneur anglais de l'île Maurice, sir Robert Farquhar, qui appuie la monarchie merina afin d'écarter définitivement la présence française sur la côte est et d'éviter toute autre tentative de pénétration. Le traité de Paris de 1814, qui a redistribué les cartes au profit de l'Angleterre, victorieuse de la compétition coloniale franco-britannique dans l'océan Indien, est une référence non négligeable pour Radama Ier qui a des ambitions de conquête, d'unification et de modernisation.
En 1817, il conclut avec l'Angleterre un traité par lequel il renonce à la traite des esclaves en contrepartie d'une assistance financière, technique et militaire : livraison d'armes et mise sur pied d'une armée de métier formée par des instructeurs anglais. Cette supériorité technique permet à Radama Ier d'entreprendre, entre 1817 et 1826, des opérations de conquête, de pacification et/ou d'alliances. Il s'ouvre la route de Tamatave dès 1817 et obtient la soumission des mpanjaka de la côte orientale, éliminant ainsi les derniers postes français – à l'exception de l'île Sainte-Marie. Ses officiers occupent ensuite les petits royaumes du Sud et du Sud-Est, et aussi bien l'extrême nord de l'île que l'extrême sud, notamment Fort-Dauphin qui n'est plus tenu que par... cinq Français. Ailleurs, des garnisons merina contrôlent les chefs locaux maintenus en fonction. Mais, malgré plusieurs expéditions 1822-1824 qui déciment ses troupes, Radama Ier ne parvient pas à soumettre définitivement les peuples du Menabe et du Boina. Une partie des Sakalava et des ethnies du Sud demeurent donc indépendantes.
Cette volonté d'hégémonie et d'expansion territoriale, encouragée certes par l'Angleterre, était aussi celle de la monarchie merina, soucieuse de désenclaver le royaume par un accès aux deux façades maritimes côte est et côte ouest afin d'échapper ainsi à l'asphyxie... et aux razzias des peuples voisins, et intéressée par le développement des relations commerciales avec l'extérieur. À la mort de Radama Ier, les limites extrêmes de la monarchie merina, avec son système de quasi-protectorats, sont pratiquement atteintes et vont se maintenir ainsi jusqu'à la fin du royaume. L'unification politique de l'île a fait un grand pas et l'on peut effectivement parler, désormais, d'un royaume malgache même si la domination merina n'est pas territorialement complète ni politiquement toujours bien acceptée. La brutalité des expéditions de conquête ou de pacification a déjà compromis l'assimilation des populations non merina. Une manière de colonisation ? qui laissera des traces et des préjugés dans les mentalités.
L'aspect novateur du règne de Radama Ier est l'ouverture à la civilisation occidentale, ouverture qui elle aussi laissera des traces profondes dans la formation sociale malgache. Soucieux de modernisation, Radama fit venir des ouvriers européens. Esprit curieux mais prudent, il n'accepta une coopération des Européens que dans des domaines qu'il délimita lui-même : création des toutes premières manufactures à Antananarivo, fixation par écrit de la langue malgache, lui-même ayant choisi, dit-on, les consonnes anglaises et les voyelles françaises pour la transcription phonétique du malgache.
C'est sous le règne de Radama Ier que débarquent à Madagascar, en 1820, les premiers missionnaires protestants britanniques de la London Missionary Society dont l'impact se révélera considérable. Dans l'immédiat, ces pasteurs se bornent, si l'on peut dire, à exposer leur mode de vie chrétien sans chercher à faire du prosélytisme et des conversions. Missionnaires-artisans, particulièrement attachés à la rédaction d'un vocabulaire et d'une grammaire de la langue malgache, ils furent en somme les premiers coopérants techniques au sens contemporain de l'expression.
Du repli nationaliste au retour à l'ouverture sur l'Europe
À Radama Ier, qui meurt prématurément en 1828, succède son épouse, Ranavalona Ire, portée au pouvoir par l'oligarchie dominante, les chefs de clans andriana et surtout hova qui avaient soutenu autrefois Andrianampoinimerina. Ranavalona Ire inaugure la série des reines qui constitue l'un des traits caractéristiques du XIXe siècle à Madagascar.
Son long règne 1828-1861 offre deux images contradictoires. Ainsi que l'écrit un historien contemporain Guy Jacob, Ranavalona Ire apparaît comme une Caligula femelle pour les traitants et les missionnaires qu'elle expulsa et pour la poignée de Malgaches convertis au christianisme qu'elle persécuta , tandis qu'à la fin du XIXe siècle elle incarne, aux yeux des nationalistes, la fierté malgache face aux vazaha étrangers. Le portrait de cette reine, cruelle et xénophobe selon l'historiographie occidentale, mais proche du peuple malgache dont elle respecta les cultes ancestraux, est aujourd'hui beaucoup plus nuancé. Méfiante à l'égard des étrangers, elle s'opposa autant qu'elle en eut la possibilité aux tentatives d'invasion. Deux coups de main sur Tananarive des flottes française et anglaise échouèrent. Réduisant en esclavage le capitaine d'un navire de commerce français, Ranavalona Ire aurait déclaré : Puisqu'on vend les Noirs, on peut bien vendre aussi les Blancs.
L'hostilité témoignée aux étrangers par la reine est sans doute moins l'expression d'un paganisme agressif et d'un sentiment xénophobe primaire que la conséquence d'un nationalisme merina – et plus largement malgache – qui se renforcera au cours de ces trente-trois années de règne. Ranavalona Ire veut avant tout préserver les structures de la société malgache liées au culte des ancêtres. D'où sa méfiance naturelle à l'égard des étrangers – Européens de diverses nationalités – qui, marchands ou missionnaires, peuvent ou veulent perturber l'ordre social issu de la tradition. Si les missionnaires sont effectivement chassés du royaume, c'est parce qu'ils procèdent à des conversions et ne s'en tiennent pas à leur fonction, très appréciée, d'instruction. Il est vrai que la fin du règne de Ranavalona Ire sera particulièrement violente, avec les premiers martyrs malgaches chrétiens et les multiples victimes accusées, à tort ou à raison, de complot ou de sorcellerie. Mais Ranavalona sait retenir dans le royaume quelques rares étrangers qui lui paraissent œuvrer au bénéfice du pays et du régime. Le principal est le célèbre Jean Laborde mort en 1878, un Gascon qui, par son génie inventif et grâce à la main-d'œuvre des corvéables, produit à peu près tout ce que la reine souhaite, des étoffes aux canons. Les installations fours, fonderie de Mantasoa emploient jusqu'à dix mille ouvriers.
À la mort de Ranavalona Ire, en 1861, succède pour une très courte période son fils Radama II. Esprit libéral et très francophile, utopiste, il pratique une politique d'ouverture totale. Les Européens reviennent : les missionnaires, protestants anglais et catholiques français, entrent dans une compétition – évangélique et politique – qui laissera des traces durables dans le système politique malgache. Radama II disparaît en 1863, assassiné dans des intrigues de palais. Sa veuve Rasoherina lui succède, mais la réalité du pouvoir passe rapidement au Premier ministre Rainilaiarivony, un Hova qui sera l'homme fort de la monarchie merina jusqu'à la fin du siècle et qui renforcera sa légitimité en ayant la prudence politique d'épouser successivement les trois reines du royaume malgache : Rasoherina 1863-1868, Ranavalona II (1868-1883) et Ranavalona III 1883-1897. Mais ce Premier ministre, d'origine roturière, doit déjouer les intrigues de l'oligarchie noble qui l'accepte mal et il est bientôt confronté aux pressions extérieures, notamment française, consécutives à l'expansion coloniale et à la rivalité des impérialismes anglais et français dans cette partie du monde.
La conversion au protestantisme, en 1869, de la reine Ranavalona II et de son mari, Premier ministre, est un événement à longue portée. Il est à la fois d'ordre culturel – le christianisme devenant la religion à la mode dans la société aristocratique merina l'Église du Palais au grand dam des traditionalistes fidèles à l'esprit de Ranavalona Ire qui s'étaient déjà opposés à Radama II– et d'ordre politique : l'Angleterre, par l'intermédiaire notamment de ses évangélistes, soutient le gouvernement du Premier ministre en lui imposant outre ses cotonnades ! un modèle politique modernisé qui n'était peut-être pas le mieux adapté à la situation.
Entre 1860 et 1885, le royaume de Madagascar connaît en effet une marche accélérée vers la modernisation, occidentalisation. L'ouverture économique donne libre jeu à l'esprit d'entreprise et aux affaires. La monarchie s'associe à des étrangers dans certaines activités, telles que les sucreries. Le Français Jean-François Lambert – que Ranavalona Ire avait expulsé – revient sous Radama II et laissera son nom à un projet d'envergure la charte Lambert visant à établir une compagnie à charte et un traité de commerce franco-malgache conforme aux principes du pacte colonial. Les missionnaires protestants, puis catholiques, développent écoles et hôpitaux, construisent l'Écossais Cameron fait édifier entre 1868 et 1873 le palais de la reine sur le rova de Antananarivo, conseillent et s'efforcent d'adoucir la condition des esclaves.
La modernisation se reflète dans l'adoption d'une législation partiellement écrite et de nouvelles structures administratives. Des codes sont promulgués, le plus célèbre (toujours en vigueur sur certains points étant celui dit des 305 articles publié en 1881, et qui sera le dernier pour le royaume de Madagascar. Tout en laissant subsister les coutumes ancestrales, on adoucit le système pénal traditionnel en amendant le type et l'échelle des peines abolition, par exemple, de la sanglante ordalie du tanguin ou épreuve du poison ; on procède aussi à d'importantes innovations : suppression de la polygamie, institution de l'état civil, du divorce. Des réformes qui s'appliquent essentiellement en Imerina et, partiellement, au Betsileo.
Le Premier ministre Rainilaiarivony restructure progressivement son gouvernement sur le modèle occidental : création de ministères huit en 1881 et d'agents locaux déconcentrés les antily ; réorganisation des tribunaux et essai de rénovation des fokonolona. Mais ce renforcement voulu du pouvoir central coexiste avec le maintien, par la force des choses, de structures de type féodal dans les lointaines provinces qui sont des provinces stratégiques : des officiers-marchands, c'est-à-dire non payés, encadrent des garnisons de soldats-colons. Les gouverneurs nommés dans ces provinces sont souvent des prédicants formés à l'Église protestante du Palais devenue source de légitimité du pouvoir, mais ils sont rarement compétents.
Le royaume de Madagascar, en cette fin de XIXe siècle, se délite sous l'effet conjugué de la domination économique étrangère, de la bureaucratie parasitaire, du manque de ressources budgétaires. Du coup, la corvée, à laquelle sont en droit soumis tous les roturiers du royaume, s'alourdit et se pervertit au profit d'intérêts particuliers ; elle est de plus en plus mal supportée.
En quelques décennies, la monarchie merina est donc passée du Moyen Âge, la modeste case en bois du roi Andrianampoinimerina à Ambohimanga à l'ère victorienne la cour du palais des Reines à Antananarivo. Mais les intrigues permanentes et les coteries au sein de l'oligarchie qui détient le pouvoir, tout comme les difficultés d'administration et de contrôle d'un royaume qui s'étend à cette date sur plus des deux tiers de l'île, ont affaibli sérieusement le système politique.
C'est un État miné de l'intérieur qui va affronter une première agression française, prélude à la véritable conquête coloniale.
La conquête de Madagascar par la France 1883-1896
La conquête par la France s'effectue en deux temps, d'abord dans le cadre d'un protectorat, puis par l'annexion pure et simple ; soit plus d'une décennie de débats diplomatiques et politiques, et d'actions militaires.
En décembre 1885, la monarchie merina conclut un premier traité de protectorat avec la France qui, depuis mai 1883, pratiquait la politique de la canonnière, occupant les ports de Majunga et de Tamatave. Poussé par les notables de la Réunion relayés par les députés créoles, l'ancienne île Bourbon, qui a changé de nom sous la Révolution de 1789, traverse une crise économique profonde et par certains milieux catholiques, le gouvernement français s'est lancé dans cette aventure coloniale en invoquant d'incertains droits historiques. La monarchie merina a plié mais n'est pas vaincue. L'échec politique serait plutôt français. Le traité donne à la France un droit d'occupation à Diégo-Suarez et prévoit l'installation d'un résident français à Tananarive, le premier sera Le Myre de Vilers mais qui n'aura guère de moyens effectifs d'action. Après bien des équivoques et des contestations, querelle des exequatur à propos des consuls étrangers, problèmes de la succession aux traités conclus antérieurement par l'État malgache avec l'Angleterre et les États-Unis, l'Angleterre reconnaît en 1890 ce prétendu protectorat français, le mot ne figure pas expressément dans le texte du traité.
L'aggravation du malaise économique et social dans le royaume va fournir le prétexte à une seconde et décisive intervention militaire française. Le Premier ministre merina ruse et négocie pied à pied avec le résident français, mais il ne peut éviter les conséquences de l'indemnité de guerre imposée par le traité de 1885 – dix millions de francs –, somme colossale pour un modeste royaume déjà épuisé par l'effort de guerre. Pour faire face, c'est-à-dire rembourser un emprunt contracté auprès du Comptoir d'escompte de Paris, le gouvernement malgache doit étendre encore la corvée, offrir d'immenses concessions à des colons ou aventuriers français, ouvrir aux Malgaches l'exploitation jusqu'ici interdite des mines d'or. Le pouvoir monarchique se décompose, les exactions se multiplient, le désordre s'installe. Les fahavalo bandits, hors-la-loi sèment la terreur jusqu'au cœur de l'Imerina, menaçant la sécurité des Européens.
En refusant, en octobre 1894, de céder à un ultimatum que le résident français a été chargé de lui présenter, Rainilaiarivony consacre la rupture avec la France. À Paris, la Chambre des députés vote les crédits nécessaires pour une expédition militaire qui, cette fois, doit marcher sur Tananarive. Les troupes débarquent à Majunga le 15 janvier 1895. Il faudra huit mois avant que des éléments avancés parviennent enfin à Tananarive, juste avant la saison des pluies. Pour les soldats français, près de 20 000, dont beaucoup de jeunes recrues, c'est une sorte d'odyssée à rebours sur cette route à tracer !de 600 kilomètres qui s'élève progressivement du niveau de la mer à presque 1 500 mètres d'altitude en traversant sur les premiers 200 kilomètres, le long du fleuve Betsiboka, une région humide et malsaine. Les généraux malgaches hazo et tazo la forêt et la fièvre sont les principaux responsables de l'hécatombe : on estime que 40 p. 100 du corps expéditionnaire a disparu sur cette piste aujourd'hui encore ponctuée de modestes et émouvants monuments commémoratifs et de tombes – qui font désormais partie du patrimoine national malgache. Une page importante de l'histoire moderne de Madagascar s'est en effet inscrite dans cette expédition de 1895.
Une expédition dont la mémoire collective tant en France qu'à Madagascar n'a peut-être pas gardé un souvenir aussi vif et idéalisé que pour d'autres batailles coloniales. Les travaux des historiens contemporains malgaches et français, études publiées dans la revue Omaly sy Anio ; travaux de Guy Jacob sur la période de 1880 à 1894 : Aux origines d'une conquête coloniale ont le grand mérite, à travers l'exploration systématique des archives, de donner une analyse beaucoup plus exacte de cette période d'affrontement franco-ho va. Du côté français, la préparation de l'expédition s'est déroulée dans l'enthousiasme populaire entretenu par une propagande anti-merina systématique, laissant croire que la République partait pour reconquérir une terre française depuis Louis XIV et pour libérer les populations côtières de la tyrannie merina, G. Jacob. Mais la conduite de l'expédition sous les ordres du général Duchesne, qui a tout de même laissé son nom, ainsi que le général Voiron et l'amiral Pierre, à des rues ou à des quartiers de Tananarive s'est révélée lamentable. Ni l'équipement vestimentaire, ni l'armement des soldats, portant fusil, pelle ou pioche et un sac de 35 kg, ni le mode initialement prévu de locomotion – les fameuses voitures Lefebvre, lourdes charrettes en aluminium tirées par des mulets et dont aucune, semble-t-il il y en eut 5 000 !, ne parvint à Tananarive – n'étaient adaptés au relief et au climat du pays. Il est vrai qu'à l'époque, il y a à peine un siècle ! Madagascar était, pour les états-majors de l'armée française, un pays du bout du monde. Du côté malgache, toutes proportions gardées, l'effet de distance est le même. Les garnisons merina, installées dans de solides forteresses, celle d'Andriba en particulier, se sentent plus ou moins en pays étranger, sakalava. L'isolement, la démoralisation et le paludisme expliquent leur faible combativité devant l'envahisseur français. Il semble bien que les troupes merina aient, sauf exception, systématiquement décroché et déserté, signe de la déliquescence du royaume. Mais, si l'armée royale donnait l'impression de renoncer au combat, d'autres résistances se préparaient ou étaient déjà en action.
Une colonne française, dite légère, atteint finalement la capitale Tananarive le 30 septembre 1895. Aux premiers coups de canon, la reine Ranavalona III fait hisser le drapeau blanc. Elle accepte, cette fois, un second et véritable traité de protectorat, 1er oct. 1895. Le vieux Premier ministre Rainilaiarivony est exilé et la reine provisoirement maintenue. L'année suivante, la prise de possession est consacrée non sans vifs débats au Parlement français, puis sanctionnée par le vote de la loi d'annexion du 6 août 1896 : Madagascar devient une colonie française.
De la domination coloniale à l'indépendance retrouvée 1896-1960
Sous trois statuts juridiques différents, colonie, territoire d'outre-mer, État autonome, Madagascar aura connu la dépendance coloniale directe durant un peu plus d'un demi-siècle. C'est une période très brève si on la compare avec la situation d'autres anciennes possessions françaises, mais riche en transformations et en contestations.
La période Gallieni
Pendant neuf ans 1896-1905, le général Gallieni, secondé un temps par le colonel Lyautey, imprime sa marque à la colonisation. Il se comporte en véritable proconsul de la République française, attachant définitivement son nom à l'histoire moderne de Madagascar. Jusqu'en 1972, sa statue équestre, retirée alors discrètement par les autorités françaises ornait le square Gallieni au centre de la capitale malgache.
Gallieni, général républicain, a été envoyé avec des troupes de renfort pour une reprise énergique de la situation politique et militaire. Arrivé le 16 septembre 1896, il fait abolir par divers arrêtés la monarchie, la féodalité, l'esclavage, l'arrêté du 26 septembre 1896 a été signé par son prédécesseur, le résident Laroche, et exiler 27 févr. 1897 la reine Ranavalona III, d'abord à la Réunion puis à Alger. Entre-temps, il a fait fusiller deux ministres du gouvernement Rainilaiarivony, membres de l'aristocratie, afin de mater l'oligarchie merina.
Premier gouverneur en titre de la colonie malgache, on dit aussi à l'époque madécasse et investi des pouvoirs civils et militaires, Gallieni pacifie et organise. La pacification consiste à rétablir l'ordre dans l'ancien royaume merina et à soumettre définitivement les peuples indépendants du Sud et de l'Ouest qui résistent farouchement de façon dispersée. Dans ces régions, la domination française est pratiquement acquise en 1899 ; mais des soulèvements éclateront encore en 1904-1905, puis en 1915-1917. Pendant ce temps, en Imerina, Gallieni a dû faire face au mouvement de résistance nationaliste des Menalambo (les Toges rouges), véritables partisans qui se réclament du pouvoir royal et qui profitent de la désagrégation des institutions pour s'attaquer à l'occupant étranger ainsi qu'aux Merina jugés complices. Les insurgés, refoulés dans la forêt, se rendent en juin 1897. La résistance des Menalambo – tout comme les soulèvements sporadiques de 1895 sur la côte est dirigés contre les Merina et, à travers eux, contre la présence française – témoigne d'une authentique prise de conscience nationale, même si le colonisateur français n'y voit que du banditisme, fahavalo ou, comme on dirait aujourd'hui, du terrorisme. Il reste que cette pacification, énergique, aura contribué à sa façon à l'unification de la Grande Île. Soumises désormais aux ordres d'un pouvoir étranger, les ethnies malgaches sont, quelle que soit leur diversité, ou même leur animosité, poussées à se retrouver.
Parallèlement, Gallieni organise le pays en appliquant, affirme-t-il, une « politique des races ». En réalité, il va s'appuyer surtout sur des lettrés merina pour des raisons compréhensibles d'efficacité administrative. Il crée des cadres indigènes, entreprend un nouveau découpage administratif de l'île, organise un remarquable système d'assistance médicale gratuite avec un corps de médecins et de sages-femmes malgaches. Il instaure, à coté des écoles des missions chrétiennes, une école officielle laïque par laquelle seront formés des instituteurs malgaches. L'enseignement du français devient obligatoire, l'Académie malgache est créée en 1902, dans l'esprit mission civilisatrice de la IIIe République.
Les premiers grands travaux, chemin de fer Tamatave-Tananarive, routes charretières sont entrepris sous l'impulsion de Gallieni qui entend mener une politique de développement économique dans le cadre de l'assimilation douanière qui favorise l'introduction des produits français, mais pas nécessairement le consommateur malgache.... Pour encourager la production agricole aux fins d'exportation, Gallieni reprend de façon plus méthodique le système de l'ancienne corvée qu'il remplace partiellement par une fiscalité directe accablante la capitation, destinée à obliger les Malgaches à produire plus par eux-mêmes ou à se placer au service des colons qui paieront l'impôt à leur place. Gallieni est convaincu de l'effet moralisateur de l'impôt. Et le code de l'indigénat, qui donne des attributions judiciaires aux administrateurs, est un excellent adjuvant.
Lorsque Gallieni – esprit républicain, laïque et par-dessus tout militaire – quitte son poste de commandement, les grands axes de la politique coloniale française à Madagascar sont tracés.
La mise en valeur de la colonie 1907-1946
Les gouverneurs généraux successeurs de Gallieni il y en aura dix-huit entre 1905-1946, dont certains joueront un rôle important ont eu surtout en vue la mise en valeur de la Grande Île et son développement économique. Ce qui supposait d'abord une structuration administrative efficace. On hésitera entre le système des petites provinces, une vingtaine, puis celui d'un véritable régionalisme (création de six à huit régions dans les années 1930 et, finalement, le système de la grande province en 1946 il y en aura six qui sont les provinces actuelles, subdivisée en circonscriptions administratives hiérarchisées (postes ou sous-préfectures, arrondissements et cantons dans lesquelles s'exerce la réalité du pouvoir administratif colonial relayé, aux échelons inférieurs, par les cadres indigènes.
Le développement des voies de communication, problème majeur dans cette île au relief tourmenté, s'accélère : chemins de fer, Tananarive-Tamatave achevé en 1913, embranchements d'Antsirabe et de Alaotra en 1923, Fianarantsoa-Manakara en 1935 ; routes dont le réseau passe de 2 000 à 15 000 kilomètres entre 1925 et 1935 ; aviation liaison avec la métropole et lignes intérieures développées à partir de 1936 ; ports fluviaux et maritimes aménagés, ceux de Tamatave et de Diégo-Suarez recevant des équipements modernes. Cette politique de grands travaux caractérise surtout la période de l'entre-deux-guerres qui voit aussi le développement de l'urbanisation et de la démographie : la capitale Tananarive passe de 65 000 habitants en 1914 à 140 000 en 1940 ; la population malgache, bien que faible, double presque en un demi-siècle 2,5 millions en 1900 et 4 millions en 1940 selon les statistiques les plus fiables ; des migrations intérieures spontanées, notamment vers le moyen Ouest sakalava, appelé aussi le Far West, peuplent modestement des régions jusqu'ici vides.
L'administration encourage les cultures d'exportation. Aux produits de cueillette – caoutchouc, raphia – et aux produits agricoles traditionnels – riz et manioc – sans oublier les bovidés Madagascar ravitaille la France en viande frigorifiée et viande de conserve durant la guerre de 1914-1918 vont s'ajouter, surtout après 1920, les cultures dites riches, celles qui contribuent à l'apport de devises. Ainsi le café, développé notamment sur la côte est, fournira plus de 40 p. 100 du total des exportations. Les autres postes principaux sont la vanille, également sur la côte est ; le girofle à Sainte-Marie ; le tabac Maryland, introduit avec succès en 1920 dans l'Ouest malgache ; le sisal dans le Sud ; le pois du Cap et la canne à sucre.
Prospecté sans grand succès au début du siècle, l'or laisse la place au graphite, au mica et à d'autres minéraux et gemmes qualifiés de semi-précieux. Après la chute enregistrée durant la crise économique mondiale des années 1930, les exportations, aidées par un système de primes, retrouvent un volume important. En 1938, la France en absorbe 77 p. 100 et fournit 74 p. 100 des importations.
Mais ce développement économique global, incontestable, s'inscrit dans le cadre d'une mise en valeur coloniale, conformément aux doctrines impérialistes de l'époque. L'indigène, perçu par l'administration coloniale comme étant naturellement indolent et paresseux, est incité au travail par des procédures contraignantes, notamment fiscales et pénales. Celle du travail forcé, le S.M.O.T.I.G. (service de main-d'œuvre pour les travaux d'intérêt général), appliqué dans tout l'empire colonial français jusqu'en 1946, n'étant qu'un exemple parmi d'autres.
Il est vrai que, parallèlement, l'administration s'efforce d'encourager la petite exploitation agricole indigène et un système de véritable salariat. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, cette formule, destinée à favoriser les cultures d'exportation, est mise en échec par l'écart grandissant entre l'augmentation continue des prix et le quasi-plafonnement des salaires. Le paysan malgache qui n'en retire pas de profit en vient à se méfier et du travail salarié et des cultures d'exportation. Attitude de repli sur soi, en quasi-autarcie, que l'on retrouvera plus tard encore. Par ailleurs, les très vastes domaines concédés par le pouvoir colonial – la coutume et la législation de la monarchie merina qui accordaient l'usufruit à ceux qui cultivent ayant été écartées – à de grandes compagnies ne sont pas nécessairement source d'investissements productifs, les bénéfices immédiats de l'import-export et du commerce de traite, appuyé sur le système du collectage effectué par les petits commerçants de brousse chinois, indiens ou créoles étant plus attirants. Ces grandes sociétés coloniales, Marseillaise, Lyonnaise, Rochefortaise, Emyrne, entre autres ont, certes, contribué au développement de Madagascar en créant et en gérant des réseaux d'activités agricoles, industrielles et commerciales multiples : rizières du lac Alaotra, sucreries du Nord malgache et de Nosy Bé, exploitations forestières, plantations de coton, commerce de bovidés, etc. Mais la retombée des profits est modeste pour le producteur malgache ainsi que pour le petit colon européen ou réunionnais qui se trouve marginalisé. Les travaux contemporains d'histoire économique démontrent et démontent les mécanismes du processus. Le succès spectaculaire de quelques exportations à cette époque ne saurait masquer la réalité du problème.
D'où les clivages enregistrés dans la société coloniale malgache par-delà le statut d'indigénat : problème des rapports entre colons, petits ou grands et administration coloniale ; clivage surtout entre population malgache et pouvoir colonial, qui se situe à la fois sur le plan du statut social et du statut juridique.
La revendication nationaliste malgache
La révolte des Menalambo, révolte primaire si l'on peut dire, avait été – à côté d'autres manifestations sporadiques de résistance au pouvoir merina ou français xénophobie ou nationalisme populaire ?ortait un autre témoignage de la résistance à la domination étrangère, sans que l'on puisse distinguer entre ce qui relevait des rivalités ethniques traditionnelles ou de l'opposition entre païens, fidèles aux cultes des idoles, et convertis malgaches au christianisme. Tout cela relève aujourd'hui de l'histoire.
Une fois la colonisation française politiquement affirmée, la question nationale malgache se présente en termes nouveaux, en particulier dans la communauté merina autrefois dominante. Pour les notables merina, écartés du pouvoir par l'occupant français et parfois ruinés par l'abolition de l'esclavage en 1896, la stratégie du moment est simple : soit collaborer (officiellement) avec l'autorité coloniale pour se (re)placer socialement et économiquement juste au-dessous des Vazaha (Européens et surtout Français ; soit entrer dans une opposition politique plus ou moins discrète mais effective contre ces mêmes Vazaha.
L'affaire de la V.V.S. (Vy, Vato, Sakelika, fer-pierre-ramification) affole littéralement l'administration française entre 1913-1915. Cette société secrète, qui s'est développée dans le milieu intellectuel merina protestant (médecins, pasteurs, instituteurs), est liée au mouvement de renouveau culturel qui s'efforce de faire la synthèse entre la culture malgache et la modernisation dans le contexte colonial de l'époque. L'un des inspirateurs écoutés, le pasteur Ravelojaona, montre l'exemple du Japon qui s'est ouvert aux influences occidentales sans perdre son identité. L'inspiration nationaliste (on évoque la patrie malgache de la V.V.S. incite le colonisateur à y voir un complot. Les sanctions sont sévères. Les quarante et un condamnés, dont trente-quatre aux travaux forcés, seront finalement amnistiés en 1921.
Après la Première Guerre mondiale, la revendication nationaliste s'affirme ouvertement en même temps que commence à se manifester une presse autochtone et que s'implantent, non sans tracasseries administratives, les premiers groupements politiques et syndicaux. La revendication principale est celle de l'assimilation effective, officiellement prônée par la France mais en fait refusée malgré les textes en vigueur (à peine 8 000 Malgaches ont la citoyenneté française en 1938). Il se crée une Ligue pour l'accession des indigènes à la citoyenneté française, voire pour le statut de Madagascar-département français. C'est, avant tout, la revendication de l'égalité des droits pour les Malgaches. L'instituteur betsileo Jean Ralaimongo (1884-1943), engagé volontaire en 1914-1918, devenu défenseur des paysans malgaches du nord de l'île, soutenu par la bourgeoisie commerçante tananarivienne et aussi par certains colons français, est alors la figure de proue du mouvement national malgache. Son journal L'Opinion, fondé en 1927, dénonce les abus de la colonisation. Le point culminant de la contestation est la grande manifestation du 19 mai 1929 à Tananarive, qui se déroule aux cris de Madagascar aux Malgaches. Le refus de l'assimilation, toujours promise et toujours repoussée, a naturellement conduit au rejet de la domination coloniale. L'idée de l'indépendance commence à gagner les esprits, et plus encore après l'expérience du Front populaire (1936-1938) qui aura apporté à Madagascar comme dans d'autres colonies de grandes et brèves illusions. Cette expérience aura contribué cependant à augmenter les espaces de liberté expression, presse et à légaliser le syndicalisme ainsi que les partis politiques autochtones (naissance du Parti communiste malgache) promis à d'autres développements après la guerre de 1939-1945.
Le nationalisme d'après-guerre et l'insurrection de 1947
La fin de la Seconde Guerre mondiale amorce une nouvelle liberté politique pour les Malgaches. Les réformes concernant les colonies leur permettent d'avoir une représentativité, au moins symbolique, au niveau national. La conférence de Brazzaville qui a lieu du 30 janvier au 8 février 1944, destinée, en partie, à affirmer la souveraineté de la France sur son empire colonial, marque une étape importante. En mars 1945 est créé un Conseil représentatif comportant autant de Français que de Malgaches. À l'automne suivant, Madagascar envoie quatre députés à l'Assemblée constituante dont deux élus par les Malgaches, Joseph Ravoahangy et Joseph Raseta, nationalistes fervents.
La Charte de l'O.N.U., signée le 26 juin 1945, fixe comme objectif de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Cette ambiance de liberté permet aux Malgaches de s'engager dans des activités politiques. En février 1946, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache M.D.R.M., indépendantiste, est créé. Il est souvent considéré, sur les côtes, comme le parti des Merina. En juin, la création du Parti des déshérités de Madagascar P.A.D.E.S.M., encouragée par le gouvernement colonial et soutenue par la presse dite loyaliste, prônant la collaboration et la fidélité à la France, rassemble les populations côtières et des mainty, descendants d'anciens esclaves merina. Les nationalistes y décèlent une manœuvre de l'administration pour diviser les Malgaches et affaiblir la conscience nationale. En juin 1946, la nouvelle Constitution consacre la naissance de l'Union française dans le cadre de la IVe République. À Madagascar, un ensemble de lois et de décrets instaure un régime plus démocratique. Ainsi, le décret du 25 octobre 1946 prévoit la création de cinq assemblées provinciales et d'une assemblée représentative au niveau national à Tananarive, actuelle Antananarivo. Celles-ci n'ont qu'un rôle consultatif et des pouvoirs restreints, mais beaucoup de colonisés y voient l'amorce d'un changement. En novembre 1946, les députés malgaches sont réélus et un nouveau siège est adjoint pour la côte est. Ainsi, Jacques Rabemananjara, jeune poète, rejoint Ravoahangy et Raseta. Sous l'étiquette M.D.R.M., ils remportent des succès politiques face au P.A.D.E.S.M. L'espoir croît dans les milieux nationalistes et l'on assiste à la naissance d'une activité politique agitée, exprimée essentiellement par l'intermédiaire des deux partis politiques. Cette dualité est à l'image de l'opposition traditionnelle entre les côtiers et la population des Hautes Terres, regroupée sous la dénomination de Merina. Une opposition qui sera sans cesse utilisée par l'autorité coloniale, mais aussi par les acteurs de la vie politique.
Dans un climat de trouble, ponctué de grèves et de manifestations, l'Assemblée représentative doit se réunir le 30 mars 1947. Or, dans la nuit du 29 au 30 mars, une insurrection violente se déclenche contre le pouvoir colonial, en divers points de l'île, et s'étend durant plusieurs mois, essentiellement sur la côte est. En décembre 1947, l'insurrection est complètement matée, de nombreux villageois sont toujours réfugiés dans les forêts d'une zone allant de Farafangana au nord de Tamatave actuelle Toamasina. Les émeutes et la répression provoquent la mort d'environ 89 000 personnes selon les sources officielles de l'époque, chiffre aujourd'hui contesté par de nombreux historiens qui parlent de 30 000 à 40 000 victimes. L'opinion française incrimine les parlementaires malgaches. Plusieurs procès sont menés devant des tribunaux militaires, dont celui des leaders du M.D.R.M., accusés d'être les responsables du déclenchement de la rébellion, qui se déroule du 22 juillet au 4 octobre 1948 à Tananarive. Le parti est dissous et six condamnations à mort sont prononcées, dont celles de Ravoahangy et de Raseta. Ils seront graciés puis amnistiés en 1954.
En 1948, le P.A.D.E.S.M. sort victorieux des élections provinciales partielles et conforte les notables côtiers dans leurs prérogatives. L'administration coloniale, qui s'est beaucoup appuyée sur les compétences des Merina, forme une élite côtière afin de contrecarrer le poids politique des Hautes Terres. Les élections législatives du 17 juin 1951, puis les élections provinciales et sénatoriales de mars 1952, marquent la défaite des nationalistes.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=6445#forumpost6445
Posté le : 09/08/2014 18:26
|
|
|
|
|
Découverte de Madagascar 4 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Vers l'indépendance
Le 23 juin 1956, la loi-cadre Deferre est votée. Elle autorise le gouvernement français à prendre des mesures propres à l'évolution des territoires relevant du ministère de l'Outre-mer et à la décentralisation administrative (postes administratifs progressivement occupés par des Malgaches notamment). Des assemblées provinciales, élues au suffrage universel, délèguent leurs membres à une Assemblée législative, qui élit un conseil de gouvernement présidé par un haut-commissaire nommé par la France.
Les anciens partis, le P.A.D.E.S.M. et le M.D.R.M., sont à l'origine de nouveaux mouvements politiques. Ainsi, le 28 décembre 1956, le Parti social démocrate (P.S.D.), proche de la S.F.I.O., est créé à Majunga actuelle Mahajanga par les chefs historiques du P.A.D.E.S.M. comme Philibert Tsiranana, André Resampa, ou encore René Rasidy, des fonctionnaires issus de milieux modestes petite paysannerie côtière. Le P.S.D. devient un grand parti dominant qui noyaute tous les rouages de l'administration et se développe autour de la personnalité de Tsiranana. En 1957, les élections aux assemblées provinciales sont remportées par les éléments côtiers. En mai 1958 se réunit à Tamatave un congrès de l'Indépendance, à l'issue duquel est créé le Parti du congrès de l'indépendance de Madagascar (Antokon'ny Kongresin'ny Fahaleovantenan'I Madagasikara, A.K.F.M., en partie composé des membres de l'Union des démocrates sociaux, fondée en décembre 1956, et soutenue par les colons et du P.S.D. Il rassemble les partis politiques nationaux hostiles à une indépendance octroyée.
Le 28 septembre 1958 a lieu le référendum sur le projet de création de la Communauté française. Trois semaines après la victoire du oui, le 14 octobre 1958, la République malgache autonome est proclamée. Le Congrès des députés provinciaux se transforme en Assemblée constituante et le Conseil de gouvernement adopte l'appellation de gouvernement provisoire. Les institutions se mettent en place au cours de l'année 1959, président de la République, chef de gouvernement, Assemblée nationale élue au suffrage universel et Sénat. La Constitution de 1959 garantit le pluralisme et les grands principes de la démocratie.
La République malgache
Trois républiques se sont succédé à Madagascar depuis l'indépendance, entrecoupées par la fracture historique de 1972-1975, par le difficile régime de transition démocratique de 1990-1992 et par la crise de 2002 qui a paralysé le pays. Ces régimes ne se comprennent qu'en prenant en considération l'impact de la présence française dans l'histoire de la Grande Île et la question de la reconnaissance internationale, devenu un enjeu important.
De la présidence Tsiranana à la IIe République
Le premier gouvernement constitutionnel entre en fonction le 14 mai 1959, mais l'indépendance n'est proclamée que le 26 juin 1960, après la négociation d'accords bilatéraux de coopération technique et culturelle. Élu premier président de la République de Madagascar le 1er mai 1959, Philibert Tsiranana adopte une politique de continuité avec la France et développe des liens diplomatiques avec des pays non communistes comme les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest, Taiwan ainsi qu'avec le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, ce qui lui sera reproché par les pays de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A., créée en 1963) dont Madagascar est un des membres fondateurs. Les choix du gouvernement Tsiranana dans le domaine économique se traduisent par un néo-libéralisme qui, à la fois, encourage l'initiative privée, nationale et internationale, le développement économique grâce à des actions communautaires et la mise en valeur des fokonolona, communautés villageoises, et se caractérise également par un interventionnisme étatique dans les secteurs clefs. Le pays connaît une stabilité relative durant cette première décennie après l'indépendance, mais des indices alarmants s'accumulent : faiblesse de l'industrialisation, croissance du chômage, étroitesse du marché intérieur due au faible pouvoir d'achat des paysans et dérive autocratique du régime.
À la fin de la décennie 1960, le malaise et le vide politiques liés à la maladie de Tsiranana, ainsi que la rivalité des deux prétendants à sa succession (André Resampa, alors ministre de l'Intérieur, et Jacques Rabemananjara, ministre des Affaires étrangères), provoquent une crise. Celle-ci était latente face à une économie affaiblie, à un néocolonialisme trop présent, à un durcissement de l'appareil étatique et sa mise en question par la nouvelle génération. Plusieurs forces politiques d'opposition entrent alors en scène, notamment le Monima de Monja Jaona, fondé en 1958, comprenant une base de paysans, de migrants urbains pauvres et une minorité d'intellectuels de Tananarive faisant référence à différents modèles marxistes. Proche de l'A.K.F.M. et solidement implanté dans les milieux ruraux, surtout dans le Sud, le Monima représente une force d'opposition sérieuse pour le P.S.D. En avril 1971, sous son impulsion, les paysans se soulèvent et la répression est sanglante. Le 30 janvier 1972, Tsiranana est réélu à la présidence avec 99 p. 100 des voix, mais le 13 mai éclate à Tananarive une émeute populaire issue d'un mouvement étudiant qui a été relayé par une grève générale. Elle est durement réprimée par la garde présidentielle et les forces républicaines de sécurité. Les forces armées refusent d'intervenir au nom du président et le contraignent à solliciter Gabriel Ramanantsoa, le chef d'état-major, qui constitue un gouvernement d'union nationale, composé de militaires et de techniciens. Le 11 octobre 1972, Tsiranana démissionne.
Le ministre des Affaires étrangères Didier Ratsiraka est à l'origine de la rupture avec la France entre 1972 et 1974 lorsqu'il négocie la fermeture des bases militaires et navales à Madagascar et le retrait de la zone franc. Les coopérants qui occupaient les principaux postes administratifs quittent l'île. Des liens politiques sont tissés avec l'U.R.S.S., la République populaire de Chine ou encore la Corée du Nord. En 1973, le ministre de l'Intérieur, Richard Ratsimandrava, met en œuvre un programme de réforme rurale, basé sur le fokonolona. Cette tentative de restructuration rurale et la mise en place des fokonolona donnent l'illusion d'une paysannerie qui détient le pouvoir de décision et à qui l'on a promis le partage des terres anciennes et l'autogestion. Ces réforment laisseront les sociétés rurales sans moyens. En 1975, l'opposition des partis politiques et l'agitation sociale augmentent. Le général Ramanantsoa transmet les pouvoirs au colonel Richard Ratsimandrava, qui est assassiné six jours plus tard. Un Directoire militaire est alors formé et proclame la loi martiale. Il sera dissous le 15 juin 1975 et remplacé par un Conseil supérieur de la révolution, présidé par Didier Ratsiraka qui est également nommé chef du gouvernement. Le 21 décembre 1975, la République démocratique de Madagascar est fondée. Le parti Avant-garde pour la rénovation malgache (Arema), créé en 1976, devient l'organe principal de la présidence Ratsiraka.
De la IIe à la IIIe République
De fait, la chute de l'ère Tsiranana ouvre, après la période transitoire de 1972 à 1975, la voie à un régime autoritaire, de type socialiste, désireux de couper les ponts avec la France et prônant un nationalisme fervent. Cela se traduit par une politique de malgachisation de l'enseignement scolaire et des noms de ville. En organisant le référendum du 30 décembre 1975, Ratsiraka dote le pays d'institutions à l'orientation révolutionnaire, dont il a lui-même défini les grandes lignes dans le Boky Mena (livre rouge). L'institution militaire devient le support de la nouvelle idéologie socialiste. Ainsi légitimé, le nouveau pouvoir procède à une série de nationalisations (banques, assurances...) et promeut une politique d'investissements à outrance mobilisant tous les acteurs de l'économie (création d'entreprises publiques et de complexes industriels, extension des surfaces rizicoles, promotion de cultures d'exportation, recherche pétrolière, infrastructures routières et transports).
À partir de 1978, une politique immodérée d'endettement public aggrave une situation déjà fragile, tandis que s'accentue la répression contre l'opposition nationaliste (particulièrement dans le Sud). La détérioration économique et sociale, les atteintes aux libertés individuelles provoquent des mouvements de contestation et de remise en cause du régime. Dès 1982, les Églises catholiques et protestantes mettent en garde le pouvoir en dénonçant les échecs et les dérives de l'idéologie révolutionnaire. À partir de 1987, la gravité de la situation économique et les contraintes imposées par le F.M.I. et la Banque mondiale pour obtenir l'aide internationale, aboutissent à une libéralisation de l'économie. Le secteur nationalisé est réduit et la porte s'ouvre aux investissements privés malgaches et étrangers. Cette situation accroît l'appauvrissement généralisé de la population tandis que certains s'enrichissent effrontément.
En 1989, la réélection de Ratsiraka avec seulement 62 p. 100 des voix augure un changement de régime et une transition démocratique. En 1991 éclate une nouvelle crise avec des manifestations populaires importantes, en juin et en juillet, qui réclament le départ de Ratsiraka. Au cours de l'année 1991, le gouvernement est « doublé » (et plus ou moins paralysé) par un gouvernement parallèle (la Haute autorité de l'État) qui court-circuite le président. Issue de la société civile, l'opposition, connue sous le nom de Forces vives, opposée au parti Arema, est décidée à changer de régime politique. Ritualisé dans le cadre des manifestations quotidiennes sur la place du 13-Mai à Antananarivo, le mouvement est pacifique. Mais, le 10 août 1991, une marche populaire, dominée par les Forces vives, vers le palais présidentiel d'Iavoloha, s'achève par une répression sanglante et contribue au discrédit international du régime. Les Églises, notamment le puissant Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar (F.F.K.M., fondé en 1979), jouent alors un rôle majeur en organisant une médiation entre Ratsiraka et les Forces vives, pour permettre la constitution d'un gouvernement de transition. Les Églises fournissent ainsi l'encadrement et la légitimité morale des manifestations populaires. À la fin du mois d'octobre 1991, Ratsiraka signe avec le nouveau Premier ministre Guy Razanamasy et les représentants de l'opposition un accord qui prévoit la création d'un gouvernement de transition jusqu'aux prochaines élections. Le 19 août 1992, un référendum approuve, avec 76 p. 100 des suffrages, la nouvelle Constitution qui limite les pouvoirs présidentiels et fonde la IIIe République. Le second tour de l'élection présidentielle, en février 1993, confirme l'avance du candidat de l'opposition, Albert Zafy, ancien ministre de la Santé sous le gouvernement Ramanantsoa en 1972, qui remporte 66,74 p. 100 des votes. Madagascar sort peu à peu de son isolement économique en introduisant des réformes structurelles libérales et en cherchant à attirer les investisseurs étrangers. En 1996, un accord prévoyant la restructuration de l'économie est signé avec le F.M.I.
Cinq ans après la mise en place du nouveau régime, la popularité des dirigeants malgaches est entamée par des scandales financiers, par le manque d'autorité et l'impuissance du président Zafy à combattre la corruption. En 1995, une crise institutionnelle provoque un renforcement du régime présidentiel — le président, et non plus l'Assemblée, nomme le Premier ministre —, entériné par un référendum. De fait, des perspectives économiques sombres et une instabilité politique flagrante (six gouvernements se sont succédé depuis 1992) déclenchent une nouvelle crise qui aboutit à la destitution, par voie constitutionnelle, du président Zafy et à la réélection, de justesse, 50,71 p. 100 des voix de Ratsiraka en décembre
Celui-ci se lance dans une nouvelle politique qui vise à promouvoir une république humaniste et écologiste. En 1998, une nouvelle Constitution est adoptée. Elle introduit la décentralisation administrative, notamment avec la création de provinces autonomes. Suite à la mise en œuvre des directives du F.M.I. et à un réaménagement de la dette, le pays connaît une reprise économique, qui touche en particulier les domaines des télécommunications et du textile. À partir de 2000, les conséquences du programme de privatisation préconisé par le F.M.I. commencent à inquiéter la population malgache, notamment la forte inflation.
Succession de crises politiques depuis 2001 : un avenir compromis L’espoir de Ravalomanana
À la fin de l'année 2001 a lieu une nouvelle élection présidentielle où la victoire de Ratsiraka semble assurée. Le président sortant maîtrise les principaux rouages de l'État et dispose d'une Assemblée et d'une administration locale soumises. Or, le 16 décembre 2001, à l'issue du premier tour, Marc Ravalomanana – maire de la capitale, entrepreneur florissant issu d'une noblesse rurale appauvrie de l'est d'Antananarivo – arrive largement en tête grâce, notamment, à l'affirmation de sa foi protestante, le soutien des Églises et son aura de self-made-man. Ratsiraka conteste le résultat et un bras de fer s'engage entre les deux candidats et leurs partisans jusqu'à l'été de 2002, à l'issue duquel la victoire de Ravalomanana est confirmée. Madagascar voit, pendant cette période, apparaître deux centres de commandement : l'un se proclamant pouvoir légal (Ratsiraka déplace son régime à Toamasina sur la côte est et l'autre pouvoir légitime (Ravalomanana constitue son propre gouvernement dans la capitale. Ce contexte s'accompagne d'une grève générale, de manifestations quotidiennes dénonçant la fraude électorale, du blocage des principales voies de communication. Les velléités sécessionnistes de certaines provinces, encouragées par le président sortant, ont paralysé le pays. Cette tentative de diviser la nation sur un mode opposant côtiers et merina fief du camp ravalomananiste, à l'instar de ce qu'ont fait le pouvoir monarchique au XIXe siècle, le gouvernement colonial ou encore l'État postcolonial, au risque de l'anéantir économiquement, reste inopérante. Madagascar sort exsangue de la crise du point de vue économique mais sauvée dans son unité.
Dans un contexte de rejet des précédents régimes par la population, Marc Ravalomanana représente une figure politique nouvelle qui s'appuie sur l'image du messie venu sauver l'île. Reprenant un verset de l'Évangile de Marc, « Ne crains point ; crois seulement », dont il a fait sa devise, il bénéficie du soutien de la F.F.K.M. Sous son impulsion, les pasteurs deviennent des « agents de développement ». En août 2004, le président est réélu vice-président de l'Église réformée de Jésus-Christ, une des composantes de la F.F.K.M.
Cette tonalité religieuse s'accompagne d'un libéralisme économique. Marc Ravalomanana, qui a alors le monopole de la fabrication industrielle des produits laitiers à Madagascar, qui est propriétaire d'une radio, d'une chaîne de télévision et d'un journal, et qui a également investi dans les travaux publics, se lance dans la course à la présidence avec son parti Tiako'i Madagasikara, J'aime Madagascar. Certains dirigeants de son groupe laitier deviennent députés ou agents de l'administration et des membres du gouvernement obtiennent des fonctions importantes au sein de la F.F.K.M. De même, plusieurs mesures prises par le président de la République bénéficient particulièrement à son groupe. Ainsi, en 2005, Tiko Oil profitera d'une détaxation sur l'huile brute, tandis que l'huile raffinée importée par ses concurrents sera taxée à 20 p. 100. Dans le même temps, le prix du litre d'essence double presque, signifiant pour de nombreux Malgaches une augmentation générale du coût de la vie.
Sous son gouvernement, certaines infrastructures, notamment les ports, sont améliorées. Ceux de Toliara, dans le sud-ouest du pays, et de Mahajanga, dans le nord-ouest, ont été réhabilités. La ville de Mahajanga, à la faveur de la visite éclair du président Jacques Chirac en juillet 2005, voit son front de mer ainsi qu'un certain nombre d'axes urbains rénovés pour le tourisme, tandis que la ville de Toamasina, à l’est, fief ratsirakiste, se trouve dans un état de délabrement. Les villes semblent se développer, 1 500 kilomètres de routes reliant la capitale aux chefs-lieux des six provinces ont été refaits, une certaine forme de richesse devient visible. Ce développement ne cache toutefois pas l'appauvrissement continu des campagnes et la fragilité de l'économie du pays. De janvier à avril 2004, la monnaie malgache perd 50 p. 100 de sa valeur. Cette dévaluation s'accompagne d'une inflation galopante ainsi que d'un changement de monnaie. En 2005, le franc malgache est remplacé par l'ariary. Le pays connaît également d'importantes coupures d'électricité quotidiennes du fait de la quasi-faillite de la compagnie nationale. Il est classé 146e sur 177 par rapport à l'indice du développement humain (I.D.H.) du Programme des Nations unies pour le développement.
Le 3 décembre 2006, Marc Ravalomanana est réélu président dès le premier tour en l'absence de leader d'opposition crédible. Les élections se déroulent dans le calme, mais pas dans les meilleures conditions. Le Comité national d'observation des élections, collectif de la société civile, a dénoncé des lacunes dans l'organisation, notamment dans l'élaboration des listes, la distribution des cartes d'électeurs et des bulletins de vote. La campagne est également marquée par une grande disparité de moyens entre les candidats. Le 23 septembre 2007, des élections législatives anticipées, souhaitées par le chef de l’État afin d'affaiblir une opposition naissante au sein de l'Assemblée nationale, aboutissent au renforcement de la majorité présidentielle.
Durant son mandat, le président Ravalomanana a des intérêts économiques dans presque tous les secteurs. Ses méthodes néolibérales, son marketing politique moderne ainsi que son allégeance à l'Église causent ainsi maintes déceptions parmi la population, mais également chez les intellectuels et les cadres économiques, qui l'avaient pourtant soutenu face à Ratsiraka en 2002.
Le cercle vicieux malgache
Au début de 2009, le maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, entrepreneur prospère lui aussi, dénonce une dérive autoritaire et organise d'importantes manifestations pour demander la destitution du président Ravalomanana. Il accuse ce dernier d'avoir confisqué le pouvoir au profit des entreprises qu'il dirige et d'avoir réduit les libertés de la presse (fermeture de la station de radio privée du maire de la capitale notamment).
Après plusieurs semaines d'affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre qui font une centaine de victimes en février 2009, Andry Rajoelina, surnommé TGV, comme son parti Tanora malaGasy Vonona Les Jeunes Malgaches décidés, prend la tête, le 7 février 2009, d'une Haute Autorité de transition. Estimant le changement de gouvernement non constitutionnel, l'Union africaine (U.A.) suspend Madagascar de ses instances, la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (S.A.D.C.) refuse de reconnaître le nouveau président et l'Union européenne estime qu'il s'agit d'un coup d'État.
Le 21 mars 2009, Andry Rajoelina prête serment dans le stade de Mahamasina à Antananarivo devant plus de quarante mille personnes et s'engage à organiser des élections et à rédiger une nouvelle Constitution d'ici deux ans – un délai que la communauté internationale juge trop long. Un processus de médiation conduit par l'U.A. et la S.A.D.C. avec le soutien des Nations unies et de l’Organisation internationale de la francophonie (O.I.F.) se met alors en place. Il aboutit à un accord, signé le 9 août à Maputo (Mozambique), qui prévoit la constitution d'un gouvernement de transition chargé d'organiser des élections avant la fin de l'année 2010. Il envisage un partage du pouvoir entre les quatre principales formations politiques dont les leaders, outre le président autoproclamé, ne sont autres que les anciens présidents Didier Ratsiraka, Albert Zafy et Marc Ravalomanana.
Dans les faits, Andry Rajoelina garde le pouvoir et Eugène Mangalaza, ratsirakiste, devient Premier ministre. Toutefois, cet arrangement ne sera pas respecté. En décembre 2009, Andry Rajoelina met fin unilatéralement au processus de transition en limogeant Eugène Mangalaza et en le remplaçant par un militaire, le colonel Albert Camille Vital. Le spectre des divisions au sein de l'armée, des tensions régionales et des manifestations non contrôlées resurgit. En mars 2010, une seconde médiation est organisée à Addis-Abeba (Éthiopie) afin de rassembler le gouvernement et l'opposition. Mais Andry Rajoelina, pour qui le processus de résolution de la crise doit être national, n'y envoie qu'une délégation, ce qui conduit à de nouvelles sanctions de la part de l'U.A. qui suspend son aide au développement à Madagascar. En août 2010, il avalise la tenue d'un référendum devant aboutir à des élections législatives et présidentielle. Cette consultation, conçue comme une étape du processus de sortie de crise, se déroule le 17 novembre 2010. Elle est boycottée par l'opposition et contestée par la communauté internationale, qui souligne le manque de consensus et de transparence. Mais 52,6 p. 100 des Malgaches se déplacent pour aller voter et 74,2 p. 100 approuvent le projet d’une nouvelle Constitution. Le 11 décembre, le régime de la transition promulgue la nouvelle Loi fondamentale qui instaure la Quatrième République. L’âge d’éligibilité à la présidence est abaissé à trente-cinq ans pour permettre à Andry Rajoelina de se porter candidat à la magistrature suprême. La diversité des groupes et le rôle des différents acteurs, les Églises, l'armée, le secteur privé, la communauté internationale, la société civile, les populations contribuent à la complexité de la situation.
Une sortie de crise difficile
En 2011, une mission de médiation est confiée par la S.A.D.C. et l’U.A. à l’ancien président mozambicain, Joaquim Chissano. Une feuille de route est signée, le 16 septembre 2011, par les principales formations politiques malgaches ; celle-ci prévoit la formation d’un nouveau gouvernement et le retour sans condition de l’ex-président Ravalomanana. Elle engage également une réforme des institutions de la transition et vise à la tenue d’élections crédibles, avec l’aide de la communauté internationale. Le 28 octobre 2011, Jean-Omer Beriziky est nommé Premier ministre de transition. Cette nomination est suivie de la formation d’un gouvernement d’union nationale de transition le 21 novembre. Ce dernier est rapidement contesté par les dirigeants de l’opposition, qui estiment que la Haute Autorité de transition est favorisée dans la mesure où elle conserve le contrôle de ministères stratégiques. En mars 2012, la Commission électorale nationale indépendante est mise en place et, le 14 avril, une loi d’amnistie est adoptée, excluant Marc Ravalomanana, condamné à plusieurs reprises pour la mort de manifestants en février 2009.
Pendant plus d’un an, une course-poursuite à la candidature, jalonnée de nombreuses volte-face et tractations, s’engage entre les trois principaux anciens dirigeants et leurs poulains. Elle se termine le 17 août 2013 avec l’annonce par la nouvelle Cour électorale spéciale (C.E.S.) d'une liste de trente-trois candidats autorisés à se présenter au suffrage universel. Sous la pression de la communauté internationale, la C.E.S. invalide huit candidatures, dont celles de Lalao Ravalomanana (femme de l’ancien président), d’Andry Rajoelina et de Didier Ratsiraka. La stratégie du « ni-ni » (ni candidature de Rajoelina ni celle de Ravalomanana, considérés comme les principaux responsables de la crise), imposée par la communauté internationale, l’emporte. Les présidents déchus s’affrontent désormais par candidats interposés.
L’élection présidentielle se déroule les 25 octobre et 20 décembre 2013 ; des élections législatives ont lieu en même temps que le second tour. Hery Rajaonarimampianina, ancien ministre des Finances du gouvernement Rajoelina, arrive en tête, face à Jean-Louis Robinson, proche de Ravalomanana. Le 17 janvier 2014, la C.E.S. de Madagascar valide ce résultat.
Madagascar a désormais un nouveau président de la République élu dans des conditions jugées satisfaisantes par la communauté internationale. Mais les crises politiques récurrentes qu’a connues Madagascar depuis son indépendance, même si elles ont été entrecoupées d’épisodes éphémères de croissance, ont généré une situation économique très préoccupante qui n’a cessé de s’aggraver ces dernières années : fermeture des zones franches créées dans les années 1990, suspension des aides et arrêt des financements accordés par les bailleurs de fonds internationaux, etc. La population malgache a durement souffert (chômage important, déscolarisation, insécurité grandissante, détérioration des infrastructures...) et plus de 92 p. 100 des Malgaches vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, avec des disparités et des inégalités importantes entre régions ainsi qu’entre zones rurales et zones urbaines. Cette dégradation des conditions de vie a exacerbé les tensions sociales et la montée des sentiments d'injustice et d'exclusion.
La fin de la période de transition, avec l’élection de Hery Rajaonarimampianina, devrait permettre à Madagascar de retrouver la confiance des institutions internationales (U.A., S.A.D.C., O.I.T.) et le soutien des bailleurs internationaux. Mais comme le souligne l’historien Solofo Randrianja, tous les ingrédients d’une nouvelle crise sont d’ores et déjà présents. Le constat est amer mais il reflète une réalité qui l’est plus encore. L’île reste parmi les pays les plus pauvres au monde et l’avenir de sa population est très incertain.
Littérature
Hors de Madagascar, l'homme averti, mais qui n'est pas versé dans les choses malgaches, citera trois noms : Rabemananjara, Rabearivelo et Jean Paulhan. Si, par penchant ou profession, cet homme est au fait de la petite histoire littéraire, il ajoutera peut-être avec le sourire celui du chevalier de Parny salué par Sainte-Beuve et mis en musique par Ravel. Mais que dira l'étranger que sa curiosité aura conduit auprès de quelque Malgache de bonne compagnie ? Selon ce qu'aura signifié pour son guide le qualificatif ambigu de malgache ( madécasse ? malagasy ? ou les deux ?) appliqué au concept non moins ambigu de littérature, peut-être concédera-t-il – côté fleur-d'herbe – les noms de Robert Edward Hart ou de Robert Mallet, ou avancera-t-il – côté folklore unique au monde – celui de Flavien Ranaivo. Et si sa curiosité a pu se faire insistante, par une pointe d'indiscrétion que la sympathie justifie, l'étranger devenu ami, voire coopérant, reconnaîtra sans trop d'effort, quand on les prononcera, l'étrange pseudonyme de Dox et le long murmure du nom vénéré de Ny-Avana-Ramanantoanina. En revanche, le nom d'Andriamalala sera pour lui un nom bien malgache mais sans rapport avec la littérature, et il se trouvera bien quelqu'un pour l'approuver en arguant du fait qu'Andriamalala, plutôt que d'employer literatiora, si transparent, fût-il d'emprunt, préféra lancer le néologisme de haisoratra. Quant aux noms de Ramarajaona ou Bilôha Zamanitandra, Iabanimaka ou Ramasy, ce ne sont sans doute que les fruits d'une tendance à mystifier autrui.
Si l'on parvient à abattre l'arbre, dit un exemple des Anciens malgaches, c'est que le manche de la cognée s'est mis de la partie. L'arbre de la littérature malgache n'est pas un zahana (Phyllarthron bojerianum) ; les noms inscrits sur ses feuilles sont souvent illisibles ; certains pour l'effeuiller à la cime le voudront couché à leurs pieds. Il est temps de comprendre que l'essentiel est de savoir jeter le manche après la cognée. Noms de ceux qui ont pris place au soleil, noms des obscurs et des vaincus, noms effacés sur les plus belles des feuilles mortes... Admettons même ces noms qui se sont inscrits sur les feuilles les plus vertes des branches entées ! Des noms, l'on peut bien, entrant dans le jeu habituel, en citer tant et plus ; quand on les aura multipliés pour permettre à qui sait de jongler avec eux, serait-ce en un brillant numéro d'illusionniste, le public n'aura rien vu de ce qui fait encore l'arbre après la saison des fruits : racines et branches qui ne meurent que séparées du tronc, à moins que la foudre ne soit passée par là.
Condition de la littérature malgache
Madagascar n'est plus, comme au seuil des années 1970, le pays naturellement paradisiaque que certains, se prévalant à tort du silence, voulaient déjà faire passer pour l'Île heureuse et délivrée naguère entrevue par le poète derrière l'Île heureuse de dérision du romancier dont il hérita. Mais qui donc prenait garde à cette île flottante qui, à l'écart des grands courants internationaux, venait à l'appel de son ancre sudiste et mettait le cap sur l'Orient ? Même quand éclata en 1971, dans le Sud de la misère et de l'abandon, la jacquerie des paysans en sagaies de l'armée de Monja Jaona, dont la levée était périodiquement annoncée depuis une trentaine d'années, bien peu voulurent comprendre le sens évident de l'événement. Alors s'en saisirent au vol, dans une stratégie de rupture qui n'épargna nullement les domaines linguistique et littéraire, quelques minorités marxisantes tournées vers les modèles asiatiques et qui voulurent voir en cette révolte les signes précurseurs d'une révolution populaire enfin proche. Émergeaient au cœur des débats, habilement brouillés par des politiciens en quête de pouvoir, le néocolonialisme jugé responsable de tous les maux (sous-développement, corruption, népotisme...) et la langue française, à la fois perçue comme symbole de l'impérialisme occidental et première cause des échecs scolaires et universitaires de plus en plus nombreux. À l'arrière-plan, une certaine population des villes, sans regard pour la campagne et le menu peuple, et désormais impatiente d'accéder au mieux-être et à l'égalité promis avec l'indépendance ; et, masse de manœuvre toute prête, la population scolaire et universitaire, prise au piège d'une politique démagogique qui, en guise de carotte, joua l'ouverture de maternités et d'écoles, en faisant fi des problèmes de l'économie et de l'emploi. Aussi suffit-il d'une atmosphère de fin de règne, créée par la vieillesse et la maladie du président, et de l'application brutale – mais calculée ? – de la politique de dégagement de la France dans le domaine de l'enseignement, pour que le gouvernement social-démocrate, obligé de traduire dans les faits l'équation démocratisation + justice = malgachisation + sélection, se trouvât totalement isolé, victime de son ancienne confiance aveugle dans les vertus du néocolonialisme.
Levée de boucliers au premier rang, chez ceux dont les privilèges, liés à la francophonie, étaient menacés par ses réformes tardives ; levée de boucliers dans les derniers rangs, chez ceux qui – malgachisation ou non – avaient espéré de lui des portes plus grandes ouvertes. Instituteur formé par l'école coloniale française, le ministre de l'Éducation nationale et des Affaires culturelles – qui, non sans raison, se faisait un titre de gloire d'être, dans la tradition ancestrale, le plus grand orateur de l'Ouest malgache – ne put résister aux attaques verbales d'une étudiante de la capitale radicalement irrespectueuse du code traditionnel des échanges et aussi profondément nationaliste qu'incapable de tenir un discours cohérent dans la langue de ses ancêtres, objet de ses études universitaires... Le ministre démissionna, cédant la place à un scientifique issu de l'Université française, qui d'ailleurs n'en put mais, tandis que loin des affrontements, le poète francophone, ministre des Affaires étrangères, troisième vice-président de la République et chargé à ce titre de superviser les affaires culturelles, se taisait. Ainsi, quand, à la faveur des erreurs d'analyse et des multiples contre-sens, déferla le carnaval masqué de 1972, l'effondrement de la Ire République malgache, dans un simulacre de grand soir ponctué de mouvements de foule et de lueurs d'incendies, de brèves rafales et de tocsins divers, sonna les débuts d'une guerre linguistique dont la littérature écrite devait être l'une des premières victimes, et l'une des plus sérieusement touchées. Bien sûr, Madagascar, aujourd'hui, est un pays remis à plat. Mais chaque chose en son lieu. Et quoique la vitalité d'une littérature dépende de fort nombreux facteurs, nous ne parlerons ici que de ce que la situation présente et à venir doit au sort fait aux langues qui furent les moyens d'expression de la littérature malgache, comme aux cultures dont elle était l'expression.
Sous la Ire République, entre la juste revendication de l'égalité dans la différence et la dure nécessité de s'insérer dans le vaste univers du XXe siècle qui impose le regroupement, les esprits étaient restés partagés. Le plus grave était que bien des groupes d'« adultes » répugnaient ouvertement à faire l'effort de cultiver ou le pluralisme dialectal, qui reste pourtant le chemin d'accès aux richesses des terroirs, ou la langue nationale, qui reste le miroir historique de l'identité dont on est fier, ou le français, seconde langue officielle, qui reste la chance d'ouverture sur le monde, cette répugnance pouvant d'ailleurs concerner deux domaines, ou même les trois à la fois. Trompés par ces irresponsables qui, d'autre part, reprenaient sottement le reproche de favoriser les disciplines littéraires au détriment des scientifiques et des techniques, – reproche couramment adressé par les « experts » aux pays du Tiers Monde mais sans guère de fondement à Madagascar –, les moins vigoureux des enfants s'étaient endormis, bercés dans leur fierté de former une nation déclarée sans problèmes, ni frontaliers ni linguistiques, parfois déjà grisés par le parfum et le nectar de leurs fleurs de trois-couleurs, ou telomiova, curiosité botanique qui porte à la fois des fleurs mauves, des fleurs violettes et des fleurs blanches. Quant aux gouvernements successifs du Président Tsiranana – conduite témoignant peut-être d'autant de candeur et de négligence que d'une certaine foi en la magie de l'écrit –, leur action en faveur de la paix linguistique avait en somme consisté à rappeler gravement que l'on avait donné au bilinguisme franco-malgache, inscrit en 1959 dans la Constitution, la suprême consécration d'un statut officiel. Dans un pays néocolonial, où l'intercommunication sans contrainte formelle prenait de plus en plus le biais d'un sabir diamétralement à l'opposé d'une langue de culture – rien à voir avec le créole –, ce n'était là que des gestes en quelque sorte rituels, aussi incapables de sauver les deux langues d'une perte assurée que d'instaurer le bilinguisme dans la sérénité quotidienne. Et cette sérénité se trouvait moins encore dans la conscience partagée des écrivains qui savaient que, dans le contexte d'une culture dominée par l'oral, la vie et la survie de leurs œuvres dépendaient avant tout de la formation de leurs lecteurs potentiels par les écoles, où le pire côtoyait le meilleur.
En 1972 se trouvaient dans les locaux de la fondation Charles de Gaulle, université de langue française mais de statut malgache depuis un an, des jeunes gens, qui avaient pris le chemin de l'école avec la proclamation de la Ire République et qui, dans l'ensemble, ne maîtrisaient ni le français ni le malgache – situation peu propice aux réussites dans les études supérieures et, moins encore, à l'éclosion puis au développement du goût littéraire. Leurs maîtres avaient été en majorité des coopérants français – surtout des volontaires du service national inexpérimentés et, dans les dernières années, des jeunes gens frais émoulus de l'effervescence et des barricades de Mai-68 : à de très rares exceptions près, les uns et les autres, persuadés d'offrir les clefs d'une science et d'une culture modernes à vocation universelle, ignoraient tout de la langue et de la culture malgaches – situation de monologue bien peu propice à la réussite des missions invoquées. Quant au malgache, langue littéraire ayant abondamment fait ses preuves en ses diverses variétés dialectales depuis des temps immémoriaux, si, dans sa forme classique en tant que langue ayant évolué dans le cadre d'une culture écrite amplement soumise aux influences européennes, il s'était vu reconnaître une place en différents lieux, tout comme au début et à la fin de la colonisation, du moins était-il demeuré le parent pauvre du système éducatif : il était enseigné, le plus souvent, par des diplômés de l'Université française assez profondément déculturés et qui, en cette matière, n'avaient généralement pour seul brevet que d'être nés de parents malgaches... Aucune erreur n'était alors aussi répandue que cette confusion du biologique et du culturel, fréquemment étendu à la langue, si ce n'est peut-être le culte du diplôme que l'on retrouve à l'origine d'autres aberrations. Ainsi, tandis que l'enseignement supérieur – université de coopération française et institut pédagogique sous le patronage de l'U.N.E.S.C.O. réunis – n'était pas parvenu à former sur place assez d'enseignants pour assurer à la langue nationale le modeste statut de langue vivante obligatoire pour les élèves malgaches de l'enseignement secondaire, l'administration responsable s'était, mal à propos, refusée à faire une exception pour les vrais maîtres de la langue, écrivains et orateurs, qui avaient le tort de ne pas être munis de titres universitaires. C'est tout cet ensemble que nombre de manifestants de l'automne 1972 percevaient comme un dispositif d'impérialisme culturel en action, une sorte de bastion qu'il convenait d'investir pour obtenir les réformes indispensables.
La destinée du pays remise par le président aux mains du chef d'état-major, les partisans des réformes, qui ignoraient les décisions françaises restées quasi confidentielles, prirent donc leur élan, sans se douter que, d'une part, la reddition sans résistance du bastion supposé et l'ivresse d'une victoire facile les entraîneraient bien au-delà de leurs revendications premières et que, d'autre part, certains, perdant complètement de vue les réalités, élèveraient des chimères sur des ruines. Ils ne purent ainsi qu'assister, dans l'impuissance, à la mise en œuvre d'une malgachisation d'autant plus outrancière que nourrie de passion, d'ignorance et de mauvaise conscience alourdies d'une forte dose de démagogie, laquelle transparaissait plus clairement encore à travers la reprise de la politique d'ouverture d'écoles, au moment même où diminuait tragiquement le nombre d'enseignants qualifiés. Cette œuvre objectivement destructive bénéficiant de la caution des « techniciens » placés aux postes de commande dans un esprit d'union nationale, ce fut en vain que se firent entendre les protestations des jeunes gens trop pauvres pour bénéficier d'ouvertures, faire leurs bagages et aller s'inscrire, aux frais de leurs parents ou des contribuables, dans les universités et les lycées de France. Chacun ses extrémistes et ses déviationnistes : on se mit à parler d'impérialisme merina, et l'on assista, dans un paroxysme, à la mise à feu et à sang de Tamatave/Toamasina, la ville portuaire de l'Est, depuis longtemps tournée vers les Mascareignes francophones et créolophones, par des manifestants chantant la Marseillaise et clamant leur refus d'un enseignement donné dans la langue nationale, identifiée au dialecte merina dont elle était initialement dérivée. Le tribalisme, relativement discret jusque-là, faisait ainsi irruption sur la place publique, accroché significativement au problème de la langue d'enseignement, que ne pouvait plus résoudre la simple affirmation de ce qu'on appelle depuis des siècles « unité linguistique et culturelle » de l'île. Celle-ci était certes aussi généralement reconnue que scientifiquement fondée, mais par ailleurs elle restait marquée par deux puissants facteurs de différenciation : d'une part l'adoption de l'alphabet latin – effective dans le Centre dès le début du XIXe siècle – et sa diffusion par l'école, qui firent passer le dialecte merina codifié au statut de malgache classique – langue officielle de la couronne et des Églises protestantes jusqu'à la fin de la monarchie, en 1897, reconnue comme telle mais minorée par les autorités coloniales, puis par celles de la République malgache – et, d'autre part, la position dominante du français dans toutes les villes malgaches au XXe siècle, période néocoloniale comprise.
Aucun don de voyance n'était indispensable pour deviner que des explosions en cascade pouvaient se produire au moindre faux-pas et que, non maîtrisée, la situation dégénérerait rapidement. La malgachisation telle qu'elle fut mal conçue et mise en application dans la pire des ambiances – même si l'on tient compte de la prise en considération des dialectes et des actions menées en faveur de la naissance d'un nouveau malgache commun – ne pouvait être qu'un échec... Elle le fut, mais on mit dix ans à le reconnaître, sacrifiant ainsi des centaines de milliers d'enfants scolarisés et déformés, en majorité perdus pour nombre de secteurs de la vie active, économique ou culturelle. Dans un tel contexte, on devine aisément ce qu'est et ce que pourra devenir la situation de la littérature, qui n'est certes pas au cœur des préoccupations générales.
De fait, même si l'on ne peut oublier que, dans cette période, la littérature malgache écrite a jeté quelques flammes en s'ouvrant aux passions, sans négliger de livrer des pages blanches aux paroles dialectales et argotiques, jamais, à ne considérer que la frange de la vie malgache se situant dans la mouvance des villes et du monde moderne, les situations linguistique et littéraire ne furent aussi déplorables. Hasardées sur un terrain miné, la langue classique et sa littérature en sortent à présent comme désarticulées, tandis que le français, longtemps réduit au statut de langue technique inconsidérément livrée au laxisme, n'est plus aux mains des nouvelles générations qu'un pauvre outil défectueux, la jouissance de ses trésors littéraires laissée en privilège aux classes dominantes d'hier et d'aujourd'hui. Cela constaté, parallèlement à la fermeture des chemins de l'Occident aux jeunes gens non boursiers, la nouvelle tendance est aujourd'hui à une sorte de retour au français.
La différence entre la loi et la coutume, disait un juriste jacobin, c'est que celle-ci s'efforce de maintenir l'homme dans la fidélité au passé tandis que celle-là veut le modeler en vue d'un avenir meilleur. Certains y crurent en 1972, d'autres y croient aujourd'hui... Ce sont, parfois, les mêmes. Mais ce sont, écrivains compris, des hommes qui tâchent de récupérer une langue et une culture par-delà une période de marginalisation et de déclin dont ils étaient au moins partiellement responsables ; qui plus est, des hommes avançant les mains vides. Loin de tendre vers un heureux dénouement, le vieux drame de la littérature malgache écrite n'en finit pas de se renouer et de se rejouer sous nos yeux. En attendant qu'il puisse enfin naître du magma autre chose que des avortons, le véritable espoir pour la littérature, nous semble-t-il, est à mettre une fois encore dans la contribution des artistes qui n'ont cessé de faire fleurir les chefs-d'œuvre de la littérature orale inscrite dans la tradition vivante, non pas immuable mais aussi fidèle à soi-même qu'accueillante aux souffles venus du large. De cela du moins des hommes et des œuvres nous sont garants.
Littérature de combat
Jacques Rabemananjara est, avec Ranaivo, l'un des deux écrivains malgaches dont la réputation ne s'est pas bornée aux côtes de la Grande Île. Ses chefs-d'œuvre, écrits en français, sont des fruits qui mûrirent au soleil de la torture et des prisons que lui firent connaître les Français de la IVe République, à cause des sanglants événements de 1947 dont il nie la responsabilité. Le chemin qu'il a parcouru peut servir à illustrer la naissance et le développement d'une littérature de combat.
Le sang européen qui coule dans ses veines est celui de l'inénarrable baron polono-hongrois Maurice Auguste Benyowski, qui mourut en 1786 sous les balles françaises, paré du titre illusoire d empereur de Madagascar. Ses ascendances malgaches vont des intrépides piroguiers betsimisaraka des siècles passés, qui de la côte nord-est s'en allaient porter la guerre dans les îles et les pays de l'Est africain, aux réunisseurs de terres et de pouvoirs du XIXe siècle merina, qui descendaient de leurs hauteurs en quête de l'unité malgache, au service de la monarchie. Enfant choyé de la croix catholique, jeune homme protégé du drapeau français, Rabemananjara devint le chef de file, trop curieux de sciences sociales, des apprentis-poètes de l'éphémère Revue des jeunes, dont la naissance (1935) fut saluée sur place comme un « fait important dans l'ordre littéraire, si important aussi dans l'ordre politique que la colonie, après avoir cherché à empêcher, avec le concours de l'Église, la parution de la revue, envoya son animateur à Paris pour le défilé du cent cinquantième anniversaire de la Révolution française. Grâce à la compréhension de Georges Mandel, il put y rester et fréquenter la Sorbonne, et c'est là que se nouèrent les liens qui unirent les futurs compagnons de Présence africaine dans la découverte de la solidarité des vaincus.
Rentré à Madagascar pour se présenter aux élections législatives d'après guerre comme candidat M.D.R.M. (Mouvement démocratique de la rénovation malgache), élu par le peuple malgache, Jacques Rabemananjara fut jeté en prison, quand éclata la rébellion, sans même avoir bénéficié de son immunité parlementaire. Dans les fers, il s'éveilla conscience tourmentée de son peuple et voix de sa révolte, tour à tour puissante et nostalgique. De ce moment et pendant un peu plus d'une dizaine d'années, celui que ses amis appelaient brièvement « Rabe » publia des chants – et non seulement des cris ; au-delà de la grandeur « révolutionnaire » que Sartre dans Orphée noir, préface à l'Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache d'expression française de Senghor (1948), reconnaissait alors comme apanage exclusif de cette « poésie noire de langue française », ces chants atteignent plus d'une fois à la véritable grandeur poétique. Brisés les liens de sa condition antérieure qui l'avaient même conduit aux abords du chauvinisme occidental, l'alexandrin de ses débuts trop sages peut enfin éclater jusqu'à devenir méconnaissable.
À la première mesure du souffle ou selon les rythmes de l'émotion malgache apprivoisée, le poète enfin libéré dans le citoyen enchaîné peut désormais transfigurer ce qui fut son idole le verbe humain qui a pu donner un Racine, un Lamartine et un Baudelaire, pour marteler en dissonance les cris de douleur et d'indignation de l'homme pris en traître, scander en dramaturge trop éloigné de la scène l'arrivée dans la baie d'Antongil des ancêtres venus d'Asie, entonner l'hymne d'éloges en l'honneur de la souveraine Liberté trahie par la France et de l'Île aux syllabes de flammes qu'il lui préfère comme jamais, lamenter la détresse et l'angoisse de l'homme que menace d'anéantissement le poids d'une langue et d'une culture étrangères à son peuple.
Puis, sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité ayant été commuée en exil à Paris, c'est dans la liberté surveillée qu'il poursuit sa réflexion politique. Celle-ci s'exprime souvent en une prose passionnée, où l'éloquence voisine avec l'humour ; mais bientôt apparaît une prose limpide et serrée d'analyste dont la finesse n'est pas la moindre qualité.
Quand fut recouvrée l'indépendance, Rabemananjara revint au pays dans l'avion du président, pour y exercer des fonctions d'homme d'État. Pour lui, la création littéraire parut alors appartenir au passé, et le sonnet composé lors de la mort du général de Gaulle sembla moins l'œuvre du poète que celle du ministre désirant célébrer la mémoire de l'homme qui fit advenir la décolonisation. Cependant, le poète, qui, vers le même temps, disait la joie que lui apporta la publication des Hainteny d'autrefois recueillis sous les auspices de Ranavalona Ire, garda sa plume pour travailler aux pièces d'Ordalies, expressément données pour des « exercices de style mais qui, nourries de l'ancienne culture, restent par le fond ses œuvres les plus malgaches.
Œuvre aussi importante que symbolique, pouvait-on dire en ce temps-là de la sienne, et dont la postérité était non moins nombreuse que clandestine. Cependant, défaut majeur déjà – quoique son auteur ait pu affirmer : «La vérité est que sous l'impératif de notre drame, nous parlons malgache [...] dans la langue de nos maîtres –, elle est restée inaccessible à la majorité des Malgaches. Que dire aujourd'hui ? Ordalies ne parut que plus tard, à Paris, où Rabemananjara, ayant préféré reprendre le chemin de l'exil après 1972, est venu retrouver le monde de Présence africaine.
Littérature de détresse et d'espoir
Aîné de Rabemananjara, Rabearivelo est le poète maudit de la littérature malgache : naissance aristocratique mais marginale, suicide de poète « apolitique » mais qui témoigne contre tout régime colonial ; entre les deux, une vie douloureuse de proscrit dont l'unique ambition était de devenir un grand écrivain et d'atteindre à la gloire. Mais cette gloire qu'il a recherchée hors de l'étouffante société coloniale de l'Emyrne qui le tenait prisonnier, cette gloire ne l'a jamais atteint vivant, de tous les coins du monde où il lança son œuvre : de l'Amérique du Sud à l'Afrique du Nord, de Vienne à Paris, de Marseille à Port-Louis, sans oublier Tananarive. Elle ne lui permit même pas de vivre décemment dans sa capitale prise dans l'impasse de l'assimilation : parent trop pauvre des notables malgaches enfoncés dans leurs ornières » et plus gênés que lui par les « oripeaux chrétiens et occidentaux , allié méconnu des colonisateurs qui le rejettent violemment dans l'indigénat et la misère, il n'avait plus pour pairs et amis que quelques hommes de lettres dont il restait néanmoins séparé par la distance (Amrouche, Guibert) ou le souci de sa dignité (Boudry, Razafintsalama, Rabemananjara). On ne peut se faire une consolation de ce que, confrontée à la mort, la gloire ait rapidement effleuré son nom sur l air du mois de la Nouvelle Revue française et les pages du Mercure de France ; mais, venue trop tard pour l'homme, fait-elle au moins vivre ce qui reste de son œuvre ?
Cette œuvre, bilingue si l'on ne tient compte de l'espagnol un moment taquiné par amour de l'histoire malgache, embrasse pour ainsi dire tous les genres, de la nouvelle à la critique en passant par la traduction (Poe, Baudelaire). Mais la vocation de Rabearivelo resta la poésie à laquelle il donna ses chefs-d'œuvre : en malgache, des poèmes crépusculaires dominés par l'angoisse et la nostalgie qu'il éparpilla dans les très nombreux journaux tananariviens de son temps ; en français, des recueils de poèmes d'une grande beauté formelle, où le sentiment n'est plus qu'un imperceptible frémissement ; mais surtout, en un texte bilingue, deux œuvres qui témoignent et de son talent, et de ses trouvailles fécondes en malgache, et de sa grande maîtrise de la langue française harmonieusement dépaysée par la respiration de l'ancien vers libre malgache et naturalisée par les thèmes.
Depuis sa mort, son œuvre fut aussi tiraillée que lui de son vivant, et scandaleusement. Rabearivelo, Latin égaré en Scythie ou inversement Scythe latinisé, écartelé entre deux cultures et deux langues, victime à en mourir du régime colonial, est un exemple unique de réussite personnelle (il fréquenta à peine l'école) à peu près égale dans les deux langues. Il est le seul qui puisse servir de guide à la foule innombrable de jeunes et de moins jeunes que tient le démon de la littérature.
Que nul des contemporains malgaches de Rabearivelo n'ait été connu à l'étranger peut aisément s'expliquer : d'une part, alors qu'il était seul à user du français en maître, on n'étudiait pas le malgache pour sa littérature, condamnée d'avance par les préjugés colonialo-racistes ; d'autre part, la curiosité littéraire pour l'Île trouvait à se satisfaire par les récits de voyages, par la littérature exotique qui la choisit parfois pour thème le plus souvent alterné avec celui des îles sœurs de l'océan Indien, ou par l'infidèle traduction du folkloriste qui, tantôt sacrifiant la forme au fond, tantôt saisi par la fausse élégance, détruit l'œuvre.
Quant à la faiblesse de la production littéraire contemporaine comparée à celle des devanciers, déjà peut largement l'expliquer ce que l'on sait de ses conditions d'existence. Peut-être même doit-on s'émerveiller de ce qu'une telle adversité n'ait pu empêcher la croissance de quelques œuvres, évidemment bien plus nombreuses en malgache qu'en français, mais les unes et les autres comme libérées des vieilles pesanteurs, qui en étreignent encore tant d'autres, qu'il s'agisse du puritanisme transmis par les Églises devenues les refuges du malgache classique au temps de son éviction des écoles publiques, ou du nationalisme étroit encore à l'œuvre ces derniers temps.
Devant toutes les raisons de craindre que la relève ne soit pas de sitôt assurée, ces quelques lueurs paraissent bien faibles. Mais l'on ne peut oublier qu'il reste effectivement une grande raison d'espérer. C'est loin des écoles, en effet, qu'au lendemain de l'indépendance, la langue littéraire s'est mise à récupérer, avec le vieux fonds traditionnel remis au jour, ses vertus d'autrefois. Et c'est ainsi que se fait à nouveau entendre le message que Rabearivelo tenta d'exprimer à travers une réinterprétation du mythe d'Antée, ressuscitant comme tous ceux qui savent boire à la source. Pensons notamment à la belle œuvre de Flavien Ranaivo (1914-1999) et à son effort pour donner un équivalent français des poèmes malgaches. Traduction et création sont ici indissociables.
Littérature coulant de source
J'avais lu, lycéen, Les Hainteny et, sais-je pourquoi ? je doutai longtemps (j'aime à douter encore) si les Malgaches avaient eu vraiment tant de chance, si ces merveilles poétiques n'étaient pas dues tout entières à un poète caché qui se donnait pour leur traducteur, si Jean Paulhan, en somme, n'avait pas réussi ce que le Pierre Louýs des Chansons de Bilitis avait autrefois manqué. Tangible, irrécusable aboutissement, pensais-je, d'une méditation sur le langage poétique et comme l'incarnation, ou la démonstration, de ses pouvoirs. Un poète ? (À qui cette vérification, peut-être, avait suffi. À l'affût, désormais, de la voix des autres) Jacques Borel, Jean Paulhan et la Nouvelle Revue française, 1969
Paulhan poète ? La beauté de ses traductions en fait foi, et nous savons, pour l'avoir entendu, qu'il était effectivement capable d'improviser en hainteny, en malgache comme en français (même s'il les appelle parfois haikai). Mais c'est depuis sa jeunesse que Paulhan a été « à l'affût de la voix des autres » et a su se mettre à leur école sans l'ombre d'un préjugé. On peut répondre de façon définitive à ceux qui, avec Jacques Borel ou avec Guy Dumur, se demandent encore si les hainteny, tels que les a fait connaître Paulhan, sont ou non une supercherie. Laissons à la littérature française, jusqu'à preuve du contraire, les Chansons madécasses de Parny qui n'ont que leur exotisme et leur générosité, mais les hainteny sont authentiquement malgaches : ceux qui se disent encore dans les campagnes épargnées par la civilisation, comme ceux de Rabearivelo, ceux qu'a traduits Paulhan, ceux que Dahle a recueillis une quarantaine d'années auparavant et qu'il a traduits en norvégien en les rapprochant des stev de son pays, comme ceux du manuscrit vieux d'un siècle et demi qui furent publiés en 1968, et qui auraient sans doute plu à Paulhan pour leur érotisme sans autre fard que la poésie. Cela dit, Jacques Borel a fort bien saisi ce que représentent les hainteny en tant que production littéraire ; d'ailleurs, « science et puissance des mots » traduit mieux leur nom que « science des paroles » d'une ambiguïté aussi paulhanienne que française.
L'existence des hainteny merina, des saimbola sakalava, des fampariahitse betsileo, etc. – tous déjà aussi souvent dits que chantés (dans les spectacles de mpilalao qui évoquent les sotties) – atteste et l'origine asiatique et l'ancienneté (les chansons de l'ancienne Chine du Sud, les chants alternés de l'Indochine, les haies de chants de l'ancien Japon, etc.) de la littérature malgache traditionnelle, tout comme témoignent peut-être de l'influence africaine et de l'originalité malgache les analogies thématiques entre le cycle africain du Roman de Lièvre et le cycle du Roman d'Ikotofetsy (le rusé) et Imahakà (le jeteur de sort ?) remarquable par l'absence de recours au masque animal. Des anciens vazo (récitatifs psalmodiés) aux éternels et universels ohabolana (poésie gnomique) en passant par les grands sôva (blasons) de l'actuel ôsika tsimihety, cette littérature a illustré plus d'un genre poétique issu du rythme et du chant, n'ignorant même pas la rime, et, des mythes à l'embryon de roman apologétique du conte d'Ibonia en passant par les légendes et les traditions historiques, plus d'une forme du récit. Il restait donc à renouer avec la tradition établie par les katibo des sorabe antemoro et reprise par les secrétaires et les mémorialistes de la cour de Ranavalona Ire, pour recueillir et étudier ce trésor littéraire avant qu'il ne fût trop tard. Dans les dernières décennies ce fut à nouveau, pour quelques-uns, une préoccupation majeure. Et, dans le contexte d'une reconnaissance émerveillée de richesses hier encore insoupçonnées, l'intérêt que l'on a vu ainsi porté à la littérature orale a paru ne plus devoir se démentir.
En revanche, la littérature malgache contemporaine compte peu de romanciers (Pélandrova Dreo, Pélandrova, 1975 ; Michèle Rakotoson, Le Bain des reliques, 1988), et il lui a fallu affronter une situation compliquée par la révolution de 1972, qui voulut faire prévaloir l'écriture en malgache. Depuis 1980, avec l'évolution politique du régime, la littérature malgache d'expression française a en partie retrouvé sa place. En témoignent les œuvres de Charlotte Rafenomanjato (Le Pétale écarlate, 1980, Lente Spirale, 1990)
Liens
http://youtu.be/6OrhB2ukRQU Voyage sur l'île rouge 1
http://youtu.be/fwB2Qpf02Lg Voyage sur l'île rouge 2
http://youtu.be/Zjxb-vcdt68 Madagascar D'Ambilobe à Vohémar 1
http://youtu.be/ZabC2r4Syis Madagascar Baie d'ANtogil 2
http://youtu.be/JxL9YDPMihE De Vohémar à Sambava3
http://youtu.be/6OrhB2ukRQU?list=PL6AC2393A0671771C Madagascar.[img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Detail_of_Diogo_Dias's_ship_(Cabral_Armada).jpg[/img]  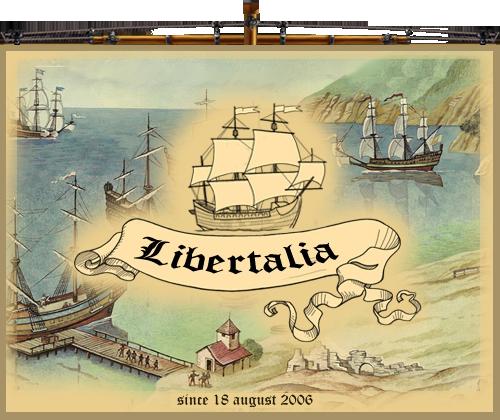 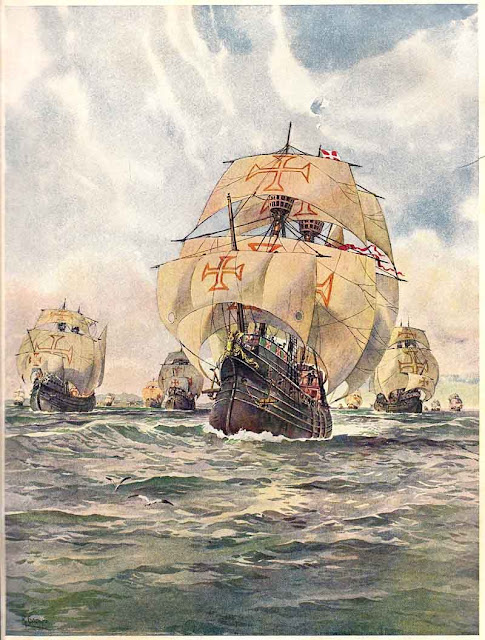              
Posté le : 09/08/2014 18:23
|
|
|
|
|
Fulgence Bienvenue |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Le 3 août 1936 à Paris, à 84 ans, meurt Fulgence Marie Auguste Bienvenüe
né le 27 janvier 1852 à Uzel en Côtes-du-Nord, inspecteur général des Ponts et il se forme à l'école polytechnique, École nationale des ponts et chaussées, il sera distingué : une station de métro porte son nom : Montparnasse - Bienvenüe métro de Paris, Place Bienvenüe à Paris, Légion d'honneur dès 1879, chevalier de la Légion d'honneur le 2 mars 1881, officier de la Légion d'honneur en 1900, en 1909 grand prix Berger de l’Académie des sciences, Grand-Croix de la Légion d'honneur en 26 janvier 1929, timbre postal en 1987. Il est, avec Edmond Huet, le père du métro de Paris.
En bref
Ingénieur au corps des Ponts et Chaussées, il est nommé en 1875 ingénieur au service ordinaire du département de l'Orne, où il s'occupe des chemins de fer de l'État. Après un très grave accident de service, à la suite duquel il perd le bras droit, il entre en 1886 au service municipal de la Ville de Paris.
Ingénieur en chef en 1891, il dirige le service d'adduction des nouvelles eaux de source, construisant notamment les aqueducs des dérivations dites de l'Avre et du Loing, crée à Gennevilliers un port de Paris et établit, en amont de Paris, sur la Marne et sur l'Yonne, des réservoirs de régularisation.
En 1896, il reçoit la mission d'établir l'avant-projet d'un réseau urbain de lignes de chemin de fer à traction électrique et destiné au transport des voyageurs Métropolitain. Déclarée d'utilité publique en 1898, la construction de l'infrastructure de ce chemin de fer est exécutée par la Ville de Paris, sous la direction de Bienvenüe. Ce dernier fut surnommé le Père du métro.
Les travaux du chemin de fer métropolitain de Londres, le premier au monde, commencèrent en 1853.
Dix ans plus tard, l'Inner Circle, dont les deux extrémités – Bishop's Gate et Mansion House – sont situées dans la City, était achevé. La ligne de 17 kilomètres et comptant vingt et une stations était gérée par deux compagnies : le Metropolitan Railway et le Metropolitan District.
Le métro londonien, initialement à vapeur, fut électrifié en 1890. À Paris, les premiers chantiers ne s'ouvrirent qu'en 1898, deux ans après la mise en service du premier métro sur le continent, à Budapest.
Les projets français, conçus par Brame et Flachat, remontaient cependant à 1855, mais leur réalisation buta sur un antagonisme fondamental entre la Ville et l'État.
L'ingénieur Fulgence Bienvenüe (1852-1936) devait vaincre toutes les difficultés et devenir le véritable père du métro parisien : inaugurée le 19 juillet 1900, la première ligne, allant de la porte de Vincennes à la porte Maillot, était prête à fonctionner pour l'ouverture de l'Exposition universelle.
Sa vie
Il est le treizième et dernier enfant d'une famille bretonne Côtes-du-Nord.
Son père notaire très cultivé consacrait son temps libre à l'histoire et l'archéologie, se passionnant en particulier pour les monuments antiques de la région. Il a transmis son goût pour les auteurs grecs et latins à son dernier fils, et eu sans doute une influence importante sur ses brillantes études. Son grand-père, magistrat, juriste, écrivain, polémiste est l'auteur d'une œuvre considérable, et fut député à la Chambre des représentants en 1815. Son cousin Édouard Bienvenüe 1901-1980 était notaire à Mayenne de 1934 à 1965, et conseiller municipal de cette ville de 1940 à 1958.
Sa famille est apparentée notamment au maréchal Foch, ce dernier ayant épousé le 5 novembre 1883 en l'église Saint-Michel de Saint-Brieuc Julie Bienvenüe, petite-cousine de Fulgence, et aux Mazurié de Keroualin de Segré.
Fulgence Bienvenüe rentre à l’âge de dix ans au collège des Eudistes de Valognes et obtient à quinze ans un baccalauréat de philosophie. L’influence de Pascal et Descartes devait le marquer durablement. Son désir d’action le conduit à entreprendre des études en vue de devenir ingénieur, au lycée Sainte-Geneviève tenu par les jésuites, rue Lhomond à Paris, où il prépare le baccalauréat scientifique, puis le concours d’entrée de l’École polytechnique. Il perd sa mère en 1868. Après un échec en 1869, il est reçu au rang 55 sur 151 en 1870.
La rentrée a lieu en janvier à Bordeaux, en raison de la guerre puis de la Commune. Le général Riffault, qui commande l’École, renvoie les élèves chez eux sauf une trentaine, mis à la disposition de Thiers, notamment pour la diffusion de messages.
Parmi eux, se trouve Bienvenüe, qui est pris à partie, le 24 mai 1871, par des fédérés et associé à un groupe d’otages, sauvé in extremis par Clemenceau.
De retour à l’École, Bienvenüe devient l’ami de Foch, qui épousera par la suite sa nièce, et de Joffre.
Classé neuvième à la sortie de l’École, il est admis 5e sur 18 au Corps des Ponts le 1er novembre 1872 et entre à l'École nationale des ponts et chaussées.
Il a l’occasion de donner des cours de mathématiques à Charles de Foucauld, avant d’être nommé Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées de 3e classe le 26 octobre 1875.
Cette même année voit le décès de son père.
Il souhaite retourner en Bretagne, mais comme celle-ci est inaccessible aux débutants, il est affecté à l’arrondissement du centre du service ordinaire des Ponts et Chaussées du département de l’Orne à Alençon.
Chargé de l’exploitation de 197 kilomètres de routes nationales et d’un système hydraulique de 1 400 kilomètres, ainsi que de l’administration de la pêche et des prévisions météorologiques, il s’attache à améliorer la desserte du territoire par les lignes de chemin de fer.
Il s’attelle tout d’abord à la construction du chemin de fer de Fougères à Vire, dont le passage à Mortain est particulièrement difficile à réaliser.
Pour son succès, ainsi que la réalisation de la ligne entre Alençon et Domfront, il est proposé pour la Légion d'honneur dès 1879.
Il travaille ensuite sur le tracé de la ligne de Pré-en-Pail à Mayenne, rendu délicat par les contreforts tourmentés qui bordent la région. Trois inventions aident à atteindre l’objectif de desservir tous les villages : la dynamite, le détonateur et le perforateur à percussion.
Le 25 février 1881, alors qu’il s’assure de la sécurité des ouvriers lors d'une visite d'expropriation assez mouvementée, un démarrage intempestif le projette sur la voie. Il est amputé de son bras gauche, faisant preuve d’un stoïcisme impressionnant. Il disait avoir été exproprié de son bras. Le 2 mars 1881, il est fait chevalier de la Légion d'honneur.
La ligne ouest est établie en mai et la transversale en octobre.
Paris
Pris d’amour pour la capitale, il se rapproche de Paris. Affecté en février 1884 au 1er arrondissement de la 1re section du contrôle de l’exploitation des chemins de fer de l’Est 900 kilomètres de voies, il fait construire la ligne Paris - Strasbourg jusqu’à Épernay, et contrôle également les 247 kilomètres des chemins de fer du Nord. Il préfère agir plutôt que surveiller l’action des autres.
Souhaitant être affecté au service municipal, il devient en février 1886 responsable de la 8e section du service municipal de la voie publique dans les 19e et 20e arrondissements, des quartiers populaires. Il poursuit l’équipement en égouts des différents quartiers, fait percer l’avenue de la République jusqu'à la limite du 20e arrondissement boulevard de Ménilmontant et aménage le parc des Buttes-Chaumont.
Il s’intéresse également au problème des transports pour les quartiers en hauteur, comme Belleville, les ouvriers devant y remonter après leurs journées de travail. C’est ainsi qu’il conçoit le tramway funiculaire, pris en charge par le conseil municipal et inauguré en septembre 1890.
En 1891, il est promu Ingénieur en Chef, en service spécial sous l’autorité de l’Inspecteur Général Humblot pour résoudre un certain nombre de problèmes d’alimentation en eau potable. Il dirige notamment la construction de l'aqueduc de l'Avre de 1891 à 1893, et réalise l’étude de la dérivation des sources du Loing et du Lunain.
Après des apports à la dérivation de la Dhuis et de la Vanne, il devient responsable du service de la dérivation, puis Ingénieur en chef de 2e classe. En 1894 apparaît la loi qui exige le raccordement de tous les bâtiments aux égouts.
Le métro
En 1895, il réalise avec Edmond Huet l’avant-projet d’un réseau de chemin de fer métropolitain pour la Ville de Paris, à voie étroite et à traction électrique, en s'inspirant des études de Jean-Baptiste Berlier.
Le premier projet de métro remontait à 1851, avait été repris en 1871, puis rediscuté en 1877 et 1883. Le conseil municipal, qui souhaite un service local, adapté aux attentes de la population de la ville, se heurte jusqu’en 1894 à l’opposition des grandes compagnies de chemin de fer soutenues par l’État, qui souhaitent le simple prolongement de leurs lignes. Cependant, l’exposition universelle de 1900 nécessite la concrétisation rapide de ce projet.
Fin 1895, une dépêche ministérielle reconnaît enfin à la ville de Paris le droit de réaliser une desserte orientée par les intérêts urbains. Bienvenüe présente un projet définitif que le conseil municipal adopte le 9 juillet 1897, et le 30 mars 1898, une loi déclare d’utilité publique l’établissement dans Paris du Chemin de Fer Métropolitain.
Les travaux sont lancés le 4 octobre suivant afin d'être prêts avant l'exposition universelle de 1900. En 1899, Bienvenüe est déchargé de ses autres fonctions pour se consacrer exclusivement à cette tâche. Cette première ligne, "Porte de Vincennes -> porte Maillot" ligne N° 1- est inaugurée le 19 juillet 1900 par M. Bienvenüe. La même année, il est nommé officier de la Légion d'honneur.
En cinq ans, les 42 kilomètres des lignes 2 et 3 sont établis. Adopté en 1903, le tracé de la ligne 4 nécessite la traversée sous-fluviale de la Seine, ce qui représente un important défi technique2, même si le passage sous la Tamise avait été couronné de succès à Londres. Commencés en 1904, les travaux sont rendus possibles par la méthode inédite de Résal mise en œuvre par Chagnaud, dite de fonçage, qui consiste au forage vertical de caissons préfabriqués en béton armé, formant les tronçons du futur souterrain, ainsi que par une méthode de construction d’un souterrain en zone inondable par congélation du sol. La mise en œuvre de la ligne intervient finalement le 9 janvier 1910.
Le 28 avril 1909, Bienvenüe épouse Jeanne Loret. Cette même année, le grand prix Berger de l’Académie des sciences lui est décerné. À partir de 1911 et pendant une durée de dix ans, Bienvenüe assume, en plus de ses autres fonctions, celle de directeur du Service de la Voie publique, de l’Éclairage et du Nettoiement.
Bien qu’ayant soixante-deux ans lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il obtient sa mobilisation le 3 août 1914, en tant que colonel du Génie, pour participer à la mise en état de défense du camp retranché de Paris.
Une fois la menace allemande éloignée, le préfet de la Seine négocie le maintien des chantiers du métropolitain, toujours sous la direction de Bienvenüe, démobilisé le 26 août 1914, qui assume également celle du service du port de Paris à partir de 1917. S’en suivent la création du port de Gennevilliers, l’aménagement du canal Saint-Denis et l’élargissement du canal de l'Ourcq.
En 1924, la ville de Paris lui décerne sa Grande Médaille d’or. Le décret du 26 janvier 1929 l'élève à la dignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur. Il choisit, comme l'usage le veut, un parrain pour être promu et ce fut le maréchal Foch qui mourut quelques semaines plus tard. Cette distinction lui est décernée en récompense des services rendus auprès de la ville de Paris.
Bienvenüe demeure Ingénieur Conseiller de la Ville jusqu’à sa retraite, le 6 décembre 1932, à l'âge de 80 ans. L'année suivante, le Conseil municipal de Paris décide de donner son nom à la station de métro et à la place du Maine.
Un jour après Louis Blériot, Fulgence Bienvenüe meurt dans la capitale le 3 août 1936 à 84 ans, et est inhumé le 7 août au cimetière du Père-Lachaise division 82 dans l'indifférence générale. En janvier 1987, un timbre a été édité en sa mémoire.
Pensée
Agissant dans une tradition de sérieux et de travail, il n’accorde aucune importance au confort domestique. À propos du métro de Paris, il déclare : « L’artiste imprime à son œuvre un sceau de personnalité alors que l’ingénieur est amené à se considérer comme l’artisan d’une œuvre impersonnelle.
Car si, dans l’ordre technique, toute œuvre précise et concrète est bien le fruit de la méditation individuelle, la forme qu’elle revêt résulte de la synthèse d’un grand nombre d’efforts différents. »
Son goût pour le latin et le grec nous vaut cet hexamètre symbolisant sa réalisation majeure
Jovis erepto fulmine, per inferna vehitur Promethei genus.
" Par la foudre ravie à Jupiter, la race de Prométhée est transportée dans les profondeurs ".
Objet commémoratif
Une médaille a été éditée en souvenir de l’ouverture au public de la première ligne de métro de Paris sur laquelle figure un portrait de Fulgence Bienvenüe6.
Le nom de Bienvenüe a été donné à l'ex-station de métro qui, située derrière l'ancienne gare de Paris-Montparnasse, assurait la correspondance entre les lignes numérotées aujourd'hui 6 et 13.
La station Bienvenüe et la station Montparnasse ont fusionné en 1942 sous le nom de Montparnasse - Bienvenüe.
Un lycée porte son nom à Loudéac, dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne : le lycée Fulgence-Bienvenüe.
Liens
http://youtu.be/1ml8flC7lgMreportage
http://youtu.be/uEbUV2V4Ptk Fulgence Bienvenue chanson
http://youtu.be/96Yw8o42VeE?list=PL-D ... kKPSuq__lneOBOsDCsRaQj3Td histoire du métro parisien
[img width=6*00]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Bienvenue.jpg/220px-Bienvenue.jpg[/img]   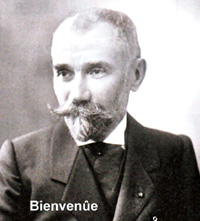 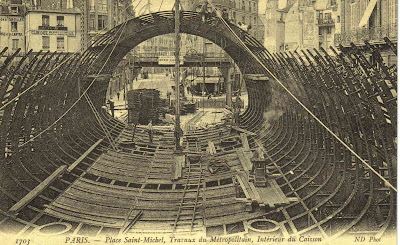    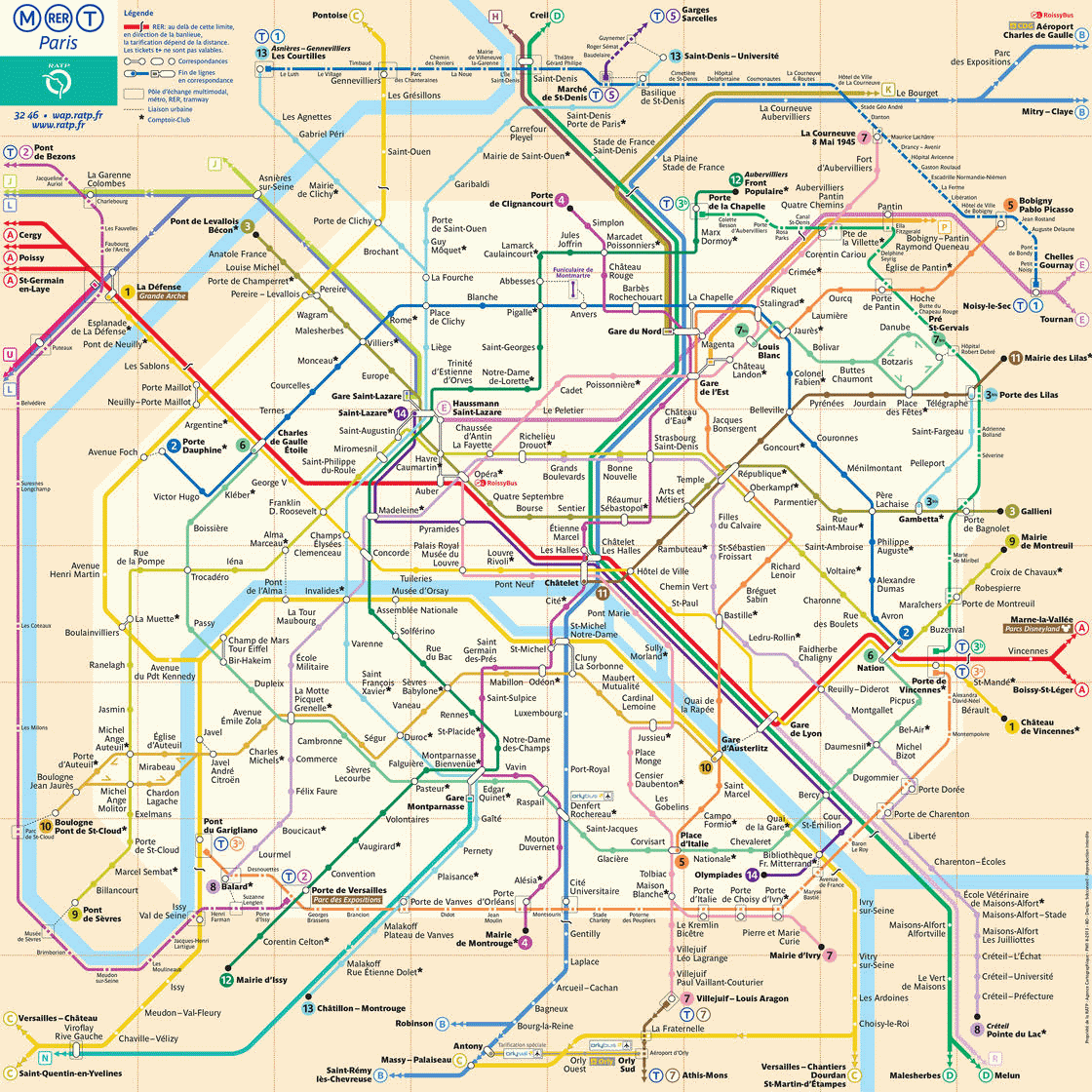   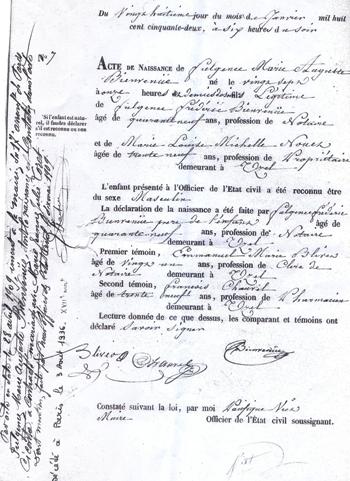          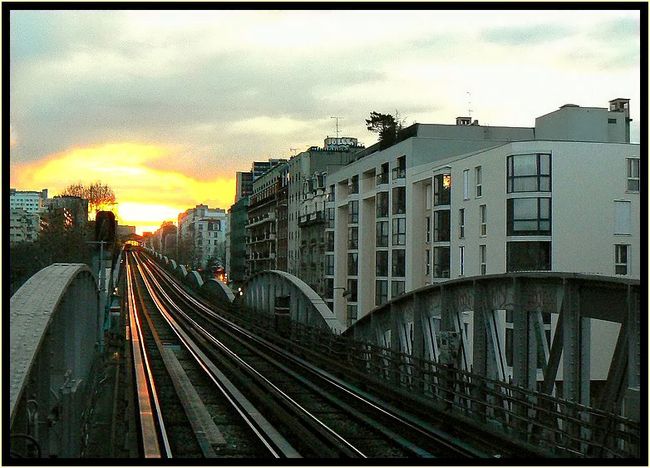     
Posté le : 02/08/2014 18:39
|
|
|
|
|
Henri de la tour d'Auvergne Bouillon dit Turenne |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Le 27 juillet 1675, à 63 ans, à la bataille de Salzbach meurt, Henri de la Tour
d'Auvergne-Bouillon surnommé Turenne,
né le 11 septembre 1611 au château de Sedan Ardennes - mort à la bataille de Salzbach le 27 juillet 1675, vicomte de Turenne, fils du duc de Bouillon et prince de Sedan, généralement connu sous le nom de Turenne. Maréchal de France en 1643 et maréchal général des camps et armées du roi en 1660, il fut l'un des meilleurs généraux de Louis XIII puis de Louis XIV. Il participe à la Guerre de Trente Ans, Guerre de Dévolution, Guerre de Hollande, il se distigua par des Faits d'armes à la bataille de Nördlingen, bataille de Zusmarshausen, bataille de Bléneau, bataille des Dunes, bataille de Turckheim il fut également colonel général de la cavalerie et appartient à la famille de la maison de La Tour d'Auvergne
En Bref
Sans doute le plus grand homme de guerre qu'ait produit la France avant Napoléon. Taciturne et souvent bourru, Turenne cachait mal, sous une apparence de froideur une chaude humanité qui le faisait adorer de ses hommes. Stoïque dans les revers comme réservé dans les victoires, ambitieux uniquement de la gloire, généreux au point de payer ses soldats en puisant dans sa propre fortune, il était désintéressé au point de refuser l'épée de connétable qui lui était offerte sous condition qu'il se convertît au catholicisme, pour s'y convertir quelques années plus tard par conviction et sans nul avantage.
Le parallèle entre Turenne et Condé, aussi classique pour les écoliers d'antan que celui entre Corneille et Racine, met en cause la notion même de génie en matière militaire. Turenne n'est pas l'homme des soudaines illuminations sur le champ de bataille, bien qu'à tout prendre il soit plus souvent inspiré comme tacticien que Condé, mais son génie foncier est celui de la stratégie.
Homme d'études, il a médité sur tous les grands exemples ; homme de pensée, il conçoit une campagne comme une œuvre d'art et non comme un affrontement. La sûreté de son raisonnement et de sa prévision lui permet de surprendre ses adversaires par la hardiesse réfléchie de ses plans ; comme pour Bonaparte, la bataille est souvent gagnée par lui avant même d'être engagée, grâce à l'envergure et à la précision de la manœuvre préalable.
Maréchal général des camps et armées du roi depuis 1660, Turenne se consacre à la réorganisation des forces armées. Il est alors au sommet de sa gloire à la cour, ayant part aux relations diplomatiques avec la Suède, l'Angleterre et le Portugal. Après le célèbre passage du Rhin mené par Louis XIV lui-même, Turenne, généralissime, se trouve face au comte de Montecucculi, stratège digne de lui, et l'empêche de franchir le fleuve, force l'Électeur de Brandebourg à regagner ses États, puis le bat après son retour à Sinzheim avec une armée inférieure en nombre. Maître du Palatinat, il semble qu'il ait eu quelque responsabilité dans la dévastation de ce pays.
À la tête de vingt mille hommes contre un ennemi qui en compte trois fois plus, il entreprend cette campagne de 1674-1675 qui sera la plus admirée des théoriciens militaires. Après des mouvements hardis, il attire l'ennemi sur un terrain favorable, le bat à Insheim, puis se retire en Lorraine afin de laisser l'ennemi aller prendre ses quartiers d'hiver en Alsace.
Ayant reçu alors des renforts, il concentre ses troupes derrière les Vosges ; passe par le col de Bussang, au sud, après avoir feint d'attaquer par Saverne, au nord ; défait l'ennemi à Turckheim et le surprend près de Colmar, l'écrase 5 janv. 1675 et le rejette en pleine déroute hors d'Alsace. Quand il revient à la cour, c'est une marche triomphale : la foule se presse pour voir le libérateur du royaume. Toujours modeste, Turenne veut alors se retirer à l'Oratoire, mais en est dissuadé par le roi qui lui donne le commandement de la campagne de 1675 où il se trouve de nouveau face à son vieil adversaire, Montecucculi.
Pendant deux mois, tous deux déploient leurs plus beaux dons de manœuvriers ; mais, enfin, Turenne se voit sur le point d'amener son adversaire sur les positions qu'il juge souhaitables pour une bataille décisive, lorsqu'il est tué d'un boulet de canon. Le roi, qui lui devait tant, le pleure, ainsi que la France tout entière. Inhumé à Saint-Denis, il sera transporté pendant la Révolution au musée des Monuments et Napoléon le fera déposer aux Invalides, avant de dicter à Sainte-Hélène un précis justement admiratif sur les campagnes du vainqueur de Turckheim.
Sa vie
Henri de la Tour d'Auvergne-Bouillon est petit-fils de Guillaume le Taciturne par sa mère Élisabeth de Nassau, et fils de Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, premier gentilhomme de la chambre d'Henri IV, maréchal de France en 1592, duc de Bouillon par son premier mariage avec Charlotte de La Marck.
Deuxième fils du duc de Bouillon, petit-fils de Guillaume d'Orange le Taciturne par Élisabeth de Nassau il est élevé dans la religion réformée, dans un calvinisme austère et ardent, il se convertit au catholicisme en 1668 sous l'influence de Bossuet, notamment après la lecture de son livre Histoire des variations des Églises protestantes. Il accède aux plus hautes dignités : prince étranger en 1651, maréchal de France et maréchal général.
Dès l'enfance, il manifeste les traits les plus marquants de son caractère ; dès l'adolescence, il montre ce courage qui ne doit rien à une instinctive impétuosité (on se souvient de sa fameuse apostrophe à lui-même :
" Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais bien plus si tu savais où je vais te mener".
Son père, le jugeant trop fragile de constitution, ne le destinait pas à la carrière des armes, mais le jeune Henri obtient pourtant d'être envoyé auprès de ses oncles de Nassau en Hollande 1625-1629 : il sert d'abord comme simple soldat avant de commander une compagnie. Passé au service de la France, colonel d'un régiment d'infanterie,
Turenne épousa en 1653 Charlotte de Caumont La Force, fille de Armand Nompar de Caumont. Elle mourut en 1666. Ils n'eurent pas d'enfants.
Guerre de Trente Ans
Pendant la Guerre de Trente Ans, par commission du 17 janvier 1625, il lève un régiment d'infanterie qui porte son nom
La même année, il fait ses premières armes dans l'armée hollandaise, sous les ordres de son oncle, le stathouder Frédéric-Henri d'Orange-Nassau, en tant que simple soldat puis il lui offre un commandement en 1626. Le régiment qu'il avait créé en France est licencié en mai 1626. En 1627 et 1628, il participe aux sièges de Klundert, de Williamstadt et dans la plupart des expéditions contre Spinola. Il s'illustre notamment dans l'armée hollandaise, aux côtés de Frédéric-Henri d'Orange-Nassau, au siège de Bois-le-Duc en 1629, contre les Espagnols.
Cependant, il choisit l'année suivante de passer au service de la France, plus prestigieux et son régiment d'infanterie est rétabli, le 27 mars 1630, sous le nom de régiment d'Eu. Richelieu le nomme colonel et il participe au siège de La Mothe en 1634, où ses états de service lui valent une promotion au grade de maréchal de camp. Après avoir participé à diverses campagnes en Lorraine, sur le Rhin et dans les Flandres, il s'empare notamment de Saverne en 1636, où il manque de perdre un bras, et de Landrecies en 1637. Il dirige l'assaut sur la puissante forteresse de Brisach en 1638 et obtient sa capitulation le 17 décembre.
Sa réputation allant croissant, il sert en Italie de 1639 à 1641 sous le commandement d'Henri de Lorraine-Harcourt et s'illustre à plusieurs reprises, puis participe comme commandant en second à la conquête du Roussillon en 1642. Louis XIII disparait le 14 mai 1643, c'est Anne d'Autriche, régente de France qui, le 19 décembre, le fait maréchal de France. Turenne n'a alors que 32 ans. Il est envoyé en Alsace où les armées françaises sont en position délicate.
Empruntant sur ses deniers, il réorganise l'armée et traverse le Rhin au mois de juin 1644 avant d'opérer sa jonction avec les forces de Condé, qui prend le commandement. Il participe aux sièges de Mayence et de Philippsburg et aux batailles de Fribourg 1644 et Nördlingen 1645 aux côtés de Condé.
Celui-ci reparti, il mène ensuite avec ses alliés Suédois une campagne décisive qui se termine par la victoire de Zusmarshausen le 17 mai 1648 et son armée dévaste la Bavière. Les traités de Westphalie sont signés peu après et mettent fin à la guerre de Trente Ans.
Guerres de Louis XIV
Un temps passé du côté des Frondeurs, il échappe à l'arrestation dont sont victimes d'autres princes dont Condé et cherche l'aide des Espagnols. Il connaît à cette occasion l'un de ses rares revers militaires en étant vaincu lors de la bataille de Rethel le 15 décembre 1650. Après la libération des princes, il se réconcilie avec Mazarin et obtient le commandement des armées royales lorsque Condé se révolte à nouveau. Après l'indécise bataille de Bléneau le 7 avril 1652, il bat l'armée espagnole à la bataille du faubourg Saint-Antoine le 2 juillet 1652 commandée par Condé au faubourg Saint-Antoine et réoccupe Paris le 21 octobre 1652, obtenant définitivement le pardon de Louis XIV. Les flammes variées de la duchesse de Longueville et le départ de Mazarin pour un exil momentané le poussent à se rapprocher de la cour. Il est mis à la tête des troupes royales, vainqueur à Jargeau et dans la région de Gien où il attire Condé dans un piège, et le force à se retirer dans Paris après l'avoir battu à Étampes.
Les troupes royales, bien menées par Turenne qui ne ménage ni son courage ni son habileté, ont raison des rebelles après six mois de campagne en 1652. Son crédit est alors sans bornes auprès du roi ; la reine lui avait écrit à Gien :
" Vous venez une seconde fois de mettre la couronne sur la tête de mon fils."
Une telle phrase aurait pu faire tourner l'esprit de bien des grands seigneurs, mais Turenne, désintéressé sur le plan politique, demeurera scrupuleusement fidèle au roi. Louis XIV le comprit et, s'il ne le fit jamais entrer au Conseil, sut toujours prendre l'avis de Turenne, le consultant sur les affaires les plus secrètes, n'attachant aucune importance aux attaques dont il était l'objet, lui laissant toujours carte blanche pour diriger campagnes et batailles.
Poursuivant la lutte contre Condé et les Espagnols, il les bat à Arras le 25 août 1654 mais est à son tour sévèrement battu à la bataille de Valenciennes le 16 juillet 1656. Il remporte néanmoins la décisive victoire des Dunes, près de Dunkerque, le 14 juin 1658, et le traité des Pyrénées signé l'année suivante met fin à la guerre franco-espagnol
Turenne terminera la guerre contre Condé et les Espagnols en s'emparant en 1653 de Rethel, de Mousson, de Sainte-Menehould, en faisant lever le siège d'Arras en 1654 et en remportant en 1658 l'éclatante victoire des Dunes près de Dunkerque. Vainqueur, il écrit : Nous l'avons emporté ; mais quand il lui arrivait d'être défait, il déclarait : "J'ai été battu.
En 1653, il avait épousé la fille du duc de La Force, protestante comme lui, de laquelle il n'eut jamais d'enfants. Après la mort de sa femme en 1666, il se laisse convertir par les arguments de Bossuet et abjure en 1668."
Durant la guerre de Dévolution, il dirige l'armée française qui envahit la Flandre et s'empare de plusieurs villes.
En 1672, il est nommé capitaine général par Louis XIV. Durant la guerre de Hollande, battu par les Impériaux de Raimondo Montecuccoli, il est obligé de repasser le Rhin en 1673. Il prend sa revanche le 16 juin 1674, à la bataille de Sinsheim, où il empêche la jonction des deux armées ennemies. Un mois plus tard, il ordonne le ravage du Palatinat. Il vainc à nouveau les Impériaux en Alsace à la bataille d'Entzheim en octobre 1674, mais devant la disproportion des forces, il se replie sur Saverne et Haguenau, laissant les Allemands prendre leurs quartiers d’hiver en Alsace.
Contrairement à tous les usages militaires du temps, il n’hésite pas à attaquer en plein hiver, fond sur Belfort le 27 décembre 1674, entre dans Mulhouse le 29. Les impériaux sont basés à Turckheim, dans une vallée des Vosges côté alsacien. Sa stratégie consiste à surprendre l'ennemi en attaquant par la montagne.
Il monte au-dessus de la ville de Thann, passe à côté du château de l'Engelburg qui n'a pas encore été détruit par Louis XIV, et établit son camp à l'endroit encore dénommé aujourd'hui camp Turenne. Puis son armée longe la crête et, arrivée au-dessus du camp adverse le 5 janvier 1675, déboule dans la vallée et prend l'adversaire par surprise : il y a très peu de victimes et l'adversaire est mis en fuite.
La bataille de Turckheim est un modèle du genre :
Information plusieurs jours à l'avance sur la viabilité du terrain,
Préparation de la marche d'approche,
Surprise froid, arrivée par la montagne, etc.
Les Impériaux sont contraints de battre en retraite et de repasser le Rhin. Louis XIV donne de nouveau à Turenne le commandement de la campagne de 1675, où il se trouve de nouveau face à un vieil adversaire, Montecuccoli. Pendant deux mois, tous deux déploient leurs plus beaux dons de manœuvriers. Lors de la Bataille de Salzbach, enfin Turenne est sur le point d’amener son adversaire sur les positions qu’il juge souhaitables pour une bataille décisive, lorsqu'il est tué par un boulet de canon. Raimondo Montecuccoli se serait alors écrié :
" Il est mort aujourd'hui un homme qui faisait honneur à l'Homme !. Selon les mémorialistes du temps, la France entière le pleurera, et le peuple rassemblé sur les routes honora "le bon Monsieur de Turenne"" lors du passage du convoi funèbre vers Paris. Son oraison funèbre fut prononcée par Fléchier en l'église Saint-Eustache.
Tué ainsi au combat à 63 ans, il est resté jusqu'au bout un stratège remarquable et un guerrier intrépide. Cependant, à l'approche du danger, il ne pouvait réprimer un frissonnement de tout son corps.
On l'entendit encore à la fin de sa carrière, alors qu'il avait atteint les dignités les plus élevées, marmonner avec colère: « Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener. Une autre légende met une majuscule à "Carcasse" : c'était peut-être le nom de sa jument...
Postérité
Louis XIV accordera à Turenne l'honneur posthume d'être enseveli à la basilique Saint-Denis, avec les rois de France. Pendant la Révolution française, le samedi 12 octobre 1793, son tombeau fut ouvert par des ouvriers ayant reçu les ordres d'exhumation des corps des rois et reines, des princes et princesses et des hommes célèbres.
Le corps de Turenne fut trouvé dans un très bon état de conservation. Il fut exposé à la foule puis remis à un gardien de la basilique qui l'exposa plusieurs mois et, comme pour beaucoup de corps lors de la profanation des tombes de la basilique Saint-Denis, n'hésita pas à vendre ses dents au détail. Puis il fut transféré aux Jardin des plantes de Paris et le 22 messidor de l'an VII, mercredi 10 juillet 1799 son corps fut transporté dans le musée des monuments français où un tombeau lui était destiné.
Le cinquième jour complémentaire de l'an VIII 22 septembre 1800, Napoléon Bonaparte fit transférer sa dépouille à l'église Saint-Louis des Invalides, nécropole des gloires militaires de la France. Son cœur embaumé fut rendu au comte Bernard de la Tour d'Auvergne Lauraguais en 1814 et conservé longtemps dans un coffret de plomb, au château de Saint-Paulet.
Le boulet ayant tué Turenne est exposé au musée de l'Armée à Paris ainsi qu'au musée Turenne à Sasbach (Allemagne).
Napoléon Ier disait son admiration pour le génie militaire de Turenne, et affirmait qu'en toutes circonstances il aurait pris les mêmes décisions que lui.
Un timbre postal à l'effigie de Turenne a été émis le 13 juin 1960.
Le nom de Turenne a été donné à un cuirassé de croisière, 850 cv - 12 canons - portant pavillon de l'amiral Henri Rieunier dans l'escadre d'Amédée Courbet (lui étant à bord du Bayard, cuirassé de croisière, frère du Turenne.
Les Dragons de Noailles, chant militaire français, raconte le ravage du Palatinat en faisant mention de Turenne.
La société d'histoire et d'archéologie de Sedan a organisé les 17 et 18 septembre 2011, un colloque européen pour célébrer le 400e anniversaire de sa naissance.
A donné son nom à la 160° promotion de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 1973-1975
Iconographie
Une médaille à l'effigie de Turenne fut exécutée par le graveur Thomas Bernard en 1683. Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet..
Une autre médaille à l'effigie de Turenne, due au graveur Henri Auguste, fut frappée en 1800 à l'initiative de Lucien Bonaparte, à l'occasion du transfert des restes du maréchal aux Invalides. Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet.
Liens
http://youtu.be/l36lTMK44BM Turenne 1
http://youtu.be/_J9fuKZX5V0 Turenne 2
http://youtu.be/bgarWbI1H0g Turenne 3
http://youtu.be/S-QR2DFNYP0 Marche du régiment Turenne de Lully
http://youtu.be/S-QR2DFNYP0 Chant nationaliste "Monsieur Turenne" Paroles
[img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Henri_de_la_Tour_d'Auvergne,_Vicomte_de_Turenne_by_Circle_of_Philippe_de_Champaigne.jpg[/img]       [img width=600]http://www.artvalue.com/image.aspx?PHOTO_ID=1698616&width=500&height=500[/img]    [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Henri_de_la_Tour_d'Auvergne-Bouillon.jpg[/img]    
Posté le : 25/07/2014 14:33
Edité par Loriane sur 26-07-2014 23:28:32
Edité par Loriane sur 27-07-2014 10:50:07
|
|
|
|
|
Jacques Coeur |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Le 27 juillet 1447, Jacques Cœur est l’instigateur d’une ordonnance décidant
pour la première fois depuis 1370, la frappe de pièces d'argent
de bon aloi, à 92 % d’argent fin, qui vont être surnommées "Gros de Jacques Cœur". Celui-ci rachète les mines d'argent de la montagne de Pampailly, sur la commune de Brussieu, puis les développe. Jacques Cœur va ouvrir dans le Beaujolais et le Lyonnais des mines d'argent, de fer, de plomb, de cuivre. Il prend à ferme pour douze ans le droit que le roi levait sur toutes les mines. Il fonde une compagnie avec un maître mineur, un fondeur, un marchand de Beaujeu. Jacques Cœur a là une possibilité reconnue de se procurer du métal d'argent, alors que les ordonnances royales interdisent l'exportation des pièces monnayées. Désormais, où qu'il rafle des pièces d'argent, il pourra prétendre, en les embarquant pour le Levant, fondues en lingots, avoir extrait cet argent de ses mines.
Jacques Cœur et le roi Charles VII sont très proches. Quand celui-ci lui expose son désir de reconquérir la Normandie sur les Anglais, Jacques Cœur avance aussitôt deux cent mille écus. Le 6 août 1449, la guerre contre l’Angleterre reprend. Dunois et le duc de Bretagne conduisent l’opération.
Aussi, lors de l'entrée du roi à Rouen, le lundi 27 juillet 1447, l'argentier a une place d’honneur dans le cortège, marchant à côté de Dunois et vêtu comme lui. Il est devant les plus hauts membres de la noblesse et du clergé. Ces derniers ne protestent pas, car ils sont les obligés de Jacques Cœur. Ils ont tous recours à la bourse de l'argentier.
Jacques Cuer ou Cueur, devenu Jacques Cœur naît entre 1395/1400 à Bourges, il décéde à Île de chios, le 25 novembre 1456 âgé d'environ 56 ans, île de Chios , il est marchand Marchand, Négociant, Banquier, Armateur français, devenu négociant-banquier et armateur, il sera maître des monnaies en 1436, argentier en 1439, membre du Conseil du Roi en 1442, visiteur général des gabelles pour le Languedoc en 1447, puis diplomate, seigneur amiral en 1456. Il fut anobli et il fit construire le palais Jacques-coeur à Bourges.Il fut l'un des premiers Français à établir et entretenir des relations commerciales suivies avec les pays du Levant. Ayant réussi à s'introduire auprès du roi, il est nommé à la tête de la grande argenterie du roi de France par Charles VII en 1436. Il se lance dans de nombreuses entreprises commerciales et industrielles, et amasse une fortune considérable qui lui permet d'aider Charles VII, à l'époque le petit Roi de Bourges, à reconquérir son territoire occupé par les Anglais. Mais sa réussite éclatante l'amène à la disgrâce : en invoquant diverses accusations, ses rivaux et ses nombreux débiteurs, dont le roi, réussissent à provoquer sa chute en 1451. Emprisonné, il s'évade en 1454 et meurt en exil.
Sa vie
Jacques Cœur est né à Bourges, vers la fin du quatorzième siècle, peut-être en 1395 ou bien encore en 1400. La date diffère selon les historiens. Il n’est pas né dans le Bourbonnais, c’est son père qui est venu de cette province une dizaine d’années plus tôt et surtout pas à Pézenas, ville où par contre il habitera réellement pendant un temps. Pierre Cœur, son père né à Saint-Pourçain-sur-Sioule, et décédé à Bourges en 1435, est maître fourreur et le marchand pelletier le plus riche de son temps, suivant d’anciens auteurs. L’opulence de la cour du duc Jean Ier de Berry permet un très bon débit de pelleteries. Bourges est alors une ville importante dans laquelle le commerce est florissant. Pierre Cœur épouse Marie Lambert, veuve d'un boucher, Jean Bacquelier, qui donne naissance à un second fils vers 1403, Nicolas Cœur.
L’enfance de Jacques Cœur ne paraît pas avoir été studieuse, au dire d'un contemporain, qui le représente comme étant sans éducation. Mais en revanche, il est de bonne heure initié par son père à la vie pratique des affaires, et ses qualités personnelles suppléent à son défaut d'instruction.
Jacques Cœur a 15 ans lorsque se déroule une des plus cuisantes défaites de l’armée française à la bataille d’Azincourt, une partie importante de l’aristocratie est décimée et une part essentielle de la France passe sous la coupe des Anglais. Trois ans plus tard, le dauphin, futur Charles VII quitte précipitamment Paris, chassé par Jean sans Peur et se réfugie dans le Berry, devenant le petit roi de Bourges, titre donné par dérision. La présence du dauphin et de la cour va stimuler la ville sur le plan des échanges et du commerce.
Jean Bochetel, secrétaire de Charles VII, arrière-grand-père de Guillaume Bochetel, épouse l’une de ses sœurs. Son frère, Nicolas Cœur, est évêque de Luçon 1441-1451, et un autre frère, le père de Perrette qui épouse Jean de Village, chambellan du duc de Calabre. Ce maître des galères de Jacques Cœur lui reste fidèle et le libère de son incarcération à Beaucaire. Il participe à la conquête de Naples.
Très jeune, Jacques Cœur gère l'un des douze bureaux de change de la ville. Considéré comme un homme des plus industrieux et des plus ingénieux, il se marie en 1420, ou 1418, avec Macée de Léodepart, fille d'un ancien valet de chambre du duc Jean Ier de Berry, Lambert de Léodepart, devenu prévôt de Bourges. La belle-mère de Jacques Cœur, Jeanne Roussart, est la fille d'un maître des monnaies de Bourges, et son mariage contribua à l’origine de sa carrière au service du roi de France.
En effet, en 1427, associé avec Pierre Godart, changeur, il afferme la monnaie de Bourges, et fabrique au nom de Ravau le Danois, maître titulaire de ladite monnaie. Deux ans après, il est accusé d'avoir fait affiner trois cents marcs d'argent au-dessous du titre légal, ce qui lui aurait procuré un bénéfice de six à sept vingt écus. Ravau le Danois sollicite en 1429 des lettres de rémission pour ce fait, et le roi les accorde le 6 décembre 1429, après la levée du siège d'Orléans avec Jeanne d'Arc et le sacre de Charles VII moyennant une amende de 1 000 écus d'or. Cœur est gracié moyennant une légère amende. D’autres ont été ou seront envoyés dans une basse fosse ou sur une galère pour le même délit.
Son ascension sociale : négociant, banquier, armateur, etc.
Jacques Cœur dirige ses vues vers le négoce international et forme une société avec les frères Barthomié et Pierre Godart. Cette association dure jusqu'à la mort des deux Godart, en 1439. Il conçoit un plan grandiose, plein d'audace, et d'une exécution difficile, mais qui doit lui apporter gloire et profit. Il ne s'agit de rien moins que de se porter rival des Vénitiens, des Pisans et des Génois pour le commerce du Levant. Afin de poser les bases de ses relations futures avec les nations orientales, Jacques Cœur favorise les opérations économiques non plus par le troc mais par du numéraire en exploitant notamment des mines d'argent, de cuivre et de plomb dans le Lyonnais et le Beaujolais, fait copier les navires génois et se rend en Égypte et en Syrie dans le courant de l'année 1432. Un écuyer de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dans le récit d'un pèlerinage qu'il fait à cette époque, dit l’avoir rencontré à Damas. Il se rend ensuite à Beyrouth, et s'y embarque sur une galère de Narbonne. De retour en France, Jacques Cœur établit des comptoirs à Montpellier, qui jouissent de privilèges spéciaux suppression de péages pour commercer avec les infidèles.
Le début de ses opérations est presque instantanément couronné de succès. L'incompréhension et la jalousie de ses contemporains face à cette ascension fulgurante donne naissance à des légendes sur sa prétendue découverte du secret de la pierre philosophale grâce à sa rencontre avec le fameux alchimiste Raimond Lulle, mort 120 ans plus tôt en 1316. Ainsi Pierre Borel, dans Recherches et antiquités gauloises et françaises en 1655 écrira très sérieusement que le père de Jacques Cœur était si pauvre qu'il n'avait pas de quoi louer boutique, mais qu'ayant fait la connaissance de Raimond Lulle, majorquin, celui-ci lui communiqua le secret pour faire de l'or, secret qu'il transmit à son fils, qui feignant d’avoir beaucoup gagné dans le commerce, couvrit, par ce moyen, l'origine de sa richesse .
En réalité, Jacques a plus de douze navires sillonnant la Méditerranée en tous sens, et à lui seul, dit le chroniqueur Matthieu de Coucy, il gagne chacun plus que l’ensemble de tous les autres marchands du royaume. Ses agents sont répandus au nombre de trois cents dans tous les ports et dans les villes principales de l'intérieur. Au surplus, il met une grande loyauté et une extrême bonne foi dans ses transactionsnon neutre ; et des témoignages de générosité habilement répandus auprès des princes d'Orient lui donnent autorité et un grand crédit auprès d'eux. Il reçoit le monopole d’importation des épices et du transport des marchandises françaises vers les ports musulmans.
Jacques Cœur transporte aussi, illégalement, car l'exportation de l'or et de l'argent est interdit, des monnaies françaises toujours fort recherchées dans les échelles du Levant.Cela lui sera reproché lors de son procès.
En 1432, de retour de Damas, Jacques Cœur débarque dans un Languedoc ravagé par la peste. Il vient de jeter les bases du commerce avec le Levant : bientôt sa flotte desservira toute la Méditerranée. Pour centre de ses affaires, il choisit Montpellier, attiré par le rayonnement culturel de la cité et par ses liens avec les pays arabes. Entre ses mains s’amasse une prodigieuse fortune : il achète de splendides hôtels, une trentaine de seigneuries, et prête de l’argent au roi lui-même.
Pour mener sa politique commerciale méditerranéenne, Jacques Cœur s'appuie sur Aigues-Mortes, Montpellier et Marseille. Il installe un chantier naval à Aigues-Mortes où il fera venir par flottage sur le Rhône des troncs de résineux de Savoie, étrangère à la France à l'époque, organise ses propres écuries pour le transport de ses marchandises. Au XVe siècle, Montpellier se redresse économiquement grâce à l'activité du port voisin de Lattes et au génie mercantile de Jacques Cœur. Ce dernier crée une factorerie à Pézenas réputée pour son activité de négoce.
Au service du roi 1439-1440
Son mariage avec la petite-fille du maître de la monnaie de Bourges l’a introduit à la cour du futur Charles VII, et il a attiré son attention. Malgré les abus qui lui sont reprochés, on le retrouve maître des monnaies à Bourges en 1435. L'année suivante, après la reddition de Paris, l'hôtel des monnaies de cette ville lui est également confié, et il y fait fabriquer les écus d'or à la couronne, dont la valeur réelle ne tarde pas à concurrencer les monnaies anglaises. Charles VII croit pouvoir demander plus encore à l'activité du maître des monnaies : il rétablit la charge d'argentier, et la lui confère. Le 2 février 1439, Jacques Cœur est nommé par Charles VII à la tête de l'Argenterie du royaume de France. Cette charge consiste à recevoir tous les ans des trésoriers généraux une certaine somme affectée aux dépenses de la maison du roi, et dont il devait faire connaître l'emploi à la chambre des comptes. Entre les mains de Jacques Cœur ces fonctions prennent un caractère d'une utilité beaucoup plus générale. En régularisant l'emploi des finances du roi, livrées au désordre, et en créant des ressources nouvelles, il contribue puissamment à fournir les moyens dont Charles VII a besoin pour délivrer la France du joug anglais. Jacques Cœur institue progressivement la taille et le fouage, impôts directs, les aides et la gabelle, impôts indirects. La levée de ces impôts entraîne la création de nouvelles institutions.
Écu d'or à la couronne du règne de Charles VII
Cet homme intelligent, dit Jules Michelet, rétablit les monnaies, invente en finances la chose inouïe, la justice, et croit que pour le roi, comme pour tout le monde, le moyen d'être riche, est de payer. Il comprend les bienfaits de la statistique pour établir l'assiette de l'impôt et l'évaluation des ressources, et présente au roi un dénombrement sommaire de la population et du revenu du royaume ; de plus, des instructions pour policer la Maison du roi, le Royaume de France. Ces services signalés méritent un témoignage de reconnaissance.
Au mois d'avril 1441, Charles VII accorde à son argentier des lettres d'anoblissement pour lui, sa femme et ses descendants. Le marchand est devenu homme d'État, le roturier devient noble, et prend armoiries : D'azur à la fasce d'or, chargées de trois coquilles de sable, allusion à saint Jacques, et accompagnées de trois cœurs de gueules, avec cette devise : A vaillans cuers riens impossible.
Conseiller, marchand et pourvoyeur de monnaies
Tout en administrant les monnaies et les finances du roi, Jacques Cœur dirige son commerce avec les ports du Levant et de l’Italie. Il exporte draps, fers, toiles, vins et cuivre, et importe soieries, draps d’or, fourrures, maroquins, tapis et pierres précieuses. Il jouit de la plus haute position de considération et de fortune qu’un homme peut envier à son époque.
En 1442, il devient le conseiller du roi de France. Le 25 septembre 1443, la Grande Ordonnance de Saumur, promulguée à l’instigation de Jacques Cœur, fait que les finances de l’État vont être assainies. Le conseil du roi de 1444, dirigé par Dunois, est composé presque exclusivement de roturiers, Jacques Cœur, Jean Bureau, Étienne Chevalier, Guillaume Cousinot, Jouvenel des Ursins, Guillaume d'Estouteville, Tancarville, Blainville, Beauvau et le maréchal Machet. La France se relève et connaît la prospérité.
Charles VII lui donne de nombreuses marques de confiance. Il lui confie plusieurs missions diplomatiques. En 1444, il le charge, avec l'archevêque de Toulouse, de procéder à l'installation du nouveau parlement du Languedoc. La même année, en septembre, Jacques Cœur figure au nombre des commissaires chargés de présider, au nom du roi, les États généraux de cette province. Il remplit chaque année ces fonctions jusqu'à sa disgrâce.
Ces États de Languedoc votent à diverses reprises des sommes importantes pour Jacques Cœur, en témoignage de reconnaissance pour les services qu'il rend au pays.
En 1446, l'argentier est chargé d'une mission à Gênes, où s'est formé un parti qui demandait la réunion de la ville à la France. L'année suivante, il est envoyé à Rome, à l'occasion du schisme que menace d'introduire dans l'Église l'élection par le concile de Bâle d'Amédée de Savoie, contre Eugène IV, candidat de la France. Dans toutes ces missions, il fait preuve de grande habileté.
Possessions
Jacques Cœur est le propriétaire de biens immobiliers considérables, de terres et de maisons dans toutes les provinces. Les seigneurs ruinés par les guerres ou leurs veuves lui vendent leurs patrimoines. Les seigneuries et châtellenies passent entre ses mains. Il en a plus de vingt, comprenant quarante paroisses. Ses multiples habitations se trouvent dans plusieurs villes : Deux à Paris, où il fonde et fait d’importants dons au collège des Bons-Enfants, de l'ancienne université de Paris. À Montpellier, il a deux hôtels, dont l'un construit à l'italienne, est recouvert d'une terrasse d'où l'on aperçoit la mer, et d'où Jacques peut signaler l'arrivée de ses navires. À Lyon, Marseille, Béziers, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Sancerre, Cézy ; mais la plus remarquable de toutes, qui reste attachée à sa mémoire, est le palais Jacques-Cœur à Bourges9.
En 1450, la terre de Saint-Fargeau est vendue à Jacques Cœur et c'est à cette occasion, que Georges II de La Trémoille fils du sire de la Trémoille, désireux de rester propriétaire de Saint-Fargeau, garde un tenace ressentiment envers le nouveau propriétaire. Au xve siècle, faute d'entretien et du fait des pillages, le château d'Augerville devient une ruine que rachète Jacques Cœur qui, en tant que grand argentier du roi Charles VII, a coutume de racheter les fiefs abandonnés après la guerre de Cent Ans pour les remembrer à sa guise. L'achat du château d'Augerville par Jacques Cœur en 1452 correspond à l'apogée du ministre, mais il n'aura pas le temps d'y séjourner.
Palais Jacques-Cœur
Jacques Cœur fait construire un fastueux palais à Bourges. Il est bâti entre les années 1443 et 1453, et sa construction coûte la somme de cent mille écus d'or. C'est un chef-d’œuvre de l’architecture gothique tardive. Cet édifice naît de la volonté de Jacques Cœur de bâtir une grant’maison dans sa ville natale. Toutefois, l’argentier de Charles VII n’y habite pas. Lorsque Jacques Cœur est arrêté, le palais est alors confisqué avec tout son mobilier par la couronne.
La mort d'Agnès Sorel
En cette année 1444, le roi offre à Agnès Sorel vingt mille six cents écus de bijoux dont le premier diamant taillé connu à ce jour. Pour se procurer ces atours précieux, elle devient la meilleure cliente de Jacques Cœur, marchand international et grand argentier du roi, qui a amassé des trésors venus d’Orient dans son palais de Bourges. Elle consomme de grandes quantités d'étoffes précieuses et, bien sûr, toutes les femmes de la cour l’imitent.
Une amitié va les lier, elle protège Jacques Cœur, et cela lui permettra de monter dans l'honorabilité et favorise son commerce. Il est l’un de ses trois exécuteurs testamentaires avec Étienne Chevalier et le médecin d'Agnès. Certains auteurs ou romanciers feront d'une liaison entre Jacques Cœur et Agnès Sorel la clé des malheurs du grand argentier.
Elle meurt officiellement d'une infection puerpérale à l’âge de vingt-huit ans au Mesnil-sous-Jumièges, le 9 février 1450. Son enfant meurt quelques semaines après elle. Sa mort est si rapide qu’on croit tout d’abord à un empoisonnement. Des études réalisées au début des années 2000 ont d'ailleurs montré qu'elle était décédée d'un empoisonnement au mercure sans que l'on sache s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un accident thérapeutique, le mercure étant employé à l'époque comme traitement vermifuge. Deux de ses débiteurs Jeanne de Vendôme, épouse de François de Montberon et un Italien Jacques Colonna accusent même Jacques Cœur, qui avait été désigné comme son exécuteur testamentaire, de l’avoir fait assassiner, mais il est lavé de ce chef d’inculpation. Les soupçons se portèrent alors, jusqu'au XXIe siècle, sur le dauphin, le futur Louis XI, ennemi du parti qu’elle soutient.
Jacques Cœur étant très jalousé pour sa grande fortune, ses ennemis et ses envieux parviennent à le perdre. Après la mort d'Agnès Sorel qui le protégeait, Charles oublie ses services et l'abandonne à l'avidité des courtisans, qui se partagent ses dépouilles. Accusé de crimes imaginaires, il est arrêté pour malversation en 1451.
Disgrâce et procès
Le 31 juillet 1451, après avoir entendu le Grand Conseil au château de Taillebourg près de Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime, le roi Charles VII décide d'imputer à Jacques Cœur, en sa présence, le crime de lèse-majesté, ce qui a pour conséquence son arrestation immédiate, son emprisonnement, et la mise sous séquestres de ses biens. Antoine de Chabannes participe au procès de Jacques Cœur, partie par devoir, partie par jalousie, et bénéficie largement du dépeçage de ses biens, se voyant octroyer en fief une bonne partie de la Puisaye, et le château de Saint-Fargeau.
Le roi prend aussitôt cent mille écus pour la guerre de Guyenne. Le Florentin Otto Castellain obtient les fonctions d'argentier. Il y a trop de gens intéressés à ne pas laisser déclarer innocent un homme dont ils ont déjà en partie partagé les biens : ceux à qui il a prêté de l'argent sans intérêt, et dont la liste est longue, Antoine de Chabannes, Antoinette de Maignelais, Guillaume Gouffier, se trouvent tout d'un coup quittes de leurs dettes par la condamnation de leur bienfaiteur. Ainsi il ne faut pas s'étonner s'il s'élève contre lui tant d'ennemis qui lui cherchent des crimes pour le rendre coupable. Ils obtiennent donc du roi une autre commission pour faire informer sur de nouvelles accusations : les principales sont qu'il avait fait sortir du royaume de l'argent et du cuivre en grande quantité ; qu'il avait renvoyé à Alexandrie un esclave chrétien qui s'était réfugié en France, et avait abjuré le christianisme depuis son retour en Égypte ; qu'il avait contrefait le petit sceau du secret du roi et ruiné le pays de Languedoc par des exactions sans nombre, par d'affreuses concussions colorées de différents prétextes propres à faire retomber sur le prince tout le mécontentement des peuples. On l'accuse enfin d'avoir, sans l'autorisation écrite du roi et du pape, transporté chez les Sarrasins une grande quantité d'armes qui n'avait pas peu contribué au gain d'une victoire remportée par ces infidèles sur les chrétiens.
Jacques Cœur face à la justice fait amende honorable.
Le 14 juin 1452, une réunion générale se tient au château de Chissay, à proximité de Tours, pour faire le point sur l'affaire Jacques Cœur, savoir s'il convient de poursuivre l'instruction et de lever le secret. À tout il répond avec simplicité et précision. Il explique et justifie tout, protestant qu'il avait servi constamment le roi sans lui avoir fait aucune faute d'avoir pris larcineusemeut aucun de ses deniers. On lui demande ses preuves, et on le met dans l'impossibilité de les fournir. On éloigne de lui tous ceux qui peuvent lui être utiles, et on n'accueille que les dépositions de ses ennemis, à savoir 150 témoins à charge. Ses enfants se battent pour le défendre, mais n'obtiennent rien. L'évêque de Poitiers, Jacques Jouvenel des Ursins, et l'archevêque de Bourges réclament l'argentier, comme clerc tonsuré, au nom de la juridiction ecclésiastique. Le pape lui-même écrit à Charles VII en faveur de l'argentier, et envoie un ambassadeur ; tout est sans effet. Le procès traîne en longueur, pendant que le prisonnier est conduit de château en château, de château de Taillebourg au château de Lusignan, de Lusignan à Maillé, puis à Tours et à Poitiers.
La commission dont Castellain fait partie décide de faire donner la question à Jacques Cœur. Il renonce à son appel à la juridiction ecclésiastique, et s'en rapporte au témoignage de qui l'on veut. C'est au milieu de ces tortures, il subit le supplice des brodequins à Poitiers en mars 1453 qu'il apprend que sa femme vient de mourir de chagrin à Bourges.
Le 29 mai 1453, Jacques Cœur est reconnu coupable des crimes de lèse-majesté, de concussion et d'exactions Il est condamné à la saisie de ses biens, au paiement d'une amende de trois cent mille écus, au remboursement de cent mille écus au Trésor royal. Sa condamnation à mort est commuée en bannissement perpétuel pour service rendu à la couronne. Il doit rester en prison jusqu'au paiement de l'amende et ensuite être banni hors du royaume. Sur l'accusation d'empoisonnement d'Agnès Sorel, l'arrêt décide de suspendre la procédure. Quant aux créances des tiers sur les biens, on refuse, par ordre du roi, d'en reconnaître aucune.
Jacques Cœur reçoit, le 2 juin 1453, à Poitiers, commandement de payer la somme de quatre cent mille écus. Trois jours après un échafaud est dressé sur la grande place de cette ville, et en présence d'une foule immense, Jacques à genoux, sans ceinture ni chaperon, une torche de cire au poing, doit faire amende honorable. Tout ce que la reconnaissance peut inspirer à Charles VII est d'accorder cinq cents livres aux enfants de l'argentier.
Évasion et fin de vie
En octobre 1454, il réussit à s'échapper du château de Poitiers, alors qu'il était sous la garde de Chabannes. Il se réfugie d'abord à Limoges, puis, en février 1455, il est à Beaucaire chez les frères franciscains. Accompagné de son fils et avec l'aide de son neveu Jean Village, il gagne la Provence, puis rejoint Rome.
Le pape Nicolas V, qui apprécie beaucoup Jacques Cœur depuis le voyage diplomatique que celui-ci a fait Rome en 1447, veut qu'il demeure en son propre palais, et le fait soigner par ses médecins. Miné par la maladie qu'il contracta à la suite des mauvais traitements endurés, Jacques Cœur passe l'année 1455 à Rome, à recueillir les débris de sa fortune, car tout n'était pas en France : nombre de galères se trouvaient en mer pendant son procès, et il a des biens qui sont entre les mains de ses correspondants d'Italie et du Levant. De plus, il reçoit des bénéfices qui ont pu être mis à l'abri par certains agents demeurés fidèles.
Jacques Cœur prépare pour le nouveau pape Calixte III une expédition sur l'île génoise de Chios qui est menacée par les Ottomans, alors maîtres depuis peu de Constantinople. Il devient le conseiller et le financier de l’expédition. Il a le titre de capitaine général de l'Église et commande la flotte sous la direction du patriarche d'Aquilée. Il embarque en 1456. L'expédition passe par Rhodes, puis aborde à Chios. Pendant son séjour dans cette île, le capitaine général est blessé (version romantique : lésion traumatique par un boulet de canon lors du siège de Chios par les Turcs ou tombe malade, version plus probable d'une maladie infectieuse type dysenterie, et meurt le 25 novembre 1456. Il est enseveli au milieu du chœur de l'église des Cordeliers de la ville de Chios, église qui sera, par la suite, détruite par les musulmans.
L'obituaire de Saint-Étienne de Bourges lui donne le titre de capitaine-général de l'Église contre les infidèles, et Charles VII, auquel il recommande ses enfants en mourant, déclare dans des lettres du 5 août 1457, que Jacques Cœur étoit mort en exposant sa personne à l'encontre des ennemis de la foi catholique.
Famille et descendance
Charles VII, par lettres patentes datées du 5 août 1457, restitue à Ravant et à Geoffroy Cœur une faible partie des biens de leur père. Sous Louis XI, Geoffroy, qui est maître d'hôtel de ce roi, obtient la réhabilitation de la mémoire de son père et des lettres de restitution plus complètes. Mais les contestations qui s'élèvent à ce sujet entre la famille Cœur et le comte Antoine de Chabannes ne prendront fin que sous Charles VIII, au moyen d'une transaction entre Isabelle Bureau, la veuve de Geoffroy, et le fils d’Antoine de Chabannes.
Après 10 ans de séquestre, en 1463, son fils Geoffroy loue une partie du fief, privé qu'il est de l'héritage paternel. Geoffroy Cœur est mort en 1488, léguant le château d'Augerville à son fils Jacques II Cœur, qui ayant accès à l'héritage de son grand-père, dilapide sa fortune. Quand il meurt en 1505 sans descendance, la lignée directe des Cœur s'éteint avec lui. Néanmoins, sa sœur Marie Cœur hérite du château d'Augerville grâce à la création d'un marché et de deux foires à Augerville-la-Rivière par le roi Louis XII, dès 1508.
Jacques Cœur ne néglige aucune occasion d'établir sa famille dans des postes importants, et d'ajouter à sa puissance personnelle celle que donnent des alliances considérables. Nicolas Cœur, son frère, est chanoine de la Sainte-Chapelle à Bourges ; déjà, en 1441, Jacques Cœur l'avait fait nommer évêque de Luçon. Jacques Cœur a aussi une nièce et une sœur : la première, Perrette, est mariée à Jean de Village, qu'il avait associé à son commerce, et qui était chargé de la direction de ses affaires à Marseille; l'autre épouse Jean Bochetel, secrétaire du roi, dont quelques descendants seront secrétaires d'État et ambassadeurs. L'argentier a cinq enfants avec Macée de Léodepart, quatre fils et une fille :
Jean Cœur 1421-1483, même avant d'avoir atteint l'âge canonique, est élu par le chapitre pour succéder à l'archevêque de Bourges Henry d'Avangour 1421-1446, à l’âge de 25 ans. Cependant, son élection, bien que fortement appuyée par Charles VII, n’est approuvée que quatre ans plus tard par le Saint-Siège. Après la disgrâce de son père, il ne cessera de solliciter sa réhabilitation et la restitution de ses biens ;
Henri Cœur 1429-14? chanoine de la Sainte Chapelle de Bourges. Après la mort de son père, il obtient du pape l'autorisation de ramener son corps en France. Jean d'Auton, historien de Louis XII, et qui a vécu avec les enfants de Jacques Cœur, dit qu’il y est enterré dans l'église des Cordeliers ;
Ravant Cœur ;
Perrette Cœur, mariée en juin 1447 avec Jacques Trousseau, écuyer, seigneur de Saint-Palais et Marville, fils d’Arthaud Trousseau, vicomte de Bourges, propriétaire du château de Bois-Sire-Amé, lieu de résidence de Charles VII et d'Agnès Sorel. Ce château, qui est en très mauvais état, est réparé par l'argentier sur son argent propre ;
Geoffroy Cœur, seigneur de La Chaussée, échanson de Louis XI, décédé le 11 octobre 1488, marié le 29 août 1463 avec Isabelle Bureau, fille de Jean Bureau, baron de Monglat, prévôt des marchands de Paris 1450-1452, maître de l'artillerie sous Charles VII, maire perpétuel de Bordeaux, gouverneur du château Trompette. Antoine de Chabannes fait Geoffroy Cœur prisonnier ;
Geoffrette Cœur, mariée avec Jean de Cambrai, seigneur de La Tour de Clamecy, panetier de Charles VII.
Ses descendants ne sont pas restés gens d'affaires car ils sont tous désormais soit seigneurs, soit membres de l’Église. Après la mort de Jacques Cœur aucun homme d’affaires n’a la puissance politique des maîtres de Lisbonne ou d’Amsterdam. Toutefois la Provence, qui échoit au Royaume de France, va permettre à ce dernier, grâce à la bourgeoisie de Marseille, de refonder sa fortune méditerranéenne.
Une légende dans le Berry raconte que Jacques Cœur n'est pas mort à Chios où il a rencontré une femme, dame Théodora, et qu'il a refait sa vie avec elle dans l'île de Chypre, acquérant une nouvelle fortune, se mariant avec elle qui lui donne deux filles.
Hommage et postérité
Honoré de Balzac lui rend hommage dans Splendeurs et misères des courtisanes, 1844, comme un négociant exemplaire, en opposition aux financiers et banquiers dont les faillites frauduleuse nuisent à l'économie :
"Les fortunes colossales des Jacques Cœur, des Médicis, des Ango de Dieppe, des Aufrédy de La Rochelle, des Fugger, furent jadis loyalement conquises … ; mais aujourd'hui, … la concurrence a si bien limité les profits, que toute fortune rapidement faite est : ou l'effet d'un hasard et d'une découverte, ou le résultat d'un vol légal."
Il est aussi le sujet principal du billet de la Banque de France de 50 francs type 1941.
Il est le personnage central et narrateur du roman Le Grand Cœur de Jean-Christophe Rufin, publié en 2012 chez Gallimard.
Liens
http://youtu.be/vbRff8PwLhQ La route Jacque Coeur
http://youtu.be/cmYvkW23sLA Visite du palais
http://youtu.be/hqXZ6bfTIeM Visite insolite du palais Jacques Coeur
  [img width=600]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfEV7puYHYldE8yrJ2yyL8I0sNYJ1wdmSQ5Ex99WXUhW8y8m-Th7nRzJmlUg[/img]  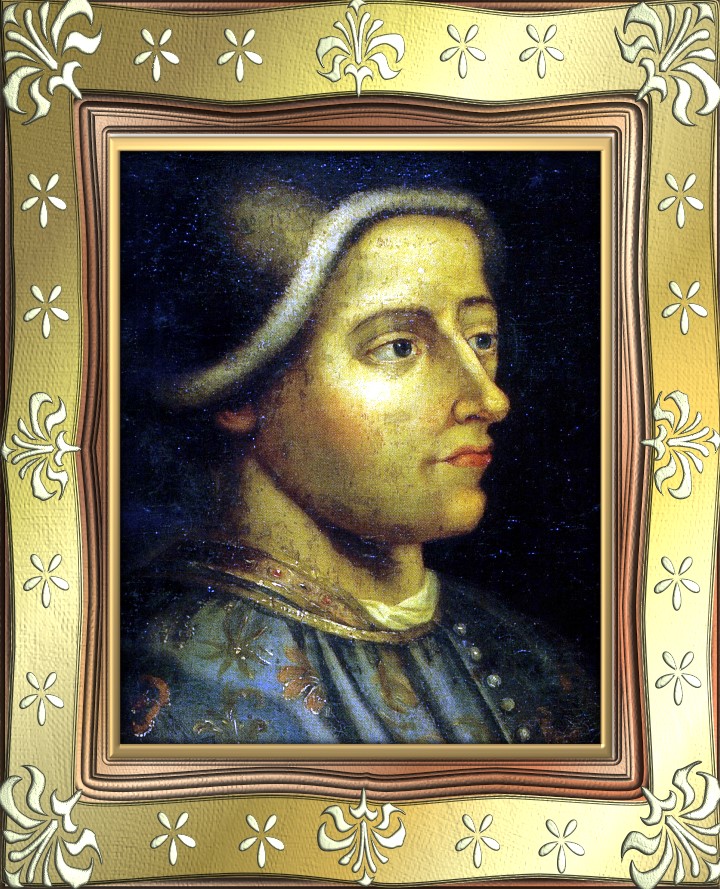  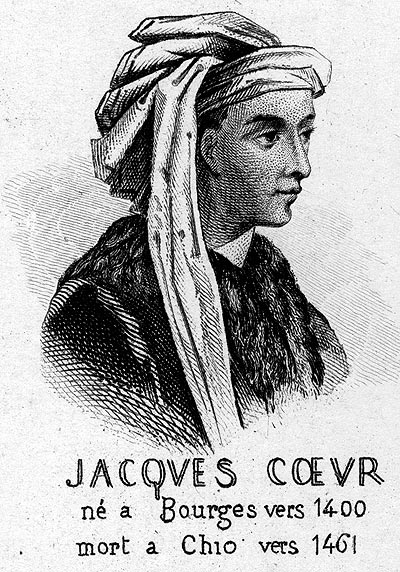              [img width=600]http://www.jacques-coeur-bourges.com/Tr%E9sor_OR/1_tr%E9sor_jacques_coeur%20(31)%20(500x375)_1.jpg[/img] 
Posté le : 25/07/2014 13:00
Edité par Loriane sur 26-07-2014 22:57:29
Edité par Loriane sur 27-07-2014 10:35:48
|
|
|
|
|
Acadie 1 Début |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Le 27 Juillet 1605 Port-Royal en Acadie,Canada, est fondée
par Pierre dugua de Mons. Forteresse de 2, 04 Km2 elle fut peuplée de 1750 habitants et fut la capitale de l'Acadie jusqu'en 1710 quand, après sa capture par les Anglais, elle fut renommée Annapolis Royal. Port Royal devient l'endroit le plus peuplé de l'Acadie durant les premiers cent ans de son existence. Port-Royal fut victime de la lutte pour le contrôle de l'Amérique du Nord. Elle changea souvent de souverains jusqu'en 1710 où elle devient britannique. La population fut déportée par les Britanniques à l'automne 1755.
Port-Royal en 1753.
Avec l’habitation de Port-Royal, cette région se trouve être la colonie européenne la plus ancienne au nord de Saint Augustine en Floride. Cette colonie a été fondée par Samuel de Champlain et Pierre Dugua de Mons en 1605.
Pierre Dugua de Mons explore les environs en 1604 mais fonde la première colonie de l'Acadie à l'île Sainte-Croix. Suite à l'échec de la colonie, Pierre Dugua de Mons fonde, construit l'Habitation de Port-Royal en 1605.
Durant de très longues années, cette colonie française fera l'objet d'attaques incessantes de la part des anglais et Port Royal sera tour à tour aglais, français puis ... La prelière attaque eut lei en 1613, Samuel Argall, venant de Virginie, attaque et détruit Port-Royal. En 1621, le roi Jacques Ier d'Angleterre accorde l'Acadie, qu'il renomme Nouvelle-Écosse, à William Alexander. En 1622, ce dernier envoie un bateau et quelques colons pour construire le fort Anne. L'Acadie un moment anglaise retourne à la France en 1629. Charles de Menou d'Aulnay déplace des colons de La Hève vers Port-Royal entre 1632 et 1634. En 1654, Sedgwick prend Port-Royal mais elle est reprise par la France en 1667. Port-Royal est à nouveau prise par les anglais en 1680 mais redevient française, probablement au cours de la même année. William Phips attaque et reprend Port-Royal en 1690 mais elle est rendue aux Français peu après. Les Acadiens reconstruirent le fort en 1702 en carré fait de terre avec quatre bastions. Le fort demeure encore intact aujourd'hui. Le fort a résisté aux assauts des Anglais en 1704 et aux mois de juin et juillet 1707, lorsque le Massachusetts tente de s'en emparer, mais sans succès. Le magasin du fort fut construit en 1708. mais de nouveau les anglais attaque et Francis Nicholson parvient à prendre la ville et le fort en octobre 1710 durant le Siège de Port-Royal et il renomme Port-Royal, Annapolis Royal. En 1711, un détachement parti du fort Anne se fait prendre en embuscade durant la bataille de Bloody Creek, faisant 30 morts. Un groupe d'Amérindiens mené par le prêtre Le Loutre attaque Annapolis Royal en 1744. Halifax remplace Annapolis Royal à titre de capitale provinciale en 1749. En 1755, environ 1 750 Acadiens des environs sont déportés par les Britanniques, alors que leurs maisons et fermes sont incendiées.
Démographie
Dessin militaire de Port-Royal et de son fort en 1702
Population de Port-Royal
Année Nombre d'habitants
1605 44
1630 300
1671 363
1686 592
1693 499
1698 575
1701 456
1703 504
1707 570
1714 900
1730 900
1737 1 406
1748 1 750
Acadie
L’Acadie est généralement considérée comme une région nord-américaine comptant environ 500 000 habitants, majoritairement des Acadiens francophones. L'Acadie située sur le territoire du Canada actuel, comprendrait ainsi grosso modo le nord et l'est de la province canadienne du Nouveau-Brunswick ainsi que des localités plus isolées à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. La communauté de Terre-Neuve-et-Labrador est de plus en plus incluse dans cette définition.
D'autres définitions, faisant presque toutes allusion à un territoire, comprennent en général la Louisiane – les Cadiens – et la plupart du temps les autres localités de la diaspora acadienne, notamment au Québec et au Maine. La question des frontières de l'Acadie est donc fondamentale mais seules celles de la Louisiane sont reconnues. En fait, selon un certain point de vue, l'Acadie serait donc une nation sans reconnaissance explicite.
L'Acadie historique, colonie de la Nouvelle-France, est fondée en 1604 – sur des territoires amérindiens habités depuis 11 millénaires – et peuplée à partir de l'Ouest de la France. Conquise en 1713 par le Royaume de Grande-Bretagne, elle subit le Grand Dérangement c'est à dire la Déportation des Acadiens de 1755 à 1763, son territoire est morcelé. De retour d'exil, les Acadiens subissent des lois discriminatoires. La renaissance acadienne, dans laquelle est impliquée le clergé, leur permet toutefois de redécouvrir leur histoire et leur culture. Ils acceptent mal la Confédération canadienne de 1867. Des symboles et des institutions sont créées dès la 1re Convention nationale acadienne de 1881. Les Acadiens sont durement touchés par la Grande Dépression et s'opposent à la conscription mais participent activement aux deux guerres mondiales. La communauté néo-brunswikoise fait figure de chef de file et la seconde moitié du XXe siècle est une période contestataire, marquée par le gain de plusieurs droits et libertés.
L'exode rural et l'anglicisation influencent toujours la démographie de l'Acadie. Le rejet de l'assimilation a d'ailleurs un impact important sur la politique acadienne. L'Acadie n'a toutefois pas d'organisation politique propre, excepté au niveau local et dans certains domaines comme la santé et l'éducation, tandis que la Société nationale de l'Acadie en est la représentante officielle. L'économie de l'Acadie ne repose plus uniquement sur des activités traditionnelles comme la pêche et est en croissance depuis la fin du XXe siècle. La culture de l'Acadie, fruit d'une longue tradition orale, est mise en valeur depuis les années 1960. L'Université de Moncton, qui a joué un rôle important dans son épanouissement, est également le principal établissement d'enseignement et de recherche. La population dispose en effet d'un vaste réseau de services publics de langue française, quoique peu accessibles dans certaines localités. L'Acadie nouvelle et Radio-Canada Acadie sont les principaux médias. Les liens entre les différentes régions et la diaspora restent forts et sont favorisés par des événements comme le Congrès mondial acadien et les Jeux de l'Acadie.
Autres villes Bathurst, Caraquet, Campbellton, Clare, Dieppe, Edmundston, Moncton, Tracadie-Sheila
Géographie de l'Acadie. Frontières de l'Acadie.
L'Acadie est généralement considérée comme un territoire regroupant les localités francophones des provinces de l'Atlantique, dans l'est du Canada.
Il existe une diaspora acadienne.
Dans son acception la plus courante, l'Acadie est donc constituée, au N.-B., d'un territoire ayant grossièrement la forme d'un croissant comprenant le Nord du comté de Victoria, Grand-Sault, Drummond, le comté de Madawaska, le comté de Restigouche, le comté de Gloucester, l'est du comté de Northumberland, Rogersville, Néguac, Baie-Sainte-Anne, le comté de Kent et le centre du comté de Westmorland, Beaubassin-Est, Cap-Pelé, Dieppe, Memramcook, Moncton et Shédiac ; il y a également des minorités significatives à Fredericton, Minto, Miramichi, Nackawic et Saint-Jean. En N.-É., il y a des communautés isolées dans le comté d'Antigonish Pomquet, Havre-Boucher et Tracadie, le comté de Guysborough, Larry's River, le comté d'Inverness, région de Chéticamp et le comté de Richmond, isle Madame et environs, à l'est, ainsi que les municipalités de district de Clare, Baie-Sainte-Marie et d'Argyle, Par-en-Bas, à l'ouest ; il y a également une minorité significative à Halifax, alors que les Acadiens sont majoritaires dans le quartier de Chezzetcook. À l'Î.-P.-É., les principales communautés sont dans le comté de Prince, Tignish, région Évangéline, Miscouche, à l'ouest. Il y a également des populations acadiennes dans le comté de Queens Rustico et dans le comté de Kings Souris. Il y a finalement des minorités significatives à Summerside et à Charlottetown. La péninsule de Port-au-Port, Cap-Saint-Georges, La Grand'Terre, L'Anse-aux-Canards–Maisons-d'Hiver, à l'ouest de T.-N.-L., est la principale communauté acadienne de cette province5 ; il y a aussi une minorité significative à St. John's et dans le reste de la péninsule d'Avalon, à l'est. Certains lieux historiques sont aussi fréquemment associés à l'Acadie, tels que le fort Beauséjour, la forteresse de Louisbourg, l'habitation de Port-Royal, l'île Sainte-Croix et Grand-Pré.
Cette vision de l'Acadie est en fait la troisième définition proposée par le géographe Adrien Bérubé dans les années 1970 afin d'illustrer le territoire de l'Acadie ainsi que sa perception, qui ont évolué au fil de l'Histoire ; les trois autres définitions sont l'Acadie historique – un territoire plus vaste ayant cessé d'exister en 1763 –, l'Acadie généalogique – ayant accueilli les réfugiés de la Déportation des Acadiens à partir de 1755 – ainsi que l'Acadie prospective, la plus petite, constituée des communautés au N.-B. seulement, où se trouve la principale concentration de population. L'existence de la diaspora acadienne rend nécessaire d'autres définitions : l'Acadie du Nord fait ainsi référence à toutes les localités au Canada et en Nouvelle-Angleterre, alors que l'Acadie du Sud fait référence à l'Acadiane, en Louisianec. L'Acadie des terres et des forêts est un ensemble de régions éloignées de la mer, au N.-B., au Maine et au Québec. Par ailleurs, une Cadie ou Petite Cadie est une ville ou une région québécoise où vivent les Acadiens. En Louisiane, Cadie est plutôt un synonyme de l'Acadiane, pays du monde comprenant des communautés de l'Acadie généalogique, les principales régions acadiennes et cadiennes sont en Amérique du Nord.L'Acadie des Maritimes et les régions acadiennes limitrophes sont la Gaspésie, îles de la Madeleine et Maine.
géographie, Géologie
Les principaux cours d'eau sont la rivière Ristigouche et la rivière Népisiguit, qui se jettent dans la baie des Chaleurs, la rivière Miramichi, qui se jette dans le golfe du Saint-Laurent, la rivière Petitcodiac et le fleuve Saint-Jean, qui se jettent dans la baie de Fundy. L'Acadie compte de nombreux lacs mais ils sont de petite taille. Il y a par contre de nombreuses terres humides, particulièrement dans la Péninsule acadienne et dans le comté de Kent. Le principal sommet est le mont Carleton, haut de 817 mètres. L'Acadie est en fait située à l'extrémité nord des Appalaches. D'autres massifs y sont reliés, notamment le plateau du Cap-Breton ; son principal sommet, la butte White, a une altitude de 532 mètres11. Les terres de l'Î.-P.-É. ne dépassent pourtant pas 142 mètres au-dessus du niveau de la mera.
La composition géologique est constitué des roches qui datent généralement de l'ère paléozoïque 543 à 250 millions d'années mais il y en a du précambrien, vieilles de 4,5 milliards à 542 millions d'années, à Chéticamp et du mésozoïque, -251 à -65,5 millions d'années dans le fond marin près de Clare.
Elles font toutes partie de l'orogenèse des Appalaches. La majeure partie du territoire est composé de roches sédimentaires mais il y a aussi une présence de roches volcaniques dans les environs de Bathurst, Campbellton et Grand-Sault, de roches intrusives à Bathurst, Belledune et Argyle alors qu'à Chéticamp se trouvent à la fois des roches sédimentaires, volcaniques, intrusives et métamorphiques.
L'aléa sismique est relativement faible, sauf au N.-B., où des tremblements de terres d'une magnitude de plus de 5,0 peuvent avoir lieu, mais surtout dans les Grands Bancs de Terre-Neuve, où le séisme de 1929, d'une magnitude de 7,2, a causé un raz-de-marée, le seul à ce jour.
Climat en détail
L'Acadie a un climat tempéré de type continental humide, adouci par la proximité de l'océan Atlantique, ce qui donne des hivers longs, enneigés et pouvant être très froids. Le printemps et l'été sont courts alors que l'automne est long et plaisant, avec toutefois des nuits froides. Deux masses d'air influencent le climat, soit de l'air froid en provenance du Nord-Ouest et de l'air marin chaud et humide en provenance du Sud-Ouest. Le courant chaud du Gulf Stream n'influence pas directement le climat mais sa rencontre avec les eaux froides du courant du Labrador créée de vastes bancs de brume. Deux régions comptent un climat très différent, soit le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, Madawaska et Ristigouche avec des hivers plus longs et des été plus courts, ainsi que le Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse, Par-en-Bas et Baie-Sainte-Marie avec un climat humide et tempéré avec des hivers pluvieux et peu d'extrêmes de températures.
En janvier, la température minimale moyenne oscille entre -24 °C et -5 °C selon les régions, la plus froide étant celle de Saint-Quentin, les plus chaudes étant Argyle, Clare et le Cap-Breton. Toujours en janvier, la température maximale moyenne peut aller entre -9 °C et -5 °C au Nord, entre 6 °C et 10 °C dans Clare et Argyle ainsi qu'entre -4 °C et 0 °C dans les autres régions. En juillet, la température minimale moyenne oscille entre 11 °C et 15 °C. La température maximale moyenne oscille quant à elle entre 21 °C et 25 °C mais peut dépasser 25 °C dans le Kent, tout en oscillant entre 16° à 20 °C à la péninsule de Port-au-Port et dans certains secteurs d'Argyle.
Les précipitations sont de l'ordre de 801 à 1 200 mm en moyenne à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick sauf à Memramcook ainsi que de 1201 à 1 600 mm dans le reste du territoire. La neige apparaît vers la fin novembre au Nord-ouest, au début décembre à l'Î.-P.-É. et dans l'est du N.-B. sauf à Memramcook, à la fin décembre à Memramcook et dans le reste de la N.-É. sauf en Argyle et dans Clare, où elle tombe vers le début janvier. Elle atteint une épaisseur maximale moyenne 30 à 49 cm en N.-É. sauf à Chéticamp et de 50 à 99 cm ailleurs. La neige fond en moyenne au début mars en Argyle, à la fin mars dans Clare, au début avril à l'Î.-P.-É., au Sud-est du N.-B. et dans le reste de la N.-É. sauf à Chéticamp et finalement à la fin avril dans le reste du territoire.
Les glaces sont présentes dans le golfe du Saint-Laurent. Elles prennent forme à la mi-janvier à l'Île-du-Prince-Édouard et au N.-B., au début février à Pomquet et Chéticamp ainsi qu'entre la mi-février et la mi-mars selon les secteurs à la péninsule de Port-au-Port. Elles atteignent leur étendue maximale au début mars et la débâcle a lieu entre la mi-mars et la mi-avril selon les secteurs.
L'Acadie est peu vulnérable aux catastrophes naturelles et les principaux problèmes climatiques touchent les côtes, où les inondations et les ondes de tempête causent dans plusieurs localités des dégâts aux infrastructures et résidences ainsi que l'érosion des berges. Les ouragans sont très rares mais dévastateurs, Désastre d'Escuminac, 35 morts en 1959, ouragan Juan, huit morts en 2003. Les tempêtes tropicales sont plus fréquentes sans causer autant de dommages. Les tempêtes du Cap Hatteras représentent également une menace, par exemple la tempête Juan blanc en 2004. Les tornades sont rares, mais l'une d'elles a tuée cinq personnes à Bouctouche en 1879. La configuration du relief de Chéticamp cause un vent violent, le suête, qui se lève quelquefois par année, surtout au printemps. Le niveau de la mer s'est élevé de 30 cm depuis 1869 et, selon Robert Capozi, devrait augmenter d'au moins 20 cm d'ici 2100, alors que la croûte terrestre devrait s'affaisser de 30 cm au cours de la même période, ce qui devrait augmenter l'intensité des dégâts des tempêtes.
Faune et flore
Il existe deux principales classifications pour les écorégions de l'Acadie. Selon la classification du Commission de coopération environnementale, sur laquelle se fondent le fédéral et les provinces, le territoire est situé dans l'écozone maritime de l'Atlantique alors que selon le World Wide Fund for Nature, le territoire se divise plutôt entre les forêts des basses-terres du Golfe du Saint-Laurent, Î.-P.-É., est du N.-B., les forêts de la Nouvelle-Angleterre et de l'Acadie, ouest et nord du N.-B., N.-É. sauf Chéticamp et les forêts de l'Est du Canada Allardville, Chéticamp, Terre-Neuve-et-Labrador.
Le climat favorise la croissance des forêts16. Il y a un fort taux d'endémisme dans certaines parties du littoral, notamment à T.-N.-L. ; les espèces endémiques incluent l'aster du Saint-Laurent.
Le chat sauvage lynx roux, l'orignal élan, l'ours noir et le renard roux sont des mammifères courants tandis que le chevreuil, cerf de Virginie, le lièvre d'Amérique, le porc-épic d'Amérique, le pékan, le castor du Canada, la martre d'Amérique, le raton laveur et le rat musqué se retrouvent en grande quantité au N.-B. et en N.-É. Seuls le renard roux, le lièvre d'Amérique, le castor du Canada et le rat musqué sont courants à l'Île-du-Prince-Édouard, les autres espèces ayant disparu. Le chevreuil a repoussé le caribou des bois au nord. Le coyote a été introduit dans plusieurs régions et a remplacé le loup au N.-B. et en N.-É. De nombreuses espèces d'oiseau de mer vivent sur les côtes et il a de grandes populations de grand Héron et de pluvier siffleur alors que la N.-É. compte la plus forte concentration de pygargue à tête blanche au Nord-est du continent. Parmi les espèces endémiques figurent le satyre fauve des Maritimes, un papillon.
La majeure partie de la forêt a été coupée avant la fin du xixe siècle en raison de l'exploitation forestière et de l'agriculture. La fragmentation est également élevée dans certaines régions. Les plus grandes superficies de milieux intacts sont donc comprises dans les limites du parc national de Kouchibouguac et du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. L'exploitation forestière, en particulier au N.-B., représente la principale menace écologique, suivie dans certaines régions de l'exploitation de la tourbe, de l'agriculture, du développement du littoral, du développement touristique et du développement résidentiel.
Transports
Toutes les régions sont accessibles par la route, bien qu'il n'y ait pas d'autoroutes partout. La principale route est la Transcanadienne. Charlottetown, Saint-Jean, Saint-John's, Halifax, Moncton et Clare comptent des réseaux de transport en commun par autobus. Seules certaines régions sont reliées par le réseau d'autobus Maritime Bus; des taxis longue distance desservent tout de même la Péninsule acadienne et Chéticamp. T.-N.-L. est reliée par traversier au Québec et à la N.-É. L'Île-du-Prince-Édouard est aussi reliée à la N.-É. par traversier. Le pont de la Confédération relie l'Île-du-Prince-Édouard au N.-B. La chaussée de Canso relie l'île du Cap-Breton au continent. L'Acadie est partiellement desservie par le train L'Océan, de VIA Rail Canada, reliant Halifax à Montréal. Le chemin de fer dessert aussi les communautés du N.-B. excepté la Péninsule acadienne. Les principaux ports acadiens sont celui de Belledune et celui de Dalhousie. La plupart des marchandises transitent toutefois par d'autres ports, notamment port d'Halifax et le port de Saint-Jean. Les principaux aéroports, offrant plusieurs liaisons internationales, sont l'aéroport international Stanfield d'Halifax, l'aéroport international du Grand Moncton et l'aéroport international de Gander. Chaque région dispose toutefois d'aéroports offrant des liaisons régulières.
Histoire de l'Acadie, Nouvelle-France et Histoire du terme Acadie.
Le territoire de l'Acadie est exploré vers l'an mil par les Vikings puis dès le XIIIe siècle par les pêcheurs européens attirés par la morue.
Le nom Acadie aurait été utilisé pour la première fois sous la forme Arcadie en 1524 par l'explorateur italien Giovanni da Verrazano, au service de François Ier de France. Il désignait la péninsule de Delmarva, près de Washington, aux États-Unis, dont la beauté de ses arbres rappelait à l'explorateur cette région grecque représentant un lieu idyllique pour les poètes. Selon certains historiens, le nom proviendrait plutôt du micmac ou du malécite-passamaquoddy.
Jacques Cartier rencontre les Micmacs dès sa première exploration en 1534. Il faut tout de même attendre 1604 pour que Pierre Dugua de Mons fonde l'Acadie. Accompagné d'environ 80 personnes dont Samuel de Champlain et Jean de Poutrincourt, Dugua de Mons s'établit sur l'île Sainte-Croix, aujourd'hui située au Maine mais 36 personnes meurent du scorbut durant le premier hiver. La colonie est déplacée l'année suivante à Port-Royal au bord de la baie de Fundy, dans l'actuelle Nouvelle-Écosse. Le monopole commercial de De Mons est contesté en 1607 et il ramène tous les colons en France. Aucun ne revient avant 1610. En 1613, Samuel Argall de Virginie s'empare de l'Acadie et chasse la majeure partie de la population. En 1621, le gouvernement anglais change le nom de la colonie en Nouvelle-Écosse et y fait venir les colons écossais de William Alexander en 1629. En 1631, Charles de la Tour est nommé lieutenant général de l'Acadie par la France et construits des forts au cap Sable et à Saint-Jean. L'Acadie est cédée à la France en 1632 par la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye, qui met aussi fin à la colonisation écossaise. Le gouverneur Isaac de Razilly déplace alors la capitale à La Hève et reprend la colonisation en faisant venir 300 personnes. Razilly s'intéresse plus au commerce maritime qu'à l'agriculture, ce qui explique ses choix d'établissements. Des missionnaires français participaient à la colonisation depuis 1613 et quelques églises de bois sont construites à partir de 1680. Après la mort de Razilly, survenue en 1635, Charles de Menou d'Aulnay ramène la capitale à Port-Royal et déclenche une guerre civile contre La Tour, les deux se disputant la succession. D'Aulnay considère que l'avenir de l'Acadie passe par la production agricole et il parvient à faire venir 20 familles avant sa mort en 1650, rendant la colonie plus autonome. Le peuplement de l'Acadie se fait essentiellement sous le mandat des gouverneurs Razilly et d'Aulnay qui font appel à des colons majoritairement recrutés dans leur région d'origine, soit la Sénéchaussée de Loudun qui, à l'époque, est encore rattaché à l'Anjou, administrativement aussi bien que culturellement et linguistiquement.
La France et l'Angleterre entrent à nouveau en guerre et l'Acadie est conquise par les Anglais en 1654, avant d'être cédée à la France en 1667 par le traité de Bréda. L'Acadie est à nouveau conquise par William Phips en 1690 puis retournée encore une fois à la France en 1697 par le traité de Ryswick. À partir de 1670, des habitants de Port-Royal fondent de nouveaux villages, dont les principaux sont Beaubassin et Grand-Préa.
Acadie anglaise ou Nouvelle-Écosse.
L'Acadie, renommée Nouvelle-Écosse, est cédée au Royaume-Uni en 1713 par le traité d'Utrecht. Ce dernier, assoupli par une lettre de la reine Anne, permet aux Acadiens de quitter la Nouvelle-Écosse sans conditions. Au même moment, la France tente de les attirer à l'île Royale, qui a remplacé Plaisance comme centre de commerce français dans le golfe du Saint-Laurent, ainsi qu'à l'île Saint-Jean, qui doit servir de colonie agricole. La plupart des Acadiens décident tout de même de rester sur place, en raison des conditions de vie difficiles de ces deux îles. Par contre, les Anglais sont encore peu nombreux en Nouvelle-Écosse et tentent d'empêcher les Acadiens de la quitter, car il n'y a pas encore d'agriculteurs anglais et ils craignent que les relations commerciales des Acadiens contribuent à la puissance de l'île Royale. En outre, les Français changent rapidement de stratégie, en supposant que les Acadiens empêcheraient une colonisation britannique s'ils restent en Nouvelle-Écosse.
Les Français construisent la forteresse de Louisbourg sur l'île Royale à partir de 1720, ce qui assoit leur contrôle sur la région, au même moment où une importante immigration de France et de Terre-Neuve grossit la population de l'île. Lors de la guerre de Succession d'Autriche, les Français tentent sans succès de reprendre la Nouvelle-Écosse. Les Britanniques prennent Louisbourg en 1745. Une importante expédition militaire française tente de reprendre la Nouvelle-Écosse en 1746, mais une tempête tue la moitié des hommes et disperse les bateaux. Une expédition terrestre reprend tout de même les Mines en 1746, mais est rapidement expulsée par les Britanniques.
En 1748, le traité d'Aix-la-Chapelle redonne l'île Saint-Jean et l'île Royale à la France, ce que les Britanniques considèrent comme un affront. Ils décident alors de changer de stratégie et d'en finir avec la présence française, y compris acadienne. C'est ainsi que 2 000 colons fondent Halifax en 1749. Les Acadiens conservent depuis un certain temps une attitude neutre et leur exode se poursuit vers les régions limitrophes de la Nouvelle-France. Les Britanniques tentent encore de leur faire prêter serment d'allégeance et, en 1761, les Français déclarent rebelle tout Acadien refusant de prêter allégeance au roi de France. Entre 1751 et 1754, les deux puissances construisent plusieurs forts en préparation de la guerre.
Grand Dérangement : déportation des Acadiens.
En 1755, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, fait prendre le fort Beauséjour aux mains des Français et commence la Déportation des Acadiens. Jusqu'en 1763, les territoires limitrophes de la Nouvelle-Écosse sont annexés et les Acadiens déportés vers la Nouvelle-Angleterre. De nombreux autres réussissent à s'enfuir vers le Canada ou l'île Saint-Jean, actuelle Île-du-Prince-Édouard ou encore se cachent chez les Amérindiens. Plusieurs colonies refusent ces prisonniers, qui sont ensuite déportés vers l'Angleterre ou ramenés en Nouvelle-Écosse. L'île Saint-Jean est presque vidée de sa population en 1758. Les deux tiers sont déportés en France alors que les autres se réfugient à la rivière Ristigouche ou au Québec. Les réfugiés d'Angleterre sont expatriés en France en 1763. Des Acadiens se réfugient à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais sont presque tous à nouveau déportés en 1778. Plus de la moitié des Acadiens meurent durant cette période.
Migrations
Après la signature du Traité de Paris en 1763, les Acadiens se déplacent vers les Antilles, en France, en Louisiane et au Québec, mais surtout en Nouvelle-Écosse. 12 000 immigrants de la Nouvelle-Angleterre se sont déjà établis dans les anciens villages acadiens et la loi interdit aux Acadiens de s'établir en communautés trop nombreuses. Ils ont alors la possibilité de s'établir sur certaines terres qui leur sont réservées parmi les anglophones ou plutôt de fonder de nouveaux villages dans les recoins éloignés de l'ancienne l'Acadie, soit l'île du Cap-Breton, l'Î.-P.-É. ou le territoire qui deviendra le N.-B. en 1784, ce que la plupart font. Parmi tous les anciens villages du cœur de l'Acadie, les seuls n'étant pas réservés aux anglophones sont Pobomcoup et la rive gauche des Trois-Rivières ainsi que Beaubassin, bien que ce dernier accueille très peu d'Acadiens. Les exilés s'établissent au fur et à mesure à Halifax et au bord du détroit de Canso puis dès 1767 à la Baie-Saint-Marie, à Tousquet et à Pobomcoup et, à partir de 1780, à Chéticamp et Margaree.Près de la moitié des Acadiens de France se rendent en Louisiane en 1785, pour des raisons apparemment fortuites.
Un groupe d'Acadiens de Saint-Malo s'établit aux îles Malouines en 1764. La plupart quittent l'archipel dans les années suivantes mais il semble que quelques familles aient laissées des descendants sur ces îles ainsi qu'à Montevideo, en Uruguay.
À partir de 1785, le Madawaska voit l'arrivée des Acadiens, qui avaient dû laisser la basse vallée du fleuve Saint-Jean aux Loyalistes. À la fin du XVIIIe siècle, 36 % des Acadiens sont établis dans les Provinces maritimes et leur retour d'exil se poursuit jusqu'aux années 1820. Jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, les établissements des Maritimes s'étendent le long des côtes et dans l'arrière-pays. Plusieurs facteurs contribuent aux mouvements de population, mais le plus constant est la présence religieuse. Ainsi, la construction d'une chapelle ou l'établissement d'un prêtre signifient généralement qu'une communauté est établie pour de bon. Durant cette période, l'arrivée de nombreux immigrants britanniques accentue le statut minoritaire des Acadiens.
Rétablissement
Au début du XIXe siècle, les Acadiens tentent surtout de combler leurs besoins élémentaires. Toutes leurs ambitions et leurs activités sont ainsi liées à leur survie. Aucune institution n'est proprement acadienne. L'Église est la seule institution française et le clergé catholique vient du Québec ou de France. Seuls quelques villages possèdent une école et l'éducation est dispensée par de rares enseignants, pour la plupart des maîtres itinérants. Il n'y a pas de journal francophone, ni même de médecins ni d'avocats ou de classe moyenne.
Renaissance 1850-1881 Renaissance acadienne.
Les Acadiens se reconnaissent dans l'intrigue du poème "Evangéline" en 1847, de l'Américain Henry Longfellow, alors que La France aux colonies : Acadiens et Canadiens 1859, de François-Edme Rameau de Saint-Père, un Français, leur permet de découvrir leur histoire dans leur langue.
Les Maritimes obtiennent toutes un gouvernement responsable en 1850. L'union des Maritimes est proposée comme solution aux problèmes économiques causés par le libre-échange. Les délégués à la conférence de Charlottetown proposent plutôt la Confédération canadienne, qui est entérinée en 1867 par Londres malgré l'opposition, entre autres, des Acadiens, qui sont pourtant les seuls à être accusés d'être réactionnaires. Certains politiciens font ensuite leur marque, comme Joseph-Octave Arsenault, Pierre-Amand Landry, Isidore Leblanc et Stanislaus Francis Perry ; certains occupent des postes importants mais d'autres sont accusés de ne pas défendre les intérêts acadiens– le népotisme se développe.
L'agriculture de subsistance est toujours la norme et les techniques évoluent lentement mais certaines régions parviennent à diversifier leur cultures et même exporter des patates. Le chemin de fer se développe à partir de 1850 ; il fait surtout la richesse des anglophones mais représente tout de même une bonne opportunité pour les Acadiens. Des Américains relancent l'industrie des pêches au moment où les terres agricoles viennent à manquer. Certains Acadiens ouvrent d'ailleurs de petites usines et même des commerces dès 1856. L'exploitation forestière devient florissante dans la Péninsule acadienne, au Madawaska ainsi que dans Clare, où elle profite de la construction navale ; la concession de terres à une compagnie de chemin de fer près de Saint-Léonard en 1878 entrave toutefois l'expansion du Madawaska.
François-Xavier Lafrance ouvre en 1854 à Memramcook le premier établissement d'enseignement supérieur de langue française, le Séminaire Saint-Thomas. Il doit fermer ses portes en 1862 mais il est rouvert deux ans plus tard par des prêtres de la Congrégation de Sainte-Croix et devient le Collège Saint-Joseph. Le premier journal francophone, Le Moniteur acadien, est fondé en 1867 à Shédiac. D'autres journaux suivront, dont L'Impartial, fondé en 1893 à Tignish et L'Évangéline, qui fut le plus durable, publié de 1887 à 1982. Les communautés religieuses féminines qui s'établissent en Acadie y jouent un rôle essentiel dans l'éducation et les soins de santéa 3. Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, de Montréal, ouvrent des pensionnats à l'Île-du-Prince-Édouard. En 1868, les Sœurs de Saint-Joseph prennent la direction du lazaret de Tracadie et s'établissent aussi à Saint-Basile où leur pensionnat deviendra plus tard le Collège Maillet.
Période nationaliste 1881-1982
Une classe moyenne se forme à partir des années 1860. Bien que le Collège Saint-Joseph et le Collège Sainte-Anne contribuent à la formation d'une élite instruite, l'Acadie compte au moins quatre catégories d'élite. Les deux plus en vue sont le clergé et les membres des professions libérales, soit les avocats, les médecins et les notaires. De plus, même si les agriculteurs et les commerçants acadiens ne bénéficient pas d'un capital considérable comme leurs homologues anglophones, bon nombre d'entre eux réussissent tout de même à se distinguer.
Les conventions nationales acadiennes sont tenue de manière intermittentes à partir de 1881 dans différentes localités. Elles sont des tribunes publiques qui permettent à la population de parvenir à un consensus sur des projets importants comme la promotion du développement agricole, l'éducation en français et la mise en place d'un clergé catholique acadien.
La Société nationale de l'Acadie, qui a pour but de promouvoir le fait acadien, est fondée en 1881. L'Acadie se dote ainsi de symboles nationaux : un drapeau, une fête nationale, une devise et un hymne national. En 1912, Édouard Leblanc devient le premier évêque acadien.
Au moins trois communautés religieuses sont constituées entre 1881 er 1925. Les couvents dirigés par ces religieuses contribuent de façon indéniable à améliorer l'éducation des Acadiennes et à rehausser la vie culturelle de la collectivité. Ces communautés fondent également les premiers collèges pour jeunes filles en Acadie.
À cette époque, quelques femmes parviennent, par la voie des journaux, à exprimer leurs opinions sur des questions importantes. Elles abordent aussi les droits de la femme, notamment le droit de vote et l'accès à l'éducation.
Fondation d'Allardville, le 12 septembre 1932.
Dans les années 1920 est créé le Comité France-Acadie avec du côté français, le diplomate Robert de Caix de Saint-Aymour et l'historien Émile Lauvrière.
La période nationaliste est caractérisée par une importante évolution économique, représentée par l'intégration complète des Acadiens dans le processus d'industrialisation et d'urbanisation canadien. Bien que l'exode rural soit moins prononcé en Acadie qu'ailleurs au Canada, nombreux sont ceux qui s'établissent à Moncton, à Yarmouth, à Amherst et dans les villes de la Nouvelle-Angleterre, où les hommes travaillent dans des usines et les femmes dans des filatures.
Certains membres de l'élite acadienne se méfient d'une telle évolution, qui risquerait selon eux une assimilation à la majorité anglo-saxonne. De 1880 à 1940, des mouvements de colonisation cherchent à freiner l'exode de la population, à détourner les Acadiens de l'industrie de la pêche, qui appartient en majeure partie à des compagnies étrangères, et à aider les familles à faire face aux conditions difficiles de la Grande Dépression. Le mouvement coopératif, en particulier le mouvement d'Antigonish des années 1930, permet enfin aux pêcheurs exploités pendant des générations de travailler de façon autonome.
Certaines différences régionales se manifestent aussi. La communauté acadienne du N.-B., plus importante et plus sûre d'elle-même, prend l'initiative de parler au nom de tous les Acadiens.
Durant les années 1950, les Acadiens deviennent de plus en plus présent dans l'économie, la politique et la culture des provinces maritimes. La préservation des valeurs et de la culture à domicile facilite la mise sur pied d'un système d'éducation francophone, en particulier au Nouveau-Brunswick. La vitalité de la culture acadienne ainsi que son originalité face aux cultures canadiennes anglaises et américaines réduit les effets de l'assimilation et aident les Acadiens à être reconnus en tant que minorité dans les Maritimes.
La survie de la culture acadienne n'est pas assurée malgré toutes ces victoires. Durant les années 1960, le Mouvement souverainiste du Québec et l'opposition au bilinguisme dans l'Ouest ont un impact partout au Canada. Les Acadiens sont alors divisés mais surtout ignorés entre les deux camps. Néanmoins, ils peuvent faire des progrès en vue de préserver leurs droits.
Préservation des acquis de 1982 à nos jours
Au N.-B., les politiques de Frank McKenna réduisent la place de la communauté acadienne et conduisent aux émeutes de Saint-Sauveur et Saint-Simon en 1997. Les Acadiens Joseph Raymond Frenette, Camille Thériault et Bernard Lord sont tour à tour premiers ministres après McKenna ; Dominic LeBlanc tente de devenir chef du parti libéral du Canada en 2008, alors que Yvon Godin, Pierrette Ringuette, Bernard Valcourt et Mark Muise sont aussi à noter.
Plusieurs reconnaissances officielles se succèdent – communauté francophone du Nouveau-Brunswick en 1993, torts causés par le Grand Dérangement en 2003, jour de commémoration en 2005 et monuments érigés à travers le monde dès la même année – et le premier Congrès mondial acadien a lieu en 1994.
Si plusieurs crises récurrentes secouent les années 1980 – secteurs de la pêche, de l'agriculture et de l'industrie forestière – et que le chômage et les disparités régionales sont toujours importants, les industries des mines et de la tourbe prospèrent alors que l'économie de l'Î.-P.-É. se diversifie. Le gouvernement fédéral décentralise certaines activités et les Acadiens y sont favorisés à l'embauche par leur bilinguisme. Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick est mis sur pied en 1979 et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique est fondée en 1988 ; la coopération demeure importante dans l'économie mais de plus en plus d'Acadiens entrent dans la fonction publique ou les professions libérales. Le taux d'emploi est plus que triplé entre 1961 et 1986 – de 17 % à 59 % – alors que le taux de chômage passe de 20 % en 1986 à 10-14 % en 1999. Le revenu, composé à 22 % de transferts fédéraux, correspond à 66 % de la moyenne canadienne en 1986 mais l'économie de l'Acadie n'est désormais plus en retard sur celle des régions anglophones.
À l'Île-du-Prince-Édouard, la reconnaissance du droit à l'éducation en français et du droit de gestion dans les années 1980 mènent à la création de la Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard en 1990. Le Conseil scolaire acadien provincial est mis sur pied en N.-É. en 1996 mais l'ouverture d'écoles francophones est ralentie à la fois par la réticence des parents et de certains politiciens. Une première école francophone est ouverte en 1984 à T.-N.-L. et le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador est fondée en 1996. À l'Université de Moncton, une école de droit s'ajoute en 1983 et une école de médecine en 200673. La N.-É., l'Î.-P.-É. et T.-N.-L. adoptent des mesures sur les services en français durant les années 2000. Le quotidien L'Évangéline cesse d'être publié en 1982 mais est remplacé par L'Acadie nouvelle en 1984 ; plusieurs radios sont fondés après l'ouverture de CKRO la même année.
Population et société Démographie de l'Acadie.
Langue maternelle dans les provinces des Maritimes.
Majorité francophone, moins de 33 % d'anglophones
Majorité francophone, plus de 33 % d'anglophones
Majorité anglophone, plus de 33 % de francophones
Majorité anglophone, moins de 33 % de francophones
Données non disponibles
En 2001, il y avait 276 355 francophones dans les provinces maritimes, pour la plupart Acadiens2. En comptant les personnes anglicisées, il y aurait en tout 500 000 Acadiens dans les provinces de l'Atlantique1. Pourtant, selon le recensement 2001 de Statistique Canada, ce pays comptait 96 145 Acadiens en 2001. Ce nombre est à prendre en considération, car de nombreux Acadiens s'identifient par exemple comme Canadiens ou Français dans le recensement. De plus, l'option Acadien ne figurait pas à l'origine sur le recensement, bien que le nombre de personnes s'identifiant ainsi est en forte hausse depuis 1986.
Les Acadiens représentent ainsi 15,6 % de la population totale des provinces de l'Atlantique, comparativement à une proportion de 22,6 % de francophones au Canadaa 4. Les francophones représentent 32,9 % de la population au Nouveau-Brunswick, 4,2 % à l'Île-du-Prince-Édouard et 3,8 % en Nouvelle-Écosse.
Le fort taux d'Acadiens au Nouveau-Brunswick s'explique par la croissance démographique et l'indice de continuité linguistique, qui est le rapport entre le nombre de personnes utilisant le français et le nombre de personnes ayant le français comme langue maternelle. Le nombre de francophones a augmenté de 12,4 % au Nouveau-Brunswick entre 1961 et 2001, alors qu'il diminuait de 14 % en Nouvelle-Écosse et de 28,8 % à l'Île-du-Prince-Édouard.
L'indice de continuité linguistique varie fortement d'une région à l'autre. Il est ainsi de 92 % au N.-B., 58,2 % en Nouvelle-Écosse et 49,8 % à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans des régions comme le Madawaska canadien et la Péninsule acadienne, où la proportion de francophones dépasse 95 %, le taux d'assimilation est inférieur à 1 %, parfois même négatif, c'est-à-dire que des personnes de langue maternelle anglaise ou autre parlent français à la maison. Par contre, des régions ayant un faible taux de francophones comme l'Île-du-Prince-Édouard 9 % ont un fort taux d'assimilation, 68 % dans ce cas.
En 2006, le français est utilisé régulièrement ou toujours par 46,9 % des travailleurs des communautés de l'Île-du-Prince-Édouard, par 90,5 % au Nouveau-Brunswick78, par 41,7 % en Nouvelle-Écosse et par 31 % à Terre-Neuve-et-Labrador.
Plusieurs communautés acadiennes restent tout de même minoritaires. Le cas le plus connu est Moncton, où les francophones ne représentent que 33 % de la populationb 2.
Minorités et immigrationÉcole anglophone à Bathurst
Tout comme les Acadiens sont minoritaires dans certaines localités, l'Acadie compte aussi ses minorités. Les Malécites et les Micmacs sont d'ailleurs implantés sur le territoire depuis environ l'an -50080, soit deux millénaires avant la fondation même de l'Acadie. Les premières nations de Bouctouche, Burnt Church, Eel River Bar, Indian Island, Madawaska et Pabineau sont enclavées en territoire acadien. Il y a également des minorités malécites ou micmacques dans des localités acadiennes et les autochtones, d'une manière générale, sont les plus nombreux dans Argyle 14,8 % et dans la paroisse de Saint-Louis 10,5 %. Les autochtones sont pourtant moins nombreux dans les Maritimes que dans le reste du pays.
De nombreux canadiens d'autres origines ainsi que des immigrants sont intégrés dans la société acadienne, même si la proportion d'immigrants reste relativement faible, ceux-ci ayant préféré s'établir dans les grandes villes canadiennes et les provinces plus prospères81. D'une manière générale, la N.-É. a la population la plus diverse. La plus grande proportion d'immigrants se retrouve dans le comté de Madawaska, en particulier dans la paroisse de Clair 22 % et à Lac-Baker 18,5 %. Les communautés accueillant le plus de minorités visibles sont aussi concentrées dans le Madawaska, plus précisément dans la paroisse de Baker-Brook 5,7 %, à Saint-Léonard 4,3 %, à Saint-André 5,0 % et dans la paroisse de Saint-Quentin 3,2 %. Certaines communautés sont surtout présentes dans une localités en particulier, comme les Libanais à Kedgwick. Les francophones ne sont pas tous des Acadiens, et il y a notamment environ 13 000 Québécoisc 2 et 1 500 Français dans les provinces de l'Atlantique. Très peu nombreux, les Juifs forment toutefois une communauté dynamique. Plusieurs personnalités issues des minorités se sont illustrés dans la société acadienne, dont le cinéaste libanais Robert Awad, l'écrivain haïtien Gérard Étienne et l'artiste multidisciplinaire belge Ivan Vanhecke.
Langues
Il existe plusieurs dialectes acadiens. Le français acadien est le principal dialecte du français, parlé dans toute l'Acadie, sauf au Madawaska, où le français de la vallée, ou brayon, est beaucoup plus influencé par le français québécois. Par ailleurs, les Acadiens du Québec parlent surtout le français québécois, bien que le français acadien soit très courant dans certaines régions comme les îles de la Madeleine. Le chiac, parlé aussi dans la région de Moncton, est parfois décrit comme un dialecte du français fortement influencé par l'anglais, parfois comme une langue à part entière. Les populations anglicisés parlent généralement l'anglais des Maritimes.
Il n'existe pas d'organisme de normalisation en Acadie mais l'Office québécois de la langue française y joue une influence indéniable, particulièrement dans le langage technique. Certains organismes provinciaux jouent par contre un rôle restreint, par exemple dans la toponymie. Plusieurs auteurs se sont penchés sur l'étude du français acadien. Le glossaire acadien a été publié par Pascal Poirier en 1925 et réédité en 1993. Yves Cormier a présenté son Dictionnaire du français acadien en 2009. Ces dictionnaires se concentrent uniquement sur les acadianismes. Les principaux dictionnaires français en incluent par contre quelques-uns, mais il existe de nombreux oublis notables, par exemple de mots n'ayant pas d'équivalents dans la francophonie, ainsi que certaines erreurs.
Éducation en Acadie.
Université de Moncton
Le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick a la responsabilité du financement et du respect des normes tandis que la gestion des écoles et du programme scolaire est confiée aux deux secteurs indépendants. Le secteur francophone compte 32 353 élèves fréquentant 98 écoles regroupées dans cinq districts scolaires ainsi que 2 434 enseignants. La N.-É. a quant à elle un Conseil scolaire acadien provincial au sein de son ministère. Le Conseil gère 20 écoles unilingues françaises, comptant 4 000 élèves et 600 employés. La Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard gère les six écoles francophones de la province. Le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador regroupe cinq écoles.
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick compte un secteur francophone de cinq établissements. Le Collège Acadie de l'Î.-P.-É. possède trois campus.
L'Université Sainte-Anne compte cinq campus en N.-É., le principal étant à Pointe-de-l'Église et les autres à Tusket, à Halifax, à Petit-de-Grat et à Saint-Joseph-du-Moine. L'établissement comprend la faculté des Arts et Sciences, offrant des baccalauréats ainsi qu'une maîtrise en éducation, la faculté des programmes professionnels et l'école d'immersion. Il y a de plus cinq chaires et centres de recherches.
L'Université de Moncton possède aussi un campus à Edmundston, desservant ainsi le Maine et le Québec, ainsi qu'un campus à Shippagan. Cette université compte neuf facultés, dont une de droit, offre 180 programmes du premier au troisième cycle et compte 37 centres, chaires et instituts. Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick y offre un programme complet de médecine en partenariat avec l'Université de Sherbrooke91. L'université compte 6 219 étudiants et 826 employés dont 390 professeurs en 2009 alors que son budget annuel est de 103 millions $.
Le Canada compte la plus grande proportion de personnes entre 18 et 35 ans possédant un diplôme post-secondaire, et les provinces de l'Atlantique ont les plus grands budgets per capita dédiées à l'éducation parmi les pays du G8. La situation diffère pourtant grandement chez les Acadiens. À l'Î.-P.-É., ceux-ci restent peu éduqués, 34 % n'ayant pas de diplôme secondaire ; le taux de diplômés collégiaux 21,5 % est par contre dans la moyenne canadienne alors que le taux d'universitaires 13 % s'approche de la moyenne provinciale. Au N.-B., 37 % des Acadiens n'ont pas leur diplôme secondaire, comparativement à la moyenne provinciale de 29 %, alors que le taux d'universitaires à Moncton est comparable à Montréal 20,4 % ; la situation serait due à l'économie basée sur les ressources naturelles de la plupart des régions. En N.-É., les Acadiens sont de plus en plus éduqués 70 % de diplômés, dépassant la moyenne des francophones canadiens, mais restent toujours sous le niveau provincial 73 % de diplômés, une situation liée aussi à la situation économique. Les francophones terre-neuviens, toutes origines confondues, sont un plus éduqués que la majorité anglophone et 21 % sont diplômés de l'université, comparativement à 11 % chez les anglophones et à 16 % chez les francophones canadiens. En 2006, selon une étude de l'Institut de politique d'enseignement, les universités néo-écossaises étaient considérées les moins abordables en Amérique du Nord, alors que celles du N.-B. arrivaient en 57e rang sur 60. De plus, le nombre d'inscription est à la baisse dans toutes les universités de l'Atlantique, excepté Sainte-Anne, une situation qui ne s'expliquerait pas uniquement pas le déclin démographique, selon Mireille Duguay.
Un problème important à l'heure actuelle est l'accès aux services sur l'ensemble du territoire, en particulier la santé, qui cause de nombreux débats au N.-B. La centralisation et la rationalisation de ces services causent une plus grandes spécialisation des institutions, ce qui à son tour réduit le nombre d'emplois et accentue la différence entre les villes et la campagne.
Santé et services sociaux
La santé et les services sociaux sont des compétences principalement provinciales.
À l'Î.-P.-É., les services de santé ne sont pas répartis également et il y a un seul centre de santé bilingue, dans la région Évangéline. Au N.-B., depuis la réforme de 2008, c'est un organisme bilingue, le réseau de santé Vitalité, qui gère, en région acadienne, 1 197 lits répartis dans 73 établissements dont 11 hôpitaux, 7600 employés dont 470 médecins et un budget de près de 600 millions $. Cette réforme est jugée inéquitable par le comité Égalité Santé, qui la conteste avec le soutien de la SANB. La N.-É. compte plusieurs centres de santé bilingues. Le projet d'une clinique bilingue à T.-N.-L. est menacé notamment par l'interprétation du nombre de francophones. Afin de faciliter l'accès aux services, le Réseau des services de santé en français de l'Î.-P.-É., fondé en 2002, et les gouvernement de N.-É. et de T.-N.-L. tiennent à jour un répertoire des professionnels bilingues.
Le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont est affilié à l'Université de Moncton.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=6277#forumpost6277
Posté le : 25/07/2014 11:20
|
|
|
|
|
Acadie 2 suite |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Médias et communications Histoire des médias en Acadie.
L'Acadie est desservie par de nombreux médias, pour la plupart anglophones, dont le principal est la Société Radio-Canada. La station francophone Radio-Canada Acadie dispose quant à elle d'une salle de nouvelles à Moncton ainsi que des bureaux régionaux dans onze villes. Il y a également des stations communautaires ou régionales, comme Télévision Rogers ou CHAU-TV. Le N.-B. possède le seul journal quotidien francophone, L'Acadie nouvelle. Il y a aussi des hebdomadaires, notamment L'Étoile, Le Moniteur acadien, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse et La Voix acadienne ainsi que des mensuels et d'autres publications, tel que Le Gaboteur. La radio est bien implantée et la principale station est la Première Chaîne de Radio-Canada. Une quinzaine de radios communautaires francophones, dont 10 au Nouveau-Brunswick, font aussi partie du paysage médiatique depuis la fin du XXe siècle. Plusieurs de ces radios sont très populaires et occupent parfois la première place dans leurs régions. L'internet se développe rapidement.
Les médias, en particulier la presse écrite, ont joué un rôle important dans le développement de la culture et de la politique acadienne à partir du milieu du xixe siècle. Ils se sont pourtant développés lentement à cause de divers facteurs comme la répartition géographique, le statut minoritaire, le dynamisme économique, le niveau d'éducation et les transports. Le Moniteur acadien, fondé en 1867, est le plus ancien. Parmi les journaux disparus, le plus influent a été L'Évangéline. Au campus de Moncton de l'Université de Moncton, les médias étudiants notamment CKUM-FM et l'hebdomadaire Le Front ont souvent été des acteurs dans divers mouvements de revendication acadiens.
L'Acadie dispose de l'un des meilleurs réseaux de télécommunications au monde. Totalement numérique92, il comprend l'internet, disponible à haute vitesse sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick98, et la téléphonie cellulaire, disponible partout. En 2009, entre 69 % et 77 % de la population, selon les provinces, utilisait l'internet à des fins personnelles, légèrement sous la moyenne canadienne de 80 %. Le réseau est contrôlé principalement par Bell Aliant, Rogers Communications et EastLink. Les télécommunications sont régies par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC. Postes Canada ainsi que plusieurs services de courrier privés desservent le territoire.
Sport en Acadie.
Plusieurs Acadiens se sont démarqués dans le sport professionnel, comme Yvon Durelle à la boxe, Rhéal Cormier au baseball, Ron Turcotte dans le sport hippique ainsi que Luc Bourdon et Roland Melanson au hockey sur glace. Quelques équipes professionnelles sont installées dans les régions acadiennes, dont plusieurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Le sport est pratiqué en Acadie depuis sa fondation mais est à l'origine peu présent dans la culture à cause des conditions de vie difficiles100. Les collèges fondés vers la fin du XIXe jouent un rôle dans l'implantation du sport dans la vie quotidienne. À partir des années 1960, de nouvelles écoles sont construites avec des gymnases et d'autres installations sportives. La fondation d'une école normale francophone à Moncton, puis l'ouverture du Département d'éducation physique de l'Université de Moncton permet la formation des enseignants en français. Depuis 1979, les Jeux de l'Acadie sont l'occasion, pour les athlètes en herbe de toute l'Acadie, de se mesurer les uns aux autres.
Religion en Acadie.
Les Acadiens sont majoritairement catholiques. L'archidiocèse de Saint-Jean recouvre tout le territoire de T.-N.-L., l'archidiocèse de Moncton comprend tout le N.-B. alors que l'archidiocèse de Halifax couvre à la fois la N.-É. et l'Î.-P.-É.
Les Acadiens sont à l'origine tolérants envers les autres religions et confessions car certains des fondateurs sont protestants. Le clergé n'est d'ailleurs pas très présent et s'intéresse surtout à l'évangélisation des Micmacs ; en fait, la pratique de la religion est surtout une affaire familiale à cause de la pénurie de prêtres. Les Acadiens conservent la liberté de religion après la signature du traité d'Utrecht en 1713. À la suite de la déportation des Acadiens, les relations deviennent tendues entre la population et les prêtres et évêques, qui sont désormais majoritairement Écossais ou Irlandais, et anglophones. Des prêtres acadiens sont formés au Collège Saint-Joseph dès 1865 mais ceux-ci sont envoyés principalement dans des régions anglophones. Un débat pour l'acadianisation du clergé commence dans les années 1880 et un premier évêque, Alfred-Édouard Leblanc, est nommé en 1913. Un mouvement s'organise ensuite pour demander au pape une meilleure représentation dans le clergé, malgré l'opposition des anglophones, avec succès. La demande de créer un archidiocèse à Moncton cause encore plus d'opposition mais est aussi acceptée en 1936. Le diocèse d'Edmundston en est détaché en 1944 alors que le diocèse de Yarmouth est séparé de celui d'Halifax en 1953. La foi catholique reste liée à l'acadianité jusque dans les années 1940, où une majorité des membres de l'élite sont soit des religieux, soit ont été formés dans des collèges catholiques. Les communautés religieuses occupent une place fondamentale dans les secteurs de l'éducation et de la santé jusqu'aux années 1970. Comme dans plusieurs régions du monde, la pratique religieuse baisse ensuite alors que le nombre de prêtres est en baisse et que certaines paroisses ne sont même plus desservies103. La foi catholique reste toutefois importante pour une bonne partie de la population mais son lien avec l'acadianité devrait être différent dans l'avenir selon l'historienne Naomi Griffiths.
L'interprétation du catholicisme en Acadie accorde une place importante aux femmes, une situation démontrée par le grand nombre d'églises dédiées à une sainte, aux cathédrales qui sont dédiées à Marie ou à Sainte Anne et au fait que deux communautés religieuses féminines ont été fondées en Acadie, soit la Congrégation des Filles de Marie de l'Assomption et la Congrégation des Religieuses de Notre-Dame du Sacré-Cœur, contrairement aux communautés masculines, qui proviennent toutes du Québec ou de France. Le culte de Sainte-Anne est en fait très important et l'imposition de Marie de l'Assomption comme sainte-patronne n'y a rien changé. La mer occupe aussi une place importante dans la religion, notamment par la célébration toujours très populaire du dimanche des pêcheurs et de la bénédiction des bateaux.
Économie Économie de l'Acadie.
Depuis 1961, la situation économique de l'Acadie s'est améliorée face à la moyenne canadienne. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution, dont l'augmentation de l'accès à l'éducation post-secondaire, l'augmentation de la participation au marché du travail et finalement le dynamisme entrepreneurial. L'économie traditionnelle acadienne était plutôt socialiste et encourageait la coopération, alors que l'individualisme qui accompagne l'urbanisation et la modernisation a orienté les entrepreneurs vers le capitalisme. Ce dynamisme mena au développement d'un réseau d'organisations économique, qui augmentent l'implication de la population dans les décisions du gouvernement. La montée de l'état-providence a joué un rôle majeur: les transferts de revenus représentent 20 % du revenu total chez les Acadiens, contre 16 % chez les anglophones, ce qui permet surtout de soutenir le secteur des services. Le développement des services publics permet la création de nombreux emplois bien rémunérés dans toutes les régions. Le soutien du développement de l'entrepreneuriat, par l'entremise de programmes comme l'APECA, permet la création d'emplois.
Ces progrès s’accompagnent néanmoins de la persistance d’un important écart de développement. Cela s’explique, entre autres, par le fait que le taux d’activité y est inférieur à la moyenne canadienne et le taux de chômage supérieur. L’activité économique est très saisonnière dans plusieurs régions, en partie parce que le secteur manufacturier est axé sur la transformation des ressources naturelles. L'emploi demeure donc la principale préoccupation, causant une forte opposition à la réforme de certains programmes gouvernementaux, en particulier dans le secteur de la pêche, où l'assurance-emploi permet au travailleurs de subvenir à leurs besoins durant les périodes d'inactivité. Certains projets de diversification ont tout de même suscité un vaste mouvement d’opposition, comme la construction d’un incinérateur de sols contaminés à Belledune.
Revenu et emplois
À l'Î.-P.-É., le revenu individuel moyen est de 29 152 $, ce qui dépasse la moyenne provinciale, mais 40 % de la population a un revenu sous la barre des 20 000 $. Au N.-B., le revenu moyen est de 26 929 $, sous la moyenne provinciale de 28 450 $, une situation expliquée en partie par l'importance du secteur primaire et du secteur manufacturier, où les emplois tendent à être moins payés, saisonniers ou de courte durée. Près de la moitié des gens gagnent moins de 20 000 $ annuellement et seulement 12 % gagnent plus de 50 000 $, une situation due en grande partie à l'importance de la population rurale, où l'économie est moins dynamique. En N.-É., le revenu moyen des Acadiens, s'élevant à 32 168 $, dépasse la moyenne provinciale, notamment à cause des emplois bien rémunérés du secteur public ; en plus, l'écart a augmenté depuis 2001. Seulement une personne sur dix gagne moins de 10 000 $, et leur nombre baisse constamment ; le revenu moyen change néanmoins d'une région à l'autre. À T.-N.-L., le revenu moyen de la population francophone s'élève à 36 447 $, dépassant largement la moyenne provinciale de 27 636 $. Par contre, deux personnes sur cinq gagne moins de 20 000 $ annuellement alors que plus du quart gagne plus de 60 000 $.
L'administration publique, la santé et l'éducation constituent les principaux secteurs d'emplois à l'Î.-P.-É. et en N.-É., où ils regroupent respectivement 31,3 % et 36 % des emplois, notamment au ministère des Anciens combattants à Charlottetown. La fabrication est le domaine le plus important au Nouveau-Brunswick et le second plus important à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. L'économie terre-neuvienne est basée avant tout sur les matières premières. Pourtant, les communautés francophones ont une économie postindustrielle, où les emplois dans le commerce et les services jouent un rôle important. Au N.-B. et en N.-É., les Acadiens sont plus présents que les anglophones dans les secteurs primaires et secondaires.
Les entrepreneurs représentent, en 2006, 8,4 % des travailleurs à l'Île-du-Prince-Édouard, 7,7 % au Nouveau-Brunswick, 8,7 % en Nouvelle-Écosse et 4,9 % à Terre-Neuve-et-Labrador.
La vente et les services constitue la principale occupation des Acadiens, soit 21,0 % des travailleurs à l'I.-P.-E., 24,0 % au N.-B78., 23,5 % en N.-É. et 25,5 % à T.-N.-L. Les domaines des affaires, de la finance et de l'administration gagnent en importance en Nouveau-Brunswick ; les Acadiens du N.-B. y sont quant à eux moins présents que les anglophones78. Au N.-B. également, le secteur de la vente et des services est plus faible que la moyenne provinciale.
Principaux secteurs de l'économie Pêche, agriculture et agroalimentaire
La pêche est la base de l'économie des provinces de l'Atlantique avec des revenus annuels de 3 milliards $ et représente le tiers de ses exportations. Le plus grand port de pêche est Escuminac, avec 500 bateaux tandis que le port de Shippagan est le plus rentable. Depuis l'effondrement des stocks de morue et le moratoire de 1992, les principales espèces pêchées sont le crabe des neiges et le homard ; le principal marché du crabe est le Japon104. La ressource de crabe est très étudiée mais le contrôle des prises de homard est plus difficile et la ressource pourrait s'épuiser ; il y a dix fois plus de pêcheurs de homard que de crabe mais les prises sont du même ordre. La transformation du poisson et des fruits de mer a lieu dans la plupart des villes portuaires mais certaines usines comme à Saint-Simon transforment le surplus des autres usines. L'industrie cherche de plus en plus la valeur ajoutée.
La période des récoltes dure en moyenne 133 jours. L'aquaculture est en expansion depuis les années 1990. La mousse d'Irlande est récoltée ou cultivée par une entreprise acadienne d'Halifax, qui est considérée comme le chef de file mondial de l'algue comestible, en plus d'être le plus grand fournisseur du Japon. Le N.-B. a le plus important secteur de produits agricoles à valeur ajoutée au pays ; l'industrie de la pomme de terre en est le chef de file, dont la multinational McCain Foods. Les aliments surgelés représentent 61 % des exportations alimentaires de l'Atlantique ; en région acadienne, cette industrie est concentrée à Grand-Sault et Scoudouc. Les boissons gazeuses Scoudouc et la bière Moncton représentent quant à eux 8 % des exportations. Les confiseries, pourtant importantes, sont peu développées en région acadienne. Toutefois, la fabrication du sirop d'érable est répandue, particulièrement à Saint-Quentin. La Péninsule acadienne est la principale région productrice de bleuets mais la transformation et l'exportation est concentrée à Oxford, en N.-É. anglophone. L'industrie des canneberges est concentrée à Rogersville mais se développe ailleurs. L'élevage et l'abattage du poulet est concentré à Saint-François-de-Madawaska.
Industrie
Il y a plusieurs mines près de Bathurst. La majeure partie des marchandises transitant par le port de Belledune sont d'ailleurs le bois et le minerais. Les usines de la ville produisent ou transforment le plomb, l'acide sulfurique, l'argent, l'or, le gypse et l'engrais. Le N.-B. produit 31 % de la tourbe au Canada et la production y est concentrée dans la Péninsule acadienne. Le Nord-ouest compte sur l'exploitation forestière et possède plusieurs usines, certaines de propriété locale comme Groupe Savoie mais la plupart appartenant a des intérêts anglophones ou étrangers, comme la compagnie J.D. Irving. Edmundston, Belledune, Saint-Quentin, Kedgwick et Atholville comptent des usines de pâte et papier. La fabrication de papiers spécialisés est concentrée à Dieppe et Richibouctou. Certains autres produits dérivés sont fabriqués en Acadie, notamment les couronnes de Noël à Notre-Dame-des-Érables.
La construction accapare 12 % du PIB au niveau fédéral et constitue le septième employeur de l'Atlantique. Plusieurs villes comptent d'importants fabricants de matériaux de construction et d'équipements résidentiels comme le béton, l'asphalte, l'acier, les équipements de ventilation et de climatisation, les portes et fenêtres, les armoires de cuisine et les matériaux de construction divers. Il y a des usines de maisons préfabriquées à Tracadie-Sheila et à Bouctouche.
L'environnement est également un secteur d'avenir, comprenant plus de 800 entreprises dans tout l'Atlantique ; T.-N.-L. est un chef de file dans le traitement des marées noires, le N.-B. dans le traitement des eaux usées, la N.-É. en matière de recyclage et l'Î.-P.-É. dans le domaine de la collecte des déchets. L'aérospatiale et la défense sont parmi les secteurs industriels connaissant la plus forte croissance ; l'industrie est concentrée en N.-É., surtout à Halifax, mais des parcs industriels importants sont aussi présents à Summerside près de la région Évangéline ainsi qu'à Moncton. Moncton et sa voisine Dieppe sont d'ailleurs les principales villes industrielles, avec des entreprises œuvrant dans les domaines de haute technologie, des véhicules d'urgence, des portes et fenêtres, de l'usinage, du verre, des équipements de jeux de hasard, de l'aérospatiale et de la défense. Edmundston regroupe aussi quelques usines importantes, dans les domaines du plastique, des articles de sport, des enseignes et des meubles. Quelques autres industries sont présentes, telles que la construction navale Bas-Caraquet, Methegan, les véhicules terrestres Bathurst, Lamèque, Notre-Dame-de-Kent, Tracadie-Sheila, les moteurs Eel River Crossing, les équipements industriels Balmora, Caraque, Tracadie-Sheila, l'engrais Petit-Rocher et les matelas Scoudouc.
Énergie
La puissance installée des centrales électriques des provinces de l'Atlantique est de plus de 14 000 mégawatts MW. L'électricité est produite, transportée et distribuée par des monopoles de sociétés de la couronne Énergie NB, Newfoundland and Labrador Hydro et Maritime Electric ou d'une compagnie privée, Nova Scotia Power. La centrale de Churchill Falls, inaugurée en 1971, fait l'objet d'un contentieux entre le Québec et T.-N.-L. Le coût de l'électricité reste le plus bas dans les pays du G8, sauf à l'Î.-P.-É., où il est le plus élevé au paysa 1. Cette province est d'ailleurs la plus innovatrice en matière d'énergie éolienne et de plus en plus imitée par les autres provinces92. Le plus grand raffineur et distributeur de produits pétroliers est Irving Oil, dont la raffinerie de Saint-Jean, la plus importante au pays, représente 43 % des exportations de pétrole. Un champ de gaz naturel est exploité à l'île de Sable et un gazoduc le relie aux États-Unis via la N.-É. et le N.-B. Le champ de pétrole et de gaz de Old Harry, entre les île de la Madeleine et T.-N.-L., crée des tensions entre cette province et le Québec. Le chauffage se fait de plus en plus au bois à l'Î.-P.-É. puisque le mazout y est également trop cher.
Science et technologie
Les provinces de l'Atlantique sont des chefs de file dans les domaines des technologies marines. La N.-É. se démarque au plan des sciences de la vie mais T.-N.-L. est aussi reconnue dans les biotechnologies marines, le N.-B. dans les biotechnologies agricoles et environnementales et l'Î.-P.-É. dans la nutrition et la santé des sols.
Le Grand Moncton bénéficie de sa position stratégique, de sa population bilingue et de son réseau de télécommunications. Le secteur des centres d'appel y emploie 7 300 personnes. Le secteur de l'infographie et de la conception de logiciels y est également développé.
En Acadie, les sciences et technologies ont pourtant tendance à être mises de côté en faveur de l'industrie et des arts, une situation qu'Alain Haché déplore mais explique par des raisons historiques. La recherche s'est toutefois diversifiée et il y a quelques spécialistes de renom, tels que l'économiste Donald Savoie, le physicien Alain Haché, l'astrophysicien Francis Leblanc, le chirurgien Sylvain Beausoleil, l'ophtalmologue Raymond Leblanc et la biologiste Chantal Motar. L'Université de Moncton joue un rôle clé dans la recherche, qui inclut notamment, au tournant du XXIe siècle, l'étude de la photonique, du glaucome, de l'obésité – touchant une personne sur trois au N.-B. –, de la couleur des étoiles chaudes – théorie de la diffusion –, des effets bénéfiques des aliments fermentés et de la conservation des ressources naturelles. De plus, quelques innovations se démarquent au Canada et à l'étranger, par exemple l'excavatrice multi-fonction d'Éco-technologies.
Commerce
Dieppe compte le principal centre commercial de l'Atlantique, la Place Champlain, alors que d'autres villes de petites tailles comme Shippagan et Atholville basent une partie de l'économie sur les services a leur région respective. Les grandes surfaces et les chaînes de restaurant sont quant à elles généralement contrôlées par des intérêts étrangers. Les chaînes de restaurant Pizza Delight, Mikes, Bâton Rouge et Scores appartiennent toutefois à Imvescor, de Moncton. Co-op Atlantique, dont le siège est à Moncton, compte 99 succursales dans les provinces de l'Atlantique et au Québec et son chiffre d'affaires s'élève à plus d'un milliards de dollars en 2010, faisant d'elle la dixième entreprise au Canada atlantique en 2007 ; elle opère aussi plusieurs autres commerces et une usine de moulée.
Finance et assurance Siège-social des Caisses populaires acadiennes
Le secteur de la finance est surtout contrôlé par des entreprises ontariennes mais il y a quelques exceptions notables. La fédération des Caisses populaires acadiennes, dont le siège-social est situé à Caraquet, regroupe 22 caisses et 82 centres de services et a un actif de 2,9 milliards$ en 2009. Assomption Vie est une entreprise de services financiers basée à Moncton et dont les bénéfices s'élevaient à 6,3 millions $ en 2009, pour des revenus de 124,9 millions $. L'entreprise gère aussi les Placements Louisbourg, la plus ancienne maison de gestion d'actifs au Canada atlantique, avec un actif de 1,2 milliards $ en 2009. Croix Bleue Medavie, aussi basée à Moncton, est une entreprises d'assurances comptant 1 450 employés en 2008, avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards $ en 2007.
Politique et administration Politique de l'Acadie.
Place de l'Acadie dans la confédération canadienne
L'Acadie est principalement séparée entre quatre provinces canadiennes mais celles-ci ont sensiblement le même fonctionnement politique. Le système politique canadien est en effet fondé sur la Constitution du Canada, qui définit les principes politiques, les institutions, les pouvoirs ainsi que les responsabilités du fédéral et des provinces129. Les provinces et le gouvernement fédéral ont chacun des responsabilités exclusives alors que certaines autres, comme l'agriculture, l'immigration et la pêche, sont partagées.
En 2010, les provinces de l'Atlantique comptent 32 députés à la Chambre des communes, alors que leur représentants au Sénat sont traditionnellement au nombre de 30. Depuis le début du XXe siècle, le nombre de députés fédéraux acadiens, provenant surtout du N.-B., oscille entre trois et quatre. De plus, par tradition, un gouverneur général sur deux est francophone ; le seul Acadien à ce jour a toutefois été Roméo LeBlanc, entre 1995 et 1999. Il n'y a par contre jamais eu de premier ministre acadien, bien que Dominic Leblanc, le fils de Roméo, ait tenté de devenir chef du parti libéral du Canada en 2008.
Au niveau provincial, le pouvoir législatif est détenu par une assemblée législative Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard ou une chambre d'assemblée Chambre d'Assemblée de la Nouvelle-Écosse, Chambre d'Assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador, dont les députés sont élus par circonscriptions. Le premier ministre est généralement le chef du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. Il dirige un conseil exécutif détenant le pouvoir exécutif. Le chef d'État est en théorie le lieutenant-gouverneur, nommé par le gouverneur général du Canada sur proposition du premier ministre, mais il a dans les fait un titre honorifique.
Le pouvoir judiciaire est réparti dans plusieurs cours provinciales tandis que le tribunal de plus haute instance est la Cour suprême du Canada. La common law est utilisée à tous les niveaux. L'Acadie étant la principale région francophone dans cette situation, le Centre de traduction et de terminologie juridiques CTTJ, créé par l'Université de Moncton en 1979, a depuis acquis une autorité internationale en matière de common law en français.
Gouvernements locaux Liste des municipalités de l'Acadie.
La gouvernance locale est une responsabilité provinciale mais chacune des provinces possède en fait son propre système ; la gouvernance locale est le principal palier de gouvernement où les Acadiens ont un contrôle effectif. L'Î.-P.-É. compte une cité, des villes et des municipalités, ou villages. La cité et les villes sont dirigées par un conseil municipal, les villages par un commissaire ; la plupart du territoire reste sous la responsabilité du ministère des Finances et des Affaires municipales de l'Île-du-Prince-Édouard.
Au N.-B., les villes ainsi que les villages ont sensiblement le même fonctionnement mais les villages n'ont pas l'obligation d'offrir autant de services. Les cités sont les municipalités les plus populeuse mais leur fonctionnement est généralement le même que les autres municipalités. Il y a finalement des communautés rurales. La plupart des localités restent toutefois dans le système des districts de services locaux DSL. Ceux-ci sont gérés directement par le ministère des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick mais leur population peut élire un comité consultatif dénué de pouvoirs. Le rapport Finn, publié en 2008, propose de revoir complètement l'administration municipale, en regroupant les municipalités existantes pour en réduire le nombre ainsi qu'en améliorant la fiscalité, la transparence et l'imputabilité. Le gouvernement de David Alward est en période de consultations publiques en 2011 afin de procéder à une partie des recommandations.
La N.-É. est totalement constituée en municipalités et villages. Les municipalités ont tendance à retourner la responsabilité de certains de leur services à la province. La plupart des municipalités étant très grandes, certaines localités comme Chéticamp aspirent à se constituer en municipalité.
À T.-N.-L., les municipalités et les districts de services locaux ont un faible pouvoir de taxation et peuvent seulement fournir quelques services, les autres étant sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales de Terre-Neuve-et-Labrador ; la plupart des localités ne sont même pas constituées alors que plusieurs autres ne perçoivent pas de taxes municipales ni n'ont de règlements, renonçant donc aux avantages dont jouissent les autres municipalités.
Liste des vingt principales municipalités acadiennes en 2006 :
Municipalité
Moncton
Dieppe
Edmundston
Bathurst
Comté de Richmond
Clare
Argyle
Campbellton
Beaubassin-Est
Grand-Sault
Shédiac
Memramcook
Tracadie-Sheila
Beresford
Caraque
Dalhousie
Chéticamp
Bouctouche
Saint-Quentin
Politique nationale
Carte approximative d'une province acadienne, telle que proposée par le parti acadien. En bleu pâle, les comtés du N.-B. contenant une proportion importante de francophones. En bleu foncé, les régions majoritairement francophones.
Selon l'historienne Naomi Griffiths, les éléments fondamentaux de la politique acadienne sont la situation minoritaire et le rejet de l'assimilation.
Certaines prises de positions créent à l'occasion des tensions importantes, menant parfois à la création de groupes radicaux chez la majorité anglophone, comme le New Brunswick Confederation of Regions Party en 1989 ou l'Anglo Society of New Brunswick durant les années 2000. Les relations se sont malgré tout améliorées depuis les années 1950 et sont marquées par l'accommodation depuis la fin du siècle. De nombreux intellectuels pensent que la coopération avec les gouvernement provinciaux et fédéraux peut continuer d'être bénéfique pour les Acadiens. Le mouvement souverainiste du Québec a toutefois une influence négative sur les relations avec les anglophones tandis que l'avenir de l'Acadie, advenant la souveraineté du Québec, fait toujours l'objet de débat. L'échec de l'accord du lac Meech en 1987 et de l'accord de Charlottetown en 1992 alimentent d'ailleurs le pessimisme. En 1992, Jean-Marie Nadeau propose, dans Que le tintamarre commence!, de forger de meilleurs liens avec la diaspora acadienne afin d'assurer la survie de l'Acadie, une opinion défendue lors du premier Congrès mondial acadien en 1994. Une autre doctrine courante cherche la décentralisation des services gouvernementaux du N.-B. en faveur des municipalités et une revitalisation du régionalisme.
Une partie des intellectuels, tel que Michel Roy, accordent une importance fondamentale aux institutions et à l'acquisition d'une autonomie politique tandis que certains autres comme Antonine Maillet considèrent que seules une mémoire, une culture, une langue, une âme, une mentalité, une identité comptent. Quoi qu'il en soit, une bonne partie de la population reste persuadée que les Acadiens n'ont pas encore été pleinement reconnus en tant que peuple. Le premier ministre du Canada Stephen Harper avoue d'ailleurs l'existence de l'Acadie mais s'oppose toujours à ce qu'elle soit officiellement reconnue comme une nation, contrairement à ce qui a été fait pour le Québec en 2006. Il reste que l'existence même de l'Acadie n'est jamais réellement mise en doute, que ce soit par les Acadiens eux-mêmes ou par les anglophones du reste du Canada, notamment. Par contre, un sondage de Léger Marketing, produit en 2006, révèle que seulement 45 % des Canadiens reconnaissent l'existence d'une nation acadienne.
Le Parti acadien, fondé en 1972 au N.-B., avait pour objectif principal la formation d'une province acadienne mais, en raison de la situation minoritaire, visait en fait à politiser la population. Les tensions entre les militants du Nord et du Sud puis les politiques conciliantes de Richard Bennett Hatfield minèrent toutefois les appuis du parti, qui disparut en 1986. L'union des Maritimes est quant à elle proposée depuis le milieu du XIXe siècle. Cette union impliquerait soit la formation d'une province canadienne unique, soit la création d'un nouveau pays, avec la possibilité d'une province acadienne.
Quoi qu'il en soit, l'article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnait deux communautés linguistiques au N.-B., l'une francophone et l'autre anglophone. La Proclamation royale de 2003 reconnait officiellement les torts causés par la Déportation des Acadiens.
Politiques linguistiques
Plusieurs articles de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissent le bilinguisme au Canada et au N.-B., c'est-à-dire que le français et l'anglais y ont un statut égal. Le N.-B. possède plusieurs lois provinciales protégeant les langues officielles, dont la loi sur les langues officielles et la loi.
Le gouvernement fédéral offre des services en français dans toutes les provinces de l'Atlantique, notamment dans la moitié des points de service du Nouveau-Brunswich. Conformément au Code criminel du Canada, tous peuvent subir un procès criminel en français de même que recevoir des services judiciaires dans cette langue; au N.-B., tout le domaine judiciaire est bilingue.
L'Î.-P.-É. possède une Division des affaires acadiennes et francophones ainsi qu'un Comité consultatif des communautés acadiennes, en plus de désigner au cabinet un ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones ; concrètement, certains postes gouvernementaux sont bilingues et la Loi sur le services en français, adoptée en 2000, s'applique à tous les services du gouvernement. Au N.-B., tout service public doit être disponible en français. En N.-É., l'Office des affaires acadiennes applique la Loi sur les services en français, adoptée en 2004. T.-N.-L. n'a aucune politique officielle de services en français mais possède un Bureau des services en français.
À T.-N.-L., seule la municipalité de Cap-Saint-Georges offre des services en français. À l'Î.-P.-É., il n'existe aucune loi forçant les municipalités à offrir des services en français mais Abrams-Village et Wellington le font dans certains cas. En N.-É., seule Clare offre tous ses services en français ; toutefois, le comté de Richmond et Argyle offrent certains services dans cette langue. Au N.-B., la Loi sur les municipalités oblige toute localité comptant au moins 20 % de francophones, ainsi que toutes les cités, à offrir des services en français ; 50 municipalités sont membres de l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick. Les municipalités néo-brunswickoise de Dieppe et Atholville ont un règlement sur l'affichage commercial extérieur bilingue alors qu'à Petit-Rocher, l'affichage doit obligatoirement contenir du français ; le débat est en cours dans d'autres municipalités.
Lors de l'élection fédérale canadienne de 2011, tous les partis politiques, sauf le parti progressiste-conservateur du Canada, répondent à la demande de la Société nationale de l'Acadie de faire des provinces de l'Atlantique une région officiellement bilingue.
Institutions nationales et symboles
Fête nationale de l'Acadie, Drapeau de l'Acadie et Hymne national de l'Acadie.
La sainte-patronne de l'Acadie, Notre-Dame-de-l'Assomption, fut le premier symbole choisi, lors de la première Convention nationale acadienne, organisée en 1881 à Memramcook. La fête nationale de l'Acadie est le 15 août, jour de l'Assomption. Le drapeau de l'Acadie fut proposé lors de la deuxième Convention nationale acadienne se déroulant à Miscouche en 1884 ; l'original est conservé au Musée acadien. Il consiste en un drapeau français avec une étoile dorée, ou Stella Maris étoile de la mer, dans la partie bleue ; l'étoile représente la Vierge Marie et sa couleur est associée à la papauté. Le drapeau est aujourd'hui le plus populaire des symboles de l'Acadie. L'hymne national de l'Acadie fut choisi lors de la convention de 1884 ; en liaison avec le drapeau, il consiste en une hymne chrétienne latine, adressée à la Vierge Marie, la prière grégorienne Ave Maris Stella. Un concours fut organisé par la Société nationale de l'Acadie en 1994 afin de créer des paroles en français ; la gagnante fut Jacinthe Laforest et la nouvelle version fut chantée pour la première fois par Lina Boudreau. Les deux derniers symboles officiels, la devise et l'insigne acadienne, furent choisis durant la convention de 1884 ; la devise est peu utilisée de nos jours et l'insigne, qui n'a jamais été populaire, est pratiquement oubliée. La devise est L'union fait la force. L'insigne consiste en une bandelette de soie bleue à franges dorées, surmontée d'une rosette rouge et blanche, sur laquelle figure la devise nationale, une étoile et un bateau dont le pavillon porte le mot Acadie jour de 1755 ou fut décidé la déportation des Acadiens.
Il existe plusieurs autres symboles non-officiels de l'Acadie. L'un des plus anciens et des plus populaires est le poème Evangéline de l'auteur américain Henry Longfellow, publié en 1847. Des concours annuels sont organisés dans plusieurs communautés afin de choisir un Gabriel et une Évangéline, les deux personnages principaux du poème.
Société nationale de l'Acadie
La Société nationale de l'Acadie SNA a pour mission de promouvoir les intérêts des Acadiens, plus particulièrement ceux des provinces de l'Atlantique. La SNA compte 8 membres fédératifs, soit la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, le Conseil Jeunesse Provincial, la Société Saint-Thomas-d'Aquin, Jeunesse Acadienne, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador et Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador. Il y a aussi un membre privilégié, soit Les Amitiés Acadiennes en France et finalement 4 membres associés, soit la Corporation des Acadiens aux Îles-de-la-Madeleine, le Comité Louisiane-Acadie, l'Association Miquelon Culture Patrimoine et la Coalition des organisations acadiennes du Québec. La SNA fut fondée en 1881 et son président actuel est René Légère, du Nouveau-Brunswick.
Par le biais de la SNA, l'Acadie entretient diverses relations internationales officieuses ou officielles. Les relations les plus anciennes et les plus importantes sont avec la France. Celles-ci commencèrent en 1968, à l'initiative de la SNA. La France avait déjà déplacé sa chancellerie d'Halifax vers Moncton en 1964, avant de la transformer en consulat général en 1966. La coopération France-Acadie est renouvelée à tous les deux ans et inclut un programme d'échange, de bourses d'études ainsi que de l'aide financière et technique. La SNA gère la Fondation Franco-Acadienne pour la Jeunesse, qui favorise l'échange entre jeunes, alors que la France a instauré un Service culturel à son consulat de Moncton. Les relations avec la Communauté française de Belgique commencent en 1983 et depuis, un programme d'échange est renouvelé tous les trois ans. Depuis les années 1990, le Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des délégations de la SNA discutent d'enjeux communs. Un entente est finalement signée en 2001 et l'Association SPM-Acadie est fondée, plus tard remplacée par l'Association Miquelon Culture. Les relations avec le CODOFIL en Louisiane commencent à la même époque. À partir de 1995, le Québec tente de se rapprocher de la francophonie canadienne. En 2002, un monument commémorant l'apport des Acadiens au Québec est inauguré dans la ville de Québec. En 2003, l'Assemblée nationale du Québec appuya unanimement la SNA dans sa démarche pour faire reconnaître les torts causés par la Déportation des Acadiens. Le Centre de la francophonie des Amériques fut fondé en 2008. Au-delà de cette reconnaissance, il existe une Commission Acadie-Québec. La SNA siège à l'Organisation internationale de la francophonie en tant que membre de la délégation d'accompagnement du Canada et ce depuis 2005.
En 2011, tous les partis politiques fédéraux du Canada, sauf les progressistes-conservateurs, s'engagent à accorde à la SNA un statut particulier de porte-parole officiel du peuple acadien ainsi que de soutenir la SNA et les artiste acadiens dans le rayonnement international de l'Acadie.
Congrès mondial acadien
Le Congrès mondial acadien est organisé à tous les cinq ans et a pour but de développer des liens plus étroits dans la diaspora acadienne. Toutes sortes d'activités, des retrouvailles familiales, des spectacles et des conférences ont lieu à cette occasion. Le premier congrès se déroula en 1994 au sud-est du N.-B.. Il fut ensuite organisé en 1999 en Louisiane, en 2004 au sud-ouest de la N.-É. et en 2009 au nord-est du N.-B. Le Ve congrès aura lieu en 2014 dans l'Acadie des terres et des forêts. Le CMA était à l'origine géré par la société du CMA, qui devint inopérante après le premier congrès. À la suite des difficultés représentées pour l'organisation du troisième congrès, la Société nationale de l'Acadie accepta de gérer l'événement en 2001.
Capitale Grand-Pré
Plusieurs lieux revendiquent le titre de capitale de l'Acadie, le plus ancien étant Grand-Pré, qui était par ailleurs la principale ville de l'Acadie en 1755. En 1847, l'américain Henry Longfellow publie le poème Evangéline. Le succès du poème attire des milliers de touristes à Grand-Pré, le point de départ du récit, alors que l'image d’Évangéline est utilisée à des fins publicitaires et que l'élite acadienne en fait un symbole national caractérisant la persévérance. Un parc commémoratif prend forme en 1907 à l'instigation de John Frederic Herbin, auquel se greffent une statue offerte par le Chemin de fer Windsor et Annapolis et l'église-souvenir, commanditée par la Société nationale de l'Acadie. Un pèlerinage annuel y est institué. Le parc devient un lieu historique national en 1955. L'image d'Évangéline est rejetée durant les années 1960. Evangéline est ensuite considéré comme un poème sur l'amour et ses ardeurs alors que Grand-Pré refait surface dans la culture et que le pèlerinage continue. Le lieu est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012.
Memramcook est l'un des seuls villages ayant survécu à la Déportation des Acadiens. Plusieurs réfugiés y retournent dès 1763, en faisant le plus important en Acadie. Par la suite, des habitants fondent d'autres villages, ce qui lui vaut le surnom de Berceau de l'Acadie. Memramcook joue aussi un rôle important dans la renaissance acadienne du XIXe siècle.
Moncton profite du rejet des valeurs traditionnelles et de la critique du poème Évangéline durant les années 1960 pour être considérée comme la capitale de l'Acadie. Cette réputation est controversée car le nom même de la ville commémore Robert Monckton, un militaire britannique ayant dirigé la Déportation des Acadiens dans la région. De plus, Moncton est une ville à majorité anglophone, avec un fort taux d'anglicisation, où les Acadiens ont eu beaucoup de difficulté à faire respecter leur droits. La ville abrite par contre plusieurs institutions dont l'Université de Moncton, alors que sa voisine Dieppe est le siège de la Société nationale de l'Acadie.
Caraquet s'autoproclame capitale de l'Acadie en 1993. Cette ville abrite trois importantes institutions, soit le Théâtre populaire d'Acadie, le quotidien L'Acadie nouvelle ainsi que la fédération des Caisses populaires acadiennes. Plusieurs municipalités critiquent cette proclamation, dont Shippagan.
Acadianité, Acadiens, Brayons et Cadiens.
L'acadianité est la définition de ce qu'est un Acadien, qui se résume bien souvent au sentiment d'appartenance à l'Acadie. Ce sentiment serait apparu dès le XVIIe siècle et aurait été engendré par l'isolement de l'Acadie face aux autres colonies de la Nouvelle-France. La première mention écrite du mot Acadien a lieu en 1699
La définition officielle de l'acadianité fut choisie lors de la première Convention nationale acadienne à Memramcook, en 1881: un francophone catholique, descendant soit d'un colon établi dans l'ancienne Acadie, soit d'un déporté. Cette définition est moins bien acceptée de nos jours. En effet, certaines communautés sont anglicisées ou en voie d'anglicisation, le catholicisme n'est plus la seule religion et la pratique religieuse est en baisse tandis que l'Acadie n'est plus isolée comme autrefois et le nombre de mariages interethniques s'accroit, sans oublier que la population est de plus en plus consciente des origines diverses de plusieurs familles.
Les Acadiens sont enclins à s'identifier avant tout à leur ville, leur région, leur province ou leur pays avant de s'identifier à l'Acadie.Parmi toutes les régions, le Madawaska est celle ayant le plus fort sentiment identitaire distinctif. Une partie des habitants se considèrent comme des Brayons au lieu d'Acadiens. Le Madawaska possède plusieurs symboles dont un drapeau, des armoiries, un plat national ainsi qu'une Foire brayonne, alors que le nom de République du Madawaska est toujours utilisé de façon symbolique. Les Acadiens du Maine, en particulier ceux du Madawaska, sont depuis les années 1970 de plus en plus conscients de leur acadianité et maintiennent d'importants liens avec la partie canadienne du Madawaska, bien qu'ils se considèrent avant tout Américains. Les Acadiens du Québec sont rarement au courant de leur origine, qu'ils découvrent souvent en faisant leur arbre généalogique. Les Cadiens sont intimement liés aux Acadiens, car ils descendent d'expatriés acadiens et d'autres immigrants établis en Louisiane vers la fin du XVIIIe siècle. Les Cadiens sont fréquemment appelés Cajuns, un anglicisme dérivé de l'ancienne prononciation acadienne du mot acadien, acadjonne.
Culture de l'Acadie.
La musique et le folklore demeurent les formes d’expression artistiques les plus répandues jusqu’au milieu du XXe siècle. La marginalisation géographique et économique des régions acadiennes ont ainsi causé un isolement culturel. L’arrivée de l’enseignement supérieur et l’ouverture au monde des années 1960 provoquent une effervescence de la culture acadienne, qui se diversifie dans l’artisanat, la peinture, la sculpture, la musique, la danse, le théâtre, le cinéma ou la littérature.
Architecture acadienne.
Église Sainte-Anne du Ruisseau
L'architecture acadienne puise son origine en France mais s'adapte rapidement aux conditions climatiques et aux matériaux locaux ; des techniques de construction micmaques et malécites sont ainsi adoptées pour améliorer l'isolation des maisons. Après la destruction presque totale causée par la Déportation des Acadiens, les maisons sont de piètre qualité et construites à la hâte. Malgré l'amélioration des conditions de vie, l'architecture reste simple jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les traces d'inspiration française s'effacent alors progressivement devant les influences américaine et anglaise. Les premiers architectes acadiens débutent leur carrière vers la fin du siècle. Léon Léger est reconnu pour son couvent de l'Immaculée-Conception de Bouctouche et Nazaire Dugas a dessiné le Château Albert. Des matériaux comme la brique font progressivement leur apparition. Il est difficile de définir un style typique acadien puisque aucune étude exhaustive n'a été effectuée à ce sujet. Plusieurs villages historiques ont été construits depuis les années 1970 et de nombreux nouveaux édifices s'harmonisent avec l'architecture traditionnelle.
Arts Histoire de l'art en Acadie, Cinéma acadien, Littérature acadienne, Musique acadienne et Théâtre acadien.
Peinture et sculpture Paul Carmel Laporte
Jusqu'au début du XXe siècle, la sculpture et la peinture est surtout réalisées par les décorateurs d'églises. Parmi les principales œuvres toujours existantes, notons celles de Philomène Belliveau, Caroline Léger, Anna Bourque-Bourgeois, Jeanne Léger, Alma Buote et Yolande Boudreau, qui ont toutes étudié l'art à l'étranger. À partir des années 1930, le docteur Paul Carmel Laporte enseigne la sculpture et le dessin à Edmundston et forme plusieurs artistes de renom, dont Claude Picard, Claude Roussel et Marie Hélène Allain. À la même époque, plusieurs autres doivent suivre des cours à l'extérieur avant de poursuivre leur carrière en Acadie, dont Gertrude Godbout, Eulalie Boudreau, René Hébert, Georges Goguen, Roméo Savoie, Hilda Lavoie-Franchon et Claude Gauvin. Certains réalisent des peintures religieuses et murales pour les églises, dont Édouard Gautreau, Claude Picard et Ernest Cormier. L'église Sainte-Anne-de-Kent, qui comptait entre autres des tableaux de Gautreau, était surnommée la chapelle Sixtine de l'Acadie jusqu'à sa destruction dans un incendie en 2007. Nelson Surette se fait connaître grâce à ses tableaux représentant la vie quotidienne. Adrien Arsenault est aussi reconnu. Nérée De Grâce puise son inspiration dans le folklore acadien et ses tableaux se retrouvent dans plusieurs collections à travers le monde, ainsi que sur un timbre canadien. Les musées canadiens possèdent des œuvres d'autres artistes, dont les plus connus sont les sculpteurs Arthur Gallant, Alfred Morneault et Octave Verret ainsi que les peintres Léo B. LeBlanc, Médard Cormier et Camille Cormier.
En 1963, Claude Roussel met sur pied le département d'arts visuels de l'Université de Moncton. Les diplômés les plus prolifiques sont l'artiste multidisciplinaire Herménégilde Chiasson et le peintre Yvon Gallant mais on compte aussi Paul Édouard Bourque, Jacques Arseneault, Francis Coutellier, Marc Cyr, Pierre Noël LeBlanc, Anne-Marie Sirois, Lucille Robichaud, Lionel Cormier, Luc A. Charette, Daniel Dugas, Guy Duguay, Roger Vautour, Ghislaine McLaughlin, Gilles LeBlanc, Georges Blanchette, Gilles Arsenault, Hélène LaRoche, André Lapointe, Robert Saucier, Jocelyn Jean et Paul-Émile Saulnier.
Musique Natasha St-Pier
Au XIXe siècle, les communautés religieuses jouent un rôle important dans le développement de la musique acadienne alors que les fanfares des collèges et les chorales paroissiales deviennent rapidement populaires. Plusieurs musiciens dont Arthur Leblanc et Anna Malenfant se font connaître à l'étranger à partir du XXe siècle. À partir des années 1960, les musiciens sont inspirés par le folklore, comme Angèle Arsenault, Édith Butler, Calixte Duguay, Donat Lacroix et les groupes 1755 et Beausoleil-Broussard, tandis que Patsy Gallant jouit d'une grande popularité au Québec avec des genres variés. La musique se diversifie ensuite en plusieurs genres, dont le country Cayouche, le pop Danny Boudreau, Jean-François Breau, Wilfred LeBouthillier, Natasha St-Pier, Roch Voisine, Marie-Jo Thério, le hip-hop Radio Radio, le jazz Les Païens et le rock Christian Kit Goguen, Trans Akadi alors que la musique folklorique reste populaire Barachois, Grand Dérangement, La Virée, Ode à l'Acadie, Zéro Degrés Celcius. Le Gala de la chanson de Caraquet est le principal événement musical. Un instrument d'invention acadienne est la tritare.
Littérature
Marc Lescarbot donne naissance à la littérature acadienne et au théâtre acadien à Port-Royal en 1606 en produisant Le Théâtre de Neptune. Plusieurs visiteurs ainsi que des prêtres ont ensuite écrit sur la géographie ainsi que sur les conditions religieuses et économiques. La situation politique trouble et la lente croissance de la population expliquent le faible nombre de textes produits par les Acadiens durant cette période. Après la Déportation, la littérature prend du temps à réapparaître mais la tradition orale reste florissante. Avec la fondation d'écoles et de collèges au XIXe siècle puis les Conventions nationales acadiennes, les Acadiens et leur clergé commencent à redécouvrir leur identité et leurs aspirations dans un monde d'anglophones. Jusqu'aux années 1960, la littérature est dominée par le débat nationaliste. La redécouverte de l'histoire de l'Acadie donne lieu à un nombre important de textes, en particulier ceux de Pascal Poirier. Au XXe siècle, le nationalisme devient moins important et plusieurs auteurs dont Antonine Maillet se penchent sur d'autres sujets. Plusieurs auteurs de la diaspora publient durant les années 1960, dont Donat Coste et Rénald Després. Dès 1966, les plus jeunes auteurs remettent en question les valeurs traditionnelles ; ce mouvement est amplifié par la Révolution tranquille au Québec, par les réformes de Louis Robichaud au N.-B., par les grèves étudiantes et par le succès phénoménal de La Sagouine d'Antonine Maillet. La poésie est la première forme littéraire à suivre cette tendance ; le roman est dominé par l'œuvre d'Antonine Maillet mais de nombreux autres auteurs sont à remarquer. Depuis le milieu des années 1980, la littérature acadienne se porte très bien, ce qu'illustre le nombre grandissant des maisons d'éditions et la reconnaissance dont elle jouit tant en Amérique qu'en Europe. Les œuvres sont de genres variés et la littérature pour enfants se développe.
Théâtre acadien.
La première pièce, Le Théâtre de Neptune, fut créée par Marc Lescarbot en 1606. Il n'y a ensuite plus de théâtre durant deux siècles en raison du contexte socio-économique et politique difficile. La tradition orale devint toutefois florissante et a une influence jusqu'à ce jour. Des collèges, notamment le Collège Saint-Joseph de Memramcook, s'intéressent au théâtre dès 1864. Des professeurs comme Alexandre Braud et Jean-Baptiste Jégo créent des pièces très populaires. Des nationalistes comme Pascal Poirier et James Branch créent aussi des pièces de théâtre paroissiales. Les premières troupes indépendantes sont fondées dans les années 1950.
La production de Les Crasseux d'Antonine Maillet en 1968 est considérée comme le véritable début du théâtre acadien. Un programme d'arts dramatiques est créé l'année suivante à l'Université de Moncton et les troupes Les Feux chalins et le Théâtre amateur de Moncton sont fondées la même année. Présentée en 1971, La Sagouine d'Antonine Maillet connait un succès phénoménal à la suite de sa mise en scène au Théâtre du Rideau Vert de Montréal en 1972. Elle a depuis été représentée à plus de 2000 reprises avec Viola Léger en tant qu'unique interprète.
Le Théâtre populaire d'Acadie, la première troupe professionnelle, est fondée en 1974 à Caraquet. Elle produit, entre autres, Louis Mailloux de Jules Boudreau et Calixte Duguay ainsi que Le Djibou de Laval Goupil. Le Théâtre l'Escaouette est fondé en 1977 à Moncton et donne une grande place à l'œuvre d'Herménégilde Chiasson. Antonine Maillet poursuivit sa carrière, autant au théâtre qu'en littérature. Le théâtre acadien se diversifie dans ses genres et ses thèmes ; le TPA se concentre sur le répertoire alors que le Théâtre l'Escaouette favorise la création. La dramaturgie s'améliore mais le manque de textes acadiens est difficile à combler.
Le contexte économique difficile des années 1980 force les troupes à annuler des productions et la Compagnie Viola-Léger à cesser ses activités en 1989. Les troupes se redirigent vers les productions pour enfants, où les textes d'Herménégilde Chiasson se démarquent. Le Pays de la Sagouine est fondé en 1992 à Bouctouche d'après l'œuvre d'Antonine Maillet. De plus en plus de pièces de théâtre sont publiés. Le théâtre redevient plus adulte au milieu des années 1990, et connait un renouveau par la fondation de nouvelles troupes, dont Moncton Sable en 1996, et l'arrivée de nouveaux dramaturges, dont Gracia Couturier. La place qu'occupe les productions québécoises s'attire toutefois des critiques. Quelques nouveaux succès critiques et financiers, dont la reprise de la pièce Louis Mailloux, ainsi que la fondation de festivals, mettent tout de même en valeur les créations typiquement acadiennes.
Cinéma
Le pionnier du cinéma acadien dans les années 1950, Léonard Forest, est l'instigateur du studio de Moncton de l'Office national du film du Canada, où furent réalisés la plupart des films acadiens. Éloge du Chiac par Michel Brault ainsi que L'Acadie, l'Acadie de Brault et Pierre Pereault marquent réellement les débuts de l'expression acadienne en 1969. La plupart des films acadiens sont des documentaires et des courts ou moyens métrages ; il y a toutefois quelques longs métrages, dont Le Secret de Jérôme et Lost Song alors que certains réalisateurs ont fait incursion dans le domaine de la fiction et de l'animation. Parmi les cinéastes notoires, mentionnons Bettie Arsenault, Robert Awad, Renée Blanchar, Rodolphe Caron, Herménégilde Chiasson, Phil Comeau, Claudette Lajoie, Christien Leblanc, Monique Leblanc, Ginette Pellerin, Jacques Savoie et Anne-Marie Sirois. Les principaux acteurs et réalisateurs font carrière à Hollywood: les frères Joseph De Grasse et Sam De Grasse au début du XXe siècle et Robert Maillet au XXIe siècle. Le Festival international du cinéma francophone en Acadie, de Moncton, est le principal événement annuel.
Bande dessinée et télévision
Acadieman est probablement la première bande dessinée acadienne, créée par Daniel Dano Leblanc au début des années 20001 ; adapté en série animée à partir de 2005, le succès du personnage mène à la production du long métrage Acadieman vs. le C.M.A. en 2009. Une autre série télévisée notable est Belle-Baie, diffusée depuis 2008.
Artisanat acadien.Fabrication d'un tapis houqué
L'artisanat acadien est avant tout traditionnel. La courtepointe est un artisanat très populaire et bien qu'Evelyn Coutellier a créé des motifs originaux, la plupart des artisanes conservent les motifs traditionnels en ne changeant que les couleurs. Chéticamp est reconnu pour ses tapis houqués, qui sont généralement fait en série mais certaines houqueuses comme Elizabeth LeFort se sont fait connaître par leurs murales. Les Tisserands du Madawaska, dans la région éponyme, produisent des vêtements et des napperons. La plupart des régions acadiennes de cette province comptent des tisseurs, des sculpteurs sur bois et d'autres sortes d'artisans. On en retrouve aussi à la Baie-Sainte-Marie. Adrienne Landry de Dieppe était auparavant la seule tisseuse d'expérience du sud-est du N.-B. Les Artisans de St-Louis se sont par la suite orientés vers le tissage à l'aide d'une formation financée par le Développement régional. La Coopérative d'artisanat de St-Paul s'est quant à elle dirigée en symmographie artisanat à base de ficelles et ses plaquettes représentant La Sagouine sont très populaires. Plusieurs ateliers de poterie ont été aménagés par des diplômés en céramique, comme Les Métiers d'art du Nord-Est par les Frachon, le studio Keramos de Cocagne par Ronald Gauguen, Fernand Daigle à Saint-Louis-de-Kent et Nancy Morin à Moncton.
Cuisine acadienne.Une poutine à trou
La cuisine acadienne est d'origine française mais on trouve plusieurs autres influences, particulièrement canadiennes françaises, amérindiennes et même allemandes. Il y a en fait plusieurs cuisines régionales. La plupart des ingrédients sont disponibles sur places alors que certains proviennent d'un commerce ancien avec les Antilles et le Brésil, comme les raisins secs, le riz, la cassonade et la mélasse. La pomme de terre est l'aliment de base et le poisson et les fruits de mer sont très populaires.
Folklore acadien.Anselme Chiasson
Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'isolement de l'Acadie permet la préservation d'un folklore varié, transmis de générations en générations. Les chansons du début du XXe siècle témoignent de l'éveil à la culture. Le folklore est en quelque sorte méprisé par l'élite jusqu'à ce que le journal L'Évangéline publie à partir de 1939 une chronique de Thomas LeBlanc sur les chansons acadiennes. Anselme Chiasson et Daniel Boudreau y publient aussi le recueil Chansons d'Acadie entre 1942 et 1956. Des chercheurs étrangers s'intéressent dès lors au folklore acadien, tôt imités par les Acadiens eux-mêmes. L'Université de Moncton enseigne le folklore depuis 1966 et son Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson possède une importante collection à ce sujet, s'ajoutant par exemple à celle de l'Université Lavala . Le folklore inspire également de nombreux auteurs, dont Antonine Maillet.
Diaspora acadienne et rayonnement.
L'Acadiane dans la Louisiane ; la partie foncée est celle où la culture cadienne est la plus présente.
L'influence culturelle de l'Acadie se ressent surtout aux États-Unis et au Canada. En plus des 500 000 Acadiens des provinces de l'Atlantique, il y aurait en tout un million d'Acadiens ou de Cadiens en Louisiane, un million en Nouvelle-Angleterre, un million au Québec et probablement 300 000 en France, soit un total d'au moins 3,8 million dans le monde.
Les Cadiens sont en intimement liés aux Acadiens car ils descendent d'expatriés acadiens et d'autres immigrants établis en Louisiane vers la fin du XVIIIe siècle. L'Acadiane, en Louisiane, est d'ailleurs un territoire officiellement reconnu.
Une trentaine de villes et de régions presque partout au Québec peuvent être considérées comme des Cadies173. À noter que plusieurs de ces communautés ne sont plus de culture acadiennes de nos jours et que les Acadiens n'ont parfois été que de passage dans certaines d'entre elles. Aux États-Unis, il y a des communautés acadiennes au nord du Maine Madawaska, ainsi que des minorités significatives dans plusieurs villes de la Nouvelle-Angleterre et en Floride. Les Cadiens sont présents au sud-ouest de la Louisiane Acadiane et au sud-est du Texas Beaumont, Port Arthur. Il y a finalement une minorité significative dans la région de Los Angeles. En France, on compte entre autres Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane, Belle-Île-en-Mer en Bretagne, Archigny en Poitou-Charentes ainsi qu’une minorité à Nantes et Saint-Malo.
Le français cadien est influencé par le français acadien. Le Conseil pour le développement du français en Louisiane CODOFIL est une agence de l'État pour la promotion de l'usage du français dans la population de Louisiane. La population anglophone du nord de l'état américain du Maine a tendance à adopter la syntaxe et du vocabulaire français à cause de la présence d'Acadiens dans la région. L'anglais cadien est d'ailleurs un dialecte d'anglais parlé par les Cadiens anglicisés.
La cuisine cadienne a été introduite en Louisiane par les Acadiens. Elle reprend donc des influences acadiennes et originellement françaises, à laquelle s'ajoutent des influences espagnoles, africaines, anglo-américaines, antillaises et amérindiennes.
La musique cadienne, originaire de Louisiane, est un mélange de genres musicaux et d'influences culturelles. Elle est liée à la musique country et au Western Swing mais puise ses racines dans la musique acadienne du XVIIIe siècle. Ses instruments de prédilection sont le violon puis l'accordéon. Viennent ensuite la guitare, le 'tit fer triangle, le frottoir planche à laver et la musique à bouche harmonica. Les premiers enregistrements datent de 1928. Le zarico, ou zydeco est un genre musical dérivé de la musique cadienne. La musique cadienne est en effet très populaire et de nombreux musiciens appartiennent à d'autres cultures. Cette musique se chante ainsi autant en français cadien qu'en anglais, en créole ou d'autres langues. Parmi les musiciens notoires, mentionnons Zachary Richard, Cléoma Falcon et Joe Falcon.
Les exilés en Louisiane développent trois styles d'architecture, dont l'un inspiré de l'architecture acadienne traditionnelle. Ces différents styles ne sont plus utilisés à partir de 1911 mais reviennent à la mode depuis les années 1990. De nombreux exemples d'architecture acadienne par ailleurs visibles au Maine, au Québec et en France.
Liens
http://youtu.be/AswOGfiMj7w Samuel de Champlain 1
http://youtu.be/aUPnrdaoi_Y Samuel de Champlain 2
http://youtu.be/7ddxfGZsw_Y Samuel de Champlain 3
http://youtu.be/r-qZadzS0NI La déportation
http://youtu.be/H0FaxyKKc0A 1Canada histoire et population
http://youtu.be/VSPKy0jJlOY Canada histoire 2
http://youtu.be/wEG_8g84s3E Canada Histoire 3
http://youtu.be/RFPZm7TmXX0 Canada Histoire 4
http://youtu.be/9btGke_I7Cs Canada Histoire 5
http://youtu.be/drZrsps5SYY Canada histoire 6
http://youtu.be/A3X1lYJ0rVg Chansons Acadiennes
http://youtu.be/iBIQcsp4BOc Retour en Acadie
http://youtu.be/XCWIXIEizKM Zachary Richard
http://youtu.be/vC7i9KoWrV4 Zachary Richard Lutte de l'acadie
http://youtu.be/XCWIXIEizKM Chanson acadienne
http://youtu.be/XCWIXIEizKM Leçon de turlutte acadienne
http://youtu.be/BYKDOzUY3UQ?list=PLAF0A61AB16EF0945 34 Vidéos du folklore acadien
http://youtu.be/0l1EYNoHY1A Vive le Quebec libre
http://youtu.be/MnuwsREDINU Mystère d'archive, "vive le Quebec libre"
   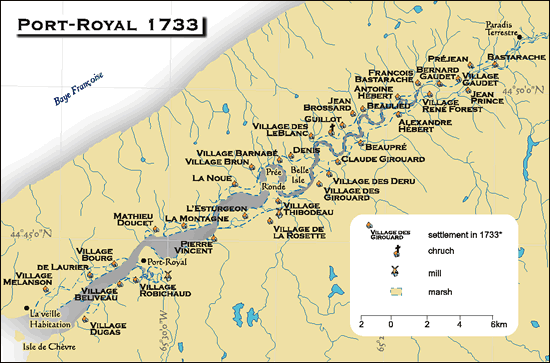    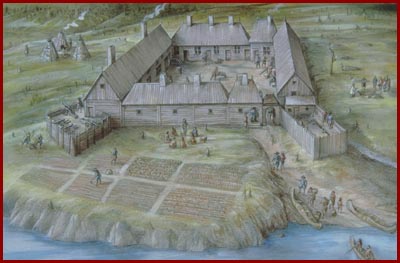     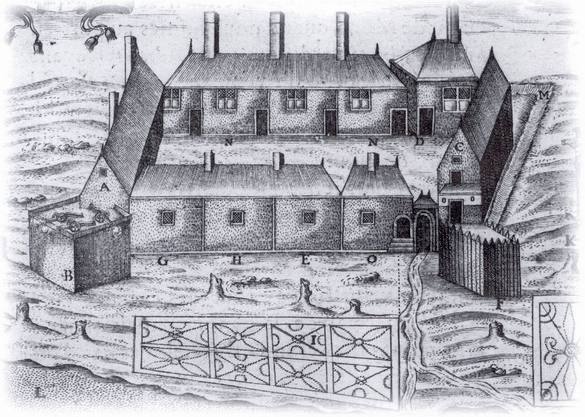    [img width=600]http://www.sapr.ca/wp-content/upl
Posté le : 25/07/2014 11:17
Edité par Loriane sur 26-07-2014 22:42:07
Edité par Loriane sur 27-07-2014 10:16:17
Edité par Loriane sur 27-07-2014 10:18:14
Edité par Loriane sur 27-07-2014 10:18:27
|
|
|
|
|
Robert II 1 début |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Le 20 juillet 1031, à 59 ans, meurt au château de Melun Robert II de France
surnommé Robert le Pieux
né à Orléans vers 972. Fils d’Hugues Capet et de son épouse Adélaïde d'Aquitaine, il est le deuxième roi franc de la dynastie capétienne. Il règne de 996 à 1031 et est ainsi l'un des souverains de l’an mil.
Roi des Francs 24 octobre 996 – 20 juillet 1031 durant 34 ans, 8 mois et 26 jours, il est Couronné le 25 décembre 987 à Orléans son Prédécesseur est Hugues Capet
et son Successeur Henri Ier. Il porte le titre de de Duc de Bourgogne de novembre 1005 – janvier 1016 c'est à dire durant environ 10 ans, 2 mois à la suite de Otte-Guillaume de Bourgogne et il sera Succedé par Henri Ier. Il appartient à la dynastie des capétiens, il a pour Conjointe Rozala d'Italie, Berthe de Bourgogne puis Constance d'Arles. Il a pour descendance avec Constance d'Arles, Gisèle de France, Alix de France, Hugues de France, Henri de France, Adèle de France, Robert de France, Eudes, la famille royale à pour Résidence le Palais de la Cité, Château de Compiègne, Château de Melun, Château de Senlis, Château d'Étampes, Château de Poissy, Château de Vauvert, Château de Saint-Léger, Château de Vitry-aux-Loges et le Château de Montreuil.
Sa vie
Associé dès 987 à la royauté, il assiste son père sur les questions militaires avec le siège par deux fois, en 988 et 991 de Laon. Sa solide instruction, assurée par Gerbert d'Aurillac à Reims, lui permet de s’occuper des questions religieuses dont il devient rapidement le garant il dirige le concile de Verzy en 991 et celui de Chelles en 994. Poursuivant l’œuvre politique de son père, après 996, il parvient à maintenir l’alliance avec la Normandie et l’Anjou et à contenir les ambitions d'Eudes II de Blois.
Au prix d’une longue lutte débutée en avril 1003, il conquiert le duché de Bourgogne qui aurait dû lui revenir en héritage à la mort, sans descendance directe, de son oncle Henri Ier de Bourgogne, mais que ce dernier avait transmis à son beau-fils Otte-Guillaume.
Les déboires conjugaux de Robert le Pieux avec Rozala d'Italie et Berthe de Bourgogne qui lui valent une menace d’excommunication, puis la mauvaise réputation de Constance d'Arles, contrastent étrangement avec l’aura pieuse, à la limite de la sainteté, que veut bien lui prêter son biographe Helgaud de Fleury dans la Vie du roi Robert le Pieux Epitoma vitae regis Roberti pii.
Sa vie est alors présentée comme un modèle à suivre, faite d’innombrables donations pieuses à divers établissements religieux, de charité envers les pauvres et surtout de gestes considérés comme sacrés, telle que la guérison de certains lépreux : Robert est le premier souverain considéré comme thaumaturge. La fin de son règne révèle la relative faiblesse du souverain qui doit faire face à la révolte de son épouse Constance d'Arles puis de ses propres fils Henri et Robert entre 1025 et 1031.
L’historiographie se consacre depuis longtemps à l’époque de Robert le Pieux, l’an mil, et s’est attachée à décrire l’instauration de la paix de Dieu qui visait à canaliser les seigneurs et assurer la protection des biens de l’Église et des seigneuries. Par ailleurs, si, depuis Jules Michelet, les historiens ont longtemps avancé que le passage à l’an mil avait provoqué des peurs collectives de fin du monde, cette thèse a été réfutée par l'historien Georges Duby puis par Sylvain Gouguenheim, professeur d'histoire médiévale à l'École normale supérieure de Lyon. En fait, la fin du xe siècle et la première moitié du XIe siècle connaissent le début d’un changement économique et social avec l’augmentation de la productivité agricole et des capacités d’échanges permises par le développement de l’usage du denier d’argent. Dans le même temps, la fin des invasions et les continuelles guerres personnelles entraînent, à partir de 1020, la prolifération des châteaux privés, du haut desquels le droit de ban s’impose, ainsi que l’émergence de la chevalerie, nouvelle élite sociale qui tient son origine des cavaliers carolingiens.
Contrairement à son père Hugues Capet, nous avons conservé une littérature contemporaine de Robert le Pieux, exclusivement ecclésiastique, qui évoque la vie du roi. En premier lieu, il y a la biographie écrite par Helgaud de Fleury Epitoma vitae regis Roberti pii, v. 1033, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, qui n’est en réalité qu’un panégyrique voire une hagiographie du souverain. Autres sources exceptionnelles sont les Histoires v. 1026-1047 du moine bourguignon Raoul Glaber. Homme de haute culture, il est, par son réseau clunisien, très bien renseigné sur l’Occident tout entier. Raoul est de loin l’informateur le plus complet sur le règne de Robert le Pieux. Secondairement, il faut noter la traditionnelle Histoire de Richer de Reims et le poème que l’évêque Adalbéron de Laon, dit Ascelin, a adressé à Robert, décrivant ainsi la société de son temps.
Robertiens et Hugues Capet.L’unique héritier du duc des Francs
Comme pour son père Hugues Capet, on ne connaît ni la date, ni le lieu précis de la naissance de Robert, et cela bien que les historiens penchent fortement pour l’année 972 et pour Orléans, capitale du duché robertien depuis le ixe siècle. Le fils unique du duc des Francs, Hugues, et de sa femme, Adélaïde de Poitiers, se prénomme Robert comme son ancêtre héroïque Robert le Fort, qui est mort en combattant les Vikings en 866. Le reste de la progéniture royale est composé de trois sœurs : Gisèle, Edwige et Adélaïde.
Au Xe siècle, la famille des Robertiens est le clan aristocratique le plus puissant et le plus illustre du royaume de Francie. Durant les décennies précédentes, deux de ses membres sont déjà montés sur le trône, évinçant déjà la dynastie carolingienne : Eudes Ier 888 et Robert Ier 922. Le principat d’Hugues le Grand, duc des Francs et grand-père de Robert le Pieux, marque l’apogée des Robertiens jusqu’à sa mort en 956. Néanmoins à partir du milieu du xe siècle, Hugues Capet, qui lui a succédé à la tête du duché et malgré un rayonnement encore important, ne parvient pas à s’imposer comme son père.
La jeunesse de Robert est surtout marquée par les combats incessants du roi Lothaire pour récupérer la Lorraine, berceau de la famille carolingienne, aux dépens de l’empereur Otton II :
" Comme Otton possédait la Belgique la Lorraine et que Lothaire cherchait à s’en emparer, les deux rois tentèrent l’un contre l’autre des machinations très perfides et des coups de force, car tous les deux prétendaient que leur père l’avait possédée "
En août 978, le roi Lothaire lance à l'improviste un assaut général sur Aix-la-Chapelle où réside la famille impériale qui échappe de peu à la capture. Après avoir pillé le palais impérial et les alentours, il retourne en Francie en emportant les insignes de l'Empire. Au mois d'octobre suivant, pour se venger, Otton II réunit une armée forte de soixante mille hommes et envahit le royaume de Lothaire. Ce dernier, n'ayant que peu de troupes autour de lui, est contraint de se réfugier chez Hugues Capet, qui passe pour être le sauveur de la royauté carolingienne. La dynastie robertienne prend alors un virage qui bouleverse le destin du jeune Robert. L’évêque Adalbéron de Reims, à l’origine homme du roi Lothaire, se tourne de plus en plus vers la cour ottonienne pour laquelle il éprouve une grande sympathie.
Une éducation exemplaire
Denier anonyme attribuable à Reims et à l'archevêque Gerbert d'Aurillac ou à Arnoul, fin du Xe siècle.
Hugues comprend rapidement que son ascension ne peut se faire sans l’appui de l’archevêque de Reims. Lui-même illettré, ne maîtrisant pas le latin, il décide d’envoyer Robert, vers 984, non pas chez l’écolâtre Abbon de Fleury, près d’Orléans, mais chez Adalbéron afin qu’il le forme aux rudiments de la connaissance. En effet, à la fin du Xe siècle, Reims a la réputation d’être la plus prestigieuse école de tout l’Occident chrétien. Le prélat accueille volontiers Robert, qu’il confie à son secrétaire le fameux Gerbert d'Aurillac, l’un des hommes les plus instruits de son temps.
On suppose que pour suivre l’enseignement de Gerbert, le jeune garçon dut acquérir les bases du latin. Il enrichit ainsi ses connaissances en étudiant le trivium c’est-à-dire ce qui se réfère à la logique : grammaire, rhétorique et dialectique et le quadrivium c’est-à-dire les sciences : arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Robert est l’un des rares laïcs de son temps à profiter de la même vision du monde que les clercs. Après environ deux années d’études à Reims, il regagne Orléans. Son niveau intellectuel s’est aussi développé dans le domaine musical, comme le reconnaît un autre grand lettré de son temps, Richer de Reims. D’après Helgaud de Fleury, à un âge inconnu de son adolescence, le jeune robertien tombe gravement malade, à tel point qu’Hugues et Adélaïde craignent pour sa vie. C’est alors que ses parents vont prier à l’église Sainte-Croix d’Orléans et offrent un crucifix d’or et un vase somptueux de 60 livres 30 kg en offrande. Robert guérit miraculeusement.
Sa pieuse mère l’envoya aux écoles de Reims et le confia au maître Gerbert, pour être élevé par lui et instruit suffisamment dans les doctrines libérales.
L’association de Robert au trône 987
Devenu roi des Francs, Hugues souhaite en finir avec l'alternance entre Carolingiens et Robertiens pour le trône de France. Eudes en 898 et Robert Ier en 923 ayant eu des Carolingiens pour successeurs. C’est ainsi, qu’il propose à Adalbéron l’association de Robert au trône. L’archevêque de Reims est hostile à cette proposition et selon Richer, il aurait répondu au roi, on n’a pas le droit de créer deux rois la même année. On pense que Gerbert d’Aurillac qui est lui-même proche de Borell II qui fut un temps son protecteur, serait alors venu au secours d’Hugues pour convaincre le prélat d’évoquer l’appel du comte Borell II, comte de Barcelone, demandant l’aide du nouveau roi pour lutter contre Al-Mansur. Si Hugues venait à mourir, qui lui succéderait ? Sous la contrainte, Adalbéron cède.
À la différence de celui d’Hugues Capet, le sacre de Robert est raconté précisément par Richer de Reims jour et lieu bien identifiés. Vêtu de pourpre tissé de fils d’or, comme le voulait la tradition, le jeune garçon de quinze ans est acclamé, couronné puis sacré par l’archevêque de Reims le 25 décembre 987 dans la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans. Le chroniqueur souligne que Robert est seulement roi des peuples de l’Ouest, depuis la Meuse jusqu’à l’Océan et non pas roi des Gaulois, des Aquitains, des Danois, des Goths, des Espagnols et des Gascons comme son père. Aussitôt associé, Hugues veut pour son fils une princesse royale mais l’interdiction d’épouser des personnes sous le seuil du troisième degré de parenté, l’oblige à chercher en Orient. Il fait rédiger une lettre de la plume de Gerbert qui demande au basileus, Basile II, la main de sa fille pour le jeune Robert. Aucune réponse ne parvient. Finalement, sous la pression de son père, Robert doit épouser, au printemps 988, Rozala d'Italie, trentenaire et veuve d’Arnoul II, comte de Flandre et fille de Bérenger II, roi d’Italie. Elle apporte à la royauté capétienne Montreuil, le Ponthieu et une possible tutelle sur la Flandre étant donné le jeune âge de son fils Baudouin IV.
Le corps épiscopal, premier soutien du roi Robert dirige les affaires religieuses
Sacré et marié, Robert collabore avec son père comme le prouve son signum au bas de certains actes d’Hugues Capet. À partir de 990, tous les actes ont sa souscription. Dans les actes écrits : Robert, roi très glorieux comme le souligne une charte pour Corbie avril 988 ou encore filii nostri Rotberti regis ac consortis regni nostri dans une charte pour Saint-Maur-des-Fossés juin 989. Fort de son instruction reçue de Gerbert d’Aurillac, sa tâche, dans un premier temps, est de présider les synodes épiscopaux :
"Il Robert assistait aux synodes les évêques pour discuter avec eux des affaires ecclésiastiques."
Contrairement aux derniers Carolingiens, les premiers Capétiens s’attachent un clan d’évêques au nord-est de Paris Amiens, Laon, Soissons, Châlons, etc. dont le soutien se montrera déterminant dans la suite des événements. Dans un de leurs diplômes, les deux rois apparaissent comme les intermédiaires entre les clercs et le peuple mediatores et plebis et sous la plume de Gerbert d’Aurillac, ils insistent sur cette nécessité de consilium :
…ne voulant en rien abuser de la puissance royale, nous décidons toutes les affaires de la res publica en recourant aux conseils et sentences de nos fidèles . Hugues et Robert ont besoin de l’appui de l’Église pour asseoir davantage leur légitimité et également parce que les contingents de cavaliers qui composent l’armée royale, proviennent en grande partie des évêchés. Robert apparaît déjà aux yeux de ses contemporains comme un souverain pieux d’où son surnom et proche de l’Église pour plusieurs raisons :
il s’adonne aux arts libéraux ;
il est présent aux synodes des évêques ;
Abbon de Fleury lui dédie spécialement sa collection canonique ;
Robert pardonne facilement à ses ennemis ;
les abbayes reçoivent de nombreux dons de sa part.
Charles de Lorraine s’empare de Laon 988-991
Justement, les deux rois, Hugues et Robert ont besoin de contingents envoyés par les évêchés puisque la cité de Laon vient d’être prise d’assaut par Charles de Lorraine, dernier prétendant carolingien au trône. Les souverains assiègent par deux fois la ville sans résultat22. Préoccupé par son échec laonnois, Hugues contacte plusieurs souverains afin d’obtenir leur aide le pape Jean XV, l’impératrice Théophano, mère du jeune Otton III), en vain. Après la mort d’Adalbéron de Reims, 24 janvier 989, Hugues Capet décide de faire élire comme nouvel archevêque le carolingien Arnoul, un fils illégitime du roi Lothaire, plutôt que Gerbert. On pense qu’il s’agit d’apaiser les partisans du carolingien, mais la situation se retourne contre les Capétiens puisque Arnoul livre Reims à Charles.
La situation se débloque grâce à la trahison d’Adalbéron Ascelin, évêque de Laon, qui s’empare de Charles et d’Arnoul pendant leur sommeil et les livre au roi : l’épiscopat sauve la royauté capétienne in extremis. S’en suit le concile de Saint-Basle de Verzy où Arnoul le traître est jugé par une assemblée présidée par Robert le Pieux juin 991. Malgré les protestations d’Abbon de Fleury, Arnoul est déposé. Quelques jours plus tard, Gerbert d’Aurillac est nommé archevêque de Reims avec l’appui de son ancien élève Robert. Le pape Jean XV n’accepte pas cette procédure et veut convoquer un nouveau concile à Aix-la-Chapelle, mais les évêques confirment leur décision à Chelles hiver 993-994.
Gerbert et Ascelin : deux figures de déloyauté
Lorsque son maître Adalbéron de Reims meurt, Gerbert est dans l’obligation de suivre les intrigues du nouvel archevêque Arnoul, décidé à livrer Reims à Charles de Lorraine. Bien que la documentation soit très lacunaire à ce sujet, il semblerait que l’écolâtre ait changé par la suite ses positions pour devenir le partisan de Charles :
"Le frère de Lothaire Auguste, héritier du trône, en a été expulsé. Ses concurrents, Hugues et Robert, beaucoup de gens le pensent, ont reçu l’intérim du règne. De quel droit l’héritier légitime a-t-il été déshérité ?"
Un doute en légitimité s’installe sur la couronne d’Hugues et de Robert. Ce même Gerbert, voyant la situation changer en défaveur de Charles de Lorraine, change de camp durant l’année 991. Devenu archevêque de Reims par la grâce du roi Robert il témoigne :
"De l’assentiment des deux princes Hugues et Robert, monseigneur Hugues Auguste et l’excellentissime roi Robert. "
Quant à Ascelin, l'évêque de Laon, après avoir servi la couronne en trahissant Charles et Arnoul, il se retourne contre elle. On sait qu’au printemps 993, il s’allie avec Eudes Ier de Blois afin de planifier la capture d’Hugues et de Robert en accord avec Otton III. Ainsi Louis le fils de Charles de Lorraine deviendrait roi des Francs, Eudes duc des Francs, et Ascelin évêque de Reims. L’intrigue est dénoncée et ce dernier est placé en résidence surveillée.
Les problèmes conjugaux Un amour pour Berthe de Bourgogne 996-1003
Après environ trois ou quatre années de mariage vers 991-992, le jeune Robert répudie Rozala ou Suzanne que son père l'avait forcé à épouser en dépit de l’âge déjà avancé de la mariée environ 35 ans. Elle est invitée à repartir dans ses domaines en Flandre rejoindre son fils Baudouin IV. En revanche, Robert a pris le soin de préserver la dot de Rozala, c’est-à-dire le port de Montreuil qui se révèle être un point stratégique sur la Manche. Les historiens pensent qu’à partir de cette période, Robert souhaite défier son père, il aimerait enfin régner seul. De plus, comment approuver une union qui n’a donné, au bout de plusieurs années, aucune progéniture ? C’est pour cette raison que le vieux Hugues et ses conseillers ne s’opposent pas à la procédure de divorce.
Le roi Robert, arrivé à l’âge de sa dix-neuvième année, dans la fleur de sa jeunesse, répudia, parce qu’elle était trop vieille, sa femme Suzanne, Italienne de nation.
Homme seul, Robert recherche une conjointe qui lui donnerait la progéniture mâle tant espérée. Au début de l’an 996, probablement au cours de la campagne militaire contre Eudes de Blois, il rencontre la comtesse Berthe de Bourgogne, épouse de ce dernier. Elle est la fille du roi de Bourgogne Conrad III et de Mathilde, fille de Louis IV d’Outremer. Robert et Berthe sont attirés l’un vers l’autre, malgré l’hostilité du roi Hugues, la maison de Blois est le grand ennemi des Capétiens. Pourtant, Robert y voit outre son intérêt sentimental, également un gain territorial puisque Berthe apporterait l’ensemble des territoires blésois. Or, en 996, Eudes de Blois décède en mars puis Hugues Capet en octobre : le mariage peut avoir lieu.
D'après Michel Rouche, cette alliance est assez politique : desserrer l'étau menaçant la maison et son fief l'Île-de-France, vraisemblablement selon la volonté de la reine Adélaïde de Poitiers. En effet, les territoires d'Eudes se composent de Blois, de Chartres, de Melun ainsi que de Meaux. De plus, le couple attend juste les neuf mois réglementaires fixés par la loi, après la mort d'Eudes. Il est donc évident qu'un autre objectif est avoir des enfants légitimes.
Cependant deux détails s’opposent à cette union. D'une part, Robert et Berthe sont cousins au troisième degré. D'autre part, celui-ci est le parrain de Thibaud, un des fils de Berthe. Selon le droit canon, le mariage est alors impossible. Les deux amants ont des relations physiques et Robert met sous tutelle une partie du comté de Blois. Il reprend à son compte la cité de Tours et Langeais à Foulques Nerra, rompant ainsi l’alliance angevine, fidèle soutien du feu roi Hugues Capet. En ce début de règne, les rapports d’alliance s’inversent.
« Berthe, l’épouse d’Eudes, prit le roi Robert pour défenseur de ses affaires et pour avoir
Le couple trouve rapidement des évêques complaisants pour les marier, ce qui est fait vers novembre-décembre 996 par Archambaud de Sully, archevêque de Tours, au grand dam du nouveau pape Grégoire V. Pour plaire à l’autorité pontificale, le jeune souverain annule la sentence du concile de Saint-Basle, libère l’archevêque Arnoul et le restaure sur le siège épiscopal de Reims. Gerbert d’Aurillac doit alors se réfugier auprès de l’empereur Otton III en 997. Le pape rappelle à l’ordre Robert et Berthe pour union incestueuse. Enfin, deux conciles réunis d’abord à Pavie février 997 puis à Rome en été 998 les condamnent à faire pénitence pendant sept années, et en cas de non-séparation, ils seraient frappés d’excommunication. Mais au bout de 5 ans d’union, il n’y pas de descendance : Berthe et Robert qui sont consanguins n’ont eu qu’un enfant mort-né. L’accession de Gerbert d'Aurillac au pontificat sous le nom de Sylvestre II n’y change rien. En 999, à la suite d'un synode, le pape accepta la condamnation du roi de France dont il avait eu à subir la perfidie. Finalement, les sept ans de pénitence sont acomplis vers 1003.
Ils vinrent au siège apostolique et après avoir reçu satisfaction pour leur pénitence, ils revinrent chez eux, Postea ad sedem apostolicam venientes, cum satisfactione suscepta peitentia, redierunt ad propria
Sans enfant, Robert II la quitte finalement avant d'épouser Constance d'Arles.
Constance d'Arles, une reine à poigne 1003-1032
Constance d’Arles, nouvelle reine des Francs, une forte personnalité du XIe siècle. Gravure de la fin du xixe siècle.
Le roi ne divorce pas de Berthe, l’union n’ayant pas été reconnue par l’Église, cette opération se révèle inutile. Il se marie une troisième fois vers 1003-1004 avec une princesse lointaine qu’il n’a jamais rencontrée pour éviter toute parenté. Âgée de 17 ans, Constance d'Arles vient de Provence. Elle est de sang noble, étant la fille de Guillaume Ier, comte de Provence et Arles et d’Adélaïde-Blanche d’Anjou. Cette famille provençale s’est illustrée au Xe siècle puisque Guillaume surnommé le Libérateur Avait repoussé définitivement les Sarrasins à La Garde-Freinet 972 et sa mère Adélaïde avait été un temps reine des Francs lors de son mariage éphémère avec le Carolingien Louis V de 982 à 984. Surtout, la famille d’Arles est apparentée à la maison d’Anjou avec laquelle l’alliance est ainsi rétablie.
Mais Constance est une maîtresse-femme qui ne rend pas le roi heureux. La personnalité de la reine donne lieu de la part des chroniqueurs à des commentaires défavorables : vaniteuse, avare, arrogante, vindicative. Les remarques misogynes, de la part de moines, surtout envers une reine sont tout à fait exceptionnels au XIe siècle. D’autre part, on sait aussi que les Méridionaux venus à la cour avec Constance sont méprisés par les Francs et exclus. Lors de la rencontre entre les deux camps au tout début du xie siècle, les contemporains font référence à un véritable choc culturel. Raoul Glaber souligne, par exemple, que les ecclésiastiques francs les plus conservateurs méprisent la mode provençale qui suggère la nouveauté et donc le désordre. En général, les Provençaux de l’an mil ne portent pas la barbe ou la moustache on peut les confondre avec les femmes et les laïcs ont les cheveux rasés coiffe réservée aux clercs. Tout ceci expliquerait-il le comportement de la reine ?
Si on en croit Helgaud de Fleury, le roi lui-même craint sa femme :
"Ami Ogier, va-t-en d’ici pour que Constance, mon épouse, l’inconstante ne te dévore pas ! "
Le seul point positif est que Constance lui donne une progéniture nombreuse :
Alix de France v. 1003-apr. 1063, mariée à Renaud Ier comte de Nevers et d’Auxerre.
Hugues de France v. 1007-1025, associé à son père, mais qui meurt prématurément.
Henri Ier v. 1008-1060, roi des Francs.
Adèle de France ou Adélaïde v. 1009-1079, épouse Richard III de Normandie puis Baudouin V de Flandre.
Robert de France v. 1011-1076, duc de Bourgogne.
Eudes v. 1013-v. 1057/1059, considéré comme imbécile et incapable de régner selon la chronique terminée en 1138 de Pierre, fils de Béchin, chanoine de Saint-Martin-de-Tours.
Au cours du règne de Robert le Pieux, Constance se place souvent au centre des intrigues afin de préserver une place singulière à la cour franque. Raoul Glaber souligne justement que la souveraine a la haute main sur son mari. Pour les contemporains, une femme qui dirige c’est le monde à l’envers. Tout commence au début de l’an 1008, un jour où le roi et son fidèle Hugues de Beauvais chassent en forêt d’Orléans. Soudain, douze hommes en armes surgissent et se jettent sur Hugues avant de le trucider sous les yeux du roi. Le crime a été commandé par Foulques Nerra et sûrement soutenu par la reine. Robert, excédé par son épouse au bout de six ou sept années de mariage, se rend personnellement auprès du pape ; il est accompagné de Angilramme un moine de Saint-Riquier et de Berthe de Bourgogne vers 1009-1010. Son dessein est bien entendu de faire annuler le mariage avec Constance. Odorannus, un moine de Saint-Pierre-le-Vif à Sens, explique dans ses écrits que, de son côté en l’absence de son mari, Constance l’attend attristée dans son domaine de Theil. Selon lui, saint Savinien lui serait apparu et trois jours plus tard Robert était de retour, délaissant définitivement Berthe.
Les problèmes ne s’arrêtent pas pour autant. À la suite de la victoire de Eudes II de Blois sur Foulques Nerra à Pontlevoy 1016, Raoul Glaber raconte que le jour de la Pentecôte 1017 à Saint-Corneille de Compiègne, Constance et son clan angevin imposent l’association d’Hugues, le fils aîné, contre l’avis des princes territoriaux. Ainsi, en cas de trépas du roi Robert, Constance assurerait la régence du royaume. En outre, on ne donne aucun pouvoir à Hugues qui est sans cesse humilié par sa mère avant de mourir prématurément en 1025. La reine s’oppose alors au sacre de son deuxième fils, Henri, qu’elle n’aime guère au profit de son cadet Robert. Mais la cérémonie a lieu à Reims à la Pentecôte 1027.
Les conquêtes territoriales
Le roi Robert mène une politique claire : récupérer à son profit la fonction comtale, soit en se l’appropriant soit en la cédant à un évêque ami, ainsi que l’ont fait les Ottoniens, la dynastie la plus puissante d’Occident à l’époque.
La victoire la plus éclatante de Robert reste l’acquisition du duché de Bourgogne.
Le duc de Bourgogne Henri Ier meurt en octobre 1002, sans héritier légitime. Son beau-fils Otte-Guillaume, comte de Mâcon et comte de Bourgogne la future Franche-Comté et issu du premier mariage de Gerberge de Chalon avec Aubert d’Italie, avait, selon la Chronique de Saint-Bénigne, été désigné comme l’héritier du duché, et l’appui de nombreux seigneurs bourguignons lui était assuré, mais il se soucie plus de ses terres d’Outre-Saône et son intérêt se porte aussi vers l’Italie dont il est issu. Le duché de Bourgogne, acquis en 943, par Hugues le Grand, père d’Henri, fait partie des possessions familiales robertiennes. De plus, la Bourgogne est un enjeu de taille puisqu’elle regorge de riches cités Dijon, Auxerre, Langres, Sens….
Une rivalité entre Hugues Ier de Chalon, évêque d’Auxerre, partisan du roi Robert et Landry, comte de Nevers, gendre et allié naturel d’Otte-Guillaume qui avait des droits à Auxerre, déclenche l’intervention armée du roi Robert.
Ce dernieR, rejoint par Richard II de Normandie, rassemble ses troupes au printemps 1003 et les engage en Bourgogne mais elles échouent devant Auxerre et Saint-Germain d’Auxerre. En 1005, Robert et ses hommes sont de retour. Ils prennent Avallon après quelques jours de combats, puis Auxerre. Un arrangement avait déjà dû intervenir entre le roi et Otte-Guillaume qui se trouve auprès du roi lors du siège d’Avallon. Sous la médiation duc-évêque Hugues de Chalon, le comte Landry se réconcilie avec le roi en renonçant aux comtés d’Avallon et d’Auxerre. À l’issue des accords de 1005-1006, Otte-Guillaume avait renoncé au titre ducal et l’ensemble des possessions du feu duc Henri reviennent à la Couronne, exceptée la cité de Dijon, toujours en possession de Brun de Roucy l’irréductible évêque de Langres qui ne voulait à aucun prix laisser Robert s’y installer.
À Sens, une lutte s’instaure entre le comte Fromond et l’archevêque Léotheric pour le contrôle de la cité. Léotheric, qui est un proche du roi, est furieux du comportement du comte qui a fait construire une puissante tour de défense. En 1012, Rainard succède à son père Fromond et la situation empire d’autant que l’évêque de Langres, Brunon de Roucy, ennemi du roi Robert, est l’oncle maternel de Rainard. L’archevêque de Sens, isolé, fait appel au roi. Ce dernier souhaite intervenir pour plusieurs raisons : Sens est une des principales cités archiépiscopales du royaume, c’est également un passage obligé pour se rendre en Bourgogne et enfin la possession du comté sénonais permettrait à Robert de couper les possessions de Eudes II de Blois en deux. Le comte est excommunié et subit l’attaque du roi qui s’empare de Sens le 22 avril 1015. Rainard, qui s’est entre temps allié à Eudes de Blois, propose un compromis à Robert : il continue d’exercer sa charge comtale et à sa mort le territoire reviendra à la Couronne. Rainard meurt 40 ans plus tard mais Robert a réussi à placer Sens sous son contrôle.
Sitôt l’affaire sénonaise terminée, Robert part pour Dijon achever sa conquête bourguignonne. Selon la chronique de Saint-Bénigne de Dijon, Odilon de Cluny serait intervenu et le roi, ému, aurait renoncé à l’assaut. L’évêque de Langres Brunon de Roucy meurt à la fin du mois de janvier 1016. Les troupes royales rentrent dans Dijon quelques jours plus tard et Robert installe l’évêque Lambert de Vignory sur le siège de Langres qui lui cède Dijon et son comté59. Après une quinzaine d’années de campagnes militaires et diplomatiques, le roi rentre en possession du duché bourguignon.
Le jeune Henri, son fils cadet, reçoit le titre ducal mais compte tenu de son jeune âge, Robert en garde le gouvernement et s'y rend régulièrement. La mort en 1027 d’Hugues, le frère aîné d’Henri, fait de ce dernier l’héritier de la couronne royale ; le duché revient au cadet Robert, désigné aussi Robert le Vieux, dont la descendance bourguignonne régnera jusqu’au milieu du xive siècle. Le terres d’Outre-Saône du royaume de Bourgogne, le comté de Bourgogne, suivent les destinées de l’Empire.
Lorsque vers 1007, Bouchard de Vendôme l’ancien fidèle d’Hugues Capet meurt, le comté de Paris qu’il détenait n’est pas attribué à son fils Renaud. Lorsque ce dernier meurt à son tour 1017, le roi s’approprie son comté de Melun et le comté de Dreux. À Bourges, l’archevêque Daibert décède en 1012. Robert nomme lui-même son remplaçant, Gauzlin, ancien abbé de Fleury. Mais le vicomte de cette même cité, Geoffroi, tente d’intervenir personnellement dans le choix du successeur de Daibert et empêche le nouvel archevêque d’accéder à son siège : le pape Benoît VIII, Odilon de Cluny et Robert le Pieux doivent intervenir pour que Gauzlin puisse œuvrer.
L’affaire des hérétiques d’Orléans 1022Hérésie d'Orléans.
L’an mil constitue le réveil de l’hérésie. Au cours du haut Moyen Âge, on n’avait pas connu de persécutions de ce type. Le XIe siècle inaugure une série de bûchers hérétiques en Occident : Orléans 1022, Milan 1027, Cambrai 1078. En ce qui concerne le roi Robert, l’affaire des hérétiques d’Orléans constitue un élément fondamental de son règne et a, à l’époque, un retentissement sans précédent.
D’où viennent ces hérétiques ? La nature des événements nous est contée par des sources exclusivement ecclésiastiques : Raoul Glaber, Adémar de Chabannes, André de Fleury, Jean de Ripoll et Paul de Chartres. L’an mil prolonge l’idée d’un siècle corrompu où la richesse du clergé contraste terriblement avec l’humilité prônée par Jésus Christ. Certains clercs remettent en cause ce système et désirent purifier la société chrétienne. Le débat n’est pas nouveau, déjà au IXe siècle, il y avait eu des controverses entre lettrés à propos de l’eucharistie, le culte des saints… mais en 1022, c’est d’une autre nature.
Raoul Glaber fait le récit du paysan Leutard de Vertus Champagne qui, vers 994, décide de renvoyer son épouse, de détruire le crucifix de son église locale et de prêcher aux villageois le refus d’acquitter les dîmes avec comme prétexte la lecture des saintes Écritures. L’évêque de son diocèse, Gibuin Ier de Châlons, le convoque, argumente avec lui devant la population et le convainc de sa folie hérétique. Abandonné de tous, Leutard se suicide. D’autres hérétiques connaissent au cours du siècle la mésaventure de Leutard, c’est-à-dire se ridiculiser sur des questions intellectuelles, face à des savants de sorte que leur message ne vaut plus rien et soit discrédité aux yeux des simples mortels64. Adémar de Chabannes quant à lui signale, vers 1015-1020, l’apparition de manichéens en Aquitaine, surtout dans les cités de Toulouse et de Limoges.
Les thèmes communs des hérétiques sont le renoncement à la copulation charnelle, la destruction des images, l’inutilité de l’Église et la répudiation des sacrements en particulier le baptême et le mariage. Étonné par cette vague de contestations, Raoul Glaber évoque dans ses écrits que Satan a été libéré après mille ans selon l’Apocalypse et qu’il a dû inspirer tous ces hérétiques depuis Leutard jusqu’aux Orléanais. Un autre contemporain du temps s’exprime :
"Ils les hérétiques prétendaient qu’ils avaient foi en la Trinité dans l’unité divine et en l’Incarnation du Fils de Dieu mais c’était mensonge car ils disaient que les baptisés ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit dans le baptême et que après un péché mortel, nul ne peut en aucune façon recevoir le pardon. "
Pour les chroniqueurs, l’hérésie orléanaise provient tantôt d’un paysan périgourdin Adémar de Chabannes tantôt d’une femme de Ravennes Raoul Glaber. Mais surtout, le plus inadmissible c’est que le mal touche Orléans, la cité royale et la cathédrale Sainte-Croix, là où Robert a été baptisé et sacré il y a quelques décennies. Des chanoines proches du pouvoir avaient été endoctrinés par l’hérésie : Théodat, Herbert maître de la collégiale de Saint-Pierre-le Puellier, Foucher et surtout Étienne confesseur de la reine Constance et Lisoie chantre de Sainte-Croix entre autres. Le roi Robert est averti par Richard de Normandie et le jour de Noël 1022, les hérétiques sont arrêtés et interrogés pendant de longues heures. Raoul Glaber rapporte qu’ils reconnaissaient appartenir à la secte depuis longtemps et que leur dessein étaient de convaincre la cour royale de leurs croyances refus des sacrements, interdits alimentaires, sur la virginité de la Vierge Marie et sur la Trinité. Ces détails sont sûrement vrais, par contre, c’est abusivement que Raoul Glaber et les autres chroniqueurs diabolisent à l’envi les réunions du cercle orléanais : ils les soupçonnent de pratiquer des orgies sexuelles, d’adorer le diable, de crimes rituels. Ces reproches sont ceux qu’on faisait aux premiers chrétiens durant l’Antiquité tardive.
"À cette époque, dix des chanoines de Sainte-Croix d’Orléans, qui semblaient plus pieux que les autres, furent convaincus d’être manichéens. Le roi Robert, devant leur refus de revenir à la foi, les fit d’abord dépouiller de leur dignité sacerdotale, puis expulser de l’Église, enfin livrer aux flammes."
D’après la légende, Étienne, le confesseur de Constance, aurait reçu un coup de canne d’elle qui lui aurait crevé un œil. Le roi Robert fait dresser à l’extérieur de la cité un immense bûcher le 28 décembre 1022. Espérant les effrayer, le roi est surpris de leur réaction :
"Sûrs d’eux-mêmes, ils ne craignaient rien du feu ; ils annonçaient qu’ils sortiraient indemnes des flammes, et en riant ils se laissèrent attacher au milieu du bûcher. Bientôt ils furent totalement réduits en cendres et l’on ne retrouva même pas un débris de leurs os. "
Cet acharnement surprend les contemporains et encore les historiens modernes. Les différents chroniqueurs, bien qu’ils soient horrifiés par les pratiques des hérétiques, ne commentent à aucun moment la sentence et Helgaud de Fleury passe même l’épisode sous silence. À croire que l’histoire des hérétiques d’Orléans entacherait sa réputation de saint ? En tout cas l’événement fait tellement de bruit dans le royaume qu’il aurait été perçu jusqu’en Catalogne à en croire une lettre du moine Jean à son abbé Oliba de Ripoll : Si vous en avez entendu parler ce fut bien vrai dit-il. Pour les historiens, cet épisode ferait référence à un règlement de compte. En 1016, Robert avait imposé sur la chaire épiscopale d’Orléans un de ses proches, Thierry II, aux dépens de Oudry de Broyes, le candidat d’Eudes II de Blois. Or, l’affaire, à laquelle il est peut-être mêlé, éclate sous son épiscopat. Pour se laver de toute responsabilité, le roi Robert aurait souhaité liquider violemment les imposteurs.
Fin de règne
Le dernier grand événement du règne de Robert le Pieux est l’association au trône de son second fils, Henri. Encore une fois, il doit supporter les arguments de la reine Constance qui souhaite imposer son fils cadet, Robert. Dans l’entourage royal, le prince Henri est considéré comme trop efféminé, ce qui est contraire au principe masculin de la virtus. Favorables à l’élection du meilleur, l’épiscopat et de nombreux princes territoriaux montrent leur refus. Néanmoins le roi, soutenu par quelques personnalités Eudes II de Blois, Odilon de Cluny, Guillaume de Volpiano, tient bon et Henri est finalement sacré le jour de la Pentecôte 1027 à Reims par l’archevêque Ebles de Roucy. Robert entérine définitivement l’association royale établie par le souverain en place. Les plus grands du royaume ont fait le déplacement : Eudes de Blois, Guillaume V d'Aquitaine, Richard III de Normandie. D’après le chroniqueur Hildegaire de Poitiers, la cérémonie une fois finie, Constance se serait enfuie à cheval folle de rage. Après quarante années de règne, une agitation politique pointe dans le royaume. En Normandie, le nouveau duc Robert le Magnifique expulse son oncle Robert, archevêque de Rouen v. 1027-1029. Le souverain doit arbitrer le conflit et tout rentre dans l'ordre. Même type de scénario en Flandre où le jeune Baudouin, désireux de pouvoir, se soulève contre son père Baudouin IV en vain. De son côté, Eudes II de Blois enrôle à son profit le nouveau souverain Henri dans sa lutte contre Foulques Nerra. Ces campagnes sont sans suite 1027-1028. Âgé de plus de 55 ans, un âge auquel dans la tradition de l’époque on doit s’effacer du pouvoir, le roi Robert est toujours sur son trône. Il doit essuyer plusieurs révoltes de la part de ses fils Henri et Robert, probablement intriguées par la reine Constance 1030. Robert et Constance doivent s’enfuir en Bourgogne où ils rassemblent leurs forces auprès de leur gendre, le comte de Nevers, Renaud er, l’époux de leur première fille Alix. De retour dans leur domaine, la paix est rétablie avec les membres de la famille royale.
Robert le Pieux décède finalement au cours de l’été 1031, à sa résidence de Melun, d’une fièvre accablante dit-on :
Quelques jours auparavant, le 29 juin, selon Helgaud de Fleury, une éclipse de soleil était venue annoncer un mauvais présage :
"Quelque temps avant sa très-sainte mort, qui arriva le 20 juillet, le jour de la mort des saints apôtres Pierre et Paul, le soleil, semblable au dernier quartier de la lune, voila ses rayons à tout le monde, et parut à la sixième heure du jour, pâlissant au-dessus de la tête des hommes, dont la vue fut obscurcie de telle sorte, qu’ils demeurèrent sans se reconnaître jusqu’à ce que le moment d’y voir fut revenu."
Très apprécié par les moines de Saint-Denis, le roi défunt est transporté en hâte de Melun jusqu’à l’abbaye où repose déjà son père, devant l’autel de la Sainte-Trinité. Les bénéfices que le souverain a offerts à l’abbaye sont énormes. Lorsqu’ils rédigent leur chronique, les moines affirment qu’au moment de sa mort, les rivières ont débordé renversant des maisons et emportant des enfants, une comète est passée dans le ciel et une famine a touché le royaume pendant près de deux années. Lorsqu’il achève sa biographie vers 1033, Helgaud s’étonne que le tombeau du pieux Robert ne soit encore recouvert que d’une simple dalle et d’aucun ornement. Au milieu du XIIIe siècle, saint Louis fait sculpter de nouveaux gisants pour tous les membres de la famille royale.
Lorsqu’il apprend la nouvelle de la mort de son père, Henri Ier monte sur le trône pour un règne de trente années.
Bilan du règne de Robert le Pieux Le roi de l’an mil An mil.Les fausses terreurs
Les Terreurs ou Peurs de l’an mil sont un mythe du XVIe siècle, façonné sur la base d’une chronologie de Sigebert de Gembloux XIIe s., avant d’être repris par les historiens romantiques du XIXe siècle dont Jules Michelet. Il s’agissait d’expliquer que les chrétiens occidentaux étaient terrifiés par le passage de l’an mil à la suite duquel Satan pourrait surgir de l’Abîme et provoquer la fin du monde. Le christianisme est une religion eschatologique à travers laquelle les hommes doivent se comporter idéalement durant la vie terrestre pour espérer avoir leur Salut éternel avant quoi ils seront tous soumis au Jugement dernier. Cette croyance est très présente tout au long du Moyen Âge est en particulier aux Xe et XIe siècles, période durant laquelle l’Église est encore très ritualisée et sacrée. Néanmoins, il ne faut pas confondre l’eschatologie et le millénarisme : c’est-à-dire craindre la fin du monde après les mille années de l’incarnation du Christ. Pourquoi ?
Tout part de l’Apocalypse selon Jean qui, à l’origine, menace du retour de Satan mille ans après l’incarnation du Christ :
"Puis je vis un Ange descendre du ciel ayant en main la clé de l’Abîme ainsi qu’une énorme chaîne. Il maîtrisa le Dragon et l’antique Serpent Satan et l’enchaîna pour mille années. Il le jeta dans l’Abîme tira sur lui les verrous, apposa les scellés afin qu’il cessât de fourvoyer les nations jusqu’à l’achèvement de mille années. Après quoi il doit être relâché pour un peu de temps. "
Déjà au Ve siècle, saint Augustin interprète le millénarisme comme une allégorie spirituelle à travers laquelle le nombre mille ne signifie finalement qu’une longue durée non déterminée numériquement Cité de Dieu. Quelques années plus tard, le concile d'Éphèse 431 décide de condamner officiellement la conception littérale du millénium. À partir de la fin du Xe siècle, l’intérêt que portent les clercs pour l’Apocalypse est marqué par la diffusion de Commentaires à travers tout l’Occident Apocalypse de Valladolid, de Saint-Saver…. Cependant, l’Église maîtrise le mouvement millénariste.
Ce sont les analyses des sources, exclusivement ecclésiastiques, qui peuvent provoquer des contre-sens. L’énormité des péchés accumulés depuis des siècles par les hommes », soulignent les chroniqueurs, laisse croire que le monde court à sa perte, que le temps de la fin est venue. L’un d’eux, Raoul Glaber, est encore une fois l'une des rares sources sur la période. Il rédige ses Histoires vers 1045-1048, soit une quinzaine d’années après le millénaire de la Passion 1033 :
"On croyait que l’ordonnance des saisons et des éléments, qui avait régné depuis le commencement sur les siècles passés, était retournée pour toujours au chaos et que c’était la fin du genre humain."
En fait, le moine bourguignon décrit la situation plusieurs années après dans une dimension encore une fois eschatologique fidèle à l’Apocalypse. Celle-ci a pour but d’interpréter l’action de Dieu les prodiges qui doit être vue comme des avertissements envers les hommes pour que ces derniers fassent acte de pénitence. Ces signes sont attentivement relevés par les clercs. D’abord les incendies cathédrale Sainte-Croix d’Orléans en 989, les faubourgs de Tours en 997, Notre-Dame de Chartres en 1020, l’abbaye de Fleury en 1026..., les dérèglements de la nature séisme, sécheresse, comète, famine, l’invasion des Païens les Sarrasins vainqueurs de Otton II en 982 et enfin la prolifération d’hérétiques conduits par des femmes et des paysans Orléans en 1022, Milan en 1027. Il ajoute :
" Ces signes concordent avec la prophétie de Jean, selon laquelle Satan sera déchaîné après mille ans accomplis."
D’autre part, il faut savoir qu’autour de l’an mil, seule une infime partie de la population, l’élite ecclésiastique de Francie est capable de calculer l’année en cours à des fins liturgiques ou juridiques dater les chartes royales. Ceux qui peuvent déterminer précisément la date conçoivent un millénaire dédoublé : 1000 pour l’Incarnation et 1033 pour la Passion du Christ. De plus, bien que l’ère chrétienne soit mise en place depuis le vie siècle, son emploi ne se généralise qu’à partir de la seconde moitié du XIe siècle : en bref, les hommes ne se repèrent pas dans la durée par les années. La vie est alors rythmée par les saisons, les prières quotidiennes et surtout les grandes fêtes du calendrier religieux : d’ailleurs l’année ne commence pas partout à la même date Noël en Angleterre, Pâques en Francie….
En outre, rien dans ces écrits prouvent qu’il y ait bien eu des terreurs collectives. D’ailleurs, vers 960 à la demande de Gerberge de Saxe, l’abbé de Montier-en-Der Adson rédige un traité De la naissance de l’époque de l’Antéchrist dans lequel il rassemble un dossier de ce que les saintes Écritures disent de l’Antéchrist. Il en conclut que la fin des temps ne surviendrait pas avant que les royaumes du monde soient séparés de l’Empire. Chez Abbon de Fleury, le passage au IIe millénaire n’est pas passé inaperçu, puisque vers 998 il adresse un plaidoyer à Hugues Capet et son fils Robert. Il accuse ainsi un clerc qui, lorsqu’il était étudiant, revendiquait la fin du monde au tournant de l’an mil. Ainsi, même les grands savants du Xe siècle sont anti-millénaristes.
"On m’a appris que dans l’année 994, des prêtres dans Paris annonçaient la fin du monde. Ce sont des fous. Il n’y a qu’à ouvrir le texte sacré, la Bible, pour voir qu’on ne saura ni le jour ni l’heure. "
Depuis Edgar Pognon, les historiens modernes ont bien montré que ces grandes Terreurs populaires n’ont jamais existé. Cependant, au cours des années 1970, une nouvelle explication s’est imposée. Georges Duby explique ainsi qu’aucune panique populaire ne s’est manifestée autour de l’an mil mais qu’en revanche on peut déceler une certaine inquiétude diffuse et permanente dans l’Occident de cette époque. Il y a probablement, à la fin du xe siècle, des personnes concernées par l’approche de l’an mil et qui ont quelques inquiétudes. Mais elles furent très minoritaires, puisque les gens les plus instruits comme Abbon de Fleury, Raoul Glaber ou Adson de Montierender n’y croyaient pas. Sylvain Gougenheim et Dominique Barthélemy combattent alors avec force la thèse de G. Duby de l’inquiétude diffuse. Pour eux, si la fin des temps avait été martelée par l’Église, celle-ci aurait probablement pu perdre son pouvoir et sa légitimité. La vraie seule inquiétude, à toutes les époques, c’est le Salut.
La mutation féodale Féodalité et Motte castrale.
La féodalité est un terme complexe dont l’étude historique est quelquefois délicate. C’est un ensemble d’institutions et de relations concernant toute la société, dite alors "féodale". Les historiens médiévistes modernes ne sont pas d’accord sur la chronologie et la diffusion de cette féodalité.
La juridiction carolingienne IXe siècle-vers 1020
Au cours du haut Moyen Âge, un certain lien féodal existe déjà puisque certains puissants cèdent un bénéfice beneficium à leurs fidèles souvent une terre. Pourtant la société est encore dominée par un servage latent qui se rencontre dans la justice : seuls les hommes libres ont le droit d’y accéder ; les non-libres sont châtiés corporellement et défendus par leur maître. Le roi et le prince du Xe siècle se servent encore du pouvoir judiciaire, pour défendre leurs biens et leurs droits, en infligeant aux condamnés l’hériban taxe de 60 sous à ceux qui refusent de servir l’ost et en confisquant les biens de ceux qui les ont offensés.
À partir des années 920, l’autorité publique commence à se concentrer en plusieurs points routes, cités, sites défensifs…. Les alliances matrimoniales unissent les enfants royaux et comtaux depuis le ixe siècle : les dynasties princières se mettent en place, ce qui fait dire à Adalbéron de Laon :
"Les lignées de nobles descendent du sang des rois."
Déjà les textes font référence à un serment de fidélité : le baiser osculum est généralement perçu comme un geste de paix entre parentés ou entre alliés. D’autre part, l’hommage commandatio est vu comme un geste humiliant et il semblerait que peu de comtes en fassent allégeance au roi. Du côté des humbles, la fidélité peut être également d’ordre servile, comme le montre la pratique ancienne du versement du chevage, qui devient au cours du IXe siècle une sorte d' hommage servile. Cela fait dire à D. Barthélemy, à l’inverse de G. Duby et P. Bonnassie, que le haut Moyen Âge est le témoin d’un binôme : l’affranchissement et l’hommage servile. Cela montrerait que la servitude est de moins en moins ancrée dans la société.
Affligés de nombreuses charges, les comtes délèguent une partie de leur pouvoir judiciaire à certains de leurs gardiens de châteaux, les castellani châtelains. Ces derniers reçoivent soit au château pour les plus aisés soit à la vicaria ou viguerie, une assemblée judiciaire réservée aux plus humbles.
Constitution des châtellenies vers 1020-1040
Entre 980 et 1030, explique Georges Duby, le pagus du haut Moyen Âge s’est progressivement transformé en un territoire centré sur sa forteresse publique, devenue rapidement le point d’attache de nombreuses familles aristocratiques. Sur l’ensemble du royaume, un certain nombre de castra châteaux privés et publics en bois se construisent très rapidement sur une motte castrale artificielle ou non contre l’autorité publique, il y a une véritable prolifération après 1020. La motte n’est pas toujours la résidence principale mais un point par lequel s’affirme la légitimité du pouvoir seigneurial.
On assiste également à certains changements d’ordre juridique. Les châtelains prennent à leur compte la justice publique qu’ils privatisent et qu’ils rendent héréditaire. C’est ce que certains historiens appellent le choc châtelain, y voyant ainsi une véritable révolution sociale. Aux marges du domaine royal de Robert le Pieux, les forestiers du roi par exemple Guillaume de Montfort dirigent à Montlhéry ou à Montfort-l'Amaury leur forteresse, dont ils étaient les gardiens, vers 1020-1030. Pour faire régner l’ordre sur le territoire qui constitue leur ressort juridique districtus, ils embauchent, à leur tour, des milites chevaliers, des hommes qui se battent à cheval, qui proviennent de catégories sociales différentes cadets de familles nobles, alleutiers riches, certains possèdent des terres, quelques serfs mais qui n’ont pas la responsabilité de chef. La pyramide féodale est ainsi presque achevée :
La pyramide féodale vers 1030, Roi Comte Châtelain ou sire Chevalier de village Humble
Le premier de ses pairs responsable du royaume, de la guerre et de la paix. Prince territorial de sang royal, à l’origine auxiliaire du roi, il est devenu indépendant au IXe siècle responsable du comté. Cadet du comte, à l’origine auxiliaire de celui-ci, il est devenu indépendant au xie siècle responsable de la châtellenie. Combattant à cheval et auxiliaire du châtelain, il est chargé de maintenir le droit du ban à l’échelle locale responsable d’une seigneurie. Il dépend d’un seigneur foncier, à qui il paye une redevance fixe cens pour sa tenure, et d’un seigneur du ban, à qui il paye des redevances arbitraires pour utiliser les outils vitaux moulin, pressoir, four....
Le nouveau détenteur accumule une force accrue et il légitime son nouveau pouvoir en avançant sa noblesse de sang. L’ensemble des pouvoirs publics deviennent désormais privés : c’est le bannum. Il semblerait même que certains d’entre eux se soient en partie détournés des comtes. Ainsi, dans sa thèse, Georges Duby montre qu’entre 980 et 1030, les châtelains désertent le plaid du comte de Mâcon, s’approprient la vicaria et finissent par concentrer tout le pouvoir local. Cette situation n’est cependant pas générale et on assiste à des hommages par les mains jointes du vassal à son seigneur, au développement de l’aide vassalique qui se précise dans les textesfidélité, appui et conseil militaires…. Enfin, le bénéfice devient le fief feodum et l’alleu devient de plus en plus rare.
La mise en place de la seigneurie banale
L’objectif de ces châtelains n’est pas d’obtenir une pleine indépendance politique envers le comte mais plutôt de s’assurer des droits de commandement solides sur la paysannerie. Ainsi, vers 1030 dans le comté de Provence, on les voit obliger les alleutiers à entrer dans leur dépendance en échange d’un bien foncier ou d’une rémunération monétaire.
Une des caractéristiques de l’époque féodale, c’est la prolifération de ce que les textes appellent les mals usos les mauvaises coutumes. Sous le règne de Charles le Chauve, l’édit de Pîtres 864 faisait déjà référence aux coutumes, ce qui laisse à croire qu’il y aurait une continuité juridique entre l’époque carolingienne et l’an mil. En règle générale, la documentation ne permet pas d’évaluer la part des divers types de revenus, des droits sur les terres, les manses ou les parcelles, et des prélèvements sur les hommes. Ces usages sont réputés néfastes et nouveaux pour les communautés paysannes, mais quelques cas démontrent l’inverse. Quelles sont ces coutumes ?
Depuis l’époque carolingienne, le paysan vit dans un manse ou tenure, une petite maison et un petit champ qu’il exploite en échange d’une redevance le cens ou le champart qu’il paie à son seigneur et de corvées c’est-à-dire exploiter la réserve au compte du seigneur. Le seigneur fait appel à la justice publique, la vicaria du comte ou du roi puisqu’il n’a pas cette compétence. Ce système est la seigneurie foncière.
À partir des années 1020-1030, se met en place, en parallèle à la seigneurie foncière, un nouveau statut juridique. Le paysan paie toujours sa redevance cens ou champart à son seigneur foncier, mais un autre seigneur le sire aidé de ses milites s’empare plus ou moins violemment de la justice publique qu’il prend à son compte. Il dirige donc la vicaria et impose aux paysans de la seigneurie son droit de ban : la communauté doit désormais se soumettre juridiquement à cet usurpateur et lui payer des redevances pour l’utilisation du moulin, du four, du pressoir, des voies les banalités… Pour certains historiens D. Duby, P. Bonnassie, les sires ont rétabli l’égalité entre libres et non-libres en les soumettant au titre de serf. Pour d’autres D. Barthélemy, il n’y a qu’un changement de nom dans les textes mais la condition reste la même depuis les temps carolingiens, c’est-à-dire une sorte d’hommage servile plutôt que d’une situation esclavagiste. Ce système est la seigneurie banale.
Les conflits locaux dits féodaux ont pour but la perception des coutumes sur telle ou telle seigneurie, ce qui représente un enjeu financier considérable. L’ensemble des seigneuries constituent ainsi le ressort du château : la châtellenie. Il ne faut pas cependant pas imaginer un espace centralisé autour du château, c’est un territoire fluctuant au gré des guerres privées. Aucun bâtiment n’est encore parfaitement associé à la seigneurie avant au moins 1050. Quelquefois, dans l’enchevêtrement des seigneuries, le sire se retrouve à la fois seigneur foncier et seigneur du ban. Ne pouvant tout contrôler de sa seule personne, le châtelain délègue alors à ses vassaux, les chevaliers, tel ou tel droit la vicaria dans telle seigneurie, le cens dans telle autre….
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... hp?topic_id=2506&forum=24
Posté le : 19/07/2014 13:34
|
|
|
|
|
Robert II le pieux 2 suite |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57901
|
Robert et la paix de Dieu
La paix de Dieu est un mouvement conciliaire d’initiative épiscopale qui apparaît au cours de la seconde moitié du xe siècle dans le sud de la Gaule et qui se poursuit les décennies suivantes dans certaines régions septentrionales (1010-1030). Pendant longtemps, l’historiographie a avancé le contexte d’une « déliquescence des structures carolingiennes et de violences au cours d’une période que Georges Duby a appelée Premier Âge féodal ou Mutation féodale. Aujourd’hui le tableau de la paix de Dieu est plus nuancé : les prélats auraient-ils pu concevoir une société religieuse où les liens auraient été horizontaux à une époque où précisément un Adalbéron de Laon ou un Gérard de Cambrai méprisaient le serf des champs, bien que son travail fût utile. D’autre part, comment peut-on envisager à la fois une croissance économique importante aux Xe et XIe siècles au cours d’une époque violente et anarchique?
On sait que les mouvements de paix existaient déjà au Haut Moyen Âge. D’ailleurs les pénitentiels carolingiens se préoccupaient tous de la souillure que représentait l’homicide et les violations de l’Église. Selon Christian Lauranson-Rosaz, les premiers signes de la paix de Dieu apparaissent dans les montagnes auvergnates lors du plaid de Clermont en958 où les prélats déclarent que la paix vaut mieux que tout. Puis la première assemblée se serait tenue à Aurillac 972 à l’initiative d’Étienne II de Clermont et des évêques de Cahors et de Périgueux. On contraint par les armes ceux qui ne veulent pas jurer la paix. En revanche, tout le monde est d’accord pour dater de 989 la première assemblée de paix connue à Charroux Poitou à l’initiative de Gombaud, archevêque de Bordeaux. Elle est suivie quelques années plus tard par celles de Narbonne (990), du Puy 994… À chaque fois, on évoque la paix, la loi et on prête serment sur les reliques qu’on a amenées pour l’occasion. Les premières assemblées se réalisent souvent sans la présence des princes, car elles ne concernent que les zones périphériques, externes à leur champ d’investigation même si Guillaume d’Aquitaine en préside certaines dès 1010.
Progressivement, les assemblées deviennent des conciles car les décisions sont consignées dans des canons élaborés. D’ailleurs la violation du serment et des sentences conciliaires est passible de l’anathème. Ainsi la paix est montrée comme une condition nécessaire au salut de l’âme discours du Puy en 994. Les objectifs pris, au cours de ces assemblées, concernent avant tout la protection des biens d’Église contre les laïcs continuité de la réforme carolingienne. Mais la paix de Dieu n’est pas pour autant antiféodale puisque les droits des seigneurs sur leurs serfs et la vengeance privée, qui appartenaient au droit coutumier, sont confirmés. Ce qui, au contraire, est dénoncé ce sont les influences nuisibles provoquées par les guerriers aux tiers non armés. Quelquefois un arrangement est trouvé entre le clerc et le chevalier. Le moine pardonne alors à son interlocuteur qui a martyrisé des serfs en échange d’un don pour sa communauté. Que demandent précisément ces assemblées conciliaires ?
-La protection des bâtiments religieux, puis l’emplacement des églises : lutter contre la mainmise laïque.
-La protection des clercs désarmés : le port d’armes est interdit pour les oratores et les laboratores.
-L’interdiction de voler du bétail : il s’agit surtout ici d’assurer l’approvisionnement de la seigneurie on remarque que les vagues de paix concordent souvent avec les famines du Xe siècle.
-La participation des évêques à la paix de Dieu. D’après H.-W. Goetz, La paix de Dieu en France….
-La paix de Dieu, partie d’Aquitaine, se diffuse dans tout le royaume :
" En l’an mille de la Passion du Seigneur,… tout d’abord dans les régions de l’Aquitaine, les évêques, les abbés et les autres hommes voués à la sainte religion commencèrent à réunir le peuple en des assemblées plénières, auxquelles on apporta de nombreux corps de saints et d’innombrables châsses remplies de saintes reliques."
Après l’Aquitaine, le mouvement gagne la cour de Robert le Pieux qui tient sa première assemblée connue à Orléans le 25 décembre 1010 ou 1011. Du peu qu’on en connaisse, il semble que ce soit un échec. Les sources ne nous ont laissé de cette réunion qu’un chant de Fulbert de Chartres :
" Ô foule des pauvres, rend grâce au Dieu tout-puissant. Honore-le de tes louanges car il a remis dans la voie droite ce siècle condamné au vice. Il te vient en aide, toi qui devait supporter un lourd labeur. Il t’apporte le repos et la paix."
La paix de Dieu n’est sûrement pas homogène, au contraire pendant longtemps c’est un mouvement intermittent et localisé : où l’Église en a besoin et peut l’imposer, elle le fait. Une fois prise en main par Cluny à partir de 1016, le mouvement continue sa progression vers la Bourgogne où un concile se tient à Verdun-sur-le-Doubs 1021. Sous la présidence de Hugues de Châlon, évêque d’Auxerre, d’Odilon de Cluny et peut-être du roi Robert, la paix des Bourguignons est signée. Odilon commence alors à jouer un rôle majeur. Il propose dans un premier temps aux chevaliers bourguignons une diminution de la faide guerre privée et la protection des chevaliers qui feront le Carême. Dans un second temps à partir de 1020, il instaure une nouvelle paix clunisienne en Auvergne par le biais de sires de sa parenté. La seconde vague de paix, de plus en plus imprégnée par les moines, connaît son paroxysme avec l’initiation à la trêve de Dieu concile de Toulouges, 1027. Cependant, les évêques du Nord, tels que Adalbéron de Laon et Gérard de Cambrai ne sont pas favorables à l’instauration des mouvements de paix dans leur diocèse. Pourquoi ? Dans le Nord-Est du royaume, la tradition carolingienne est encore très forte et elle avance que seul le roi est le garant de la justice et de la paix. D’autre part, les évêques sont souvent à la tête de puissants comtés et n’ont pas besoin d’asseoir leur autorité par la paix de Dieu, contrairement à leurs confrères méridionaux. Les prélats considèrent aussi que la participation populaire au mouvement est telle qu’elle risque de montrer un caractère trop ostentatoire des reliques, ce qui est contraire aux volontés divines. En outre, Gérard de Cambrai accepte finalement de faire promettre et non de jurer la paix de Dieu dans son diocèse.
Y a-t-il vraiment un contexte de faiblesse royale ? La société féodale du XIe siècle n’a-t-elle pour faire sa police rien d’autre que la paix de Dieu ? D’une part, la justice et la paix d’Aquitaine sont sous la responsabilité exclusive du duc Guillaume et dans l’ensemble de ces régions où le roi ne règne qu’en titre, les clercs se bornent à mentionner ses années de règne au bas des chartes. De son côté, le roi Robert multiplie les assemblées : après celle d’Orléans, il en rassemble une à Compiègne 1023, puis à Ivois 1023 et enfin à Héry 1024. Il y a bien beaucoup de violences au temps du roi Robert mais certains historiens insistent sur la perception des limites de cette violence et l’existence de formes de paix. Ce que veulent ducs et évêques c’est surtout que ces négociations se déroulent sous leur tutelle. D’autre part la faide, que déplorent les nombreux lettrés qui décrivent leur époque, est une nécessité sociale dans la société : trouver des vengeurs garantit la sécurité de telle ou telle seigneurie. En bref, la paix de Dieu n’est pas un groupe de mouvement populaire pour changer le monde mais une paix pour aider au maintien du monde. Bien qu’ils craignent les colères de Dieu, lorsqu’ils le peuvent, les moines tentent toujours de négocier la situation et de s’arranger avec les chevaliers.
Le mouvement se poursuit une dernière fois dans la partie méridionale jusqu’en 1033 où il disparaît. En réalité, l’Église pense que la répression des dégâts de la guerre privée serait plus efficace si des armées paysannes étaient lancées contre les châteaux. Certains seigneurs utilisent de plus en plus la paix de Dieu comme moyen de pression contre leurs adversaires : v. 1030-1031, raconte André de Fleury, l’archevêque Aymon de Bourges constitue et encadre une milice de paix anti-châtelaine dont le but est la destruction de la forteresse du vicomte Eudes de Déols. Pourtant en 1038, les paysans sont défaits définitivement par les hommes d’armes du vicomte : "c’est la fin de la paix de Dieu."
La société ordonnée du XIe siècle
À la fin de sa vie vers 80 ans, l’évêque Adalbéron de Laon, qui s’était autrefois illustré par ses nombreuses trahisons, adresse au roi Robert un poème Carmen ad Rotbertum regem de 433 vers, écrit entre 1027 et 1030. Il s’agit en fait d’un dialogue entre le religieux et le roi, bien qu’Adalbéron monopolise la parole. Ce dernier dresse un portrait de la société de son temps, il dénonce par ses vers le bouleversement de l’ordre du royaume dont les moines de Cluny sont largement responsables et dont le principal usurpateur n’est autre que l’abbé Odilon de Cluny.
" Les lois dépérissent et déjà toute paix a disparu. Les mœurs des hommes changent comme change l’ordre de la société "
Ce texte souligne le discours moralisateur des clercs, dont le rôle est de décrire l’ordre idéal de la société. Ainsi le désordre apparent de la société et ses conséquences les mouvements de paix dérangent les prélats du Nord de la France de tradition carolingienne. Le schéma des trois ordres ou tripartite a été élaboré dès le ixe siècle avant d’être repris dans les années 1020 par Adalbéron et Gérard de Cambrai, deux évêques de même parenté. Pour quelles raisons ? Il s’agit de remettre de l’ordre dans la société et de rappeler à chacun le rôle qu’il tient dans celle-ci. L’évêque de Laon résume sa pensée par une phrase célèbre :
Triplex ego Dei domus est quae creditur una. Nunc orant, alii pugnant, aliique laborant On croit que la maison de Dieu est une, mais elle est triple. Sur Terre, les uns prient, d’autres combattent et d’autres enfin travaillent.
Depuis le commencement, le genre humain est divisé en trois : les orants, les agriculteurs, les combattants et chacun des trois est réchauffé à droite et à gauche par les autres.
Ceux qui prient : pour l’auteur, l’ensemble de la société constitue un seul corps à partir duquel l’Église apparaît unique et entière. Jusqu’au IXe siècle, les moines et les séculiers faisaient partie de deux catégories distinctes sacerdotes et orantes. Leur rôle, rappelle Adalbéron, est de dire la messe et de prier pour les péchés des autres hommes. À aucun moment, les clercs ne doivent juger ou diriger les hommes, cela est du ressort du roi ! Son témoignage souligne le profond malaise qui existe au XIe siècle entre l’épiscopat et les monastères, en particulier les abbés de Cluny qu’il voit en horreur puisqu’ils se prennent pour des rois dit-il.
Ceux qui combattent : l’aristocratie châtelaine qui émerge au même moment a bien conscience de son appartenance aux lignages princiers et royaux de par l’apparition des noms de famille, l’émergence des récits généalogiques et du développement du titre de miles chevalier dans les sources du XIe siècle. Tous descendent directement des rois carolingiens et ne sont pas comme on l’a longtemps cru des hommes neufs. Adalbéron n’aime pas cette nouvelle catégorie de personnes qui se montre arrogante et usurpatrice. Néanmoins, les guerriers protègent les églises et défendent les hommes du peuple, grands et petits. Dans ce texte, la notion de liberté est très proche de celle d' aristocratie, les domini seigneurs, aptes au commandement, se distinguent des soumis.
Ceux qui travaillent : les serfs travaillent toute leur vie avec effort. Ils ne possèdent rien sans souffrance et fournissent à tous la nourriture et le vêtement. Le fait que la servitude reste la condition du paysan reste très ancrée dans les classes dirigeantes de l’an mil. D’ailleurs pour désigner le paysan, Adalbéron n’utilise pas d’autres termes que servus esclave puis serf en latin. D’autre part, il englobe dans la condition servile l’ensemble de ceux qui fendent la terre, suivent la coupe des bœufs … criblent le blé, cuisent près du chaudron graisseux. En bref, le monde paysan est peuplé par des individus soumis et souillés par la crasse du monde. Cette image péjorative des catégories populaires est le fait des élites ecclésiastiques.
Ce message du vieil Adalbéron est néanmoins plus complexe qu’il n’y paraît. Il faut d’abord remarquer que la protection des paysans est un faux problème. Cette protection n’est-ce pas en réalité les seigneurs qui leur interdisent de s’armer eux-mêmes pour mieux les dominer ? Ce schéma tripartite fonctionne, uniquement, dans un contexte national, contre un ennemi extérieur. Lors des guerres privées, qui sont monnaie courante au XIe siècle, les bellatores combattent pour leur intérêt propre et ils ne défendent que partiellement leurs paysans. Pire, ils les exposent à leurs adversaires qui se feront un plaisir de les piller dans un dessein de vengeance chevaleresque. En allant plus loin que Georges Duby, il faut enfin souligner que le modèle tripartite proposé par Adalbéron est l'un des nombreux modèles possibles : bipartite clercs et laïcs, quadripartite clercs, moines, guerriers et serfs. Il ne faudrait pas croire non plus à une certaine hiérarchie des ordres. Les contemporains sont conscients que chacun a besoin de l’autre pour survivre.
Ces trois ordres sont indispensables l’un à l’autre : l’activité de l’un d’eux permet aux deux autres de vivre.
Dans l’idéal, les paysans doivent recevoir une protection, insuffisante soit-elle, des guerriers et la rémission à Dieu aux clercs. Les guerriers doivent leur subsistance et leur profit impôts aux paysans et leur rémission à Dieu aux clercs. Enfin les clercs doivent leur nourriture aux paysans et leur protection aux guerriers. Pour Adalbéron et Gérard, cette société idéale est déréglée lorsqu’ils écrivent vers 1025-1030.
Robert le Pieux et l’Église Un roi moine
L’abbaye de Fleury et l’ascension du mouvement monastique Ordre de Cluny.
Le règne de Hugues Capet était celui de l’épiscopat, celui de Robert en sera autrement. Depuis le concile de Verzy 991-992, les Capétiens sont au cœur d’une crise politico-religieuse qui oppose d’un côté, un proche du pouvoir, l’évêque Arnoul II d'Orléans et de l’autre l’abbé Abbon de Fleury.
En ces temps troublés Xe-XIe s., on assiste au renouveau du monachisme qui se caractérise par la volonté de réformer l’Église, un retour à la tradition bénédictine, éphémèrement revivifiée au temps de Louis le Pieux par Benoît d'Aniane. Leur rôle est de réparer les péchés du peuple. Les moines rencontrent rapidement un grand succès : rois et comtes les attirent près d’eux et les dotent richement en terres (souvent confisquées à des ennemis, en objets de toute nature, les grands abbés sont appelés à purifier certains lieux : ainsi Guillaume de Volpiano est appelé par Richard II de Normandie à Fécamp 1001. Sous l’égide de Cluny, les monastères cherchent de plus en plus à s’émanciper de la tutelle épiscopale, en particulier Fleury-sur-Loire. D’ailleurs des abbés s’en vont à Rome entre 996 et 998 réclamer des privilèges d’exemption au pape. Dans les régions méridionales du royaume, Cluny et les autres établissements, les mouvements de paix sont diffusés avec l’aide de certains ecclésiastiques qui espèrent un renforcement de leur pouvoir : Odilon, appuyé par sa parenté, travaille en étroite collaboration avec l’évêque du Puy pour commencer la trêve de Dieu en Auvergne v. 1030. Néanmoins, dans les provinces septentrionales, Cluny n’a pas bonne presse. Ici les évêques sont à la tête de comtés puissants et l’intervention des clunisiens pourrait leur nuire. Adalbéron de Laon et Gérard de Cambrai n’apprécient pas les moines qu’ils considèrent comme des imposteurs. D’ailleurs du côté des évêques, les critiques contre les moines ne manquent pas : ainsi on leur reproche d’avoir une vie opulente, d’avoir des activités sexuelles contre nature et de porter des vêtements de luxe l’exemple de l’abbé Mainard de Saint-Maur-des-Fossés est détaillé. Du côté des réguliers, les exemples contre les évêques foisonnent : on affirme que les prélats sont très riches trafic d’objets sacrés, la simonie et dominent en véritables seigneurs de la guerre. Abbon, le chef de file du mouvement réformateur monastique, montre l’exemple en tentant d’aller pacifier et purifier le monastère de La Réole, où il trouvera la mort dans une bagarre en 1004.
La force de Fleury et de Cluny est leur centre intellectuel respectif : le premier conserve au XIe siècle plus de 600 manuscrits de tout horizon, l’abbé Abbon lui-même écrit de nombreux traités, fruits de lointains voyages notamment en Angleterre, sur lesquels il réfléchit par exemple sur le rôle du prince idéal ; le second par l’intermédiaire de Raoul Glaber est un lieu où on écrit l’Histoire. Les rois Hugues et Robert, sollicités par les deux partis épiscopal et monastique, reçoivent la plainte d’Abbon qui dénonce les agissements d’un laïc, Arnoul châtelain d’Yèvres, qui aurait élevé sans autorisation royale une tour et surtout aurait soumis par la force les communautés paysannes qui appartiennent à l’abbaye de Fleury. Arnoul d’Orléans, l’oncle d’Arnoul d’Yèvres, affirme quant à lui que son neveu est, pour le roi, un appui indispensable pour lutter contre Eudes Ier de Blois. Finalement une négociation se déroule sous la présidence de Robert et un diplôme daté à Paris de 994 met fin provisoirement à la querelle. Abbon est alors dénoncé de corrupteur et convoqué à une assemblée royale. Il écrit pour l’événement une lettre s’intitulant Livre apologétique contre l’évêque Arnoul d’Orléans qu’il adresse au roi Robert, réputé lettré et piqué de culture religieuse. L’abbé de Fleury saisit l’opportunité pour réclamer la protection de Robert, qui y répond favorablement. L’épiscopat traditionnel carolingien se sent alors lâché par la royauté et menacé par les moines. Cette situation va se renforcer avec la mort de Hugues Capet à l’automne 996. Robert est désormais plutôt tenté par la culture monastique que par un pouvoir épiscopal et pontifical qui reste encore en grande partie le serviteur de l’Empereur germanique. En parallèle de ces luttes de factions, on sait également que les évêques et les abbés se retrouvent aux côtés des comtes pour veiller au respect de leurs immunités juridiques.
Robert, le prince idéal
À la mort du roi Robert, les chanoines de Saint-Aignan demandent à un moine de Fleury ayant côtoyé le roi et ayant accès à la bibliothèque de l’abbaye ligérienne, de composer la biographie du second Capétien.
"Le très bon et très pieux Robert, roi des Francs, fils de Hugues, dont la piété et la bonté ont retenti par tout le monde, a de tout son pouvoir enrichi chéri et honoré ce saint Aignan par la permission duquel nous avons voulu écrire la vie de ce très excellent roi.
Dans sa biographie, Helgaud s’efforce de démontrer la sainteté de ce roi puisqu’il n’entend pas relater les faits touchant aux fonctions guerrières.
Cette œuvre semble s’être inspirée de la vie de Géraud d'Aurillac, un autre saint laïque racontée par Odilon de Cluny. La vie de Robert est une série d’exempla, destinés à montrer que le comportement du roi fut celui d’un prince humble qui possédait toutes les qualités : douceur, charité, accessible à tous, pardonnant tout. Cette hagiographie est différente de l’idéologie royale traditionnelle, puisque le roi semble suivre les traces du Christ. Le péché permet aux rois de se reconnaître comme simples mortels et ainsi asseoir des bases solides pour la nouvelle dynastie.
L’abbaye de Fleury, depuis le règne de Hugues Capet, s’est occupée de légitimer profondément la monarchie capétienne en créant une nouvelle idéologie royale. Selon Helgaud, Robert est depuis son sacre, particeps Dei regni participant à la royauté de Dieu. En effet, le jeune robertien a reçu en 987 l’onction de l’huile à la fois temporelle et spirituelle, désireux de remplir sa puissance et sa volonté du don de la sainte bénédiction. L’ensemble des clercs pour qui on possède les travaux, se soumet à l’égard de la personne royale : pour Helgaud, Robert tient la place de Dieu sur terre princeps Dei, Fulbert de Chartres le nomme « Saint père ou votre Sainteté , pour Adémar de Chabannes c’est le père des pauvres et enfin selon Adalbéron de Laon, il a reçu de Dieu la vraie sagesse lui donnant accès à la connaissance de l’univers céleste et immuable. Un autre grand lettré de son temps, Raoul Glaber, relate l’entrevue d’Ivois août 1023 entre Henri II et Robert le Pieux. Ils s’efforcèrent de définir ensemble les principes d’une paix commune à toute la chrétienté. Selon les théoriciens du XIe siècle, Robert était du niveau de l’empereur puisque par sa mère des ascendances romaines, c’est le Francorum imperator.
Secret de leur succès auprès des moines, les premiers Capétiens et en premier lieu Robert II sont réputés pour avoir effectué de nombreuses fondations religieuses. Hugues le Grand et Hugues Capet en leur temps avaient fondé le monastère de Saint-Magloire sur la rive droite à Paris. La reine Adélaïde, mère du roi Robert, réputée très pieuse, ordonne la construction du monastère Saint-Frambourg à Senlis et surtout celui dédié à sainte Marie à Argenteuil. À ce propos voici le commentaire de Helgaud de Fleury :
Elle la reine Adélaïde construisit aussi dans le Parisis, au lieu appelé Argenteuil, un monastère où elle réunit un nombre considérable de serviteurs du Seigneur, vivant selon la règle de saint Benoît.
Le second Capétien se porte au premier rang dans la défense des saints qui, selon lui, garantissent l’efficacité de la grâce divine et concourent ainsi à la purification de la société en faisant barrage aux forces du mal. Ainsi plusieurs cryptes sont construites ou rénovées pour l’occasion : Saint-Cassien à Autun, Sainte-Marie à Melun, Saint-Rieul de Senlis à Saint-Germain-l'Auxerrois. Le souverain va plus loin en offrant des morceaux de reliques à certains moines un fragment du chasuble de saint Denis à Helgaud de Fleury. On sait aussi que v. 1015-1018, à la demande de la reine Constance, Robert commande la réalisation d’une châsse à l’intention de saint Savinien pour l’autel des reliques de l’église abbatiale de Saint-Pierre-le-Vif près de Sens. D’après la légende, saint Savinien aurait protégé le couple royal lorsque Robert était parti à Rome avec Berthe avant de la quitter définitivement. La commande est faite à un des meilleurs moine-orfèvres du royaume, Odorannus. Au total, l’objet sacré est composé de 900 grammes d’or et de 5 kg d’argent. Au total, l’inventaire est impressionnant : durant son règne le roi offre une quantité de chapes, de vêtements sacerdotaux, de nappes, de vases, de calices, de croix, d’encensoirs… L’un des présents qui marque le plus les contemporains est probablement l’Évangéliaire dits de Gaignières, réalisé par Nivardus, artiste lombard, pour le compte de l’abbaye de Fleury début du XIe s..
L’élu du Seigneur
La définition de la royauté au temps de Robert le Pieux est difficilement appréciable de nos jours. Le roi n’a qu’une préséance sur les princes du royaume des Francs. Certains comme Eudes II de Blois en 1023, bien que le respect soit de mise, lui font bien comprendre qu’ils souhaitent gouverner à leur guise sans son consentement. Un prince respecte le roi mais il ne se sent pas son subordonné. Pourtant en parallèle le souverain tend à s’imposer comme Primus inter pares, le premier des princes. Qui plus est, les textes datés de la première partie du xie siècle évoquent largement la fidélité des princes envers le roi.
Un jour de 1027, une pluie de sang tombe sur le duché d’Aquitaine. Le phénomène inquiète suffisamment les contemporains pour que Guillaume d’Aquitaine l’explique comme un signe divin. Le duc décide alors d’envoyer des messagers à la rencontre du roi Robert pour que ce dernier demande aux meilleurs savants de sa cour une explication et des conseils. Gauzlin, abbé de Fleury et archevêque de Bourges et Fulbert de Chartres prennent en main l’affaire. Gauzlin répond que le sang annonce toujours un malheur qui s’abattra sur l’Église et la population, mais qu’après viendra la miséricorde divine. Quant à Fulbert, mieux documenté, il analyse les anciennes historiae les ouvrages qui relatent les faits passés :
J’ai trouvé Tite-Live, Valère, Orose et plusieurs autres relatant cet événement ; en la circonstance je me suis contenté de produire le témoignage de Grégoire, évêque de Tours, à cause de son autorité religieuse.
Fulbert conclut d’après Grégoire de Tours Histoire des Francs, VII, que seuls les impies et les fornicateurs mourront pour l’éternité dans leur sang, s’ils ne se sont pas préalablement amendés . Ami de l’évêque Fulbert, Guillaume d’Aquitaine aurait pu s’adresser directement à celui-ci. Or, conscient que le roi Robert est l’élu du Seigneur, c’est à lui, responsable du royaume tout entier, qu’il faut demander conseil. Il est le mieux placé pour connaître les mystères du monde et les volontés de Dieu. Au XIe siècle, même les plus puissants des hommes respectent l’ordre établi par Dieu, c’est-à-dire se recueillir auprès de son seigneur le roi.
L’histoire des pouvoirs magiques royaux a été traitée par Marc Bloch dans les Rois thaumaturges 1924. Pendant le haut Moyen Âge, le pouvoir de faire des miracles était strictement réservé à Dieu, aux saints et aux reliques. À l’époque mérovingienne, on a la mention du pieux Gontran, mentionné par Grégoire de Tours VIe siècle et considéré comme le premier roi guérisseur franc. Durant le règne d’Henri Ier, au milieu du XIe siècle, on commence à raconter à Saint-Benoît-sur-Loire que le roi Robert avait le don de guérir les plaies de certaines maladies en les touchant. Helgaud de Fleury écrit dans sa Epitoma vitae regis Roberti pii :
… cet homme de Dieu n’avait pas horreur d’eux des lépreux, car il avait lu dans les saintes Écritures que souvent notre Seigneur Jésus avait reçu l’hospitalité sous la figure d’un lépreux. Il allait à eux, s’en approchait avec empressement, leur donnait l’argent de sa propre main, leur baisait les mains avec sa bouche …. Au reste, la divine vertu conféra à ce saint homme une telle grâce pour la guérison des corps qu’en touchant aux malades le lieu de leurs plaies avec sa pieuse main, et y imprimant le signe de la croix, il leur enlevait toute douleur de maladie.
En effet, le Capétien est le premier souverain de sa lignée à être crédité d’un don thaumaturgique. Peut-être est-ce une compensation symbolique à la faiblesse du pouvoir royal ? Probablement que oui, ne pouvant s’imposer par la force épisode d’Eudes de Blois en 1023, la monarchie a dû trouver une alternative pour imposer sa primauté. Néanmoins, cette première thaumaturgie est reconnue comme généraliste c’est-à-dire que le roi n’était pas spécialisé dans telle ou telle maladie comme ce sera le cas pour ses successeurs avec les écrouelles. On ne sait pas grand-chose des actions magiques de Robert si ce n’est qu’il aurait guéri des lépreux dans le Midi au cours de son voyage de 1018-1020. Le roi des Francs n’est pas le seul à user de ce genre de pratique, son contemporain Édouard le Confesseur en fait de même en Angleterre. Selon la tradition populaire, le sang du roi véhicule une capacité à faire des miracles, don qui est renforcé par le sacre royal. Enfin, selon Jacques Le Goff, aucun document ne prouve que les rois des Francs aient pratiqué régulièrement le toucher des écrouelles avant saint Louis.
Robert le Pieux et l’économie Une période de pleine croissance économique
À partir du IXe siècle l’amélioration progressive de la productivité agricole entraine une expansion démographique qui est à la base d’une phase de croissance qui s’accélère à partir de Xe siècle dure jusqu’au XIVe siècle.
Si au IXe siècle les pillages ont notablement ralenti l’économie, celle-ci est en expansion soutenue à partir du Xe siècle. En effet avec l’instauration d’une défense décentralisée, la seigneurie banale apporte une réponse bien adaptée aux rapides raids sarrasins ou vikings. Il devient plus rentable pour les pillards de s’installer sur un territoire, recevoir un tribut contre la tranquillité des populations et commercer, plutôt que de guerroyer, et ce dès le Xe siècle. Les Vikings participent ainsi pleinement au processus de féodalisation et à l’expansion économique qui l’accompagne. Ils doivent écouler leur butin, et ils frappent de la monnaie à partir des métaux précieux qui étaient thésaurisés dans les biens religieux pillés. Ce numéraire, qui est réinjecté dans l’économie, est un catalyseur de premier plan pour la mutation économique en cours. La masse monétaire globale augmente d’autant qu’avec l’affaiblissement du pouvoir central de plus en plus d’évêques et de princes battent monnaie. Or la monétarisation grandissante de l’économie est un puissant catalyseur : les paysans peuvent tirer profit de leurs surplus agricoles et sont motivés pour accroitre leur capacité de production par l’emploi de nouvelles techniques et l’augmentation des surfaces cultivables via le défrichage. L’instauration du droit banal contribue à cette évolution car le producteur doit dégager suffisamment de bénéfices pour pouvoir reverser le cens. Les châtelains réinjectent d’ailleurs ce numéraire dans l’économie car l’un des principaux critères d’appartenance à la noblesse en pleine structuration est d’avoir une conduite large et dispendieuse envers ses pendants cette conduite étant d’ailleurs nécessaire pour s’assurer la fidélité de ses milites.
De fait, dans certaines régions, les mottes jouent un rôle pionnier dans la conquête agraire sur le saltus. En Thiérache, c’est à l’essartage de terres revenues à la forêt qu’est lié le premier mouvement castral. En Cinglais, région située au sud de Caen, les châteaux primitifs s’étaient installés aux confins des ensembles forestiers. Dans tous les cas, l’implantation castrale en périphérie du village est très courante. Ce phénomène s’insère dans un peuplement linéaire très ancré et ancien qui se juxtapose à un défrichement précoce sûrement carolingien bien antérieur au phénomène castral. Néanmoins, les chartes du nord de la France ont confirmé une activité d’essartage intensive encore présente jusqu’au milieu du XIIe siècle et même au-delà.
D’autre part, la seigneurie comme le clergé ont bien perçu l’intérêt de stimuler et de profiter de cette expansion économique : ils favorisent les défrichages et la construction de nouveaux villages, et ils investissent dans des équipements augmentant les capacité de production moulins, pressoirs, fours, charrues…, de transports ponts, routes…. D’autant que ces infrastructures permettent d’augmenter les revenus banaux, de prélever péages et tonlieu… De fait, l’augmentation des échanges entraîne la multiplication des routes et des marchés le réseau qui se met en place est immensément plus dense et ramifié que ce qui pouvait exister dans l’Antiquité. Ces ponts, villages et marchés se construisent donc sous la protection d’un seigneur qui est matérialisée par une motte castrale. Le pouvoir châtelain filtre les échanges de toute sorte qui s’amplifient à partir du XIe siècle. On voit de nombreux castra implantés sur les axes routiers importants, sources d’un apport financier considérable pour le seigneur du lieu. Pour la Picardie, Robert Fossier a remarqué que près de 35 % des sites localisables en terroirs villageois sont situés sur des voies romaines ou à proximité, et que 55 % des nœuds routiers et fluviaux possédaient des points fortifiés.
Politique monétaire
Le denier d’argent est, nous l’avons vu, l’un des principaux moteurs de la croissance économique depuis le ixe siècle. La faiblesse du pouvoir royal a entrainé la frappe de monnaie par de nombreux évêques, seigneurs et abbayes. Alors que Charles le Chauve comptait 26 ateliers de frappe monétaire, Hugues Capet et Robert le Pieux n’ont plus que celui de Laon. Le règne d’Hugues Capet marque l’apogée de la féodalisation de la monnaie. Il en résulte une diminution de l’uniformité du denier et l’apparition de la pratique de la refrappe de la monnaie aux marchés on se fie au poids de la pièce pour en déterminer la valeur. Par contre on est dans une période où l’augmentation des échanges est soutenue par l’augmentation du volume de métal disponible. En effet l’expansion vers l’est de l’empire permet aux Ottoniens de pouvoir exploiter de nouveaux gisement d’argent. La marge de manœuvre de Robert le Pieux est faible. Or, la pratique du rognage ou des mutations, entraine des dévaluations tout à fait préjudiciables. Cependant en soutenant la paix de Dieu, Robert soutient la lutte contre ces abus. Les clunisiens qui comme d’autres abbayes battent leur monnaie ont tout intérêt à limiter ces pratiques.
C’est pourquoi, au XIe siècle dans le Midi, les utilisateurs doivent s’engager à ne pas rogner ou falsifier les monnaies et les émetteurs s’engagent à ne pas prendre prétexte d’une guerre pour pratiquer une mutation monétaire.
Robert le Pieux et l’État L’administration royale
On sait que depuis 992 environ, Robert a la réalité du pouvoir face à un Hugues Capet vieillissant. Les historiens montrent ainsi que les premiers Capétiens commencent à renoncer au pouvoir autour de 50 ans, par tradition mais aussi parce que l’espérance de vie d’un souverain est d’environ 55-60 ans. Robert fera la même chose en 1027, Henri Ier en 1059 et Philippe Ier en 1100. À l’image de son père et dans la tradition carolingienne de Hincmar de Reims, Robert prend conseil auprès des ecclésiastiques, chose qui ne se faisait plus, au grand regret des clercs, depuis les derniers Carolingiens. Cette politique est reprise et théorisée par l’abbé Abbon de Fleury. Du temps qu’il était encore associé à Hugues, le roi pouvait écrire de la plume de Gerbert :
Ne voulant en rien abuser de la puissance royale, nous décidons toutes les affaires de la res publica en recourant aux conseils et sentences de nos fidèles.
Le terme qui revient le plus souvent dans les chartes royales est celui de bien commun res publica, notion reprise de l’Antiquité romaine. Le roi est ainsi le garant, du haut de sa magistrature suprême, du bien-être de tous ses sujets.
L’administration royale nous est connue par les archives et en particulier par le contenu des actes diplômes royaux. Comme pour son père, on enregistre à la fois une continuité avec l’époque précédente et une rupture. L’historiographie a véritablement changé son point de vue sur l’administration au temps de Robert depuis une quinzaine d’années. Depuis la thèse de Jean-François Lemarignier, on pensait que l’espace dans lequel les diplômes étaient expédiés avaient eu tendance à se rétrécir au cours du xie siècle : le déclin s’observe entre 1025-1028 et 1031 aux divers points de vue des catégories de diplômes. Mais cet historien affirmait que, à partir d’Hugues Capet et encore plus sous Robert le Pieux, les chartes comportaient de plus en plus de souscriptions signatures étrangères à la chancellerie royale traditionnelle : ainsi les châtelains et même de simples chevaliers se mêlaient aux comtes et aux évêques jusqu’alors prépondérants et devenaient plus nombreux qu’eux à la fin du règne. Le roi n’aurait plus suffi à garantir ses propres actes.
Plus récemment, Olivier Guyotjeannin a mis en évidence un tout autre regard sur l’administration du roi Robert. L’introduction et la multiplication des souscriptions et des listes de témoins au bas des actes signent, selon lui, plutôt une nouvelle donne dans les systèmes de preuves. Les actes royaux par des destinataires et par une chancellerie réduite à quelques personnes se composent pour la moitié d’entre eux encore, d’une diplomatique de type carolingien monogramme, formulaires carolingiens jusque vers 1010. Les préambules se modifient légèrement sous le chancelier Baudouin à partir de 1018 mais il y a toujours l’augustinisme politique et l’idée du roi protecteur de l’Église. Surtout, souligne l’historien, les actes royaux établis par la chancellerie de Robert ne s’ouvrent que très tardivement et très partiellement à des signatures étrangères à celles du roi et du chancelier. En revanche, dans la seconde partie du règne, on note quelques actes à souscriptions multiples : par exemple dans l’acte délivré pour Flavigny 1018, on note le signum de six évêques, de Henri, de Eudes II, du comte de Vermandois et de quelques ajouts ultérieurs. Il semble néanmoins que les chevaliers et les petits comtes présents dans les chartes ne soient pas les châtelains révoltés de l’historiographie traditionnelle mais plutôt les membres d’un réseau local tissé autour des abbayes et des évêchés tenus par le roi. En clair, les transformations des actes royaux à partir de la fin du règne de Robert ne traduisent pas un déclin de la royauté.
La justice du roi Robert
Depuis la fin du xe siècle, la formulation de l’idéologie royale est l’œuvre du monde monastique, et en particulier dans le très dynamique monastère de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Dans la théorie d’Abbon de Fleury v. 993-994, le souci du souverain de l’an mil est de faire régner l’équité et la justice, garantir la paix et la concorde du royaume. Son dessein est de sauvegarder la mémoire capétienne pour des siècles. De leur côté, les princes territoriaux du XIe siècle savent ce qui fonde et légitime leur pouvoir jusque dans leurs aspects royaux. La présence d’une autorité royale en Francie reste indispensable pour les contemporains. Cependant, Abbon souligne également dans ses écrits la nécessité pour le souverain franc d’exercer son office en vue du bien commun, en décidant des affaires avec le consentement des conseillers les évêques et les princes. Or, Robert le Pieux n’a pas toujours suivi, à son grand tort, cette théorie, en particulier dans l’affaire de la succession des comtés de Meaux et de Troyes 1021-1024.
Depuis le début du règne de Robert le Pieux, les comtés de Meaux et Troyes étaient aux mains d’un puissant personnage, Étienne de Vermandois, un cousin germain du roi. En 1019, Étienne en appelle à la générosité du roi, c’est-à-dire qu’il lui confirme la restitution d’un bien à l’abbaye de Lagny. Le roi accepte mais le comte décède quelques années plus tard à une date inconnue entre 1021 et 1023. Fait rare à l’époque, Étienne n’a pas de successeur ni d’héritier clairement nommé. Le roi se charge de gérer la succession qu’il cède sans difficulté à Eudes II de Blois, seigneur déjà implanté dans la région Épernay, Reims, Vaucouleurs, Commercy et surtout cousin germain d’Étienne. Quelques mois plus tard une crise éclate. L’archevêque de Reims Ebles de Roucy fait part au roi des mauvaises actions du comte Eudes qui accapare tous les pouvoirs à Reims au détriment du prélat. Robert, en tant que défenseur de l’Église, décide, sans le consentement de quiconque, de retirer la charge comtale à Eudes de Blois. Ce dernier, furieux, s’impose à Reims par la force. En outre, le roi des Francs n’est pas soutenu, sa justice est mise à mal. Ses fidèles Fulbert de Chartres et Richard II soutiennent Eudes de Blois en avançant que le roi ne doit pas se comporter en tyran. Convoqué par Robert en 1023, le comte de Blois informe courtoisement son roi qu’il ne se déplacera pas et ce dernier n’a ni les moyens de l’obliger ni les moyens de saisir son patrimoine comtal, car ces terres n’ont pas été données personnellement par Robert à Eudes, ce dernier les ayant acquises de ses ancêtres par la volonté du Seigneur.
Sorti affaibli de cette affaire, le roi ne réitère pas la même erreur. En 1024, après une réunion des grands à Compiègne qui lui suggèrent l’apaisement avec Eudes de Blois, Robert doit confirmer les possessions de Eudes. Quelques années plus tard, en mai 1027, Dudon, abbé de Montierender, se plaint publiquement de l’usurpation violente exercée par Étienne le châtelain de Joinville. Ce dernier s’est emparé de sept églises au détriment du monastère dont il est pourtant l’avoué. Le roi se charge une nouvelle fois de l’affaire, et profitant du couronnement de son second fils Henri à la Pentecôte 1027 à Reims, il convoque le châtelain Étienne. Ce dernier ne se déplace pas pour l’événement. L’assemblée présente, composée entre autres par Ebles de Reims, Odilon de Cluny, Dudon de Montierender, Guillaume V d’Aquitaine, Eudes II de Blois, décide collégialement de lancer l’anathème sur le châtelain de Joinville. En bref, le roi Robert n’est pas le roi faible que l’historiographie a toujours présenté. Certes, ses décisions en matière de justice doivent tenir compte du conseil des ecclésiastiques et des princes territoriaux, mais le souverain reste le Primer inter pares, c’est-à-dire le premier parmi ses pairs.
Le roi des Francs est-il reconnu ?
Nous avons conservé deux visions tout à fait opposées du roi Robert : d’un côté Raoul Glaber qui fait, entre autres, le récit de la campagne de Bourgogne soulignant l’attitude énergique et déterminée du roi; et de l’autre Helgaud de Fleury, qui n’hésite pas à en faire un roi saint qui pardonne à ses ennemis :
Le reste, ce qui a trait à ses combats dans le siècle, aux défaites de ses ennemis, aux honneurs qu’il a acquis par son courage et son habileté, je la laisse écrire aux historiens, s’il s’en trouve.
Robert est le premier et le seul des premiers Capétiens à s’aventurer loin au sud de la Loire. Selon Helgaud de Fleury il s’agit uniquement d’une visite des reliques les plus vénérées du Midi. Le roi est reconnu par plusieurs de ses vassaux. En 1000, un comte des Bretons, Béranger, vient prêter allégeance au roi. En 1010, le roi Robert, qui est invité par son ami Guillaume V d'Aquitaine à Saint-Jean-d'Angély, offre à l’église un plat d’or fin et des étoffes tissées de soie et d’or. Les résidences royales sont embellies et agrandies, surtout celles où le roi passe le plus de temps (Orléans, Paris et Compiègne. De nombreuses personnalités sont reçues par le roi Robert, telles que Odilon de Cluny ou Guillaume de Volpiano. Le souverain est ainsi le dernier roi jusqu’à Louis VII à entretenir des contacts avec la plus grande partie du royaume. Raoul Glaber affirme dans sa chronique qu’excepté le roi Henri II du Saint-Empire, Robert n’a pas d’autre concurrent en Occident. Sur son sceau, le roi des Francs porte le globe, ce qui prouve sa vocation à rassembler la chrétienté. On dit que les rois Æthelred II d'Angleterre, Rodolphe III de Bourgogne et Sanche III de Navarre l’honorent de cadeaux et n’ont pas son envergure royale. On raconte que dans certaines régions où le roi n’est jamais allé Languedoc les actes sont datés de son règne. Il mène à la fois des actions offensives qui ne sont pas toujours victorieuses en Lorraine et des actions matrimoniales auprès des princes territoriaux : Adèle de France, veuve de Richard III de Normandie, épouse en secondes noces Baudouin V de Flandre 1028. Le roi avait précédemment lancé de vaines attaques sur la principauté du Nord. À la fin de son règne, les deux plus puissantes principautés territoriales, la Normandie et la Flandre, sont alliées du roi.
Siège de Melun par Robert le Pieux, roi de France. Grandes Chroniques de France de Charles V, Paris, XIVe siècle.
A contrario, la royauté capétienne n’impose pas son autorité partout, comme l’illustre la prise de Melun par Eudes Ier en 991, que Robert et son père avaient dû reprendre par la force. À travers les très rares témoignages qu’on garde du voyage dans le Midi, on sait que le roi n’a pas eu des rapports très amicaux avec les princes méridionaux. Même si Guillaume V d'Aquitaine et Robert sont amis, le duc parle à son propos de la nullité du roi vilitas regis dans une lettre. La couronne d’Italie a échappé au duc d’Aquitaine et Robert s’en réjouit169. Vers 1018-1020, l’Auvergne est soumise au désordre et le passage du roi ne rétablit pas la situation autour du Puy et d’Aurillac. À proximité de son domaine, la maison de Blois pose à la royauté la plus grosse menace. Le roi laisse à Eudes II de Blois, fils de son épouse Berthe de Bourgogne, à la suite de l’affaire du comté de Champagne, le soin d’obtenir la succession du comté de Troyes 1024. Mais ce choix permet au comte de brouiller les relations entre Robert et les évêchés du Nord-Est. Le roi ne se montre pas pour autant vaincu en s’appuyant sur les arrières du Blésois dans le Maine et à Saint-Martin de Tours170. Lors d’un voyage en Gascogne, Abbon de Fleury s’exprime :
Me voici plus puissant en ce pays que le roi, car ici personne ne connaît sa domination.
Et à Fulbert de Chartres de rajouter :
Le roi notre seigneur qui a la haute responsabilité de la justice est tellement empêché par la perfidie des méchants que pour le moment il ne peut ni se venger, ni nous secourir comme il convient.
La reconstitution réelle de son action dans le royaume est très difficile à cerner tant les sources sont flatteuses à son égard conception hagiographique de Helgaud. Doit-on au contraire considérer que son règne a été dans la continuité d’un déclin commencé sous les derniers Carolingiens ? En réalité, les chartes du premier tiers du xie siècle montrent plutôt une lente adaptation des structures dans le temps. Dans tous les cas, Robert le Pieux, Capétien continuateur des valeurs carolingiennes, reste un grand personnage du XIe siècle.
Suite les Capétiens -> http://www.loree-des-reves.com/module ... hp?topic_id=2505&forum=24
Posté le : 19/07/2014 13:31
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
46 Personne(s) en ligne ( 21 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 46
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages