Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 96
HP : 629 / 1574
MP : 3170 / 61474
|
Vers l'indépendance
Le 23 juin 1956, la loi-cadre Deferre est votée. Elle autorise le gouvernement français à prendre des mesures propres à l'évolution des territoires relevant du ministère de l'Outre-mer et à la décentralisation administrative (postes administratifs progressivement occupés par des Malgaches notamment). Des assemblées provinciales, élues au suffrage universel, délèguent leurs membres à une Assemblée législative, qui élit un conseil de gouvernement présidé par un haut-commissaire nommé par la France.
Les anciens partis, le P.A.D.E.S.M. et le M.D.R.M., sont à l'origine de nouveaux mouvements politiques. Ainsi, le 28 décembre 1956, le Parti social démocrate (P.S.D.), proche de la S.F.I.O., est créé à Majunga actuelle Mahajanga par les chefs historiques du P.A.D.E.S.M. comme Philibert Tsiranana, André Resampa, ou encore René Rasidy, des fonctionnaires issus de milieux modestes petite paysannerie côtière. Le P.S.D. devient un grand parti dominant qui noyaute tous les rouages de l'administration et se développe autour de la personnalité de Tsiranana. En 1957, les élections aux assemblées provinciales sont remportées par les éléments côtiers. En mai 1958 se réunit à Tamatave un congrès de l'Indépendance, à l'issue duquel est créé le Parti du congrès de l'indépendance de Madagascar (Antokon'ny Kongresin'ny Fahaleovantenan'I Madagasikara, A.K.F.M., en partie composé des membres de l'Union des démocrates sociaux, fondée en décembre 1956, et soutenue par les colons et du P.S.D. Il rassemble les partis politiques nationaux hostiles à une indépendance octroyée.
Le 28 septembre 1958 a lieu le référendum sur le projet de création de la Communauté française. Trois semaines après la victoire du oui, le 14 octobre 1958, la République malgache autonome est proclamée. Le Congrès des députés provinciaux se transforme en Assemblée constituante et le Conseil de gouvernement adopte l'appellation de gouvernement provisoire. Les institutions se mettent en place au cours de l'année 1959, président de la République, chef de gouvernement, Assemblée nationale élue au suffrage universel et Sénat. La Constitution de 1959 garantit le pluralisme et les grands principes de la démocratie.
La République malgache
Trois républiques se sont succédé à Madagascar depuis l'indépendance, entrecoupées par la fracture historique de 1972-1975, par le difficile régime de transition démocratique de 1990-1992 et par la crise de 2002 qui a paralysé le pays. Ces régimes ne se comprennent qu'en prenant en considération l'impact de la présence française dans l'histoire de la Grande Île et la question de la reconnaissance internationale, devenu un enjeu important.
De la présidence Tsiranana à la IIe République
Le premier gouvernement constitutionnel entre en fonction le 14 mai 1959, mais l'indépendance n'est proclamée que le 26 juin 1960, après la négociation d'accords bilatéraux de coopération technique et culturelle. Élu premier président de la République de Madagascar le 1er mai 1959, Philibert Tsiranana adopte une politique de continuité avec la France et développe des liens diplomatiques avec des pays non communistes comme les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest, Taiwan ainsi qu'avec le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, ce qui lui sera reproché par les pays de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A., créée en 1963) dont Madagascar est un des membres fondateurs. Les choix du gouvernement Tsiranana dans le domaine économique se traduisent par un néo-libéralisme qui, à la fois, encourage l'initiative privée, nationale et internationale, le développement économique grâce à des actions communautaires et la mise en valeur des fokonolona, communautés villageoises, et se caractérise également par un interventionnisme étatique dans les secteurs clefs. Le pays connaît une stabilité relative durant cette première décennie après l'indépendance, mais des indices alarmants s'accumulent : faiblesse de l'industrialisation, croissance du chômage, étroitesse du marché intérieur due au faible pouvoir d'achat des paysans et dérive autocratique du régime.
À la fin de la décennie 1960, le malaise et le vide politiques liés à la maladie de Tsiranana, ainsi que la rivalité des deux prétendants à sa succession (André Resampa, alors ministre de l'Intérieur, et Jacques Rabemananjara, ministre des Affaires étrangères), provoquent une crise. Celle-ci était latente face à une économie affaiblie, à un néocolonialisme trop présent, à un durcissement de l'appareil étatique et sa mise en question par la nouvelle génération. Plusieurs forces politiques d'opposition entrent alors en scène, notamment le Monima de Monja Jaona, fondé en 1958, comprenant une base de paysans, de migrants urbains pauvres et une minorité d'intellectuels de Tananarive faisant référence à différents modèles marxistes. Proche de l'A.K.F.M. et solidement implanté dans les milieux ruraux, surtout dans le Sud, le Monima représente une force d'opposition sérieuse pour le P.S.D. En avril 1971, sous son impulsion, les paysans se soulèvent et la répression est sanglante. Le 30 janvier 1972, Tsiranana est réélu à la présidence avec 99 p. 100 des voix, mais le 13 mai éclate à Tananarive une émeute populaire issue d'un mouvement étudiant qui a été relayé par une grève générale. Elle est durement réprimée par la garde présidentielle et les forces républicaines de sécurité. Les forces armées refusent d'intervenir au nom du président et le contraignent à solliciter Gabriel Ramanantsoa, le chef d'état-major, qui constitue un gouvernement d'union nationale, composé de militaires et de techniciens. Le 11 octobre 1972, Tsiranana démissionne.
Le ministre des Affaires étrangères Didier Ratsiraka est à l'origine de la rupture avec la France entre 1972 et 1974 lorsqu'il négocie la fermeture des bases militaires et navales à Madagascar et le retrait de la zone franc. Les coopérants qui occupaient les principaux postes administratifs quittent l'île. Des liens politiques sont tissés avec l'U.R.S.S., la République populaire de Chine ou encore la Corée du Nord. En 1973, le ministre de l'Intérieur, Richard Ratsimandrava, met en œuvre un programme de réforme rurale, basé sur le fokonolona. Cette tentative de restructuration rurale et la mise en place des fokonolona donnent l'illusion d'une paysannerie qui détient le pouvoir de décision et à qui l'on a promis le partage des terres anciennes et l'autogestion. Ces réforment laisseront les sociétés rurales sans moyens. En 1975, l'opposition des partis politiques et l'agitation sociale augmentent. Le général Ramanantsoa transmet les pouvoirs au colonel Richard Ratsimandrava, qui est assassiné six jours plus tard. Un Directoire militaire est alors formé et proclame la loi martiale. Il sera dissous le 15 juin 1975 et remplacé par un Conseil supérieur de la révolution, présidé par Didier Ratsiraka qui est également nommé chef du gouvernement. Le 21 décembre 1975, la République démocratique de Madagascar est fondée. Le parti Avant-garde pour la rénovation malgache (Arema), créé en 1976, devient l'organe principal de la présidence Ratsiraka.
De la IIe à la IIIe République
De fait, la chute de l'ère Tsiranana ouvre, après la période transitoire de 1972 à 1975, la voie à un régime autoritaire, de type socialiste, désireux de couper les ponts avec la France et prônant un nationalisme fervent. Cela se traduit par une politique de malgachisation de l'enseignement scolaire et des noms de ville. En organisant le référendum du 30 décembre 1975, Ratsiraka dote le pays d'institutions à l'orientation révolutionnaire, dont il a lui-même défini les grandes lignes dans le Boky Mena (livre rouge). L'institution militaire devient le support de la nouvelle idéologie socialiste. Ainsi légitimé, le nouveau pouvoir procède à une série de nationalisations (banques, assurances...) et promeut une politique d'investissements à outrance mobilisant tous les acteurs de l'économie (création d'entreprises publiques et de complexes industriels, extension des surfaces rizicoles, promotion de cultures d'exportation, recherche pétrolière, infrastructures routières et transports).
À partir de 1978, une politique immodérée d'endettement public aggrave une situation déjà fragile, tandis que s'accentue la répression contre l'opposition nationaliste (particulièrement dans le Sud). La détérioration économique et sociale, les atteintes aux libertés individuelles provoquent des mouvements de contestation et de remise en cause du régime. Dès 1982, les Églises catholiques et protestantes mettent en garde le pouvoir en dénonçant les échecs et les dérives de l'idéologie révolutionnaire. À partir de 1987, la gravité de la situation économique et les contraintes imposées par le F.M.I. et la Banque mondiale pour obtenir l'aide internationale, aboutissent à une libéralisation de l'économie. Le secteur nationalisé est réduit et la porte s'ouvre aux investissements privés malgaches et étrangers. Cette situation accroît l'appauvrissement généralisé de la population tandis que certains s'enrichissent effrontément.
En 1989, la réélection de Ratsiraka avec seulement 62 p. 100 des voix augure un changement de régime et une transition démocratique. En 1991 éclate une nouvelle crise avec des manifestations populaires importantes, en juin et en juillet, qui réclament le départ de Ratsiraka. Au cours de l'année 1991, le gouvernement est « doublé » (et plus ou moins paralysé) par un gouvernement parallèle (la Haute autorité de l'État) qui court-circuite le président. Issue de la société civile, l'opposition, connue sous le nom de Forces vives, opposée au parti Arema, est décidée à changer de régime politique. Ritualisé dans le cadre des manifestations quotidiennes sur la place du 13-Mai à Antananarivo, le mouvement est pacifique. Mais, le 10 août 1991, une marche populaire, dominée par les Forces vives, vers le palais présidentiel d'Iavoloha, s'achève par une répression sanglante et contribue au discrédit international du régime. Les Églises, notamment le puissant Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar (F.F.K.M., fondé en 1979), jouent alors un rôle majeur en organisant une médiation entre Ratsiraka et les Forces vives, pour permettre la constitution d'un gouvernement de transition. Les Églises fournissent ainsi l'encadrement et la légitimité morale des manifestations populaires. À la fin du mois d'octobre 1991, Ratsiraka signe avec le nouveau Premier ministre Guy Razanamasy et les représentants de l'opposition un accord qui prévoit la création d'un gouvernement de transition jusqu'aux prochaines élections. Le 19 août 1992, un référendum approuve, avec 76 p. 100 des suffrages, la nouvelle Constitution qui limite les pouvoirs présidentiels et fonde la IIIe République. Le second tour de l'élection présidentielle, en février 1993, confirme l'avance du candidat de l'opposition, Albert Zafy, ancien ministre de la Santé sous le gouvernement Ramanantsoa en 1972, qui remporte 66,74 p. 100 des votes. Madagascar sort peu à peu de son isolement économique en introduisant des réformes structurelles libérales et en cherchant à attirer les investisseurs étrangers. En 1996, un accord prévoyant la restructuration de l'économie est signé avec le F.M.I.
Cinq ans après la mise en place du nouveau régime, la popularité des dirigeants malgaches est entamée par des scandales financiers, par le manque d'autorité et l'impuissance du président Zafy à combattre la corruption. En 1995, une crise institutionnelle provoque un renforcement du régime présidentiel — le président, et non plus l'Assemblée, nomme le Premier ministre —, entériné par un référendum. De fait, des perspectives économiques sombres et une instabilité politique flagrante (six gouvernements se sont succédé depuis 1992) déclenchent une nouvelle crise qui aboutit à la destitution, par voie constitutionnelle, du président Zafy et à la réélection, de justesse, 50,71 p. 100 des voix de Ratsiraka en décembre
Celui-ci se lance dans une nouvelle politique qui vise à promouvoir une république humaniste et écologiste. En 1998, une nouvelle Constitution est adoptée. Elle introduit la décentralisation administrative, notamment avec la création de provinces autonomes. Suite à la mise en œuvre des directives du F.M.I. et à un réaménagement de la dette, le pays connaît une reprise économique, qui touche en particulier les domaines des télécommunications et du textile. À partir de 2000, les conséquences du programme de privatisation préconisé par le F.M.I. commencent à inquiéter la population malgache, notamment la forte inflation.
Succession de crises politiques depuis 2001 : un avenir compromis L’espoir de Ravalomanana
À la fin de l'année 2001 a lieu une nouvelle élection présidentielle où la victoire de Ratsiraka semble assurée. Le président sortant maîtrise les principaux rouages de l'État et dispose d'une Assemblée et d'une administration locale soumises. Or, le 16 décembre 2001, à l'issue du premier tour, Marc Ravalomanana – maire de la capitale, entrepreneur florissant issu d'une noblesse rurale appauvrie de l'est d'Antananarivo – arrive largement en tête grâce, notamment, à l'affirmation de sa foi protestante, le soutien des Églises et son aura de self-made-man. Ratsiraka conteste le résultat et un bras de fer s'engage entre les deux candidats et leurs partisans jusqu'à l'été de 2002, à l'issue duquel la victoire de Ravalomanana est confirmée. Madagascar voit, pendant cette période, apparaître deux centres de commandement : l'un se proclamant pouvoir légal (Ratsiraka déplace son régime à Toamasina sur la côte est et l'autre pouvoir légitime (Ravalomanana constitue son propre gouvernement dans la capitale. Ce contexte s'accompagne d'une grève générale, de manifestations quotidiennes dénonçant la fraude électorale, du blocage des principales voies de communication. Les velléités sécessionnistes de certaines provinces, encouragées par le président sortant, ont paralysé le pays. Cette tentative de diviser la nation sur un mode opposant côtiers et merina fief du camp ravalomananiste, à l'instar de ce qu'ont fait le pouvoir monarchique au XIXe siècle, le gouvernement colonial ou encore l'État postcolonial, au risque de l'anéantir économiquement, reste inopérante. Madagascar sort exsangue de la crise du point de vue économique mais sauvée dans son unité.
Dans un contexte de rejet des précédents régimes par la population, Marc Ravalomanana représente une figure politique nouvelle qui s'appuie sur l'image du messie venu sauver l'île. Reprenant un verset de l'Évangile de Marc, « Ne crains point ; crois seulement », dont il a fait sa devise, il bénéficie du soutien de la F.F.K.M. Sous son impulsion, les pasteurs deviennent des « agents de développement ». En août 2004, le président est réélu vice-président de l'Église réformée de Jésus-Christ, une des composantes de la F.F.K.M.
Cette tonalité religieuse s'accompagne d'un libéralisme économique. Marc Ravalomanana, qui a alors le monopole de la fabrication industrielle des produits laitiers à Madagascar, qui est propriétaire d'une radio, d'une chaîne de télévision et d'un journal, et qui a également investi dans les travaux publics, se lance dans la course à la présidence avec son parti Tiako'i Madagasikara, J'aime Madagascar. Certains dirigeants de son groupe laitier deviennent députés ou agents de l'administration et des membres du gouvernement obtiennent des fonctions importantes au sein de la F.F.K.M. De même, plusieurs mesures prises par le président de la République bénéficient particulièrement à son groupe. Ainsi, en 2005, Tiko Oil profitera d'une détaxation sur l'huile brute, tandis que l'huile raffinée importée par ses concurrents sera taxée à 20 p. 100. Dans le même temps, le prix du litre d'essence double presque, signifiant pour de nombreux Malgaches une augmentation générale du coût de la vie.
Sous son gouvernement, certaines infrastructures, notamment les ports, sont améliorées. Ceux de Toliara, dans le sud-ouest du pays, et de Mahajanga, dans le nord-ouest, ont été réhabilités. La ville de Mahajanga, à la faveur de la visite éclair du président Jacques Chirac en juillet 2005, voit son front de mer ainsi qu'un certain nombre d'axes urbains rénovés pour le tourisme, tandis que la ville de Toamasina, à l’est, fief ratsirakiste, se trouve dans un état de délabrement. Les villes semblent se développer, 1 500 kilomètres de routes reliant la capitale aux chefs-lieux des six provinces ont été refaits, une certaine forme de richesse devient visible. Ce développement ne cache toutefois pas l'appauvrissement continu des campagnes et la fragilité de l'économie du pays. De janvier à avril 2004, la monnaie malgache perd 50 p. 100 de sa valeur. Cette dévaluation s'accompagne d'une inflation galopante ainsi que d'un changement de monnaie. En 2005, le franc malgache est remplacé par l'ariary. Le pays connaît également d'importantes coupures d'électricité quotidiennes du fait de la quasi-faillite de la compagnie nationale. Il est classé 146e sur 177 par rapport à l'indice du développement humain (I.D.H.) du Programme des Nations unies pour le développement.
Le 3 décembre 2006, Marc Ravalomanana est réélu président dès le premier tour en l'absence de leader d'opposition crédible. Les élections se déroulent dans le calme, mais pas dans les meilleures conditions. Le Comité national d'observation des élections, collectif de la société civile, a dénoncé des lacunes dans l'organisation, notamment dans l'élaboration des listes, la distribution des cartes d'électeurs et des bulletins de vote. La campagne est également marquée par une grande disparité de moyens entre les candidats. Le 23 septembre 2007, des élections législatives anticipées, souhaitées par le chef de l’État afin d'affaiblir une opposition naissante au sein de l'Assemblée nationale, aboutissent au renforcement de la majorité présidentielle.
Durant son mandat, le président Ravalomanana a des intérêts économiques dans presque tous les secteurs. Ses méthodes néolibérales, son marketing politique moderne ainsi que son allégeance à l'Église causent ainsi maintes déceptions parmi la population, mais également chez les intellectuels et les cadres économiques, qui l'avaient pourtant soutenu face à Ratsiraka en 2002.
Le cercle vicieux malgache
Au début de 2009, le maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, entrepreneur prospère lui aussi, dénonce une dérive autoritaire et organise d'importantes manifestations pour demander la destitution du président Ravalomanana. Il accuse ce dernier d'avoir confisqué le pouvoir au profit des entreprises qu'il dirige et d'avoir réduit les libertés de la presse (fermeture de la station de radio privée du maire de la capitale notamment).
Après plusieurs semaines d'affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre qui font une centaine de victimes en février 2009, Andry Rajoelina, surnommé TGV, comme son parti Tanora malaGasy Vonona Les Jeunes Malgaches décidés, prend la tête, le 7 février 2009, d'une Haute Autorité de transition. Estimant le changement de gouvernement non constitutionnel, l'Union africaine (U.A.) suspend Madagascar de ses instances, la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (S.A.D.C.) refuse de reconnaître le nouveau président et l'Union européenne estime qu'il s'agit d'un coup d'État.
Le 21 mars 2009, Andry Rajoelina prête serment dans le stade de Mahamasina à Antananarivo devant plus de quarante mille personnes et s'engage à organiser des élections et à rédiger une nouvelle Constitution d'ici deux ans – un délai que la communauté internationale juge trop long. Un processus de médiation conduit par l'U.A. et la S.A.D.C. avec le soutien des Nations unies et de l’Organisation internationale de la francophonie (O.I.F.) se met alors en place. Il aboutit à un accord, signé le 9 août à Maputo (Mozambique), qui prévoit la constitution d'un gouvernement de transition chargé d'organiser des élections avant la fin de l'année 2010. Il envisage un partage du pouvoir entre les quatre principales formations politiques dont les leaders, outre le président autoproclamé, ne sont autres que les anciens présidents Didier Ratsiraka, Albert Zafy et Marc Ravalomanana.
Dans les faits, Andry Rajoelina garde le pouvoir et Eugène Mangalaza, ratsirakiste, devient Premier ministre. Toutefois, cet arrangement ne sera pas respecté. En décembre 2009, Andry Rajoelina met fin unilatéralement au processus de transition en limogeant Eugène Mangalaza et en le remplaçant par un militaire, le colonel Albert Camille Vital. Le spectre des divisions au sein de l'armée, des tensions régionales et des manifestations non contrôlées resurgit. En mars 2010, une seconde médiation est organisée à Addis-Abeba (Éthiopie) afin de rassembler le gouvernement et l'opposition. Mais Andry Rajoelina, pour qui le processus de résolution de la crise doit être national, n'y envoie qu'une délégation, ce qui conduit à de nouvelles sanctions de la part de l'U.A. qui suspend son aide au développement à Madagascar. En août 2010, il avalise la tenue d'un référendum devant aboutir à des élections législatives et présidentielle. Cette consultation, conçue comme une étape du processus de sortie de crise, se déroule le 17 novembre 2010. Elle est boycottée par l'opposition et contestée par la communauté internationale, qui souligne le manque de consensus et de transparence. Mais 52,6 p. 100 des Malgaches se déplacent pour aller voter et 74,2 p. 100 approuvent le projet d’une nouvelle Constitution. Le 11 décembre, le régime de la transition promulgue la nouvelle Loi fondamentale qui instaure la Quatrième République. L’âge d’éligibilité à la présidence est abaissé à trente-cinq ans pour permettre à Andry Rajoelina de se porter candidat à la magistrature suprême. La diversité des groupes et le rôle des différents acteurs, les Églises, l'armée, le secteur privé, la communauté internationale, la société civile, les populations contribuent à la complexité de la situation.
Une sortie de crise difficile
En 2011, une mission de médiation est confiée par la S.A.D.C. et l’U.A. à l’ancien président mozambicain, Joaquim Chissano. Une feuille de route est signée, le 16 septembre 2011, par les principales formations politiques malgaches ; celle-ci prévoit la formation d’un nouveau gouvernement et le retour sans condition de l’ex-président Ravalomanana. Elle engage également une réforme des institutions de la transition et vise à la tenue d’élections crédibles, avec l’aide de la communauté internationale. Le 28 octobre 2011, Jean-Omer Beriziky est nommé Premier ministre de transition. Cette nomination est suivie de la formation d’un gouvernement d’union nationale de transition le 21 novembre. Ce dernier est rapidement contesté par les dirigeants de l’opposition, qui estiment que la Haute Autorité de transition est favorisée dans la mesure où elle conserve le contrôle de ministères stratégiques. En mars 2012, la Commission électorale nationale indépendante est mise en place et, le 14 avril, une loi d’amnistie est adoptée, excluant Marc Ravalomanana, condamné à plusieurs reprises pour la mort de manifestants en février 2009.
Pendant plus d’un an, une course-poursuite à la candidature, jalonnée de nombreuses volte-face et tractations, s’engage entre les trois principaux anciens dirigeants et leurs poulains. Elle se termine le 17 août 2013 avec l’annonce par la nouvelle Cour électorale spéciale (C.E.S.) d'une liste de trente-trois candidats autorisés à se présenter au suffrage universel. Sous la pression de la communauté internationale, la C.E.S. invalide huit candidatures, dont celles de Lalao Ravalomanana (femme de l’ancien président), d’Andry Rajoelina et de Didier Ratsiraka. La stratégie du « ni-ni » (ni candidature de Rajoelina ni celle de Ravalomanana, considérés comme les principaux responsables de la crise), imposée par la communauté internationale, l’emporte. Les présidents déchus s’affrontent désormais par candidats interposés.
L’élection présidentielle se déroule les 25 octobre et 20 décembre 2013 ; des élections législatives ont lieu en même temps que le second tour. Hery Rajaonarimampianina, ancien ministre des Finances du gouvernement Rajoelina, arrive en tête, face à Jean-Louis Robinson, proche de Ravalomanana. Le 17 janvier 2014, la C.E.S. de Madagascar valide ce résultat.
Madagascar a désormais un nouveau président de la République élu dans des conditions jugées satisfaisantes par la communauté internationale. Mais les crises politiques récurrentes qu’a connues Madagascar depuis son indépendance, même si elles ont été entrecoupées d’épisodes éphémères de croissance, ont généré une situation économique très préoccupante qui n’a cessé de s’aggraver ces dernières années : fermeture des zones franches créées dans les années 1990, suspension des aides et arrêt des financements accordés par les bailleurs de fonds internationaux, etc. La population malgache a durement souffert (chômage important, déscolarisation, insécurité grandissante, détérioration des infrastructures...) et plus de 92 p. 100 des Malgaches vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, avec des disparités et des inégalités importantes entre régions ainsi qu’entre zones rurales et zones urbaines. Cette dégradation des conditions de vie a exacerbé les tensions sociales et la montée des sentiments d'injustice et d'exclusion.
La fin de la période de transition, avec l’élection de Hery Rajaonarimampianina, devrait permettre à Madagascar de retrouver la confiance des institutions internationales (U.A., S.A.D.C., O.I.T.) et le soutien des bailleurs internationaux. Mais comme le souligne l’historien Solofo Randrianja, tous les ingrédients d’une nouvelle crise sont d’ores et déjà présents. Le constat est amer mais il reflète une réalité qui l’est plus encore. L’île reste parmi les pays les plus pauvres au monde et l’avenir de sa population est très incertain.
Littérature
Hors de Madagascar, l'homme averti, mais qui n'est pas versé dans les choses malgaches, citera trois noms : Rabemananjara, Rabearivelo et Jean Paulhan. Si, par penchant ou profession, cet homme est au fait de la petite histoire littéraire, il ajoutera peut-être avec le sourire celui du chevalier de Parny salué par Sainte-Beuve et mis en musique par Ravel. Mais que dira l'étranger que sa curiosité aura conduit auprès de quelque Malgache de bonne compagnie ? Selon ce qu'aura signifié pour son guide le qualificatif ambigu de malgache ( madécasse ? malagasy ? ou les deux ?) appliqué au concept non moins ambigu de littérature, peut-être concédera-t-il – côté fleur-d'herbe – les noms de Robert Edward Hart ou de Robert Mallet, ou avancera-t-il – côté folklore unique au monde – celui de Flavien Ranaivo. Et si sa curiosité a pu se faire insistante, par une pointe d'indiscrétion que la sympathie justifie, l'étranger devenu ami, voire coopérant, reconnaîtra sans trop d'effort, quand on les prononcera, l'étrange pseudonyme de Dox et le long murmure du nom vénéré de Ny-Avana-Ramanantoanina. En revanche, le nom d'Andriamalala sera pour lui un nom bien malgache mais sans rapport avec la littérature, et il se trouvera bien quelqu'un pour l'approuver en arguant du fait qu'Andriamalala, plutôt que d'employer literatiora, si transparent, fût-il d'emprunt, préféra lancer le néologisme de haisoratra. Quant aux noms de Ramarajaona ou Bilôha Zamanitandra, Iabanimaka ou Ramasy, ce ne sont sans doute que les fruits d'une tendance à mystifier autrui.
Si l'on parvient à abattre l'arbre, dit un exemple des Anciens malgaches, c'est que le manche de la cognée s'est mis de la partie. L'arbre de la littérature malgache n'est pas un zahana (Phyllarthron bojerianum) ; les noms inscrits sur ses feuilles sont souvent illisibles ; certains pour l'effeuiller à la cime le voudront couché à leurs pieds. Il est temps de comprendre que l'essentiel est de savoir jeter le manche après la cognée. Noms de ceux qui ont pris place au soleil, noms des obscurs et des vaincus, noms effacés sur les plus belles des feuilles mortes... Admettons même ces noms qui se sont inscrits sur les feuilles les plus vertes des branches entées ! Des noms, l'on peut bien, entrant dans le jeu habituel, en citer tant et plus ; quand on les aura multipliés pour permettre à qui sait de jongler avec eux, serait-ce en un brillant numéro d'illusionniste, le public n'aura rien vu de ce qui fait encore l'arbre après la saison des fruits : racines et branches qui ne meurent que séparées du tronc, à moins que la foudre ne soit passée par là.
Condition de la littérature malgache
Madagascar n'est plus, comme au seuil des années 1970, le pays naturellement paradisiaque que certains, se prévalant à tort du silence, voulaient déjà faire passer pour l'Île heureuse et délivrée naguère entrevue par le poète derrière l'Île heureuse de dérision du romancier dont il hérita. Mais qui donc prenait garde à cette île flottante qui, à l'écart des grands courants internationaux, venait à l'appel de son ancre sudiste et mettait le cap sur l'Orient ? Même quand éclata en 1971, dans le Sud de la misère et de l'abandon, la jacquerie des paysans en sagaies de l'armée de Monja Jaona, dont la levée était périodiquement annoncée depuis une trentaine d'années, bien peu voulurent comprendre le sens évident de l'événement. Alors s'en saisirent au vol, dans une stratégie de rupture qui n'épargna nullement les domaines linguistique et littéraire, quelques minorités marxisantes tournées vers les modèles asiatiques et qui voulurent voir en cette révolte les signes précurseurs d'une révolution populaire enfin proche. Émergeaient au cœur des débats, habilement brouillés par des politiciens en quête de pouvoir, le néocolonialisme jugé responsable de tous les maux (sous-développement, corruption, népotisme...) et la langue française, à la fois perçue comme symbole de l'impérialisme occidental et première cause des échecs scolaires et universitaires de plus en plus nombreux. À l'arrière-plan, une certaine population des villes, sans regard pour la campagne et le menu peuple, et désormais impatiente d'accéder au mieux-être et à l'égalité promis avec l'indépendance ; et, masse de manœuvre toute prête, la population scolaire et universitaire, prise au piège d'une politique démagogique qui, en guise de carotte, joua l'ouverture de maternités et d'écoles, en faisant fi des problèmes de l'économie et de l'emploi. Aussi suffit-il d'une atmosphère de fin de règne, créée par la vieillesse et la maladie du président, et de l'application brutale – mais calculée ? – de la politique de dégagement de la France dans le domaine de l'enseignement, pour que le gouvernement social-démocrate, obligé de traduire dans les faits l'équation démocratisation + justice = malgachisation + sélection, se trouvât totalement isolé, victime de son ancienne confiance aveugle dans les vertus du néocolonialisme.
Levée de boucliers au premier rang, chez ceux dont les privilèges, liés à la francophonie, étaient menacés par ses réformes tardives ; levée de boucliers dans les derniers rangs, chez ceux qui – malgachisation ou non – avaient espéré de lui des portes plus grandes ouvertes. Instituteur formé par l'école coloniale française, le ministre de l'Éducation nationale et des Affaires culturelles – qui, non sans raison, se faisait un titre de gloire d'être, dans la tradition ancestrale, le plus grand orateur de l'Ouest malgache – ne put résister aux attaques verbales d'une étudiante de la capitale radicalement irrespectueuse du code traditionnel des échanges et aussi profondément nationaliste qu'incapable de tenir un discours cohérent dans la langue de ses ancêtres, objet de ses études universitaires... Le ministre démissionna, cédant la place à un scientifique issu de l'Université française, qui d'ailleurs n'en put mais, tandis que loin des affrontements, le poète francophone, ministre des Affaires étrangères, troisième vice-président de la République et chargé à ce titre de superviser les affaires culturelles, se taisait. Ainsi, quand, à la faveur des erreurs d'analyse et des multiples contre-sens, déferla le carnaval masqué de 1972, l'effondrement de la Ire République malgache, dans un simulacre de grand soir ponctué de mouvements de foule et de lueurs d'incendies, de brèves rafales et de tocsins divers, sonna les débuts d'une guerre linguistique dont la littérature écrite devait être l'une des premières victimes, et l'une des plus sérieusement touchées. Bien sûr, Madagascar, aujourd'hui, est un pays remis à plat. Mais chaque chose en son lieu. Et quoique la vitalité d'une littérature dépende de fort nombreux facteurs, nous ne parlerons ici que de ce que la situation présente et à venir doit au sort fait aux langues qui furent les moyens d'expression de la littérature malgache, comme aux cultures dont elle était l'expression.
Sous la Ire République, entre la juste revendication de l'égalité dans la différence et la dure nécessité de s'insérer dans le vaste univers du XXe siècle qui impose le regroupement, les esprits étaient restés partagés. Le plus grave était que bien des groupes d'« adultes » répugnaient ouvertement à faire l'effort de cultiver ou le pluralisme dialectal, qui reste pourtant le chemin d'accès aux richesses des terroirs, ou la langue nationale, qui reste le miroir historique de l'identité dont on est fier, ou le français, seconde langue officielle, qui reste la chance d'ouverture sur le monde, cette répugnance pouvant d'ailleurs concerner deux domaines, ou même les trois à la fois. Trompés par ces irresponsables qui, d'autre part, reprenaient sottement le reproche de favoriser les disciplines littéraires au détriment des scientifiques et des techniques, – reproche couramment adressé par les « experts » aux pays du Tiers Monde mais sans guère de fondement à Madagascar –, les moins vigoureux des enfants s'étaient endormis, bercés dans leur fierté de former une nation déclarée sans problèmes, ni frontaliers ni linguistiques, parfois déjà grisés par le parfum et le nectar de leurs fleurs de trois-couleurs, ou telomiova, curiosité botanique qui porte à la fois des fleurs mauves, des fleurs violettes et des fleurs blanches. Quant aux gouvernements successifs du Président Tsiranana – conduite témoignant peut-être d'autant de candeur et de négligence que d'une certaine foi en la magie de l'écrit –, leur action en faveur de la paix linguistique avait en somme consisté à rappeler gravement que l'on avait donné au bilinguisme franco-malgache, inscrit en 1959 dans la Constitution, la suprême consécration d'un statut officiel. Dans un pays néocolonial, où l'intercommunication sans contrainte formelle prenait de plus en plus le biais d'un sabir diamétralement à l'opposé d'une langue de culture – rien à voir avec le créole –, ce n'était là que des gestes en quelque sorte rituels, aussi incapables de sauver les deux langues d'une perte assurée que d'instaurer le bilinguisme dans la sérénité quotidienne. Et cette sérénité se trouvait moins encore dans la conscience partagée des écrivains qui savaient que, dans le contexte d'une culture dominée par l'oral, la vie et la survie de leurs œuvres dépendaient avant tout de la formation de leurs lecteurs potentiels par les écoles, où le pire côtoyait le meilleur.
En 1972 se trouvaient dans les locaux de la fondation Charles de Gaulle, université de langue française mais de statut malgache depuis un an, des jeunes gens, qui avaient pris le chemin de l'école avec la proclamation de la Ire République et qui, dans l'ensemble, ne maîtrisaient ni le français ni le malgache – situation peu propice aux réussites dans les études supérieures et, moins encore, à l'éclosion puis au développement du goût littéraire. Leurs maîtres avaient été en majorité des coopérants français – surtout des volontaires du service national inexpérimentés et, dans les dernières années, des jeunes gens frais émoulus de l'effervescence et des barricades de Mai-68 : à de très rares exceptions près, les uns et les autres, persuadés d'offrir les clefs d'une science et d'une culture modernes à vocation universelle, ignoraient tout de la langue et de la culture malgaches – situation de monologue bien peu propice à la réussite des missions invoquées. Quant au malgache, langue littéraire ayant abondamment fait ses preuves en ses diverses variétés dialectales depuis des temps immémoriaux, si, dans sa forme classique en tant que langue ayant évolué dans le cadre d'une culture écrite amplement soumise aux influences européennes, il s'était vu reconnaître une place en différents lieux, tout comme au début et à la fin de la colonisation, du moins était-il demeuré le parent pauvre du système éducatif : il était enseigné, le plus souvent, par des diplômés de l'Université française assez profondément déculturés et qui, en cette matière, n'avaient généralement pour seul brevet que d'être nés de parents malgaches... Aucune erreur n'était alors aussi répandue que cette confusion du biologique et du culturel, fréquemment étendu à la langue, si ce n'est peut-être le culte du diplôme que l'on retrouve à l'origine d'autres aberrations. Ainsi, tandis que l'enseignement supérieur – université de coopération française et institut pédagogique sous le patronage de l'U.N.E.S.C.O. réunis – n'était pas parvenu à former sur place assez d'enseignants pour assurer à la langue nationale le modeste statut de langue vivante obligatoire pour les élèves malgaches de l'enseignement secondaire, l'administration responsable s'était, mal à propos, refusée à faire une exception pour les vrais maîtres de la langue, écrivains et orateurs, qui avaient le tort de ne pas être munis de titres universitaires. C'est tout cet ensemble que nombre de manifestants de l'automne 1972 percevaient comme un dispositif d'impérialisme culturel en action, une sorte de bastion qu'il convenait d'investir pour obtenir les réformes indispensables.
La destinée du pays remise par le président aux mains du chef d'état-major, les partisans des réformes, qui ignoraient les décisions françaises restées quasi confidentielles, prirent donc leur élan, sans se douter que, d'une part, la reddition sans résistance du bastion supposé et l'ivresse d'une victoire facile les entraîneraient bien au-delà de leurs revendications premières et que, d'autre part, certains, perdant complètement de vue les réalités, élèveraient des chimères sur des ruines. Ils ne purent ainsi qu'assister, dans l'impuissance, à la mise en œuvre d'une malgachisation d'autant plus outrancière que nourrie de passion, d'ignorance et de mauvaise conscience alourdies d'une forte dose de démagogie, laquelle transparaissait plus clairement encore à travers la reprise de la politique d'ouverture d'écoles, au moment même où diminuait tragiquement le nombre d'enseignants qualifiés. Cette œuvre objectivement destructive bénéficiant de la caution des « techniciens » placés aux postes de commande dans un esprit d'union nationale, ce fut en vain que se firent entendre les protestations des jeunes gens trop pauvres pour bénéficier d'ouvertures, faire leurs bagages et aller s'inscrire, aux frais de leurs parents ou des contribuables, dans les universités et les lycées de France. Chacun ses extrémistes et ses déviationnistes : on se mit à parler d'impérialisme merina, et l'on assista, dans un paroxysme, à la mise à feu et à sang de Tamatave/Toamasina, la ville portuaire de l'Est, depuis longtemps tournée vers les Mascareignes francophones et créolophones, par des manifestants chantant la Marseillaise et clamant leur refus d'un enseignement donné dans la langue nationale, identifiée au dialecte merina dont elle était initialement dérivée. Le tribalisme, relativement discret jusque-là, faisait ainsi irruption sur la place publique, accroché significativement au problème de la langue d'enseignement, que ne pouvait plus résoudre la simple affirmation de ce qu'on appelle depuis des siècles « unité linguistique et culturelle » de l'île. Celle-ci était certes aussi généralement reconnue que scientifiquement fondée, mais par ailleurs elle restait marquée par deux puissants facteurs de différenciation : d'une part l'adoption de l'alphabet latin – effective dans le Centre dès le début du XIXe siècle – et sa diffusion par l'école, qui firent passer le dialecte merina codifié au statut de malgache classique – langue officielle de la couronne et des Églises protestantes jusqu'à la fin de la monarchie, en 1897, reconnue comme telle mais minorée par les autorités coloniales, puis par celles de la République malgache – et, d'autre part, la position dominante du français dans toutes les villes malgaches au XXe siècle, période néocoloniale comprise.
Aucun don de voyance n'était indispensable pour deviner que des explosions en cascade pouvaient se produire au moindre faux-pas et que, non maîtrisée, la situation dégénérerait rapidement. La malgachisation telle qu'elle fut mal conçue et mise en application dans la pire des ambiances – même si l'on tient compte de la prise en considération des dialectes et des actions menées en faveur de la naissance d'un nouveau malgache commun – ne pouvait être qu'un échec... Elle le fut, mais on mit dix ans à le reconnaître, sacrifiant ainsi des centaines de milliers d'enfants scolarisés et déformés, en majorité perdus pour nombre de secteurs de la vie active, économique ou culturelle. Dans un tel contexte, on devine aisément ce qu'est et ce que pourra devenir la situation de la littérature, qui n'est certes pas au cœur des préoccupations générales.
De fait, même si l'on ne peut oublier que, dans cette période, la littérature malgache écrite a jeté quelques flammes en s'ouvrant aux passions, sans négliger de livrer des pages blanches aux paroles dialectales et argotiques, jamais, à ne considérer que la frange de la vie malgache se situant dans la mouvance des villes et du monde moderne, les situations linguistique et littéraire ne furent aussi déplorables. Hasardées sur un terrain miné, la langue classique et sa littérature en sortent à présent comme désarticulées, tandis que le français, longtemps réduit au statut de langue technique inconsidérément livrée au laxisme, n'est plus aux mains des nouvelles générations qu'un pauvre outil défectueux, la jouissance de ses trésors littéraires laissée en privilège aux classes dominantes d'hier et d'aujourd'hui. Cela constaté, parallèlement à la fermeture des chemins de l'Occident aux jeunes gens non boursiers, la nouvelle tendance est aujourd'hui à une sorte de retour au français.
La différence entre la loi et la coutume, disait un juriste jacobin, c'est que celle-ci s'efforce de maintenir l'homme dans la fidélité au passé tandis que celle-là veut le modeler en vue d'un avenir meilleur. Certains y crurent en 1972, d'autres y croient aujourd'hui... Ce sont, parfois, les mêmes. Mais ce sont, écrivains compris, des hommes qui tâchent de récupérer une langue et une culture par-delà une période de marginalisation et de déclin dont ils étaient au moins partiellement responsables ; qui plus est, des hommes avançant les mains vides. Loin de tendre vers un heureux dénouement, le vieux drame de la littérature malgache écrite n'en finit pas de se renouer et de se rejouer sous nos yeux. En attendant qu'il puisse enfin naître du magma autre chose que des avortons, le véritable espoir pour la littérature, nous semble-t-il, est à mettre une fois encore dans la contribution des artistes qui n'ont cessé de faire fleurir les chefs-d'œuvre de la littérature orale inscrite dans la tradition vivante, non pas immuable mais aussi fidèle à soi-même qu'accueillante aux souffles venus du large. De cela du moins des hommes et des œuvres nous sont garants.
Littérature de combat
Jacques Rabemananjara est, avec Ranaivo, l'un des deux écrivains malgaches dont la réputation ne s'est pas bornée aux côtes de la Grande Île. Ses chefs-d'œuvre, écrits en français, sont des fruits qui mûrirent au soleil de la torture et des prisons que lui firent connaître les Français de la IVe République, à cause des sanglants événements de 1947 dont il nie la responsabilité. Le chemin qu'il a parcouru peut servir à illustrer la naissance et le développement d'une littérature de combat.
Le sang européen qui coule dans ses veines est celui de l'inénarrable baron polono-hongrois Maurice Auguste Benyowski, qui mourut en 1786 sous les balles françaises, paré du titre illusoire d empereur de Madagascar. Ses ascendances malgaches vont des intrépides piroguiers betsimisaraka des siècles passés, qui de la côte nord-est s'en allaient porter la guerre dans les îles et les pays de l'Est africain, aux réunisseurs de terres et de pouvoirs du XIXe siècle merina, qui descendaient de leurs hauteurs en quête de l'unité malgache, au service de la monarchie. Enfant choyé de la croix catholique, jeune homme protégé du drapeau français, Rabemananjara devint le chef de file, trop curieux de sciences sociales, des apprentis-poètes de l'éphémère Revue des jeunes, dont la naissance (1935) fut saluée sur place comme un « fait important dans l'ordre littéraire, si important aussi dans l'ordre politique que la colonie, après avoir cherché à empêcher, avec le concours de l'Église, la parution de la revue, envoya son animateur à Paris pour le défilé du cent cinquantième anniversaire de la Révolution française. Grâce à la compréhension de Georges Mandel, il put y rester et fréquenter la Sorbonne, et c'est là que se nouèrent les liens qui unirent les futurs compagnons de Présence africaine dans la découverte de la solidarité des vaincus.
Rentré à Madagascar pour se présenter aux élections législatives d'après guerre comme candidat M.D.R.M. (Mouvement démocratique de la rénovation malgache), élu par le peuple malgache, Jacques Rabemananjara fut jeté en prison, quand éclata la rébellion, sans même avoir bénéficié de son immunité parlementaire. Dans les fers, il s'éveilla conscience tourmentée de son peuple et voix de sa révolte, tour à tour puissante et nostalgique. De ce moment et pendant un peu plus d'une dizaine d'années, celui que ses amis appelaient brièvement « Rabe » publia des chants – et non seulement des cris ; au-delà de la grandeur « révolutionnaire » que Sartre dans Orphée noir, préface à l'Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache d'expression française de Senghor (1948), reconnaissait alors comme apanage exclusif de cette « poésie noire de langue française », ces chants atteignent plus d'une fois à la véritable grandeur poétique. Brisés les liens de sa condition antérieure qui l'avaient même conduit aux abords du chauvinisme occidental, l'alexandrin de ses débuts trop sages peut enfin éclater jusqu'à devenir méconnaissable.
À la première mesure du souffle ou selon les rythmes de l'émotion malgache apprivoisée, le poète enfin libéré dans le citoyen enchaîné peut désormais transfigurer ce qui fut son idole le verbe humain qui a pu donner un Racine, un Lamartine et un Baudelaire, pour marteler en dissonance les cris de douleur et d'indignation de l'homme pris en traître, scander en dramaturge trop éloigné de la scène l'arrivée dans la baie d'Antongil des ancêtres venus d'Asie, entonner l'hymne d'éloges en l'honneur de la souveraine Liberté trahie par la France et de l'Île aux syllabes de flammes qu'il lui préfère comme jamais, lamenter la détresse et l'angoisse de l'homme que menace d'anéantissement le poids d'une langue et d'une culture étrangères à son peuple.
Puis, sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité ayant été commuée en exil à Paris, c'est dans la liberté surveillée qu'il poursuit sa réflexion politique. Celle-ci s'exprime souvent en une prose passionnée, où l'éloquence voisine avec l'humour ; mais bientôt apparaît une prose limpide et serrée d'analyste dont la finesse n'est pas la moindre qualité.
Quand fut recouvrée l'indépendance, Rabemananjara revint au pays dans l'avion du président, pour y exercer des fonctions d'homme d'État. Pour lui, la création littéraire parut alors appartenir au passé, et le sonnet composé lors de la mort du général de Gaulle sembla moins l'œuvre du poète que celle du ministre désirant célébrer la mémoire de l'homme qui fit advenir la décolonisation. Cependant, le poète, qui, vers le même temps, disait la joie que lui apporta la publication des Hainteny d'autrefois recueillis sous les auspices de Ranavalona Ire, garda sa plume pour travailler aux pièces d'Ordalies, expressément données pour des « exercices de style mais qui, nourries de l'ancienne culture, restent par le fond ses œuvres les plus malgaches.
Œuvre aussi importante que symbolique, pouvait-on dire en ce temps-là de la sienne, et dont la postérité était non moins nombreuse que clandestine. Cependant, défaut majeur déjà – quoique son auteur ait pu affirmer : «La vérité est que sous l'impératif de notre drame, nous parlons malgache [...] dans la langue de nos maîtres –, elle est restée inaccessible à la majorité des Malgaches. Que dire aujourd'hui ? Ordalies ne parut que plus tard, à Paris, où Rabemananjara, ayant préféré reprendre le chemin de l'exil après 1972, est venu retrouver le monde de Présence africaine.
Littérature de détresse et d'espoir
Aîné de Rabemananjara, Rabearivelo est le poète maudit de la littérature malgache : naissance aristocratique mais marginale, suicide de poète « apolitique » mais qui témoigne contre tout régime colonial ; entre les deux, une vie douloureuse de proscrit dont l'unique ambition était de devenir un grand écrivain et d'atteindre à la gloire. Mais cette gloire qu'il a recherchée hors de l'étouffante société coloniale de l'Emyrne qui le tenait prisonnier, cette gloire ne l'a jamais atteint vivant, de tous les coins du monde où il lança son œuvre : de l'Amérique du Sud à l'Afrique du Nord, de Vienne à Paris, de Marseille à Port-Louis, sans oublier Tananarive. Elle ne lui permit même pas de vivre décemment dans sa capitale prise dans l'impasse de l'assimilation : parent trop pauvre des notables malgaches enfoncés dans leurs ornières » et plus gênés que lui par les « oripeaux chrétiens et occidentaux , allié méconnu des colonisateurs qui le rejettent violemment dans l'indigénat et la misère, il n'avait plus pour pairs et amis que quelques hommes de lettres dont il restait néanmoins séparé par la distance (Amrouche, Guibert) ou le souci de sa dignité (Boudry, Razafintsalama, Rabemananjara). On ne peut se faire une consolation de ce que, confrontée à la mort, la gloire ait rapidement effleuré son nom sur l air du mois de la Nouvelle Revue française et les pages du Mercure de France ; mais, venue trop tard pour l'homme, fait-elle au moins vivre ce qui reste de son œuvre ?
Cette œuvre, bilingue si l'on ne tient compte de l'espagnol un moment taquiné par amour de l'histoire malgache, embrasse pour ainsi dire tous les genres, de la nouvelle à la critique en passant par la traduction (Poe, Baudelaire). Mais la vocation de Rabearivelo resta la poésie à laquelle il donna ses chefs-d'œuvre : en malgache, des poèmes crépusculaires dominés par l'angoisse et la nostalgie qu'il éparpilla dans les très nombreux journaux tananariviens de son temps ; en français, des recueils de poèmes d'une grande beauté formelle, où le sentiment n'est plus qu'un imperceptible frémissement ; mais surtout, en un texte bilingue, deux œuvres qui témoignent et de son talent, et de ses trouvailles fécondes en malgache, et de sa grande maîtrise de la langue française harmonieusement dépaysée par la respiration de l'ancien vers libre malgache et naturalisée par les thèmes.
Depuis sa mort, son œuvre fut aussi tiraillée que lui de son vivant, et scandaleusement. Rabearivelo, Latin égaré en Scythie ou inversement Scythe latinisé, écartelé entre deux cultures et deux langues, victime à en mourir du régime colonial, est un exemple unique de réussite personnelle (il fréquenta à peine l'école) à peu près égale dans les deux langues. Il est le seul qui puisse servir de guide à la foule innombrable de jeunes et de moins jeunes que tient le démon de la littérature.
Que nul des contemporains malgaches de Rabearivelo n'ait été connu à l'étranger peut aisément s'expliquer : d'une part, alors qu'il était seul à user du français en maître, on n'étudiait pas le malgache pour sa littérature, condamnée d'avance par les préjugés colonialo-racistes ; d'autre part, la curiosité littéraire pour l'Île trouvait à se satisfaire par les récits de voyages, par la littérature exotique qui la choisit parfois pour thème le plus souvent alterné avec celui des îles sœurs de l'océan Indien, ou par l'infidèle traduction du folkloriste qui, tantôt sacrifiant la forme au fond, tantôt saisi par la fausse élégance, détruit l'œuvre.
Quant à la faiblesse de la production littéraire contemporaine comparée à celle des devanciers, déjà peut largement l'expliquer ce que l'on sait de ses conditions d'existence. Peut-être même doit-on s'émerveiller de ce qu'une telle adversité n'ait pu empêcher la croissance de quelques œuvres, évidemment bien plus nombreuses en malgache qu'en français, mais les unes et les autres comme libérées des vieilles pesanteurs, qui en étreignent encore tant d'autres, qu'il s'agisse du puritanisme transmis par les Églises devenues les refuges du malgache classique au temps de son éviction des écoles publiques, ou du nationalisme étroit encore à l'œuvre ces derniers temps.
Devant toutes les raisons de craindre que la relève ne soit pas de sitôt assurée, ces quelques lueurs paraissent bien faibles. Mais l'on ne peut oublier qu'il reste effectivement une grande raison d'espérer. C'est loin des écoles, en effet, qu'au lendemain de l'indépendance, la langue littéraire s'est mise à récupérer, avec le vieux fonds traditionnel remis au jour, ses vertus d'autrefois. Et c'est ainsi que se fait à nouveau entendre le message que Rabearivelo tenta d'exprimer à travers une réinterprétation du mythe d'Antée, ressuscitant comme tous ceux qui savent boire à la source. Pensons notamment à la belle œuvre de Flavien Ranaivo (1914-1999) et à son effort pour donner un équivalent français des poèmes malgaches. Traduction et création sont ici indissociables.
Littérature coulant de source
J'avais lu, lycéen, Les Hainteny et, sais-je pourquoi ? je doutai longtemps (j'aime à douter encore) si les Malgaches avaient eu vraiment tant de chance, si ces merveilles poétiques n'étaient pas dues tout entières à un poète caché qui se donnait pour leur traducteur, si Jean Paulhan, en somme, n'avait pas réussi ce que le Pierre Louýs des Chansons de Bilitis avait autrefois manqué. Tangible, irrécusable aboutissement, pensais-je, d'une méditation sur le langage poétique et comme l'incarnation, ou la démonstration, de ses pouvoirs. Un poète ? (À qui cette vérification, peut-être, avait suffi. À l'affût, désormais, de la voix des autres) Jacques Borel, Jean Paulhan et la Nouvelle Revue française, 1969
Paulhan poète ? La beauté de ses traductions en fait foi, et nous savons, pour l'avoir entendu, qu'il était effectivement capable d'improviser en hainteny, en malgache comme en français (même s'il les appelle parfois haikai). Mais c'est depuis sa jeunesse que Paulhan a été « à l'affût de la voix des autres » et a su se mettre à leur école sans l'ombre d'un préjugé. On peut répondre de façon définitive à ceux qui, avec Jacques Borel ou avec Guy Dumur, se demandent encore si les hainteny, tels que les a fait connaître Paulhan, sont ou non une supercherie. Laissons à la littérature française, jusqu'à preuve du contraire, les Chansons madécasses de Parny qui n'ont que leur exotisme et leur générosité, mais les hainteny sont authentiquement malgaches : ceux qui se disent encore dans les campagnes épargnées par la civilisation, comme ceux de Rabearivelo, ceux qu'a traduits Paulhan, ceux que Dahle a recueillis une quarantaine d'années auparavant et qu'il a traduits en norvégien en les rapprochant des stev de son pays, comme ceux du manuscrit vieux d'un siècle et demi qui furent publiés en 1968, et qui auraient sans doute plu à Paulhan pour leur érotisme sans autre fard que la poésie. Cela dit, Jacques Borel a fort bien saisi ce que représentent les hainteny en tant que production littéraire ; d'ailleurs, « science et puissance des mots » traduit mieux leur nom que « science des paroles » d'une ambiguïté aussi paulhanienne que française.
L'existence des hainteny merina, des saimbola sakalava, des fampariahitse betsileo, etc. – tous déjà aussi souvent dits que chantés (dans les spectacles de mpilalao qui évoquent les sotties) – atteste et l'origine asiatique et l'ancienneté (les chansons de l'ancienne Chine du Sud, les chants alternés de l'Indochine, les haies de chants de l'ancien Japon, etc.) de la littérature malgache traditionnelle, tout comme témoignent peut-être de l'influence africaine et de l'originalité malgache les analogies thématiques entre le cycle africain du Roman de Lièvre et le cycle du Roman d'Ikotofetsy (le rusé) et Imahakà (le jeteur de sort ?) remarquable par l'absence de recours au masque animal. Des anciens vazo (récitatifs psalmodiés) aux éternels et universels ohabolana (poésie gnomique) en passant par les grands sôva (blasons) de l'actuel ôsika tsimihety, cette littérature a illustré plus d'un genre poétique issu du rythme et du chant, n'ignorant même pas la rime, et, des mythes à l'embryon de roman apologétique du conte d'Ibonia en passant par les légendes et les traditions historiques, plus d'une forme du récit. Il restait donc à renouer avec la tradition établie par les katibo des sorabe antemoro et reprise par les secrétaires et les mémorialistes de la cour de Ranavalona Ire, pour recueillir et étudier ce trésor littéraire avant qu'il ne fût trop tard. Dans les dernières décennies ce fut à nouveau, pour quelques-uns, une préoccupation majeure. Et, dans le contexte d'une reconnaissance émerveillée de richesses hier encore insoupçonnées, l'intérêt que l'on a vu ainsi porté à la littérature orale a paru ne plus devoir se démentir.
En revanche, la littérature malgache contemporaine compte peu de romanciers (Pélandrova Dreo, Pélandrova, 1975 ; Michèle Rakotoson, Le Bain des reliques, 1988), et il lui a fallu affronter une situation compliquée par la révolution de 1972, qui voulut faire prévaloir l'écriture en malgache. Depuis 1980, avec l'évolution politique du régime, la littérature malgache d'expression française a en partie retrouvé sa place. En témoignent les œuvres de Charlotte Rafenomanjato (Le Pétale écarlate, 1980, Lente Spirale, 1990)
Liens
http://youtu.be/6OrhB2ukRQU Voyage sur l'île rouge 1
http://youtu.be/fwB2Qpf02Lg Voyage sur l'île rouge 2
http://youtu.be/Zjxb-vcdt68 Madagascar D'Ambilobe à Vohémar 1
http://youtu.be/ZabC2r4Syis Madagascar Baie d'ANtogil 2
http://youtu.be/JxL9YDPMihE De Vohémar à Sambava3
http://youtu.be/6OrhB2ukRQU?list=PL6AC2393A0671771C Madagascar.[img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Detail_of_Diogo_Dias's_ship_(Cabral_Armada).jpg[/img]  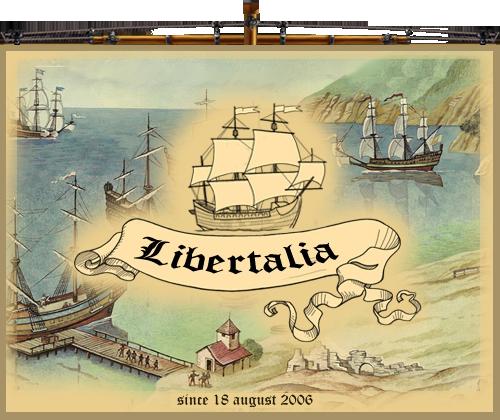 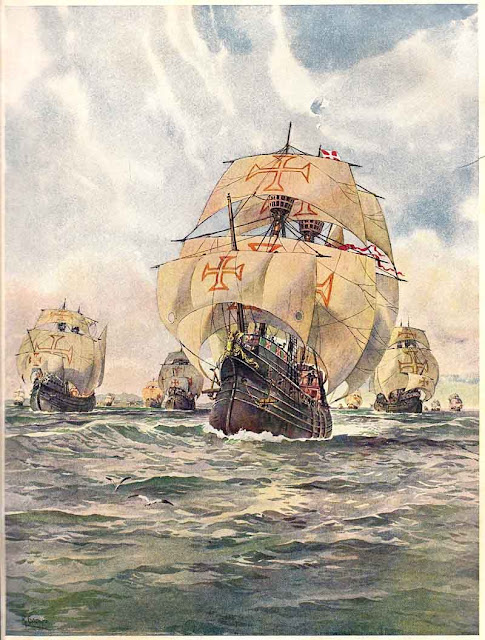              
Posté le : 09/08/2014 18:23
|