|
|
Jean Moulin |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 juin 1899 naît Jean Moulin
à Béziers Hérault, Alias, Romanin, nom d'artiste, Joseph Jean Mercier, Rex, Max, M. X, Alix, EX. 20, Régis, Richelieu, Joseph Marchand
Jacques Martel, mort, à 44 ans, le 8 juillet 1943 à Metz Moselle, haut fonctionnaire préfet d'Eure-et-Loir et résistant français. Il fut Préfet, Dessinateur, Commissaire du CNF, Membre du Comité national français, Délégué du général de Gaulle en France, Membre Chef emblématique du CNR. Il fut distingiué et fait Officier de la Légion d'honneur, Compagnon de la Libération, il reçut la médaille militaire, la Croix de guerre 1939-1945?. Son père est Antoine-Émile Moulin, sa mère Blanche Élisabeth Pègue, il eut une soeur Laure Moulin née en 1892 morte en 1975. Ses cendres ont été transférées au Panthéon.
En septembre 1941, il rejoint la France libre à Londres en passant par l’Espagne et le Portugal. Il est reçu par Charles de Gaulle à qui il fait un compte rendu de l’état de la Résistance en France et de ses besoins, notamment financiers et en armement.
À l'issue de quelques entretiens, il est envoyé à Lyon par Charles de Gaulle pour unifier les mouvements de la Résistance. Il est arrêté à Caluire, dans la banlieue de Lyon, le 21 juin 1943 et conduit au siège de la Gestapo. Il meurt dans le train qui le transporte en Allemagne peu avant le passage de la frontière, le 8 juillet 1943. Son décès est enregistré en gare de Metz.
Il dirigea le Conseil national de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Il est souvent considéré comme l'un des principaux héros de la Résistance. Il est nommé général de brigade à titre posthume lors de la Libération, puis général de division en novembre 1946.
Un cénotaphe lui est dédié au Panthéon où se trouvent les tombeaux des grands hommes de la République française. Son corps n'a jamais été identifié avec certitude, et l'urne transférée au Panthéon ne contient que les cendres présumées de Jean Moulin.
En bref
Serviteur de la République, préfet et chef de cabinet de plusieurs ministères dans les années 1930, Jean Moulin se convertit à un gaullisme de raison et de circonstance après sa rencontre avec le général en octobre 1941. Il devient le délégué de celui-ci en France, organisant les structures clandestines, renforçant les mouvements, intégrant les partis, donnant ainsi, au sein de la Résistance française, une légitimité supplémentaire à la France libre installée à Londres. Ses actions de coordination des réseaux aboutissent à la création du Conseil national de la Résistance en mai 1943, qu'il ne préside que brièvement, puisqu’il est arrêté par la Gestapo de Lyon le 21 juin suivant. Même si Jean Moulin fait l'objet de polémiques depuis les années 1950, son entrée au Panthéon, en 1964, l'a élevé au rang de héros national, incarnation même de la Résistance
Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers, dans une famille de militants républicains. Son père, franc-maçon, professeur et conseiller général radical-socialiste, l'incite à entrer dès l'âge de dix-huit ans dans l'administration préfectorale. Il met ensuite à profit ses relations dans le monde politique pour favoriser la carrière de son fils.
Après une courte mobilisation à la toute fin de la Première Guerre mondiale, Jean Moulin débute comme attaché au cabinet puis sous-chef de cabinet du préfet de l'Hérault 1917. Il est tour à tour chef de cabinet du préfet de la Savoie 1922, sous-préfet d'Albertville plus jeune sous-préfet de France, 1925, de Châteaulin 1930, de Thonon 1933, secrétaire général de la préfecture de la Somme 1936, préfet de l'Aveyron, plus jeune préfet de France, 1937 puis d'Eure-et-Loir 1939.
Son amitié avec Pierre Cot, jeune et brillant député radical, lui ouvre la porte des cabinets ministériels. À plusieurs reprises, il est chef de cabinet de Cot, au secrétariat d'État aux Affaires étrangères 1932, au ministère de l'Air 1936, puis du Commerce 1938. En tant que chef de cabinet du ministre de l'Air du Front populaire, à partir de l'été de 1936, il prend part aux livraisons clandestines d'armes et d'avions au gouvernement républicain lors de la guerre d'Espagne.
La réputation du préfet Jean Moulin auprès de son ministère de tutelle est celle d'un excellent administrateur, à tel point que le ministre de l'Intérieur du gouvernement formé le 17 juin 1940 par le maréchal Pétain à la suite de la demande d'armistice, envisage de le nommer directeur de la Sûreté. Projet abandonné lorsqu'on apprend son arrestation le soir même par le commandant allemand qu'il a dû accueillir dans sa préfecture de Chartres. Pour échapper aux brutalités qui lui sont infligées dans le but de lui faire avaliser un texte raciste et mensonger à l'égard des troupes coloniales, Jean Moulin tente de se suicider dans la nuit du 17 au 18 juin 1940. Soigné, libéré, il reprend ses fonctions à la tête de son département occupé, faisant preuve d'opiniâtreté tant à tenir tête aux Allemands et à protéger ses administrés qu'à remettre son département en état de marche. En vertu de ses opinions de gauche et de sa personnalité marquée, il est révoqué par le maréchal Pétain et quitte l'administration le 16 novembre 1940.
Dès les premiers mois de l'Occupation, Jean Moulin a utilisé sa fonction pour se renseigner sur la Résistance naissante et se forger une fausse identité lui permettant de quitter la France pour chercher à l'étranger une aide pour les réfractaires. Les mois suivant sa révocation, il intensifie ses activités clandestines, rencontrant nombre de pionniers, dont Henri Frenay et François de Menthon. Son inventaire est modeste, mais il sait en dresser, dans un texte intitulé Rapport sur l'activité, les projets et les besoins des groupements constitués en France en vue de la libération du territoire national, un tableau sélectif qui présente les perspectives d'une résistance susceptible d'organisation et d'extension.
Jean Moulin quitte la France le 9 septembre 1941, muni d'un visa pour les États-Unis. Il choisit pourtant de se rendre en Angleterre, où il arrive le 20 octobre, via l'Espagne et le Portugal. Il se présente en émissaire des mouvements de résistance et sollicite l'aide des Britanniques et de la France libre.
Sa rencontre avec de Gaulle, le 25 octobre 1941, est décisive. Alors qu'il ignorait presque tout de la France libre, Moulin est convaincu par le projet du général de maintenir la France dans la guerre au nom d'une légitimité supplantant la légalité de Vichy. Sa vision de la résistance métropolitaine emporte l'adhésion de De Gaulle, qui le charge, sous son autorité, d'une triple mission de propagande, d'unification militaire et de fédération politique des mouvements de Résistance de la zone libre.
Parachuté en France le 2 janvier 1942, Jean Moulin reprend les contacts établis avant son départ, distinguant trois groupes auxquels il apporte financement et soutien : Combat, Libération-Sud et Franc-Tireur.
Sa première tâche consiste, non sans difficulté, à faire reconnaître à des groupes nés indépendamment de la France libre l'autorité du général de Gaulle. Jean Moulin crée aussi des services centraux : radio, opérations aériennes, bureau de presse, comité général des experts C.G.E., noyautage des administrations publiques N.A.P. et exécute, malgré de nombreux obstacles, sa mission de coordination technique et d'unification militaire. Le 2 octobre 1942, le Comité de coordination, dont il est président, est créé à Londres, regroupant les trois mouvements sous les ordres du général de Gaulle.
Ces résultats, difficilement acquis, sont brutalement remis en cause après le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, les Américains cherchant à évincer de Gaulle au profit de l'amiral Darlan 13 novembre, puis du général Giraud 26 décembre.
Pour assurer de Gaulle du soutien des résistances métropolitaines et proclamer à l'extérieur la légitimité démocratique de celui-ci, Jean Moulin travaille au processus qui aboutit à la création du Conseil de la Résistance, institution clandestine représentative des mouvements de Résistance des deux zones huit mouvements, des fractions résistantes des partis politiques de la IIIe République six partis et de deux syndicats. Lors de sa première réunion, le 27 mai 1943, le Conseil de la Résistance connu par la suite sous le nom de Conseil national de la Résistance, C.N.R. adopte une motion confiant l'autorité militaire à Giraud et l'autorité politique à de Gaulle. Parallèlement est mise sur pied, au cours du premier semestre de 1943, une Armée secrète, dont la direction est confiée au général Delestraint.
L'institutionnalisation de la Résistance et sa soumission à l'autorité du général de Gaulle ont suscité de terribles affrontements au sein de la Résistance métropolitaine et entre ses chefs et la France libre. Jean Moulin, nommé président des comités de coordination de zone sud et nord et du C.N.R., et commissaire national en mission, titre équivalent à celui de ministre, cristallise sur sa personne les dissensions internes, qui susciteront un certain nombre d'imprudences, aux conséquences parfois tragiques, de la part de dirigeants de mouvements, pris dans le tourbillon de leurs batailles. Ce sont ces imprudences qui, jointes à la trahison, mènent à l'arrestation de Jean Moulin à Caluire, le 21 juin 1943, par les services de la Gestapo de Lyon dirigés par Klaus Barbie.
Trahi une seconde fois en prison, Jean Moulin est identifié et torturé. Il tente probablement de se suicider pour échapper à ses tortionnaires. C'est dans un état désespéré qu'il est provisoirement transféré à Paris puis dirigé vers l'Allemagne. Il meurt durant le trajet. Son décès est déclaré en gare de Metz à la date du 8 juillet 1943.
Sa vie
Jean Pierre Moulin naît le 20 juin 1899 au 6 rue d'Alsace à Béziers Hérault, fils d'Antoine-Émile Moulin, professeur d’histoire-géographie dans cette ville, et de Blanche Élisabeth Pègue. Il est le petit-fils d'un insurgé de 1851. Antoine-Émile Moulin est un enseignant laïque à l’Université populaire, et franc-maçon à la loge Action sociale. Il est baptisé le 6 août 1899 par le père Guigues en l'église Saint-Vincent de Saint-Andiol Bouches-du-Rhône, village d'origine de ses parents : son parrain est son frère Joseph Moulin et sa marraine est sa cousine Jeanne Sabatier. Il passe une enfance paisible en compagnie de sa sœur Laure et de son frère Joseph, et s'adonne à sa passion pour le dessin, où il excelle, au point de pouvoir vendre dessins, aquarelles ou caricatures à des journaux. Au lycée Henri-IV de Béziers, il est un élève moyen.
Plus tard, et dans la lignée de son père, élu conseiller général de l'Hérault en 1913 sous la bannière radicale-socialiste, Jean Moulin se forge de profondes convictions républicaines, suivant avec assiduité la vie politique nationale.
En 1917, il s'inscrit à la faculté de droit de Montpellier, et grâce à l'entregent de son père, il est nommé attaché au cabinet du préfet de l'Hérault sous la présidence de Raymond Poincaré.
Mobilisé le 17 avril 1918, Jean Moulin est affecté au 2e régiment du génie, basé à Metz après la victoire. Après une formation accélérée, il arrive dans les Vosges à Charmes le 20 septembre et s'apprête à monter en ligne quand l'armistice est proclamé. Il est envoyé successivement en Seine-et-Oise, à Verdun, puis à Chalon-sur-Saône ; il est tour à tour menuisier, terrassier, téléphoniste au 7e régiment du génie et au 9e régiment du génie. Il est démobilisé début novembre 1919 et se présente tout de suite à la préfecture de Montpellier, où il reprend ses fonctions le 4 novembre 1919.
La qualité de son travail l'amène à être promu chef-adjoint de cabinet fin 1920. En 1921, il obtient sa licence en droit. Parallèlement, il devient vice-président de l'assemblée générale des étudiants de Montpellier section locale de l'UNEF et membre des Jeunesses laïques et républicaines.
Le 6 février 1922, il entre dans l'administration préfectorale en tant que chef de cabinet du préfet de la Savoie, à Chambéry, poste très important pour son âge, sous la présidence d'Alexandre Millerand. Au soir des élections législatives de mai 1924, il se réjouit de la victoire du cartel des gauches en Savoie comme dans tout le pays.
De 1925 à 1930, il est sous-préfet d'Albertville. Il est à l'époque le plus jeune sous-préfet de France, sous la présidence de Gaston Doumergue.
En septembre 1926, il se marie avec Marguerite Cerruti ; mais celle-ci s'ennuie dans la sous-préfecture et quitte Jean Moulin pour aller vivre à Paris ; il demande le divorce et l'obtient deux ans plus tard.
En 1930, il est promu sous-préfet de 2e classe à Châteaulin dans le Finistère. Il y fréquente des poètes locaux comme Saint-Pol-Roux à Camaret et le poète et peintre Max Jacob à Quimper. Il est reçu chez le sculpteur Giovanni Leonardi et commence à collectionner les tableaux.
Il est également illustrateur du morlaisien Tristan Corbière pour son recueil de poèmes Armor. Parallèlement, il publie des caricatures et des dessins humoristiques dans la revue Le Rire et dans Candide sous le pseudonyme de Romanin. Sa passion pour l'art et notamment l'art contemporain s'exprime aussi à travers son amitié pour Max Jacob et sa collection de tableaux où sont représentés Chirico, Dufy et Friesz.
En décembre 1932, Pierre Cot, homme politique radical-socialiste, le nomme chef adjoint de son cabinet aux Affaires étrangères sous la présidence de Paul Doumer.
En 1933, il est sous-préfet de Thonon-les-Bains et occupe parallèlement la fonction de chef de cabinet de Pierre Cot au ministère de l'Air sous la présidence d’Albert Lebrun. Il est promu sous-préfet de 1re classe, et le 19 janvier 1934, il est nommé sous-préfet de Montargis mais n'occupe pas cette fonction, préférant demeurer au cabinet de Pierre Cot. Au début avril, il est rattaché à la préfecture de la Seine, s'installe à Paris, puis, le 1er juillet 1934, il prend ses fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Somme à Amiens.
En 1936, il est à nouveau nommé chef de cabinet de Pierre Cot au ministère de l'Air du Front populaire, et avec le ministre, conformément à la politique décidée par Léon Blum, aide clandestinement les républicains espagnols en leur envoyant des avions et des pilotes. Il participe à cette époque à l'organisation de nombreux raids aériens civils comme la traversée de l'Atlantique Sud par Maryse Bastié, la course Istres - Damas - Le Bourget. À cette occasion, il doit remettre le chèque aux vainqueurs équipage italien parmi lesquels se trouve le propre fils de Benito Mussolini.
En janvier 1937, à l'âge de 38 ans, il est nommé préfet de l'Aveyron ; c'est à l’époque le plus jeune préfet de France. Ses actions en faveur de l'aviation lui permettent de passer cette même année du Génie à la réserve de l'Armée de l'air. Il est affecté à partir de février 1937 à la base de Marignane avec le grade de caporal-chef mars 1937, puis en février 1938 au Bataillon de l'Air no 117 basé à Issy-les-Moulineaux. Il est nommé sergent de réserve le 10 décembre 1938.
La Résistance La révocation de sa fonction de préfet
En janvier 1939, il est nommé préfet d'Eure-et-Loir à Chartres. Après la déclaration de guerre, il demande à plusieurs reprises à être dégagé de ses fonctions de préfet, persuadé, comme il l'écrit, que sa place n'est point à l'arrière, à la tête d'un département essentiellement rural. Il se porte donc candidat à l'école des mitrailleurs en allant à l'encontre de la décision du ministère de l'Intérieur. Il passe sa visite médicale d'incorporation à l'école le 9 décembre 1939 sur la base 117 d'Issy-les-Moulineaux. Il est déclaré inapte le lendemain pour un problème de vue. Il force alors le destin en exigeant une contre-visite à Tours qui, cette fois, le déclare apte. Mais le ministère de l'Intérieur l’oblige dès le lendemain à reprendre immédiatement son poste de préfet, d'où il s'emploie, dans des conditions très difficiles, à assurer la sécurité de la population. Devant l'arrivée imminente des Allemands dans Chartres, Jean Moulin écrit à ses parents, le 15 juin 1940 : Si les Allemands — ils sont capables de tout — me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai.
Il est arrêté le 17 juin 1940 par les Allemands parce qu'il refuse d'accuser une troupe de tirailleurs sénégalais de l'Armée française d'avoir commis de prétendues atrocités envers des civils à La Taye, un hameau de Saint-Georges-sur-Eure, en réalité victimes de bombardements allemands. Frappé à coups de poing et enfermé pour refus de complicité avec les Allemands, il tente de se suicider en se tranchant la gorge avec un débris de verre. Il évite la mort de peu et conservera une cicatrice qu'il cachera sous un foulard sur des clichés pris après sa guérison, à la préfecture de Chartres.
En raison de ses idées républicaines marquées à gauche comme radical-socialiste, il est révoqué par le régime de Vichy du maréchal Pétain le 2 novembre 1940 et placé en disponibilité. Il se met alors à la rédaction de son journal, Premier combat, où il relate sa résistance contre les nazis à Chartres de manière sobre et extrêmement détaillée ; ce journal sera publié à la Libération et préfacé par le général de Gaulle.
Décidé à entrer dans la clandestinité, il quitte Chartres le 15 novembre 1940 et s'installe dans sa maison familiale de Saint-Andiol Bouches-du-Rhône d'où, pressé par le besoin de faire quelque chose, il s'impose deux buts : tout d’abord il veut se rendre compte de l’ampleur de la Résistance française et ensuite aller à Londres afin d’engager les pourparlers avec la France libre. Il possède une fausse carte d'identité au nom de Joseph Mercier, professeur de droit. Il s'installe à Marseille, à l’Hôtel Moderne et rencontre, dans plusieurs villes du Midi, des résistants parmi lesquels Henri Frenay, le chef du mouvement de Libération nationale, ainsi qu'Antoinette Sachs qui lui facilite les contacts.
L'unification des mouvements de résistance
Après avoir réussi à obtenir un visa et un faux passeport, le 9 septembre 1941, il rejoint Londres en passant par l’Espagne et le Portugal, par ses propres moyens, sous le nom de Joseph Jean Mercier. Il est reçu par le général de Gaulle qui l'impressionne vivement et en qui il reconnaît un très grand bonhomme. Grand de toutes façons . Il lui fait un compte-rendu controversé de l’état de la Résistance en France et de ses besoins, notamment financiers et en armement. Son compte rendu donnera lieu à de nombreuses contestations de la part des mouvements de résistance intérieure comme étant tendancieux avec des visées personnelles tout en perturbant les actions de renseignements au profit de l’armée britannique et le système, en contrepartie de financement et de fourniture d’armes au profit de chacun d'entre eux. À Londres, il suit un entraînement pour apprendre à sauter en parachute, tirer au revolver et se servir d'un poignard.
Misant sur l’ambition et les capacités de réseau de Jean Moulin, de Gaulle en fait son délégué civil et militaire pour la zone libre ; il le charge d’unifier sur le territoire français les trois principaux mouvements de résistance, Combat, dirigé par Henri Frenay, Franc-Tireur, et Libération-Nord-Libération-Sud, ainsi que tous leurs différents services propagande, renseignements, sabotage, entraide, afin d’en faire une armée secrète chaperonnée par les forces françaises libres complètement placées sous les ordres du général. Avec des ordres de mission, des moyens financiers et de communication radio directe avec le général de Gaulle à Londres, il est parachuté, en compagnie de Raymond Fassin et Hervé Monjaret, au cours d'une opération Blind, à l'aveugle, dans les Alpilles dans la nuit du 31 décembre 1941 au 1er janvier 1942 à 15 km de Saint-Andiol qu’il rejoint à pied. Il prend le pseudonyme évocateur de Rex dans la Résistance. Pour accomplir sa mission, Jean Moulin rencontre, entre autres, Henri Frenay à Marseille et Raymond Aubrac à Lyon. Il est aidé dans sa tâche par Daniel Cordier qui s'occupe de la logistique, et par Colette Pons.
Le 27 novembre 1942 est créé le Comité de coordination de la Zone Sud à Collonges-au-Mont-d'Or dans le but de coordonner, avec la mouvance communiste, les trois mouvements principaux de résistance de la zone libre ; ce regroupement donnera naissance aux Mouvements unis de la Résistance MUR, membre du directoire et secrétaire général : Pierre Dumas le 26 janvier 1943, lors d’une réunion au domicile d’Henri Deschamps à Miribel, en banlieue lyonnaise. Dans ce nouveau mouvement, Jean Moulin cherche, non sans mal, à contenir les velléités de commandement d’Henri Frenay, chef du mouvement Combat, d’Emmanuel d’Astier de La Vigerie, chef de Libération-Sud et de Jean-Pierre Lévy, chef de Franc-Tireur.
Il utilise ensuite ses dons artistiques pour se créer une couverture de marchand de tableaux et ouvre la galerie d’art Romanin — pseudonyme d’artiste de Jean Moulin — au 22, rue de France à Nice. En février 1943, il retourne rendre compte de sa mission à Londres avec le général Delestraint, le chef de l’Armée Secrète AS choisi d'un commun accord par les mouvements de résistance et par le général de Gaulle pour diriger uniquement leurs actions militaires sous l’ordre direct de ce dernier. Toutefois, si les mouvements de résistance ont accepté l'unification des mouvements pour améliorer leur efficacité ainsi que leur financement, leurs chefs n'acceptent que difficilement la tutelle militaire de Londres : Henri Frenay en particulier souhaite garder le contrôle de la résistance intérieure et mène une violente campagne contre le général Delestraint, dont il refuse de reconnaître l'autorité à la tête de l'Armée Secrète.
La création du Conseil national de la Résistance
Le 14 février 1943, Jean Moulin va à Londres rendre compte de sa mission à Charles de Gaulle qui le décore de la Croix de la Libération et le nomme secrètement ministre membre du Comité national français et seul représentant de ce comité pour l'ensemble du territoire métropolitain.
Il revient en France le 21 mars 1943, en atterrissant de nuit à Melay, chargé de créer le CNR, Conseil national de la Résistance, tâche complexe, car il est toujours peu reconnu par les mouvements de résistance. En particulier le responsable de la zone Nord, Pierre Brossolette, suscite bien des difficultés. Cependant, les sujets de discorde sont résolus, et la première réunion en séance plénière du CNR se tient à Paris, 4827 rue du Four, le 27 mai 1943.
Jean Moulin parvient à se faire admettre comme chef du CNR qui réunit les dirigeants de tous les groupes de la résistance française. Le CNR représente alors l'unité des forces résistantes françaises aux yeux des Alliés et l'embryon d'une assemblée politique représentative. Le CNR reconnaît en de Gaulle le chef légitime du gouvernement provisoire français et souhaite que le général Giraud prenne le commandement de l'armée française.
Moulin participe avec le mouvement Franc-Tireur à la création du maquis du Vercors, également pas clair contesté par les hommes de Combat. Cependant les motifs d'inquiétude s'accumulent : le commandant Henri Manhès est arrêté à Paris en mars 1943, quelques mois avant l'arrestation du général Charles Delestraint, l'Armée secrète est décapitée, et Jean Moulin lui-même se sait traqué, comme il l'écrit au général de Gaulle : Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo qui n'ignore rien de mon identité, ni de mes activités. Ma tâche devient donc de plus en plus délicate, alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Si je venais à disparaître, je n'aurais pas eu le temps matériel de mettre au courant mes successeurs.
L'arrestation à Caluire-et-Cuire
L'arrestation de Jean Moulin est l'un des aboutissements d'investigations et de manipulations menées par différents services allemands. Elle a lieu le 21 juin 1943 à Caluire-et-Cuire Rhône, dans la maison du docteur Dugoujon, en fait louée par le docteur Dugoujon, où s'est tenue une réunion avec plusieurs responsables de la Résistance dont André Lassagne, Albert Lacaze, Raymond Aubrac et Bruno Larat. La venue de René Hardy à la réunion alors qu'il n'y est pas convoqué a amené nombre de résistants à suspecter ce dernier d'avoir, par sa présence, indiqué à Klaus Barbie le lieu précis de cette réunion secrète. René Hardy, arrêté puis relâché par la Gestapo quelques jours auparavant, est d'ailleurs le seul à s'évader lors de cette arrestation, n'étant pas menotté mais ayant eu juste les poignets entravés par de simples liens. René Hardy sera accusé d'avoir dénoncé Jean Moulin aux Allemands, et comparaîtra dans un procès en 1947.
Jean Moulin est interné avec les autres responsables de la Résistance à la prison Montluc, à Lyon. Après avoir été identifié, il est quotidiennement conduit au siège de la Gestapo à l’École de santé, avenue Berthelot à Lyon afin d'être interrogé et torturé par le chef de la Gestapo, Klaus Barbie. Il est ensuite transféré à la Gestapo de Paris, avenue Foch. Il meurt de ses blessures le 8 juillet 1943 en gare de Metz, dans le train Paris-Berlin qui le conduisait en Allemagne.
La légende
Jean Moulin a d'abord été inhumé le 11 février 1944 au cimetière parisien du Père-Lachaise, puis ses cendres présumées ont été transférées au Panthéon le 19 décembre 1964, lors de la célébration du vingtième anniversaire de la Libération, sous la présidence du général de Gaulle. En réalité il s’agit d’un cénotaphe, car son corps n'a jamais été identifié avec certitude.
Le discours d’André Malraux
Le 19 décembre 1964, un discours solennel fut prononcé lors de la grande cérémonie officielle où André Malraux, ministre de la Culture, fait entrer Jean Moulin au Panthéon des grands Hommes de la République française. Il fait de lui à cette occasion le symbole de l'héroïsme français, de toute la Résistance à lui seul en l'associant à tous les Résistants français, héros de l'ombre, connus et inconnus, qui ont permis de libérer la France au prix de leur souffrance, de leur vie, et de leur idéologie de liberté. Ce discours composé et prononcé par André Malraux est souvent considéré comme un des plus grands discours de la République française.
Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi ; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé ; avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de Nuit et brouillard, enfin tombé sous les crosses ; avec les huit mille Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre, avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle — nos frères dans l'ordre de la Nuit…
C'est la marche funèbre des cendres que voici. À côté de celles de Carnot avec les soldats de l'an II, de celles de Victor Hugo avec les Misérables, de celles de Jaurès veillées par la Justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé ; ce jour-là, elle était le visage de la France...
Ce discours légendaire fut suivi du chant des Partisans interprété par une grande chorale devant le Panthéon.
Il fut prononcé dans des conditions rendant difficile la prise de son le vent soufflait fort et fut notamment retransmis en direct dans de nombreux lycées. Des enregistrements ont été réalisés, on peut notamment l'écouter à l'audiothèque du centre Georges-Pompidou ainsi que sur le site de l'INA.
Le manuscrit original de ce discours est conservé et présenté au public au musée de l’Ordre de la Libération situé dans l'Hôtel des Invalides à Paris aux côtés de la tenue de préfet de Jean Moulin, de son chapeau, sa gabardine et son écharpe.
L'hommage de Charles de Gaulle
Dans une note datée du 1er juin 1946, le général de Gaulle rend hommage à la conduite héroïque de Jean Moulin, alias Max :
MAX, pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, a su mourir héroïquement pour elle.
Le rôle capital qu'il a joué dans notre combat ne sera jamais raconté par lui-même, mais ce n'est pas sans émotion qu'on lira le JOURNAL que Jean Moulin écrivit à propos des évènements qui l'amenèrent, dès 1940, à dire NON à l'ennemi.
La force de caractère, la clairvoyance et l'énergie qu'il montra en cette occasion ne se démentirent jamais. Que son nom demeure vivant comme son œuvre demeure vivante !
Plus tard, dans ses Mémoires de guerre, Charles de Gaulle rend de nouveau hommage à Jean Moulin en ces termes :
Cet homme, jeune encore, mais dont la carrière avait déjà formé l'expérience, était pétri de la même pâte que les meilleurs de mes compagnons. Rempli, jusqu'aux bords de l'âme, de la passion de la France, convaincu que le gaullisme devait être, non seulement l'instrument du combat, mais encore le moteur de toute une rénovation, pénétré du sentiment que l'État s'incorporait à la France Libre, il aspirait aux grandes entreprises. Mais aussi, plein de jugement, voyant choses et gens comme ils étaient, c'est à pas comptés qu'il marcherait sur une route minée par les pièges des adversaires et encombrée des obstacles élevés par les amis. Homme de foi et de calcul, ne doutant de rien et se défiant de tout, apôtre en même temps que ministre, Moulin devait, en dix-huit mois, accomplir une tâche capitale. La Résistance dans la Métropole, où ne se dessinait encore qu'une unité symbolique, il allait l'amener à l'unité pratique. Ensuite, trahi, fait prisonnier, affreusement torturé par un ennemi sans honneur, Jean Moulin mourrait pour la France, comme tant de bons soldats qui, sous le soleil ou dans l'ombre, sacrifièrent un long soir vide pour mieux remplir leur matin.
Hommages
Plusieurs écoles (Marignane..., collèges Chartres et Rodez où il fut préfet, à Chateaulin où il fut sous-préfet de 1930 à 1933, Brive-la-Gaillarde, Sannois, Toulouse, Villefranche-sur-Saône, Vannes, Chaville, Domont, Saint-Amand-Montrond, Montceau-les-Mines, Draguignan, etc., lycées, à Béziers, sa ville natale, à Albertville où il fut sous-préfet de 1925 à 1930, Torcy, Metz, etc. et une université Lyon III portent le nom de Jean Moulin. Son nom figure dans les premiers rangs des appellations de rues dans le pays. La quarante-troisième promotion de commissaires de police issue de l'école nationale supérieure de la police, entrée en fonction en 1993, porte également son nom.
Jean Moulin est devenu le résistant le plus célèbre et le plus honoré de France. Comme l'explique son biographe Jean-Pierre Azéma, c'est le seul dont pratiquement tous les Français connaissent le nom et le visage, en particulier grâce à sa célèbre photo en noir et blanc, celle à l'écharpe et au chapeau mou. Cela au risque de faire parfois oublier d'autres grands organisateurs de l'armée souterraine, et de reléguer dans l'ombre d'autres martyrs héroïques de la lutte clandestine tels que Pierre Brossolette, Jean Cavaillès ou Jacques Bingen. Jean Moulin est ainsi devenu le symbole et le visage même de la Résistance.
La journaliste Ghislaine Ottenheimer affirme que Jean Moulin aurait été franc-maçon, mais aucun historien n'a pu le confirmer. En revanche les ouvrages de Daniel Ligou et André Combes confirment que son père Antoine-Émile Moulin l'était.
Le portrait de Moulin
Plaque apposée sur un immeuble de la Grand rue Jean Moulin à Montpellier.
La célèbre photographie de Jean Moulin, portant un chapeau, réalisée en noir et blanc, est prise par son ami Marcel Bernard, au cours de l'hiver 1939, à Montpellier, en contrebas du château d'eau du Peyrou.
Le photographe est un ami d'enfance et voisin, résidant au no 4 de la rue d'Alsace, en face du Champ-de-Mars, à Béziers. Jean Moulin est né au no 6 de la même rue. Bernard habite au no 4 jusqu'à sa mort en 1991. Par une ironie de l'histoire, des résistants du Maquis de Fontjun, venus des villages des environs, Capestang, Montady, Puisserguier, etc. ont été fusillés par l'occupant allemand sur la place du Champ-de-Mars, le 5 juin 1944.
Controverses
Lorsqu'il vint à la réunion de Caluire, René Hardy, qui avait déjà été arrêté par la Gestapo, puis libéré, aurait été suivi par celle-ci. Certains estiment qu'il s'agissait d'une trahison, d'autres d'une imprudence fatale. Certains résistants tentèrent plus tard d'assassiner Hardy. Ayant rejoint d'autres secteurs de la Résistance, il passa deux fois en jugement après la Libération à cause de cette suspicion qui pesait sur lui, mais fut acquitté les deux fois, au bénéfice du doute.
Frenay, lui, a la conviction que Lydie Bastien, maîtresse de Hardy, joua un rôle très trouble dans cette affaire.
La controverse est relancée au cours du procès de Klaus Barbie. Son avocat, Me Jacques Vergès, insinue que les Aubrac ont trahi Jean Moulin et fait signer à Barbie un « testament. Quelques historiens et quelques journalistes reprennent ce testament à leur compte ou s'appuient sur des documents du KGB pour dénoncer ce qu'ils pensent être des relations entre le stalinisme et la résistance. Aujourd'hui, les thèses contestées de ces historiens ont été largement réfutées : il n'est pas fait grand crédit aux déclarations prêtées par Vergès à Barbie.
Il faut par exemple citer, dans le même registre, le livre controversé du journaliste et historien lyonnais Gérard Chauvy, paru en 1997. Malgré le soutien de Stéphane Courtois, universitaire et spécialiste du communisme, lors du procès en diffamation intenté par les Aubrac, et malgré la longue hésitation d'un certain nombre d'historiens de l'Institut de l'histoire du temps présent François Bédarida, Jean-Pierre Azéma, Henry Rousso, beaucoup se sont prononcés sans ambiguïté contre Chauvy et ses méthodes, prenant parti pour les Aubrac.
Jacques Baynac soutint quant à lui la thèse d'une arrestation créditée au seul engagement policier de la Gestapo, sans aucune dénonciation.
Par ailleurs, certains, comme Henri Frenay, chef du réseau Combat, ou l'avocat et historien Charles Benfredj accusent Jean Moulin d'avoir été cryptocommuniste, c'est-à-dire d'avoir par ses relations dans les milieux radicaux secrètement favorisé les intérêts pro-soviétiques en France en détournant notamment l'aide anglo-américaine aux mouvements de résistance ; ils évoquent ses liens avec Pierre Cot, lui-même proche du communisme, et d'autres sympathisants issus de la CGT, du mouvement de résistance communiste Front national et du Parti communiste proprement dit qui seront représentés au sein du CNR, sur les dix-neuf participants à la réunion fondatrice du CNR, deux représentent le Parti communiste et le Front national et un la CGT. Henri Frenay lui reproche également d'avoir voulu réhabiliter les partis de la IIIe République au sein du CNR, au détriment des mouvements de Résistance qui, pour certains, se voulaient seuls légitimes à diriger la France à la Libération.
Thierry Wolton met en avant quant à lui les liens existant entre Jean Moulin et Harry Robinson, chef clandestin Residenz d'un des principaux réseaux de renseignement de l'Armée rouge en Europe, notamment au travers du communiste Maurice Panier.
Les défenseurs de Jean Moulin font remarquer qu'il avait accepté de s'entourer d'hommes venus de tous horizons — ses deux plus proches collaborateurs, son secrétaire Daniel Cordier et son successeur Georges Bidault, sont ainsi à l'époque issus l'un de l'Action française royaliste, l'autre de la démocratie-chrétienne — et qu'il aurait été comme tout le monde assez méfiant envers les communistes, depuis l'épisode du pacte germano-soviétique, ayant plutôt cherché à les contenir et à les ranger sous la discipline commune d'une Résistance unifiée.
Pour répondre aux diverses critiques entourant Jean Moulin, et démentir notamment les accusations de cryptocommunisme, son ancien secrétaire Daniel Cordier a entrepris à la fin des années 1970 une biographie en six volumes. Refusant l'emploi des souvenirs personnels et des témoignages oraux facilement imprécis ou déformés par le temps, Daniel Cordier s'est appuyé sur les archives de Jean Moulin en sa possession, sur une patiente étude critique des documents écrits, et sur un effort de rétablissement de la stricte chronologie des faits. Publiée entre 1989 Jean Moulin – L'inconnu du Panthéon, t. 1, J.Cl. Lattès et 1999 Jean Moulin – La République des catacombes, Gallimard, la somme de Daniel Cordier, et son apport à l'histoire de la Résistance intérieure française, dont il ne cherche pas à gommer les aspérités et les difficultés, ont été discutés, notamment par Charles Benfredj, historiographe d'Henri Frenay. Dans un documentaire de 2003 Jean Moulin, lettre à un inconnu, réalisé par William Karel et produit par Point du jour, diffusé par la chaîne TV Histoire, il déclare que l'Annuaire de la Résistance ne mentionne curieusement pas le nom de Jean Moulin.
Décorations
Officier de la Légion d'honneur décret du 1er octobre 1945
Compagnon de la Libération décret du 17 octobre 1942, sous le pseudonyme de caporal Mercier
Médaille militaire
Croix de guerre 1939-1945 avec palme décret du 1er octobre 1945
Chevalier du Mérite agricole
Médaille interalliée 1914-1918, dite Médaille de la Victoire
Médaille commémorative de la guerre 1914-1918
Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 avec barrettes France et Libération
Médaille d'or de l'Éducation physique
Médaille d'argent de l'Assistance publique
Médaille d'argent des Assurances sociales
Médaille d'argent de la Prévoyance sociale
Chevalier de la Couronne d'Italie Italie, 1926
Ordre de la Couronne yougoslave Royaume de Yougoslavie
Ordre du Jade brillant Chine, 1938
Ouvrage
Premier combat, journal posthume de Jean Moulin, préface du général de Gaulle, publié aux éditions de Minuit en 1947. Ce journal, récit des événements qui se sont déroulés à Chartres du 14 juin au mois de novembre 1940, a été écrit par Jean Moulin à Saint-Andiol après sa révocation par le gouvernement de Vichy le 2 novembre 1940 ; il y relate notamment l’épisode tragique des 17-18 juin, lorsqu’il refusa, sous les coups, de signer un document accusant à tort les tirailleurs sénégalais de massacres sur les populations civiles, et tenta de se suicider pour défendre leur honneur.
Filmographie Cinéma
1997 : Lucie Aubrac, de Claude Berri, avec Patrice Chéreau
Télévision
1977 : dans le cadre des Dossiers de l'écran, avec Serge Vincent
2002 : Jean Moulin, d’Yves Boisset, avec Charles Berling
2003 : Jean Moulin : une affaire française, de Pierre Aknine, avec Francis Huster
2007 : La Résistance, de Félix Olivier, avec Scali Delpeyrat
2013 : Alias Caracalla, au cœur de la résistance, d'Alain Tasma, avec Éric Caravaca
2014 : Dassault, l'homme au pardessus, d’Olivier Guignard, avec Frédéric Andrau
Musées Jean Moulin
Paris : Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin
Bordeaux : Centre national Jean Moulin - Musée et centre de documentation de la Seconde Guerre Mondiale.
Lyon : Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation - Cellule de Jean Moulin dans la prison Montluc..     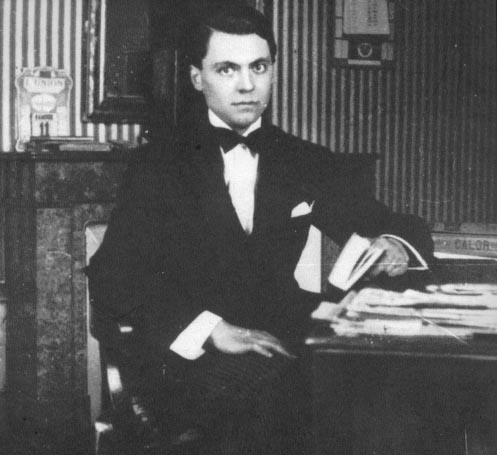     
Posté le : 19/06/2015 15:11
|
|
|
|
|
Siège de Nicée, première croisade. |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 Juin 1097 -du 14 Mai au 19 juin- Nicée était assiégée
au cours de la première Croisade. C’est la première action militaire des croisés contre les musulmans et cette victoire permet un arrêt de la progression de l’Islam dans cette région. Les commandants sont Bohémond de Tarente, Raymond de Toulouse, Godefroy de Bouillon, Alexis Ier Commène Kılıç Arslan Ier. Les forces en présence sontt les belligérants de la première croisade qui connut les batailles de Nicée, de Dorylée, d'Antioche, de Jérusalem, de Rama pour la première croisade puis d'Ascalon, de Rama, de Haran, de Rama, de Tripoli.
Il semble que le pape Calixte II, dès 1120, ait envisagé d'organiser une nouvelle croisade pour secourir les Latins d'Orient très menacés par les Turcs. Son appel ne rencontra pas un grand succès ; mais, pendant tout le XIIe siècle, des pèlerins allèrent, individuellement ou en groupe, accomplir le pèlerinage de Jérusalem et secourir les Latins.
Nicée
Nicée anciennement İznik, se trouve aujourd'hui en Anatolie, sur le territoire de la Turquie actuelle, cette ville est connue surtout pour deux conciles du début de l'histoire de l'Église chrétienne. Elle fut aussi au Moyen Âge la capitale de l'empire de Nicée, vestige de l'empire byzantin pendant les croisades.
La ville se situe dans un bassin fertile à l'extrémité orientale du lac Ascanion, entouré par une chaîne de collines au nord et au sud. Le mur ouest donne sur le lac, fournissant une protection contre un siège et une source de ravitaillement difficile à bloquer. Le lac est suffisamment grand pour qu'il soit difficile d'y organiser un blocus, durant le siège de Nicée, la ville fut d'ailleurs ravitaillée par le lac et la ville assez importante pour rendre difficile toute tentative de blocage des bateaux avec des machines de siège depuis la côte.
Ancien évêché, la ville était complètement entourée par 5 km de murs d'une hauteur de 10 m, renforcés de plus de cent tours. Eux-mêmes étaient entourés par un double fossé sur la partie terrestre. De grandes portes sur les trois côtés terrestres étaient les seules entrées dans la ville.
De nos jours les murs sont percés à de nombreux endroits par les routes, mais beaucoup de ces fortifications demeurent et sont un attrait touristique majeur. La population est d'environ 15 000 personnes.
Histoire Fondation
Nicée en grec ancien : Νίκαια / Nikaia, victoire fut fondée vers 316 av. J.-C. par le roi macédonien Antigone le Borgne, sur un site sans doute plus ancien. Il avait pris le contrôle de la plus grande partie de l'Asie Mineure après le décès d'Alexandre le Grand, sous les ordres duquel il avait servi comme général. Il donna son nom à cette nouvelle ville : Antigoneia.
D'autres généraux d'Alexandre le Grand, connus ensemble comme les diadoques, conspirèrent ensuite pour chasser Antigone le Borgne. L'ayant vaincu, le territoire fut donné, comme sa part, à Lysimaque, roi de Thrace, en 301 av. J.-C.. Il renomma la ville Nicée en hommage à son épouse Nikaia.
Antiquité
Nicée devint ensuite la capitale du royaume de Bithynie qui devait être annexé en 74 av. J.-C. à l’Empire romain. Cette domination ne pénalisa pas la ville qui se développa encore et se dota même de nouveaux remparts, d’un théâtre antique, de bains et de temples. Le christianisme s’y imposa facilement.
La ville était bâtie sur un carrefour important entre la Galatie et la Phrygie, elle avait donc un commerce actif. Elle paraît avoir perdu de son importance pendant le début de l'empire romain, quelques centaines d'années après. Mais cela changea complètement avec la division de l'empire entre l'est et l'ouest. La partie orientale connue ensuite comme l'Empire byzantin en fit une protection au sud de sa capitale Constantinople. La plus grande partie de l'architecture et des travaux défensifs furent érigés à cette période vers 300 avant que des tremblements de terre ne les ruinent.
En 325, la ville abrita le premier concile de l’Église alors universelle. Ce premier concile de Nicée, sous le règne de Constantin Ier, élabora le symbole de Nicée et condamna l'arianisme.
Moyen Âge
L'église Ayasofya de Nicée en grec Αγία Σοφία / Hagia Sophia, la sagesse divine fut construite au vie siècle par Justinien Ier au milieu de la ville, sur le modèle de Sainte-Sophie de Constantinople. Le IIe concile de Nicée en 787 y discuta de la question des icônes, dans le cadre de la crise iconoclaste dite également "querelle des images". Transformée en mosquée après la prise de la ville par les Turcs en 1331, elle fut incendiée en 1922, puis abandonnée jusqu’à sa restauration en 20071.
Atteinte par les Sassanides, Guerre perso-byzantine de 602-628), menacée par les Omeyyades, siège de 727, la ville releva pendant plusieurs siècles de l'Empire byzantin Empire romain d'Orient. Conquise par les Turcs seldjoukides siège de 1077, elle fut la première capitale du Sultanat de Roum de 1081 à 1097.
Byzance réagit en faisant appel à la première croisade. Les armées d'Europe occidentale convergèrent en vue de mettre le siège devant la ville (siège de 1097). N'ayant pu s'emparer de la ville dont les Byzantins venaient de reprendre possession, les croisés en éprouvèrent un ressentiment. En 1113 les Seldjoukides tentèrent en vain de reprendre la ville aux Byzantins.
En 1204 Constantinople tomba aux mains des armées occidentales de la quatrième croisade qui y établirent un empire latin de Constantinople. Celui-ci avait peu d'emprise sur les zones périphériques et plusieurs petits royaumes byzantins virent le jour comme le Despotat d'Épire et l'Empire de Trébizonde. C'est cependant l'Empire de Nicée qui forma le noyau de la résistance byzantine autour de Théodore Ier Lascaris. Ses successeurs agrandirent lentement leur domaine. En 1259 Michel VIII Paléologue usurpa le trône et reprit en 1261 Constantinople sur les Latins, restaurant ainsi l'Empire byzantin.
Les Turcs Ottomans conquirent la ville siège de 1331 et lui donnèrent son nom actuel d'İznik. Avec la conquête de Constantinople en 1453, la ville perdit de son importance, mais fut néanmoins un centre réputé de fabrication de céramiques, en particulier au XVIIe siècle. Cette industrie se déplaça par la suite à Kütahya et Istanbul.
La première croisade
La première croisade, prêchée à Clermont par Urbain II lui-même, fut organisée par lui au cours d'un voyage dans le midi de la France. Son appel fut repris par de nombreux prédicateurs, parmi lesquels le célèbre Pierre l'Ermite, auquel la tradition postérieure attribua une part décisive dans la naissance de la croisade, c'est lui qui aurait révélé au pape les souffrances des chrétiens d'Orient. On composa une encyclique attribuée au pape Sergius IV, pour rappeler les profanations commises au début du siècle à Jérusalem par le khalife al-Hâkim. Le pape écrivit lui-même aux Bolonais et aux Flamands pour les inviter à se joindre à l'expédition, dont le départ fut fixé au 15 août 1096.
En fait, des bandes de pèlerins la croisade populaire se mirent en marche avant cette date. Mal équipées, sans vivres et sans argent, elles se livrèrent à des déprédations, notamment contre les juifs d'Allemagne, qui valurent à plusieurs d'entre elles d'être anéanties par les Hongrois. L'empereur byzantin cantonna les survivants sur la rive asiatique du Bosphore pour attendre les barons ; mais les pèlerins se firent massacrer par les Turcs.
Les quatre principales armées partirent, l'une de la France du Nord et de la Basse-Lorraine, sous les ordres de Godefroi de Bouillon ; la deuxième, de la France du Midi, sous la direction du comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, et du légat du pape, Adhémar de Monteil ; la troisième, d'Italie méridionale, sous le commandement du prince normand Bohémond ; la quatrième, de la France centrale, avec Étienne de Blois et Robert de Normandie. La première descendit le Danube ; la deuxième traversa la Lombardie, la Dalmatie et le nord de la Grèce ; la troisième gagna directement Durazzo par mer, comme la quatrième, qui était passée par Rome. Toutes firent leur jonction sur la terre d'Asie, après avoir séjourné à Constantinople, le séjour de Godefroi fut marqué par des incidents avec les Grecs.
Un traité passé avec Alexis Comnène stipulait la restitution à l'Empire byzantin des villes que les Turcs lui avaient enlevées : les croisés s'emparèrent de Nicée et la remirent aux Byzantins, ainsi que quelques autres places d'Asie Mineure. Ils bousculèrent l'armée turque à Dorylée et atteignirent la Syrie, où Édesse fut occupée, 1097. Ils assiégèrent longuement Antioche et s'en emparèrent au moment même où une armée de secours, envoyée par le sultan seldjoukide allait arriver ; ils étaient bloqués dans Antioche, mais, au cours d'une sortie, parvinrent à écraser l'armée turque 1098. L'empereur n'était pas venu au secours des croisés ; Bohémond en tira argument pour s'établir lui-même à Antioche et ne pas remettre la ville aux Grecs. Les croisés se remirent en marche, assiégèrent Jérusalem et prirent la ville d'assaut ; après quoi, à la bataille d'Ascalon 1099, ils écrasèrent l'armée égyptienne, qui venait les attaquer.
De nouvelles armées, l'arrière croisade s'étaient constituées en Allemagne, en Bourgogne, en Poitou et en Lombardie ; descendant le Danube, elles gagnèrent Constantinople. Mais elles furent anéanties au cours de la traversée de l'Asie Mineure et seuls quelques éléments parvinrent en Syrie 1101. En revanche, des contingents venus par mer – Génois, Pisans, Vénitiens, Norvégiens – arrivèrent sans encombre et aidèrent ceux des croisés qui s'étaient fixés en Terre sainte à occuper les villes de la côte.
La progression turque et la première croisade
Au cours du XIe siècle, l’affaiblissement du califat, le pouvoir central de l’Islam, amène l’arrivée au premier plan de dirigeants turcs qui se taillent des fiefs dans l’empire musulman induisant un morcellement politique de l’empire. Cette arrivée des Turcs s’accompagne d’un fanatisme et de persécutions vis-à-vis des peuples non musulmans. Dès 1009, le calife fatimide Al-Hakim fait détruire des églises chrétiennes à Jérusalem.
Les turcs saljûqides s’installent en Anatolie, fondent le sultanat de Roum et commencent à s’emparer de territoires byzantins. Le sultan Alp Arslan occupe l’Arménie en 1064 et détruit Ani, l’une de ses capitales. L’empereur byzantin Romain IV Diogène, tente de relever la situation, mais son armée est anéantie à Manzikert en 1071 et il est capturé. Cette victoire permet la conquête définitive de l’Arménie, et prépare celle d’Édesse et d’Antioche. À Byzance, le général Michel Doukas profite de la vacance impériale pour monter sur le trône et se proclamer empereur. Sans opposition, les Seldjoukides n’ont aucun mal à s’emparer de l’Anatolie, prendre en 1081 la ville de Nicée à quelques dizaines de kilomètres de Byzance et à y établir leur capitale en 1081. La ville d’Antioche est prise en 1085 et Édesse en 1087.
Pour les pèlerins chrétiens, cette prise de possession de l'Anatolie par les Seldjoukides se traduit par de plus grandes difficultés à atteindre Jérusalem, les rançonnages, les persécutions, voire les meurtres sont autant d’obstacles sur la route des Lieux saints. De plus les Byzantins voient avec une grande inquiétude la présence des Turcs aux portes de leur capitale sans qu’ils puissent vraiment s’y opposer militairement et envoient des messages au pape Urbain II afin d’obtenir de l’aide de la part des Occidentaux. Les messagers sont reçus au concile de Plaisance en mars 1095, et le 27 novembre de la même année, le pape profite du concile de Clermont pour lancer un appel à la chrétienté afin de combattre les Turcs et de délivrer les Lieux Saints.
L’arrivée des croisades
Tandis que les barons d’Europe s’organisent pour partir en croisade, de nombreuses personnes issues des couches humbles de la population partent en direction de l’Orient, assemblés en croisade populaire, sous la conduite de quelques chefs tel Pierre l’Ermite. Ces croisés, peu ou mal armés, atteignent Constantinople le 1er août 1096 et s’établissent dans le camp de Civitot sur la rive asiatique de la mer de Marmara. Sans la moindre discipline, certaines bandes vont piller les environs de Nicée. Un certain Renaud prend le château de Xérigordon, à proximité de Nicée, mais sa troupe est massacrée par Kılıç Arslan, sultan de Nicée qui attire ensuite les croisés restés à Civitot et les massacre 21 octobre.
Kılıç Arslan reprend alors un conflit contre un voisin oriental, Danichmend, en laissant famille et trésor à Nicée. L’enjeu de ce conflit est la souveraineté de la région au nord d’Edesse, et Kılıç Arslan entend soumettre un arménien, Gabriel qui s’est emparé de la ville de Malatya et faire en même temps une démonstration de force destinée à assagir Danichmend.
Pendant ce temps, la croisade des barons arrive à Constantinople en avril 1097 et des premières dissensions apparaissent entre l’empereur byzantin et les croisés. Ces litiges aplanis, les croisés traversent le Bosphore et se regroupent à Nicomédie.
Le siège
La cité bénéficie de solides défenses, six kilomètres de remparts avec 240 tours et, au sud-ouest, le lac Ascanios qui empêche l'accès de ce côté en assurant un approvisionnement en eau.
Pour parvenir à Nicée, Godefroy de Bouillon fait élargir la route reliant Nicomédie à Nicée et l’empereur Alexis Ier Comnène s’engage à assurer un ravitaillement régulier. Après une étape à Nicomédie du 1er au 3 mai 1097, le 4 mai les croisés s'avancent vers Nicée. La ville est atteinte le 6 mai. Les Lorrains menés par Godefroy de Bouillon s'installent au nord, les Normands de Bohémond de Tarente à l'est, et les troupes de Raymond de Saint-Gilles, arrivées le 16 mai, au sud. Entre-temps un premier assaut a lieu le 14 mai.
Enfin, les survivants de la croisade populaire, autour de Pierre l'Ermite, arrivent avec un contingent byzantin commandé par Manuel Boutoumitès. Alexis Comnène fait également venir des machines de sièges et la ville est bientôt cernée aux trois quarts. Seule subsiste libre la porte sud de la ville, par laquelle Kılıç Arslan tente de faire parvenir des renforts, mais l’armée de Raymond de Saint-Gilles et d’Adhémar de Monteil, arrivée peu après sur les lieux, les surprend et anéantit cette troupe de renforts.
Les assiégés tentent une sortie le 16 mai, mais elle est repoussée et ils laissent environ 200 hommes sur le champ de bataille. Profitant de ce succès, Raymond tente de miner une tour de l’enceinte en la faisant saper par ses mineurs. Cette tour s’écroule enfin au cours d’une nuit, mais les Turcs réussissent à réparer la brèche et les croisés n’ont d’autre choix que de faire un siège en règle. L’arrivée de l’armée de Robert Courteheuse, duc de Normandie permet de réaliser un blocus complet du côté terrestre, mais les Nicéens peuvent encore se ravitailler par des barques naviguant sur le lac Ascanios.
La réaction de Kılıç Arslan
En pleine campagne à Malatya, Kiliç Arslan reçoit des nouvelles lui annonçant l'arrivée de la Croisade des barons mais il s'en soucie d'abord assez peu. Lorsque la gravité de la situation se confirme, il convient d'une trêve avec son adversaire pour repousser les occidentaux, les Franj.
Du côté turc, si Kilij Arslan a expédié quelques renforts symboliques aux premières alertes, il est trop tard lorsqu'il arrive en vue de la ville. Son avant-garde est battue par un contingent mené par Raymond et Robert de Flandre le 20 mai. Le 21 mai, Kılıç Arslan tente de percer les lignes adverses, mais la bataille qui se termine tard le soir est sanglante et il doit renoncer.
Kılıç Arslan se replie sur Konya, désormais nouvelle capitale du sultanat. Il aurait transmis aux assiégés un message sibyllin suggérant de se rendre aux Byzantins plutôt qu'aux Francs qui l'année précédente avaient fait de terribles ravages et qui s'amusaient à catapulter les têtes de soldats turcs morts dans les précédents combats.
Le 3 juin, le dernier contingent croisé, mené par Robert Courteheuse et Étienne II de Blois complète le dispositif franc. Une tour de siège est montée par les Toulousains, et poussée vers la Porte Gonatas, pendant que les sapeurs œuvrent en sous-sol. Mais la tour est endommagée, et ne parvient pas au contact de la muraille
L'empire Byzantin
L'empereur byzantin Alexis Ier, qui a suivi sans accompagner les Croisés, arrive avec des bateaux qui permettent d'établir un blocus sur le lac Ascanios : les Turcs ravitaillaient en effet la ville par le lac depuis le début du siège. Deux mille peltastes, commandés par Taticius et Tzitas, arrivent aussi sur les lieux.
Alexis Ier avait fait mener des négociations secrètes par Boutoumitès, qui aboutirent la reddition de la ville.
Dans la nuit du 25 au 26 juin des membres turcs de l'armée byzantine pénètrent dans la ville par le lac, et au petit matin, alors que les Francs préparent l'assaut décisif, ils ont la surprise de voir l'étendard impérial flotter sur les remparts, décevant leur espoir de mettre à sac la ville.
La suite du siège
Boutoumites, nouveau duc de Nicée, interdit aux Croisés d'entrer par groupes de plus de dix dans la ville.
Malgré les cadeaux de l'empereur en or, chevaux et autres, les Croisés partirent plein de rancœur, le 26 juin. Le premier contingent était mené par Bohémond de Tarente, Tancrède de Hauteville, Robert Courteheuse, Robert de Flandre, accompagnés par Taticius. Godefroy de Bouillon, Baudoin de Boulogne, Étienne de Blois et Hugues de Vermandois composaient le second. Taticius était chargé d'assurer le retour à l'Empire des villes prises. Les Croisés avaient cependant le moral au plus haut : Étienne de Blois écrit à sa femme Adela qu'il espérait être à Jérusalem cinq semaines plus tard.
Conséquences
Pour les Croisés, la prise de Nicée est la première action militaire contre l’Islam, et leur permet de continuer sur la route de Jérusalem. Le 1er juillet, les Croisés battent Kılıç Arslan à la bataille de Dorylée, et atteignent Antioche en octobre. Ils atteignent Jérusalem deux ans plus tard et fondent une série d’état chrétiens en Syrie, qui se perpétuent pendant près de deux siècles. Mais la rancœur et la méfiance s’est installée entre les Francs et la Byzantins et sera la cause de nombreuses mésententes, voire de trahison, pendant les siècles suivants.
Parmi les pertes franques de ce siège, Robert, comte de Gand, mort au combat du 21 mai Baudouin de Mons, Baudouin Cauderons, Guillaume Ier l'Ancien, comte de Lyon et de Forez et Gui de Porsenne.
L'empire byzantin au XIIe siècle
Pour les Grecs, cette prise est la première action d'envergure de reconquête de l’Asie Mineure. Avant la Croisade, les Turcs sont presque aux portes de Byzance, bien qu'Alexis Comnène leur ait repris la Bithynie. Après le passage de la croisade, Alexis Comnène profite de ce que les Seldjoukides soient aux prises avec les Croisés pour reprendre de nombreux territoires côtiers de l’Asie Mineure, jusqu’à Trébizonde au nord et la Cilicie au Sud.
Le sultanat de Roum a subi un premier revers, qui ne met pas en cause son existence, mais son importance. Il survit pendant plus de trois siècles, mais d’autres États alors vassaux gagnent en prestige et en puissance lors des combats contre les croisés, tels les émirats d’Alep, de Mossoul et de Damas.
Quand l'histoire devient légende
Il est surprenant que des villes fondées en pleine époque historique aient été dotées de légendes d'origine, fantaisistes à nos yeux, qui furent répétées durant des siècles. Deux exemples illustrent ces fabrications récentes, à Nicée et à Nysa/Scythopolis. Nicée, ville nouvelle, fut fondée après 323 sous le nom d'Antigoneia. En 301, Lysimaque lui donna le nom de son épouse, la princesse macédonienne Nicaia. Dans les années 270, le roi indigène de Bithynie, Nicomède, l'annexa à son tour, mais sans changer son nom. C'est après cette annexion, à une date impossible à préciser, que fut imaginée la nymphe Nicaia, chasseresse dévouée à Artémis et subjuguée par Dionysos près d'une source qui est restée presque jusqu'à nos jours un site sacré de la ville. Cette version officielle des origines de Nicée fit oublier l'intermède lysimachéen au profit d'une divinité autochtone et elle resta connue jusqu'en pleine période byzantine. Quant à Nysa, ce nom de princesse séleucide fut donné à deux cités, une en Asie Mineure et une dans la Décapole syrienne, la très ancienne ville cananéenne de Beisan. En 63 avant J.-C., lorsque Pompée supprima la monarchie séleucide et réorganisa la Syrie, Nysa garda son nom, mais il évoquait désormais la nourrice de Dionysos, qui serait morte en cet endroit.
   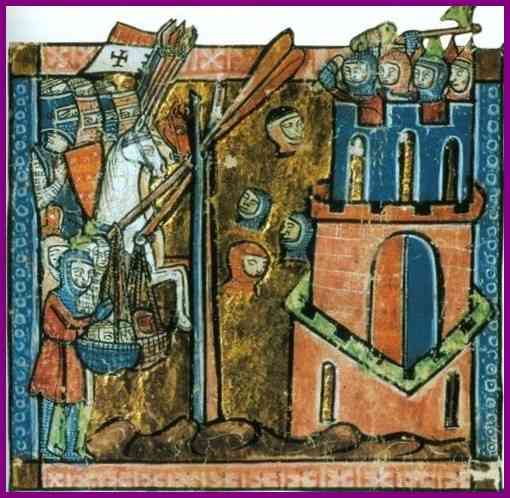 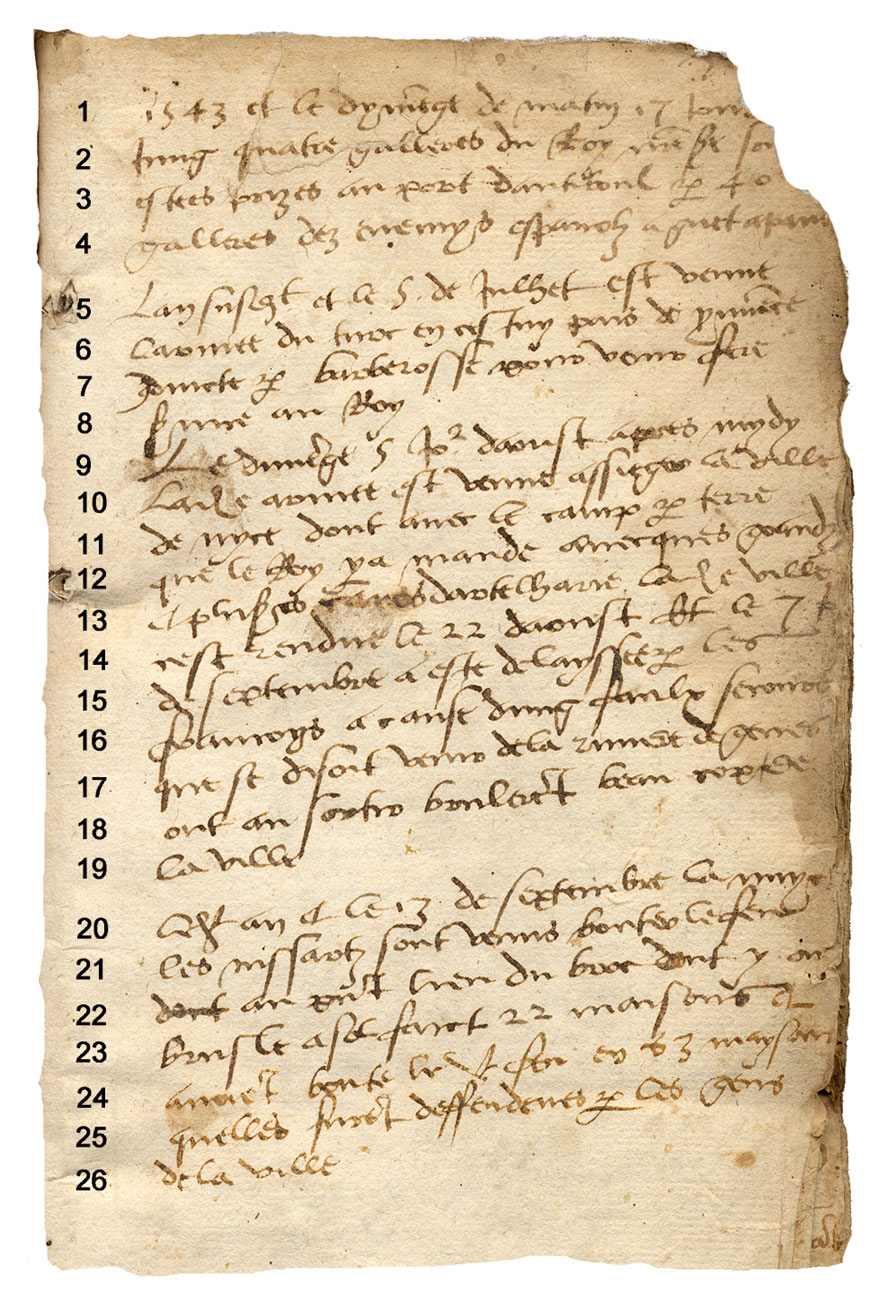  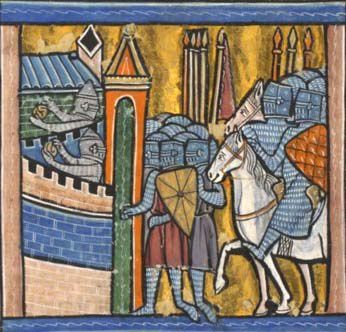  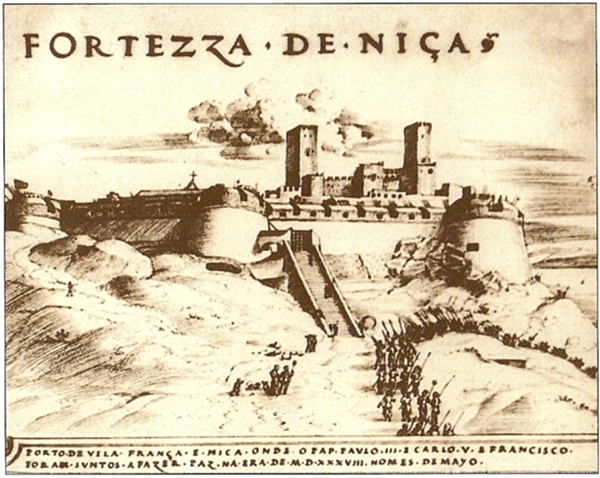  
Posté le : 12/06/2015 19:23
|
|
|
|
|
Accords de Schengen |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 juin 1985 à Schengen ville du Luxembourg est signée
la convention d'application entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Cet accord entre en vigueur le 26 mars 1995, le dépositaire est le Gouvernement du Grand Duché du Luxembourg, les Langues du traité sont l'allemand, le français, le néerlandais
La convention de Schengen promulgue l'ouverture des frontières entre les pays signataires pour les étrangers à l'Union européenne. Pour les citoyens européens, la libre circulation dans l'Union européenne découle de la directive 2004/38/CE. Le territoire ainsi créé est communément appelé espace Schengen, du nom du village luxembourgeois de Schengen, tripoint frontalier entre l'Allemagne, le Luxembourg, donc le Benelux et la France, au bord de la Moselle, où a été signé l'accord entre les cinq États concernés à l'époque le 14 juin 1985. Si la première convention de Schengen date de 1985, l'espace Schengen a été institutionnalisé à l'échelle européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997. L'espace Schengen comprend actuellement 26 États membres.
Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, modifie les règles juridiques concernant l'espace Schengen, en renforçant la notion d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Celui-ci fait intervenir davantage de coopération policière et judiciaire, et vise à une mise en commun des politiques de visas, d'asile et d'immigration, notamment par le remplacement de la méthode intergouvernementale par la méthode communautaire.
Les pays signataires pratiquent une politique commune en ce qui concerne les visas et ont renforcé les contrôles aux frontières limitrophes de pays extérieurs à l'espace. Bien qu'il n'y ait en théorie plus de contrôles aux frontières internes à l'espace Schengen, ceux-ci peuvent être mis en place de manière temporaire s'ils s'avèrent nécessaires au maintien de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Désormais, les citoyens étrangers qui disposent d'un visa de longue durée pour l'un des pays membres peuvent circuler librement à l'intérieur de la zone.
En bref
Accords signés en 1985 et 1990 à Schengen Luxembourg par l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, auxquels se sont joints par la suite la plupart des autres membres de l'Union européenne, ainsi que – à titre de pays associés – l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, au total : 26 États. La Bulgarie 2007, la Roumanie 2007, la Croatie 2011 et Chypre 2004 ont signé les accords mais ne sont pas membres à part entière de l'espace Schengen.
Ces accords, entrés en application graduelle à partir de 1995, visent à instaurer, par la suppression progressive des frontières, la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace communautaire ainsi défini, dit espace Schengen et à améliorer, par une étroite coopération, la sécurité à l'intérieur de cet espace
Dans le cadre de la coopération intergouvernementale européenne, la France, la république fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont signé le 14 juin 1985 les accords de Schengen du nom d'une petite commune luxembourgeoise. Ces accords visent à supprimer progressivement les contrôles aux frontières communes, instaurant un régime de libre circulation pour toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité.
Les cinq États signent le 19 juin 1990 à Dublin la convention complémentaire définissant les conditions d'application et les garanties de mise en œuvre de cette libre circulation mise au point de procédures uniques pour les États concernés. La Convention organise aussi la coopération entre les systèmes judiciaires, les polices et les services administratifs. Des règles communes sont fixées dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, les trafics illicites et la grande criminalité.
L'Italie en 1990, l'Espagne et le Portugal en 1991, la Grèce en 1992 rejoignent le groupe de Schengen, formant l'espace Schengen. L'Autriche en 1995, puis le Danemark, la Finlande, la Suède et, en tant que membres associés, la Norvège et l'Islande en 1996 adhèrent à la convention. Le 26 mars 1995, la convention de Schengen entre en vigueur dans sept des États signataires Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. L'application effective de la convention par les autres États date de 1998. Le traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, a intégré les acquis de la convention de Schengen dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne, au titre des coopérations renforcées entre États membres méritant l'aval de l'Union. Le Royaume-Uni et l'Irlande n'ont pas adhéré à ce dispositif.
En 2004, les dix nouveaux pays membres de l'Union ont adhéré également à la convention qui est entrée en application pour eux en 2007. La Suisse, ayant fait pareillement la même année, est entrée dans l'espace Schengen en 2008. Quant à la Bulgarie et à la Roumanie, elles ont adhéré à la convention en 2007.
Carte de l'espace Schengen
Après l'accord de Schengen qui remonte à 1985, sera signée la convention de Schengen en 1990 ; celle-ci entra en application en 1995. Alors qu'ils étaient minoritaires dans l'accord de 1985, les articles concernant la coopération policière, l'immigration et l'asile sont désormais majoritaires, 100 sur les 142 articles. La Convention consacre la notion de douane volante, permettant des contrôles des douanes sur tout point du territoire, que ce soit contrôle des marchandises ou des titres de séjour, art. 67 du Code des douanes français. La notion de frontière évolue alors, sortant de la stricte compréhension géographique pour devenir mobile, fluctuante, sujette à la perception des douaniers.
La convention d'application de l'accord Schengen a été ratifiée par l'Allemagne, les pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, la France 19 juin 1990, l'Italie, 27 novembre 1990, l'Espagne, le Portugal, 25 juin 1991. Les accords entrent en vigueur pour les sept pays dès le 26 mars 1995, mais la France demande une période probatoire de trois mois, durant lesquels des contrôles aléatoires sont menés aux frontières terrestres, tandis qu'ils sont levés aux aéroports. Suite à la vague d'attentats de l'été 1995, elle rétablit tous les contrôles, faisant ainsi appel à l'art. 2.2 qui prévoit cette possibilité pour une période limitée et lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent. Elle finit par lever tous les contrôles le 26 mars 1996, à l'exception des frontières avec la Belgique et le Luxembourg, en raison de la tolérance néerlandaise vis-à-vis de certaines drogues. Cela lui vaut des remontrances de la part de ses partenaires, et en 1996, le groupe Schengen détermine plus précisément la portée de la clause de sauvegarde art. 2.2.
Extension de l'espace suite aux élargissements de l'UE
La Convention est aussi signée par la Grèce, 6 novembre 1992 et l'Autriche, 28 avril 1995, puis par le Danemark, la Finlande, la Suède, et aussi la Norvège et l'Islande pour prendre en compte et préserver le traité existant de libre circulation entre les pays nordiques le 19 décembre 1996.
La Norvège et l'Islande, par ailleurs signataires de la Convention de Dublin, ont signé un accord de coopération avec les États Schengen en même temps que l'accord signé avec le Danemark, la Finlande et la Suède : ces trois derniers, membres de l'UE, disposaient déjà d'un régime de libre circulation incluant la Norvège et l'Islande, dénommé Union nordique des passeports.
L'Italie applique la convention depuis le 1er juillet 1997, l'Autriche et la Grèce l'appliquent depuis le 1er décembre 1997 ; cependant, la levée totale des contrôles des personnes aux frontières intérieures aériennes et maritimes n'est intervenue en Grèce que le 26 mars 2000, alors que l'Italie les levait le 26 octobre 1997 et l'Autriche le 1er décembre 1997.
Le traité d'Amsterdam en 1997 prévoit l'incorporation de l'accord de Schengen aux autres traités de l'Union européenne. L'Irlande et le Royaume-Uni n'ont toutefois pas signé la Convention de Schengen ; mais Londres a bien signé la Convention de Dublin à propos du droit d'asile. En effet, des difficultés sont survenues à propos du contrôle aux frontières de Gibraltar et de la coopération avec l'Espagne. D'autre part, les questions relatives à la liberté de circulation entre les îles britanniques y compris l'Irlande et les îles Anglo-Normandes sont en cours d'examen et font l'objet d'un accord spécifique, dit compromis de Dublin destiné à préserver les acquis des deux espaces de liberté, mais surtout à mettre en œuvre le dispositif commun de contrôle prévu dans le système Schengen et pouvant bénéficier d'une coopération renforcée par un échange d'informations entre les signataires du compromis de Dublin, comme cela a été fait pour préserver les acquis de la liberté de circulation entre les pays nordiques. Ce dispositif a d'abord été mis en œuvre pour la lutte contre le hooliganisme, par le partage des signalements d'interdictions prises contre certaines personnes, mais qui s'étend maintenant à la prévention des trafics illégaux de biens, de services ou de personnes.
Extension à la Suisse et au Liechtenstein
Le 13 mai 2004, les négociations avec la Suisse pour sa participation à l'espace Schengen ont abouti. 54,6 % des votants ont approuvé cette adhésion par votation populaire le 5 juin 2005. La Suisse devient ainsi membre de l'espace Schengen, aux mêmes conditions que les autres pays non-membres de l'Union européenne parties à cet accord, l'Islande et la Norvège. Cette adhésion fut effective dès que tous les pays membres ont ratifié l'accord passé avec la Suisse, en février 2008. Puis la procédure d'évaluation a abouti en novembre 2008. Le 12 décembre 2008 à minuit, la Confédération suisse a intégré l'espace Schengen. Cependant, les marchandises continuent à être contrôlées car la Suisse n'a pas conclu d'union douanière avec l'Union européenne.
Le Liechtenstein est aussi concerné car la Suisse s'occupe depuis 1924 du contrôle de la frontière entre le Liechtenstein et l'Autriche. De plus, le Liechtenstein a également signé le 28 février 2008 un accord pour son intégration formelle dans l'espace Schengen, qui a été ratifié le 7 mars 2011. Après un processus d'évaluation dans les domaines de la protection des données, la coopération policière et le Système d’information Schengen SIS/Sirene, l'adhésion du Liechtenstein à l'espace de Schengen fut confirmée le 18 décembre 2011.
Membres et mise en application Espace Schengen.
Pour chaque État membre, il existe un délai entre la signature de l'accord devenir membre et la mise en œuvre de celui-ci.
Application
26 mars 1995 : Allemagne, Belgique, France avec des restrictions jusqu'en mars 1996, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne.
26 octobre 1997 : Italie
1er décembre 1997 : Autriche
8 décembre 1997 : Grèce. Ce dernier pays n'applique l'accord que dans les aéroports et les ports, principalement liaisons entre Igoumenitsa et différents ports italiens, n'ayant pas de frontières terrestres avec un autre État appliquant les accords de Schengen. De plus, ce pays n'applique pas la convention de Schengen pour les ressortissants de la République de Macédoine.
25 mars 2001 : Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède.
21 décembre 2007 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie et Malte.
12 décembre 2008 : Suisse.
19 décembre 2011 : Liechtenstein
Les huit États d'Europe centrale et orientale qui ont signé le 1er mai 2004, ainsi que Malte, ont mis en œuvre l'accord à partir du 21 décembre 2007 pour les frontières terrestres et maritimes, et à partir du 30 mars 2008 pour les frontières aériennes, Chypre suivant un planning différé. La Suisse a commencé à appliquer l'accord le 12 décembre 2008, suite au feu vert de la commission d'évaluation. La décision formelle a été prise le 27 novembre 2008.
Chaque nouveau pays doit, avant d'appliquer complètement l'accord Schengen, satisfaire à certaines conditions dans les quatre domaines suivants : les frontières aériennes, les visas, la coopération policière et la protection des données personnelles. Ce processus d'évaluation implique qu'un questionnaire soit rempli par les États candidats et que des visites d'experts de l'Union européenne aux institutions et lieux de travail sélectionnés dans les pays concernés soient effectuées.
Mesures d'accompagnement
L'article 2.2 permet de rétablir de façon temporaire un contrôle des personnes à ses frontières ou dans certaines régions d'un pays pour des raisons d'ordre public ou de sécurité.
Cela a été utilisé à de multiples reprises, lors de sommets du G8 et autres lieux de rassemblement du mouvement altermondialiste, récemment lors du sommet de l'OTAN Strasbourg-Kehl 2009, ou encore par l'Allemagne lors de la Coupe du monde de football de 2006, afin d'interdire l'entrée sur le territoire de présumés hooligans suivant des listes préétablies par les services de police.
Les États membres peuvent déterminer à discrétion l'étendue des notions d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, en accord avec leur législation et selon leur jurisprudence nationale, mais cela ne s'applique pas dans le cadre du droit communautaire. Cependant les accords prévoient que toute mesure de restriction de déplacement prise pour ces raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publique doit être conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, obéir au principe de proportionnalité, et être motivée par une menace réelle et suffisamment grave touchant un intérêt fondamental du pays. Ces restrictions ne peuvent concerner que des individus, et non des groupes d'individus, la nationalité ou l'origine du voyageur, travailleur ou migrant, ou son lieu d'entrée dans l'espace de Schengen ne pouvant pas constituer une raison suffisante pour lui interdire un déplacement.
L'entrée immédiate dans l'espace de Schengen ne signifie pas acceptation de cette entrée, puisque la décision d'interdire l'entrée dans l'espace de Schengen peut être prise et notifiée à l'intéressé dans les trois mois suivant son entrée provisoire dans l'Espace de Schengen ; seul le pays d'entrée peut prendre sa décision d'accepter ou refuser un individu, et il conserve toutes les données et signalements relatifs à cette personne selon sa législation nationale. Toutefois, les autres pays signataires peuvent notifier leur appréciation au pays d'entrée qui déterminera si le signalement doit être inscrit et communiqué dans le système Schengen aux autres pays de l'espace.
De plus en cas d'utilisation de faux documents à l'entrée dans l'espace de Schengen, notamment en cas de fausse déclarations de ressources ou d'assurance, ou de faux documents d'identité, la décision provisoire de laisser entrer un individu peut être cassée sans limite de durée, en accord avec la Convention européenne des droits de l'homme et les législations nationales, mais uniquement par le pays d'entrée qui seul peut supprimer un signalement et annuler une autorisation d'entrée. En pratique, cela évite la constitution de fichiers multiples et contradictoires pour un même individu, et évite les conflits de législation qui pourraient retarder une décision d'expulsion, par des recours multiples, et cela simplifie les recours en annulation pour les individus concernés, notamment dans le cadre de la lutte contre le trafic de personnes.
Pour les visiteurs hors EEE, le droit d'entrée est de 3 mois à la première entrée dans l'espace de Schengen, quel que soit le nombre de pays visités. À l'expiration du délai, la présence sur le territoire d'un pays de l'espace Schengen n'est plus autorisée, et le ressortissant doit refaire une nouvelle procédure d'entrée et pouvoir prouver qu'il a résidé hors de l'espace Schengen ou de l'EEE durant les trois derniers mois, pour être autorisé à y revenir. Pour le prouver, un visa de sortie est apposé lors de sa sortie de l'espace Schengen, sur le formulaire remis avec le passeport lors de son entrée, cependant le visiteur peut présenter une preuve suffisante de résidence hors de l'espace par tout autre moyen, notamment par la preuve de visas d'entrée ou de sortie dans un autre pays, ou les preuves nominatives de ce déplacement hors de l'espace.
Des mesures d'accompagnement permettent toutefois au visiteur de s'affranchir parfois d'un certain nombre de formalités, notamment l'obligation d'une assurance d'assistance au retour, ou de couverture maladie, si le visiteur est seulement en transit temporaire dans un point d'échange de trafic international, ports, gares, aéroports…, où il peut séjourner légalement pour une durée limitée dans le temps. Si pour assurer une correspondance, il doit sortir d'une zone internationale de transit, il est tenu de se présenter aux contrôles et signaler sa zone de transit ou de destination, par exemple pour les correspondances d'une gare à une autre. Généralement, ces transferts de voyageurs hors Schengen sont assurés par les voyagistes qui remettent aux autorités les listes de voyageurs dont ils assurent le transport de correspondance d'une zone de transit à une autre.
 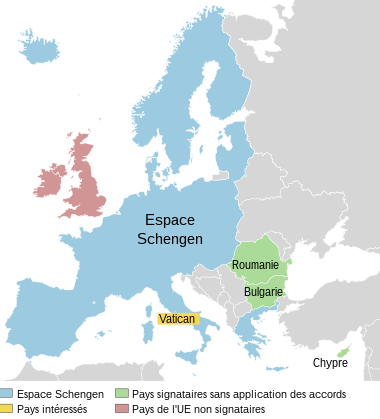  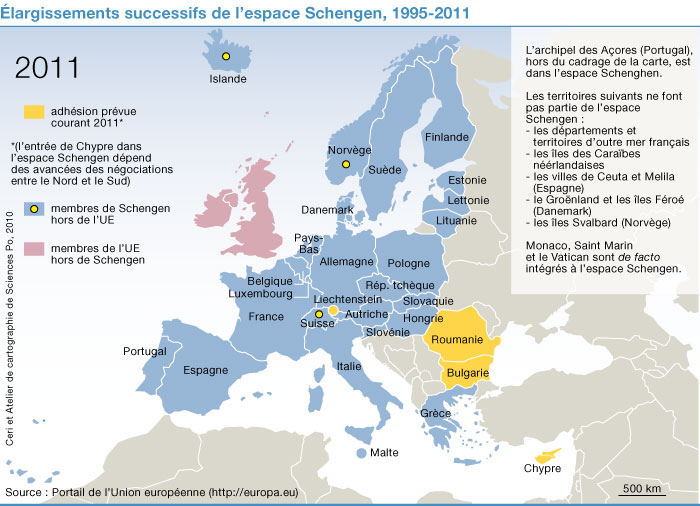    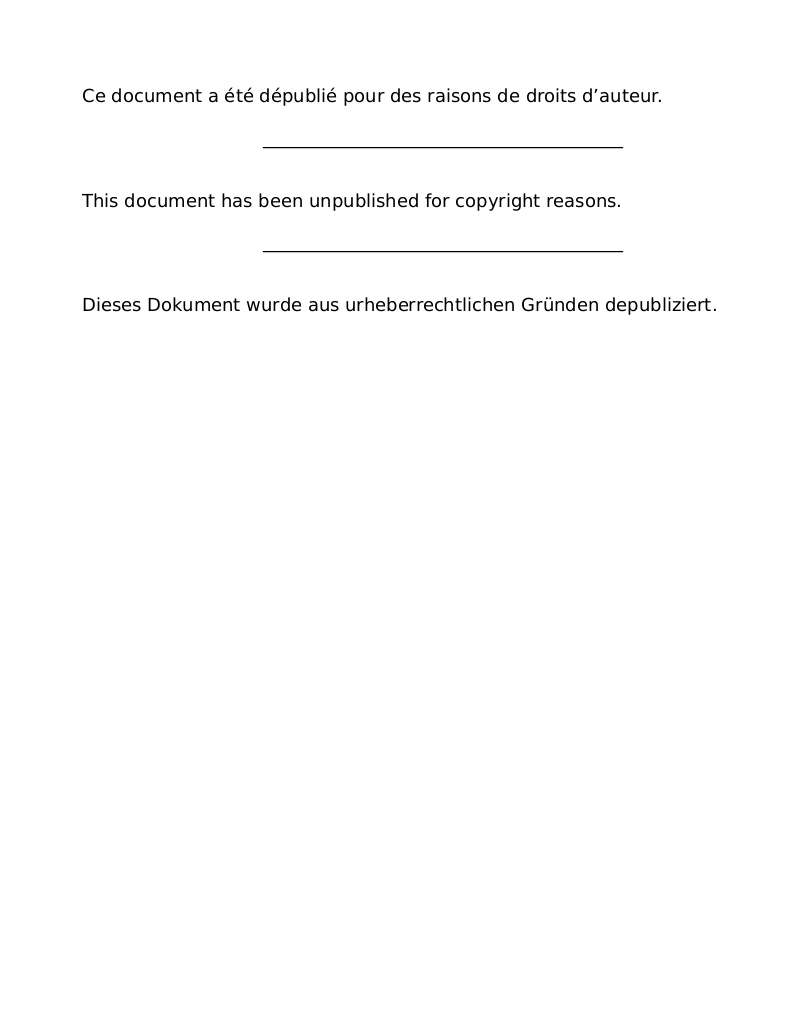  
Posté le : 12/06/2015 19:20
|
|
|
|
|
Accords du Latran |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 7 juin 1929 sont ratifiés les accords du Latran
officiellement titrés Traité entre le Saint-Siège et l’Italie, ils sont signés au palais du Latran le 11 février 1929 entre le Royaume d'Italie, représenté par le président du conseil des ministres Benito Mussolini, et le Saint-Siège, représenté par le cardinal Pietro Gasparri, secrétaire d'État du pape Pie XI, ils mettent fin à la question romaine, survenue en 1870 après la prise de Rome et son annexion par la monarchie italienne. Ils réduisent la souveraineté temporelle du pape au seul État de la Cité du Vatican. En contrepartie, le catholicisme devient religion d'État en Italie.
Signés par le pape Pie XI, 1922-1939 et Mussolini, les accords du Latran règlent la question romaine, qui envenimait les relations entre la papauté, par suite, les catholiques et l'État unitaire italien, depuis que ce dernier avait annexé Rome le 2 octobre 1870, mettant fin à l'existence millénaire des États du pape. La papauté, qui disposait déjà d'une souveraineté internationale reconnue, conforte alors celle-ci par l'obtention d'une assise territoriale : c'est la création de l'État du Vatican, réduit à un quartier enclavé de Rome. Les relations entre Saint-Siège et État italien sont en outre normalisées par un concordat, qui confère au catholicisme un statut de religion d'État en Italie, autorise l'enseignement religieux dans les écoles et interdit le divorce. En contrepartie, Mussolini, qui entend se placer dans une certaine continuité idéologique du Risorgimento, obtient la reconnaissance par la papauté de l'État unitaire italien et, plus largement, le soutien des catholiques italiens ainsi qu'un indéniable prestige international. Cet accord constitue un des succès majeurs du régime fasciste à son apogée.
En bref
Les Accords du Latran, 1929 sont des accords passés au palais du Latran entre le Saint-Siège et le chef du gouvernement italien, Mussolini.
Cet acte diplomatique comportait : un traité politique, qui abrogeait la loi des Garanties du 13 mai 1871 et reconnaissait la plénitude dela souveraineté papale sur l'État du Vatican, cité du Vatican, palais de Castel Gandolfo, trois basiliques patriarcales de St-Jean-de-Latran, Ste-Marie-Majeure et St-Paul-hors-les-Murs ; une convention financière, qui accordait au Saint-Siège un dédommagement pour la perte des revenus temporels en 1871 ; un concordat religieux, donnant à l'Église italienne une position privilégiée, notamment en matière scolaire et matrimoniale. La Constitution républicaine qui entre en vigueur le 2 décembre 1947 a établi les rapports de l'État italien et de l'Église catholique sur la base des accords du Latran. Un nouveau concordat signé le 18 février 1984 se substitue à celui de 1929 et modifie profondément les rapports entre l'Église et l'État en Italie, le catholicisme n'est plus religion d'État.
Question romaine.
En 1870, le général Cadorna envahit les États pontificaux et Rome devient la capitale présomptive du Royaume d'Italie, le pape Pie IX, est contraint de se réfugier au Vatican et se considère comme prisonnier. En 1871, le parlement italien vote une « loi des Garanties » pour garantir les prérogatives du pape que celui-ci refuse provoquant un désaccord qui durera 60 ans. Ce n'est qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale que l'Église, le gouvernement italien et les libéraux modérés se rapprochent et les catholiques réintègrent la vie politique. Avec l'arrivée du fascisme, l'Église parie sur les composantes les moins hostiles du fascisme ; cela se traduit par la réforme des lois ecclésiastiques de 1923–1925, favorable à l'Église, mais c'est le discours de Mussolini le 3 janvier 1925 qui marque la restauration de bons rapports entre le Saint-Siège et le gouvernement italien.
Accords du Latran
Les négociations qui aboutiront aux accords du Latran commencent en 1926. Elles aboutissent à la signature par Mgr Gasparri Cardinal secrétaire d'État et par Mussolini de protocoles au palais du Latran, le 11 février 1929. Pie XI voit dans ces accords la restauration de l'Italie à Dieu et de Dieu à l'Italie.
Les accords comprennent trois conventions distinctes :
un traité politique qui règle la question romaine ;
une convention financière qui dédommage le Saint-Siège ;
un concordat qui statue sur la position de l'Église en Italie.
Traité politique
Le Pape accepte de n'être plus souverain temporel que sur l'État de la Cité du Vatican, dont l'État italien reconnaît la pleine propriété et l'autorité souveraine au Saint-Siège. Toute forme d'ingérence italienne est abandonnée. En compensation, le Saint-Siège renonce à toute prétention sur les anciens États Pontificaux. Il reconnaît le Royaume d'Italie sous la maison de Savoie, et Rome comme capitale du Royaume d'Italie. L'Italie reconnaît quant à elle en Rome une città sacra. Concrètement, cela signifie que l'Italie prend le Vatican sous sa protection. Ainsi, en cas d'incident place Saint-Pierre, c'est la police italienne qui se doit d'intervenir.
On reconnaît au nouvel État des services publics : le Vatican aura une gare, des services postaux, une monnaie la lire vaticane, un organe de presse, une radio et une télévision avec le droit d'émettre, etc. L'État du Vatican, dernier reste subsistant des États Pontificaux, devient l'instrument du Saint-Siège, personne de droit international, défini comme l'ensemble des Institutions Supérieures Catholiques Dicastères. Le préambule du pacte dispose ainsi :
" Étant donné que, pour assurer au Saint-Siège l'indépendance absolue et visible, il faut lui garantir une souveraineté indiscutable, même dans le domaine international, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de constituer, avec des modalités particulières, la Cité du Vatican, reconnaissant au Saint-Siège, sur cette même Cité, la pleine propriété, la puissance exclusive et absolue et la juridiction souveraine."
Le pape est reconnu comme le chef d'État temporel du Vatican, avec tous les pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire – le gouvernement effectif du Vatican étant pourtant délégué à un gouverneur général. En cas de vacance, le pouvoir passe au Sacré Collège des cardinaux.
Le nouveau territoire pontifical est formé de 44 hectares, ce qui fait du Vatican l'État le plus petit du monde. Pour l'essentiel, il s'agit de la place Saint-Pierre, de la basilique homonyme, du palais du Vatican et des jardins attenants. L'ensemble est entouré d'une frontière qui fut fixée à l'occasion de ces accords, constituée pour l'essentiel de murs, avec cinq points d'accès. Seule la place Saint-Pierre et la basilique sont librement accessibles. Mussolini avait proposé d'inclure d'autres bâtiments dans le nouvel État, mais Pie XI avait refusé, affirmant :
"Il sera clair pour tous, nous l'espérons, que le Souverain Pontife n'a vraiment que cette portion de territoire matériel indispensable pour l'exercice d'un pouvoir spirituel confié à des hommes pour le bénéfice des hommes."
Convention financière
Après la perte des États Pontificaux, le Saint-Siège se trouvait dans une situation financière difficile. En 1871, la loi des Garanties offrait la somme de 2 milliards de lires à titre de compensation pour la perte des États et des biens ecclésiastiques. Les Garanties ont été refusées par tous les papes, de 1871 aux accords du Latran. À l'occasion de ces derniers, Mussolini propose cette même somme augmentée de ses intérêts, portant le montant total à 4 milliards de lires.
Cette somme n'est pas versée directement au Vatican. Le Saint-Siège reçoit en fait 750 millions de lires en argent comptant et des titres à 5 % d'une valeur nominale d'un milliard de lires, confiés par Pie XI à l'Administration spéciale des biens du Saint-Siège.
Concordat
Le concordat fait du Catholicisme la religion officielle de l'État italien. Les mariages catholiques et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire, un prêtre apostat pouvant ainsi se voir refuser un emploi public. L'enseignement religieux catholique devient obligatoire à tous les niveaux scolaires.
De son côté, l'État italien se voit reconnaître un droit de nomination des évêques, lesquels doivent jurer fidélité au roi. Toute activité politique est interdite à l'Action catholique. Les religieux et les prêtres se voient interdire de militer dans un parti. Le but de Mussolini est d'empêcher la recréation d'un parti catholique hostile au fascisme.
Mussolini ajoutera au concordat des dispositions unilatérales réglant le sort des autres confessions, qui sont désormais reconnues. Un fossé juridique s'installe alors entre le catholicisme et les autres religions.
Après les accords
Quatre jours avant la signature formelle des accords, le 7 février, le contenu de ces derniers est dévoilé à l'ensemble des représentations diplomatiques près le Saint-Siège. Le gouvernement français, alors dirigé par Aristide Briand, est le premier des gouvernements du monde à présenter ses félicitations au pape. Le 9 février, lors d'une audience solennelle spéciale, les différents États concernés prennent acte du nouveau statut du Vatican.
Entente cordiale
Avec ces accords, les buts respectifs des signataires sont : de fasciser l'Église pour l'un, et de restaurer un État catholique et de droit pour l'autre. Tous deux échouent dans leurs objectifs, mais néanmoins les relations restent relativement bonnes entre l'Église et le gouvernement fasciste jusqu'en 1945. Ainsi, en 1931, l'Église concède de nouvelles garanties concernant l'Action catholique, dont on réaffirme le caractère religieux et diocésain.
La seule crise d'envergure concerne encore une fois les organisations catholiques laïques, perçues par le gouvernement fasciste comme une menace. Mussolini, répugnant à attaquer l'Église de face, comme le fait Hitler au même moment, préfère des actions d'intimidation des militants catholiques. En janvier 1938, Pie XI menace en représailles d'excommunier le fascisme, déjà condamné par la Bulle "Non Abbiamo bisogno" et le gouvernement mussolinien. Finalement, en 1939, Mussolini obtient une réforme des statuts de l'Action catholique.
Après la Seconde Guerre mondiale
On aurait pu imaginer la fin des accords du Latran avec l'effondrement du gouvernement fasciste, mais une partie sera confirmée par la nouvelle république italienne qui reconnaît la partie des accords du Latran réglant la question romaine. Toutefois, avec l'accord du Pape Pie XII, l'article 7 de la nouvelle constitution italienne affirmera la séparation de l'Église et de l'État, comme en France en 1905. L'Église n'a donc plus le pouvoir temporel d'appliquer la doctrine chrétienne au sein de la société civile. La République italienne précise que les modifications qui furent apportées aux accords ne nécessitent pas une révision constitutionnelle. Le nouvel État italien reconnaît l'Église catholique et l'État du Vatican mais n'accepte plus les lois catholiques, même si les actes d'état civil religieux, comme le mariage, continuent d'avoir un effet civil en Italie. La péninsule italique ne se trouve plus, pour la première fois depuis l'Empire romain, sous l'autorité spirituelle directe du Saint-Siège.
Le Vatican
Devise nationale aucune
Hymne national Inno e Marcia Pontificale
Administration
Forme de l'État Monarchie absolue, de droit divin et élective
Pape François
Président du gouvernorat Giuseppe Bertello
Langues officielles italien
latin
français
allemand
Capitale Le Vatican
Géographie
Édifice principal Basilique Saint-Pierre
Superficie totale 0,44 km2
(classé 237e)
Superficie en eau Négligeable
Fuseau horaire UTC +1 (été +2)
Histoire
Indépendance
Accords du Latran 11 février 1929
Démographie
Gentilé Vatican, -ane
Population totale (2014) 921 hab.
(classé 197e)
Densité 2 0931 hab./km2
Économie
Monnaie Euro2 (EUR)
Divers
Code ISO 3166-1 VAT, VA
Domaine Internet .va
Indicatif téléphonique +379
modifier
Le Vatican, officiellement l'État de la Cité du Vatican, en italien : Stato della Città del Vaticano est un pays d'Europe. Il s'agit du support territorial du Saint-Siège enclavé dans la ville italienne de Rome. En 2014, il compte 921 habitants sur une superficie totale de 0,44 km2, ce qui en fait le plus petit État au monde ainsi que le moins peuplé.
La colline du Vatican est déjà mentionnée sous la république romaine. De nos jours, le Vatican est la représentation temporelle du Saint-Siège et de l'ensemble des institutions de l'Église catholique romaine : l'État de la Cité du Vatican est, lui, créé le 11 février 1929 aux termes des accords du Latran, signés par l'Italie représentée par Mussolini et par le Saint-Siège représenté par le cardinal Gasparri.
Le Vatican, important site archéologique du monde romain, situé sur la colline du même nom, est le siège de la papauté et du monde catholique. Selon la tradition catholique, il remonte à saint Pierre lui-même, comme premier évêque de Rome et est le centre officiel de tout le christianisme depuis l'empereur Constantin, IVe siècle, mais ce point de vue n'est pas forcément partagé par tous les historiens ni par toutes les confessions chrétiennes.
Le Vatican est un état de type monarchie absolue, de droit divin et élective dirigé par l'Évêque de Rome, c'est-à-dire actuellement le pape François, élu le 13 mars 2013, à la suite de la renonciation de Benoît XVI, le 28 février de la même année. Le Pape y exerce souverainement le triple pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.
Étymologie
Selon les étymologistes anciens comme Festus Grammaticus, cité par Paul Diacre, ce nom de Vaticanus tirerait son origine du mot Vaticinium, ou plus exactement Vātēs ou Vātis signifiant devin ou voyant, parce que beaucoup de devins auraient résidé de ce côté du Tibre, car on sait notamment que sous Tibère, l’art de la divination était interdit à Rome même, c’était un délit passible de la confiscation des biens et de la relégation.
Cette étymologie étant incertaine, d'autres parlent d'une ville étrusque nommée Vaticum, qui aurait jadis existé à cet endroit ou du dieu Vaticanus qui présidait aux premières paroles des enfants et dont le temple était construit sur l'ancien site de "Vaticanum", la colline du Vatican. En effet, cette colline était la maison des Vates longtemps avant l'époque pré-Chrétienne de Rome.
Histoire de l'État du Vatican.
La Cité du Vatican actuelle peut être considérée comme le reliquat des anciens États pontificaux. L'origine ancienne de ce territoire des 'États pontificaux' est une accumulation de donations foncières reçues par les papes successifs, depuis l'époque constantinienne jusqu'à celle du royaume lombard, avec par exemple la donation de Sutri. Le pape s'est ainsi trouvé placé à la tête d'un important domaine foncier connu sous le nom de patrimoine de Saint-Pierre, sous suzeraineté byzantine.
Une justification longtemps avancée pour le pouvoir temporel du pape réside dans la donation de Constantin, un faux par lequel l'empereur Constantin Ier aurait donné au pape Sylvestre la primauté sur les Églises d'Orient et l'imperium, pouvoir impérial sur l'Occident, le caractère apocryphe de ce document a été établi en 1442 par l'humaniste Lorenzo Valla. La justification réelle réside essentiellement dans la Donation de Pépin de 754 confirmée par Charlemagne en 774, donation cette fois bien réelle.
La cité se situe sur ce que l'on appelait dans l'antiquité l'ager Vaticanus qui se compose d'une petite plaine, la plaine vaticane aux bords du Tibre, se relevant à quelque distance en une colline d'une faible élévation, les Montes Vaticani, colline Vaticane.
Quelques villas, bâties autour de jardins impériaux y furent propriété d'Agrippine. Le fils de cette dernière, l’empereur Caligula, 37-41 ap. J.-C., y fit réaliser un cirque privé, le Circus Vaticanus, dont l'actuel obélisque du Vatican constitue un des seuls vestiges. C’est là, ainsi que dans les jardins adjacents, qu’eut lieu le martyre de nombreux chrétiens de Rome à l’époque de Néron 54-68. On dit que Saint Pierre fut enterré au nord de ce cirque, dans une nécropole qui longeait une route secondaire, la via Cornelia. Sur le lieu de sa sépulture, l’empereur Constantin fit édifier entre 326 et 333 une basilique grandiose à l'emplacement du site de l'ancien cirque romain qui fut alors démoli. L'édifice a été remplacé par la basilique actuelle au cours des XVIe et XVIIe siècles.
Situation de la Basilique actuelle par rapport à la basilique constantinienne et au Circus Vaticanus.
Au ve siècle, le pape Symmaque y fit construire une résidence dans laquelle certains personnages illustres vinrent séjourner, tel Charlemagne lors de son couronnement (800). Au xiie siècle, Célestin II, puis Innocent III la firent rénover. La construction du Palais du Vatican débuta sous le pontificat de Nicolas V durant la première moitié du xve siècle.
Le 20 septembre 1870, après l'évacuation des troupes françaises, Rome est conquise par les troupes piémontaises et rattachée au Royaume d'Italie. Le Pape Pie IX qui résidait au palais du Quirinal, devenu depuis, la résidence officielle des rois d'Italie, puis du président de la République italienne, se réfugie alors au Palais du Vatican. Son refus de l'annexion entraîne une dimension politique et diplomatique au conflit causé par l'État italien, c'est le début de la question romaine. Cette controverse dure jusqu'aux accords du Latran en 1929, qui assurent que le gouvernement italien respecte les frontières de l’État qu'il reconnaît alors de facto.
Vatican durant la Seconde Guerre mondiale
Bombardement du Vatican. Politique au Vatican et Saint-Siège.
Le pape dispose du pouvoir absolu, exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir exécutif est délégué à un gouverneur nommé qui est également chargé de la représentation diplomatique. Une commission composée de cinq à sept cardinaux exerce par délégation le pouvoir législatif. Les institutions du Vatican sont réglées par une constitution, dont la première mouture a été rédigée par Pie XI au moment des accords du Latran. Actuellement, le Vatican est régi par la loi fondamentale du 26 novembre 2000, entrée en vigueur le 22 février 2001. Ses lois sont consignées dans les Acta Apostolicæ Sedis.
Le Vatican est une monarchie absolue et élective : le pape est élu à la majorité qualifiée 2/3 des voix lors du conclave, et règne à vie, Ad vitam æternam en principe, mais il peut aussi renoncer, cette possibilité a été exploitée par Benoît XVI en 2013. Il peut également se définir comme une théocratie dans la mesure où son existence, son fonctionnement et son action sont dominés par un impératif religieux.
La citoyenneté vaticane n'est pas l'expression d'une appartenance nationale. Elle est liée à l'exercice de fonctions au sein du Vatican ou du Saint-Siège. Par conséquent, cette citoyenneté vient toujours s'ajouter à une nationalité d'origine. Dès que ces fonctions cessent, la citoyenneté cesse. Ainsi, un prélat de la Curie prenant des fonctions pastorales perd sa citoyenneté. Celle-ci est attribuée également au conjoint et à la famille, ascendants, descendants et collatéraux directs des fonctionnaires du Vatican, à l'âge de 25 ans pour les garçons et au moment de leur mariage pour les filles.
C'est le Saint-Siège, organe de gouvernement de l'Église catholique romaine, et non l'État de la Cité du Vatican, qui fait l'objet d'une représentation internationale. Il dispose d'un siège d'État non membre observateur à l'ONU.
Le Vatican a exprimé le désir de rejoindre l'espace Schengen.
Armée
La plus vieille armée encore en exercice, si l'on peut dire, est celle du Vatican. Elle comptait encore en 1977, quatre-vingt-neuf officiers et hommes de troupes, recrutés depuis 1506, exclusivement dans les cantons suisses. Les troupes pontificales ne sont plus montées au feu des combats depuis leur défaite par les troupes italiennes, survenue en 1870.
Diplomatie Politique étrangère du Vatican.
La diplomatie du Saint-Siège est l'activité de négociation internationale de l'Église catholique. Avant la Réforme et le siècle des Lumières, la papauté a exercé à plusieurs reprises des fonctions d’arbitre entre les souverains chrétiens européens. La diplomatie du Saint-Siège trouva sa première expression formelle véritable vers la fin du XIe siècle quand le pape commença à envoyer des légats vers les différents royaumes de la Chrétienté. Il s’agissait de permettre au clergé résident d’avoir une plus grande marge de manœuvre à l’égard des autorités civiles locales.
À partir du XVIe siècle, les premières nonciatures apparaissent, avec à leur tête un archevêque venant de Rome. Fragilisée par la Réforme et le développement de la philosophie des Lumières, l’autorité du Saint-Siège est contestée, mais celui-ci reste toujours présent sur la scène internationale. La légitimité de la diplomatie pontificale dans la sphère internationale est ensuite entérinée à plusieurs reprises par des traités de référence, le congrès de Vienne en 1815 et la conférence de Vienne de 1961 codifiant le droit diplomatique.
Géographie du Vatican,
Du fait de sa très faible superficie, le Vatican est le plus petit pays du monde. Toutefois l’État du Vatican n’est pas un État souverain au sens strict, puisqu’il n’est pas lui-même sujet de droit international et se fait représenter par le Saint-Siège, dont les compétences s’étendent au-delà du seul État du Vatican aux ambassades, sous l’autorité du pape qui est à la fois le souverain du Saint-Siège et le dirigeant du Vatican. De plus, il n'a pas de nationaux en propre et sa puissance souveraine sur son territoire est, dans certaines circonstances et sur certaines parcelles définies par l'accord du Latran, partagée avec l’État italien, notamment la place Saint-Pierre. De ce fait, selon la Convention de Montevideo, le statut juridique international du Vatican n'est, d'après certains juristes, pas celui d'un État, mais plutôt celui d'un sujet international analogue à une organisation internationale telle que l'ONU.
À ce titre, les ambassades, nonciatures et propriétés du Saint-Siège hors-les-murs ne relèvent pas de l’État du Vatican, mais de la seule autorité du Saint-Siège, manifestée à travers ses institutions, regroupées dans la Curie romaine siégeant au Vatican et son souverain.
La superficie du Vatican représente un cinquième de celle de la Principauté de Monaco : le Vatican peut être qualifié de micro-État. Il est enserré dans des murailles imposées par l'article 5 des Accords du Latran, entièrement enclavé dans la ville de Rome, dans le territoire italien. Cette enclave comprend notamment la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, le Palais apostolique, les Musées du Vatican et des jardins.
Le Saint-Siège a également la pleine propriété sur plusieurs bâtiments situés hors de la Cité vaticane, qui bénéficient d'un statut d'immunité diplomatique, à l'instar d'une ambassade. Il s'agit notamment de :
l'ensemble du Latran : la basilique Saint-Jean de Latran, le palais et ses annexes, ainsi que la Scala Santa ;
la basilique Sainte-Marie-Majeure ;
la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs et son monastère ;
plusieurs palais abritant les services de la Curie romaine : les palais de la Daterie et de la Chancellerie, sièges de la Rote romaine, du Tribunal suprême de la Signature apostolique et de la Pénitencerie apostolique, le palais de la Propagation de la foi, siège de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, etc. ;
le complexe de Castel Gandolfo, résidence d'été du pape, 55 hectares.
En outre, l'Université grégorienne, la station d'émission de Radio Vatican située dans la banlieue de Rome et divers autres bâtiments sont exempts d'impôts et préservés de toute expropriation. Ces bâtiments et propriétés ne font pas partie stricto sensu de l'État de la Cité du Vatican mais leur superficie cumulée représente environ le double de celle du Vatican.
Économie du Vatican.
En 2002, le déficit consolidé du Vatican s'élevait à 13,5 millions d'euros pour 216 millions d'euros de recettes. Les dépenses sont principalement les salaires des 2 600 employés, dont environ 750 ecclésiastiques. En 2010, l'économie vaticane a réalisé un excédent budgétaire de 10 millions d'euros, malgré la baisse des dons des fidèles.
Outre les revenus touristiques tels les revenus des musées du Vatican, 91,3 millions d'euros de recettes en 2011, l'organisation de voyages et pèlerinages, l'émission de timbres postaux et de monnaies recherchés par les collectionneurs et la vente de publications, les revenus viennent de placements mobiliers, 32 millions d'euros de plus-value en 2002 et immobiliers, 12,9 millions d'euros.
Un autre poste financier non négligeable est le denier de Saint-Pierre qui a avoisiné les 50 millions d'euros en 2002, même si une partie de cette somme seulement est affectée au budget du Vatican. Son origine remonte au viiie siècle, quand les Anglo-Saxons commencèrent à envoyer une contribution annuelle au pape. Cet usage s'étendit ensuite aux autres pays d'Europe et a été reconnu officiellement par le pape Pie IX le 5 août 1871 dans l'encyclique Sæpe venerabilis.
Depuis le 1er janvier 2013, la Deutsche Bank, qui gère les paiements monétiques au sein de la Cité vaticane, s'est vue dans l'obligation de désactiver l'utilisation de tous ses terminaux électroniques sur ordre de la Banque d'Italie, car le Saint-Siège n'a pas encore atteint les standards requis au niveau international contre le blanchiment d'argent. Les membres du comité Moneyval, un comité d'experts dépendant du Conseil de l'Europe qui repère notamment les blanchiments des capitaux et les sources occultes de financement du terrorisme estiment en effet que le Vatican remplit à peine 9 des 16 recommandations clés et lui attribuent 7 mentions négatives. Le Vatican a lancé depuis 2010 une série de réformes à la suite d'importants scandales financiers ayant impliqué sa banque, l'Institut pour les œuvres de religion, IOR et qui gère en 2011 plus de 6,3 milliards d'euros répartis en 20 772 comptes, dont 37 des membres de la famille du pape, 236 de cardinaux, 1 604 d'évêques et 128 de monastères, couvents ou abbayes. L’IOR s’est trouvé au cours des années au cœur de nombreux scandales notamment sous le mandat de Mgr Paul Casimir Marcinkus, ex-directeur de la banque du Vatican. L’établissement était le principal actionnaire du Banco Ambrosiano, banque accusée dans les années 1980 de blanchiment d’argent de la drogue pour la mafia. En mai 2012, l’IOR refait parler d’elle avec le limogeage de son président Ettore Gotti Tedeschi24. Les États-Unis ont ajouté en 2012 le Vatican à une liste de 68 États dont la situation est jugée préoccupante, selon le rapport annuel du Département d'État américain sur la lutte contre le trafic de drogue dans le monde.
Le pape François tend à sortir l'économie du Vatican des réseaux mafieux, et a d’ailleurs fait plusieurs déclarations à ce sujet.
Démographie du Vatican.
La quasi-totalité des habitants vivent à l'intérieur des murs de la cité. Ce sont principalement des membres du clergé, incluant les hauts dignitaires, les prêtres, les religieuses. La fameuse Garde suisse pontificale, chargée de la protection du pape, réside également au Vatican. Près de 3 000 travailleurs étrangers composent la majorité de la main-d'œuvre du pays, tout en résidant en dehors du Vatican. Sauf exception, les personnes possédant un passeport de la cité du Vatican conservent leur nationalité d'origine. Faute de maternité, il n'y a aucune naissance au Vatican.
Le Vatican comptait 921 habitants en 2014, ce qui en fait le pays le moins peuplé du monde. En revanche, il en est l'un des plus densément peuplé avec plus de 2 000 habitants par kilomètre-carré, le troisième derrière Monaco et Singapour. En effet, cette population est concentrée sur une superficie de 0,44 km2 seulement.
Langues officielles
Les langues officielles de la Cité du Vatican sont :
l'italien pour l'État de la Cité du Vatican ;
le latin, langue officielle de l'Église catholique romaine et langue juridique du Vatican ;
le français pour la diplomatie du Saint-Siège, le Vatican est enregistré comme État francophone auprès des organisations internationales ;
l'allemand26pour l'armée du Vatican, les gardes suisses ;
Sont également utilisés :
l'italien, pour le dialogue avec le diocèse de Rome ;
le français, l'anglais et l'espagnol pour le dialogue avec les catholiques du monde entier ;
le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol sur son site web
Culture du Vatican.
En tant que siège du catholicisme, le Vatican a une influence culturelle très importante. Il a aussi une activité culturelle propre, comme sa radio, Radio Vatican, qui émet en plusieurs langues.
Les onze musées du Vatican possèdent de riches collections d'art sacré et profane ainsi que des antiquités étrusques et égyptiennes et des œuvres de peintres, dont Michel-Ange. Ils ont été fondés par Clément XIV au XVIII siècle.
Le Vatican a pour codes :
SCV ou CV, pour les plaques minéralogiques ;
VA, selon la norme ISO 3166-1 liste des codes pays, code alpha-2 ;
.va, selon la liste des Internet TLD Top level domain ;
VAT, selon la norme ISO 3166-1 liste des codes pays, code alpha-3 ;
VAT, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
VT, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.
              
Posté le : 05/06/2015 18:09
|
|
|
|
|
Le camp du Drap d'or |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Du 7 au 24 juin 1520 François Ier roi de France et Henry VIII roi d'Angleterre
se rencontrent au camp du Drap d'Or, ce nom est donné à leur rencontre diplomatique qui se déroula dans un lieu situé dans le nord de la France, près de Calais, entre Ardres et Guînes.
Lieu situé entre Guînes et Ardres où se rencontrèrent du 7 au 24 juin 1520 François Ier et le roi d'Angleterre Henri VIII pour discuter les conditions d'une entente.
François Ier, près d'Ardres, et Henri VIII, près de Guînes, avaient fait dresser de somptueux pavillons dont l'un, édifié à la demande du roi de France, était tendu de drap d'or.
Le camp est établi en plaine de Flandre, entre le château d'Ardres, possession française, et celui de Guînes au Calaisis, possession anglaise. Sa finalité est d'accueillir une entrevue entre François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d'Angleterre, organisée par Galiot de Genouillac et Gilles de la Pommeraie.
L'histoire
L' entrevue des deux monarques se déroule dans un camp de toile d'un luxe inouï.
François 1er, dans le désir d'épater son hôte, s'est offert une tente de drap d'or doublé de velours bleu. D'où le surnom de Camp du Drap d'Or qu'a gardé cette rencontre.
Une fanfaronnade de trop
L'année précédente, le roi de France François 1er s'est étourdiment endetté pour se faire élire à la tête du Saint Empire romain germanique. Battu, il en garde rancune au vainqueur, Charles Quint, et veut contre lui nouer une coalition avec l'Anglais Henri VIII. C'est dans cette perspective qu'il organise la rencontre du Camp du Drap d'Or.
François 1er 25 ans et Henri VIII 28 ans sont alors au faîte de leur gloire. L'un et l'autre sont des gentilshommes de la Renaissance, cultivés, charmeurs et sportifs.
Pendant trois semaines, la vie de cour va étaler toutes ses séductions au milieu des tournois et des fêtes. C'est une première dans l'Histoire de l'Europe.
Henri VIII n'aime pas beaucoup François 1er et celui-ci va encore trouver moyen de l'humilier par un excès de fanfaronnade. À l'Anglais, obèse, qui lui propose de lutter, le vainqueur de Marignan ne se le fait pas dire deux fois et, pour plaire à l'assistance féminine, fait chuter Henri sans façon.
Du coup, les diplomates ont le plus grand mal à s'entendre sur un traité et les festivités s'achèvent sur un échec diplomatique... en creusant un peu plus la dette du roi de France. Deux semaines à peine après les embrassades du Camp du Drap d'Or, Henri VIII rencontre Charles Quint dans des conditions autrement plus modestes.
Avec l'empereur 20 ans, qui est le neveu de sa femme Catherine d'Aragon, le roi d'Angleterre signe un traité secret contre le roi de France ! Tout cela s'achèvera par la défaite des armées françaises et la capture du roi de France à Pavie, près de Milan cinq ans plus tard.
L'entrevue du Camp du Drap d'Or est représentée sur les bas-reliefs en pierre de l'hôtel de Bourgtheroulde à Rouen, qui datent du XVIe siècle.
L'élection de Charles Quint comme empereur du Saint Empire romain germanique, le 28 juin 1519, signifie, face à la puissance française, l'alliance, autour du noyau bourguignon puis espagnol, des pays limitrophes. Pour rétablir l'équilibre, compromis par l'afflux des richesses américaines, François Ier est contraint de rechercher des alliés.
L'entrevue du camp du Drap d'or, en Flandre, manifestation spectaculaire d'une diplomatie quelque peu ostentatoire, relève des fastes et des prestiges, sinon des mythes de la Renaissance : prouesses chevaleresques et fêtes baroques accompagnent les négociations politiques qui aboutissent, le 7 juin 1520, entre l'Anglais Wolsey et les représentants français Bonneval et Duprat, à un traité prévoyant le mariage du Dauphin avec Marie Tudor, moyennant l'abandon par la France du soutien à l'Écosse.
Traité mort-né ! On a parfois accusé la prodigalité de François Ier d'être à l'origine du retournement anglais. En fait, la rencontre s'insère entre deux séries de négociations anglo-bourguignonnes.
Avant de voir le roi de France, Henri VIII a déjà vu Charles Quint, de retour d'Espagne, à Calais. Dès le 14 juillet, les négociateurs anglais, dont Wolsey, signent à Calais un accord secret, annulant les clauses du camp du Drap d'or.
Les premières défaites françaises aboutissent à la déclaration de guerre anglaise et à l'invasion du Boulonnais et de la Picardie 1522. On en est donc revenu à la situation d'avant le traité de paix du 2 octobre 1518. Seul le divorce de Henri VIII et l'éloignement de Wolsey du pouvoir — il a été, pratiquement, le véritable chef de la diplomatie anglaise entre 1515 et 1525 — permettront à nouveau un rapprochement franco-anglais.
L'entrevue du camp du Drap d'or sert le prestige des deux puissances ; elle n'est qu'une manifestation éphémère comme les riches tentes, dressées pour la circonstance et vite repliées, qui lui ont donné son nom dans l'histoire. Jean Meyer
Son nom lui fut donné à cause du faste que les deux cours rivales y déployèrent à l'envi. François Ier, dont le but était de gagner le roi d'Angleterre et de déjouer les intrigues de Charles Quint, obtint par un traité la confirmation du mariage du Dauphin de France avec Marie Tudor.
Mais le cardinal Thomas Wolsey, ministre du roi d'Angleterre, acheté par Charles Quint, prévint les effets de cette entrevue, qui fut finalement un échec pour le roi de France. Celui-ci ne parvint pas à l'alliance souhaitée, notamment en raison d'une démonstration de puissance et de richesse trop importante de sa part. On peut ainsi citer l'anecdote d'un combat à main nue amical, qui vit François Ier gagner facilement et Henri VIII frustré, lors de cette entrevue.
Le récit de Martin du Bellay sur la description du camp parle d'un logis de bois où y avoit quatre corps de maison qu'il, le roi d'Angleterre avoit faict charpenter en Angleterre, et amener par mer toute faicte, et estoit couverte de toille peinte en forme de pierre de taille, puis tendue par dedans des plus riches tapisseries qui se peuvent trouver ; et estoit le dessein pris sur la maison des marchands à Calais.
Robert de La Marck, pour sa part, parle de la magnificence de leurs accoustremens puisque leurs serviteurs en avoient en si grande superfluité, qu'on nomma ladite assemblée le camp de Drap d'Or.
Il décrit également un pavillon ayant soixante pieds en quarté le dessus de drap d'or frizé, et le dedans doublé de veloux bleu, tout semé de fleurs de lis de broderie d'or de Chypre, et quatre autres pavillons aux quatre coings, de pareille despense et estoit le cordage de fil d'or de Chypre et de soye bleue turquine, chose fort riche.
    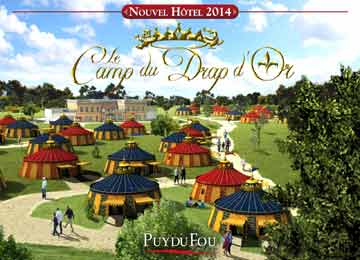         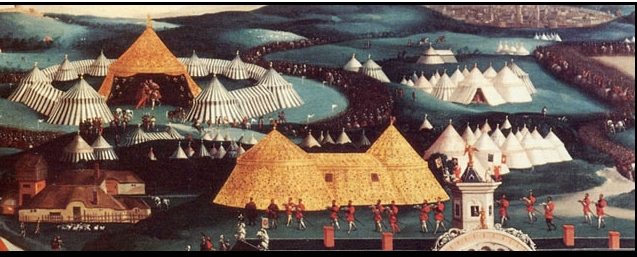
Posté le : 05/06/2015 17:36
Edité par Loriane sur 06-06-2015 16:55:27
Edité par Loriane sur 06-06-2015 16:59:37
|
|
|
|
|
Big Ben |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 31 mai 1859, entre en service Big Ben la célèbre cloche
de la tour horloge de Londres. Big Ben est le surnom de la grande cloche de 13,5 tonnes installée dans la tour horloge appelée Tour Elizabeth, ou anciennement Clock Tower, du Palais de Westminster, qui est le siège du parlement britannique Houses of Parliament, à Londres.
Big Ben est devenu le symbole de Londres tout comme la Tour Eiffel est celui de Paris. Cette tour de style victorien, située aux bords de la tamise et haute de presque 100 mètres abrite depuis plus de 150 ans la plus célèbre horloge du monde.
Big Ben est en fait le nom de la cloche qui fait plus de 7 mètres de diamètre et pèse plus de treize tonnes et demi. A l'origine, elle s'appelait the great bell mais a été affectueusement surnommée Big Ben en mémoire de Benjamin Hall, 1er commissaire aux travaux publics et à la carrure imposante, mais les sources divergent encore quant à l'origine du surnom. La tour elle-même porte le nom de clock tower mais pour le monde entier aujourd'hui, elle est Big Ben. Les cadrans de l'horloge font sept mètres et la cloche sonne toutes les heures. On l'entend jusqu'à six kilomètres de là.
Seules les personnes qui habitent au Royaume-Uni peuvent visiter Big Ben, après avoir obtenu une autorisation.
Le bâtiment fait face à la Tamise, entre le Pont de Westminster Bridge et l'Abbaye de Westminster Westminster Abbey.
Un incendie dévaste une partie du bâtiment du Parlement en 1835. À la suite de cet événement, une commission est mise en place pour choisir le nouveau style du bâtiment. Le plan qui remporte ce grand concours est celui de Charles Barry qui prévoit entre autres d’intégrer un clocher au bâtiment.
La première cloche est fabriquée en 1856. Pour pouvoir la transporter jusqu’à la tour de l’horloge, elle est installée sur un chariot tiré par 16 chevaux. Elle se fend quelques mois après son installation, une deuxième cloche est alors moulée à la fonderie de Whitechapel le 10 avril 1858. En octobre de la même année, la cloche est déplacée de 61 mètres jusqu’au beffroi du clocher en 18 heures. Le 31 mai 1859, la célèbre horloge entre en service.
La fréquence du balancier est réglé à 2 cinquièmes de seconde près par jour, par l'ajout pour accélérer ou le retrait pour ralentir d'anciennes pièces de 1 penny datant de l'époque ou le système monétaire britannique n'était pas décimal.
Le son de la cloche Big Ben est dû au fait que celle-ci s'est fissurée en 1859, à peine deux mois après son installation officielle, ce qui lui donne cette tonalité très distinctive. Pour des raisons techniques, la cloche est orientée de manière que le marteau ne frappe pas à l'endroit de la fissure.
Le célèbre air du carillon qui marque l'heure est appelé Westminster Quarters. La mélodie est constituée de cinq permutations de quatre notes dans la tonalité de mi majeur : si, mi, fa#, sol#, écouter la mélodie marquant six heures
La première émission sur la radio BBC du carillon de Big Ben date du 31 décembre 1923.
La tour de l'horloge est devenue la Tour Elizabeth, en hommage à la reine Élisabeth II, pour son jubilé de diamant.
Les détails sur Big Ben
La hauteur de la tour est de 315 pieds, soit environ 96 mètres.
Pour atteindre le beffroi, les visiteurs doivent franchir 335 marches.
L'horloge est composée de 4 cadrans, un sur chaque face, de 7 mètres de diamètre et d'une cloche pesant 13,5 tonnes pour un diamètre de 2,7 mètres et une hauteur de 2,2 mètres.
Les aiguilles des minutes mesurent 4,2 mètres de long.
Les aiguilles des heures mesurent 2,7 mètres de long.
Les chiffres mesurent environ 60 cm de long.
Il y a 312 morceaux de verre dans chaque cadran de l'horloge.
Le mécanisme de l'horloge pèse 5 tonnes et le marteau pèse 200 kg.
Les aiguilles des minutes et celles des heures sont fabriquées en métaux différents : les premières sont fabriquées en cuivre, et pèsent 101 kg, et les secondes en fer, et pèsent 304 kg8.
À l'inverse de la plupart des cadrans, ceux du Big Ben ont le numéro 4 noté IV et non IIII.
Quand le Parlement siège, un drapeau britannique est hissé et flotte au-dessus de l'horloge.
Quand le Parlement se réunit, la lumière éclairant les cadrans s'allume.
La cloche sonna pour la première fois le 31 mai 1859.
Le son de la cloche porte sur six kilomètres à la ronde.
Elle sonne les heures, les quarts d'heure étant sonnés par d'autres cloches.
Une bombe a détruit la Chambre des Communes au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Origine du nom
Au départ, le nom réel de cette cloche est The Great Bell. L’origine de l’appellation "Big Ben" est incertaine. L’une des théories les plus connues à ce sujet se réfère à celui qui a ordonné la fonte de la cloche, Benjamin Hall, ingénieur civil et politicien, dont le surnom était Ben, et qui était très grand, Big, on l'appelait Big Ben. Une autre théorie renvoie plutôt au surnom d’un champion de boxe Ben Caunt qui aurait acquis la célébrité grâce à un combat de soixante rounds à poings nus contre Nat Langham, champion en titre, l’année où le nom de la cloche était au cœur des débats.
Big Ben aujourd'hui
Si Big Ben se réfère strictement à la cloche, les Anglais utilisent souvent ce terme pour parler de la tour londonienne. Depuis 1859, ce sont les cloches de Big Ben qui, à minuit le 31 décembre, annoncent dans tous les foyers anglais le début de la nouvelle année. Le son est retransmis sur toutes les chaînes de télévision et de radio du pays.
John Burland, professeur et directeur de recherche à l'Imperial College de Londres, a rapporté au Sunday Telegraph que la tour s'enfonçait dans le sol de manière inégale, penchant de plus en plus en direction du nord-ouest, cette tendance s'étant accélérée depuis 2003.
Les carillons de Big Ben et les autres cloches sont diffusés sur BBC Radio 4, une des radios les plus écoutées en Grande-Bretagne, à 6 h du soir et à minuit.
Little Ben
Il existe aussi une petite tour d'horloge à Londres, proche de la gare Victoria, d'un dessin similaire à "Big Ben", elle s'appelle Little Ben. Fabriquée en 1894, placée à proximité d'un lieu de rencontre populaire pour les visiteurs français arrivant à la gare Victoria quand elle était utilisée pour les liaisons trains + bateaux. Déménagée en 1961, "Little Ben" est retournée après remise en état à Victoria en 1981 en partenariat avec la compagnie pétrolière française Elf Aquitaine, mais en 2012 elle a été déménagée de nouveau dans le cadre de travaux d’amélioration de la gare, son retour est prévu en 2016.
Culture populaire Télévision
Big Ben apparaît dans Life After People dans l'épisode 2. Elle s'écroule au bout de 150-200 ans.
Big Ben apparaît à de nombreuses reprises dans la série britannique Doctor Who.
Big Ben apparaît à la fin de Basil, détective privé.
Big Ben apparaît dans V pour Vendetta qui explose avec le reste du parlement à la fin du film.
Galerie
Vue en contre-plongée
Partie supérieure de la tour de l'horloge
La cloche Big Ben
Big Ben le 27 novembre 2011 depuis Birdcage Walk Vue depuis la Tamise
Little Ben, une petite tour
Anecdotes :
•Il faut savoir que le mécanisme de l'horloge est très bien rodé et il est vérifié et réglé chaque année. Si l'horloge prend un peu d'avance, un ancien penny est posé sur le mécanisme pour ralentir l'horloge, à l'inverse si elle retarde, on enlève un penny.
•On entend le tintement de la cloche à plus de 18km à la ronde.
•Big Ben doit son surnom à son créateur qui était un peu enrobé.
Cloche
Une cloche est un instrument à percussion idiophone, c'est-à-dire sonnant par la vibration d'un matériau solide résonant en forme de récipient, généralement en métal – mais parfois en corne, en bois, en verre ou en argile –, qui est frappé près de son bord par un battant interne, ou par un marteau ou une mailloche externes pour produire un son retentissant. La forme des cloches dépend de l'environnement culturel, de l'utilisation voulue et du matériau de construction. Les parois peuvent en être droites, convexes, concaves, hémisphériques, en forme de tonneau, comme en Asie orientale ou de tulipe, avec dans ce cas une ligne de frappe, renflement près du bord, comme toutes les cloches de beffrois en Occident. Vues en coupe, les cloches peuvent être rondes, carrées, rectangulaires, elliptiques ou à multiples facettes. Les bords des cloches chinoises sont souvent en forme de lotus.
Les vibrations des cloches qui produisent les sons les plus forts se situent près du bord (sur la ligne de frappe dans le cas des cloches occidentales, à la différence des gongs creux, dont les vibrations sont les plus fortes au centre. L'acoustique des cloches est fort complexe et n'a été vraiment comprise qu'au XXe siècle. Toutes les cloches émettent une gamme de partiels, ondes sonores de diverses hauteurs, mais le son d'une cloche musicale se compose à la fois de partiels harmoniques et de partiels de fréquence plus élevée non harmoniques. Les cloches occidentales sont toujours sonnées par un battant métallique ; à l'exception des cloches manuelles à battant métallique et des cloches à vent, les cloches asiatiques sont normalement frappées à la main par un maillet en bois ou par un bélier horizontal qui percute leur paroi extérieure ; les cloches asiatiques sont également dépourvues de ligne de frappe et ne se balancent jamais.
Les cloches sont répandues dans le monde entier et possèdent généralement un statut culturel bien défini. Elles sont entourées de légendes, et de multiples croyances leur attribuent des pouvoirs spéciaux : provoquer la pluie ou faire disparaître les nuages d'orage ; contrecarrer les desseins des démons lorsqu'on les porte comme des amulettes ou lorsqu'on les place sur des animaux, des bâtiments ou des véhicules ; invoquer des malédictions et lever des sortilèges. Ce concept d'action purificatrice est ancien, de même que leur utilisation dans des cérémonies rituelles, notamment dans les religions d'Asie de l'Est et du Sud. Les Chinois faisaient sonner les cloches pour communiquer directement avec les esprits et, dans la religion orthodoxe russe, les cloches s'adressent directement à la divinité, d'où les énormes cloches qui ont été fondues par ces deux peuples pour leur prêter une plus grande autorité. Dans le bouddhisme comme dans le christianisme, les cloches sont consacrées avant d'être utilisées à des fins liturgiques ; en Asie orientale, l'affaiblissement du son de la cloche revêt une signification spirituelle. Dans la religion catholique romaine, les cloches symbolisent le paradis et la voix de Dieu.
Les cloches servent à marquer des points importants des rites, à appeler au culte, à sonner les heures, à annoncer des événements, des réjouissances, des deuils, à avertir... Dans les monastères chrétiens et dans leurs homologues bouddhistes, les cloches régulent la journée, d'où les cloches médiévales et chrétiennes tirent leur nom : squilla pour le réfectoire, nola pour le chœur...
Les cloches ont aussi joué un rôle précieux comme symboles patriotiques et trophées de guerre, les envahisseurs réduisant au silence celles des vaincus afin d'éliminer le symbole le plus frappant de leur résistance. La plupart des cultures ont fabriqué des cloches artistiques, tant par leur forme que leur matériau et leur ornementation ; les religions orientales et occidentales ont incorporé des motifs symboliques dans l'ornementation des cloches.
Dans l'Antiquité, les Chinois ont été les premiers à utiliser musicalement des carillons, c'est-à-dire des séries de cloches, appelées bianzhong. En Occident, on trouve fréquemment depuis le IXe siècle de petits jeux de cloches fixées suspendues et généralement accordées diatoniquement. En français, on désigne par carillon toute sorte de jeux de cloches. Mais les Anglais appliquent une autre terminologie : les jeux de cloches accordées d'au moins vingt-trois cloches sont appelés carillons, ceux de deux cloches ou davantage qui se balance librement, peal, et une seule cloche fixe en répétition lente, glas. De nos jours, elles peuvent toutes être actionnées électriquement. Le change-ringing est une pratique anglaise de sonneries de cloches avec plusieurs combinaisons possibles, de cinq à douze cloches sonnées en permutations mathématiques. Le zvon carillon de l'Église russe orthodoxe sonne des schémas rythmiques répétitifs. En Angleterre et aux États-Unis, on trouve depuis le XIXe siècle des jeux de cloches manuelles sonnant jusqu'à cinq octaves, et capables de produire des mélodies et des harmonies simples. Dans l'ensemble, les fonctions liturgiques et utilitaires des cloches ont beaucoup diminué, alors que leur utilisation musicale a augmenté.
Les cloches métalliques forgées et rivetées sont antérieures à celles en métal fondu. La plus ancienne fonte de cloche, c'est-à-dire le moulage de cloches à partir de métal en fusion remonte à l'âge du bronze. Dans la Chine antique, il y avait de merveilleux fondeurs, qui ont atteint le sommet de leur art sous la dynastie des Zhou vers — 1045-256. Les cloches de temple elliptiques avec de remarquables décorations symboliques coulées sur leur surface grâce au procédé à cire perdue étaient caractéristiques.
La facture de cloches européenne a été à l'origine un art monastique. Les premières cloches chrétiennes étaient faites dans des plaques de fer martelées et rivetées elles ressemblaient à des cloches de vaches. Bien qu'on ait pratiqué le moulage du bronze dans l'Europe préchrétienne, celui-ci n'a pas été repris avant le VIIIe siècle.
Dans la fonte de cloches, le métal en fusion, généralement du bronze est versé dans un moule composé d'un noyau interne et d'un moule externe, ou chape, dont les contours correspondent au profil de la cloche. La plupart des moules sont revêtus de glaise, ceux des cloches manuelles de sable. Le métal liquide, chauffé à environ 1 100 0C, entre dans un trou percé au sommet, tout en étant tassé (par une série de coups légers dans un autre. Pour éviter une porosité indésirable, on laisse s'échapper les gaz formés. Le refroidissement est soigneusement contrôlé pour éviter que la surface externe ne refroidisse plus vite que la surface interne, ce qui créerait une tension susceptible d'entraîner par la suite des fêlures. Les grosses cloches ont besoin d'une ou deux semaines pour refroidir. Une fois le moule retiré, on décape et on polit la cloche à la sableuse. Si une certaine hauteur de son est requise, on retire du métal avec un tour en divers endroits de sa face interne. Le bronze des cloches est un alliage de cuivre et d'étain. Le contenu en étain peut aller de 13 à 25 p. 100 du poids, rarement plus. L'étain augmente la fragilité et les grosses cloches en contiennent moins que les petites. La plupart des carillons en contiennent 20 p 100.
Le moulage a amélioré le son des cloches en permettant une plus grande épaisseur des parois et un contrôle plus précis du contour rond de nos jours. Pendant des siècles, les cloches ont eu une paroi convexe d'épaisseur uniforme, forme appelée en ruche d'abeille ou cloche primitive. La paroi a été allongée pour utiliser les cloches dans les beffrois et le bord a été renforcé pour augmenter la résonance et la force. La maîtrise de la hauteur du son remonte au IXe siècle, lorsque des jeux accordés de petites cloches appelés cymbala ont vu le jour.
Dès le XIe siècle, des fondeurs de cloches laïques – souvent itinérants – ont commencé à jouer un rôle actif et ont occupé une place prépondérante à la Renaissance. Les hautes tours de l'architecture gothique ont conduit à fabriquer des cloches beaucoup plus grandes et plus résonantes ce qui a donné naissance à une version archaïque de l'actuelle cloche de campanile : en forme de tulipe dont le sommet est étroit et arrondi ; une panse longue et droite qui s'élargit vers l'extérieur en bas ; et une ligne de frappe évasée. Cette forme s'est imposée au XIIIe siècle. Jusqu'au XVe siècle, lorsqu'une forme analogue à la forme moderne occidentale est apparue, elle s'est lentement transformée, la panse est devenue proportionnellement plus courte et concave, le sommet plus large, le bord supérieur plus carré et la ligne de frappe a épaissi.
Les fonderies de cloches jouissaient d'un prestige considérable et l'apparition de la poudre à canon au XIVe siècle a permis aux fondeurs d'ajouter à leur production la fabrique de canons. Les fondeurs de Belgique et des Pays-Bas surpassaient tous les autres ; leur réputation n'a fait qu'augmenter lorsque le carillon s'est répandu dans ces pays du XVe au XVIIIe siècle, leur art culminant avec lesfrères néerlandais François Hemony, vers 1609-1667 et Pieter Hemony 1619-1680. Cet art a décliné au XIXe siècle, particulièrement en ce qui concerne la précision de l'accord, mais il a retrouvé son excellence au XXe siècle.
La fonderie de cloches russe date du XIIIe siècle et, au XVIe siècle, on fabriquait en Russie des cloches de plusieurs tonnes. La plus grosse cloche du monde, le Tsar Kolokol III, cloche du Tsar III à Moscou, a été fondue en 1733-1735 ; elle pèse environ 180 tonnes ; brisée dans un incendie en 1737, elle n'a jamais sonné. Traditionnellement les fondeurs anglais ne se sont jamais tellement préoccupés de l'accord interne des partiels de leurs cloches, parce que l'usage des cloches – change ringing et carillons – n'impliquait pas d'harmonie. Au XXe siècle, ils ont adopté l'accord des partiels utilisé en Belgique et aux Pays-Bas.
Les grelots, petites cloches sphériques dans lesquelles se déplace une ou plusieurs billes en métal, ont été considérés historiquement comme une sorte de cloche, mais les experts modernes les classent maintenant dans les hochets ; les sonnailles en sont des exemples familiers. Très ancienne, elle participe d'un grand nombre des fonctions rituelles et magiques des cloches.
Histoire de la tour de Londres
Ensemble fortifié situé au cœur de la Cité de Londres. Les bâtiments de la Tour de Londres, mis à part les restes d'une muraille romaine, ont été construits progressivement à partir de 1078 et certains ne datent que du milieu du XIXe siècle. Une tour centrale, la tour Blanche, est la plus ancienne ; elle a constitué à l'époque du Conquérant un donjon fortifié permettant de contrôler à la fois la Tamise et les habitants de la bourgade londonienne ; elle a été plus tard reliée par des murs crénelés à des tours plus petites. Citadelle, palais royal, prison d'État, arsenal, dépôt d'archives et de trésors, la Tour a été et est parfois encore tout cela. Elle fut aussi le lieu d'exécution des sentences criminelles prononcées contre des prisonniers d'État et d'autres gêneurs, tels les infortunés enfants d'Édouard 1483. Un régiment de gardes royaux y tient encore garnison, mais un corps spécial de gardiens, surnommés les beefeaters, et revêtus d'un uniforme pittoresque qui remonterait à la tradition des Tudors, joue le rôle majeur. Ce corps doit en particulier protéger les joyaux de la Couronne, exposés dans la tour de Wakefield. De la fonction carcérale ne subsistent que la dénomination de certaines tours et portes, tour Sanglante, porte des Traîtres, les instruments de torture, les tombeaux de quelques condamnés célèbres, comme Ann Boleyn et Thomas More. La Tour commande le site du premier pont, à présent remplacé par une construction du XIXe siècle, et qui se dresse légèrement en aval du fleuve.
Le palais du Parlement, surmonté par la tour de l'Horloge, est beaucoup moins ancien que l'abbaye : détruit par un incendie en 1834, l'ancien palais royal datait du XIe siècle et abritait les deux chambres durant le XVIe siècle. La reconstruction 1840-1850 a voulu respecter un style disparu ; des dégâts sérieux lui ont été infligés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais sont aujourd'hui réparés. Le palais de Westminster demeure ainsi le siège du plus vieux Parlement du monde et loge, d'une façon quelque peu incommode, plus de six cents députés, les quelques centaines de lords qui viennent siéger ainsi que les services administratifs annexes. Le nom de Westminster symbolise parfaitement l'association du souverain et de son Parlement qui a fondé les libertés anglaises. L'abbaye a pu jouer occasionnellement un rôle politique en accueillant, en 1643-1647, sur l'ordre du Parlement, l'assemblée des théologiens chargés de définir le statut religieux du royaume au temps de la première révolution anglaise. Les grandes mesures qui portent le nom de Westminster, comme les Statuts de 1931 établissant le Commonwealth britannique des Nations, ont été prises par le roi ou le Parlement dans le cadre de leur palais.
             
Posté le : 30/05/2015 18:11
|
|
|
|
|
Pont neuf 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 31 mai 1579, le pont neuf, à Paris est inauguré
en présence de la reine mère Catherine de Médicis et de la reine Louise de Lorraine. C'est un pont en maçonnerie construit de pierres entre 1578 et 1607 pour la construction finale. Il est conçu par Baptiste, Jacques II Androuet du Cerceau, F. des Isles,
G. Marchand, T. Métezeau sont les architectes de ce monument parisien encore en service en 2015.
Le pont Neuf est, malgré son nom, le plus ancien pont existant de Paris. Il traverse la Seine à la pointe ouest de l'île de la Cité.
Construit à la fin du XVIe siècle et terminé au début du XVIIe, il doit son nom à la nouveauté que constituait à l'époque un pont dénué d'habitations et pourvu de trottoirs protégeant les piétons de la boue et des chevaux. Il est aussi le tout premier pont de pierre de Paris à traverser entièrement la Seine. On trouve écrit le pont Neuf mais aussi le Pont-Neuf.
Ce monument fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1889. En 1991, il a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, avec l'ensemble des quais de la Seine à Paris.
Le pont
Le pont Neuf est actuellement le plus ancien pont de Paris. C'est, après le pont aval et le pont amont du périphérique, le troisième plus long pont de Paris 238 m.
Il a gardé le nom qu'on lui a attribué spontanément à l'époque de sa construction. Celle-ci est décidée en 1577, et le 2 novembre de cette année-là, Henri III désigne une commission chargée d'assurer la bonne construction du pont et le suivi des travaux. Il charge Claude Marcel, contrôleur général des Finances, d'assurer la liaison entre lui et la commission.
Le 16 mars 1578, la construction est autorisée par lettres patentes du roi, lequel pose la première pierre de l'ouvrage le 31 mai suivant en présence de la reine mère Catherine de Médicis et de la reine Louise de Lorraine.
Sa construction se poursuivra jusqu'en 1607, sous le règne d'Henri IV. Du fait du soulèvement de la ville contre le roi, le chantier prend du retard et les travaux doivent être suspendus pendant dix ans, de 1588 à 1598 . En 1599, Henri IV ordonne la reprise des travaux et confie leur conduite à Guillaume Marchant et François Petit.
C'est aussi le premier pont de Paris à ne plus être couvert.
On trouve de part et d'autre du pont des repères témoins de la crue de la Seine de 1910. Son niveau moyen est au-dessus du niveau moyen du quartier du Marais.
Au premier trimestre 2007, la Ville de Paris en a achevé la restauration intégrale, avec la dernière arche et ses mascarons, côté rive droite et voie sur berge.
Les aménagements associés
En juillet 1606, alors que la construction du pont s'achève, Henri IV décide de l'aménagement d'une place presque fermée avec des maisons ayant des façades identiques — la place Dauphine — entre le palais de la Cité et le terre-plein situé entre les deux culées du pont.
Place du Pont-Neuf.
Le 23 août 1614, quatre ans après l'assassinat du roi, la statue équestre d'Henri IV commandée à Jean de Bologne par Marie de Médicis pour être placée sur le terre-plein de l'île de la Cité, entre les deux culées du pont, est inaugurée. Elle sera fondue ainsi que les deux bas-reliefs des faces latérales, Œuvres de Pierre Francheville, de Cambrai pour faire des canons en 1792 lors de la Révolution française et dont des fragments du cheval ainsi que les quatre statues, ornant les angles, d'esclaves ou de nations vaincues Œuvres de Pierre Francheville sont conservés au Musée du Louvre. Sous la Restauration, à la suite d'une souscription lancée par Louis XVIII, elle est remplacée par une nouvelle statue équestre d'Henri IV, réalisée d'après le modèle du sculpteur Lemot s'inspirant de l'original du fondeur Pietro Tacca, premier assistant de Jean de Bologne. Cette statue est inaugurée en 1818. Elle a été réalisée avec le bronze de l'effigie de Desaix.
La pointe de l'île a toujours été convoitée par les architectes et les urbanistes. Plusieurs projets sont connus dont le plan de Pierre Patte de 1775, qui recense les emplacements pour installer une statue de Louis XV à Paris. Un premier projet propose d'élever cette statue de Louis XV face à celle d'Henri IV, un autre dû à Patte lui-même suggère le remplacement de la statue d'Henri IV par celle de Louis XV, le socle devenant une grande fontaine. En 1809, Benjamin Zix, inspiré par le retour d'Égypte de Napoléon Ier élabore un projet d'obélisque, et en 2010, dans le cadre de la consultation du Grand Paris, l'architecte Roland Castro n'hésite pas à proposer une tour très contemporaine à la pointe du Vert-Galant.
La Pompe de la Samaritaine
Le 2 janvier 1602, le roi autorise la construction d'une grande pompe à eau au droit de la deuxième arche depuis la rive gauche côté aval : Pompe de la Samaritaine. Cette pompe, la première machine élévatrice d'eau construite dans Paris, fut conçue par le Flamand Jean Lintlaër. Il s'agissait d'un petit immeuble d'habitation sur pilotis (dans lequel vécut, par exemple, Lintlaër lui-même) entre lesquels tournaient deux roues de moulin. Elle était surmontée d'une horloge munie d'un carillon qui rythmait la vie des habitants. Elle alimentait en eau les palais du Louvre et des Tuileries, ainsi que le jardin de ce dernier. Elle devait son nom à une représentation sculptée de la rencontre entre Jésus et la samaritaine au Puits de Jacob relatée dans l'Évangile selon Jean, œuvre de Bernard et René Frémin 1672-1744.
La pompe fut reconstruite par Robert de Cotte entre 1712 et 1719, puis rénovée par Soufflot et Gabriel vers 1771.
Le 26 août 1791, le roi Louis XVI abandonna la fontaine à la municipalité. L'édifice fut dépouillé de sa façade. Les sculptures du Christ et de la Samaritaine furent envoyées à la fonte. L'édifice, devenu un poste de la garde nationale, se délabra. Il fut détruit en 1813. Il n'en reste rien, sauf une des cloches transférée à l'église Saint-Eustache.
Ernest Cognacq aurait installé sa première échoppe dans la corbeille du pont Neuf à l'emplacement même de cette ancienne pompe. Les affaires aidant, l'échoppe laissera vite la place au célèbre grand magasin homonyme construit non loin de là sur la rive droite du fleuve.
Architecture Un pont différent des précédents
Le premier architecte chargé des travaux, Baptiste Androuet du Cerceau, avait décidé que ce pont porterait des maisons, à l'instar des autres ponts de Paris. Il ménagea donc des caves dans les piles et sous les arches. Comme la plupart des ponts construits à l'époque, le pont Neuf se compose d'une série de courtes arches. À la reprise des travaux interrompus dix ans, Henri IV opta pour un pont sans maisons, mais les caves déjà construites restèrent. Un souterrain les reliait. Elles furent par la suite transformées en chambres basses. Elles ont été bouchées au XIXe siècle.
Le pont mesure 238 m. Sa largeur est de 20,50 m, la chaussée mesurant 11,50 m, et les deux trottoirs, 4,50 m chacun. Le grand bras possède sept arches d'ouverture, comprises entre 16,40 m et 19,40 m. Il mesure 154 m. Le petit bras possède quant à lui, cinq arches d'ouverture, comprises entre 9 et 16,70 m. Il mesure 78 m.
Le pont Neuf diffère des autres ponts parisiens à bien des égards. Tout d'abord, il est le premier pont à traverser la Seine dans toute sa largeur, reliant la rive gauche, la rive droite, et l'extrémité occidentale de l'île de la Cité. Il dispose de trottoirs les premiers de Paris et de balcons en demi-cercles au-dessus de chaque pile, où des marchands et artisans tiennent boutique. Une autre nouveauté est l'absence de maisons sur sa bordure. Enfin, pour la première fois, on orne le pont d'une statue équestre en l'honneur d'Henri IV. Le long de ses corniches, sont sculptés 385 mascarons ou masques grotesques que l'on doit à Germain Pilon.
Les Dates du pont neuf
La dernière boutique n'en disparaît que vers 1854.
Classé monument historique depuis 1889.
Empaqueté par Christo en 1985.
Fleuri par le couturier Kenzo en 1994.
Les berges de la Seine du quai Branly jusqu'au pont de Sully sont classées depuis 1991 au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le pont Neuf et les arts Iconographie
Le musée Carnavalet conserve de nombreux tableaux de toutes époques représentant le pont Neuf. Le plus intéressant est une toile anonyme de la seconde moitié du xvie siècle, qui s'inspire du dessin approuvé par Henri III en 1577 et montre une décoration beaucoup plus riche que celle qui fut réalisée en définitive, avec des arcs de triomphe, des obélisques et un pavillon central.
Le pont Neuf vu par les artistes
le Pont-Neuf empaqueté
Sculpture éphémère de Christo et de Jeanne-Claude 1985. Toiles et cordes.
L'empaquetage du Pont-Neuf par Christo et Jeanne-Claude fut un véritable événement parisien, du 22 septembre au 7 octobre 1985. Les artistes réalisaient ainsi un projet esquissé dès 1975 et préparé par une multitude de dessins, dont la vente servit aussi à financer la réalisation matérielle de cette œuvre d'art. Avec 13 000 mètres de cordes et 12 tonnes de chaînes d'acier qui retenaient les 40 000 m2 de toile, ce chef-d'œuvre de virtuosité technique transformait en un monument étrange et mystérieux le plus ancien pont de Paris et ouvrait à la sculpture un espace nouveau.
Le pont Neuf au cinéma
1971 : Quatre nuits d'un rêveur, film de Robert Bresson
1991 : Les Amants du Pont-Neuf, film de Léos Carax
2002 : La Mémoire dans la peau, film de Doug Liman
Le pont Neuf et les architectes
Du xviie siècle au xixe siècle, le Pont-Neuf inspira les architectes qui imaginèrent de nombreux projets pour aménager son terre-plein.
En 1662, l'architecte Nicolas de l'Espine, conçut un projet, à la demande du sieur Dupin, aide des cérémonies de Louis XIV, sous le ministère de Colbert qui était désireux de magnifier les abords de la statue équestre du grand-père de Louis XIV. Il s'agissait d'établir une sorte de forum à l'antique, établi sur le terre-plein qui aurait été agrandi et percé, à l'ouest, d'une loggia surmontée de deux obélisques ; les statues des grands capitaines, qui de règne en règne, ont vaillamment défendu le royaume de France, devaient être érigées sur la balustrade qui aurait entouré la nouvelle place. Un bassin aurait été creusé derrière la statue d'Henri IV ; en son centre, aurait été installé sur un piédestal la statue de Jeanne d'Arc11. Le roi ne donna pas suite à cette proposition.
En 1748, Germain Boffrand proposa de construire la place Louis XV à l'emplacement de la place Dauphine, qu'il aurait rasée et sur laquelle il aurait aménagé une colonne ludovise surmontée de la statue pédestre du roi. Derrière cette nouvelle colonne Trajane, se serait étendue une place semi-circulaire, bordée d'une balustrade, rythmée de colonnes et de pilastres corinthiens, avec en son centre un arc de triomphe dominant le Pont-neuf qui aurait été modifié12.
En 1787, l'architecte Jacques-Pierre Gisors, proposa à Louis XVI un projet qui consistait à célébrer les vertus de Louis XVI sur le terre-plein du Pont-Neuf. À l'emplacement des deux maisons qui marquent l'entrée du Pont-Neuf, un arc de triomphe, décoré d'un grand nombre de colonnes corinthiennes, aurait servi d'arrière-plan à la statue équestre du roi régnant, placée face à celle de son ancêtre12.
En 1804, l'architecte Guy de Gisors exposa un projet de création de thermes qui auraient porté le nom de Napoléon Ier. Il s'agissait d'une épaisse construction à quatre étages d'arcades et à deux ailes en retrour d'équerre au milieu desquelles les eaux d'une fontaine auraient jailli. La bâtisse devait abriter cent soixante-seize cabines de bain. Il était également prévu d'aménager un bassin de plein air destiné aux baigneurs et auquel on aurait accédé par un escalier à double évolution13. L'empereur ne donna pas suite à cette proposition. En revanche, Napoléon Ier lança en 1810 un concours ouvert en vertu d'un décret signé au camp de Schönbrunn : il s'agissait d'élever, sur le terre plein du Pont Neuf, un obélisque en granit de Cherbourg, avec une inscription « L'empereur Napoléon au peuple français » ; l'obélisque devait faire 180 pieds d'élévation14.
Exemples de projets d'aménagement du terre-plein du Pont-Neuf
Les sections « Anecdotes », « Autres détails », « Le saviez-vous ? », « Citations », etc., peuvent être inopportunes dans les articles.
Pour améliorer cet article il convient, si ces faits présentent un intérêt encyclopédique et sont correctement sourcés, de les intégrer dans d’autres sections.
Dans les siècles passés, on entendait beaucoup chanter sur le Pont-Neuf, ce qui avait donné l'expression aujourd'hui oubliée « un Pont-Neuf » pour désigner un air très connu sur lequel on pouvait mettre d'autres chansons15.
Le 1er janvier 2002, le pont Neuf a été choisi pour symboliser le passage à la nouvelle monnaie européenne lors de la cérémonie du passage à l'euro. Le ministre de l'économie de l'époque, Laurent Fabius l'aurait choisi pour sa solidité et ses 12 arches qui symbolisaient les 12 pays de la zone Euro en 200216.
les Amants du Pont-Neuf Le film
Drame de Léos Carax, avec Juliette Binoche Michèle, Denis Lavant Alex, Klaus Michael Grüber Hans, Crichan Larson Julien)
Scénario : Léos Carax
Photographie : Jean-Yves Escoffier
Effets spéciaux : Jack Dubus
Décor : Cindy Carr
Musique : George Fenton
Montage : Nelly Quettier
Pays : France
Date de sortie : 1991
Son : couleurs
Durée : 2 h 05
Résumé
Le Pont-Neuf, dont la sagesse populaire fait un symbole de solidité, est malade. Interdit à la circulation pour cause de réhabilitation, il est envahi par une population de clochards. L'un d'eux, Alex, jeune, candide, recueille une nouvelle venue, en dépit de l'interdiction que lui en fait son ami Hans qui règne sur le lieu. Cette fille a un passé complexe et douloureux. Elle a aussi un futur angoissant : sa vue baisse inexorablement. Mais le destin est quelquefois clément et complaisant.
Commentaire
Ce film était mythique avant même que d'exister. Son jeune réalisateur, glorifié par la critique comme un nouveau génie, a voulu aller jusqu'au bout d'une entreprise extrêmement coûteuse et par là même dangereuse. Les aléas de la production l'ont amené à reconstituer le Pont-Neuf en province. Tous ces remous n'empêchent pas le film d'être à la fois fascinant et émouvant dans son lyrisme exacerbé et son optimisme surprenant. Quelques excès de zèle l'alourdissent par moments, mais ne compromettent pas son intérêt.
L'histoire de la construction des ponts
L'histoire de la construction des ponts est avant tout celle des matériaux qui les constituent. Les ouvrages primitifs étaient réalisés avec des matériaux naturels tels que le bois, les lianes et la pierre. Avec des lianes, on a construit des passerelles suspendues ; avec la pierre, des ponts en poutre – une simple dalle de pierre jetée entre deux appuis – et des arcs ; avec le bois, des ponts en poutre – une série de troncs d'arbres entre deux appuis – et des treillis de plus en plus complexes, travaillant en poutre ou en arc. Des passerelles de l'Himalaya constituent même des exemples de construction par encorbellements successifs, avec des troncs d'arbre encastrés dans une culée de pierres sèches et s'avançant de plus en plus au-dessus de la brèche ; et des exemples de pont-ruban tendus entre deux rives.
Ponts en bois
Le bois a été le matériau le plus utilisé dans l'Antiquité et jusqu'au XVIIe siècle, même si nous n'en avons gardé que de rares témoignages tels que le pont de la Chapelle à Lucerne, le plus célèbre, et celui de l'Accademia à Venise. Toutefois, les historiens ont laissé la description d'ouvrages très importants : Hérodote parle de ponts sur le Nil et l'Euphrate vingt siècles avant Jésus-Christ ; Darius aurait franchi le Bosphore et Xerxès les Dardanelles sur des ponts de bateaux ; César a réalisé en huit jours un ouvrage sur le Rhin pour aller écraser les Germains en 55 avant J.-C. ; et Trajan fit construire un pont de 1 100 m sur le Danube, en 105 après J.-C., dont le dessin nous est laissé par la colonne Trajane. Le bois a encore été largement utilisé au XIXe siècle en Amérique du Nord pour les grands viaducs ferroviaires.
Ponts en pierre
La pierre et la maçonnerie ont été utilisées pour des ouvrages importants et durables, depuis la haute Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle et même jusqu'à tout récemment en Chine, pendant la révolution culturelle. L'origine des arcs en pierre remonterait aux Sumériens, mais ce sont les Étrusques et surtout les Romains qui ont développé leur construction, acquérant une compétence technique (traité de Vitruvius Pollio) qui ne sera retrouvée qu'au XVIe siècle en Italie. Les arcs primaires des ponts en grand appareil du haut Empire sont bâtis par anneaux de pierres successifs, les uns à côté des autres, pour limiter la taille des cintres ; les ponts du bas Empire sont réalisés en maçonnerie, grâce à la découverte des ciments naturels ; l'arc primaire est alors construit par rouleaux successifs. L'ouvrage est complété par les tympans qui maintiennent les matériaux de remplissage portant la chaussée. Les voûtes romaines sont en plein cintre et les portées peuvent atteindre 30 m.
L'art romain.
Le Moyen Âge n'apportera aucun progrès sensible pont Bénezet à Avignon, en 1187 ; celui de Céret, en 1339, avec une forme un peu différente des voûtes en arc brisé pont Valentré à Cahors, en 1308, celui d'Entraygues, en 1269, probablement sous l'influence des constructions orientales qui atteindront leur apogée dans l'empire turc pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine par Hayruddin. Il faudra attendre la Renaissance italienne pour que les voûtes soient surbaissées et les piles affinées. Le pont de la Trinité à Florence, en 1570, et celui du Rialto à Venise, en 1590, en sont des bons exemples. En France, la technique fit des progrès considérables au XVIIIe siècle grâce à la création du Corps des ponts et chaussées, en 1716, de l'École des ponts et chaussées, en 1747, et aux ouvrages de Jean-Rodolphe Perronet, son premier directeur pont Georges V à Orléans en 1761 et celui de la Concorde en 1791. La construction des lignes de chemin de fer, au cours du XIXe siècle, fut l'occasion de concevoir, surtout en France et en Grande-Bretagne, de grands viaducs ferroviaires en maçonnerie dont les aqueducs des XVIIe et XVIIIe siècles avaient constitué une remarquable préfiguration. La maçonnerie se découpe, des voûtes d'élégissement diminuent la masse de la construction, particulièrement au-dessus des piles. Paul Séjourné, célèbre par les six tomes de ses Grandes Voûtes et considéré comme le plus brillant des ingénieurs français de cette époque, a réalisé le pont Adolphe à Luxembourg sur la vallée de la Pétruse, en 1903, avec pour la première fois une dalle de roulement en béton armé, et le viaduc de Fontpédrouze, en 1911.
Ponts métalliques
La construction métallique est ancienne puisque, dès le sixième siècle de notre ère, des moines bouddhistes ont bâti au Tibet des ponts suspendus dans lesquels des chaînes de fer ont remplacé les lianes. En Chine – où l'on avait déjà édifié de remarquables voûtes en maçonnerie –, un pont suspendu, qui existe encore, a été bâti dès 1706 avec une portée de 100 m. En Occident, le développement de la construction métallique date des débuts de l'ère industrielle, à la fin du XVIIIe siècle : un maître de forge, Abraham Darby III, construit le Coalbrookdale Bridge sur la Severn en 1779. L'ouvrage est constitué de cinq arcs parallèles en fonte. Le pont de Sunderland en Grande-Bretagne en 1796, avec une portée de 72 m, et la passerelle des Arts, réalisée par Cessart en 1803, marquent les débuts des ponts métalliques. Tous ceux qui ont été construits en fonte, jusque vers 1850, se sont effondrés, comme le pont Saint-Louis à Paris en 1939, ou ont été démolis, car ce matériau résistait mal à la traction et aux chocs.
Mais, avec le développement de la sidérurgie, le fer remplace la fonte : le fer battu d'abord, appelé fer puddlé, puis le fer directement issu de l'affinage de la fonte. Parmi les ponts les plus célèbres, celui de Britannia construit en 1850 par Robert Stephenson, avec deux portées de 140 m, est une structure tubulaire en caisson rectangulaire à âmes pleines. On peut aussi citer les constructions de Gustave Eiffel comme le pont Maria Pia à Porto, qui est un arc de 160 m d'ouverture, en 1878, le viaduc routier de Saint-André-de-Cubzac, en 1882, et le viaduc ferroviaire sur la Sioule.
Après l'invention du convertisseur Bessemer en 1856, puis des procédés Siemens-Martin en 1867, l'acier remplace le fer. Grâce à des caractéristiques mécaniques qui ne cessent de s'améliorer, comme la limite d'élasticité de l'acier qui passe de 100 ou 150 MPa, à cette époque, à 240 MPa, puis à 360 MPa après la Seconde Guerre mondiale et à 600 MPa au moins aujourd'hui pour certains ponts japonais, les structures sont progressivement allégées. Le premier pont en acier est celui de Saint Louis sur le Mississippi, édifié par Eads en 1874. C'est le début d'une évolution extraordinaire marquée par la réalisation du célèbre pont du Firth of Forth par Fowler et Baker en 1890 qui est, à l'époque, le plus grand pont du monde avec deux travées de 521 m.
Parallèlement à l'amélioration de la limite d'élasticité de l'acier, l'évolution de la construction métallique a été marquée par celle des modes d'assemblage et celle de la couverture des ponts. Dans les premiers ouvrages en fer et en acier, les différentes pièces étaient assemblées par rivetage au moyen de plaques couvre-joint. En dehors du supplément de poids qu'elle engendre, cette technique est chère en main-d'œuvre. Elle est aujourd'hui abandonnée au profit du soudage. Toutefois, les premières soudures se sont avérées très fragiles par temps froid : ainsi le pont de Hasselt sur le canal Albert, en Belgique, s'est effondré en 1938 sans que la moindre charge ait été placée sur l'ouvrage ; de nombreux Liberty Ships ont subi le même sort pendant la guerre ; et, au Canada, le pont Duplessis s'est écroulé en 1951, par — 35 0C. Il a donc fallu mettre au point des nuances d'acier spéciales aptes au soudage (acier A 52 Sγ Nb en France, maintenant appelé acier E355), et des conditions de soudage qui ne provoquent pas leur fragilisation. On a ensuite utilisé des boulons, puis des boulons à haute résistance dont le principe est de serrer les pièces l'une contre l'autre, par l'intermédiaire de plaques couvre-joint. La résistance de l'assemblage est obtenue par frottement des plaques l'une contre l'autre, grâce à l'effort de serrage contrôlé produit par les boulons. Cette procédure est quelquefois utilisée pour assembler sur chantier de grands éléments de charpente en acier soudé pont Masséna et ponts métalliques de l'échangeur de Bercy, au-dessus des voies ferrées Paris-Lyon, sur le boulevard périphérique de Paris. Mais les progrès considérables qui ont été faits dans le domaine du soudage ont fortement limité l'intérêt de cette solution. Aujourd'hui, les procédures de traçage, de découpage, de soudage et de manutention des pièces en usine sont automatisées et dirigées par ordinateur ; il s'agit de la F.A.O. fabrication assistée par ordinateur qui est associée à la C.A.O. conception assistée par ordinateur pour permettre une fabrication automatique en usine, avec des interventions humaines extrêmement réduites, à partir d'ordres découlant directement des consignes du concepteur, qui les génère sur la console de son ordinateur.
Dans les premiers ponts métalliques, la couverture – c'est-à-dire l'élément qui recouvre l'ossature métallique porteuse et qui soutient ou constitue la chaussée – était soit en bois, notamment dans les ponts suspendus, soit en tôles embouties, soit en maçonnerie. Il s'agissait alors de voûtelettes de briques appuyées sur des pièces de pont ou sur des longerons, comme dans les viaducs aériens du métro de Paris. Au début du XXe siècle, ces couvertures ont été remplacées par des dalles en béton armé, posées sur l'ossature métallique et destinées à lui transmettre les charges. Depuis plusieurs décennies, on lie cette dalle de couverture en béton armé à la charpente métallique par des connecteurs, pour qu'elle participe à la résistance de l'ouvrage en flexion longitudinale, au moins dans les zones de moment positif où la dalle est comprimée. Cela permet de diminuer la taille des membrures supérieures des poutres en acier. Les connecteurs peuvent être de plusieurs types : goujons Nelson soudés au pistolet électrique sur les semelles supérieures des poutres, cornières, arceaux... Pour les ouvrages de très grande portée poutres de grande portée, ponts suspendus et à haubans, le souci de la légèreté a conduit à concevoir des dalles purement métalliques, constituées par une tôle raidie dans les deux directions, d'où leur nom de dalle orthotrope, contraction de orthogonal-anisotrope. Longitudinalement, la tôle est renforcée par des raidisseurs ouverts plats, plats à bulbe, cornières, profils en Té... ou fermés de diverses formes, dont la plus courante en France est celle des augets en U. Ces raidisseurs longitudinaux s'appuient sur des entretoises qui assurent le raidissage transversal, et qui sont espacées de quelques mètres, généralement 4 m en France. C'est le cas du pont de Chaumont sur la Loire, du pont de l'Alma à Paris et de celui de Cornouaille à Bénodet en 1973. Une solution intermédiaire est la dalle Robinson, peu employée aujourd'hui, constituée d'une tôle métallique sur laquelle est coulée une mince dalle de béton de 8 à 10 cm d'épaisseur, à laquelle elle est fortement connectée. Cette dalle doit être portée par des poutres longitudinales modérément espacées, ou par des pièces de pont pont de Tancarville sur la Seine, pont d'Aquitaine à Bordeaux.
Les ponts suspendus
Sans oublier les ouvrages suspendus chinois, la première réalisation occidentale est un modeste pont de 21 m de portée, bâti par l'Américain James Findlay ; les câbles étaient des chaînes de fer forgé. L'invention par l'Anglais Brown, en 1817, des chaînes formées de barres articulées, appelées barres à œillets, a permis des progrès substantiels : le pont de Berwick a une portée de 137 m dès 1820, mais il est détruit six mois plus tard par le vent ; Thomas Telford construit, en 1826, le pont sur le détroit de Menai, dont la portée atteint 177 m ; il restera en service jusqu'en 1940. Les frères Seguin inventent les câbles formés de fils de fer parallèles de petit diamètre 3 mm, d'une résistance nettement supérieure aux chaînes à barres, et bâtissent le pont de Tournon sur le Rhône, en 1825, avec deux travées de 85 m ; il sera suivi d'une centaine d'autres ouvrages suspendus dans la région Rhône-Alpes. Le pont de Fribourg, édifié en 1834 par J. Chaley, a une portée de 273 m. Le record est battu en 1883 par J. Roebling avec des câbles formés de fils d'acier parallèles : la portée du pont de Brooklyn, à New York, atteint 486 m. Les câbles sont désormais en acier à très haute limite élastique. Le Français F. Arnodin invente le câble à torsion alterné obtenu en enroulant plusieurs couches de fils autour d'un premier fil rectiligne, les hélices étant alternativement dans un sens et dans l'autre. La portée du George Washington Bridge, construit par O. H. Amman sur l'Hudson à New York en 1931, dépasse pour la première fois les 1 000 m. C'est le premier grand pont suspendu moderne, mais il est moins connu que le Golden Gate Bridge, édifié par J. Strauss en 1937 à San Francisco, qui lui ravit le record avec 1 281 m. Amman le reprendra en 1964 en bâtissant le Verrazzano Narrows Bridge, à l'entrée du port de New York 1 298 m.
De nombreux ponts suspendus se sont écroulés : celui de Berwick en 1820, et celui de la Roche-Bernard en 1840, quatre ans après son achèvement, tous les deux sous l'effet du vent. Dans ces premiers ouvrages, en effet, les pièces de pont transversales, attachées aux suspentes, n'étaient souvent reliées que par un simple platelage dans le sens longitudinal, incapable de résister aux moments de flexion transversale produits par le vent. La légèreté de ce platelage conduisait à de grandes déformations au passage des charges : le pont ferroviaire sur la Tees a dû être mis hors service pour cette raison quelques années après sa construction, vers 1830. Cette grande flexibilité avait d'autres conséquences tout aussi graves : en 1831, le pont de Broughton s'est effondré au passage d'une troupe marchant au pas cadencé, qui avait produit des vibrations forcées ; l'ouvrage de la Basse-Chaîne, à Angers, s'est écroulé en 1850 dans des circonstances semblables, bien que d'autres explications aient été avancées. À partir de 1840, les ingénieurs ont cherché à augmenter la rigidité des tabliers pour éviter ces accidents, mais ce n'est qu'à la fin du siècle, sous l'influence d'ingénieurs comme Roebling et Arnodin, que sont apparues les véritables poutres de rigidité.
L'effondrement du pont de Tacoma Narrows, le 7 novembre 1940, quatre mois après sa construction, mit en évidence des phénomènes aérodynamiques insoupçonnés jusqu'alors. Un vent de vitesse modérée de l'ordre de 18 mètres par seconde a pu produire des oscillations de flexion qui ont été entretenues et amplifiées par couplage avec la torsion de l'ouvrage, dont la période propre était très voisine. Les études aéroélastiques et de réponse aux effets du vent turbulent sont donc essentielles aujourd'hui pour les ponts de très grande portée, et conditionnent largement la conception.
Mais, actuellement, les ponts suspendus ont perdu une grande partie de leur domaine d'emploi au profit des ouvrages à haubans, dont certains ont déjà été bâtis dès le début du XIXe siècle. Mais comme leurs tabliers étaient aussi insuffisants que ceux des ponts suspendus de l'époque, et qu'ils ne bénéficiaient pas de la rigidité apportée par les grands câbles porteurs, ils se sont très vite effondrés : les ponts sur la Tweed, en 1818, et sur la Saale, en 1825. Ce qui jeta un large discrédit sur ce type de structure. À la fin du siècle, des haubans furent ajoutés sur certains ponts suspendus pour faciliter la construction et rigidifier en flexion longitudinale les zones proches des pylônes : le pont de Brooklyn et celui du Bonhomme sur le Blavet en comptent un certain nombre. En France, Gisclard développa un système extrêmement proche du haubanage direct (pont de la Cassagne sur la ligne de chemin de fer de Montlouis en 1909 qui fut repris pour la construction du pont de Lézardrieux sur le Trieux en 1924. Le système fut apuré dans deux ouvrages révolutionnaires en béton : l'aqueduc de Tampul édifié par Eduardo Torroja en Espagne, et le pont sur le canal de Donzère-Mondragon bâti par Albert Caquot en 1952. Ce sont les ingénieurs allemands qui ont largement développé ce système de construction à partir de 1955, et l'ont amené à un haut degré de perfectionnement sous l'influence de Helmut Homberg et surtout de Fritz Leonhardt : le pont de Strömsund, en Suède, a été construit en 1955, ceux de Düsseldorf à partir de 1957, celui de Severin à Cologne en 1959, de Hambourg Norderelbe en 1963, de Leverküssen en 1965.
L'invention du béton
Un autre grand chapitre de la construction s'est ouvert au XIXe siècle avec l'invention du béton, du béton armé et, plus tard, du béton précontraint. Les Romains utilisaient déjà des liants hydrauliques tels que les mortiers de chaux, et même de chaux hydraulique, mais la technique fut perdue avec les grandes invasions, et les constructeurs n'ont plus utilisé que la chaux grasse ou la chaux maigre pour jointoyer des ponts en maçonnerie. Chaptal en France et Parkes en Angleterre redécouvrirent les ciments naturels à la fin du XVIIIe siècle pouzzolanes, roches argilo-calcaires de l'île de Sheppy, puis Vicat inventa le ciment artificiel en 1818. Mais c'est un ingénieur anglais, Apsidin, qui déposa en 1824 les brevets du ciment Portland artificiel. Bien que l'on connaisse depuis la haute Antiquité des antécédents d'armatures primitives pour renforcer des constructions en maçonnerie, le béton armé n'a été inventé que vers 1850 par Lambot, qui a fabriqué une barque en ciment armé d'un quadrillage de barres de fer et qui a déposé le brevet en 1855. En 1852, François Coignet enrobe des profilés de fer dans du béton pour construire une terrasse à Saint-Denis. Mais c'est un troisième Français, jardinier à Versailles, Joseph Monier, qui a fait du béton armé un véritable matériau de construction : il a commencé par fabriquer et breveter des caisses à fleurs en ciment armé de fers ronds 1867, puis a déposé des brevets pour des tuyaux, des ponts, des passerelles (1873) et des poutres (1878). Le Français François Hennebique construit les premiers grands ouvrages : les premières dalles en béton armé en 1880, le premier grand pont en béton armé à Châtellerault en 1899 (pont à trois arches de 40, 50 et 40 m de portée), et le célèbre pont en arc du Resorgimento à Rome, sur le Tibre, qui dépasse en 1911 les plus grandes voûtes en maçonnerie avec une portée de 100 m. Si des inventeurs géniaux ont pu construire très vite en béton armé, le fonctionnement de ce matériau n'a été compris et modélisé que peu à peu par des ingénieurs allemands (Koenen, Mörsch), suisse (Ritter) et français (Considère, Mesnager, Harel de La Noe et Rabut : le béton est fissuré dans les zones tendues de l'ouvrage où seules résistent les armatures passives, liées au béton par adhérence.
L'utilisation du béton armé s'est largement développée à partir du début du XXe siècle pour la construction de dalles de couverture, de ponts en dalle, de ponts à poutres sous chaussée à âmes pleines, ou à poutres en treillis sous chaussée comme le pont sur le Loukos au Maroc, ou à poutres latérales en treillis comme celui de la rue La Fayette à Paris sur les voies de la gare de l'Est, réalisé par Albert Caquot en 1928, ou de ponts en bow-string qui en constituent une forme particulière (ainsi le pont de l'oued Mélègue en Tunisie, construit par Henri Lossier en 1927, celui de la Coudette achevé par Nicolas Esquillan en 1943 avec des suspentes triangulées). Tous ces ouvrages en treillis ont été bâtis à l'imitation des ponts métalliques. Mais le béton armé est mal adapté à ce type de structures où de nombreuses pièces sont en tension : la passerelle d'Ivry, sur la Seine, en est une caricature extrême. Le domaine d'emploi privilégié du béton armé a été la construction des ponts en arc, pour lesquels le béton qui résiste bien à la compression est particulièrement adapté. Les arcs sont de plus en plus surbaissés : en 1911, Eugène Freyssinet construit le pont du Veurdre sur l'Allier avec trois arches de 68, 72,5 et 68 m de portée, élancées au quinzième, avec des articulations aux clefs. Freyssinet découvre alors le fluage du béton : la mise en compression de l'arc par enlèvement de l'échafaudage produit un raccourcissement élastique parfaitement classique, qui se poursuit dans le temps jusqu'à devenir deux ou trois fois supérieur ; le béton flue sous la charge, et les effets du retrait hydraulique s'y ajoutent. Pour compenser ces déformations inattendues, Freyssinet dispose des vérins de décintrement aux clefs. Les records se succèdent alors : pont de la Caille sur le ravin des Usses, 137,50 m (Caquot, 1928) ; celui de Plougastel sur l'Elorn avec trois arches de 172 m d'ouverture Freyssinet, 1930 ; celui du río Esla en Espagne, 192,4 m 1942 ; celui de Sandö en Suède, qui constitue un bond en avant considérable avec une ouverture de 264 m 1943 ; celui d'Arrabida à Porto, 270 m (1963 ; celui qui franchit le río Paranà entre le Brésil et le Paraguay, 290 m 1964 ; et l'ouvrage de Gladesville à Sydney, 304,8 m 1964.
Inventé par Eugène Freyssinet qui en dépose les brevets en 1928, le béton précontraint commence à supplanter le béton armé au milieu des années cinquante. Son principe consiste à comprimer le béton de la structure par des câbles fortement tendus ; on utilise aujourd'hui des fils et des torons de précontrainte dont la résistance à la traction est voisine de 1 800 MPa et qui sont tendus à plus de 1 400 MPa. Aux débuts de la précontrainte, Freyssinet tendait des fils de 5 mm de diamètre à 800 MPa ; une aussi forte tension initiale était indispensable pour que la précontrainte ne disparaisse pas avec le fluage et le retrait du béton, et avec la relaxation de l'acier. Si les efforts de précontrainte sont suffisants et bien placés, la totalité des sections de béton reste comprimée ; le béton ne subit plus de fissuration et l'ouvrage devient capable de supporter des charges qui, si elles étaient appliquées seules, produiraient des efforts de traction. Pour que les câbles puissent être tendus, ils sont placés dans des gaines noyées dans le béton, qui sont injectées au coulis de ciment après la mise en tension des câbles et leur ancrage à leurs extrémités ; cette injection permet de reconstituer l'adhérence et d'assurer une protection contre la corrosion. Grâce à un tracé judicieux des câbles de précontrainte, il devient possible de bâtir les structures les plus audacieuses, et surtout de développer des méthodes de construction que ne permettait pas le béton armé. Les premières réalisations de Freyssinet datent de l'avant-guerre : le renforcement de la gare maritime du Havre en 1934, les conduites pour les travaux d'Oued Fodda en Algérie en 1936. En Allemagne, quelques constructions méritent d'être signalées : le pont sur la gare d'Aue avec des barres de précontrainte extérieures au béton (Franz Dischinger, 1936 – mais il ne s'agit pas encore d'une véritable précontrainte, à cause de la faible limite d'élasticité des barres utilisées : les pertes par fluage et retrait du béton sont trop importantes, et il a fallu retendre les barres du pont d'Aue en 1962 et en 1983 avant qu'il ne s'écroule lors d'une nouvelle opération mal conduite – ; le pont-route d'Oelde en Westphalie, avec des barres de précontrainte prétendues avant coulage du béton Wayss und Freitag, 1938 ; et l'ouvrage de Rheda-Wiedenbrück, également avec des barres de précontrainte extérieures Finsterwalder, 1938.
Le véritable essor du béton précontraint date de l'après-guerre, avec le pont de Luzancy sur la Marne, commencé en 1941 et achevé en 1946, et avec la série des cinq autres ponts de Freyssinet sur la Marne entre 1947 et 1950 Esbly, Annet, Trilbardou, Changis et Ussy ; il s'agit d'ouvrages à une travée à petites béquilles obliques articulées dont la portée atteint 55 m à Luzancy et 74 m pour les cinq autres. Les ponts à travées isostatiques constitués de poutres préfabriquées et précontraintes sous chaussée se multiplient à partir de la fin de la guerre : pont de Bourg d'Oisans, 42 m en 1946 ; travées d'accès au pont de Tancarville, 50 m en 1959 ; pont du lac Ponchartrain aux États-Unis, long de 38 km et constitué de 2 232 travées de 17 m, en 1956. En Allemagne, Ulrich Finsterwalder développe la construction par encorbellements successifs à partir de 1950 ponts de Balduinstein et de Neckarrens en 1950, de Worms en 1952 et de Coblence en 1953 : chaque fléau est construit symétriquement à partir de sa pile, par voussoirs successifs coulés dans des équipages mobiles ; lorsque le béton est durci, on tend des câbles de précontrainte, dits de fléau, d'une extrémité à l'autre du fléau pour solidariser les deux nouveaux voussoirs et assurer la résistance sous l'effet du poids propre ; puis on lance vers l'avant l'équipage mobile pour recommencer l'opération. Cette technique, introduite en France par Jean Courbon, a été utilisée pour le pont de Chazey, en 1957, et ceux de Beaucaire et de Savine. Dans ces premiers ouvrages, les fléaux étaient encastrés sur leurs piles et les travées articulées aux clefs ; mais le manque de maîtrise des efforts de précontrainte dans ces premières constructions et les effets du retrait et surtout du fluage du béton ont provoqué des déformations importantes : l'abaissement de la clef a atteint plusieurs dizaines de centimètres au pont de Bendorf sur le Rhin (par Finsterwalder en 1964, avec une travée centrale de 208 m), et il a fallu démolir certains de ces ouvrages d'avant-garde. La technique a été améliorée en France par la constitution de poutres continues, et surtout par le développement par Campenon Bernard des voussoirs préfabriqués conjugués-collés. Les tronçons de ponts en caisson – les voussoirs – sont préfabriqués sur banc et plus tard dans une cellule de préfabrication, ce qui donne de meilleurs résultats, dans la position qu'ils auront dans l'ouvrage, et en moulant le nouveau voussoir contre le précédent pour en reproduire exactement les formes. Ils sont ensuite posés avec un film de colle dans les joints entre voussoirs et des « clefs d'emboîtement » pour permettre le transfert des efforts ; la résistance est alors assurée par les câbles de précontrainte (pont de Choisy-le-Roi en 1965 ; pont d'Oléron en 1966).
Les plus grands ponts qui ont été construits par encorbellements successifs sont ceux de la baie Urado 230 m et de Hamana 240 m, en 1977 au Japon, et celui de Brisbane en Australie 260 m en 1986 et, plus récemment, deux ouvrages norvégiens construits en béton léger avec une portée de l'ordre de 300 mètres. En France, les plus grands sont les ponts de Gennevilliers 1976 et d'Ottmarsheim 1979 avec une portée de 172 m, le viaduc de Tanus sur le Viaur 190 m, 2000 et le pont sur le Rhin, au sud de Strasbourg 205 m, 2002.
D'autres méthodes de construction ont été développées en Allemagne : la construction travée par travée sur cintre autolanceur et la mise en place par poussage. La première méthode fait appel à un cintre outil métallique extrêmement lourd de 200 à 600 t selon la portée de l'ouvrage et la largeur du tablier, qui peut être lancé vers l'avant en ne s'appuyant que sur la partie déjà réalisée de l'ouvrage et sur ses appuis définitifs ; une fois en place, le cintre est capable de supporter le poids de la travée à construire (pont de Bremeke et, en France, viaducs de l'autoroute Roquebrune-Menton en 1970 ; viaducs d'accès au pont de Martigues sur la passe de Caronte en 1974. Le coût des cintres autolanceurs a conduit au développement de la technique du poussage par Fritz Leonhardt (pont sur le río Caroni au Venezuela en 1964 : l'ouvrage est bétonné au sol en arrière d'une des culées, par tronçons successifs, et il est poussé vers l'avant dans son ensemble à l'aide de vérins, par étapes successives correspondant aux phases de bétonnage, après la construction d'un nouveau tronçon ou l'achèvement d'une travée. Des équipements permettent de limiter les moments de porte-à-faux dans les phases les plus défavorables avant-bec de poussage, mât de haubanage auxiliaire ou appuis provisoires intermédiaires. Cette technique, introduite en France par Spie Batignolles, a été utilisée pour la construction de l'aqueduc de l'Abéou en 1968, du viaduc de la Boivre près de Poitiers en 1970, de ceux du Luc, du Var, de l'Oli et de la Nuec sur l'autoroute A8 près de Nice de 1972 à 1978, et a été largement diffusée depuis lors. C'est par cette méthode qu'ont été mis en place les grands viaducs en béton précontraint de la ligne Paris-Sud-Est du train à grande vitesse (viaducs de la Roche, de la Digoine, du Serein et de la Saône), puis du T.G.V. Atlantique viaducs de Vouvray et du Cher.
Le développement de la précontrainte et de la construction par encorbellements successifs a redonné une impulsion à la construction des arcs, essentiellement sous l'influence des ingénieurs yougoslaves, Ilia Stojadinovic et Stanko Sram. Au lieu de bétonner l'arc sur un échafaudage ou un cintre – qui sont extrêmement coûteux –, ils ont construit les grands arcs de Sibenik 256 m, 1964, Pag 193 m, 1966 et surtout de Krk 244 et 390 m, 1979 par encorbellements successifs à partir des culées, en soutenant les consoles par des haubans provisoires ancrés au rocher sur les rives et déviés par les pilettes. L'idée – originaire de Grande-Bretagne – s'est largement répandue en Autriche, en Allemagne, au Japon, en Afrique du Sud et en France pont de Trellins, en 1985, pont Chateaubriand 1991 sur la Rance, avec une ouverture de 260 m et pont du Morbihan 1995 sur la Vilaine d'une ouverture de 200 m. Une autre solution, imaginée par Ricardo Morandi, consiste à construire chacun des deux demi-arcs sensiblement à la verticale, comme on le faisait déjà pour le montage du cintre de certains arcs en béton armé, puis à les rabattre l'un vers l'autre en les retenant par des câbles passerelle de Lussia et pont de la Storms River en Afrique du Sud ; l'idée a été reprise en Allemagne Argentobelbrücke, 1985.
Enfin, le béton précontraint a permis la construction de quelques ponts suspendus pont de Mariakerke en Belgique ; et surtout de très nombreux ponts à haubans, lointains successeurs de l'aqueduc de Tampul et de l'ouvrage du canal de Donzère. C'est l'ingénieur italien Morandi qui a édifié les premiers grands ouvrages, avec des formes lourdes et coûteuses en matière, et avec des haubans très peu nombreux pont du lac Maracaibo en 1962, avec des portées de 235 m ; pont de Wadi Kuf, en Libye, avec une portée de 282 m en 1972. Le premier grand pont à haubans moderne en béton précontraint est celui de Brotonne, construit par Jean Muller et Jacques Mathivat portée de 320 m, 1977 avec un haubanage réparti repris des idées de Homberg pour les ponts métalliques.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=8872#forumpost8872
Posté le : 30/05/2015 17:51
|
|
|
|
|
Pont neuf 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Les ponts modernes
Aujourd'hui, dans leur grande majorité, les ponts sont des poutres en acier, en ossature mixte acier-béton ou en béton précontraint. Les grandes portées restent le domaine réservé des ponts à câbles, et les très petites portées, au-dessous de 10 à 12 mètres, celui du béton armé.
Les ponts en poutre
Les poutres en treillis métallique ont été pratiquement abandonnées en Europe au profit des poutres à âmes pleines sous chaussée. C'est une conséquence de l'évolution historique des coûts relatifs de la main-d'œuvre et de la matière. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le coût de la main-d'œuvre était assez faible tandis que le prix des matériaux – et tout particulièrement de l'acier – était très élevé. Il était donc intéressant de construire des treillis permettant de sensibles économies de matière, au prix d'assemblages complexes. Mais, avec l'augmentation du coût de la main-d'œuvre et la chute du prix des matériaux, la tendance s'est inversée. D'autant que l'amélioration des caractéristiques mécaniques de l'acier a limité la quantité de matière que permet d'économiser la complication de la structure. Dans leur grande majorité, les ponts métalliques sont donc construits avec des poutres à âmes pleines sous chaussée. Il arrive encore, cependant, qu'on construise des ponts à poutres latérales en treillis – du type Warren ou Warren à montants – lorsqu'on ne dispose que d'un très faible espace entre l'obstacle à franchir et le niveau de la chaussée.
Les ponts à poutres à âmes pleines sous chaussée ont pratiquement la même structure, qu'il s'agisse d'ouvrages en acier à dalle orthotrope ou qu'il s'agisse de ponts en ossature mixte avec une dalle participante en béton. La dalle – orthotrope ou en béton – constitue la membrure supérieure de l'ossature, complétée par des poutres en I ou un caisson (ou plusieurs caissons). Les ouvrages en ossature mixte étaient souvent constitués de nombreuses poutres reliées par des entretoises ; la tendance est aujourd'hui de construire des ponts à deux poutres, dits bipoutres. Lorsque le tablier est étroit, ces poutres sont reliées par de simples entretoises et la dalle ne porte transversalement que de poutre à poutre. Lorsque le pont s'élargit, les efforts transversaux augmentent dans la dalle qui est alors précontrainte dans le sens transversal, comme pour le viaduc de la Somme sur l'autoroute A26. Mais on peut aussi, pour les ouvrages larges et très larges, multiplier les poutres principales, ou relier les deux poutres principales par des pièces de pont qui portent le hourdis supérieur en béton avec un entre-axe limité, de l'ordre de 3 à 4 m ; la dalle en béton travaille alors surtout dans le sens longitudinal comme pour le viaduc de la Planchette sur l'autoroute A75 près de Chirac. Les choix sont beaucoup plus limités dans le cas des ponts en acier : les deux poutres principales doivent obligatoirement être reliées par les pièces de pont qui supportent les augets, comme pour le viaduc d'Autreville. Pour des portées très importantes, ou lorsqu'on a besoin d'une grande rigidité de torsion dans les ponts courbes ou très en biais, voire pour des raisons esthétiques, on remplace les poutres en I par des caissons. Mais l'importance des contraintes de compression dans la membrure inférieure, et dans le bas des âmes au voisinage des appuis, impose un fort raidissage des tôles, qui leur donne le même aspect qu'une dalle orthotrope. La sous-estimation des risques de voilement de la membrure inférieure de ces caissons a conduit à de graves accidents au début des années 1970 effondrements, en cours de construction, du pont de Vienne sur le Danube en 1969, de celui de Milford Haven en 1970, de Melbourne en 1970 et de Coblence en 1971. On peut citer de nombreux ouvrages français à dalle orthotrope à un ou plusieurs caissons : pont de Chaumont sur la Loire 121,6 m ; pont de l'Alma à Paris 110 m, 1970 ; pont de Cornouailles à Bénodet 200 m, 1973. Mais aussi des ouvrages en ossature mixte : pont de Belleville 84 m, 1970 ; viaduc de la Chiers à Longwy 110 m, 1985.
Ces ouvrages sont le plus souvent construits par lancement, ou poussage, tant que leur portée reste modérée, moins de 100 m environ. Lorsqu'il s'agit d'un pont à dalle orthotrope, il est évidemment lancé avec sa dalle ; mais, lorsque l'ouvrage est en ossature mixte, l'ossature métallique doit être lancée seule, ce qui détermine les dimensions des membrures supérieures des poutres ou des caissons. La dalle en béton armé est ensuite coulée en place, ou constituée au moyen d'éléments préfabriqués. Plus récemment, les ingénieurs suisses ont imaginé de lancer une dalle préfabriquée sur la charpente métallique déjà en place. Cette technique a été reprise et améliorée par Michel Placidi qui l'a utilisée pour la construction d'une demi-douzaine de ponts en France.
Les formes des ponts en béton précontraint sont plus diverses, mais elles sont, elles aussi, guidées par les évolutions économiques. Entre les deux guerres, les tabliers des ouvrages en béton armé étaient le plus souvent constitués de poutres longitudinales nombreuses et peu espacées, reliées par des entretoises formant pièces de pont. Avec l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, particulièrement important dans le prix des coffrages, et avec la diminution du coût des matériaux, il est préférable de construire des ouvrages un peu plus lourds mais de formes plus simples. Ce qui explique le succès des ponts en dalle précontrainte. Pour les faibles portées, jusqu'à 15 ou 20 m, on construit des dalles rectangulaires. Lorsque la portée augmente, il faut accroître leur épaisseur et, pour que les efforts de poids propre ne deviennent pas excessifs, il faut les alléger. On crée alors des dalles à larges encorbellements, qui deviennent progressivement nervurées, lorsqu'on concentre la matière en une ou plusieurs nervures, pour des portées d'environ 20 à 35 m. Les nervures deviennent plus hautes et s'amincissent, devenant de véritables poutres rectangulaires lorsque la portée atteint 40 m. Mais le rendement géométrique – qui traduit l'efficacité mécanique de la section par rapport à son poids – n'augmente que lentement, passant de 0,33 pour une dalle rectangulaire à environ 0,42 pour un pont à nervures. Pour construire des ouvrages de portée supérieure à 50 m, il faut concentrer la matière sur les fibres extrêmes, au prix d'une complication du coffrage. Cela conduit aux sections en caisson, beaucoup plus efficaces, mais dont la fabrication est nettement plus difficile et plus coûteuse. Leur rendement géométrique est de l'ordre de 0,55 à 0,65. Il apparaît ainsi, sous la pression de l'économie, une correspondance à peu près parfaite entre les portées du pont et les formes de la section transversale. La méthode de construction intervient cependant comme correctif dans le choix de la section transversale. Si l'ouvrage est bétonné sur cintre ou sur cintre autolanceur, la distribution des moments fléchissants de poids propre est proche de l'optimum ; on peut alors concevoir des ponts à nervures pour des portées nettement supérieures à 50 m. Si l'ouvrage est construit par encorbellements successifs, il apparaît d'importants moments négatifs de poids propre sur piles, juste avant la fin de la construction des fléaux ; une section en caisson, beaucoup plus efficace, s'impose alors de façon quasi systématique. Enfin, si l'ouvrage est mis en place par poussage, il apparaît des moments fléchissants importants en cours de lancement, alternativement positifs et négatifs ; il faut alors concevoir des sections assez hautes, nettement plus que pour les autres méthodes de construction, qui peuvent être à nervures jusque vers 40 m, mais qui doivent être en caisson au-delà.
Le développement de la préfabrication a légèrement modifié cet équilibre : le coût de la main-d'œuvre est plus faible en usine que sur le chantier, et les rendements sont plus élevés ; en outre, il est nécessaire de diminuer le poids des pièces pour réduire le coût des engins de manutention, de transport et de mise en place. Les ponts construits au moyen d'éléments préfabriqués – qu'il s'agisse de poutres sous chaussée ou de voussoirs destinés à reconstituer une poutre en caisson voire à nervures – ont donc des formes plus découpées et plus complexes, dans le but d'alléger les pièces. L'entreprise Bouygues a même imaginé des poutres en treillis spatial en béton précontraint pont de Bubiyan au Koweït, en 1983 ; viaducs de Sylans et des Glacières sur l'autoroute A40, en 1988, mais l'économie de matière ne compense pas le prix trop élevé de la main-d'œuvre.
La largeur du pont intervient aussi dans la conception de la section transversale, particulièrement dans le cas des ouvrages en caisson dont la portée est supérieure à 50 m en général. À la fin des années 1960, la solution classique consistait à concevoir un caisson unique à deux âmes pour des ponts d'une dizaine de mètres de largeur, un caisson unique à trois âmes pour une largeur de 12 à 16 m pont d'Oissel sur la Seine, 1978, et à constituer le tablier au moyen de deux caissons parallèles à deux âmes viaduc de Calix à Caen, 1974, ou même de trois caissons parallèles pour les ponts très larges pont Saint-Jean à Bordeaux, 1968. Les ouvrages d'autoroute étaient alors fréquemment constitués de deux ponts parallèles et indépendants, chacun portant une chaussée autoroutière pont d'Ottmarsheim, 1979. Au cours des années 1970, la tendance a été d'élargir le domaine d'emploi des caissons à deux âmes jusque vers 14 ou 15 m, et à trois âmes jusque vers 20 m, afin d'alléger la structure en réduisant le nombre des âmes, dans un but d'économie. Et les ingénieurs ont cherché à généraliser l'emploi des caissons à deux âmes quelle que soit leur largeur, en aménageant leur conception pour assurer leur résistance en flexion transversale : on construit aujourd'hui des caissons larges à deux âmes à hourdis supérieur épais, précontraint transversalement viaduc de Poncin, 1986 ; des caissons larges à deux âmes avec un hourdis supérieur nervuré transversalement pont de Saint-André-de-Cubzac, 1978 ; viaduc des Ponts-de-Cé ; pont de Saumur ; viaduc de l'Arrêt Darré ; pont à béquilles d'Auray, 1988 ; pont de Cheviré, 1990 ; et des caissons à deux âmes dont les larges encorbellements sont soutenus par des voiles minces inclinés, continus ou discontinus, qui prennent l'apparence d'âmes supplémentaires viaducs et pont de la ligne de Marne-la-Vallée du R.E.R., 1977 ; ouvrage no 36 de l'autoroute du Littoral à Marseille, 1986 ; ou soutenus par des bracons rectangulaires distants de trois ou quatre mètres Erschachtalbrücke et Kochertalbrücke, en Allemagne ; en France, viaducs du Piou et du Rioulong sur l'autoroute A75 avec des bracons tubulaires en acier. Grâce à cette évolution technique, on préfère aujourd'hui porter les autoroutes par des ponts à tablier unique de grande largeur, non seulement pour des raisons économiques, mais surtout pour améliorer l'esthétique des ouvrages et leur inscription dans le site.
La technique de la précontrainte évolue, elle aussi. Plusieurs ponts avaient été construits, aux débuts de la précontrainte, avec des câbles extérieurs au béton les ponts allemands déjà cités ; les ponts de Villeneuve-Saint-Georges, de Vaux-sur-Seine, de Port-à-Binson et de Can Bia en France, vers 1950 ; les ponts de Gustave Magnel en Belgique..., mais la technologie des câbles intérieurs, mise au point par Freyssinet, s'était largement imposée. La précontrainte extérieure a été remise à l'honneurvers 1980, par Jean Muller aux États-Unis ponts des Keys de Floride : Long Key, Channel Five, Niles Channel et Seven Mile ; viaducs et pont du Sunshine Skyway à Tampaet par l'administration du ministère de l'Équipement en France le S.E.T.R.A.. Les câbles de précontrainte extérieurs sont généralement ancrés sur les entretoises qui raidissent le caisson au-dessus des piles, et déviés dans les travées par des bossages en béton, ou des entretoises, pour leur donner un tracé optimal. Mais il ne peuvent être mis en place ainsi qu'après l'achèvement de la construction de la travée. Les ponts peuvent alors être édifiés travée par travée à l'avancement, à l'aide d'un échafaudage au sol viaducs du métro de Lille, de multiples palées provisoires viaduc de Saint-Agnant, d'une poutre de pose lançable viaducs du Mass Transit System d'Atlanta ou autolanceuse la poutre de pose du pont de Bubiyan, qui agit comme une véritable grue portant toute la nouvelle travée, ou d'un haubanage provisoire viaducs du Vallon des Fleurs et de la Banquière ; viaduc de Frébuje. Ils peuvent être construits par encorbellements successifs à condition de mettre en œuvre, à mesure de la construction des fléaux, une précontrainte intérieure qui équilibre les moments négatifs de poids propre pont de Chinon sur la Vienne ; cette méthode permet aussi de mettre en place par rotation des fléaux construits sur échafaudages au sol parallèlement à la rivière pont sur le Loir à La Flèche, ou de mettre en place par poussage les deux moitiés d'un ouvrage, réalisées au sol sur chaque berge pont de Cergy-Pontoise. Les ouvrages peuvent aussi êtrte mis en place par la méthode de poussage classique, à condition de concevoir un schéma de précontrainte centré pendant le poussage, associant des câbles extérieurs définitifs et d'autres câbles provisoires, intérieurs ou extérieurs viaduc sur la Somme à Amiens ; viaduc de Charix.
La construction du viaduc central du pont Vasco-de-Gama 1995-1998, sur le Tage à Lisbonne, a été menée en préfabriquant des travées entières de 2 000 tonnes posées sur leurs piles par un bateau grue, la Rambiz, et solidarisées par des clavages sur piles. La précontrainte initiale des travées préfabriquées – intérieure et extérieure – a alors été complétée par des câbles extérieurs au béton avec une disposition spécifique 1998.
Le viaduc central du pont Vasco-de-Gama est aussi un exemple de préfabrication lourde ; en site nautique, pour les très grands ouvrages, il peut être intéressant de préfabriquer des éléments très lourds dans une véritable usine et de les mettre en place à l'aide de grues nautiques de très forte capacité, d'énormes bateaux spécialisés. Les premiers exemples importants ont été donnés par la construction du Coastway de Bahreïn et celle du pont ouest du Storebelt (Danemark), mais le plus spectaculaire est la construction du pont de la Confédération au Canada, qui donne accès à l'île du Prince-Édouard : les travées de 250 mètres ont été construites en posant sur les piles elles-mêmes constituées d'éléments préfabriqués des fléaux de 200 mètres pesant 7 200 tonnes, qui ont ensuite été reliés par de courtes travées de 50 mètres.
Une autre évolution importante vient des progrès dans la fabrication des bétons eux-mêmes. Au cours des années 1970, de nombreuses tentatives avaient été faites pour développer l'emploi des bétons légers, mais l'importance de la quantité d'énergie nécessaire à l'obtention des granulats légers fit perdre beaucoup de son intérêt économique à cette solution. Plus récemment, sous l'influence des progrès réalisés dans ce domaine aux États-Unis et dans les pays scandinaves, se développe l'emploi des bétons à hautes performances, et notamment l'utilisation de bétons dans lesquels une partie du ciment est remplacée par de la fumée de silice. Leur résistance varie de 60 à 80 MPa et peut atteindre 100 MPa dans certaines conditions ; leur utilisation s'est développée en France à partir de la construction du pont de l'île de Ré 1988 par l'entreprise Bouygues, et elle est aujourd'hui courante pour des résistances de 60 à 80 MPa.
Un nouveau matériau se développe, le béton de fibres à ultra-hautes performances, dont la résistance à la compression peut atteindre 200 MPa ; mais ses applications sont encore très limitées.
Les ponts à câbles, à haubans ou suspendus
Enfin, les ponts à câbles modernes, ponts à haubans et ponts suspendus, constituent les seules solutions adaptées aux très grandes portées. Les ouvrages à haubans commencent à devenir plus économiques que ceux en poutre à partir de 200 m environ. Mais il arrive qu'on construise des ponts à haubans ou même des ponts suspendus de portée beaucoup plus modeste pour des raisons esthétiques, ou du fait de contraintes particulières. Les passerelles pour les piétons et les cyclistes constituent un domaine d'emploi particulièrement intéressant des ponts à haubans : celle du bassin du Commerce au Havre, avec un tablier en ossature mixte ; les passerelles en béton précontraint de Meylan sur l'Isère, près de Grenoble 1978, et de l'Illhof sur l'Ill, près de Strasbourg 1979, qui ont été bétonnées sur un échafaudage au sol, parallèlement à la rivière, et mises en place par rotation autour de leurs piles. Jorg Schlaich a même construit en béton à Stuttgart deux passerelles suspendues, dont l'une sur le Neckar, avec un tablier en dalle mince de béton armé.
Beaucoup de ponts à haubans construits ces dernières années en béton précontraint ont été fortement inspirés du pont de Brotonne, avec une nappe de haubanage axiale et une section transversale en caisson, complétée par un système de bracons permettant de transférer au bas des âmes l'effort de tension des haubans : le pont de Coatzacoalcos au Mexique 1984 et celui du Sunshine Skyway à Tampa, en Floride 1986, tous les deux construits par encorbellements successifs ; les pont de Ben Ahin, mis en place par rotation autour de son pylône en s'inspirant des passerelles de Meylan et de l'Illhof 1987 ; celui de Wandre, sur la Meuse en Belgique, installé par poussage sur des appuis provisoires, en 1987. Mais la mise en place de multiples haubans répartis permet de concevoir des tabliers de beaucoup plus faible inertie ; et le remplacement de la nappe de haubanage axiale par des nappes latérales, capables d'équilibrer directement les efforts de torsion, autorise la conception de tabliers qui n'ont, en outre, qu'une faible rigidité de torsion. Le pont de Pascoe Kennewick, en 1979, est la première application de ces idées : la section transversale est constituée de deux petits caissons triangulaires, réunis par un hourdis entretoisé. Cette solution a logiquement évolué vers la construction de tabliers à deux nervures latérales, reliées par un hourdis mince et des entretoises formant pièce de pont : ouvrage de Quincy, avec des entretoises métalliques, et de Dames Point, à Jacksonville en Floride, avec une travée centrale de 400 m 1988. René Walther et Jorg Schlaich sont allés au bout de l'idée en concevant des dalles haubanées : le pont de Dieppoldsau en Suisse, en 1986, l'Akkar Bridge dans le Sikkim, en 1988, et l'ouvrage d'Evripos en Grèce, en 1990, avec une travée centrale de 215 m. En France, deux ouvrages de cette famille ont été construits : le pont de Bourgogne, à Chalon-sur-Saône 152 m, 1992 et le pont de Tarascon sur le Rhône 192 m, 1998. Le record du monde des ponts à haubans en béton et des ponts en béton toutes catégories confondues est actuellement détenu par le pont de Skarnsund, en Norvège 1993, avec une portée de 530 m.
Les ponts à haubans métalliques les plus anciens comportent un platelage orthotrope : celui de Saint-Nazaire a détenu, pendant longtemps, le record du monde de portée 404 m, 1975 avec son caisson orthotrope de forme quasi rectangulaire ; l'ouvrage du Faro, au Danemark, a une section nettement plus profilée, mais de conception voisine. Le Düsseldorf Kniebrücke, en 1969, et le Düsseldorf Flehe, en 1979, ne comportent qu'un seul pylône ; avec leurs portées de 320 et 368 m, ils ont longtemps constitué les plus grands fléaux haubanés du monde, les plus longs câbles dépassant 300 m. Depuis le début des années 1980, les tabliers en caisson orthotrope – ou à poutres réunies par un platelage orthotrope et des entretoises – sont souvent remplacés par des tabliers en ossature mixte jusqu'à des portées de 600 m : le tablier est constitué de deux poutres latérales de faible hauteur, réunies par des pièces de ponts, également métalliques, et par une dalle en béton armé souvent réalisée à partir d'éléments préfabriqués. Les meilleurs exemples de ce type d'ouvrage sont le pont Alex-Frazer au Canada, aussi appelé le pont d'Anacis, qui a détenu le record du monde avec une portée de 465 m 1986 ; le pont de Hoogly à Calcutta 450 m, 1993 et le pont de Yang Pu à Shanghai qui a lui aussi détenu le record pendant une courte période 608 m, 1994. En France, le pont de Seyssel 1987 est encore le seul exemple de ce type.
Quelques rares ouvrages associent le béton précontraint et la construction métallique. C'est le cas du pont de Tampico au Mexique, dans lequel les travées d'accès de chaque côté sont en béton précontraint, ainsi que les amorces de la grande travée, dont la partie centrale est constituée par un caisson orthotrope en acier. C'est aussi le cas du pont de Normandie sur la Seine, entre Le Havre et Honfleur, dont la construction a démarré en 1989 et s'est achevée en janvier 1995, avec ses deux pylônes de 215 mètres et sa travée centrale en caisson profilé de 856 mètres ; il a détenu le record du monde jusqu'à la mise en service du pont de Tatara, au Japon 890 m, 1998. Deux ouvrages dépassent aujourd'hui les 1 000 mètres de portée : le pont de Sutong sur le Yangzi, en Chine 1 080 m, 2008 et le pont de Stonecutters, à Hong Kong, un peu plus court, qui devrait être mis en service en 2009.
Il faut évoquer une famille particulière de ponts à haubans, les ponts à haubans à travées multiples, dont le fonctionnement mécanique est très différent des ponts à haubans classiques à trois travées ; le tablier étant nécessairement très souple à l'échelle des portées, et les têtes de pylônes ne pouvant pas être rigidifiées par des haubans arrière ancrés à des points fixes – et appelés haubans de retenue –, la résistance ne peut être assurée que par la rigidité des ensembles pile-pylône. Les exemples les plus spectaculaires sont : le pont de Rion-Antirion 2004, en Grèce, qui franchit le détroit de Patras avec quatre énormes pylônes posés au fond de la mer par 90 mètres de profondeur, et avec trois travées principales de 560 mètres ; le célèbre viaduc de Millau 2004, en France, enjambant la vallée du Tarn, avec ses sept pylônes et ses six travées principales de 342 mètres.
De nombreux experts considèrent qu'il est possible de construire des ouvrages à haubans jusqu'à 1 500 m de portée. Mais, pour l'instant, les très grandes portées – à partir de 800 à 1 000 mètres – restent l'apanage des ponts suspendus. Deux grandes écoles se sont longtemps affrontées. D'un côté, l'école américaine, avec des ouvrages dont le tablier est un treillis métallique de grandes dimensions, et bien souvent à deux étages de circulation : le pont de Mackinac, construit en 1957 par D. B. Steinman, sur le détroit qui sépare le lac Michigan du lac Huron, est le premier grand ouvrage édifié après l'écroulement du pont de Tacoma, avec une portée centrale de 1 158 m ; il précède de peu le pont du Verrazzano à New York 1 298 m, 1964 ; . Cette école américaine a largement inspiré la construction en Europe : le pont de Tancarville, réalisé en 1959 sous la direction de Marcel Huet, a détenu quelques années le record d'Europe avec 608 m ; ce fut ensuite l'ouvrage du Firth of Forth (1 006 m, 1964, puis le pont sur le Tage à Lisbonne 1 013 m, 1966. Les grands ouvrages suspendus japonais sont construits suivant les mêmes principes : le Kammon Bridge 712 m n'a été que le prototype d'une impressionnante série, puisqu'une douzaine de ponts dépassent ou dépasseront cette portée ; la liaison centrale entre l'île principale, Honshu, et l'île de Shikoku en comporte trois, celui de Shimotsui Seto (940 m) et les ponts nord et sud de Bisan-Seto (respectivement 990 m et 1 100 m, tous achevés en 1988 ; mais la liaison est de Honshu à Shikoku comportera un ouvrage bien plus exceptionnel, sur le détroit d'Akashi Kaikyo, dont la portée devait être initialement de 1 990 mètres. Toutefois, le séisme de Kobe, en janvier 1995, a déplacé un pylône d'1 mètre pendant la construction de cet ouvrage, si bien qu'il détient le record du monde absolu avec une portée de 1 991 mètres 1998.
L'autre école est anglaise, fortement inspirée par des travaux de Fritz Leonhardt qu'il n'a jamais pu concrétiser. Deux idées majeures dominent la conception. La première consiste à remplacer le tablier en treillis des ponts suspendus classiques par un caisson orthotrope très mince, dont le profilage permet de réduire les efforts produits par le vent et d'assurer la stabilité aéroélastique. La seconde est d'utiliser des suspentes inclinées à la place de suspentes verticales ce qui constitue, avec les câbles porteurs et le tablier, une poutre en treillis de hauteur variable, qui permet un bon étalement des charges routières. La première application a été la construction en 1966 du pont sur la Severn en Angleterre 988 m, suivie par celle du premier ouvrage sur le Bosphore à Istanbul en 1973 1 074 m, puis par celle du pont sur la Humber 1 410 m en 1981, qui a longtemps détenu le record du monde de portée. Tous ont été projetés par le bureau Freeman, Fox & Partners. Le deuxième ouvrage sur le Bosphore est achevé, mais avec des suspentes verticales, pour tenir compte de certaines critiques et des désordres qui ont été constatés sur les suspentes du pont de la Severn, qu'il a fallu remplacer. Le plus grand pontà tablier profilé est aujourd'hui le pont du Storebelt, au Danemark 1 624 m, 1998. Il existe plusieurs ouvrages récents analogues en Chine, avec des portées de plus de 1 000 mètres. Même les Japonais et les Américains ont adopté cette conception pour leurs ouvrages les plus récents, avec des portées plus modestes.
De nombreuses solutions sont aujourd'hui imaginées pour construire des ponts de plus de 2 000 m de portée. Le franchissement des grands détroits est une occasion de développer ces idées ; les projets d'ouvrages pour le franchissement des détroits de Messine et de Gibraltar sont autant de prototypes des grands ouvrages du XXIe siècle.
Les ponts spéciaux
Certains ponts sont tout à fait particuliers, du fait de leurs fonctions ou de leurs conditions de fonctionnement.
Les ponts-canaux sont rares aujourd'hui, car les voies de navigation modernes sont de plus en plus limitées aux basses vallées des grands fleuves : le pont-canal de Toulouse est, en France, le seul exemple récent.
Les ouvrages mobiles sont plus nombreux. Il en existe plusieurs types. Les ponts levants sont constitués d'un tablier aussi léger que possible – d'abord construit en treillis métallique puis, le plus souvent aujourd'hui, en caisson orthotrope –, et de deux tours qui permettent de loger les contrepoids qui équilibrent la plus grande partie de la masse du tablier. La descente des contrepoids permet un levage rapide du tablier pour laisser le passage aux navires. Les plus grands ponts levants français sont le pont de Recouvrance sur le Penfeld, à Brest 88 m, 1954, et celui du Martrou sur la Charente 92 m, 1966 et le pont Gustave-Flaubert à Rouen, 119 m, 2008. Les ponts basculants sont constitués d'un ou de deux fléaux équilibrés, avec une console aussi légère que possible pour franchir la brèche, équilibrée par un contrepoids arrière qui pénètre dans une culasse en béton armé. Le basculement du fléau, autour de son axe d'appui, permet le passage des navires. Le pont de Martigues, à l'entrée de l'étang de Berre, comporte deux fléaux de 27,50 m 1962 ; celui de l'écluse François Ier, au Havre, comporte un seul fléau de 74 m ; le pont de Bizerte en est une copie fidèle. Il existe aussi des ouvrages tournants : un fléau équilibré tourne autour d'un axe vertical à terre, sur une rive pour les petits ouvrages, ou sur chacune des deux rives pour des portées plus importantes, ce qui dégage un chenal navigable. On peut aussi faire tourner un fléau unique et symétrique autour d'une pile séparant le chenal en deux bras. On construit également des ponts roulants : le fléau, toujours équilibré par un contrepoids, est retiré vers l'arrière en descendant légèrement pour pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une culasse en béton armé.
             
Posté le : 30/05/2015 17:49
|
|
|
|
|
La reine Victoria |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 mai 1819 naît Alexandrina Victoria
au Palais de Kensington à Londres, morte à 81 ans, le 22 janvier 1901 à Osborne House sur l'Île de Wight, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 20 juin 1837 jusqu'à sa mort. À partir du 1er juillet 1867, elle fut également reine du Canada, ainsi qu'impératrice des Indes à compter du 1er mai 1876, puis enfin reine d'Australie le 1er janvier 1901.
Reine du Royaume-Uni du 20 juin 1837 au 22 janvier 1901 soit durant 63 ans, 7 mois et 2 jours. Elle fut couronnée le 28 juin 1838 en l'Abbaye de Westminster. Ses premiers ministres furent Lord Melbourne, Robert Peel, Lord Russell, Lord Derby, Lord Aberdeen, Lord Palmerston, Benjamin Disraeli, William Gladstone, Lord Salisbury
et Lord Rosebery. Son prédécesseur était Guillaume IV, son successeur Édouard VII. Elle fut reine du Canada du 1er juillet 1867 au 22 janvier 1901 soit durant 33 ans, 6 mois et 21 jours. Sans prédécesseur elle eut pour successeur Édouard VII. Faite impératrice des Indes du 1er mai 1876 au 22 janvier 1901 soit durant 24 ans, 8 mois et 21 jours, ellen'avait pas de prédécesseur et eut pour successeur Édouard VII. Devenue reine d'Australie du 1er janvier 1901 au 22 janvier 1901 soit durant 21 jours
sans prédécésseur elle eut pour successeur Édouard VII. Elle était héritière présomptive du trône du Royaume-Uni du 26 juin 1830 au 20 juin 1837 soit durant 6 ans, 11 mois et 25 jours, sous le règne de Guillaume IV qui eut pour prédécesseur Guillaume, duc de Clarence et pour successeur Ernest-Auguste, duc de Cumberland et Teviotdale
Victoria appartient à la dynastie de la Maison de Hanovre, son nom de naissance était Alexandrina Victoria
Sa sépulture est le Mausolée royal de Frogmore. Son père était Édouard Auguste, duc de Kent et Strathearn, sa mère Victoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld
Elle épousa Albert de Saxe-Cobourg-Gotha qui fut fait prince consort et avec qui elle eut 9 Enfants qui atteindront tous l'âge adulte , ce qui a l'époque était relativement rare, ses enfants sont : Victoria, princesse royale, Édouard VII, Alice du Royaume-Uni, Alfred, duc de Saxe-Cobourg et Gotha, Helena du Royaume-Uni, Louise du Royaume-Uni, Arthur, duc de Connaught et Strathearn, Leopold, duc d'Albany, Béatrice du Royaume-Uni.
Les historiens donnérent à la reine victoria l’appellation de " grand-mère de l’Europe » ce qui peut-être considéré comme un cliqué, certes, mais qui recouvre une réalité : par une habile politique de mariages de ses enfants et de ses petits-enfants, la reine de Grande-Bretagne et d’Irlande, impératrice des Indes, s’est alliée à la plupart des cours européennes.
Victoria était la fille du prince Édouard Auguste de Kent et de Strathearn, le quatrième fils du roi George III. Le duc et le roi moururent en 1820 et Victoria fut élevée par sa mère d'origine allemande, la princesse Victoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Elle monta sur le trône à l'âge de 18 ans après la mort sans héritiers légitimes des trois frères aînés de son père. Le Royaume-Uni était déjà une monarchie constitutionnelle établie dans laquelle le souverain avait relativement peu de pouvoir politique. En privé, Victoria essaya d'influencer les politiques gouvernementales et les nominations ministérielles. En public, elle devint une icône nationale et fut assimilée aux normes strictes de la morale de l'époque.
Victoria épousa son cousin le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha en 1840. Leurs neuf enfants épousèrent des membres de nombreuses familles royales et nobles, ce qui valut à Victoria le surnom de « grand-mère de l'Europe ». Après la mort d'Albert en 1861, Victoria sombra dans une profonde tristesse et se retira de la vie publique. En conséquence de ce retrait, le républicanisme gagna temporairement en influence mais sa popularité remonta dans les dernières années de son règne grâce à ses jubilés d'or et de diamant qui donnèrent lieu à de grandes célébrations publiques.
Son règne de 63 ans et sept mois, le plus long de toute l'histoire du Royaume-Uni, est appelé époque victorienne, une période de profonds changements sociaux, économiques et technologiques au Royaume-Uni et de rapide expansion de l'Empire britannique. Elle fut le dernier monarque britannique de la Maison de Hanovre qui régnait sur les îles britanniques depuis 1714 car son fils et héritier, Édouard VII, appartenait à la lignée de son père, la Maison de Saxe-Cobourg et Gotha.
En bref
Lorsque Victoria naît, le 24 mai 1819, nul ne peut deviner qu'elle sera l'une des six reines qui auront présidé aux destinées de l'Angleterre ni qu'elle vivra plus longtemps que tout autre monarque anglais. Issue de la dynastie de Hanovre, elle est la petite-fille de George III, mais elle n'est alors qu'au cinquième rang pour la succession au trône, et c'est seulement parce que ses oncles n'ont pas d'héritiers mâles légitimes que la couronne un jour lui reviendra.
Son père, Édouard 1767-1820, duc de Kent, quatrième fils de George III, après avoir vécu vingt-sept ans avec une maîtresse, avait fini par se marier en 1818 : il avait épousé une princesse allemande, Victoria de Saxe-Cobourg-et-Gotha 1786-1861, sœur de Léopold, futur roi des Belges. De cette union naît une fille unique, Victoria.
La petite princesse est élevée sous l'influence de sa mère son père meurt dès 1820, assez à l'écart, dans une atmosphère morose faite de gêne le duc de Kent a laissé beaucoup de dettes et d'intrigues politiques et sentimentales sa mère a une liaison avec le chambellan Conroy. De ces années, Victoria gardera un souvenir amer elle dira plus tard ma triste enfance. Cependant, son éducation est soignée, studieuse, appliquée, car ni George IV roi de 1820 à 1830 ni Guillaume IV roi de 1830 à 1837)n'ont d'héritiers ; ainsi, il apparaît que c'est la jeune Victoria qui sera appelée à monter sur le trône. Toutefois, pendant cette période, son tempérament vif et volontaire se manifeste déjà. Elle-même ressent durement le caractère despotique de sa mère, ambitieuse et brouillonne, qui n'a qu'une idée, devenir régente. Mais ce calcul est déjoué, car Victoria vient juste d'atteindre dix-huit ans, l'âge de la majorité, quand son vieil oncle Guillaume IV meurt le 20 juin 1837.
Le premier acte de la nouvelle reine est d'écarter sa mère : c'est à elle et à elle seule qu'est échue la couronne. Et elle manifestera toujours la plus grande fermeté dans l'accomplissement de sa tâche. Avec un sens aigu de ses devoirs, jamais elle ne renoncera à une parcelle de ses prérogatives. En toutes circonstances, elle se réserve les droits régaliens, qu'elle prendra grand soin de ne point partager même avec le prince Albert.
En réalité, la difficulté même des circonstances dans lesquelles Victoria monte sur le trône va lui donner une chance inespérée, qu'elle saura saisir et utiliser avec une habileté consommée et un remarquable flair politique. En effet, en 1837, le prestige de la monarchie n'a jamais été aussi bas.
Montée sur le trône en 1837, et disparue le 22 janvier 1901, la reine Victoria aura symbolisé le Royaume-Uni à l'apogée de sa puissance. L'ère victorienne » résume ainsi le succès et les ambiguïtés de l'Angleterre de la seconde moitié du XIXe siècle. Le pays a en effet été épargné par les guerres et les révolutions, tout en se taillant le premier empire colonial du monde Victoria régnait sur un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais ; la Royal Navy, la City de Londres sont les symboles d'une réussite qui est d'abord économique, articulée autour de la trilogie sidérurgie, charbon et coton. Victoria a été la reine de la première puissance industrielle et commerciale de la planète. Elle a été aussi la reine du plus ancien régime parlementaire d'Europe, qui s'est alors considérablement démocratisé et à la tête duquel alternaient les conservateurs tel Disraeli et les libéraux tel Gladstone. Cela dit, les prérogatives royales ont été largement rognées sous son règne, et la reine qui meurt en 1901 a moins de pouvoir que jamais en Angleterre. Elle laisse également son nom à une société et à une morale victoriennes , qui allient les inégalités sociales les plus criantes au plus strict conformisme intellectuel.
Souveraine dont le règne a été le plus long et le plus glorieux de l'histoire de la Grande-Bretagne, Victoria Ire incarne avec majesté la grandeur britannique à son apogée. L'empire sur lequel elle règne s'étend sur des espaces immenses, puisque à sa mort en 1901 il couvre le cinquième des terres émergées. La prépondérance britannique, quasi incontestée, s'affirme alors aussi bien sur le plan industriel l'atelier du monde, commercial ou naval que dans le domaine diplomatique (la pax britannica. L'ère victorienne est également remarquable pour sa stabilité : en soixante-quatre ans de règne, non seulement la Grande-Bretagne a échappé aux guerres et aux révolutions, mais son évolution tranche avec celle des autres pays européens. Victoria est restée paisiblement assise sur le trône alors qu'autour d'elle s'effondraient les régimes et que disparaissaient les souverains. Qui plus est, le modèle de la monarchie constitutionnelle fondé sur des institutions représentatives se renforce : à l'intérieur, il évolue vers la démocratie, tandis qu'à l'extérieur il fait de nombreux adeptes dans le monde.
Enfin, l'un des grands mérites politiques de Victoria a été, en gagnant l'attachement de ses sujets, d'asseoir la monarchie en Angleterre sur des bases si solides que la marque en est encore visible de nos jours. À la fin de sa vie, la reine-impératrice, devenue une très vieille dame on l'a baptisée la grand-mère de l'Europe , mais toujours aussi volontaire et décidée, apparaît comme le symbole même de la puissance mondiale de la Grande-Bretagne, avec sa figure hiératique, imposante, orgueilleuse, mais non dénuée de quelque chose de maternel : aussi sa disparition sera-t-elle ressentie intensément par tout un peuple.
Sa vie
Le père de Victoria était le prince Édouard Auguste de Kent et de Strathearn, le quatrième fils du roi George III du Royaume-Uni. Jusqu'en 1817, la nièce d'Édouard, la princesse Charlotte Augusta de Galles était la seule petite-fille légitime de George III. Sa mort en 1817 entraîna une crise de succession au Royaume-Uni et le duc de Kent et ses frères célibataires furent invités à se marier et à avoir des enfants. En 1818, le duc épousa la princesse Victoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld, une princesse allemande dont le frère Léopold était le veuf de la princesse Charlotte Augusta. Ils eurent un seul enfant, Victoria, née à 4 h 15 le 24 mai 1819 au palais de Kensington à Londres1. La duchesse de Kent avait déjà deux enfants issus de son premier mariage avec Émile Charles de Linange 1763-1814 : Charles de Leiningen 1804-1856 et Feodora de Leiningen 1807-1872. Plus tard dans sa vie, Victoria maintint des contacts étroits avec sa demi-sœur.
La princesse Alexandrina Victoria fut baptisée en privé par l'archevêque de Cantorbéry, Charles Manners-Sutton, le 24 juin 1819 dans la Cupola Room du palais de Kensingtonn. Elle fut baptisée Alexandrina d'après l'un de ses parrains, l'empereur Alexandre Ier de Russie et Victoria d'après sa mère. D'autres noms proposés par ses parents, Georgina ou Georgiana, Charlotte et Augusta, furent abandonnés sur les instructions du frère aîné du duc, le prince régent futur George IV.
À sa naissance, Victoria était en cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique derrière son père et ses trois frères aînés : le prince régent, le duc d'York et le duc de Clarence futur Guillaume IV. Le prince régent et le duc d'York étaient séparés de leurs épouses et étaient d'un âge avancé donc il était improbable qu'ils eussent d'autres enfants. Les ducs de Kent et de Clarence se marièrent le même jour un an avant la naissance de Victoria mais les deux filles du duc de Clarence nées respectivement en 1819 et 1820 moururent en bas-âge. Le grand-père et le père de Victoria décédèrent en 1820 à moins d'une semaine d'écart et le duc d'York mourut en 1827. À la mort de son oncle George IV en 1830, Victoria devint l'héritière présomptive de son dernier oncle encore en vie, Guillaume IV. Le Regency Act de 1830 chargea la duchesse de Kent d'assurer la régence dans l'éventualité où Guillaume IV mourrait avant que Victoria n'eût 18 ans. Le roi n'avait pas confiance en la capacité de la duchesse à jouer le rôle de régente et en 1836, il déclara en sa présence qu'il voulait vivre jusqu'au 18e anniversaire de Victoria pour éviter une régence.
Héritière présomptive
Victoria décrivit plus tard son enfance comme plutôt triste. Sa mère était extrêmement protectrice et Victoria fut en grande partie élevée à l'écart des autres enfants sous le dit système de Kensington, une série de règles et de protocoles stricts rédigée par la duchesse et son ambitieux et dominateur contrôleur de gestion, John Conroy dont la rumeur courait qu'il était son amant. Ce système empêchait la princesse de rencontrer des personnes que sa mère et Conroy jugeaient indésirables dont la plus grande partie de la famille de son père et était conçu pour la rendre faible et dépendante. La duchesse évitait la cour car elle était scandalisée par la présence des enfants illégitimes du roi et fut peut-être à l'origine de la morale victorienne en insistant pour que sa fille ne fût pas exposée à l'inconvenance sexuelle. Victoria partageait sa chambre avec sa mère chaque nuit, étudiait avec des tuteurs privés selon un emploi du temps précis et passait ses heures de jeu avec ses poupées et son King Charles Spaniel, Dash. Elle apprit le français, l'allemand, l'italien et le latin mais elle parlait uniquement anglais à la maison.
En 1830, la duchesse de Kent et Conroy emmenèrent Victoria dans le centre de l'Angleterre pour visiter les collines de Malvern. Ils s'arrêtèrent dans de nombreuses résidences aristocratiques sur le trajet. D'autres voyages similaires furent organisés en Angleterre et au Pays de Galles en 1832, 1833, 1834 et 1835. Au grand agacement du roi Guillaume IV, Victoria fut accueillie avec enthousiasme à chacune de ses étapes. Guillaume IV compara les voyages à des Joyeuses Entrées et s'inquiéta de voir Victoria présentée comme une rivale plutôt que comme son héritière présomptive. Victoria appréciait peu ces déplacements ; les constantes apparitions publiques la fatiguaient et elle avait trop peu de temps pour se reposer. Malgré ses plaintes, appuyées par la désapprobation du roi, sa mère refusa d'interrompre ces déplacements. À Ramsgate en octobre 1835, Victoria développa une forte fièvre, ce que Conroy ignora d'abord en considérant qu'il ne s'agissait que d'un caprice enfantin. Pendant la maladie de Victoria, Conroy et la duchesse tentèrent sans succès de la convaincre de prendre Conroy comme secrétaire particulier. À l'adolescence, Victoria résista encore aux tentatives répétées de sa mère et de Conroy pour que ce dernier soit officiellement nommé dans son entourage. Devenue reine, elle le bannit de la cour, mais il demeura dans la résidence de sa mère.
En 1836, le frère de la duchesse, Léopold, devenu roi des Belges en 1831, espérait marier sa nièce avec son neveu, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Comme Léopold, la mère de Victoria et le père d'Albert Ernest Ier de Saxe-Cobourg et Gotha étaient frères et sœur, Victoria et Albert étaient cousins germains. En mai 1836, Léopold organisa une réunion de ses proches appartenant à la famille Saxe-Cobourg et Gotha avec la mère de Victoria dans l'objectif de présenter Victoria à Albert. Guillaume IV était cependant peu favorable à une union avec les Saxe-Cobourg et Gotha et préférait le parti d'Alexandre des Pays-Bas, le second fils du prince d'Orange. Victoria était consciente des nombreux projets matrimoniaux la concernant, et elle évaluait de manière critique les différents candidats. Selon son journal, elle apprécia la compagnie d'Albert dès leur première rencontre. Après sa visite, elle écrivit Albert est extrêmement beau ; ses cheveux sont de même couleur que les miens ; ses yeux sont grands et bleus et il a un beau nez et une bouche très douce avec de belles dents ; mais le charme de sa contenance est son atout le plus délicieux. À l'inverse, Alexandre était jugé très quelconque.
Victoria écrivit à son oncle Léopold, qu'elle considérait comme son meilleur et plus gentil conseiller, pour le remercier de la perspective de l'immense bonheur que vous avez contribué à me donner en la personne de ce cher Albert… Il possède toutes les qualités qui pourraient être désirées pour me rendre parfaitement heureuse. Il est si raisonnable, si gentil et si bon et si aimable aussi. Il a en plus l'apparence et l'extérieur les plus plaisants et les plus délicieux qu'il vous est possible de voir. À 17 ans, Victoria, bien qu'intéressée par Albert, n'était cependant pas prête à se marier. Les deux parties ne s'accordèrent pas sur un engagement formel mais supposèrent que l'union se ferait en temps et en heure.
Début de règne
Victoria fêta ses 18 ans le 24 mai 1837 et une régence fut évitée. Le 20 juin 1837, Guillaume IV mourut à l'âge de 71 ans et Victoria devint reine du Royaume-Uni. Dans son journal, elle écrivit, j'ai été réveillée à 6 h pile par Mamma qui me dit que l'archevêque de Cantorbéry et Lord Conyngham étaient là et qu'ils voulaient me voir. Je suis sortie du lit et me suis rendue dans mon salon en ne portant que ma robe de chambre et seule, je les ai vus. Lord Conyngham m'informa alors que mon pauvre oncle, le roi, n'était plus et avait expiré à 2 h 12 ce matin et que par conséquent Je suis Reine. Les documents officiels préparés le premier jour de son règne la nommaient Alexandrina Victoria mais le premier prénom fut retiré à sa demande et ne fut plus utilisé.
Depuis 1714, le Royaume-Uni était en union personnelle avec le royaume de Hanovre en Allemagne mais d'après la loi salique, les femmes étaient exclues de la succession au trône hanovrien. Alors que Victoria hérita de toutes les colonies britanniques, le pouvoir au Hanovre passa au jeune frère de son père, l'impopulaire duc de Cumberland et Teviotdale qui devint roi sous le nom d'Ernest-Auguste Ier de Hanovre. Il était l'héritier apparent de Victoria jusqu'à ce qu'elle ait un enfant.
Au moment de son accession au trône, le gouvernement était mené par le premier ministre whig Lord Melbourne et ce dernier exerça une influence importante sur la reine politiquement inexpérimentée. L'écrivain Charles Greville suggère que Lord Melbourne, veuf et sans enfants, était aussi attaché à elle que si elle avait été sa fille et Victoria le considérait probablement comme une figure paternelle. Son couronnement fut organisé le 28 juin 1838 et elle devint le premier souverain à résider au palais de Buckingham. Elle hérita des revenus des duchés de Lancastre et de Cornouailles et reçut une liste civile annuelle de 385 000 £ 28,5 millions de livres de 2011. Financièrement prudente, elle remboursa les dettes de son père.
Victoria était populaire au début de son règne, mais sa réputation fut ternie par une intrigue de cour en 1839 lorsque l'une des dames d'honneur, Flora Hastings, développa une rondeur abdominale dont la rumeur disait qu'il s'agissait d'une grossesse hors mariage liée à une relation avec John Conroy ; Victoria considérait que les rumeurs étaient véridiques. Elle détestait Conroy et méprisait cette odieuse Lady Flora car elle avait participé avec Conroy et la duchesse de Kent au système de Kensington. Hastings refusa initialement de se faire examiner avant d'accepter au milieu du mois de février et il se révéla qu'elle était vierge. Conroy, la famille de Hastings et les tories appartenant à l'opposition organisèrent une conférence de presse accusant la reine de propager de fausses rumeurs au sujet de Flora Hastings. Lorsqu'elle mourut en juillet, l'autopsie révéla une importante tumeur hépatique qui avait distendu son abdomen. Lors des apparitions publiques, Victoria fut sifflée et conspuée comme étant Mme Melbourne.
En 1839, Lord Melbourne démissionna après que les radicaux et les tories que Victoria détestait eurent voté contre une loi suspendant la constitution en Jamaïque. La législation supprimait les pouvoirs politiques des planteurs qui s'opposaient aux mesures associées à l'abolition de l'esclavage. La reine chargea un tory, Robert Peel de former un nouveau gouvernement. À l'époque, il était de coutume pour le premier ministre de nommer les dames de la chambre à coucher qui servaient de domestiques dans les résidences royales et étaient généralement des épouses de membres du parti au pouvoir. De nombreuses dames étaient des épouses de whigs et Peel souhaitait les remplacer par des épouses de tories. Dans ce qui fut appelé la crise de la chambre à coucher, Victoria, conseillée par Lord Melbourne, s'opposa à leur renvoi. Peel refusa de gouverner selon les conditions imposées par la reine et offrit sa démission, ce qui permit à Lord Melbourne de revenir au pouvoir.
Mariage
Même si elle était devenue reine, Victoria restait une jeune femme célibataire et les conventions sociales lui imposaient de vivre avec sa mère malgré leurs différends sur son éducation et la confiance que sa mère continuait d'accorder à Conroy. Sa mère était consignée dans un appartement isolé du palais de Buckingham et Victoria refusait souvent de la rencontrer. Lorsque Victoria se plaignit à Lord Melbourne que la proximité de sa mère promettait des souffrances pendant de nombreuses années, ce dernier compatit mais répondit que cela ne pouvait être évité que par un mariage, ce que Victoria qualifia d'alternative choquante. Elle montra de l'intérêt pour l'éducation d'Albert en vue de son futur rôle d'époux mais elle résista aux pressions qui la poussaient à se marier.
Victoria continua de faire l'éloge d'Albert après sa seconde visite en octobre 1839. Albert et Victoria ressentaient de l'attrait l'un pour l'autre et la reine le demanda en mariage le 15 octobre 1839, juste cinq jours après qu'il fut arrivé à Windsor. Ils se marièrent le 10 février 1840 dans la Chapel Royal du palais St. James à Londres. Victoria était follement éprise d'Albert et elle passa la nuit après son mariage alitée avec une migraine, mais qu'elle décrivit avec extase dans son journal :
Jamais, jamais, je n'oublierai une telle soirée !!! Mon très très cher Albert… sa passion et son affection excessives m'ont offert des sensations d'amour et de bonheur divins que je n'aurais jamais espéré ressentir auparavant ! Il m'a serrée dans ses bras et nous nous sommes embrassés encore et encore ! Sa beauté, sa douceur et sa gentillesse ; vraiment comment pourrais-je jamais être reconnaissante d'avoir un tel mari ! … d'être appelée par des noms de tendresse que je n'avais encore jamais entendus auparavant ; le bonheur était incroyable ! Oh ! Ce fut le plus beau jour de ma vie.!
Albert devint un influent conseiller politique de la reine en plus de son compagnon et remplaça Lord Melbourne comme la figure dominante de la première moitié de sa vie. La mère de Victoria fut expulsée du palais vers Ingestre House à Belgrave Square. Après la mort de la princesse Augusta en 1840, la mère de Victoria reçut les résidences de Clarence et de Frogmore. Grâce à la médiation d'Albert, les relations entre mère et fille s'améliorèrent progressivement.
Durant la première grossesse de Victoria en 1840, Edward Oxford âgé de 18 ans tenta d'assassiner la reine alors qu'elle se trouvait dans une calèche avec le prince Albert lors d'un déplacement pour rendre visite à sa mère. Oxford tira deux fois mais les deux balles manquèrent leur cible ou, comme il l'avança par la suite, les pistolets n'avaient pas fonctionné. Il fut jugé pour haute trahison et reconnu coupable mais fut acquitté pour raisons mentales ; il fut cependant interné pendant une trentaine d'années. La popularité de Victoria augmenta fortement après l'agression et cela apaisa le mécontentement résiduel au sujet de l'affaire Hastings et de la crise de la chambre à coucher. Sa fille, également appelée Victoria, naquit le 21 novembre 1840. La reine détestait être enceinte, considérait l'allaitement avec dégoût et pensait que les nouveau-nés étaient laids. Albert et elle eurent néanmoins huit autres enfants.
Le foyer de Victoria était largement géré par son ancienne gouvernante, la baronne Louise Lehzen originaire du Hanovre. Lehzen avait eu une profonde influence sur Victoria et l'avait défendue contre le système de Kensington. Albert considérait cependant que Lezhen était incompétente et que sa mauvaise gestion menaçait la santé de sa fille. Après une violente dispute entre Victoria et Albert à ce sujet, Lezhen fut limogée, ce qui mit un terme à sa relation étroite avec Victoria.
1842-1860
Le 28 mai 1842, Victoria descendait The Mall dans une calèche quand John Francis tenta de lui tirer dessus mais le pistolet ne fonctionna pas ; il parvint à s'échapper. Le lendemain, Victoria emprunta le même trajet plus rapidement et avec une plus grande escorte avec l'objectif délibéré de pousser Francis à attaquer à nouveau afin de le capturer. Comme prévu, Francis tira sur la calèche mais il fut arrêté par des policiers en civil et fut condamné pour haute trahison. Le 3 juillet, deux jours après que la condamnation à mort de Francis eut été commuée en déportation à vie, John William Bean tenta également de tirer sur la reine mais son pistolet n'avait pas la puissance espérée. Edward Oxford considérait que ces tentatives étaient encouragées par son acquittement en 1840. Bean fut condamné à 18 mois de prison. À nouveau en 1849, le chômeur irlandais William Hamilton tira sur la calèche de la reine alors qu'elle passait dans Constitution Hill. En 1850, la reine fut blessée par un ancien policier peut-être dément, Robert Pate. Alors que Victoria se trouvait dans une calèche, Pate la frappa avec une canne, écrasa son chapeau et la blessa au front. Hamilton et Pate furent tous deux condamnés à sept ans de déportation.
Le soutien à Lord Melbourn au sein de la Chambre des communes s'affaiblit dans les premières années du règne de Victoria et les whigs furent battus lors des élections générales de 1841. Peel devint premier ministre et les dames de la chambre à coucher les plus associées avec les whigs furent remplacées.
En 1845, L'agriculture irlandaise fut touchée par le mildiou de la pomme de terre. Dans les quatre années qui suivirent, un million d'Irlandais moururent de faim et un million d'autres émigrèrent dans ce qui fut appelé la Grande famine. En Irlande, Victoria fut surnommée The Famine Queen, la reine famine. Elle donna personnellement 2 000 £ 162 000 £ de 2011 pour lutter contre la famine, plus que tout autre donneur individuel78 et soutint également une aide à un séminaire catholique en Irlande malgré l'opposition des protestants. L'histoire selon laquelle elle n'aurait donné que 5 £ d'aide aux Irlandais et qu'elle aurait donné le même jour une somme similaire à l'organisation de protection des animaux, Battersea Dogs Home, est un mythe créé vers la fin du XIXe siècle.
En 1846, le gouvernement de Peel affronta une crise liée à l'abolition des Corn Laws. De nombreux tories, alors appelés conservateurs, étaient opposés au rejet mais Peel, certains tories, les Peelites, la plupart des whigs et Victoria y étaient favorables. Peel démissionna en 1846 après que l'abolition eut été votée de justesse et il fut remplacé par Lord Russell.
Au niveau international, Victoria s'intéressa particulièrement à l'amélioration des relations entre la France et le Royaume-Uni. Elle réalisa et accueillit plusieurs rencontres entre la famille royale britannique et la Maison d'Orléans qui étaient liées par mariage via les Cobourgs. En 1843 et 1845, Albert et elle rejoignirent le roi Louis-Philippe Ier au château d'Eu en Normandie ; elle fut ainsi le premier souverain britannique ou anglais à rencontrer son homologue français depuis Henri VIII d'Angleterre et François Ier de France au camp du Drap d'Or en 1520. Lorsque Louis-Philippe Ier réalisa le voyage inverse en 1844, il devint le premier roi français à se rendre en Grande-Bretagne. Louis-Philippe Ier fut déposé lors de la Révolution française de 1848 et partit en exil en Angleterre. Alors que les soulèvements se propageaient à toute l'Europe, Victoria et sa famille quittèrent Londres en avril 1848 pour la plus grande sécurité d'Osborne House, une résidence privée sur l'île de Wight qu'elle avait achetée en 1845. Les manifestations des chartistes et des nationalistes irlandais ne se transformèrent pas en soulèvements et la crainte d'une révolution s'éloigna. La visite de Victoria en Irlande en 1849 fut un succès en termes de relations publiques mais elle n'eut pas d'impact sur la croissance du nationalisme irlandais.
Le gouvernement de Lord Russel, bien que dominé par les whigs, n'était pas apprécié par la reine. Elle détestait particulièrement le secrétaire d'État des Affaires étrangères, Lord Palmerston, qui agissait souvent sans consulter le Cabinet, le premier ministre ou la reine. Victoria se plaignit à Russell que Palmerston envoyât des dépêches officielles à des chefs d'États étrangers sans l'informer mais Palmerston resta en poste et continua d'agir de sa propre initiative malgré les remontrances répétées. Ce ne fut qu'en 1851 que Palmerston fut limogé après avoir annoncé que le gouvernement britannique approuvait le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en France sans avoir consulté le premier ministre. L'année suivante, le président Bonaparte devint l'empereur Napoléon III et le gouvernement de Russel fut remplacé par un gouvernement minoritaire mené par Lord Derby.
En 1853, Victoria donna naissance à son huitième enfant, Leopold, avec l'aide d'un nouvel anesthésiant, le chloroforme. Victoria fut tellement impressionnée par son efficacité qu'elle l'utilisa à nouveau en 1857 pour la naissance de son neuvième et dernier enfant, Béatrice du Royaume-Uni, malgré l'opposition du clergé qui considérait que cela s'opposait aux commandements bibliques Genèse 3,16 et des médecins qui le considéraient comme dangereux. Victoria a peut-être été victime de dépression post-partum après ses nombreuses grossesses. Dans ses lettres à Albert, Victoria se plaignait parfois de sa perte de sang-froid. Un mois après la naissance de Leopold, Albert écrivit une lettre à Victoria pour se plaindre de son hystérie continue au sujet de misérables broutilles.
Au début de l'année 1855, le gouvernement de Lord Aberdeen, qui avait remplacé Derbey en décembre 1852, démissionna du fait des critiques concernant la mauvaise gestion de la guerre de Crimée. Victoria approcha Derby et Russel pour qu'ils forment un gouvernement mais aucun n'avait suffisamment de soutiens et elle fut obligée de nommer Palmerston au poste de premier ministre.
Le prince Albert, la reine Victoria et leurs neuf enfants en 1857. De gauche à droite : Alice, Arthur, le prince consort, Edward, Leopold, Louise, la reine Victoria avec Beatrice, Alfred, Victoria et Helena
Napoléon III, l'allié le plus proche du Royaume-Uni depuis la guerre de Crimée, se rendit à Londres en avril 1855 et Victoria et Albert firent le trajet inverse du 17 au 28 août de la même année98. L'empereur français accueillit le couple à Dunkerque et les accompagna à Paris où ils visitèrent l'exposition universelle, une réponse à l'exposition londonienne de 1851 imaginée par Albert, et la tombe de Napoléon Ier aux Invalides, dont les cendres avaient été rapatriées en 1840. Ils furent également les invités d'honneur à un bal de 1 200 invités au château de Versailles.
Le 14 janvier 1858, un Italien réfugié en Grande-Bretagne appelé Felice Orsini tenta d'assassiner Napoléon III avec une bombe fabriquée au Royaume-Uni. La crise diplomatique qui suivit déstabilisa le gouvernement : Palmerston démissionna et Derby redevint premier ministre. Victoria et Albert assistèrent à l'inauguration d'une nouvelle cale sèche dans le port militaire français de Cherbourg le 5 août 1858. À son retour, Victoria réprimanda Derby pour le mauvais état de la Royal Navy par rapport à la marine française. Le gouvernement de Derby ne survécut pas longtemps et Victoria rappela Palmerston en juin 1859.
Le 25 janvier 1858, La fille aînée de Victoria épousa le prince Frédéric Guillaume de Prusse à Londres. Ils étaient fiancés depuis septembre 1855 alors que la princesse Victoria n'avait que 14 ans et le mariage fut repoussé par la reine et le prince Albert jusqu'à ce que la mariée eût 17 ans. Victoria et Albert espéraient que leur fille et leur beau-fils auraient une influence libérale sur la Prusse en pleine ascension. Victoria vit partir sa fille pour l'Allemagne la mort dans l'âme; elle lui écrivit dans l'une de ses nombreuses lettres, cela me fait vraiment frissonner quand je regarde vos sœurs douces, joyeuses et inconscientes et que je pense que je devrais les abandonner également, une par une. Presque un an plus tard, la princesse Victoria donna naissance au premier petit-enfant de la reine, Guillaume.
Veuvage
En mars 1861, la mère de Victoria mourut avec sa fille à ses côtés. En lisant les documents de sa mère, Victoria découvrit que sa mère l'aimait profondément ; elle eut le cœur brisé et blâma Conroy et Lehzen pour l'avoir diaboliquement éloignée de sa mère. Pour soulager son épouse pendant cette période de deuil, Albert assuma une grande partie de ses fonctions bien qu'il souffrît de problèmes digestifs chroniques. En août, Victoria et Albert rendirent visite à leur fils, le Prince de Galles, qui assistait à des manœuvres militaires près de Dublin et passèrent quelques jours à Killarney. En novembre, Albert apprit les rumeurs selon lesquelles son fils avait couché avec une actrice en Irlande. Choqué, Albert se rendit à Cambridge où Edward étudiait pour le réprimander. Au début du mois de décembre, Albert tomba gravement malade. William Jenner diagnostiqua une fièvre typhoïde et il mourut le 14 décembre 1861 ; Victoria fut anéantie. Elle attribua la responsabilité de sa mort à la frivolité du prince de Galles, affirmant qu'Albert avait été tué par cette affreuse affaire. Elle resta en deuil et porta des vêtements noirs jusqu'à la fin de sa vie. Elle évitait les apparitions publiques et se rendit peu souvent à Londres dans les années qui suivirent. Son retrait dans le château de Windsor lui valut le surnom de veuve de Windsor.
Cet isolement volontaire diminua la popularité de la monarchie et encouragea le mouvement républicain118. Elle continua d'assumer ses fonctions gouvernementales mais choisit de rester confinée dans ses résidences royales de Windsor, de Balmoral et d'Osborne. En mars 1864, un manifestant placarda une affiche sur les grilles du palais de Buckingham annonçant que ces imposants bâtiments étaient à vendre en raison du déclin des affaires de l'ancien propriétaire. Son oncle Léopold lui écrivit pour lui conseiller d'apparaître en public. Elle accepta de visiter les jardins de la Royal Horticultural Society à Kensington et de traverser Londres dans une calèche ouverte.
Durant les années 1860, Victoria se reposa de plus en plus sur un domestique écossais, John Brown. Des rumeurs calomnieuses d'une relation romantique et même d'un mariage secret commencèrent à être imprimées dans la presse et la reine fut même affublée du sobriquet de Mme Brown. Une peinture d'Edwin Landseer représentant la reine avec Brown fut exposée à la Royal Academy et Victoria elle-même publia avec grand succès un livre, Leaves from the Journal of Our Life in the Highlands, où elle faisait un vibrant éloge de son homme de confiance. L'histoire de leur relation fit l'objet du film La Dame de Windsor de 1997.
Lord Palmerston mourut en 1865 et après un bref gouvernement mené par Russel, Derby revint au pouvoir. En 1866, Victoria assista à la cérémonie d'ouverture du Parlement pour la première fois depuis la mort d'Albert. L'année suivante, elle soutint le passage du Reform Act de 1867 qui doubla le nombre d'hommes ayant accès au suffrage même si elle n'était pas favorable au droit de vote des femmes. Derby démissionna en 1868 et fut remplacé par Benjamin Disraeli qui charma Victoria. Il déclara tout le monde aime la flatterie et, quand il s'agit de princes, il faut l'étendre avec une truelle. Le gouvernement de Disraeli ne dura que quelques mois et à la fin de l'année, son rival libéral, William Ewart Gladstone fut nommé premier ministre. Victoria considérait que la personnalité de Gladstone était bien moins attrayante ; elle aurait ainsi dit qu'il lui parlait comme si elle était une réunion publique plutôt qu'une femme.
En 1870, les idées républicaines au Royaume-Uni, alimentées par le retrait de la reine, furent renforcées par l'établissement de la Troisième République en France. Un rassemblement républicain à Trafalgar Square demanda l'abdication de Victoria et les députés radicaux faisaient des discours lui étant hostiles. En août et septembre 1871, elle tomba gravement malade et développa un abcès au bras ; Joseph Lister l'incisa avec succès et désinfecta la plaie avec une pulvérisation de phénol. À la fin du mois de novembre 1871, au maximum du mouvement républicain, le prince de Galles contracta la fièvre typhoïde, la maladie qui aurait tué son père, et Victoria craignait que son fils mourût aussi. Alors que le dixième anniversaire de la mort d'Albert approchait, la santé de son fils ne s'améliorait pas et l'angoisse de Victoria augmentait. Au grand soulagement du peuple, Edward se remit de la maladie. La mère et le fils assistèrent à une célébration publique à Londres et à une grande messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul le 27 février 1872 ; le mouvement républicain fut affaibli et la popularité de la monarchie remonta.
Le 28 février 1872, Arthur O'Connor âgé de 17 ans petit-neveu du député irlandais Feargus O'Connor agita un pistolet non-chargé devant le cortège de Victoria à sa sortie du palais de Buckingham. Brown, qui accompagnait la reine, neutralisa O'Connor qui fut par la suite condamné à 12 mois de prison. La popularité de Victoria fut encore renforcée par l'incident.
Impératrice des Indes
Après la révolte des cipayes de 1857 en Inde, la compagnie anglaise des Indes orientales, qui gouvernait une grande partie de l'Inde, fut dissoute et les possessions et les protectorats britanniques du sous-continent indien furent formellement incorporés dans l'Empire britannique. La reine avait une opinion assez partagée sur le soulèvement et elle condamna les atrocités perpétrées par les deux camps. Elle écrivit ses sentiments d'horreur et de regret à la suite de cette sanglante guerre civile et elle insista, pressée par Albert, pour qu'une proclamation officielle annonçant le transfert de pouvoir de la compagnie vers l'État portât des sentiments de générosité, de bienveillance et de tolérance religieuse. À sa demande, un passage menaçant de saper les coutumes et les religions locales fut remplacé par un paragraphe garantissant la liberté religieuse.
Après l'élection générale de 1874, Disraeli redevint premier ministre. Il présenta le Public Worship Regulation Act de 1874 qui supprimait les rituels catholiques de la liturgie anglicane et que Victoria soutenait fermement. Elle préférait les services religieux simples et courts et se considérait personnellement plus proche de l'Église d'Écosse presbytérienne plutôt que de l'Église d'Angleterre épiscopale. Il poussa également le Royal Titles Act de 1876 devant le Parlement pour que Victoria prît le titre d'impératrice des Indes à partir du 1er mai 1876. Ce nouveau titre fut proclamé par le darbâr de Delhi le 1er janvier 1877.
Le 14 décembre 1878, l'anniversaire de la mort d'Albert, la seconde fille de Victoria, Alice, qui avait épousé Louis IV de Hesse, mourut de la diphtérie à Darmstadt. Victoria nota que la coïncidence des dates était presque incroyable et des plus mystérieuses. En mai 1879, elle devint arrière-grand-mère à l'occasion de la naissance de la princesse Théodora de Saxe-Meiningen et fêta son pauvre et triste 60e anniversaire. Elle se sentit vieillie par la perte de son enfant chéri.
Entre avril 1877 et février 1878, Victoria menaça à cinq reprises d'abdiquer pour faire pression sur Disraeli pour qu'il agît contre la Russie lors de la guerre russo-turque mais ses menaces n'eurent pas d'effets sur les événements ou sur leur conclusion avec le traité de Berlin. La politique étrangère expansionniste de Disraeli, soutenue par Victoria, entraîna des conflits comme la guerre anglo-zouloue et la seconde guerre anglo-afghane. Elle écrivit si nous voulons maintenir notre position de puissance de premier rang, nous devons… être préparés à des attaques et des guerres, quelque part ou ailleurs.. Victoria voyait l'expansion de l'Empire britannique comme une manière civilisatrice et bénigne de protéger les peuples indigènes contre des puissances plus agressives, ou des dirigeants cruels, il n'est pas dans nos habitudes d'annexer des pays à moins que nous n'y soyons obligés et forcés. Au désarroi de Victoria, Disraeli perdit les élections générales de 1880 et Gladstone redevint premier ministre. Lorsque Disreali mourut l'année suivante, elle était aveuglée par les larmes coulant rapidement.
Dernières années
Le 2 mars 1882, Roderick McLean, un poète apparemment offensé par le refus de Victoria d'accepter l'un de ses poèmes, tira sur la calèche de la reine alors qu'elle quittait la gare de Windsor. Deux élèves de l'Eton College le frappèrent avec leurs parapluies jusqu'à ce qu'il fût neutralisé par un policier. Victoria fut outrée lorsqu'il échappa à la condamnation pour raisons mentales ; elle fut cependant ravie par les nombreuses expressions de loyauté qu'elle reçut après l'agression et déclara que cela valait la peine de se faire tirer dessus pour voir à quel point l'on est aimée.
Le 17 mars 1883 elle tomba dans les escaliers à Windsor et elle boita jusqu'au mois de juillet ; elle ne récupéra jamais complètement et commença à souffrir de rhumatismes. Brown mourut 10 jours après l'accident et à la consternation de son secrétaire privé, Henry Ponsonby, Victoria commença à rédiger une biographie eulogique de son ancien domestique. Ponsonby et Randall Davidson, le doyen de Windsor, qui avaient lu les brouillons, conseillèrent à Victoria de ne pas les publier car cela alimenterait les rumeurs d'une relation amoureuse; le manuscrit fut détruit. Au début de l'année 1884, Victoria publia More Leaves from a Journal of a Life in the Highlands, une suite de son précédent livre dédiée à son assistant personnel dévoué et ami fidèle John Brown. Un an exactement après la mort de Brown, Victoria fut informée par télégramme que son plus jeune fils, Léopold, était mort à Cannes. Elle se lamenta sur la perte du plus cher de mes chers fils. Le mois suivant, son plus jeune enfant, Beatrice, rencontra le prince Henri de Battenberg dont elle tomba amoureuse lors du mariage de la petite-fille de Victoria, la princesse Victoria de Hesse-Darmstadt, avec le frère d'Henri, le prince Louis Alexandre de Battenberg. Beatrice et Henri planifièrent un mariage mais Victoria commença par s'opposer à l'union car elle souhaitait que sa petite-fille restât avec elle en tant que suivante. Elle fut finalement convaincue par la promesse du futur couple de rester avec elle.
Victoria fut ravie quand Gladstone démissionna en 1885 après le rejet de son budget. Elle considérait que son gouvernement était le pire que j'aie jamais eu et lui fit porter la responsabilité de la mort du général Gordon à Khartoum. Gladstone fut remplacé par Lord Salisbury. Son gouvernement ne se maintint cependant que pendant quelques mois et Victoria fut obligée de rappeler Gladstone qu'elle qualifiait d'à moitié fou et un vieil homme en de nombreux points ridicule. Gladstone tenta de faire voter une loi garantissant une plus grande autonomie à l'Irlande mais à la jubilation de Victoria, elle fut rejetée. Après l'élection générale de 1886, les libéraux de Gladstone furent battus par les conservateurs de Salisbury qui formèrent à nouveau un gouvernement.
Jubilé d'Or
En 1887, l'Empire britannique célébra le jubilé d'or de Victoria. La reine fêta le cinquantième anniversaire de son accession au trône le 20 juin avec un banquet auquel participèrent 50 nobles européens. Le lendemain, elle participa à une procession et à un service religieux à l'abbaye de Westminster. Victoria était alors redevenue extrêmement populaire. Deux jours plus tard, le 23 juin, elle recruta deux Indiens musulmans comme domestiques. L'un d'eux, Mohammed Abdul Karim devint Munshi secrétaire et enseigna l'hindoustani à la reine. Sa famille et les autres domestiques furent choqués et accusèrent Abdul Karim d'espionner pour la Muslim Patriotic League et de monter la reine contre les hindous. L'écuyer Frederick Ponsonby, le fils d'Henry découvrit qu'Abdul Karim avait menti au sujet de ses origines et rapporta au vice-roi des Indes, Lord Elgin, que le Munshi occupe exactement la même position que celle qu'avait John Brown. Victoria ignora ces plaintes qu'elle qualifia de racistes. Abdul Karim resta à son service jusqu'à la mort de la souveraine en 1901 et il rentra alors en Inde avec une pension.
La fille aînée de Victoria devint impératrice d'Allemagne en 1888 mais elle devint veuve avant la fin de l'année et le petit-fils de Victoria monta sur le trône sous le nom de Guillaume II. Sous son règne, les espoirs de libéralisation de l'Allemagne ne furent pas comblés et Guillaume II mit en place un régime autocratique.
Gladstone redevint premier ministre à l'âge de 82 ans après l'élection générale de 1892. Victoria s'opposa à la nomination du député radical Henry Labouchère au Cabinet et Gladstone accepta. En 1894, le premier ministre prit sa retraite et, sans le consulter, Victoria nomma Lord Rosebery. Son gouvernement était faible et il fut remplacé l'année suivante par Lord Salisbury qui resta premier ministre jusqu'à la fin du règne de Victoria.
Jubilé de diamant
Le 23 septembre 1896, Victoria devint le monarque de l'histoire anglaise, écossaise, ou britannique ayant régné le plus longtemps, dépassant le record détenu jusqu'alors par son grand-père, George III. Conformément à la demande de la reine, toutes les célébrations publiques spéciales de l'événement furent retardées jusqu'en 1897 pour coïncider avec son jubilé de diamant marquant ses 60 années de règne. Le secrétaire d'État aux colonies, Joseph Chamberlain, proposa que le jubilé devînt un festival de l'Empire britannique.
Les Premiers ministres de tous les dominions autonomes furent invités et des troupes de tout l'Empire britannique participèrent à la procession du jubilé dans Londres. Les célébrations du soixantième anniversaire furent marquées par de grands débordements d'affection envers la reine bientôt octogénaire.
Victoria se rendait régulièrement en Europe continentale pendant ses vacances. En 1889, durant un séjour à Biarritz, elle devint le premier monarque britannique à poser le pied en Espagne lorsqu'elle traversa la frontière pour une courte visite. En avril 1900, la guerre des Boers était devenue tellement impopulaire en Europe que son voyage annuel en France fut jugé inopportun. Elle se rendit donc en Irlande pour la première fois depuis 1861, en partie pour reconnaître la contribution des régiments irlandais dans le conflit en Afrique du Sud. En juillet, son second fils, Alfred Affie mourut et elle écrivit dans son journal Oh, Dieu ! Mon pauvre chéri Affie est parti aussi. C'est une année horrible, rien d'autre que la tristesse et l'horreur sous une forme ou une autre.
Mort et succession
Suivant une coutume qu'elle maintint tout au long de son veuvage, Victoria passa le réveillon de Noël 1900 à Osborne House sur l'île de Wight. Elle boitait du fait de ses rhumatismes et sa vision était obscurcie par la cataracte. Durant le mois de janvier, elle se sentit faible et souffrante et au milieu du mois, elle était somnolente… hébétée et perdue. Elle mourut le 22 janvier 1901 vers 18 h 30 à l'âge de 81 ans. Son fils et successeur, Édouard VII, et son petit-fils le plus âgé, Guillaume II, se trouvaient à son chevet. Sa dernière volonté fut que son Poméranien préféré, Turri, fût posé sur son lit de mort.
En 1897, Victoria avait demandé que ses funérailles fussent militaires du fait de son statut de chef de l'armée et de fille de soldat et que le blanc dominât par rapport au noir. Le 25 janvier, Édouard VII, l'empereur d'Allemagne et le prince Arthur de Connaught aidèrent à la porter dans son cercueil. Elle fut habillée d'une robe blanche et d'un voile de mariée. Des souvenirs rappelant sa famille élargie, ses amis et ses domestiques furent placés dans le cercueil à sa demande. Un des peignoirs d'Albert fut placé à son côté avec un moulage en plâtre de sa main tandis qu'une mèche de cheveux de John Brown et une photographie de lui furent placées dans sa main gauche et dissimulées à la famille par un bouquet de fleur bien positionné. Ses funérailles furent organisées le samedi 2 février dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor et après deux jours d'exposition publique, elle fut inhumée aux côtés d'Albert dans le mausolée royal de Frogmore dans le Grand Parc de Windsor195.
Héritage
Le règne de Victoria, qui dura 63 ans, sept mois et deux jours, demeure le plus long de toute l'histoire du Royaume-Uni et le plus long pour une reine au niveau mondial. Elle fut le dernier souverain britannique de la Maison de Hanovre car son fils et héritier Édouard VII appartenait à la Maison de Saxe-Cobourg-Gotha de son mari le prince Albert.
Selon l'un de ses biographes, Giles St Aubyn, Victoria écrivait chaque jour une moyenne de 2 500 mots. De juillet 1832 jusqu'à sa mort, elle rédigea un journal détaillé qui finit par représenter 122 volumes. Après la mort de Victoria, sa plus jeune fille, Béatrice du Royaume-Uni devint son exécutrice littéraire et elle retranscrivit et édita les journaux de Victoria et détruisit les originaux. Malgré leur destruction, la plupart des journaux ont été préservés. En plus des copies éditées de Béatrice, Lord Esher retranscrivit les journaux écrits entre 1832 et 1861 avant leur destruction par Beatrice. Une partie de l'importante correspondance de Victoria a été publiée en volumes par Arthur Christopher Benson, Hector Bolitho, George Earle Buckle, Lord Esher, Roger Fulford et Richard Hough entre autres.
Victoria était physiquement peu attrayante ; elle était corpulente, inélégante et ne mesurait que 150 cm mais elle parvint à projeter une image impressionnante. Elle rencontra l'impopularité dans les premières années de son veuvage mais elle devint très appréciée dans les années 1880 et 1890 lorsqu'elle incarna l'Empire sous la forme d'une figure matriarcale bienveillante. Ce ne fut qu'après la publication de ses journaux et de ses lettres que l'étendue de son influence politique fut révélée au grand public. Les biographies rédigées avant que la plus grande partie des sources primaires ne fût devenue disponible, comme celle de Lytton Strachey, Queen Victoria de 1921, sont aujourd'hui considérées comme dépassées. Celles d'Elizabeth Longford et de Cecil Woodham-Smith en 1964 et 1972 restent encore largement admirées. Celles-ci et d'autres concluent que Victoria avait une personnalité émotive, obstinée, honnête et franche.
Durant le règne de Victoria, l'établissement progressif d'une monarchie constitutionnelle en Grande-Bretagne continua. Les réformes du système électoral accrurent le pouvoir de la Chambre des communes aux dépens de la Chambre des Lords et du souverain. En 1867, le journaliste Walter Bagehot écrivit que le monarque ne conservait que le droit d'être consulté, le droit de conseiller et le droit de mettre en garde. Alors que la monarchie britannique devenait plus symbolique que politique, elle mit un fort accent sur la morale et les valeurs familiales en opposition aux scandales sexuels et financiers qui avaient été associés aux précédents membres de la Maison de Hanovre et avaient discrédité la monarchie. Son règne vit la création du concept de monarchie familiale, à laquelle pouvaient s'identifier les classes moyennes naissantes.
Les liens de Victoria avec les familles royales d'Europe lui valurent le surnom de grand-mère de l'Europe. Victoria et Albert eurent 42 petits-enfants et 34 arrivèrent à l'âge adulte. Parmi ses descendants figurent Élisabeth II du Royaume-Uni, son époux Philip Mountbatten, Harald V de Norvège, Charles XVI Gustave de Suède, Marguerite II de Danemark, Juan-Carlos Ier d'Espagne et son épouse Sofía de Grèce.
Le plus jeune fils de Victoria, Leopold était atteint d'hémophilie B ainsi que deux de ses cinq filles, Alice et Béatrice du Royaume-Uni. Cette maladie fut ainsi transmise aux descendants de Victoria dont ses arrière-petits-fils, Alexis Nikolaïevitch de Russie, Alphonse et Gonzalve de Bourbon. La présence de cette maladie chez les descendants de Victoria mais pas chez ses ancêtres ont poussé certains à avancer que son véritable père n'était pas le duc de Kent mais un hémophile. Rien n'indique qu'un hémophile ait été en relation avec la mère de Victoria et comme les porteurs masculins souffrent toujours de la maladie, si ce dernier existait il aurait été gravement malade. Il est plus probable que la mutation se soit produite spontanément chez le père de Victoria qui avait plus de 50 ans au moment de sa conception et l'hémophilie se développe plus souvent chez les enfants de pères âgés. Des mutations spontanées sont la cause de 30 % des cas.
Dans la culture populaire
Lieux nommés d'après la reine Victoria en anglais.
Du fait de sa longévité et du développement de l'Empire britannique, un très grand nombre de lieux et de bâtiments ont été nommés en l'honneur de la reine Victoria essentiellement dans le Commonwealth of Nations. On peut par exemple citer la capitale des Seychelles, le plus grand lac d'Afrique, les chutes Victoria, les capitales de la Colombie-Britannique Victoria et de la Saskatchewan Regina et les États australiens du Victoria et du Queensland.
La Croix de Victoria fut créée en 1856 pour récompenser les actes de bravoure pendant la guerre de Crimée et elle reste la plus haute distinction militaire britannique, canadienne, australienne et néo-zélandaise. La Fête de la Reine Victoria Day est un jour férié au Canada et dans certaines parties de l'Écosse et elle est célébrée le lundi précédant le 25 mai pour commémorer la naissance de la reine Victoria.
Le Penny Black fut le premier timbre-poste émis en 1840 et portait l'effigie de la reine Victoria.
Médaille à l'effigie de Victoria décernée aux participants de l'expédition britannique en Éthiopie de 1868
Victoria a été jouée à l'écran par :
Julia Faye dans le film muet The Yankee Clipper 1927
Madeleine Ozeray dans le film La Guerre des valses 1933
Fay Holden dans le film The White Angel 1936 sur la vie de Florence Nightingale
Yvette Pienne dans le film Les Perles de la couronne 1937
Viva Tattersall dans le film Âmes à la mer 1937
Anna Neagle dans le film biographique Victoria the Great 1937 et Sixty Glorious Years 1938
Beryl Mercer dans le film Petite Princesse 1939, basé sur le roman de Frances Hodgson Burnett
Fay Compton dans le film The Prime Minister 1941 sur Benjamin Disraeli et Journey to Midnight 1968
Pamela Brown dans le film Alice au pays des merveilles 1949 dans lequel elle joua également la reine de cœur
Irene Dunne dans le film Moineau de la Tamise 1950
Renée Asherson dans la série Happy and Glorious 1952
Sybil Thorndike dans le film La Valse de Monte-Carlo 1953 sur la vie de la soprano Nellie Melba
Romy Schneider dans le film Les Jeunes Années d'une reine 1954
Julie Harris dans le téléfilm Victoria Regina 1961 pour lequel elle remporta l'Emmy Award de la meilleure actrice
Jane Connell dans l'épisode La reine Victoria de la série Ma sorcière bien-aimée 1967
Terry Jones dans l'épisode Sexe et Violence de la série Monty Python's Flying Circus 1969
Mollie Maureen dans le film La Vie privée de Sherlock Holmes 1970
Peter Sellers dans le film parodique The Great McGonagall 1974 sur la vie de William McGonagall
Michael Palin dans l'épisode Michael Ellis de la série Monty Python's Flying Circus 1974
Perlita Neilson et Mavis Edwards pour la fin de sa vie dans la série La Chute des aigles 1974
Susan Field dans le film parodique Le Frère le plus futé de Sherlock Holmes 1975
Annette Crosbie dans la série Edward the King 1975
Rosemary Leach dans la série Disraeli 1978
Lurene Tuttle dans l'épisode Buffalo Bill & Annie Oakley Play the Palace de la série Voyages au bout du temps 1983
Miriam Margolyes dans l'épisode de Noël de la série La Vipère noire 1988
Anna Massey dans la série Le Tour du monde en quatre-vingts jours 1989
Honora Burke dans le téléfilm La Main de l'assassin 1990
Judi Dench dans le film La Dame de Windsor 1997 pour lequel elle fut nommée pour l'oscar de la meilleure actrice
Rhoda Lewis et Avril Angers pour la fin de sa vie dans la série Victoria and Albert 1997
Patti Allen dans la série The Secret Adventures of Jules Verne 2000
Liz Moscrop dans le film From Hell 2001 basé sur le roman graphique éponyme
Victoria Hamilton et Joyce Redman pour la fin de sa vie dans la série Victoria & Albert 2001
Gemma Jones dans le film Shanghai Kid 2 2003
Prunella Scales dans le téléfilm Station Jim 2001 et dans le documentaire Looking for Victoria 2003
Kathy Bates dans le film Le Tour du monde en quatre-vingts jours 2004 basé sur le roman éponyme de Jules Verne
Pauline Collins dans l'épisode Un loup-garou royal de la série Doctor Who 2006
Emily Blunt dans le film Victoria : Les Jeunes Années d'une reine 2009 avec Michaela Brooks jouant la jeune Victoria
Imelda Staunton doublant Victoria dans le film d'animation Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout 2012.
Titres et armoiries
24 mai 1819 - 20 juin 1837 : Son Altesse royale la princesse Alexandrina Victoria de Kent
20 juin 1837 - 22 janvier 1901 : Sa Majesté la reine
1er mai 1876 - 22 janvier 1901 : Sa Majesté Impériale la reine-impératrice par rapport à l'Inde britannique
À la fin de son règne, son titre complet était Sa Majesté Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Défenseur de la Foi.
Armoiries
Il ne fut pas concédé d'armoiries à Victoria avant son accession au trône. Comme elle ne pouvait pas monter sur le trône de Hanovre, ses armoiries de monarque ne portaient pas les symboles hanovriens arborés par celles de ses prédécesseurs. Ses armoiries ont été portées par tous ses successeurs britanniques y compris la reine actuelle, Élisabeth II du Royaume-Uni.
En dehors de l'Écosse, l'écu des armoiries royales de Victoria, également utilisé sur les armes royales, était : Écartelé : au 1 et 4, de gueules, à trois léopards d'or armés et lampassés d'azur l'un sur l'autre qui est Angleterre, au 2, d'or, au lion de gueules armé et lampassé d'azur, au double trescheur fleuronné et contre-fleuronné du même qui est Écosse, au 3, d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent qui est Irlande. En Écosse, les premier et quatrième quarts sont occupés par le lion écossais et le second par les lions anglais. Les supports diffèrent également entre l'Écosse et le reste du Royaume-Uni          6  
Posté le : 16/05/2015 14:21
|
|
|
|
|
Nicolas Copernic |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 mai 1543, à 70 ans meurt Nicolas Copernic
en polonais : Mikołaj Kopernik [miˈkɔwaj kɔˈpɜrnik] en allemand : Nikolaus Kopernikus, latin : Nicolaus Copernicus Torinensis/Thorunensis/Torunensis, né le 19 février 1473 à Toruń, Prusse royale, Royaume de Pologne, chanoine, médecin et astronome polonais. Il existe une controverse sur sa véritable nationalité. Il explore plusieur champs scientifique, l'astronomie, mathématiques, physique, médecine, il reçoit sa formation à l'université de Cracovie, puis celle de Bologne, De Padoue,et enfin celle de Ferrare en italie. Il est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'Univers et la Terre tourne autour de lui contre la croyance répandue que cette dernière était centrale et immobile. Les conséquences de cette théorie dans le changement profond des points de vue scientifique, philosophique et religieux qu'elle impose sont baptisées révolution copernicienne.
L'astronome polonais Nicolas Copernic doit être considéré comme l'un des plus grands génies de son époque. Il a conquis une gloire universelle grâce à sa théorie du mouvement de la Terre et des planètes. Dans son système héliocentrique (connu, depuis lors, sous le nom de système de Copernic), toutes les planètes tournent autour du Soleil, et la Terre n'est plus qu'une planète comme les autres, dont la rotation sur elle-même donne l'alternance du jour et de la nuit. Malgré la grande simplicité de son système, Copernic ne réussit pas à faire admettre ses idées à ses contemporains.
À côté de son intérêt astronomique, l'œuvre de Copernic eut une portée philosophique immense. Elle marqua l'un des tournants essentiels de la pensée, ébranlant la vision médiévale du monde, qui plaçait l'homme au centre d'un univers fait pour lui. Cela explique les réactions violentes qu'elle souleva pendant plus de deux siècles.
En bref
Nicolas Copernic est né le 19 février 1473 à Toruń, ville dont le nom dérive d'un mot polonais tarn, et, plus tard, tarnina qui désigne le prunellier, espèce abondante dans la région. Située à un point stratégique de la rive nord de la Vistule, la ville de Toruń avait été transformée en forteresse par les chevaliers de l'ordre Teutonique, qui l'appelèrent Thorn. Ils y avaient introduit des colons de langue allemande afin de fortifier leur emprise sur les terres qu'ils avaient arrachées de force aux précédents habitants. D'autres immigrés de même langue s'étaient installés pacifiquement en de nombreuses régions de la Pologne. Ce mouvement des Allemands vers l'est, en partie militaire, en partie pacifique, chassa les aïeux de Nicolas Copernic, aux environs de 1275, vers un petit village de Haute-Silésie nommé Kopernik. Lorsqu'un habitant d'un village s'installait dans une ville, il associait fréquemment à son nom de baptême, le seul nom couramment employé à l'époque, la désignation de son ancien lieu de résidence. Avec le temps, ce dernier nom devenait un nom de famille héréditaire, porté par plusieurs familles. C'est ce qui se produisit pour celle de Nicolas Copernic.
Vers 1400, un de ses ancêtres quitta la ville de Kopernik et alla à Cracovie, alors capitale du royaume de Pologne. Nicolas Copernic père était un important négociant de cette ville lorsque la guerre vint bouleverser le cours de sa vie. Les villes et la noblesse rurale supportaient de plus en plus mal la tyrannie de l'ordre Teutonique ; leur organisme représentatif, la Ligue prussienne, sollicita l'alliance avec le roi de Pologne par des négociations au cours desquelles le père de l'astronome servit d'émissaire et, le 4 février 1454, la guerre éclata entre l'ordre Teutonique et la Ligue prussienne alliée à la Pologne. Peu après, Copernic père déménagea de Cracovie à Toruń, l'un des principaux centres de l'insurrection.
C'est à Toruń, en 1464, qu'il épousa la fille d'un riche bourgeois, Barbara Watzenrode, dont il eut quatre enfants. Le cadet, Nicolas, qui allait devenir chanoine et astronome, n'avait que dix ans lorsque le père mourut, en 1483. Heureusement, le frère unique de Barbara, Lucas Watzenrode, qui poursuivait une brillante carrière ecclésiastique et jouissait des revenus de plusieurs bénéfices, était en mesure de venir en aide à sa sœur et à ses neveux. Devenu en 1489 évêque de Warmie, il fit entrer ses neveux, André et Nicolas, à l'université Jagellon de Cracovie, dont les archives ont gardé la trace de l'inscription du second pour le semestre d'hiver de 1491 : Nicolas fils de Nicolas, de Toruń, a tout payé. Les mathématiques et l'astronomie étaient alors enseignées à Cracovie par de bons spécialistes. On ne trouve, en revanche, aucune trace de la fin des études universitaires de Nicolas à Cracovie. Il est probable que, comme beaucoup de ses condisciples, il n'y resta pas pendant les quatre années requises pour l'obtention d'un diplôme. Il lui fallait résoudre le problème de sa carrière future. L'évêque de Warmie y veillait. La mort d'un chanoine, survenue le 26 août 1495, ouvrit une vacance au chapitre de Frombork et permit l'élection de Copernic comme chanoine de Warmie. Puis celui-ci partit pour l'Italie et s'inscrivit à l'université de Bologne pour y préparer un doctorat en droit canon : les cours débutèrent le 19 octobre 1496.
Bien qu'étudiant en droit canon, Copernic semblait marquer déjà une préférence pour l'astronomie. Il eut alors la chance de rencontrer l'astronome Domenico Maria Novara 1454-1504 et de devenir plus son assistant que son élève, si l'on en croit Rheticus. En tout cas, sa première observation astronomique se situe à Bologne : le 9 mars 1497, la Lune occulta l'étoile Aldébaran vers onze heures du soir. Dans son De revolutionibus, Copernic utilisera cette observation pour estimer la parallaxe lunaire.
Le pape Alexandre VI ayant proclamé l'an 1500 année de jubilé, Copernic, le 6 septembre, à la fin des cours de l'université de Bologne, partit pour Rome. Dans sa Narratio prima, Rheticus dit que vers l'an 1500, âgé de vingt-sept ans environ, Copernic fut à Rome professeur de mathématiques devant une large audience d'étudiants et un cercle d'hommes éminents et de spécialistes dans cette branche de la science. On peut se demander quel sujet il exposa alors devant ce public de choix. En fait, il est à peu près certain que sa conception de la Terre comme planète en mouvement autour du Soleil n'a été élaborée qu'une dizaine d'années plus tard. S'il en avait discuté au grand jour à Rome vers 1500, devant un public de spécialistes, leurs publications et leurs correspondances en auraient fait écho et l'affirmation de Rheticus ne serait pas la seule trace de ce cycle de conférences romaines. On sait aussi que, lors de son séjour à Rome, Copernic observa l'éclipse partielle de Lune du 6 novembre 1500.
Le 27 juillet 1501, il se présenta devant le chapitre de la cathédrale de Frombork et sollicita deux années supplémentaires d'études en Italie. Alors que ses études de droit canon n'avaient pas encore été sanctionnées par un titre de docteur, c'est pour y étudier spécialement la médecine qu'il obtint cette nouvelle bourse du chapitre. Pour tenir sa promesse, il lui fallut aller à Padoue, où se trouvait alors la plus célèbre école de médecine, sachant toutefois qu'il ne pourrait obtenir un titre en cette discipline puisqu'il ne partait que pour deux ans ! Il entra donc à la faculté de médecine de Padoue pour le semestre d'hiver 1501 et revint en Warmie au cours du second semestre de 1503. Pour éviter de rentrer les mains vides au chapitre de Frombork, il obtint le droit de présenter une thèse en droit canon devant l'université de Ferrare et fut proclamé docteur dans cette discipline le 31 mai 1503.
Dans les quelques années qui suivirent, on ne trouve aucune trace de ses activités au chapitre de la cathédrale de Frombork. En revanche, on le sait toujours en compagnie de son oncle, dont le palais épiscopal ne se trouvait pas à Frombork mais à Lidzbark en allemand Heilsberg. Le jeune chanoine était alors occupé plus par la diplomatie et la médecine, le 7 janvier 1507, le chapitre de Warmie le nomma médecin de l'évêque que par l'astronomie et les tâches capitulaires. C'est probablement de cette époque que datent les deux portraits que fit Copernic de lui-même et qui ont été perdus : il reste cependant une copie d'une de ces peintures à la cathédrale de Strasbourg et une gravure de l'autre comme frontispice du livre de Tycho Brahe Astronomiae instauratae Mechanica.
L'activité médicale de Copernic ne cessa pas avec la mort de son oncle, survenue le 29 mars 1512, mais elle devint plus épisodique, Nicolas étant plus présent à Frombork, où il se consacra à l'astronomie et à la gestion des fermages du chapitre. Il fut même nommé administrateur de celui-ci, le 11 novembre 1516, pour une durée d'un an. Il s'acquitta sans doute de sa charge d'une façon satisfaisante, puisque ce mandat lui fut renouvelé en 1517 et en 1518. Auparavant, il avait eu le temps de rédiger son premier écrit astronomique, vers 1513, en tout cas avant le 1er mai 1514 : en effet, à cette date, Matthias de Miechow 1457-1523, professeur à l'université de Cracovie, signale dans le catalogue de sa bibliothèque personnelle un manuscrit de six feuilles exposant la théorie d'un auteur qui affirme que la Terre se déplace tandis que le Soleil reste immobile. Cette référence fait allusion à un manuscrit ayant circulé anonymement et sans titre. Cependant, le bref sommaire qu'en donne Matthias de Miechow permet de penser qu'il ne peut s'agir que du premier écrit astronomique de Copernic, qui est maintenant connu sous le titre de Commentariolus et dont on a retrouvé trois exemplaires manuscrits, aucun n'étant de la main de Copernic.
Les décisions de l'administrateur étaient consignées dans un registre. Quinze pages de ce registre comportent soixante-treize entrées différentes, dont soixante-six sont de la main même de Copernic : elles s'étendent sur une période allant du 10 décembre 1516 au 14 août 1519. À peine Copernic était-il déchargé de ses tâches d'administrateur du chapitre que les chevaliers Teutoniques envahissaient la Warmie, le 1er janvier 1520. Il se retrouva alors administrateur d'Olsztyn, dont il fut le commandant militaire jusqu'à la signature d'une trêve marquant la fin des hostilités, le 15 février 1521. Puis il lui fallut réinstaller des paysans dans les fermes abandonnées à cause de la guerre et rétablir le contrôle du chapitre dans tout le nord de la Warmie.
Mais l'activité qui l'intéressait le plus en dehors de l'astronomie fut celle d'économiste. Au début du XVIe siècle se développait une crise monétaire aiguë. La monnaie de papier n'était pas encore introduite dans la région et, dans les transactions courantes, on utilisait encore exclusivement des pièces de monnaie métalliques, faites habituellement d'un alliage d'argent et de cuivre. Comme ces pièces provenaient de différents ateliers de frappe, le pourcentage d'argent par rapport au cuivre se réduisait sans cesse. Les responsables de la frappe tiraient profit de ces réductions, ainsi que les orfèvres qui faisaient fondre de vieilles pièces et vendaient l'argent ainsi obtenu. Seuls les gens du peuple, qui ne comprenaient pas cette astuce spéculative, ainsi que le souligne Copernic, continuaient à régler leurs achats avec des pièces anciennes. À mesure que la mauvaise monnaie chassait la bonne, les pauvres s'appauvrissant davantage et les riches s'enrichissant, la crise monétaire devenait plus aiguë. La plus ancienne étude empirique sur la désorganisation économique provoquée par ce système monétaire métallique fut l'Essai sur la frappe de la monnaie que Copernic composa en latin et data du 15 août 1517. À la demande des États de la Prusse-Occidentale, il en rédigea une version en allemand, en 1519. Il suggérait de retirer de la circulation l'ancienne monnaie et d'interdire son emploi à l'avenir, et conseillait de n'émettre que 10 nouveaux marks pour 13 anciens, chacun devant se résigner à cette perte permettant d'obtenir une monnaie stable. Cette stabilité devait pouvoir s'instaurer si le droit de frapper la monnaie était réservé à un organisme unique qui s'engagerait à maintenir une proportion fixe d'argent par rapport au cuivre. Enfin, devant la nécessité d'établir une parité entre les monnaies prussienne et polonaise, Copernic établit une table de correspondance entre les deux ; il joignit cette table à la version allemande de son Essai, qui fut lu le 21 mars 1522 à la réunion des États de Prusse-Occidentale. On ne sera pas étonné d'apprendre qu'aucune décision ne fut prise ni à cette occasion, ni durant les années qui suivirent !
Sa vie
Nicolas Copernic naît le 19 février 1473 dans une famille riche de la ville hanséatique de Toruń Thorn, en Poméranie. Son père, prénommé également Nicolas, est un bourgeois de Cracovie venu s'établir à Thorn peu avant l'annexion de la région par le royaume de Pologne, et suffisamment intégré pour y devenir échevin. Sa mère, Barbara Watzelrode ou Watzenrode est d'une ancienne famille de Thorn, probablement originaire de Silésie. Il est recueilli par son oncle maternel, futur évêque de Varmie en allemand : Ermland, Lukas Watzelrode ou Lucas Watzenrode à la suite du décès de son père vers 1483.
Toruń en allemand : Thorn, la ville où est né Nicolas Copernic
Celui-ci veille sur son neveu et s'assure qu'il fréquente les meilleures écoles et universités ; en 1491, il devient étudiant à l'Université de Cracovie, actuellement l'université jagellonne de Cracovie où il étudie les mathématiques et l'astronomie quadrivium, mais aussi la médecine et le droit, tout en suivant probablement le trivium, cours habituel de la Faculté des arts centré sur la dialectique et la philosophie. Il quitte cette université après trois ou quatre ans, trop tôt pour obtenir un diplôme.
Il retourne alors chez son oncle, qui tente de le faire élire chanoine au chapitre de la cathédrale de Frombork. Sans attendre la confirmation de son élection en 1497, il se rend en 1496 en Italie où il étudie à l'université de Bologne le droit canonique puis le droit civil, mais aussi la médecine et la philosophie. Il y apprend de plus le grec, qui lui servira grandement pour étudier les sources de la science antique. À Bologne, il loge chez l'astronome Domenico Maria Novara, qui est l'un des premiers à remettre en cause l'autorité de Ptolémée.
Selon Rheticus, il fut moins le disciple que l'assistant et le témoin des observations du très savant Dominicus Maria. C'est ainsi que Copernic fit la première observation dont nous ayons connaissance, celle de l'occultation de l'étoile Aldébaran par la Lune, le 9 mars 1497.
En 1500, il donne, d'après Rheticus, une conférence sur l'astronomie à Rome, et y observe une éclipse partielle de lune. Le chanoine Copernic se rend l'année suivante au chapitre de la cathédrale de Frombork, où on lui accorde une absence supplémentaire de deux ans pour étudier la médecine. Il poursuit donc ses études en médecine et droit à l'université de Padoue, réputée pour son enseignement de médecine. Mais c'est à Ferrare, le 31 mai 1503, qu'il obtient le titre de docteur en droit canon, le doctorat de médecine aurait nécessité trois années d'études.
À la fin de ses études, en 1503, il quitte définitivement l'Italie et réintègre son diocèse.
Humaniste aux activités multiples
À son retour en Pologne, Copernic se loge auprès de son oncle dans le palais épiscopal de Lidzbark Warmiński. Il assiste l'évêque dans l'administration du diocèse (qui disposait d'une autonomie politique vis-à-vis du roi de Pologne, et devient également son médecin personnel. La réputation du médecin Copernic semble avoir été grande, puisqu'après la mort de Lukas Watzelrode, il soigne deux de ses successeurs les évêques Maurice Ferber et Johannes Dantiscus, mais aussi d'autres personnalités et des gens du peuple.
En bon humaniste, Copernic s'essaye aussi à la traduction du grec : son premier livre, imprimé en 1509, est une traduction latine de lettres grecques dont l'auteur est un Byzantin du VIIe siècle, Théophylacte Simocatta. Copernic devient ainsi le premier Polonais à publier en Pologne une traduction d'un auteur grec.
Copernic ne succèdera pas à son oncle, ainsi que celui-ci l'aurait souhaité, mais il ne délaisse pas pour autant ses tâches de chanoine de l'évêché de Warmie institution politique tout autant que religieuse. Ainsi, il occupe à plusieurs reprises le poste important d'administrateur des biens du chapitre à Olsztyn, Allenstein. L'invasion de la Warmie par les chevaliers teutoniques en 1520 l'amène même à devenir commandant militaire d'Olsztyn jusqu'à la fin des hostilités. C'est encore à Olsztyn qu'il compose un Essai sur la frappe de la monnaie, à l'occasion de la crise monétaire qui touche son pays.
Tout au long de ces années, et probablement dès son retour d'Italie, Copernic continue ses recherches en astronomie, et réalise quelques observations des astres depuis la tour de la cathédrale de Frombork en allemand Frauenburg, qu'il a fait aménager pour cela et où il vécut la plus grande partie de sa vie. Il se convainc rapidement de la nécessité d'abandonner le modèle d'Univers de Ptolémée au profit d'un système héliocentrique. C'est ainsi qu'il écrit, dès les années 1511-1513, De Hypothesibus Motuum Coelestium a se Contitutis Commentariolus connu sous le titre de Commentariolus, un court traité qui expose le système héliocentrique et qu'il fait circuler, sous forme manuscrite, auprès de ses amis.
Palais épiscopal de Heilsberg Lidzbark Warmiński où vécut Copernic
C'est à la même période que Copernic, dont les compétences astronomiques sont visiblement reconnues, est sollicité dans le cadre du Ve concile du Latran sur la réforme du calendrier.
Il écrit plus tard son œuvre principale De Revolutionibus Orbium Coelestium, Des révolutions des sphères célestes, achevé vers 1530. Cette œuvre magistrale ne sera publiée, par un imprimeur luthérien de Nuremberg, que le 24 mai 1543, peu de temps avant la mort de Copernic. Elle n'aurait sans doute jamais été publiée sans l'intervention enthousiaste d'un jeune professeur de mathématiques, Georg Joachim Rheticus.
Système et théories de Copernic
Le système héliocentrique de Copernic " De Revolutionibus orbium coelestium "
Copernic propose une rupture radicale dans l'organisation du cosmos jusque-là établie : les systèmes du monde admis à son époque avaient un point commun, leur géocentrisme : la Terre était immobile au centre de l'univers, tous les astres tournant autour. Au contraire, Copernic place le Soleil au centre de l'univers, la Terre devenant une planète tournant autour de ce point fixe ; c'est l'héliocentrisme.
Motivations
Pour justifier cette remise en cause totale, Copernic met en exergue les défaillances des systèmes astronomiques existants : tout d'abord, leur multiplicité, d'Eudoxe à Ptolémée en passant par les nombreux aménagements opérés aux théories de ce dernier par les astronomes qui lui ont succédé. Ensuite, leur incapacité à décrire avec précision les phénomènes observés. Enfin, le manque d'ordre et d'harmonie dans ces systèmes extrêmement complexes. Concernant la théorie de Ptolémée, il ajoute une sévère critique de l'astucieuse invention de ce dernier, l'équant, qui viole le principe de l'uniformité des mouvements circulaires par rapport à leur centre, ce qui la rend irréaliste aux yeux de Copernic.
Il propose en réponse à ces insuffisances un système reposant sur quelques axiomes révolutionnaires présentés dès le Commentariolus, et étayé par une démonstration mathématique minutieuse, exposée dans le De Revolutionibus.
Axiomes du système héliocentrique
Ayant disposé le Soleil au centre de l'Univers, il dote donc la Terre de deux mouvements principaux : sa rotation, la Terre tourne sur elle-même et fait un tour sur son axe en une journée explique dans un premier temps le mouvement diurne de la sphère céleste en un jour, la sphère des étoiles demeurant immobile ; sa révolution annuelle autour du Soleil fait de la Terre une planète, toutes les planètes tournant autour du Soleil. La Terre n'est plus que le centre des mouvements de la Lune.
Pour Copernic, le mouvement de la terre seule suffit donc à expliquer un nombre considérable d'irrégularités apparentes dans le ciel, notamment le mouvement rétrograde des planètes, phénomène qui n'était expliqué qu'à grand peine par les systèmes géocentriques. Pour justifier que l'on ne perçoive pas les effets de la révolution annuelle de la Terre par un effet de parallaxe sur les étoiles, Copernic postule enfin que la sphère des étoiles se situe à une distance considérable, bien plus importante que ce que l'on imaginait jusqu'alors.
Avantages du système copernicien
Pour son auteur, la grande force de ce système héliocentrique est qu'il introduit ordre et harmonie dans le cosmos. Il y a en particulier une corrélation logique entre les distances des planètes au centre du système et leur période de révolution. En effet, plus l'orbite d'une planète est grande, plus il lui faudra de temps pour faire une révolution complète autour du Soleil, ce qui n'était pas le cas pour Mercure et Vénus dans le système de Ptolémée, ces deux planètes ayant la même période de révolution que le Soleil. Copernic n'a plus besoin des monstrueux épicycles des planètes que Ptolémée avait introduits pour expliquer leurs rétrogradations. Il élimine également l'incroyable coïncidence qui donnait par exemple à Mars, Jupiter et Saturne la même période d'un an sur ces épicycles de tailles pourtant inégales. Sa théorie explique en outre pourquoi les planètes internes, Vénus et Mercure, ne s'écartent jamais beaucoup du Soleil, et ne se retrouvent jamais en opposition par rapport à lui.
Le système de Copernic permet même de mesurer les distances de chaque planète au Soleil, ce qui était impossible dans un système géocentrique. C'est ce qui permettra plus tard à Johannes Kepler de calculer les trajectoires de ces astres, et d'établir les lois du mouvement dans le Système solaire, lois sur lesquelles Isaac Newton s'appuiera pour élaborer sa théorie de la gravité.
Univers de Copernic : plus simple et moderne que celui de Ptolémée ?
Malgré la modernité révolutionnaire de son système, Copernic conserve toutefois certains éléments archaïques des anciens systèmes du monde : ainsi l'idée aristotélicienne, pourtant abandonnée par Ptolémée et même probablement déjà par Hipparque des sphères solides, ou encore la sphère des fixes, contenant les étoiles et marquant la limite d'un univers fini.
On oppose souvent la complexité du système de Ptolémée et de leurs dérivés à la simplicité du système de Copernic. En effet, le premier comporte une multitude de cercles, excentriques et épicycles, tandis que la représentation classique du second ne montre que les six cercles des planètes et celui de la Lune, voir l'illustration. Et il est vrai, comme Copernic nous le dit, que son modèle a permis de supprimer les énormes cercles disgracieux épicycles ou excentriques destinés à justifier les inégalités des mouvements des astres, rétrogradations. Cependant, ce schéma du système héliocentrique est trompeur, car extrêmement simplifié. En effet, Copernic considère que le mouvement circulaire uniforme est un principe fondamental de l'astronomie. Or, les observations contredisent l'uniformité des mouvements célestes. Pour concilier ce principe avec la réalité, Copernic, qui a rejeté l'équant de Ptolémée, est obligé d'ajouter à son système une multitude de petits épicycles et d'excentriques dont l'effet est de moduler la vitesse de chaque planète sur son parcours.
Au nom du principe antique de l'uniformité des mouvements circulaires, Copernic a donc rendu son système tout aussi complexe que celui de Ptolémée. Cependant, de nombreux commentateurs de l’œuvre du chanoine-astronome maintiennent que celui-ci a introduit une simplification, car les épicycles de Copernic, beaucoup plus petits que les cercles déférents, ne sont là que pour corriger les petites variations de vitesse et de position des planètes, qui se déplacent en réalité à vitesse variable sur des orbites elliptiques par rapport à une trajectoire circulaire uniforme, et ne sont pas nécessaires, en première approche, pour décrire les irrégularités apparentes les plus importantes de leurs trajectoires, rétrogradations. Au contraire, les épicycles de Ptolémée, de tailles beaucoup plus importantes, et comparables à celles des déférents, sont indispensables pour expliquer ces irrégularités et ne peuvent donc être omis, même en première approximation.
Influences Inspirateurs, selon Copernic, de sa théorie
Copernic n'est pas l'inventeur de la théorie héliocentrique. Selon Archimède et Plutarque, l'astronome grec Aristarque de Samos était partisan de l'héliocentrisme, dès le iiie siècle avant notre ère. Copernic d'ailleurs mentionne son prédécesseur, ainsi que les sources antiques qui lui ont inspiré l'hypothèse du mouvement de la Terre. Car, selon son propre témoignage, il a commencé sa recherche, en bon humaniste, par la lecture des textes des Anciens : C'est pourquoi je pris la peine de lire les livres de tous les philosophes que je pus obtenir, pour rechercher si quelqu'un d'eux n'avait jamais pensé que les mouvements des sphères du monde soient autres que ne l'admettent ceux qui enseignèrent les mathématiques dans les écoles. Et je trouvai d'abord chez Cicéron que Nicétus40 pensait que la terre se mouvait. Plus tard je retrouvai aussi chez Plutarque que quelques autres ont également eu cette opinion.
— Nicolas Copernic, De Revolutionibus orbium coelestium
Il nomme alors, dans une citation de pseudo Plutarque, Philolaus le pythagoricien, pour qui la Terre tournait, comme le Soleil et tous les astres, autour d'un feu central, Héraclide du Pont et Ecphantus le pythagoricien qui admettaient la rotation de la Terre sur son axe. Et il poursuit : Partant de là, j'ai commencé, moi aussi, à penser à la mobilité de la Terre.
Il est à noter que, s'il reconnaît que ces astronomes antiques ont eu l'idée du mouvement de la Terre, il ne signale pas qu'Héraclide avait imaginé, en plus de la rotation de la Terre sur elle-même, que Mercure et Vénus tournaient autour du Soleil, ni qu'Aristarque était à l'origine d'un système héliocentrique: il se contente d'écrire que, selon certains, Aristarque, comme Philolaus, avait admis la mobilité de la Terre. Cette unique mention d'Aristarque, d'ailleurs, sera rayée dans le manuscrit et n'apparaîtra pas dans la version imprimée du De Revolutionibus.
Enfin, il fait référence à Martianus Capella, ainsi qu'à quelques autres Latins, qui estimèrent, en effet, que Vénus et Mercure tournent autour du soleil, qui est au centre, et pour cette raison-là ne peuvent s'éloigner de lui plus loin que ne le permettent les convexités de leurs orbes. Le système de Capella que celui-ci appelle système égyptien, et qui est aussi celui d'Héraclide, dans lequel seules Vénus et Mercure tournent autour du Soleil, ce dernier et les autres planètes tournant autour de la Terre, pourrait avoir amené Copernic sur la voie de l'héliocentrisme.
Influences possibles ou probables
En plus des influences grecques qu'il revendique, Copernic a peut-être été influencé par des astronomes arabes et perses du Moyen Âge. Il n'en fait pas mention dans son œuvre, mais certains modèles mathématiques utilisés pour décrire le mouvement des astres sont identiques à ceux établis par les astronomes de l’école de Maragha aux XIII et XIVe siècles. Ainsi, il utilise pour décomposer un mouvement linéaire en mouvements circulaires la même méthode que l'astronome perse al-Tusi.
De même, son modèle du mouvement de la Lune est pratiquement identique à celui d’Ibn al-Shatir, qui a en outre développé au XIVe siècle des théories planétaires proches de celles décrites par Copernic. Copernic a-t-il eu connaissance des textes de l'école de Maragha ? Nous l'ignorons, mais nous ne pouvons qu'être frappés par ces similitudes.
Ce qui est intéressant, c'est que certains astronomes du monde musulman ont évoqué contre Ptolémée la possibilité d'un mouvement de la Terre, suivant en cela les Grecs et Latins que nous avons cités. Ainsi, la rotation de la Terre sur elle-même a été discutée dès le xe siècle, en particulier par al-Biruni, qui l'a finalement rejetée pour les mêmes raisons qu'Aristote et Ptolémée. Plus tard, des astronomes de Maragha, parmi lesquels Ibn al-Shatir, ont poursuivi et approfondi cette réflexion.
En Europe également, le système de Ptolémée et la physique d'Aristote ont été contestés par des philosophes et des astronomes connus de Copernic, et qui ont pu l'amener sur la voie de l'héliocentrisme. Ainsi, les philosophes Nicolas de Cues, XVe siècle, qui dans la Docte ignorance chasse la Terre du centre du monde et la rend mobile, ou Jean Scot Érigène IXe siècle, qui, allant plus loin qu'Héraclide et Martianus Capella, fait tourner autour du Soleil non seulement Mercure et Vénus, mais aussi Mars et Jupiter. Au XIVe siècle, des débats ont eu lieu à l'université de Paris sur l'hypothèse du mouvement de rotation de la Terre, comme le rapporte Pierre Duhem, qui cite à ce propos Nicole Oresme, dont il fait un précurseur de Copernic. L'astronome du XVe siècle Peurbach et son élève Regiomontanus, étudiés par Copernic, pourraient avoir eu, selon Ernst Zinner, une influence sur la conversion de Copernic à l'héliocentrisme. Le premier avait débattu du mouvement de la Terre, et noté la corrélation entre les mouvements des planètes et ceux du Soleil ; le second aurait écrit à la fin de sa vie : Il faut modifier un peu le mouvement des étoiles à cause du mouvement de la Terre.
Copernic, inventeur génial ou plagiaire ,
Nous voyons donc que les réflexions sur le mouvement de la Terre et la place du Soleil n'étaient pas neuves au temps de Copernic, et que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, elles avaient largement eu cours au Moyen Âge, tant dans l'Europe chrétienne que dans le monde musulman. Thomas S. Kuhn écrit à ce propos59 :
Du fait que Copernic commença là où Ptolémée s'était arrêté, beaucoup de gens conclurent que la science fut inexistante au cours des siècles qui séparent la vie de ces deux hommes. En fait, l'activité scientifique, bien qu'intermittente, fut très intense et joua un rôle essentiel dans la préparation du terrain qui permit à la révolution copernicienne de commencer et de s'imposer.
Toutefois, il ne faudrait pas pour autant, ainsi que le fait Arthur Koestler, minimiser l'apport personnel de Copernic dans la révolution héliocentrique. L'opinion du célèbre auteur des Somnambules a d'ailleurs été reprise depuis, l'étude récente des précurseurs arabo-perses de l'astronome polonais tendant à la renforcer. Mais Koestler reconnaît lui-même60 que Copernic a eu l'immense mérite de développer l'idée de l'héliocentrisme, envisagée par d'autres avant lui, pour en faire un système complet, à l'instar de celui de Ptolémée. Personne avant lui n'avait construit un tel système, dans toute sa complexité, ni défendu l'héliocentrisme avec autant d'application et de conviction. Et nul ne conteste que c'est le De Revolutionibus, conçu comme un nouvel Almageste, qui marque, par son importance historique considérable, l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler, à juste titre, la révolution copernicienne.
Révolution copernicienne
Avant Copernic, la façon de voir le cosmos reposait sur la thèse aristotélicienne que la Terre est au centre de l'univers et que tout tourne autour d'elle : l'univers géocentrique . La description des mouvements des astres reposait sur le système dit de Ptolémée et la théorie des épicycles. Cette vision de l'univers le géocentrisme demeura la doctrine établie jusqu’à la fin de la Renaissance et ne fut totalement abandonnée par les savants et par l'Église que vers 1750.
Réticences
Portrait de Copernic par Jan Matejko : Conversation avec Dieu.
Au xvie siècle, on croit fermement que la Terre est immobile, et la théorie du géocentrisme est la règle universelle. On accepte mal que la Terre soit mobile. Les chercheurs et scientifiques du xvie siècle acceptent certains éléments de la théorie, en revanche la base de l'héliocentrisme est rejetée.
L'acceptation de la nouvelle théorie va devenir l'enjeu d'une lutte d'influence aux confins de l'Université, de la politique et de la religion. Dès 1533, le pape Clément VII avait connaissance des travaux de Copernic sans les critiquer et, en 1536, le cardinal-archevêque de Capoue Nikolaus von Schönberg l'encourage à communiquer ses recherches64. Fort de cet accueil, Copernic fait parvenir au pape Paul III un exemplaire dédicacé de la première version de son livre De revolutionibus coelestium. De son vivant, à aucun moment, Copernic ne fut inquiété par l'Église.
Cependant, seuls une dizaine de chercheurs de son époque lui accordent un appui. Mais ces chercheurs travaillent souvent à l'extérieur des universités subventionnées, dans des cours royales ou impériales, ou encore même tout près de l'Église. Les plus célèbres sont Galilée 1564-1642 qui n'était pas contemporain de Nicolas Copernic, mort en 1543, Léonard de Vinci ses correspondances privées en font état au travers de messages codés et l'astronome allemand Johannes Kepler 1571-1630. En 1582, lors de la grande réforme du calendrier par le pape Grégoire XIII les travaux de Copernic sur l'héliocentrisme furent utilisés. Ce n'est qu'après, qu'une féroce bataille d'universitaires va déclencher la polémique qui aboutira à la condamnation des travaux de Copernic, malgré des efforts pour tenter de trouver un compromis.
Près de cent ans après la parution du livre Des révolutions des sphères célestes, réticences et hésitations existent toujours. Si certains philosophes jésuites sont profondément convaincus, certains sont même disciples de Copernic, d'autres acceptent plutôt le système de Tycho Brahe. L'astronome danois Tycho Brahe soutient une théorie qui garde la Terre immobile mais qui prévoit que toutes les autres planètes tournent autour du Soleil pendant que celui-ci tourne autour de la Terre, ce qui, sur le strict plan mathématique, est équivalent au système de Copernic.
Galilée défend les travaux de Copernic et mène une féroce guerre d'influence contre ses collègues universitaires italiens qui montent contre lui les dominicains. Galilée est l'ami du pape et ne peut être directement attaqué. Ses adversaires vont donc s'attacher à mettre à l'Index les travaux de Copernic qui est sa référence. Le pape refuse de déclarer Copernic hérétique mais ne peut empêcher de faire condamner ce qui pourrait déborder sur la théologie. Le système de Copernic sera finalement condamné en 1616. Galilée reste un fervent défenseur de la théorie copernicienne et son attitude aboutit au fameux procès de 1633 où il est condamné par un tribunal ecclésiastique.
Dès 1664, les auteurs coperniciens sont retirés de l'Index, mais il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir se réconcilier la plupart des savants de l'Europe, grâce à la mise en place de la mécanique céleste d'Isaac Newton. Mis à part la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et le Danemark, le reste de l'Europe garde sa position anti-copernicienne pendant encore un siècle. La première preuve scientifique de la rotation de la Terre autour du Soleil fut produite, en 1728, par James Bradley, par l'explication qu'il donna à l'aberration de la lumière.
À partir de 1741 et sous l'influence de Roger Boscovich le pape Benoît XIV abandonne progressivement le système géocentrique. En 1757 le jésuite obtient que les livres de Copernic et Galilée soient retirés de l'Index. Galilée est réhabilité en 1784, mais ce n'est que dans les années 1820-1830 que l'Église accepte définitivement et complètement l'idée que la Terre tourne autour du Soleil.
Son influence
Copernic a retardé de plusieurs années la parution de l'œuvre de sa vie. Ses croyances et la peur de la réaction de l'Église et de Wittenberg en sont les principales raisons. Ce texte ne sera publié que le jour de sa mort.
Il n'oublia pas une dédicace au pape Paul III dans son œuvre rédigée en latin où il revendiqua le droit à la liberté d'expression.
Copernic sut libérer les scientifiques et chercheurs de leurs préjugés le système cosmologique d'Aristote et de Ptolémée était longtemps resté la référence. Il amena aussi par la suite les théologiens à s'interroger sur l'interprétation des textes sacrés. Il fallut attendre le XIXe siècle pour que les théologiens prennent une certaine distance vis-à-vis de l'interprétation trop littérale des textes sacrés, ce qui nécessita tout de même un renouvellement des études bibliques exégèse et herméneutique.
L'influence de Copernic se fit sentir jusque dans le domaine philosophique : Descartes, qui avait rédigé un Traité du monde et de la lumière, fut étonné de la décision de l'Inquisition lorsqu'il apprit la condamnation de Galilée procopernicien en 1633. C'est la raison pour laquelle Descartes s'orienta vers la philosophie et rédigea le fameux Discours de la méthode et quelques autres ouvrages philosophiques qui constituaient un projet de recherche d'une science universelle.
Ce n'est pas sans raison que l'on parle de révolution copernicienne, car l'influence du système de Copernic se fit sentir profondément dans tous les domaines de la connaissance humaine.
La publication du De revolutionibus
Il est probable que Copernic, en ces années 1520, non seulement pratiquait l'astronomie, mais aussi travaillait déjà au livre qui devait être l'Almageste des Temps modernes et amorcer cette grande révolution astronomique et physique dont les Principia de Newton allaient être le sommet et l'achèvement, un siècle et demi plus tard. À lire le récit des nombreuses charges que Copernic dut assumer, on comprend que l'ouvrage ne pouvait que lentement avancer. En tout cas, le Commentariolus en fait foi, Copernic avait, depuis déjà au moins une dizaine d'années, choisi l'héliocentrisme comme système du monde. Il travaillait donc, sans doute épisodiquement, à son grand ouvrage, mais il n'est pas certain qu'il ait eu l'intntion de le publier un jour, malgré l'insistance de son ami le plus intime, Tiedemann Giese 1480-1550, alors évêque de Chełmno. Lorsque Bernard Wapowski 1450-1535, secrétaire du roi de Pologne, lui rendit visite à l'automne 1535, Copernic lui annonça qu'il avait rédigé de nouvelles tables planétaires qui devaient servir de bases au calcul d'un almanach beaucoup plus exact que ceux qui étaient alors en circulation et qu'il souhaitait que cet almanach fût effectivement publié. Le manuscrit, aujourd'hui perdu, fut envoyé par Wapowski à Vienne mais ne fut jamais édité.
Si Copernic était disposé à livrer au public de simples colonnes de chiffres, il en allait tout autrement des principes novateurs sur lesquels ces chiffres étaient fondés. Il ne tenait nullement, semble-t-il, à provoquer les philosophes et les théologiens par la publication de ses théories révolutionnaires. Il pensait, comme il l'écrit dans le livre I du De revolutionibus, qu'il fallait « ne confier les secrets de la philosophie qu'à des amis fidèles et à des proches, et ne pas mettre ces secrets par écrit, ni les révéler à n'importe qui ». Et, lorsque, le 1er mai 1536, le cardinal Nicolas Schönberg 1472-1537 offrit de faire copier à ses frais les œuvres de Copernic, ce dernier ne lui communiqua rien et ne permit aucune copie ! En tout cas, par les amis fidèles, Giese, Wapowski, Schönberg, et par les quelques privilégiés qui avaient disposé d'une copie manuscrite du Commentariolus, les théories de Copernic cheminaient lentement dans le monde savant. Suffisamment pour atteindre Wittenberg et intéresser George Joachim von Lauchen, dit Rheticus.
Rheticus 1514-1574, unique disciple que Copernic ait eu de son vivant, arriva à la fin de mai 1539 auprès de lui, à Frombork. Il dut se mettre aussitôt au travail et assimiler très vite l'essentiel de ses théories, puisque, dès 1540, un résumé des thèses coperniciennes, la Narratio prima, fut publié anonymement à Gdańsk. Philipp Melanchthon 1497-1560, principal guide intellectuel de l'Allemagne luthérienne et protecteur de Rheticus à l'université de Wittenberg, eut l'honneur de recevoir les premiers feuillets de la Narratio en cours d'édition. L'accueil fut plutôt bon et la sortie de cet opuscule d'une soixantaine de pages ne provoqua pas l'explosion redoutée par Copernic. Et, l'année suivante, en 1541, une deuxième édition de la Narratio, signée par Rheticus cette fois-ci, vit le jour à Bâle. Grand ami de Rheticus, le médecin Achilles Pirmin Gasser 1505-1577 avait accepté d'en écrire la préface. Aussi Copernic laissa-t-il imprimer son De revolutionibus et entreprit-il de faire les retouches finales à son manuscrit, encore que la lecture du dernier livre de l'ouvrage donne une fâcheuse impression de brouillon inachevé.
Rheticus fit une copie du manuscrit, en y apportant, avec l'accord de Copernic, quelques corrections mineures. Le 29 août 1541, Rheticus pria le duc Albert de Prusse d'intervenir auprès de l'Électeur de Saxe et de l'université de Wittenberg, afin qu'il lui fût permis de publier le De revolutionibus de Copernic. Trois jours plus tard, le duc répondit à sa demande et Rheticus reprit, peu après, ses fonctions de professeur de mathématiques à Wittenberg. En revanche, il semble que ni l'Électeur de Saxe, ni l'université de Wittenberg n'accordèrent l'autorisation demandée.
Si Rheticus parvint à publier, sans difficulté, à Wittenberg en 1542, un ouvrage purement technique de Copernic, le De lateribus et angulis triangulorum, le problème était entièrement différent avec le De revolutionibus et, bien que les autorités de Wittenberg n'eussent pas été hostiles à sa personne – il avait été élu doyen de la faculté des arts le 18 octobre 1541 –, Rheticus estima que l'atmosphère régnant à Wittenberg n'était pas propice à la publication d'un ouvrage qui risquait de provoquer d'âpres controverses. Et, en effet, les sentiments anticoperniciens étaient très forts dans la citadelle du luthéranisme. Si, par la suite, l'Église catholique devait se rattraper, c'est, dans un premier temps, au sein du monde protestant que les réactions furent les plus négatives. Aussi Rheticus décida-t-il de prendre un autre congé à la fin du semestre d'hiver, le 1er mai 1542. Il gagna Nuremberg, où résidait l'imprimeur Johannes Petreius 1497-1550, avec lequel il était en excellents termes et qui était spécialisé dans l'impression d'ouvrages mathématiques et astronomiques. En août 1540, Petreius avait publié un ouvrage qu'il avait dédié à Rheticus ; dans cette dédicace, il avait fait une allusion à la Narratio prima et exprimé l'espoir que la publication du grand ouvrage de Copernic couronnerait les efforts de Rheticus. Et c'est chez Petreius que, vers la fin de mai 1542, furent imprimés, et corrigés par Rheticus, deux cahiers du De revolutionibus. Le mois suivant, en juin 1542, Copernic composa sa belle dédicace au pape Paul III, qui est l'un des plaidoyers les plus convaincants en faveur de la liberté d'expression. L'astronome y fait preuve d'une clarté d'esprit et d'un courage qui démentent l'expression, littérairement efficace mais totalement fausse, de chanoine craintif sous laquelle Arthur Koestler désigne Copernic.
Rheticus ne put rester assez longtemps à Nuremberg pour surveiller toute l'impression du De revolutionibus : il s'était, en effet, fait nommer professeur de mathématiques à l'université de Leipzig, où il devait se rendre en personne pour le début de l'année universitaire, à la mi-octobre 1542. Petreius confia la tâche de réviseur à un autre de ses amis, Andreas Osiander 1498-1552, éminent pasteur luthérien, passionné de mathématiques, qui était certainement compétent mais se crut autorisé à écrire une lettre préface qui diminuait considérablement la portée de l'œuvre de Copernic. Cette préface non signée, dans laquelle beaucoup virent l'œuvre de Copernic lui-même, présentait le système héliocentrique comme une hypothèse parmi d'autres possibles, fiction calculatoire un peu plus efficace que la fiction ptoléméenne.
Pendant que ces événements se déroulaient à Nuremberg, loin de là, à Frombork, Copernic tombait gravement malade. Il avait déjà pris la précaution de se choisir, comme coadjuteur dans son canonicat, un parent éloigné. Ayant reconnu la gravité de la maladie de Copernic, le père du coadjuteur demanda, le 30 décembre 1542, à l'évêque de Warmie, Johannes Dantiscus, d'intervenir pour que son fils pût prendre possession sans difficulté du canonicat qui devait être bientôt vacant. Copernic donc, dès la fin de 1542, touchait au terme de sa vie.
Le 29 janvier 1543, l'évêque de Warmie écrivait à l'un de ses amis – l'astronome hollandais Gemma Frisius 1508-1555 – qui éprouvait un grand intérêt pour l'œuvre de Copernic que celui-ci, souffrant des effets d'une attaque de paralysie, était maintenant presque mourant. Une hémorragie cérébrale, suivie de la paralysie de tout le côté droit, entraîna sa mort, le 24 mai 1543. La tradition veut que, le même jour, un exemplaire de l'édition de Nuremberg du De revolutionibus lui soit parvenu alors qu'il était sur le point d'expirer. L'anecdote est hagiographiquement trop séduisante pour que l'on se prive de la rapporter.
Sens et limite d'une révolution
Parmi les grandes œuvres qui jalonnent la route de l'astronomie, celle de Copernic est peut-être la plus contestée. Ainsi ce dernier apparaît-il comme ayant été par deux fois fauteur de troubles. Fauteur de troubles en son temps, parmi les astronomes, les philosophes et les théologiens. Fauteur de troubles aujourd'hui, parmi les historiens des sciences, les uns le considérant, non seulement comme le père de l'astronomie moderne, mais de toute la science moderne, les autres le traitant comme négligeable. Faux débat, bien souvent, qu'illustre cette fausse question : Copernic est-il le dernier astronome du Moyen Âge ou le premier des Temps modernes ?
Or, s'il est vrai que l'œuvre scientifique de Copernic est déroutante déroutante par sa minceur même, par les conditions de son apparition et, il faut bien l'avouer, par certaines de ses faiblesses, s'il est vrai que Copernic lui-même a été en grande partie ignorant de ses propres richesses Copernic mauvais copernicien, la simple objectivité oblige à cette constatation qu'avec lui, et avec lui seul, s'amorce un grand bouleversement d'où sortiront l'astronomie et la physique modernes. Les jugements et les choix d'un Galilée et d'un Kepler pèsent plus lourd dans la balance que les arguties des compteurs d'épicycles ! À notre avis, il s'agit donc d'une révolution. Mais encore faut-il savoir de quoi l'on parle.
Au temps de Copernic, l'astronomie était dominée depuis quatorze siècles par l'œuvre de Ptolémée. Si ce n'est pas dans l'Almageste lui-même, c'est au moins dans ses adaptations, ses paraphrases et ses commentaires que les étudiants apprennent cette science. Dans l'Almageste se mêlent trois composantes bien distinctes : d'abord, une vision globale du monde, une cosmologie ; ensuite, un outil mathématique, essentiellement la trigonométrie, au service de la résolution des triangles plans et sphériques ; enfin, une astronomie pratique, en l'occurrence un ensemble de modèles géométriques, de tableaux de chiffres et de recettes de cuisine permettant de localiser à un moment donné les astres vagabonds, les planètes, la Lune et le Soleil sur le grand quadrillage immuable des étoiles fixes.
Si la trigonométrie et la pratique astronomique peuvent être innocentes, il n'en saurait être de même pour la cosmologie. Une cosmologie suppose une philosophie de la nature, pour le moins une physique, au sens moderne du terme. La cosmologie de Ptolémée est tributaire d'une physique qui règne depuis déjà cinq siècles, celle d'Aristote. Il en résulte une série d'axiomes qui longtemps verrouilleront l'astronomie.
Premièrement, le géocentrisme, qui veut que la Terre, rigoureusement immobile, siège au milieu du monde, unique centre des mouvements célestes. Deuxièmement, une dichotomie de l'Univers : d'une part, le monde terrestre, qui va jusqu'à l'orbe de la Lune, monde du changement, du périssable, de la génération et de la corruption, monde des mouvements rectilignes, vers le haut pour les éléments légers, l'air et le feu ; vers le bas, pour les éléments lourds, la terre et l'eau ; d'autre part, le cosmos, au-delà de l'orbe de la Lune, monde de l'immuable, de la non-physique, du cinquième élément, l'éther. Troisièmement, l'axiome du mouvement circulaire uniforme ou de ses combinaisons comme étant le seul mouvement possible pour les corps célestes – avec, comme pour marquer les limites de l'emprise idéologique sur les sciences, la tricherie géniale de Ptolémée, l'équant.
Pendant quatorze siècles donc, cette astronomie devait fonctionner sans troubles graves. Les astronomes, à partir des modèles et des paramètres de Ptolémée, au besoin légèrement modifiés, dressaient des tables des mouvements planétaires, lunaires et solaires, tables qu'ils remettaient à jour lorsque les écarts entre les prévisions et les observations devenaient intolérables. Et – singularité de la révolution copernicienne – au temps de Copernic, cette situation pouvait se perpétuer ; aucun progrès dans la précision des observations pas plus d'ailleurs que dans l'outil mathématique ou la physique du monde ne venait obliger à bouleverser le système du monde. On en a une preuve dans le fait que Tycho Brahe 1546-1601, astronome des générations suivantes qui fera gagner un facteur dix à la précision des observations, refusera l'héliocentrisme copernicien et imaginera un système mixte entre celui de Ptolémée et celui de Copernic.
Pourtant, en 1543, ce dernier avait offert au monde savant un nouveau système cosmologique en contradiction totale avec les apparences et le vécu immédiat. Et cela dans un ouvrage, le De revolutionibus, qui se voulait construit à l'image de l'Almageste et où l'on retrouve les trois composantes de celui-ci : une cosmologie totalement nouvelle sur laquelle nous reviendrons ; un outil mathématique rigoureusement identique à celui des prédécesseurs ; une astronomie pratique qui n'est ni plus ni moins efficace que celle de Ptolémée et où foisonnent effectivement, à ce niveau opératoire, les épicycles, les excentriques et les épicycles d'épicycles. Autant, et peut-être même plus, que dans l'astronomie pratique de Ptolémée. Peu de changements donc. Simplement, dans la grande machinerie de l'Univers, en apparence toujours aussi complexe, Copernic se contente de permuter le lieu, et la fonction, de deux pièces, la Terre et le Soleil. On serait tenté de dire : la révolution copernicienne, c'est, bien entendu, l'héliocentrisme, mais ce n'est que l'héliocentrisme. Peut-être. Mais quelle brèche se trouve ainsi ouverte dans l'ancienne conception du monde et quelle dynamique est offerte aux générations suivantes ! Et d'abord, quoi qu'en pense Arthur Koestler dans Les Somnambules, quelle simplification du monde ! Le nombre des cercles n'a rien à voir ici ; ce sont leurs fonctions qui comptent.
Chez Ptolémée, au centre du monde, siège la Terre, immobile ; puis vient la Lune, qui tourne en un mois ; puis Mercure, Vénus et le Soleil, qui bouclent leurs révolutions sur le déférent en un an ; puis Mars en deux ans, Jupiter en douze ans et Saturne en trente ans ; enfin, les étoiles fixes, qui accomplissent leurs révolutions en un jour. Quelle pagaïe ! De plus, pour comprendre, sans même chercher à calculer, les mouvements irréguliers des planètes mouvements directs, stations et rétrogradations, impossible de faire l'économie du premier et grand épicycle. Ajoutons que, pour comprendre les comportements différents des planètes inférieures – Mercure et Vénus, qui ne s'éloignent pas du Soleil – et des planètes supérieures – Mars, Jupiter et Saturne, qui prennent toutes les élongations possibles –, il faut leur donner deux statuts cosmologiques différents, c'est-à-dire croiser les rôles des déférents et des premiers épicycles.
Chez Copernic, l'Univers s'harmonise. Au centre, le Soleil ; puis viennent Mercure, Vénus, la Terre, qui prend rang de simple planète, Mars, Jupiter et Saturne, puis la sphère des étoiles fixes. Là, point de rupture : il y a un lien simple entre les distances par rapport au Soleil et la durée des révolutions, de celle de Mercure 88 jours à celle de Saturne 30 ans et, pour finir par l'immobilité de la sphère des fixes. Stations et rétrogradations s'expliquent par le jeu des mouvements des planètes et de la Terre ; le comportement différent de Mercure et Vénus, par leurs positions respectives entre la Terre et le centre du monde. Dans une première approche, le monde se déchiffre sans qu'on fasse intervenir le premier épicycle ; les déférents y suffisent. Le premier épicycle, de dimension modeste, n'est là, on le sait maintenant, que pour rendre compte des écarts entre le mouvement circulaire supposé échoir aux astres et le mouvement elliptique réel. Car le mouvement circulaire est maintenu par Copernic, et même renforcé. Pour lui, l'une de ses fiertés, outre la nouvelle cosmologie qu'il a offerte au monde, est d'avoir aboli l'équant, inadmissible entorse au mouvement circulaire uniforme. Un seul des trois verrous saute donc explicitement, celui du géocentrisme. Copernic ne se prononce pas sur la dichotomie du monde ; mais, implicitement, la Lune n'étant plus qu'un satellite de la Terre, cette dichotomie devient insoutenable. Le troisième verrou sort renforcé de la bataille. Pourtant quelle bombe à retardement Copernic laisse-t-il sur son lit d'agonie ! Le mouvement de la Terre autour du Soleil ouvre une stratégie nouvelle à l'astronomie, que Kepler utilisera en étudiant le mouvement de Mars après en avoir retranché celui de la Terre. Le même Kepler, sans cette mise en évidence d'un lien simple entre distances et périodes de révolution, n'aurait jamais eu l'occasion de mettre son acharnement de mathématicien à la recherche de la troisième loi des mouvements planétaires. Voilà ce qu'il en est, notamment, pour l'astronomie.
Mais, plus profondément peut-être, la nouvelle astronomie devait bouleverser la physique. Une cosmologie, disions-nous, ne saurait être innocente. Celle de Ptolémée s'appuyait sur une physique, celle d'Aristote, qui l'avait largement précédée. Copernic propose une nouvelle cosmologie sans faire œuvre de physicien ; et cette cosmologie est incompatible avec la physique d'Aristote. Le monde savant se retrouve face à une cosmologie pour ainsi dire suspendue dans le vide. Il faut choisir. Ou bien adhérer à la cosmologie nouvelle, répudier la physique d'Aristote et donc se voir obligé de construire une nouvelle physique. Ou bien garder la physique d'Aristote et refuser l'héliocentrisme. C'est bien dans ces termes que Galilée qui a de bonnes raisons, lui qui a vu les phases de Vénus et les satellites de Jupiter, d'adopter la cosmologie de Copernic pose le problème de la physique dans la première journée du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Adepte de la nouvelle cosmologie, il construira une nouvelle physique avec le succès et les conséquences que l'on sait. Le chemin est ouvert qui conduira à Newton. Jean-Pierre Verdet
Controverse sur sa nationalité
La nationalité de Copernic est, depuis le XIXe siècle, sujette à controverses. Ainsi, note Konrad Rudnicki, le père de Copernic était polonais, et sa mère allemande. Il est né sur le territoire de la Pologne, dans une ville hanséatique avec une population majoritairement allemande. Il a longtemps été débattu pour savoir si Nicolas Copernic était vraiment allemand ou polonais. Cette discussion est devenue une féroce querelle savante aux époques nationalistes, de la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale».
Toutefois, de son vivant, le concept de nationalité n'existait pas. Le mot lui-même n'a été forgé qu'au XVIIIe siècle.
Enquête sur sa tombe
Le lieu exact d'inhumation de Copernic demeura longtemps inconnu avant que des ossements soient retrouvés en 2005 dans la cathédrale de Frombork (Pologne), près de l'autel dont il avait la charge.
Le 20 novembre 2008, des chercheurs de l'Institut médico-légal de Cracovie et de l'université d'Uppsala ont confirmé que le crâne et le fémur retrouvés sont bien ceux de Copernic, grâce à deux cheveux retrouvés dans un exemplaire du Calendarium Romanum Magnum de Johannes Stoeffler (dont Copernic s'est servi toute sa vie)70,71.
Le 22 mai 2010, l'astronome dont les restes ont été identifiés, a été enterré à nouveau à la cathédrale de Frombork dans le Nord de la Pologne, au lendemain du 467e anniversaire de sa mort. Lors d'une cérémonie religieuse, le cercueil de Copernic a été à nouveau enfoui sous le sol de la cathédrale construite au XIVe siècle, au pied d'une tombe neuve en granit noir frappée d'une représentation d'un modèle du Système solaire. Dans un discours, l'archevêque Jozef Zycinski a déploré les excès de zèle de défenseurs autoproclamés de l'Église. Il a rappelé dans ce contexte la condamnation en 1616 par le pape Paul V de l'œuvre de l'astronome, considérée à l'époque comme contraire aux Écritures.
Hommages
Bundesrepublik Deutschland, 5 marks d'argent 1973 pour commémorer le 500e anniversaire de Nicolas Copernic.
Copernic est un cratère d'impact lunaire.
L'astéroïde 1322 Coppernicus a été nommé en son honneur Coppernicus est une des appellations allemandes.
Le copernicium est un élément chimique, de symbole Cn et de numéro atomique.
 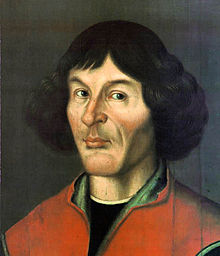    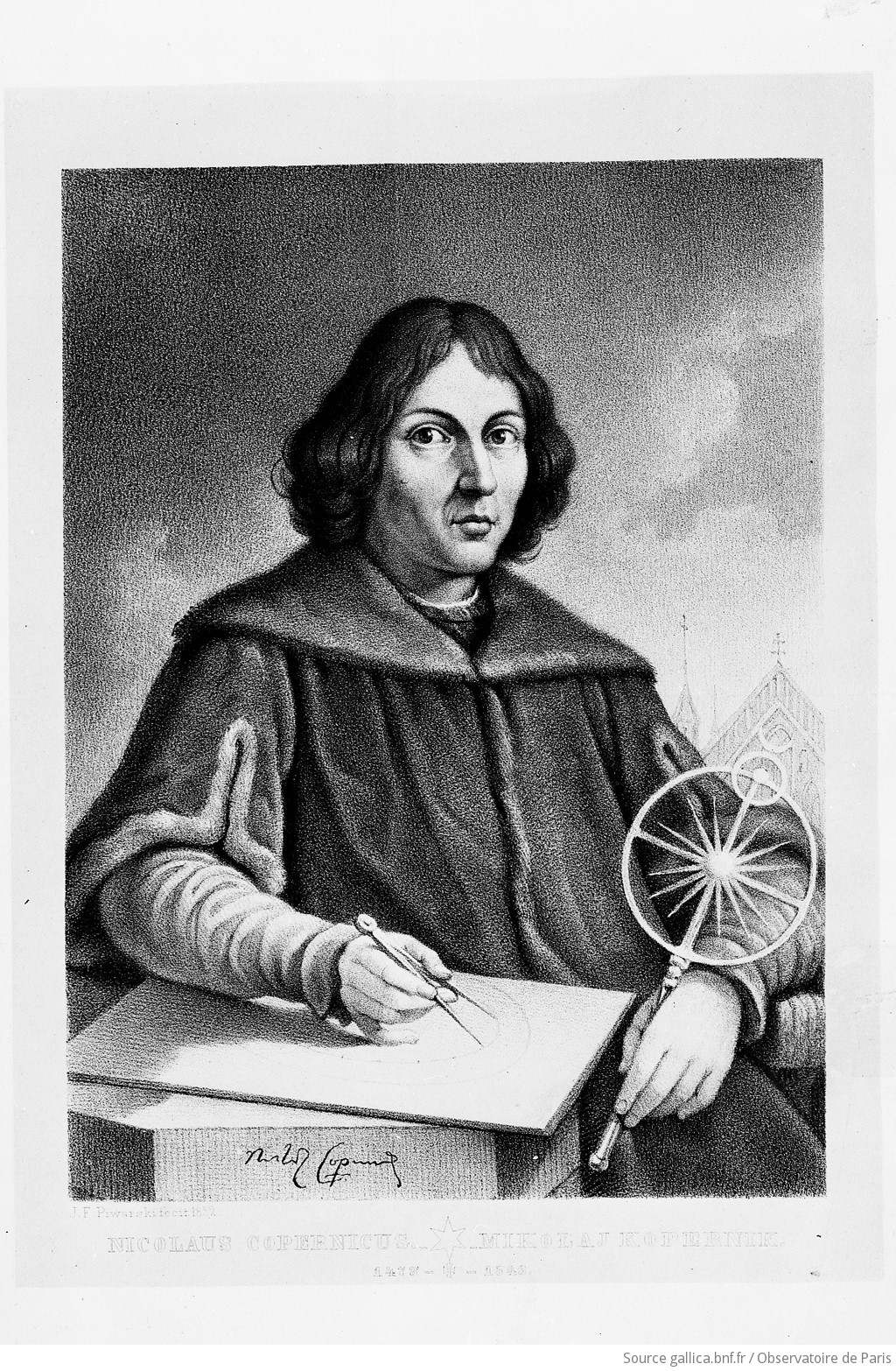    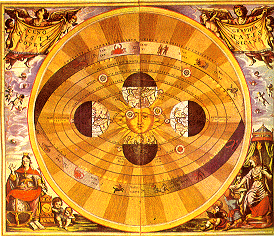 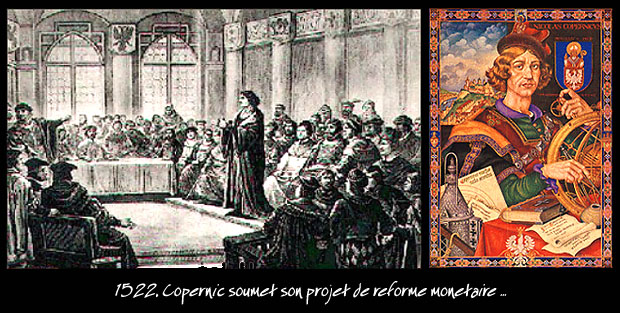   
Posté le : 16/05/2015 12:18
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
157 Personne(s) en ligne ( 99 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 157
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages