|
|
Jean Sans terre 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Dispute avec le pape
Après la mort de l'archevêque de Cantorbéry, Hubert Walter, le 13 juillet 1205, Jean fut impliqué dans une dispute avec le pape Innocent III qui mena à son excommunication. Les rois normands et Plantagenêt exerçaient une forte influence dans les questions religieuses de leurs territoires. À partir des années 1040, les papes soulignèrent néanmoins le besoin de réforme pour que l'Église soit, selon l'historien Richard Hushcroft, gouvernée depuis le centre d'une manière plus cohérente et hiérarchisée et qu'elle établisse sa propre sphère d'autorité distincte du pouvoir temporel. Ces principes avaient largement été acceptés dans l'Église anglaise à la fin du XIIe siècle malgré les inquiétudes concernant la centralisation du pouvoir à Rome. Ces changements remettaient toutefois en cause le droit traditionnel des souverains laïcs à nommer les ecclésiastiques de leur choix. Innocent III était, selon l'historien Ralph Turner, un chef religieux ambitieux et agressif insistant sur ses droits et responsabilités au sein de l'Église.
Jean voulait que John de Gray, l'évêque de Norwich et l'un de ses principaux partisans, succède à Walter mais le chapitre de chanoines de la cathédrale de Cantorbéry estima qu'il était de son droit exclusif de désigner le nouvel archevêque et il soutint Reginald, son sous-prieur162. Pour compliquer la situation, les évêques de la province de Cantorbéry revendiquaient également le droit de désigner le successeur de Walter. Reginald fut secrètement élu par le chapitre et se rendit à Rome pour être confirmé dans sa nouvelle fonction ; les évêques contestèrent cette nomination et portèrent leur plainte devant Innocent III. Dans le même temps, Jean força le chapitre de Cantorbéry à soutenir de Gray et un messager fut envoyé à Rome pour informer le pape de ce changement. Ce dernier désavoua à la fois Reginald et John de Gray et nomma son propre candidat, Étienne Langton, un théologien de l'université de Paris. Jean refusa ce nouvel archevêque mais Langton fut néanmoins ordonné en juin 1207 par le pape.
Le roi anglais fut ulcéré par ce qu'il considérait être une violation de son droit traditionnel à influencer l'élection des ecclésiastiques dans son royaume. Considérant que Langton était trop influencé par la cour capétienne à Paris, il s'opposa à son entrée en Angleterre et confisqua les terres et les possessions de l'archevêché et de la Papauté. Innocent III essaya sans succès de convaincre Jean de changer d'avis et en mars 1208, il promulgua un interdit en Angleterre en mars 1208 interdisant le clergé de toute cérémonie religieuse à l'exception du baptême et de l'absolution des mourants.
Le château de Rochester était l'une des nombreuses propriétés de l'archevêché de Cantorbéry et une importante fortification de la fin du règne de Jean
John considéra que l'interdit était l'équivalent d'une déclaration de guerre du pape et il répondit en jouant sur la division du clergé anglais sur la question. Il confisqua les terres des ecclésiastiques respectant l'interdit et arrêta les concubines des religieux en ne les libérant qu'après le paiement d'une amende. En 1209, la situation semblait bloquée et Innocent III menaça Jean d'excommunication s'il n'acceptait pas la nomination de Langton168 ; le roi refusa et il fut excommunié en novembre 1209. Même si cela représentait un coup sévère au prestige royal, cela ne sembla pas vraiment inquiéter Jean. Deux de ses alliés, Otton IV et Raymond VI de Toulouse, avaient déjà subi la même punition et les faibles répercussions de ces décisions avaient dévalué la signification de l'excommunication. La seule conséquence tangible fut un durcissement des mesures envers l'Église et un accroissement des taxes sur ses revenus ; selon une estimation de 1213, Jean avait obtenu environ 100 000 marcs environ 66 666 livres de l'époque du clergé. Un autre document suggère que les confiscations des possessions ecclésiastiques et les pénalités contre l'Église représentaient environ 14% des revenus de la Couronne.
Alors que la crise se prolongeait, le pape accorda des dispenses. Les communautés monastiques furent autorisées à célébrer la messe en privé à partir de 1209 et à la fin de l'année 1212, le viatique fut réintroduit pour les mourants. Les restrictions sur les enterrements et l'accès des laïcs aux églises semblent avoir été rapidement contournés du moins officieusement. Même si l'interdit impactait largement la vie de la population, cela ne provoqua pas de révolte contre Jean. Ce dernier s'inquiétait cependant de plus en plus de l'attitude de la France. Certains chroniqueurs ont avancé qu'en janvier 1213, Philippe II avait été chargé par le pape de renverser Jean même s'il est apparu par la suite qu'Innocent III avait simplement préparé des lettres secrètes pour revendiquer le crédit d'une éventuelle invasion victorieuse de l'Angleterre par le roi de France.
Devant les pressions politiques, Jean accepta finalement de négocier une réconciliation avec le pape via le légat apostolique Pandulf Musca et le texte final fut signé en mai 1213 à Douvres. Par ce traité, Jean plaçait son royaume sous la suzeraineté papale et acceptait de payer un tribut annuel de 1 000 marcs environ 666 livres de l'époque pour l'Angleterre et de 200 marcs pour l'Irlande en plus de dédommager l'Église pour ses pertes durant la crise. Cette résolution reçut un accueil mitigé car si certains chroniqueurs ont avancé que Jean avait été humilié, il n'y eut pas de véritable réaction populaire. Innocent III tira certainement profit de cette résolution du problème anglais mais Jean y gagna probablement encore plus car le pape devint un soutien indéfectible de Jean jusqu'à la fin de son règne. Le souverain pontife se retourna immédiatement contre Philippe II et lui ordonna de renoncer à une invasion de l'Angleterre et de demander la paix. Jean paya une partie des indemnités dues à l'Église mais il cessa les paiements à la fin de l'année 1214 ; même si le roi anglais n'avait remboursé qu'un tiers de sa dette, Innocent III ne fit pas pression pour qu'il paye, probablement pour ne pas nuire à ses relations avec l'Angleterre.
Première guerre des barons
Mécontentement des barons
Les tensions entre Jean et les barons s'accroissaient depuis plusieurs années en raison des politiques impopulaires du souverain. Beaucoup de barons mécontents venaient du Nord de l'Angleterre, ce qui poussa les chroniqueurs et les historiens à les désigner comme les Nordistes. Ces derniers se sentaient peu concernés par le conflit en France et beaucoup avaient d'importantes dettes envers la Couronne; leur soulèvement ultérieur a ainsi été qualifié de révolte des débiteurs du roi. Les tensions étaient également élevées en Galles du Nord où l'opposition entre Jean et Llywelyn au sujet du traité de 1211 dégénérait en conflit ouvert. Même au sein de la cour royale, de nombreux courtisans, en particulier ceux que le souverain avait nommés à des fonctions administratives dans le royaume, estimaient que leurs responsabilités locales surpassaient leurs loyautés personnelles envers Jean et ils rejoignirent ses opposants. Pour certains historiens, la nomination de Pierre des Roches au poste de justiciar fut le catalyseur de la crise car il était considéré comme un étranger rugueux par beaucoup de barons. L'élément déclencheur qui précipita la révolte de la noblesse fut finalement la désastreuse campagne française de 1214; pour l'historien James Holt, la route vers la guerre civile après la défaite de Bouvines était directe, courte et inévitable.
Échec de la campagne en France
Quand Jean entama son invasion de la Normandie en 1214, il avait toutes les raisons d'être optimiste. Il avait formé une solide alliance avec l'empereur Otton IV, Renaud de Boulogne et Ferrand des Flandres ; il disposait du soutien du pape et avait rassemblé suffisamment de fonds pour financer le déploiement d'une armée expérimentée. De nombreux barons refusèrent cependant de rejoindre ses troupes quand il prit la mer pour le Poitou en février 1214 et ils durent être remplacés par des mercenaires. Le plan de Jean était de couper les forces françaises en deux en menant une offensive vers Paris depuis le Poitou tandis qu'Otton IV, Renaud et Ferrand, soutenus par Guillaume de Longue-Épée attaqueraient vers le sud depuis les Flandres.
Les Anglais remportèrent initialement plusieurs succès notamment quand Jean envahit le comté d'Anjou tenu par le prince Louis à la fin du mois de juin. Le siège du château stratégique de la Roche-au-Moine, contraignit le prince français à livrer bataille contre l'armée anglaise plus nombreuse. Les nobles locaux refusèrent cependant de combattre et Jean fut obligé de se replier à La Rochelle. Le 28 juillet, Philippe II remporta une victoire décisive à Bouvines contre Otton IV. Ayant perdu tout espoir de reprendre la Normandie, Jean dut demander la paix ; l'Anjou fut rendu à la France et le roi anglais dut payer une indemnité à Philippe II. La trêve devait durer six ans et Jean rentra en Angleterre en octobre 1214.
Magna Carta
Dans les mois qui suivirent le retour de Jean, les barons rebelles dans le Nord et l'Est de l'Angleterre organisèrent l'opposition à son pouvoir. Jean organisa un conseil à Londres en janvier 1215 pour débattre d'éventuelles réformes et il encouragea des discussions à Oxford entre ses représentants et ceux des rebelles durant le printemps. Il semble qu'il essayait ainsi de gagner du temps pour qu'Innocent III puisse lui envoyer des lettres de soutien. Cela était particulièrement important pour le roi anglais qui pourrait ainsi faire pression sur les barons et contrôler Langton. Jean annonça également son intention de rejoindre les croisades, ce qui lui offrit une protection supplémentaire de l'Église. Dans le même temps, il commença à recruter des troupes mercenaires dans le Poitou même si certains soldats furent par la suite renvoyés pour ne pas donner l'impression que le roi voulait une aggravation de la crise.
Les lettres de soutien du pape arrivèrent en avril mais les rebelles s'étaient alors organisés. Ils se rassemblèrent à Northampton en mai et déclarèrent qu'ils n'étaient plus liés à Jean par les liens féodaux. L'auto-proclamée Armée de Dieu commandée par Robert Fitzwalter s'empara de Londres ainsi que de Lincoln et d'Exeter. Les tentatives de Jean pour apparaître modéré et conciliant avaient été relativement efficaces mais après la prise de la capitale, beaucoup de ses partisans firent défection. Il demanda alors à Langton d'organiser des négociations avec les barons rebelles.
Les chefs rebelles et le roi se rencontrèrent à Runnymede près du château de Windsor le 15 juin 1215. Le résultat fut la Magna Carta ou Grande Charte qui était bien plus qu'une simple réponse aux plaintes des barons et représentait une profonde réforme politique même si elle se concentrait sur les droits des hommes libres et non sur ceux des serfs. Le texte garantissait les droits de l'Église, des protections contre les emprisonnements arbitraires, l'accès à une justice rapide, une limitation de l'écuage et des autres impôts féodaux en plus d'interdire la mise en place de nouvelles taxes sans l'accord des barons. Un conseil composé de 25 nobles neutres devait être créé pour s'assurer du respect de la Charte par Jean tandis que l'armée rebelle serait démobilisée et que Londres serait rendu au roi.
Ni les barons rebelles ni Jean ne tentèrent réellement de respecter l'accord. Les premiers pensaient que le roi n'accepterait pas le conseil et qu'il allait contester la légalité de la Charte ; ils désignèrent ainsi leurs représentants les plus radicaux pour siéger au conseil et refusèrent de démobiliser leurs forces ou de rendre Londres. Malgré ses dénégations, Jean demanda l'appui d'Innocent III en avançant que la Charte affectait les droits du pape qui était devenu le suzerain du roi anglais par l'accord de 1213. Le souverain pontife s'exécuta et déclara que la Charte était non seulement honteuse et dévalorisante mais également illégale et injuste et il excommunia les barons rebelles. L'échec de l'accord entraîna rapidement l'éclatement de la première guerre des barons.
Première Guerre des barons
Les rebelles prirent immédiatement l'initiative et s'emparèrent du château de Rochester appartenant à Langton mais que ce dernier avait laissé sans véritable garnison1. Jean était prêt à la guerre car il avait accumulé suffisamment d'argent pour payer ses mercenaires et s'était assuré du soutien des puissants seigneurs des Marches qui disposaient de leurs propres armées tels que Guillaume le Maréchal et Ranulph de Blondeville. De leur côté, les rebelles manquaient d'expérience ou d'équipements dans la guerre de siège pour s'emparer des forteresses royales qui séparaient leurs forces dans le Nord et le Sud de l'Angleterre. Le plan du roi était d'isoler les barons rebelles dans Londres, protéger ses propres lignes de communication avec la Flandre d'où venaient beaucoup de ses mercenaires, empêcher une invasion française dans le Sud-Est et mener une guerre d'usure. Dans le même temps, Llywelyn profita du chaos pour mener un soulèvement en Galles du Nord contre le traité de 1211.
Les débuts de sa campagne furent victorieux et en novembre, il reprit le château de Rochester défendu par William d'Aubigny. Un chroniqueur rapporta qu'il n'avait jamais vu un siège si durement mené tandis que l'historien Reginald Brown le décrit comme l'une des plus grandes opérations de siège de l'époque en Angleterre. Ayant sécurisé le Sud-Est, Jean divisa ses forces et envoya Guillaume de Longue-Épée reprendre l'Est-Anglie tandis que lui-même mena ses forces vers le nord via Nottingham pour s'emparer des possessions des barons. Les deux offensives furent victorieuses et la plupart des derniers rebelles furent isolés dans Londres. En janvier 1216, Jean marcha contre Alexandre II d'Écosse qui s'était allié aux insurgés. Les troupes anglaises progressèrent rapidement et atteignirent Édimbourg au bout d'une campagne de dix jours.
Se sentant acculés, les rebelles demandèrent l'appui du prince Louis de France qui accepta d'autant plus facilement que par son mariage à Blanche de Castille, petite-fille d'Henri II, il avait une revendication au trône d'Angleterre. Son intervention contre Jean lui valut l'excommunication et cela empêcha Philippe II de le soutenir officiellement même s'il lui a sans doute apporté une aide officieuse. Craignant une invasion française qui pourrait fournir aux rebelles les armes de sièges qui leur manquaient, Jean fit rapidement route vers le Sud pour s'y opposer après avoir vaincu Alexandre II.
Jean rassembla une force navale pour intercepter la flotte française mais ses navires furent dispersés par une tempête et Louis débarqua sans opposition dans le Kent en mai 1216. Le roi anglais hésita et décida de ne pas attaquer immédiatement peut-être car il doutait de la loyauté de ses hommes. Louis et les barons rebelles progressèrent vers l'ouest et repoussèrent Jean qui passa l'été à réorganiser ses forces et ses défenses. Plusieurs de ses commandants dont Guillaume de Longue-Épée firent défection durant cette période et au début de l'automne, les rebelles contrôlaient le Sud-Est de l'Angleterre ainsi qu'une partie du Nord.
Mort
En septembre 1216, Jean lança une nouvelle offensive depuis les Cotswolds et, feignant de secourir le château de Windsor assiégé, attaqua vers Cambridge pour isoler les forces rebelles du Lincolnshire et d'Est-Anglie. Il poursuivit vers l'est pour lever le siège de Lincoln et arriva sur la côte à Lynn probablement pour obtenir des renforts du continent. Alors qu'il se trouvait dans cette ville, il contracta la dysenterie. Dans le même temps, Alexandre II attaqua à nouveau le Nord de l'Angleterre et s'empara de Carlisle en août avant de progresser vers le sud. Alors que la situation du roi anglais était de plus en plus difficile, les rebelles commencèrent à se diviser en raison de tensions entre Louis et les barons ; plusieurs d'entre-eux dont le fils de Guillaume le Maréchal et Guillaume de Longue-Épée, firent défection et rejoignirent Jean.
Le roi avança vers l'ouest mais une grande partie de son ravitaillement aurait été perdu en route. Le chroniqueur Roger de Wendover suggère notamment que les biens royaux dont les Joyaux de la Couronne, furent perdus dans les sables mouvants lors de la traversée d'un des estuaires du Wash. Les détails de l'incident varient considérablement selon les récits et son emplacement exact n'a jamais été déterminé ; il est possible que seuls quelques chevaux de bât aient été perdus. Les historiens modernes estiment qu'en octobre 1216, Jean se trouvait dans une impasse.
La maladie du roi s'aggrava et il fut incapable d'aller plus loin que le château de Newark. Il mourut dans la nuit du 18 au 19 octobre. De nombreux témoignages, probablement inventés, commencèrent rapidement à circuler et suggérèrent que Jean avait été tué par de la bière ou des prunes empoisonnées voire par un excès de pêches. Sa dépouille fut emmenée par une compagnie de mercenaires vers le sud et elle fut inhumée dans la cathédrale de Worcester face à l'autel de Wulfstan. Son corps fut exhumé en 1232 pour être placé dans un nouveau sarcophage où il repose toujours.
Héritage
Après la mort de Jean, Guillaume le Maréchal fut désigné comme protecteur du nouveau roi, Henri III âgé de seulement neuf ans. La guerre civile perdura jusqu'aux victoires royalistes de Lincoln et de Sandwich en 1217. Louis renonça à sa revendication au trône anglais et signa le traité de Lambeth. Pour ramener le calme, Guillaume réintroduisit une version modifiée de la Magna Carta en 1217 et celle-ci devint la base des futurs gouvernements. Henri III tenta de reconquérir la Normandie et l'Anjou jusqu'en 1259 mais les pertes continentales de Jean et la croissance du pouvoir capétien au XIIIe siècle se révélèrent être un tournant de l'histoire européenne. La première épouse de Jean, Isabelle de Gloucester se remaria avec Geoffrey Fitz Geoffrey de Mandeville en 1216 et avec Hubert de Burgh l'année suivante peu avant sa mort. Sa seconde épouse quitta l'Angleterre pour Angoulême peu après la mort du roi ; elle y épousa Hugues X de Lusignan et eut une faible influence sur les enfants issus de sa première union.
Historiographie
Les évaluations historiques du règne de Jean ont considérablement varié selon les époques. Les chroniqueurs ayant écrit sur sa jeunesse et son accession au trône comme Richard de Devizes, William de Newburgh, Roger de Hoveden et Raoul de Dicet étaient généralement critiques envers son comportement sous Richard Ier mais leur perception de son début de règne était plus favorable. Les récits fiables sur la suite de son règne sont plus rares mais les principales sources de cette période rédigées par Gervais de Canterbury et Raoul de Coggeshall étaient assez hostiles. Cette perception négative de Jean fut renforcée par les écrits postérieurs à sa mort de Roger de Wendover et de Matthieu Paris.
Au XVIe siècle, les évolutions politiques et religieuses entraînèrent une vision plus favorable du règne de Jean. Les historiens Tudor voyaient positivement son opposition à la Papauté et sa défense des droits et des prérogatives royales. Les récits réformistes de John Foxe, William Tyndale et Robert Barnes le présentaient comme un héros protestant et le premier l'inclut dans son Livre des Martyrs. Dans son Historie of Great Britaine de 1632, John Speed loua la grande renommée du roi Jean et accusa les chroniqueurs médiévaux de partialité dans leurs évaluations de son règne.
Durant l'ère victorienne du XIXe siècle, les historiens se concentrèrent sur la personnalité de Jean et leurs études s'appuyaient essentiellement sur les récits de ses contemporains. Kate Norgate avança par exemple que sa chute n'était pas liée à ses échecs militaires mais à son immoralité presque surhumaine tandis que James Ramsay accusa son environnement familial et sa cruauté. Son bilan était plus favorable chez les historiens de tradition whig qui voyaient des documents comme le Domesday Book et la Magna Carta comme les étapes du développement politique et économique de l'Angleterre durant le Moyen Âge menant au libéralisme. Pour eux, la signature de la Magna Carta marquait un événement majeur de l'histoire constitutionnelle anglaise malgré les défauts du monarque. Winston Churchill écrivit notamment qu'avec le recul du temps, il apparaît que la nation britannique et le monde anglophone doivent bien plus aux vices de Jean qu'au labeur des souverains vertueux.
L'étude des sources primaires sur son règne comme les pipe rolls, les chartes et les documents de la cour donna lieu à de nouvelles interprétations dans les années 1940. Dans un essai de 1945, Vivian Galbraith proposa ainsi une nouvelle approche pour comprendre cette période. Cette utilisation plus importante des documents de l'époque s'est associée à un plus grand scepticisme sur les récits de Roger de Wendover et de Matthieu Paris. Dans de nombreux cas, les écrits de ces deux chroniqueurs, rédigés après la mort de Jean, furent rejetés par les historiens modernes. La signification de la Magna Carta a également été revue ; si sa valeur symbolique et constitutionnelle pour les générations ultérieures ne fait aucun doute, elle n'était, dans le contexte du règne de Jean, qu'une proposition de paix ayant échoué.
Le consensus actuel, illustré par les deux biographies de Ralph Turner et Lewis Warren, est que Jean fut un monarque sans grand succès dont les erreurs furent exagérées par les chroniqueurs des XIIe et XIIIe siècles. Pour Jim Bradbury, il fut un administrateur appliqué ainsi qu'un général compétent avec des traits de personnalité déplaisants voire dangereux comme la mesquinerie, la méchanceté et la cruauté ; il souligne également que les historiens les plus récents ont eu tendance à être trop cléments envers les nombreuses erreurs du roi. John Gillingham, auteur d'une biographie influente de Richard Ier, est du même avis mais est plus mitigé que Turner ou Warren sur ses compétences militaires qu'il estime médiocres. À l'inverse, l'historien Frank McLynn avance que cette réputation relativement positive parmi les historiens modernes est bizarre étant donné que Jean « échoue à quasiment tous les tests que l'on peut légitimement poser à un souverain.
Culture populaire
Les premières représentations de Jean dans des œuvres de fiction datent de la période Tudor et reflètent les opinions réformatrices de l'époque. L'auteur anonyme du Troublesome Reign of King John présente le roi comme un martyr proto-protestant ; de même, dans la moralité de Jean Bale, Kynge Johan, Jean tente de sauver l'Angleterre des « agents maléfiques de l'Église romaine. Par contraste, La Vie et la Mort du roi Jean de William Shakespeare, qui reprend des éléments anti-catholiques du Troublesome Reign of King John, offre une vision duale et plus nuancée d'un souverain complexe à la fois victime proto-protestante des machinations de Rome et dirigeant faible et égoïste. La pièce d'Anthony Munday, The Downfall and The Death of Robert Earl of Huntington, illustre les défauts du souverain mais présente une vision positive de son opposition à la Papauté dans la ligne de l'historiographie de l'époque. Au milieu du XVIIe siècle, les pièces comme King John and Matilda de Robert Davenport, bien que largement basées sur les œuvres élisabéthaines, présentent à l'inverse les barons comme les champions de la cause protestante et se concentrent sur les aspects tyranniques du comportement de Jean.
Les représentations fictives du XIXe siècle de Jean étaient fortement influencées par la romance historique de Walter Scott, Ivanhoé, dans laquelle le roi est présenté sous un aspect presque entièrement défavorable ; le roman s'appuyait fortement sur les études historiques victoriennes et sur la pièce de Shakespeare. Cette œuvre inspira The Merry Adventures of Robin Hood de l'écrivain pour enfant Howard Pyle qui établit Jean comme le principal méchant dans les récits traditionnels de Robin des Bois. Il conserva ce rôle avec l'avènement du cinéma et le film Robin des Bois de 1922 le montre commettant de nombreuses atrocités et se livrant à la torture. Les Aventures de Robin des Bois de 1938 créa une nouvelle version du souverain présenté comme un pantouflard peureux, arrogant et efféminé dont les actes permettent de souligner les vertus de Richard Ier et contrastent avec le courage du shérif de Nottingham qui n'hésite pas à affronter personnellement Robin des Bois. Un exemple extrême de ce personnage est visible dans le dessin animé de 1973 où Jean est présenté comme un lion pleurnichard et cupide. D'autres œuvres de fiction, distinctes de l'univers de Robin des Bois, comme la pièce Le Lion en Hiver de James Goldman le présentent souvent comme un personnage faible et efféminé contrastant, dans ce cas, avec le plus viril Henri II.
Jean a été joué à l'écran par :
Herbert Beerbohm Tree dans le film muet King John 1899
Sam De Grasse dans le film muet Robin des Bois 1922
Ramsay Hill dans le film Les Croisades 1935
Claude Rains dans le film Les Aventures de Robin des Bois 1938
George Macready dans le film La Revanche des Gueux 1950
Hubert Gregg dans le film Robin des Bois et ses joyeux compagnons 1952
Guy Rolfe dans le film Ivanhoe 1952
Donald Pleasence dans la série télévisée britannique Robin des Bois 1955-1960
Andrew Keir dans la série télévisée britannique Ivanhoé 1958
Nigel Terry dans le film Le Lion en hiver 1968
Peter Ustinov voix dans le dessin animé Robin des Bois 1973
Ian Holm dans le film La Rose et la Flèche 1976
Phil Davis dans la série télévisée britannique Robin of Sherwood 1984-1986
Michael Rudder voix dans la série de dessins animés américaine Robin des Bois Junior 1992
Edward Fox dans le film Robin des Bois 1991
Richard Lewis dans le film Sacré Robin des Bois 1994
Andrew Bicknell dans la série télévisée franco-américaine Les Nouvelles Aventures de Robin des Bois 1997-1998
Ralph Brown dans la série télévisée britannique Ivanhoé 1997
Jonathan Hyde dans la téléfilm américain Le Royaume des voleurs 2001
Soma Marko enfant) et Rafe Spall adulte dans le téléfilm américain Le Lion en hiver 2003
Toby Stephens dans la série télévisée britannique Robin des Bois 2006-2009
Oscar Isaac dans le film Robin des Bois 2010
Paul Giamatti dans le film Le Sang des Templiers 2011
Descendance
Jean eut cinq enfants légitimes, tous avec Isabelle d'Angoulême. Il eut également plusieurs enfants illégitimes avec diverses maîtresses dont au moins neuf garçons et trois filles. Parmi ceux-ci, les plus connus sont Richard Fitz Roy et Jeanne qui épousa le prince gallois Llewelyn en 1205.
Nom Naissance Mort
Henri III 1er octobre 1207 16 novembre 1272 Épouse Éléonore de Provence en 1236 ; cinq enfants dont le roi Édouard Ier
Richard 5 janvier 1209 2 avril 1272 Épouse Isabel Marshal en 1231 ; quatre enfants
(b) Épouse Sancie de Provence en 1257 ; deux enfants
(c) Épouse Béatrice de Falkenbourg en 1269 ; aucun enfant
Jeanne146 22 juillet 1210 4 mars 1238 Épouse Alexandre II d'Écosse en 1221 ; aucun enfant
Isabelle261 1214 1er décembre 1241 Épouse Frédéric II du Saint-Empire en 1235 ; quatre enfants
Aliénor262 1215 13 avril 1275 Épouse Guillaume le Maréchal en 1224 ; aucun enfant
(b) Épouse Simon V de Montfort en en 1238 ;
Voir aussi
Robert de Tourneham, sénéchal d'Anjou sous les ordres de Jean sans Terre.
Girard d’Athée, sénéchal de Touraine, conseiller de Jean sans Terre.        
Posté le : 16/10/2015 22:13
Edité par Loriane sur 17-10-2015 16:59:34
|
|
|
|
|
Dagobert |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 18 octobre 629 Dagobert Ier devient roi des francs
né vers 602/605, mort le 19 janvier 638 ou 639, est un roi des Francs de la dynastie mérovingienne. Fils de Clotaire II 584-629, un arrière-petit-fils de Clovis, il règne sur l'Austrasie de 622 à 632 et est roi des Francs de 629 à 639. Durant cette période, il a sa résidence le plus souvent autour de Paris, notamment à Clichy actuel département des Hauts-de-Seine. Sous son règne, la royauté mérovingienne jette un dernier éclat avant que la réalité du pouvoir ne passe aux maires du palais. Roi des Francs du 18 octobre 629 au 19 janvier 638 ou 639, son prédécesseur est Clotaire II, Caribert II Unification de l'Aquitaine en 632, son successeur est Sigebert III: Roi d'Austrasie. Clovis II: Roi de Neustrie et des Burgondes. Il appartient à la dynastie des Mérovingiens. Son père est Clotaire II, sa mère Bertrude. Sa conjointe : Gomatrude, Nanthilde, Ragnetrude: concubine, Wulfégonde, Berchilde: concubine? ses enfants : Sigebert III, Clovis II
En bref
ils de Clotaire II et de Bertrade. Afin de satisfaire le particularisme de l'aristocratie austrasienne, que dominaient le maire du palais Pépin de Landen et l'évêque de Metz Arnoul, son père l'avait envoyé en Austrasie comme roi dès 623. Dagobert devint l'unique roi des Francs à la mort de Clotaire 629 et surtout à la mort de son propre frère, Caribert, à qui il avait dû laisser le gouvernement d'une partie de l'Aquitaine et du Languedoc 632. Il dut cependant composer à son tour avec les exigences de l'aristocratie et donner pour roi aux Austrasiens son fils Sigebert, alors en bas âge 634. Afin d'éviter que celui-ci ne s'approprie un jour la totalité du royaume, Dagobert attribua de son vivant à son second fils, Clovis II, la Bourgogne et la Neustrie.
Pendant les dix années de son règne, Dagobert a joui d'un pouvoir absolu, et la postérité en a gardé le souvenir, embelli par la comparaison avec ses médiocres successeurs. Il fut l'un des très rares Mérovingiens qui parvinrent à la royauté à l'âge d'homme et purent régner sans partage. Il fit reconnaître son autorité par les Saxons, les Gascons et les Bretons, intervint dans les affaires intérieures du royaume wisigothique d'Espagne, entretint de bonnes relations avec Byzance et tenta de s'opposer, avec les Saxons, les Thuringiens, les Alamans et les Lombards, à la poussée de la nouvelle puissance slave. Le prestige personnel de Dagobert, qui lui assura la soumission absolue de son royaume, fut tel, hors de ce royaume, qu'aucun roi des Francs ne l'égala plus avant l'avènement de Pépin le Bref. Jean Favier
"Le Bon roi Dagobert" Cette chanson composée à une époque qui reste imprécise – probablement antérieure à la révolution de 1789 –, cette chanson redevint tout à coup à la mode en 1814. On y intercala des couplets satiriques d'actualité. Interdite par la police, elle reprit au retour des Bourbons.
Contexte historique
Le règne de Dagobert se déroule environ 130 ans après celui de Clovis et 120 ans avant l'avènement du carolingien Pépin le Bref. Dagobert prend la succession de son père Clotaire II, ce dernier a unifié les terres franques alors réparties entre les petits fils de Clovis. Dagobert règne donc sur un royaume unifié. Cependant, il doit compter avec la noblesse austrasienne, qui avait su monnayer son aide auprès de Clotaire II contre Brunehaut.
La dynastie mérovingienne de Clovis à Dagobert
Le règne de Clovis 481-511 a établi la domination des Francs sur la plus grande partie de la Gaule ex-romaine. À la mort de Clovis, le royaume est partagé entre ses quatre fils, puis réunifié vers 555, augmenté de la Bourgogne, par Clotaire Ier.
Un nouveau partage entre fils a lieu à la mort de celui-ci, entre de nouveau quatre fils : l'un, Caribert meurt en 567 ; Gontran, roi de Bourgogne, reste dans une certaine mesure à l'écart du conflit, commencé vers 570, entre les couples Sigebert-Brunehilde/Brunehaut royaume de Metz, l et Chilpéric-Frédégonde royaume de Paris, Neustrie ; Sigebert est assassiné en 575, Chilpéric en 584 ; il laisse un fils de quelques mois, Clotaire, qui triomphe en 613 avec l'exécution de Brunehilde et de ses petits-enfants. Il réunifie alors le royaume franc. Cependant, sous la pression des nobles austrasiens, il doit dès 623 confier le royaume d'Austrasie à son fils Dagobert, qui lui succède comme roi des Francs en 629.
Le monde à l'époque de Dagobert
Sous le règne de Dagobert, le royaume franc couvre l'ancienne Gaule ainsi que des dépendances en Germanie, notamment la Bavière. Il est ici au contact de peuples encore païens : les Frisons, les Saxons et les Alamans en Germanie, les Avars en Pannonie actuelle Hongrie. Au nord, l'actuelle Angleterre est divisée entre différents royaumes anglo-saxons Kent, Mercie, etc., dont certains sont encore païens. Au sud-est, l'Italie est aux mains des Lombards, royaume des Lombards, duchés de Spolète et de Bénévent, dont beaucoup sont encore ariens ou païens, et de l'Empire byzantin, Exarchat de Ravenne, dont dépend Rome, siège de la papauté ; Sicile et Italie du sud. Au sud, l'Espagne est aux mains des Wisigoths, royaume de Tolède, dont était originaire la reine Brunehilde. La grande puissance de l'époque est l'Empire byzantin capitale : Constantinople qui contrôle, en plus des provinces italiennes, le sud des Balkans, le Moyen-Orient et l'Afrique du nord. La date de 630 est importante pour l'avenir de ces régions : c'est l'année de la prise de La Mecque par les musulmans de Médine, donc le début des conquêtes musulmanes ; le prophète de l'islam Mahomet meurt en 632.
Pépinides et Arnulfiens à l'époque de Dagobert
Les Pépinides et arnulfides, ancêtres des Carolingiens, constituent dès cette époque deux familles importantes en Austrasie. Parmi eux, on doit citer le maire du palais Pépin de Landen et saint Arnoul. De leur alliance et du mariage de leurs enfants, naîtra la famille carolingienne. Ils possèdent de très nombreux domaines en particulier dans la vallée de la Meuse Herstal, Jupille, etc.. Après Dagobert, les maires du palais d'Austrasie, de Neustrie ou de Bourgogne jouent un rôle croissant, au détriment des rois de la famille mérovingienne.
la chronique de Frédégaire, qui date du VIIe siècle,
le Liber Historiae Francorum VIIIe siècle,
les5 Gesta Dagoberti, ouvrage rédigé au IXe siècle aux environs de 835 par Hilduin de Saint-Denis et Hincmar de Reims.
La chronique de Frédégaire est rédigée peu après le règne de Dagobert. Mais elle est tout de même biaisée par le point de vue de son auteur, qui juge les rois en fonction de leur attitude vis-à-vis de l'Église. Les deux chroniques ultérieures sont encore plus biaisées, parce que le règne de Dagobert est, dans les milieux carolingiens, l'objet d'une reconstruction qui en fait le roi mérovingien le plus remarquable après Clovis.
Il existe aussi quelques chartes le plus souvent des chartes de donation. Certaines datent du règne de Dagobert, mais un assez grand nombre de fausses chartes attribuées à Dagobert ont été rédigées après sa mort, du IXe au XIIe siècle, en particulier à l'abbaye de Saint-Denis, lieu de la sépulture de Dagobert, et plus tard de Charles Martel et Pépin le Bref, puis des Capétiens. On a au total 40 documents dont 33 sont faux 20 documents concernent Saint-Denis, dont 18 faux.
Ce phénomène des fausses chartes de Dagobert est lié à la valorisation de son rôle à l'époque carolingienne, puis sous les Ottoniens et les Capétiens. Dans cette perspective, ont aussi été élaborées de fausses généalogies10 établissant le rattachement des Carolingiens, puis d'autres familles, aux Mérovingiens grâce à une sœur inventée de Dagobert ; cette pratique a encore lieu au XVIe siècle au sein de la famille des ducs de Lorraine en lutte contre la famille royale française des Valois.
Sa vie
Dagobert est le fils de Clotaire II fils de Chilpéric Ier et arrière-petit-fils de Clovi). Sa mère s'appelle Bertrude.
À l'âge de neuf ans, il est atteint d'une entérite colique. Bertrude l'envoie, avec son demi-frère Caribert, dans la villa royale de Reuilly, à l'est de Paris. Il est instruit par des clercs qui lui enseignent le latin et l'histoire. À dix ans, il apprend à monter à cheval, pratique du sport et le maniement des armes11. Il pratique également comme passe-temps certaines activités manuelles comme l'ébénisterie et la menuiserie. En 615, il rejoint la cour du roi son père, avec qui il entretient des relations dictées par la raison d'État, pour y suivre l'instruction de l'École du palais où il enrichit ses connaissances politiques et administratives.
En 618, quelques mois après le décès de Bertrude, l'épouse de Clotaire, ce dernier, père de Dagobert se remarie avec Sichilde, alors gouvernante de Caribert. Dagobert la voit comme une intrigante cherchant à favoriser Caribert tout en la soupçonnant d'avoir été la maîtresse de son père. Avec son frère Brodulf ou Brunulf, elle tente de faire obtenir un héritage égal entre les deux fils de Clotaire, alors que Caribert est mis à l'écart de la succession royale pour cause d'incapacité à régner. En 621, aux quinze ans de Caribert, Sichilde obtient de Clotaire un don de petits domaines disparates et éloignés les uns des autres, formant des comtés gérés par des intendants royaux, à chacun de ses deux fils. L'âge de la majorité est donné aux deux princes, supprimant leur gouvernance. En guise de remplacement, un maire du palais est désigné pour chacun d'eux, bien que ne régnant sur aucun royaume. Harmaire échoit à Caribert, quant à Dagobert, il lui est permis de choisir : il propose le duc Ega, qui, en plus d'avoir bonne réputation, participe à sa formation à l'école du palais, ce dernier accepte et la proposition est approuvée par le roi. Brodulf et Sichilde font en sorte d'éloigner le plus possible Dagobert de la cour, afin que le roi porte plus d'attention à Caribert, en incitant Clotaire à envoyer Dagobert un peu partout à travers la Gaule : en Austrasie, Burgondie et Neustrie. Ceci permet à Dagobert de connaître les régions du royaume avec leurs particularités, de rencontrer des gens de toutes conditions et de visiter toutes sortes de lieux, de lier des relations et d'être perçu comme délégué de la couronne18.
En 622, il siège au conseil du royaume, où il participe aux décisions gouvernementales en étant consulté par son père et ses ministres. Il recommande la prolifération des immunistes, octroyant un diplôme royal d'immunité aux propriétaires de domaine, refusant l'accès au domaine à toute personne extérieure autre que le roi afin de limiter le pouvoir des Grands du royaume qui usurpent le pouvoir du roi pour exercer une juridiction à ses dépens et accaparer des pouvoirs judiciaires ainsi que des biens, taxes, capitations, récoltes... Il promeut également des recommandations pour assurer une meilleure hiérarchisation seigneuriale : un seigneur reçoit l'hommage d'un guerrier ou d'un chef qui prête serment de fidélité et offre ses services en échange d'avantages et de la protection du seigneur. Une protection spéciale et des devoirs particuliers sont attribués à ceux qui se recommandent au roi. Les leudes sont des recommandés qui placent leurs terres sous la protection du roi et en échange de quoi, le roi leur en offre d'autres.
Dans le but d'augmenter la production agricole des paysans libres, le concept d'origine romaine des précaires est répandu : un propriétaire terrien accorde l'exploitation d'un terrain à un paysan libre pour un certain nombre d'années qui peut faire ce que bon lui semble de la récolte, en échange le paysan doit aménager et entretenir la terre. À l'expiration du délai d'exploitation, le propriétaire bénéficie des aménagements et constructions réalisées.
Pour fidéliser les vassaux à la monarchie, des bénéfices peuvent être accordés : l'usufruit d'un domaine, pour une durée déterminée d'au moins cinq ans et à vie la plupart du temps, est attribué à un favori du roi en échange de services rendus.
Roi d'Austrasie
En 623, l'évêque de Metz, Arnoul, demande à être visité par le roi, mais celui-ci préfère envoyer Dagobert. Arnoul rend compte que les Austrasiens sont jaloux des Neustriens qui bénéficient de la présence du monarque et s'estiment lésés. Aussi, ils souhaitent la présence du roi en leur contrée ce que Clotaire refuse. Mais cédant aux revendications autonomistes des nobles d'Austrasie, il nomme Dagobert vice-roi de ce territoire, amputé néanmoins des régions à l'ouest des Ardennes et des Vosges ; les vallées de la Haute-Meuse, de la Haute-Marne, de l'Aisne, de la Champagne. Les villes de Verdun, Toul, Châlons et Reims, également exclues, sont déclarées cités royales et ne dépendent que du roi en tant qu'associé à la couronne avec délégation d'autorité. Cette décision est approuvée par Brodulf qui voit là une occasion d'éloigner Dagobert ainsi que Harmaire, que Brodulf suggère qu'il commande des troupes afin d'apaiser les troubles causés outre-Rhin par le duc saxon Aighina. C'est alternativement à Metz et à Trèves qu'il réside alors. Ses tuteurs seront le maire du palais Pépin de Landen, saint Arnoul et Cunibert ou Chunibert, évêque de Cologne, qui sont déjà les dirigeants effectifs de la contrée. Son éducation s'oriente de manière à répondre aux besoins de l'Église, et il ne peut se passer de la compagnie d'Arnoul au point de menacer ses fils de mort si ce dernier ose mener une vie érémitique.
Il se consacre à l'amélioration du système judiciaire afin d'étendre les compétences du roi par la mise en place de réformes. Le wergeld prix de l’homme pour une même catégorie sociale est pratiquement équilibré, quelle que soit la naissance des hommes, les conditions de l'état civil, de la famille, des successions s'uniformisent. En conformité avec l'édit de 614, il impose que durant les jugements, un évêque ou un clerc intervienne pendant les débats ou délibérations pour réduire les injustices. Le comte du palais ou le clerc peuvent demander la reconsidération des sentences et interjeter appel. Il pousse à la périodicisation régulière des sessions, au maintien des jurys populaires, à la désignation de conseillers-auditeurs compétents au mandat de longue durée. Le référendaire spécialise les juristes auxquels le roi fait appel. Il laisse le chancelier-référendaire promouvoir à la chancellerie des magistrats pour des missions juridiques ou d'inspections. Les accusés, défendeurs et demandeurs peuvent s'appuyer sur des témoins, des garants ou cautions. Les problèmes concernant les veuves, orphelins et déshérités sont soumis aux clercs, qui ont mission de représentant et conseiller. Les conseillers-auditeurs non convoqués à une session peuvent assister ou représenter en justice des plaideurs. La taille des pagus unité administrative principale des états du royaume, où les comtes exercent la juridiction du roi, sont de tailles variables, empêchant ainsi le comte d'y assurer la représentation du roi à chacune des audiences des différents centres judiciaires. Les comtés sont donc partagés en vicairies où à leurs têtes sont nommés des vicaires, qui président les tribunaux locaux, sous autorité du comte. Les affaires importantes sont directement présidées par les comtes. Les comtes et les vicaires doivent désigner juristes et clercs de leur entourage pour assistance. Les comtes eux-mêmes ont appel à des vicaires pour les affaires courantes et pour les remplacer lors de leurs déplacements.
Chrodoald, un aristocrate bavarois de la famille des Agilolfing propriétaire d'un domaine à l'ouest de Trèves, exerce un trafic de marchandises avec les duchés alliés de l'Est et étend son influence au détriment de celle du roi, pour constituer un État indépendant. Il refuse également de payer l'impôt à Pépin de Landen, dont il a acheté certains de ses officiers, et ne se soumet guère au ban. Arnoul souhaite sa mise à l'arrêt et un jugement par le tribunal royal. Chrodoald se réfugie à Paris auprès de Clotaire qui demande à Dagobert d'abandonner toute poursuite, et de promettre de le laisser regagner ses terres. Clotaire aurait reçu serment de Chrodoald qu'aucun trouble n'interviendrait de sa part. Après consultation de Pepin, Arnoul, Harmaire, Anségisèle et l'évêque Clodulf de Metz, également conseiller royal, Dagobert accorde son pardon. À son retour au palais de Metz, il est assassiné par des hommes du patrice Harmaire sur ordre de Dagobert. Clotaire se rend compte qu'il y a eu accord entre son fils et l'entourage de celui-ci. Il menace de le destituer s'il ne vient pas de lui-même pour repentance et soumission. Dagobert en profite pour étendre son autorité sur Metz et Trèves. Il envoya Cunibert à Clichy demander au roi l'Austrasie avec la Champagne, Brie et les cités royales. Un comité de douze Grands a lieu pour en délibérer. En septembre 626, il rencontre son père et s'installe dans la villa royale de Saint-Denis. C'est peut-être à cette date ou en 625 qu'il fait embellir son monastère.
L'assemblée accorde l'intégralité de l'Austrasie à Dagobert excepté l'Aquitaine et la Provence, habituellement rattachées aux rois Austrasiens. Il est convoqué par son père à Clichy en présence d'Amand et de Caribert, pour reconnaissance officielle du royaume d'Austrasie et prêter serment d'allégeance. Mais Clotaire impose la condition qu'il épouse la sœur de la reine Sichilde, Gomatrude et que Caribert épouse Fulberte, belle-sœur de Brodulf, l'existence de Fulberte serait contestée, voir article Faux Mérovingiens. Ces mariages permettent à Sichilde et Brodulf que des membres de leur famille soient reines. Le mariage a lieu en décembre 626 à Clichy, Amand célèbre l'union. Il unit également Caribert et Fulberte quelques jours après.
Le duc Aighina doit s'expliquer devant Dagobert des troubles causés, à l'extérieur de son duché, par ses soldats. Il remet en cause la gestion de ses troupes par le patrice Harmaire et un différend éclate entre eux. Aighina doit faire serment de fidélité et est convié à une assemblée de Grands présidée par Clotaire, qui se situe entre décembre 626 et 627. Harmaire se fait assassiner en sortant de la grande salle de la villa royale. Les assassins s'enfuient mais des témoins reconnaissent des hommes de la garde personnelle d'Aighina qui s'est réfugié à Montmartre. Les fidèles de Harmaire veulent le venger et assiègent le duc. Brodulf demande l'intervention du roi qui convoque Ega pour imposer la paix du roi entre les rivaux. Aighina est destitué de son duché, remis à Berthoald, exilé à Montmartre avec une petite garde en compagnie et avec l'octroi d'un petit domaine comme résidence forcée.
En avril 627, profitant de la mort d'Harmaire, qui n'est pas encore remplacé dans ses fonctions, les Saxons commandés par Berthoald attaquent l'Austrasie. Dagobert lève le ban et commande les troupes à Spa. Durant la bataille, les cavaleries ennemies s'affrontent laissant les deux chefs face-à-face : Berthoald agrippe la chevelure de Dagobert et la lui coupe.
Dagobert demande de l'aide à Clotaire qui, avec Ega et l'armée Neustrienne, arrive près d'Aix-la-Chapelle. Le duc fond avec sa cavalerie sur les troupes de l'armée neustrienne tentant de la prendre à revers mais Ega et ses hommes, grâce à leurs piques et lances, font Berthoal prisonnier et mettent ses troupes en déroute. Ega convoque le roi et son fils et demande l'application des lois de la guerre concernant les traîtres : Clotaire ordonne l'exécution de Berthoald qui est décapité.
À la suite des affrontements, Dagobert doit reconstituer les royaumes de Saxe et de Thuringe.
En matière fiscale, il ordonne la restauration du cadastre, le versement annuel d'une redevance par les Grands. Les levées exceptionnelles sont supprimées et le droit de gîte et d'hospitalité, qui permet au roi et son escorte de bénéficier d'un hébergement et de subsistance, n'est plus accablant et des dédommagements sont accordés aux cités d'accueil. Les zones de stationnement et les relais des armées doivent être dédommagées par les provinces ou le pays dans son ensemble. Il encourage les comtes à rendre une justice moins intéressée en accroissant les inspections, les modifications de sentences. Il accorde des faveurs aux magistrats intègres. Il dote les comtes de bénéfices personnels qu'ils tentent de rendre héréditaires.
Face à l'augmentation des biens ecclésiastiques, Cunibert et Clodulf en informent le roi qui promeut de nouvelles lois : en cas de fraude électorale pour la nomination d'un évêque, ainsi que pour les désignations abusives de diacres et de prêtres, un appel peut être fait au roi. Il en est de même en cas de manquement d'un évêque pour l'assistance aux déshérités. L'enseignement leur revenant de fait, il leur est imparti d'ouvrir des écoles et de veiller à la bonne formation des clercs instructeurs, sous peine de voir leurs privilèges remis en cause. Les biens de l'Église ont pour objectifs l'amélioration des conditions des paysans et l'augmentation de leurs rendements. Les affranchis, esclaves, veuves et orphelins passent sous la juridiction des évêques tout comme les contrats de mariages et testaments.
Roi des Francs
Dagobert reçoit le royaume Franc par les évêques et les grands de Burgondie. Bibliothèque municipale de Castres. XIVe siècle
Dès le décès de Clotaire II 18 octobre 629, un messager lui transmet une invitation aux funérailles de son père à Paris. Le roi est enterré à l'église saint-Vincent. Alors que Sichilde s'est rendue dans sa villa de Bonneuil, Brodulf explique qu'avant sa mort, Clotaire aurait légué le royaume à Caribert, secondé par le maire du palais neustrien Landri. Dagobert exigea des témoignages et Brodulf dit que Landri et Amand sont témoins de la scène. Tous les deux sont convoqués et le contredisent : Landri dit qu'il n'a pas reçu de consignes particulières et Amand n'a entendu qu'un bredouillage de confession sans rapport. Dagobert ordonne à Brodulf de partir le plus loin et le plus vite possible, ce qui est fait. Face à toute la cour, il déclare son titre royal en se faisant nommer roi de Bourgogne, puis chasse Caribert de la Neustrie, lui faisant jurer de renoncer définitivement à la Gaule, Caribert devant lui succéder en l'absence de descendance. Quelques jours plus tard, Landri meurt et est remplacé par Ega. Il visite la Neustrie et la Burgondie pour y établir les réformes mises en place en Austrasie, puis s'installe dans l'abbaye de Saint-Denis.
La division du royaume des Francs 628.
Ega et le trésorier royal Didier, viennent le voir pour lui annoncer que l'Aquitaine se révolte du fait de l'absence de visite du roi dans cette province. Le comte de Cahors se fait assiéger par un groupement de bandits et de population locale, entrainant la lapidation de l'évêque Rubique, frère de Didier, qui tente de s'interposer. Didier est désigné comme successeur de Rubique. Afin d'apaiser les tensions, le roi doit se faire représenter en Aquitaine. Poussé par son oncle Brodulf, Caribert réclame son dû. Dagobert ne lui laisse pour territoire que le royaume d'Aquitaine, créé pour l'occasion. Ce royaume a Toulouse pour capitale et englobe l'Aquitaine méridionale duché de Vasconie jusqu'au Pyrénées avec comme principales villes Agen, Cahors, Périgueux et Saintes. Aidé par les ducs Vascons et Aighinan ainsi que par d'autres ducs et comtes, il envoie des troupes sur les principaux lieux de rébellion. Il repousse les Vascons ibériques ainsi que leurs alliés Aquitains, Proto-basques, soumettant à l'autorité royale toute l'Aquitaine. Le duc Aighinan s'installe avec ses troupes aux bords des Pyrénées. Lorsque Caribert rejoignit Toulouse, il reçoit un légat de Dagobert pour le complimenter de sa victoire.
Voulant répudier Gomatrude qui lui a été imposée par son père, il convoque le référendaire Dadon, l'évêque Amand et un officier de sa garde. L'officier est chargé d'avertir la reine qu'elle ne doit plus que se contenter de vivre dans une aile de sa villa de Romilly et d'y rester. Puis le roi accompagné de Dadon, Amand et de hauts dignitaires, signe l'acte de répudiation, ne laissant à la reine que la liberté de choisir son lieu de résidence, l'accompagnement de serviteurs et la possibilité de percevoir une pension de la part du comté de son lieu de résidence. Amand s'oppose à cette décision et est destitué de ses fonctions à la cour pour être envoyé auprès de Caribert, qui accepte de l'héberger. Mais devant son refus, Dagobert nomme Amand évêque sans siège fixe, en lui donnant pour mission l'évangélisation des païens du Pays basque. Avec l'aide de clercs qui l'accompagnent et des seigneurs chrétiens locaux, il fonde des paroisses, crée des séminaires d'enseignement de langue romane et de formation des diacres. Sa mission achevée, Caribert fait d'Amand son aumônier. Gomatrude est finalement répudiée et se réfugie dans le domaine de se belle-sœur Bruère.
En 630, afin de rendre justice et secourir les pauvres, il voyage en Burgondie, se rendant dans plusieurs villes dont Saint-Jean-de-Losne, où il fait assassiner Brodulf. Il répudie Gomatrude à Reuilly et épouse Nanthilde. Il prend ensuite comme concubine Ragnetrude qui enfante de Sigebert, Saint Amand et Dagobert Ier.
En décembre 630 ou en janvier 631, Dagobert parraine Chilpéric, le nouveau-né de Caribert II et de Fulberte. Caribert est malade de dysenterie ou de tuberculose, ce qui engendre des troubles causés par les seigneurs aquitains ainsi qu'une crainte de rébellion vasconne ou d'offensive wisigothe.
En 631, accompagné à Orléans par Pépin de Landen, son fils Sigebert est baptisé par l'évêque Amand et Caribert II. Il signe un traité de Paix Perpétuelle avec l'empereur byzantin Héraclius. Sur les conseils de ce dernier, il fait baptiser tous les juifs de son royaume.
Les Wendes ou Vénèdes, ethnie Slave, agressent une caravane de négociants Francs, provoquant un conflit diplomatique entre Dagobert et Samo, roi des Wendes. Les Francs d’Austrasie s’unissent avec les Lombards et les Alamans pour battre les Wendes. Dans la bataille, qui a lieu à Kaaden-sur-l'Oder (Wogatisburg)44, les Austrasiens sont vaincus. On attribue cette défaite par un manque de motivation, dû à une politique pro-neustrienne et au fait « qu'ils se voyaient haïs de Dagobert et continuellement dépouillés par lui.
En mars 631, Sisenand, aristocrate Wisigoth, demande l'appui de Dagobert pour détrôner son rival. Dagobert lève des troupes en Bourgogne et envoie les ducs Abondance et Vénérande qui marchent jusqu'à Saragosse. Sisenand monte alors sur le trône et offre aux envoyés de Dagobert 200 000 sous d'or, qui bénéficient à l'abbaye de Saint-Denis.
En janvier 632, Caribert II meurt. La volonté d'autonomie en Aquitaine est ébranlée par la mort du roi. Il est décidé que le duc Egina et l'évêque de Toulouse assurent la gouvernance de l'Aquitaine accompagné par l'évêque Didier de Cahors, qui dispense des conseils en cas de problème, pendant la minorité de Chilpéric. Cependant, celui-ci meurt quelque temps après, peut-être assassiné sur ordre de Dagobert. Le 8 avril 632, il récupère l'Aquitaine, reconstituant ainsi le royaume franc tel qu'il était sous le règne de son père. Dès lors, il choisit de quitter l'Austrasie, et de prendre Paris pour capitale, de par sa position géographique au centre du royaume.
Il se sépare ensuite de Pépin de Landen, tentant de recouvrer un peu du pouvoir que son père avait laissé aller aux maires du palais. Il choisit alors d'excellents conseillers tels que le chancelier Didier, le référendaire gardien du sceau royal Dadon canonisé sous le nom de Saint Ouen et l'orfèvre Eligius futur saint Éloi. Avec leur aide, il s'occupe en priorité des affaires intérieures du grand royaume des Francs et son règne constitue une trêve heureuse dans l'anarchie mérovingienne et apporte une paix relative, grâce à sa volonté d'unifier le gouvernement du pays. Il entreprend un certain nombre de réformes essentielles :
Il lutte contre les revendications autonomistes de certaines parties de la noblesse, et continuant l'œuvre entreprise par Clotaire II, il parvient à supprimer la pratique successorale dite de la patrimonialité qui fut, à cause des mésententes de partage, génératrice de nombreux conflits.
Il parvient aussi à réorganiser l'administration et la justice du royaume, et prend l'initiative, sur les conseils de l'ancien orfèvre Éloi, d'éliminer toute la fraude monétaire, en centralisant au palais la frappe de la monnaie.
Construction de Saint-Denis. Campagne de Dagobert Ier en Poitou. Robinet Testard, Poitiers XVe siècle. Grandes Chroniques de France. Bibliothèque nationale de France.
Il développe également l'éducation et les arts, et fait de nombreux dons importants au clergé il fonde entre autres l'abbaye de Saint-Denis qui accueille son tombeau quelques années plus tard : il lui accorde un droit de foire où tous les ans à partir du 9 octobre, jour de la saint Denis, le clergé peut organiser une foire pour effectuer du commerce et prélever des taxes à la place du pouvoir royal. Il aide Éloi à la fondation du monastère de Solignac, près de Limoges, et celui de saint Martial, dans l'île de la cité à Paris. Il accorde des privilèges d'immunité à Dadon, favorise le monastère de Rebais et choisit Didier au siège épiscopal de Cahors. Il est en fait le dernier roi mérovingien à diriger personnellement le regnum francorum.
Au niveau politique, Dagobert développe les relations diplomatiques avec les pays voisins : un accord en 633 avec les Saxons pour qu'ils l'aident à protéger ses frontières des Slaves de Samo. Les Saxons proposent à Dagobert de protéger le royaume en échange de rémission de leur tribut de cinq cents vaches. Il mène également des campagnes militaires, notamment contre les Vascons 638, les Bretons, et surtout les Slaves qui lui résisteront en 632.
Mais en 634, la noblesse d'Austrasie se révolte. Pour apaiser les esprits, Dagobert est contraint d'abandonner le royaume d'Austrasie à son fils Sigebert III qui n'a alors que deux ans il réussit néanmoins à écarter cette fois Pépin de Landen du poste de maire du palais. Il lui donne comme tuteurs l'évêque de Cologne et le duc Andalgésil.
En 635, il a de Nanthilde un fils nommé Clovis. Ce sont ensuite les nobles de Neustrie qui revendiquent leur rattachement à la Burgondie ; ils exigent et obtiennent que Dagobert rassemble les deux régions, et qu'il place son fils Clovis II à la tête de ce nouveau royaume.
Un traité fut conclu avec Sigebert, afin qu’à la mort de Dagobert la Neustrie et la Bourgogne reviennent à Clovis, l’Austrasie restant à Sigebert et à sa descendance.
En 637, une révolte de Vascons éclate. Une armée est envoyée de Bourgogne, avec à sa tête Chadoinde et dix ducs, qui ravagent leurs vallées. Lors du retour, un duc est piégé dans la vallée de la Soule et sa troupe est vaincue.
À la mort, en 612, du duc de Domnonée Hoël III, qui détient également le titre de roi des Bretons, ses deux fils Judicaël et Gazlun sont désignés pour gouverner conjointement48. Néanmoins, Gazlun refuse de partager le pouvoir et tente d'obtenir le titre de roi. Après une bataille partisane, Gazlun avec l'appui du duc-roi du Bro-Waroch, prend le dessus sur Judicaël et ses partisans cornouaillais. Celui-ci se consacre alors à la vie monastique du monastère de Saint-Méen-de-Ghé. Par l'intermédiaire d'intrusions, Gazlun dépossède alors des leudes partisans de son frère, en enferme certains en prison, en assigne à résidence et fait saccager des domaines et chantiers de construction. Il tente même d'imposer en culte des saints de son choix. Par crainte de voir cette pagaille déborder sur le royaume des Francs, les villes de Nantes et Rennes qui constituent ses défenses et ont été ravagées44, sont renforcées. Afin de savoir ce qui se passe, un notable est envoyé auprès de l’entourage de Gazlun qui décède en fin d’année 632.
Une délégation bretonne se rend au monastère de Saint-Méen-de-Ghé pour inciter à Judicaël à devenir roi. Celui-ci a pris goût à la vie monastique et préfère que son fils de douze ans, Alaüs, prenne sa place. La délégation lui demande d’au moins régner jusqu’à la majorité de son fils. Finalement, Judicaël accepte de devenir duc de Domnonée. Les nouvelles de Bretagne parviennent difficilement à la cour de Dagobert, qui décide de voyager en Poitou, dans l’Orléanais, la Touraine et le Maine pour enrichir ses informations. Il rencontre sans doute Berthilde dans un grand domaine des environs d’Orléans. Il apprend la mort de Gazlun et la prise de pouvoir de Bretagne par Judicaël. Eloi a pour mission d’obtenir la soumission de Judicaël et la réparation de tous les préjudices subis par ses leudes. Durant l’absence d’Eloi, le duc Ega assure sa fonction au gouvernement. Eloi s’installe alors dans le palais du gouverneur de Vannes. Avec l’aide de clercs qui l’accompagnent et qui se déplacent dans le Bro-Waroch, la Cornouaille et la Domnonée, il apprend que Judicaël n’a pas demandé audience à Dagobert pour se consacrer au redressement de la Bretagne, après les troubles causés par Gazlun. Des officiers laïcs de la délégation d’Éloi apprennent que les leudes ont été libérés et dédommagés. Éloi rencontre l’abbé du monastère de Saint-Méen-de-Ghé pour établir un accord en vue de faire se rencontrer Judicaël et Dagobert. Une ambassade est alors accueillie au palais de l’évêque à Vannes, où Éloi accueille des laïcs et ecclésiastiques. Il leur demande s’ils peuvent exprimer les intentions du roi Judicaël et celui-ci qui fait partie du groupe répond Je suis Judicaël et je ne suis pas roi. Après cette délégation, plusieurs négociations ont lieu tantôt à Vannes tantôt à Saint-Méen-de-Ghé. Judicaël y explique qu’il a accepté le titre de duc de Domnonée, que son père lui a attribué à lui et son frère, mais qu’il refuse tout titre royal. Il ajoute que tous les seigneurs bretons reconnaissent la suzeraineté de Dagobert, qu’il n’a jamais failli à sa parole, et refuse de se soumettre, ce qui serait reconnaître une faute qu’il n’a pas faite. Judicaël reproche aux Francs leur indifférence et de n’être pas intervenus contre Gazlun, ce à quoi Éloi répond que la situation bretonne est mal connue de la cour franque et que l’envoi d’un légat auprès de Gazlun signifie la reconnaissance de son pouvoir. L’insistance d’Éloi pour que Judicaël rencontre le roi des Francs est vouée à l’échec, Judicaël affirmant que Je ne suis qu’un duc, non un roi. Je n’ai nulle raison de solliciter une faveur particulière, et nulle raison non plus de réitérer un acte d’allégeance auquel mon pays est fidèle. Il accepte néanmoins d’être reçu par un haut représentant du roi comme le serait n’importe quel duc plutôt que de dîner avec Dagobert. Éloi accepte de le faire recevoir par le référendaire Dadon. Judicaël accorde une audience aux représentants de Cornouaille et du Bro-Waroch, qui le saluent comme roi, pour exprimer aux représentant du roi des Francs la fidélité de la Bretagne. Judicaël rencontre alors Dadon à Creil pendant deux jours, en tant que duc des Bretons. Celui-ci enregistre les déclarations et renouvelle l’amitié et l’appui du roi. Le jour du départ de Judicaël, alors qu’il vient prévenir son hôte, Dagobert apparaît derrière une tenture qui se soulève, et donne l’accolade au duc pris de court, puis se retire. À la fin de l’année 634, Judicaël cède sa place à son fils Alaüs Alain II, qui sera traité en souverain de toute la Bretagne, pour se retirer au couvent de Saint-Méen-de-Ghé. Cette relation entre la Bretagne et le royaume des Francs permet d’accroître les liens entre seigneurs bretons pouvant devenir leudes du roi des Francs, et les autres leudes. De plus, de riches Francs peuvent s’installer en Bretagne et contribuer à faire vivre la région. Des liens commerciaux s’installent notamment avec le développement des manufactures de toiles de Vitré et de Locronan, des salines de Guérande et de Bourgneuf-en-Retz. Par l’intermédiaire des transports rapides dits de cache-marée, la Bretagne approvisionne de grandes villes telles que Paris en poisson frais. Les grandes villes bretonnes se développent : Brest devient un centre de construction navale et port de commerce. Le Mans devient un centre d’échange entre la Bretagne et la Neustrie et des populations bretonnes s’installent dans l’Alençonnais et dans l’ouest sarthois.
L’aristocratie vasconne se soumet à Clichy.
Mort de Dagobert 639. Chronique des empereurs, XVe siècle, Paris, bibliothèque de l'Arsenal.
En 638 ou 639, Dagobert tombe malade d’un flux au ventre à Épinay-sur-Seine. Il recommande alors la reine Nanthilde et son fils Clovis au maire du palais de Neustrie Aega. Il meurt quelques jours après, le 19 janvier à l'âge de 36 ans.
Héritage
À sa mort, ses deux héritiers sont encore très jeunes : Sigebert a huit ans et Clovis quatre ; l'unité de commandement disparaît et les luttes et l'anarchie reprennent. Le pouvoir des maires du palais va s'accroître au détriment des rois, car ils en profitent pour manipuler les jeunes souverains et s'emparer définitivement du pouvoir : c'est le début de l'époque dite des Rois fainéants qui marquera la fin de la dynastie mérovingienne.
Avant de mourir, le roi Dagobert a choisi d'être enterré, non à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, comme ses prédécesseurs depuis Childebert Ier en 558, mais à la nouvelle basilique Saint-Denis dont il a fait construire l'enceinte, sur le lieu où reposait déjà depuis 570 Arégonde, la quatrième épouse de Clotaire Ier. De Dagobert, dernier roi unique du regnum Francorum, il subsiste le tombeau que fait installer au XIIIe siècle le roi Louis IX.
Au XIIIe siècle, les moines de Saint-Denis voulurent rendre hommage au roi Dagobert en réalisant, pour sa dépouille, un tombeau exceptionnel. Mais la sulfureuse réputation du bon roi les fit trembler. Ils imaginèrent donc une sculpture un peu ambiguë et qui se lit dans la pierre comme une bande dessinée… L'âme du roi, figurée en enfant nu et couronné, est emportée en Enfer par les griffes des démons. Heureusement, saint Denis, saint Martin et saint Maurice délivrent cette âme, la présentent au Ciel et lui permettent d'accéder au Paradis. Le message est clair : Dagobert aurait mérité l'Enfer, mais l'intercession des saints lui a miraculeusement ouvert les portes de la bienheureuse éternité.
Le restaurateur de l'unité du regnum Francorum
Construction de la cathédrale de Saint-Denis
Il est reconnu roi d'Austrasie 623 par son père, Clotaire II, désireux de satisfaire le particularisme de l'aristocratie austrasienne. D'abord placé sous la tutelle du maire du palais Pépin de Landen et d'Arnoul, évêque de Metz, il leur échappe à sa majorité et, à la mort de son père, se fait reconnaître roi en Bourgogne puis en Neustrie, évinçant son frère cadet Caribert, relégué en Aquitaine.
Il reconstitue ainsi, pour la deuxième fois depuis la mort de Clovis, l'unité du regnum Francorum, dont il établit la capitale à Paris.
Tombeau de Dagobert Ier
Dernier roi mérovingien à avoir effectivement gouverné, il fut enseveli à l'abbaye de Saint-Denis, qu'il avait enrichie de ses dons. Au lendemain de sa mort, l'anarchie reparaît, inexorable, facilitée par une nouvelle et définitive division du regnum entre ses deux fils : Sigebert III, roi d'Austrasie depuis 634, et Clovis II, roi de Neustrie depuis 635.
Étymologie du nom Dagobert
Le nom de Dagobert est généralement considéré comme d'origine germanique : il pourrait signifier Jour brillant ou Bonheur du jour, obert ou oberth bonheur et dag jour, en vieux francique.
Une autre hypothèse est celle de l'étymologie celtique : dago signifierait bon et ber, grand .
Mémoire de Dagobert Récits de la vie de Dagobert
Alors qu'il était adolescent, Dagobert partit à la chasse au cerf. Ses chiens en poursuivirent un qui se réfugia dans une chapelle édifiée, à Catulliacum, sur le tombeau des saints Denis, Rustique et Eleuthère, évêques de Paris. Un miracle empêcha les chiens d'entrer, impressionnant Dagobert qui conçut pour les saints une grande vénération.
Chassant un cerf avec saint Ouen dans la forêt de Cuise, il aperçoit dans l'air une croix d'une blancheur lumineuse. Saint Ouen décida de bâtir une église à cet endroit, qui devint le prieuré de Lacroix.
Peu de jours après son entrée à Metz pour y exercer la délégation d'autorité de la couronne de son père, Dagobert aurait reçu la visite d'un prince d'Arabie attiré en Francie et en Alémanie par des perspectives d'échanges commerciaux. Ce prince l'aurait averti de la fuite de Mahomet, l'hégire, et de son retrait à Médine.
Notburge, fille de Dagobert, se vit proposer en mariage par son père, qui séjournait dans la vallée du Neckar près du royaume Wende, au roi Samo. Horrifiée par un mariage païen, Notburge se réfugia dans une grotte de l'autre côté de la rivière. Irrité, le roi la retrouva et la saisit par le bras qui lui resta dans la main. Reprenant ses esprits, Notburge entend le bruit d'un être rampant, un serpent s'avance et la remplit d'effroi. Cependant, jetant les yeux sur le reptile, elle lui voit la tête surmontée d'une couronne, une herbe dans la bouche, et fixant ses regards sur la plaie. Serpent divin, blessure guérie. Pieuse, Notburge obtint la conversion des habitants du lieu. La grotte devint un lieu de pèlerinage, et on éleva une église sur sa tombe à Hochhausen. Elle fut sanctifiée sainte Notburge.
Dagobert tomba malade d'une fièvre que les médecins ne savaient guérir. Au bout de six mois, son père envoya en Sarthe à saint Longis, fondateur du monastère du même nom « un calice et une patène en argent, que l'on voit encore aujourd'hui dans ce monastère. Le messager qui s'y rendait n'était pas encore à la moitié du chemin que la fièvre quittait le prince. .
Dagobert fut atteint de lèpre. Il confia son royaume à son fils et partit en pèlerinage avec son épouse. En Alsace, ils s'établirent à Atenborg. Au cours d'une chasse, le roi s'étendit sur un pré fleuri pour y dormir. Au réveil, le contact de sa peau avec la rosée rendit saine une partie de son corps. Sur conseil de sa femme, il s'immergea complètement et guérit de même. Le roi rendit pieusement grâce à Dieu, et dit dans un élan joyeux : Il est sûr que des saints se trouvent ici, ou que ce lieu même est sanctifié. Ainsi, je veux que cet endroit soit appelé désormais Lieu-Saint, ou Lieu-des-Saints Heiligenstadt. Les saints étaient les martyrs Aureus et Justin, une église fut construite en leur honneur.
La sœur de Dagobert, Énimie, se vit offerte en mariage. Or, elle était vouée au Christ. Elle demanda au seigneur d'empêcher cela, et fut atteinte de lèpre. Une vision lui intima de partir guérir à la fontaine de Burle, en Gévaudan. Ainsi, elle put guérir. De retour dans le royaume franc, la lèpre frappa à nouveau. Elle retourna à Burle et compris qu'elle devait rester en Gévaudan. Elle y accomplit de grands miracles, où tel saint Romain, elle anéantit le Drac, accompagnée partout de sa filleule également nommée Énimie. Elles moururent quasiment en même temps et furent ensevelies l'une au-dessus de l'autre, en sorte que seul le tombeau de la filleule, placé en haut, portait mention d'Énimie. Dagobert se rendit jusque dans le Gévaudan qu'en explorateur zélé il se mit à parcourir pour chercher l'endroit où se trouvait enseveli le corps de sa sœur la bienheureuse Énimie, tant il avait le désir de l'emporter dans son pays, pour glorifier sa sœur d'innombrables louanges et pour qu'honneur lui soit rendu. Mais trompé par la disposition des tombeaux, il s'empara d'Énimie la jeune. Ainsi, les reliques de la sainte restèrent en son abbaye.
Clotaire II fit Sadragésile duc d’Aquitaine. Celui-ci n’appréciait pas Dagobert et, lorsque ce dernier l’invita à sa table, en l’absence de Clotaire II, Sadragésile refusa de boire à trois reprises avec Dagobert en plus de se montrer impoli. Dagobert le ridiculisa en lui faisant couper la barbe et en le faisant battre avec des verges. Au retour de Clotaire II, son ministre raconta les faits. Le roi menaça son fils qui se réfugia en la chapelle de Saint-Denis où les hommes de son père ne purent entrer. Durant cette captivité, Dagobert fit un songe où les saints lui seraient apparus. Dagobert s’engagea à les honorer en échange de leur protection. Clotaire II s’inclina devant le pouvoir des saints et se réconcilia avec son fils. Il offrit, en plus, des dons au tombeau des saints.
Dagobert, ayant rassemblé une armée aussi nombreuse qu'il le put, passa le Rhin en personne, et n'hésita point à aller attaquer les saxons. Durant la bataille, Dagobert fut blessé à la tête et son père vint à son secours. Ils combattirent ne laissant vivant aucun homme dont la taille surpassât la longueur de son épée. Ce serait après la mort de son père que Dagobert aurait fait reconstruire l'église de saint-Denis en remerciement de la protection des saints.
La chanson Le bon roi Dagobert
Dans la culture populaire française, Dagobert est surtout connu au travers de la chanson du Bon Roi Dagobert. Celle-ci semble dater de la Révolution française. Selon la légende, Dagobert était tellement distrait qu'il avait l'habitude de mettre ses culottes ses braies, pantalons à l'envers. Myope, Dagobert avait l'habitude, selon Wulfram de Strasbourg VIIIe siècle, de se prendre les pieds dans les tapis et de chuter, sous les regards médusés des témoins. Bon vivant et populaire, il riait bien souvent de sa propre personne. Le respect dû au roi a fait passer sa légendaire distraction pour une simple légende.
Cette chanson, écrite sur un air de danse dit Fanfare du Cerf, n'a pas pour but de transcrire une vérité historique mais plutôt de se moquer du roi Louis XVI, connu entre autres pour sa personnalité distraite, et de la reine Marie-Antoinette, à travers ce roi ancien et mal connu.
Dagobert Ier, roi d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, mort en 638 peint par Émile Signol 1804-1892. Peinture conservée au musée national du château et des Trianons de Versailles.
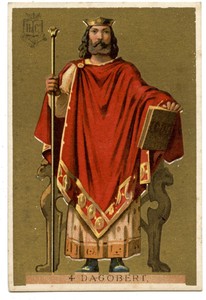   6     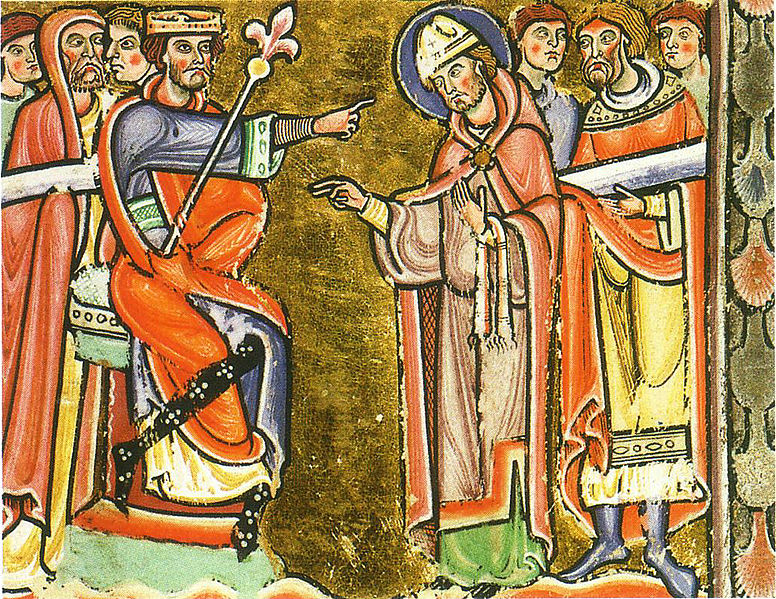       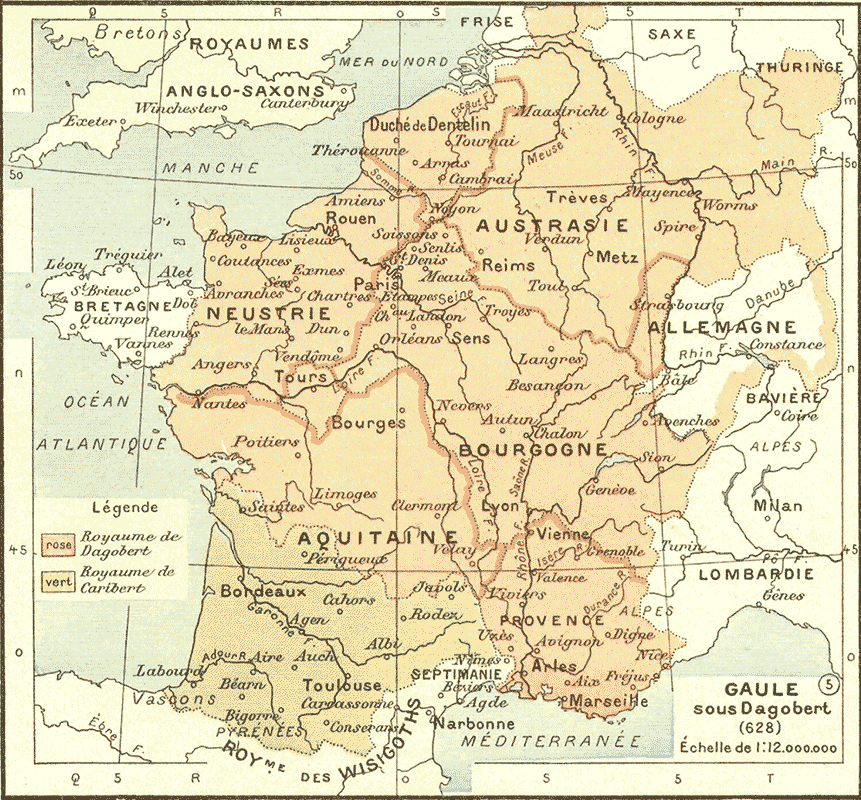
Posté le : 16/10/2015 22:06
|
|
|
|
|
Re: Conrad de Marbourg |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
17/05/2014 09:31
De 24
Niveau : 24; EXP : 40
HP : 0 / 585
MP : 241 / 17303
|
J'adhère totalement à ta thèse ; L'islam reproduit exactement ce que la religion catholique à engendrer, après 14 siècles d'existence. Par contre, je suis beaucoup moins optimiste que toi, les moyens de propagandes à notre époque sont gigantesques, il existe une multitude de groupes radicaux se revendiquant de l'islam qui sont éparpillés dans le monde.
Il faut aussi bien savoir que certains pays très riches alimentent, que ce soit en armes en explosifs et en dollars tous ces " Fous d'Allah". Tu rajoutes à cela tous les marchands d'armes, de ce foutu monde ! Et puis, tu as une puissance comme la Russie qui a une position des plus obscurs sur le sujet.
Et surtout le vivier de pauvres, de gens perdus, les laissés-pour-compte de notre société (toutes nationalités confondues) près à écouter tout discours qui leur donne de l'importance, un rôle majeur dans l'évolution de ce nouveau monde qu'ils veulent mettre en place ; des bombes ambulantes dont le stock me semble inépuisable.
Loriane , je souhaite que tu es raison, qu'avec le temps l'islam soit une religion de paix, ce qu'elle a toujours été mais détourné à des fins de totalitarisme idéologique.
Marco
Posté le : 15/10/2015 11:36
|
|
|
|
|
Re: Conrad de Marbourg |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Tu as raison lorsque la spiritualité se transforme en outil de pouvoir pour assujettir avec des moyens d'une cruauté monstrueuse.
Tu remarqueras que cette crise de " démence " du christianisme qui produisit des tueurs en série en masse, et pesa sur le monde entier pour le régenter, se situe autour du 14ème siècle de son existence, or aujourd'hui la religion qui a 14 siècle d'existence produit les mêmes effets, les mêmes démons répugnants, ce qui me fait dire et me convainc que cette période d'explosion est le chant du cygne de cette religion de fous, de l'islam, qui prendra le même chemin que les précédentes et s'amendera, s'adoucira pour devenir acceptable par la civilisation humaine.
Il y a donc de l'espoir au bout de cette violence excessive.
Ce n'est que ma thèse mais j'en suis convaincue.
Merci pour ton passage.
Posté le : 12/10/2015 21:58
|
|
|
|
|
Re: Conrad de Marbourg |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Chère Loriane,
Merci pour cet article richement documenté qui présente l'inquisition dans son évolution historique, entre tous les pays qui l'ont pratiqué.
Quelle tristesse de penser que des hommes d'église sensés promouvoir le don de l'amour aient pu se livrer à une barbarie!
Au plaisir de lire encore de belles synthèses historiques.
Amitiés.
Jacques
Posté le : 12/10/2015 13:38
|
|
|
|
|
Eléanor Roosevelt |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 11 Octobre 1884 naît Anna Eleanor Roosevelt
Éléonore est la version traduite de son prénom, est souvent aussi d'usage pour les francophones, née le 11 octobre 1884 et morte, à 78 ans le 7 novembre 1962, est l’épouse de Franklin Delano Roosevelt. Par cette union, elle devient la Première dame des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945. Elle a été la première à rendre ce rôle actif.Elle est la première présidente de la Commission présidentielle américaine sur le statut de la femme du 20 janvier 1961 au 7 novembre 1962. Le président de cette commission est John Kennedy et son successeur Esther Peterson.
Elle est déléguée des États-Unis auprès de l’Assemblée générale des Nations unies du 31 décembre 1946 au 31 décembre 1952, le président est Harry S. Truman. Elle est présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations unies de 1946 à 1951 avec pour président Harry S. Truman, son successeur est Charles Malik
Représentante des États-Unis auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations unie de 1947 à 1953 avec pour président Harry S. Truman son successeur est Mary Lord, 34e Première dame des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945. Sous le président Franklin Delano Roosevelt, son prédécesseur est Lou Henry Hoover, son successeur est Bess Truman. Elle pèse aussi sur la décision d'engager les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Féministe engagée, elle s'oppose au racisme1 et défend le Mouvement américain pour les droits civiques.
Après le conflit, elle joue un rôle déterminant dans la création de l’Organisation des Nations unies ONU puis préside, pendant la présidence de Harry S. Truman, la commission chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ses nombreux voyages dans le monde et sa diplomatie contribuent à l'adoption de cette déclaration par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.
En bref
Épouse de Franklin Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt, Première Dame des États-Unis de 1933 à 1945, fut ensuite diplomate pour les Nations unies. Elle fut, en son temps, l'une des femmes les plus admirées et les plus puissantes au monde.
Née le 11 octobre 1884 à New York, Anna Eleanor Roosevelt est la nièce du président Theodore Roosevelt 1901-1908. Élevée dans une famille aisée, elle perd ses deux parents, Elliott Roosevelt et Anna Hall Roosevelt, avant l'âge de dix ans et est confiée avec son frère à des proches. À quinze ans, la jeune fille entre au pensionnat d'Allenswood, près de Londres. Elle apprend à y cultiver la curiosité intellectuelle mais aussi le goût des voyages et de l'excellence. C'est avec regret qu'elle rentre à New York à l'été de 1902 pour préparer ses débuts en société. Perpétuant la tradition familiale, elle consacre son temps à la communauté, donnant par exemple des cours dans un centre social de Manhattan.
Peu après son retour aux États-Unis, la jeune Eleanor est courtisée par son lointain cousin Franklin D. Roosevelt, qu'elle épouse le 17 mars 1905. Entre 1906 et 1916, elle lui donnera six enfants, dont un mourra en bas âge. Lorsque Franklin devient sénateur de l'État de New York en 1911, la famille déménage à Albany, où Eleanor Roosevelt apprend le métier d'épouse d'un personnage public. Quand son mari est nommé secrétaire adjoint à la Marine en 1913, elle le suit à Washington, continuant à remplir son rôle sans enthousiasme. Après l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917, elle reprend ses activités bénévoles auprès des soldats blessés et de la Croix-Rouge.
En 1918, elle découvre que son mari a une aventure avec une secrétaire. Soucieux de sa carrière politique, Franklin refuse le divorce qu'elle lui propose et accepte de ne plus voir sa maîtresse. Il continuera cependant à être attiré par d'autres femmes. En 1920, il postule sans succès à la vice-présidence pour le Parti démocrate. Nourrissant à cette époque un intérêt accru pour la politique, Eleanor Roosevelt désire œuvrer pour de grandes causes et soutenir la carrière de son mari, atteint de poliomyélite depuis 1921. Elle rejoint la Women's Trade Union League et adhère au Parti démocrate local. Membre de la commission des affaires législatives de la League of Women Voters, elle commence à étudier le Bulletin du Congrès et apprend à interpréter les relevés de vote et les débats. Lorsque Franklin Roosevelt devient gouverneur de l'État de New York en 1929, elle saisit cette occasion pour allier sa carrière naissante à ses devoirs d'épouse. Elle continue à enseigner dans l'école de jeunes filles Todhunter, à Manhattan.
Durant les douze années où elle assume la charge de First Lady, elle devient, par l'ampleur de ses activités et sa défense des causes libérales, une figure presque aussi controversée que celle de son époux. Eleanor Roosevelt instaure ainsi à la Maison-Blanche des conférences de presse réservées aux correspondantes féminines et oblige les services télégraphiques qui n'employaient pas de femmes à le faire. Par déférence pour l'infirmité du président, elle réalise pour lui de nombreux voyages d'où elle lui rapporte la situation du pays et de l'opinion publique. Critiquées par certains, ces excursions inhabituelles sont souvent accueillies chaleureusement par les intéressés. À partir de 1936, la Première Dame tient une rubrique quotidienne, intitulée My Day, dans un journal. Appréciée pour ses interventions lors de diverses réunions, elle défend plus particulièrement la condition des enfants, l'amélioration des logements et l'égalité des droits pour les femmes et les minorités raciales.
En 1939, lorsque l'organisation conservatrice Daughters of the American Revolution refuse à la cantatrice noire Marian Anderson de se produire au Constitution Hall, la First Lady rend sa carte de membre et fait organiser le concert devant le Lincoln Memorial. Près de 75 000 personnes assistent à cette représentation en plein air. De même, lorsque les organisateurs d'une réunion publique en Alabama insistent pour marquer la ségrégation raciale dans la salle, elle s'installe sur une chaise pliante qu'elle place dans l'allée centrale. Sa défense des droits des Noirs américains, des jeunes et des pauvres permettra à certains groupes autrefois privés de représentation d'entrer au gouvernement.
Après la mort de Franklin Roosevelt en 1945, le président Truman nomme Eleanor Roosevelt déléguée auprès des Nations unies. L'ancienne First Lady y dirige la Commission des droits de l'homme 1946-1951 et joue un rôle majeur dans la rédaction et l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. Durant les dix dernières années de sa vie, elle demeure un membre actif du Parti démocrate. En 1961, le président John F. Kennedy la nomme à la tête de la Commission sur le statut de la femme, charge qu'elle occupera encore peu de temps avant sa mort. Opposée au départ à l'Equal Rights Amendment, au motif que son adoption priverait les femmes de la précieuse protection légale pour laquelle elles se sont battues et dont elles ont toujours besoin, elle finit par approuver pleinement ce texte.
Voyageuse infatigable, elle fait plusieurs fois le tour du monde, visitant des dizaines de pays et rencontrant la plupart des grands chefs d'État. Eleanor Roosevelt continue à rédiger ouvrages (dont une autobiographie, Ma Vie) et articles quelques semaines encore avant sa mort, précipitée par une forme rare de tuberculose, le 7 novembre 1962, à New York. Betty Boyd_Caroli
Sa vie
Anna Eleanor Roosevelt est née à New York. Elle est le premier enfant de Elliott Roosevelt, wasp de Virginie et Anna Hall Roosevelt. Elle a deux frères, Elliott Roosevelt, Jr. 1889-1893 et Hall Roosevelt 1891-1941 ainsi qu'un demi-frère, Elliott Roosevelt Mann mort en 1941 né d'une relation extraconjugale de son père avec Katy Mann, une servante de la famille. Elle est la nièce du président des États-Unis Theodore Roosevelt. Manquant d'affection de la part de sa mère, elle se considère comme laide.
Élevée dans une famille aristocratique américaine aisée, à l'âge de 8 ans elle perd sa mère morte de diphtérie, son père alcoolique et drogué maintenu dans un sanatorium meurt deux ans plus tard, elle est alors confiée avec son frère à sa grand-mère maternelle, Marie Ludlow Hall 1843-1919 à Tivoli, New York. En 1898, elle entre au pensionnat d'Allenswood, école anglaise réputée près de Londres, dont la directrice Marie Souvestre lui apprend à cultiver la curiosité intellectuelle mais aussi le goût des voyages et des langues elle parle notamment couramment le français ainsi que de la cause féminine. De retour à New York en 1902, elle fait ses débuts dans la société new-yorkaise.
Mariage
Elle rencontre Franklin D. Roosevelt, avec qui sa famille partageait un ancêtre commun d'origine hollandaise, Nicholas Roosevelt 1658-1742, qui l'éblouit lorsqu'il la courtise. En novembre 1904, ils se fiancent malgré l'opposition de la mère de Franklin, Sara Delano Roosevelt. Le mariage très médiatique, de par la présence du président des États-Unis Theodore Roosevelt a lieu le 17 mars 1905. Les nouveaux mariés s'installent à New York dans une maison fournie par la mère de Franklin. Sa belle-mère se mêle de toutes les questions domestiques, Eleanor acceptant une position assez effacée en dépit des préceptes inculqués par Marie Souvestre, mais elle reprend progressivement de l'autorité. Quand son mari est élu membre du Sénat de l'État de New York, la famille déménage à Albany New York et elle échappe à l'emprise de Sara, à son grand soulagement.
Quand son mari est nommé secrétaire adjoint à la Marine en 1913, elle le suit à Washington, D.C., continuant à remplir son rôle de femme de personnage public. En 1919, elle découvre dans les poches de costume de son mari des lettres d'amour de sa secrétaire Lucy Mercer. Trompée, elle lui demande le divorce mais Franklin refuse pour préserver sa carrière politique. Désormais un nouveau contrat s'établit dans le couple : ils deviennent bien plutôt des partenaires politiques que des conjoints.
Elle a plusieurs amitiés suivies avec des femmes, la plus notable étant, alors qu'elle a 49 ans et que son mari entre à la Maison-Blanche, celle qu'elle entretient avec Lorena Hickok, journaliste, avec laquelle elle passe beaucoup de temps et échange plusieurs milliers de lettres, aux alentours de 3300 lettres entre 1933 et 1962, une partie ayant été brulée par Lorena Hickok pour préserver l'intimité d'Eleanor. Lorena Hickok en consacrant nombre d'articles à l'enfance malheureuse et aux déboires mondains de la First Lady contribue fortement à façonner l'image qui passera à la postérité d'Eleanor Roosevelt. C'est elle qui l'encourage à tenir des rubriques dans les journaux comme My Day. Cette importante correspondance est perçue par le patron du FBI J. Edgar Hoover, comme une possibilité de faire pression sur le président des États-Unis. La presse évoque également cette relation.
Vie publique
Quand Franklin contracte la poliomyélite en août 192110, elle le soigne avec un grand dévouement et devient ses yeux, ses oreilles et ses jambes, bien que timide, elle fait des apparitions publiques en son nom, sous les conseils de Louis McHenry Howe, le poussant à poursuivre sa carrière politique contre l'avis de sa belle-mère possessive qui souhaite voir son fils devenir gentleman farmer dans la propriété familiale : doublure de son mari, elle contribue à l'ascension de son mari au poste de gouverneur de New York en 1928 puis à la présidence des États-Unis en 1933. Elle devient la Première dame des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945, ayant notamment une influence sur la politique intérieure de son époux, programmes sociaux du New Deal, amélioration du sort des femmes, droits civiques de la population noire, etc., faisant des conférences de presse, tenant des rubriques dans les journaux puis produisant des émissions de radio6. Grâce au talent d'Eleanor, le couple présidentiel gagne en popularité en se servant du nouveau pouvoir que représentent les médias.
« Ministre sans portefeuille » qui donne son avis sur tout, elle provoque dès 1940 des inquiètudes concernant l'étendue de son pouvoir et commence à devenir la cible de la presse et des humoristes.
À compter de 1933, elle est favorable au rétablissement des relations diplomatiques avec l'Union soviétique et nourrit l'espérance de pouvoir s'entretenir directement avec Staline8. Elle introduit à la Maison Blanche un jeune militant syndicaliste, Joseph Lash, membre des Jeunesses communistes qui milite, sans grand succès d'ailleurs, pour une intervention américaine en faveur des républicains espagnols lors de la guerre d'Espagne. Averti par les services secrets, Franklin Roosevelt fait affecter Lash dans le Pacifique sud. Des archives de Moscou, dont le degré de véracité ou d'intégralité est difficile à estimer eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont rendues publiques, évoquent l'amitié entre Eleanor et Lash, notant que celle-ci est « facile à influencer et à mener quand on sait la prendre ».
Elle est favorable à la décision d'engager les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et n’hésite pas à rendre visite aux troupes sur le front. Elle soutient la création d'une escadrille de chasse composée de pilotes noirs qui se battent en Italie et escortent les bombardiers sur l'Allemagne, escadrille Tuskegee Airmen; elle est également à l'origine du corps féminin de pilote de l'armée de l'air américaine, le Women Airforce Service Pilots, qui permettra à de nombreuses femmes de devenir pilotes.
Le cinquième des six collèges de l’université de Californie à San Diego a été nommé le Eleanor Roosevelt College.
Elle entretint une célèbre polémique avec le cardinal Francis Spellman en raison de ses idées, jugées anti-catholiques par ses opposants, au nombre desquels comptait la machine démocrate de Tammany Hall à New York, largement dominée par des Américains d'origine irlandaise et de religion catholique, également adversaires politiques de son mari.
À la mort de son mari, elle utilise son charisme et son talent diplomatique pour contribuer à la commission chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle lit celle-ci à la tribune de l'Organisation des Nations unies et reçoit à titre posthume le prix des droits de l'homme des Nations unies en 1968.
Vie privée
Le couple a eu six enfants, dont l'un meurt en bas âge :
Anna Eleanor, Jr. 3 mai 1906 - 1er décembre 1975 : journaliste, responsable des relations publiques.
James (23 décembre 1907 - 13 août 1991 : homme d'affaires, membre du Congrès.
Franklin Delano, Jr. 18 mars 1909 - 1er novembre 1909).
Elliott (23 septembre 1910 - 27 octobre 1990 : homme d'affaires, maire.
Franklin Delano, Jr. 17 août 1914 - 17 août 1988 : homme d'affaires, membre du Congrès, agriculteur.
John Aspinwall 13 mars 1916 - 27 avril 1981 : commerçant, courtier en valeurs mobilières.
Eleanor Roosevelt est donnée par certains auteurs comme bisexuelle, et ferait partie de ces personnalités célèbres dont la bisexualité aurait été volontairement ignorée ou effacée. Elle a parfois été présentée comme une lesbienne. La découverte de ses relations avec des femmes causa une crise familiale similaire à celle résultant de la révélation de l'infidélité de son mari avec sa secrétaire. Plus qu'une question d'ignorance il a surtout fallu attendre la mort de Lorena Hickok pour accéder à des lettres qui montrent par bien des aspects une relation passionnée: "... je me souviens le plus clairement de vos yeux et de cette sorte de sourire taquin qu'on peut y lire, et du contacte contre mes lèvres de cette douce petite tache au coin nord-est de votre bouche" écrit Lorena dans une lettre à Eleanor. Les auteurs divergent toutefois à ce sujet, et rien ne prouve que la relation avec Lorena Hickok ait été de nature sexuelle, tout comme rien ne démontre que se développa en une liaison l'attachement qu'elle eut à compter de 1929 pour Earl Miller, un policier désigné pour être son garde du corps.
Citations
« Tu dois accepter tout ce qui arrive, et la seule chose importante est d'y faire face avec courage et avec le meilleur que tu as à offrir. »
« You have to accept whatever comes, and the only important thing is that you meet it with courage and with the best that you have to give. »
« L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »
« The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. »
« Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des gens. »
« Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people »
« Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. »
« No one can make you feel inferior without your consent. »
« Fais ce que ton cœur te dit de faire – de toutes les façons, on te critiquera. Tu seras damné si tu le fais, et damné si tu ne le fais pas. »
« Do what you feel in your heart to be right — for you’ll be criticized anyway. You'll be damned if you do, and damned if you don’t. »
« La paix mondiale ne peut être le travail d'un seul homme, d'un seul parti, ou d'une seule nation. Cette paix doit reposer sur la volonté commune du monde entier »
« The structure of the world peace cannot be the work of one man, or one party or one nation. It must be a peace which rests on the cooperative effort of the whole world.
Hommage
Elle est inscrite au National Women's Hall of Fame.
Filmographie
The Eleanor Roosevelt Story, documentaire de 90 minutes ayant remporté l'Oscar du meilleur film documentaire en 1965
Dans la fiction
1975 : elle est mentionnée dans le film policier de Dick Richard Adieu ma jolie, comme symbole, en juin 1941, des premiers combats politiques contre la ségrégation raciale.
2000 : Dans le film 60 secondes chrono de Dominic Sena, avec e.a. Nicolas Cage, la voiture 46, la mythique Mustang Shelby de 1967 est dénommée Eleanor.
2013 : dans le film américain Week-end royal (=rôle interprété par Olivia Williams
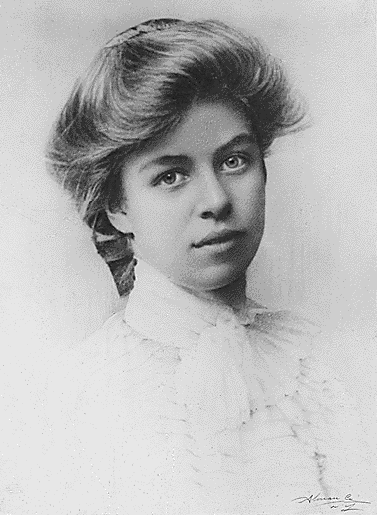        
Posté le : 10/10/2015 17:45
|
|
|
|
|
Grégory Potemkine |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 11 octobre 1739 naît Grigori Aleksandrovitch Potemkine
ou Potiomkine, Григорий Александрович Потёмкин, à Tchijovo et mort à 52 ans, le 16 octobre 1791 durant un voyage de Iaşi à Nikolaïev, est un militaire et homme de gouvernement russe du XVIIIe siècle. Beau et intelligent, il devint l'amant et le favori de Catherine II jusqu'à sa mort. Il est l'un des colonisateurs des steppes sous-peuplées du sud de l'Ukraine, qui deviennent russes avec le traité de Küçük Kaynarca 1774 et du sud du Don.
Il a le grade de Feld-maréchal, il participe au conflits de la Guerre russo-turque de 1768-1774, et de la Guerre russo-turque de 1787-1792Il devientommandement Président du conseil militaire. Il reçoit pour distinctions l'ordre de Saint-André, l'ordre de Saint-Vladimir, l'ordre de Saint-Alexandre Nevski, l'ordre de Saint-Georges 1er, 2e et 3e degrés, l'ordre de l'Aigle blanc, l'ordre de Sainte-Anne, l'ordre de Saint-Stanislas, l'ordre de l'Aigle noir, l'ordre du Séraphin, l'ordre de l'éléphant. En hommage on nomme un Cuirassé de son nom" Potemkine ". Il fonde les villes de Kherson, Nikolaïev, Sébastopol et Iekaterinoslav qui étaient regroupées dans les territoires de la Nouvelle Russie.
En bref
Militaire, Grigori Potemkine est remarqué par l'impératrice Catherine II, dont il devient le favori, et fait une carrière exceptionnellement rapide. Il s'illustre pendant la guerre contre la Turquie en 1774, puis, après la signature du traité de paix, est nommé gouverneur général des provinces nouvellement annexées qui vont de la mer Noire à l'Ukraine. Il y révèle tout son génie d'organisateur. Il fait venir des immigrants pour peupler et coloniser la campagne ukrainienne et fonde des villes comme Ekaterinoslav, des forteresses comme Kherson, ainsi que plusieurs ports et places fortifiées le long des côtes. Profitant des discordes dynastiques dans le khānat de Crimée, il annexe cette presqu'île à la Russie 1783. Il y construit la ville de Sébastopol où sera basée la flotte de la mer Noire.
Maréchal et ministre de la Guerre en 1784, il prépare en 1787 le voyage de l'impératrice dans les régions nouvellement organisées. Catherine II était accompagnée dans ce voyage triomphal par l'empereur Joseph II d'Autriche, le roi de Pologne, le prince de Ligne et le comte de Ségur, ambassadeur de France. Les voyageurs sont non seulement surpris par l'organisation de la vie en Nouvelle-Russie, mais par la vue d'une flotte de quarante vaisseaux nouvellement construite. Le cortège impérial est acclamé tout au long du trajet par la population accourue de loin. La légende selon laquelle Potemkine aurait construit le long de la route des villages factices pour faire valoir les résultats de son administration a été inventée par Helbig. Elle est infirmée par tous les participants du voyage, le prince de Ligne en tête.
Les derniers faits d'armes de Potemkine se rapportent à la seconde guerre contre la Turquie 1787-1791. Il forme, avec le prince Bezborodko, le projet de restaurer l'Empire byzantin et de placer sur le trône impérial le petit-fils de Catherine II, Constantin 1779-1831. Nommé commandant en chef de l'armée, il subit des revers et encourt une semi-disgrâce. Excédé par les intrigues de ses adversaires et surtout du nouveau et dernier favori, le comte Zoubov, homme inapte et plein d'orgueil, il essaie en vain de regagner la faveur impériale et entreprend un dernier voyage en Nouvelle-Russie, mais il meurt en route le 5 octobre. Malgré la défaveur finale, Potemkine fut de tous les favoris de Catherine II celui qui contribua le plus à la gloire de son règne. Pierre Kovalewsky
Sa vie
Grigori Aleksandrovitch Potemkine naît dans le village de Tchijovo, près de Smolensk dans une famille de petits officiers. Après des études inachevées à l’université de Moscou, il s'engage dans la Garde à cheval. Il participe au coup d'État de 1762 qui détrône Pierre III et couronne Catherine II. Il reçoit le grade de second lieutenant des Gardes. Catherine demandait des adjoints dignes de confiance et appréciait l'énergie de Potemkine et ses capacités d'organisation. Les anecdotes biographiques récentes comme celle de son implication dans le meurtre de Pierre III, sont obscures et souvent apocryphes.
Amant de Catherine II
En 1774, ses relations prennent un caractère plus intime. Succédant à Grigori Orlov, Potemkine devient le favori de l'impératrice, son aînée de dix ans, il reçoit de nombreuses récompenses ainsi que d'importants postes, notamment sa nomination au poste de Président du conseil militaire 1774-1791. Durant les dix-sept années qui suivent, il est le personnage le plus puissant de Russie. Potemkine trouvait du plaisir dans le luxe ostentatoire et la richesse personnelle. Comme Catherine, il tombe dans la tentation de l'absolutisme, cependant, dans de nombreuses actions il est guidé par l'esprit des Lumières. Il se montre tolérant à l'égard des différentes religions, et protège les minorités. En tant que commandant en chef de l'armée russe nommé en 1784, il prône un concept plus humain de la discipline, exigeant que les officiers prennent soin des soldats d'une manière paternelle.
En 1776, à la requête de Catherine, l'empereur Joseph II élève Potemkine au rang de prince du Saint-Empire romain germanique. En 1775, il est remplacé dans les bonnes grâces de Catherine par Zavadovsky ; mais les relations entre Catherine et son ancien amant continuent à être amicales, et son influence n'a jamais été remplacée par celle d'aucun de ses autres amants. De très nombreux faits attestent de la gigantesque et extraordinaire influence de Potemkine durant les dix années suivantes. Les plus importants documents d'État sont passés entre ses mains.
Controverse
Potemkine reste un personnage controversé et donne lieu à des opinions à propos opposées à son sujet. Le pamphlet German, publié en 1794, affiche l'opinion de ceux qui l'ont considéré comme un diable génial de Catherine et de la Russie. Mais il y en avait beaucoup, et l'impératrice elle-même, qui le considéraient comme un homme multiple et un commandant de génie, un administrateur doué, mais exigeant. Il fut indubitablement le plus extraordinaire de tous les amants de Catherine.
Immoralité, extravagance et total mépris de la vie humaine étaient ses points faibles, mais il était loyal, généreux et magnanime. Presque toutes les anecdotes du diplomate de Saxe Georg von Helbig à son sujet, dans la biographie pour le journal Minerva, et abondamment utilisées par les biographes suivants, sont fausses.
Mort
Malade depuis quelque temps, Grigori Potemkine demanda à être transporté à Nikolaïev ; il décéda au cours de ce voyage le 5 octobre 1791. Grigori Potemkine fut d'abord inhumé en la cathédrale de Kherson. Mais après son accession au trône impérial, Paul Ier de Russie fit disperser les restes de celui qui fut pendant des années l'amant de sa mère, Catherine II de Russie.
Postérité
Son nom est surtout connu de nos jours pour la légende de mises en scène de façades de villages prospères sur une réalité misérable (villages Potemkine), ainsi que pour le cuirassé qui portait son nom durant la Révolution russe, duquel fut tiré le célèbre film Le Cuirassé Potemkine.
         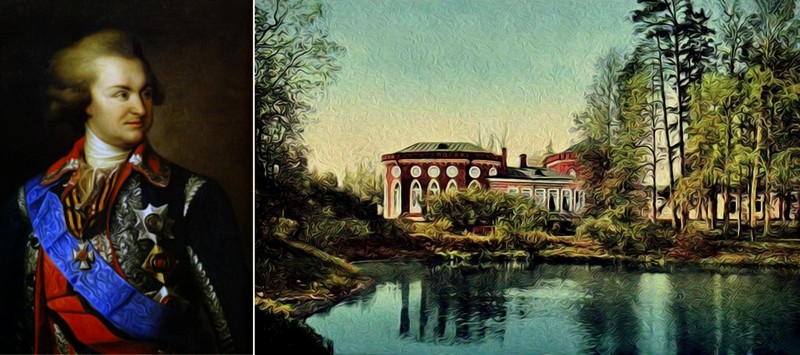 
Posté le : 10/10/2015 16:39
|
|
|
|
|
Ulrich Zwingli 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 11 octobre 1531 meurt Ulrich Zwingli
à Kappel am Albis dans le canton de Zurich, à 47 ans, pasteur, hommes de lettres de langue allemande, théologien et réformateur protestant suisse, né à Wildhaus dans le canton de Saint-Gall le 1er janvier 1484.Exègue et prédicateur son Œuvre principale est " La foi retrouvée "
Très présent dans la société, il est un des principaux artisans des différentes tentatives de convertir, y compris militairement, la Suisse à la Réforme protestante. En 1523, il parvient à faire adopter la Réforme par le canton de Zurich, premier canton à le faire. Il est, depuis Zurich, à l'origine des Églises réformées de Suisse alémaniques. Il est l'une des références historiques du protestantisme libéral.
Après un ministère à Glaris et à Einsiedeln, où il combattit la mariolâtrie, Zwingli fut appelé comme prédicateur à Zurich. Logicien rigoureux, il alla plus loin que Luther en ce sens que, selon lui, ce qui n'était pas enseigné dans la Bible devait être aboli : la Cène représentait un mémorial, sans présence réelle du Christ, et les images, qu'il considérait comme des idoles, devaient être enlevées des églises. Enfin, l'ancienne liturgie devait être remplacée.
En bref
Zwingli est un personnage complexe et multidimensionnel. Humaniste et autodidacte, penseur religieux et réformateur, patriote et figure nationale suisse – certains ajoutent prophète biblique –, il est tout cela en une personne, dont la vie et l'action sont conditionnées par l'histoire suisse durant le premier tiers du XVIe siècle. On ne saurait détacher ni abstraire tel ou tel aspect de sa personnalité sans fausser l'ensemble. Aussi convient-il dans toute étude, même partielle, de tenir toujours présentes à l'esprit ces différentes coordonnées
Huldrych Ulrich Zwingli naquit à Wildhaus dans le Toggenburg, au pied du mont Santis Suisse orientale. Il était le troisième fils de l'ammann principal notable du district. Le Toggenburg dépendait de l'abbé de Saint-Gall, mais était lié par traité avec Schwyz, l'un des cantons primitifs de la Confédération – ce qui explique la conscience patriotique suisse de Zwingli. Celui-ci fréquenta d'abord l'école primaire de Weesen Walensee, puis la Trivialschule de Bâle et celle de Berne, dirigée par H. Wölflin Lupulus. Inscrit à l'université de Vienne en 1498 puis en 1500, il passa en 1502 à celle de Bâle où il fut formé dans l'esprit de la via antiqua ; il y devint bachelier ès arts en 1504 et maître en 1506 de Glarus après un semestre d'étude de théologie, il fut ordonné prêtre à Constance par l'évêque Hugo von Hohenlandenberg sept. 1506. Son séjour à Glarus 1506-1516 fut interrompu par deux voyages en Italie du Nord Novare, 1513 ; Marignan, 1515, où il accompagna les troupes suisses comme aumônier Feldprediger. D'abord partisan de l'alliance papale, il obtint du Saint-Siège une pension annuelle de cinquante florins, à laquelle il renonça en 1520. La défaite sanglante de Marignan lui ouvrit les yeux sur les méfaits du mercenariat et du régime des pensions. Ses premiers écrits sont des poèmes de portée politique : Allégorie du bœuf 1510, Le Labyrinthe 1516. En même temps, il se plongeait dans l'étude des scolastiques et des Pères, puis, sous l'influence d' Érasme, il se mit à étudier le grec 1513 et copia les épîtres de saint Paul en grec, d'après l'édition du Nouveau Testament Bâle, mars 1516, pour les mémoriser suivant le conseil que donne Érasme dans l'Enchiridion. Zwingli se rattache au cercle des humanistes bâlois admirateurs d'Érasme, dont Glarean était le centre. À partir de 1514, on peut parler d'un « humanisme suisse W. Näf, L. von Muralt, K. Maeder ; celui-ci n'eut qu'une existence éphémère, mais Zwingli retira de sa visite à Érasme à Bâle, au printemps 1516 une impression durable. Déjà dans un poème de 1510 Expostulatio Iesu cum homine, Érasme insinuait qu'il était vain de chercher un bien quelconque en dehors du Christ, alors que celui-ci était la source de tout bien, sauveur, consolateur et trésor de l'âme ; Zwingli en eut connaissance vers 1514-1515 Corpus Reformatorum, II, et dès ce temps il concentra ses pensées sur le Christ solus Christus, par opposition aux créatures et aux formes accessoires de la religion. Première appréhension mystique, qui avec le temps ne cessa de s'amplifier. La lecture des ouvrages du maître l'initia à la philosophia Christi et à ce qu'on appelait alors la « nouvelle théologie Écriture et Pères ; il fit sien le double idéal d'Érasme du Christus renascens renaissance des belles-lettres et du christianisme puisé à ses sources et du pacifisme. Ce dernier trait se conjuguait avec sa propre campagne pour la neutralité de la Confédération dans les luttes politiques que se livraient les grandes puissances. L'attitude de Zwingli indisposa la majorité de ses paroissiens de Glarus, qui militaient pour l'alliance française. Du 26 novembre 1516 à la fin de 1518, il se retira à Einsiedeln, où il devint curé Leutpriester, tout en faisant administrer provisoirement la cure de Glarus par son vicaire. S'il tenta à Einsiedeln de rénover la prédication par le recours aux textes de l'Écriture et des Pères, il resta dans la ligne traditionnelle ; il fit même alors le pèlerinage d'Aix-la-Chapelle. Son état d'âme du moment nous est révélé par la lettre qu'il écrivit au chanoine H. Utinger 5 déc. 1518 ; C.R., VII. À Érasme il demandait de le rendre meilleur et de l'aider dans le combat spirituel qu'il menait contre la chair. Le succès de sa prédication et son opposition à l'alliance française le désignèrent aux suffrages du chapitre de Zurich, qui l'élut le 11 décembre 1518 comme curé de la cathédrale. Il arriva à Zurich le 1er janvier 1519.
On date d'ordinaire de l'arrivée de Zwingli à Zurich l'adoption de la Réforme en cette ville. En fait, cet événement n'eut lieu que trois années plus tard. En 1519, Zwingli se déclara contre le renouvellement de l'alliance française, question alors à l'ordre du jour ; seul des cantons suisses, Zurich y renonça effectivement en 1521 et se trouva de ce chef isolé. Il se détacha également de l'alliance avec le pape et les Habsbourg, sous l'influence de Zwingli, dont on cite les paroles à l'adresse du cardinal Schinner, légat papal : Retournez son chapeau rouge, il en tombe des ducats et des couronnes ; pressez-le, il ruisselle du sang de vos fils, frères, pères ou amis. » L'entrée en scène de Luther dispute de Leipzig, juin 1519 provoqua des remous en Allemagne méridionale et en Suisse. Zwingli lut nombre d'ouvrages de Luther et fit entrer dans sa synthèse en formation une partie des thèses luthériennes tout en leur donnant un accent propre égation du libre arbitre, rôle de la foi dans la justification, sens plus aigu du péché : C.R., I. D'une manière plus décisive, il fit à l'occasion d'une grave maladie la peste l'expérience du Tout de Dieu et du néant de la créature, qu'il a chantée ensuite dans le Pestlied 1520. Faisant écho à une parole de saint Paul Rom., IX, 20, il écrit : Je suis ton vase, façonne-moi ou brise-moi à ton gré ; jouet ou plutôt instrument entre les mains de Dieu, Zwingli acquiert alors une conscience plus vive de sa mission.
À la différence de Luther, il associait intimement à ses problèmes personnels le salut de son peuple Zurich et la Confédération, avec les implications morales, sociales et politiques que cela comportait. Cette mystique de l'action sous la mouvance de l'Esprit, désormais intégré à la lettre de l'Écriture le sola scriptura au sens zwinglien ne s'entend pas autrement, ouvre une phase nouvelle de sa carrière. On discute sur le point de savoir à quelle époque précise Zwingli passa de l'attitude de réformiste au sens érasmien à celle du reformatorisch au sens luthérien. La question suppose une définition de ces termes, sur lesquels les historiens ne sont pas d'accord. Un fait paraît certain, c'est que ce passage fut ressenti par Zwingli non comme une rupture, mais comme un approfondissement ; déjà Érasme lui avait révélé le Christ comme source de tout bien, la doctrine de Luther entendue comme Christusmystik A. Adam s'en rapprochait. Mais ce qui est proprement reformatorisch chez Zwingli, c'est l'opposition radicale entre Dieu et la créature, opposition qui l'amena à éliminer de la doctrine et du culte tout ce qu'il considérait comme adventice inventions humaines dans les dogmes ; pratiques accessoires de piété.
Les années 1522 et 1523 marquent le tournant. Zwingli entra d'abord en conflit avec l'autorité diocésaine sur des points de discipline : abstinence avr. 1522, célibat ecclésiastique juill. 1522. Il soumit le litige à l'arbitrage du Conseil, qui convoqua une dispute 29 janv. 1523. Il proposa soixante-sept thèses Schlussreden, sur quoi le Conseil confirma sa décision de l'année précédente juill. 1522, qui autorisait la prédication sur la seule base de l'Écriture. C'était donner un blanc-seing à Zwingli. La messe comme sacrifice et le culte des saints furent l'objet d'une dispute subséquente 26-29 oct. 1523. Cependant, la crainte de complications politiques obligea d'abord à surseoir abrogation des images en juin 1524, de la messe le Jeudi saint, en 1525. En même temps, les couvents furent supprimés, tandis que le chapitre cathédral était réorganisé 29 sept. 1523. Si césure il y a, elle se place en 1522, quand Zwingli renonça au mandat qu'il tenait de l'évêque pour se mettre à la disposition du magistrat Conseil, qui le confirma dans ses fonctions de Leutpriester. Zwingli passa alors d'une obédience à l'autre. Il cessa, de ce chef, de célébrer la messe, encore qu'il ait affirmé avoir cru à la présence réelle jusqu'en 1523. Les deux disputes de 1523, où l'on peut voir, avec B. Moeller, l'acte de naissance de la nouvelle communauté zurichoise, hâtèrent l'évolution. Notons que Zwingli se maria clandestinement en avril 1524 avec la veuve Anna Reinhard, avec qui il vivait maritalement depuis 1522.
Durant ces années cruciales 1522 et 1523, Zwingli s'appuya de plus en plus sur le Conseil, et notamment le Grand Conseil représentant les corporations, où il comptait le plus de partisans ; le Petit Conseil était plus réactionnaire. De l'enquête minutieuse de W. Jacob il ressort que la Réforme à Zurich recruta ses adeptes dans toutes les couches de la population. Cependant, comme le remarque N. Birnbaum, les partisans de Zwingli viennent principalement de l'élite artisanale et mercantile dans les branches de la production affectées par les changements économiques et techniques récents. La campagne fut plus lente à se rallier et, d'après O. Vasella, la juridiction épiscopale s'y maintint plus longtemps qu'on ne l'a cru. Le clivage se produisit plutôt dans les rangs des partisans de Zwingli appartenant à l'élite intellectuelle C. Grebel, F. Mantz, qui optèrent pour un christianisme communautaire indépendant du pouvoir civil. Ce fut l'origine du mouvement ana baptiste en Suisse et en Allemagne méridionale communauté de Zollikon étudiée par F. Blanke. S'il y avait dans l'enseignement de Zwingli des amorces dans ce sens, on ne peut cependant parler à ce sujet de revirement dans sa pensée avec R. Walton contre J. H. Yoder. Faute de venir à bout du mouvement par des colloques avec les leaders, Zwingli appela contre eux la répression du pouvoir civil exécution de Mantz, 1527.
En même temps que la Réforme zurichoise prenait sa physionomie particulière Volkskirche bénéficiant de l'appui du pouvoir séculier, Zwingli achevait de dessiner les grandes lignes de sa théologie Commentarius de vera et falsa religione, mars 1525. En matière de culte, il réagit contre certains excès de la dévotion populaire (notamment en ce qui concerne le culte des saints et vise à instaurer un culte plus dépouillé, plus spirituel, à l'image du Dieu-Esprit et en vertu du principe que le sensible ne peut agir sur la partie spirituelle de l'être humain. De ce point de vue, l'épuration du culte devait conduire à l'élimination d'une bonne part de ce qu'on entend communément par catholicisme . Mais, même en matière de musique et d'art religieux, Zwingli n'est pas aussi radical qu'on le présente d'ordinaire. Des études de C. Garside, H. Reimann, M. Jenny et O. Söhngen il ressort que ses attitudes négatives sur la musique religieuse datent de 1523 et qu'elles visent la psalmodie traditionnelle en latin et non le chant choral de la communauté évangélique. Plus hardies furent ses initiatives dans le domaine de la discipline : l'institution du tribunal matrimonial, où W. Köhler a vu le prélude du consistoire de Calvin à Genève, transférait au Conseil une part de la juridiction épiscopale, concernant notamment les mariages, la surveillance des pasteurs, l'assistance au culte, et même finalement l'excommunication des délinquants. Alors qu'ailleurs, à Bâle et à Strasbourg, l' Église se réservait le pouvoir d'excommunication et tendait à se distinguer du magistrat, on constate à Zurich l'évolution inverse. L'Église s'intègre de plus en plus à la cité corporative et se coule dans ses cadres ; de ce chef, elle perd son autonomie. Cette absorption a pour contrepartie le rôle de leader spirituel dévolu aux Pfarrer et à Zwingli lui-même. Leur tâche est d'éclairer les pouvoirs publics sur les démarches à faire dans l'intérêt général, ce qui suppose à la base un idéal religieux commun : la volonté de Dieu révélée dans l'Écriture admise comme règle de vie sociale aussi bien qu'ecclésiale. C'est en ce sens seulement qu'on peut parler de théocratie à Zurich R. Walton. L'élément pneumatique disparu, les Pfarrer devinrent des fonctionnaires du culte, et l'Église confondue avec l'État chrétien donna naissance au Staatskirchentum Église d'État ; ainsi à Berne après 1550. Mais, par là, la réforme zwinglienne n'a fait qu'accélérer un processus dont les débuts sont bien antérieurs : devant la carence de l'autorité épiscopale, le Conseil de Zurich s'était habitué à traiter même des affaires religieuses. En lui reconnaissant un jus in sacra, ce qu'en Allemagne les Luthériens étaient enclins à lui refuser, Zwingli ne faisait guère que renforcer sa compétence en ce domaine. Son action n'est donc pas aussi révolutionnaire qu'on la représente d'ordinaire.
Chronologie
1502 : S'inscrit à l'université de Bâle, où il obtient le grade de maître ès arts.
1506 : Achève ses études de théologie et est ordonné prêtre à Constance.
1506-1516 : Curé de la ville de Glaris. Ses sermons anti-mercenariat ne plaisent pas à la communauté rurale.
1516-1518 : Chapelain de l'abbaye territoriale d'Einsiedeln Notre-Dame des Ermites.
1512 : Comme aumônier militaire des Suisses à la solde du pape, il participe aux batailles de Novare 1513 et de Marignan 1515.
1513 : Apprend le grec ancien.
1516 : Rencontre Érasme et l'imprimeur Johann Froben à Bâle.
Fin 1518 : Appelé comme prédicateur de la collégiale de Zurich.
1er janvier 1519 : Zwingli prêche pour la première fois à la Grossmünster de Zürich. Marqué par l'épidémie de peste qui décime plus du tiers des habitants de la ville cette année-là2, il approfondit sa foi et devient peu à peu un authentique réformateur.
1519 : Devient curé de Zurich.
1520 : Renonce volontairement à sa pension papale.
16 mai 1522 : Par la publication de Vermahnung an die zu Schwyz, dass sie sich vor fremden Herren hutend, Zwingli commence à se faire connaitre en dehors de Zurich.
1523 : Passe définitivement à la Réforme avec la rédaction des 67 thèses (les Schlussreden) qu'il rédige pour participer à la première dispute de Zurich qui se tient le 29 janvier. Dès lors Zwingli va tout faire pour que Zurich devienne une cité réformée.
1524 : Épouse la veuve Anna Reinhart. Ils auront quatre enfants : Regula, Guillaume, Ulrich et Anna.
Septembre 1525 : Zurich abolit la messe (Berne l'interdira en 1528, Bâle et Glaris en feront de même en 1529.
Mars 1526 : Le premier culte réformé est célébré. Les moines se dépouillent de leurs habits religieux, la lecture du texte sacré se substitue au chant et les reliques sont abandonnées.
Mai Zwingli est excommunié suite à la dispute de Baden (canton d'Argovie.
1529 : Colloque de Marbourg. Sous la présidence du landgrave Philippe Ier de Hesse, Zwingli y rencontre Martin Luther pour faire le point de leurs accords et désaccords sur la doctrine eucharistique.
En juin, première bataille de Kappel. La Réforme, grâce à la Ligue évangélique réunissant les cantons de Berne, Saint-Gall, Bâle et Zurich, et sous l'action de Zwingli, s'étend aux bailliages communs alliance combourgeoise après la première paix de Kappel.
Octobre 1531 : Les cantons catholiques attaquent les Zurichois et les battent à la 2e bataille de Kappel. Zwingli - aumônier des troupes zurichoises - est tué sur ce champ de bataille le 11 octobre 1531 alors qu'il assiste blessés et mourants.
Sa vie
Ulrich Zwingli naît le 1er janvier 1484 à Wildhaus dans le Toggenbourg canton de Saint-Gall. Il a neuf frères et sœurs. Son père est un simple paysan, amman ou magistrat de sa paroisse qui, connaissant toute l'importance de l'instruction, ne négligea rien pour lui en assurer les avantages. Zwingli en puisa les éléments à Bâle et à Berne. Les dominicains, augurant favorablement de ses débuts, cherchèrent à l'attirer dans leur ordre : mais son père, voulant l'y soustraire, l'envoya se perfectionner à l'université de Vienne en Autriche au semestre d'hiver 1498. Cependant le jeune Zwingli n'y apprit qu'un peu d'astronomie, de physique et de philosophie. Zwingli est exclu de l'université. Deux ans plus tard, on le retrouve à Bâle, où le professeur Thomas Wyttenbach l'encourage à se consacrer à des études de théologie.
De retour dans sa patrie, après une absence de deux ans, il revint une seconde fois à Bâle, où il fut bientôt nommé régent. À peine âgé de dix-huit ans, il se livra avec toute l'ardeur d'un jeune homme aux devoirs de sa place ; et il acquit une connaissance plus profonde des langues qu'il était obligé d'apprendre à ses élèves. Il avait une inclination prononcée pour Horace, Salluste, Pline le Jeune, Sénèque, Aristote, Platon et Démosthène, dont la lecture l'occupait nuit et jour, et qui contribuèrent si puissamment à enrichir ses idées et à polir son style. Il ne négligea pas néanmoins l'étude des sciences nécessaires à l'état auquel il se destinait. Il eut pour professeur de théologie Thomas Wyttenbach, dont l'enseignement, sans avoir rien d'extraordinaire, s'élevait cependant au-dessus des préjugés de ses contemporains. D'autres historiens font l'éloge de la méthode qu'il employait dans l'enseignement, et de la confiance qu'il inspirait à ses disciples.
Débuts comme curé de la ville de Glaris 1506-1512
En 1506, il prit le degré de maître des arts, et fut promu à la cure de Glaris. Ce bénéfice lui convenait assez, parce qu'il le rapprochait de ses parents, et parce qu'il était honorable d'être à vingt-deux ans pasteur d'un chef-lieu de canton. L'évêque de Constance lui conféra les ordres sans difficulté, et souscrivit à son installation.
Dès ce moment Zwingli crut devoir recommencer ses études théologiques sur un nouveau plan qu'il s'était formé. Après avoir relu les auteurs classiques de l'ancienne Grèce, pour se rendre leur langue familière, et pour en approfondir toutes les beautés, il se livra à l'étude du Nouveau Testament, et à la recherche des textes qui servent de fondement aux dogmes catholiques. Il suivit la méthode qui consiste à interpréter un passage obscur par un passage analogue plus clair, un mot inusité par des mots plus connus, ayant égard au lieu, au temps ; à l'intention de l'écrivain et à une foule d'autres circonstances qui modifient et changent souvent la signification des mots : II se mit ensuite à lire les Pères de l'Église, pour savoir de quelle manière ils avaient entendu les endroits qui lui semblaient obscurs. Ce n'était pas assez pour lui de connaître le sentiment des anciens théologiens ; il voulut aussi consulter les modernes, même les écrivains qui avaient été frappés d'anathème, comme John Wyclif et Jean Huss.
Il paraît cependant qu'il se borna d'abord à gémir en secret sur les abus qui déshonoraient le clergé, et qu'il ne se pressa pas de les attaquer de front : le moment favorable n'était pas encore venu, mais il s'avançait à grands pas : gardant sur les articles de foi qui lui déplaisaient le silence le plus absolu, il ne les approuvait ni ne les condamnait.
Expérience de la guerre comme aumônier militaire 1512-1515
En 1512, lorsque 20 000 Suisses marchèrent à la voix de Jules II, pour secourir l'Italie contre les armes de Louis XII, Zwingli accompagna le contingent de Glaris, en qualité d'aumônier. Le fameux Matthieu Schiner, cardinal évêque de Sion, légat a latere, le chargea de distribuer à ses compatriotes les gratifications du pape.
Après la bataille de Novare, où il avait été présent, Zwingli retourna dans sa paroisse reprendre ses fonctions pastorales, qu'il quitta de nouveau en 1515 pour marcher avec les Suisses au secours du duc de Milan, attaqué par François Ier, et il fut témoin de la bataille de Marignan, aussi fatale à sa patrie que la victoire de Novare lui avait été glorieuse. Zwingli avait prévu ce désastre, et il s'était efforcé de le prévenir dans un discours qu'il adressa aux Suisses à Monza, près de Milan. Zwingli interpréta la défaite de Marignan comme une punition divine envers les mercenaires suisses, engagés par des princes étrangers et menant la guerre par appât du gain.
Le manque d'harmonie entre les chefs dit son historien à l'insubordination des soldats et leur penchant à suivre tour à tour des impulsions opposées, lui faisaient craindre pour eux quelque grand revers dont il aurait désiré de les préserver par ses conseils. Il approuva le refus qu'ils avaient fait d'accéder au traité offert par le roi de France, avant de connaitre la volonté de leurs gouvernements, Il donna de grands éloges à leur courage, les conjurant de ne pas se livrer à une sécurité doublement dangereuse, au moment où ils étaient en présence d'un ennemi supérieur en nombre. Il pria les chefs de renoncer à leurs rivalités ; il exhorta les soldats à n'écouter que la vois de leurs officiers, et à ne pas compromettre par une déci marche imprudente leur propre vie et la gloire de leur pays.
Le désastre de Marignan fortifia Zwingli dans son aversion pour toute guerre qui n'est point entreprise dans le dessein de défendre la patrie. Peu de temps après son retour de Milan il fut nommé à la cure d'Einsiedeln, autrement Notre-Dame des Ermites, L'austérité de ses principes et la publication de la Fable du bœuf et de quelques autres animaux, contre l'usage barbare des Suisses de se mettre à la solde de l'étranger lui avaient fait des ennemis à Glaris.
Chapelain de l'abbaye d'Einsiedeln 1516-1519
Ne pouvant plus y rester sans éprouver des désagréments, il prit possession d'Einsiedeln en 1516. Cette abbaye était alors sous la direction de Théobald, baron de Geroldseck, qui en était administrateur, à cause de l'extrême vieillesse de l'abbé Conrad de Rechberg quoique ce religieux eût plutôt reçu l'éducation d'un soldat que celle d'un moine, il aimait les sciences et la régularité, et il voulait qu'elles fussent en honneur dans son abbaye ; il y appela Zwingli.
Celui-ci accepta volontiers un poste qui le mettait en relation directe avec les hommes les plus éclairés de la Suisse. Tout son temps fut employé à l'étude ou à l'accomplissement de ses devoirs. Il débuta dans la carrière de la réformation en conseillant à l'administrateur d'effacer l'inscription placée au-dessus de la principale porte de l'abbaye : Ici l'on obtient rémission plénière de tous les péchés, et de faire enterrer les reliques, objets de la dévotion superstitieuse des pèlerins. Il introduisit ensuite quelques changements dans la discipline d'un couvent de femmes qui était sous sa direction.
Bientôt il écrivit à Hugues de Landenberg, évêque de Constance, pour l'engager à supprimer dans son diocèse une foule de pratiques puériles et ridicules, qui pouvaient entraîner des maux sans remède. Il développa les mêmes idées dans un entretien avec le cardinal de Sion, et lui fit sentir la nécessité d'une réforme générale. La chose n'était pas difficile.
Jusque-là Zwingli ne s'était guère communiqué qu'à ses amis ou à des hommes dont il connaissait la droiture. Le jour où il devait commencer la prédication de ce qu'il appelle le pur Évangile ne tarda pas à luire. Ce fut le jour même où l'on célébrait la fête de la consécration de l'église d'Einsiedeln par les anges. Au milieu d'une nombreuse assemblée que la solennité avait attirée, il monta en chaire, et prononça le discours d'usage tous les sept ans. Après un exorde plein de chaleur et d'onction, qui avait disposé les auditeurs à une attention soutenue, il passa aux motifs qui les réunissaient dans cette église, déplora leur aveuglement sur les moyens qu'ils employaient pour plaire à Dieu
Ce discours produisit un effet étonnant : quelques auditeurs furent scandalisés d'une pareille doctrine, tandis que le plus grand nombre donna les marques les moins équivoques de son assentiment. On dit même que quelques pèlerins remportèrent leurs offrandes, ne croyant pas devoir contribuer au luxe qui était étalé dans l'abbaye de Notre-Dame des Ermites. Ces circonstances excitèrent l'animosité des moines contre celui qui diminuait ainsi leurs revenus.
Cependant, il ne paraît pas que les supérieurs aient été irrités de sa conduite, puisque le pape Léon X lui fit remettre, vers la même époque, par le nonce Pucci, un bref apostolique dans lequel Zwingli était revêtu du titre de chapelain du Saint-Siège, et gratifié d'une pension. Le sermon du réformateur fut prononcé dans le courant de suivant ses historiens, d'où il suit qu'il devança Luther d'un an dans ses prédications, et que quand bien même la prédication des indulgences n'aurait point occasionné l'explosion, elle eût éclaté infailliblement d'elle-même à la première occasion qui se serait présentée.
Curé de Zurich 1519–1525
Le chapitre de Zurich le nomma curé de cette ville, à la sollicitation de ses partisans. Il s'y rendit vers la fin de l'année, et peu de jours après son arrivée, il parut devant le chapitre, déclara qu'il abandonnerait, dans ses discours, l'ordre des leçons dominicales, qui avait été suivi depuis Charlemagne, et qu'il expliquerait sans interruption tous les livres du Nouveau Testament.
Il promit aussi de n'avoir en vue que la gloire de Dieu, l'instruction et l'édification des fidèles Cette déclaration fut approuvée par la majorité du chapitre. La minorité la regarda comme une innovation dangereuse. Zwingli répondit aux objections qu'il revenait à l'usage de l'Église primitive, qu'on avait observé jusqu'à Charlemagne ; qu'il se servirait de la méthode employée par les Pères de l'Église dans leurs homélies, et qu'avec l'assistance divine, il espérait prêcher de manière qu'aucun partisan de la vérité évangélique n'aurait lieu de se plaindre. On put voir, dès son premier sermon, prononcé le jour de la Circoncision, 1519, qu'il serait fidèle à son plan. Il en fut comme de tout ce qu'il avait fait jusqu'alors : les uns s'en édifièrent, les autres s'en scandalisèrent. S'il se fût contenté d'attaquer les abus, qui oserait le blâmer maintenant ? Mais il mit beaucoup d'aigreur dans ses attaques ; et, en outre, il s'éleva contre des pratiques vénérables, avec une amertume sans excuse. Il jugeait sévèrement : il fut jugé de même.
Les esprits s'animèrent ; et il en naquit des tempêtes. Du reste, il se fit remarquer par une conduite très régulière. Il fit chasser de la ville par les magistrats toutes les filles publiques. Vers ce temps-là, Léon X envoya le cordelier Bernard Samson dans les treize cantons, pour y prêcher les indulgences, dont le produit était destiné à l'achèvement de la magnifique basilique de St-Pierre. Ce religieux éhonté ne craignit pas d'user de toutes sortes de supercheries pour tromper ses auditeurs. Il porta l'insolence à un point inconcevable. Quand il paraissait en public, il faisait crier à haute voix : Laissez approcher d'abord les riches, qui peuvent acheter le pardon de leurs péchés ; après les avoir satisfaits, on écoutera les prières du pauvre. Tant d'excès indignèrent les plus patients.
L'évêque de Constance défendit aux curés de son diocèse de le recevoir dans leurs paroisses. Presque tous obéirent ; mais aucun ne mit autant d'ardeur dans son obéissance que le curé de Zurich. Il avait prévenu les désirs du prélat : il les avait même dépassés. En 1520, Zwingli renonça à la pension qu'il recevait du St-Siège, et obtint du conseil de Zurich qu'on prêcherait purement l'Évangile dans le canton. L'ambition de Charles Quint et de François Ier, qui se disputaient la couronne impériale, fournit à Zwingli l'occasion de développer de nouveau ses talents. Les deux compétiteurs s'efforcèrent d'intéresser la confédération helvétique en leur faveur.
Zwingli était d'avis de garder la plus stricte neutralité ; et il s'en expliqua ouvertement. Lorsque les deux rivaux se furent déclaré la guerre, Zwingli, qui penchait pour la France, détourna le canton de Zurich de se joindre aux autres cantons ; ce qui lui attira la haine des personnages les plus marquants de la confédération, et lui enleva plusieurs partisans dans sa propre paroisse. Bientôt il engagea le conseil de Zurich à refuser au pape un secours de troupes que le saint-père demandait pour attaquer le Milanais ; et ce ne fut qu'après la promesse formelle d'employer ailleurs les Suisses que Léon X put obtenir trois mille Zurichois. La sagesse des avis de Zwingli fut manifestée par l’événement. Cependant son aversion pour une nouvelle alliance avec François Ier lui fit le plus grand tort dans l'esprit de beaucoup de personnes, qui ne furent pas fâchées de pouvoir confondre dans la même haine ses principes politiques et ses opinions religieuses.
Premiers conflits avec Rome 1522-1524
Le 14 mai 1522, Zwingli adressa une allocution très éloquente aux habitants de Schwyz, que la défaite de la Bicoque, commune à tous les cantons, excepté celui de Zurich, avait portés à réfléchir sur la position fâcheuse dans laquelle ils se trouvaient engagés et sur les moyens d'en sortir
Quoique cette allocution soit plus conforme aux règles de la morale qu'à celles de la politique, les habitants du canton de Schwyz l'accueillirent favorablement. Ils chargèrent le secrétaire d'État d'exprimer leur reconnaissance à Zwingli ; et peu de temps après ils firent une loi dans leur assemblée générale pour abolir toute alliance et tout subside durant vingt-cinq ans.
Sur le carême
Pendant le carême de cette même année 1522, quelques personnes attachées à la nouvelle doctrine avaient enfreint publiquement l'abstinence et le jeûne ; le magistrat les fit mettre en prison, et refusa de les écouter. Zwingli entreprit de les justifier, dans un Traité sur l'observation du carême, qu'il terminait en priant les hommes versés dans l'intelligence des Écritures de le réfuter, s'ils croyaient qu'il avait fait violence au sens de l'Évangile. Cet ouvrage fut comme un manifeste de la part de Zwingli. Il jeta l'alarme parmi les ecclésiastiques et tous ceux qui étaient dévoués à l'Église catholique. L'évêque de Constance, pressé par ses propres craintes, et par de nombreuses sollicitations, adressa un mandement à ses diocésains, pour les prémunir contre la séduction. Il écrivit en même temps au conseil de Zurich, qui ne répondit pas de manière à le satisfaire ; et au chapitre de la même ville, qui permit à Zwingli de se défendre par un traité publié le 22 août dans lequel il établissait : que l'Évangile seul est une autorité irrécusable, à laquelle il faut recourir pour terminer les incertitudes, et décider toutes les disputes, et que les décisions de l'Église ne peuvent être obligatoires qu'autant qu'elles sont fondées sur l'Évangile.
Pendant que Zwingli composait ce traité, la diète de Baden ordonna l'arrestation d'un curé de village qui avait prêché la nouvelle doctrine, et le fit transférer dans les prisons de l'évêché de Constance. Le réformateur n'eut pas de peine à voir que les gouvernements des cantons s'opposaient à la propagation de ses opinions. Dans le dessein de les gagner, il leur adressa, en son nom et en celui de neuf de ses amis, un précis de sa doctrine et une prière expresse de laisser libre la prédication de l'Évangile.
Sur le célibat des prêtres
Zwingli finissait par demander aux cantons de tolérer le mariage des prêtres, et s'élevait fortement contre les inconvénients du célibat. Il adressa une requête à l'évêque de Constance pour l'engager à se mettre à la tête de la Réforme, et à permettre qu'on démolît avec prudence et précaution ce qui avait été bâti avec témérité. Cette levée de boucliers souleva contre lui les prêtres et les moines, qui le décrièrent et le traitèrent en chaire de luthérien, injure la plus forte que l'on connût alors. Le scandale était à son comble. L'évêque de Constance crut bien faire en interdisant toute espèce de dispute jusqu'à ce qu'un concile général eût prononcé sur les points controversés. Mais il ne fut obéi ni des uns ni des autres ; et les discussions continuèrent avec autant de violence et d'acharnement qu'auparavant.
Disputes de Zurich 1523-1524
Zwingli s'imagina qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour y mettre un terme que de se présenter, dans les premiers jours de 1523, devant le grand conseil et de solliciter un colloque public, où il pût rendre compte de sa doctrine en présence des députés de l'évêque de Constance. Il promit de se rétracter si on lui prouvait qu'il était dans l'erreur ; mais il demanda la protection spéciale du gouvernement, dans le cas où il prouverait que ses adversaires avaient tort. Le grand conseil fit droit à sa demande et adressa, peu de jours après, une circulaire à tous les ecclésiastiques du canton, pour les convoquer dans la maison de ville le lendemain de la fête de Saint-Charlemagne 29 janvier, afin que chacun eût la liberté de désigner publiquement les opinions qu'il regardait comme hérétiques et pût les combattre l'Évangile à la main. Il se réservait le droit de prononcer définitivement sur ce qui serait dit de part et d'autre et de procéder contre quiconque refuserait de se soumettre à sa décision. Aussitôt que cet acte fut devenu public, Zwingli fit paraître soixante-sept articles qui devaient être soumis au colloque : il y en avait de très raisonnables.
Première Dispute janvier 1523
Au jour fixé 29 janvier 1523, le colloque ouvrit ses séances. L'évêque de Constance y était représenté par Jean Faber, son grand vicaire, et par d'autres théologiens ; le clergé du canton avait à sa tête Zwingli et ses amis. Il y avait en tout près de six cents personnes. Le bourgmestre de Zurich exposa le but de la convocation et exhorta les assistants à manifester leurs sentiments sans crainte. Le chevalier d'Anweil, intendant de l'évêque, Faber et Zwingli prirent successivement la parole. Celui-ci demanda instamment qu'on le convainquît d'hérésie, s'il en était coupable, en se servant toutefois de la seule autorité de l'Écriture. Le grand vicaire éluda la question, mais insensiblement et par son indiscrétion la dispute s'entama. Zwingli, qui s'exprimait avec beaucoup d'éloquence et de facilité, le poussa vivement; Faber s'aperçut qu'on l'écoutait avec défaveur et refusa de poursuivre. Alors la séance fut levée, et le conseil ordonna que Zwingli, n'ayant été ni convaincu d'hérésie ni réfuté, continuerait à prêcher l'Évangile comme il l'avait fait, que les pasteurs de Zurich et de son territoire se borneraient à appuyer leur prédication sur l'Écriture sainte, et que des deux côtés on eût à s'abstenir de toute injure personnelle. Cette décision de l'autorité civile en matière de religion irrita les catholiques qui jetèrent les hauts cris ; mais elle assura le triomphe de la réforme qui, dès ce moment, ne cessa de se fortifier de jour en jour par les écrits et les discours de Zwingli.
Deuxième Dispute septembre 1523
Vers la même époque, le pape Adrien VI lui adressa un bref très flatteur, pour l'engager à maintenir les privilèges du Saint-Siège. Il publia le procès-verbal de la conférence et la défense des soixante-sept articles sous le titre de Areheielèsgli. Cependant rien n'était changé dans le culte, et les offices se faisaient comme par le passé, lorsqu'il parut un écrit très véhément intitulé Jugement de Dieu sur les images. Les têtes ardentes en furent exaltées, et un cordonnier nommé Klaus Hottinger, accompagné de quelques fanatiques, renversa un crucifix élevé à la porte de la ville. Cet homme fut arrêté ; on voulait le punir, mais les avis furent partagés sur la culpabilité. Zwingli lui-même, tout en convenant qu'Hottinger méritait châtiment pour avoir agi sans l'autorisation du magistrat, déclarait formellement que la défense d'adorer les images ne regardait pas moins les chrétiens que les Israélites. Dans cette perplexité, le grand conseil convoqua un nouveau colloque pour examiner si le culte des images était autorisé par l’Évangile et s'il fallait conserver ou abolir la messe. Le 28 octobre 1523, plus de neuf cents personnes des cantons de Schaffhouse, de Saint-Gall et de Zurich se trouvaient réunies dans cette dernière ville ; les autres cantons n'avaient pas voulu s'y rendre. Le colloque dura deux ou trois jours. Zwingli parut avoir entraîné la majorité de l'assemblée ; mais il ne réussit pas à persuader le grand conseil, qui ne prit aucune détermination, par la crainte peut-être de choquer les autres cantons et les évêques qui avaient refusé d'envoyer des députés au colloque.
Troisième Dispute janvier 1524 et progrès de la Réforme à Zurich 1524-1525
En janvier 1524, il se tint une troisième conférence, qui fut un nouveau triomphe pour le réformateur. L'abolition de la messe en fut le résultat, et désormais le sénat et le peuple de Zurich montrèrent la plus grande déférence aux avis de Zwingli. Ce fait, consigné dans le Musée des protestants célèbres, ne se trouve pas dans la Vie de Zwingli, par Hess. Cet historien dit seulement que l'évêque de Constance ayant envoyé au sénat de Zurich une Apologie de la messe et du culte des images, le réformateur y répondit avec tant de solidité que le gouvernement permit d'enlever des églises les statues et les tableaux, que l'on remplaça par des inscriptions tirées des livres saints. Quant à la messe, elle ne fut définitivement supprimée qu'en 1525, le jour de Pâques, où l'on célébra la cène. Il avait été question du célibat ecclésiastique dans la conférence d'octobre 1523 ; Zwingli s'était attaché à prouver qu'il n'a aucun fondement dans le Nouveau Testament : c'était tout pour lui. Le gouvernement de Zurich ne se prononça pas d'une manière expresse sur ce point délicat : il se borna à là simple tolérance du mariage des prêtres.
Zwingli en profita, et le 2 avril 1524, il épousa Anne Reinhart, veuve d'un magistrat, de laquelle il eut quatre enfants : : Regula, Guillaume, Ulrich, et Anna. Dans le même temps, il s'occupa de réformer le chapitre de Zurich, l'abbaye de Fraumûnster et les religieux mendiants. Les revenus des communautés supprimées furent employés à la dotation des professeurs de l'université, qu'il organisa avec autant de talent que de sagesse. Nommé recteur du gymnase en 1525, il appela auprès de lui les hommes les plus distingués dans la nouvelle réforme, les Pellican, les Gollinus, et leur confia l'enseignement du grec et de l'hébreu. Les autres chaires furent à peu près aussi bien remplies.
Controverse avec les Anabaptistes et les Luthériens 1525–1529
Tout allait suivant ses désirs, sans secousses et sans effusion de sang ; il jouissait d'une grande considération quand les divisions intestines de la réforme vinrent troubler son repos et lui mettre les armes à la main contre ceux mêmes qui, à son exemple, avaient secoué le joug de l'autorité.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=9954#forumpost9954
Posté le : 10/10/2015 16:23
|
|
|
|
|
Ulrich Zwingli 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Conflit puis séparation définitive avec les Anabaptistes 1525–1527
Les chefs du parti des anabaptistes en Suisse, Felix Manz et Conrad Grebel, d'accord avec Thomas Münzer, s'étaient engagés en présence de Zwingli à ne plus prêcher leurs opinions et lui, de son côté, avait promis de ne point les attaquer publiquement. Les frères manquèrent les premiers à leurs engagements, et le réformateur se crut affranchi des siens. Toute la Suisse retentit des déclamations contre les abus que la Réforme avait laissé subsister et des désirs de les voir disparaître. Les opinions les plus extravagantes furent suivies des crimes les plus atroces. Le gouvernement de Zurich désirait mettre un terme à ce débordement ; il força les anabaptistes d'entrer en conférence avec Zwingli.
Ce moyen valait mieux que la persécution ; mais il n'eut pas le succès qu'on en avait attendu. Deux conférences eurent lieu à différentes reprises ; et, si quelques-uns des plus modérés parmi les anabaptistes se rendirent aux raisonnements de Zwingli, ils n'exercèrent aucune influence sur l'esprit de la multitude, qui persévéra dans ses égarements. Il faut le dire aussi : Zwingli, très louable sous le rapport de la tolérance qu'il professa constamment et sans restriction, ne s'éloignait pas assez des erreurs de l'anabaptisme, ou ne les combattait que par d'autres erreurs aussi répréhensibles, de l'aveu même des protestants.
Tentative d'entente avec les Luthériens 1525–1529
Une autre dispute qui tracassa beaucoup Zwingli fut celle qu'il eut à soutenir contre Luther au sujet de la présence de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Le réformateur saxon admettait la réalité ; le réformateur de Zurich s'en tenait à la figure. Celui-ci avait consigné sa doctrine dans le Commentaire sur la vraie et la fausse religion, qu il publia en 1525. Immédiatement après, Œcolampade fit paraître, à Bâle, une Explication des paroles de l'institution de la sainte Cène, suivant les anciens docteurs, dans laquelle il appuyait et défendait les sentiments de son ami.
II fut sensible à Luther de voir, non plus des particuliers, mais des églises entières de la réforme se soulever contre lui. Il traita d'abord Œcolampade avec assez de ménagement, mais il s'emporta avec beaucoup de violence contre Zwingli et déclara son opinion dangereuse et sacrilège. Celui-ci n'épargna rien pour adoucir l'esprit de Luther, dont il estimait le courage et le talent ; il lui expliqua sa doctrine dans un langage plein de modération ; mais Luther fut inflexible et ne voulut entendre à aucun accommodement. Tout était brouillé dans la réforme : les uns se prononçaient en faveur du Saxon, et les autres en faveur du Zurichois. Le landgrave de Hesse, qui prévit tous les maux que pouvait entraîner un si grave démêlé, résolut de rapprocher les deux partis, et Marbourg fut choisi pour le lieu de la conférence.
Zwingli s'y rendit en 1529, avec Rodolphe Collinus, Martin Bucer, Hédion et Œcolampade ; Luther avec Melanchthon, Osiander, Jonas, Agricola et Brentius. Après bien des entretiens particuliers et des contestations publiques, ces théologiens rédigèrent quatorze articles qui contenaient l'exposition des dogmes controversés, et ils les signèrent d'un commun accord. Quant à la présence corporelle dans l'eucharistie, il fut dit que la différence qui divisait les Suisses et les Allemands ne devait pas troubler leur harmonie, ni les empêcher d'exercer, les uns envers les autres, la charité chrétienne, autant que le permettait à chacun sa conscience. Pour sceller la réconciliation des deux partis, le landgrave exigea de Luther et de Zwingli la déclaration qu'ils se regardaient comme frères. Zwingli y consentit sans peine ; mais on ne put arracher de Luther que la promesse de modérer à l'avenir ses expressions lorsqu'il parlerait des Suisses. Zwingli observa religieusement ses engagements, et la paix ne fut troublée qu'après sa mort. Pendant qu'il était en querelle avec Luther, il continuait ses controverses avec les catholiques. Eckius, chancelier d'Ingolstadt, et Jean Faber, grand vicaire de l'évêque de Constance, lui firent proposer, en 1526, une conférence à Baden ; mais, comme il se doutait qu'on lui tendait un piège pour s'emparer de sa personne, il refusa de s'y trouver, et l'événement justifia ses soupçons. Œcolampade lui-même, qui l'avait pressé de s'y rendre, lui écrivit peu de jours après son arrivée à Baden : Je remercie Dieu de ce que vous n'êtes pas ici. La tournure que prennent les affaires me fait voir clairement que si vous étiez venu nous n'aurions échappé au bûcher ni l'un ni l'autre.
Progression de la Réforme en Suisse sous l'égide de Zwingli 1524-1529
Ne pouvant sévir contre sa personne, on condamna sa doctrine et ses écrits ; ce qui ne nuisit point aux progrès de la réforme. Au commencement de 1528, Berne l'embrassa de la manière la plus solennelle. Une assemblée nombreuse fut convoquée dans cette ville ; Zwingli y assista, d'après l'invitation de Haller, qui avait composé dix thèses sur les points essentiels de la nouvelle doctrine. Elles furent discutées dans dix-huit séances et signées à la fin par la majorité du clergé bernois, comme fondées sur l'Écriture, et autorisées par délibération des magistrats. L'éloquence véhémente de Zwingli brilla dans cette occasion du plus vif éclat et lui acquit l'ascendant le plus marqué. Après ce triomphe, tous ses collègues le regardèrent comme leur chef et leur soutien ; et l'autorité qu'ils lui accordèrent tacitement contribua puissamment à maintenir l'union parmi eux. De retour à Zurich, après trois semaines d'absence, Zwingli y continua ses fonctions de pasteur, de prédicateur, de professeur et d'écrivain avec un zèle et un talent remarquables ; il institua des synodes annuels, composés de tous les pasteurs du canton, et devant lesquels devaient être portées les affaires générales de l'Église. Rien ne se faisait dans le canton, même en matière de législation, qu'il ne fût consulté.
Zwingli était devenu l'oracle des Suisses qui partageaient ses opinions religieuses. Les catholiques, de leur côté, le détestaient autant que les protestants l'estimaient. Ils le regardaient généralement comme un boute-feu et comme la cause des maux de la patrie. Ils persécutaient violemment les partisans des nouvelles idées, qui, à leur tour, ne se montraient ni assez prudents, ni assez réservés. Au milieu de tant de tracasseries, de tant de violations de la liberté de conscience de part et d'autre, il était impossible que la paix se conservât. Elle fut rompue en 1529.
Première Guerre de Kappel 1529 conclue par une simple trêve 1529-1531
Les Suisses s'armèrent et marchèrent les uns contre les autres ; mais, par la sagesse du landamman de Glaris, les deux partis parvinrent à se concilier ; ils signèrent, à Kappel, une trêve qui mit fin aux hostilités, tout en laissant subsister les passions intraitables qui pouvaient les renouveler à chaque instant.
En 1530, Zwingli envoya à la diète d'Augsbourg une confession de foi approuvée de tous les Suisses, et dans laquelle il expliquait nettement que le corps de Jésus-Christ, depuis son ascension, n'était plus que dans le ciel, et ne pouvait être autre part ; qu'à la vérité, il était comme présent dans la cène par la contemplation de la foi, et non pas réellement ni par son essence. Il accompagna sa confession de foi d'une lettre à Charles-Quint, dans laquelle il tient le même langage. La même année, il envoya à François Ier, par son ambassadeur, une autre confession de foi
Luther ne l'épargna pas sur cet article, pas plus que sur d'autres non moins importants. Cependant la trêve de Kappel am Albis ne dura pas deux ans entiers. Les mêmes causes. produisirent les mêmes effets. Les hostilités n'avaient été que suspendues. Zwingli, dont l'influence était connue de tout le monde, fut accusé de fomenter le fanatisme des protestants et d'attiser le feu de la discorde. Sensible à cette accusation, et ne pouvant supporter l'idée des fléaux qui menaçaient la patrie, il conjura le conseil, dans le mois de juillet 1531, de lui accorder sa retraite.
Le conseil s'y refusa, et Zwingli resta à son poste. La guerre était sur le point d'éclater. Les Zurichois montraient une exigence insatiable, et les catholiques devenaient de plus en plus intolérants. Zwingli plaidait avec éloquence la cause des victimes d'un zèle trop ardent.
Seconde Guerre de Kappel et mort de Zwingli 1531
Le 6 octobre de la même année, les cinq cantons publièrent leur manifeste et entrèrent en campagne. Les protestants s'armèrent aussi, et Zwingli reçut du sénat l'ordre de les accompagner. Il obéit. Un pressentiment funeste le tourmentait ; mais il n'en fit pas moins tous ses efforts pour encourager les Zurichois. Notre cause est bonne, leur dit-il, mais elle est mal défendue. Il m'en coûtera la vie et celle d'un grand nombre d'hommes de bien, qui désiraient rendre à la religion sa simplicité primitive, et à notre patrie ses anciennes mœurs. N'importe : Dieu n'abandonnera pas ses serviteurs ; il viendra à leur secours, lorsque vous croirez tout perdu. Ma confiance repose sur lui seul et non sur les hommes. Je me soumets à sa volonté. II arriva le 10 à Kappel am Albis avec les siens. Le combat s'engagea vers les trois heures de l'après-midi. Dans les premiers moments de la mêlée, il reçut un coup mortel et tomba sans connaissance. Revenu à lui, il se soulève, croise ses mains sur sa poitrine, fixe ses regards vers le ciel et s'écrie - Qu'importe que je succombe. : ils peuvent bien tuer le corps, mais ils ne peuvent rien sur l'âme.
Quelques soldats catholiques, qui le voient dans cet état, lui demandent s'il veut se confesser ; il fait un signe négatif, mais qu'ils ne comprennent pas. Ils l'exhortent à recommander son âme à la sainte Vierge ; et d'après son refus plus expressif, un d'entre eux lui plonge l'épée dans le cœur, en lui disant : Meurs donc, hérétique obstiné !. Le lendemain, Jean Schonbrunner, qui s'était éloigné de Zurich par attachement pour la religion catholique, ne put s'empêcher de dire en le voyant : Quelle qu'ait été ta croyance, je sais que tu aimas ta patrie, et que tu fus toujours de bonne foi ; Dieu veuille avoir en paix ton âme. La soldatesque fut moins tolérante et moins humaine : elle déchira son cadavre, livra ses lambeaux aux flammes et jeta les cendres aux vents. Zwingli avait 47 ans au moment de sa mort.
Bossuet a dit de lui, d'après Léon de Juda : C'était un homme hardi, et qui avait plus de feu que de savoir. II y avait beaucoup de netteté dans son discours, et aucun des prétendus réformateurs n'a expliqué ses pensées d'une manière plus précise, plus uniforme et plus suivie : mais aussi aucun ne les a poussées plus loin ni avec autant de hardiesse Luther, opposé à Zwingli sur un certain nombre de points dont l'Eucharistie, propose pour Zwingli, non sans provocation, la piquante épitaphe que voici "Celui qui tira l'épée, périra par l'épée".
Progrès de la Réforme en Suisse. La guerre de Kappel
Restait à assurer l'extension de la Réforme à la Suisse, et d'abord aux bailliages communs gemeine Herrschaften, sur lesquels Zurich avait des droits qu'il partageait avec les cinq cantons de l'intérieur Urkantone. Ceux-ci réagirent en s'unissant (ligue de Beckenried, avr. 1524 et en ralliant la majorité des cantons, à la diète de Baden Argovie mai 1526, pour condamner Zwingli in absentia. Ce fut en partie l'œuvre de J. Eck. À Rome même, où le secrétaire municipal Joachim am Grüt dénonça Zwingli, Clément VII chargea Cajétan de le réfuter. Peu après, Zwingli s'entendit avec Berne pour organiser une dispute à grand spectacle janv. 1528, qui lui donna l'occasion d'une revanche. Une ligue évangélique se forma, à laquelle adhérèrent successivement Berne, Saint-Gall, Bâle 1529. À Zurich même, Zwingli se débarrassa des adversaires les plus gênants, notamment parmi les patriciens, en les évinçant du Conseil ; l'exécution de Jakob Grebel, conseiller municipal accusé d'avoir touché une pension de l'étranger, servit d'exemple 30 oct. 1526. De leur côté, les cantons catholiques invoquèrent l'aide de l'archiduc Ferdinand ligue de Feldkirch, févr. 1529. Un conflit armé paraissait inévitable. Zwingli proposa d'ouvrir aussitôt les hostilités fin mai 1529, ce qui eut lieu peu après 9 juin. La première paix de Kappel, qui fut à l'avantage des Évangéliques, obligea les cinq cantons à renoncer à l'alliance avec l'Autriche et permit aux communautés des bailliages communs d'adopter la Réforme sur décision de la majorité. Au dehors, notamment en Allemagne du Sud, les progrès de la réforme zwinglienne furent contrariés par le différend qui, à partir de 1525, opposa Zwingli à Luther sur la question de la cène la première expression de la doctrine zwinglienne de la cène se trouve dans une lettre à Matthäus Alber, nov. 1524. En vain Zwingli et ses partisans, dont Bucer, arguaient-ils qu'il suffisait de s'entendre sur les vérités chrétiennes essentielles au nombre desquelles ils ne rangeaient pas la doctrine eucharistique pour former une ligue politique Bündnis vor Bekenntnis ; les Luthériens renversaient les termes. La conférence de Marburg convoquée à cet effet par le landgrave Philippe de Hesse oct. 1529 fut sans résultat, et la diète d'Augsbourg 1530 donna lieu à des confessions de foi séparées. En même temps, le projet de Zwingli de grouper les États évangéliques de la mer du Nord à la Suisse en une coalition européenne anti-habsbourgeoise devint caduc. En Suisse même, Zwingli était résolu à donner la primauté à deux États – Zurich et Berne – et à modifier le statut de la Confédération à leur profit, ce qui permettrait d'évincer les cantons catholiques de l'administration des bailliages communs. Cette proposition hardie ne fut pas retenue. Il en fut de même du mémoire par lequel Zwingli préconisait l'offensive militaire immédiate contre les cinq cantons début juin 1531. Conseiller écouté, notamment du Conseil secret chargé de la politique extérieure, il n'était pas néanmoins, on le voit, le maître incontesté de la politique zurichoise. Commission permanente ou véritable institution, la nature du Conseil secret est aujourd'hui discutée L. von Muralt, W. Jacob contre E. Fabian ; Zwingli n'en était pas membre, il était seulement rapporteur pour les questions de la compétence de ce Conseil. Si l'on prend une à une les suggestions contenues dans les mémoires sortis de sa plume C.R., VI, I et II, on s'aperçoit que les pouvoirs responsables n'en ont retenu qu'une partie, tandis qu'en revanche – à en juger par les mandements disciplinaires qui allèrent jusqu'à prescrire l'assistance au culte comme obligatoire Sittenmandat du 26 mars 1530 – il apparaît que, sous l'égide du magistrat, le conformisme religieux tendait à s'implanter à Zurich. Il est vrai que, dans la pensée de Zwingli, cette évolution mi-subie mi-voulue devait servir les intérêts religieux ; faute de pouvoir rallier tous les États de la Confédération à son programme de réforme évangélique, il crut devoir hâter le dénouement en plaçant la décision sur le terrain politique et militaire. Les faits lui donnèrent tort. La seconde guerre de Kappel aboutit à la défaite des troupes zurichoises mal préparées et démoralisées à la suite de remaniements dans le commandement. Servant comme aumônier, Zwingli se jeta dans la mêlée et tomba à Kappel am Albis, le 11 octobre 1531. On trouva sur lui une petite Bible latine Lyon, 1519, où il avait marqué certains textes Is., XXX, 1 ; I Macch., XI, sur lesquels il aurait sans doute prêché s'il avait survécu C.R., XII.
Cette fin tragique illustre ce qu'il y a de caduc dans l'idéologie zwinglienne. On était arrivé à une impasse dont on ne put sortir qu'en rendant à chacune des instances, Église et magistrat, ses attributions propres. Aussi, au lendemain du désastre de Kappel, les pasteurs, avec H. Bullinger qui avait succédé à Zwingli, durent-ils renoncer à toute ingérence dans les affaires civiles. Chez Zwingli même, il semble que, durant les dernières années, le politique ait pris le pas sur le prophète et le patriote suisse sur le pacifiste universaliste à la manière d'Érasme. Mais on aurait tort de juger trop péjorativement cette évolution. Elle s'explique par des motifs religieux : la conscience qu'avait Zwingli de sa mission « providentielle » ; le sentiment qu'il aurait un jour à rendre compte des talents reçus d'apr. Matth., XXV ; C.R., I, c'est-à-dire des possibilités d'action qui lui étaient offertes ; la croyance aussi que l'histoire était arrivée à un tournant – le dernier avant la fin du monde – où l'Évangile devait être prêché partout Matth., XXVIII, 19 ; cf. la diffusion de l'imprimerie ; la conviction optimiste que les pouvoirs publics à Zurich et au dehors se hausseraient jusqu'à l'idéal évangélique et concourraient à la transformation morale de la société sous l'action irrésistible de la Parole et de l'Esprit, etc. Il faut noter enfin que Zwingli n'abdiqua pas la primauté du spirituel, mais il voyait plutôt celui-ci comme concentré dans la personne du « prophète » dominant de toute sa stature l'autorité civile. Si d'ailleurs il ne recula pas devant l'emploi de la force, il ne s'agissait pas pour lui de contraindre les consciences, dont il respectait la liberté.
Théologie
En collaborant avec le magistrat 1519, cela aboutit en 1524 à l'abolition de la messe. 1525 - La première communauté Anabaptiste naît près de Zurich par les disciples de Zwingli. Zwingli nie toute influence qu'aurait eu Martin Luther sur lui mais admet après coup, que les écrits du célèbre réformateur lui auraient été utiles.
Pouvoir temporel pouvoir spirituel selon Zwingli
Zwingli voit un seul pouvoir qui doit être uni. c'est la différence avec Luther qui voyait le pouvoir divisé en deux parties : - temporel le roi sur Terre - éternel Dieu au ciel Dans un premier temps, il pense que l'Église doit par tous les moyens politiques, militaires, etc., gagner la confédération helvétique à la Réforme. Ce n'est que par la suite qu'il veut gagner l'Allemagne et faire progresser la Réforme jusqu'à Zurich puis la France. Il rencontre Luther pour mettre sur pied une grande alliance 1520-1529. En 1531 : affrontements entre catholiques et protestants. Zwingli accompagne ses troupes en tant qu'aumônier. Il est blessé puis tué. La réforme en Suisse arrête son expansion.
Pour lui, l'église visible doit être intégrée dans la société. Le magistrat chrétien avait le droit et la responsabilité de déterminer les formes externes de la vie et du culte ainsi que de gouverner la république chrétienne. Le magistrat travail avec le prophète qui explique et proclame les Écritures pour le bien de toute la communauté.
La pensée religieuse de Zwingli
Zwingli a traduit et commenté vingt et un livres de l'Ancien Testament C.R., XIII, XIV à l'occasion de la Prophezei, cercle d'études bibliques remplaçant l'office choral et inauguré le 19 juin 1525. La Bible de Zurich 1529 est le fruit de ce travail. Les sermons, dont il ne reste que des notes d'auditeurs publiées en partie par O. Farner, suivent l'ordre des leçons de la Prophezei. Quelques sermons de circonstance sur un thème particulier ont été retravaillés et publiés par Zwingli lui-même : sur la liberté du chrétien en matière d'abstinence et sur la Vierge Marie 1522, sur la justice divine et la justice humaine 1523, le pasteur 1524, la Providence 1529. Il existe, en outre, des traités plus systématiques ou résumés de la foi chrétienne : Auslegung und Gründe der Schlussreden 1523 ; Commentarius de vera et falsa religione, que connaissait Calvin ; Fidei ratio 1530, parallèle à la Confession d'Augsbourg ; Fidei professio 1531, dédié à François Ier (autographe à Paris, Bibl. nat. ; des traités d'allure polémique sur le baptême et la Cène dirigés contre les baptistes et Luther 1525-1529.
La pensée religieuse de Zwingli peut se définir comme un effort de simplification et d'épuration de la religion en même temps que d'harmonisation des données de la raison et de la Révélation. Ces tendances étant apparemment contraires, l'accord entre elles ne se réalise que par voie dialectique. L'unification se fait autour de l'idée de Dieu, dont Zwingli met en relief la transcendance et la simplicité. L'unité ou unicité de l'être Wesen divin le retient surtout ; les personnes divines passent à l'arrière-plan ; les principaux attributs de Dieu – justice et miséricorde – se fondent dans la souveraine bonté, qui exprime au mieux l'essence divine et en laquelle se rejoignent le Dieu-Père du christianisme et le Deus optimus maximus des Anciens. Or Dieu est Esprit. La notion d'esprit est prise au sens objectif et universaliste ; elle fonde le spiritualisme zwinglien et son extension du fait qu'elle permet de passer de Dieu au monde. L'esprit de l'homme a, en effet, une affinité avec l'Esprit de Dieu ; à la limite, ils ne font qu'un. Le dualisme radical entre le Dieu transcendant et la créature, encore renforcé par le péché, semble ici s'atténuer. En même temps, l'unicité et l'universalité de l'Esprit permettent de résoudre dans le sens d'une unité dialectique les oppositions entre Révélation comme Heilsgeschichte histoire du salut et Révélation comme oracle de Dieu, entre connaissance naturelle de Dieu et foi, entre Loi et Évangile, entre justice divine et justice humaine et, plus radicalement encore, entre intellectualisme et volontarisme. En maints endroits, Zwingli affirme le primat de l'intelligence en Dieu (Dieu est vérité ; lex est lux ; la Révélation est l'abord illumination de l'intelligence) à la suite de saint Augustin (Illuminationstheorie) et de saint Thomas d'Aquin. Dans le De providentia 1529, la Heilsgeschichte semble n'avoir d'autre but que de manifester les attributs divins dans leur diversité et leur unité théorie de la satisfaction inspirée de saint Anselme ; la prédestination est rattachée à la providence au sens de prévision ; etc.. Cependant, le volontarisme d'origine scotiste l'emporte chez Zwingli : Dieu est considéré comme la seule cause efficiente véritable ; la nature est le terrain de son action ; le Christ lui-même dans son humanité n'est qu'instrument ou organe de la divinité ; la tare originelle appelée Presten, ou maladie incurable ne devient péché que par transgression actuelle ; la religion est fondée sur l'Alliance foedus, pactum, qui émane de la volonté gratuite de Dieu ; encore que la foi précède la prédication, celle-ci correspond à une ordination positive de Dieu ; il en est de même des sacrements, qui supposent la foi mais s'autorisent de l'institution divine. On a même relevé dans la mariologie de Zwingli, assez modérée, des traces d'influence scotiste.
L'effort de simplification se poursuit dans le domaine du culte défini comme culte en esprit et en vérité ; d'où la critique du sacramentalisme, qui associe l'intelligible et le sensible, et des cérémonies accessoires, dont certaines, tel le culte des saints, semblent attribuer à la créature ce qui n'appartient qu'à Dieu. Les sacrements réduits au baptême et à la cène ne valent que par référence au sujet dont ils explicitent la foi sans agir proprement sur elle, ou à titre d'engagement envers la communauté Pflichtzeichen. Zwingli critique de même (à partir de 1523) la présence réelle comme hétérogène à la foi, qui est l'unique voie de salut. Or la foi ne regarde pas seulement la rédemption accomplie dans le Christ, elle s'étend au Dieu créateur et ordonnateur de toutes choses. Sous cet aspect, elle est synonyme de confiance filiale pietas et d'abandon à la Providence. De ce double chef, elle constitue le centre et l'essence de la religion.
Le système de Zwingli forme donc un ensemble parfaitement cohérent. Ce qui frappe surtout en lui, c'est la place qu'il fait à la raison éclairée par la foi s'efforçant de comprendre Dieu et de pénétrer ses desseins à l'égard de l'humanité Heilsgeschichte, Christologie. Par là, Zwingli est le premier dans le protestantisme à avoir cherché à construire une théologie rationnelle selon la tradition de la via antiqua. Ainsi, dans le De providentia, il procède par déduction rationnelle à partir de l'idée de Dieu et de ses attributs, idée qu'il tient, implicitement du moins, de la Révélation ; les textes scripturaires ne sont invoqués que pour corroborer la démonstration. Ailleurs, l'Écriture comme parole de Dieu le cède à l'esprit qui l'interprète sans qu'on voie toujours bien s'il s'agit de l'Esprit de Dieu ou de l'esprit de l'homme opérant avec toutes les ressources de la rhétorique : synecdoque, catachrèse, énallage, alloiosis, etc. Cependant, cet effort d'investigation a ses limites. Si l'on ne trouve pas chez lui la distinction entre Deus absconditus et Deus revelatus Luther, Zwingli ne s'arrête pas moins devant l'inscrutabilité des jugements divins et particulièrement du décret divin d'élection. Ainsi s'explique le relief que prend dans son système l'idée de prédestination et d'élection : l'élection est conçue comme un décret positif de Dieu en faveur des élus sans contrepartie directe pour les réprouvés à la différence de Calvin ; la foi elle-même s'entend en fonction de l'élection dont elle est le signe. Par là aussi se comprend la critique radicale du libre arbitre et du mérite des œuvres, qui semble s'opposer à la gratuité du salut. Les bonnes œuvres accompagnent nécessairement la foi vive et font corps avec elle ; elles sont le gage de l'élection. La justification, interprétée au sens de Gerechtmachen, est synonyme de rémission des péchés et de régénération. Finalement, réduite à ses éléments essentiels, la Révélation chrétienne paraît devoir s'imposer à tout esprit éclairé d'en haut ; l'universalité salvifique, salut des païens d'élite s'allie à l'élection dans une unité dialectique.
La genèse de ce système comporte plusieurs étapes qu'il est difficile de reconstituer, chaque étape se retrouvant, encore que modifiée, dans la suivante. C'est ainsi que Zwingli a adopté la doctrine luthérienne de la justification, mais en y incorporant des données héritées de l'humanisme. Dans l'Épître aux Romains, là où Luther traduit : Rechtfertigung, Gerechtigkeit, il traduit en 1524 : innocentia, pietas. La rupture avec Érasme ne fut complète qu'en 1525 quand, délaissant le Nouveau Testament (idéal communautaire, morale évangélique, Zwingli se concentra sur l'Ancien Testament prophétisme, règles de vie sociale. Simultanément, la question de la cène l'éloigna de Luther. Il adopta la théorie symbolique importée des Pays-Bas, qui cadrait à merveille avec son système présence du Christ-Esprit ; la communauté devient le véritable sujet de l'eucharistie, tandis que le réalisme eucharistique paraissait indispensable à Luther comme soutien de la foi et assurance de la rémission des péchés et du salut. Les divergences entre eux tiennent d'ailleurs moins à l'interprétation littérale ou figurée des paroles de l'Institution qu'à des présupposés métaphysiques différents scotisme ou occamisme.
Le système de Zwingli s'est développé en réaction contre divers mouvements concurrents, qui chacun à sa manière tendaient à s'affirmer : catholicisme conservateur ou réformiste, luthéranisme, anabaptisme ; il y a de ce fait dans son orientation quelque chose d'imprévisible. Le tournant de l'évolution se situe à la fin de 1519 ou au milieu de 1520, et il s'opère au niveau de l'anthropologie. Zwingli est passé de l'anthropologie des Pères grecs, cultivés à la suite d'Érasme Origène, Cappadociens, à celle de saint Augustin, et cela sous l'influence de Luther, laquelle fut sur lui plus considérable qu'on ne le croit généralement. Parallèlement, il a modifié sa sotériologie : le salut dépend moins de l'effort humain ou de l'illumination divine que de la grâce, synonyme d'action du Saint-Esprit. La transition fut assurée par la lecture de saint Paul et des Tractatus de saint Augustin sur le Quatrième Évangile C.R., V.
En même temps, Zwingli fait preuve d'un pessimisme augustinien d'après Luther, tempéré par l'optimisme hérité de l'humanisme ; ainsi, avec les années, il a étendu plutôt que restreint les limites de la connaissance rationnelle de Dieu et il a intégré à son système des éléments provenant des philosophes anciens – néo-platonisme d'après l'Académie de Florence, stoïcisme –, cherchant à réaliser une synthèse entre valeurs profanes et religieuses : Christentum und Antike W. Köhler. Au sommet, le spiritualisme est la note dominante du système et la clef d'interprétation de la plupart des doctrines zwingliennes C. Gestrich ; son origine est complexe et encore en partie indéterminée saint Augustin, mystique rhénane, néo-platonisme, Érasme, etc. ; il s'affirme dans la pratique de multiples manières : par la conscience que Zwingli a de sa mission «prophétique, par l'efficacité attribuée à la parole de Dieu, par la transformation surnaturelle attendue de la société où est prêché l'Évangile, etc.
Théologie eucharistique
Dans ses premières années à Zurich, il proclame la doctrine mémorialique symbole de la cène. Il combattait la doctrine consubstantiationaliste de Luther. Zwingli développa une doctrine de la cène nommée plus tard par Jean Calvin Présence spirituelle.
Idées sociales et politiques
La doctrine sociale de Zwingli est le corollaire de sa christologie : Mundum veni non modo redimere, sed etiam mutare, Je ne suis pas venu seulement racheter le monde, mais bien le changer. Le pivot en est la doctrine de la double justice divine et humaine, qui occupe dans ce système une place analogue à celle des deux règnes Zwei-Reiche-Lehre dans celui de Luther. La « justice divine » était le slogan des paysans qui s'autorisaient du Sermon sur la montagne Matth., V pour réclamer des réformes radicales, notamment l'abolition de la dîme. Zwingli lui juxtapose, dans un écrit de 1523, la justice humaine cf. la justitia civilis des scolastiques, justice distincte mais subordonnée à la première. La justice humaine n'est pas un absolu, pas plus que l'autorité Obrigkeit qui est chargée de l'administrer. Toutes deux sont sujettes à un principe supérieur : die Richtschnur Christi le commandement de l'amour, vers lequel elles doivent tendre. On retrouve, sous les termes de l'idéal et du concret ou relatif, la dialectique de la réalité et de la figure ou ombre, qui détermine nombre de positions zwingliennes néo-platonisme. En même temps, cette solution apparaît comme une voie moyenne entre deux tendances rivales : celle des radicaux baptistes, qui n'admettaient aucun ordre extérieur qui ne fût fondé sur l'Évangile, et celle des princes et magistrats des villes, qui ne connaissaient d'autre règle que leur bon plaisir. À la différence de Luther, Zwingli accorde aux citoyens un droit de résistance à l'autorité pouvant aller jusqu'à la déposition du tyran.
Zwingli critique d'abord les dîmes, et ses sympathies vont à ceux qui vivent de leur travail. Mais quand les paysans rejettent les dîmes et que les paiements des intérêts sur morts-gages sont menacés, il maintient la propriété privée comme consécutive à l'état de chute et propose un certain nombre de réformes : ainsi les morts-gages ruraux se justifient seulement comme avances sur la productivité future des terres, l'intérêt doit varier avec la récolte, les dîmes doivent retrouver leur ancienne destination bien public et aide à une Église purifiée, la petite dîme est à supprimer, etc. Zwingli conseille aux paysans d'abandonner leurs tenures improductives plutôt que de les hypothéquer, mais ceux qui vendaient leurs fermes et s'exilaient avaient à payer aux officiers communaux le tiers du prix de la ferme en compensation de la perte d'un sujet.
En ville, Zwingli dénonce l'usure et les compagnies marchandes monopoles, mais il rejette également l'excès opposé : Ceux qui sont si bien informés qu'ils savent que toutes choses devraient être mises en commun devraient être pendus aux gibets comme un exemple pour tous cité par P. Meyer, Zwinglis Soziallehren. Zurich n'avait pas alors l'importance d'une ville commerçante comme Augsbourg et ne comptait guère, du temps de Zwingli, que 5 000 habitants contre 50 000 à la campagne ; Zwingli n'eut donc pas à prendre position sur les problèmes économiques et sociaux que posait le capitalisme naissant. S'il n'admet pas le prêt à intérêt, c'est que celui-ci représentait plutôt une avance du propriétaire foncier vivant en ville au tenancier pauvre sans que le principe de la fructification de l'argent fût directement en cause. En outre, il enseignait que les conventions une fois passées, qu'il s'agisse de dîmes ou d'intérêts, devaient être observées.
L'adoption de la Réforme à Zurich eut pour résultat le remplacement d'une élite politique par une autre ; les marchands et maîtres artisans, dont certains étaient de véritables chefs d'entreprise, remplacèrent l'ancien patriarcat, qui vivait de pensions reçues à la suite de services rendus à l'étranger mercenariat, racolage ou de rentes foncières. À partir de 1524, et surtout après la purge de 1528, les postes de commandement dans l'administration bourgmestres et échelons inférieurs et dans l'armée passent aux mains des partisans de Zwingli. Celui-ci favorisa leur ascension, comptant sur eux pour faire accepter du reste de la population urbaine ou rurale cette dernière, quoique numériquement la plus importante, n'était guère représentée dans les Conseils ses réformes tant religieuses que sociales. Parmi ces dernières, on peut mentionner, comme suite à la sécularisation des couvents, la création, avec le concours du magistrat, de l'assistance publique Almosenamt et la réforme scolaire au niveau de l'enseignement supérieur et secondaire – mais non primaire Volksschulen – avec K. Spillmann. La montée de la nouvelle oligarchie fut accompagnée de concessions concrètes aux artisans et aux bourgeois qui au début soutenaient la Réforme. Certains profitèrent de la liquidation des biens d'Église pour s'enrichir ; comme l'écrivait un chroniqueur : Messeigneurs ont brûlé les images de bois, mais ils ont emporté les images d'or et les ont volées dans leurs poches, et beaucoup sont devenus évangéliques pour obtenir un office cité par N. Birnbaum. La réorganisation de l'armée en 1529 donna aux zwingliens les postes de commandement, les officiers patriciens furent ramenés au rang de conseillers techniques ; le fardeau financier qui retombait sur les simples citoyens en fut accru à noter qu'à cette date 1529 le nombre de citoyens mâles à Zurich en âge de porter les armes était de 923.
Ces quelques données suggèrent que l'action de Zwingli à Zurich se déroula sur un théâtre relativement petit. Replacée dans cette perspective, elle prend ses justes dimensions, encore que le regard de Zwingli embrassât le reste de la Confédération et qu'il intervînt par des admonitions dans les affaires intérieures des autres cantons. Il tenta même, par ses partisans de Berne, de prendre pied en Suisse occidentale. Enfin, il fut initié par ses amis de Strasbourg, en septembre 1529, alors qu'il était sur le chemin de Marburg, à la grande politique européenne. Il n'en est pas moins vrai que ses vues sociales et politiques sont celles d'un montagnard du Toggenburg transplanté dans la ville de Zurich, à laquelle il demeura au fond de lui-même étranger ; il passait pour tel aux yeux des chanoines prébendés du Grossmünster la Bastille de Zurich et du patriarcat. Pour Zwingli, en effet, la patrie désigne le pays natal ou la Confédération. Devant l'opposition, il offrit sa démission au Conseil, qui la refusa 26 juill. 1531. Politiquement parlant, il préférait, parmi les formes de gouvernement, l'aristocratie, régime en vigueur à Zurich et dans les cités suisses. C'est donc à tort qu'on parle dans ce contexte de démocratie au sens moderne du mot ; on peut seulement relever chez Zwingli des aspirations qui concordent avec celles des démocrates. Ajoutons que la réforme zwinglienne coïncide avec l'émancipation de Zurich vis-à-vis de la tutelle de Rome et du pouvoir ecclésiastique, émancipation faisant suite à la guerre de libération du joug des Habsbourg à la fin du siècle précédent. Ce qui était motif religieux chez Zwingli pouvait devenir chez les gouvernants motivation politique.
Influence de Zwingli
La guerre de Smalkalde 1547 refoula le zwinglianisme des villes d'Allemagne méridionale et d'Alsace ; peu après, Bullinger se rapprocha de Calvin, notamment sur la question de la Cène Consensus Tigurinus, 1549 ; à partir de cette époque et jusqu'au synode de Dordrecht, le type zurichois d'Église uni au calvinisme a marqué les Églises réformées. La seconde Confession helvétique 1566 rédigée par Bullinger fit l'union des réformés de Suisse et d'Europe centrale. Elle fut traduite en de nombreuses langues. Encore obligatoire en Suisse au XVIIIe siècle, elle cessa de l'être à partir du XIXe siècle ; c'est pourquoi de toutes les Églises réformées celle de Suisse est la seule à ne pas posséder de confession ; elle n'admet qu'un fondement : l'Écriture. En dépit du passage à la Landeskirche, les Églises réformées suisses gardent le type zwinglien dans la liturgie, plus dépouillée et centrée sur la prédication, dans l'attitude de leurs membres à l'égard de la vie publique, etc. Mais le radicalisme de la réforme zwinglienne suppression des images, rigueur disciplinaire a disparu.
À l'étranger, il y eut de bonne heure des zwingliens en Hongrie et en Moravie (cf. Archiv für Reformationsgeschichte, LXIII). La vallée du Rhin surtout fut la voie de pénétration vers le nord, à travers le Palatinat et la Hesse, jusqu'aux Pays-Bas et en Angleterre. On rencontre des succédanés de la Prophezei zurichoise dans ces diverses contrées ; les « Décades » de Bullinger répandues aux Pays-Bas contribuèrent à faire connaître les doctrines du réformateur zurichois ; l'anglicanisme et le puritanisme portent des traces d'influence zwinglienne. Mais celle-ci se situe plutôt, en dehors de toute institution, dans un certain nombre d'idées mères qui ont continué d'agir dans le protestantisme : le biblicisme à base de philologie, qui s'est maintenu en marge de l'orthodoxie régnante ; le relief pris par l'idée d'Alliance systématisée par Bullinger, d'où procède la Föderaltheologie ; la concentration sur l'essence du christianisme chère au libéralisme ; mieux encore la distinction des articles fondamentaux et accessoires, par où Zwingli fait figure de précurseur de l'œcuménisme contemporain ; l'ouverture de l'Église au monde, qui renverse la position luthérienne regnum Dei non est externum critiquée par Zwingli, et l'action caritative et sociale. Si l'on en croit W. Dilthey Gesammelte Schriften, II, c'est surtout par ce dernier trait que Zwingli est plus moderne que Luther cf. Ernst-Staehelin-Festschrift, Gottesreich und Menschenreich. Jacques Vincent Pollet
Œuvres
Traités :
1522 : avril. De la Liberté des mets.
1522 : mai. Exhortation contre les enrôlements et les pensions.
1522 : juillet. Prière et exhortation amicale en faveur du mariage des prêtres.
1524 : Le Berger.
1525 : De la vraie et fausse religion, en latin commentarius de vera et falsa religione
Ouvrages :
1530 : Fidei Ratio.
1531 : Expositio Fidei
Publications
Zwingli est l'auteur d'ouvrages imprimés en 4 volumes in-fol. publiés à Zurich en 1544-1545 par Rodolphe Gualter qui est l'auteur de la Préface apologétique. Il est également l'auteur de 4 tomes en 3 volumes in-fol. publiés à Zurich en 1581. Les deux premiers tomes renferment ses traités de controverse et des discours, dont quelques-uns avaient été imprimés séparément de son vivant. Le troisième et le quatrième contiennent ses commentaires sur l'Écriture sainte.
Bibliographie ancienne
MM. Usteri et Vogelin de Zurich ont publié depuis 1819, en allemand, des extraits des Œuvres complètes de Zwingli, rangés par ordre de matières. Ce réformateur a laissé un grand nombre d'ouvrages, qui sont encore inédits. On peut consulter sur sa vie et sur ses écrits : Oswald Myconius, De cita et obitu Zwinglii ; J.-Gr. Hess, Vie de Zwingli Paris, 1810, in--8 ° ; Richard, Ulrich Zwingli, etc., Strasbourg, 1819 ; J. Willm, Musée des protestants célèbres; Bayle, Chaufepié, Jurieu ; Mosheim, Histoire ecclésiastique, et l'abbé Pluquet, Dictionnaire des hérésies, t. 2.
La vie de Zwingli a été écrite en allemand par H.-W. Rotermundt, Brème, 1819 ; par H. TMueller, Leipsick, 1819 ; par J.-M. Schuler, Zurich, 1818 ; par G. Rœder, Coire, 1834 ; par J.-J. Hottinger, Zurich, 1842. C'est également en langue allemande qu'est écrit le livre de M. E. Zeller : Tableau du système théologique de Zwingli, Tubingue, 1853, in-18. Le second volume des Études sur la réformation du XVIe siècle, par M. Victor Chauffour-Kestner Paris, 1833, 2 vol. in-18, est consacré à Zwingli.
Principaux ouvrages
La foi réformée, 2000, Éditeur / Édition : Bergers et Mages- traduction française de Fidei Ratio et de Expositio Fidei, les deux opuscules de la fin de la vie du réformateur.
 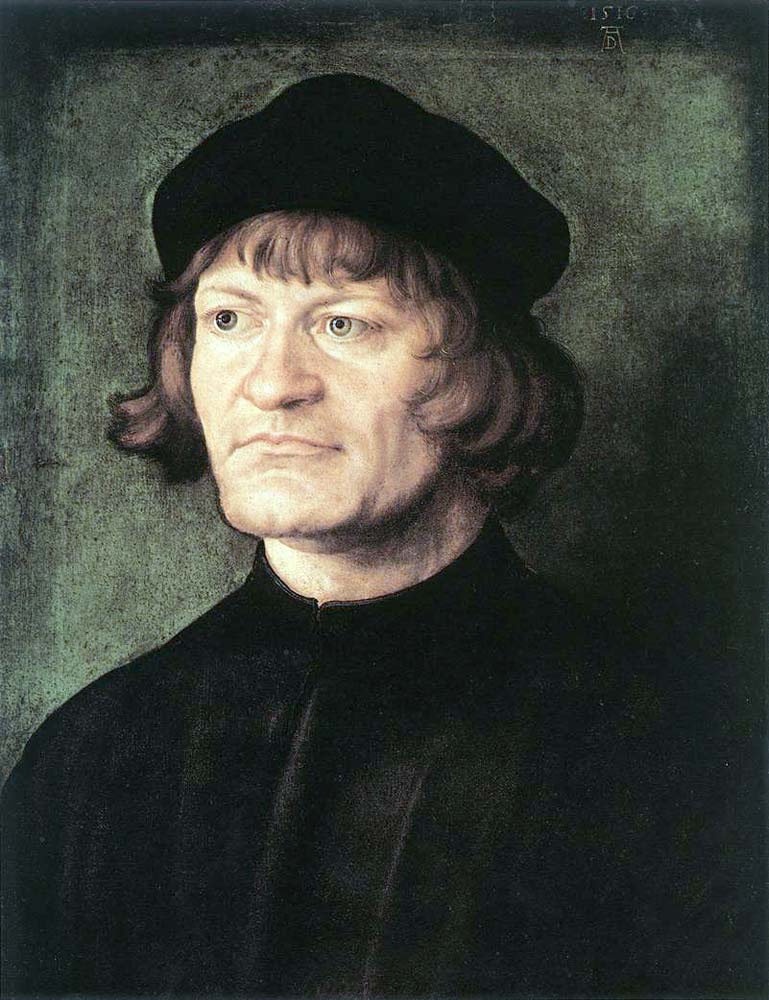    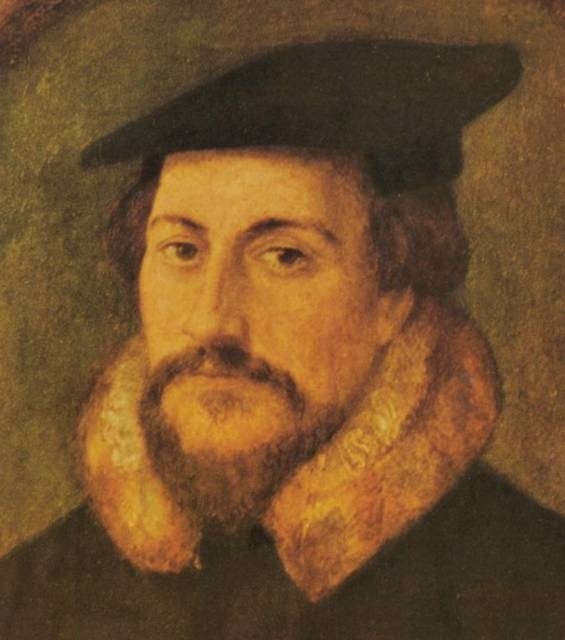    
Posté le : 10/10/2015 16:20
|
|
|
|
|
Conrad de Marbourg |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 11 Octobre 1231 Conrad de Marbourg
règne sur l'inquisition.
Conrad de Marbourg, prêtre séculier qui se voit conférer le titre d'inquisiteur par Grégoire IX qui met en application sa constitution Excommunicamus instituant l'Inquisition médiévale.
Conrad de Marbourg est un Prêtre séculier de l'ordre des Prémontrés. Ses contemporains l'appellent magister, montrant qu'il eut une formation universitaire, probablement à Paris ou Bologne. Il est décrit comme un homme d'une grande éloquence, très bon théologien, défenseur zélé de la pureté de la Foi Catholique et menant une vie ascétique.
Il se signale d'abord en prêchant la Cinquième croisade, proclamée en 1213 par Innocent III.
En bref
Célèbre inquisiteur du XIIIe siècle. Conrad de Marburg appartenait à l'ordre de Prémontré, qui s'était considérablement développé en Allemagne à la fin du siècle précédent et était très attentif à la christianisation des populations. Homme rigide, Conrad fut d'abord le confesseur de sainte Élisabeth de Hongrie, épouse du landgrave Louis de Thuringe. En 1231, le pape Grégoire IX, qui mettait en place l'Inquisition, le munit de pouvoirs très étendus pour poursuivre les hérétiques, et particulièrement la secte cathare extrémiste des lucifériens, qui s'adonnait à des pratiques proches de la sorcellerie. Avec ses auxiliaires Dorso et Jean, il agit avec un tel fanatisme et d'une manière tellement illégale qu'il souleva le mécontentement d'un grand nombre d'habitants et fut massacré par des chevaliers dans le voisinage de Marburg.
On n'a pas toujours précisé le caractère original de l'Inquisition, forme de répression de l'hérésie établie par le pape Grégoire IX à partir de 1231. À cette date, la punition des hérétiques et l'anathème contre les ennemis de la foi étaient des faits déjà anciens, selon ce qui avait été en particulier prescrit par le deuxième concile du Latran (1139). Il appartenait aux évêques de rechercher les hérétiques, aux juges séculiers de les punir, aux rois et aux princes de prêter, sous peine de déchéance, leur concours à cette répression.
Très différente est l'Inquisition ; elle se présente comme un tribunal d'exception, permanent, qui intervient dans toutes les affaires intéressant la défense de la foi. Elle doit son nom à la procédure inquisitoire qui permet la recherche d'office des suspects par le juge. Créée pour lutter contre les cathares et les vaudois, l'Inquisition a ensuite étendu son activité aux béguins, aux fraticelles, aux spirituels, ainsi qu'aux devins, sorciers et blasphémateurs. Dans ce vaste domaine, elle dessaisit, en fait sinon en droit, la juridiction ordinaire, celle de l'évêque. L'Inquisition n'aurait pu remplir son rôle sans le concours du pouvoir civil qui lui fournissait ses moyens d'existence et assurait l'exécution de ses sentences. D'ailleurs, à une époque où la vie de toute principauté reposait sur l'unité de religion, les intérêts de l' État et de l'Église se trouvaient, sauf exception, confondus au sein de cette juridiction.
Apparue au moment où l'Espagne réalisait son unité politique, l'Inquisition espagnole a constitué une institution originale, sans rapport avec l'Inquisition pontificale créée au XIIIe siècle pour lutter contre l'hérésie. Par ses origines, comme par l'action considérable qu'elle exerça dans les domaines religieux et intellectuel, elle constitua un élément caractéristique de la personnalité historique de l'Espagne. Marcelin Defournaux.
Sa vie
En 1225, il devient le directeur spirituel de la jeune veuve du landgrave de Thuringe, la future sainte Élisabeth de Hongrie. Il la traite avec la même sévérité que lui-même, conformément à ses souhaits. Il lui arrive cependant de restreindre son zèle et de lui interdire des mortifications excessives. Après la mort d'Élisabeth en 1231, Conrad sera chargé d'examiner les témoignages relatifs à sa vie et les miracles attribués à son intercession.
En 1227, alors qu'il est écolâtre à Mayence, il est nommé commissaire pontifical en Rhénanie.
En 1231, Grégoire IX met en application sa constitution Excommunicamus instituant l'Inquisition médiévale : le 11 octobre, il confère à Conrad le titre d'inquisiteur, le premier à porter ce titre en Allemagne. Le pape le dispense de suivre les obligations de la procédure canonique, te a cognitionibus causarum habere volumus excusatum et l'autorise à procéder au mieux contre les hérétiques, mais en respectant les décrets papaux. À sa demande, le pape édicte en 1233 la première bulle de l’histoire contre les sorcières, la Vox in Rama en y décrivant le sabbat des sorciers et leur culte du diable.
Conrad est laissé libre de choisir ses collaborateurs : il s'adresse aux dominicains par l'intermédiaire des prieurs de Regensburg, Friesach et Strasbourg. Appuyé par le dominicain Conrad Dorso et Jean le Borgne un laïc, il aide les évêques à réprimer l'hérésie en reprenant le rôle des témoins synodaux, ces clercs chargés de dénoncer l'hérésie pour permettre à la procédure de s'ouvrir. Conrad de Marbourg lutte contre les Vaudois et Cathares, comme on les appelle alors, sans distinction réelle entre les hérésies, ainsi que contre le groupe cathare des Lucifériens.
De l'avis même de ses contemporains, Conrad se montre trop sévère et brutal dans sa fonction. Ses deux assistants sont des ignorants fanatiques, inaptes à cette tâche. Conrad prend pour argent comptant les déclarations des suspects, et sur la foi de ces accusations, enchaîne les arrestations pour hérésie, sans chercher à vérifier l'exactitude des accusations portées. Les accusés peuvent soit confesser leur faute et se retrouver avec la tête rasée en guise de pénitence, soit protester de leur innocence, au risque d'être jugé hérétique non repenti, et livrés au bras séculier pour finir sur le bûcher. Le nombre de ses victimes n'est pas connu avec précision. En Allemagne occidentale, son activité d'inquisiteur provoqua une panique générale. Il agit avec un tel fanatisme et de manière tellement illégale qu'il soulève la population contre lui.
Il se tourne même contre la haute noblesse, en particulier le comte Henri II de Sayn, qu'il accuse d'hérésie luciférienne. Sayn fait appel à l'achevêque de Mayence, Siegfried III von Eppstein, qui convoque pour le 25 juillet 1233 un synode pour vérifier les charges pesant contre l'aristocrate. Les évêques et les nobles présents au synode voient l'activité de Conrad d'un œil hostile, et Conrad est incapable de prouver ses accusations contre le comte Henri. Sur ce, désavoué, Conrad ne renonce pas à sa mission qu'il jugeait juste. Fort du mandat qu'il tient du pape, il entreprend de prêcher une croisade contre les nobles hérétiques. Cinq jours plus tard, le 30 juillet 1233, il meurt avec son compagnon Gerhard Lutzelkolb dans une embuscade, massacré par des chevaliers alors qu'il revient à Marbourg.
Littérature
Conrad von Marburg est représenté dans la tragédie des Saints du romancier anglais Charles Kingsley. Il est aussi représenté dans les bandes dessinées Le Troisième Testament de Xavier Dorison et Alex Alice, et Urielle de Clarke et Denis Lapière
Mise en place et fonctionnement de l'inquisition
De nouveaux moyens de répression
Les moyens traditionnels de répression, la procédure par accusation ou par dénonciation convenaient peu à la lutte contre l'hérésie. Ignorée du droit romain, la procédure inquisitoire permit de poursuivre d'office toute personne vaguement soupçonnée, ce qui rendait possible une répression rapide et efficace. Celui qui était interrogé devait jurer de dire la vérité sur son propre compte et sur celui des autres. Innocent III définit la nouvelle procédure dans la décrétale Licet Heli de 1213, complétée par la décrétale Per tuas litteras.
Les nombreuses mesures qui frappaient les hérétiques avaient trouvé leur couronnement dans la décrétale Vergentes in senium publiée par Innocent III en 1199. En 1215, le Concile du Latran reprit toutes les dispositions antérieures. Les autorités civiles ne restèrent pas inactives : l'empereur Frédéric II en 1220 et 1224, le roi de France Louis VIII en 1226, la régente Blanche de Castille en 1229, le comte de Toulouse lui-même 1229 publièrent des ordonnances contre les hérétiques. Il restait à régulariser la répression. Grégoire IX lui donna une forme précise par la constitution Excommunicamus févr. 1231. La prison perpétuelle devenait la pénitence salutaire infligée à l'hérétique repentant ; l'hérétique obstiné devait recevoir le châtiment qu'il méritait animadversio debita avec l'abandon au juge séculier et la peine de mort par le feu. Ceux qui étaient en rapport avec les différentes sectes étaient frappés d'excommunication.
Pour appliquer sa constitution dans l'Empire, Grégoire IX, dès le 11 octobre 1231, désigna Conrad de Marbourg, prêtre séculier, qui, choisissant librement ses collaborateurs, pouvait user de l'excommunication et de l'interdit, faire appel au bras séculier ; il jouissait de pouvoirs à peu près illimités. Mais le pape eut aussi recours aux dominicains. Par ses bulles Ille humani generis, il confia nov.-déc-1231 aux prieurs de Ratisbonne, de Friesach près de Klagenfurth, de Strasbourg, la mission de poursuivre, suivant les statuts qu'il avait promulgués, les coupables et leurs aides. Semblable mission fut confiée au prieur de Besançon et à Robert le Petit, plus connu sous le surnom de Bougre. Pour la première fois, on se trouve en présence d'un ensemble de mesures qui attribuent à un tribunal d'exception le châtiment des ennemis de la foi, par application d'une législation précise : c'est la naissance de l'Inquisition. Mais le choix de Conrad de Marbourg fut très malencontreux. Fanatique, agissant sans discernement, il érigea çà et là de nombreux bûchers, et ses violences soulevèrent une inquiétude générale. Il se heurta aux prélats et tint tête au Concile de Mayence juill. 1233. Ses ennemis se débarrassèrent de lui par l'assassinat 30 juill.. L'Office ne se releva jamais de cet échec à l'intérieur de l'Empire. Mais l'Inquisition se développa néanmoins très rapidement.
Les tribunaux et les juges
En avril 1233, la juridiction nouvelle, bientôt connue sous le nom d'Inquisitio hereticae pravitatis, fut étendue au royaume de France et aux régions voisines. Le 20 avril 1233, le pape informa les archevêques et les autres prélats qu'il les soulageait d'une partie de leur fardeau en choisissant, pour combattre l'hérésie, les Frères prêcheurs. Le 22, il confia au provincial de Provence le soin de désigner plusieurs de ses religieux pour remplir cette mission dans les conditions prévues. Cette mesure s'appliquait aussi aux provinces de Vienne, Arles, Aix et Embrun. Avec l'aide d'un légat, Jean de Bernin, archevêque de Vienne, le provincial mit en place, à la fin de 1233 ou au début de 1234, des tribunaux à Avignon, Montpellier, Toulouse. En 1237, des juges furent installés à Carcassonne. Pour le nord de la France, le pape disposait déjà de juges. Il lui suffit de donner mandat 19 avr. 1233 à Robert le Bougre et aux inquisiteurs de Besançon pour extirper l'hérésie de La Charité-sur-Loire et des régions voisines ; ces pouvoirs furent en fait étendus aux provinces de Sens, Reims et Bourges. Des difficultés retardèrent l'établissement de l'Inquisition en Italie, jusqu'en 1235 en Italie centrale, jusqu'en 1237 en Lombardie ; elle fut confiée, dans le premier cas, au prieur du couvent des prêcheurs de Sainte-Marie de Viterbe, dans le second, au provincial de Lombardie.
L'Inquisition a été parfois itinérante, mais en général le tribunal possédait un siège fixe, la maison de l'Inquisition, ou vivaient les inquisiteurs, leurs notaires et leurs familiers. Les archives s'y trouvaient en lieu sûr. Les inquisiteurs touchaient une pension annuelle, ou, selon un système plus aléatoire, une partie du produit des confiscations, en Italie le tiers. Chaque tribunal était présidé par deux juges, avec des pouvoir égaux, qui étaient presque toujours, mais non obligatoirement, des Prêcheurs ou des Mineurs. Ils étaient désignés par les supérieurs de leur ordre, en général les provinciaux, qui recevaient une délégation du pape. Après le début du XIVe siècle, il n'y eut plus qu'un inquisiteur, qui se faisait assister par des lieutenants ou des commissaires. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inquisiteurs n'étaient pas tenus d'obéir à leurs supérieurs, ils vivaient en marge de la vie conventuelle et échappaient à l'emprise de la règle. On s'efforça de faire coïncider les circonscriptions inquisitoriales et les limites politiques. Ainsi, en 1248, le diocèse d'Elne province de Narbonne cessa de dépendre de Carcassonne et fut rattaché à l'Inquisition aragonaise.
Pour bien s'acquitter de leur charge, les inquisiteurs disposaient de nombreux textes pontificaux ; ils pouvaient consulter des juristes par exemple, à Avignon, le 21 juin 1235, sur les vaudois ou une personnalité particulièrement compétente, tel, vers 1256, puis vers 1260, Gui Foucois, le futur pape Clément IV. Très vite, ils eurent à leur disposition des manuels, d'abord simples recueils de formules le plus ancien, en 1242, est dû au dominicain Raimond de Pennafort, pour l'Aragon, puis de véritables traités raisonnés, comme la célèbre Pratica Inquisitionis de l'inquisiteur toulousain Bernard Gui 1324.
Procédure et pénalités
Pour rechercher les suspects, les inquisiteurs pouvaient recourir à l'enquête générale ou à la citation individuelle. Dans le premier cas, ils partaient en tournée ou, le plus souvent, convoquaient au siège de leur tribunal la population entière d'une région, hommes et femmes. Tous étaient tenus de comparaître. Ceux qui faisaient des dépositions sincères dans les délais accordés étaient sûrs d'échapper aux peines les plus graves. Ils bénéficiaient du temps de grâce, usage remontant aux origines de l'Inquisition. Pour une comparution individuelle, la citation se faisait par l'intermédiaire du curé. Le refus de comparaître entraînait l'excommunication qui devenait définitive au bout d'un an. L'arrestation de certains suspects pouvait être jugée nécessaire. Pour toutes ces poursuites, le sergent de l'Inquisition demandait l'aide des autorités civiles.
Le suspect, interrogé par l'inquisiteur ou un de ses collaborateurs, devait s'engager par serment à révéler tout ce qu'il savait sur l'hérésie. Un notaire, en présence de témoins, recueillait les éléments de l'interrogatoire, mais en retenant seulement la substance des réponses, ce qui paraissait exprimer le mieux la vérité. Toujours rédigé en latin, le texte, traduit en langue vulgaire, était ensuite lu à l'accusé qui devait s'en remettre à la volonté des inquisiteurs. Pour faire avouer les récalcitrants, de nombreux moyens de contrainte pouvaient être employés, en dehors même de la torture, considérée comme licite après le milieu du XIIIe siècle : convocations nombreuses, incarcération plus ou moins confortable, recours à des délateurs. À défaut d'aveux, la preuve de l'hérésie était administrée par des témoins.
L'Inquisition n'infligeait pas de vraies peines, mais des pénitences salutaires pour le bien des adeptes de l'hérésie revenus à la foi. Les moins graves, qui étaient qualifiées de pénitences arbitraires, pouvaient être imposées ou commuées par les inquisiteurs eux-mêmes : elles étaient les seules infligées à ceux qui avaient comparu pendant le temps de grâce. On comptait parmi elles la fustigation au cours de la messe, les visites aux églises, les pèlerinages, l'entretien d'un pauvre, le port de croix d'infamie sur les vêtements, ces pénitences pouvant être combinées. La peine normale de l'hérétique converti lorsque son cas n'appelait pas une indulgence particulière, était la peine de la prison, en principe perpétuelle. Mais les réductions n'étaient pas rares : l'inquisiteur Bernard Gui commua environ deux peines sur cinq. Le régime du mur large laissait aux incarcérés une vie tolérable, surtout du fait de l'incurie des geôliers. Le « mur étroit » était beaucoup plus rigoureux. Avant de prononcer la sentence, les inquisiteurs consultaient des assesseurs ou boni viri, dont le rôle, peu important au début, n'a cessé de croître par la suite.
Devant l'hérétique opiniâtre ou le relaps, l'Inquisition, se trouvant désarmée, n'avait d'autre ressource que de les abandonner à l'autorité séculière, à laquelle il appartenait de les conduire au bûcher. Cette mesure gardait quelque chose d'exceptionnel : au cours de sa longue carrière, Bernard Gui abandonna quarante hérétiques au bras séculier.
Les sentences étaient prononcées au cours d'une cérémonie officielle qui se déroulait en présence des autorités religieuses et civiles, et qu'on appelait le sermon général parce qu'elle débutait par une allocution de l'inquisiteur.
Les peines les plus graves entraînaient obligatoirement la confiscation des biens du coupable au profit de l'autorité qui avait la charge des dépenses de l'Inquisition. Il en était de même dans le cas de condamnations posthumes, car la mort ne mettait pas un terme à l'action de la justice.
L'évolution de l'Inquisition
Le XIIIe siècle et l'apogée de l'institution
Des tribunaux ont fonctionné régulièrement dans le midi de la France. À Avignon et à l'est du Rhône où il avait à faire surtout à des vaudois, l'inquisiteur Guillaume de Valence eut, en 1246, des difficultés avec les Avignonnais qui en vinrent même à libérer des prisonniers. À Montpellier, le dominicain Pierre de Marseillan poursuivit les cathares et les vaudois jusqu'à la suppression du tribunal, vers 1244. À Carcassonne, où la tâche des inquisiteurs fut dure, le Catalan Ferrier a laissé une réputation particulière d'énergie 1237-1244 : il y gagna le surnom de Marteau des hérétiques. Les juges de Toulouse eurent le sort le plus difficile ; en 1235, ils furent expulsés de la ville. Pour tenter d'améliorer la situation, le légat associa au dominicain Guillaume Arnaud le franciscain Étienne de Saint-Thibéry et un séculier Raimond Escriban, archidiacre de Villelongue. Mais ceux-ci furent massacrés, la veille de l'Ascension 1242 28 mai, à Avignonet, victimes d'un guet-apens tendu par les hérétiques réfugiés à Montségur. La conjoncture ne redevint favorable à l'Inquisition qu'avec la nomination de Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre qui s'établirent à Toulouse en 1245.
Dans le reste du royaume, l'Inquisition prit un caractère désordonné, en raison de la personnalité de Robert le Bougre, ancien hérétique, considéré par ses contemporains comme faux et hypocrite. Après avoir vécu pendant de longues années dans la loi de mescréandise à Milan, il avait pris l'habit de frère prêcheur. L'action de Robert à La Charité-sur-Loire fut si brutale, en 1233, que Grégroire IX suspendit les pouvoirs de l'inquisiteur dès février 1234. Rentré en grâce en août 1235, celui-ci reprit son activité frénétique et, au cours d'une brève tournée 1236 par Châlons-sur-Marne, Péronne, Cambrai, Douai, Lille et sa région, il fit au moins une cinquantaine de victimes. Puis il sévit en Champagne. Des accusés, amenés de toutes parts dans la forteresse comtale du Mont-Aimé, furent brûlés, au nombre de cent quatre-vingt-trois, le 13 mai 1239, en présence de Thibaut IV, au milieu d'une affluence imposante. De tels excès entraînèrent la disgrâce de Robert, mais on ignore la date exacte et la nature de celle-ci.
En Italie, les inquisiteurs dominicains firent preuve d'une grande activité, de Rome à la Lombardie et jusqu'aux bords de l'Adriatique. Mais leur tâche fut rendue malaisée par la guerre entre les factions et par l'hostilité des gibelins. La mort de Frédéric II n'arrangea rien. Le 9 avril 1252, sur la route de Côme à Milan, Pierre de Vérone fut assassiné. Bien qu'il n'eût exercé sa charge que pendant quelques mois, ce prédicateur réputé, honoré ensuite sous le nom de saint Pierre Martyr, fut considéré comme le modèle de l'inquisiteur. Rainier Sacconi, ancien hérétique lui-même, et auteur d'un traité très documenté sur le catharisme, continua la lutte. En 1254, le prieur et un moine du couvent de Ferrare besognaient encore comme inquisiteurs dans la Marche d'Ancône et en Lombardie. Il est à croire que la tâche était trop lourde, car, le 30 mai 1254, Innocent IV confia aux Frères mineurs la répression de l'hérésie dans toute l'Italie centrale et dans la partie orientale de la plaine du Pô. Les dominicains gardaient juridiction sur la Lombardie et la Marche de Gênes. L'Inquisition fut même étendue par Grégoire IX à la Dalmatie. D'abord confiée aux dominicains, elle fut attribuée à partir de la fin du XIIIe siècle aux franciscains.
En France, l'Inquisition connut une crise longue et beaucoup plus grave. Innocent IV entendit suivre de près le fonctionnement des tribunaux, contrôle que les juges apprécièrent peu. Les inquisiteurs réussirent à lui tenir tête dans une affaire de commutation de peines au profit d'habitants de Limoux 1246 et la mesure fut annulée. Le pape mit alors l'Inquisition sous la tutelle de l'évêque d'Agen 1248 qui se révéla effective : l'évêque, le 14 février 1250, céda à l'abbé de Saint-Sernin de Toulouse une maison qui appartenait à l'Inquisition, afin d'assurer un meilleur logement des étudiants pauvres collège Saint-Raimond. L'inquisiteur Bernard de Caux fut simplement informé de la décision. Peu après, les dominicains renoncèrent à leur charge. Le tribunal continua cependant à fonctionner sous la direction des évêques, avec des juges séculiers, en gardant tous ses caractères de juridiction d'exception. Mais Innocent IV s'efforça d'obtenir le retour des religieux ; les négociations aboutirent seulement après l'avènement d'Alexandre IV. C'est en mars 1255, sous la direction du prieur conventuel de Paris, que les prêcheurs Renaud de Chartres et Jean de Saint-Pierre s'établirent à Toulouse. À la fin de 1258 ou au début de 1259, Guillaume-Raimond de Bordeaux et Baudouin de Montfort vinrent siéger à Carcassonne. Mais, en Provence, sur les terres de Charles d'Anjou, les franciscains succédèrent aux dominicains. Il en résulta une rivalité violente entre les deux ordres mendiants. Les dominicains accusèrent frère Maurin d'avoir pris parti, à Marseille, contre Charles d'Anjou 1264, et n'hésitèrent pas à produire de faux témoins.
Dans l'ensemble, l'Inquisition sortit renforcée de la crise. La papauté abdiqua presque tous ses droits, et les inquisiteurs échappèrent à l'autorité des légats pontificaux eux-mêmes. Dès 1256, Alexandre IV accorda aux inquisiteurs le droit de se relever mutuellement de l'excommunication encourue ou de l'irrégularité commise. Le recours à la torture se trouvait légalisé. L'Inquisition est à son apogée. En Vénétie, Philippe de Mantoue traque les hérétiques de 1276 à 1289. Environ deux cents cathares sont arrêtés à Sirmione et terminent leurs jours sur le bûcher à Vérone, le 13 février 1278. Pour Toulouse, le texte d'une partie des dépositions reçues par Renous de Plessac et Ponce de Parnac 1273-1279 a été conservé. À Carcassonne, Étienne de Gâtine et Hugues de Bouniols prononcèrent des condamnations en 1276. L'inquisiteur de France, Simon Duval, cita par-devant lui, à Saint-Quentin, pour le 18 janvier 1277, Siger de Brabant et ses adeptes qui se gardèrent de comparaître. Mais il était impossible de surveiller la marche de l'Office qui connut des abus. Après 1290, les franciscains se déconsidérèrent en Vénétie par leurs exactions et leurs malversations ; on incrimina particulièrement Boninsegna de Trente et Antoine de Padoue, qui n'a qu'un simple rapport d'homonymie avec l'autre disciple de saint François. À Carcassonne, l'action brutale des inquisiteurs et l'usage abusif de la torture entraînèrent une irritation générale. Des protestations s'élevèrent contre Jean Galand 1278-1293 et Nicolas d'Abbeville 1293-1302, attisées par le franciscain Bernard Délicieux. Des désordres éclatèrent. Les plaintes arrivèrent jusqu'au pape Clément V qui décida d'intervenir.
Celui-ci confia une enquête aux cardinaux Taillefer de La Chapelle et Bérenger Frézouls mars 1306 qui visitèrent les prisons de Carcassonne et d'Albi et prirent des mesures pour améliorer les conditions de détention. Après avoir mis un terme à cette mission 1308, Clément V promulgua toutefois, au cours du Concile de Vienne 1312, les constitutions Multorum querela et Nolentes qui exigeaient la collaboration des inquisiteurs et des évêques pour tous les actes importants de la procédure ainsi que pour la mise à la torture, la promulgation des sentences et la gestion des prisons. La puissance de l'Inquisition en fut irrémédiablement atteinte. Passant outre aux oppositions, Jean XXII, par la décrétale Cum Matthaeus 1321, restreignit un peu plus les pouvoirs des inquisiteurs.
Le déclin
Le tribunal de Toulouse conserva encore toute son activité avec Bernard Gui (1306-1323) ; il combattit les cathares et les vaudois, lutta contre les fraticelles, bizoches, béguins. Mais cela ne dura pas. À Carcassonne, en 1330, Henri de Chamay fut obligé de renoncer à des procès posthumes. Accusé de corruption et d'abus de pouvoir, un commissaire de l'Inquisition fut, en 1340, révoqué de sa charge. L'inquisiteur de France réprima la magie dans l'affaire de Jean l'Archevêque, sire de Parthenay, évoquée par Jean XXII. Contre les vaudois du Dauphiné, des poursuites, parfois entravées par le manque d'argent, furent engagées par le mineur François Borrel, à partir de 1375. Dans l'Empire, la nomination de Jean Scadelent resta sans effet (1349-1357). Au XVe siècle, le déclin s'accentue. À Carcassonne, les décisions prises par l'inquisiteur Pierre de Marvejols furent remises en cause par la papauté (1411). À Lyon, des habitants mécontents firent arrêter le franciscain Bernard Tremosii en 1458. On continua à nommer régulièrement des inquisiteurs, mais ce ne fut plus qu'une fonction accessoire ; tel fut le cas de Thomas de Ferrare en Lombardie de 1462 à 1474.
L'Inquisition a assuré, avec des fortunes variables, pendant les derniers siècles du Moyen Âge, la police de la foi, au profit de l'Église aussi bien que de l'État. Mais les progrès de la centralisation et le développement des institutions administratives et judiciaires mirent en cause l'indépendance et l'utilité du tribunal. Déjà, en plein milieu du XIIIe siècle, la république de Venise entendait faire de la poursuite des hérétiques son domaine propre. À Toulouse, en 1331, un commissaire du roi prétendit que l'Inquisition était une cour royale et non une cour ecclésiastique. Plus tard, sur ordre du roi, Étienne de Lacombe, inquisiteur à Toulouse, fut arrêté dans son hôtel et incarcéré dans sa propre prison 1412. C'était, il est vrai, au plus fort de la crise du Grand Schisme. En Dauphiné, le tribunal finit par être subordonné au Parlement de Grenoble et, en 1509, le Grand Conseil cassa les sentences de l'Inquisition, comme s'il s'agissait d'actes abusifs d'officiers royaux. Aux temps de la Réforme, les Parlements s'attribuèrent sans difficultés la connaissance des nouveaux cas d'hérésie. Mais, en Espagne, les Rois Catholiques organisèrent, sous leur étroite dépendance, un tribunal de caractère ecclésiastique, et déterminèrent ainsi l'essor inattendu de l'Inquisition espagnole. Yves DOSSAT
L'Inquisition espagnole
Les origines
La création de l'Inquisition espagnole se rattache à la réaction contre les minorités ethnico-religieuses, musulmanes et juives, incorporées par la Reconquista à l'Espagne chrétienne où elles jouirent d'abord d'une large tolérance. Cette réaction, accentuée par le malaise économique qui marque les derniers siècles du Moyen Âge, se traduit par la montée des rancunes populaires contre les Maures et surtout contre les Juifs, manieurs d'argent. La pression des autorités religieuses et les massacres de Juifs amènent de nombreuses conversions dont la sincérité apparaît douteuse. C'est pour surveiller ces nouveaux chrétiens ou conversos d'origine juive, et pour punir les relaps, que les Rois Catholiques obtiennent du pape Sixte IV, en 1478, l'autorisation de désigner des inquisiteurs dont la juridiction, d'abord limitée au royaume de Castille, fut étendue ensuite aux territoires de la couronne d'Aragon.
L'Inquisition et l'unification religieuse de l'Espagne
La juridiction inquisitoriale ne touchant que les convertis, Juifs et Maures conservaient, après 1478, la possibilité de pratiquer leur religion. Cette situation fut modifiée dans le quart de siècle suivant par la politique d'unification religieuse pratiquée par les Rois Catholiques. Dès 1492, les Juifs doivent choisir entre le baptême et l'exil ; en 1501, la même mesure est appliquée aux Maures du royaume de Grenade, reconquis vingt années auparavant ; en 1502, elle est étendue aux mudejars de Castille, puis à ceux d'Aragon et de Catalogne. Désormais, la population de l'Espagne ne comprend plus – du moins en principe – que des chrétiens, mais la foi des nouveaux chrétiens reste suspecte, et l'Inquisition est amenée à exercer une surveillance rigoureuse sur les Morisques Maures convertis et davantage encore sur les Marranes suspects de judaïser en secret. Parmi eux se recrute la majeure partie de ceux qui comparaissent dans les autos de fe organisés à partir de 1481. Tomás de Torquemada, premier inquisiteur général 1485-1494, se signala par sa rigueur impitoyable qui suscita de vives protestations, surtout en Aragon et en Catalogne, et souleva la réprobation du pape Sixte IV lui-même.
Cependant sont apparus, au début du XVIe siècle, d'autres courants de pensées hétérodoxes : en réaction contre les excès de la dévotion extérieure, des illuminés alumbrados se réclament d'un christianisme plus intériorisé visant à une union directe avec Dieu. La même aspiration à une vie religieuse plus profonde explique l'accueil très favorable que reçoit, dans les milieux humanistes et dans une partie du clergé, la pensée d'Érasme. Mais illuminisme et éramisme apparaissent d'autant plus redoutables à l'Inquisition qu'ils évoquent la justification par la foi » qui a abouti à la révolte de Luther. Contre les illuminés et les érasmiens, l'Inquisition engage, après 1525, des poursuites qui aboutissent généralement à des condamnations modérées. Il en est tout autrement lorsque, au début du règne de Philippe II, sont découverts, à Séville et Valladolid, des noyaux luthériens influencés en fait par la pensée calvinienne, peu nombreux, mais inquiétants par la qualité sociale et intellectuelle de leurs adeptes. La réaction est, cette fois, brutale : les autos de fe organisés dans les deux villes en 1559 et 1560 font périr plusieurs dizaines de personnes, tandis que l'archevêque de Tolède est lui-même emprisonné comme suspect d'hérésie. Ces rigueurs extirpent totalement le protestantisme d' Espagne. Cependant, la crainte de toute déviation religieuse dans le sens de l'illuminisme entretient la défiance de l'Inquisition à l'égard de la pensée mystique dont les plus illustres représentants, sainte Thérèse et saint Jean de la Croix, sont inquiétés ou poursuivis par le tribunal.
Organisation et procédure
De ses origines, l'Inquisition garde un caractère mixte : tribunal spirituel, elle relève de l'autorité romaine, mais elle constitue en même temps un organisme du gouvernement espagnol. À sa tête se trouve un Conseil suprême placé sur le même plan que les autres, tels le Conseil de Castille, celui des Finances qui assistent le monarque. Son président, l'Inquisiteur général, et ses membres sont nommés par le souverain ; son autorité s'exerce par l'intermédiaire d'une quinzaine de tribunaux ou inquisitions locales auxquels s'ajoutent, aux Indes de Castille, ceux de Mexico, Lima et Carthagène. Chaque tribunal comprend des juges ou inquisiteurs, des qualificateurs chargés de donner une qualification théologique erroné, sentant l'hérésie, hérétique, etc aux propositions ou crimes contre la foi qui leur sont déférés, enfin un procureur fiscal chargé de soutenir l'accusation. L'Inquisition dispose en outre de la collaboration de ses familiers qui constituent pour elle une sorte de police bénévole à laquelle des gens du plus haut rang se font gloire d'appartenir.
La compétence du saint tribunal s'est étendue, au cours du XVIe siècle, à tout ce qui apparaît comme déviation de la foi : non seulement l'hérésie, mais aussi la sorcellerie, la magie, le blasphème et la sollicitation séduction d'une pénitente par son confesseur. Sa procédure est rigoureusement secrète : l'accusé, maintenu dans un isolement total, n'a connaissance ni du nom des dénonciateurs ou des témoins à charge, ni même des accusations exactes portées contre lui : son défenseur, choisi par les inquisiteurs, a essentiellement pour tâche de l'amener à reconnaître ses erreurs ou ses crimes. La torture est couramment employée pour arracher des aveux, mais, contrairement à la légende, elle n'est ni plus ni moins cruelle ou raffinée dans ses procédés que celle qu'emploient les autres tribunaux criminels, en Espagne et ailleurs.
Les sentences rendues par les juges sont gardées secrètes jusqu'au jour de leur procla mation publique, lors d'un auto de fe, cérémonie solennelle, souvent associée à une festivité publique, et au début de laquelle les assistants et le roi lui-même, s'il est présent prêtent serment de fidélité au Saint-Office. Les condamnés impénitents et les relaps sont relaxés au bras séculier, l'exécution par le feu ayant lieu ensuite en un autre endroit ; ceux qui adjurent leurs erreurs sont réconciliés et condamnés à des peines pouvant aller de la simple pénitence ecclésiastique et du port du san benito casaque jaune croisée de rouge à la prison perpétuelle.
Si l'on excepte les premières années du fonctionnement de la justice inquisitoriale et la crise des années 1559-1560, les autos furent des cérémonies relativement peu fréquentes. Quant au nombre des victimes livrées aux flammes, il reste très difficile à établir : peut-être plusieurs milliers. Il ne représente en tout cas qu'une faible proportion de ceux qui eurent affaire au tribunal. Mais le rôle de l'Inquisition dans la vie espagnole ne peut être mesuré au nombre des condamnés : le seul fait d'avoir comparu devant elle constitue pour l'accusé – et pour toute sa famille – une tache indélébile. D'autre part, l'Inquisition exerce, par les condamnations de livres qu'elle inscrit à ses Index dont une dizaine furent publiés entre 1569 et 1790 et par les poursuites engagées contre leurs lecteurs, une police intellectuelle qui a pesé sur la culture espagnole, en limitant la pénétration des influences étrangères.
L'Inquisition aux XVIIe et XVIIIe siècles
Un demi-siècle après l'extirpation du protestantisme, l'expulsion des Morisques d' Espagne 1609-1610 élimina un élément ethnique quelque 300 000 individus qui, malgré tous les efforts de l'Inquisition, s'était révélé inassimilable. Mais, à la même époque, et comme conséquence de l'annexion du Portugal 1580, se produit en Espagne un afflux de Marranes qui, profitant des difficultés financières de la monarchie, se font concéder une tolérance de fait qui leur permet de prendre une place importante dans la vie économique et financière du pays. Les jalousies qu'ils suscitent amènent cependant, à partir de 1640, une reprise de la persécution inquisitoriale qui aboutira, au début du XVIIIe siècle, à leur élimination à peu près complète.
L'avènement de la dynastie des Bourbons conduit à un changement progressif dans les rapports entre l'Inquisition et le pouvoir royal, soucieux de défendre les droits « régaliens contre les empiètements de la juridiction ecclésiastique. Face aux courants de pensée éclairée qui pénètrent en Espagne et inspirent, sous Charles III 1759-1788, l'action de certains ministres réformateurs, l'Inquisition apparaît de plus en plus comme le rempart de la tradition et de l'ordre établi, non seulement dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine politique et social. Par ses condamnations d'ouvrages étrangers surtout français, elle cherche à éviter la contagion des idées philosophiques, ce qui suscite contre elle une vive réaction de l'opinion éclairée et conduit à des projets de réforme et même de suppression du tribunal. Mais l'Inquisition reste encore assez forte pour frapper d'une condamnation exemplaire l'un des représentants les plus audacieux de l'esprit nouveau, l'intendant de Séville, Olavide 1776.
Les dernières années de l'Inquisition espagnole. Après une brève période 1789-1793 où la crainte de la contagion révolutionnaire amena une collaboration entre l'autorité civile et l'Inquisition, les attaques des milieux éclairés reprirent contre le Saint-Office. Sa suppression fut l'une des conséquences de l'intervention napoléonienne en Espagne : supprimée en 1809 par un décret impérial, elle fut abolie d'autre part en 1811 par les Cortès constituantes de Cadix qui défendaient la cause de l'indépendance nationale. Restaurée en 1814 par Ferdinand VII, elle participa activement à la politique de réaction des années 1814-1820, avant d'être à nouveau supprimée par le gouvernement constitutionnel issu du pronunciamiento de Riego (1820). Lorsque Ferdinand VII fut, en 1823, rétabli dans son pouvoir absolu, il n'osa pas remettre en vigueur la juridiction inquisitoriale ; ce ne fut qu'en 1834 que l'Inquisition fut officiellement abolie par le gouvernement de la régente Marie-Christine. Marcelin Defournaux
   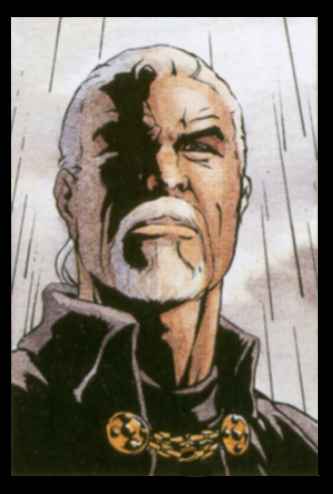       
Posté le : 09/10/2015 21:43
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
64 Personne(s) en ligne ( 34 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 64
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages