|
|
Page du 7 Juillet, Jeanne d'arc, Marc Chagall, Conan Doyle, Gustav Malher |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Posté le : 14/07/2013 15:00
|
|
|
|
|
Mazarin |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 Juillet 1602 naquit Jules Mazarin
De son nom de naissance, Giulio Mazzarino, Mazarini, ou Mazzarini,
nom qu'il il francisa pendant son ministère en France en écrivant simplement "Mazarin", malgré tout il signera encore Mazarini, à l'italienne, à la fin de sa vie, au bas du Traité des PyrénéeS.
Il est né dans une famille modeste, à Pescina, dans les Abruzzes devenue aujourd'hui une province Italienne.
Mieux connu sous le nom de cardinal Mazarin, il fut un diplomate et homme politique, dans un premier temps, il fut au service de la Papauté, puis il servit les rois de France Louis XIII et Louis XIV, succédant à Richelieu en tant que principal ministre de 1643 à 1661.
Il passa son enfance à Rome où ses parents demeuraient. Son père, Pietro Mazzarini, avait coutume d'aller de temps en temps chez son beau-frère, l'abbé Buffalini, lequel convia son épouse Hortensia, enceinte, à venir passer les dernières semaines de sa grossesse loin des miasmes de l'été romain.
Elle accoucha ainsi de son premier fils qui naquit coiffé et doté de deux dents.
On pensait alors que de tels signes présageaient d'une haute fortune. Plus tard, le cardinal s'en prévalait souvent.
La famille Mazzarini était d'origine génoise. Le grand-père de Mazarin, Giulio, partit s'installer en Sicile et s'établit en tant que simple citoyen palermitain, non noble. L'oncle Hieronimo et le père du cardinal, Pietro Mazzarini, eux, naquirent en Sicile. La relative réussite de la famille dans l'artisanat ou le commerce, les sources sont imprécises, permit d'envoyer les fils à l'école.
À quatorze ans, le fils de Pietro fut envoyé à Rome afin de terminer ses études, muni de lettres de recommandation pour Filippo Colonna, connétable du Royaume de Naples.
Mazarin fut d'ailleurs toujours reconnaissant envers la famille Colonna, répétant toujours que sa fortune lui était venue de la faveur de cette maison.
Fort de ses recommandations, son père sollicita en effet un emploi. Pietro plut au connétable, mais les fonctions qu'il exerça au départ pour ce dernier sont inconnues.
Sans doute lui confia-t-il la gestion de certains de ses domaines. Par sa conduite habile et prudente, Pietro se vit proposer par son maître de réaliser un beau mariage avec Hortensia Buffalini, filleule du connétable, appartenant à une famille noble mais désargentée de Città di Castello en Ombrie. La jeune fille avait une réputation de beauté et de vertu. Le couple eut deux fils et quatre filles.
Sa famille d'origine
Pietro Mazzarini Palerme, 1576 - Rome, 13 novembre 1654.
En 1600 il épouse Hortensia Buffalini . Sept enfants suivent.
Le 1er janvier 1645 il épouse Portia Orsini. Sans postérité.
Enfants du premier lit :
1. Geronima, née à Rome le 11 janvier 1601 et morte dans l'été qui a suivi.
2. Giulio, né à Pescina le 14 juillet 1602. Cardinal. Mort à Vincennes le 9 mars 1661.
3. Alessandro, baptisé à Pescina le 1er septembre 1605.
En religion, Michele Mazzarini, dominicain, cardinal de Sainte-Cécile. Mort à Rome le 31 août 1648.
4. Margarita Rome, 14 octobre 1606 - Rome, 1687. épouse le 16 juillet 1634 Geronimo Martinozzi mort en septembre 1639, fils du comte Vicenzo Martinozzi mort le 1er octobre 1646. Dont 2 filles :
Laure Martinozzi Rome, début 1636 - Rome, 1687. épouse en 1655 Alphonse IV, duc de Modène, 1634-1662. Deux de leurs enfants survécurent :
un fils, François II, duc de Modène 1660-1694,
une fille, Marie Béatrice 1658-1718, épouse en 1672 Jacques II, roi d'Angleterre.
Anne-Marie Martinozzi Rome, 1637-Paris, 1672, épouse en 1654 Armand de Bourbon, prince de Conti 1629-1666. d'où deux fils.
5. Anna-Maria (d'abord nommée Geronima en souvenir de la petite morte), née à Rome le 14 janvier 1608. Morte en 1669. Religieuse.
6. Cléria, Rome le 10 avril 1609 baptisée le 13 avril- vers le 12 juillet 1649, épouse en avril 1643 Pietro Antonio Muti, fils du marquis Fabrizio Muti. Sans postérité.
7. Geronima Mazzarini, dite Girolama, Rome, 29 décembre 1614 baptisée le 2 janvier 1614- Paris le 29 décembre 1656 épouse le 6 août 1634 le baron Lorenzo Mancini mort en octobre 1650. Neuf enfants :
Vittoria, dite Laure Mancini Rome, 1635 - Paris, 8 février 1657, épouse en 1651 Louis II de Vendôme, duc de Mercœur 1612-1668. Trois fils.
Paolo, dit Paul Mancini 1637 - Paris, 18 juillet 1652.
Olympe Mancini Rome, 1638 - Bruxelles, 9 octobre 1708, épouse le 20 février 1657 Eugène-Maurice de Savoie-Carignan, comte de Soissons 1635 - 1673. Entre autres enfants, deux fils :
Louis-Thomas de Savoie-Carignan, 4e comte de Soissons, né le 1er août 1657 - Landau, 14 août 1702.
Eugène de Savoie-Carignan, 1663 - 1736, capitaine et diplomate au service de l'Autriche.
Marie Mancini Rome, 28 août 1639 - Madrid, 1715, épouse en 1661 Lorenzo Onofrio Colonna, connétable de Naples 1636 - 15 avril 1689). Trois fils.
Philippe Mancini 26 mai 1641 - Rome, 8 mai 1707, duc de Nevers. épouse le 15 décembre 1670 Diane-Gabrielle de Damas-Thianges, nièce de Madame de Montespan. Deux fils et deux filles.
Alphonse Mancini Rome, 1644 - Paris, 5 janvier 1658.
Hortense Mancini Rome, 6 juin 1646 - Chelsea, Angleterre, 1699, épouse le 28 février 1661 Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye, puis duc de Mazarin, duc de Mayenne 1632 - 9 novembre 1713. Trois filles et un fils.
Une fillette, en 1647, qui meurt à l'âge de deux ans.
Marie Anne Mancini Rome, 1649 - 1715. épouse en 1662 Godefroy Maurice de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon et neveu de Turenne. Dix enfants.
Une enfance d’élève brillant
Bien qu’elle demeure peu documentée, l’enfance de Mazarin laisse déjà deviner un garçon doué, remarqué dès son plus jeune âge pour son habileté à séduire et son aisance intellectuelle. C’est là ce qui fera tout au long de sa jeunesse la force du futur cardinal : une étonnante capacité à plaire et à savoir se rendre indispensable.
À sept ans, le petit prodige entra au Collège romain tenu par les Jésuites. Élève brillant, il eut à soutenir sa thèse de fin d’études sur la comète qui provoqua tant de polémiques en 1618 sur l’incorruptibilité des cieux et conduisit Galilée à publier le célèbre Saggiatore, L'Essayeur. Mazarin sut manifestement éviter les nombreux pièges que le sujet comportait et obtint l’approbation unanime du jury.
Mazarin grandit avec les enfants de la Famille Colonna ce qui lui permit, sans qu’il en fasse partie, de fréquenter le grand monde et ses palais. Il semble que dès son adolescence, Giulio a développé une passion pour le jeu qui ne l’a jamais quitté. Sans doute ce vice lui offrit d’abord un moyen de gagner ce que l’on appellerait aujourd’hui de l’« argent de poche ».
Il est établi que le futur cardinal passa trois ans en Espagne de 1619 à 1621 ? pour accompagner Jérôme-Girolamo Colonna qui sera nommé cardinal le 30 août 1627 par Urbain VIII et qu'il y termina ses études de droit civil et canon à l'université d'Alcalá de Henares. De cette expérience, Mazarin tira une maîtrise parfaite de l’espagnol qui devait s’avérer très utile tout au long de sa carrière. Les légendes sont nombreuses quant à la vie du jeune homme en Espagne. Une chose est certaine, il dut rentrer en Italie car son père, accusé de meurtre, avait été contraint de se tenir à l’écart de Rome pendant quelque temps. Cet épisode fit basculer Mazarin dans le monde des adultes : il était à présent tenu de soutenir sa famille. Il s’engagea alors dans des études de droit canon, qu’il termina en avril 1628, renonçant à une carrière artistique pour laquelle il présentait pourtant des dispositions. Comme la plupart des jeunes Romains, il s’engagea ensuite au service du pape et devint secrétaire du nonce apostolique à Milan, voie qui lui offrait les meilleures perspectives.
Au service du Pape
Durant la guerre de Trente Ans, un conflit opposa la France à l’Espagne au sujet de la vallée de la Valteline dans les Grisons. Le pape Urbain VIII envoya des troupes en tant que force d’interposition. Mazarin se vit offrir une commission de capitaine d’infanterie au sein du régiment équipé par la famille Colonna.
Il fit, avec sa compagnie, quelques séjours à Lorette et à Ancône. Sans jamais avoir à mener de combat, il montra dans l'exercice de ses fonctions, et notamment dans la gestion des troupes et des vivres, la supériorité de son esprit et un grand talent pour discipliner les soldats.
Il se fit alors remarquer par le commissaire apostolique Jean-François Sacchetti. Le Traité de Monzón en 1626 régla temporairement la situation sans que les troupes du Pape ne soient intervenues.
En 1627 éclata en Italie du nord le conflit appelé guerre de succession de Mantoue. Il opposait d'une part, l'empereur Ferdinand II, le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier et la maison des Gonzague de Guastalla, représentée par Ferdinand II de Guastalla, candidat des Habsbourg au duché et, d'autre part, le roi de France Louis XIII venu secourir Charles Gonzague, duc de Nevers, candidat français à l'héritage de la branche aînée des Gonzague. Une légation papale fut envoyée à Milan afin d'apaiser le conflit qui menaçait de dégénérer.
Elle fut conduite par Jean-François Sacchetti, en tant que nonce extraordinaire. Mazarin l'accompagna en qualité de secrétaire.
La légation arriva trop tard et surtout Sacchetti dut rentrer rapidement à Rome. Une autre légation fut programmée, dirigée cette fois par le neveu du pape Urbain VIII, Antonio Barberini, mais elle tarda à se mettre en place. Ce fut la chance de Mazarin qui resta à Milan et continua le travail entrepris, sachant parallèlement provoquer en sa faveur une réelle campagne de publicité à Rome, relayée par sa famille, les Sacchetti et les Colonna. Il bombarda le Saint-Siège de rapports, espérant attirer la bienveillance papale. En préparation de l'arrivée de la nouvelle légation, Mazarin fut finalement chargé en septembre 1629 de sonder les vues des parties prenantes. Il faisait son entrée officielle dans la diplomatie.
Lorsque le légat pontifical arriva dans le Montferrat, pour traiter de la paix entre la France et l'Espagne, Giulio resta attaché à la légation au titre de secrétaire. Le légat apostolique négociait la paix avec grand zèle. Mazarin, comme secrétaire, allait d'un camp à l'autre, pour hâter la conclusion d'un traité. Le jeune homme avait l'avantage d'avoir pris la mesure des évolutions en Europe : le rêve papal d'un retour à l'unité de l'Église n'aboutirait pas et la paix en Europe ne pourrait reposer que sur un équilibre des puissances.
À court terme, il ne mit pas longtemps à s'apercevoir que le marquis de Santa-Cruz, qui représentait la couronne d'Espagne, avait une peur violente de perdre son armée, et un ardent désir d'arriver à un accommodement.
Comprenant tout le parti qu'il pouvait tirer de cette faiblesse, il pressa le général espagnol, lui représentant avec exagération la force des Français. Pour éviter les conflits, Mazarin lança son cheval au galop entre les deux armées, et agitant son chapeau, criait « Pace ! Pace ! ».
Cette intervention empêcha la bataille. Après le « coup » de Casale, en octobre 1630, la tâche du diplomate pontifical qu'est devenu Mazarin consiste à faire respecter les trêves conclues entre Espagnols, Impériaux, Français et Savoyards, puis à jeter les bases d'un traité de paix, spécialement entre Louis XIII et son beau-frère de Turin.
Les négociations de Mazarin comme ambassadeur extraordinaire en Savoie d'Abel Servien aboutirent le 6 avril 1631 au traité de Cherasco par lequel l'empereur et le duc de Savoie reconnaissaient la possession de Mantoue et d'une partie du Montferrat à Charles Gonzague et surtout l'occupation française de la place forte de Pignerol, porte de la vallée du Pô. Elles apportèrent à Louis XIII et au cardinal de Richelieu une telle satisfaction que celui-ci en regarda l'auteur comme un homme inépuisable en ressources, fécond en ruses et stratagèmes militaires et qu'il en conçut le vif désir de le connaître personnellement.
Il le manda à Paris, où Mazarin se rendit avec un plaisir inexprimable. Richelieu l'accueillit avec de grandes démonstrations d'affection, l'engagea par les plus belles promesses, et lui fit donner une chaîne d'or avec le portrait de Louis XIII, des bijoux et une épée d'une valeur considérable.
Ses premiers contacts avec la France
Il est d’abord vice-légat d'Avignon en 1634, puis nonce à Paris de 1634 à 1636), où il déplut par ses sympathies pour l'Espagne, ce qui le fit renvoyer à Avignon en 1636 et l'empêcha, malgré les efforts de Richelieu, de devenir cardinal.
Richelieu, se sentant accablé par l'âge, bien qu'il fût infatigable au travail, pensa que Mazarin pouvait être l'homme qu'il cherchait pour l'aider au gouvernement.
Dès son retour en France après un bref voyage à Rome, il retint Mazarin près de lui et lui confia plusieurs missions dont il s'acquitta fort honorablement, puis il le présenta au roi qui l'aima beaucoup. Mazarin s'établit alors dans le palais royal.
Toujours très habile au jeu, un jour qu'il gagnait beaucoup, on accourut en foule pour voir la masse d'or qu'il avait amassée devant lui.
La reine elle-même ne tarda pas à paraître.
Mazarin risqua tout et gagna. Il attribua son succès à la présence de la reine et, pour la remercier, lui offrit cinquante mille écus d'or et donna le reste aux dames de la cour. La reine refusa d'abord, puis finit par accepter, mais quelques jours après, Mazarin reçut beaucoup plus qu'il n'avait donné.
Mazarin envoya à son père, à Rome, une grosse somme d'argent et une cassette de bijoux pour doter ses trois sœurs et s'affermit dans l'idée de servir la Couronne, dont la faveur, pensait-il, était le plus sûr moyen d'obtenir la pourpre, car seul moyen pour lui étant sans naissance d'accéder aux responsabilités auxquelles il aspirait.
Mais Richelieu, qui l'estimait beaucoup et le jugeait digne du chapeau de cardinal, n'avait pas hâte de le combler.
Un jour, il lui offrit un évêché avec trente mille écus de rente.
Mazarin, craignant de se voir enterré loin de Paris et des affaires, ne voulut pas courir le risque d'arrêter là sa fortune et refusa aimablement.
Il attendit encore longtemps puis, las d'attendre, rentra en Italie en 1636, pensant qu'à Rome, au service du cardinal Antonio Barberini, neveu du pape, il serait plus en mesure d'avoir la pourpre.
La carrière de Mazarin fut donc d'abord romaine et, même s'il devint ensuite un serviteur incontestablement fidèle de la monarchie française, il conserva des goûts et un style de vie romains et son habileté diplomatique doit beaucoup à la formation qu'il avait reçue à la cour pontificale.
Mazarin fut un pur produit de la Rome baroque dont la culture et le décor s'éloignaient de la raideur dogmatique et artistique des deux grands papes de la Contre-Réforme que furent dans la seconde moitié du XVIe siècle pie V et Sixte Quint.
À partir de 1623 et pendant seize ans la carrière de Mazarin se déroula essentiellement au service de la diplomatie pontificale, en particulier comme négociateur dans la difficile succession de Mantoue et comme nonce à Paris.
Ces missions le mirent en rapport dès 1630 avec Richelieu et Louis XIII qui apprécièrent son charme, son intelligence son habileté, sa puissance de travail et la générosité de ses cadeaux.
Richelieu, grand collectionneur, le mit de plus en plus à contribution pour réaliser en Italie des acquisitions d'antiques et autres œuvres d'art destinées à son palais parisien et à son château du Poitou. Lorsque, en 1639, Mazarin, appelé par Louis XIII et Richelieu, quitta définitivement Rome pour la France, il fit embarquer " 50 statues antiques de marbre et d'autres gentillesses... pour les donner à Sa Majesté Chrétienne, au Seigneur cardinal de Richelieu et aux autres grands de cette cour ".
Ministre en France
En avril 1639, naturalisé français, il retourne à Paris et se met à la disposition de Richelieu. En décembre 1640, il fait un heureux début en gagnant à la cause française les princes de Savoie ; un an plus tard, le pape lui accordait le chapeau de cardinal.
Lors de la conspiration de Cinq-Mars et du duc de Bouillon, celui-ci n'obtint sa grâce qu'en livrant la Principauté de Sedan ; Mazarin signa la convention et vint occuper Sedan.
Le 5 décembre 1642, lendemain de la mort de Richelieu, Mazarin fut nommé Principal Ministre de l'État, comme l'avait recommandé Richelieu qui voyait en lui son digne successeur.
Louis XIII le choisit comme parrain du dauphin, futur Louis XIV.
Après la mort de Louis XIII, il créa la surprise en obtenant le soutien de la régente. Longtemps opposée à Richelieu et estimée comme favorable à un rapprochement avec l'Espagne, étant elle-même espagnole, Anne d'Autriche fait volte-face à la surprise de la plupart des observateurs de l'époque.
En réalité, le rapprochement entre Mazarin et la régente fut antérieur à la mort de Louis XIII et de son principal ministre. Le souci de préservation de la souveraineté de son fils et la conscience des dommages qu'aurait causés pour celle-ci un rapprochement avec Madrid, furent des arguments de poids dans sa décision de poursuivre la politique du feu roi et du cardinal de Richelieu – et donc d'appuyer Mazarin.
Les inestimables compétences de ce dernier en politique extérieure furent un prétexte pour justifier ce soutien. Mazarin sut par la suite très vite se rendre indispensable à la régente, se chargeant habilement de compléter son éducation politique et l'incitant à se décharger entièrement sur lui du poids des affaires.
Ainsi, à partir de 1643, à la mort de Louis XIII, alors que Louis XIV n'est encore qu'un enfant, la régente Anne d'Autriche nomme Mazarin Premier Ministre.
En mars 1646, il devient également « surintendant au gouvernement et à la conduite de la personne du roi et de celle de Monsieur le duc d'Anjou ».
À Rome, Mazarin avait vécu jusque-là dans l'entourage des cardinaux-neveux successifs, à la fois ministres des papes et grands amateurs d'oeuvres d'art. L'un d'eux, Antonio Baberini, fut son principal padrone romain.
Son exemple l'a certainement marqué. Avant même d'être promu cardinal mais déjà au service de la France Mazarin acheta à Rome le prestigieux palais Bentivoglio qui aurait pu lui servir de lieu de repli en Italie en cas de nécessité mais où, en fait, il n' a pas vécu, conservant toutefois d' étroites relations avec la ville des papes où il avait des agents et son père.
Un de ses proches lui écrivait lors de cet achat : " Ce palais est le plus beau de Rome ; mais, à vrai dire, plus celui d'un grand cardinal que celui d'un prélat ". À quoi Mazarin répondit : " servant un grand roi et jouissant de la protection de Son Eminence le cardinal-duc (de Richelieu), je crois ne pas devoir entreprendre des choses ordinaires ". En fait Mazarin, qui reçut en 1639 des " lettres de naturalité " françaises, espérait certainement devenir bientôt cardinal. Ce qui effectivement advint dès 1641 sur proposition de Richelieu. Or en 1630 Urbain VIII Barberini avait octroyé aux cardinaux le titre d'" éminentissimes " qui faisait d'eux sur le plan protocolaire des princes de l'Église et les égaux des rois ou chefs de gouvernement. Être cardinal constituait donc une promotion considérable, même pour un ministre et, le cas échéant, une brillante position de repli: Un cardinal était quasiment intouchable. C'est pourquoi les ennemis de Mazarin, au temps de la Fronde, demandèrent au Pape de l'appeler à Rome, de lui faire un procès et de le priver de son cardinalat. Si cette procédure avait abouti, Mazarin ne s' en serait sans doute pas relevé.
À l'époque il n'était pas nécessaire d'être prêtre pour devenir cardinal.
Mazarin reçut seulement la tonsure en 1632, ce qui faisait de lui un " clerc " et lui permettait de se faire conférer des bénéfices ecclésiastiques.
Peu après Urbain VIII le fit prélat dit "monsignore" avec obligation de porter la soutane et l'intégra au collège des " protonotaires apostoliques ".
Ceux-ci avaient peu d'obligations mais, dans les cérémonies romaines, ils venaient à égalité avec les évêques.
Cardinal en 1641, Mazarin, bénéficiant de dispenses constamment, mais souvent tardivement renouvelées, n'effectua pas la visite ad limina, ne reçut jamais les ordres même mineurs, ni l'anneau de cardinal, ni le chapeau, ne prit jamais possession de son titulus, le vieux sanctuaire de Rome affecté à chaque cardinal.
Le pape dut lui envoyer la " barrette rouge " que Louis XIII lui remit solennellement le 26 février 1642 dans la cathédrale de Valence.
Mazarin ne s'est donc habillé de pourpre qu'à partir de quarante ans et il aurait pu, comme d'autres le firent en son temps, renoncer au cardinalat pour se marier.
En revanche son frère Michele, dominicain, lui aussi cardinal, était prêtre et fut archevêque d'Aix-en-Provence.
En résumé, Mazarin fut au service de la diplomatie papale jusqu'en 1639.
Il resta ensuite " romain " aux yeux de l' administration pontificale. Mais ses " lettres de naturalité " donnaient à cet étranger le droit de posséder, d'acquérir et de léguer des biens et des revenus en France, y compris des bénéfices ecclésiastiques.
La première abbaye que Mazarin reçut en commende fut celle de Saint Médard de Soissons.
En un temps où l'Église et l'État, dans le système de chrétienté , étaient imbriqués l'une dans l'autre Mazarin, premier ministre du roi de France, eut évidemment à prendre des décisions ayant des incidences religieuses.
On peut globalement affirmer que, dans ce type de difficultés, son souci majeur fut celui de l'autorité royale et de la tranquillité de l'État et que son statut d'homme d'Église ne fut jamais sa première considération, soit dans la politique extérieure, soit dans les affaires intérieures.
S'agissant de la première, il continua l'action de Richelieu et, durant la guerre de Trente ans, cette série de conflits européens, puis dans le conflit avec l'Espagne, au grand dam du parti dévot en France, il maintint les alliances protestantes, s'entendant même avec le régicide Cromwell pour mettre un terme à la guerre contre l'Espagne : ce qui scandalisa beaucoup de catholiques.
Mazarin et le protestantisme
Dans les négociations qui conduisirent aux traités de Westphalie il considéra Innocent X Pamphili, il est vrai pro-espagnol et qu' il détestait, comme quantité négligeable, imposa le français comme langue diplomatique à la place du latin et fit triompher un statut de l'empire qui consacrait la consolidation du protestantisme en Allemagne, le calvinisme y étant, en outre, reconnu désormais officiellement à côté du luthéranisme.
Le pape protesta en vain.
Comme son maître Richelieu qui, lui, était évêque, Mazarin fit donc passer ce qui lui paraissait l'intérêt de la France avant celui du catholicisme.
De même, à l'intérieur, son attitude dans les questions religieuses fut essentiellement dictée par la volonté de faire respecter le pouvoir royal.
Dans la mesure où les protestants, vaincus militairement depuis la Paix d'Alès (l629), faisaient désormais preuve de fidélité envers le roi, il ne chercha pas à les faire rentrer dans le giron de l'Église romaine.
En 1643 et, encore en 1652 en pleine Fronde, il fit renouveler l'Édit de Nantes par déclarations royales.
Dans celle de 1652 on pouvait lire : " nos sujets de la Religion Prétendue Réformée nous ont donné des preuves de leur fidélité, notamment dans les circonstances présentes, dont nous demeurons très satisfait ".
Sept ans plus tard, au moment du synode réformé de Loudun, Mazarin écrivit aux délégués : " Je vous prie de croire que j'ai une grande estime pour vous, étant de si bons et si fidèles serviteurs du roi ".
Quelles qu'en fussent les raisons, guerre à l'extérieur, troubles à l'intérieur, relative indifférence personnelle, Mazarin resta sourd aux demandes de l'assemblée du clergé de France qui, en 1651, avait suggéré une tactique au gouvernement pour que " ce mal " le protestantisme ne fasse pas de progrès : si le roi ne peut " l'étouffer tout d'un coup ", qu'il le rende " languissant " et le fasse " périr peu à peu par le retranchement et la diminution de ses forces ".
Mazarin fit de Bartélemy Hervart, homme d'affaires depuis longtemps en relation avec lui, un contrôleur général des finances. Or Hervart était protestant et refusa d'abjurer.
Toutefois certains indices conduisent à se demander si, à la fin de son gouvernement, Mazarin, désormais assuré de la paix intérieure et extérieure, ne songeait pas à une application plus rigoureuse de l'édit de Nantes.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas au protestantisme que Mazarin se heurta, mais au jansénisme. Il n'avait, certes, aucun penchant personnel pour le rigorisme, notamment celui des jansénistes.
D'autre part, il ne semble pas avoir eu le goût des discussions théologiques. Quand il qualifia le jansénisme de " calvinisme rebouilli ", il ne retenait que la doctrine de la prédestination sans voir que les jansénistes maintenaient les sept sacrements, les rites et la hiérarchie de l'Église romaine.
Mazarin et le jansénisme
Mais Mazarin, politiquement, rencontra le jansénisme sur sa route, Car il lui parut plus ou moins lié aux cercles frondeurs, donc dangereux pour la paix publique et l'autorité du roi.
Aussi bien Richelieu avait-il fait emprisonner Saint-Cyran, ami de Jansénius et de la famille Arnauld et favorable à une politique extérieure pro-espagnole. Mazarin libéra Saint-Cyran qui mourut bientôt.
Mais, durant les Frondes successives, Mazarin dut constater que, si les défenseurs déclarés de l'Augustinus n'étaient pas eux mêmes frondeurs, leurs amis l'étaient, à commencer par son ennemi personnel, Paul de Gondi, bientôt cardinal de Retz.
Mazarin rangea donc les jansénistes parmi les contestataires de l'autorité royale.
Mais il avait une autre raison de les combattre.
A une époque où ses relations avec Rome étaient détestables en raison de la continuation de la guerre avec la catholique Espagne il trouvait dans le conflit doctrinal avec les jansénistes une occasion de faire une bonne manière au pape et de diminuer ses rancoeurs à l'égard de la politique française.
Aussi appuya-t-il la demande du syndic de la Sorbonne et de 93 évêques français qui, en 1651, souhaitèrent voir Rome se prononcer sur cinq propositions tirées de l'Augustinus et, à leurs yeux , suspectes d'hérésie. Mazarin fut ravi de voir ces propositions condamnées par la bulle cum occasione de 1653 et il fit immédiatement le nécessaire pour que la bulle fût reçue en France.
À quoi les jansénistes répondirent par la distinction du droit et du fait : les cinq propositions sont bien hérétiques, mais, dirent-ils, nous ne les trouvons pas dans le livre de Jansénius.
D'où l'idée de faire signer aux prêtres, religieux et religieuses et même aux enseignants laïcs un " formulaire " d'obéissance aux décisions romaines sur les cinq propositions.
Mazarin réunit en 1655 une quinzaine d'évêques qui proposèrent ce formulaire, lequel fut approuvé par l'assemblée du clergé de France en 1656 et par le pape l'année suivante.
Il est vrai qu'il ne fut vraiment exigé qu'après la mort de Mazarin qui, sans doute impressionné par le succès des Provinciales, semble avoir pris du champ par rapport au problème janséniste dans les dernières années de sa vie. Mais, auparavant, il avait tout de même contribué à poser une bombe à retardement dans ce conflit religieux.
L'attitude de Mazarin face au jansénisme est à rapprocher de sa défiance à l'égard de la Compagnie du Saint-Sacrement. Créée vers 1630 par le duc de Ventadour, celle-ci voulait promouvoir le culte de l'eucharistie, suivre les consignes du concile de Trente, secourir les pauvres, lutter contre la prostitution et toutes les formes d'immoralité. Saint Vincent de Paul, saint jean eudes, Bossuet notamment en firent partie.
Mais, " pour se conformer à la vie cachée de Jésus-Christ au Très-Saint Sacrement " et pour fuir tout amour propre la société voulait rester secrète. En outre, elle était surtout composée de laïcs, plus difficiles à contrôler que des ecclésiastiques.
Vers 1660 elle émit des critiques sur le style de vie de Mazarin. Celui-ci fit prendre par le Parlement un arrêt qui interdisait toute réunion à Paris sans l'autorisation du roi.
La compagnie disparut définitivement en 1666.
On sait, par ailleurs, que les rapports entre Mazarin et saint-Vincent-de-Paul ne furent pas excellents.
M. Vincent souhaitait, dans l'esprit du concile de Trente, que les candidats aux fonctions ecclésiastiques fussent animés de motivations seulement spirituelles.
Mais, selon le concordat de Bologne de 1516, c'est le roi de France qui choisissait les titulaires de la plupart des évêchés et abbayes du royaume. Richelieu avait créé un " Conseil de conscience " pour s'occuper de l'ensemble des affaires ecclésiastiques et, notamment, des candidatures aux charges épiscopales et abbatiales.
M. Vincent y fut nommé.
Devenu régente, Anne d'Autriche maintint ce conseil auquel participait, bien entendu, Mazarin. Mais le cardinal se méfiait du fondateur des Lazaristes, selon lui, trop lié avec Paul de Gondi et trop écouté d'Anne d'Autriche.
En outre, sa stratégie de nominations ecclésiastiques ne rejoignait pas les idéaux de M. Vincent. Il s'arrangea donc pour réunir de plus en plus rarement le Conseil de conscience, en fait pour en écarter quelqu'un qui venait en travers de ses projets.
C'est ici le lieu de rappeler que Mazarin, imitant Richelieu, accumula un nombre impressionnant de bénéfices ecclésiastiques. On l'a surnommé " le cardinal aux vingt-cinq abbayes ".
Parmi celles-ci figuraient notamment, lors de sa mort, les plus célèbres et les plus riches du royaume : Saint-Denis, Cluny, Saint-Médard de Soissons Moissac, Saint-Etienne de Caen, La Chaise-Dieu, Saint-Germain d'Auxerre, Saint-Honorat de Lérins.
Il s'agit d'un record dans l'histoire de France.
Plusieurs indices conduisent à penser qu'à la fin de sa vie Mazarin songea à devenir prêtre, à un moment où la Paix des Pyrénées avait porté sa gloire au zénith et où il avait réussi à réconcilier les deux grandes puissances catholiques.
Prêtre, il aurait pu se faire élire pape à un prochain conclave. Alexandre VII était en mauvaise santé et Mazarin avait ses chances.
Mais Alexandre VII vécut jusqu'en 1667 et Mazarin, au contraire, mourut dès 1661 à cinquante-neuf ans.
A bien des égards Mazarin est une énigme et tout jugement simpliste sur l'homme paraît anti-historique.
Ainsi, abbé commendataire de Cluny, il essaya réellement mais, il est vrai, sans succès d'y rétablir la discipline monastique.
Sa vie privée a, bien sûr, fait l'objet de " mazarinades ", mais contradictoires entre elles.
Tantôt on l'a accusé en termes orduriers d' être l' amant d' Anne d' Autriche, tantôt au contraire on a raillé sa virilité défaillante.
Les historiens s’interrogent sur la nature exacte des relations de Mazarin et d'Anne d’Autriche. Des lettres échangées depuis son premier exil, utilisant des codes, sont parfois très sentimentales, bien que ce soit le style de l’époque d’écrire avec beaucoup d’emphase.
« Au pis aller, vous n'avez qu'à rejeter la faute du retardement sur ... (qui signifie Anne) , qui est…(illisible) (signe pour Anne) (signe pour Mazarin) jusques au dernier soupir. L'enfant vous mandera toutes choses. Adieu, je n'en puis plus. (signe pour Mazarin) lui sait bien de quoi. »
Leur relation fut en tous cas très étroite. Elle a sans doute été renforcée par leur isolement politique lors de la Fronde. La question de savoir si Mazarin et Anne d'Autriche s'aimèrent est controversée. Certains ont analysé leur correspondance de sorte qu'ils ont cru pouvoir y déceler une liaison (voire un mariage secret), qui reste hypothétique, entre l'homme d'Église et la reine-mère.
De nombreux amants ont été attribués à Anne d'Autriche. Le duc de La Rochefoucauld disait, pendant la Fronde, que Mazarin rappelait sûrement à la reine le duc de Buckingham.
Son éventuelle paternité de Louis XIV, comme des historiens l'ont avancé, est aujourd'hui démentie par l'analyse génétique.
La correspondance de Mazarin
Ces lettres de la reine, nous ne les avons plus la série de 11 lettres autographes qui a subsisté ne commence qu'en 1653, mais on peut juger de leur ton par celui qu'employait Mazarin lui-même.
Lettres à la reine du 11 mai 1651 :
Mon Dieu, que je serais heureux et vous satisfaite si vous pouviez voir mon cœur, ou si je pouvais vous écrire ce qu'il en est, et seulement la moitié des choses que je me suis proposé. Vous n'auriez pas grand-peine, en ce cas, à tomber d'accord que jamais il n'y a eu une amitié approchante à celle que j'ai pour vous.
Je vous avoue que je ne me fusse pu imaginer qu'elle allât jusqu'à m'ôter toute sorte de contentement lorsque j'emploie le temps à autre chose qu'à songer à vous : mais cela est, à tel point qu'il me serait impossible d'agir en quoi qui en pût être, si je ne croyais d'en devoir user ainsi pour votre service.
Je voudrais aussi vous pouvoir exprimer la haine que j'ai contre ces indiscrets qui travaillent sans relâche pour faire que vous m'oubliez et empêcher que nous ne nous voyions plus ...La peine qu'ils nous donnent ne sert qu'à échauffer l'amitié qui ne peut jamais finir.
Je crois la vôtre à toute épreuve et telle que vous me dîtes ; mais j'ai meilleure opinion de la mienne, car elle me reproche à tout moment que je ne vous en donne pas assez de belles marques et me fait penser à des choses étranges pour cela et à des moyens hardis et hors du commun pour vous revoir. Si mon malheur ne reçoit bientôt quelque remède je ne réponds pas d'être sage jusqu'au bout, car cette grande prudence ne s'accorde pas avec une passion telle qu'est la mien
Ah ! que je suis injuste quand je dis que votre affection n'est pas comparable à la mienne ! Je vous en demande pardon et je proteste que vous faites plus pour moi en un moment que je ne saurais faire en cent ans : et si vous saviez à quel point me touchent les choses que vous m'écrivez, vous en retrancheriez quelqu'une par pitié, car je suis inconsolable de recevoir des marques si obligeantes d'une amitié si tendre et constante, et d'être éloigné.
Je songe quelquefois s'il ne serait pas mieux pour mon repos que vous ne m'écrivissiez pas, ou que, le faisant, ce fût froidement ; que vous dissiez que j'ai été bien fou à croire ce que vous m'avez mandé de votre amitié, et enfin que vous ne vous souvenez plus de moi comme si je n'étais au monde. Il me semble qu'un tel procédé, glorieux comme je suis, me guérirait de tant de peines et de l'inquiétude que je souffre et adoucirait le déplaisir de mon éloignement. Mais gardez-vous bien d'en user ainsi ! Je prie Dieu de m'envoyer la mort plutôt qu'un semblable malheur, qui me le donnerait mille fois le jour : et si je ne suis pas capable de recevoir tant de grâces, il est toujours plus agréable de mourir de joie que de douleur"
Voici donc la première lettre autographe connue de la reine à Mazarin ; elle n'est pas datée, mais elle est antérieure à celle du 26 janvier 1653, qui suivra:
Ce dimanche au soir,
Ce porteur m'ayant assuré qu'il ira fort sûrement, je me suis résolue de vous envoyer ces papiers et vous dire que, pour votre retour, que vous me remettez, je n'ai garde de vous en rien mander, puisque vous savez bien que le service du roi m'est bien plus cher que ma propre satisfaction ; mais je ne puis m'empêcher de vous dire que je crois que, quand l'on a de l'amitié, la vue de ceux que l'on aime n'est pas désagréable, quand ce ne serait que pour quelques heures. J'ai bien peur que l'amitié de l'armée ne soit plus grande que toutes les autres. Tout cela ne m'empêchera pas de vous prier d'embrasser de ma part notre ancien ami et de croire que je serai toujours telle que je dois, quoi qu'il arrive.
Le 26 janvier, Mazarin n'étant pas encore revenu, Anne lui écrit :
Je ne sais plus quand je dois attendre votre retour, puisqu'il se présente tous les jours des obstacles pour l'empêcher. Tout ce que je vous puis dire est que je m'en ennuie fort et supporte ce retardement avec beaucoup d'impatience, et si Mazarin savait tout ce que souffre sur ce sujet, je suis assurée qu'il en serait touché. Je le suis si fort en ce moment que je n'ai pas la force d'écrire longtemps ni ne sais pas trop bien ce que je dis. J'ai reçu de vos lettres tous les jours presque, et sans cela je ne sais ce qui arrivera. Continuez à m'en écrire aussi souvent puisque vous me donnez du soulagement en l'état où je suis. J'ai fait ce que vous m'avez mandé touchant[signes indéchiffrables. Au pis aller, vous n'aurez qu'à rejeter la faute du retardement sur elle, qui est un million de fois et jusques au dernier soupir. L'Enfant Ondedeï vous mandera toutes choses. Adieu, je n'en puis plus et lui, Mazarin, sait bien de quoi.
Deux jours plus tard, le 28 janvier, Anne écrit encore à Mazarin.
C'est qu'elle a reçu de lui quelques reproches voilés pour avoir, sur l'instance de Molé, annulé une mesure de bannissement à l'encontre de quatre mauvais esprits du Parlement. Aussi s'excuse-t-elle en ces termes :
Votre lettre, que j'ai reçue du 24, m'a mis bien en peine, puisque elle a fait une chose que vous ne souhaitiez pas ... Suivent de longues explications, après lesquelles la reine conclut : Voilà comme l'affaire s'est passée véritablement et, si elle vous a déplu, vous pouvez croire que ce n'a pas été nullement à ce dessein-là, puisque elle n'a ni n'est capable d'en avoir d'autres que ce que lui et lui témoigner qu'il n'y a rien au monde pareil à l'amitié que elle a pour, et elle ne sera point en repos qu'il ne sache que n'a pas trouvé mauvais ce qu'il a fait, puisque non seulement, en effet, il ne voudrait pas lui déplaire, même seulement de la pensée, qui n'est employée guère à autre chose qu'à songer à la chose du monde qui est la plus chère à qui est. J'en dirais davantage si je ne craignais de vous importuner par une si longue lettre et, quoique je sois bien aise de vous écrire, je m'ennuie si fort que cela dure que je voudrais fort vous entretenir autrement. Je ne dis rien là-dessus, car j'aurais peur de ne pas parler trop raisonnablement sur ce sujet."
Sur le sujet de la vie privée de Mazarin la modération du cardinal de Retz peut surprendre. Il semble pencher pour l'opinion de Mme de Chevreuse qui jugeait qu'il n'y avait entre le cardinal et Anne d'Autriche qu'une " liaison intime d'esprits ".
La note dominante des " mazarinades " est autre.
Elle porte sur la " tyrannie " exercée par un étranger " lâche, ingrat, perfide et voleur ", " perturbateur du repos public " et " infracteur des lois ". Selon Paul de Gondi " il porta le filoutage dans le ministère ".
Il ajoute que " le fort de M. le cardinal Mazarin était proprement de ravauder, de donner à entendre, de faire espérer ; de jeter des lueurs (et) de les retirer ; de donner des vues et de les brouiller ", autrement dit, de promettre sans tenir ses promesses.
Toujours selon le cardinal de Retz Mazarin " se moqua de la religion ". Lourde accusation.
Ce que l'on peut constater avec plus de retenue est que le grief de " machiavélisme " vint sous la plume de ses détracteurs.
Ce terme péjoratif, apparu en français à la fin du XVIe siècle aussi bien sous des plumes protestantes que sous des plumes catholiques, signifiait le cynisme politique plaçant la raison d'État avant la morale chrétienne. Le parti pro-espagnol l'utilisa contre Richelieu et Mazarin.
En France, l'un des principaux défenseurs du comportement machiavélique fut Gabriel Naudé, auteur en 1639 de Considérations politiques sur les coups d'État.
Dans ce livre Naudé affirmait que ce qu' interdit la justice " naturelle, universelle, noble et philosophique " est parfois requis pour le bien de l'Etat.
Or Naudé était l'un des proches de Mazarin et son bibliothécaire. En outre Mazarin, que Louis XIII avait choisi comme parrain de son fils, désigna parmi le précepteurs du jeune Louis XIV Naudé et La Mothe Le Vayer qui, l'un et l'autre, appartenaient au cercle des " libertins érudits ".
Les Mazarinades
Cyrano de Bergerac d'abord contre Mazarin, puis en sa faveur
Les mazarinades, feuilles d'informations de quelques pages et de toutes origines (celles qu'inspira Condé sont parmi les plus audacieuses contre la monarchie), parfois pamphlets grossiers et creux, mais aussi parfois savants et ironiques (le cardinal de Retz en écrivit quelques-uns), l'attaquèrent très souvent sous cet angle, fustigeant le « voleur de Sicile ».
Quelques titres de Mazarinades parmi plus de 5 000 autres :
La gueuserie de la Cour ;
La Champagne désolée par l'armée d'Erlach ;
Plainte du poète champêtre ;
Mémoires des besoins de la campagne ;
Plainte publique sur l'interruption du commerce ;
Le dérèglement de l'État ;
Le manifeste des Bourdelois ;
Dialogue de Jodelet et de Lorviétan sur les affaires du temps ;
Que la voix du peuple est la voix de Dieu.
On n'a donc pas fini de se poser la question de la religion de Mazarin, un dossier rempli d'éléments contradictoires entre eux. Car l' iconographie religieuse prédominait dans sa riche collection de tableaux.
Mais elle était minoritaire dans les sculptures, les tapisseries et l'orfèvrerie. Les " nudités " de certaines oeuvres exposées chez lui choquèrent certains frondeurs et, plus encore, son légataire universel le duc Mazarin, qui, en 1670, animé d'une sainte fureur et armé d'un marteau, en fit un massacre.
Mais on aurait pu agir pareillement dans le palais romain des cardinaux Farnèse au début du XVIIe siècle.
Nicolas Fouquet
Au long de sa carrière de Premier Ministre, Mazarin s’enrichit. À sa mort, il dispose d'environ trente-cinq millions de livres. Cela lui procura une grande souplesse financière, qui se révéla vite indispensable pour remplir ses objectifs politiques.
Progressivement Mazarin abandonne la gestion de sa fortune personnelle à Nicolas Fouquet et Jean-Baptiste Colbert, issu de la clientèle de Michel Le Tellier et qui venait d'épouser une Charron, cent mille livres de dot. Ils sont les véritables artisans de la démesure de sa fortune après la Fronde.
Bien que les sommes en question, en raison de la virtuosité du concerné et de ses aides, Fouquet et Colbert, dépassent de loin tout ce qui pouvait se voir à cette époque, il est nécessaire de relativiser le caractère exceptionnel de telles pratiques financières.
Mazarin, aussi peu populaire chez les nobles dont il sapait l'autorité que chez le peuple dont il prolongeait les souffrances issues de la guerre, souffrit d'une large hypocrisie sur ce point.
Postérieurement à la Fronde, période où il put mesurer toute la fragilité de sa position, Mazarin n’eut de cesse de consolider sa position. N'ayant aucun quartier de noblesse, son pouvoir était assujetti au bon vouloir d’une régente disposant elle-même d’un pouvoir contesté.
Seule sa dignité de cardinal d’ailleurs révocable lui permettait de prétendre aux fonctions qu'il occupait. Sans une situation financière solide, une disgrâce aurait tôt fait de le descendre au bas de l’échelle sociale. Ce point explique en partie l’acharnement de Mazarin à s’enrichir de manière exponentielle.
Malgré les succès militaires et diplomatiques mettant enfin un terme à la guerre de Trente Ans (traité de Westphalie-1648), les difficultés financières s'aggravèrent, rendant les lourdes mesures fiscales de Mazarin de plus en plus impopulaires. Ce fut l'une d'elles qui déclencha la première Fronde, la Fronde Parlementaire de 1648.
Paris est assiégée par l'armée royale, qui ravage les villages de la région parisienne : pillages, incendies, viols… N'obtenant pas la soumission de la capitale, les partis concluent la paix de Saint-Germain (1er avril 1649). Ce ne fut qu'un répit.
La Fronde des princes qui dura de 1650 à 1652 lui succéda, déclenchée par l'arrestation de Condé avide de récompenses, défiant ainsi la primauté naissante et fragile de l'autorité royale promue par Mazarin.
Ce dernier fut obligé de s'exiler à deux reprises en 1651 et 1652, tout en continuant de gouverner par l'intermédiaire d'Anne d'Autriche et de fidèles collaborateurs comme Hugues de Lionne et Michel Le Tellier.
La région parisienne fut à nouveau ravagée, par les armées et par une épidémie de typhoïde répandue par les soldats, lors d'un été torride qui entraîna au moins 20 % de pertes dans la population.
Son épuisement facilita le retour du roi, acclamé dans un Paris soumis, puis bientôt, celui de Mazarin.
Les critiques contre Mazarin concernaient en partie son origine italienne et roturière, mais surtout le renforcement de l'autorité royale, condition nécessaire à la mise en place d'un état moderne, au détriment des grands du royaume.
La guerre contre l'Espagne, mal comprise et mal acceptée par l'opinion publique, entraîna une formidable et impopulaire augmentation des impôts.
Ayant brisé toutes les oppositions, dirigeant le pays en véritable monarque absolu, il est resté premier ministre jusqu’à sa mort au château de Vincennes, le 9 mars 1661 des suites d'une longue maladie.
Deux jours avant sa mort, il fait appeler les trois ministres du Conseil, Michel Le Tellier, Nicolas Fouquet et Hugues de Lionne, et les recommande chaudement au roi.
Mais le lendemain, veille de sa mort, sur les conseils de Colbert, il revient sur ses propos concernant Fouquet jugé trop ambitieux et conseille au roi de s'en méfier et de choisir Colbert comme Intendant des finances.
Sur les derniers jours de Mazarin nous possédons un récit précieux qui dormait dans les archives de Rome et qui n'a été redécouvert qu'en 1955.
Il fut rédigé par un théatin italien vivant à Paris, le P.Bissaro, en qui Mazarin avait toute confiance.
Ce récit n'était pas destiné à la publication.
Il a été révélé par Raymond Darricau et Madeleine Laurain-Portemer.
Le P. Bissaro déclare dans sa Relation :
"S.E. a toujours vécu en France avec une dignité et une intégrité telles que jamais personne n'a pu la taxer de grave scandale et cette justice, ses ennemis eux- mêmes la lui rendent.
Mais, comme elle était toujours distraite par les affaires politiques et les très lourdes occupations de la guerre, elle ne paraissait pas s'acquitter d'une manière satisfaisante des manifestations vraies de la piété à laquelle elle était tenue de par sa condition ecclésiastique.
Toutefois au fond de son coeur, elle eut toujours des sentiments solides de piété... ".
Bissaro, voyant que Mazarin, déjà sérieusement malade, sans doute d'un œdème pulmonaire, se faisait un peu trop lire des ouvrages " de navigation et d'histoires étranges ", lui conseilla des livres de spiritualité, notamment ceux de Louis de Grenade qu'on lui lisait en espagnol langue que Mazarin affectionnait.
Sa mort
Mazarin meurt le 9 mars 1661 en laissant une Europe en paix. Louis XIV ne protégera pas cet héritage de Mazarin, bien au contraire : soucieux d'affirmer sa grandeur par de vastes conquêtes, le roi trouvera dans les traités de paix, si difficilement obtenus par le Cardinal, les prétextes qui justifieront ses innombrables guerres. La Fronde est alors finie depuis plus de huit ans 1653.
Le cardinal, qui garda sa lucidité jusqu'au bout, reçut en toute conscience les sacrements de l'Église catholique--confession, extrême-onction, viatique. Il embrassa tous ses proches, " le visage serein et égal en se recommandant à leurs prières ".
Une mort classique au grand siècle.
Son héritage spirituel et matériel
Par testament, Mazarin fit réaliser le Collège des Quatre-Nations, devenu l'Institut de France. L'acquisition, en août 1643, de la bibliothèque du chanoine Descordes constitue l'acte fondateur de celle-ci : la Bibliothèque Mazarine, issue de la bibliothèque personnelle du cardinal.
La réussite de Mazarin constitua un véritable outrage à l'ordre social de son époque. La formidable réussite d'un homme sans naissance et de condition modeste ne pouvait que s'attirer les foudres d'une noblesse censée seule avoir été dotée par Dieu des vertus et qualités propres au commandement. Le souci de Mazarin de renforcer l'autorité royale attisa le ressentiment des nobles, et celui de poursuivre une guerre mal comprise celui du peuple. Les mazarinades diffusées pendant son ministère, ainsi que la qualité littéraire de nombre d'entre elles, contribuèrent à ruiner durablement sa réputation. Ses origines étrangères ne plaidèrent pas non plus en sa faveur. Ainsi, en dépit des indéniables réussites que compta sa politique, Mazarin ne laissa pas un bon souvenir dans la mémoire du peuple français, les mémorialistes préférant mettre en avant ses pratiques financières douteuses plutôt que ses victoires politiques.
La richesse du Cardinal Mazarin et sa volonté de se lier à la haute aristocratie par les mariages avantageux de ses nièces (moyen pour les Grands de bénéficier des grâces royales) créèrent une dynastie.
Les sœurs Olympe, Marie, Hortense et Marie Anne Mancini furent célèbres pour leur beauté, leur esprit et leurs amours libérées.
Marie Mancini fut le grand et platonique amour de jeunesse de Louis XIV, qui renonça à elle pour épouser sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche.
Hortense épousa le 28 février 1661 Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye, duc de Mayenne, puis duc de Mazarin.
Il est l’un des grands personnages de l’histoire de Mayenne. Il a acheté le duché en mai 1654.
Puis, par alliances successives, le duché passa dans d’autres familles jusqu’à échoir à Louise d'Aumont, épouse d’Honoré IV de Grimaldi, prince de Monaco, ancêtre de l’actuel souverain de la principauté Albert II de Monaco.
Olympe Mancini, comtesse de Soissons, était la mère du fameux Prince Eugène, passé au service des Habsbourgs, et tant de fois vainqueur des armées de Louis XIV.
Leur frère Philippe épousa Diane de Thianges, nièce de Madame de Montespan ; ils furent les grands-parents de l'académicien Louis-Jules Mancini-Mazarini et également des ancêtres des actuels Grimaldi.
Pour avoir conté les amours des nièces avec Louis XIV, Abraham de Wicquefort s'est retrouvé embastillé.
Blasonnement
Blason de Jules Mazarin (1602-1661)
Armes du cardinal Mazarin :
D’azur au faisceau de licteur d’or lié d’argent, la hache du même, à la faces de gueules brochant sur le tout chargée de trois étoiles d’or.
Oeuvres inspirées par Mazarin
Bréviaire des politiciens, ouvrage publié aux éditions Arléa, présenté par Umberto Eco qui indique que la première parution date de 1684. Umberto Eco indique que Dumas a dû en entendre parler et n’avoir qu’un résumé de ce bréviaire, ce qui expliquerait le personnage dont il a tracé le portrait dans Vingt ans après
Personnage de fiction
Alexandre Dumas le met en scène dans Vingt ans après. D'Artagnan ainsi que Porthos deviennent ses créatures. Athos et Aramis se glissent du côté des princes, opposés au cardinal.
Dumas le remet en scène dans Le Vicomte de Bragelonne : Mazarin y sépare Louis XIV de Marie de Mancini, marie le roi de France à l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse, puis meurt en 1661.
Mazarin, série de 4 téléfilm, réalisé pour FR3-Telecip par Pierre Cardinal - scénario de Pierre Moinot sur une continuité historique de Philippe Erlanger. Mazarin : François Perier / Anne d'Autriche Martine Sarcey. Mazarin apparaît ici comme l'antithèse de Richelieu. Richelieu avait fait régner la terreur pour décapiter les factions. Mais de l'excès de terreur était née la révolte, la guerre civile. Mazarin plus politique fut un pacificateur. Selon la formule de Lamartine : « C'est Mazarin qui fut grand ministre, c'est Richelieu qui fut grand vengeur ». Passionnément dévoué à la France à laquelle il s'était identifié, il le fut encore plus à son filleul, cet enfant dont il fit un roi / texte de la série édité chez Gallimard en 1978.
Le téléfilm La Reine et le Cardinal, diffusé en février 2009 sur France 2, traite de ses relations avec la régente Anne d'Autriche. Ce dernier met l'accent sur une relation d'amants entre la Régente et Mazarin, ce qui n'a jamais été prouvé historiquement, même si la découverte d'une correspondance codée assez intime entre les deux a porté certains historiens à pencher pour cette version.
Le Diable rouge est une pièce de théâtre écrite par Antoine Rault et mise en scène par Christophe Lidon. La pièce retrace les derniers mois de la vie de Mazarin.
Quelques interprétations de Mazarin au cinéma et à la télévision :
Samson Fainsilber dans Si Versailles m'était conté... (1954).
Enrico Maria Salerno dans Le Masque de fer (1962).
Sergio Nicolaï dans D'Artagnan amoureux, mini-série en cinq épisodes (1977).
François Périer dans Mazarin, mini-série en cinq épisodes (1978).
Philippe Noiret dans Le Retour des Mousquetaires (1989).
Paolo Graziosi, dans Louis, enfant roi (1993).
Luigi Proietti dans La Fille de d'Artagnan (1994).
Jean Rochefort dans Blanche (2002).
Gérard Depardieu dans La Femme mousquetaire, téléfilm (2005).
Philippe Torreton dans La Reine et le Cardinal, téléfilm (2009).
Jean-Pol Dubois dans Le Roi, l'Écureuil et la Couleuvre, téléfilm (2010).
Liens à écouter
http://youtu.be/MQvjH6diV0I Mazarin par simone Bertière
http://youtu.be/jE5suj15IYA 2000 mille ans d'histoire 1
http://youtu.be/Xte5yFjTOsY 2000 mille ans d'histoire 2
http://youtu.be/varr2IgH1t8 2000 mille ans d'histoire 3
http://youtu.be/xlncuk4LYh0 1/4
http://youtu.be/oRVPzGPKNe4 2/4
http://youtu.be/f6k0yryOqqs 3/4
http://youtu.be/dHDzEQoRfw4 4/4
Posté le : 14/07/2013 14:28
|
|
|
|
|
Re: Lino Ventura |
|
Modérateur  
Inscrit:
03/05/2012 10:18
De Corse
Niveau : 30; EXP : 5
HP : 0 / 726
MP : 395 / 25802
|
Est-ce que je me trompais quand, adolescent, j'imaginais qu'il était le modèle type du Français, représentant la France à l'étranger ? Et puis, son langage était le mien.
Posté le : 13/07/2013 23:05
|
|
|
|
|
Re: Léo Ferré |
|
Modérateur  
Inscrit:
03/05/2012 10:18
De Corse
Niveau : 30; EXP : 5
HP : 0 / 726
MP : 395 / 25802
|
Sa façon de vous accrocher les tripes, de chanter une France qu'on ne retrouve plus, sa poèsie qui faisait vivre un Paris que l'on ne connaissait pas, c'était extra....
Posté le : 13/07/2013 22:58
|
|
|
|
|
Origine de la fète du 14 Juillet |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Origine de la Fête nationale Française
Le 14 Juillet, qui cette année tombe méchamment un dimanche, est le jour de la fête nationale, un jour férié, chômé et payé, qui nous laisse donc le temps de nous replonger dans l'histoire de cet évènement fondateur de la République Française
Le 14 Juillet comme tous les ans sera donc la fête de la France et de tous les Français.
Nous fêtons aujourd'hui le traditionnel 14 juillet : le défilé militaire sur les Champs-Elysées, feux d’artifices, bals des pompiers…
Petit aparté, sachez qu’un petit village (gaulois) résiste depuis plus de 130 ans – car ce jour férié a été fixé en 1880, voir plus bas – à l’enthousiasme révolutionnaire, et célèbre le 14 juillet… au mois d’août : le petit village de Viriat, à côté de Bourg en Bresse, fête effectivement le 14 juillet après la moisson. D’après certaines sources, ce décalage serait dû à la lenteur des représentants locaux du Tiers-Etat, qui auraient mis 15 jours à apporter à Viriat l’information de la prise de la Bastille : personnellement, je n’y crois pas une seconde, ou ce n’est du moins pas une explication suffisante car sinon il n’y aurait pas deux dates communes dans l’Hexagone (la simultanéité, tout ça…).En dehors de Viriat, la France fête donc le 14 juillet chaque 14 juillet (c’est un scoop !). Mais que fête-t-on exactement ?
A l’instar de l’excellentissime article sur le 8 mai, vous serez peut-être surpris d’apprendre que contrairement à ce que l'on pense d'ordinaire, la fête du 14 juillet n’est pas un hommage à la prise de la Bastille. Et oui…
Petit rappel historique :
La fête du 14 Juillet est la conjonction de divers évènements historiques. Peu de gens le savent, mais le 14 juillet ne commémore pas seulement la prise de la Bastille de 1789, elle célèbre avant tout la fête de la fédération, qui a eu lieu l’année suivante, en 1790. Ce jour est déclaré férié, (chomé, payé) pas de chance, cette année, il tombe un Dimanche !
Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille
Cet été là, une grande agitation règne à Paris. Face au mécontentement populaire, le roi a réuni les Etats généraux, une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état qui comprend donc les péons de base mais également la petite bourgeoisie. Ces derniers demandent une réforme profonde des institutions et, le 9 juillet, se proclament Assemblée nationale constituante. L’initiative inquiète le roi qui fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. La rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, un orateur harangue la foule qu’il appelle à réagir : ce député est Camille Desmoulins, qui monté sur un tonneau, annonce une « Saint Barthélemy des patriotes ».
Au matin du 14 juillet, des Parisiens en colère vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent vers la vieille forteresse royale de la Bastille, en quête de poudre. Pour la grande majorité des Français, fêter le 14 Juillet dans les pétarades et les feux d'artifice commémore la chute de la Bastille, cette imposante forteresse où les rois emprisonnaient ceux qui leur déplaisaient par simple lettre de cachet. Ce jour-là, en plein été 1789, une foule de Parisiens parvient à investir la place forte en négociant avec son gouverneur : il aura la vie sauve contre l'ouverture du pont-levis. Les émeutiers promettent tout ce que l'on veut, ils veulent à tout prix récupérer la poudre pour utiliser leurs fusils contre les troupes du roi qui se font menaçantes.
On connaît la suite : la garnison se fait écharper, le gouverneur est traîné dans les rues, une épaule ouverte par un coup d'épée. Il supplie qu'on l'achève, ce qui est fait à coups de baïonnette, tandis qu'un garçon cuisinier s'applique à découper sa tête pour en garnir une pique. On libère les prisonniers du "despote" : deux fous - vite renfermés à Charenton -, quatre faussaires et un dangereux pervers, noble de surcroît... Mais qu'importe ! Un symbole de l'arbitraire, de l'ancien règime est tombé, Versailles tremble, les princes de sang prennent le large, la Révolution est cette fois bien lancée.
Le 14 juillet 1790 : fête de la Fédération
Un an plus tard, il s'agit donc de célébrer l’évènement de la prise de la bastille, et d'en faire perdurer le succès. Que faire ?
Depuis l’été 1789, partout dans les provinces françaises le gouvernement central autrefois fort s'est délité et se sont créées des « fédérations » régionales de gardes nationaux, réaction à l’affaiblissement du pouvoir central. Afin de contrôler ce mouvement spontané, la Commune de Paris, sous l’impulsion de Lafayette, décide de fonder une grande Fédération nationale regroupant des représentants des fédérations locales et de les réunir à Paris le 14 juillet. La cérémonie est censée célébrer la prise de la Bastille bien sûr, mais aussi apporter un semblant d’ordre et d’unité dans un pays en crise. Le jour dit, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille jusqu’au Champ-de-Mars
Le roi est toujours là, aimé du peuple, la République n'est pas encore proclamée.
Le 14 juillet 1790, une grande fête de la Fédération est organisée sur le Champ-de-Mars, en face de l'école militaire. L'idée est de symboliser l'unité nationale autour des députés et du souverain. Sur la grande esplanade, entourée d'immenses tribunes où se pressent des dizaines de milliers de Français, se dresse l'autel de la patrie. Sur cette plate-forme de six mètres de haut, le cauteleux Talleyrand, alors évêque d'Autun, célèbre une grand-messe, assisté par trois cents prêtres et de quatre cents enfants de choeur ! Te Deum, coups de canon, défilés des représentants des départements français...
À la fin de la grandiose cérémonie, le roi s'avance et jure de maintenir la Constitution et d'être fidèle aux lois : «Moi, roi des Français, je jure d’employer le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de l’État, à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi et à faire exécuter les lois». La reine, se levant et montrant le Dauphin dira également : «Voilà mon fils, il s’unit, ainsi que moi, aux mêmes sentiments».
Marie-Antoinette soulève son fils, la famille royale est acclamée, ainsi que le dauphin.
Ce sera l'une des dernières manifestations populaires d'adhésion à la royauté, dans un grand mouvement d'unité nationale.
En réalité, la réconciliation nationale sera de courte durée : deux ans plus tard, le roi est arrêté à Varenne alors qu’il cherchait à rejoindre les royalistes en exil, et condamné à mort.
Devant le renforcement de la majorité républicaine aux élections de 1879, le royaliste Mac-Mahon, découragé, démissionne de la présidence de la République et est remplacé par un vieux républicain modéré, Jules Grévy (1807-1891).
Désormais à toutes les commandes du pouvoir, les républicains prennent simultanément des mesures symboliques : transfert du siège des pouvoirs publics de Versailles en 1871, à Paris en 1879, amnistie accordée aux condamnés de la Commune le 10 juillet 1880, adoption de La Marseillaise comme hymne national en 1879 et du 14 juillet pour fête nationale le 6 juillet 1880.
Il fallut bien du temps et une volonté politique infaillible pour effacer les divisions et les effets négatifs de la révolution française. Cette première fête nationale se veut donc à la mesure des Evénements, à Paris comme en province, il est important de veiller à ménager les opinions locales comme par exemple, à Angers, dans le Maine-et-Loire, département catholique et conservateur.
Le vote pour la « République » a rassemblé les partisans de la liberté et de la laïcité qui veulent établir sans délai l’égalité par le suffrage universel et une véritable souveraineté populaire.
Cependant la France de 1880 n’est ni unanime ni paisible, et les nouveaux gouvernants n’affichent pas ouvertement leur doctrine : l’heure n’est pas à la propagande, mais à l’opportunisme républicain
1880 : le 14 juillet devient fête nationale
Pendant près d’un siècle, la commémoration du 14 juillet est abandonnée. Elle réapparaît en 1880, sous la IIIe République.
La fête nationale est née, mais ne survivra pas longtemps aux aléas de l'histoire, elle sera remplacée par des fêtes opportunistes durant un certain temps.
Les révolutionnaires multiplieront par la suite les fêtes symboliques, dont celle du 1er vendémiaire (septembre) en l'honneur de la République.
Ensuite, Bonaparte établira la Saint-Napoléon, vite reprise par son neveu l'empereur Napoléon III, arrivé au pouvoir.
Et lorsque les députés de la IIIe République naissante décident d'instaurer une fête nationale, la question divise la Chambre.
On cherche d'abord des dates et des symboles : le serment du Jeu de paume, la Déclaration des droits de l'homme ou encore l'instauration de la Ire république en septembre 1792 ?
Car si le 14 juillet est une date symbolique, une date que l’on reprend souvent dans les cours du secondaire, avec moult images, il n’allait pas de soi qu’on choisisse cette date précise : cela pouvait être l’anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août ou encore l’anniversaire de la I ère République le 21 septembre 1792, c'était là des concurrents sérieux !
Alors… quoi ? De fait, la commémoration du 14 juillet est abandonnée jusqu’à ce que les Républicains de la IIIème république, et notamment le grand personnage que fut Gambetta, cherchent à solidariser le peuple français au nouveau régime, et décident de célébrer ses fondements. C’est sur proposition du député de la Seine, Benjamin Raspail, que la loi du 6 juillet 1880 fait du 14 juillet la fête nationale de la République.
Que commémore-t-elle ? Non pas la prise de la Bastille en elle-même, mais la "fête de la Fédération", du 14 juillet 1790, qui, elle-même, reprend le souvenir de 1789.
En fait, Lorsqu'en en 1880, le député de la Seine, Benjamin Raspail, dépose une loi pour adopter le 14 juillet comme jour de fête nationale. Les débats font rage...
Faut-il célébrer l'émeute de la Bastille, sanglante et au final peu glorieuse aux yeux de certains, ou bien honorer la fête de la Fédération, qui symbolise davantage l'esprit national ? Finalement, les élus acceptent la deuxième solution : évoquer et perpétuer une grande fête pacifique qui célébrait elle-même une émeute populaire. "Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l'histoire de France, et peut-être de toute l'histoire !" s'enflamment les sénateurs. "Cette seconde journée n'a coûté ni une goûte de sang ni une larme... Elle symbolise l'union fraternelle de toutes les parties de la France." Le subtil compromis emporte les suffrages. C'est ainsi que, chaque 14 juillet, nous célébrons d'abord une ancienne fête patriotique, bénie par l'Église et présidée par un ancien roi de France...
Le régime, pour se consolider, cherche à construire un nouvel imaginaire national, autour de symboles républicains. C’est ainsi que la Marseillaise devient hymne officiel, et le 14 juillet fête nationale. Mais la proposition qui émane du député de la Seine Benjamin Raspail n’est pas accueillie unanimement par l’Assemblée, certains députés mettant en cause la violence du 14 juillet 1789.
Et c’est finalement autour du 14 juillet 1790 que se fait le consensus.
La commémoration du 14 juillet 1790, fut retenue car était symbolique d’une union nationale qui selon les débat du Sénat :
« n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme » : « cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole de l’union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin accomplie l’unité nationale, préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité garde un souvenir reconnaissant ».
Depuis cette date, tous les 14 juillet, des troupes défilent sur les Champs Elysées, des cérémonies militaires sont organisées un peu partout dans le pays, ainsi que des feux d’artifice, cette journée symbolise pour les Français la fin de la monarchie absolue et le début de la République.
Partout le programme de la fête adopte le même rituel : concerts dans les jardins, décoration de certaines places, illuminations, feux d’artifice et distributions de secours aux indigents. À Paris doit dominer la distribution des nouveaux drapeaux à l’armée, à Longchamp. J
En 1880, pour la première fête nationale, la République fait les choses en grand.
Le ministre de l'Intérieur prescrit aux préfets de veiller à ce que cette journée "soit célébrée avec autant d'éclat que le comportent les ressources locales". Un défilé militaire est organisé sur l'hippodrome de Longchamp devant 300 000 spectateurs, en présence du Président Jules Grévy. Cette remise des drapeaux à l’hippodrome de Longchamp a visiblement été imaginée sans connaître le déroulement de la fête grandiose qu’illustrera Édouard Detaille.
Il s'agit de montrer le redressement de l'armée française après la défaite contre la Prusse en 1870. Ce défilé militaire, toujours en vigueur, s'inspire aussi du défilé des gardes fédérés de 1790.
Cette année là, on inaugure également le monument surmonté de la statue de la place de la République, et partout sont donnés concerts et feux d'artifices. "La colonne de Juillet" qui surplombe la place de la Bastille, elle, ne se réfère pas au 14 juillet 1789. Elle porte le nom des victimes des journées révolutionnaire de juillet 1830, les "Trois glorieuses".
Le 14 juillet 1880 à Paris
Cet exemplaire est même enjolivé de pastilles d’argent rehaussant les initiales républicaines. Marianne qui représente la République préside à la cérémonie en arborant le drapeau tricolore et l’épée, mais son bonnet phrygien orné d’une cocarde tricolore constitue un signe plus frappant pour les contemporains.
Cet attribut révolutionnaire de la Liberté encore officiellement interdit, même si la couronne de lauriers l’atténue quelque peu, révèle l’audace du courant radical et expressionniste qui porte alors la République dans la capitale. À Paris, l’opinion de la rue dépasse en hardiesse les hommes politiques : on expose la Marianne partout, sur les appuis de fenêtre, sur les marchés, et on l’y met avec son bonnet.
La cérémonie se veut le symbole du renouveau de l’armée française au lendemain de la guerre de 1870. Les régiments reconstitués après la chute de la Commune avaient reçu un drapeau provisoire en 1871. Leur emblème définitif n’est choisi qu’au début de 1879, et c’est le 14 juillet 1880 qu’ils reçoivent du président de la République les emblèmes qui sont encore aujourd’hui ceux de l’armée française.
Entre les nuages du ciel et ceux des canons d’artillerie, la prise de la Bastille commémore une aurore.
Mais la date qui vient d’être choisie pour fête nationale correspond malgré tout dans tous les esprits, à l' événement fondateur de 1789 et non à la fête de la Fédération nationale du 14 juillet 1790, invoquée lors des débats au Sénat.
La fête du 14 Juillet de 1880 à nos jours
Programme de la fête nationale du 14 juillet 1880
Distribution de secours aux indigents. Grands concerts au jardin des Tuileries et au jardin du Luxembourg. Décorations de certaines places, notamment de la place de la Bastille et de la place Denfert où l’on verra le fameux Lion de Belfort qui figurait au Salon de cette année, monument élevé au colonel Denfert-Rochereau, de glorieuse mémoire - illuminations, feux d’artifices - ajoutons les fêtes locales, comprenant des décorations, des trophées, des arcs de triomphe et le tout organisé par les soins des municipalités de chaque arrondissement avec le concours des habitants.
Deux cérémonies importantes doivent dominer toute la fête : la distribution des nouveaux drapeaux à l’armée et l’inauguration, sur l’ancienne place du Château d’eau, du monument surmonté de la figure de la République, monument qui a fait l’objet d’un concours ouvert l’année dernière par la Ville de Paris.
Les célébrations des années suivantes
Après 1790, le 14 juillet fut célébré mais il fut souvent estompé par d’autres évènements : l’anniversaire du 10 août 1792 date de la destitution de Louis XVI et création de la commune insurrectionnelle de Paris et/ou celui du 9 thermidor (27 juillet 1794).
Après les célébrations de 1790, Mirabeau se met au travail et prépare un rapport sur les fêtes publiques nationales et militaires, qui n'aura pas de suite.
La Fête de la Fédération, en tant que telle, n'est pas non plus reprise : le 14 juillet 1791, au lendemain de la fuite à Varennes, l'Assemblée ne s'y associe pas.
En 1792, la patrie a été déclarée en danger le 11 juillet : la fête a lieu, mais sans éclat.
En 1793, la fête est limitée à l'enceinte de l'Assemblée qui apprend alors la mort de Marat.
La fête est célébrée le 10 août, jour où le public court à Saint-Denis pour disperser les os du Roi de France.
Ce sera la dernière tentative de la période révolutionnaire. en attendant la décision du Sénat en 1880
En 1796, le Directoire décide de célébrer pèle-mêle les 27 et 28 juillet,
les anniversaires des 14 juillet,
10 août et 9 thermidor.
Ces jours-là, le cortège, qui défila dans Paris, comprenait notamment des jeunes gens et des jeunes filles de " 18 ans au moins ".
En 1797 a lieu la première cérémonie militaire.
Le 14 juillet est célébré par les troupes dans les pays conquis, notamment en Italie.
En 1799, le 14 juillet n’est plus celui de la " liberté " mais de la " Concorde " et se résume à un défilé militaire.
Le 14 juillet 1800, la garde consulaire défile des Tuileries au Champ de Mars.
Après 1804, le 14 juillet s’efface devant le 15 août, date de naissance de Napoléon.
Après 1814, c’est le 5 août, fête de Saint-Louis, qui lui est préféré.
Après la révolution de 1830, Louis-Philippe associe le souvenir de la " grande victoire nationale " du 14 juillet 1789 à la pose solennelle de la première pierre de la colonne érigée en l’honneur des martyrs de juillet sur la place de la Bastille, le 27 janvier 1831.
Chaque année, se déroulent les " Fêtes de juillet ".
La Deuxième République ne rétablit pas le 14 juillet mais fête la Première République par des discours et des banquets le 22 septembre.
Le Second empire fixe la date de la fête nationale au 15 août, date de la naissance de Napoléon Bonaparte.
Le 14 juillet reste célébré par les Républicains.
Malgré la proclamation de la République le 4 septembre 1870, il faudra encore attendre dix ans pour que le 14 juillet soit proclamé " Fête nationale ".
La Seconde Guerre mondiale
Pour cette première fête nationale, la République fait les choses en grand. Le Champ de Mars est abandonné au profit de l’hippodrome de Longchamp où se déroule désormais le défilé militaire qui marque la réconciliation de la République et de l’armée.
Devant 300 000 spectateurs et en présence du Président de la République Jules Grévy, le ministre de la guerre distribue de nouveaux drapeaux et étendards.
"Deux cérémonies importantes doivent dominer toute la fête : la distribution des nouveaux drapeaux à l'armée, et l’inauguration, sur l’ancienne place du Château d’eau, du monument surmonté de la figure de la République, monument qui a fait l’objet d’un concours ouvert l’année dernière par la Ville de Paris."
Extraits du programme de la célébration du 14 juillet 1880.
Egalement au programme : décorations de certaines places, notamment de la place de la Bastille, illuminations, feux d'artifices...
Et un grand concert au jardin du Luxembourg ! C'est en effet en 1880 que le Sénat s'installe au Palais.
Une fois la fête instituée, les célébrations se suivent, apportant leur lot de surprise et d'innovations.
Le 14 juillet 1886, par exemple, défile pour la première fois une femme, cantinière du 131e régiment d’infanterie, qui vient de recevoir la médaille militaire.
Le 14 juillet 1888, le nouveau Président de la République, Sadi Carnot, offre un banquet à tous les maires des chefs-lieux d’arrondissements et de cantons. 4.000 répondent à l’invitation.
Le 14 juillet 1915, pour la première fois, les troupes défilent sur les Champs Elysées.
De 1915 à 1917, la fête n’a, provisoirement, qu’un caractère " exclusivement patriotique et commémoratif ".
Après l'armistice du 11 novembre 1918, le traité de paix qui conclut quatre années de guerre mondiale est signé le 28 juin 1919.
Le 14 juillet 1919 coïncide donc avec le défilé de la victoire qui réunit sur les Champs-Elysées, les forces des pays alliés. : "c’était beau comme le tonnerre et les éclairs".
En 1936 : après le défilé militaire, un million de personne défile à l'appel des organisations syndicales.
De 1939 à 1945 : dans le Paris occupé, la journée n'est pas célébrée.
Le 14 juillet 1940, à Londres, le général de Gaulle réitère ses appels à la résistance.
En juillet 1945, on célèbre la Libération partout en France.
Toutes les armées alliées défilent dans l’ordre alphabétique. L’armée française clôt le défilé.
Les festivités du 14 juillet 2013 partout en France
Le 14 juillet est l'occasion de festivités au succès populaire. Dans de nombreuses villes, un défilé militaire a lieu dans la journée. Le soir, des bals et concerts sont organisés dans toutes les communes de France, suivis généralement d'un feu d'artifice. Les dates peuvent varier selon les communes : généralement le 13 juillet est consacré au bal populaire et le 14 au feu d'artifice, mais il peut arriver que le feu d'artifice soit tiré le 13 juillet dans certaines communes, de façon à ne pas interférer avec les festivités d'autres villes aux alentours. Si vous vous y prenez bien, vous pourrez donc assister à deux feux d'artifice dans deux endroits différents !
Les festivités parisiennes du 14 juillet 2013
En prélude au feu d’artifice, tiré depuis le Trocadéro, la Mairie de Paris, France Télévisions et Radio France créent un grand rendez-vous de la musique classique dès 21h30 avec « le Concert de Paris », organisé sur le Champ de Mars.
Le soir venu, nous pourrons assister au Feu d'artifice d’artifice qui commence à 23h. L'accès se fait par le Champ de Mars. Le thème 2013 est "Liberté, égalité, fraternité". Des effets visuels seront mis en place pour l'occasion : plus de 100 projecteurs de lumière, des projections d’images, un drapeau tricolore géant déployé sur la Tour Eiffel…
La veille, le 13 juillet, les casernes parisiennes vous ouvrent leurs portes pour les traditionnels bals des Pompiers de Paris.
----------------------------------------------------------
Séance du Sénat du 29 Juin 1880
relatif au projet de loi ayant pour objet l'établissement d'une fête nationale
Rapport
Projet de loi
Programme du 14 juillet 1880
Rapport:
On connaît rarement l'année - 1880 - qui marque pour la France la consécration du 14 Juillet comme fête nationale. Voici les textes fondateurs : comme le dit Henri Martin, rapporteur au Sénat de la loi du 6 juillet faisant du 14 juillet une "journée Fête Nationale annuelle", "ce jour-là, le 14 juillet 1790, a fait, je ne veux pas dire l’âme de la France [...] mais la révolution a donné à la France conscience d’elle-même".
En 1878, le ministère Dufaure avait fixé au 30 juin une fête parisienne en l’honneur de la République. Elle est immortalisée par un tableau de Claude Monet. Le 14 juillet 1879 prend un caractère semi-officiel. Après une revue des troupes à Longchamp (le 13 juillet), une réception est organisée le 14 à la Chambre des députés à l’initiative de Gambetta qui la préside, une fête républicaine a lieu au pré Catelan en présence de Louis Blanc et de Victor Hugo. Dans toute la France, note Le Figaro : "on a beaucoup banqueté en l’honneur de la Bastille" (16 juillet 1879).
Le 21 mai 1880, Benjamin Raspail dépose une proposition de loi signée par 64 députés, selon laquelle " la République adopte comme jour de fête nationale annuelle le 14 juillet ". L’Assemblée vote le texte dans ses séances des 21 mai et 8 juin ; le Sénat l’approuve dans ses séances des 27 et 29 juin 1880 à la majorité de 173 contre 64, après qu’une proposition en faveur du 4 août eut été refusée.
La loi est promulguée le 6 juillet 1880. Le ministre de l’intérieur prescrit aux préfets de veiller à ce que cette journée " soit célébrée avec autant d’éclat que le comportent les ressources locales ".
La fête célébrée cette année-là fut à la mesure de l’évènement.
Documents Sénat, séance du 29 juin 1880
Discussion du projet de loi ayant pour objet l'établissement d'une fête nationale
M. Le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Martin, rapporteur. Messieurs, nous ne pouvons que remercier l'honorable orateur, auquel je réponds, de l'entière franchise, de l'entière loyauté avec laquelle il a posé la question comme elle doit être posée, entre l'ancienne société et la société nouvelle, issue de la Révolution.
Cette ancienne société, cette monarchie, messieurs, nous vous l'avons dit bien des fois, nous en acceptons tout ce qui a été grand, tout ce qui a été national, tout ce qui a contribué à faire la France.
Mais où en était-elle, à la veille du 14 juillet 1789 ?
Vous le savez : la royauté, arrivée au pouvoir le plus illimité qu'on ait vu en Europe, était devenue incapable d'en user ; elle-même se vit contrainte d'en appeler à la nation, après un siècle et trois quarts d'interruption des Assemblées nationales de l'ancien régime. (C'est vrai ! - Très-bien ! à gauche.)
Je n'ai pas la prétention de vous refaire l'histoire de cette grande année 1789 ; mais enfin, puisqu'on vient de faire ici le procès du 14 juillet, puisqu'on a symbolisé, dans ce petit acte de guerre qu'on appelle la prise de la Bastille (Rires ironiques à droite) et qui est un très-grand évènement historique, tout l'ensemble de la Révolution, il faut bien que nous nous rendions compte, en quelques mots, de la situation où étaient alors Paris et la France.
Le 17 juin 1789, le Tiers Etat s'était déclaré Assemblée nationale. Le 20 juin, la salle de l'Assemblée nationale fut fermée par ordre de la cour. Vous savez où se transporta l'Assemblée, à la salle du Jeu de Paume ! Vous savez aussi quel serment elle y prononça ! L'ère moderne tout entière est sortie de ce serment.
Le 23, déclaration du roi annulant tous les actes de l'Assemblée nationale et la sommant de se séparer.
L'Assemblée ne se sépara pas. La cour parut céder. Mais, le 11 juillet, le ministre populaire, qui était l'intermédiaire entre la cour et le pays, M. Necker, fut congédié, remplacé par un ministère de coup d'Etat ; en même temps, on appela, on concentra autour de Paris une armée entière, une armée, ne l'oubliez pas, messieurs, en très-grande partie étrangère.
A gauche. C'est vrai ! Très-bien !
M. le rapporteur. Et le même jour, le nouveau conseil décida l'émission de cent millions de papier-monnaie, attendu qu'il ne pouvait plus espérer obtenir des ressources de l'Assemblée nationale. C'était la préface de la banqueroute, comme la préface d'un coup d'Etat.
Le malheureux Louis XVI était retombé dans les mains de ceux qui devaient le mener à sa perte. Eh bien, le même jour, dans Paris, vous vous rappelez ce qui se passa au Palais-Royal, cet épisode fameux d'où sortit le grand mouvement des trois journées qui suivirent. Cette petite action de guerre à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, en manifestant la force populaire, mit à néant tout les projets arrêtés contre l'Assemblée nationale ; cette petite action de guerre sauva l'avenir de la France. Elle assura l'existence et la puissance féconde de l'Assemblée nationale contre toutes les tentatives de violence qui la menaçaient (Nouvelle approbation sur les mêmes bancs).
On parlait de conflit du peuple et de l’armée, dont il ne fallait pas réveiller le souvenir ; mais contre qui le peuple, soutenu par les gardes françaises, avait-il été engagé, dans les rues, sur les places de Paris, durant les deux journées qui ont précédé le 14 juillet ? Qu’est-ce qu’il y avait autour de Paris et surtout dans Paris ? De l’infanterie suisse, de la cavalerie allemande, de la cavalerie hongroise, dix régiments étrangers, peu de troupes françaises, et c’est contre ces régiments étrangers que les gardes-françaises avaient défendu le peuple et l’Assemblée.
Laissons donc ces souvenirs qui ne sont pas ceux d’une vraie guerre civile.
Il y a eu ensuite, au 14 juillet, il y a eu du sang versé, quelques actes déplorables ; mais, hélas ! dans tous les grands événements de l’histoire, les progrès ont été jusqu’ici achetés par bien des douleurs, par bien du sang. Espérons qu’il n’en sera plus ainsi dans l’avenir. (Très bien ! à gauche. - Interruptions à droite.)
A droite. Oui, espérons !
M. Hervé de Saisy. Nous n’en sommes pas bien sûrs !
M. le rapporteur. Nous avons le droit de l’espérer. Mais n’oubliez pas que, derrière ce 14 juillet, où la victoire de l’ère nouvelle sur l’ancien régime fut achetée par une lutte armée, n’oubliez pas qu’après la journée du 14 juillet 1789 il y a eu la journée du 14 juillet 1790. (Très-bien ! à gauche.)
Cette journée-là, vous ne lui reprocherez pas d’avoir versé une goutte de sang, d’avoir jeté la division à un degré quelconque dans le pays, Elle a été la consécration de l’unité de la France. Oui, elle a consacré ce que l’ancienne royauté avait préparé.
L’ancienne royauté avait fait pour ainsi dire le corps de la France, et nous ne l’avons pas oublié ; la Révolution, ce jour-là, le 14 juillet 1790, a fait, je ne veux pas dire l’âme de la France, - personne que Dieu n’a fait l’âme de la France, - mais la Révolution a donné à la France conscience d’elle-même (Très-bien ! sur les mêmes bancs) ; elle a révélé à elle-même l’âme de la France. Rappelez-vous donc que ce jour-là, le plus beau et le plus pur de notre histoire, que d’un bout à l’autre du pays, les Pyrénées aux Alpes et au Rhin, tous les Français se donnèrent la main. Rappelez-vous que, de toutes les parties du territoire national, arrivèrent à Paris des députations des gardes nationales et de l’armée qui venaient sanctionner l’œuvre de 89. Rappelez-vous ce qu’elles trouvaient dans ce Paris : tout un peuple, sans distinction d’âge ni de sexe, de rang ni de fortune, s’était associé de cœur, avait participé de ses mains aux prodigieux préparatifs de la fête de la Fédération ; Paris avait travaillé à ériger autour du Champ-de-Mars cet amphithéâtre vraiment sacré qui a été rasé par le second empire. Nous ne pouvons plus aujourd’hui convier Paris et les départements sur ces talus du Champ-de-Mars où tant de milliers d’hommes se pressaient pour assister aux solennités nationales.
M. Lambert de Sainte-Croix. Il faut faire dire une messe !
M. le rapporteur. Nous trouverons moyen de remplacer le Champ-de-Mars. Un peuple trouve toujours moyen d’exprimer ce qu’il a dans le cœur et dans la pensée ! Oui, cette journée a été la plus belle de notre histoire. C’est alors qu’a été consacrée cette unité nationale qui ne consiste pas dans les rapports matériels des hommes, qui est bien loin d’être uniquement une question de territoire, de langue et d’habitudes, comme on l’a trop souvent prétendu. Cette question de nationalité, qui a soulevé tant de débats, elle est plus simple qu’on ne l’a faite. Elle se résume dans la libre volonté humaine, dans le droit des peuples à disposer de leur propre sort, quelles que soient leur origine, leur langue ou leurs moeurs. Si des hommes associés de sentiments et d'idées veulent être frères, ils sont frères. Contre cette volonté, la violence ne peut rien, la fatalité ne peut rien, la volonté humaine y peut tout. Ce qu’une force fatale a fait, la libre volonté le défait. Je crois être plus religieux que personne en proclamant cette puissance et ce droit de la volonté humaine contre la prétendue force des choses qui n’est que la faiblesse des hommes. (Très-bien ! très-bien à gauche.)
Si quelques-uns d’entre vous ont des scrupules contre le premier 14 juillet, ils n’en ont certainement pas quant au second. Quelles que soient les divergences qui nous séparent, si profondes qu’elles puissent être, il y a quelque chose qui plane au-dessus d’elles, c’est la grande image de l’unité nationale, que nous voulons tous, pour laquelle nous nous lèverions tous, prêts à mourir, si c’était nécessaire. (Approbation à gauche.)
M. le vicomte de Lorgeril. Et l’expulsion de demain ? (Exclamations à gauche.)
M. le rapporteur. Oui, je ne doute pas que ce soit là un sentiment unanime, et j’espère que vous voterez unanimement cette grande date qu’aucune autre ne saurait remplacer ; cette date qui a été la consécration de la nationalité française et qui restera éternellement gravée dans le cœur des Français.
Sans doute, au lendemain de cette belle journée, les nuages s’assemblèrent de nouveau, la foudre en sortit : la France, en repoussant d’une main l’étranger, se déchira de l’autre main, mais, à travers toutes les calamités que nous avons subies, à travers tous ces courants d’action et de réaction qui ont si longtemps désolé la France, cette grande image et cette grande idée de la Fédération n’ont pas cessé de planer sur nos têtes comme un souvenir impérissable, comme une indomptable espérance.
Messieurs, vous consacrerez ce souvenir, et vous ferez de cette espérance une réalité. Vous répondrez, soyez-en assurés, au sentiment public, en faisant définitivement du 14 juillet, de cette date sans égale qu’a désignée l’histoire, la fête nationale de la France. (Applaudissements à gauche.)
Rapport
fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet l’établissement d’un jour de fête nationale annuelle, par M. Henri Martin, sénateur.
Messieurs, le Sénat a été saisi d’une proposition de loi votée, le 10 juin dernier, par la Chambre des députés, d’après laquelle la République adopterait la date du 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle.
La commission, qui m’a fait l’honneur de me nommer son rapporteur, a délibéré sur le projet de loi dont vous avez bien voulu lui confier l’examen.
Deux de nos collègues ont combattu, non la pensée d’une fête nationale, mais la date choisie pour cette fête. Ils ont proposé deux autres dates, prises dans l’histoire de la Révolution, et qui, toutes deux, avaient, suivant eux, l’avantage de ne rappeler ni luttes intestines, ni sang versé. L’un préférait le 5 mai, anniversaire de l’ouverture des Etats généraux en 1789 ; l’autre recommandait le 4 août, dont la nuit fameuse est restée dans toutes les mémoires.
La majorité, composée des sept autres membres de la commission, s’est prononcée en faveur de la date votée par la Chambre des députés. Le 5 mai, date peu connue aujourd’hui du grand nombre, n’indique que la préface de l’ère nouvelle : les Etats généraux n’étaient pas encore l’Assemblée nationale ; ils n’étaient que la transition de l’ancienne France à la France de la Révolution.
La nuit du 4 août, bien plus caractéristique et plus populaire, si grand qu’ait été le spectacle qu’elle a donné au monde, n’a marqué cependant qu’une des phases de la Révolution, la fondation de l’égalité civile.
Le 14 juillet, c’est la Révolution tout entière. C’est bien plus que le 4 août, qui est l’abolition des privilèges féodaux ; c’est bien plus que le 21 septembre, qui est l’abolition du privilège royal, de la monarchie héréditaire. C’est la victoire décisive de l’ère nouvelle sur l’ancien régime. Les premières conquêtes qu’avait values à nos pères le serment du Jeu de Paume étaient menacées ; un effort suprême se préparait pour étouffer la Révolution dans son berceau ; une armée en grande partie étrangère, se concentrait autour de Paris. Paris se leva, et, en prenant la vieille citadelle du despotisme, il sauva l’Assemblée nationale et l’avenir.
Il y eut du sang versé le 14 juillet : les grandes transformations des sociétés humaines, - et celle-ci a été la plus grande de toutes, - ont toujours jusqu’ici coûté bien des douleurs et bien du sang. Nous espérons fermement que, dans notre chère patrie, au progrès par les Révolutions, succède, enfin ! le progrès par les réformes pacifiques.
Mais, à ceux de nos collègues que des souvenirs tragiques feraient hésiter, rappelons que le 14 juillet 1789, ce 14 juillet qui vit prendre la Bastille, fut suivi d’un autre 14 juillet, celui de 1790, qui consacra le premier par l’adhésion de la France entière, d’après l’initiative de Bordeaux et de la Bretagne. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme, cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole de l’union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin accomplie l’unité nationale, préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité garde un souvenir reconnaissant. Fédération, ce jour-là, a signifié unité volontaire.
Elles ont passé trop vite, ces heures où tous les coeurs français ont battu d’un seul élan ; mais les terribles années qui ont suivi n’ont pu effacer cet immortel souvenir, cette prophétie d’un avenir qu’il appartient à nous et à nos fils de réaliser.
Votre commission, pénétrée de la nécessité de donner à la République une fête nationale ;
Persuadée par l’admirable exemple qu’a offert le peuple de Paris le 30 juin 1878, que notre époque est capable d’imprimer à une telle fête un caractère digne de son but ;
Convaincue qu’il n’est aucune date qui réponde comme celle du 14 juillet à la pensée d’une semblable institution,
Votre commission, messieurs, a l’honneur de vous proposer d’adopter le projet de loi voté par la Chambre des députés.
L’un de nos collègues avait pensé qu’il serait utile d’ajouter la qualification de légale à celle de nationale que la Chambre des députés a appliquée à la fête du 14 juillet, et ce afin de préciser les conséquences juridiques qui découleront de l’adoption de la présente loi.
Comme une fête consacrée par une loi est nécessairement une fête légale, votre commission a pensé que cette addition n’avait point d’utilité, et qu’il n’y avait pas lieu de modifier la rédaction du projet de loi qui vous est présenté ainsi qu’il suit.
Projet de loi
Article unique. - La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle
liens
HISTOIRE
http://youtu.be/bNGSmK3j-qc L'ombre d'un doute Fête Nationale
http://youtu.be/FDOligI_Nic création de la fête nationale
http://youtu.be/TpaO7d7rCV0 fête de la fédération
http://youtu.be/Yjrw1koSh9c le 14 Juillet 1789 (1)
http://youtu.be/76xp3WzP590 le 14 Juillet 1789 (2)
http://youtu.be/VX9k_ZAPkmc le 14 Juillet 1789 (3)
MUSIQUE
http://youtu.be/4K1q9Ntcr5g la marseillaise²sdfghhgfghgfdsqhttp://www.youtube.com/watch?v=tz8Z4C ... e&list=PLE1C4F03CAF604FC0 la légion étrangère
http://youtu.be/uEGoEjlorIc Le boudin
http://youtu.be/V5bBE1ywuek chants marquisiens
http://youtu.be/27n5NaIkCEg Chants guerriers pacifica
http://youtu.be/CrAOw5i9UwM la marseillaise de Giansbourg
http://youtu.be/-mW8D0UNyLk La Marseillaise de Berlioz
http://youtu.be/1kascyn7O74 Tchaïkovski et la Marseillaise
http://youtu.be/w23P4OimgqE on n'est pas là pour se faire engueuler
.    [img width=600]http://www.saphirnews.com/photo/art/default/1345893-1776877.jpg?v=1289442038[/img]    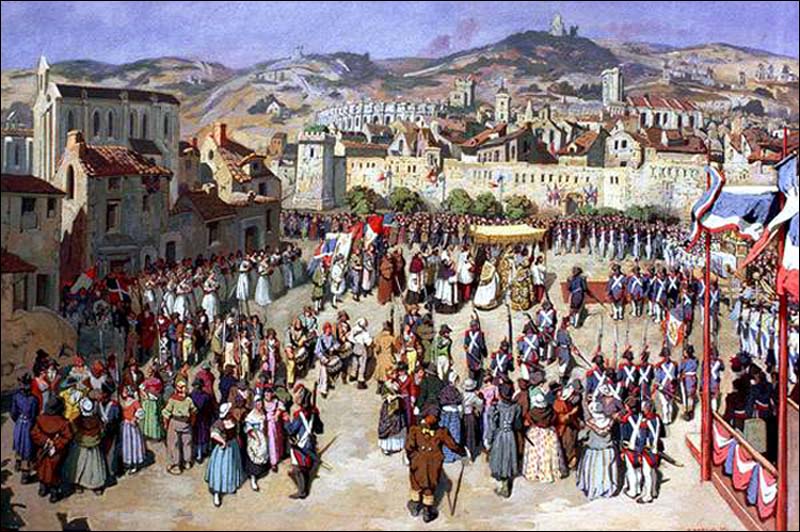  
Posté le : 13/07/2013 22:48
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:12:24
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:43:18
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:47:59
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:48:59
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:50:43
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:51:23
|
|
|
|
|
Léo Ferré |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 Juillet 1993 LEO FERRE nous quitte.
Présenté par Iktomi
On ne l’a pas su tout de suite, qu’il était mort. La nouvelle a commencé à filtrer dans la presse deux ou trois jours après. Mais c’est bien le 14 juillet 1993 que tout s’est arrêté. Et quand tout avait-il commencé ? Le 24 août 1916 à Monaco ?
Oui et non. La vie de l’homme Ferré, certes. La vie de l’artiste Ferré voit habituellement fixer ses débuts en 1946. Au vrai, ceux qui se souviennent du Ferré débutant (et Dieu sait pourtant que ses débuts ont été longs, il s’en est assez plaint par la suite…), ceux-là donc ne sont plus très nombreux. Celui qui a marqué les esprits, c’est le Ferré d’après-68, le jusqu’au-boutiste de l’anarchie, mais aussi le poète de l’amour désespéré, sans issue, perdu.
« Amour, anarchie… vaste programme ! » aurait pu dire railleusement le Général de Gaulle. Raillerie pour raillerie, Léo Ferré ne l’aura guère épargné (Mon Général, Ils ont voté…), tout comme il aura pris pour cible le pape (Monsieur Tout Blanc) dès 1950. C’est pourquoi certains croient pouvoir affirmer qu’il avait très opportunément pris en marche le train de mai 68, ce qui n’est pas juste. Il serait plus exact de dire que nombre de ses textes et chansons libertaires, anti-système, anti-pouvoir, anti-autorité, ont été écrits alors que les « révolutionnaires » de 1968 étaient encore au berceau ou à l’école maternelle.
Comme en tout bon poète sans doute, il y avait du visionnaire en Léo Ferré : bien avant l’invasion de la télé-réalité (qui fait précisément tout pour lui tourner le dos, à la réalité) et l’instauration du rituel vespéral et morbide du journal télévisé, il avait fort bien discerné l’arme de crétinisation massive qu’allait devenir la télévision. Il faisait partie de ceux qui ont bien vu que consommer n’est pas vivre.
Je ne ferai pas une énumération chronologique des grandes étapes de sa vie et de sa carrière. Je préfère vous inviter à vous documenter vous-mêmes, si tant est que le sujet vous intéresse. Je prends cette précaution car je suis moi-même passé à côté de Léo Ferré sans y faire vraiment attention. Or il n’y a peut-être pas grand mal à passer à côté de Didier Barbelivien ou Francis Lalanne (il se trouve que Léo Ferré appréciait beaucoup l’un et l’autre…), mais Ferré, tout de même…
Quand j’étais plus jeune, la simple évocation de son nom me mettait en fuite. Je le trouvais exaspérant, bourré de tics, clownesque. Il y a vingt ans (je n’étais déjà plus un gamin pourtant), sa disparition aurait pu m’inciter à faire l’effort de le découvrir, et cela ne s’est pas produit.
A présent, je tâche de me rattraper, d’écouter ses disques, de lire ses textes. J’ai entendu pour la première fois il y a moins de deux semaines Il n’y a plus rien, un très long texte dit et non pas chanté. J’ai pris une baffe… d’ailleurs c’est ce qu’il dit peu après le début du texte (certes dans un contexte très spécial) : « Fous-lui une baffe. » Bien sûr on peut froncer le nez devant certaines outrances, mais ce texte, comme tous ceux de Ferré, a une genèse, on ne peut pas le réduire à l’ « ici et maintenant. »
Ferré est un champion de l’autofiction, mais c’est de l’autofiction intelligente et pas nombriliste. Je recommande l’excellente biographie de Robert Belleret qui démonte de façon très astucieuse le mécanisme de création de nombreuses œuvres de Ferré.
Outre ses propres textes, Léo Ferré a mis en musique et chanté de grands et parfois très anciens et très oubliés poètes, tel Rutebeuf. Pauvre Rutebeuf est un texte superbe, dont Ferré n’est pas l’auteur : il a puisé dans trois œuvres de Rutebeuf (Le mariage Rutebeuf, La complainte Rutebeuf, La griesche d’hiver). Pauvre Rutebeuf a été repris par plusieurs chanteurs dont Joan Baez – pour ma part, ex æquo avec celle de Catherine Sauvage, ma version préférée : son petit accent ricain pour chanter des vers français vieux de sept siècles est irrésistible…
Tout au long de sa carrière, Léo Ferré a mis en pratique sa théorie personnelle sur la poésie dont voici un aperçu, extrait de Préface :
« La poésie est une clameur
Elle doit être entendue comme la musique
Toute poésie destinée à n’être que lue et enfermée dans sa typographie n’est pas finie. »
Il a souvent répété « Te marie pas, ne vote jamais », mais n’aura été fidèle qu’à son second commandement. Trois fois marié et père de trois enfants – après avoir servi durant une dizaine d’années de père nourricier à une guenon nommée Pépée – Ferré n’aura jamais vraiment correspondu à l’idée qu’on se fait de l’anticonformisme ou de la marginalité.
En tout état de cause, c’est une bonne chose que personne n’ait osé faire de lui, post-mortem, un chef de file ou un maître à penser. Léo Ferré s’est voulu poète, j’ai failli écrire avant tout, mais ce n’est pas tout à fait ça. Car, et ce n’est pas donné à tout le monde, il aura réalisé longtemps avant de tirer sa révérence un vieux rêve d’enfant : composer de la musique et diriger un orchestre.
Pour lui, après cela, il n’y avait plus rien…
********
Les dates de sa vie :
Fils de Joseph Ferré, directeur du personnel du Casino de Monte-Carlo, et de Marie Scotto, couturière d'origine italienne, il a une sœur, Lucienne, de deux ans son aînée.
Léo Ferré s'intéresse très tôt à la musique. À l’âge de sept ans, il intègre la Chorale de la Maîtrise de la cathédrale de Monaco comme soprano. Il découvre la polyphonie au contact des œuvres de Palestrina et de Tomás Luis de Victoria.
En 1935, il vient à Paris pour y suivre des études de droit.il peaufine son apprentissage du piano en complet autodidacte en même temps qu'il mûrit son rapport à l'écriture.
Il rentre en 1939 avec un diplôme de sciences politiques
Il est mobilisé la même année et dirige un groupe de tirailleurs algériens.
En 1940, à l'occasion du mariage de sa sœur, il écrit un Ave Maria pour orgue et violoncelle,
Il commence la mise en musique de chansons écrites par une amie.
Il se produit pour la première fois en public le 26 février 1941, au Théâtre des Beaux-arts de Monte-Carlo, sous le nom de Forlane.
En 1941, il rencontre Charles Trenet à Montpellier, il lui présente trois de ses chansons, mais ce dernier lui conseille de ne pas les chanter lui-même et de se contenter d'écrire pour les autres.
En 1943, René Baer qui est le grand-oncle d'Édouard Baer lui confie des textes qui deviendront plus tard des succès : La Chanson du scaphandrier, qui sera aussi chantée par Claire Leclerc, et La Chambre. La même année, Léo Ferré épouse Odette Shunck, qu'il a rencontrée en 1940 à Castres. Le couple s'installe dans une ferme à Beausoleil, sur les hauteurs de Monaco.
En 1945, alors qu’il est toujours « fermier » et occasionnellement « homme à tout faire » à Radio Monte-Carlo, Léo Ferré rencontre Édith Piaf qui l’encourage à tenter sa chance à Paris.
Ils broyaient du noir, L'opéra du ciel, Suzon, sont à ce jour les plus vieux enregistrements connus de Léo Ferré.
Ils furent retrouvés par son fils, Mathieu Ferré, dans le bureau de son père.
Il découvre une demi-douzaine d'enregistrements sur disque en « pyral », constitué d'une feuille d'aluminium ou de zinc recouverte d'une laque.
Mêlés à un amoncellement de partitions et de manuscrits, ils sont la plupart totalement inutilisables et seules trois chansons purent être « récupérées ».
Si la date et les circonstances des enregistrements demeurent inconnues, tout laisse à croire que c'est vers le milieu des années 1940 que Ferré les grava
Premiers pas sur scène
1946 En novembre ce sont ses premiers débuts parisiens
Il chante au Boeuf sur le Toit en compagnie des Frères Jacques et du duo Roche & Aznavour. Il interprète notamment "L'inconnue de Londres", "Le bateau espagnol" et "Le flamenco de Paris".
1947 3 mars Premier contrat d'édition avec Le chant du monde
1947 décembre il rencontre la chanteuse Catherine Sauvage Elle deviendra le principale interprète des titres de Léo Ferré. Elle contribue à faire connaitre le compositeur parolier et connait un succès avec deux de ces compositions "Paris Canaille" (1952) et "L'homme" (1954)
1955 10 mars Premier Olympia en vedette Le nom de Léo Ferré s'affiche en lettres lumineuses sur le fronton de l'Olympia. Il monte sur scène du 10 au 29 mars 1955.
1960 Léo Ferré entre dans l'écurie Barclay. Léo Ferré signe un contrat avec Eddy Barclay. Il y signe ses titres les plus connus : "Joli Mome", "Paname", "C'est extra", "Avec le temps".
1969 6 janvier Brel, Brassens et Ferré pour un entretien historique Sur une proposition du magazine "Rock'n Folk" et en collaboration avec RTL, une interview exceptionnelle est organisée dans un petit appartement de la rue Saint-Placide à Paris qui réuni Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré. Autour d'une table ronde, les trois "monstres sacrés" de la chanson française échangeront leurs opinions sur le monde et la musique. La rencontre organisée par le journaliste de "Rock'n Folk", François-René Christiani, sera immortalisée par une photographie noir et blanc de Jean-Pierre Leloir.
1970 1 mars Sortie du double album "Amour-Anarchie" Sur cet opus, on retrouve les titres "La mémoire et la mer" et "Avec le temps"
1974 Changement de maison de disques
Il quitte sa maison de disques Barclay, pour CBS puis RCA avant de créer son propre label EPM (Les Editions et Productions Musicales)
1990 septembre Sortie de son dernier album "Les vieux copains"
1993 14 juillet Décès de Léo Ferré à Castellina en Toscane, des suites d'une longue maladie
2000 3 mars Sortie de l'album posthume "Métamec"
Quelques citations de Léo Ferré :
"La mort, c'est une très jolie femme qui viendra me dire : Léo, come on, boy !"
"L'histoire de l'humanité est une statistique de la contrainte."
"Les hommes sont des brigands, ils font des lois pour justifier leurs brigandages...."
"Le monde se divise entre ceux qui aiment et les autres."
"Le taux usuraire de l'astuce n'est jamais assez élevé."
"L'indifférence est notre béquille, à nous les misanthropes."
"La mélancolie, c'est un désespoir qui n'a pas les moyens."
"Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pieds ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes"
"Le bonheur... C'est du chagrin qui se repose."
"Le désespoir... C'est un espoir perdu qui se cherche un préfixe."
Honneurs et distinctions
« Le seul honneur pour un artiste, c'est de n'en pas avoir »
— déclare Léo Ferré, en Aout 1984, sur France 3, dans un entretien avec Pierre Bouteiller
-De son vivant, Léo Ferré a refusé de recevoir le Grand Prix de la Chanson Française en 1986,
d'être fait Commandeur des Arts et Lettres,
de soutenir François Mitterrand contre la promesse d'avoir à sa disposition un orchestre symphonique de premier ordre,
et d'être l'invité d'honneur des premières Victoires de la musique en 1987.
On trouve:
A Livry-Gargan un Square Léo Ferré.
En 2003, a été inaugurée la place Léo Ferré à Monaco, sur laquelle a été installé le visage en bronze de l'artiste, par le sculpteur Blaise Devissi.
La Cité scolaire de Gourdon dans le Lot porte le nom de l'artiste. Elle comprend un collège, un lycée général et un lycée professionnel.
Il existe une rue Léo Ferré à Angers,
à Bagneux,
à Gratentour
et à Pierrefitte-sur-Seine,
Chateaubriant.
Une école primaire publique porte son nom à Montauban.
Une variété de rose originaire d'Asie porte le nom de l'artiste. Sa fleur est bicolore : blanc-or bordé de rouge carmin.
En 2006, la commune de Grigny, dans le Rhône, inaugure une médiathèque Léo Ferré.
En 2007, l'artiste plasticienne Miss.Tic a réalisé deux grands pochoirs muraux représentant Ferré et son chimpanzée Pépée pour la résidence universitaire d'Orly.
En 2009 ont été inaugurés la place et le square Léo-Ferré, à Paris (XIIe arrondissement).
En 2012 La première école de musique à porter son nom est à Martignas sur Jalle en Gironde
Plusieurs salles de concerts portent son nom.
Discographie
1984 : Léo Ferré au Théâtre des Champs-Élysées, (récital intégral, 36 titres)
1986 : Léo Ferré chante les poètes (Théâtre libertaire de Paris, récital intégral, 36 titres)
2001 : Sur la scène (Lausanne/Montreux 1973, 31 titres)
2002 : Thank you Ferre, 2002
2006 : Concert au Théâtre Libertaire de Paris, 1988, filmé par Raphaël Caussimon (DVD inclus dans le coffret CD éponyme)
Bibliographie
Ouvrages de Léo Ferré
La Nuit, feuilleton lyrique (La Table ronde, 1956)
Poète... vos papiers !, poèmes (La Table ronde, 1956)
Mon programme, plaquette auto-éditée (1968)
Benoît Misère, roman (Robert Laffont, 1970)
Il est six heures ici et midi à New York, plaquette auto-éditée (Gufo del Tramonto, 1974)
Je parle à n'importe qui, plaquette auto-éditée (Gufo del Tramonto, 1979)
La Méthode, plaquette auto-éditée (Gufo del Tramonto, 1979)
Testament phonographe, textes, poèmes et chansons (Plasma, 1980)
Parutions posthumes
La Mauvaise Graine, textes et chansons (Édition n°1, 1993)
La musique souvent me prend… comme l'amour, recueil critique (La Mémoire et la Mer, 1999)
Les Noces de Londres, feuilleton lyrique (La Mémoire et la Mer, 2000)
Marie-Jeanne (La Mémoire et la Mer, 2000)
Lettres non postées (La Mémoire et la Mer, 2006)
Les Chants de la fureur, anthologie (Gallimard-La Mémoire et la Mer, 2013 - à paraître)
En collaboration
Avec le photographe Patrick Ullmann : La Mémoire et la mer, Henri Berger, 1977N 39.
Avec le photographe Hubert Grooteclaes : L'Éternité de l'instant, Éditions du Perron, 1984.
Parutions posthumes
Avec le dessinateur Serge Arnoux : Alma Matrix, La Mémoire et la Mer, 2000.
Ouvrages sur Léo Ferré
Études
Charles Estienne, Poètes d'aujourd'hui : Léo Ferré. Seghers, 1962.
Françoise Travelet, Léo Ferré, les années-galaxie. Seghers, 1986.
Christine Letellier, Léo Ferré, l'Unique et sa Solitude. Nizet, 1993.
Collectif, Cahiers d'études Léo Ferré. Éditions du Petit Véhicule, 1998-2013.
N°0 - Olivier Bernex et la barque du temps (2003)
N°1 - La Marge (1998)
N°2 - Words… Words… Words… (1999)
N°3 - De toutes les couleurs (1999)
N°4 - Écoute-moi (2000)
N°5 - Muss es sein ? Es muss sein ! (2000)
N°6 - Technique de l’exil (2001)
N°7 - Marseille (2002)
N°8 - La Mélancolie (2003)
N°9 - Amour Anarchie (2005)
N°10 - À la Seine : Caussimon-Ferré, frères du hasard (2007)
N°11 - La Mémoire et la Mer (2013)
Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré. Christian Pirot, 2005.
Claude Frigara, Léo Ferré ou l'astre de liberté, in Chroniques d'un âge d'or. Christian Pirot, 2007.
Yann Valade, Léo Ferré, la Révolte et l'Amour. Les Belles Lettres, 2008.
Céline Chabot-Canet, Léo Ferré : une voix et un phrasé emblématiques. L'Harmattan, 2008.
Max Leroy, Les Orages libertaires - Politique de Léo Ferré, Atelier de création libertaire, 2012, (ISBN 978-2-35104-056-0)
Livres de photographies
André Villers, Léo Ferré, Nice, Z'Éditions, 1989.
Patrick Ullmann, Thank you Léo, Les Humanoïdes associés, 1994.
Hubert Grooteclaes & Patrick Buisson, Léo Ferré. Avec le temps. Éditions du Chêne, 1995.
Alain Marouani, Léo Ferré, inédits. Michel Lafon, 2005
Témoignages
Maurice Frot, Je n'suis pas Léo Ferré. Fil d'Ariane, 2001.
Louis-Jean Calvet, Léo Ferré. Flammarion, 2003.
Annie Butor, Comment voulez-vous que j'oublie... Madeleine et Léo Ferré, 1950-1973, Phébus, 2013.
Divers
Dominique Lacout & Didier Barbelivien, Léo Ferré, la Chanson du Bien-Aimé. Éditions du Rocher, 1993.
Collectif, Les Copains d'la neuille (bulletin d'information semestriel sur l'actualité autour de Léo Ferré). La Mémoire et la Mer, 2001-aujourd'hui.
Dominique Lacout & Alain Wodraska, Léo Ferré, je parle pour dans dix siècles. Didier Carpentier, 2003.
Alain Fournier, Jacques Layani, José Corréa, Léo Ferré, Je vous vois encore... 2003 La Lauze éditions (Une mémoire graphique + Portraits).
José Corréa, Léo Ferré. Nocturne, 2009
Nicolas Désiré-Frisque, Léo Ferré. Études, dessins et croquis. Éditions du Petit Véhicule, 2009.
Robert Belleret, Dictionnaire Ferré. Fayard, 2013.
Ludovic Perrin, On couche toujours avec des morts, la remontée fleuve de l'enfant Ferré. Gallimard, 2013
Interprètes de Léo Ferré
Du vivant de Ferré
Madeleine Rabereau-Ferré : Poètes, vos papiers (poèmes dits, 1956)
Jean Cardon : Surpat' chez Léo Ferré (album instrumental, 1959)
Pia Colombo : Pia Colombo chante Ferré 75 (1975)
Catherine Sauvage : 25 ans de Léo Ferré vol. 1 et 2 (1979)
Années 90
Philippe Léotard : Philippe Léotard chante Léo Ferré (1993, Grand Prix de l'Académie Charles-Cros)
Renée Claude (Canada) : On a marché sur l'amour (double-album, 1994, Grand Prix de l'Académie Charles-Cros)
Ann Gaytan (Belgique) : Thank you Ferré (1994)
Mama Béa : Du côté de chez Léo (1995)
Michel Hermon : Thank you Satan (1998)
Marc Ogeret : De grogne et de velours : Marc Ogeret chante Léo Ferré (1999)
Années 2000
Michel Orion chante Léo Ferré et Michel Orion (2000)
Joan-Pau Verdier : Léo Domani (2001)
Morice Benin : Morice Benin chante Léo Ferré (2002)
Les Faux Bijoux : Les Faux Bijoux chantent Ferré (2002, Compagnie de l'an 10000)
Les Faux Bijoux & Gilles Droulez : Inédits de Léo Ferré (2003, double CD)
Didier Barbelivien : Léo - Barbelivien chante Ferré (2003)
Manu Lann Huel : Manu Lann Huel chante Léo Ferré (2003)
Christophe Bell Œil : Hurletout... Léo Ferré (2003)
Michel Avalon : Pas vrai, Léo !
Nicolas Reggiani et Giovanni Mirabassi : Léo en toute liberté (2004)
Sapho : Sapho chante Léo Ferré (2006)
Michel Bouquet : Lettres non postées (2006)
Joan-Pau Verdier : Léo en òc (2006)
Jean-Louis Murat : Charles et Léo (2007)
Yves Rousseau Sextet (avec Claudia Solal et Jeanne Added) : Poète, vos papiers ! (2007)
Michel Hermon : Compagnons d'enfer (2008)
Bernard Lavilliers : Lavilliers chante Ferré (DVD, 2009)
Michel Orion : "Ferré, Baudelaire et moi" (volume 1) (2009)
Années 2010
Annick Cisaruk : Léo Ferré, l'âge d'or (2010)
Serge Utgé-Royo : D'amour et de révolte : Serge Utgé-Royo chante Léo Ferré (2010)
Sarah Eddy et Jean-Baptiste Mersiol : Léo (2010)
Catherine Lara : Une voix pour Ferré : Catherine Lara chante Léo Ferré (2011)
Marcel Kanche et I.Overdrive Trio : Et vint un mec d'outre saison (2012)
Philippe Guillard : Philippe Guillard chante Léo Ferré : Live 1-2009 et Live 2-2010 (2013)
Alain Meilland : Léo de Hurlevent (2012)
Philippe Guillard : Philippe Guillard chante Léo Ferré (2013)
LetZeLéo : LetZeLéo joue et chante Léo Ferré (2013)
Natasha Bezriche : Lumière noire (2013)
Interprètes reprenant les poètes et paroliers mis en musique par Ferré
Années 40
Yvette Giraud : La Chambre
Années 50-60
Béatrice Arnac : Pauvre Rutebeuf
Michèle Arnaud : Pauvre Rutebeuf
Hugues Aufray : Pauvre Rutebeuf
Philippe Clay : Stances
Eddie Constantine : La Chanson du scaphandrier
Jacques Douai1 : La Chanson du scaphandrier, La Chambre, Pauvre Rutebeuf, Harmonie du soir
Jean Dréjac : Juke-box troubadour (paroles de Jean Dréjac)
Yvette Giraud : Le Pont Mirabeau
Zizi Jeanmaire : Les P'tits Hôtels (paroles de Bernard Dimey)
Pauline Julien : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, La Fille des Bois
Monique Leyrac : Harmonie du soir
Simone Langlois : Le Pont Mirabeau
Marc et André : Pauvre Rutebeuf
Hélène Martin : L'Affiche rouge, Je chante pour passer le temps, Pauvre Rutebeuf
Camille Maurane : La Chanson du mal-aimé (version 57)
Yves Montand : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, L'Étrangère
Germaine Montero : Pauvre Rutebeuf
Monique Morelli : L'Affiche rouge, Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, Il n'aurait fallu
Mouloudji : Des filles, il en pleut...
Nana Mouskouri : Pauvre Rutebeuf
Marc Ogeret : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, Merde à Vauban, Noël
Henri Salvador : La Chanson du scaphandrier
Catherine Sauvage : Pauvre Rutebeuf, Noël, La Fille des Bois, Tu n'en reviendras pas, Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, Je t'aime tant, Il n'aurait fallu, Je chante pour passer le temps, L'Affiche rouge, Elsa, Blues
Christine Sèvres : Âme, te souvient-il ?
Francesca Solleville : Je chante pour passer le temps, Tu n'en reviendras pas, Noël, Merde à Vauban, Blues, L'Affiche rouge, La Fille des bois
Les Trois Ménestrels : Des filles, il en pleut...
Cora Vaucaire : Pauvre Rutebeuf
Claude Vinci : L'Affiche rouge
Claude Goaty : Le bateau espagnol
Années 70-80
Leny Escudero : L'Affiche rouge
Bernard Lavilliers : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Yves Montand : Les Bijoux
Claude Nougaro : La Chanson du scaphandrier
Jacques Bertin : L'Affiche rouge, Noël
Années 90-2000
Isabelle Aubret : L'Étrangère, Blues, L'Affiche rouge, Il n'aurait fallu
Annick Cisaruk : L'Étrangère, Je chante pour passer le temps, Il n'aurait fallu, Tu n'en reviendras pas, Blues
Julien Clerc : On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans
D'elph : Marizibill
Brigitte Fontaine : Âme, te souvient-il ?
Gamine : Pauvre Rutebeuf
Miossec : Ô triste, triste était mon âme
Rita Mitsouko : Écoutez la chanson bien douce, Il patinait merveilleusement, Ô triste, triste était mon âme
Catherine Ribeiro : L'Affiche rouge
Sanseverino : L'Étrangère
Serge Utgé-Royo : L'âge d'or, Flamenco de Paris, Les anarchistes, Ni dieu, ni maître
Cora Vaucaire : Le Pont Mirabeau
Vaya Con Dios (Belgique) : Pauvre Rutebeuf
Françoise Kucheida: "Est-ce ainsi que les hommes vivent"
Années 2010
Interprètes reprenant Caussimon-Ferré
Serge Utgé-Royo (France) : Nous deux (2011)
Dominique A : Mon camarade
Arno (Belgique) : Comme à Ostende
Isabelle Aubret : Nous deux
Éric Barret : Le Temps du tango (instrumental)
Réda Caire : Le Temps du tango
Jean-Roger Caussimon : Monsieur William, Mon camarade, Mon Sébasto, Le Temps du tango, Comme à Ostende, Nous deux, Ne chantez pas la mort
André Claveau : Nous deux
Philippe Clay : Monsieur William
Julien Clerc : Mon camarade
les Frères Jacques : Monsieur William
Serge Gainsbourg : Monsieur William
Marc et André : Monsieur William
Renée Passeur : Le Temps du tango
Catherine Sauvage : Monsieur William
Cora Vaucaire : Le Temps du tango
Cali : L'Affiche rouge
Anne Gacoin : Comme à Ostende
Interprètes reprenant Ferré
Années 40
Renée Lebas : Elle tourne... la Terre
Édith Piaf : Les Amants de Paris
Suzy Solidor : L'Inconnue de Londres
Années 50-60
Michèle Arnaud : La Vie d'artiste, L'Étang chimérique, L'Inconnue de Londres, En amour, Le Bateau espagnol
André Claveau : L'Amour, Les Chéris, Les Parisiens
Philippe Clay : La Rue, Bleu blanc rouge
Eddie Constantine : Les Amoureux du Havre
Annie Cordy (Belgique) : Paname
Dany Dauberson : Paname
Jacques Douai : L'Inconnue de Londres, Les Forains, La Fortune, L'Étang chimérique, Le Bateau espagnol, Le Fleuve des amants, Mon p'tit voyou, Notre amour
Lily Fayol : Java partout
Anny Gould : Monsieur mon passé
Juliette Gréco : L'Amour, Dieu est nègre2, Le Guinche, Java partout, Jolie Môme, Paname, Paris canaille, Plus jamais, La Rue, T'en as
Pauline Julien : T'en as, L'Amour, Vingt ans, La Lune
Renée Lebas : L'Île Saint-Louis, Paris canaille
Marc et André : L’Île Saint-Louis, Le Bateau espagnol, Les Poètes…
Léo Marjane : Monsieur mon passé.
Los Machucambos : La Lune
Yves Montand : Flamenco de Paris, Paris canaille
Germaine Montero : Les Amoureux du Havre, Mon p'tit voyou, Le Piano du pauvre, La Chanson triste, Ma vieille branche, La Fortune, Le Temps du plastique
Mouloudji3 : Elle tourne... la Terre
Marc Ogeret : Le Piano du pauvre, Paris canaille, L'Île St-Louis, Flamenco de Paris
Renée Passeur : Les Rupins
Patachou : Le Piano du pauvre, La Fortune, Le Temps du plastique, Nous les filles
Colette Renard : Paris canaille
Henri Salvador : À Saint-Germain-des-Prés
Catherine Sauvage : une centaine de titres étalés du début des années 50 à la fin des années 70.
Serge et Sonia (Andréguy) : La Grande Vie, L'Amour, La Fortune, L'Étang chimérique, Java partout, Comme dans la haute, Dieu est nègre, La Maffia, La poésie fout l'camp, Villon !, Comme à Ostende, Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, L'Étrangère.
Francesca Solleville : L'Âge d'or, Vingt ans
les Trois Ménestrels : Les Amoureux du Havre
Cora Vaucaire : La Vie d'artiste
Années 70-80
Barbara : La Vie d'artiste
Mama Béa : Les Anarchistes
Jacques Bertin : Le Bateau espagnol, L'Étang chimérique
Jane Birkin : Avec le temps
Brégent (Canada) : Le Chien, La Mélancolie, Dieu est nègre, T'es rock, coco !
Dalida : Avec le temps, Col Tempo
François Deguelt : Avec le temps
Anny Gould : Avec le temps
Johnny Hallyday : Avec le temps
Jacques Higelin : Jolie môme
Hélène Martin : Avec le temps, À Saint-Germain-des-Prés
Nicoletta : Dieu est nègre
Patachou : Les Amants de Paris
Catherine Ribeiro : La Mémoire et la Mer
Catherine Sauvage : Avec le temps
Joan-Pau Verdier : Ni Dieu ni maître
Jean-Marie Vivier : Ça t'va, Barbarie
Années 90-2000
Noël Akchoté : C'est extra
Isabelle Aubret : Paris canaille
Éric Barret : La Vieille Pèlerine, L'Amour fou, E.P. Love (instrumentaux)
Alain Bashung : Avec le temps
Dan Bigras (Canada) : Avec le temps
Céline Caussimon : Mon P'tit Voyou
Annick Cisaruk : Y en a marre
Dionysos : Thank you Satan
Eiffel : Le Conditionnel de variétés
Nilda Fernandez : Les Anarchistes
Juliette Gréco : Avec le temps
Jacques Higelin : Jolie Môme
Ignatus : Vise la réclame
Michel Jonasz : Avec le temps, La Mémoire et la Mer
Patricia Kaas : Avec le temps
Katerine : L'Été 68
La Tordue : Jolie Môme
Éric Lapointe & Mario Pelchat : Avec le temps
Bernard Lavilliers : Préface, La Mémoire et la Mer
Eva Lopez : Col tempo sai (Avec le temps), Jolie Môme
Eddy Louiss et Richard Galliano : Avec le temps (instrumental)
Terez Montcalm (Canada) : C'est extra
Noir Désir : Des armes (musique : Noir Désir)
Gérard Pierron : La Mer noire
Prodige Namor : La Vie d'artiste
Catherine Ribeiro : La Mémoire et la Mer, Avec le temps
Marc Robine : Richard, La Mémoire et la Mer
Henri Salvador : Avec le temps
Hubert-Félix Thiéfaine : La Solitude
Jean Vasca : La poésie fout l'camp, Villon !
Cora Vaucaire : À Saint-Germain-des-Prés, Avec le temps
Vaya Con Dios (Belgique) : Vingt ans
David Venitucci : Avec le temps (instrumental)
Louis Ville : Y en a marre
Les Wampas : Les Anarchistes
Zebda : Vingt ans
Années 2010
Anne Sofie von Otter : Avec le temps
Mônica Passos : Avec le temps, La Mémoire et la Mer
R Wan : La Maffia
Place des arts : La Vie d'artiste
Youn Sun Nah : Avec le temps
Fabien Biancalani : Avec le temps
Albums collectifs & compilations
2003 : Avec Léo !
Les interprètes de Léo Ferré
Dans les pays non-francophones
Interprètes ayant consacré un album entier à Ferré
Enrico Médail (Italie) : Né Dio né padrone (1977)
Xavier Ribalta (Espagne) : Xavier Ribalta canta Léo Ferré (2001)
Têtes de bois (Italie) : Ferré, l'amore e la rivolta (2003)
Roberto Cipelli, Paolo Fresu, Gianmaria Testa (Italie) : F. à Léo (2007)
Amancio Prada (Espagne) : Vida de artista (2008)
Ester Formosa Quartet (Espagne) : Thank you Satan (2012)
Peter Hawkins (Angleterre) : Love and Anarchy : the songs of Léo Ferré (2 CD, 2013)
Interprètes reprenant les poètes et paroliers mis en musique par Ferré
Années 50-60
Joan Baez (États-Unis) : Pauvre Rutebeuf
Années 90-2000
Victoria Abril (Espagne) : Elsa
Marc Almond (Angleterre) : Abel and Cain (Abel et Caïn), Remorse of the dead (Remords posthume)
Interprètes reprenant Caussimon-Ferré
Serge Utgé-Royo (France) : Nous deux (2011)
Valeria Munarriz : Le Temps du tango
Gianmaria Testa (Italie) : Monsieur William
Interprètes reprenant Ferré
Années 50-60
Eartha Kitt (États-Unis) : The Heel (L'Homme)
Olle Adolphson (Suède) : Snurra min jord (Elle tourne la Terre)
Années 70-80
Paco Ibañez (Espagne) : Les Anarchistes
Patty Pravo (Italie) : Col tempo (Avec le temps)
Gigliola Cinquetti (Italie): Avec le temps
Années 90-2000
Victoria Abril (Espagne) : Jolie môme
Alice (Italie) : Col tempo (Avec le temps)
Didier Caesar (Allemagne) : So mit der Zeit (Avec le temps)
Dee Dee Bridgewater (États-Unis) : Avec le temps
Figli di origine oscura (Italie) : Les Anarchistes, Tu non d'ici mai niente (Tu ne dis jamais rien), Il tuo stile (Ton style)
Angélique Ionatos (Grèce) : Cette blessure
Barb Jungr (Angleterre) : Quartier Latin, Les Poètes
Jef Lee Johnson & Nathalie Richard (États-Unis & France) : Le Chien
Abbey Lincoln (États-Unis) : Avec le temps
Beverly Jo Scott (États-Unis) : C'est extra
Wende Snijders (Pays-bas) : Paris canaille, Avec le temps
Gianmaria Testa (Italie) : Les Forains, Les Poètes, Avec le temps
Paola Turci (Italie) : Tu non dici mai niente (Tu ne dis jamais rien)
Cristina Branco (Portugal) : Avec le temps
Années 2010
Cannibales & Vahinés (France & Pays-Bas) : Lazarus listen (Écoute-moi), Night and Day
Lucy Dixon (Angleterre) : Paname
Claudine Carle (Canada) : Col Tempo
Interprètes ayant écrit une chanson en hommage à Ferré
Boris Santeff : Musique monsieur Léo
Ann Gaytan : Thank you Ferré
Catherine Boulanger : Pour Léo
Romain Didier : Français toscan de Monaco
Nicole Croisille : Léo
Didier Barbelivien : Léo
Mama Béa : À Léo
Maurice Fanon : Mr Léo de Hurlevent
Francis Lalanne : À Léo
Joan Pau Verdier : Maledetto Leo
Joan Pau Verdier : Les Sentiers interdits
Patrick Sébastien : Au secours l'amour
(Pascal Auberson ) : Hello Léo tiré de l'album Kélomès 2007, chanson créér au théatre de Beausobre à Morges en Suisse.
(Michel Buzon): Graine d'albatros (Dans "Les réfugiés du dedans",long poème à Léo-1989 Maldoror/1990 sur "Repérages" Baillemont)
Franco Battiato
Arthur H
Alain Aurenche
Francis Lemarque
Alain Souchon
Liens :
http://www.babelio.com/livres/Ferre-Benoit-Misere/199279
http://www.babelio.com/livres/Ferre-Poete-Vos-papiers-/331769
http://www.babelio.com/livres/Bellere ... rre-une-vie-dartiste/6558
http://www.babelio.com/livres/Frot-Le ... -si-je-vous-disais/503542
http://fr.wikisource.org/wiki/Ci_enco ... z_de_la_Griesche_D%27Yver
http://fr.wikisource.org/wiki/Ci_enco ... inte_Rutebuef_de_son_oeul
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Mariage_de_Rutebeuf
http://youtu.be/QHsmFSHCd8s Ferré/Gabin
http://youtu.be/-rZO_x0ZPUA Ferré/Gabin
http://youtu.be/bK7slk0oisU Pauvre Ruteboeuf J. Baez
http://youtu.be/6MvQ3JUWxk0 Pauvre Rubteboeuf C. Sauvage
http://youtu.be/01mZX3F_05A Ferré. Il n'y a plus rien
        
Posté le : 13/07/2013 21:57
|
|
|
|
|
Lino Ventura |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 Juillet 1919 naît Lino Ventura
Présenté par Iktomi
« Dans ma petite tête de Parmesan… »,
comme il aimait à dire. C’est en effet à Parme qu’Angiolino Pasquale Ventura est né le 14 juillet 1919. Italien il est né, Rital il est resté, ayant toujours refusé la naturalisation.
Pourtant peut-on imaginer personnage plus français, voire franchouillard, que le brigadier Théo Dumas (Un taxi pour Tobrouk), que Fernand Naudin (Les tontons flingueurs), moins méditerranéen que Clément Tibère (Le Silencieux), ou que le commissaire Vergeat (Adieu poulet) ?
Tard venu au cinéma, à près de trente-cinq ans, il représente l’antithèse de ces jeunes prodiges, ces révélations âgées d’à peine vingt ans qui ne savent rien mais paraissent avoir tout compris. Lino Ventura ne paraissait pas, lui. Il était. Et il avait réellement compris : ce qu’il pouvait attendre du cinéma et ce qu’il pouvait lui donner.
Résultat : il suffit de regarder sa filmographie, il y a vraiment très peu de films devant lesquels on se demande ce qu’il est allé faire dans cette galère (pour ma part, je mettrai Boulevard du rhum dans cette catégorie, mais ce choix n’engage que moi). Lino Ventura, jouer dans de mauvais films ? Allons donc ! Lino Ventura, être mauvais dans un film ? Jamais !
« J'ai dérouillé de quatre briques et morflé de cinq ans dans vos farces et attrapes… » lui fait dire Audiard dans La métamorphose des cloportes. C’est que, justement, on ne lui faisait pas dire ou faire n’importe quoi. Parce que Lino Ventura c’était avant tout une grande pudeur.
Alors vouloir lui faire rouler une pelle à Angie Dickinson (L’homme en colère), c’était de la pure inconscience de la part de Claude Pinoteau. Souvenez-vous aussi des Barbouzes : vers la fin du film, quand Francis Lagneau (Ventura, donc) est censé avoir passé une nuit torride avec la très blonde et juvénile Amaranthe (Mireille Darc, rien que ça !), ladite Amaranthe est très peu vêtue alors que Lagneau a tout juste tombé la cravate…
Ce n’était certes pas un homme enclin à la haine, mais il n’en avait pas moins quelques aversions bien prononcées.
Contre le mépris tout d’abord, et spécialement le mépris envers les humbles. « Un garçon de café, je lui dit monsieur » avait-il confessé lors d’une interview télévisée. Le respect réciproque, c’était son crédo. Avoir des égards pour autrui, il voulait bien tant que ça marchait dans les deux sens : « Faut pas me louper, sinon ça peut aller très, très loin. »
Aversion pour les intellectuels aussi, plus exactement pour une certaine catégorie d’entre eux : les petits donneurs de leçons très « rive gauche » qui s’ingéniaient à opposer le cinéma d’auteur aux films « commerciaux », lesdits films étant nécessairement formatés pour un public de cérébro-déficients.
Lino Ventura s’insurgeait contre cette pose pour ce qu’elle avait de méprisant – ce qui ramène à son aversion numéro un – et aussi parce qu’il y avait flairé une grande malhonnêteté intellectuelle.
Car qui oserait encore prétendre qu’on ressort plus intelligent (ou moins bête ?) d’A bout de souffle que de Classe tous risques ?
Une petite tête de Parmesan, peut-être, mais aussi un très grand coeur que ceux qui ne le connaissaient pas bien ont découvert lorsque Perce-Neige a été fondée.
Ce coeur qui l'a lâché le 22 octobre 1987. L'ultime farce et attrape, mais vraiment la moins drôle.
Sa vie
Lino Ventura est le fils de Giovanni Ventura et Luisa Borrini.
En 1927, il est âgé de sept ans lorsqu'il quitte l'Italie avec sa mère pour rejoindre son père parti travailler comme représentant de commerce à Paris quelques années auparavant. Par fidélité à ses origines, il n'a jamais consenti à prendre la nationalité française, comme cela lui fut souvent suggéré.
Lino Ventura parlait le français sans aucun accent, ayant passé l'essentiel de sa vie en France, et s'exprimait au contraire en italien avec une pointe d'accent français.
Il quitte rapidement l'école et commence à travailler dès l'âge de huit ans.
Il exercera successivement divers métiers : groom, mécanicien, représentant de commerce et employé de bureau.
C'est le sport qui va l'emporter. Il devient lutteur professionnel poids moyens sous le nom de Lino Borrini qui fut plus tard, de manière erronée, considéré par certains comme son véritable nom.
Il sera aussi catcheur.
En 1942, il épouse Odette Lecomte son amour de jeunesse dont il a quatre enfants :
Mylène en 1946,
Laurent en 1950,
Linda en 1958 et
Clelia en 1961.
En 1950, il est champion d'Europe poids moyens de lutte gréco-romaine, puis à la suite d'un accident, une grave blessure à la jambe droite au cours d'un combat contre Henri Cogan, qui deviendra acteur lui aussi. Passionné il deviendra organisateur de combats
ter. Passionné par son activité, il se reconvertit en organisateur de combats. Il est notamment un habitué de la Salle Wagram à Paris.
En 1953, tout à fait par hasard, un de ses amis parle de lui au réalisateur Jacques Becker qui cherchait un italien pour jouer face à Jean Gabin dans son film Touchez pas au grisbi. La rencontre se fait et Jacques Becker lui propose illico le rôle d'Angelo que Lino refusera dans un premier temps.
À la sortie de Touchez pas au grisbi, sa présence est telle que toute la profession le remarque.
Il est immédiatement adopté par le milieu du cinéma, par Jean Gabin avec qui il devient grand ami et par le public grâce à sa carrure, sa « gueule » et son exceptionnel naturel de comédien qui font de lui l'interprète idéal du film noir, de truand et de policier dur à cuire au grand cœur.
Sans avoir pris de cours de comédie, il va rapidement gravir les échelons ; il est tout d'abord acteur de complément, puis accède rapidement aux premiers rôles, son jeu d'acteur s'affinant.
Il devient l'un des poids lourds du cinéma hexagonal et restera à tout jamais reconnu comme l'un des meilleurs acteurs du cinéma français.
Père d'une enfant inadaptée, à cause d'un problème à la naissance, sa fille Linda née en 1958, il a créé avec son épouse Odette en 1966 l'association humanitaire Perce-Neige à Saint-Cloud, là où il vivait, avec pour but « l'aide à l'enfance inadaptée ».
Il décède le 22 octobre 1987 à Saint-Cloud, à l'âge de 68 ans d'une crise cardiaque après 34 ans de carrière cinématographique et 75 films. Il repose au cimetière du Val-Saint-Germain dans l'Essonne.
Filmographie
• 1954 : Touchez pas au grisbi de Jacques Becker : Angelo, le chef de la bande rivale
• 1955 : Razzia sur la chnouf de Henri Decoin : Roger, Le Catalan
• 1956 : La Loi des rues de Ralph Habib : Mario
• 1956 : Crime et Châtiment de Georges Lampin : Le patron du bistrot
• 1957 : Le Feu aux poudres de Henri Decoin : L'inspecteur Legentil
• 1957 : Action immédiate de Maurice Labro : Bérès
• 1957 : Trois Jours à vivre de Gilles Grangier : Lino Ferrari, l'accusé à tort
• 1957 : Le rouge est mis de Gilles Grangier : Pépito, le truand au couteau
• 1957 : L'Étrange Monsieur Steve de Raymond Bailly : Denis
• 1957 : Maigret tend un piège de Jean Delannoy : L'inspecteur Torrence
• 1958 : Ces dames préfèrent le mambo de Bernard Borderie : Paulo
• 1958 : Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle : Le commissaire Cherrier
• 1958 : Montparnasse 19 de Jacques Becker : Morel
• 1958 : Le Gorille vous salue bien de Bernard Borderie : Géo Paquet, dit « Le Gorille », agent de la D.S.T
• 1958 : Sursis pour un vivant de Víctor Merenda : Borcher
• 1959 : Douze heures d'horloge de Geza Radvanyi : Fourbieux
• 1959 : Marie-Octobre de Julien Duvivier : Carlo Bernardi
• 1959 : 125, rue Montmartre de Gilles Grangier : Pascal, le vendeur de journaux
• 1959 : Un témoin dans la ville de Édouard Molinaro : Ancelin; l'assassin poursuivi
• 1959 : Le Chemin des écoliers de Michel Boisrond : Tiercelin, le restaurateur collaborateur
• 1959 : Le fauve est lâché de Maurice Labro : Paul Lamiani
• 1960 : Classe tous risques de Claude Sautet : Abel Davos
• 1960 : Les Mystères d'Angkor de William Dieterle : Biamonte
• 1961 : Un taxi pour Tobrouk de Denys de La Patellière : Théo Dumas
• 1961 : La Fille dans la vitrine de Luciano Emmer : Federico
• 1961 : Le Roi des truands de Duilio Coletti : Le truand
• 1961 : Le Bateau d'Émile de Denys de La Patellière: Emile Bouet, pêcheur
• 1961 : Les Lions sont lâchés de Henri Verneuil : Le Docteur Challenberg
• 1961 : Le Jugement dernier de Vittorio de Sica : Le père
• 1962 : Le Diable et les Dix Commandements de Julien Duvivier : Garigny, le proxénète
• 1962 : Les Petits Matins de Jacqueline Audry : Le chauffeur de bus
• 1962 : L'Opéra de quat'sous de Wolfgang Staudte : Tiger Brown
• 1963 : Les Tontons flingueurs de Georges Lautner : Fernand Naudin
• 1963 : Cent mille dollars au soleil de Henri Verneuil : Hervé Marec
• 1963 : Carmen 63 de Carmine Gallone : Vincenzo
• 1964 : Les Bandits (Llanto por un bandito) de Carlos Saura : El Lutos
• 1964 : Les Barbouzes de Georges Lautner : Francis Lagneau, un barbouze
• 1964 : Le Monocle rit jaune de Georges Lautner : Le client d'Elie (caméo)
• 1965 : L'Arme à gauche de Claude Sautet : Jacques Cournot
• 1965 : Les Grandes Gueules de Robert Enrico : Laurent, un repris de justice libéré
• 1965 : La Métamorphose des cloportes de Pierre Granier-Deferre : Alphonse
• 1966 : Avec la peau des autres de Jacques Deray : Pascal Fabre
• 1966 : Ne nous fâchons pas de Georges Lautner : Antoine Beretto
• 1966 : Le Deuxième Souffle de Jean-Pierre Melville : Gustave Minda, dit « Gu »
• 1967 : Les Aventuriers de Robert Enrico : Roland
• 1968 : Le Rapace de José Giovanni : Le Rital
• 1969 : Le Clan des Siciliens de Henri Verneuil : L'inspecteur Le Goff
• 1969 : L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville : Philippe Gerbier
• 1970 : Dernier domicile connu de José Giovanni : L'inspecteur Marceau Léonetti
• 1971 : Fantasia chez les ploucs de Gérard Pirès : Sagamore Noonan
• 1971 : Boulevard du rhum de Robert Enrico : Cornelius
• 1972 : Cosa Nostra de Terence Young : Vito Genovese
• 1972 : Le Silencieux de Claude Pinoteau : Clément Tibère
• 1972 : La Raison du plus fou de Raymond Devos et François Reichenbach : Le motard
• 1972 : L'aventure c'est l'aventure de Claude Lelouch : Lino Massaro
• 1973 : La Bonne Année de Claude Lelouch : Simon
• 1973 : Far West de Jacques Brel : Le prisonnier
• 1973 : L'Emmerdeur de Édouard Molinaro : Milan, le tueur professionnel
• 1974 : Les Durs (Uomini Duri / Three tough guys) de Duccio Tessari : Le Père Charlie
• 1974 : La Gifle de Claude Pinoteau : Jean
• 1975 : Adieu poulet de Pierre Granier-Deferre : Le Commissaire Verjeat
• 1975 : La Cage de Pierre Granier-Deferre : Julien
• 1976 : Cadavres exquis (Cadaveri Eccellenti) de Francesco Rosi : L'Inspecteur Amerigo Rogas
• 1978 : Un papillon sur l'épaule de Jacques Deray : Roland Fériaud
• 1978 : La Grande Menace (The Medusa Touch) de Jack Gold : L'Inspecteur Brunel
• 1978 : L'Homme en colère de Claude Pinoteau : Romain Dupré
• 1980 : Les Séducteurs de Édouard Molinaro : François Quérole
• 1981 : Garde à vue de Claude Miller : L'inspecteur Antoine Gallien
• 1981 : Espion, lève-toi de Yves Boisset : Sébastien Grenier
• 1982 : Les Misérables de Robert Hossein : Jean Valjean, l'ancien forçat
• 1983 : Cent Jours à Palerme (Cento Giorni a Palermo) de Giuseppe Ferrara : Le général Carlo Dalla Chiesa
• 1983 : Le Ruffian de José Giovanni : Aldo Sévenac
• 1984 : La Septième Cible de Claude Pinoteau : Bastien Grimaldy
• 1987 : La Rumba de Roger Hanin : Le caïd du milieu (non crédité)
• 1987 : Maledetto ferragosto (Film inachevé)
• 1987 : La Jonque (Film inachevé)
Hommage
En 2003, la ville de Parme lui rend hommage en donnant son nom au centre du cinéma de la commune : Centro cinema Lino Ventura.
Bibliographie
• 1979 : Lino Ventura, Gilles Colpart - Éditions PAC - Monographie
• 1980 : Lino Ventura, Didier Vallée - Éditions Solar
• 1987 : Lino Ventura, Philippe Durant - Éditions Favre - Monographie
• 1992 : Lino, Odette Ventura - Éditions Robert Laffont - Biographie
• 2003 : Lino, tout simplement, Clelia Ventura (sa fille) - Éditions Robert Laffont - Souvenirs d'enfance et recettes de famille
• 2004 : Lino Ventura - Une leçon de vie, Clelia Ventura (sa fille) - Éditions Marque pages - Biographie
• 2007 : Signé : Lino Ventura, Clelia Ventura (sa fille) - Éditions Marque pages - Beau livre avec 20 objets facsimilés
• 2008 : Dictionnaire des comédiens français disparus, Yvan Foucart - Mormoiron : Éditions cinéma, 2008, 1185 p. (ISBN 978-2-9531-1390-7)
• 2010 : Les légendes du cinéma français, Lino Ventura, Bernard Boyé - Éditions Autres Temps - Album photos retraçant sa carrière cinématographique
• 2012 : Lino Ventura, Carnet de Voyages, Clelia Ventura (sa fille) - Éditions Barnea Productions -
Liens
http://www.perce-neige.org/
http://youtu.be/gJm9Sm8RpOQ interview
http://youtu.be/jFyzXIfXlBE Le ruffian film entier
http://youtu.be/UNtSgKz9ues un témoin dans la ville 1959
http://www.youtube.com/watch?v=DTr8_R ... e&list=PL260F39206C1648BF L'aventure c'est l'aventure
http://youtu.be/OYKXadKOSNA L'emmerdeur
http://youtu.be/Ai1NxKdOngA l'emmerdeur
http://youtu.be/HmI6co3ensE les tontons flingueurs
http://www.youtube.com/watch?v=Frrp6L ... e&list=PLCF98691FEF56BD04 les tontons fligueurs
      
Posté le : 13/07/2013 21:41
|
|
|
|
|
Re: Luis Mariano |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
J'ai été bercée par "Mexico" chez mes grands-parents ainsi que d'autres de ses succès. Quand je l'entends, je retourne en enfance.
Posté le : 13/07/2013 20:19
|
|
_________________
Belge et drôle et vice versa.
|
|
|
Luis Mariano |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 juillet 1970 meurt Luis Mariano
Ce ténor talentueux, fera briller l'opérette et pour qui à eut la chance de connaître le théâtre du châtelet dans cette époque de bonheur, empli de danse, de chant, de scène envahie de musique, de ballets aux mille couleurs, l'enchantement était garanti et probablement inoubliable.
Luis-Mariano Eusebio Gonzalez y Garcia est né à Irun dans le pays basque espagnol, le 13 Août 1914. fils d'un mécanicien. Il fait d'abord partie de l'Orphéon Donostiarra de Saint-Sébastien, chœur mixte où il est ténor solo. De 1937 à 1939 il est deuxième ténor dans le groupe vocal Eresoinka avec lequel il chantera salle Pleyel à Paris, puis à Chaillot, à l'Opéra, il se produira ensuite à Bruxelles, Amsterdam et Londres. Sa famille se réfugie en France, à Bordeaux, au moment de la guerre civile espagnole et la défaite du parti républicain, alors que son pays souffre sous la botte franquiste. Son père reprends son métier de mécanicien et sa mère fait des ménages et des travaux de couture. Le jeune Luis attire par le dessin entre à l'école des beaux-arts de bordeaux. De plus il chante. Alors que pour se faire quelque argent, il travaille à la plonge du cabaret "Le caveau des chartrons" le chef d'orchestre du cabaret découvre la "voix d'or" de jeune Luis, qui passera directement des cuisines à la salle où ses prestations seront très applaudies.
Reçu au concours d'entrée du conservatoire de bordeaux, sous la direction de Gaston Poulet, il est remarqué par Jeannine Micheau, qui s'aperçoit qu'on lui fait travailler des rôles trop lourds pour lui. La cantatrice lui fait connaître Miguel Fonteca, dont les leçons lui seront bénéfiques.
En septembre 1942, Luis Mariano quitte le Conservatoire de Bordeaux, se rend à Paris muni d'une lettre d'introduction de Jeanine Micheau et va recevoir des leçons du grand ténor basque, le maestro Miguel Fonteca. Cet éminent professeur va lui enseigner le "bel canto", technique de chant dans la plus pure tradition lyrique italienne se caractérisant par la beauté du son et la recherche de la virtuosité.
Luis-Mariano affronte la scène du Palais de Chaillot en décembre 1943, dans le rôle d'Ernesto de Don Pascual, au coté de Vina Bovy et Gilbert Maurin.
En attendant le résultat d'une audition à l'opéra comique il chante dans des spectacles de variété à la radio. Il commence à être connu.
En 1943, il apparaît dans le film « L'escalier sans fin » aux côtés de Madeleine Renaud et de Pierre Fresnay. Le jeune Luis Gonzalez y chante « Seul avec toi », un titre signé Loulou Gasté.
C'est en 1944 que Luis Gonzalez devient Luis Mariano, comme en témoignent la presse et les affiches de l'époque.
En 1945, Luis enregistre ses premiers disques : « Amor Amor » et « Besame mucho ». En avril, il se produit au Théâtre de Chaillot avec la cantatrice sud-américaine Carmen Torres. En novembre de la même année, toujours à Chaillot, il partage l'affiche avec Édith Piaf et Yves Montand.
Il fait la connaissance de Francis Lopez et Raymond Vinci.
Il crée et chante "La belle de Cadix", qui devait décider de sa carrière 24 décembre au théâtre du Casino Montparnasse.
C'est grâce à cette opérette qu'il accéda à la célébrité en 1945, puis suivra une autre opérette tout aussi fameuse : , "Le Chanteur de Mexico", opérette de Francis Lopez. Il devint alors, à la scène comme au grand écran, le prince de l'opérette.
Prévue pour six semaines de représentations "la belle de Cadix" devait tenir l'affiche pendant cinq ans. La popularité de Luis-Mariano grandit rapidement. Pendant une dizaine d'années il domine le monde de la chanson et de l'opérette.
Le disque qui est tiré de l'Opérette et qui comprend le titre Maria Luisa explose le Box-office : 1.250.000 exemplaires seront vendus.
Pathé-Marconi est obligé de réaménager ses chaînes de productions pour faire face à la demande.
La popularité de Luis Mariano grandit rapidement. Pendant une dizaine d'années, il domine le monde de la chanson et de l'opérette. On l'entend notamment dans Fandango en 1949.
Dans les années 1951.1952 il est à l'apogée de sa carrière, c'est l'époque d'or du "chanteur de Mexico" et du film "violettes impériales".
Au théâtre il triomphe dans Andalousie 1947, le chanteur de Mexico 1951, chevalier du ciel 1955.
Pour le cinéma, de 1945 à 1958, Mariano tourne une vingtaine de films qui seront traduits dans de nombreuses langues. Le tour de chant lui permet de se produire aux quatre coins du monde : USA en 1949, Amérique du sud 1952. Il reçoit les ovations de foule énorme qui l'attend à chaque escale d'avion ou de bateau. Les mouvements de foule sont si enthousiastes que l'on craint pour sa sécurité en Uruguay; A Montévidéo, c'est plus de 60 000 personnes qui l'accueillent à la passerelle du transatlantique, on comptera plus de 100 000 personnes à ses concerts, et c'est 160 000 personnes qui l'applaudissent au stade de Mexico
En 1957 et 1959, il accompagne la caravane du cirque Pinder sur les routes de France, puis il se produit à l'Olympia.
Mariano a toujours autant de succès sur les théâtres d'opérettes : Le Secret de Marco Polo (1959), Visa pour l'amour (« véritable jouvence pour l'artiste »), le Prince de Madrid (1967), sont de véritables succès.
Les années 1958-1960 marquent un certain tournant dans la carrière de Mariano.
C'est la vague des "yéyés" qui envahit les ondes et les écrans de télévision.
Si Mariano a toujours autant de succès sur les théâtres d'opérettes : la cancion d'el amor mio à Madrid en 1958 le Secret de Marco Polo en 1959, et surtout le Prince de Madrid en 1967, il ne tourne plus et ses incursions dans la chanson se font plus rares. L'époque est entièrement changée.
Signalons toutefois une tournée triomphale en Roumanie 1966, et l'enregistrement d'un disque de chansons Espagnoles et d'un disque de chansons Napolitaines. En province il a fait des reprise très remarquées du chanteur de Mexico et de la belle de Cadix, pour le vingtième anniversaire de la création.
En décembre 1969 il assure la création de la "Caravelle d'or" au Châtelet, mais terrassé par la maladie probablement une hépatite, mal diagnostiquée, il doit abandonner son rôle au bout de quelques mois.
Ce merveilleux ténor espagnol aura vécu la majeure partie de sa vie en France.
Il était titulaire de diverses décorations, dont l'ordre espagnol d'Isabelle la Catholique.
Sa santé était bien fragilisée quand à la suite d'une hémorragie cérébrale il est transporté le 13 juillet 1970 à l'Hôpital de la Salpêtrière à Paris, où il décède le 14 Juillet .Il avait 55 ans.
Sa tombe à Arcangues est encore visitée et fleurie par ses fans plus de quarante ans après sa mort.
Luis Mariano était célibataire, cependant sa relation avec Patchi Lacan, son chauffeur et ami rencontré en 1949, est souvent interprétée comme une liaison homosexuelle sans que cela ne soit jamais avéré.
Il a par ailleurs adopté le fils de Patchi, Mariano Lacan, qu'ils ont élevé ensemble, et il a légué sa maison à son fils adoptif mais c'est Patchi qui va la gérer.
---------------------------
Opérettes
La musique des opérettes créées par Luis Mariano est de Francis Lopez, à l'exception de celle de Chevalier du ciel composée par Henri Bourtayre.
La Belle de Cadix 1945,
Andalousie 1947,
Le Chanteur de Mexico 1951,
Chevalier du ciel 1955,
La canción del amor mío 1958,
Le Secret de Marco Polo 1959,
1961 : Visa pour l'amour de Raymond Vinci et Francis Lopez, mise en scène René Dupuy, Théâtre de la Gaîté-Lyrique
Le Prince de Madrid 1967,
La Caravelle d'or 1969.
Films
1937 : Ramuntcho de René Barberis - Figuration chantée
1942 : Le chant de l'exilé de André Hugon - Un jeune Basque
1946 : L'Escalier sans fin de Georges Lacombe - Le chanteur
1946 : Luis-Mariano chante de Louis Leclerc - court métrage , 22 min - Lui même
1946 : Histoire de chanter de Gilles Grangier - Gino Fabretti
1946 : Gai Paris : Music-hall de Lucette Gaulard - court métrage
1947 : Cargaison clandestine de Alfred Rode
1948 : Fandango de Emil-Edwin Reinert
1948 : Je n'aime que toi de Pierre Montazel - Don Renaldo
1949 : Pas de week-end pour notre amour de Pierre Montazel - Franck Reno, la vedette
1949 : Vedettes en liberté de Jacques Guillon - court métrage, documentaire 20 min - Lui-même
1951 : Andalousie de Robert Vernay : Juanito Var
1951 : El Sueño de Andalucia de Luis Lucia Mingarro : Juanito Var
1951 : Au pays basque de Pierre et Jean-François Apestéguy - court métrage, documentaire de 750 m - Lui-même
1951 : Rendez-vous à Grenade de Richard Pottier - Mario Da Costa
1952 : Violettes impériales - (Violetas imperiales) de Richard Pottier - Juan de Ayala
1953 : La Belle de Cadix de Raymond Bernard et Eusebio Fernandez Ardavin - Carlos
1953 : Paris chante toujours de Pierre Montazel - Participation en chanteur
1953 : La Route du bonheur - (Saluti e baci) de Maurice Labro et Giorgio Simonelli - Participation en chanteur
1953 : L'Aventurier de Séville - (Aventuras del barbero de Sevilla) de Ladislao Vajda - Figaro
1953 : Le Tsarévitch - (Der Zarewitsch) de Arthur Maria Rabenalt - Luis Mariano / Aljoscha
1953 : Quatre jours à Paris de André Berthomieu - Mario, le coiffeur pour dames
1955 : Sur toute la gamme de Maurice Regamey - court métrage
1955 : Napoléon de Sacha Guitry - Le chanteur Garat
1956 : Le Chanteur de Mexico - (El cantor de México) de Richard Pottier - Miguel Morano et Vincent Etchebar, son sosie
1956 : À la Jamaïque de André Berthomieu - Jacques Gardell
1956 : Printemps à Paris de Jean-Claude Roy
1958 : Sérénade au Texas de Richard Pottier
1960 : Candide ou l'Optimisme au XXe siècle de Norbert Carbonnaux - Un dictateur sud-américain
1964 : Les pieds dans le plâtre de Jacques Fabbri et Pierre Lary - L'agriculteur
De nombreux films ont été adaptés des opérettes où il avait triomphé à la scène.
Quelques-uns de ses succès
L'Amour est un bouquet de violettes
Andalucia mia
Acapulco (de l'opérette le Chanteur de Mexico)
Maria-Luisa (de l'opérette la Belle de Cadix)
Granada
J'ai dans mon cœur une chanson
España (de l'opérette le Prince de Madrid)
La Vie est là
Mattinata
Mayoumba
Je chante pour toi que j'aime (du film Histoire de chanter)
le Ciel luisait d'étoiles (de l'opéra Tosca)
Mélodie pour toi (du film Cargaison clandestine)
Prière péruvienne
Cavalier du grand retour (reprise de Gilbert Bécaud)
Plus je t'entends (reprise à Alain Barrière)
Oublie-moi
Mexico
La Belle de Cadix
Rossignol de mes amours
Olé toréro
Visa pour l'amour (avec Annie Cordy)
Quand on est deux amis (avec Bourvil)
Il est un coin de France - 1957
Le Charme de Dolorès
Maman la plus belle du monde
Marco Polo (de l'opérette le Secret de Marco Polo)
le Voyageur sans étoile (reprise du grand prix du Coq d'or 1961 créée par John William)
Combien de nuits (Tonight de l'opéra West Side Story)
-----------------------------
Son fils adoptif
«j'ai grandi dans le culte de Luis Mariano»
Publié le 21/04/2013
à l'interview du dimanche
Luis Mariano et son fils adoptif Mariano Lacan. Aujourd'hui âgé de 48 ans, Mariano Lacan confie à la Cinémathèque sa collection de souvenirs.
Mariano Lacan, fils adoptif de Luis Mariano vient de confier à la Cinémathèque de Toulouse sa collection privée de souvenirs. Un cadeau impérial pour la capitale des violettes !
Adopté par son parrain Luis Mariano quand il était petit, Mariano Lacan, 48 ans, est le fils de Patchi Lacan, ami et homme de confiance du prince de l'opérette et d'une danseuse. il porte aussi le nom de Gonzalès y Garcia, véritable patronyme du créateur de «Violettes Impériales». C'est grâce au «fils» de Luis Mariano que la Cinémathèque de Toulouse va récupérer tous les souvenirs artistiques et personnels du chanteur qui étaient conservés dans sa maison à Arcangues (Pyrénées-Atlantiques).
Qu'est-ce qui vous a décidé à ressortir tous ces souvenirs, plus de 40 ans après la mort de Luis Mariano ?
Il faut se rendre compte que pour mon père, c'était difficile de se dessaisir de tous ces souvenirs car c'est toute sa vie. Il s'est battu pour conserver Arcangues. Ma sœur et moi on a grandi dans le souvenir, dans le culte de Luis Mariano. La maison est restée telle qu'elle était du vivant de Luis Mariano. Comprenez que le sujet des archives était un peu tabou pour mes parents. Je pense que leur rencontre avec Henri-Jean Servat, qui prépare un livre sur Luis Mariano pour le centenaire de sa naissance les a aidés à se décider.
Pourquoi avez-vous choisi la cinémathèque de Toulouse pour mettre à l'abri cette collection, plutôt qu'une structure au Pays Basque, ou à Paris ?
La Cinémathèque de Toulouse a des compétences reconnues, qui sont pour ma famille un gage de sérieux et de qualité. Il y a aussi le fait que Toulouse n'est pas très loin de chez nous. Ce qui va nous permettre de nous investir dans la sauvegarde de cette collection. A mon niveau cet aspect de pérennité est très important car c'est aussi l'histoire, même un peu lointaine, de mes enfants. On a trouvé avec la Cinémathèque de Toulouse un partenaire, un allié pour que l'on continue à parler de Luis Mariano. Ces archives seront accessibles aux universitaires, à ceux qui veulent aller un peu au-delà de sa carrière d'acteur et chanteur d'opérette.
Que déposez-vous exactement à la Cinémathèque ?
Il y a les copies de tous ses films, des affiches, beaucoup de photos, plusieurs costumes de scène comme l'habit de torero qu'il portait dans «La Belle de Cadix». Et de nombreux films en 16 millimètres qui sont exploitables.
Des films personnels ?
Oui. En 1946 Luis Mariano avait acheté une caméra avec laquelle il filmait ses voyages pour montrer les endroits où il allait à sa mère. Et puis assez vite c'est mon père qui a tenu la caméra et qui l'a filmé en tournée, dans les loges, sur les tournages, avec des amis, des célébrités, en famille… J'ai envie que les gens connaissent ces différentes facettes. Peu de gens savent qu'il dessinait ses décors, qu'il peignait. C'est lui qui a dessiné la maison d'Arcangues. C'était aussi quelqu'un de gentil, abordable, aussi à l'aise avec le général de Gaulle qu'avec ses cousins pêcheurs à Irun.
Vous souvenez-vous de lui ?
Je me souviens d'endroits où on est allés comme la maison du Vésiney. Je me rappelle bien aussi de l'odeur de cuir dans la Rolls ! Je ne me rendais pas bien compte, pour moi c'était quelqu'un de normal, mon parrain, on était sa famille.
Son centenaire en 2014
«La belle de Cadix», «L'amour est un bouquet de violettes», «Mexico», «Fandago du Pays Basque», «Rossignol de mes amours», «Il est un coin de France»… ces pépites extraites des joyeuses opérettes de Luis Mariano peuvent paraître ringardes à certains mais elles font partie du patrimoine et plaisent encore. La preuve, l'album de Roberto Alagna, et sa tournée «hommage à Luis Mariano» en 2 011 ont fait un succès. En 2014, pour le centenaire de sa naissance, on va beaucoup revoir Luis Mariano et réentendre sa sublime voix de ténor. Des projets sont dans les tuyaux : un spectacle musical qui pourrait être donné dans les Arènes de Bayonne en juillet, un livre du journaliste Henri Jean Servat, et un probable hommage à la Cinémathèque de Toulouse.
----------------------------------
Hommage de Gaby NOUARD
‘’ Luis Mariano Éternel’’ en hommage a Luis Mariano pour le 40ème anniversaire célébrant sa mort.
la chanson inédite "Luis Mariano Prince de lumière"
interprète Tony Gama , Musique de Gaby Nouard
En 1949 Luis Mariano cherchait un chauffeur. C’est Patchi Lacan qui a été retenu. Depuis, une complicité durable s’est installée. Ils ne se sont plus quitté jusqu'aux derniers instants où Patchi ferma les yeux de son vénéré ami Luis Mariano. Patchi qui a partagé dans une tourmente passionnante durant 21 ans une vie malheureusement bien trop courte, fut à la fois son confident, serviteur, chauffeur, secrétaire et deviendra son héritier. On évoque le tandem Luis Mariano, Francis Lopez ; il en est un autre dont on ne parle pas et qui fut tellement intense entre ces deux hommes : Patchi et Luis.
Mariano a fait de Patchi l’héritier de sa maison basque qu’il occupe avec son épouse Françoise et ses enfants sans y avoir rien changé « gardant intacts leurs souvenirs des jours heureux ». La maison ne se visite pas ; un bosquet de pins et de mimosas préserve leur intimité familiale. Quarante ans après ce 14 juillet 1970, date à laquelle Luis Mariano fut mis en terre à Arcangues où il repose dans le caveau avec ses parents, la famille Gonzalèz, chaque jour qui passe Patchi se recueille sur la tombe de son fidèle ami. Une tombe magnifiquement fleurie à souhait et entretenue avec minutie.
Ce site d’Arcangues, se compose de la mairie, du fronton, d’un bar et de la belle église qui jouxte le cimetière. Ou chaque dimanche, cette église de grès rouge, dédiée à Saint Jean Baptiste, est comble, outre les offices dominicaux, on y célèbre régulièrement des messes pour le repos de l’âme du vénéré Luis Mariano.
Cette sépulture ne cesse d’avoir la visite d’un public fidèle qu’accompagne le chant des oiseaux et du rossignol. La tombe de Gonzalèz qui est la dernière dans l’allée à la sortie du cimetière ayant accès sur la petite route qui mène au Syndicat d’initiative, donnant sur une prairie ouverte où il n’est pas rare de trouver les poules du fermier voisin qui pénètrent librement dans le cimetière.
Depuis de nombreuses années, j’ai l’honneur d’entretenir une relation amicale avec Françoise et Patchi Lacan, Ces liens qui nous unissent sont d’autant plus réconfortants pour moi qui suis avant tout un fervent admirateur de Luis Mariano. J’éprouve une profonde gratitude à l’égard de Françoise et Patchi qui préservent avec amour et fidélité les souvenirs du prince d’Arcangues de plus en plus visité après 40 ans qui nous séparent de ce 14 juillet 1970…
J’ai une chanson qui lui est dédiée, intitulée « J’aurais voulu chanter avec Luis Mariano », en août 2010 en hommage au 40éme anniversaire de la mort de Luis Mariano, l’édition Marianne Mélodie a inséré en chanson ‘’Bonus’’ dans son album cette chanson sous l’intitulé ‘’ Luis Mariano Prince de Lumière’’ ainsi qu’un CD nommé ‘’ Luis Mariano L’éternel’’ vente en grande distribution. Ma grande satisfaction de voir bon nombre d’artistes qui interprètent mes chansons du Pays Basque…
Puis et arrivée une formidable opportunité qui s’offrait à moi, la rencontre tout à fait par hasard en 1960 aux Folies bergères où le chef d’orchestre qui était un ami, m’a fait connaître Daniel Ringold, Un auteur compositeur récent dans le métier, ayant écrit pour des vedettes de grand renom, au passage : Jacqueline François, Maurice Chevalier, Tino Rossi, Frank Alamo, etc.
Il avait annoncé qu’il était sur le point de devenir le parolier attitré de Luis Mariano, se qui s’est avéré exact à peine un an plus tard. La suite, ces 88 chansons écrites pour Luis Mariano. Dans la foulée, c’est à la demande de Luis Mariano que Daniel Ringold est devenu le premier collaborateur de Francis Lopez, ayant signé les lyrics de 35 livrets d’opérette depuis Gipsy jusqu'à la Caravelle d’Or.
Devenu moi-même un proche de Francis Lopez, il acceptait que son parolier Daniel Ringold écrive sur mes musiques. Je souligne que je suis le seul compositeur à qui Francis Lopez accordait un tel privilège. Ce qui s’est traduit par 300 textes sur mes musiques. Une trentaine d’artistes de Francis Lopez m’ont honoré de leurs interprétations, notamment dans l’émission télévisée de Pascal Sevran.
Début 1970 Nous avons fait Daniel Ringold et moi-même sur ma musique une chanson d’hommage aux mamans qui ne sont plus… « Maman, c’est un Noël sans toi ». Daniel voulait la faire écouter à Luis Mariano, persuadé qu’il aurait enregistré et aimé la chanter à la date anniversaire du décès de sa maman en mai 1959. Hélas, c’était au début de l’année 1970, avec la création la Caravelle d’or et Luis était déjà très fatigué par sa maladie, ce qui n’a pas permis de réaliser ce rêve. Ce sera le plus grand regret de ma vie, car si cette chanson avait été dans le répertoire de Luis Mariano, je pense qu’elle aurait eu une place d’honneur dans son cœur. J’aurais été lié à jamais à ce prince de l’Opérette...
Mais rien ne peut être dit sans rendre hommage à Françoise et Patchi. C’est bien à cet adorable couple que revient le mérite, quarante ans après la disparition de Luis Mariano, d’entendre toujours sa voix rayonner et ses chansons reprises par les plus grands.
Beaucoup d’artistes font carrière sur le répertoire de notre illustre ténor basque et la nouvelle génération n’est pas en reste. C’est sur qu’il vont donner un nouveau look au tempo dans les rythmiques… Si c’est bien et beau, pourquoi pas, ne sont-ils pas formidables et talentueux nos jeunes ?
Personnellement, et pour les raisons décrites dans cette page, j’aimerais rendre un hommage à Patchi Lacan et à Françoise son épouse pour leur engagement à maintenir le souvenir de notre idole Luis Mariano. Un hommage qui pourrait être l’occasion de réunir les artistes qui ont écrit des chansons d’hommage à leur maître, mais aussi à tous ceux qui souhaitent donner leur prestation à cette célébration. Je pense aux artistes, mais également aux clubs de Luis Mariano. La date n’est pas encore fixée, mais j’invite tous ceux qui voudraient participer à cette fête à m’envoyer un message en pièce jointe.
Mon attachement à cette grande famille de l’opérette, je la dois à Rudy Hirigoyen qui fût durant de nombreuses années la doublure que Luis Mariano avait choisi pour alterner les représentations du théâtre du Châtelet où, faut il le rappeler, une opérette tenait l’affiche entre un et trois ans !
Rudy Hirigoyen qui m’a tout appris dans cet art, est un ami que je connais depuis 1947. Nos familles étaient voisines. Précisément, la tradition voulait que nos familles se réunissent pour partager les gâteaux d’anniversaire. Et c’est 10 ans plus tard que Rudy m’a présenté à Francis Lopez. De là s’est installée une amitié jusqu’au derniers instant.
Mon instinct de mélodiste n’a pas échappé au charme de se Sud-Ouest qui flirte avec le Pays Basque.
On retrouve dans mon répertoire des farandoles basques, des paso-doble, des valses et berceuses espagnoles sur des textes de Daniel Ringold qui savait trouver les mots pour ce beau Pays Basque.
Merci à Patchi et Françoise Lacan et à l’équipe de la logistique d’Arcangues pour les photos de Luis Mariano et de ses amis : elles sont pour la plupart des inédits. Elles m’ont été confiées par Patchi avec l’autorisation d’en insérer dans mon site pour le plus grand plaisir des « Marianistes ».
Ce texte a été rédigé par Gaby Nouard
---------------------------------
L'héritage
Luis Mariano, un héritage tabou : l'insoluble malaise entre son fils adoptif et son frère de coeur !
Luis Mariano : Bataille familiale autour de son héritage, entre son frère de coeur Patchi Lacan et son fils adoptif Mariano Lacan (fils biologique de Patchi)...
Quarante ans après le décès du plus beau sourire de l'opérette, les amicales dédiées à la mémoire de Luis Mariano se réduisent à peau de chagrin : l'art du ténor menace de s'abîmer dans la poussière ; ses adeptes, vieillissant, s'amenuisent ; seule sa tombe, à Arcangues (Pyrénées-Atlantiques), semble vouée à être fleurie pour l'éternité
Et pourtant, quel talent, quelle success story, quelle frénésie bien avant l'avènement du starsystem moderne que l'on nomme showbizz ! Expatrié, jeune, à Bordeaux, le natif d'Irun (pays basque espagnol) y connaîtra, avant ses 30 ans, une ascension fulgurante : initié, après son entrée au conservatoire, au bel canto, Luis Mariano fera la rencontre décisive d'un autre Basque, Francis Lopez, et gagnera ses tout premiers galons de prince de l'opérette en portant au firmament La Belle de Cadix (d'après un livret de Raymond Vinci, qui devint dès lors le librettiste attitré de Lopez) composée par ce dernier : créée dans la discrétion inhérente à l'absence de moyens et à l'anonymat de son ténor, la pièce, initialement prévue pour une cinquantaine de dates en 1945, tiendra le haut de l'affiche... deux ans.
La suite, étincelante, appartient à la légende, aussi bien de l'opérette (Andalousie, Le Chanteur de Mexico, Le Secret de Marco Polo, Visa pour l'amour, Le prince de Madrid) que du cinéma (Histoire de chanter, Fandango, Je n'aime que toi, Violettes impériales...). Jusqu'à la fin abrupte du voyage sur les cimes du chant, avec cette Caravelle d'or créée au Théâtre du Châtelet et que Luis Mariano quitta contre sa volonté le 14 juillet 1970, décédant à la Pitié-Salpêtrière (Paris) des suites d'une maladie.
Le prince de l'opérette, son frère de coeur et "leur" fils...
Pas de compagne connue, pas même d'aventure connue, pas d'enfant : le chanteur de Mexico laisse pourtant des héritiers. Au premier rang, son "frère de coeur" Patchi Lacan, aujourd'hui âgé de 86 ans, qui, après leur rencontre, devint l'ami sincère et l'homme à tout faire de la vedette, qui l'embaucha comme chauffeur. Une fraternité qui alla jusqu'à l'adoption de l'enfant de Patchi par Mariano. A quelques jours du 40e anniversaire de la disparition de Luis Mariano, le JDD a rencontré Mariano Lacan, ce fils adoptif dont le père biologique est toujours vivant, qui revendique un héritage crucial : la maison du ténor à Arcangues ("Mariano ko Etchea, soit "la maison de Mariano"), léguée à son père Patchi, lequel "veut par-dessus tout conserver en l'état ce qui [leur] a été laissé". Mais voilà : Mariano a également des droits sur la propriété, et ne supporte pas de la voir s'empoussiérer et se détériorer plutôt que de devenir un lieu d'activité et de mémoire. Un héritage vivant. Il dénonce dans les colonnes du JDD cette situation "injuste et mensongère", qui risque de le contraindre à solliciter la justice pour changer le cours des choses contre le gré de son père - alors que ce sont bien leurs deux noms qui nous accueillent sur le site officiel dédié à Luis Mariano.
Pour bien comprendre l'ambiguité de la bataille autour de la propriété construite en 1960 sur un terrain de 20 hectares, le JDD retrace l'histoire de famille intense, la "relation fusionnelle" qui lie tous les protagonistes. En premier lieu, Luis Mariano et Patchi Lacan (qui corédigeait en 2006 une des biographies consacrées au prince de l'opérette) : "Issu, comme Luis Mariano, d'un milieu modeste, basque comme lui, orphelin à l'âge de 10 ans, cet enfant de l'Assistance publique, devenu garçon de ferme à Arcangues, monte à Paris et trouve un petit boulot de livreur chez Javel Lacroix. En 1949, son chemin de peine croise la trajectoire lumineuse d'une étoile dont il ne quittera plus le sillage : Luis Mariano, qui l'embauche comme chauffeur."
Un héritage devenu tabou : Mariano Lacan tiraillé entre ses deux papas...
C'est dans les coulisses d'une représentation de Mariano, dont il partage la vie fastueuse, que Patchi rencontre une danseuse, qui deviendra sa femme. "Peu après la naissance de leur fils aîné, Patchi choisit, malgré les réticences de sa femme, de "donner" son enfant au prince de l'opérette. Selon Patchi, c'est Mariano qui aurait proposé cet "arrangement", afin que la famille de son fidèle serviteur soit à l'abri du besoin s'il devait lui arriver malheur. Ainsi, en 1967, Luis Mariano adopte ce petit garçon dont il est déjà le parrain (...) Aujourd'hui âgé de 45 ans, Mariano Luis Lacan Gonzalez y Garcia ne condamne pas cet étrange pacte." Le fils, effectivement, comprend bien la "confiance aveugle" qui existait entre Luis Mariano et ceux qui étaient devenus pour lui une "famille de substitution". Et s'il n'avait que 5 ans à la mort de l'un, l'amitié de ses deux papas et le récit des aventures de cette grande famille, ce "clan à l'espagnole", font partie de sa vie : "Avec mes parents, ma soeur cadette et Luis Mariano, on faisait tout ensemble". "On était comme des bohémiens, renchérit Patchi (...) Et Mariano s'occupait plus de mon fils que moi-même".
Après le choc du décès de Luis Mariano en 1970, le second bouleversement survient en 2002, lorsque Mariano Lacan "apprend qu'il est le principal héritier du patrimoine légué par son père adoptif", et "réalise qu'il a toujours été écarté de la gestion du domaine" : "le testament rédigé en 1968 n'a pas été fait dans les règles, explique-t-il. Il a dû être interprété au terme d'une procédure qui a duré six ans. Les biens en Espagne sont revenus à la soeur de Luis Mariano et notre famille a hérité de la propriété d'Arcangues, mais d'une façon inextricable, car mes parents jouissent de l'usufruit jusqu'à leur mort, ma soeur a des droits sur la propriété et je possède la moitié du tout". Et de reprocher : "Depuis quarante ans, tout est gelé par mon père, qui veut par-dessus tout conserver en l'état ce qui nous a été laissé. Il a agi comme si Luis Mariano était encore vivant, et il s'est imposé comme son unique dépositaire. Il a décidé seul du devenir d'un patrimoine qui nous appartient pourtant aussi".
A tel point que : "Mon avenir, celui de ma femme, de mes enfants, de ma soeur, tous nos projets sont liés à cette propriété". Une propriété dans l'entretien de laquelle sont englouties toutes les royalties, en pure perte - il a même fallu vendre des parcelles du terrain...
Mais pour envisager un avenir, il faut affronter le "gardien du temple" - le père, chahuter le souvenir, braver la mort : "Le temps, la vie se sont subitement arrêtés [quand Luis Mariano est mort]. Chacun de nous s'est refermé sur lui-même. Voilà quarante ans que mes parents vivent dans le passé. Le deuil n'a jamais été fait. Quant à moi, j'ai été élevé dans le souvenir. J'ai vécu toutes ces années avec un mort à mes côtés." Voici venir le temps de la résurrection ?
Liens :
http://www.youtube.com/watch?v=qMkFM6 ... e&list=PL597A4E8AA78B2B2D 14 Titres
http://youtu.be/jHEv8ueJWKQ La samba Brésilienne
http://youtu.be/UUv5FduE4Q4 maman la plus belle du monde
http://youtu.be/YDecLPXm_ws Andalousia 1951
http://youtu.be/Hr3Y3VVtmBQ La belle de Cadix
http://youtu.be/ZEBKeoOMJBw enterrement
Posté le : 13/07/2013 19:16
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
98 Personne(s) en ligne ( 70 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 98
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages