|
|
Louise-Victorine Ackermann |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 3 août 1890, à 76 ans, meurt près de Nice, Louise-Victorine Ackermann,
de son nom, Louise-Victorine Choquet naît à Paris le 30 novembre 1813, poétesse française du mouvement Parnasse, ses oeuvres principales sont Contes, Garnier, Paris en 1855, Contes et Poésies en 1863, Poésies philosophiques, Caisson et Mignon, Nice en 1861. Poésies, Premières Poésies, Poésies philosophiques, Lemerre, Paris en 1874, ma vie, Premières Poésies, Poésies philosophiques. Paris: Lemerre en 1885 puis 1893.
.
Sa vie
Louise-Victorine Choquet est née à Paris, de parents parisiens, d'origine picarde. Son père, voltairien et amoureux des lettres, lui fera donner une éducation éloignée de l'enseignement religieux. Il sera l'initiateur des premières lectures de sa fille. De tempérament indépendant, il quittera Paris à trente-trois ans pour la solitude de la campagne, emmenant avec lui sa femme et ses trois filles.
Louise vivra une enfance solitaire. Son tempérament studieux et méditatif se déclarera très tôt, la mettant à l'écart des enfants de son âge et de ses sœurs. Sa mère, qui se fait mal à la vie campagnarde, est rongée par l'ennui et sera peu conciliante envers sa fille aînée.
Elle exige que celle-ci fasse sa première communion, pour respecter les conventions mondaines. Louise découvre ainsi la religion en entrant en pension à Montdidier, et y porte tout d'abord une adhésion fervente, qui alarme son père. Ce dernier lui fait lire Voltaire, et l'esprit du philosophe créera le premier divorce entre Louise Choquet et le catholicisme.
De retour de pension, elle poursuit ses lectures et études dans la bibliothèque paternelle, et découvre Platon et Buffon.
C'est vers cette époque qu'elle commence à faire ses premiers vers. Sa mère s'en inquiète, ayant une prévention envers les gens de lettres. Elle demande conseil à une cousine parisienne, qui lui recommande au contraire de ne pas brider les élans de sa fille mais de les encourager.
Louise est alors mise en pension à Paris, dans une grande institution dirigée par la mère de l'abbé Saint-Léon Daubrée. Élève farouche, elle est surnommée l'« ourson » par ses camarades de classe, mais devient vite la favorite de son professeur de littérature, Félix Biscarrat ami intime de Victor Hugo.
Découvrant que Louise compose des vers, Félix Biscarrat porte même certaines de ses œuvres à Victor Hugo qui lui donne des conseils.
Félix Biscarrat nourrit les lectures de son élève en lui fournissant les productions des auteurs contemporains. Elle découvre également les auteurs anglais et allemands, Byron, Shakespeare, Goethe et Schiller.
La lecture parallèle de la théologie de l'abbé Daubrée la fait renoncer définitivement à la pensée religieuse, même si elle avoue dans ses mémoires avoir eu par la suite des rechutes de mysticisme.
Au terme de trois années de pension, elle regagne sa famille où elle poursuit l'étude et la composition en solitaire, faisant découvrir à ses proches les auteurs modernes, Hugo, Vigny, Musset, Sénancour.
Mais le décès de son père la privera bientôt du seul soutien familial qui valorisait ses compétences littéraires.
Sa mère lui interdit la fréquentation des auteurs, et Louise renonce pour un temps à la poésie. Elle obtient en 1838 qu'on la laisse partir à Berlin pour un an, dans une institution modèle de jeunes filles dirigée par Schubart. Ce dernier l'aidera à parfaire son allemand, et elle sera sous le charme de la ville de Berlin, qu'elle définit ainsi :
"La ville de mes rêves. À peu d'exceptions près, ses habitants ne vivaient que pour apprendre ou enseigner."
Elle y reviendra trois ans plus tard, après le décès de sa mère. Elle y rencontre le linguiste français Paul Ackermann, ami de Proudhon, qui en devient amoureux et qu'elle épouse sans réel enthousiasme :
Je me serais donc passée sans peine de tout amour dans ma vie ; mais rencontrant celui-là, si sincère et si profond, je n'eus pas le courage de le repousser. Je me mariai donc, mais sans entraînement aucun ; je faisais simplement un mariage de convenance morale.
À sa grande surprise, ce mariage sera parfaitement heureux, mais bref : Paul Ackermann décède de maladie le 26 juillet 1846, à l'âge de 34 ans.
Très éprouvée par son veuvage, Louise rejoint une de ses sœurs à Nice, où elle achète un petit domaine isolé. Elle consacre plusieurs années aux travaux agricoles, jusqu'à ce que lui revienne l'envie de faire de la poésie.
Ses premières publications ne suscitent que peu d'intérêt, mais retiennent tout de même l'attention de quelques critiques, qui en font la louange tout en blâmant son pessimisme qu'ils attribuent à l'influence de la littérature allemande.
Elle se défendra de cette influence, réclamant pour sienne la part de négativisme de ses pensées, et démontrant que celle-ci apparaissait déjà dans ses toutes premières poésies.
Son autobiographie révèle une pensée lucide, un amour de l'étude et de la solitude, ainsi que le souci de l'humanité qui transparaîtra dans ses textes.
Citations
Considéré de loin, à travers mes méditations solitaires, le genre humain m'apparaissait comme le héros d'un drame lamentable qui se joue dans un coin perdu de l'univers, en vertu de lois aveugles, devant une nature indifférente, avec le néant pour dénouement.
Mon enfance fut triste. Aussi haut que remontent mes souvenirs, je n'aperçois qu'un lointain sombre. Il me semble que le soleil n'a jamais lui dans ce temps-là. J'étais naturellement sauvage et concentrée. Les rares caresses auxquelles j'étais exposée m'étaient insupportables ; je leur préférais cent fois les rebuffades.
Ma paresse et mon indolence s'arrangeraient fort bien de garder mes Contes en portefeuille. Mon talent de fraîche date me fait l'effet de ces enfants survenus tard et sur lesquels on ne comptait pas. Ils dérangent terriblement les projets et menacent de troubler le repos des vieux jours.
Pour écrire en prose, il faut absolument avoir quelque chose à dire ; pour écrire en vers, ce n'est pas indispensable
La Nature sourit, mais elle est insensible : Que lui font vos bonheurs.
Œuvres
Louise-Victorine Ackermann, sur Wikimedia Commons Louise-Victorine Ackermann, sur Wikisource
Toute l'œuvre de Louise Ackermann, mise en lumière par Geruzez, Caro et Havet, se composait de trois volumes de contes et de poésies, plusieurs fois réimprimés et dont le mérite poétique était très loué par ceux-mêmes qui en blâmaient les tendances ou les prétentions philosophiques. Ils avaient pour titre :
Contes, Garnier, Paris, 1855. Réédités en 2011 avec un appareil critique de Victor Flori, aux éditions du Livre unique.
Contes et Poésies 1863
Poésies philosophiques, Caisson et Mignon, Nice, 1861.
Poésies. Premières Poésies. Poésies philosophiques, Lemerre, Paris, 1874.
Œuvres de Louise Ackermann : Ma vie, Premières Poésies, Poésies philosophiques. Paris: Lemerre, 1885 puis 1893.
Condensant en prose ses doctrines ou ses impressions pessimistes, elle a donné un recueil de poésie des Pensées d'une solitaire précédé d'une autobiographie (1883)
Pensées d'une solitaire, précédées de fragments inédits, Lemerre, Paris, 1903. Rééditées avec le Journal de Madame Ackermann par les éditions du Livre unique en 2008, avec un appareil critique de Victor Flori.
Bibliographie
Un poète positiviste, article de Elme-Marie Caro, dans l’édition du 15 mai 1874 de la Revue des deux mondes.
Pontmartin, Armand comte de, Madame Ackermann: la poésie athée , Nouveaux samedis
Madame Ackermann, Comte d'Haussonville, Paris, Alphonse Lemerre, 1892.
Préface de Louise Read à l’édition d’Alphonse Lemerre des Pensées d’une solitaire en 1903.
La Poésie philosophique au XIXe siècle, thèse de doctorat de Marc Citoleux, Paris, Plon, Nourrit et Compagnie, 1906.
Thérive, André, « À propos de Mme Ackermann », La Revue critique des idées et des œuvres, 24, janvier-mars 1914, p. 142-154.
Le Séjour de Madame Ackermann à Nice de Bernard Barbery, Toulouse, L’Archer, 1923.
La Conscience embrasée d’Aurel, Paris, Radot, 1927.
Préface de Marie Delcourt et Dorothée Costa à l’édition L’Harmattan des Œuvres en 2005.
Préface de Victor Flori à l’édition critique au Livre unique des Pensées d’une solitaire en 2008.
Préface de Victor Flori à l’édition critique au Livre unique des Contes en 2
          [img width=600]http://ecimages.kobobooks.com/Image.ashx?imageID=zlfAPGHejku9m4Ib0Y1sWw[/img] 
Posté le : 01/08/2014 22:05
|
|
|
|
|
Re: Défi du 26 juillet |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35559
|
Mais j'aime le saucisson Kjtiti et ta citation est tellement vraie !
à ta santé donc mon ami.
Posté le : 01/08/2014 18:35
|
|
|
|
|
Re: Défi du 26 juillet |
|
Administrateur  
Inscrit:
30/05/2013 12:47
Niveau : 34; EXP : 7
HP : 0 / 826
MP : 540 / 26799
|
Chère couscous, voila une belle histoire qui est finalement une hymne à la vie, et quand celle ci n'est pas charitable, alors, il faut s'envelopper dans le cocon de son âme, se faire chrysalide et attendre la métamorphose, car elle arrive toujours.
De manière moins poétique , mais plus réaliste Cavana prétendait:'' La chenille devient papillon, le cochon devient saucisson, c'est une grande loi de la nature. ''
Merci couscous et mille excuses pour cette citation alimentaire, mais accompagnée d'un petit rosé de Touraine ...................!!!
Posté le : 01/08/2014 18:31
|
|
_________________
Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …
Titi
|
|
|
Alexandre Soljenitsine |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 3 août 2008 à Moscou à 89 ans, meurt Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne
en russe : Александр Исаевич Солженицын, ISO : Aleksandr Isajevič Solženicyn né le 11 décembre 1918 à Kislovodsk RSFS de Russie, écrivain et dissident russe, auteur notamment d'Une journée d'Ivan Denissovitch, de L'Archipel du Goulag et de La Roue rouge, autres Œuvres principales, Le Premier Cercle, Le Pavillon des cancéreux, il est distingué du Prix Nobel de littérature en 1970, le Prix Templeton en 1983, le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 2000, et le Prix d'État en Russie en 2007.
En Bref
" Tout passe, seule la vérité reste " proclame un proverbe russe. Pour Soljenitsyne, toute sa vie sera une tentative obstinée pour répondre à cette grande question : Cette vérité, comment contribuer à la faire triompher ?
Proscrit d'U.R.S.S. en février 1974, Alexandre Soljénitsyne est rentré en Russie en juillet 1994. Vingt ans d'exil, vingt ans d'écriture forcenée en sa retraite américaine du Vermont n'avaient pas entamé l'énergie du dissident, ni la force du prophète. Il choisit de rentrer lentement, étape par étape, d'est en ouest. Son avion fit escale à Magadan, cette porte de l'enfer concentrationnaire de la Kolyma ; tel un pape, Soljénitsyne baisa ce sol foulé par les martyrs anonymes auxquels son monumental Archipel du Goulag avait donné parole. À chaque gare les anciens zeks détenus venaient à sa rencontre. Chaque soir, le maître écoutait les doléances d'un public désorienté par la chute du communisme, les réformes économiques, la perte d'un empire. Humiliés et offensés avaient trouvé leur porte-parole attentif. Une fois de plus, Soljénitsyne disait non. Non à la liberté économique débridée, non à la confiscation de la démocratie par les anciens profiteurs. Soljénitsyne n'est pas un politicien, il ne présente pas un programme susceptible de rassembler des adhésions. Il est avant tout un rebelle, un prophète qui dit non. Une grande part du malentendu actuel entre lui et l'Occident vient de ce que l'Occident a toujours mal perçu la racine spirituelle du non de Soljénitsyne. Cette racine est religieuse : l'homme Soljénitsyne a trouvé la foi dans le dénuement absolu des camps ; son premier refus a été celui de l'avilissement, de l'homme matriculaire. De ce refus central sont venus les autres : refus de la parole serve l'idéologie, refus des pouvoirs qui annihilent les personnes, refus du progrès économique transformé en veau d'or, du libéralisme politique en tant que fauteur d'une jungle économique et sociale. Ces refus ont leur histoire, Soljénitsyne ne les a pas tous articulés d'un coup, mais l'un contenait l'autre.
Un poète de l'énergie
On a parfois accusé Soljénitsyne de passéisme artistique. Parce qu'il croit encore au personnage de roman. Et il est vrai que Soljénitsyne croit au réel, à l'autonomie humaine, à la révélation de l'homme dans l'épreuve. Du camp il garde et gardera à tout jamais la rapidité de réflexe du zek, l'ironie libératrice, la haine des fabriques industrielles du déchet humain. Mais à la Quête du Graal et au Parzifal d'Eschenbach il emprunte une lumière mystique qui baigne ses chevaliers du renoncement.
Cette quête de l'énergie et du vrai marque entièrement sa langue : la langue de Soljénitsyne est immédiatement reconnaissable à sa poétique propre. Elle vise à une détente énergétique maximale, comme dans la langue populaire, et dans le proverbe. Elle élimine du russe les européanismes, gallicismes ou germanismes, elle restitue la syntaxe syncopée du parler populaire. Elle renoue avec les recherches linguistiques qui avaient marqué l'avancée poétique du début du siècle : Biely, Khlebnikov, et surtout Marina Tsvetaeva. Son œuvre de publiciste est également chargée de cette densité du langage, de cette énergie des raccourcis populaires. Ingénieur d'une histoire lourde qu'il grée de documents, de collages de matériaux et ponctue de la sanction ironique des proverbes-sentences, Soljénitsyne est aussi un maître de la forme courte : division des longs romans et brefs chapitres lyriques, condensation de l'histoire en nœuds, intenses pauses poétiques, poèmes en prose, tant ses Miettes en prose que les poèmes insérés dans le roman ; par exemple, dans Le Pavillon des cancéreux, le chapitre sur l'abricotier en fleur. Contre la langue de bois de l'idéologie, dénationalisée, énucléée, Soljénitsyne mène avec fureur et verve une lutte acharnée. Le premier péché de Lénine, pour lui, c'est son style.
Ainsi, le publiciste Soljénitsyne ne peut être lu et compris qu'à la lumière du poète, de l'historien, du réformateur du langage. De la Lettre aux dirigeants 1973)à Comment réorganiser notre Russie 1990 et Le Problème russe au XXe siècle 1994, Soljénitsyne reste un disciple du grand révolté religieux du XVIIe siècle : Avvakum, qui déclarait : Je n'ai cure de beau parler et n'humilie pas ma langue russe. Le commun dénominateur de toutes ses prises de position est la quête du vrai visage de la Russie, un visage altéré par l'occidentalisation forcenée de Pierre le Grand, occulté par le libéralisme athée des Milioukov et autres leaders bourgeois du début du XXe siècle, définitivement mutilé par le totalitarisme idéologique. Qu'il y ait chez Soljénitsyne un héritage de la tradition russe antioccidentale est évident. Il a lu avec soin le Journal d'un écrivain de Dostoïevski et les articles de Constantin Leontiev. Sa condamnation virulente des « rapaces » le rapproche tantôt des écologistes, tantôt des réformateurs religieux. Son œuvre d'historien est inséparable de celle du romancier et de son souffle de prophète. Ses imprécations contre l'Occident repu, sa conviction que la liberté sans la foi religieuse ne peut que dégénérer viennent d'un patriote russe qui prêche le renoncement à l'empire, d'un sceptique de la démocratie prêt à lutter pour restaurer en Russie le self-government local, les zemstvo. Insaisissable avec nos instruments occidentaux, l'homme au visage de prophète tire sa force d'avoir su lutter seul contre le Léviathan soviétique, et d'avoir senti vaciller le géant sous ses coups. Son retour en Russie est comparable à celui de Hugo en France. Il a su et faire vaciller le géant, et saisir dans ses mains fortes la matière historique de deux décennies fatales dans l'histoire russe. Sa « roue rouge » dévale à jamais l'histoire catastrophique de la Russie au XXe siècle. Mais le poète Soljénitsyne sait encore tendre tout son être dans l'extase d'une odeur de pommier.
Sa vie
Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne naît le 28 novembre/11 décembre 19184 à Kislovodsk, dans le nord du Caucase. La famille de Soljenitsyne, de souche paysanne, était relativement aisée. Son père, Issaïe, est le premier à faire des études supérieure, Issaaki Sémionovitch Soljenitsyne, étudiant en philologie et en histoire à l'université de Moscou, s'engage volontairement dans l'armée russe dès l'été 1914 et sert en Prusse-Orientale. Au printemps 1918, devenu officier, de retour du front, il se blesse grièvement lors d'un accident de chasse et meurt d'une septicémie le 15 juin 1918 à l'hôpital de Gueorguievsk. La mère d'Alexandre, Taïssia Zakharovna Chtcherbak, d'origine ukrainienne, qui est fille d'un self-made man paysan de la région de la Kouma, est alors étudiante en agronomie à Moscou. Les parents d'Alexandre se sont connus à Moscou lors d'une permission d'Issaaki en avril 1917 et se sont mariés le 23 août 1917 dans la brigade d'Issaaki.
Jusqu'à l'âge de six ans, le jeune Alexandre est confié à la famille de sa mère tandis que celle-ci travaille comme sténodactylo à Rostov-sur-le-Don. Il reçoit des rudiments d'instruction religieuse, tout en étant admis parmi les Pionniers. L'origine sociale dite "malsaine" de sa famille maternelle lui vaut d'ailleurs une exclusion temporaire de l'organisation. À Rostov, il partage avec sa mère un petit logement de neuf mètres carrés situé à proximité de l'immeuble de la Guépéou.
Épris très jeune de littérature, ayant fait ses premiers essais littéraires alors qu'il était collégien, Alexandre Soljenitsyne choisit néanmoins de poursuivre des études universitaires de mathématiques et de physique. À la fois parce qu'il n'y avait pas de chaire de littérature à l'université de Rostov et pour des raisons alimentaires. Il suit des cours de philosophie et de littérature par correspondance ; il s'inscrit à un cours d'anglais et suit également des cours de latin. Comme il le reconnaissait volontiers, à l'époque il adhère encore à l’idéologie communiste dans laquelle il a grandi.
Le 27 avril 1940, il épouse Natalia Alexeïevna Rechetovskaïa, une étudiante en chimie et pianiste dont il fait la connaissance en septembre 1936. Il passe avec succès ses examens finaux de mathématiques le 16 juin 1941. Il est à Moscou pour ses examens de littérature le 22 juin 1941, quand éclate la guerre contre le Troisième Reich.
La guerre
Lors de l'invasion allemande en 1941, il manque d'abord de se faire réformer, puis, à l'automne 1941, il est engagé comme soldat dans une troupe hippomobile à l'arrière avant d'obtenir le 14 avril 1942 — à sa demande — une place à l'école d'artillerie. Fin 1942, il est nommé commandant d'une batterie de repérage par le son. Il combat comme officier de l'Armée rouge, et sera décoré en 1944 de l'Étoile rouge pour sa participation à la prise de Rogatchov.
Le Goulag
En 1945, il est condamné à huit ans de prison dans les camps de travail pour activité contre-révolutionnaire, après avoir critiqué dans sa correspondance privée la politique de Staline ainsi que ses compétences militaires. Dans une lettre interceptée par la censure militaire, Soljénitsyne reprochait au génialissime maréchal, meilleur ami de tous les soldats, selon les qualificatifs officiels d'avoir décapité l'Armée rouge lors des purges, d'avoir fait alliance avec Hitler et refusé d'écouter les voix qui le mettaient en garde contre l'attaque allemande, puis d'avoir mené la guerre sans aucun égard pour ses hommes et pour les souffrances de la Russie Nous étions deux qui échangions nos pensées en secret : c'est-à-dire un embryon d'organisation, c'est-à-dire une organisation !.
Au début 1952, Natalia Rechetovskaïa, qui a été renvoyée de l'université d'État de Moscou en tant qu'épouse d'un ennemi du peuple en 1948, demande et obtient le divorce. À sa sortie du camp en février 1953, quelques semaines avant la mort de Staline, Soljenitsyne – matricule CH-262, anciennement matricule CH-232 – est envoyé en exil perpétuel au Kazakhstan. Il est réhabilité le 9 avril 1956 et s'installe à Riazan, à 200 km au sud de Moscou, où il enseigne les sciences physiques. Il se remarie avec Natalia le 2 février 1957, divorce à nouveau en 1972 pour épouser, l'année suivante, Natalia Dmitrievna Svetlova, une mathématicienne.
Auteur en URSS
C'est Une journée d'Ivan Denissovitch publié en 1962 dans la revue soviétique Novy Mir grâce à l'autorisation de Nikita Khrouchtchev en personne, qui lui acquiert une renommée tant dans son pays que dans le monde. Le roman décrit les conditions de vie dans un camp de travail forcé soviétique du début des années 1950 à travers les yeux d'un zek, Ivan Denissovitch Choukhov.
Il est reçu au Kremlin par Khrouchtchev. Cependant, deux ans plus tard, sous Léonid Brejnev, il lui est de plus en plus difficile de publier ses textes en Union soviétique. En 1967, dans une lettre au Congrès des écrivains soviétiques, il exige la suppression de toute censure – ouverte ou cachée – sur la production artistique .
Ses romans Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux, ainsi que le premier tome de son épopée historique La Roue rouge, paraissent en Occident et lui valent le prix Nobel de littérature en 1970, récompense qu'il ne pourra recevoir que quatre ans plus tard, après avoir été expulsé d'URSS. Il n'a en effet pas pu se rendre à Stockholm de peur d'être déchu de sa nationalité soviétique et de ne pouvoir rentrer en URSS, le gouvernement suédois ayant refusé de lui transmettre le prix à son ambassade de Moscou. Sa vie devient une conspiration permanente pour voler le droit d’écrire en dépit de la surveillance de plus en plus assidue du KGB.
Une partie de ses archives est saisie chez un de ses amis en septembre 1965. En 1969, alors qu'il est persécuté par les autorités et ne sait plus où vivre, il est hébergé par Mstislav Rostropovitch. Il manque d'être assassiné en août 1971, par un parapluie bulgare. Une de ses plus proches collaboratrices échappe de justesse à une tentative d'étranglement et à un accident de voiture.
En décembre 1973, la version russe de L'Archipel du Goulag parait à Paris, car le manuscrit avait pu être clandestinement sorti d'URSS et remis à l'imprimerie Beresniak, rue du Faubourg du Temple à Paris, une des rares imprimeries françaises à disposer des caractères typographiques cyrilliques.
Il y décrit le système concentrationnaire soviétique du Goulag, qu'il a vécu de l'intérieur, et la nature totalitaire du régime. L'ouvrage avait été écrit entre 1958 et 1967 sur de minuscules feuilles de papier enterrées une à une dans des jardins amis, une copie étant envoyée en Occident, par amis interposés qui risquaient gros pour échapper à la censure. Il décida sa publication après qu'une de ses aides, Élisabeth Voronianskaïa, fut retrouvée pendue : elle avait avoué au KGB la cachette où se trouvait un exemplaire de l’œuvre. L'ouvrage est, comme d'autres avant lui, un témoignage, mais contrairement à ceux qui l'ont précédé, il est extrêmement précis, sourcé, et cite de nombreuses lois et décrets soviétiques servant à la mise en œuvre de la politique carcérale, de sorte qu'il est beaucoup plus difficile aux négationnistes du Goulag de nier la véracité des faits décrits. Cette publication connaît une grande diffusion et le rend célèbre, ce qui lui vaut d'être déchu de sa citoyenneté soviétique et d'être arrêté. Mais, au lieu d'être condamné et incarcéré, il est expulsé d’Union soviétique en février 1974. En URSS, ses textes continuent cependant d’être diffusés clandestinement, sous forme de samizdats.
Auteur en exil
Grâce à l'aide de l'écrivain allemand Heinrich Böll, il s'installe d'abord à Zurich en Suisse, puis émigre aux États-Unis. Soljénitsyne devient alors la figure de proue des dissidents soviétiques, mais déjà apparaît, à travers ses interviews, un clivage avec certains de ses interlocuteurs qui le soupçonnent d'être réactionnaire ; il se montre en effet méfiant vis-à-vis du matérialisme occidental et attaché à l'identité russe traditionnelle, où la spiritualité orthodoxe joue un grand rôle.
Après une période agitée faite d'interviews et de discours, comme le fameux discours de Harvard prononcé en 1978 aux États-Unis, Soljenitsyne fut souvent invité à d’importantes conférences. Le 15 juillet 1975, il fut même invité à donner une conférence sur la situation mondiale au Sénat américain. L'Occident découvre alors un chrétien orthodoxe et slavophile très critique sur la société occidentale de consommation, et que les médias français classent dès lors parmi les conservateurs13. Comme Victor Serge ou Victor Kravtchenko avant lui, l'écrivain doit affronter une campagne supplémentaire de diffamation.
Il se retire avec sa famille à Cavendish, dans le Vermont, pour écrire l'œuvre dont il rêvait depuis sa jeunesse, La Roue rouge, une épopée historique comptant des milliers de pages, qui retrace la plongée de la Russie dans la violence révolutionnaire.
En 1983, il reçoit le prix Templeton.
Le 25 septembre 1993, à l'occasion de l'inauguration du Mémorial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, il prononce un célèbre discours sur les guerres de Vendée et la Révolution française, comparant ces événements, qu'il qualifie de génocide, aux soulèvements populaires anti-communistes en Russie. Il pose ainsi une réflexion sur l'idéalisme initial des révolutions, sur leur récupération par les plus violents des extrémistes, chaque fois que les conservateurs refusent de céder du terrain, et sur les bains de sang que cela représente pour les peuples. Aux yeux des révolutionnaires, il se classe ainsi parmi les réformistes qui visent à améliorer le capitalisme pour le rendre supportable.
Retour en Russie
Dans le cadre de la Glasnost menée par Mikhaïl Gorbatchev, sa citoyenneté soviétique lui est restituée, et L'Archipel du Goulag est publié en URSS à partir de 1989. Après la dislocation de l'Union soviétique, via la France où il participe à l'inauguration du Mémorial de la Vendée des Lucs-sur-Boulogne, en Vendée, le 25 septembre 1993, il rentre en Russie le 27 mai 1994, en arrivant par l'est, à Magadan, jadis grand centre de tri carcéral. Il met un mois à traverser son pays en train. Il résidera en Russie jusqu'à sa mort. Jusqu'en 1998, il conserve une activité sociale intense, il a sa propre émission de télévision, voyage à travers la Russie, rencontre une multitude de personnes et d'anciens déportés. La maladie interrompt cette activité.
Soljenitsyne vit ensuite retiré près de Moscou, au milieu de sa famille. Le Fonds Soljenitsyne aide les anciens zeks et leurs familles démunies en leur versant des pensions, en payant des médicaments. Après avoir pensé pouvoir jouer un rôle cathartique dans la Russie post-communiste, Soljenitsyne réalise que la nomenklatura a simplement changé d'idéologie, passant du communisme au nationalisme, mais qu'elle s'est maintenue aux affaires et que les démocrates, s'ils veulent convaincre, ne peuvent agir que sur les plans associatif et culturel, le plan politique étant entièrement verrouillé par Boris Eltsine, puis par Vladimir Poutine, seuls interlocuteurs agréés par l'Occident.
Déçus, les Russes, après l'avoir plus ou moins enterré, semblent ces derniers temps s'intéresser de nouveau à Soljenitsyne et redécouvrir la valeur de ses écrits politico-sociaux. Un colloque international a été consacré à son œuvre en décembre 2003 à Moscou. Le 12 juin 2007, le président Vladimir Poutine rend hommage à Soljenitsyne en lui décernant le prestigieux Prix d'État.
L'ancien dissident Viktor Erofeev estima que c'était vraiment un paradoxe douloureux de voir comment l'ancien prisonnier pouvait sympathiser avec l'ancien officier du KGB. Malgré plusieurs rencontres privées avec Poutine et des marques de sympathie réciproque, Soljenitsyne accusa la politique impérialiste du président russe d'épuiser à l'extérieur les forces vives de la nation et reprocha à son nationalisme de détourner les Russes des vrais enjeux de leur avenir. Ces positions sur la politique de la Russie sont expliquées dès 1990 dans son essai Comment réaménager notre Russie.
Il meurt à son domicile de Moscou à 89 ans dans la nuit du 3 au 4 août 2008 d'une insuffisance cardiaque aiguë. Il est enterré au cimetière du monastère de Donskoï. Ses funérailles sont retransmises en direct à la télévision russe.
Un engagement controversé, Œuvre et vision historique
Un des principaux symboles de la résistance intellectuelle à l'oppression soviétique, Alexandre Soljenitsyne a été régulièrement attaqué, ses ouvrages et interprétations historiques souvent dénoncés comme réactionnaires, principalement par la gauche occidentale. Les opérations de déstabilisation à son encontre n'ont pratiquement jamais cessé des années 1960 jusqu’aux années 1980, et au-delà jusqu'à sa mort.
Un zek détenu, manipulé par le KGB, l'a accusé d'être un informateur des autorités communistes, et a pour cela écrit une fausse dénonciation. Le KGB a fait écrire quelques livres contre lui par d'anciens amis, comme son ancien éditeur, Alec Flagon, et même par sa première femme.
Durant sa carrière littéraire, il aurait été successivement ou simultanément accusé d'être nationaliste, tsariste, ultra-orthodoxe, antisémite ou favorable à Israël, traître, complice objectif de la Gestapo, de la CIA, des francs-maçons, des services secrets français et même du KGB. Dans son autobiographie littéraire, Le grain tombé entre les meules, et plus récemment dans un article de la Litératournaïa Gazeta, Les barbouilleurs ne cherchent pas la lumière, Soljenitsyne a répondu à ces accusations en les juxtaposant pour montrer leur incohérence.
Soljenitsyne pense que si Staline n'avait pas décapité l'Armée rouge lors des Grandes Purges en 1937, s'il n'avait pas fait "aveuglément" confiance à Hitler, pacte germano-soviétique 1939-1941, s'il avait écouté les agents tels Richard Sorge qui le mettaient en garde contre l'attaque allemande du 22 juin 1941, l'invasion nazie aurait été moins désastreuse pour le pays. Soljenitsyne reproche aussi à Staline d'avoir envoyé au Goulag tous les soldats soviétiques prisonniers des Allemands se laisser capturer vivant étant considéré comme une trahison alors que la reconstruction du pays nécessitait la participation de tous.
Accusations d'antisémitisme
Soljenitsyne a fait régulièrement l'objet d'accusations d'antisémitisme, provenant d'auteurs juifs, en raison de ses travaux historiques sur la révolution bolchevique où il étudie l'implication des juifs au sommet de l'appareil d'État et de l'appareil répressif et, plus récemment, en raison de son opposition aux oligarques russes majoritairement juifs et de la publication de son ouvrage historique Deux siècles ensemble sur les relations entre Juifs et Russes de 1795 à 1995. L'écrivain et ancien dissident soviétique Vladimir Voïnovitch a ainsi voulu démontrer le caractère antisémite de ce livre dans une étude polémique.
En France, l'historien d'extrême gauche trotskiste Jean-Jacques Marie a consacré un article à chaque tome de Deux siècles ensemble, qu'il qualifie de bible antisémite. Selon lui, Soljenitsyne expose, dans Deux siècles ensemble, une conception de l'histoire des Juifs en Russie digne de figurer dans un manuel de falsification historique en écrivant une histoire des pogroms telle qu'elle a été vue par la police tsariste. L'historien britannique Robert Service a cependant défendu le livre de Soljenitsyne, arguant que les rapports de la police avaient intérêt à grossir, non à minimiser les faits et qu'une étude de la place des juifs dans le parti bolchevique n'était en rien antisémite par elle-même.
L'historien américain d'origine juive polonaise Richard Pipes, père du néoconservateur américain et ultrasioniste Daniel Pipes, dont les travaux sur l'histoire de la Russie soviétique avaient été qualifiés par Soljenitsyne de version polonaise de l'histoire russe a répondu à celui-ci en le taxant d'antisémitisme et d'ultra-nationalisme. En 1985, Pipes a développé son propos dans sa critique d'Août 14 : Chaque culture a une forme propre d'antisémitisme. Dans le cas de Soljenitsyne, celui-ci n'est pas racial. Cela n'a rien à voir avec le sang. Soljenitsyne n'est pas raciste, la question est fondamentalement religieuse et culturelle. Il présente de nombreuses ressemblances avec Dostoïevski, qui était un chrétien fervent, un patriote et un antisémite farouche. Soljenitsyne se place incontestablement dans la vision de la Révolution défendue par l'extrême droite russe, comme une création des Juifs.
Une comparaison avec Dostoïevski, reprise de manière plus flatteuse par le président français, Nicolas Sarkozy, qui déclara en 2008:
" Son intransigeance, son idéal et sa vie longue et mouvementée font d’Alexandre Soljenitsyne une figure romanesque, héritière de Dostoïevski. Il appartient au panthéon de la littérature mondiale. Je rends hommage à sa mémoire, l’une des plus grandes consciences de la Russie du XXe siècle. "
Les critiques apparaissent largement partisanes, provenant soit de l'extrême gauche soit des néoconservateurs, rien de proprement antisémite ne pouvant être relevé dans l'oeuvre de l'auteur et sa seconde épouse étant à moitié juive.
On peut rapprocher ces critiques de la campagne de presse menée en 1947 contre un des premiers dissidents Kravtchenko: la publication de son livre en France sous le titre J'ai choisi la liberté : La vie publique et privée d'un haut fonctionnaire soviétique donna lieu à une polémique retentissante et à de nombreuses attaques des milieux communistes. Le 13 novembre 1947, dans un article signé Sim Thomas, rédigé par le journaliste André Ullmann, l'hebdomadaire Les Lettres françaises, journal proche du Parti communiste français, l'accuse de désinformation et d'être un agent des États-Unis.
Positions politiques sur l'avenir de la Russie
Ses prises de position pour une période autoritaire de transition lui valurent de sévères critiques de la part de dissidents comme Andreï Siniavski et Andreï Sakharov, pour lesquels la Russie ne saurait se régénérer sans démocratie. En fait, Soljenitsyne n'est pas hostile à la démocratie en général, mais il ne croit pas que la Russie puisse passer du jour au lendemain d'un régime totalitaire à un régime de type occidental.
À la démocratie représentative à l'occidentale, qu'il perçoit comme génératrice d'une classe politique corrompue, coupée du peuple et soucieuse avant tout de ses propres intérêts, il oppose son souhait, pour la Russie, d'un pouvoir présidentiel fort, et d'une forme de démocratie locale constituée par un tissu d'associations gérant les affaires indépendamment du pouvoir qui, lui, ne devrait s'occuper que des affaires nationales, armée, politique étrangère, etc..
Il affirme dans son livre sur le réaménagement de la Russie que celle-ci peut emprunter à la Suisse le référendum d'initiative populaire.S’affirmant comme un fervent patriote, notion qu'il oppose au nationalisme du pouvoir, Soljenitsyne a désapprouvé la Première guerre de Tchétchénie, qui visait à empêcher l'indépendance tchétchène et luttait contre des patriotes, mais a approuvé la seconde alors que les indépendantistes étaient devenus islamistes, et selon lui, mafieux. Il a eu un commentaire favorable au président Poutine lors de son arrivée au pouvoir, espérant de lui des changements significatifs.
Alexandre Soljenitsyne n'a jamais démenti les accusations de royalisme portées contre lui par le pouvoir soviétique : pour lui, le bilan du tsarisme est supérieur à celui du communisme, en termes de satisfaction des besoins et d'élévation morale du peuple russe.
Ses convictions religieuses orthodoxes suscitent également de la méfiance dans les milieux républicains. Il fut également accusé d'être favorable aux dictatures militaires menées par Francisco Franco en Espagne et Augusto Pinochet au Chili : en fait, il déplorait surtout que l'occident s'émeuve beaucoup des crimes de ces dictateurs, et fort peu de ceux du régime soviétique, et il déclara en 1976 que l'on entendait plus parler du Chili que du mur de Berlin et que si le Chili n'existait pas, il faudrait l'inventer, ajoutant après la mort de Franco que les Espagnols vivaient dans la liberté la plus absolue de son vivant, soulignant la victoire du concept de vie chrétienne durant la guerre d'Espagne.
Toutefois, Alexandre Soljenitstyne admirait au moins deux formes de démocratie occidentale : celle des États-Unis, qu'il qualifia de « pays le plus magnanime et le plus généreux de la Terre. Il admirait aussi la démocratie suisse et dans son livre Le Grain tombé entre les meules, il écrit : Ah si l'Europe pouvait écouter son demi canton d'Appenzell. En revanche, il a parfois critiqué la politique menée par le gouvernement américain, par exemple sur la paix négociée au Vietnam, qu'il qualifie d' armistice stupide, incompréhensible, sans garantie aucune.
La Russie sous le fléau de Dieu
Août 14 est centré sur les dix jours d'août 1914 où se joua le sort de la IIe armée russe, commandée par le général Samsonov, qui se suicida à l'issue du désastre militaire. Le roman saisit les protagonistes en gros plan au moment mathématique où toutes les lignes du faisceau historique passent par eux. Contrairement à Tolstoï qui figure dans son roman, Soljénitsyne croit que l'histoire est faite par les individus ; il traque l'instant de vérité, où l'homme, seul, opte pour le bien ou le mal, le vrai ou le faux. En un sens, Soljénitsyne est existentialiste : l'homme est ce qu'il décide d'être. Les pages militaires de ce roman sont d'une grandiose poésie. La décision militaire, que ce soit celle du général en chef ou du simple fantassin, est un moment qui fascine Soljénitsyne : le moment de l'abnégation où l'homme, mystérieusement mû, se libère des lois de la pesanteur biologique et cesse de se protéger lui-même. Portraits de capitaines nés, dialogues de guerriers dans la nuit étoilée, complicité émouvante du simple soldat et de son chef, égaux dans le sacrifice de soi, violente satire des Q.G. de généraux incapables et couards : tout s'organise autour d'intenses moments poétiques : la métaphore de l'aire de battage et du fléau de Dieu, empruntée au poète paysan Essenine et celle de la forêt originelle, berceau d'innocence, de pureté, d'émotion liturgique. Dans le chaos de la défaite, des soldats épars regroupés en pleine forêt par le colonel Vorotyntsev reconstituent dans une symbolique clairière l'antique assemblée villageoise russe, le mir.
Cependant la deuxième partie d'Août 14, parue en 1983, apporte à l'économie du livre une retouche gigantesque, un flash-back de trois cents pages, intitulé « Extrait des nœuds précédents. Ce retour va de 1899 à 1914, mais se concentre sur l'assassinat du Premier ministre Stolypine, à Kiev, le 1er septembre 1911. Déséquilibrant le livre, lui conférant un véritable suspens policier, écrit dans un halètement de courtes séquences, cet épisode révèle les difficultés que rencontra Soljénitsyne dans l'élaboration de son œuvre : il introduit, en contrepoint, d'immenses chapitres didactiques, très enlevés, l'un sur Nicolas II – hésitant quoique bien intentionné – l'autre sur Stolypine, le réformateur national cher à Soljénitsyne. Le symbolisme même se modifie. Au duel des regards, moment de la relation interpersonnelle, se substitue la fascination de tous par un seul : l'image du terroriste-funambule montant vertigineusement au mât du cirque. Le funambule Bogrov, l'assassin de Stolypine, est un dandy terroriste qui berne une police corrompue et bureaucratique devant la Russie, changée en arène de cirque.
Dans cette fresque historique, chaque nœud a son rythme propre. Celui d'Octobre 16 est ralenti, à l'image du front où règne l'accalmie. Celui de Mars 17 est haletant, atomisé, le récit dédoublé à l'infini semble une quête unanimiste d'instants éphémères dans la vie des rues de Petrograd en révolte, instants de peur, de lâcheté, de cabotinage sur fond de houle sauvage. Les grands protagonistes de l'histoire, Milioukov ou Kerenski, deviennent des poupées gonflées de mots et vides d'énergie. La trame de la fiction se raréfie, le didactisme grandit. L'auteur, désespérément, cherche les restes de ce qui fut l'homme russe, bon, courageux, tempérant...
Un dialogue libérateur
Ce prophète qui dit non a connu la joie intense que procure précisément le refus. La jubilation de la révolte, le rire de l'esclave affranchi, la mordante ironie de l'imprécateur marquent son œuvre. La première de ses œuvres majeures, dans l'ordre de leur genèse, c'est Le Premier Cercle : transposition à peine romancée du séjour du zek Soljénitsyne dans une des nombreuses prisons-laboratoires où Staline tenait sous clé presque tous les savants de son pays. Cette prison, c'est le premier cercle, celui où Dante situe les sages de l'Antiquité, qui n'ont pas connu le Christ. Le Premier Cercle est un dialogue libérateur entre bagnards-savants. Revenus au point zéro de la condition humaine, ces zeks se libèrent mutuellement par le rire, par le débat philosophique et par le sacrifice de soi. Ils créent une sorte de fraternité les nouveaux rosicruciens et, détachés de la vie réelle, placés par leurs bourreaux dans une situation d'ascèse totale, ils recréent la valeur, la culture, l'égalité humaine. Les chapitres extérieurs à la prison, ceux du monde libre, sont, au contraire, entièrement plongés dans les ténèbres de la peur, de la délation, du mensonge. Le despote suprême, Staline, enfermé dans son caveau du Kremlin, soupçonneux de tous, se condamne lui-même à une existence nocturne, solitaire et apeurée. Le Premier Cercle a été la thérapeutique que Soljénitsyne s'est appliquée à lui-même : un transfert de la peur des victimes sur les bourreaux. Dans l'édition russe corrigée de 1978, cette symbolique est encore plus marquée : en acceptant l'enfermement dans le cercle des purs, le diplomate innocent Volodine échappe aux épouvantes du monde totalitaire. Le cercle des savants-bagnards devient une Arche, semblable à celle de Noé. En ce refuge qu'est la prison acceptée, l'homme se libère intérieurement, tel Épictète ou Marc Aurèle. Et ces nouveaux stoïciens aperçoivent fugitivement le futur Graal chrétien.
Le Dante du goulag
Une journée d'Ivan Denissovitch, dont la parution en 1962 dans le numéro 11 de la revue Novy Mir dirigée alors par Tvardovski révéla le nom de Soljénitsyne à l'univers entier, est une chute du grand roman dialogué et philosophique. Nous sommes au cinquième ou sixième cercle de l'enfer du goulag. Spiridon, l'homme de peine du Premier Cercle, s'appelle ici Ivan Denissovitch. Mais le thème central reste l'affranchissement intérieur de l'homme. Ce n'est plus un intellectuel qui est au centre de la quête de vérité, c'est un simple moujik russe, paysan et maçon. Du lever très tôt au coucher très tard, dans les affres du froid sibérien, la lutte de la brigade pour remplir la norme, la dure compétition pour le maigre brouet alloué, nous voyons Ivan Denissovitch survivre sans déshonneur et même connaître des instants d'une joie intense que procurent la solidarité avec d'autres hommes et la victoire sur soi, sur le froid et la faim dans la célèbre scène du mur que construit le vaillant petit maçon. Débrouillard mais jamais tricheur, serviable, digne, se découvrant majestueusement pour avaler son bol au réfectoire, comme s'il présidait à un repas familial chez lui, Ivan Denissovitch, par le seul fait que la brigade le nomme ainsi, respectueusement, par son prénom et son patronymique – et non par le matricule que les bourreaux font marquer sur ses habits –, représente la victoire de la dignité. Pierre Daix et Jorge Semprun, rescapés des camps nazis, ont dit comme tous les détails de cette journée leur étaient familiers : c'est que la civilisation concentrationnaire est partout la même. Sur son châlit, le soir, Ivan a pour voisin le baptiste Aliocha, et quand Ivan dit à son voisin : Tu as beau prier, c'est pas ça qui te raccourcira ta peine, le baptiste répond par le mot de saint Paul : Réjouis-toi d'être en prison ! car ici, au moins, les ronces ont moins de chance de pousser sur ton cœur.
La publication de ce récit, deux ans avant la chute de Nikita Khrouchtchev, marqua en U.R.S.S. l'apogée de la déstalinisation. Soljénitsyne, ex-bagnard circonspect, avait jusqu'alors soigneusement caché ses écrits. Le voici partiellement dévoilé. Il profite de la brèche pour publier La Maison de Matriona, centrée sur une inoubliable figure de vieille femme fruste qui est une vraie sainte. Mais en 1964 Khrouchtchev est limogé ; commence le long duel entre Soljénitsyne et le pouvoir soviétique.
L'opposition qui consruit
Un duel qui dure dix ans, passe par le refus de publier Le Pavillon des cancéreux, par l'attribution du prix Nobel de littérature 1970 et le bannissement 1974. Ce duel étonnant a marqué notre époque, comme autrefois ceux d'un Voltaire ou d'un Tolstoï avec les pouvoirs de leur temps. Ancien zek, Soljénitsyne a l'obstination d'un homme qui revient de l'Enfer, mais il a aussi la célébrité que le pouvoir lui a lui-même conférée en 1962 en publiant son fameux récit, aveu définitif de l'existence des camps au pays du socialisme. Le pouvoir soviétique est pris de court par un individu dont les faits et gestes ne sont pas calculés en fonction du principe de prudence.
En outre, le phénomène Soljénitsyne s'inscrit dans le phénomène plus vaste de la dissidence, qui ne sera liquidée, grosso modo, que vers 1975. Dans cette lutte, Soljénitsyne se révèle un extraordinaire tacticien : il sait choisir lui-même le moment pour asséner les coups. De plus, infatigable, il rédige alors, dans une retraite clandestine, L'Archipel du Goulag, qu'il envoie clandestinement en Occident et donne ordre de publier en 1973.
La chronique de cette lutte, il l'a écrite dans un livre dont le titre fait allusion à un proverbe russe : Le Chêne et le Veau. Écrit au fur et à mesure des rebondissements de la lutte mortelle entre un écrivain et un pouvoir, Le Chêne et le Veau a la respiration haletante du danger et de l'audace. L'auteur lui a ajouté en 1992 une belle galerie de portraits : Les Invisibles, ceux et surtout celles qui l'aidèrent dans sa lutte. Jamais combat littéraire n'a été aussi instantanément traduit en œuvre littéraire. Chronique de la décennie du « dégel », magistral et émouvant portrait de Tvardovski – lutteur enchaîné, comparable au Samsonov d'Août 14 –, tour à tour invocation de Dieu, prière ou déploration à l'instant d'abandonner le sol et la beauté russes, Le Chêne et le Veau, en marge du reste de l'œuvre de Soljénitsyne, est la meilleure introduction à cette œuvre ; comme Passé et méditation de Herzen, il est l'écriture faite combat.
L'Archipael du goulag
L'Archipel du Goulag, lui, est un gigantesque édifice qui se veut chronique, description historique, géographique, ethnographique du monde concentrationnaire, engendré par la révolution russe. Aidé par les témoignages secrets de nombreux rescapés des camps, Soljénitsyne s'est senti le porte-parole de millions de morts, de toute une humanité engloutie. Mais son livre est néanmoins l'œuvre d'un auteur bien présent. Elle a pour sous-titre : Essai d'investigation artistique », titre que Soljénitsyne a en quelque sorte explicité dans son Discours du Nobel. Et ce sens est double : d'une part, seul l'art – avec son ordonnancement émotionnel, poétique, ironique – peut pallier l'absence de documents, déjouer le systématique engloutissement d'une part énorme de la vérité humaine ; d'autre part, cet immense drainage de souffrances, cet archipel de l'inhumain sécrète, en définitive, une sorte de beauté. Et, en effet, Soljénitsyne, au terme d'une enquête aussi minutieuse que grondante de colère, nous montre une floraison de martyrs et de saints, preuve que le camp ne produit pas que de l'inhumain. Là, il polémique implicitement avec les autres grands chroniqueurs des camps : un Élie Wiesel pour les camps nazis, un Chalamov pour les camps soviétiques. Le camp, cette ascèse absolue, débroussaille définitivement l'âme. Un des chapitres les plus grandioses de cette Odyssée est celui qui décrit les révoltes dans les camps, en particulier les quarante jours de Kenguir. Porté par un souffle épique, cachant l'émotion sous la gouaille et l'ironie, Soljénitsyne y célèbre la naissance authentique d'un non au nouvel asservissement, un non naïf, primitif, quasi enfantin, originel.
Le pavillon des cancéreux
Ainsi, le monde entier lisait Le Pavillon des cancéreux, récit poétique sur la convalescence de l'homme, tandis que son auteur achevait les sept livres de L'Archipel et, cette besogne finie, enchaînait sur un gigantesque roman historique, entrevu dès l'âge de dix-huit ans, intitulé La Roue rouge et dont le premier nœud, Août 14, parut en 1971, suivi de chapitres tirés des nœuds suivants, encore inédits, groupés autour de Lénine à Zurich. Cette fresque historique, primitivement conçue en vingt nœuds, n'en comporte en définitive que quatre Août 14, Octobre 16, Mars 17, Avril 17, qui totalisent néanmoins six mille six cents pages. Le récit s'arrête en avril 1917 (allant jusqu'au retour de Lénine à Petrograd car, nous dit l'auteur, le poids spécifique s'est déplacé vers la révolution de Février 1917, à un moment où tout est déjà joué, c'est-à-dire perdu : Le putsch d'Octobre, déjà en avril, se dessine comme inéluctable. Néanmoins, en appendice, l'auteur fournit au lecteur un synopsis de la suite à laquelle il a renoncé, et qui conduisait jusqu'en 1945. Ainsi cet énorme vaisseau d'écriture est-il lesté d'une quille inachevée, virtuelle si l'on ose dire, ce qui en fait une sorte d'hapax dans la longue histoire du roman européen...
Une journée d'Ivan Denissovitch, livre de Alexandre Soljénitsyne
En 1962 Alexandre Soljénitsyne, un inconnu, envoie le manuscrit d'un récit écrit trois ans plus tôt à la revue soviétique réputée libérale, Novy Mir, Monde nouveau. Son directeur, Alexandre Tvardovski, obtient l'imprimatur de Nikita Khrouchtchev lui-même, qui, s'il est loin d'être un libéral, entend utiliser le livre contre ses adversaires conservateurs. Les lecteurs russes s'arrachent Une journée d'Ivan Denissovitch.
En France, les communistes organisent aussitôt la traduction et le lancement du livre qui, préfacé par Pierre Daix, connaît un grand succès. L'opération, supervisée par Aragon et Elsa Triolet, vise à faire croire que l'U.R.S.S. a changé, que le stalinisme fut une déviation ou une erreur mais que le régime fondé par Lénine est foncièrement sain. En fait, les communistes ne vont pas pouvoir longtemps contrôler la réception du récit. Un fait est désormais acquis : il a existé un système concentrationnaire de masse au pays des soviets.
C'est la vérité qui compte, écrit Soljénitsyne, il faut écrire pour que tout cela ne soit pas oublié, pour qu'un jour nos descendants l'apprennent. Rescapé de huit saisons en enfer, huit années au Goulag, l'écrivain sait quelles limites il lui est interdit de franchir : il a consenti à toutes les coupes que le pouvoir lui demandait. L'essentiel était que le livre paraisse et fasse son chemin. Il faudra attendre 1973 pour que le texte original soit connu et fasse l'objet d'une traduction plus fidèle que la première
Le quotidien concentrationnaire
Une journée d'Ivan Denissovitch est un récit semi-autobiographique, linéaire et laconique dont le titre indique clairement le contenu. Il ne se passe rien d'extraordinaire dans les quelque dix-huit heures de cette journée d'Ivan Choukhov : réveil, soupe à la cantine, appels et contre-appels, travail dans le froid, retour à la baraque. Des journées comme ça – conclut le narrateur – dans sa peine, il y en avait, d'un bout à l'autre, trois mille six cent cinquante-trois.
Le personnage focal du récit est un paysan russe qui fut soldat de deuxième classe. Du moujik tolstoïen, Ivan Choukhov a gardé quelques traits caractéristiques. Il est fruste, superstitieux mais roublard. Il aime la belle ouvrage et respecte son chef de brigade, mais il chaparde des suppléments. Ce n'est pas un révolté, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas non plus un héros soviétique : il reste complètement étranger à l'idéologie officielle. Coupé des siens, il vit au présent et économise ses forces. L'essentiel est qu'il a su garder sa dignité. C'est pourquoi il a des chances de survivre.
D'autres figures traversent le récit, l'ex-commandant Bouynovski châtié pour s'être rebellé, César le planqué, Aliocha le baptiste. L'échantillon de la population concentrationnaire ruine le mensonge de la propagande officielle. Il n'y a là que des anciens prisonniers de guerre, des croyants, des paysans, des Baltes, des Ukrainiens. Leur culpabilité est sociologique ou ethnologique. Le seul délinquant de droit commun avéré se retrouve, comme par hasard, chef de baraque. Quand les Choukhov se comptent par millions, le pouvoir est contre le peuple, suggère Soljénitsyne.
Un regard sociologique
Le narrateur porte un regard sociologique sur le camp. Il dépeint au quotidien des mécanismes de domination et d'exploitation, une bureaucratie parasitaire, quelques brutes mais pas de tortionnaires. Les détenus les zeks ont perdu leur identité. Ce sont de simples matricules, taillables et corvéables à merci. Quelques-uns, en échange de menus privilèges, se font les auxiliaires zélés de l'administration ; les plus nombreux triment, mal nourris, dans le cadre d'une brigade. Au-delà du camp, Soljénitsyne donne de la société soviétique une image impitoyable : le mensonge, la gabegie, l'irresponsabilité et la corruption y règnent sans partage.
Le romancier livre une tranche de vie et s'interdit tout commentaire inutile. Il donne la priorité à la transmission de son expérience. Ignorant les recherches modernistes de ses contemporains occidentaux comme les médiocres platitudes du réalisme socialiste, le mémorialiste du Goulag s'inscrit dans la tradition du XIXe siècle, marquée notamment par les Récits de la maison des morts 1861-1862 de Dostoïevski. Il choisit une focalisation interne et restreinte. L'économie du récit est d'une rigueur extrême. Le récit n'est pas découpé en chapitres, l'espace-temps est resserré. Des détails concrets restituent l'univers oppressant d'un camp que Soljénitsyne transforme en métaphore de la société totalitaire.
Les traductions rendent malaisément le travail stylistique de l'auteur. S'étant dégagé de l'idiome idéologico-politique officiel, de la langue de bois , Soljénitsyne a forgé une langue populaire mi-écrite mi-orale, truffée de mots anciens, d'argotismes et de dialectalismes. Les ellipses et les discontinuités font éclater le moule de la syntaxe classique. Aux slogans officiels, le narrateur sarcastique oppose des dictons anciens ou fabriqués et des énoncés à l'humour ravageur.
Œuvres
L'œuvre d'Alexandre Soljenitsyne entend révéler la double injustice faite aux millions de Russes victimes d'un État traître à son propre peuple : celle de l'exil et des camps du Goulag et souvent de la mort, sans justice ni culpabilité, mais aussi l'injustice du silence et de l'oubli. Ainsi, L'Archipel du Goulag rapporte le témoignage de quelque 220 victimes, part infime du flot des déportés. La datation des œuvres d'Alexandre Soljenitsyne est difficile à établir avec précision, la plupart d'entre elles ayant connu une gestation très longue et plusieurs versions y compris parfois une réécriture quasi complète. En ce sens, l'exergue placé au début du Premier Cercle est significatif : Écrit de 1955 à 1958. Défiguré en 1964. Réécrit en 1968.
Une journée d'Ivan Denissovitch 1962
La Maison de Matriona 1963, qui contient aussi L'Inconnu de Krétchétovka et Pour le bien et la cause recueil de nouvelles
Le Pavillon des cancéreux 1968
Les Droits de l'écrivain 1969
Le Premier cercle commencé en 1955, version finale en 1968
La fille d'amour et l'innocent pièce en 4 actes et 11 tableaux 1971
Zacharie l'escarcelle 1971 nouvelles
Août quatorze, premier nœud (série de livres nœuds en plusieurs volumes tomes)réédités en 1983 sous le titre commun La Roue rouge 1972
L'Archipel du Goulag tomes I et II 1974
Le chêne et le Veau 1975
Discours américains 1975
Des voix sous les décombres 1975
Lénine à Zurich 1975
L'Archipel du Goulag tome III 1976
Flamme au vent, théâtre 1977
Le Déclin du courage 1978
Message d'exil 1979
L'Erreur de l'Occident 1980
Les Tanks connaissent la vérité 1982
Nos pluralistes 1983
La Roue rouge, tome 2 : Deuxième nœud - Novembre seize 1985
Comment réaménager notre Russie ? 1990
Les Invisibles 1992
La Roue rouge, tome 3 : Troisième nœud - Mars dix-sept 4 tomes 1993-1998
Le Problème russe à la fin du XXe siècle 1994
Ego, suivi de Sur le fil récits 1995
Nos jeunes récits 1997
Le Grain tombé entre les meules 1998, éd. Fayard, 500 pages.
La Russie sous l'avalanche 1998
Deux récits de guerre 000
Deux siècles ensemble, 1795-1995, tome 1 : Juifs et Russes avant la révolution 2002
Deux siècles ensemble, 1917-1972, tome 2 : Juifs et Russes pendant la période soviétique 2003
Esquisses d'exil – Le grain tombé entre les meules, tome 2, 1979-1994, traduit du russe par Françoise Lesourd, 2005
Aime la révolution !, roman inachevé 2007
Réflexions sur la révolution de février, 2007
Une minute par jour, entretiens 2007
La Roue rouge : Quatrième nœud : Avril dix-sept 2009
Récompenses, distinctions, Prix
Prix Nobel de littérature, 1970
Prix Templeton, 1983
Ordre de Saint-André, 199841
Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques, 2000
Docteur Honoris Causa de l'Université d'État de Moscou
Ordre de l'Étoile de Roumanie, 2008 à titre posthume
Liens
http://youtu.be/WH0zW5rBtJo Une journée d'Ivan Denissovitch H. Guillemin
http://youtu.be/X6FJM-Ncb44 Prophète ou réactionnaire
http://youtu.be/q5ZBKIpxn3o A propos de l'occident
http://youtu.be/s5jjU8YCqRc Et l'occident apostat
http://youtu.be/MQrL7jDEfc4 Dialogue
http://youtu.be/ot281lb91_8 Chez Pivot
http://youtu.be/1EuCtcBHsL4 Le courage d'écrire
http://youtu.be/t6pULYct-OA A propos de sa méthode de travail
http://youtu.be/7Vqf5zYzxvo Dans sa maison de Cavendish
http://youtu.be/WypcADANOXw a propos de sa célébrité
http://youtu.be/U6Kp3yoyAEI A propos de son écriture en occident
http://youtu.be/pN9t8q0ypJU interview
  [img width=600]http://s.tf1.fr/mmdia/i/88/7/alexandre-soljenitsyne-2570887_1713.jpg?v=1[/img]          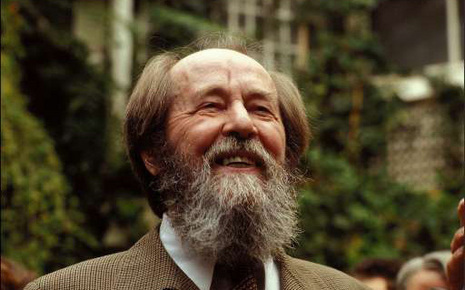 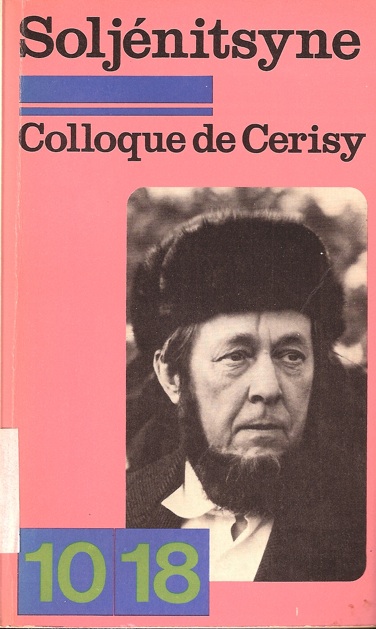   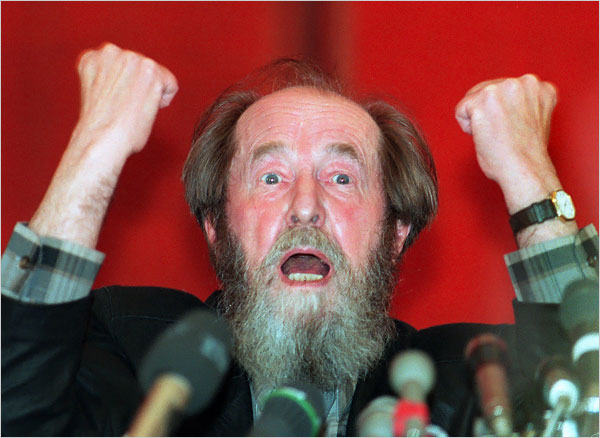  
Posté le : 01/08/2014 16:53
|
|
|
|
|
Alexandre Soljenitsine |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 3 août 2008 à Moscou à 89 ans, meurt Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne
en russe : Александр Исаевич Солженицын, ISO : Aleksandr Isajevič Solženicyn né le 11 décembre 1918 à Kislovodsk RSFS de Russie, écrivain et dissident russe, auteur notamment d'Une journée d'Ivan Denissovitch, de L'Archipel du Goulag et de La Roue rouge, autres Œuvres principales, Le Premier Cercle, Le Pavillon des cancéreux, il est distingué du Prix Nobel de littérature en 1970, le Prix Templeton en 1983, le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 2000, et le Prix d'État en Russie en 2007.
En Bref
" Tout passe, seule la vérité reste " proclame un proverbe russe. Pour Soljenitsyne, toute sa vie sera une tentative obstinée pour répondre à cette grande question : Cette vérité, comment contribuer à la faire triompher ?
Proscrit d'U.R.S.S. en février 1974, Alexandre Soljénitsyne est rentré en Russie en juillet 1994. Vingt ans d'exil, vingt ans d'écriture forcenée en sa retraite américaine du Vermont n'avaient pas entamé l'énergie du dissident, ni la force du prophète. Il choisit de rentrer lentement, étape par étape, d'est en ouest. Son avion fit escale à Magadan, cette porte de l'enfer concentrationnaire de la Kolyma ; tel un pape, Soljénitsyne baisa ce sol foulé par les martyrs anonymes auxquels son monumental Archipel du Goulag avait donné parole. À chaque gare les anciens zeks détenus venaient à sa rencontre. Chaque soir, le maître écoutait les doléances d'un public désorienté par la chute du communisme, les réformes économiques, la perte d'un empire. Humiliés et offensés avaient trouvé leur porte-parole attentif. Une fois de plus, Soljénitsyne disait non. Non à la liberté économique débridée, non à la confiscation de la démocratie par les anciens profiteurs. Soljénitsyne n'est pas un politicien, il ne présente pas un programme susceptible de rassembler des adhésions. Il est avant tout un rebelle, un prophète qui dit non. Une grande part du malentendu actuel entre lui et l'Occident vient de ce que l'Occident a toujours mal perçu la racine spirituelle du non de Soljénitsyne. Cette racine est religieuse : l'homme Soljénitsyne a trouvé la foi dans le dénuement absolu des camps ; son premier refus a été celui de l'avilissement, de l'homme matriculaire. De ce refus central sont venus les autres : refus de la parole serve l'idéologie, refus des pouvoirs qui annihilent les personnes, refus du progrès économique transformé en veau d'or, du libéralisme politique en tant que fauteur d'une jungle économique et sociale. Ces refus ont leur histoire, Soljénitsyne ne les a pas tous articulés d'un coup, mais l'un contenait l'autre.
Un poète de l'énergie
On a parfois accusé Soljénitsyne de passéisme artistique. Parce qu'il croit encore au personnage de roman. Et il est vrai que Soljénitsyne croit au réel, à l'autonomie humaine, à la révélation de l'homme dans l'épreuve. Du camp il garde et gardera à tout jamais la rapidité de réflexe du zek, l'ironie libératrice, la haine des fabriques industrielles du déchet humain. Mais à la Quête du Graal et au Parzifal d'Eschenbach il emprunte une lumière mystique qui baigne ses chevaliers du renoncement.
Cette quête de l'énergie et du vrai marque entièrement sa langue : la langue de Soljénitsyne est immédiatement reconnaissable à sa poétique propre. Elle vise à une détente énergétique maximale, comme dans la langue populaire, et dans le proverbe. Elle élimine du russe les européanismes, gallicismes ou germanismes, elle restitue la syntaxe syncopée du parler populaire. Elle renoue avec les recherches linguistiques qui avaient marqué l'avancée poétique du début du siècle : Biely, Khlebnikov, et surtout Marina Tsvetaeva. Son œuvre de publiciste est également chargée de cette densité du langage, de cette énergie des raccourcis populaires. Ingénieur d'une histoire lourde qu'il grée de documents, de collages de matériaux et ponctue de la sanction ironique des proverbes-sentences, Soljénitsyne est aussi un maître de la forme courte : division des longs romans et brefs chapitres lyriques, condensation de l'histoire en nœuds, intenses pauses poétiques, poèmes en prose, tant ses Miettes en prose que les poèmes insérés dans le roman ; par exemple, dans Le Pavillon des cancéreux, le chapitre sur l'abricotier en fleur. Contre la langue de bois de l'idéologie, dénationalisée, énucléée, Soljénitsyne mène avec fureur et verve une lutte acharnée. Le premier péché de Lénine, pour lui, c'est son style.
Ainsi, le publiciste Soljénitsyne ne peut être lu et compris qu'à la lumière du poète, de l'historien, du réformateur du langage. De la Lettre aux dirigeants 1973)à Comment réorganiser notre Russie 1990 et Le Problème russe au XXe siècle 1994, Soljénitsyne reste un disciple du grand révolté religieux du XVIIe siècle : Avvakum, qui déclarait : Je n'ai cure de beau parler et n'humilie pas ma langue russe. Le commun dénominateur de toutes ses prises de position est la quête du vrai visage de la Russie, un visage altéré par l'occidentalisation forcenée de Pierre le Grand, occulté par le libéralisme athée des Milioukov et autres leaders bourgeois du début du XXe siècle, définitivement mutilé par le totalitarisme idéologique. Qu'il y ait chez Soljénitsyne un héritage de la tradition russe antioccidentale est évident. Il a lu avec soin le Journal d'un écrivain de Dostoïevski et les articles de Constantin Leontiev. Sa condamnation virulente des « rapaces » le rapproche tantôt des écologistes, tantôt des réformateurs religieux. Son œuvre d'historien est inséparable de celle du romancier et de son souffle de prophète. Ses imprécations contre l'Occident repu, sa conviction que la liberté sans la foi religieuse ne peut que dégénérer viennent d'un patriote russe qui prêche le renoncement à l'empire, d'un sceptique de la démocratie prêt à lutter pour restaurer en Russie le self-government local, les zemstvo. Insaisissable avec nos instruments occidentaux, l'homme au visage de prophète tire sa force d'avoir su lutter seul contre le Léviathan soviétique, et d'avoir senti vaciller le géant sous ses coups. Son retour en Russie est comparable à celui de Hugo en France. Il a su et faire vaciller le géant, et saisir dans ses mains fortes la matière historique de deux décennies fatales dans l'histoire russe. Sa « roue rouge » dévale à jamais l'histoire catastrophique de la Russie au XXe siècle. Mais le poète Soljénitsyne sait encore tendre tout son être dans l'extase d'une odeur de pommier.
Sa vie
Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne naît le 28 novembre/11 décembre 19184 à Kislovodsk, dans le nord du Caucase. La famille de Soljenitsyne, de souche paysanne, était relativement aisée. Son père, Issaïe, est le premier à faire des études supérieure, Issaaki Sémionovitch Soljenitsyne, étudiant en philologie et en histoire à l'université de Moscou, s'engage volontairement dans l'armée russe dès l'été 1914 et sert en Prusse-Orientale. Au printemps 1918, devenu officier, de retour du front, il se blesse grièvement lors d'un accident de chasse et meurt d'une septicémie le 15 juin 1918 à l'hôpital de Gueorguievsk. La mère d'Alexandre, Taïssia Zakharovna Chtcherbak, d'origine ukrainienne, qui est fille d'un self-made man paysan de la région de la Kouma, est alors étudiante en agronomie à Moscou. Les parents d'Alexandre se sont connus à Moscou lors d'une permission d'Issaaki en avril 1917 et se sont mariés le 23 août 1917 dans la brigade d'Issaaki.
Jusqu'à l'âge de six ans, le jeune Alexandre est confié à la famille de sa mère tandis que celle-ci travaille comme sténodactylo à Rostov-sur-le-Don. Il reçoit des rudiments d'instruction religieuse, tout en étant admis parmi les Pionniers. L'origine sociale dite "malsaine" de sa famille maternelle lui vaut d'ailleurs une exclusion temporaire de l'organisation. À Rostov, il partage avec sa mère un petit logement de neuf mètres carrés situé à proximité de l'immeuble de la Guépéou.
Épris très jeune de littérature, ayant fait ses premiers essais littéraires alors qu'il était collégien, Alexandre Soljenitsyne choisit néanmoins de poursuivre des études universitaires de mathématiques et de physique. À la fois parce qu'il n'y avait pas de chaire de littérature à l'université de Rostov et pour des raisons alimentaires. Il suit des cours de philosophie et de littérature par correspondance ; il s'inscrit à un cours d'anglais et suit également des cours de latin. Comme il le reconnaissait volontiers, à l'époque il adhère encore à l’idéologie communiste dans laquelle il a grandi.
Le 27 avril 1940, il épouse Natalia Alexeïevna Rechetovskaïa, une étudiante en chimie et pianiste dont il fait la connaissance en septembre 1936. Il passe avec succès ses examens finaux de mathématiques le 16 juin 1941. Il est à Moscou pour ses examens de littérature le 22 juin 1941, quand éclate la guerre contre le Troisième Reich.
La guerre
Lors de l'invasion allemande en 1941, il manque d'abord de se faire réformer, puis, à l'automne 1941, il est engagé comme soldat dans une troupe hippomobile à l'arrière avant d'obtenir le 14 avril 1942 — à sa demande — une place à l'école d'artillerie. Fin 1942, il est nommé commandant d'une batterie de repérage par le son. Il combat comme officier de l'Armée rouge, et sera décoré en 1944 de l'Étoile rouge pour sa participation à la prise de Rogatchov.
Le Goulag
En 1945, il est condamné à huit ans de prison dans les camps de travail pour activité contre-révolutionnaire, après avoir critiqué dans sa correspondance privée la politique de Staline ainsi que ses compétences militaires. Dans une lettre interceptée par la censure militaire, Soljénitsyne reprochait au génialissime maréchal, meilleur ami de tous les soldats, selon les qualificatifs officiels d'avoir décapité l'Armée rouge lors des purges, d'avoir fait alliance avec Hitler et refusé d'écouter les voix qui le mettaient en garde contre l'attaque allemande, puis d'avoir mené la guerre sans aucun égard pour ses hommes et pour les souffrances de la Russie Nous étions deux qui échangions nos pensées en secret : c'est-à-dire un embryon d'organisation, c'est-à-dire une organisation !.
Au début 1952, Natalia Rechetovskaïa, qui a été renvoyée de l'université d'État de Moscou en tant qu'épouse d'un ennemi du peuple en 1948, demande et obtient le divorce. À sa sortie du camp en février 1953, quelques semaines avant la mort de Staline, Soljenitsyne – matricule CH-262, anciennement matricule CH-232 – est envoyé en exil perpétuel au Kazakhstan. Il est réhabilité le 9 avril 1956 et s'installe à Riazan, à 200 km au sud de Moscou, où il enseigne les sciences physiques. Il se remarie avec Natalia le 2 février 1957, divorce à nouveau en 1972 pour épouser, l'année suivante, Natalia Dmitrievna Svetlova, une mathématicienne.
Auteur en URSS
C'est Une journée d'Ivan Denissovitch publié en 1962 dans la revue soviétique Novy Mir grâce à l'autorisation de Nikita Khrouchtchev en personne, qui lui acquiert une renommée tant dans son pays que dans le monde. Le roman décrit les conditions de vie dans un camp de travail forcé soviétique du début des années 1950 à travers les yeux d'un zek, Ivan Denissovitch Choukhov.
Il est reçu au Kremlin par Khrouchtchev. Cependant, deux ans plus tard, sous Léonid Brejnev, il lui est de plus en plus difficile de publier ses textes en Union soviétique. En 1967, dans une lettre au Congrès des écrivains soviétiques, il exige la suppression de toute censure – ouverte ou cachée – sur la production artistique .
Ses romans Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux, ainsi que le premier tome de son épopée historique La Roue rouge, paraissent en Occident et lui valent le prix Nobel de littérature en 1970, récompense qu'il ne pourra recevoir que quatre ans plus tard, après avoir été expulsé d'URSS. Il n'a en effet pas pu se rendre à Stockholm de peur d'être déchu de sa nationalité soviétique et de ne pouvoir rentrer en URSS, le gouvernement suédois ayant refusé de lui transmettre le prix à son ambassade de Moscou. Sa vie devient une conspiration permanente pour voler le droit d’écrire en dépit de la surveillance de plus en plus assidue du KGB.
Une partie de ses archives est saisie chez un de ses amis en septembre 1965. En 1969, alors qu'il est persécuté par les autorités et ne sait plus où vivre, il est hébergé par Mstislav Rostropovitch. Il manque d'être assassiné en août 1971, par un parapluie bulgare. Une de ses plus proches collaboratrices échappe de justesse à une tentative d'étranglement et à un accident de voiture.
En décembre 1973, la version russe de L'Archipel du Goulag parait à Paris, car le manuscrit avait pu être clandestinement sorti d'URSS et remis à l'imprimerie Beresniak, rue du Faubourg du Temple à Paris, une des rares imprimeries françaises à disposer des caractères typographiques cyrilliques.
Il y décrit le système concentrationnaire soviétique du Goulag, qu'il a vécu de l'intérieur, et la nature totalitaire du régime. L'ouvrage avait été écrit entre 1958 et 1967 sur de minuscules feuilles de papier enterrées une à une dans des jardins amis, une copie étant envoyée en Occident, par amis interposés qui risquaient gros pour échapper à la censure. Il décida sa publication après qu'une de ses aides, Élisabeth Voronianskaïa, fut retrouvée pendue : elle avait avoué au KGB la cachette où se trouvait un exemplaire de l’œuvre. L'ouvrage est, comme d'autres avant lui, un témoignage, mais contrairement à ceux qui l'ont précédé, il est extrêmement précis, sourcé, et cite de nombreuses lois et décrets soviétiques servant à la mise en œuvre de la politique carcérale, de sorte qu'il est beaucoup plus difficile aux négationnistes du Goulag de nier la véracité des faits décrits. Cette publication connaît une grande diffusion et le rend célèbre, ce qui lui vaut d'être déchu de sa citoyenneté soviétique et d'être arrêté. Mais, au lieu d'être condamné et incarcéré, il est expulsé d’Union soviétique en février 1974. En URSS, ses textes continuent cependant d’être diffusés clandestinement, sous forme de samizdats.
Auteur en exil
Grâce à l'aide de l'écrivain allemand Heinrich Böll, il s'installe d'abord à Zurich en Suisse, puis émigre aux États-Unis. Soljénitsyne devient alors la figure de proue des dissidents soviétiques, mais déjà apparaît, à travers ses interviews, un clivage avec certains de ses interlocuteurs qui le soupçonnent d'être réactionnaire ; il se montre en effet méfiant vis-à-vis du matérialisme occidental et attaché à l'identité russe traditionnelle, où la spiritualité orthodoxe joue un grand rôle.
Après une période agitée faite d'interviews et de discours, comme le fameux discours de Harvard prononcé en 1978 aux États-Unis, Soljenitsyne fut souvent invité à d’importantes conférences. Le 15 juillet 1975, il fut même invité à donner une conférence sur la situation mondiale au Sénat américain. L'Occident découvre alors un chrétien orthodoxe et slavophile très critique sur la société occidentale de consommation, et que les médias français classent dès lors parmi les conservateurs13. Comme Victor Serge ou Victor Kravtchenko avant lui, l'écrivain doit affronter une campagne supplémentaire de diffamation.
Il se retire avec sa famille à Cavendish, dans le Vermont, pour écrire l'œuvre dont il rêvait depuis sa jeunesse, La Roue rouge, une épopée historique comptant des milliers de pages, qui retrace la plongée de la Russie dans la violence révolutionnaire.
En 1983, il reçoit le prix Templeton.
Le 25 septembre 1993, à l'occasion de l'inauguration du Mémorial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, il prononce un célèbre discours sur les guerres de Vendée et la Révolution française, comparant ces événements, qu'il qualifie de génocide, aux soulèvements populaires anti-communistes en Russie. Il pose ainsi une réflexion sur l'idéalisme initial des révolutions, sur leur récupération par les plus violents des extrémistes, chaque fois que les conservateurs refusent de céder du terrain, et sur les bains de sang que cela représente pour les peuples. Aux yeux des révolutionnaires, il se classe ainsi parmi les réformistes qui visent à améliorer le capitalisme pour le rendre supportable.
Retour en Russie
Dans le cadre de la Glasnost menée par Mikhaïl Gorbatchev, sa citoyenneté soviétique lui est restituée, et L'Archipel du Goulag est publié en URSS à partir de 1989. Après la dislocation de l'Union soviétique, via la France où il participe à l'inauguration du Mémorial de la Vendée des Lucs-sur-Boulogne, en Vendée, le 25 septembre 1993, il rentre en Russie le 27 mai 1994, en arrivant par l'est, à Magadan, jadis grand centre de tri carcéral. Il met un mois à traverser son pays en train. Il résidera en Russie jusqu'à sa mort. Jusqu'en 1998, il conserve une activité sociale intense, il a sa propre émission de télévision, voyage à travers la Russie, rencontre une multitude de personnes et d'anciens déportés. La maladie interrompt cette activité.
Soljenitsyne vit ensuite retiré près de Moscou, au milieu de sa famille. Le Fonds Soljenitsyne aide les anciens zeks et leurs familles démunies en leur versant des pensions, en payant des médicaments. Après avoir pensé pouvoir jouer un rôle cathartique dans la Russie post-communiste, Soljenitsyne réalise que la nomenklatura a simplement changé d'idéologie, passant du communisme au nationalisme, mais qu'elle s'est maintenue aux affaires et que les démocrates, s'ils veulent convaincre, ne peuvent agir que sur les plans associatif et culturel, le plan politique étant entièrement verrouillé par Boris Eltsine, puis par Vladimir Poutine, seuls interlocuteurs agréés par l'Occident.
Déçus, les Russes, après l'avoir plus ou moins enterré, semblent ces derniers temps s'intéresser de nouveau à Soljenitsyne et redécouvrir la valeur de ses écrits politico-sociaux. Un colloque international a été consacré à son œuvre en décembre 2003 à Moscou. Le 12 juin 2007, le président Vladimir Poutine rend hommage à Soljenitsyne en lui décernant le prestigieux Prix d'État.
L'ancien dissident Viktor Erofeev estima que c'était vraiment un paradoxe douloureux de voir comment l'ancien prisonnier pouvait sympathiser avec l'ancien officier du KGB. Malgré plusieurs rencontres privées avec Poutine et des marques de sympathie réciproque, Soljenitsyne accusa la politique impérialiste du président russe d'épuiser à l'extérieur les forces vives de la nation et reprocha à son nationalisme de détourner les Russes des vrais enjeux de leur avenir. Ces positions sur la politique de la Russie sont expliquées dès 1990 dans son essai Comment réaménager notre Russie.
Il meurt à son domicile de Moscou à 89 ans dans la nuit du 3 au 4 août 2008 d'une insuffisance cardiaque aiguë. Il est enterré au cimetière du monastère de Donskoï. Ses funérailles sont retransmises en direct à la télévision russe.
Un engagement controversé, Œuvre et vision historique
Un des principaux symboles de la résistance intellectuelle à l'oppression soviétique, Alexandre Soljenitsyne a été régulièrement attaqué, ses ouvrages et interprétations historiques souvent dénoncés comme réactionnaires, principalement par la gauche occidentale. Les opérations de déstabilisation à son encontre n'ont pratiquement jamais cessé des années 1960 jusqu’aux années 1980, et au-delà jusqu'à sa mort.
Un zek détenu, manipulé par le KGB, l'a accusé d'être un informateur des autorités communistes, et a pour cela écrit une fausse dénonciation. Le KGB a fait écrire quelques livres contre lui par d'anciens amis, comme son ancien éditeur, Alec Flagon, et même par sa première femme.
Durant sa carrière littéraire, il aurait été successivement ou simultanément accusé d'être nationaliste, tsariste, ultra-orthodoxe, antisémite ou favorable à Israël, traître, complice objectif de la Gestapo, de la CIA, des francs-maçons, des services secrets français et même du KGB. Dans son autobiographie littéraire, Le grain tombé entre les meules, et plus récemment dans un article de la Litératournaïa Gazeta, Les barbouilleurs ne cherchent pas la lumière, Soljenitsyne a répondu à ces accusations en les juxtaposant pour montrer leur incohérence.
Soljenitsyne pense que si Staline n'avait pas décapité l'Armée rouge lors des Grandes Purges en 1937, s'il n'avait pas fait "aveuglément" confiance à Hitler, pacte germano-soviétique 1939-1941, s'il avait écouté les agents tels Richard Sorge qui le mettaient en garde contre l'attaque allemande du 22 juin 1941, l'invasion nazie aurait été moins désastreuse pour le pays. Soljenitsyne reproche aussi à Staline d'avoir envoyé au Goulag tous les soldats soviétiques prisonniers des Allemands se laisser capturer vivant étant considéré comme une trahison alors que la reconstruction du pays nécessitait la participation de tous.
Accusations d'antisémitisme
Soljenitsyne a fait régulièrement l'objet d'accusations d'antisémitisme, provenant d'auteurs juifs, en raison de ses travaux historiques sur la révolution bolchevique où il étudie l'implication des juifs au sommet de l'appareil d'État et de l'appareil répressif et, plus récemment, en raison de son opposition aux oligarques russes majoritairement juifs et de la publication de son ouvrage historique Deux siècles ensemble sur les relations entre Juifs et Russes de 1795 à 1995. L'écrivain et ancien dissident soviétique Vladimir Voïnovitch a ainsi voulu démontrer le caractère antisémite de ce livre dans une étude polémique.
En France, l'historien d'extrême gauche trotskiste Jean-Jacques Marie a consacré un article à chaque tome de Deux siècles ensemble, qu'il qualifie de bible antisémite. Selon lui, Soljenitsyne expose, dans Deux siècles ensemble, une conception de l'histoire des Juifs en Russie digne de figurer dans un manuel de falsification historique en écrivant une histoire des pogroms telle qu'elle a été vue par la police tsariste. L'historien britannique Robert Service a cependant défendu le livre de Soljenitsyne, arguant que les rapports de la police avaient intérêt à grossir, non à minimiser les faits et qu'une étude de la place des juifs dans le parti bolchevique n'était en rien antisémite par elle-même.
L'historien américain d'origine juive polonaise Richard Pipes, père du néoconservateur américain et ultrasioniste Daniel Pipes, dont les travaux sur l'histoire de la Russie soviétique avaient été qualifiés par Soljenitsyne de version polonaise de l'histoire russe a répondu à celui-ci en le taxant d'antisémitisme et d'ultra-nationalisme. En 1985, Pipes a développé son propos dans sa critique d'Août 14 : Chaque culture a une forme propre d'antisémitisme. Dans le cas de Soljenitsyne, celui-ci n'est pas racial. Cela n'a rien à voir avec le sang. Soljenitsyne n'est pas raciste, la question est fondamentalement religieuse et culturelle. Il présente de nombreuses ressemblances avec Dostoïevski, qui était un chrétien fervent, un patriote et un antisémite farouche. Soljenitsyne se place incontestablement dans la vision de la Révolution défendue par l'extrême droite russe, comme une création des Juifs.
Une comparaison avec Dostoïevski, reprise de manière plus flatteuse par le président français, Nicolas Sarkozy, qui déclara en 2008:
" Son intransigeance, son idéal et sa vie longue et mouvementée font d’Alexandre Soljenitsyne une figure romanesque, héritière de Dostoïevski. Il appartient au panthéon de la littérature mondiale. Je rends hommage à sa mémoire, l’une des plus grandes consciences de la Russie du XXe siècle. "
Les critiques apparaissent largement partisanes, provenant soit de l'extrême gauche soit des néoconservateurs, rien de proprement antisémite ne pouvant être relevé dans l'oeuvre de l'auteur et sa seconde épouse étant à moitié juive.
On peut rapprocher ces critiques de la campagne de presse menée en 1947 contre un des premiers dissidents Kravtchenko: la publication de son livre en France sous le titre J'ai choisi la liberté : La vie publique et privée d'un haut fonctionnaire soviétique donna lieu à une polémique retentissante et à de nombreuses attaques des milieux communistes. Le 13 novembre 1947, dans un article signé Sim Thomas, rédigé par le journaliste André Ullmann, l'hebdomadaire Les Lettres françaises, journal proche du Parti communiste français, l'accuse de désinformation et d'être un agent des États-Unis.
Positions politiques sur l'avenir de la Russie
Ses prises de position pour une période autoritaire de transition lui valurent de sévères critiques de la part de dissidents comme Andreï Siniavski et Andreï Sakharov, pour lesquels la Russie ne saurait se régénérer sans démocratie. En fait, Soljenitsyne n'est pas hostile à la démocratie en général, mais il ne croit pas que la Russie puisse passer du jour au lendemain d'un régime totalitaire à un régime de type occidental.
À la démocratie représentative à l'occidentale, qu'il perçoit comme génératrice d'une classe politique corrompue, coupée du peuple et soucieuse avant tout de ses propres intérêts, il oppose son souhait, pour la Russie, d'un pouvoir présidentiel fort, et d'une forme de démocratie locale constituée par un tissu d'associations gérant les affaires indépendamment du pouvoir qui, lui, ne devrait s'occuper que des affaires nationales, armée, politique étrangère, etc..
Il affirme dans son livre sur le réaménagement de la Russie que celle-ci peut emprunter à la Suisse le référendum d'initiative populaire.S’affirmant comme un fervent patriote, notion qu'il oppose au nationalisme du pouvoir, Soljenitsyne a désapprouvé la Première guerre de Tchétchénie, qui visait à empêcher l'indépendance tchétchène et luttait contre des patriotes, mais a approuvé la seconde alors que les indépendantistes étaient devenus islamistes, et selon lui, mafieux. Il a eu un commentaire favorable au président Poutine lors de son arrivée au pouvoir, espérant de lui des changements significatifs.
Alexandre Soljenitsyne n'a jamais démenti les accusations de royalisme portées contre lui par le pouvoir soviétique : pour lui, le bilan du tsarisme est supérieur à celui du communisme, en termes de satisfaction des besoins et d'élévation morale du peuple russe.
Ses convictions religieuses orthodoxes suscitent également de la méfiance dans les milieux républicains. Il fut également accusé d'être favorable aux dictatures militaires menées par Francisco Franco en Espagne et Augusto Pinochet au Chili : en fait, il déplorait surtout que l'occident s'émeuve beaucoup des crimes de ces dictateurs, et fort peu de ceux du régime soviétique, et il déclara en 1976 que l'on entendait plus parler du Chili que du mur de Berlin et que si le Chili n'existait pas, il faudrait l'inventer, ajoutant après la mort de Franco que les Espagnols vivaient dans la liberté la plus absolue de son vivant, soulignant la victoire du concept de vie chrétienne durant la guerre d'Espagne.
Toutefois, Alexandre Soljenitstyne admirait au moins deux formes de démocratie occidentale : celle des États-Unis, qu'il qualifia de « pays le plus magnanime et le plus généreux de la Terre. Il admirait aussi la démocratie suisse et dans son livre Le Grain tombé entre les meules, il écrit : Ah si l'Europe pouvait écouter son demi canton d'Appenzell. En revanche, il a parfois critiqué la politique menée par le gouvernement américain, par exemple sur la paix négociée au Vietnam, qu'il qualifie d' armistice stupide, incompréhensible, sans garantie aucune.
La Russie sous le fléau de Dieu
Août 14 est centré sur les dix jours d'août 1914 où se joua le sort de la IIe armée russe, commandée par le général Samsonov, qui se suicida à l'issue du désastre militaire. Le roman saisit les protagonistes en gros plan au moment mathématique où toutes les lignes du faisceau historique passent par eux. Contrairement à Tolstoï qui figure dans son roman, Soljénitsyne croit que l'histoire est faite par les individus ; il traque l'instant de vérité, où l'homme, seul, opte pour le bien ou le mal, le vrai ou le faux. En un sens, Soljénitsyne est existentialiste : l'homme est ce qu'il décide d'être. Les pages militaires de ce roman sont d'une grandiose poésie. La décision militaire, que ce soit celle du général en chef ou du simple fantassin, est un moment qui fascine Soljénitsyne : le moment de l'abnégation où l'homme, mystérieusement mû, se libère des lois de la pesanteur biologique et cesse de se protéger lui-même. Portraits de capitaines nés, dialogues de guerriers dans la nuit étoilée, complicité émouvante du simple soldat et de son chef, égaux dans le sacrifice de soi, violente satire des Q.G. de généraux incapables et couards : tout s'organise autour d'intenses moments poétiques : la métaphore de l'aire de battage et du fléau de Dieu, empruntée au poète paysan Essenine et celle de la forêt originelle, berceau d'innocence, de pureté, d'émotion liturgique. Dans le chaos de la défaite, des soldats épars regroupés en pleine forêt par le colonel Vorotyntsev reconstituent dans une symbolique clairière l'antique assemblée villageoise russe, le mir.
Cependant la deuxième partie d'Août 14, parue en 1983, apporte à l'économie du livre une retouche gigantesque, un flash-back de trois cents pages, intitulé « Extrait des nœuds précédents. Ce retour va de 1899 à 1914, mais se concentre sur l'assassinat du Premier ministre Stolypine, à Kiev, le 1er septembre 1911. Déséquilibrant le livre, lui conférant un véritable suspens policier, écrit dans un halètement de courtes séquences, cet épisode révèle les difficultés que rencontra Soljénitsyne dans l'élaboration de son œuvre : il introduit, en contrepoint, d'immenses chapitres didactiques, très enlevés, l'un sur Nicolas II – hésitant quoique bien intentionné – l'autre sur Stolypine, le réformateur national cher à Soljénitsyne. Le symbolisme même se modifie. Au duel des regards, moment de la relation interpersonnelle, se substitue la fascination de tous par un seul : l'image du terroriste-funambule montant vertigineusement au mât du cirque. Le funambule Bogrov, l'assassin de Stolypine, est un dandy terroriste qui berne une police corrompue et bureaucratique devant la Russie, changée en arène de cirque.
Dans cette fresque historique, chaque nœud a son rythme propre. Celui d'Octobre 16 est ralenti, à l'image du front où règne l'accalmie. Celui de Mars 17 est haletant, atomisé, le récit dédoublé à l'infini semble une quête unanimiste d'instants éphémères dans la vie des rues de Petrograd en révolte, instants de peur, de lâcheté, de cabotinage sur fond de houle sauvage. Les grands protagonistes de l'histoire, Milioukov ou Kerenski, deviennent des poupées gonflées de mots et vides d'énergie. La trame de la fiction se raréfie, le didactisme grandit. L'auteur, désespérément, cherche les restes de ce qui fut l'homme russe, bon, courageux, tempérant...
Un dialogue libérateur
Ce prophète qui dit non a connu la joie intense que procure précisément le refus. La jubilation de la révolte, le rire de l'esclave affranchi, la mordante ironie de l'imprécateur marquent son œuvre. La première de ses œuvres majeures, dans l'ordre de leur genèse, c'est Le Premier Cercle : transposition à peine romancée du séjour du zek Soljénitsyne dans une des nombreuses prisons-laboratoires où Staline tenait sous clé presque tous les savants de son pays. Cette prison, c'est le premier cercle, celui où Dante situe les sages de l'Antiquité, qui n'ont pas connu le Christ. Le Premier Cercle est un dialogue libérateur entre bagnards-savants. Revenus au point zéro de la condition humaine, ces zeks se libèrent mutuellement par le rire, par le débat philosophique et par le sacrifice de soi. Ils créent une sorte de fraternité les nouveaux rosicruciens et, détachés de la vie réelle, placés par leurs bourreaux dans une situation d'ascèse totale, ils recréent la valeur, la culture, l'égalité humaine. Les chapitres extérieurs à la prison, ceux du monde libre, sont, au contraire, entièrement plongés dans les ténèbres de la peur, de la délation, du mensonge. Le despote suprême, Staline, enfermé dans son caveau du Kremlin, soupçonneux de tous, se condamne lui-même à une existence nocturne, solitaire et apeurée. Le Premier Cercle a été la thérapeutique que Soljénitsyne s'est appliquée à lui-même : un transfert de la peur des victimes sur les bourreaux. Dans l'édition russe corrigée de 1978, cette symbolique est encore plus marquée : en acceptant l'enfermement dans le cercle des purs, le diplomate innocent Volodine échappe aux épouvantes du monde totalitaire. Le cercle des savants-bagnards devient une Arche, semblable à celle de Noé. En ce refuge qu'est la prison acceptée, l'homme se libère intérieurement, tel Épictète ou Marc Aurèle. Et ces nouveaux stoïciens aperçoivent fugitivement le futur Graal chrétien.
Le Dante du goulag
Une journée d'Ivan Denissovitch, dont la parution en 1962 dans le numéro 11 de la revue Novy Mir dirigée alors par Tvardovski révéla le nom de Soljénitsyne à l'univers entier, est une chute du grand roman dialogué et philosophique. Nous sommes au cinquième ou sixième cercle de l'enfer du goulag. Spiridon, l'homme de peine du Premier Cercle, s'appelle ici Ivan Denissovitch. Mais le thème central reste l'affranchissement intérieur de l'homme. Ce n'est plus un intellectuel qui est au centre de la quête de vérité, c'est un simple moujik russe, paysan et maçon. Du lever très tôt au coucher très tard, dans les affres du froid sibérien, la lutte de la brigade pour remplir la norme, la dure compétition pour le maigre brouet alloué, nous voyons Ivan Denissovitch survivre sans déshonneur et même connaître des instants d'une joie intense que procurent la solidarité avec d'autres hommes et la victoire sur soi, sur le froid et la faim dans la célèbre scène du mur que construit le vaillant petit maçon. Débrouillard mais jamais tricheur, serviable, digne, se découvrant majestueusement pour avaler son bol au réfectoire, comme s'il présidait à un repas familial chez lui, Ivan Denissovitch, par le seul fait que la brigade le nomme ainsi, respectueusement, par son prénom et son patronymique – et non par le matricule que les bourreaux font marquer sur ses habits –, représente la victoire de la dignité. Pierre Daix et Jorge Semprun, rescapés des camps nazis, ont dit comme tous les détails de cette journée leur étaient familiers : c'est que la civilisation concentrationnaire est partout la même. Sur son châlit, le soir, Ivan a pour voisin le baptiste Aliocha, et quand Ivan dit à son voisin : Tu as beau prier, c'est pas ça qui te raccourcira ta peine, le baptiste répond par le mot de saint Paul : Réjouis-toi d'être en prison ! car ici, au moins, les ronces ont moins de chance de pousser sur ton cœur.
La publication de ce récit, deux ans avant la chute de Nikita Khrouchtchev, marqua en U.R.S.S. l'apogée de la déstalinisation. Soljénitsyne, ex-bagnard circonspect, avait jusqu'alors soigneusement caché ses écrits. Le voici partiellement dévoilé. Il profite de la brèche pour publier La Maison de Matriona, centrée sur une inoubliable figure de vieille femme fruste qui est une vraie sainte. Mais en 1964 Khrouchtchev est limogé ; commence le long duel entre Soljénitsyne et le pouvoir soviétique.
L'opposition qui consruit
Un duel qui dure dix ans, passe par le refus de publier Le Pavillon des cancéreux, par l'attribution du prix Nobel de littérature 1970 et le bannissement 1974. Ce duel étonnant a marqué notre époque, comme autrefois ceux d'un Voltaire ou d'un Tolstoï avec les pouvoirs de leur temps. Ancien zek, Soljénitsyne a l'obstination d'un homme qui revient de l'Enfer, mais il a aussi la célébrité que le pouvoir lui a lui-même conférée en 1962 en publiant son fameux récit, aveu définitif de l'existence des camps au pays du socialisme. Le pouvoir soviétique est pris de court par un individu dont les faits et gestes ne sont pas calculés en fonction du principe de prudence.
En outre, le phénomène Soljénitsyne s'inscrit dans le phénomène plus vaste de la dissidence, qui ne sera liquidée, grosso modo, que vers 1975. Dans cette lutte, Soljénitsyne se révèle un extraordinaire tacticien : il sait choisir lui-même le moment pour asséner les coups. De plus, infatigable, il rédige alors, dans une retraite clandestine, L'Archipel du Goulag, qu'il envoie clandestinement en Occident et donne ordre de publier en 1973.
La chronique de cette lutte, il l'a écrite dans un livre dont le titre fait allusion à un proverbe russe : Le Chêne et le Veau. Écrit au fur et à mesure des rebondissements de la lutte mortelle entre un écrivain et un pouvoir, Le Chêne et le Veau a la respiration haletante du danger et de l'audace. L'auteur lui a ajouté en 1992 une belle galerie de portraits : Les Invisibles, ceux et surtout celles qui l'aidèrent dans sa lutte. Jamais combat littéraire n'a été aussi instantanément traduit en œuvre littéraire. Chronique de la décennie du « dégel », magistral et émouvant portrait de Tvardovski – lutteur enchaîné, comparable au Samsonov d'Août 14 –, tour à tour invocation de Dieu, prière ou déploration à l'instant d'abandonner le sol et la beauté russes, Le Chêne et le Veau, en marge du reste de l'œuvre de Soljénitsyne, est la meilleure introduction à cette œuvre ; comme Passé et méditation de Herzen, il est l'écriture faite combat.
L'Archipael du goulag
L'Archipel du Goulag, lui, est un gigantesque édifice qui se veut chronique, description historique, géographique, ethnographique du monde concentrationnaire, engendré par la révolution russe. Aidé par les témoignages secrets de nombreux rescapés des camps, Soljénitsyne s'est senti le porte-parole de millions de morts, de toute une humanité engloutie. Mais son livre est néanmoins l'œuvre d'un auteur bien présent. Elle a pour sous-titre : Essai d'investigation artistique », titre que Soljénitsyne a en quelque sorte explicité dans son Discours du Nobel. Et ce sens est double : d'une part, seul l'art – avec son ordonnancement émotionnel, poétique, ironique – peut pallier l'absence de documents, déjouer le systématique engloutissement d'une part énorme de la vérité humaine ; d'autre part, cet immense drainage de souffrances, cet archipel de l'inhumain sécrète, en définitive, une sorte de beauté. Et, en effet, Soljénitsyne, au terme d'une enquête aussi minutieuse que grondante de colère, nous montre une floraison de martyrs et de saints, preuve que le camp ne produit pas que de l'inhumain. Là, il polémique implicitement avec les autres grands chroniqueurs des camps : un Élie Wiesel pour les camps nazis, un Chalamov pour les camps soviétiques. Le camp, cette ascèse absolue, débroussaille définitivement l'âme. Un des chapitres les plus grandioses de cette Odyssée est celui qui décrit les révoltes dans les camps, en particulier les quarante jours de Kenguir. Porté par un souffle épique, cachant l'émotion sous la gouaille et l'ironie, Soljénitsyne y célèbre la naissance authentique d'un non au nouvel asservissement, un non naïf, primitif, quasi enfantin, originel.
Le pavillon des cancéreux
Ainsi, le monde entier lisait Le Pavillon des cancéreux, récit poétique sur la convalescence de l'homme, tandis que son auteur achevait les sept livres de L'Archipel et, cette besogne finie, enchaînait sur un gigantesque roman historique, entrevu dès l'âge de dix-huit ans, intitulé La Roue rouge et dont le premier nœud, Août 14, parut en 1971, suivi de chapitres tirés des nœuds suivants, encore inédits, groupés autour de Lénine à Zurich. Cette fresque historique, primitivement conçue en vingt nœuds, n'en comporte en définitive que quatre Août 14, Octobre 16, Mars 17, Avril 17, qui totalisent néanmoins six mille six cents pages. Le récit s'arrête en avril 1917 (allant jusqu'au retour de Lénine à Petrograd car, nous dit l'auteur, le poids spécifique s'est déplacé vers la révolution de Février 1917, à un moment où tout est déjà joué, c'est-à-dire perdu : Le putsch d'Octobre, déjà en avril, se dessine comme inéluctable. Néanmoins, en appendice, l'auteur fournit au lecteur un synopsis de la suite à laquelle il a renoncé, et qui conduisait jusqu'en 1945. Ainsi cet énorme vaisseau d'écriture est-il lesté d'une quille inachevée, virtuelle si l'on ose dire, ce qui en fait une sorte d'hapax dans la longue histoire du roman européen...
Une journée d'Ivan Denissovitch, livre de Alexandre Soljénitsyne
En 1962 Alexandre Soljénitsyne, un inconnu, envoie le manuscrit d'un récit écrit trois ans plus tôt à la revue soviétique réputée libérale, Novy Mir, Monde nouveau. Son directeur, Alexandre Tvardovski, obtient l'imprimatur de Nikita Khrouchtchev lui-même, qui, s'il est loin d'être un libéral, entend utiliser le livre contre ses adversaires conservateurs. Les lecteurs russes s'arrachent Une journée d'Ivan Denissovitch.
En France, les communistes organisent aussitôt la traduction et le lancement du livre qui, préfacé par Pierre Daix, connaît un grand succès. L'opération, supervisée par Aragon et Elsa Triolet, vise à faire croire que l'U.R.S.S. a changé, que le stalinisme fut une déviation ou une erreur mais que le régime fondé par Lénine est foncièrement sain. En fait, les communistes ne vont pas pouvoir longtemps contrôler la réception du récit. Un fait est désormais acquis : il a existé un système concentrationnaire de masse au pays des soviets.
C'est la vérité qui compte, écrit Soljénitsyne, il faut écrire pour que tout cela ne soit pas oublié, pour qu'un jour nos descendants l'apprennent. Rescapé de huit saisons en enfer, huit années au Goulag, l'écrivain sait quelles limites il lui est interdit de franchir : il a consenti à toutes les coupes que le pouvoir lui demandait. L'essentiel était que le livre paraisse et fasse son chemin. Il faudra attendre 1973 pour que le texte original soit connu et fasse l'objet d'une traduction plus fidèle que la première
Le quotidien concentrationnaire
Une journée d'Ivan Denissovitch est un récit semi-autobiographique, linéaire et laconique dont le titre indique clairement le contenu. Il ne se passe rien d'extraordinaire dans les quelque dix-huit heures de cette journée d'Ivan Choukhov : réveil, soupe à la cantine, appels et contre-appels, travail dans le froid, retour à la baraque. Des journées comme ça – conclut le narrateur – dans sa peine, il y en avait, d'un bout à l'autre, trois mille six cent cinquante-trois.
Le personnage focal du récit est un paysan russe qui fut soldat de deuxième classe. Du moujik tolstoïen, Ivan Choukhov a gardé quelques traits caractéristiques. Il est fruste, superstitieux mais roublard. Il aime la belle ouvrage et respecte son chef de brigade, mais il chaparde des suppléments. Ce n'est pas un révolté, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas non plus un héros soviétique : il reste complètement étranger à l'idéologie officielle. Coupé des siens, il vit au présent et économise ses forces. L'essentiel est qu'il a su garder sa dignité. C'est pourquoi il a des chances de survivre.
D'autres figures traversent le récit, l'ex-commandant Bouynovski châtié pour s'être rebellé, César le planqué, Aliocha le baptiste. L'échantillon de la population concentrationnaire ruine le mensonge de la propagande officielle. Il n'y a là que des anciens prisonniers de guerre, des croyants, des paysans, des Baltes, des Ukrainiens. Leur culpabilité est sociologique ou ethnologique. Le seul délinquant de droit commun avéré se retrouve, comme par hasard, chef de baraque. Quand les Choukhov se comptent par millions, le pouvoir est contre le peuple, suggère Soljénitsyne.
Un regard sociologique
Le narrateur porte un regard sociologique sur le camp. Il dépeint au quotidien des mécanismes de domination et d'exploitation, une bureaucratie parasitaire, quelques brutes mais pas de tortionnaires. Les détenus les zeks ont perdu leur identité. Ce sont de simples matricules, taillables et corvéables à merci. Quelques-uns, en échange de menus privilèges, se font les auxiliaires zélés de l'administration ; les plus nombreux triment, mal nourris, dans le cadre d'une brigade. Au-delà du camp, Soljénitsyne donne de la société soviétique une image impitoyable : le mensonge, la gabegie, l'irresponsabilité et la corruption y règnent sans partage.
Le romancier livre une tranche de vie et s'interdit tout commentaire inutile. Il donne la priorité à la transmission de son expérience. Ignorant les recherches modernistes de ses contemporains occidentaux comme les médiocres platitudes du réalisme socialiste, le mémorialiste du Goulag s'inscrit dans la tradition du XIXe siècle, marquée notamment par les Récits de la maison des morts 1861-1862 de Dostoïevski. Il choisit une focalisation interne et restreinte. L'économie du récit est d'une rigueur extrême. Le récit n'est pas découpé en chapitres, l'espace-temps est resserré. Des détails concrets restituent l'univers oppressant d'un camp que Soljénitsyne transforme en métaphore de la société totalitaire.
Les traductions rendent malaisément le travail stylistique de l'auteur. S'étant dégagé de l'idiome idéologico-politique officiel, de la langue de bois , Soljénitsyne a forgé une langue populaire mi-écrite mi-orale, truffée de mots anciens, d'argotismes et de dialectalismes. Les ellipses et les discontinuités font éclater le moule de la syntaxe classique. Aux slogans officiels, le narrateur sarcastique oppose des dictons anciens ou fabriqués et des énoncés à l'humour ravageur.
Œuvres
L'œuvre d'Alexandre Soljenitsyne entend révéler la double injustice faite aux millions de Russes victimes d'un État traître à son propre peuple : celle de l'exil et des camps du Goulag et souvent de la mort, sans justice ni culpabilité, mais aussi l'injustice du silence et de l'oubli. Ainsi, L'Archipel du Goulag rapporte le témoignage de quelque 220 victimes, part infime du flot des déportés. La datation des œuvres d'Alexandre Soljenitsyne est difficile à établir avec précision, la plupart d'entre elles ayant connu une gestation très longue et plusieurs versions y compris parfois une réécriture quasi complète. En ce sens, l'exergue placé au début du Premier Cercle est significatif : Écrit de 1955 à 1958. Défiguré en 1964. Réécrit en 1968.
Une journée d'Ivan Denissovitch 1962
La Maison de Matriona 1963, qui contient aussi L'Inconnu de Krétchétovka et Pour le bien et la cause recueil de nouvelles
Le Pavillon des cancéreux 1968
Les Droits de l'écrivain 1969
Le Premier cercle commencé en 1955, version finale en 1968
La fille d'amour et l'innocent pièce en 4 actes et 11 tableaux 1971
Zacharie l'escarcelle 1971 nouvelles
Août quatorze, premier nœud (série de livres nœuds en plusieurs volumes tomes)réédités en 1983 sous le titre commun La Roue rouge 1972
L'Archipel du Goulag tomes I et II 1974
Le chêne et le Veau 1975
Discours américains 1975
Des voix sous les décombres 1975
Lénine à Zurich 1975
L'Archipel du Goulag tome III 1976
Flamme au vent, théâtre 1977
Le Déclin du courage 1978
Message d'exil 1979
L'Erreur de l'Occident 1980
Les Tanks connaissent la vérité 1982
Nos pluralistes 1983
La Roue rouge, tome 2 : Deuxième nœud - Novembre seize 1985
Comment réaménager notre Russie ? 1990
Les Invisibles 1992
La Roue rouge, tome 3 : Troisième nœud - Mars dix-sept 4 tomes 1993-1998
Le Problème russe à la fin du XXe siècle 1994
Ego, suivi de Sur le fil récits 1995
Nos jeunes récits 1997
Le Grain tombé entre les meules 1998, éd. Fayard, 500 pages.
La Russie sous l'avalanche 1998
Deux récits de guerre 000
Deux siècles ensemble, 1795-1995, tome 1 : Juifs et Russes avant la révolution 2002
Deux siècles ensemble, 1917-1972, tome 2 : Juifs et Russes pendant la période soviétique 2003
Esquisses d'exil – Le grain tombé entre les meules, tome 2, 1979-1994, traduit du russe par Françoise Lesourd, 2005
Aime la révolution !, roman inachevé 2007
Réflexions sur la révolution de février, 2007
Une minute par jour, entretiens 2007
La Roue rouge : Quatrième nœud : Avril dix-sept 2009
Récompenses, distinctions, Prix
Prix Nobel de littérature, 1970
Prix Templeton, 1983
Ordre de Saint-André, 199841
Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques, 2000
Docteur Honoris Causa de l'Université d'État de Moscou
Ordre de l'Étoile de Roumanie, 2008 à titre posthume
Liens
http://youtu.be/WH0zW5rBtJo Une journée d'Ivan Denissovitch H. Guillemin
http://youtu.be/X6FJM-Ncb44 Prophète ou réactionnaire
http://youtu.be/q5ZBKIpxn3o A propos de l'occident
http://youtu.be/s5jjU8YCqRc Et l'occident apostat
http://youtu.be/MQrL7jDEfc4 Dialogue
http://youtu.be/ot281lb91_8 Chez Pivot
http://youtu.be/1EuCtcBHsL4 Le courage d'écrire
http://youtu.be/t6pULYct-OA A propos de sa méthode de travail
http://youtu.be/7Vqf5zYzxvo Dans sa maison de Cavendish
http://youtu.be/WypcADANOXw a propos de sa célébrité
http://youtu.be/U6Kp3yoyAEI A propos de son écriture en occident
http://youtu.be/pN9t8q0ypJU interview
  [img width=600]http://s.tf1.fr/mmdia/i/88/7/alexandre-soljenitsyne-2570887_1713.jpg?v=1[/img]          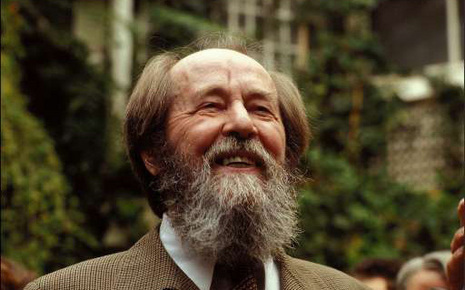 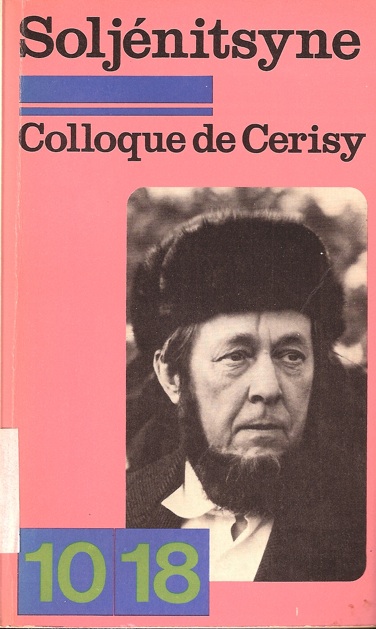   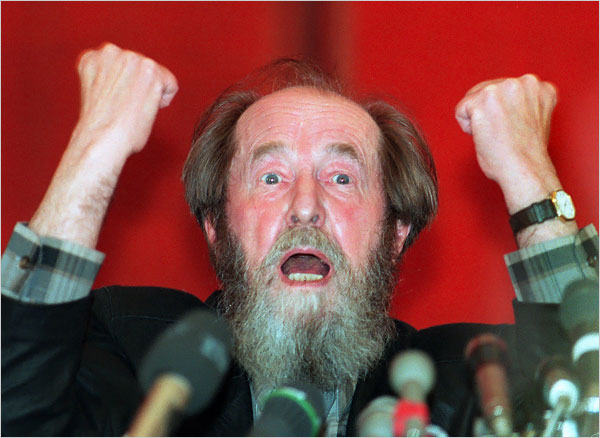  
Posté le : 01/08/2014 16:53
|
|
|
|
|
Elisabeth Schwarzkopf |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 3 août 2006 à Schruns, en Autriche, à 90 ans meurt Dame Elisabeth
Schwarzkopf
une artiste lyrique soprano allemande, naturalisée anglaise, née le 9 décembre 1915 à Jarocin, ville de l'ancienne province prussienne de Posnanie, actuellement en Pologne, et décédée le 3 août 2006 à Schruns, en Autriche. Elle fut l'une des grandes sopranos du XXe siècle. Elle est formée à la Hochschule für Musik de Berlin, elle à pour maître Maria Ivogün et pour Conjoint Walter Leggeen. En activité de 1938 à 1979, elle Collabore avec Wilhelm Furtwängler, Karl Böhm, Herbert von Karajan, Dietrich Fischer-Dieskau, Maria Callas, Christa Ludwig, George Szell, Irmgard Seefried, Gerald Moore...
En bref
Une beauté rare, à la fois radieuse et distante, et un port de reine lui promettaient une irrésistible carrière sur les scènes lyriques. La débutante a certes connu les planches, mais, au fil des années, l'opéra a vu ses apparitions se raréfier et son répertoire se concentrer autour de quelques grands rôles de Richard Strauss et de Mozart. La soprano allemande Elisabeth Schwarzkopf doit en partie sa gloire au microsillon : instrument docile entre les mains d'un mari Pygmalion, elle a su répondre, par un travail acharné, à toutes les exigences artistiques et techniques de ce nouveau support ainsi qu'aux insatiables attentes de son Mentor. Sa dévorante obsession de la précision, de la perfection de l'intonation et de la pureté stylistique lui ont permis de s'approprier pendant de longues années les rôles de la Comtesse des Noces de Figaro ou ceux de la Maréchale du Chevalier à la rose, au point d'occulter d'autres incarnations tout aussi dignes d'admiration. Elle personnifie l'un des sommets de l'idéal musical au disque, et l'une des références absolues du chant straussien et mozartien.
Sa vie
Olga Maria Friederike Schwarzkopf naît le 9 décembre 1915 à Jarocin, près de Poznań. Son père, Friedrich, est un instituteur prussien à la mentalité rigide qui lui fait don de son intransigeance et de sa passion pour la langue allemande. Sa mère, née Elisabeth Fröhlich, la gratifie d’une oreille musicale très sûre, d’une volonté de fer, et de son prénom.
Dès l’âge de 10 ans, Elisabeth déchiffre parfaitement les partitions, s’accompagne elle-même au piano et chante souvent dans des concerts amateurs, ce qui lui permet de tenir le rôle-titre de l’Orphée et Eurydice de Gluck dans la production de fin d’année de son école de Magdebourg, en 1928.
Studieuse, appliquée, elle est facilement reçue à la Hochschule für Musik de Berlin en 1934 où son premier professeur, une certaine Lula Mysz-Gmeiner, décide qu’elle a une tessiture de mezzo-soprano. Sa mère proteste fermement, et obtient qu’Elisabeth soit acceptée dans la classe du Professeur Egonolf comme soprano colorature. C’est le 15 avril 1938 qu’elle fait ses débuts comme l’une des filles-fleurs de Klingsor dans Parsifal, de Richard Wagner, sous la baguette de Karl Böhm, puis comme l’un des trois pages de La Flûte enchantée de Mozart.
Période 1933 - 1945
Elle n'a pas encore 18 ans lorsque Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Comme bon nombre de jeunes artistes, elle s’inscrit, dès 1935, au syndicat des étudiants nazis. En 1938, elle demande son adhésion au Parti national-socialiste, mais elle soutiendra plus tard ne pas en avoir reçu la carte1 — cette initiative lui vaudra d'être surnommée la diva nazie par le quotidien américain The New York Times. Mais si on lui offre des rôles plus importants — que ce soit dans l’opérette aussi bien que dans les productions de Richard Strauss —, c’est aussi parce que son talent est déjà exceptionnel.
Richard Strauss la recommande à sa cantatrice fétiche, Maria Ivogün, qui la prend comme élève. En 1942, le chef d’orchestre Karl Böhm l’invite à Vienne, où elle touche un public de connaisseurs dans ses interprétations de lieder, accompagnée par le pianiste Michael Raucheisen, avec qui elle réalise ses premiers enregistrements.
En septembre 1941, elle fait entrer La Chauve-Souris de Johann Strauss II au répertoire de l'Opéra de Paris devant un public de sympathisants de l'armée d'occupation. Ce début de carrière est interrompu brutalement par un début de tuberculose qu’elle doit soigner pendant deux ans dans un sanatorium des Monts Tatras, dans le sud de la Pologne, où le Gauleiter Hans Frank lui fait une cour assidue.
Guérie, c’est en 1944 qu’elle fait ses grands débuts à Vienne, en Rosine, du Barbier de Séville, en Blondine, de L’Enlèvement au Sérail, et en Zerbinetta d’Ariane à Naxos de Richard Strauss.
Après la défaite de l’Allemagne, son appartenance au parti nazi et ses liens avec Hans Frank et Joseph Goebbels, ministre de la propagande d’Hitler, lui valent de passer devant le tribunal de dénazification des artistes de Berlin. Ce tribunal l’acquitte, ainsi que bien d’autres artistes, comme par exemple son ami le chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler. C’est alors que commence une carrière internationale d’une incomparable qualité, sous la houlette d’un producteur et directeur artistique anglais, Walter Legge, qui lui fait réaliser ses premiers enregistrements et qu’elle épouse en 1953.
La carrière internationale
En 1946, à Vienne, elle chante les rôles de Mimi La Bohême et de Violetta La Traviata ; par la suite, c'est après avoir vu Maria Callas l'interpréter qu'elle renoncera à Violetta. À Londres, en 1947, elle est Donna Elvira Don Giovanni de Mozart. La même année, elle est Susanne à Salzbourg Les Noces de Figaro. Herbert von Karajan l’engage à la Scala de Milan où elle chante Mozart La Flûte enchantée, Cosi fan Tutte, Wagner Tannhäuser, Gounod Faust, Richard Strauss Le Chevalier à la rose, Debussy Pelléas et Mélisande.
En 1950, elle est Marcelline dans Fidelio, sous la baguette de Wilhelm Furtwängler. Pendant la période 1950-54, elle chanta souvent avec le chef d'orchestre allemand: durant la célèbre Symphonie n° 9 de Beethoven pour la réouverture du festival de Bayreuth en 1951 ainsi que pour la 9ème de Beethoven de Lucerne en 1954. Elle participa aux Don Giovanni de Wilhelm Furtwängler aux festival de Salzbourg de 1953 et 1954. Le chef d'orchestre allemand l'accompagna aussi au piano, en 1953, dans les Lieders d'Hugo Wolf3. La personnalité musicale de Wilhelm Furtwängler semble avoir beaucoup impressionné Elisabeth Schwarzkopf car elle déclara, à la fin de sa vie, dans un interview qu'elle le tenait pour le plus grand chef d'orchestre avec qui elle avait chanté.
En 1951, elle crée, à Venise, le rôle d’Anne Trulove dans l’opéra The Rake's Progress La Carrière d'un libertin d'Igor Stravinski, sous la direction du compositeur. En 1952, avec Karajan, ce sont les débuts de la Maréchale Le Chevalier à la rose à la Scala de Milan. En 1951, pour le cinquantenaire de la mort de Verdi, elle chante le Requiem, sous la direction de Victor de Sabata. La même année, elle crée Le Triomphe d’Aphrodite de Carl Orff. En 1955, à San Francisco, elle est de nouveau la Maréchale. La même année, elle est Alice Ford dans le Falstaff de Verdi.
La voix de son maître
Walter Legge, infatigable découvreur de talents, la distingue – il l'épousera en 1953 –, lui offre la nationalité britannique et réalise ses premiers enregistrements. Véritable maître à chanter, il lui transmet sa passion pour Hugo Wolf, sa rigueur et sa vaste culture. Après une tournée triomphale en Grande-Bretagne 1947, elle rejoint la troupe du Covent Garden de Londres, où elle va chanter jusqu'en 1951 – en anglais – dans des rôles aussi divers que Mimì La Bohème de Puccini, Violetta La Traviata de Verdi, Eva Les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner, Sophie Le Chevalier à la rose de Richard Strauss, Gilda Rigoletto de Verdi, Nedda Paillasse de Leoncavallo, Pamina La Flûte enchantée, Cio-cio-san Madama Butterfly de Puccini ou le rôle-titre de Manon de Massenet. De 1947 à 1964 elle paraît fréquemment au festival de Salzbourg sous les traits de Susanna Les Noces de Figaro de Mozart, 1947, de Donna Elvira Don Giovanni de Mozart, 1948-1950, 1953-1954, 1960, de Marzelline Fidelio de Beethoven, 1950, de la Comtesse Almaviva Les Noces de Figaro,1952-1953, 1956, 1958, d'Alice Ford Falstaff de Verdi, 1957, de Fiordiligi Così fan tutte de Mozart, 1958, 1961-1964, de la Maréchale Le Chevalier à la rose, 1960-1961, 1964. En 1951, elle inaugure le nouveau Bayreuth en chantant dans la Neuvième Symphonie inaugurale sous la direction de Wilhelm Furtwängler 29 juillet et en interprétant Eva des Maîtres chanteurs sous celle de Karajan ainsi que Woglinde dans L'Or du Rhin et Le Crépuscule des Dieux.
Le 11 septembre 1951, elle crée à La Fenice de Venise, sur la demande expresse du compositeur, Anne Trulove du Rake's Progress de Stravinski. Le 13 février 1953, elle participe à la création du Trionfo di Afrodite de Carl Orff à la Scala de Milan, sous la direction de Karajan. En 1961, Bruno Walter l'appellera pour ses adieux à Vienne avec une très émouvante Quatrième Symphonie de Mahler. Le Metropolitan Opera ne l'accueillera, bien tardivement, qu'en 1964, dans le rôle emblématique de la Maréchale. Elle crée encore, en 1967, le cycle des Canti della lontananza, de Gian Carlo Menotti. Depuis de nombreuses années déjà ses apparitions publiques s'espacent, essentiellement des récitals de 1971 à 1975. Le 31 décembre 1972, au Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles, elle fait ses adieux à la scène en interprétant la Maréchale. À la mort de Walter Legge, en 1979, elle cesse définitivement de donner des concerts. Elle se tourne alors vers l'enseignement et la mise en scène. Sous le sourire angélique se dissimulent un professeur souvent cruel et une consœur parfois venimeuse... En 1982 paraissent ses mémoires, dont le titre français, voulu par elle – elle parlait fort bien cette langue –, La Voix de mon maître : Walter Legge, témoigne tout à la fois de sa fidélité et de son humour. Elisabeth Schwarzkopf meurt à Schruns Autriche le 3 août 2006.
En 1957, sous la direction de Tullio Serafin, elle est Liù, Turandot de Pucciniaux côtés de Maria Callas dans le rôle-titre, pour l'enregistrement studio de cet opéra. Elle ne fait sa première apparition au Metropolitan Opera de New York qu’en 1964, dans Le Chevalier à la Rose, car Rudolf Bing, le directeur du Met, reste longtemps opposé à la venue de certains artistes dont il conteste la « dénazification. De 1960 à 1967, elle se consacre surtout aux rôles mozartiens, Donna Elvira, la comtesse Almaviva, Fiordiligi, et à ses deux rôles fétiches des opéras de Richard Strauss : la Maréchale du Chevalier à la rose et la comtesse Madeleine de Capriccio. En 1967, elle interprète le Duo des chats de Rossini avec Victoria de los Ángeles.
Durant toute cette carrière dédiée au théâtre lyrique, elle reste fidèle aux lieder de langue allemande, de Mozart à Mahler, en passant par Schubert, Schumann, et donne de nombreux récitals. On notera en particulier tous ceux qu’elle a réalisés avec le pianiste Gerald Moore, ceux chantés avec les sopranos Irmgard Seefried ou Victoria de los Ángeles, la mezzo-soprano Christa Ludwig et le baryton Dietrich Fischer-Dieskau. Parmi ses récitals devenus légendaires : un récital Schubert en 1952 avec Edwin Fischer, un récital Wolf avec Wilhelm Furtwängler au piano en 1953, un récital Mozart en 1956 avec Walter Gieseking, les Quatre derniers Lieder de Richard Strauss avec George Szell en 1965, Des Knaben Wunderhorn de Mahler avec le même Szell en compagnie de Fischer-Dieskau en 1968…
À partir de 1971, elle ne chante plus sur les scènes lyriques. Le 19 mars 1979, son mari Walter Legge, qui vient de subir un infarctus, veut pourtant assister au récital qu’elle donne à Zurich, et il meurt trois jours plus tard. Schwarzkopf quitte alors définitivement la scène. Elle consacre à son mari un livre sous forme d’autobiographie, On and Off The Record, qui, curieusement mais avec son assentiment, est traduit en français par La Voix de mon maître. Elle se consacre désormais à l’enseignement et donne, de par le monde, des classes de maître mémorables, notamment à Paris, salle Gaveau. Faite « Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (DBE) » par la reine Élisabeth II en 1992, Elisabeth Schwarzkopf décède le 3 août 2006, à l'âge de 90 ans, dans la petite ville autrichienne de Schruns, dans le Vorarlberg, où elle vient de s’installer.
La légende Schwarzkopf
L'organe possède d'emblée d'évidentes qualités : la voix est fraîche et brillante avec des aigus très faciles – elle les prêtera à Kirsten Flagstad, l'Isolde de l'enregistrement de Tristan et Isolde dirigé par Wilhelm Furtwängler en 1952 –, avec de hauts pianissimos enchanteurs, un vibrato arachnéen et une agilité aérienne impressionnante. Héritées d'Ivogün, une noblesse de ton, une pudeur patricienne, une sensualité contenue, et une nostalgie diffuse qui font merveille dans son répertoire d'élection. Un timbre d'une luminosité unique, un legato d'une infinie souplesse, une ahurissante maîtrise du souffle et de l'articulation, toutes qualités conquises de haute lutte – sans doute au prix de la perte d'une certaine spontanéité – font bien vite oublier un registre peu étendu et une puissance vocale limitée. Elle triomphe dans des opérettes de Johann Strauss (Rosalinde dans La Chauve-Souris, Karajan, 1955) ou Franz Lehár (Lisa dans Le Pays du sourire, Hanna dans La Veuve joyeuse, Otto Ackermann, 1953), jamais jouées sur scène, avec un abattage, une gourmandise et une élégance inimitables. Son legs discographique, où elle côtoie l'élite du chant et de la direction de son temps, puisée dans l'« écurie Legge », est d'une qualité exceptionnelle, que ce soit dans Mozart – deux Noces de Figaro (Karajan, 1950 ; Carlo Maria Giulini, 1959), deux Così (Karajan, 1954 ; Böhm, 1962), Don Giovanni (Giulini, 1959) –, Richard Strauss – les Quatre Derniers Lieder (avec Ackermann, en 1953, et George Szell, en 1965), Le Chevalier à la Rose (Karajan, 1956), Ariane à Naxos (Karajan, 1954), Capriccio (Wolfgang Sawallisch, 1957) –, Humperdinck – Hänsel und Gretel (Karajan, 1953) – ou même Verdi avec un Falstaff d'anthologie (Karajan, 1956). Elle pratique le lied en compagnie des plus grands – qu'il s'agisse de pianistes ou de chefs d'orchestre – avec autant d'inspiration que de savoir-faire. Walter Gieseking, Edwin Fischer, Sviatoslav Richter, Gerald Moore, Geoffrey Parsons, Karajan, Sawallisch, Ackermann, Hans Rosbaud et Furtwängler rejoignent, dans Mozart, Schubert ou Wolf, celle qui a fait de la sophistication une voie royale vers les sommets de l'art. L'univers poétique d'Hugo Wolf notamment n'a pas de secrets pour elle. Avec une subtile intelligence du texte, une volonté de perfectionnisme dans l'infinitésimal et des nuances d'une finesse diabolique, Elisabeth Schwarzkopf se révèle, accompagnée par Gerald Moore, l'interprète rêvée de ses vénéneux sortilèges.
Juste après sa mort, une fausse rumeur refait surface, à savoir qu'elle serait la tante du général américain Norman Schwarzkopf. Cette légende a été publiée dans de nombreuses nécrologies, alors que, fille unique, Elisabeth Schwarzkopf n'a pas pu avoir de neveu.
Citations
Le son numérique rend toutes les voix beaucoup trop claires. Elles deviennent perçantes au point de nous faire mal, on croirait des lames de couteau. Mais la jeune génération ne connaît rien d'autre ; son oreille est faussée, pervertie.
Bibliographie
Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale de la Diète • WorldCat
(en) Elisabeth Schwarzkopf, On and Off the Record. A Memoir of Walter Legge, Charles Scribner's Sons, New York, 1982, 2e éd. 1988.
(fr) Elisabeth Schwarzkopf, La Voix de mon maître : Walter Legge (traduit de l'anglais par Janine Barry-Delongchamps), Belfond, collection Voix, Paris, septembre 1983, 322 pages (ISBN 978-2-71441-627-8), rééditions 1990 (ISBN 2-7144-1627-6), 1998, 2003.
(fr) Sergio Segalini, Elisabeth Schwarzkopf, éditions Fayard, Paris, octobre 1983, 158 pages
(fr) Elisabeth Schwarzkopf et André Tubeuf, Les autres soirs, Mémoires
, Tallandier, Paris, juillet 2004, 370 pages .
Discographie
Sauf indication contraire, ces enregistrements ont été publiés par EMI.
Bach, Passion selon saint Matthieu, dir. Otto Klemperer
Bach, Messe en si mineur, dir. Herbert von Karajan, avec Kathleen Ferrier
Bach, Cantates BWV 51, 199 & 202 / Arias des cantates BWV 68 & 208
Beethoven, Symphonie n° 9, dir. Wilhelm Furtwängler
Beethoven, Symphonie n° 9, dir. Herbert von Karajan
Beethoven, Missa Solemnis, dir. Herbert von Karajan Testament
Beethoven, Fidelio Marzeline, dir. Wilhelm Furtwängler
Brahms, Un requiem allemand Ein deutsches Requiem, dir. Herbert von Karajan, avec Hans Hotter
Brahms, Un requiem allemand, dir. Otto Klemperer, avec Dietrich Fischer-Dieskau
Brahms, Deutsches Volkslieder, piano Gerald Moore, avec Dietrich Fischer-Dieskau
Haendel, Le Messie, dir. Otto Klemperer
Humperdinck, Hänsel et Gretel Gretel, dir. Herbert von Karajan, avec Elisabeth Grummer
Lehar, La Veuve joyeuse - Le Pays du sourire, dir. Otto Ackermann, avec Nicolai Gedda
Mahler, Des Knaben Wunderhorn, dir. George Szell, avec Dietrich Fischer-Dieskau
Mahler, Symphonie n° 2, dir. Otto Klemperer
Mahler, Symphonie n° 4, dir. Otto Klemperer
Mahler, Symphonie n° 4, dir. Bruno Walter Coda
Mozart, Don Giovanni Donna Elvira, dir. Wilhelm Furtwängler
Mozart, Don Giovanni Donna Elvira, dir. Carlo Maria Giulini
Mozart, Cosi fan tutte Fiordiligi, dir. Karl Böhm
Mozart, Cosi fan tutte Fiordiligi, dir. Herbert von Karajan
Mozart, Les Noces de Figaro la comtesse, dir. Herbert von Karajan
Mozart, Les Noces de Figaro la comtesse, dir. Carlo Maria Giulini
Mozart, La Flûte enchantée première dame, dir. Otto Klemperer
Mozart, Airs d'opéras
Mozart, Lieder et arias de concerts
Offenbach, Les Contes d'Hoffmann Giulietta, dir. André Cluytens
Orff, Die Kluge, dir. Wolfgang Sawallisch
Puccini, Turandot Liù, dir. Tullio Serafin, avec Maria Callas
Purcell, Didon et Enée (elinda & second lady, avec Kirsten Flagstad
Schubert, Lieder, piano Edwin Fischer, Geoffrey Parsons, Gerald Moore
Schubert, Schumann, Strauss, Lieder, piano Geoffrey Parsons
Johann Strauss II, La Chauve-Souris Die Fledermaus Rosalinde, dir. Herbert von Karajan
Johann Strauss II, Le Baron tzigane Saffi dir. Otto Ackermann
Johann Strauss II, Sang viennois / Une nuit à Venise, dir. Otto Ackermann
Richard Strauss, Le Chevalier à la rose (la maréchale) , dir. Herbert von Karajan, avec Christa Ludwig et Teresa Stich-Randall
Richard Strauss, Ariadne auf Naxos Ariane, dir. Herbert von Karajan
Richard Strauss, Capriccio Madeleine, dir. Wolfgang Sawallisch
Richard Strauss, Quatre derniers Lieder - Capriccio scène finale - Arabella extr., dir. Otto Ackermann
Richard Strauss, Quatre derniers Lieder - Lieder avec orchestre, dir. George Szell
Richard Strauss, Ophelia Lieder, piano Glenn Gould Sony
Stravinski, The Rake's Progress Anne Trulove, dir. Igor Stravinski Gala
Verdi, Requiem, dir. Carlo Maria Giulini
Verdi, Falstaff Alice Ford, dir. Herbert von Karajan, avec Tito Gobbi
Wagner, Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg Eva, dir. Herbert von Karajan
Wagner, Le Crépuscule des Dieux Woglinde, dir. Hans Knappertsbusch Testament
Walton, Scenes from Troilus and Cressida, dir. William Walton
Wolf, 22 Lieder, piano Wilhelm Furtwängler
Wolf, Lieder Recital, piano Gerald Moore
Wolf, Italienisches Liederbuch, piano Gerald Moore, avec Dietrich Fischer-Dieskau
Wolf, Spanisches Liederbuch, piano Gerald Moore, avec Dietrich Fischer-Dieskau Deutsche Grammophon
Duos pour sopranos, avec Irmgard Seefried
Le Duo des chats et autres airs, duos et trios, avec Victoria de Los Angeles, Dietrich Fischer-Dieskau et Gerald Moore
Operetta Arias
Lieder Recital (Bach, Pergolesi, Haendel, Gluck, Beethoven, Schubert, Wolf, Strauss, Mozart, Schumann), piano Gerald Moore
Recital Elisabeth Schwarzkopf Bach, Mozart, Mahler, Strauss
Recital at Carnegie Hall, November 25, 1956 Mozart, Schubert, Gluck, Strauss, Wolf..., piano George Reeves
Songs You Love, piano Gerald Moore
The Christmas Album, dir. Charles Mackerras
Elisabeth Schwarzkopf: un portrait DVD
Schwarzkopf, Seefried, Fischer-Dieskau Mahler, R. Strauss DVD
Une soirée viennoise DVD VAI
rano allemande, naturalisée anglaise, née le 9 décembre 1915 à Jarocin, ville de l'ancienne province prusLe 3 août 2006 à Schruns, en Autriche, à 90 ans meurt Dame Elisabeth Schwarzkopfsienne de Posnanie, actuellement en Pologne, et décédée le 3 août 2006 à Schruns, en Autriche. Elle fut l'une des grandes sopranos du XXe siècle. Elle est formée à la Hochschule für Musik de Berlin, elle à pour maître Maria Ivogün et pour Conjoint Walter Leggeen. En activité de 1938 à 1979, elle Collabore avec Wilhelm Furtwängler, Karl Böhm, Herbert von Karajan, Dietrich Fischer-Dieskau, Maria Callas, Christa Ludwig, George Szell, Irmgard Seefried, Gerald Moore...
Liens
http://youtu.be/C8NtQtw6iHk 12 Lieder (démarrage long)
http://youtu.be/_aSPTzj3y-s Strauss
http://youtu.be/IjBNp07_qok Plaisir d'amour
http://youtu.be/ZoGQd1dsAlw
http://youtu.be/MGzVZWYIUlc Mme Butterfly Puccini
[img width=600]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXvUwUXsDswB98qZtMm7mJ9-_tQEJ-murkVwLVLYpqxxQBGxO97cBfTxIR[/img]              
Posté le : 01/08/2014 15:58
|
|
|
|
|
Henri Cartier-Bresson |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 3 août 2004 à Montjustin dans les Alpes-de-Haute-Provence, à 95 ans
meurt Henri Cartier-Bresson
né 22 août 1908 à Chanteloup-en-Brie - 3 août 2004 à Chanteloup -en-brie photographe et humaniste français.
En bref
Malgré sa nature discrète il aura eu le souci de laisser le moins possible d'images de lui-même, Henri Cartier-Bresson fut et demeurera une figure mythique de la photographie du XXe siècle. Sa longévité lui permit une traversée du siècle dont il témoigne à travers les photographies de ses événements majeurs, pendant près de cinquante ans. Et son talent précoce lui fait réaliser, âgé d'une vingtaine d'années seulement, un grand nombre de chefs-d'œuvre de l'histoire de la photographie.
Henri Cartier-Bresson ne fut jamais un débutant. Équipé du nouvel appareil de poche Leica et d'un simple objectif 50 mm, il adopte dès ses premiers instantanés le style d'une photographie directe qui ne supporte ni la pose, ni la retouche, ni le recadrage, et proscrit le flash, qu'il craint « comme la détonation d'un revolver au milieu d'un concert .
Fils de famille épris de littérature et de philosophie, mais aussi passionné par le dessin et par la peinture, Henri Cartier-Bresson découvre sa vocation de photographe en 1931. Avec son premier appareil Leica, il parcourt l’Afrique noire et y met au point sa méthode, qui consiste à appréhender la réalité, comme un chasseur, au moyen du tir photographique. Passant au cinéma, dont il a appris le métier lors de son séjour aux États-Unis de 1935, il devient assistant réalisateur aux côtés de Jean Renoir La vie est à nous, 1936 ; Une partie de campagne, id. ; la Règle du jeu, 1939. Engagé en faveur des républicains au moment de la guerre civile d’Espagne, il est seul maître de la caméra dans les deux documentaires qu’il leur consacre en 1937, Victoire de la vie et L’Espagne vivra. Lors de la libération de Paris, en août 1944, il fait partie des reporters qui immortalisent l’événement. Au service des prisonniers de guerre pendant et après la Seconde Guerre mondiale, il relate leur rapatriement dans un autre documentaire, le Retour 1945.
À Paris, en 1932, Le Pont de l'Europe saisit la course d'un piéton au-dessus d'une flaque d'eau ; derrière lui se découpe la gare Saint-Lazare. L'image est un condensé de l'art sans artifice de Cartier-Bresson : un cliché pris à la sauvette, en cet instant décisif qui suspend le mouvement dans une éternité, moment où tout se complexifie du fait d'infinis reflets dans l'eau, d'un jeu surréaliste entre rêve et réalité, et par-dessus tout, de l'expression même, fugitive, de l'élégance et de la légèreté. De cette grâce combinée de l'image et du piéton aérien naît la tentation de voir ici l'autoportrait bien involontaire d'un photographe agile, qui, sans que personne ne le remarque jamais, avait l'habitude de sortir son Leica pour deux ou trois prises furtives et définitives. Faisant corps avec son appareil, qu'il considérait comme un prolongement de son œil, Cartier-Bresson exécutait auprès de ses modèles une manière de chorégraphie évoquant, pour Truman Capote, « une libellule inquiète .
Avec Walker Evans, Brassaï, Kertész et quelques autres, Henri Cartier-Bresson est considéré comme un pionnier du photojournalisme allié à la photographie d'art. Il est souvent fait référence à lui sous les trois lettres HCB.
Avec Robert Capa, David Seymour, William de Vandivert et George Rodger, il fonde en 1947 la célèbre agence coopérative Magnum Photos. En 2003, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans, un an avant sa mort, une fondation portant son nom a été créée à Paris pour assurer la conservation et la présentation de son œuvre et aussi pour soutenir et exposer les photographes dont il se sentait proche.
Connu pour la précision au couperet et le graphisme de ses compositions, jamais recadrées au tirage, il s'est surtout illustré dans le reportage de rue, la représentation des aspects pittoresques ou significatifs de la vie quotidienne, Des Européens. Le concept de l'instant décisif est souvent utilisé à propos de ses photos, mais on peut l'estimer trop réducteur et préférer le concept de tir photographique, qui prend le contexte en compte.
Pour certains, il est une figure mythique de la photographie du XXe siècle, que sa longévité lui permit de traverser, en portant son regard sur les évènements majeurs qui ont jalonné son histoire. Un de ses biographes, Pierre Assouline dit ainsi de lui qu'il était l'œil du siècle.
L’exposition Henri Cartier-Bresson au Centre Pompidou renouvelle complètement la vision qu’on a de Cartier-Bresson, en montrant de façon explicite son activité militante pour le parti communiste dans la période 1936-1946. Le catalogue comporte un texte très détaillé de présentation et d’analyse, dû à Clément Chéroux, conservateur du Musée national d'art moderne du Centre Pompidou et chef du cabinet de la photographie, c’est lui qui a conçu l’exposition.
Sa vie
Né en 1908 à Chanteloup Seine-et-Marne, Henri Cartier-Bresson jouit d'une enfance privilégiée dans une famille de la haute bourgeoisie. À dix-neuf ans il fréquente à Montparnasse l'académie du peintre André Lhote ; la formation qu'il y reçoit lui laisse un goût définitif pour le dessin, auquel il reviendra, comme à un premier amour, dans les dernières décennies de sa vie. Familier des artistes, c'est d'abord au contact de la peinture, remarquera son biographe Pierre Assouline, qu'il apprend la photographie. Cette sensibilité, même, cette « passion pour la peinture » explique sans doute que ses portraits les plus célèbres soient ceux d'amis artistes, Henri Matisse et ses blanches colombes 1944 ou Alberto Giacometti traversant la rue d'Alesia sous la pluie 1961.
Avec son «carnet de croquis , comme il aimait appeler son appareil photo, Cartier-Bresson décide, au début des années 1930, de parcourir la planète ; il ne s'arrêtera plus jusqu'en 1966, date à laquelle il abandonne la photographie. Il commence par découvrir les pays du soleil – Espagne, Italie, Mexique –, dont les contrastes violents et lumineux se prêtent à une atmosphère sensuelle et à des compositions géométriques affirmées. Dans un cadre qu'il sait toujours rendre plus que parfait, il saisit la truculence et la vivacité des ruelles populaires, qui resteront un de ses motifs privilégiés : le regard oblique d'un travesti garçon-coiffeur à Alicante, l'intimité de prostituées acrobates à Barcelone, la course éperdue d'un enfant aveugle le long d'un mur ou la cruauté insouciante de gosses des rues... Au Mexique, il est encore un amateur de liberté, épris de hasards heureux et nourri de surréalisme. La rencontre inspire des photos prises d'instinct, où plane une étrangeté faite de noirs profonds, qu'il abandonnera par la suite au profit de constructions plus rationnelles. Avec New York, il noue ensuite une relation durable ; les Américains sauront, avant les autres, reconnaître son talent. Dès 1932, la galerie Julien Levy l'expose, puis de nouveau en 1934 aux côtés de Manuel Alvarez Bravo et de Walker Evans, et en 1947, le Museum of Modern Art lui consacre une première rétrospective.
De retour en France, Cartier-Bresson hésite un temps entre le cinéma et la photographie, assistant-réalisateur sur le tournage de Partie de campagne de Jean Renoir en 1936 et témoin de la guerre d'Espagne à travers un film documentaire... avant de publier ses premières images de presse en 1937. Désormais vouée au reportage, sa photographie se fait moins personnelle, plus sociale. La France des premiers congés payés, puis celle de la Libération, lui seront redevables de quelques images inoubliables – pique-niqueurs des bords de Marne ou gifle administrée à une collaboratrice, à la fin de la guerre. En 1947, Cartier-Bresson fonde, avec ses amis Capa, Chim et Rodger, l'agence-coopérative Magnum, qui permettra aux photoreporters d'accéder au statut d'auteurs, les rendant propriétaires de leurs négatifs.
Dans la carrière de Cartier-Bresson, on peut repérer quatre grandes périodes.
1926-1935 : la double influence d’André Lhote et des surréalistes
Tout d’abord, Cartier-Bresson apprend la peinture avec André Lhote en 1927-1928. Dans l’atelier, rue d'Odessa, dans le quartier du Montparnasse, les élèves analysent les toiles des maîtres en superposant des constructions géométriques selon la divine proportion le nombre d’or. Dès sa parution, un ouvrage de Matila Ghyka sur le nombre d’or deviendra un des livres de chevet du jeune Cartier-Bresson.
Pendant son service militaire, il rencontre, chez les Crosby, Max Ernst, André Breton et les surréalistes, et il découvre la photo avec le couple Gretchen et Peter Powell. Il entretient pendant quelques mois une liaison avec Gretchen Powell qui selon ses termes, ne pouvait pas aboutir, puis part pour l’Afrique en 1930. C'est à vingt-trois ans, en Côte d'Ivoire, qu'il prend ses premiers clichés avec un Krauss d'occasion. Il publie son reportage l'année suivante 1931. Il achète son premier Leica à Marseille en 1932, il décide de se consacrer à la photographie et part en Italie avec André Pieyre de Mandiargues et Leonor Fini. Puis il photographie l’Espagne, l’Italie, le Mexique et le Maroc. Ses photos montrent une très grande maîtrise de la composition, fruit de l’acquis chez Lhote, en même temps que des éléments de vie pris sur le vif. Les photographies de Cartier-Bresson sont toujours situées avec précision géographiquement et dans le temps, ainsi que dans chaque contexte culturel.
Parallèlement, sous l’influence surréaliste, Henri Cartier-Bresson se conçoit comme un agent récepteur des manifestations du merveilleux urbain et confie : les photos me prennent et non l’inverse. Il retient d’André Breton la définition de la beauté convulsive : explosante-fixe une chose perçue simultanément au mouvement et en repos, magique-circonstancielle rencontre fortuite, hasard objectif, érotique voilée un érotisme de l’œil. Cartier Bresson aime aussi photographier les spectateurs d’une scène hors champ, autre forme de l’érotique voilée : l’objet du regard étant dissimulé, le désir de voir s’intensifie. Clément Chéroux rappelle comment Peter Galassi, curateur de la photographie au MoMA, a précisé le mode opératoire du photographe :
Il repère d’abord un arrière-plan dont la valeur graphique lui semble intéressante. C’est souvent un mur parallèle au plan de l’image, et qui vient comme cadrer celle-ci en profondeur. … Puis, comme quelques séquences de négatifs conservés permettent de le vérifier, le photographe attend qu’un ou plusieurs éléments doués de vie … viennent trouver leur place dans cet agencement de formes qu’il définit lui-même dans une terminologie très surréalisante comme une « coalition simultanée . Une part de l’image est donc très composée, l’autre plus spontanée.
1936-1946 : l’engagement politique, le travail pour la presse communiste,
le cinéma et la guerre
Cartier-Bresson s’oriente entièrement dans l’engagement communiste et la lutte antifasciste. Il lit le Ludwig Feuerbach d'Engels, qui formule le concept de matérialisme dialectique, et encourage ses proches à le lire. Il fréquente l’AEAR Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires dès 1933 et, en 1934, au Mexique, ses amis sont tous des communistes proches du parti national révolutionnaire au pouvoir. En 1935, à New York, il milite activement dans Nykino, coopérative de cinéastes militants très inspirés par les conceptions politiques et esthétiques soviétiques dont Ralph Steiner et Paul Strand, et il découvre le cinéma soviétique Eisenstein, Dovjenko. S'il ne semble pas avoir pris sa carte au PCF, à Paris, ses amis sont les personnalités communistes Robert Capa, Chim, Henri Tracol, Louis Aragon, Léon Moussinac, Georges Sadoul qui épouse sa sœur. Il dira à Hervé Le Goff : Naturellement, nous étions tous communistes. Il suit les cours de matérialisme dialectique de Johann Lorenz Schmidt et assiste aux réunions de cellule à proximité du domicile d'Aragon.
En 1937, Cartier-Bresson épouse Eli, danseuse traditionnelle javanaise célèbre sous le nom de scène de Ratna Mohini. Avec elle, il milite pour l’indépendance de l’Indonésie.
Il descend d'une famille de riches industriels et, afin de ne plus être assimilé à sa famille, il prend le nom d’Henri Cartier, sous lequel il sera connu dans toute son activité militante, la signature de tracts en 1934, les citations de son nom dans la presse communiste, et dans toute sa production de photos et de films jusqu’à la fin de la guerre.
Le 2 mars 1937, le nouveau quotidien communiste Ce soir, direction Louis Aragon, photographes attitrés Robert Capa et Chim publie en première page, chaque jour à partir de son premier numéro, 31 photos d’enfants miséreux prises par Henri Cartier concours dit de l’enfant perdu.
En mai 1937, ce quotidien l'envoie à Londres pour réaliser un reportage sur le couronnement de George VI. Henri Cartier prend une série de clichés des gens regardant le cortège, sans montrer celui-ci. Les images obtiennent un grand succès dans Ce soir, le reportage est repris dans le magazine communiste Regards, direction Léon Moussinac, photographe attitré Robert Capa.
Henri Cartier abandonne le nombre d’or et la beauté convulsive au profit d’un réalisme dialectique et, le cinéma ayant aux yeux des militants communistes un impact plus fort16 que la photo, Henri Cartier se tourne vers le cinéma.
Il devient l’assistant de Renoir pour La vie est à nous, film commandé par le Parti communiste pour les élections législatives de mai 1936, effigies monumentales de Lénine, Marx et Staline, participation de dignitaires du parti tels que Paul Vaillant-Couturier, Marcel Cachin, Maurice Thorez, Marcel Gitton et Jacques Duclos. Henri Cartier est membre de Ciné-Liberté, la section film de l’AEAR, qui a produit La vie est à nous. Il sera également dans l’équipe de tournage de Partie de campagne, où il est aussi acteur et La Règle du jeu. Le travail pour Renoir s’échelonne de 1936 à 1939.
À l’initiative de Frontier Film, le nouveau nom de Nykino, fondé et dirigé par Paul Strand, mais avec une équipe française, Henri Cartier tourne Victoire de la vie en Espagne, conséquences des bombardements italiens et allemands, aide sanitaire internationale, installation d’un hôpital mobile, rééducation des blessés.
Il est mobilisé, fait prisonnier, s’évade, rejoint un groupe de résistants à Lyon. Il photographie les combats lors de la Libération de Paris, le village martyr d’Oradour-sur-Glane. Le film Le Retour découverte en Allemagne des camps par les alliés, rapatriement en France des prisonniers sort sur les écrans français fin 1945.
En août 1939, suite au Pacte germano-soviétique, la presse communiste est interdite et le Parti communiste français est dissous. Robert Capa et Georges Sadoul se voient refuser leurs visas, donc empêchés de travailler. Le maccarthysme et la déstalinisation conduisent Cartier-Bresson à organiser l’occultation de son engagement politique et de ses photos et films signés Henri Cartier. Cette opération est couronnée de succès : une note des Renseignements généraux de mars 1946, en effet, précise qu’ à ce jour il n’a pas attiré l’attention du point de vue politique. Mais cette occultation radicale conduira à la parution d'études très mal informées voire fantaisistes, et à une vision faussée de son œuvre pendant de nombreuses années, car on ne peut pas saisir la vision du monde de Cartier-Bresson si on ignore tout de l’engagement politique qui a contribué à la former. Cartier-Bresson a voté communiste jusqu'à l'écrasement de la révolte hongroise par les Soviétiques en 195619.
1947-1970 : de la création de Magnum à l’arrêt du reportage
En février 1947, Cartier-Bresson inaugure sa grande rétrospective au MoMA, qui entérine l’occultation de son militantisme communiste.
Avec ses amis communistes Robert Capa et Chim, il fonde Magnum en 1947 : une coopérative en autogestion, aux parts exclusivement détenues par les photographes, propriétaires de leurs négatifs, où toutes les décisions sont prises en commun et où les profits sont équitablement redistribués. Sur le conseil de Robert Capa, Cartier-Bresson laisse de côté la photographie surréaliste pour se consacrer au photojournalisme et au reportage.
En août 1947, il est nommé expert pour la photographie auprès de l’Organisation des Nations unies. Il part en Inde pour Magnum et parcourt, avec sa femme Eli Ratna, l’Inde, le Pakistan, le Cachemire et la Birmanie. Il constate sur le terrain les conséquences de la partition avec le déplacement de douze millions de personnes sur les routes. Par l’intermédiaire d’une amie de sa femme, il obtient un rendez-vous avec Gandhi, et ceci, quelques heures avant sa mort. Il photographie l'annonce de sa mort par Nehru, puis les funérailles de Gandhi, images qui seront publiées dans Life et feront le tour du monde.
À la demande de Magnum, Cartier-Bresson se rend à Pékin et photographie les dernières heures du Kuomintang, l’ampleur de la déflation et, à Shanghai, la ruée des gens vers une banque pour convertir leur argent en or, image publiée dans le premier numéro de Paris Match et largement reprise dans toute la presse.
Cartier-Bresson obtient, au moment du dégel qui suit la mort de Staline, un visa pour se rendre en Union soviétique et arrive à Moscou en juillet 1954. Magnum vend à prix d’or le reportage à Life, qui paraît les 10 et 17 janvier 1955, puis est vendu à Paris Match, Stern, Picture Post et Epoca.
Robert Capa est tué en Indochine en 1954 lors d'un reportage pour Life. Chim est tué en 1956 lors d'un reportage sur la crise du canal de Suez.
Début 1963, tout de suite après la crise des missiles, Cartier-Bresson se rend à Cuba. Les photographies seront publiées le 15 mars 1963 à la une et sur huit doubles pages de Life, accompagnées d’un article écrit par le photographe lui-même.
Pendant un an, il sillonne l’hexagone en voiture. L'ouvrage Vive la France sera publié en 1970. Il photographie également la course cycliste les Six jours de Paris. Suite à une demande des éditions Braun, il réalise une série de portraits de peintres Matisse, Picasso, Bonnard, Braque et Rouault, puis, pour des magazines ou des éditeurs, de nombreux portraits Giacometti, Sartre, Irène et Frédéric Joliot-Curie.
Refusant toute idée de photographie de mode, il fait une exception pour Bettina dans les années 1950.
Parallèlement aux reportages, qui imposent leur rythme rapide de travail, Cartier-Bresson réalise pour son propre compte des études thématiques sur le long terme. Dès 1930, la danse l’intéresse et, avec Eli Ratna, il réalise un travail de fond sur la danse à Bali. Il découvre le langage pictural que la danse constitue, et il s’intéressera par la suite, à de nombreuses reprises, à la façon dont les corps en mouvement s’inscrivent dans l’espace urbain. Contrairement aux périodes antérieures où ses images étaient principalement en aplat, Cartier-Bresson utilise désormais la profondeur de champ apprise de Jean Renoir, elle constitue même l'élément principal de composition dans plusieurs de ses photographies.
D’autres thèmes récurrents seront l’homme et la machine, les icônes du pouvoir, la société de consommation, les foules. Avec la danse, cette accumulation documentaire à long terme constitue une étude à caractère scientifique de l’être humain dans son langage visuel, une véritable anthropologie visuelle.
1970-2002 : le temps du dessin et de la contemplation
Cartier-Bresson ressent la fatigue de cette vie intense, son désir de faire des photos n’est plus le même. D’autre part, en 1966, il a rencontré Martine Franck, photographe, qui va devenir en 1970 sa seconde épouse. Avec la naissance de leur fille Mélanie, Cartier-Bresson aspire légitimement à plus de calme et de sédentarité.
Il soutient la candidature de René Dumont aux élections présidentielles de 1974. Depuis la fin de la guerre, il se reconnaît dans l'humanisme, à ceci près qu'il est dubitatif devant l'unanimisme que l'on trouve souvent dans ce vaste courant philosophique : il s'attache toujours, au contraire, à rendre fidèlement compte des ancrages à la fois géographiques et historiques de ceux qu’il photographie, et du contexte de la prise de vue. Il exige que la légende détaillée accompagnant chaque photo qu'il envoie à Magnum soit impérativement publiée en même temps que toute photo qui sera reproduite et il précise :
Je veux que les légendes soient strictement des informations et non des remarques sentimentales ou d'une quelconque ironie. ... Laissons les photos parler d'elles-mêmes et pour l'amour de Nadar, ne laissons pas des gens assis derrière des bureaux rajouter ce qu'ils n'ont pas vu. Je fais une affaire personnelle du respect de ces légendes comme Capa le fit avec son reportage.
Enfin, Cartier-Bresson ne se reconnaît plus dans l’agence Magnum qu’il a fondée : ses jeunes collègues adoptent les modes de la consommation et vont jusqu’à se compromettre en faisant de la publicité, comportement que ne peut comprendre celui qui avait reçu une formation marxiste-léniniste dans sa jeunesse. Il se retire des affaires de l’agence, cesse de répondre aux commandes de reportages, se consacre à l’organisation de ses archives et, à partir de 1972, il retourne au dessin. Il gardera pourtant toujours son Leica à portée de main et continuera à faire des photos selon son envie.
Le dessin est, pour Cartier Bresson, un art de la méditation, très différent de la photo. On a voulu réduire la photographie de Cartier-Bresson à l’instant décisif, formule qui résulte d'une traduction de l'anglais dont il n'est pas l'auteur, alors que la citation du cardinal de Retz qu'il avait initialement mise en exergue d’Images à la sauvette disait : Il n’y a rien en ce monde qui n’ait un moment décisif. Beaucoup des photos de Cartier-Bresson ne relèvent pas d’un instant décisif, elles auraient pu être prises un instant avant ou un instant après. De plus, la prise sur le vif ne représente pour lui qu’une moitié de la démarche, l’autre moitié étant la composition de l’image, qui nécessite une connaissance préalable, donc du temps. Cartier-Bresson est un passionné de chasse, activité qui nécessite, comme la photo, la connaissance du terrain et la lecture des modes de vie. En ce sens, sa pratique de la photographie se rapproche de la chasse. Après sa période surréaliste, il se passionne pour le tir à l’arc avec la philosophie zen qui l’accompagne. Plutôt que d'instant décisif, on peut parler de tir photographique, concept qui prend le contexte en compte. Clément Chéroux intitule son livre de photos Henri Cartier-Bresson: Le tir photographique 2008.
Cartier-Bresson n'aime pas la photographie en couleurs, il ne la pratique que par nécessité professionnelle. Contrairement aux pellicules noir et blanc, dont la sensibilité relativement élevée permet au chasseur photographe de tirer au bon moment, les pellicules couleur, beaucoup plus lentes, sont d'un usage contraignant. De plus, alors que le photographe dispose en noir et blanc d'une large gamme de gris permettant de traduire toutes les nuances de valeurs degrés d'intensité lumineuse, les valeurs qu'offrent les pellicules trichromes sont, pour Cartier-Bresson, beaucoup trop éloignées de la réalité.
En 1996, Cartier-Bresson est nommé professeur honoraire à l'Académie des Beaux-Arts de Chine, puis, concernant le Tibet, il écrit une lettre aux autorités chinoise pour dénoncer les persécutions dont la Chine se rend coupable. Bouddhiste, il assiste régulièrement aux enseignements du 14e dalaï-lama qu'il a également photographié. Il a milité pour la cause tibétaine.
Henri Cartier-Bresson – HCB pour les initiés –, devient un synonyme d'excellence. En 1952, il publie son premier livre, Images à la sauvette, aux éditions Verve à Paris. La couverture est dessinée par Matisse et Cartier-Bresson rédige une longue préface dont le titre, L'Instant décisif, marquera durablement de son empreinte la philosophie d'un art jusqu'alors très empirique Dans le seul texte théorique que le photographe ait jamais écrit, certains énoncés prendront, malgré lui, valeur de référence : La photographie est pour moi la reconnaissance simultanée, dans une fraction de seconde, d'une part de la signification d'un fait, et de l'autre, d'une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui expriment ce fait.
À la fin de sa vie, l'artiste préférait en revenir à une définition plus légère, parfaitement en accord avec son style : Seule la mesure ne dévoile jamais son secret. Un détachement quasi oriental et amusé lui faisait également dire : Je n'ai ni message ni mission, seulement un point de vue. La mécanique de son œil était si parfaite qu'il n'est pas sûr qu'Henri Cartier-Bresson ait jamais pris un jour une mauvaise photographie. Surtout, au-delà de ce talent, il aura su rencontrer pleinement une époque où la photographie devient un mode d'expression privilégié pour ses contemporains. C'est pourquoi les photographies d'Henri Cartier-Bresson ne sont pas seulement à l'image de son temps, mais en resteront l'image même.
En 2003, un an avant sa mort, la Bibliothèque nationale de France lui consacre une grande exposition rétrospective, avec Robert Delpire comme commissaire. L'exposition Henri Cartier-Bresson au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou se déroule du 12 février 2014 au 9 juin 2014. Avec comme commissaire Clément Chéroux, on y découvre notamment une abondante documentation sur son engagement communiste et son activité militante dans la période 1936-1946.
La même année, peu après la rétrospective de la Bibliothèque nationale de France, Martine Franck fonde avec sa fille la Fondation Henri Cartier-Bresson. La fondation HCB impasse Lebouis, à Montparnasse dans le quartier de Plaisance assure la conservation de son œuvre et sa présentation au public, ainsi que celles des photographes qui lui sont chers, autour de la ou des pratiques du reportage. Cette Fondation décerne également tous les deux ans un Prix qui donne droit à une exposition, deux ans après, au sein de la Fondation.
Citations
-La grande passion, c’est le tir photographique, qui est un dessin accéléré, fait d’intuition et de reconnaissance d’un ordre plastique, fruit de ma fréquentation des musées et des galeries de peinture, de la lecture et d’un appétit du monde. Les cahiers de la Photographie n°18, 1986. Conversation avec Gilles Mora.
-La photo, c’est la concentration du regard. C’est l’œil qui guette, qui tourne inlassablement, à l’affût, toujours prêt. La photo est un dessin immédiat. Elle est question et réponse. Entretien avec Henri Cartier Bresson, 1975.
-La composition doit être une de nos préoccupations, mais au moment de photographier elle ne peut être qu’intuitive, car nous sommes aux prises avec des instants fugitifs où les rapports sont mouvants. Pour appliquer le rapport de la section d’or, le compas du photographe ne peut être que dans son œil. L’instant décisif, Les Cahiers de la Photographie n°18, 1986. H. Cartier Bresson.
Prix et récompenses
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
1959 : Prix de la Société française de photographie
1967 : Prix culturel de la Société allemande de photographie
1971 : Prix Nadar
1981 : Grand Prix national de la photographie
1982 : Prix international de la Fondation Hasselblad
2003 : Lucie Award
Œuvre
La maison Cartier-Bresson à Scanno en Italie, village que Cartier-Bresson a beaucoup photographié
L'exposition "photographier l'Amérique" Henri Cartier-Bresson/Walker Evans
La fondation Henri Cartier-Bresson célébrait, du 10 septembre au 21 décembre 2008, le centenaire de la naissance du photographe en confrontant sa vision de l'Amérique à celle qu'en avait son contemporain Walker Evans. Deux regards que rassemble d'abord la volonté de rompre avec les manières d'écoles pour mieux appréhender le réel.
Sur les cent douze auteurs de cent quatorze photographies retenues dans Les Choix d'Henri Cartier-Bresson, l'exposition inaugurale de la fondation H.C.B. de mai 2003, Walker Evans partageait avec Man Ray le privilège d'être présent avec deux images. L'estime et l'influence réciproques qui devaient aboutir à une profonde amitié entre Evans et Cartier-Bresson précèdent leur exposition commune d'avril-mai 1935 à la galerie new-yorkaise Julien Levy, qui présentait aussi les travaux du Mexicain Manuel Alvarez Bravo. La découverte des photographies d'Evans compte parmi les raisons qui ont conforté Cartier-Bresson dans sa vocation de photographe. Evans, quant à lui, découvrait le travail de Cartier-Bresson à la faveur de la première exposition personnelle que la même galerie Julien Levy avait consacrée au jeune Français.
Walker Evans 1903-1975 de cinq ans l'aîné, commence à photographier en amateur à Paris en 1926, pendant ses études littéraires à la Sorbonne. À son retour à New York, en 1927, la photographie qu'il commence à maîtriser va lui offrir une alternative à la carrière littéraire qu'il abandonne. Découvrant Eugène Atget grâce à la photographe Berenice Abbott, il entreprend en 1930 une importante série d'images consacrées aux demeures américaines du XIXe siècle. Sa première commande le mène en 1933 à Cuba, d'où il rapportera les images destinées à illustrer le livre de Carleton Beals, The Crime of Cuba.
Henri Cartier-Bresson (1908-2004) se passionne dès l'enfance pour la peinture qu'il étudie dans l'atelier d'André Lhote. Un séjour d'un an en Côte d'Ivoire lui permet de s'essayer à la photographie, à l'aide d'un appareil à plaque de verre puis d'un Rolleiflex. La découverte en 1932 de l'appareil Leica et des possibilités offertes par sa légèreté et sa maniabilité l'amènera à s'éloigner de la peinture pour cultiver le regard de voyageur qu'il commence à exercer en Italie et en Espagne, puis au Mexique où il accompagne en 1934 une mission ethnographique. Ses premières images de New York datent de 1935.
"Photographier l'Amérique"couvre une période qui court de 1929 à 1947 et correspond aux débuts de la notoriété des deux photographes. La scénographie consacre le premier niveau de la fondation Henri Cartier-Bresson à la ville de New York et aux quartiers de Harlem, de Queens et de Brooklyn pour étendre au second l'approche d'autres grandes villes, notamment Los Angeles, Atlanta, Chicago, San Francisco, Washington ou La Nouvelle-Orléans. Si une chronologie se dessine dans l'un et l'autre des deux espaces, la disposition privilégie le regroupement des tirages par auteur, permettant au visiteur d'apprécier la singularité de chaque regard.
La composante documentaire et son corollaire humaniste, le contenu social, dominent chez Walker Evans qui, dès le début de sa carrière, prenait ses distances avec la photographie américaine héritière des tendances esthétiques du pictorialisme et acquise au sentimentalisme et au sensationnel de la presse. Les photographies d'alignement de voitures de Saratoga Springs, New York (1931) et de Greensboro, Alabama (1936), la perspective de Bethlehem, Pennsylvanie (1935) offrent des vues d'ensemble d'un environnement urbain privilégiant la description sur la recherche photographique. De même que les photographies des anciennes maisons adoptent le point de vue géométral des architectes, ses images de quartiers commerçants concentrent affiches et enseignes comme autant d'informations littérales. Son approche humaniste – essentiellement tournée vers les classes pauvres américaines –, participe de la même volonté d'informer le spectateur en incluant les signes d'une condition sociale dont il perçoit et dénonce la dégradation. Conscients pour la plupart de la démarche du photographe, ses sujets consentent à poser, voire à sourire. La commande du reportage photographique dans les États du sud des États-Unis au cours de la Ressettlement Administration qui l'occupe entre 1935 et 1938, la somme d'images présentées en 1938 dans l'exposition Walker Evans : American Photographs au MoMA et dans le livre Let us Now Praise Famous Men, publié en 1941 avec James Agee, seront empreintes de cette même préoccupation.
Les images américaines de Henri Cartier-Bresson, qui datent presque toutes de son deuxième séjour aux États-Unis, de 1946-1947, ne sont pas moins sombres que celles d'Evans. Mais le regard est ici celui d'un étranger qui explore et découvre, au seuil d'une longue carrière de photojournaliste, la réalité sociale d'un pays. Malgré quelques convergences, le style de Cartier-Bresson se détache de celui d'Evans par la proximité qu'il entretient avec des sujets observés et photographiés à leur insu, également par la constance dans l'emploi de l'objectif standard du 50 mm qu'il maintiendra toute sa vie. La conductrice à l'œil bandé de Knoxville, les joueurs de cartes de La Nouvelle-Orléans, la cliente du Délicatessen de Brooklyn sont trois exemples parmi d'autres de la précision au déclenchement, qui allait façonner en 1952 la matière de son premier livre, Images à la sauvette, devenu la même année The Decisive Moment pour l'édition américaine. Le souci d'une composition parfaitement équilibrée s'annonce déjà comme une des caractéristiques que Cartier-Bresson imprimera aux nombreux reportages réalisés à travers le monde et qui suivront la création de l'agence Magnum Photos, fondée avec Robert Capa en 1947. Le pont Triborough photographié dans le quartier de Queens, le consommateur assoupi d'un bar de Brooklyn, la passante au parapluie de Washington s'inscrivent déjà dans cette « géométrie » érigée en principe d'auteur.
Photographier l'Amérique reste une des expositions les plus pertinentes dans l'appréhension comparée de deux œuvres majeures de la période moderne de l'histoire de la photographie.
Liens
http://youtu.be/r6l09YEeEpI Henri C-B 1
http://youtu.be/XfwNrPX2pvw Henri C-B 2
http://youtu.be/Ea3E_8otCME Henri C-B 3
http://youtu.be/SBDV26UvaNA Henri C-B 4
http://youtu.be/h-rHc2--Mv8 Henri C-B 5
http://youtu.be/2SHyDkNagzU Diaporama
http://youtu.be/30N6_i7TGh4 Le retour film avec HCB
http://youtu.be/skVZOb3-pM8 Le Nord vu par HCB 1
http://youtu.be/_jtVmShhc24 Le nord vue par HCB2
http://youtu.be/utZqGoBrRDc Le nord vu par HCB 3
http://youtu.be/pHMLBAH8IZM Le nord vu par HCB 4
http://youtu.be/qm4QH9bdnpg Le nord vu par HCB 5
                      
Posté le : 01/08/2014 15:32
|
|
|
|
|
Re: Défi du 26 juillet |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35559
|
Les derniers et les premiers
Je me déplace dans ce magnifique jardin depuis ma naissance, avançant à mon rythme mais surtout selon mon appétit. Mes frères et moi sommes insatiables. Certains ont bien essayé de nous chasser de ce paradis à coups de bec, de vaporisations nauséabondes et de taille-haies vrombissantes. Mais je suis toujours là, accroché à ma feuille, fuyant les rayons du soleil trop agressifs. Le temps et les jours deviennent de plus en plus chauds. Je sens que je vis mes derniers jours. Ma vie éphémère prend bientôt fin. Je choisis un endroit calme et ombragé au cœur du groseillier aux fruits encore verts pour me préparer un nid douillet. Confortablement installé, je me laisse glisser vers un profond sommeil dont je sais que je ne me réveillerai pas.
Mais la nature est ainsi faite que la mort n’est pas une fin destructrice. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » selon Lavoisier. La décomposition des feuilles nourrit l’arbre qui les a portées. La goutte de pluie qui tombe sur la montagne ne fait que retrouver son lieu de naissance.
C’est ainsi que du sarcophage formé par le corps du petit insecte caché dans le groseillier de votre jardin sort un magnifique papillon aux ailes irisées et dont les couleurs chatoyantes feraient pâlir les plus jolies fleurs. La vie ne fait que commencer pour lui.
Posté le : 01/08/2014 12:54
|
|
|
|
|
Re: Les expressions |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
« Pousser comme un champignon »
Se développer, croître rapidement.
Il ne faut surtout pas confondre "pousser comme un champignon" et "pousser sur le champignon" !
Pousser 'comme' un champignon', ça se passe plus souvent à l'automne, dans les sous-bois où il fait bon folâtrer pour profiter des couleurs magnifiques et de la douceur du fond de l'air, en faisant quand même attention qu'un chasseur en mal de gibier ne vous prenne pas pour une grosse bécasse.
En effet, les véritables champignons communs, qui ne sont pas des végétaux, ont la particularité, contrairement à la plupart des plantes, de pousser très rapidement, parfois du jour au lendemain, si les conditions atmosphériques humidité, température... sont réunies.
C'est de la comparaison avec ces poussées très rapides que l'expression est née, étant attestée dès le XVIe siècle.
Au départ, elle désignait des personnes qui devenaient rapidement riches et puissantes un "champignon d'une nuit" désignait un nouveau riche.
Maintenant, on l'utilise pour évoquer une croissance rapide "la ville, le quartier, l'entreprise pousse comme uchampignon"probablement suite à l'influence de l'expression anglaise "a mushroom city" "une ville-champignon"
Posté le : 01/08/2014 12:30
|
|
|
|
|
L'origine du monde de Courbet |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
" L'Origine du monde "
L'Origine du monde est un tableau de nu féminin réalisé par Gustave Courbet en 1866. Il s'agit d'une huile sur toile de 46 cm par 55 cm, exposée au musée d'Orsay depuis 1995.
Le premier propriétaire de L'Origine du monde, et certainement son commanditaire, fut le diplomate turco-égyptien Khalil-Bey (1831-1879). Figure flamboyante du Tout-Paris des années 1860, il rassemble une éphémère mais éblouissante collection, dédiée à la célébration du corps féminin, avant d'être ruiné par ses dettes de jeux. Par la suite, le destin précis du tableau reste mal connu. Jusqu'à son entrée au musée d'Orsay en 1995, L'Origine du monde, qui faisait alors partie de la collection du psychanalyste Jacques Lacan, représente le paradoxe d'une oeuvre célèbre, mais peu vue.
Courbet n'a cessé de revisiter le nu féminin, parfois dans une veine franchement libertine. Mais avec L'Origine du monde, il s'autorise une audace et une franchise qui donnent au tableau son pouvoir de fascination. La description quasi anatomique d'un sexe féminin n'est atténuée par aucun artifice historique ou littéraire. Grâce à la grande virtuosité de Courbet, au raffinement d'une gamme colorée ambrée, L'Origine du monde échappe cependant au statut d'image pornographique. La franchise et l'audace de ce nouveau langage n'excluent pas un lien avec la tradition : ainsi, la touche ample et sensuelle et l'utilisation de la couleur rappelle la peinture vénitienne, et Courbet lui-même se réclamait de Titien et Véronèse, de Corrège, et de la tradition d'une peinture charnelle et lyrique.
L'Origine du monde, désormais présenté sans aucun cache, retrouve sa juste place dans l'histoire de la peinture moderne. Mais il ne cesse pourtant de poser d'une façon troublante la question du regard.
Le 7 février 2013, la presse se fait l'écho d'une hypothèse selon laquelle le tableau aurait été initialement plus grand, et aurait comporté le visage du modèle. Un collectionneur anonyme aurait acheté à un antiquaire parisien en 2010 un portrait non signé représentant une tête de femme renversée qui, d'après l'expert Jean-Jacques Fernier, correspond au reste du tableau de Courbet.
Les experts du musée d'Orsay rejettent toutefois cette théorie d'un tableau découpé en deux parties, en la qualifiant de fantaisiste . Le format du tableau (46 × 55 cm) est un format standard de l'époque que Courbet lui-même a utilisé pour d'autres tableaux. De plus, la position de la tête et le style de peinture ne correspondent pas au bas.
En 2014 des experts ont mis à nu la toile de Courbet, une fois celle-ci sortie de son cadre, ils ont découvert la partie du haut de la toile. Ils ont pu constater une bande de toile de plusieurs centimètres n'ayant jamais été peinte. Cette découverte confirme de façon définitive que l'oeuvre de Courbet est bien complète et n'a jamais comporté de visage.
Attacher un fichier:
 Origin-of-the-World.jpg (174.79 KB) Origin-of-the-World.jpg (174.79 KB)
Posté le : 01/08/2014 07:22
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
100 Personne(s) en ligne ( 63 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 100
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages