|
|
Francis Picabia |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 30 novembre 1953, à 74 ans meurt Francis-Marie Martinez de Picabia
à Paris, né le 22 janvier 1879 à Paris 2e, peintre, graphiste et écrivain proche des mouvements Dada et surréaliste.Artiste peintre, graphiste, écrivain, formé à l'École des beaux-arts, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, il appartient au mouvement artistique Dadaïsme, surréalisme, ses Œuvres réputées sont Corrida, 1926-1927, Le Matador dans l'arène, 1941-1943
Francis Picabia est le petit-fils de Juan Martinez Picabia, né à Cuba, puis émigré à New York et Madrid et, côté maternel, d'Alphonse Davanne 1824-1912, chimiste et photographe, et président de la SFP.
Sa mère meurt alors qu'il a sept ans. Il fait ses études chez les maristes au Collège Stanislas, puis au Lycée Monge, à Paris.
Sa vie
En 1894, voulant éprouver la vocation tôt manifestée de son fils, " Pancho " Picabia envoie au Salon des artistes français la toile de Francis intitulée Vue des Martigues. Le tableau ayant été non seulement accepté, mais primé, Francis entre à l'École des arts décoratifs l'année suivante ; mais il fréquente plus volontiers l'école du Louvre et l'académie Humbert, où il travaille aux côtés de Georges Braque et de Marie Laurencin. L'année 1897 marque un tournant dans sa carrière : la découverte de Alfred Sisley lui révèle l'Impressionnisme, pour lequel son enthousiasme se renforce avec la rencontre de la famille Pissarro en 1898. C'est pour lui le début d'une période extrêmement féconde, qui durera dix ans ; les centaines de toiles qu'il peint alors, où l'influence impressionniste reste toujours plus ou moins sensible, sont propres à séduire le public : sa première exposition personnelle de 1905, à la galerie Haussmann, est un triomphe. Les tableaux exposés, étrangers aux nouvelles recherches plastiques, relèvent de l'imitation du " pur luminisme impressionniste " Bords du Loing, 1905 Philadelphie, Museum of Art. Cependant, Picabia remet peu à peu en cause les valeurs plastiques qui lui valent son succès grandissant ; et, en 1908, sa rencontre avec Gabrièle Buffet — qui l'encourage à poursuivre de récentes recherches — détermine la rupture avec l'Impressionnisme comme avec ses marchands, rupture permise aussi par sa fortune personnelle.
Il étudie ensuite à l'École du Louvre puis à l'École des beaux-arts et à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. De 1903 à 1908, influencé par les peintres de Barbizon, il côtoie Alfred Sisley, Camille Pissarro et Marius Borgeaud. Son aquarelle Caoutchouc 1909, MNAM, Paris est considérée comme une des œuvres fondatrices de l'art abstrait.
À sa majorité il prend possession de l'héritage maternel qui lui assure de confortables revenus. Sa première exposition personnelle, 61 tableaux est organisée en 1905 à Paris à la Galerie Haussmann, chez Danthon, la suivante à Berlin à la Kaspar Kunstsalon. Il montrera ensuite ses œuvres à nouveau chez Danthon en 1907, puis à Londres, Munich, Barcelone.
De 1905 à 1908, Picabia séjourne deux fois à Martigues et réalise de nombreux paysages de style impressionniste de la ville et de ses canaux.
En 1909, il épouse Gabrièle Buffet, peut-être petite-nièce d'Alphonse de Lamartine et petite-fille de l'amiral de Challié et descendante d'un frère de Jussieu, l'homme qui rapporta le cèdre du Liban dans son chapeau, dixit Picabia. Une fille, Laure, Marie, Catalina naît en 1910; un garçon, Pancho, Gabriel, François en 1911. Ils auront encore une fille, Gabrielle, Cécile, dite Jeannine en 1913, et un garçon, Vincente, né en 1919.
En 1911, il rejoint le groupe de Puteaux qui se réunissait dans le studio du peintre Jacques Villon, frère de Marcel Duchamp qu'il a rencontré en 1910. Il devient aussi orphiste et créé en 1912, à Puteaux, le Salon de la Section d'or, avant de connaître un premier succès international à l'exposition de l'Armory Show de New York en 1913, où il fonde avec Marcel Duchamp et Man Ray la revue 291. Marqué par la Broyeuse de chocolat et le concept de ready-made de Marcel Duchamp, il confectionne dès 1913 une série d'œuvres où il reprend l'esthétique du dessin industriel, recopiant ou simplifiant des images qu'il trouvait dans le magazine scientifique La Science et la Vie.
Dada
De 1913 à 1915, Picabia se rend plusieurs fois à New York et prend une part active dans les mouvements d'avant-garde, introduisant l'art moderne sur le continent américain. En 1916, après une série de compositions « mécanistes » où il traite les objets manufacturés avec une distante ironie, il lance à Barcelone la revue 391 et se rallie au dadaïsme. Il rencontre Tristan Tzara et le groupe dada de Zurich en 1918. Il se fait alors le gateur de dada avec André Breton à Paris. Polémiste, iconoclaste, sacrilège, Picabia s'agite autour de Dada en électron libre, en étant en principe anti-tout, voire anti-Picabia. En 1921, il rompt avec ses anciens complices. J'ai inventé le dadaïsme ainsi qu'un homme met le feu autour de lui, au cours d'un incendie qui gagne, afin de ne pas être brûlé, dixit Francis Picabia en 1947. En 1917, il rencontre Germaine Everling avec laquelle il part, en 1918, pour Lausanne. Quand elle rentre à Paris, Picabia est assailli à coup de feu par Costica Gregori qui lui reproche d'avoir eu des relations avec son épouse Charlotte, peintre sous le nom de "Charles". Picabia revient alors vivre à Paris, voyageant souvent vers New York, la Normandie, la Côte d'Azur et joue souvent dans les casinos avec des fortunes diverses. Un fils, Lorenzo, naît de sa liaison avec Germaine. Olga Mohler, suisse, est embauchée pour s'occuper de Lorenzo qui a cinq ans en 1923.
Outre l'automobile et les jeux de hasard, il se passionne pour le cinéma et la photographie. Dans ses écrits sur le cinéma, il pressent le rôle prépondérant du cinéma américain. En 1924, il a écrit un scénario du court-métrage Entr'acte, réalisé par René Clair et destiné à être projeté à l'entracte de son ballet instantanéiste Relâche, chorégraphie de Jean Börlin et musique d'Erik Satie, celui-ci y figurant d'ailleurs au tout début. Il travaille ensuite pour les Ballets suédois de Rolf de Maré, pour lesquels il réalise de nombreux décors.
La guerre et après
En 1940, conviés sans doute par leur ami Robert Dumas - haut personnage des casinos qui sera préfet du Lot de la Résistance, dit "le préfet des bois" - qu'ils ont connu à Monte-Carlo, Francis Picabia et Olga se réfugient chez les Dumas à Calamane dans le Lot. Ils s'y marient le 14 juin. Mme Dumas est leur témoin. Ils reviendront, plus tard, à Golfe Juan. Ils s'installent ensuite à Tourette-sur-Loup, puis à Felletin dans la Creuse.
Après 1945, il renoue avec l'abstraction.
Son goût immodéré pour les fêtes et les voitures il en collectionnera plus de 150, le ruine. Il multiplie les petites toiles de nombreux genres, parfois même inspirées de magazines pornographiques. Ses derniers tableaux relèvent du minimalisme : des points de couleurs semés sur des fonds épais et monochromes, titrés Je n'ai plus envie de peindre, quel prix ?, Peinture sans but ou Silence.... Au printemps 1949, la galerie René Drouin à Paris, organise sa première rétrospective.
Il pèse sur Picabia et sur son œuvre différents malentendus qui ne facilitent pas la juste appréciation de son apport à l'art du XXe siècle ni l'élucidation des nombreuses zones d'ombre qui constituent la trame même d'une des entreprises artistiques les plus énigmatiques de son époque. Les difficultés d'analyse et d'interprétation que l'on y rencontre ont contribué à faire naître des lieux communs derrière lesquels on a souvent estimé plus commode, ou plus prudent, de se retrancher. C'est essentiellement sur la légende du dadaïste que s'est bâtie la réception de cette œuvre ; dans l'ensemble de la carrière de Picabia, la période de Dada a fonctionné comme une sorte d'étalon de modernité à l'aune duquel ont été comparées toutes les autres manifestations de sa démarche créatrice. Avec le risque que cette situation comporte : celui de tenir pour quantité négligeable tout ce qui se sépare trop visiblement de l'anti-peinture dadaïste, ou de ce qui l'annonce, ou de ce qui se place dans sa postérité immédiate. On a alors tôt fait d'assimiler certaines des expressions picturales contradictoires de Picabia à celles d'un anti-modernisme aussi radical que l'avait été la poussée dadaïste – et leur auteur lui-même à une sorte de renégat vis-à-vis de la cause avant-gardiste. C'est ainsi qu'ont longtemps été bannis (ou peu s'en faut des rétrospectives et des commentaires de vastes ensembles appartenant à l'œuvre postérieure au milieu des années 1920, comme les Transparences autour de 1930, la figuration réaliste des années de guerre, et même l'abstraction primitivisante qui leur succède. Or, dévoilement après dévoilement, les études picabiennes les plus récentes, et notamment celles qui portent sur la recherche des sources visuelles de l'artiste, et par conséquent sur sa méthode, ont contribué à réévaluer des pans entiers de l'œuvre sur lesquels pesaient des jugements aussi péremptoires qu'autoritaires, souvent mal fondés d'ailleurs sur le plan de l'information historique.
De sa confrontation permanente aux images mécaniques dont son époque voit le développement, photographie, cinématographe, carte postale, presse populaire..., Picabia développe, comme de nombreux autres artistes de sa génération, la conscience cruelle de la possible disparition de son art, rendu obsolète par l'irruption de nouvelles techniques de fabrication et de diffusion des images, en même temps qu'une fascination pour cette disparition même, qui pouvait faire naître l'insidieuse tentation d'en accélérer le processus. Mais de tous les assassins de la peinture, Picabia est sans doute celui qui aura le plus difficilement assumé son geste, et qui l'aura même secrètement déploré, incapable qu'il était de se résoudre au détachement cyniquement affiché par son principal complice, Marcel Duchamp. Son humeur créative, au contraire, oscille entre deux extrêmes : d'un côté, il semble prêt à croire jusqu'au bout en la puissance de la peinture, laissant supposer qu'elle pourrait être investie de pouvoirs démesurés, quasi magiques ; mais par ailleurs, il semble se résigner à devoir porter définitivement son deuil, à accepter sa fin et même à lui asséner de nouveaux coups fatals. Les atermoiements auxquels l'artiste aura été confronté toute sa vie, l'alternance épuisante de ses élans de vitalité et de ses phases dépressives profondes, montrent d'ailleurs à quel point ces contradictions auront été vécues sur le mode tragique.
Un art dévoyé
Contradictions et paradoxes sont d'ailleurs symboliquement présents aux sources mêmes de la vocation de Picabia, dans les deux récits originaires qu'il en a laissé accréditer. Picabia est né à Paris en 1879 de Francisco Vicente Martinez y Picabia, attaché à l'ambassade de Cuba, et de Marie-Cécile Davanne, fille d'Alphonse Davanne, haute figure patriarcale, président de la Société française de photographie, photographe lui-même et ardent défenseur de son art ; son atelier qui deviendra bien plus tard celui de son petit-fils dominait l'immeuble familial de la rue des Petits-Champs, où étaient accrochés les tableaux, Ziem, Roybet, Checa... collectionnés par le père et un oncle maternel de Picabia. C'est à leur sujet que naît le premier de ces récits : J'ai copié, étant jeune, les tableaux de mon père, déclare Picabia en 1923. J'ai vendu les tableaux originaux et les ai remplacés par les copies. Personne ne s'en étant aperçu, je me suis découvert une vocation. L'anecdote entretient la réputation du jeune homme surdoué, qui aurait exposé dès 1895 sous un nom d'emprunt une toile récompensée par le jury du Salon des Artistes français – mais d'un surdoué qui aurait malencontreusement placé ses dons précoces au service d'une conception dévoyée de son art, rompant le tabou de l'authenticité, la frontière éthique et morale de l'original. Il entre bien sûr une large part de provocation dans ce court récit, dont la véracité n'est même pas assurée ; il est remarquable à cet égard qu'il ait été délivré à un moment où la fièvre dadaïste n'était pas encore retombée, l'apologie du mensonge et du faux ayant fait partie des revendications de l'artiste à cette époque. De plus, cette anti-légende est contrebalancée par un second récit fondateur, fort opposé dans ses implications. Au jeune Picabia lui faisant part de sa vocation naissante, le grand-père Davanne aurait déclaré en substance : « Tu veux devenir peintre ? Pourquoi ? Bientôt, nous aurons rendu la peinture inutile. Nous reproduirons toutes les formes et toutes les couleurs, mieux et plus vite ! » À quoi son interlocuteur aurait répliqué : Tu peux photographier un paysage, mais non les idées que j'ai dans la tête. Nous ferons des tableaux qui n'imiteront pas la nature. A contrario de la pratique cynique dont il vient d'être question, voilà donc la peinture investie d'une ambition démesurée ; contre le réalisme trivial de l'image photographique, elle pourra renoncer à la copie des formes extérieures, aller voir plus loin et plus profond dans les régions de l'âme et du monde intérieur.
Cependant, les conditions dans lesquelles Picabia s'est lancé dans la carrière n'étaient pas de nature à faire naître en lui une haute idée de sa pratique ; au contraire, la soumission de la peinture à des objectifs purement commerciaux et mondains a certainement pu nourrir au moins le début d'une grave mésestime envers elle. L'autoportrait que Picabia donne de lui en faussaire est sans doute exagéré ; il suffit de présenter le Picabia des débuts en faiseur, en habile pasticheur de certains de ses célèbres précurseurs pour comprendre comment devait se déconsidérer à ses yeux la pratique artistique. On pourrait esquisser une liste très longue de ses nombreux emprunts à une tradition impressionniste s'académisant aimablement pour répondre aux attentes d'une clientèle aisée, encline à adopter certains signes de modernité sans trop se compromettre pour autant. Soutenu par de grands marchands parisiens, Picabia marche alors sur les brisées de Monet, de Pissarro, dont il connaît les fils, ou de Sisley, dans la filiation symbolique duquel il se place en présidant un Comité Sisley qui fera ériger un monument à la mémoire du peintre impressionniste. Picabia revient sur les motifs des pionniers de l'impressionnisme et s'approprie leur manière ; avec plusieurs années de retard, il adopte sans distinction et dans le plus grand éclectisme les transformations de la tradition impressionniste, sans que sa démarche corresponde pour autant à une évolution personnelle : il recycle plutôt des procédés, en y mettant d'ailleurs une très grande virtuosité, et puise dans un large stock d'images qui sont en passe de devenir des stéréotypes du paysage impressionniste – il ira même jusqu'au plagiat, avec L'Église de Moret 1904, qui démarque point par point le regard que Sisley avait précédemment porté sur ce motif.
Des méthodes de création de Picabia, une autre semble en plus totale contradiction encore avec l'idéologie impressionniste de la vérité et de la sincérité : il s'agit de celle qui le voit faire usage de documents photographiques, de cartes postales plus précisément, comme source directe ou transposée de nombreux dessins et de quelques peintures. De cette première confrontation à l'image mécanique, Picabia semble bien avoir développé une sorte de complexe – le complexe du peintre devant le progrès des techniques qui détermine si profondément cette génération d'artistes, de même nature que celui qui avait fait prendre conscience à Duchamp, Brancusi et Léger, devant la perfection d'une hélice d'avion, du danger d'obsolescence guettant leur art. L'artiste n'a plus le monopole de la fabrication des images ; lorsqu'il se place devant un site, un monde de représentations dont il est impossible de ne pas tenir compte préexiste déjà par rapport au sien. Les conséquences de cet état de fait s'observent chez Picabia dans un art qui non seulement n'arrive pas à marquer suffisamment sa distance et sa différence par rapport aux nouvelles images, mais montre même à leur égard une attirance inavouée, le début d'une fascination coupable. Au point que son auteur commence à en organiser le recyclage, à en faire le point de départ de certaines œuvres, suivant une procédure qui n'en est qu'à ses débuts et qui ira s'amplifiant – tout en restant secrète et cachée, cette dissimulation étant en réalité un aveu en creux et légèrement honteux : celui d'une possible faiblesse de la peinture face à sa concurrente.
La peinture de l'âme
La rupture qui intervient dans l'art de Picabia au cours de l'hiver 1908-1909, rupture avec son impressionnisme de convention, rupture avec ses marchands) a toutes les apparences d'un sursaut, d'une réaction instinctive de survie : il ne s'agit ni plus ni moins que de sauver la peinture, de se convaincre qu'elle peut être autre chose qu'un exercice de virtuosité pratiqué à des fins commerciales et dévalué par le recyclage de poncifs aimables. Pour contrer la trivialité qui la menace, la peinture doit désormais se recentrer sur son univers propre, s'arroger un domaine de compétence sur lequel la photographie ne pourrait empiéter. L'art que Picabia investira de cette mission sera un art abstrait, non figuratif, dont il est par là même l'un des premiers inventeurs dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Dans ce laps de temps, il passe rapidement d'une figuration paysagère fortement simplifiée par l'aplat et le cerne, L'Arbre rouge, 1912, Musée national d'art moderne, Paris à un langage d'inspiration à la fois cubiste et futuriste où le vague souvenir de motifs dynamiques s'efface derrière l'émiettement de la surface en éclats kaléidoscopiques, Danses à la source II, 1912, Museum of Modern Art, New York, pour déboucher dans ces chefs-d'œuvre que sont Udnie, 1913, Musée national d'art moderne, Paris et Edtaonisl, 1913, Art Institute, Chicago, sommets de la peinture que Guillaume Apollinaire venait de baptiser du nom d'orphisme. Or il se trouve que Picabia en justifie la forme en prenant constamment comme repoussoir ce qui lui en semble la contradiction même : à savoir la photographie et le type de réalisme qu'elle impliquerait. La photographie, déclare Picabia en 1913 à l'occasion de la présentation de plusieurs de ses œuvres à l'Armory Show à New York, a aidé l'art à prendre conscience de sa nature propre, qui ne consiste pas à être un miroir du monde extérieur, mais à donner une réalité plastique à des états d'esprit intérieurs. ... L'appareil ne peut reproduire un fait mental. Logiquement, l'art pur ne sera pas celui qui reproduira un objet matériel, mais celui qui conférera la réalité à un fait immatériel, émotif. De sorte que l'art et la photographie s'opposent. À cette justification s'ajoute celle d'une théorie musicaliste de la peinture devant sans doute beaucoup à la première épouse de Picabia, la musicienne et brillante intellectuelle Gabrielle Buffet – leur rencontre en 1908 ayant déjà coïncidé avec le renoncement de l'artiste à son statut de peintre à succès.
La période orphique est un moment de grâce pour Picabia, qui semble croire en la possibilité d'un art susceptible d'exprimer tous les mouvements de l'âme humaine : Moi je ne peins pas ce que voient mes yeux. Je peins ce que voit mon esprit, ce que voit mon âme. Le drame de Picabia sera d'avoir ensuite désespéré de cette âme – et c'est ce qui pouvait arriver de pire au peintre qui avait retrouvé en elle la justification d'une peinture capable d'échapper au réalisme trivial de l'image mécanique. La sorte d'idéalisme auquel il s'était raccroché ou avait feint de se raccrocher n'est bientôt plus de mise : la guerre le rappelle aux plus cruelles réalités, et l'âme reste, avec un certain nombre d'autres croyances illusoires, Dieu, amour, raison, civilisation..., sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Après une courte période de mobilisation, il fuit à New York ce qu'il désigne comme l'agonie du monde en vertige et les valses hideuses de la guerre, Poèmes et dessins de la fille née sans mère, 1918.
L'art désenchanté
Or, si cette âme n'existe pas, que restera-t-il alors à la peinture, quel paysage mental reflétera-t-elle ? La mort de l'âme signe celle de l'art : c'est le début, pour Picabia, de la grande crise dadaïste et d'un premier cycle d'anti-peintures où, ce n'est certainement pas par hasard, l'artiste se met de nouveau à recycler des images dont il n'est pas l'auteur – schémas de machines, coupes, élévations, images ready-made, proches parentes des objets prélevés et élevés au rang d'œuvres d'art par Marcel Duchamp. Faire des images avec d'autres images : le fonctionnement des œuvres machinistes de Francis Picabia est emblématique d'une attitude envers la création typiquement dadaïste. Au déploiement démiurgique du savoir-faire de l'artiste, Picabia substitue l'image frustrante et déceptive de la machine, réalisée selon des codes graphiques d'une rigueur et d'une monotonie qui ne laissent plus aucune place ni à l'invention, ni à la recherche, ni à la sensibilité, ni à la main, Machine sans nom, 1915, Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh. Le dédain du métier et de la mythologie qui l'accompagne est à son apogée dans une œuvre-manifeste comme M'amenez-y 1919-1920, Museum of Modern Art, New York. Réalisée à partir d'un schéma publié à la même époque dans La Science et la vie, elle oppose la sécheresse du dessin technique à une parodie de touche appliquée avec des effets de brosse volontairement bâclés et exagérément visibles ; l'œuvre est en outre parsemée d'inscriptions qui tournent en dérision, par le biais de mauvais jeux de mots, le métier d'artiste et une certaine idée de la peinture : la première d'entre elles la désigne comme un portrait à l'huile, mais... de ricin ! ; une autre, râtelier d'artiste, porte atteinte à la dignité du lieu mythique de la création ; peinture crocodile, enfin, suggère une parenté avec l'expression larmes de crocodile, désignant de fausses larmes, des larmes d'hypocrite – il faudrait donc comprendre, peinture crocodile comme fausse peinture ou fausseté de la peinture... Ailleurs, les inscriptions qui parsèment certaines œuvres visent explicitement les clichés sentimentaux qui s'attachent, par exemple, à l'amour humain, assimilé à une sexualité absurde et répétitive de bielles et de pistons Parade amoureuse, 1918. Ces machines des idées actuelles dans l'amour, comme s'intitule l'une d'elles, sont les petites filles, nées sans mère du Grand Verre de Duchamp et ont leur équivalent dans la poésie que Picabia commence à produire, tout aussi dénuée d'émotion que sa peinture, ainsi que dans sa vaste production d'aphorismes : Notre phallus devrait avoir des yeux, grâce à eux nous pourrions croire un instant que nous avons vu l'amour de près. Ainsi, avec quelques autres esprits forts (Jarry, Roussel, Duchamp, Tzara, qu'il ira rencontrer à Zurich en 1919 avant de l'accueillir à Paris l'année suivante, Picabia chasse les derniers relents d'idéalisme légués par l'époque précédente et nous fait entrer de plain-pied dans la modernité désenchantée du XXe siècle.
Contre le retour à l'ordre
Lorsque, le conflit terminé, Picabia se réinstalle à Paris, il a dans ses bagages 391, une revue qui reste un des témoignages les plus forts de l'activisme dadaïste ; son anti-peinture prend aussi une dimension plus provocante encore dans le contexte de retour à l'ordre que connaissait alors le milieu de l'art parisien – spécialement chez certains de ses anciens amis cubistes. Leur chauvinisme, leur sacralisation du métier et de la tradition nationale deviennent les cibles de Picabia, de même que leur goût pour les références au passé historique, contre lequel il défend une salutaire conception de la table rase et de l'amnésie – l'amnésie que l'on entend justement dans M'amenez-y. Alors qu'elles ont invariablement été décriées comme le signe de son imposture, de l'insincérité de son engagement dadaïste, les Espagnoles réalistes que Picabia dessine et expose en même temps que ses machines servent exactement les mêmes fins subversives ; mais il faut pour cela s'apercevoir qu'elles détournent de célèbres effigies ingresques, comme celle de La Belle Zélie notamment en les affublant des accessoires dérisoires d'un hispanisme de pacotille (peignes ouvragés, châles et mantilles, coiffures fleuries plus extravagantes les unes que les autres. Au moment même où le nom d'Ingres sert systématiquement de caution aux tenants du rappel à l'ordre en peinture, Picabia détourne l'héritage du maître de Montauban et dévalorise ses emprunts en les faisant servir à la fabrication d'images sans aura, fondées sur les poncifs d'un exotisme et d'un érotisme de folklore. Ingres est la cible : c'est ce que montre très littéralement un grand tableau ripoliné, La Nuit espagnole, 1922, Wallraf-Richartz Museum und Ludwig Museum, Cologne, où la silhouette d'un nu empruntée à La Source d'Ingres est transformée en panneau de foire et parsemée d'impacts de tirs. Avec son pendant, La Feuille de vigne, 1922, Tate Gallery, Londres, qui détourne Œdipe et le sphinx d'Ingres, et un tableau immédiatement postérieur, Le Dresseur d'animaux, 1923, Musée national d'art moderne, Paris, La Nuit espagnole parodie les tableaux de salon dont ils ont les dimensions, les sujets, le nu essentiellement et les emprunts aux sources nobles – à la différence que ces œuvres de Picabia, les toiles au Ripolin mobilisant le moins de science picturale possible ne peuvent sérieusement passer pour le manifeste d'un quelconque rappel à la tradition et au beau métier. Ils connaîtront une importante descendance jusqu'au milieu des années 1920 avec la série des Monstres, qui montre des couples d'amoureux bariolés dérivant d'un genre de carte postale très populaire à cette époque, Jeunes Mariés, 1925, coll. part.. Bien après la date officielle du décès de Dada, ces œuvres prolongent très tard une tradition d'anti-peinture dont relèvent aussi plusieurs collages constitués de matériaux hétéroclites englués dans le Ripolin, Pot de fleurs, 1925-1926, musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
Sources nobles et vulgaires se croisent dans une des premières œuvres significatives de la série des Transparences : il s'agit de Rocking-Chair, 1928, coll. part., dont le principal motif, une femme nue dans un fauteuil qui démarque une carte postale érotique de la Belle Époque, s'accompagne de citations botticelliennes. Cela pose le délicat problème du statut de ces œuvres à l'aspect porcelainé, exécutées dans une technique raffinée, glacis, vernis et multipliant, par système plus que par nécessité, les références aux exemples les plus accomplis de l'art du passé, entremêlées dans un jeu confus de superpositions créant d'insurmontables difficultés de lecture. Si parodie il y a, celle-ci heurte en tout cas beaucoup moins frontalement le sens commun, et il est intéressant de constater, à cet égard, que ces tableaux ont trouvé à satisfaire à la fois le goût du rêve et de l'énigme des surréalistes, comme celui d'une nouvelle clientèle mondaine, trop heureuse de pouvoir s'offrir les tableaux plus anodins en apparence d'un artiste à la réputation scandaleuse. L'époque des Transparences est en effet celle au cours de laquelle Picabia renoue avec les fastes de ses débuts – par penchant personnel certainement, mais aussi peut-être par nécessité, sa situation matérielle s'étant progressivement compliquée pendant l'entre-deux-guerres. Établi le plus clair de l'année sur la Côte d'Azur, il devient alors l'ordonnateur de fêtes brillantes et le pourvoyeur d'expositions qui sont autant de rendez-vous de la haute société, à laquelle il sert la soupe avec une propension au cynisme difficile à évaluer. Picabia se réserve cependant de discrètes marges de manœuvre, dont il profite par exemple pour produire, à la fin des années 1930, une nouvelle série d'œuvres abstraites, 7091, 1938, coll. part. ou encore un ensemble de paysages truellés qui anticipe curieusement sur la période vache de Magritte ou sur les croûtes de Gasiorowski.
La peinture : grandeur et servitude
Plus homogène, l'ensemble de toiles réalistes, des couples érotiques, des nus jeunes et sportifs, quelques scènes de genre... que Picabia entreprend pendant les années de guerre est celui qui a fait peser les plus graves soupçons sur la valeur du projet artistique de son auteur : soupçon d'attirance inavouée pour certains critères de la peinture académique, soupçon d'adhésion à l'idéologie de la jeunesse sur laquelle s'appuyait la Révolution nationale pétainiste.
Pourtant, sur le plan de la méthode comme du programme qui l'accompagne, la cohérence de cette peinture avec ce que l'on sait des obsessions de Picabia paraît remarquable. Cohérence de méthode, puisque toutes ces mises en scène sont strictement calquées sur les photographies que mettaient à la disposition du peintre les revues de charme de la fin des années 1930, Paris Plaisir, Paris Magazine, Paris Sex Appeal, Mon Paris... ; cohérence de programme, celui de la dévalorisation systématique des ressources de la peinture en soumettant tous ses effets à ceux des documents utilisés. Les toiles de Picabia imitent en effet les photographies dans leurs caractéristiques les plus brutales : éclairages fortement contrastés, points de vue inhabituels, décadrages, raccourcis et aberrations optiques, Nu, 1942-1943, coll. part.. Transposés en peinture, ces effets donnent aux toiles de Picabia leur aspect singulièrement âpre et tranchant, très loin de toute élégance et de toute tentation académique – il suffirait pour s'en convaincre de les comparer aux nus d'un authentique peintre mondain comme Jean-Gabriel Domergue. En outre, de la même manière qu'à l'époque des machines dadaïstes, l'utilisation de plusieurs sources éparses dans la confection de certaines toiles occasionne des étrangetés spatiales et des ruptures d'échelle qui désignent bien ces tableaux pour ce qu'ils sont : de véritables collages peints, comme dans le spectaculaire Cinq femmes env. 1942, coll. part.. Picabia, une fois de plus, se complaît dans la réalisation d'une peinture sans aura, brutalement confrontée au risque que Delacroix, à l'aube du nouvel art photographique, voyait planer sur le peintre qui en ferait mauvais usage, celui de ne plus rien devenir d'autre que cette machine attelée à une autre machine .
La couleur qui est dans ces toiles l'une des seules parts d'arbitraire que puisse s'autoriser Picabia renforce par les teintes outrées le kitsch de ces mises en scène, très peu bien-pensantes, qui utilisent tous les poncifs d'un érotisme de bas-étage, bordels exotiques, alcôves et bonbonnières de fausses marquises. Mais l'iconographie de ces tableaux est parfois aussi celle de la libération du corps, du naturisme et du développement des loisirs qui avait cours dans l'entre-deux-guerres et que les revues de charme détournaient à leurs propres fins en y cherchant systématiquement le côté scabreux, Printemps, 1942-1943, coll. part. ; c'est, par exemple, l'iconographie des photographes de la Nouvelle Vision, comme Jean Moral, un ami de Picabia, dont les clichés de baigneuses étaient parfois reproduits dans Paris Magazine. Replacées dans leur contexte, celui d'une sous-culture populaire, les effigies picabiennes sont ainsi les proches parentes des pin-up qui apparaissent au même moment dans les derniers collages de Schwitters, avant de passer chez Richard Hamilton et Eduardo Paolozzi et d'entrer dans le répertoire de base du pop art.
Après cette période une nouvelle fois hantée par le spectre de la photographie, Picabia se lance, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une nouvelle forme de peinture qui est, selon ses propres termes, l'expression de ce qu'il y a de plus vrai dans notre être intérieur et une prise de contact de plus en plus profonde avec un univers intérieur – c'est-à-dire que se rejoue, comme en 1912, l'exaltation des pouvoirs de la peinture contre la menace, sinon de sa disparition, du moins de sa réification dans un monde d'images de plus en plus homogène et dominé par un paradigme réaliste issu de la photographie. La peinture de Picabia se recentre alors sur un fort contenu de significations à la fois personnelles et universelles qu'il incarne dans un répertoire mi-abstrait mi-figuratif de signes idéographiques, de symboles archaïques et d'images archétypales, où dominent surtout les symboles sexuels plus ou moins éloquents, vulves ou phallus, Ça m'est égal, 1947, coll. part.. L'ensemble est traité dans un style qui témoigne d'un possible intérêt pour les arts archaïques et primitifs, et d'un goût certain pour les surfaces texturées qui renvoie aux tendances matiéristes de la peinture de ce temps. Cette dernière remarque vaut également pour la série des Points aux champs de couleurs unis parsemés de pastilles rondes, étonnants jalons dans l'histoire encore balbutiante du monochrome, interprétés en termes néo-dadaïstes par Michel Seuphor qui y voyait la même peinture anti-peinture qui est réellement la création, et sans doute le point final à toute possibilité de faire de la peinture.
Point final, en effet. Déjà affaibli par une première attaque en 1944, Picabia succombe à la suivante en 1951 ; lorsqu'il meurt en 1953, il ne peignait plus depuis deux ans. Dans une œuvre au sujet énigmatique Sans titre, 1951, coll. part., Marcel Jean a vu une forme indéfinissable mais précise, enveloppée de bandelettes : ainsi jadis on emmaillotait les nouveau-nés, comme les morts qu'on menait à la tombe. Cadavre ou tout petit enfant prometteur, cet objet indéfinissable et insaisissable n'est sans doute rien d'autre que la peinture elle-même, toujours engagée dans le cycle des morts et des résurrections auquel Picabia l'aura soumis sa vie durant.
À la fin de l'année 1951, Picabia souffre d'une artériosclérose paralysante qui l'empêche de peindre et meurt deux ans plus tard.
Œuvres
Peintures
Les Martigues, 1902, fusain sur papier, Musée Pierre André Benoit, Alès
La Rivière: bord de la Douceline à Munot près de La Charité sur Loire 1906
Udnie, 1913, huile sur toile, 290 × 300 cm, Musée national d'art moderne de Paris
Edtaonisl, 1913, Art institute of Chicago
La Ville de New York aperçue à travers mon corps, 1913, gouache, aquarelle, crayon et encre, 55 × 74,5 cm4
Prostitution universelle, 1916, Yale University Art Gallery, New Haven
Parade amoureuse, 1917, huile sur carton, 97 × 74 cm, Paris, collection particulière.
Danse de Saint-Guy Tabac Rat, 1919, MNAM Paris
L'Enfant Carburateur, 1919, huile, émail, feuille d'or, crayon sur contreplaqué, New York, musée Guggenheim
L'Œil cacodylate, 1921, huile sur toile, MNAM Paris
Chapeau de paille ?, 1921, MNAM Paris
La Nuit espagnole, 1922, Musée Ludwig, Cologne
Optophone II , 1923, huile sur toile, 116 × 88,5 cm, Musée d'art moderne de la Ville de Paris
Le dresseur d'animaux , 1923, Ripolin sur toile, 250 x 200 cm, Centre Pompidou, Musée d'art moderne de la Ville de Paris6
Cure-dents », 1925, huile et collage sur toile, 129 × 110 cm7
Corrida, 1926-1927, Gouache, 104.8 × 75.2, collection privée, Suisse
Idylle, 1927, Musée de Grenoble, huile sur caton 105,7 × 75,7cm
L'Autoportrait de dos avec femme enlacée et masque, 1927-30, Musée Picasso, Antibes
Le Masque et le Miroir, 1930-45, huile sur contre- plaqué, 85,2 × 69,9 cm, Musée national d'art moderne, Paris
Figure et fleurs, 1935-45, huile sur toile, 100 × 73 cm, Musée national d'art moderne, Paris
Maternité, 1936, huile sur toile, 162,4 × 130,3 cm, Musée national d'art moderne, Paris
Printemps, 1938, Galerie Rose Fried
Le Matador dans l'arène, 1941-1943, huile sur carton, 105 × 76 cm Musée du petit palais, Genève
Sans titre masque, 1946/47, huile sur carton, 64,5 × 52,5 cm, Musée national d'art moderne
Chose à moi-même, 1946, huile sur carton, 92 × 72,5 cm, collection particulière
Cherchez d'abord votre Orphée, 1948, huile sur toile, 169 × 70 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès
L'Insensé, 1948, huile sur toile, 151 × 10 cm, Musée Ludwig, Cologne
Veuve, 1948, huile sur bois, 153,2 × 116,Musée national d'art moderne, Paris
Déclaration d'amour, 1949, huile sur panneau, 96 × 69 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès
Symbole, 1950, huile sur contreplaqué, 100 × 85 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès
Écrits
Première édition de Jésus-Christ Rastaquouère, 1920 illustrations de Georges Ribemont-Dessaignes)
Cinquante-deux miroirs, Barcelone, octobre 1917.
Poèmes et dessins de la Fille née sans mère, Lausanne, Imprimeries réunies, avril 1918.
L'Ilot de Beau-Séjour dans le Canton de Nudité, Lausanne, juin 1918.
L'Athlète des Pompes funèbres, Bégnins, décembre 1918.
Râteliers platoniques, Lausanne, décembre 1918.
Poésie ron-ron, Lausanne, février 1919.
Pensées sans langage, Paris, Figuière, avril 1919.
Unique Eunuque Paris, Au Sans Pareil, Coll. Dada, février 1920. Rééd. Paris, Allia, 1992.
Jésus-Christ Rastaquouère, Paris, Au Sans Pareil, « Dada », automne 1920. Rééd. Paris, Allia, 1996.
Caravansérail 1924. Ed. Luc-Henri Mercié. Paris, Belfond, 1975.
Choix de poèmes par Henri Parisot, Paris, Guy Lévis-Mano, 1947.
Lettres à Christine, édition établie par Jean Sireuil. Présentation, chronologie et bibliographie par Marc Dachy. Paris, Champ Libre, 1988.
Écrits, deux volumes. Ed. Olivier Revault d'Allonnes et Dominique Bouissou. Paris, Belfond, 1975 et 1978.
Écrits critiques, préf. Bernard Noël. Ed. Carole Boulbès. Paris, Mémoire du Livre, 2005.
Liens
http://www.ina.fr/audio/P11180790/int ... rancis-picabia-audio.html Interview de Piacabia
http://www.ina.fr/audio/00771740/francis-picabia-audio.html Une vie une oeuvre Picabia
http://youtu.be/sS2av7z7ofs Picabia
http://youtu.be/jTv-vNhPoZs Diaporama
http://youtu.be/SE-4Hxygl8o Les dernières toiles
http://youtu.be/0xtFAIMpFdc Transparence diaporama
http://youtu.be/DdejF4YAjLM Francis Picabia
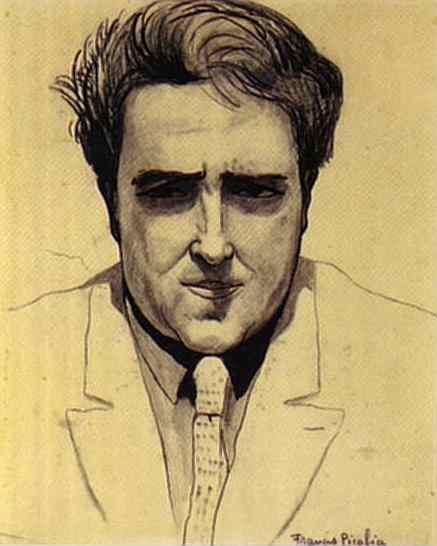      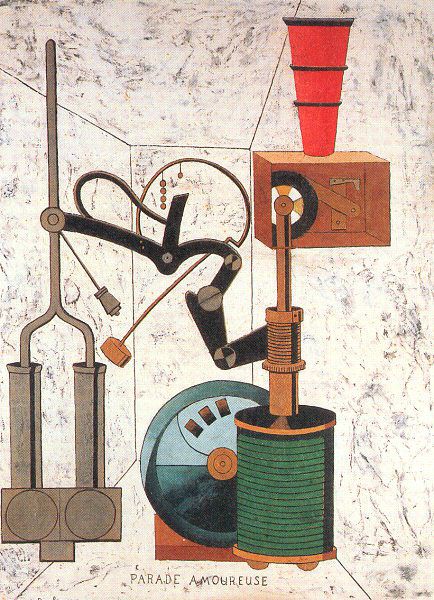     
Posté le : 29/11/2014 21:42
|
|
|
|
|
Fernando de Passoa |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 30 novembre 1935, meurt Fernando António Nogueira Pessoa
à 47 ans, des suites de son alcoolisme, à Lisbonne Portugal, écrivain, critique, polémiste et poète portugais trilingue anglais, dans une faible mesure français, et principalement portugais.Il a pour autre pseudos Bernardo Soares, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos, né le 13 juin 1888 à Lisbonne, ville où il meurt , il a vécu une partie de son enfance en Afrique du Sud.
Théoricien de la littérature engagé dans une époque troublée par la guerre et les dictatures, inventeur inspiré par Cesário Verde du sensationnismecf, ses vers mystiques et sa prose poétique ont été les principaux agents du surgissement du modernisme au Portugal.
... est-ce que je sais que je vis, ou bien seulement que je le sais ?
— Poèmes inconnus d'Alberto Caeiro.
Pessoa flâneur, poète de l'errance, auteur d'une flânerie, Lisbon revisited, et d'un guide touristique posthume anglais
En bref
Né et mort à Lisbonne, mais élevé en Afrique du Sud, alors britannique, poète bilingue, à la fois cosmopolite et nationaliste, sentimental et cynique, rationaliste et mystique, classique et baroque, Fernando Pessoa éprouvait très fortement le sentiment de n'être personne, à moins d'être plusieurs. C'est autour de cette intuition que s'organise son œuvre. Incapable de gérer ses contradictions dans la vie, il en a fait la matière de ses livres. Prenant Shakespeare pour modèle, il définit son entreprise comme un drama em gente, drame en personnes ; il fait dialoguer entre eux les divers moi qui existent virtuellement en lui et leur donne une réalité fictive par l'écriture. Mais on peut aussi lire son œuvre comme une sorte d'épopée intellectuelle, qui décrit l'exploration non de terres lointaines, comme celle de Camões, mais de modes d'être inconnus.
Ce qui déconcerte ou fascine ses lecteurs, c'est l'existence en lui de tous ces auteurs hétéronymes dont il a écrit les œuvres et assumé les personnalités : le poète paysan Alberto Caeiro, le docteur Ricardo Reis, l'ingénieur Álvaro de Campos, l'employé de bureau Bernardo Soares et bien d'autres. L'auteur orthonyme, Fernando Pessoa lui-même c'est, paradoxalement, son vrai nom, qui signifie personne, joue sa partie dans ce concert, au même titre que les autres. Pessoa est donc à lui seul plus qu'une pléiade. Il est à la fois chacun des poètes qui la constituent et le poète total qui les contient tous. Mais cet éclatement de son être en plusieurs personnes distinctes ne serait qu'une curiosité clinique s'il ne s'agissait pas aussi d'un acte créateur, destiné à changer la vie.
Sa vie
L'enfant, qui a grandi en face de l'opéra de Lisbonne, 4 place Saint-Charles dans le quartier du Chiado, perd à l'âge de cinq ans son père, emporté le 13 juillet 1893 dans sa quarante quatrième année par la tuberculose. Ce père, Joaquim de Seabra Pessoa , fils d'un général qui s'était illustré durant la Guerre civile portugaise, travaillait comme fonctionnaire du secrétariat à la Justice et publiait régulièrement des critiques musicales dans le Diário de Notícias il a en outre publié une brochure sur le Hollandais Volant. Le 2 janvier 1894, c'est au tour de son frère né en juillet 1893, Jorge, de mourir. Le garçon, alors que la famille a dû en novembre emménager avec une grand-mère maternelle dans une maison plus modeste 104 rue Saint Marcel, s'invente un double, le Chevalier de Pas, et dédie un premier poème annonciateur de prédilections futures À ma chère maman.
Sa mère, Maria Magdalena Pinheiro Nogueira, îlienne de Terceira, femme de culture quadrilingue et versificatrice à ses heures, de qui le père, directeur général du ministère de la Reine, fréquentait entre autres personnalités le poète Tomás Ribeiro, avait appris l'anglais auprès du précepteur des infants. Elle s'était remariée, par procuration, en décembre 1895 avec le consul du Portugal à Durban, le commandant João Miguel Rosa, qui lui avait été présenté à Lisbonne quatorze mois plus tôt, avant la nomination de celui-ci. Elle embarqua avec son fils le 7 janvier 1896 pour rejoindre son nouvel époux au Natal, colonie autonome d'Afrique du Sud, où l'éducation de l'enfant se poursuivit en anglais. Celui-ci franchit en deux années les quatre de l'enseignement primaire dispensé par les sœurs irlandaises et françaises de l'école catholique Saint-Joseph.
Vie en Angleterre
Introverti et modeste dans ses échanges, Fernando Pessoa se montre un frère amuseur en organisant des jeux de rôles ou en faisant le clown devant la galerie, attitude ambivalente qu'il conservera toute sa vie.
Devenu le crac solitaire et inapte au sport du lycée de Durban il est premier en français en 1900, il est admis en juin 1901 au lycée du Cap de Bonne Espérance. C'est l'année où meurt sa seconde demi-sœur, Madalena Henriqueta, âgée de deux ans, et où il s'invente le personnage d'Alexander Search dans lequel il se glisse pour écrire des poèmes, en anglais, langue qui restera, sans exclusivité, celle de son écriture jusqu'en 1921. Il y en aura cent dix-sept, le dernier datant de 1909. Ses tentatives d'écrire des nouvelles, parfois sous le pseudonyme de David Merrick ou de Horace James Faber, sont des échecs.
Cependant, à la rentrée scolaire, il est avec sa famille sur le paquebot qui conduit via Alexandrie le corps de sa sœur jusqu'à une sépulture lisboète. En mai 1902, le voyage familial se prolonge aux Açores où habite la famille maternelle. Sa belle-famille, rentrant sans lui, le laisse visiter de son côté sa famille paternelle à Tavira en Algarve. C'est seul qu'il regagne Durban en septembre. Préparant seul son entrée à l'université, il suit parallèlement des cours du soir au Lycée de Commerce de Durban. En novembre 1903, il est lauréat d'anglais, sur huit cent quatre-vingt-dix-neuf candidats, à l'examen d'admission à l'Université du Cap de Bonne Espérance.
C'est toutefois de nouveau au lycée de Durban qu'il suit l'équivalent d'une khâgne. Ébloui par Shakespeare, il compose alors, en anglais, Le Marin, première et seule pièce achevée des cinq œuvres dramatiques qu'il produira. Il est publié pour la première fois en juillet 1904 par Le Mercure du Natal pour un poème signé Charles Robert Anon, comme anonyme. Le journal du lycée de décembre 1904 révèle par un article intitulé Macaulay ses talents de critique. Il achève ses études undergraduate en décembre 1904 en obtenant précocement le diplôme Intermediate Examination in Arts.
Immigré à Lisbonne, exilé à soi-même
La dictature ne favorise pas la jeunesse. Les plus riches s'exilent à Paris. Fernando Pessoa rêve alors de s'éditer lui-même. C'est un échec.
En 1905, à l'âge de dix-sept ans, il part pour Lisbonne vivre auprès de sa grand-mère paternelle atteinte de démence à éclipses, Dionísia Perestrelo de Seabra, laissant sa mère à Durban, ce dans le but de devenir diplomate. Une santé fragile qu'il tente de maintenir par psychothérapie et gymnastique suédoise lui fait perdre une année universitaire et en octobre de l'année suivante, il s'inscrit au Cours Supérieur de Lettres, qui n'était pas encore faculté, mais son cursus est compromis par sa participation aux grèves estudiantines suscitées par le coup d'État du dictateur João Franco.
Fernando Pessoa à vingt ans en 1908. Devenu indépendant, tout en poursuivant en autodidacte des études littéraires et philosophiques, il entre alors dans la vie active et simultanément en écriture.
À la mort de sa grand-mère en août 1907, il se fait engager par l'agence américaine d'information commerciale R.G. Dun & Company. En septembre, il utilise la part d'héritage que sa grand-mère lui a laissé, pour ouvrir, 38 rue de la Conception de Gloire, un atelier de typographie et d'édition intitulé Ibisnote 8 et écrit sa première nouvelle aboutie, A Very Original Dinner, récit d'humour noir et de cannibalisme. En quelques mois, l'affaire tourne au désastre financier et en 1908 il se fait embaucher au journal Comércio comme correspondant étranger.
Il trouve également à travailler comme rédacteur de courrier commercial et traducteur indépendant pour différents transitaires du port. C'est en tant que traducteur commercial qu'il tirera jusqu’à la fin de sa vie son revenu de subsistance, revenu précaire qui l'aura fait passer par vingt maisons différentes, parfois deux ou trois simultanément.
C'est encore en 1908 qu'il inaugure une recherche intérieure, une longue marche vers soi, vers la connaissance d'un soi qui se révèle multiple, sous la forme d'un journal intime transcrivant dans ce qui devait devenir un drame en cinq actes, Tragédie subjective, le monologue de Faust, monologue qui ne s’arrêtera qu'avec la mort de l'écrivain et dont seuls des fragments ont été publiés. Cette quête intérieure répond à une errance physique, de chambre louée en chambre louée, de quartier en quartier, qui ne cessera qu'en 1921 et se ponctue de crises cénestopathiques.
Conscient de son état, il lit en 1910 Max Nordau, qui décrit le fou comme un dégénéré enfermé dans une subjectivité artistique, lecture qui le persuade que son génie à objectiver la perception du monde l'écarte de la folie. Aussi, en 1911, commence-t-il la rédaction, en anglais, de poèmes sensationnistes. Dépassant l'interprétation symboliste des correspondances de Baudelaire, le poète tend à travers celles-ci à restituer une perception non teintée de subjectivité d'un au-delà présent. Il réalise ainsi le projet nietzschéen d'une tragédie délivrée du moi de l'artiste. Il est conforté dans le sens mystique d'un tel dépassement par les expériences de dépersonnalisation décrites par Edgar Poe, écrivain qu'il a beaucoup lu depuis son arrivée à Lisbonne et qu'il traduira à l'instar d'un Mallarmé qu'il a également étudié de façon approfondie. Après le refus de Constable & Robinson de l'éditer, le 6 juin 1917, l'expérience sensationniste s'achèvera là sous cette forme, laissant place entièrement au projet futuriste, avant d'être repris comme testament de l'artiste. Les cinquante-deux poèmes composant The Mad Fiddler ne seront publiés qu'après 1979, quatre autres volumes et une tragédie en anglais, que l'auteur jugeait imparfaits, restant inédits.
Du critique au pasticheur maniaque
En 1912, il publie sa première critique en portugais suivies de deux autresnote 10 dans la revue nostalgiste L'Aigle, organe de la Renaissance Portugaise . Introduit par le frère de son beau-père, le général retraité Henrique Rosa, il entre dans le groupe Orpheu, cercle littéraire qui se forme autour de celui-ci et qui se réunit au moderne café A Brasileira. Il propose régulièrement de publier leurs créations à Alvaro Pinto, rédacteur de L'Aigle dans laquelle il prophétise la venue d'un super Camoens. À la fin de l'année, il trouve un hébergement, qu'il conservera jusqu'à la guerre, chez sa marraine et tante maternelle, Ana Luísa Pinheiro Nogueira dite Anica, 18 place des Carmes.
C'est alors, en 1913, qu'il verse dans l'ésotérisme et qu'il entame en la personne lusophone de Bernardo Soares, la rédaction décousue du Livre de l'intranquillité qui s'étalera également jusqu'à la mort de l'écrivain. La même revue, L'Aigle, innove en en publiant un extrait, Dans la forêt du songe, premier poème en prose portugaise, et entérine la mutation, fortement encouragée par l'amitié du poète, dramaturge et nouvelliste Mário de Sá-Carneiro, du critique en poète. Cependant une divergence grandit entre les écrivains avides d'ouverture que soutient Fernando Pessoa et la ligne nostalgiste de L'Aigle. En deux jours, du 11 au 12 octobre, Fernando Pessoa reprend le manuscrit de sa pièce Le Marin qu'il destinait au public anglais dans le but de surpasser en raffinements le prix Nobel de littérature Maurice Maeterlinck, ce à quoi il parvient excessivement.
En février 1914, Renascença, Renaissance publie dans ce qui fut l'unique numéro de la revue ses poèmes Impressions du crépuscule et O cloche de mon village qui rallient la jeune garde littéraire à la bannière d'une forme de post-symbolisme initié par Camilo Pessanha, le paulisme ou succédentisme. Dès lors, il se sentira, comme maints de ses prédécesseurs portugais, investi d'une mission de promouvoir une sorte de révolution culturelle pour sauver la nation de la stagnation. En l'occurrence, il se fait une religion de l'intersectionnisme ou sensationnisme à deux dimensions, application à la littérature du simultanéisme qu'avaient expérimentée Apollinaire et Sá-Carneiro. Le 8 mars 1914, lui apparait au cours d'une transe l'hétéronyme Alberto Caeiro, syncope de Carneiro, qui, pendant plusieurs jours, lui dicte en portugais les trente neuf poèmes en vers libres du Gardeur de troupeau. Suivront les deux disciples de cette allégorie du Poète, le portuan Ricardo Reis, Richard Rois, figure intellectuelle auteur des Odes, et le judéo algarvois Alvaro de Campos, Aubéron des Champs, écrivain du cœur qui lui rédigera sans pause ni rature les quelque mille vers de l'Ode maritime.
Le génie du modernisme
Le n° du 28 juin 1915 dont la rédaction était dirigée par Pessoa & Sá-Carneiro sera le dernier de la revue.
L'effervescence du moment est amplifiée par le retour consécutif à l'entrée en guerre de la France d'une jeunesse exilée, durant le régime de João Franco, à Paris où elle a vécu les expériences d'un surréalisme naissant.
Le 28 mars 1915, avec son alter ego Mário de Sá-Carneiro et l'argent du père de celui-ci, ainsi que d'autres artistes engagés contre les mouvements réactionnaires opposés ou favorables à la Première République, Fernando Pessoa lance une revue, Orpheu , référence à l'orphisme. Plus qu'une revue moderne et plus qu'un objet d'art, Orpheu se veut un acte créateur et même l'art en acte. Calligrammes, vers libres, détournement de la ponctuation, éclectisme de l'orthographe et des styles, néologismes, archaïsmes, anachronismes, ruptures et synchronie du discours, paradoxes amphigouriques et antithèses ironiques, ekphrâsis à satiété, interjections, pornographie et allusions homosexuelles, outrances déclenchent le fracas dans toute la presse lisboète et jusqu'en province. L'avant-gardisme provocateur et suicidaire de la revue, la dénonciation d'une sexualité bourgeoise et hypocrite, le défi lancé à une littérature compassée et conformiste, le mépris affiché pour une critique étouffante choquent tant celle-ci que le public et révèlent au sein de la rédaction des clivages politiques envenimés par une diatribe de Fernando Pessoa contre le chef du Parti Républicain, Afonso Costa. C'est à cette occasion qu'il tue le maître sensationniste Alberto Caeiro. Malgré les maquettes qu'il s'obstinera à concevoir, la revue ne survit pas à l'opposition du pseudonote 16 éditeur, António Ferro et au suicide dandy de Mário de Sá-Carneiro. Elle ne comptera que deux numéros premier et deuxième trimestre 1915 ; le troisième numéro imprimé ne fut pas diffusé.
Thème astral de l'hétéronyme Ricardo Reis élaboré par Pessoa. Après le deuil de Sá-Carneiro, traduction des ouvrages de théosophie et séances de spiritisme lui ont été un secours au point d'envisager la carrière d'astrologue.
En septembre 1917, en pleine guerre, Alvaro de Campos, inspiré par le Manifeste du futurisme du nationaliste italien Marinetti, appelle, par un Ultimatum aux générations futuristes portugaises du XXe siècle publié dans le premier et dernier numéro de la revue Portugal futuriste, au renvoi de tous les mandarins européens et à l'avènement d'une civilisation technicienne de surhommes. Quelques mois après, en 1918, parce qu'ils contiennent des insultes tant contre les Alliés que contre le Portugal qui attisent les divisions entre germanophiles et républicains, la police de Sidónio Pais, dans les suites de l'arrestation d'Afonso Costa et du coup d'état du 5 décembre 1917 que pourtant Fernando Pessoa approuve, saisit les exemplaires restants et poursuit les auteurs au prétexte qu'un des dix poèmes d'Almada Negreiros y figurant, Apologie du triangle féminin, est pornographique. Inversement, Antinoüs, poésie où passion charnelle et spiritualité s'entremêlent, et 35 sonnets, plus élizabethains que Shakespeare lui-même et tout emprunts de métaphysique, valent à Fernando Pessoa une critique élogieuse venue de Londres.
L'écrivain mélancolique
En 1920, il s'installe à Campo de Ourique, un quartier de Lisbonne, au 16 rue Coelho da Rocha, avec sa mère invalide devenue une seconde fois veuve et bientôt reléguée dans un hospice de Buraca, campagne du nord-ouest de Lisbonne. Il déserte désormais le café A Brasileira pour l'antique café Martinho da Arcada, place du Commerce. Une correspondance amoureuse et une relation intense avec une secrétaire de dix-neuf ans très entreprenante rencontrée en janvier chez un de ses employeurs, Ofélia Queiroz, coïncide avec un état qui lui fait envisager son propre internement et se solde en octobre par la rupture.
La prestigieuse revue londonienne Athenaeum avait publié le 30 janvier de cette année Meantime, un des cinquante-deux poèmes de The Mad Fiddler qui avait été refusé en 1917, classant ainsi son auteur au Parnasse anglais. L'année suivante, il fonde avec deux amis la librairie Olisipo qui opère également comme maison d’édition. Celle-ci publie English Poems en trois séries. À partir de 1922, il donne de nombreux textes à la revue littéraire Contemporaine dont Le banquier anarchiste, brûlot à l'humour provocateur fustigeant tant l'ordre bourgeois que l'intellectualisme des révolutionnaires. Destinée à une traduction anglaise, ce fut la seule œuvre que l'auteur considéra comme achevée66 quoique la naïveté de sa construction la fit dédaigner des spécialistes. En octobre 1924, il fonde avec Ruy Vaz la revue de poésie Athena dans laquelle il continue de publier mais en portugais.
Fernando Pessoa martyr de la génération montante des modernes.
Le 17 mars 1925, il perd sa mère, dont il ne désespérera jamais retrouver par delà la mort l'affection69 éteinte par la maladie, renonce à poursuivre sa revue Athena, et c'est sa première demi-sœur Henriquetanote 25 et son beau-frère, le colonel Caetano Dias, qui viennent habiter avec lui. En 1926, alors qu'il envisage à son tour le suicide, un de ses demi-frères le fait venir à ses côtés à la direction de la Revue de Commerce et de Comptabilité.
À partir de 1927, il est, avec maints de ses jeunes admirateurs, un des collaborateurs de la nouvelle revue Presença, laquelle revendique la ligne moderne de l'éphémère revue Orpheu. En 1928, il publie dans la brochure gouvernementale L'interrègne une Justification de la dictature militaire au Portugal, appelant à la remise en ordre du pays et soutenant la répression militaire de février 1927, position qu'il regrettera et reniera après l'instauration de la dictature civile. Alvaro de Campos écrit son désenchantement ironique dans Bureau de tabac et lui-même entame à partir de son poème Mer portugaise publié en 1922 dans Contemporânea la rédaction de ce qui deviendra Message.
Fidèle à l'esthétique paronomastique du futurisme que lui avait fait partager Mário de Sá-Carneiro de trouver la poésie dans la réclame, il forge cette même année le slogan pour Coca-Cola nouvellement implanté au Portugal. Il concevra aussi la publicité d'une laque pour carrosseries d'automobiles.
Approfondissements intérieurs
En septembre 1929, il renoue avec Ofélia, seule histoire d’amour qui lui soit connue, mais leur liaison ne connaîtra pas de suite après 1931. En septembre 1930, il rencontre, en tant que disciple gnostique de la société secrète dite de l'Ordre des Templiers, le thélémite Aleister Crowley, qu'il avait impressionné au cours de leur correspondance par son érudition astrologique, alors que celui-ci est de passage en compagnie d'une magicienne de dix-neuf ans, Hanni Larissa Jaeger. La farce du faux suicide de son hôte à la Boca do Inferno à Cascais, rivage prédestiné à l'ouest de Lisbonne, est tout à fait dans l'esprit mystificateur du poète et devait servir, en alertant toutes les polices d'Europe, au lancement d'une série de romans policiers qui restera à l'état d'ébauche, les enquêtes du Docteur Parcequime, déchiffreur qui se seraient voulues une méthode d'investigation de la criminalité de l'homme. Fernando Pessoa fait l'objet d'un article paru à Paris.
En 1931, il écrit Autopsychographie, art poétique en trois quatrains. Il observe la mode du freudisme auquel il reproche de rabaisser l'homme au sexe tout en prétendant dépasser la psychanalyse et conçoit une nouvelle en forme d'étude psychiatrique, Marcos Alves. Sa candidature au poste de bibliothécaire du musée de Cascais est rejetée en 1932. En 1933, paraissent les premières traductions de ses textes. Dans un poème, il rationalise son sentiment d'une vie double, l'une rêvée et vraie, l'autre vécue et fausse.
En 1934, il publie son premier recueil en portugais, Message. Ces quarante cinq poèmes mystiques composent en trois parties une sorte d’épopée rosicrucienne dont le messianisme sébastianiste prophétise une humanité nouvelle et l'avénement du Cinquième Empire de paix universelle. Présentés par ses soins au jury du prix Antero de Quental fondé l'année précédente par l'ex éditeur de la revue Orpheu, António Ferro devenu chef de la propagande de l'Estado Novo, ils lui valent de remporter le second prix, sa création étant jugée trop éparse pour un premier prix.
Fernando Pessoa vieilli prématurément peu avant son décès à l'âge de 47 ans.
À la suite d'un projet de loi d'interdire les sociétés secrètes, il publie dans la presse une apologie de la franc-maçonnerie85 et des pamphlets contre Salazar. L’année suivante, il refuse d’assister à la cérémonie de remise de son prix présidée par celui-ci. En octobre, en guise de protestation contre la censure, il décide de cesser de publier au Portugal.
Il est enterré un mois et demi plus tard, le 2 décembre 1935, pauvre et méconnu du grand public, estimé d'un petit cercle d'amis. Le 29 novembre, veille de son décès et jour de son admission à l’hôpital Saint-Louis des Français pour une cirrhose décompensée, il écrivait son dernier mot, I know not what tomorrow will bring
Ses œuvres complètes seront éditées de 1942 à 1946. Des recherches plus complexes ont permis de faire resurgir son théâtre en 1952 et des inédits en 1955 et 1956. L'inventaire dressé par la Bibliothèque nationale du Portugal à la suite de son achat, à l'hiver 1978-197926, des manuscrits aux héritiers a permis de composer un certain nombre de publications dont Le Livre de l'intranquillité en 1982 et Faust en 1988. Les articles publiés de son vivant ainsi que les manuscrits inédits font l'objet de reconstitutions qui paraissent sous formes d'essais ou de recueils.
L'homme fait œuvre Hétéronymie
Fernando Pessoa. Hétéronymes.
Pessoa a créé une œuvre poétique multiple et complexe sous différents hétéronymes en sus de son propre nom :
Alberto Caeiro, qui incarne la nature et la sagesse païenne;
Ricardo Reis, l'épicurisme à la manière d'Horace;
Alvaro de Campos, le modernisme et la désillusion;
Bernardo Soares, modeste employé de bureau à la vie insignifiante s'il n'était l'auteur du Livre de l'intranquillité,
et alii soixante-douze en incluant les simples pseudonymes.
Bernardo Soares est considéré par lui comme son semi-hétéronyme, plus proche de l'auteur orthonyme. Il signe aussi quelques textes en prose sous son propre nom, comme Le Banquier anarchiste. L'hétéronymie deviendra sa façon d'être. De multiples autres hétéronymes auront des fonctions diverses, de l'astrologie à l'auteur de rébus.
Il reste que les grands hétéronymes littéraires auront une telle force, seront à l'origine d'une création littéraire si unique que l'auteur leur trouvera même à chacun une biographie justifiant leurs différences. Fernando Pessoa deviendra le cas Pessoa pour grand nombre d'intellectuels, de critiques, de littérateurs, de simples lecteurs.
Nombreux sont ceux qui vivent en nous ;
Si je pense, si je ressens, j’ignore
Qui est celui qui pense, qui ressent.
Je suis seulement le lieu
Où l’on pense, où l’on ressent..
— Version du "je" est un autre rimbaldien de Ricardo Reis, double philosophe de Fernando Pessoa.
Une œuvre transocéanique
Prolifique et protéiforme, Pessoa est un auteur majeur de la littérature de langue portugaise dont le succès mondial croissant depuis les années quatre-vingt a été consacré par la Pléiade. Son œuvre, dont de nombreux textes écrits directement en anglais, a été traduite dans un grand nombre de langues, des langues européennes au chinois. Des hommes de théâtre, des chorégraphes, des compositeurs se sont désormais emparés de cette œuvre très riche pour des spectacles. Le cinéma également a produit des films inspirés par ce poète.
Pessoa a la singularité d'être simultanément un écrivain anglophone. En volume, approximativement un dixième de sa production est anglaise, nonobstant l'apport qualitatif de cette production à la littérature. Élevé à Durban, capitale du Natal britannique, brillantissime diplômé de l'Université du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, c'est en tant que dramaturge shakespearien qu'il y commence en 1904 le métier d'écrivain et en tant que poète anglais qu'il le poursuit jusqu'en 1921 dans sa Lisbonne natale. De son vivant, sa production en portugais a été principalement celle d'un critique et les poèmes portugais qu'il a alors donnés l'ont été bien souvent pour le service de cette critique.
Pessoa a aussi écrit, souvent à des dates inconnues, en français, langue de la relation privilégiée avec une mère réinventée par delà les conflits familiaux. Cinq dossiers de ses archives regroupent ses poèmes français, sa prose française et les traductions qu'il a faites de ses poèmes anglais. De cette production, seuls trois poèmes ont été publiés : Trois chansons mortes, Aux volets clos de ton rêve épanoui, Le sourire de tes yeux bleus. Les poèmes français de Pessoa, tel Je vous ai trouvé, ressemblent plus souvent à des chansons.
Le portugais deviendra, cependant, la langue de sa grande créativité, la perfection de son anglais donnant en revanche à celui-ci un air factice. Il affirmera avec force ma patrie est la langue portugaise alors même qu'il ne cessera de penser en anglais, passant naturellement d'une langue à l'autre au cours d'un même écrit.
L'échec et la gloire
Sa sensibilité avait été blessée dès l'enfance par la mort de son père, le remariage de sa mère et l'arrachement à son village natal, le quartier du Chiado, au centre de Lisbonne. Pessoa passe toutes ses années de formation, de sept à dix-sept ans, à Durban, où son beau-père est consul du Portugal et où il reçoit une formation entièrement anglaise. À son retour, il se fixe à Lisbonne, qu'il ne quittera plus, et décide de se consacrer à la littérature. Il devra se contenter, pour gagner sa vie, d'emplois subalternes dans plusieurs maisons de commerce.
Il fait ses débuts littéraires en 1912 dans la revue du mouvement de la Renaissance portugaise. Dans ces premières années de la République proclamée en 1910, il partage l'exaltation messianique du poète Teixeira de Pascoaes. Il cherche sa voie du côté du symbolisme. La rencontre du jeune poète Mário de Sá-Carneiro, qui vit à Paris, l'oriente vers l'avant-garde. Le tournant de sa carrière se situe en 1914. L'apparition en lui des hétéronymes marque le début d'une période d'extraordinaire fièvre créatrice : il invente une philosophie, le néo-paganisme , découvre la théosophie et l'occultisme, participe au mouvement futuriste, propose une nouvelle esthétique, fonde des écoles littéraires intersectionnisme , sensationnisme. En 1915, il crée, avec Sá-Carneiro et quelques autres amis, dont Almada Negreiros, une revue d'avant-garde, Orpheu, dont la brève existence inaugure le modernisme portugais.
Le suicide de Sá-Carneiro, en 1916, l'affecte très profondément. Désormais, sans cesser de participer à la vie littéraire, il vit de plus en plus à l'écart, sacrifiant tout à son œuvre, y compris le seul amour qu'on lui connaisse, celui de la jeune Ophelia Queiroz. En près de vingt ans de solitude, Pessoa écrit des milliers de pages, mais il n'aura publié de son vivant que trois plaquettes de vers anglais, dont deux sur des sujets érotiques et, tout à la fin, un recueil épique et mystique, Mensagem, Message, considéré aujourd'hui par les Portugais comme leur grand poème national, au même titre que les Lusiades.
Un prix lui est décerné, en décembre 1934, pour ce livre, par le secrétariat à la propagande du gouvernement Salazar, dont il semble avoir, pendant quelque temps, approuvé l'idéologie. Quelques années plus tôt, il avait été redécouvert par les jeunes poètes de Coimbra réunis autour de la revue Presença. Ce n'est donc pas un inconnu qui meurt à quarante-sept ans, détruit par la boisson. Pessoa laisse une œuvre énorme, mais fragmentaire, dont il n'existe encore aujourd'hui aucune édition critique. C'est au fil des années, puis des décennies, que paraissent, dans le désordre, les ouvrages dont les manuscrits s'entassaient dans un coffre arca devenu légendaire, et que commence à se dessiner l'immense figure du poète qui prend place dans le panthéon national portugais auprès des deux gloires du passé, Vasco de Gama et Camões.
Pessoa avait désiré et prévu cet accomplissement posthume, comme il avait accepté l'échec de sa vie terrestre. Son héros emblématique est dom Sébastien, le roi caché, dont la défaite et la mort au combat, en 1578, ont précipité le déclin du Portugal, mais qui doit réapparaître un jour pour fonder en esprit un empire portugais éternel et universel.
Tout sentir de toutes les manières
On peut répartir les ouvrages de Pessoa en six grands massifs : l'œuvre poétique écrite en portugais sous son propre nom Cancioneiro, Message ; l'œuvre dramatique Le Marin, Faust ; l'œuvre poétique en anglais The Mad Fiddler, Sonnets, Antinoüs, Epithalame ; les fictions de l'interlude , regroupant tous les poèmes des hétéronymes Alberto Caiero, Ricardo Reis et Alvaro de Campos ; le Livro do desassossego Livre de l'intranquillité, journal intime attribué au demi-hétéronyme Bernardo Soares ; enfin l'ensemble des autres écrits en prose récits, essais, articles, presque tous posthumes, la plupart inachevés, qui traitent des sujets les plus variés : littérature, philosophie, théologie, beaux-arts, psychologie, sociologie, politique, économie et même comptabilité. Une place à part peut y être faite au seul récit publié du vivant de l'auteur, le Banquier anarchiste, dont l'humour tranche sur la tonalité tragique de l'ensemble de l'œuvre.
L'expérience fondamentale de Pessoa, c'est celle de l'excès de conscience de soi, qui lui donne le sentiment d'une totale irréalité de soi-même et du monde. Plus je vois clair en moi, plus obscur est ce que je vois, dit son Faust, qui éprouve à la fois la douleur d'être lui-même et « l'horreur métaphysique de l'Autre. La poésie élégiaque que Pessoa signe de son nom est la plainte d'une conscience privée d'être, qui s'analyse au lieu de sentir et qui feint l'émotion qu'elle ne ressent pas, ou même celle qu'elle ressent trop confusément pour pouvoir l'exprimer. Cette poésie est un lyrisme critique. Pessoa est le poète de l'ère du soupçon. Il a la nostalgie d'une culture primitive, antérieure au platonisme et au christianisme, où il était possible à l'homme de vivre en relation immédiate avec la nature. C'est pour retrouver cette innocence qu'il devient Alberto Caeiro, puis Ricardo Reis. Sous ces identités différentes, il fait l'expérience d'une autre forme de la condition humaine, où le critère de la vérité n'est plus intellectuel mais sensoriel, sensuel. Au lieu de postuler une valeur transcendante, le poète païen reconnaît dans la diversité des choses la présence concrète et plurielle des dieux, dont le philosophe du néo-paganisme, Antonio Mora encore un hétéronyme annonce le retour. Dans le Gardeur de troupeaux, Alberto Caeiro célèbre ses noces avec la terre : il refuse de penser le monde ; il se borne à constater son existence, pour s'en émerveiller. Ricardo Reis, dans ses Odes horatiennes, exprime la sérénité d'une conscience qui accepte sa condition mortelle et choisit de jouir de l'instant fugitif. Le troisième grand hétéronyme, Álvaro de Campos, choisit la voie dionysiaque. Il s'abandonne à la violence des sensations et des sentiments, jusqu'à éprouver le vertige du sacré. Disciple de Walt Whitman, il est le poète des grands espaces sauvages, mais aussi de la civilisation urbaine industrielle. Il crie l'intensité de son désir dans d'immenses Odes plus de mille vers pour la seule Ode maritime, dont l'éloquence délirante contraste avec la retenue de Caeiro et de Reis.
Pessoa va se débarrasser assez vite des deux premiers poètes païens. Il garde auprès de lui Campos, qui sera de plus en plus son double ; mais c'est un Campos différent. Sa soif de vivre ne peut pas être étanchée ; elle n'est pas à la mesure du réel. Il se fait le chantre de son propre échec et de l'échec humain en général. Si l'auteur orthonyme est le plus harmonieux des poètes de la constellation Pessoa, Caeiro le plus sobre, Reis le plus artiste, le jeune Campos le plus puissant, le Campos des dernières années en est le plus pathétique et le plus ironique. Dans ses poèmes en vers libres, dont le plus célèbre est Bureau de tabac, il met son cœur à nu comme jamais Pessoa « lui-même » n'aurait osé le faire. Insomniaque, alcoolique, angoissé mais cynique, il n'attend plus rien de son existence injustifiable, sinon le sommeil qui procure les rêves, ou alors cette forme d'éveil qu'est peut-être la mort.
Alberto Caeiro
C'est l'un des trois principaux personnages dans lesquels Fernando Pessoa s'est dédoublé. D'après les précisions de Pessoa lui-même, il ne s'agit pas d'un pseudonyme mais d'un hétéronyme, une création véritable tout à fait indépendante de son auteur, douée de sentiments particuliers et même d'un style propre. Il a été considéré comme un maître non seulement par Pessoa, mais aussi par les deux autres hétéronymes majeurs : Ricardo Reis et Álvaro de Campos. Il énonce dans ses poèmes des préceptes qui permettent de vivre sans angoisse, comme une plante, et de mourir sans panique, naturellement, comme le jour se meurt. Caeiro apparaît, en effet, comme une sorte de grande mère, Álvaro de Campos l'appelle dans un de ses poèmes : présence humaine de la terre maternelle, le giron où Pessoa et ses autres se cachent pour échapper à la mort en apprenant, par un certain mimétisme avec les bêtes et les plantes, à entrer pour toujours dans le cycle de la sève. Caeiro est tout le contraire de Pessoa, qui l'a justement créé pour qu'il lui apprenne à prendre le réel tel qu'il est, une présence qui finit en elle-même et ne renvoie à aucune absence. C'est pourquoi il privilégie le sens de la vue, il veut apprendre à ses disciples la sagesse de voir au détriment de la pensée. En écrivant sa biographie, Pessoa l'a conçue comme celle d'un autodidacte vivant à la campagne, une sorte de guérisseur avec lequel il voulait apprendre la santé d'exister des arbres et des plantes. Les poèmes-monologues de Caeiro ont été réunis après la mort de Pessoa dans un seul volume intitulé simplement Poèmes.
Álvaro de Campos
C'est l'hétéronyme le plus fécond de Fernando Pessoa. Tandis que Ricardo Reis et Alberto Caeiro ont été créés pour apprendre à leur auteur une certaine sérénité devant la vie et la mort, Campos feint la douleur que Pessoa réellement ressent. Ainsi, dans la présentation que Pessoa fait de lui, on voit que Campos est le portrait non seulement physique mais aussi moral de son auteur, qui exprime à travers ce personnage sa profonde inquiétude, son incapacité de trouver le chemin qui mène vers la vie. Le culte du paradoxe, si caractéristique de Pessoa – la seule façon pour lui d'approcher la vérité –, prend avec Campos une expression dramatique ; il y a, en effet, deux Campos : un personnage turbulent, provocateur, qui doit un peu au futurisme, et son contraire, un personnage nocturne, tourné vers l'intérieur de lui-même, penché vers le puits qu'il se sent être. Pessoa s'exprime, en prose et en vers, au nom de Campos tout au long de sa vie. Sous ce masque, il fait en quelque sorte son journal de voyage, celui de l'éternel voyageur, une valise à la main, tel que son compagnon de route Almada Negreiros l'a représenté. Pour Campos et pour Pessoa, tout est voyage : sensations Sentir, c'est voyager, aventure esthétique, Je n'évolue pas, je voyage , la vie même, Nous sommes tous nés à bord. Les poèmes d'Álvaro de Campos ont été réunis après la mort de Pessoa dans un volume intitulé Poésies et publié, ainsi que les poèmes des autres hétéronymes et de Pessoa lui-même, par l'éditeur Ática Lisbonne. Ses autres textes sont dispersés dans les recueils de prose de Fernando Pessoa.
Ricardo Reis
C'est le troisième hétéronyme du poète. Son créateur le fait naître à Porto en 1887 et élever dans un collège de Jésuites, où il devient un fervent latiniste. Brun, mat, petit et sec, il se réfugie, comme son modèle Horace, dans une sagesse épicurienne et des Odes qui laissent percer l'angoisse de la mort. Il est probablement le plus énigmatique des hétéronymes, ce qui lui valut de devenir le personnage d'un roman de José Saramago, l'Année de la mort de Ricardo Reis 1984. La postérité de Fernando Pessoa semble ainsi s'affirmer prodigue, et autonom
La vie est un songe
Rêver sa vie, à défaut de pouvoir vivre ses rêves : tel est le parti que prend Bernardo Soares. Petit employé perdu dans la foule anonyme, il domine pourtant le monde de toute la hauteur majestueuse de ses rêves. Dans son recueil de poèmes de jeunesse écrits en anglais, The Mad Fiddler, Pessoa affirmait que seul le rêve est vrai. Naufragé du réel, Soares veut bâtir sa demeure dans l'imaginaire. Il voyage abstraitement, sans sortir de sa chambre, comme Des Esseintes. Puisqu'il n'est pas possible d'atteindre le réel pour en exprimer la beauté, l'art consiste à exprimer la beauté de cette impossibilité même d'en exprimer la beauté.
Écrit dans une prose somptueuse, le Livre de l'intranquillité, révélé au public près d'un demi-siècle après sa mort, est sans doute l'ouvrage où Pessoa accomplit le plus parfaitement son projet paradoxal : vivre l'impossibilité de vivre. Mais le poète orthonyme, Pessoa lui-même, à certains moments, est allé encore beaucoup plus loin dans le refus du monde visible. À la devise que Soares emprunte à Calderón, la vie est un songe, répond, chez le Pessoa occultiste, celle qui s'inspire de la foi gnostique : il n'y a pas de mort. La vie est une forme de mort. C'est ce que nous appelons la mort qui est la vraie vie absente. Passionné par l'alchimie et la magie, pratiquant lui-même l'astrologie, héritier de la tradition secrète du christianisme, issue de la cabale juive et du spiritualisme néo-platonicien, qui affleure, au cours des siècles, dans l'ordre du Temple, la fraternité Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, le poète initié décrit, dans Message et dans certains des poèmes lyriques du Cancioneiro, un univers dans lequel le mythe est la réalité absolue, l'échec la valeur suprême et l'absence l'attribut essentiel de Dieu. Il se voit lui-même sous l'apparence du moine-chevalier du Moyen Âge, appelé à poursuivre toute sa vie une quête sans objet, vers des plaines sans horizon.
Écrivain posthume
Les cendres de Fernando Pessoa, monument de la littérature, ont été transférées en 1988 pour le centenaire de sa naissance au Monastère des Hiéronymites à une centaine de pas de Camoens et Gama.
De son vivant, Fernando Pessoa a régulièrement écrit dans des revues littéraires portugaises dont celles qu'il a créées. En outre, il a fait paraître en anglais deux ouvrages mais sa mort prématurée ne lui a laissé le temps de publier qu'un seul livre en portugais, qui eut toutefois un succès retentissant : le recueil de poèmes Message, en 1934.
Le livre de la malle
À sa mort, on découvrit, enfouis dans une malle, 27 543 textes que l'on a exhumés peu à peu. Le Livre de l'intranquillité n'a été publié qu'en 1982 et son Faust en 1988. Tous ces manuscrits se trouvent depuis 1979 à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne.
Son apport à la langue portugaise a été comparé au cours de l'hommage national officiel rendu le jour anniversaire de sa naissance, en 1988, à celui de Luís de Camões.
Le nom ou l'image-symbole de Fernando Pessoa ont été donnés à de nombreuses institutions portugaises. Depuis 1996, il existe une Université Fernando Pessoa à Porto.
Œuvres
Fiction
Alexander Search, Un souper très singuliernote 34 inédit en langue originale nouvelle gothique écrite en 1907 en anglais d'environ 60 pp.
Tsarkresko, in M.L. Machado de Sousa, O Horror na Literatura Portuguesa, Instituto de Cultura Portuguesa, Lisbonne, 1989 conte gothique en anglais.
Le vainqueur du temps, inachevé, in Textos Filosóficos, vol. II, Ática, Lisbonne, 1968 conte métaphysique.
Bernardo Soares, Le Livre de l'intranquillité, Ática, Lisbonne, 1982 journal aphoristique.
Fables pour les jeunes nations, Pessoa Inédito, pp. 266-270, Livros Horizonte, Lisbonne, 1993
cinq fablesnote 35 auxquelles s'ajoute Soie rose, parue in Le Journal nº1, Lisbonne, 4 avril 1915.
Le Pèlerin, Mealibra nº 23, Centro Cultural do Alto Minho, Viana do Castelo Portugal, 2009 nouvelle d'environ 88 pp.
Le Banquier anarchiste, Contemporânea, Lisbonne, 1922 pamphlet social.
Marcos Alves, inachevé, in T.R. Lopes, Pessoa por Conhecer - Textos para um Novo Mapa, Estampa, Lisbonne, 1990 portrait psychologique.
Quaresma, déchiffreur, Assírio & Alvim, Lisbonne, 2008, 477 pages nouvelles policières.
Essais en portugais Attribués à des hétéronymes
Fernand Pessoa en flagrant délitre vers 1928.
Álvaro de Campos, Ultimatum, Portugal Futurista no 1, Lisbonne, 1917.
Álvaro de Campos, Notes en mémoire de mon maître Caeiro, in Textos de Crítica e de Intervenção, Ática, Lisboa, 1980 étude littéraire posthume rassemblant autour d'articles publiés du vivant de l'auteur sous ce titre des manuscrits portant sur le même sujet.
António Mora, Introduction à l'étude de la métaphysique, titre prévu par l'auteur d'un essai dont divers manuscrits écrits sous divers hétéronymes à différentes époques font la substance, in Textos Filosóficos, vol. I & II, Ática, Lisbonne, 1968.
António Mora, La morale, titre prévu par l'auteur d'un essai dont la substance morale de la Force, morale de la Domination de soi, morale de l'Idéal, l'Humilité, l'Ascétisme a été retrouvé dans divers manuscrits, in Textos Filosóficos, vol. I, p. 226, Ática, Lisbonne, 1968.
António Mora, Le retour des dieux, inachevé, in G.R. Lind & J. do Prado Coelho, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, Ática, Lisbonne, 1996 apologie d'un retour à une religion polythéiste.
Bernardo Soares ou baron de Teive, L'éducation du stoïcien, Assirio & Alvim, Lisbonne, 1999 essai sur le suicide.
Attribués à Fernando Pessoa
Chronique de la vie qui passe in M.I. Rocheta & M.P. Morão, Ultimatum e Páginas de Sociologia Política, Ática, Lisbonne, 1980
recueil des articles parus dans cette rubrique du Journal en 1915.
Erostratus in Páginas de Estética e de Teoria Literárias, Ática, Lisbonne, 1966 essai sur la création littéraire.
Recueil de critiques d'économie politique parus dans la presse, Páginas de Pensamento Político, vol. II, Publicações Europa-América, Mem Martins Portugal, 1986.
Lisbonne: ce que le touriste doit voir, Livros Horizonte, Lisbonne, 1992.
Le Paganisme Supérieur, titre prévu par l'auteur99 d'un recueil d'articles ésotériques et métaphysiques parus dans diverses publications posthumes.
Théorie de la République aristocratique, titre prévu par l'auteur100 d'un essai dont des articles parus de son vivant dans des journaux et des manuscrits de nature sociologique et politique parus dans diverses collections posthumes font la substance.
De la dictature à la république, inachevé, in M.I. Rocheta & M.P. Mourão, Da República 1910 - 1935, Ática, Lisbonne, 1979, histoire politique du Portugal moderne.
Le sens du sidonisme, inachevé, in M.I. Rocheta & M.P. Mourão, Da República 1910 - 1935, Ática, Lisbonne, 1979.
Le préjugé des révolutionnaires, inachevé, in M.I. Rocheta & M.P. Mourão, Ultimatum e Páginas de Sociologia Política, Ática, Lisbonne, 1980.
Cinq dialogues sur la tyrannie, inachevé, in M.I. Rocheta & M.P. Morão, Ultimatum e Páginas de Sociologia Política, Ática, Lisbonne, 1980 défense de la liberté individuelle et dénonciation de la dictature.
Commerce et civilisation, traduit du portugais par Simone Biberfeld et Parcidio Gonçalves, Éditions de la Différence, Paris, 2012
Poésie portugaise De Fernando Pessoa, orthonyme
Message, 1ª ed., 1934, troisième et dernier recueil de Pessoa publié de son vivant après ceux parus en anglais en 1918 et en 1921 hormis son manifeste Ultimatum, les poèmes de la revue Athéna, les textes parus dans Orpheu et Contemporânea, ainsi que ses nombreux articles...
Message, Império, Lisbonne, 1934.
Rubaiyat, trente deux quatrains.
Cancioneiro, titre prévu par l'auteur du recueil paru épars en éditions posthumes
Poésies, Ática, Lisbonne, 1942 reprend en sus les poèmes parus en revue du vivant de l'auteur.
Poésies inédites, Ática, Lisbonne, 1956.
Œuvre poètique, José Aguilar, Rio de Janeiro, 1960.
Nouvelles poésies inédites, Ática, Lisbonne, 1973.
Œuvre poétique et en prose, vol. I, Lello, Porto, 1986.
Patésnote 36 d'un goût populaire, Ática, Lisbonne, 1965.
Pessoa inédit, Livros Horizonte, Lisbonne, 1993 poèmes satiriques.
D'Alberto Caeiro, hétéronyme
Le Gardeur de troupeaux in João Gaspar Simões & Luís de Montalvor, Poemas de Alberto Caeiro, Ática, Lisbonne, 1946.
Le Berger amoureux in João Gaspar Simões & Luís de Montalvor, Poemas de Alberto Caeiro, Ática, Lisbonne, 1946.
Autres poèmes et fragments, titre prévu par l'auteur de poèmes parus en éditions posthumes
Fragments in T. Sobral Cunha, Pessoa por conhecer - Textos para um novo mapa, Estampa, Lisbonne, 1990.
Poèmes inconnus in T. Sobral Cunha, Poemas Completos de Alberto Caeiro, Presença, Lisbonne, 1994
Certains étaient parus dans Athena, Presença ou l'édition de 1946
D'António Mora, pseudonyme d'Alberto Caeiro
Le Retour des Dieux, titre prévu par l'auteur de poèmes néopaïens parus dans diverses publications posthumes.
De Ricardo Reis, hétéronyme
Livre premier, Presença no 1, Lisbonne, 1924
Odes, Ática, Lisbonne, 1946.
Poèmes, INMC, Lisbonne, 1994.
D'Alvaro de Campos, hétéronyme
Opiacé, Orpheu no 1, Lisbonne, 1er trimestre 1915.
Ode triomphale, Orpheu no 1, Lisbonne, 1er trimestre 1915.
Ode maritime, Orpheu no 2, Lisbonne, 2e trimestre 1915. Réédition France : Ode maritime et autres poèmes, traduit du portugais par Dominique Touti et Michel Chandeigne, présenté par Claude Michel Cluny, éd. bilingue, Éditions de la Différence, coll. Orphée, Paris, 1990.
Poésies d'Álvaro de Campos, Ática, Lisbonne, 1944.
Livre de vers, Estampa, Lisbonne, 1993.
Poésie des autres hétéronymes lusophones
in T.R. Lopes, Pessoa por Conhecer - Textos para um Novo Mapa, Estampa, Lisbonne, 1990.
Théâtre
Le point central de ma personnalité, en tant qu’artiste, c’est que je suis un poète dramatique
— Pessoa s'expliquant dans une lettre à un jeune universitaire.
Le marin, drame statique en un tableau, Orpheu no 1, Lisbonne, 1er trimestre 1915.
L"heure du Diable, Rolim, Lisbonne, 1988.
Un soir à Lima, inachevé.
Fragments
Dialogue à l'ombre in A. de Pina Coelho, Textos filosóficos vol. I - Fernando Pessoa, Ática, Lisbonne, 1968.
Mort du Prince in T.R. Lopes, Fernando Pessoa et le drame Symboliste, Fondation Calouste Gulbenkian, Paris, 1977..
Salomé in T.R. Lopes, Fernando Pessoa et le drame Symboliste, Fondation Calouste Gulbenkian, Paris, 1977.
Dialogue dans le jardin du Palais in T.R. Lopes, Fernando Pessoa et le drame Symboliste, Fondation Calouste Gulbenkian, Paris, 1977.
Sakyamuni fragments in T.R. Lopes, Fernando Pessoa et le drame Symboliste, Fondation Calouste Gulbenkian, Paris, 1977.
Tragédie subjective en cinq actes, inachevée, publiée sous le titre Faust Presença, Barcarena, 1988.
The Duke of Parm, tragedy, inédit.
Poésie anglaise
117 poèmes signés Alexander Search, Poesia Inglesa, Livros Horizonte, Lisbonne, 1995, devant composés
Delirium106
Agony106
Poésie signée Charles Robert Anon, pseudonyme d'Alexander Search, Pessoa Inédito, Livros Horizonte, Lisbonne, 1993, dont le poème
Meantime, publié dans l’Athenaeum, Londres, 30 janvier 1920.
Poésie inédite signée Thomas Crosse.
Le violoneux foun, INCM, Lisbonne, 1993, 1er pub. non critique Presença, Lisbonne, 1988.
Antinoüs, Monteiro, Lisbonne, 1918 .
35 Sonnets, Monteiro, Lisbonne, 1918.
Poèmes anglais I & II Antinoüs & Inscriptions, Olisipo, Lisbonne, 1921.
Poèmes anglais III Epithalamium, Olisipo, Lisbonne, 1921.
Deux poèmes anglais de Fernando Pessoa sur la Première Guerre mondiale in Ocidente nº 405, Lisbonne, janvier 1972.
Huit poèmes anglais inédits in G.R. Lind107, Estudos sobre Fernando Pessoa, INCM, Lisbonne, 1981.
30 poèmes non hétéronymiques, certains fragmentaires, écrits entre 1911 et 19357, Pessoa Inédito, Livros Horizonte, Lisbonne, 1993.
Essais en anglais
EPITAPH
Here lies who thought himself the best
Of poets in the world's extent;
In life he had not joy nor rest.
Alexander Search, 1907.
Œuvres de jeunesse inachevées signées Alexander Search
The portuguese regicide and the politicical situation in Portugal.
The philosphy of rationalism.
The mental disorder of Jesus
Selected Poems by Jonathan Griffin - Penguin Poetry
Fragments destinés à une publication portugaise
Le temple de Janus in Pessoa Inédito, Livros Horizonte, Lisbonne, 1993.
Le reste de la prose anglaise de Pessoa ou ses hétéronymes anglais n'est pas organisé correspondance, notes diverses, brouillons...
Œuvres traduites en français
Notes en souvenir de mon maître Caeiro
Chronique de la vie qui passe œuvres en prose en dehors du Livre de l'intranquillité
Ode maritime et autres poèmes 1915
Le Gardeur de troupeaux et les autres poèmes d'Alberto Caeiro avec Poésies d'Alvaro de Campos 1914
Erostratus Erostrate
Lisbonne
Le Marin
Bureau de tabac, traduit par Adolfo Casais Monteiro et Pierre Hourcade, ed. bilingue,éditions Inquérito Limitada, 1952.
Ode Maritime, préface et traduction d'Armand Guibert, éditions Seghers
Bureau de tabac et autres poèmes, préface et traduction d'Armand Guibert, éditions Caractères, 1955.
Le Gardeur de troupeaux et les autres poèmes d'Alberto Caeiro, traduit par Armand Guibert, Éditions Gallimard, collection blanche, 1960, 224 p.
Visage avec masques, poèmes des principaux hétéronymes, traduits et présentés par Armand Guibert, Alfred Eibel éditeur, Lausanne,1978, , 228 p.
Antinoüs, préfacé et traduit par Armand Guibert, éditions Fata Morgana, collection Dioscures, 1979, 64 p.
Le Gardeur de troupeaux, traduit par Rémy Hourcade et Jean-Louis Giovannoni, 1986. E.O Éditions Unes
L'Ode triomphale & douze poèmes de la fin d'Alvaro de Campos, traduits par Rémy Hourcade et Emmanuel Hocquard, éditions Royaumont, 1986, non paginé.
Cent cinquante-quatre quatrains, traduit et préfacé par Henry Deluy, 1986 Éditions Unes
Le Livre de l'inquiétude, traduit et préfacé par Inês Oseki-Dépré, 1987. E.O Éditions Unes
Le Gardeur de troupeaux et autres poèmes, présentés et traduits par Armand Guibert, Poésie/Gallimard, 1987
Alvaros de Campos, choix de poèmes traduits par Rémy Hourcade et Emmanuel Hocquard, éditions Royaumont, 1988, 64
Quatrains complets, traduit et préfacé par Henry Deluy, 1988. E.O Éditions Unes
Bureau de tabac, préface de Adolfo Casais Monteiro 1952 et postface de Pierre Hourcade 1975, traduit par Rémy Hourcade, 1993 - édition définitive
Ultimatum, 1993 - traduit par Michel Chandeigne et Jean-François Vargas E.O Éditions Unes
Opium à bord, traduit et préfacé par Armand Guibert, 1993 - nouvelle édition Éditions Unes
Sur les hétéronymes, traduit et préfacé par Rémy Hourcade, 1993 - édition définitive Éditions Unes
Quaresma, déchiffreur, 2010
Histoires d'un raisonneur, traduit de l’anglais par Christine Laferrière et du portugais par Michelle Giudicelli, 2014 Christian Bourgois
Publiés dans la collection Pléiade Gallimard, sous le titre Œuvres poétiques, préface par Robert Bréchon, traduction, notices et notes de Patrick Quillier.
Correspondance
Fernando Pessoa, José Blanco, Pessoa en personne, Paris, La Différence, 1986, rééd. coll. "Minos", 2003.
Correspondance avec Ofélia Queiroz, Cartas de Amor, Ática, Lisbonne, 1978.
Correspondance avec Armando Cortes Rodrigues, Cartas de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues, Confluência, Lisbonne, 1944.
Correspondance avec João Gaspar Simões, Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, Europa-América, Lisbonne, 1957.
Correspondance diverse in Escritos Íntimos, Cartas e Páginas Autobiográficas, Europa-América, Mem Martins Portugal, 1986 & in Pessoa Inédito, Livros Horizonte, Lisbonne, 1993.
Œuvres inspirées de Pessoa
Musique
Bévinda : Pessoa em pessoas Celluloïd, 1997
Jean-Marie Machado : Leve leve muito leve - Rêves et déambulations d'après Fernando Pessoa Éditions Hortus, 2003
Mariza : Do vale a montanha, poème de 1932 dans Mensagem chanté sous le titre de Cavaleiro monge dans Fado curvo 2003
Films
Jean Lefaux : Pessoa l'inquiéteur Zaradoc, 1990 sur le site de Zaradoc
Benoît Laure : L'ami poète 2004 Film d'animation imaginant une rencontre poétique entre le poète portugais Fernando Pessoa et l'Argentin Jorge Luis Borges.
Liens
http://youtu.be/KUcZaBoOuyQ Poésie
http://youtu.be/zZoxPhi6rHs poésie
http://youtu.be/MMQ7eCpnp-E Phrases de Pessoa
http://www.ina.fr/video/I08046725/a-propos-de-pessoa-video.html a propos de Pessoa
http://www.ina.fr/video/CPC98003344/poemes-video.html I livre I jour, de Pessoa
          
Posté le : 29/11/2014 21:38
|
|
|
|
|
Armande Béjart 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 30 novembre 1700, Armande-Grésinde-Claire-Élisabeth Béjart meurt ,
à Paris, comédienne française, née entre 1640 et 1642, et morte à Paris le 30 novembre 1700.
Sa vie
Armande est née dans la famille Béjart, célèbre famille de comédiens du XVIIe siècle.
D'après l'acte de mariage de Molière et d'Armande Béjart, Armande serait fille de Joseph Béjart 1585-1641 et de son épouse Marie Hervé 1593-1670. Elle serait née entre 1640 et juin 1642.
Des rumeurs ont couru sur sa naissance. Madeleine Béjart 1618-1672, fille de Joseph Béjart et Marie-Hervé, et donc officiellement sa sœur aînée, avec environ 24 ans de différence, serait en réalité sa mère. Cette thèse est soutenue par le biographe de Molière Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest 1659-1713. De plus, comme Madeleine avait été la maîtresse de Molière, des contemporains, comme le comédien Montfleury, ont jugé qu'il pouvait être le père d'Armande.
Concernant l'hypothèse selon laquelle Madeleine serait la mère d'Armande, le fait que les parents officiels avaient respectivement 56 ou 57 ans et 48 ou 49 ans à la naissance d'Armande, un âge avancé pour cette époque, que la fille d'Armande et de Molière fut appelée Esprit-Madeleine du nom de ses parrain et marraine, qui étaient au XVIIe siècle presque toujours les grands-parents, que Madeleine Béjart fit d'Armande sa légataire universelle, alors que vivait une autre sœur elle aussi membre de la troupe de Molière et que le comédien Montfleury accusa Molière d'avoir épousé la fille et d'avoir autrefois couché avec la mère, tous ces éléments pourraient conforter l'information donnée par Grimarest, généralement très peu fiable, mais qui déclare tenir ses renseignements d'Esprit-Madeleine elle-même.
D'après Roger Duchêne, auteur de Molière 1998, l'hypothèse d'une filiation entre Madeleine et Armande est possible, mais pas avérée. Si l'on s'en tient aux seuls documents officiels parvenus à notre connaissance, Armande est bien la fille de Joseph Béjart 1585-1641 et de son épouse Marie Hervé 1593-1670. C'est ce qu'indiquent l'acte de mariage de Molière et Armande, ainsi que leur contrat de Mariage, signé par Marie Hervé, en qualité de mère d'Armande et par Madeleine en qualité de sœur d'Armande. Par ailleurs, le récit de Grimarest présente plusieurs erreurs majeures. Il avance qu'Armande est fille de Madeleine et du comte Esprit Rémond de Modène, avec qui elle aurait contracté un mariage secret. Or, Rémond de Modène était déjà marié à cette époque. De plus, la fille qu'il a eue avec Madeleine Béjart, alors sa maîtresse, s'appelait Françoise, née en 1638. Autre invraisemblance, Grimarest parle d'un mariage secret entre Molière et Armande, ce que contredit l'acte de mariage. De plus, un tel mariage clandestin avec Armande, sans le consentement de la famille, aurait mis Molière sous la menace d'une accusation de rapt. Le récit de Grimarest peut donc difficilement être retenu comme plausible. À propos de l'âge de Marie Hervé au moment de la naissance d'Armande à peu près 48 ans, Roger Duchêne souligne que si la ménopause était plus précoce à l'époque, une telle naissance tardive n'était toutefois pas impossible. Il situe celle d'Armande entre 1640 et 1642, Marie Hervé ayant eu une autre fille en 1639 Bénigne, enfant mort-née et son époux Joseph étant mort en 1641. Quant à l'accusation de Montfleury selon laquelle Madeleine et Molière seraient les parents d'Armande, elle ne fut pas retenue par la cour et par le roi Louis XIV. Ces allégations graves sur un mariage incestueux entre Molière et Armande, peuvent peut-être s'expliquer par le désir de Montfleury, membre d'une autre troupe, de faire du tort à son rival. Le choix d'Esprit Rémond de Modène et Madeleine Béjart comme parrain et marraine d'Esprit-Madeleine, fille d'Armande et Molière, peut aussi suggérer une filiation secrète entre Madeleine et Armande. Mais pour Roger Duchêne, cette volonté de mettre en avant le comte de Modène auprès de Madeleine dans cette cérémonie est peut-être une façon de déjouer les accusations d'inceste dont Molière faisait l'objet. Enfin, le fait que Madeleine, dans son testament, favorise nettement Armande et sa descendance peut bien sûr donner à penser qu'elle était bien sa mère. Au vu de tous ces éléments, Roger Duchêne laisse toutefois la question en suspens.
Épouse de Molière et actrice
Élevée dans le giron de la troupe des Béjart et de Molière, elle l'épouse celui-ci le 20 février 1662, âgée de vingt ans ou environ. Elle figure dans la liste des comédiens dès le début de la nouvelle saison théâtrale suivante printemps 1662 sous le nom de scène de Mlle Molière, mais elle attend un an pour tenir un rôle important, en juin 1663, dans La Critique de l'École des femmes, puis en octobre suivant dans L'Impromptu de Versailles. En 1664, elle reçoit le premier rôle, celui de la princesse, dans La Princesse d'Elide de Molière10. Elle succède dès lors à Madeleine Béjart dans les premiers rôles féminins, aux côtés de Catherine de Brie, dans quasiment toutes les pièces de Molière, ainsi que dans les pièces d'autres auteurs créés sur la scène du Palais-Royal, d'Alexandre le Grand 1665 de Racine, à Attila 1667 et Tite et Bérénice 1670 de Corneille.
Contrat de mariage entre Molière et Armande Béjart, 23 Janvier 1662.
À partir de 1667, les relations avec son mari commencent à se dégrader. À cette époque Molière est probablement dans la situation d'un mari trompé par sa femme avec notamment le comédien Michel Baron.
Après la mort de Molière en 1673 et le départ de plusieurs acteurs qui passent dans la troupe rivale de l'Hôtel de Bourgogne durant le relâche de Pâques, le comédien La Grange ancien bras droit de Molière et elle obtiennent de réunir les restes de leur troupe avec les acteurs du Marais définitivement fermée par ordre royal. Privée de sa salle du Palais-Royal attribuée par le roi à Lully pour ses spectacles d'opéra, la Troupe du Roi ainsi reconstituée loue la salle de l'hôtel Guénégaud le 23 mai 1673. Ainsi, le 9 juillet 1673, la troupe du roi en son hôtel de la rue Guénégaud ouvre la nouvelle saison avec Tartuffe puis joue le répertoire de Molière. Armande figure la première dans la liste des comédiennes.
Le 31 mai 1677, elle épousa en secondes noces le comédien Guérin d'Estriché, membre de la même Troupe du Roi à l'Hôtel Guénégaud. Ils eurent un fils unique, Nicolas Guérin, qui s'essaya au théâtre, en réécrivant et complétant une comédie que Molière avait laissée inachevée Mélicerte sous le titre Myrtil et Mélicerte, une pastorale héroïque en trois actes, mais qui mourut en 1708 à l’âge de trente ans.
En 1676, trois ans après le décès de son premier époux, Armande acquiert à Meudon et pour 5400 livres, une maison qui avait été auparavant celle du chirurgien Ambroise Paré dès 1550. Elle y séjourna principalement, avec son second mari. Cette demeure est devenue le musée d'art et d'histoire de la ville.
Sociétaire de la Comédie-Française dès sa création, en août 1680, – ce fut le résultat de la fusion de la Troupe du Roi théâtre Guénégaud à laquelle elle appartenait et de la Troupe Royale de l'Hôtel de Bourgogne – elle prit sa retraite le 14 octobre 1694 avec une pension de 1 000 livres. Elle meurt en 1700.
Armande et la troupe de l'illustre théâtre
Molière avait près de quarante ans, l’âge où le célibat et la solitude deviennent pénibles. Il était las des amours banales ; la fortune et le succès commençaient à lui sourire, mais son triple métier pesait sur lui d’un poids de plus en plus lourd. Il en vint, naturellement, à examiner pour son compte l’embarrassante question que soulève le Panurge de Rabelais et que lui-même devait porter à la scène dans le Mariage forcé, c’est-à-dire à se demander pourquoi il n’associerait pas à son existence une jeune femme qui en serait la joie et le délassement. Sans doute, c’était là une expérience dangereuse à tenter ; et l’impitoyable railleur des maris trompés ne pouvait méconnaître cette vérité d’expérience qu’à la jeunesse il faut unir la jeunesse. Mais on a beau savoir les choses et la vie, on rêve toujours des exceptions pour soi-même. La gloire qu’il voyait prochaine, le génie dont il avait conscience, ne sauraient-ils compenser, pour un jeune cœur facile à l’enthousiasme, ce que l’âge lui avait enlevé ? Il dut forcément chercher autour de lui. Sa profession et le préjugé qui pesait sur elle restreignaient son choix ; il ne pouvait guère prendre sa femme qu’au théâtre ou dans une famille qui tint au théâtre. Or, depuis dix ans, il voyait grandir près de lui une jeune fille à laquelle il s’était attaché d’abord d’une affection presque paternelle, mais qui, en grandissant, semblait diminuer la distance qui les séparait et venir d’elle-même au-devant de lui. On s’imagine volontiers, en pareil cas, que l’on reste à la même place tandis que les autres marchent ; on voit les enfans devenir de jeunes hommes ou de jeunes filles, et on ne se doute pas que, tout le chemin qu’ils ont fait vers la jeunesse, on l’a fait soi-même vers la vieillesse. Molière s’avisa donc un jour qu’Armande Béjart, sœur de sa camarade et amie Madeleine, pouvait devenir sa femme. Elle avait sans doute pour lui cette affection que les enfans rendent aisément à ceux dont ils se sentent aimés ; ce sentiment n’aurait pas de peine à se changer en amour conjugal. Quant à la jeune fille, elle ne pouvait qu’être flattée de se voir rechercher par le chef de cette troupe à laquelle appartenaient tous les siens et où elle-même devait entrer.
Il paraît peu probable que la première enfance d’Armande Béjart se soit passée sur les grandes routes. Ce que l’on sait de sa culture d’esprit et de ses talens donne à croire qu’elle reçut une autre éducation que celle d’une petite bohémienne. D’après l’auteur de la Fameuse Comédienne, Armande aurait passé sa plus tendre jeunesse dans le Languedoc, chez une dame d’un rang distingué dans la province. Rien n’empêche de tenir le renseignement pour exact. Un biographe de Molière, Petitot, a déterminé de son chef, sans donner, du reste, aucune preuve, dans quelle ville on la laissa ; il veut que ce soit Nîmes, sans doute parce que l’on y a trouvé un des portraits auxquels on applique son nom. Toujours d’après la Fameuse Comédienne, lorsque la troupe, relativement plus stable, eut pris Lyon pour quartier général, en 1653, Armande, alors âgée d’une dizaine d’années, fut retirée de chez la dame d’un rang distingué, et, depuis, elle ne quitta plus sa famille. A Lyon, la troupe joua l’Andromède de Corneille. Un exemplaire de cette tragédie, qui faisait partie de la bibliothèque Soleinne, donne, en face des personnages, une liste manuscrite d’acteurs ; ces noms sont ceux des camarades de Molière, on prétend même y reconnaître l’écriture de celui-ci. Parmi ces noms se trouve celui d’une Mlle Menou, qui faisait la néréide Éphyre, rôle de figuration à peu près muet, car il ne compte pas plus de quatre vers, et, dans cette Mlle Menou, on veut voir la petite Armande Béjart, sous prétexte que c’est là un diminutif de son prénom d’usage. Mais d’abord, Menou supposerait plutôt Germaine qu’Armande. De plus, Éphyre, comme les deux autres néréides de la pièce, ne peut être jouée que par une jeune fille ou une jeune femme, car la seule raison d’être du personnage est de servir à un effet plastique. Enfin, Armande semble n’être montée sur le théâtre qu’après son mariage ; elle ne fait point partie de la troupe de Molière telle que nous la trouvons constituée en 1658, lors de l’arrivée à Paris, et, jamais, lorsqu’elle est devenue comédienne en renom et dont on.parle, il n’est fait allusion au nom prétendu qu’elle aurait autrefois porté.
On retrouve Mlle Menou dans une lettre mêlée de prose et devers écrite par Chapelle à Molière et, malheureusement, non datée. Cette lettre, assez entortillée et obscure, fait allusion aux embarras de tout genre qu’éprouvait Molière au milieu des trois principales actrices de sa troupe ; Chapelle l’y compare à Jupiter tiraillé entre Junon, Minerve et Vénus durant la guerre de Troie. De ces trois actrices, Mlle Menou est la seule nommée ; les deux autres, Mlle du Parc et Mlle de Brie sans doute, se disputent avec elle le cœur de Molière, mais surtout la distribution des rôles. Si Armande est la même personne que Mlle Menou, il faut donc admettre qu’elle était déjà un des premiers sujets de la troupe, et c’est peu vraisemblable, car elle n’avait encore que seize ans. On ne s’expliquerait guère non plus qu’elle eût entièrement disparu de 1658 à 1663, époque où elle parait pour la première fois sur la scène du Palais-Royal. Molière se serait bien gardé de la tenir à l’écart, au moment où sa troupe avait besoin de toutes ses forces pour soutenir de redoutables rivalités et conquérir de haute lutte la faveur publique. L’identité prétendue d’Armande avec cette énigmatique Mlle Menou prête donc à beaucoup d’objections. Le plus sage est de se résigner à ne la voir paraître dans la troupe qu’en 1663, lorsqu’elle est devenue la femme de Molière.
On peut admettre, en revanche, que son influence est profondément marquée dans cette École des maris, dont la première représentation ne précéda son mariage que de quelques mois. Je n’hésite pas à y voir le contre-coup des réflexions de Molière ; réflexions mêlées d’espérance et de crainte. Qu’il y ait peint tout à fait et au juste son état d’esprit, il était trop poète pour cela. Mais est-il possible que, sur le point de tenter l’expérience qui fait le sujet de l’École des maris, il n’ait rien mis de lui-même et de sa fiancée dans deux des héros de sa pièce : cet Ariste qui lui ressemble comme un frère, cette Léonor où l’on retrouve si aisément Armande Béjart ? Ami intime de Madeleine, il avait dû partager avec elle le soin de l’éducation d’Armande, et cette éducation, terminée dans les coulisses d’un théâtre, n’eut sans doute rien de bien austère. De même Ariste a élevé Léonor avec une philosophie très indulgente ; elle a vu « les belles compagnies, les divertissemens, les bals, les comédies ; on lui permet de satisfaire ses goûts d’élégance, de dépenser en habits, linge et nœuds. Il est, ce rôle d’Ariste, plein d’une franchise de brave homme, d’une bonté sereine et douce, avec une pointe de mélancolie ; et les beaux vers qui le composent, d’un tour si net et d’un mouvement si aisé, ont jailli sans effort du cœur du poète, car ils traduisaient l’état de son âme. Enfin, Molière supposait les sentimens d’Armande, ou plutôt il lui indiquait, sous le couvert d’une allusion transparente, ceux qu’il désirait qu’elle eût lorsqu’il montrait Léonor excédée de tous « ces jeunes fous qui la raillent sottement sur l’amour d’un vieillard, et déclarant qu’elle préfère de beaucoup cet amour à tous les beaux transports de leurs jeunes cervelles. Si une jeune fille peut parler ainsi d’un vieillard qui recherche sa main, à plus forte raison peut-elle consentir sans effroi à devenir la femme d’un homme jeune encore, dans la maturité de l’âge. Tout, dans ce rôle de Léonor, par la raison sereine et l’honnêteté virile qu’il respire, laisse voir quel caractère, quelle plénitude de consentement Molière eût souhaité chez celle qu’il allait épouser.
L’École des maris est du 24 juin 1661. Dès le mois d’avril précédent, Molière avait fait part à ses camarades de ses projets de mariage et pris ses mesures comme directeur. Sœur et femme de comédiens, Armande devait naturellement être comédienne ; aussi Molière s’inquiétait-il, au début d’une nouvelle année théâtrale, de lui assurer une place dans la troupe. A la rentrée, La Grange écrivait sur son registre : Avant que de recommencer, après Pâques, au Palais-Royal, M. de Molière demanda deux parts au lieu d’une qu’il avait. La troupe les lui accorda, pour lui ou pour sa femme s’il se mariait. Le contrat de mariage fut signé, le 23 janvier 1662, dans la maison de Marie Hervé, rue Saint-Thomas-du-Louvre. Molière se présentait assisté de son père, Jean Poquelin, et de André Boudet, beau-frère de celui-ci. Marie Hervé, veuve de feu Joseph Béjart, écuyer, sieur de Belleville, stipulait pour sa fille Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart. Les futurs époux adoptaient le régime de la communauté, tout à l’avantage d’Armande. Marie Hervé promettait de donner à sa fille, la veille des épousailles, la somme de 10,000 livres tournois, dont un tiers entrerait dans la communauté et les deux autres tiers demeureraient propres à la future épouse et aux siens de son côté et ligne. On sait ce qu’il faut penser de cette dot, et pourquoi, si elle a vraiment été payée, elle dut venir de Madeleine Béjart ou de Molière lui-même. Celui-ci, de son côté, constituait à sa future 4,000 livres tournois de douaire. Un mois après, le lundi 20 février 1662, le mariage était célébré à Saint-Germain-l’Auxerrois, en présence des mêmes parens, de Madeleine et Louis Béjart, et d’autres, qui ne sont pas désignés nommément et dont la signature no figure pas au bas de l’acte.
A la seule lecture de ces deux pièces, contrat et acte de célébration, tombent les diverses fables imaginées sur le mariage de Molière. La présence de Jean Poquelin et de André Boudet aux deux cérémonies prouve d’abord que l’union projetée ne rencontra pas, dans la famille du poète, les résistances dont on a parlé, ou, s’il y eut des difficultés, qu’elles n’empêchèrent pas un accord final. Quant à l’origine d’Armande, elle est aussi nettement spécifiée que possible : deux fois la jeune femme est dite fille de Joseph Béjart et de Marie Hervé. Or si, alors comme aujourd’hui, les notaires se montraient fort accommodans et inscrivaient de bonne grâce les noms et titres qu’on voulait ; en revanche, pas plus alors qu’aujourd’hui, un mariage ne pouvait être célébré à l’église sans la production de l’acte de baptême des époux. L’âge de Marie Hervé, se donnant, à soixante-sept ans, comme mère d’une fille de vingt, était pour éveiller l’attention, et, certainement, le clergé de Saint-Germain-l’Auxerrois ne se contenta pas d’une simple déclaration verbale. Enfin, rien ne tient moins que cette autre hypothèse d’après laquelle Molière, en raison de l’état civil douteux de sa femme et pour éviter le bruit, se serait marié un mardi gras, jour où les églises sont désertes, à dix heures du soir, en présence de rares témoins, et après dispense de deux bans obtenue par grâce spéciale. D’abord, le 20 février 1622 n’était pas un mardi, mais un lundi, lendemain du premier dimanche de carême ; l’église n’était pas déserte ce jour-là ; il y eut sept autres mariages avec celui de Molière ; ce mariage n’eut pas lieu à dix heures du soir, mais entre neuf et dix heures du matin, car il est le premier inscrit de la série des huit ; quant à la dispense de doux bans, elle était d’usage comme elle l’est encore : on la demandait et on l’accordait couramment. Enfin, les mots et autres, qui suivent la mention des témoins, prouvent que ces derniers n’étaient pas les seuls assistans et permettent de supposer un cortège d’amis aussi nombreux que l’on voudra. Un passage du registre de La Grange donne à croire que le mardi précédent, au sortir d’une représentation en visite chez M. d’Équevilly, Molière avait officiellement annoncé son mariage à ses camarades assemblés. Rencontre piquante : c’était l’École des maris que la troupe donnait ce jour-là. Les encourageantes répliques de Léonor sonnaient encore à son oreille, lorsque au dénoûment pour rire de la comédie, il faisait succéder ce prologue d’une pièce vraie, autrement sérieuse, et qui devait tourner au drame.
Pas plus d’Armande Béjart que de Madeleine, il ne nous reste de portrait peint ou gravé d’une authenticité certaine. En revanche, les portraits écrits ne manquent pas, et ils se complètent les uns par les autres, car ils sont de mains et d’intentions bien différentes. En 1670, dans le Bourgeois gentilhomme, où Armande tenait le rôle de Lucile, Molière la représentait avec une délicatesse de flatterie et un parti-pris d’admiration, qui témoignent, après huit ans de mariage, d’un amour aussi vif et aussi ardent que le premier jour. On se rappelle la situation ; dans une de ces ravissantes scènes de dépit amoureux, souvent reprises par le poète et toujours traitées avec le même bonheur, Cléonte s’excite à la colère contre Lucile : Donne la main à mon dépit, dit-il à son valet Covielle, et soutiens ma résolution contre tous les restes d’amour qui me pourroient parler pour elle. Dis-m’en, je t’en conjure, tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable ; et marque-moi bien, pour m’en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. Rebuté comme son maître et animé contre sa Nicole du même ressentiment, Covielle s’empresse d’obéir et prend très au sérieux son rôle d’aristarque galant : Elle, monsieur, voilà une belle mijaurée, une pimpesouée bien bâtie, pour vous donner de l’amour ! Je ne lui vois rien que de très médiocre et vous trouverez cent personnes qui seront plus dignes de vous. » Il commence donc un portrait tout en laid ; mais à mesure que Covielle relève les défauts de Lucile, Cléonte les transforme en traits de beauté, avec une impatience et une chaleur croissantes : Premièrement, elle a les yeux petits. — Cela, est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins de feu, les plus brillans, les plus perçans du monde, les plus touchans qu’on puisse voir. — Elle a la bouche grande. — Oui, mais on y voit des grâces qu’on ne voit point aux autres bouches ; et celte bouche, en la voyant, inspire des désirs, est la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. — Pour sa taille, elle n’est pas grande. — Non, mais elle est aisée et bien prise. — Elle affecte une nonchalance dans son parler et dans ses actions. — Il est vrai, mais elle a grâce à tout cela, et ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme à s’insinuer dans les cœurs. — Pour de l’esprit…. — Ah ! elle en a, Covielle, du plus fin, du plus délicat. — Sa conversation… — Sa conversation est charmante. — Elle est toujours sérieuse. — Veux-tu de ces enjouemens épanouis, de ces joies toujours ‘ouvertes ? et vois-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos ? — Mais enfin elle est capricieuse autant que personne du monde. — Oui, elle est capricieuse, j’en demeure d’accord ; mais tout sied bien aux belles ; on souffre tout des belles !
C’est un petit chef-d’œuvre que ce dialogue ; chef-d’œuvre d’art et de poésie, de finesse comique et de grâce, de vérité aussi. Pris un à un, les traits d’Armande Béjart étaient défectueux, mais l’ensemble respirait un charme souverain. Vers le milieu du XVIIIe siècle, une comédienne qui l’avait vue encore jeune, Mlle Poisson, disait d’elle, en ayant soin de rappeler que son portrait était dans le Bourgeois gentilhomme : Elle avoit la taille médiocre, mais un air engageant, quoique avec de très petits yeux, une bouche fort grande et fort plate, mais faisant tout avec grâce. Grandval le père s’accorde avec Mlle Poisson : Sans être belle, elle étoit piquante et capable d’inspirer une grande passion. Il n’est pas jusqu’à l’auteur de la Fameuse Comédienne, auquel le même aveu n’échappe, enveloppé de toutes sortes de restrictions. Elle n’avait, dit-il, aucun trait de beauté ; mais il confesse que sa physionomie et ses manières la rendaient très aimable au goût de bien des gens, que, surtout, elle était fort touchante quand elle vouloit plaire. Il nous apprend qu’elle aimait extrêmement la parure, et Mlle Poisson ajoute qu’elle se mettoit dans un goût extraordinaire et d’une manière presque toujours opposée à la mode du temps ; ce qui l’étonné : elle n’a pas vu qu’Armande possédait cet art piquant et rare de s’habiller elle-même, en dehors et en dépit de la mode, et de donner à sa beauté ce ragoût d’étrangeté dont ceux-là mêmes qui le blâment ou le méconnaissent ne peuvent s’empêcher de subir l’effet. Les frères Parfaict rapportent l’avis d’un meilleur juge en ce genre : Personne n’a mieux su se mettre à l’air de son visage par l’arrangement de sa coiffure, et plus noblement par l’ajustement de son habit. Non-seulement elle ne suivait pas servilement la mode, mais elle la corrigeait quelquefois avec une telle sûreté de goût qu’elle la faisait et l’imposait. La toilette des femmes sous Louis XIV était majestueuse, mais un peu lourde ; elle cachait sous des plis trop amples la grâce des formes. Armande réagit avec succès contre ce caractère peu esthétique. Le Mercure galant de 1673 disait : Tous les manteaux de femmes que l’on fait présentement ne sont plus plissés ; ils sont tout unis sur le corps, de manière que la taille paraît plus belle ; ils ont été inventés par Mlle Molière. Est-il téméraire de conclure de ce renseignement qu’Armande avait la taille bien faite ?
La comédienne fut vite hors de pair et fit encore valoir la femme. D’abord, Armande était une Béjart, c’est-à-dire qu’elle avait dans le sang la passion et l’instinct du théâtre. Outre sa beauté, elle y apportait une voix extrêmement jolie, elle chantoit avec un grand goût le français et l’italien, elle dansoit à ravir. Molière, nous apprend de Visé, se vantait de faire jouer jusques à des fagots ; on devine quel maître eut en lui une élève si bien douée et dont le succès lui tenait au cœur autant que le sien propre. L’ampleur et la force manquaient à Armande ; elle ne put donc tenir dans la tragédie que les seconds emplois ; mais, là même, relevant le luxe très grand de ses costumes par le même goût d’originalité hardie qui lui allait si bien à la ville, ou par un tour de fantaisie romanesque, elle obtenait des succès éclatans ; ainsi, dans une Circé où elle charmait les yeux, en habit de magicienne, avec une quantité de cheveux épars. En revanche, elle excellait dans les rôles de femmes coquettes et satiriques, lesquels s’accordaient d’eux-mêmes avec sa nature, et dans ceux d’ingénues, bien qu’elle eût sans doute plus d’efforts à y faire.
Dans ceux-ci elle trouvait un partenaire accompli en la personne de La Grange, le type du parfait amoureux, tel qu’on le voulait alors : tendre avec noblesse, empressé avec respect, d’une simple et grande politesse, comme le Cléonte du Bourgeois gentilhomme, à l’occasion dédaigneux ou hautain, d’une fine ironie ou d’une insolence méprisante, comme le Clitandre des Femmes savantes. Ils se faisaient valoir l’un l’autre et, lorsqu’ils jouaient ensemble, c’était un enchantement. Un anonyme a tracé de ce couple rare un portrait enthousiaste. Ils sont, dit-il, d’un naturel accompli, et lorsqu’une fois on les a vus dans un rôle, on ne peut plus y voir qu’eux ; ils produisent l’illusion complète ; certains de leurs jeux de scène, par leur justesse ou leur force, leur finesse ou leur pathétique, valent les tirades les mieux composées. Jamais, chez eux, de ces oublis de la situation, de ces distractions d’ennui ou de coquetterie qui détournent sur la salle l’attention de l’acteur : « Leur jeu continue encore, lors même que leur rôle est fini ; ils ne sont jamais inutiles sur le théâtre, ils jouent presque aussi bien lorsqu’ils écoutent que lorsqu’ils parlent. Leurs regards ne sont jamais dissipés ; leurs yeux ne parcourent pas les loges ; ils savent que leur salle est remplie, mais ils parlent et agissent comme s’ils ne voyaient que ceux qui ont part à leur rôle et à leur action. Ainsi qu’Armande, La Grange excelle à composer ses costumes, il les porte avec la même élégance. Mais, si tous deux « se mettent parfaitement bien, ils ne pensent plus à leur parure dès qu’ils sont en scène. Le croirait-on, Armande n’y est coquette que dans la mesure où son rôle l’exige : Si Mlle Molière retouche quelquefois à ses cheveux, si elle raccommode ses nœuds ou ses pierreries, ces petites façons cachent une satire judicieuse et naturelle ; elle entre par là dans le ridicule des femmes qu’elle veut jouer. Enfin, elle n’est jamais semblable à elle-même ; elle change à volonté le caractère de sa voix ; elle prend autant de divers tons qu’elle a de rôles différens.
Mais elle excelle surtout dans les ingénues et les grandes coquettes du théâtre de son mari. Mlle Poisson et Grandval s’accordent encore à dire qu’il faisoit ces rôles pour elle et travailloit exprès pour ses talens. Elle parut pour la première fois dans la Critique de l’École des femmes, représentée le 1er juin 1663, c’est-à-dire un an et quatre mois après son mariage : Molière n’avait voulu la laisser débuter qu’après le temps d’études nécessaire, et sûr pour elle du succès. Comment n’eût-elle pas réussi avec l’aimable petit rôle qu’il lui confiait : celui d’Elise ? Il en est peu d’aussi propres à faire valoir une actrice. Élise est une jeune femme sensée, spirituelle et maniant l’ironie avec un sérieux qui en double la force. Sa verve mordante s’exerce aux dépens de tous les ridicules qui défilent devant elle et va jusqu’à la mystification, d’abord avec la précieuse Climène ; puis avec le marquis et le poète Lysidas, celui-ci pédant et pesant, celui-là fat, évaporé, turlupin. Ce premier rôle a si bien fait valoir Armande qu’elle en reçoit un autre du même genre dans l’Impromptu de Versailles, représenté le 14 octobre suivant : Mlle Molière, satirique spirituelle, ainsi l’appelle la distribution. Outre une petite escarmouche avec Molière, en qui elle raille plaisamment le directeur et le mari, elle a toute une scène à part, et des plus brillantes, avec Mlle du Parc, l’autre étoile de la troupe ; elle reprend le malheureux Lysidas, ramené sous son feu. De petites tirades, pas trop longues, sont ménagées pour elle, et Molière, en distribuant ses conseils, lui a fait le même compliment qu’à La Grange et à Mlle du Parc, les deux parfaits comédiens : Pour vous, je n’ai rien à vous dire. L’actrice que sera Mlle Molière se laisse déjà voir avec ses traits essentiels dans ces deux rôles de début ; la femme y est aussi, ce me semble, avec son caractère : bon sens net, mais un peu étroit ; humeur railleuse, par suite un peu méchante ; assez d’esprit ; peu de bonté.
Elle ne joue pas dans le Mariage forcé, qui est du 29 janvier 1664, car le 19 elle a donné un fils à Molière. Il y a cependant pour elle un joli rôle de figuration, dont elle prendra possession après ses relevailles, car on trouve, dans l’inventaire dressé à la mort de Molière, parmi les costumes de sa femme, un habit d’Égyptienne du Mariage forcé, en satin de plusieurs couleurs. La Princesse d’Élide, représentée au mois de mai suivant, est une pièce fade et mal venue, retour malheureux vers le genre noble auquel appartenait Don Garcie de Navarre ; elle ne dut qu’au divertissement dans lequel elle était intercalée de réussir pour un temps. Armande faisait la princesse, une sorte de Diane farouche, ennemie de l’amour, mais qui ne tarde pas à s’humaniser en faveur du prince d’Ithaque, Euryale, un Hippolyte promptement revenu, lui aussi, de son orgueilleuse froideur. Toute la pièce était conçue pour mettre en relief ses diverses qualités, art de la parure, chant, danse ; et Euryale, représenté par La Grange, détaillait en son honneur un portrait qui dut être salué de longs applaudissemens : Elle est adorable en tout temps, il est vrai ; mais ce moment l’a emporté sur tous les autres, et des grâces nouvelles ont redoublé l’éclat de ses beautés. Jamais son visage ne s’est paré de plus vives couleurs ni ses yeux ne se sont armés de traits plus vifs et plus perçans. La douceur de sa voix a voulu se faire paraître dans un air tout charmant qu’elle a daigné chanter, et les sons merveilleux qu’elle formoit passoient jusqu’au fond de mon âme et tenoient tous mes sens dans un ravissement à ne pouvoir en revenir. Elle a fait éclater ensuite une disposition toute divine, et ses pieds amoureux sur l’émail du tendre gazon traçoient d’aimables caractères qui m’enlevoiont hors de moi-même et m’attachoient par des nœuds invincibles aux doux et justes mouvemens dont tout son corps suivoit les mouvemens de l’harmonie.
En paraissant devant la cour avec l’Elmire du Tartufe, Armande aborde un caractère autrement sérieux que les rôles d’aimable fantaisie et de convention romanesque où nous venons de la voir. Cette fois, elle entre en même temps dans la grande comédie et dans les grands emplois. Ce type de la parfaite honnête femme telle que la comprenait Molière, d’une raison si calme et d’un si ferme bon sens, pourrait sembler un peu froid. Molière eut soin d’y mêler un peu de coquetterie, qui, loin d’en altérer le caractère, le rendait encore plus vrai, et aussi le rapprochait davantage des moyens d’Armande. Elmire a, du reste, les goûts de luxe et d’élégance d’Armande elle-même ; ce train de maison, ces robes de princesse, qui excitent les colères de Mme Pernelle, étaient le cadre que Molière avait donné à la beauté de sa femme. Aussi Armande crut-elle pouvoir aborder le rôle avec tous ses avantages : le jour de la première représentation publique, elle s’était parée si magnifiquement que son mari dut lui rappeler qu’elle faisait le personnage d’une honnête femme et l’engager à prendre un costume moins éclatant. Elle tint compte de l’observation, et le public ne s’aperçut en rien de cet incident de coulisses, car le chroniqueur Loret déclare qu’on ne saurait jouer avec plus de naturel qu’elle ne fit. Un an avant que Tartufe parût devant les Parisiens, elle avait incarné la Célimène du Misanthrope, son triomphe, la plus fameuse de ses créations, celle où son empreinte est restée le plus profondément. Célimène est le type de femme le plus original et le plus complet qui soit sorti du génie de Molière ; c’est aussi le plus difficile du répertoire classique. Tentation éternelle des comédiennes, celles qui l’ont abordé s’appellent légion, celles qui ont pu s’en rendre maîtresses forment un groupe d’élite, admiré, envié : telle actrice de génie, comme Rachel, y échoua misérablement, et une vraie Célimène, comme Mlle Mars, est sûre de transmettre son nom à la postérité. On a noté, cependant, les intonations et les gestes des grandes interprètes du rôle ; la tradition les conserve et ils s’enseignent ; mais une élève intelligente aura beau en savoir tout ce qui peut s’apprendre, si elle ne tire de son propre fond le sentiment du personnage, elle ne fera que grossir le nombre enrayant des vaines tentatives qu’enregistre l’histoire théâtrale. Célimène a vingt ans et son expérience est celle d’une femme de quarante. Coquette et féline avec Alceste, d’une médisance légère avec les petits marquis, d’une ironie terrible avec Arsinoé, à chaque acte, à chaque scène, elle se montre sous un aspect différent. Contemporaine, ou à peu près, de Mmes de Châtillon, de Luynes, de Monaco, de Soubise, des nièces de Mazarin, elle doit éveiller comme un vague souvenir de ces grands noms ; elle est le produit exquis et rare d’une civilisation aristocratique dans le plein éclat de son développement, et souvent elle parle une langue d’une franchise d’allures et d’une verdeur presque populaires. Dans le salon où elle règne, il faut qu’elle donne le sentiment de l’aisance parfaite et de la suprême distinction ; et, au dénoûment, elle subit une humiliation cruelle, sans revanche possible ; elle a une sortie écrasante, et, même alors, elle ne doit rien perdre de sa fière attitude et de son sourire tranquille. La comédienne qui, la première, sut porter un tel rôle et s’y incarner fut vraiment une grande actrice. Or, Armande s’y surpassa elle-même ; ce fut, dit un contemporain, ce pauvre Robinet, qui sent mieux qu’il n’exprime, ce fut un charme, un ravissement, expressions que le temps devait rendre banales, mais qui retenaient encore toute leur force.
Qu’il y ait beaucoup d’elle-même dans le rôle, on ne saurait le méconnaître. Célimène est, par excellence, la grande coquette, et il semble bien qu’à la ville Armande tenait le rôle comme au théâtre. A défaut d’autres preuves, son goût de la parure et ses recherches de fantaisie originale suffiraient pour l’indiquer. Que l’on se rappelle son portrait dans le Bourgeois gentilhomme : sa beauté toute dans le regard, le sourire et les manières, cette beauté, où la nature a la moindre part et la volonté de plaire la plus grande était, par excellence, une beauté coquette. N’est-ce pas le genre d’attraits que l’on voit à la Célimène idéale, celle qui n’est point telle ou telle actrice, mais le type créé par le poète ? Armande avait aussi de la coquette l’humeur impérieuse et vaine ; elle vouloit, dit la Fameuse Comédienne, être applaudie en tout, n’être contredite en rien, et surtout elle prétendoit qu’un amant fût soumis comme un esclave. On se rappelle de quel air et de quel ton, au second acte du Misanthrope notamment, Célimène réprime les révoltes d’Alceste. Cette foule d’amans qui l’entoure, et dont le poète ne met en scène que le nombre nécessaire à l’action, se retrouvait certainement autour d’Armande. Quelle que pût être la conduite de celle-ci, — grosse question qu’il faudra bien aborder, — les adorateurs affluaient autour d’elle, attirés par une profession qui la mettait si en vue.
A la grande comédie du Misanthrope 4 juin 1666 succède, deux mois après, la simple farce du Médecin malgré lui. Armande y fait Lucinde, petit rôle d’ingénue sans grande importance, car le personnage n’ouvre pas la bouche durant la plus grande partie de la pièce ; il n’y a guère pour elle que des jeux de scène et une situation très plaisante vers la fin, lorsque la fausse muette s’épanche tout à coup en un bavardage torrentiel. Elle se dédommage par un luxe assez déplacé chez une jeune fille de moyenne condition : son habit se composait d’une jupe de satin couleur de feu, avec trois guipures et trois volans et le corps de toile d’argent et soie verte.Elle n’eut qu’une part secondaire dans les représentations de Mélicerte, du Sicilien et d’Amphitryon : on ne sait même pas si elle joua dans la première et la dernière de ces pièces ; dans la seconde elle tenait le rôle de Zaïde, personnage de simple figuration, et elle dut s’y contenter d’un succès de costume, sous une « riche mante, » présent du roi. Pourquoi cette série de méchans lots dans trois pièces successives ? Il sera peut-être possible de les expliquer par le très mauvais ménage qu’elle faisait à ce moment avec son mari. En revanche, dans le rôle d’Angélique, elle est au premier plan de George Dandin. Sans pousser plus loin qu’il ne convient la ressemblance du personnage et de l’actrice, il est probable que celle-ci n’eut pas trop à violenter sa nature pour entrer dans l’esprit du rôle, et qu’Angélique, avec son humeur impérieuse et son ironie froide, ne pouvait être mieux représentée que par Armande. On la verrait volontiers dans Élise de l’Avare, d’abord parce qu’elle y aurait eu son partenaire habituel, La Grange, et aussi parce que le caractère de cette fille exaspérée lui conviendrait mieux que le rôle passif de Mariane ; cependant, c’est bien celui-ci que lui attribue une distribution datée de 1685. L’incertitude continue avec M. de Pourceaugnac, quoique le rôle de Lucette, la feinte Gasconne, y semble fait pour elle : si elle fut vraiment élevée en Languedoc, elle put retrouver dans les souvenirs de sa jeunesse l’accent nécessaire au patois qui étourdit le gentilhomme limousin. Les renseignemens positifs manquent aussi sur le personnage qu’elle fit dans les Amans magnifiques ; on voudrait pouvoir lui attribuer en toute certitude celui d’Ériphyle, la princesse aimée par un homme d’une condition inférieure à la sienne et qui lutte entre l’amour qu’elle-même ressent et le sentiment de sa dignité : sorte de Grande Mademoiselle, tendre et fière, engageante et réservée, chez laquelle on a vu, non sans raison, le premier modèle de quelques héroïnes de Marivaux. Mais nous savons par Molière lui-même ce qu’elle fut dans la capricieuse Lucile du Bourgeois gentilhomme ; on a vu quel ravissant portrait elle lui inspirait alors. A ce moment, la concorde régnait entre les deux époux et le poète n’avait pour sa femme qu’ingénieuses prévenances et délicates flatteries.
Aussi lui ménage-t-il dans Psyché un triomphe égal à celui qu’elle avait obtenu dans le Misanthrope, mais dans un rôle tout sympathique cette fois et tout aimable. Il y a, certes, des œuvres plus fortes que cette « tragédie-ballet ; » il n’y en a guère qui soient une plus fidèle image de la société qui les inspira. Molière y avait mis le comique tempéré de ses travestissemens mythologiques, Corneille sa galanterie héroïque, Quinault la molle harmonie de ses vers, Lulli sa musique spirituelle et passionnée, Vigarani la fastueuse ordonnance de ses décorations : l’ensemble se trouva réaliser l’idéal dramatique des contemporains de Louis XIV. Au milieu d’une pompe royale, c’est l’apothéose de leur manière d’entendre l’amour ; tous les sentimens y sont grandioses et nobles, presque naturels avec cela. Quant à l’héroïne, bien éloignée assurément de son modèle antique, charmante encore cependant, avec sa pudeur fière, sa tendresse réglée par le sentiment de « sa gloire » et de son rang, elle est entourée d’une véritable idolâtrie. Armande dut éprouver dans ce rôle d’enivrantes joies d’amour-propre ; princesse, amante adorée, déesse, elle s’offrait aux applaudissemens avec toutes les séductions que l’art et la poésie peuvent réunir autour d’une comédienne. Il n’y a, malheureusement, que Robinet pour nous dire l’impression qu’elle produisait, et, cependant, quelque chose de cette impression nous arrive à travers la burlesque poésie du pauvre rimeur : il compare ses attraits au javelot infaillible de Céphale, « elle est merveilleuse, elle joue divinement, elle fait courir les gens à tas. Enfin, on entrevoit la splendeur de ses costumes dans la sèche description du notaire qui inventoria « les habits pour la représentation de Psyché : en tout cinq costumes, un par acte.
Il n’est pas sûr qu’elle ait été l’Hyacinthe assez insignifiante des Fourberies de Scapin ; dans la Comtesse d’Escarbagnas, elle ne parut certainement pas : au contraire de sa sœur Madeleine, qui, dans toute sa carrière, jouait tous les rôles, les plus modestes comme les plus importuns, elle agissait en étoile, dédaignant ceux où elle n’aurait fait que rendre service au théâtre, sans profit pour son amour-propre. En dehors des grandes créations, elle se réservait pour les seuls petits emplois capables de la flatter, comme dans ce divertissement, que nous n’avons plus, de la Pastorale comique, où elle représentait à la fois une bergère en femme et une bergère en homme, » ne dédaignant pas l’attrait piquant du travesti. On la vit ensuite dans l’Henriette des Femmes savantes, ce type délicieux de la jeune fille française, dont la grâce facile, le bon sens, aiguisé d’ironie mais tempéré de bonté, montrent, en quelque sorte, l’Elmire du Tartufe avant le mariage. Angélique du Malade imaginaire fut le dernier rôle qu’elle dut au génie de son mari. Plus ingénue qu’Henriette, mais point trop naïve, Angélique est d’un ordre à part ; elle tempère par un sourire mouillé de larmes l’exubérante gaieté de la pièce et mêle la plainte mélancolique d’une Iphigénie bourgeoise aux terreurs burlesques d’Argan, aux complimens niais de Thomas Diafoirus, aux éclats de colère de M. Purgon. La voix touchante d’Armande était bien celle qu’il fallait au rôle, et c’est surtout le souvenir du Malade imaginaire qui inspirait à l’auteur des Entretiens galants son double portrait de La Grange et de Mlle Molière.
Telle fut la comédienne dans Armande Béjart : très digne d’attention, comme on le voit. Mais, si remarquables qu’aient été ses talens dramatiques, ils comptent pour la moindre part dans la curiosité que son nom excite. Ce que l’on veut surtout connaître, c’est la conduite privée de la femme, la place qu’elle tint dans l’existence de son mari. On a déjà beaucoup écrit sur elle, et presque toujours en se plaçant à ce point de vue exclusif. Pour la grande majorité des biographes de Molière, Armande fut une épouse indigne ; elle tortura, elle couvrit de ridicule le grand homme dont elle portait le nom. Une fois lancé dans cette voie, on ne s’arrête plus ; on amoncelle autour d’elle, sans trop y regarder, les imputations les plus graves ; on interprète hardiment les renseignemens les plus suspects. Cependant, a examiner d’un peu près les faits qu’on lui reproche, il n’en résulte clairement qu’une seule chose, c’est qu’elle rendit Molière très malheureux. Mais pour quels motifs ? Est-ce de l’inconduite, est-ce seulement de la coquetterie de sa femme que souffrait l’auteur de Sganarelle et du Misanthrope ? Il est difficile de trancher la question. A part deux ou trois allusions, on n’a contre Armande que deux dépositions contemporaines, toutes deux bien suspectes ; le reste n’est que tradition vague ou conjecture. Je ne crois pas qu’il y ait, dans l’histoire littéraire, de question qui montre davantage les dangers de l’à-peu-près et du parti-pris en matière d’érudition. Que de critiques, et des mieux intentionnés, sont prompts à l’épithète vengeresse dès qu’ils prononcent le nom d’Armande ! On les embarrasserait beaucoup en leur demandant des preuves : ils déclament et ne peuvent que déclamer.
Consultons d’abord le principal intéressé dans la question, Molière lui-même. S’il a plusieurs fois emprunté certains traits à sa femme pour les appliquer aux personnages qu’il lui donnait à représenter, il est impossible qu’il ne laisse pas voir çà et là à travers ces personnages les sentimens qu’elle lui inspirait. Et d’abord, s’est-il peint lui-même dans le rôle d’Arnolphe de l’École des femmes, l’a-t-il peinte dans celui d’Agnès ? On l’a dit, mais, si cela était, la lune de miel de ce ménage aurait vraiment trop peu duré : le mariage est du 20 février 1662 et l’École des femmes du 26 décembre suivant. En outre, peut-on admettre que, de gaieté de cœur et pour le seul plaisir, un homme se représente lui-même sous les traits du grotesque tuteur d’Agnès et se bafoue aussi cruellement ? Molière, enfin, n’avait trace de l’égoïsme et de la sotte infatuation qu’il prête à Arnolphe ; sa femme, spirituelle et hardie, ressemblait encore moins à la timide et passive Agnès. On invoque des analogies ; ainsi l’histoire d’Agnès, remarquée par Arnolphe dès l’âge de quatre ans, obtenue par lui d’une mère pauvre et par ses soins élevée. Voilà, dit-on, Armande prise par Molière aux Béjart, vers le même âge, et confiée dans le Languedoc aux soins d’une honnête et sûre famille. Comme si l’éducation d’Agnès, tenue dans l’ignorance de tout, rendue idiote autant qu’il se pouvoit, n’était pas juste le contraire de celle d’Armande, telle qu’on la connaît ou qu’on la devine par l’École des maris ! Tout ce qu’il est possible d’admettre c’est que, mari déjà mûr d’une très jeune femme plus exposée qu’aucune autre aux entreprises des blondins, Molière se trouvait, en écrivant sa pièce, dans un état d’esprit dont il n’avait peut-être pas encore une conscience bien nette et qu’il laissa percer çà et là quelque chose de ses vagues appréhensions.
La petite querelle de directeur et de mari qu’il introduit dans l’Impromptu de Versailles laisserait même croire qu’il vivait encore à ce moment dans une parfaite sécurité. Sur une observation d’Armande, il l’interrompt : Taisez-vous, ma femme ! vous êtes une bête. — C’est une chose étrange, réplique Armande sans s’émouvoir, c’est une chose étrange qu’une petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités, et qu’un mari et un galant vous regardent la même personne avec des yeux si différens ! Molière impatienté : Que de discours ! Armande poursuit avec le même flegme : Ma foi, si je faisois une comédie, je la ferois sur ce sujet. Je justifierois les femmes de bien des choses dont on les accuse, et je ferois craindre aux maris la différence qu’il y a de leurs manières brusques aux civilités des galans. Et les critiques de s’écrier : La menace est assez claire ! Molière prévoit le sort qui l’attend, puisqu’il le fait pressentir lui-même. Non ; il se sert ici, pour un effet plaisant, d’un simple lieu-commun de comédie, et, par cela même qu’il l’emploie, c’est qu’il n’en redoute pas l’application pour lui-même.
Le Mariage forcé et George Dandin offrent peut-être des allusions plus directes à son ménage. Il ne serait pas impossible qu’aussitôt marié il ait entendu de la bouche de sa femme la déclaration que Dorimène fait à Sganarelle : Je crois que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous avoue que je ne m’accommoderois pas de cela et que la solitude me désespère. J’aime le jeu, les visites, les assemblées, les cadeaux et les promenades ; en un mot, toutes les choses de plaisir. Angélique, de son côté, dit à George Dandin : C’est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris et je les trouve bons de vouloir qu’on soit morte à tous les divertissemens et qu’on ne vive que pour eux ! Je me moque de cela et ne veux point mourir si jeune… Je veux jouir, s’il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m’offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l’âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de m’ouïr dire des douceurs. Ces deux passages rappellent ce que nous apprend Grimarest du ménage de Molière. Aussitôt mariée, Armande se croit une duchesse, se pare avec fureur et coquette avec le courtisan désœuvré qui lui en conte ; elle hausse les épaules aux observations de son mari ; ces leçons lui paraissent trop sévères pour une jeune personne qui, d’ailleurs, n’a rien à se reprocher. Avec le Mariage forcé nous sommes au commencement de 1664, au milieu de 1668 avec George Dandin ; après deux ans de mariage, à plus forte raison après six ans, les conséquences fatales de la différence d’âge et de caractère ont dû se produire pour les deux époux. Avide de plaisirs et de vie bruyante, Armande aurait voulu imposer ses goûts à son mari ; revenu de bien des choses, souffrant, écrasé de travail et de soucis, Molière aspirait à la vie de famille, intime et cachée. Profondément bon, mais nerveux et irritable comme les hommes de vive sensibilité, il dut quelquefois contrarier et rudoyer la créature frivole et de petit jugement qu’était Armande. Mais la ressemblance des situations s’arrête ici ; il est peu probable que Molière ait vu son propre sort dans celui que l’avenir réserve à Sganarelle et que le présent est en train de faire à George Dandin.
En arrivant au Misanthrope, la question se précise. On veut qu’Alceste soit tout Molière comme Célimène toute Armande. Si l’on admet, comme j’ai essayé de l’établir, que le rapprochement ne manque pas de justesse pour Armande, il est difficile de le rejeter complètement pour Molière. Le poète dut éprouver les mêmes souffrances que son héros, avec ce surcroît d’irritation et d’inquiétude que donne la qualité de mari, c’est-à-dire la crainte de perdre non pas seulement ce que l’on désire, mais ce que l’on possède, et le souci de l’honneur en danger. Il y a, dans le rôle d’Alceste, je ne sais quoi de profondément vrai que la puissance créatrice du poète ne suffirait pas à expliquer, une mélancolie profonde où percent les souvenirs d’une expérience personnelle. On objecte qu’un assez grand nombre de vers, et des plus passionnés, du rôle d’Alceste, notamment aux scènes deuxième et troisième du quatrième acte, se trouvaient déjà dans Don Garcie de Navarre, représenté un an avant le mariage de Molière. En revanche, que de tirades brûlantes sont dans le Misanthrope qui ne sont pas dans Don Garcie ! Il y a surtout, dans tout le rôle d’Alceste, un relief et une vérité dont le pâle et chimérique amant de la princesse de Léon ne saurait donner le modèle. Après le naufrage d’une première pièce où il avait déjà peint la jalousie, Molière voulut sauver quelques beaux vers qu’il regrettait et il leur donna place dans le Misanthrope. En quoi la portée de celui-ci en est-elle diminuée ? Une tirade heureuse, une scène bien venue, sont peu de chose au théâtre ; un caractère vrai, une action qui donne l’illusion de la vie, sont tout, et, de quelques élémens empruntés ou repris que soit formée cette création, il n’importe guère.
Toutefois, de ce qu’il y a beaucoup de Molière et de sa femme dans le Misanthrope, on ne saurait conclure autre chose sinon qu’Armande était une fort méchante coquette ; il faut renoncer à en tirer une présomption contre sa conduite. Célimène est impeccable, si je ne m’abuse ; elle n’a ni cœur ni sens. Quant à Molière, si on le voit sous les traits d’Alceste, il y apparaît malheureux, mais nullement ridicule. Le reste de son théâtre ne fournit pas de nouvelles preuves contre Armande ; il fortifie, au contraire, l’impression que, tout en souffrant beaucoup du caractère de sa femme, il ne crut jamais à une indignité de sa part.
Cette impression semble bien avoir été celle des contemporains du poète. Ils le savaient jaloux, et, de fait, n’eussent-ils pas pris soin de nous éclairer sur ce côté de son caractère, nous le devinerions aisément, car la jalousie sous toutes ses formes, presque tragique comme dans Don Garcie et le Misanthrope, burlesque comme dans Sganarelle et George Dandin, inspire une bonne part de son théâtre. Aussi, avec la prévoyance de la haine, s’efforçaient-ils de l’attaquer dans ce qu’il avait de plus sensible, de peser sur sa blessure intime. Mais aucun d’eux ne l’accusa d’être ce qu’il craignait tant de devenir.
Vers la fin de son Impromptu de l’hôtel de Condé, Montfleury le fils faisait dire par un de ses personnages :
… L’on doit finement dessus certain chapitre…
Un autre répondait par ces deux vers de l’École des femmes :
Hé, mon Dieu ! notre ami, ne te tourmente point ;
Bien huppé qui pourra l’attraper sur ce point.
L’allusion est anodine, et ce serait trop en tirer que d’y prendre un argument contre Armande mariée depuis deux ans à peine. Bientôt, un comédien de l’hôtel de Bourgogne, de Villiers, lance sa Vengeance des marquis. Venant après Montfleury, il éprouve le besoin d’insister sur l’insinuation de son prédécesseur. Dans l’Impromptu de Versailles, Molière avait dit du Portrait du peintre de Boursault : Je réponds de douze marquis, de six précieuses, de vingt coquettes et de trente c…s, qui ne manqueront pas d’y battre des mains. Le raisonneur de la Vengeance des marquis, Ariste, relève et reprend le mot : Il a été plus de c…s qu’il ne dit voir le Portrait du peintre : j’y en comptai un jour jusqu’à trente et un. Cette représentation ne manqua pas d’approbateurs : trente de ces c…s applaudirent fort, et le dernier fit ce qu’il put pour rire, mais il n’en avoit pas beaucoup d’envie. Le dernier, c’est évidemment Molière ; mais ne voit-on pas qu’il n’est incorporé dans la bande que pour donner lieu à retourner contre lui le trait qu’il avait lancé ? De Villiers ne croyait pas lui-même au bien fondé de son allusion, et la preuve c’est que, dans un recueil par lui publié en cette même année 1663, les Nouvelles nouvelles, il disait de Molière : Si vous voulez savoir pourquoi, presque dans toutes ses pièces, il raille tant les c…s et dépeint naturellement les jaloux, c’est qu’il est du nombre de ces derniers. Ce n’est pas que je ne doive dire, pour lui rendre justice, qu’il ne témoigne pas sa jalousie hors du théâtre : il a trop de prudence et ne voudrait pas s’exposer à la raillerie publique ; mais il voudrait faire en sorte par le moyen de ses pièces que tous les hommes pussent devenir jaloux et témoigner leur jalousie sans en être blâmés, afin de pouvoir faire comme les autres, et de témoigner la sienne sans crainte d’être raillé. Voilà qui est bien alambiqué, mais la réserve, du moins, est expresse : dans Molière, De Villiers ne voyait qu’un jaloux.
Sept ans après, en 1670, alors que la réputation d’Armande, si elle fut jamais compromise, devait l’être définitivement, Le Boulanger de Chalussay, l’auteur d’Élomire hypocondre, n’était pas plus affirmatif que De Villiers. Il représentait Elomire, c’est-à-dire Molière, se plaignant de sa santé à L’Orviétan et à Baru. Elomire a une grosse toux et l’oreille lui corne de mille tintoins. Bary répond :
Les cornes sont toujours fort proches des oreilles.
ELOMIRE
J’aurais des cornes, moi ? moi je serais eu.
L’ORVIETAN.
On ne dit pas qu’encor vous le soyez actu ;
Mais, étant marié, c’est chose très certaine
Que vous l’êtes, du moins, en puissance prochaine.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7348#forumpost7348
Posté le : 29/11/2014 21:08
Edité par Loriane sur 30-11-2014 16:51:48
|
|
|
|
|
Armande Béjart 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Les cornes sont toujours fort proches des oreilles.
ELOMIRE
J’aurais des cornes, moi ? moi je serais eu.
L’ORVIETAN.
On ne dit pas qu’encor vous le soyez actu ;
Mais, étant marié, c’est chose très certaine
Que vous l’êtes, du moins, en puissance prochaine.
Du vivant de Molière, il ne fut pas imprimé autre chose sur son ménage. Après sa mort, à une époque indéterminée, un grossoyeur de notes et d’anecdotes, de petits papiers et d’extraits de jurnaux, dont le recueil manuscrit est venu jusqu’à nous, le sieur Jean-Nicolas de Tralage, parait-il, s’amusait à dresser un double catalogue des comédiens qui vivaient bien et de ceux qui vivoient mal, et, parmi ces derniers, il rangeoit la femme de Molière entretenue à diverses fois par des gens de qualité et séparée de son mari. C’est là un renseignement à la Tallemant des Réaux, un on-dit recueilli et enregistré sans critique ; comme on le verra, l’entretien et la séparation sont purement imaginaires. Il y a bien encore le factum du Guichard que nous connaissons, mais il se retrouvera bientôt.
J’arrive enfin à l’acte d’accusation formel et détaillé qui pèse le plus lourdement sur la mémoire d’Armande, à la Fameuse Comédienne. C’est un petit livre, publié à Francfort en 1688, réimprimé jusqu’à cinq fois en neuf ans, et anonyme. On pouvait donc se donner carrière pour lui chercher un auteur, et on n’y a pas manqué ; on l’a attribué successivement à La Fontaine, à Racine, à Chapelle, à Blot, le chansonnier de la Fronde, à Mlle Guyot, comédienne de la rue Guénégaud, à Mlle Roudin, comédienne de campagne, à Rosimont, autre acteur de la rue Guénégaud, etc. Il n’y a lieu de discuter aucune de ces attributions, également dénuées de preuves ; les deux premières surtout sont d’une haute fantaisie : ni La Fontaine, malgré sa médiocre dignité de caractère, ni Racine, bien qu’il ait eu des torts envers Molière, n’étaient capables de commettre une infamie, et la Fameuse Comédienne en est une. Racine, en particulier, repentant, converti, entièrement retiré de la littérature depuis 1677, avait d’autres soucis en tête que d’écrire des libelles orduriers. Tout ce que l’on est en droit de supposer, c’est que le livre part de la main d’un homme ou d’une femme de théâtre. Il dénote, en effet, du tripot comique et de la vie des comédiens, une si exacte et si minutieuse connaissance, que l’auteur masqué dut être non pas seulement un écrivain dramatique ou un amateur très répandu dans ce milieu spécial, mais un comédien. Toute profession très absorbante, — et aucune plus que celle-là ne prend son homme tout entier, — imprime une marque spéciale aux idées et au langage ; quelle que soit l’originalité de caractère que la nature ait donnée à un comédien, il sent et pense, voit et parle d’une manière qui lui est plus ou moins commune avec tous ceux qui montent sur les planches. Or, quiconque est un peu familier avec l’envers du théâtre, reconnaît dans la Fameuse Comédienne un parfum de coulisses prononcé. Mais si un comédien pense et écrit de façon spéciale, encore plus une comédienne, qui joint au tour d’esprit et de langage particuliers à sa profession celui qu’elle doit à son sexe. C’est le cas du livre qui nous occupe. La place prépondérante qu’il donne aux femmes, la manière dont il parle des hommes, la haine jalouse qui l’inspire, le choix des médisances ou des calomnies, je ne sais quoi d’oblique et d’insinuant, tout cela dénote une main féminine ; comme aussi la finesse de certaines remarques, la grâce facile et l’agréable négligence des tours. Car si le livre est odieux, il s’en faut de beaucoup qu’il soit mal écrit ; il a sa valeur littéraire, et assez grande, par sa langue, qui est de la meilleure époque et du meilleur aloi, par son style libre et souple, périodique sans lourdeur, familier sans trivialité. Il n’est aucunement pour donner tort à la boutade célèbre de P.-L. Courier que « la moindre femmelette de ce temps-là vaut mieux pour le langage que les Jean-Jacques et les Diderot. » Quant au fond, les inventions haineuses dominent, mais tout n’est pas à rejeter. II faut distinguer d’abord les faits généraux se rapportant au milieu où vivait Armande : ils sont généralement exacts ; et les faits particuliers qui lui sont attribués : la plupart sont imaginaires. L’auteur a certainement vu de près Molière et Armande, elle a probablement fait partie de leur troupe, elle connaît par le menu l’histoire de leur théâtre. Le caractère et la manière d’être qu’elle prête aux deux époux, les incidens publics de leur existence qu’elle raconte, tout cela montre en elle un témoin bon à entendre. Mais c’est tout. Possédée contre Armande d’une haine féroce, haine de femme et de comédienne, elle n’a qu’un but qui est de la rendre odieuse ; ce qu’elle sait des actions de son ennemie, elle le dénature, ou, tout au moins, l’exagère ; ce qu’elle ne sait pas, elle l’invente. Qui veut déshonorer un homme lui attribue des actes d’indélicatesse ou de lâcheté ; qui veut déshonorer une femme lui prête des amans : ce sont les moyens les plus sûrs. Aussi notre auteur fait-elle d’Armande une vraie Messaline, et une Messaline du dernier ordre, de celles que l’on paie. Malheureusement pour l’effet de son récit, elle voulut trop prouver, et, surtout en pareille matière, qui veut trop prouver ne prouve rien. La réputation d’une femme est chose fragile ; mais, par cela même, redoubler les coups est une tactique maladroite. A celui qui s’acharne dans l’attaque comme dans la défense, on est toujours tenté de répondre avec la marquise de Lassay : Comment faites-vous donc pour être si sûr de ces choses-là ? Et dans la Fameuse Comédienne les affirmations abondent, avec pièces à l’appui, lettres, conversations, etc. Il y a trop de faits précis articulés, trop de détails complaisamment énumérés sur des actes qui, par leur nature même, ne sont exactement connus que des seuls participans. Aussi, dès les premières pages, l’incrédulité naît chez le lecteur ; il voit trop bien qu’il a sous les yeux un ramassis d’histoire suspectes, et, s’il lui prend fantaisie de les contrôler, il reconnaît que toutes celles que l’on peut contrôler sont démenties par des faits positifs, et que les autres pèchent contre la plus simple vraisemblance.
Le premier amant attribué à Armande est l’abbé de Richelieu, petit-neveu du grand cardinal ; il était, en effet, d’humeur galante avec une préférence marquée pour les comédiennes. Et voici comment se seraient établies ses relations avec la femme de Molière : Comme il étoit libéral et que la demoiselle aimoit la dépense, la chose fut bientôt conclue. Ils convinrent qu’il lui donneroit quatre pistoles par jour sans ses habits et les régals. L’abbé ne manquoit pas de lui envoyer tous les matins par un page le gage de leur traité et de l’aller voir toutes les après-midi. Ce marché d’amour est commode et simple ; mais, outre que l’on sait par les contemporains les noms des principales amies de l’abbé et que Mlle Molière n’en est pas, il faut admettre, Molière et sa femme demeurant dans la même maison, ou bien que les allées et venues du page et de l’abbé ont passé inaperçues pour le mari, ou bien qu’il en a su le motif et les a tolérées : deux hypothèses également inadmissibles. Si maintenant nous consultons les dates, l’invraisemblance devient une impossibilité. Armande s’était mariée le 20 février 1662, et, le 10 janvier 1664, elle donnait un fils à Molière. Veut-on placer une intrigue galante entre ces deux époques ? Ce serait faire commencer son inconduite de bien bonne heure. Quant à l’abbé, il part, dès le mois de mars 1664, avec l’expédition organisée pour défendre la Hongrie contre les Turcs et meurt à Venise le 9 janvier 1666. Cela n’empêche point la Fameuse Comédienne de faire durer sa liaison avec Mlle Molière jusqu’après les représentations de la Princesse d’Elide, à Chambord ; or cette pièce ne fut jouée qu’après le départ de l’abbé, le 8 mai 1664, et à Versailles.
Une nouvelle et double aventure se serait greffée sur celle-là, Durant les représentations de la Princesse, Armande devint folle du comte de Guiche, et le comte de Lauzun devint fou d’elle ; irritée des dédains du premier, elle se jeta résolument à la tête du second. Ici encore se présentent une impossibilité et une invraisemblance. Éloigné de la cour depuis 1663, à la suite d’un petit complot contre Mlle de La Vallière, le comte de Guiche était ensuite parti pour la Pologne et se trouvait encore à Varsovie en mai 1664. Quant à Lauzun, on ne le trouve pas nommé parmi les personnages qui figuraient dans les fêtes où fut donnée la Princesse d’Élide ; plusieurs, cependant, étaient à la fois moins qualifiés et moins en vue que lui. En outre, tout plein à ce moment de sa passion pour Mme de Monaco, il était peu désireux, sans doute, de se prêter aux caprices d’une comédienne aussi bruyante et encombrante que l’Armande représentée dans la Fameuse Comédienne. Ainsi, la médisante ennemie a eu la main malheureuse ; entre les grands seigneurs célèbres à la cour par leurs aventures galantes, elle a choisi trois des plus connus, se disant que, dans la foule de leurs maîtresses, une de plus passerait sans difficulté ; mais elle savait mal ce monde-là et son ignorance l’a trahie.
Bien que l’abbé de Richelieu soit en route pour la Hongrie, notre libelle le retient en scène, et pour lui faire jouer un fort vilain rôle. Furieux d’être abandonné par Armande, il aurait fait apercevoir à Molière que le grand soin qu’il avoit de plaire au public lui ôtoit celui d’examiner la conduite de sa femme ; et que, pendant qu’il travailloit pour divertir tout le monde, tout le monde cherchoit à divertir sa femme. Une grosse querelle conjugale suit naturellement cette confidence. Armande joue la comédie des larmes ; elle avoue son penchant pour Guiche, mais elle proteste que tout le crime a été dans l’intention, ne dit mot de Lauzun, demande un pardon qu’elle obtient sans peine, et profite de la crédulité de son mari pour continuer ses intrigues avec plus d’éclat que jamais.Cette fois, elle y met une indifférence de cœur, une régularité et une âpreté au gain qui la rangent parmi les femmes galantes de profession. Elle prend une entremetteuse en titre, la Châteauneuf, et ne refuse aucun des nombreux amans que cette matrone lui présente pendant qu’elle fait languir une infinité de sots qui la croient d’une vertu sans exemple. » Ne voilà-t-il pas deux choses assez difficiles à concilier, l’éclat d’une vie galante et une cour d’amoureux transis ? Cependant Molière, averti de nouveau, se met dans une fureur violente et il menace sa femme de la faire enfermer. Nouvelle scène de cris et de larmes ; mais, au lieu de s’humilier une seconde fois, Armande le prend de haut, et exige une séparation. En vain, sa famille, celle de Molière, leurs amis communs essaient de l’apaiser : Elle conçut dès lors une aversion terrible pour son mari, elle le traita avec le dernier mépris ; enfin, elle porta les choses à une telle extrémité que Molière, commençant à s’apercevoir de ses méchantes inclinations, consentit à la rupture qu’elle demandoit incessamment depuis leur querelle ; si bien que, sous arrêt du parlement, ils demeurèrent d’accord qu’ils n’auroient plus d’habitude ensemble. Il y eut donc non pas séparation judiciaire, comme l’a cru Tralage, mais séparation à l’amiable. D’autres témoignages s’accordant ici avec celui de la Fameuse Comédienne, on peut tenir le fait pour assuré.
Cette rupture ne saurait être antérieure au mois d’avril 1666, car à cette époque Armande donnait à son mari un second enfant : une fille qui eut pour parrain M. de Modène et pour marraine Madeleine Béjart. Peu de temps après, Molière tombait malade ; nous le savons par Robinet, qui annonce, le 21 février 1666, sa guérison et sa rentrée au théâtre. Si l’on admet que le Misanthrope reflète quelque chose de l’état d’esprit du poète et de ses sentimens envers sa femme, la séparation peut être rapportée au moment où cette pièce fut jouée, c’est-à-dire en juin 1666, ou, au plus tard, vers le mois d’août de la même année, après le Médecin malgré lui. On a vu que, dans les trois pièces qui suivent celle-ci : Mélicerte, le Sicilien et Amphitryon, Armande est laissée de côté : c’est Mlle de Brie qui en obtient les beaux rôles ; ne serait-ce point un effet du ressentiment de son mari, effet très naturel et d’autant plus pénible pour elle que jusqu’alors elle avait eu dans les distributions une part plus flatteuse et plus large ?
Depuis ce moment ils ne se virent plus qu’au théâtre, Armande restant à Paris avec sa mère et ses sœurs, Molière passant ses rares loisirs dans une petite maison de campagne qu’il avait louée à Auteuil. Un jour, il rêvait tristement dans son jardin, lorsque, selon la Fameuse Comédienne, il reçut la visite de son ami Chapelle, et, comme il étoit alors dans une de ces plénitudes de cœur si connues par les gens qui ont aimé, il s’épancha dans une confidence que l’auteur du pamphlet prétend reproduire tout au long et au vrai :
Je suis né, disait-il, avec les dernières dispositions à la tendresse ; et, comme j’ai cru que mes efforts pouvoient lui inspirer par l’habitude des sentimens que le temps ne pourrait détruire, je n’ai rien oublié pour y parvenir. Comme elle étoit jeune quand je l’épousai, je ne m’aperçus pas de ses méchantes inclinations, et je me crus un peu moins malheureux que la plupart de ceux qui prennent de pareils engagemens. Aussi le mariage ne ralentit point mes empressemens ; mais je lui trouvai tant d’indifférence que je commençai à m’apercevoir que toute ma précaution avoit été inutile et que tout ce qu’elle sentoit pour moi étoit bien éloigné de ce que j’aurois souhaité pour être heureux. Je me fis à moi-même des reproches sur une délicatesse qui me sembloit ridicule dans un mari, et j’attribuai à son humeur ce qui étoit un effet de son peu de tendresse pour moi. Mais je n’eus que trop de moyens de m’apercevoir de mon erreur ; et la folle passion qu’elle eut, peu de temps après, pour le comte de Guiche, fit trop de bruit pour me laisser dans cette tranquillité apparente. Je n’épargnai rien, à la première connaissance que j’en eus, pour me vaincre, dans l’impossibilité que je trouvai à la changer. Je me servis pour cela de toutes les forces de mon esprit ; j’appelai à mon secours tout ce qui pouvoit contribuer à ma consolation ; je la considérai comme une personne de qui tout le mérite est dans l’innocence, et que son infidélité rendoit sans charmes. Je pris dès lors la résolution de vivre avec elle comme un honnête homme qui a une femme coquette, et qui est bien persuadé, quoi qu’on puisse dire, que sa réputation ne dépend point de la méchante conduite de son épouse. Mais j’eus le chagrin de voir qu’une personne sans beauté, qui doit le peu d’esprit qu’on lui trouve à l’éducation que je lui ai donnée, détruisoit, en un moment, toute ma philosophie. Sa présence me fit oublier mes résolutions, et les premières paroles qu’elle me dit pour sa défense me laissèrent si convaincu que mes soupçons étoient mal fondés, que je lui demandai pardon d’avoir été si crédule.
Cependant mes bontés ne l’ont point changée ; et si vous saviez ce que je souffre, vous auriez pitié de moi. Ma passion est venue à un tel point qu’elle va jusques à entrer avec compassion dans ses intérêts ; et quand je considère combien il m’est impossible de vaincre ce que je sens pour elle, je me dis en même temps qu’elle a peut-être une même difficulté à détruire le penchant qu’elle a d’être coquette, et je me trouve plus dans la disposition de la plaindre que de la blâmer. Vous me direz sans doute qu’il faut être père pour aimer de cette manière ; mais, pour moi, je crois qu’il n’y a qu’une sorte d’amour, et que les gens qui n’ont point senti de semblables délicatesses n’ont jamais véritablement aimé. Toutes les choses du monde ont du rapport avec elle dans mon cœur. Mon idée en est si fort occupée que je ne sais rien en son absence qui me puisse divertir. Quand je la vois, une émotion et des transports qu’où peut sentir, mais qu’on ne sauroit dire, m’ôtent l’usage de la réflexion. Je n’ai plus d’yeux pour ses défauts, il m’en reste seulement pour ce qu’elle a d’aimable. N’est-ce pas là le dernier point de la folie, et n’admirez-vous pas que tout ce que j’ai de raison ne sert qu’à me faire connaître ma faiblesse sans on pouvoir triompher ?
Le passage est éloquent et une grande émotion s’en dégage ; non-seulement il ne part pas d’une plume ordinaire, mais je n’hésite pas à y voir, malgré quelques tournures languissantes et quelques-faiblesses d’expression, un des beaux morceaux de la prose française en sa plus belle époque.
Faut-il aller plus loin, et y reconnaître, comme on le veut, l’esprit ou la main de Molière lui-même, que ce soit un compte-rendu écrit de souvenir par Chapelle, ou une lettre adressée par Molière à son ami, compte-rendu ou lettre tombés dans les mains du libelliste ? Il n’est besoin, ce semble, de recourir ni à l’une ni à l’autre de ces deux hypothèses. Si l’on admet que la Fameuse Comédienne, malgré sa détestable inspiration, n’est pas l’œuvre du premier venu, mais d’une actrice douée d’un talent de style naturel, le plus simple serait d’admettre encore que ce morceau est aussi bien son œuvre que tout le reste. Rompue à la pratique du théâtre, elle combine certaines parties de son récit comme autant de petites pièces. La situation est ici de celles qui inspirent et portent ; soutenue donc parle souvenir du Misanthrope, l’imagination échauffée par les plaintes brûlantes d’Alceste, sa haine contre Armande venant par-dessus, elle a réussi la scène et la tirade. Sauf en un point, toutefois, le rôle prêté à Chapelle. Epicurien insouciant, Chapelle n’en était pas moins sensible aux peines de ses amis ; il l’a prouvé en plusieurs circonstances. Or, le langage qu’il tient dans la scène d’Auteuil est celui d’un fort vilain égoïste ; .jamais confident ne joua son rôle de façon plus piteuse. Il ne comprend rien à la douleur de Molière, qui est obligé de lui dire : Je vois bien que vous n’avez encore rien aimé. La confession achevée, mal à l’aise, dérangé dans sa quiétude d’esprit, il se dérobe au plus vite : Je vous avoue à mon tour que vous êtes plus à plaindre que je ne pensois ; mais il faut tout espérer du temps. Continuez cependant à faire vos efforts ; ils feront leur effet lorsque vous y penserez le moins. Pour moi, je vais faire des vœux afin que vous soyez bientôt content. C’est l’attitude et le langage de ce solennel imbécile de baron dans On ne badine pas avec l’amour, lorsqu’il répond aux supplications passionnées de la pauvre Camille : Cela me jettera dans le désespoir pour tout le carnaval… Je serai vêtu de noir ; tenez-le pour assuré… Je vais m’enfermer pour m’abandonner à ma douleur !
Les consolations de l’amitié sont insuffisantes pour adoucir des amertumes aussi douloureuses que celles dont souffrait Molière. Seul, un autre amour peut les rendre supportables, en attendant que l’on revienne au premier. C’est Mlle de Brie qui aurait rempli auprès de Molière ce rôle d’abnégation.
Dans le Misanthrope, elle avait représenté Éliante, et, de même qu’Éliante eût volontiers consolé Alceste des caprices de Célimène, de même Mlle de Brie accueillit Molière rebuté par Armande. Mais elle n’eut pas la pudique réserve d’Éliante, son intervention dans une passion troublée fut moins irréprochable ; enfin sa liaison avec Molière ne saurait leur valoir à l’un et à l’autre une sympathie sans mélange. Elle l’aimait avant son mariage avec Armande ; et, quoi qu’en dise l’auteur de la Fameuse Comédienne, elle semble s’y être résignée facilement ; elle nous apparaît, en effet, comme très accommodante, sans rancune, admettant l’abandon ou le partage et ne tenant pas rigueur à qui lui revenait. Mais il est fâcheux pour Molière qu’une fois marié il n’ait pas pris à son égard une attitude nette et n’admettant aucune interprétation de nature à froisser Armande. Au lieu de cela, un an à peine après son mariage, on le voit habiter la même maison que son ancienne maîtresse. Si la femme légitime avait des torts, quelle arme pour elle ! Armande ne manqua donc pas, dans l’occasion, d’employer cette tactique, féminine entre toutes, qui consiste à attaquer au lieu de se défendre. Dans la grande querelle qui précéda la séparation de 1666, elle déclara bien haut « qu’elle ne pouvoit plus souffrir un homme qui avoit toujours conservé des liaisons particulières avec la de Brie, qui demeurait dans leur maison et qui n’en étoit point sortie depuis leur mariage. » Elle exagérait sans doute un peu en précisant ainsi son grief ; Molière était alors trop épris de sa femme pour l’abandonner si tôt. Mais ne lui avait-il pas fourni lui-même cette triomphante réponse ? Et il paraît bien que, une fois rebuté, il acheva de lui donner raison en revenant à Mlle de Brie. C’était une maladresse, et ses amis ne le lui cachèrent pas. L’un d’eux, selon Grimarest, lui en faisait un jour le reproche, et, comme de raison, traitait fort mal Mlle de Brie ; elle n’avait, disait-il, ni vertu, ni esprit, ni beauté. Molière en convenait, mais en ajoutant : Je suis accoutumé à ses défauts, et il faudrait que je prisse trop sur moi pour m’accommoder aux imperfections d’une autre ; je n’en ai ni le temps ni la patience. Il y a bien des choses dans ce peu de mots : de la tristesse, de la résignation, le dédain amer de soi-même et d’autrui, peut-être aussi cette espèce d’inconscience qui résulte de certains états d’esprit et de certaines situations. Molière était un très grand homme, mais un homme, et qui avait ses faiblesses ; il serait puéril de les nier et de l’absoudre en tout et pour tout avec un parti-pris d’admiration. Comédien, sa profession admettait alors bien des licences, et il on prit sa part. Il ne faut donc pas chercher dans sa conduite, ou plutôt y mettre les yeux fermés une régularité bourgeoise qui n’y est pas et n’y saurait être. En l’espèce, il commit ou une faute ou une maladresse, les deux si l’on veut.
Faute ou maladresse, au surplus, la réconciliation n’en fut pas empêchée. L’auteur de la Fameuse Comédienne n’en parle pas : cela dérangerait sa thèse. Entre temps, le libelle place une nouvelle intrigue d’Armande. Durant les représentations de Psyché, au carnaval de 1671, elle se serait éprise d’une passion violente pour le très jeune Baron, qui faisait l’Amour, et ils auraient continué leur rôle hors du théâtre. Cette liaison n’est guère admissible ; non parce que Baron était tenu envers Molière par les devoirs d’une reconnaissance filiale : ce que l’on sait de cet insupportable fat, très dégagé de préjugés comme tous les dons Juans, permet de penser qu’une telle considération ne l’aurait pas retenu. Mais il était encore bien jeune : il avait à peine dix-sept ans et Armande n’était pas assez âgée elle-même pour rechercher les passions d’adolescens ; les Rosines ont passé la trentaine lorsqu’elles font chanter la romance aux Chérubins. De plus, il semble prouvé que Baron, traité par Molière avec la plus grande bonté, eut au contraire beaucoup à se plaindre d’Armande, qu’il dut même, rebuté par ses mauvais procédés, quitter la troupe pendant quelque temps, et qu’il y rentra malgré elle, sur les vives instances de Molière. Ce qui est certain, c’est que, aussitôt Molière mort, il s’empressa d’aller à l’hôtel de Bourgogne, dans un moment où Armande, devenue chef de la troupe, aurait eu grand besoin de lui.
A côté de toutes ces intrigues apocryphes ou douteuses, plus répugnantes les unes que les autres, on est heureux de rencontrer non pas un amour, mais un hommage aussi pur qu’honorable pour Armande, et où son souvenir se trouve mêlé à celui du vieux Corneille. Modèle des époux et père de six enfants, l’auteur de tant de stances à Iris n’en aimait pas moins jouer auprès des reines de théâtre le rôle du don Guritan de Ruy Blas auprès de dona Maria de Neubourg. Il y avait quelque chose d’espagnol dans son âme comme dans son génie, et lorsqu’il rencontrait un type de grâce charmante ou noble, il s’en faisait avec une galanterie fière l’admirateur et le servant. Devenu l’ami de Molière, il offrit à sa jeune femme une admiration platonique, et il paraît bien qu’il exprimait ses propres sentimens pour Mlle Molière lorsque, dans Psyché, il faisait parler à l’Amour le langage délicieusement précieux qui est dans toutes les mémoires. Mais cette déclaration voilée ne suffit pas au poète ; il voulut écrire pour sa déesse une tragédie dont elle jouerait le principal rôle et où il se représenterait-lui-même sous les traits d’un de ces vieillards amoureux qu’il dessinait d’une touche si fière. De là Pulchérie, son avant-dernière pièce, qui, l’on ne sait trop pourquoi, au lieu d’être jouée par la troupe de Molière, parut sur le théâtre du Marais ; pièce étrange, languissante et froide dans l’ensemble, d’une donnée qui fait un peu sourire, mais où se trouvent beaucoup de beaux vers et un caractère original, le vieux sénateur Martian, c’est-à-dire, nous apprend Fontenelle, Corneille lui-même. Le sentiment que l’Amour murmurait avec une espérance passionnée, Martian le gronde avec plus de mélancolie que de résignation ; il met dans son regret de ses jeunes années autant de force et de noblesse que le chevalier romain Laberius exhalant devant César sa plainte fameuse :
Moi qui me figurais que ma caducité
Près de la beauté même étoit en sûreté !
Je m’attachois sans crainte à servir la princesse,
Fier de mes cheveux blancs et fort de ma faiblesse ;
Et, quand je ne pensois qu’à remplir mon devoir,
Je devenois amant sans m’en apercevoir.
Mon âme, de ce feu nonchalamment saisie,
Ne l’a point reconnu que par ma jalousie ;
Tout ce qui l’approchoit vouloit me l’enlever,
Tout ce qui lui parloit cherchoit à m’en priver ;
Je tremblois qu’à leurs yeux elle ne fût trop belle ;
Je les haïssois tous comme plus dignes d’elle,
Et ne pouvois souffrir qu’on s’enrichit d’un bien
Que j’enviois à tous sans y prétendre rien.
Ces beaux vers durent charmer Armande et faire sourire Molière. Il serait imprudent de juger les comédiennes d’après les hommages poétiques qui leur sont consacrés ; mais on sait gré à Armande d’avoir inspiré celui-là et, au sortir de la Fameuse Comédienne, on est quelque peu dédommagé en retrouvant, grâce à Corneille, quelque chose d’elle dans l’idylle héroïque de Psyché, dans une noble scène de Pulchérie.
La réconciliation de Molière et de sa femme était peut-être chose faite lors de Psyché ; en tout cas, elle n’eut pas lieu plus tard que la fin de 1671, entre les Fourberies de Scapin et la Comtesse d’Escarbagnas. Des amis communs, entre autres Chapelle et le marquis de Jonzac, s’y étaient employés avec dévoûment. Vers le milieu de l’année suivante, les deux époux allèrent habiter rue de Richelieu. En s’éloignant de cette maison de la place du Palais-Royal, où il avait longtemps vécu, avec les Béjart et Mlle de Brie, Molière voulait sans doute mettre son foyer à l’abri des causes de discorde qui l’avaient troublé. Il semble que peu de temps après son mariage, il avait déjà pris semblable mesure et s’était installé dans cette même rue de Richelieu, bien inspiré en cela ; mais, on ne sait pour quelle cause, il serait revenu bientôt habiter avec les Béjart. Cette fois, au contraire, il prit toutes les mesures qui annoncent une installation définitive. La demeure commode et vaste qu’il avait choisie, il s’efforça de la rendre agréable à Armande : il y déploya un grand luxe, il y porta des recherches et des attentions d’amoureux, combinant le choix de l’ameublement, la disposition des tentures, l’harmonie des couleurs, la distribution des pièces pour la commodité et l’agrément de sa femme. Quelle différence avec le pauvre et froid petit logis où nous avons vu mourir Madeleine Béjart ! Il semble qu’une seconde lune de miel suivit cette réconciliation, et que le pauvre grand homme connut, du moins, avant de mourir, quatre mois de bonheur intime et de tranquillité. Le 15 septembre 1672, il devenait père pour la troisième fois ; il lui naissait un fils. Courte joie : l’enfant ne vivait que onze jours, précédant son père dans la tombe de quatre mois et demi. Cette réconciliation, en effet, si heureuse en elle-même, devait être funeste à Molière et l’on peut y voir une des causes de sa mort prématurée. Atteint depuis longtemps d’une grave maladie de poitrine, il avait dû se soumettre à un régime sévère, ne vivant que de lait, gardant le silence en dehors de la scène et confiné dans la solitude. Heureux, il se crut guéri, et, ne voulant pas imposer à sa femme la triste société d’un valétudinaire, il se remit à la viande, rouvrit sa maison, reprit son existence d’autrefois. Les suites de ce brusque changement furent une aggravation rapide de son mal et une catastrophe foudroyante : on sait dans quelles circonstances dramatiques, le 17 février 1673, il était surpris par la mort.
Des témoignages que l’on vient de parcourir se dégage sur la conduite et le caractère d’Armande une opinion assez nette pour qu’il ne soit pas nécessaire de l’exposer longuement. C’était une femme très séduisante, mais, comme la plupart des coquettes, égoïste et d’esprit borné quoique vif. Unie trop jeune à un mari trop âgé et d’une sensibilité très vive, elle le fit beaucoup souffrir par une humeur très différente de la sienne ; mais elle dut souffrir autant que lui. C’était, il est vrai, un homme de génie ; avec un jugement plus large, elle aurait rempli près de lui le beau rôle que bien des femmes surent prendre en pareil cas, celui de l’abnégation et du dévoûment. Mais elle n’avait rien de ce qu’il faut pour cela ; elle voulait vivre pour elle-même. De là des froissemens continuels, une irritation croissante, et bientôt la vie commune insupportable, Peut-on dire, cependant, que Molière ne rencontra près d’elle qu’indifférence ? Il serait imprudent de l’affirmer. On trouve, en effet, dans cet Elomire hypocondre, qui n’est pas plus suspect de partialité envers elle qu’envers son mari, une scène que l’on n’a pas assez remarquée et qui donne à penser. Le Boulanger de Chalussay représente Molière tourmenté par ces souffrances imaginaires aussi douloureuses que les maladies les plus certaines et se livrant aux accès de colère futile et violente si communs en pareil cas. Sa femme est près de lui et s’efforce à le calmer ; sincèrement affligée de l’état où elle le voit, elle le raisonne comme un enfant ; si Chalussay lui prête quelques duretés de parole, c’est qu’il en veut à tout ce qui touche Molière et qu’il tient à ne pas représenter sous un aspect trop sympathique la femme de son ennemi. Il semble, cependant, qu’il ne puisse, malgré qu’il en ait, s’empêcher de lui conserver un peu du rôle qu’elle avait dans la réalité.
Reste la conduite. En somme, tout ce que les contemporains d’Armande ont écrit contre elle se trouve faux si on l’examine d’un peu près ; à plus forte raison ce qu’une admiration mal entendue pour, Molière a fait imaginer depuis. Mais prétendre qu’elle fut une épouse irréprochable serait aussi hasardeux qu’affirmer son inconduite. Il n’y a pas, dit-on, de fumée sans feu, et ici la fumée est particulièrement épaisse et noire. Le mieux est de garder une réserve fort sage en pareil cas. On peut, tout au plus, admettre comme l’expression possible de la vérité ces paroles que Grimarest met dans la bouche de Molière : Cette femme, cent fois plus raisonnable que je ne le suis, veut jouir agréablement de la vie ; elle va son chemin ; et, assurée par son innocence, elle dédaigne de s’assujettir aux précautions que je lui demande. Je prends cette négligence pour du mépris ; je voudrais des marques d’amitié pour croire que l’on en a pour moi, et que l’on eût plus de justesse dans sa conduite pour que j’eusse l’esprit tranquille. Mais ma femme, toujours égale et libre dans la sienne, qui seroit exempte de tout soupçon pour tout autre homme moins inquiet que je ne le suis, me laisse impitoyablement dans mes peines ; et, occupée seulement du désir de plaire en général comme toutes les femmes, sans avoir de dessein particulier, elle rit de ma faiblesse. Il y a bien là un air d’arrangement, une insistance maladroite sur la parfaite innocence d’Armande, qui compromettent la cause même que Grimarest veut servir. Mais, en fait, il ne serait pas impossible que ce passage traduisit l’opinion moyenne des contemporains de Molière et que cette opinion fût conforme à la vérité. Ainsi Molière aurait été malheureux surtout de n’être pas aimé, jaloux, mais sans croire à l’infidélité de sa femme, et Armande une coquette aimant plus les manèges de l’amour et les satisfactions de vanité qu’ils procurent que l’amour lui-même. Si ce n’est point là un caractère très sympathique, encore vaut-il mieux que l’Armande de convention.
Du reste, une fois veuve, il semble qu’elle comprit tout à coup la perte qu’elle avait faite et s’efforça de réparer son erreur dans la mesure du possible. Elle porta dignement le deuil de son mari, elle assura le respect de sa mémoire, elle contribua grandement à empêcher la ruine du théâtre qu’il avait fondé, et lorsque enfin elle put songer à elle-même, elle sut, quoiqu’on en ait dit, concilier ce qu’elle devait au grand nom qu’elle avait partagé avec son droit d’arranger son existence à sa guise.
On sait les tristes incidens qui marquèrent les funérailles de Molière. Frappé d’une mort presque subite, il n’avait pu faire la renonciation dont l’église s’assurait toujours avant d’accorder aux comédiens la sépulture religieuse. Il est certain que les souvenirs de Tartufe et de Don Juan, furent pour beaucoup, d’abord, dans le refus du curé de Saint-Eustache, puis dans la mauvaise grâce de l’archevêque à exécuter la volonté de Louis XIV ; mais, en somme, le prélat comme le curé ne faisaient qu’appliquer une règle strictement suivie en pareil cas. La veuve de Molière eut donc à vaincre des résistances d’autant plus fortes qu’elles s’appuyaient sur une prescription formelle et sur une antipathie particulière inspirée au clergé par le défunt. Il faut lui tenir compte de la douleur sincère dont elle donna les marques, de la noblesse de son attitude, de son énergie. Accompagnée du curé d’Auteuil, elle courut à Versailles se jeter aux pieds du roi ; elle supplia, mais avec fierté, avec courage. Non contente de s’écrier : Quoi ! l’on refuse la sépulture à un homme qui, dans la Grèce, eût mérité des autels ! » elle ne craignit pas de dire que « si son mari était criminel, ses crimes avaient été autorisés par Sa Majesté même. C’était logique, mais hardi. Avec ce tact qui était une de ses qualités royales, Louis XIV fit respecter à la fois sa dignité, celle de l’archevêque, Harlay de Chanvalon, fort méprisable comme homme, mais, en somme, son archevêque de Paris, et la justice due à Molière : il congédia la veuve en disant que l’affaire ne dépendait pas de lui et il manda au prélat qu’il fît en sorte d’éviter l’éclat et le scandale.Le soir des funérailles, la foule s’amassait devant la maison mortuaire, non sans doute, comme on le dit habituellement, pour insulter le cercueil : les Parisiens n’ont jamais été de grands rigoristes. Molière les avait beaucoup amusés ; enfin, ils sont presque toujours respectueux devant la mort. Il est à croire qu’ils obéissaient ce soir-là à des sentimens assez mêlés : leur curiosité très vive pour tout ce qui touche au théâtre, la sympathie, enfin, et surtout leur éternel esprit badaud. Grimarest donne clairement à entendre que cette affluence de populaire était inoffensive et que, si la veuve en fut épouvantée, c’est qu’elle ne pouvoit pénétrer son intention. Dans l’incertitude, Armande employa un moyen infaillible de tourner à la bienveillance déclarée des dispositions douteuses : elle fit répandre par les fenêtres un millier de livres en priant avec des termes si touchans le peuple amassé de donner des prières à son mari, qu’il n’y eut personne de ces gens-là qui ne priât Dieu de tout son cœur.Sur la tombe elle fit placer une large pierre, et, deux ou trois ans après, durant un hiver rigoureux, on y alluma par son ordre un grand feu, auquel vinrent se chauffer les pauvres du quartier. Symbole touchant du génie de Molière ; la veuve ne voulait qu’honorer la mémoire de son mari par un acte de bienfaisance, mais la postérité a bien le droit de voir l’allégorie involontaire qui se dégage de cet acte. Ce foyer de chaleur, accessible à tous, et qui semble sortir de la tombe même du poète, n’est-ce pas l’image de son génie, cet autre foyer de raison, de poésie et de gaîté ?
Malgré le coup terrible qui la frappait, la troupe ne fit relâche que six jours ; il n’y avait pas de temps à perdre si elle voulait prouver son intention de survivre. Elle aurait pu se joindre immédiatement à l’hôtel de Bourgogne ; le roi le souhaitait et l’hôtel n’eût pas mieux demandé à, ce moment que d’accueillir le Palais-Royal : une longue rivalité aurait ainsi pris fin. Mais, accepter cette réunion, n’était-ce pas, de la part des camarades de Molière, manquer de respect à la mémoire de leur chef, auquel les grands comédiens avaient fait une guerre acharnée ? S’il devait un jour y avoir réunion, il fallait non pas que l’hôtel absorbât la troupe de Molière, mais qu’il fût absorbé par elle, qu’il y eût là pour les camarades de Montfleury et de Villiers défaite et non victoire. La Grange et Armande parvinrent à réaliser ce projet ; avec Louis XIV et Colbert, ils furent vraiment les fondateurs de la Comédie-Française. Il n’y a pas lieu, pour le moment, de raconter en détail par quels moyens : la part de La Grange y fut trop considérable, et il faudrait mêler à l’histoire d’Armande trop de faits qui regardent plutôt son camarade. Mais, comme lui, elle s’y dévoua tout entière ; elle y engagea une grosse part de sa fortune, elle y déploya une activité méritoire, car, Molière nous l’a dit, elle était naturellement nonchalante. Elle aussi triomphait, lorsqu’une lettre de cachet du 21 octobre 1680 ordonna qu’il n’y aurait plus à Paris qu’un seul théâtre français, le sien.
A cette date, un grand événement avait eu lieu dans l’existence d’Armande : depuis le mois de mai 1677, elle avait échangé le nom glorieux de Molière contre celui, beaucoup plus modeste, de son camarade François Guérin d’Estriché. On lui a reproché ce second mariage avec beaucoup de sévérité. La veuve de Molière se remarier ! On dirait vraiment qu’elle a commis un crime, ou plutôt un sacrilège ; car, depuis tantôt un siècle, Molière est passé dieu. Il faut pourtant tenir compte, en ceci comme en toutes choses, de la différence des temps et des idées. Dans les années qui suivirent sa mort, Molière n’était pas encore regardé comme le génie prodigieux que nous voyons en lui. Sauf pour quelques-uns, comme Boileau, qui mesuraient toute l’étendue de cette perte, ce n’était qu’un très amusant comédien, qu’un excellent auteur, dont on regrettait la mort prématurée, mais dont on ne songeait nullement à faire l’apothéose. Quant à sa veuve, elle ne songeait pas davantage à faire d’elle-même une relique. Elle était jeune encore, plus belle que jamais ; elle n’avait pas été heureuse dans son premier mariage ; la vie lui devait un dédommagement. Ce dédommagement s’offrit à elle sous les espèces d’un fort honnête homme, bien fait, estimé dans son art ; pourquoi aurait-elle joué sans conviction le rôle d’une Andromaque inconsolable ? Soyons indulgens pour elle, en raison même de cette délicatesse morale et de ces scrupules qui nous honorent et qui lui manquaient. D’autant plus qu’elle avait bien besoin d’un homme pour la protéger et mettre fin par sa seule présence à une situation des plus pénibles. Depuis son veuvage, en effet, elle se trouvait en butte à des attaques multipliées. Outre le soin de ses affaires, ses intérêts dans l’exploitation du théâtre, sa situation jalousée dans la troupe, elle avait eu de très graves ennuis. Ç’avait été d’abord son affaire avec un président au parlement de Grenoble, M. de Lescot. Magistrat galant et coureur, ce Lescot était par surcroît, emporté, brutal, capable de toutes les maladresses. Il s’était déjà compromis dans de fâcheuses aventures ; à la suite d’une escapade nocturne, on l’avait trouvé roué de coups et laissé pour mort sur le pavé de Paris. Très épris d’Armande, mais n’osant se déclarer directement, il se servit d’une entremetteuse, la Ledoux. Par une rencontre singulière, celle-ci avait à sa disposition une femme La Tourelle, qui ressemblait à s’y méprendre à Mlle Molière et qui en profitait de façon très lucrative dans l’exercice de son métier, se faisant passer auprès des naïfs ou des ignorans pour la brillante comédienne de la rue Guénégaud. Facilement abusé par les deux femmes, Lescot profita quelque temps en secret de sa prétendue bonne fortune ; il suivait assidûment les représentations d’Armande, mais il gardait sur le théâtre une réserve que La Tourelle lui avait expressément ordonnée. Un soir il n’y tient pas, s’introduit dans la loge d’Armande et se permet des familiarités. Elle s’indigne, il s’emporte ; dans un collier qu’elle portait, il croit en reconnaître un dont il avait fait présent à La Tourelle et il le lui arrache ; la garde arrive au bruit et il est arrêté. Une information judiciaire suivit naturellement, et un arrêt du parlement de Paris, en date du 17 octobre 1675, condamna le président à faire amende honorable devant témoins à Mlle Molière, et les femmes Ledoux et La Tourelle à être fustigées, nues, de verges, au-devant de la principale porte du Châtelet et devant la maison de Mlle Molière ; ce fait, bannies pour trois ans de Paris. On est frappé de l’étrange ressemblance que présente cette affaire avec celle du Collier, qui, en 1785, compromit le nom de Marie-Antoinette. Les mêmes rôles sont repris à cent dix ans de distance, celui d’Armande par la reine, celui de l’entremetteuse Ledoux par la comtesse de La Motte, celui de la femme La Tourelle par la demoiselle Oliva, enfin celui du président Lescot par le cardinal de Rohan. Et pour que rien ne manque au parallèle, de même que la reine fut salie par un infâme libelle publié à Londres par Mme de La Motte, Armande eut à subir la Fameuse Comédienne. Moins d’un an après éclatait un nouveau scandale, plus pénible encore pour la veuve de Molière, le procès Guichard. Ce fut le 16 juillet 1676 que l’ennemi de Lulli lança le factum où elle était si maltraitée. J’ai assez parlé du personnage pour qu’il ne soit pas utile de le présenter à nouveau. Mais les imputations infamantes que nous connaissons déjà n’étaient qu’une faible partie des injures dont il couvrait Armande. Il est impossible de transcrire au long le passage qui la concerne ; quelques lignes feront juger du reste : La Molière, disait-il, est infâme de droit et de fait, c’est-à-dire par sa profession et son inconduite ; avant que d’être mariée, elle a toujours vécu dans une prostitution universelle ; pendant qu’elle a été mariée, elle a toujours vécu dans un adultère public ; enfin, qui dit La Molière dit la plus infâme de toutes les infâmes. L’exagération même de ces injures leur enlève jusqu’à l’apparence du sérieux, d’autant plus que Guichard traite avec la même violence de calomnies sans preuves tous ceux dont il redoute le témoignage. Il était très protégé, semble-t-il, en raison de sa charge d’intendant des bâtimens de Monsieur ; mais il n’y eut pas moyen de lui épargner les conséquences de sa mâle rage. L’accusation d’empoisonnement qui pesait sur lui fut reconnue fondée et, le 27 février 1676, il s’entendit condamner au blâme, à l’amende honorable, à 4,000 livres de dommages-intérêts et 200 livres d’amende ; les imprimeurs de son factum devaient être appréhendés au corps et poursuivis. On remarquera la sévérité avec laquelle la justice frappait à deux reprises deux accusateurs d’Armande. Si elle eût été la femme absolument décriée que disent ses ennemis, aurait-elle obtenu réparation aussi complète ?
On trouvera sans doute que les ennuis suscités à la malheureuse femme par ces deux affaires suffisaient, avec le soin de son théâtre et l’exercice de sa profession, pour l’absorber tout entière et lui enlever tout désir de suivre des intrigues galantes. Aussi n’y a-t-il pas lieu de discuter celles que la Fameuse Comédienne lui prête encore à la même époque. Pouvait-elle, ainsi tourmentée, calomniée, surchargée d’embarras de tout genre, ne pas désirer un protecteur et un appui ? Peut-on, sa situation une fois connue, ne pas reconnaître que la nécessité d’un second mariage s’imposait à elle ? Ce qui prouve bien que, dans le premier, tous les torts n’étaient pas de son côté, c’est que, devenue la femme de Guérin, elle vécut parfaitement heureuse et que sa conduite ne donna plus lieu à aucun bruit fâcheux. L’auteur de la Fameuse Comédienne, lui-même, est obligé de le reconnaître ; il s’empresse, naturellement d’expliquer cette sagesse à sa façon en disant qu’Armande avait trouvé cette fois un maître impérieux et dur ; mais les témoignages désintéressés s’accordent à représenter Guérin comme un excellent homme. Il faut ajouter à l’honneur de l’un et de l’autre que, dans leur ménage, la mémoire de Molière fut entourée non-seulement de respect, mais de vénération. Ce sont les propres termes qu’employait en parlant du premier mari de sa mère, un fils né de leur mariage : en 1698, à peine âgé de vingt ans, ce jeune homme avait imaginé d’achever et de mettre en vers libres la Mélicerte de Molière, et c’est dans la préface de ce travail bien inutile qu’il s’exprimait de cette façon.
Depuis lors, Armande continua sans incidens sa carrière de comédienne, jusqu’à ce qu’elle prit sa retraite, en 1694, à la clôture de Pâques. Le bonheur qu’elle trouvait dans sa nouvelle famille, et aussi la nonchalance naturelle que nous lui connaissons par Molière, l’avaient détachée peu à peu de son art ; elle n’avait encore que cinquante-deux ans, et elle aurait pu briller longtemps encore, à une époque où les comédiennes, même les ingénues et les grandes coquettes, s’éternisaient volontiers dans leur emploi, car, dans un théâtre où un public constant les voyait chaque jour, il ne s’apercevait pas qu’elles vieillissaient. Mais elle s’attachait de plus en plus à son intérieur, où elle vivait très retirée, au fils qu’elle avait eu de Guérin, enfin à une riante maison des champs qu’elle possédait à Meudon et où elle passait tout le temps que lui laissait le théâtre. Cette maison existe encore, au n° 11 de la rue des Pierres, à peu près telle qu’Armande l’a laissée, avec sa porte à plein cintre et ses pavillons dans le style du temps, comme aussi le jardin avec ses allées géométriques, ses charmilles et son berceau de vigne. Elle mourut à Paris, rue de Touraine, le 30 novembre 1700, âgée de cinquante-huit ans. Son acte de décès, ne fait, naturellement, aucune mention de Molière, dont elle ne portait plus le nom : elle n’en reste pas moins pour la postérité, en dépit de ce brave Guérin, la veuve de Molière, celle qui a vécu onze ans près de lui, l’interprète et l’inspiratrice de ses chefs-d’œuvre. Elle le fit souffrir, mais la souffrance est une part de l’inspiration, et, peut-être, sans elle, n’aurions-nous pas le Misanthrope.
La famille Béjart
Famille de Comédiens parisiens issus de Joseph Béjart, sieur de Belleville, huissier audiencier à la grande maîtrise des Eaux et Forêts, et de Marie Hervé. Cinq de leurs dix enfants lient leur destin à celui de la troupe de Molière.
Joseph BÉJART 1616 ou 1617-1659 contribue en 1643 à la création de L’Illustre Théâtre qu’il quitte de 1644 à 1655. Il interprète, en dépit de son bégaiement, les rôles de jeune premier. Pris d’un malaise en jouant Lélie, dans L’Étourdi, il meurt quelques jours plus tard.
Madeleine BÉJART 1618-1672, sœur du précédent, mène une jeunesse assez libre, et a une fille du comte de Modène en 1639, avant de se consacrer au théâtre et de devenir une comédienne accomplie. Un contemporain, G. de Scudéry, fait d’elle ce portrait élogieux : Elle était belle, elle était galante, elle avait beaucoup d’esprit, elle chantait bien ; elle dansait bien ; elle jouait de toute sorte d’instruments ; elle écrivait fort joliment en vers et en prose et sa conversation était fort divertissante. Elle était de plus une des meilleures actrices de son siècle et son récit avait tant de charmes qu’elle inspirait véritablement toutes les feintes passions qu’on lui voyait représenter sur le Théâtre. C’est par amour pour elle, selon Tallemant des réaux, que Molière quitte les bancs de la Sorbonne et qu’ils fondent ensemble en 1643 L’Illustre Théâtre. Il ajoute : Je ne l’ai jamais vu jouer ; mais on dit que c’est la meilleure actrice de toutes …. Son chef-d’œuvre, c’était le personnage d’Épicharis, à qui Néron venait de faire donner la question, dans La Mort de Sénèque, de Tristan L’Hermite. On lui doit, en outre, une adaptation du Don Quichotte de Guérin de Bouscal. Dans le registre comique, elle joue d’abord le rôle de Marinette dans Le Dépit amoureux, de Magdelon, dans Les Précieuses ridicules, celui de la Nymphe, dans le prologue des Fâcheux, puis elle s’oriente vers les emplois de servante, telle Dorine, dans Le Tartuffe, ou de femme d’intrigue, comme Frosine dans L’Avare.
Geneviève BÉJART 1624-1675, sœur des précédents, est beaucoup plus effacée dans la troupe de L’Illustre Théâtre qu’elle a contribué pourtant à fonder, jouant les confidentes et les utilités sous le nom de sa mère, Mlle Hervé.
Louis BÉJART, dit l’Éguisé 1630-1678, frère des précédents, fait partie de la troupe, non pas au début, mais au moins depuis le moment où elle obtient le Théâtre du Petit-Bourbon, en 1658. Il boite, et cela contribue sans doute à le cantonner dans les emplois secondaires de vieillards ou de valets, comme celui de La Flêche, dans L’Avare, dont Harpagon dit, faisant allusion à sa disgrâce : ce chien de boiteux-là. En 1670, il devient officier au régiment de La Ferté.
Armande BÉJART 1640 ou 1642-1700, sœur ou fille de Madeleine, de vingt ans sa cadette, joue dès 1653 les rôles d’enfant sous le nom de Mlle Menou, avant de devenir l’épouse de Molière le 20 février 1662. Les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne, dans leur lutte contre la troupe de Molière, médisent de ce mariage, accusant le dramaturge d’avoir épousé sa propre fille, ce qui est sans fondement. De cette union naissent trois enfants dont une seule, Esprit-Madeleine, survivra à son père.
Armande, qui semble, d’après les contemporains, plus gracieuse que belle, est coquette et fort courtisée, mais ses prétendues infidélités n’ont jamais été établies. Elle crée généralement les premiers rôles féminins tels que celui d’Elmire, dans Le Tartuffe, d’Angélique, dans Le Malade imaginaire, probablement celui de Célimène, dans Le Misanthrope, de Lucile, dans Le Bourgeois gentilhomme, et d’Henriette, dans Les Femmes savantes ; mais elle joue également les rôles tragiques, Cléophile, dans Alexandre de Racine, Flavie dans Attila, et Bérénice dans Tite et Bérénice de Corneille.
Après la mort de Molière, elle veille avec La Grange à la survie de l’œuvre du poète et épouse en secondes noces Isaac François Guérin d’Estriché, lui-même comédien du Marais. Elle joue à l’Hôtel Guénégaud et à la Comédie-Française jusqu’à sa retraite, en 1694, les rôles que Molière a écrits pour elle.
Liens
http://youtu.be/A6OZd8HXHIg La maison de Armande Béjart
http://www.ina.fr/video/CPF03001362/m ... iage-d-armande-video.html Le mariage d'Armande
http://www.ina.fr/video/CPF03001383/m ... ort-de-moliere-video.html La mort de Molière
              
Posté le : 29/11/2014 21:06
|
|
|
|
|
Oscar Wilde |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 30 novembre 1900 à 46 ans, meurt à Paris Oscar Wilde

dont le nom complet est Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, écrivain Romancier Dramaturge, Poète, britannique d'origine irlandaise, né à Dublin le 16 octobre 1854, il écrit roman, Théätre et nouvelles dans la mouvance "esthétisme", ses Œuvres les plus remarquables sont : "L'Importance d'être Constant" en 1895 et " Le Portrait de Dorian Gray " en 1890.
La célébrité d'Oscar Wilde tient à son destin. Prodigieusement doué, d'un esprit étincelant qui subjugua la société londonienne, fin lettré, nourri de Swinburne, de Ruskin, de Walter Pater, il a surtout été considéré comme un esthète décadent et révolté : son procès pour mœurs acheva de faire de lui une figure publique entourée d'éclat, de honte et de scandale. Lui-même savait combien la vie empiétait dangereusement sur son art et sur sa personne quand il confiait à Gide avoir mis tout son génie dans sa vie et son talent seulement dans son œuvre. Son personnage fut, et par sa propre faute, entouré par une légende de causeur génial et d'écrivain mineur, mais ses poèmes, son roman Le Portrait de Dorian Gray, sa correspondance, dont la lettre si importante dite De profundis écrite à lord Alfred Douglas en 1897, révèlent une personnalité divisée et tragique, un profond narcissisme, une attirance de l'échec qui l'apparentent aux romantiques et sur lesquels il faut de nouveau s'interroger.
Il naît dans la bourgeoisie irlandaise et protestante de Dublin, d’un père ophtalmologiste renommé et d’une mère poétesse, Oscar Wilde se distingue par un parcours scolaire brillant. Nourri de culture classique, couronné de prix au sein du Trinity College de Dublin, il intègre le Magdalene College de l'université d’Oxford, où il se construit un personnage d’esthète et de dandy, sous l’influence des préraphaélites et des théories de L'art pour l’art de Walter Pater, John Ruskin ou Whistler. À l’issue de ses études, Wilde s’installe à Londres, où il parvient à s'insérer dans la bonne société et les cercles cultivés, s’illustrant dans plusieurs genres littéraires.
S’il publie, conformément aux exigences de l’esthétisme le plus pur, un volume de poésie, il ne néglige pas des activités moins considérées des cercles littéraires, mais plus lucratives : ainsi, il se fait le porte-parole de la nouvelle Renaissance anglaise dans les arts dans une série de conférences aux États-Unis et au Canada, puis exerce une prolifique activité de journaliste. Au tournant des années 1890, il précise sa théorie esthétique dans une série de dialogues et d’essais, et explore dans son roman Le Portrait de Dorian Gray en 1890 les liens entretenus par la beauté, la décadence et la duplicité. Sa pièce Salomé en 1891, rédigée en français à Paris l’année suivante, ne peut être jouée en Angleterre, faute d’avoir obtenu la licence d’autorisation, au motif qu’elle met en scène des personnages bibliques. Confronté une première fois aux rigueurs de la morale victorienne, Wilde enchaîne cependant avec quatre comédies de mœurs, qui font de lui l’un des dramaturges les plus en vue de Londres. Indissociables de son talent littéraire, sa personnalité hors du commun, le mordant de son esprit, le brillant de sa conversation et de ses costumes assuraient sa renommée.
Au faîte de sa gloire, alors que sa pièce maîtresse L'Importance d'être Constant 1895 triomphe à Londres, Oscar Wilde poursuit le père de son amant Alfred Bruce Douglas pour diffamation, après que celui-ci a entrepris de faire scandale de son homosexualité. Après une série de trois procès retentissants, Wilde est condamné pour grave immoralité à deux ans de travaux forcés. Ruiné par ses différents procès, condamné à la banqueroute, il écrit en prison De Profundis, une longue lettre adressée à son amant dont la noirceur forme un contraste saisissant avec sa première philosophie du plaisir. Dès sa libération en mai 1897, il quitte définitivement la Grande-Bretagne pour la France. C’est dans ce pays d’accueil qu’il met un point final à son œuvre avec La Ballade de la geôle de Reading 1898, un long poème commémorant l’expérience éprouvante de la vie en prison. Il meurt à Paris en 1900, dans le dénuement à l'âge de quarante-six ans.
En bref
L'hérédité et l'éducation jouent un rôle particulièrement important dans la vie d'Oscar Wilde : sa mère, Jane Francisca Elgee, ardente poétesse qui avait choisi comme pseudonyme Speranza, collaborait au journal nationaliste irlandais The Nation quand un procès retentissant mit fin à ses activités littéraires. Comme d'autres furent accusés d'avoir composé les appels aux armes dont elle était l'auteur, elle revendiqua la paternité de ses écrits. Cette Junon théâtrale, courageuse, capable de grandeur comme de grotesque, finit par épouser William Wilde, oculiste célèbre et chirurgien, don Juan obstiné, d'une infatigable activité. La carrière brillante de ce médecin fut à son tour interrompue par les accusations venimeuses d'une maîtresse abandonnée, d'où un procès entouré de ridicule qui signa la déchéance d'un des hommes les plus remarquables d'Irlande. Oscar Wilde et son frère, Willie, assistèrent à cette lente dégradation qui se termina par la mort de leur père avant la cinquantaine.
À la naissance d'Oscar à Dublin, lady Wilde désirait à tout prix une fille ; elle déguisa sa déception en travestissant son fils qui fut élevé comme la fille qu'elle n'avait pas eue. La naissance d'une petite Isola n'y changea rien et la mort à l'âge de neuf ans de cette sœur fut un grand drame dans l'enfance de Wilde : Toute ma vie est enterrée là, jetez de la terre dessus, écrira-t-il dans un poème. Drame d'autant plus marquant que la mère demeurait, plus que jamais, l'unique figure féminine qui sût le retenir. Ainsi ce fils d'un couple fantasque, original, ce produit d'une famille sale, désordonnée, hardie, imaginative et cultivée, selon les termes de Yeats, sera-t-il la victime d'une enfance étrange et d'une hérédité aux mains chargées de présents. Ce n'est pas notre propre vie que nous vivons, mais la vie des morts, écrira-t-il dans Intentions 1891. Comme le souligne Robert Merle dans le remarquable ouvrage qu'il lui a consacré, le goût du vêtement, de l'apparence, du travesti et du mot d'esprit hérité de sa mère, le deuil d'Isola qui le frustrait d'une présence féminine bénéfique, un mariage sans passion durable avec une jeune héritière, Constance Lloyd, dépourvue de personnalité, le dégoût du physiologique et de la procréation, la peur de la vieillesse, un narcissisme insatiable parce que dès l'abord blessé, une nature fluctuante et masochiste, tout prédisposait Wilde à l'homosexualité. Certes, ses goûts devaient déjà être définis dès son adolescence, il fit ses études au Trinity College de Dublin en 1871-1874, et à Oxford en 1874-1878, mais ce fut la rencontre d'Alfred Douglas qui les affirma avec éclat. Étrangement, le roman d'Oscar Wilde Le Portrait de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, 1891 précéda cette passion, et l'on ne peut qu'être frappé par la prescience que dévoile ce récit du sort qui attendait son auteur. Le père de Douglas, homme irascible et violent, accusa Wilde de pervertir son fils par ses mœurs ; Wilde releva le défi, d'où le troisième procès de la famille Wilde, à l'image de ceux qui le précèdent. L'attitude de Wilde révèle une identification à la mère dans le fait qu'il ne chercha aucunement à éviter l'accusation ; et l'on devine le souvenir de la dégradation paternelle dans une sorte de vertige de l'échec et de l'autopunition, car, après l'épreuve du procès qui s'était terminé par une condamnation à deux ans de travaux forcés à la geôle de Reading, Wilde s'enfonça dans la maladie et la tristesse. C'est en prison qu'il composa De profundis, sorte de règlement de comptes bouleversant avec Alfred Douglas et document des plus révélateurs sur sa propre nature. Il y commença sa fameuse Ballade de la geôle de Reading, The Ballad of Reading Gaol, 1898, qu'il termina en Italie au sortir de prison. Wilde, qui séjourna près de Dieppe, puis à Naples où il retrouva Douglas, adopta comme pseudonyme Melmoth, nom du Juif errant dans le roman de l'écrivain irlandais Charles Robert Maturin, son grand-oncle. Il mourut d'une méningite à Paris, et il est enterré au cimetière du Père-Lachaise.
Sa vie
Oscar Wilde est né au 21, Westland Row à Dublin, aujourd'hui le siège de l'Oscar Wilde Centre, Trinity College. Il est le second des trois enfants de Sir William Wilde et de Jane Francesca Elgee, de deux ans le cadet de son frère aîné William.
Sa mère ne se départit jamais sa vie durant de son soutien à la cause nationaliste irlandaise, bien qu'elle restât fidèle à la tradition anglicane de ses grands-pères, tous deux pasteurs. Elle s'enorgueillissait tout particulièrement de ses poésies nationalistes, dont elle avait commencé la composition en 1845, après la mort du journaliste et poète Thomas Davis, l'une des figures de proue des Jeunes Irlandais. Publiées sous le pseudonyme de Speranza dans le journal The Nation, l'organe de presse du mouvement cofondé par Davis, ces poésies jouissaient d'une certaine estime dans le milieu littéraire irlandais. W. B. Yeats lui-même ne manquait pas d'en faire l'éloge.
Les poèmes des Young Irelanders, que leur mère leur lisait régulièrement, firent dès le plus jeune âge partie intégrante de l'univers culturel dans lequel baignaient les deux frères Oscar et Willie Wilde. Les peintures et les bustes antiques dont la maison familiale était ornée témoignaient quant à eux de l'engouement maternel pour la mode néo-classique de l'époque. L'influence de Jane Wilde sur Oscar ne se limita pas au cadre culturel dans lequel grandit son fils : elle ne cessa, dès qu'elle eut perçu chez lui les prémices d'une vocation littéraire, de l'encourager et de la nourrir.
William Wilde était un médecin oculiste éminent, il soigna notamment la reine Victoria elle-même, Napoléon III ou le roi de Suède Oscar II qui tint à le remercier en devenant le parrain d'Oscar Wilde, d'où le prénom original donné à celui-ci. William Wilde fut annobli, et devint chevalie en 1864 pour les services rendus comme conseiller médical et commissaire adjoint au recensement de l'Irlande. Il était par ailleurs versé dans l'érudition locale et écrivit plusieurs ouvrages traitant de l'archéologie et du folklore irlandais. Philanthrope reconnu, il ouvrit un dispensaire à l'intention des pauvres de Dublin qui préfigurait le Dublin Eye and Ear Hospital, situé de nos jours à Adelaide Road.
En 1855, la famille Wilde emménagea au 1, Merrion Square, où leur fille Isola vit le jour deux ans plus tard. La nouvelle résidence, à la hauteur de la notoriété grandissante du couple, lui permit de tenir un salon composé de l'élite culturelle et médicale de la ville. Ces réunions, qui se tenaient les samedis après-midis, pouvaient réunir jusqu'à cent invités, et comptaient parmi ses habitués des noms tels que Sheridan Le Fanu, Charles Lever , George Petrie, Isaac Butt, William Rowan Hamilton et Samuel Ferguson.
Sa mère Jane Francesca Elgee aurait préféré une fille à la naissance d'Oscar, elle l'éleva comme tel jusqu'à l'âge de sept ans : toute sa vie Oscar Wilde restera dans sa tête ce jeune garçon ambigu, transformé par sa mère en petite idole hindoue. Jusqu'à l'âge de neuf ans, Oscar Wilde fut éduqué à domicile, sous la garde d'une bonne française et d'une gouvernante allemande. Il fréquenta ensuite la Portora Royal School à Enniskillen, dans le comté de Fermanagh, établissement qui se targuait d'être l'Eton irlandais. Pendant son adolescence, il passa l'essentiel de ses étés dans la villa familiale de Moytora, dans le comté de Mayo où il fréquentait avec son frère le futur écrivain George Moore. Sa jeune sœur Isola mourut à 11 ans d'une méningite. Wilde lui a dédié le poème Requiescat.
Études supérieures Trinity College
Wilde quitta Portora en ayant obtenu une bourse royale pour le prestigieux Trinity College de Dublin qu'il fréquenta de 1871 à 1874, en compagnie de son frère, dont il partageait la chambre. Il reçut l'enseignement de R.Y. Tyrell, Arthur Palmer, Edward Dowden et surtout de son tuteur, le révérend J.P. Mahaffy, vieil érudit qui éveilla son intérêt pour la culture grecque antique et la passion des questions nobiliaires. Malgré des réserves tardives, Wilde tenait encore en 1893 Mahaffy pour son premier et meilleur maître, celui qui lui apprit à aimer les œuvres grecques. De son côté Mahaffy se vanta dans un premier temps d'avoir créé Wilde, puis dans un second temps, après les revers de fortune de son élève, déplora qu'il fût la seule tache de son tutorat. Les deux hommes entretenaient à l'époque une relation suffisamment étroite pour que Mahaffy jugeât de citer nommément son élève en exergue de son ouvrage Social Life in Greece from Homer to Menander.
Cette découverte de l'hellénisme alla pour Wilde de pair avec un approfondissement de ses conceptions esthétiques, qui commencèrent à se préciser. Outre les enseignements de Mahaffy, il subit pendant cette période l'influence des poètes et des peintres préraphaélites, en premier lieu de Dante Gabriel Rossetti et d'Algernon Swinburne, qui orienta ses lectures vers Baudelaire puis Walt Whitman. Sous l'effet de ces théories esthétiques, inséparables d'une conception plus générale, et assez exigeante, des rapports entre l'art et la vie, il commença à modeler le personnage d'esthète qui devait faire sa réputation.
Wilde devint également un membre actif de l'University Philosophical Society, une société de débats qui publiait une feuille de chou. Remarqué pour ses activités parascolaires, il brillait également sur le terrain plus proprement académique : premier de sa classe lors de sa première année, récipiendaire d'une bourse par concours la seconde, il remporta finalement la médaille d'or de Berkeley, la récompense suprême de l'université en grec pour clore son cursus. Il était dans la logique du système universitaire britannique qu'un élève aussi brillant intégrât l'une des prestigieuses universités anglaises. Encouragé par Mahaffy, il postula pour une bourse spéciale du Magdalene College de l'université d'Oxford, qu'il remporta aisément.
Oxford
Pendant sa scolarité à Oxford, Wilde gagna rapidement une certaine renommée parmi ses condisciples pour son esthétisme affiché et son rôle dans le mouvement décadent. Il portait les cheveux longs, méprisant ouvertement les sports virils, qui jouaient un rôle central dans la vie sociale des étudiants d'Oxford, bien qu'il pratiquât occasionnellement la boxe. Dans sa chambre, les plumes de paon, les fleurs de lys ou de tournesol côtoyaient des porcelaines de Chine bleues, des photographies du pape et des gravures de peintres préraphaélites. Il confia un jour à des amis qu'il lui était chaque jour plus difficile de se montrer digne de sa porcelaine bleue ; la phrase fit rapidement le tour du campus, reprise comme un slogan par les esthètes et utilisés contre eux par ceux qui l'érigeaient en symbole de leur vacuité. L'hostilité de certains étudiants contre ces excentriques qui se distinguaient par leurs poses languides et leurs costumes tape-à-l'œil pouvait parfois tourner à la provocation physique. Attaqué par un groupe de quatre jeunes gens, Wilde désarçonna un jour tous ces critiques en répondant seul du tac au tac à l'aide de ses poings.
Dès sa troisième année à Oxford, il avait définitivement posé les bases de son personnage de dandy et assis sa notoriété, qui reposait pour partie sur la distance désinvolte qu'il adoptait avec l'imposante institution qu'était l'université d'Oxford. Il fut ainsi exclu provisoirement, après avoir manqué le début des cours à l'issue d'un voyage en Grèce en compagnie du Professeur Mahaffy.
Plusieurs professeurs d'Oxford exercèrent une influence décisive sur sa trajectoire. Si Wilde ne fit pas la connaissance de Walter Pater avant sa troisième année, il avait été enthousiasmé par la lecture de ses Studies in the History of the Renaissance, publiées alors qu'il était encore étudiant à Trinity24. Pater considérait que la sensibilité esthétique de l'homme devait être cultivée avant toute chose, et accordait une attention toute particulière à l'expérience, dont la splendeur et la terrible brièveté exigeaient qu'elle mobilise la concentration de tout notre être. Des années plus tard, dans De Profundis, Wilde reconnut l'influence si étrange que l'ouvrage de Pater avait eue sur sa vie. Il en connaissait des extraits par cœur et l'emporta avec lui en voyage jusque dans ses dernières années. Si Pater donna à Wilde son sens du dévouement à l'art, on peut créditer John Ruskin d'avoir donné un but à cet investissement esthétique.
La fin de son cycle oxonien fut couronnée de succès. Il sortit diplômé du Magdalene College en ayant obtenu les mentions les plus hautes first class honours dans ses deux matières principales après avoir remporté le prix de poésie de l'université d'Oxford, le Newdigate Prize, exercice de style dont le thème imposé était cette année-là Ravenne. La ville ne lui était pas inconnue puisqu'il l'avait visitée l'année précédente. Ce prix assez prestigieux, doté de la somme confortable de 21 livres, lui donnait le droit à son récipiendaire de lire son poème lors de la cérémonie annuelle, mais lui assurait surtout une petite notoriété dans le monde des lettres.
Carrière artistique et premiers succès londoniens
Son diplôme en poche, Wilde retourna à Dublin où il rencontra Florence Balcombe, dont il s'amouracha, mais la jeune femme se fiança à l'écrivain Bram Stoker qu'elle épousa en 1878. Peu après avoir appris ses fiançailles, Wilde lui annonça son intention de retourner en Angleterre, probablement pour de bon. Incertain de la marche à suivre pour lancer sa carrière, il s'enquit d'abord auprès de plusieurs connaissances de positions libres à Oxbridge. Puis, profitant de la part d'héritage qu'il avait reçu de son père, il s'installa peu après, comme pensionnaire du peintre Frank Miles, d'abord près du Strand, puis à partir de 1880 au 1, Tite Street dans le quartier de Chelsea. La capitale paraissait être la rampe de lancement idéal pour un apprenti artiste ambitieux. Wilde put y profiter des relations dont Miles bénéficiaient déjà dans le monde du théâtre londonien. Il devint proche des comédiennes Lillie Langtry, Ellen Terry, avant de devenir un intime de Sarah Bernhardt.
Bien qu'il se destinât avant tout à une carrière de critique d'art, ce fut par le biais de la poésie qu'il parvint à se faire un nom dans le monde littéraire de la capitale britannique. Dès son entrée à Trinity College, Wilde avait publié de la poésie dans de petites revues telles que Kottabos et le Dublin University Magazine. Inspiré par ses voyages en Grèce et en Italie, il n'avait depuis jamais cessé d'écrire, publiant occasionnellement dans des magazines. En 1881, un recueil titré Poems, publié quasiment à compte d'auteur, réunit ses premières compositions et des œuvres jusqu'alors inédites. Il reçoit un bon accueil et l'écoulement rapide des 750 premiers exemplaires rend nécessaire une nouvelle édition l'année suivante.
Tournée nord-américaine
Bien qu'il n'eût alors que peu produit, Wilde profita pleinement de la notoriété de son cercle d'amis pour faire valoir ses qualités mondaines ; il était déjà une figure suffisamment célèbre pour que son style hors norme fît l'objet de caricatures dans la presse. Cette notoriété prit une nouvelle ampleur en 1881 lorsque Gilbert et Sullivan, deux compositeurs en vogue, s'inspirèrent directement de Wilde pour l'un des personnages de leur nouvel opéra intitulé Patience35. Lorsque la pièce fut produite aux États-Unis, on lui proposa une série de conférences visant à familiariser le public américain aux ressorts de l'esthétisme britannique. Wilde arriva aux États-Unis le 3 janvier 1882, précédé d'une réputation d'homme d'esprit. Il s'empressa de confirmer cette réputation devant la foule venue l'accueillir dès sa descente de bateau en répondant à un douanier qu'il n'avait rien d'autre à déclarer que son génie.
Le succès fut au rendez-vous dans des proportions que les organisateurs n'avaient pas su prévoir : programmée initialement pour quatre mois, la tournée dura finalement plus d'un an, avec un crochet final par le Canada. Le séjour américain de Wilde lui fut finalement extrêmement profitable. Ce détour transatlantique, autorisé à l'origine par la petite notoriété dont il jouissait à Londres, lui permit en retour de se parer d'une aura plus grande encore qui affermit considérablement sa position en Angleterre. D'un point de vue intellectuel, l'exercice difficile de la conférence publique et la diversité des auditoires auxquels il fut confronté, se produisant aussi bien dans les salons de la grande bourgeoisie que face à des parterres d'ouvriers, lui permit d'affuter sa pensée dans le domaine de l'esthétique. Ces nouveaux développements, inspirés de la lecture de Théophile Gautier, Baudelaire ou William Morris, nourrirent directement les premiers essais qu'il devait publier à son retour en Angleterre.
Parenthèse parisienne
À peine revenu à Londres, Wilde s'embarqua pour Paris où il séjourna de février à la mi-mai 1883. Les revenus tirés de ses conférences et les gains qu'il attendait d'une pièce en cours d'écriture, La Duchesse de Padoue, lui permirent de revenir dans une ville qui avait déjà marqué son adolescence et était un des hauts lieux de la vie intellectuelle européenne. Il fit peu de temps après son arrivée la connaissance du jeune poète Robert Sherard qui devait devenir son biographe. L'ascendance glorieuse de Sherard, qui n'était autre que l'arrière-petit-fils du poète William Wordsworth, lui ouvrait les portes des plus illustres écrivains. Dans son sillage, Wilde put dîner chez Victor Hugo.
Son étape parisienne marqua un changement notable dans le style de Wilde, qui entra alors, selon Schiffer, dans sa deuxième période esthétique. Troquant ses tenues extravagantes contre des costumes toujours aussi soignés, mais plus sobres, il fit également couper ses fameux cheveux longs, qui lui valaient maints commentaires sarcastiques de la presse, pour une coupe qu'il qualifiait fièrement d'à la Néron. Paris marqua également la rencontre de Wilde avec le décadentisme français ; s'il fit la connaissance de Marcel Proust, il fut néanmoins beaucoup plus marqué par sa rencontre avec Maurice Rollinat, avec lequel il s'entretint à plusieurs reprises. Les soirées organisées par le peintre Giuseppe De Nittis furent également l'occasion pour Wilde de côtoyer les peintres impressionnistes Edgar Degas et Camille Pissaro.
Mariage
Dès son retour en Angleterre, Wilde convia Constance Lloyd, la fille d'Horace Lloyd, un riche conseil de la Reine, au thé dominical donné par sa mère. À l'issue d'une cour assidue, il se fiança avec la jeune femme le 26 novembre 1883, avant de l'épouser en grande pompe le 29 mai 1884 dans la très distinguée église St James, à Londres dans le quartier de Paddington. L'entreprise de séduction, savamment orchestrée, tombait à point nommé pour mettre fin aux racontars sur son homosexualité, qui s'étaient accentués lors de son séjour français. De cette union naîtront deux enfants, Cyril et Vyvyan. Avant même son mariage, le jeune couple s'afficha assez ouvertement lors de la série de conférences sur ses Impressions personnelles sur l'Amérique, La mode ou La valeur de l'art dans la vie moderne dans laquelle Wilde, à nouveau à court d'argent après son dispendieux séjour parisien, avait été contraint de se lancer. Le conférencier ne tarissait pas d'éloges sur sa nouvelle femme qui incarnait à ses yeux l'essence même du modèle préraphaélite et dont le caractère était trempé aux nouvelles idées féministes. Le 9 mai 1884, Oscar s'était rendu, avec son frère et sa mère, chez Charles Carleton Massey, pour assister à la première réunion de la loge théosophique de l'Hermetic Society.
Les revenus annuels de Constance Lloyd s'élevaient à 250 livres, somme généreuse pour une jeune femme, mais qui était bien le moins qu'il fallait à un chantre de l'esthétisme qui devait maintenant incarner les principes qu'il s'était fait profession d'enseigner aux autres. Le 16, Titre Street, qui devait abriter le jeune couple, fut rénové à grand frais, consumant l'intégralité des 5 000 livres d'avance sur héritage que le grand-père de Constance lui avait consenti. La villa dont la décoration fut confiée à l'architecte Edward William Godwin accueillit les trésors que Wilde avait amassés, comme le bureau de travail de Thomas Carlyle.
Il devint rédacteur en chef de The Womans' World. En 1886, il rencontra Robert Ross qui devient son amant et sera plus tard son exécuteur testamentaire.
Le Portrait de Dorian Gray
Publié dans sa première version le 20 juin 1890, Le Portrait de Dorian Gray The Picture of Dorian Gray est le produit d'une commande de l'éditeur américain J.M Stoddart pour sa revue, le Lippincotts Monthly Magazine. Il parut en volume, augmenté de six chapitres, l'année suivante aux États-Unis et en Angleterre et déclencha une tempête de protestations parmi les critiques anglais. La qualité littéraire du texte n'était certes pas mise en cause. À l'instar du Scots Observer, qui mena campagne contre le roman aux côtés du Daily Chronicle et de la St James Gazette, la plupart des critiques reconnaissaient à Wilde de l'intelligence, de l'art et du style. Ils lui reprochaient en revanche de compromettre ses qualités en illustrant des thèmes qui portaient atteinte à la morale publique. Art travesti que celui de Wilde, car son intérêt est d'ordre médico-légal ; il travestit la nature, car son héros est un monstre ; il travestit la morale, car l'auteur ne dit pas assez explicitement qu'il ne préfère pas un itinéraire de monstrueuse iniquité à une vie droite, saine et sensée.
Wilde ne fut pas pour rien dans l'ampleur que prit la controverse. Il ne se déroba pas face aux critiques et choisit de répondre avec vigueur à chacune des objections de ses détracteurs. Sa défense fut pour lui l'occasion de mettre en lumière, et parfois même de préciser, les lignes du programme qu'il venait de développer dans son essai Le Critique comme artiste 1891. Elle tenait dans l'affirmation de l'indépendance que l'art doit maintenir vis-à-vis de la morale, et plus généralement dans la supériorité de l'Esthétique sur l’Éthique.
En 1891, il rencontre Lord Alfred Douglas de Queensberry, s'en éprend et tous deux mènent une vie débridée en affichant en public leur homosexualité. Le père d'Alfred, John Douglas, 9e Marquis de Queensberry et frère de Florence Dixie, désapprouve cette relation et provoque Wilde à plusieurs reprises. Cela entraînera le scandale Queensberry et un procès.
Le scandale Queensberry
Lord Alfred Douglas, surnommé Bosie , et Oscar Wilde.
Le marquis de Queensberry a demandé à Wilde de s'éloigner de son fils. Début 1895, il remet au portier du club Albermarle, l’un des clubs d’Oscar Wilde, sa carte de visite où il écrit :
For Oscar Wilde posing as Somdomite
Pour Oscar Wilde, s’affichant comme Somdomite sic.l'orthographe fautive du mot sodomite créa en anglais le mot somdomite
Wilde décide alors de lui intenter un procès pour diffamation, qu'il perd. Le marquis se retourne contre Wilde.
C'est le premier des procès intentés contre Wilde. Il débute le 3 avril 1895. L'avocat de Queensberry, Edward Carson, va s'y révéler un accusateur habile et coriace, et les joutes verbales opposant les deux hommes vont rester fameuses. Wilde joue tout d'abord de son charme habituel, de son inégalable sens de la répartie, déclenchant l'hilarité du public, transformant par moment le tribunal en salle de théâtre. Mais il finit par se faire piéger pour un bon mot à propos de Walter Grainger, un jeune domestique de Lord Alfred Douglas à Oxford : Carson lui demandant s'il l'a jamais embrassé, Wilde répond Oh non, jamais, jamais ! C’était un garçon singulièrement quelconque, malheureusement très laid, je l'ai plaint pour cela. He was a particularly plain boy—unfortunately ugly—I pitied him for it.
Emprisonnement
Pressé par ses amis, Robert Ross en particulier, de s'enfuir sur le continent, il préfère attendre l'inéluctable. Daniel Salvatore Schiffer reprend l'explication de Yeats concernant cette attitude, citant les propos de Lady Wilde : "Si vous restez, et même si vous allez en prison, vous serez toujours mon fils.... Mais si vous partez, je ne vous adresserai jamais plus la parole"53. Il est arrêté le 6 avril dans sa chambre n°118 du palace londonien Cadogan Hotel, puis, après deux autres procès, il est condamné le 25 mai, en vertu d'une loi datant de 1885 interdisant l'homosexualité, à la peine maximale de deux ans de travaux forcés en 1895. Ses biens sont confisqués pour payer les frais de justice. Constance Lloyd, sa femme, se réfugie en Allemagne avec ses fils qui prennent le nom de Holland.
Après quatorze mois de travaux forcés et à la suite de son transfert de la prison de Reading, Wilde se voit accorder le privilège exceptionnel de la part du directeur de la prison de posséder un petit matériel d’écriture et reçoit la permission d’écrire à condition de remettre tous les soirs ses écrits, son papier et son stylo aux autorités pénitentiaires. Il n'écrira en prison que de la correspondance, et en particulier une longue lettre adressée à Alfred Douglas qui sera, après sa mort, publiée sur le nom de De Profundis. Les travaux forcés et l'enfermement l'affecteront au point qu'il ne produira qu'une seule œuvre après sa libération, elle-même sur le thème de la prison: La Ballade de la geôle de Reading. Durant son incarcération, il continue de recevoir la visite de Robert Ross. Alfred Douglas est, quant à lui, poussé à l'exil en France et en Italie pendant plus de trois ans.
Après sa libération de prison
Vitre plastique protégeant sa tombe recouverte de nombreuses traces de rouge à lèvres laissées par des fans.
Sa libération, en 1897, est un grand moment de joie, il s'exclame à de nombreuses reprises "Que le monde est beau" sur le quai de la gare, ce que ses amis lui reprochent puisqu'il lui est plus que nécessaire de se faire discret. Il souhaite épouser le catholicisme, à la suite de sa conversion spirituelle que lui a coûté la prison, et désire se retirer un an dans un cloître. Les Jésuites qu'il sollicite refusent d'accueillir un tel membre et lui conseillent d'attendre encore un an ou deux. Il quitte alors l'Angleterre pour la France, où il demeure quelque temps à Berneval, près de Dieppe en Normandie, sous le nom de Sébastien Melmoth, en référence au roman Melmoth, l'homme errant Melmoth the Wanderer, 1820 de Charles Robert Maturin, un des romans fondateurs du courant gothique en littérature, et du martyr Sébastien, personnage qui le fascine. Maturin était par ailleurs le grand-oncle de Wilde. Il vit sous la tutelle de Robert Ross, qui s'étonne de le voir se comporter tel un enfant. En effet, Wilde est très dispendieux alors même que ses ressources se sont taries. Traumatisé par son expérience de la prison, il semble avoir plus que besoin d'une présence à ses côtés, alors que Ross doit retourner à Londres pour affaires. Il s'étonne des réticences que Constance met à le rejoindre. Or cette dernière est non seulement très éprouvée, mais combat en plus la maladie. Extrêmement déçu, Wilde reçoit un billet de Lord Alfred Douglas et désire ardemment le retrouver malgré les avertissements de Ross et les menaces de Constance de lui couper les vivres. Vraisemblablement, Bosie n'a pas lu De Profundis, qui lui était pourtant originellement destiné, encore que cela fasse débat entre Ross qui devait le lui remettre, et Alfred Douglas qui assure encore dans son autobiographie ne l'avoir jamais eu en main. Finalement, une rencontre à Rouen le 28 août leur fait retrouver la vie commune. Et, après être passés par Paris afin d'obtenir les fonds nécessaires, généreusement offerts par O'Sullivan, les deux amants partent pour Naples en septembre 97. Ils entretiennent un train de vie très confortable, compte tenu de leurs revenus communs. Toutefois, lorsque Constance apprend la situation, elle met sa menace à exécution, et le couple s'enfonce alors dans le besoin.
Oisif, il sort avec ses amis ou fréquente de jeunes hommes prostitués à Paris. Commence alors une période de déchéance dont il ne sortira pas et, malgré l'aide de ses amis qui lui prêtent de l'argent, ses revenus littéraires étant devenus insuffisants, notamment André Gide, Robert Ross, il finit ses jours dans la solitude et la misère. Oscar Wilde meurt probablement d'une méningite, âgé de 46 ans, en exil volontaire à Paris, le 30 novembre 1900. Plusieurs causes de cette mort ont été données par ses biographes : méningite consécutive à sa syphilis chronique, il n'en a jamais montré de symptômes ; consécutive à une opération chirurgicale, peut-être une mastoïdectomie selon Merlin Holland, unique petit-fils d'Oscar Wilde ; les médecins de Wilde, le Dr Paul Cleiss et Tucker A'Court, pensent que cette inflammation des méninges est la conséquence d'une « ancienne suppuration de l'oreille droite d'ailleurs en traitement depuis plusieurs années.
Le 28 octobre 1900, il s'était converti au catholicisme. À cette occasion, la tradition voulant que l'on offre une coupe de champagne à un adulte qui se convertissait, il aurait eu ce mot : Je meurs comme j'ai vécu, largement au-dessus de mes moyens. Ses derniers mots, dans une chambre d'hôtel61 au décor miteux Hôtel d'Alsace, 13, rue des Beaux-Arts à Paris, devenu aujourd’hui L'Hôtel auraient été : Ou c'est ce papier peint qui disparaît, ou c'est moi. Guy-Louis Duboucheron, propriétaire de L'Hôtel, Jacques de Ricaumont et Maria Pia de Savoie présidente de l'Association des amis d'Oscar Wilde, ont créé le prix Oscar-Wilde remis par le Cercle Oscar-Wilde lors de la réouverture de l'établissement en 2000. Le premier prix a été attribué à Frédéric Mitterrand pour son livre Un jour dans le siècle.
Après un enterrement de sixième classe le dernier avant la fosse commune et une inhumation au cimetière de Bagneux, ses restes sont transférés en 1909 au cimetière du Père-Lachaise, division 89, à Paris. Son tombeau surmonté d’un monument s'inspirant d'un taureau ailé assyrien, conservé au British Museum et dont le visage est celui du dramaturge allusion au poème La Sphinge de Wilde, a été sculpté par l'artiste expressionniste Sir Jacob Epstein de 1911 à 1914.
Le drame de l'ambiguïté
Oscar Wilde connut les esprits les plus remarquables de l'Angleterre de son temps : Dante Gabriel Rossetti, Robert Browning, Meredith, Swinburne et Whistler. On n'a que trop insisté sur sa conversation éblouissante, son goût du paradoxe, ses aphorismes insolents, sur son cynisme et son humour que l'on retrouve dans les excellentes reparties de ses pièces. Entre 1887 et 1895, l'écrivain connut une période de grande créativité et de succès immédiat avec ses contes, comme Le Crime de lord Arthur Savile Lord Arthur Savile's Crime, 1891, son Portrait de Dorian Gray, roman prémonitoire étrangement torturé et puritain, ses pièces : L'Éventail de lady Windermere Lady Windermere's Fan, 1892, Une femme sans importance A Woman of No Importance, 1893, Un mari idéal An Ideal Husband, 1895, L'Importance d'être constant The Importance of Being Earnest, 1895. Mais l'intérêt de la personnalité de Wilde réside en son ambiguïté. Derrière l'insolence du dandy en apparence révolutionnaire se cache un autre Wilde, secrètement attiré par les forces de mort. Gide avait bien compris combien le théâtre de Wilde comportait sa propre image dans le tapis et que son esthétisme d'emprunt n'était pour lui qu'un revêtement ingénieux pour cacher en révélant à demi ce qu'il ne pouvait laisser voir au grand jour. Un autre écrivain aura l'intuition du fond tragique de l'œuvre wildienne : Hugo von Hofmannsthal. Dans son étude Sébastien Melmoth, il écrit : Le destin de cet homme aura été de porter successivement trois masques : Oscar Wilde, C. 3.3., Sébastien Melmoth, et de descendre vers la catastrophe du même pas qu'Œdipe aveugle et clairvoyant. Certaines hantises reviennent dans les contes, les essais et le théâtre, celles du masque, de la mort et de la femme liée à la destruction. Malgré la différence de ton entre leurs œuvres, ces hantises dénotent certaines affinités frappantes entre Wilde et Henry James : même passion du secret, même renversement des sexes, car les femmes sont fortes et les pères dominés ou absents Le Portrait de Mr. W. H., qui concerne le jeune inconnu des Sonnets de Shakespeare, a plus d'un point commun avec L'Image dans le tapis. Les essais groupés dans le recueil Intentions, où Wilde a exprimé sa théorie de l'art, mettent en relief la nécessité de remédier à l'inachèvement total de la nature par la création artistique et le rôle profond que doit jouer le masque dans l'œuvre et dans la vie. Ce rôle, la préface au Portrait de Dorian Gray l'annonçait déjà : Révéler l'art et cacher l'artiste, tel est le but de l'art. Le masque, pour Wilde, est lié au passé qu'il travestit ; comme il est posé sur un visage déjà existant, il demeure en quelque sorte commandé par ce qui fut. Aussi, rien de plus impitoyable : Un masque est plus révélateur qu'un visage ; ou encore : L'homme cesse d'être lui-même dès qu'il parle pour son propre compte, mais donnez-lui un masque et il vous dira la vérité Intentions.
En fait, on se demande si la scandaleuse homosexualité de Wilde, tant affichée par lui, ne masquait pas, justement, un amour passionné et passif pour sa mère. L'analyse de certains poèmes, par ailleurs fort beaux, comme Charmides 1881 ou Le Sphinx 1894 révèle un attachement ambivalent envers une figure maternelle omnisciente et dévoratrice. Ce fantasme incestueux est flagrant dans un roman érotique, Teleny, dont le manuscrit circulait en 1893 à Londres et dont certaines parties sont attribuées à Wilde par Montgomery-Hyde. La femme, l'amour, la mort se retrouvent dans la Salomé 1896écrite par Wilde en français, traduite en anglais par Alfred Douglas, et créée par Sarah Bernhardt en 1896 au théâtre de l'Œuvre. L'ouvrage fut illustré par Aubrey Beardsley. Salomé y fait couper la tête de Jokanaan avec l'accord d'Hérodias : c'est peut-être pour venger tant de victimes masculines dans son œuvre que Wilde s'intéressa à l'assassin Wainewright, qu'il choisit comme héros d'un de ses essais les plus frappants, Plume, pinceaux, poison. Wainewright était bien un personnage qui pouvait tenter Wilde : il était maudit dès sa naissance puisqu'il coûta la vie à sa mère en venant au monde.
On voit combien la complexité d'un tel auteur l'éloigne de la réputation superficielle qui fut sienne. Il apparaît comme l'héritier des derniers romantiques. Peut-être la clef d'un tel personnage se trouve-t-elle dans cette confession désabusée qu'il fit à la fin de sa vie à Laurence Housman : La mission de l'artiste est de vivre une vie complète et le succès n'en est qu'un aspect, l'échec en est la vraie fin.
Conceptions esthétique
En ces dernières décennies du XIXe siècle, Wilde incarne une nouvelle sensibilité qui apparaît en réaction contre le positivisme et le naturalisme.
Dans sa préface au Portrait de Dorian Gray, il défend la séparation de l'esthétique et de l'éthique, du beau et du moral :
« The artist is the creator of beautiful things. ... There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all. … No artist desires to prove anything. Even things that are true can be proved. … All art is quite useless.
L'artiste est le créateur de belles choses.… il n'y a pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien ou mal écrits. Voilà tout. … Aucun artiste ne désire prouver quoi que ce soit. Même une vérité générale peut être prouvée. … Tout art est plutôt inutile.
Vivian, le porte-parole de Wilde dans Le Déclin du mensonge, s'oppose clairement au mimétisme en littérature qu'implique le réalisme. Selon lui, la vérité est entièrement et absolument une affaire de style ; en aucun cas l'art ne doit se faire le reflet de l’humeur du temps, de l’esprit de l’époque, des conditions morales et sociales qui l’entourent. Wilde contestait d'ailleurs la classification d'Honoré de Balzac, dans la catégorie des réalistes : Balzac n'est pas plus un réaliste que ne l'était Holbein. Il créait la vie, il ne la copiait pas. Il ne cachait d'ailleurs pas son admiration pour Balzac, en particulier pour Illusions perdues, Le Père Goriot et surtout pour le personnage de Lucien de Rubempré dont il disait Une des plus grandes tragédies de ma vie est la mort de Lucien de Rubempré. C'est un chagrin qui ne me quitte jamais vraiment. Cela me tourmente dans les moments de ma vie les plus agréables. Cela me revient en mémoire si je ris.
Dans The Critic as Artist Le Critique en tant qu'artiste, Wilde s'oppose à une critique littéraire positiviste, qui voit dans l'objectivité le seul salut de la critique. Le critique, selon Wilde, ne doit considérer l'œuvre littéraire que comme un point de départ pour une nouvelle création, et non pas tenter d'en révéler, par l'analyse, un hypothétique sens caché. Selon lui, la critique n'est pas affaire d'objectivité, bien au contraire: le vrai critique n'est ni impartial, ni sincère, ni rationnel. La critique elle-même doit se faire œuvre d'art, et ne peut dès lors se réaliser que dans le subjectif ; à cet égard, dit Wilde, la critique est la forme la plus pure de l'expression personnelle. La critique ne peut caractériser l'art aux moyens de canons prétendument objectifs ; elle doit bien plutôt en montrer la singularité.
La théorie critique de Wilde a été très influencée par les œuvres de Walter Pater. Il reconnaîtra dans De profundis que le livre de Pater Studies in the History of the Renaissance a eu une si étrange influence sur sa vie.
Dans Le Portrait de M. W. H., Wilde raconte l'histoire d'un jeune homme qui, en vue de faire triompher sa théorie sur les sonnets de Shakespeare, va se servir d'un faux, puis décrit la fascination qu'exerce cette démarche sur d'autres personnages. Le fait que la théorie ne soit pas d'office disqualifiée, dans l'esprit du narrateur, par l'usage d'un faux, va de pair avec l'idée qu'il n'y a pas de vérité en soi de l'œuvre d'art, et que toute lecture, car subjective, peut ou doit donner lieu à une nouvelle interprétation.
On pourrait distinguer deux esthétiques correspondant aux deux périodes marquantes, bien qu'inégalement longues, de la vie littéraire de Wilde. La première, décrite ci-dessus, pourrait se résumer à l'éloge de la superficialité. L'intuition de Wilde, fortement influencée par les écrivains français de son temps qu'il lisait dans le texte, était que dans la forme même, gît le sens et le secret de tout art. Dans Le Portrait de Dorian Gray, il fait dire à Lord Henry : Seuls les gens superficiels ne jugent pas sur les apparences. Son écriture d'ailleurs correspond exactement à ses conceptions : se refusant aux descriptions naturalistes, il se contente de poser une ambiance en égrenant quelques détails : la couleur d'un rideau, la présence d'un vase, le passage d'une abeille près d'une orchidée. La deuxième période, celle de la prison et de la déchéance prend l'exact contre-pied théorique : dans son De Profundis, Wilde répète comme une litanie pénitentiaire ce refrain : Le crime, c’est d'être superficiel. On assiste dans cette œuvre, ainsi que dans l'autre production de cette période, dans la vie de Wilde, La Ballade de la geôle de Reading, à la reprise de formes d'écriture, comme la ballade, qui sont plus traditionnelles, jouant plus sur la répétition et l'approfondissement que sur la légèreté et l'effet de contraste.
La deuxième esthétique ne s'inscrit pas en faux envers la première : l'œil averti trouvera qu'elle la révèle. Le masque du Dandy et l'affectation de superficialité, chez un esprit aussi puissant et cultivé que Wilde, étaient la marque d'une volonté de dissimuler des conflits sous-jacents. L'éloge wildien n'était pas un éloge de la superficialité, ce qu'il révèlera lui-même lorsqu'il déchut de son statut de lion au XIXe siècle, on appelait lion les personnes en vue dans les salons anglais pour tomber en celui de réprouvé.
Œuvres
Poésie
Ravenna 1878 : poème pour lequel lui est attribué le prix Newdigate;
Poems 1881;
Poèmes en prose 1894 : publié dans The Fortnightly Review;
The Sphinge 1894: court texte lyrique généralement associé avec poèmes en prose
La Ballade de la geôle de Reading (The Ballad of Reading Gaol, long poème écrit en 1897 après sa libération et décrivant les derniers moments d'un condamné à mort, traduit en français par Henry D. Davray Mercure de France, 1898; il l'offrit à Octave Mirbeau n°237 du catalogue de la vente de la bibliothèque de Sacha Guitry, 25/03/1976 - arch. pers.
.
Théâtre
Véra ou Les Nihilistes 1880, pièce retirée de l'affiche la veille de la première
La Duchesse de Padoue The Duchess of Padua 1883, première pièce de théâtre tirée à douze exemplaires en 1883, elle fut représentée pour la première fois à New York en 1891;
L'Éventail de Lady Windermere Lady Windermere's Fan, jouée pour la première fois en février 1892, publiée en 1893;
Salomé 1893, pièce écrite en français pour Sarah Bernhardt ; traduite en anglais par Lord Alfred Douglas, illustrée par Aubrey Beardsley 1894 ;
Une femme sans importance A Woman of No Importance 1894
L'Importance d'être Constant The Importance of Being Earnest 1895;
Un mari idéal An Ideal Husband 1895;
La Sainte Courtisane, pièce qui ne fut publiée qu'en 1908, mais dont on pense qu'elle a été écrite en 1893;
Une tragédie florentine A Florentine Tragedy, pièce parue après la mort de Wilde en 1908.
Romans et nouvelles
Le Fantôme de Canterville et autres nouvelles Lord Arthur Savile's Crime and Other Stories;
Le Fantôme de Canterville The Canterville Ghost 1887 : aussi publié dans The Court And Society Review
Le Crime de Lord Arthur Savile Lord Arthur Savile's Crime 1887 : aussi publié dans The Court And Society Review ;
Le Modèle millionnaire The Model Millionaire1887: aussi publié dans The World;
Un Sphinx sans secret The Sphinx Without a Secret 1894;
Le Prince heureux et autres contes The Happy Prince and Other Stories 1888;
Le Portrait de Mr. W. H. The Portrait of M. W. H.
Le Portrait de Dorian Gray The Picture of Dorian Gray 1891 ;
Une maison de grenades A House of Pomegranates 1891 : second recueil de contes.
Teleny Etude physiologique Cosmopolis Leonard Smithers, Londres, 1893
Essais
La Vérité des masques sur Shakespeare 1886;
Trois volumes constituent son œuvre critique intégrale;
Essais de littérature et d'esthétique;
Nouveaux Essais de littérature et d'esthétique 1886-1887;
Derniers Essais de littérature et d'esthétique 1887-1890;
et aussi :
Intentions 1891, trad. 1905 : recueil d'essais contenant Le Déclin du mensonge; Le Critique comme artiste et La Vérité des masques;
L'Âme de l'homme sous le socialisme The Soul of Man under Socialism, court essai publié en 1891 et défendant une vision individualiste dans un monde socialiste; il a été republié en 2010 par les éditions aux Forges de Vulcain sous le titre L'Âme humaine et le socialisme.
voir différentes éditions sur Gallica
Autres publications
De Profundis écrit en prison 1897, version expurgée 1905, version intégrale corrigée 1962;
The Letters of Oscar Wilde 1960 ;
Epistola in Carcere et Vinculis ~ De Profundis 1905;
Teleny or The Reverse of the Medal Paris, 1893.
Recueils
Aristote à l'heure du thé et autres essais, traduction de Charles Dantzig, éditions 10/18 1999;
Le Prince heureux, recueil de contes, première parution en 1888, traduction par Léo Lack.
Adaptations cinématographiques
L'Éventail de Lady Windermere Lady Windermere's Fan d'Ernst Lubitsch 1925;
Le Portrait de Dorian Gray The Picture of Dorian Gray d'Albert Lewin 1945;
Un mari idéal An Ideal Husband d'Alexander Korda 1947
L'Éventail de Lady Windermere The Fan d'Otto Preminger 1949
Il importe d'être Constant The Importance of Being Earnest d'Anthony Asquith 1952 avec Michael Redgrave;
Oscar Wilde de Gregory Ratoff 1960;
Oscar Wilde de Brian Gilbert 1997;
Un mari idéal An Ideal Husband d'Oliver Parker 1999 avec Rupert Everett et Cate Blanchett;
L'Importance d'être Constant The Importance of Being Earnest d'Oliver Parker 1999 avec Rupert Everett et Colin Firth;
Le Procès d'Oscar Wilde de Christian Merlhiot France, 2008 avec Nasri Sayegh;
Le Portrait de Dorian Gray d'Oliver Parker 2009.
Adaptations musicales
Plusieurs opéras et ballets ont été composés sur des livrets traduisant ou adaptant des pièces de théâtre d'Oscar Wilde, parmi lesquels on peut citer :
Salomé, opéra de Richard Strauss sur un livret de Hedwig Lachmann, créé le 9 décembre 1905 au Hofoper de Dresde,
Salomé, opéra d'Antoine Mariotte composé à la même époque, créé le 30 octobre 1910 au Grand-Théâtre de Lyon,
La Tragédie de Salomé, op. 50, ballet de Florent Schmitt sur un livret de Robert d’Humières, créé le 9 novembre 1907 au Théâtre des Arts de Paris.
Eine florentinische Tragödie, opéra d'Alexander von Zemlinsky, sur un livret du compositeur d'après A florentine tragedy traduite en allemand par Max Meyerfeld, créé le 30 janvier 1917 au Hoftheater de Stuttgart,
Der Zwerg Le Nain , parfois traduit en français sous le titre L'anniversaire de l'infante, opéra d' Alexander von Zemlinsky sur un livret de George Klaren, d'après la nouvelle The Birthday of the Infanta, créé le 28 mai 1922 au Staatstheater de Cologne,
Le Fantôme de Canterville, opéra d'Heinrich Sutermeister composé en 1963.
Romans où Wilde apparaît comme personnage
1924 : Si le grain ne meurt, André Gide;
2002 : L'Instinct de l'équarrisseur : Vie et Mort de Sherlock Holmes, Thomas Day, éditions Mnémos Paris;
2007 : Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles Oscar Wilde and the Candlelight Murders, Gyles Brandreth, éditions 10/18 Paris,;
2008 : Oscar Wilde et le jeu de la mort Oscar Wilde and the Ring of Death, Gyles Brandreth, éditions 10/18 Paris, ;
2010 : Oscar Wilde et le cadavre souriant Oscar Wilde and the Dead Man's Smile, Gyles Brandreth, éditions 10/18 Paris,;
2011 : Oscar Wilde et le nid de vipères Oscar Wilde and the Nest of Vipers, Gyles Brandreth, éditions 10/18 Paris,;
2012 : Oscar Wilde et les crimes du Vatican Oscar Wilde and the Vatican murders, Gyles Brandreth, éditions 10/18 Paris, .
Liens
http://www.ina.fr/video/CPC95000027/g ... -d-oscar-wilde-video.html I jour I livre Wilde
http://youtu.be/30fiaasNNdc l'importance d'être constant de Oscar Wilde
http://www.ina.fr/video/3609252001/gy ... aux-chandelles-video.html le meurtre aux chandelles
http://www.ina.fr/video/CPC00005694/p ... an-oscar-wilde-video.html Oscar Wilde
http://www.ina.fr/video/CAB95008084/oscar-wilde-video.html Réhabilitation d'OscarWilde
http://www.ina.fr/video/CAB95057360/oscar-wilde-video.html C33
http://www.ina.fr/video/CPF86637015/salome-video.html Salomé d'Oxcar Wilde
http://www.ina.fr/audio/00142437/oscar-wilde-audio.html Dorian Gray
http://youtu.be/Zg7Qx6-s__c La vie de Dorian Gray Music
  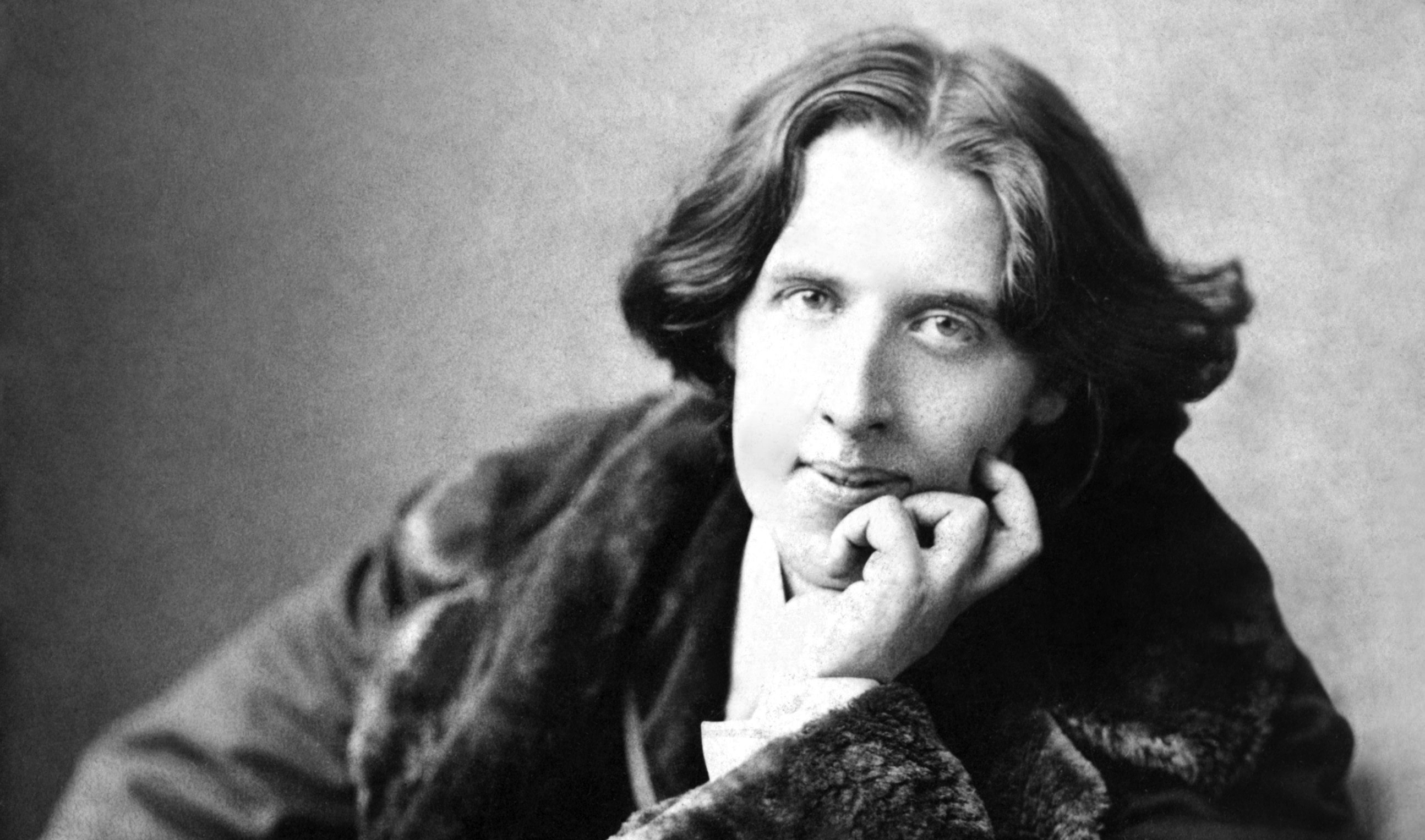   [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Oscar_Wilde_(1854-1900)_1889,_May_23._Picture_by_W._and_D._Downey.jpg[/img]      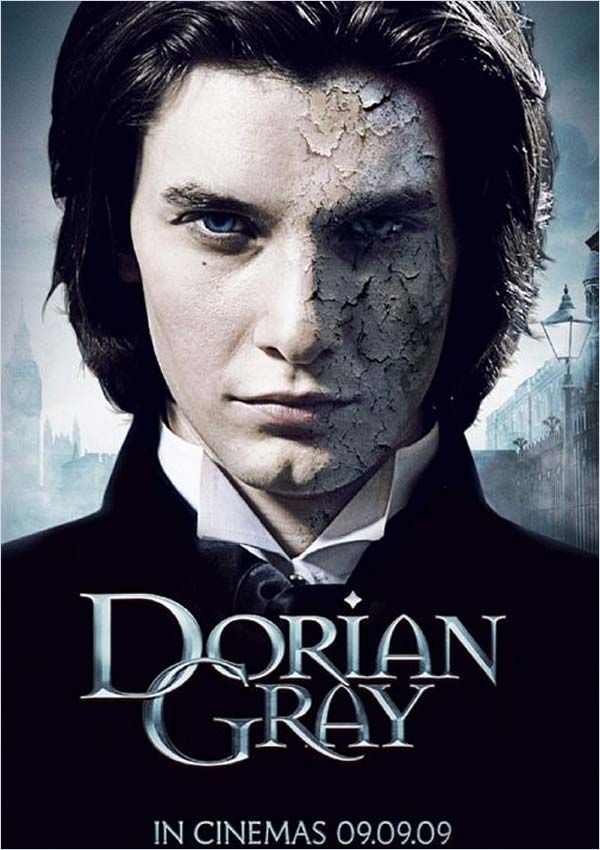 
Posté le : 29/11/2014 21:04
|
|
|
|
|
Winston Churchill 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 30 novembre 1874 naît Winston Churchill, Winston Leonard
Spencer-Churchill
au palais de Blenheim, Woodstock, Oxfordshire, Royaume-Uni, mort à 90 ans, le 24 janvier 1965 à Londres, homme d'État britannique, dans le parti politique Conservateur de 1900 à 1904, et dans le parti libéral de 1924 à 1964. Sa carrière : il est secrétaire à l’Intérieur du Royaume-Uni du 10 février 1910 au 24 octobre 1911 pendant 1 an, 8 mois et 14 jours il succède à Herbert Gladstone et sera remplacé par Reginald McKenna, puis Chancelier de l'Échiquier du Royaume-Uni du 6 novembre 1924 au 4 juin 1929 pendant 4 ans, 6 mois et 29 jours, son prédécesseur est Philip Snowden, son successeur Philip Snowden, il devient le 61e Premier ministre du Royaume-Uni
du 10 mai 1940 au 27 juillet 1945, pendant 5 ans, 2 mois et 17 jours sous le règne de George VI, son prédécesseur est Neville Chamberlain et son successeur Clement Attlee, il termine sa carrière après la guerre, comme 63e Premier ministre du Royaume-Uni du 26 octobre 1951 au 7 avril 1955
pendant 3 ans, 5 mois et 12 jours sous le règne de George VI, puis Élisabeth II, son prédécesseur est Clement Attlee, son successeur Anthony Eden. Il est marié Clementine Hozier et pour enfants Diana Churchill, Randolph Churchill, Sarah Churchill, Marigold Churchill, Mary Soames. Diplômé de Harrow School, Académie royale militaire de Sandhurst. Profession Député, homme d'État, militaire, journaliste, historien, écrivain, peintre. Résidence 10 Downing Street en tant que Premier ministre britannique Chartwell privée. Son action décisive en tant que Premier ministre de 1940 à 1945 du Royaume-Uni, son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents d'orateur et à ses bons mots en ont fait un des grands hommes politiques du XXe siècle. Ne disposant pas d'une fortune personnelle, il tire l'essentiel de ses revenus de sa plume. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de littérature. Il est aussi un peintre estimé. Plus qu'un simple loisir, la peinture est pour lui un refuge dans les moments difficiles.
En bref
Vingt ans avant sa mort, Winston Leonard Spencer Churchill est entré dans l'histoire du peuple britannique, à l'instant même où, la guerre terminée, le verdict des élections, par un étrange paradoxe, l'éloignait du poste de Premier ministre. Pour les Anglais, il est l'égal du second Pitt, parce que sa gloire est d'avoir triomphé du nazisme, tout comme son illustre prédécesseur avait affronté Napoléon. Les historiens ont consacré sa légende, et les Mémoires de son médecin personnel, lord Moran, publiés au lendemain de sa mort, firent scandale parce que l'auteur imputait les erreurs de l'homme d'État à la maladie et au caractère de celui-ci.
Pourtant, à la fin d'une carrière politique qui commence avec le siècle et sera la plus longue de l'histoire britannique, Churchill n'aurait sans doute laissé qu'un souvenir marginal sans ses cinq années de leadership national 1940-1945 qui amenèrent la Grande-Bretagne et l'empire à la victoire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, malgré une présence parlementaire et ministérielle mouvementée, il paraissait définitivement écarté des conseils gouvernementaux du Parti conservateur et sa vie publique se soldait par un échec. Après la guerre et une expérience travailliste difficile, il revient au pouvoir à la tête des conservateurs 1951-1955, sans qu'on puisse affirmer que ce dernier principat ait marqué l'efficacité du gouvernement britannique.
Churchill, en effet, a été surtout un leader de guerre, dans la tradition de Lloyd George ou de Clemenceau. L'étonnant divorce entre le héros national du temps de crise et le politique discuté des jours ordinaires tient pour beaucoup à ce qu'il fut le dernier héritier de l'époque victorienne et de la grandeur britannique dans un monde qui a consacré la décadence de l'establishment et le déclin de l'Angleterre. En témoignent aussi bien sa personnalité que sa politique et le rôle qu'il a joué dans l'histoire politique et sociale du Royaume-Uni.
Winston Leonard Spencer-Churchill appartient à la famille aristocratique Spencer, dont il est la plus brillante figure depuis le fondateur, son ancêtre John Churchill, 1er duc de Marlborough 1650-1722, auquel il a consacré une biographie. Fils d'un homme politique conservateur atypique n'ayant pas connu le succès escompté et mort relativement jeune, il ambitionne très vite de réussir dans ce domaine. De fait, s'il débute dans la carrière militaire et combat en Inde, au Soudan et lors de la Seconde Guerre des Boers, il y cherche surtout l'occasion de briller et de se faire connaître. Cette recherche de gloire lui vaut parfois un certain nombre d'inimitiés parmi ses pairs. Assez rapidement, en partie pour des questions financières – l'armée paie moins que le journalisme et il a besoin d'argent – il sert en tant que correspondant de guerre, écrivant des livres sur les campagnes auxquelles il participe. Bien plus tard, il sert brièvement sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale, comme commandant du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers. En 1953, la reine le fait chevalier de l'ordre de la Jarretière.
Il est député durant la majeure partie de sa carrière politique, longue de près de soixante années, et occupe des postes ministériels pendant près de trente ans. Avant la Première Guerre mondiale, il est ministre du Commerce, secrétaire du Home Office et Premier Lord de l'Amirauté du gouvernement libéral d'Herbert Henry Asquith. À ce titre, il participe à la création des premières lois sociales de son pays et à un mouvement visant à restreindre l'importance de la Chambre des Lords, deux éléments qui lui valent une forte inimitié de la part des conservateurs. Il reste à cette fonction jusqu'à la défaite britannique lors de la bataille des Dardanelles, dont il est tenu pour responsable, et qui provoque son éviction du gouvernement. Blanchi de ces accusations par une commission d'enquête parlementaire, il est rappelé comme ministre de l'Armement, secrétaire d'État à la Guerre et secrétaire d'État de l'air par David Lloyd George, alors Premier ministre.
Durant l'entre-deux-guerres, il quitte le Parti libéral et revient au Parti conservateur, avant de devenir chancelier de l'Échiquier. Son bilan à ce poste est mitigé. L'économie n'est pas son domaine de prédilection, à la différence de la politique étrangère et des affaires de stratégie militaire. Dans les années 1930, il n'est pas en phase avec le milieu politique d'alors, et connaît une dizaine d'années de traversée du désert au moment même où, eu égard à son âge et son expérience, il aurait dû atteindre le sommet.
Il faut attendre le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale pour que Winston Churchill redevienne ministre en tant que Premier Lord de l'Amirauté. Après la démission de Neville Chamberlain, le 10 mai 1940, il devient, plus par défaut que par adhésion, Premier ministre du Royaume-Uni. À 65 ans, un âge qui en fait le plus âgé des grands dirigeants alliés, il atteint le sommet de sa carrière politique. Il organise les forces armées britanniques et conduit le pays à la victoire contre les puissances de l'Axe. Ses discours et ses paroles frappantes marquent le peuple britannique et les forces alliées.
Après avoir perdu les élections législatives de 1945, il devient chef de l'opposition conservatrice, dénonçant dès 1946 le rideau de fer. Il redevient Premier ministre en 1951, et ce, jusqu'à sa retraite, en 1955. À sa mort, la reine le gratifie d'obsèques nationales, qui seront l'occasion, avec celles du pape Jean-Paul II en 2005, de l'un des plus importants rassemblements d'hommes d'État ayant eu lieu dans le monde.
Origines
Membre de la famille Spencer, renommée pour la participation de plusieurs de ses membres à la vie politique britannique, Winston Leonard Spencer-Churchill utilise, comme son père, le seul nom de Churchill dans la vie publique. Son ancêtre George Spencer a changé son nom de famille pour Spencer-Churchill lorsqu'il est devenu duc de Marlborough, en 1817, pour souligner son lien de parenté avec John Churchill, le premier duc de Marlborough. Son père, Randolph, est le fils cadet du 7e duc de la lignée. En vertu du droit d'aînesse, il n'est pas l'héritier du château familial, le palais de Blenheim, et ses enfants ne peuvent pas porter le titre de Lord. En 1874, lorsque Randolph Churchill épouse Jennie Jerome, fille du millionnaire américain Leonard Jerome, c'est un homme politique prometteur. Sa carrière est cependant brève, car il meurt prématurément à 46 ans, laissant sa famille démunie.
Par ses ascendants, Winston Churchill a des liens privilégiés avec la France, ce qui explique qu'à l'instar de sa mère, il estt francophile et parle très tôt et assez correctement le français. La grand-mère maternelle de Winston Churchill est une Américaine francophile et francophone, aimant les mondanités et ayant vécu à Paris de 1867 à 1873 où elle a connu les fastes de la cour impériale de l'impératrice Eugénie : elle y était familière au point de recevoir le surnom de Jeannette. On compte dans la généalogie de Winston Churchill des ascendants français à la fois du côté de son père et de sa mère : son grand-père maternel est issu d'une famille huguenote française immigrée aux États-Unis ; du côté paternel, l'un des ancêtres des Churchill est le fils d'Othon de Leon, châtelain de Gisors, qui a servi Guillaume le Conquérant et s'est établi en Angleterre après la bataille d'Hastings à laquelle il a participé.
Sa vie
Winston Leonard Spencer-Churchill naît au bout de sept mois et demi de grossesse dans la nuit du 29 au 30 novembre 1874, à 1 h 30. C'est donc un prématuré, mis au monde par sa mère dans les vestiaires du palais de Blenheim, celui-là même où il rencontrera plus tard sa future épouse, ce qui est à l'origine de cet aphorisme resté fameux : C'est à Blenheim que j'ai pris les deux décisions les plus importantes de ma vie, celle de naître et celle de me marier. Je n'ai regretté aucune des deux !. Randolph et Jennie ont un second enfant en 1880, John Strange, dont la fille Clarissa épousera Anthony Eden. Une rumeur court après cette naissance quant à la paternité de ce frère cadet, les parents étant séparés depuis quelque temps lors de sa venue au monde. La mère ayant la réputation d'être très frivole, on soupçonne ce deuxième enfant d'être le fils de John Strange Jocelyn, 5e comte de Roden.
Comme il est d’usage dans les familles nobles de l'époque, Winston est confié à une nourrice, Elizabeth Anne Everest, qui sera ensuite celle de son frère. Ses parents ne le voient que rarement et ont des rapports distants, bien qu'aimants. Son père étant occupé par sa carrière politique, et sa mère par ses mondanités, cela renforce l'isolement du jeune Winston. Ce manque de contact avec ses parents le rapproche de sa nourrice qu'il prend l'habitude d'appeler Woomany, et dont il garde jusqu'à la fin de sa vie un portrait dans son bureau. Il passe ses deux premières années au château familial de Marlborough. En janvier 1877, son père accompagne son grand-père à Dublin, où il vient d'être nommé vice-roi d'Irlande ; Winston le suit, y passe près de trois ans avant que ses parents ne reviennent à Londres, dans la maison familiale de St James Place en mars 1880. Il y apprend à lire, car il ne fréquente pas l'école jusqu'à l'âge de sept ans, mais suit des cours chez lui avec l'aide de sa nourrice.
Churchill entre à l'école à l'âge de sept ans. Il est placé en octobre 1881 dans la prestigieuse St. George's School d'Ascot. Il a très peu d'argent de poche et vit très difficilement cette première séparation d'avec sa famille. Sa mère, alors connue sous le nom de Lady Randolph, ne lui rend visite que très rarement, malgré les lettres dans lesquelles Winston la supplie de venir ou de lui permettre de retourner à la maison. Il a une relation distante avec son père avec lequel il note qu'il n'a presque jamais de conversation. Ce manque d'affection l'endurcit, il en est conscient et est persuadé que ce qu'il perd étant jeune le servira étant vieux. Le régime dur et discipliné de cette école lui déplaît et ne lui réussit pas : très franc mais fait des bêtises est la première appréciation que laissent les professeurs. Plus tard sa nourrice Elizabeth Anne Everest s'aperçoit que des blessures ont été infligées à Winston, et elle alerte les parents qui le changent d'école. À 9 ans, en septembre 1884, il est placé dans un pensionnat moins strict, celui des Demoiselles Thomson de Brighton où il demeure jusqu'en 1888 sans subir de mauvais traitements. Son père décide de lui faire faire une carrière militaire, car ses résultats scolaires ne sont pas assez bons pour envisager une carrière politique ou même ecclésiastique. Lui-même a fait ses classes à Eton, la meilleure école du pays, mais Winston doit se contenter de Harrow School, la grande rivale, moins cotée. Il y entre le 17 avril 1888 à l'âge de 14 ans et y reste jusqu'à ses 18 ans. Dans les semaines suivant son arrivée, il rejoint le Harrow Rifle Corps. Il obtient des notes élevées en anglais et en histoire et obtient un titre de champion d'escrime de l'école. À 18 ans, il prépare son entrée à l'Académie royale militaire de Sandhurst, mais le concours du Royal Military College est extrêmement difficile. Churchill paie alors ses mauvaises années d'études : il échoue deux fois de suite. Même s'il a progressé entre les deux tentatives de manière plutôt spectaculaire, il est déçu et demande à ses parents dépités d'envisager une carrière ecclésiastique. Lors de sa troisième tentative, il doit absolument réussir, sinon il devra se réorienter. Winston fait valoir à ses parents que la scolarité à Harrow n'est pas adaptée pour Standhurst puisque seuls 1 % des reçus de Sandhurst en sont issus. Ses parents soucieux de sa réussite lui paient alors des cours dans un institut privé spécialisé : le Captain James Establishment, ce qui lui réussit : il est admis à l'Académie militaire de Sandhurst le 28 juin 1893. C'est un grand jour dans la vie du jeune Churchill, même s'il n'est reçu que 92e sur 102.
Churchill se décrit comme affligé d'un défaut d'élocution. Après avoir travaillé de longues années à le surmonter, il a finalement déclaré : mon défaut n'est pas une entrave. On présente souvent aux stagiaires orthophonistes des cassettes vidéo montrant les manies de Churchill pendant ses discours, et la Stuttering Foundation of America présente sa photo sur sa page d'accueil comme l'un de ses modèles de bègues ayant réussi. Si des écrits contemporains des années 1920, 1930 et 1940 confirment ce diagnostic de bégaiement, le Churchill Centre, cependant, réfute catégoriquement l'allégation selon laquelle Churchill ait été affecté de ce défaut : il aurait eu un bredouillement, voire un zézaiement et une certaine difficulté à prononcer la lettre S, tout comme son père.
Churchill se marie relativement tard à presque 34 ans. Jusqu'à sa rencontre avec sa femme, il estime qu'il n'a pas le droit de folâtrer dans les plaisantes vallées des distractions car son seul bien est son ambition : Et si je n'y arrivais pas ! Quelle chose affreuse ! J'en aurais le cœur brisé, car je n'ai que l'ambition à quoi me raccrocher. Il n'est pas réellement à l'aise avec les femmes – hors celles de sa famille – et pense que les Américaines sa mère est américaine tyrannisent leur mari. Pour Violet Bonham Carter, son attitude à leur égard était fondamentalement romantique ... il les paraît de toutes les vertus cardinales. Pour son biographe William Manchester, il fait partie du genre de phallocrates qui font une cible de choix pour les féministes. De fait, les suffragettes, notamment Emmeline Pankhurst, perturbent assez régulièrement ses meetings électoraux.
Churchill rencontre sa future épouse, Clementine Hozier, en 1904, lors d'un bal chez le comte de Crewe et sa femme Margaret Primrose. En 1908, ils sont de nouveau réunis lors d'un dîner offert par Lady St. Helier. Churchill et Clementine sont placés côte à côte et entament bientôt une histoire d'amour qui durera toute leur vie. Il lui demande sa main au cours d'une house party au palais de Blenheim le 10 août 1908 dans le temple de Diane, la maison d'été du palais. Ils sont mariés le 12 septembre 1908 en l'église St. Margaret à Westminster, comble pour l'occasion, par l'évêque de St. Asaph. En mars 1909, le couple emménage dans une maison au 33 Eccleston Square, dans le quartier de Pimlico. Clementine Churchill est libérale au sens anglo-saxon du terme. Elle est un peu jalouse de Violet Bonham Carter – fille du Premier ministre Herbert Henry Asquith et grand-mère de l'actrice Helena Bonham Carter – qui est, après elle, l'autre grande amie de Churchill. Elle reste néanmoins plus pondérée que son mari et pour François Bédarida a un bien meilleur jugement que lui aussi bien sur les hommes que sur les situations. Si les femmes qui lui sont proches sont politiquement libérales, par contre, entre lui et la députée conservatrice Nancy Astor, l'inimitié est aussi forte que réciproque. Lors d'une réception donnée par sa cousine par alliance Consuelo Vanderbilt où il est arrivé à l'improviste - elle évite de les inviter ensemble - se produit une anecdote demeurée célèbre. À Nancy Astor lui disant : Si vous étiez mon mari, j'empoisonnerais votre café !, Churchill répond : Et si vous étiez ma femme, je le boirais.
Leur premier enfant, Diana, naît le 11 juillet 1909 à Londres. Après la grossesse, Clementine déménage dans le Sussex afin de se reposer, tandis que Diana reste à Londres avec sa nourrice. Le 28 mai 1911, leur deuxième enfant, Randolph, naît au 33 Eccleston Square. Un troisième enfant, Sarah, naît le 7 octobre 1914 à Admiralty House. Clementine est anxieuse, car Winston est alors à Anvers, envoyé par le Conseil des ministres pour renforcer la résistance de la ville assiégée après l'annonce de l'intention belge de capituler. Clementine donne naissance à son quatrième enfant, Frances Marigold Churchill, le 15 novembre 1918, quatre jours après la fin officielle de la Première Guerre mondiale. Celle-ci ne vit que deux ans et demi : au début du mois d'août, les enfants Churchill sont confiés à Mlle Rose, une gouvernante française, dans le comté de Kent pendant que Clementine est à Eaton Hall pour jouer au tennis avec Hugh Grosvenor, 2e duc de Westminster, et sa famille. Marigold attrape un rhume, d'abord sans gravité, mais qui évolue en septicémie. La maladie emporte Marigold le 23 août 1921. Elle est enterrée dans le cimetière de Kensal Green trois jours plus tard. Le 15 septembre 1922 naît Mary, le dernier de leurs enfants. Après quelques jours, les Churchill achètent Chartwell, qui devient la maison de Winston jusqu'à sa mort en 1965. Les enfants, à l'exception de Mary, ne leur apportent que peu de satisfaction.
Le sous-lieutenant correspondant de guerre
À l'Académie royale militaire de Sandhurst, Churchill reçoit son premier commandement dans le 4th Queen's Own Hussars en tant que sous-lieutenant le 20 février 1895. Il juge que son salaire de sous-lieutenant, de 300 livres sterling par an, est insuffisant pour avoir un style de vie équivalent à celui des autres officiers du régiment. Il estime avoir besoin de 500 £, soit l'équivalent d'environ 34 000 £ en 2013. Sa mère lui fournit une rente de 400 £ par an, mais il dépense plus qu'il ne gagne. Selon le biographe Roy Jenkins, c'est une des raisons pour lesquelles il devient correspondant de guerre. Il n'a pas l'intention de suivre une carrière classique en recherchant les promotions, mais bien d'être impliqué dans l'action. À cette fin, il utilise l'influence de sa mère et de sa famille dans la haute société pour avoir un poste dans les campagnes en cours. Ses écrits de correspondant de guerre pour plusieurs journaux de Londres8 attirent l'attention du public, et lui valent d'importants revenus supplémentaires. Ils constituent la base de ses livres sur ces campagnes. Toutefois, comme ses écrits montrent à la fois son ambition et des critiques de l'armée, ils lui attirent une certaine hostilité et une réputation de chasseur de médailles et de coureur de publicité. Pour W. Manchester, il n'éprouvait aucun intérêt pour la carrière militaire, et avait l'intention de se servir de son passage dans l'armée pour favoriser ses desseins politique.
Trois événements importants pour Churchill surviennent lors de l'année 1895 : les décès de son père et de Mrs Everest, sa nourrice, ainsi que son baptême du feu à Cuba.
La mort de Randolph Henry Spencer Churchill
Souffrant de syphilis, incurable à cette époque, depuis au moins 1885, le père de Winston décède le 24 janvier 1895 à l'âge de 46 ans. Sa mort affecte bien sûr Winston car elle le prive d'un soutien important pour sa future carrière, mais cela marque également pour lui le début de la liberté : son père n'impose plus ses choix et Winston peut donc faire ce qu'il veut. De plus, de nombreux ancêtres mâles du jeune Winston étant décédés à peu près à cet âge, il croit pendant longtemps que ses propres jours sont alors comptés. Aussi, lorsqu'il passe le cap des cinquante ans, il en conçoit une immense joie, et a en quelque sorte le sentiment que tout lui est permis5. Le jeune Winston vouait une immense admiration à son père Randolph alors même que ce dernier prenait son fils pour un attardé. Pourtant, lorsque plus tard Winston accède à de hautes fonctions gouvernementales, c'est à son père qu'il pense avec émotion.
La mort de Mrs Everest
En juillet, un message l'informe que sa nourrice, Mrs Everest, est mourante. Il retourne alors en Angleterre et reste auprès d'elle pendant une semaine, jusqu'à sa mort le 3 juillet, à 62 ans. Il écrit dans son journal : Elle était mon amie préférée. Dans My Early Life, il ajoute : Elle a été ma plus chère et ma plus intime amie pendant les vingt ans que j'ai vécus. Après avoir été la nourrice dévouée de Winston et son frère, elle a été congédiée brutalement et meurt dans la misère. Churchill organise ses obsèques tandis que Lady Randolph ne se déplace même pas pour l'enterrement. Il s'en souviendra lors de la loi de 1908 sur la retraite à 70 ans.
Le baptême du feu à Cuba
Le 20 février 1895, Winston sort diplômé de Sandhurst et à une place honorable : il est vingtième. Il est placé à sa demande dans le 4th Queen's Own Hussars du colonel Brabazon au camp d'Aldershot, car il sait que ce corps va partir pour les Indes en 1896, et il espère y faire l'expérience du combat. Le jeune Winston, qui pense que les succès militaires sur le terrain sont un gage de succès politique, est impatient d'aller au combat. Disposant de temps libre avant de rejoindre son affectation, il est envoyé avec son ami Reginald Barne, par le journal le Daily Graphic à Cuba où les Espagnols sont confrontés à une insurrection. Pour ce faire, il a obtenu l'aval du commandement britannique et du directeur du service du renseignement militaire. Le trajet aller est pour lui son premier grand voyage car il n'a jusqu'alors visité que la France et la Suisse. La première étape est New York, occasion pour lui de fouler le sol américain pour la première fois et de rendre visite à sa famille maternelle et ses amis. Pendant son séjour, il demeure chez William Bourke Cockran, l'amant de sa mère. Bourke est un homme politique américain établi, membre de la Chambre des représentants, potentiel candidat à l'élection présidentielle. Il influence fortement Churchill dans son approche des discours et de la politique, et fait naître en lui un sentiment de tendresse envers l'Amérique. Arrivé à Cuba comme journaliste pour couvrir la Guerre d'indépendance cubaine, il suit les troupes du colonel Valdez et à son vingt-et-unième anniversaire il s'offre un baptême du feu. Il apprécie Cuba : il la décrit comme une ...grande, riche, belle île... . Il y prend goût aux habanos, ces cigares cubains qu'il fume jusqu'à la fin de sa vie.
Officier aux Indes
Au début du mois d'octobre 1896, Churchill est transféré à Bombay, en Inde britannique. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de polo de son régiment, il mène son équipe à la victoire lors de nombreux tournois prestigieux.
Aux environs de Bangalore où il est affecté en 1896 avec les 4th Queen's Own Hussars, il dispose de temps libre qu'il met à profit pour lire. Il lit d'abord des livres d'histoire : Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain d'Edward Gibbon et l'Histoire de Thomas Babington Macaulay – des auteurs assez peu conservateurs; des philosophes grecs : Platon, notamment La République, ainsi que les écrits politiques d'Aristote. Parmi les auteurs français, il lit Les Provinciales de Blaise Pascal et les Mémoires de Saint-Simon. Il lit aussi La richesse des Nations d'Adam Smith, Schopenhauer, Malthus et bien d'autres. Il en tire une très profonde culture historique qui le servira toute sa vie. Il est fortement impressionné par le darwinismecdv. Il devient alors, selon ses propres termes, un matérialiste jusqu'au bout des doigts, et défend avec ferveur sa conception d'un monde où la vie humaine est une lutte pour l'existence, avec pour résultat la survie des plus forts. Cette vision a sans doute été influencée par le livre Martyrdom of Man de William Winwood Reade, un classique de l'athéisme victorien, présentant la vision d'un univers sans Dieu dans lequel l'humanité est destinée à progresser par le biais du conflit entre les races les plus avancées et les plus rétrogrades. Churchill exprime cette philosophie de vie et de l'histoire dans son premier et unique roman, Savrola. Toutefois, cet agnosticisme est peu affiché et il participe parfois à des services religieux. Il a également eu une action importante en faveur du christianisme anglican dans le Commonwealth, notamment à Bangalore où l'Église anglicane a joué un rôle de premier plan à ses côtés dans les cantonments.
Premiers combats au Malakand
Carte des possessions coloniales britanniques en Inde. Le Malakand est sur la frontière du nord-ouest à la limite de la zone du Grand Jeu.
En 1897, Churchill part à nouveau à la fois pour des reportages et, si possible, pour combattre durant la guerre gréco-turque : le conflit prend toutefois fin avant son arrivée. Lors d'une permission en Angleterre, il apprend que trois brigades de l'armée britannique vont se battre contre une tribu de pachtounes, et demande à son supérieur hiérarchique l'autorisation de se joindre au combat. Placé sous les ordres du général Jeffery, commandant de la deuxième brigade opérant au Malakand, dans l'actuel Pakistan, il est envoyé avec quinze éclaireurs reconnaître la vallée des Mamund, où, rencontrant une tribu ennemie, ils descendent de leurs montures et ouvrent le feu. Après une heure de tirs, des renforts du 35e Sikhs arrivent et les tirs cessent peu à peu ; la brigade et les Sikhs reprennent leur avance. Plus tard des centaines d'hommes de la tribu leur tendent une embuscade et ouvrent le feu, les forçant à battre en retraite. Quatre hommes, qui transportent un officier blessé, doivent l'abandonner devant l'âpreté du combat. L'homme laissé à l'arrière est tailladé à mort sous les yeux de Churchill. Il écrit à propos de l'événement : j'ai oublié tout le reste, à l'exception de la volonté de tuer cet homme. Les troupes sikhs diminuent, et le commandant suppléant ordonne à Churchill de mettre le reste des hommes en sécurité. Churchill demande une confirmation écrite pour ne pas être accusé de désertion et, ayant reçu la note demandée, rapidement signée, il escalade la colline puis alerte une des autres brigades, qui engage l'ennemi. Les combats dans la zone durent encore deux semaines avant que les morts ne puissent être récupérés. Churchill écrit dans son journal : que cela en valait la peine je ne peux pas dire. Son compte-rendu de la bataille est l'un de ses premiers récits publiés, pour lequel il reçoit cinq livres sterling par colonne dans le Daily Telegraph. Un compte-rendu du siège de Malakand est publié en décembre 1900 sous le titre de The Story of the Malakand Field Force et lui rapporte 600 livres sterling. Au cours de cette campagne, il écrit également des articles pour le journal The Pioneer. Sa grande récompense, alors que jusque-là il n'a presque toujours reçu que des reproches, tant de ses parents que de ses enseignants, est qu'il se voit décerner des éloges publics et privés. Le Prince de Galles, ami de sa mère et futur Édouard VII, lui écrit : je ne puis résister à l'envie de vous écrire quelques lignes pour vous féliciter du succès de votre livre.
Churchill est transféré en Égypte en 1898, où il visite Louxor, avant de rejoindre un détachement du 21st Lancers servant au Soudan sous le commandement du général Herbert Kitchener. Durant son service, il rencontre deux officiers avec lesquels il est amené à travailler plus tard, au cours de la Première Guerre mondiale : Douglas Haig, alors capitaine et David Beatty, alors lieutenant d'une canonnière. Au Soudan, il participe à ce qui est décrit comme la dernière véritable charge de cavalerie britannique, à la bataille d'Omdurman, en septembre 1898. Il travaille également comme correspondant de guerre pour le Morning Post. En octobre, rentré en Grande-Bretagne, il commence son ouvrage en deux volumes The River War, un livre sur la reconquête du Soudan publié l'année suivante.
Churchill démissionne de l'armée britannique le 5 mai 1899 pour se présenter au Parlement comme candidat conservateur à Oldham, lors de l'élection partielle de la même année, mais il perd en n'étant que troisième pour deux sièges à pourvoir.
La guerre des Boers et la notoriété
Après l'échec électoral d'Oldham, Churchill cherche une autre occasion de faire progresser sa carrière. Le 12 octobre 1899, la Seconde Guerre des Boers entre la Grande-Bretagne et les républiques boers éclate. Il obtient une commission pour agir en tant que correspondant de guerre pour le Morning Post avec un salaire de 250 £ par mois. Il a hâte de naviguer sur le même bateau que le nouveau commandant britannique, Redvers Buller. Après quelques semaines dans les zones exposées, il accompagne une expédition d'éclaireurs dans un train blindé, au cours de laquelle il est capturé par les hommes du raid dirigé par Piet Joubert et Louis Botha sur la colonie du Natal, et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre à Pretoria. Son attitude pendant l'embuscade du train fait évoquer une éventuelle obtention de la Croix de Victoria, plus haute distinction de la Grande-Bretagne décernée pour bravoure face à l'ennemi, mais cela ne se produit pas. Cette même attitude lui vaut plus tard d'être emprisonné, alors qu'il n'est que civil. Les dirigeants boers se félicitent d'avoir ainsi pu s'emparer d'un Lord. Dans London to Ladysmith via Pretoria, un recueil de ses rapports écrits tout au long de cette guerre, il décrit l'expérience :
J'avais eu, durant les quatre dernières années, l'avantage, si c'est un avantage, de plusieurs expériences étranges et variées, desquelles l'étudiant des réalités pourrait tirer profit et enseignement. Mais rien n'était aussi saisissant que cela : attendre et lutter dans ces boîtes en fer résonnantes, déchirées, avec les explosions répétées des obus et de l'artillerie, le bruit des projectiles frappant les wagons, le sifflement alors qu'ils passaient dans l'air, le grognement et le halètement du moteur — pauvre chose torturée, martelée par au moins douze obus, dont chacun, en pénétrant dans la chaudière, aurait pu mettre fin à tout cela − l'attente de la destruction apparemment proche, la prise de conscience de l'impuissance, et les alternances d'espoir et désespoir − tout cela en soixante-dix minutes montre en main, avec seulement dix centimètres d'un blindage de fer tordu pour faire la différence entre le danger, la captivité et la honte, d'un côté − la sécurité, la liberté et le triomphe, de l'autre.
Il demande à plusieurs reprises sa libération à Piet Joubert en arguant de son statut civil. Finalement, il s'échappe du camp de prisonniers quelques heures avant que sa libération ne lui soit accordée, et parcourt près de 480 km jusqu'à la ville portugaise de Lourenço Marques dans la baie de Delagoa. Quittant Pretoria vers l'est, il est un temps caché dans une mine des environs de l'actuelle Witbank par un responsable de mines anglais ; il gagne ensuite Lourenço Marques dissimulé dans un train emportant des balles de laine. Son évasion lui vaut un moment l'attention du public et en fait un quasi-héros national en Grande-Bretagne, d'autant qu'au lieu de rentrer chez lui, il rejoint l'armée du général Buller qui après avoir secouru les Britanniques encerclés à Ladysmith prend Pretoria. Cette fois-ci, bien que toujours correspondant de guerre, Churchill reçoit un commandement dans le South African Light Horse. Il s'illustre notamment à la bataille de Spion Kop et, avec son cousin Charles Spencer-Churchill dans la libération du camp de prisonniers de Prétoria.
En juin 1900, après s'être une dernière fois fait remarquer à la bataille de Diamond Hill, Churchill retourne en Angleterre à bord du RMS Dunottar Castle, le même navire qui l'a emmené en Afrique du Sud, huit mois plus tôt. Il publie London to Ladysmith et un deuxième volume sur ses expériences de la guerre des Boers, La Marche de Ian Hamilton. Cette fois, il est élu en 1900 à Oldham, lors des élections générales, à la Chambre des Communes, et entreprend une tournée de conférences en Grande-Bretagne, suivie par des tournées aux États-Unis et au Canada. Ses revenus dépassent désormais 5 000 £ annuels.
Ayant quitté l'armée régulière en 1900, Churchill rejoint l'Imperial Yeomanry en janvier 1902 en tant que capitaine des Queen's Own Oxfordshire Hussars. En avril 1905, il est promu major et nommé au commandement de l'escadron Henley du Queen's Own Oxfordshire Hussars. C'est également à cette époque qu'il rencontre sa future femme.
Entrée en politique
La politique est presque aussi excitante que la guerre, et tout aussi dangereuse – à la guerre vous pouvez être tué une fois seulement, en politique plusieurs.
Après son échec initial à devenir Member of Parlement en 1899, Churchill se représente pour le siège d'Oldham aux élections générales de 1900. Soutenu par sa notoriété familiale et son statut de héros de la guerre des Boers, il remporte le siège. Il entame alors une tournée en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada où il participe à des conférences, qui lui rapportent 10 000 £. Au Parlement, il s'associe à une faction du Parti conservateur dirigée par Lord Hugh Cecil, les Hughligans, qui sont opposés au leadership de Balfour. Au cours de sa première session parlementaire, il s'oppose aux dépenses militaires du gouvernement et à la proposition de Joseph Chamberlain d'augmenter les droits de douane pour protéger l'industrie anglaise. À cette même époque, il lit une étude de Rowentree sur la pauvreté en Angleterre qui le touche beaucoup. De 1903 à 1905, il s'attache également à écrire Lord Randolph Churchill, une biographie de son père en deux volumes, publiée en 1906, qui reçoit de nombreuses critiques élogieuses.
De 1903 à 1905, le pays traverse une phase où les conservateurs, autour de Joseph Chamberlain, préconisent une politique protectionniste basée sur la préférence impériale et se heurtent à l'opposition des libéraux. Churchill se fait un des champions du libre-échange et en mars 1904, attaque une loi protectionniste sur le sucre. Son discours est remarqué par le chef du parti libéral Henry Campbell-Bannerman qui lui envoie une invitation qu'il accepte. Pour Roy Jenkins, ce choix de Churchill est un peu paradoxal. En effet l'homme qui l'invite est alors considéré comme un Little Englander, ou anti-impérialiste, quand il y a alors au parti libéral des liberal imperialists tels Asquith, Grey ou Haldane, dont on pourrait le croire plus proche. Quoi qu'il en soit, il décide, à la Pentecôte 1904, de quitter son parti afin de rejoindre les bancs du Parti libéral, restant député d'Oldham jusqu'à la fin du mandat. En décembre 1905, les libéraux renversent le gouvernement et Henry Campbell-Bannerman devient Premier ministre. Il nomme Churchill Sous-secrétaire d'État aux Colonies, avec pour mission de s'occuper principalement de l'Afrique du Sud après la guerre des Boers. À ce poste, il doit défendre Alfred Milner accusé d'avoir admis des Chinois en Afrique du Sud sans base légale. Pour le défendre, il dit de celui qui sera membre du Cabinet de guerre de 1916 à un moment où cet honneur est formellement refusé à Churchill, qu'il est un homme du passé.
Passage au parti libéral, réforme sociale et bras de fer avec l'aristocratie
Rejeté par les conservateurs d'Oldham, notamment en raison de son soutien au libre-échange, Churchill est invité à se présenter pour les libéraux dans la circonscription de Manchester Nord-Ouest. Il remporte le siège aux élections générales de 1906 avec une majorité de 1 214 voix, et représente la circonscription pendant deux ans, jusqu'en 1908. Lorsque Herbert Henry Asquith devient la même année Premier ministre à la place de Campbell-Bannerman, Churchill est promu au Cabinet en tant que ministre du Commerce. Il doit en partie ce poste à un article sur les réformes sociales intitulé Un domaine inexploré en politique rédigé après des rencontres avec Beatrice Webb, membre influente de la Fabian Society ainsi qu'avec William Beveridge. Il puise aussi son inspiration dans les idées de Lloyd George et dans l'expérience sociale allemande. Comme le veut la loi à l'époque, il est obligé de solliciter un nouveau mandat lors d'une élection partielle ; Churchill perd son siège, mais revient rapidement député de la circonscription de Dundee.
Comme ministre du Commerce, il se joint au nouveau Chancelier Lloyd George pour s'opposer au Premier Lord de l'Amirauté Reginald McKenna, et à son programme coûteux de construction de vaisseaux de guerre dreadnought, ainsi que pour soutenir les réformes libérales. En 1908, il présente le projet de loi qui impose pour la première fois un salaire minimum en Grande-Bretagne. En 1909, il crée les bourses de l'emploi pour aider les chômeurs à trouver du travail. Il participe aussi à la rédaction de la première loi sur les pensions de chômage, et du National Insurance Act de 1911, fondement de la sécurité sociale au Royaume-Uni. Pour Élie Halévy, Churchill et Lloyd George veulent que le parti libéral adopte ce programme pour empêcher les travaillistes de gagner du terrain sur la gauche.
Ce programme se heurte à une vive opposition de l'aristocratie car le People's BudgetJe 21 de 1909 comporte une augmentation des droits de succession. Si cette réforme qui ne touche que ceux qui gagnent plus de 3 000 £ par an ne concerne que 11 500 Anglais, ce sont précisément ceux qui gouvernent. Aussi, la Chambre des Lords met son veto. Churchill est alors attaqué par les milieux conservateurs qui se répandent en propos hostiles tant envers lui qu'envers sa famille qui n'aurait jamais donné naissance à un gentleman. Pour résoudre la crise, le Premier ministre demande la dissolution du Parlement. Les libéraux réélus sont majoritaires avec le soutien du parti travailliste et d'un parti irlandais. La Chambre des Lords sous la pression de Lloyd George adopte durant l'été 1911 une loi qui limite ses pouvoirs.
Ministre de l'Intérieur
Churchill est réélu en 1909 et fait part de son désir de briguer soit le poste de Premier Lord de l'Amirauté soit celui de ministre de l'Intérieur. Les libéraux le nomment à l'Intérieur en raison de son image de fermeté. C'est un poste à haut risque pour lui, car s'il est maintenant détesté par les conservateurs, la gauche du parti libéral ne l'aime pas plus. Pour les uns, c'est un traître à l'aristocratie, et pour les autres, c'est un aristocrate qui fait semblant d'être social. Churchill voit son action à ce poste mise à mal en trois occasions : le conflit minier cambrien, le siège de Sidney Street et les premières actions des suffragettes.
En 1910, un certain nombre de mineurs de charbon dans la vallée de Rhondda commencent la manifestation connue sous le nom d'émeute de Tonypandy. Le chef de police de Glamorgan demande à ce que des troupes soient envoyées afin d'aider la police à réprimer les émeutes. Churchill, apprenant que celles-ci sont déjà en route, leur permet d'aller jusqu'à Swindon et Cardiff, mais interdit leur déploiement. Le 9 novembre, le Times critique cette décision. En dépit de cela, la rumeur dans les milieux ouvriers et travaillistes persiste que Churchill a ordonné aux troupes d'attaquer : sa réputation au Pays de Galles et dans les milieux travaillistes y est alors définitivement ternie. En somme, pour la gauche il a été trop dur et pour la droite trop mou. Lui estime qu'il a fait son travail.
Au début du mois de janvier 1911, Churchill fait une apparition controversée au siège de Sidney Street, une opération ayant pour but d'arrêter les auteurs d'un braquage, des révolutionnaires armés et retranchés, semblables à ceux de la bande à Bonnot, à Londres. Il y a une certaine incertitude quant à savoir s'il y a donné des commandements opérationnels. Sa présence, photographiée, attire beaucoup de critiques. Après enquête, Arthur Balfour fait remarquer : lui, Churchill et un photographe risquaient tous les deux leurs précieuses vies. Je comprends ce que faisait le photographe, mais qu'y faisait le très honorable gentleman ? Un biographe, Roy Jenkins, suggère qu'il y est tout simplement allé parce qu' il n'a pas pu résister à l'envie d'aller voir par lui-même » et qu'il n'a pas donné d'ordre. En réalité, derrière la mise en cause de son comportement se cache un problème plus politique. En effet, l'affaire a lieu dans le quartier de Whitechapel où résident de nombreux réfugiés politiques. Joseph Staline y vit par exemple en juin 1907. Les libéraux ont refusé en 1905 de restreindre cette forme d'immigration et les hommes cernés sont membres d'un gang dirigé par un réfugié letton ce qui vaut à Churchill d'être là encore critiqué tant par la droite qui le trouve trop laxiste que par la gauche.
La solution que propose Churchill à la question des suffragettes est un référendum, mais cette idée n'obtient pas l'approbation de Herbert Henry Asquith, et le droit de vote des femmes reste en suspens jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale.
Tous ces évènements mènent le Premier ministre à le nommer Premier Lord de l'Amirauté où il a besoin d'un homme capable de s'imposer face à l'état-major de la Marine.
Le Premier Lord de l'Amirauté et la préparation de la guerre
Début 1911, Churchill est nommé Premier Lord de l'Amirauté. Son premier geste est de prendre pour conseiller l'ancien amiral John Arbuthnot Fisher, le concepteur des dreadnoughts, qui le pousse à accélérer le passage de la propulsion au charbon à celle au fioul sur les bâtiments de la Royal Navy. Pour assurer l'approvisionnement en pétrole, le gouvernement britannique devient l'actionnaire principal de l'Anglo-Persian Oil Company. Fischer lui transmet aussi ses idées concernant la nécessité d'avoir des canons de plus en plus gros calibre, donnant naissance à la première classe de super-dreadnoughts de la marine britannique, la classe Queen Elizabeth. Sur le plan social, il veille à l'amélioration des conditions de vie des marins non officiers. Il s'occupe ensuite de trouver un successeur au Premier Lord de la Mer, Arthur Wilson – c'est surtout pour cela que Churchill a été nommé à ce poste. En effet, Arthur Wilson s'oppose à la création d'un état-major de guerre naval. Il nomme à sa place Francis Bridgeman, et comme Second Lord de la Mer, le prince Louis Alexandre de Battenberg. Fin 1913, il propose à l'Allemagne des vacances navales, c'est-à-dire une trêve dans la construction de bateaux de guerre. Devant le refus de l'Empereur Guillaume II, il présente un projet de budget pour la marine de 50 millions de livres sterling. Pour lui « La marine anglaise est une nécessité » pour les Anglais alors que pour les Allemands, la marine est un luxe. Les dépenses consacrées à la marine provoquent une polémique avec les libéraux, particulièrement avec Lloyd George alors Chancelier de l'Échiquier. Après tractation, Churchill obtient satisfaction et peut lancer de nouveaux cuirassés. Il favorise également le développement de l'aviation navale, prend lui-même des leçons pour être pilote et est l'artisan du développement des chars d'assaut.
Churchill reste attaqué à la fois par les conservateurs et par des membres son propre parti. Aussi, quand le Premier ministre Herbert Henry Asquith propose la Home Rule, c'est-à-dire un projet, sinon d'indépendance, du moins de large autonomie de l'Irlande en 1912, il le soutient sans réserve. Cela du fait que d'une part, il faut selon lui satisfaire les députés irlandais qui ont permis la victoire des libéraux dans le bras de fer concernant la Chambre des lords, et d'autre part car il s'est déclaré favorable au projet dès 1910. Comme Asquith a désigné Churchill comme son principal porte-parole sur le sujet, l'essentiel de la polémique avec les conservateurs et les protestants d'Ulster repose sur ses épaules, ce qui renforce le ressentiment des milieux conservateurs et de leur chef Andrew Bonar Law à son égard.
En juillet 1914, Churchill empêche les Turcs de prendre possession de deux bateaux qu'ils ont pourtant payés, les poussant ainsi à se ranger du côté des Allemands. À cette même période, Churchill reçoit Albert Ballin, président de la Hamburg America Line et chef du lobby maritime allemand, qui s'inquiète de l'aggravation de la crise et l'implore presque les larmes aux yeux de ne pas faire la guerre. Le 1er août, il prévient le Premier ministre Asquith qu'il va rappeler 40 000 réservistes. Le chancelier de l'Échiquier Lloyd George s'y oppose violemment, considérant cette décision comme une provocation contre l'Allemagne. Cependant, avec l'accord tacite d'Asquith, Churchill passe outre : tous deux savent qu'Andrew Bonar Law, le leader conservateur, est partisan de l'intervention aux côtés de la France. Aussi, quand le Cabinet se réunit de nouveau, les opposants à l'intervention se soumettent ou démissionnent, comme le fait John Simon. Cette mobilisation préventive a grandement facilité l'envoi d'un ultimatum à l'Allemagne par Edward Grey, le Secrétaire d'État des Affaires étrangères, qui exige l'évacuation de la Belgique par l'armée allemande, qui vient alors de l'attaquer.
Lire La suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7345#forumpost7345
Posté le : 29/11/2014 21:02
|
|
|
|
|
Winston Churchill2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Les débuts de la guerre
HMS Queen Elizabeth à Alexandrie, La classe Queen Elizabeth, armée de canon de 15 pouces est lancée à l'initiative de Churchill.
Si Churchill est l'un des seuls ministres à s'être réjoui du début du conflit, il doit très vite déchanter. Deux sous-marins allemands coulent chacun trois croiseurs anglais, l'un au large de la Hollande les HMS Aboukir, Hogue, Cressy, l'autre dans la base navale de Scapa Flow HMS Hawke, Audacious et Formidable. Churchill ayant fait sortir la flotte de cette base pour ne pas l'exposer, trois croiseurs allemands bombardent des ports anglais. Enfin, une escadre allemande sillonne l'océan Pacifique et coule de nombreux bateaux de commerce. Lorsqu'une escadre anglaise composée de vieux navires, commandée par l'amiral Christopher Cradock veut les arrêter, elle est envoyée par le fond lors de la bataille de Coronel, l'Amirauté ayant refusé d'envoyer des renforts. Churchill doit faire face à une opinion publique hostile. Le premier Lord naval Louis Alexandre de Battenberg ayant des origines allemandes, le public s'en prend à lui : Churchill et Asquith doivent l'inciter à présenter sa démission. Pour le remplacer, Churchill, malgré les réticences du roi George V, qui a longtemps servi dans la marine, choisit John Arbuthnot Fisher.
Le 5 octobre 1914, Churchill, qui aime l'action, se rend dans la place forte d'Anvers où l'armée belge soutient un siège ponctué de plusieurs sorties contre une importante armée allemande. Le roi Albert Ier et le gouvernement belge souhaitent évacuer tandis que Churchill préfère qu'ils continuent à résister. Churchill en sus de la brigade des Royal Marines qui se trouve sur place envoie les 1re et 2e Naval Brigades. Mais, malgré l'appui de canons de l'artillerie de marine anglaise montés par les Belges sur des wagons plats, les trois lignes de défense de la ville succombent et Anvers est évacuée par l'armée belge le 10 octobre. Parmi les victimes du siège, il y a 500 Anglais. À l'époque, on accuse Churchill d'avoir gaspillé des ressources. Mais il est plus que probable que ses actions ont prolongé la résistance d'Anvers d'une semaine, la Belgique ayant proposé de renoncer à Anvers le 3 octobre et permit de sauver Calais et Dunkerque. En effet, l'armée belge a pu se regrouper avec les forces franco-anglaises dans la région de l'Yser, et participer des 17 au 30 octobre à la bataille de l'Yser qui permet aux alliés de stopper la course à la mer de l'armée allemande bien au-delà de ces deux ports.
Au tournant de 1914-1915, les choses s'améliorent. La Royal Navy commence à renouer avec le succès : elle coule l'escadre allemande qui a ravagé le Pacifique lors de la bataille des Falklands ainsi qu'un croiseur lourd en mer du Nord lors de la bataille de Dogger Bank. Ces succès sont en partie dus à la constitution par Churchill d'une cellule de décryptage des codes secrets, la Room.
L'idée d'un char de combat a déjà été avancée par Herbert George Wells en 1903. Churchill fait en sorte qu'elle devienne une réalité, grâce notamment à des fonds de recherche navale. L'Amirauté nomme ce projet : la folie de Winston. Par la suite, il dirige le Landships Committee, chargé de créer le premier corps de chars d'assaut, ce qui est considéré comme un détournement de fonds même si, une décennie plus tard, le développement du char de combat est porté à son actif.
Bataille des Dardanelles.
Les Dardanelles est un des points clés de l'accès de la Russie à la Méditerranée.
En novembre 1914, les Français et les Britanniques ont déjà perdu presqu'un million d'hommes. Aussi Londres envisage une stratégie de contournement, d'autant que l'Empire ottoman est menaçant tant au Sud, du côté du Canal de Suez, qu'au Nord, contre l'Empire russe dont l'armée est en difficulté . Ce dernier point pousse le ministre de la guerre Lord Kitchener, un militaire de carrière, à se faire l'avocat d'un projet qui aurait également l'avantage d'entraîner la Grèce et peut-être d'autres pays des Balkans dans la guerre, ainsi que de permettre d'avoir accès au blé russe. Churchill, qui alors ne privilégie pas cette hypothèse, reçoit un message de l'amiral Sackville Carden, commandant l'escadre de Méditerranée, qui considère que les Dardanelles pourraient être forcées par des opérations d'envergure mettant en œuvre un grand nombre de navires. À ce moment Winston Churchill se déclare favorable au projet, d'autant que son premier lord naval y est favorable. L'opération est adoptée le 15 janvier 1915 en conseil de guerre. Pourtant ensuite, rien ne va se dérouler comme prévu, en particulier parce que les acteurs, notamment Kitchener et le premier Lord naval Fisher, sont partagés : le premier, parce qu'il doit trancher entre les occidentaux, c'est-à-dire les militaires qui veulent se concentrer sur le front occidental, et les orientaux, qui veulent ouvrir un front en Asie mineure. Le premier lord naval quant à lui hésite, après avoir donné son accord, car il a peur de devoir employer trop de bateaux loin de l'Angleterre qu'il estime devoir protéger en priorité. De ce fait, une opération conçue pour être menée rapidement et de façon déterminée, va se perdre dans des méandres administratifs, laissant aux adversaires le soin de préparer leur défense. Enfin, l'amiral Sackville Hamilton Carden qui a eu l'idée du projet flanche au moment de passer à l'action et doit être soigné. Le problème est que Churchill a fait tant et si bien qu'il passe pour le principal instigateur du projet, et que l'échec va lui être imputé. Une commission d'enquête parlementaire exonère ensuite Churchill et conclut à la responsabilité du Premier ministre Asquith, qui n'a pas fait preuve lors des conseils de guerre de la fermeté nécessaire, et à celle de Kitchener. Mais entre temps, Churchill a dû démissionner de l'Amirauté le 11 novembre 1915.
Les conséquences des Dardanelles pour Churchill
Il se voit attribuer une grande part de responsabilité de l'échec, et, lorsque le Premier ministre Asquith forme une coalition comprenant tous les partis, les conservateurs réclament sa rétrogradation comme condition à leur participation. Ce retrait de la vie politique active le conduit, pour se détendre, à se mettre à la peinture. Churchill se voit attribuer la sinécure de chancelier du duché de Lancaster, poste subalterne du gouvernement.
Toutefois, le 15 novembre 1915, il démissionne, ayant le sentiment que son énergie n'est pas utilisée et, tout en restant député, sert pendant plusieurs mois sur le front de l'Ouest en commandant le 6e bataillon du Royal Scots Fusiliers avec le grade de colonel. En mars 1916, il retourne en Angleterre, car il s'impatiente en France et souhaite intervenir à nouveau à la Chambre des communes. La correspondance avec son épouse durant cette période de sa vie montre que si le but de sa participation au service actif est la réhabilitation de sa réputation, il est conscient du risque d'être tué. En tant que commandant, il continue à montrer l'audace dont il a fait sa marque dans ses actions militaires précédentes, bien qu'il désapprouve fortement les hécatombes ayant lieu dans de nombreuses batailles du front occidental. Lord Deedes a expliqué, lors d'une réunion de la Royal Historical Society en 2001, pourquoi Churchill s'est rendu sur la ligne de front : Il était avec les Grenadier Guards, qui étaient à sec sans alcool au quartier général du bataillon. Ils aimaient beaucoup le thé et le lait condensé, ce qui n'avait pas beaucoup d'attrait pour Winston, mais l'alcool était autorisé dans la ligne de front, dans les tranchées. Il a donc suggéré au colonel qu'il se devait de voir la guerre de plus près et se rendre là-bas, ce qui fut vivement recommandé par le colonel, qui pensait que c'était une très bonne chose à faire.
Le ministre de Lloyd George
Le 7 décembre 1916, David Lloyd George devient Premier ministre d'un gouvernement de coalition libéral-conservateur. Winston Churchill espère en faire partie mais se heurte au veto des conservateurs d'Andrew Bonar Law. Malgré cela le Premier ministre, qui comme Churchill se méfie du commandement militaire, finit par le nommer ministre de l'Armement le 17 juillet 1917.
Ministre de l'armement puis ministre de la guerre
À ce poste, il veille à l'approvisionnement des armées et continue à plaider pour l'utilisation de chars qui commencent à se montrer efficaces, notamment aux environs de Cambrai en 1918. Pour A. J. P. Taylor, les chars ont été plus importants au niveau psychologique que stratégique car ils ont ébranlé la foi allemande en la victoire.
Comme ministre de la guerre à partir de janvier 1919, il fait face au mécontentement des soldats qui veulent être rapidement démobilisés. Il est le principal architecte de la Ten Year Rule, ligne de conduite permettant au Trésor de diriger et de contrôler les politiques stratégique, financière et diplomatique en soutenant l'hypothèse qu' il n'y aurait pas de grande guerre européenne pour les cinq ou dix prochaines années. Durant les négociations sur le Traité de Versailles, il s'efforce de modérer les exigences de Georges Clemenceau et se désole du peu d'enthousiasme de David Lloyd George pour la Société des Nations.
Churchill, qui est opposé au bolchevisme, veut faire adopter par le cabinet de guerre une politique agressive contre la Russie. Néanmoins David Lloyd George n'y est pas favorable et le modère. Les libéraux et les travaillistes du Labour s'y opposent aussi et le Daily Express estime que le pays a suffisamment toléré la mégalomanie de M. Winston Churchill. Par ailleurs, le gouvernement veut reprendre le commerce avec la Russie et l'activisme de Churchill est perçu comme gênant.
Secrétaire d'État aux colonies en 1921-1922
Il devient Secrétaire d'État aux colonies en 1921. À ce titre, il est signataire du traité anglo-irlandais de la même année, qui établit l'État libre d'Irlande. Il est impliqué dans les longues négociations du traité et, pour protéger les intérêts maritimes britanniques, conçoit une partie de l'accord de l'État libre d'Irlande afin d'inclure trois ports : Queenstown Cobh, Berehaven et Lough Swilly, ports pouvant être utilisés comme bases atlantiques pour la Royal Navy. En accord avec les termes du traité anglo-irlandais du Commerce, ces bases seront restituées à la nouvellement nommée Irlande en 1938. Le traité stipule également que l'État libre d'Irlande est membre du Commonwealth of Nations, terme qui pour la première fois se substitue dans un document officiel à celui d'Empire britannique
En tant que Secrétaire d'État aux colonies, il est chargé du Proche-Orient qui vient de passer sous contrôle britannique, et prend le colonel Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie, comme conseiller. C'est lui qui favorise le couronnement de l'émir Fayçal en Mésopotamie britannique et d'Abd-Allah en Transjordanie. Par ailleurs, dans ce qui deviendra l'Irak, il remplace les forces terrestres anglaises par des avions de chasse, moins visibles. Il se montre par ailleurs favorable à l'utilisation d'armes chimiques sur les populations kurdes du nord de l'Irak animées par des velléités d'indépendance comme il le précise dans une note adressée au War Office en mai 1919 : "Je suis fortement en faveur de l'usage de gaz empoisonné contre des tribus non civilisées". Thomas Edward Lawrence dans son livre, Les Sept Piliers de la sagesse, cite Churchill de façon positive.
David Lloyd George mène une politique pro-grecque après la Première Guerre mondiale et soutient ce pays lors de la guerre gréco-turque de 1919. Churchill n'est pas favorable à cette option, car il pense que pour arriver à une paix durable dans la région, Smyrne et ses environs doivent être maintenus sous souveraineté turque. Par ailleurs, il est pour l'abandon de la ville de Chanak située sur la rive asiatique des Dardanelles et pour un repli des troupes britanniques sur la rive européenne à Gallipoli. Lloyd George ne le suit pas, ce qui conduit à une forte tension entre Britanniques et Turcs qui aboutira au traité de Lausanne. Cette affaire contribue auparavant à la chute du cabinet de Lloyd George car l'opinion publique britannique, les conservateurs ainsi qu'Herbert Asquith leur reprochent à lui et Churchill d'être trop attirés par les rapports de force et de ne pas assez penser à la paix. Certains ont vu dans la déclaration d'Andrew Bonar Law, le leader des conservateurs, selon laquelle nous ne pouvons être le gendarme du monde, l'épitaphe de l'âge d'or de l'Empire.
Churchill durant l'entre-deux guerres Retour au Parti conservateur
En septembre, le Parti conservateur se retire de la coalition du gouvernement à la suite d'une réunion de députés insatisfaits de la gestion de l'affaire Chanak, ce qui provoque les élections générales d'octobre 1922. Churchill tombe malade durant la campagne, et doit subir une appendicectomie de sorte que sa femme Clementine doit faire l'essentiel de la campagne à sa place. Il doit aussi composer avec les problèmes internes du Parti libéral, divisé entre ceux qui soutiennent David Lloyd George comme lui et ceux qui soutiennent Herbert Asquith. Il arrive quatrième à l'élection de Dundee, perdant au profit d'Edmund Dene Morel sa place de député. Sa défaite ne passe pas inaperçue et Churchill préfère prendre du recul sur la Côte d'Azur où il se détend en peignant des tableaux. Le vainqueur, Andrew Bonar Law, est élu en partie parce qu'il est celui qui ressemble le moins au Premier ministre précédent. Néanmoins, il tombe très vite malade et est remplacé par Stanley Baldwin qui pour faire face au chômage veut instaurer des mesures protectionnistes. Churchill toujours en faveur du libre-échange se présente de nouveau pour les libéraux aux élections générales de 1923, et perd cette fois-ci à Leicester. Les travaillistes qui sont également pour le libre-échange s'allient alors aux libéraux pour former un gouvernement. Churchill n'approuvant pas ce rapprochement quitte le parti libéral et se présente comme indépendant d'abord sans succès dans une élection partielle dans la circonscription de l'abbaye de Westminster, puis avec succès aux élections générales de 1924, à Epping. Stanley Baldwin qui craint que Churchill, LLoyd Georges et F.E. Smith, trois grands orateurs, ne montent un parti du centre et ne le mettent en difficulté au parlement décide de le nommer ministre. Neville Chamberlain qui ne veut pas du poste lui suggère de nommer Churchill chancelier de l'échiquier. L'année suivante, il rejoint officiellement le Parti conservateur, en commentant ironiquement que n'importe qui peut être un lâcheur, mais il faut une certaine ingéniosité pour l'être à nouveau.
Deux points sont ici à noter : Churchill qui voit dans le socialisme l'ombre de la folie communiste, est alors extrêmement impopulaire dans toute la gauche anglaise. Emmanuel Shinwell, un député travailliste écrit : lorsqu'un orateur travailliste se trouvait à court d'arguments, il lui suffisait de dire "À bas Winston Churchill !" ... pour déclencher un tonnerre d'applaudissements. Par ailleurs, Churchill n'est pas un homme de parti. Il écrit dans les années 1920 tous les petits politiciens chérissaient de tout cœur les drapeaux des partis, les tribunes des partis... tout heureux de constater le retour des bons vieux jours de faction d'avant-guerre ! Plus tard, il sera marginalisé au sein du parti conservateur pour des raisons politiques, mais également parce que ce n'est pas un homme d'appareil.
Ministre des Finances 1924-1929
Churchill est surpris d'apprendre qu'il est nommé ministre des Finances du Royaume-Uni, et demande au Premier ministre Le foutu canard va-t-il nager? De fait, il confie un jour à son secrétaire privé parlementaire Robert Boothby, après une réunion avec des économistes, des banquiers et des hauts fonctionnaires des finances : si seulement c'étaient des amiraux ou des généraux. Je parle leur langue, et je peux les battre. Mais au bout d'un instant, ces types commencent à parler chinois. Et alors je suis noyé. À ce poste, Churchill dirigera le désastreux retour à l'étalon-or qui aboutit à la déflation, au chômage et à la grève des mineurs, prémices de la grève générale de 1926. Manchester note qu'il est malgré tout loin d'être le pire Chancelier de l'échiquier qu'a connu le pays.
L'élément le plus notable de son premier budget est le retour à l'étalon-or. En fait, Churchill a beaucoup hésité et beaucoup consulté, car il craint pour l'industrie britannique. Il se heurte à la détermination des hauts responsables économiques et financiers Otto Niemeyer, Ralph George Hawtrey du trésor, Lord Bradbury du Joint Select Committee, chargé d'étudier la question, et Montagu Norman de la Banque d'Angleterre. Côté politique, le Premier ministre aurait été déçu que Churchill prenne une autre décision, d'autant plus que Philip Snowden, son prédécesseur travailliste, est favorable à la mesure. En revanche y sont opposés John Maynard Keynes et Reginald McKenna. Lors d'un dîner le 27 mars 1925 où Bradbury et Niemeyer font face à Keynes et MacKenna ce dernier affirme qu'en matière de politique pratique Churchill n'a pas d'autre possibilité que le retour à l'or. Churchill prend alors la décision qu'il considérera comme la plus grande erreur de sa vie, en ayant déjà conscience de son caractère plus politique qu'économique. Dans son discours sur le projet de loi, il déclare : Je vais vous dire ce qu'il [le retour à l'étalon-or va nous attacher. Il va nous attacher à la réalité ». Cette décision incite Keynes à écrire The Economic Consequences of Mr. Churchill, faisant valoir que le retour à l'étalon-or avec sa parité d'avant-guerre en 1925, 1 £ = 4 86 $, conduirait à une dépression mondiale. Sont également opposés à cette décision Lord Beaverbrook et la fédération des industries britanniques. Son premier projet de budget comporte aussi plusieurs mesures sociales comme l'abaissement de l'âge de la retraite, les subsides aux veuves et aux orphelins ainsi qu'un accès plus facile aux aides sociales. Elles sont financées par une baisse des impôts pour les plus pauvres et une hausse pour les revenus non salariaux ainsi qu'une baisse du budget de la Défense, Marine et aviation notamment. Il ne sera en faveur du réarmement qu'à partir des années 1930.
Le retour au taux de change d'avant-guerre et à l'étalon-or déprime les industries. La plus touchée est celle du charbon. Déjà affectée par la baisse de la production depuis que les navires sont passés au pétrole, le retour aux changes d'avant-guerre crée des coûts additionnels pouvant atteindre 10 % pour l'industrie. En juillet 1925, les propriétaires des mines de charbon veulent imposer une baisse des salaires pour faire face à la concurrence étrangère. Le gouvernement qui craint un conflit dur nomme une commission d'enquête présidée par Herbert Samuel. Il verse en attendant une subvention aux entreprises. La Commission conclut que les propriétaires des mines ont réalisé d'importants bénéfices et négligé les investissements de telle sorte que le matériel est désuet et que de forts gains de productivité sont possibles. Pourtant, Baldwin ne veut pas forcer les propriétaires des mines à investir et maintient que des baisses de salaires sont nécessaires. Cela conduit à la grève générale de 1926. Une fois le bras de fer commencé Churchill ne veut absolument pas capituler et Baldwin, qui ne veut pas que Churchill se mêle trop de la question, le charge de la British Gazette, un organe gouvernemental de presse temporaire chargé de faire connaître au public, alors que les journaux sont en grève et ne paraissent plus, la position du gouvernement. Churchill se met au travail avec entrain et sans aucune impartialité, car l'État ne peut être impartial dans ses rapports entre lui-même et le groupe de sujets contre lequel il lutte. Le journal connait une forte progression de sa diffusion pour le dernier numéro correspondant au dernier jour de grève, avec 2 209 000 exemplaires diffusés. Une fois la victoire atteinte Churchill tient à ce que le gouvernement fasse preuve de magnanimité, mais du fait des réticences patronales, et malgré ses efforts, la grève est relancée dans les mines et dure jusqu'au début de l'hiver.
En 1927, lors d'une conférence de presse à Rome, il tient des propos favorables à Mussolini qui provoquent la fureur du rédacteur en chef du Manchester Guardian. Pour sa défense, Churchill affirme que l'Angleterre doit défendre tout régime continental opposé à son plus grand ennemi, le communisme.
La philosophie de l'Histoire de Churchill
La parution des volumes de The World Crisis, littéralement Le Monde en crise s'échelonne entre 1923 et 1931. Une des thèses centrales des deux premiers volumes parus en 1923 peut être formulée ainsi : durant le conflit, les professionnels de la guerre, généraux et amiraux – the brass-hat –, ont eu régulièrement tort, tandis que les professionnels de la politique – the frocks – ont eu généralement raison. John Maynard Keynes, qui apprécie l'ouvrage, suggère dans une remarque les réserves qu'il inspire au Groupe de Bloomsbury. Pour lui, le livre provoque un peu d'envie peut-être, devant sa conviction inébranlable que les frontières, les races, les patriotismes, et même les guerres s'il le faut, sont des vérités ultimes de l'Humanité, ce qui confère dans son esprit une sorte de dignité et même de noblesse à des évènements qui ne sont pour d'autres qu'un intermède cauchemardesque, quelque chose qu'il convient d'éviter constamment.
Dans Toughts and Adventure, Churchill développe une vision de l'Histoire à l'opposé de celle de Karl Marx. Pour lui, elle est d'abord faite par les grands hommes. Dans le livre précédemment cité, il écrit : l'histoire du monde est principalement le geste des êtres exceptionnels, dont la pensée, les actions, les qualités, les vertus, les triomphes, les faiblesses ou les crimes ont dominé la fortune des hommes. De là découlent selon François Bédarida trois conséquences. Tout d'abord, l'Histoire, soumise au libre choix des hommes, est imprévisible. Ensuite, pour Churchill, le présent éclaire plus le passé que l'inverse. Par exemple, dans son livre sur son ancêtre, le Duc de Malborough, c'est le présent, les actions de Lloyd George ou même d'Hitler, qui lui permettent de comprendre le xviie siècle. Enfin, comme pour le grand historien Whig Lord Acton, et, dans une moindre mesure, comme Augustin d'Hippone, il voit l'Histoire comme un combat moral entre le bien et le mal. De là, il s'ensuit que, pour Bédarida, Churchill adopte une approche à la fois idéologique et mythique dans la lignée de la Conception whig de l'histoire.
Traversée du désert
Churchill a écrit une biographie de son ancêtre John Churchill, 1er duc de Marlborough dans le milieu des années 1930.
Le gouvernement conservateur est défait aux élections générales de 1929. Churchill prend du recul et va faire un cycle de conférences aux États-Unis il est présent par hasard à la tribune de la bourse de Wall Street le Jeudi noir qui plonge le monde et la Grande-Bretagne dans la crise. En désaccord avec la majorité du parti conservateur sur les questions de protection tarifaire et du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, il n'occupe rapidement plus aucune position d'influence dans le parti. Lorsque, face à la crise, Ramsay MacDonald forme le gouvernement d'unité nationale en 1931, il n'est pas invité à s'y joindre. Sa carrière est au ralenti, c'est une période connue comme étant sa traversée du désert.
Me voici, après quelque trente années à la Chambre des communes, après avoir détenu plusieurs des plus hautes fonctions de l'État. Me voici congédié, écarté, abandonné, rejeté et détesté. Parlant des hommes politiques en vue de l'époque Ramsay MacDonald et Stanley Baldwin ... deux infirmières idéales pour garder le silence dans une chambre obscure.
La majeure partie des années suivantes est consacrée à ses écrits, dont Marlborough : His Life and Times, une biographie de son ancêtre John Churchill, 1er duc de Marlborough, A History of the English-Speaking Peoples, œuvre publiée bien après la Seconde Guerre mondiale, et Great Contemporaries, une série de portraits d'hommes ou de femmes politiques contemporains comme Nancy Astor ou Ramsay MacDonald. Il est alors l'un des écrivains les mieux payés de son temps. Pour sa femme Clémentine, et plus tard pour Churchill lui-même, cet isolement est une chance car, eût-il été ministre, il y a peu de chances qu'il eût pu réellement peser sur le cours des événements tellement la situation politique intérieure était, selon elle, déprimante. Durant les années 1930, trois éléments au moins expliquent la persistance de sa traversée du désert : sa position sur l'IndeBe 15, son rôle dans l'affaire de l'abdication royale qui renforce dans l'opinion l'idée que Churchill est imprévisible, et son opposition à l'Allemagne nazie, qui pour lui représente la principale menace, le fascisme italien ou l'Espagne franquiste, dont il faut néanmoins éviter qu'ils ne renforcent l'Allemagne, étant pour lui moins importants. Cela le met en porte-à-faux par rapport à une classe politique pacifiste. Pour toutes ces raisons, son parti préfère, dans la seconde moitié des années 1930, nommer au poste de Premier ministre un homme comme Neville Chamberlain.
Le statut de l'Inde Partition des Indes.
Au cours de la première moitié des années 1930, Churchill est franchement opposé à l'octroi du statut de dominion à l'Inde. Après un voyage aux États-Unis en 1930, il aurait dit : « l'Inde est un terme géographique, ... elle n'est pas plus une nation unie que l'Équateur. Il est l'un des fondateurs de la Ligue de défense de l'Inde, un groupe dédié à la préservation du pouvoir britannique dans la colonie. Dans des discours et des articles de presse de cette période, il prévoit un taux de chômage britannique élevé et la guerre civile en Inde si l'indépendance devait être accordée. Le vice-roi Edward Wood, qui deviendra Lord Halifax, qui avait été nommé par le précédent gouvernement conservateur, participe à la première Round Table Conference, qui se tient de novembre 1930 à janvier 1931, puis annonce la décision gouvernementale selon laquelle l'Inde devrait recevoir le statut de dominion. En cela, le gouvernement est appuyé par le Parti libéral et par la majorité du Parti conservateur. Churchill dénonce la conférence. Lors d'une réunion de l'Association conservatrice d'Essex-Ouest spécialement convoquée afin que Churchill puisse expliquer sa position, il affirme : il est aussi alarmant et nauséabond de voir M. Gandhi, un avocat séditieux du Middle Temple, qui pose maintenant comme un fakir d'un type bien connu en Orient, montant à demi-nu jusqu'aux marches du palais du vice-roi ... afin de parlementer sur un pied d'égalité avec le représentant de l'empereur-roi. Il nomme les dirigeants du Congrès indien « des brahmanes qui vocifèrent et baratinent les principes du libéralisme occidental.
Deux incidents contribuent à affaiblir la position déjà chancelante de Churchill au sein du Parti conservateur et tous deux sont considérés comme des attaques envers la majorité des conservateurs. La veille d'une élection partielle à St-George, en avril 1931 où le candidat officiel du parti Duff Cooper est opposé à un conservateur indépendant appuyé par Lord Rothermere, Lord Beaverbrook et leurs journaux respectifs, il prononce un discours considéré comme une déclaration de soutien au candidat indépendant et comme un appui à la campagne des barons de la presse contre Baldwin. Finalement l'élection de Duff Cooper renforce BaldwinRh 6d'autant que la campagne de désobéissance civile en Inde cesse avec le pacte Gandhi-Irwin Irwin deviendra Lord Halifax. Le deuxième incident fait suite à une mise en cause de Samuel Hoare et Lord Derby selon laquelle ils auraient fait pression sur la Chambre de commerce de Manchester afin qu'elle modifie le rapport transmis au Joint Select Committee, examinant la loi sur le gouvernement de l'Inde, violant ainsi le privilège parlementaire. Churchill évoque la question devant le Comité des privilèges de la Chambre des communes qui, après enquête, rapporte à la Chambre qu'il n'y a pas eu violation. Le rapport est débattu le 13 juin. Churchill n'est pas en mesure de trouver un seul partisan et le débat prend fin sans vote.
Churchill rompt définitivement avec Stanley Baldwin sur le statut de l'Inde, et n'obtient aucun ministère tant que celui-ci est Premier ministre. Par ailleurs, il se prive du soutien de personnalités progressistes du Parti conservateur tels qu'Anthony Eden, Harold Macmillan ou Duff Cooper qui auraient pu l'aider dans sa lutte contre la politique d'apaisement menée envers Hitler. En fait, trois éléments posent problème à Churchill. Durant cette période, l'Angleterre abandonne de facto le libre-échange qui a été le pilier de sa doctrine depuis le milieu du XIXe siècle. Par ailleurs, avec l'indépendance de l'Inde qu'il voit se dessiner, l'Angleterre devient une puissance moyenne : sans ses possessions impériales, le pays ne serait plus qu'une île obscure au large du continent européen. Enfin, Churchill cherche à revenir au pouvoir. Pour Lord Beaverbrook, son attitude relève du vice de caractère qui le conduit à accepter n'importe quoi pourvu que cela conduise au pouvoir. Pour certains historiens, l'explication de l'attitude de Churchill à l'égard de l'Inde est à chercher dans son livre My Early Life, publié en 1930.
Le réarmement de l'Allemagne
À partir de 1932, il s'oppose à ceux qui préconisent de donner à la République de Weimar le droit de parité militaire avec la France, et parle souvent des dangers de son réarmement. Sur ce point, il suit Lord Lloyd qui le premier a mis en garde contre ce problème. L'attitude de Churchill envers les futurs membres de l'Axe Rome-Berlin-Tokyo est ambigüe. En 1931, il met en garde la Société des Nations lorsqu'elle veut s'opposer à l'invasion japonaise en Mandchourie : J'espère que nous allons essayer en Angleterre de comprendre la position du Japon, un État ancien... D'un côté, il fait face à la sombre menace de la Russie soviétique. De l'autre, il y a le chaos de la Chine, avec quatre ou cinq provinces qui sont torturées sous le régime communiste. Dans les articles de presse, il compare le gouvernement républicain espagnol à un bastion du communisme, et voit l'armée de Franco comme un mouvement anti-rouges.
À partir de 1933, des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui sont en désaccord avec la politique suivie envers l'Allemagne vont commencer à tenir Churchill informé de ce qui se passe exactement. Les plus notables de ses informateurs sont Ralph Wigram, directeur du département Europe centrale, et dans une moindre mesure Robert Vansittart, ainsi que le lieutenant colonel Thor Anderson – une connaissance de sa secrétaire principale Violet Pearman. Wigram lui apprend notamment que les nazis construisent en secret des sous-marins et des avions. Ces informations nourrissent son premier grand discours sur la défense du 7 février 1934, où il insiste sur la nécessité de reconstruire la Royal Air Force et de créer un ministère de la Défense. Son poids politique commence alors à reprendre de la consistance et il est rejoint par des hommes comme Leo Amery ou Robert Horne, ce qui force Baldwin à prendre l'engagement de maintenir l'aviation anglaise à parité avec l'aviation allemande ; ce sera fait après bien des avanies. Notons que Churchill n'est pas forcément un visionnaire en matière d'avions, car il n'est pas très enthousiaste pour la production des deux types d'avion qui pourtant lui permettront de gagner la bataille d'Angleterre : le Supermarine Spitfire et le Hawker Hurricane. Son second, le 13 juillet, demande instamment un pouvoir renforcé de la Société des Nations. Ces points restent ses thèmes primordiaux avant 1936.
Dans un essai de 1935, intitulé Hitler and his Choice et republié dans Great Contemporaries en 1968, il exprime l'espoir qu'en dépit de son ascension au pouvoir par des méthodes dictatoriales, par la haine et la cruauté, Hitler puisse encore passer à l'Histoire comme l'homme qui a restauré l'honneur et la tranquillité d'esprit de la grande nation germanique, de nouveau sereine, utile et forte, et au premier plan du cercle de la famille européenne. Lorsqu'Hitler peu de temps après décrète à nouveau la conscription, il espère que la France fasse usage de sa supériorité temporaire pour attaquer l'Allemagne, ce qu'elle ne fait pas comme Hitler l'a anticipé. Churchill s'oppose avec David Lloyd George au Traité naval germano-britannique de juin 1935 car pour lui, le Royaume-Uni a tort d'accepter qu'en violation des traités l'Allemagne ait autant de sous-marins que le Royaume-Uni et que sa flotte puisse se situer à 35% de son homologue britannique. En effet, la flotte britannique a un Empire à défendre et n'est pas circonscrite comme les Allemands à la mer du Nord. Lors de ce pacte le Royaume-Uni ne prend pas vraiment l'aval de Paris qui ne dit rien. Par contre, il ne s'oppose pas au pacte Hoare-Laval sur l'Éthiopie, car il veut ménager l'Italie pour essayer de la couper de l'Allemagne nazie qui est son principal adversaire
Quand les Allemands réoccupent la Rhénanie en février 1936, la Grande-Bretagne est divisée : l'opposition travailliste est fermement opposée à toute sanction, tandis que le gouvernement national est désuni, entre ceux qui soutiennent des sanctions économiques, et ceux qui affirment que cela peut conduire à un recul humiliant de la Grande-Bretagne, car la France ne pourrait soutenir une intervention. Le discours mesuré de Churchill, le 9 mars, est salué par Neville Chamberlain comme constructif. Pourtant dans les semaines suivantes, il n'obtient pas le poste de ministre pour la Coordination de la Défense, qui échoit au procureur général Thomas Inskip. En juin 1936, Churchill organise une délégation de hauts responsables conservateurs, qui partagent son inquiétude, afin de voir Baldwin, Chamberlain et Halifax. Il essaie de convaincre des délégués des deux autres partis de se joindre à eux, et, plus tard, écrit : si les dirigeants de l'opposition des libéraux et du Labour étaient venus avec nous, cela aurait pu aboutir à une situation politique aussi puissante que les résultats des actions mises en place. Mais son initiative n'aboutit à rien, Baldwin faisant valoir que le gouvernement fait tout ce qu'il peut étant donné le sentiment antiguerre de l'électorat.
Le 12 novembre, Churchill revient sur le sujet dans un discours que Robert Rodhe James qualifie comme étant l'un des plus brillants de Churchill au cours de cette période. Après avoir donné quelques exemples qui montrent que l'Allemagne se prépare à la guerre, il dit : le gouvernement est incapable de prendre une décision ou de contraindre le Premier ministre à en prendre une. Les membres du cabinet s'empêtrent dans d'étranges paradoxes, bien décidés à ne rien décider, bien résolus à ne rien résoudre ; ils mettent toute leur énergie à filer à la dérive, tous leurs efforts à être malléables, toutes leurs forces à se montrer impuissantes. Les mois et les années qui vont suivre seront d'un si grand prix pour la grandeur de l'Angleterre, elles seront même d'une importance vitale, mais ils ne feront rien, ils nous laisseront nous faire dévorer par les sauterelles. En face, la réponse de Baldwin semble faible et perturbe la Chambre.
Crise d'abdication d'Édouard VIII.
En juin 1936, Walter Monckton confirme à Churchill que les rumeurs selon lesquelles le roi Édouard VIII a l'intention d'épouser Wallis Simpson, une roturière américaine, sont crédibles, ce qui le contraindrait à abdiquer. En novembre, il refuse l'invitation de Lord Salisbury à faire partie d'une délégation de conservateurs chevronnés qui veut discuter avec Baldwin de la question. Le 25 novembre, lui, Attlee et le leader libéral Archibald Sinclair s'entretiennent avec Baldwin, qui leur annonce officiellement l'intention du roi. On leur demande s'ils accepteraient de prendre la suite du gouvernement national en place s'il démissionnait en cas de refus du roi de se soumettre. Attlee et Sinclair font part de leur solidarité avec Baldwin sur cette question. Churchill répond que son état d'esprit est un peu différent, mais qu'il soutiendrait le gouvernement.
La crise d'abdication devient publique dans les quinze premiers jours du mois de décembre 1936. À ce moment, Churchill donne officiellement son soutien au roi. La première réunion publique du Arms and the Covenant Movement a lieu le 3 décembre. Churchill était un grand orateur et écrivit plus tard que dans la réponse au discours de remerciement, il fait une déclaration sur l'inspiration du moment, demandant un délai avant que toute décision soit prise soit par le roi soit par son cabinet. Plus tard dans la nuit, Churchill examine le projet de déclaration d'abdication, et en discute avec Beaverbrook et l'avocat du roi. Le 4 décembre, il rencontre le monarque et l'exhorte de nouveau à retarder toute décision. Le 5 décembre, il publie une longue déclaration dénonçant la pression inconstitutionnelle que le ministère applique sur le roi, pour le forcer à prendre une décision hâtive. Le 7 décembre, il tente d'intervenir aux Communes pour plaider en faveur d'un délai. Il est hué. Apparemment déstabilisé par l'hostilité de tous les membres, il quitte la salle.
La réputation de Churchill au Parlement, comme dans le reste de l'Angleterre, est gravement compromise. Certains, comme Alistair Cooke, l'imaginent essayant de fonder un parti royaliste, le King's Party. D'autres, comme Harold Macmillan, sont consternés par les dégâts, provoqués par l'appui de Churchill au roi, envers le Arms and the Covenant Movement. Churchill lui-même écrit plus tard : J'ai été frappé que dans l'opinion publique, cela fut presque unanimement vu comme la fin de ma vie politique. Les historiens sont divisés sur les motifs de Churchill à apporter son soutien à Édouard VIII. Certains, comme A. J. P. Taylor, voient cela comme une tentative de « renverser un gouvernement d'hommes faibles. D'autres, comme Rhode James, voient les motivations de Churchill comme honorables et désintéressées.
Loin du pouvoir mais présent
S'il est vrai qu'il a peu d'appui à la Chambre des communes pendant une bonne partie des années 1930, qu'il est isolé au sein du Parti conservateur, son exil est plus apparent que réel. Churchill continue d'être consulté sur de nombreuses questions par le gouvernement, et est toujours considéré comme un leader alternatif.
Même à l'époque où il fait campagne contre l'indépendance de l'Inde, il reçoit des informations officielles, et par ailleurs secrètes. Dès 1932, le voisin de Churchill, le major Desmond Morton, avec l'approbation de Ramsay MacDonald, lui donne des informations du même type sur la force aérienne allemande. À partir de 1930, Morton dirige un département du Comité de Défense impériale chargé de la recherche sur la capacité opérationnelle des défenses des autres nations. Lord Swinton, en tant que Secrétaire d'État de l'air, et avec l'approbation de Baldwin, lui donne accès en 1934 à tous ces renseignements. Tout en sachant que Churchill resterait très critique envers le gouvernement, Swinton le renseigne, car il pense qu'un adversaire bien informé est préférable à un autre se fondant sur des rumeurs et des ouï-dire.
Churchill est un féroce opposant de la politique d'apaisement de Neville Chamberlain envers Adolf Hitler et après la crise de Munich, au cours de laquelle la Grande-Bretagne et la France ont abandonné la Tchécoslovaquie à l'Allemagne, il déclare de façon prophétique au cours d'un discours à la Chambre des communes : Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. Ce moment restera à jamais gravé dans vos cœurs. Churchill est, alors, en faveur d'une alliance avec l'URSS. En effet, il estime qu'elle est nécessaire à la lutte contre l'Allemagne nazie. Il tente d'autant plus de faire avancer ce dossier qu'il connaît l'ambassadeur soviétique au Royaume-Uni, Ivan Maisky, et qu'il sait que le ministre des Affaires étrangères soviétique Maxime Litvinov pousse dans ce sens. Mais, Neville Chamberlain et son ministre des Affaires étrangères s'opposent à une telle alliance, tout comme, d'ailleurs, l'administration française. Face à cette situation Joseph Staline limoge Litvinov et nomme Molotov à sa place pour mener une politique qui conduit au pacte germano-soviétique, le 23 août 1939.
L’influence de Churchill, bien qu'il n'ait plus aucun poste officiel, s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, en Angleterre, les apparences peuvent être trompeuses. Il rappelle que « des décisions politiques historiques, dont certaines figurent dans The English Constitution de Walter Bagehot ont été prises par des hommes qui n'ont jamais exercé de fonctions publiques et n'ont jamais siégé au parlement. D'autre part, Churchill a une présence imposante, il montre qu'il est là, il sait se faire entendre, voire en imposer aux autres. Enfin, il est considéré comme faisant partie de la classe dirigeante de son pays tant en raison des postes importants qu'il a tenus, que de son ascendance. Hitler a traité avec Chamberlain qu'il n'aimait pas mais qu'il trouvait malléable ; avec Churchill, les choses sont différentes. En effet, si comme W. Manchester et Walter Lippmann, on pense que la qualité indispensable à l'exercice des fonctions suprêmes est le tempérament, et non l'intelligence, alors, Churchill et Hitler l'ont en commun : tous deux ont un fort tempérament même s'ils n'en font pas le même usage et s'ils n'ont pas les mêmes fins. Au demeurant, ils partagent d'une certaine façon ce trait de caractère avec les deux ou trois autres Grands de la deuxième guerre mondiale.
Churchill durant la Seconde Guerre mondiale
Le Premier Lord de l'Amirauté is back
Après le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, les événements se précipitent. L'Allemagne envahit la Pologne le 3 septembre 1939, ce qui oblige le Royaume-Uni à lui déclarer la guerre. Churchill est alors nommé Premier Lord de l'Amirauté et membre du Cabinet de guerre, tout comme il l'avait été pendant la première partie de la Première Guerre mondiale. La légende veut que lorsqu'il en est informé, le Conseil de l'Amirauté envoie ce message à la flotte : Winston is back60. En fait, pour François Bédarida, il n'en est rien, le biographe de Churchill Martin Gilbert n'ayant jamais trouvé trace de ce message. En revanche, il est exact que la marine accueille favorablement sa nomination. Churchill est nommé en raison de la défiance des députés et d'une partie du gouvernement envers le Premier ministre Neville Chamberlain. Aussi, celui-ci juge opportun de faire entrer au gouvernement un député partisan d'une attitude plus résolue face à l'Allemagne nazie. Peu de temps après sa nomination, Churchill reçoit un appel téléphonique de Franklin Delano Roosevelt l'informant que l'amiral Raeder de la marine allemande l'a averti d'un complot britannique visant à couler un bateau américain l'Iroquoi et d'en faire porter la responsabilité sur les Allemands. Les Britanniques vérifient que le complot n'est pas allemand couler le bateau pour leur en faire porter la responsabilité. Finalement rien ne se passe et l'incident marque surtout le début d'un long échange épistolaire de mille six cent quatre-vingt-huit lettres entre les deux hommes. À l'Amirauté, Churchill est très occupé. En effet, durant la drôle de guerre, les seules actions notables ont lieu en mer. Comme au cours de la Première Guerre mondiale, la Royal Navy subit d'abord des pertes avant de connaître une première victoire sur le Graf Spee lors de la bataille du Rio de la Plata. À ce poste, Churchill montre qu'il sait se faire obéir et que son autorité n'est pas contestée.
Churchill préconise l'occupation préventive du port de Narvik où transite le minerai de fer de la Norvège, alors neutre, et des mines de fer de Kiruna, en Suède vers l'Allemagne. Néanmoins, Chamberlain et une partie du Cabinet de guerre sont en désaccord sur ce qu'il convient de faire, retardant l'opération jusqu'à l'invasion allemande de la Norvège. Tout cela conduit les députés à douter de plus en plus des capacités de Chamberlain à conduire le pays en temps de guerre. Après un vote du Parlement où il ne fait pas le plein des voix escomptées et où il est très critiqué, Neville Chamberlain se résout le 8 mai 1940 à la création d'un gouvernement d'union nationale. Pourtant, si les travaillistes veulent bien d'un tel gouvernement, ils ne veulent pas de Chamberlain comme Premier ministre.
Churchill Premier ministre d'un gouvernement de coalition
Organisation défensive du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale.
À partir du 8 mai 1940 et de la décision de Chamberlain de créer un cabinet d'union nationale, les choses se précipitent. Les travaillistes, réunis en congrès à Bournemouth, confirment qu'ils sont prêts à participer à un gouvernement mais sous l'autorité d'un nouveau Premier ministre. Hugh Dalton fait ajouter cette précision car il craint que Chamberlain ne s'accroche au pouvoir. De fait, lorsque le 10 mai 1940, une attaque éclair sur les Pays-Bas et la Belgique, prélude à l’invasion allemande de la France, est déclenchée par Adolf Hitler, Chamberlain semble vouloir profiter de la situation pour se maintenir au pouvoir. Quoi qu'il en soit la décision travailliste l'oblige à aller remettre sa démission au roi et à suggérer le nom du successeur. Lord Halifax, le favori de Chamberlain, du roi George VI et des conservateurs refuse le poste de Premier ministre, parce qu'il pense ne pas pouvoir gouverner efficacement en tant que membre de la Chambre des Lords, estimant qu'un Premier ministre doit siéger à la Chambre des communes. Reste donc Winston Churchill, ce qui n'enchante ni le roi ni l' establishment. Le News Chronicle faisant état d'un sondage d'opinion montre que les partisans de Churchill se trouvent alors parmi les membres des groupes de revenus inférieurs, les personnes de vingt-et-un ans à trente ans et les hommes.... Lorsqu'il se présente au Parlement, Churchill est moins applaudi que son prédécesseur Chamberlain, qui d'ailleurs reste à la tête du partiWm. Cette tiédeur envers Churchill tiendrait au fait que l'establisment anglais voit en Adolf Hitler le produit de forces sociales et historiques complexes, quand Churchill, homme convaincu que les individus sont responsables de leur actes, le voit comme représentant les forces du Mal et voit le conflit comme un combat manichéen.
Churchill forme alors un gouvernement, rassemblant le Cabinet de guerre et les ministres, responsables des décisions stratégiques. Ce Cabinet de guerre se compose, en sus de Churchill, de deux conservateurs : Neville Chamberlain et Lord Halifax, et de deux travaillistes : Clement Attlee, Lord du Sceau privé, et Arthur Greenwood. Le gouvernement lui-même est composé à la fois des membres éminents des partis conservateur et travailliste et, dans une moindre mesure, de libéraux et indépendants. Parmi les ministres, on peut citer les noms de Duff Cooper, un conservateur critique à l'Information, d'Anthony Eden à la Guerre puis aux Affaires étrangères, de Archibald Sinclair, un libéral, à l'Air, du syndicaliste Ernest Bevin au ministère du Travail, d'Herbert Morrison à la production industrielle, de Hugh Dalton travailliste à la Guerre Économique ; A.V. Alexander travailliste étant Premier Lord de l'Amirauté. Les Finances sont d'abord confiées à Kingsley Wood puis à John Anderson, deux conservateurs. Toutefois, concernant les problèmes économiques, les techniciens, parmi lesquels John Maynard Keynes, disposent d'une large autonomie. En février 1942 intervient un remaniement : Clement Attlee devient vice-Premier ministre, Lord Beaverbrook, chargé de la production d'avions, démissionne, Oliver Lyttelton devient ministre de la Production, Lord Cranborne ministre des colonies, et James Grigg, un technocrate, remplace David Margeson au ministère de la Guerre.
Churchill, quand il est nommé Premier ministre, a près de soixante cinq ans. S'il est le doyen de ses grands homologues Franklin Delano Roosevelt et Joseph Staline, c'est malgré tout à lui qu'il reste le plus d'années à vivre. Pourtant, il est doté d'une santé relativement fragile. Il fait une légère crise cardiaque en décembre 1941 à la Maison-Blanche, et contracte une pneumonie en décembre 1943. Cela ne l'empêche pas de parcourir plus de 160 000 km tout au long de la guerre, notamment à l'occasion de rencontres avec les autres dirigeants. Pour des raisons de sécurité, il voyage habituellement en utilisant le pseudonyme de colonel Warden.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7344#forumpost7344
Posté le : 29/11/2014 21:00
|
|
|
|
|
Winston Churchill 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Du sang et des larmes
Les débuts de la Seconde Guerre mondiale Bataille d'Angleterre et Seconde bataille de l'Atlantique.
J'aimerais dire à la Chambre, comme je l'ai dit à ceux qui ont rejoint ce gouvernement : je n'ai à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Vous me demandez, quelle est notre politique ? Je vous dirais : C'est faire la guerre sur mer, sur terre et dans les airs, de toute notre puissance et de toutes les forces que Dieu pourra nous donner.
Si les discours de Churchill contribuent à renforcer l'énergie des Anglais, il n'en demeure pas moins que les députés conservateurs sont des plus réservés quand il prononce ce discours le 13 mai 1940. Geoffrey Dawson le qualifie de bon petit discours martial. Le Premier ministre doit surtout faire face à une débâcle : les forces franco-britanniques sont rapidement en très grande difficulté. De fin mai à début juin, il doit évacuer à Dunkerque l'armée britannique pour qu'elle puisse continuer le combat ailleurs ; le 28 mai, la Belgique capitule ; le 10 juin, la Norvège le fait à son tour ; la France signe l'armistice le 22 juin 1940. Churchill quant à lui, refuse d'étudier l'éventualité d'un armistice avec le Troisième Reich. Son usage de la rhétorique affermit l'opinion publique contre un règlement pacifique, et prépare les Britanniques à une longue guerre. Il remanie alors légèrement son gouvernement. En souvenir des difficultés rencontrées jadis il crée un ministère de la Défense dont il prend la direction. Il nomme également son ami, l'industriel et baron de la presse Lord Beaverbrook, responsable de la production des avions. Celui-ci met toute son énergie à accélérer la production et à favoriser la conception de nouveaux avions.
Churchill déclare dans son discours This was their finest hour à la Chambre des communes le 18 juin 1940 : Je pense que la bataille d'Angleterre va bientôt commencer. De fait, elle commence en juillet 1940. Il s'agit essentiellement d'une guerre des airs destinée à s'assurer la maîtrise de l'espace aérien du Royaume-Uni. De cette maîtrise dépend la possibilité ou non pour les Allemands de débarquer en Angleterre. S'agissant d'une guerre menée par quelques milliers d'aviateurs, Churchill déclare : Jamais dans l'histoire des conflits humains un si grand nombre d'hommes n'a dû autant à un si petit nombre. Cette phrase est à l'origine du surnom The Few pour les pilotes de chasse alliés. La bataille d'Angleterre comporte plusieurs phases. Dans un premier temps, les Allemands tentent de conquérir la supériorité aérienne pour pouvoir débarquer. Puis, à partir du 7 septembre 1940 à travers le Blitz, c'est-à-dire des bombardements massifs de villes, comme celui de Coventry, ils tentent d'ébranler la volonté de résistance anglaise.
Sur mer, à partir de la mi-1940, commence la seconde bataille de l'Atlantique menée par les sous-marins de l'amiral Karl Dönitz. Il s'agit d'attaquer en meute les navires civils pour empêcher le ravitaillement de l'Angleterre. Avec l'occupation de la France, les sous-marins agissent à partir de bases situées en France, notamment à Bordeaux, Brest, La Rochelle, Lorient, Saint-Nazaire. En mars 1941, Churchill rédige le Battle of Atlantic Directive pour organiser et donner une nouvelle impulsion aux forces britanniques engagées dans la bataille.
Dès l'été 1940, il veut protéger les lignes de communication anglaises vers les Indes et l'Asie et envoie en renfort des hommes et des blindés au Moyen-Orient. En mer a lieu la bataille du cap Matapan qui voit la marine anglaise vaincre la marine italienne. Dans les Balkans, les Britanniques doivent accepter la prise de la Grèce par les Allemands et évacuer la Crète vers le milieu 1941. En décembre 1940, les Anglais lancent une offensive terrestre sur Tobrouk et Benghazi alors sous contrôle de l'Italie. Pour aider les Italiens, Hitler doit envoyer des troupes de l'Afrikakorps, commandées par Erwin Rommel, qui inflige des défaites aux Anglais jusqu'à ce que la situation s'inverse lors de la seconde bataille d'El Alamein, dont Churchill dit dans un de ses discours de guerre les plus mémorables : Maintenant ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. Mais c'est, peut-être, la fin du commencement. Néanmoins, à cette époque Churchill et l'Angleterre ne sont plus seuls, l'URSS de Staline ayant été entrainée dans la guerre le 22 juin 1941 par une attaque allemande opération Barbarossa et les États-Unis le 7 décembre 1941 par l'attaque de Pearl Harbor. Dans un premier temps, l'entrée en guerre du Japon cause bien des problèmes à Churchill. En effet, les Japonais attaquent les possessions anglaises en Birmanie, en Malaisie, pendant la bataille de Hong Kong et à Singapour. Les forces anglaises subissent de sérieux revers, ne parvenant alors à se maintenir qu'en Birmanie. Parallèlement, Churchill enregistre la perte de deux cuirassés, le HMS Prince of Wales et le HMS Repulse, ce qui rend inopérante la stratégie de Singapour.
Churchill le stratège La stratégie de Churchill
Avec la disposition des forces, à El Alamein, c'est la première victoire des Alliés, le 23 novembre 1942.
En 1940, Churchill est certainement le dirigeant britannique ayant la plus vaste expérience dans le domaine de la stratégie, tant par sa participation aux gouvernements anglais durant la Première Guerre mondiale que par les réflexions élaborées lors de l'écriture des six volumes de The World in Crisis, dans lequel il écrit : la manœuvre qui aboutit à introduire un nouvel allié à vos côtés est aussi fructueuse qu'une victoire sur le champ de bataille. Une phrase que sa femme Clementine eût aimé qu'il la mît en pratique dans la vie politique, où, à son sens, il est surtout doué pour transformer des alliés potentiels en ennemis résolus. Les points forts de Churchill sont de bien saisir les enjeux essentiels et sa capacité à prendre des décisions à haut risque. Il est aussi très inventif et imaginatif. Pourtant, il s'agit ici aussi bien d'un point fort que d'un point faible, comme l'aurait dit en effet Franklin Delano Roosevelt : Winston a cent idées par jour, dont trois ou quatre sont bonnes. De fait, il élabore parfois des plans chimériques et ses collaborateurs doivent déployer beaucoup d'énergie pour l'empêcher de les mettre en œuvre. De plus, il se mêle de tout ; le Chief of the Imperial General Staff, Alan Brooke, dit de lui qu'il veut coller ses doigts dans chaque gâteau avant qu'il ne soit cuit.
Lorsque les États-Unis entrent en guerre fin 1941, les discussions stratégiques entre les deux grands alliés du camp occidental sont vives. Churchill est peu intéressé par l'océan Pacifique et sa région. En Europe, il est favorable à une stratégie indirecte, dite parfois stratégie périphérique, d'affaiblissement de l'Allemagne, appuyée sur un emploi de la force navale. Face à cela, les États-Unis ont une approche d'attaque plus directe, et se méfient du point de vue de Churchill, qu'ils soupçonnent d'être dicté par des intérêts impériaux. Au départ, Churchill gagne et fait approuver une opération de débarquement en Afrique du Nord : l'opération Torch. Ce débarquement se situe à une période clé. En effet, jusqu'à la mi-1942, les Alliés ne cessent d'accumuler les défaites : chute de Singapour le 15 février 1942, de Rangoon le 8 mars, puis de Tobrouk le 21 juin. En revanche, après la Seconde bataille d'El Alamein fin 1942, les choses changent et les victoires se succèdent. En janvier 1943, à la conférence de Casablanca, Churchill continue à faire prévaloir son option et se réjouit de la décision d'effectuer un débarquement en Sicile : c'est l'Operation Husky. Alors que le général Eisenhower recherche un juste équilibre des forces alliées entre les armées engagées dans la conquête de l'Italie et celles devant participer à l'operation Overlord, Churchill préconise vainement de prélever des troupes pour une intervention à Rhodes. Il est en effet persuadé, à tort, qu'une telle intervention pourrait faire basculer la Turquie alors neutre, dans le camp des alliés. Concernant l'approche directe centrée sur l'operation Overlord, l'échec du débarquement de Dieppe en août 1942 en a montré les dangers. Néanmoins il s'y rallie et à partir de 1944, la stratégie américaine prévaut. Néanmoins lorsque les Alliés organisent un débarquement en Provence, Churchill eût préféré que l'armée alliée stationnée en Italie marche sur Vienne
Controverse sur certaines décisions stratégiques : le bombardement de Dresde
En 1942, les Alliés optent pour un bombardement stratégique de l'Allemagne en effectuant le 30 mai 1942 le bombardement de Cologne par environ mille avions alliés. Churchill doute rapidement de cette stratégie très coûteuse pour l'Angleterre, perte de 56 000 pilotes et membres d'équipage en trois ans. Le bombardement entre le 13 février et le 15 février 1945, par les Britanniques et les Américains, de la ville de Dresde entraîne une polémique. Plusieurs raisons à cela : il s'agit d'une ville avec un passé culturel important, et le bombardement fait un nombre de victimes civiles élevé alors que la fin de la guerre est proche et que la cité est bondée d'Allemands blessés comme de réfugiés. Cette action reste celle des Alliés la plus controversée sur le front occidental. Churchill déclare après le bombardement, dans un télégramme top secret : Il me semble que le moment est venu où la question du bombardement intensif des villes allemandes devrait être examinée du point de vue de nos intérêts propres. Si nous prenons le contrôle d'un pays en ruine, il y aura une grande pénurie de logements pour nous et nos alliés ... Nous devons veiller à ce que nos attaques ne nous nuisent pas, sur le long terme, plus à nous-mêmes que ce qu'elles nuisent à l'effort de guerre de l'ennemi.
Malgré tout, la responsabilité de la partie britannique de l'attaque incombe à Churchill, et c'est pour cette raison qu'il est actuellement critiqué pour avoir permis les bombardements. L'historien allemand Jörg Friedrich affirme que sa décision de bombarder une région d'une Allemagne sinistrée entre janvier et mai 1945 était un crime de guerre, alors que le philosophe Anthony Grayling, dans des écrits de 2006, remet en question l'ensemble de la campagne de bombardement stratégique par la RAF, en exposant comme argument que bien que n'étant pas un crime de guerre, il s'agissait d'un crime moral et nuisible à l'affirmation selon laquelle les Alliés ont mené une guerre juste. Certains affirment aussi que la participation de Churchill dans la décision du bombardement de Dresde est fondée sur les orientations stratégiques et les aspects tactiques pour gagner la guerre. La destruction de Dresde, qui fut immense, avait été décidée dans le but d'accélérer la défaite de l'Allemagne. L'historien britannique Frederick Taylor affirme que : Toutes les parties ont bombardé les villes des autres pendant la guerre. Un demi-million de citoyens soviétiques, par exemple, décèdent des suites de bombardements allemands pendant l'invasion et l'occupation de la Russie. C'est à peu près équivalent au nombre de citoyens allemands qui décèdent des suites de raids des forces alliées. Mais la campagne de bombardement des Alliés est rattachée aux opérations militaires et cesse dès que les opérations militaires ont cessé.
Churchill et la guerre de l'ombre
Churchill, dès son premier passage en tant que premier Lord de l'Amirauté, s'est intéressé aux problèmes de décryptage. À peine revenu aux affaires, il crée à Bletchley Park un centre chargé de casser les codes ennemis et qui emploie de très nombreux scientifiques, souvent étudiants ou enseignants des universités de Cambridge et d'Oxford. C'est ce service qui poursuivit le travail de décryptage d'Enigma initié par le Biuro Szyfrów. Ces moyens de décodage lui sont d'une grande utilité tout au long de la guerre, notamment lors de la bataille de l'Atlantique, ainsi que lors du débarquement de Normandie. D'une façon générale, Churchill s'est toujours intéressé au renseignement et, dès 1909, a soutenu la création par le gouvernement Asquith, auquel il appartenait, la création du MI5 et du MI6.
En sus des services traditionnels évoqués précédemment Churchill crée le MI9 chargé de récupérer les militaires ou les résistants tombés derrière les lignes ennemies. En lien avec sa stratégie indirecte d'affaiblissement de l'ennemi, il crée aussi le Special Operations Executive ou SOE, rattaché au ministère de la Guerre économique dirigé par Hugh Dalton, un travailliste, ancien de la London School of Economics. Le SOE est présent dans tous les pays européens, où il apporte un soutien logistique et organisationnel à la Résistance. En France, il coopère avec de nombreux groupes de résistance, grâce à la formation d’une centaine de réseaux chargés du recrutement et de l’entraînement, de la fourniture d’armes, des sabotages et de la préparation de la guérilla de libération. Actif aussi en Asie, le SOE, nommé Force 136, compte parmi ses agents l'écrivain français Pierre Boulle. Concernant la Yougoslavie, la direction du SOE du Caire, qui traite ces dossiers, est infiltrée d'après François Kersaudy par les communistes, dont le plus notable est James Klugmann.
Sont également créées à cette époque des troupes de forces spéciales comme le Special Air Service et le Combined Operations qui mène plusieurs actions commandos, dont l'opération Chariot à Saint-Nazaire dans le cadre de la traque du cuirassé Tirpitz. Enfin, pour mettre fin à la palette de moyens disponibles, Churchill crée le Political Warfare Executive, chargé de la propagande. Ce service dépend autant du Foreign Office, ministère des Affaires Étrangères que du ministère de l'Information.
Churchill et ses principaux alliés
Churchill, en pensant à l'entente que son ancêtre le duc de Malborough a constitué contre Louis XIV, appelle Grande Alliance la coalition composée de l'Angleterre, des États-Unis et de l'URSS. En général, les Français s'en sentent également partie.
Relations avec les États-Unis
Les bonnes relations qu'entretient Churchill avec Franklin D. Roosevelt facilitent l'obtention par la Grande-Bretagne du ravitaillement dont elle a besoin nourriture, pétrole et munitions par les routes maritimes de l'Atlantique du Nord. Aussi, il est soulagé lorsque le président américain est réélu en 1940. Roosevelt met immédiatement en œuvre une nouvelle méthode pour la fourniture et le transport du matériel militaire vers la Grande-Bretagne, sans la nécessité d'un paiement immédiat : le prêt-bail. Après l'attaque de Pearl Harbor, la première pensée qu'a Churchill, prévoyant l'entrée en guerre des États-Unis est : Nous avons gagné la guerre.
Churchill plaide tant pour l'idée de special relationship pour caractériser la relation entre les deux pays qu'elle devient un lieu commun, même si en réalité les choses sont plus complexes, les deux pays ayant par exemple des visions divergentes sur la décolonisation. Churchill, qui écrit plus tard un livre intitulé A History of the English-Speaking Peoples, est également très sensible à l'idée d'une communauté constituée par ceux qui parlent la même langue. Plus généralement, il est l'un de ceux qui travaillent le plus à l'adoption de la notion d'Occident, entendu comme foyer de la liberté et de la démocratie investi de la mission sacrée de lutter contre la tyrannie. C'est dans cette optique qu'il dresse les grands axes de la charte de l'Atlantique, adoptée lors d'une rencontre avec Roosevelt au large de Terre-Neuve le 12, c'est-à-dire avant l'entrée en guerre des États-Unis. La rencontre débute par un office religieux dont Churchill a choisi les chants, dont le Onward, Christians Soldiers.
Relations avec l'Union soviétique
Quand Hitler envahit l'Union soviétique, Winston Churchill, anticommuniste convaincu, déclare : Si Hitler voulait envahir l'enfer, je pourrais trouver l'occasion de faire une recommandation favorable au diable à la chambre des Communes, en référence à sa politique à l'égard de Staline. Bientôt, de l'équipement et des blindés britanniques sont envoyés, via les convois de l'Arctique, afin d'aider l'Union soviétique.
Le gouvernement polonais en exil et une partie des Polonais reprochent à Churchill d'avoir accepté des frontières entre la Pologne et l'Union soviétique et entre l'Allemagne et la Pologne qui ne leur conviennent pas. Cela l'agace et il déclare en 1944 nous ne nous sommes jamais engagés à défendre les frontières de la Pologne de 1939, affirmant aussi que la Russie a droit à une frontière inexpugnable à l'ouest. En fait, Churchill cherche à éviter les mélanges de populations comme il l'expose à la Chambre des communes le 15 décembre 1944 : l'expulsion est la méthode qui, pour autant que nous ayons pu le constater, sera la plus satisfaisante et durable. Il n'y aura pas de mélange des populations causant des problèmes sans fin... Une remise à zéro sera faite. Je ne suis pas alarmé par ces transferts, qui sont plus que faisables dans des conditions modernes. Cependant, l'expulsion des Allemands est réalisée par l'Union soviétique d'une manière qui aboutit à beaucoup plus de difficultés et, selon un rapport de 1966 du Ministère ouest-allemand des réfugiés et des personnes déplacées, à la mort de plus de 2,1 millions de personnes. Churchill s'oppose à l'annexion de la Pologne par l'Union soviétique et l'écrit amèrement dans ses livres, mais il est incapable de l'empêcher lors des différentes conférences.
Les Polonais reprochent aussi à Churchill et au monde occidental en général la tiédeur de leur réaction face au massacre de Katyń avril-mai 1940, où des milliers de membres de l'élite polonaise ont été exécutés par l'Armée rouge, qui s'en dédouane en accusant les nazis. Le Premier ministre, informé de l'implication des Soviétiques, la condamne en privé, mais refuse d'accuser l'URSS pour ne pas menacer la Grande Alliance et empêche une investigation de la Croix-Rouge.
Relations avec la France
Churchill et Charles de Gaulle descendant l'avenue des Champs-Élysées durant la parade célébrant l'armistice de 1918, le 11 novembre 1944 à Paris.
Churchill s'oppose au maréchal Pétain et au général Weygand sur l'idée d'armistice dès les 11-12 juin 1940 lors d'une rencontre à Briare, puis à nouveau le 13 juin à Tours. Le projet d'Union franco-britannique élaboré par Jean Monnet et Churchill en 1940 qui vise à fusionner les deux pays et leurs territoires est abandonné le 16 juin 1940, à la suite de la démission de Paul Reynaud et de la nomination du maréchal Pétain comme président du Conseil. Deux jours plus tard, il autorise le général de Gaulle à lancer l'Appel du 18 juin. Le 22 juin la France signe l'armistice et le régime de Vichy devient l'adversaire du Royaume-Uni, lequel soutient la France libre. Le 2 juillet 1940 est lancée l'opération Catapult, visant à rallier la flotte française ou à la neutraliser.
Les relations entre deux hommes de fort caractère, ayant des idées sur l'Histoire, l'Europe et la guerre assez proches, connaissent des hauts et des bas, liés à des divergences d'intérêts. La presse française s'est fait l'écho dans les années 2000 d'un projet de Churchill, auquel s'est rallié Roosevelt, qui pense que de Gaulle est peut-être un honnête homme, mais il a des tendances messianiques, il croit avoir le peuple de France derrière lui, ce dont je doute. Ils visent à se débarrasser politiquement du général, en lui offrant le poste de gouverneur de Madagascar, et à mettre à sa place le général Henri Giraud, qu'ils jugent plus malléable. Le projet est abandonné lorsque Clement Attlee et Anthony Eden, ayant eu vent de la nouvelle, s'opposent à toute action contre de Gaulle, argumentant qu'ils ne peuvent se permettre de perdre l'appui des Forces françaises libres.
Si de Gaulle veut à tout prix que la France apparaisse comme victorieuse à la fin de la guerre, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS, ses alliés n'ont pas le même point de vue et l'écartent délibérément de la conférence de Yalta. Cela tend leurs relations, d'autant plus que Churchill et Roosevelt craignent que de Gaulle décide finalement de s'allier aux Soviétiques. Néanmoins Churchill, qui comprend que le soutien d'une autre puissance coloniale européenne est un atout majeur au sein du futur Conseil de sécurité des Nations unies, fait le nécessaire pour que la France en devienne le cinquième membre permanent. Plus tard, après la guerre, de Gaulle parlera du Premier ministre britannique comme du Grand Churchill.
Churchill et les conférences interalliées structurant le monde de l'après-guerre
L'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Bloc de l'Ouest, pays de l'OTAN
Bloc de l'Est, pays du pacte de Varsovie
Rideau de fer
Pays neutres
Mouvement des non-alignés l'Albanie finira par rompre avec l'URSS pour s'aligner sur la Chine populaire
Churchill participe à douze conférences inter-alliées stratégiques avec Roosevelt, auxquelles Staline est aussi parfois présent. Certaines d'entre elles marquent profondément le monde de l'après-guerre.
La conférence Arcadia, du 22 décembre 1941 au 15 janvier 1942, décide de la stratégie L'Allemagne d'abord et proclame la Déclaration des Nations unies, qui doit aboutir à la création de l'Organisation des Nations unies. Par ailleurs, il est décidé de continuer l'effort en matière d'arme nucléaire, d'un plan de production d'avions et de chars d'assaut, ainsi que de la création à Washington d'un Comité des chefs d'état-major combiné . Enfin, Churchill et Roosevelt ont de longues conversations concernant l'Empire britannique en général et l'Inde en particulier.
Lors de la conférence de Québec, du 17 au 24 août, il est surtout décidé que le débarquement de Normandie aura lieu en mai 1944. Churchill accepte qu'il soit dirigé par un Américain, en contrepartie de quoi il obtient que le général britannique Henry Maitland Wilson commande en Méditerranée, et que Louis Mountbatten soit promu commandant suprême allié pour l'Asie du Sud-Est. Avec le président américain Franklin D. Roosevelt, il signe une version plus modérée du plan Morgenthau original, dans laquelle ils s'engagent à transformer l'Allemagne, après la capitulation inconditionnelle, en un pays d'un style essentiellement agricole et pastora.
C'est à la conférence de Téhéran, de fin novembre à début décembre 1943, qu'il prend conscience que le Royaume-Uni n'est plus qu'une petite nation. Il écrit à Violet Bonham Carter j'étais là assis avec le grand ours russe à ma gauche, et à ma droite le gros buffle américain. Entre les deux se tenait le pauvre petit bourricot anglais.
Lors de la conférence Tolstoï du 9 au 19 octobre 1944, Il glisse à Staline un vilain petit document où est inscrit, Roumanie : 90% URSS, 2 Grèce : 90% Grande-Bretagne, Yougoslavie : 50% -50%, Hongrie : 50%-50%, Bulgarie 90% URSS, que Staline approuve. Churchill, fidèle à la tradition stratégique anglaise, est soucieux du sort de la Grèce où le Special Operations Executive est très actif. Début 1944, après maintes péripéties, il parvient à maintenir le pays dans le bloc occidental.
Lors de la conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945, Churchill est inquiet et nerveux, car il sait qu'il existe des fissures au sein du camp occidental et notamment entre lui, partisan de la realpolitik, et Roosevelt, plus idéaliste. Malgré tout, Yalta pour François Bédarida ne fait qu'entériner la carte de guerre à laquelle sont parvenus les belligérants en 1945. Churchill est accueilli avec réserve dans les milieux officiels britanniques, qui lui reprochent d'avoir trop cédé aux Soviétiques, notamment sur la Pologne. Il fait observer à un ami, Harold Nicolson, que les bellicistes du temps de Munich sont devenus des partisans de l'apaisement, ce sont les anciens apeasers qui sont devenus bellicistes.
À la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945, les propositions des nouvelles frontières de l'Europe et des colonies sont officiellement acceptées par Harry S. Truman, Churchill et Staline. Churchill est extrêmement favorable à Truman durant ses premiers jours au pouvoir, disant de lui qu'il est le type de leader dont le monde a besoin, lorsque celui-ci a le plus besoin de leader. Notons que Churchill au début de la conférence est assisté par Clement Attlee, qui, une fois Churchill battu lors des élections générales, représente seul la Grande-Bretagne au moment de la signature.
Un manque de vision sur le devenir économique du pays
Churchill saluant la foule à Whitehall, le jour de son discours à la nation annonçant que la guerre avec l'Allemagne a été remportée, le 8 mai 1945.
Churchill se passionne pour les affaires liées à la guerre, à la géopolitique et à la diplomatie, et laisse les affaires intérieures au conservateur John Anderson et aux travaillistes. Par ailleurs, tout comme les autres personnalités politiques de son gouvernement de coalition, il n'a ni objectifs économiques de guerre ni vision de l'économie d'après guerre. Pour Robert Skidelsky, c'est précisément l'échec du gouvernement à définir une vision économique du monde qui précipite la rupture de la coalition conservatrice-travailliste et cause la défaite des conservateurs, et donc de Churchill, en 1945. Durant la guerre, l'indifférence de la classe politique et de Churchill envers ce domaine laisse une grande latitude aux économistes qui vont pouvoir faire avancer leurs propres projets.
Lorsqu'en 1942 William Beveridge présente son plan sur la sécurité sociale, Keynes obtient du Trésor la constitution d'un groupe de travail composé de lui-même, de Lionel Robbins et d'un actuaire afin de reprofiler le projet de façon à le rendre financièrement acceptable, mais les politiques, dont Churchill, s'impliquent peu dans le sujet que ce soit pour le critiquer ou le soutenir. De même, les négociations de Bretton Woods sont menées par Keynes, ou plutôt par le tandem Keynes-Lionel Robbins, sans réelle implication du Premier ministre et plus généralement du personnel politique.
Une des causes de cette situation tient à ce que Churchill n'a pas de grandes connaissances, ni peut-être un grand attrait pour l'économie et ce d'autant qu'il a conscience de s'être trompé dans les années 1920, lorsqu'il a fait revenir l'Angleterre à l'étalon-or. Aussi il a tendance à faire confiance à Keynes avec qui il dîne régulièrement au The Other Club. C'est Churchill qui, en 1942, propose au roi d'élever Keynes à la pairie. Dans une intervention radiophonique de 1945, à l'occasion des élections générales, le Premier ministre prononce un discours contre l'économie planifiée. Clement Attlee, son opposant travailliste, voit les sources théoriques de cette intervention dans l'essai La Route de la servitude de l'économiste libéral Friedrich Hayek. En fait, Hayek et Churchill ne se sont rencontrés qu'une fois85. Néanmoins les conservateurs ont participé à la mise au point d'une version abrégée de l'ouvrage – on ignore l'implication réelle de Churchill en ce domaine – qui a été publié sur du papier alloué au parti conservateur pour sa campagne, car l'Angleterre souffrant alors de pénurie le papier était contingenté.
Fin de la Seconde Guerre mondiale et sortie de scène
En juin 1944, les forces alliées débarquent en Normandie et repoussent les forces nazies vers l'Allemagne au cours de l'année suivante. Le 28 mars 1945, le général Eisenhower informe Staline qu'il arrête ses troupes sur l'Elbe, et que donc les deux armées devront y faire leur jonction. Si Staline approuve cette décision, Churchill est très mécontent, car d'une part, il n'a pas été informé officiellement de la décision alors qu'un tiers des unités combattantes sont britanniques ou canadiennes, et d'autre part, il désapprouve la décision sur le fond estimant que l'objectif est Berlin. Malgré tous ses efforts, la décision est maintenue.
Le 12 avril 1945, Franklin Delano Roosevelt meurt, ce qui provoque les larmes de Churchill. Un de ses biographes, François Kersaudy, se demande s'il ne s'est pas fait des illusions sur la réalité de sa relation avec Roosevelt, qu'il analyse lui comme étant pour le Président américain un éphémère mariage de convenance avec un impérialiste antédiluvien.
Le 7 mai 1945, au siège du SHAEF à Reims, les Alliés acceptent la reddition de l'Allemagne nazie. Le même jour, dans un flash d'information de la BBC, John Snagge annonce que le 8 mai est la journée de la victoire en Europe. Churchill annonce à la nation que l'Allemagne a capitulé, et qu'un cessez-le-feu définitif sur tous les fronts du continent entre en vigueur une minute après minuit, cette nuit-là. Par la suite, il déclare à une foule immense à Whitehall : Ceci est votre victoire. Le peuple répond : Non, c'est la vôtre, et Churchill entame le chant du Land of Hope and Glory avec la foule. Dans la soirée, il fait une autre annonce à la nation en affirmant que la défaite du Japon se concrétisera dans les mois à venir.
Le 19 mai 1945, le Parti travailliste décide de quitter la coalition. Churchill demande la dissolution du Parlement et annonce que les élections se tiendront le 5 juillet ; les résultats ne pourront être connus que le 26 juillet 1945 du fait de la dispersion des soldats mobilisés. Aussi, il peut assister au début de la Conférence de Potsdam qui s'ouvre le 17 juillet 1945. Il prend toutefois la précaution de s'y rendre avec Clement Attlee, le vice-Premier ministre et son futur successeur. Les résultats des élections générales de 1945 sont sans appel : les travaillistes obtiennent 393 sièges contre 210 aux conservateurs alliés aux libéraux et Churchill, battu, remet rapidement sa démission au roi. De nombreuses raisons expliquent son échec : le désir de réforme d'après-guerre qui se répand au sein de la population, ou le fait qu'elle pense que l'homme qui a conduit le Royaume-Uni pendant la guerre n'est pas le mieux avisé pour le conduire en temps de paix. En effet, Churchill est surtout considéré comme un warlord, ou seigneur de guerre. Par ailleurs, les deux responsables conservateurs Brendan Bracken et Lord Beaverbrook, que Clementine Churchill n'apprécie pas, ne sont pas des modèles de finesse politique. Enfin, Churchill, las, est excessif dans ses discours. Quoi qu'il en soit, lorsque les Japonais capitulent trois mois plus tard, le 15 août 1945, mettant définitivement fin à la guerre, il n'est déjà plus au pouvoir.
Churchill et la politique après 1945 Le chef de file de l'opposition conservatrice
Si sa femme accueille bien la défaite de Winston Churchill, lui est plutôt malheureux. Dépressif, il se remet à la peinture à l'occasion d'un séjour sur le lac de Côme à l'automne 1945. Pendant six ans, il sert en tant que chef de l'opposition officielle et se préoccupe peu de politique intérieure, préférant les affaires du monde sur lesquelles il continue d'influer. Au cours de son voyage de mars 1946 aux États-Unis, il fait un discours sur le rideau de fer, évoquant l'URSS et la création du bloc de l'Est. Il déclare :
De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia ; toutes ces villes célèbres et leurs populations sont désormais dans ce que j'appellerais la sphère d'influence soviétique, et sont toutes soumises, sous une forme ou une autre, non seulement à l'influence soviétique mais aussi au contrôle très étendu et dans certains cas croissant de Moscou.
Churchill imprime au conservatisme anglais une ligne de centre droit, appelée par les Anglais le butskellism, du nom des ministres Rab Butler, un conservateur, et son homologue travailliste Hugh Gaitskell. Selon François Bédarida, il s'agit d'une expression symbolique de l'hybride bipartisan entre centre droit et centre gauche à laquelle Margaret Thatcher s'est fortement opposée plus tard.
Churchill et l'Europe
Churchill est intéressé par le projet européen d'Aristide Briand dès l'entre-deux-guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, il est président d'honneur du congrès de La Haye et participe à la mise en place du Conseil de l'Europe en 1949. Néanmoins sa vision n'est pas celle de Jean Monnet, aussi approuve-t-il que son pays n'entre pas dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qu'il considère comme un projet franco-allemand.
Il élabore la théorie des trois cercles : le premier cercle est constitué par l'Angleterre et le Commonwealth, le deuxième par le monde anglophone autour des États-Unis et le troisième l'Europe. Il constate que l'Angleterre, qui est à la croisée des trois cercles, a un rôle privilégié à jouer. Nous sommes avec l'Europe, mais sans faire partie de l'Europe, with Europe, but not of it. Nous avons des intérêts communs mais nous ne voulons pas être absorbés.
Second mandat de Premier ministre et déclin de l'Empire britannique
Après les élections générales de 1951, Churchill redevient Premier ministre. Son troisième gouvernement, après celui durant la guerre et le bref gouvernement de 1945, dure jusqu'à sa démission en 1955. Ses priorités nationales sont alors éclipsées par une série de crises de politique étrangère, qui sont en partie le résultat du mouvement déjà amorcé du déclin de l'armée britannique, du prestige et du pouvoir impérial. Étant un fervent partisan de la Grande-Bretagne en tant que puissance internationale, Churchill répond souvent à de telles situations avec des actions directes. Il envoie par exemple des troupes britanniques au Kenya pour faire face à la rébellion Mau Mau. Essayant de conserver ce qu'il peut de l'Empire, il déclare : je ne présiderai pas un démembrement.
Malaisie en guerre
Une série d'événements qui sont devenus connus sous le nom d'insurrection malaise s'ensuivent. En Malaisie, une rébellion contre la domination britannique est en cours depuis 1948. Une fois de plus, le gouvernement de Churchill hérite d'une crise, et ce dernier choisit d'utiliser l'action militaire directe contre les opposants. Il tente également de construire une alliance avec ceux qui soutiennent encore les Britanniques. Alors que la rébellion est lentement défaite, il est cependant tout aussi clair que la domination coloniale de la Grande-Bretagne n'est plus possible.
La santé déclinante
En juin 1953, à l'âge de 78 ans, il est victime d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se trouve au 10 Downing Street. La nouvelle est tenue secrète alors qu'officiellement on annonce au public et au Parlement qu'il souffre d'épuisement. Il se rend à Chartwell où il réside durant sa période de convalescence, l'attaque cérébrale ayant altéré son élocution dans ses discours et diminué sa capacité à marcher. Il revient à la politique en octobre pour prendre la parole en public lors d'une conférence du Parti conservateur à Margate. Dans les années qui suivent cependant, il doit admettre la nécessité de ralentir ses activités physiques et intellectuelles. Il décide de prendre sa retraite en 1955 et est remplacé au poste de Premier ministre par Anthony Eden.
L’homme et sa postérité
Churchill passe une grande partie de sa retraite à son domicile de Chartwell, dans le comté de Kent. Il l'achète en 1922 après la naissance de sa fille Mary.
Le caractère
Par moments, l'esprit du mal s'empare de lui, et je le considère comme un petit garçon très désobéissant, très insupportable et dangereux, un petit garçon qui mériterait le fouet. Ce n'est qu'en pensant à lui de la sorte que je peux continuer à l'aimer.
— H. G. Wells
Churchill n'est pas à proprement parler un homme raisonnable. Il écrit de lui-même : c'est lorsque je suis Jeanne d'Arc que je m'exalte. Manchester écrit à ce propos : il était bien davantage un Élie, un Isaïe : un prophète. Selon ce même biographe, une enfance malheureuse avec des parents au mieux indifférents, où seule sa nourrice, Elizabeth Everest, lui donne de l'amour parental, explique en partie la scolarité chaotique de Churchill. Il écrit à ce propos, aussi haut qu'il s'élevât, l'homme qui avait connu, enfant, les brimades et les coups sut toujours s'identifier au perdant. Tout au fond de lui, du reste, il fut toujours un perdant. Il souffrit toute sa vie d'accès de dépression, sombrant dans les abîmes menaçants de la mélancolie.
Même si son parcours scolaire est moyen, celui de Franklin Delano Roosevelt l'est aussi, il a malgré tout un certain nombre de qualités qui en font un grand politique. Il a une excellente mémoire, c'est un orateur qui sait toucher les gens, il sait prendre des décisions rapides et faire preuve de magnanimité dans la victoire. Il a aussi des défauts. Ses projets parfois très aventureux peuvent tourner mal, engendrant une certaine défiance de la classe politique envers lui. De plus, il ne sait pas toujours juger les hommes et manque parfois d'antennes pour comprendre la société anglaise et son appartenance à l'aristocratie le dessert : son côté patricien explique en partie les éclipses de sa carrière.
Churchill aime les parades, les bannières qui flottent au vent, le son du clairon, et se désole que la guerre soit devenue une affaire de chimistes masqués et de conducteurs manœuvrant les leviers de leurs aéroplanes, de leurs mitrailleuses. Pour lui, la guerre garde un côté chevaleresque, arthurien, comme la vie pour Peter Pan, une immense aventure.
Politiquement, sa vision de la guerre et de la paix est totalement différente de celle de notre époque. Nous considérerions selon l'auteur cité que la paix est la norme et la guerre une aberration primitive, Churchill penserait strictement l'inverse. De façon générale, il aime le passé et vit, non pas dans le passé, mais avec un passé toujours présent. Tant à l'écrit qu'à l'oral, son expression reste profondément victorienne avec des expressions telles que je vous prie de.. ou je me permets de dire. À Harold Laski qui lui reproche d'être un vestige chevaleresque et romantique de l'impérialisme anglais du XVIIIe siècle, il rétorque j'aime vivre dans le passé. Je n'ai pas l'impression que l'avenir réserve beaucoup d'agrément aux hommes.
Il aime se déguiser, paraître, faire le spectacle. Il possède plus de chapeaux que son épouse, il ne se rend au Parlement ou à Buckingham Palace qu'en redingote et il porte les uniformes les plus variés en arborant avec délectation les décorations qui lui ont été décernées.
Il aime le champagne, le cognac et autres boissons ainsi que la bonne chère. L'été, il apprécie de se faire inviter dans des villas sur la côte d'Azur (dans l'entre-deux-guerres il va notamment chez Maxine Elliott et chez sa cousine par alliance Consuelo Vanderbilt ou du côté de Biarritz. Mais ce n'est pas quelqu'un porté sur la danse ou sur les jeux de l'amour et il refuse ou ne voit pas les avances qui lui sont parfois faites par des femmes – dont Daisy Fellowes.
Financièrement c'est un spéculateur perdant-né et dans la vie courante à Chartwell, il a les pires difficultés à équilibrer et à gérer ses comptes. En 1938, à la suite d'une chute de la bourse à Wall Street, il connait des problèmes financiers sérieux qui l'obligent à envisager de mettre en vente Chartwell. Finalement, il arrive à trouver une solution grâce à un prêt de Henry Strakosch.
Dans le domaine littéraire Churchill a une préférence pour les auteurs anglais ; en matière de musique, il aime les chansons populaires comme Ta-ra-ra-boom-der-ay ou Hang Out the Washing on the Siegfried Line ; en matière de cinéma, il a une préférence pour les mélodrames, durant lesquels il pleure beaucoup. Il a vu au moins vingt fois son film préféré, Lady Hamilton, avec Laurence Olivier dans le rôle de l'amiral Nelson et Vivien Leigh dans celui de Lady Hamilton.
Un aspect secondaire de la personnalité de Churchill est son tempérament artistique, c'est un bon peintre et un écrivain de talent.
Le peintre
Winston Churchill commence à s'adonner à la peinture après sa démission en tant que Premier Lord de l'Amirauté en 1915 afin de vaincre sa dépression, qu'il appelait le Black Dog, ou chien noir. Il est ensuite conseillé par John Lavery. Les thèmes sont des paysages anglais mais aussi des scènes du front de Flandres. Par la suite, il peint la Côte d’Azur. Il expose à Paris en 1921, à la galerie Drouet, 20 rue Royale, sous le pseudonyme de Charles Morin, et il vend quelques toiles. La même année, il écrit un petit livre, Painting as a Pastime. Il adopte ensuite le pseudonyme de Charles Winter et se lie d'amitié avec le peintre franco-anglais Paul Maze.
Selon William Rees-Mogg, si dans sa propre vie, il a dû subir le Black Dog de la dépression, dans ses paysages et ses natures mortes, il n’y a aucun signe de dépression. Il est surtout connu pour ses scènes de paysage impressionnistes, dont beaucoup ont été peintes durant ses vacances dans le sud de la France, en particulier à la villa La Pausa chez ses amis Reves, chez son ami le duc de Westminster au château Woolsack, sur les berges du lac d’Aureilhan, ou au Maroc. Une collection de peintures et de memorabilia est conservée au sein de la collection Reves au Dallas Museum of Art tandis que d'autres toiles sont exposées à Chartwell.
L’écrivain et l'orateur Winston Churchill l'écrivain.
Malgré sa renommée et ses origines sociales, Churchill lutte toujours pour faire face à ses dépenses et à ses créanciers. Jusqu'à la loi sur le Parlement de 1911, les députés exercent leur fonction à titre gratuit. De cette date à 1946, ils reçoivent un salaire symbolique. Aussi nombre d'entre eux doivent-ils exercer une profession pour vivre. De son premier livre, The Story of the Malakand Field Force 1898, jusqu'à son deuxième mandat en tant que Premier ministre, le revenu de Churchill est presque entièrement assuré par l'écriture de livres et de chroniques pour des journaux et des magazines. Dans les années 1930, Churchill tire l'essentiel de ses revenus du livre sur son ancêtre le duc de Malborough. Le plus célèbre de ses articles est celui publié dans l'Evening Standard en 1936, avertissant de la montée en puissance d'Hitler et du danger de la politique d'apaisement.
Churchill a écrit seul son premier livre mais, à partir du Monde en crise, il dicte les suivants à des secrétaires et, pour la documentation, il emploie des assistants de recherche issus de l'université d'Oxford. Edward Marsh, son chef de cabinet, relit les manuscrits en corrigeant l'orthographe et la ponctuation. En règle générale, Churchill travaille le matin dans son lit où il mûrit un texte qu'il dicte tard le soir. Il est à ce jour l'unique ancien Premier ministre à recevoir, en 1953, le prix Nobel de littérature pour sa maîtrise de la description historique et biographique ainsi que pour ses discours brillants pour la défense des valeurs humaines. Lors de l'attribution de son prix, Winston est à la fois déçu – il vise le Prix Nobel de la paix – et surpris, s'exclamant : Tiens je ne savais pas que j'écrivais si bien !
Parmi ses œuvres les plus célèbres de renommée internationale, :
Les six volumes de souvenirs, The Second World War, 1948-1954.
Les quatre volumes d'histoire, A History of the English-Speaking Peoples, 1956-1958, qui couvrent la période s'étendant de l'invasion de la Grande-Bretagne par César 55 av. J.-C. au début de la Première Guerre mondiale 1914.
Dans les toutes dernières années de sa vie, il regrette de ne pas avoir écrit les biographies de Jules César et de Napoléon Bonaparte.
L'orateur
À l'origine, Churchill n'est pas un orateur et a même des difficultés d'élocution. Ses discours ne sont pas improvisés, un discours de quarante minutes lui demande entre six et huit heures de préparation. Pour F.E. Smith, Winston Churchill a passé les plus belles années de sa vie à écrire des discours improvisés. De même, pour d'autres, ses bons mots sont parfois travaillés, parfois spontanés – mais dans ces cas là l'auditoire les sent souvent venir car alors son propre rire prenait naissance quelque part du côté de ses pieds. De Clement Attlee, son adversaire travailliste qui ne déteste pas ses piques, il dit un jour qu'il est un mouton déguisé en mouton.
Si Churchill devient un grand orateur, malgré tout, il reste meilleur dans le monologue que dans l'échange. Lord Balfour remarque un jour : l'artillerie du Très Honorable Gentleman est forte et puissante, mais elle ne me semble guère mobile. En général, ses discours commencent sur un tempo lent et dubitatif avant de donner libre cours, à l'essence de sa prose : un rythme hardi, pesant, houleux, retentissant, coulant, interrompu par des cadences lancinantes et éclatantes.
Churchill n'aime ni l'euphémisme, ni le langage technocratique. Par exemple, il s'oppose à ce qu'on remplace pauvres par économiquement faibles, ou foyer par unité d'habitation. Pour lui, les mots, comme il le dit un jour à Violet Bonham-Carter, la fille d'Herbert Henry Asquith, ont une magie et une musique propres. Chez lui, la sonorité du mot est un élément important dans le choix des termes employés. Il aime les mots courts qui frappent dur et aligne souvent les adjectifs par quatre avec des préférences pour unflinching inébranlable, auster austère, somber sombre, et squalid sordide.
Sa rhétorique est parfois contestée. Pour Robert Menzies, Premier ministre d'Australie, durant une partie de la Seconde Guerre mondiale : sa pensée dominante est la possibilité, si attrayante à ses yeux, que les faits gênants disparaissent d'eux-mêmes. Un autre, allié également, écrit : Il est … l'esclave des mots que son esprit invente à partir des idées … et il peut se convaincre lui-même de la vérité dans presque tous les cas, si à travers son mécanisme de rhétorique, il peut continuer ce parcours effréné.
Une politique réaliste
Churchill a été avant tout l'homme des situations. Il leur applique ses conceptions du gouvernement et c'est à leur contact qu'il forge ses idées politiques. Pour lui, la responsabilité de l'homme d'État se fonde sur le loyalisme monarchique et la grandeur britannique. Le loyalisme monarchique impose le respect du système politique, mais aussi la sauvegarde des institutions sociales ; il se montrera toujours passionnément attaché aux prérogatives des Communes comme à celles de l'aristocratie. La grandeur britannique est pour lui l'impératif majeur de l'intérêt national ; c'est ainsi qu'il n'hésitera pas à heurter l'opinion pacifiste de l'entre-deux-guerres. Tout en respectant les rites et conventions politiques, il applique ses conceptions avec une fermeté fortement teintée d'autoritarisme. Il a gardé de la dernière guerre le sentiment que l'homme d'État est essentiellement un chef qui commande, dès lors qu'il prend conscience de sa mission. En cela, il s'est élevé au-dessus des institutions : Premier ministre, il domine son cabinet ; leader du Parti conservateur, il ignore les réactions partisanes. Cependant sa ligne de gouvernement est d'inspiration réaliste et ses choix politiques ne laissent aucune part à l'idéalisme. Passionnément humain, soucieux de faire éclater la vérité, il se sert de l'émotion qui le pénètre pour la communiquer aux autres : « Je n'ai rien à offrir que du sang, du travail, des larmes et de la sueur 1940. Il fait taire les scrupules, au nom des intérêts de son pays, comme pourraient en témoigner les épisodes de Mers el-Kébir ou de Yalta pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans cette atmosphère réaliste, ses idées sont les éléments d'une politique concrète, voire conjoncturelle ; elles peuvent varier selon le moment et la position du personnage sur la scène politique. Elles relèvent toutes de la politique internationale et il ne semble pas que Churchill, convaincu sans doute de l'excellence de l'héritage traditionnel et victorien, ait poursuivi de grands desseins de politique intérieure. Sa première idée est l'impérialisme, la seule dont il gardera la passion, puis la nostalgie avec le déclin de l'empire. Patriote finalement satisfait d'avoir autrefois tempêté contre « l'heure de la faiblesse en Grande-Bretagne » en face de la montée hitlérienne, il défendra l'empire jusqu'au bout et s'insurgera contre l'abandon des Indes par les travaillistes en 1947. Son choix du « grand large » et de l'alliance privilégiée avec les Américains n'en est que le corollaire, dans la conviction que son pays doit jouer aux côtés des États-Unis un rôle particulier dans le concert international. Peut-être l'idée d'une Europe unie qu'il lance en 1947, avant de patronner l'année suivante la fondation du Conseil de l'Europe, se trouve-t-elle dans la même ligne, encore qu'à son retour au pouvoir il se soit bien gardé d'y engager la Grande-Bretagne. Par ailleurs, il s'est fait l'apôtre de l'anticommunisme. Dès 1918, il manifeste son horreur du bolchevisme et réclame une intervention alliée en Russie ; c'est lui qui, dans son célèbre discours de Fulton 1946, parlera le premier du « rideau de fer » et engagera la guerre froide. Mais les sentiments ne l'ont jamais aveuglé et il n'hésite pas à faire de l'U.R.S.S. un allié contre le nazisme, avant de partager avec Staline l'Europe en zones d'influence. En fin de compte, toutes ses conceptions relèvent de la politique et de la diplomatie traditionnelles, mais Churchill leur a parfois donné la vigueur incomparable de son génie et du sentiment de sa mission.
Un témoin de l'histoire
Le général de Gaulle a écrit de Churchill, qu'il connaissait bien, qu'il avait été le grand champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire. Sa place dans la société britannique apparaît, en effet, comme celle d'un remarquable leader national pendant la guerre, mais aussi d'un témoin de l'histoire chez qui le passé a quelquefois estompé les difficultés du présent.
Il a été le leader de la Grande-Bretagne et du Commonwealth en guerre : en mai 1940, il est appelé à remplacer Chamberlain comme Premier ministre, parce que l'opinion et les députés savent qu'il s'impose pour diriger la guerre ; en juillet 1945, il se retire parce qu'aux élections les Anglais lui ont préféré, pour la paix, Attlee et les travaillistes. À sa mort, ces années ont été parfaitement résumées par le message de la reine Elizabeth : La survivance de notre pays ... sera un monument perpétuel à la mémoire de ses dons de chef, de sa clairvoyance et de son indomptable courage. Pendant cinq ans, il a fait la guerre, et sa suprématie n'a jamais été mise en question. Il s'est montré un animateur exceptionnel qui sut inspirer aux Anglais sa passion de l'Angleterre. Il s'est manifesté comme un éminent chef de guerre, à la fois par sa capacité de déterminer les grands choix politiques et par son aptitude à régler personnellement les affaires militaires, même si ses généraux s'en sont quelquefois plaints. Churchill appartient à cette lignée d'hommes d'État qui font l'histoire, parce qu'il a marqué la vie de son pays à un moment dramatique.
Ses valeurs étaient tournées vers le passé, mais il ne faut pas y voir un élément contrariant au sein d'une nation où les institutions et les libertés sont traditionnelles. Il a été un homme d'État du XIXe siècle, imprégné de la grandeur victorienne, à un de ces moments privilégiés où le génie politique n'a pas d'époque.
Toutefois, le rétablissement de la paix a relancé la dynamique de l'histoire et, lorsqu'il est revenu au pouvoir en 1951, Mr. Churchill appartenait au passé. Sa légende a maintenu son prestige jusqu'à son départ en 1955, sans que son gouvernement soit véritablement efficace et apprécié. Ses proches et ses amis politiques se faisaient cependant de plus en plus pressants pour l'inviter à la retraite. C'est seulement après sa mort (à Londres en 1965), après quelques polémistes isolés, que lord Moran fait de son illustre malade une critique décisive : « Il a été foncièrement victorien par son incapacité à se mettre au pas de son époque en mouvement. » Le jugement est sévère sur l'après-guerre : « Il est certain que l'âge et les congestions cérébrales successives expliquent en partie pourquoi il ne fut pas plus efficace dans son rôle de leader de l'opposition, et plus tard de Premier ministre de la Couronne. » Mais la condamnation va plus loin et met en cause son obstination, sa conception personnelle du pouvoir, l'excentricité de son jugement, à qui le familier impute les échecs politiques d'après guerre. Cette opinion peut paraître outrancière, mais Churchill n'en a pas moins été dépassé par les problèmes du temps de paix et il émerge finalement du déclin de la Grande-Bretagne d'après guerre par une admirable légende, qu'il faut bien rattacher aux grandeurs victoriennes.
Les honneurs Liste des distinctions de Winston Churchill.
Churchill a reçu au cours de sa vie de nombreuses décorations. Sa titulature officielle est sur le modèle anglo-saxon : Sir Winston Churchill KG, OM, CH, TD, FRS, CP RU, CP Can, DL, Hon. RA. Il est en outre prix Nobel de littérature et premier citoyen d'honneur des États-Unis, a reçu de nombreux autres prix et honneurs. Il est fait Compagnon de la Libération en 1958 par le général de Gaulle. Lors d'un sondage de la BBC tenu en 2002, basé sur environ un million de votes de téléspectateurs, 100 Greatest Britons, il est proclamé le plus grand de tous. Il est également membre à titre héréditaire de la Société des Cincinnati.
Derniers jours et funérailles
Après avoir quitté le poste de Premier ministre, Churchill passe moins de temps au Parlement. Il vit sa retraite à Chartwell et à son domicile londonien du 28 Hyde Park Gate, au sud-ouest de Kensington Gardens. Lorsque son état mental et ses facultés physiques se dégradent, il sombre dans la dépression.
Churchill, sa femme et de nombreux membres de sa famille sont enterrés autour de l'église Saint Martin de Bladon.
En 1963, le président américain John F. Kennedy, agissant en vertu de l'autorisation accordée par une loi du Congrès, le proclame citoyen d'honneur des États-Unis, mais il est dans l'impossibilité d'assister à la cérémonie à la Maison-Blanche. Le 15 janvier 1965, Churchill subit un grave accident vasculaire cérébral qui lui sera fatal : il meurt à son domicile neuf jours plus tard, à l'âge de 90 ans, le matin du dimanche 24 janvier 1965, soit 70 ans jour pour jour après son père.
Les obsèques nationales ont lieu à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Ce sont les premières obsèques nationales pour une personnalité ne faisant pas partie de la famille royale depuis 1914. Le cercueil parcourt ensuite la courte distance jusqu'à la gare de Londres-Waterloo où il est chargé sur un wagon spécialement préparé et peint, le Southern Railway Van, dans le cadre du cortège funéraire pour son trajet par chemin de fer jusqu'à Bladon. La Royal Artillery tire dix-neuf coups de canon, comme à son habitude pour un chef de gouvernement, et la RAF met en scène un défilé aérien de seize avions de combat English Electric Lightning. Les funérailles connaissent le plus grand rassemblement de chefs d'État dans le monde, jusqu'en 2005 lors des funérailles du pape Jean-Paul II. Le wagon Pullman transportant sa famille en deuil est remorqué par une locomotive à vapeur Bulleid Pacifique no 34051 Winston Churchill. Dans les champs le long de la voie ferrée, et aux gares rencontrées sur le trajet, des milliers de personnes se tiennent en silence pour lui rendre un dernier hommage. L'hymne lors des funérailles est The Battle Hymn of the Republic. À sa demande, Churchill est enterré dans la parcelle familiale du cimetière de l'église St Martin de Bladon dont dépend le Palais de Blenheim, son lieu de naissance.
La postérité The Winston Churchill Memorial Trust
Lorsque Churchill a 88 ans, le duc d'Édimbourg lui demande comment il aimerait qu'on se souvienne de lui. Churchill lui répond : avec une bourse d'étude comme la bourse Rhodes, mais pour un groupe d'individus plus grand. Après sa mort, le Winston Churchill Memorial Trust est créé au Royaume-Uni et en Australie. Un Churchill Memorial Day Trust a lieu en Australie, ce qui permet d'amasser 4,3 millions de dollars australiens. Depuis ce temps, le Churchill Trust en Australie a soutenu plus de 3 000 bénéficiaires de bourses d'études dans divers domaines, où le mérite soit sur la base de l'expérience acquise, soit en fonction du potentiel et la propension à contribuer à la collectivité ont été les seuls critères.
Churchill, leader préféré des patrons en 2013
Dans une étude réalisée auprès des dirigeants d'entreprises de trente pays, Churchill est considéré début 2013 comme le dirigeant préféré des patrons devant Steve Jobs. Churchill est classé parmi les guerriers avec Napoléon Bonaparte et Alexandre le Grand. Parmi les autres politiques, le Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, arrivés troisième et quatrième, sont classés parmi les pacificateurs. Margaret Thatcher est classée parmi les réformateurs et Bill Clinton parmi les bâtisseurs de consensus.
Films et séries montrant Churchill
Le personnage de Churchill apparait dans de nombreux films et séries télévisées. Ont notamment joué son personnage :
Films et téléfilms sur la vie de Churchill :
Simon Ward Les Griffes du lion, 1972, sur sa jeunesse
Richard Burton The Gathering Storm, 1974
Timothy West Churchill and the Generals, 1979
Robert Hardy Winston Churchill: The Wilderness Years, 1981,
Albert Finney The Gathering Storm 2002, sur la période 1934-1939
Bob Hoskins World War II: When Lions Roared 1994
Brendan Gleeson Into the Storm, 2009, sur la Seconde Guerre mondiale
Apparition du personnage Churchill :
Peter Sellers L'Homme qui n'a jamais existé, 1956
Warren Clarke Jennie: Lady Randolph Churchill, 1974
Wensley Pithey Edward and Mrs. Simpson, 1978
William Hootkins The Life and Times of David Lloyd George, 1981
Timothy West Hiroshima, 1995
Ian Mune Ike. Opération Overlord, 2004
Rod Taylor Inglourious Basterds, 2009
Ian McNeice Doctor Who: Victory of the Daleks; The Pandorica Opens; Le Mariage de River Song en 2010 et 2011
Timothy Spall Le Discours d'un roi, 2010
La biographie rédigée par Randolph Churchill et Martin Gilbert
Plusieurs historiens à travers le monde, ont publié des biographies de Winston Churchill. Cependant, celle réalisée par Randolph Churchill et Martin Gilbert apparaît comme la biographie officielle.
À la fin des années 50, le fils de Winston, Randolph, qui est un écrivain reconnu, réussit à convaincre son père de rédiger sa biographie. Randolph doit en effet accéder aux archives de son père, mais demande à ce que cet ouvrage ne soit pas publié avant sa mort.
Dans cette entreprise, Randolph est assisté de l'historien Martin Gilbert et les premiers tomes paraissent dès 1966 aux éditions Heinemann. Lorsque Randolph décède en 1968, seule la période 1874-1914 a été publiée. C'est donc Martin Gilbert qui termine seul la biographie de Winston Churchill.
Cette biographie se subdivise en 8 volumes comprenant la biographie proprement-dite fractionnée sur les périodes 1874-1900, 1901-1914, 1914-1916, 1917-1922, 1922-1939, 1939-1941, 1941-1945 et 1945-1965, ainsi que des volumes Companion qui fournissent divers documents lettres etc..
Liens
http://youtu.be/_wx7lXiJ1_Q les bunkers secrets de Churchill
http://youtu.be/D5uqduSXSyA Mers el kébir
http://youtu.be/_tIuf8t4ra4 La bataille d'angleterre
http://youtu.be/FL2CoYBfkts Le char Churchill
http://youtu.be/CHBCMjyHxwQ Discours aux français
http://www.dailymotion.com/video/x27l ... dans-le-siecle-extrait_tv
        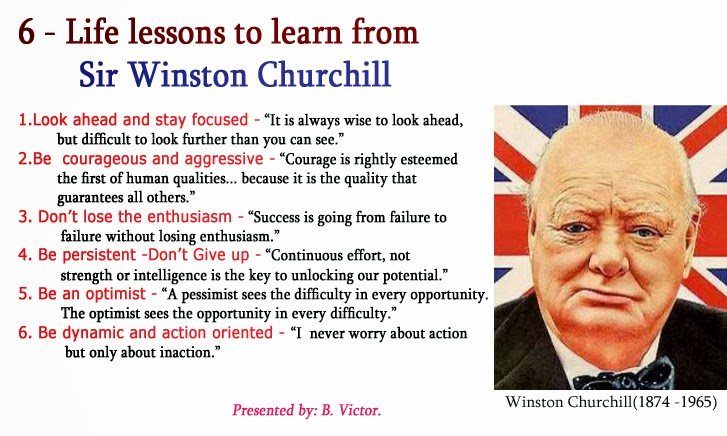   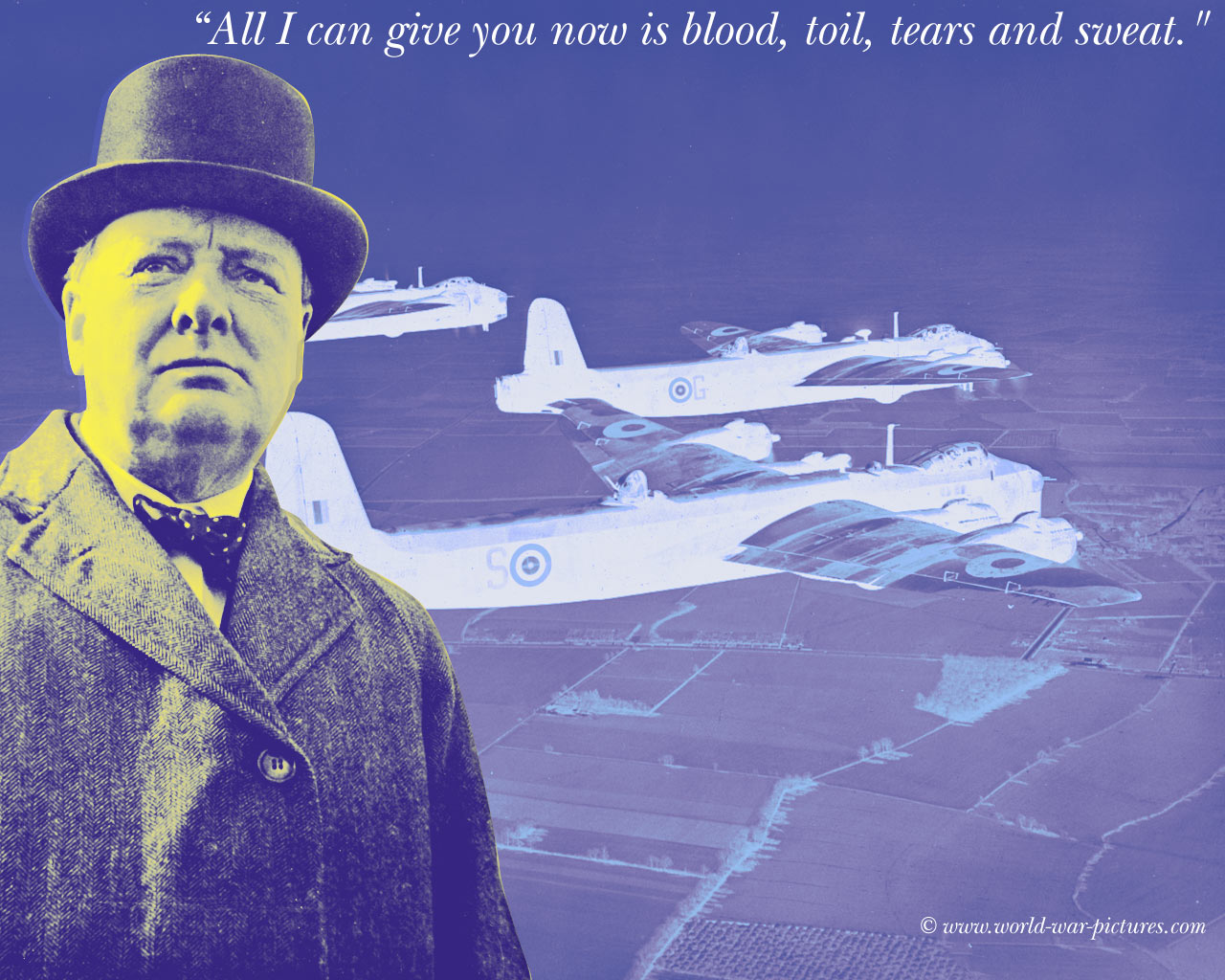   
Posté le : 29/11/2014 20:58
|
|
|
|
|
Re: Défi du 29 Novembre 2014- Arène Sanglante |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
23/10/2013 18:00
Niveau : 32; EXP : 86
HP : 0 / 796
MP : 493 / 24872
|
@ Couscous,
Genial. J'ai adoré. L'optique du sujet est très originale et pleine d'humour (à la faveur du toro). Bien des vérités sy sont dites. De plus, cette fin se rapproche de celle que j'ai écrite.
Merci Couscous pour ton concours.
Bises.
Posté le : 29/11/2014 19:34
|
|
|
|
|
Re: Dédi du 29 Novembre 2014- Arène Sanglante |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Cher Exem, j'avoue avoir opté pour la seconde option... Voici ma production :
Oreille pour oreille, queue pour queue
Je piaffe d’impatience dans ce minuscule box. Il fait sombre ici. Je suis affamé et nerveux. Des hommes viennent me titiller en me piquant les fesses depuis plusieurs heures. Je gratte le sol de mes sabots. Je veux sortir, ramenez-moi à ma prairie ! Je dois veiller sur Bianca, Dolores et surtout Isabella. Elle a une si belle croupe. Je ne me tiens plus quand elle passe nonchalamment devant moi, en battant des cils.
Soudain, une grande porte s’ouvre face à moi. Sans trop réfléchir, je me précipite. Aveuglé par un soleil agressif, j’entends une clameur autour de moi. Mes yeux s’habituent peu à peu à la luminosité et je découvre que je suis au cœur d’une arène. Du sable sous mes sabots émane une odeur de sang. Je ne peux m’empêcher de frissonner. Face à moi se trouve un homme dans un drôle d’accoutrement brillant. Il porte une coiffe sombre et me toise d’un air supérieur. La foule scande « Fédérico ». Je suppose que c’est le petit nom de cet adversaire, bien chétif à mon goût. Il va voir de quel bois se chauffe le grand El Diablo !
Il agite une sorte de petit rideau, semblant m’inviter à découvrir ce qui se cache derrière. Il veut jouer ? D’accord. Je me précipite vers le morceau de tissu mouvant. Au dernier moment, le fourbe le relève et je sens une douleur fulgurante me traverser l’échine. Que m’a-t’il fait ? Il continue son manège et cela semble plaire au public qui crie son nom encore plus fort. Galvanisé par ce succès, il se met à exécuter quelques pas de danse. Ridicule ! Son cirque m’énerve profondément. Je cours à nouveau vers son drapeau qui s’agite frénétiquement. J’entends « Olé !» et encore cette douleur sur le haut de mon dos. Un liquide chaud coule le long de mes flancs. Mon souffle devient court. Il faut que je montre ma supériorité à ce gringalet de danseur de ballet. Il feinte ? Eh bien moi aussi !
Je le laisse un peu se fatiguer à secouer son drap de bain, ce qui me permet de rassembler toutes mes forces. La pression monte dans l’assistance qui scande toujours son prénom. Je gratte le sol, baisse la tête et fonce soudainement vers lui. Il n’a pas le temps d’esquiver mes cornes et se retrouve projeté à plusieurs mètres. Là, d’autres hommes se précipitent dans l’arène, ils tentent de détourner mon attention du pantin qui git sur le sol, inanimé. J’ai gagné ! Et personne ne chante mon patronyme. Ils sauront désormais qu’il ne faut pas se frotter au grand El Diablo !
Je suis reconduit dans mon box et on me retire les piques que l’autre m’avait plantées dans le dos. Quand je vais montrer ces blessures de guerre à Isabella, je serai son héros et on fera un beau petit veau. Mais j’y pense… selon la tradition, ne devrais-je pas recevoir les oreilles et la queue du danseur en guise de trophée ?
Posté le : 29/11/2014 18:28
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
123 Personne(s) en ligne ( 74 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 123
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages