|
|
7/9/2015RodolpheIII,MarioPraz,L.Pavarotti,V.Soudière,LaFayette,J.Green,DessalinesD'Orbigni,Colbert |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Posté le : 13/09/2015 23:45
Edité par Loriane sur 19-09-2015 19:25:49
|
|
|
|
|
Clara Schumann |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 13 septembre 1819, naît Clara Schumann
de son nom de naissance Clara Wieck, à Leipzig, royaume de Saxe pianiste et compositrice et éditrice allemande, épouse du musicien Robert Schumann, morte, à 76 ans, le 20 mai 1896 à Francfort-sur-le-Main alors royaume de Prusse.
Élève de son père, Friedrich Wieck, elle donna son premier concert en 1828 à Leipzig. En 1831, au début de sa première tournée qui la conduisit à Paris, elle joua devant Goethe. Au retour, elle compléta ses études de composition. Sa renommée précoce lui valut d'être nommée pianiste de la cour d'Autriche en 1838. L'année suivante, au cours d'un second séjour à Paris où elle songea à se fixer, elle fit connaître à un cercle restreint les premières œuvres qu'elle avait inspirées à Robert Schumann.
En bref
La pianiste et compositrice allemande Clara Schumann fut l' épouse du compositeur Robert Schumann et l' inspiratrice de Johannes Brahms.Elle l'épousa le 12 septembre 1840, au terme d'une longue et douloureuse attente provoquée par l'opposition de Wieck. Grâce à Schumann qui l'initia intensivement à J. S. Bach et à Beethoven, la virtuose qu'elle était devint l'une des premières interprètes de son temps.
Née le 13 septembre 1819, à Leipzig, en Saxe, Clara Josephine Wieck étudie le piano dès l'âge de cinq ans, sur les encouragements de son père, Friedrich Wieck. En 1835, elle jouit déjà de la réputation d'enfant prodige dans toute l'Europe. Trois ans plus tard, la jeune fille est honorée par la cour d'Autriche, dont elle est nommée pianiste virtuose, et elle est élue membre de la prestigieuse Société philharmonique Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne.
En dépit des fortes objections de son père, la jeune Clara épouse le 12 septembre 1840 Robert Schumann, dont elle aura huit enfants entre 1841 et 1854. Bien que ses devoirs de mère de famille l'obligent à ralentir ses activités, elle enseigne au conservatoire de Leipzig, compose et réalise de nombreuses tournées. Le 1er janvier 1846, Clara Schumann crée à Leipzig, avec l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig placé sous la direction de Felix Mendelssohn, le Concerto pour piano et orchestre, en la mineur, opus 54, de son époux. À partir de 1853, le couple noue avec Johannes Brahms une étroite relation professionnelle en même temps qu'une profonde amitié que Clara Schumann entretiendra après la mort de son époux, survenue en 1856. Son répertoire s'étend de Bach à Brahms. Elle édite par ailleurs les œuvres complètes de son mari, publiées en 34 volumes, de 1881 à 1893. À son catalogue figurent des œuvres pour orchestre parmi lesquelles un Concerto pour piano, opus 7, 1835, de la musique de chambre Trio avec piano, opus 17, 1846 ; Trois Romances pour piano et violon, opus 22, 1853, trois remarquables recueils de lieder et de nombreuses pièces pour piano seul Scherzo, opus 10 ; Trois Romances, opus 11, 1838-1839 ; Trois Romances, opus 21, 1853. Clara Schumann meurt le 20 mai 1896, à Francfort-sur-le-Main.
Sa vie
La fille du professeur Wieck
Son père Friedrich Wieck, célèbre professeur de piano, fait d'elle une concertiste prodige dès l'âge de neuf ans.
En 1827, elle a déjà rencontré son futur époux, Robert Schumann elle a huit ans, il en a dix-sept, qui étudie auprès de son père. Clara donne son premier concert au Gewandhaus de Leipzig, où elle est remarquée par Goethe. En tournée à Paris, elle connaît un triomphe. Dès 1829, Clara publie ses premières œuvres, Quatre Polonaises tandis qu'en 1832, Robert publie Papillons ; Clara joue cette œuvre en concert l'année même. Entre 1834 et 1836, elle compose les Soirées musicales, qui connaissent un grand succès notamment auprès de Liszt.
L'épouse du musicien Schumann
À l'âge de seize ans, elle s'éprend de Robert Schumann. Robert demande sa main à son père lorsque la jeune fille atteint sa dix-huitième année. Mais Wieck s'oppose vigoureusement à leur mariage. Les amoureux sont séparés de force, mais communiquent par le biais d'amis et de messages musicaux dans les concerts de Clara. Le mariage est finalement célébré en 1840 à Schönefeld en exécution d'une décision judiciaire. Huit enfants, dont Felix Schumann, sont issus de leur union, ce qui tend à ralentir sérieusement le parcours musical de Clara.
Première interprète des œuvres de son mari, elle fait connaître et apprécier sa musique dont, selon ce dernier, elle est alors la seule à bien comprendre les délicatesses. Clara est elle-même l'auteur d'une quarantaine d'œuvres, mais elle a en partie négligé la composition au profit du piano et de son rôle d'inspiratrice auprès de son mari.
Jusqu'en 1856, elle n'effectua que deux tournées importantes, l'une au Danemark 1842, l'autre en Russie 1844, et créa à Leipzig, le 1er janvier 1846, le concerto pour piano que Schumann avait conçu pour elle. Un peu avant la mort de celui-ci, elle reprit par nécessité la vie errante de concertiste, moralement soutenue par l'amitié passionnée que lui vouait Johannes Brahms. De 1856 à 1891, année de son dernier concert public, elle se rendit seize fois en Angleterre, deux fois à Paris 1862 et 1863, où elle joua avec le quatuor Armingaud le quintette que Schumann lui avait dédié, fit une seconde tournée en Russie 1864 et donna plusieurs concerts avec le violoniste Joseph Joachim. Dans son répertoire qui s'étendait de Bach à Brahms, elle marqua toujours une prédilection pour les œuvres les plus brillantes de Schumann.
Son jeu, bien que puissant et timbré, était basé sur une technique opposée à celle de Liszt, pour qui elle avait peu de sympathie. D'esprit conservateur, elle prit parti pour Brahms contre Wagner. En 1878, elle fut nommée professeur au conservatoire de Francfort. Elle établit, en collaboration avec Brahms, une édition complète des œuvres de Schumann 1881-1893 et publia en 1885 sa correspondance de jeunesse. Inspiratrice et conseillère de deux des plus grands musiciens du romantisme, Clara Schumann a sous-estimé ses dons de compositeur. Sa production, une quarantaine d'œuvres, est d'une réelle qualité. L'ensemble des pièces pour piano écrites avant 1840, sous l'influence de Chopin et de Mendelssohn, est dominé par le concerto op. 7 1835. Ensuite, son évolution suit celle de Schumann et culmine avec le trio op. 17 1847. Ce sont surtout ses trois recueils de lieder 1840, 1844, 1853 qui sont remarquables. Schumann, qui avait déjà écrit ses Impromptus op. 5, ses Davidsbündlertänze op. 6 et sa 3e Sonate op. 14 à partir de motifs empruntés à des œuvres de sa fiancée, a inclus dans son Liebesfrühling op. 37 1840 trois lieder de l'opus 12 de Clara, qui égalent sa propre inspiration
En 1854, Robert Schumann est interné. Veuve dès 1856, Clara devient l'amie, la conseillère et l'inspiratrice de Johannes Brahms mais elle affirme désormais que ses seuls moments de bonheur sont ceux où elle joue ou écoute la musique de son cher disparu.
Une artiste reconnue
Clara se lance à corps perdu dans des tournées en Angleterre, en France, en Russie… jusqu'en 1891, date de son dernier concert. Elle enseigne par ailleurs le piano au Conservatoire de Francfort de 1878 à 1892. Elle est reçue dans le salon de la Landgravine de Hesse-Cassel, nièce de l'empereur, mélomane et musicienne au talent reconnu.
De 1881 à 1893, elle établit une édition complète des travaux de son mari, dont elle n'a de cesse de défendre l'œuvre. C'est précisément en écoutant son petit-fils, Ferdinand, interpréter une œuvre de son célèbre aïeul Romance en fa majeur, Op. 28 n° 2 qu'elle s'éteint le 20 mai 1896, ayant enduré vers la fin de sa vie des problèmes de surdité. Elle est enterrée aux côtés de son mari au Vieux-Cimetière de Bonn.
Elle fait partie des rares femmes compositrices de renom au XIXe siècle, avec Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc et Cécile Chaminade.
Catalogue des œuvres
Clara Schumann 1878/79
Pastel de Franz von Lenbach
Quatre Polonaises pour piano op. 1 1829/30
Caprices en forme de Valse pour piano op. 2 1831/32
Romance variée pour piano op. 31833
Valses romantiques pour piano op. 4 1835
Quatre Pièces caractéristiques op. 5 1833 ?, 1835/36
Soirées Musicales op. 6 1834-36
Premier Concerto en la mineur pour piano, avec accompagnement d'orchestre op. 7 1833-35
Variations de Concert pour piano sur la Cavatine du Pirate de Bellini op. 8
Souvenir de Vienne, Impromptu pour piano op. 9 1838
Scherzo pour piano op. 10
Trois Romances pour piano op. 11 1838/39
Douze chants sur Liebesfrühling de F. Rückert pour chant et piano de Robert et Clara Schumann op. 12 (Lieder Nr. 2, 4 et 11 de Clara, inclus dans l'op. 37 de Robert Schumann 1841
Six Lieder avec accompagnement de piano op. 13
Deuxième Scherzo pour piano op. 14 1841
Quatre Pièces fugitives pour piano op. 15 1840 - 44?
Trois Préludes et Fugues pour piano op. 16 1845
Trio en sol mineur pour piano, violon et violoncelle op. 17 1846
op. 18 et op. 19 perdus
Variations sur un thème de Robert Schumann pour piano, Ihm gewidmet op. 20 1853
Trois Romances pour piano op. 21 1853
Trois Romances pour piano et violon op. 22 1853
Six Lieder sur Jucunde de Hermann Rollet op. 23 1853
          
Posté le : 13/09/2015 23:37
|
|
|
|
|
Maurice Jarre |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 13 septembre 1924 naît Maurice Jarre,
à Lyon 5ème, compositeur français de musiques de scènes et de musiques de films, mort le 29 mars 2009, à 84 ans, à Malibu États-Unis. Maurice Jarre est le fils du directeur technique de Radio Lyon, André Jarre. Compositeur, Chef d'orchestre, ses films les plus notables sont Lawrence d'Arabie
Le Docteur Jivago, Paris brule-t-il ?, La Fille de Ryan, Le Message, Le Lion du désert, La Route des Indes, Witness, Le Cercle des poètes disparus, Ghost
Dans les années 1940, il épouse France Pejot ancienne résistante 1914-2010. Leur fils Jean-Michel naît le 24 août 1948. Le couple divorce en 1953 et Maurice part aux États-Unis. En 1965, il épouse l'actrice Dany Saval et une fille, Stéphanie, naît en 1966. Ils divorcent peu après. Fin 1967, il épouse l'actrice Laura Devon 1931-2007 ; il adopte son fils, Kevin Jarre 1954-2011. Le couple divorce en 1984. Il épouse, en 1984, Fong F. Khong, d'origine chinoise, qui l'accompagnera jusqu'à sa mort.
En bref
Maurice Jarre s'est intéressé assez tard à la musique. Timbalier de formation, Jarre débute à la Compagnie Renaud-Barrault en 1946, formant un duo avec Pierre Boulez au piano et aux ondes Martenot, mais Jarre s'intéresse très vite à la composition.
On lui commande en 1948 sa première musique de scène pour Le Gardien du Tombeau, de Franz Kafka. Il devient directeur musical du Théâtre national populaire durant douze années 1951-1963. Il compose les mythiques trompettes, la fanfare d'accueil de Lorenzaccio, qui retentit en juillet lors de chaque représentation du Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur du Palais des Papes. Parmi les musiques de scène composées alors pour le T.N.P. il faut remarquer, outre Lorenzaccio déjà cité, les musiques de Richard II, Macbeth, Le Prince de Hombourg, Nucléa, Meurtre dans la cathédrale, Don Juan, Le Médecin malgré lui, Ruy Blas, La Découverte du Nouveau-Monde. Il est à remarquer que Maurice Jarre compose une nouvelle musique de scène pour Lorenzaccio, cette fois lors de la reprise de cette pièce à la Comédie-Française dans la mise en scène de Franco Zeffirelli. Sa carrière dans la musique de film démarra dans les années 1950 pour des courts métrages des compositions pour les films de Georges Franju, Jacques Demy, Alain Resnais notamment puis des longs métrages à partir de 1958 La Tête contre les murs de Georges Franju.
C'est également dans les années 1950 que Maurice Jarre composa l'indicatif de fin d'émission de la station de radio française Europe .
Sa carrière hollywoodienne ne démarra véritablement qu'en 1962 avec Lawrence d'Arabie, un film qui scella la collaboration du réalisateur David Lean avec Jarre.
Il a composé de très nombreuses musiques de films dont celles de Lawrence d'Arabie 1962, Le Docteur Jivago 1965, Paris brûle-t-il ? 1966, Les Damnés 1969, Soleil rouge 1971, Le Message 1976, Jésus de Nazareth 1977, Shogun 1980, Le Lion du désert 1981, Witness 1985, Gorilles dans la brume 1988, Le Cercle des poètes disparus 1989, Ghost 1990 ou L'Échelle de Jacob 1990. En 1996, il compose la musique du film vivement critiqué de Bernard Henry-Lévy, Le Jour et la Nuit, qui a voulu reproduire le style de David Lean. Jarre a aussi composé des œuvres de concert majeures et écrit cinq ballets dont Notre-Dame de Paris pour l'Opéra de Paris.
Lors du Festival de Berlin en février 2009, il reçoit un Ours d'Or pour l'ensemble de sa carrière. C'est sa dernière apparition en public. Atteint d'un cancer, il meurt le 28 mars 2009 dans sa villa de Los Angeles à l'âge de 84 ans.
Il fait partie des très rares artistes français à avoir été honorés par une étoile au Hollywood Walk of Fame à Los Angeles.
Sa vie
Maurice Alexis Jarre naît à Lyon le 13 septembre 1924. Il envisage d'abord une carrière d'ingénieur et ce n'est qu'à l'âge de seize ans qu'il découvre véritablement la musique, lorsque son père, qui travaille à la Radio de Lyon, amène quelques disques à la maison. « J'en ai passé un, il s'agissait de la Deuxième Rhapsodie hongroise de Liszt, arrangée et enregistrée par Leopold Stokowski. Je venais de découvrir quelque chose qui allait bouleverser ma vie : le son. » Conscient que sa vocation est tardive, il travaille de manière acharnée et choisit d'apprendre les percussions car « il était déjà trop tard pour devenir violoniste ou clarinettiste ». Il intègre en 1943 le Conservatoire national supérieur de Paris, où il étudie les percussions avec Félix Passerone – dont un des élèves a été Pierre Henry–, l'orchestration avec Louis Aubert et la composition avec Arthur Honegger, qui l'initie à la musique de film.
Devenu un excellent percussionniste, Maurice Jarre est engagé par la Compagnie Renaud-Barrault, où il se lie d'amitié avec Georges Delerue et Pierre Boulez : Maurice Jarre y joue de toutes les percussions – des timbales au xylophone –, Pierre Boulez est au piano ou aux ondes Martenot. En 1951, Jean Vilar invite le jeune compositeur à écrire, pour le festival d'Avignon, la musique de scène de la pièce de Heinrich von Kleist Le Prince de Hombourg, où triomphe Gérard Philipe. En août 1951, Vilar est nommé directeur du Théâtre national populaire (T.N.P.) ; il demande immédiatement à Maurice Jarre d'en devenir le directeur musical et le chef d'orchestre. Jarre, qui conservera cette fonction jusqu'à la fin du mandat de Vilar, en 1963, va composer les musiques de scène de plus de soixante-dix pièces différentes, de Shakespeare, Brecht, von Kleist, Musset, Marivaux, Pirandello, Cocteau, Camus... Disposant d'un orchestre de trente musiciens, il dirige lui-même ses propres compositions. C'est à lui que l'on doit les célèbres sonneries du T.N.P.
Parallèlement à la musique de scène, Maurice Jarre commence en 1952 à composer pour l'image : il écrit une musique pour un court-métrage de Georges Franju, Hôtel des Invalides, qui connaît une certaine notoriété. Jarre va rapidement se consacrer quasi exclusivement à la musique de film, composant pour Franju (Le Théâtre national populaire, 1956 ; La Tête contre les murs, 1958 ; Les Yeux sans visage, 1960 ; Pleins feux sur l'assassin, 1961 ; Thérèse Desqueyroux, 1962 ; Judex, 1963), Alain Resnais (Toute la mémoire du monde, 1956), Jacques Demy (Le Bel Indifférent, 1958), Jean-Pierre Mocky (Les Dragueurs, 1958), Jean-Paul Rappeneau (Chronique provinciale, 1958), Henri Verneuil (Le Président, 1961)... La musique du documentaire d'Alain Resnais Toute la mémoire du monde repose essentiellement sur la répétition, sur un long ostinato qui n'enjolive à aucun moment le propos du film. L'étrangeté que secrète cet ostinato confère au film un caractère volontairement non réaliste, ce qui peut paraître paradoxal pour un documentaire. Mais il ne faut pas oublier que la Bibliothèque nationale, sujet du film, est un lieu de mémoire. Et c'est là que se situe le remarquable travail de Resnais et de Jarre : amener le spectateur à éprouver la sensation d'être hors de l'espace et hors du temps.
En 1962, Maurice Jarre signe la musique du film Cybèle, ou les Dimanches de Ville-d'Avray de Serge Bourguignon. Sam Spiegel, producteur de David Lean, voit ce film, en apprécie la partition et demande à Maurice Jarre de venir à Hollywood pour travailler sur Lawrence d'Arabie. C'est le début, pour le compositeur français, d'une longue et riche carrière aux États-Unis.
Avec Georges Delerue, Maurice Jarre est le plus important compositeur français de musiques de films de la seconde moitié du XXe siècle, mais aussi un des plus controversés : ses partitions flamboyantes pour Hollywood lui vaudront la notoriété auprès du grand public en même temps que le rejet de la part d'une critique rigoriste.
Hollywood
Pour beaucoup de cinéastes, la musique constitue une facette secondaire de leur œuvre. Mais, à l'instar de certains scénaristes ou directeurs de la photographie, des compositeurs ont su mener à bien des collaborations privilégiées et suivies avec des réalisateurs. Quelques exemples illustres inscrits dans l'histoire du cinéma – au premier rang desquels Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock, John Williams et George Lucas – prouvent heureusement qu'une véritable symbiose peut s'instaurer entre un réalisateur et un compositeur. C'est le cas de David Lean et de Maurice Jarre, dont la collaboration se concrétisera par quatre films et trois oscars pour la meilleure partition originale : Lawrence of Arabia (Lawrence d'Arabie, 1962, oscar), Doctor Zhivago (Docteur Jivago, 1965, oscar), Ryan's Daughter (La Fille de Ryan, 1970) et A Passage to India La Route des Indes, 1984, oscar.
Pour la bande originale de Lawrence d'Arabie, Lean avait tout d'abord pensé à Aram Khatchatourian pour la musique de caractère arabe et à Benjamin Britten pour la partition « britannique », Jarre étant censé signer la musique du générique. Khatchatourian ne put quitter l'U.R.S.S. et Britten exigea un an et demi pour écrire la partition. Sans demander l'avis de David Lean, Sam Spiegel décida que Richard Rodgers composerait 90 p. 100 de la musique et Maurice Jarre 10 p. 100. Mais les premiers envois de Rodgers au réalisateur ne furent pas convaincants et Lean réussit, en 1962, à imposer Maurice Jarre pour l'intégralité de la bande originale de Lawrence d'Arabie. Un thème unique parcourt tout le film, dont il accélère, anticipe, rompt ou fige le déroulement dramatique. Jarre déclarera : « Il me semblait important d'avoir un thème principal unique que l'on pouvait ensuite décliner à l'infini plutôt que de perturber le public avec une multitude de thèmes différents. » Pour Docteur Jivago, Maurice Jarre compose ce qui va devenir la référence classique pour Hollywood, le « leitmotiv » de cette partition – la célèbre « chanson de Lara » – constituant le plus sûr garant du romanesque.
Si le thème unique – que l'on retrouve avec la valse de Paris brûle-t-il ? de René Clément (1966) – constitue une sorte d'image de marque pour le compositeur, il établit cependant les limites de ses interventions à l'intérieur d'un film. Sans nier le bénéfice de l'impact au premier degré que représente la reconnaissance immédiate d'un thème pour le spectateur et la possibilité de le fredonner sans difficulté, force est de constater que le choix d'une politique thématique en matière de musique de film bloque le genre, et le relègue à un rang accessoire.
La musique de Maurice Jarre pour Lean dépassera heureusement ce simple rôle de médiateur entre le public et le film dans leurs deux dernières collaborations, La Fille de Ryan et La Route des Indes. Car Lean a toujours considéré que ce n'est pas par l'illusion de la réalité que le cinéma s'est donné un statut d'art réaliste, mais par le développement d'une toile de fond romanesque, le romanesque constituant la traduction culturelle de l'idée de réel. Et, par sa désuétude, la musique de Jarre contribue largement à ouvrir le champ romanesque.
Après le succès immense de Lawrence d'Arabie, Maurice Jarre va travailler avec les plus grands réalisateurs d'Hollywood : Fred Zinnemann (Behold a Pale Horse – Que vienne l'heure de la vengeance –, 1964), John Frankenheimer (The Train – Le Train –, 1964 ; Grand Prix, 1966 ; The Fixer – L'Homme de Kiev –, 1968), William Wyler (The Collector – L'Obsédé –, 1965), John Huston (The Life and Times of Judge Roy Bean – Juge et hors-la-loi –, 1972 ; The Man who would be King – L'Homme qui voulut être roi –, 1975), Peter Weir (The Year of Living Dangerously – L'Année de tous les dangers –, 1982 ; The Mosquito Coast, 1985 ; Witness, 1985 ; Dead Poets Society – Le Cercle des poètes disparus –, 1989 ; Fearless – État second –, 1994), Clint Eastwood (Firefox – L'Arme absolu –, 1982)... Il a également travaillé avec Roger Vadim (Barbarella, 1967), Luchino Visconti (La Caduta degli dei – Les Damnés –, 1969), Alfred Hitchcock (Topaz – L'Étau –, 1969), Volker Schlöndorff (Die Blechtrommel – Le Tambour –, 1979 ; Die Fälschung – Le Faussaire –, 1981)...
Utilisant à ses débuts des effectifs restreints, Maurice Jarre a adopté à Hollywood, un style symphonique tirant parti de toutes les ressources d'un grand orchestre. Il a également parfaitement su mettre à profit l'« exotisme » des films : la partition de Lawrence d'Arabie recourt ainsi largement aux modes chromatiques et inclut dans son instrumentation un instrument rarement utilisé au cinéma, les ondes Martenot ; celle de Docteur Jivago manifeste l'influence de Borodine, use de la balalaïka et de chants populaires russes. Dans les années 1980, Maurice Jarre s'intéressera aux sons électroniques, échantillonnés et mixés avec ceux d'instruments acoustiques – comme dans Witness, qui ne nécessite que cinq exécutants –, ou aux formations traditionnelles, comme dans The Year of Living Dangerously, dans lequel figure un gamelan javanais.
Maurice Jarre a également composé des ballets (le plus connu est Notre-Dame de Paris, composé pour l'Opéra de Paris en 1964) et de la musique pour orchestre (Mouvements en relief, 1954 ; Passacaille à la mémoire d'Honegger, 1956 ; Polyphonies concertantes, pour piano, trompette, percussion et orchestre, 1959 ; Mobiles, pour violon et orchestre, 1961.Juliette Garrigues
Œuvres de concert
Trois danses pour ondes Martenot et percussion
Passacaille à la mémoire d'Arthur Honegger pour orchestre
Ronde de nuit, pour orchestre
Mobiles pour violon et orchestre
Suite ancienne pour piano et percussion
Couleurs du temps pour 5 cuivres, cordes, timbales et percussion
Le Premier Jour du printemps pour percussion
Cantate pour une démente pour voix, chœur et orchestre
Étoiles de midi
Concerto pour cordes et percussion
Polyphonies concertantes pour piano, trompette, percussion et orchestre
Concerto pour EVI et orchestre
Mouvements en relief pour orchestre
Béatitudines pour chœur
Sinfonietta
Ballets
Fâcheuse Rencontre
Le Jardin de Tinajatama
Notre-Dame de Paris
Masques de femmes
Le Poète assassiné
Winter War
Les Filles du feu
Maldoror
Divers
Loin de Rueil, comédie musicale
Ubu
Le Palais du vent violent
Armida, opéra-ballet
Giubileo pour chœur et orchestre
Ruisselle, opéra
Récompenses
Une étoile porte son nom sur la promenade de la gloire d'Hollywood.
Il a été récompensé de trois Oscars de la meilleure musique de film, chaque fois pour un film de David Lean :
1963 : Lawrence d'Arabie
1966 : Docteur Jivago
1985 : La Route des Indes
Récompensé également de quatre Golden Globes de la meilleure musique de film :
1966 : Docteur Jivago
1985 : La Route des Indes
1989 : Gorilles dans la brume
1996 : Les Vendanges de feu
autres récompenses
1985 : 7 d'or, catégorie : Meilleure musique / Meilleure musique originale, pour Au nom de tous les miens
1986 : César d'honneur
1989 : BAFTA de la meilleure musique de film pour Le Cercle des poètes disparus
1991 : Récompense « Top Box Office Films » par l'American Society of Composers, Authors, and Publishers, pour Ghost
1997 : Prix SACD, catégorie : Musique
1999 : Hommage du Festival du cinéma américain de Deauville
2005 : Prix du cinéma européen European Award d'honneur-Contribution européenne au cinéma mondial
2009 : Ours d'Or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière
Nomination pour
1963 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Lawrence d'Arabie
1964 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Les Dimanches de Ville d'Avray
1967 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Paris brûle-t-il ?
1973 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Juge et Hors-la-loi
1973 : Oscar de la meilleure chanson originale, avec Juge et Hors-la-loi (pour la chanson Marmalade, Molasses & Honey)
1976 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec L'Homme qui voulut être roi
1978 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Le Message
1986 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Witness
1986 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Witness
1987 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Mosquito Coast
1989 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Gorilles dans la brume
1991 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Ghost
Filmographie cinéma
Années 1950
1957 : Le Feu aux poudres de Henri Decoin
1959 : La Tête contre les murs de Georges Franju
1959 : Les Dragueurs de Jean-Pierre Mocky
1959 : La Bête à l'affût de Pierre Chenal
1959 : Les Étoiles de midi de Marcel Ichac
1959 : Vous n'avez rien à déclarer ? de Clément Duhour
Années 1960
1960 : Les Yeux sans visage de Georges Franju
1960 : La Main chaude de Gérard Oury
1960 : La Corde raide de Jean-Charles Dudrumet
1960 : Drame dans un miroir (Crack in the Mirror) de Richard Fleischer
1960 : Recours en grâce de László Benedek
1961 : Le Puits aux trois vérités de François Villiers
1961 : Le Président d'Henri Verneuil
1961 : Pleins feux sur l'assassin de Georges Franju
1961 : Le Grand Risque (The Big Gamble) de Richard Fleischer
1961 : Amours célèbres de Michel Boisrond
1962 : Le Soleil dans l'œil de Jacques Bourdon
1962 : Les Oliviers de la justice de James Blue
1962 : L'Oiseau de paradis de Marcel Camus
1962 : Ton ombre est la mienne d'André Michel
1962 : Thérèse Desqueyroux de Georges Franju
1962 : Le Jour le plus long (The Longest Day) de Ken Annakin, Andrew Marton, Darryl F. Zanuck et Bernhard Wicki
1962 : Les Dimanches de Ville d'Avray de Serge Bourguignon
1962 : Lawrence d'Arabie (Lawrence of Arabia) de David Lean
1963 : Un roi sans divertissement de François Leterrier
1963 : Judex de Georges Franju
1964 : Et vint le jour de la vengeance (Behold a Pale Horse) de Fred Zinnemann
1964 : Le Train (The Train) de John Frankenheimer et Bernard Farrel
1964 : Week-end à Zuydcoote de Henri Verneuil
1965 : L'Obsédé (The Collector) de William Wyler
1965 : Le Docteur Jivago (Doctor Zhivago) de David Lean
1966 : Paris brûle-t-il ? de René Clément
1966 : Les Professionnels (The Professionals) de Richard Brooks
1966 : Un hold-up extraordinaire (Gambit) de Ronald Neame
1966 : Grand Prix de John Frankenheimer
1967 : La Nuit des généraux (The Night of the Generals) d'Anatole Litvak
1967 : La Vingt-cinquième heure d'Henri Verneuil
1968 : Pancho Villa (Villa Rides) de Buzz Kulik
1968 : Cinq cartes à abattre (5 Card Stud) de Henry Hathaway
1968 : L'Homme de Kiev (The Fixer) de John Frankenheimer
1968 : Isadora de Karel Reisz
1969 : The Extraordinary Seaman de John Frankenheimer
1969 : Les Damnés (La Caduta degli dei) de Luchino Visconti
1969 : L'Étau (Topaz) d'Alfred Hitchcock
Années 1970
1970 : Las Vegas, un couple (The Only Game in Town) de George Stevens
1970 : El Condor de John Guillermin
1970 : La Fille de Ryan (Ryan's Daughter) de David Lean
1971 : Une saison en enfer (Una stagione all'inferno) de Nelo Risi
1971 : Trois soirées au Plaza (Plaza Suite) d'Arthur Hiller
1971 : Soleil rouge de Terence Young
1972 : Jeanne, papesse du diable (Pope Joan) de Michael Anderson
1972 : Juge et Hors-la-loi (The Life and Times of Judge Roy Bean) de John Huston
1972 : De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites (The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds) de Paul Newman
1973 : Le Piège (The MacKintosh Man) de John Huston
1973 : Les Noces de cendre (Ash Wednesday) de Larry Peerce
1974 : Grandeur nature de Luis García Berlanga
1974 : L'Île sur le toit du monde (The Island at the Top of the World) de Robert Stevenson
1975 : Mandingo de Richard Fleischer
1975 : La Brigade du Texas (Posse) de Kirk Douglas
1975 : Mr. Sycamore de Pancho Kohner
1975 : L'Homme qui voulut être roi (The Man Who Would Be King) de John Huston et John Foreman
1976 : Le Message (The Message / Ar Risala) de Moustapha Akkad
1976 : Parole d'homme (en) (Shout at the Devil) de Peter R. Hunt
1976 : Le Dernier nabab (The Last Tycoon) d'Elia Kazan
1977 : Crossed Swords de Richard Fleischer
1977 : Il était une fois la légion (March or Die) de Dick Richards
1978 : La Tortue sur le dos de Luc Béraud
1978 : Two Solitudes (en) de Lionel Chetwynd
1979 : Le Tambour (Die Blechtrommel) de Volker Schlöndorff
1979 : Qui a tué le président ? (Winter Kills) de William Richert
1979 : The Magician of Lublin (en) de Menahem Golan
Années 1980
1980 : The Black Marble (en) de Harold Becker
1980 : The American Success Company de William Richert
1980 : The Last Flight of Noah's Ark (en) de Charles Jarrott
1980 : Resurrection de Daniel Petrie
1981 : Le Lion du désert (Lion of the Desert) de Moustapha Akkad
1981 : Le Faussaire (Die Fälschung) de Volker Schlöndorff
1981 : Le Dernier clairon (Taps) de Harold Becker
1982 : Firefox, l'arme absolue (Firefox) de Clint Eastwood
1982 : Docteurs in love (Young Doctors in Love) de Garry Marshall
1982 : Don't Cry, It's Only Thunder (en) de Peter Werner
1982 : L'Année de tous les dangers (The Year of Living Dangerously) de Peter Weir
1983 : Au nom de tous les miens de Robert Enrico
1984 : Top Secret! de Jim Abrahams, David Zucker et Jerry Zucker
1984 : Dreamscape de Joseph Ruben
1984 : La Route des Indes (A Passage to India) de David Lean
1985 : Witness: Témoin sous surveillance (Witness) de Peter Weir
1985 : Mad Max: au-delà du dôme du tonnerre (Mad Max Beyond Thunderdome) de George Miller et George Ogilvie
1985 : La Promise (The Bride) de Franc Roddam
1985 : Enemy (Enemy Mine) de Wolfgang Petersen
1986 : Tai-Pan (en) de Daryl Duke
1986 : Mosquito Coast (The Mosquito Coast) de Peter Weir
1986 : Les Guerriers du soleil (en) (Solarbabies) d'Alan Johnson
1987 : Le Palanquin des larmes de Jacques Dorfmann
1987 : Shuto shoshitsu de Toshio Masuda
1987 : Sens unique (No Way Out) de Roger Donaldson
1987 : Liaison fatale (Fatal Attraction) d'Adrian Lyne
1987 : Julia et Julia (Giulia e Giulia) de Peter Del Monte
1987 : Gaby: A True Story de Luis Mandoki
1988 : Wildfire de Zalman King
1988 : Pleine lune sur Parador (Moon over Parador), de Paul Mazursky de Paul Mazursky
1988 : Gorilles dans la brume (Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey) de Michael Apted
1988 : Distant Thunder (en) de Rick Rosenthal
1989 : Le Ciel s'est trompé (Chances Are) d'Emile Ardolino
1989 : Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society) de Peter Weir
1989 : Prancer de John D. Hancock
1989 : Ennemies, une histoire d'amour (Enemies: A Love Story) de Paul Mazursky
Années 1990
1990 : Ghost de Jerry Zucker
1990 : Solar Crisis de Richard C. Sarafian
1990 : La Mort sera si douce (After Dark, My Sweet) de James Foley
1990 : L'Échelle de Jacob (Jacob's Ladder) d'Adrian Lyne
1990 : Un ange... ou presque (Almost an Angel) de John Cornell
1991 : Ta mère ou moi (Only the Lonely) de Chris Columbus
1991 : Cruel dilemme (en) (Fires Within) de Gillian Armstrong
1992 : Rakuyô de Rou Tomono
1992 : La Différence (School Ties) de Robert Mandel
1992 : Agaguk (Shadow of the Wolf) de Jacques Dorfmann
1993 : Mr. Jones de Mike Figgis
1993 : État second (Fearless) de Peter Weir
1995 : Les Vendanges de feu (A Walk in the Clouds) d'Alfonso Arau
1996 : The Sunchaser de Michael Cimino
1997 : Le Jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy
1999 : Sunshine d'István Szabó
Années 2000
2000 : Je rêvais de l'Afrique (en) (I Dreamed of Africa) de Hugh Hudson
Télévision
1952 : Hôtel des Invalides de Georges Franju (documentaire)
1956 : Toute la mémoire du monde d'Alain Resnais (documentaire)
1956 : Le Théâtre national populaire de Georges Franju (documentaire)
1956 : Sur le pont d'Avignon de Georges Franju (documentaire)
1957 : Le Bel indifférent de Jacques Demy (court-métrage)
1959 : Vel' d'Hiv de Guy Blanc et Frédéric Rossif (documentaire)
1960 : De fil en aiguille (TV)
1961 : Loin de Rueil (TV)
1961 : Le Temps du ghetto de Frédéric Rossif (documentaire)
1962 : Othello (TV)
1962 : Les Travestis du diable (documentaire)
1963 : Les Rustres (TV)
1963 : Les Animaux de Frédéric Rossif (documentaire)
1963 : Pour l'Espagne de Frédéric Rossif (documentaire)
1963 : Mourir à Madrid de Frédéric Rossif (documentaire)
1965 : Le Dernier matin d'Arthur Rimbaud de Jean Barral (court-métrage)
1965 : Le Dernier matin de Guy de Maupassant de Maurice Fasquel (court-métrage)
1972 : Jean Vilar, une belle vie de Jacques Rutman (documentaire)
1974 : Great Expectations (TV)
1975 : The Silence (TV)
1977 : Jésus de Nazareth (Jesus of Nazareth) (feuilleton TV)
1978 : The Users (en) (TV)
1978 : Mourning Becomes Electra (feuilleton TV)
1978 : Ishi: The Last of His Tribe (en) (TV)
Année 1980
1980 : Shogun (TV)
1980 : Shogun (feuilleton TV)
1980 : Enola Gay: The Men, the Mission, the Atomic Bomb (TV)
1981 : Vendredi ou la vie sauvage (TV)
1982 : Coming Out of the Ice (TV)
1984 : The Sky's No Limit (TV)
1984 : Samson and Delilah (TV)
1985 : Au nom de tous les miens feuilleton TV
1986 : Apology TV
1988 : Le Meurtre de Mary Phagan The Murder of Mary Phagan TV
2001 : 'Topaz': An Appreciation by Film Critic/Historian Leonard Maltin vidéo
2001 : In Love with the Desert (vidéo)
2001 : 1943 l'ultime révolte Uprising TV
Films biographiques
Bandes Originales - Maurice Jarre
     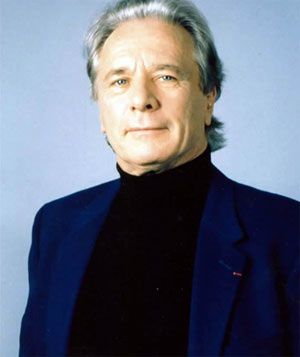 
Posté le : 13/09/2015 23:18
|
|
|
|
|
Re: Michel Eyquem de Montaigne 2 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 26014
|
Chère Loriane,
J'ai lu avec grand bonheur ce texte sur Montaigne.
Trois ouvrages occupent une place priviliégiée dans mon esprit car ils sont les livres dans lesquels je me replonge le plus : "les pensée sur moi-même" de Marc Aurèle, "les confessions" de Saint Augustin et "les Essais " de Montaigne.
Pour ma part, je trouve que Montaigne a su faire la synthèse, dans son évolution phylosophique, entre le stoïcisme, le scepticisme et l'épicurisme. je le considère comme le plus grand humaniste.
Merci pour ce texte magnifique.
Je te souhaite une magnifique semaine.
Amitiés de Bourgogne.
Jacques
Posté le : 13/09/2015 22:59
|
|
|
|
|
Michel Eyquem de Montaigne 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
L'exemplum...
Or le nombre de citations et d'exempla figurant dans les Essais et leur fréquence, notamment dans les chapitres du début, ont souvent amené les chercheurs à rapprocher l'ouvrage de Montaigne des recueils de « leçons » qui étaient à la mode à la Renaissance. Pierre Villey avait évoqué Adages et Apophtegmes d'Érasme, Lectiones antiquae de Celio Rodigino, De honesta disciplina de Pietro Crinito, Officina de Ravisius Textor, Épîtres dorées (traduction française des Epistolas familiares) de Guevara – bref, toutes ces collections d'anecdotes et de sentences où l'on repère effectivement l'origine des nombreuses histoires qui ponctuent les Essais. Il faudrait encore ajouter les Apophtegmata de Conrad Lycosthenes (dont Étienne Ithurria a retrouvé un exemplaire couvert d'annotations qui pourraient être de la main du futur auteur des Essais) et le Theatrum vitae humanae, ouvrage encyclopédique du médecin et philosophe bâlois Theodor Zwinger, qui se situe toutefois bien au-dessus d'une simple compilation. C'est là le cadre culturel où les Essais viennent prendre place, tout en le dépassant. Les matériaux de Montaigne en effet ne sont pas toujours de première main, il prend son bien où il le trouve : « Et moi ai pris des lieux assez ailleurs qu'en leur source. » Si les citations, poétiques ou en prose, qui émaillent sa page, viennent directement de ses auteurs préférés, pour les exemples, les « lieux » dits communs, c'est-à-dire la topique du savoir anthropologique transmise de l'Ad Herennium à Érasme, il est certain qu'il a souvent recours à ces collectes préparées dès l'Antiquité à l'usage de l'éducation rhétorique et de l'édification morale. Il peut même arriver parfois de remarquer une structure similaire entre quelques chapitres de Montaigne et certaines sections de tel ou tel recueil de leçons.
Cela n'entraîne pas cependant une filiation directe des Essais avec ces compilations dont le XVIe siècle était gourmand. Quelque chose change sous la plume de Montaigne : il y a d'abord le travail du jugement, qui opère la mise en œuvre des matériaux rassemblés et la greffe de l'analyse critique sur le tissu de la compilation. Mais l'extraordinaire nouveauté de l'œuvre réside surtout dans les métamorphoses par lesquelles ce texte transmue les modèles culturels de l' humanisme en une écriture de la subjectivité. Certes, Montaigne semble se laisser guider par des concepts ; mais aucun texte, même le plus spéculatif, n'est issu simplement d'un itinéraire mental au pays abstrait des idées. À la base, il y a toujours une expérience, concrète ou fantasmatique. Nous sommes là au cœur du grand débat autour des concepts de raison et d'expérience, et de son écho dans la littérature morale du XVIe siècle. Les exempla représentent justement les occasions où se vérifie et se diversifie l'expérience, sur laquelle seule peut se fonder le raisonnement. Or l'expérience de tout ce qu'on ne peut pas vivre directement, c'est précisément à travers les lectures qu'on la fait. La lecture est avant tout un apprentissage de soi.
Mais comment se trouver soi-même si ce n'est en s'identifiant à l'agent d'une action ou au sujet d'un acte moral, bref au personnage d'un récit ? Les « exemples » ne répondent pas chez Montaigne au besoin de composer une mosaïque des variétés et des contradictions de la nature humaine en général, intention habituelle des compilateurs. Il ne les choisit pas au hasard : « Je remarque plus volontiers les exemples qui me touchent. » Ces anecdotes signifient que le sujet est directement concerné par les attitudes qu'il observe chez ses semblables et qu'il enregistre comme autant de témoignages de dispositions qu'il reconnaît en lui-même, ou au contraire de tendances qui lui sont étrangères. Qu'il réfléchisse ainsi à la diversité et aux incohérences de notre nature, c'est d'une certaine façon secondaire. Le point principal est la question qui perce sous chaque exemple : que ferais-je, moi Michel de Montaigne, dans des circonstances analogues ? Interrogation qui résume, à la limite, toute l'entreprise des Essais : « s'essayer », c'est aussi se mettre dans la peau des autres (« Je m'insinue, par imagination, fort bien en leur place »), c'est essayer de vivre, par l'entremise d'autrui, toutes les expériences qu'on ne peut vivre dans son quotidien, c'est élargir sa vie réelle par les directions infinies de ses vies possibles. Celui qui a renoncé à être toujours un seul et même homme trouve dans les protagonistes des exempla le moyen d'être plusieurs personnes.
Montaigne, tout près d'être un romancier, doué d'un mimétisme imaginaire ? En un certain sens, pourquoi pas ? Les Essais ne reproduiraient-ils pas le dessein d'un roman de chevalerie, ce qui n'aurait rien d'extraordinaire dans la culture de l'auteur ? Le chevalier devenait lui-même, à travers une suite de mises à l'épreuve : il en va de même pour l'auteur dans la lice de l'esprit. Pour ce probabiliste pyrrhonien, les expériences fictives comptent autant que les réelles, et les « témoignages fabuleux » ont la même valeur et la même utilité que les « vrais » : « Avenu ou non avenu, à Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, c'est toujours un tour de l'humaine capacité duquel je suis utilement avisé par ce récit. » Les personnages évoqués sont en somme les ego expérimentaux à travers lesquels l'écrivain examine quelques grands thèmes qui le hantent. Il y a dans son livre comme une mise en fiction du fonds de boutique des moralistes.
...et le fantasme
Le sens latent du choix des anecdotes n'est pas toujours délivré clairement dans le texte. Au contraire, la plupart des exemples peuvent paraître parfaitement opaques : d'où l'indifférence de la critique à l'égard des chapitres les plus anciens, considérés à peu près comme des assemblages bruts d'exempla et classés comme « impersonnels ». Alors qu'à la limite plus les exemples semblent difficiles à déchiffrer, plus ils sont susceptibles de révéler le sens profond qui travaille le sujet, et qui échappe au travail de son jugement. Il importe de se demander ce que ces exemples impliquent tacitement, de s'interroger sur le non-dit qui enveloppe l'anecdote citée, pour comprendre que peut-être l'écrivain découvre, en citant, beaucoup plus et autre chose qu'il ne croit ; l'accent est mis non sur un fait illustrant un certain comportement, mais sur le fait que ce comportement est un miroir où le sujet se regarde, parfois sans s'en douter. Lorsque, par exemple, Montaigne disserte « Du parler prompt ou tardif », derrière l'argumentation concernant l'éloquence et les dons nécessaires aux prêcheurs et aux avocats, apparaît le problème du sujet scripteur : l'obsession de rester muet, révélée par l'exemple d'un malheureux avocat qui fut incapable de prononcer la harangue dont il avait été chargé. Le roi égyptien Psammenitus, le cardinal de Lorraine et les autres personnages hébétés par la douleur et incapables de l'exprimer qui défilent dans le chapitre « De la tristesse » représentent eux aussi une peur de l'écrivain : le cauchemar de la parole inhibée. Car le langage est tout ce que nous avons pour faire obstacle à la mort, au silence, au vide (les Essais sont en ce sens une entreprise vitale, au sens littéral du terme). C'est ensuite la hantise de la survivance du cadavre qui nous est donnée à lire dans « Nos affections s'emportent au-delà de nous », où par ailleurs Montaigne reconnaît son propre problème dans la pudeur obsessionnelle de l'empereur Maximilien ; au niveau de la première rédaction, l'exemplum dit ce que Montaigne n'avouera que dans un ajout postérieur : « Moi, qui ai la bouche si effrontée, suis pourtant par complexion touché de cette honte [...]. J'y souffre plus de contrainte, que je n'estime bienséant à un homme, et sur tout, à un homme de ma profession. » Dans le chapitre « De la constance », le marquis Del Guasto et Laurent de Médicis, qui se sauvèrent de canonnades en s'accroupissant, sont dans une certaine mesure les interprètes du dialogue que le moi prudent et craintif de Montaigne engage avec son sur-moi héroïque, en se demandant implicitement ce qu'il ferait, lui, sous le feu des canonnades. Et ainsi de suite...
Masque ou miroir du sujet, l'anecdote est en quelque sorte le lieu où s'inscrit le fantasme du scripteur. Si Montaigne emprunte les tracés des recueils de leçons, c'est pour se poser des questions sur lui-même. C'est ainsi qu'il se met en jeu en tant que sujet de l'écriture : ses lectures donnent corps aux « chimères et monstres fantasques » engendrés par son esprit, dans lesquels il n'est sans doute pas abusif de reconnaître précisément les fantasmes de son inconscient. De toute façon, l'écriture suit d'autres cheminements que ceux de la logique. Ce qui guide l'écrivain n'est pas le souci de construire un texte plus ou moins bien agencé, d'obéir à un parcours conceptuel plus ou moins rigoureux, mais d'articuler de façon à peu près cohérente un propos dont l'origine est cependant émotionnelle. Pascal tenait pour les deux principaux défauts de Montaigne « qu'il faisait trop d'histoires » et « qu'il parlait trop de soi ». Mais l'auteur des Pensées ne savait pas que ces deux défauts n'en font qu'un : la tendance de Montaigne à multiplier les anecdotes est encore une façon de parler de soi. Cette utilisation de l'exemplum forme précisément la charnière entre le genre des leçons et l'écriture de la subjectivité telle qu'elle s'élabore dans les Essais : dans l'exemplum, le sujet se trouve et l'écriture devient engendrement de soi. C'est dans ce sens que Montaigne parvient à « ne faire montre que du [sien] » tout en utilisant le discours des autres, le discours de l'encyclopédie de la Renaissance.
Les lieux d'ancrage les plus profonds de la subjectivité se situent ainsi dans les parties dites « impersonnelles ». Montaigne ne parle pas directement des « monstres » qui l'obsèdent. Un certain nombre de passages dans les Essais montrent qu'il perçoit et indique l'existence du continent immergé de l'inconscient, mais il n'en fait pas l'objet de son propos. Il n'aime pas ces forces qui échappent au contrôle de sa raison. Ce qui le dépossède de lui-même, il n'en parle que peu. Le texte primitif – celui des deux premiers livres, parus en 1580 – est donc le plus souvent contracté, secret, énigmatique : Montaigne cherche à résister à ses pulsions, aux fantasmes qui le hantent, sans parvenir tout à fait à les maîtriser.
Le livre en devenir
Les additions ultérieures changent l'aspect du livre. Une force obscure fait saigner à nouveau les blessures non cicatrisées. Au-delà de l'intention de « représenter le progrès de [ses] humeurs », de la tension vers une adhérence maximale du « je » à la page, au-delà aussi de cette pratique d'écriture réflexive qui fonde la structure même de l'essai, quelque chose pousse Montaigne à revenir sans cesse sur son texte, à intervenir à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Les nouveaux exemples que l'écrivain ajoute et qui n'apportent parfois aucun élément nouveau signifient qu'en se relisant il se trouve aux prises avec un problème non réglé : s'il revient ainsi sur le point névralgique de sa première rédaction, ce n'est pas pour enrichir un répertoire d'anecdotes, mais pour continuer, à travers ces anecdotes, à répertorier – inconsciemment – ses fantasmes. En outre, les informations d'ordre confidentiel introduites au fur et à mesure, les fragments de description de soi, au physique et au moral, et de ses modes de vie semblent souvent autant d'aveux qui explicitent la première personne implicite dans la version précédente, en indiquant que le sujet est effectivement engagé dans ce qu'il avait d'abord relaté sur le mode du récit impersonnel. Ces insertions tendent parfois à nier la sujétion du « je » à une « passion » aliénante (dont les effets dévastateurs avaient été décrits à l'aide des exemples), ou à souligner l'effort accompli pour la dominer en la soumettant au contrôle de la raison, ou encore à se reconnaître victime des mêmes contraintes que les personnages dont il avait été question dans la première version. Mouvement de frayeur qui se masque en geste de bravoure, réaction crispée pour se rassurer dans sa normalité, aveu de faiblesse, l'ajout explicite en tout cas ce que taisait la première rédaction. En somme, lorsqu'il revient sur le déjà-écrit, Montaigne laisse parfois s'y glisser ce qu'il avait tenté d'abord de repousser : dans le dialogue du texte, de l'exemplum à la confidence, l'énigme du sujet se donne à lire désormais. De cette façon, les histoires racontées se chargent de la densité trouble de l'expérience personnelle de l'écrivain. Mais en même temps le « je » qui reconnaît sa défaillance désamorce la charge de trouble et de détresse qui se condensait dans le non-dit de la première version. Les réflexions d'ordre philosophique qui se développent dans le texte peuvent aussi avoir pour rôle, dans certains cas, de diluer l'angoisse, de noyer les « monstres » du sujet dans la mer de la condition humaine.
Quant au troisième livre, entièrement nouveau, avec ses treize « grands » chapitres, on dirait que les nœuds s'y défont. L'écrivain a en quelque sorte domestiqué ses monstres, il a appris à vivre avec, il s'est sauvé – il continue à se sauver – par l'écriture. Les Essais sont devenus un livre différent, celui que tout le monde lit : plus coulant, plus discursif et inventif, splendide, où Montaigne s'affirme comme un arpenteur lucide du chemin qui conduit au plus profond de soi, où il semble poursuivre dans ses phrases labyrinthiques les sinuosités de la nature humaine. Mais où il efface peut-être – et naturellement sans s'en rendre compte – ce qui lui tient trop à cœur. Ce livre inattendu, si étrange et si dérangeant, qui s'emploie à secouer les entraves des préjugés et à dérégler patiemment les oppositions fondatrices de nos cadres de pensée est en même temps le discours d'un « je » qui essaie de dominer les forces obscures : non pas pour imposer un individu sans faille, mais pour assurer l'emprise de la raison sur les ténèbres. De ce point de vue, le « je » est un garde-fou : il est le moyen de conserver, en toutes circonstances, son quant-à-soi critique, un regard froid, une position légèrement surplombante, en évitant l'immersion dans le pays inconnu. Ce « je » qui n'est sans doute jamais identique à lui-même, qui varie selon les circonstances de la vie et du discours, garde toujours sa prérogative essentielle, celle du jugement, et son rôle de sentinelle aux frontières de l'inconnaissable.
Les « allongeails » en somme – additions aux deux premiers livres, totalité du troisième, et interventions des dernières années sur l'ensemble – permettent au sujet, en s'exprimant à la première personne, de se démarquer des attitudes dont il a parlé de façon « impersonnelle », qu'il a illustrées à l'aide d'exemples, et où est enfoui son secret. Ici, le « je » du texte ne coïncide donc pas avec le sujet de l'écrivain. Il représente le moyen qu'a l'auteur de s'approprier l'ensemble de la réalité, d'intérioriser les choses conformément à sa nature et à son histoire. Mais c'est aussi en même temps ce qui l'arrête au seuil de l'analyse introspective : les interventions déchiffrent souvent le non-dit, mais ne sauraient lever tous les interdits.
Là où le « je » n'intervient pas, le trou noir est intact. Certains chapitres, ou certains passages restent opaques, véritables lieux de l'obscur : car il n'est pas permis de franchir la frontière de l'inconnu, il est défendu de lever certains masques. Les longs exercices de lucidité n'amènent qu'à prendre conscience de l'existence du trou noir, qui reste indescriptible. Tout ce qui est dans le trou est le partage du « il » (cet « il » qui recouvre le « ça » des psychanalystes), tandis que le rôle du « je » est l'observation, le jugement, le regard froid, parfois la distance ironique ou l'humour complaisant. L'écriture des Essais vit de ce balancement entre le « il » et le « je », et son enjeu est bien dans cette stratégie protectrice par laquelle « je » négocie le lieu de son énonciation.
Ce processus n'a en soi rien d'étonnant. La « personne » est dans l'écriture ce qui nous protège de nous-mêmes, le barrage qui nous sauve du vertige de l'abandon : c'est l'autodéfense du sujet contre les puissances qui surgissent des ténèbres. Elle seule empêche que l'écriture ne renverse les digues. Alors que le personnage de roman, qui est la « non-personne » (dans la terminologie de Benveniste), est ce qui donne la possibilité de se dire en dehors de la censure sociale et surtout de l'autocensure du sujet lui-même qui revendique son droit au secret. La fiction – plusieurs l'ont dit – permet de s'exprimer beaucoup plus librement que l'autobiographie ou les différentes formes de ce qu'on appelle « écriture du moi », où le sujet scripteur qui s'expose au premier plan exerce naturellement sa vigilance : le « je » signifie précisément la pleine présence à soi dans l'acte d'écrire. C'est bien une manière de fiction qui permet au Montaigne inconnu de se glisser malgré lui dans les Essais : l'exemplum est le passage par lequel l'« autre » s'introduit. Les anecdotes s'accumulent dans le texte, qui devient ainsi une galerie des glaces où se multiplient, dans les attitudes les plus imprévues, les images incontrôlées du sujet. Et le rôle du « je » est de raisonner sur les exemples afin de se raisonner, d'être le maître du sens qui, en niant la production du sens, empêche la dérive de l'écriture. Cas peut-être unique, les Essais sont un livre ainsi construit où l'on assiste tout à la fois au défilé des fantasmes et à l'émergence du « je », à son affirmation progressive sur l'irrationnel. Et cela grâce à l'intuition et à la décision fondamentale de Montaigne, de faire en sorte que son livre fût « toujours un », sans rien désavouer des rédactions primitives : « J'ajoute, mais je ne corrige pas. » Entre la mise en fiction et la mise en « je », entre l'impersonnel libérateur et la personne masquée, se joue la vie du « livre du sujet ». Fausta Garavini
Dernières années
Montaigne, mûri par ses expériences multiples, s’est remis à la rédaction des Essais, et commence le livre III dont la sensibilité s’est singulièrement enrichie. Mais la situation s’aggrave et la guerre est à sa porte (Henri III vient de s’allier avec Henri de Guise, chef de la Ligue, contre Henri de Navarre déclenchant la huitième guerre civile). En juillet 1586, l’armée royale met le siège, avec vingt mille hommes, devant Castillon défendu par Turenne, à huit kilomètres du château de Montaigne : « J’avais d’une part les ennemis à ma porte, d’autre part les maraudeurs, ennemis pires. » Il n’a pas répondu à l’appel convoquant la noblesse à combattre dans l’armée royale. Son abstention le rend suspect aux deux partis : « Je fus étrillé par toutes les mains : pour le Gibelin, j’étais Guelfe, pour le Guelfe, Gibelin. ». La peste fait son apparition en août et gagne toute la région. Le 1er septembre, Castillon tombe. Pour fuir la peste, Montaigne abandonne son château avec sa mère, sa femme et sa fille dans des chariots. Pendant six mois, il va errer, mal accueilli par les amis à qui il demande refuge, « ayant à changer de demeure aussitôt que quelqu’un de la troupe venait à souffrir du bout du doigt47 ». Il rentre chez lui en mars 1587 pour retrouver son domaine dévasté par la guerre et la peste. « Cet écroulement me stimula assurément plus qu’il ne m’atterra. (…) Je me résigne un peu trop facilement aux malheurs qui me frappent personnellement, et, pour me plaindre à moi, je considère non pas tant ce que l’on m’enlève que ce qui me reste. » Turenne reprend Castillon en avril. Le 23 octobre, Henri de Navarre, après sa victoire de Coutras arrive au château de Montaigne et y séjourne deux jours (pour solliciter ses conseils ?).
Montaigne embastillé 10 juillet 1588.
Note prise par Montaigne sur son Ephemeris historica à la fois mémento historique et agenda.
En janvier 1588, à 55 ans, Montaigne part à Paris pour faire imprimer son livre, chargé aussi par le roi de Navarre et le maréchal de Matignon (Son fils aîné accompagne Montaigne) d’une négociation avec Henri III. Le voyage est mouvementé. Arrêté, dévalisé par une troupe de protestants près d’Angoulême, il est relâché sur l’intervention du prince de Condé. Il arrive à Paris le 18 février. Les ambassadeurs anglais et espagnols, qui connaissent ses liens avec Henri de Navarre, le soupçonnent d’être chargé d’une mission secrète auprès du roi (une alliance militaire contre la Ligue ?). On n’en sait pas plus, Montaigne ayant toujours gardé le silence sur ses activités de négociateur. En mai, toujours à Paris (il doit surveiller l’impression des Essais de 1588), il assiste à la journée des Barricades qui accompagne l’entrée triomphante d’Henri de Guise. Le roi s’enfuit. Montaigne le suit. De retour à Paris en juillet, les autorités de la Ligue le font enfermer à la Bastille. La reine mère doit intervenir auprès du duc de Guise pour le faire libérer.
C’est à Paris qu’il rencontre Marie de Gournay (1565-1645), jeune fille de vingt-deux ans, admiratrice passionnée, à qui il propose de devenir sa « fille d’alliance » et qui, après la mort de Montaigne, consacrera sa vie et sa fortune à assurer jusqu’à onze éditions posthumes des Essais. Montaigne va la visiter à Gournay-sur-Aronde et y séjourne à plusieurs reprises. Marie de Gournay transmettra aux philosophes érudits du xviie siècle l'évêque Pierre-Daniel Huet ou La Mothe Le Vayer l'héritage dit « sceptique » de Montaigne ainsi que des livres hérités de son père d'élection.
En octobre ou en novembre 1588, il est à Blois où doivent se tenir les états généraux. Y est-il encore lors de l’assassinat des Guise le 23 décembre 1588 ou est-il de retour dans son château ? Jusqu’à l’été 1590, il va se rendre encore à Bordeaux pour aider Matignon à maintenir la ville dans l’obéissance au nouveau roi Henri IV (Henri III, assassiné le 1er août 1589 par un moine ligueur, a publiquement déclaré Henri de Navarre son successeur). Puis jusqu’à sa mort en 1592 il va demeurer dans son château, perfectionnant, complétant les Essais en vue d’une sixième édition : « Qui ne voit que j’ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans peine, j’irai autant qu’il y aura d’encre et de papier au monde? »
Mort de Montaigne
Les idées de Montaigne sur la mort ont évolué depuis 1572 quand il pensait, en stoïcien, que la grande affaire de l’homme est de se préparer à bien mourir. Il pense maintenant en épicurien qu’il faut suivre la nature : « Nous troublons la vie par le souci de la mort (…) Je ne vis jamais un paysan de mes voisins réfléchir pour savoir dans quelle attitude et avec quelle assurance il passerait cette heure dernière. La Nature lui apprend à ne songer à la mort que lorsqu’il est en train de mourir. » La mort est « une chose trop momentanée » : « Un quart d’heure de souffrance passive sans conséquence, sans dommage, ne mérite pas des préceptes particuliers. » « La mort est bien le bout, non pas le but de la vie ; la vie doit être pour elle-même son but, son dessein. » Et les Essais s’achèvent sur une invitation au bonheur de vivre : « C’est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. Nous cherchons d’autres manières d’être parce que nous ne comprenons pas l’usage des nôtres, et nous sortons hors de nous parce que nous ne savons pas quel temps il y fait. De même est-il pour nous inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses il faut encore marcher avec nos jambes. Et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. »
Montaigne meurt dans son château le 13 septembre 1592, à 59 ans. Nous n’avons aucun témoignage direct de sa mort, mais trois lettres d’amis qui n’ont pas assisté à ses derniers moments : deux de Pierre de Brach, datées d’octobre 1592 et février 1593, ne donnant pas d’informations précises et parlant d’une mort « prise avec douceur » ajoutant : « Après avoir heureusement vécu, il est heureusement mort. » et une d’Étienne Pasquier écrite vingt-sept ans plus tard, en 1619, plus détaillée, parlant d’une « esquinancie » (tumeur de la gorge) qui l’empêcha de parler durant ses trois derniers jours. Pasquier rapporte que Montaigne fit convoquer par écrit dans sa chambre sa femme et quelques gentilshommes du voisinage et que, pendant qu’on disait la messe en leur présence, il rendit l’âme au moment de l’élévation.
Selon son vœu, sa veuve le fait transporter à Bordeaux en l’église des Feuillants où il est inhumé. Son cœur est resté dans l'église de Saint-Michel de Montaigne. Lors de la démolition du couvent des Feuillants, ses cendres sont transportées au dépositoire du cimetière de la Chartreuse. Un an après son décès, son épouse commande aux sculpteurs Prieur et Guillermain un cénotaphe monumental couvert par le gisant de Montaigne en armure, le heaume derrière la tête, un lion couché à ses pieds. En 1886, ce cénotaphe est transféré en grande pompe dans le grand vestibule de la faculté des lettres de Bordeaux, devenue à présent le Musée d'Aquitaine. Le monument a été depuis transféré dans une autre salle du musée. Les cendres du philosophe, mélées à celles des Dominicains des Feuillants, sont enfouies dans les murs du sous-sol du Musée d'Aquitaine.
Son œuvre Le style de Montaigne
La « librairie » où écrivait Montaigne, dans sa tour. Sur les poutres, les maximes lui rappellent les principes essentiels.
Montaigne choisit le français alors que les ouvrages philosophiques ou scientifiques sont écrits en latin et que le français, consacré comme langue administrative en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, est en pleine évolution : « J’écris mon livre pour peu d’hommes et pour peu d’années. Si cela avait été une matière destinée à durer, il aurait fallu la confier à une langue plus stable. D’après la variation continuelle qui a accompagné la nôtre jusqu’à l’heure actuelle, qui peut espérer que sa forme actuelle sera en usage dans cinquante ans d’ici ? Depuis que je vis elle a changé pour la moitié. »
Son style s’est développé en même temps que sa pensée. Les premiers essais de 1580 laissent voir une certaine raideur. N’ayant pas de sujet personnel, Montaigne n’a pas non plus de forme qui soit sienne. Il cherche alors à imiter le style de Sénèque. Quand il conçoit le dessein de se peindre, il trouve son accent personnel. Pour l’analyse et pour la confidence il faut s’assouplir et se détendre. Il adopte l’allure de la causerie familière. Il a pris conscience de ce qu’il voulait faire, mais aussi de la manière de le faire. Son style arrive à la perfection dans les Essais de 1588 (Livre III).
Montaigne écrit son livre comme il parle : « Le langage que j’aime, c’est un langage simple et naturel, tel sur le papier qu’à la bouche. » Il virevolte d'une pensée à l'autre. Pas de plan. Aucune rigueur dans l’ordonnance d’ensemble, ni dans la composition de chaque chapitre : « J’aime l’allure poétique, par sauts et gambades (…) Je m’égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes idées se suivent, mais parfois c’est de loin, et se regardent, mais d’une vue oblique (…) Les noms de mes chapitres n’en embrassent pas toujours la matière (…) Mon style et mon esprit vagabondent l’un comme l’autre. Il faut avoir un peu de folie si l’on ne veut pas avoir plus de sottise. »
Ce qui caractérise son style, en même temps que le naturel et la simplicité, c’est une grande intensité d’expression. Montaigne veut une langue simple mais aussi expressive : « Ah ! si j’avais pu ne me servir que des mots qui sont employés aux halles de Paris » Sa langue abonde en emprunts au langage populaire (comme Rabelais qu’il lit avec plaisir). L’emploi de comparaisons et d’images prises souvent dans les faits de la vie quotidienne et les objets les plus familiers lui permet de concrétiser sa pensée et de nuancer des sentiments et des impressions qu’il est difficile d’exprimer par des mots. « Dans l’habitude et la continuité de son style, écrit Sainte-Beuve, Montaigne est l’écrivain le plus riche en comparaisons vives, hardies, le plus naturellement fertile en métaphores, lesquelles chez lui ne se séparent jamais de la pensée, mais la prennent par le milieu, par le dedans, la joignent et l’étreignent… Ce style dont on peut dire qu’il est une épigramme continue, une métaphore toujours renaissante, n’a été employé chez nous avec succès qu’une seule fois, et c’est sous la plume de Montaigne. »
Montaigne n’arrive pas sans travail à ce style si original. Il revoit inlassablement ses Essais pendant les quatre dernières années de sa vie. Les nombreuses corrections concernant le style ou le vocabulaire que l’on relève sur l’Exemplaire de Bordeaux, resté sur sa table de travail après sa mort, témoignent d’un idéal d’art très élevé et d’une extrême rigueur envers soi-même: « Mes ouvrages à moi, il s’en faut tellement qu’ils me plaisent qu’au contraire autant de fois que je les réexamine autant de fois je suis par eux déçu et chagriné. J’ai toujours dans l’esprit une meilleure forme que celle que j’ai mise en œuvre, mais je ne peux pas la saisir et l’expliciter. »
On peut s’étonner de voir Montaigne multiplier les citations latines (plus de 1300 !) pour orner et embellir ses réflexions, dans un livre aussi personnel, où il n’a d’autre objet que de se peindre. Il en est conscient : « Nos pédants ne cessent de grappiller la science dans les livres (…) Il est étonnant de voir comme cette sottise trouve exactement place chez moi. Je ne cesse d’écornifler par-ci, par-là, dans les livres, les pensées qui me plaisent (…) pour les transporter dans celui-ci où, à vrai dire, elles ne sont pas plus miennes qu’en leur première place. ». Il explique avoir cédé au goût de ses contemporains. Tout ce qui vient de l'Antiquité jouit alors d'une vogue considérable, un homme instruit doit faire des citations pour prouver son érudition : « J’ai concédé à l’opinion publique que ces ornements empruntés m’accompagnent ; mais je ne veux pas qu’ils me recouvrent et qu’ils me cachent : c’est là le contraire de mon dessein, qui ne veut exposer que ce qui est mien, et ce qui est mien par nature ; et si je m’étais cru à ce sujet, j’aurais, à tout hasard, parlé absolument seul. Je me charge tous les jours plus fortement d’emprunts, au-delà de mon dessein et de ma forme première, pour suivre la fantaisie du siècle et les exhortations d’autrui. Si cela ne me convient pas à moi, comme je le crois, peu importe ; cela peut être utile à quelque autre. »
Montaigne, qui subit l'influence du milieu littéraire, a pleinement partagé ce goût général mais il va faire une œuvre profondément originale : « Si le grand public lit encore aujourd'hui Les Essais, écrit Michel Magnien, c'est que leur auteur a su s'arracher à cette fascination pour la culture livresque qui empèse et alourdit tous les beaux esprits d'alors. Ils furent légion, mais leurs œuvres croupissent, désormais inutiles, au fond des bibliothèques. Franc-tireur de l'Humanisme, Montaigne ne se trouve jamais là où on l'attend. À la différence de ses confrères en « parlerie », il est le premier sur la brèche à combattre, auprès des gens de cour et de guerre, la culture livresque lorsqu'elle conduit au pédantisme et au dessèchement de l'être. » Et toujours, ajoute Pierre Villey, il leur oppose « sa méthode à lui, celle dont il se sent maître et qu'il pense posséder presque seul à l'époque : je veux dire l'expression franche et libre d'une pensée personnelle, qui s'éclaire sans doute par les idées des anciens, mais qui est originale néanmoins ».
La philosophie de Montaigne
Le scepticisme représente un moment important de l'évolution de Montaigne. La devise qu'il fait graver sur une médaille en 1576 « Que-sais-je ? » signifie la volonté de rester en doute pour rechercher la vérité. La balance dont les plateaux sont en équilibre, la difficulté de juger.
« La philosophie est la science qui nous apprend à vivre. » dit Montaigne. Il entend par philosophie le mouvement de la pensée vivante quand elle se confronte à l’essentiel (la mort, l’amour, l’amitié, l’éducation des enfants, la solitude, l’expérience…) et à soi. C’est pour lui l’apprentissage de la sagesse : philosopher c’est vivre heureusement, ou le plus heureusement possible. C’est « une très douce médecine que la philosophie, car des autres on n’en sent le plaisir qu’après la guérison, celle-ci plaît et guérit ensemble (…) On a grand tort de la peindre comme inaccessible aux enfants et avec un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Il n’est rien de plus gai, de plus allègre et peu s’en faut que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps.»
La philosophie de Montaigne, qui s’exprime le plus nettement dans les derniers essais à partir de 1588 et du livre III, est l’aboutissement de ses expériences (magistratures, guerres civiles, maladie, voyages) et de ses lectures philosophiques (systèmes qui l’ont influencé et modèles auxquels il a cherché à s’identifier : Caton, Épaminondas, Socrate enfin). Son évolution a été conforme à celle de la Renaissance elle-même, dit Pierre Villey, qui a commencé par répéter les leçons de l’Antiquité avant de produire des œuvres originales.
L'évolution de sa pensée.
Dans les premiers essais, Montaigne s’enthousiasme, comme beaucoup d’humanistes de son époque, pour le stoïcisme (celui des Lettres à Lucilius de Sénèque en particulier) : la raison bien préparée est toute puissante et la volonté suffit à supporter tous les malheurs. En 1572 il écrit un essai pour prouver « que le goût des biens et des maux dépend de l’opinion que nous en avons (I, 14) ». Dans l’essai Que philosopher c’est apprendre à mourir (I, 20) de même tonalité, il emprunte la fin à Lucrèce (De la nature des choses) et à l’épicurisme. Mais dès qu’il commence à s’étudier lui-même et qu’il découvre ses vrais besoins et sa nature, il sent que les remèdes de Sénèque sont trop violents pour lui et il va s’en éloigner peu à peu : « À quoi nous sert cette curiosité qui consiste à imaginer à l’avance tous les malheurs de la nature humaine et de nous préparer avec tant de peine à l’encontre de ceux mêmes qui peut-être ne sont pas destinés à nous atteindre ? C’est non seulement le coup, mais le vent et le bruit qui nous frappent (…) Au contraire, le plus facile et le plus naturel serait d’en délivrer même sa pensée? « Il est certain qu’à la plupart des savants la préparation à la mort a donné plus de tourment que n’a fait la souffrance même de la mort. »
Plutarque (Vies parallèles des hommes illustres, Œuvres morales), dont l’influence sur Montaigne est considérable (plus de 400 emprunts dans les Essais), l’aide à se montrer de plus en plus réservé à l’égard de ceux qui croient posséder la vérité absolue et incontestable. Le moraliste grec (traduit par Amyot en 1572) observateur de la vie courante, oriente sa pensée dans le sens de la complexité psychologique et de l’analyse intérieure. Sous son influence Montaigne va mêler de plus en plus la réflexion personnelle à ses Essais et développer son goût pour une morale familière, simple et pratique. Vers 1576, à la lecture du sceptique grec Sextus Empiricus (Esquisses pyrrhoniennes), Montaigne adopte comme mode de pensée le scepticisme qui représente un moment important de son évolution et un aspect définitif de sa sagesse : une grande circonspection dans le jugement et une extrême prudence à se défendre des préjugés qui envahissent l’esprit de l’homme, du seul fait qu’il appartient à une époque, à un milieu, qu’il est pris dans un engrenage d’habitudes et d’idées. Il en expose la doctrine dans son essai Apologie de Sebond qui est un véritable livre à lui tout seul (trois fois plus long que le plus long de ses essais). Enfin, à travers Platon et Xénophon, il a accès à Socrate, « le maître des maîtres», dont la personnalité domine le livre III.
Souffrant de la gravelle depuis 1578, il a du mal à supporter la douleur : « Je suis éprouvé un peu trop rudement pour un apprenti et par un changement bien soudain et bien rude, étant tombé tout à coup d’une condition de vie très douce et très heureuse dans la plus douloureuse et la plus pénible qui puisse s’imaginer. ». Il voit la mort tout près de lui. Il a là une ample matière à observations. Il se sent en possession d’idées bien siennes, originales. Il se jugera lui-même dans le chapitre Sur la présomption, et se reconnaitra un seul mérite celui d’avoir un jugement bon: « je pense avoir des opinions bonnes et saines (mais qui n’en croit pas autant des siennes ?) : l’une des meilleures preuves que j’en aie, c’est le peu d’estime que j’ai de moi ». Plus encore que ses idées, écrit Pierre Villey,il a une manière critique qui le distingue parmi ses contemporains : « il a le sentiment que tout est relatif, il sait qu’il ne faut pas affirmer trop vite, que les choses ont bien des faces, qu’il faut tourner autour et les examiner sous bien des aspects avant de prononcer un jugement … Il sait que ses idées sont relatives à lui-même, qu’elles n’ont pas l’ambition de régenter les autres, qu’elles présentent au public non ce qu’il faut croire, mais ce que croit Montaigne, qu’elles ne sont que la peintures de ses humeurs: « Les autres façonnent l’homme ; moi je le raconte, et je peins un homme particulier bien mal formé. »
La sagesse de Montaigne
Il aboutit ainsi peu à peu à une philosophie très personnelle qui est l’expression de sa personnalité bien qu’elle soit faite de pièces empruntées à la grande philosophie grecque dont il se sent si proche. « Ne cherchez pas quelque principe logique qui en cimente les différentes parties et bâtisse un système, dit Pierre Villey Il n’y a pas de système chez Montaigne. Le seul lien qui unisse entre elles toutes ses idées, c’est sa personne, ce sont ses goûts, ses besoins, ses habitudes, qui tous s’expriment par elles.
L’épicurisme de Montaigne ne fera que s’accentuer avec le temps (« Il faut étendre la joie, mais retrancher autant qu’on peut la tristesse. »), mais il reste un philosophe sceptique et n’arrive pas à croire que les autres aient pu se fier totalement à leurs propres conceptions : « Je ne me persuade pas aisément qu’Épicure, Platon et Pythagore nous aient donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leurs nombres. Ils étaient trop sages pour établir leurs articles de foi sur une chose aussi incertaine et contestable. »
La sagesse de Montaigne est une sagesse pour les gens ordinaires. « Qui ne se sent plus proche de Montaigne que de Socrate et d’Epicure, ou qui ne sent Montaigne plus proche de soi, tellement plus proche, tellement plus fraternel, oui, bouleversant de fraternelle proximité, plus intime que tout autre, plus éclairant, plus utile, plus vrai ? Montaigne accepte de n’être pas un sage, et c’est la seule sagesse peut-être qui ne mente pas, la seule, en tout cas, que nous puissions viser, nous, sans mentir ni rêver. Est-ce encore une sagesse ? Ceux qui ont lu les Essais savent bien que oui, et que c’est la plus humaine, la plus merveilleusement humaine (…) Montaigne est un maître, aussi grand que les plus grands, et plus accessible que la plupart. »
Il nous apprend à suivre la nature :
« La nature a maternellement observé ce principe que les actions qu’elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent très agréables également, et elle nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par le désir : c’est une injustice de détériorer ses règles. »
à savoir rester libre :
Mon opinion est qu’il faut se prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même.
à ne pas se prendre au sérieux :
La plupart de nos occupations sont comiques. Il faut jouer notre rôle comme il faut, mais comme le rôle d’un personnage emprunté
à se méfier de tous les extrémismes :
« Le peuple se trompe : on va bien plus facilement par les bouts, là où l’extrémité sert de borne d’arrêt et de guide, que par la voie du milieu large et ouverte, mais bien moins noblement et de façon moins estimable79. »
à être tolérant :
« Je ne partage point cette erreur commune de juger d’un autre d’après ce que je suis. Je crois aisément qu’il y a des qualités différentes des miennes … Je conçois et crois bonnes mille manières de vivre opposées ; au contraire du commun des hommes, j’admets en nous plus facilement la différence que la ressemblance.
et surtout à aimer la vie telle qu’elle est et à la goûter pleinement :
« J’ai un dictionnaire tout à fait personnel ; je « passe » le temps quand il est mauvais et désagréable ; quand il est bon, je ne veux pas le ...
N’hésitons pas à bien accueillir les plaisirs voulus par la nature :
« Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; et même quand je me promène solitairement dans un beau verger82, si mes pensées se sont occupées de choses étrangères pendant quelque partie du temps, une autre partie du temps je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi83. »
et à savoir les amplifier :
Les autres ressentent la douceur d’une satisfaction et de la prospérité ; je la ressens comme eux, mais ce n’est pas en passant et en glissant. Il faut plutôt l’étudier, la savourer et la ruminer pour en rendre grâces comme il convient à celui qui nous l’accorde. Eux jouissent des autres plaisirs comme ils le font de celui du sommeil, sans les connaître. Afin que le « dormir » lui-même ne m’échappât point stupidement ainsi, j’ai trouvé bon autrefois qu’on me le troublât pour que je l’entrevisse.
sans toutefois en être la dupe, en sachant qu’en tout cela il n’y a que vanité :
Moi qui me vante d’accueillir avec tant de soin les agréments de la vie, je n’y trouve, quand je les considère ainsi avec minutie, à peu près que du vent. Mais quoi ! Nous sommes à tous égards du vent. Et encore le vent, plus sagement que nous, se complait à bruire, à s’agiter et il est content de ses propres fonctions, sans désirer la stabilité, la solidité, qualités qui ne sont pas siennes.
L'héritage de Montaigne
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Pascal a jugé l'entreprise avec sévérité dans ses Pensées : « Le sot projet qu'il a de se peindre86», reprochant notamment à Montaigne son manque de piété et sa désinvolture vis-à-vis du salut. Mais Voltaire a écrit : « Savant dans un siècle d’ignorance, philosophe parmi des fanatiques, (Montaigne) qui peint sous son nom nos faiblesses et nos folies, est un homme qui sera toujours aimé87. » Et Nietzsche : Je ne connais qu'un seul écrivain que, pour l'honnêteté, je place aussi haut, sinon plus, que Schopenhauer, c'est Montaigne. En vérité, qu'un tel homme ait écrit, vraiment la joie de vivre sur cette terre en a été augmentée. »
Sa personnalité et sa vie ont suscité des images contradictoires : Sceptique retiré dans sa tour d’ivoire, égoïste ou généreux, lâche ou courageux, ambitieux ou sage souriant, stoïcien ou épicurien, chrétien sincère ou libre-penseur masqué, catholique convaincu ou sympathisant de la Réforme, esprit serein ou mélancolique redoutant la folie ? Les portraits qu’on a donnés de Michel de Montaigne sont aussi divers que les interprétations des Essais.
Œuvres de Montaigne Les éditions des Essais
Le fameux exemplaire de l’édition de 1588 – connu sous le nom d’Exemplaire de Bordeaux – sur lequel l’auteur a accumulé corrections et additions jusqu’à sa mort en 1592, longtemps considéré comme la dernière volonté littéraire de Montaigne.
Éditions originales :
Essais, livres I et II, Bordeaux, Simon Millanges, 1582
Essais, livres I et II, Bordeaux, Simon Millanges, 1582
Essais, livres I et II, Paris, Jean Richer, 1587.
Essais, livres I, II et III, Paris, Abel L'Angelier, 1588
Essais, éd. posthume, Paris, Abel Langelier, 1595 établie par Pierre de Brach et Marie de Gournay, préface de Mlle de Gournay.
Éditions scientifiques :
Essais, éd. F.Strowski, P.Villey, F.Gébelin, dite Édition municipale, 1906-1933.
Essais, reproduction phototypique de l’Exemplaire de Bordeaux, Paris, Hachette, 1912 réimpression Slatkine, 1988, 3 vol..
Essais, reproduction typographique de l’Exemplaire de Bordeaux, Paris, Imprimerie nationale, 1913-1931.
Essais, reproduction photographique du texte de 1580, Genève, Slatkine, 1976
Éditions de référence :
Essais, éd. Villey-Saulnier reproduisant l’Exemplaire de Bordeaux, Paris, PUF, 1965 réimpression en 2 vol., 1978) avec notices, notes et répertoire des sources par P.Villey dont la thèse sur Les sources et l’évolution des Essais 1933, fait toujours autorité. Réimpression dans la coll. Quadrige, PUF, 2004.
Cette édition distingue par des lettres les strates successives du texte des Essais A désigne le texte de 1580, B le texte de 1588, C le texte postérieur.
Essais, éd. J. Balsamo, C. Magnien-Simonin et M. Magnien reproduisant l'édition posthume publiée en 1595 par Marie de Gournay, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, suivis des sonnets de La Boétie supprimés en 1588, des annotations de Montaigne sur des livres de sa bibliothèque, et du recueil de sentences latines et grecques peintes sur les poutres de sa bibliothèque.
Cette édition prend à revers la tradition installée depuis le début du xxe siècle par F. Strowski et P. Villey, adoptant pour base l'Exemplaire de Bordeaux que les éditeurs de La Pléiade tiennent pour un premier état de l'édition de 1595, esquissé en marge du texte de 1588. Ils conjecturent l'existence d'un état définitif du texte en deux exemplaires disparus, l'un resté en Gascogne, l'autre envoyé à Paris pour établir l'édition de 1595.
Éditions en français moderne :
Les Essais, traduction en français moderne (en fait seule l'orthographe est modernisée par Claude Pinganaud, Arléa, 1994, 813 p.
Essais, traduction en français moderne par A. Lanly à partir de l’Exemplaire de Bordeaux, coll. Quarto, Gallimard, 2009. Cette traduction conserve la structure de la phrase de Montaigne.
Essais, traduction en français moderne par Guy de Pernon à partir de l'édition de 1595, parution sur Internet, 2008.
Des idées que l'on se fait sur soi De la présomption, traduction en français moderne à partir de l'édition de 1595 par Christophe Salaün, Mille et une nuits, 2014.
Journal de voyage
Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse & l'Allemagne en 1580 & 1581, Avec des Notes par M. de Querlon. Édition par Meusnier de Querlon du journal rédigé en route et non repris par Montaigne. Le Jay, Rome et Paris, 1774. lire en ligne sur Wikisource.
Numismate
Michel de Montaigne figure sur une pièce de 10 € en argent édité en 2012 par la Monnaie de Paris pour représenter sa région natale, l'Aquitaine
Sources
Les sources principales de cet article sont :
Pierre Villey, Les Sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Hachette, 1908
Madeleine Lazard, Michel de Montaigne, Fayard, 1992        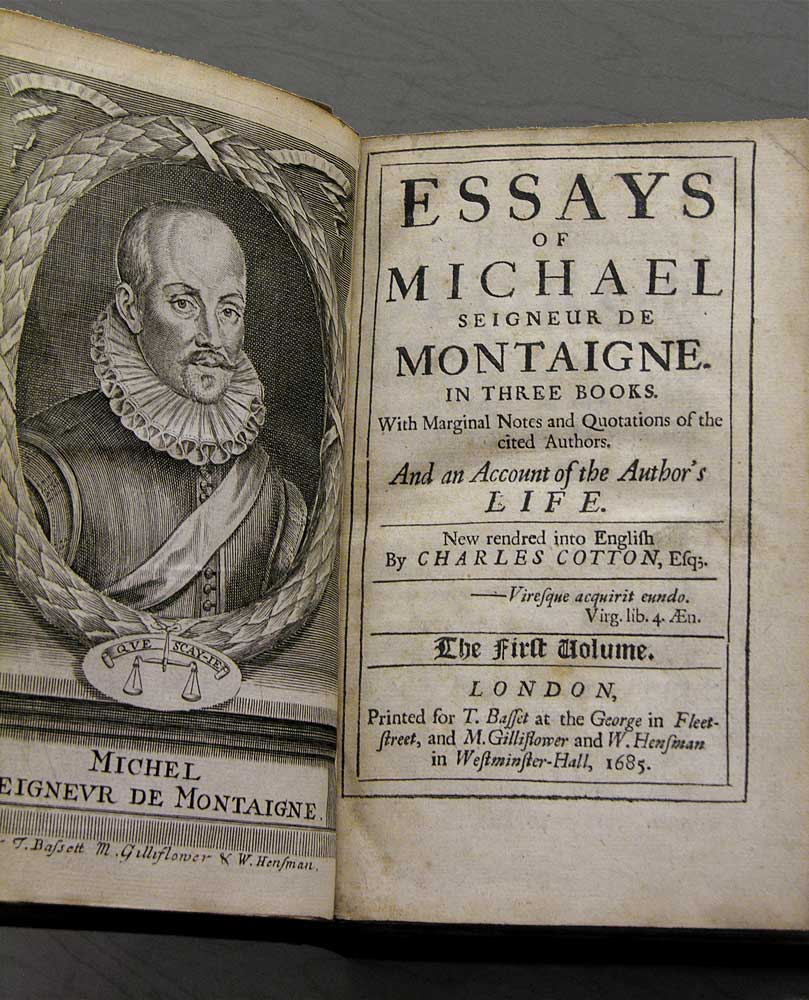  
Posté le : 13/09/2015 22:01
Edité par Loriane sur 14-09-2015 22:33:12
|
|
|
|
|
Michel Eyquem de Montaigne 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 13 septembre 1592 meurt Michel Eyquem de Montaigne
dit Montaigne, seigneur de Montaigne, à 59 ans, en son château de Saint-Michel-de-Montaigne en Dordogne, né le 28 février 1533 dans ce mù$ême château, philosophe et moraliste de la Renaissance. Il a pris une part active à la vie politique, comme maire de Bordeaux et comme négociateur entre les partis, alors en guerre dans le royaume voir Guerres de religion France. Il appartient à l'école/tradition Humanisme, scepticisme; Ses principaux intérêts sont l'Homme, l'histoire, la littérature, la philosophie, la politique, le droit, la religion. Il traita de la vertu aimable. Ses Œuvres principales sont
Les Essais, La Lettre au père de La Boétie après sa mort. Il est influencé par L'Antiquité et Jean de Léry, il a influencé Marie de Gournay, La Mothe Le Vayer, Descartes, Pascal, Voltaire, Schopenhauer, Nietzsche, Merleau-Ponty, Cioran
Les Essais 1572-1592 ont nourri la réflexion des plus grands auteurs en France et en Europe, de Shakespeare à Pascal et Descartes, de Nietzsche et Proust à Heidegger.
Le projet de se peindre soi-même pour instruire le lecteur semble original, si l'on ignore les Confessions de Saint Augustin : « Je n’ai d’autre objet que de me peindre moi-même. cf. introspection ; Ce ne sont pas mes actes que je décris, c’est moi, c’est mon essence. Saint Augustin dans ses Confessions retraçait l'itinéraire d'une âme passée de la jeunesse aux erreurs de la dévotion. Jean-Jacques Rousseau cherchera à se justifier devant ses contemporains ; Stendhal cultive l'égotisme ; avant ces deux-là, Montaigne a une autre ambition que de se faire connaître à ses amis et parents : celle d'explorer le psychisme humain, de décrire la forme de la condition humaine.
Si son livre « ne sert à rien » Au lecteur, — parce qu'il se distingue des traités de morale autorisés par la Sorbonne, Montaigne souligne quand même que quiconque le lira pourra tirer profit de son expérience. Appréciée par les contemporains, la sagesse des Essais s'étend hors des barrières du dogmatisme, et peut en effet profiter à tous, car : Chaque homme porte la forme entière, de l’humaine condition.
Le bonheur du sage consiste à aimer la vie et à la goûter pleinement : C'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir loyalement de son être.
Sa vie
Le château de Montaigne a été presque complètement détruit par un incendie en 1885, mais la tour où se trouvait la bibliothèque de Montaigne a échappé au feu et est donc demeurée inchangée depuis le xvie siècle.
Michel de Montaigne est issu d'une famille de riches négociants bordelais, les Eyquem.
En 1477, son arrière-grand-père, Ramon Eyquem 1402-1478, fait l'acquisition de la petite seigneurie périgourdine de Montaigne, arrière-fief de la baronnie de Montravel, composée de terres nobles et d’une maison forte6. Cette acquisition est la première étape de l’accession à la noblesse
Son grand-père, Grimon Eyquem 1450-1519, fils de Ramon Eyquem et de Isabeau de Ferraygues 1428-1508, reste marchand et continue à faire prospérer la maison de commerce de Bordeaux.
Son père, Pierre Eyquem, premier de la famille à naître au château de Montaigne, en 1495, rompt avec le commerce et embrasse la carrière des armes. Il participe aux campagnes d'Italie.
En 1519, noble homme, Pierre Eyquem, seigneur de Montaigne, écuyer », rend hommage à Jean de Foix, archevêque de Bordeaux, suzerain de la baronnie de Montravel. Sa roture est définitivement éteinte.
En 1529, il épouse Antoinette de Louppes de Villeneuve (ou Lopez de Villanueva), fille et nièce de marchands toulousains et bordelais enrichis dans le commerce du pastel. La famille d'Antoinette est d'origine espagnole, descendant peut-être de juifs convertis, mais parfaitement intégrée dans le cadre de la société française et chrétienne. Les Louppes de Villeneuve jouissent d'une fortune identique à celle des Eyquem, mais sont en retard sur eux d'une génération dans l'accession à la noblesse. Ils abandonneront le nom de Louppes pour celui de Villeneuve, comme Montaigne celui d'Eyquem.
Les deux premiers enfants du couple meurent en bas âge ; Michel est le premier qui survit. Il sera l'aîné de sept frères et sœurs.
Pierre de Montaigne, excellent gestionnaire de ses biens, arrondit son domaine avec l'aide de son épouse, forte personnalité et intendante hors pair, par achats ou par échanges de terres.
Reconnu et considéré par ses concitoyens bordelais, il parcourt tous les degrés de la carrière municipale avant d'obtenir en 1554 la mairie de Bordeaux.
Si Michel de Montaigne montre dans les Essais son admiration et sa reconnaissance pour son père, il ne dit presque rien de sa mère. Il aurait eu des rapports tendus avec elle. Pierre de Montaigne devait en être conscient, qui a pris soin dans son testament de définir dans les moindres détails les conditions de cohabitation entre la mère, fière d'avoir par son travail avec son mari, « grandement avaluée, bonifiée et augmentée » la maison de Montaigne, comme elle l'écrit dans son testament de 1597, cinq ans après la mort de Michel, et le fils qui s'est contenté de jouir paisiblement de l'héritage acquis.
Montaigne est le frère de Jeanne Eyquem de Montaigne, mariée à Richard de Lestonnac, et donc l'oncle de sainte Jeanne de Lestonnac.
Éducation
« Le bon père que Dieu me donna m’envoya dès le berceau, pour que j’y fusse élevé, dans un pauvre village de ceux qui dépendaient de lui et m’y maintint aussi longtemps que j’y fus en nourrice et encore au-delà, m’habituant à la plus humble et à la plus ordinaire façon de vivre.» écrit Montaigne qui ajoute : « La pensée de mon père visait aussi à une autre fin : m’accorder avec le peuple et cette classe d’hommes qui a besoin de notre aide, et il estimait que je devais être obligé à regarder plutôt vers celui qui me tend les bras que vers celui qui me tourne le dos (…) Son dessein n’a pas mal réussi du tout : je me dévoue volontiers envers les petits. »
Père cultivé et tendre, Pierre Eyquem donne à son fils de retour au château une éducation selon les principes humanistes, en particulier inspirée du De pueris instituendis d’Érasme, se proposant de lui donner le goût de l’étude « par une volonté non forcée et de son propre désir ». L’enfant est élevé sans contrainte. La sollicitude paternelle va jusqu’à le faire éveiller « par un joueur d’épinette » pour ménager ses sens fragiles. Vers deux ans, il quitte sa nourrice puis a pour précepteur domestique un médecin allemand nommé Horstanus, qui doit lui enseigner les humanités et entretenir l’enfant en latin seulement (seconde langue de toute l’élite européenne cultivée, comme une langue maternelle), règle à laquelle se plie également le reste de la maisonnée : « C’était une règle inviolable que ni mon père ni ma mère ni valet ni chambrière n’employassent, quand ils parlaient en ma compagnie, autre chose que des mots latins, autant que chacun en avait appris pour baragouiner avec moi. » La méthode réussit parfaitement : « Sans livre, sans grammaire, sans fouet et sans larmes, j’avais appris du latin - un latin aussi pur que mon maître d’école le connaissait. » Mais ajoute Montaigne, « j’avais plus de six ans que je ne comprenais pas encore plus de français ou de périgourdin que d’arabe ».
De 7 à 13 ans, Montaigne est envoyé suivre le « cours » de grammaire et de rhétorique au collège de Guyenne à Bordeaux, haut lieu de l'humanisme bordelais, dirigé par un Portugais, André de Gouvéa entouré d’une équipe renommée : Cordier, Vinet, Buchanan, Visagier. Rétif à la dure discipline de l’époque, il gardera le souvenir des souffrances et des déplaisirs subis: « Le collège est une vraie geôle pour une jeunesse captive. On la rend déréglée en la punissant de l’être avant qu’elle le soit. La belle manière d’éveiller l’intérêt pour la leçon chez des âmes tendres et craintives que de les y guider avec une trogne effrayante, les mains armées de fouet ! » Il y fait cependant de solides études et y acquiert le goût des livres (il lit Ovide, Virgile, Térence et Plaute), du théâtre (Gouvea encourageait la représentation des tragédies en latin) de la poésie (latine), et des joutes rhétoriques, véritable gymnastique de l’intelligence selon Érasme.
On ne sait presque rien de sa vie de 14 à 22 ans. On retrouve le jeune Montaigne vers 1556 conseiller à la cour des Aides de Périgueux, reprenant la charge de son père qui étant devenu maire de Bordeaux pour deux ans, au moment des guerres de religion. Ses biographes en ont déduit qu’il avait suivi, dans le collège de Guyenne, des cours de philosophie de la Faculté des Arts où enseignait l'humaniste Marc Antoine Muret puis fait des études de droit à l'université de Toulouse, de Paris ou probablement dans ces deux villes, rien ne permet à ce jour de trancher de façon décisive.
La carrière juridique peut surprendre pour un aîné traditionnellement dirigé dans la noblesse vers la carrière des armes, la diplomatie ou les offices royaux. À l’inverse de son père, Montaigne était peu doué pour les exercices physiques à l’exception de l’équitation. Son tempérament nonchalant a peut-être déterminé Pierre Eyquem à orienter son fils vers la magistrature.
La "religion" de Montaigne
Montaigne a été élevé dans la religion catholique et en respectera toutes les pratiques jusqu’à sa mort. Ses contemporains n’ont pas douté de la sincérité de son comportement. Ses convictions intimes sont-elles en harmonie avec cette dévotion extérieure ou se contente-t-il, plus probablement, d’accepter la religion en usage dans son pays (« Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. », « Ce n’est pas par la réflexion ou par notre intelligence que nous avons reçu notre religion, c’est par voie d’autorité et par un ordre étranger. ») ? Les interprétations sont contradictoires : à la toute fin des Essais (III, xiii), Montaigne, par le biais prudent d'une citation d'Horace, recommande non son âme, mais la vieillesse, - non au Dieu chrétien mais à Apollon.
On a vu en lui un incrédule (Sainte-Beuve, André Gide, Marcel Conche), un catholique sincère (Villey), un esprit favorable à la Réforme Nakam, un fidéiste Tournon, Onfray, un nouveau-chrétien contraint de taire les origines juives de sa famille Jama. Les Essais, reçus avec indulgence à Rome lors de son voyage de 1581 (le Saint-Office lui demandera seulement de retrancher ce qu'il jugerait "de mauvais goût"), seront mis à l’Index en 1676 à la demande de Bossuet.
Montaigne magistrat 1556-1570
De l'âge de 22 ans à celui de 37 ans, Montaigne siège comme magistrat d’abord à la Cour des aides de Périgueux puis, après sa suppression en 1557, au Parlement de Bordeaux, où siègent déjà son oncle et deux cousins de sa mère, sans compter le grand-père et le père de sa future femme ainsi que son futur beau-frère.
Le Parlement de Bordeaux comporte une Grand’Chambre ou Chambre des plaidoiries et deux Chambres des enquêtes chargées d’examiner les dossiers trop complexes. Montaigne est affecté à l’une d’elles. Le Parlement ne se contente pas de rendre la justice. Il enregistre les édits et ordonnances du roi qui sans cela ne sont pas exécutoires. En périodes de troubles (la période des guerres de religion s’ouvre en 1562 et va durer trente ans), il collabore avec le gouverneur de la ville nommé par le roi et le maire élu par la municipalité pour maintenir l’ordre public et peut lever des troupes. Ses membres se recrutent par cooptation, les charges se vendant ou se transmettant par résignation.
La charge d’un conseiller au Parlement comporte aussi des missions politiques. Celles à la cour sont les plus recherchées. On en recense une dizaine pour Montaigne à la cour de Henri II, François II et Charles IX. Séduit par le climat de la cour, Montaigne, trop indépendant pour devenir un courtisan, n'a pas cherché à y faire carrière.
Politique et religion
Cette attitude reçoit sa définition essentiellement dans le grand chapitre de l'Apologie de Raymond Sebond, défense prétendue du théologien catalan dont Montaigne avait traduit l'ouvrage (une tentative de démonstration rationnelle des vérités de la foi), et qui finit en réalité par mettre en pièces son anthropocentrisme. Cependant, il faut souligner que cette position avait été adoptée par Montaigne dès le début, et gouverne nécessairement ses réponses aux grandes questions de l'époque, dans le domaine politique et religieux. Conservateur pour les uns, révolutionnaire pour les autres, Montaigne est amené par le relativisme pyrrhonien à souligner l'arbitraire et la contingence des lois et des coutumes, dont il établit ironiquement des listes hétéroclites, pour conclure que seul compte le consensus de la communauté dans laquelle elles sont reçues : à chacun d'observer celles du lieu où il se trouve. Sous ce « conservatisme » apparent pourrait couver en réalité un désir primordial de subversion au nom de la justice : on voit parfois percer dans les Essais (notamment à la fin du chapitre « Des cannibales », où sont rapportées les réactions des « sauvages » confrontés à notre civilisation) le fantasme de la prise de pouvoir par les pauvres. Mais l'histoire – celle du passé et celle de son temps – enseigne à Montaigne que la révolte n'est pas un remède à l'inégalité des ressources et que les lois, même irrationnelles ou aberrantes, ont de toute façon une fonction régulatrice et stabilisante, sans laquelle les sociétés sombrent dans la violence.
De même, la critique des raisons de croire ne peut aller jusqu'à l'invalidation de la foi. Certains ont fait de Montaigne un catholique fervent, d'autres l'ont peint en sceptique ou en incroyant. Il serait évidemment sans exemple qu'un homme du questionnement perpétuel et fondamental n'ait pas essayé de comprendre, non pas Dieu (l'incompréhensible même), mais le besoin de Dieu. D'autant plus que son aventure intellectuelle s'inscrit dans cette période charnière de l'âge moderne où la religion et les fanatismes religieux envahissent tous les secteurs de la vie publique. Face à ce phénomène majeur de l'Occident que fut le déchirement du christianisme latin, dans cette période troublée où les certitudes vacillent, Montaigne évalue la complexité des problèmes et refuse d'être la victime du jeu ambigu des partis ; il circonscrit l'espace où sa pensée peut se permettre certaines audaces, et décide de n'interroger que le visible. Le fidéisme de l'Apologie soustrait les dogmes aux investigations critiques : révélation et transcendance sont hors de la portée des facultés humaines. Impuissants à pénétrer ces mystères, nous ne pouvons pas non plus nous arroger le droit de légiférer en la matière, en nous substituant à l'autorité ecclésiastique : il est bon que chacun suive la religion dans laquelle il est né. « Nous sommes Chrétiens à même titre que nous sommes ou Périgourdins ou Allemands » : ce constat, qu'on lui a souvent reproché comme une déclaration d'indifférence, signifie que Montaigne ne prend en compte que la réalité sociale de la religion chrétienne. Les Essais se situent exclusivement sur le plan de la vie terrestre.
En retour, aucun aspect de la vie terrestre n'échappe à cette réflexion qui ne veut connaître que l'immanence : elle détruit les contreforts plus ou moins solides des discours dominants, bouscule l'ordre rassurant des valeurs établies et nous oblige à nous considérer, pantins ridicules dérisoirement accrochés à leurs certitudes. Il s'agit pour Montaigne de présenter au lecteur – constamment interpellé par des tours interrogatifs, des apostrophes, des exhortations, de soudains silences – non des avis préconçus (« C'est par manière de devis que je parle de tout, et de rien par manière d'avis »), mais des sujets de réflexion, afin qu'il collabore au texte et éventuellement en parachève le message. Message qui signifie toutefois que l'enquête précisément est toujours ouverte, qu'il n'y a pas lieu de prononcer un arrêt définitif. C'est ainsi que, conçus sous le signe du possible et du multiple, les Essais affirment leur cohérence en échappant au corset d'une pensée systématique et en proposant la nouveauté radicale d'une insatisfaction constamment entretenue sur les rapports de l'individu avec la culture et l'actualité de son temps, sur ses attitudes face au chaos de son époque.
De la jurisprudence à l'essai
Cette démarche proche de l'enquête, dubitative, non résolutive, avatar de l'épochè pyrrhonienne, doit sans doute son étrangeté radicale, comme le montre André Tournon, à la culture juridique de l'auteur et à son expérience de magistrat. Les méandres de son discours, ses bifurcations qui fragmentent l'unité factice ordonnée par les règles rhétoriques pour faire place à la dénonciation ironique de l'incertitude de notre jugement, ces prises de distance en somme, par lesquelles la pensée s'éloigne de son objet afin de sonder le sens de ses propres opérations, trouvent d'abord leur source dans les procédés des gloses juridiques, lieu crucial de la crise de la pensée à la Renaissance. Dans l'effort pour renouveler l'étude du droit romain et adapter le Digeste et les Pandectes aux nouvelles nécessités en dépouillant les sources des incrustations parasitaires qu'on y a agrégées au cours des siècles, les jurisconsultes, francs-tireurs attelés à la tradition qu'ils contestent, doivent infirmer prudemment la glose traditionnelle en s'appuyant sur le principe que toute autorité est suspecte, qu'on peut la réduire à une opinion, et présenter à son tour comme une opinion la nouvelle interprétation. C'est cet exercice probabiliste, ce refus de l'affirmation catégorique que Montaigne a sans doute puisés dans les ouvrages d'Alciat ou de Cujas. Loin donc de réfléchir le vagabondage d'une rêverie sans projet, le « désordre » des Essais épouse le mouvement d'une pensée qui obéit à des contraintes tout en cherchant et en trouvant le moyen de les contourner : il s'agit de négocier la composition entre la structure idéologique dominante (et rassurante) et un discours critique qui pourrait se révéler dévastateur.
Mais les modes d'investigation et de réflexion qui sont mis en œuvre dans les Essais, les perturbations qui traversent l'écriture de Montaigne jusqu'à troubler son armature syntaxique relèvent probablement aussi de la mimésis des procédés de l'élaboration et de l'examen des témoignages qu'il avait pratiqués dans sa fonction de conseiller à la Chambre des enquêtes du parlement de Bordeaux. Étudier des dossiers, examiner des procès-verbaux, les réinterpréter dans un rapport qui résume les arguments de chaque partie et en fasse le bilan en vue du verdict qui sera émis par le juge, tout cela signifie mettre à l'épreuve le caractère aléatoire des sentences, faire l'expérience de la confusion des controverses. Du coup, Montaigne, loin d'ériger un système ou de se présenter en porte-parole d'un savoir universel, ne peut que s'habiller en simple témoin, exprimer ses idées comme des opinions personnelles sujettes à caution, et les proposer au lecteur qui aura à en juger.
Le sujet en questions
Façonné ainsi par son activité de magistrat, l'homme qui, en 1571, démissionne de sa charge pour se faire écrivain ne peut que s'écrire de manière problématique, c'est-à-dire se poser en sujet écrivant, anticipant les recherches actuelles sur l'écriture. Les Essais disent le malaise d'un moi placé entre l'exigence de se fixer dans le livre et l'impossibilité, sanctionnée en refus, de se constituer en être stable. Ce que Montaigne se propose en effet n'est pas de représenter l'« être » mais de décrire « le passage [...] de jour en jour, de minute en minute », persuadé comme il est que « nous sommes tous des lopins, et d'une contexture si informe et diverse, que chaque pièce, chaque moment, fait son jeu ». Le texte se bâtit tout en faisant voler en éclats l'illusion d'un moi entièrement saisissable : la subjectivité n'est que l'unité imaginaire du multiple, l'individu n'est qu'une diversité incompréhensible de sujets instantanés, une mosaïque de « je » qui varient selon les contingences et les occasions du discours : « Moi à cette heure et moi tantôt sommes bien deux. » Ce sont là les fragments épars dans les Essais d'une sorte de « théorie du sujet » la lettre et la méthode en moins. Chacun est soi-même à chaque instant, donc il est plusieurs fois soi-même.
En dernière analyse, c'est le manque de confiance dans une identité personnelle fixe qui justifie et rend possible l'« anomalie » de l'écriture de Montaigne : une écriture de la subjectivité qui ne tend pas à coaguler le moi mais plutôt à le dissocier, à le disperser, et qui par conséquent ne correspond à aucune des formes reconnues, qui toutes supposent, d'une manière ou d'une autre, la confiance dans l'unité identitaire de l'être. Autobiographie ? Certes non : il n'y a pas d'enchaînement linéaire ou chronologique des actions, plus exactement il n'y a même pas d'actions : « Je peins principalement mes cogitations, sujet informe, qui ne peut tomber en production ouvragère. » Un journal intime alors ? L'écriture au présent, qui est le propre du journal, semble se rapprocher davantage de l'intention manifestée par Montaigne de rendre compte de soi « de jour en jour, de minute en minute », mais cette composante décisive qu'est la fidélité au calendrier, laquelle implique la contingence du quotidien, demeure exclue du texte. Un autoportrait ? L'étiquette ne semble pas convenir à l'œuvre d'un écrivain qui a obstinément répété son incapacité à se définir lui-même, si ce n'est par la conscience d'une incontournable fragmentation. Sa démarche semblerait plutôt se rapprocher de l'antiprojet formulé par Michel Foucault dans L'Archéologie du savoir : « Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même. » Lorsque Montaigne déclare : « Ce ne sont mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence », ce « moi », qui ici vaut par opposition à « mes gestes », a un statut tout à fait provisoire : « Je ne vise ici qu'à découvrir moi-même, qui serai par aventure autre demain, si nouveau apprentissage me change. » D'où, aussi, la structure malléable et instable de l'œuvre : Montaigne doit reprendre continuellement son livre pour enregistrer ses changements, sans cependant rien modifier, sinon sur le plan formel, aux couches précédentes du texte, sans rien désavouer de ce qui s'était écrit auparavant, témoignage irremplaçable d'autres moments de sa vie auxquels se confronter, et qui sont autant de miroirs de sa propre diversité. Si les « allongeails » s'accumulent, c'est pour obéir à ce mouvement réflexif qui amène le sujet à se mesurer à son être d'hier, tout en essayant de combler le retard pris par le livre sur l'être vivant, de cerner une fois encore la figure mobile de ce moi qui ne saurait se dire et se sentir identique à soi-même tout au long d'une vie. Ces textes, donnés à lire dans la perspective de la longue durée d'une vie d'homme, signifient en somme une façon de comprendre le dispositif du monde dans son changement continuel et de s'inclure dans ses mutations ; de privilégier l'éphémère pour ne pas renier le passé en lui substituant une image faussement de rêve.
La Boétie
L’événement le plus marquant de cette période de sa vie est sa rencontre à 25 ans avec La Boétie. La Boétie siège au Parlement de Bordeaux. Il a 28 ans – il meurt à 32 ans. Orphelin de bonne heure, marié, chargé par ses collègues de missions de confiance (pacification de la Guyenne durant les troubles de 1561), il est plus mûr que Montaigne. Juriste érudit avec une solide culture humaniste, il écrit des poésies latines et des traités politiques. Son ouvrage le plus connu est le Discours de la servitude volontaire que Montaigne voulait insérer dans les Essais; mais Montaigne s'en est abstenu quand les protestants prétendirent présenter l'ouvrage de La Boétie comme une attaque contre le Roi.
L’amitié de Montaigne et de La Boétie est devenue légendaire. Montaigne a écrit dans la première édition des Essais : « Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer. » C’est dans l’édition posthume de 1595 dite « d'après l'exemplaire de Bordeaux » qu’on lit la formule célèbre: « parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Cet ajout a été écrit par l'auteur dans la marge de son exemplaire personnel (édition de 1588): d’abord « parce que c’était lui », puis d’une autre encre « parce que c’était moi ».
Montaigne qui, fort sociable, a eu beaucoup d’amis ordinaires, a jugé exceptionnelle cette amitié, comme on en rencontre qu’ « une fois en trois siècles » : « Nos âmes ont marché si uniment ensemble (…) que non seulement je connaissais la sienne comme la mienne, mais que je me serais certainement plus volontiers fié à lui qu’à moi à mon sujet (…) C’est un assez grand miracle que de se doubler. »
Son admiration pour la grandeur intellectuelle de son aîné s’allie à de profondes affinités culturelles et à un parfait accord idéologique dans cette période de guerres religieuses.
Mais cette amitié dure peu. La Boétie meurt, sans doute de la peste, en 1563, conservant pendant trois jours d’agonie une force d’âme qui fascine Montaigne et qu’il veut faire connaître, d’abord dans une lettre à son père, puis dans un Discours publié en 1571 en postface aux œuvres de son ami.
« Il n’est action ou pensée où il ne me manque. » écrit Montaigne « J’étais déjà si formé et habitué à être deuxième partout qu’il me semble n’exister plus qu’à demi. » Il va dès lors songer à perpétuer son souvenir, d’abord en publiant ses œuvres adressées à de hauts personnages, puis en continuant seul le dialogue avec son ami, dialogue intérieur qui aboutira aux Essais.
Mariage
Il semble que Montaigne ait voulu soulager le mal causé par la perte de son ami par des aventures amoureuses. La passion pour les femmes que Montaigne eut très jeune et tout au long de sa vie se confond chez lui avec le désir sensuel. « Je trouve après tout que l’amour n’est pas autre chose que la soif de la jouissance sur un objet désiré et que Venus n’est pas autre chose non plus que le plaisir de décharger ses vases, qui devient vicieux ou s’il est immodéré ou s’il manque de discernement. » « Qu’a fait aux hommes l’acte génital qui est si naturel, si nécessaire et si légitime pour que nous n’osions pas en parler sans honte. » Trois chapitres des Essais – « De la force de l’imagination », « Les trois commerces » et « Sur des vers de Virgile » – parlent de ses expériences amoureuses. Mais on ne lui connaît aucune passion, aucune liaison durable. « Cet amoureux des femmes n’aurait-il, en fin de compte, aimé qu’un homme ? » se demande Jean Lacouture.
Cette période de dissipation et de débauches cesse en 1565. Il se laisse marier. Il épouse le 23 septembre 1565, après un contrat passé le jour précédent devant le notaire Destivals, Françoise de la Chassaigne, qui en a 20, d’une bonne famille de parlementaires bordelais (son père devient président du Parlement en 1569). Concession de toute évidence faite à ses parents. On ne sait si le mariage de Montaigne a été heureux, les avis de ses biographes divergent. On sait que Montaigne, avec toute son époque, distingue le mariage de l’amour. Convaincu de son utilité, il se résigne à suivre la coutume et l’usage mais dort seul dans une chambre à part. On sait cependant que sa femme a montré, après sa mort, beaucoup de soin de sa mémoire et de son œuvre.
La mort de son père en juin 1568 (ce qui le met en possession d’une belle fortune et du domaine familial qui lui permettent de vivre de ses rentes) et celle prématurée de cinq de ses six filles l'affectent et l'invitent à se retirer des affaires et abandonner sa charge de magistrat. Il demande néanmoins en 1569 son admission à la Grand’Chambre, promotion qui lui est refusée. Il préfère alors se retirer et résigne sa charge en faveur de Florimond de Raemond le 23 juillet 1570.
Montaigne écrivain 1571-1592
En démissionnant du Parlement, Montaigne change de vie. Il se retire sur ses terres, désireux de jouir de sa fortune, de se consacrer à la fois à l’administration de son domaine et à l’étude et à la réflexion. Mais sa retraite n’est pas une réclusion. Quand le roi le convoque, il fait la guerre, s’entremet entre les clans lorsqu’on le lui demande, accepte la mairie de Bordeaux lorsqu’il est élu, sans rechercher les honneurs toutefois et surtout sans consentir à enchaîner sa liberté.
En 1571, il est fait chevalier de l’ordre de Saint-Michel par Charles IX qui le nomme encore gentilhomme ordinaire de sa chambre en 1573, charge purement honorifique mais très prisée. Henri de Navarre, le chef du parti protestant, futur Henri IV, fait de même en 1577. Sans que l’on sache précisément quels mérites étaient récompensés par toutes ces distinctions.
Il n’hésite pas non plus à s’absenter de chez lui plusieurs mois durant pour voyager à travers l’Europe.
Les Essais
« La forme de ma bibliothèque est ronde et n’a de rectiligne que ce qu’il faut à ma table et à mon siège, et elle m’offre dans sa courbe, d’un seul regard, tous mes livres rangés sur cinq rayons tout autour. »
Montaigne orne les poutres de sa bibliothèque de maximes, en latin ou en grec, d'auteurs anciens. Une seule est en français : « Que sais-je ? ». Sur la poutre la plus proche de son écritoire, l’adage latin de Térence : « Je suis homme et crois que rien d’humain ne m’est étranger. »
Dans son château, Montaigne s’est aménagé un refuge consacré à sa liberté, à sa tranquillité et à ses loisirs, sa bibliothèque : « Je passe dans ma bibliothèque et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour (…) Je suis au-dessus de l’entrée et je vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour et dans la plupart des parties de la maison. Là je feuillette tantôt un livre, tantôt un autre, sans ordre et sans dessein ; tantôt je rêve, tantôt je note et je dicte, en me promenant, mes rêveries que je vous livre. »
Il entame la rédaction des Essais au début de 1572 à 39 ans et la poursuivra jusqu’à sa mort en 1592, soit une vingtaine d’années, travaillant lorsque sa vie politique, militaire, diplomatique et ses voyages lui en laissent le loisir. Les premiers Essais (livre I et début du livre II composés en 1572-1573) sont impersonnels et ont une structure qui les rapproche des ouvrages de vulgarisation des enseignements des auteurs de l'Antiquité, ouvrages très à la mode alors : petites compositions très simples rassemblant exemples historiques et sentences morales auxquels s’accrochent quelques réflexions souvent sans grande originalité. Le Moi est absent. « Parmi mes premiers Essais, certains sentent un peu l’étranger. » reconnaît Montaigne qui s’efforcera dans les additions de 1588 d’ajouter des confidences personnelles parfois mal jointes à l’ensemble.
Puis, autour de 1579, au fur et à mesure qu’il comprend ce qu’il cherche à faire, il se peint lui-même. L'intérêt principal du livre passe dans ce portrait. Un genre est né. « Si l’étrangeté et la nouveauté ne me sauvent pas, je ne sortirai jamais de cette sotte entreprise ; mais elle est si fantastique et a un air si éloigné de l’usage commun que cela pourra lui donner un passage (…) Me trouvant entièrement dépourvu et vide de tout autre matière, je me suis offert à moi-même comme sujet. C’est le seul livre au monde de son espèce : le dessein en est bizarre et extravagant. Il n’y a rien dans ce travail qui soit digne d’être remarqué sinon cette bizarrerie… »
L’avant-propos de la première édition confirme :« Je veux qu’on m’y voie dans ma façon d’être simple, naturelle et ordinaire, sans recherche ni artifice : car c’est moi que je peins. Mes défauts s’y liront sur le vif, ainsi que ma manière d’être naturelle, autant que le respect humain me l’a permis (…) Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre : il n’est pas raisonnable que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole. Adieu donc ? De Montaigne, ce 1er mars 1580. »
La première édition, environ un millier d’exemplaires, ne comportant que les deux premiers livres, est publiée à Bordeaux en 1580. La deuxième en 1582, de retour de son grand voyage en Allemagne et en Italie, étant maire de Bordeaux. Dès 1587, un imprimeur parisien réimprime les Essais sans attendre les annotations de Montaigne. Le livre se vend très bien. Une nouvelle édition, estimée à 4000 exemplaires, est éditée à Paris en 1588, avec le livre III, où la peinture du Moi atteint toute son ampleur et nous fait entrer dans l’intimité de sa pensée. Le succès de ses premières éditions, l’âge aussi lui donnent de l’assurance : « Je dis la vérité, non pas tout mon saoul, mais autant que j’ose la dire, et j’ose un peu plus en vieillissant. » Il est attentif à se montrer en perpétuel devenir : « Je ne peins pas l’être, je peins le passage, non un passage d’un âge à un autre, mais de jour en jour, de minute en minute31. » Il est alors bien conscient de la portée de son projet : en s’étudiant pour se faire connaître, il fait connaître ses lecteurs à eux-mêmes. « Si les gens se plaignent de ce que je parle trop de moi, moi je me plains de ce qu’ils ne pensent même pas à eux-mêmes. »
Il prépare une nouvelle mouture de son livre, l’Exemplaire de Bordeaux quand il meurt en 1592.
Soldat et diplomame.
Il est vraisemblable que Montaigne, convoqué par le roi comme tout gentilhomme, a pris part aux guerres qui se sont déchainées entre 1573 et 1577. Les Essais ne disent pas à quels engagements il a pris part et les historiens et mémorialistes n’en font pas mention. Mais plusieurs allusions prouvent qu’il a été soldat et la part (le dixième) des livres I et II consacrée à l’armement et aux problèmes de stratégie montre son intérêt pour la vie militaire. Mais il condamne la guerre civile et la guerre de conquête, s’il admet la guerre défensive. Quant aux cruautés des guerres religieuses : « Je pouvais avec peine me persuader, avant de l’avoir vu, qu’il eût existé des âmes si monstrueuses (…) pour inventer des tortures inusitées et des mises à mort nouvelles, sans inimitié, sans profit et à seul fin de jouir de l’amusant spectacle des gestes et des mouvements pitoyables, des gémissements et des paroles lamentables d’un homme mourant dans la douleur. »
Montaigne est toujours resté discret sur ses activités de négociateur. Nous savons cependant par les Mémoires de de Thou qu’il est chargé à la cour des négociations entre Henri de Navarre et Henri de Guise, peut-être en 1572. En 1574, à la demande du gouverneur de Bordeaux, il doit mettre fin à la rivalité entre les chefs de l’armée royale du Périgord et, en 1583, il s’entremet entre le maréchal de Matignon, lieutenant du roi en Guyenne et Henri de Navarre. Ce dernier lui rend visite à Montaigne en 1587. Enfin, en 1588, il est chargé d’une mission entre le roi de France et le roi de Navarre, mission dont on ignore l’objet précis mais dont la correspondance diplomatique fait état (proposition d’alliance militaire contre la Ligue ? éventualité d’une abjuration d’Henri de Navarre ?).
Montaigne décrit dans les Essais l’attitude qu’il a toujours adoptée « dans le peu que j’ai eu à négocier entre nos princes » : « Les gens du métier restent le plus dissimulés qu’ils peuvent et se présentent comme les hommes les plus modérés et les plus proches des opinions de ceux qu’ils approchent. Moi je me montre avec mes opinions les plus vives et sous ma forme la plus personnelle : négociateur tendre et novice, j’aime mieux faillir à ma mission que faillir à moi-même ! Cette tâche a pourtant été faite jusqu’à cette heure avec une telle réussite (assurément le hasard y a la part principale) que peu d’hommes sont entrés en rapport avec un parti, puis avec l’autre, avec moins de soupçon, plus de faveur et de familiarité. »
Voyageur
Coffre du château de Montaigne dans lequel fut retrouvé en 1770 par l'abbé Prunis, chanoine érudit spécialiste de l’histoire du Périgord, le manuscrit du Journal de voyage édité en 1774.
« Faire des voyages me semble un exercice profitable. L’esprit y a une activité continuelle pour remarquer les choses inconnues et nouvelles, et je ne connais pas de meilleure école pour former la vie que de mettre sans cesse devant nos yeux la diversité de tant d’autres vies, opinions et usages. »
Voyage en Italie par Michel de Montaigne 1580-1581
En 1580, après la publication des deux premiers livres des Essais, Montaigne entreprend un grand voyage de quelque dix-sept mois à travers la Suisse, l’Allemagne et l’Italie, à la fois pour soigner sa maladie – la gravelle (coliques néphrétiques) dont son père avait souffert sept ans avant de mourir – dans diverses villes d’eaux, se libérer de ses soucis de maître de maison (« Absent, je me défais de toutes pensées de cette sorte, et je ressentirais alors moins l’écroulement d’une tour que je ne fais, présent, la chute d’une ardoise. ») et du spectacle désolant de la guerre civile « Dans mon voisinage, nous sommes à présent incrustés dans une forme d’État si déréglée qu’à la vérité c’est miracle qu’elle puisse subsister […] Je vois des façons de se conduire, devenues habituelles et admises, si monstrueuses, particulièrement en inhumanité et déloyauté que je ne peux pas y penser sans éprouver de l’horreur. ».
Le Journal de voyage n’est pas destiné au public. C'est une simple collection de notes qui parlent surtout de la santé de Montaigne, il note tous les incidents de sa maladie qu’il veut apprendre à connaître) et des curiosités locales, sans le moindre souci littéraire. La première partie (un peu moins de la moitié est rédigée par un secrétaire qui rapporte les propos de « Monsieur de Montaigne », la deuxième par Montaigne en italien à titre d’exercice. Il permet de saisir Montaigne sans apprêt.
Les voyages sont alors non sans risques ni difficultés et fort coûteux « Les voyages ne me gênent que par la dépense qui est grande et excède mes moyens. ». Montaigne, qui part en grand équipage (son plus jeune frère, son beau-frère, un secrétaire, des domestiques, des mulets portant les bagages. Charles d’Estissac, le fils d’une amie, qui se joint à lui et partage la dépense est escorté d’un gentilhomme, d’un valet de chambres, d’un muletier et de deux laquais) et qui aime les logis confortables « dut dépenser une petite fortune sur les routes d’Europe38» .
Le Journal permet de connaître très exactement l’itinéraire des voyageurs. Ils s’arrêtent en particulier à Plombières (11 jours), à Bâle, à Baden 5 jours, à Munich, à Venise (1 semaine), à Rome haut lieu de l'Antiquité romaine (5 mois) et à Lucques (17 jours).
Montaigne voyage pour son plaisir. « S’il ne fait pas beau à droite, je prends à gauche; si je me trouve peu apte à monter à cheval, je m’arrête… Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi ? J’y retourne ; c’est toujours mon chemin. Je ne trace à l’avance aucune ligne déterminée, ni droite ni courbe (…) J’ai une constitution physique qui se plie à tout et un goût qui accepte tout, autant qu’homme au monde. La diversité des usages d’un peuple à l’autre ne m’affecte que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison d’être. » Les rencontres surtout l’intéressent, le plaisir de « frotter et limer » sa cervelle à celle d’autrui: autorités des lieux visités auxquelles il rend toujours visite et qui le reçoivent souvent avec beaucoup d’égards, « gens de savoir », personnalités religieuses les plus diverses (un des intérêts du voyage est de mener une vaste enquête sur les croyances). Il est assez peu sensible aux chefs-d’œuvre de l’art ou aux beautés de la nature.
En septembre 1581, il reçoit aux bains de Lucques la nouvelle qu’il a été élu maire de Bordeaux. Il prend alors le chemin du retour.
Maire de Bordeaux
Estampe de Montaigne par Thomas de Leu ornant l'édition des Essais de 1608, exécuté d'après celui du musée Condé. Le quatrain qui suit est attribué, sans fondement, à Malherbe.
« Messieurs de Bordeaux41 m’élurent maire de leur ville alors que j’étais éloigné de la France et encore plus éloigné d’une telle pensée. Je refusai, mais on m’apprit que j’avais tort, l’ordre du roi intervenant aussi en l’affaire. » En arrivant à son château, Montaigne trouve une lettre de Henri III le félicitant et lui enjoignant de prendre sa charge sans délai. « Et vous ferez chose qui me sera agréable et le contraire me déplairait grandement » ajoute le roi.
Il est vraisemblable que ce sont les qualités de négociateur de Montaigne, sa modération, son honnêteté, son impartialité et ses bonnes relations avec Henri III et Henri de Navarre, qui l’ont désigné pour ce poste.
« À mon arrivée, j’expliquai fidèlement et consciencieusement mon caractère, tel exactement que je le sens être : sans mémoire, sans vigilance, sans expérience et sans vigueur ; sans haine aussi, sans ambition, sans cupidité et sans violence, pour qu’ils fussent informés et instruits de ce qu’ils avaient à attendre de mon service (…) Je ne veux pas que l’on refuse aux charges publiques que l’on assume l’attention, les pas, les paroles, et la sueur et le sang au besoin, mais je veux que l’on s’acquitte de ces fonctions en se prêtant seulement et accessoirement, l’esprit se tenant toujours en repos et en bonne santé, non pas sans action, mais sans tourment et passion.» Sans passion surtout car : « Nous ne conduisons jamais bien la chose par laquelle nous sommes possédés et conduits. »
Moyennant quoi, Montaigne déploie une grande activité pendant son mandat de maire pour conserver la ville en paix alors que les troubles sont incessants entre catholiques et protestants, le Parlement divisé entre catholiques ultras la Ligue et modérés et la situation politique particulièrement délicate entre le roi de France représenté sur place par le maréchal de Matignon, lieutenant général et le roi de Navarre, gouverneur de la province.
Après deux ans de fonction, il est réélu en 1583 rare honneur qui n’a été accordé que deux fois avant lui malgré l’opposition violente de la Ligue.
À six semaines de l’expiration de son deuxième mandat 31 juillet 1585, la peste éclate à Bordeaux et fait de juin à décembre environ quatorze mille victimes. Montaigne absent ne revient pas dans la ville pour la cérémonie d’installation de son successeur et regagne son château, avouant sans embarras dans une lettre qu’il craint la contagion. Cet incident - dont aucun contemporain ne parle - déclenchera trois siècles plus tard une polémique, les critiques de Montaigne lui reprochant d’avoir manqué aux obligations de sa charge.
Livre unique et livre mystère, repris et modifié incessamment pendant toute une vie, les Essais paraissent être un mélange de substances disparates, de thèmes désaccordés. Est-ce un livre éclaté – mais où situer son point d'éclatement ? Un nouveau mode de pensée qui détruit les systèmes de l'Antiquité, quitte à réutiliser leurs ruines ? Un livre du moi qui libère pour l'avenir l'écriture de la subjectivité ? Un croisement inédit de ces deux projets ?
La critique s'est longuement posé toutes ces questions. Il reste qu'on ne saurait lire les Essais sans revenir encore au titre : Montaigne s'« essaie » (s'exerce, s'examine). Il est donc indispensable que le monde fasse irruption dans le livre et qu'inversement l'auteur réagisse à ce monde : la politique le stimule, la critique des mœurs l'intrigue, l'injustice l'indigne, les idéologies le provoquent, les utopies l'attirent.
La vie publique
Michel Eyquem naquit au château de Montaigne d'une famille de noblesse récente et fut d'abord élevé selon les méthodes pédagogiques libérales dont il parlera dans ses Essais (I, 26, « De l'institution des enfants »). Entré à six ans au collège de Guyenne à Bordeaux, il fit ensuite des études de droit à Toulouse ou à Paris. Conseiller à la cour des aides de Périgueux, puis au parlement de Bordeaux, il se lie d'une profonde amitié avec Étienne de La Boétie, qui mourra en 1563. Il avait commencé entre-temps, à la demande de son père, la traduction de la Theologia naturalis de Raymond Sebond (dont l'énigmatique Apologie se lit dans les Essais, II, 12). En 1565, Montaigne se marie avec Françoise de La Chassaigne, fille d'un parlementaire bordelais. À la mort de son père (1568), il hérite du nom et du patrimoine et, en 1571, démissionne de sa charge. Il s'occupe d'abord de faire publier à Paris les écrits de La Boétie, ensuite il se retire dans sa « librairie ». Sans s'exclure pour autant de la vie politique, il consacre le plus clair de son temps à la rédaction des Essais : la première édition en deux livres paraît à Bordeaux en 1580.
Montaigne entreprend en juin de la même année un long voyage en Italie à travers la Suisse et l'Allemagne, dans le but officiel de soigner aux eaux thermales de ces pays la gravelle qui le tourmentait depuis deux ans, mais sans doute aussi pour s'éloigner de la France, tourmentée par les guerres civiles, en accomplissant une sorte de pèlerinage humaniste ; le souci de vérifier les possibilités d'accord entre réformés et catholiques inspire peut-être l'enquête qu'il mène au passage sur la situation religieuse dans les pays protestants ou de confession mixte. À Rome, ses Essais sont soumis à la censure pontificale : Montaigne ne se corrigera cependant pas dans la nouvelle édition de son ouvrage (1582). Le Journal qu'il a laissé de ce voyage, rédigé au début par un « secrétaire » dont on ignore l'identité, ensuite par lui-même et en partie en italien, n'était pas destiné à la publication. Il fut retrouvé et édité en 1774.
Rentré à Bordeaux en novembre 1581, Montaigne assume la charge de maire qui lui a été conférée en son absence ; il sera réélu deux ans plus tard. Au cours de sa magistrature, honnête et courageuse, il joue le rôle de médiateur entre le parti du roi de France et celui d'Henri de Navarre. Après 1586, il travaille surtout à la nouvelle édition des Essais (1588) qu'il augmente d'un troisième livre et de plus de six cents additions aux deux premiers. Il continue néanmoins à jouer un rôle politique de médiateur entre Henri III et Henri de Navarre, héritier présomptif de la Couronne. Dans ce cadre, au cours d'un voyage à Paris en 1588, il rencontre Marie de Gournay qu'il appellera sa « fille d'alliance » et qui se chargera de l'édition posthume des Essais. Montaigne continuera en effet, jusqu'à sa mort, à travailler à son ouvrage sur un exemplaire de l'édition de 1588 dont les marges se couvriront d'environ un millier d'additions. Les éditions publiées par Marie de Gournay, depuis la première (1595) jusqu'à la définitive (1635), reproduites jusqu'au XIXe siècle, ne sont pas fidèles au manuscrit original, dit exemplaire de Bordeaux, sur lequel se fondent les éditions modernes. Mais l'édition critique qui permettra de suivre le devenir de l'œuvre dans toutes ses mutations est encore à faire.
S'essayer par doute
Comment Montaigne n'aurait-il pas tout mis dans ce livre singulier à titre pluriel ? Comment n'aurait-il pas admis la discordance entre des titres de chapitres et un contenu accidentel grossissant et se bariolant sous les retours de sa plume ?
Peu importe l'objet dont il traite : toute occasion lui est bonne pour mettre son jugement à l'épreuve. Peu importe aussi, à la limite, le résultat auquel il parvient – affirmation, doute, refus – dans la mesure où il ne prétend jamais le proposer comme une vérité assurée, mais seulement comme un témoignage subjectif, une opinion personnelle. On risque fort de ne pas saisir l'intérêt de ce livre vertigineux, l'une des plus surprenantes inventions littéraires de l'âge moderne, si l'on ne cherche pas à comprendre la démarche intellectuelle spécifique qui l'anime : l'« essai » – terme souvent utilisé par la critique pour désigner les subdivisions de l'ensemble, que Montaigne appelle « chapitres » – dénote précisément cette démarche ; on dira donc que l'essai est en acte dans chaque chapitre, mais chaque chapitre n'est pas (pas toujours, du moins) un essai. En voulant identifier les catégories implicites qui y sont à l'œuvre, on découvre une forme particulière du pyrrhonisme, compris comme une philosophie de la recherche perpétuelle, un exercice de la raison délivrée de ses illusions ; s'opposant au scepticisme négatif et à sa contestation radicale et stérile du savoir, ainsi qu'au dogmatisme qui prétend se fonder sur des vérités irrécusables, ce pyrrhonisme problématique vise des acquis qu'il sait toujours provisoires et toujours à dépasser : « Nous sommes nés à quêter la vérité ; il appartient de la posséder à une plus grande puissance. »
Le livre du deuil
La formule : « Ce ne sont mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence », ne doit pas abuser. Le terme d'« essence » ne fonde en rien un moi transcendant. Il traduit en programme d'écriture une intuition tardive (la phrase appartient à la dernière couche textuelle), mais fulgurante. En se débarrassant ainsi de ses « gestes », autrement dit de la chronologie, Montaigne se situe dans l'achronie de l'inconscient, il balaie les ombres de son temps biographique, il élimine la lanterne magique de l'expérience revécue, réinterprétée, réinventée : sans rien d'autre devant lui – sauf ce qu'on pourrait nommer le désir d'écrire à l'état pur –, il peut franchir le pas qui l'autorise, alors qu'il dit « je », à laisser apparaître ses fissures de sujet.
Il faut tenir compte, pour l'émergence de ce besoin d'écrire, projet fondamental autour duquel s'organisera toute l'existence de Montaigne, et pour la formation de ce sujet scripteur, du sens des deux deuils successifs qui frappent l'individu et qui tout à la fois l'affranchissent en lui permettant de gagner son autonomie : la mort de La Boétie, l'ami unique, de trois ans son aîné, qui dut jouer le rôle d'un guide spirituel ; ensuite la mort de Pierre Eyquem, ce « si bon père » dont les Essais semblent célébrer l'apologie. Montaigne reconnaît lui-même avoir été poussé à écrire par « une humeur mélancolique [...] produite par le chagrin de la solitude » ; et le premier texte de sa plume que nous connaissons est la lettre à son père sur la mort de La Boétie.
Le décès de l'ami constitue la donnée essentielle à partir de laquelle Montaigne s'affirme écrivain. Les Essais auraient pu se structurer sous forme de lettres, si précisément le destinataire privilégié n'avait fait défaut : ils sont en quelque sorte le moyen, pour Montaigne, de continuer son dialogue avec le disparu, à qui l'ouvrage est implicitement dédié. Le premier livre, en effet, est tout entier construit autour du texte qui avait procuré à Montaigne la « première connaissance » de celui qui allait devenir son compagnon : le Discours de la servitude volontaire de La Boétie, qui aurait dû figurer en son centre, présenté comme un tableau accompli entouré de grotesques. Il en fut retranché (dit Montaigne dans le chapitre « De l'amitié »), car il avait été publié entre-temps par les protestants qui en avaient fait un usage tendancieux ; mais il en reste le foyer virtuel, autour duquel se dessine dans les Essais le rapport fondamental et sûrement complexe par lequel Montaigne appréhende l'amitié, la possession et la dépossession de soi, la façon de régler sa relation au monde. La mort du père, cinq ans plus tard, qui joue certainement un rôle de délivrance, donne à Montaigne son indépendance matérielle et morale, et lui permet de prendre ses distances avec cette figure sans doute oppressante : il s'agit pour lui de se démarquer du modèle de Pierre Eyquem – homme pratique, doué de bon sens et de qualités administratives, par ailleurs médiocrement cultivé, d'après son fils lui-même –, et de refuser les rôles qui avaient été ceux du défunt. Magistrat réticent et démissionnaire, Montaigne va construire de soi une image contraire et s'affirmer par le livre dans le domaine de la méditation et des lettres.
Les monstres dans la bibliothèque
Mais comment, par quelles voies, ce « je » problématique et « mélancolique » entre-t-il en écriture ? De quelle façon se réalise ce projet insolite, cette « sotte entreprise » qui consiste à se prendre soi-même pour argument et pour sujet ? « Me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute autre matière, je me suis présenté moi-même à moi, pour argument et pour sujet », dit Montaigne, se proposant de « mettre en rôle » – encore un terme juridique –, d'enregistrer les « chimères et monstres fantasques » qu'enfante son esprit laissé « en pleine oisiveté ». S'agit-il de canaliser le flux capricieux de ses rêveries pour éviter la dispersion de la pensée ? Ou bien ces monstres et chimères pourraient-ils désigner les fantasmes émergeant des profondeurs de son inconscient ? Ce livre aurait en tout cas pour fonction d'élaborer un discours rationnel qui tienne les « monstres » à distance, qui vise à les apprivoiser : Montaigne, ce champion de la lucidité, écrirait pour découvrir l'étranger qui est en lui, pour le neutraliser peut-être. L'écriture des Essais, une thérapie sans fin qui, revendiquant l'ordre et la logique, résiste au charme étrange de la folie, et mobilise contre elle la puissance rédemptrice de la parole raisonnable ? Quoi qu'il en soit, comme toute écriture, celle des Essais est une lutte à coups de plume contre une inquiétude essentielle : Montaigne écrit pour s'écrire, pour liquider un malaise intime.
Livre de l'exil intérieur et livre au destinataire aboli, ce registre des impressions plus que des actions, des activités propres à l'otium plus que des événements extérieurs, peut trouver son prototype dans certaines pratiques scripturales de l'Antiquité : l'épître bien sûr (les Lettres à Lucilius de Sénèque, auxquelles on pourrait apparenter les Essais en tant que lettre interminable adressée à La Boétie), ou les Œuvres morales de Plutarque dont Montaigne admire tant la liberté d'allure ; mais surtout, sans doute, les hypomnèmata, ces calepins où l'on transcrivait pour mémoire des citations, des exemples, des réflexions personnelles ou venues d'autrui, afin de constituer non pas un magasin d'objets inertes, mais un réservoir de matériaux utilisables pour la méditation ultérieure. Il s'agissait, Michel Foucault l'a souligné dans Le Souci de soi, de capter le déjà-dit, de « rassembler ce qu'on a pu entendre ou lire, et cela pour une fin qui n'est rien moins que la constitution de soi ». De toute évidence, à la base de la pratique constitutive des Essais, il existe un processus similaire de lecture-écriture-relecture du déjà-écrit, dont la fonction est de former non un corps de doctrine mais, suivant la métaphore de la digestion si souvent employée par Montaigne, le corps même de celui qui, en transcrivant ces lectures, les a justement incorporées : à savoir, le corps du « livre consubstantiel à son auteur », qui forme celui qui l'écrit autant qu'il en est formé : « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. » Montaigne a dû commencer précisément par noter, en lisant, ce qui l'intéressait. « Un livre né des livres, écrit en marge d'autres livres », disait Albert Thibaudet, bourré de débris venus d'ailleurs.
Mais tout livre vit de la tension entre la présence envahissante du discours d'autrui et l'intention d'une écriture propre et personnelle : le déjà-dit est le lieu d'émergence du sujet. Le « je » scripteur ne saurait se définir autrement que par rapport à la société dont il parle et qui parle à travers lui avec le langage qui appartient à tous : chaque écriture de la subjectivité oscille inévitablement entre deux types de discours, menés par un « je » et par un « il », où « il » est l'« autre », la machine de la culture et de l'écriture, avec ses lieux communs, son encyclopédie aliénée, ses fantasmes envahissants. Le texte, tout texte – mais surtout le texte réflexif, qui parle de lui-même – se produit comme une dispute entre « je » et l'« autre » : « Les autres forment l'homme ; je le récite » n'est que le fragment le plus souvent cité parmi tous ceux où ce débat est explicitement inscrit dans les Essais.
C'est précisément sur cette charnière mobile que s'articule, d'une manière forcément titubante et obscure, le processus de la constitution du sujet. Et c'est dans cette perspective qu'il faut considérer la pratique de la citation chez Montaigne : le dialogue avec les autres auteurs, le choc des opinions constituent l'indispensable provocation extérieure qui lui permet d'actualiser son potentiel d'invention, de formuler l'idée latente. Le jeu des citations est un « art de conférer » par lequel Montaigne « essaie » le discours d'autrui. Ni parole gelée ni simple matériau transformable, la citation est un noyau d'énergie verbale qui dynamise le texte où elle se loge, pour s'en trouver modifiée à son tour. Aussi est-ce par ce travail d'une écriture qui se constitue en organisant à nouveau celle des autres, qui sollicite le vocabulaire, creuse les mots en jouant sur leur étymologie et dérive presque systématiquement sur les signifiants en multipliant jeux phoniques, allitérations, paronomases, que les Essais se séparent du discours humaniste, de la tautologie encyclopédique de la Renaissance, et se situent sur le versant de l'invention et de l'imaginaire. L'analyse de ce travail montre à travers quels mécanismes Montaigne déjoue le pouvoir phagocytaire de la citation, dont il est parfaitement averti : « Comme quelqu'un pourrait dire de moi que j'ai seulement fait ici un amas de fleurs étrangères, n'y ayant fourni du mien que le filet à les lier. Certes, j'ai donné à l'opinion publique que ces parements empruntés m'accompagnent. Mais je n'entends pas qu'ils me couvrent, et qu'ils me cachent : c'est le rebours de mon dessein, qui ne veux faire montre que du mien, et de ce qui est mien par nature ; et si je m'en fusse cru, à tout hasard, j'eusse parlé tout fin seul. » Mais personne, Montaigne le sait, ne peut parler « tout fin seul ». Si une chance existe pour le sujet de parler tout en étant parlé, d'écrire tout en étant écrit, elle est bien dans ces opérations textuelles : brèche ouverte dans la barrière des stéréotypes, à travers laquelle le sujet peut se sauver, en se délimitant dans la pluralité des autres, pour se dire à son tour, avec sa propre voix, et se représenter dans sa propre énonciation.
Lire La suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... php?topic_id=4021&forum=4
Posté le : 13/09/2015 22:01
Edité par Loriane sur 14-09-2015 22:31:24
Edité par Loriane sur 14-09-2015 22:34:28
Edité par Loriane sur 14-09-2015 22:35:32
Edité par Loriane sur 14-09-2015 22:36:34
|
|
|
|
|
Re: Alcide Charles Victor Marie Dessalines d'Orbigny |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 26014
|
Souvenirs, souvenirs,
Cela me rappelle mes études de paléontologie.
Il est un grand au panthéon des paléontologistes qui nous ont éclairé sur l'origine des espèces.
Merci Loriane.
Amitiés de Bourgogne.
Jacques
Posté le : 13/09/2015 21:03
|
|
|
|
|
Re: Luciano Pavarotti |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 26014
|
Chère Loriane,
Quel bonheur aussi de lire cet article sur Pavarotti.
J'étais toujours ému à l'écoute de sa voix. Elle me conduisait et me conduit encore dans l'absolu!
Je pouvais en avoir la chair de poule!
Merci vraiment.
Amitiés de Bourgogne.
Jacques
Posté le : 13/09/2015 20:54
|
|
|
|
|
Re: Rodolphe III de Bourgogne |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 26014
|
Chère Loriane,
Je lis la plupart de tes écrits mais je ne pense pas à te faire un petit mot.
Alors je le fais ici avec d'autant plus de plaisir que tu écris sur la région de mon coeur: la Bourgogne.
Eh oui, nous avons eu une grande Bourgogne qui allait bien au delà de ses frontières étriquées actuelles.
En lisant ton texte, j'ai repensé aussi au destin désastreux de notre Charles Le Téméraire qui désirait tant reconstitué le royaume de Bourgogne.
Faisons un peu d'histoire fiction. Tiens, je ferai un texte à ce sujet. Charles Le Téméraire n'est pas mort à Nancy. Il a survécu et il est devenu Roi de Bourgogne. A la bataille de Molois en Bourgogne, il vainquit les armées de Louis XI. Et ....
Merci pour tous les textes que tu nous proposes et qui font de ce site un site de grande valeur intellectuel mais aussi de partage.
Je m'y sens bien.
Amitiés de Bourgogne, bien sûr.
Jacques
Posté le : 13/09/2015 20:45
|
|
|
|
|
Alexis Emmanuel Chabrier |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57700
|
Le 13 septembre 1894 meurt, Alexis Emmanuel Chabrier
à 53 ans, à Paris, compositeur romantique français né à Ambert le 18 janvier 1841 . Bien que principalement connu pour deux de ses œuvres orchestrales, España et Joyeuse Marche, il composa de nombreux opéras, pièces pour piano et chansons. Ses créations étaient admirées de nombreux compositeurs, comme Debussy, Ravel, Satie, Richard Strauss, ou encore Stravinsky.
Chabrier était ami avec beaucoup d'écrivains et de peintres de son temps, comme Claude Monet, Édouard Manet, Émile Zola ou encore Alphonse Daudet, avec qui il entretenait une grande amitié. Admirateur des peintres impressionnistes, il acheta de nombreuses toiles, dont certaines sont aujourd'hui exposées dans les plus grands musées du monde.
Entré dans l'Administration, il démissionna en 1879 afin de se consacrer à la musique. Il a écrit des mélodies l'Invitation au voyage, Ode à la musique, 1890 ; des œuvres pour piano Bourrée fantasque, 1891 ; des œuvres pour orchestre España, 1883, des opéras le Roi malgré lui, 1887. Chabrier se tourna de préférence vers les sources populaires françaises ou espagnoles et les recherches rythmiques. Son style est plein de jovialité exubérante et de vitalité ardente.
En bref
Né dans une famille bourgeoise implantée en Auvergne depuis plusieurs générations, il étudia, à six ans, le piano avec Manuel Zaporta, puis Mateo Pitarch. En 1852, ses parents s'installèrent à Clermont-Ferrand, où il travailla avec le violoncelliste Tarnowski. Une de ses compositions, Aïka, polka mazurka arabe, fut imprimée à Riom. En 1856, il suivit ses parents à Paris, où, tout en poursuivant ses études classiques, il étudia le piano avec Édouard Wolff, tandis que Th. Semet, puis R. Hammer et A. Hignard lui enseignèrent l'écriture. Bien qu'il se sentît une vocation de compositeur, Emmanuel Chabrier sembla accepter sans révolte l'idée de suivre la tradition familiale en poursuivant des études de droit qui le menèrent au ministère de l'Intérieur, où il resta de 1861 à 1880.
Peu après, il fréquentait le milieu parnassien et s'y liait avec Verlaine, qui lui fournit le livret de deux opéras bouffes, Fisch-Ton-Kan et Vaucochard et Fils Ier. Les poètes qu'il rencontra alors lui inspirèrent, en 1862, neuf mélodies. Cette même année parurent ses Souvenirs de Brunehaut pour piano. Mais un projet plus ambitieux devait le retenir à partir de 1867 : la composition d'un opéra en 4 actes sur un livret de H. Fouquier : Jean Hunyade. À cette époque, il se lia aussi avec les impressionnistes, dont il allait être l'un des rares et des plus avertis collectionneurs. Son ami Manet fit plusieurs portraits de lui.
En 1876, Chabrier devint membre de la Société nationale de musique qui allait accueillir la plus grande partie de ses œuvres. Son Larghetto pour cor et orchestre y fut créé en 1877 et, l'année suivante, son Lamento pour orchestre. En 1877, le théâtre des Bouffes-Parisiens avait créé son opéra bouffe, l'Étoile. L'opérette Une éducation manquée fut jouée en 1879 dans un cercle privé. L'audition de Tristan et Isolde à Munich, en 1880, bouleversa le compositeur. L'année suivante, son ami Lamoureux créa les Nouveaux Concerts et l'appela pour le seconder dans l'étude des œuvres wagnériennes qui allaient former le fond de son répertoire. Le musicien venait de composer ses Pièces pittoresques pour piano. Un voyage à travers l'Espagne, au cours de l'automne de 1882, lui inspira España. Donnée en première audition par Lamoureux en 1883, cette œuvre rendit son auteur célèbre. Cette même année, il donna à la Société nationale de musique ses Valses romantiques pour 2 pianos.
1883 marqua un changement dans la vie de Chabrier. Désormais, il séjourna plusieurs mois, chaque année, à La Membrolle, petit village de Touraine, où il composa la majeure partie de son œuvre. Après plusieurs tentatives lyriques infructueuses Jean Hunyade, 1867 ; le Sabbat, 1877 ; les Muscadins, 1878, il composa Gwendoline, puis le Roi malgré lui. Mais ces deux œuvres virent leur essor arrêté peu après leur création : le 10 avril 1886, à la Monnaie de Bruxelles pour Gwendoline, abandonnée après quelques représentations à la suite de la faillite du directeur ; le 18 mai 1887, pour le Roi malgré lui, à l'Opéra-Comique qui brûla une semaine plus tard. Quant à Briséis, Chabrier ne put l'achever pour raison de santé. Seul le premier acte fut joué après sa mort par Lamoureux (1897), avant d'être monté par l'opéra de Berlin, puis par celui de Paris. Sans l'amitié agissante de Félix Mottl qui accueillit avec succès Gwendoline, en 1889, et le Roi malgré lui, en 1890, au théâtre de Karlsruhe, favorisant ainsi leurs entrées sur plusieurs grandes scènes d'outre-Rhin (Munich, Leipzig, Dresde, Cologne, Düsseldorf) , Chabrier n'aurait connu que d'éphémères succès.
Avant d'assister, impuissant, à la perte progressive de ses facultés, le compositeur écrivit encore quelques œuvres radieuses où apparaissent les deux faces de son génie cocasse et tendre. Prélude et Marche française qu'il rebaptisa Joyeuse Marche fut créé en 1888 à l'Association artistique d'Angers, sous sa direction, avec Suite pastorale formée de quatre des Pièces pittoresques orchestrées, Idylle, Danse villageoise, Sous-Bois et Scherzo-Valse. En 1890, il publia une série de mélodies d'aspect tout nouveau, qu'il baptisa avec humour ses « volailleries ». Cette même année, il réorchestra la Sulamite vieille de six ans, et composa, pour l'inauguration de la maison d'un ami, l'Ode à la musique. Avec la Bourrée fantasque de 1891 confiée au piano sur lequel il fut, au témoignage de tous, un remarquable virtuose , il abandonna son papier réglé sur un chef-d'œuvre qui inaugurait une nouvelle manière de traiter cet instrument.
Chabrier déroute. Comme son ami Manet, il présente plusieurs manières admirables d'être soi . Ses volte-face déconcertent. À peine remis de l'audition de Tristan et Isolde, qui l'assombrit, et le fit douter de lui, il composa allégrement l'éblouissante España. Connu pour son fervent wagnérisme Fantin-Latour le campa devant le piano au centre d'une grande toile que le public baptisa les Wagnéristes ; le pape du wagnérisme, Lamoureux, se l'attacha à la fondation des Nouveaux Concerts , il aborda la composition par de désopilantes opérettes écrites en collaboration avec son ami Verlaine : Fisch-Ton-Kan et Vaucochard et Fils Ier. Il écrivit des œuvres plus ambitieuses que ces tentatives de jeunesse, mais sans abandonner pour autant sa veine comique. Parallèlement à Gwendoline et à Briséis, drames lyriques wagnériens d'intention, surtout à cause des livrets de Catulle Mendès, il composa non seulement d'autres opérettes comme l'Étoile, Une éducation manquée, le Roi malgré lui opéra bouffe transformé en opéra-comique à la demande de Carvallho , mais également des pièces orchestrales comme la Joyeuse Marche ou des romances telles que la cocasse suite des « volailleries », ainsi qu'il nommait plaisamment la Villanelle des petits canards, la Ballade des gros dindons, les Cigales, la Pastorale des cochons roses.
Ce ne fut pas par hasard que des musiciens des plus divers, voire les plus étrangers les uns aux autres, chérirent comme un père spirituel un compositeur si mobile dans ses expressions. Son influence se décèle dans les directions les plus opposées, chez Fauré comme chez Richard Strauss, chez Messager comme chez Satie, chez Ravel, qui le vénéra, et chez Debussy, qui pourtant était plus secret sur ses sources, mais dont le Pelléas rappelle Briséis, chez R. Hahn et chez M. de Falla, chez Milhaud, Poulenc, etc.
Mais quel que fût le genre qu'il adopta, comique ou grave, léger ou dramatique, la rupture des styles reste de surface et n'affecte pas sa manière. En toutes circonstances réapparaissent des obsessions syntaxiques qui lui confèrent un visage très particulier, où la tendresse, le chatoiement harmonique, l'imprévu rythmique, l'ardeur, la naïveté, tout un monde de sensations captées dans l'allégresse se combinent subtilement.
Il n'aborda d'ailleurs pas les grandes surfaces. Point de symphonies, de poèmes symphoniques, de sonates comme chez ses amis de la Société nationale de musique qui gravitèrent autour de Franck. Chabrier fut un musicien sérieux, mais c'était un sérieux qui se cachait. Il ne joua pas les importants. La hiérarchie des genres, il l'ignorait et, de même que ses amis impressionnistes, Manet, Monet, Renoir, Sisley, Cazin, Sargent, dont les toiles, et des plus belles, illuminèrent son appartement, il traita avec une lucide conscience de courtes pages pour le piano comme l'Impromptu en ut majeur (1873) dédié on pourrait dire symboliquement à Mme Manet, de petites pièces improprement appelées « pittoresques », la Bourrée fantasque ou des romances comme la troublante Chanson pour Jeanne, de même que ces peintres aimés donnèrent, par leurs vertus strictement picturales, de la noblesse à des sujets qui en principe n'en avaient guère : une serveuse de bar, une femme enfilant ses bas, une danseuse de café-concert…
Cet autodidacte « écrivit » comme personne, avec la science cachée d'un maître déduisant avec sûreté l'effet recherché. Néanmoins, un départ relativement tardif dans la carrière musicale, un emploi de fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, un enseignement musical dispensé hors des écoles patentées lui créèrent une réputation d'amateur. Lui-même ne fut pas sans en éprouver un obscur complexe. « J'ai peut-être plus de tempérament que de talent », confia-t-il trois ans avant sa mort. « De nombreuses choses que l'on apprend dans sa jeunesse, je ne les conquerrai plus jamais. » Sans doute regrettait-il cette aisance à composer qu'il observa chez tant de ses amis et camarades, Saint-Saëns, Massenet, Messager, Lecocq. « Je n'ai pas ce que l'on appelle de la facilité ! » soupira-t-il. Il est vrai qu'il travaillait minutieusement, au petit point, dans une trame serrée, où vinrent s'entrecroiser des éléments variés.
On y trouve, et dès ses premières compositions, dès Fisch-Ton-Kan avant un Fauré par exemple, plus long à se dégager de l'emprise tonale , une utilisation très caractérisée des gammes modales. Les gammes défectives suivirent, comme par exemple dans la troisième des Valses romantiques. Wagner, Chopin, Schumann, qu'il a soigneusement étudiés, l'aidèrent à se libérer de contraintes d'une écriture toujours pesantes à l'esprit. Enchaînements inusités de neuvième parallèles, frottements audacieux autant que délicieux, accords incomplets sont chez lui autant de piments. Sa nature tellurique, liée à son hérédité auvergnate, lui fit, comme il le disait plaisamment, « rythmer sa musique avec ses sabots d'Auvergnat » et pas seulement dans la Bourrée fantasque et retrouver dans la polyrythmie espagnole un monde rythmique en liberté qui le confirmait dans sa voie. Et Berlioz, dont il avait réduit à quatre mains Harold en Italie en 1876, n'avait pu que renforcer sa tendance à rompre avec les carrures prévues. Ajoutons-y l'esprit léger, allusif, tout d'accentuation, en trompe-oreille, de la musique de nos grands clavecinistes, qui anime tant de ses œuvres, telles les Pièces pittoresques et la Suite pastorale qui en découle. Quant à son génie de l'orchestration, plus que chez certains musiciens, dont Berlioz en premier lieu, sa source pourrait en être décelée sur les toiles de ses amis impressionnistes où la couleur prélevée sur le motif irradie avec une véhémence et une pureté sans précédent. De même, sa couleur orchestrale aux timbres sans mélange, ignorant les bitumes, a pu choquer ou surprendre, jusqu'à paraître « crue, voire outrancière », même un ami et admirateur comme Vincent d'Indy, encore que le coup de soleil d'España lorsqu'il éclata sous la baguette de Lamoureux sous un tonnerre d'applaudissements ait, et pour longtemps, chassé plus d'une ombre, dissipé bien des brumes, éclairant vers l'avenir un radieux paysage musical français.
Sa vie
Né à Ambert Puy de Dôme, il passe par Clermont-Ferrand de 1852 à 1856 au lycée impérial avant de rejoindre le lycée Saint-Louis à Paris en 1856.
À partir de 1862, il travaille au ministère de l'Intérieur à Paris. En 1880, il choisit de se consacrer entièrement à la musique. Il fréquente les peintres Auguste Renoir, Claude Monet, Édouard Manet dont il est un fidèle admirateur.
Il meurt le 13 septembre 1894, à Paris. Il est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris.
Présentation de l'œuvre
Le style d'Emmanuel Chabrier est très varié : harmonies wagnériennes d'opéra Gwendoline, esprit mélodique d'opérette Duo de l'ouvreuse de l'Opéra-Comique et de l'employé du Bon Marché et de mélodies traditionnelles (Les plus jolies chansons du pays de France, créations amusantes Ballade des gros dindons.
En 1882, Chabrier se rend en Espagne. Ce voyage lui inspire sa plus célèbre œuvre, la rhapsodie España 1883, mélange d'airs populaires espagnols et des créations de son imagination. À en croire son ami Duparc, cette composition pour orchestre affirmait un style personnel, riche et très coloré. Ses compositions influencèrent de nombreux compositeurs français, notamment Claude Debussy, Maurice Ravel et Francis Poulenc. Joyeuse marche (un arrangement de ses propres partitions pour piano, Pièces pittoresques et España sont ses œuvres les plus connues. La femme de Renoir, ami de Chabrier, écrit de lui : Un jour, Chabrier vint, et joua España pour moi. Ce fut comme si un ouragan avait été libéré. Il battait et battait encore le clavier. Une foule s'était réunie dans la rue et écoutait, fascinée. Quand Chabrier atteignit les formidables derniers accords, je me jurai à moi-même de ne jamais plus toucher un piano... Il avait d'ailleurs cassé plusieurs cordes, et mis le piano complètement hors d'usage.
Il partage avec les Parnassiens un humour dans sa vision critique de la société.
Emmanuel Chabrier disait de lui-même : Je rythme ma musique avec mes sabots d'Auvergnat. » Au contraire de George Onslow, Chabrier ne fut cependant pas attaché à l'Auvergne et ne s'impliqua d'aucune façon dans la vie culturelle de cette région qu'il quitta très tôt pour s'installer à Paris. Il présida néanmoins l'association dénommée "La Soupe aux choux d'Auvergne", laquelle se réunissait régulièrement à Paris.
Comment définir Chabrier ? Quel trait choisir pour exprimer la juste physionomie de son art ? Qu'on cherche à le classer, et il se dérobe. Combien n'ont vu qu'une seule de ses expressions si variées, si mouvantes surtout et promptes à s'entrecroiser, à se superposer ? Rien d'étonnant dès lors à ce que divers clans ou écoles l'aient revendiqué, que des compositeurs dissemblables, voire opposés – un Milhaud, un Reynaldo Hahn – se soient retrouvés en lui.
Ce n'est pas que son œuvre soit abondante : le destin lui fut cruel et ne lui laissa que trop peu de temps pour la bâtir. Il disposa de vingt ans à peine pour composer ses pièces pour piano, quelques mélodies, chœurs et pièces d'orchestre, deux opérettes, un opéra-comique, deux opéras dont l'un, inachevé. Ce bagage léger tient pourtant une place considérable dans l'histoire de la musique. Car, si l'œuvre reflète les aspirations diverses et parfois contradictoires de leur auteur, elle connaît une unité profonde, elle est marquée du sceau particulier que le tempérament unique de Chabrier lui imprima. Cette œuvre, en effet, est moins le fruit d'une idée sur l'art qu'elle ne témoigne de la passion de son auteur à le vivre.
Chabrier, Wagner et les romantiques
Dès que Chabrier connaît Wagner, il en fait son dieu. À vingt et un ans, il recopie la partition entière de Tannhäuser. Il se rendra à Munich, à Bruxelles, à Bayreuth pour entendre et applaudir les œuvres du maître. À Paris, il sera l'un des piliers du « Petit Bayreuth » et ce n'est pas sans raison que Lamoureux, grand prêtre du wagnérisme en France, se l'attachera lorsqu'il créera, en 1881, les Nouveaux Concerts. Cependant, il aborde la composition par des opéras bouffes, tant la force comique est grande chez lui. Vers sa vingtième année, il écrit en collaboration avec son ami Verlaine deux opérettes restées inachevées, Fisch Ton Kan et Vaucochard et fils Ier. En 1877, on représente L'Étoile au théâtre des Bouffes-Parisiens et, deux ans plus tard, il donnera Une éducation manquée, opérette en un acte dont le livret est dû aussi à Leterrier et Van Loo. Chabrier ne cessera jamais d'être attiré par le genre comique. C'est ainsi que Le Roi malgré lui fut un opéra bouffe avant d'être transformé en opéra-comique, sur la demande de Carvalho. Et, jusqu'à la fin de sa vie, il rechercha de nouveaux livrets qui lui auraient encore permis de « raconter pompeusement des choses comiques », ainsi que le conseillait Baudelaire. Dans cet apparent divorce entre le grave et le gai, Chabrier se mouvait avec aisance. « Je n'aime plus qu'Offenbach et Wagner », dira-t-il à la fin de sa vie, indiquant bien par là ses tendances extrêmes.
Nous touchons ici à l'incompréhension dont eut à souffrir et dont souffre toujours son œuvre. Le malchanceux Chabrier est mis en accusation de plusieurs côtés à la fois. Ses contemporains jugeaient sa musique légère trop sérieuse, trop savante, en un mot trop wagnérienne, alors que, à notre époque, des auditeurs non moins étourdis trouvent frivole un compositeur qui s'est arrêté à des sujets si peu sérieux. Debussy, oreille attentive, assurait que Chabrier était « merveilleusement doué par la Muse comique », et que « la Marche Joyeuse, certaines mélodies sont des chefs-d'œuvre de haute fantaisie dus à la seule musique ». Ajoutons que la verve de l'homme, sa drôlerie, son langage coloré, épicé d'expressions argotiques et provinciales (il est né à Ambert, petite ville d'Auvergne), joints à une certaine caricature trop répandue de Detaille, ont fait écran à sa nature profonde. Comme il le confiait à Felix Mottl : « Malheureusement pour moi, j'appartiens, malgré ma joviale apparence, à la catégorie des gens qui ressentent très vivement. » Auprès des voix épurées, châtiées, la sienne n'a pas paru « convenable ». De même qu'Aristophane, que Rabelais qu'il avait souhaité mettre en musique, on l'accusa de vulgarité. Peut-on méconnaître plus radicalement un auteur d'une originalité si éclatante qu'« il est impossible », comme l'assurait Ravel, « d'entendre deux accords de lui sans immédiatement les lui attribuer » ?
Cette verve puissante qui soulève toute son œuvre ne peut faire oublier tout ce qu'il doit à Wagner. Si l'auteur de Tristan le désespéra en plus d'une circonstance – « dire que je suis du même métier », soupirait-il – il ne cessa jamais de voir en lui un maître à penser. Son admiration reste néanmoins lucide. Chez l'enchanteur, il déplore, « sous prétexte d'unité, j'allais dire d'uniformité, des quarts d'heure de musique ou récit absolu, dont tout être sincère, sans parti pris, dépourvu de fétichisme, doit trouver chaque minute longue d'un siècle ». Ce qui ne l'empêche pas de s'adresser au plus wagnérien des littérateurs, Catulle Mendès, pour les livrets de ses opéras Gwendoline et Briséis, conçus, de son propre aveu, « dans l'esprit de la nouvelle école dramatique ». C'est également le même homme que l'audition de Tristan à Munich bouleverse au point de le décider à se consacrer entièrement à la musique et qui compose peu après les irrévérencieux Souvenirs de Munich, quadrille sur les thèmes favoris de Tristan et Iseult. Au vrai, ce « wagnérien d'intention » utilisait les propres armes de son maître pour s'affranchir de lui. Un wagnérien de stricte obédience comme Vincent d'Indy ne s'y trompera pas, préférant renier en partie un compositeur qu'il aimait et qu'il avait si heureusement nommé l'« ange du cocasse », dans l'impossibilité de rattacher son œuvre à cette culture romantique et wagnérienne sur laquelle reposaient sa propre production et son enseignement. Mais, là encore, Chabrier nous déroute : cet antiromantique, ce « moderne » ne cessa d'admirer Berlioz, le musicien romantique par excellence. Déjà, dans sa jeunesse, il avait fait une réduction pour piano à quatre mains de Harold en Italie. « Je veux que ça pète », aimait-il à dire en parlant de ses œuvres. Or celles de Berlioz ne montraient-elles pas l'impétuosité qu'il recherchait ? L'intensité de la couleur orchestrale de Chabrier est en fait apparentée à celle du grand romantique. Il avait dépouillé, étudié minutieusement les partitions de Chopin et de Schumann, grâce à qui son langage s'émancipa. Ce sont, en effet, moins des leçons de style qu'il leur demandait que des raisons d'utiliser et d'élargir certaines libertés d'écriture.
Un musicien français
On remarquera que Chabrier ne s'intéressa jamais aux grandes formes musicales romantiques. Il ne fut attiré ni par la symphonie ni par aucun des nombreux aspects de la musique de chambre. Cet ami de Franck et de ses disciples ne se laissa pas distraire de sa « vocation ». Il revêtit allégrement ces habits apparemment désuets que sont la romance, les courtes pièces de piano, l'opérette, l'opéra-comique, en dépit du mépris que les partisans de la « musique de l'avenir » portaient à ces vieux modèles « périmés » dans lesquels ils voyaient une des causes de la décadence de la musique française. Ce faisant, Chabrier retrouvait l'esprit de la tradition française de nos grands clavecinistes. Franck lui-même l'avait décelé qui, après avoir écouté les Pièces pittoresques, confiait : Nous venons d'entendre quelque chose d'extraordinaire. Cette musique relie notre temps à celui de Couperin et de Rameau. » Comme eux, Chabrier avait moins cherché à construire son œuvre suivant un plan orgueilleux qu'à organiser ses sensations. Son humour énorme et délicat démystifiait la pédanterie, la vaine éloquence qui, trop souvent, se cachent derrière l'attitude sublime du romantique. S'il fut sublime, il le fut à sa manière, familièrement pourrait-on dire, avec le plus entier abandon, cherchant à préserver – et c'est ça le plus dur, disait-il – cette naïveté qu'il jugeait indispensable au véritable esprit de création. Aux mystères vagues de l'ombre, il préférait ceux, non moins profonds, de la clarté : C'est très clair, cette musique-là, écrivait-il à ses éditeurs au sujet d'une de ses œuvres, ne vous y trompez pas et ça paie comptant : c'est certainement de la musique d'aujourd'hui ou de demain, mais pas d'hier... Ce qu'il ne faut pas, c'est de la musique malade ; ils sont là quelques-uns, et des plus jeunes, qui se tourmentent tout le temps pour lâcher trois pauvres bougres d'accords altérés, toujours les mêmes, du reste ; ça ne vit pas, ça ne chante pas, ça ne pète pas.
Toutes ces préoccupations étaient aussi celles de ses amis, les peintres impressionnistes, incompris alors, dont les toiles garnissaient les murs de son appartement. Manet, auquel le lie la plus tendre des amitiés, a le même langage : « Qui nous rendra le simple et le clair ? Qui nous délivrera du tarabiscotage ? » Et Renoir s'accorde également avec lui lorsqu'il assure : « Un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie, oui jolie. Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas encore d'autres. Je sais bien qu'il est difficile de faire admettre qu'une peinture puisse être de la très grande peinture en restant joyeuse. On ne prend pas au sérieux les gens qui rient. L'art en redingote, que ce soit en peinture, en musique ou en littérature, épatera toujours. » De même que ceux-ci répugnaient à une hiérarchie des genres et haussaient au grand art des motifs quotidiens ou frivoles (une serveuse de bar ou une chanteuse de café-concert), Chabrier, au mépris des catégories – « Je ne connais que la bonne et la mauvaise musique et celle d'Ambroise Thomas », aimait-il à dire –, composait de la musique sérieuse avec des opérettes, de courtes pièces pour piano et des romances. Cependant, à cette légèreté de la touche, à cette fluidité de l'écriture, à ce thème de l'eau qui inspire tant de ses œuvres, des plus courtes aux plus ambitieuses, comme Gwendoline et Briséis, et qui anticipe sur toute la musique liquide des Debussy et Ravel, se mêle un thème non moins puissant : celui de la terre.
Le passé restauré
Bien que Chabrier ait quitté sa ville natale dès sa onzième année pour Clermont-Ferrand puis Paris où il se fixera – et dont l'influence sur son œuvre est indéniable –, l'Auvergne, où depuis des générations sa famille était enracinée, revivra intensément dans sa musique et la marquera d'une forte empreinte. Lui-même présente l'aspect caractéristique des gens de sa province et son caractère indépendant, son opiniâtreté et jusqu'à sa crainte de « manquer » rappellent ses origines. Nanine, sa nounou qui veillera toujours sur lui et ne le précédera que de trois ans dans la mort, lui avait chanté, dans sa petite enfance, le riche répertoire des vieilles chansons auvergnates. La bourrée était passée en lui ; les rythmes scandés de la terre d'Auvergne formaient en quelque sorte sa respiration musicale ; il affirmait : « Je rythme ma musique avec mes sabots d'Auvergnat. » Non seulement la Bourrée fantasque mais son œuvre entière en porte témoignage, sans compter un projet de partition lyrique et chorégraphique dans laquelle il aurait souhaité faire revivre les paysans de sa province. Rythmicien audacieux, exceptionnel, l'Espagne l'attira. Il y retrouvait une polyrythmie qui le confirmait dans sa voie, et l'on sait le succès foudroyant, le violent coup de soleil, que fut la création d'España en 1883, écrite au lendemain de son voyage outre-Pyrénées et qui le rendit célèbre. Mais ce n'est pas seulement par ses rythmes que l'Auvergne devait agir sur son œuvre ; cette terre ancienne, préservée, avait conservé dans son folklore les caractères indélébiles des vieux modes dont on redécouvrait à cette époque les vertus. Les amis de Chabrier, Bourgault-Ducoudray, puis Charles Bordes dont les auditions des polyphonistes de la Renaissance revivaient sous sa baguette à la tête des chanteurs de Saint-Gervais et que l'auteur du Roi malgré lui suivait attentivement, allaient remettre en honneur des manières qu'on avait oubliées. Il reste que Chabrier, par une pente toute naturelle, « pense » modal. Ainsi conjurait-il ingénument les effets du philtre tristanesque par le « charme profond, magique, dont nous grise, dans le présent, le passé restauré ». Tandis que Wagner et ses successeurs traquent la tonalité jusque dans ses ultimes ressources, Chabrier, par l'apport de gammes modales et défectives, la fait éclater, la régénère, lui ouvrant des perspectives nouvelles vers lesquelles s'orienteront, à sa suite, tous les musiciens français.
Car enfin, son influence, pour cachée qu'elle soit, n'en est pas moins considérable. Florent Schmitt voyait justement en Chabrier « le véritable inventeur de la musique française moderne ». Il y faut ajouter l'influence exercée sur des Espagnols tels Albéniz, Granados, de Falla, sur le Russe Stravinski, sur l'Allemand Richard Strauss... Mais la malchance qui l'a poursuivi toute sa vie n'a guère abandonné l'œuvre après la mort du compositeur, survenue à Paris. Le goût des catégories, la vigueur des idées reçues n'ont pas cessé de masquer son importance. Il n'y a pas moins rhétoriqueur que Chabrier, pas moins bavard. Qu'il aborde la fresque dans une grande œuvre lyrique comme Gwendoline ou qu'il fignole une courte pièce de piano comme l'Impromptu en ut majeur, c'est toujours cette même matière travaillée, précieuse, lumineuse, ce charme profond d'une harmonie libérée des vaines contraintes, cette émancipation des timbres orchestraux, pianistiques, voire vocaux, cette ardeur du discours familier et grandiose que soulève un rythme tellurique. Comme nul avant lui ne l'avait fait, et préfigurant ainsi l'esthétique debussyste, Chabrier enrichit son œuvre de résonances extra-musicales tirées des autres arts. Roger Delage
Principales œuvres
Musique pour piano :
Dix Pièces pittoresques 1881
Habanera 1885
Bourrée fantasque 1891
Cinq Pièces pour piano 1897
Musique orchestrale :
España 1883
Joyeuse marche 1888
Suite pastorale 1881
Larghetto pour Cor et Orchestre 1875
Musique vocale :
Lieder
Les plus jolies chansons du pays de France, chansons du folklore arrangées 1888
Ballade des gros dindons ; Villanelle des petits canards ; Pastorale des cochons roses..., chansons de la basse-cour 1889
Opérettes :
Fisch-Ton-Kan 1873, livret de Paul Verlaine
Une Éducation manquée 1879, livret d'Eugène Leterrier et d'Albert Vanloo
Opéras :
L'Étoile 1877, livret d’Eugène Leterrier et Albert Vanloo.
Gwendoline 1886, livret de Catulle Mendès
Le Roi malgré lui 1887, livret d'Émile de Najac et Paul Burani
Briséis, ou les amants de Corinthe, œuvre inachevée 1897, livret d’Éphraïm Mikhaël et Catulle Mendès
       
Posté le : 13/09/2015 19:53
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
43 Personne(s) en ligne ( 29 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 43
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages