|
|
Re: Défi du 23-01-2016 |
|
Administrateur  
Inscrit:
30/05/2013 12:47
Niveau : 34; EXP : 7
HP : 0 / 826
MP : 540 / 26786
|
Donald, voila une histoire finement racontée avec le talent d'écriture que l'on connaît et dont je ne doute pas qu'elle soit, un tant soit peu, autobiographique………….
C'est toujours un délice de lire tes aventures, même si l'on perçoit une certaine désillusion du monde qui nous entoure, sous le finesse tes écrits, sans doute la détresse légendaire de l'écrivain de talent!!
''J’écoutai Muriel me raconter sa mutation de chrysalide sombre en papillon gris, ses longues études de journalisme, ses quatre enfants, son mari absent, son inéluctable divorce, ses nombreux reportages en Afrique et sa progression dans les cercles fermés de la gauche utopiste''
Je ressors juste cette phrase pour mettre en valeur la qualité de tes descriptions et de tes parallèles que tu nous proposes avec bonheur et avec une vraie richesse d'écriture!!!............
Seul peut être le :'' gauche utopiste'' serait de nature à me froisser, mais, sans doute, ne faut il voir là qu'un effet de style???
…..Bien que, par les temps qui courent.la vérité n'est, hélas peu être pas si éloignée….
Après tout, Antoine Blondin avait peut être raison :’’Etant jeune il faut éviter d’être de gauche, au risque de devenir de droite en vieillissant’’…………….
Mon cher Donald, je mégotte pour faire mon malin, mais très sincèrement et sans aucune flagornerie, j'envie cette vivacité d'écriture qui est tienne, cette faculté de décrire en quelques mots une situation, que c'en en est un vrai bonheur pour le lecteur assidu que je suis!! !!
Merci pour ce bel exercice, et pour ma part je vais tenter de faire une petite bluette sur le sujet, pour faire sourire, il faut avoir conscience de ses moyens et de ses limites:'':Le loup attaque de la dent et l'écrevisse de sa pince''
Amitiés Donald, et que ce dimanche te soit plaisant.
Posté le : 24/01/2016 08:07
|
|
_________________
Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …
Titi
|
|
|
Muzio Clémenti |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 janvier 1752 naît Muzio Clementi,
à Rome, de son nom de naissance Mutius Philippus Vincentius Franciscus Xaverius Clementi, mort à 80 ans le 10 mars 1832 à Evesham en Angleterre, compositeur, pianiste, italien et éditeur de musique à Londres, principalement connu de son vivant comme pianiste, mais également organiste et claveciniste. Ses Élèves sont Johann Baptist Cramer, John Field. Ses Œuvres principales sont Gradus ad Parnassum.
Il est considéré comme le premier à avoir composé spécifiquement pour le piano et surtout connu pour son recueil d'études pianistiques Gradus ad Parnassum dont le titre rappelle le fameux traité de contrepoint de Johann Joseph Fux.
En bref
Pianiste, compositeur et éditeur de musique italien né à Rome, Muzio Clementi fut sans doute le premier à avoir, dès les années 1780, non seulement écrit mais aussi et surtout adapté sa musique au piano « moderne », et à ce titre, il influença fortement Beethoven, dont il fut, dans le domaine de la sonate pour clavier, le prédécesseur principal. Enfant prodige, organiste à neuf ans et auteur à douze ans d'un oratorio, il est remarqué en 1766 par un mécène anglais, sir Peter Beckford, qui l'emmène en Angleterre (ce pays deviendra sa seconde patrie) et le fait travailler assidûment pendant sept ans. En 1773, il s'installe à Londres comme concertiste et professeur, et exerce de 1777 à 1780 les activités de maître de clavecin au King's Theatre de Haymarket. Mais il n'atteint sa pleine maturité stylistique qu'au cours de la première grande tournée qui, de 1780 à 1783, le mènera à Paris, à Strasbourg, à Munich, à Vienne (où il se livre avec Mozart à un duel pianistique demeuré célèbre), à Zurich et à Lyon. Son séjour à Vienne a coïncidé (1781) avec les débuts officiels du style classique (installation de Mozart dans cette ville et publication des quatuors op. 33 de Haydn). De retour à Londres, auteur déjà d'un nombre imposant de sonates, Clementi y compose ses premières œuvres didactiques (Preludi ed esercizi, 1790) ainsi que cinq symphonies perdues ; il a comme élèves Johann Baptist Cramer et John Field, et fonde en 1798 une affaire florissante d'édition musicale et de fabrique de pianos. Entre 1802 et 1810, de nouveaux grands voyages le conduisent notamment à Saint-Pétersbourg, ouil'accompagne John Field, et à Vienne, ainsi que, pour la première fois depuis quarante ans,
en Italie. Au cours de la dernière période de sa vie, il participe à la fondation de la Royal Philharmonic Society 1813, par le biais de laquelle il diffuse en Angleterre les œuvres de Beethoven et de Cherubini ; il voyage encore plusieurs fois à travers l'Europe, et publie, de 1817 à 1826, les trois volumes de son ouvrage didactique principal, le Gradus ad Parnassum. En 1828, il se retire dans sa propriété d'Evesham Worcestershire, et y meurt quatre ans plus tard.
Les quelques sonatines qu'on met entre les doigts de tout apprenti pianiste donnent de Clementi une image très incomplète, voire entièrement fausse. Musicalement, ses meilleures sonates il en composa plusieurs dizaines ne craignent aucune comparaison : ainsi celles en fa mineur op. 13 no 6 vers 1784, en si mineur op. 40 no 2 publiée en 1802, en sol mineur dite Didone Abbandonata, en fa dièse mineur, et bien d'autres. Ces sonates contiennent certaines particularités techniques passages brillamment virtuoses qui font le lien à travers Beethoven avec Weber par exemple, voire avec Liszt et Chopin. On a encore de Clementi quelques symphonies et ouvertures. Marc Vignal
Sa vie
Muzio Clementi, premier de sept frères et sœurs, naquit à Rome de la famille de Nicolo Clementi, honorable orfèvre de souche romaine et de son épouse, la suissesse Magdalena Kaiser. On décela ses talents pour la musique alors qu'il était très jeune : confié à l'âge de sept ans aux soins d'un organiste nommé Cordicelli, il en assimila si bien les leçons que, à l'âge de neuf ans, il put se présenter avec succès à un concours pour une place d'organiste d'église, après avoir interprété à l'orgue une transposition multitonale d'une basse figurée, tirée d'une œuvre de Corelli.
En 1766, Peter Beckford 1740–1811, un riche anglais qui était par ailleurs cousin de l'excentrique William Beckford, fut séduit par les talents musicaux du jeune garçon et conclut un marché avec Nicolo, le père, pour emmener Muzio en Angleterre dans son domaine de Steepleton Iwerne, au nord de Blandford Forum dans le comté de Devon. Backford s'engageait à financer l'éducation musicale de Clementi en échange de quoi celui-ci assurerait l'animation musicale de la propriété. Ce fut donc là que Clementi passa les sept années qui suivirent, se consacrant à l'étude et à la pratique du clavecin. Ainsi Clementi a pu connaître les œuvres de Ignazio Cirri, publiées à Londres. Les compositions qui remontent à cette période de jeunesse sont peu nombreuses et d'ailleurs toutes à peu près perdues.
En 1770, Clementi donna son premier concert public de piano. Le public fut très favorablement impressionné par son jeu et ce fut le début d'une des carrières pianistiques les plus prestigieuses. En 1774, il fut libéré de ses obligations vis-à-vis de Peter Beckford, et il partit s'installer à Londres où, entre autres activités, il donna plusieurs concerts de bienfaisance au bénéfice d'un chanteur et d'un harpiste et dirigea aussi de son clavier, pendant quelque temps des concerts au King's Theater de Haymarket. Sa renommée s'accrut en 1779-1780 avec la publication des sonates de son opus 2, Devenu très célèbre, il était considéré dans beaucoup de cercles musicaux comme le plus grand pianiste de son temps.
Clementi entreprit un voyage en Europe continentale en 1781, qui l'amena en France, en Allemagne, en Autriche. À Vienne, sur proposition de l'empereur Joseph II il accepta de participer à une joute musicale contre Wolfgang Amadeus Mozart pour l'agrément de l'empereur et de ses hôtes. Chacun des musiciens dut improviser et exécuter des œuvres de sa propre composition. Le talent de chacun d'entre eux, comme compositeur et comme virtuose, était tel que l'empereur dut déclarer match nul.
Le 12 janvier 1782, Mozart écrivait à son père : « Clementi joue bien, tant qu'il s'agit de la main droite. Sa plus grande force est dans les passages de tierces. Mis à part cela, il ne vaut pas Kreutzer quant au goût et à la sensibilité – en clair, c'est une vraie mécanique ». Dans une lettre postérieure il alla même jusqu'à écrire : « Clementi est un charlatan, comme tous les Italiens, il écrit presto mais ne joue qu'allegro, j'ai pu le constater.» En revanche, l'opinion de Clementi quant à Mozart a toujours été très positive.
Cependant le motif principal de la sonate en si bémol majeur de Clementi sembla avoir capté l'imagination de Mozart puisque dix années plus tard, il s'en serait servi pour l'ouverture de son opéra La Flûte enchantée, du moins on le suppose vu leur ressemblance. Ceci contraria tellement Clementi que ce dernier prit soin, chaque fois que la partition de sa sonate fut éditée, de faire inclure un commentaire expliquant qu'elle avait été composée dix ans avant la Flûte enchantée.
À partir de 1782 et pendant les vingt années qui suivirent, Clementi resta en Angleterre. Pendant les années 1790, ces œuvres furent jouées lors des concerts Salomon à Londres, avec celles de Joseph Haydn. Jouant du piano, dirigeant des orchestres et donnant des cours, deux de ses élèves acquirent une grande notoriété, Johann Baptist Cramer et John Field - ce dernier devait à son tour exercer son influence sur Frédéric Chopin. Clementi entreprit aussi la fabrication de piano, mais son atelier fut détruit par un incendie en 1807.
Cette même année, Clementi conclut un contrat avec Ludwig van Beethoven, qui était un de ses admirateurs, ce qui lui octroya tous les droits de reproduction et d'édition de sa musique.
En avril 1784, ayant séjourné à plusieurs reprises à Lyon, il eut une idylle amoureuse avec Marie-Victoire, 18 ans, la fille de l'échevin Jacques Imbert-Colomès, qu'il enleva après lui avoir dédicacé son opus 8. Jacques Imbert-Colomès furieux poursuivit les deux amants jusqu'à Chambéry et ramena sa fille, Clementi devant alors séjourner plusieurs semaines en Suisse, à Berne, où désespéré il composa un duo en mi bémol en hommage à son amour impossible.
Sa place dans l'histoire de la musique, en tant qu'éditeur et interprète de Beethoven n'est certainement pas moindre que celle qu'il a pu acquérir en tant que compositeur lui-même. Cependant on a pu lui reprocher certaines libertés éditoriales qu'il s'est autorisées comme lorsqu'il a opéré des corrections harmoniques de son cru à la musique de son illustre collègue. Le fait que Beethoven a entrepris de composer spécifiquement pour le public anglais, notamment dans le domaine de la musique de chambre est évidemment lié au fait que son éditeur était basé dans ce pays.
En 1810, Clementi arrêta de donner des concerts pour se consacrer à la composition et à la facture de pianos. En 1830 il déménagea pour vivre près de Lichfield puis termina sa vie, un peu oublié, à Evesham. Il y mourut âgé de 80 ans. Il fut inhumé à l'abbaye de Westminster. Il avait été marié trois fois.
Musique
Clementi est connu pour son recueil d'études pianistiques Gradus ad Parnassum auquel Claude Debussy fait allusion dans le premier mouvement de sa suite Children's Corner qui s'intitule Docteur Gradus Ad Parnassum. De la même manière, ses sonatines ont été le passage obligé dans l'apprentissage du piano pendant tout le xxe siècle. Erik Satie, qui était contemporain de Debussy en a fait une caricature dans sa Sonatine Bureaucratique
Sonatina, opus 36, no 1.ogg
Clementi composa près de 110 sonates pour le piano. Certaines des plus anciennes et des plus faciles furent rééditées sous la forme de sonatines après le succès obtenu par ses sonatines de l'opus 36. Elles continuent d'être très appréciées comme pièces d'exécution assez facile. Pourtant, à l'exception de l'opus 36, les sonates de Clementi sont souvent d'exécution plus difficile que celles de Mozart - ce dernier écrivit dans une lettre adressée à sa sœur qu'il ne lui conseillait pas de jouer les sonates de Clementi à cause des difficultés techniques, de l'écartement des doigts qu'elles nécessitent, et de la difficulté des accords dont il pensait qu'elle pouvait se faire du mal en les jouant.
Outre ses compositions pour piano solo, Clementi a composé une grande quantité de pièces musicales d'autres sortes, y compris des symphonies reconstituées depuis peu, sur lesquelles il a longuement travaillé et que l'on commence progressivement à considérer comme des œuvres intéressantes et de qualité. Si Clementi est généralement absent des programmes de concerts, on trouve de plus en plus d'enregistrements discographiques qui lui sont consacrés.
Mozart était animé d'un manque de respect patent pour Clementi : de ce fait, on les a généralement considérés comme des rivaux irréconciliables. Mais la réciproque n'était pas vraie, autant qu'on puisse en juger, de la part de Clementi, et de toute façon, les propos peu amènes de Mozart à l'encontre de Clementi n'étaient pas destinés, dans son esprit, à être révélés en public.
Le grand pianiste russe Vladimir Horowitz fut saisi d'une prédilection toute particulière pour Muzio Clementi après que son épouse, Wanda Toscanini lui eut offert les œuvres complètes de celui-ci. Horowitz les mettait au même niveau que les pièces les plus accomplies de Beethoven. C'est en grande partie à lui que Clementi doit d'être à nouveau considéré comme un musicien digne d'intérêt et aujourd'hui à Andreas Staier, Maria Tipo et à Constantino Mastroprimiano, au pianoforte.
Muzio Clementi est injustement sous-estimé dans l'histoire de la musique. Les experts d'aujourd'hui le considèrent en effet comme le vrai créateur de la technique pianistique moderne.
Clementi a eu la relative malchance d'être le contemporain des géants de la musique que furent Mozart et Beethoven : à côté d'eux, il passe pour un "petit maître" – ses œuvres sont un peu délaissées en concert – et pourtant il a joué un rôle capital dans le développement de la musique pour le piano et tout spécialement dans celui de la sonate.
Liste des œuvres
Article connexe : Sonate pour piano.
Opus 1 : Six sonates 1771
Opus 1 bis : Cinq sonates et Un duo pour 2 pianos 1780-1781
Opus 2 : Six sonates pour piano et violon ou flûte 1779
Opus 3 : Trois duos à 4 mains et Trois sonates pour piano et violon ou flûte 1779
Opus 4 : Six sonates pour piano et violon violon ou flûte 1790
Opus 5 : Trois sonates pour piano et violon et Trois fugues 1780-1781
Opus 6 : Un duo à 4 mains, Deux sonates pour piano et violon et Trois fugues 1780-1781
Opus 7 : Trois sonates 1782
Opus 8 : Trois sonates 1782
Opus 9 : Trois sonates 1783
Opus 10 : Trois sonates 1783
Opus 11 : Une sonate et Une toccata 1784
Opus 12 : Quatre sonates et Un duo pour 2 pianos 1784
Opus 13 : Six sonates, dont trois avec violon ou flûte 1785
Opus 14 : Trois duos à 4 mains 1786
Opus 15 : Trois sonates pour piano et violon 1786
Opus 16 : Sonate La Chasse 1786
Opus 17 : Capriccio 1787
Opus 18 : Deux symphonies 1787
Opus 19 : Clementi's Musical Characteristics 1787
Opus 20 : Sonate 1787
Opus 21 : Trois trios 1788
Opus 22 : Trois trios 1788
Opus 23 : Trois sonates 1790
Opus 24 : Deux sonates 1788
Opus 25 : Six sonates 1790
Opus 26 : Sonate 1791
Opus 27 : Trois trios 1791
Opus 28 : Trois trios 1792
Opus 29 : Trois trios 1793
Opus 30 : Sonate pour piano et violon rév. de l'opus 2 n°2 1794
Opus 31 : Sonate pour flûte et piano rév. de l'opus 2 n°4 1794
Opus 32 : Trois trios 1793
Opus 33 : Trois sonates 1794
Opus 34 : Deux sonates et Deux capricci 1795
Opus 35 : Trois trios 1796
Opus 36 : Six sonatines 1797
Opus 37 : Trois sonates 1798
Opus 38 : Douze valses 1798
Opus 39 : Douze valses 1800
Opus 40 : Trois sonates 1802
Sonate opus 40 nº 1
Sonate opus 40 nº 2
Sonate opus 40 nº 3
Opus 41 : Sonate 1804
Opus 42 : Introduction to the Art of Playing on the Piano Forte 1801
Opus 43 : Clementi's Appendix à l'opus 42 1811
Opus 44 : Gradus ad Parnassum 1817, 1819, 1826: Recueil de 100 études pour piano
Opus 46 : Sonate 1820
Opus 47 : Deux capricci 1821
Opus 48 : Fantaisie avec Variations sur l'Air « Au Clair de la Lune » 1821
Opus 49 : Douze monferrines 1821
Opus 50 : Trois sonates 1821
  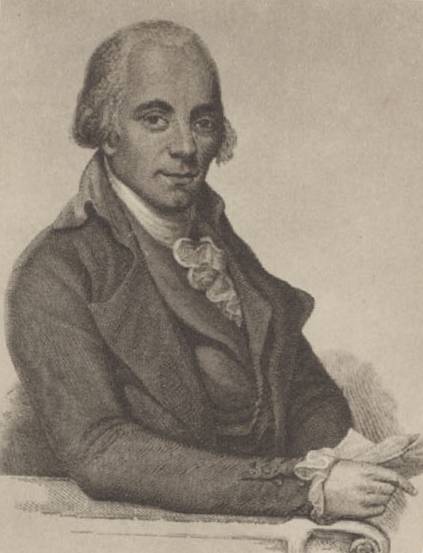 
Posté le : 23/01/2016 23:17
Edité par Loriane sur 24-01-2016 17:27:57
Edité par Loriane sur 24-01-2016 17:29:16
|
|
|
|
|
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
LE MARIAGE DE FIGARO ,
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Le Mariage de Figaro , comédie en cinq actes, créée à la Comédie-Française le 27 avril 1784, est sans aucun doute le grand succès théâtral du XVIIIe siècle (73 représentations au cours de la seule saison 1784-1785). C'est aussi l'œuvre dramatique la plus profondément novatrice entre la période classique et l'aube du XXe siècle. De 1781 à 1784, Beaumarchais (1732-1799) dut se débattre dans des difficultés sans nombre pour la faire représenter. Pour contourner les censures successives, il mena avec succès une campagne de lectures dans les salons de la grande noblesse dont il obtint l'appui. Louis XVI avait déclaré de façon péremptoire : « C'est détestable ; cela ne sera jamais joué. Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. » Il céda pourtant, et ce recul du pouvoir fut sans doute la première raison du succès public de la pièce.
Un entrelacement d'intrigues
Le Mariage de Figaro compose, avec Le Barbier de Séville (1775) et La Mère coupable (1792), une trilogie dont il constitue l'épisode médian. Son sujet est esquissé dans la « Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville » que Beaumarchais rédigea en 1775. Le début de la pièce nous transporte au château d'Aguas Frescas où nous retrouvons les héros du Barbier de Séville : Rosine, devenue comtesse Almaviva, et son époux, le comte, ainsi que Figaro, valet de chambre et concierge du château, qui se prépare à épouser le soir même Suzanne, la camériste de la comtesse. Alors que Le Barbier de Séville développe une intrigue simple mais traversée de péripéties très complexes, Le Mariage de Figaro entrelace plusieurs intrigues dont le croisement détermine les péripéties. D'une longueur exceptionnelle, la comédie compte seize personnages actifs.
Le premier fil du tissu est celui des projets de mariage de Figaro et de Suzanne, entravés par une succession d'obstacles. Le second fil dessine un motif galant : le comte se détourne de son épouse et tente de séduire Suzanne ou d'acheter ses faveurs ; c'est à ce prix qu'il autorisera son mariage. Le troisième trace le roman familial de Figaro : Marceline veut épouser Figaro qui a contracté une dette à son égard ; mais on découvre qu'elle est sa mère et que Bartholo, le barbon, tuteur de Rosine dans le Barbier, est son père. Une quatrième intrigue vient perturber toutes les autres. Elle a pour héros le jeune Chérubin, amoureux de toutes les femmes de la maison, dont les entreprises de séduction viennent déranger les projets de tous les protagonistes. À l'intérieur de chacun des cinq actes, les scènes s'organisent en séquences. L'exposition a pour cadre la chambre encore démeublée promise au couple des domestiques. On y apprend le projet de mariage imminent de Suzanne et de Figaro, les deux premiers obstacles qu'il rencontre, le dessein libertin du comte et le projet conjugal de Marceline. L'apparition de Chérubin, puis de Bazile et du comte, constitue une première péripétie et marque le début du nœud.
La contre-attaque de Figaro (acte II) déclenche le retour intempestif du comte qui vient faire irruption dans la chambre de la comtesse, et perturbe une scène ambiguë où la comtesse et Suzanne font essayer un costume de Suzanne à Chérubin : leur intention est de prendre le comte en flagrant délit d'infidélité, à la faveur de ce travestissement. Le troisième acte se déroule dans la salle d'apparat du château. On y assiste à l'affrontement de Figaro et du comte qui tente de percer à jour les projets de son valet. Pris au piège d'un procès, Figaro n'échappe au mariage avec Marceline que par la soudaine révélation, au cours d'une scène de « reconnaissance », des liens de filiation qui l'unissent à elle. Le quatrième acte, dans une galerie du château, est surtout consacré au piège monté par la comtesse et Suzanne à l'insu de Figaro pour attraper le séducteur. Mais Figaro en découvre partiellement l'existence, sans en comprendre le sens. D'où la fureur jalouse qui l'anime au dernier acte : « Ô Femme ! femme ! femme ! créature faible et décevante !... nul animal créé ne peut manquer à son instinct ; le tien est-il donc de tromper ? » (V, 3). Celui-ci a pour cadre la « salle de marronniers » du parc. Il fait se succéder des moments de tension extrême, entrecoupés par un immense monologue de Figaro, et le soulagement qui naît de la confusion de « l'époux suborneur », avec la fantaisie comique qui caractérise la fête finale.
Beaumarchais, inventeur de la comédie moderne
Le succès premier du Mariage de Figaro, dans le milieu de la grande noblesse du royaume, reposait sur un paradoxe dont certains contemporains s'étaient avisés. La baronne d'Oberkirch écrit ainsi : « Le Mariage de Figaro est peut-être la chose la plus spirituelle qu'on ait écrite, sans en excepter peut-être les œuvres de Monsieur de Voltaire [...] Je rentrai chez moi en sortant de la comédie, le cœur serré de ce que je venais de voir et furieuse de m'être amusée. » Emportée par le tempo rapide de cette conversation à la mode dans les milieux des élites sociales de l'Ancien Régime, la comédie de Beaumarchais décoche une volée de traits brillants contre les abus qui caractérisent cette société. Elle se fait l'écho de toutes les insolences satiriques de l'époque et leur donne cette forme acérée qui emporte l'adhésion complice des spectateurs : la censure, la justice, les préjugés de la naissance, les privilèges de la noblesse, les mœurs libertines des « mâles », les relations de service, marquées par leur origine féodale et désormais insupportables, sont des cibles désignées pour un rire qui n'exclut pas la révolte. La fable elle-même, parce qu'elle raconte la rivalité d'un aristocrate et d'un plébéien qui parvient à ses fins, confirme une leçon politique et morale dans l'esprit des Lumières.
La virtuosité du jeu sur l'espace et le temps est d'autant plus sensible qu'ils sont « réalistes » dans leur détermination. Beaumarchais ne cesse de jouer sur des gageures : comment se cacher dans une chambre démeublée (au premier acte), comment escamoter cinq personnages dans un jardin, comment résoudre le mystère, déjà policier, qui s'offre au comte devant un cabinet fermé à clé, dans une chambre non moins fermée, qui devait bien receler un amant, mais qui est vide lorsqu'il y revient. Le théâtre du XIXe siècle tout entier s'en inspirera.
Beaumarchais introduit dans la comédie la tonalité « sensible » qui caractérisait ses deux drames (Eugénie, 1767, et Les Deux Amis, 1770) et dote ses « héros » d'une épaisseur romanesque soulignée par la temporalité spécifique de la trilogie. La comtesse, jeune femme délaissée par son époux, est l'âme poétique d'un gynécée où s'organise une sorte de résistance morale (Mozart et son librettiste Da Ponte se montreront très sensibles à cette dimension dans Les Noces de Figaro, opéra-comique représenté en 1786). Figaro, dont les entreprises ne parviennent qu'à embrouiller l'intrigue, ne parvient à ses fins que par la rencontre du hasard et des projets de Suzanne et de la comtesse. Nouveau héros bourgeois, le « bâtard conquérant » des romans suscite une interrogation profonde sur le sujet, sur l'identité d'un plébéien en même temps que sur la parole théâtrale, sur le « je » qui advient au théâtre.
Dans Le Mariage de Figaro, Beaumarchais invente les structures profondes de la comédie moderne, lisibles chez Labiche ou chez Feydeau comme dans le cinéma de René Clair ou de Renoir, et du drame romantique : l'hommage rendu par Hugo à Beaumarchais en qui il voit, aux côtés de Corneille et de Molière, l'un des trois fondateurs de la scène française, a valeur emblématique. Si le lien du Mariage de Figaro à la Révolution française a été longtemps surévalué, sa portée idéologique et poétique en fait une œuvre majeure de la littérature française. Pierre Frantz
LE BARBIER DE SÉVILLE ,
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Le Barbier de Séville, ou la Précaution inutile fut créé à la Comédie-Française le 23 février 1775 dans une version en cinq actes et connut un échec retentissant. Mais Beaumarchais (1732-1799) sut revoir rapidement sa pièce pour la resserrer en quatre actes. Ce fut alors un triomphe mémorable, et le premier grand succès au théâtre de l'auteur. Le parfum de scandale qui flottait autour de Beaumarchais à la suite de diverses affaires et son goût immodéré pour les allusions piquantes donnèrent des armes à la censure qui tarda à autoriser la première représentation. La pièce est publiée avec une Préface, un morceau de bravoure, insolent, vif et drôle, la Lettre modérée sur la chute et la critique du « Barbier de Séville », où Beaumarchais dessine également les contours de son projet littéraire. Le Barbier de Séville frappe par son originalité : c'est une comédie qui, sur un canevas très classique, voire banal, brode des incidents, un suspense et une poésie comiques d'une radicale nouveauté.
L'imbroglio
Le Barbier de Séville constitue le premier épisode d'une trilogie dramatique qui comprendra ensuite Le Mariage de Figaro (1784) et La Mère coupable (1792). Ses protagonistes reviennent dans ces deux pièces (auxquelles il faudrait adjoindre, en toute rigueur, le Compliment de clôture), fictivement séparées dans le temps par quelques années. « Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille ; un jeune amant plus adroit le prévient, et ce jour même en fait sa femme, à la barbe et dans la maison du tuteur. Voilà le fond... », tel que le résume Beaumarchais. Rien de plus simple en apparence que cette intrigue. Voyons sa mise en œuvre.
Nous sommes dans une rue de Séville, à l'aube. Un jeune homme fait le guet sous le balcon de la jolie Rosine dont il espère être remarqué. C'est le comte Almaviva qui est tombé amoureux de la jeune fille sans lui avoir jamais parlé, et qui a quitté Madrid pour la suivre. Apparaît un personnage au costume pittoresque, Figaro, ancienne connaissance du comte et présentement « barbier de Séville », qui officie précisément chez le docteur Bartholo, tuteur de Rosine. Il apprend au comte que le vieillard s'apprête à épouser sa pupille – le soir même, on le saura plus tard –, mais se fait fort d'aider le galant à s'introduire dans la place. De sa fenêtre, Rosine laisse échapper un papier, une chanson au titre symbolique, La Précaution inutile, au grand dam de Bartholo. Elle y demande au jeune homme de se faire connaître en chantant une romance. Il se présente sous le nom de Lindor, bachelier de son état.
Dans les actes suivants, qui se déroulent à l'intérieur de la maison du docteur, nous assistons aux tentatives successives du comte, déguisé en soldat, puis en bachelier maître de musique, pour tromper la surveillance du barbon et entrer en contact avec Rosine – manœuvres facilitées par Figaro mais intelligemment contrées par Bartholo et son allié don Bazile, le maître de musique de la jeune fille. Au fil des scènes, Beaumarchais emmêle les fils de l'intrigue en un imbroglio d'une éblouissante virtuosité, qui atteint son sommet avec la « scène de la stupéfaction » : le comte affirme être envoyé par don Bazile, malade, pour donner une leçon de musique à Rosine ; il a convaincu Bartholo qu'il était dans son camp grâce à un stratagème complexe et compromettant (il lui a remis une lettre de Rosine) mais doit en informer Rosine de toute urgence. Les amoureux jouissent à peine d'un instant d'entretien, ménagé par Figaro, lorsque arrive inopinément don Bazile. Stupéfaction générale. Tension extrême. Chacun a intérêt, ou croit avoir intérêt, à éviter une explication générale. Le comte, sans aucun doute le plus directement menacé d'une révélation, manœuvre de telle façon qu'il réussit à pousser Bartholo contre Bazile, finalement renvoyé dans son lit : « LE COMTE.– Allez vous coucher, mon cher Bazile : vous n'êtes pas bien, et vous nous faites mourir de frayeur. Allez vous coucher./ FIGARO.– Il a la physionomie toute renversée. Allez vous coucher./ BARTHOLO.– D'honneur, il sent la fièvre d'une lieue. Allez vous coucher./ ROSINE.– Pourquoi êtes-vous donc sorti ! On dit que cela se gagne. Allez vous coucher./ BAZILE, au dernier étonnement.– Que j'aille me coucher !/ TOUS LES ACTEURS ENSEMBLE.– Eh ! sans doute./ BAZILE, les regardant tous.– En effet, Messieurs, je crois que je ne ferai pas mal de me retirer ; je sens que je ne suis pas ici dans mon assiette ordinaire. » Au dernier acte, Rosine, trompée par son tuteur, lui avoue que son amant doit venir la rejoindre en passant par la jalousie dont Figaro a dérobé la clef. Le temps que Bartholo file chercher main forte, Almaviva pénètre dans la maison, s'explique avec la jeune fille, révèle son identité et l'épouse devant le notaire qui devait la marier à son tuteur.
La poésie comique
Avant que Le Mariage de Figaro ne vienne fonder un théâtre radicalement nouveau, Beaumarchais transforme profondément la comédie en lui donnant une étonnante poésie. « L'embrouille », on l'a vu, provoque sur le spectateur un effet d'éblouissement obtenu non seulement par le mélange de complexité et de lisibilité, mais encore par l'utilisation simultanée ou par la succession en accéléré des procédés de l'intrigue comique traditionnelle. À tout instant, la complexité des situations donne aux répliques une multiplicité de significations : le spectateur les entend ainsi dans un « feuilletage » étonnant, car il sait immédiatement et ce que chacun des personnages peut comprendre, et ce que le personnage qui parle veut dire ; il mesure les risques, la provocation, la part d'implicite et les présupposés de chaque mot. L'art de la scène n'est pas moins admirable dans les scènes de chansons qui donnent à chaque personnage sa couleur poétique et campent son caractère, offrant au comédien des possibilités de jeu extrêmement riches.
La sécheresse du canevas ou de la comédie d'intrigue n'entraîne pas, comme à l'habitude, le schématisme de personnages. Almaviva est bien plus que l'amoureux de la commedia dell'arte ou du théâtre forain. C'est un jeune noble impérieux, plein d'énergie et de flamme, et qui veut être aimé pour lui-même. C'est aussi un joueur virtuose, un comédien farceur. Plus qu'une amoureuse, Rosine est une jeune fille hardie, éprise de liberté, révoltée par le sort qu'on lui prépare. Quant à Bartholo, « beau, gros, court, jeune vieillard, gris pommelé, rusé, rasé, blasé, qui guette et furète et gronde et geint tout à la fois », c'est un barbon à l'intelligence toujours en éveil, et non un monstre fascinant comme l'Arnolphe de L'École des femmes. Sa lucidité fait son malheur, et son malheur lui donne in extremis une dignité qu'on ne rencontre guère dans ce type comique. Figaro et don Bazile sont dessinés avec une sûreté de trait qui a fait d'eux, immédiatement, des types : le premier vif et ironique, à l'image de la langue qu'il emploie, le second, comme nous le dépeint Beaumarchais, « chapeau noir rabattu, soutanelle et long manteau ».
Relève enfin de cette poésie comique nouvelle un sens du mot brillant, qui frappe et ne se laisse pas oublier, comme cette réplique adressée par Figaro au comte et qui condense si bien l'insolence du personnage, celle de l'auteur et la portée sociale de la pièce : « Aux vertus qu'on exige dans un domestique, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ? » C'est ce sens de la formule que le théâtre de boulevard des XIXe et XXe siècles s'échinera si laborieusement à reproduire comme une recette destinée à entraîner le spectateur dans une complicité faite de distinction sociale. La complicité sollicitée par Beaumarchais est, au contraire de tout conformisme, celle de la fronde et de la jeunesse. Cette relation est le secret d'un théâtre que rien ne peut démoder.
En 1816, Gioacchino Rossini a donné une étincelante version pour l'opéra du Barbier de Séville. Pierre Frantz
       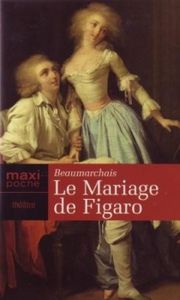 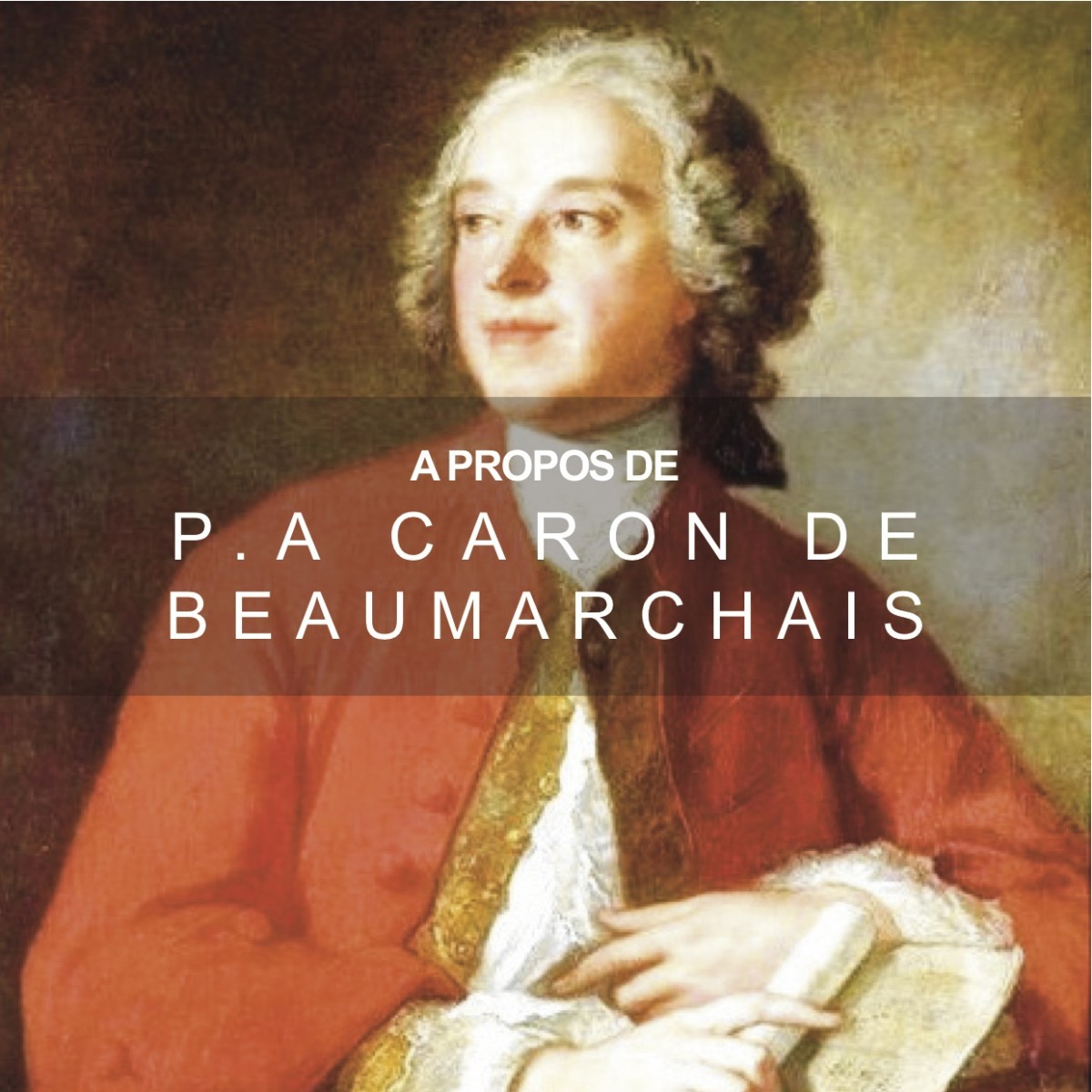   
Posté le : 23/01/2016 23:02
Edité par Loriane sur 24-01-2016 17:42:19
Edité par Loriane sur 24-01-2016 17:44:02
|
|
|
|
|
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 janvier 1732 naît Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
à Paris où il est mort, à 67 ans le 18 mai 1799 ; homme d'affaires français, philosophe, musicien, poète et dramaturge, il est surtout connu pour ses talents d'écrivain du mouvement des lumières Il fut également espion et marchand d'armes pour le compte du roi.Ses Œuvres principales sont Le Barbier de Séville en 1775, Le Mariage de Figaro en 1784 et La Mère coupable en 1792.
Une des figures emblématiques du siècle des Lumières, il est considéré comme un précurseur de la Révolution française et de la liberté d'opinion ainsi résumée dans sa pièce Le Mariage de Figaro : Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur.
L'apparition de Beaumarchais dans le théâtre et les lettres françaises de la fin du XVIIIe siècle relève de la magie. Il touche à tout, fait flèche de tout bois et apporte au théâtre le charme qui s'en est absenté après la mort de Marivaux. Ce séducteur écrit et agit dans un roman qui ne s'embarrasse que rarement du récit et de la rétrospection parce qu'il va son chemin sans s'arrêter longtemps. L'auteur et l'aventurier vont du même pas. Comme les « bâtards conquérants » des romans, Beaumarchais ne doit pas son succès à sa naissance mais à son talent et à sa propre énergie.
En bref
L'élégance roturière, Si Beaumarchais a peu de naissance, il n'en a pas moins une famille très présente et très aimée : Pierre-Augustin, fils de l'horloger Caron, qui doit le nom de Beaumarchais à une maison de sa première femme, et son anoblissement à l'argent, à la différence de tant de parvenus, revendique sa filiation roturière au même titre que sa noblesse, récente mais personnelle. Vif, ami des plaisirs et des femmes, il est aussi le bon fils des drames bourgeois, dévoué à sa famille et fort de son soutien, entouré par l'affection de ses cinq sœurs. Mais cette famille n'est pas fermée. La boutique de l'artisan est ouverte sur la ville. On y joue de la musique, on y lit des romans, on y parle d'abondance. Le travail d'horlogerie est créatif : Beaumarchais invente en juillet 1753 un nouveau système d'échappement pour le ressort des montres. Il doit défendre sa découverte contre un confrère de son père qui, abusant de sa confiance, s'en est attribué la paternité. Devant l'inertie judiciaire, il écrit au Mercure, en appelle à l'Académie des sciences et obtient gain de cause. Sa victoire lui permet d'être reçu par le roi et ses filles – à qui il donnera bientôt des leçons de musique – et d'être introduit à la cour. Il fait un premier mariage avantageux mais perd sa femme avant de pouvoir en hériter. Il se lie et s'associe avec le financier Pâris-Duverney, devient homme d'affaires, s'enrichit, et achète une charge qui l'anoblit. Il fréquente Le Normand d'Étioles, financier et mari de Mme de Pompadour ; pour divertir sa société, il écrit des Parades, courtes comédies à la mode, qui sont représentées sur la scène privée de son riche ami. Il part pour l'Espagne en 1764, où l'appellent des affaires de famille et d'argent : à Madrid, il s'emploie vainement à marier sa sœur Lisette avec son prétendu, Clavijo, qui se dérobait, et ne réussit pas plus dans les projets mirifiques qu'il agitait. Il racontera plus tard cet épisode qui devait inspirer Goethe, dans les Mémoires contre Goezman, avec un sens étonnant du drame et du roman. Pendant les années qui suivent son retour à Paris, il fait jouer un drame, Eugénie, à la Comédie-Française (1767) se remarie, puis perd sa femme en 1770 et, la même année, son ami Pâris-Duverney. Beaumarchais entre dans une période de grandes difficultés.
Sa réussite lui avait valu beaucoup d'ennemis, mais le procès qui l'oppose au comte de La Blache, l'héritier de Pâris-Duverney, va déboucher sur une véritable coalition d'obstacles placés sur son chemin. La mauvaise foi et la cupidité de son adversaire n'ont d'égales que celles du juge corrompu qui rapporte contre lui : le conseiller Goezman. Une méchante affaire de femme avec le duc de Chaulnes vient tout compliquer et le conduit en prison. Beaumarchais se débat et publie des Mémoires justificatifs où éclatent ses talents de rhéteur et son intelligence précise. Ce sont des textes travaillés à la manière de Voltaire, mais avec un humour et un sens de l'émotion qui n'appartiennent qu'à leur auteur et entraînent la conviction. Si, dans un premier temps, il n'obtient pas satisfaction devant le tribunal qui se contente de le blâmer à égalité avec son adversaire, il triomphe dans l'opinion publique. Il devient agent secret de Louis XV, puis de Louis XVI, en Angleterre et en Hollande, avec pour mission de faire disparaître des libelles injurieux contre la monarchie. Il convainc son maître de venir en aide aux insurgents d'Amérique et sert d'intermédiaire pour l'achat des armes nécessaires à cette guerre. L'intérêt personnel et l'attachement à une cause juste lui paraissent marcher de conserve.
Au milieu de toute cette agitation, Beaumarchais trouve le temps d'écrire un second drame, Les Deux Amis (1770) et une comédie, Le Barbier de Séville, qui est représentée pour la première fois le 23 février 1775. Il achève Le Mariage de Figaro en 1778. Il lance en 1780 (le prospectus paraît en janvier 1781) le projet d'une grande édition complète des Œuvres de Voltaire et va le mener à bien : c'est l'édition de Kehl dont le dernier volume paraît en 1790. Il est, dès 1776, en conflit avec la Comédie-Française et réussit à regrouper les auteurs dramatiques pour faire valoir leurs droits ; il jette ainsi les bases d'une réglementation de la propriété littéraire qui sera fixée une première fois en 1780 par le Conseil d'État puis par l'Assemblée constituante en 1791. C'est que sa vie d'homme de lettres ne constitue pas pour lui une alternative à son engagement dans la vie sociale. Le choix du théâtre est, à cet égard, significatif : l'esprit de divertissement, poussé au XVIIIe siècle jusqu'à l'ivresse, coexiste avec un sérieux didactique et moral qui le lie délibérément à la société. La campagne d'opinion menée par Beaumarchais pour faire représenter Le Mariage de Figaro en dépit des censeurs fait apparaître cette profonde unité. La pièce est reçue, dans une première version, à la Comédie-Française dès septembre 1781. L'action avait pour cadre la France et les allusions aux abus du régime étaient directes. Le roi, alerté par la rumeur, se fait lire la pièce et est scandalisé par le persiflage de Beaumarchais. Celui-ci révise son œuvre et en transporte l'action en Espagne. Elle est lue partout, dans les cercles de la grande noblesse. Le comte d'Artois en fait préparer la représentation à la cour, mais le 13 juin 1783, au moment où le rideau va se lever, l'interdiction royale est signifiée. La campagne d'opinion cristallise alors une véritable fronde aristocratique. En septembre 1783, le Mariage est joué à Gennevilliers, chez le comte de Vaudreuil, devant le comte d'Artois et l'assistance la plus brillante ; le roi s'est tu. Le 27 avril 1784, c'est la première, dans la nouvelle salle de la Comédie-Française. Le tout-Paris s'écrase dans la salle qui vibre d'enthousiasme et fait un triomphe à la représentation qui sera suivie de cent autres entre 1784 et 1787. La distribution était la meilleure qu'on pût trouver, avec Dazincourt, Molé, Mlles Contat, Saint-Val et Olivier. Cette soirée éblouissante est sans aucun doute l'événement théâtral majeur du XVIIIe siècle, à la fois par sa signification esthétique et son importance politique. La bataille qui va se poursuivre dans la presse, avec ses surprises (l'auteur est à nouveau momentanément incarcéré), prolonge le succès de la pièce. Dernière consécration : Le Barbier de Séville est repris à la cour, avec la reine dans le rôle de Rosine et le comte d'Artois dans celui de Figaro.
Mais, bientôt, l'auteur vient se jeter dans l'affaire Kornmann-Bergasse, dont l'épilogue judiciaire lui sera favorable alors que l'opinion se détachera de lui : Beaumarchais est enveloppé, piégé dans une guerre de pamphlets qui débute en 1787, et l'avocat Bergasse parvient à le faire passer, au début de la Révolution, pour l'incarnation même de la dépravation de l'Ancien Régime. Au reste, l'auteur, malgré quelques sympathies au début, ne se trouve pas en phase avec les événements. Il écrit, avec le musicien Salieri, un opéra, Tarare (1787), qui déconcerte mais connaît un vif succès et dont il modifiera certains éléments en fonction des changements politiques. Puis il donne une suite au Mariage, à La Mère coupable, achevant ainsi une véritable trilogie. Bergasse, sous le nom transparent de Bégearss, y fait figure du traître de mélodrame. Ce drame, après avoir connu un demi-échec en juin-juillet 1792 (du fait, probablement, des événements), réussit honorablement sous le Directoire. Beaumarchais entreprend une nouvelle opération politique et spéculative dans laquelle il va manquer de laisser la vie. L'Assemblée législative se prépare à la guerre et l'infatigable aventurier entreprend de fournir des armes à sa patrie : soixante mille fusils, déposés en Hollande, qu'il s'agit de faire entrer en France. Mais les affaires traînent et les événements vont vite. Il est accusé de cacher ces armes et, le 11 août, le peuple envahit la luxueuse maison qu'il s'était fait construire à côté de la Bastille. On ne trouve rien. Beaumarchais est incarcéré, libéré de justesse au milieu des massacres de septembre 1792 ; il ne renonce pas à défendre ses intérêts et, en pleine Terreur, quitte Londres où il s'était réfugié et vient à Paris où il publie un Mémoire justificatif. Sa tactique réussit : il se rétablit, quitte la France comme commissaire de la République mais se retrouve émigré. Il revient en 1796 et meurt le 17 mai 1799.
Sa vie
Pierre-Augustin Caron, né le 24 janvier 1732, est le septième enfant d'André-Charles Caron et de sa femme Louise Pichon. Des dix qui leur naîtront, six seulement vivront : Pierre-Augustin, dit Pierrot, et cinq filles Marie-Josèphe dite Dame Guilbert du nom de son époux, Marie-Louise dite Lisette - future héroïne de l'affaire Clavijo -, Madeleine-Françoise dite Fanchon, Marie-Julie dite Bécasse et Jeanne-Marguerite, dite Melle Tonton. Le père, issu d'une famille d'horlogers protestants, était lui-même devenu maître-horloger après avoir abjuré le protestantisme ; c'est un artisan réputé, créateur de la première montre-squelette, et la famille jouit d'une certaine prospérité. Pierre-Augustin, après des études à l’école des métiers d’Alfort de 1742 à 1745, entre en apprentissage dans l'atelier paternel à l’âge de 13 ans. Il donne du fil à retordre à son père, qui le chasse quelque temps de la maison familiale, mais finit par devenir un artisan compétent, puisqu'il invente en 1753 un nouveau mécanisme d'échappement, dit à hampe ou à double virgule peu utilisé aujourd'hui du fait des problèmes de frottement ; ce sera l'occasion d'une première controverse : l'horloger du Roi Jean-André Lepaute s'attribue l'invention et Beaumarchais doit faire appel à l'Académie des Sciences pour que lui soit reconnue la propriété de l'invention. Il devient fournisseur de la famille royale. Il ne tarde toutefois pas à abandonner l'horlogerie ; ce sera Jean-Antoine Lépine qui le remplacera dans l'atelier paternel, épousera Fanchon et deviendra l'associé, puis le successeur d'André-Charles Caron.
Beaumarchais est également l’inventeur d’un mécanisme de perfectionnement destiné aux pédales de harpes.
Il écrit sa première pièce de théâtre à 9 ans dans laquelle il crée le personnage de Figaro, alors chevalier du Roi de France. Cependant, cette pièce sera détruite dans un incendie.
Il se marie une première fois le 27 novembre 1756 avec Madeleine-Catherine Aubertin, veuve Franquet. L'épouse est de dix ans son aînée mais possède des biens. Il se fait dès lors appeler de Beaumarchais, nom d’une terre qui appartient à son épouse et qui donne l'illusion de la noblesse.
Madeleine-Catherine meurt subitement l'année suivante à 35 ans. Immédiatement, le jeune veuf est soupçonné et se trouve confronté au premier de la longue suite de procès et de scandales qui marqueront son existence.
Travaux et rencontres
Madame Adélaïde solfiant, les filles du roi étaient des musiciennes consommées.
Nonobstant les ennuis de sa vie privée, il commence à être connu. Il se lie d’amitié avec le financier de la Cour, Joseph Pâris Duverney qui favorise son entrée dans le monde de la finance et des affaires. Il se lance alors dans les spéculations commerciales et déploie un tel génie en ce genre qu’en peu d’années il acquiert une grande fortune et achète une charge de secrétaire du roi qui lui confère la noblesse.
En 1759, faveur insigne, il est nommé professeur de harpe de Mesdames, les quatre filles du roi Louis XV, qui résident à la cour.
Patronné par un prince du sang, Louis-François de Bourbon, prince de Conti, il devient bientôt lieutenant général des chasses et commence à écrire de petites parades pour des théâtres privés Les Bottes de sept lieues, Zirzabelle, Jean Bête à la foire qui jouent sur le comique de mots du langage populaire des Halles de Paris.
Menant un train de vie aisé mais toujours à la merci d'une disgrâce, il se remarie en 1768 avec Mme de Sotenville, la très riche veuve du garde général des Menus-Plaisirs, née Geneviève-Madeleine Wattebled. Celle-ci meurt dès 1770, à trente-neuf ans, après seulement deux ans de mariage, lui laissant une importante fortune. À l'occasion de ce second veuvage précoce, Beaumarchais est accusé de détournement d’héritage.
Procès
Les années 1770-1773 sont pour Beaumarchais des années de procès et de défaveur : outre ses démêlés judiciaires avec le comte de la Blache, engendrés par la succession testamentaire de Joseph Pâris Duverney, il est victime de la corruption régnant au sein de la Grande-Chambre du Parlement, ce qui va entraîner l’affaire Goëzman. Il y manifeste un art consommé des factums, allant jusqu’à renouveler le genre, mais il y perd sa fortune, ses alliés et ses droits civiques.
Beaumarchais se fait agent secret
Expert en intrigues et marchandages de toutes sortes et intégré au Secret du Roi — service personnel d'espionnage du roi —, il est en mars 1774 une première fois envoyé à Londres pour négocier la suppression du libelle les Mémoires secrets d’une femme publique de Théveneau de Morande, dirigé contre la comtesse du Barry, favorite royale, mission où il espère regagner les faveurs de la Cour. Cependant, le roi meurt en mai suivant et la comtesse du Barry est bannie de la cour par Louis XVI.
Le 8 avril 1775, sur les conseils de Sartine, il est chargé par le nouveau souverain d’empêcher la publication d’un nouveau pamphlet, l’Avis à la branche espagnole sur ses droits à la couronne de France à défaut d’héritiers, d’un certain Angelucci, qui prétend que le roi a l’aiguillette nouée
Cette mission, qui conduisit Beaumarchais en Angleterre, aux Pays-bas, dans les États allemands et en Autriche, où il fut pour un temps incarcéré pour motif d’espionnage, devient sous sa plume une aventure picaresque.
La même année, il est chargé à Londres de récupérer des documents secrets détenus par le chevalier d’Éon.
La guerre d’indépendance des États-Unis
À partir du mois de juin 1777, il se lance dans une nouvelle aventure et il se fait l’avocat d’une intervention française dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Il entame alors une correspondance enflammée avec le comte de Vergennes, où il défend la cause des Insurgents. Dès le mois de septembre 1775, Beaumarchais joue un rôle politique en tant qu’intermédiaire entre les Insurgents et la France, et il rencontre fréquemment Arthur Lee, député secret des Insurgents.
Le 10 juin 1777, le secrétaire d’État aux affaires étrangères lui confie une somme importante pour soutenir secrètement les Américains3. Initié secrètement par Louis XVI et Vergennes, Beaumarchais reçoit l’autorisation de vendre poudre et munitions pour près d’un million de livres tournois sous le couvert de la compagnie portugaise Rodrigue Hortalez et Compagnie qu’il monte de toutes pièces. La société Rodrigue Hortalez et Cie, devait lui permettre, pensait-il, de s’enrichir en vendant armes et munitions et en envoyant une flotte privée pour soutenir les Insurgés.
Cette péripétie, alors que Beaumarchais s'implique dans les grandes spéculations boursières sous Louis XVI, est le sujet central du roman historique de Lion Feuchtwanger intitulé Beaumarchais, Benjamin Franklin et la naissance des États-Unis, paru en 1946. En fin de compte, bien qu'il ait reçu plus tard les félicitations publiques du Congrès, il engagea dans cette opération une grosse somme plus de cinq millions dont, après d'interminables débats, ses héritiers ne purent recouvrer qu'une faible part.
Il milite au sein de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, fondée en 1777 à son initiative, et obtient à la Révolution la reconnaissance des droits d'auteur. Ceux-ci sont automatiques à la création d’une œuvre. Ils garantissent à son auteur ses droits patrimoniaux et moraux la reconnaissance de la paternité de l’œuvre notamment. Dans De la littérature industrielle, Sainte-Beuve présente l’action de Beaumarchais comme un tournant décisif de l’histoire de la littérature, car l’écrivain passe du statut de bénévole, de passionné ou de mendiant dépendant de ses mécènes à celui d’industriel et de gestionnaire : Beaumarchais, le grand corrupteur, commença à spéculer avec génie sur les éditions et à combiner du Law dans l’écrivain
Il se lance dans l'édition des Œuvres de Voltaire, et, après avoir acquis les caractères de Baskerville, loue pour vingt ans le fort à Kehl en décembre 17806.
En 1786, il épouse en troisièmes noces Marie-Thérèse Willer-Mawlaz. Née en 1751, la nouvelle épousée, âgée de 35 ans, a dix-neuf ans de moins que son mari. Ils se sont rencontrés en 1774 et ont eu une fille, Amélie-Eugénie, en 1777. Marie-Thérèse lui survivra et mourra au début de la Restauration en 1816.
En 1788, après d’importants travaux de reconstruction inachevés, il vend à Aimé Jacquot et Jean Hérisé la papeterie de Plombières-les-Bains qu’il avait acquise en 17807.
En février 1789, il cède aux frères Claude Joseph et François Grégoire Léopold Desgranges les papeteries qu'il possède en Lorraine à Arches et Archettes.
La Révolution française
En 1790, il a 58 ans et se rallie à la Révolution française qui le nomme membre provisoire de la commune de Paris. Mais il quitte bientôt les affaires publiques pour se livrer à de nouvelles spéculations ; moins heureux cette fois, il se ruine presque en voulant fournir des armes aux troupes de la République.
Devenu suspect sous la Convention, il est emprisonné à l’Abbaye pendant la Terreur. Il échappe cependant à l’échafaud et se tient caché quelques années. Il s’exile à Hambourg puis revient en France en 1796.
Il écrit ses Mémoires, chef-d’œuvre de pamphlet, et meurt d’apoplexie à Paris le 18 mai 1799 à l'âge de 67 ans. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise division 28 à Paris.
Sa descendance
De son union avec Marie Thérèse Willer-Mawlaz 1753-1816 qu’il épouse le 8 mars 1786, il eut une fille, Amélie-Eugénie de Beaumarchais 1777-1832.
Amélie-Eugénie épouse en 1796, André Toussaint Delarue 1768-1863, beau-frère du comte Mathieu Dumas dont elle aura quatre enfants :
Palmyre 1797-1835 qui intente, en 1814, un procès afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées par son père pour financer la livraison d’armes destinées à la Révolution américaine. Palmyre aura une descendance directe sous l’Empire et la Restauration via les familles Poncet, puis Roulleaux-Dugage ;
Charles-Édouard 1799-1878 qui deviendra général de brigade. Il obtiendra en 1835, 800 000 dollars et la branche de la famille des deux petits-fils sera ensuite autorisée à relever le nom de Beaumarchais décret impérial de 1853. Il épouse Marthe Paule Roederer dont il aura un fils:
Raoul 1835-1900, colonel de cavalerie, épouse le 22 avril 1869 Caroline de Etcheverry de Préjan, dont il aura 4 enfants 2 fils et 2 filles.
Alfred-Henri 1803-? qui travaillera dans l'administration des finances.
Jean-Pierre Delarüe Caron de Beaumarchais, coauteur du Dictionnaire des littératures de langue française, figure parmi les desciption.
Une dramaturgie nouvelle
L'œuvre de Beaumarchais a traversé les siècles. L'œuvre, c'est-à-dire Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro ; mais des rééditions récentes des Mémoires contre Goezman et des Parades, tout comme les mises en scène de La Mère coupable et de Tarare incitent à moins de sévérité que n'en a témoigné la critique contre ces œuvres mineures. En 1990, on a pu voir représenter au cours de la même saison les trois pièces de la trilogie sur la scène du Théâtre-Français et on a joué Tarare à Strasbourg en 1991 ; cet heureux rapprochement rendait sensible la portée de l'étonnante révolution dramaturgique opérée par l'auteur, aussi bien dans la comédie que dans le drame et l'opéra. Cette dimension, essentielle pourtant, fut occultée par le scandale politique du Mariage, mais les contemporains, comme la comtesse d'Oberkirch, l'avaient perçue : ne s'étonnet-elle pas du succès d'une pièce si manifestement contre « les règles de l'art » ? Le dessein réformateur de Beaumarchais s'inscrit dans des réalisations de ton et d'intérêt variés, mais aussi dans des textes théoriques d'une grande clarté. Entre 1759 et 1767, il élabore sa théorie du théâtre sérieux et se réclame des innovations de Diderot ; Eugénie et l'Essai sur le genre dramatique sérieux (préface à la seconde édition de ce « drame ») en sont les fruits directs mais on en retrouve l'empreinte partout, dans la préface du Barbier de Séville (La Lettre modérée sur la chute et la critique du « Barbier de Séville ») et dans celle de Tarare (Aux abonnés de l'opéra qui voudraient aimer l'opéra), dans Le Mariage et dans La Mère coupable. Il s'agit de bousculer profondément le système des genres dramatiques français, fondé sur la distance tragique ou comique qui sépare le spectateur de la scène et sur le clivage des personnages nobles et bourgeois. Ce projet poétique repose sur une critique idéologique des formes du théâtre de cour. Beaumarchais choisit l'effet de proximité et de sympathie, visé dans le drame ou la tragédie domestique, et la complicité dans le comique. Le spectateur doit se retrouver dans le personnage parce que, comme lui, il est homme. C'est le « caractère », Figaro ou Tarare, qui compte plus que l'« état », Beaumarchais proclame brillamment l'idéologie humaniste et morale des Lumières.
Ce qui distingue vraiment les genres, c'est ainsi leur effet : le sérieux ou la gaîté ; encore peuvent-ils se mêler, comme on le voit dans Le Mariage de Figaro mais aussi dans Eugénie et dans Les Deux Amis : on passe sans rupture de l'attendrissement au sourire. Le genre sérieux, tournant le dos à la tragédie héroïque, doit être écrit en prose : sa beauté doit naître du naturel, de l'« énergie » des situations, des caractères et des émotions. De même, l' opéra doit être débarrassé d'un trop-plein de musique qui l'éloigne de la nature : « une abondance vicieuse étouffe, éteint la vérité : l'oreille est rassasiée et le cœur reste vide » (Aux abonnés de l'opéra). Contre le formalisme poétique, Beaumarchais affirme avec force la prépondérance de la qualité dramatique, proprement théâtrale, du texte : la réévaluation récente de La Mère coupable et de Tarare est directement liée à la réussite scénique de ces textes, qu'encombrent pourtant une rhétorique d'époque ou des vers de mirliton. Tarare n'est pas seulement intéressant par la qualité dramatique (assez rare en 1787) de son livret, mais aussi par l'équilibre obtenu entre drame et musique grâce à une collaboration étroite entre Beaumarchais et Salieri. Ce n'est certes pas non plus hasard si les pièces de Beaumarchais ont fourni des livrets d'opéra à Mozart et à Rossini, qui sont parmi les meilleurs (on peut encore mentionner pour mémoire Darius Milhaud).
Mais ces réformes, dessinées dans la théorie et consciemment mises en œuvre dans les pièces, ne constituent qu'un élément plus immédiatement lisible d'une transformation profonde qui atteint l'ensemble de la structure dramatique. C'est « une révolution théâtrale profonde, et si bien intégrée qu'elle est à présent à peine perçue » (A. Ubersfeld). Beaumarchais tire les leçons de l'évolution de la scène en France et des possiblités décoratives nouvelles qui permettent d'absorber la scène dans le décor, donc dans la fiction. L'espace de la scène devient tout entier mimétique ; il se prolonge fictivement et continûment au-delà de la toile de fond ou des coulisses. Dans Le Barbier de Séville, on est tantôt dans la rue sous la jalousie de Rosine, tantôt de l'autre côté, à l'intérieur de la maison. La scène n'est qu'un fragment prélevé sur l'espace fictif : la plupart des scènes essentielles du Mariage impliquent ce réalisme visuel. Le théâtre doit rivaliser avec la peinture et bien des scènes sont conçues comme des tableaux de genre. Il ne s'agit pas au reste d'un détail formel, car le conflit dramatique est formulé en termes spatiaux : effraction de la maison du bourgeois Bartholo par le noble comte Almaviva (Le Barbier), menaces sur la chambre domestique, arpentée et mesurée par Figaro, pénétrations de l'espace des femmes par Chérubin ou par le comte (Le Mariage). Le temps dramatique est, lui aussi, l'objet d'un travail de ce genre. Il s'agit de dénier la clôture du temps dramatique. De là les « jeux d'entracte » dans Eugénie, mais surtout l'extension de la trilogie selon un modèle d'illusion temporelle semblable à celui qu'on rencontre dans le roman. Du coup, le travail du temps sur le monde et sur les héros est rendu sensible : on passe de Séville, la ville des chansons et de la jeunesse, au château de la maturité, puis au Paris de la Révolution et aux tristesses du second versant de la vie. En 1990, à la Comédie-Française Jean-Pierre Vincent achevait La Mère coupable par un tableau qui regroupait tous les personnages de la famille, s'endormant au son de la bourgeoise pendule. Le temps intérieur et le temps de l'histoire agissent sur la scène. Beaumarchais « invente » la scène de Hugo, de Dumas, père et fils, et de Tchekhov. C'est enfin, comme l'a noté Anne Ubersfeld, la conception de l' action qui constitue le troisième axe de cette révolution. Dès Eugénie, mais de façon tout à fait nette dans Le Mariage, l'action n'est pas dirigée par le héros. Tout semble se faire en dépit de Figaro. Seules triomphent les forces du hasard, qui ne sont providentielles que parce qu'on se trouve dans un monde comique. Là encore, Beaumarchais est un précurseur de Hugo et de la comédie d'intrigue de Labiche ou de Feydeau.
La dernière fête : ambiguïtés et audaces
L'audace politique de la trilogie de Figaro, et surtout celle du Mariage, n'a pas frappé que les contemporains (Danton disait qu'il avait « tué la noblesse »). C'est la valeur subversive de cette pièce qui l'a portée, contre toutes les hypocrisies de l'ordre politique et moral, à travers le XIXe siècle. Elle tient à l'étincelante fête de mots décochés contre l'ordre privilégié et contre les abus de l'Ancien Régime dont Beaumarchais avait tant souffert. Ce verbe d'enfer s'est affûté dans la rédaction des Mémoires contre Goezman qui constituent l'un des plus brillants textes pamphlétaires du siècle : l'étude attentive des différentes phases de leur rédaction, tout comme celle des brouillons et versions successives du Barbier et du Mariage, fait apparaître le travail minutieux de Beaumarchais pour rendre le mot incisif ou percutant. Mais l'insolence du plébéien, paradoxalement, s'intègre merveilleusement dans l'art de la conversation des salons de l'Ancien Régime. L'« esprit » y est plus à l'aise que dans la rhétorique sentencieuse de ceux qui feront la Révolution et qui considèrent la comédie elle-même comme une inconvenance monarchiste : c'est là une autre raison de l'éclipse de Beaumarchais après 1789.
Tout aussi ambiguë est l'audace idéologique et structurelle de la trilogie. Le Barbier de Séville est construit sur le modèle de certaines des parades auxquelles l'auteur s'était essayé de si bonne humeur. Ces pièces en un acte mettent en œuvre un canevas conventionnel, adapté de la commedia dell'arte : Léandre, aidé par Arlequin, recherche une Isabelle peu farouche et s'oppose ainsi aux desseins du barbon, Cassandre. Zizabelle mannequin, Jean-Bête à la foire ou Léandre marchand d'agnus sont des variations sur ce schéma. Le Barbier l'enrichit. La jeunesse triomphe de cette comédie d'intrigue au rythme stupéfiant (c'est l'effet, entre autres choses, de la « contraction » de la pièce en quatre actes), mais aussi le grand seigneur, libertin quoique amoureux. Dans Le Mariage, le modèle se transforme, le valet Figaro n'est plus au service des desseins de son maître, il s'oppose à lui et tente de mener une action qui assure la réalisation de ses ambitions et de ses désirs propres : c'est déjà Ruy Blas. Le plébéien s'oppose ainsi à la pratique du « droit du seigneur » qui livrerait au comte Almaviva sa propre fiancée, Suzanne, et rameute autour de lui une véritable troupe populaire. Mais la jacquerie tourne à la fête réconciliatrice autour de l'union conjugale, celle du comte et de la comtesse, celle de Bartholo et de Marceline, celle de Figaro et de Suzanne. Les déguisements de la parade, le feu d'artifice, les fêtes traditionnelles font oublier les menaces et les insolences de Figaro ou de Chérubin. Ainsi tout finit par des chansons : Le Mariage de Figaro est la dernière fête de l'Ancien Régime, sa dernière utopie. Quant au dernier drame de Beaumarchais, il porte partout la trace de la politique, mais d'une politique qui se fait ailleurs et dont le foyer n'est nullement le discours dramatique ; la présence du buste de Washington, l'engagement de Léon au club, le renoncement aux marques extérieures de noblesse révèlent l'inscription de la pièce dans l'histoire.
Ce n'est pas non plus le moindre paradoxe de voir « monter » dans la trilogie le thème de la famille comme valeur et refuge, thème présent dès les deux drames de 1767 et 1770, en même temps que le travaillent ceux du désir, de l'adultère, de l'inceste et de la perversion. À cet égard, La Mère coupable révèle étonnamment les pulsions qui étaient à l'œuvre dans Le Mariage. Le jeune Chérubin, ce morveux sans conséquence, qui s'introduit si facilement chez les femmes du château et surtout chez sa belle marraine, ce joli valet de cœur n'en est pas moins promis à la mort par la jalousie du roi, et l'on apprend qu'il a violé la comtesse. Le désir, comme le ruban taché de sang, ne circule pas impunément. L'ombre de l'inceste plane sur les amours de Léon et de Florestine. Le double adultère de La Mère coupable appartient à la thématique du drame moderne. Beaumarchais lève un tabou de la scène d'Ancien Régime (on n'y évoquait que des « mariages secrets ») et annonce un topos du théâtre bourgeois des siècles suivants. Il inscrit aussi cet événement historique majeur qu'est l'instauration du divorce par la Révolution. Par une série d'opérations magiques, l'intrigue de la pièce débouche sur une réconciliation générale autour d'une famille reconstituée, et Figaro peut conclure par cette sentence : « On gagne assez dans les familles quand on en expulse un méchant. » Mais cette expulsion ne clôt pas l'imaginaire. Le traître satanique (ainsi est-il désigné par Figaro) part en proférant des menaces qui restent dangereuses. Le drame de famille naît de tous les secrets enfouis, chuchotés ou surpris, sans lesquels il n'est pas de famille. C'est cette structure détraquée qui donne au drame son actualité.
Beaumarchais, grâce à l'épaisseur d'histoire individuelle dont il les dote, fait de ses personnages de véritables sujets. Recentrant Le Barbier de Séville autour de Bartholo, admirablement interprété par Roland Bertin, la mise en scène de Jean-Luc Boutté (à la Comédie-Française en 1990) montrait à nu la mutation du statut du personnage conventionnel du barbon ou du docteur de la commedia dell'arte. Bartholo aime, mais il est vieux et laid, or sa jalousie lui confère une rare profondeur de souffrance et d'intelligence. Quand Beaumarchais se saisit de l'emploi du valet de comédie, il le traite tantôt en usant des ressources de la tradition (l'Éveillé et la jeunesse du Barbier, Guillaume de La Mère coupable), tantôt en le transformant totalement. Figaro (dont la personnalité s'esquisse avec Drink dans Eugénie) est un sujet avec son histoire, ses contradictions, avec sa conscience réfléchissante, en un mot avec son moi. Il peut s'interroger dans son monologue célèbre. Il est d'ailleurs plus qu'un personnage, il est encore le spectateur de son histoire et surplombe la comédie comme le spectateur lui-même, avec lequel il est en profonde sympathie. Et dans ce moi, comme dans le théâtre romantique, nous sentons, nous cherchons l'auteur et sa subjectivité. Son amour des femmes est présent dans chaque scène. C'est ce qu'a vu Mozart, qui a écrit les Nozze autour du sublime trio vocal de la comtesse, de Suzanne et de Chérubin. En elles est le secret du charme et de l'énergie de Figaro. En elles toutes les nuances de la vertu, de l'audace, de l'amour conjugal, mais aussi la fragilité, le désir et ses abandons. Beaumarchais, touché par la grâce, réussit l'alliance du libertinage et de la tendresse.
Si Le Mariage de Figaro est la plus indiscutablement réussie des comédies. c'est que Beaumarchais nous entraîne dans un rythme admirable, parce qu'il est celui de la vie et du désir. Même lorsqu'on sent l'amertume (dans le monologue de Figaro), on la devine passagère : l'insolence tourne à la fête et non pas au ressentiment. Quand on sent cette gaîté s'estomper, ce tempo se casser, le charme s'évanouit : c'est le temps du dernier drame et de la Révolution. Beaumarchais est en vérité l'homme de deux siècles : c'est qu'il est tout à fait libre. Il est libre des traditions, dont il sait pourtant retenir les ressources, libre dans l'idéologie même des Lumières, à laquelle il est attaché, libre dans sa parole et dans ses sentiments. Cette liberté est le secret de sa jeunesse Pierre Frantz
Œuvres
Statue de Beaumarchais par Louis Clausade, 4e arrondissement de Paris.
Théâtre
Eugénie, drame en 5 actes en prose avec un essai sur le drame sérieux. Première représentation : 29 janvier 1767.
Les Deux Amis, ou le Négociant de Lyon, drame en 5 actes et en prose, Vve Duchesne, Paris, 1770. Première donnée à la Comédie-Française le 13 janvier 1770.
Tarare, mélodrame en 5 actes, P. de Lormel, Paris, 1787. Première donnée à l’Académie royale de musique le 8 juin 1787. Livret de Beaumarchais, musique de Salieri.
Trilogie de Figaro, ou Le Roman de la famille Almaviva, selon l’appellation donnée par Beaumarchais dans une préface de La Mère coupable :
Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile, comédie en 4 actes, Ruault, Paris, 1775. Première donnée à la Comédie-Française le 23 février 1775 et 2e représentation du Barbier de Séville en 4 actes le 25 février 1775.
La Folle journée, ou le Mariage de Figaro, comédie en 5 actes et en prose, Ruault, Paris, 1778. Première donnée à la Comédie-Française le 27 avril 1784.
L’Autre Tartuffe, ou la Mère coupable, drame moral en 5 actes, Silvestre, Paris, 1792, an II. Première donnée le 6 juin 1792.
Factum
Concernant l’affaire Goëzman : « Le 17 juillet 1770, le financier Pâris-Duverney meurt et les dispositions qu’il a prises dans son testament en faveur de Beaumarchais sont contestées par le comte de La Blache, son légataire universel. Un procès s’ensuit et les biens de Beaumarchais sont finalement saisis lorsqu’en 1773 il publie à propos des agissements du rapporteur à son procès, le juge Goëzman, quatre mémoires dont l’esprit et la dialectique ont un retentissement considérable et font condamner le juge, le 26 février 1774. Michaud
Requête d’atténuation pour le sieur Caron de Beaumarchais, A Nosseigneurs de parlement, les chambres assemblées, Knapen, Paris, 1773
Supplément au mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Quillau, Paris, 1773.
Addition au supplément du mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (...) servant de réponse à madame Goëzman (...) au sieur Bertrand d’Airolles, ... aux sieur Marin, ... et Darnaud-Baculard ..., P.-D. Pierres, Paris, 1774.
Quatrième mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais... contre M. Goëzman, ... madame Goëzman et le sieur Bertrand, (...) les sieurs Marin, (...) Darnaud-Baculard ... et consorts ..., J.-G. Clousier, Paris, 1774.
Œuvre éditions
Œuvres complètes de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, publiées par P.-P. Gudin de La Brenellerie, L. Collin, Paris, 1809. 7 volumes in-8° avec gravures. I-II. Théâtre ; III-IX. Mémoires ; V. Époques ; VI-VII. Correspondance.
Le Tartare à la Légion, édition établie, présentée et annotée par Marc Cheynet de Beaupré, Le Castor Astral, Collection "Les Inattendus", 1998, 232 pp. Cet ouvrage retrace les liens entre Beaumarchais et Joseph Pâris Duverney, détaillant les phases du procès qui opposa Beaumarchais au comte de La Blache, relatif à la succession du financier. Outre le texte annoté du dernier mémoire à consulter de l’affaire, il donne un éclairage intéressant sur les circonstances ayant présidé à la rédaction du Mariage de Figaro et du Barbier de Séville.
Opéras
Le Nozze di Figaro, Vienne, Burgtheater, 1er mai 1786, par Mozart, livret de Lorenzo da Ponte ;
Il barbiere di Siviglia (Rossini), Paris, Comédie-Française, 23 février 1775, par Gioachino Rossini, livret de Cesare Sterbini.
Cinéma
Le Mariage de Figaro et Le Barbier de Séville ont fait l’objet de nombreuses adaptations cinématographiques en plusieurs langues, pour la télévision essentiellement. Le personnage historique lui-même a été porté à l’écran, notamment dans les films suivants :
Beaumarchais ou 60 000 fusils de Marcel Bluwal - Téléfilm, 1966, France. Avec Bernard Noël dans le rôle de Beaumarchais.
Beaumarchais, l'insolent d’Édouard Molinaro - 1996, France, 96 minutes, Couleur. D’après une pièce de Sacha Guitry. Avec Fabrice Luchini dans le rôle de Beaumarchais.
Posté le : 23/01/2016 22:57
|
|
|
|
|
L. Ronald Hubbard |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 janvier 1986 meurt à 74 ans Lafayette Ronald Hubbard,
à 74 ans à Creston en californie dit L. Ron Hubbard, né le 13 mars 1911 à Tilden dans le Nebraska, écrivain américain qui s'est d'abord fait connaître pour ses œuvres de fantasy à l'époque de l'âge d'or de la science-fiction.Ses Œuvres principales sont Terre, champ de bataille, Mission Terre.Il est également connu pour avoir élaboré, en 1950, la Dianétique, qu'il décrit comme une technique de développement personnel, et surtout comme fondateur de la Scientologie. Il la déclare comme une religion en décembre 1953, date à laquelle la première Église de Scientologie est fondée. Il supervise ensuite la croissance de ce qui devient une organisation mondiale, avant de revenir à l'écriture de science-fiction à la fin de sa vie.
Lorsque la Scientologie fut mise en cause dans les années 1970, il fut condamné par contumace à quatre ans de prison ferme pour escroquerie en France ; aux États-Unis, s'étant à cette époque retiré de la direction de l'organisation, il ne fut pas poursuivi lors de l'affaire d'espionnage Snow White où son épouse et d'autres dirigeants scientologues furent condamnés.
Sa vie
L. Ron Hubbard est né en 1911 à Tilden, au Nebraska, de Harry Ross Hubbard 1886-1975 et de Ledora May Waterbury.
Son père est né Henry August Wilson à Fayette en Iowa ; devenu orphelin encore enfant, il fut adopté par les Hubbard, des fermiers de Fredericksburg en Iowa. Harry, son père, a servi dans la marine américaine de 1904 à 1908. Sa mère, May, était une féministe qui suivit une formation d’enseignante. Les parents de L. Ron Hubbard se marient en 1909, et il naît en 1911. Son père se réengage en 1917 lors de la déclaration de guerre à l’Allemagne, et reste dans la marine jusqu'en 1946 avec un grade d’officier subalterne obtenu en 1934. Il est affecté à la base de Guam dans le Pacifique, où L. Ron Hubbard alla deux fois dans les années 1920 pour rendre visite à ses parents.
Dans sa jeunesse, Hubbard fut un Eagle scout dans les Boy Scouts of America1, et voyagea dans plusieurs régions des États-Unis au fil des diverses affectations de son père. Pour les scientologues, il aurait été dès l'époque de l'enfance et de l'adolescence un être hors du commun, tandis que leurs adversaires s'attachent à montrer qu'il n'en est rien. Selon une biographie de J. Gordon Melton, il aurait été initié à l'âge de 12 ans à la psychanalyse par un ancien élève de Sigmund Freud, Joseph Thompson, au cours du voyage qui menait la famille Hubbard à la côte est des États-Unis. Pour le policier Arnaud Palisson, cette initiation serait sujette à caution car même dans les biographies de l'Église sa durée et son lieu varieraient et le journal du jeune LRH ne la mentionnerait pas.
Après avoir été diplômé de l’école de Woodward pour garçons en 1930, Hubbard s’est inscrit à la George Washington University pour suivre des cours d’ingénieur civil. Ses résultats furent médiocres et il abandonna en 1931 sans aucune qualification. Selon d'anciens scientologues, Hubbard se serait proclamé physicien nucléaire sur la base d'un de ses cours s’intitulant phénomènes atomiques et moléculaires, bien qu’il n’ait jamais obtenu de notes supérieures à F dans cette matière8. En fait, lui-même déclarait dans une interview avoir eu des notes catastrophiques à l'université ainsi qu'un manque d'engouement pour sa matière principale.
Des années plus tard, Hubbard aurait également affirmé posséder un PhD doctorat de l’université de Sequoia en Californie ; cette université n’a jamais donné de cours reconnus par une autorité académique et attribuait des diplômes de complaisance par correspondance. Hubbard a renoncé ensuite à se prévaloir de ce doctorat.
En 1931, il monte une expédition en voilier aux Antilles, dont les visées scientifiques sont également contestées.
En 1933, Hubbard épousa Margaret Poly Grubb dont il eut deux enfants : Ronald Dewolf L. Ron, Jr 1934-1991 et Katherine May née en 1936. Ils vécurent à Bremerton, Washington, durant la fin des années 1930.
Hubbard commença à cette époque à publier de nombreuses histoires d'aventure et de science-fiction dans des Pulps. Auteur prolifique, il connut le succès à partir de 1939 pour des nouvelles de science-fiction et surtout des romans de fantasy parus dans Astounding ou Unknown dont il devient un auteur phare.
En juin 1941, Hubbard a rejoint l' United States Navy avec le grade de lieutenant junior sous-lieutenant et aura diverses affectations jusqu'à la fin de la guerre. Après l’attaque de Pearl Harbor, il a été affecté en Australie puis reçut le commandement d’un patrouilleur côtier USS YP-422 basé à Boston Massachusetts. Après un entraînement à l’école navale en Floride, il reçut le commandement du chasseur de sous-marin USS PC-815. Il affirma avoir repéré deux sous-marins japonais près de l’embouchure de la Columbia River et en avoir coulé au moins un. Ce fait d’armes n’a jamais été reconnu par l’US Navy, selon Gordon Melton parce que le gouvernement américain refusait d’admettre que les Japonais opéraient au large de la côte Ouest des États-Unis, et selon la Navy parce que Hubbard aurait pris pour un sous-marin un dépôt magnétique connu.
Les états de service de Hubbard sont controversés, en particulier sur cette affaire de sous-marin et le nombre de médailles et citations reçues. L’Église de Scientologie met en avant l’estime de ses subordonnés tandis que des adversaires de la scientologie comme Jon Atack ou Russel Miller citent des rapports concernant l'inaptitude au commandement de Hubbard.
Il fut hospitalisé à la fin de la guerre. Selon lui, c'est à cette époque, alors qu'il était entouré de blessés de guerre, qu'il commença à réfléchir sur l'importance du mental dans la santé humaine et à son influence sur le corps.
En 1945, il s'impliqua dans les activités de l'Ordo Templi Orientis au côté d'Aleister Crowley et Jack Parsons; sans être initié à cet ordre, il participa avec Parsons à la pratique de rituel sexuel magique destiné à appeler une déesse ou moonchild.
Selon Hubbard, il aurait agi dans le cadre d'une mission d'espionnage3 pour interrompre les activités magiques de Parsons et sauver une jeune fille que Parsons utilisait dans un but magique.
En 1946, Hubbard quitta son épouse Margaret, et épousa Sara Betty Northrup, la compagne de Jack Parsons ; le divorce de Hubbard pour bigamie et cruauté, devint un sujet de gros titres à la fin de l’année 1950 lorsque sa seconde épouse l'accusa de tortures et d'avoir enlevé leur fille de 13 mois Alexis.
Hubbard retourna à l’écriture de fiction en 1947 ; son œuvre la plus connue de cette période est le roman Return to Tomorrow parue dans le magazine Astounding Science-Fiction.
C’est dans les pages de ce magazine que parut en mai 1950 le premier article de Ron Hubbard sur la dianétique, annoncé depuis plusieurs mois par le rédacteur en chef John W. Campbell qui le présente comme un travail scientifique important. En parallèle paraissait le livre Dianétique : la science moderne de la santé mentale, qui connut un succès rapide. Dès juillet, le livre était un best seller, et des clubs de dianétique se créèrent un peu partout dans le pays pour expérimenter la méthode d'audition qu'il décrivait.
Le corps médical réagit rapidement, l'Association Psychiatrique Américaine exigeant que la dianétique soit soumise à une enquête scientifique15.
En 1952, Hubbard élargit la dianétique en une philosophie laïque qu’il appela scientologie. Cette année-là, Hubbard épousa sa troisième épouse, Mary Sue Whipp dont il eut quatre enfants en six ans : Diana, Quentin, Suzette et Arthur, et en resta l’époux jusqu'à la fin de la vie.
EN 1953, Hubbard déclara la scientologie religion et la première Église de scientologie fut fondée à Camden au New Jersey. Il déménagea vers l’Angleterre à cette époque. Durant le reste des années cinquante, il supervisa la croissance de l’organisation depuis un bureau à Londres. Entre autres la scientologie ouvrit en 1957 un bureau en Afrique du Sud, ce qui amena ses adversaires à imputer à des sympathies pour le régime d'apartheid.
En 1959, il acheta le manoir de Saint Hill, situé près de la ville de East Grinstead au Sussex. Ce manoir géorgien appartenait au maharajah de Jaipur. Il devint le quartier général mondial de la scientologie.
La scientologie devint le sujet de controverses dans le monde anglophone, vers le milieu des années 1960. Le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’État de Victoria en Australie et la province de l’Ontario au Canada menèrent des enquêtes publiques sur les activités de la Scientologie.
Hubbard laissa ces attentions indésirables derrière lui, en 1966, lorsqu’il déménagea vers la Rhodésie, alors sous le coup de sanctions des Nations unies, en suivant la déclaration unilatérale d’indépendance de Ian Smith ; mais il fut prié de quitter le pays.
En 1967, Hubbard prit plus de distance encore avec la controverse attachée à la Scientologie en démissionnant du poste de directeur exécutif et en se rémunérant comme Commodore » d’une petite flotte de navires manœuvrés par des Scientologues. Il croisa pendant les huit années suivantes en Méditerranée. C’est là que Hubbard fonda l’ordre religieux baptisé Sea Organisation ou Sea Org, avec titres et uniformes. La Sea Org devint le groupe de gestion internationale de la Scientologie.
À cette époque, la Grande-Bretagne tenta d'interdire l'accès du pays aux scientologues et en 1968, Ron Hubbard y fut déclaré étranger indésirable. Hubbard retourna aux États-Unis vers le milieu des années 1970 et vécut en Floride pendant un moment.
Quentin Hubbard, un des fils de Ron Hubbard, aurait été élevé dans la perspective de succéder à son père à la tête de la scientologie. Il mourut en 1976 pour une cause toujours indéterminée à ce jour. Des hypothèses de suicide et de meurtre ont été avancées mais aucune n'a été prouvée.
En 1977, les bureaux de Scientologie des deux côtes furent perquisitionnés par des agents du FBI cherchant des preuves de l’opération Snow White un réseau d’espionnage monté par l’Église. En 1979, l’épouse de Hubbard, Mary Sue, et une douzaine d’autres responsables de la Scientologie sont convaincus de conspiration contre le gouvernement fédéral des États-Unis. Hubbard fut mentionné, par le procureur fédéral, comme « coconspirateur non poursuivi, et aucun lien ne lui fut trouvé avec l'affaire. C'est à cette époque qu'il se retira dans un ranch à Tiny Creston, en Californie, au nord de San Luis Obispo.
En 1978, Hubbard fut convaincu d'escroquerie et condamné par contumace à quatre ans de prison et à 35 000 FRF 5 300 € d’amende par un tribunal français.
Dans les années 1980, Hubbard revint à la science-fiction et publia la trilogie Terre champ de bataille puis Mission Terre, dont neuf volumes sur les dix furent publiés à titre posthume.
Hubbard est mort dans son ranch le 24 janvier 1986, à l’âge de 74 ans d’une attaque cérébrale. Il n’avait pas été vu en public durant les cinq années précédentes.
L'auteur de science-fiction
Hubbard a débuté sa carrière d’écrivain par des nouvelles d’aventure publiées dans des magazines bon marché pulp fiction durant les années 1930, sous de multiples pseudonymes dont Rene Lafayette, Legionnaire 148, Lieutenant Scott Morgan, Morgan de Wolf, Michael de Wolf, Michael Keith, Kurt von Rachen, Captain Charles Gordon, Legionnaire 148, Elron, Bernard Hubbel, Captain B.A. Northrup, Joe Blitz et Winchester Remington Colt.
Il commença en 1938 à écrire des récits de science fiction et d’heroic fantasy paraissant dans Astonishing Stories, Astounding ou Unknown.
Il rencontre un premier succès avec la publication dans Astounding de La dimension parallèle, une des premières histoires de téléportation ; mais c'est surtout pour ses textes publiés dans Unknown, plus orientés vers le fantastique, qu'il se taille une vraie réputation. Ses œuvres significatives de cette époque sont Slaves of the sleep où un homme mène une vie double à l'état de veille et dans ses rêves, Death deputy, une histoire de porte-guigne qui paraîtra en français sous le titre de Le Bras droit de la mort ainsi que Typewriter in the sky. Dans ce roman, le héros - nommé de Wolf - se retrouve transporté dans le récit que son ami romancier est en train d'écrire.
En 1940, paraît Fear, fantastique et réaliste à la fois à la façon d'un conte anglais, puis un roman très noir, Final Blackout, récit post apocalyptique qui a pour cadre une Europe ravagée par la guerre.
Cette carrière est interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Après avoir quitté la marine à la fin de la guerre, Hubbard retourna à l’écriture de fiction et publia en 1950 Return to Tomorrow Retour à demain roman sur le décalage temporel des voyageurs interstellaires, qui fait d’eux des parias.
À cette époque où les romans de science-fiction étaient encore exclusivement publiés sous la forme de pulps, deux maisons d'édition spécialisées se créent qui choisiront parmi leurs premières publications en livres Final blackout pour l'une et Slave of Sleep pour l'autre.
C’est dans les pages du magazine Astounding que parut en mai 1950 le premier article sur la dianétique, annoncé depuis plusieurs mois par le rédacteur en chef John W. Campbell comme un travail scientifique important.
La communauté de la science fiction fut divisée sur les mérites de cette publication de Hubbard. Isaac Asimov en critiqua les aspects non scientifiques, et Jack Williamson qualifia la Dianétique de révision lunatique de la psychologie freudienne qui ressemble à une superbe escroquerie rémunératrice. Mais, Campbell et A. E. Van Vogt s’enthousiasmèrent. Campbell devint le trésorier de Hubbard et Van Vogt interrompit sa carrière d’écrivain pour ouvrir le premier centre de Dianétique à Los Angeles.
Des années plus tard, Hubbard retourna à la science fiction, publiant en 1982 Terre champ de bataille et surtout en 1985 Mission Terre, une grande fresque publiée en une série de dix volumes qui fut bien accueillie par de grands auteurs de science fiction et remporta le prix cosmos 2000 en France. Ces dernières œuvres de science fiction de Hubbard se vendirent bien mais furent en partie jugées à l'aune des opinions sur la scientologie. Selon un journal de San Diego les ventes des livres de Hubbard auraient été artificiellement gonflées par les scientologues qui auraient acheté en masse des exemplaires pour manipuler les statistiques des meilleures ventes, tandis qu'à l'inverse un magazine de science-fiction se vit reprocher d'avoir accepté un encart publicitaire.
En 1983 il lance le concours Les écrivains du futur qui existe encore aujourd'hui, dont le but est de lancer de jeunes écrivains n'ayant jamais encore publié, et qui accueille dans son jury des auteurs comme Isaac Asimov et Jack Williamson réconciliés, Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, Robert Silverberg, Frank Herbert, Anne McCaffrey. Il écrivit aussi un scénario, non publié, Revolt in the Stars, qui met en scène les enseignements des niveaux avancés de la scientologie.
En 2000, Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000, adaptation cinématographique de Terre, champ de bataille fut un fiasco, qui se vit attribuer sept Razzie Awards réservés aux pires films de l'année.
En 2006, le Livre Guinness des Records attribua à Ron Hubbard le record de l'auteur le plus traduit et le record de l'auteur le plus publié dans le monde, avec 1084 œuvres publiées en 71 langues.
L'inventeur de la dianétique
En mai 1950, Hubbard publie un livre intitulé Dianétique : La Science Moderne de la Santé Mentale et décrivant une technique de développement personnel. Avec la dianétique, Hubbard introduit le concept d’audition, une thérapie à deux personnes basée sur des questions-réponses et focalisée sur les souvenirs pénibles. D’après Hubbard, l’audition dianétique peut éliminer les problèmes émotionnels, guérir les maladies physiques et augmenter l’intelligence. Dans son introduction, Hubbard écrit « La création de la dianétique est une étape pour l’homme, comparable à la découverte du feu et est supérieure aux inventions de la roue et de l’arc.
L’éditorialiste du New York Daily Mirror, Walter Winchell, avait écrit le 31 janvier 1950 : Quelque chose de nouveau, appelé la Dianétique, va arriver en avril. C’est une nouvelle science qui marche d’une façon aussi invariable que les lois de la science physique, mais dans le domaine du mental. Selon toutes les apparences, elle s’avérera aussi révolutionnaire pour l’humanité que la découverte et l’utilisation du feu par l’homme des cavernes.
Dianetics, the Modern Science of Mental Health se vendit à 150 000 exemplaires dans l’année de sa publication chez Hermitage House. Comme elle se diffusait, la dianétique devint l’objet d’observations critiques par la presse et les autorités médicales. En septembre 1950, The New York Times a publié un avertissement de l’ American Psychological Association » sur le sujet : L’association attire l’attention sur le fait que les prétentions de la dianétique ne sont pas confortées par des preuves expérimentales et met en garde contre les techniques étranges de la dianétique tant qu’elles n’ont pas été validées par une expérimentation scientifique. Consumer Reports, dans une évaluation de la dianétique en août 1951, écrit sèchement on cherche en vain dans dianétique la modestie généralement associée à l’annonce d’une découverte médicale ou scientifique, et souligne que ce livre est devenu la base d’une nouvelle secte. L’article remarque qu’à l’étude du texte de Hubbard, on est surpris depuis le début par la tendance à la généralisation et aux déclarations autoritaires non soutenues par des preuves ou des faits. Consumer Reports met en garde ses lecteurs contre la possibilité de préjudices sérieux pouvant provenir de l’abus de l’intimité de confidences faite dans la relation entre l’auditeur et le patient, un risque qui serait d'autant plus sérieux dans une secte sans tradition professionnelle.
La Hubbard Dianetic Research Foundation est créée à Elizabeth au New Jersey. Cinq bureaux régionaux sont ouverts dans d’autres villes américaines avant la fin de l’année 1950. Hubbard abandonne la fondation en dénonçant certains de ses anciens associés comme communistes .
Le fondateur de la scientologie
En 1952, Hubbard élargit la Dianétique en Scientologie.
Hubbard déclara avoir conduit des années de recherches intensives sur la nature de l’existence humaine. Pour décrire ses découvertes, il développa un vocabulaire avec beaucoup de néologismes. Il codifia un ensemble d’axiomes et de « philosophie religieuse appliquée » qui promettent d’améliorer l’état de l’esprit humain, qu’il appelle le Thétan. L’essentiel de la scientologie se focalise sur la réhabilitation du Thétan.
Les adeptes d’Hubbard croient que sa technologie leur donne accès à leurs vies antérieures, dont les traumas conduisent à des défaillances dans le présent, sauf s'ils sont audités. À cette époque, Hubbard introduisit un appareil de biofeedback dans la procédure d’audition. Il le baptisa Hubbard Electropsychometer ou E-meter bien qu’il fut conçu par M. Volney Mathison, un chiropracteur adepte de la dianétique. Il ne s’agit que d’un ohmmètre logarithmique c'est-à-dire d’un appareil, banal en électronique, mesurant la résistance placée entre ses électrodes. Cet appareil, proche des détecteurs de mensonges de l’époque, est utilisé par les scientologues durant l’ audition pour évaluer la masse mentale entourant le Thétan. Cette masse est censée empêcher le Thétan de réaliser pleinement son potentiel.
Selon Hubbard, une bonne partie des maladies physiques seraient psychosomatiques et celui qui, comme lui, a atteint l’état révélateur de Clair et est devenu un Thétan Opérant serait relativement préservé des maladies. D’après ses biographes, Hubbard s'est donné beaucoup de peine pour supprimer son recours à la médecine moderne, attribuant ses symptômes à des attaques de forces malicieuses, autant spirituelles que terrestres. Hubbard souligna que l’humanité était menacée par de telles forces, qui résultaient des mémoires négatives ou engrammes, stockées dans l’inconscient ou mental réactif, certaines portées en un Thétan immortel depuis des milliards d’années. En conséquence, Hubbard décréta que la seule possibilité de salut de l’esprit était un effort concerté pour clarifier la planète, c’est-à-dire, d’apporter les bénéfices de la Scientologie à tout le monde, partout, et d’attaquer toutes les forces, sociales ou morales, hostiles aux intérêts du mouvement.
Les motivations de Ron Hubbard concernant la fondation de la scientologie, de même que ses sources d'inspiration ont été sujettes à diverses conjonctures. Son expérience d'écrivain de science-fiction et de fantastique est fréquemment rappelée à propos de l'élaboration des théories sur les thétans et la création du mythe de Xénu.
Certains anciens scientologues, s'appuyant en particulier sur le témoignage de Virginia Downsborough, une ancienne membre de la Sea Org, affiment qu'à l'époque où il créa ces théories, il était en permanence sous l'emprise de drogues hallucinogènes, en dépit de ses discours contre toute drogue ou médicament.
D'autres, comme l'ex-scientologue Jon Atack, estiment que Hubbard s’est fortement inspiré dans les principes de la scientologie des expériences occultes de l'Ordo Templi Orientis qu'il a mené au côté d'Aleister Crowley et Jack Parsons ; selon des sociologues il ne s'agirait que d'une influence parmi d'autres, voire minime.
Certains documents, qui auraient été écrits par Hubbard lui-même, suggèrent qu’il considérait la scientologie comme une entreprise, pas comme une religion. Une lettre qui lui est attribuée par ses détracteurs, datée du 10 avril 1953, dit qu’appeler la scientologie une religion résout un problème d’affaires pratique, et que l’ériger en religion parvient à des fins plus justes… avec ce que nous avons à vendre. Dans une directive officielle de 1962, il aurait écrit La scientologie de 1970 sera préparée sur la base d’une organisation religieuse à travers le monde. Cela ne doit pas contrecarrer, en aucune manière, les activités habituelles de toute organisation. Il s’agit uniquement d'un travail de comptable et de juriste.
Des propos qu'il aurait tenus sont fréquemment rapportés : Je vais inventer une religion qui me rapportera une fortune. Je suis fatigué d’écrire pour un penny le mot .
À l'inverse, dans une interview donnée en 1958 au Dr Stillson Judah, théologien et professeur d’histoire religieuse, Hubbard explique qu'à la suite de ses travaux sur la Dianétique, s'étant confronté au fait que l'homme était son propre esprit et que le domaine qu'il explorait maintenant était celui de la spiritualité, il avait dû se rendra à l'évidence qu'il avait pénétré le champ de la religion.
En 1958, la fondation de Scientologie de Washington DC, a perdu son statut d’exonération de taxes à cause des émoluments de Hubbard qui s'élevaient à plus de 108 000 $ sur une période de quatre ans et ce, en plus du pourcentage des revenus bruts habituellement 10 % qu’il recevait.
Justice Latey, juge de la Haute Cour de Justice de Londres, eut des déclarations très critiques concernant Hubbard et la scientologie.
Le Commodore de la Sea Org
En septembre 1966, Hubbard quitte ses fonctions de leader administratif de l'Église de Scientologie. Il se consacre alors au développement des niveaux supérieurs de la scientologie. Il fait l'acquisition d'une flotte de trois bateaux et s'embarque avec des scientologues de longue date qui le soutiennent dans ses recherches. Ceux-ci ne sont pour la plupart pas familiers avec la vie en mer, et ont tout à apprendre du maniement d'un bateau en haute mer. En 1967 il établit officiellement "l'organisation maritime" sea org, ordre religieux dont le premier objectif est de former des scientologues dévoués aux niveaux supérieurs de scientologie, afin de les envoyer dans les organisations prévues à cet effet.
Selon d'anciens scientologues Hubbard avait à son service personnel les Messagers qui transmettaient ses ordres, et desquels était attendue une obéissance aveugle et immédiate ; ils évoquent des punitions brutales telles que l’incarcération et l’estrapade, l'impossibilité de vie familiale entre le temps consacré au service et celui des auditions, ainsi que l'implication d'enfants très jeunes. D'autres restés fidèles au mouvement accordent à cette expérience de vie en mer avec Hubbard une valeur inestimable. Il était attendu des membres de la Sea Org une loyauté et un dévouement absolus ; en cas de faute, ils pouvaient éviter l'exclusion comme fair game en se soumettant à un programme de réhabilitation, selon Melton certains dirigeants actuels seraient eux-mêmes passés par cette réhabilitation.
Certains textes de cette époque attribués à Hubbard décrivent des procédures pour résister aux personnes suppressives, c'est-à-dire les gens ou les groupes qui cherchent activement à nuire à la Scientologie ou à un scientologue par des actes suppressifs. Ils préconisent des comportements criminels, l’exploitation des lois et des tromperies, et en particulier la propagande noire, campagne de diffamation pour détruire la réputation de la personne. L’Église de scientologie affirme que ces propos étaient sortis de leur contexte, qu'ils ont depuis été retirés de sa doctrine, et que cette ligne de conduite n’existerait plus, affirmation vigoureusement contestée par les critiques de l’Église.
En 1971, suivant les consignes de Hubbard, l'organisation maritime assumera la direction internationale de l'Église de scientologie. La vie en mer de Hubbard et de l'organisation maritime s'arrêtera en 1975, date à laquelle cette dernière s'installera à terre tout en continuant d'assumer ses fonctions. Hubbard vivra alors en Floride pendant quelques années.
À partir des années 1970, Hubbard fut concerné par des poursuites judiciaires dans plusieurs pays, lors de procès impliquant diverses organisations de la Scientologie.
Procès pour escroquerie
En 1978, en France, des scientologues furent convaincus d'escroquerie en première instance au terme de six années de procédure. Il leur était reproché de réaliser « une pression intellectuelle et morale sur les personnes attirées par l'espérance d'un meilleur équilibre personnel, d'une plus grande réussite professionnelle et en définitive du "bonheur" pour vendre des livres, formations et autres services à un coût totalement disproportionné par rapport à leur valeur intrinsèque. Ils furent tous relaxés en appel
Hubbard, qui, outre les droits d'auteur sur ses livres et autres matériels, aurait perçu 10 % du revenu brut des différentes filiales de l'Église, fut condamné par contumace à quatre ans de prison et à 35 000 FRF d’amende. En janvier 2013, la Cour d'appel de Caen a rappelé qu'il n'avait jamais été cité et n'avait pas eu l'occasion de faire opposition, et que sa condamnation tombait sous le coup de la réhabilitation, donc devait être considérée comme non avenue.
L'opération Snow White
En 1977, les bureaux de Scientologie des deux côtes furent perquisitionnés par des agents du FBI cherchant des preuves de l’opération Snow White, un réseau d’espionnage et d'infiltration de diverses organisations monté par l’Office du gardien dans le but de faire disparaître des documents sur celle-ci et sur Hubbard. À cette occasion fut découverte la mise en œuvre de la politique de propagande noire attribuée aux préconisations de Hubbard envers les adversaires de scientologie.
En 1979, l’épouse de Hubbard, Mary Sue, et une douzaine d’autres responsables de la Scientologie sont convaincus de conspiration contre le gouvernement fédéral des États-Unis. Hubbard fut mentionné, par le procureur fédéral, comme coconspirateur non poursuivi; aucun lien direct ne lui fut trouvé avec l'affaire, l'Office du Gardien ayant, selon l'Église, agi de sa propre initiative. L'épouse de Hubbard fut condamnée à quatre années de prison.
Affaire Gerry Armstrong
En 1984, un procès opposa la Scientologie à Gerry Armstrong, ancien scientologue exclu de l'Église de Scientologie et déclaré suppressif en novembre 1981. Celui-ci, scientologue depuis dix ans et membre de la Sea Org, participa en janvier 1980 à la destruction de divers documents sur ordre de l'organisation qui craignait une opération de police. Il eut accès à cette occasion aux carnets de jeunesse d'Hubbard, qu'il conserva, et obtint l'autorisation de l'Église de Scientologie de faire des recherches complémentaires pour la rédaction d'une biographie confiée à l'écrivain Omar Garrison. Selon Russel Miller, c'est quand il voulut faire rectifier la biographie officielle de l'Église de Scientologie qu'il fut exclu de celle-ci et déclaré suppressif en novembre 198115. Lors du procès, Armstrong se plaignait du harcèlement lié à la politique de fair game envers les suppressifs dont il avait fait l'objet de la part de l'Église, tandis que celle-ci lui reprochait le détournement de documents, les atteintes à la vie privée et le non-respect du contrat. Gerry Armstrong reconnut aussi avoir eu des contacts répétés avec l'IRS et la CIA qui lui ont été reprochés par l'Église, qui a vu en lui l'un de leurs agents. Le procès aboutit à un compromis en 1986, par lequel l'organisation versa 800 000$ à Armstrong. Armstrong fut par la suite reconnu coupable à plusieurs reprises par des tribunaux des États-Unis d'avoir violé le compromis et fut condamné à payer 800 000 dollars à L'Église de Scientologie. Il partit vivre au Canada pour éviter d'avoir à répondre d'une peine de prison de 26 jours.
Mort et autopsie
Hubbard est décédé dans son ranch le 24 janvier 1986, à l’âge de 74 ans d’une attaque cérébrale. Il n’avait pas été vu en public durant les cinq années précédentes. L’Église de scientologie annonça que Hubbard s’était délibérément débarrassé de son corps pour faire des recherches d’un plus haut niveau spirituel sans être encombré de son enveloppe mortelle.
Selon certains sites internet comme Xenu.net, l'autopsie obtenue par le médecin légiste du comté de San Luis Obispo pour vérifier s'il avait pu y avoir une intoxication aurait révélé qu'il avait reçu du Vistaril médicament à base d'hydroxyzine quelques jours avant sa mort, qu'il présentait dix traces de piqûre sur la fesse droite et qu'il était atteint selon son médecin personnel, Gene Denk, d'une pancréatite chronique alcoolique58 mais qu'aucune trace de stupéfiant ni de poison n'apparaissait. Le médecin de Ron Hubbard déclara aussi dans l'enquête qu'il le soignait depuis 8 jours de manifestations de dysphasie qui ne lui laissaient pas de doute sur l'issue rapide de sa dégénérescence neurologique à la suite de sa première attaque cérébrale. L'administration d'hydroxyzine par voie intramusculaire qui est présumée à la lecture de l'autopsie chez différents auteurs ou par voie orale étant initialement réservée aux personnes souffrant de graves manifestations psychiatriques permet la contention chimique ou encore présentant des troubles de l'addiction aux narcotiques ou aigus de l'alcoolisme, sembla déplacée et paradoxale chez Hubbard qui avait souvent dénoncé en public l'usage de la drogue et des médicaments à vocation psychiatrique. Cependant, d'autres témoignages l'ont accusé d'avoir été lui-même un consommateur de drogues.
Succession
Bien qu'ayant abandonné toute responsabilité dans la gestion de la scientologie, il aurait continué à en percevoir des revenus importants, les membres de l’Église étant redevables de donations tarifées pour les cours, les auditions, les livres et les E-meters dont lui revenait une partie en sus des royalties sur ses œuvres. Le magazine Forbes estima ses revenus provenant de la scientologie en 1982 à plus de 40 millions de dollars US. Cependant, Hubbard a nié avoir reçu ces émoluments, à plusieurs reprises par écrit. Il proclamait n’avoir jamais reçu d’argent de l’Église.
Après l'affaire Snow White, l'Office du Gardien avait été démantelé et dans la réorganisation qui avait suivi, les scientologues de haut rang mêlés à cette affaire avaient été écartés des instances dirigeantes.
En mai 1982, Ron Hubbard et son entourage a créé la "Church of spiritual technology" chargé de percevoir ses droits d'auteurs sur ses publications.
En mai 1987, c'est donc David Miscavige, un des anciens assistants personnels de Hubbard, qui prit la présidence du centre de technologie religieuse RTC, une société commerciale détenant les marques et symboles déposés de la dianétique et de la scientologie. Bien que le centre de technologie religieuse soit une entreprise distincte de l’Église internationale de scientologie, Miscavige est le dirigeant de la religion. Herber Jantzsch est le président de l’Église internationale de scientologie.
Controverses biographiques
La biographie de Ron Hubbard est fort controversée et beaucoup de détails de sa vie sont litigieux. D’une part, les quelques biographies publiées par l'Église de scientologie présentent Hubbard et ses diverses réalisations sous un éclairage hagiographique. D’autre part, les biographies de Hubbard écrites par des journalistes indépendants ou par d’anciens scientologues peignent un tableau beaucoup moins flatteur de Hubbard et contredisent dans beaucoup de cas le matériel présenté par l'organisation. En dernier lieu quelques universitaires ont écrit sur le sujet, analysant à la fois les biographies de l'Église et celles de ses détracteurs.
Une des premières controverses sur la biographie de Hubbard est celle liée à la découverte puis à l'exploitation d'archives personnelles de Ron Hubbard par Gerry Armstrong, qui donna lieu au procès exposé plus haut. Selon Russel Miller, c'est quand il voulut faire rectifier la biographie officielle de l'Église de Scientologie qu'il fut exclu de celle-ci et déclaré suppressif en novembre 1981. Russell Miller exploita ces carnets dans une biographie Bare-Faced Messiah Le gourou démasqué, où il mettait en exergue le caractère fabulateur de ces récits de jeunesse, et présentait le caractère de Hubbard sous un jour fort peu flatteur. Il insiste entre autres sur la période de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur les récits des voyages en Asie de Hubbard, où des commentaires péjoratifs sur les chinois ou les lamas tibétains sont assez éloignés du récit officiel disant Ron parla de regarder les moines méditer durant des semaines … il tira profit de cette occasion unique d’étudier la culture d’Extrême-Orient. L'Église de Scientologie tenta de faire interdire sa publication pour utilisation de matériel sous copyright à des fins de dénigrement systématique, mais n'obtint pas gain de cause.
En 1987, une autre biographie fit également scandale, où était impliqué le propre fils de Ron Hubbard. Celui-ci, L. Ron Hubbard Jr., après avoir changé son nom pour Ron DeWolfe, avait attaqué son père à plusieurs reprises dans certains medias, en particulier une interview dans Penthouse, où il l'accusait de toxicomanie, de pratique de rituels sataniques et d'être un menteur invétéré. Quelques années plus tard, Bent Corydon reprit ses allégations dans la biographie qu'il écrivait, Ron Hubbard, Messiah or Madman?, où il était prévu de créditer Ron DeWolfe comme coauteur. Celui-ci le refusa et rétracta ses accusations initiales en 1987 dans un affidavit.
Une étude de l'université de Marburg fait le point sur ces différentes biographies.
La collection "Ron" qui comprend une douzaine de fascicules illustrés, confectionnée par les scientologues eux-mêmes dans les années 1990, contient une prise en compte de données issues de la masse de documents inédits relatifs à Hubbard et développe une autre appréciation de la trajectoire du fondateur. Le film américain The Master de Paul Thomas Anderson en 2012, accumulant les récompenses, dresse un portrait transparent de Ron Hubbard à travers le rôle de Lancaster Dodd. Elle est le fait d'artistes d'Hollywood dont le compagnonnage avec la scientologie ne s'est guère démenti depuis les années 1950, de Errol Flynn à Tom Cruise et de B. de Mille à Paul Anderson.
Œuvres Livres de fantasy et science-fiction
Ron Hubbard a écrit plus d'une centaine de romans de fiction. Cette bibliographie ne comprend que les titres des livres traduits en français. Les dates sont celles de la publication en France.
Romans :
Terre champ de bataille, Presses Pocket Science-fiction no 5280 5281 et 5282, 1985.
Mission Terre, suite romanesque en dix volumes, Presses de la Cité, 1988-1990.
Return to To-Morrow - Retour à demain, trad. A. Audiberti, Fleuve Noir, Coll. Anticipation, no 98, 1957.
Doc Mathusalem, Presses de la Cité, 1993.
Final Black-out, Presses de la Cité, 1992.
Fear, 1991 - Au bout du cauchemar, trad. Michel Demuth, Presses de la Cité, Presses Pocket, Coll. Science-Fiction no 5543, 1991.
Death's Deputy, 1940 - Le bras droit de la mort, trad. Igor B. Maslowski, Hachette, Romans extraordinaires - L'Énigme, 1951.
Nouvelles :
La Dimension périlleuse, in L'âge d'or de la SF 4e série, Opta, Fiction-Spécial no 21, 1973.
Quand montent les ombres, in Histoires galactiques, Livre de Poche, La Grande Anthologie de la SF, no 3774.
Derrière la nébuleuse noire, in Les Pièges de l'espace, Le Masque SF, no 53, 1977.
Livres de dianétique et de scientologie
Par ordre chronologique de publication :
Dianétique, la Thèse Originelle, New Era Publications, Dernière édition 2007.
Évolution d'une Science, New Era Publications, Dernière édition 2007.
La Dianétique, la Puissance de la pensée sur le Corps, New Era Publications, Dernière édition 2007.
Science de la Survie, New Era Publications, Dernière édition 2007.
Self Analyse, New Era Publications, Dernière édition 2007.
Procédure Avancée et Axiomes, New Era Publications, Dernière édition 2007.
Guide pour préclairs, New Era Publications, Dernière édition 2007.
Scientologie, une Histoire de l'Homme, New Era Publications, dernière édition 2007.
Scientologie 8/80, New Era Publications, dernière édition 2007.
Scientologie 8/8008, New Era Publications, dernière édition 2007.
La Création des Aptitudes Humaines, New Era Publications, dernière édition 2007.
Dianétique 55, New Era Publications, Dernière édition 2007.
Scientologie, les Fondements de la Vie, New Era Publications, dernière édition 2007.
Les Problèmes du Travail, New Era Publications, dernière édition 2007.
Une Nouvelle Optique sur la Vie, New Era Publications, dernière édition 2007.
Scientologie 8/08, le Livre des Fondements, New Era Publications, dernière édition 2007.
Introduction à l'Éthique de Scientologie, New Era Publications, dernière édition 2007.
Un Corps Pur, l'Esprit Clair, New Era Publications, dernière édition 2007.
Films
Les films suivants furent réalisés à partir des scénarios de Ron Hubbard
1964 : The Mastery of GPMs
1964 : The Bank and Its Pattern
1964 : The Pattern of the Bank
1966 : Composition of the Bank
1966 : General Information
1966 : Auditing Demonstration
1966 : The Technical Materials
1967 : Affinity (dont il fut également réalisateur et producteur
1976 : How to Set Up a Session and an E-Meter également réalisateur et producteur
1976 : How the E-Meter Works également réalisateur et producteur
1976 : Man the Unfathomable également réalisateur et producteur
1977 : The Secret of Flag Results
1978 : An Afternoon at Saint Hill également réalisateur et producteur
1980 : The Problem of Life également réalisateur et producteur, ainsi que compositeur et directeur de la photo
1981 : The Auditor's Code
1981 : The Cycle of Communication également producteur et compositeur
1981 : The Case He Couldn't Crack également réalisateur et compositeur
1985 : The Tone Scale également réalisateur, producteur, compositeur et narrateur
1985 : E-Meter Reads Dril
1988 : Classification, Gradation & Awareness Chart
1988 : The Auditor's Code
1988 : The History of the E-Meter
1989 : TRs in Life également narrateur
1989 : Assists
1995 : Assists
1995 : The Art of Communication également compositeur
1995 : Confessional TRs également compositeur
1996 : The Cycle of Communication également narrateur
1996 : Orientation: A Scientology Information Film
1997 : The Auditor's Code
1997 : Body Motion Reads
1998 : The Different TR Courses and Their Criticism
Il est réalisateur, producteur, compositeur et narrateur de :
1983 : The Professional TR Course
et compositeur des musiques de
1986 : What Happened to These Civilizations?
1988 : The Married Couple
Prix Ig Nobel
Il reçoit un prix Ig Nobel en 1994 pour son crépitant Grand Livre, "La Dianétique", très profitable pour l’humanité ou pour une partie d’entre elle.
SCIENTOLOGIE
La scientologie nom officiel : Church of Scientology est l'œuvre de Lafayette Ronald Hubbard 1911-1986, dénommé par les adeptes L.R.H., Ron ou Commodore, célèbre auteur américain de romans de science-fiction. Il était selon lui le premier être à avoir trouvé, au péril de sa vie, le chemin vers la liberté totale. La doctrine, désignée sous le nom de Tech Standard, qu'il en a tirée permettrait désormais au reste de l'humanité de se libérer. Son altération constitue de ce fait le crime absolu aux yeux de ses adeptes. Hubbard est l'unique source de la doctrine et de la technologie qu'il a baptisées du nom de Dianétique, puis de scientologie. Tous ses travaux s'y rapportant sont considérés comme des écrits sacrés. Ce sacré s'est annexé des domaines ordinairement profanes comme le management. Il tend même à recouvrir la réalité tout entière, à nier tout espace profane. La scientologie effectue depuis la mort de son fondateur un important travail de purification des sources.
Identifiée par le rapport parlementaire français de décembre 1995 comme une secte dangereuse, surveillée étroitement par l'État fédéral allemand, la scientologie est reconnue en revanche comme religion aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Suèd et en Espagne notamment. Elle compterait en 2005 entre 8 et 15 millions de membres selon les estimations. D'autres sources faisaient état d'un million de membres dont 10 000 environ pour la France. La scientologie est éminemment moderne par son organisation, son mode de prosélytisme mais aussi par sa doctrine et les comportements qu'elle génère. Sa conception de l'homme et de la société s'avère très en prise avec les ultimes évolutions enregistrées par les sociétés avancées.
Historique de la scientologie
L. R. Hubbard publie en 1950 La Dianétique, science moderne de la santé mentale. Cet ouvrage est un livre banal parmi tous ceux qui, aux États-Unis, proposent alors de créer une psychothérapie en dehors des enseignements de la psychanalyse freudienne. De nombreux groupes de Dianétique sont bientôt créés (États-Unis, Australie, Israël...). La Dianétique se présente alors comme une discipline scientifique et thérapeutique. Elle suscite rapidement l'opposition du corps médical, notamment psychiatrique. Hubbard imprime alors à son enseignement une orientation religieuse afin de bénéficier de la protection du premier amendement de la Constitution américaine (liberté des cultes) et du régime d'exonération fiscale qui lui correspond. La scientologie adopte tout un arsenal de signes religieux (credo, prières, cérémonies...). La première Église de scientologie est ouverte en 1954 aux États-Unis (Washington). Sur décision de son fondateur, le siège de l'organisation est transféré un temps en Angleterre (Saint Hill Manoir) et l'Association des amis de la scientologie, qu'il crée dans la foulée, essaime dans de nombreux pays dont la France. En 1966, il abandonne la direction officielle du mouvement pour se consacrer à ses recherches. Il embarque en 1967 à bord d'une flottille et fonde la Sea Org (Organisation maritime). La flotte est désarmée en 1976 et son état-major s'installe définitivement aux États-Unis. La scientologie continue de croître malgré la retraite de Hubbard à partir de 1977 et bien que se prépare déjà en coulisse ce qui va devenir une véritable guerre de succession. David Miscavige, ancien Messager du Commandant (Commodore's Messenger Organization, C.M.O. – structure fondée pour regrouper les enfants des scientologues chargés de transmettre la parole du Maître) dénonce bientôt l'altération de la Tech par David Mayo, dauphin présumé du fondateur, et obtient la mise à l'écart des dirigeants du Bureau des Gardiens (dont Marie Sue, épouse du fondateur) après leur condamnation par la justice américaine pour espionnage et vol. Un compromis est finalement trouvé entre une partie de l'appareil et la jeune garde. L'Église de scientologie internationale (Church of Scientology International, C.S.I.) reste la plus haute autorité ecclésiastique mais le cœur du système passe sous contrôle du Centre de technologie religieuse (Religious Technology Center, C.T.R.) fondé par Miscavige pour préserver l'orthodoxie des Écrits et de la Tech et gérer ses marques. L'état-major du C.T.R. exerce notamment son pouvoir à travers le comité de surveillance (Watchdog Committee) qui contrôle l'activité de onze secteurs d'organisation et du Bureau international des affaires spéciales (Office of Special Affairs International, O.S.A.I.), service de sécurité, régulièrement dénoncé par les associations dites antisectes. La quasi-totalité des postes de direction est contrôlée par des membres de la Sea Org, véritable ordre de moines-soldats ayant signé un engagement pour un milliard d'années, portant des grades et des uniformes militaires. La scientologie a ainsi survécu au décès de son fondateur, puis à la création de groupes dissidents commercialisant des produits analogues à des tarifs beaucoup moins onéreux.
L'organisation scientologique
La structure de la scientologie organise un système de progression sur le « pont ». Les organisations de base (orgs de classe 5) vendent les services d'introduction (classés de « préclair » à « clair »). Les orgs plus avancées (Advanced Orgs) commercialisent les niveaux secrets,gradués de 1 à 8, qui sont réservés aux « thétans opérants », les O.T., Operating Thetans). Les nouveaux adeptes appartenant à l'élite sociale, particulièrement prisés, sont dirigés vers les centres de célébrités (Églises de classe 5). L'ensemble des orgs observent des comportements standardisés à l'extrême en appliquant les mêmes procédures. Ces structures non électives sont excessivement hiérarchisées, cloisonnées et complexes. La scientologie se caractérise par un fantasme de toute-puissance qui entretient une mystique de l'organisation propre à attirer des sujets fragilisés. Elle innove cependant en coulant sa forme religieuse dans le moule managérial. La scientologie n'a en effet qu'un seul but : concevoir, fabriquer et vendre ses produits. Elle se développe notamment par des franchises percevant un pourcentage sur les ventes. Le prosélytisme est fondé sur des techniques de communication et de commercialisation, dont le fameux test de personnalité : test d'analyse de capacité d'Oxford. Les adeptes sont formés pour recruter. Ce commerce utilise les méthodes les plus profanes (promotions, achats groupés, etc.). La scientologie est naturellement très présente sur le terrain économique à travers son réseau Wise (World Institute of Scientology Enterprises, Institut mondial des entreprises de scientologie). Elle développe enfin un réseau d'associations caritatives utilisant aussi la Tech Standard. La scientologie « produit » l'adepte comme objet adéquat à son propre fonctionnement. Elle pratique peu l'injonction mais obtient une normalisation en travaillant le désir. L'adepte entretient en effet avec la scientologie une relation de nature asymétrique du fait de sa soumission inconditionnelle à une organisation hyperhiérarchisée et aussi du fait de sa croyance en la promesse proclamée de guérison qui provoque une situation de transfert. Dévalorisé par la découverte de sa « ruine », il trouve une valorisation dans le don de soi, forme particulière de sacrifice, qu'il accomplit en se conformant aveuglément aux normes. Cette soumission s'appuie sur des doctrines – la Tech Standard –, des instruments – l'électromètre –, des rituels – l'audition – et bien sûr des interprètes autorisés.
La doctrine
La scientologie, se présentant comme une philosophie religieuse appliquée, entend « clarifier la planète ». Selon son enseignement, les hommes seraient des thétans (principes spirituels immortels) qui, après avoir créé l'univers, se seraient accidentellement englués dans leur création. Ils auraient perdu leur puissance et auraient régressé jusqu'à oublier qui ils étaient. La scientologie propose donc à ses adeptes de recouvrer la conscience de soi-même en tant que thétan, de parvenir à l'état de « clair », qui seul libère le thétan et le rend « opérant » donc littéralement tout-puissant. L'initiation scientologique apparaît formellement comme un enchaînement d'étapes. Les premiers niveaux sont publics, les niveaux supérieurs sont secrets. Ils représenteraient un danger vital pour des individus non préalablement initiés. La scientologie se caractérise en réalité par un fonctionnement au secret sans secret : c'est de la dramatisation de sa transmission qu'elle tire son efficacité plutôt que du contenu de ses révélations. Ces étapes obligatoires forment ce que la scientologie nomme le « pont vers la liberté totale » qui fait passer de la non-existence à la toute-puissance. L'adepte accomplit deux parcours en parallèle, l'un de doctrine, l'autre d'audition. Le premier parcours, dénommé « entraînement », consiste en une étude intensive des Écrits. Cette formation s'accomplit sous le contrôle d'un superviseur de cours. Il existe, en outre, au sein de chaque « académie », un « clarificateur de mots » chargé de l'orthodoxie. La doctrine ne relèverait pas de la croyance car elle serait confirmée par la pratique. L'adepte accomplit également un second parcours parallèle en « audition ».
L'audition doit libérer le thétan du fardeau de mest (néologisme formé à partir des initiales de matière, énergie, espace, temps). Révélation standardisée et progressive du passé du thétan à l'adepte, elle est qualifiée de sacrement. De même, l'électromètre est considéré religieusement bien qu'il relève, comme l'audition, d'une même démarche technico-magique par excès de rationalisation, autrement dit par scientisme. L'appareil, qui existe en diverses versions, enregistre en fait les réactions électrodermiques. Il aiderait à détecter les zones de souffrances spirituelles liées à des épisodes douloureux. L'objectif serait de les « travailler » jusqu'à ce que l'aiguille de l'appareil devienne « libre ». Un auditeur (ministre scientologue) guide l'audité (l'adepte) tout au long de ce travail. L'audition se donne pour objectif de retrouver tous les événements traumatiques de la vie présente et des vies antérieures (la piste du temps, remontant l'histoire de l'univers jusqu'à 75 millions d'années) qui aliènent une grande quantité d'énergie et réduisent ainsi les capacités d'action et de pensée du thétan, entravé par la condition d'homme de l'adepte. La libération du thétan exige tout d'abord l'effacement des engrammes, ces marques du temps propres à la mémoire de chaque individu, c'est-à-dire l'effacement de la condition d'homme. Puis une seconde phase permettrait de passer de l'état de « clair » à celui de pré-O.T. puis de O.T. Elle marquerait la progression d'une dimension individuelle à une dimension collective, depuis les « incidents » qui ont marqué l'histoire du monde.
Cette technologie du bonheur fait finalement de l'homme lui-même le vrai problème. Elle marque en outre la victoire du signe clos sur le symbole ouvert, annihilant la possibilité même d'interprétation. Elle enclenche enfin une logique de purification destinée à chasser toute faiblesse de l'homme. Les procédures de purification (sauna, effort physique, régime alimentaire) obligatoires au début du parcours pour débarrasser, dans un but spirituel, le corps de ses résidus de drogues, de substances toxiques, expriment bien cette réification, cette réduction de l'homme à l'état de produit. Tout bien pesé, la Tech reste, d'un point de vue psychiatrique, très voisine des rééducations comportementales de type béhavioriste imageries mentales libres, répétition, accompagnement dans le délire, etc.. La nouveauté ne résiderait pas tant dans ces techniques que dans leur généralisation.
Le rapport au monde extérieur
La scientologie postule que l'homme est bon mais distingue entre l'individu d'élite, le suspect et l'asocial. Chacun voit son éthique définie par sa position sur « l'échelle des conditions ». Toute activité est pour cela systématiquement encadrée, quantifiée, enregistrée. L'objectif n'est pas officiellement de surveiller et de punir, mais d'aider à progresser. L'organisation dispose pour cela d'officiers d'éthique mettant en œuvre plusieurs procédures. (confessions en audition, interrogatoires de sécurité pour les adultes ou les enfants, etc.). L'adepte en « mauvais standing » devient une « source potentielle de trouble » (Potential Trouble Source, P.T.S.). Il existe 34 degrés de sanction, allant de la perte d'un droit à celle d'un bien (grade). Un programme de redressement (Rehabilitation Project Force, R.P.F.) a même été créé en 1973. Selon les scientologues, ces personnes antisociales représenteraient environ 20 p. 100 de la population globale, parmi lesquelles on compterait 2,5 p. 100 de personnes vraiment dangereuses, dites « suppressives » (Suppressive Persons, S.P.). Un cours de détection explique que les « P.T.S. » font des « montagnes russes » (qu'ils sont sujets à des variations de tonus), mais qu'ils se libèrent en se « déconnectant » de S.P. La scientologie a formalisé 72 actes permettant d'identifier ces « suppressifs ». Il n'existerait pas, selon elle, un seul adversaire qui ne soit ou n'ait été par le passé un criminel. La scientologie, accusée par ses détracteurs de pratiquer la « propagande noire », c'est-à-dire de lancer des campagnes de rumeurs, explique qu'elle en est la victime. Elle se heurte cependant à sa propre logique normalisatrice : elle a dû ainsi établir des garde-fous en définissant un pourcentage normal de « P.T.S.-S.P. » dans ses rangs, en mettant en garde ses officiers d'éthique contre les « fausses conditions P.T.S. » et en prononçant des amnisties.
La scientologie peut apparaître d'une certaine manière comme la première technologie religieuse commercialisable mondialement. En ce sens elle ne fait somme toute que systématiser un certain nombre de tendances actuelles (culte de la performance, de la technique, refus de l'État-providence, de la faiblesse, critique de la démocratie, etc.). Elle s'avère très révélatrice du monde contemporain dans la mesure où elle expérimente un mode de sociabilité marchand qui brouille les catégories habituelles de pensée. Paul Arieès
       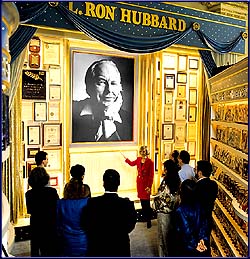 
Posté le : 23/01/2016 22:27
Edité par Loriane sur 24-01-2016 19:06:54
Edité par Loriane sur 24-01-2016 19:08:00
Edité par Loriane sur 24-01-2016 19:08:35
|
|
|
|
|
Jean Raine |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 janvier 1927 naît à Schaerbeek Jean-Philippe Robert Geenen
de nationalité Belge, Il décéde à 59 ans, le 30 juin 1986 à Rochetaillée-sur-Saône
Nationalité belge. Il est peintre, poète, écrivain et cinéaste
Jean Raine, né Jean-Philippe Robert Geenen, est un peintre, poète, écrivain et cinéaste belge.
Sa vie
Dès ses années de lycée, Jean Raine publie dans la revue de poésie créée par son professeur de français, Fernand Verhesen, il se lie d’amitié avec ses condisciples Luc de Heusch, avec lequel il collabore plus tard à de nombreux films, et Hubert Juin qui l’initie au surréalisme.
Il rencontre Pierre Alechinsky en 1944 ou 45. Grâce à leur amitié, il participe en tant que poète et cinéaste à l’aventure du groupe CoBrA. Il publie des textes dans plusieurs numéros de la revue et organise Le Festival du film expérimental et abstrait lors de la Deuxième Exposition d’Art Expérimental CoBrA au palais des Beaux Arts de Liège en 1951.
Ses premières amours sont la poésie et le cinéma. Il a rencontré Henri Langlois lors d’une exposition que celui-ci a organisé à Bruxelles et le rejoint à Paris en 1946. L’amitié de Langlois et les multiples rencontres qu’il fait à la Cinémathèque française le marquent profondément.
Très intéressé par le surréalisme, il a, à Bruxelles, rencontré René Magritte, Marcel Lecomte qui plus tard préface sa première exposition à Bruxelles et Louis Scutenaire, qui préface l’une de ses expositions à Paris. Dès son arrivée à Paris, il rend visite à André Breton qui lui fait connaître le docteur Pierre Mabille avec lequel il réalise son premier film documentaire sur le Test du Village.
Il collabore à divers films avec Henri Storck, Henri Kessels et Luc de Heusch, principalement pour la rédaction des commentaires de leurs films, notamment pour Perséphone, le seul film COBRA réalisé par Luc de Heusch et dans lequel joue Nadine Bellaigue fille de Jean Camille Bellaigue, sa première épouse.
Alors que toute sa vie Jean Raine écrivit poèmes et textes, les mots peu à peu lui semblent insuffisants et il commence à dessiner puis à peindre. En 1962, son ami Marcel Broodthaers le présente à Philippe Toussaint, propriétaire de la Galerie Saint Laurent à Bruxelles où il expose pour la première fois, préfacé par Marcel Lecomte.
À Paris, Pierre Alechinsky l’introduit auprès de la Galerie du Ranelagh où il expose en 1964, exposition préfacée par Christiane Rochefort. C’est de ces années 1964 à 1967 que datent ses grandes encres de Chine. Il séjourne de 1966 à 1968 à San Francisco où il découvre la peinture acrylique et l'Action Painting. Il revoit Kenneth Anger qu’il avait hébergé lors de son premier passage à Paris vers 1950. Il y expose dans les universités de Berkeley et Stanford, ainsi que dans des galeries de San Francisco et Los Angeles. À partir de 1968, il s’installe définitivement à Lyon où enseigne son épouse Sanky Raine.
Depuis 1970, attiré à Calice Ligure par Théodore Kœnig un ami de longue date, il séjourne tous les étés en Italie, où il expose à de nombreuses reprises4.
« C'est Théodore Koenig qui me fit connaître l'Italie des ligures et les peintres qui y séjournaient tous les étés à Calice autour de la galerie Il Punto et de Remo Pastori. »
Ancien patient de l'Institut de psychiatrie l’hôpital Brugmann, Jean Raine fait partie des fondateurs du Club Antonin Artaud en 1962. En proposant comme thérapie la pratique d’une discipline artistique, le Club Artaud s’inscrit dans le courant de la déshospitalisation psychiatrique.
Il meurt à Rochetaillée-sur-Saône, près de Lyon, le 30 juin 1986.
Depuis, plusieurs rétrospectives ont eu lieu régulièrement sur son œuvre, aussi bien en France qu'en Belgique et en Italie.
Expositions
Liste des expositions multiples individuelles ou collectives.
Individuelles de son vivant
1962 - Galerie Saint-Laurent - Bruxelles, Belgique -
1964 - Galerie Le Ranelagh - Paris, France -
1965 - Galerie Les Contemporains - Bruxelles, Belgique -
1965 - Galerie Michelangeli - Orvieto, Italie -
1965 - Galerie Saint-Laurent - Bruxelles, Belgique -
1966 - Galerie Le Ranelagh - Paris, France -
1967 - Britton Gallery - San Francisco, USA -
1967 - Mead Gallery - Menlo Park, USA -
1967 - U.C. Berkeley Student Union Gallery - Berkeley, USA -
1967 - U.C. Medical Center Student Union Gallery - San Francisco, USA -
1968 - Bechtel Center, Student Union Gallery, université Stanford - Stanford, USA -
1968 - Mead Gallery - San Francisco, USA -
1968 - Silvan Simone Gallery -Los Angeles, USA -
1968 - Smith Andersen Gallery - Palo Alto Cal, USA -
1970 - Galerie Saint-Laurent - Bruxelles, Belgique -
1970 - Galleria Il Punto - Calice Ligure, Italie -
1970 - Gammelstrand Gallery - Copenhague, Danemark -
1970 - Smith Andersen Gallery - Palo Alto Cal, USA -
1972 - Cinémathèque française - Paris, France -
1972 - Galerie l'Œil Ecoute - Lyon, France -
1972 - Galerie Le Soleil dans la Tête - Paris, France -
1972-1973 - Maison de la Culture de Hauteville - Hauteville, France -
1974 - Centre National d'Art Dramatique - Lyon, France -
1974 - Galleria Effemeridi - Modène, Italie -
1974 - Galleria Il Salotto - Côme, Italie -
1974 - Galleria La Tavolozza - Bergame, Italie -
1974 - Galleria Nove Colonne - Trente, Italie -
1974 - Galleria Spazzio - Brescia, Italie -
1974 - New Gallery - Catane, Italie -
1974 - New Smith Gallery - Bruxelles, Belgique -
1975 - Banca Popolare di Milano - Milan, Italie -
1975 - Galerie l'Œil Ecoute - Lyon, France -
1975 - Galerie Le Soleil dans la Tête - Paris, France -
1975 - Galleria La Tavolozza - Bergame, Italie -
1976 - City Bank - Roma, Italie -
1976 - Galleria La Tela - Palerme, Italie -
1976 - Galleria S.M.13 Studio d'Arte Moderna - Rome, Italie -
1977 - Centre Culturel de Woluwé Saint-Pierre - Woluwe-Saint-Pierre, Belgique -
1977 - Galleria La Tela - Palerme, Italie -
1977 - Galleria Penna - Messine, Italie -
1978 - Galleria Il Punto - Calice Ligure, Italie -
1979 - Galleria Il Brandale - Savone, Italie -
1979 - Galleria Il Salotto - Como, Italie -
1980 - Galerie Détour - Jambes Namur, Belgique -
1980 - Galerie l'Œil Ecoute - Lyon, France -
1981 - Galleria Il Navicello - Pise, Italie -
1981 - Maison pour Tous - Annemasse, France -
1981 - Musée cantonal des beaux-arts - Lausanne, Suisse -
1982 - 1983 - Centre d'action culturelle de Toulouse - Toulouse, France -
1984 - Hôtel de ville de Villeurbanne - Villeurbanne, France -
1986 - Galerie l'Ollave - Lyon, France -
1986 - Museo d'arte contemporanea "Casa del Consolo" - Calice Ligure, Italie -
Expositions posthumes
Depuis sa mort en 1986, de très nombreuses manifestations ont eu lieu dans des musées et centres d’art, [1] individuelles ou collectives :
Individuelles depuis 2000
2000 - Galerie Protée - Paris, France -
2000 - I.U.F.M. Galerie Confluence - Lyon, France -
2001 - Galerie Quadri - Bruxelles, Belgique -
2001 - I.U.F.M. des Maîtres - Bourg-en-Bresse, France -
2004 :
Archives et musée de la Littérature - Bruxelles, Belgique -
École municipale Jean-Raine - Rochetaillée-sur-Saône, France -
Le Bal des Ardents - Lyon, France -
2006 :
Galerie Jean Michel de Dion - Bruxelles, Belgique -
Galerie Quadri - Bruxelles, Belgique -
Galleria Il Salotto - Côme, Italie -
PMMK, Musée d'Art Moderne d'Ostende en Belgique - Exposition de ses très grands formats jusqu’à 450 cm × 300 cm - Musée d’Art Moderne d’Ostende
2007 - Galerie Henri-Chartier (http://henrichartier.com), Lyon, du 18 janvier au 3 mars 2007,
Expositions récentes
2008 :
Galerie Quadri Ben Durant à Bruxelles, à partir du 20 février
Galerie Henri-Chartier du 6 mars au 19 avril : « COBRA pour qui en veut
Musée des beaux-arts de Lyon du 8 mars au 9 juin exposition à l'occasion de la donation d’une encre sur papier, La Proie de l’Ombre de 1966.
2012 :
Collection de la Praye à Fareins Ain du 14 avril au 20 mai http://www.artpraye.com/-Exposition-Jean-Raine-
2013 :
Jean Raine. Revoir la question, Galerie Michel Descours, Lyon, du 28 juin au 14 septembre 2013.
Rêverie pour le futur. Quatre artistes contemporains autour de Jean Raine du 28 septembre 2013 au 26 janvier 2014, Centre International d'Art Contemporain, Château de Carros Alpes-Maritmes.
Œuvres Plastiques
Elles se composent de dessins, de peintures souvent de papiers marouflés sur toiles), d'encres, d'estampes et aussi de sculptures.
Ses œuvres se trouvent dans de très nombreux musées et dans plusieurs collections privées6. Ainsi le musée des beaux-arts de Lyon expose une de ses œuvres La Proie de l'ombre7, depuis juin 2008.
Littéraires
De nombreux textes, pendant CoBrA Un propos ayant le dessin pour objet, 1951, de temps en temps pamphlétaires Lettre à Monsieur le Percepteur, des poésies Six poèmes, 1965), des essais Sur la peinture abstraite, 1969, auto-analysant Journal d'un délirium, 1958, sur ses rencontres Une grande famille, 1985 nombreuses qu'il a eu avec Kenneth Anger, André Breton, Marcel Marceau, Michel de Ghelderode, Pierre Mabille, René Magritte, Jean-Louis Barrault, Pierre Alechinsky, Henri Langlois...
Œuvre poétique, présentée par Stéphen Lévy-Kuentz. Ed. La Différence 1993
Michael Lonsdale lit Jean Raine
Jean Raine - Aponévrose 1977-1981 - Sélection de textes inédits par la revue Hippocampe - édité par l’association Art Contemporain Diffusion Rhône-Alpes
Cinématographiques
Les Arts et la Raison 1964 réalisé par Jean Raine et Michel Coupez. Scénario et commentaire de Jean Raine.
Le Test du Village 195- réalisation, production et texte de Jean Raine.
Michel de Ghelderode 1957 réalisé par Luc de Heusch et Jean Raine.
Perséphone 1951, seul film CoBrA, réalisé par Luc de Heusch. Poème de Jean Raine dit par Jacques Jeannet.
Mona ou 3 minutes de la vie d’une femme réalisé par Michel Coupez et Bob Milord "cameraman". Scénario de Jean Raine.
Entre 1953 et 1956, Jean Raine collabore à divers films avec Henri Storck, Henri Kessels, Luc de Heusch, par son écriture du commentaire et sa participation aux
scénarios
Jeu de Construction de Henri Kessels scénario et découpage.
Goût moderne de Luc de Heusch coréalisation et commentaire.
Magritte, de Luc de Heusch et Jacques Delcorde conseiller artistique.
Les Ports belges de Henri Storck assistant à la réalisation, scénario et commentaire.
Le Festival de Cannes de Luc de Heusch (découpage et commentaire.
Pêcheurs flamands dans la tempête de Henri Kessels et Serge Vandercam découpage et commentaire.
Ruanda et Fête chez les Hamba de Luc de Heusch aide au montage et commentaire.
          
Posté le : 23/01/2016 20:05
Edité par Loriane sur 24-01-2016 18:34:56
|
|
|
|
|
17/1/16A.Brontë,A.HoudardelaMotte,J.Dotourd,L.C.Tiffany,A.Tchekhov,B.Franklin,P.Potter,P.Calderon |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Posté le : 23/01/2016 19:48
|
|
|
|
|
Otton III 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 ou 23 janvier 1002 meurt Otton III
ou Othon III à Paterno Latium sur le mont Soracte en Italie, né en juin ou juillet 980 dans la forêt royale de Kessel Ketil, près de Clèves, en Italie. Prince de la lignée ottonienne, il est roi des Romains à partir de 983 et empereur des Romains de 996 à 1002.
Roi de Francie Orientale Germanie de 983 à 1002, son prédécesseur est Otton II du Saint-Empire, son successeur est Henri II du Saint-Empire, empereur du Saint-Empire
de 996 – 1002 son prédécesseur est son père Otton II son successeur est Henri II. il est Roi d'Italie de 996 – 1002, son prédécesseur est Otton II du Saint-Empire, son successeur est Arduin d’Ivrée
Sa mère est Théophano, après la mort de son père Otton II du saint empire, survenue le 7 décembre 983, il est couronné roi des Romains le 25 décembre 983 à Aix-la-Chapelle, à l'âge de trois ans. Le prince Henri le Querelleur l'enlève alors et tente de se faire attribuer sa tutelle. Mais l'archevêque de Mayence Willigis, soutenu par d'autres grands, condamne cette usurpation et impose la régence de sa mère, la princesse byzantine Théophano. Après le décès de celle-ci, en 991, c'est Adélaïde, grand-mère de l'empereur, qui assure sa tutelle.
En 995, Otton est majeur et prend officiellement le pouvoir ; il rêve de fonder un empire universel qui réunirait d'abord tous les peuples chrétiens d'Occident. Il intervient dans les affaires de l'Église et impose contre l'avis des cités rebelles de la péninsule italienne ses propres candidats au trône papal. Il y fait ainsi placer son homme de confiance, par ailleurs son cousin, Brunon de Carinthie, premier pape d'origine germanique, sous le nom de Grégoire V. Couronné empereur par ce dernier le 21 mai 996, Otton installe sa cour à Rome : sous son règne, l'Italie redevient le siège du gouvernement impérial.
Avec l'aide de Gerbert d'Aurillac, l'écolâtre de Reims qui fut son précepteur et qu'il fait élire pape en 999, Otton se rapproche de la Pologne et fait parvenir à Étienne de Hongrie la première couronne royale de ce pays.
Dans un texte de janvier 1001, les rapports entre le pape Sylvestre II et l'empereur sont redéfinis. Otton III refuse de confirmer le Privilegium Ottonianum accordé par Otton Ier en 962. L'empereur accorde au souverain pontife huit comtés de la Pentapole. Otton III se voit comme Esclave des Apôtres, le représentant direct de Pierre et le responsable de son patrimoine. Il souhaite gouverner la chrétienté et se met sur le même plan que le pape, avec lequel il veut présider les synodes. Mais les deux hommes se trouvent bientôt chassés de Rome par la population et la tentative d'unir le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel tourne court. Otton meurt en 1002, à l'âge de 22 ans, et son corps est ramené d'Italie en Germanie pour être inhumé à Aix-la-Chapelle.
En bref
OTTON III 980-1002 et l' empereur germanique 996-1002 Empereur germanique 983-1002, né en juillet 980 près de Clèves, mort le 23 janvier 1002, près de Viterbe Italie.
Fils d'Otton II 955-983 et de l'impératrice Théophano v. 955-991, Otton est élu roi des Germains en juin 983 et couronné à Aix-la-Chapelle en décembre de la même année, peu après la mort de son père. Durant son enfance, il est enlevé par Henri le Querelleur, le duc de Bavière déposé par son père, qui espère ainsi s'assurer la régence, voire le trône. En mai 984, la diète impériale contraint cependant Henri à restituer l'enfant à sa mère, laquelle assumera la régence jusqu'à sa mort en 991. La grand-mère d'Otton, l'impératrice douairière Adélaïde, prend alors le relais jusqu'à la majorité du roi, en 994.
Répondant à l'appel du pape Jean XV qui lui demande de l'aider à mater une rébellion conduite par le noble romain Crescentius II, Otton III traverse les Alpes en 996. Déclaré roi de Lombardie à Pavie, il atteint Rome après la mort du pape. Il fait alors élire au Saint-Siège son cousin de vingt-trois ans, Bruno de Carinthie, qui prend le nom de Grégoire V. Premier pape germanique, celui-ci sacre Otton empereur le 21 mai 996. Lorsque ce dernier rentre en Germanie, Crescentius chasse Grégoire de Rome et le remplace par Jean XVI. Otton III retourne alors en Italie à la fin de l'année 997. Après s'être emparé de Rome en février 998, il exécute Crescentius, dépose Jean XVI et restaure le pape Grégoire.
Rêvant de faire renaître la gloire et la puissance de l'ancien Empire romain, Otton ambitionne de créer un État chrétien universel gouverné depuis Rome et dans lequel le pape serait soumis à l'autorité de l'empereur tant pour les questions religieuses que civiles. Il s'attelle ainsi à faire de Rome sa résidence officielle et le centre administratif de l'empire. Instituant un cérémonial de cour byzantin élaboré et rétablissant d'anciennes traditions romaines, il se nomme « serviteur de Jésus Christ », « esclave des apôtres » et « empereur du monde » et se considère comme le souverain de la chrétienté. Lorsque Grégoire V meurt en 999, Otton fait élire à sa place le Français Gerbert d'Aurillac, son ancien précepteur qui accepte son concept d'empereur théocratique, et prend le nom de Sylvestre II.
En l'an 1000, Otton se rend en pèlerinage sur la tombe de l'archevêque mystique Adalbert de Prague, à Gniezno, et fait de la ville l'archevêché de Pologne. Lorsqu'en janvier 1001 Tibur Tivoli, en Italie s'insurge contre Otton, l'empereur assiège la ville et la force à se rendre avant de donner son pardon à ses habitants. Furieux de cette décision, les Romains, qui voulaient voir cette rivale détruite, se révoltent à leur tour contre Otton en février 1001 et assiègent son palais. Après avoir momentanément apaisé les rebelles, Otton se retire au monastère de Saint-Apollinaire, près de Ravenne, afin de faire pénitence. Incapable de reprendre le contrôle de la cité impériale, il demande une aide militaire à son cousin Henri de Bavière, qui lui succédera comme roi des Germains puis comme empereur sous le nom de Henri II le Saint. Otton III meurt peu après l'arrivée des troupes bavaroises dans son campement.
Sa vie
L'Europe ottonienne
Pendant la seconde moitié du xe siècle, les Ottoniens sont la dynastie la plus puissante d'Occident. Otton Ier, grâce à une puissante clientèle, a pu mettre fin aux incursions des Magyars, en leur infligeant une sévère défaite à la bataille du Lechfeld en 955. À la suite de cette victoire face aux Hongrois, Otton Ier rétablit, au sud de la Germanie, les marches d'Ostmark la future Autriche, dont les Babenberg vont devenir les margraves jusqu'au XIIIe siècle. Otton Ier reconstitue aussi la marche de Carinthie, et apparaît ainsi comme le défenseur de la chrétienté. La même année, il bat les Slaves Abodrites en Mecklembourg.
Ces victoires lui permettent aussi de jouer un rôle majeur sur le plan européen. Il obtient l'allégeance des rois de Bourgogne. Face aux Slaves, il conduit une véritable politique d'expansion vers l'est. Il établit des marches à l'est de l'Elbe : marche des Billung, autour de l'évêché d'Oldenbourg, Nordmark ancien nom du Brandebourg et trois petites marches chez les Sorbes. En 968, il fonde l’archevêché de Magdebourg, avec des évêques suffrageants à Meissen, Mersebourg et Zeitz, dans le but de convertir les peuples slaves de l'Elbe. Mieszko Ier, premier souverain historique de la Pologne, lui rend hommage en 966. En Germanie, Othon Ier rend la Bohême tributaire et vainc les ducs de Franconie et de Lotharingie.
Le pape Jean XII, menacé par les projets expansionnistes du roi de Lombardie Bérenger II, doit demander la protection d'Otton Ier6. Celui-ci peut ainsi se faire couronner empereur et promulguer, le 13 février 962, le Privilegium Ottonianum, qui accorde au souverain pontife les mêmes privilèges que ceux que les Carolingiens avaient reconnus à la papauté, à savoir les donations faites par Pépin le Bref et Charlemagne, mais oblige tout nouveau pape à prêter serment auprès de l'empereur ou de son envoyé avant de recevoir la consécration pontificale. Tout en donnant des avantages au Saint-Siège, le Privilegium Ottonianum place la papauté sous tutelle impériale. Le pape ayant essayé de s'opposer à cette mainmise en s'alliant au fils de Béranger et aux Byzantins, Otton revient en Italie à la tête de son armée et le fait déposer le 4 décembre 963. Jean XII est remplacé par un laïc, qui prend le nom de Léon VIII. Otton Ier fait également jurer aux Romains qu'ils n'éliraient ni n'ordonneraient aucun pape en dehors du consentement du seigneur Otton ou de son fils. Les Ottoniens contrôlent alors totalement l'élection du pape et la collaboration du pontife garantit l'autorité impériale sur les Églises locales du Saint-Empire. Comme Charlemagne, Otton reçoit de Rome la mission de défendre l'ordre et la paix de la chrétienté.
Le nouvel empereur accroît sa puissance sur la Francie occidentale en portant son attention sur l'ensemble des évêchés frontaliers Reims, Verdun, Metz. L'archevêque de Reims qui assure le choix des rois de Francie Adalbéron tend ainsi à afficher ses sympathies impériales.
À la mort de leurs pères en 954 et 956, Lothaire, le nouveau roi des Francs, n'a que 13 ans et Hugues Capet, l’aîné des Robertiens, seulement 15. Otton Ier entend alors mettre sous tutelle la Francie, ce qui lui est possible puisqu'il est l'oncle maternel des deux adolescents. Le royaume de Francie, en 954, et la principauté robertienne, en 956, sont donc mis sous la tutelle de Brunon, archevêque de Cologne et duc de Lotharingie, frère d'Otton Ier. Son objectif est de maintenir l'équilibre entre les Robertiens, les Carolingiens et les Ottoniens. La tutelle d'Hugues Capet est doublée par celle de Lothaire. En 960, le roi des Francs consent à rendre à Hugues l'héritage de son père, avec le marquisat de Neustrie et le titre de duc des Francs. Mais, en contrepartie, le duc doit accepter la nouvelle indépendance acquise par les comtes de Neustrie pendant la vacance du pouvoir. Son frère Otton n'obtient que le duché de Bourgogne. Sous la tutelle de Brunon de Cologne, la Francie est de plus en plus satellisée par Aix-la-Chapelle. En 965, Lothaire fait ainsi pâle figure au rassemblement des vassaux et parents d'Otton.
L'empire : puissance économique
Avoir une clientèle suffisamment puissante pour contrôler l'empire nécessite de grandes ressources financières. Avec la généralisation du denier d'argent par les Carolingiens, une révolution économique est en cours : les surplus agricoles deviennent commercialisables et on assiste, dans tout l'Occident, à l'accroissement de la productivité et à la multiplication des échanges. En réunissant Italie et Germanie dans un même empire, Otton Ier contrôle les principales voies de commerce entre l'Europe du Nord et la Méditerranée. Le trafic commercial avec Byzance et l'Orient transite en effet de la Méditerranée vers l'Italie du Sud et surtout le bassin du Pô et rejoint celui du Rhin via les voies romaines traversant les cols alpins. Cette voie est, à l'époque, plus utilisée que la traditionnelle voie rhodanienne parce que l'Adriatique est plus sûre que la Méditerranée occidentale, où sévissent les pirates sarrasins. Les Ottoniens ont su garder la mainmise sur les péages prélevés sur ce trafic et développer les marchés nécessaires à son augmentation. Ainsi, contrairement à ce qui se passe en Francie, ils gardent le monopole de la frappe monétaire et font ouvrir des mines d'argent près de Goslar. Or, la création d'un atelier monétaire dans une ville ou une abbaye entraîne la création d'un marché où peut être prélevé le tonlieu. Cette puissance commerciale leur permet d'acheter la clientèle qui est la base de leur pouvoir, mais aussi d'étendre leur influence à la périphérie de l'Empire : les marchands italiens ou anglais ont besoin de leur soutien, les Slaves adoptent le denier d'argent...
L'Église, clef de voûte de l'administration ottonienne
Sous les Carolingiens, la mise en place progressive de l'hérédité des charges avait fortement contribué à l'affaiblissement de leur autorité. Pour éviter une pareille dérive, les Ottoniens s'appuient sur l'Église germanique qu'ils comblent de bienfaits mais qu'ils assujettissent.
Les évêques et les abbés constituent l'armature de l'administration ottonienne. L'empereur s'assure la nomination de tous les membres du Haut clergé de l'Empire. Une fois désignés, ils reçoivent du souverain l'investiture symbolisée par les insignes de leur fonction, la crosse et l'anneau. En plus de leur mission spirituelle, ils doivent remplir des tâches temporelles que leur délègue l'empereur. L'autorité impériale se trouve ainsi relayée par des hommes compétents et dévoués. Cette Église d'Empire ou Reichskirche, assure la solidité d'un État pauvre en ressources propres. Elle permet de contrebalancer le pouvoir des grands féodaux ducs de Bavière, Souabe, Franconie, Lotharingie. L'évêché d'Utrecht constitue, jusqu'aux environs de 1100, l'entité la plus puissante des Pays-Bas du Nord, comme ceux de Liège et Cambrai pour les Pays-Bas du Sud. Le pouvoir impérial choisit ses hauts dignitaires de préférence dans sa parentèle, proche ou élargie. Celle-ci bénéficie des plus hautes charges épiscopales ou monastiques. Le meilleur exemple en est le propre frère d'Otton, Brunon de Cologne, archevêque de Cologne, qui impose la règle de l'abbaye de Gorze à tous les monastères de son diocèse. On peut citer aussi Thierry Ier, cousin germain d'Otton, évêque de Metz de 965 à 984 ; un parent proche d'Otton, le margrave de Saxe Gero, qui fonde l'abbaye de Gernrode vers 960-961, en Saxe ; Gerberge, nièce de l'empereur, abbesse de Notre-Dame de Gandersheim.
L’empire en l'an mil.
Royaume de Germanie
Royaume d'Italie
États pontificaux
Royaume de Bourgogne indépendant
Les marches sont figurées en hachuré
La puissance des grands féodaux
L'empire ottonien est cependant relativement décentralisé et, contrairement aux évêques dont la charge est remise entre les mains de l'empereur après leur mort, les grands féodaux jouissent d'une transmission héréditaire de leurs possessions. Dès lors, le souverain n'a que peu de contrôle sur eux et de grandes familles aristocratiques soutenues par de fortes clientèles sont en mesure de contester son pouvoir.
Otton II doit ainsi faire face au puissant duc de Bavière, son cousin Henri le Querelleur. En effet, les ducs de Bavière disposent des évêchés du sud de la Germanie qu'ils attribuent à des membres de leur famille. La Bavière impose sa suzeraineté à une grande partie de l'Autriche actuelle et au sud, jusqu'à la mer Adriatique et au lac de Garde. Allié à Boleslav II de Bohême, à Mieszko Ier de Pologne, aux Danois et à des minorités slaves, Henri est en mesure de menacer le jeune Otton II qui doit le vaincre militairement, ainsi que ses alliés, pour prendre effectivement le pouvoir. Ce danger ressurgit à chaque affaiblissement du pouvoir impérial. C'est le premier défi auquel sont confrontés Otton III et sa mère, la régente Théophano, à la mort d'Otton II.
Des frontières menacées
Durant tout son règne, Otton II doit lutter à ses frontières. À l'ouest, les Carolingiens veulent récupérer leur berceau familial qui pourrait leur permettre de revendiquer la couronne impériale : la Lotharingie. Au nord, les Danois ou, à l'est, les Slaves s'allient à ses ennemis. Au sud, il doit lutter contre les Byzantins et les Sarrasins pour le contrôle du sud de la péninsule. C'est donc d'un empire plus fragile qu'il n'y paraît qu'hérite Otton III en 983.
Période de régence Des débuts difficiles
La Couronne d'Otton III, probablement ceinte lors du couronnement à Aix-la-Chapelle, est conservée depuis des siècles dans le trésor de la cathédrale d'Essen.
Otton III n'a que deux ans en juillet 982, quand l'armée impériale est anéantie en Calabre par les Sarrasins à la bataille du cap Colonne. Son père Otton II est alors en grande difficulté et doit demander des renforts en Germanie. Il est courant, à l'époque, de faire sacrer son successeur de son vivant surtout quand le souverain est à la tête de l'armée pour que le pays ne subisse pas de remous politique en cas de décès sur le champ de bataille : Otton II est ainsi associé à la couronne par son père Otton Ier dès 967 ; de même Hugues Capet fait couronner Robert le Pieux dès le début de son règne car il doit prêter secours à son vassal Borrell II dont le comté de Barcelone est menacé par les Sarrasins.
Otton III est donc élu roi des Romains par les grands de Germanie et d’Italie dès l'âge de trois ans, du vivant de son père, lors d'un ban royal à Vérone en mai 983. Les sources ne nous disent pas pourquoi il a fallu, à ce moment précis, assurer la succession au trône du fils mineur du souverain, mais il est possible que la défaite du cap Colonne ait fragilisé la position de l'empereur vis-à-vis de ses vassaux et qu'il ait voulu conforter la succession dynastique dont le principe n'est nullement garanti par le système électif utilisé dans le Saint-Empire. Après avoir pris congé des princes électeurs du ban, Otton III traverse les Alpes pour être couronné à Aix-la-Chapelle, ville traditionnelle du sacre des Ottoniens. Lorsque l'enfant est couronné roi à Aix-la-Chapelle à la Noël de l'an 983 par l'archevêque de Mayence Willigis et par Jean de Ravenne, son père Otton II est déjà mort depuis trois semaines. Ce n'est qu'après les fêtes de couronnement que la cour apprend la mort du souverain, ce qui « met un terme aux réjouissances.
L'anéantissement de l'armée impériale à la bataille du cap Colonne a aussi des conséquences graves à la périphérie. Les Slaves, qui supportent mal leur christianisation forcée, y voient l'occasion de se soulever19. Ils détruisent les évêchés de Brandebourg et Havelberg et menacent Magdebourg. Apprenant que le nouveau roi n'est qu'un enfant, ils redoublent leurs incursions : les évêchés de Schlesvig et d'Oldenbourg sont anéantis à leur tour. En liaison avec les Danois, les Sorabes atteignent Hambourg. Les premiers succès des missionnaires chrétiens à l'est de l'Elbe sont effacés par le soulèvement des Slaves. La seule présence germanique subsistant à l'est du fleuve est le poste avancé de Meissen. La mort d'Otton II provoque de nombreux soulèvements contre les représentants du pouvoir royal en Italie.
Cette situation précaire incite de nombreux évêques à prendre leurs distances vis-à-vis de l'enfant roi alors qu'ils forment la colonne vertébrale du pouvoir ottonien : nommés par l'empereur qui récupère leur charge à leur mort, ils constituent normalement une clientèle fidèle qui garantit la puissance de l'empereur vis-à-vis de ses grands vassaux.
La guerre de succession
En tant que chef de la maison de Bavière, Henri le Querelleur est le plus proche parent d'Otton. Il est emprisonné à Utrecht à la suite d'une rébellion armée. L'évêque Folcmar lui rend sa liberté dès qu'est connue la mort d'Otton II. L'archevêque de Cologne, s'appuyant sur leur lien de parenté jus propinquitatis, lui remet immédiatement le jeune roi. Cela n'est pas surprenant, car outre la mère d'Otton, Théophano, sa grand-mère Adélaïde de Bourgogne et sa tante Mathilde de Quedlinbourg sont alors en Italie.
Les menées du Querelleur visent moins à accaparer la régence qu'à s'assurer un véritable partage du pouvoir avec l'enfant à la tête du royaume. Pour Lothaire, roi des Francs carolingiens, le contrôle de la Lotharingie - berceau des Pippinides - lui permettrait de revendiquer l'empire. N'ayant pu assurer la tutelle impériale, Lothaire renonce au rapprochement qu'il a négocié vis-à-vis des Ottoniens pour neutraliser son rival Hugues Capet, et décide de reprendre l'offensive contre la Lotharingie en janvier 985 à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Il prend Verdun en mars et fait prisonnier le comte Godefroy Ier de Verdun frère d'Adalbéron de Reims, Frédéric fils de Godefroy Ier, Sigefroid de Luxembourg oncle de Godefroy et Thierry Ier de Lorraine neveu de Hugues Capet.
Hugues Capet se garde bien de faire partie de l'expédition. Henri organise sans retard une rencontre à Brisach avec Lothaire, parent du jeune Otton III au même degré que lui. Mais Henri, redoutant ce face-à-face avec son rival pour la couronne impériale, quitte précipitamment Cologne, où il a enlevé le jeune Otton, et part en Saxe via Corvey. Là, il invite tous les grands de l'empire à fêter les Rameaux à Magdebourg. Sa proposition ouverte à proclamer son avènement reçoit un accueil mitigé chez ses convives. Il trouve toutefois suffisamment de partisans pour gagner Quedlinbourg et pour fêter Pâques avec une suite de fidèles dans la grande tradition des Ottoniens. Henri s'efforce par des tractations avec les princes présents d'obtenir son élévation à la royauté et parvient à ce que plusieurs lui prêtent serment d'honneur et d'aide comme leur roi et suzerain. Parmi ses partisans, il faut citer Mieszko Ier de Pologne, Boleslav II de Bohême et le prince slave Mistivoï.
Pour barrer la route d'Henri vers le trône, ses opposants quittent Quedlinbourg et, réunis au château d'Asselburg, forment une conjuration. Lorsqu'il a vent de cette conjuration, Henri mène ses troupes à Werla, non loin de ses ennemis, pour les intimider ou tenter de les raisonner. Il dépêche vers eux l'évêque Folcmar d'Utrecht pour négocier. Mais lors des pourparlers, il apparaît clairement que ses adversaires ne sont pas prêts à lui prêter serment en tant que leur roi. Il n'obtient que la promesse de reprise des pourparlers ultérieurement à Seesen. Sur ces entrefaites, Henri gagne la Bavière, où il obtient la reconnaissance de tous les évêques et de quelques comtes. Après son demi-échec en Saxe et l'appui de la Bavière, tout dépend à présent de la position des princes francs, qui ne veulent à aucun prix revenir sur le sacre d'Otton III. Redoutant l'issue d'un éventuel conflit, Henri renonce au trône et remet l'enfant roi à sa mère et à sa grand-mère le 29 juin 984 à Rohr Thuringe.
La régence des impératrices 985–994
L'impératrice Adélaïde, qui a une cinquantaine d'années, a la carrure politique pour prétendre à la régence car elle a été associée à la gestion de l'Empire consors imperii pendant le règne de son mari Otton Ier, comme en témoignent une bonne partie des actes émis par la chancellerie. Mais Théophano s'impose de par son exceptionnelle personnalité et Adélaïde se contente d'une délégation de pouvoir en Italie : de 985 à sa mort en 991, la mère d'Otton III exerce donc pleinement le pouvoir.
Théophano s'établit au nord des Alpes. Elle s'efforce de rétablir l'évêché de Mersebourg, que son mari Otton II a dissous en 981. Elle réorganise la chapelle royale d'Otton II et en confie la direction à l'évêque chancelier Hildebold de Worms et à l'archevêque Willigis de Mayence. Par leur loyalisme, ces deux prélats parviennent à s'assurer le rôle de premiers conseillers de l'impératrice.
En 986, Otton III, alors âgé de six ans, fait organiser les festivités de Pâques à Quedlinbourg. Le service du roi est confié à quatre ducs : Henri le Querelleur en tant qu'écuyer tranchant, Conrad de Souabe en tant que chambellan, Henri de Carinthie le Jeune en tant qu'échanson et Bernard de Saxe en tant que maréchal. On a déjà mis en scène ce service des ducs lors des sacres d'Otton le Grand en 936 et d'Otton II en 961 : les grands manifestant ainsi leur loyauté envers le jeune roi. En particulier, Henri le Querelleur tâche de faire oublier sa tentative d'usurpation manquée deux ans plus tôt et montre sa soumission à la dignité royale.
Au cours de la régence de Théophano éclate la querelle de Gandersheim, opposant l'évêché d'Hildesheim à l'archevêché de Mayence pour l'administration de l'abbaye. La querelle éclate lorsque Sophie, la propre sœur du roi, refuse de recevoir l'habit de moniale des mains du père supérieur d'Hildesheim, l'évêque Osdag, lui préférant l'archevêque de Mayence Willigis. La menace d'un scandale en présence du roi Otton III et de la régente peut être évitée par un compromis : les deux évêques doivent remettre l'habit à la princesse, tandis que les autres moniales d'Osdag prennent seules l'habit.
Si les marches orientales du royaume sont calmes tout le temps que dure l'affrontement avec Henri le Querelleur pour la succession au trône, le soulèvement des Slaves n'en représente pas moins un échec pour la politique d'évangélisation. Par la suite, des armées saxonnes partent en campagne contre les Slaves de l'Elbe en 985, 986 et 987; Otton, à six ans, s'associe à la seconde de ces campagnes. Le duc de Pologne Mieszko appuie à plusieurs reprises les Saxons par la mobilisation d'une armée importante et prête serment à Otton lors de cette campagne, lui offrant en cadeau un chameau
À l’ouest, la mort de Lothaire en mars 986 met fin à ses prétentions sur la Lotharingie berceau des Carolingiens et dont la possession permet de revendiquer l'Empire)29. Son fils et successeur, Louis V, a à peine le temps de prendre le pouvoir et de consentir à faire la paix lorsqu'il meurt d'un accident de chasse en forêt de Senlis, fin mai 987. L'archevêque de Reims, fervent soutien des Ottonniens, fait élire Hugues Capet contre le prétendant légitime Charles de Basse-Lotharingie, frère du défunt. L’arrivée des Capétiens sur le trône de France instaure une nouvelle dynastie et les Carolingiens, évincés du pouvoir, ne sont plus un danger pour l'Empire ni pour la Lotharingie. À l'est, les relations avec la Bohême sont consolidées sans que la Pologne n'en prenne ombrage. Les dangers extérieurs neutralisés, Otton, qui n'a rien à craindre des princes germaniques, peut se laisser aller au rêve qu'a dû entretenir sa mère, de porter la couronne d'un Empire d'Occident réunifié.
En 989, Théophano prend le chemin de Rome sans son fils pour prier pour le salut de l'âme de son époux Otton II le jour anniversaire de sa mort. Parvenue à Pavie, elle confie les rênes du pouvoir à son homme de confiance, Jean Philagathos, qu'elle a fait archevêque de Plaisance. Théophane meurt à Nimègue le 15 juin 991, un an après son retour d'Italie, avec Otton III à son chevet. Elle est inhumée dans la crypte de la basilique Saint-Pantaléon de Cologne. On ignore quels sont les derniers conseils de Théophano au jeune roi. La basilique que Théophano voulait ériger à la mémoire de son époux Otton II, et dont elle avait confié la direction à sa nièce, l'abbesse Mathilde d'Essen, fille du duc Ludolphe de Souabe, n'est commencée par Otton III qu'en 999, à l'occasion de la translation des reliques de saint Marsus. Le roi, quant à lui, ne fait pas d'efforts comparables pour le salut de sa mère. Il la qualifie dans ses actes de « mère bien-aimée », et fait de riches dons au diocèse de Cologne.
Lors des dernières années de minorité d'Otton, sa grand-mère Adélaïde assume la régence, largement secondée par l'abbesse Mathilde de Quedlinbourg, sa tante paternelle, et l'archevêque Willigis de Mayence. C'est sous sa régence que le monnayage du royaume atteint son apogée34. Par contre, alors que Théophano voulait de toute force rétablir le diocèse de Mersebourg, Adélaïde n'y tient pas. Otton, rompu au métier des armes, dirige la reconquête du Brandebourg. À quatorze ans, il est prêt pour prendre en main les rênes du pouvoir.
L'éducation d'Otton
Otton III recevant son livre de prières. Manuscrit offert par sa mère ou Willigis pour son éducation. Vers 983-991, Bibliothèque d'État de Bavière, Clm 30111.
Otton III reçoit une instruction solide : ses maîtres sont Hoico, un comte saxon chargé de lui enseigner l'art de la guerre et les rites et usages de la - future - chevalerie, Willigis qui reste l'un de ses principaux conseillers, un clerc saxon Bernard d'Hildesheim de 987 à 993 et l'évêque calabrais Jean Philagathos, le futur antipape, qui lui enseigne quelques rudiments de grec.
En 996, arrivé à l’adolescence et alors qu’il règne déjà, il se sent insuffisamment instruit. Il demande à Gerbert d'Aurillac, alors archevêque de Reims, considéré comme le plus grand esprit de son temps, de venir compléter son instruction. Ce dernier est en position délicate vis-à-vis du Saint-Siège car il a pris la tête de l'épiscopat de Francie occidentale dans le conflit qui oppose Hugues Capet dont Gerbert est secrétaire à Arnoul qui a le soutien du pape. Gerbert est alors sous la menace d'une excommunication ainsi que les évêques ayant siégé au concile de Sainte-Basle de Verzy. Cette excommunication collective ouvre la voie à un schisme entre l'Église des Gaules et celle de Rome. Le roi, Robert le Pieux, cherche à ménager le pape car il s'est marié avec sa cousine sans l'approbation du Saint-Siège, et lâche Gerbert qui fut son précepteur et dont il est très proche. Gerbert préfère abandonner et répond favorablement à la demande du jeune empereur, cette solution lui permet d'échapper à l'excommunication et évite le schisme.
Précepteur de l'empereur, il l’initie à l’arithmétique, à la musique et à la philosophie. Devenu son conseiller, il souhaite voir appliquer les principes de la philosophie à la vie politique : car l'usage de la raison enseigne la modération et la maîtrise des passions. Il rédige pour l'empereur un traité de logique sur Le Raisonnable et l'Usage de la raison qui s’ouvre sur un programme de rénovation de l'Empire romain, considérant que l'empereur, mi-grec par sa mère, est à même de reconstruire un empire universel.
Le début du règne.
En 994, Otton III a quatorze ans ce qui, pour les canons de l'époque, signifie qu'il est adulte : au haut Moyen Âge, un acte rituel, l'adoubement, sanctionne normalement ce passage. Mais dans le cas d'Otton, l'adoubement aurait signifié la fin de la régence et le début du règne personnel, ce dont les sources ne font pas état. Un diplôme du 6 juillet 994, par lequel Otton offre à sa sœur Sophie le fief d'Eschwege, est parfois considéré comme le premier acte personnel du règne du roi. Quoi qu'il en soit, Otton fait un grand nombre de donations alors qu'il est encore mineur.
Otton prend ses premiers décrets et nomme, contre l'usage, un Germain à la tête des affaires italiennes de la chancellerie : son homme de confiance, l'archevêque Héribert de Cologne. La même année, à Ratisbonne, Otton confère la mitre d'évêque à son chapelain Gebhard, au lieu du prélat Tagino, élu par le chapitre de Ratisbonne.
Au cours de l'été 995, il convoque le ban à Quedlinbourg et, avec l'aide de contingents de Bohême et de Pologne, se lance au cours de l'hiver 994-995 puis à nouveau au printemps 995 dans une campagne militaire plus au nord contre les slaves rebelles de l'Elbe, expéditions qui, depuis le soulèvement de 983, reprenaient presque chaque année. À son retour, il élargit considérablement le diocèse de Meissen et multiplie ainsi les bénéfices de la dîme. Au mois de septembre 995, on dépêche l'archevêque Jean Philagathos et l'évêque Bernard de Wurtzbourg à Byzance pour demander la main d'une princesse de la part d'Otton IIIN 5. Les négociations avec Byzance n'aboutissent que peu de temps avant la mort d'Otton ; on ignore le nom de la princesse qui lui était promise mais certaines sources proposent Zoé la Porphyrogénète.
L'empereur Otton III
Le couronnement impérial et la première campagne d'Italie
Otton III se rend en Italie afin de se faire couronner, mais aussi pour répondre à l'appel à l'aide du pape Jean XV, agressé et chassé de Rome par le préfet Crescentius et ses partisans. Otton quitte Ratisbonne et se met en marche pour Rome en mars 996.
À Vérone, il accepte de devenir le parrain d'un fils du doge Pietro II Orseolo inaugurant ainsi les relations traditionnellement cordiales entre les Ottoniens et Venise. À Pavie, Otton reçoit une délégation romaine qui lui confie le choix du successeur du défunt pape Jean XV. Il n'est encore qu'à Ravenne lorsqu'il nomme comme souverain pontife son parent et chapelain privé Brun de Carinthie, et le fait accompagner par l'archevêque de Mayence Willigis et l'évêque Hildebold jusqu'à Rome, où il est le premier pape d'origine germanique à recevoir la tiare pontificale.
Le lendemain de son arrivée à Rome, Otton est joyeusement acclamé par le Sénat et la noblesse. Le 21 mai 996, jour de l'Ascension, il est couronné empereur des Romains par le pape qu'il a nommé.
Avec la nomination du pape lui-même, Otton III est allé au-delà des espérances de son grand-père Otton Ier, dans la mesure où il ne se contente plus d'agréer l'issue d'un vote mais impose son propre candidat à la Curie romaine. Mais, du fait de cette nomination discrétionnaire, le pape n'a plus de partisans déclarés à Rome et dépend d'autant plus de l'appui de l'empereur. Déjà, sous le règne d'Otton Ier, ces circonstances avaient opposé les papes fidèles à l'empereur et les candidats de la noblesse romaine. L'influente dynastie patricienne des Crescentii devait ainsi son autorité à la cession des droits pontificaux et des bénéfices tirés de la province de Sabine aux premiers papes italiens.
Au milieu de l'agitation des cérémonies du couronnement, on décide de convoquer un synode, au cours duquel la coopération étroite entre l'empereur et le pape se manifeste par la coprésidence du synode et la double signature des décrets. Ce synode met aussi Otton en relation avec deux personnalités hors du commun, qui vont fortement influencer le reste de sa vie. Gerbert d'Aurillac, archevêque de Reims, proche de l'empereur qui rédige plusieurs lettres en son nom, et Adalbert de Prague, un représentant du courant ascétique et érémitique qui fait de plus en plus d'adeptes à l'approche de l'an mil.
Gerbert d'Aurillac, en délicatesse avec l'ancien pape Jean XV, trouve là l'occasion d'obtenir le soutien impérial. La situation est très tendue entre la papauté et l'église de France car Gerbert a été nommé évêque de Reims grâce à Hugues Capet sans l'approbation papale, on est ainsi proche du schisme entre la papauté et l'église. Pris de court, le nouveau pape évite de trancher lors du synode mais, influencé par sa chancellerie, il décide de rester ferme vis-à-vis de Gerbert. Lorsque Hugues Capet meurt le 24 octobre 996, Robert le Pieux épouse sa cousine Berthe de Bourgogne alors que cette union consanguine a été interdite par le pape. C'est l'occasion d'obtenir du nouveau roi de France qu'il arrête de soutenir Gerbert.
Grégoire V est le premier pape d'origine étrangère et non désigné parmi l'aristocratie romaine. Les Romains et, en particulier, les Crescentii vivent d'autant plus mal cet empiètement sur leurs prérogatives que le nouveau pape est particulièrement peu diplomate. Rapidement, il s'aliène la noblesse romaine.
Dans les derniers jours du mois de septembre 996, quelques mois seulement après avoir sur l'intercession du pape Grégoire V été gracié par Otton III, qui se prévaut de la clementia des césars, un concept-clef de l'exercice du pouvoir chez les Ottoniens, Crescentius entreprend de faire chasser Grégoire V de Rome. Crescentius complote avec l'archevêque de Plaisance et ancien conseiller de Théophane, Jean Philagathos, pour faire élire un antipape. Mais Otton III, plutôt que d'intervenir immédiatement, donne la priorité à la sauvegarde des frontières saxonnes. Il regagne la Germanie. De décembre 996 à avril 997, il séjourne en Rhénanie, notamment à Aix-la-Chapelle. Mais, on ne connaît pas le détail de cette partie de son règne, comme la tenue de bans. Il lance, à l'été 997, une nouvelle campagne contre les Slaves de l'Elbe. Une fois couronné empereur, Otton III
Le synode se réunit à Pavie, où Grégoire V s'est réfugié après avoir été chassé de Rome par Crescentius. Il y est décidé que Robert le Pieux et sa femme doivent venir s'expliquer et être éventuellement excommuniés. Ce synode condamne aussi les évêques du concile de Saint-Basle qui ont destitué Arnoul. S'il est vrai que l'empereur se défie d'abord de Gerbert d'Aurillac, il demande, quelques mois plus tard, à l'archevêque de Reims d'entrer à son service : il s'agit d'aider Otton III à se dépouiller de sa grossièreté rusticitas saxonne, et de le faire accéder à la finesse subtilitas grecque.
La seconde campagne d'Italie
Ce n'est qu'en décembre 997 qu'il retourne en Italie. On ignore l'effectif exact de son armée, mais il est accompagné des princes et prélats de tout l'Empire, à l'exception de sa très chère sœur dilectissima soror Sophie, qui l'a accompagné lors de son sacre à Rome, et qui réside auprès de lui à Aix-la-Chapelle. Il n'est plus jamais question désormais de sa présence à la cour.
Lorsqu'Otton III pénètre en Italie en février 998, les Romains adoptent une attitude conciliante et le laissent marcher sur Rome sans combattre. Entretemps, le préfet Crescentius Ier Nomentanus se barricade dans le château Saint-Ange. L'antipape Jean XVI s'enfuit de Rome et se réfugie dans un donjon, mais il est capturé par un détachement de l'armée impériale. Grégoire V est sans pitié pour celui qui a usurpé sa fonction : il lui fait crever les yeux, couper le nez et arracher la langue. Otton III ne fait rien pour sauver ou adoucir la peine de celui qui fut son précepteur et cela malgré l'intercession de l'ermite Nil de Rossano, qui vient implorer la grâce papale puis impériale. Ramené à Rome, Jean Philagathos est jugé par un synode et traîné dans les rues de la ville juché sur un âne pour que chacun sache ce qu'il en coûte de remettre en cause la nomination du pape par l'empereur.
Le comportement cruel de l'empereur et du pape est cependant contreproductif : ils sont critiqués dès cette époque, ce qui nuit fortement à leur crédit. C'est ainsi que le vieil abbé Nil de Rossano part pour Rome dès qu'il apprend la mutilation de l'antipape, pour l'héberger dans son monastère. Mais Grégoire V et Otton III repoussent cette requête. Nil aurait alors appelé l'éternelle punition divine sur l'empereur en quittant Rome :
« Si vous, n'avez pas eu pitié de celui qui a été livré entre vos mains, le père céleste ne vous remettra pas davantage vos péchés »
— Nil de Rossano à l'envoyé de l'empereur Probablement Gerbert d'Aurillac.
De la même manière, lorsque, après un siège acharné, l'armée impériale parvient à se saisir de Crescentius au retour d'une entrevue avec l'empereur, le rebelle est décapité50. Son cadavre est d'abord pendu aux créneaux du château Saint-Ange, puis finalement, avec les corps de douze de ses comparses, suspendu par les pieds sur le Monte Mario, où il est exposé aux outrages du public.
La volonté d'Otton III d'imposer un nouvel Empire romain en dépit des désirs d'indépendance romaines ne fait aucun doute : il se fait construire un palais sur le Mont Palatin, où les empereurs romains résidaient autrefois, et organise sa cour à la façon byzantine50. Sur un décret impérial d'Otton III, daté du 28 avril 998 et concernant l'abbaye d'Einsiedeln, dont la date coïncide avec l'exécution de Crescentius, apparaît pour la première fois un sceau portant la devise Renovatio imperii Romanorum Restauration de l'Empire romain. Cette nouvelle devise figure ensuite systématiquement sur les décrets impériaux jusqu'au retour d'Otton III de Gniezno, avant d'être remplacée, à partir de janvier 1001, par la formule Aurea Roma Rome d'or, rayonnante Rome. Soucieux d'apaiser la noblesse romaine, il gratifie l'aristocratie locale de charges au palais50. Cependant, celle-ci n'oublie pas les terribles châtiments qu'ont subi Jean XVI et Crescentius.
Le séjour d'Italie 997–999
Otton III assoit l'autorité impériale et tente, avec le soutien du pape, de mener à bien la réforme de l'Église, affaiblissant ainsi l'aristocratie, prompte à user de simonie. Il délivre des diplômes aux évêchés et aux abbayes et oblige l'aristocratie laïque à restituer les biens de l'Église dont elle s'était emparée. La lutte contre un parent de Crescentius, un comte de Sabine du nom de Benoît, s'inscrit dans ce cadre : ils le contraignent par la force à rendre les biens confisqués au monastère de Farfa.
Dans la droite ligne de ses prédécesseurs, Otton attribue les évêchés à des hommes de confiance. Les charges épiscopales, contrairement aux charges comtales, sont restituées à l'empereur au décès de l'évêque, ce qui permet d'éviter l'affaiblissement du patrimoine impérial et donc de conserver de l'autorité sur sa clientèle.
Lorsque meurt l'évêque Hildiward d'Halberstadt, naguère un des instigateurs de la dissolution de l'évêché de Mersebourg en novembre 996, Otton III et Grégoire V s'attaquent à la reconstitution de ce diocèse et justifiant cela par une motion qu'ils font adopter par un synode de la Noël 998-99, selon laquelle la dissolution prononcée en 981 était une infraction au droit ecclésiastique : le diocèse aurait été dissout sine concilio sans vote. Ce n'est toutefois qu'en 1014, sous le règne du successeur d'Otton, l'empereur Henri II, que le diocèse de Mersebourg est rétabli.
En 999, Otton délaisse quelque temps les affaires pour un pèlerinage en Bénévent sur le mont Gargano, que Romuald, prêcheur d'Einsiedeln, lui aurait imposé en expiation des atrocités commises envers Crescentius et Jean Philagathos. En chemin, Otton apprend que Grégoire V vient de mourir à Rome. Aussi cherche-t-il à rendre visite au père Nil en rémission de ses péchés. Mais, loin de contribuer à retrouver son crédit, cette démarche est perçue comme une preuve de vulnérabilité.
Dès son retour, il élève à la dignité papale son précepteur Gerbert d'Aurillac, qui prend le nom de Sylvestre II. Pour la seconde fois d'affilée, le pape nommé est un non-romain Gerbert est franc. À Rome, il continue de renforcer son pouvoir en attribuant les évêchés à ses proches. C'est ainsi qu'il nomme son propre chapelain, Léon, évêque de Verceil, lui confiant un diocèse difficile, car son prédécesseur Petrus de Verceil vient d'être assassiné par le margrave Arduin d’Ivrée. En 999, un synode romain condamne Arduin à faire amende honorable. Il lui est demandé de déposer les armes et de ne pas passer la nuit deux fois de suite au même endroit, dans la mesure où sa santé le lui permet. Il peut s'exonérer de cette peine en entrant dans les ordres. Otton attribue aussi la succession de l'évêque Everger de Cologne à son chancelier Herbert.
Posté le : 23/01/2016 19:41
|
|
|
|
|
Otton III 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Intervention en Europe orientale
L'empereur entouré des princes d'Empire et des évêques ; à sa gauche, les 4 nations la Slavonie, la Germanie, les Gaules et Rome lui rendent hommage en tant que successeur à l'imperium miniature du scriptorium de Reichenau, Évangéliaire d'Otton III, XIe siècle.
En décembre 999, Otton quitte finalement Rome pour un pèlerinage à Gnesen : il veut prier sur la tombe de son ami Adalbert. Les hagiographies laissent entendre qu'Otton serait allé à Gnesen pour accaparer des reliques d'Adalbert. Toutefois, les motifs du monarque sont essentiellement religieux. À son arrivée dans la ville, Otton se fait mener pieds nus jusqu'au tombeau d'Adalbert par l'évêque de Posen Unger et, par ses prières en larmes, supplie les martyrs d'intercéder pour lui auprès du Christ. Puis il élève la ville au rang d'archevêché, fondant par là l'Église autonome de Pologne. L'archidiocèse de Cracovie et les nouveaux évêchés de Kolberg et Breslau sont rattachés à la nouvelle province ecclésiastique de Gnesen où siégerait un évêque métropolite. Le royaume de Boleslas Chrobry se trouve ainsi doté d'une Église indépendante.
Les autres activités d'Otton à Gnesen sont controversées. L'Histoire de Pologne de Gallus Anonymus, qui n'a été rédigée qu'au XIIe siècle, offre le seul récit détaillé des événements. Elle rapporte avec force comment Otton III a fait roi Boleslas, ce que les sources saxonnes passent systématiquement sous silence. Le fait qu'un couronnement ait pu avoir lieu est aujourd'hui très débattu. La thèse de Johannes Fried, un historien allemand, selon laquelle Gnesen aurait été le théâtre de la création purement civile d'un roi, a été récemment combattue par Gerd Althoff, pour qui le couronnement de Boleslas à Gnesen n'est que la célébration particulièrement fastueuse du pacte d'amitié avec l'empereur Otton III.
Pour son retour en terre d'Empire, Boleslas confie à l'empereur un équipage fastueux et l'accompagne via Magdebourg jusqu'à Aix-la-Chapelle. Là, Otton lui aurait offert le trône de Charlemagne.
Retour à Rome
Otton fête les Rameaux à Magdebourg et Pâques à Quedlinbourg. Puis, passant par Trebur, il rentre à Aix-la-Chapelle, la ville qu'il aimait le plus après Rome. Au cours de ces quelques mois, il appelle à l'occasion de plusieurs synodes tenus à Magdebourg, Quedlinbourg et Aix-la-Chapelle à la renaissance de l'évêché de Mersebourg, sans parvenir à arracher la décision. À Aix-la-Chapelle, il fonde une église en l'honneur de son ami Adalbert, martyrisé en Prusse, et lui fait don des reliques du missionnaire. Il fait aussi rechercher et ouvrir le tombeau de Charlemagne. Même aux yeux de ses contemporains, ce comportement passe pour une violation de sépulture, pour laquelle Dieu l'aurait puni d'une mort prématurée. Actuellement on interprète l'action d'Otton comme un premier pas vers la création du culte de Charlemagne.
D'Aix, il retourne à Rome au cours de l'été de l'an mil. C'est à ce moment que reprend la querelle de Gandersheim, qui oppose l'évêque de Mayence Willigis à l'évêque Bernard d'Hildesheim : la consécration d'une nouvelle église à Gandersheim rend inévitable une décision sur le rattachement de la paroisse à l'un des deux évêchés. L'évêque Bernard prend le temps d'aller à Rome pour y faire valoir sa cause devant Otton III et un synode romain. En conséquence de la démarche de Bernard, deux nouveaux synodes se réunissent presque simultanément pour trancher l'affaire de Gandersheim : l'un, provincial, à Gandersheim même, et l'autre, impérial, à Rome, sous la présidence de l'empereur et du pape. Toutefois, ni ces deux conclaves, ni celui qui suit, à Pöhlde, ne parvient à décider du parti à prendre. Cette querelle occupe alors plusieurs empereurs et de multiples synodes, avant d'être finalement tranchée en 1030.
L'empereur passe la fin de l'année en Italie sans qu'il en ressorte d'initiative politique significative. Il faut attendre le début de l'année 1001 pour que le pouvoir se manifeste à nouveau, et cela à l'occasion d'un soulèvement des habitants de Tivoli contre l'autorité impériale. Otton assiège donc cette ville, bien que la Vita Bernwardi, un éloge de l'évêque Bernard composé par son professeur Thangmar, vante plutôt le rôle de Bernard dans la soumission durable des rebelles. Le mois même où ce siège de Tivoli a lieu, survient un autre événement inhabituel, à savoir la publication d'un acte de donation impérial au bénéfice du pape Sylvestre. Cette donation met brutalement un terme à la politique habituelle des papes qui, déchus de leurs propres territoires par leur insouciance et leur incompétence, ont essayé, hors de tout cadre juridique, de s'y approprier les droits et les devoirs de l'imperium. Par cet acte, Otton est considéré comme le défenseur de l'autorité impériale contre la Papauté. Il dénonce comme mensongères les prétentions territoriales de l'Église romaine exprimées dans la donation de Constantin, y compris la donation elle-même ou sa restitution par Jean Diacre, tout en abandonnant à Saint Pierre par pure bienveillance impériale huit comtés de la Pentapole italienne.
Dans les semaines qui suivent la publication de cet acte de donation, un soulèvement éclate à Rome. On a attribué la cause de cette émeute à l'indolence excessive du pouvoir après les événements de Tivoli. Elle est contenue pacifiquement au bout de quelques semaines par voie de négociation. Le doyen du chapitre d'Hildesheim, Thangmar, qui, en 1001, avait accompagné son évêque Bernard d'Hildesheim à Rome, rapporte la teneur d'un discours fameux adressé par Otton aux Romains au cours de ces négociations, par lequel l'empereur aurait exprimé à la foule son amour pour Rome et son renoncement complet à ses attaches saxonnes. Émus aux larmes par cette profession de foi, les Romains se saisissent de deux hommes qu'ils molestent cruellement pour manifester leur regret et leur souhait de retour à la paix civile. Malgré ces gestes d'apaisement, la versatilité de l'opinion inspire la méfiance aux conseillers de l'empereur, qui l'engagent à s'éloigner des dangers et à regrouper ses troupes autour de Rome.
La mort de l'empereur
Otton III et le pape Sylvestre II s'éloignent de Rome et prennent la direction du Nord vers Ravenne. Par la suite, Otton recevant une ambassade de Boleslaw Chobry, conclut avec la délégation hongroise la création d'une nouvelle province de l'Église avec pour métropole l'évêché de Gran et s'assure que le nouvel archevêque, Astericus, couronne roi le prince Étienne de Hongrie. Otton fait aussi en sorte de resserrer encore les liens avec le doge de Venise.
Mais les sources hagiographiques Vie du Bienheureux Romuald » de Pierre Damien et la Vie des Cinq Frères de Brun de Querfur donnent au même moment plutôt l'image d'un monarque abattu moralement. La détresse reflétée par ces témoignages culmine avec la promesse d'Otton de renoncer aux choses terrestres et d'entrer dans les ordres. Il aurait en tout cas voulu prendre encore trois ans pour corriger les erreurs de son règne : on ignore cependant de quelles erreurs il s'agissait.
Vers la fin de l'année 1001, il rejoint Rome avec l'appui des contingents de quelques évêques de l'Empire, qui n'ont pu rallier l'Italie que très lentement. Ayant contracté une fièvre violente, il décède le 23 janvier 1002, au château de Paterno, situé à Faleria, non loin de Rome. Plusieurs témoignages rapportent la mort apaisée et édifiante du prince chrétien.
La mort de l'empereur est d'abord tenue secrète, jusqu'à ce que sa garde personnelle soit informée et mise en état d'alerte. L'armée, continuellement entourée d'ennemis, quitte l'Italie afin d'exaucer les dernières volontés d'Otton d'être inhumé à Aix-la-Chapelle. En février 1002, alors que le convoi, parti de Paterno, traverse Lucques et Vérone et pénètre en Bavière, le duc Henri II le prend en charge à Polling et exige des évêques et des nobles, par des menaces et des promesses, qu'ils le proclament roi. Cependant, aucun de ceux qui accompagnent le convoi, à l'exception de l'évêque Siegfried d'Augsbourg, n'aurait pris le parti d'Henri. On ignore au juste quelles préventions les collaborateurs d'Otton éprouvent à l'égard d'Henri. Quelques semaines plus tard, pendant les célébrations de la mort de l'empereur, ces hommes confirment leur refus, car de leur avis, Henri, à bien des égards, n'est pas apte à gouverner le royaume. Ainsi, alors qu'en Italie, dès le 15 février 1002, les barons lombards ont acclamé roi, à Pavie, Arduin d’Ivrée, adversaire d'Otton III, le duc Henri II continue à se débattre au milieu d'interminables négociations et de querelles privées.
La succession d'Otton III
Dès le début de son règne, Henri II permet les célébrations pour le salut de l'âme de son prédécesseur, son oncle bien-aimé, et pour la mémoire du « bon empereur Otton. Il fait connaître les dernières volontés et les legs d'Otton et, comme lui, il célèbre les Rameaux en 1003 à Magdebourg, sur la tombe d'Otton Ier, ainsi que la fête de Pâques à Quedlinbourg, lieu de sépulture d'Henri Ier et de son épouse Mathilde. Mais avant tout, Henri II fait de la Saxe le nouveau centre du pouvoir. Il se laisse ainsi au moins une décennie, avant de s'en prendre à son rival en Italie.
On a longtemps vu dans l'abandon par Henri II de l'inscription d'Otton III : Renovatio imperii Romanorum (Renaissance de l'empire romain sur les sceaux impériaux au profit de Renovatio regni Francorum Renaissance du royaume des Francs un virage décisif de la politique des empereurs. Mais, plus récemment Knut Görich, historien allemand, a attiré l'attention sur le nombre des sceaux concernés : il faut en effet rapporter les vingt-trois décrets d'Otton III aux quatre décrets d'Henri II. Ainsi, l'emploi occasionnel et éphémère de l'apostille franque, qui n'apparaît que de façon circonstancielle après une succession réussie à la tête du royaume en janvier et février 1003, n'est qu'une formule d'authentification parmi toutes celles qui nous sont parvenues et est bientôt elle-même abandonnée.
En revanche, c'est bien un tournant que représente la politique extérieure d'Henri II en ce qui concerne les affaires polonaises ; car si, en l'an mil, Boleslas Chobry est gratifié de l'épithète de frère et appui de l'empereur, d'ami et allié du peuple romain fratrem et cooperatorem imperii constituit et populi Romani amicum et socium appelavit, la politique d'Henri II tourne à une confrontation armée, seulement rythmée par les trois traités de paix successifs de Posen 1005, Mersebourg 1013, et Bautzen 1018.
Bilan du règne Politique économique et monétaire
Les Ottoniens doivent leur prospérité et celle de leur empire à l'encouragement et à l'accompagnement des échanges entre l'Europe du Nord et de l'Est et la Méditerranée, via les bassins du Rhin, de la Meuse et du Danube et leur connexion à celui du Pô par les routes passant par les cols alpins. Ils développent les échanges en créant des ateliers de monnayage et, de ce fait, facilite les marchés. Ils alimentent ces ateliers de frappe monétaire par l'exploitation de mines d'argent. C'est sous la régence d'Adélaïde que le monnayage atteint son apogée en Germanie. Otton III s'inscrit dans cette politique économique et monétaire en autorisant, par exemple, l'évêque de Freissing à fonder un marché quotidien et place la fréquentation de ce marché sous le ban de la paix impériale.
L'autre moyen de remplir les caisses est de créer des cours de justice. Celles-ci sont sources d'entrées financières sous forme de réparations : le wergeld. Comme la monnaie, elles permettent de manifester l'autorité impériale dans tout l'Empire. Ainsi, Otton III établit une cour à Ravenne, qui est un riche archiépiscopat qui régente toute l'Italie du Nord et commerce avec Venise et Pavie.
Politique religieuse
Si, depuis Otton Ier, l'Église est assujettie aux empereurs, le soutien de ces derniers à la réforme monastique fait que ce sont les clercs qui éduquent les princes et acquièrent en retour une réelle influence politique. Otton III, élevé par sa mère grecque dans le souvenir de Byzance et entouré de prêtres depuis sa plus tendre enfance, nourrit à la fois une très haute idée de l'empire et une aspiration à la perfection monastique. Pendant sa minorité, le pouvoir impérial est gravement menacé par les grands féodaux, menés par le duc de Bavière Henri le Querelleur. Celui-ci contrôle en effet les évêchés du sud de la Germanie et donc une puissante clientèle lui permettant de rivaliser avec le pouvoir impérial. Otton s'emploie donc à affaiblir cette concurrence en obligeant l'aristocratie laïque à restituer les biens de l'Église dont elle s'est emparée.
Il profite pour cela du mouvement de réforme monastique en cours, promu par Cluny ou des monastères lotharingiens tels que Gorze. Cette réforme lutte contre la simonie et souhaite n'avoir à répondre qu'à l'autorité pontificale. L'empereur y est d'autant plus favorable qu'il a été éduqué par des érudits proches de ce mouvement réformateur. C'est pourquoi il délivre des diplômes aux évêchés et aux abbayes qui les libèrent de l'autorité des grands féodaux. La régente Théophano puis l'empereur lui-même œuvrent à la création de puissantes principautés ecclésiastiques en concédant des évêchés renforcés de comtés et d'abbayes à des fidèles. Les exemples les plus probants sont Notger qui se voit attribuer une véritable principauté à Liège en adjoignant à l'évêché les comtés de Huy et de Brunengeruz, ou Gerbert d'Aurillac qui reçoit l'archiépiscopat de Ravenne dont dépendent 15 évêchés : il contrôle tout le nord de l'Italie. De fait, c'est l'autorité impériale qu'il renforce ainsi : c'est sous le règne d'Otton III que l'emprise de l'empereur sur le Saint-Siège est la plus grande car il nomme les papes sans en référer aux Romains. Il va au-delà de la main mise sur l'Église de son grand-père Otton Ier, dans la mesure où il ne se contente plus d'agréer l'issue d'un vote, mais où il impose son propre candidat à la Curie romaine.
Paradoxalement, Otton III met fin à la décadence de la papauté en l'associant à ses projets d'empire universel : il choisit, pour cela, des papes brillants et en phase avec son projet politique et culturel. Cependant, le pape nommé à discrétion et étranger Grégoire V est germain et Sylvestre II franc n'a que peu de soutien à Rome et dépend d'autant plus de l'appui de l'empereur. Ce pouvoir, Otton l'obtient par la pression militaire en descendant, en 996, en Italie pour soutenir Jean XV chassé par les Romains. Plutôt que d'entrer en conflit avec l'empereur, les Romains préfèrent lui confier le choix du successeur du défunt pape Jean XV. Cette pratique se perpétue avec ses successeurs qui descendent régulièrement en Italie avec l'Ost impérial pour y ramener l'ordre et y influer sur le choix du pape.
Cependant, cet état de fait est mal accepté par la noblesse romaine qui n'a de cesse d'intriguer pour reprendre ses prérogatives dès que l'empereur et son armée sont éloignés de la péninsule italienne.
Politique culturelle
Renaissance ottonienne, art ottonien et architecture ottonienne.
Les Ottoniens sont également des commanditaires de manuscrits de luxe, mais ne semblent pas avoir réuni des artistes à la cour : les manuscrits de luxe sont réalisés à Corvey, à Fulda et surtout à Reichenau d'où proviennent l'évangéliaire d'Otton III et l'évangéliaire de Liuthar, aux représentations impériales de grande valeur pour leur soin et leur sens politique Offrandes des quatre provinces de l'Empire, apothéose d'Otton III représentant en fait peut-être Otton Ier.
Enfin, certaines réalisations architecturales notables, dans le domaine religieux essentiellement, sont marquées par la double inspiration carolingienne et byzantine, et participent à l'émergence du roman. C'est sous Otton III qu'est réalisé le chef-d'œuvre de l'architecture ottonienne, Saint-Michel d'Hildesheim, construction confiée au précepteur de l'empereur, l'évêque Bernward.
Politique diplomatique Restauration d'un empire universel
Otton III, qui est grec par sa mère Théophano, n'essaie pas simplement comme son grand-père Otton Ier de restaurer l'empire carolingien, mais tente de restaurer un empire universel. Son rêve est un empire qui aurait la dignité de celui de Byzance et l'efficacité de celui de Charlemagne. Adalbert ouvre l'esprit d'Otton vers l'instauration d'un empire universel, mais c'est Gerbert d'Aurillac qui le théorise : il rédige pour l'empereur un traité sur le raisonnable et l'usage de la raison qui s’ouvre sur un programme de rénovation de l'Empire romain, considérant que l'empereur, mi-grec par sa mère, est à même de reconstruire un empire universel. L'idée est celle d'une union de pays organisés de manière identique, indépendants du royaume germanique, ayant Rome pour capitale spirituelle et politique : la chrétienté latine doit retrouver son unité sous la double impulsion du pape et de l'empereur. Ce vaste projet d'empire fédéral composé de peuples unis par leur commune adhésion au christianisme, en dehors de toute soumission vassalique, explique que Gerbert d'Aurillac et Otton aient soutenu l'apparition de royaumes chrétiens indépendants de la Germanie en France, en Pologne, en Hongrie ou en Catalogne. Le basileus n'ayant pas d'héritier mâle, il dépêche l'évêque de Milan pour demander la main d'une princesse byzantine, ce qui ouvrirait la voie à une réunification des deux moitiés de l'Empire romain. Cependant, il meurt trop vite pour que ce projet puisse se concrétiser.
Royaume de Pologne
En l'an mil, Otton III est reçu à l’assemblée de Gniezno. Il marie sa fille avec le fils de Boleslas et les charges imposées à Mieszko sont supprimées, ce qui signifie la reconnaissance de l’indépendance polonaise. Le pays est organisé en province ecclésiastique autonome avec un archevêché à Gniezno et trois évêchés à Cracovie, Wroclaw et Kolobrzeg. Boleslas reprend à l’empereur le droit d’investiture et de nomination des évêques, garantissant ainsi l’émancipation de l’Église polonaise84.
Royaume de Hongrie
Le rôle de la bataille du Lechfeld 955 dans l'arrêt des invasions hongroises est en fait limité, le peuple magyar ayant déjà commencé sa sédentarisation. Le prince Géza, séduit par la puissance et l'influence culturelle de la renaissance ottonienne, œuvre pour un rapprochement avec l'Occident. De nombreuses missions de christianisation sont menées avec son soutien. Elles s'interrompent à la mort d'Otton Ier en 973, mais peuvent reprendre une fois passées les difficultés de la régence impériale vers 983. Elles sont animées par des clercs germaniques mais aussi tchèques, dans le sillage du missionnaire Adalbert de Prague, maître et ami intime d'Otton III, qui aurait baptisé le futur Étienne Ier vers 995. Poursuivant sa politique de christianisation et de rapprochement avec l'Occident, le prince Géza fonde, vers 996, le monastère bénédictin de Pannonhalma ainsi que le premier évêché de Hongrie à Veszprém. Pour renforcer les liens naissants avec l'Empire, il marie son fils Étienne à Gisèle, fille d'Henri le Querelleur. la contrepartie de cette union est l'attribution d'une bande de territoires au nord de la Leitha et la promesse d'achever sans tarder l'évangélisation de son peuple. À la mort de Géza 997, les chefs tribaux tentent de mettre un terme aux réformes amorcées. Ils opposent au jeune Étienne, pourtant désigné comme son successeur par Géza, son vieux cousin Koppany qui, satisfaisant aux critères traditionnels de transmission du pouvoir princier chez les Hongrois, se présente comme le champion de la réaction magyare contre les dangereuses innovations venues d'Occident.
Mais il est vaincu par Étienne en quelques mois grâce à l'aide militaire apportée par les chevaliers bavarois, qui sont récompensés par l'autorisation de s'installer en Hongrie. Il considère que son avenir politique passe par l'appropriation des méthodes occidentales. Il se considère déjà comme roi, titre que les sources écrites attribuent avant lui à son père et à son grand-père ; mais il a besoin d'un symbole faisant de lui un roi chrétien, l'oint du Seigneur, comme le sont les rois francs puis les empereurs germaniques, dans la continuité des rois bibliques. Il envoie une délégation auprès du pape, qui est d'autant mieux reçue que sa démarche correspond au projet d'empire fédéral caressé par Sylvestre II et Otton III. Le détail a son importance : Étienne n'aurait jamais voulu faire ce qu'avaient fait les ducs tchèques quelques décennies plus tôt, c'est-à-dire prêter allégeance à l'empereur germanique en échange de la reconnaissance de leur autorité monarchique. La seule contrepartie à fournir est l'engagement d'achever la conversion des Magyars.
En 1000 le 25 décembre ou 1001 le 1er janvier, fort de la bénédiction pontificale, le prince Étienne est couronné roi à Esztergom, avec la couronne qu'il a reçue de Sylvestre II. Le jeune roi s'acquitte aussitôt de ses engagements en relançant les missions de conversion. Il impose à ses sujets une pratique religieuse régulière et l'entretien du clergé local : la loi veut que les habitants construisent eux-mêmes par groupes de dix villages les églises qui leur servent de lieu de culte chaque dimanche85. Il fonde une Église nationale, placée sous la direction de l'archevêque d'Esztergom. D'abord limitée à la Transdanubie, que contrôlent depuis longtemps les princes arpadiens, elle comprend une petite dizaine de diocèses à la fin du règne. Étienne fait achever le monastère de Pannonhalma et le dote généreusement, comme en témoigne la charte de 1002 dont le texte a été conservé. Il multiplie les fondations monastiques bénédictines et comble les nouveaux établissements de biens fonciers.
Alliance avec Venise
C'est sous l'impulsion de Venise que le christianisme progresse le long de la côte dalmate. L'alliance de Venise, qui cherche à s'émanciper de l'empire Byzantin, est toute naturelle. Elle est matérialisée par le doge qui fait d'Otton le parrain de son fils et de sa fille.
L'image d'Otton III Les témoignages d'époque
La politique italienne d'Otton suscite visiblement l'incompréhension de ses contemporains.
Selon les Annales de Quedlinbourg, qui reflètent fidèlement le point de vue des monastères ottoniens et de leurs abbesses royales, à savoir la tante et la sœur d'Otton III, l'empereur veut marquer sa préférence pour les Romains sur les autres peuples. Mais elles s'abstiennent de critiquer la politique d'Otton III ; sa mort, qui apparaît comme la conséquence de ses propres péchés ou de ceux des étrangers, est déplorée par la terre entière.
Dithmar, évêque de Mersebourg ou encore Thietmar, ou Dietmar, dont le récit est imprégné de l'idée que la dissolution de l'évêché de Mersebourg a été une injustice profonde, désapprouve la politique italienne d'Otton III. C'est ainsi que, selon lui, l'empereur aurait, dans son palais, dîné sur une table en demi-cercle portée par ses proches, un usage tout contraire aux habitudes des cours franques et saxonnes.
Plus tard encore, Bruno de Querfurt reproche à l'empereur d'avoir voulu faire de Rome sa résidence ordinaire et de l'avoir considérée comme sa véritable patrie. Selon les propos de Bruno, qui vise à l'hagiographie, Rome symbolise le dépassement des cultes païens par les croyances chrétiennes ; avec son monarque païen, la Ville aurait perdu son rayonnement spirituel universel, elle qui, depuis la Donation de Constantin, est la ville des apôtres, sur laquelle plus aucun monarque profane ne doit régner. C'est pourquoi la répression exercée contre le siège des apôtres constitue pour Bruno un péché si grave que la mort prématurée de l'empereur est perçue comme un châtiment inévitable. Cependant Bruno de Querfurt salue certains traits agréables chez l'empereur, comme son tempérament chaleureux : encore enfant et livré aux errements de son comportement, il fit un bon empereur, un Imperator Augustus d'une profonde humanité.
Aussi Otton III, avec sa culture inaccoutumée et sa finesse reconnue, ne tarde-t-il pas à faire l'admiration de tous et est surnommé, aussi bien en Germanie qu'en Italie, Merveille du Monde.
Historiographie
Les jugements critiques des cercles dirigeants contemporains déteignaient d'ordinaire sur l'œuvre des historiens du xixe et du début du xxe siècle. L'opinion sur Otton III fut longtemps celle exprimée par Wilhelm von Giesebrecht dans son Histoire du Saint-Empire Geschichte der deutschen Kaiserzeit, qui critiquait fondamentalement l'absence du sentiment national chez Otton III et lui reprochait ses rêveries et son manque de pragmatisme. Pire même, Otton III aurait dilapidé un gros héritage par sa frivolité, aurait poursuivi des chimères et se serait commis avec des intellectuels et des étrangers. Giesebrecht forgea les conceptions des historiens nationalistes pour des décennies.
Au début du XXe siècle, plusieurs objections concrètes remirent en cause ces idées reçues. Avec son ouvrage intitulé Kaiser, Rom und Renovatio 1929, l'historien Percy Ernst Schramm a imposé une nouvelle image d'Otton III. Son nouveau portrait de l'empereur, contredisant l'image traditionnelle du souverain non-germanique, bigot et évaporé, constituait une réhabilitation dans la mesure où Schramm essayait de saisir Otton III dans la tourmente religieuse de son époque. La nouveauté résidait avant tout dans une interprétation historico-religieuse de la politique d'Otton III, selon laquelle la politique de renaissance de Rome constituait la véritable motivation du gouvernement de l'empereur. Schramm donnait comme preuve essentielle de cette politique de renaissance l'adoption, à partir de 998, de la fameuse devise Renovatio imperii Romanorum sur les sceaux.
Robert Holtzmann, historien allemand, rejoignait encore, en 1941, dans son Histoire des empereurs saxons Geschichte der sächsischen Kaiserzeit le point de vue de Giesebrecht et concluait : L'État d'Otton le Grand vacillait sur ses bases lorsqu'Otton III mourut. Si cet empereur avait vécu plus longtemps, son empire se serait effondré. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les opinions sur Otton III dans la veine d'Holtzmann sont devenues plus rares.
Mathilde Uhlirz, historienne autrichienne, compléta en 1954 le point de vue de Schramm, en considérant la politique de l'empereur plutôt sous l'angle d'une consolidation du pouvoir du prince dans les régions méridionales de l'Empire, et en prêtant ainsi à Otton III l'intention d'y renforcer son autorité. Contrairement à Schramm, Uhlirz mettait l'accent sur la collaboration entre l'empereur et le pape, lequel était surtout soucieux de gagner la Pologne et la Hongrie à la Chrétienté de spiritualité romaine. Par la suite, il apparut une synthèse entre les points de vue de Schramm et d'Uhlirz, qui voit dans les efforts de consolidation de l'autorité impériale au Sud, autant que dans le rapprochement avec la Pologne et la Hongrie les grandes lignes de la politique d'Otton III. Mais la tentation persistait d'expliquer la politique d'Otton III par son caractère et ses traits de personnalité.
Ces dernières années, le sens que Schramm a donné au terme de renovatio a été contesté à plusieurs reprises. D'après Knut Görich, il faut analyser la politique italienne et les campagnes contre Rome plutôt comme une préoccupation de pérennité de la papauté que comme un programme de régénération de l'Empire romain.
Gerd Althoff s'est plus récemment détourné des concepts politiques employés en histoire médiévale, qu'il juge anachroniques, dans la mesure où la place de l'écrit et les équivalences institutionnelles nous échappent pour comprendre la royauté au Moyen Âge. En outre, d'après Althoff, les sources invoquées à l'appui sont ambivalentes. On ignore s'il faut les rattacher à la tradition de la Rome antique ou à celle de la Rome chrétienne.
Otton III dans la poésie et les romans
Un poème du xie siècle, dans lequel le conseiller impérial Léon de Verceil chante la collaboration de l'empereur et du pape, évoque la reconstitution de l'Empire romain par Otton III. Ce poème commence surtout par une invocation au Christ, afin qu'il daigne porter les yeux sur Rome et lui rendre son lustre, pour qu'elle puisse prospérer sous le règne du troisième Otton.
Depuis le XVIe siècle, Otton III, de par sa vie courte et les événements dramatiques qui ont émaillé son règne, sert de personnage-titre à de nombreux témoignages littéraires ; mais bien peu ont pu survivre par leur valeur littéraire.
Dans son poème intitulé La Complainte de l'empereur Otton III Klagelied Kaiser Otto III., August von Platen-Hallermünde rabaisse Otton III par pur nationalisme. L'historienne et philosophe Ricarda Huch, dans son livre intitulé Römisches Reich Deutscher Nation 1934, compare Otton III à Otton Ier : son rejet d'Otton III s'appuie sur les idées de Giesebrecht. Mais les jugements favorables à la carrière d'Otton III s'expriment aussi dans la littérature. Ainsi paraissent, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux romans historiques sur l'empereur ottonien. Gertrude Bäumer, politicienne allemande du Mouvement de libération des femmes, donne à sa reconstitution de la vie d’Otton III le titre Le jeune homme au manteau d'étoiles : grandeur et tragédie d'Otton III Der Jüngling im Sternenmantel. Größe und Tragik Ottos III. Et simultanément, Albert H. Rausch Henry Benrath, son pseudonyme, auteur allemand, essaie de saisir la personnalité d’Otton III de façon plus subjective et avec davantage d’emphase. Il s'agit pour lui d’appréhender citation|la spiritualité dans la vie d'un monarque ».
Ascendance
Ancêtres d'Otton III du Saint-Empire
Sources primaires et vit
Theodor Sickel, Ottonis II. et Ottonis III. Diplomata, Hanovre, Monumenta Germaniae Historica, coll.Diplomata, 1893
Johann Friedrich Böhmer et Mathilde Uhlirz, Res gestae Imperii II, 3. Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III, Vienne, 1956
Sources littéraires
Arnulf de Milan trad. W. North, dir. Claudia Zey, Liber gestorum recentium, vol. 67, Hanovre: Hahn, Monumenta Germaniae Historica,
Monumenta Germaniae Historica Diplomata, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 8: Annales Hildesheimenses. Éd. de Georg Waitz. Hanovre 1878
Georg Heinrich Pertz, Annales Quedlinburgenses, Hanovre, Monumenta Germaniae Historica, 1839, p. 22
Bruno Georg Waitz et Wilhelm Wattenbach trad. W. Hartmann, Vita quinque fratrum eremitarum, vol. Supplementa tomorum I-XII, pars III. Supplementum tomi XIII pars II, Hanovre, Monumenta Germaniae Historica, 1888, p. 709
réimpr. par W. Hartmann sous le titre Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. vol. 1, Stuttgart 1995, p. 202–204.
Die Jahrbücher von Quedlinburg, trad. par Eduard Winkelmann Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit 36, Leipzig 1891.
Herman de Reichenau et Werner Trillmich dir. trad. Rudolf Buchner, Chronicon, Darmstadt, Monumenta Germaniae Historica, coll. Quellen des 9. und 10. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches, series in Folio 13, Mélanges Baron vom Stein, 1961. Texte en latin dans les Monumenta Germaniae Historica, Scriptores: Supplementa tomorum I-XII, pars I. Ed. par Georg Waitz et al. Hanovre 1881, p. 61
Dithmar et Robert Holtzmann dir. trad. Werner Trillmich, Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, Darmstadt, Monumenta Germaniae Historica, 1935 réimpr. 957
Thangmar: Vita Bernwardi episcopi Hildesheimensis. In Monumenta Germaniae Historica, Scriptores in Folio 4: Annales, chronica et historiae aevi Carolini et Saxonici. éd. par Georg Heinrich Pertz et al. Hanovre 1841, p. 754–782
Bibliographie Présentations générales
Pierre Riché, Les Grandeurs de l'an mille, Bartillat, édition 2008.
Francis Rapp, Le Saint-Empire romain germanique, Éditions du Seuil, coll. Points Histoire, 2003
Robert Folz, La Naissance du Saint-Empire, ed. Albin Michel, 1967
Gerd Althoff: Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat. 2e éd. augm., Kohlhammer Taschenbücher, Stuttgart u. a. 2005,
Helmut Beumann: Die Ottonen. 5e éd. Stuttgart 2000,
Hagen Keller: Ottonische Königsherrschaft, Organisation und Legitimation königlicher Macht. Darmstadt 2002,
Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter: Otto III. – Heinrich II. Eine Wende?. Sigmaringen 1997,
Biographies
Gerd Althoff: Otto III. Gestalten des Mittelalters und der Renaissance. Darmstadt 1997,
Ekkehard Eickhoff: Theophanu und der König. Otto III. und seine Welt. Stuttgart 1999
Ekkehard Eickhoff: Kaiser Otto III. Die erste Jahrtausendwende und die Entfaltung Europas. 2e éd. Stuttgart 2000,
Knut Görich: Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus: kaiserliche Rompolitik und sächsische Historiographie. Sigmaringen 1995, .
Percy Ernst Schramm: Kaiser, Rom und Renovatio. Darmstadt 1962 réimpr. de l'éd. de 1929.
Mathilde Uhlirz: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. Zweiter Band: Otto III. 983–1002, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1954.
Articles d'encyclopédie
Knut Görich, Otto III in Neue Deutsche Biographie, vol. 19 1999 p. 662–665.
Tilman Struve, Otto III in Lexikon des Mittelalters, vol. 6 1999
[ 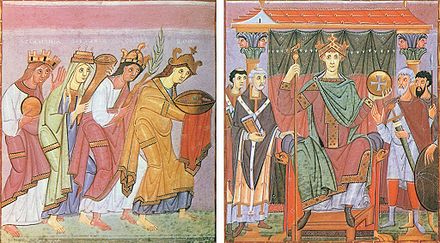 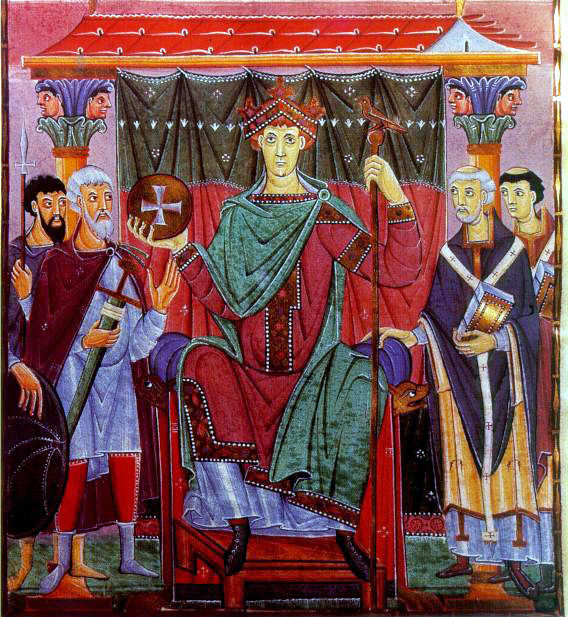  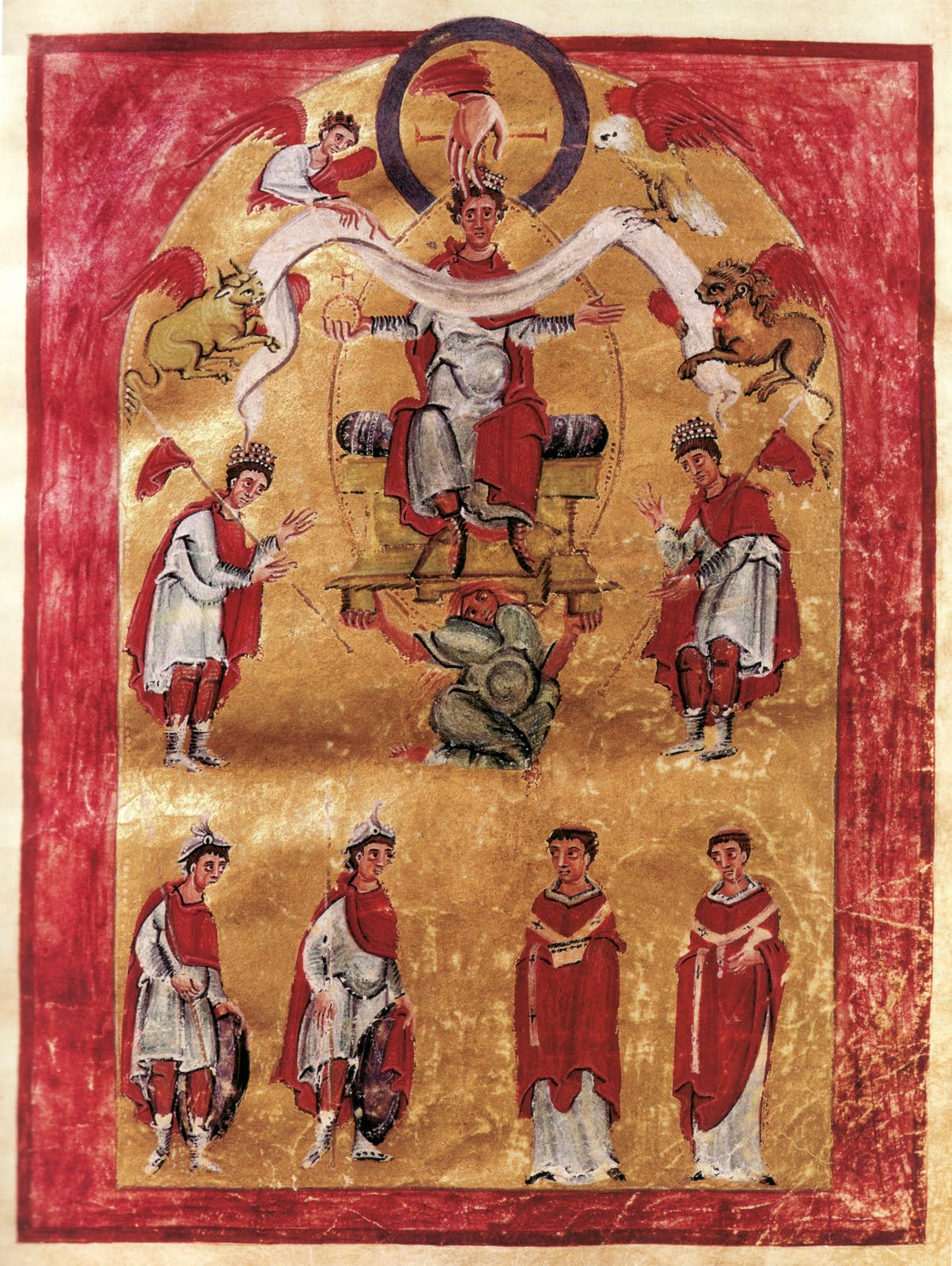        
Posté le : 23/01/2016 19:40
Edité par Loriane sur 24-01-2016 19:24:43
|
|
|
|
|
Re: Défi du 23-01-2016 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
14/03/2014 18:40
De Paris
Niveau : 29; EXP : 25
HP : 0 / 706
MP : 370 / 21252
|
La fête des anciens Je roulai sans réfléchir, en direction de la fête des anciens. Retrouver mes camarades de terminale, trente ans après le baccalauréat, me semblait irréel. J’avais quitté cette grande ville depuis bien longtemps, et avec elle mes souvenirs s’étaient envolés. Je ne savais même pas si j’allais reconnaitre mes supposés meilleurs copains de l’époque, mes prétendues amourettes de jeunesse et mes incontournables inimitiés. Seule la curiosité m’avait poussé à revenir à Lyon, capitale des Gaules et de l’autosatisfaction. Le parking était plein, signe du succès indéniable de l’événement. Une ancienne discothèque reconvertie en maison de la culture avait été louée pour l’occasion. Je me souvenais de cet endroit, haut lieu des soirées branchées propres à la jeunesse lyonnaise. J’avais testé sa piste de danse, le jour de mes dix-huit ans, avec d’autres copains, mes véritables amis, pas ceux du lycée mais des fils à papa rencontrés en Angleterre et devenus les vrais compagnons de mes années adolescentes. Ils me manquaient encore, de temps à autres, quand la nostalgie prenait le dessus sur le réalisme, quand mes quarante ans me pesaient trop. A l’entrée, un cerbère me demanda mon nom et mes papiers. Je m’exécutai sans rechigner, revenu sur Terre avant l’heure, de retour au pays des peureux et des nouveaux riches, là où les bien-pensants craignaient de voir leur argenterie disparaître sous le manteau d’un Roumain. Une fois l’épreuve réussie, je rentrai dans la place, déjà moins certain de vouloir rester au-delà des vingt minutes diplomatiques. Comme je m’y attendais, tout le monde s’était mis sur son trente et un. J’avais l’impression d’un mariage princier, à la mode provinciale, avec des quadragénaires en costume trois pièces ou en robes de soirée. Heureusement, tout le monde n’avait pas suivi ce code vestimentaire et certains arboraient une tenue plus décontractée, du genre gentleman-farmer venu présenter sa belle collection de champignons forestiers. On était loin de la rébellion lycéenne. Je décidai d’investir le bar, une tradition ancestrale chez les réfractaires au troupeau, les timides et les philosophes. Je ne savais pas encore dans quelle catégorie je me rangeais ce soir là. L’avenir me le dirait, assurément. La barmaid, une jolie brunette aux yeux bleus, m’arracha à mes profondes réflexions sociologiques. — Qu’est-ce que je vous sers, monsieur ? — Une camomille pour commencer, mademoiselle. — Nous n’avons pas ça. Les seules boissons chaudes disponibles sont le thé et le café. — Je plaisantais. M’entendre appelé monsieur m’a vieilli de vingt ans. Je me suis imaginé à la maison de retraite, peinant avec mon déambulateur pour atteindre la buvette. — Je suis désolée. — Ne le soyez pas. Vous êtes polie et je suis ronchon. — Vous allez bientôt revoir des amis de jeunesse. Je suppose que ce n’est pas toujours facile, surtout si vous ne les avez pas vus depuis le lycée. — Quel est votre prénom ? — Annette. — Ravi de vous rencontre, Annette. Moi, c’est Donald. — Le plaisir est partagé, Donald. — Vous me sauverez, Annette, quand je serai submergé par les souvenirs à deux balles et les caresses hypocrites. — Je ferai de mon mieux, Donald. — Alors, je suis d’accord pour un soda. — C’est parti ! Annette me rappelait une actrice américaine, fille d’un chanteur de rock métallique, devenue égérie des nains de jardin et des fans de jeux de rôle. J’optai alors pour la technique du phare dans la nuit, avec la belle brune comme repère absolu, une étoile fixe et rassurante au milieu des météores, des comètes et des trous noirs. Cette décision me permit de passer le cap de la première impression et de ne pas repartir immédiatement chez moi. J’avais à peine attaqué ma boisson pétillante qu’une minuscule blonde perchée sur de hauts talons me regarda avec ses gros yeux, ouvrit une bouche de truite de mer puis se dirigea vers moi, l’air décidé de me socialiser. — Je rêve ! C’est Donald, commença-t-elle avec la discrétion d’une cantatrice italienne. — En chair et en os, répondis-je avec un sourire plaqué toc. — Tu te souviens de moi ? Myriam. Nous étions dans la même classe de terminale. — Comment aurais-je pu t’oublier, Myriam ? — Toujours aussi charmeur, Donald. — C’est un bête don, ma chère. Peu de personnes l’ont, beaucoup en rêvent secrètement. — Je vois que l’humilité ne fait toujours pas partie de ton matériel biologique. — Mon confesseur me le dit souvent. — Tu ne me demandes pas ce que je deviens ? — Tu m’ôtes les mots de la bouche. La question me brulait les lèvres mais je n’osais pas. Je me souvenais de Myriam, la reine du maquillage. Jolie poupée à l’époque, elle affolait les premiers de la classe, avec ses grands yeux bleus à la Barbie, ses beaux cheveux blonds tout lisses et ses dents parfaites. Non seulement elle était magnifique, pour qui aimait les modèles réduits, mais en plus elle caracolait en tête du classement des élèves, dans toutes les matières, sauf le basket-ball évidemment. Myriam représentait la beauté des classes de terminale scientifique, ce réservoir d’ingénieurs, de médecins, de pharmaciens et autres professions supérieures, du moins dans mon lycée élitiste. Trente ans plus tard, elle n’avait presque pas pris une ride, gardait une silhouette gracieuse et maniait sa langue de vipère avec agilité. En cinq minutes montre en main, j’appris tout de Myriam. Elle avait épousé Patrick, le frimeur de ma classe, pondu trois enfants, décroché son doctorat de sciences et obtenu une chaire à l’Université. Son mari, l’amour de sa jeunesse, l’avait quitté après vingt ans de bons et loyaux services, pour sa passion de la course automobile. Depuis, elle lui vouait une fidélité exacerbée, allant jusqu’à conserver son nom de femme mariée et lui dédier un autel marbré dans ses souvenirs. Fidèle à son statut social, Myriam avait gardé le contact avec chaque membre de son clan de l’époque, celui dont elle était la reine et Patrick le roi. D’ailleurs, elle se félicitait de les avoir réunis dans cette fête, même si elle ne l’avait pas organisée. Flaubert aurait consacré des pages à dépeindre Myriam, ses amis et ses paillettes. Fière de m’avoir raconté sa réussite, Myriam me lâcha sous le prétexte de mettre de l’huile dans les rouages. Je l’excusai d’un sourire convenu puis retournai à mon soda. Annette me ramena sur Terre. — Vous avez une touche, Donald ! — Avec qui, Annette ? — Ce serait trop simple, si je vous le disais. Sachez seulement que pendant vos retrouvailles avec Madame Myriam, une femme brune n’a pas cessé de vous regarder, n’osant pas vous interrompre. — Vous pouvez la décrire ? Dites moi qu’elle est belle, grande, prénommée Annette et un peu coquine. Annette se mit à rire. Visiblement, elle appréciait mon humour, un sérieux prérequis avant d’envisager des relations plus horizontales. — Donald, je vais vous décevoir. — Vous n’aimez pas les quadragénaires drôles, bien conservés et prénommés Donald ? — Bien essayé, Donald. Je choisis le joker. — Vous allez appeler un ami ? — Vous préférez que je demande au public ? — C’est toujours mieux que le cinquante-cinquante, non ? — Revenons à nos moutons, Donald. Je vous la décris, votre amoureuse transie, celle dont vous avez certainement fait palpiter le cœur sans le savoir, quand vous n’étiez qu’un jeune impertinent occupé à raconter des blagues et distribuer les bons mots. — Vous me connaissez trop bien, Annette. Vous êtes médium, c’est ça ? — Exactement ! Dans ma boule de cristal, je vois cette femme brune, le genre quelconque, ni vilaine ni jolie, juste insignifiante, s’engaillardir et venir vous aborder, dans l’espoir intime de vous arracher votre costume de scène et conquérir votre cœur d’artichaut. Non seulement Annette ne manquait pas de répondant, mais en plus elle avait raison. Une main se posa sur mon épaule et une voix féminine interrompit mon flirt. — Donald ? — En personne, répondis-je en me retournant. — Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Nous étions dans la même classe de terminale. Je m’appelle Muriel. — Bien sûr, Muriel, je ne t’ai pas oublié, mentis-je. Que deviens-tu ? — Je suis journaliste. — Presse écrite ou audio-visuel ? — Les deux. En fait, je travaille pour CNN Europe et écris en même temps pour un journal dématérialisé. — Bravo ! En vérité, même si Muriel semblait un million de fois plus intéressante que Myriam, elle-même certainement moins morne que la majorité des invités, je n’avais pas l’intention de discuter géopolitique avec une ancienne invisible, une de ces filles sans saveur et sans odeur comme il y en avait tant dans mon lycée. Même avec un Nobel et deux Pulitzer, Muriel restait Muriel, un non-souvenir de ma vie lycéenne, un élément de décor au sein de ma lointaine adolescence. Il me fallait m’en débarrasser au plus vite, en respectant bien sûr l’étiquette bourgeoise et les principes de mon éducation catholique, et me concentrer sur mon objectif à court-terme : quitter cette fête ringarde, avec Annette sous le bras. J’écoutai Muriel me raconter sa mutation de chrysalide sombre en papillon gris, ses longues études de journalisme, ses quatre enfants, son mari absent, son inéluctable divorce, ses nombreux reportages en Afrique et sa progression dans les cercles fermés de la gauche utopiste. Je me surpris à la revoir avec ses lunettes cerclées de métal, sa coupe de communiante, son rire hystérique et sa bande de vilaines. Muriel revenait, petit à petit, dans les méandres de ma mémoire, figurante d’un théâtre effacé, anonyme perdue au milieu des ombres. Je n’avais jamais porté mon attention sur elle ou ses copines, remarqué ses yeux de grenouille morte d’amour et son rouge aux joues dès que je lui souriais les yeux dans les yeux. Sous une écorce anodine se cachait un être profond, une sensibilité exacerbée, une intelligence remarquable et malheureusement pas assez remarquée. Muriel ressemblait à un diamant brut enfermé dans un charbon fossilisé. Plus le temps passait, plus il me semblait difficile d’éconduire Muriel proprement. J’éprouvais de la compassion pour mon ancienne camarade de classe, toujours aussi invisible mais un peu plus courageuse. Mon salut vint de Myriam, la reine des poupées. — Donald, te souviens-tu de Sophie et Fabienne ? Je leur ai dit que tu étais venu. Elles ont hâte d’en savoir plus sur ta vie, tes amours, ta carrière, dit Myriam sans se préoccuper de Muriel. — J’en suis ravi, répondis-je. Je discutais justement avec Muriel. Tu te souviens d’elle, n’est-ce pas ? — Bien entendu, siffla Myriam. Salut, Muriel ! — Bonjour Myriam, répliqua poliment Muriel. — Parfait, je vois que tout le monde est en phase, lançai-je. Allons réveiller nos souvenirs adolescents, au son des bulles de champagne. Nous te suivons Myriam ! Myriam nous guida jusqu’à une table ronde, placée idéalement, pas trop près de la piste de danse, proche d’un autre bar, loin des enceintes d’où vomissait une atroce musique des années quatre-vingt. J’encourageai Muriel en lui pressant délicatement l’avant-bras, provoquant un rougissement express de son visage et un sourire ravi. La lycéenne revenait à la surface. Arrivée à la table, Myriam s’acquitta des présentations d’usage. Fabienne, une brune fade, était également une élève de ma classe de terminale, la suiveuse par excellence, la meilleure dame de compagnie pour la reine Myriam. Le gras du bide assis à côté d’elle se présenta comme son mari, un autre ancien du lycée, de la promotion précédente. Je fis semblant de me souvenir de lui, même si son visage ne me rappelait rien. Sophie, une rousse à la face ronde, le genre Anglaise à grandes dents, avait été une de mes camarades de classe en seconde. Le hasard des plannings scolaires nous avait affecté dans des classes différentes dès la première scientifique et j’avais eu la chance de ne plus la côtoyer le reste de ma scolarité. Je ne savais même pas qu’elle était devenue un maillon important du clan de Myriam. Quant au dernier de la table, c’était le mari de Sophie, un grand échalas prénommé Olivier, amoureux de sa rouquine depuis le lycée. Aussi important dans son couple que le mâle chez la baudroie, il apportait les consommations et les gâteaux apéritifs, riait aux blagues de Myriam, coassait un ou deux compliments à sa femelle crapaud puis s’endormait sur son nénuphar. Muriel me regarda, amusé, puis s’assit à mes côtés. Fidèle a son habitude, du moins dans mes souvenirs, Sophie commença en beauté, en mettant les pieds dans le plat. — Alors Donald et Muriel, vous êtes ensemble ? — Je vois que notre secret est éventé, ma chérie, dis-je en caressant la joue de Muriel. — Tu ne me l’avais pas dit toute à l’heure, me reprocha Myriam. — Pourquoi, tu voulais me présenter une célibataire ? — Je crois que c’est elle la célibataire, persifla Sophie. — C’est bon, on ne va pas passer la soirée la dessus, coupa Myriam. — Ce serait dommage, en effet, confirma Muriel. Sophie affichait un regard victorieux, comme si elle venait de déposer la tenante du titre. Myriam essayait de ne rien montrer mais était visiblement atteinte, prise au dépourvu par la question perfide de sa supposée amie, par ma réponse inattendue et par mon choix en termes d’amoureuse. Dans l’esprit étriqué de Myriam, je ne pouvais pas sortir avec Muriel, l’anonyme de service quand nous avions dix-sept ans. Elle avait probablement établie sa stratégie de reine du bal sur cette hypothèse, sachant certainement que j’étais divorcé, une information écrite noir sur blanc dans mon formulaire de réponse à l’invitation. Parce qu’elle régnait sur sa mare, Myriam se croyait toujours au lycée, la fille irrésistible, le rêve des batraciens mal dégrossis et des frimeurs en quête de gloriole. Je devais être le prochain. Le reste de la soirée se passa sans surprise. Myriam quitta rapidement la table pour parader auprès des autres invités, Fabienne la suivit, son mari nous raconta ses anecdotes de pharmacien, Sophie joua aux questions et réponses pour tester ma relation avec Muriel, j’inventai une vie amoureuse digne d’un film américain des années soixante et Muriel testa tous les alcools forts. Lassée d’éprouver notre amour, Sophie se lança sur la piste de danse, bientôt suivie de son époux et de celui de Fabienne. Nous étions enfin seuls, Muriel et moi, amants officiels dans une soirée d’anciens. Il était temps de revenir à la réalité. — J’espère que tu ne m’en veux pas de ce mensonge, Muriel, commençai-je. — C’était un beau mensonge, répondit-elle. Moi-même, j’y ai cru. Il ne manquait plus que le baiser. — Je n’ai pas voulu forcer la dose, sinon Myriam n’aurait pas avalé la couleuvre. — Question manipulation, tu as l’air de t’y connaître. — Je dirais plutôt que j’habille bien le réel d’habits de lumière. C’est mon métier. — Tu étais déjà comme ça au lycée. — Je sais. — C’est ce que j’aimais en toi. — Je ne savais pas. — Tu ne me regardais pas. — Je ne regardais personne au lycée. Ma vie était ailleurs. Myriam et sa clique ne m’intéressaient pas plus que les autres. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici ce soir. — Moi non plus. — Au moins, on s’est bien marré. Myriam a perdu sa couronne. Sophie va désormais régner sur leur royaume de nains. — Maigre consolation. La conversation prenait un mauvais tour. Muriel avait forcé sur les spiritueux et annonçait une mer agitée. Je devais retrouver mon cap, fixer mon phare et tenir ma route. Je me levai. — Je vais te chercher un café fort, Muriel. Tu es bourrée. — Il ne fallait pas me faire rêver, Donald. Je ne veux pas me réveiller. — Alors endors-toi gentiment, Muriel, je vais au bar prendre du soda puis reviens te bercer. — Tu me chanteras une chanson ? — Oui. — Je t’attends. Ne te perds pas en route, conclut Muriel en vacillant des yeux. Je me dirigeai vers le bar, pas très fier de mon stratagème. Annette essuyait quelques verres et fournissait les rares accoudés en cacahouètes et bretzels. — Le joli cœur est de retour, ironisa-t-elle. — Que vous dit votre boule de cristal, Annette ? — Qu’il est l’heure de vous évader. — Voulez-vous me sauver, Annette ? — Je crains bien que ce soit mon destin, du moins ce soir, Donald. — Ne traînons pas, Annette, sinon mes souvenirs vont nous rattraper. — A ce point ? — Je vous raconterai. — En Technicolor et Dolby Stéréo, j’espère. — En Donaldocolor, une nouvelle technique multidimensionnelle. — On est parti !
Posté le : 23/01/2016 19:05
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
77 Personne(s) en ligne ( 41 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 77
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages