|
|
Théo Van Gogh |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57813
|
Le 25 janvier 1891 à Utrecht meurt Théodorus van Gogh
dit Théo van Gogh, né le 1er mai 1857 à Groot Zundert, marchand d'art néerlandais, frère cadet du peintre Vincent van Gogh. Les 652 lettres que Vincent écrivit à son frère Théo constituent un témoignage unique de la vie et de la pensée de l'artiste.
Sa vie
Alors que Vincent travaille à La Haye, aux Pays-Bas, au bureau des vendeurs d'arts parisiens Goupil & Cie, le 1er janvier 1873, Théo se joint au bureau bruxellois de cette même société en tant que jeune employé. Après la mutation de Vincent à Londres, Théo retourne à la Haye, où il perfectionne son métier de marchand d'art. Au cours de l'hiver 1880-1881, Théo est transféré à Paris, à la maison mère, et de là, il envoie tout un nécessaire à peinture à son frère afin que celui-ci puisse continuer à exercer son art.
Montmartre
En 1886, il invite Vincent à venir vivre avec lui, et en mars de cette année, ils louent un appartement à Montmartre, au no 54 de la rue Lepic. Théo fait rencontrer à Vincent d'autres artistes célèbres tels que : Paul Gauguin, Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Rousseau, Camille Pissarro et Georges Seurat.
En 1888, il persuade Gauguin de rejoindre Vincent qui a déménagé à Arles.
Le sculpteur Antoine Bourdelle travaille pour Théo vers 1886 après avoir quitté l'École des beaux-arts.
Mariage
À Paris, Théo rencontre le collectionneur Andries Bonger et sa sœur Johanna, avec qui il se marie à Amsterdam le 17 avril 1889. Le jeune ménage vit à Paris, où leur fils Vincent Willem naît le 31 janvier 1890. Le 8 juin, la famille rend visite à Vincent qui habite près de la capitale, à Auvers-sur-Oise. La compagnie Goupil commence à avoir des difficultés financières et Théo considère qu'il est temps de fonder sa propre activité, et il y est encouragé par Vincent.
Rapports entre les frères
Théo ressentit une admiration inaltérable envers son frère pendant toute sa vie, mais leurs rapports étaient parfois difficiles à cause de la différence de leurs points de vue concernant leur façon de vivre. Cependant c'est Théo qui gardait le contact avec son frère en lui écrivant régulièrement et en l'aidant matériellement, faisant croire au début que c'est leur père qui envoyait cet argent. Vincent de son côté, qui avait envisagé une carrière littéraire avant de se décider tardivement — à l'âge de vingt-sept ans — de se consacrer à la peinture, lui répondait en évoquant tous ses états d'âme et l'évolution de sa sensibilité artistique, ainsi que sa production elle-même qui était toujours le reflet de ses réflexions poétiques et empreintes de symbolisme. Il dessinait aussi souvent des croquis pour expliquer sa vie et ses tableaux, ce qui ne manquait pas de ravir son frère. Théo était l'une des rares personnes à comprendre le tréfonds de l'âme de son frère et à suivre aussi l'évolution de sa maladie psychique. La plupart des lettres de Théo à son frère sont un témoignage aimant d'encouragement.
Mort
Atteint de syphilis, il devient fou et meurt de dementia paralytica dans une maison de santé d'Utrecht, le 25 janvier 18914, six mois après le suicide de Vincent. Théo a alors 34 ans et est de quatre ans son cadet. D'abord enterré au cimetière d'Utrecht, c'est en 1914 que Johanna fera transférer la dépouille de son mari, réunissant les deux frères l'un à côté de l'autre au cimetière d'Auvers-sur-Oise.
Littérature
Judith Perrignon, C'était mon frère... Théo et Vincent van Gogh, L'Iconoclaste, 2006, 161 p.
S'appuyant sur de nombreuses archives dont certaines inédites, Judith Perignon y construit, dans un style intime et délicat, un récit poignant : Vincent raconté par son frère Theo. La source majeure est la considérable correspondance entre les deux frères, mais aussi le journal intime de Johanna, la femme de Théo, et des documents glanés à la clinique du Dr Blanche ou à Utrecht.
Theo van Gogh, son arrière-petit-fils, réalisateur à controverse, assassiné en 2004.
Vincent van Gogh
Film La Vie passionnée de Vincent van Gogh 1956
Film Vincent et Théo 1990
Film Van Gogh 1991
Film Moi, Van Gogh 2009
Bande dessinée Vincent et Van Gogh de Gradimir Smudja    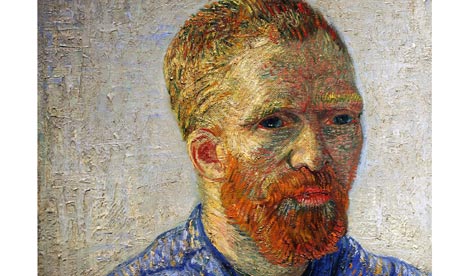         
Posté le : 24/01/2015 18:27
|
|
|
|
|
Re: L'atelier de Mafalda |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
02/02/2013 11:24
Niveau : 25; EXP : 95
HP : 0 / 623
MP : 278 / 20851
|
Et un autre
Attacher un fichier:
 IMG_1146.JPG (19.24 KB) IMG_1146.JPG (19.24 KB)
Posté le : 14/01/2015 02:13
|
|
|
|
|
Re: L'atelier de Mafalda |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
02/02/2013 11:24
Niveau : 25; EXP : 95
HP : 0 / 623
MP : 278 / 20851
|
Un petit portrait vite fait
Attacher un fichier:
 IMG_1147.JPG (288.86 KB) IMG_1147.JPG (288.86 KB)
Posté le : 14/01/2015 02:11
|
|
|
|
|
Re: L'atelier de Mafalda |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
02/02/2013 11:24
Niveau : 25; EXP : 95
HP : 0 / 623
MP : 278 / 20851
|
Voici fenêtre sur tours
Attacher un fichier:
 IMG_1142.JPG (340.31 KB) IMG_1142.JPG (340.31 KB)
Posté le : 14/01/2015 02:09
|
|
|
|
|
Alberto Giacometti |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57813
|
Le 11 janvier 1966, à 64 ans meurt Alberto Giacometti
à Coire, né à Borgonovo dans le Val Bregaglia le 10 octobre 1901, sculpteur et un peintre suisse surréaliste formé à l'académie de la grande chaumière, son oeuvre la plus réputée est "l'homme qui marche"en 1960.
En Bref
Élève d'Antoine Bourdelle 1922-1925, il évolue, sous l'influence des arts primitifs et du cubisme, vers des formes simplifiées ; il développe une thématique obsessionnelle Femme-cuillère, bronze, 1926, Kunsthaus de Zurich qui s'épanouit, vers 1930-1935, dans les œuvres à la fois simples et ambiguës de sa période surréaliste le Palais à quatre heures de l'après-midi, 1932, musée d'Art moderne de New York ; l'Objet invisible 1934-1935. Mais, à travers de multiples recherches, il revient à la figure humaine figure debout immobile, figure en marche, buste, d'abord dans des sculptures, puis dans des dessins et des peintures. Ses sculptures, d'une facture tourmentée Femme debout, 1948, Kunsthaus de Zurich ; Homme qui marche I et II, 1959-1960, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, et ses toiles aux couleurs neutres et grises, structurées par des entrelacements linéaires Diego, 1951, Kunsthaus de Zurich, ont en commun un allongement et un déchargement caractéristiques, et répondent à une volonté de situer les figures dans l'espace vide plutôt que de les décrire. Avec l'aspect d'inachèvement, ce dépouillement participe à l'expression hagarde et angoissée qui domine sa production jusque dans les œuvres plus étoffées et plus réalistes d'après 1957 (Caroline, 1962, Bâle.
Il fréquenta l'École des arts et métiers de Genève. Après un séjour d'une année en Italie 1920-21, où Cimabue, Giotto et Tintoret le frappent , il gagne Paris 1922 et étudie chez Archipenko et Bourdelle. Dès 1925, il partage son atelier avec son frère Diego, qui, surtout après 1935, lui servira de modèle. Il passe la Seconde Guerre mondiale à Genève et, en 1949, épouse Annette Arm. Après une première période, où sa peinture se rattache au Néo-Impressionnisme, il se rallie quelque temps 1925-1928 au Cubisme, puis, en 1930, au Surréalisme, Femme, 1926, Zurich, Kunsthaus. Mais la puissance et l'originalité de son tempérament lui rendirent l'orthodoxie surréaliste rapidement intolérable. Aussi, dès 1935, s'ouvre une période de huit années de recherches centrées principalement sur la représentation de la figure humaine, presque exclusivement en sculpture. Dès 1945, Giacometti revient de façon constante aux expressions picturale et graphique : dessins, lithographies et eaux-fortes, illustrations d'André Breton (l'Air de l'eau), de Georges Bataille, Histoire de rats, de René Char (Poèmes des deux années), d'Eluard, de Genet et enfin une importante série de peintures comprenant de très nombreux portraits d'Annette et de Diego. Monochromes — gris sur gris — dominés par les éléments linéaires qui articulent l'espace, ses dessins et ses peintures prolongent et aident à définir son œuvre de sculpteur. Comme lorsqu'il crée dans trois dimensions, Giacometti organise et construit le dialogue dépouillé de la figure et de l'espace dans une relation qui tend à l'absolue vérité et à l'unicité du sujet (la Mère de l'artiste, 1950, New York, M.O.M.A. ; Diego, 1951, Zurich, Kunsthaus). Son œuvre se manifeste comme une totalité qui met en cause le sens même de notre existence : ces innombrables personnages, têtes, bustes, qui nous percent de leur regard intense au point que l'on craint de les approcher, surgissent dans leur immédiateté comme un cri désespéré, comme l'expression la plus humaine d'un monde qui se disloque, entraînant avec lui une humanité décharnée, déjà pourrissante. L'artiste est représenté à New York M.O.M.A., Pittsburgh (Carnegie Inst.), Paris (M.N.A.M., Portrait d'Isaku Yanaïhara, 1956 ; Caroline, 1965), Detroit (Inst. of Arts), Saint-Paul-de-Vence, fondation Maeght, Zurich (fondation Giacometti) et dans des coll. part. L'Orangerie des Tuileries à Paris lui a consacré une rétrospective en 1969-70. En 1986, une exposition portant exclusivement sur la période de son " retour à la figuration " 1933-1947 fut présentée au Musée Rath de Genève et au M.N.A.M., Paris. Une importante rétrospective a été consacrée à l'artiste M.A.M. de la Ville de Paris en 1991-92.
Sa vie
Alberto Giacometti naît en 1901 dans le canton des Grisons, l'ainé de quatre enfants. Son père, Giovanni Giacometti, lui-même peintre, le pousse à s'intéresser à l'art. Il peint ses premières œuvres dans le domicile familial, essentiellement des portraits des membres de sa famille ou de ses condisciples, reprenant le style postimpressionniste paternel. Au terme de ses écoles obligatoires, Alberto part étudier à l'École des beaux-arts de Genève avant d’arriver à Paris en janvier 1922. Il fréquente l'atelier d’Antoine Bourdelle à l’Académie de la Grande Chaumière à Montparnasse. Il découvre le cubisme, l’art africain et la statuaire grecque et s'en inspire dans ses premières œuvres1. Ses sculptures sont en plâtre, parfois peintes secondairement, ou coulées en bronze, technique qu'il pratiquera jusqu'à la fin de sa vie. Il étudia aussi au collège de Leonard de Vinci où il s'ennuya énormément.
Il emménage en décembre 1926 au 46 rue Hippolyte-Maindron 14e arrondissement dans la caverne-atelier qu'il ne quittera plus, malgré sa petite taille et son inconfort. Son frère Diego le rejoint de façon permanente en 1930. Bien que l'essentiel de sa production soit fait à Paris, Giacometti retourne régulièrement en Suisse où il travaille dans les ateliers de son père, à Stampa et Maloja. En 1927, Giacometti expose ses premières œuvres au Salon des Tuileries (Femme cuillère, 1927).
Peu de destins plus singuliers, dans l'histoire de l'art contemporain, que celui du sculpteur suisse Alberto Giacometti. Célèbre dans les années trente, fêté par les surréalistes, présent au sommaire de toutes les revues d'avant-garde, il semble s'effacer de la scène artistique à partir de la Seconde Guerre mondiale, car il apparaît comme à contre-courant des grands mouvements de l'esthétique du temps. C'est seulement vers 1960 que s'achève sa longue traversée du désert : rétrospectives, hommages, prix et grand prix celui de la Biennale de Venise en 1962 se succèdent, consacrant soudain une démarche sans précédent et restée sans héritier.
En 1969, l'exposition du musée de l'Orangerie à Paris, en rassemblant plus de trois cents numéros couvrant l'œuvre sculpté, l'œuvre peint et l'œuvre graphique, offrait les aspects successifs d'une recherche jusque-là restée presque secrète et la complexité d'une figure déjà devenue légendaire trois ans seulement après sa disparition. Dès 1950, cependant, des philosophes comme Sartre et Merleau-Ponty, des écrivains comme Jean Genet, Georges Bataille, Michel Leiris, des poètes comme Francis Ponge, René Char, Yves Bonnefoy, André Du Bouchet témoignaient de l'importance unique de cette œuvre en laquelle ils reconnaissaient une communauté de préoccupations avec leur propre démarche. C'est en effet par rapport aux courants existentialistes et phénoménologiques de l'après-guerre que l'œuvre de Giacometti prend toute sa signification. Elle est, dans les arts plastiques, le parallèle exemplaire de ces philosophies de l'humanisme athée qui devaient tirer les conséquences extrêmes de la « mort de Dieu ». L'érotisme et l'angoisse, le désir et l'absurde, l'être et l'étant, l'être-pour-la-mort enfin : d'Éros à Thanatos, l'œuvre de Giacometti a décrit les divers points d'une spirale rigoureuse dont on ne fait peut-être que commencer de saisir les lois de construction interne et la solidaire grandeur.
La tentation cubiste
Il est difficile de parler de Giacometti sans évoquer sa terre natale, le petit hameau de Stampa, dans la haute vallée des Grisons, au cœur de ce paysage métaphysique que venait d'illustrer la présence ou le passage d'un Nietzsche, d'un Rilke ou d'un Segantini, dominé par la crête aiguë et dépouillée des monts qui sont, écrit André du Bouchet, comme le surplomb aveuglant que toute figure de Giacometti suppose ; sans évoquer encore la caverne où, enfant, il passait des heures entières, et que le minuscule atelier du 46 de la rue Hippolyte-Maindron semblera plus tard reconstituer. Il est l'aîné des enfants d'Annetta et de Giovanni Giacometti 1868-1933, peintre post-impressionniste de renom. Deux artistes encore dans sa famille : son cousin, Augusto Giacometti 1877-1947, en qui l'on voit parfois un précurseur du tachisme, et son propre frère, Diego, sculpteur lui-même et ornemaniste, qui l'assistera fidèlement toute sa vie, fondant les plâtres au fur et à mesure de leur production, les sauvant souvent d'une ruine certaine, abandonnés qu'ils étaient aussitôt conçus, sans jamais qu'Alberto songeât à les considérer autrement que comme les approches imparfaites d'un projet toujours poursuivi et dont seule l'œuvre en cours concrétisait l'espoir.
La première œuvre qu'on connaisse de lui est un petit buste de son frère Diego, qu'il exécute à treize ans, d'une autorité étonnamment précoce, fruit d'une sorte de grâce innocente qui obtiendrait tout sans avoir eu à chercher. Dès 1921, cependant, apparaissent des déformations singulières qui traduisent les premières impossibilités à réaliser exactement la sensation d'un volume dans l'espace : les apparences semblent se dérober à mesure, se contredire les unes les autres et finalement se détruire ; du détail d'une figure à son ensemble, du frontal au profil, se creusent des espaces immenses comme la Voie lactée ou comme le Sahara qu'aucune continuité créatrice ne paraît pouvoir combler. Les visages tendent à se réduire à des plaques sans épaisseur niant la réalité sensible de l'espace, sur lesquelles les traits sont simplement incisés. Devant cette sorte d'impuissance à traduire l'infinie variété – et la variabilité – du visible, Giacometti choisit de n'en retenir que la solidité et la permanence : s'éloignant du rendu d'après nature, il va, selon le mot de Cézanne, briser le compotier pour aller droit à des formes pures dont une loi de construction interne peut garantir la vérité more geometrico. En 1922, il se rend à Paris, entre dans l'atelier de Bourdelle et, bientôt, sous l'influence de Laurens et de Lipchitz, se soumet à la discipline cubiste. Les formes sont d'abord compactes, massives, frontales, comme le Torse ou la Femme-Cuillère, inspirée de la statuaire africaine. À partir de 1928, elles se font plus légères et plus claires : plaques et tablettes délicatement gravées ou déprimées. À l'opposé, Giacometti cherche alors à rendre la sensation d'un squelette dans l'espace : l'œuvre, comme dans L'Homme ou dans la Femme couchée, s'évide, devient construction transparente, structure à travers laquelle l'air circule, cage, enfin, emprisonnant un espace imaginaire. Le symbolisme sexuel se fait aussi plus insistant.
La tentation surréaliste Giacometti et les surréalistes
Cette intrusion de l'imaginaire au sein du conceptualisme cubiste et la rencontre avec Aragon et Breton orientent Giacometti, à partir de 1930, vers les eaux surréalistes. Pendant cinq ans, il se fait l'animateur d'un étonnant « théâtre de la cruauté », réalisant de purs et parfaits objets à fonctionnement symbolique, qui seront tantôt des mécanismes à la fois absurdes et précis, basés sur la représentation de mouvements virtuels, imminents ou répétitifs, comme la Fleur en danger ou Circuit, tantôt des constructions qu'il nomme affectives, évocatrices de catastrophes intimes, tel Le Palais de quatre heures. La coloration de l'œuvre est alors souvent l'expression d'un érotisme violent, voire sadique, comme dans la Pointe à l'œil ou la Femme égorgée : projection d'un désir toujours impuissant à rencontrer son objet et à se satisfaire et qui, indéfiniment désirant, semble se retourner contre lui-même pour se déchirer. L'Objet invisible de 1934-1935, en quoi Breton, dans L'Amour fou, reconnaissait « le désir d'aimer et d'être aimé ... en quête de son véritable objet et dans sa douloureuse ignorance », est cette figure hallucinée, au mouvement entravé, dont les mains à demi tendues se referment sur un objet toujours recherché et toujours absent, pour se l'approprier en un geste dérisoire et pathétique.
Cette sorte d'échec de la théâtralité surréaliste, dans sa répétition vaine du désir érotique, Giacometti s'en détourne, en 1935, comme d'une imposture, tout comme, auparavant, il s'était détourné du cubisme qui lui avait paru une « entreprise complètement absurde ». Tournant définitivement le dos à ces esthétiques autoritaires et volontiers terroristes, il s'engage dans une Vita Nuova dont le retour au réel serait le propos et atteindre à la « ressemblance », le terme.
Après avoir créé des sculptures plates Femme, 1929 et ouvertes Homme et Femme, 1929, Giacometti se rapproche des surréalistes et expose à partir de 1930 aux côtés de Joan Miró et Jean Arp à la galerie Pierre, avec laquelle il passe un contrat en 1929. Il rencontre Tristan Tzara, René Crevel, Louis Aragon, André Breton, Salvador Dalí, André Masson. Il adhère officiellement au groupe surréaliste parisien en 1931. Il y crée diverses œuvres ainsi que des gravures et des dessins servant d'illustration pour des livres de René Crevel, Tristan Tzara et André Breton. Il participe à la rédaction des revues du groupe.
Avec La Boule suspendue, Giacometti crée le premier objet à fonctionnement symbolique 1930 et une série de sculptures surréalistes qui enchantent Breton : L’Objet invisible 1934, Le Palais à 4 heures du matin, à propos duquel il publie un texte capital. Depuis des années, je n'ai réalisé que des sculptures qui se sont offertes tout achevées à mon esprit ; je me suis borné à les reproduire dans l'espace sans y rien changer, sans me demander ce qu'elles pouvaient signifier. … Rien ne m’est jamais apparu sous la forme de tableau, je vois rarement sous la forme de dessin. Les tentatives auxquelles je me suis livré quelquefois, de réalisation consciente d'une table ou même d'une sculpture ont toujours échoué. … L’objet une fois construit, j’ai tendance à y retrouver transformés et déplacés des images, des impressions, des faits qui m’ont profondément ému souvent à mon insu, des formes que je sens m’être très proches, bien que je sois souvent incapable de les identifier, ce qui me les rend toujours plus troublantes… Minotaure, 1933
L'inquiétude, l'onirisme, l'incertitude, la violence sont les caractéristiques des sculptures de cette époque : Cube, Femme qui marche, Femme couchée qui rêve, Femme égorgée, Cage, Fleur en danger, Objet désagréable à jeter, Table, Tête crâne. La plupart de ses œuvres de jeunesse ou surréalistes sont connues par l'édition en bronze commencée dans les dix dernières années de la vie de l'artiste.
Exclu du groupe surréaliste en 1935, Giacometti garde toutefois des relations amicales avec Michel Leiris et Georges Limbour, et ses sculptures ne cesseront d'être présentées dans les diverses expositions surréalistes.
Le retour au réel
Pendant cinq ans, jusqu'en 1940, Giacometti travaille sur modèle et, de nouveau, sent la réalité lui échapper : Une tête devenait pour moi un objet totalement inconnu et sans dimensions. Il cherche alors à utiliser les ressources de la mémoire comme si la distance temporelle pouvait devenir le substitut bénéfique de cette distance spatiale qu'il ressent comme un écueil. Les sculptures deviennent de plus en plus petites, guère plus hautes de un ou deux centimètres et, parfois, d'un dernier coup d'ébauchoir, finissent en poussière. La légende veut que toute sa production, durant les années de guerre, ait pu tenir dans quelques boîtes d'allumettes. En 1945, la pratique du dessin lui permet de donner à ses figures une taille à peu près normale, mais elles deviennent alors de plus en plus hautes et minces, jusqu'à cet aspect caractéristique qu'on leur connaît. Trois thèmes reviennent sans cesse, traités en général par séries : celui du buste, celui de la figure debout, immobile et frontale, celui enfin de la figure en marche. À partir de 1948 des groupements s'organisent soit autour du thème du mouvement, Trois Hommes qui marchent, La Place, soit autour du thème de l'immobilité, des bustes et des figures en pied, sans souci des rapports d'échelle : La Cage, La Clairière, La Forêt. De tels groupements peuvent apparaître comme la réalisation dans le bronze des rapprochements spontanés qui s'opéraient dans l'atelier de Giacometti, où les œuvres voisinaient au sol sans souci d'ordre, comme les approches successives et toujours inadéquates d'une même réalité, comme les fragments d'un tout à jamais insaisissable, comme les divers témoins, enfin, d'une même et infinie recherche : celle de la ressemblance.
La ressemblance
"Ce qui m'intéresse dans toutes les peintures, écrivait Giacometti, c'est la ressemblance, c'est-à-dire ce qui pour moi est la ressemblance : ce qui me fait découvrir un peu le monde extérieur". Ainsi envisagée, la ressemblance n'a plus rien à voir avec le souci naturaliste du rendu ; plutôt que de reproduire la réalité, il s'agit de réaliser la sensation qu'on en peut avoir, de rendre réelle la vision que l'on en a. Or, qu'est-ce que voir un objet ? Cette question qu'à la même époque se posait la phénoménologie, Giacometti semble l'inscrire dans son œuvre. La vision courante est une vision perpétuellement « redressée » par la raison, par l'intellect, par l'habitude. Que serait une vision nue, délivrée de ces « redressements » ? Quelles sont les limites exactes d'une figure ? Où, exactement, se trouve l'objet que l'on considère ? Quelle est l'échelle de cet objet ? Par quel processus visuel éprouve-t-on qu'une chose est là ? Toute l'œuvre de Giacometti semble célébrer ce mystère de la visibilité des apparences et l'énigme de la présence du monde. De là ces figures élongées, aux limites imprécises, étirées comme un plasma vibrant au sein de l'espace. De là encore ces apparentes aberrations optiques, proches parfois de certaines anamorphoses maniéristes, où la minuscule figurine acquiert la qualité monumentale de la grande figure et la grande figure la minutie de la figurine, où la figure en marche acquiert le statisme de la figure immobile et la figure dressée la mouvance de la figure en marche, en une sorte de paradoxe zénonien sur le mouvement et l'immobilité, sur l'un et le multiple, où toutes les qualités du visible s'interpénétreraient et finiraient par s'abolir dans un espace indifférent qui, tout à la fois, les suscite et les engloutit. De là, enfin, ce besoin de redonner à ces figures perdues une échelle qui soit relative à l'œuvre elle-même, soit dans la sculpture au moyen d'une cage ou d'un socle par rapport auxquels la figure retrouve une taille, soit, dans les peintures, au moyen de caches dédoublant le cadre de la toile, dans lesquels la figure inscrit sa dimension vraie. La figure peut alors apparaître hiératique, impérieuse, et devenir, selon le mot de Sartre, cette apparition qui est aussi une disparition, une « apparition interrogative ».
L'art et la mort
Si proches et si saisissantes, les figures de Giacometti semblent aussi séparées de nous par une infranchissable distance. Immédiates, leur immédiateté est saisie comme dans une sorte d'éloignement définitif. Elles sont là depuis toujours et, en même temps, elles ont depuis toujours disparu : elles surgissent d'au-delà de notre propre mort. Les plus achevées recèlent en elles une qualité qui n'a appartenu qu'aux plus grands arts funéraires du passé, à la Chaldée, à l'Égypte, au Fayoum. Cette nécessité de la présence de la mort au sein de l'œuvre est une exigence qui apparaît très tôt, et que ne pouvaient satisfaire ni le cubisme, tourné vers une sorte d'éternité conceptualiste de la forme, ni l'imaginaire surréaliste, tourné vers la dynamique répétitive du désir. Dans un texte célèbre de 1946, Giacometti a expliqué comment la mort devait, pour lui, s'imposer dans sa réalité quotidienne et fascinante et, dès ce moment, comment il devait commencer de voir les apparences de la vie sous les aspects de la mort, c'est-à-dire le mouvement sous celui de l'immobilité, la diversité du vécu sous celui d'une fixité définitive, la multiplicité sous celui d'une impossible unité ; tout être lui apparaître enfin comme un être-pour-la-mort, « quelque chose de vif et mort simultanément ». Les dernières œuvres qu'il ait faites, entre 1960 et sa propre mort, à Coire, en 1966 – série des bustes d'Annette, sa femme, série des bustes d'Élie Lotar, le cinéaste – sont parmi les plus bouleversantes de l'art contemporain. Hallucinantes en leur présence, insaisissables en leur au-delà, elles posent inlassablement la question de savoir si, en une époque privée de transcendance, un art funéraire est encore possible et si l'art, à défaut d'une religion révélée, peut encore offrir un salut.
L'art de la maturité
À partir de 1935, Giacometti délaisse l'anecdote et les titres littéraires pour poursuivre une quête de la représentation de la réalité, produisant des séries de têtes pour lesquelles posent un modèle et son frère.
En décembre 1941, il quitte Paris pour Genève. Il travaille dans une chambre d'hôtel, poursuivant la production des sculptures minuscules commencée à Paris. L'impossibilité de réaliser une sculpture de grande taille le hante, et ce n'est qu'après avoir vaincu cet obstacle avec la Femme au chariot en 1944-45 qu'il décide de quitter la Suisse.
En septembre 1945, Giacometti revient à Paris, où il est rejoint en 1946 par Annette Arm, qu'il épouse en 1949. En octobre 1946, André Breton, de retour des États-Unis, déclare à la presse : Au terme de ses nouvelles recherches, j’ai vérifié avec enthousiasme qu’en sculpture Giacometti était parvenu à faire la synthèse de ses préoccupations antérieures, de laquelle m’a toujours paru dépendre la création du style de notre époque. Néanmoins Giacometti décline la proposition de Breton de le rejoindre et de participer activement à l'exposition que Breton prépare à la galerie Maeght, Le Surréalisme en 1947. Certaines de ses œuvres font néanmoins écho au surréalisme (Le Nez 1947-49, La Main 1947.
C'est pendant cette période 1946-1947 que s'affirme le nouveau style de Giacometti, caractérisé par des hautes figures filiformes. Sa production est stimulée par les relations qu'il renoue avec le marchand new-yorkais Pierre Matisse, qui accueille sa première exposition personnelle d'après-guerre en janvier 1948. Grâce à la reconduction des accords passés en 1936 avec le galeriste, Giacometti peut faire fondre en bronze en 1947 huit de ses nouvelles sculptures, dont L'Homme qui pointe et le premier Homme qui marche. Suivent en 1948 Les Trois hommes qui marchent et les Places. Mais c'est pour l'exposition qui ouvre en décembre 1950 dans la galerie de Pierre Matisse que Giacometti produit quelques-unes de ses plus fameuses sculptures, dont commence l'édition en bronze, parmi lesquelles : Quatre femmes sur socle, Quatre figurines sur piédestal, La Forêt, La Clairière, La Cage, Le Chariot, La Femme qui marche entre deux boîtes qui sont des maisons.
C'est seulement en juin 1951 qu'a lieu sa première exposition d'après-guerre à Paris, à la galerie Maeght, où son ami Louis Clayeux l'a convaincu d'entrer. Il y présente des œuvres déjà montrées chez Matisse, et plusieurs œuvres nouvelles, toutes en plâtre, dont Le Chat et Le Chien. Contrairement à la légende qui veut qu'Aimé Maeght ait permis à Giacometti de faire fondre ses œuvres en bronze, Giacometti peut faire fondre ce qu'il veut depuis 1947, grâce à Pierre Matisse.
En 1948, Jean-Paul Sartre avait signé la préface de sa première exposition à New York, La recherche de l'absolu. En 1951, ce sont Leiris et Ponge qui accompagnent l'exposition chez Maeght. En 1954, Sartre écrit un autre texte de référence sur l'artiste. La même année, Giacometti rencontre Jean Genet, dont il fait le portrait, et c'est pour la publication de la galerie Maeght, Derrière le miroir, que Genet écrit en 1957 un des plus brillants essais sur l'artiste, L'Atelier d'Alberto Giacometti.
À partir du milieu des années 1950, Giacometti réduit ses motifs à des têtes, à des bustes et à des figures. Représentant la France à la Biennale de Venise en 1956, Giacometti expose une série de figures féminines un peu moins grandes que nature, connues par la suite sous l'appellation de Femmes de Venise, même si certaines furent montrées pour la première fois à Berne la même année. À la fin de 1958, il obtient grâce à Pierre Matisse une commande pour une place à New York devant la Chase Manhattan Bank, projet qu'il abandonnera. Pour ce monument, il crée trois éléments : une grande femme, un homme qui marche, une grande tête, poursuivant ses recherches antérieures en grande taille. Ce monument ne sera installé finalement que dans la cour de la Fondation Maeght. Il comprend alors deux Hommes qui marchent, deux Grandes femmes et une tête monumentale.
À la fin de sa vie, Giacometti est comblé d'honneurs. Il remporte le prix Carnegie International en 1961, le grand prix de sculpture de la Biennale de Venise en 1962, le prix Guggenheim en 1964, et le Grand Prix international des Arts décerné par la France en 1965.
Opéré d'un cancer de l'estomac en février 1963, Giacometti en guérit. À cette époque, il participe activement au projet de la Fondation Maeght, en faisant cadeau pour le prix de la fonte d'un nombre important de bronzes Il y a un certain intérêt à ce que ces sculptures existent groupées ensemble, écrit-il à Pierre Matisse. Dans ses dernières années, il suit attentivement le projet de Fondation à son nom qui est créée en Suisse pour recueillir la collection de G. David Thompson, un industriel de Pittsburgh qui avait le projet d'ouvrir un musée aux États-Unis.
Alberto Giacometti meurt à l’hôpital cantonal de Coire, en Suisse, le 11 janvier 1966. Son corps est transféré à Borgonovo, et inhumé près de la tombe de ses parents.
Sa veuve se consacre à la défense de son œuvre et crée par testament une Fondation Alberto et Annette Giacometti, reconnue d'utilité publique en 2003, dont le siège se situe à Paris. Elle comprend un grand nombre de tableaux et de sculptures de l'artiste, ainsi qu'un centre de recherche et de documentation.[réf. nécessaire]2.
Peintures et dessins
Il s'agit d'un pan important de l'œuvre de l'artiste. Il est connu essentiellement pour ses portraits, même s'il a fait quelques paysages ou natures mortes dans sa jeunesse. Il a également peint des tableaux abstraits dans les années 1920 et 1930.
Ses portraits sont faits soit d'après modèles, soit de mémoire. Le nombre de ses modèles est relativement limité. Les plus connus sont son frère Diego et sa femme Annette. Il a également utilisé des modèles professionnels ainsi que certains de ses amis dont le professeur de philosophie Yanaihara à partir de 1955.
Les portraits de Giacometti se caractérisent par l'absence de décor, le caractère quasi monochrome et sombre de la palette, l'attitude figée du modèle, toujours de face, qui contraste avec l'abondance des retouches au niveau du visage, jusqu'à en effacer l'esquisse initiale.
Principales œuvres, Sculptures
Torse, 1926
Femme cuillère, 1927
Le Couple, 1927
Composition cubiste. Homme, 1927, bronze3
Tête qui contemple, 1927
Femme couchée qui rêve, 1929
Homme et femme », 1929
La Boule suspendue, 1930-1931
Projet pour un couloir, 1932
Cage, 1933
Objet désagréable à jeter, 1931
Pointe à l’œil, 1932
On ne joue plus, 1932
Femme égorgée, 1932
Main prise, 1932
Table surréaliste, 1933
Le Palais à quatre heures du matin, 1932
Fleur en danger, 1933
L’Objet invisible ou Mains tenant le vide, 1934
La Femme qui marche, 1932
Nuit, 1946
Femme assise, 1946
L’Homme au doigt, 1947
Le Nez, 1947 et 1949
Tête sur tige, 1947
Homme qui marche, 1947
Femme au chignon,1948
Grande figure, 1949
La Place, 1949
Le Chariot, 1950
Le Chien, 1951
Le Chat, 1951
Tête de Diego sur socle, 1953
Femme debout, 1953, bronze à patine brune signé et numéroté4.
Le Petit Lustre avec figurine, années 1950, adjugée pour 1,86 M€ aux enchères en octobre 2007 chez Artcurial Paris. Œuvre réalisée pour le critique et éditeur Tériade de la revue surréaliste Le Minotaure.
Bust of Diego, 1954
Femmes de Venise, 1956
Buste de femme aux bras croisés Francine Torrent, Madame Télé (Mrs. T.V.), 1960' 5.
Grande femme IV, 1960
Grandes figures II et III, 1960
L'Homme qui marche I, 1960 ; Palais de l'UNESCO, Paris
Arbre, sculpture pour le décor d’En attendant Godot de Samuel Beckett, 1961
Peintures
Auto-portrait, 1921
Le Couple, 1926
La Mère de l’artiste, 1937
Pomme sur un buffet, 1937
Stehende Figur, 1947
La rue, 1952
Paysage à Stampa, 1952
Diego in a Plaid Shirt, 1954
Rue d'Alésia, 1954
Annette dans le studio, 1954
Yanaihara, 1958
Annette, 1962
Jean Genet
Michel Leiris
Dessins
Paris sans fin, recueil de 150 dessins de Paris, dernière œuvre restée inachevée, publié à 200 exemplaires par Tériade en 19696.
Écrits
Olivier Larronde Rien voila l'ordre, illustré de 31 dessins de Alberto Giacometti, chez l'Arbalète / Barbezat, 1959
Écrits, préfaces de Michel Leiris et Jacques Dupin, éd. Hermann, 1991 ; édition revue et augmentée, 2007
Écrits, nouvelle édition revue et augmentée sous la direction de la Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris, Hermann Éditeurs des sciences et des arts, 2009
Postérité, Principales expositions
Rétrospective à Londres, New-York et Copenhague en 1965
Première rétrospective française au Musée de l'Orangerie à Paris en 1969
Alberto Giacometti 1901 -1966, peintures, sculptures, dessins et estampes au Gemeente museum à La Haye, Hollande en 1986.
Rétrospective au musée d’Art moderne de Paris en 1991
L'Atelier d'Alberto Giacometti, exposition au Centre Pompidou à Paris, du 17 octobre 2007 au 11 février 2008
Fondation Maeght à Saint Paul de Vence, du 27 juin au 31 octobre 2010
Giacometti et les Étrusques, Pinacothèque de Paris, du 16 septembre 2011 au 8 janvier 2012
Alberto Giacometti au Musée de Grenoble, du 9 mars au 9 juin 2013
Cote de l'artiste
Le 3 février 2010, L'Homme qui marche I est vendu pour 74,2 millions d'euros chez Sotheby's à Londres, trois fois plus cher que son estimation la plus élevée7. Deux petites sculptures, intitulées Projet pour un monument pour Gabriel Péri et Projet pour une place ont été vendues en 2007 à Cologne, chez Lempertz Kunsthaus, pour une valeur de 1 590 000 euros frais compris. L'estimation était de 1 300 000 euros8.
Hommages
Son portrait apparaît sur les billets de 100 francs suisses.
Bibliographie
Yves Bonnefoy, Alberto Giacometti : biographie d’une œuvre, Paris, Flammarion, 1991
Jean Clair, Le Nez de Giacometti, Paris, Gallimard, 1992
Jean Clair, Le résidu de la ressemblance. Un souvenir d’enfance d’Alberto Giacometti, Paris, l’Échoppe, 2000
Claude Delay, Giacometti, Alberto et Diego, l’histoire cachée, Paris, Fayard, 2007
Georges Didi-Huberman, Le cube et le visage, Paris, Éditions Macula, 1993, réédition 2007
André Du Bouchet, Alberto Giacometti. Dessins, Paris, Maeght éditeur, 1969, réédition 1991
Thierry Dufrêne, Giacometti, Genet : masques et portrait moderne, Paris, l’Insolite, 2006
Thierry Dufrêne, Alberto Giacometti. Les dimensions de la réalité, Genève, Éditions d’art Albert Skira, 1994
Thierry Dufrêne, Le Journal de Giacometti, Paris, Hazan, 2007
Jacques Dupin, Alberto Giacometti, Tour, Farrago, 1999.
Jean Genet, L’atelier d’Alberto Giacometti, Décines (Isère), L’Arbalète, 1958. Rééditions 1963 et 2007, Paris, Gallimard
Reinhold Hohl, Alberto Giacometti, Stuttgart, Gerd Hatje Verlag, 1971
Charles Juliet, Giacometti, POL, 1995
Michel Leiris, Pierre pour un Alberto Giacometti, dans Derrière le miroir, n° 39-40, juin-juillet 1951, réédition 1991 (Paris, L’Échoppe).
James Lord, Giacometti : biographie, New York, 1983 ; Nil éditions, 1997.
Suzanne Pagès (directrice de publication), Alberto Giacometti. Sculptures - peintures - dessins, catalogue de l’exposition du Musée d'art moderne de la ville de Paris, 1991-1992
Jean Soldini, Alberto Giacometti. Le colossal, la mère, le sacré, préface de René Schérer, Lausanne, Éditions L'Âge d'Homme, 1993
David Sylvester, Looking at Giacometti, éd. Henry Holt & Co., 1996
Giacometti, Paris sans fin, Les Cahiers dessinés, Buchet/Chastel, 2003 (ISBN 2-283-01994-X)
Véronique Wiesinger, Alberto Giacometti, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 2007
Véronique Wiesinger, L'Atelier d'Alberto Giacometti. Collection de la Fondation Alberto et Annette Giacometti, cat. exp., Paris, Centre Georges Pompidou, 2007
Casimiro Di Crescenzo, Thierry Dufrêne, Marco Franciolli, Donat Rütimann, Nadia Schneider, Alberto Giacometti : Rétrospective, coédition du Musée d'art et d'histoire de Genève et des Presses du réel, Dijon, , 2009
Franck Maubert, Le Dernier Modèle, Mille et une nuits, 2  [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Alberto-Giacometti,-etching-(author-Jan-Hlad%C3%ADk-2002).jpg/220px-Alberto-Giacometti,-etching-(author-Jan-Hlad%C3%ADk-2002).jpg[/img]        
Posté le : 11/01/2015 15:33
|
|
|
|
|
Tomaso Masaccio |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57813
|
Le 21 décembre 1401 naît Tommaso di Giovanni Cassai
ou Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, dit Masaccio, à San Giovanni Altura actuellement San Giovanni Valdarno, près de Arezzo, le 21 décembre 1401, et mort à Rome vers 1428, est un peintre italien, il a pour maîtres Bicci di Lorenzo du mouvement artistique Première Renaissance
En bref
Marquis de Belle-Isle, vicomte de Melun, vice-roi d'Amérique, procureur du roi au parlement de Paris et surintendant des Finances, Fouquet, mécène fastueux qui a construit Vaux, le premier Versailles du Grand Siècle, pensionné La Fontaine, découvert et fait travailler Molière, Lebrun, Le Nôtre, est le type accompli du grand seigneur en ce premier XVIIe siècle, le « siècle de Louis XIII », lequel s'est achevé en 1661 avec la carrière du surintendant. Pourtant Fouquet est issu de la grande bourgeoisie, de cette bourgeoisie anoblie par les charges et le service du roi ; ses armes parlantes : un foucquet (écureuil) avec cette devise : Quo non ascendo. Son ascension est en effet exceptionnelle. C'est Richelieu qui épaule ce jeune homme doué : conseiller au parlement de Metz à seize ans, maître des requêtes à vingt, il passe, à la mort du grand cardinal, au service de Mazarin. À trente-cinq ans, il achète la charge de procureur du roi au parlement de Paris. En 1653 enfin, la double protection d'Anne d'Autriche et de Mazarin lui vaut la charge de surintendant des Finances ordinaires et extraordinaires ; il est alors l'homme le plus puissant de France après le cardinal. Il est vrai que jusqu'en 1659 il a un collègue, Servien ; mais, après la mort de ce dernier, Fouquet ne doit plus de comptes qu'au roi ; et, si le roi mineur règne, c'est Mazarin qui gouverne.
[size=SIZE]Sa vie[/size]
Son père, Giovanni di Mone Cassai, est un artisan devenu notaire. Il meurt alors que Tommaso a 5 ans, en 1406, l'année où naît son jeune frère, Giovanni (qui deviendra peintre lui aussi..). Sa mère, Monna Jacopa di Martinozzo, se remarie à Tedesco del Maestro Feo, un marchand d'épices, veuf et bien plus âgé, qui garantit à la famille un niveau de vie confortable. Avec sa mère et son frère (qui vivront avec lui jusqu'à sa mort), il s'installe à Florence en 1417. Il entre dans l'atelier de Bicci di Lorenzo, où il se familiarise avec les œuvres de Donatello et Brunelleschi. Il doit son surnom, qui signifie « idiot », à sa distraction et à sa fantaisie. En 1419, il est déjà reconnu comme dipintore, c'est-à-dire peintre, à Florence. Le 7 janvier 1422, il est inscrit à l'Arte dei Medici e Speziali.
La fresque détruite
En 1422, Masaccio quitte l'atelier de Bicci di Lorenzo. Il assiste à la cérémonie de consécration de l'église Santa Maria del Carmine. Il est chargé de réaliser une fresque représentant la consécration, fresque qui sera détruite à la fin du xvie siècle, lors de travaux de restructuration du couvent de Santa Maria del Carmine1. Il n'en reste que des dessins préparatoires. Vasari affirme dans Les Vies que c'est avec la fresque de la Consécration que naît l'art du portrait chez Masaccio ; de même l'usage de la perspective pour l'Annonciation de San Niccolo oltr'Arno perdue que Vasari lui attribue en 1568.
L'association avec Masolino
En 1424 commence sa collaboration artistique avec Masolino da Panicale, de vingt ans son aîné.
Leur première œuvre commune est Sainte Anne, la Vierge à l'Enfant et cinq anges, conservé à la Galerie des Offices, à Florence. La Vierge, l'Enfant et deux anges sont attribués à Masaccio, Sainte-Anne et les autres anges à Masolino.
Mais c'est avec les fresques de la magnifique chapelle Brancacci, de l'église Santa Maria del Carmine, à Florence, que s'intensifie leur collaboration.
Ils peignent ensemble, en se partageant les scènes de la chapelle, à partir de 1424, et jusqu'en 1427 ou 1428. Ils laissent alors le travail inachevé. Filippino Lippi termine le cycle, en 1481 et 1482.
Masolino et Masaccio peignent ainsi chacun Adam et Ève : Masolino les représente au Paradis, et Masaccio chassés de l'Eden par la colère de Dieu.
Masaccio est remarquable par son réalisme. Nul autre avant lui n'a aussi bien représenté les expressions et les postures de ses personnages. Nul n'a été aussi loin dans la précision des décors, des paysages ou des rues florentines de son époque.
On lit sur le visage d'Eve et dans l'attitude d'Adam, chassés du Paradis, leur désespoir immense. En regard, la fresque de Masolino représentant le péché originel au Paradis fait preuve d'un manque évident de finesse psychologique.
Daniel Arasse fait remarquer le geste du Christ, redoublé par celui de saint Pierre, dans Le Tribut de saint Pierre. Le monde s'ouvre à l'action des hommes », note-t-il4. Finies les attitudes raides peintes par les contemporains et les prédécesseurs de Masaccio. Daniel Arasse souligne également comment, dans les peintures de Masaccio, les personnages ont les pieds solidement sur terre, contrairement aux figures gothiques, qui ont l'air de se tenir sur la pointe des pieds.
C'est vraisemblablement en 1674, sous le règne du bigot Cosme III de Médicis, que la nudité d'Adam et Ève a été habillée de feuilles. La restauration de 1980 a permis de revenir à l'état originel et non censuré.
Le Trône de grâce ou La Trinité, 1425
La Crucifixion en trinité verticale
Santa Maria Novella
Au cours de l'année 1426, pendant les périodes d'interruption de son travail dans la chapelle Brancacci, Masaccio réalise le Polyptyque de Pise. C'est la commande d'un notaire, contre un salaire de 80 florins. Aujourd'hui, le polyptyque est incomplet, et dispersé en onze morceaux, dans cinq musées sur deux continents voir liste des œuvres. Il présente toutes les caractéristiques de la grande maturité de l'artiste. La physionomie des personnages profondément recueillis, le trône de la Madone en perspective, les lignes de fuite de la Crucifixion, placée au-dessus du panneau central, dépassent les conventions gothiques et créent un espace réel.
Autre œuvre majeure, la fresque de La Trinité , dans l'église Santa Maria Novella. Derrière le Christ en croix, un spectaculaire plafond voûté à caissons. Vasari, dans la seconde édition des Vies, en 1568, détaille cet extraordinaire trompe-l'œil. « C'est une voûte en berceau, tracée en perspective, et divisée en caissons ornés de rosaces qui vont en diminuant, de sorte qu'on dirait que la voûte s'enfonce dans le mur. » Cette Trinité, considérée comme une étape dans l'histoire de l'art, représente la traduction en peinture des lois de la perspective découvertes par Brunelleschi. Certains critiques estiment que Brunelleschi lui-même a tiré les traits de perspective. D'autres soutiennent que Masaccio a interprété les innovations de Brunelleschi.
Le peintre
Auteur d'un petit nombre d'œuvres, Masaccio représente dans la peinture ce bref moment de l'histoire de Florence au cours duquel, après la terrible crise de 1348 et la lente reprise de la seconde moitié du siècle, la ville est en train de devenir la capitale d'un État régional. Avec la conquête de Pise (1406), Florence réalise une aspiration séculaire et peut se donner l'illusion, pour la dernière fois, qu'elle constitue de nouveau, comme à la fin du XIIIe siècle, le centre de décision de l'histoire. C'est alors qu'on assista à une surprenante reprise de cette confiance en la raison qui avait déjà été au fondement de la révolution de Giotto. La mort prématurée du jeune artiste fit coïncider presque exactement son destin avec ce moment particulier de l'histoire florentine. Elle lui permit de ne pas connaître les désillusions et les crises que les temps nouveaux et moins heureux réserveront, par exemple, à son protecteur et maître, Donatello.
Florence, l'humanisme et les « hommes nouveaux »
Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, dit Masaccio, est né à Castel San Giovanni in Altura (aujourd'hui San Giovanni Valdarno, près de Florence). Il est mort à Rome à une date qui est certainement antérieure de peu à novembre 1429. Il est le célèbre auteur d'une partie des fresques de la chapelle du cardinal Brancacci dans l'église de Santa Maria del Carmine à Florence, qui sont considérées comme une des œuvres essentielles de l'histoire du naturalisme moderne en peinture (ces fresques ont été l'objet d'une remarquable restauration en 1990). Il est le seul peintre que cite Leon Battista Alberti, dans la dédicace de son Traité de la peinture (1436), parmi les grands novateurs de la Renaissance, avec l'architecte Filippo Brunelleschi et les trois sculpteurs Donatello, Lorenzo Ghiberti et Luca Della Robbia, artistes dont le génie est tel qu'on ne peut « les faire passer après aucun artiste aussi ancien et fameux qu'il soit dans ces différents arts ».
Des initiateurs de la Renaissance, on peut parler, en effet – et c'est peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'art –, comme d'un groupe homogène qui forme un mouvement dont les membres sont unis par des liens très différents de ceux qui régnaient dans l'atelier artisanal. En outre, ce groupe élabore et adopte une nouvelle idéologie qui lui permet de justifier et de défendre sa propre diversité.
On peut même reconnaître dans le caractère « intellectuel » du groupe un signe indirect, mais clair, du désir de ces novateurs de marquer la distance qui les sépare des anciennes pratiques, ainsi que d'affirmer le nouveau statut, plus indépendant, de l'artiste dans la société. La preuve en est dans l'intérêt de Brunelleschi pour les expériences scientifiques, dans celui de Donatello pour la « philosophie », et dans le style de vie « distrait » et « fantaisiste » qui a valu à Maso di Ser Giovanni le surnom péjoratif de Masaccio.
À cause de la citation d'Alberti on a considéré les novateurs du groupe de Brunelleschi comme équivalents, dans les arts figuratifs, aux humanistes. Mais cela est loin d'être démontré. Les recherches de Tanturli semblent plutôt indiquer les liens de Brunelleschi avec la tradition littéraire « volgare » et une sympathie des milieux humanistes (à partir de Leonardo Bruni) pour son rival « gothique tardif » Lorenzo Ghiberti. D'ailleurs à cette époque, l' humanisme ne joue pas encore le rôle de déguisement idéologique et rhétorique qui a pour fonction de cacher la décadence effective de la cité italienne dans le domaine économique et politique. La découverte de l'antique s'est faite à Florence avec un esprit d'initiative proprement capitaliste et avec un réalisme tout à fait bourgeois. L'art des Romains aide à retrouver le vrai et à rompre avec les habitudes stylistiques de l'art gothique. Le style « héroïque », truffé de citations classiques, va de pair, en un certain sens, avec l'adoption du latin par les humanistes. Vers le milieu du siècle, dans les fresques des Hommes illustres peintes par Andrea del Castagno, ce style aura déjà des résonances fausses et ostentatoires. Mais, chez Brunelleschi, chez le jeune Donatello, chez Masaccio, ce style est encore parfaitement sincère parce que réaliste ; il convient, en effet, à l'opinion que la classe dirigeante de Florence pouvait encore avoir légitimement d'elle-même.
Le néo-giottisme et la tradition gothique
En ce sens, le néo-giottisme de Masaccio se distingue nettement des emprunts que beaucoup de ses contemporains font à des motifs du début du XIVe siècle : depuis le Maestro del Bambino Vispo jusqu'à Giovanni Toscani, depuis le Maestro della Madonna Straus jusqu'à Paolo Schiavo. Cette tendance à un retour aux sources et à un historicisme précoce est certainement commune à toute la culture florentine. Elle plonge ses racines dans les faits économiques auxquels on faisait allusion plus haut. Mais les variations sur le clair-obscur, schématiques et académiques, d'un Niccolò Gerini sont une chose ; les évocations nostalgiques et précieuses des artistes qu'on vient de nommer en sont une autre ; et c'est encore tout autre chose que la nouvelle interprétation que Masaccio propose de cet âge d'or de l'histoire florentine : il s'agit cette fois d'un retour à ce que Masaccio considère comme le « vrai » Giotto, dont la peinture est réduite à son essence plastique, « pure et sans ornement », ce que le Giotto de l'histoire ne réalisa jamais (sinon, peut-être, dans la chapelle Peruzzi). Dans le cadre de la perspective de Brunelleschi, les indications spatiales de Giotto retrouvent leur valeur d'organisation rationnelle de la réalité. Le sens du relief plastique, qui avait déjà opposé Giotto aux peintres de la génération précédente, prend des dimensions héroïques grâce à l'adoption systématique des ombres portées.
Ce lien avec la peinture de Giotto n'est qu'un des aspects de l'importance que la tradition de la peinture médiévale eut pour Masaccio. Cette importance fut proportionnellement plus grande que celle que put avoir, respectivement, pour Brunelleschi et pour Donatello, la tradition de l'architecture et de la sculpture. La tradition gothique fut brisée par les plus anciens novateurs, grâce à l'exemple qu'ils trouvèrent dans maints témoignages de la sculpture et de l'architecture classiques. Ce ne fut pas le cas pour Masaccio. Les œuvres d'art qui lui permettaient d'imaginer l'aspect des héros de l'Antiquité étaient en effet des sculptures. Ces modèles, pour lui qui était peintre, appartenaient encore à la réalité mais non à l'art (bien que cette réalité fût de marbre et non de chair et d'os). Le problème du langage restait entièrement à résoudre pour lui, et ne pouvait l'être que dans les termes de la langue vernaculaire gothique et moderne. C'est pourquoi la façon dont il se distingue de la tradition est beaucoup plus subtile. C'est pourquoi aussi son rapport avec le gothique tardif contemporain est beaucoup plus complexe. Masaccio ne put certainement pas rester indifférent à la peinture dense et empâtée, d'un effet plastique certain, mais ne faisant guère appel au dessin, du giottisme « frondeur » qui va de Maso à Stefano, de Giusto de' Menabuoi à Giovanni da Milano et à Giottino. C'est de cette tradition aussi que se réclament, à leur façon, des contemporains, tels que Gentile da Fabriano, Arcangelo di Cola da Camerino et Masolino da Panicale (1383-1440), le maître qu'une longue tradition historiographique assigne à Masaccio. Mais celui que la critique la plus récente semble préférer, son compatriote Mariotto di Cristofano, est un homme de culture encore plus traditionnelle, s'il est possible. Le clair-obscur sans hachures, peint et non dessiné, les figures « seulement illuminées avec des ombres sans contours » dont parle Lomazzo ont leurs sources les plus directes, en tant que technique picturale, non pas chez les épigones de la tradition giottesque florentine, mais dans les œuvres du plus célèbre peintre contemporain, Gentile da Fabriano (env. 1370-1427). Roberto Longhi a bien montré, à propos de La Madone du Palazzo Vecchio et du Polyptique de Pise (1426) comment les outils linguistiques traditionnels ont changé de fonction, et donc de sens, à l'intérieur du discours de Masaccio : le fond d'or qui fait fonction de paysage, comme un ciel incendié de soleil ; les auréoles mises en perspective ; la bordure dorée du manteau qui permet de détacher la masse plastique du fond ; le clair-obscur qui n'est plus discret et enveloppant mais qui met en contraste l'ombre et la lumière, qui est abrupt et crée le relief ; la ligne de contour, nettement marquée, qui ne fait pas ornement ni broderie, mais définit et délimite les formes dans l'espace.
Masaccio et les peintres contemporains
Quel que soit l'artiste qui ait enseigné à Masaccio à empâter les couleurs, il faut bien garder présent à l'esprit qu'il fut dès le début l'enfant chéri du groupe des novateurs qui se réunissait autour de Brunelleschi. Il faut se rappeler les dates des premières œuvres « renaissantes » de Brunelleschi et de Donatello pour comprendre comment, vers 1420, à l'âge de dix-neuf ans, Masaccio était un artiste entièrement formé et qu'il pouvait non seulement avoir son propre atelier, mais influencer d'autres jeunes peintres : le « Maestro del 1419 », Giovanni Toscani, Fra Giovanni da Fiesole, Andrea di Giusto, Francesco d'Antonio, Paolo Schiavo. En 1422, Masaccio avait déjà peint à fresque la grande scène de La Consécration de l'église du Carmine (dite Sagra del Carmine) dans un style qui, comme l'attestent les documents, devait être tout à fait moderne par le choix du sujet et par l'emploi de la perspective. La même année fut peint aussi le triptyque de l'église de San Giovenale à Cascia (Reggello) que, dans l'enthousiasme de la découverte, on considéra d'abord comme une œuvre de jeunesse de Masaccio lui-même (L. Berti). Mais, plus tard, on l'attribua plus justement à son jeune frère Giovanni, dit le Scheggia (F. Bologna), qui est probablement le même peintre que le Maestro del Cassone degli Adimari (L. Bellosi). On a là un témoignage indirect, mais très précieux, de l'accomplissement déjà tout personnel qu'avait atteint à cette date le style du jeune artiste. En se fondant sur cette hypothèse d'un Masaccio déjà entièrement formé et donc reconnaissable dès avant sa rencontre avec Masolino, Roberto Longhi a pu, avec une exactitude parfaite, distinguer rigoureusement la part qu'ont prise les deux artistes dans des œuvres comme Sainte Anne, la Vierge avec l'Enfant et des anges et les fresques de la chapelle Brancacci.
Masaccio et Masolino
Masaccio put précocement échapper au système humiliant de l'atelier pour s'installer à son compte. Cela entraîna pour lui des difficultés financières, attestées par les documents. Ce n'est pas là un fait secondaire si l'on veut comprendre la conception nouvelle, individualiste, que Masaccio, en homme de la Renaissance, se fit de son métier d'artiste. Le nouveau statut social du groupe des novateurs implique la recherche de nouvelles formes d'organisation du travail et celle de nouveaux débouchés sur le marché de la peinture. On sait par les documents historiques que Donatello, l'ami et le protecteur de Masaccio, choisit quant à lui les formes juridiques de la « compagnie ». Dans la « compagnie », deux artistes indépendants se lient pour un temps déterminé afin d'obtenir plus de commandes et contrôler plus facilement une grande partie du marché. Ce rapport de complémentarité économique élargit énormément l'horizon du vieil atelier. Dans la « compagnie », les personnalités ne tendent pas à se fondre. Mais les deux artistes collaborent selon des méthodes rationnelles de répartition du travail. Donatello, bien qu'il soit le meneur de jeu, n'arrivera jamais à faire de Michelozzo son alter ego, pas même d'un point de vue purement artistique. On ne connaît pas aujourd'hui, par insuffisance de documents historiques, quel type de rapports économiques Masolino et Masaccio décidèrent d'instaurer entre eux, en cette même année 1425 qui a vu naître la « compagnie » de Donatello et de Michelozzo. Cependant, tout laisse croire que les deux peintres furent, en droit et en fait, sur un pied d'égalité absolue. Il n'est pas douteux que l'« étourdi » Masolino n'a jamais été capable de comprendre et de s'approprier les innovations de son jeune compatriote. Mais il faut aussi se demander jusqu'à quel point il a vraiment voulu le faire, et s'il a vraiment cherché à dépasser un accord stylistique capable de donner à l'œuvre une cohérence suffisante pour que les commanditaires ne voient pas la différence de main. Il est vrai qu'en ce qui concerne les fresques de la chapelle Brancacci la présence des deux mains sur le même morceau de fresque (au centre de la scène qui comprend La Résurrection de Tabitha) montre que, au moins à un certain moment, les deux artistes travaillèrent côte à côte. Mais cela ne fut certainement pas le cas pendant toute la durée des travaux que Masolino commença probablement seul en 1424 et qui furent continués en 1425-1427 par le seul Masaccio. Il en fut de même pour les autres œuvres où les deux artistes collaborèrent : Sainte Anne, la Vierge avec l'Enfant et des anges (1424-1425, musée des Offices, Florence) ; les fresques de la chapelle Branda (1425-1431, Saint-Clément, Rome) ; enfin, le triptyque à deux faces qui se trouvait autrefois à Sainte-Marie-Majeure à Rome (1425-1431 ; la partie centrale avec La Fondation de Sainte-Marie-Majeure et L'Assomption est actuellement au musée Capodimonte de Naples ; le panneau de gauche avec Saint Jérôme et saint Jean-Baptiste et Saint Libère et saint Matthieu est à la National Gallery de Londres ; le panneau de droite avec Saint Pierre et saint Paul et Saint Jean l'Évangéliste et saint Martin appartient à la Johnson Collection de Philadalphie). En ce qui concerne les fresques de la chapelle Brancacci, on a déjà établi depuis longtemps que Masolino a travaillé aux deux figures d'Adam et d'Ève à une époque antérieure à sa rencontre avec Masaccio. Il continua ensuite, en cherchant à suivre comme il le pouvait les innovations de son compagnon. Il réalisa la majeure partie de La Prédication de saint Pierre et de la double scène avec La Guérison de l'infirme et la résurrection de Tabitha. À la chapelle Branda de Saint-Clément à Rome, ce sont au contraire les parties hautes, vraisemblablement les plus anciennes, l'arc d'entrée, l'intrados, la voûte et la paroi du fond avec la Crucifixion, qui montrent ce clair-obscur très dense et ces amples formes que peint Masolino quand il veut imiter Masaccio. Mais la distribution spatiale de la grandiose Crucifixion et l'ange de l'Annonciation ressortissent, comme on l'a observé, à la conception moderne de la perspective qui fut celle du jeune maître ; enfin l'on pense généralement que l'Histoire de sainte Catherine et de saint Ambroise, peinte sur les parois, est postérieure à sa mort. Quant au triptyque de Sainte-Marie-Majeure, on sait ce qui a été peint par Masaccio lui-même : Saint Jérôme et saint Jean-Baptiste, à quoi nous proposerons d'ajouter certaines parties de Saint Pierre et saint Paul, les pieds et la main gauche de saint Pierre, toute la draperie bleue du bras droit de saint Paul et sa main gauche qui tient le livre. Masolino, pour sa part, ne cherche à imiter la grande manière de son jeune confrère que dans les figures des saints des panneaux latéraux, cependant que, dans la narration miraculeuse qui couvre les deux faces du panneau central, même les traces de perspective renaissante qu'on y relève appartiennent à une conception essentiellement « cosmopolite » de la peinture. Du point de vue de la chronologie, cela ne signifie pas que ces œuvres aient été réalisées à une date antérieure à la rencontre avec Masaccio. Selon toutes probabilités (comme pour l'Histoire de sainte Catherine et de saint Ambroise de Saint-Clément), c'est le contraire qui est vrai. Cela est confirmé par les fresques splendides dont Masolino décorera après 1432, pour le même commanditaire que celui de la chapelle de Saint-Clément, le baptistère de Castiglione d'Olona. Dans l'Histoire de saint Jean-Baptiste, Masolino reviendra en effet, avec beaucoup de naturel, au style doux et fleuri, à la lumière pure, à l'espace modulé jusqu'à l'infini de ses œuvres de jeunesse, antérieures à sa brève collaboration – qui ne durera pas plus de quatre années (encore en passa-t-il la moitié en Hongrie) – avec le jeune novateur.
La logique qui préside à la distribution des parties exécutées par les deux maîtres dans toutes ces œuvres semblerait donc celle d'interventions successives. Ces interventions purent avoir lieu en des temps et en des lieux relativement espacés, sur des œuvres qui sont restées longtemps en chantier et que continuait celui qui à ce moment-là se trouvait sur place et avait le temps et la volonté d'y travailler. Si l'atelier médiéval est en décadence, il est évident que l'on est encore bien loin de l'« œuvre autographe », au sens moderne du terme. L'éventualité qu'un peintre (ou une équipe, ou une « compagnie » de peintres) puisse avoir en même temps deux chantiers dans deux villes différentes n'est nullement exclue. Sur ce point aussi, Giotto fut un précurseur. Il avait ouvert deux chantiers à la fois au temps où il peignait les fresques de Saint-François à Assise et de Saint-Jean-de-Latran à Rome. Aujourd'hui encore, c'est une pratique commune chez les artisans, en période de pénurie, que d'accepter n'importe quelle commande, indépendamment de toute possibilité réelle de les réaliser. On commence immédiatement les travaux, de façon qu'ils ne soient pas confiés à d'autres, sauf à les interrompre presque aussitôt pour mener à terme les tâches que l'on avait acceptées précédemment.
Le retour inattendu de Masolino, après la mort de Masaccio, dans le groupe des peintres du « gothique tardif » constitue, si l'on y réfléchit bien, la meilleure preuve que la collaboration de deux hommes avait eu une base éminemment pratique et qu'elle ne mettait pas profondément en cause les convictions artistiques des deux peintres.
La postérité
Masaccio mourut à l'âge de 27 ans dans des conditions mystérieuses dans un voyage à Rome avec Masolino da Panicale.
Il est considéré comme le plus grand peintre de la Première Renaissance et est traditionnellement présenté comme le premier peintre moderne. Il a en effet introduit dans l'art occidental la notion de vérité optique, de perspective et de volume.
Œuvres
Baptême des néophytes.
Chapelle Brancacci, église Santa Maria del Carmine (Florence), (1424-1428), fresque :
Adam et Ève chassés du Paradis, 208 × 88 cm
Le Paiement du tribut, 255 × 598 cm,
Le Baptême des néophytes, 255 x 162 cm
La Résurrection du fils de Théophile et L'Intronisation de saint Pierre5 (complété par Filippino Lippi)
Saint Pierre guérissant avec son ombre6
Saint Pierre distribuant les aumônes et la Mort d'Ananie, fresque, 230 × 162 cm
Polyptyque de Pise (1426)
Polyptyque de Pise, reconstitué
selon G. Von Teuffel.
Madonna col Bambino, National Gallery, Londres
Crucifixion (Christ en Croix entouré de Marie, Jean et Marie-Madeleine), musée Capodimonte de Naples
San Paolo, Museo Nazionale di San Matteo (Pise)
Sant'Andrea, Jean Paul Getty Museum, Los-Angeles
Storie di San Giuliano e Nicola, panneaux de polyptyque, Staatliche Museen, Berlin
L'Adoration des mages, panneau de la prédelle 21 × 61 cm, Gemäldegalerie, Berlin
Martyre de saint Pierre et saint Jean-Baptiste8, predelle, Staatliche Museen, Berlin
Santo Carmelitano, morceau de pilastre, Staatliche Museen
Santo Carmelitano, morceau de pilastre, Staatliche Museen
Santo Vescovo, morceau de pilastre, Staatliche Museen
San Girolamo, morceau de pilastre, Staatliche Museen
Saint André, Jean-Paul Getty Museum.
Arrivée des mages, détail d'une prédelle du polyptyque de Pise
(1426) démembré et dispersé.
Crucifixion, panneau supérieur
polyptyque de Pise
Musée Capodimonte de Naples.
Autres Œuvres
Triptyque de l'église San Giovenale (1422), tempera sur panneau, Pieve di Cascia, Reggello
Desco da parto , sur la face : Scène de Naissance, au recto : Putto con animaletto, 1424-1425, (plateau peint d'accouchée), Gemaldegalerie, Berlin
Histoire de saint Julien, panneau du triptyque Carnesecchi, Musée Horne, Florence
Sant'Anna Metterza di sua mano la Madonna col Bambino e l'angelo reggicortina in alto a destra9, 1424, (avec Masolino da Panicale) tempera sur panneau, Galerie des Offices, Florence
Madonna del "solletico"10, 1426, Galerie des Offices, Florence
La Trinité ou Le Trône de grâce (1426-1428), fresque, 667 × 317 cm, Santa Maria Novella, Florence
Madonna dell'Umiltà (1423 - 1434), National Gallery of Art, Washington (œuvre complètement repeinte11 et présentée comme telle12
Orazione nell'orto e San Girolamo penitente13, Lindenau Museum, Altenburg
Santi Girolamo e Giovanni Battista14, polyptyque de Santa Maria Maggiore, National Gallery, Londres
Plateau d'accouchée, 1424-1425,
Gemaldegalerie, Berlin.
Jeune homme de profil
National Gallery, Washington
Madonna del Solletico, 1426
Musée des Offices, Florence.
Traités sur ses peintures
(it) Roberto Longhi, Masolino et Masaccio, 1983
Maurice Guillaud, Les fresques de Masaccio à la chapelle Brancacci, Guillaud, décembre 1992         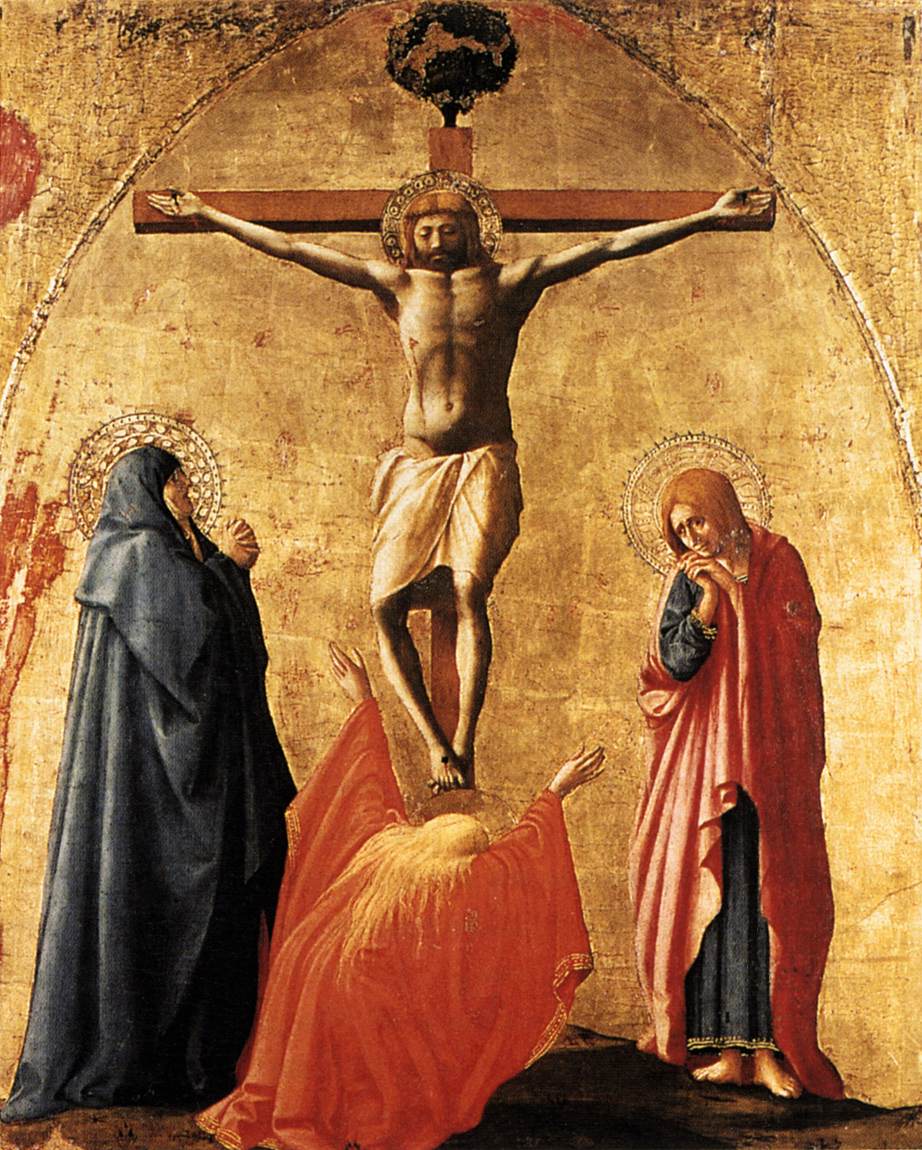    
Posté le : 20/12/2014 19:27
Edité par Loriane sur 22-12-2014 00:02:40
|
|
|
|
|
Puvis de Chavannes |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57813
|
Le 14 décembre 1824 naît Pierre Cécile Puvis de Chavannes
à Lyon mort à 73 ans, à Paris le 24 octobre 1898, peintre français, considéré comme une figure majeure de la peinture française du XIXe siècle. Il a pour maîtres Henry Scheffer, Thomas Couture, et pour élèves Henry Daras - Émile Dezaunay, appartenant au mouvement artistique Symboliste, il est influencé par Ingres, Théodore Chassériau, et il influença Odilon Redon et Maurice Denis.
En Bref
La révélation des fresquistes primitifs lors de deux séjours en Italie 1846-1848 et l'exemple de Chassériau ont guidé ses premiers pas dans la peinture murale, moyen d'expression qu'il privilégiera tout au long de sa carrière : cycles des musées d'Amiens 1861-1882, de Marseille palais de Longchamp, 1867-1869, de Lyon le Bois sacré cher aux arts et aux Muses, 1884-1886 ; grands ensembles parisiens du Panthéon 1874-1898, Vie de sainte Geneviève, de la Sorbonne 1886-1889 et de l'Hôtel de Ville 1887-1894. Son art, classique et idéaliste, d'un symbolisme simple et d'une grande sobriété d'exécution, remarquable également dans ses tableaux de chevalet le Pauvre Pêcheur, 1881, musée d'Orsay, a influencé des peintres aussi divers que Redon, Gauguin, Seurat, Maurice Denis et les nabis, Matisse, etc.
Puvis n'est pas le peintre froid et académique dont l'image s'est peu à peu imposée au public au cours du XXe siècle. Jusqu'à la dernière décennie de sa vie, son œuvre fut l'objet de vives critiques et de controverses, surtout de la part des milieux officiels. En revanche, les peintres d'avant-garde, de Gauguin à Seurat, lui portèrent toujours la plus vive admiration, et l'on ne saurait oublier non plus que Puvis soutint un Courbet, un Bazille, un Degas, au moment où ils étaient le plus vivement attaqués. Né à Lyon, sa formation repose avant tout sur la tradition idéaliste de cette importante école provinciale et sur la leçon des maîtres de la Renaissance qu'il découvre en Italie, au milieu du siècle. L'exemple de Chassériau le marque aussi très fortement, et les décorations de celui-ci pour la Cour des comptes 1848 l'orientent définitivement vers la peinture murale qui constitue la part la plus importante de son œuvre, encore qu'il n'ait pas peint véritablement à fresque, mais sur des toiles collées ensuite sur le mur dites marouflées. Ses débuts sont difficiles, et il essuie plusieurs refus jusqu'à ce qu'une médaille vienne récompenser, en 1861, Bellum et Concordia Amiens. C'est le début d'une longue suite de décors muraux qui culmine avec la Vie de sainte Geneviève au Panthéon 1874-1878, puis 1896-1898, le grand escalier du musée de Lyon 1883-1886, l'Allégorie des sciences à la Sorbonne 1887, l'escalier de l'Hôtel de Ville 1891-1894 et la bibliothèque de Boston 1894-1896. Mais les peintures de chevalet ont leur importance ; L'Espérance env. 1871, musée d'Orsay, Paris et Le Pauvre Pêcheur 1881, musée d'Orsay sont des œuvres capitales dans l'histoire de la peinture : la nouveauté de leur conception formelle tout autant que leur inspiration pèsent d'un poids déterminant dans l'œuvre d'un Gauguin, d'un Seurat ou encore dans celle des nabis, comme Maurice Denis ; et Puvis est incontestablement l'un des patrons du mouvement symboliste, bien qu'il se soit toujours défendu lui-même de travailler en ce sens. La peinture plate, l'application très sobre de la touche, la construction savante de la toile, l'élaboration du sujet faisaient un contrepoids utile à la liberté et au bariolage impressionniste, délibérément tourné vers le temps qui passe. Puvis, auquel cinq cent cinquante artistes des tendances les plus opposées rendirent hommage lors d'un grand banquet présidé par Rodin, en 1895, est l'un des maîtres de la peinture française.
Sa vie
Appartenant à une famille de la grande bourgeoisie lyonnaise, il reçut une solide éducation classique. Après des études de rhétorique et de philosophie au lycée Henri-IV de Paris, il fait un premier voyage en Italie, puis commence à étudier la peinture auprès de Henry Scheffer. Attiré par la peinture, il passa un an dans l'atelier d'Henri Scheffer, mais ne découvrit sa vocation qu'en voyageant en Italie en compagnie de Bauderon de Vermeron. Celui-ci le présenta à Delacroix, qui l'accepta parmi ses élèves. Le maître ayant dispersé son atelier quelques semaines plus tard, Puvis étudia plusieurs mois chez Couture, puis, en 1852, s'installa dans un atelier de la place Pigalle, où il réunit, pour dessiner le modèle vivant, trois amis convaincus : Bida, Picard et le graveur Pollet.
Il fait ensuite un deuxième séjour en Italie et étudie brièvement auprès d'Eugène Delacroix, puis dans l'atelier de Thomas Couture. Il est marqué par les grandes peintures murales de Théodore Chassériau, exécutées pour l'escalier de la Cour des comptes entre 1844 et 1848 détruites en 1871. Il ne trouve véritablement sa voie qu'à l'âge de trente ans en réalisant le décor de la salle à manger de la résidence campagnarde de son frère Les Quatre Saisons, Le Retour de l'enfant prodigue.
Ses débuts au Salon sont difficiles. Il est plusieurs fois refusé et quand enfin il expose, il est sévèrement critiqué. Puis, en 1861, il remporte un premier succès avec La Guerre et La Paix. La première est achetée par l'État français. Puvis offre la seconde, complétée en 1863 par Le Repos et Le Travail, et en 1865 par Ave Picardie nutrix, puis quinze ans plus tard par Ludus pro Patria. Ce décor exceptionnel sur le plan thématique et stylistique est représentatif du traitement novateur que Puvis apporte au genre allégorique dont il devient à la fin du XIXe siècle le plus brillant représentant. A son petit atelier de Pigalle, il ajoute rapidement un plus grand, à Neuilly. Il vit avenue de Villiers, auprès de la princesse roumaine Marie Cantacuzène 1820- juillet 1898, qu'il rencontre en 1856, sans doute dans l'atelier du peintre Théodore Chassériau dont elle est l'amie. Il l'épouse en 1898. Elle a une influence considérable sur lui, devenant sa compagne, sa collaboratrice, son inspiratrice. Il en fait en 1883 un portrait, aujourd'hui visible au musée des beaux-arts de Lyon. Elle lui sert également de modèle pour la Salomé de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste, pour Radegonde de l'Hôtel de ville de Poitiers, et pour la Sainte-Geneviève du Panthéon de Paris.
Puvis de Chavannes réalise de grands décors muraux : au Palais Longchamp à Marseille 1867-1869 à l'Hôtel de Ville de Poitiers 1870- 1875, à l'Hôtel de Ville de Paris 1887-1894, à la Bibliothèque publique de Boston 1881-1896. À ceux-ci s'ajoutent trois ensembles exceptionnels, celui du Panthéon de Paris, où il traite de la vie de Sainte Geneviève 1874-1878 et 1893-1898 ; le décor de l'escalier du musée des beaux-arts de Lyon 1884-1886 avec le Bois sacré cher aux Arts et aux Muses complété par Vision antique, Inspiration chrétienne et deux figures représentant le Rhône et la Saône ; et enfin le grand décor de L'amphithéâtre de la Sorbonne à Paris 1886-1889, qui développe le thème du Bois sacré. Chacun de ces décors donne lieu à des études, copies, répliques, cartons préparatoires qui popularisent l'œuvre de Puvis en particulier à l'étranger.
Par cette œuvre décorative immense, mais aussi avec des tableaux de chevalet d'un symbolisme novateur, il conquiert l'admiration d'une génération entière, influençant non seulement les idéalistes tels que Odilon Redon, Henri Martin, Alphonse Osbert, Alexandre Séon, Émile-René Ménard ou Ary Renan, mais aussi les Nabis, Paul Gauguin, Georges Seurat, Maurice Denis, et même le jeune Pablo Picasso dont nombre d'œuvres de jeunesse lui sont redevables.
En 1874, l'hôtel de ville de Poitiers reçut 2 nouvelles décorations de l'artiste, qui y abordait, pour la première fois, les thèmes religieux : Charles Martel sauvant la chrétienté par sa victoire sur les Sarrasins et surtout Sainte Radegonde écoutant une lecture du poète Fortunat expriment sa compréhension profane des vertus médiévales.
Devant ces œuvres si nouvelles, la critique réagit avec vigueur : d'aucuns, comme Charles Blanc, About, Castagnary, hurlèrent au barbouilleur ; d'autres, comme Delécluze, Théophile Gautier, Paul de Saint-Victor, Théodore de Banville, le défendirent avec enthousiasme et, plus particulièrement Claude Vignon, une des premières laudatrices de l'artiste à qui elle avait demandé, en 1866, le décor mural du hall de son hôtel parisien : quatre peintures allégoriques aujourd'hui dispersées trois à Paris, musée d'Orsay, une au musée de Kurashiki, Japon.
Puvis, maintenant sûr de lui, désirait arriver à l'accord parfait entre la surface plane du mur et ses compositions décoratives, où il supprimait volontairement tout modelé, jouant seulement de l'équilibre des masses, de l'arabesque de la ligne et de l'harmonie en camaïeu de couleurs adoucies. Il adaptait pour ces vastes toiles, marouflées sur le mur, mais traitées plastiquement comme des détrempes, la leçon picturale des fresques du quattrocento florentin et de Giotto. Paradoxe, d'ailleurs, que cet intérêt pour les débuts de la conquête de la troisième dimension de la part de l'artiste, qui, le premier, chercha à nier la grande tradition dont il était l'héritier. Il exécuta ensuite successivement ses trois plus célèbres décorations pour le musée de Lyon, la Sorbonne et le Panthéon. Dans son Bois sacré cher aux Arts et aux Muses, commandé en 1883 par la ville de Lyon pour le palais des Arts, il exprime ses convictions les plus intimes : les Muses, hiératiques et tendres, confient au poète et à l'artiste adolescents les secrets sublimes de l'esprit. Le peintre compléta cette délicate allégorie par sa Vision antique, à la sérénité mélancolique, et par son Inspiration chrétienne, où il rend un silencieux hommage à Fra Angelico. Il développa pour le grand amphithéâtre de la Sorbonne ce thème de la culture qu'il avait déjà effleuré dans son Inter artes et naturam 1890, musée de Rouen. L'équilibre rythmé de la composition et la beauté grave des figures en font une méditation plastique d'une grande qualité. L'Enfance de sainte Geneviève, au Panthéon, commandée en 1874, fut l'œuvre primordiale de sa carrière. Dans ce vaste ensemble décoratif, où l'histoire prime le style, on mesure l'apport original de Puvis de Chavannes, délaissant l'anecdote pour donner toute sa place au mur.
Le peintre atteint, dans ces 3 œuvres, à une solennité calme, à une grâce simple qui font de lui le plus grand des décorateurs de la fin du XIXe s. Mais il y mêlait parfois un peu de cette émotion purificatrice qu'inspirait la nature à Rousseau. Puvis de Chavannes se révéla, en effet, paysagiste sensible : il entourait ses allégories et ses idylles pastorales de paysages de prairies, de vallons et de forêts qui évoquent, transcrits poétiquement, la campagne d'Île-de-France, les molles collines de Picardie et les brumes lyonnaises sur les étangs. Il y plaçait, avec une grande justesse d'observation, le paysan au labour, le bûcheron et sa famille, le pâtre et ses troupeaux ; il ne s'agit pas ici d'un réalisme social à la Courbet, mais plutôt d'une vision virgilienne des travaux des champs.
Puvis peignit aussi, pour la maison de son ami Bonnat, le Doux Pays 1882, musée de Bayonne. Il décora ensuite l'Hôtel de Ville de Paris de ses admirables poèmes naturalistes : l'Été 1891 et l'Hiver 1891-92, si évocateurs et si subtils. Lorsqu'il eut achevé les Muses inspiratrices acclamant le génie messager de la lumière 1894-1896, grand ensemble décoratif pour la bibliothèque publique de Boston, il accepta la commande officielle, pour le Panthéon, de sa seconde série de décorations illustrant la Vie de sainte Geneviève et s'y consacra avec la passion d'un artiste qui se sent menacé Sainte Geneviève ravitaillant Paris, esquisse à Paris, musée d'Orsay.
Profondément affecté par la mort de sa femme, la princesse Marie Cantacuzène, son amie et inspiratrice de toujours qu'il venait d'épouser en 1897, il lui survécut quelques mois pour terminer sa Sainte Geneviève veillant sur Paris endormi, où il l'a représentée dans une composition très stricte, en camaïeu de bleus et de gris, d'une grande noblesse et d'une poésie religieuse un peu triste.
Les très nombreux dessins de l'artiste sont conservés, pour la plupart, dans les collections du Louvre, du Petit Palais à Paris et du musée de Lyon. Ce sont uniquement des études préparatoires pour les grandes décorations, tantôt croquis d'attitudes, tantôt figures plus poussées, inlassablement reprises jusqu'à la perfection. Puvis de Chavannes exécuta aussi des tableaux de chevalet, qui furent souvent blâmés par ses admirateurs, comme Albert Wolff, et, par contre, curieusement loués par J.-K. Huysmans, qui n'appréciait guère ses fresques. À côté de quelques beaux portraits d'un dépouillement déjà moderne Portrait de Mme Puvis de Chavannes, 1883, musée de Lyon, il peignit des toiles essentiellement symbolistes qui portent, en outre, un message pictural : le Sommeil 1867, musée de Lille, les deux versions de l'Espérance, d'une synthétique simplicité, montrant une jeune fille naïve et fraîche dans les décombres de la guerre franco-prussienne 1872, Baltimore, Walters Art Gallery, et Paris, musée d'Orsay, l'Été 1873, id.. Les Jeunes Filles au bord de la mer panneau décoratif, Salon de 1879, id. détachent sur un ciel de soufre et un océan orageux, parmi les bruyères, leurs figures helléniques, verticales ou lovées. Le Fils prodigue 1879, Zurich, coll. Bührle exprime le dénuement moral de l'homme qui a déchu en renonçant à l'idéal. Le Pauvre Pêcheur présenté au Salon de 1881, Paris, musée d'Orsay, qui fut une des œuvres les plus fortement controversées de sa carrière, nous apparaît comme le premier manifeste de l'art symboliste français.
Picasso ressentira directement ce message à la fois sur le plan de l'esprit et sur celui de la technique picturale : il n'y a pas loin de ce Pauvre Pêcheur à l'homme de la Tragédie Washington, N. G..
L'œuvre de Puvis de Chavannes eut, en effet, un grand retentissement parmi ses contemporains, qui le considérèrent comme le maître du Symbolisme. S'il fut toujours un professeur consciencieux, aimé de ses élèves, Puvis n'eut pas de disciples de grand talent. Paul Baudoin, Ary Renan ou Auguste Flameng ne furent que des épigones. Comme président estimé de la Société nationale des Beaux-Arts, il marqua cependant Cormon et Ferdinand Humbert et influença profondément non seulement les peintres purement symbolistes comme René Ménard, Odilon Redon, le Belge Xavier Mellery, le Danois Vilhelm Hammershøi ou le Suisse Ferdinand Hodler, mais aussi les académiques convertis, tels Henri Martin ou Osbert. Et même les peintres les plus éloignés des préoccupations académiques et des commandes officielles, tels Gauguin, Seurat, Maurice Denis et les Nabis, trouvèrent dans les subtilités révolutionnaires de l'œuvre classique de Puvis de Chavannes le ferment et la source de leurs audaces.
En 1890, il refonde avec Jean-Louis-Ernest Meissonier, Carolus-Duran, Félix Bracquemond, Jules Dalou et Auguste Rodin la Société nationale des beaux-arts, dont il est successivement vice-président et président, suite à la mort de Jean-Louis-Ernest Meissonier.
Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1867, officier en 1877, puis commandeur en 1889. Il obtint la médaille d'honneur en 1882.
Il meurt le 24 octobre 1898 à 18 heures, deux mois après le décès de sa femme Marie Cantacuzène.
Il est enterré au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine.
La seule autorité reconnue par les ayants droit pour l'authentification des œuvres est le Comité Pierre Puvis de Chavannes.
Liste des œuvres principales
Saint-Sébastien, 1854, huile sur toile, 61,5 × 51 cm, Paris, Musée d'Orsay
Retour de Chasse, 1859, 345 × 295 cm, Marseille, Musée des beaux-arts de Marseille inv. 214
Décoration du Musée de Picardie escalier d'honneur et galeries du premier étage:
Concordia, 1861, Amiens, Musée de Picardie
Bellum, 1861, Amiens, Musée de Picardie
Le Repos, 1862, Amiens, Musée de Picardie
Le Travail, 1863, Amiens, Musée de Picardie
Ave Picardia Nutrix, 1865, Amiens, Musée de Picardie
L'automne, 1865, huile sur toile, 105 × 150 cm, Cologne, Wallraf-Richartz Museum
L'automne, 1865, huile sur toile, 285 × 226 cm, Lyon, Musée des beaux-arts nv. A2963
Décoration du salon de l'hôtel parisien de Claude Vignon :
L'Histoire, 1866, huile sur toile, 271 × 153,5 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. MNR 973 A
La Vigilance, 1866, huile sur toile, 271,4 × 104 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. MNR 973 B
Le Recueillement, 1866, huile sur toile, 271 × 104 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. MNR 973 C
La Fantaisie, 1866, huile sur toile, Kurashiki, Musée d'art Ōhara
Le Sommeil 1867, huile sur toile, 381 × 600 cm, Lille, Palais des beaux-arts
Décoration du Palais Longchamp à Marseille, commandée en 1867 par la ville de Marseille:
Marseille, colonie grecque, 1869, huile sur toile, 423 × 565 cm, Marseille, Musée des beaux-arts de Marseille inv. 884
Marseille, porte de l'Orient, 1869, huile sur toile, 423 × 565 cm, Marseille, Musée des beaux-arts de Marseille inv. 885
La Décollation de saint Jean-Baptiste, 1869, huile sur toile, Londres, National Gallery
Le Ballon, 1870, huile sur toile, 136,7 × 86,5 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. RF 1987 21
Le Pigeon, 1871, huile sur toile, 136,7 × 86,5 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. RF 1897 22
Vue sur le château de Versailles et l'Orangerie, 1871, huile sur toile, 32,5 × 46,3 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. RF 2003
L'Espérance, 1871-1872, huile sur toile, 70,5 × 82 cm, Paris, Musée d'Orsay
Les Jeunes filles et la mort, 1872, huile sur toile, 146 × 105 cm, Williamstown, Sterling and Francine Clark Art Institute
décoration de l'Hôtel de ville de Poitiers, 1874:
Charles Martel sauvant la chrétienté par sa victoire sur les Sarrasins, 1874
Sainte Radegonde écoutant une lecture du poète Fortunat, 1874
Jeunes Filles au bord de la mer, 1879, huile sur toile, 205,4 × 156 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. 1970 34
Vie de sainte Geneviève, 1879, Fogg Art Museum, Cambridge Massachusett
Le Pauvre Pêcheur, 1881, huile sur toile, 154,7 × 192,5 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. RF 506
Pro Patria Ludus, 1882, Amiens, Musée de Picardie
Le Doux Pays, 1882, 230 × 428 cm, Bayonne, musée Bonnat
La Toilette, 1883, huile sur toile, 74,5 × 62,7 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. RF 3692
Le Rêve, 1883, huile sur toile, 82 × 102 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. RF 1685
Portrait de Marie Cantacuzène, 1883, huile sur toile, Lyon, Musée des beaux-arts
Décoration pour le palais des Arts, commandée en 1883 par la ville de Lyon:
Le Bois sacré cher aux arts et aux muses, 1884, huile sur toile, 460 × 1 040 cm, Lyon, Musée des beaux-arts (Inv. B355)
Vision antique, 1885, huile sur toile, 460 × 578 cm, Lyon, Musée des beaux-arts Inv. B356
Inspiration chrétienne, 1885, huile sur toile, Lyon, Musée des beaux-arts
Femme sur la plage, 1887, huile sur toile, 75 × 75 cm, Saint-Pétersbourg, Musée de l'Ermitage
La Jeune Mère ou la Charité, vers 1887, huile sur toile, 56 × 47 cm, Paris, Musée d'Orsay Inv. RF 2003
Décoration de la Sorbonne à Paris:
Le Bois sacré, 1884-1889, huile sur toile, Paris, Sorbonne, décor du grand amphithéâtre
Inter artes et naturam, 1890, Rouen, Musée des Beaux-arts
Les Baigneuses, vers 1890, huile sur toile, 55,4 × 35,5 cm, Toronto, musée des beaux-arts de l'Ontario
Décoration de l'Hôtel de ville de Paris:
L'Été, 1891, huile sur toile, 150 × 232 cm, Cleveland, Cleveland Museum of Art
L'hiver, 1891-92
La Gardeuse de chèvres, 1893, huile sur toile, 86 × 54 cm, Mâcon, musée des Ursulines Inv. A.1037
Décoration de la Bibliothèque publique de Boston:
Muses inspiratrices acclamant le génie messager de la lumière, 1894-1896
Homère la Poésie épique, 1896, huile sur toile, 126 × 62 cm, Boston, Museum of Fine Arts
Orphée, 1896, huile sur toile, 67 × 46,5 cm, Oslo, Nasjonalgalleriet.
La Madeleine, 1897, huile sur toile, 116,5 × 89,5 cm, musée des beaux-arts de Budapest
Décoration du Panthéon de Paris - Vie de Sainte Geneviève 1898
Sainte Geneviève soutenue par sa pieuse sollicitude veille sur la ville endormie, 1898, Paris, Panthéo
1850 : Expositions universelles
1861 : 2e médaille pour La Guerre et La Paix à l'Exposition universelle
1867 : 3e classe à l'Exposition universelle
1887 : National Academy of Design, New York.
2002 : Palazzo Grassi, Venise
2005-2006 : Musée de Picardie, Amiens.
2014 : Exposition d'aquarelles et de lavis dans le cadre de la biennale de Cuiseaux
Le prix Puvis de Chavannes
Fondé en 1928, ce prix est attribué à un artiste plasticien par la Société nationale des beaux-arts et comporte une rétrospective de l'œuvre du lauréat au musée d'art moderne de la ville de Paris ou au Grand Palais. Ont notamment reçu ce prix les artistes Willem van Hasselt 1941, Jean-Gabriel Domergue 1944, Tristan Klingsor 1952, Georges Delplanque 1957, Albert Decaris 1957, Jean Picart le Doux 1958, Maurice Boitel 1963, Pierre Gaillardot 1966, Pierre-Henry 1968, Louis Vuillermoz 1969, Daniel du Janerand 1970, Jean-Pierre Alaux 1971, Jean Monneret 1975, Jean Baudet 1981, Rodolphe Caillaux 1983, André Hambourg 1987, Gaston Sébire 1991, Jean Cluseau-Lanauve 1993, Paul Collomb 2006.
Élèves
Anna Kirstine Ancher
Paul Baudoüin (1844-1931), à partir de 1874
Charles Cottet
Eugen
Marcel Paul Meys
Adrien Karbowsky
Maria Wiik
[img width=600]http://www.mairie17.paris.fr/mairie17/document?id=16375&id_attribute=43[/img] 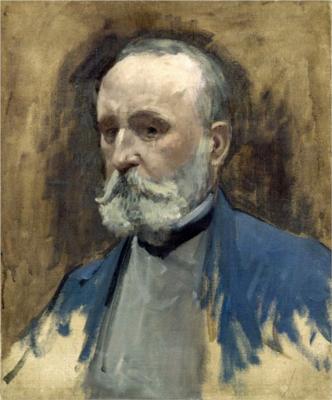       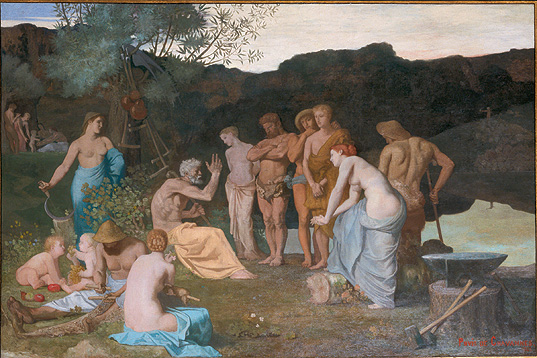    
Posté le : 13/12/2014 16:00
|
|
|
|
|
Le Bernin (Gian LorenzoBerminiolo) |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57813
|
Le 7 décembre 1598 naît Gian Lorenzo Berminiolo ou Gian Lorenzo
Bernini dit Le Bernin ou Cavaliere Bernini
à Naples, mort, à 81 ans, le 28 novembre 1680 à Rome, sculpteur, architecte et peintre du mouvement baroque, il avait pour mécènes le cardinal Scipione Borghese, il fut influencé par Michel-Ange et influença Francesco Borromini . Il fut surnommé le second Michel-Ange.
Son art, typiquement baroque, est caractérisé par la recherche du mouvement, la torsion des formes, le spectaculaire et les effets d'illusion.
Il peut être qualifié d'artiste total, dans la mesure où, non seulement il maîtrisait les différents Beaux Arts, Architecture, Peinture et Sculpture, mais aussi parce qu'il était capable de les faire concourir au sein d'une même œuvre.
Par son abondante production artistique, il se place comme la figure de proue de l'art baroque à Rome.
En bref
Giantimo Lorenzo naît, à Naples, le 7 décembre 1598 d'Angelica Galante et de Pietro Bernini, sculpteur maniériste d'origine florentine. Il est le dernier d'une fratrie de dix enfants, et l'unique garçon[réf. nécessaire]. Le couple se rend à Rome en 1605 où Pietro travaille pour le compte du cardinal Scipione Borghese ce qui est l'occasion de faire montre du talent précoce du fils qui travaille auprès de son père.
Pietromo Bernini travaille sur les chantiers de Paul V Borghèse, achevant en particulier ce qui est reconnu comme son chef-d'œuvre, l’Assomption de la Vierge du baptistère de Sainte-Marie-Majeure et la chapelle Paolina destinée à accueillir la tombe de Paul V et Clément VII pour laquelle Pietro Bernini réalise un couronnement de Clément VII 1611. Le jeune Gian Lorenzo bénéficie très jeune de l'expérience de son père, en particulier en ce qui concerne l'organisation du travail collectif sur un chantier et la fusion des œuvres architectoniques, picturales, sculpturales dans un ensemble de marbres polychromes.
La Rome des débuts du xviie siècle est une ville qui vit un renouveau artistique phénoménal avec en particulier l'introduction de la révolution naturaliste en peinture introduite par Le Caravage et l'influence baroque initiée dans les Flandres par Rubens, et où le talent ne demande qu'à être reconnu.
Bernin aurait certainement décliné le qualificatif de maître du baroque, dont on croit l'honorer. Il est en effet aux antipodes du style baroque – au sens étymologique du terme, c'est-à-dire irrégulier et bizarre, libéré des règles – de son contemporain et rival Borromini, qu'il considère comme un hérétique. Comme Rubens ou Le Brun, comme Jules Hardouin Mansart ou Wren dans leurs domaines, il est en fait le maître de ce qu'on peut appeler le grand style moderne. Formé à l'admiration des chefs-d'œuvre de la statuaire hellénistique et des maîtres de la haute Renaissance, notamment Raphaël et Michel-Ange, revenant à la discipline du dessin d'après nature selon la leçon de Caravage et des Carrache, il conçoit ses œuvres comme des tableaux et plus encore comme des mises en scène théâtrales, dont il était friand ; il joue avec virtuosité du contraste entre les chairs nues, polies, et les larges drapés qu'il anime dramatiquement pour susciter l'émotion. L'échec de son séjour à Paris en 1665 ne résulte pas d'une opposition entre baroque et classicisme, mais seulement d'une méconnaissance des usages français de construction et de distribution.
Il se concilia par son talent précoce la faveur du pape Paul V. Favori des papes, il devient l'architecte de la basilique Saint-Pierre. Il fut employé sans interruption par les pontifes : Grégoire XV le nomma chevalier ; Urbain VIII le combla de richesses ; plutôt en disgrâce sous le pontificat d'Innocent X il n'en conçut pas moins la fontaine des quatre fleuves de la place Navone. On lui doit le baldaquin aux colonnes torsadées du maître-autel et le dessin de la majestueuse colonnade et des statues qui encerclent la place devant la basilique Saint-Pierre. Ses fontaines monumentales, dont celle des Quatre Fleuves, offrant à la vue de tous le déchaînement des forces vives du baroque, exerceront une grande influence sur l'urbanisme romain et sur l'organisation des places publiques dans les autres capitales européennes. Charles Ier d'Angleterre lui fit faire sa statue.
Sa vie
Gian Lorenzo Bernini est né en 1598 à Naples où son père Pietro, sculpteur florentin de second ordre, était venu travailler, mais il se forme entièrement à Rome où sa famille s'installe en 1605 ou 1606. Gian Lorenzo reçoit ses premières leçons de sculpture de son père et se révèle enfant prodige. Bernin raconta plus tard que, lorsqu'il avait huit ans, le cardinal Barberini avait dit à son père : Prenez garde, cet enfant vous surpassera et sera plus habile que son maître, à quoi Pietro répliqua : Je ne m'en soucie pas. À ce jeu-là, qui perd gagne. L'amour paternel qui transparaît dans cette réplique est certainement l'une des clés de la personnalité de Bernin, qui n'a rien d'un artiste saturnien comme Michel-Ange.
Constamment stimulé par son père, le jeune Bernini se forme en dessinant les marbres antiques du Vatican, notamment le Laocoon, l'Apollon du Belvédère et surtout l'Antinoüs dans lequel nous reconnaissons aujourd'hui un Hermès qu'il va consulter comme son oracle pour composer sa première figure, raconte-t-il en 1665 devant l'Académie de peinture et de sculpture de Paris, et dont il s'inspire encore pour sculpter les figures d'ange du pont Saint-Ange, 1668-1669, deux originaux aujourd'hui à Sant'Andrea delle Fratte. Il apprend aussi à grouper harmonieusement les figures en dessinant d'après les Stanze de Raphaël et Le Jugement dernier de Michel-Ange, se montre sensible au coloris et à l'atmosphère de Titien et de Corrège, et revient également à une étude directe de la nature, cherchant à saisir dans le miroir ou par de rapides esquisses la vérité de l'expression et du mouvement. Il y est encouragé par l'exemple de Caravage, dont les œuvres, petits tableaux de chevalet ou grandes toiles d'autel, ont ouvert la voie d'un retour à la leçon de la nature en réaction contre les virtuoses déformations de la maniera, et plus encore par les compositions d'Annibal Carrache qui le premier proposa dans ses fresques de la galerie Farnèse cette nouvelle synthèse entre idéal antique et vérité d'expression, qui fit la gloire de l'école bolonaise. Ce faisant, Bernin inverse en quelque sorte la démarche des artistes de la haute Renaissance : ceux-ci avaient renouvelé la peinture en étudiant la statuaire antique ; Bernin renouvelle la sculpture en s'inspirant de leurs œuvres.
Plus précoce encore que Michel-Ange, Gian Lorenzo aurait sculpté à treize ans un groupe qui put passer pour un antique, Zeus allaité par la chèvre Amalthée 1609 ? , galerie Borghèse, Rome, et à dix-sept ans un Saint Laurent, son saint patron martyrisé sur le gril vers 1614-1615, coll. Bonacossi, Florence, où il affirme sa maîtrise. Introduit par son père dans le cercle du pape Paul V Borghèse 1605-1621, puis auprès des cardinaux amateurs d'art, le jeune Bernin sculpte pour le cardinal Maffeo Barberini, le futur Urbain VIII, un Martyre de saint Sébastien 1615-1616 coll. Thyssen, Lugano et pour le cardinal Montalto, neveu de Sixte V, un Neptune et Triton, destiné à une fontaine vers 1620, Victoria and Albert Museum, Londres. Pour la villa du cardinal Scipion Borghèse, neveu de Paul V, où ils se trouvent toujours, il sculpte les groupes d'Énée, Anchise et Ascagne fuyant Troie 1619-1620, Pluton et Proserpine 1621-1622, Apollon et Daphné 1622-1625, qu'il saisit en pleine course et en pleine métamorphose. Il réalise également un David 1623-1624, pour lequel il prend le contre-pied du David serein et méditatif de Michel-Ange, en donnant à sa figure bandant sa fronde la torsion du Polyphème de Carrache à la galerie Farnèse. Comme les sculptures de Jean de Bologne, ces groupes, qui veulent rivaliser avec les groupes hellénistiques, font oublier qu'ils sont taillés dans un bloc de marbre. Bernin abandonne cependant les points de vue multiples chers aux maniéristes : faites pour être vues de face comme des tableaux, ses sculptures étaient présentées adossées aux murs de la galerie Borghèse.
S'intéressant aux expressions changeantes des visages sous l'effet de la souffrance Saint Laurent, déjà cité, et L'Âme damnée, vers 1619, de la peur Daphné ou de la détermination David, il taille aussi à cette époque ses premiers bustes, Paul V vers 1618, galerie Borghèse, Monsignor Pedro de Foix Montoya 1622, couvent de Sainte-Marie de Monserrato. Il réalise également plusieurs bustes en bronze et en marbre du pape Grégoire XV Ludovisi 1621-1623, qui le nomme cavaliere dès 1621, année où il est élu principe de l'académie de Saint-Lucie
Les œuvres de jeunesse 1609 - 1617
Sous le patronage du cardinal Scipion Borghèse, alors membre de la famille papale régnante, le jeune Bernini commence à être reconnu comme sculpteur de talent. Ses premières œuvres sont des pièces décoratives destinées à orner le jardin de la villa Borghèse, Priape et Flore, 1615 - 1616 aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art. Un groupe décoratif des Quatre Saisons commandé par Leone Strozzi pour le jardin de sa villa romaine dont les traits sensuels et réalistes des festons de fruits dénotent l'influence des œuvres caravagiennes présentes dans la collection du cardinal et auxquelles Le Bernin n'a pas pu échapper.
Dans sa première phase stylistique, on dénote une influence nette de la sculpture hellénistique dans des œuvres qui imitent à la perfection le style antique comme le révèlent le Saint-Sébastien de la collection Thyssen Bornemisza à Madrid et un Saint-Laurent sur le gril dans la collection Contini Bonacossi à Florence.
De cette période datent aussi un Putti avec dragon et un Faune émoustillé par des Amours, circa 1617, coll. Metropolitan Museum of Art qui sont sans doute encore des œuvres collectives, les premières créations indubitablement de la main du Bernin sont la Chèvre Amalthée avec Zeus enfant et un faune 1615, coll. Galerie Borghèse de facture naturaliste, le buste de Giovanni Battista Santoni conservé en l'église Santa Prassede de Rome et les allégories de l’Âme damnée et l’Âme sauvée 1619, conservées au Palazzo di Spagna.
Les groupes Borghèse
Avec les quatre groupes Borghèse qui l'occupent pendant cinq ans, Le Bernin atteint une gloire immédiate. Il s'agit de trois sujets mythologiques et un biblique correspondant aux centres d'intérêt antiquisants de leur commanditaire, le cardinal Scipion Borghèse :
Énée, Anchise et Ascagne 1619
Rapt de Proserpine 1622
David 1624
Apollon et Daphné 1622-1625
L’Énée et Anchise ne se démarque pas encore totalement de l'influence paternelle maniériste et est sans doute forcément influencé par une fresque de Raphaël dans la Stanza dell’Incendio di Borgo au Vatican où, fuyant l'incendie de Rome, un homme mûr porte son père sur ses épaules, suivi de son fils. D'un point de vue allégorique, l'œuvre représente les trois âges de la vie, où Anchise porte sur ses épaules une statue des dieux Lares, il est lui-même porté par son fils Énée alors qu'Ascagne les suit en soutenant le feu sacré, les trois, et la statue des ancêtres portée par Anchise fondant une représentation spatiale d'un arbre généalogique. D'un point de vue psychologique, il n'est pas innocent que Le Bernin choisisse ce thème un fils dans la force de l'âge portant son père affaibli sur ses épaules alors qu'il atteint la majorité.
Le Rapt de Proserpine est un sujet tiré des Métamorphoses d'Ovide quand Pluton enlève Proserpine. Il est offert au cardinal Ludovico Ludovisi neveu du pape Grégoire XV et secrétaire d’État, il reviendra par la suite dans les collections de la galerie Borghèse. Sa composition en spirale est faite pour accentuer le dynamisme dramatique et est soulignée par le mouvement des cheveux et des drapés. L'empreinte des doigts du dieu des enfers dans les chairs de Proserpine est virtuosement réaliste et participe aussi de l'effet dramatique du rapt.
Avec son David, Le Bernin, âgé d'à peine vingt-cinq ans, se mesure avec l'icône insurpassable de la Renaissance italienne, le David de Michel-Ange, l'un comme l'autre symbolisent à la perfection l'art de leur temps : autant l'œuvre michelangelesque est posée, digne, racée, élégante, autant Le Bernin parvient, en représentant David sur le point de lancer son projectile à l'aide de sa fronde, le torse tourné, le visage grimaçant d'effort, à réunir tous les éléments de l'art baroque : l'énergie, le mouvement, le dynamisme. Et l'on peut dire que celui-ci est le symbole de la Rome de la Contre-Réforme, d'une église prête à affronter ses adversaires alors que celui-là représente à la perfection la Florence de la Renaissance, fière cité jalouse de son indépendance. À moins qu'il ne s'agisse du geste du Bernin lui-même, défiant le Goliath-Michel-Ange.
Le sujet d’Apollon et Daphné est une fois de plus tiré des Métamorphoses d'Ovide : la nymphe Daphné, victime des ardeurs du dieu Apollon, supplie son père de lui venir en aide ; Pénée transforme alors sa fille en laurier et Le Bernin capture ce moment précis opérant par-là une mise en abyme puisque dans une scène pleine de vie et de pathos, il immobilise dans le marbre la jeune nymphe qui se fige dans une écorce protectrice et s'enracine dans la terre. Au risque de nous répéter, on ne peut que souligner la tension dramatique, l'impression de mouvement donnée par une construction en spirale typique de l'art baroque en général et marque de fabrique du Bernin en particulier. Avec cette œuvre, Le Bernin atteint un summum esthétique.
L'Âme damnée, Bernin
L'Âme damnée, marbre, vers 1619. Ambassade d'Espagne à Rome, Italie.
Gian Lorenzo Bernini, dit le Cavalier Bernin, Apollon et Daphné, 1622-1625, marbre de Carrare, hauteur 243 cm. Galleria Borghese, Rome. Détail des visages d'Apollon et de Daphné, où se mêlent les expressions de sentiments divers : surprise, puis déception chez le dieu, peur, étonnement, enfin soulagement chez la nymphe, qui, par sa métamorphose, parvient à lui échapper.
Le pontificat d'Urbain VIII Barberini, Grand ordonnateur des arts
En 1623, succédant à Grégoire XV, le florentin Maffeo Barberini monte sur le trône pontifical sous le nom d'Urbain VIII. Le Bernin trouve en lui le mécène idéal, Urbain mène une politique de grands travaux pour graver dans la pierre la volonté de reconquête de l'église comme force triomphante du paganisme via les missions et du protestantisme via la Contre-Réforme : une architecture spectaculaire, une esthétique communicante, persuasive et festive voire fastueuse en seront les vecteurs.
Première commande pontificale, dès 1623, une Santa Bibiana, statue destinée à orner l'église homonyme, déjà représentée en posture d'extase et qui s'intègre en une scénographie toute baroque aux fresques de Pierre de Cortone. Par la suite, il utilisera souvent l'effet théâtral des draperies, des jeux de marbres, de l'intégration de la peinture, de la dramatisation de la scène par un clair-obscur.
En 1624, le pape décide de l'édification d'un baldaquin de bronze au-dessus de l'autel de Saint Pierre. La construction s'étend de 1624 à 1633 et, pour ce faire, on utilise le bronze du Panthéon ce qui fera dire : Quod non fecerunt Barbari fecerunt Barberini Ce que les Barbares n'ont pas fait, les Barberini l'ont fait. Le génie théâtral du Bernin s'exprime à plein dans ce dais soutenu par des colonnes torses qui rappellent le trône et le temple du roi Salomon, iconographie jamais innocente liant Rome à Jérusalem, soulignant la continuité sinon la légitimité voire le primat du Vatican avec/sur le judaïsme. La modénature du monument souligne également l'importance des Barberini des abeilles en référence aux armes de la famille papale et la sûreté de leur goût le laurier, symbole d'Apollon et des arts.
Bernin dessine ainsi le nouveau portique de l'église Santa Bibiena 1624-1626, pour laquelle il sculpte aussi une statue de Sainte Viviane destinée à être placée dans une niche au-dessus du maître-autel. Mais son grand projet est le chantier de Saint-Pierre, qui l'occupe pratiquement jusqu'à sa mort. Il dessine le Baldaquin de marbre et de bronze qui se trouve sous le dôme à l'emplacement du tombeau de saint Pierre 1624-1633, et la décoration des quatre grands piliers qui supportent le dôme ; il y conçoit le projet de quatre statues colossales destinées à célébrer les reliques les plus précieuses de la basilique, se réservant l'exécution du Saint Longin dont le geste spectaculaire et le large plissé conviennent pour une vision à distance 1629-1638.
En 1627, le tombeau du pape est commandé au Bernin. Il sera achevé des années plus tard et placé en face de celui de Paul III, l'initiateur de la Contre-Réforme qu'Urbain VIII pensait avoir achevée. C'est l'occasion pour le Bernin de se mesurer, comme il l'a déjà fait avec son David, avec Michel-Ange qui avait réalisé le tombeau de Paul III. La statuaire représente le pape bénissant de la main, la Justice et la Charité à ses côtés et la Mort, sous forme d'un squelette aux pieds du Saint-Père, écrit son épitaphe ; l'idée iconographique novatrice est que la Mort elle-même est soumise au pouvoir du pape…
Le chantier du palais Barberini est confié, vers 1630, au Bernin en collaboration avec Francesco Borromini qui deviendra son grand rival par la suite. La fontaine du Triton Fontana del Tritone qu'il achève en 1643 est la première d'une longue série de réalisations de « mobilier urbain. La fontaine des abeilles Fontana delle Api immortalise peu après les trois abeilles symbole de la famille Barberini.
Pour le tombeau d'Urbain VIII à Saint-Pierre 1628-1647, Bernin s'inspire de la composition de Guglielmo della Porta pour le mausolée de Paul III Farnèse 1549-1575, mais il anime ses figures avec une remarquable autorité. Pendant sa disgrâce sous le pontificat d'Innocent X, Bernin conçoit ce qu'il considérera comme son œuvre la plus parfaite : la chapelle funéraire du cardinal vénitien Federico Cornaro, dans la petite église des carmélites de Sainte-Marie-de-la-Victoire 1645-1652. Il dessine un pavement de marbres, orné de médaillons dans lesquels s'animent des squelettes ; sur les côtés, il sculpte, comme accoudés à une tribune, les membres de la famille Cornaro et, au-dessus de l'autel, sainte Thérèse d'Avila en extase : la transverbération est fidèlement représentée d'après le récit de la nouvelle sainte, canonisée en 1622. Les expériences théâtrales de Bernin ne sont sans doute pas étrangères à cette véritable mise en scène de marbres.
Ces réalisations donnent à Bernin une renommée internationale. Comme Pierre de Cortone, Carlo Rainaldi et quelques autres, Bernin participe au concours international organisé par Colbert pour l'achèvement du Louvre et il est invité en France au printemps de 1665. Grâce au Journal tenu par Paul Fréart de Chantelou, maître d'hôtel du roi chargé d'assister Bernin, nous sommes parfaitement renseignés sur ce séjour de cinq mois, de juin à octobre, du Cavalier à Paris. Il établit alors un nouveau dessin pour le palais du Louvre, que l'on renonça finalement à exécuter, et sculpta un Buste de Louis XIV, 1665, Versailles. Le portrait est un genre que Bernin pratiqua épisodiquement toute sa vie, Cardinal Scipion Borghèse, 1632, galerie Borghèse, Rome ; Paolo Giordano Orsini, vers 1635, château de Bracciano ; Thomas Baker, vers 1638, Victoria and Albert Museum, Londres ; Urbain VIII, 1638, coll. part. ; François Ier d'Este, duc de Modène, 1650-1651, galerie Estense, Modène ; Gabriele Fonseca, vers 1670, chapelle funéraire de la famille Fonseca à San Lorenzo in Lucina. Son don d'observation du visage en mouvement qui est, comme le raconte fort bien Chantelou, l'élaboration d'un buste s'exprime aussi dans des caricatures, qui sont les premières à représenter des personnages en vue.
Le Bernin dessine les clochers qui devaient encadrer la façade de Maderno 1637, mais la tour sud se fissura, fut abattue en 1646, et les clochers ne furent jamais réalisés. En disgrâce au début du pontificat d'Innocent X Pamphili 1644-1655, le Cavalier garde la conduite du chantier de Saint-Pierre, dirigeant la décoration des écoinçons des arcs de la nef par des figures de Vertus, travail quasiment achevé par une armée de sculpteurs pour le jubilé de 1650. Sa maîtrise est telle que le pape, plus proche de Borromini, mais reconnaissant néanmoins qu'il est né pour traiter avec les plus grands princes, lui demande un buste vers 1647 et lui confie la réalisation de la Fontaine des Quatre-Fleuves, place Navone, sous les fenêtres du palais familial Pamphili 1648-1651. Bernin y pousse plus loin encore la virtuosité anthropomorphe de la Fontaine du Triton 1642-1643, place Barberini. Sous le pontificat d'Alexandre VII Chigi 1655-1667, qui veut renouer avec la grande politique d'Urbain VIII et lui rend toute sa confiance, le Cavalier exécute le dessin de la place Saint-Pierre 1656-1667. Ce parvis monumental, destiné à contenir la foule des pèlerins lors des bénédictions urbi et orbi, rappelle la grandeur de la Rome antique et s'inspire peut-être du cortile Baccanario, péristyle qui servait de parvis au prétendu temple de Bacchus, en fait mausolée de Sainte-Constance, gravé par Serlio. Presque en même temps, Bernin conçoit dans l'abside un monument destiné à porter la chaire de saint Pierre, 1657-1666 ; symbole du pouvoir pontifical et exaltation de la cathedra Petri, elle est soutenue par les quatre Pères de l'Église 1657-1666. Pour le palais du Vatican, le Cavalier dessine la Scala regia 1663-1666, qu'il orne d'une statue équestre de Constantin 1654-1670 et qu'il anime d'une colonnade en perspective accélérée comme Borromini l'avait fait au palais Spada 1652. Mais s'il imite ici Borromini, son architecture prend généralement le contre-pied de celle de son rival, dont il condamne le libertinage architectural, déclarant qu'il préfère un mauvais catholique à un bon hérétique. Lorsqu'il s'inspire de Michel-Ange, c'est plus de l'architecte classique de la place du Capitole ou de Saint-Pierre que de l'hérétique à la fantaisie trop libre de la porta Pia. Pour l'église du noviciat des jésuites, Saint-André-au-Quirinal 1658-1670, il dessine une façade qui est une variation sur la travée du palais des Conservateurs de la place du Capitole et délimite un espace ovale beaucoup plus banal que celui de l'église voisine de Borromini, Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines. Borromini à Saint-Charles et à Saint-Yves-de-la-Sapience crée un espace complexe qu'il décore de stuc blanc et or, alors que Bernin transfigure l'espace en utilisant marbres polychromes et en multipliant les statues. Pour Sainte-Marie-de-l'Assomption à Ariccia 1662-1664, il revient à un langage architectural encore plus sage, sobre variation sur le thème du Panthéon.
Dans ses dernières œuvres, Daniel et Hababuc et l'ange 1655-1657 et 1655-1661, chapelle Chigi de Sainte-Marie-du-Peuple, la Sainte Madeleine et le Saint Jérôme 1661-1663, chapelle Chigi de la cathédrale de Sienne, les Anges qui devaient couronner la balustrade du pont Saint-Ange, la Statue équestre de Louis XIV 1670, qui déplut au roi et fut transformée en Marcus Curtius Versailles, le Tombeau d'Alexandre VII 1671-1678, Saint-Pierre, les figures, plus libres, s'allongent, se balancent, les drapés sont plus expressifs, le contraposto plus marqué. Dans la chapelle Altieri à San Francesco a Ripa, dessinée en 1674 pour le cardinal Paluzzi degli Albertoni, apparenté au pape Clément X 1670-1676, dont il prit le nom, le Cavalier retrouve les problèmes artistiques qu'il avait résolus à la chapelle Cornaro. L'éclairage indirect des fenêtres illumine le lit où est étendue la bienheureuse Ludovica Albertoni mourante, dont le culte fut institué en 1671. Les toutes dernières œuvres de Bernin furent un buste du Salvator Mundi pour la reine Christine de Suède et des projets de restauration du palais de la Chancellerie pour Innocent XI Odescalchi 1676-1689, le huitième pape qu'il ait servi.
Le pontificat
En 1644, Gian Battista Pamphili est élu au trône de Saint-Pierre. C'est un pape austère ou aux ambitions artistiques limitées par la crise des finances du Saint-Siège fin de la guerre de Trente Ans et traités de Westphalie. Coup dur à la réputation du Bernin, c'est aussi l'année de la démolition du campanile de la basilique Saint-Pierre pour des raisons de statique. Ses concurrents en profitent pour faire valoir leur place, Borromini obtient le chantier de Saint-Jean de Latran, Carlo Rainaldi construit le Palazzo Pamphilj et commence la construction de l'église Sainte-Agnès en Agone sur la Piazza Navona.
Le Bernin n'est pas en disgrâce mais cela y ressemble presque et il faut l'habile médiation du prince Niccolò Ludovisi pour qu'on lui commande la réalisation de la magnifique fontaine des Quatre-Fleuves 1648 - 1651.
Entre 1647 et 1652, Le Bernin travaille sur ce qui est son chef-d'œuvre et celui de la sculpture baroque, l’Extase de sainte Thérèse dans la chapelle Cornaro de Santa Maria Della Vittoria à Rome. Commande du cardinal Federico Cornaro pour célébrer sainte Thérèse récemment canonisée 1622 et première carmélite à l'avoir été. La lumière zénithale accentue la position extatique de la sainte, comme terrassée par la flèche mystique de l'ange.
Durant cette décennie, il réalise également un Monument à la sœur Maria Raggi à Santa Maria sopra Minerva, une Verità aujourd'hui dans la galerie Borghèse, un buste d'Innocent X coll. Galleria Doria Pamphili et un buste de Francesco I d’Este coll. museo Estense di Modena.
Le pontificat d'Alexandre VII Chigi
Alexandre VII est un pape humaniste et urbaniste qui monte sur le trône de saint Pierre en 1655.
Il commande au Bernin la colonnade de la place Saint-Pierre lequel trouve une solution urbanistique et symbolique élégante en concevant une colonnade qui s'écarte depuis la basilique comme deux bras qui accueilleraient la foule. Dans son projet, l'architecte aurait souhaité fermer entièrement la place par une troisième aile à l'est de celle-ci, mais la mort d'Alexandre VII, interrompit définitivement les travaux1. Le plan elliptique est typique de l'architecture baroque influencée par les découvertes contemporaines en astronomie, l'usage de l'ellipse se généralisera pour devenir un lieu commun de l'architecture baroque et rococo.
Cathedra Petri
Avant cela, le Bernin a réalisé, pour l'abside de la basilique Saint-Pierre, la Chaire de saint Pierre Cathedra Petri, ajoutant un chef-d'œuvre de plus à la liste déjà longue. L'œuvre est un reliquaire contenant la cathèdre paléochrétienne, portée par les statues monumentales des quatre pères de l'Église, symboles de la sagesse et de la connaissance qui soutiennent l'autorité papale. L'originalité est ici de situer le siège de l'évêque (et le pape, successeur de saint Pierre n'est autre qu'un évêque parmi d'autres dans une longue lignée, en théorie appelé à s'asseoir sur la chaire du premier évêque de Rome) en hauteur, comme inaccessible, inatteignable, affirmant indirectement la suprématie de Rome sur les autres patriarcats.
De 1658 à 1678, il travaille à l'édification de l'église Saint-André du Quirinal dont le plan elliptique servira de modèle pour nombre d'églises baroques par la suite. Le Bernin, qui a beaucoup contribué à l'embellissement ou la complétion de bâtiments existants et peu construit d'édifices dans leur totalité considère cette église comme son chef-d'œuvre architectural.
Le Bernin est un artiste de réputation internationale et, dès 1664, Colbert l'invite en France pour le compte de Louis XIV qui doit faire pression sur le pape pour qu'il libère son architecte préféré, lequel part pour Paris en avril 1665 pour travailler sur la restructuration du Louvre. Reçu comme un prince, il réalise alors un buste du roi, mais aucun de ses projets de façade pour le Louvre ne sera retenu, marquant le début du déclin de l'influence italienne sur l'art architectural français. On lui préfère le projet de Claude Perrault. La statue équestre du roi, qu'il avait proposée lors de son séjour en France, et qui sera réalisée quelques années plus tard à Rome, sera livrée, mais exilée dans un coin peu prestigieux du parc de Versailles. Il retourna à Rome dès octobre 1665.
Comme pour Urbain VIII, il réalise le tombeau d'Alexandre VII avec les allégories de la Charité, de la Vérité devant la Prudence et la Justice avec une porte qui symbolise le passage vers l'au-delà.
Les dernières années
Extase de la bienheureuse Ludovica Albertoni 1675
Sous Clément IX, Le Bernin réalise une série d'anges pour le pont Saint-Ange de Rome. De cette série, seule une statue est de la seule main du Bernin laquelle est aujourd'hui conservée en la basilique Sant'Andrea delle Fratte.
Il s'attaque une ultime fois au thème de l'extase avec celle de la bienheureuse Ludovica Albertoni terminée en 1674.
Il meurt à Rome en 1680 et est enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure.
Deux ans après sa mort, la reine Christine de Suède, alors en exil à Rome commande sa biographie à Philippe Baldinucci La Vie du chevalier de Bernin.
Œuvres Sculptures
Éléphant par Le Bernin, Piazza Minerva
Fontaine de la Barcaccia
Fontaine du Triton
Fontaine des Quatre-Fleuves
Buste de Louis XIV par Le Bernin, salon de Diane, Versailles, 1665.
Buste de Giovanni Battista Santoni c. 1612 - Marbre, Basilique Santa Prassede, Rome.
Saint Laurent sur le grill 1614-1615 - Marbre, 66 × 108 cm, Contini Bonacossi Collection, Florence.
La Chèvre Amalthée avec Jupiter enfant et un faune 1615 - Marbre, Galerie Borghèse, Rome.
Saint Sébastien c. 1617 - Marbre, Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.
Faune émoustillé par des Amours 1616-1617 - Marbre, 132 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.
Énée, Anchise et Ascagne 1618-1619 - Marbre, 220 cm, Galerie Borghèse, Rome
Âme damnée 1619 - Palazzo di Spagna, Rome.
Âme sauvée 1619 - Palazzo di Spagna, Rome.
Buste du Cardinal Escoubleau de Sourdis 1620 - Musée des beaux-arts de Bordeaux, Bordeaux.
Annonciation ? - groupe sculpté par Bernini le père pour l'Archange Gabriel et la Vierge par Gian Lorenzo Bernini, Église Saint-Bruno, Bordeaux.
Apollon et Daphné 1622-1625 - marbre, 243 cm, Galerie Borghèse, Rome.
La Charité avec quatre enfants 1627-1628 - terre cuite, 39 cm, Musées du Vatican, Vatican.
David 1623-1624 - marbre, 170 cm, Galerie Borghèse, Rome.
Fontana della Barcaccia 1627-1628 - marbre, Piazza di Spagna, Rome
Buste de Monsignor Pedro de Foix Montoya c. 1621 - marbre, Santa Maria di Monserrato, Rome
Neptune et Triton 1620 - marbre, 182 cm, Victoria and Albert Museum, Londres.
Le Rapt de Perséphone 1621-1622 - marbre, 295 cm, galerie Borghèse, Rome.
Fontaine du Triton Fontana del Tritone 1624-1643 - travertin, Piazza Barberini, Rome.
Tombe d'Urbain VIII 1627-1647 - bronze doré et marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican.
Buste de Thomas Baker 1638 - marbre, 81,6 cm, Victoria and Albert Museum, Londres.
Buste de Costanza Bonarelli c. 1635 - marbre, 70 cm, Bargello, Florence.
Charité avec deux enfants 1634 - terre-cuite, 42 cm, musées du Vatican, Vatican.
Saint Longinus 1631-1638- marbre, 450 cm, basilique Saint-Pierre, Vatican.
Buste de Scipione Borghèse 1632 - marbre, height 78 cm, galerie Borghèse, Rome
Buste de Scipione Borghèse 1632 - marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican.
Buste d'Urbain VIII 1632-1633 - bronze, 100 cm, musées du Vatican, Vatican.
Buste du Cardinal Armand de Richelieu 1640-1641 - marbre, Musée du Louvre, Paris.
Mémorial à Maria Raggi 1643 - bronze doré et marbres polychromes, Santa Maria sopra Minerva, Rome.
Buste d'Innocent X circa 1650- marbre, Galerie Doria-Pamphilj, Rome.
La Vérité 1645-1652 - marbre, 280 cm, Galerie Borghèse, Rome.
L'Extase de Sainte Thérèse (647-1652 - marbre, Chapelle Cornaro, Santa Maria della Vittoria, Rome.
Loggia des fondateurs 1647-1652 - marbre, Chapelle Cornaro, Santa Maria della Vittoria, Rome.
Buste d'Urbain - marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican.
Noli me tangere 1649 marbre, Église Santi Domenico e Sisto, Rome.
Fontaine des Quatre-Fleuves 1648-1651 - travertin et marbre, Piazza Navona, Rome.
Daniel et le lion 1650 - marbre, Santa Maria del Popolo, Rome.
François Ier d'Este 1650-1651 - marbre, 107 cm, Galleria Estense, Modène
Fontaine du Maure 1653-1654 - marbre, Piazza Navona, Rome
Constantin 1654-1670 - marbre, Palais du Vatican, Vatican.
Daniel et le lion 1655 - terre-cuite, 42 cm, Musées du Vatican, Vatican.
Habacuc et l'ange 1655 - terre-cuite, 52 cm, Musées du Vatican, Vatican.
Buste de Louis XIV 1655- terre-cuite, 52 cm, Musées du Vatican, Vatican.
Buste de Louis XIV 1682- terre-cuite, Place Royale, Québec, Canada
Croix d'autel 1657-1661 - bronze doré, 185 cm, basilique Saint-Pierre, Vatican.
Trône de Saint Pierre 1657-1666 - marbre, bronze, stuc, basilique Saint-Pierre, Vatican.
Saint Augustin 1657-1666 - bronze, basilique Saint-Pierre, Vatican.
Constantin, Scala Regia 1663-1670 - marbre et stucs polychromes, Palais du Vatican, Vatican.
Ange debout avec un parchemin 1667-1668 - terre-cuite, 29 cm, Fogg Art Museum, Cambridge.
Ange avec la couronne d'épines 1667-1669 - marbre, Basilique Sant'Andrea delle Fratte, Rome.
Ange avec les Écritures 1667-1669 - marbre, over life-size, Sant'Andrea delle Fratte, Rome
Éléphant de la Minerve 1667-1669 - marbre, Piazza di Santa Maria sopra Minerva, Rome attribué par certains à Giuseppe Paglia.
Buste de Gabriele Fonseca 1668-1675 - marbre, San Lorenzo in Lucina, Rome.
Statue équestre de Louis XIV 1669-1670 - terre-cuite, 76 cm, Galerie Borghèse, Rome.
Statue équestre de Louis XIV 1671-1677, transformée en Statue équestre de Louis XIV sous les traits de Marcus Curtius par Girardon - marbre, château de Versailles.
Buste de Louis XIV 1665 - marbre, 105 × 99 × 46 cm, salon de Diane, Château de Versailles, Versailles.
Herm de Saint Étienne de Hongrie - bronze, Cathédrale de Zagreb, Zagreb.
Saint Jérôme 1661-1663 - marbre, 180 cm, Chapelle Chigi, Duomo di Siena, Sienne.
Tombe d'Alexandre VII 1671-1678- marbre et bronze doré, basilique Saint-Pierre, Vatican. Au sommet le pape est en prière; au-dessous de lui un précieux suaire, au centre, un squelette surgit de la porte de la mort tenant une clepsydre pour avertir le pape de sa fin proche.
Bienheureuse Ludovica Albertoni 1671-1674 - marbre, Chapelle Altieri-Albertoni, de l'Église San Francesco a Ripa, Rome.
Buste Salvator mundi 1680 - marbre Disparu à la fin du XVIIe siècle, il a été redécouvert à Rome au couvent Saint-Sébastien-hors-les-murs. Ce buste avait été offert par La Bernin à Christine de Suède, grande amie du sculpteur2
Souvenir funèbre d'Ippolito Merenda (ate inconnue - église San Giacomo in Settimiana, via della Lungara, Rome. Monument représentant un squelette ailé qui plane en soutenant, de ses doigts crochus et de ses dents, le cartouche commémoratif du défunt, un juriste.
Architecture
Façade de l'église Santa Bibiana c. 1623, Rome.
Baldaquin de la basilique Saint-Pierre 1624 – 1633, Rome.
Baldaquin de la basilique San Crisogono, Rome.
Chapelle Cornaro en l'église de Notre-Dame de la Victoire, contenant la célèbre Extase de Sainte Thérèse 1647 – 1652, Rome.
Palazzo Montecitorio c. 1650, Rome.
Fontaine des Quatre-Fleuves 1651, Rome.
Colonnade de la place Saint-Pierre c. 1660, Rome.
Restauration de l'église Sainte-Marie-du-Peuple 1655 - 1661, Rome - avec en particulier la décoration de la nef et du transept et réalisation de la chapelle Chigi.
Église Saint-André du Quirinal 1658 - 1678, Rome.
Palais Chigi c. 1660, Rome.
Scala Regia au Vatican 1662 - 1668, Rome - avec en particulier une statue équestre de Constantin.
Colonnade du Louvre 1665, Paris.
Peintures
Pour Le Bernin, la peinture est une activité annexe. Ses toiles révèlent néanmoins une touche sûre dénuée de pédanterie.
Saint André et Saint Thomas c. 1627 - huile sur toile, 59 × 76 cm, National Gallery, Londres
Portrait de garçon c. 1638 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome
Autoportrait en jeune homme c. 1623 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome
Autoportrait à l'âge mûr 1630-1635 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome
Portrait d'Urbain VIII
Liens
http://youtu.be/d7CrI5uxEJg le Bernin en musique
http://youtu.be/NzjBH9nb-f0 ( Geoffroy Drouin )
http://youtu.be/P0uY8YorFC4 (geoffroy Drouin)
http://youtu.be/WNHS3cQrYdo Le Bernin
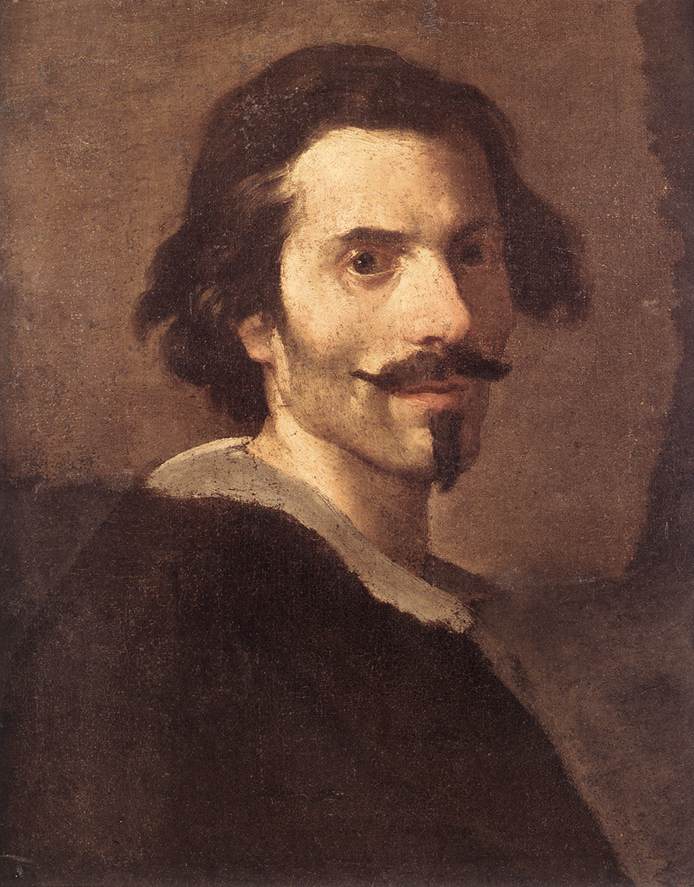       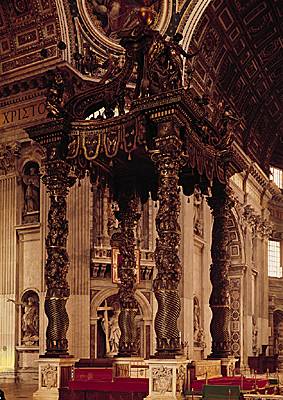       
Posté le : 06/12/2014 18:26
|
|
|
|
|
William Bouguereau |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57813
|
Le 30 novembre 1825 à La Rochelle naît William Bouguereau
de son nom Adolphe-William ou William-Adolphe Bouguereau, mort le 19 août 1905, à 79 ans dans la même ville, peintre français représentatif de la peinture académique.Il reçoit sa formation à l'école des beaux-arts de Paris, où il a pour maître François-Edouard Picot et pour élèves Elizabeth Jane Gardner Bouguereau, Gustave Doyen et Guillaume Seignac, il appartient au mouvement
artistique Peinture académique, il a pour mécènes Paul Durand-Ruel, il est influencé par Ingres. Ilm reçoit pour récompense le second Prix de Rome en 1848, le premier Prix de Rome en 1850, et il est Grand officier de la Légion d'honneur. Ses Œuvres les plus réputées sont Zénobie retrouvée par les bergers sur les bords de l'Araxe, La naissance de Vénus.
Grand prix de Rome en 1850, académiste épris de Raphaël, il fut une gloire officielle sous le second Empire et au début de la IIIe République
Son acte de naissance indique Adolphe Williams Bouguereau, mais la dénomination d'usage est celle de la signature de ses tableaux, William Bouguereau.
En bref
Par sa formation et surtout par les étapes de sa carrière soigneusement franchies, William Bouguereau appartient à la peinture académique française qui a eu droit à tous les triomphes officiels comme au mépris et à l'oubli des historiens de l'art moderne. Après un apprentissage à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, le jeune peintre originaire de La Rochelle est admis à Paris dans l'atelier de Picot 1846, un des hauts lieux de l'enseignement académique où métier et carrière se préparent. Le prix de Rome, remporté en 1850, lui vaut l'indispensable séjour italien qui semble l'orienter vers les sujets historiques et religieux. Dès son retour en France, ses compositions sont remarquées et achetées par l'État ou par des collectionneurs étrangers. À la célébrité s'ajoutent les récompenses : accès à l'Institut, médailles obtenues lors des expositions, Légion d'honneur, véritable cursus honorum des arts qui consacre le talent et confère au peintre un rôle de conscience et de censeur sur l'ensemble de la production artistique soumise aux jurys dont il fait partie. Rendant, au Salon de 1877, un pédant hommage à Ingres avec sa Vierge consolatrice, il tente d'intégrer le goût néo-byzantin proche des décorations réalisées pour des églises parisiennes, Sainte-Clotilde, Saint-Augustin. On critique sa technique froide, son sentiment est pincé, sa matière picturale est trop fine, trop léchée. Pourtant l'aspect de ses esquisses est beaucoup plus personnel, avec des coups de brosse fluides et des couleurs franches rappelant une certaine fougue romantique. Mais, lors de l'exécution du tableau, on applique les recettes de l'art officiel qui rendent le modelé plat, l'expression rigide, la touche pauvre, glacée par un vernis brillant. Substance des formes et lumière disparaissent dans une sorte de peinture gazeuse comme l'écrit Huysmans. Au demeurant, l'invention est médiocre et les figures se répètent : la plupart du temps des nus aux rondeurs bourgeoises ; vers 1900, remarque Pierre Francastel, c'est Bouguereau qui donnait le frisson, qui émoustillait le bon public. Ses défauts sont ceux de la peinture académique. Ce producteur fécond pour clientèle de riches amateurs a dominé avec d'autres peintres — comme Cabanel — l'art officiel des dernières années du siècle, au moment où luttent pour s'affirmer des artistes comme Manet ou les impressionnistes, porteurs d'une autre conception de l'art. On oublie moins aujourd'hui les peintres académiques qui ont cru transmettre — à l'exemple de Bouguereau — une vision picturale immuable au moyen d'une facture laborieuse.
Sa vie
Il est le fils d'un négociant en vins de Bordeaux et sa famille, de confession catholique, a des origines anglaises.
Il apprend le dessin à l'école municipale de dessins et de peintures de Bordeaux. En 1846, il entre aux Beaux-arts de Paris dans l'atelier de François-Édouard Picot sur la recommandation de J. P. Allaux. Il remporte le second prix de Rome ex æquo avec Gustave Boulanger pour sa peinture Saint Pierre après sa délivrance de prison vient retrouver les fidèles chez Marie 1848.
Il remporte le Premier Prix de Rome en 1850 avec Zénobie retrouvée par les bergers sur les bords de l'Araxe.
En 1866, le marchand de tableaux Paul Durand-Ruel s'occupe de sa carrière et permet à l'artiste de vendre plusieurs toiles à des clients privés. Il a ainsi énormément de succès auprès des acheteurs américains, au point qu'en 1878 lors de la première rétrospective de sa peinture pour l'exposition internationale de Paris, l'État ne peut rassembler que douze œuvres, le reste de sa production étant localisée aux États-Unis. Il passe aussi un contrat avec la maison d'édition Goupil pour la commercialisation de reproductions en gravure de ses œuvres.
Professeur en 1888 à l'école des beaux-arts de Paris et à l’Académie Julian, ses peintures de genre, réalistes ou sur des thèmes mythologiques sont exposées annuellement au Salon de Paris pendant toute la durée de sa carrière. Il travaille aussi à de grands travaux de décoration, notamment pour l'hôtel de Jean-François Bartholoni, et fait aussi le plafond du Grand-Théâtre de Bordeaux.
En 1876, il devient membre de l'Académie des beaux-arts, mais l'année suivante est marquée par des deuils successifs, d'abord deux de ses enfants et ensuite son épouse décèdent.
En 1885, il est élu président de la Fondation Taylor, fonction qu'il occupera jusqu'à la fin de sa vie. Il obtient la médaille d'honneur au Salon.
À un âge assez avancé, Bouguereau épouse, en deuxièmes noces, une de ses élèves, le peintre Elizabeth Jane Gardner. Le peintre use également de son influence pour permettre l'accès des femmes à beaucoup d'institutions artistiques en France.
Il meurt en 1905 à La Rochelle.
Un peintre de la femme
Ses tableaux sur la mythologie grecque foisonnent et renvoient aux thèmes déjà repris par la Première Renaissance et le néo-classicisme, périodes qui ont influencé sa peinture, il a notamment abondamment traité des sujets allégoriques. De nombreuses scènes idylliques, champêtres et bucoliques constituent son répertoire.
Ce travailleur opiniâtre obtint un immense succès en France et en Amérique avec ses nus féminins et les compositions mythologiques qui leur servent de prétexte Flore et Zéphyr, 1875, musée de Mulhouse. Si certains sont réalistes jusqu'à la minutie, mièvres ou même ridicules, d'autres, par contre, atteignent par leur matière vitrifiée et leur délicatesse de tons à une poésie suave la Naissance de Vénus, 1879, Paris, Orsay. Les tableaux religieux de Bourguereau, essais de synthèse entre la Renaissance italienne, l'art byzantin et le Préraphaélisme anglais, Mater afflictorum, 1877, musée de Strasbourg, témoignent de son souci de perfection graphique, de sa facture soignée et de la sincérité de son inspiration Regina angelorum, 1900, Paris, Petit Palais. Les décorations murales qu'il exécuta à la cathédrale de La Rochelle et à Paris pour Sainte-Clotilde, Saint-Augustin ou Saint-Vincent-de-Paul, bien qu'habilement composées, sont plus lourdes et ternes. Membre de l'Institut en 1881, il joua, avec Cabanel, un rôle primordial dans la direction du Salon officiel et, très intransigeant lors de l'intervention du jury au Salon, soutint le rejet systématique de Manet et des Impressionnistes. Il devait être le premier artiste " pompier " français à qui fut consacrée une exposition personnelle Paris, gal. Breteau. Il a depuis été très largement étudié surtout aux États-Unis expositions à New York, Detroit et San Francisco, 1974-75, puis Paris, Montréal et Harford en 1984-85.
Un bon nombre de ses tableaux illustrent également les thèmes des liens familiaux et de l'enfance.
Entre toutes ses peintures, son thème de prédilection revient à l'image de la femme. Avec Cabanel, Gervex et Gérome son nom est associé au genre du nu académique. Sa Naissance de Vénus est emblématique, d'une peinture sensuelle profondément influencée par les vénus d'Ingres. C'est avec ce genre qu'il connaîtra le plus de succès mais rencontrera aussi le plus de critiques. À cause de la texture lisse et minutieuse de sa peinture, Joris-Karl Huysmans dira à son encontre : Ce n'est même plus de la porcelaine, c'est du léché flasque!. Le peintre impressionniste Edgar Degas invente le verbe bouguereauter pour désigner ironiquement l'action de fondre et de lisser le rendu pictural de cette manière.
Après le deuil qu'il subit en 1877 il se tourne vers une peinture à thème religieux et délaisse les thèmes en rapport avec l'Antiquité de ses débuts.
Postérité
Déconsidéré en Europe peu après sa mort et jusque vers la fin du XXe siècle, son œuvre y est redécouverte tardivement. De son vivant, les toiles de Bouguereau sont très recherchées par de riches Américains qui les achètent à des prix élevés, de sorte qu'une grande partie de ses œuvres a quitté la France.
Dans le contexte du xxe siècle, où l'influence du modernisme grandit en histoire de l'art pour en devenir finalement le courant officiel, l'art académique se trouva discrédité, dévalué, sévèrement critiqué par une pensée moderniste favorable à l'art d'avant-garde et mis à l'index. Les artistes académiques comme Bouguereau connurent alors une dévaluation très significative. Pendant des décennies, le nom du peintre a même fréquemment disparu des encyclopédies généralistes et des enseignements artistiques ou fut simplement mentionné comme celui d'un exemple à ne pas suivre, objet de moqueries souvent appuyées sur des citations de Zola ou de Huysmans et entaché par des rumeurs diffamantes. On reprocha au peintre sa participation aux jurys des Salons officiels de peinture du XIXe siècle qui étaient majoritairement opposés à l'admission des œuvres relevant des mouvements modernes de la peinture Cézanne surnommait le Salon Salon de Bouguereau .
À partir des années cinquante, Salvador Dalí manifeste son admiration pour l'art de Bouguereau, qu'il oppose à Picasso, et contribue à sa redécouverte. Dans Les cocus du vieil art moderne, Salvador Dali écrit : Picasso qui a peur de tout, fabriquait du laid par peur de Bouguereau. Mais, lui, à la différence des autres, en fabriquait exprès, cocufiant ainsi ces critiques dithyrambiques qui prétendaient retrouver la beauté.
Depuis l'exposition rétrospective de ses œuvres organisée au Petit Palais à Paris en 1984, la réputation de Bouguereau s'est progressivement améliorée, sur fond de controverse entre partisans et opposants au retour en grâce de la peinture académique. Ainsi, à l'ouverture du musée d'Orsay, à Paris en 1986, l'exposition d'œuvres académiques est sévèrement critiquée par une majorité de critiques d'art. En 2001, Fred Ross, président du Art Renewal Center qui promeut la réhabilitation de Bouguereau, fustige ce qu'il estime être une propagande du modernisme ayant conduit, selon lui, au système de pensée le plus oppressif et restrictif de toute l'histoire de l'art. Il édite un catalogue raisonné de l'œuvre peint de Bouguereau écrit par Damien Bartoli.
En 2006-2007 a lieu au Philbrook Museum of Art une exposition consacrée au peintre et à ses élèves américains. La cote élevée de ses peintures témoigne du regain d'intérêt des collectionneurs d'art pour son œuvre et du goût du public pour ses peintures dans les musées.
Œuvres dans les collections publiques peintures de William Bouguereau
Flore et Zéphyr, 1875, musée des beaux-arts de Mulhouse.
France
Égalité, 1848, musée d'Orsay, Paris.
Dante et Virgile, 1850, musée d'Orsay, Paris.
La Danse, 1856, musée d'Orsay, Paris.
Vierge consolatrice, 1875, Musée des Beaux-Arts, Strasbourg.
Flore et Zéphyr, 1875, Musée des Beaux-Arts, Mulhouse.
La naissance de Vénus, 1879, musée d'Orsay, Paris.
Compassion, 1897, musée d'Orsay, Paris.
L'Assaut, 1898, musée d'Orsay, Paris.
Les Oréades, 1902, musée d'Orsay, Paris.
Vierge aux anges, 1900, Petit Palais, Paris.
Le Jour des morts, 1859, musée des beaux-arts, Bordeaux.
Bacchante jouant avec une chèvre, 1862, musée des beaux-arts, Bordeaux.
Une Âme au Ciel, 1878, Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord, Périgueux.
Flagellation de Notre Seigneur Jésus-Christ, 1880, musée des beaux-arts de La Rochelle en dépôt à la Cathédrale Saint-Louis de La Rochelle.
L'Océanide, 1904, musée des beaux-arts de La Rochelle.
Étude de tête femme, vers 1894, musée d'Évreux
Argentine
Premier Deuil, 1888, musée national des beaux-arts, Buenos Aires
Canada
Parure des champs, 1884, musée des beaux-arts de Montréal, Québec
Cuba
Le Crépuscule, 1882, National Museum of Art, La Havane
Espagne
Baigneuse, 1870, musée Gala-Salvador Dali
Après le Bain, 1875, Museo Teatro Salvador Dali, Figueiras
États-Unis
L'Art et la Littérature, 1867, Arnot Art Museum, New York
Amour Fraternel, 1851, Museum of Fine Arts, Boston
La Bataille des Centaures et des Lapithes, 1853, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond
Le Printemps, 1866, Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska
Premières Caresses, 1866, Lyndhurst, National Trust for Historic Preservation, New York
L'art et la Litterature, 1867, Arnot Art Museum, New York
La Tricoteuse, 1869, Joslyn Art Museum in Omaha, Nebraska
La Sœur aînée, 1869, musée des beaux-arts de Houston
Homère et son guide, 1874, Milwaukee Art Museum, Milwaukee
La Charité, 1878, Smith College Museum of Art, Massachusetts
Jeune fille se défendant contre Éros, 1880, Getty Center, Los Angeles, Californie
Les Noisettes, 1882, Detroit Institute of Arts, Detroit
Enfant au Bain, 1886, Henry Art Gallery, University of Washington
Les Petites Mendiantes, 1890|, Syracuse University of Art Gallery
Fille, 1895, Carnegie Institute Museum of Art, Pittsburgh
L'admiration, 1897, Museum of Art, San Antonio, Texas
Inspiration, 1898, Columbus Museum of Art, Columbus, Ohio
Idylle Enfantine, 1900, Denver Art Museum, Colorado
Jeune Prêtresse, 1902, Memorial Art Gallery of the University of Rochester
Grande-Bretagne
Famille Indigente, 1865, Birmingham Museum and Art Gallery, Birmingham
Inde
Biblis, 1884, Salar Jung Museum
Œuvres
Prix, récompenses
1848, second prix de Rome pour Saint Pierre après sa délivrance de prison, vient retrouver les fidèles chez Marie .
1850, premier grand prix de Rome pour Zenobie retrouvée par les bergers sur les bords de l'Araxe .
Élèves
Henri Beau 1863-1949
William Barbotin
Henri Biva 1848-1928, à l'Académie Julian
Paul Chabas
Louis-Joseph-Raphaël Collin 1850-1916
François-Alfred Delobbe
Louis-Marie Désiré-Lucas
Théophile Deyrolle1844-1923
Jean de Francqueville
Gabriel Guérin 1869-1916
Émile Jourdan 1860-1931
Charles Amable Lenoir
Georges Meunier
Jules Ronsin 1867-1937
Lucien Simon 1861-1945 de 1880 à 1883
Émile Vernon
Émilie Desjeux
Liens
http://youtu.be/tPCnyYCB8_s Diaporama La pudibonderie américaine est effroyable (ce lien était bloqué il faut donner son âge !!!, pas de corps nus, par contre des gens qui se dégomment à coup de mitraillettes pas de problèmes !!!!
http://youtu.be/hpchE6ZrvNI Diaporama
http://youtu.be/ImDLYChb_Tg diaporama musical
http://youtu.be/eMmoayz4wDg diaporama
http://www.ina.fr/video/SXC02008782/a ... -a-la-peinture-video.html William Bouguereau
[img width=600]http://dedictvipredku.files.wordpress.com/2013/11/a0100212_4970838bdece1.jpg?w=629&h=1024[/img]   [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Biblis_(1884).jpg[/img]        
Posté le : 29/11/2014 21:45
Edité par Loriane sur 30-11-2014 14:57:46
|
|
|
|
|
Francis Picabia |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57813
|
Le 30 novembre 1953, à 74 ans meurt Francis-Marie Martinez de Picabia
à Paris, né le 22 janvier 1879 à Paris 2e, peintre, graphiste et écrivain proche des mouvements Dada et surréaliste.Artiste peintre, graphiste, écrivain, formé à l'École des beaux-arts, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, il appartient au mouvement artistique Dadaïsme, surréalisme, ses Œuvres réputées sont Corrida, 1926-1927, Le Matador dans l'arène, 1941-1943
Francis Picabia est le petit-fils de Juan Martinez Picabia, né à Cuba, puis émigré à New York et Madrid et, côté maternel, d'Alphonse Davanne 1824-1912, chimiste et photographe, et président de la SFP.
Sa mère meurt alors qu'il a sept ans. Il fait ses études chez les maristes au Collège Stanislas, puis au Lycée Monge, à Paris.
Sa vie
En 1894, voulant éprouver la vocation tôt manifestée de son fils, " Pancho " Picabia envoie au Salon des artistes français la toile de Francis intitulée Vue des Martigues. Le tableau ayant été non seulement accepté, mais primé, Francis entre à l'École des arts décoratifs l'année suivante ; mais il fréquente plus volontiers l'école du Louvre et l'académie Humbert, où il travaille aux côtés de Georges Braque et de Marie Laurencin. L'année 1897 marque un tournant dans sa carrière : la découverte de Alfred Sisley lui révèle l'Impressionnisme, pour lequel son enthousiasme se renforce avec la rencontre de la famille Pissarro en 1898. C'est pour lui le début d'une période extrêmement féconde, qui durera dix ans ; les centaines de toiles qu'il peint alors, où l'influence impressionniste reste toujours plus ou moins sensible, sont propres à séduire le public : sa première exposition personnelle de 1905, à la galerie Haussmann, est un triomphe. Les tableaux exposés, étrangers aux nouvelles recherches plastiques, relèvent de l'imitation du " pur luminisme impressionniste " Bords du Loing, 1905 Philadelphie, Museum of Art. Cependant, Picabia remet peu à peu en cause les valeurs plastiques qui lui valent son succès grandissant ; et, en 1908, sa rencontre avec Gabrièle Buffet — qui l'encourage à poursuivre de récentes recherches — détermine la rupture avec l'Impressionnisme comme avec ses marchands, rupture permise aussi par sa fortune personnelle.
Il étudie ensuite à l'École du Louvre puis à l'École des beaux-arts et à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. De 1903 à 1908, influencé par les peintres de Barbizon, il côtoie Alfred Sisley, Camille Pissarro et Marius Borgeaud. Son aquarelle Caoutchouc 1909, MNAM, Paris est considérée comme une des œuvres fondatrices de l'art abstrait.
À sa majorité il prend possession de l'héritage maternel qui lui assure de confortables revenus. Sa première exposition personnelle, 61 tableaux est organisée en 1905 à Paris à la Galerie Haussmann, chez Danthon, la suivante à Berlin à la Kaspar Kunstsalon. Il montrera ensuite ses œuvres à nouveau chez Danthon en 1907, puis à Londres, Munich, Barcelone.
De 1905 à 1908, Picabia séjourne deux fois à Martigues et réalise de nombreux paysages de style impressionniste de la ville et de ses canaux.
En 1909, il épouse Gabrièle Buffet, peut-être petite-nièce d'Alphonse de Lamartine et petite-fille de l'amiral de Challié et descendante d'un frère de Jussieu, l'homme qui rapporta le cèdre du Liban dans son chapeau, dixit Picabia. Une fille, Laure, Marie, Catalina naît en 1910; un garçon, Pancho, Gabriel, François en 1911. Ils auront encore une fille, Gabrielle, Cécile, dite Jeannine en 1913, et un garçon, Vincente, né en 1919.
En 1911, il rejoint le groupe de Puteaux qui se réunissait dans le studio du peintre Jacques Villon, frère de Marcel Duchamp qu'il a rencontré en 1910. Il devient aussi orphiste et créé en 1912, à Puteaux, le Salon de la Section d'or, avant de connaître un premier succès international à l'exposition de l'Armory Show de New York en 1913, où il fonde avec Marcel Duchamp et Man Ray la revue 291. Marqué par la Broyeuse de chocolat et le concept de ready-made de Marcel Duchamp, il confectionne dès 1913 une série d'œuvres où il reprend l'esthétique du dessin industriel, recopiant ou simplifiant des images qu'il trouvait dans le magazine scientifique La Science et la Vie.
Dada
De 1913 à 1915, Picabia se rend plusieurs fois à New York et prend une part active dans les mouvements d'avant-garde, introduisant l'art moderne sur le continent américain. En 1916, après une série de compositions « mécanistes » où il traite les objets manufacturés avec une distante ironie, il lance à Barcelone la revue 391 et se rallie au dadaïsme. Il rencontre Tristan Tzara et le groupe dada de Zurich en 1918. Il se fait alors le gateur de dada avec André Breton à Paris. Polémiste, iconoclaste, sacrilège, Picabia s'agite autour de Dada en électron libre, en étant en principe anti-tout, voire anti-Picabia. En 1921, il rompt avec ses anciens complices. J'ai inventé le dadaïsme ainsi qu'un homme met le feu autour de lui, au cours d'un incendie qui gagne, afin de ne pas être brûlé, dixit Francis Picabia en 1947. En 1917, il rencontre Germaine Everling avec laquelle il part, en 1918, pour Lausanne. Quand elle rentre à Paris, Picabia est assailli à coup de feu par Costica Gregori qui lui reproche d'avoir eu des relations avec son épouse Charlotte, peintre sous le nom de "Charles". Picabia revient alors vivre à Paris, voyageant souvent vers New York, la Normandie, la Côte d'Azur et joue souvent dans les casinos avec des fortunes diverses. Un fils, Lorenzo, naît de sa liaison avec Germaine. Olga Mohler, suisse, est embauchée pour s'occuper de Lorenzo qui a cinq ans en 1923.
Outre l'automobile et les jeux de hasard, il se passionne pour le cinéma et la photographie. Dans ses écrits sur le cinéma, il pressent le rôle prépondérant du cinéma américain. En 1924, il a écrit un scénario du court-métrage Entr'acte, réalisé par René Clair et destiné à être projeté à l'entracte de son ballet instantanéiste Relâche, chorégraphie de Jean Börlin et musique d'Erik Satie, celui-ci y figurant d'ailleurs au tout début. Il travaille ensuite pour les Ballets suédois de Rolf de Maré, pour lesquels il réalise de nombreux décors.
La guerre et après
En 1940, conviés sans doute par leur ami Robert Dumas - haut personnage des casinos qui sera préfet du Lot de la Résistance, dit "le préfet des bois" - qu'ils ont connu à Monte-Carlo, Francis Picabia et Olga se réfugient chez les Dumas à Calamane dans le Lot. Ils s'y marient le 14 juin. Mme Dumas est leur témoin. Ils reviendront, plus tard, à Golfe Juan. Ils s'installent ensuite à Tourette-sur-Loup, puis à Felletin dans la Creuse.
Après 1945, il renoue avec l'abstraction.
Son goût immodéré pour les fêtes et les voitures il en collectionnera plus de 150, le ruine. Il multiplie les petites toiles de nombreux genres, parfois même inspirées de magazines pornographiques. Ses derniers tableaux relèvent du minimalisme : des points de couleurs semés sur des fonds épais et monochromes, titrés Je n'ai plus envie de peindre, quel prix ?, Peinture sans but ou Silence.... Au printemps 1949, la galerie René Drouin à Paris, organise sa première rétrospective.
Il pèse sur Picabia et sur son œuvre différents malentendus qui ne facilitent pas la juste appréciation de son apport à l'art du XXe siècle ni l'élucidation des nombreuses zones d'ombre qui constituent la trame même d'une des entreprises artistiques les plus énigmatiques de son époque. Les difficultés d'analyse et d'interprétation que l'on y rencontre ont contribué à faire naître des lieux communs derrière lesquels on a souvent estimé plus commode, ou plus prudent, de se retrancher. C'est essentiellement sur la légende du dadaïste que s'est bâtie la réception de cette œuvre ; dans l'ensemble de la carrière de Picabia, la période de Dada a fonctionné comme une sorte d'étalon de modernité à l'aune duquel ont été comparées toutes les autres manifestations de sa démarche créatrice. Avec le risque que cette situation comporte : celui de tenir pour quantité négligeable tout ce qui se sépare trop visiblement de l'anti-peinture dadaïste, ou de ce qui l'annonce, ou de ce qui se place dans sa postérité immédiate. On a alors tôt fait d'assimiler certaines des expressions picturales contradictoires de Picabia à celles d'un anti-modernisme aussi radical que l'avait été la poussée dadaïste – et leur auteur lui-même à une sorte de renégat vis-à-vis de la cause avant-gardiste. C'est ainsi qu'ont longtemps été bannis (ou peu s'en faut des rétrospectives et des commentaires de vastes ensembles appartenant à l'œuvre postérieure au milieu des années 1920, comme les Transparences autour de 1930, la figuration réaliste des années de guerre, et même l'abstraction primitivisante qui leur succède. Or, dévoilement après dévoilement, les études picabiennes les plus récentes, et notamment celles qui portent sur la recherche des sources visuelles de l'artiste, et par conséquent sur sa méthode, ont contribué à réévaluer des pans entiers de l'œuvre sur lesquels pesaient des jugements aussi péremptoires qu'autoritaires, souvent mal fondés d'ailleurs sur le plan de l'information historique.
De sa confrontation permanente aux images mécaniques dont son époque voit le développement, photographie, cinématographe, carte postale, presse populaire..., Picabia développe, comme de nombreux autres artistes de sa génération, la conscience cruelle de la possible disparition de son art, rendu obsolète par l'irruption de nouvelles techniques de fabrication et de diffusion des images, en même temps qu'une fascination pour cette disparition même, qui pouvait faire naître l'insidieuse tentation d'en accélérer le processus. Mais de tous les assassins de la peinture, Picabia est sans doute celui qui aura le plus difficilement assumé son geste, et qui l'aura même secrètement déploré, incapable qu'il était de se résoudre au détachement cyniquement affiché par son principal complice, Marcel Duchamp. Son humeur créative, au contraire, oscille entre deux extrêmes : d'un côté, il semble prêt à croire jusqu'au bout en la puissance de la peinture, laissant supposer qu'elle pourrait être investie de pouvoirs démesurés, quasi magiques ; mais par ailleurs, il semble se résigner à devoir porter définitivement son deuil, à accepter sa fin et même à lui asséner de nouveaux coups fatals. Les atermoiements auxquels l'artiste aura été confronté toute sa vie, l'alternance épuisante de ses élans de vitalité et de ses phases dépressives profondes, montrent d'ailleurs à quel point ces contradictions auront été vécues sur le mode tragique.
Un art dévoyé
Contradictions et paradoxes sont d'ailleurs symboliquement présents aux sources mêmes de la vocation de Picabia, dans les deux récits originaires qu'il en a laissé accréditer. Picabia est né à Paris en 1879 de Francisco Vicente Martinez y Picabia, attaché à l'ambassade de Cuba, et de Marie-Cécile Davanne, fille d'Alphonse Davanne, haute figure patriarcale, président de la Société française de photographie, photographe lui-même et ardent défenseur de son art ; son atelier qui deviendra bien plus tard celui de son petit-fils dominait l'immeuble familial de la rue des Petits-Champs, où étaient accrochés les tableaux, Ziem, Roybet, Checa... collectionnés par le père et un oncle maternel de Picabia. C'est à leur sujet que naît le premier de ces récits : J'ai copié, étant jeune, les tableaux de mon père, déclare Picabia en 1923. J'ai vendu les tableaux originaux et les ai remplacés par les copies. Personne ne s'en étant aperçu, je me suis découvert une vocation. L'anecdote entretient la réputation du jeune homme surdoué, qui aurait exposé dès 1895 sous un nom d'emprunt une toile récompensée par le jury du Salon des Artistes français – mais d'un surdoué qui aurait malencontreusement placé ses dons précoces au service d'une conception dévoyée de son art, rompant le tabou de l'authenticité, la frontière éthique et morale de l'original. Il entre bien sûr une large part de provocation dans ce court récit, dont la véracité n'est même pas assurée ; il est remarquable à cet égard qu'il ait été délivré à un moment où la fièvre dadaïste n'était pas encore retombée, l'apologie du mensonge et du faux ayant fait partie des revendications de l'artiste à cette époque. De plus, cette anti-légende est contrebalancée par un second récit fondateur, fort opposé dans ses implications. Au jeune Picabia lui faisant part de sa vocation naissante, le grand-père Davanne aurait déclaré en substance : « Tu veux devenir peintre ? Pourquoi ? Bientôt, nous aurons rendu la peinture inutile. Nous reproduirons toutes les formes et toutes les couleurs, mieux et plus vite ! » À quoi son interlocuteur aurait répliqué : Tu peux photographier un paysage, mais non les idées que j'ai dans la tête. Nous ferons des tableaux qui n'imiteront pas la nature. A contrario de la pratique cynique dont il vient d'être question, voilà donc la peinture investie d'une ambition démesurée ; contre le réalisme trivial de l'image photographique, elle pourra renoncer à la copie des formes extérieures, aller voir plus loin et plus profond dans les régions de l'âme et du monde intérieur.
Cependant, les conditions dans lesquelles Picabia s'est lancé dans la carrière n'étaient pas de nature à faire naître en lui une haute idée de sa pratique ; au contraire, la soumission de la peinture à des objectifs purement commerciaux et mondains a certainement pu nourrir au moins le début d'une grave mésestime envers elle. L'autoportrait que Picabia donne de lui en faussaire est sans doute exagéré ; il suffit de présenter le Picabia des débuts en faiseur, en habile pasticheur de certains de ses célèbres précurseurs pour comprendre comment devait se déconsidérer à ses yeux la pratique artistique. On pourrait esquisser une liste très longue de ses nombreux emprunts à une tradition impressionniste s'académisant aimablement pour répondre aux attentes d'une clientèle aisée, encline à adopter certains signes de modernité sans trop se compromettre pour autant. Soutenu par de grands marchands parisiens, Picabia marche alors sur les brisées de Monet, de Pissarro, dont il connaît les fils, ou de Sisley, dans la filiation symbolique duquel il se place en présidant un Comité Sisley qui fera ériger un monument à la mémoire du peintre impressionniste. Picabia revient sur les motifs des pionniers de l'impressionnisme et s'approprie leur manière ; avec plusieurs années de retard, il adopte sans distinction et dans le plus grand éclectisme les transformations de la tradition impressionniste, sans que sa démarche corresponde pour autant à une évolution personnelle : il recycle plutôt des procédés, en y mettant d'ailleurs une très grande virtuosité, et puise dans un large stock d'images qui sont en passe de devenir des stéréotypes du paysage impressionniste – il ira même jusqu'au plagiat, avec L'Église de Moret 1904, qui démarque point par point le regard que Sisley avait précédemment porté sur ce motif.
Des méthodes de création de Picabia, une autre semble en plus totale contradiction encore avec l'idéologie impressionniste de la vérité et de la sincérité : il s'agit de celle qui le voit faire usage de documents photographiques, de cartes postales plus précisément, comme source directe ou transposée de nombreux dessins et de quelques peintures. De cette première confrontation à l'image mécanique, Picabia semble bien avoir développé une sorte de complexe – le complexe du peintre devant le progrès des techniques qui détermine si profondément cette génération d'artistes, de même nature que celui qui avait fait prendre conscience à Duchamp, Brancusi et Léger, devant la perfection d'une hélice d'avion, du danger d'obsolescence guettant leur art. L'artiste n'a plus le monopole de la fabrication des images ; lorsqu'il se place devant un site, un monde de représentations dont il est impossible de ne pas tenir compte préexiste déjà par rapport au sien. Les conséquences de cet état de fait s'observent chez Picabia dans un art qui non seulement n'arrive pas à marquer suffisamment sa distance et sa différence par rapport aux nouvelles images, mais montre même à leur égard une attirance inavouée, le début d'une fascination coupable. Au point que son auteur commence à en organiser le recyclage, à en faire le point de départ de certaines œuvres, suivant une procédure qui n'en est qu'à ses débuts et qui ira s'amplifiant – tout en restant secrète et cachée, cette dissimulation étant en réalité un aveu en creux et légèrement honteux : celui d'une possible faiblesse de la peinture face à sa concurrente.
La peinture de l'âme
La rupture qui intervient dans l'art de Picabia au cours de l'hiver 1908-1909, rupture avec son impressionnisme de convention, rupture avec ses marchands) a toutes les apparences d'un sursaut, d'une réaction instinctive de survie : il ne s'agit ni plus ni moins que de sauver la peinture, de se convaincre qu'elle peut être autre chose qu'un exercice de virtuosité pratiqué à des fins commerciales et dévalué par le recyclage de poncifs aimables. Pour contrer la trivialité qui la menace, la peinture doit désormais se recentrer sur son univers propre, s'arroger un domaine de compétence sur lequel la photographie ne pourrait empiéter. L'art que Picabia investira de cette mission sera un art abstrait, non figuratif, dont il est par là même l'un des premiers inventeurs dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Dans ce laps de temps, il passe rapidement d'une figuration paysagère fortement simplifiée par l'aplat et le cerne, L'Arbre rouge, 1912, Musée national d'art moderne, Paris à un langage d'inspiration à la fois cubiste et futuriste où le vague souvenir de motifs dynamiques s'efface derrière l'émiettement de la surface en éclats kaléidoscopiques, Danses à la source II, 1912, Museum of Modern Art, New York, pour déboucher dans ces chefs-d'œuvre que sont Udnie, 1913, Musée national d'art moderne, Paris et Edtaonisl, 1913, Art Institute, Chicago, sommets de la peinture que Guillaume Apollinaire venait de baptiser du nom d'orphisme. Or il se trouve que Picabia en justifie la forme en prenant constamment comme repoussoir ce qui lui en semble la contradiction même : à savoir la photographie et le type de réalisme qu'elle impliquerait. La photographie, déclare Picabia en 1913 à l'occasion de la présentation de plusieurs de ses œuvres à l'Armory Show à New York, a aidé l'art à prendre conscience de sa nature propre, qui ne consiste pas à être un miroir du monde extérieur, mais à donner une réalité plastique à des états d'esprit intérieurs. ... L'appareil ne peut reproduire un fait mental. Logiquement, l'art pur ne sera pas celui qui reproduira un objet matériel, mais celui qui conférera la réalité à un fait immatériel, émotif. De sorte que l'art et la photographie s'opposent. À cette justification s'ajoute celle d'une théorie musicaliste de la peinture devant sans doute beaucoup à la première épouse de Picabia, la musicienne et brillante intellectuelle Gabrielle Buffet – leur rencontre en 1908 ayant déjà coïncidé avec le renoncement de l'artiste à son statut de peintre à succès.
La période orphique est un moment de grâce pour Picabia, qui semble croire en la possibilité d'un art susceptible d'exprimer tous les mouvements de l'âme humaine : Moi je ne peins pas ce que voient mes yeux. Je peins ce que voit mon esprit, ce que voit mon âme. Le drame de Picabia sera d'avoir ensuite désespéré de cette âme – et c'est ce qui pouvait arriver de pire au peintre qui avait retrouvé en elle la justification d'une peinture capable d'échapper au réalisme trivial de l'image mécanique. La sorte d'idéalisme auquel il s'était raccroché ou avait feint de se raccrocher n'est bientôt plus de mise : la guerre le rappelle aux plus cruelles réalités, et l'âme reste, avec un certain nombre d'autres croyances illusoires, Dieu, amour, raison, civilisation..., sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Après une courte période de mobilisation, il fuit à New York ce qu'il désigne comme l'agonie du monde en vertige et les valses hideuses de la guerre, Poèmes et dessins de la fille née sans mère, 1918.
L'art désenchanté
Or, si cette âme n'existe pas, que restera-t-il alors à la peinture, quel paysage mental reflétera-t-elle ? La mort de l'âme signe celle de l'art : c'est le début, pour Picabia, de la grande crise dadaïste et d'un premier cycle d'anti-peintures où, ce n'est certainement pas par hasard, l'artiste se met de nouveau à recycler des images dont il n'est pas l'auteur – schémas de machines, coupes, élévations, images ready-made, proches parentes des objets prélevés et élevés au rang d'œuvres d'art par Marcel Duchamp. Faire des images avec d'autres images : le fonctionnement des œuvres machinistes de Francis Picabia est emblématique d'une attitude envers la création typiquement dadaïste. Au déploiement démiurgique du savoir-faire de l'artiste, Picabia substitue l'image frustrante et déceptive de la machine, réalisée selon des codes graphiques d'une rigueur et d'une monotonie qui ne laissent plus aucune place ni à l'invention, ni à la recherche, ni à la sensibilité, ni à la main, Machine sans nom, 1915, Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh. Le dédain du métier et de la mythologie qui l'accompagne est à son apogée dans une œuvre-manifeste comme M'amenez-y 1919-1920, Museum of Modern Art, New York. Réalisée à partir d'un schéma publié à la même époque dans La Science et la vie, elle oppose la sécheresse du dessin technique à une parodie de touche appliquée avec des effets de brosse volontairement bâclés et exagérément visibles ; l'œuvre est en outre parsemée d'inscriptions qui tournent en dérision, par le biais de mauvais jeux de mots, le métier d'artiste et une certaine idée de la peinture : la première d'entre elles la désigne comme un portrait à l'huile, mais... de ricin ! ; une autre, râtelier d'artiste, porte atteinte à la dignité du lieu mythique de la création ; peinture crocodile, enfin, suggère une parenté avec l'expression larmes de crocodile, désignant de fausses larmes, des larmes d'hypocrite – il faudrait donc comprendre, peinture crocodile comme fausse peinture ou fausseté de la peinture... Ailleurs, les inscriptions qui parsèment certaines œuvres visent explicitement les clichés sentimentaux qui s'attachent, par exemple, à l'amour humain, assimilé à une sexualité absurde et répétitive de bielles et de pistons Parade amoureuse, 1918. Ces machines des idées actuelles dans l'amour, comme s'intitule l'une d'elles, sont les petites filles, nées sans mère du Grand Verre de Duchamp et ont leur équivalent dans la poésie que Picabia commence à produire, tout aussi dénuée d'émotion que sa peinture, ainsi que dans sa vaste production d'aphorismes : Notre phallus devrait avoir des yeux, grâce à eux nous pourrions croire un instant que nous avons vu l'amour de près. Ainsi, avec quelques autres esprits forts (Jarry, Roussel, Duchamp, Tzara, qu'il ira rencontrer à Zurich en 1919 avant de l'accueillir à Paris l'année suivante, Picabia chasse les derniers relents d'idéalisme légués par l'époque précédente et nous fait entrer de plain-pied dans la modernité désenchantée du XXe siècle.
Contre le retour à l'ordre
Lorsque, le conflit terminé, Picabia se réinstalle à Paris, il a dans ses bagages 391, une revue qui reste un des témoignages les plus forts de l'activisme dadaïste ; son anti-peinture prend aussi une dimension plus provocante encore dans le contexte de retour à l'ordre que connaissait alors le milieu de l'art parisien – spécialement chez certains de ses anciens amis cubistes. Leur chauvinisme, leur sacralisation du métier et de la tradition nationale deviennent les cibles de Picabia, de même que leur goût pour les références au passé historique, contre lequel il défend une salutaire conception de la table rase et de l'amnésie – l'amnésie que l'on entend justement dans M'amenez-y. Alors qu'elles ont invariablement été décriées comme le signe de son imposture, de l'insincérité de son engagement dadaïste, les Espagnoles réalistes que Picabia dessine et expose en même temps que ses machines servent exactement les mêmes fins subversives ; mais il faut pour cela s'apercevoir qu'elles détournent de célèbres effigies ingresques, comme celle de La Belle Zélie notamment en les affublant des accessoires dérisoires d'un hispanisme de pacotille (peignes ouvragés, châles et mantilles, coiffures fleuries plus extravagantes les unes que les autres. Au moment même où le nom d'Ingres sert systématiquement de caution aux tenants du rappel à l'ordre en peinture, Picabia détourne l'héritage du maître de Montauban et dévalorise ses emprunts en les faisant servir à la fabrication d'images sans aura, fondées sur les poncifs d'un exotisme et d'un érotisme de folklore. Ingres est la cible : c'est ce que montre très littéralement un grand tableau ripoliné, La Nuit espagnole, 1922, Wallraf-Richartz Museum und Ludwig Museum, Cologne, où la silhouette d'un nu empruntée à La Source d'Ingres est transformée en panneau de foire et parsemée d'impacts de tirs. Avec son pendant, La Feuille de vigne, 1922, Tate Gallery, Londres, qui détourne Œdipe et le sphinx d'Ingres, et un tableau immédiatement postérieur, Le Dresseur d'animaux, 1923, Musée national d'art moderne, Paris, La Nuit espagnole parodie les tableaux de salon dont ils ont les dimensions, les sujets, le nu essentiellement et les emprunts aux sources nobles – à la différence que ces œuvres de Picabia, les toiles au Ripolin mobilisant le moins de science picturale possible ne peuvent sérieusement passer pour le manifeste d'un quelconque rappel à la tradition et au beau métier. Ils connaîtront une importante descendance jusqu'au milieu des années 1920 avec la série des Monstres, qui montre des couples d'amoureux bariolés dérivant d'un genre de carte postale très populaire à cette époque, Jeunes Mariés, 1925, coll. part.. Bien après la date officielle du décès de Dada, ces œuvres prolongent très tard une tradition d'anti-peinture dont relèvent aussi plusieurs collages constitués de matériaux hétéroclites englués dans le Ripolin, Pot de fleurs, 1925-1926, musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
Sources nobles et vulgaires se croisent dans une des premières œuvres significatives de la série des Transparences : il s'agit de Rocking-Chair, 1928, coll. part., dont le principal motif, une femme nue dans un fauteuil qui démarque une carte postale érotique de la Belle Époque, s'accompagne de citations botticelliennes. Cela pose le délicat problème du statut de ces œuvres à l'aspect porcelainé, exécutées dans une technique raffinée, glacis, vernis et multipliant, par système plus que par nécessité, les références aux exemples les plus accomplis de l'art du passé, entremêlées dans un jeu confus de superpositions créant d'insurmontables difficultés de lecture. Si parodie il y a, celle-ci heurte en tout cas beaucoup moins frontalement le sens commun, et il est intéressant de constater, à cet égard, que ces tableaux ont trouvé à satisfaire à la fois le goût du rêve et de l'énigme des surréalistes, comme celui d'une nouvelle clientèle mondaine, trop heureuse de pouvoir s'offrir les tableaux plus anodins en apparence d'un artiste à la réputation scandaleuse. L'époque des Transparences est en effet celle au cours de laquelle Picabia renoue avec les fastes de ses débuts – par penchant personnel certainement, mais aussi peut-être par nécessité, sa situation matérielle s'étant progressivement compliquée pendant l'entre-deux-guerres. Établi le plus clair de l'année sur la Côte d'Azur, il devient alors l'ordonnateur de fêtes brillantes et le pourvoyeur d'expositions qui sont autant de rendez-vous de la haute société, à laquelle il sert la soupe avec une propension au cynisme difficile à évaluer. Picabia se réserve cependant de discrètes marges de manœuvre, dont il profite par exemple pour produire, à la fin des années 1930, une nouvelle série d'œuvres abstraites, 7091, 1938, coll. part. ou encore un ensemble de paysages truellés qui anticipe curieusement sur la période vache de Magritte ou sur les croûtes de Gasiorowski.
La peinture : grandeur et servitude
Plus homogène, l'ensemble de toiles réalistes, des couples érotiques, des nus jeunes et sportifs, quelques scènes de genre... que Picabia entreprend pendant les années de guerre est celui qui a fait peser les plus graves soupçons sur la valeur du projet artistique de son auteur : soupçon d'attirance inavouée pour certains critères de la peinture académique, soupçon d'adhésion à l'idéologie de la jeunesse sur laquelle s'appuyait la Révolution nationale pétainiste.
Pourtant, sur le plan de la méthode comme du programme qui l'accompagne, la cohérence de cette peinture avec ce que l'on sait des obsessions de Picabia paraît remarquable. Cohérence de méthode, puisque toutes ces mises en scène sont strictement calquées sur les photographies que mettaient à la disposition du peintre les revues de charme de la fin des années 1930, Paris Plaisir, Paris Magazine, Paris Sex Appeal, Mon Paris... ; cohérence de programme, celui de la dévalorisation systématique des ressources de la peinture en soumettant tous ses effets à ceux des documents utilisés. Les toiles de Picabia imitent en effet les photographies dans leurs caractéristiques les plus brutales : éclairages fortement contrastés, points de vue inhabituels, décadrages, raccourcis et aberrations optiques, Nu, 1942-1943, coll. part.. Transposés en peinture, ces effets donnent aux toiles de Picabia leur aspect singulièrement âpre et tranchant, très loin de toute élégance et de toute tentation académique – il suffirait pour s'en convaincre de les comparer aux nus d'un authentique peintre mondain comme Jean-Gabriel Domergue. En outre, de la même manière qu'à l'époque des machines dadaïstes, l'utilisation de plusieurs sources éparses dans la confection de certaines toiles occasionne des étrangetés spatiales et des ruptures d'échelle qui désignent bien ces tableaux pour ce qu'ils sont : de véritables collages peints, comme dans le spectaculaire Cinq femmes env. 1942, coll. part.. Picabia, une fois de plus, se complaît dans la réalisation d'une peinture sans aura, brutalement confrontée au risque que Delacroix, à l'aube du nouvel art photographique, voyait planer sur le peintre qui en ferait mauvais usage, celui de ne plus rien devenir d'autre que cette machine attelée à une autre machine .
La couleur qui est dans ces toiles l'une des seules parts d'arbitraire que puisse s'autoriser Picabia renforce par les teintes outrées le kitsch de ces mises en scène, très peu bien-pensantes, qui utilisent tous les poncifs d'un érotisme de bas-étage, bordels exotiques, alcôves et bonbonnières de fausses marquises. Mais l'iconographie de ces tableaux est parfois aussi celle de la libération du corps, du naturisme et du développement des loisirs qui avait cours dans l'entre-deux-guerres et que les revues de charme détournaient à leurs propres fins en y cherchant systématiquement le côté scabreux, Printemps, 1942-1943, coll. part. ; c'est, par exemple, l'iconographie des photographes de la Nouvelle Vision, comme Jean Moral, un ami de Picabia, dont les clichés de baigneuses étaient parfois reproduits dans Paris Magazine. Replacées dans leur contexte, celui d'une sous-culture populaire, les effigies picabiennes sont ainsi les proches parentes des pin-up qui apparaissent au même moment dans les derniers collages de Schwitters, avant de passer chez Richard Hamilton et Eduardo Paolozzi et d'entrer dans le répertoire de base du pop art.
Après cette période une nouvelle fois hantée par le spectre de la photographie, Picabia se lance, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une nouvelle forme de peinture qui est, selon ses propres termes, l'expression de ce qu'il y a de plus vrai dans notre être intérieur et une prise de contact de plus en plus profonde avec un univers intérieur – c'est-à-dire que se rejoue, comme en 1912, l'exaltation des pouvoirs de la peinture contre la menace, sinon de sa disparition, du moins de sa réification dans un monde d'images de plus en plus homogène et dominé par un paradigme réaliste issu de la photographie. La peinture de Picabia se recentre alors sur un fort contenu de significations à la fois personnelles et universelles qu'il incarne dans un répertoire mi-abstrait mi-figuratif de signes idéographiques, de symboles archaïques et d'images archétypales, où dominent surtout les symboles sexuels plus ou moins éloquents, vulves ou phallus, Ça m'est égal, 1947, coll. part.. L'ensemble est traité dans un style qui témoigne d'un possible intérêt pour les arts archaïques et primitifs, et d'un goût certain pour les surfaces texturées qui renvoie aux tendances matiéristes de la peinture de ce temps. Cette dernière remarque vaut également pour la série des Points aux champs de couleurs unis parsemés de pastilles rondes, étonnants jalons dans l'histoire encore balbutiante du monochrome, interprétés en termes néo-dadaïstes par Michel Seuphor qui y voyait la même peinture anti-peinture qui est réellement la création, et sans doute le point final à toute possibilité de faire de la peinture.
Point final, en effet. Déjà affaibli par une première attaque en 1944, Picabia succombe à la suivante en 1951 ; lorsqu'il meurt en 1953, il ne peignait plus depuis deux ans. Dans une œuvre au sujet énigmatique Sans titre, 1951, coll. part., Marcel Jean a vu une forme indéfinissable mais précise, enveloppée de bandelettes : ainsi jadis on emmaillotait les nouveau-nés, comme les morts qu'on menait à la tombe. Cadavre ou tout petit enfant prometteur, cet objet indéfinissable et insaisissable n'est sans doute rien d'autre que la peinture elle-même, toujours engagée dans le cycle des morts et des résurrections auquel Picabia l'aura soumis sa vie durant.
À la fin de l'année 1951, Picabia souffre d'une artériosclérose paralysante qui l'empêche de peindre et meurt deux ans plus tard.
Œuvres
Peintures
Les Martigues, 1902, fusain sur papier, Musée Pierre André Benoit, Alès
La Rivière: bord de la Douceline à Munot près de La Charité sur Loire 1906
Udnie, 1913, huile sur toile, 290 × 300 cm, Musée national d'art moderne de Paris
Edtaonisl, 1913, Art institute of Chicago
La Ville de New York aperçue à travers mon corps, 1913, gouache, aquarelle, crayon et encre, 55 × 74,5 cm4
Prostitution universelle, 1916, Yale University Art Gallery, New Haven
Parade amoureuse, 1917, huile sur carton, 97 × 74 cm, Paris, collection particulière.
Danse de Saint-Guy Tabac Rat, 1919, MNAM Paris
L'Enfant Carburateur, 1919, huile, émail, feuille d'or, crayon sur contreplaqué, New York, musée Guggenheim
L'Œil cacodylate, 1921, huile sur toile, MNAM Paris
Chapeau de paille ?, 1921, MNAM Paris
La Nuit espagnole, 1922, Musée Ludwig, Cologne
Optophone II , 1923, huile sur toile, 116 × 88,5 cm, Musée d'art moderne de la Ville de Paris
Le dresseur d'animaux , 1923, Ripolin sur toile, 250 x 200 cm, Centre Pompidou, Musée d'art moderne de la Ville de Paris6
Cure-dents », 1925, huile et collage sur toile, 129 × 110 cm7
Corrida, 1926-1927, Gouache, 104.8 × 75.2, collection privée, Suisse
Idylle, 1927, Musée de Grenoble, huile sur caton 105,7 × 75,7cm
L'Autoportrait de dos avec femme enlacée et masque, 1927-30, Musée Picasso, Antibes
Le Masque et le Miroir, 1930-45, huile sur contre- plaqué, 85,2 × 69,9 cm, Musée national d'art moderne, Paris
Figure et fleurs, 1935-45, huile sur toile, 100 × 73 cm, Musée national d'art moderne, Paris
Maternité, 1936, huile sur toile, 162,4 × 130,3 cm, Musée national d'art moderne, Paris
Printemps, 1938, Galerie Rose Fried
Le Matador dans l'arène, 1941-1943, huile sur carton, 105 × 76 cm Musée du petit palais, Genève
Sans titre masque, 1946/47, huile sur carton, 64,5 × 52,5 cm, Musée national d'art moderne
Chose à moi-même, 1946, huile sur carton, 92 × 72,5 cm, collection particulière
Cherchez d'abord votre Orphée, 1948, huile sur toile, 169 × 70 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès
L'Insensé, 1948, huile sur toile, 151 × 10 cm, Musée Ludwig, Cologne
Veuve, 1948, huile sur bois, 153,2 × 116,Musée national d'art moderne, Paris
Déclaration d'amour, 1949, huile sur panneau, 96 × 69 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès
Symbole, 1950, huile sur contreplaqué, 100 × 85 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès
Écrits
Première édition de Jésus-Christ Rastaquouère, 1920 illustrations de Georges Ribemont-Dessaignes)
Cinquante-deux miroirs, Barcelone, octobre 1917.
Poèmes et dessins de la Fille née sans mère, Lausanne, Imprimeries réunies, avril 1918.
L'Ilot de Beau-Séjour dans le Canton de Nudité, Lausanne, juin 1918.
L'Athlète des Pompes funèbres, Bégnins, décembre 1918.
Râteliers platoniques, Lausanne, décembre 1918.
Poésie ron-ron, Lausanne, février 1919.
Pensées sans langage, Paris, Figuière, avril 1919.
Unique Eunuque Paris, Au Sans Pareil, Coll. Dada, février 1920. Rééd. Paris, Allia, 1992.
Jésus-Christ Rastaquouère, Paris, Au Sans Pareil, « Dada », automne 1920. Rééd. Paris, Allia, 1996.
Caravansérail 1924. Ed. Luc-Henri Mercié. Paris, Belfond, 1975.
Choix de poèmes par Henri Parisot, Paris, Guy Lévis-Mano, 1947.
Lettres à Christine, édition établie par Jean Sireuil. Présentation, chronologie et bibliographie par Marc Dachy. Paris, Champ Libre, 1988.
Écrits, deux volumes. Ed. Olivier Revault d'Allonnes et Dominique Bouissou. Paris, Belfond, 1975 et 1978.
Écrits critiques, préf. Bernard Noël. Ed. Carole Boulbès. Paris, Mémoire du Livre, 2005.
Liens
http://www.ina.fr/audio/P11180790/int ... rancis-picabia-audio.html Interview de Piacabia
http://www.ina.fr/audio/00771740/francis-picabia-audio.html Une vie une oeuvre Picabia
http://youtu.be/sS2av7z7ofs Picabia
http://youtu.be/jTv-vNhPoZs Diaporama
http://youtu.be/SE-4Hxygl8o Les dernières toiles
http://youtu.be/0xtFAIMpFdc Transparence diaporama
http://youtu.be/DdejF4YAjLM Francis Picabia
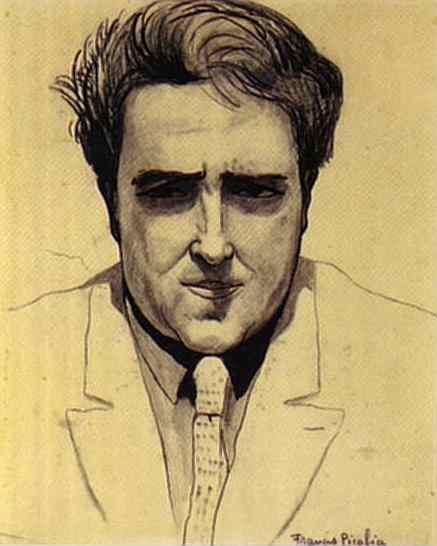      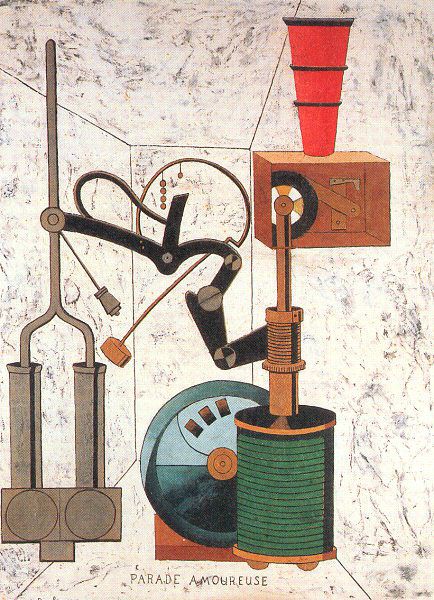     
Posté le : 29/11/2014 21:42
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
35 Personne(s) en ligne ( 21 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 35
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages