 Tous les messages Tous les messages
#91
Henry de Monfreid
Loriane
Posté le : 13/12/2015 16:10
Le 13 décembre 1974 à 95 ans meurt Henry de Monfreid,
à Ingrandes dans l'Indre, il naît à La Franqui, commune de Leucate Aude le 15 novembre 1879 commerçant et écrivain aventurier et navigateur français.récits autobiographiques, roman d'aventures, souvenirs. Il écrit des Œuvres principales, ses ŒuvresLes les plus connues sont Secrets de la mer Rouge en 1931, Aventures de mer en 1932, La croisière du hachich en 1933. Il a mis en scène sa vie aventureuse, centrée sur la mer Rouge et l'Éthiopie de 1911 à la Seconde Guerre mondiale, dans de nombreux livres, autobiographies et romans, publiés à partir de 1931. Une exposition intitulée En mer Rouge, Henry de Monfreid photographe lui a été consacrée au Musée national de la Marine à Paris du 17 mai 2006 au 2 octobre 2006. En bref Aventurier, explorateur, écrivain, Henri de Monfreid est mort, à quatre-vingt-quinze ans, dans sa maison d'Ingrandes (Indre). Il passa la majeure partie de sa vie sur les rivages de la mer Rouge, où il mena une vie d'aventures qui lui inspira la plupart de ses romans. Rien ne semblait le destiner à une vie aventureuse. Après avoir échoué au concours d'entrée à Polytechnique, il rompt avec sa famille et subsiste en s'essayant aux métiers de courtier, de chimiste, de laitier en gros. Ce n'est qu'en 1911 qu'il débarque à Djibouti afin d'y occuper un emploi obscur dans une maison de commerce. Le choix de l'Afrique n'est pas fortuit : son père, peintre et graveur, lui a donné le goût de l'exotisme en lui parlant de son ami Gauguin, dont il reçoit des toiles de Tahiti. À trente-deux ans le voilà saisi par l'éblouissement des tropiques. À bord de son bâtiment, l'Altaïr, il commence à explorer les rivages de la mer Rouge où il deviendra, au gré de la fortune, pêcheur de perles, transporteur d'armes, contrebandier de tabac et de hachisch. Lors de la Première Guerre mondiale, qui ruine ses entreprises, il fait de l'espionnage contre les Turcs, au service de la France. La paix revenue, il rencontre Joseph Kessel. Sur ses conseils, il entreprend le récit de ses aventures. En 1932, il publie coup sur coup Les Secrets de la mer Rouge et Aventures de mer. Le voilà célèbre. Gagné par le goût d'écrire, il se livre, pendant cinq ans, à une production fiévreuse. En 1935, par exemple, il ne publie pas moins de huit volumes, parmi lesquels Le Drame éthiopien, Les Espions d'Ato Joseph, L'Île aux perles... Puis ce sont Trafic d'armes en mer Rouge, Le Roi du Toukan, L'Enfant sauvage, Le Roi des abeilles... Son dernier ouvrage, Le Feu Saint-Elme, paraît en 1973. Son séjour préféré, l'Éthiopie, lui est interdit en 1932 après une brouille avec le négus. Il y revient en 1936 avec l'armée italienne. Lorsque, au cours de la Seconde Guerre mondiale l'Éthiopie est libérée, il est jeté en prison par les Anglais. Échappant de justesse à la condamnation à mort, il gagne alors le Kenya avec sa seconde épouse. En 1947, il s'installe dans sa propriété d'Ingrandes, aux confins de la Sologne. Il y poursuit ses écrits : La Triolette, Le Bracelet d'argent, Du Harrar au Kenya à la poursuite de la liberté, Le Naufrageur, L'Homme sorti de la mer, Le Cimetière des éléphants, La Route interdite. Son œuvre supporte mal les analyses et les classifications. Ses romans, ses récits, inspirés d'une vie qui ressemble à un conte oriental, d'une psychologie sommaire et d'une écriture rapide, n'en sont pas moins attachants ; on y retrouve sans cesse le goût de l'action, la violence de l'aventure et la chaleur de l'amitié à travers des intrigues insolites ayant pour cadre l'Afrique abyssine. Pierre Ripert Sa vie Henry de Monfreid est le fils de George-Daniel de Monfreid, peintre, graveur et collectionneur d'art, et de Marie-Amélie Bertrand généralement appelée Amélie. Sa jeune enfance s'écoule à la petite station balnéaire de La Franqui Leucate où la famille de sa mère exploite un établissement pour vacanciers. Dès cette époque, le jeune Henry développe un goût marqué pour la voile et le large en naviguant avec son père sur les voiliers de ce dernier, d'abord le Follet, puis l'Amélie, un yacht de 22 mètres, notamment lors d'une traversée de Port-Vendres à Alger alors qu'il a 5 ans. À 7 ans, il va rejoindre ses parents à Paris où on l'inscrit à l'École alsacienne. Son père fréquente assidument la bohème, peintres ou écrivains, qu'il reçoit dans son appartement bourgeois. Monfreid va donc côtoyer des peintres comme Matisse et Gauguin. Durant l'été, et jusqu'à la mort de sa mère en 19028, il continuera de passer ses vacances à La Franqui. La Franqui. Henry devient le petit maître d'un domaine hôtelier en plein essor9. George-Daniel de Monfreid à bord du Follet. Ma première jeunesse passée à l'ombre du cap de Leucate et, plus tard, la navigation sur le voilier de mon père m'avaient mis au cœur la nostalgie de la mer, au point de me faire sacrifier les situations les plus enviables . Il a 13 ans lorsque ses parents se séparent et quittent Paris, et le jeune Henry est placé en pension pour qu'il n'ait pas à quitter son école. En 1892, il entre au lycée à Carcassonne où habite alors sa mère. Il passe son premier bac en 1896, retourne à Paris et prépare Centrale au Lycée Saint-Louis où il est interne. Il obtient d'assez bonnes notes et décroche même des distinctions mais il étouffe entre les quatre murs du lycée et se laisse aller à des frasques. Il se fait renvoyer, mais l'examen étant proche, il est réadmis comme externe. Il rate l'examen de peu. Henry de Monfreid ne fera donc pas carrière comme ingénieur des Chemins de fer et devra trouver un autre moyen d'existence. Il lui restera de ses études d'ingénieur un goût et une facilité pour les sciences et les techniques qui lui seront d'une grande utilité en mer Rouge lorsqu'il se mettra à construire des bateaux ou devra réparer en haute mer un moteur en panne. En 1900, Henry, qui vit depuis quelques mois avec sa nouvelle compagne Lucie, se voit contraint d'entamer son service militaire. Il cherche en vain à obtenir un sursis et finalement réussit à se faire réformer en simulant une congestion pulmonaire après avoir aspiré de l'hypochlorite de chaux mélangé à de l'acide chlorhydrique. Monfreid vit pendant plusieurs années de petits boulots. Il décroche un emploi de colporteur au Planteur de Caïffa, où il se tire assez bien d'affaire et monte même en grade, mais son père lui fait quitter ce métier de « tireur de sonnettes » en lui promettant une rente mensuelle. Après une brève carrière comme chauffeur de maître, il se fait engager à la société Maggi où il devient rapidement un contrôleur de la qualité du lait. Mais Monfreid rêve d'être son propre patron: il démissionne et achète une affaire d'élevage de volaille avec l'argent reçu de son oncle dans le cadre du procès en captation d'héritage. Manque de chance, les poulets meurent tous et l'entreprise fait faillite. Maggi le réengage et il réussit à se faire nommer chef de ramassage à Fécamp, pour être près de la mer. Traficoter avec la qualité du lait et du beurre est un fléau à l'époque et Monfreid s'y laisse prendre. Il est en mer sur sa barque lorsque le représentant juridique de son employeur arrive à Fécamp pour le congédier. Monfreid, qui rêve de plus en plus à une carrière maritime, songe à se présenter à l'examen de capitaine au long cours mais il se laisse convaincre de mettre à profit ses connaissances de l'industrie laitière et il achète une petite laiterie près de Melun. Manque de chance encore un fois: Melun est très touchée par les débordements de le Seine en 1910 et la laiterie, isolée pendant des semaines, perd ses clients. Au même moment, il est gravement atteint de la fièvre de Malte qui manque l'emporter et qui le cloue au lit pendant des mois. La laiterie est vendue à perte. Ses rapports avec Lucie se sont dégradés avec le temps et c'est au cours de sa convalescence chez son père qu'il décide de mettre fin à sa relation de dix ans. C'est aussi durant sa convalescence qu'il fait la connaissance d'Armgart Freudenfeld, une jeune Allemande à qui Georges-Daniel donne des cours de peinture, et qui épousera Henry en 1915. Je revois encore la silhouette de l'Oxus... Monfreid, qui termine sa convalescence, cherche une piste pour partir et mettre la plus grande distance possible entre son passé, notamment Lucie, et lui. Justement, un ami connaît un négociant en Éthiopie, Gabriel Guigniony. Quelques jours plus tard, Monfreid apprend qu’il est engagé à l’essai comme agent de factorerie au salaire de 150 francs par mois. Cet emploi est loin d’être le pactole, il doit payer son propre voyage pour Djibouti et n’a aucune garantie d’emploi. Mais cela n'a aucune importance: Monfreid veut partir. À la mi-août 1911, il embarque à bord du vapeur l'Oxus comme passager de troisième classe à destination de Djibouti. Dans la Corne de l'Afrique Il fait d'abord le négoce du café et de peaux en Éthiopie puis, attiré par la mer, il s'installe à Djibouti fin 1913 où il achète un boutre, baptisé le Fath-el-Rahman, et avec lequel il amorce la vie aventureuse qui fera l'objet de son premier récit autobiographique : Les Secrets de la Mer Rouge. Plus tard, installé à Obock, il construit ses navires avec ses propres moyens, dont le plus célèbre, l'Altaïr, goélette de 25 mètres avec seulement 2 mètres de tirant d'eau et gréé de voiles auriques, lui permettra de fréquenter les rives de la mer Rouge cernée de bancs de récifs. Sa connaissance des mouillages et des ports en fait une source de renseignements utile à la France pendant la Première Guerre mondiale. Le Djibouti colonial de Monfreid Il entame ensuite une vie de contrebandier, se convertit à l'islam en 191425, religion de son équipage, se fait circoncire, et prend le nom d'Abd-el-Haï (esclave du vivant). Selon Guillaume de Monfreid, sa conversion était une conversion de circonstance. Il continue : je ne crois pas qu'il fût plus attaché à un rite qu'à un autre, parce que de toute façon, ce n'était pas un homme pour qui le spirituel avait beaucoup d'importance. Il était trop noyé dans l'action. Et puis, ayant découvert la vraie liberté, il ne veut plus de carcan. De même, Henry de Monfreid a été enterré selon le rite catholique. Il vit de différents trafics, perles il arrête vite ce commerce qui n'est plus lucratif après que les Japonais inventent la perle de culture, armes, haschisch, et même morphine (qu'il achète en gros en Allemagne au laboratoire pharmaceutique qui produit la drogue, et qu'il revend aux riches Égyptiens, ce qui lui vaut des démêlés avec la justice et mêmes quelques brefs séjours en prison. Monfreid s'est toujours défendu d'avoir pratiqué la traite des Noirs entre l'Afrique et l'Arabie, qui persistait encore en 192526. Cependant dans sa correspondance il explique avoir des femmes asservies. Dans son journal de bord, il raconte que pendant la Première Guerre mondiale, les autorités françaises lui demandent d'aller espionner les positions turques sur la côte du Yémen en prenant des photographies. Obock. Maison de Monfreid. Obock, depuis qu’il a cessé d’être le chef-lieu de la colonie, est redevenu une bourgade indigène; son déclin a été consommé par l’abandon total dans lequel il a été laissé durant les années qui ont suivi la guerre. Vers la fin de la guerre, il s'installe définitivement avec sa famille à Obock, loin des regards inquisiteurs des gouverneurs et autres coloniaux de Djibouti ; sa maison est près du rivage, ce qui permet à sa femme de disposer des lumières sur la terrasse si la vedette des gardes-côtes est à l'affût. Entièrement absorbé dans ses projets, Monfreid est presque toujours absent et sa femme souffre de ses longues absences et de la chaleur accablante des lieux. Elle et les enfants se réfugient fréquemment aux monts Mabla dans l'arrière-pays d'Obock, qui offrent un peu de fraicheur. Au début des années vingt, il se fait construire une petite maison à Araoué, près de Harar en Éthiopie et il y passe la saison chaude avec sa famille. Avec ses trafics, en particulier la vente de hashish en Égypte, il a fait assez de bénéfices pour acheter une minoterie et construire une centrale électrique a Diré Dawa, ville-champignon surgie au pied de Harar lors de la construction du premier tronçon du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Les Secrets de la Mer Rouge, premier récit autobiographique Monfreid fait la connaissance de Paul Vaillant-Couturier ainsi que de Joseph Kessel, fascinés par sa personnalité. Kessel lui conseille d'écrire. Monfreid tire de ses aventures dans la mer Rouge, les eaux littorales de la Corne de l'Afrique et le détroit de Bab-el-Mandeb Porte des Pleurs en arabe des romans et nouvelles captivants, où les observations maritimes et ethnologiques pertinentes et vécues voisinent avec les descriptions cyniques d'exploits de contrebande exercés livraisons d'armes, de haschich ou de morphine. Ses romans remportent un franc succès dans les années 1930. Il est également correspondant de presse pour plusieurs journaux parisiens. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, il soutient les Italiens, notamment pendant leur conquête de l'Éthiopie en 1935. Proche conseiller du général Rodolfo Graziani, Henry de Monfreid fait tout pour rencontrer le Duce Mussolini afin de pouvoir se joindre aux troupes italiennes. Il participe à quelques missions aériennes italiennes sur les territoires éthiopiens et manque d'être blessé en vol Les Guerriers de L'Ogaden, 1935. Après la débâcle de l'armée du Duce en Éthiopie devant les armées alliées en 1941, Monfreid est arrêté par les Britanniques et déporté au Kenya. Il raconte cette épopée dans le livre Du Harrar au Kenya. Libéré, il vit de chasse et de pêche sur les pentes du Mont Kenya, épisode qui lui inspirera d'autres romans comme Karembo. Après la Seconde Guerre mondiale Il retourne en France en 1947 et s'installe dans une grande maison à Ingrandes, dans l'Indre, où il peint, joue du piano, et surtout écrit. Les habitants de ce petit village de la « France profonde » resteront en plusieurs circonstances perplexes devant le mode de vie de Monfreid, patriarche sans complexes. Ainsi, étant un opiomane d'habitudes régulières, il va à l'épicerie locale pour peser et diviser en doses journalières les têtes de pavots qu'il fait pousser dans son jardin. L'épicier n'y voit pas matière à s'alarmer, d'autant que Monfreid est un bon client : il achète de grosses quantités de miel, qui lui permettent de combattre la constipation opiniâtre entraînée par l'usage quotidien de l'opium. Quelqu'un s'avise cependant un jour de dénoncer Monfreid à la gendarmerie. L'affaire est abandonnée, l'opium n'étant à l'époque utilisé que par des artistes non conventionnels, tel que son ami Jean Cocteau. Par ailleurs Monfreid se flatte à plusieurs reprises dans son œuvre de savoir à merveille décourager et amadouer les officiels trop curieux, par la flatterie, le mimétisme, et l'étalage d'une apparente bonne foi. En 1958, à l'âge de 79 ans, Monfreid entreprend un voyage à La Réunion où réside son fils Daniel. Après une visite de l'île, il fait la connaissance de Guézé, un marin qui lui propose de rejoindre l'île Maurice à bord de son bateau portant le nom créole de Rodali ; Monfreid accepte à condition d'équiper le vaisseau d'une voile. Monfreid, son fils Daniel, Guézé et un matelot nommé Fanfan composent l'équipage, qui prend la mer le dimanche 3 août 1958. Malgré l'expérience du capitaine, le bateau dérive pendant plusieurs jours avant d'être finalement secouru au large de Tamatave, à Madagascar, plus de 8 jours après le départ de La Réunion. Monfreid et son équipage sont accueillis par M. Bossuet, un agent des Messageries maritimes. Après quelques jours de visite à Madagascar qui les conduisent de Tananarive où ils visitent le palais de la Reine et sont invités à dîner par le Haut Commissaire, André Soucadaux, puis à Mantasoa, Monfreid et son fils regagnent La Réunion. L'écrivain relate ce périple dans Mon Aventure à l'île des Forbans Grasset, 1958. À la mort de Monfreid, on se rend compte que les tableaux de maîtres qu'il disait tenir de son père, et qu'il hypothéquait quand le revenu tiré de ses livres était insuffisant, étaient des faux, peut-être peints par lui-même. Œuvres Récits autobiographiques Les secrets de la mer Rouge 1931 Aventures de mer Grasset, 1932 La croisière du hachich Grasset, 1934 La poursuite du Kaïpan Grasset, 1934 Le lépreux Grasset, 1935 Charras Pavois, 1947, réédité en 1962 sous le titre La cargaison enchantée, Grasset Du Harrar au Kénia Éditions du Triolet, 1949 L'homme sorti de la mer Grasset, 1951 Mon aventure à l’île des Forbans Grasset, 1958 Le Feu de Saint-Elme Laffont, 1973, réédité en 1992 sous le titre Mes vies d'aventures Contes et aventures Abdi - L'homme à la main coupée 1937 L'enfant sauvage Grasset, 1938 Karembo La Table Ronde, 1949 Djalia ou la Revanche de Karembo La Table Ronde, 1951 Le Cimetière des éléphants (La Table Ronde, 1952 Le Serpent rouge, ou la dernière mission de Karembo La Table Ronde, 1953 Wahanga La Vallée de la mort) Grasset, 1955 Pilleurs d’épaves Flammarion, 1955 L’esclave du batteur d’or Grasset, 1957 Le Sang du parjure Flammarion, 1958 Le Récif maudit Flammarion, 1961 La Sirène de Rio Pongo (lammarion, 1961 L’Homme aux yeux de verre Grasset, 1965 Les Deux Frères Grasset, 1969 Légende de Madjélis Grasset, 1997 Romans Le naufrage de la Marietta Grasset, 1934 Le Trésor du pèlerin Gallimard, 1938 Sir Henry Middleton ou l'amiral pirate Gallimard, 1938 Le secret du lac noir N.R.F, 1940 La triolette La Table Ronde, 1948 Le naufrageur La Table Ronde, 1950 Zulma Wapler, 1951 La route interdite Grasset, 1952 Sous le masque Mau-Mau Grasset, 1956 La Croix de fer forgé Grasset, 1966 Journalisme Vers les terres hostiles de l'Éthiopie Grasset, 1933 Le drame éthiopien Grasset, 1935 Les derniers jours de l'Arabie Heureuse N.R.F, 1935 Les guerriers de l'Ogaden N.R.F, 1936 Le masque d'or Grasset, 1936 L'avion noir Grasset, 1936 Ménélik tel qu’il fut Grasset, 1954 Le Radeau de la Méduse : comment fut sauvé Djibouti Grasset, 1958 Les Lionnes d’or d’Éthiopie Laffont, 1964 L'envers de l'aventure Dix volumes publiés chez Grasset entre 1953 et 1970 1 - La vocation de Caroline 1953 2 - L’oncle Locamus ou Caroline chez les bourgeois 1954 3 - Le capitaine à la caquette blanche 1957 4 - Le cap des Trois-Frères 1959 5 - L’exilé 1960 6 - L’abandon 1962 7 - Combat 1963 8 - La chute imprévue 1965 9 - L’ornière 1967 10 - L’escalade 1969 Correspondance Journal de bord Arthaud, 1984 Lettres d'Abyssinie. Écrits d'aventurier - Tome 1, édité par Guillaume de Monfreid, Paris, Flammarion, 1999, 233 p. Lettres de la mer Rouge. Écrits d'aventurier - Tome 2, édité par Guillaume de Monfreid, Paris, Flammarion, 2000, 315 p. Aventures extraordinaires 1911-1921, édité par Guillaume de Monfreid, Paris, Arthaud, 2007, 889 p. Contient Lettres d'Abyssinie Flammarion, 1999, Lettres de la mer Rouge Flammarion, 2000, des extraits de Journal de bord, Arthaud, 1984 et Lettres d'Égypte, Arabie, Érythrée, Inde et autres lieux Arthaud, 2007. Chanson Henry de Monfreid chante la mer, microsillon 33 tours, Polygram distribution, PY 899. Monfreid y interprète des chansons de marins accompagné à l'accordéon. L'enregistrement date de 1965. Il a paru également en CD en 1996 (RYM Music 191 677-2, Polygram distribution PY 899. Œuvres inspirées par Henry de Monfreid Ouvrages Giséle de Monfreid, Mes secrets de la Mer Rouge, France-Empire, 1982. Ce livre de mémoires écrit par sa fille apporte un éclairage latéral sur la vie et l'œuvre de Monfreid, personnalité narcissique et dédiée à l'action avec qui le quotidien n'était pas facile. Joseph Kessel, Fortune carrée, Les Éditions de France, 1932. Ce roman met en scène un personnage inspiré d'Henry de Monfreid. Hergé aurait dessiné sous les traits de Henry de Monfreid le capitaine qui sauve de la noyade Tintin et Milou en mer Rouge, dans Les Cigares du Pharaon. Radio Entretiens radiophoniques menés et produits par Paul Guimard, diffusés sous le titre « les Chemins de l'aventure ». Onze entretiens entre le 19 octobre et le 21 décembre 1956, archivés par la phonothèque de l'Institut national de l'audiovisuel INA et édités sous la forme de trois disques. Télévision Les Secrets de la mer Rouge série télévisée réalisée par Claude Guillemot et Pierre Lary, 1968. Scénario : Henry de Monfreid, Roland Laudenbach, Edmond Levy et Jean O'Neill. Musique : François de Roubaix. Interprétation : Pierre Massimi, Alex Lacaste, Miloud Khetib, Mustapha Chadli, Mostéfa Stiti, Hans Wyprächtiger, Baaron, Alphonse Beni, Jean-Claude Ballard, Christiane Krüger. Lettres de la mer rouge réalisation Éric Martin et Emmanuel Caussé. Première diffusion sur ARTE le 7 avril 200634. Arnaud Giovaninetti dans la série télévisée Lettres de la mer Rouge. « Coup de cœur du Jury du public » au Festival du film de télévision de Luchon, 2006. Lauriers de l'Audiovisuel, Prix Marcel Jullian de la première œuvre. Résumé : Dans le château de George Daniel de Monfreid, au début du xxe siècle, le fils Henry, gravement malade, qui s'est vu au seuil de la mort, décide de rompre avec son existence petite-bourgeoise et rangée (on l'orientait alors vers une carrière d'ingénieur35). Il confie ses deux enfants à une jeune Allemande proche de la famille et part le plus loin possible : à Djibouti, « dans ces pays où on n'allait pas, ou plutôt où on allait, mais dont on ne revenait pas »35. Il s'y livre au commerce de peaux, d'armes, de café, ce qui, dans ces contrées frontalières, se confond souvent avec trafic et contrebande. Il entame alors une correspondance régulière et aussi détaillée qu'un journal de bord, avec son père et son amie allemande et future épouse, Armgart Freudenfeld (jouée par Elodie Navarre). Scénario : Gilles Taurand, d'après Henry de Monfreid Image : Christophe Paturange Son : Erik Ménard Montage : Gérard Parisot Musique : Nathaniel Mechaly Interprétation : Arnaud Giovaninetti, Kalassahun Bekele, Élodie Navarre, Didier Pain, Bernard Blancan Production : Pierre Javaux Productions Coproduction ARTE France avec la participation de France 3   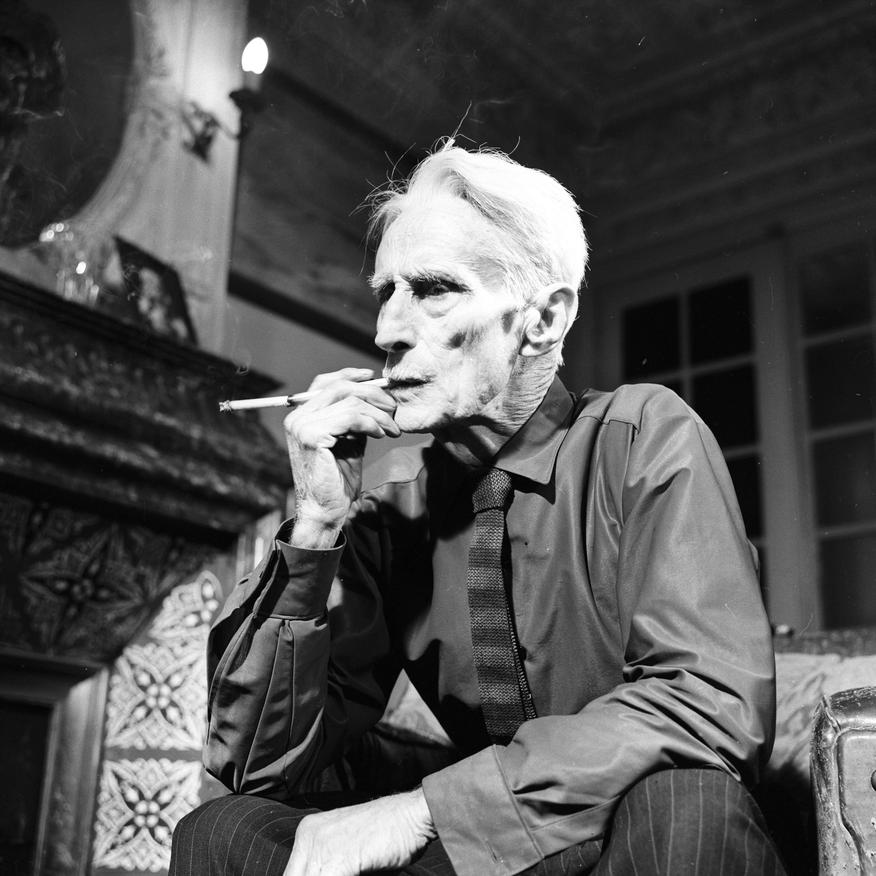     
#92
Heinrich Heine 1
Loriane
Posté le : 13/12/2015 13:28
Le 13 décembre 1797 naît Christian Johann Heinrich Heine,
à Düsseldorf, Duché de Berg, sous le nom de Harry Heine et mort le 17 février 1856 à Paris 8e arrondissement sous le nom de Henri Heine, fut l'un des plus grands écrivains allemands du XIXe siècle. Heine est considéré comme le « dernier poète du romantisme » et, tout à la fois, comme celui qui en vint à bout. Il éleva le langage courant au rang de langage poétique, la rubrique culturelle et le récit de voyage au rang de genre artistique et conféra à la littérature allemande une élégante légèreté jusqu'alors inconnue. Peu d'œuvres de poètes de langue allemande ont été aussi souvent traduites et mises en musique que les siennes. Journaliste critique et politiquement engagé, essayiste, satiriste et polémiste, Heine fut aussi admiré que redouté. Ses origines juives ainsi que son positionnement politique lui valurent hostilité et ostracisme. Ce rôle de marginal marqua sa vie, ses écrits et l'histoire mouvementée de la réception de son œuvre. En bref Plus d'un siècle après sa mort, Heine demeure un écrivain discuté, en particulier dans son propre pays. Sans qu'on lui dénie du talent, sa personne est souvent mise en cause et son nom passionne les débats. Auteur de lieder, et parmi les plus populaires dans les pays de langue allemande, il semblerait devoir, par là, échapper aux polémiques ; mais son œuvre lyrique compte aussi de grandes parties satiriques dont les traits portent et réveillent d'anciennes blessures. Il a échoué au théâtre et ne s'est jamais essayé au roman, mais il a découvert, avec le récit de voyage, une forme flexible, capable de supporter toutes les digressions et toutes les variations, et il a su, avec une exceptionnelle virtuosité, y mêler la prose et les vers, la rêverie et la moquerie, les bons mots et les aperçus soudainement révélateurs. Aussi a-t-il été, sa vie durant, journaliste, principalement à Paris où il vint après la révolution de Juillet. Il lui apparut alors que sa mission serait de servir d'interprète aux deux littératures, analysant l'Allemagne pour le public français et faisant à ses lecteurs allemands le tableau de Paris. Ce dédoublement lui a été quelquefois reproché, surtout du côté allemand où on lui pardonne souvent mal sa liberté de jugement, son goût de l'irrévérence. Pourtant, c'est le chancelier Bismarck lui-même qui l'a défendu, un jour, au Reichstag : « N'oubliez pas, Messieurs, qu'il est, après Goethe, l'auteur des plus beaux lieder en langue allemande. » Heinrich Heine a écrit que toute sa carrière, au long de sa vie, s'expliquait par ses origines. Il voulait rappeler par là qu'il était né dans une famille juive, à Düsseldorf, au bord du Rhin, en un temps où cette ville était française (elle devait le demeurer durant la période napoléonienne). Les juifs de Düsseldorf jouissaient en 1799 de plus de libertés et de droits que dans la plupart des autres villes allemandes et, si l'on en croit ses souvenirs, le jeune Heinrich, d'abord appelé Harry, a beaucoup vécu dans les rues et dans les cours, avec les enfants du voisinage, à écouter le soir des histoires et des chansons. Légendes pieuses et histoires de bourreaux, chansons d'amour et de malheur, peuplées de spectres et de démons familiers, c'est le fond où le poète devait, plus tard, largement puiser ; c'est la source d'où sont sortis les « esprits élémentaires » qui revivent dans ses vers comme dans les contes romantiques. Beaucoup plus sensible aux sons qu'aux couleurs et aux formes, Heine a été, dès son enfance, très réceptif aux mots, avant même d'en mesurer toujours le sens, et il était encore écolier qu'il savait déjà conter et jeter sur le papier des histoires imaginées, à la grande joie de sa sœur Charlotte. Après les légendes du Rhin, ce sont les souvenirs de l'épopée napoléonienne qui ont marqué ses jeunes années : le tambour de la vieille garde qui raconte ses campagnes ; les cavaliers de Murat dans le Hofgarten de Düsseldorf ; enfin, quand tout est fini, la troupe misérable des grenadiers, revenus de leur captivité en Sibérie, que Heine raconte avoir vue un jour dans ce même Hofgarten et qu'il a immortalisée dans sa ballade. Pour assurer l'avenir du jeune Harry qui se révélait inapte au commerce, son oncle Salomon Heine, qui avait édifié une grande fortune à Hambourg, lui fit faire des études de droit. Médiocre étudiant, il fut bon patriote libéral, fervent d'un passé national que la génération romantique de la guerre de libération (1813-1815) venait de sauver de l'oubli et qu'on cultivait particulièrement à Bonn. Heine passa deux semestres dans cette ville, suivant les cours de Schlegel et de Arndt, souvent en compagnie de Simrock qui devait consacrer sa vie à la poésie allemande ancienne. À Göttingen, l'année suivante, rejeté par un milieu rétrograde et borné, il prit conscience de l'antisémitisme et dut quitter la place ; mais il avait découvert aussi des cibles de choix pour ses premiers Tableaux de voyage (Reisebilder I, 1826). C'est seulement à Berlin qu'il devait trouver, dans le salon de Rachel von Varnhagen, et en écoutant les cours de philosophie politique de Hegel en 1821-1822, le milieu intellectuel et mondain qui l'a accueilli et stimulé. Intitulé simplement Poèmes (Gedichte), son premier recueil a été publié à Berlin en 1822 ; ce sont les pièces, ballades et sonnets, qui forment aujourd'hui la première partie du Livre des chants (Das Buch der Lieder), et auxquels il devait donner ensuite le titre Jeunes Souffrances (Junge Leiden, 1817-1821). Chants de malheur et rêveries, appels et désespoirs, empoisonnés par le souvenir lancinant de la vaine cour qu'il fit à Amélie, sa belle cousine de Hambourg : « Il a perdu son trésor, c'est le tombeau qui lui convient ; c'est là qu'il aimerait le mieux reposer, jusqu'au jour du Jugement Dernier » (« Le Pauvre Pierre »). En 1823 paraissait l'Intermezzo (Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo), entre deux tragédies historiques dans le goût de Walter Scott, un intermède lyrique où se trouvent quelques-unes des brèves et fulgurantes plaintes d'amour qui inspireront le musicien Robert Schumann. En 1826, avec les premiers Tableaux de voyage, Heine publiait la série de poèmes intitulée Le Retour (Die Heimkehr) où le désenchantement déchirant, le rire sur son propre malheur se révèlent comme les modes d'expression favoris du poète. Un an plus tard, avec les deux cycles de La Mer du Nord (Die Nordsee) s'ajoutant aux précédents, Heine publiait ce Livre des chants qui devait connaître treize éditions successives du vivant de l'auteur et faire de lui un poète majeur. Ballades, chansons d'amour et de deuil, tableaux de genre piquants et touchants, enfin les vastes évocations, colorées et sifflantes de la mer du Nord, les premières en langue allemande, montraient la virtuosité d'un musicien du verbe, doué dans tous les registres lyriques. Docteur en droit en 1825, baptisé peu après dans une église luthérienne (il prend alors le prénom de Heinrich), Heine cherche, des années durant et sans succès, un emploi stable dans une administration, une université ou un journal. Ses espoirs se sont tournés vers Munich où régnait Louis Ier de Bavière, un roi ami des artistes. Mais Heine était ressortissant prussien, juif bien que baptisé ; sa plume redoutable lui avait fait beaucoup d'ennemis après les Tableaux de voyage, et il avait la réputation d'être joueur et libertin. Il ne demeura pas longtemps à Munich où il rédigeait un journal, et partit pour l'Italie ; il en revint, y retourna, et en rapporta les dernières parties des Tableaux de voyage qu'il acheva de rédiger à Berlin et à Potsdam, où il vécut un temps après la mort de son père. Berlin ne lui offrit pas l'emploi que Munich lui avait refusé et, en septembre 1829, il reprenait le chemin de Hambourg, « berceau de ses malheurs » où, naguère, il s'était juré de ne jamais retourner et où ses écrits polémiques faisaient scandale, en ville et dans sa famille. Le dernier de ses grands recueils poétiques, le Romanzero a été publié en 1851. Il est le plus riche et il contient ses pièces les plus émouvantes, en particulier ses méditations sur la maladie, la mort, le dieu des Hébreux et le destin des âmes. Depuis 1848, Heine était atteint de paralysie, et il était habité par la pensée de la mort (qui surviendra huit ans plus tard à Paris). Il faisait, à l'envers, le chemin de Lazare, et revenait à ses origines, aux sources de son être. Le retour était déjà le titre d'un de ses premiers recueils, les Lamentations (Lamentationen), les Mélodies hébraïques (Hebräische Melodien), le Livre de Lazare (Das Buch Lazarus), réunies dans le Romanzero, méritaient pleinement ce titre-là. C'est le retour à la Bible de son enfance et aux récits d'antan, présents tout au long de sa carrière poétique : « Oui, je suis revenu à Dieu, comme l'enfant prodigue, après avoir longtemps gardé les cochons avec les disciples de Hegel [...] Pour ce qui est de la théologie, je dois reconnaître que j'ai fait un retour en arrière ; comme je l'ai déjà avoué, je suis revenu à une vieille superstition, la croyance en un Dieu personnel » (Postface au Romanzero, Paris, 30 sept. 1851). Mais l'univers du poète demeurait aussi riche en évocations du Moyen Âge, des mondes exotiques, des scènes amères de sa jeunesse, du « château des affronts » de Hambourg. La lampe est la compagne de ses nuits sans sommeil : quand la flamme baisse jusqu'à s'éteindre, il pense s'éteindre lui-même. À la fin la mèche geint et siffle Désespérément, et elle s'éteint. Cette pauvre lumière c'était mon âme. Durant la période hitlérienne, son nom fut rayé, en Allemagne, partout où il pouvait l'être. Il avait disparu des anthologies, mais pas tout à fait sa poésie ; il avait fallu, au moins, y laisser la Lorelei, le plus populaire de ses chants ; trop d'écoliers allemands l'avaient appris par cœur. Alors, pour ne pas imprimer au bas de ses vers le nom du poète maudit, on avait mis seulement : « auteur inconnu ». Mais ceux qui le persécutaient ainsi rendaient à son génie un hommage involontaire : même sans son nom, ses vers demeuraient. Pierre Grappin Sa vie La ville de Dusseldorf est très belle, et quand au loin on pense à elle et que par hasard on y est né, on se sent tout drôle. J’y suis né, et dans ces cas-là je crois que je dois rentrer à la maison tout de suite. Et quand je dis rentrer à la maison, je veux dire la Bolkerstrasse et la maison où je suis né… Si le lieu de naissance de Heine n'a jamais fait le moindre doute, la date précise de sa naissance reste aujourd'hui incertaine. Tous les documents qui auraient pu fournir des indications à ce sujet ont été perdus au cours des deux derniers siècles. Heine lui-même s'est qualifié, en plaisantant, de "premier homme du siècle", car il serait né au Nouvel an 1800. De temps en temps, il mentionne aussi 1799 comme année de naissance. Les spécialistes de Heine considèrent aujourd'hui la date du 13 décembre 1797 comme la plus vraisemblable. À la suite de la Révolution française, son enfance et sa jeunesse se passent dans une époque de grands bouleversements. La présence de la famille Heine est attestée à Bückeburg depuis le XVIIe siècle. Harry Heine — de son nom de naissance — était l'aîné des quatre enfants du drapier Samson Heine * 19 août 1764 à Hanovre; † 2 décembre 1829 à Hambourg et de sa femme Betty à l'origine Peira, née van Geldern *27 novembre 1770 à Dusseldorf; † 3 septembre 1859 à Hambourg. Betty était l'arrière-petite-fille de Joseph Jacob van Geldern, banquier et membre de la Chambre des comptes du prince-électeur Jean-Guillaume de Neubourg-Wittelsbach. C'est dans la maison de Joseph Jacob van Geldern que fut aménagée la première synagogue de Dusseldorf, au début du xviiie siècle. sa famille: Gustav v. 18033 in Dusseldorf; † 15 novembre 1886 à Wien, le futur baron Heine-Geldern et éditeur de la Fremden-Blatt de Vienne, Maximilian v. 18043; † 1879, plus tard médecin à Saint Petersbourg. Tous, ils grandirent dans une famille imprégnée de l'esprit de la Haskala les Lumières juives et très largement assimilée. À partir de 1803, Harry Heine fréquenta l'école privée israélite de Hein Hertz Rintelsohn. Lorsqu'en 1804, le gouvernement de Bavière-Palatinat, dont dépendait le duché de Berg et sa capitale Dusseldorf, autorisa la fréquentation des écoles chrétiennes aux enfants juifs, il intégra la Grundschule école primaire de la ville, puis, en 1807, la classe préparatoire du lycée de Dusseldorf, qui dispensait un enseignement dans l'esprit des secondes Lumières. Il fréquenta le lycée lui-même à partir de 1810, mais le quitta en 1814, sans certificat de fin de scolarité, pour suivre la tradition familiale et se préparer à un métier marchand, dans une école de commerce. En 1811, Heine, âgé de 13 ans, assiste à l'entrée de Napoléon dans Dusseldorf. En 1806, le roi Maximilien Ier de Bavière avait cédé sa souveraineté sur le duché de Berg à l'Empereur des Français. Certaines biographies avancent l'hypothèse infondée, selon laquelle Heine aurait pu, pour cette raison, prétendre à la citoyenneté française. Contrairement aux assertions ultérieures de Heinrich von Treitschke, il ne le fit jamais. Son pays natal devint le grand-duché de Berg, gouverné par le beau-frère de Napoléon, Joachim Murat, de 1806 à 1808, puis par Napoléon lui-même jusqu'en 1813. État membre de la Confédération du Rhin, le grand-duché subissait une forte influence de la France. Durant toute sa vie, Heine admira l'Empereur pour l'introduction du Code civil, qui fit des juifs et des non-juifs des égaux aux yeux de la loi. Salomon Heine 1767–1844 par Friedrich Carl Gröger; Jusqu'à sa mort, cet oncle fortuné apporta son soutien à son neveu. En 1815 et 1816, Heine travailla, d'abord comme stagiaire chez le banquier francfortois Rindskoppf. C'est dans la Judengasse Juiverie de Francfort qu'il découvrit alors l'oppressante existence des Juifs dans les Ghettos, une vie qui lui était, jusqu'alors, restée étrangère. Heine et son père fréquentèrent à cette époque la loge franc-maçonnique francfortoise Zur aufgehenden Morgenröte ». Parmi les francs-maçons, ils connurent la reconnaissance sociale, qui, en tant que juifs, leur était souvent refusée. De nombreuses années plus tard, en 1844, à Paris, Heine devint membre de la loge Les Trinosophes. En 1816, il entra dans la banque de son oncle Salomon Heine à Hambourg. Salomon, qui, contrairement à son frère Samson, avait vu prospérer ses affaires et était plusieurs fois millionnaire, prit en charge son neveu. Jusqu'à sa mort en 1844, il lui apporta un soutien financier, bien qu'il n'eût que peu de compréhension pour les penchants littéraires de celui-ci. Salomon disait à propos d'Heinrich : « S'il avait appris quelque chose d'utile, il n'aurait pas à écrire des livres. Au cours de sa scolarité au lycée, Harry Heine s'était déjà essayé à la poésie. Depuis 1815, il écrivait régulièrement. En 1817, pour la première fois, des poèmes de sa main furent publiés dans la revue Hamburgs Wächter. Amalie Heine, une cousine d'Heinrich et son premier amour Puisque Heine ne montrait ni goût ni talent pour les affaires d'argent, son oncle lui ouvrit un commerce de draps. Mais, dès 1819, Harry Heine & Comp. se trouva dans l'obligation de déposer le bilan. Son propriétaire préférait déjà se consacrer à la poésie. Les amours malheureuses de Heine avec sa cousine Amalie vinrent également troubler la paix familiale. Par la suite, il fit de cet amour non partagé le sujet de poèmes amoureux romantiques dans Le Livre des Chants. Dans le poème Affrontenburg, il décrivit l'atmosphère oppressante qui régnait dans la maison de son oncle, dans laquelle il se sentait de plus en plus indésirable. Études à Bonn, Göttingen et Berlin Vraisemblablement les dissensions au sein de la famille ont-elles enfin convaincu Salomon de faire cesser les pressions sur son neveu et de lui permettre de faire des études loin de Hambourg. En 1819, Heine entreprit des études de droit et de science camérale, bien qu'il n'eût que peu d'intérêt pour ces deux disciplines' il écrit dans ses Mémoires qu'il a "gaspillé trois des belles années de ma jeunesse" et qualifie le Corpus juris de "Bible de l'égoïsme"7. Il s'inscrivit tout d'abord à l'Université de Bonn, mais n'y suivit que quelques cours de droit. August Wilhelm Schlegel En revanche, durant le semestre d'hiver 1819/20, il assista aux cours d'August Wilhelm Schlegel sur « L'histoire de la langue et de la poésie allemande ». Le cofondateur du romantisme exerça une grande influence sur le jeune Heine, ce qui n'empêcha pas ce dernier de tenir des propos moqueurs sur Schlegel dans ses œuvres ultérieures. La même chose arriva à un autre de ses professeurs bonnois, Ernst Moritz Arndt, dont il prit, par la suite, les opinions nationalistes pour cibles dans plusieurs de ses poèmes et textes en prose. Durant cette période passée à Bonn, Heine traduisit en allemand des ouvrages du poète romantique anglais Lord Byron. Durant le semestre d'hiver 1820, il fréquenta l'Université de Göttingen, qu'il dut cependant quitter, après quelques mois seulement, à la suite d'une affaire de duel : en raison du mépris dont les Juifs étaient l'objet dans la société allemande de l'époque, Heine avait tout fait pour dissimuler ses origines. Lorsqu'un autre étudiant l'insulta, du fait de sa judéité, il le provoqua en duel. L'Université le renvoya alors, en février 1821, ainsi que son adversaire, pour un semestre. Le même mois, il fut exclu de la Burschenschaft Société d'étudiant, pour cause d'atteinte à l'exigence de chasteté. À Bonn, en 1819, il avait adhéré à la communauté étudiante. En 1821, à Göttingen, il devint membre du Corps Guestphalia. Quelques années plus tard, avec beaucoup de sarcasmes et d'ironie, il écrivit dans Le voyage dans le Harz, à propos de Göttingen : En général, les habitants de Göttingen sont partagés en étudiants, en professeurs, en philistins et en bétail, quatre états entre lesquels les lignes de démarcation sont pourtant très marquées. Celui du bétail est le plus considérable. Rapporter ici les noms de tous les étudiants et de tous les professeurs ordinaires et extraordinaires serait trop long; d'ailleurs, je ne me rappelle pas en ce moment les noms de tous les étudiants, et parmi les professeurs il en est qui n'ont pas de nom du tout. La quantité de philistins de Göttingen doit être très grande, comme le sable, ou, pour mieux dire, comme la boue aux bords de la mer. En vérité, quand je les voyais, le matin, avec leurs figures sales et leurs blancs mémoires à payer, plantés devant la porte du sénat académique, je pouvais à peine comprendre comment Dieu avait pu créer tant de semblables canailles. Heine partit pour l'Université de Berlin, où il étudia de 1821 à 1823 et où il suivit les cours de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bientôt il se lia avec les cercles littéraires de la ville et devint un hôte régulier du salon d'Elise von Hohenhausen 1789-1857 ainsi que du second salon de Rahel Varnhagen. Rahel et son époux, Karl August Varnhagen von Ense, restèrent très proches de Heine et lui apportèrent leur soutien, en faisant l'éloge de ses premières œuvres et en lui apportant d'autres contacts, par exemple avec la sœur de Varnhagen, Rosa Maria Assing, dont il fréquenta le salon à Hambourg. Jusqu'à la mort de Heine, Varnhagen von Ense entretint avec lui une abondante correspondance épistolaire. C'est durant sa période berlinoise que Heine débuta en tant qu'écrivain. Au début de l'année 1822, ses Poèmes parurent dans les librairies maçonniques, puis, en 1823, ses Tragédies avec un intermède lyrique aux éditions Dümmler. Heine avait d'abord accordé beaucoup d'importance à ses tragédies Almansor et William Ratcliff, elle n'eurent cependant aucun succès. La première d'Almansor, en 1823, à Brunswick, dut être interrompue, en raison des protestations du public. Ratcliff ne fut jamais joué de son vivant. De 1822 à 1824, Heine se consacra, pour la première fois, de façon intensive, au judaïsme : à Berlin, il fut membre actif du Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden Association pour la Culture et la Science des Juifs, il entra en relation avec Leopold Zunz, l'un des fondateurs de la « Science juive » et entreprit en 1824 l'écriture du roman Le Rabbin de Bacharach, resté inachevé. Lors d'un voyage à Poznań, qu'il fit en 1822, il découvrit, pour la première fois, le judaïsme hassidique, qui le fascina, avec lequel il ne put pourtant pas s'identifier. Au printemps 1823, deux ans avant sa conversion au christianisme, il écrivit, dans une lettre à son ami Immanuel Wohlwill : « Je n'ai pas la force de porter une barbe, de me faire insulter de « Judemauschel », de jeûner, etc. »11 Après sa conversion, les thèmes relatifs au judaïsme passèrent certes au second plan, mais ils l'occupèrent cependant toute sa vie et revinrent avec plus de force au premier plan dans son œuvre tardive, par exemple dans les Mélodies hébraïques, le troisième livre de Romancero. Doctorat, conversion et affaire Platen En 1824, Heine retourna à Göttingen. En mai de l'année suivante, il passa ses examens et devint docteur en droit en juillet 1825. Cependant, son projet de s'installer comme avocat à Hambourg échoua encore à la fin de cette même année. Pour augmenter ses chances de travailler en tant que juriste, Heine s'était fait baptiser selon le rite protestant, juste après son succès aux examens, en juin 1825, à Heiligenstadt et avait pris les prénoms de Christian Johann Heinrich. Désormais, il s'appela Heinrich Heine. Il tenta d'abord de tenir ce baptême secret : c'est ainsi qu'il n'eut pas lieu à l'église, mais dans la maison du pasteur, avec le parrain pour seul témoin. Alors tout à fait indifférent au fait religieux, il ne voyait, de toute façon, dans le certificat de baptême qu'un billet d'entrée vers la culture européenne. Il dut cependant constater que bien des porteurs de cette culture n'acceptaient pas un juif, même converti, comme faisant partie des leurs. Heine n'était cependant pas prêt à supporter les humiliations et les discriminations sans répliquer. Ceci fut démontré de façon très claire par la dite affaire Plate : une dispute littéraire avec le poète August von Platen, auquel il était reproché sa manie orientalisante, dégénéra en affrontement personnel, au cours duquel Heine fut attaqué du fait de ses origines juives. Ainsi, dans la comédie Der romantische Ödipus parue en 1829, Platen le décrivait comme le « Pétrarque de la fête des cabanes. Il lui reprochait sa fierté des synagogues et écrivait : « […] mais je ne voudrais pas être sa petite chérie […] Car ses baisers sécrètent une odeur d'ail. Heine considéra ces propos comme faisant partie d'une campagne destinée à faire échouer sa candidature à une chaire de professeur à l'Université de Munich. Lorsque, tout d'abord, les prêtres m'ont attaqué à Munich et s'en sont pris au juif dans Heine, je n'ai fait que rire : j'envisageais cette manœuvre comme une simple sottise. Mais, lorsque j'eus éventé le système, quand je vis le ridicule fantôme devenir peu à peu un vampire, quand je pénétrai l'intention de la satire de Platen, […] alors je ceignis mes reins, et je frappai aussi dru, aussi vite que possible. Le coup porta, sous forme littéraire, dans la troisième partie des Tableaux de voyage : dans les Bains de Lucques, Heine critique les poèmes de Platen jugés stériles et attribue cela à l'homosexualité du comte, qu'il rend ainsi publique. Il le décrivait sous les traits d'un « ami chaleureux et écrivait que le comte était plus un homme de croupe qu'un homme de tête. Le conflit porta gravement préjudice aux deux adversaires. Platen, socialement déconsidéré et menacé par une enquête policière, s'exila en Italie. Heine, pour sa part, ne rencontra que peu de compréhension et pas plus de soutien public pour son procédé. Jusqu'à un passé très récent, à cause de ses propos, des critiques lui reprochèrent constamment sa bassesse, sans évoquer les motifs et circonstances de l'affaire. D'autres, comme son contemporain, le critique littéraire Karl Herloßsohn, concédèrent en revanche à Heine qu'il n'avait fait que rendre à Platen la monnaie de sa pièce. Heine vit dans les attaques antisémites de Platen, mais pas seulement, la raison pour laquelle le roi Louis Ier de Bavière ne lui accorda pas la chaire de professeur, qu'il pensait déjà assurée. C'est pour cette raison qu'il gratifia, par la suite, le monarque de toute une série de vers moqueurs, par exemple dans les Chants de louange du roi Louis : « Voici Sire Louis de Bavière. De semblable il y en a peu ; Le peuple des Bavares honore en lui Le roi devant qui l'on balbutie. » Le baptême de Heine n'eut pas les conséquences espérées et il a, par la suite, à de multiples reprises, regretté explicitement sa conversion au christianisme. «Je me repens beaucoup de m'être fait baptiser ; je ne vois nullement que, dès lors, les choses aient mieux tourné pour moi : au contraire, je n'ai eu, depuis, que malheur. Presque toutes les biographies insistent sur le caractère significatif des origines juives de Heine pour sa vie et son œuvre. En particulier, le critique littéraire Marcel Reich-Ranicki est de l'avis que l'émigration de Heine vers la France est moins politique que, bien plus, motivée par son exclusion de la société allemande. En France, Heine était considéré comme allemand et donc comme un étranger, alors qu'en Allemagne il restait un juif et un pari. Avec l'affaire Platen avait échoué la dernière tentative de Heine pour obtenir un emploi de juriste dans un État allemand. Il décida alors de gagner sa vie en tant qu'écrivain indépendant, ce qui était plutôt inhabituel pour l'époque. Premiers succès littéraires En 1816, durant son séjour hambourgeois, Heine publia ses premiers poèmes Un rêve, certes bien étrange, De roses, de cyprès dans la revue Hamburgs Wächter, sous le pseudonyme de Sy. Freudhold Riesenharf anagramme de « Harry Heine, Dusseldorff. En décembre 1821, il publia son premier recueil de poésie, Poèmes, à Berlin, sous le nom de H. Heine. En 1823 suivirent les Tragédies avec un intermède lyrique. Dans la tragédie Almansor, parue en 1821, Heine s'intéresse pour la première fois, de façon détaillée, à la culture islamique en Andalousie mauresque, qu'il a célébré, toujours et encore, et dont il a déploré la disparition, dans de nombreux poèmes. Dans Almansor apparaît son premier propos politique : « Ce n’était qu’un début. Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. » Almansor En 1824 parut le recueil Trente-trois poèmes, dans lequel on trouve le texte de Heine aujourd'hui le plus célèbre en Allemagne : La Loreley. La même année, lors d'un voyage dans le Harz, il se rendit à Weimar pour rencontrer Johann Wolfgang von Goethe, pour lequel il avait une grande admiration. Deux ans auparavant, il lui avait déjà envoyé son premier volume de poèmes, avec une dédicace. Cette visite se révéla cependant décevante pour Heine, car il se montra inhibé et gauche - tout à l'opposé de son naturel habituel - et Goethe le reçut avec politesse, mais resta distant. Julius Campe, éditeur de Heine En 1826, Heine publia le récit de voyage Voyage dans le Harz, qui fut son premier grand succès public. La même année, il entra en affaires avec l'éditeur hambourgeois Hoffmann und Campe. Jusqu'à la mort de Heine, Julius Campe devait rester son éditeur. En octobre 1827, il édita le recueil Le Livre des Chants, qui fit la renommée de Heine et est resté populaire jusqu'à nos jours. La tonalité romantique, souvent proche des chants populaires, de ces poèmes et d'autres encore, qui furent, entre autres, mis en musique par Robert Schumann dans son œuvre Dichterliebe Les amours du poète, toucha le public au-delà de son temps. Mais Heine surmonta bientôt cette tonalité romantique. Pour la saper, il utilise l'ironie21 et use également des moyens stylistiques de la poésie romantique pour des vers à contenu politique. Lui-même se qualifiait de « romantique échappé. Voici un exemple de cette rupture ironique, dans lequel il se moque du rapport sentimentalo-romantique à la nature : « La demoiselle au bord de la mer Poussait de grands soupirs, Elle était émue profondément Par le coucher du soleil Ne vous tourmentez pas, mademoiselle, C'est une vieille chanson. Il disparaît par devant Pour réapparaître par derrière. » Paris Il était aux bains de mer, sur le rocher nu et rouge d'Héligoland, quand lui parvint la nouvelle des journées de juillet 1830 et du changement de régime à Paris. Patriote et libéral comme l'était alors la jeunesse universitaire allemande, victime de la politique de restauration qui lui avait fermé une porte après l'autre, se sentant à l'étroit dans le cadre provincial des cités dynastiques d'Allemagne, Heine regardait depuis longtemps vers Paris. C'était la capitale des lettres et de la liberté, la patrie d'élection des exilés, des révoltés et des prophètes. Après avoir, encore une fois, échoué dans une candidature à un emploi à Hambourg, Heine prend la route de Paris où il arrive au début de mai 1831 ; il devait y passer le reste de ses jours. Plus facilement que dans aucune ville allemande d'alors, on pouvait mener à Paris la vie libre d'un homme de lettres. Ses bons mots, son esprit lui ouvrent les salles de rédaction, et il devient rapidement une figure des cafés littéraires. Sur les boulevards et dans les salons du monde de la finance, il passe pour « l'homme le plus spirituel de l'Europe moderne ». « Quoiqu'il y eût encore en sa parole un restant d'accent tudesque, les maîtresses de maison suppliaient leurs amis de l'amener », rapporte ce même témoin qui a parlé aussi de la griserie de Heine quand il s'est vu introduit dans le milieu romantique parisien. Théophile Gautier a été son ami le plus sûr, il a été lié durablement aussi avec Gérard de Nerval qui a traduit ses poèmes en français. Ses amis parisiens parlent de lui comme d'un demi-dieu moqueur et douloureux : « Beau comme la beauté, avec un nez un peu juif ; c'est, voyez-vous, Apollon mélangé de Méphistophélès », a dit Théophile Gautier ; et Philarète Chasles : « Quand ces yeux bleus germaniques riaient de concert avec cette bouche qui mordait, on découvrait l'amertume de tant de gaieté. » L'auteur des lieder touchants et troublants du Livre des chants est aussi celui d'âpres satires, et il devait chanter les grisettes du Palais-Royal après avoir adoré Lorelei. Ses contradictions, son rire sans gaieté, ses larmes qui se donnent pour feintes et ne le sont peut-être pas, ses indignations rares et bientôt oubliées, sa subtilité et sa susceptibilité ont toujours attiré et dérouté. L'Allemagne et la France Continuant madame de Staël, Heine compose bientôt, à l'usage des Français, une histoire de L'École romantique allemande et une autre de La Religion et la philosophie en Allemagne publiées en 1835 dans la Revue des deux mondes. La seconde étude donne une vue rapide mais pénétrante des croyances, des confessions, des philosophies, du Moyen Âge à Hegel, en passant par Luther et Spinoza. L'ouvrage s'achève sur des pages célèbres où Heine prophétise le réveil de l'Allemagne de 1830, encore rêveuse, et où il souligne l'importance européenne de la pensée de Hegel. L'événement est venu confirmer la prophétie du poète. En même temps qu'il expliquait aux Parisiens les mystères de la Germanie, il faisait, pour le public des journaux allemands alors en plein essor, des tableaux de Paris. Ses correspondances pour la Augsburger allgemeine Zeitung font revivre avec vivacité le Parlement, la presse, le monde des arts et des théâtres sous la monarchie de Juillet ; elles furent rassemblées en plusieurs volumes : Les Peintres français (Die französischen Maler, 1830) ; De la France (Französische Zustände, 1839) ; Lutèce (Lutezia, 1854). La poésie engagée a fait aussi son apparition dans la vie de Heine durant sa première période parisienne, celle de sa liaison puis de son mariage avec une jeune normande rencontrée dans une boutique du Palais-Royal, Mathilde Mirat, celle aussi des combats politiques et philosophiques dont ses poèmes porteront la trace. Entre 1830 et 1848, les Allemands étaient nombreux à Paris où les ateliers attiraient des ouvriers et où les exilés politiques se rencontraient dans des associations que Heine a connues. Il y a retrouvé Ludwig Börne, qui venait de Francfort, et Karl Marx qui passa quelques mois à Paris en 1843-1844. Il a collaboré au Vorwärts, qui devait être, plus tard, un journal socialiste, et aux éphémères Annales franco-allemandes, où écrivait le jeune Marx. Pourtant, un des grands poèmes satiriques de Heine, Atta-Troll, est une charge contre les poètes libéraux allemands de son temps, signe de la difficulté qu'il éprouve à aimer tous ceux qui auraient dû être de ses amis politiques. Son esprit de franc-tireur incapable de résister au plaisir de railler fleurit avec une verve plus heureuse dans l'Allemagne, conte d'hiver (Deutschland, ein Wintermärchen, 1844). Heine a laissé quelques belles pièces politiques, ainsi Les Tisserands de Silésie (Die Schlesischen Weber) pour lequel il a même repris une image qu'il avait trouvée dans le chant des « canuts » insurgés de Lyon en 1832. Poète de la liberté, Heine savait donner de la résonance aux grands mots populaires ; il disait de lui-même qu'il était « un bon tambour ». Il se vantait volontiers aussi d'avoir marqué une date dans l'histoire de la poésie allemande en mettant fin à l'époque de l'art pour l'art, celle des classiques de Weimar ; il se voulait le premier poète « moderne » de langue allemande, divisé contre lui-même et tirant de son propre tourment une délectation subtile. Mais, au milieu de la vie parisienne, il entendait aussi le cor des postillons du Harz et le chant des filles du Rhin ; le premier, il a raconté à Richard Wagner l'histoire du Hollandais volant, qui devint Le Vaisseau fantôme, et celle de ce chevalier Tannhäuser, déchiré entre les maléfices de Vénus et la grandeur de sainte Elisabeth de Thuringe. Nouveaux poèmes Heine lui-même ne vit la mer pour la première fois que dans les années 1827 et 1828, durant ses voyages en Angleterre et en Italie. Il dépeignit ses impressions dans les Tableaux de voyage, qu'il publia entre 1826 et 1831. On y trouve le cycle Mer du Nord, ainsi que Les Bains de Lucques et Idées. Le Livre Le Grand, et enfin une profession de foi en faveur de Napoléon et des accomplissements de la Révolution française. La vénération de Heine pour Napoléon n'était cependant pas absolue. Il le formule dans les Tableaux de voyage : […] mon hommage ne vaut pas pour les actes, mais uniquement pour le génie de l'homme. Je ne l'aime inconditionnellement que jusqu'au jour du 18 Brumaire - il trahit alors la liberté. Il se révèle commentateur spirituel et sarcastique, lorsqu'il écrit, par exemple, pendant son voyage à Gènes, en Italie : « Oui, il me semble parfois que le diable, la noblesse et les jésuites n'existent qu'aussi longtemps que l'on y croit »24 Une citation du même ouvrage montre combien l'humour de Heine pouvait être méchant : « Les Tyroliens sont beaux, enjoués, probes, honnêtes, et d'esprit borné au-delà de toute idée. C'est une race d'hommes saine, peut-être parce qu'ils sont trop sots pour pouvoir être malades. » Heine s'entendait aussi à égratigner la censure, à laquelle étaient soumises toutes ses publications en Allemagne, comme en 1827, dans Le Livre Le Grand, avec le texte suivant, prétendument censuré : Heine connut la censure à partir de novembre 1827, lorsqu'il devint rédacteur des Neue allgemeine politische Annalen à Munich. C'est, à peu près, à partir de cette époque que Heine fut peu à peu perçu comme un grand talent littéraire. À partir du début des années 1830, sa renommée s'étendit en Allemagne et en Europe. Les années parisiennes C'est lors d'un séjour de détente sur l'île d'Heligoland, durant l'été 1830, que Heine apprit le début de la Révolution de Juillet, qu'il salua dans ses Lettres de Helgoland - qui ne parurent qu'en 1840, en deuxième livre de son mémoire sur Ludwig Börne. Le 10 août 1830, il écrivait : Moi aussi, je suis le fils de la révolution, et de nouveau je tends les mains vers les armes sacrées, sur lesquelles ma mère a prononcé les paroles magiques de sa bénédiction… Des fleurs ! Des fleurs ! je veux en couronner ma tête pour le combat. La lyre aussi, donnez-moi la lyre, pour que j'entonne un chant de guerre… Des paroles flamboyantes, qui en tombant incendient les palais et éclairent les cabanes… De plus en plus attaqué - surtout en Prusse -, à cause de ses prises de position politiques, et exaspéré par la censure en Allemagne, il partit pour Paris en 1831. C'est ici le début de la seconde période de sa vie et de son œuvre. Durant toute sa vie, Heine devait avoir la nostalgie de l'Allemagne, comme l'atteste son poème A l'étranger : « J'avais autrefois une belle patrie. Le chêne Y croissait si haut, les violettes opinaient doucement. C'était un rêve. Elle m'embrassait en allemand, et en allemand prononçait (On imagine à peine comme cela sonne bien) Les mots : "Je t'aime !" C'était un rêve. » Nouveaux poèmes Il ne devait plus revoir sa patrie que deux fois encore, mais il resta en contact constant avec ses relations sur place. Son premier écrit à Paris fut le compte-rendu de l'exposition de peinture au Salon de Paris de 1831 pour la revue allemande Morgenblatt für gebildete Stände. Il y traite, entre autres, en détail, du tableau de Delacroix peint en 1830, La Liberté guidant le peuple. À partir de 1832, Heine fut correspondant à Paris du journal augsbourgeois Allgemeine Zeitung, le quotidien en langue allemande le plus lu alors, créé par Johann Friedrich Cotta, l'incontournable éditeur des classiques de Weimar. Johann Friedrich von Cotta Pour ce journal, il rédigea une série d'articles, qui devaient paraître la même année sous la forme d'un livre, avec pour titre La Situation Française. Ces articles furent ressentis comme une bombe politique. Le journal de Cotta publiait certes les correspondances de façon anonyme, mais, pour tous ceux qui s'intéressaient à la politique, leur auteur ne faisait pas de doute. Autant les lecteurs étaient enthousiastes, autant les autorités étaient indignées de ces articles et exigeaient qu'ils soient censurés. En effet, à la suite de la révolution de juillet 1830 à Paris, l'opposition démocratique, nationale et libérale s'était formée en Allemagne et réclamait, avec toujours plus de force, des constitutions pour les états de la Confédération germanique. Le chancelier autrichien Metternich intervint auprès de Cotta, pour que la Allgemeine Zeitung arrête la série d'articles et ne publie plus le chapitre IX, écrit par Heine. Son éditeur hambourgeois, Julius Campe, réédita cependant l'ensemble des articles de La Situation Française, en décembre 1832, non sans avoir, contre la volonté de Heine, remis le manuscrit à l'autorité de censure. Les autorités réagirent par des interdictions, des perquisitions, des saisies et des interrogatoires. C'était surtout la préface de Heine à l'édition allemande du livre qui provoquait leur mécontentement. Aussi Campe édita-t-il alors un tiré à part, qu'il dut cependant à nouveau mettre au pilon. À la suite de cela, les ouvrages de Heine - présents et futurs - furent interdits, d'abord en Prusse, en 1833, puis dans tous les États membres de la Confédération germanique, en 1835, par décision Parlement de Francfort. Le même destin attendait les écrivains de la Jeune-Allemagne. Le Parlement expliquait sa décision en indiquant que les membres de ce groupe tentaient de s'attaquer à la religion chrétienne de la manière la plus impudente, de dégrader la situation actuelle et de détruire toute discipline et toute forme de moralité, sous couvert d'un style s'apparentant aux belles lettres et accessible à toutes les classes de lecteurs De l'avis de nombreux historiens et spécialistes de la littérature, avec La Situation Française, Heine fonda le journalisme politique moderne. Avec cette série d'articles, Heine commence son historiographie du présent, un nouveau genre, dans lequel les journalistes et écrivains rendent compte de leur temps. Son style influence, encore aujourd'hui, les pages culturelles allemandes. De ce fait, elle reste un fait marquant de l'histoire de la littérature et de la presse allemandes. De surcroît, Heine prit, dès lors, le rôle d'un médiateur spirituel entre l'Allemagne et la France et il se plaça également pour la première fois dans un cadre général européen. En 2010, les éditions Hoffmann und Campe ont publié un fac-similé du manuscrit de La Situation Française, dont l'original passait jusqu'alors pour avoir disparu. Après l'interdiction de ses œuvres en Allemagne, Paris devint définitivement le lieu d'exil de Heine. Durant ces années, apparurent les premiers symptômes de la maladie - crises de paralysie, migraines et problèmes de vue -, qui devaient le clouer au lit pendant les huit dernières années de sa vie. Mais, d'abord, il profita de la vie parisienne. Il entra en contact avec les grands noms de la culture européenne qui y vivaient, tels que Hector Berlioz, Ludwig Börne, Frédéric Chopin, George Sand, Alexandre Dumas et Alexander von Humboldt. Pendant un temps, il se rapprocha également des socialistes utopiques, comme Prosper Enfantin, un élève de Henri de Saint-Simon. L'espoir de Heine de trouver, dans le mouvement quasi-religieux de ses derniers, un nouvel évangile, un troisième testament, a contribué à sa décision de partir s'installer à Paris. Malgré sa fascination initiale, il se détourna bientôt des saint-simoniens, entre autres parce qu'ils attendaient de lui qu'il mette ses talents d'écrivain à leur service. En 1835, après que l'échec du mouvement fut devenu manifeste, Heine écrivit : « Nous [les panthéistes] ne voulons ni sans-culottes, ni bourgeoisie frugale, ni présidents modestes; nous fondons une démocratie de dieux terrestres, égaux en béatitude et en sainteté. […]Les saint-simoniens ont compris et voulu quelque chose d'analogue; mais ils étaient placés sur un terrain défavorable, et le matérialisme qui les entourait les a écrasés, au moins pour quelque temps. On les a mieux appréciés en Allemagne. Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne Paris inspira à Heine une abondance d'essais, d'articles politique, de polémiques, de mémorandums, poèmes et œuvres en prose. Alors qu'il cherchait à rapprocher les Allemands de la France et les Français de l'Allemagne, il mena à bien des analyses quasi prophétiques, par exemple en conclusion de Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne. Heine écrivit ce texte en 1834, à l'adresse des Français, 99 ans avant la prise du pouvoir par ceux qui allaient brûler ses livres : « Le christianisme a adouci jusqu'à un certain point cette brutale ardeur batailleuse des Germains, mais il n'a pu la détruire, et quand la croix, ce talisman qui l'enchaîne, viendra à se briser, alors débordera de nouveau la férocité des anciens combattants, l'exaltation frénétique des Berserkers que les poètes du Nord chantent encore aujourd'hui. Alors, et ce jour, hélas, viendra, les vieilles divinités guerrières se lèveront de leurs tombeaux fabuleux, essuieront de leurs yeux la poussière séculaire; Thor se dressera avec son marteau gigantesque et démolira les cathédrales gothiques. [...] Ne riez pas à ces avertissements, quoiqu'ils viennent d'un rêveur qui vous invite à vous défier de kantistes, de fichtéens, de philosophes de la nature; ne riez pas du poète fantasque qui attend dans le monde des faits la même révolution qui s'est opérée dans le domaine de l'esprit. […] La pensée précède l'action comme l'éclair le tonnerre. Le tonnerre en Allemagne est bien à la vérité allemand aussi : il n'est pas très leste, et vient en roulant un peu lentement ; mais il viendra, et quand vous entendrez un craquement comme jamais craquement ne s'est fait encore entendre dans l'histoire du monde, sachez que le tonnerre allemand aura enfin touché le but. À ce bruit, les aigles tomberont morts du haut des airs, et les lions, dans les déserts les plus reculés de l'Afrique, baisseront la queue et se glisseront dans leurs antres royaux. On exécutera en Allemagne un drame auprès duquel la révolution française ne sera qu'une innocente idylle. » — De l'Allemagne, 1835 Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne Bien avant la plupart de ses contemporains, Heine prit conscience du caractère destructeur du nationalisme allemand, qui - à la différence de la France - s'éloignait de plus en plus des idées de démocratie et de souveraineté du peuple. Le poète y ressentait, plus exactement, une haine sous-jacente de tout ce qui était étranger, comme il l'écrivait dans le poème En deçà et au-delà du Rhin : Nous autres Allemands, nous nous entendions mieux à la haine. Elle sourd des profondeurs de l’âme, la haine allemande ! Et pourtant elle se gonfle, géante, et peu s’en faut qu’elle ne remplisse de ses poisons le tonneau de Heidelberg Poésies inédites La controverse avec Ludwig Börne L'École Romantique 1836, le roman inachevé Le Rabbin de Bacharach et le mémorandum Sur Ludwig Börne 1840 sont d'autres ouvrages importants de ces années-là. Heine y réagit aux Lettres de Paris de son ancien ami, dans lesquelles ce dernier lui reproche d'avoir trahi les idéaux de la Révolution. De même que lors du conflit avec Platen, des animosités personnelles jouèrent un rôle dans son affrontement avec Ludwig Börne, qui fut, en son temps, plus célèbre que Heine. Les causes profondes étaient cependant de nature fondamentale et reposaient sur l'idée que le poète et l'artiste se faisait de lui-même en général. L'ensemble de l'œuvre de Heine est marquée par ses efforts pour être un artiste au-dessus des partis. Il se voulait être un poète et journaliste libre, indépendant, et, sa vie durant, il ne se considéra jamais engagé dans aucun courant politique. Il se démarquait encore du publiciste, Ludwig Börne, républicain radical, d'une manière que Börne pouvait ressentir comme bienveillante : « Je suis une guillotine ordinaire et Börne une guillotine à vapeur. Mais quand il s'agissait d'art et de poésie, Heine accordait toujours un rang plus élevé à la qualité de l'œuvre qu'à l'intention ou à la manière de penser de l'artiste. Börne voyait de l'opportunisme dans cette attitude. À de multiples reprises, il reprocha à Heine son manque d'opinion et il exigeait d'un poète qu'il se positionnât clairement dans le combat pour la liberté. Avec cette controverse pour savoir si, et à quel point, un écrivain peut être partial, Heine et Börne annoncent des polémiques à venir sur la morale politique en littérature, telles que celles qui, au XXe siècle ont opposé Heinrich et Thomas Mann, Gottfried Benn et Bertolt Brecht, Georg Lukács et Theodor W. Adorno, Jean-Paul Sartre et Claude Simon. C'est pourquoi Hans Magnus Enzensberger a tenu la dispute entre Heine et Börne pour la controverse la plus importante de l'histoire de la littérature allemande. Le mémorandum ne parut qu'en 1840, trois ans après la mort de Börne, sous le titre équivoque, non autorisé par Heine, de Heinrich Heine sur Ludwig Börne. Même des lecteurs par ailleurs bien disposés à son égard en tinrent rigueur à Heine, ainsi que des railleries qu'il contenait, sur la relation triangulaire de Börne avec son amie Jeannette Wohl et l'époux de celle-ci, le marchand francfortois Salomon Strauss. Strauss, qui se sentit ridiculisé par cette publication, affirma par la suite qu'il avait giflé le poète en public, à cause de ses propos. Heine le provoqua alors en duel et fut légèrement blessé à la hanche, tandis que Strauss en sortit indemne. Mariage, voyage en Allemagne et conflit successoral Un peu avant le duel, Heine épousa, en 1841, à l'église St-Sulpice l'ancienne vendeuse de chaussures Augustine Crescence Mirat, qu'il appelait Mathilde et qu'il voulait savoir à l'abri du besoin, au cas où il viendrait à mourir. Le mariage eut lieu, selon son souhait à elle, selon le rite catholique. Toute sa vie durant, Heine lui a dissimulé ses origines juives. En 1833, il avait fait la connaissance de la jeune fille, alors âgée de 18 ans, et vivait avec elle, vraisemblablement, depuis octobre 1834. Depuis 1830, Mathilde était ce que l'on appelait une grisette parisienne, c'est-à-dire une jeune ouvrière, non mariée, qui, selon les normes de l'époque, n'était pas respectable. Elle était séduisante, avait de grands yeux sombres, une chevelure brune, un visage rond et une silhouette très admirée. Reconnaissable entre toutes, sa « voix de fauvette » haut perchée lui donnait un air infantile, mais fascinait Heine. Il semble s'être épris de Mathilde très soudainement38. Bon nombre de ses amis, en revanche, parmi lesquels Marx et Engels, désapprouvaient cette liaison avec une femme simple et joviale. Mais Heine semble aussi l'avoir aimée pour ces raisons, car elle lui apportait l'exact opposé de son entourage intellectuel. Au début de leur relation, il avait essayé de rehausser un peu le niveau d'instruction de son amie, issue de la campagne. Grâce à lui, elle apprit à lire et à écrire. Il lui finança plusieurs séjours dans des institutions d'éducation pour jeunes femmes. Leur vie commune connut des turbulences : à de violentes scènes de ménage, souvent provoquées par la prodigalité de Mathilde, succédaient les réconciliations. À côté d'affectueuses descriptions de sa femme, on trouve également chez Heine des vers pleins de méchanceté, comme ceux du poème Célimène: « Tes lubies, tes perfidies, Je les ai endurées en silence D'autres à ma place T'auraient depuis longtemps assommée. Heine l'estimait, bien que Mathilde ne parlât pas allemand ou - plus exactement - parce qu'elle ne parlait pas l'allemand et, de ce fait, ne pouvait se faire une idée réelle de sa valeur en tant que poète. Ce propos de Mathilde nous est parvenu : Mon mari écrivait des poèmes à longueur de temps ; mais je ne crois pas que cela avait beaucoup de valeur, car il n'en était jamais content. Pour Heine, cette ignorance était justement le signe de ce que Mathilde l'aimait pour l'homme qu'il était et non en tant que poète éminent. En 1843, Heine écrivit son poème Pensées nocturnes: « Quand je pense à l’Allemagne dans la nuit, C'en est fini de mon sommeil, Je ne peux plus fermer l’œil, Et mes larmes brûlantes s'écoulent. Il finit par ces vers : « Dieu merci ! par ma fenêtre se réfracte La lumière du jour, française et joyeuse ; Arrive ma femme, belle comme l'aube, Et d'un sourire chasse les préoccupations allemandes. Les préoccupations allemandes » de Heine ne concernaient pas seulement la situation politique outre-Rhin, mais aussi sa mère, désormais veuve et seule. C'est notamment pour la revoir et lui présenter son épouse, qu'il entreprit, en 1843 L'Allemagne. Un conte d'hiver et 1844 ses deux derniers voyages en l'Allemagne. À Hambourg, il rendit visite à son éditeur Campe et, pour la dernière fois, à son oncle et soutien de toujours, Salomon Heine. À la mort de Salomon, en décembre 1844, un conflit de succession éclata entre son fils Carl et son neveu Heinrich Heine, conflit qui allait durer plus de deux ans. Après la mort de son père, Carl cessa de payer la rente annuelle que Salomon avait accordée à son neveu en 1838, mais dont il n'avait pas prévu la poursuite dans ses dispositions testamentaires. Heinrich Heine, qui en éprouva de l'humiliation, usa également de sa plume au cours de ce conflit et fit ainsi publiquement pression sur son cousin. En février 1847, ce dernier finit par accepter la poursuite du paiement de la rente, à la condition que Heinrich Heine ne publiât plus d'écrits sur la famille sans son assentiment. Le conflit trouva son origine dans le souci constant qu'avait Heine d'assurer sa situation financière et celle de son épouse. Par ailleurs, en tant qu'écrivain, son succès n'était pas qu'artistique, mais aussi économique : durant ses meilleures années parisiennes, il gagna jusqu'à 34700 francs par an, ce qui correspondrait aujourd'hui 2007 à plus de 200 000 euros. Il devait une partie de ce revenu à un apanage de l'État français, qui sera cependant supprimé après la Révolution de février 1848. Heine ressentit cependant toujours sa situation financière comme incertaine et, en public, la décrivait souvent plus mauvaise qu'elle ne l'était en vérité. Durant les années qui suivirent, il s'agit surtout, pour lui, d'assurer l'avenir matériel de sa femme. Après la mort de Heine, Mathilde se révéla d'ailleurs particulièrement douée pour les affaires. C'est très favorablement qu'elle négocia avec Campe pour l'exploitation à venir des ouvrages de son époux. Elle lui survécut plus d'un quart de siècle et mourut en 1883. Leur union resta sans enfants.
#93
Heinrich Heine 2
Loriane
Posté le : 13/12/2015 13:20
Heine et le socialisme
Du milieu des années 1840 datent les grandes épopées en vers de Heine Atta Troll et — nourri par son voyage en Allemagne de 1843 — Allemagne. Un Conte d'Hiver. Il y commentait, avec un mordant tout particulier, la situation de l'État, de l'Église et de la société en Allemagne. Il décrit ainsi, dans les vers d'introduction, une scène juste après le passage de la frontière, où une jeune fille chante un air pieux, sur une harpe, « avec de vrais sentiments et une fausse voix : Elle chantait le chant du vieux renoncement, Le tra-la-la du paradis Avec lequel, quand il pleurniche, on assoupit Le peuple, ce grand malappris. J'en connais la mélodie, j'en connais les paroles, Je connais même Messieurs les auteurs ; Je sais, qu'en secret, ils buvaient du vin Et prêchaient l'eau à leurs auditeurs. Je veux vous composer, mes amis, Un chant nouveau, ce qu'il y a de mieux ! Nous voulons déjà, ici-bas sur terre, Fonder le royaume des cieux. Nous voulons être heureux sur terre, Et cesser d'être dans le besoin ; Le ventre paresseux ne doit pas digérer Le produit du dur labeur de nos mains. Karl Marx Dans ces vers résonnent des idées de Karl Marx. Il avait fait sa connaissance durant ces années-là, ainsi que celle du futur fondateur de la social-démocratie allemande, Ferdinand Lassalle. Par la suite, Heine collabora aux revues de Marx, le Vorwärts ! et les Deutsch-Französische Jahrbücher. Il publia ses nouveaux chants, en 1844, dans le recueil Nouveaux Poèmes, dans lequel le Conte d'hiver apparaissait également au départ. Depuis le début des années 1840, le ton de Heine s'était considérablement radicalisé. Il fit partie des premiers poètes allemands qui prirent conscience des conséquences de la révolution industrielle en marche et soulevèrent dans leurs œuvres la question de la misère de la toute nouvelle classe ouvrière. Son poème Les Tisserands Silésiens, de juin 1844, est exemplaire à ce sujet. Il était inspiré de la révolte des tisserands, qui avait éclaté, le même mois, dans les villes silésiennes de Peterswaldau et Langenbielau. « Les Tisserands Silésiens L'œil sombre et sans larmes, Devant le métier, ils montrent les dents ; Allemagne, nous tissons ton linceul. Nous le tissons d'une triple malédiction - Nous tissons, nous tissons ! Maudit le dieu que nous avons prié Dans la froideur de l'hiver, dans les jours de famine ; Nous avons en vain attendu et espéré, Il nous a moqués, bafoués, ridiculisés - Nous tissons, nous tissons ! Maudit le roi, le roi des riches, Que notre misère n'a pu fléchir, Qui nous a arraché jusqu'au dernier sou Et nous fait abattre comme des chiens - Nous tissons, nous tissons ! Maudite l'hypocrite patrie, Où seuls croissent l'ignominie et la honte, Où chaque fleur s'affaisse bien tôt, Et la pourriture, la putréfaction régalent la vermine - Nous tissons, nous tissons ! La navette vole, le métier craque, Nous tissons avec ardeur, et le jour, et la nuit - Vieille Allemagne, nous tissons ton linceul, Nous le tissons d'une triple malédiction, Nous tissons, nous tissons ! Ce poème, également connu sous le nom de Chant des Tisserands parut le 10 juin 1844, sous le titre Les Pauvres Tisserands, dans le journal Vorwärts !, édité par Karl Marx, et, tiré à 50 000 exemplaires, il fut distribué, sous forme de tract, dans les régions où avait lieu la révolte. Le ministre de l'intérieur de Prusse, Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg, décrivit ce texte, dans un rapport au roi Frédéric-Guillaume IV, comme « une harangue aux pauvres parmi le peuple, au ton séditieux et remplie de propos criminels. La Chambre Royale de justice de Prusse décréta l'interdiction du poème. En 1846, en Prusse, un récitant, qui avait, malgré tout, eu l'audace de dire ce poème en public, fut condamné à la prison. Friedrich Engels, qui avait fait la connaissance de Heine en août 1844, traduisit le Chant des Tisserands en anglais et le fit publier, en décembre de la même année, dans le journal The New Moral World. Depuis le début de sa période parisienne, Heine entretenait des liens avec des représentants du saint-simonisme, l'un des premiers courants socialistes. Malgré ces contacts et ses relations amicales avec Marx et Engels, il eut cependant toujours une attitude ambivalente à l'égard de la philosophie marxiste. Heine reconnaissait la misère de la classe ouvrière naissante et soutenait ses revendications. En même temps, il craignait que le matérialisme et la radicalité des idées communistes ne détruisent beaucoup de ce qu'il aimait et admirait dans la culture européenne. Dans la préface de l'édition française de Lutèce, Heine écrivait, un an avant sa mort : Cet aveu, que l'avenir appartient aux communistes, je le fis d'un ton d'appréhension et d'angoisse extrêmes, et hélas ! ce n'était nullement un masque ! En effet, ce n'est qu'avec horreur et effroi que je pense à l'époque où ces sombres iconoclastes parviendront à la domination : de leurs mains calleuses ils briseront sans merci toutes les statues de marbre de la beauté, si chères à mon cœur ; ils fracasseront toutes ces babioles et fanfreluches fantastiques de l'art, qu'aimait tant le poète ; ils détruiront mes bois de lauriers et y planteront des pommes de terre ; […] et hélas ! mon Livre des Chants servira à l'épicier pour en faire des cornets où il versera du café ou du tabac à priser pour les vieilles femmes de l'avenir. Hélas ! je prévois tout cela, et je suis saisi d'une indicible tristesse en pensant à la ruine dont le prolétariat vainqueur menace mes vers, qui périront avec tout l'ancien monde romantique. Et pourtant, je l'avoue avec franchise, ce même communisme, si hostile à tous mes intérêts et mes penchants, exerce sur mon âme un charme dont je ne puis me défendre ; deux voix s'élèvent en sa faveur dans ma poitrine, deux voix qui ne veulent pas se laisser imposer silence […]. Car la première de ces voix est celle de la logique. […] et si je ne puis réfuter cette prémisse : que les hommes ont tous le droit de manger, je suis forcé de me soumettre aussi à toutes ses conséquences […]. La seconde des deux voix impérieuses qui m'ensorcèlent est plus puissante et plus infernale encore que la première, car c'est celle de la haine, de la haine que je voue à un parti dont le communisme est le plus terrible antagoniste, et qui est pour cette raison notre ennemi commun. Je parle du parti des soi-disant représentants de la nationalité en Allemagne, de ces faux patriotes dont l'amour pour la patrie ne consiste qu'en une aversion idiote contre l'étranger et les peuples voisins, et qui déversent chaque jour leur fiel, notamment contre la France. La révolution échouée Proche du mouvement libéral constitutionnel, Heine suivit les événements de l'année 1848 en Europe avec des sentiments mélangés. Il était largement en accord avec la situation politique instaurée en France par la Révolution de juillet 1830. C'est pourquoi il n'avait aucun problème à accepter une rente de l'État français. De ce point de vue, il regarda la révolution parisienne de février et ses répercussions avec un scepticisme grandissant. Dans une lettre du 9 juillet 1848 à Julius Campe, par exemple, il qualifiait les événements d'anarchie universelle, embrouillamini mondial, folie divine devenue manifeste ! En revanche, en Allemagne, il fallait absolument créer un État national et avec une constitution démocratique. Cet objectif, que Heine soutenait, était alors également celui que poursuivaient les libéraux durant la Révolution de Mars dans les États de la Confédération germanique. Cependant, les défenseurs d'un régime républicain et démocratique restaient minoritaires, non seulement dans les parlements des différents États, mais également au Parlement de Francfort : déçu, Heine se détourna bientôt de l'évolution des événements en Allemagne. Dans la tentative du premier parlement élu en Allemagne de créer une monarchie impériale héréditaire, il ne vit que le rêve romantique, et politiquement impropre, de la résurrection du Saint-Empire romain germanique, disparu en 1806. Dans le poème Michel après mars, il écrit : « Lorsque le drapeau noir-rouge-or, Le bric-à-brac de la vieille Allemagne, Parut à nouveau, alors l'illusion chancela Ainsi que la féerie suave des contes. Je connaissais les couleurs de cette bannière Et leur présage : De la liberté allemande, elles m'apportaient Les pires nouvelles. Je voyais déjà le Arndt et le père Jahn Ces héros d'un autre temps S'extirper de leurs tombeaux Et se battre pour l'Empereur. Toute cette faune d'étudiants Sortis de mes jeunes années Qui s'enflammaient pour l'Empereur, Lorsqu'ils étaient ivres. Je voyais la gent grissonante à force de péchés Des diplomates et des prêtres, Les vieux chevaliers servants du droit romain, S'affairant au temple de l'unité - (…) Les couleurs noir-rouge-or étaient donc, aux yeux de Heine, un symbole tourné vers le passé, les couleurs des Burschenschaften allemandes, à qui il reprochait leur teutomanie et leur « patriotisme pompeux. À ceux qui critiquaient cette position, il avait déjà répondu en 1844, dans la préface de Allemagne. Un conte d'hiver : Plantez les couleurs noir-rouge-or au sommet de la pensée allemande, faites-en l'étendard de la liberté des hommes, et je verserai pour elle le meilleur sang de mon cœur. Tranquillisez-vous, j'aime la patrie, tout comme vous. La première phase de la révolution échoua lorsque le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV refusa la couronne impériale, que lui proposait la majorité à l'assemblée nationale. En réaction, de nouveaux soulèvements démocratiques eurent lieu, à l'ouest et dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'objectif était d'imposer aux princes la constitution de Francfort. Mais, entre l'été et l'automne, cette seconde vague révolutionnaire fut bientôt vaincue, en grande partie par les troupes prussiennes. Résigné, Heine commente les événements dans son poème En octobre 1849: « Les vents violents se sont couchés Et le calme revient au pays. Germania, la grande enfant se réjouit à nouveau de ses arbres de Noël. (…) Dans une douillette intimité se reposent le fleuve et la forêt, baignés d'un doux clair de lune ; Ne reste parfois qu'un bruit sec - Est-ce un coup de feu ? - C'est un ami peut-être, que l'on fusille. Le tombeau-matelas En février 1848, alors que la révolution éclatait à Paris, Heine fit une grave crise. Presque totalement paralysé, il devra passer ses huit dernières années alité, dans ce qu'il appela lui-même son « matelas-tombeau ». Depuis 1845, une maladie neurologique le rongeait, s'aggravant de façon dramatique par crises successives. En 1846, il fut même déclaré mort. Des séjours dans des lieux de cure, à Barèges dans les Pyrénées en 1846 ou à la campagne près de Montmorency en 1847, par exemple, ne lui apportèrent aucun soulagement sensible. S'y ajoutèrent les désagréments occasionnés par le conflit de succession qu'il eut, des années durant, avec son cousin de Hambourg, Carl Heine, conflit qui ne sera réglé qu'en 1847. L'état de santé de Heine était alors déjà très dégradé. Friedrich Engels rapportait, en janvier 1848, soit encore avant la crise décisive : Heine est au plus mal. Il y a quinze jours, je suis allé le voir, il était au lit et venait d'avoir une crise nerveuse. Hier, il était debout, mais faisait peine à voir. Il ne peut plus faire trois pas. En s'appuyant aux murs, il se glisse du fauteuil au lit, et vice versa. En plus de cela, le bruit dans sa maison, qui le rend fou. Heine lui-même semblait convaincu d'être malade de la syphilis et certains se prononcent, encore aujourd'hui, en faveur au moins du caractère syphilitique de son mal. De nombreux biographes reprirent d'abord ce diagnostic, qui est pourtant, depuis peu, de plus en plus remis en question. Une étude plus poussée de tous les documents contemporains relatifs aux antécédents de Heine attribue plutôt les symptômes les plus importants à une maladie tuberculeuse, tandis qu'une analyse des cheveux du poète, effectuée en 1997, suggère un saturnisme chronique54,55. Une autre hypothèse circule, selon laquelle il aurait souffert de sclérose latérale amyotrophique ou de sclérose en plaques. La puissance créatrice et intellectuelle de Heine ne faiblit pas durant les années passées dans son lit de douleur. Alors qu'il ne pouvait quasi plus écrire lui-même, il dictait le plus souvent ses vers et ses écrits à un secrétaire ou confiait à celui-ci la recopie des brouillons écrits de sa propre main. La relecture des manuscrits, dont il se chargera jusqu'à la fin, constituait pour Heine, presque aveugle, un tourment supplémentaire. Malgré ses conditions difficiles, il publia encore tout une série d'œuvres essentielles, au nombre desquelles le volume de poésie Romancero 1851, ainsi que Le Docteur Faust et, en 1854, trois volumes d'Écrits mêlés, qui comprenaient, entre autres, son testament politique Lutèce et Les poèmes. 1853 et 1854. Dans le poème Enfant perdu tiré du Romancero, il tire le bilan de sa vie politique: « Sentinelle perdue dans la guerre de la liberté, J'ai tenu, fidèle, pendant trente années. J'ai combattu sans espoir de vaincre. Je savais que je ne rentrerais pas indemne. […] Mais je tombe invaincu, et mes armes Ne se sont pas brisées - Mon cœur seul s'est brisé. Dans les années qui ont précédé sa mort, Heine développa une vision plus indulgente de la religion. Dans son testament du 13 novembre 1851 il déclare sa foi en un Dieu personnel, sans pour autant se rapprocher de l'une des Églises chrétiennes ou du judaïsme. Il s'y exprime ainsi : Bien que, par mon acte de baptême, j'appartienne à la confession luthérienne, je ne souhaite pas que des représentants de cette Église soient invités à mon enterrement ; de même, je refuse que tout autre prêtre officie, lors de l'inhumation de mon corps. Ce souhait n'est pas une lubie de libre-penseur. Depuis quatre ans, j'ai renoncé à tout orgueil philosophique et suis revenu vers des idées et des sentiments religieux ; je meurs dans la croyance en un Dieu unique, le créateur éternel de ce monde, dont j'implore la miséricorde pour mon âme immortelle. Je regrette d'avoir parfois parlé de choses saintes sans le respect qui leur était dû, mais j'étais entraîné bien plus par l'esprit de mon époque que par mes propres penchants. Si j'ai, sans le savoir, offensé les bonnes mœurs et la morale, essence véritable de toutes les religions monothéistes, alors j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. Elise Krinitz, Déjà en septembre 1851, il avait justifié, par sa longue maladie, sa foi renouvelée en un Dieu capable d'aider. Il comparait, en même temps, la conviction de l'immortalité de l'âme, qui accompagnait cette foi, avec un os à moelle que le boucher, content de son client, lui glisse dans le panier, en guise de cadeau. D'un tel os, on fait de délicieux bouillons, qui, pour un pauvre malade languissant, constituent un festin tout à fait bénéfique. Le texte s'achève finalement par le refus de toute religiosité organisée : « Je dois pourtant démentir formellement la rumeur, selon laquelle mes pas en arrière m'auraient mené jusqu'au sein ou même au seuil de quelque Église que ce soit. Non, mes convictions et opinions religieuses sont restées libres de tout clergé ; aucun son de cloche ne m'a séduit, aucun cierge ne m'a ébloui. Je n'ai joué d'aucune symbolique et n'ai pas tout à fait renoncé à ma raison. Je n'ai rien abjuré, pas même mes vieilles divinités païennes, dont je m'étais certes détourné, mais ne m'en séparant qu'avec amour et amitié. Postface de Romancero Malgré sa souffrance, l'humour et la passion ne firent pas défaut à Heine. Les derniers mois de sa vie furent rendus plus supportables par les visites de son admiratrice Elise Krinitz, qu'il appelait tendrement Mouche, faisant référence à l'animal figurant sur le cachet de ses lettres. La jeune femme, âgée de 31 ans, étaient née en Allemagne et était venue à Paris avec ses parents adoptifs. Elle vivait en donnant des cours de piano et de langue allemande. Par la suite, elle deviendra écrivain sous le pseudonyme de Camille ou de Camille Selden. Heine fit d'elle sa fleur de lotus adorée et son gracieux chat musqué. Elise Krinitz aimait sincèrement cet homme moribond, quasi aveugle. Il avait été le poète favori de ses jeunes années. À cause de l'état de Heine, cette passion ne put pourtant s'épanouir que sur un plan purement intellectuel. Il commenta cela avec beaucoup d'auto-dérision dans les vers suivants : « Des mots ! Des mots ! Pas de faits ! jamais de viande, poupée chérie. L'esprit toujours et pas de rôti, pas de boulettes dans la soupe Sa capacité à plaisanter encore de la mort - ainsi que la pleine conscience qu'il avait de son rang au sein de la littérature allemande -, c'est ce que montre ce poème : « En mon sein sont morts Tous les désirs vains de ce monde, Quasi morte aussi en moi La haine des méchants, et même le sens De ma propre misère, comme de celle des autres - En moi ne vit encore que la mort ! Le rideau tombe, la pièce est jouée, Et maintenant, lassé, il rentre chez lui Mon cher public allemand, Les bonnes gens ne sont pas stupides, Réjoui, il mange jusqu'à la nuit, Et boit son verre, chante et rit - Il a raison, le noble héros, qui jadis disait, dans le livre d'Homère : Le moindre philistin vivant De Stuckert sur Neckar, est bien plus heureux Que moi, le Pélide, le héros mort, Le prince de l'ombre dans le monde souterrain. Plaque commémorative Henri Heine au 3 avenue Matignon à Paris Le 17 février 1856, Heinrich Heine mourut au 3 avenue Matignon à Paris dans l'ancien 1er arrondissement actuellement dans le 8e arrondissement. Trois jours plus tard, il fut enterré au cimetière de Montmartre. Selon ses dernières volontés, Mathilde, dont il avait fait sa légataire universelle, sera enterrée avec lui, après sa mort, 27 ans plus tard. Le tombeau, construit en 1901, a été décoré par un buste en marbre du sculpteur danois Louis Hasselriis et du poème Où ?. Tombe de Heine à Paris et poème "Où ?" « Le dernier repos de celui que le voyage A fatigué, où sera-t-il ? Sous les palmiers du sud ? Sous les tilleuls du Rhin ? Serai-je, quelque part dans le désert, Enfoui par des mains étrangères ? Ou reposerai-je sur les bords D’une mer, dans le sable ? Quoi qu’il en soit ! le ciel de Dieu m’entourera, là-bas comme ici Et en guise de veilleuses flotteront La nuit au-dessus de moi les étoiles. » Importance et héritage En raison de son originalité autant que de son étendue, tant au niveau de la forme que du fond, l'œuvre de Heine ne peut être clairement classée dans aucun courant littéraire. Heine est issu du romantisme, mais il en a très vite dépassé la tonalité et la thématique - même en poésie. Son biographe Joseph A. Kruse voit dans son œuvre des éléments issus de l'Aufklärung les Lumières allemandes, du classicisme de Weimar, du réalisme et du symbolisme. Il était surtout un auteur critique du Vormärz. Son aspiration au changement politique, à plus de démocratie dans toute l'Europe, et particulièrement en Allemagne, le rapproche des écrivains de la Jeune-Allemagne, au nombre desquels on le compte parfois. Qu'il puisse concevoir la démocratie dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle, comme celle du « Roi Citoyen », Louis-Philippe Ier, lui a valu la critique des républicains convaincus. Par contre, la prise de distance de Heine avec la littérature engagée, qu'il comparait à des « articles de journaux rimés »68 eut lieu bien moins pour des motifs politiques qu'esthétiques. Heine était proche de Karl Marx et de Friedrich Engels, sans pour autant partager tout à fait leur philosophie politique. Heine divisait déjà ses contemporains, notamment parce que lui-même ne reculait pas devant des jugements clivants. Il attaquait ses adversaires, réels ou supposés, aussi durement qu'il était attaqué lui-même, et ne s'effrayait d'aucune polémique. Après sa mort, l'âpreté des débats à son égard s'accrut encore - et persista encore plus d'un siècle. Le conflit de la mémoire Symptomatique fut le conflit autour de l'édification d'un monument à la mémoire de Heine en Allemagne, qui fit dire à Kurt Tucholsky en 1929 : Dans ce pays, le nombre des monuments allemands élevés à des guerriers se rapporte au nombre des monuments allemands à Heine comme le pouvoir à l'esprit. Depuis 1887, il existait des initiatives pour l'érection d'un monument en l'honneur du poète dans sa ville natale de Dusseldorf, afin de célébrer le prochain centenaire de sa naissance. Mais la perception de Heine par le public était alors de plus en plus influencée par des spécialistes littéraires aux arguments nationalistes et antisémites. Ainsi, dans son fameux essai publié en 1906 Heinrich Heine. Un monument aussi, Adolf Bartels dénonçait, après coup, les projets de monument de Dusseldorf comme une capitulation devant le judaïsme » et Heine lui-même comme Juif de la décadence. En 1893, face à de semblables attaques, le conseil municipal de Dusseldorf avait déjà retiré son approbation à l'érection du monument conçu par le sculpteur Ernst Herter. Cette représentation de la Loreley fut finalement acquise par des germano-américains pour le quartier du Bronx à New York. Aujourd'hui connue sous le nom de Lorelei fountain, elle se trouve à proximité du Yankee Stadium. À Dusseldorf, on apposa plus tard une plaque commémorative sur la maison natale de Heine, qui fut toutefois démontée et fondue en 1940. Entreprise en 1931, une seconde tentative à Dusseldorf pour ériger un monument à Heine échoua deux ans plus tard, avec l'arrivée des nazis au pouvoir. La sculpture allégorique, déjà achevée, le Jeune homme montant fut exposée, sans référence explicite à Heine, d'abord dans un musée, puis, après-guerre, au Ehrenhof de Dusseldorf. Ce n'est que depuis 2002 qu'une inscription sur son socle désigne Heine. La ville natale de Heine n'a honoré le poète officiellement, avec l'érection d'un monument, qu'en 1981, soit près de 100 ans après les premières initiatives dans ce sens, et cela a, à nouveau, généré un conflit. La Heinrich-Heine-Gesellschaft souhaitait l'exécution d'un projet qu'Arno Breker avait déjà conçu pour le concours de 1931. Breker, admirateur de Heine, mais également l'un des sculpteurs officiels au temps du national-socialisme, avait réalisé une figure assise idéalisée, qui représente le poète sous les traits d'un jeune homme lisant. Le responsable du service culturel de Dusseldorf refusa cependant cette sculpture. Par la suite, elle fut exposée sur l'île Nordeney. C'est finalement le projet du sculpteur Bert Gerresheim qui a été réalisé, l'actuel monument à Heine sur le Schwanenmarkt de Dusseldorf. Tout comme à Dusseldorf, l'érection d'un monument à Hambourg posa problème. L'impératrice Élisabeth d'Autriche, qui admirait Heine et avait soutenu la première initiative en faveur de l'érection d'un monument à Dusseldorf, voulut offrir à la ville hanséatique une statue en marbre représentant Heine assis, que le danois Louis Hasselriis - également créateur du buste ornant la tombe de Heine - avait exécutée en 1873. Cependant la ville refusa ce cadeau. L'impératrice fit alors exposer cette statue, en 1892, dans le parc de l'Achilléon, son château sur l'île de Corfou. En 1909, sur ordre de l'empereur allemand Guillaume II, qui, entre-temps, avait acquis le château, la statue fut retirée. L'empereur qui considérait Heine comme le pire saligaud de tous les poètes allemands, céda la statue à l'éditeur hambourgeois Heinrich Julius Campe, le fils de Julius Campe. Celui-ci voulut en faire cadeau, pour la seconde fois, au sénat de Hambourg. Mais elle fut à nouveau refusée, au motif de la prétendue attitude anti-patriotique de Heine. À cette occasion, un débat public avait également eu lieu, auquel Adolf Bartels prit part, avec une argumentation antisémite. Le monument fut enfin érigé sur la propriété de la maison d'édition Hoffmann und Campe dans la Mönckebergstraße. Il ne fut exposé publiquement à Altona qu'en 1927. Afin de le protéger de la destruction par les nazis, la fille de Campe le fit démonter en 1934 et, en 1939, elle le fit transporter dans sa résidence de Toulon, dans le sud de la France. Durant la période de l'occupation allemande, la statue fut cachée et ne trouva son emplacement définitif qu'en 1956, dans le jardin botanique de Toulon. Il y a quelques années, une initiative du comédien Christian Quadflieg pour ramener la sculpture à Hambourg fut conclue par un échec. Ce n'est qu'en 1926 que Hambourg eut un monument dédié à Heine, lorsqu'une statue, réalisée en 1911 par le sculpteur Hugo Lederer, fut inaugurée dans parc municipal de Winterhuder70. Ce monument fut enlevé par les nazis, dès 1933, et fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1982, une nouvelle statue de Heine, du sculpteur Waldemar Otto, se trouve sur le Rathausmarkt. Le premier monument, sans doute, qui fut érigé en Allemagne, en l'honneur de Heine, fut le fruit d'une initiative privée : en 1893, la baronne Selma von der Heydt fit ériger, sur le Friedensaue à Küllenhahn aujourd'hui annexé à Wuppertal, une pyramide tronquée d'environ deux mètres de haut, dans laquelle étaient enchâssées trois plaques commémoratives. Un mât de drapeau qui en faisait partie avait déjà disparu en 1926, le reste fut détruit à l'époque nazie, par les jeunesses hitlériennes73. En 1958, la ville de Wuppertal inaugura un nouveau monument dans le Von-der-Heydt-Park. Le sculpteur Harald Schmahl utilisa trois blocs en calcaire coquillier, issus des ruines du Barmer Rathaus. Le plus vieux monument à Heine encore existant se trouve à Francfort-sur-le-Main. Il s'agit également du premier érigé par les pouvoirs publics. En 1913, Georg Kolbe, qui allait également recevoir, 20 ans plus tard, la commande du monument à Heine pour le Ehrenhof de Dusseldorf, avait déjà réalisé, à la demande de la ville de Francfort, une sculpture allégorique représentant un jeune homme marchant. Durant la période nazie, cette œuvre fut cachée dans la cave du Städel-Museum sous le nom inoffensif de Chant du printemps. Il fut ainsi le seul monument allemand dédié à Heine qui survécut à la dictature hitlérienne et à la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui, à nouveau, sur le Wallanlagen. Bert Gerresheim, le créateur du monument de Dusseldorf, érigé en 1981, a également réalisé le buste de marbre de Heinrich Heine, inauguré le 28 juillet 2010 au Walhalla. Le cercle des amis de Heine de Dusseldorf s'y était employé dix années durant. En 2006, le gouvernement bavarois a approuvé l'entrée de Heine dans ce « panthéon », qu'il avait lui-même qualifié, de façon ironique, de cimetière pour crânes de marbre. Réception controversée jusqu'après-guerre Durant le Troisième Reich, les œuvres de Heine furent interdites et furent victimes des autodafés de 1933. Après-guerre, le germaniste Walter Arthur Berendsohn affirma que La Loreley de Heine était parue dans des manuels de la période nazie, avec la mention « poète : inconnu ». Theodor W. Adorno contribua à diffuser cette assertion, cependant cela n'a, encore aujourd'hui, pas été attesté. Même après 1945, la réception de Heine et de son œuvre en Allemagne est restée encore longtemps ambivalente et l'objet de multiples conflits, auxquels contribua notamment la division de l'Allemagne. Alors que, dans la République fédérale d'Allemagne du temps d'Adenauer, Heine était plutôt reçu avec réserve, et tout au plus comme un poète romantique, la RDA se l'était approprié plutôt rapidement, conformément au concept d'« héritage culturel, et s'efforçait de populariser son œuvre. C'étaient, en fait, surtout Allemagne. Un conte d'hiver et ses liens avec Karl Marx qui étaient au centre de cet intérêt. Le premier congrès scientifique international consacré à Heine fut organisé à Weimar, en 1956, année de commémoration de sa mort. La même année parut, pour la première fois, l'édition de ses œuvres en cinq volumes dans la Bibliothek Deutscher Klassiker chez Aufbau-Verlag. Le germaniste est-allemand Hans Kaufmann livra, en 1967, la monographie de Heine, aujourd'hui encore la plus importante de l'après-guerre. En 1956, à Dusseldorf, la Heinrich-Heine-Gesellschaft (de) fut certes fondée, à l'occasion du centième anniversaire de sa mort. Mais ce n'est que dans les années 1960 que l'intérêt pour Heine se fit également sentir en RFA. Dusseldorf, sa ville de naissance, s'imposa peu à peu comme le centre de la recherche ouest-allemande sur Heine. À partir des archives sur Heine se développa progressivement le Heinrich-Heine-Institut (de) avec des archives, une bibliothèque et un musée. Depuis 1962 paraît régulièrement le Heinrich-Heine-Jahrbuch, qui est devenu le forum international de la recherche sur Heine. Par ailleurs, depuis 1972, la ville de Dusseldorf décerne le Prix Heinrich Heine. Le débat autour de Heine persista cependant. Le projet de donner à l'Université de Dusseldorf le nom du plus important poète que la ville ait jamais donné, fut l'occasion d'un conflit de près de 20 ans. Ce n'est que depuis 1989 que l'université s'appelle Heinrich-Heine-Universität. L'image de Heine aujourd'hui Indépendamment des hommages officiels, l'écrivain politique Heinrich Heine connaît un regain d'intérêt auprès des jeunes chercheurs et des lecteurs politiquement engagés - phénomène accéléré par le mouvement étudiant de 1968. L'organisation en 1972 de deux congrès concurrents consacrés à Heine montre clairement que la RFA a rattrapé la RDA en matière de réception de l'œuvre de Heine. Autre conséquence de cette concurrence germano-allemande, les premiers volumes de deux éditions critiques et historiques de grande envergure paraissent de façon quasi simultanée : la Düsseldorfer Heine-Ausgabe et la Heine-Säkularausgabe à Weimar. Dans les années 1980, le conflit autour de Heine, fortement idéologique, s'apaise sensiblement et tend à une certaine normalisation. La recherche se tourne vers des aspects jusqu'alors négligés, comme, par exemple, l'œuvre tardive de Heine. Son œuvre prend une place grandissante dans les programmes de lecture et d'enseignement des écoles et des universités, ce qui a conduit également à une augmentation significative de la littérature à vocation didactique sur Heine. La renaissance heinienne a atteint son apogée temporaire avec les nombreuses manifestations organisées en 1997, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. En dépit de débats idéologiques et scientifiques, la poésie de Heine, tout particulièrement, jouit d'une popularité intacte. Ses poèmes romantiques et souvent proche du style du Volkslied, les poèmes de Heine sont mis en musique voir ci-dessous - en premier lieu le Livre des Chants. Au théâtre, en revanche, les propres pièces de Heine sont peu présentes. Par contre, lors de l'année Heine, en 1997, Tankred Dorst a fait du poète l'objet d'une pièce : Harrys Kopf. Réception par les écrivains et les journalistes De nombreux écrivains du XIX et XXe se sont emparés de l'œuvre de Heine, parmi eux les grands romanciers Theodor Fontane et Thomas Mann. Comme Heine, Bertolt Brecht et Kurt Tucholsky ont osé l'équilibre délicat entre poésie et politique. Les lauréats du Prix Heine Wolf Biermann et Robert Gernhardt se situent également dans la tradition de Heine. En 1979, Biermann, par exemple, a dédié à son modèle le chant Au cimetière de Montmartre. Dans une diction typique de Heine, on peut y lire : « Sous le marbre blanc gèlent Dans l'exil ses ossements Avec lui repose là madame Mathilde Aussi n'y gèle-t-il pas seul. » Gernhardt a également parodié, dans son recueil Klappaltar de 1997, le style de Heine et son poème Loreley, pour attirer l'attention sur l'absence de l'œuvre du poète dans les écoles allemandes jusqu'en plein xxe. Après le premier vers tiré de la Loreley Je ne sais ce que cela signifie, il énonce les préjugés que sa génération, influencée par Karl Kraus, a nourri à l'encontre de Heine, et ce depuis le tout jeune temps de l'école. Il conclut : « Heine est nul, apparemment, S'est dit alors l'élève. C'est ce qu'avec son chant Le professeur Kraus a fait. » Le style de la prose de Heine imprègne le journalisme, en particulier les pages culturelles, encore aujourd'hui. Beaucoup de notions portant son empreinte sont entrées dans la langue allemande courante, telles que le mot Fiasko, emprunté au français, ou que la métaphore Vorschusslorbeeren éloges anticipés qu'il utilise dans son poème contre Platen. Réception de Heine dans le monde Si Heine a longtemps été rejeté en Allemagne à cause de ses origines juives, en Israël, il reste aujourd'hui controversé, pour s'être détourné du judaïsme. On a ainsi assisté à un débat à Tel Aviv entre juifs séculaires et orthodoxes à propos de la dénomination d'une rue en hommage à Heine. Alors que les uns voient en lui une figure majeure du judaïsme, les autres jugent sa conversion au christianisme impardonnable. C'est finalement une rue située isolée dans une zone industrielle qui a été baptisée de son nom, au lieu d'une rue à proximité de l'université, comme le proposaient les défenseurs de Heine. L'hebdomadaire de Tel Avivi Ha'ir a, à l'époque, ironisé sur l'exil de la rue Heine, dans lequel la vie du poète se reflétait symboliquement. Depuis d'autres rues portent le nom de Heine, à Jérusalem74 et Haifa. Une société Heine est également active en Israël. La réception de Heine dans le reste du monde s'est passée, pour l'essentiel, sans heurt. Heine a été l'un des premiers auteurs allemands dont l'œuvre a pu être lue dans toutes les langues. Ainsi s'explique l'influence qu'il a exercé sur les autres littératures nationales. En plus de la France, en Angleterre, en Europe de l'Est et en Asie, il jouit d'une reconnaissance toute particulière. Heine et la musique Heinrich Heine ne jouait d'aucun instrument de musique et était également profane en matière de théorie de la musique. Mais, puisque, selon sa compréhension des choses artistiques, il n'y avait aucune frontière entre les différentes formes d'art, il commenta, en tant que journaliste - par exemple, dans le Augsburger Allgemeine Zeitung -, bon nombre de représentations et d'œuvres musicales de son époque, parmi lesquelles quelques-unes de renommée internationale composées par Giacomo Meyerbeer, Franz Liszt, Robert Schumann ou Richard Wagner. Son intérêt pour la musique transparaît également dans sa poésie, par exemple dans le poème ironique De la téléologie : « Des oreilles, Dieu nous en donna deux, Pour écouter les chefs-d'œuvre De Mozart, Gluck et Haydn - S'il n'y avait eu que les coliques musicales Et les sonorités hémorroïdales Du grand Meyerbeer, Une oreille déjà aurait suffi ! » Malgré ses lacunes théoriques dans le domaine de la musique, beaucoup de compositeurs et interprètes de son temps accordaient de l'importance à son opinion, vraisemblablement parce qu'ils lui reconnaissaient, en tant que poète, une certaine compétence en matière musicale. Il serait cependant incorrect de considérer Heine comme un critique musical. Il était conscient des limites de ses compétences dans le domaine et écrivait toujours en tant que feuilletoniste, abordant la thématique d'une pièce de façon subjective et intuitive. Plus importantes encore que les propos de Heine sur la musique sont les adaptations de beaucoup de ses œuvres par des compositeurs. La première date de 1825, avec la mise en musique par Carl Friedrich Curschmann du poème Gekommen ist der Maie Le mois de mai est arrivé. Dans son ouvrage Heine in der Musik. Bibliographie der Heine-Vertonungen75, Günter Metzner établit la liste chronologique de toutes les adaptations musicales des poèmes de Heine. Pour l'année 1840, il répertorie 14 musiciens, qui ont composé 71 pièces à partir d'œuvres de Heine. Quatre ans plus tard, ce sont déjà plus de 50 compositeurs et 159 œuvres. La raison de cette augmentation rapide fût sans doute la publication du recueil Nouveaux poèmes chez Campe. Le nombre des mises en musique des œuvres de Heine atteignit son apogée presque 30 ans après la mort du poète, en 1884 - avec 1093 pièces par 538 musiciens et compositeurs. Jamais auparavant ni plus jamais après, un seul poète ne vit ses œuvres être à l'origine d'autant de compositions musicales en une seule année. Au total, la biographie de Metzner recense 6833 adaptations de Heine, parmi lesquelles celles de Franz Schubert, Robert et Clara Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Richard Wagner, Piotr Ilitch Tchaikovski, Alexander Borodin, Wendelin Weißheimer, Alma Mahler-Werfel et Charles Ives. Entre autres, le Liederkreis et le Dichterliebe de Schumann, ainsi que le Schwanengesang (D 957) de Franz Schubert appartiennent au répertoire régulier des salles de concert du monde entier. L'adaptation musicale de Heine la plus populaire en Allemagne est sans doute La Lorelei de Friedrich Silcher. Comme Schumann, Richard Wagner, qui entretint, à Paris, des relations amicales avec Heine, adapta également le poème faisant l'apologie de Napoléon Les grenadiers, toutefois dans une traduction française. Un récit tiré de Dans les mémoires de monsieur von Schnabelewopski“ de Heine inspira Wagner pour son opéra Le Hollandais volant. L'importance de Heine pour la création musicale perdura jusqu'à la Première Guerre mondiale. Par la suite, l'antisémitisme croissant fit considérablement retomber le « boom Heine, jusqu'à ce qu'il cesse tout à fait au temps du national-socialisme en Allemagne. En 1972, encore, la chanteuse de Schlager et de variété, Katja Ebstein fut très critiquée par les conservateurs, pour avoir sorti un album avec des chants de Heinrich Heine. Aujourd'hui, musiciens et compositeurs s'emparent à nouveau de l'œuvre de Heine, parmi eux également des compositeurs d'opéra comme Günter Bialas, dont l'opéra Aus der Matratzengruft a été donné pour la première fois en 1992. Publications Gedichte Poèmes, 1821. Tragödien, nebst einem lyrischen Intermezzo, F. Dümmler, Berlin, 1823. contient William Ratcliff, Almansor et Lyrisches Intermezzo Reisebilder Tableaux de voyage, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1826-31. Die Harzreise Le Voyage dans le Harz, 1826. Ideen, das Buch le Grand Idées : le livre de Le Grand, 1827. Englische Fragmente Fragments anglais, 1827. Buch der Lieder, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1827 Le Livre des chants, Éditions SDE, 2004. Französische Zustände Particularités françaises, Heideloff und Campe, Leipzig, 1833. Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland (De l'histoire de la nouvelle et belle littérature en Allemagne), Heideloff und Campe, Paris/Leipzig, 1833. De l'Allemagne sur Gallica, essai de critique littéraire visant à faire connaître la culture allemande en France, d'abord paru en français sous ce titre en 1834 dans la Revue des Deux-Mondes 2° partie ici, avec article v. et en 1835 à la Librairie de Renduel (v. BnF catalogue; puis en Allemagne sous le titre Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland autres titres français: La religion et la philosophie en Allemagne, Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne. Die romantische Schule L'École romantique, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1836. Der Salon Le Salon, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1836-40. Le Rabbin de Bacharach, 1840. Shakspeares Maedchen und Frauen, Brockhaus und Avenarius, Leipzig, 1839. Über Ludwig Börne (À propos de Ludwig Börne, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1840. Neue Gedichte (Poèmes tardifs, Hoffmann und Campe, Hambourg,1846. Deutschland. Ein Wintermärchen Allemagne - un conte d'Hiver, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1844. Atta Troll. Ein Sommernachtstraum Atta Troll - Rêve d'une nuit d'été, 1847 Romanzero, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1851. Der Doktor Faust Le Docteur Faust, Hoffmann und Campe, Hambourg, 1851. Les Dieux en Exil, A. Lebègue, Bruxelles, 1853. Lutezia, 1854. Letzte Gedichte und Gedanken Dernières pensées et poèmes, 1869 - posthume. Mémoires de Henri Heine traduction de J.Bourdea - posthume, Paris, Calmann-Lévy, 1884, 142 p. ‘‘Mémoires et Aveux éditions de Paris, Max Chaleil, 1887 - posthume. Écrits juifs, Éditions du Sandre. Lutèce, Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de France, précédé d'une présentation de Patricia Baudouin, Bibliographie En français Augustin Cabanès, Grands névropathes, t. 3, Paris, Albin Michel, 1935, « Henri Heine », p. 37-72. Armand Colin, Heine le médiateur, Romantisme no 101, Paris, 2002, Gerhard Höhn, Heinrich Heine : un intellectuel moderne. Paris, Presses universitaires de France, 1994; 190 pages. . Marie-Ange Maillet, Heinrich Heine. Paris, Éditions Belin 2006 = Voix allemandes. Vol. 12, 223 pages, Euro 16,50 Camille Mauclair, La vie humilié de Henri Heine", Le roman des grandes existences, no 32, Éditions Plon 1930 Eugène de Mirecourt: Henri Heine, G. Havard Paris, 1856, 1 vol. (96 p.-1 f. de front.-1 dépl. autographe ; in-16, disponible sur Gallica Michael Werner et Jan-Christoph Hauschild, Heinrich Heine, une biographie, trad. de Stéphane Pesnel Norbert Waszek, "L'excursion panthéiste dans l'Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne (1834/35 de Heinrich Heine". - In: Dieu et la nature. La question du panthéisme dans l'idéalisme allemand. Ed. par Christophe Bouton. Hildesheim, Olms, 2005 [Europaea Memoria, Bd. 40, p. 159-178. Heine à Paris : témoin et critique de la vie culturelle française, sous la direction de Marie-Ange Maillet et Norbert Waszek. Paris, éditions de l'éclat, 2014. En allemand Dietmar Goltschnigg et Hartmut Steinecke dir., Heine und die Nachwelt. Geschichte seiner Wirkung in den deutschsprachigen Ländern, Berlin, Schmidt, 2006–2011 tome 1 tome 2 tome 3 (de) Jan-Christoph Hauschild et Michael Werner, Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Heinrich Heine. Eine Biographie, Cologne, Kiepenheuer & Witsch, 1997, nouvelle édition en 2005 chez Zweitausendeins, (de) Ernst Pawel, Der Dichter stirbt. Heinrich Heines letzte Jahre in Paris, Berlin, Berlin Verlag, 1997 (de) Marcel Reich-Ranicki, Der Fall Heine, Stuttgart, DVA, 1997 et chez dtv, à Munich en 2000, Filmographie Dans son long métrage La Femme-Enfant 1980, l'écrivain et réalisatrice Raphaële Billetdoux rend hommage au poète juif allemand Heinrich Heine en abordant une de ses œuvres Die Harzreise Le Voyage dans le Harz, 1826. Dans La Salamandre 1971 du réalisateur suisse Alain Tanner co-scénarisé avec John Berger, un texte de Heinrich Heine est lu de la 67e à la 68e minute: "[...] Une nouvelle génération se lèvera, engendrée dans des embrassements librement choisis, et non plus sur une couche de corvée et sous le contrôle de percepteurs du clergé [...]". Il est extrait du "Voyage de Munich à Gênes", 1828 (dans H. Heine, Riesebilder. Tableaux de voyage, nouvelle édition, Paris 1856, vol. 2, p. 104) .  [img width=600]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Heinrich_Heine(IsidorPopper1843).jpg/220px-Heinrich_Heine(IsidorPopper1843).jpg[/img]     
#94
Peter Handke
Loriane
Posté le : 05/12/2015 15:50
Le 6 décembre 1942 naît Peter Handke à Griffen
en Carinthie, écrivain, auteur dramatique, scénariste, réalisateur et traducteur autrichien. Poète, essayiste, romancier, auteur de théâtre, cinéaste, Peter Handke est l'une des personnalités les plus en vue de la littérature autrichienne actuelle. Admirateur précoce de Beckett et du Nouveau Roman, il apparaît d'abord comme un homme d'avant-garde chez qui l'austérité, l'hermétisme et le goût de la provocation – il a été très marqué par les événements de 1968 – se combinent selon un équilibre original. Mais son évolution ultérieure semble remettre en cause cette image, au point qu'on a pu l'accuser d'être devenu le « chantre d'un idéalisme néo-romantique ou néo-classique ». Dans sa rébellion contre les images irréelles et convenues que les médias nous imposent, il se livre au contraire à une tentative méritoire pour réinventer l'authenticité d'une présence humaine au sein du monde « postmoderne » ; ce conflit avec l'image du monde diffusée par les médias prend aujourd'hui chez Handke une dimension de plus en plus politique. En bref Né le 6 décembre 1942 à Griffen, en Carinthie, d'une mère cuisinière qui, enceinte et délaissée par le père de l'enfant, employé de banque nazi, épouse en hâte un sous-officier allemand (Le Malheur indifférent), Handke a trop bien connu les épreuves de l'extrême pauvreté matérielle et morale pour ne pas ressentir au plus intime de lui-même l'abandon où sont réduits les opprimés. Il y a chez lui une fascination des vies misérables et étriquées, de la déréliction culturelle de ceux que le sort n'a pas favorisés. Pourtant, il se définit agressivement comme un « habitant de la tour d'ivoire », dans la mesure où la confusion entre littérature et action politique lui semble dérisoire. Non seulement l'agitation politique directe lui paraît dégrader l'écrivain, réduit à employer les méthodes de son adversaire réactionnaire, mais sa nature même la désamorce automatiquement : « La littérature transforme tout ce qui est réel, y compris l'engagement, en style. Elle rend tous les mots inutilisables et les corrompt plus ou moins. » C'est seulement en exerçant en toute rigueur son activité d'écrivain que l'auteur peut influencer la société qui l'entoure, car « les questions formelles sont en fait des questions morales ». Aussi se montre-t-il très dur pour Brecht, tout en reconnaissant sa dette envers lui : « Il n'a jamais troublé les gens qui ne l'étaient pas, il a simplement fait passer quelques heures agréables à un immense public. » Comparé à Faulkner ou à Beckett, Brecht est pour lui un auteur de seconde zone. D'où la sévérité des jugements portés naguère sur Handke en Allemagne de l'Est, où le dictionnaire Meyer le présentait ainsi : « L'influence exercée par Handke qui pousse jusqu'à l'absurde les expériences structuralistes sur le langage et refuse tout engagement social montre bien l'impuissance culturelle de l'impérialisme et fait apparaître Handke lui-même comme un représentant de la manipulation des consciences dans le capitalisme d'aujourd'hui. » Bien que la notion d'écriture engagée lui reste tout à fait étrangère, il semble toutefois que cette réserve politique s'affaiblisse chez Handke ; la mauvaise conscience suscitée par le passé nazi domine un texte comme Le Chinois de la douleur. Vivant à cette époque en Autriche, Handke ressent comme son compatriote Thomas Bernhard un grand malaise devant les relents de nazisme qu'il perçoit dans son propre pays. Le héros, Andreas Loser, spécialiste de recherche archéologique sur les « seuils », est déstabilisé par la découverte de sa propre violence alors qu'il s'en prend à un inconnu. Cette violence le mènera à entrer dans le « peuple des malfaiteurs » lorsqu'il commettra un meurtre pour éliminer « l'Empêcheur », qui barbouillait des croix gammées sur les chemins du Mönchsberg, sorte d'incarnation du Mal en soi devant laquelle l'indifférence est inacceptable. À l'occasion du drame yougoslave, Handke va même prendre à contre-pied certains de ses anciens admirateurs. Dans Un voyage hivernal vers le Danube, la Save, La Morava et la Drina, il exprime sa méfiance envers les intellectuels qui tranchent de tout sans avoir rien vérifié, envers « les hordes des agités à distance, lesquels confondent leur métier qui est d'écrire avec celui d'un juge et même avec le rôle d'un démagogue ». Il voit dans les réactions dominantes à l'Ouest une nouvelle illustration du danger des images qui se substituent à la complexité du rapport au réel : « Que sait celui-là à qui on donne à voir au lieu de la chose rien que l'image de celle-ci ou qui ne reçoit qu'un abrégé d'image comme dans les informations télévisées ou, comme dans le monde de la connexion, qu'un abrégé d'abrégé ? » Contre cela, il va mener sur place sa propre enquête, non pour en retirer des révélations politiques fracassantes, mais pour y constater la dignité du peuple serbe. En contraste avec la simplicité directe de ce témoignage, le bref ouvrage de 2003 consacré aux procès intentés aux Serbes, Autour du Grand Tribunal, laisse une impression confuse et peu convaincante. Cette sympathie pour la Serbie suscitera le scandale lorsqu'il assistera le 18 mars 2006 aux funérailles de Slobodan Miloševiæ et déclarera : « Le monde, le soi-disant monde sait tout sur la Yougoslavie, la Serbie.[...] Le soi-disant monde connaît la vérité. C'est pour ça que le soi-disant monde est absent aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, et pas seulement ici.[...] Moi, je ne connais pas la vérité. Mais je regarde. J'écoute. Je ressens. Je me souviens. Je questionne. C'est pour ça que je suis aujourd'hui présent. » Les réactions sont vives : à Düsseldorf, le jury du prix Heinrich-Heine l'avait choisi pour lauréat, mais la municipalité s'y oppose ; Handke renonce au prix de lui-même, mais il contre-attaque, déplorant que la morale soit « devenue dans cette guerre un autre mot pour dire l'arbitraire ». En France, Marcel Bozonnet, administrateur général de la Comédie-Française, provoque de nombreux remous en annulant la programmation de la pièce de Handke, Voyage au pays sonore, ou l'Art de la question, initialement prévue en 2007. Sa vie Peter Handke est le fils d'une cuisinière d'origine slovène et d'un soldat allemand, employé de banque dans le civil, stationné en Carinthie1. Peu avant sa naissance elle épouse un soldat allemand, conducteur de tram dans le civil. Le jeune Peter vit avec sa mère à Berlin-Est avant de retourner à Griffen. L'alcoolisme grandissant de son beau-père Bruno Handke, et l'étroitesse des conditions de vie sociale dans cette petite ville isolée le conduisent plus tard à se révolter continuellement contre les habitudes et les restrictions de la vie. En 1954, il entre en internat au lycée catholique et humaniste de Tanzenberg. Il se plonge dans la lecture de classiques et est impressionné, à 15 ans, par Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos qui l'abreuve du sang noir du catholicisme. Dans le journal de l'internat, Fackel La Torche, il publie ses premiers textes. En 1959, il entre à l'internat de Klagenfurt et y obtient en 1961 la Matura, diplôme qui sanctionne en Autriche la fin des études secondaires. Il entame alors des études de droit à Graz. Après ses premiers succès littéraires, il rejoint le groupe Forum Stadtpark der Grazer Gruppe et abandonne ses études en 1965, pour se consacrer entièrement à l'écriture, après que l'éditeur Suhrkamp a accepté son manuscrit Die Hornissen Les Frelons. À ses débuts, Peter Handke rejette les modèles dominants de la littérature et se lance dans une révolte langagière et narrative sous l'influence de l'absurde et du Nouveau Roman2. Il est également marqué par ses lectures de Franz Kafka, Samuel Beckett et William Faulkner qui l'amènent à réfuter avec violence le réalisme et à prôner une écriture expérimentale. Il se revendique également du Wiener Gruppe dont il partage les valeurs et les techniques stylistiques. Cette influence transparaît dans ses romans (Le Colporteur, L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty, ses pièces de théâtre Gaspard, La Chevauchée sur le lac de Constance et sa poésie, située entre rêve et évocation de la banalité quotidienne L'Intérieur de l'extérieur de l'intérieur, Poème bleu. La thématique de ses textes se centre sur l'angoisse procurée par la société contemporaine, l'incommunicabilité et l'errance de l'être dans le monde comme dans le langage. L'auteur se montre soucieux de maîtriser ses effets et manifeste une grande retenue, mêlant un style inventif à des images marquantes4. Son travail sur la langue se situe volontairement du côté de la culture moderne littéraire et philosophique autrichienne qui analyse le langage et le met à distance (Karl Kraus, Ludwig Wittgenstein, Fritz Mauthner). L'auteur déclare : « La littérature, c'est le langage devenu langage; la langue qui s'incarne. J'écris avec la respiration, pour découvrir le sacré, celui de la vie. Je crois être un romantique décidé, qui rend grâce à la mémoire. En 1966, il réussit une intervention spectaculaire lors de la rencontre du Groupe 47 à Princeton, où il présente sa pièce provocante et avant-gardiste Publikumsbeschimpfung (Outrage au public). Lors de la réception du prix Gerhart Hauptmann en 1967, il exprime sa colère et sa tristesse au sujet de l'acquittement d'un policier qui causa le décès d'un étudiant. Handke est largement marqué par les événements de mai 1968. Il est le cofondateur de « l'édition de Francfort des auteurs » en 1969 et membre de l'assemblée des auteurs de Graz de 1973 à 1977. Il reçoit le prix Büchner en 1973. Dans Der kurze Brief zum langen Abschied (La Courte Lettre), il évoque l'échec de son mariage à travers l'histoire d'un Autrichien qui erre dans toute l'Europe et les États-Unis à la recherche de son épouse. Il part un temps s'installer en région parisienne avant de revenir en Autriche. Ultérieurement, il revient vivre en France. Passionné de cinéma, Handke entame une collaboration avec Wim Wenders. En 1978 sort son film en tant que réalisateur, La Femme gauchère. Dans les années 1980, il évolue vers une production littéraire plus conventionnelle, ce qui lui vaut des critiques de la part de l'intelligenstia qui lui reproche d'être le « chantre d'un idéalisme néo-romantique ou néo-classique »5,1. Il voyage alors en Alaska, au Japon et en Yougoslavie. Ces récits de voyage Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien Voyage hivernal vers le Danube, parus en 1996, où il présente les Serbes comme victimes de la guerre civile, soulèvent de violentes controverses qui perdurent encore jusqu'à ce jour. Yves Laplace analyse notamment la « déroute » de Peter Handke à ce sujet dans son ouvrage Considérations salutaires sur le massacre de Srebrenica. En 1999, Handke condamne les bombardements de l'OTAN sur la République serbe1. En 2005, l'ex-président Slobodan Milošević, accusé de génocide et de crime contre l'humanité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de La Haye, cite Peter Handke comme témoin pour sa défense. Même si Handke refuse de répondre à cette demande, il écrit un essai s'intitulant Die Tablas von Daimiel (Les Tables de Daimiel qui porte comme sous-titre Ein Umwegzeugenbericht zum Prozeß gegen Slobodan Milošević Un rapport testimonial détourné pour le procès contre Slobodan Milošević. Peter Handke a vécu à Graz, Düsseldorf, Berlin, Paris, Kronberg in Taunus, aux États-Unis 1978-79, à Salzbourg 1979-88 et, depuis 1991, à Chaville près de Paris6 ; il retourne parfois à Salzbourg. Il a traduit en allemand des œuvres d'Emmanuel Bove, René Char, Francis Ponge et Patrick Modiano1. Outre-Rhin, il a également contribué à faire connaître l'un des premiers romans de Julien Green. En 2012, il publie une nouvelle pièce : Les Beaux Jours d’Aranjuez : un dialogue d'été, écrite directement en français. En 2014, le Prix Ibsen lui a été décerné en récompense de son « œuvre hors pair, dans sa beauté formelle et sa réflexion brillante». Il a deux filles, Amina Handke, qui a étudié la peinture et les médias, et Léocadie. Controverse relative aux funérailles de Milošević Ses écrits ont déclenché la polémique lorsqu'il est intervenu en faveur de la Serbie. Le 18 mars 2006, à l'occasion des funérailles de Slobodan Milošević auxquelles il assiste, il déclare : « Le monde, le soi-disant monde sait tout sur la Yougoslavie, la Serbie. Le monde, le soi-disant monde, sait tout sur Slobodan Milošević. Le soi-disant monde connaît la vérité. C'est pour ça que le soi-disant monde est absent aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, et pas seulement ici. Le soi-disant monde n'est pas le monde. Moi, je ne connais pas la vérité. Mais je regarde. J'écoute. Je ressens. Je me souviens. Je questionne. C'est pour ça que je suis aujourd'hui présent, près de la Yougoslavie, près de la Serbie, près de Slobodan Milosevic. ». Cette intervention entraîne l'annulation par l'administrateur général de la Comédie-Française, Marcel Bozonnet, des représentations de sa pièce Voyage au pays sonore ou l'art de la question prévues pour 2007. Peter Handke bénéficie du soutien du monde de la culture qui, dans son ensemble, considère cet acte comme une censure injustifiée. Une pétition contre la censure de son œuvre circule et rassemble Emir Kusturica, Patrick Modiano, Paul Nizon, Bulle Ogier, Luc Bondy ou encore sa compatriote Elfriede Jelinek, lauréate du prix Nobel de littérature en 2004. La même année, une polémique éclate à Düsseldorf où le prestigieux prix Heinrich Heine est décerné à Handke. Mais le conseil de la ville refuse de lui remettre la récompense, spécialement dotée de 50 000 euros pour célébrer le 150e anniversaire de la mort du poète. De même, deux jurés du prix démissionnent pour protester contre ce choix. Afin de ne pas faire enfler la polémique, Peter Handke renonce finalement à la distinction. Il décline également l'offre des comédiens Rolf Becker et Käthe Reichel de lui offrir un prix Heine alternatif de la ville de Berlin, dotée d'une somme équivalente et déclare que cela le « renforcerait dans le statut de paria et de coupable ; celui d'avoir commis le crime de penser différemment et d'avoir un autre point de vue sur l'histoire de la Yougoslavie. ». Condamnation du Nouvel Observateur Le 4 décembre 2007, la 17e chambre civile du TGI de Paris a jugé l'hebdomadaire coupable de diffamation envers Peter Handke pour un article publié le 6 avril 2006, sous la signature de Ruth Valentini, sous le titre « Handke à Pozarevac », dans la rubrique Sifflets, article auquel est reproché par le tribunal l'allégation selon laquelle, par sa présence aux obsèques de Slobodan Milošević, Peter Handke aurait pu « approuver le massacre de Srebrenica et d'autres crimes dits de purification ethnique », le tribunal ayant rejeté l'excuse de la bonne foi11. Le journal et son directeur de la publication devront payer un euro de dommages et intérêts ainsi que 2 500 € au titre de frais de justice. Phases révolutionnaires Une de ses premières œuvres, intitulée significativement Outrage au public, déclenche un beau scandale lors de sa représentation à Francfort, à Experimenta 1. Durant la session de 1966, à Princeton, du Groupe 47, qui exerce alors une tutelle un peu lourde sur les lettres allemandes, il fait un éclat en attaquant violemment l'esthétique descriptive, le « nouveau réalisme » prôné par la majorité des participants. Pourtant les récompenses officielles ne lui font pas défaut : lauréat du prix Büchner en 1973, il avait déjà reçu le prix Gerhart-Hauptmann en 1967. Lors de l'attribution de celui-ci, refusant le jeu convenu des réponses académiques, Handke prononce un discours antilittéraire où il exprime exclusivement sa « tristesse et sa colère, sa colère et sa tristesse », à propos de l'acquittement récent d'un policier responsable de la mort d'un étudiant. Après ces débuts fracassants, sans abandonner ses recherches et ses ambiguïtés, son art est allé vers davantage de dépouillement et de simplicité. Dès 1972, Handke affirmait le caractère non agressif d'Outrage au public (dont il avait volontairement arrêté les représentations en plein succès), et retrouvait le goût de raconter des histoires, à arrière-plan souvent autobiographique, où des êtres à la fois quotidiens et énigmatiques vivaient au jour le jour le malaise d'exister. Depuis lors, cette dimension autobiographique s'est affirmée de manière de plus en plus ouverte ; dans une œuvre importante plus tardive, Mon Année dans la baie de Personne 1994, la personnalité du narrateur, Georg Keuschnig, semble bien proche de la sienne, et l'on n'est pas loin d'une sorte de journal au jour le jour où sont interpolés, à la façon des Mille et Une Nuits, de brefs récits anecdotiques regroupés sous le titre « L'Histoire de mes amis ». [size=SIZE]Grandeur et insuffisance du langage [/size] Méfiant envers les « rituels théoriques et la critique de la culture, Handke n'en a pas moins consacré une large part de son activité à la réflexion sur la vie des formes et la puissance du mot. Influencé par la théorie du langage de Wittgenstein, il n'a pas suffisamment foi en une existence factuelle du monde pour pouvoir l'abstraire de la médiation de la parole par laquelle il nous interpelle. À la limite, il n'y a pas pour lui de monde, mais seulement une parole du monde, elle-même décevante et trompeuse : « Au lieu de faire comme si on pouvait regarder à travers la langue comme à travers une vitre, c'est la langue elle-même, dans sa perfidie, qu'il faudrait percer à jour » ; d'où, dans ses premiers textes, ces rêves éveillés articulés sur la langue, ces images qui n'arrivent pas à se dépêtrer des expressions stéréotypées (Histoires du demi-sommeil), ces phrases qui s'engluent dans leur propre syntaxe sans parvenir à se formuler (Modèle pour un rêve), ou encore ces affirmations qui, aussitôt énoncées, sont démenties par une image filmique (L'Angoisse du gardien de but). La langue reste pourtant le seul recours de l'homme dans son désarroi : « La littérature a été longtemps pour moi le moyen, sinon de voir clair en moi-même, du moins d'y voir un peu plus clair. [...] Certes, j'étais déjà parvenu à la conscience avant de m'occuper de littérature, mais c'est seulement la littérature qui m'a montré que cette conscience de soi n'était pas un cas isolé, un „cas“, une maladie. » Et puisqu'il en est ainsi, toute œuvre véritable nous apporte une nouvelle appréhension de ce qui nous entoure, constate Handke, nous livrant du même coup une liste de ses admirations : « Kleist, Flaubert, Dostoïevski, Kafka, Faulkner, Robbe-Grillet ont modifié ma conscience du monde. » Il faudrait y ajouter les écrivains, en majorité français, qu'il a choisi de traduire en allemand : Bove, Char, Modiano, Ponge, et son traducteur G. A. Goldschmidt. Mais c'est peut-être à travers la vision des peintres qu'il retrouvera sa confiance en une possibilité de dire le monde. La Leçon de la Sainte-Victoire l'aide à trouver son lieu dans la « maison des couleurs » et suscite son espoir en une forme d'écriture qui permette de voir les choses selon un rapport d'appartenance et non plus d'irréalisation médiatique. Le monde inhabité Au-delà de toute visée politique, l'œuvre de Handke est surtout un réquisitoire contre la condition humaine. Axée sur des thèmes apparemment rebattus – la solitude, l'incommunicabilité, l'absence de tout recours transcendant, un érotisme triste où l'homme a rapport à son corps comme à une machine étrangère –, elle les renouvelle par une extraordinaire intensité de la vision, où à force de froideur et de distance l'émotion jaillit et submerge tout. Le mystère de la banalité s'instaure au détour d'une phrase, d'une réplique, d'un plan. Des êtres absents, murés dans le silence et l'incompréhension d'eux-mêmes – souvent des femmes, dont Handke aborde les problèmes avec une particulière tendresse –, finissent par se révéler dans leurs gestes, leurs refus, leurs dérobades mêmes. Handke pratique avec une suprême maîtrise l'art de l'understatement, fidèle à son principe esthétique selon lequel toute œuvre doit rendre « consciente une nouvelle possibilité du réel encore inconsciente, une nouvelle possibilité de voir, de parler, de penser, d'exister ». Errant lui-même et déraciné (La Courte Lettre reflète les difficultés d'un mariage dont il a eu une petite fille, Amina ; il a résidé longuement à Chaville, dans la région parisienne qu'il a ensuite momentanément quittée pour l'Autriche avant de revenir s'y installer), il est, comme son ami Wim Wenders, avec lequel il a travaillé dans plusieurs films, le maître des errances et des longues séquences descriptives qu'il envisage non comme l'expression d'un « nouveau réalisme », mais comme le « moyen nécessaire pour parvenir à la réflexion ». Il était naturel que cette qualité exceptionnelle du regard entraînât un jour ce cinéphile passionné sur les voies de la mise en scène, révélant, avec La Femme gauchère, un souci de recherches plastiques et une préciosité esthétisante qui étonnent un peu, par contraste avec la sobriété de ses écrits. Handke, qui tournera seul L'Absence en 1993, avait déjà collaboré comme scénariste avec plusieurs cinéastes, dont Benoît Jacquot pour l'adaptation du roman de Henry James Les Ailes de la colombe, en 1981. Mais c'est dans sa collaboration avec Wim Wenders qu'il atteint ses plus grandes réussites. Après L'Angoisse du gardien de but (1972) et Faux Mouvement (1975), Les Ailes du désir (1987) constituent un point d'équilibre où la présence de Wenders semble tonifier l'univers de Handke en renforçant sa dimension historique, tout en ménageant leur place à l'humour et au rêve ; l'image, ici, comme ailleurs le mot, s'applique à suggérer le secret des êtres avec une complicité retenue. Cette intensité du regard qui s'oppose au déferlement postmoderne des images retrouve toutefois dans l'écriture du dernier Handke son lieu le plus propre. Si le rapport à autrui reste toujours problématique, sauf peut-être lorsqu'il concerne les enfants, la vérité de la présence du narrateur au monde s'affirme avec de plus en plus de force, grâce à la confiance retrouvée dans les pouvoirs du langage. Les images de Mon Année dans la baie de Personne ou celles des relations d'errances, jusqu'à La Perte de l'image ou par la Sierra de Gredos atteignent souvent à une puissance épiphanique, au sens joycien du terme. En dehors de toute réaction partisane, il reste permis d'apprécier la rigueur et la persévérance avec lesquelles Handke poursuit, non sans une nuance d'ascétisme, une œuvre d'écrivain qui s'interdit la moindre concession aux modes du jour. Julien Hervier [size=SIZE]Œuvres[/size] Les Frelons 1966 Bienvenue au conseil d'administration 1967 Le Colporteur 1967 Espaces intermédiaires 1969 L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty 1970 Le Vent et la Mer pièces radiophoniques 1970 La Courte Lettre pour un long adieu 1972, trad. Georges-Arthur Goldschmidt J'habite une tour d'ivoire 1972 Le Malheur indifférent 1972 L'Heure de la sensation vraie 1975, trad. Georges-Arthur Goldschmidt Faux Mouvements 1975 La Femme gauchère 1976, trad. Georges-Arthur Goldschmidt Le Poids du monde 1977, trad. Georges-Arthur Goldschmidt Lent Retour 1979, trad. Georges-Arthur Goldschmidt La Leçon de la Sainte-Victoire 1980, trad. Georges-Arthur Goldschmidt Histoire d'enfant 1981, trad. Georges-Arthur Goldschmidt L'Histoire du crayon, carnet 1982, trad. Georges-Arthur Goldschmidt Le Chinois de la douleur 1983 Le Recommencement 1986 L'Absence 1987, trad. Georges-Arthur Goldschmidt L'Après-midi d'un écrivain 1987, trad. Georges-Arthur Goldschmidt Poème à la durée 1987, trad. Georges-Arthur Goldschmidt Essai sur la fatigue 1989 Encore une fois pour Thucydide 1990, trad. Georges-Arthur Goldschmidt Essai sur le juke-box 1990 Essai sur la journée réussie 1991 Mon année dans la baie de personne 1994 Quelques notes sur le travail de Jan Voss 1995 Un voyage hivernal vers le Danube 1996 Par une nuit obscure je sortis de ma maison tranquille 1997, trad. Georges-Arthur Goldschmidt La Perte de l'image ou par la Sierra de Gredos 2002 Milos Sobaïc, avec Dimitri Analis essai sur le peintre yougoslave 2002 Don Juan 2004 À ma fenêtre le matin, Paris, Verdier 2006 Kali 2006, trad. Georges-Arthur Goldschmidt La Nuit morave 2008, trad. Olivier Le Lay Coucous de Velika Hova 2011, trad. Marie-Claude Van Lendeghem Hier en chemin : Carnets, novembre 1987-juillet 1990 2011, trad. Olivier Le Lay Les Beaux Jours d'Aranjuez - un dialogue d'été 2012 Toujours la tempête 2012, trad. Olivier Le Lay Une année dite au sortir de la nuit 2012, trad. Anne Weber Essai sur le Lieu Tranquille 2012, 2014 en français, trad. Olivier Le Lay Théâtre Outrage au public 1966 Introspection 1966 Prédiction 1966 Appel au secours 1967 Gaspard 1967 Le pupille veut être tuteur 1969 Quodlibet 1970 La Chevauchée sur le lac de Constance 1971 Les Gens déraisonnables sont en voie de disparition 1974 Par les villages 1981, Über die Dörfer Voyage au pays sonore ou l'Art de la question 1989 L'Heure où nous ne savions rien l'un de l'autre 1992 Préparatifs d'immortalité 1997 Souterrain-Blues 2013 Les Beaux Jours d’Aranjuez : un dialogue d'été 2012 Filmographie 1969 : Publikumsbeschimpfung, de Claus Peymann (TV) (scénario) 1969 : Drei Amerikanische LP's, de Wim Wenders (TV) (scénario) 1971 : Chronik der laufenden Ereignisse, de Peter Handke (TV) 1972 : L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty, de Wim Wenders (scénario et roman) 1975 : Faux Mouvement (Falsche Bewegung) de Wim Wenders (scénario) 1978 : La Femme gauchère (Die Linkshändige Frau), de Peter Handke (scénario et roman) 1981 : Les Ailes de la colombe, réalisé par Benoît Jacquot d'après le roman éponyme de Henry James (scénario) 1987 : Les Ailes du désir (Der Himmel über Berlin), de Wim Wenders (scénario - coauteur du synopsis) 1993 : L'Absence, de Peter Handke 1998 : La Cité des anges (City of Angels), de Brad Silberling (scénario)   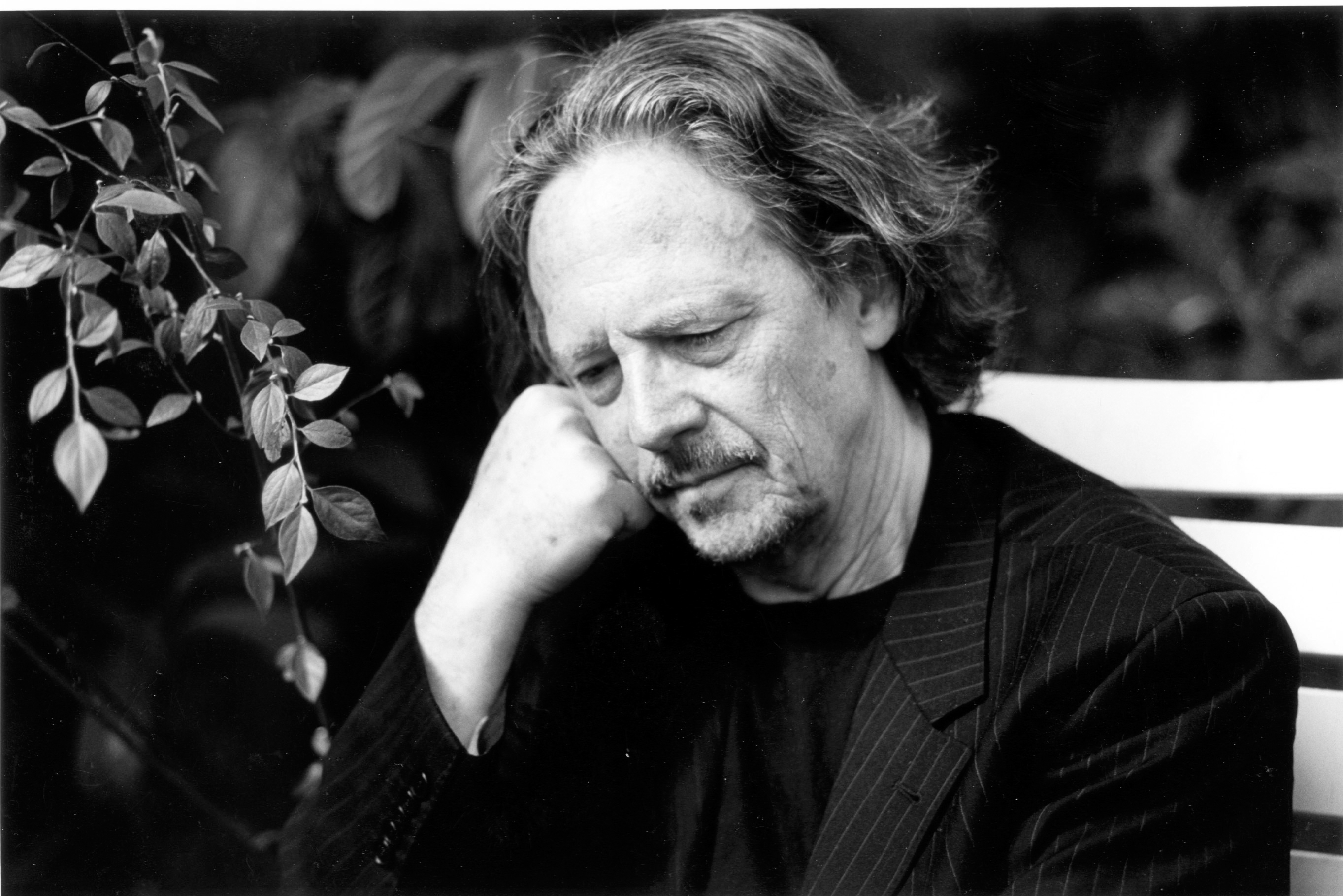  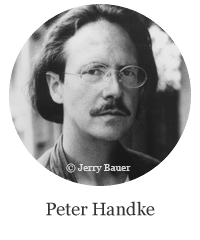   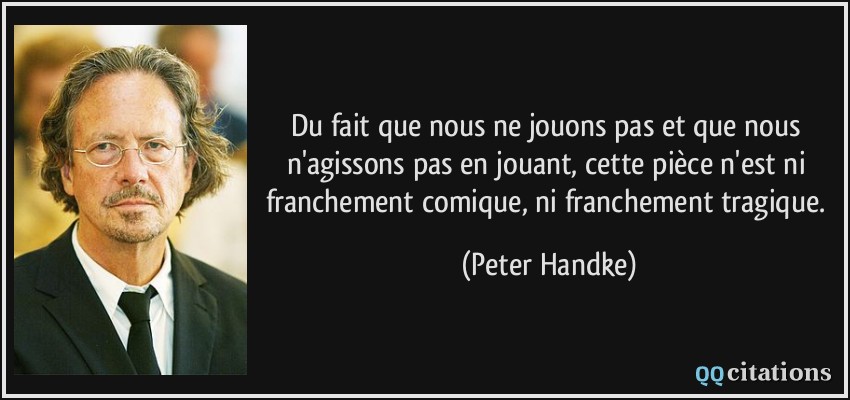 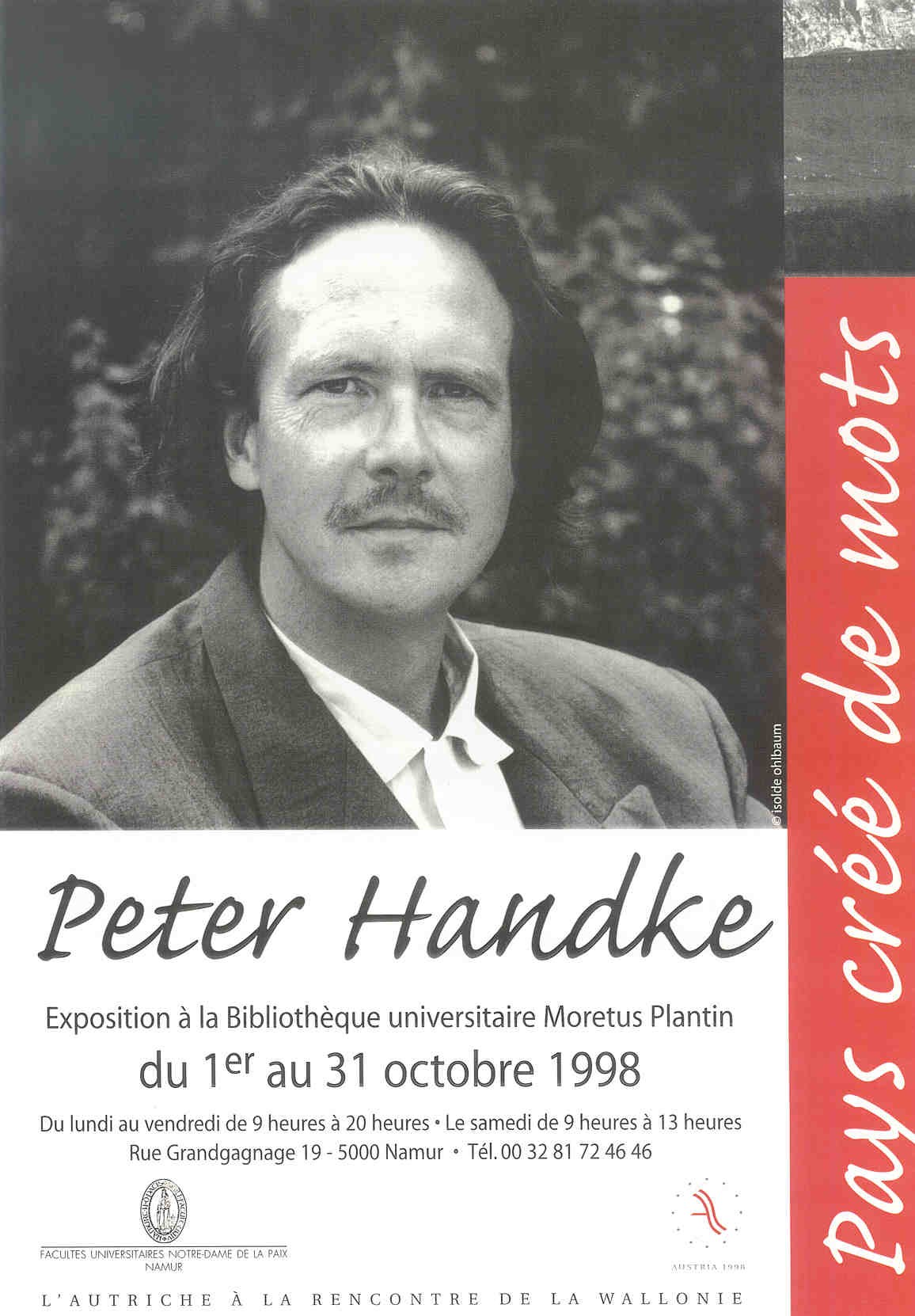
#95
Paul Auguste Marie Adam
Loriane
Posté le : 05/12/2015 15:28
Le 6 décembre 1862 à Paris naît Paul Auguste Marie Adam
né le 6 décembre 1862 à Paris où il est mort le 2 janvier 1920, est un écrivain français et critique d'art. Sa vie Issu d'une famille d'industriels et de militaires originaires de l'Artois, fils d'un directeur des Postes sous le Second Empire, Paul Adam fait ses études secondaires au lycée Henri-IV à Paris avant de se lancer dans la carrière littéraire dès 1884. Il collabore à La Revue indépendante avant de publier en Belgique son premier roman, Chair molle 1885, qui est accusé d'immoralité, provoque le scandale et vaut au jeune auteur une condamnation à quinze jours de prison avec sursis et une lourde amende. Délaissant le naturalisme, Paul Adam se tourne vers le symbolisme. Il contribue à diverses revues liées à ce mouvement, anime Le Symboliste et La Vogue et fonde avec Paul Ajalbert Le Carcan. En 1886, il collabore avec Jean Moréas dans Le Thé chez Miranda et Les Demoiselles Goubert et publie un roman intimiste, Soi. Sa notoriété est établie avec le roman Être 1888. En 1892, il prononce son célèbre Éloge de Ravachol : « De tous les actes de Ravachol, il en est un plus symbolique peut-être de lui-même. En ouvrant la sépulture de cette vieille et en allant chercher à tâtons sur les mains gluantes du cadavre le bijou capable d'épargner la faim, pour des mois, à une famille de misérables, il démontra la honte d'une société qui pare somptueusement ses charognes, alors que, pour une année seule, 91 000 individus meurent d'inanition entre les frontières du riche pays de France, sans que nul y pense, hormis lui et nous. » En 1906, dans Vues d'Amérique, Paul Adam synthétise son approche de l'art : « L'art est l'œuvre d'inscrire un dogme dans un symbole. » Il fut l'un des témoins de Jean Lorrain lors de son duel, à Meudon, avec Marcel Proust le 6 février 1897. Partisan du général Boulanger, il milite dans les mouvements nationalistes et traditionalistes et, pendant la Première Guerre mondiale, il se rend auprès des troupes pour soutenir leur moral et fonde la Ligue intellectuelle de fraternité latine. Parallèlement, il publie de très nombreux ouvrages : essais, romans, nouvelles, récits de voyage, parmi lesquels on peut citer les romans de son cycle napoléonien : La Force (1899), L'Enfant d'Austerlitz 1901, Au soleil de juillet 1903, ainsi que La Ruse 1903 et Stéphanie 1913, curieux plaidoyer en faveur des mariages arrangés par rapport aux mariages d'amour. Le guide Paris-Parisien, qui le considère en 1899 comme une « notoriété des lettres », note qu'il a des « conceptions audacieuses » auxquelles il donne une « forme très audacieuse »3. Remy de Gourmont disait de lui : « J’ai pensé à Balzac — M. Paul Adam en sera flatté, j’espère — en lisant, dans la biographie que l’on vient de donner de l’auteur de la Ruse, la liste de ses œuvres. Il y a en effet quelque chose de balzacien dans la fécondité de ce jeune romancier qui, en dix-sept ans de travail, nous aura donné trente-cinq volumes, et souvent des volumes énormes, qui en valent deux ou trois par la compacité. Quelle est sa méthode de travail, je ne l’ignore pas absolument ; elle est plus raisonnable que celle de Balzac et, par conséquent, elle durera sans doute plus longtemps. » Hommage Un monument en son honneur, sculpté par Paul Landowski, a été érigé contre le mur du Palais du Trocadéro, avenue Albert-de-Mun. Œuvres Chair molle, A. Brancart, Bruxelles, 1885. Soi, Tresse et Stock, Paris, 1886. Les Demoiselles Goubert, Mœurs de Paris avec Jean Moréas, Tresse et Stock, Paris, 1886. Le Thé chez Miranda avec Jean Moréas, Tresse et Stock, Paris, 1886. La glèbe, Tresse et Stock, Paris, 1887. Les Volontés merveilleuses : Être, Librairie illustrée, Paris, 1888. Les Volontés merveilleuses : L'essence de soleil, Tresse et Stock, Paris, 1890. Les Volontés merveilleuses : en décor, 1890. L'Époque : Le Vice filial, E. Kolb, Paris, 1891. L'Époque : Robes rouges, E. Kolb, Paris, 1891. L'Époque : Les Cœurs utiles, E. Kolb, Paris, 1892. L'Automne : drame en trois actes, E. Kolb, Paris, 1893. Interdit par la censure le 3 février 1893. Le Conte futur, Librairie de l'Art indépendant, Paris, 1893. Critique des mœurs, E. Kolb, Paris, 1893. Les Images sentimentales, Paul Ollendorff, Paris, 1893. Princesses byzantines, Firmin-Didot, Paris, 1893. La Parade amoureuse, P. Ollendorff, Paris, 1894. Le Mystère des foules, P. Ollendorff, Paris, 1895. Les Cœurs nouveaux, P. Ollendorff, Paris, 1896. La Force du mal, A. Colin, Paris, 1896. L'Année de Clarisse, P. Ollendorff, Paris, 1897 illustr. de Gaston Darbour. La bataille d'Uhde, P. Ollendorff, Paris, 1897. Le Vice filial, Paris, Librairie Borel, 1898, illustré par Jan Dědina. Tétralogie Le Temps et la Vie, épopée de la famille Héricourt : La Force, P. Ollendorff, Paris, 1899. L'Enfant d'Austerlitz, P. Ollendorff, Paris, 1901. La Ruse, 1827-1828, P. Ollendorff, Paris, 1903. Au soleil de juillet, 1829-1830, P. Ollendorff, Paris, 1903. Basile et Sophia, Société d'éditions littéraires et artistiques, Paris, 1901. Lettres de Malaisie, La Revue Blanche, Paris, 1898 ; réédition Séguier, « Bibliothèque Décadente », 1996 (ISBN 2-84049-100-1) Le Troupeau de Clarisse, P. Ollendorff, Paris, 1904. Le Serpent noir, P. Ollendorff, Paris, 1905. Vues d'Amérique, P. Ollendorff, Paris, 1906. Clarisse et l'homme heureux, J. Bosc & Cie, Paris, 1907. La Morale des Sports, la Librairie mondiale, Paris, 1907. La cité prochaine, 1908. Les Impérialismes et la morale des peuples, Boivin & Cie, Paris, 1908. Le Malaise du monde latin, 1910. Le Trust, A. Fayard, Paris, 1910. Contre l’Aigle, H. Falque, Paris, 1910. Stéphanie 1913 Le Lion d'Arras, E. Flammarion, 1919 ajout tardif à la série Le Temps et la Vie Notre Carthage, E. Fasquelle , 1922 Préface du Général Charles Mangin, publication posthume. théâtre Les Mouettes, première représentation par la Comédie-Française le 14 novembre 1906 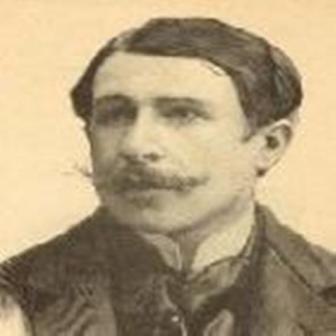   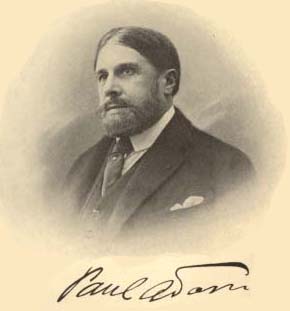  
#96
Baldassare Castiglione
Loriane
Posté le : 05/12/2015 15:05
Le 6 décembre 1478 à Casatico naît Baldassare Castiglione
dans le marquisat de Mantou, épelé aussi Baldassarre, Baldesar ou Baldassar, comte de Novellata, écrivain et diplomate italien de la Renaissance. Il reste connu pour avoir écrit Le Livre du courtisan, manuel de savoir-vivre qui connut un succès important à sa parution. Il meurt le 8 février 1529 à 50 ans à Tolède, en Espagne En bref Si détaché qu'il semble de la dure histoire italienne du temps où il fut écrit, Le Parfait Courtisan (Il Cortegiano) de Castiglione est le fruit d'une expérience à la fois guidée, compensée et transcendée par un idéal éthique foncièrement tributaire de la culture humaniste. Il a constitué, pendant un siècle et plus, en Europe occidentale, la source et souvent le modèle d'un art de cour équilibré entre le devoir politique et l'animation culturelle, ayant pour double objet de soutenir la gloire du souverain et la dignité du courtisan. De 1537 à 1690 ont paru six traductions françaises. Fils d'un homme de guerre et d'une parente des Gonzague, Baldassarre Castiglione naquit à Mantoue. C'est à Milan, quand s'y exerçait le mécénat de Ludovic le More, qu'il fit ses études. Entré en 1499 au service de François Gonzague, à Mantoue, il passe, en 1503, à la cour du beau-frère de François, Guidobaldo da Montefeltro, seigneur d'Urbino, et, abstraction faite de diverses campagnes et missions, y reste jusqu'en 1513, année où il part pour Rome en qualité d'ambassadeur du duché d'Urbino auprès du pape. Le duché passant, en 1516, aux mains d'un Médicis, Castiglione retourne au service des Gonzague, devient en 1520 leur ambassadeur à Rome, avant d'être nommé, en 1524, protonotaire apostolique par le pape Clément VII et envoyé, l'année suivante, en Espagne en qualité de nonce auprès de Charles Quint. Ce ne fut pas la mission la plus heureuse de sa vie. Le terrible sac de Rome de 1527, commis par des mercenaires à la solde de Charles Quint, advint au temps de sa nonciature : Clément VII lui reprocha violemment de n'avoir su ni le prévoir ni le prévenir. Castiglione présenta sa défense avec une dignité que se plaisent à souligner tous ses biographes. Apprenant, sur ces entrefaites, qu'un manuscrit du Cortegiano, confié à un de ses amis, commençait à être reproduit sans son assentiment, il prit le parti de le publier avant d'en avoir achevé la révision. Le livre fut imprimé à Venise en 1528. Cette première édition devança de peu la mort de Castiglione, survenue à Tolède. Sa vie Baldassare Castiglione est né à Casatico, province de Mantoue, en Italie, dans une ancienne famille lombarde ayant émigré à Mantoue à l'époque du marquis Ludovic Gonzague, un parent de Luigia Gonzague, la mère de Castiglione. À Casatico, son lieu natal, il y a encore la Corte Castiglioni, le palais de la famille Castiglione, symbole du marquisat de la famille sur ces territoires, et résidence où Baldassarre Castiglione est né et à vécu ses premières années. Il fait des études classiques à Venise et à Milan, où il est l'élève de Merula et de Calcondila. Il fait partie de la cour de Ludovic le More et à la mort de celui-ci, il rejoint la cour des Gonzague à Mantoue. En 1495, son père meurt et Baldassare lui succède dans ses fonctions de chef de famille, il accompagne ainsi le marquis lors de l'arrivée de Louis XII à Milan. Pour le service de Gonzague, il part à Rome rencontrer Guidobaldo Ier de Montefeltro, duc d'Urbino, dont il rejoint la cour en 1504. Urbino est alors la cour la plus brillante et la plus raffinée d'Italie, un carrefour culturel dirigé par la duchesse Elisabetta Gonzague et sa belle-sœur Maria Emilia Pia avec parmi les invités permanents Pietro Bembo ou Michel-Ange, ainsi que de nombreux hommes de lettres. Les invités ont pour habitude d'organiser à la cour des compétitions intellectuelles produisant ainsi une riche activité littéraire et culturelle. En 1506, Castiglione écrit et interprète avec Cosimo Gonzague, son églogue Tirsi dans lequel de façon voilée, il dépeint la vie de la cour d'Urbino. L'œuvre contient des résonances de poésie ancienne et contemporaine, avec des rappels à Virgile, Poliziano ou Sannazzaro. Il fut ambassadeur du duc d'Urbino auprès de Henri VIII d'Angleterre, roi d'Angleterre. François Marie Ier della Rovere succède à Guidobaldo à la mort de ce dernier, et Castiglione demeure à sa cour, et, avec lui, prend part à l'expédition contre Venise menée par le pape Jules II, ce qui lui vaut d'obtenir le comté de Novellata, près de Pesaro. Quand le pape Léon X est élu, Castiglione est envoyé à Rome comme ambassadeur d'Urbino. Il y devient l'ami d'artistes et d'écrivains, notamment de Raphaël, qui a peint son portrait, conservé aujourd'hui au musée du Louvre. En 1516, Castiglione retourne à Mantoue, où il se marie avec Ippolita Torelli, descendante d'une famille noble. Il lui avait écrit deux lettres passionnées, lui exprimant ses sentiments profonds, mais celle-ci devait mourir quatre ans plus tard, alors que son époux se trouvait à Rome, en qualité d'ambassadeur du duc de Mantoue. En 1521, le pape Léon X lui accorda la tonsure et Castiglione commença une carrière ecclésiastique. C'est à cette époque qu'il met en relation le peintre et architecte Giulio Romano avec le duc de Mantoue, celui-ci cherchant embellir sa ville et à se faire construire un palais. En 1524, le pape Clément VII l'envoie à Madrid en qualité de nonce apostolique ambassadeur du Saint-Siège, il suit l'empereur Charles V à Tolède, Séville et Grenade. En mai 1527 les impériaux envahissent et mettent Rome à sac ; le pape reprochera à Castiglione de ne pas l'avoir prévenu des intentions de Charles Quint. Castiglione enverra une lettre au pape, datée du 10 décembre 1527, soulignant que le saccage était motivé par l'ambiguïté et les contradictions de la politique du pape. Contre toute attente, il reçut des excuses du pape, et les honneurs de l'empereur. De nos jours, Baldassare Castiglione n'est plus perçu comme responsable du sac de Rome, car il semble qu'il ait joué honnêtement son rôle en Espagne. Ainsi, le bruit que Castiglione soit décédé suite aux remords qu'il aurait pu éprouver est infondée, il est mort des suites d'une épidémie de peste. En 1528, l'année précédant sa mort, son livre le plus célèbre, Le Livre du courtisan, est publié à Venise. Il décrit la cour d'Urbino, au temps du duc Guidobaldo Ier de Montefeltro, et son courtisan idéal, au travers de dialogues philosophiques et culturels qui lui ont été rapportés alors qu'il se trouvait en Angleterre. Son livre est traduit en français dès 1537, puis en espagnol, en anglais, en allemand et en latin. Ce livre deviendra vite un manuel de savoir-vivre dans les cours européennes. Cette œuvre prône la courtoisie et les valeurs sociales que l'homme civilisé se doit d'avoir. Il s'inspire alors du célèbre proverbe de Platon : « Omnia vincit politus » qui renvoyait initialement à l'utilité de l'éducation. Le miroir d'une époque Bien que les entretiens qui forment l'essentiel du livre soient fictivement situés entre septembre 1506 et février 1507, il semble que Castiglione n'ait pas entrepris de composer son ouvrage avant 1513, au terme de son séjour à la cour d'Urbino, où il s'était lié d'amitié avec Pietro Bembo, avec le futur cardinal Bibbiena, favori de l'exilé Jean de Médicis qui allait bientôt devenir le pape Léon X, et avec bien d'autres qui se retrouvent dans les rôles du Cortegiano. Des invasions, des batailles, des renversements d'alliances qui se succèdent en Italie, de 1494 à 1529, et qui furent loin d'être sans effet sur la vie et la carrière du diplomate Castiglione, on ne perçoit dans le Cortegiano que de brefs et lointains échos. Bien qu'il y soit souvent question de la formation et des devoirs des princes, l'ouvrage peut passer pour apolitique, si l'attention politique véritable est celle qu'un auteur, témoin ou juge, donne aux mouvements et aux crises de la société où il vit. À la différence de son contemporain Machiavel, Castiglione ne s'interroge pas sur les chances qu'ont les dynasties ou les États de second ordre de subsister ou de s'agrandir. Son propos n'a pas trait à leur débilité relative en face des grands royaumes dévorants, mais au style de vie prestigieux que tout État peut tendre à édifier au niveau de la cour, comme si la fin du pouvoir régnant était non la puissance mais une civilité supérieure. Plus qu'un centre d'où s'exerce la force politique, la cour est dans le Cortegiano le lieu où aboutit et s'affine la culture, où l'apparat se rend inséparable du savoir, l'agrément de la dignité, où s'élabore, en un mot, un art de vivre exemplaire, de portée universelle. On ne peut rêver assemblage plus révélateur d'une vision « d'époque », de l'importance des qualités et des grades. Au centre, deux animatrices représentant la dynastie régnante : l'épouse du souverain, Elisabeth, et la « dame de palais », Emilia Pio, apparentée au souverain par alliance. Près d'elles, des hommes réputés et hautement protégés auxquels sourit un bel avenir : trois futurs cardinaux, Bembo, Bibbiena, Federico Fregoso ; le fils de Laurent le Magnifique, Julien de Médicis, qui sera duc de Nemours ; Ottaviano Fregoso, qui sera doge de Gênes ; le comte Ludovic de Canossa, qui sera ambassadeur de Léon X en Angleterre et en France. À ceux-ci s'ajoutent des gentilshommes qui donnent de grands espoirs, mais disparaîtront prématurément. Moins chargés de dignités ou de promesses, d'autres personnages sont plus strictement fonctionnels. Ils font songer aux experts qui composent de nos jours l'escorte des diplomates. « Spécialistes » à l'autorité restreinte et subordonnée, ils sont là pour garantir l'information de leurs supérieurs et répondre, le cas échéant, aux questions que ceux-ci leur posent. La distribution obéit donc à une hiérarchie des rôles où les simples commis de cour restent à bonne distance des dignitaires, de ceux qui sont destinés à le devenir, et des seigneurs. Une vision aristocratique et humaniste Cette hiérarchie est assurément le signe d'une vision aristocratique. Mais Castiglione, qui fut à Milan l'élève des humanistes, en vient à équilibrer sa considération entre un Bibbiena, plébéien de cour savant et disert, et le noble lettré vénitien Pietro Bembo. Plus qu'à leur naissance, il mesure le prix des hommes à leur culture, au rôle qu'ils tiennent auprès des grands, au succès qu'on peut leur prédire. Par là est annoncé le courtisan bourgeois, apte autant que le noble à devenir l'animateur et le sage du milieu privilégié auquel l'attachent ses dons et ses mérites. Sous son triple visage de « féal », de juge en toute matière et d'instructeur, le bon courtisan a pour premier devoir d'informer loyalement son prince, d'abattre les écrans de l'adulation ou des fausses prévenances qui dissimulent à ses regards le monde qui lui appartient, sans mettre jamais en cause son pouvoir absolu. Aucun participant du Cortegiano ne conteste la maxime énoncée par Ottaviano Fregoso : le prince n'est responsable que devant Dieu ; tout ce que les hommes peuvent faire est de tâcher à le rendre meilleur. Pour informer son prince, l'homme de cour devra se mettre au fait de tout ce que requièrent l'intérêt politique de la dynastie et son prestige, dont une large part tient à l'éclat de sa cour. C'est sous cette rubrique, qui commande tout un programme de culture, que s'inscrit ce que le Cortegiano offre de plus riche et de plus neuf. Si la dignité des armes n'est pas réfutée, il en est fait peu de cas, lorsqu'elle prétend tenir lieu de tout. Dès le premier livre de l'ouvrage, l'axe de la balance tend à se déplacer des aptitudes guerrières vers les qualités de l'esprit. Le deuxième livre s'ouvre bien par des considérations sur les batailles, les tournois, les exercices corporels, mais on passe bientôt à la musique, aux entretiens de société, à la modestie, avant que ne commence un long propos sur l'art de divertir par de bons mots ou de bons tours. Après une discussion animée entre féministes et antiféministes, le troisième livre s'offre comme un exemple de conversation brillante et raffinée sur l'amour. Le dernier livre, enfin, traite surtout de l'utilité du courtisan pour le prince dans l'espèce de préceptorat qu'il se sera rendu digne d'exercer par son savoir et de faire accepter par son charme. Dans ces pages, Bembo disserte longuement, en termes platoniciens, de la beauté corporelle et spirituelle avant de célébrer, dans une ample péroraison, la divinité de l'amour. Un absolutisme princier tempéré par la sagesse éclairée de l'homme de cour : la « pédagogie » du Cortegiano aboutit au ministre d'État, confident respecté du souverain, non moins qu'au courtisan. Ce ministre ne saurait se trouver pour Castiglione que dans l'« homme complet » de l'idéal humaniste. À l'homme qui a su se composer harmonieusement lui-même, confiance peut être faite en politique, non moins qu'en culture, s'il se dit prêt au service du souverain et de l'État. Tel est le sens dominant d'un ouvrage où une inquiète revendication d'intellectuel se marie à un tranquille esprit de caste au fil d'une prose d'art à la fois substantielle et détendue, noblement appropriée à sa matière. Paul Renucci Ses œuvres mineures sont moins connues mais intéressantes. Les sonnets d'amour et les quatre Amorose canzoni content son amour platonique pour Elisabetta Gonzaga dans un style qui rappelle Pétrarque. Les pré-romantiques puiseront leur inspiration dans son sonnet Superbi colli e voi, sacre ruine. Ses poésies latines sont remarquables, comme l'élégie De morte Raphællis pictoris à la mort de Raphaël, et une autre, où il imagine sa propre mort. Son intéressante correspondance dépeint non seulement l'homme et sa personnalité, mais aussi les gens célèbres qu'il a rencontrés et fréquentés, lors de son activité diplomatique. Baldassare Castiglione meurt à Tolède en 1529.        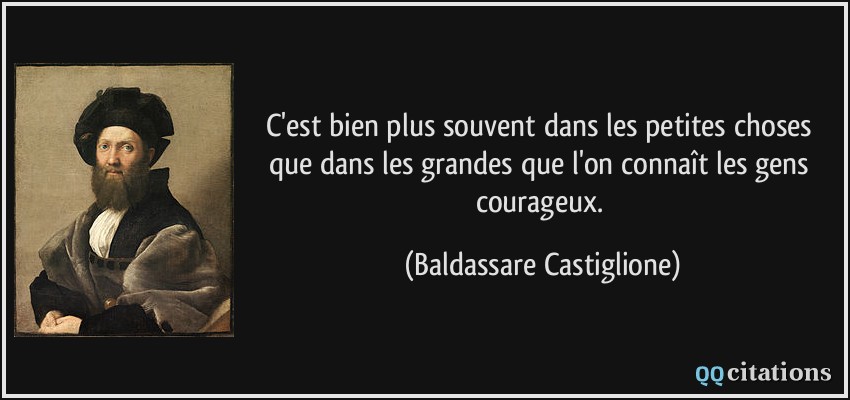  
#97
Raoul Follereau
Loriane
Posté le : 05/12/2015 12:59
Le 6 décembre 1977 meurt à Paris Raoul Follereau,
à 74 ans, écrivain, journaliste, poète français, créateur de la journée mondiale de lutte contre la lèpre et fondateur de l’œuvre connue aujourd’hui en France sous le nom de Fondation Raoul-Follereau, qui lutte contre la lèpre et la pauvreté et promeut l’accès à l’éducation. Il est né à Nevers le 17 août 1903. Sa vie Raoul Follereau naît le 17 août 1903 à Nevers. Il est le deuxième enfant d'une famille de trois : son frère Georges est de trois ans son aîné et Suzanne, sa petite sœur, de six ans sa cadette. Son père, Émile Follereau, dirige un établissement de construction métallique qu'il a créé et sa femme lui apporte une aide pour la gestion de l'entreprise. En 1917, Raoul Follereau apprend la mort de son père tué à la guerre, en Champagne. Pour faire vivre sa famille, il travaille dans la journée à l'usine familiale et le soir il étudie avec un prêtre pour préparer son baccalauréat. Il passe la première partie de son baccalauréat en 1919. En octobre de la même année, il réintègre l'école dans l'institution des Frères des Ecoles Chrétiennes. Raoul Follereau et Madeleine Boudou se rencontrent en 1917 en vendant des bleuets au profit des blessés de guerre². En 1918, à quinze ans, au cinéma Majestic de Nevers, Raoul Follereau prononce un discours lors d'une cérémonie à la mémoire des victimes de guerre. Il y exprime la devise : « Vivre, c'est aider les autres à vivre2 [...] être heureux, c'est faire des heureux». Raoul Follereau publie, en 1920, à dix-sept ans, son premier ouvrage, Le Livre d’amour. Après la guerre, à vingt ans, il obtient deux licences en philosophie et en droit à la Sorbonne. En 1924, Raoul Follereau part à Bonn, en Allemagne, pour son service militaire. Le 22 juin de l'année suivante, à sa démobilisation, il épouse Madeleine Boudou à Nevers. Au cours de leur voyage de noces, Raoul Follereau rencontre Gabriele d'Annunzio. Raoul Follereau commence une carrière d'avocat qu'il abandonne pour celle de journaliste puis devient secrétaire de rédaction au journal L'Intransigeant. La Ligue d’union latine Raoul Follereau crée la Ligue de l’Union Latine en 1927, avec Michel Rameaud et Monseigneur Ducaux-Bourget. Selon Jean-François Six, elle est « destinée à défendre la civilisation chrétienne contre tous les paganismes et toutes les barbaries », et elle s'inscrit « dans le courant de Maurras et de l'Action française ». Selon l'Annuaire général des lettres, son but est d'« unir et fédérer les élites latines pour la défense et la gloire de leur civilisation ». Déjà en 1920, quand Raoul Follereau avait publié son premier ouvrage, il avait créé la Jeune Académie, destinée à faire connaître de jeunes auteurs ou poètes de son âge en les publiant dans Les Éditions de la Jeune Académie, ou aidant à les faire publier. Continuant sur cette lancée, en cinq ans plus de 150 volumes de 100 auteurs seront publiés par l’intermédiaire du journal mensuel de la ligue, L’Œuvre latine8 dont le premier numéro parait en 1928. Et c'est plus de 300 auteurs ou interprètes de théâtre qui seront révélés. Au travers de la Ligue, Raoul Follereau développe une activité culturelle faite de conférences, de concerts, d’exposés qui va lui permettre de forger une doctrine qu’il expose lors d'une conférence à la Sorbonne en 1930. Il y expose toutes les valeurs qu’il pense représenter sa civilisation. Il met en avant les études classiques, il crée l’Institut de l’Union Latine pour favoriser les développements des études gréco-latines qu’il voudrait indispensable dans la formation car il pense qu’elles apportent une réelle formation pour les individus et la société qu’ils composent : « la latinité est héritière et continuatrice des civilisations antiques » déclare-t-il. En 1930, en compagnie de son épouse, il traverse la cordillère des Andes dans un avion de l’Aéropostale piloté par Jean Mermoz alors qu’il promeut la culture française en Amérique du Sud. Il s’investit alors dans la culture en créant ou en aidant à créer des bibliothèques en Amérique latine avec le patronage du ministre de l’Instruction publique. Il crée L’Œuvre du livre français à l’étranger et pour cette opération, il lève des fonds afin d’envoyer dans ces pays des livres français. Dès novembre 1931, il est fier de la création de trente-deux bibliothèques publiques et gratuites regroupant plus de 25 000 volumes « dignes de la France et soigneusement sélectionnés quant à leur valeur et à leur moralité ». Pierre Guillaume écrit, à propos de la Ligue de l’Union Latine : « Raoul Follereau fut aussi un témoin très engagé dans l’histoire intellectuelle et politique de son temps. C’est en maurrassien convaincu qu’il crée avant la guerre la Ligue de l’Union latine, dont le mensuel exprime une sympathie sans ambiguïté pour le Portugal de Salazar, comme pour l’Italie de Mussolini ». En France, il œuvre à l'abrogation des lois de 1901 et de 1904 sur les congrégations religieuses. A Paris, il participe en février 1936 à la première réunion du Centre de documentation et de propagande ( qui "a pour mission de lutter contre la judéo-maçonnerie, le marxisme et tous les agents de l'Anti-France"), avec des militants antimaçons et antisémites tels Louis Darquier de Pellepoix et Henry Coston. Il y vitupère les « machinations maçonniques dans le drame de Marseille qui coûta la vie » au roi de Yougoslavie. La même année, il vante l'action et la personnalité de Benito Mussolini. En Algérie, ses conférences sont des occasions de rassemblement pour l’extrême-droite locale qui cherche à s’unifier au lendemain de la victoire du Front populaire aux élections législatives de 1936. Le Figaro du 3 septembre 1936 mentionne que Raoul Follereau a été reçu par le Prince de Piémont au camp de Montella, quartier général des grandes manœuvres de l’armée italienne. Dans le contexte du Front populaire et de la guerre d'Espagne Raoul Follereau participe, le 4 septembre 1936, à Bruxelles au Congrès de la Ligue pour la réforme de la Société des Nations organisé par la branche belge des CAUR - les Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma. Dans les faits, c'est « la fine fleur de l'extrême-droite francophone »20 qui se rassemble à cette occasion afin de marquer son opposition au Rassemblement universel pour la paix. Il y demanda qu'une « union de tous les patriotes de tous les pays soit créée pour défendre contre toutes les anarchies rouges et leurs satellites la famille, la cité, la patrie, leur indépendance et leur honneur » et, deux mois plus tard, il prêche la « croisade des patries » contre « l'Internationale rouge, le bolchevisme envahisseur dont les menaces et les menées sont évidentes » et loue la valeur du patriotisme. Raoul Follereau accompagne l’enthousiasme pro-Franco des « amitiés latines » du maire d’Oran Gabriel Lambert en proposant « des voyages organisés depuis Paris en zone franquiste et [...] une collecte nationale pour la reconstruction des églises ». Une annonce parue dans Le Figaro du 19 avril 1938 indique que « la Ligue de l’Union Latine fera un don au cardinal Goma, primat d’Espagne, pour aider à la reconstruction des église mutilées ». La Ligue lance une souscription : « Sur la terre héroïque de nos frères d'Espagne, l'âme universelle de la chrétienté fut menacée. (...) Il revenait à la France des croisades, à la France de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc (...) d'aider à relever le premier clocher » . À Vichy, en juillet-août 1940, le président de la Ligue de l'Union Latine Raoul Follereau expose le « point de vue français » lors d'une réunion avec des diplomates sud-américains présidée par l'ambassadeur brésilien Luís Martins de Sousa Dantas. En 1940, Follereau est tout acquis aux thèses de la Révolution nationale (RN) et à la personne du Maréchal. Le mensuel de la Ligue de l’Union Latine se déplace de Paris à Lyon et change de nom pour s’intituler Paroles de France jusqu’à l’arrêt de la publication en 1944. Il va demeurer un catholique conservateur ; on le trouve président d'une séance lors du sixième congrès de l'Office international des œuvres de formation civique et d'action culturelle selon le droit naturel et chrétien (avatar de la Cité catholique de Jean Ousset), en 1969 à Lausanne. Les Fondations Charles de Foucauld C'est en 1936 que Raoul Follereau découvre la vie de Charles de Foucauld. Il fonde en 1937 les Fondations Charles de Foucauld et entreprend de lever des fonds afin de « reconstruire l'Église française du Sahara ». Les Fondations Charles de Foucauld sont bénies par le cardinal Pacelli lors de son déplacement à Lisieux, en juillet 1937 pour l'inauguration de la basilique Sainte-Thérèse. En octobre 1937, Raoul Follereau annonce la prochaine inauguration de l'église d'El-Goléa en rendant un vibrant hommage à l'ermite du désert : « En Charles de Foucauld, la France chrétienne retrouve son visage, elle s'exprime par lui, elle se reconnaît en lui. Et le Monde tout entier la reconnaît en lui. [...] C'est du désert que nous vient aujourd'hui la grande figure blanche qui nous affirme l'immortalité de la France et de sa foi. [...] Et si Charles de Foucauld mourut, martyr de sa foi, nous ne saurons jamais oublier qu'il tomba pour la France, que le saint Ermite était demeuré le patriote le plus accompli, le plus ardent qu'on puisse rêver, qu'il sut servir, comme le font avec tant de dévouement nos milliers de missionnaires, sa Croix et son Drapeau, exaltant l'une et l'autre dans son âme splendide incapable d'imaginer leur désunion. Celui-là, vraiment, fut de la France, fille aînée de l'Église. Premier Croisé du désert, premier « Chevalier des Sables », il résuma toute l'histoire de la France dans sa simple et grandiose épopée. » Raoul Follereau donne des conférences sur Charles de Foucauld au début des années 1940 à l’École des cadres d'Uriage auprès d’étudiants coloniaux venus du Foyer des étudiants africains et asiatiques de Marseille, ou encore en janvier 1943 au Théâtre des Fleurs de Vichy. En 1945, les Fondations Charles de Foucauld soutiennent l’abbé Albert Peyriguère qui lutte contre la malnutrition à Elkbab, en lui faisant parvenir 220 000 ancien francs et des farines alimentaires. Raoul Follereau subit l’opposition de Louis Massignon après guerre, lorsqu’il finance la grande exposition Charles de Foucauld organisée par l’abbé Louis, l’aumônier des Invalides avec le père Georges Gorée. Le rayonnement que le père de Foucauld, ancien officier, saharien passionné, avait sur les militaires français n’est pas étranger à cet intérêt. Le père Voillaume, fondateur des Petits Frères de Jésus, est interpellé par Louis Massignon qui s’en émeut : « l’exposition Foucauld aux invalides aura un budget de deux millions et demi fourni probablement par R. Follereau que l’abbé Louis a mis dans le comité ; avec le père Gorrée qui est chargé du "rayonnement" du père de Foucauld. [...] La fondation Follereau, grâce à l’exposition, deviendra une sorte de "caisse Foucauld", avec exclusivité et monopole ». L’exposition est cependant ouverte aux Invalides en 1946 et elle impressionne favorablement le père Voillaume. En fait Follereau, avec ses Fondations, sera pris entre d’un côté, Massignon et le Bulletin de l’association Charles de Foucauld avec Voillaume et de l’autre, Gorrée qui profite de l’exposition pour créer les Cahiers Charles de Foucauld. Alors que Gorrée refuse dans un premier temps la publication dans les Cahiers d’une note de mise au point au sujet des Fondations de Follereau, Massignon refuse de supprimer le Bulletin par fusion avec les Cahiers. Finalement les Cahiers Charles de Foucauld publient, le 8 septembre 1946, une lettre de protestation de Louis Massignon dans laquelle ce dernier, en qualité de membre fondateur de l’association de laïcs Union des Frères et Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus autorisée par le cardinal Amette, conteste l’utilisation du nom Fondations Charles de Foucauld par Raoul Follereau et met en avant l’absence de lien spirituel ou de disposition testamentaire de Charles de Foucauld en faveur de Raoul Follereau. En 1988, le Père Voillaume, interrogé par Étienne Thévenin, maintenait que « jamais les fondations Charles de Foucauld de Raoul Follereau n’ont fait partie des différents groupements et autres associations de la famille spirituelle de Charles de Foucauld ». Le 1er décembre 1953, Raoul Follereau est avec le maréchal Juin l’un des principaux orateurs prenant la parole lors de la cérémonie d’anniversaire de la mort de Charles de Foucauld célébrée au Cercle militaire de Paris37. Pour Louis Massignon, cela équivaut à placer la « croisade policière » du maréchal sous le patronage de Charles de Foucauld. La bataille contre la lèpre Selon la Fondation Raoul-Follereau, la création des Fondations Charles de Foucault et la prise de conscience des problèmes de la lèpre seraient liées. Ce serait, en 1936, au cours d’un reportage sur les pas de Charles de Foucauld, à la demande d’un quotidien sud-américain, que Follereau rencontrerait des lépreux pour la première fois. Mais Follereau, quant à lui, situera toujours cette rencontre entre 1925 et 1928 comme Thévenin le rapporte aussi : « Alors que sa voiture tombe en panne, il voit surgir de la brousse des visages apeurés. [...] Au guide j’ai dit : Qui sont ces hommes ? - Des lépreux m’a-t-il répondu. - [...] - J’entends bien, mais ne seraient-ils pas mieux au village ? Qu’ont-ils fait pour en être exclus ? - Ils sont lépreux, me répondit l’homme taciturne et têtu. - Au moins les soigne-t-on ? Alors mon interlocuteur haussa les épaules et me quitta sans rien dire. [...] et c’est ce jour-là que je me suis décidé à ne plus plaider qu’une cause, une seule cause pour toute ma vie, celle [...] des lépreux. ». Nous n’avons pas à déterminer de ces sources, toutes aussi crédibles, si une version est réelle plus qu’une autre. Peut-on juste remarquer qu’après cette rencontre et cet engagement, il ne s’est pas dévoué qu’à la seule cause des lépreux puisqu’en 1931 il s’occupait du rayonnement de la culture française en Amérique latine et qu’en 1937 et 1945, il s’occupait des fondations Charles de Foucault. Premier combat La bataille de la lèpre39 à proprement parler commence en avril 1943 avec sa première conférence sur ce sujet. La lèpre est alors une maladie mystérieuse qui effraie car, si elle tue rarement, elle mutile lentement ceux qui en sont victimes. Beaucoup y voient le signe d'une malédiction, ils ont la lèpre mais ils sont aussi lépreux. À cette époque il n'y a encore aucun traitement médical de la lèpre. L'exclusion dont sont victimes les lépreux vient autant de la peur des bien-portants que de leur abandon par le corps médical et des prescriptions sanitaires. En 1942, Raoul Follereau est réfugié à Lyon chez les religieuses de Notre-Dame des Apôtres quand il apprend que la mère générale a le projet de bâtir un village pour lépreux à Adzopé, en Côte d'Ivoire. Follereau se charge de collecter les fonds nécessaires à la construction du village. Pendant 10 ans, accompagné de deux sœurs, il parcourt les routes de France, de Belgique, de Suisse, du Liban, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Canada en donnant 1200 conférences. Avec l’ordre de Malte L’ordre de Malte en France, au travers des œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, n'est pas plus assuré que Raoul Follereau sur la date qui marque l'origine de son combat. En 2003, dans la revue de l'ordre de Malte-France, Hospitaliers no 108, un dossier spécial souligne les 75 ans d'activité de l'Œuvre, nous trouvons en titre « Reprenant le flambeau des chevaliers de Malte, les Œuvres se lancent en 1929 dans la bataille contre la lèpre ». Ce serait le 5 juin 1928 que l'Ordre posait la première pierre du pavillon de Malte à l’hôpital Saint-Louis à Paris destiné à soigner les « maladies exotiques » comme la lèpre. Ce pavillon ne sera inauguré que le 15 juillet 1932. Deux mille malades y sont suivis dans ses 40 lits. Par contre, dans son dossier de presse pour la journée mondiale des lépreux 2010, l'Ordre indique qu'il s'occupe de la lèpre depuis ses origines et qu'en 1938, c'est Justin Godart, président des œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, qui aurait demandé à Raoul Follereau le reportage sur la lèpre en Afrique qui serait à l'origine de l'engagement de celui-ci. Mais ce ne serait qu'en 1950, que les œuvres hospitalières décidaient de reprendre, en Afrique, le développement de ses activités en faveur des lépreux avec l'aide de Follereau, qui en reconnaissance se verra décerner la croix de commandeur dans l’ordre du Mérite de l’ordre souverain de Malte en 1954. En 1958, l'ordre souverain de Malte crée le CIOMAL - comité international de l'ordre de Malte - pour organiser au niveau mondial son activité en faveur de la lutte contre la lèpre. Le CIOMAL et l'association Raoul Follereau font partie des neuf membres fondateurs, en 1966, de l'ILEP - International Federation of Anti-Leprosy Association (fédération international des associations contre la lèpre) - aux côtés, entre autres de la fondation luxembourgeoise Raoul Follereau et de l'association italienne des amis de Raoul Follereau. Des initiatives originales En 1942 et 1943, Raoul Follereau initie deux actions : la première, le noël du père de Foucauld, il demande aux enfants de disposer un soulier supplémentaire pour les enfants pauvres, dès 1946 il recueille 12000 colis et 80000 en 1950 ; la deuxième, l'heure des pauvres ou la grève de l'égoïsme, consistant à faire un don pour les pauvres d'une heure de son salaire tous les Vendredi saint. En 1944, il demande à Franklin Delano Roosevelt une journée de guerre pour la paix. En 1952 on dispose pour la première fois d'un médicament qui guérit la lèpre : les sulfones. Follereau multiplie alors les initiatives visant à éveiller les consciences et mobiliser les foules. Trois de ces actions peuvent être citées pour le retentissement internationale qu'elles ont eu. Journée mondiale des lépreux En 1953, l’Abbé Balez suggère à Raoul Follereau de créer une journée mondiale de prière pour les lépreux. Follereau s’approprie l’idée et lance l’idée d'une journée mondiale des lépreux. Elle est célébrée pour la première fois le dernier dimanche de janvier 1954. Cette journée visait deux objectifs : d’abord obtenir que les malades de la lèpre soient soignés et traités comme tous les autres malades, en respectant leur liberté et leur dignité d’homme et ensuite, suivant l’expression de Follereau, « guérir les bien-portants » de la peur absurde et parfois criminelle qu’ils ont de cette maladie et de ceux qui en sont atteints. Maintenant cette journée est aussi l’occasion pour les associations de mobiliser les populations pour obtenir des dons lors de quêtes. Lors de la 57e journée organisée le 31 janvier 2010, la fondation Raoul-Follereau à mobilisé 35000 quêteurs sur le territoire français. La 58e journée a lieu les 29 et 30 janvier 2011. Deux bombardiers stratégiques Le 1er septembre 1954, la presse publie la lettre ouverture que Raoul Follereau a écrit au Général Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, et à Gueorgui Malenkov, alors encore pour une semaine premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, il est remplacé le 7 septembre par Nikita Khrouchtchev, pour leur demander un don particulier, le prix d'un bombardier stratégique chacun. « Ce que je vous demande est si peu ... Presque rien ... Donnez moi un avion, chacun un avion, un de vos avions de bombardement. Parce que j'ai appris que chacun de ces engins coûtait environ cinq milliards de francs ... Alors j'ai calculé qu'avec le prix de deux de vos avions de mort, on pourrait soigner tous les lépreux du monde ». Il ne recevra jamais la moindre réponse à ces demandes, il prend l'opinion publique à témoin, ce qui va permettre la création d'associations Raoul Follereau. Par contre l'image va avoir du succès, il deviendra habituel de comparer les dépenses militaires avec les investissements humanitaires. Un jour de guerre pour la paix Raoul Follereau reprend vingt ans après une idée qui n'avait pas eu d'écho au moment de la guerre. En 1964, il s'adresse à U Thant, secrétaire général de l'ONU : « Que toutes les nations présentes à l'ONU décident que chaque année, à l'occasion d'une Journée Mondiale de la Paix, elles prélèveront sur leur budget respectif ce que leur coûte un jour d'armement, et le mettront en commun pour lutter contre les famines, les taudis et les grandes endémies qui déciment l'humanité. Un jour de guerre pour la paix... » Pour donner de l'envergure à cet requête, Follereau lance son premier appel à la jeunesse. Il fait imprimer une carte postale pour les jeunes de 14-20 ans en leur demandant de faire parvenir cette pétition aux Nations unies. Les jeunes lisent au verso de la carte « Nous, jeunes de 14 à 20 ans, faisons nôtre l'appel Un jour de guerre pour la paix que Raoul Follereau a adressé aux Nations unies et nous nous engageons à user de nos droits civils et politiques pour assurer le succès de cet appel. ». Au total c'est entre deux à trois millions de signatures qui sont reçues au siège de l'organisation en provenance de 120 pays. De nombreux États auraient écrit à Raoul Follereau pour le soutenir, principalement des pays du tiers-monde qui auraient été les premiers bénéficiaires d'une telle disposition. Dès décembre 1968, 15 pays déposaient une Résolution, invitant tous les États membres à consacrer une journée à la paix et à verser, chaque année, un jour de leurs dépenses militaires à un Fonds spécial pour la Paix destiné à la lutte contre les épidémies, les endémies, la faim, la misère et l'analphabétisme. Dans les faits, un seul État, celui du Luxembourg, adoptera une telle résolution. Dernières années En 40 ans, l’action de Raoul Follereau a permis la création de multiples associations dans plusieurs pays européens et la collecte de trois milliards de fonds. Il se préoccupe alors de la pérennité de son action, conçue comme « une œuvre qu’il faut bâtir pour toute la Terre et pour des siècles… ». En 1968, Raoul Follereau crée l’association française Raoul-Follereau en regroupant en une seule toutes les associations créées en France sous son nom pour aider son action. Il désigne la même année André Récipon comme successeur pour mettre en place les structures nécessaires au développement et à la pérennité de son œuvre. En 1971, ils créent ensemble l’Union internationale des associations Raoul-Follereau UIARF, pour regrouper toutes les associations nationales. Follereau a toujours été conscient de l’immense réserve d’énergie et d’enthousiasme que possèdent les jeunes. À sa mort il les déclare Quand ? légataires universels : « J'institue pour légataire universelle la jeunesse du monde. Toute la jeunesse de tout le monde : de droite, de gauche, du milieu, du plafond : que m'importe ! Toute la jeunesse : celle qui a reçu le don de foi, celle qui fait comme si elle croyait, celle qui croit qu'elle ne croit pas. Il n'y a qu'un ciel pour tout le monde. Alors... demain ? Demain, c'est vous. » Raoul Follereau meurt le 6 décembre 1977. Lors de ses obsèques, de nombreux ambassadeurs, en grande majorité d’Afrique où l’organisation Follereau avait tissé ses réseaux, représentent leur gouvernement. Il est enterré au cimetière d’Auteuil situé dans le XVIe arrondissement de Paris. Hommages Outre la fondation qui porte son nom, la mémoire de Raoul Follereau est conservée à travers les noms d’institutions hospitalières comme l’Institut Raoul-Follereau d’Adzopé ou le Centre Raoul-Follereau de Nouméa, des noms de voies dans plusieurs villes dont la place Raoul-Follereau à Paris et celui des lycées Raoul-Follereau à Nevers et Belfort. La biographie « Raoul Follereau, hier et aujourd’hui » d'Étienne Thévenin paraît en 1992. Selon Pierre Guillaume, qui la recense en 1993 pour Vingtième Siècle, bien que tombant complètement dans les pièges de l’hagiographie la plus naïve, elle est indispensable pour connaître l'une des figures les plus attachantes de notre temps. L'anniversaire des vingt ans de la mort de Raoul Follereau est célébré en 1997. À cette occasion, l'ancien président libanais Elias Hraoui, prend la parole en ces termes : « Il y a longtemps, Raoul Follereau nous quittait, et le monde perdait une personnalité hors du commun, un homme de bien et de bonté, un homme qui avait érigé le devoir d'ingérence humanitaire en principe de vie, bien avant que cette expression soit à la mode ». L'ancien président béninois Mathieu Kerekou ajoute : « L'héritage qu'il nous a laissé ... c'est la bataille contre la lèpre et la promotion d'un monde d'amour, de solidarité et de tolérance ». Jacqueline de Romilly prononce à cette même occasion un discours à la Sorbonne. L'anniversaire de la naissance de Raoul Follereau est inscrit aux « célébrations nationales » du ministère de la Culture pour l'année 2003. En juin 2009, est déclarée en préfecture la création du « mouvement pour la glorification de Raoul et Madeleine Follereau ». L'objet social de cette association loi 1901 est notamment d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'un procès de canonisation de Raoul et Madeleine Follereau. Le rôle de Madeleine Follereau Raoul Follereau et Madeleine Boudou se sont rencontrés en 1917 et mariés en 1925. Madeleine a inspiré les premiers poèmes de Raoul Follereau.. En 1966, Raoul écrit la plus grande chance de ma vie, ce fut ma femme. [...] Jamais je ne fis un seul voyage sans elle. Elle m'a accompagné dans toutes les léproseries du monde. Elle fut mon soutien, toujours. Et parfois, ma consolation. [...] C'est à deux seulement qu'on est invincible.. L’œuvre littéraire de Raoul Follereau Avant l'âge de 16 ans, Raoul Follereau a été encouragé dans sa carrière de poète par Edmond Rostand avec qui il a correspondu. Plus tard, il a été encouragé par Gabriele D'Annunzio qu'il a pu rencontrer pendant son voyage de noces en 1952. Raoul Follereau a publié son premier ouvrage, Le Livre d’amour, qui contient le poème Un sourire, en 1920, à 17 ans. Il écrira en tout 44 œuvres, poèmes, romans, pièces de théâtre et récits de voyages. Selon la Fondation Raoul-Follereau, toute son œuvre, empreinte de ferveur catholique, tend à lutter contre l’injustice sociale, la misère, le fanatisme, l’égoïsme des riches et des puissants. Ses livres les plus connus sont : L’heure des pauvres, La bataille de la lèpre et Un jour de guerre pour la paix. En novembre et décembre 1944, il publie une brochure, Le premier Million d’Adzopé, expliquant pourquoi et comment une ville pour les lépreux est construite en Côte d’Ivoire. Follereau est aussi un écrivain de théâtre : sa pièce La Petite Poupée a été jouée plus de 1000 fois.         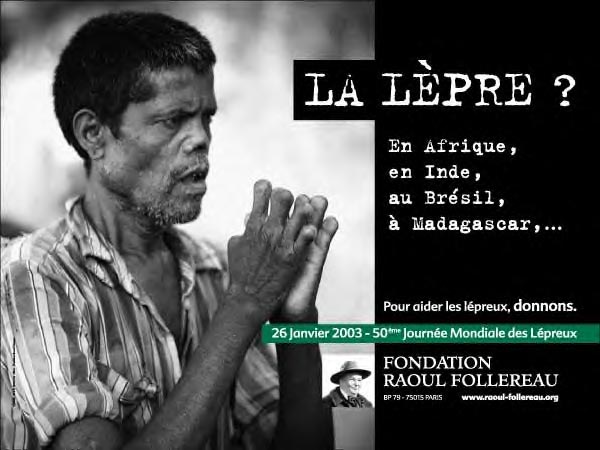 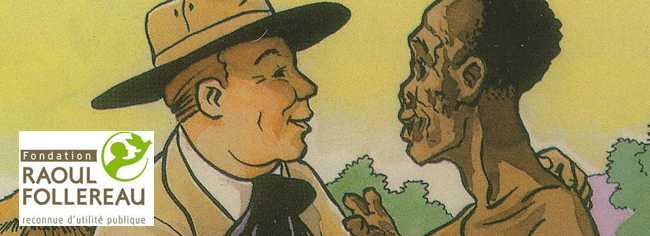 
#98
Carlo Lévi
Loriane
Posté le : 28/11/2015 19:29
Le 29 novembre 1902 à Turin naît Carlo Lévi
écrivain, médecin, peintre, journaliste, scénariste et homme politique italien, mort à 72 ans,le 4 janvier 1975 à Rome En bref Entre 1935 et 1936, Carlo Levi, écrivain et peintre, médecin de formation, vit en exil dans le sud de l'Italie à cause de ses activités antifascistes. L'écrivain et peintre né à Turin et familier des milieux intellectuels découvre alors un autre monde. Il deviendra mondialement célèbre grâce à un récit, Le Christ s'est arrêté à Eboli (Cristo si è fermato a Eboli, 1945), qui évoque son séjour en Lucanie : récit désormais historique où, à côté du portrait de l'exilé politique humilié et surveillé par la police, surgit le monde primitif des paysans du Sud que l'humanité a oubliés et qui sont exploités par les petits tyrans propriétaires et fascistes. À travers une synthèse de réalisme et de lyrisme au niveau des descriptions des lieux et des situations, Levi renouvelle un genre littéraire : celui de la critique impitoyable dirigée contre les grands et les petits bourgeois réactionnaires. Il sait aussi décrire avec sympathie et exactitude les rites et coutumes d'une civilisation paysanne en voie d'extinction. L'essai La Peur de la liberté (Paura della libertà, 1946) s'inspire également de la Lucanie, où le peuple est quotidiennement mystifié. La Montre L'Orologio, 1950 est une chronique de Rome à la fin de la guerre. Par la suite, Levi s'intéressera de nouveau au Sud en proposant successivement un texte sur la Sicile Le Parole sono pietre, 1955 et sur la Sardaigne (Tutto il miele è finito, 1964). La critique sociologique et politique de l'Allemagne qu'il nous livre dans les pages de la chronique écrite en 1959, Double Nuit des tilleuls (La Doppia Notte dei tigli), se distingue de ces premiers récits, qui ont fait de lui un classique italien contemporain, et cela même s'il se considérait d'abord comme un peintre. Giovanni Ioppolo Sa vie Carlo Levi est né à Turin de Ercole Levi, médecin d'origine juive et d'Annetta Treves, la fille de Claudio Treves . Il étudie la médecine et reçoit son diplôme de l'université de Turin en 1924. Il n'a cependant pas pratiqué la médecine, choisissant de devenir peintre et de poursuivre une activité politique commencée à l'université où il a eu comme ami Piero Gobetti. En 1929, il participe au mouvement anti-fasciste2 Giustizia e Libertà créé par Nello3 et Carlo Rosselli et il devient l'un des chefs de la branche italienne avec Leone Ginzburg, un juif russe d'Odessa qui avait émigré avec ses parents en Italie. Adversaire du fascisme, il devient également membre du Parti d'action. Arrêté en 1935, il est condamné par le régime au confino résidence surveillée dans une région désolée du Mezzogiorno, à Grassano, puis à Aliano, en Basilicate, expérience dont il tirera le livre Le Christ s'est arrêté à Eboli et qui marqua profondément sa peinture. Retrouvant sa liberté, il part en France et y vit de 1939 à 1941. En 1941, de retour en Italie, il est arrêté à Florence et emprisonné dans la prison de Murate it. Il est libéré après l'arrestation de Benito Mussolini et cherche refuge dans le palais Pitti, où il a écrit son ouvrage Cristo si è fermato a Eboli. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'installe à Rome où il devient pendant un certain temps rédacteur de Italia libera, la publication du Partito d'Azione, une organisation anti-fasciste. Il continue d'écrire et de peindre, exposant en Europe et aux États-Unis. Ses écrits se composent de L'orologio La montre 1950, Le parole sono pietre (Les mots sont des pierres 1955, et Il futuro ha un cuore antico Le futur a un cœur antique 1956. En 1963, il est élu au Sénat en tant qu'indépendant, sous l'étiquette du Parti Communiste, et réélu en 1968. Il apparaît dans le documentaire, Les écrivains italiens et l'Italie des écrivains : ombres et questions, Italiques. Il meurt d'une pneumonie à Rome le 4 janvier 1975, mais ses dernières volontés sont d'être inhumé à Aliano Gagliano en dialecte local comme il la nomme dans ses écrits. La maison qu'il y occupa peut encore être visitée. Ouvrages Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Turin, 1945 ; Paura della libertà,Turin, 1946 ; L'orologio,Turin, 1950 ; Le parole sono pietre,Turin, 1955 ; II futuro ha un cuore antico,Turin, 1956 ; La doppia notte dei tigli, Turin, 1959 ; Un volto che ci somiglia, Turin 1960 ; Tutto il miele è finito,Turin, 1964 ; Quaderno a cancelli, sous la direction de A. Marcovecchio et L. Saba, Turin, 1979. Traduction (fr) Le Christ s'est arrêté à Eboli 1948 éd. Gallimard, collection Folio réédité en 2001 (fr) "La montre"(1952)éd. Gallimard - NRF L'orologio,Turin, 1950 ; "la peur de la Liberté", traduction de Jean Claude IBERT, ed. Gallimard - NRF, 1955 Œuvres picturales Conservées au Centro Carlo Levi de Matera, à proximité d'Aliano, et à la Fondation Carlo Levi de Rome : Le Chemin vers les grottes de San Giovanni in Grassano (1935), huile sur toile de 74 cm × 93,5 cm, datée au dos (9 septembre 1935), Rome, Fondation Carlo Levi.   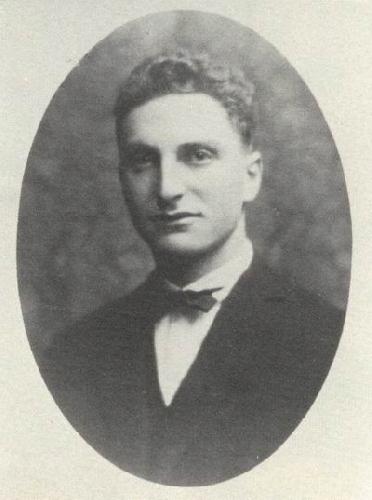         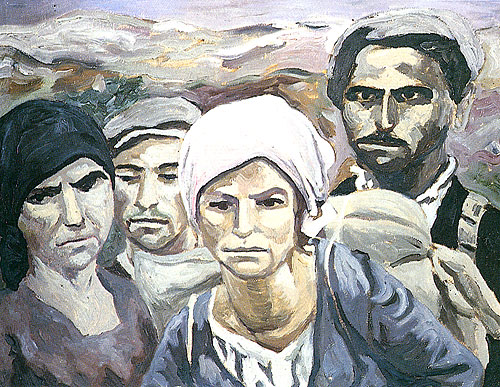 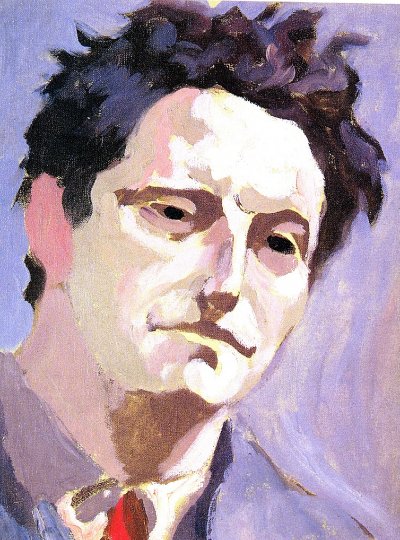  
#99
Théodor Mommsen
Loriane
Posté le : 31/10/2015 22:35
Le 1er novembre 1903 meurt Théodor Mommsen
à 85 ans à Charlottenburg de son nom complet Christian Matthias Theodor Mommsen, né le 30 novembre 1817 Garding à Schleswig-Holstein,historien allemand, et le plus influent spécialiste de la Rome antique du XIXe siècle. Il est l'auteur d'une monumentale Histoire romaine et d'un Corpus inscriptionum latinarum encore actualisé et mis à jour. Cette œuvre immense et exceptionnelle est couronnée en 1902 par le Prix Nobel de littérature, qui joua un grand rôle dans l'historiographie moderne de l'Antiquité. Il participa à la révolution de mars 1848 et, député à la diète de Prusse, s'opposa à Bismarck 1863-1866 et 1873-1879, puis au Reichstag 1881-1884. Ses Œuvres principales sont Histoire romaine 1854-1886, Histoire de la monnaie romaine 1860, Corpus inscriptionum latinarum Historien allemand de l'Antiquité, Theodor Mommsen est originaire de l'État du Schleswig-Holstein, où son père était pasteur. Il reçut chez les siens une excellente éducation littéraire. Sujets danois, les Mommsen étaient allemands d'origine et de cœur. Theodor Mommsen, dès son adolescence, deviendra, comme la génération romantique de son pays, un ardent patriote allemand. Il fit ses études au gymnase d'Altona, puis à l'université de Kiel, où il étudia philologie, histoire et droit. Remarqué pour ses travaux, il obtint une bourse pour un voyage en France et en Italie. Le grand érudit italien D. Borghesi lui conseilla de rassembler les inscriptions de l'Italie du Sud. Mommsen consacra deux ans de sa vie à une quête infatigable menée sur place et publia plusieurs livres sur les inscriptions dialectales osques Oskische Studien, 1845, marses Iscrizioni marsi, 1846, messapiennes Iscrizioni messapiche, 1848, sur les dialectes de l'Italie méridionale Unteritalische Dialekte, 1850. C'était là déjà l'œuvre d'un grand philologue. En bref En 1848, il était devenu professeur de droit civil à Leipzig, mais ses convictions libérales lui firent perdre sa chaire en 1850, alors que se manifestait un mouvement marqué de réaction. Professeur de droit en Suisse, à Zurich, en 1852 il y publia les inscriptions de la Confédération helvétique, il trouva une chaire à Breslau en 1854. Chargé par l'Académie des sciences de Prusse de diriger la publication monumentale du Corpus inscriptionum latinarum, base actuelle de toute recherche épigraphique, il fut appelé à Berlin en 1858, où il enseigna l'histoire romaine à partir de 1861. En 1874, il devint secrétaire perpétuel de la section de philosophie et d'histoire de l'Académie de Prusse. L'importance et le rayonnement de l'enseignement et de l'œuvre de Theodor Mommsen ont été considérables. Il était, à son époque, le maître incontesté dans des disciplines aussi diverses que la philologie, l'épigraphie, l'archéologie romaine ; toute une école fut formée par ses leçons. Un homme comme Camille Jullian, malgré sa défiance à l'égard de l'Allemagne et de ses professeurs, ne cachait pas son admiration pour lui et écrivait en 1883, alors qu'il suivait pour un temps son enseignement à Berlin : « M. Mommsen est peut-être le philologue auquel un texte ou un sujet peut suggérer le plus d'idées nouvelles ; sa pensée paraît en mouvement perpétuel ; elle ne se repose jamais, si bien que chaque travail de son séminaire est pour lui l'occasion, le motif de réflexions nouvelles sur un problème de la science de l'Antiquité [...]. On assiste à la formation, à la naissance d'un de ses articles, à la découverte par lui de quelque fait nouveau .... Son séminaire est extrêmement riche de révélations de toutes sortes, et ceux qui ont pu assister à de telles leçons oublieront difficilement ces heures de vie scientifique et d'enseignement intime. » Sa vie Né à Garding Schleswig-Holstein, fils de pasteur, Mommsen est né citoyen danois mais s'est toujours reconnu allemand d'origine et de cœur. Mommsen a cinq frères et sœurs dont August né en 1821 et Tycho né en 1819. Il étudie de 1831 à 1838 à Altona, puis à l'université de Kiel, où il se spécialise à la fois en histoire, droit et philologie. Brillant élève, Mommsen obtient une bourse qui lui permet de voyager en France et en Italie, dernier pays où s'affirment son goût et son habileté à déchiffrer les inscriptions antiques. Il travaille d'arrache-pied de 1845 à 1850 sur les dialectes de l'Italie méridionale marse, osque, messapien, etc., ce qui fait déjà de lui un érudit de grande envergure. Il fit un voyage en France et en Italie (1844-1847), puis s'engagea dans la politique, soutenant les idées nouvelles dans un journal local alors qu'il enseigne le droit à Leipzig en 1848. Révoqué peu après à cause de ses opinions libérales, Mommsen enseigne quelque temps à Zurich 1852, puis à Breslau 1854, et enfin à Berlin 1858 où il est chargé de l'histoire en 1861. Chargé par l'Académie prussienne d'un monumental Corpus inscriptionum latinarum, il fait de celui-ci la base, encore valable aujourd'hui, de toute recherche épigraphique. Ce chercheur hors pair, capable de maîtriser de multiples domaines, fonde par ses travaux et son enseignement une école historique qui dépasse les frontières allemandes1. Reçu par Napoléon III aux Tuileries, il est alors une sommité reconnue de l'histoire antique, non seulement par l'Empereur qui prépare son Histoire de Jules César 1865, mais aussi par les savants qui épaulent le monarque dans cette entreprise, dont Victor Duruy alors ministre de l'Instruction publique. Proche des milieux libéraux, Mommsen participe à la vie politique de son pays. Il se réjouit, en 1870, de l'unité allemande dans une série d'articles. Fustel de Coulanges lui répondit dans un article publié dans la Revue des deux Mondes, puis d'autres, réunis plus tard sous le titre de Questions contemporaines. Très souvent qualifié de francophobe, Mommsen a certes manifesté le plus grand mépris pour la politique française et ce, jusqu'à sa mort, ce que la communauté scientifique française ne lui pardonna pas. Il était cependant un admirateur de Racine, Musset et de Voltaire. Avec le temps, il s'opposa politiquement à Bismarck, attitude qui lui valut une condamnation à quelques mois de prison. Il abandonna ainsi en 1882 le siège de député au Reichstag qu'il occupait depuis 1873. Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de Prusse depuis 1878, il reçoit au crépuscule de sa vie, en 1902, le prix Nobel de littérature. Il se consacra ensuite uniquement à son œuvre, en tant que professeur à Berlin, et secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences de Prusse. Il eut seize enfants avec son épouse Marie 1832-1907 dont certains moururent en bas âge. Ses petits-enfants Hans et Wolfgang sont des historiens reconnus. Ouvrages principaux Theodor Mommsen est un spécialiste de l'histoire antique du XIXe siècle. Il ne s'appuie que sur l'épigraphie, et laisse de côté le corpus de légendes sur l'histoire romaine. Son Droit public romain fut considéré à l'époque comme une bible, et fut inclus dans le Manuel des Antiquités romaines de Marquardt ; Philologue émérite, il étudia les langues italiques, et révisa les éditions des Agronomes Latins et de Pline le Jeune ; L’Histoire de la monnaie romaine 1860 est à la fois une codification de l'ensemble de la monnaie romaine, et une avancée dans le domaine combinant droit, métrologie, épigraphie latine et histoire. son Histoire romaine 1854-1886, 8 volumes est un monument également admiré à l'époque, mais peu référencé. Si l'ensemble de son œuvre est aujourd'hui largement dépassé, elle n'en reste pas moins une référence incontournable pour les spécialistes de la Rome antique, tant du point de vue de sa rigueur scientifique que de son importance dans l'histoire de la discipline. Mommsen laissa derrière lui une œuvre vraiment monumentale dont beaucoup de parties ont surmonté l'épreuve du temps. Son Histoire romaine (Römische Geschichte), qu'il a menée jusqu'à la mort de César, est une œuvre maîtresse ; publiée en trois tomes à Breslau, de 1854 à 1856, complétée par un dernier tome publié à Berlin en 1886, elle connut plusieurs rééditions et traductions en diverses langues. Le Droit public romain (Das römische Staatsrecht, 1871-1888 et le Droit pénal Das Strafrecht, 1899) sont deux admirables synthèses. La seconde forme la contribution de Mommsen à l'important Manuel des antiquités romaines, que son ami J. Marquardt allait mener à bien. Il anime la préparation du Corpus inscriptionum latinarum, du Corpus juris civilis et d'autres entreprises scientifiques. Mommsen participe en même temps, en progressiste libéral, à la politique de son pays et à la formation de l'unité allemande. En 1902, il reçoit le prix Nobel de littérature. Le rôle de Mommsen dans la constitution de l'histoire de l'Antiquité en discipline scientifique ne saurait être surestimé. Il a dominé les disciplines de base que sont la philologie, l'archéologie, l'épigraphie, l'étude du droit, et il a montré les règles de leur utilisation pour toute synthèse historique. Mais c'est surtout dans le domaine épigraphique et juridique que son œuvre a été considérable ; elle subsiste encore aujourd'hui. Initiateur du Corpus inscriptionum latinarum, il s'est chargé personnellement du tome I (Les Inscriptions antérieures à César, du tome III Les Balkans, la Grèce et l'Orient, du tome V La Gaule cisalpine et des tomes IX et X (Italie centrale et méridionale. Ainsi avait-il pris une part décisive dans la rédaction d'un corpus qui devait comprendre seize tomes et une quarantaine de volumes. Dans l'étude du droit, sa place n'est pas moins éminente. Son Droit public, qui dresse un pénétrant tableau de la Constitution romaine, et son Droit pénal sont encore les bases des études actuelles. Le seul reproche qui puisse être fait à ce grand historien est peut-être un excès de logique et de rigueur, un trop grand esprit de système dans la peinture de l'évolution constitutionnelle de Rome, où l'empirisme a largement joué son rôle. Mais cela n'enlève rien à la valeur d'un savant complet qui a dominé les études d'histoire romaine pendant plus d'un demi-siècle et qui les a marquées d'une empreinte ineffaçable et fructueuse. Raymond Bloch Le Corpus inscriptionum latinarum Ce Recueil des inscriptions latines était attendu dans de nombreuses universités, et certaines avaient même entamé des travaux pour le réaliser. Ceux-ci, quand ils n'avortaient pas, n'aboutissaient qu'à des recueils partiels, dispersés, de valeur inégale. L'Académie de Berlin elle-même avait amorcé une compilation de ce genre, mais en rangeant les inscriptions par catégories, ce qui demandait beaucoup plus de labeur, un long travail de conception, des discussions ardues, et des mises à jour difficiles. Mommsen, lors de son voyage en Italie, avait recopié l'ensemble des inscriptions du Royaume de Naples, pensant qu'il était plus pertinent de procéder par région, puis par localité. Il compléta ce recensement par de nombreuses tables détaillées facilitant la recherche. Sa publication eut un grand succès, et sa méthode fut saluée par l'Académie de Berlin, qui le chargea de poursuivre ses travaux. Il dirigea la publication à partir de 1863, rédigeant plusieurs volumes lui-même, suivant de près ses collaborateurs pour les autres. Il mourut à Charlottenburg avant d'avoir achevé sa tâche, qui fut continuée et constamment actualisée depuis. À sa mort, le CIL contenait plus de 100 000 transcriptions graphiques d'inscriptions latines. Les 16 tomes correspondent pour 14 d'entre eux à une région, excepté le premier, réservé aux inscriptions antérieures à la mort de Jules César, et le seizième, consacré aux diplômes militaires. Il reçut la médaille pour le Mérite et le prix Nobel de littérature en 1902. Œuvres Theodor Mommsen, Histoire romaine, 2 volume, Collection Bouquins, Robert Laffont, 1985.   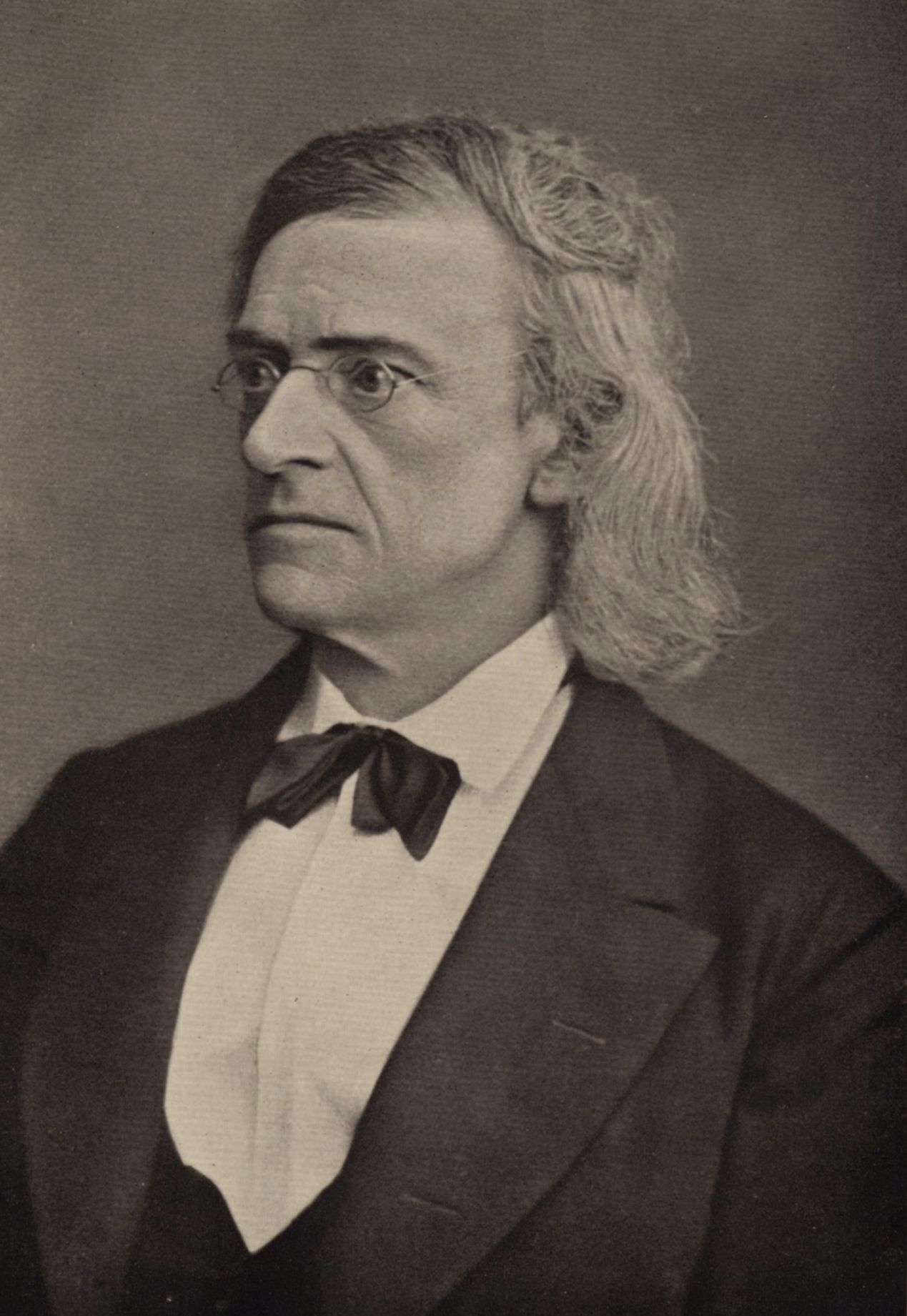    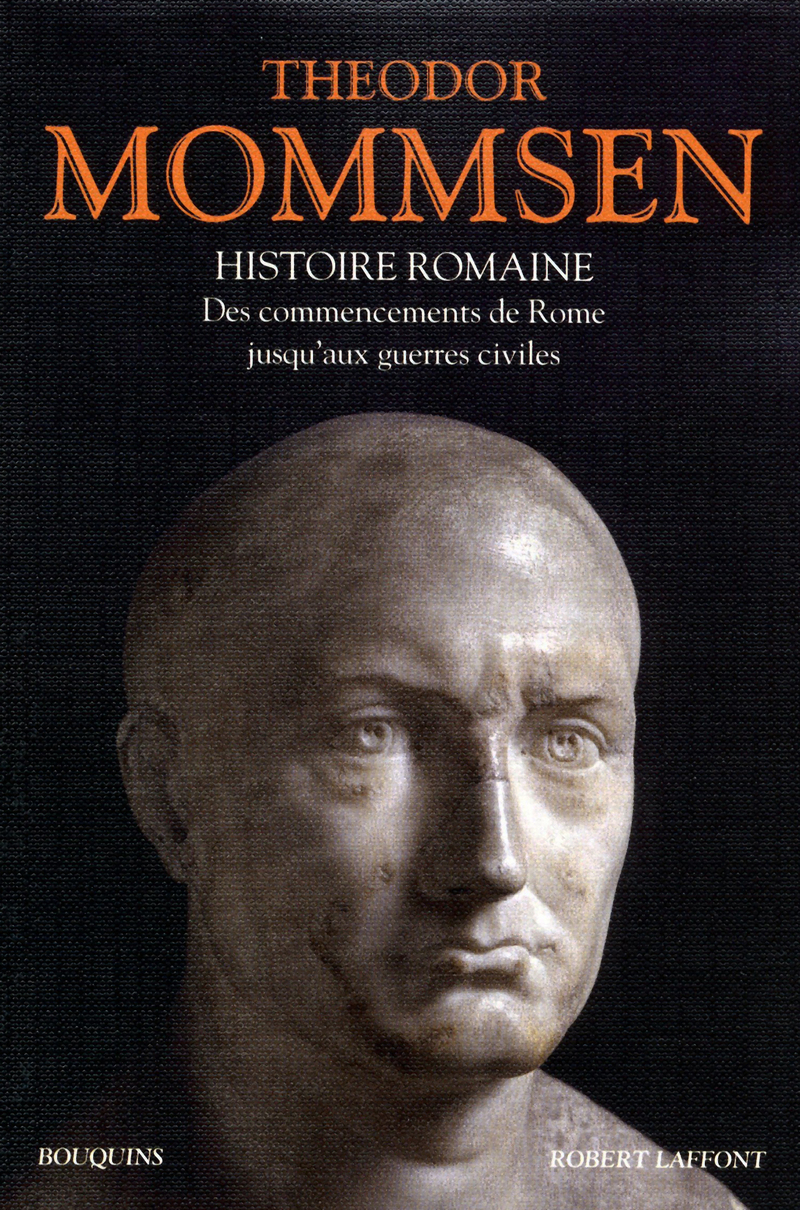   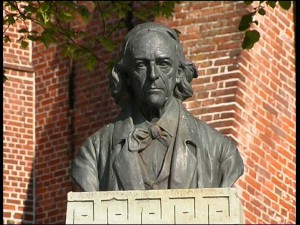  
#100
Henry Troyat
Loriane
Posté le : 31/10/2015 22:05
Le 1er novembre 1911 naît à Moscou, Henri Troyat
né Lev Aslanovitch Tarassov ; en russe moderne : Лев Асланович Тарасов, et mort à 95 ans, à Paris France le 2 mars 2007, est un écrivain français. Dans son livre de souvenirs Un si long chemin, paru en 1976, il confirme clairement l'origine arménienne de ses deux parents. Écrivain né russe d"écriture française, distincté du prix du roman populiste en 1935, du prix Goncourt en 1938, Membre de l'Académie française fauteuil 28, Prix des Ambassadeurs en 1978, auteur deroman, essai, biographie, théâtre. Ses Œuvres principales sont L'Araigne en 1938, Tant que la terre durera trois tomes, de 1947 à 1950 Les semailles et les moissons cinq tomes, de 1953 à 1958 Il est l'auteur de grands cycles romanesques qui évoquent la Russie et la France contemporaines Tant que la terre durera, 1947-1950 ; les Semailles et les Moissons, 1953-1956 ; la Lumière des justes, 1959-1962 ; les Eygletière, 1965-1967. On lui doit aussi des biographies Ivan le Terrible, 1982 ; Tourgueniev, 1985 ; Gorki, 1986 ; Flaubert, 1988 ; Maupassant, 1989 ; Alexandre II, 1990 ; Zola, 1992 ; Verlaine, 1993 ; Balzac, 1995 ; Nicolas I er, 2000. Académie française, 1959. Sa vie Lev Aslanovitch Tarassov naît à Moscou en 1911. Soixante ans plus tard, dans un livre de souvenirs, Un si long chemin (1976), il aura à cœur de rappeler les origines arméniennes de ses parents. La révolution bolchévique l'amène à quitter la Russie dès 1917 : après bien des péripéties, il arrive en France à dix-neuf ans. Des études de droit et sa naturalisation lui permettent d'occuper un poste de rédacteur à la préfecture de la Seine, un emploi qu'il conservera jusqu'en 1943. Mais sa passion est ailleurs. À vingt-cinq ans, et tandis qu'il est encore sous les drapeaux, il publie son premier roman, Faux jour 1935, immédiatement récompensé par le prix du roman populiste. Trois ans plus tard, le prix Goncourt est décerné à L'Araigne. C'est donc un écrivain déjà célèbre − l'Académie française lui offre un prix pour l'ensemble de son œuvre en 1938 − qui va s'engager pendant quarante ans dans la publication de romans La Neige en deuil, 1952 ; Grimbosq, 1976 ; Le Pain de l'étranger, 1982, de nouvelles La Geste d'Ève, 1964 ; Les Ailes du diable, 1966 ou de récits de voyage. Surtout, il va attacher son nom à la rédaction régulière de cycles romanesques, qui prennent pour cadre la France ou la Russie. Dix romans français vont connaître un succès colossal : Tant que la terre durera, 1947-1950 ; Les Semailles et les moissons, en cinq volumes, 1953-1957 ; Les Eygletière, 1965-1967. Onze autres sont « russes » : La Lumière des justes, 1959-1963 ; Les Héritiers de l'avenir, 1968-1970 ; Le Moscovite, 1973-1975. À chaque fois, Henri Troyat se documente précisément et fait de l'histoire le fond de scène sur lequel se jouent des destins singuliers. Les personnages connaissent les affres de la France d'après la Grande Guerre ou, quand ils sont russes, de la Russie des tsars jusqu'à la révolution d'Octobre. La boulimie d'écriture ne s'arrête pas là. Alors qu'il est élu à l'Académie française au fauteuil de Claude Farrère 1959, Henri Troyat se fait le biographe des grandes figures de la Russie tsariste : les personnages politiques Catherine la Grande, 1977 ; Pierre le Grand, 1979 ; Alexandre Ier, 1981 le disputent aux écrivains dont il a fait ses maîtres Dostoïevski, 1940 ; Pouchkine, 1946 ; Tolstoï, 1965 ; Gogol, 1971 ; Tchékhov, 1984 ; Tourgueniev, 1985 ; Gorki, 1986. Le domaine français n'est pas en reste avec des biographies de Flaubert, Maupassant, Verlaine... Ce qui ne va pas sans difficultés parfois, quand l'écrivain se trouve condamné à une lourde amende 1997 pour plagiat à propos de son ouvrage sur Juliette Drouet. Cette carrière, jalonnée par les titres et les honneurs, s'est poursuivie sans grand changement jusqu'à sa mort le 2 mars 2007. C'est au total la somme impressionnante de plus de soixante romans, trente biographies, huit essais et deux pièces de théâtre qu'il laisse à la postérité. Troyat est un écrivain populaire qui s'adresse non à ses pairs en littérature, mais à des lecteurs plus ordinaires, passionnés par les romans qui embarquent des personnages dans les tourbillons de la grande et de la petite histoire. Les bouleversements formels du genre romanesque au XXe siècle, de Proust à Joyce ou de Céline à Faulkner, n'ont aucunement affecté ces dizaines de milliers de pages rédigées selon la grande tradition du roman russe et français du XIXe siècle. D'où son succès considérable auprès du grand public, qui a cru reconnaître en Troyat un nouveau Balzac. À ceci près que le créateur de la Comédie humaine parlait de ses contemporains, alors que Troyat a traversé tout un siècle pour parler du précédent. Habile dans l'art d'agencer, à travers scènes et dialogues, les effets de réel dans la peinture des personnages et des climats domestiques, il sait user des ressources du roman pour rendre le climat d'une époque. S'il pratique peu l'écriture du moi à proprement parler, Aliocha 1991 ne s'en présente pas moins comme un roman d'apprentissage dans lequel le vieil homme retrace son expérience propre. Ses intrigues comme son style trahissent une forte nostalgie pour un passé englouti, en même temps qu'un imaginaire tourmenté qu'habitent des personnages brutalisés par la vie : Le mort saisit le vif 1942, Le Front dans les nuages 1977, Viou 1980, La Dérision 1983, Marie Karpovna 1984, Le Bruit solitaire du cœur 1985, etc. Cette œuvre permet une réflexion privilégiée sur le divorce entre la littérature légitimée des clercs et la lecture romanesque effective qui est celle, comme on le voit avec Troyat, de dizaines de milliers de personnes. Michel P. Schmitt Henri Troyat quitte la Russie avec sa famille en 1917 après la Révolution d’octobre. Il fait toutes ses études en France, au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Il obtient ensuite une licence en droit. Il devient rédacteur à la préfecture de la Seine en 1935. La même année, son premier roman, Faux jour, reçoit le Prix du roman populiste. En 1938, il obtient le Prix Goncourt pour son roman L'Araigne. En 1940, il commence une grande épopée inspirée de ses souvenirs de Russie, Tant que la Terre durera 7 tomes, suivi d'autres suites romanesque et de nombreux romans. Au cours de sa carrière particulièrement prolifique de romancier et de biographe, il écrit plus de cent ouvrages. Il est élu membre de l'Académie française en 1959, au fauteuil 28, à la place de Claude Farrère. En 1974, il apparaît dans Italiques pour débattre avec Nella Bielski de la rentrée littéraire. Henri Troyat est décédé à Paris dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 mars 2007 à l'âge de 95 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 9 mars à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, avant son inhumation au cimetière du Montparnasse. Son épouse est décédée en 1997. Distinctions Membre de l'Académie française depuis le 21 mai 1959. À la date de sa mort, début mars 2007, il en était le plus ancien membre doyen d'élection. Grand-croix de la Légion d'honneur Commandeur de l’ordre national du Mérite Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres L'Office des timbres de la Principauté de Monaco a honoré Henri Troyat en émettant un timbre-poste à son effigie à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, timbre-poste dessiné par Cyril de La Patellière. Condamnation pour plagiat En 2003, Henri Troyat et les éditions Flammarion ont été condamnés pour plagiat contrefaçon partielle est le terme juridique concernant sa biographie de Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo, publiée en 1997. La cour d'appel de Paris les a condamnés à verser 45 000 euros de dommages-intérêts à Gérard Pouchain et Robert Sabourin, auteurs du livre Juliette Drouet ou la dépaysée éd. Fayard, 1992. Henri Troyat s'est pourvu en cassation, puis s'est désisté. L'Académie française, contrairement à ses statuts, article 13, n'a pas pris de sanction contre son Immortel, âgé de 85 ans au moment du plagiat. Romans Faux Jour 1935, Prix du roman populiste Le Vivier 1935 Grandeur nature 1936 La Clef de voûte 1937 L'Araigne 1938, Prix Goncourt Judith Madrier 1940 Le mort saisit le vif 1942 Du philanthrope à la rouquine 1945 Le Signe du taureau 1945 Suite romanesque : Tant que la terre durera en 7 tomes Tant que la terre durera 3 tomes, 1947 Le Sac et la Cendre 2 tomes, 1948 Étrangers sur la terre 2 tomes, 1950 La Tête sur les épaules 1951 La Neige en deuil 1952 Suite romanesque : Les Semailles et les Moissons Les Semailles et les Moissons tome I, 1953 Amélie tome II, 1955 La Grive tome III, 1956 Tendre et Violtome V, 1958 La Maison des bêtes heureuses 1956 Suite romanesque : La Lumière des Justes Les Compagnons du coquelicot tome I, 1959 La Barynia tome II, 1960 La Gloire des vaincus tome III, 1961 Les Dames de Sibérie tome IV, 1962 Sophie ou la Fin des combats tome V, 1963 Une extrême amitié 1963 Suite romanesque : Les Eygletière Les Eygletière tome I, 1965 La Faim des lionceaux tome II, 1966 La Malandre tome III, 1967 Suite romanesque : Les Héritiers de l'avenir Le Cahier tome I, 1968 Cent un coups de canon tome II, 1969 L'Éléphant blanc tome III, 1970 La Pierre, la Feuille et les Ciseaux 1972 Anne Prédaille 1973 Suite romanesque : Le Moscovite Le Moscovite tome I, 1974 Les Désordres secrets tome II, 1974 Les Feux du matin tome III, 1975 Le Front dans les nuages 1976 Grimbosq 1976 Le Prisonnier n°1 1978 Suite romanesque ou Trilogie Viou : Viou tome I, 1980 À demain, Sylvie tome II, 1986 Le Troisième Bonheur tome III, 1987 Le Pain de l'étranger 1982 La Dérision 1983 Marie Karpovna 1984 Le Bruit solitaire du cœur 1985 Toute ma vie sera mensonge 1988 La Gouvernante française 1989 La Femme de David 1990 Aliocha 1991 Youri 1992 Le Chant des insensés 1993 Le Marchand de masques 1994 Le Défi d'Olga 1995 Votre très humble et très obéissant serviteur 1996 L'Affaire Crémonnière 1997 Le Fils du Satrape 1998 Namouna ou la Chaleur animale 1999 La Ballerine de Saint-Pétersbourg 2000 La Fille de l'écrivain 2001 L'Étage des bouffons 2002 L'Éternel Contretemps 2003 La Fiancée de l'ogre 2004 La Traque 2006 Le Pas du juge 2009 La Folie des anges 2010 La Perruque de Monsieur Regnard 2010 La Voisine de palier 2011 Recueils de nouvelles La Fosse commune 1939 Le Jugement de Dieu 1941 Le Geste d'Ève 1964 Les Ailes du diable 1966 Biographies 1940 : Dostoievski 1946 : Pouchkine 1952 : L'Étrange Destin de Lermontov 1965 : Tolstoi 1971 : Gogol 1977 : Catherine la Grande prix des Ambassadeurs 1978 1979 : Pierre le Grand 1981 : Alexandre ier 1982 : Ivan le Terrible 1984 : Tchekhov 1985 : Tourgueniev 1986 : Gorki 1988 : Flaubert 1989 : Maupassant 1990 : Alexandre II, le tsar libérateur (Alexandre II de Russie) 1991 : Nicolas II 1992 : Zola 1993 : Verlaine 1994 : Baudelaire 1995 : Balzac 1996 : Raspoutine 1997 : Juliette Drouet 1998 : Terribles Tsarines 1998 : Les Turbulences d'une grande famille famille Lebaudy 1999 : Nicolas ier 2001 : Marina Tsvetaeva, l'éternelle insurgée 2002 : Paul ier, le tsar mal aimé 2004 : La Baronne et le musicien, Madame Von Meck et Tchaïkovski 2004 : Alexandre III, le tsar des neiges 2005 : Alexandre Dumas, le cinquième mousquetaire 2006 : Pasternak 2008 : Boris Godounov 2010 : Trois mères, trois fils. Madame Baudelaire, Madame Verlaine, Madame Rimbaud 2012 : Gontcharov Théâtre Les Vivants, comédie en trois actes, mise en scène de Raymond Rouleau, théâtre du Vieux-Colombier, 1946 Sébastien, pièce en trois actes, mise en scène d'Alfred Pasquali, théâtre des Bouffes Parisiens, 1er mars 1949 Essais, voyages, divers Les Ponts de Paris, illustré d'aquarelles 1946 La Case de l'oncle Sam 1948 Sébastien 1949 De gratte-ciel en cocotier 1955 Sainte Russie, réflexions et souvenirs 1956 Le Fauteuil de Claude Farrère, discours à l'Académie française 1959 La Vie quotidienne en Russie au temps du dernier tsar 1959 Naissance d'une dauphine 1960 Un si long chemin 1976       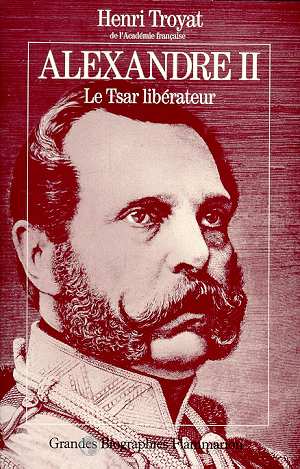     |
Connexion
Sont en ligne
39 Personne(s) en ligne (26 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 39 Plus ... |
| Haut de Page |






