|
|
Arthur Rimbaud 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 Octobre 1854 naît Arthur Rimbaud Poète français ,inclassable issu du Parnasse et du romantisme laisse une oeuvre considérable en vers et en prose.
L'extraordinaire célébrité de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud dit Arthur Rimbaud, l'évidente propagation d'un mythe que sa vie et son œuvre semblent avoir favorisé empêchent souvent d'estimer réellement ce qu'il fut.
Provoquant les admirations les plus sincères et les plus opposées, Claudel et les surréalistes, parfois même l'idolâtrie, il a pu donner lieu également à des jugements suspicieux, parmi lesquels, au premier chef, celui d'Etiemble, observateur scrupuleux du mythe, mais détracteur souvent partial du poète.
Adolescent rebelle, poète précoce et génial, Arthur Rimbaud est un phénomène de la littérature. Son abandon de la poésie à l’âge de vingt et un ans, puis sa disparition aux confins de l’Afrique et de l’Asie, ajoutent à l’attrait du personnage qu’il s’est créé et qui obsède l’époque moderne. Véritable "voyant" – suivant le terme qu’il a choisi – il exprime les vertiges de l’hallucination dans une langue audacieuse et pure, et apparaît comme un jalon essentiel entre romantisme et surréalisme.
Mieux vaut le restituer à son trajet inventif, conclu – on ne le sait que trop – par une distance prise vis-à-vis de la littérature qui d'ailleurs n'empêchera pas Rimbaud de poursuivre l'aventure de la fiction sous la forme de l'aventure géographique, ce qui marque de sa part moins de contradiction qu'on n'a bien voulu le croire.
Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à quinze ans. Lui, pour qui le poète doit être "voyant" et qui proclame qu'il faut "être absolument moderne", renonce subitement à l’écriture à l'âge de vingt ans.
Ses idées marginales, anti-bourgeoises et libertaires le poussent à choisir une vie aventureuse, dont les pérégrinations l’amènent jusqu’au Yémen et en Éthiopie, où il devient négociant, voire explorateur. De cette seconde vie, ses écritures consistent en près de cent quatre-vingts lettres : correspondance familiale et professionnelle et quelques descriptions géographiques.
Bien que brève, la densité de son œuvre poétique fait d'Arthur Rimbaud une des figures considérables de la littérature française.
Jeunesse
Né à Charleville en 1854, Rimbaud, fort tôt, dut constater l'absence de son père, militaire de carrière, qui s'était séparé de sa mère, Vitalie Cuif, une paysanne de Roche, alors qu'il n'avait que six ans.
Le père d'Arthur Rimbaud, Frédéric Rimbaud, est capitaine d'infanterie né à Dole, le 7 octobre 1814. Sa mère, Marie Catherine Vitalie Cuif, paysanne, est née à Roche, le 10 mars 1825. Ils se sont mariés le 8 février 1853 et habitent un appartement au 12 rue Napoléon. Son père militaire est souvent absent, le couple n’est réuni qu’au gré de rares permissions, le temps d’avoir cinq enfants : Jean Nicolas Frédéric, le 2 novembre 1853, Jean Nicolas Arthur, le 20 octobre 1854, Victorine Pauline Vitalie, le 4 juin 1857, celle-ci mourra le mois suivant, Jeanne Rosalie Vitalie, le 15 juin 1858 et Frédérique Marie Isabelle, le 1er juin 1860.
Après la naissance de cette dernière, le couple vivra séparé, car, désormais, le capitaine Rimbaud ne reviendra plus à Charleville.
Se déclarant veuve, la mère déménage avec ses enfants en 1861 pour habiter au 73 rue Bourbon, dans un quartier ouvrier de Charleville. En octobre, le jeune Arthur entame sa scolarité à l'institution Rossat où il récolte les premiers prix.
L'étroit milieu carolomacérien, où Mme Rimbaud fait figure de personnalité revêche et rigoriste, où l'enseignement du collège est dispensé par un personnel mêlé de laïcs et de prêtres, constitue le monde où il doit vivre.
Fin 1862, la famille déménage à nouveau pour un quartier bourgeois au 13 cours d’Orléans.
En 1865, Arthur entre au collège municipal de Charleville, où il se montre excellent élève ; collectionnant les prix d'excellence en littérature, version, thème… Il rédige en latin avec aisance, des poèmes, des élégies, des dialogues. Mais, comme cet extrait de son poème Les Poètes de sept ans5 le laisse imaginer, il bout intérieurement :
Tout le jour il suait d'obéissance ; très Intelligent ; pourtant des tics noirs, quelques traits, Semblaient prouver en lui d'âpres hypocrisies.
"Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies,
En passant il tirait la langue, les deux poings
À l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points."
En juillet 1869, il participe aux épreuves du Concours académique de composition latine sur le thème "Jugurtha", qu'il remporte facilement. Le principal du collège Jules Desdouets aurait dit de lui :
"Rien d'ordinaire ne germe dans cette tête, ce sera "le génie du Mal ou celui du Bien.". En obtenant tous les prix dès l’âge de quinze ans, il s'affranchit des humiliations de la petite enfance.
Pendant ces années il a comme ami Ernest Delahaye, avec qui il échange de nombreuses lettres.
La poésie
Enfant précoce, halluciné et d’une extrême sensibilité, il découvre alors le superbe antidote de la poésie par le biais d'exercices scolaires tout d'abord, notamment de compositions en vers latins où il excelle par son savoir et son invention : ce seront ses premiers textes publiés, dans le Bulletin de l'académie de Douai. Les recueils poétiques qu'on lui prête ou qu'il vole, les récents fascicules du Parnasse contemporain lui révèlent bientôt un autre univers.
Théodore de Banville, Gautier, Leconte de Lisle, autant de modèles qu'il admire et saura démarquer avec toute la vivacité de son génie, cependant que Hugo reste encore pour lui un inévitable sommet, dont il rejette l'emphase, mais retient la fantasia verbale.
Déjà, parmi toutes ces voix, il entend celle qui, irrésistiblement, l'appelle : l'étrangeté maléfique de Baudelaire. En 1870, l'heure est venue pour lui d'entrer plus avant en poésie, d'autant qu'un jeune professeur de vingt et un ans, Georges Izambard, assure maintenant les cours de littérature en classe de rhétorique. Confident et lecteur, Izambard donne son avis, encourage, éveille cet esprit hors du commun. Rimbaud, qui n'a pas seize ans, n'hésite pas à s'adresser au plus illustre Parnassien, Banville, auquel il envoie en mai une longue lettre et trois poèmes : Ophélie, un tableau de genre ; Sensation, deux quatrains où s'annonce son sens du vagabondage ; Credo in unam surtout, une sorte de grand manifeste en faveur du paganisme et de la traditionnelle beauté antique.
Si l'envoi ne lui vaut pas encore de figurer dans une des livraisons du Parnasse, il n'en persiste pas moins à écrire, cherchant sa voie, mais se sentant déjà soulevé par une révolte de vie. De cœur, Rimbaud appartient aux antibonapartistes. Il lit La Lanterne de Rochefort, rime avec acrimonie son Forgeron tout à la gloire de la crapule .
Cependant montent en lui, en même temps que cette révolte, les désirs sensuels ; des pièces charmantes le montrent amoureux d'espiègles fillettes. Mais dans ce lot brille déjà la très offensive Vénus anadyomène qui ne sort plus de la mer comme celle de Bouguereau, mais d'une baignoire, "Belle hideusement d'un ulcère à l'anus".
Le sarcasme fait tout naturellement partie de son langage, et il commence à camper toute une série de grotesques – bourgeois de "À la Musique, ecclésiastiques d'Un cœur sous une soutane".
Portée par les événements, sa colère trouve un aliment tout frais dans la politique du second Empire. La guerre franco-prussienne éclate en juillet 1870.
Un instant, il imagine Le Dormeur du Val, un jeune soldat mort.
Il profite du désastre de Sedan pour s'enfuir à Paris. Arrêté, libéré grâce à l'intervention d'Izambard, il se réfugie à Douai chez celui-ci ; il en profite pour mettre au point son premier recueil, qu'il confectionne à l'intention de Paul Demeny, familier d'un éditeur parisien tenant la Librairie artistique. Après un prompt retour à Charleville, une autre fugue en octobre inaugure sa profonde bohémiennerie.
Poésie et voyance
Les mois suivants sont voués au désœuvrement. Les courses à travers bois et campagne remplacent des études dont il voit mal la nécessité. Cet état de vacances favorise sa création qui tend à une frénésie sombre.
Sous ses yeux, le milieu social se réduit à des caricatures : Les Douaniers, Les Assis. Le bon élève tend au voyou.
En février 1871, il n'y tient plus et fugue de nouveau à Paris où il vit au petit bonheur une dizaine de jours. Son retour à Charleville le replonge dans sa "cité supérieurement idiote" ; mais il apprend bientôt la proclamation de la Commune.
Sa poésie en ressent une accélération offensive.
On ne comprendrait pas, sinon, les lettres dites "du voyant" qu'il envoie, l'une le 13 mai, à Izambard, l'autre, le 15 mai, à Demeny. Elles ne peuvent se concevoir, en effet, sans l'urgence ressentie d'un changement, d'une révolution en accord avec celle des "travailleurs" et qui, cette fois, concernerait le langage lui-même, chargé d'accéder à l'inconnu.
Ainsi se trouve amplifiée la figure du voyant, déjà connue avant lui, Balzac, Gautier, Hugo, Leconte de Lisle, mais à laquelle on n'avait pas encore accordé une place aussi déterminante. Plus ingénieuse, plus originale paraît la méthode qu'il préconise pour atteindre cet état :
"le long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens".
Une modification consciente des circuits émotifs, un désenclavement des façons d'être et de sentir.
Les lettres du voyant ne seront pas connues de leur temps ; elles n'auront donc aucune influence, même sur la génération symboliste ; mais leur publication tardive (1912-1928) touchera les dadaïstes, les surréalistes, les collaborateurs de la revue Le Grand Jeu.
La notion d'une poésie-vie ou action à côté d'une poésie-écriture en naîtra, fertile en malentendus, mais appliquée à faire de celui qui écrit un "esprit et un corps" » motivant le poème.
De ces lettres, on retiendra encore la fameuse formule du "Je est un autre", et les poésies qui les illustrent : Le Cœur supplicié, Chant de guerre parisien, Mes Petites Amoureuses, Accroupissements. De tels poèmes s'expliquent surtout par la volonté négative de leur auteur, tentant sciemment, par la voie noire, de trouver l'inconnu poétique, tout en "encrapulant" la langue et le sujet traité.
Que Rimbaud ait participé à la Commune ou non, le problème reste entier, il devra bien faire son deuil de celle-ci après la Semaine sanglante.
Seul, compris de lui-même, inspiré et furieux, il compose alors d'étonnantes vues psychologiques : Les Poètes de sept ans, où il s'observe dans son propre rôle, à la naissance même de son écriture, et Les Premières Communions, une exceptionnelle mise en scène de la puberté féminine soumise à la tyrannique pudeur du christianisme. Une nouvelle fois, il s'adresse à Banville et signe du narquois pseudonyme d'Alcide Bava un véritable art poétique carnavalesque : Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs.
Vers 1970, Izambard, qui a prévenu Vitalie Rimbaud de la présence de son fils à Douai, en reçoit la réponse : "…chassez-le, qu’il revienne vite!".
Pour calmer les esprits, il décide de raccompagner son élève jusqu'à Charleville.
À leur arrivée, l’accueil est rude : une volée de gifles pour le fils, une volée de reproches, en guise de remerciements, pour le professeur qui, ébahi, "s’enfuit sous l’averse".
Le 6 octobre, nouvelle fugue. Paris étant en état de siège, il part à Charleroi — il relate cette arrivée dans le sonnet, Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir. Rêvant d’être journaliste, il tente, sans succès, de se faire engager comme rédacteur dans le Journal de Charleroi.
Dans l’espoir de retrouver Izambard, il se rend à Bruxelles puis à Douai où son professeur arrive quelques jours après, aux ordres de Vitalie Rimbaud, pour le faire revenir escorté de gendarmes. Ce fut fait le 1er novembre 1870.
Entre-temps, il s'était rendu chez Paul Demeny pour lui déposer les sept poèmes composés au cours de ce dernier périple (des versions antérieures seront remises au parnassien, Théodore de Banville et à Izambard).
Le 10 juin 1871, Rimbaud écrira à Demeny : "… brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai".
Ceux-ci seront répertoriés par les biographes sous l’appellation de Recueil de Douai ou "Recueil Demeny".
Rimbaud parviendra toutefois à publier dans Le Progrès des Ardennes du 25 novembre 1870, un récit satirique, Le Rêve de Bismarck, sous le pseudonyme de Jean Baudry. Rimbaud y développe, après Victor Hugo, la symbolique d'une ville de Paris qui est la lumière de la Révolution et qui sera autrement difficile à combattre pour les Prussiens. Rimbaud prédit que Bismarck s'y brûlera le nez.
Paris sous la Commune
La réouverture du collège est retardée d'octobre 1870 à avril 1871.
En février 1871, à l'issue du siège de Paris, Rimbaud fait une nouvelle fugue vers la capitale. La situation politique du pays est tendue et Rimbaud cherche à entrer en contact avec de futurs communards comme Jules Vallès et Eugène Vermersch, mais aussi avec le milieu des poètes ; il rencontre aussi le caricaturiste André Gill.
Rimbaud revient à Charleville avant le début de la Commune. Plusieurs témoignages prétendent qu'il est retourné à Paris à ce moment-là, bien que ceci reste impossible à démontrer dans l'état actuel des recherches. Quoi qu'il en soit, le poète a ressenti très profondément la tragédie de la Commune.
Dans un poème violent, L'orgie parisienne ou : Paris se repeuple, il dénonce la lâcheté des vainqueurs.
Sa poésie se radicalise encore, devient de plus en plus sarcastique : Les Pauvres à l’Église, par exemple. L'écriture se transforme progressivement. Rimbaud en vient à critiquer fortement la poésie des romantiques et des Parnassiens, et dans sa lettre à Izambard du 13 mai 1871, il affirme son rejet de la poésie subjective.
C'est également dans la lettre dite du Voyant, adressée le 15 mai à Paul Demeny, qu'il exprime sa différence en exposant sa propre quête de la poésie : il veut se faire voyant, par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.
Selon Paul Verlaine, Rimbaud a composé son plus beau poème en vers suite à la semaine sanglante : "Les Veilleurs" ; son sujet était la douleur sacrée causée par la chute de la Commune.
Des lettres, des poèmes convainquent l'auteur déjà réputé des Fêtes galantes du génie de ce jeune homme dont il aime à distance l'âpre "lycanthropie".
Il lui dit de venir à Paris. Moment crucial dans l'existence de Rimbaud. Pour mieux assurer son élan, celui-ci compose Le Bateau ivre où il multiplie surprises et virtuosités.
Vilains Bonshommes
En automne et au début de l'hiver de 1871, Rimbaud fait partie d'un petit cercle fondé par Charles Cros, les Zutistes ; à maintes reprises, il collabore à leur Album, le couvrant de "Vieux Coppées" pornographiques et d'un long poème de la plus stupéfiante venue, Les Remembrances du vieillard idiot, pitié du sexe voué à ses obsessions les plus noires. De la même période daterait le Sonnet des voyelles, projections d'images et d'analogies, alpha et oméga du monde.
Il est difficile de situer le début de la relation épistolaire avec Verlaine. Celui-ci prétend avoir reçu très peu de courriers et ne parle que de l'envoi des Premières communions et des Effarés.
Charles Bretagne met Rimbaud en contact avec son ami Paul Verlaine et un courrier a dû sceller le prochain départ de Rimbaud pour Paris vers le mois d'août.
En août 1871, dans son poème parodique, Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, Rimbaud exprime une critique ouverte de la poétique de Banville. Finalement Verlaine l'appelle à Paris : "Venez chère grande âme, on vous appelle, on vous attend !"
Bien que brillant élève, Arthur Rimbaud ne retournera pas au collège.
Il arrive dans la capitale vers le 15 septembre 1871. Il est présenté et très bien accueilli par ses pairs plus âgés, au dîner des Vilains Bonshommes le 30 septembre. Il y rencontre une part essentielle des grands poètes de son temps. Il est successivement logé par Verlaine, rue Nicolet, non sans heurts avec la femme de ce dernier, puis chez Charles Cros, André Gill, Ernest Cabaner et même quelques jours chez Théodore de Banville.
Le 20 octobre de cette année, Rimbaud a tout juste dix-sept ans. Il a atteint sa maturité poétique comme en témoignent plusieurs chefs-d'œuvre comme Les Premières communions et Le Bateau ivre.
En mars 1872, les provocations de Rimbaud excèdent le milieu parisien depuis quelque temps. L'incident Carjat au dîner des Vilains Bonshommes du 2 mars 1872 fut la goutte qui fait déborder le vase. Rimbaud complètement saoul y a blessé le célèbre photographe d'un coup de canne-épée. Pour sauver son couple et rassurer ses amis, Verlaine se condamne à éloigner Rimbaud de Paris.
Rimbaud se fait oublier quelque temps en retournant à Charleville, puis revient dans la capitale dans le courant du premier semestre 1872 pour de nouveau quitter Paris le 7 juillet, cette fois en compagnie de Verlaine. Commence alors avec son aîné une liaison amoureuse et une vie agitée à Londres, puis à Bruxelles.
Depuis son arrivée à Paris, Rimbaud semble avoir obtenu l'adhésion d'un aréopage qui lui était tout acquis, à vrai dire, celui des Vilains Bonshommes, société quasi bachique des meilleurs poètes du temps que Mallarmé ne dédaignait pas d'honorer de sa présence.
Mais les scandales n'en finiront pas de naître sur les pas du nouveau messie qui prend un malin plaisir à déstabiliser le ménage de Verlaine et de Mathilde récemment mariés. Le tort ne lui revenait pas uniquement, et il est fort vraisemblable que Verlaine, faune libertin, le convertit à l'homosexualité.
En 1872, Verlaine souhaitant "retaper" son couple, Rimbaud doit regagner sa province.
Bardé de rancœurs, le voici à revenu à l'ancre à Charleville. La recherche du naïf semble caractériser les poésies qu'il écrit alors.
Certes, on n'a que des présomptions touchant ces textes qui, grosso modo, correspondraient à ceux que, par la suite, on publiera sous le titre de "Vers nouveaux et chansons" ou "Derniers Vers".
Une étrangeté tissue de solitude s'en dégage. Citons Larme, La Rivière de Cassis, Comédie de la soif, Éternité. Rimbaud, libéré des influences parnassiennes, avance dans un domaine vierge où murmure la voix de son altérité.
De retour à Paris dès le mois de mai 1872, il tente une ultime fois d'entraîner Verlaine à sa suite pour trouver "le lieu et la formule". Il y réussit.
En juillet, les deux hommes franchissent la frontière. La Belgique, pour eux, devient terre de poésie, en attendant mieux.
Quelques poèmes en naissent, libres, détachés. Mais le goût de l'errance les pousse plus loin. Ils s'installent à Londres, où ils vont surtout fréquenter les communards exilés. Le couple semble traverser maintes crises. Une première fois, Rimbaud revient en France à la fin de l'année 1872, laissant Verlaine.
Mais il le rejoindra en janvier. On ignore, à vrai dire, ses moindres occupations. C'est en avril-mai 1873, en fait, alors qu'il est revenu momentanément à Roche, la ferme maternelle, et que Verlaine, de son côté, habite Jehonville dans le Luxembourg belge, qu'il semble avoir la première idée de ce qui deviendra Une saison en enfer. Mais l'enfer n'avait pas été tout à fait vécu.
À la fin de mai 1873, les deux amis, réconciliés, regagnent Londres, pour peu de temps du reste, car une nouvelle brouille les sépare. Verlaine s'en va à Bruxelles. Rimbaud, seul, inquiet, décide de le rejoindre. L'histoire finira mal : coup de revolver contre Rimbaud, le 13 juillet, arrestation, puis condamnation de Verlaine et incarcération. Cependant, Rimbaud, remis de sa blessure, retourne à Roche où il achève Une saison en enfer, son "carnet de damné " qui, publié chez Poot et Cie, Alliance typographique – une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages judiciaires –, paraît, grâce aux deniers avancés par Mme Rimbaud en octobre 1873, à Bruxelles, dans la plus grande clandestinité.
Seuls cinq ou six amis recevront cet opuscule, la quasi-totalité du tirage restant chez l'éditeur où on la retrouvera en 1901. En octobre 1873, la vie littéraire de Rimbaud est apparemment finie. Pourtant, rencontrant à Paris un jeune poète : Germain Nouveau, il convainc celui-là de le suivre.
Un séjour en Angleterre n'apportera rien aux deux compagnons ; G.Nouveau part au bout de deux mois.
On sait toutefois que quelques-unes des Illuminations furent alors recopiées – ce qui montre l'intérêt que Rimbaud continuait d'accorder à la littérature, même après l'"Adieu" formulé par Une saison en enfer.
Une aventure vraie ?
La suite de la vie de l'ancien "voyant" ne laisse plus de place aux effets de l'art – qu'il semble avoir définitivement abandonnés.
Il veut être précepteur, ingénieur ; le commerce et les sciences l'attirent, comme si la modernité se confondait avec ces activités.
En mars 1875, à Stuttgart où il étudie la langue allemande, il revoit pour la dernière fois Verlaine venu là tout exprès.
C'est au cours de ces retrouvailles qu'auraient été communiqués certains feuillets des Illuminations, à charge pour le "pauvre Lélian" soit Verlaine de les transmettre à G.Nouveau qui les aurait fait imprimer ! Nous devons nous contenter de ces vagues informations.
La même année, vagabondant en Italie avec l'intention d'aller jusqu'à Brindisi et de s'embarquer pour la Grèce, Rimbaud, éprouve encore le besoin de demander à son ami Ernest Delahaye "Une saison en enfer".
Dans quel dessein ? On l'ignore. Les années ultérieures seront marquées par de perpétuels déplacements – Vienne, Java, Stockholm, Chypre... – qu'il serait vain de rappeler si l'on ne devait penser qu'ils forment un véritable supplément à son odyssée spirituelle. On s'expliquerait mal sinon ce constant désir d'aller plus loin, comme si l'horizon géographique sans cesse repoussé devait livrer un secret, résoudre l'énigme de sa vie.
Rimbaud voyageur
Fin mars 1875, il quitte Stuttgart avec, maintenant, l’envie d’apprendre l’italien.
Pour ce faire, il traverse la Suisse en train et, par manque d’argent, franchit le Saint-Gothard à pied.
À Milan, une veuve charitable lui offre opportunément l'hospitalité. Il y reste une trentaine de jours puis reprend la route. Victime d’une insolation sur le chemin de Sienne, il est soigné dans un hôpital de Livourne puis est rapatrié le 15 juin, à bord du vapeur Général Paoli. Débarqué à Marseille, il est à nouveau hospitalisé quelque temps.
Après ces aventures "épastrouillantes" dixit Ernest Delahaye, il annonce à ce dernier son intention d’aller s’engager dans les carlistes, histoire d’aller apprendre l’español, mais ne la concrétisera pas.
Redoutant les remontrances de "la Mother", il traîne des pieds en vivant d’expédients dans la cité phocéenne.
Il fera son retour à Charleville mi-août où, entre-temps, sa famille a changé de logement.
Cette année-là, à l’instar de son ami Delahaye, Rimbaud envisage de passer son baccalauréat ès science avec l’objectif de faire Polytechnique, ce qu’il ne peut réaliser, car vingt ans est l’âge limite pour y accéder et, en cet automne 1875, il en a vingt et un.
Nouvelle foucade : il suit des cours de solfège et de piano et obtient le consentement de la mère pour installer l’instrument au logis.
À ce moment, Verlaine, qui reçoit des nouvelles de Rimbaud par l’échange d’une correspondance assidue avec Delahaye, est en demande d’anciens vers d’Arthur.
"Des vers de Lui ? Il y a beau temps que sa verve est à plat. Je crois même qu’il ne se souvient plus du tout d’en avoir fait"
Le 18 décembre 1875, sa sœur Jeanne Rosalie Vitalie meurt à dix-sept ans et demi d’une synovite tuberculeuse.
Le jour des obsèques, les assistants regardent avec étonnement le crâne rasé du fils cadet.
Vers l’Orient
Rimbaud aventurier
À partir de 1880, Rimbaud rayonne dans le même espace – fort vaste il est vrai : Aden, les ports de la mer Rouge, Harar, l'Abyssinie.
Mais d'autres noms brillent à sa pensée : Zanzibar, le canal de Panamá et même le Japon. Il va bientôt gagner la ville de Harar, dans la corne orientale de l'Afrique qui semble au fil des années lui avoir offert le hâvre le plus supportable.
Agent d'un comptoir, il mène une vie presque ascétique. Ses lettres trahissent le sentiment d'une fatalité, d'un destin négatif qu'il doit suivre jusqu'au bout, coûte que coûte, subissant la loi du travail, attaché à l'or et misérablement ébloui par la perspective d'un lointain repos qu'il sait trop bien se confondre avec la mort. Parfois, ce Rimbaud perdu prend les dimensions d'un véritable aventurier, reconnaissant de nouveaux territoires l'Ogadine ou, plus tard, la route d'Ankober à Harar, ou bien se lançant dans des expéditions au long cours comme celle qu'il tente en 1886 pour, depuis Tadjourah, livrer à Ménélik, roi du Choa, plusieurs milliers de vieux fusils.
Salatiga
Après avoir mûri quelques solutions pour découvrir d’autres pays à moindres frais, il reprend la route en mars 1876, pour se rendre en Autriche. Le périple envisagé tourne court : à Vienne, dépouillé par un cocher puis arrêté pour vagabondage, il est expulsé du pays et se voit contraint de regagner Charleville.
Aux environs de mai, il repart. Cette fois, en direction de Bruxelles. S’est-il fait racoler par les services d’une armée étrangère ? Toujours est-il qu’il se présente, au bureau de recrutement de l’armée coloniale néerlandaise, pour servir dans les colonies indiennes.
Muni d’un billet de train, il aboutit – après un contrôle à la garnison de Rotterdam – dans la caserne d’Harderwijk, le 18 mai, où il signe un engagement pour six ans.
Le 10 juin, Rimbaud et les autres mercenaires, équipés, formés, riches de leur prime, 300 florins au départ du bateau, trois cents florins à l'arrivée à destination et chargés de réprimer une révolte dans l’île de Sumatra, sont transportés à Den Helder, pour embarquer à bord du Prins van Oranje, direction Java, dans ce qui était alors les Indes néerlandaises, et aujourd'hui l'Indonésie.
Après une première escale à Southampton et le contournement de Gibraltar, le voyage connaît quelques désertions lors d’escales ou passages près des côtes : Naples, Port-Saïd, traversée du canal de Suez, Suez, Aden et Padang. Le 23 juillet, le vapeur accoste à Batavia, aujourd'hui Jakarta.
Une semaine après, les engagés reprennent la mer jusqu’à Semarang dans le centre de Java pour être acheminés en train puis à pied jusqu’à la caserne de Salatiga.
En possession de la seconde partie de sa prime, goûtant peu la discipline militaire, Rimbaud déserte.
Quelques semaines lui sont nécessaires pour se cacher et retourner à Semarang où il se fait enrôler sur le Wandering Chief, un voilier écossais qui appareille le 30 août pour Queenstown, en Irlande.
Au bout d’un mois de mer, le navire essuie une tempête en passant le cap de Bonne-Espérance. La mâture détériorée, il continue néanmoins sa route sur Sainte-Hélène, l’île de l’Ascension, les Açores… Arrivé à bon port le 6 décembre, "Rimbald le marin", comme le surnommera Germain Nouveau, quand il le rencontrera à Paris, poursuit par les étapes suivantes : Cork, Liverpool, Le Havre, Paris et toujours pour finir... à Charlestown.
L’Homme aux semelles de vent
La belle saison revenue, Arthur Rimbaud quitte à nouveau Charleville en 1877.
Son entourage et ses amis peinent à suivre son itinéraire durant cette année. Les seules sources de renseignements, souvent contradictoires, viennent de son ami Ernest Delahaye et de sa sœur Isabelle.
Seule certitude : sa présence à Brême où il a rédigé une lettre en anglais le 14 mai, au consul des États-Unis d’Amérique. Lettre signée John Arthur Rimbaud, et dans laquelle il demande à quelles conditions il pourrait conclure un engagement immédiat dans la Marine américaine, en faisant valoir sa connaissance des langues anglaise, allemande, italienne et espagnole.
Il ne reçut apparemment pas de réponse favorable, car, selon Delahaye, il se serait rendu à Cologne puis à Hambourg, pour divers projets inaboutis.
Le 16 juin, ce dernier écrit à Verlaine : Du voyageur toqué pas de nouvelles. Sans doute envolé bien loin, bien loin… Le 9 août, le même épistolier informe son ami Ernest Millot qu’il a été signalé dernièrement à Stockholm, puis à Copenhague, et pas de nouvelles depuis.
Dix-neuf ans plus tard, Delahaye rapportera dans une lettre à Paterne Berrichon, du 21 août 1896, qu’à Hambourg,
"Arthur s’engagea dans la troupe du cirque Loisset, comme interprète, il passa ainsi à Copenhague, puis à Stockholm d’où rapatrié par consul français."
Pour sa part, Isabelle Rimbaud, réfutera l’épisode du cirque, mais citera un emploi dans une scierie en Suède dans une lettre du 30 décembre 189632 à Paterne Berrichon, qu'elle épousera ensuite. Isabelle révélera également que son frère « visita les côtes du Danemark, de la Suède et de la Norvège, puis revint par mer jusqu’à Bordeaux, sans passer le moins du monde par Hambourg33 ».
Après une halte à Charleville, Rimbaud se rend à Marseille en septembre où il embarque pour Alexandrie en Égypte. Pris de douleurs gastriques, peu après le début de la traversée, il est débarqué à Civita-Vecchia, en Italie. Retour à Marseille et direction les Ardennes pour y passer l’hiver.
Vers cette période, Vitalie Rimbaud habite à Saint-Laurent, dans une propriété héritée de sa famille, les Cuif.
Si l’on fait abstraction d’hypothétiques témoignages, voyage à Hambourg et périple en Suisse pour Berrichon, vu dans le quartier latin, vers Pâques par un ami d’Ernest Delahaye, Les neuf premiers mois de l’année 1878 ne sont pas plus riches de renseignements fiables que ceux de l’année précédente.
En avril, les fermiers de Roche ne désirant pas renouveler leur bail, Vitalie Rimbaud s’installe définitivement dans la ferme pour la diriger.
Fin juillet, Ernest Delahaye écrit : L'homme aux semelles de vent est décidément lavé. Rien de rien.
Pourtant, Arthur revient et participe aux moissons auprès de son frère Frédéric, de retour de ses cinq années d’armée.
Le 20 octobre, jour de ses vingt-quatre ans, Rimbaud reprend la route ; passe les Vosges, franchit le Saint-Gothard sous la neige, traverse l’Italie jusqu’à Gênes.
Le dimanche 17 novembre, dans un dernier élan littéraire, il décrit les péripéties de son périple dans une longue lettre à sa famille. Le même jour, son père meurt à Dijon.
Le 19 novembre, Rimbaud s'embarque pour Alexandrie. Arrivé vers le 30 novembre, il se met à chercher du travail. Un ingénieur français, lui propose de l'employer sur un chantier situé sur l’île anglaise de Chypre. Pour conclure l'affaire, il demande un indispensable certificat de travail à sa mère, lettre écrite d’Alexandrie, en décembre 1878.
Le 16 décembre, le voilà chef de chantier à 30 kilomètres à l’est du port de Larnaca, dans l'entreprise Ernest Jean & Thial fils. Chargé de diriger l’exploitation d’une carrière de pierres, il tient les comptes et s’occupe de la paie des ouvriers, lettre à sa famille du 15 février 1879.
En 1879, atteint de fièvres paludisme ?, il quitte Chypre muni d’une attestation de travail, datée du 28 mai37. En convalescence à Roche, il se rétablit suffisamment pour apporter son aide aux moissons d’été.
Après une ultime visite de son ami Delahaye en septembre, Arthur n’attend pas la saison froide et part avec l’intention de retourner à Alexandrie.
Repris par un accès de fortes fièvres à Marseille, il se résout à passer l’hiver dans sa famille – hiver qui se révélera particulièrement rigoureux.
Sa santé recouvrée en mars 1880, le voilà de nouveau à Alexandrie.
Ne trouvant pas d’emploi, il débarque à Chypre. Ses anciens employeurs ayant fait faillite, il réussit à décrocher un travail de surveillant dans un chantier de construction. "Il s'agit de la future résidence d'été du gouverneur anglais, que l'on bâtit au sommet des monts Troodos", lettre aux siens, du 23 mai 1880.
À la fin du mois de juin, Arthur Rimbaud quitte l’île "après des disputes … avec le payeur général et son ingénieur," lettre aux siens du 17 août 1880. Rendu dans le port d'Alexandrie, Rimbaud n'envisage plus de retour en France.
Corne d' Afrique et Arabie
Après avoir navigué le long du canal de Suez jusqu’en mer Rouge, en cherchant du travail dans différents ports : Djeddah, Souakim, Massaouah, lettre à sa famille du 17 août 1880… À Hodeidah, au Yémen, où il tombe à nouveau malade, il rencontre Trébuchet, un représentant d’une agence marseillaise importatrice de café.
Constatant qu’il connaît suffisamment la langue arabe, ce dernier lui conseille de se rendre à Aden en le recommandant à P. Dubar, un agent de la maison Mazeran, Viannay, Bardey et Cie.
L’exportation de café connaissait un commerce florissant grâce à quoi le port de transit de Moka avait connu son heure de gloire avant qu’il fut supplanté par Hodeidah.
Après avoir débarqué à Steamer Point, le port franc anglais d’Aden, Arthur Rimbaud entre en contact avec Dubar, adjoint d’Alfred Bardey, parti explorer le continent africain pour implanter une succursale.
Après quelques jours d’essai, Rimbaud est embauché le 15 août 1880 comme surveillant du tri de café.
" Aden est un roc affreux, sans un seul brin d’herbe ni une goutte d’eau bonne : on boit de l’eau distillée. La chaleur y est excessive.", Lettre à sa famille du 25 août 1880.
Ayant le sentiment de se faire exploiter, Rimbaud compte partir à Zanzibar ou sur les côtes d’Abyssinie après avoir gagné suffisamment d’argent, lettre à sa famille du 22 septembre 1880. Revenu en octobre, Bardey lui propose de seconder Pinchard, l’agent du comptoir qu’il vient d’établir au Harar, une région d’Éthiopie colonisée par les Égyptiens. Un contrat de trois ans est signé le 10 novembre.
Accompagné du Grec Constantin Rhigas, un employé de Bardey, la traversée du golfe d’Aden se fait les jours suivants.
Premier séjour au Harar
En terres africaines, Rimbaud et son acolyte forment une caravane pour transporter des marchandises pour le Harar. Ils doivent parcourir trois cent cinquante kilomètres : traverser le territoire des Issas — réputés belliqueux — puis entrer dans celui des Gallas où les attaques ne seront plus à craindre.
Les portes de la cité fortifiée de Harar sont franchies en décembre
" après vingt jours de cheval à travers le désert somalien", lettre à sa famille du 13 décembre 1880, ils sont accueillis dans l’agence Bardey par l’agent Pinchard et un autre employé grec, Constantin Sotiro.
La tenue des comptes et la paie des démarcheurs lui sont imparties. Le 15 février 1881 il relate aux siens en quoi consiste le commerce :
"des peaux …, du café, de l’ivoire, de l’or, des parfums, encens, musc, etc" ,
leur fait part de ses déceptions : " je n’ai pas trouvé ce que je présumais …Je compte trouver mieux un peu plus loin ". Se plaint aussi d’une maladie qu’il aurait " pincée".
En mars, Pinchard, atteint de paludisme, s’en va. Rimbaud assure l’intérim du comptoir jusqu’à l’arrivée d’Alfred Bardey. Bardey arrive avec l’idée d’ouvrir un magasin de produits manufacturés. Ainsi, les indigènes venant vendre leur récolte de café dépensent leur argent en achetant toutes sortes d’ustensiles.
Arthur Rimbaud ayant toujours des velléités de fuites, Zanzibar, Panamá, son patron l’envoie faire des expéditions commerciales à partir du mois de mai.
Ces campagnes, dans des régions jamais explorées par les Européens, pour des trocs de cotonnades et bibelots contre peaux ou autres s’avèrent risquées et peu rentables.
Revenu épuisé à chaque fois, Rimbaud est à nouveau frappé de fièvre tout l’été.
Le 22 septembre, déçu de n’avoir pas été promu directeur de l’agence, il annonce à sa famille qu’il a donné sa démission, il y a une vingtaine de jours.
Cependant, son contrat s’achève dans deux ans…
Suite aux missives qu’il reçoit de Roche, concernant sa période militaire qui n’est pas réglée et, pour pallier d’éventuelles difficultés qu’il rencontrerait pour se rendre dans d’autres pays, il fait valoir sa situation auprès du consul de France à Aden.
De son côté, Alfred Bardey part pour le siège lyonnais de la société aux environs du début octobre. Le frère de celui-ci devant venir le remplacer, Rimbaud gère à nouveau le comptoir en l’attendant.
Pierre Bardey arrivé, Rimbaud quitte Harar en décembre.
Après le retour d’Arthur Rimbaud à la factorerie d’Aden, c’est au tour d’Alfred Bardey de revenir en février 1882 suite au départ de P. Dubar pour la France (Lyon). Rimbaud en vient donc à seconder son patron durant toute l'année.
En septembre il commande tout le matériel nécessaire pour faire des photographies, car il compte partir pour le Choa, en Abyssinie afin de réaliser un ouvrage sur cette contrée inconnue avec cartes, gravures et photographies et le soumettre à la Société de géographie de Paris dont Alfred Bardey est membre. Ce projet ne verra pas le jour, car, à défaut de Choa, un retour au Harar est prévu pour janvier 1883 ; il l’annonce à sa famille le 3 novembre.
Le début de l’année 1883 est marqué par une rixe entre Rimbaud et un magasinier indigène qui lui manque de respect. Ce dernier porte alors plainte pour coups et blessures.
Rimbaud évite la condamnation grâce à l’intervention du vice-consul, à qui il avait aussitôt écrit pour résumer les faits et solliciter sa protection : lettre à Monsieur de Gaspary, vice-consul de France à Aden, du 28 janvier 1883.
De plus, son patron se porte garant de son comportement à venir.
Son contrat — finissant en novembre — est renouvelé jusqu’à fin décembre 1885 et son prochain départ pour Zeilah est fixé pour le 22 mars, lettre à sa famille du 20 mars 1883.
Deuxième séjour au Harar
Arrivé à Harar en avril, Rimbaud remplace Pierre Bardey, destiné à succéder à son frère à Aden.
Dans une lettre écrite le 6 mai à sa famille, il formule quelques réflexions sur sa vie actuelle, son avenir. Il songe à se marier, à avoir un fils. Il joint aussi ses premiers travaux photographiques : trois portraits en pied de lui-même.
Secondé par Constantin Sotiro, Rimbaud prend l’initiative de l’envoyer explorer l’Ogadine dont il transcrira les notes à son retour en août pour en rédiger un texte descriptif que Bardey expédiera à la Société de géographie de Paris.
Intitulé Rapport sur l’Ogadine, par M. Arthur Rimbaud, agent de MM. Mazeran, Viannay et Bardey, à Harar, Afrique orientale, ce mémoire, dans lequel les mérites de Sotiro sont quelque peu occultés, sera publié par la Société de géographie en février 1884 et sera apprécié par les géographes français et étrangers.
À Paris, Verlaine publie une étude accompagnée de poèmes sur le poète Rimbaud, dans la revue Lutèce du 5 octobre au 17 novembre. Cette étude paraîtra l’année suivante dans l’ouvrage Les Poètes maudits.
Au Harar, plusieurs caravanes de marchandises sont organisées jusqu’au moment où les répercussions de la guerre des Mahdistes, contre les occupants Égyptiens et les Anglais obligent la société à abandonner le comptoir de Harar.
L’évacuation de la cité est organisée par le gouverneur d’Aden, le major Frederick Mercer Hunter, arrivé en mars, à la tête d’une colonne d’une quinzaine de soldats. L’officier britannique, insatisfait de l’hébergement offert par le pacha d’Égypte, provoque un scandale en préférant loger dans la maison de Rimbaud.
Le retour pour Aden se fait en compagnie de Djami Wadaï, son jeune domestique abyssin, et de Constantin Sotiro43.
La société Mazeran, Viannay, Bardey et Cie tombée en faillite, Rimbaud est licencié et se retrouve sans travail. Cependant, selon les termes de son contrat, il a reçu une indemnité de trois mois d’appointements, jusqu’à fin juillet. » et espère la réussite de Bardey, parti en France « pour rechercher de nouveaux fonds pour continuer les affaires, lettre aux siens du 5 mai 1884.
Pendant cette période de désœuvrement, il vit avec une Abyssine chrétienne, prénommée Mariam.
Le 1er juillet, il est engagé jusqu’au 31 décembre 1884 dans la nouvelle société créée par les frères Bardey, aux mêmes conditions. Les mois passent et les affaires ne sont pas brillantes — ruinées par la politique menée par les Anglais. Arthur Rimbaud va avoir vingt-neuf ans et sent qu’il se fait très vieux, très vite, dans ces métiers idiots, lettre aux siens du 10 septembre 1884, aussi cherche-t-il une occasion pour changer d’emploi.
Faute de mieux, le 10 janvier 1885, il se rengage pour un an avec la maison Bardey. Malgré la poursuite de l’offensive anglo-égyptienne au Soudan, Rimbaud continue donc à s’occuper des achats et des expéditions du moka. Sans aucun jour de congé, il supporte à nouveau la chaleur étouffante de l’endroit et souffre de fièvre gastrique.
Trafic d’armes au Choa
Lors d'un court séjour au Caire où il se repose, il confie au Bosphore égyptien le récit de son dernier voyage, publié les 25 et 27 août 1887 ; il n'a donc pas renoncé à une certaine forme d'écriture, celle du journalisme qui le requérait déjà dans sa jeunesse. C'est à ce moment qu'il s'informe pour envoyer des articles au Temps, au Figaro, voire au Courrier des Ardennes.
Il y renoncera cependant. Le sarcasme est désormais sa façon d'être,
En septembre 1885, Arthur Rimbaud se voit proposer un marché par le français Pierre Labatut, un trafiquant établi au Choa, royaume abyssin de Ménélik II.
Voyant là l’opportunité de faire fortune, et de changer le cours de sa vie tout en ayant un rôle géopolitique à jouer, il n’hésite pas à s’associer avec lui pour acheter des armes plutôt dépassées et des munitions en Europe.
Ainsi ils comptent réaliser de substantiels bénéfices en satisfaisant une commande du monarque, qu'ils auront de cette façon contribué à établir comme unificateur de la région. Après avoir conclu cet accord, Arthur rompt brutalement le contrat qui le lie avec la Maison Bardey.
Quant à Mariam, elle est renvoyée dans son pays avec quelques Thalers en poche.
Fin novembre, Rimbaud débarque dans le petit port de Tadjourah, en terre Dankalie, pour monter une caravane en attendant que les armes soient réceptionnées à Aden par Labatut. Lorsque ce dernier arrive fin janvier 1886 avec le chargement, deux mille quarante fusils et soixante mille cartouches, l’organisation de la caravane rencontre des difficultés.
D’abord entravés par les exigences financières du sultan qui tire profit de tous convois en partance, les voilà empêchés d’entamer leur expédition à la mi-avril : l’interdiction d’importer des armes vient d’être signée entre Anglais et Français.
Les deux associés écrivent alors au ministre des Affaires étrangères le 15 avril pour se sortir de cette impasse. Ils obtiennent gain de cause, mais tout est remis en question quand Labatut, atteint d’un cancer, est obligé de rentrer en France, il mourra en Octobre.
Muni d’une procuration de Pierre Labatut, Rimbaud se tourne vers Paul Soleillet, célèbre commerçant et explorateur, qui lui aussi attend une autorisation pour faire partir sa caravane. En associant leurs convois, ils s'assurent d'une meilleure sécurité pour la traversée du territoire des redoutables guerriers Danakils.
Hélas, ils ne partiront pas ensemble : frappé d’une embolie, Soleillet meurt le 9 septembre.
Se retrouvant seul, Rimbaud part en octobre, à la tête de sa caravane composée d’une cinquantaine de chameaux et d’une trentaine d’hommes armés.
La route pour le Choa est très longue : deux mois de marche jusqu'à Ankober..
Sur ces entrefaites, en France, "Illuminations" et "Une saison en Enfer" sont parus dans les numéros de mai à juin et de septembre de la revue symboliste La Vogue.
Après avoir traversé, les terres arides des tribus Danakils sous une chaleur implacable, le convoi franchit la frontière du Choa sans avoir été attaqué par les pillards. Et c’est dans un environnement verdoyant que la caravane atteint Ankober le 6 février 1887.
Rimbaud y trouve l’explorateur Jules Borelli. Ménélik est absent ; parti combattre l’émir Abdullaï pour s’emparer d’Harar. Rimbaud aussitôt arrivé, les chameliers, un créancier de Labatut et la veuve abyssinienne de ce dernier viennent lui réclamer avec insistance ce qui leur est soi-disant dû.
Agacé par leur rapacité, il refuse de céder à leurs demandes. Ils s’en plaignent auprès de l’intendant du roi qui abonde en leur sens et le condamne à verser les sommes demandées.
Au lieu d’Ankober, Ménélik va revenir en vainqueur à Entoto. Rimbaud se rend là bas avec Borelli. Sur place, en attendant l’arrivée du roi, Rimbaud entre en contact avec son conseiller, un ingénieur suisse nommé Alfred Ilg avec qui il entretient de bons rapports.
Suivi de sa colonne armée, Menelik arrive triomphalement le 5 mars. Il n’a plus vraiment besoin d’armes ni de munitions, car il en ramène en grande quantité. Il accepte néanmoins de négocier le stock à un prix très inférieur à celui escompté. De surcroît, il ne se prive pas d’exploiter la disparition de Labatut à qui il avait passé commande, pour retrancher du prix la somme de quelques dettes supposées. Suivant cet exemple, toute une horde de créanciers, réels ou opportunistes de Labatut, viennent le harceler pour être remboursés à leur tour. Menelik n’ayant pas d’argent pour le payer, Rimbaud est contraint d’accepter un bon de paiement devant lui être réglé à Harar par le ras Makonnen, cousin du roi.
Pour qu’il aille au plus court pour toucher son argent, Menelik lui donne l’autorisation de prendre la route qu’il a ouverte à travers le pays des Itous.
Cette route étant inexplorée, Borelli demande au roi la permission de l’emprunter.
Rimbaud quitte donc Entoto le 1er mai, en compagnie de Borelli.
L’itinéraire traverse des régions inexplorées. Leurs observations et descriptions sont scrupuleusement relevées et consignées à chaque étape. Jules Borelli les retranscrira dans son journal de voyage. Rimbaud, pour sa part, transmettra ses notes à Alfred Bardey qui les communiquera à la Société de Géographie, lettre à Bardey du 26 août 1887.
Au bout de trois semaines, la caravane arrive à Harar. Borelli retourne à Entoto quinze jours après. Rimbaud lui, doit attendre pour se faire payer, mais le ras n’a pas d’argent et transforme son bon de paiement par deux traites payables à Massaouah.
Après avoir repris la route en direction de Zeilah, Rimbaud regagne Aden le 25 juillet. Il fait un compte-rendu détaillé de la liquidation de sa caravane au vice-consul de France, Émile de Gaspary. Résultat de cette misérable affaire : une perte de 60 % sur son capital, sans compter vingt et un mois de fatigues atroces.
Avec l’intention de prendre un peu de repos en Égypte, Rimbaud embarque avec son domestique au début du mois d’août pour encaisser ses traites à Massaouah.
Arrêté à son arrivée pour défaut de passeport, l’intervention de Gaspary est nécessaire pour lui permettre de poursuivre sa route. Nanti d’un passeport, de l’argent de ses traites et d’une recommandation du consul de France de Massaouah à l'attention d'un avocat du Caire. Il débarque à Suez pour se rendre en train jusqu’à la capitale où il arrive le 20 août. Dans une lettre aux siens du 23 août il se plaint de rhumatismes dans l’épaule droite, les reins, la cuisse et le genou gauche.
Est-ce l’avocat pour qui il avait une lettre de recommandation qui le met en relation avec son confrère, Borelli Bey, Octave Borelli, ou est-ce Jules Borelli qui lui a donné les coordonnées de son frère aîné, Octave, directeur du journal, Le Bosphore égyptien ? Toujours est-il que Rimbaud lui adresse les notes de son expédition du Choa et qu’elles sont publiées les 25 et 27 août.
Après avoir placé sa fortune dans une succursale du Crédit lyonnais, il ne sait où aller pour travailler à nouveau : Zanzibar ? Madagascar ? Il sollicite une mission en Afrique à la Société de Géographie à Paris ; sans succès. Il retourne à Aden en début d’octobre.
.
Aden,
où les déconvenues de sa livraison d’armes le poursuivent. Il doit encore justifier le paiement d’une dette de Pierre Labatut à un certain A. Deschamps, l’affaire sera soldée le 19 février 1891, après d’interminables échanges de courriers.
En décembre 1887, malgré divers contacts entrepris, Rimbaud est toujours sans travail. Il revoit Alfred Ilg, de passage à Aden avant de se rendre à Zurich (à la suite de quoi ils correspondront fréquemment). Par ailleurs, le stock d’armes de Paul Soleillet, resté à Tadjourah après sa mort, a été racheté par Armand Savouré. Malgré l’embargo sur ce commerce, celui-ci compte les livrer au roi Ménélik. Pour former sa caravane, il propose à Rimbaud de tenter de se procurer des chameaux auprès du ras de Harar. Pour cela, Arthur retourne sur les terres africaines en février 1888, mais, n’ayant pu convaincre Makonnen, il en revient bredouille un mois plus tard56.
Dans le milieu littéraire parisien, le silence et disparition inexpliqués du poète Jean-Arthur Rimbaud entourent son nom de mystère et les interrogations qu'il suscite donnent libre cours à toutes sortes de fables — en 1887 on l'a dit mort, ce qui inspira Paul Verlaine pour écrire Laeti et errabundi57. En janvier 1888, le même publie à nouveau une étude biographique dans un numéro de la revue Les Hommes d’aujourd’hui, consacré au poète disparu.
Dernier séjour au Harar
La route d’Entoto à Harar étant maintenant ouverte, la cité harari devient une étape obligée pour commercer avec le royaume du Choa.
Rimbaud est déterminé à s’y installer pour se consacrer à un commerce plus orthodoxe; café, gomme, peaux de bêtes, musc de Civette, cotonnade, ivoire, or, ustensiles manufacturés et fournisseur de chameaux pour caravanes.
Il contacte César Tian, un important exportateur de café d’Aden, pour le représenter à Harar, offre sa collaboration à Alfred Bardey à Aden, à Alfred Ilg au Choa et à Constantin Sotiro qui s’est établi à Zeilah.
Ces accords conclus, il part édifier son comptoir, départ le 13 avril, arrivée le 3 mai 1888.
Après la satisfaction des débuts, l’humeur devient maussade. Rimbaud s'ennuie.
Il l’écrit à sa famille dans une lettre datée du 4 août 1888 :
"Je m'ennuie beaucoup, toujours ; … n’est-ce pas misérable, cette existence sans famille, sans occupation intellectuelle … ?"
Fin septembre il offre l’hospitalité à l’explorateur Jules Borelli qui, venant du Choa, fait une halte d’une semaine avant de regagner le port de Zeilah.
Quelques semaines après, c’est au tour d’Armand Savouré qui a enfin réussi à livrer son stock d’armes au roi Ménélik. Dans leurs témoignages tous deux le décriront comme un être intelligent, sarcastique, peu causant, ne livrant rien sur sa vie antérieure, vivant très simplement, s’occupant de ses affaires avec précision, honnêteté et fermeté.
Le ras Makonnen quitte la ville en novembre pour rejoindre son cousin le roi qui se prépare à entrer en guerre contre l’empereur Johannès IV.
Cette guerre n’aura pas lieu, " car au mois de mars, l’empereur eut l’idée d’aller d’abord flanquer une raclée aux mahdistes du côté de Metemma. Il y est resté, que le Diable l’emporte !", lettre à ses mère et sœur du 18 mai 1889.
Le 3 novembre, Ménélik devient Negusä nägäst d’Éthiopie sous le nom de Ménélik II.
De retour de Zurich, Alfred Ilg, est hébergé du 23 décembre 1888 au 5 février 1889 ; le temps d’attendre la fin des affrontements entre Issas et Gallas pour transporter en toute sécurité ses marchandises et celles de son hôte jusqu’à Entoto.
Les affaires avec le conseiller du roi marcheront en bonne entente jusqu’au bout. Il faut souligner ici que le mythe faisant de Rimbaud un négrier est infondé :
"N’allez pas croire que je sois devenu marchand d’esclave" avait-il déjà écrit à sa famille le 3 décembre 1885.
Il est seulement vrai qu'il demande à Ilg, dans une lettre datée du 20 décembre 1889, "ses deux garçons esclaves pour son service personnel".
Si la traite est interdite par Ménélik, elle se fait clandestinement et beaucoup d’Européens possèdent des esclaves comme domestiques sans que cela soit blâmable.
Le 23 août 1890, l’ingénieur lui répondra :
"pardonnez-moi, je ne puis m’en occuper, je n’en ai jamais acheté et je ne veux pas commencer. Je reconnais absolument vos bonnes intentions, mais même pour moi je ne le ferai jamais."
À la veille de Noël, une caravane est attaquée par une tribu sur la route de Zeilah à Harar. Deux missionnaires et une grande partie des chameliers sont assassinés. Suite aux représailles qui se soldent par des pertes importantes dans les rangs anglais, les routes commerciales sont coupées jusqu’à la mi-mars 1890.
Le manque à gagner que cela occasionne est sujet de conflit avec César Tian.
Rimbaud songe alors à se rendre à Aden pour liquider ses affaires avec lui. Ensuite, il se rendrait en France dans l'espoir de se marier.
À Paris, Anatole Baju, rédacteur en chef de la revue Le Décadent et de la série Les Hommes d’Aujourd’hui, divulgue des renseignements reçus sur Arthur Rimbaud : il est vivant et vit à Aden.
Le 17 juillet 1890, Laurent de Gavoty, directeur de la revue littéraire marseillaise, La France moderne, lui écrit par le biais du consul de France à Aden pour dire qu’il a lu ses beaux vers et qu’il serait heureux et fier de voir le chef de l’école décadente et symboliste collaborer pour sa publication.
Fin de vie
Cependant, un mal étrange le frappe. Une grosseur au genou le fait souffrir à crier. Il doit tout quitter. À Aden, le diagnostic médical des plus alarmants le force à revenir en France.
En 1891, dans une lettre écrite le 20 février, Arthur demande à sa mère de lui faire parvenir un bas à varices, car il en souffre à la jambe droite depuis plusieurs semaines. Il lui signale aussi une « douleur rhumatismale » au genou droit. Il en attribue les causes aux « trop grands efforts à cheval, et aussi par des marches fatigantes. » Un médecin, consulté un mois plus tard, lui conseille d’aller se faire soigner en Europe le plus rapidement possible. Bientôt, ne pouvant plus se déplacer, il dirige ses affaires en position allongée. Au vu de l’aggravation rapide de son genou et de l’état de raideur de sa jambe, il liquide à la hâte toutes ses marchandises pour quitter le pays.
Transporté par des porteurs sur une civière – construite selon ses plans –, la caravane prend le départ au matin du 7 avril. Djami, son domestique, est du voyage. Malgré les souffrances, accentuées par l’inconfort, les intempéries et la longueur du déplacement, il note les faits marquants de chaque étape jusqu’à son arrivée au port de Zeïlah, le 18 avril. Débarqué à Steamer Point trois jours après, Rimbaud est hébergé chez César Tian le temps de régler leurs comptes.
Hospitalisé aussitôt après, les médecins lui diagnostiquent une synovite rendue à un point si inquiétant qu’une amputation semble inévitable. Cependant, quelques jours de repos lui sont accordés pour en mesurer les éventuels bienfaits. Devant le peu d’amélioration, il lui est conseillé de rentrer en France.
Le 9 mai, on l’embarque sur l’Amazone, un trois-mâts goélette à vapeur des Messageries maritimes, à destination de Marseille.
Marseille, dernier voyage
Arthur Rimbaud est débarqué à Marseille le 20 mai 1891.
"Me trouvant par trop faible à l'arrivée ici, et saisi par le froid, j'ai dû entrer ici à l'hôpital de la Conception …. Je suis très mal, très mal, je suis réduit à l'état de squelette par cette maladie de ma jambe gauche, qui est devenue à présent énorme...". Les médecins diagnostiquent un néoplasme de la cuisse. Le 22, on lui annonce qu’il va falloir l’amputer.
Il envoie immédiatement un télégramme à sa famille pour que l’une ou l’autre vienne à Marseille régler ses affaires. Sa mère lui répond aussitôt en lui annonçant son arrivée pour le lendemain, 23 mai au soir.
Puis c'est l'amputation de la jambe droite à Marseille, la remontée, comme une fuite nouvelle, à Roche, un ultime mois de campagne française vécu sous un ciel pluvieux, enfin la redescente à Marseille, une descente affolée, comme pour embarquer à tout prix, avant qu'il ne soit trop tard.
Après l’opération, Rimbaud reçoit des lettres de sympathie de Constantino Sotiro et César Tian.
Le 8 juin, madame Rimbaud écrit à sa fille pour lui annoncer son nécessaire retour à la ferme de Roche malgré les supplications de son fils pour qu’elle reste auprès de lui.
La cicatrisation faite, il ne subsiste qu’une douleur localisée. Le 24 juin, il s’exerce à se déplacer avec des béquilles.
Le 2 juillet il écrit qu’il a commandé une jambe de bois. D’autre part, maintenant qu’il se trouve en France, il s’inquiète inconsidérément sur sa période d’instruction militaire à laquelle il a réussi à se soustraire jusqu’à présent. Craignant de se faire piéger en retournant auprès des siens, il les charge de faire le nécessaire pour éclaircir sa situation. Le 8 juillet, sa sœur l’informe qu’il peut obtenir son congé définitif comme réformé en se présentant devant les autorités militaires de Marseille ou de Mézières.
En juillet, Rimbaud ne peut se servir de sa jambe artificielle, car elle enflamme le moignon. En attendant qu’il se renforce, il continue à "béquiller", mais, à la longue, cela lui occasionne de fortes névralgies dans le bras et l’épaule droite ainsi que dans sa jambe valide.
Le 23 juillet, suivant le conseil de son médecin, il quitte l’hôpital. Arrivé en gare de Voncq le lendemain, il se fait conduire à la ferme de Roche.
Ni ses anciens amis ni son frère ne sont avertis de son retour. Au lieu de s’améliorer, son état paraît empirer. Les insomnies et le manque d’appétit le reprennent. Les douleurs occasionnées par les béquilles, la jambe de bois ou les promenades en carriole le contraignent bientôt à l’inactivité. Le médecin constate une augmentation de volume du moignon et une rigidité du bras droit.
Ne renonçant pas à retourner au Harar, il prend la résolution de retourner se faire soigner à Marseille, ainsi il serait "à portée de se faire embarquer pour Aden, au premier mieux senti".
Le 23 août, il reprend le train pour Marseille accompagné d’Isabelle. Après le calvaire subi tout au long du voyage, il est admis à l’hospice de la Conception le lendemain soir.
Isabelle, qui loge en ville, se rend tous les jours à son chevet. Un mois plus tard, elle rapporte à sa mère les réponses faites à ses questions par les médecins :
"Sa vie est une question de jours, de quelques mois peut-être.
Atteint d'un cancer généralisé, Rimbaud entre à l'hôpital Saint-Jean. Il attend d'y mourir.
Le 20 octobre, il a trente-sept ans. Selon la lettre exaltée qu’Isabelle écrit huit jours après à sa mère, son frère aurait retrouvé la foi catholique durant cette épreuve. Elle lui décrit aussi la progression du cancer : son bras droit enflé, le gauche à moitié paralysé, son corps en proie à de vives douleurs, sa maigreur.
Elle raconte ses délires, lors desquels il l’appelle parfois Djami.
Le 9 novembre, il lui dicte un message sibyllin :
" M. le Directeur,…envoyez-moi donc le prix des services d'Aphinar à Suez. Je suis complètement paralysé donc je désire me trouver de bonne heure à bord dites-moi à quelle heure, je dois être transporté à bord."
Il meurt le lendemain, mardi 10 novembre — à dix heures du matin selon le registre des décès de l’hôpital, à deux heures de l’après-midi selon sa sœur.
Son corps est ramené à Charleville. Les obsèques se déroulent dans l’intimité la plus restreinte, le 14 novembre.
Arthur Rimbaud est inhumé dans le caveau familial auprès de son grand-père, Jean Nicolas Cuif et de sa sœur Vitalie. Sa mère, morte à Roche le 1er août 1907, à l’âge de quatre-vingt-deux ans, les rejoindra. Son frère Frédéric mourra à cinquante-huit ans, des suites d’une fracture d’une jambe, le 2 juillet 1911, à Vouziers ; sa sœur Isabelle se mariera en 1897 avec Paterne Berrichon – tous deux se voudront les gardiens de la mémoire du poète, quitte à censurer et falsifier la vérité.
Elle mourra à cinquante-sept ans le 20 juin 1917, à Neuilly-sur-Seine, d'un cancer.
Lire la suite --> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=3639#forumpost3639
Posté le : 19/10/2013 18:16
Edité par Loriane sur 20-10-2013 20:22:00
|
|
|
|
|
Arthur Rimbaud suite 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
L'œuvre
Comparable en cela à celles d'un Pascal ou d'un Chénier, l'œuvre de Rimbaud pose le problème de sa publication.
Si "Une saison en enfer" fut réalisée selon ses vœux, il n'en va pas de même des autres textes que l'on regroupe sous des titres qui tentent soit de rendre compte de leur genre : Poésies, Vers nouveaux et chansons, soit de s'accorder avec un intitulé que l'auteur aurait lui-même suggéré : "Illuminations".
D'une façon générale, les Poésies désignent des textes qui vont des "Étrennes des orphelins", pièce de débutant, jusqu'au "Bateau ivre".
Il paraît légitime d'y constituer d'abord un ensemble correspondant au "recueil Demeny" ou "cahier de Douai", poèmes composés de janvier à octobre 1870, puis de considérer une zone plus floue, mais stylistiquement repérable, marquée entre autres par les lettres du voyant.
La publication des Vers nouveaux et chansons, appelés parfois "Derniers Vers", relève d'une histoire autrement plus complexe.
La plupart, datés par Rimbaud de mai, juin, juillet 1872, furent d'abord publiés en 1886 avec "les Illuminations", un peu comme s'il s'agissait d'un sous-genre en vers à l'intérieur de celles-là – le cas intermédiaire entre ces deux formes étant posé par "Marine" et "Mouvement" qu'une tradition déjà ancienne a désormais choisi de ranger au nombre des "Illuminations".
En 1912 encore, dans sa Préface pour les Œuvres à Mercure de France, Claudel considérait un "double état" de cette écriture, là où nous voyons maintenant des ensembles différents :
"C'est ce double état du marcheur que traduisent les Illuminations : d'une part les petits vers qui ressemblent à une ronde d'enfants et aux paroles d'un libretto, de l'autre des images désordonnées qui substituent à l'élaboration grammaticale ainsi qu'à la logique extérieure une espèce d'accouplement direct et métaphorique." Cependant, précisément dans cette même édition de 1912, ces Vers nouveaux et chansons pour la première fois allaient acquérir au cours du volume leur autonomie.
Les Illuminations
Le titre d'"Illuminations", quant à lui, si éblouissant soit-il, n'apparut jamais sous la plume de Rimbaud, aucun des manuscrits actuellement connus ne le comporte.
À plusieurs reprises, Verlaine, pour désigner des textes de Rimbaud, l'utilisera. D'abord dans des lettres envoyées à Charles de Sivry, où il les nomme "illuminécheunes" – ce qui laisse supposer une prononciation anglaise du mot. Dans la Préface qu'il donnera à leur première publication aux éditions de la revue La Vogue en 1886 ensuite, où il le répétera en y ajoutant un sous-titre, Coloured Plates – qu'il traduit par Gravures coloriées.
Ailleurs, il indiquera un sous-titre approchant : "Painted Plates".
Ces cinquante-quatre poèmes en prose étonnent par leur beauté, mais aussi leur disparate.
Quelques-uns sont groupés par séries : Vies, Enfances, Veillées, Villes, et laissent entrevoir un projet plus articulé, au point que l'on a pu parler d'une "poétique du fragment", André Guyaux.
D'autres sont de purs météorites, venus d'un monde en puissance chez l'écrivain et ne se révélant qu'à cette seule occasion.
En dépit d'une telle dispersion, Rimbaud projette là avec une intensité visionnaire, on peut penser à une sorte de lanterne magique mentale les éléments d'un univers intérieur qu'il tient à transmettre au lecteur ou, tout simplement, à l'autre.
Plus que des descriptions comme en faisait Aloysius Bertrand ou des situations symboliques comme Baudelaire en agençait dans son Spleen de Paris, il produit souvent une annonce, presque au sens évangélique du terme, propose un monde requalifié et fait accéder l'humanité à une dimension insoupçonnée avant lui.
Vigueur et rigueur, "luxe inouï" et parfois cruauté superbe.
Ainsi en est-il de À une Raison qui visiblement veut faire succéder à la nôtre, trop réduite, une conscience nouvelle.
La figure du génie apparaît par deux fois comme instance décisive, dans Conte d'abord où le Prince, lassé de tout, finit par rencontrer cet autre de lui qui est la force de son désir, sa santé essentielle; dans Génie ensuite, texte inscrit dans l'impossible et animé par l'optimisme de l'utopie.
Fréquemment aussi des vues magiques s'organisent, frappent par leur entraînement dynamique, leur célérité. Le moderne trouve ici une expression imprévisible, il n'est pas le mime de la science, il ne se construit pas à l'aide d'une nouveauté de strass, mais il formule une clarté majeure dans cette « prose de diamant » saluée par Verlaine et nous débarrasse des pesanteurs, atteste un cosmos inconnu, ventile et revitalise, éblouit.
À chaque texte, Rimbaud rejoue la poésie, sans profiter des acquis précédents, et nous avons toujours l'impression que le spectacle qu'il propose, à plat sur la page, rassemble une pluralité, comme l'aleph, point de parfaite ubiquité vu par Borges un certain jour.
Il s'agit bien d'une révélation, un peu à l'image de l'Aube d'été, longtemps poursuivie par, l'enfant Rimbaud lui-même, puis enfin dépouillée de ses immenses voiles et livrant son amour. Comme l'avait déjà constaté le premier rassembleur de ces textes, Félix Fénéon, une thématique à coup sûr s'en dégage, Jean-Pierre Richard, puis Jean-Pierre Giusto l'ont fort bien analysée, mais elle n'est rien si l'on néglige la cinétique de ces formes ou de ces substances.
L'écriture suscite ; elle développe des naissances, des événements, voire des avènements ; l'univers décomposé, recomposé s'ouvre à des virtualités magnifiques.
Une saison en enfer
Reste le seul texte publié par Rimbaud, Une saison en enfer. Il était inutile jusqu'à maintenant de soulever le problème de la datation des Illuminations comparée à ce livret. On ne saurait toutefois s'y dérober.
Rimbaud lui-même a tenu à inscrire à la dernière page de son "carnet de damné" : "avril-août 1873". La fin du livre semble prononcer un adieu. Signifie-t-elle pour autant que c'en était fini de la littérature ? Pour la beauté du geste, on l'a longtemps cru. Rimbaud, produisant cet ouvrage, coupait court avec son passé, il devenait "absolument moderne".
Les Illuminations lui seraient donc antérieures.
Il a bien fallu cependant nuancer une opinion aussi tranchée, depuis que Bouillane de Lacoste, en 1949, dans une thèse désormais célèbre, a montré que certains de ces poèmes en prose avaient été recopiés à Londres, du temps où Nouveau était au côté de Rimbaud. Rien ne prouve de façon assurée que les Illuminations furent rédigées quand Rimbaud écrivait Une saison en enfer, où il se borne à citer plusieurs de ses "Vers nouveaux" ; mais on ne doit pas davantage éliminer l'hypothèse d'un double adieu fait à la littérature, c'est ce que conjecture Maurice Blanchot ; une fois dans la Saison, une autre fois dans les Illuminations, où quelques poèmes comme Départ ou Solde résonnent manifestement comme un congé.
Avec Une saison en enfer, Rimbaud a sans doute écrit le livre du rebelle par excellence, mais également celui qui touche de plus près l'adolescence, quand se dessine sous le signe de l'incertitude la vie d'homme toujours improbable.
Verlaine parlera à son propos de "prodigieuse autobiographie psychologique", et certes il faut voir à quel point l'existence de Rimbaud y est questionnée ; mais l'auteur l'élève constamment à un exposant mythique.
Aucun des motifs personnels, excepté peut-être la narration de Délires II, ne se referme sur lui-même.
Tour à tour l'Histoire, la Famille, la Religion sont l'objet d'une traversée et de mises en crise. À travers ces pages de colère et de lucidité, l'Occident en son ensemble est accusé de façon si mordante qu'on ne retrouvera une telle âpreté que dans une œuvre contemporaine et elle aussi décisive, Ainsi parlait Zarathoustra, 1883 de Nietzsche.
Les griefs contre la religion chrétienne forment un motif dominant. Ils furent peut-être précédés par la rédaction de "paraphrases évangéliques" que l'on a retrouvées au verso de certains brouillons de la Saison. Le Christ que dans Les Premières Communions Rimbaud appelait l'"éternel voleur des énergies" ne l'en a pas moins retenu pour ses pouvoirs de thaumaturge et l'efficacité de sa parole.
Aussi la religion est-elle à l'origine de la Saison beaucoup plus que "le drame de Bruxelles", ce "dernier couac".
C'est aux environs de Pâques 1873 que Rimbaud envisagea d'abord de rédiger un "livre païen" ou "livre nègre", lequel sera bientôt infléchi en histoire satanique. L'Enfer permet ici ce que les Anciens nommaient une katabase, descente dans l'au-delà qui se confond aussi avec une anamnèse personnelle et mène plus loin encore : dans la mémoire collective de l'Occident.
C'est contre la loi du baptême que Rimbaud se cabre, en constatant que nous sommes tous ici-bas marqués par le péché originel.
Par multiples assauts se développe alors sa rébellion, avec des cris de réel damné, une syntaxe du gril et du sarcasme, une parole-écriture torturée qui se plaît à mettre à l'épreuve les plus sûres fondations de l'Europe "aux anciens parapets".
Au milieu de son livre, Rimbaud, par une manifeste mise en abyme, s'est représenté presque théâtralement selon deux chapitres qu'il a intitulés "Délires".
L'un retrace les démêlés d'une Vierge folle aux prises avec l'Époux infernal ; l'autre tente une singulière rétrospective de son parcours poétique de l'an passé. Délires I traduit au plus intense le débat qui put exister entre un individu de faiblesse et une personnalité dangereuse, mais investie des plus fabuleux pouvoirs ou, du moins, le prétendant.
Il serait mal venu de refuser d'y voir Verlaine d'une part, de l'autre Rimbaud, d'autant plus que l'Alchimie du verbe, pendant littéraire de ce premier délire " existentiel" et conjugal, citera des poèmes indubitablement écrits par Rimbaud.
"Je suis caché et je ne le suis pas", assure celui-ci, en affirmant ainsi nettement l'ambivalence de son propos qui relève, en ce cas, moins de l'équivoque que du plurivoque – la polyphonie faisant profondément partie de celui qui, une fois pour toutes, avait pu écrire :
"Je est un autre." Reste que l'autre n'est pas nécessairement le contraire.
Il correspond plutôt à la voix secrète, toujours prête à surgir démoniquement, comme une sorte de vérité oblique.
Délires II, sous-titré « Alchimie du verbe », demeure une manière de Bible pour ceux que tentent les pouvoirs de la poésie. Une lecture attentive prouve cependant que le procédé même de l'hallucination, au moment même où il est exposé, s'y trouve remis en cause.
Ses propres poésies que Rimbaud commente d'assez loin lui paraissent désormais caduques, comme la "romance" verlainienne. Remarquons, d'ailleurs, qu'au cours de cette intrigante anthologie personnelle nulle "illumination" n'est citée à comparaître au for intérieur du souvenir.
Vertigineusement placé sur le rebord du temps, Rimbaud, avant d'entrer dans l'ignoble vie française qui le réclame, citoyen et soldat, s'interroge, au cours des quatre dernières séquences, fort de sa puissante solitude." Posséder la vérité dans une âme et un corps" demeure à la page finale le dessein qu'il se donne.
Insatisfaits des réponses suggérées par Rimbaud, mais encouragés par les indices de son parcours interrompu, nous ne pouvons qu'admirer ce poète tout à la fois incomplet et absolu. La ferveur qui depuis 1886 sut accueillir ses œuvres, elles ne consistent pourtant qu'en jalons, en amorces et points du jour, est la preuve irréfutable de leur pouvoir.
Sans doute nous entraînent-elles à coopérer à ce qu'elles esquissent, à jouer, nous aussi, notre part de merveilleux. Claudel, Breton, Roger Gilbert-Lecomte, Jouve, Bonnefoy, d'autres encore, l'ont bien perçu, au contact de cet "horrible travailleur", qui nous a dotés de pures maximes d'existence.
Sa vie même, menée à son insu à la manière d'un poème supplémentaire, a brillé d'un éclat sacrificiel qui n'a pas peu contribué à ce que l'on y capte une leçon, celle d'une sainteté, comme l'a souhaité trop ardemment Isabelle sa sœur, ou d'une détermination ontologique, comme s'est appliqué à le montrer Alain Borer. Certes, devant Rimbaud, nul n'a le dernier mot.
Celui qui prétendait n'avoir " du goût “que” pour la terre et les pierres", au moment même où il laissait entrevoir l'indigence de la littérature à "changer la vie", lui a donné des gages extrêmes en vertu desquels nous sentons que, plus qu'un artifice, elle est moyen parfois de toucher l'impossible et de rencontrer une suffisante « minute d'éveil".
Le bateau ivre en Paris
Probablement composé avant le mois de novembre 1871, étant donné une caricature d'André Gill qui y fait allusion dans l’Album zutique dont les contributions rimbaldiennes datent d'octobre - novembre 1871 également.
Des poèmes tels que Voyelles, Oraison du soir, Les Chercheuses de poux, L'Étoile a pleuré rose..., Tête de faune ou Les Mains de Jeanne-Marie, semblent dater eux aussi de cette période parisienne. Le manuscrit connu du poème Les Mains de Jeanne-Marie est daté de février 1872 par Paul Verlaine.
Certains documents laissent à penser que nous avons perdu quelques poèmes en vers de Rimbaud pour l'année 1872, à commencer par la liste de nombres de vers par poème qui figure au dos d'un manuscrit de Fêtes de la faim. Nous aurions perdu également le texte de La Chasse spirituelle, texte que Verlaine prétend avoir oublié chez sa femme au moment de l'escapade en Belgique.
Toutefois, Jacques Bienvenu a clairement montré que Verlaine a voulu faire croire que le texte de La Chasse spirituelle se confondait avec le texte infamant des lettres échangées par Rimbaud et Verlaine en mars-avril 1872. Ces lettres furent retrouvées par la femme de Verlaine, Mathilde, qui s'en servit ultérieurement pour gagner son procès en demande de séparation en 1874. Une copie de ces lettres a dû être établie par un greffe, mais, si tel est bien le cas, ces précieuses archives nationales ont été détruites à une date indéterminée au cours du vingtième siècle ! Mathilde a-t-elle détruit des poèmes de Rimbaud ? Ces poèmes réapparaîtront-ils un jour ?
En 2004, une version inédite du poème Mémoire, sous le titre Famille maudite, a redonné espoir. Mais il n'est pas absolument certain que ce manuscrit provienne des héritiers de Verlaine et de son ex-épouse. Quant au texte de La Chasse spirituelle, s'il a existé, on peut se demander à quel point il serait proche des Déserts de l'amour, voire s'il ne s'agirait pas du même texte.
Sensation inventeur du vers libre
Sur le plan de la forme, Arthur Rimbaud a pratiqué une versification de plus en plus ambitieuse en fait d'enjambements à l'entre-vers et à la césure, avant de déglinguer littéralement la mécanique ancienne du vers, autour de 1872, dans les trois quatrains de Tête de faune puis dans un ensemble de compositions souvent réunies sous le titre apocryphe de Derniers vers.
Il a introduit le vers libre en France, avec deux poèmes des Illuminations : Marine et Mouvement.
Certains symbolistes, comme Gustave Kahn, s'attribueront "l'invention" du vers libre, mais ce dernier avait justement contribué à la première publication des Illuminations en 1886 et aucune version significative de poème en vers libre non rimbaldien n'a été attestée à une date antérieure.
Rimbaud a donné ses lettres de noblesse à un type de poème en prose distinct d'expériences plus prosaïques du type du Spleen de Paris de Baudelaire. Les ressources poétiques de la langue sont encore exploitées sous un jour différent dans le célèbre poème en prose, pseudo-autobiographique, Une saison en enfer. Avec un fort penchant à l'hermétisme qu’il partage avec d'autres de ses quasi contemporains, Gérard de Nerval, Stéphane Mallarmé, sinon Paul Verlaine parfois, Rimbaud a le génie des visions saisissantes qui semblent défier tout ordre de description du réel.
Deux compositions sont emblématiques à cet égard : "Le Bateau ivre" et "Voyelles".
Les propos radicaux des deux lettres dites "du voyant" et l'étrangeté des univers poétiques suggérés dans le sonnet Voyelles, les proses des Illuminations et l'ensemble dit des Derniers vers ont contribué à forger un mythique pouvoir démiurgique de la parole poétique.
Si le sens énigmatique des Illuminations est mieux cerné de nos jours, il demeure étrangement polysémique, pour les poèmes en vers de 1872 et le sonnet Voyelles.
Appréhendée intuitivement par l'intégralité des poètes successeurs, la poésie de Rimbaud a ouvert la voie à la poésie contemporaine du xxe siècle et nombreux sont les auteurs qui s'en réclamèrent tels Alfred Jarry, Antonin Artaud, Roger Vitrac, René Char, Jean Venturini et tous les surréalistes, sans oublier les poètes de la revue Le Grand Jeu comme René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte, ou encore Henri Michaux, ainsi que des artistes-interprètes, tels que Jim Morrison, Bob Dylan et Patti Smith
Liens
http://youtu.be/lbwJZaPiE7s Rimbaud par Henri Guillemin
http://youtu.be/bU-nGqq0kqY Rimbaud sa vie 1
http://youtu.be/_bCo9DQYntE Rimbaud 2
http://youtu.be/36qskz2VEzI Rimbaud 3
http://youtu.be/JHZbQ7AGh0E Rimbaud 4
http://youtu.be/q9vfI-hadFE La bâteau ivre dit par Gérard Philipe ou
http://youtu.be/nuJuJY_qCcM dit par Laurent Terzieff
http://youtu.be/YN_Agua6mwI Conférence sur Rimbaud poète de l'impatience
http://youtu.be/8kBXnq15Ijw Le dormeur du val
http://youtu.be/eTRvvd8V--4 Léo Ferré chante Rimbaud
http://youtu.be/gaOfWFIJSlw Une saison en enfer par Léo Ferré
.      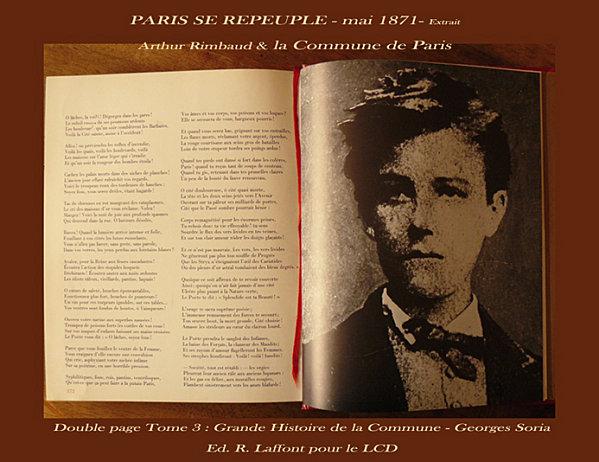 Attacher un fichier:
 rimbaudcadre.jpg (66.22 KB) rimbaudcadre.jpg (66.22 KB)
Posté le : 19/10/2013 18:13
|
|
|
|
|
Elfriede Jelinek romancière |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 Octobre 1946 naît à Mürzzuschlag, Elfriede Jelinek
Femme de lettres autrichienne, romancière, dramaturge essayiste, auteur de nombreuses pièces de théâtre, de pièces radiophoniques et d'un scénario de film, Malina, adaptation du roman d'Ingeborg Bachmann pour Werner Schroeter, traductrice et intellectuelle engagée, Elfriede Jelinek est sans doute l'écrivain le plus dérangeant et le plus énigmatique de l'Autriche contemporaine.
lauréate du prix Nobel de littérature en 2004, et du prix Heinrich böll, Georg-Büchner et le prix Heinrich-Heine
Elle entretient vis-à-vis de son pays une haine virulente et réciproque.
Elle fut membre du parti communiste autrichien de 1974 à 1991. Elle échange des imprécations avec l’extrême droite, qui fait rimer son nom d’origine tchèque avec Dreck : "saleté", et "mal baisée" et les femmes au pouvoir.
Elle s’est toujours violemment positionnée contre les idées et la personnalité de l’ancien leader du FPÖ Jörg
Une écriture de rupture
Née en 1946 à Murzzuschlag en Styrie, dans une société sans père, selon l'expression du psychanalyste Alexander Mitscherlich, elle a grandi à Vienne et reçu, dit-elle, une éducation extrêmement autoritaire et répressive. Musicienne de formation, elle étudie l'orgue et la composition musicale, et c'est par la poésie qu'elle débute en littérature. Otto Breicha, le rédacteur en chef de la revue Protokolle, publie ses premiers travaux, des poèmes érotiques qui révèlent – précise-t-elle – une sexualité réprimée, sinon niée.
À la même époque, elle découvre la littérature expérimentale, s'engage en politique, entre au parti communiste autrichien, K.P.Ö., et cherche dans l'écriture et la littérature une nouvelle méthode esthétique dont le contenu soit politique .
Son père, chimiste juif d’origine tchèque, est employé dans la recherche de matériel de guerre.
Ce poste lui permet d'échapper aux persécutions nazies. Il est dominé par une épouse d’origine roumaine issue de la bourgeoisie catholique, qu’Elfriede décrit comme despotique et paranoïaque.
Elle semble ne s’être jamais libérée du poids de ses géniteurs tous deux détestés. Elle ne leur pardonne absolument rien et reproche notamment à son père, mort fou dans un hôpital psychiatrique, de n’avoir pas su s’imposer face à une femme castratrice et de ne pas avoir protégé sa fille, forcée de se ranger du côté maternel sous le poids d’un darwinisme écrasant.
Sa mère, maîtresse-femme, l’a empêchée dès ses quatre ans de sortir du foyer familial et l’a forcée à apprendre le français, l’anglais, le piano, l’orgue, le violon, la flûte à bec et l’alto.
Après avoir suivi des études musicales au conservatoire, Jelinek décide de prendre des cours de théâtre et d’histoire de l’art à l’université de Vienne mais sans abandonner la musique.
Très tôt, la jeune femme nourrit une grande passion pour la littérature et l’écriture. C’est au contact des mouvements étudiants qu’elle franchit le cap et tente de publier ses premiers textes.
Sa carrière, lancée dans les années 1970, est émaillée d'incidents. Chaque nouvel ouvrage, auquel elle donne une note de critique sociale, provoque chahuts et polémiques en Autriche.
Son premier roman, Wir sind lockvögel baby! en 1972, trahit des penchants pour le raisonnement corrosif, l’expression obsessionnelle et la diatribe politique : ses marques de fabrique.
L'œuvre accuse le folklore et la culture populaire d'être l’écho d’une idéologie nauséabonde.
Les Amantes, "Die Liebhaberinnen" en 1975 dénonce l’humiliation, tant physique que morale, infligée aux femmes ce qui a eu pour but de cataloguer la romancière comme sympathisante féministe.
Les Exclus "Die Ausgesperrten" en 1981 est le portrait effroyable d’une bande de jeunes criminels extrémistes dont les exactions sont couvertes par une société pressée de dissimuler un passé nazi qu’elle n’a jamais exorcisé.
Dans La Pianiste, "Die Klavierspielerin" en 1983, récit quasi-autobiographique, elle fait une peinture terrifiante d’une femme sexuellement frustrée, victime de sa position culturelle dominante et d'une mère possessive et étouffante, ressemblant étrangement à la sienne, morte à 97 ans.
Comme son héroïne, Erika Kohut, l’auteur n'a jamais quitté sa mère et l'a supportée jusqu’à sa mort en dépit d’une union célébrée en 1974 et rapidement dissoute. L’ouvrage développe les règles d’expression d’une pornographie exclusivement féminine, ce que son roman suivant Lust, en 1989 approfondit.
Ce récit est la description, libérée des toutes conventions littéraires, d’une relation pornographique et perverse entre une femme et son mari, chef d’entreprise.
Le but que l’écrivain se fixe et qu’elle explique dans la postface française du livre, édité chez Point-Seuil, dans un entretien accordé à l’une de ses traductrices : Yasmin Hoffmann, est d’explorer toutes les possibilités les plus complexes du langage pour déconstruire le programme idéologique à la base des sociétés humaines, à savoir la dialectique maître-esclave qui voit le triomphe, sur le plan intime et social, de l’exploitation par un dominant de la force de travail d’entités dominées, en l’occurrence par l’employeur de celle de ses employés et par l’homme, celle de la femme.
La figure du mari-patron était issue d’une même idée normative car la violence exercée physiquement et psychologiquement sur sa femme est la même qu’il inflige symboliquement dans son usine à ses ouvriers.
En 1977, elle réécrit la pièce Une maison de poupée d’Henrik Ibsen, qu’elle transpose à l’époque actuelle, dans une usine et à laquelle elle donne un nouveau titre menaçant : Ce qui arriva quand Nora quitta son mari, ou les piliers de la société : rien que du malheur.
Elle y dénonce le sort fait aux femmes dans le monde du travail. En 1981, elle revient avec Clara S sur la vie de l’épouse du compositeur Robert Schumann, Clara Schumann née Wieck. Dans Sportstück en 1998, elle explore les domaines de la violence, de la chorégraphie et de l’apologie du corps viril dans le sport, prémices d’une idéologie fasciste.
Titulaire d’un diplôme d’organiste obtenu en 1971, elle a collaboré avec la jeune compositrice autrichienne Olga Neuwirth, Todesraten, Bählamms Fest, drame musical d’après Leonora Carrington. Elle a passé son temps à promouvoir en Autriche l’œuvre, qu’elle estime méprisée, d’Arnold Schönberg, d’Alban Berg et d’Anton von Webern.
Elle a traduit en allemand, pour subvenir à ses besoins, plusieurs pièces du répertoire traditionnel, dont certains vaudevilles d’Eugène Labiche et de Georges Feydeau ou encore quelques tragédies de William Shakespeare et de Christopher Marlowe. Elle a également traduit des romans de Thomas Pynchon.
Dans sa jeunesse, l’auteur a séjourné à Rome et Berlin. Elle a un temps partagé sa vie entre Vienne et Munich et s'est très régulièrement rendue à Paris mais son agoraphobie croissante l’a poussée à rester dans la capitale autrichienne.
Premiers romans
Ses premiers romans, Wir Sind Lockvögel, Baby !en 1970 ; Nous sommes des attrape-nigauds, baby ! et Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft en 1972 ; Michael, un livre pour la société infantile, considérés comme les premiers romans pop de langue allemande, ont apporté à leur auteur une certaine célébrité.
Mais c'est surtout la publication de Die Klavierspielerin 1983 ; La Pianiste, 1988 qui lui vaut une reconnaissance internationale.
Dévoreuse de romans policiers et de séries télévisées, Jelinek place le plus souvent au cœur de ses romans une intrigue de facture policière empruntée à un fait-divers, situant résolument son écriture romanesque du côté de la littérature populaire, Trivialliteratur par opposition à la conception romanesque héritée de l'Aufklärung, le Bildungsroman, roman de formation.
De fait, elle récuse le modèle du héros positif dont la formation est linéaire et ascendante, bien que ponctuée des crises nécessaires à sa progression, et écarte résolument toute visée pédagogique, tout recours au sublime.
Ses personnages, comme dans Die Ausgesperrten, rn 1980 ; Les Exclus, 1989, sont des êtres en marge de la société, en rupture avec la représentation traditionnelle et idyllique du modèle national.
Elfriede Jelinek rompt ainsi délibérément avec la culture bourgeoise et s'attaque aux piliers de la société autrichienne qui sont autant de tabous : la famille, l'église catholique, la musique, et surtout l'histoire autrichienne récente, avec son passé nazi trop longtemps refoulé.
Très fortement marquée par les écrivains du Wiener Gruppe, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, H. C. Artmann, Gerhard Rühm..., Jelinek développe une relation très particulière avec le langage.
"Ce n'est pas tant le contenu de la langue qui m'intéresse, explique-t-elle, que la manière dont les choses baignent dans ses eaux."
Jeux de mots, dictons populaires tournés en dérision, slogans publicitaires détournés de leur sens, expressions courantes de la réalité quotidienne, choses vues et entendues forment le terreau sur lequel fleurit son écriture.
Elle réfracte la réalité et éclaire les thèmes qu'elle aborde tantôt sous l'angle féministe, tantôt sous l'angle politique – deux axes privilégiés de ses investigations.
Elle part toujours d'un événement ou d'une histoire qu'elle cherche à transposer à un autre niveau de signification pour aboutir à la prose narrative ou à la polyphonie de l'écriture dramatique.
La déconstruction des mythes
Son œuvre, difficilement lisible, est écrite dans un style sec et péremptoire.
Jelinek concilie en réalité des recherches de langue érudites à une rythmique proche de la composition musicale contemporaine.
Sa prose explore toutes les manières possibles d’exprimer l’obsession et la névrose, vitupérant jusqu’à l’absurde sur les rapports de forces socio-politiques et leurs répercussions sur les comportements sentimentaux et sexuels.
La rhétorique pornographique, exclusivement masculine, est déconstruite et dénoncée par l’écrivain, et le pacte inconscient qui consiste à voir le triomphe de l’homme sur la femme, analysé et fustigé.
L’industrie du spectacle, le divertissement et ses propagandes mensongères sont également la cible de ses invectives.
Son théâtre, empli de brechtianisme, cherche à décortiquer le pouvoir fascinant du verbe qu’elle estime être le vecteur des dogmes idéologiques dominants, relayés et mis en scène par les grands médias surtout télévisés.
Aussi Jelinek s’attarde-t-elle sur le rôle historique ambigu des intellectuels face au pouvoir politique et aux thèses fascistes, sujet qu’elle expose dans la pièce Todtnauberg en 1991 à travers la figure du philosophe Martin Heidegger. La métaphore répétée du vampirisme et les influences de la philosophie hégélienne et marxiste ainsi que son goût du freudisme viennent parachever la composition de ses textes.
Admiratrice d'intellectuels français tels que Pierre Bourdieu, Guy Debord et Roland Barthes ou d’auteurs comme Georges Bataille et Antonin Artaud, elle s’ancre dans une tradition nationale de polémique héritée de Karl Kraus et de Thomas Bernhard. Comme chez Joyce, Woolf et Beckett, ses autres modèles littéraires avec Kafka, le véritable héros de ses livres est le langage lui-même.
Deux fils rouges qui souvent se croisent traversent son œuvre : la femme méprisée dans sa condition de femme, comme chez Bachmann, victime de la répression masculine, et la violence du passé nazi. Ce n'est pas parce que les nazis ont été vaincus que le monde a été dénazifié d'un seul coup.
Cette brutalité se retrouve dans le couple, dans la violence que l'homme exerce envers la femme, et à l'intérieur de la famille, où la femme se retourne contre ce qu'il y a de plus faible, en l'occurrence contre ses enfants.
Dans Lust en 1989 ; trad. français en 1991 et dans Gier, "ein Unterhaltungsroman" en 2000 ; Avidité en 2003, Jelinek se propose de montrer que les rapports de force existent aussi dans la sexualité. De plus, pour Jelinek, la femme n'est pas seulement une esclave sur les plans tant social que sexuel, elle est aussi une prolétaire du langage.
C'est en entreprenant l'écriture de Lust, qui devait originellement être une contre-histoire de l'Histoire de l'œil 1928 de Georges Bataille, qu'elle découvre qu'il n'y a pas de langue féminine pour écrire l'obscénité.
Ce qui reste aux femmes, c'est de tourner en ridicule cette langue masculine, de la détourner d'une façon subversive, de s'en moquer.
Les années 1980, au cours desquelles surgit l'affaire Waldheim, fournissent par ailleurs à Elfriede Jelinek l'occasion de braquer son regard sur deux "vaches sacrées" de la culture autrichienne : la représentation idyllique de la nature et le célèbre Burgtheater viennois.
En 1985, elle publie Oh Wildnis, Oh Schutz vor ihr, Méfions-nous de la nature sauvage, 1995 et sa pièce Burgtheater est mise en scène à Bonn, où elle rencontre un très grand succès.
Loin de vouloir célébrer la beauté rustique de l'Autriche ou les vertus de l'institution viennoise qu'est le Burgtheater, Jelinek se livre à une déconstruction des mythes, rappelant sans complaisance la barbarie du passé nazi autrichien et la complaisance de la bourgeoisie éclairée qui l'a acceptée, tolérée, voire encouragée.
L'opinion publique autrichienne se ligue alors contre elle, la traitant de Nestbeschmutzerin celle qui souille son nid.
La parution en 1995 de Die Kinder der Toten, Enfants des morts, 2006 accentue encore la radicalité de la critique socio-historique.
Dans une forme qui emprunte à de nombreux genres littéraires, Jelinek imagine, dans le cadre idyllique de sa Styrie natale, une farce macabre : trois morts, réincarnations de toutes les victimes innocentes de l'Autriche, reviennent pour tuer, violer, torturer les vivants qui camouflent leur passé refoulé sous une apparence vertueuse.
Le théâtre occupe une place prépondérante dans l'œuvre d'Elfriede Jelinek.
D'abord brechtienne et épique, son écriture dramatique évolue rapidement vers la déconstruction systématique du théâtre occidental traditionnel. Jelinek refuse ce que le théâtre impose habituellement : des dialogues, des personnages psychologiquement vraisemblables, de l'action, des conflits, un dénouement.
Elle en vient rapidement à concevoir des "Textflächen", des textes sans dialogues qui ne cessent de se référer aux modèles dramatiques traditionnels pour les soumettre à une critique radicale.
Ainsi dans Raststätte oder Sie machen alle, Aire de repos ou ainsi le font-elles toutes, mis en scène en 1994 par Claus Peymann, ami et metteur en scène de Thomas Bernhard, en 1994, elle utilise comme toile de fond les intrigues du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et de Cosi fan tutte de Mozart, en déplaçant contexte et propos, de manière à mettre en valeur un thème récurrent dans son œuvre : la violence sexuelle, expression des rapports de propriété au sein du mariage, et l'échec du désir féminin.
Ce jeu avec les modèles dramatiques traditionnels, Jelinek le pratique aussi en intégrant à ses œuvres les mythes de l'Antiquité et la tragédie grecque : dans Das Lebewohl, 2000 ; Les Adieux, elle introduit L'Orestie d'Eschyle à côté de propos du chef du parti libéral d'extrême droite Jörg Haider.
Dans Bambiland en 2004, elle met en relation Les Perses d'Eschyle avec les reportages des médias sur la guerre en Irak.
En 2004, le prix Nobel de littérature était décerné à Elfriede Jelinek. Trop introvertie pour s'exposer aux médias, elle choisit d'enregistrer le discours qu'elle aurait dû prononcer à Stockholm, Im Abseits, 2005 ; À l'écart.
Dans ce texte, elle s'exprime de façon très personnelle sur la situation de l'écrivain. Elle se décrit à l'écart, différente, autre dans son discours parce qu'elle
"observe les choses de l'extérieur sans jamais y participer", dans son existence parce qu'elle mène une vie en marge du monde, dans sa langue "parce qu'un tel langage ne peut se construire que dans la déconstruction".
Jelinek insiste fortement sur la dichotomie de l'écrivain, pris entre la vie et l'écriture, et sur la nécessité d'écrire les choses quand on ne peut les vivre.
Elfriede Jelinek a publié sur son site un grand nombre d'essais dans lesquels elle prend position sur des événements de l'actualité politique, sociale et culturelle. Elle les considère comme des notes qui n'ont pas encore trouvé leur formulation définitive. L'écriture à l'ordinateur, sans passer par la main, par le crayon et le papier, galvanise son écriture, et la facilité avec laquelle on peut effacer une chose et aussitôt la réécrire stimule sa relation ludique à la langue.
Œuvres
Romans
1979 : Bukolit. hörroman (commencé en 1968), Rhombus-Verlag, Vienne
1970 : Wir sind lockvögel baby!, Rowohlt, Reinbek.
1972 : Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft, Rowohlt, Reinbek.
1975 : Les Amantes (Die Liebhaberinnen), traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize et Yasmin Hoffmann aux éditions Jacqueline Chambon, Nîmes 1992.
1981 : Les Exclus (Die Ausgesperrten), traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize et Yasmin Hoffmann aux éditions Jacqueline Chambon, Nîmes 1989.
1983 : La Pianiste (Die Klavierspielerin), traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize et Yasmin Hoffmann, aux éditions Jacqueline Chambon, Nîmes 1988.
1985 : Méfions-nous de la nature sauvage (Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr), traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize et Yasmin Hoffmann, éditions J. Chambon, Nîmes, 1995.
1989 : Lust, traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize et Yasminn Hoffmann aux éditions Jacqueline Chambon, Nîmes 1991.
1995 : Enfants des morts (Die Kinder der Toten), traduit de l’allemand par Olivier Le Lay aux éditions du Seuil, Paris 2007.
2000 : Avidité (Gier), traduit de l’allemand par Claire de Oliveira aux éditions du Seuil, Paris 2003.
2007 : Neid (Privatroman)
Théâtre et pièces radiophoniques
1977 : Ce qui arriva quand Nora quitta son mari (Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften), traduit de l’allemand par Louis-Charles Sirjacq, l’Arche, Paris 1993
1981 : Clara S., Prometh-Verlag.
1987 : La Maladie ou Femmes modernes: comme une pièce (Krankheit oder Moderne Frauen, wie ein Stück), traduit de l’allemand par Patrick Démerin et Dieter Hornig, l’Arche, Paris 2001.
1985 : Burgtheater, Prometh-Verlag.
1987 : Le Président Abendwind (Präsident Abendwind).
1990 : Wolken.Heim., Verlag-Göttingen.
1991 : Totenauberg, traduit en français par Louis-Charles Sirjacq, l’Arche, Paris 1994.
1994 : Raststätte.
1996 : Stecken, Stab und Stangl.
1998 : Sportstück (Ein Sportstück), traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize, Yasmin Hoffmann et Louis-Charles Sirjacq, l’Arche, Paris 1999.
1998 : Désir et permis de conduire (comprend les textes: Ich möchte seicht sein, Sinn: egal Körper: zwecklos, Begierde und Fahrerlaubnis, Wolken.Heim., Er nicht als er), traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize, Yasmin Hoffmann et Louis-Charles Sirjacq, l’Arche, Paris 1999.
2000 : Das Lebewohl: 3 Dramen, Berlin-Verlag, Berlin.
2002 : In den Alpen, Berlin-Verlag.
2003 : Le Travail (Das Werk) [à propos de l’accident du funiculaire de Kaprun en novembre 2000], Berliner-Taschenbuch-Verlag Berlin.
2003 : Drames de princesses. La Jeune Fille et la Mort I - V (Der Tod und das Mädchen I – V, Prinzessinnendramen, Berliner-Tascherbuch-Verlag, Berlin; traduit de l’allemand par Magali Jourdan et Mathilde Sobottke, L’Arche, Paris 2004.
2004 : Bambiland, Rowohlt Verlag, Reinbek, traduit de l’allemand par Patrick Démerin, Éditions Jacqueline Chambon, Paris 2006.
2005 : Babel, Rowohlt Verlag, Reinbek.
2006 : Ulrike Maria Stuart, Rowohlt Verlag, Reinbek.
2006 : Sur les animaux (Über Tiere), Rowohlt Verlag, Reinbek.
2008 : Rechnitz (Der Würgeengel)
2009 : Die Kontrakte des Kaufmanns. Eine Wirtschaftskomödie
2010 : Das Werk/Im Bus/Ein Sturz
2011 : Winterreise, traduit de l’allemand par Sophie Herr, Le Seuil, Paris, 2012.
2011 : Blanche-Neige et La Belle au bois dormant
2012 : Restoroute. Animaux, traduit de l'allemand par Patrick Démerin et Dieter Hornig, Paris, Verdier, 2012
Poésies
1967 : L’Ombre de Lisa (Lisas Schatten), Relief-Verlag Eilers, Munich
Scénarios[modifier | modifier le code]
1982 : Les Exclus (Die Ausgesperrten), d’après son roman, écrit en collaboration avec le réalisateur Franz Novotny.
1991 : Malina de Werner Schroeter (d’après le roman éponyme d’Ingeborg Bachmann), coécrit avec le réalisateur.
2000 : Die Blutgräfin (coécrit avec Ulrike Ottinger).
2004 : Le Travail (Das Werk, d’après sa pièce) de Nicolas Stemann.
2007 : Ulrike Maria Stuart (d’après sa pièce) de Nicolas Stemann.
Sur l’auteure
Magali Jourdan et Mathilde Sobottke, Qui a peur d’Elfriede Jelinek ?, Paris, Danger Public, 2006.
Verena Koberg et Mayer, Elfriede Jelinek, un portrait, Paris, Le Seuil, 2009 (ISBN 9782020909259)
Christine Lecerf, Elfriede Jelinek, l’entretien, Paris, Seuil, janvier 2007.
Gérard Thiériot (dir.), Elfriede Jelinek et le devenir du drame, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2006 (ISBN 978-2-85816-869-9)
B. Banoun, Y. Hoffmann, K. Zeyringer (dir.), Dossier Elfriede Jelinek, in : Europe 933-934, janvier-février 2007.
Son roman le plus vendu : La Pianiste, a été adapté au cinéma en 2001 par Michael Haneke avec Isabelle Huppert, Annie Girardot et Benoît Magimel dans les rôles principaux. Jelinek a d’ailleurs participé à l’adaptation de quelques-unes de ses œuvres. En 1991, elle avait également cosigné le script du film Malina de Werner Schroeter (d’après un récit autobiographique d’Ingeborg Bachmann), déjà interprété par Isabelle Huppert.
Liens
http://youtu.be/wRjBtRi2E5s interview 1 (Allemand)
http://youtu.be/-Dbhq_9KKgA interview 2
http://youtu.be/oLh59ahphnE La pianiste extrait du film
http://youtu.be/XbVNY88gCAM la pianiste extrait
http://youtu.be/L6h9eommKeA la pianiste extrait
http://youtu.be/aAGCOwg6lc0 la pianiste extrait
Posté le : 19/10/2013 15:07
|
|
|
|
|
Re: Chef d'oeuvre ? Pas chef d'oeuvre ? |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Réponse "Les serments de Strasbourg 14 février 842"
Iktomi,
je voulais te dire merci, tu ne pouvais me faire plus plaisir qu'en présentant, qu'en nous faisant redécouvrir ce texte précieux.
Archéologue dans l'âme, (ma maîtrise dans ce domaine ne m'a pas suffit), je suis passionnée par la vie des mots, leurs naissances et la construction des langues.
"Tout d'abord fut le verbe"
Tout comme toi j'ai eu la chance de faire du latin ET du grec. j'adorai ces cours.
J'ai longtemps cru avoir tout oublié, tout, c'est certain, hormis mon amour pour mon vieux "François", et malgré tout j'observe souvent que j'en conserve une connaissance intuitive de ma langue, une méthodologie et une aisance à retrouver aisément l’étymologie des mots.(en dehors de mes étourderies de femme pressée),
Or, je crois maintenant, que je retrouve, en fait, des connaissances enfouies certes mais acquises et qui me permettent d'apprécier l'écriture et d'en admettre les contraintes.
C'est émouvant de lire ces mots, ces constructions de phrases, ces témoins du passé, tout comme lorsque l'on extrait de terre, des traces de civilisations anciennes, c'est le même bonheur, la même passion.
Je ne sais si tu as pu conserver tes cours du Lycée, pour ma part dans mes nombreux déplacements j'ai tout perdu et je le regrette, je le regrette beaucoup.
Je n'ai pu pour l'heure que faire une lecture rapide de ton article, mais je reviendrai lire, cha ché chur.
Grand merci
Posté le : 17/10/2013 17:32
|
|
|
|
|
Chef d'oeuvre ? Pas chef d'oeuvre ? |
|
Modérateur  
Inscrit:
11/01/2012 16:10
De Rivière du mât
Niveau : 23; EXP : 75
HP : 0 / 568
MP : 227 / 20726
|
Les serments de Strasbourg 14 février 842
A proprement parler, ce n’est pas un chef d’œuvre, car il ne s’agit pas d’un texte littéraire, mais politique : un traité d’assistance mutuelle entre deux des petits-fils de Charlemagne (Charles le Chauve et Louis le Germanique), dirigé contre un troisième frère (Lothaire Ier), et retranscrits par un historien nommé Nithard, lequel était également un descendant de Charlemagne... Mais le propos n’est pas d’examiner ici le contexte historique de ce texte.
Nous sommes en présence d’un monument, ou d’une sorte de fossile, car il est habituellement présenté comme le plus ancien texte en langue dite « française » qui nous soit parvenu. Mais si l’on s’en tient à une classification plus stricte, le plus ancien texte français littéraire serait alors le cantilène (ou la séquence) de Sainte Eulalie (« Buona pulcella fut Eulalia… »), postérieur d’une quarantaine d’années aux Serments.
J’ai toutefois préféré vous présenter ceux-ci car, pour des raisons que je ne suis jamais parvenu à élucider vraiment, ce texte me hante depuis que je l’ai découvert il y a plus de trente ans. Je crois que pour en saisir toute l’étrange beauté, il faut avoir eu la chance de faire un peu de latin - je le dis sans aucune arrière-pensée élitiste. Le latin est une option que j’avais choisie au collège, à une époque où il était possible de faire soit du latin, soit du grec ancien, et, si ma mémoire ne me trahit pas, certains établissements (publics, je précise) proposaient même de l’hébreu ancien.
Le latin, donc. Dans les lignes qui suivent, vous allez pouvoir contempler un instant, un très rare instant, celui où la langue qui est somme toute toujours la nôtre plus d’un millénaire après, se dégage de la gangue originaire du latin et commence déjà à ne plus en être, pour nous offrir une préfiguration de ce qui va devenir le français.
Pour les ex-latinistes, et en espérant ne pas assommer les autres, notez comment la langue du IXème siècle ne s’est pas encore défaite des cas, désinences et déclinaisons qui nous ont tant fait souffrir (mais si, mais si, ne le niez pas…), voyez comment le prénom Charles apparaît sous trois cas : Karlo, Karle, Karlus… Il faudra encore quelques siècles au français pour évacuer définitivement les déclinaisons alors que l’allemand devait les conserver (tant pis pour lui… et pour les infortunés germanistes dont je fus).
La version que je vous propose (il en existe plusieurs, avec des variantes mineures) est tirée de L'histoire des fils de Louis le Pieux, par Nithard (Editions Les Belles Lettres) :
« Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra dift, in o quid il mi altresi frazet et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit.
Si Lodhuuigs sagrament que son fradre Karlo jurat conservat et Karlus, meos sendra, de suo part non l’ostanit, si io returnar non l’int pois, ne io ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuuig nun li iu er.»
Traduction :
“Pour l’amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun, à partir d’aujourd’hui, en tant que Dieu me donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère Charles par mon aide et en toute chose, comme on doit secourir son frère, selon l’équité, à condition qu’il fasse de même pour moi, et je ne tiendrai jamais avec Lothaire aucun plaid qui, de ma volonté, puisse être dommageable à mon frère Charles.”
“Si Louis observe le serment qu’il jure à son frère Charles et que Charles, mon seigneur, de sont côté, ne le tient pas, si je ne puis l’en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j’en pourrai détourner, je ne lui serai d’aucune aide contre Louis.”
Liens et sources (texte et images) :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84238417
http://www.languefrancaise.net/HLF/Serments#top
http://www.languefrancaise.net/
http://www.babelio.com/livres/Nithard ... ieux-Avec-un-fasci/531375
Posté le : 17/10/2013 16:55
|
|
|
|
|
Charles-Augustin de Sainte Beuve |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 Octobre 1868 à Paris naît Charles Sainte-Beuve. critique littéraire et écrivain français,
L'écrivain
Comment parler aujourd'hui de Sainte-Beuve sans être contre Sainte-Beuve, avec tous ceux qu'il a méconnus ou calomniés, c'est-à-dire la plupart des grands écrivains de son temps : Balzac, Hugo, Stendhal, Baudelaire..., avec tous ceux qui ont dénoncé l'étroitesse de ses vues, la petitesse de son caractère, la mesquinerie de ses enquêtes biographiques, c'est-à-dire, derrière Proust, avec une cohorte de critiques médiocres qui, forts de l'exemple proustien, dénigrent le prétendu grand maître de la critique littéraire et se défendent de lui rien devoir alors même qu'ils ne font que l'imiter.
Mais que nous importent les jalousies et les poisons de Sainte-Beuve, ses ambitions et ses maladies ?
Les définir, écrire leur histoire, c'est être pour lui, c'est marcher sur ses traces, c'est faire cette critique biographique et psychologique qu'il pratiquait mieux que personne, en portraitiste et en causeur, et l'on a cru qu'il s'agissait de critique littéraire.
Ce qui compte, c'est le poids dont ont pesé ces volumes de feuilletons et de chroniques sur l'histoire de la littérature et sur la manière dont elle s'écrit.
Essayons de relire ce Saint-Beuve-là : portraits, causeries, histoire, mais aussi recueils de vers, romans et nouvelles, et de comprendre le sort qui lui fut réservé.
De l'échec du poète de Joseph Delorme à la consécration glorieuse du critique des Lundis, se dessine un itinéraire qui va d'un effort incompris pour créer des formes poétiques et romanesques nouvelles à une pratique à la fois érudite et diserte du discours critique qui en fixera le modèle pour un siècle.
Pour ou contre Sainte-Beuve ?
mais de quel Sainte-Beuve parle-t-on ? de l'homme ? de l'œuvre ? et de quelle œuvre ?
Vie et origine
Né à Moreuil le 6 novembre 1752, le père de l'auteur, Charles-François Sainte-Beuve, contrôleur principal des droits réunis et conseiller municipal à Boulogne-sur-Mer, se marie le 30 nivôse an XII : 21 janvier 1804 avec Augustine Coilliot, fille de Jean-Pierre Coilliot, capitaine de navire, née le 22 novembre 1764.
Toutefois, atteint par une angine, il meurt le 12 vendémiaire an XIII : 4 octobre 1804.
Orphelin de père dès sa naissance le 23 décembre 1804 à Boulogne-sur-Mer, Sainte-Beuve est élevé par sa mère et une tante paternelle, veuve également.
En 1812, il entre en classe de sixième comme externe libre à l'institution Blériot, à Boulogne-sur-Mer, où il reste jusqu'en 1818.
À cette époque, il obtient de poursuivre ses études à Paris.
Placé dans l'institution Landry en septembre 1818, il suit comme externe les cours du collège Charlemagne, de la classe de troisième à la première année de rhétorique, puis ceux du collège Bourbon, où il a pour professeur Paul-François Dubois, en seconde année de rhétorique et en philosophie.
En 1822, il est lauréat du Concours général, remportant le premier prix de poésie latine.
Après l'obtention de son baccalauréat ès lettres, le 18 octobre 1823, il s'inscrit à la faculté de médecine le 3 novembre.
Puis, conformément à l'ordonnance du 2 février 1823, qui l'exige pour les professions médicales, il prend des leçons particulières de mathématiques et passe le baccalauréat ès sciences, le 17 juillet 1824.
Toutefois, alors qu'il a été nommé en 1826 externe à l'hôpital Saint-Louis avec une chambre, il abandonne ses études de médecine en 1827 pour se consacrer aux lettres. Après un article anonyme paru le 24 octobre 1824, il publie dans Le Globe, journal libéral et doctrinaire fondé par son ancien professeur, Paul-François Dubois, un article signé "Joseph Delorme" le 4 novembre.
Le 2 et le 9 janvier 1827, il publie une critique élogieuse des Odes et ballades de Victor Hugo, et les deux hommes se lient d'amitié.
Ensemble, ils assistent aux réunions au Cénacle de Charles Nodier à la Bibliothèque de l'Arsenal.
A cette époque Charles Sainte -Beuve a une liaison avec l'épouse de Hugo, Adèle Foucher.
Le 20 septembre 1830, Sainte-Beuve et l'un des propriétaires du journal Le Globe, Paul-François Dubois, se battent en duel dans les bois de Romainville.
Sous la pluie, ils s'échangent quatre balles sans résultats. Sainte-Beuve, durant le duel, conserva son parapluie à la main, disant qu’il voulait bien être tué mais pas mouillé.
Après l'échec de ses romans, Sainte-Beuve se lance dans les études littéraires, dont la plus connue est Port-Royal, et collabore notamment à La Revue contemporaine. Port-Royal entre 1837 et 1859, le chef-d'œuvre de Saint-Beuve, décrit l'histoire de l'Abbaye de Port-Royal des Champs, de son origine à sa destruction.
Ce livre résulte d'un cours donné à l'Académie de Lausanne entre le 6 novembre 1837 et le 25 mai 1838.
Cette œuvre a joué un rôle important dans le renouvellement de l'histoire religieuse. Certains historiens qualifient Port-Royal de "tentative d'histoire totale".
Élu à l'Académie française le 14 mars 1844 au fauteuil de Casimir Delavigne, il est reçu le 27 février 1845 par Victor Hugo.
En 1848-1849, il accepte une chaire à l'université de Liège, où il donne un cours consacré à Chateaubriand et son groupe littéraire, qu'il publie en 1860.
À partir d'octobre 1849, il publie, successivement dans Le Constitutionnel, Le Moniteur et Le Temps des feuilletons hebdomadaires regroupés en volumes sous le nom de "Causeries du lundi", leur titre venant du fait que le feuilleton paraissait chaque lundi.
À la différence de Hugo, il se rallie au Second Empire en 1852.
Le 13 décembre 1854, il obtient la chaire de poésie latine au Collège de France, mais sa leçon inaugurale sur "Virgile et L'Énéide" , le 9 mars 1855, est perturbée par des étudiants qui veulent dénoncer son ralliement.
Il doit alors envoyer, le 20 mars, sa lettre de démission.
Par la suite, le 3 novembre 1857, il est nommé maître de conférences à l'École normale supérieure, où il donne des cours de langue et de littérature françaises de 1858 à 1861.
Sous l'Empire libéral, il est nommé au Sénat, où il siège du 28 avril 1865 jusqu'à sa mort en 1869.
Dans ces fonctions, il défend la liberté des lettres et la liberté de penser.
L'échec du poète
Qu'est-ce que Sainte-Beuve attendait de l'écriture ?
D'abord, la solution idéale d'une difficulté d'être qui n'était ni une angoisse métaphysique, ni, dès l'origine, un thème littéraire.
"Vie, poésies et pensées" de Joseph Delorme en 1829 racontent un mal qui, pour être aussi du siècle, n'est pas celui de René, mais celui d'un jeune plébéien sans avenir qui, pour échapper aux misères bien réelles de sa condition, rêve de la seule gloire que le règne de Charles X semble pouvoir lui offrir, Sainte-Beuve, lui-même orphelin de père, avait quitté Boulogne-sur-Mer où il était né pour venir à Paris où il connut une certaine gêne.
Il rêve de s'intégrer à une communauté étrangère aux distinctions de rang et de classe, celle des purs poètes :
" L'idée de s'associer aux êtres élus qui chantent ici-bas leurs peines et de gémir harmonieusement à leur exemple lui sourit au fond de sa misère et le releva un peu." Dans l'univers idéal où chaque poète occupe un domaine particulier, il pense obtenir le sien : si, par exemple, les vastes horizons et les hauteurs du ciel reviennent à Lamartine, il veut se réserver les aperçus terre à terre et les minuties de la vie intérieure.
Mais comment intéresser à une humble poésie domestique, toute proche de celle des lakistes, un public de privilégiés, pour qui l'élégie n'est que le luxe harmonieusement sentimental de belles âmes ennuyées ?
Passé 1830, Sainte-Beuve, Werther jacobin et carabin, saint-simonien d'un jour, a compris que, sous le régime de Juillet, il n'est pas d'Eden possible, même entre poètes.
En évoquant "le vrai des douleurs" Pensées d'août, il ne faisait qu'offenser des goûts délicats.
Ses poèmes sont rejetés comme prosaïques, dans tous les sens du mot.
En 1834, "Volupté" représente, sous l'influence de Lamennais, une nouvelle tentative pour chercher une issue au malaise de Joseph Delorme, transposé dans celui d'Amaury.
Roman poème, fondé sur l'exploration des souvenirs, "Volupté" reste une œuvre sans lendemain : en l'écrivant, Sainte-Beuve espère moins se faire reconnaître comme romancier que modifier sa propre condition et se modeler sur le personnage, guéri et unifié par la religion, qu'il s'est proposé de créer.
Mais, ainsi abordée par la littérature, la foi n'apporte pas plus de remède que la poésie.
Ces démarches de créateur, incomprises ou avortées, sont importantes, car elles ont amené Sainte-Beuve à découvrir que la littérature pouvait être mensonge : les œuvres éloquemment généreuses de tant de poètes, tel Lamartine, ou de nouveaux prophètes, tel Lamennais, lui apparaissent comme des oripeaux colorés et trompeurs dans lesquels se drapent des hommes faibles, passionnés et mesquins.
C'est à peindre ceux-ci que son œuvre ultérieure est consacrée.
L'"avocat" et le portraitiste
Pourtant, même en tant que portraitiste, Sainte-Beuve a commencé par l'illusion.
Chroniqueur du Globe, journal modérément romantique, il s'y fait très vite le propagandiste de l'école nouvelle.
Dans son Tableau historique et critique de la poésie et du théâtre français au XVIe siècle (1828), il veut
"chercher dans nos origines quelque chose de national à quoi se rattacher" dans Lundi du 15 octobre 1855, et défendre les jeunes poètes contre l'accusation d'être les imitateurs d'une poésie étrangère.
Il pratique, selon son propre mot, une critique "avant-courrière" et devient le "héraut" du génie de Victor Hugo.
Mais les enquêtes indiscrètes et véridiques succèdent bientôt aux dithyrambes.
Peu après 1830, Sainte-Beuve déclare préférer à l'éloquence et aux effusions romantiques la rigueur de l'analyse selon la méthode des idéologues.
Il s'applique à "chercher l'homme dans l'écrivain" et remarque que, pour y parvenir,"on ne saurait étudier de trop près, tandis et à mesure que l'objet vit" (Préface des Critiques et portraits littéraires, 1836).
C'est ainsi qu'il s'attachera désormais aux moindres détails pour attraper "le tic familier, le sourire révélateur, la gerçure indéfinissable" dans "Portrait de Diderot", en 1831.
Une pareille quête semble exiger que celui qui s'y livre ne soit "ni fanatique, ni même trop convaincu ou épris d'une autre passion quelconque" (article Du génie critique et de Beyle, 1835).
Mais la critique ainsi comprise consiste beaucoup plus à décrire les particularités morales qu'à analyser des œuvres littéraires.
Le "savant" et le "juge"
C'est en enseignant, à Lausanne, en 1837-1838, l'histoire de Port-Royal que Sainte-Beuve découvre comment la critique et l'histoire littéraires pourraient servir à l'édification d'une "histoire naturelle morale" et qu'il baptise "science littéraire" la détermination et le classement, à partir de documents, littéraires ou non, des "familles naturelles d'esprits".
Cette entreprise lui paraît impossible à mener à bien dans un monde où sévit le mercantilisme littéraire.
Ce n'est donc pas assez d'observer et de classer, il faudrait aussi pouvoir juger et dénoncer la décadence d'une littérature gâtée par "l'industrie", par l'abus des couleurs, la grandiloquence et le faux.
Ce nouvel exercice d'une critique fondée sur les arrêts du bon goût apparaît clandestinement dans les Chroniques parisiennes que Sainte-Beuve écrit pour la Revue suisse de Lausanne (1843-1845).
Passés les remous et les alertes de la révolution de 1848, qui l'ont obligé à un second exil, à Liège, et lui ont donné l'occasion de dire son mot sur la fausse grandeur du "père" des romantiques dans le cours sur Chateaubriand et son groupe littéraire, Sainte-Beuve se réjouit de la victoire de l'ordre moral et social, qui rend à nouveau possible l'exercice d'une critique discréditée par l'anarchie de la littérature industrielle.
Les causeries hebdomadaires qu'il commence en 1849 et poursuit quasi officiellement au Moniteur à partir de 1852 et jusqu'à sa mort à Paris apparaissent comme une entreprise de police littéraire.
Face aux dangers de corruption : romantisme et révolution, il importe de défendre la tradition.
"Le critique, assure-t-il, n'est qu'un homme qui sait lire et qui apprend à lire aux autres."
Fausse modestie d'un critique dogmatique qui veut inculquer la supériorité d'un certain classicisme, ignorant les frontières et les préjugés, mais respectueux de la mesure et du bon sens.
Cette magistrature critique se déguise toujours derrière des alibis scientifiques, résumés dans une devise :
"le vrai le vrai seul", et dans une méthode :"l'histoire naturelle des esprits".
Sainte-Beuve se fait fort de trouver pour chacun, qu'il s'agisse d'un grand écrivain ou non, et nombreux sont les Lundis consacrés à des personnages qui ne se sont signalés par aucune œuvre littéraire le mot qui le caractérise et qui permet de le rattacher à son groupe.
Vaste entreprise descriptive qui ne saurait avoir de terme et qui n'apporte aucune connaissance véritable ni de l'homme, ni des œuvres.
Contre Sainte-Beuve, "de Proust", résume assez bien par son titre même l'attitude de la pensée contemporaine à l'égard de celui qui passe encore pour le symbole de la critique littéraire.
En effet, nombreux sont les motifs du discrédit qui l'a frappé.
Mais il reste également qu'il y a aussi beaucoup de raisons pour Sainte-Beuve.
Sainte-Beuve, à différentes époques et à plusieurs reprises, a défini lui-même sa méthode.
On sait l'importance qu'il accorde à la biographie :
"En fait de critique et d'histoire littéraire, il n'est point, ce me semble, de lecture plus récréante, plus délectable et à la fois plus féconde en enseignements de toute espèce, que les biographies bien faites des grands hommes" en 1829.
Trente-cinq ans plus tard, il précise :
"Connaître, et bien connaître, un homme de plus, surtout si cet homme est un individu marquant et célèbre, c'est une grande chose et qui ne saurait être à dédaigner …. Un jour viendra …, un jour où la science sera constituée, où les grandes familles d'esprit, et leurs principales divisions seront déterminées et conçues. Alors le principal caractère d'un esprit étant donné, on pourra en déduire plusieurs autres" écrit-il en 1864.
Tel est le thème général : pénétrer par la sympathie dans l'existence d'un écrivain, c'est déjà jeter des lumières sur son œuvre ; mais il ne faut pas en rester là : il est possible de déceler des familles d'esprits parmi les écrivains, et le critique est comparable au naturaliste.
Contre Sainte-Beuve
Si la conception beuvienne paraît aujourd'hui dépassée, c'est qu'il y a déjà au départ une singulière déformation : trop souvent Sainte-Beuve a employé les œuvres à constituer des biographies. Mais surtout, et Proust l'avait bien remarqué, il méconnaît qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices", et, en conséquence, l'élément biographique, la connaissance personnelle des écrivains ne sont que d'un faible secours pour comprendre la genèse d'une œuvre. Cette œuvre est finalement insaisissable par la critique historique, comme le constate Valéry :
" Les prétendus enseignements de l'histoire littéraire ne touchent presque pas à l'arcane de la génération des poèmes …. Tout se passe dans l'intime de l'artiste …. Tout ce que l'histoire peut observer est insignifiant" écrit de 1920.
Les procédés de la critique beuvienne sont eux-mêmes d'une valeur douteuse.
Quand Sainte-Beuve déclare : Un écrivain, selon moi, n'est bien défini que quand on a nommé et distingué à côté de lui et ses proches et ses contraires, que fait-il d'autre, par un tel classement, sinon de se référer à un code artificiel ?
Car, et on l'a à bon droit souligné, en quoi sommes-nous renseignés sur un écrivain en apprenant qu'il ressemble à un autre avec quelque chose en plus ou en moins par exemple, Lesage est un "Molière adouci", Vauvenargues un "Pascal adouci et non affaibli", Beaumarchais égale Chamfort plus la gaieté ?
Sainte-Beuve dresse en effet une carte des grands écrivains, des têtes de file : Molière, La Fontaine, Pascal, Voltaire, Rousseau…, sortes d'astres de première grandeur qui servent de référence et autour desquels gravitent un certain nombre de talents moins puissants.
Ceux-là sont comparés à ceux-ci en fonction de critères politiques et moraux chers au critique : l'ordre, la raison, la discipline, et qui lui permettent de légiférer. De là une totale disparition de l'œuvre en soi au profit d'une entité inexistante, l'auteur.
On comprend que toute la critique actuelle se soit depuis longtemps insurgée contre cette façon de voir, ou plutôt de ne pas voir, la littérature.
Pour Sainte-Beuve
Mais il y a aussi un pour Sainte-Beuve. Il a eu l'intuition essentielle que la critique ne pouvait tout expliquer. En 1864, dans un article consacré à l'Histoire de la littérature anglaise de Taine et où il se montre plus souple que ce dernier, il écrit :
"Il reste toujours en dehors, jusqu'ici, échappant à toutes les mailles du filet, si bien tissé qu'il soit, cette chose qu'on appelle individualité du talent, du génie."
Sainte-Beuve l'a parfaitement compris : quel que soit le système, il ne peut que rester en dehors de ce miracle qu'est la naissance d'une œuvre d'art.
Ajoutons que l'auteur des Lundis a l'extraordinaire mérite de savoir éveiller les esprits. Rappellons sa formule : Le critique est un homme qui sait lire et qui apprend à lire aux autres.
Il s'est probablement trompé sur lui-même : au moins la lecture de son œuvre critique est-elle un remarquable ferment, tout comme son Port-Royal est une incessante invitation à la méditation.
Cette œuvre critique relègue quelque peu dans l'ombre, du fait de son ampleur, Sainte-Beuve poète.
Or, on est sensible à certains poèmes de Joseph Delorme, tels les "Rayons jaunes" : par sa mélancolie intimiste, ses notations familières dégagées de toute rhétorique, par le jeu des correspondances, Sainte-Beuve se révèle là un précurseur.
Comme s'il était conscient de la vanité de son ambition de naturaliste des esprits, Sainte-Beuve donne parfois une autre définition de sa critique.
Elle serait le prolongement de l'œuvre poétique interrompue, et, de portraits en portraits, le causeur des Lundis va en quête d'émotions nouvelles et se métamorphose en tous ceux qu'il cherche à faire revivre.
Quoi qu'il en soit, plaisir de dilettante ou devoir de moraliste, cette pratique de la critique est apparue comme un modèle.
Impressionnisme et nomenclatures pseudoscientifiques, tels sont bien les deux aspects principaux de la critique d'inspiration beuvienne.
Substituer à ce monde imaginaire de la littérature – où l'on ne rencontre que des individus : l'auteur, le lecteur, et le critique, guide du lecteur – la réalité plus complexe d'un monde où ni les œuvres littéraires ni les individus n'existent comme des entités absolument distinctes et "naturellement" définies, telle est la conversion que la critique et l'histoire littéraires n'ont pas fini d'accomplir pour atteindre leur objet véritable : ni pour, ni contre Sainte-Beuve, mais après Sainte-Beuve et ses imitateurs.
Œuvres
Poésie
Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme (1829)
Les Consolations (1830)
Pensées d'août (1837)
Livre d’amour (1843)
Poésies complètes (1863)
Romans et nouvelles
Volupté (1835)
Madame de Pontivy (1839)
Christel (1839)
Le Clou d’or qu'il dédia à Sophie de Bazancourt, femme du général François Aimé Frédéric Loyré d'Arbouville.
La Pendule (1880)
Critiques
Tombe de Sainte-Beuve au cimetière du Montparnasse, à Paris.
Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au xvie siècle (1828), 2 volumes
Port-Royal (1840-1859), 5 volumes
Portraits littéraires (1844 et 1876-78), 3 volumes
Portraits contemporains (1846 et 1869-71), 5 volumes
Portraits de femmes (1844 et 1870)
Causeries du lundi (1851-1881), 16 volumes
Nouveaux lundis (1863-1870), 13 volumes
Premiers lundis (1874-75), 3 volumes
Étude sur Virgile (1857). Texte de cette étude annoté par Henri Goelzer en 1895.
Chateaubriand et son groupe littéraire (1860), 2 volumes
Le Général Jomini (1869)
Madame Desbordes-Valmore (1870)
M. de Talleyrand (1870)
P.-J. Proudhon (1872)
Chroniques parisiennes (1843-1845 et 1876)
Les cahiers de Sainte-Beuve (1876)
Mes poisons (1926)
Correspondance
Lettres à la princesse (Mathilde) (1873)
Correspondance (1877-78), 2 volumes
Nouvelle correspondance (1880)
Lettres à Collombet (1903)
Correspondance avec M. et Mme Juste Olivier (1904)
Lettres à Charles Labitte (1912)
Lettres à deux amies (1948)
Lettres à George Sand
Lettres à Adèle Couriard
Correspondance générale, 19 volumes
Liens
http://youtu.be/I-_PtQXSQbg Ste Beuve dans le Boulonnais
http://youtu.be/HA_FwbuYgIA Portraits de femmes de Ste Beuve INA
http://youtu.be/th8SCHSM5Bg Un livre Un jour. Le siècle du progrès
http://youtu.be/KKUVd1_tGHQ Les rayons jaunes (Poème)
http://youtu.be/c98EW2MxDdU Dans ce cabriolet (Poème)
http://youtu.be/fu2aPUXfJ1M Mon âme (poème)
   [img width=600]https://www.morebooks.de/assets/product_images/9786131599/big/2734217/charles-augustin-sainte-beuve-lecteur-des-auteurs-latins.jpg?locale=fr[/img]
Posté le : 12/10/2013 14:08
Edité par Loriane sur 13-10-2013 16:04:55
|
|
|
|
|
Henry Roth |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 Octobre 1995 meurt Henry Roth, Henry Roth est un écrivain américain.
Son premier roman, L'Or de la terre promise, Call it sleep, est publié en 1934 qui passe inaperçu. De plus, comble de malchance, son éditeur fait faillite. Henry Roth laisse alors de côté ses ambitions littéraires.
Sa vie
Henry Roth est né le 8 Février 1906 à Tysmenitz, une petite bourgade de Galicie, province polonaise faisant à l'époque partie de l'Empire austro-hongrois. C'est dans les bras de sa mère à l'âge de trois ans, qu'il débarque à Ellis Island, New York.
Son enfance se passe dans le Lower East Side, qui était alors le quartier juif dans le bas Manhattan, et qui sert de toile de fond à Call It Sleep, le roman incandescent qu'il publie en 1934 avant de disparaître totalement de la scène littéraire pendant soixante ans. Call It Sleep, traduit en français sous le titre "L'Or de la Terre promise" apparaît comme un roman expressionniste de la grande ville, une version hallucinée du Manhattan Transfer "de Dos Passos".
De la rue montent les cris des colporteurs et la mélopée des marchands de guenilles.
Dans la cour de l'école maternelle, des gosses qui parlent yiddish à la maison font la ronde en chantant d'une voix claire des comptines anglaises.
De partout filtre la rumeur babélique des langues : le yiddish, mais aussi l'hébreu qu'on ânonne sur les bancs du heder, l'école traditionnelle primaire, des bribes du polonais que parlaient les parents “dans le vieux pays”, l'anglais dans la variété de ses accents et dialectes ; tout un tourbillon linguistique auquel vient se mêler la partition cacophonique du Nouveau Monde urbain : la sirène des usines, le murmure des fils électriques, le cliquetis du trolley, la corne des remorqueurs, là-bas, sur l'East River – le tout crescendo jusqu'à un finale apocalyptique aujourd'hui célèbre.
"Call it sleep"
Aucun écrivain américain n'a mieux retenu la leçon de Joyce que Henry Roth.
"Call It Sleep" : on n'a pu, dans la traduction française, conserver ce titre, splendide mais trop idiomatique.
“Tu as envie de dormir ?” demande la mère. On peut appeler cela “dormir”, mais au moment où l'enfant glisse dans le sommeil s'éveille en lui toute une fantasmagorie proustienne.
Écrit à l'ombre de Freud, que l'Amérique découvrait avec passion dans les années 1920, le roman est entièrement réfracté à travers le prisme de la conscience du petit David. David – sept ans environ – est à l'âge des premiers troubles, des premiers jeux interdits.
Et, de même que chaque fois qu'il passe devant la porte de la cave son pouls s'accélère à l'idée que de la puanteur obscure du sous-sol vont déferler des hordes de rats, de même il est terrifié par les pulsions qui surgissent des tréfonds de lui-même.
On est en fait dans le vieux triangle œdipien. Le père gagne chichement sa vie en faisant quotidiennement sa tournée de laitier “au cul d'un vieux canasson” ; mais à l'enfant traqué ce père musculeux et violent, l'arc noir de son fouet levé au-dessus de sa tête, apparaît tel un ogre effrayant, cramoisi. Heureusement qu'il y a les moments de bonheur, lorsque le petit garçon se retrouve seul dans l'intimité de sa mère, à l'heure enchantée, par exemple, du soir du sabbat, lorsqu'elle prépare la table, la nappe, les bougies.
Ce n'est pas le seul déchirement que vit cet enfant à mi-chemin entre deux mondes. D'un côté, il y a la mémoire, l'hébreu de la Torah ou du Talmud, les signes qu'un vieux rabbin apprend à déchiffrer et à psalmodier à une troupe de garnements “américains”, turbulents et rétifs : ce monde énigmatique fascine assez le jeune David pour qu'il soit hanté jusqu'à l'illumination quasi mystique par un passage du prophète Isaïe. De l'autre côté, il y a les vastes toits plats de New York, où l'on grimpe pour faire voler les cerfs-volants et d'où l'on voit au loin, à l'ouest, l'espace américain, l'espace des goyim, qui fait signe avec sa promesse d'évasion.
L'oubli
Un peu comme Tendre est la nuit de Scott Fitzgerald, paru la même année et avec lequel il n'est pas sans parenté, "Call It Sleep", météore mis sur orbite dans les années 1920, parut alors que les temps avaient changé.
Depuis 1932, on était entré dans les années noires de la Dépression.
La critique exigeait que la littérature en finisse avec l'“introspection morbide” : il fallait empoigner ses outils et décrire avec réalisme la condition du prolétariat.
Son éditeur ayant de plus fait faillite, le chef-d'œuvre de Henry Roth tomba rapidement dans l'oubli.
Il épouse, en 1939, Muriel Parker, fille d'un pasteur baptiste et pianiste qui renoncera à sa carrière pour l'accompagner dans l'État du Maine où il exerce plusieurs métiers, garde forestier, infirmier dans un hôpital psychiatrique, aide plombier….
Le couple avec ses deux enfants, finit par s'établir dans une ferme en 1954 et vit d'un élevage d'oies et de canards ainsi que du salaire d'institutrice de Muriel Parker, fille d'un pasteur baptiste de vieille souche de Nouvelle-Angleterre, Pianiste, elle avait été, à Paris, l'élève de Nadia Boulanger.
En 1954, ils achètent une petite ferme, où Henry élève des canards et des oies. Le couple et leurs deux enfants vivent en réalité du modeste salaire d'institutrice de Muriel : Henry Roth a sombré dans une longue “dépression chronique”.
Lorsqu'en 1964, un miracle se produit, dans le sillage du “réveil ethnique”, on redécouvre "Call It Sleep", beaucoup croient son auteur mort depuis longtemps.
Un succès inattendu
La réédition du livre se vend à plus d'un million d'exemplaires.
Avec les droits, le couple Roth s'installe au Nouveau-Mexique.
C'est là que, “en l'an de son soixante-treizième âge”, Henry Roth commence à rédiger, à partir de 1979, son autobiographie, qui porte le titre général d'"À la merci d'un courant violent" “qui doit m'engloutir à jamais”, ajoute la citation de Shakespeare et dont le premier volume – "Une étoile brille sur Mount Morris Park" – paraît en 1994, soit après soixante longues années d'exil intérieur et de silence.
Il sera suivi en 1995 par "Un rocher sur l'Hudson".
"À la merci d'un courant violent" reprend le fil de la chronologie là où le roman l'avait laissé : pendant “l'été 14”, à Harlem – qui n'est pas encore le “ghetto” noir que l'on sait – où la famille Roth s'est “exilée” alors que le jeune Henry a huit ans.
Plus encore qu'une “suite”, toutefois, c'est à un autre regard porté sur le “grand roman” qu'on a ici affaire.
Avec le recul, par exemple, l'énorme ogre de père s'est prodigieusement recroquevillé ; il n'était au fond qu'un “petit homme”, un immigrant timoré compensant sa faiblesse par des accès de violence.
C'est l'enfant qui, obnubilé par son drame œdipien, en a magnifié la figure : le “petit salaud” de gosse dont le vieil Henry aujourd'hui, instruit, quelque quatre-vingts ans après les faits, fait le procès.
Lorsque Henry Roth cite en l'adaptant Le Testament de François Villon, “En l'an de mon trentième âge”, il omet le vers suivant :
“Que toutes mes hontes j'eus bleues.”
Henry Roth a atteint le vieil âge où ses hontes sont désormais loin derrière lui.
Il va dire crûment tout ce qui dans le “grand roman” était resté censuré, masqué par la prestigieuse pyrotechnique apprise chez Joyce – Joyce, son héros et modèle d'antan, dont il voit aujourd'hui à quel point c'est la phobie des émotions qui l'a amené à tisser une perverse “chrysalide verbale”.
Avouer n'est pas facile.
Périodiquement, il faut qu'Ecclesias, l'ordinateur sur lequel il écrit, lui affiche un message : “Tu n'as rien oublié ?” “J'y viens, Ecclesias.
J'y viens.” Henry Roth ose raconter, avec cruauté, tout ce qu'on ne faisait que soupçonner.
La plus scandaleuse de ces révélations : les relations incestueuses qu'à seize ans il entretenait avec sa jeune sœur de quatorze – cela, il l'avait tellement censuré que dans Call It Sleep il avait fait de David un enfant unique.
L'œuvre romanesque d'Henry Roth est l'histoire de sa propre vie. Elle est marquée par une enfance miséreuse sous l'emprise d'une tradition juive orthodoxe qui l'étouffe et le complexe dans ses rapports avec le monde extérieur.
Il vit mal l'héritage culturel et ne parvient pas à l'assumer. Avec le recul de ses 80 ans, l'assurance de ne plus nuire à personne, l'auteur décrit ses rapports tourmentés avec sa famille et révèle une relation incestueuse avec sa sœur.
Un éveil dénaturé à la sexualité dont l'écho se propage toute sa vie et dans ses rapports amoureux.
Le fil du récit s'émaille de réflexions de l'auteur âgé, des parenthèses où il met en perspective les événements décrits, fait part des interrogations que lui inspire le roman qu'il est en train d'écrire.
L'œuvre demeure inachevée lorsqu'il décède le 13 octobre 1995, à Albuquerque ; des six tomes envisagés, quatre ont été publiés.
L'autre révélation, plus oblique, est la crainte où il a vécu de glisser sur la pente de la “dégénérescence”.
Là, sans doute, est une clé possible du long silence de Henry Roth ; comme s'il avait eu peur, en continuant à écrire, d'en dire trop long sur lui, de se “trahir”.
Finalement, à l'article de la mort, il a mis son cœur à nu. Après plus d'un demi-siècle de silence, il a relancé in extremis son œuvre afin de faire, juste avant ses adieux, ce long aveu.
Il décéde le 13 octobre 1995 à Albuquerque, Nouveau-Mexique, aux États-Unis.
Oeuvre
L'Or de la terre promise, Call it sleep, 1934
À la merci d'un courant violent
Mercy of a Rude Stream, 1994, en quatre tomes :
Une étoile brille sur Mount Morris Park, A Star Shines Over Mount Morris Park,
Un rocher sur l'Hudson, A Diving Rock on the Hudson,
La fin de l'exil, From Bondage et
Requiem pour Harlem, Requiem for Harlem.
Posté le : 12/10/2013 13:24
|
|
|
|
|
Patrick Cauvin |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 6 Octobre 1932 naît, à Marseille, Patrick Cauvin
Patrick Cauvin, de son vrai nom Claude Klotz est un écrivain français.
Son père, cheminot, fait de lui un intoxiqué de l’écran, en l’emmenant très tôt voir une multitude de films américains. Humphrey Bogart incarne alors, à ses yeux, l’image emblématique du cinéma;
De 1951 à 1954, Claude Klotz poursuit ses études à la Sorbonne, où il obtient une licence de philosophie.
De 1964 à 1976, il enseigne le français dans des lycées de la région parisienne, au lycée technique de Bezons et réside dans des H.L.M. à Sarcelles.
Claude Klotz qui vit depuis 1938 à Paris, est marié et père de deux enfants. Après des études de philosophie, il fait la guerre d'Algérie puis enseigne dans un collège de banlieue parisienne jusqu'en 1976. Il vit aujourd'hui de sa plume et est critique de cinéma au journal Pilote.
En 1973, il aide Joseph Joffo à écrire le best-seller Un sac de billes.
Marqué par la guerre d'Algérie, il écrit des romans noirs sous son vrai nom : une série de treize intrigues policières sanglantes au héros récurrent baptisé Reiner, puis renommé Raner. Lassé de cet univers âpre, Claude Klotz apporte en 1974 une histoire d’amour à son éditeur Jean-Claude Lattès.
Ce dernier lui demande de changer de nom s’il espère vendre son roman L’amour aveugle.
Il prend alors le pseudonyme de Patrick Cauvin.
J’étais loin d’imaginer que Cauvin battrait Klotz, qu’il vendrait plus de livres, et que cette double identité … continuerait à désarçonner les gens.
En 1977, tandis que Monsieur Papa, publié en 1976 sort sur les écrans, mis en scène par Philippe Monnier avec Daniel Auteuil et Claude Brasseur, E=mc2 mon amour, une histoire d’amour entre deux jeunes adolescents surdoués, connaît un succès retentissant. Un an plus tard, cette histoire sera également adaptée pour le cinéma, cette fois-ci par George Roy Hill.
En 1980, il est rédacteur d’une chronique de cinéma illustrée par le dessinateur Régis Franc, dans le magazine de bande dessinée Pilote.
Il signe en 1981 Nous allions vers les beaux jours, récit sur la Shoah.
Ce traitement romancé de l’Histoire lui a valu de nombreuses critiques. Or il est évident à ses yeux que cette période de l’Histoire peut faire l’objet d’une fiction. La liberté de l’écrivain — Sartre l’a écrit — est totale, ou n’est pas ! »
En 1982, dans les dédales du temple de Karnak en Égypte, Patrick Cauvin remarque un couple de handicapés qui, dans leur fauteuil, semblent beaucoup s’amuser. Revenu à Paris, il songe à l’histoire de deux jeunes gens qui, en dépit de leurs souffrances physiques, découvrent une certaine joie de vivre : Dans les bras du vent sortira l’année suivante.
Entre la violence de Claude Klotz' et la tendresse de Patrick Cauvin, Laura Brams brouille les cartes en 1984.
Signée Cauvin, cette histoire d’amour hitchcockienne ressemble étrangement à Klotz. Sans cesse partagé entre sa fascination pour l’image et son art de l’écriture, il joue dans ce récit sur des techniques empruntées au cinéma.
Mon ambition, c’est de faire du lecteur un spectateur.
À coups de dialogues qui sont mes moyens à moi de faire des champs et contrechamps.
En 1985, le temps d’une scène d’un numéro des Dossiers de l'écran, intitulé La politique est mon métier, il joue le rôle d’un député socialiste des années 1930.
Il reçoit en 1986 le prix Vogue Hommes, pour Haute-Pierre, sorti l’année précédente chez Albin Michel, un prix créé à l’initiative du magazine éponyme et destiné à récompenser un roman français susceptible d’être adapté au cinéma.
En collaboration avec le célèbre dessinateur Bilal, il signe en 1987 Hors jeu, éd. Autrement, œuvre originale d’une imagination délirante sur le football du futur.
Il est le scénariste en 1990 du film Le Mari de la coiffeuse, réalisé par Patrice Leconte.
En 1994, Jean-Pierre Cottet, directeur de l’antenne sur France 3, lui demande son aide pour la création de fictions.
Il y occupe un rôle de conseiller et assiste les scénaristes sur l’écriture des dialogues.
L'année suivante, Patrick Cauvin est invité à donner une conférence dans un centre culturel à Tananarive Madagascar pour évoquer son roman Villa Vanille. Le séjour s’avère être cauchemardesque pour l’écrivain. Il découvre, une fois sur place, que la presse locale est unanimement négative à son égard et passe, de peur d’être la cible de bandits de grands chemins, ses journées confiné dans sa chambre d’hôtel.
Vingt-deux ans après la sortie de E=mc2 mon amour, les deux protagonistes, Lauren et Daniel, se retrouvent en 1999 dans Pythagore, je t'adore, qui connaît un franc succès. Alors que le romancier s’était promis de ne jamais écrire de suite, la nostalgie de ses premières intrigues le décide, finalement, à faire revivre ses jeunes héros.
Avec l’œil d’un journaliste attentif et passionné, il signe en 2001 La Reine du monde, un roman colonial dédié aux peuples africains. L'écrivain s’impose un rythme de travail qui n’excède pas quatre heures d’écriture quotidiennes. Patrick Cauvin se met en 2002 dans la peau de son double, Claude Klotz, en signant un thriller au suspense implacable : Le Sang des roses. C’est toujours l’histoire qui décide lequel des deux prend la plume.
Il parraine en 2006 la 1re édition du Balcon Marseillais du Polar et du livre Méditerranéen créé par Laurence Mauro, présidente du Pôle Art Marseillais
Il décède le 13 août 2010 à l'âge de 77 ans
Œuvres
1969 : Sbang-sbang, Christian Bourgois, sous le nom de Claude Klotz
1970 : Et les cris de la fée, Christian Bourgeois, sous le nom de Klotz
1971 : Les Innommables, sous le nom de Claude Klotz
1972: Dolly Dollar (Série Reiner),Christian Bourgois, sous le nom de Klotz
1974: Paris Vampire, JC Lattès, sous le nom de Claude Klotz
1976 : Monsieur Papa, Le Livre de poche
1977 : E=mc2 mon amour, Le Livre de poche
1982 : Nous allions vers les beaux jours, Le Livre de poche
1982 : L'Amour aveugle, Le Livre de poche
1983 : Pourquoi pas nous ?, Le Livre de poche
1983 : Huit jours en été, Le Livre de poche
1984 : C'était le Pérou, Le Livre de poche
1985 : Dans les bras du vent, Le Livre de poche
1986 : Laura Brams, Le Livre de poche
1987 : C'était le Pérou, t. II, Le Livre de poche
1987 : Haute-Pierre, Le Livre de poche
1988 : Povchéri, Le Livre de poche
1989 : Killer kid, Albin Michel, sous le nom de Claude Klotz
1990 : Werther, ce soir..., Le Livre de poche
1992 : Rue des bons-enfants, Le Livre de poche
1992 : Kobar, Albin Michel
1993 : Belles galères, Le Livre de poche
1995 : Menteur, Le Livre de poche
1996 : Tout ce que Joseph écrivit cette année-là, Le Livre de poche
1997 : Villa Vanille, Le Livre de poche
1998 : Présidente, Le Livre de poche
1999 : Théâtre dans la nuit, Le Livre de poche
2001 : Pythagore, je t'adore, Le Livre de poche
2002 : Torrentera, Le Livre de poche
2002 : L'Homme du train, Le Livre de poche
2004 : Le Sang des roses, Le Livre de poche
2004 : Le Silence de Clara, Albin Michel
2005 : Jardin fatal, Le Livre de poche
2005 : La Reine du monde, Le Livre de poche
2007 : Belange, Le Livre de poche
2007 : Venge-moi !, Le Livre de poche
2008 : Les Pantoufles du samouraï, Le Livre de poche
2008 : La Maison de l'été, éditions NiL
2009 : Déclic, Plon
2010 : Une seconde chance, Plon
2011 : La nuit de Skyros, Plon
2012 : La Forteresse de porcelaine, Le Cherche Midi
Au théâtre
2008 : Héloïse de Patrick Cauvin, mise en scène de Patrice Leconte, avec Rufus, Mélanie Bernier, Bernard Alane, Agathe Natanson, Isabelle Spade, Laurent Gendron
Liens
http://youtu.be/jsvl0RlHTW4 Chronique livres Partick Cauvin
http://youtu.be/oWIblNw95Gs Patrcik Cauvin et d'autres chez Pivot
http://youtu.be/Ee5mZmemyVo Les pantoufles du samouraï de P. Cauvin
Posté le : 06/10/2013 11:18
|
|
|
|
|
Jose Cabanis |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 6 Octobre 2000, à Balma, meurt José Cabanis
Romancier, essayiste et magistrat français. Il fut élu mainteneur de l'Académie des Jeux floraux en 1965 et membre de l'Académie française en 1990.
Né le 24 Mars 1922 à Toulouse, José Cabanis fait ses études dans cette ville. De 1943 à 1945, il est requis au titre du S.T.O. en Allemagne.
En 1952, il publie son premier roman, L'Âge ingrat, que prolongeront L'Auberge fameuse en 1953 et Juliette Bonviolle en 1954.
Du prix Renaudot qui lui est décerné à l'unanimité au premier tour, en 1966, pour La Bataille de Toulouse à l'Académie française, où il est élu en 1990, la reconnaissance ne lui a pas été mesurée.
Mais ses racines provinciales, catholiques, et sa formation de juriste, il fit la majeure partie de sa carrière à Toulouse comme expert auprès des tribunaux l'ont toujours tenu éloigné du cœur de la vie littéraire.
D'où la distance et l'acuité d'une observation de moraliste qui se déploie aussi bien dans le tableau des mœurs de la vie de province – dans le Sud-Ouest où se situe l'action du cycle autobiographique de L'Âge ingrat – que dans de remarquables essais historiques, "Le Sacre de Napoléon", 1970 ; Charles X, roi ultra, 1972.
La part prise par l'essai, Jouhandeau, 1959 ; Mauriac, le roman et Dieu, 1991 ; Pour Sainte-Beuve, 1995, l'étude et l'histoire, Saint-Simon l'admirable, 1974) ira d'ailleurs croissant chez lui.
Au début de son œuvre romanesque, José Cabanis n'innove guère, malgré son talent d'écrivain classique, par rapport à la filiation d'un genre illustré notamment par Les Thibault de Roger Martin-du-Gard, ou Les Pasquier de Georges Duhamel.
Mais au fil de son évolution, l'affabulation poétique et l'entrecroisement de la confidence et de l'histoire lui permettent de donner toute la mesure de son talent comme dans La Bataille de Toulouse.
Sur un thème voisin d'Albertine disparue, la trahison et les mensonges de l'amour, le narrateur tisse un subtil contrepoint entre la souffrance que lui inflige Gabrielle, insaisissable, infidèle, sensuelle sans réticence, et son travail d'écrivain, en l'occurrence le récit de la bataille de Toulouse qui opposa Soult et Wellington en 1812.
Tout au long de son œuvre, l'accent très personnel de José Cabanis se reconnaît à la musicalité d'une prose, où la recherche du bonheur n'est pas séparable de la mélancolie, parce que les souvenirs de l'enfance et de l'adolescence ont à jamais rendu illusoires les plaisirs de l'amour.
En même temps, l'exercice de l'écriture tend un voile entre la conscience et l'appréhension du présent le plus comblé.
On ne s'étonnera pas que, après avoir tenté de se dévoiler dans la publication de plusieurs volumes de son journal intime L'Escaladieu, 1987 en analysant son évolution vers la foi, Cabanis se soit penché avec perspicacité dans Dieu et la N.R.F. 1994, puis dans Le Diable et la N.R.F. 1996 sur la complexité psychologique des principaux animateurs de la N.R.F. des temps héroïques : Gide, Martin-du-Gard, Schlumberger, Ghéon, et sur leur rapports au sacré.
Après avoir écrit une dizaine de romans et quelques essais, il entre à l’Académie française, le 21 juin 1990, pour y occuper le 20e fauteuil. Son épouse, née Andrée Depeyre, est décédée le 3 mars 2012 à Toulouse à l'âge de 86 ans.
Œuvres
La Pitié (Schopenhauer, Nietzsche, Max Scheler, Dostoïevski) (Gallimard, 1948)
L’Organisation de l’État d’après La République de Platon et La Politique d’Aristote (Gallimard, 1948)
L’Âge ingrat (Gallimard, 1952)
L’Auberge fameuse (Gallimard, 1953)
Juliette Bonviolle (Gallimard, 1954)
Le Fils (Gallimard, 1956)
Les Mariages de raison (Gallimard, 1957)
Jouhandeau (Gallimard, 1959)
Le Bonheur du jour, (Gallimard, 1960), Prix des Critiques
Les Cartes du temps, (Gallimard, 1964), Prix des libraires
Plaisir et lectures. I. (Gallimard, 1964)
Les Jeux de la nuit (Gallimard, 1964)
Proust et l’écrivain (Hachette, 1965)
La Bataille de Toulouse (Prix Renaudot) (Gallimard, 1966)
Plaisir et lectures. II. (Gallimard, 1968)
Une vie, Rimbaud (Hachette, 1968)
Des Jardins en Espagne (Gallimard)
Le Sacre de Napoléon (Gallimard)
Préface du Tome I des œuvres de Julien Green (Bibliothèque de la Pléiade, 1972)
Charles X, roi ultra (Prix des Ambassadeurs) (Gallimard, 1974)
Saint-Simon l’admirable (Grand Prix de la Critique) (Gallimard, 1974)
Saint-Simon ambassadeur (Gallimard, 1974)
Les Profondes Années (Grand Prix de Littérature de l’Académie française) (Gallimard, 1976)
Michelet, le prêtre et la femme (Gallimard, 1978)
Petit entracte à la guerre (Gallimard, 1980)
Lacordaire et quelques autres (Gallimard, 1982)
Préface aux Conférences de Lacordaire à Toulouse (Éd. d'Aujourd'hui)
Le Musée espagnol de Louis-Philippe. Goya (Gallimard, 1986)
Préface aux Affaires de Rome, de Lamennais (La Manufacture, 1986)
L’Escaladieu (Gallimard, 1987)
Pages de journal (Éd. Sables, 1987)
Pour Sainte-Beuve (Gallimard)
Chateaubriand, qui êtes-vous ? (La Manufacture, 1988)
Préface de La Correspondance Lacordaire-Montalembert (Le Cerf, 1989)
L’Âge ingrat, réédition de l’ensemble du cycle (Gallimard, 1989)
Préface du Tome VI des Œuvres de Julien Green (Bibliothèque de la Pléiade, 1990)
Le Crime de Torcy, suivi de Fausses nouvelles (Gallimard, 1990)
En marge d’un Mauriac (Éd. Sables, 1991)
Mauriac, le roman et Dieu (Gallimard, 1991)
Préface à un choix de pages du Temps immobile, de Claude Mauriac (Grasset, 1993)
Préface à Dits et inédits, de Bussy-Rabutin (Éd. de l’Armançon, 1993)
Dieu et la NRF, 1909-1949 (Gallimard, 1994)
Le Diable à la NRF, 1911-1951 (Gallimard, 1996)
Autour de Dieu et le Diable à la NRF (Éd. Sables, 1996)
Magnificat (Éd. Sables, 1997)
Jardins d’écrivains (en collaboration avec Georges Herscher) (Actes-Sud, 1998)
Julien Green et ses contemporains, le cas Mauriac (en collaboration à Littératures contemporaines, Julien Green) (Klincksieck, 1998)
Le Sacre de Napoléon (nouvelle édition) (Le Grand livre du mois, 1998)
Entretien (en collaboration à Chateaubriand aujourd’hui) (Éd. Cristel, 1998)
Lettres de la Forêt-Noire, 1943-1998 (Gallimard, 2000)
Hommages[modifier | modifier le code]
Il existe une médiathèque José-Cabanis à Toulouse.
Liens
http://youtu.be/-l1_AT4MR8k Léautaud par José Cabanis
http://youtu.be/9YKqSvlwD3k Le Renaudot pour José Cabanis
http://youtu.be/2aIurHEOYjg succès pour la médiathèque José Cabanis à Toulouse
http://youtu.be/JmGTYsMmrP8 lettre de la forêt noire de José Cabanis
Posté le : 06/10/2013 10:23
|
|
|
|
|
Paul Féval |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 29 Septembre 1816 naît Paul Féval écrivain français.
Ne doit pas être confondu avec Paul Féval fils.
Paul Henry Corentin Féval est un écrivain français, né le 29 septembre 1816 à Rennes et mort le 7 mars 1887 à Paris 7e.
Son œuvre, composée de plus de 200 volumes dont de nombreux romans populaires édités en feuilleton, eut un succès considérable de son vivant, égalant celle d’Honoré de Balzac et d’Alexandre Dumas.
Issu d'une famille de magistrats assez peu fortunée, Paul Féval fut l'un des auteurs de romans-feuilletons les plus productifs et les plus célèbres du XIXe siècle.
À treize ans, il passe une année dans un mystérieux manoir du Morbihan, refuge de conspirateurs chouans, et il restera fortement imprégné de folklore breton.
Les jeunes années
Paul Henry Corentin Féval naît le 29 septembre 1816 à trois heures et demie du soir dans l'Hôtel de Blossac, rue du Four-du-Chapitre à Rennes.
Son père, royaliste et chrétien, originaire de Troyes appartient à la petite magistrature, il est conseiller à la Cour royale de la ville.
Sa mère, Jeanne-Joséphine-Renée Le Baron, est Bretonne de la région de Redon. La famille est nombreuse, cinq enfants et les revenus sont insuffisants.
En 1826, à l'âge de 10 ans, Paul entre comme interne au collège royal de Rennes, aujourd'hui, lycée Émile-Zola.
Son père meurt l'année suivante.
En troisième, au plus fort des troubles révolutionnaires de 1830, il affiche au collège des opinions monarchistes, déclenche des bagarres. Le proviseur le prie d'aller se calmer à la campagne.
Il passe quelques mois chez son oncle, le comte Auguste de Foucher de Careil, au château de la Forêt-Neuve, en Glénac. Le séjour va le marquer profondément.
Des conspirateurs s'assemblent la nuit au château, on fond des balles.
Paul laisse son imagination s'enfiévrer, il ne rêve que batailles et massacres. Il entend des légendes macabres à la veillée, parcourt les landes, erre entre les marais, s'enfonce dans les brouillards, recueille des récits de la bouche d'anciens chouans de 1793…
Il revient à Rennes en janvier 1831, et entre en classe de seconde.
Il obtient son diplôme de bachelier en 1833.
Il oriente ses études vers le droit. Il passe sa licence à l’université de Rennes et devient avocat en 1836. Mais il abandonne rapidement cette profession, après une plaidoirie malheureuse. Cette première plaidoirie fut une très mémorable harangue, dans le style de Démosthène, pour défendre la cause d'un voleur de poules.
Au mois d'août 1837, il s'installe à Paris comme commis chez un oncle banquier, mais le monde de la banque et du commerce ne lui convient pas.
Son oncle le chasse parce qu'il ne travaille pas. Il est renvoyé pour avoir lu un livre de Balzac, volé à plusieurs reprises, il est retrouvé mourant de faim et de froid dans sa mansarde et soigné par une voisine charitable pour laquelle il conçut un amour profond et romanesque.
Il songe à la littérature, tout en exerçant des petits métiers qui assurent mal sa subsistance. Ses premiers écrits sont refusés par les éditeurs.
Les débuts littéraires
Puis il entre comme correcteur au Nouvelliste, et ses œuvres, enfin acceptées dans les revues de l'époque, lui confèrent une notoriété que va exploiter Anténor Joly, faisant pour la circonstance du Courrier français et de L'Époque de véritables entreprises modernes, avec campagnes publicitaires pour le lancement des nouveaux feuilletons.
Des recommandations l’introduisent dans les milieux catholiques et royalistes, le Club des phoques est le premier texte publié en 1841 dans la Revue de Paris.
Son talent est remarqué par des éditeurs de journaux tels La Législature et le Courrier français.
Anténor Joly, directeur de L’Époque, lui passe commande d'un texte de même inspiration et de facture similaire aux Mystères de Paris d'Eugène Sue, transposés en des Mystères de Londres.
Mais le résultat n'est pas publiable en l'état et Paul Féval doit procéder à une réécriture intégrale. La publication commence en 1843 sous le pseudonyme de sir Francis Trolopp. Le succès populaire est immédiat : il y a vingt rééditions, la renommée de l’auteur est faite.
La carrière littéraire
La carrière littéraire est engagée, suivent d’autres romans-feuilletons : Le Capitaine Spartacus, Les Chevaliers du Firmament, Le Loup Blanc. Féval qui est un conservateur ressent durement la Révolution française de 1848 : par ses écrits, n'a-t-il pas contribué à réveiller la conscience politique du peuple, et lancé un mouvement qu’il réprouve.
Il décide donc de réorienter sa production dans une direction plus neutre, et poursuit ses publications. 1857 est l’année où sort Le Bossu ou le Petit Parisien, roman auquel on l'associe encore de nos jours.
En 1854, il épouse la fille de son médecin, Marie Pénoyée. Le couple aura huit enfants. Paul Féval fils évoquera la rencontre et le mariage de ses parents :
Un jour, alors qu'il se sentait accablé, il se rendit au cabinet médical d'un homéopathe, le docteur Pénoyée. Ce dernier le prit un peu à sa charge et s'évertua à le guérir de sa dépression nerveuse.
Le médecin avait une fille de vingt ans, Marie Pénoyée. Si le premier garantissait les soins du corps, la seconde permit les soins du cœur. En 1854, Marie offrit sa main au futur père de ses huit enfants. L'un d'eux naquit en 1860 et porta le prénom et le nom de son écrivain de père.
En 1863, il rencontre son homologue britannique Charles Dickens, avec lequel il noue des liens d'amitié. En 1870, au moment de la défaite et de la Commune de Paris, il quitte Paris pour revenir à Rennes, quelque temps.
En 1876, il renoue ostensiblement avec la foi catholique, après un deuxième échec à l'Académie française et des problèmes financiers dus à une popularité émoussée.
Féval s'est essayé à la plupart des types de roman : le roman de cape et d'épée avec Le Bossu, Le Cavalier Fortune, Le Capitaine fantôme, le mystère urbain avec Les Mystères de Londres, Les Habits noirs, les récits bretons La Belle étoile, La Première Aventure de Corentin Quimper, le fantastique avec La Vampire, Le Chevalier Ténèbre.
Il s'est aussi essayé au théâtre et même à l'histoire politique et judiciaire.
Se revendiquant breton, il utilisa abondamment les thèmes de la chouannerie et des luttes politiques précédant l'annexion de la Bretagne. En 1879 parut chez l'éditeur Victor Palmé, le recueil de nouvelles Chouans et Bleus soigneusement revues et corrigées depuis leurs parutions en feuilletons dans des périodiques : Le Petit Gars, Le Docteur Bousseau, Le Capitaine Spartacus et La Mort de César.
Les dernières années
Rrire des livres édifiants. Atteint de paralysie vers 1880, il meurt fou quelques années plus tard.
uiné par des spéculations financières, il passe les dernières années de sa vie à expurger de son œuvre tout ce qui pouvait rappeler son passé de libre penseur et à éc
Atteint de paralysie vers 1880,
Auil est sujet à des crises d’hémiplégie et il est recueilli par les frères de Saint-Jean-de-Dieu, à Paris.
Quasi oublié dans ses dernières années, il va les consacrer à remanier son œuvre dans un sens plus conforme à la morale catholique.
Il meurt fou quelques années plus tard le 7 mars 1887 au 19 rue Oudinot, Paris 7e. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse.
Œuvres
1841 : Le Club des phoques
1843 : Les Mystères de Londres
1843 : Le Capitaine Spartacus
1843 : Les Fanfarons du Roi|Les Chevaliers du Firmament - Réédité sous le titre Les Fanfarons du Roi
1843 : Le Loup blanc
1844 : Fontaine aux perles
1844 : Les Aventures d'un émigré
1845 : La Forêt de Rennes - Contient Le Loup blanc et Le Banquier de cire
1845 : Les Amours de Paris
1846 : La Quittance de minuit - Réédité en 2006 sous le titre Les Molly-Maguires
1846 : Le Fils du diable
1848 : Le Château de Croïat
1849-1850 : Les Belles-de-nuit ou Les Anges de la famille
1850 : La Fée des grèves
1850 : Beau Démon
1851 : Le Capitaine Simon
1852 : Les Nuits de Paris
1852 : La Forêt noire - Réédité sous le titre La Reine des épées
1851-1852 : Les Tribunaux secrets
1851-1852 : Frère tranquille
1855-1856 : La Louve
1855-1856 : L'Homme de fer
1856 : Madame Gil Blas, souvenirs et aventures d'une femme de notre temps
1856 : Les Couteaux d'or
1857 : Le Bossu ou le Petit Parisien
1857 : Les Compagnons du silence
1857 : Les Errants de la nuit
1858 : La fabrique des mariages
1859 : Le Roi des gueux
1860 : Le Chevalier Tènèbre
1861 : Le Drame de la jeunesse
1862 : Le Capitaine fantôme
1862 : Valentine de Rohan, (suite de La Louve)
1863 : Le Poisson d'or
1863 : La Fille du juif errant
1863-1875 : Les Habits noirs
1865 : La Vampire
1865-1866 : La Cavalière
1866 : La Fabrique de crimes
1867 : La Ville Vampire
1867 : Annette Laïs
1868 : Le Cavalier Fortune
1869 : Le Quai de la ferraille
1871 : Le Dernier Vivant
1873 : Le Chevalier de Keramour
1874 : Les Cinq
1875 : La Ville Vampire
1876 : La Première Aventure de Corentin Quimper
1876 : Châteaupauvre - Voyage au Dernier Pays de Bretagne
1877 : Le Dernier Chevalier
1879 : Les Merveilles du Mont Saint-Michel
Adaptations
Le Bossu :
Le Bossu ou le Petit Parisien (1925), film français de Jean Kemm
Le Bossu (1944), film français de Jean Delannoy
Le Bossu (1959), film français de André Hunebelle
Le Bossu (1997), film français de Philippe de Broca
Les Habits noirs (1967), feuilleton télévisé français de René Lucot
Lagardère (1967), feuilleton télévisé de Jean-Pierre Decourt
Lagardère (2003), téléfilm français de Henri Helman
Le Loup Blanc, feuilleton télévisé, (1977) de Jean-Pierre Decourt.
Grand Prix Paul-Féval
En 1984, la Société des gens de lettres, en hommage au romancier, qui a présidé l'institution en 1867, a créé le Grand Prix Paul-Féval de littérature populaire à l'initiative de Suzanne Lacaille, arrière-petite-fille de l'auteur.
Compléments
Paul Féval fils
Grand Prix Paul-Féval de littérature populaire
Liens
http://youtu.be/msDOPphtr7E le bossu film
http://www.ina.fr/video/RCC01016674/l ... e-pere-et-fils-video.html Lagardère de Paul Féval
http://www.ina.fr/video/CAF91035645/c ... vient-le-bossu-video.html Pierre Brasseur se transforme en bossu
Posté le : 28/09/2013 22:51
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
57 Personne(s) en ligne ( 27 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 57
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages