|
|
Jules Simon 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Le 8 juin 1896 à Paris 8ème, meurt, à 81 ans François-Jules Suisse
dit Jules Simon
philosophe et homme d'État français diplomé et professeur de l'école nationale supérieure de la rue Ulm, né le 27 décembre 1814 à Lorient Morbihan 29e président du Conseil des ministres français et Ministre de l'intérieur, 41e chef du gouvernement du 12 décembre 1876 au 17 mai 1877
Président Patrice de Mac-Mahon, Ie législature, son prédécesseur était Jules Dufaure et son successeur Albert de Broglie
Sénateur inamovible du 13 décembre 1875 au 8 juin 1896
Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé et docteur en philosophie, Jules Simon est élu député en 1848. Il refuse de prêter serment à Napoléon III. Opposant à l'Empire, il est élu au Corps législatif en 1863 ; le 4 septembre 1870, il devient membre du gouvernement de la Défense nationale ; ministre de Thiers, il démissionne en mai 1871 par opposition à la droite monarchiste.
Sénateur inamovible à partir de 1875 et républicain modéré, il est appelé par Mac-Mahon à la succession de Dufaure à la présidence du Conseil en décembre 1875. Le clergé, par la voix de Mgr Dupanloup, fait preuve d'hostilité à son égard, à la suite de son action en faveur d'un enseignement primaire obligatoire. Mac-Mahon croit pouvoir, en lui confiant la présidence du Conseil, dissocier les républicains modérés des partisans de Gambetta. D'une vive intelligence, lui seul sait mettre en valeur les deux orientations possibles d'une même profession de foi :
"Je suis, vous le savez, profondément républicain et profondément conservateur "
dit-il, en se présentant tour à tour à la Chambre et au Sénat, après le choix de Mac-Mahon. Jules Simon entre dans l'histoire à l'occasion de la journée du 16 mai 1877.
Sa vie
Jules Simon était le fils d'Alexandre Simon-Suisse, marchand de draps originaire de Loudrefing en Moselle, d'abord établi à Lorient, puis à Saint-Jean-Brévelay 1818 et enfin à Uzel. Il fit de bonnes études aux collèges de Lorient et de Vannes et fut répétiteur au lycée de Rennes. Il commença de bonne heure à collaborer à la Revue de Bretagne.
Il entra à l'École normale supérieure en 1833 et devint professeur de philosophie à Caen 1836 puis à Versailles 1837. Agrégé puis Docteur en philosophie, il supplée Victor Cousin dans sa chaire à la Sorbonne, où il fit un cours, très suivi, sur les philosophes grecs, notamment Platon et Aristote.
Il collabora à la Revue des Deux Mondes, contribua à la fondation de la Liberté de penser 1847.
Il avait déjà songé à la politique et, malgré une campagne électorale des plus actives, il avait échoué aux élections législatives à Lannion en 1847 contre la coalition des partis d'extrême droite et d'extrême gauche. Il prit sa revanche, et une revanche éclatante, le 23 avril 1848. Le département des Côtes-du-Nord l'envoya à la Constituante où il siégea parmi les modérés.
Député républicain à l'assemblée constituante de 1848, puis de 1863 à 1871 sous l' Empire, il publie des études sur la condition ouvrière.
Le 7 décembre 1851, quelques jours seulement après le coup d'État du 2 décembre instaurant le Second Empire, Jules Simon se rendit à son cours de la Sorbonne et prononça l'allocution suivante, devenue célèbre :
"Messieurs, je vous fais ici un cours de morale. Je vous dois aujourd'hui non une leçon, mais un exemple. La France est convoquée demain dans ses comices pour blâmer ou approuver les événements qui viennent de se passer. N'y eût-il qu'un vote de blâme, je viens vous dire publiquement que ce sera le mien. "
Il fut révoqué le lendemain et privé, par suite, de sa conférence de l'École normale supérieure. Il se retira d'abord à Nantes où il employa ses loisirs à des recherches historiques. Pour marquer son opposition à l'Empire, il publia Le Devoir 1854 dont le retentissement fut énorme.
Bientôt suivirent La Religion naturelle 1856, La Liberté de conscience 1857, La Liberté 1859, et une série de conférences sur des questions de socialisme ou de philosophie.
Après la guerre de 1870, il devient ministre de l’Instruction publique du gouvernement provisoire au lendemain du 4 septembre 1870.
Il n'y a pas d'école neutre, disait-il, parce qu'il n'y a pas d'instituteur qui n'ait une opinion religieuse ou philosophique .
Jules Simon, qui savait être autoritaire sous des formes douces et aimables, mit de l'ordre dans l'Université et obligea à démissionner Francisque Bouillier et Octave Feuillet. Il déposa le projet d'enseignement primaire obligatoire et brusquement se retira le 17 avril 1873 à la suite d'un discours officiel où il attribuait à Thiers tout seul l'œuvre de la libération du territoire, discours qui souleva à l'Assemblée nationale d'assez vives polémiques.
Le 16 décembre 1875, il fut élu sénateur inamovible et le même jour membre de l’Académie française.
Le 13 décembre 1876, il prenait la présidence du conseil et le portefeuille de l’Intérieur. Dans le discours annonçant son programme ministériel, qu’il prononça pour obtenir l’investiture de l'Assemblée, une phrase est devenue historique, celle où il se déclare profondément républicain et résolument conservateur.
Dans la période difficile que le pays traversait alors, Jules Simon représentait une politique de conciliation entre la droite et l’extrême gauche, très agitées par la question religieuse. Il créa par une circulaire de 1877 le livret de famille.
Simon ne put maintenir longtemps la balance égale entre les partis, et son ministère prit fin suite à la crise du 16 mai 1877.
Jules Simon, au Sénat, continua à s'occuper surtout des questions d’enseignement et combattit les décrets sur les congrégations. Sa dernière mission officielle, d’un grand éclat d’ailleurs, fut sa représentation de la France à la conférence internationale de Berlin sur le Travail du 15 mars 1890.
De 1889 à 1896, Jules Simon a été le premier président de l’Association Valentin-Haüy, créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne pour venir en aide aux aveugles. Il est le premier président de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance créée en 1887 UFSE.
Jules Simon était marié à Louise, Marie, Émilie Boissonnet. Il est le père de l’écrivain et journaliste Gustave Simon et du dramaturge Charles Simon.
Les papiers personnels de Jules Simon sont conservés aux Archives nationales sous la cote 87AP4.
Distinctions et hommages
Membre de l'Académie des sciences morales et politiques
Membre de l'Académie française
Le Collège Jules-Simon de Vannes porte son nom. Un médaillon sculpté par Joseph Vallet orne la grille de l'établissement.
Décorations
Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en 1845
Citations
" Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain."
"Je suis profondément républicain et résolument conservateur."
Œuvres
Couverture de Le Devoir.
Étude sur la théodicée de Platon et d'Aristote 1840
Histoire critique de l'école d'Alexandrie 1844-1845
tome deuxième En ligne sur archive.org
La Mort de Socrate 1853
Le Devoir 1854
La Religion naturelle 1856
La Liberté de conscience 185 ; La Liberté de conscience sur Google Livres
La Liberté 1859
L'Ouvrière 1861 En ligne sur archive.org
L'École 1864
Le Travail 1866
L'Ouvrier de huit ans 1867
La Politique radicale 1868
La Peine de mort Bordeaux, 1869 édité par les éditions MARPON et E FLAMMARION 1870 4 ° édition, 186 pages dédicacé à V H
La Famille Paris, 1869
Le Libre Échange 1870
La Liberté politique 1871
Le Gouvernement de Thiers 1871, 2 vol. in-8
La Réforme de l'enseignement secondaire 1874
Souvenirs du 4 Septembre 1874
Dieu, Patrie, Liberté 1883
Une Académie sous le Directoire 1884
Thiers, Guizot, Rémusat 1885
Nos Hommes d'État 1887
Discours de réception de Jules Simon Le 22 juin 1876
Jules SIMON
M. Jules Simon ayant été élu par l’Académie française à la place rendue vacante par la mort de M. de Rémusat, y est venu prendre séance le 22 juin 1876, et a prononcé le discours suivant :
Messieurs,
L’Académie, depuis sa création, a toujours compté dans son sein, en proportions heureusement fort inégales, deux sortes de personnes : d’abord, les grands auteurs, qui entrent chez vous par droit de conquête ; et ensuite les amis fervents de la littérature, que la politique ou les affaires ont trop absorbés, mais dont vous récompensez, à défaut de mérites plus éclatants, la fidélité et le zèle. Vous avez ici, en un mot, les membres de la famille, et les amis de la maison. Ces derniers vous doivent, Messieurs, une reconnaissance bien vive, quand vous consentez à leur ouvrir vos portes.
Je ne suis pas embarrassé pour dire à laquelle de ces deux classes d’académiciens appartenait M. Charles de Rémusat. Il a autant écrit, et il a produit d’aussi beaux livres, que s’il avait passé toute sa vie à faire de la philosophie et de la littérature. Un critique illustre, qui vous a appartenu, Messieurs, a laissé échapper cette parole : « C’est, dans tous les genres, le premier des amateurs » ; et j’ai entendu un grand philosophe, qui était aussi de l’Académie, qui a été mon maître, et un peu le sien, dire de lui : « C’est un sceptique. » Un amateur et un sceptique ! Voilà un jugement complet ; mais, quoiqu’il vienne de deux hommes très-compétents, qui aimaient et admiraient M. de Rémusat, j’oserai dire que je n’en connais pas de plus faux. Dans la philosophie, M. de Rémusat était un philosophe ; dans la philosophie et dans la vie, c’était un croyant. Je n’aurai pas de peine à le montrer : il me suffira de raconter sa vie et d’analyser ses livres. Peut-être aussi, chemin faisant, trouverons-nous l’excuse de la double erreur que je viens de signaler. M. de Rémusat n’a jamais rien fait pour mériter ce double reproche, mais il a bien fait quelque chose pour l’expliquer.
M. Charles de Rémusat est né à Paris le 14 mars 1797. Toutes les familles qui, par leur origine et leurs emplois, avaient appartenu à l’ancien régime étaient alors frappées ou menacées. Le père de M. de Rémusat, avocat général à la cour des aides de Provence, en avait été quitte pour perdre sa charge et la plus grande partie de sa fortune. Il épousa en 1796 Mlle de Vergennes, dont le père, neveu du ministre de Louis XVI, avait péri sur l’échafaud. La prudence conseillait aux nouveaux époux de vivre dans la retraite ; l’état de leur fortune leur en faisait une nécessité. On vécut d’abord à Saint-Gratien, puis à Sannois. Madame de Rémusat, qui n’avait que seize ans à l’époque de son mariage, devint mère de Charles de Rémusat l’année suivante. Admirablement élevée elle-même par sa mère, éprouvée déjà par le malheur, tendre mais grave et réfléchie, elle fut pour son fils la meilleure des institutrices, en attendant qu’elle devînt la meilleure des amies, et très-rapidement le plus docile, le plus encourageant et le plus aimable des disciples ; car, suivant la remarque de Sainte-Beuve, elle instruisit d’abord M. de Rémusat comme son fils, puis elle l’aima comme son compagnon, et enfin elle l’écouta comme son guide : semblable à une sœur aînée qui apprend à marcher à un très-jeune frère, qui le précède au commencement, marche ensuite à côté de lui, et bientôt a de la peine à le suivre, mais le surveille encore et l’avertit de loin avec tendresse. Charles de Rémusat conserva toute sa vie le souvenir de cette intimité charmante. Il aimait à rapporter à la douce et sérieuse influence de sa mère tout ce qu’il avait en lui de sentiments généreux et de pensées élevées. Elle avait écrit deux romans qui sont restés manuscrits, une nouvelle qu’elle laissa publier, des mémoires sur l’empire, écrits au jour le jour pendant qu’elle vivait à la cour impériale, et qu’elle a malheureusement jetés au feu, et enfin un Essai sur l’éducation des femmes qui a paru en 1824, trois ans après sa mort, et que vous avez, Messieurs, très-justement couronné. Ce livre, quoique très-féminin dans sa forme, aurait pu être écrit et surtout pensé par son fils. C’est lui qui s’en est fait l’éditeur avec un soin pieux, et il dit dans sa préface, en parlant de madame de Rémusat, qu’elle a été « le père » de son esprit.
La famille, à Sannois, avait des relations d’intimité avec madame d’Houdetot, l’amie de Jean-Jacques, et elle connut, par elle, les derniers survivants des écrivains à côté desquels Jean-Jacques avait vécu : Suard, Saint-Lambert, l’abbé Morellet. Madame de Vergennes, qui n’avait pas quitté sa fille, même après le mariage, connaissait aussi très-intimement celle qui fut l’impératrice Joséphine. En 1802, quand Bonaparte, devenu premier consul, réorganisa tous les services publics, madame de Vergennes demanda une place pour son gendre. Joséphine fit plus qu’on ne lui demandait, plus qu’on ne désirait ; elle prit auprès d’elle madame de Rémusat comme dame du palais, et fit nommer M. de Rémusat préfet du palais du premier consul. On quitta la petite maison de Sannois, où du moins on était libre, et le salon de Madame d’Houdetot, pour le palais de Saint-Cloud. La faveur alla grandissant pendant les premières années : c’était le temps où la France, enivrée de la gloire et du génie de Napoléon, ne voulait voir en lui que la personnification de l’unité et de la force. Plus tard, quand le joug s’appesantit, M. et Mme de Rémusat partagèrent le sentiment de malaise et de sourde inquiétude qui devenait très-général dans les classes éclairées. Le maître le sentit et fit comprendre qu’il le sentait. Ce fut moins une disgrâce que la cessation de la faveur. M. de Rémusat conserva sa place jusqu’au départ pour l’île d’Elbe ; madame de Rémusat avait suivi Joséphine à la Malmaison après le divorce. Au moment de la catastrophe, leur fils achevait ses études au lycée Napoléon ; et déjà, à dix-sept ans, malgré les liens officiels de sa famille, il manifestait, par des chansons, à la manière du temps, ses dispositions libérales. C’est aussi dans ces dernières années de collège qu’il sentit naître en lui un goût très-vif pour la philosophie.
Le professeur de philosophie du lycée Napoléon s’appelait M. Fercoc. Il enseignait une doctrine qui était au fond celle de Condillac, avec quelques-unes des « nouveautés » de la Romiguière, et un peu de la sentimentalité du Vicaire savoyard. On raconte que Charles de Rémusat entra un jour par hasard à sa leçon, et qu’il en sortit philosophe. Cette anecdote en rappelle une autre plus célèbre : M. Royer-Collard, nommé professeur de philosophie à la Sorbonne, se demandant, non sans effroi, ce qu’il pourrait bien enseigner sous ce beau nom, et trouvant sur les quais la réponse qu’il cherchait, sous la forme d’un volume dépareillé des œuvres de Thomas Reid.
Non, Messieurs, le hasard n’est pour rien dans les grandes vocations. Ce n’est pas une leçon de M. Fercoc qui apprit de bonne heure à M. de Rémusat qu’il aimerait la philosophie toute sa vie ; c’est ce qui se passait en France ; ce qu’il voyait, ce qu’il entendait autour de lui, le milieu même où il vivait : voilà ce qui le rendit philosophe. Non pas qu’on fit de la philosophie dans le salon de sa mère ; tout au contraire, les hommes et les femmes distinguées qui s’y rencontraient, madame d’Houdetot, madame de Vintimille, Pauline de Meulan, qui fut la première madame Guizot, Molé, Parquier, de Barante, Georges Cuvier, le cardinal Beausset, Talleyrand, venaient là chercher la liberté décente, les plaisirs de l’esprit, les grâces d’une société aimable, et se gardaient bien, même dans l’intimité, d’aborder des questions de politique ou de philosophie. En sortant de la Terreur, on avait, sous l’impulsion de Bonaparte, créé un nouveau gouvernement, une nouvelle société, et presque une nouvelle religion. Cette religion, pour les courtisans, n’était pas une croyance, mais une sorte de police des esprits qui dispensait de réfléchir. Ils avaient repris la religion par bienséance, comme ils avaient repris leurs titres et leurs décorations. Quelqu’un, vers ce temps-là, disait à Sieyes : « Que pensez-vous ? — Je ne pense pas », répondait le vieux métaphysicien, dégoûté et intimidé. Il disait le mot de tout le monde. Ces esprits très-ouverts, qui avaient été voltairiens et encyclopédistes et qui ne voulaient plus penser, ces muets volontaires qui avaient tonné dans les clubs, ces faiseurs de révolutions et d’utopies qui s’en tenaient aux constitutions de l’empire et à la religion des articles organiques comme un fidèle à son credo ; tous ces survivants de 93 qui faisaient alors pénitence, mais que, par un malheur, la pénitence ramenait du côté de la fortune, ne pouvaient que dépraver la jeunesse qui s’élevait à côté d’eux, ou la révolter ; l’habituer à ne rien croire, à tout subir, et à tirer profit de son abaissement, ou lui inspirer le généreux désir de se faire une croyance et d’y conformer sa conduite. C’est le spectacle de ce néant qui enseigna la philosophie à M. de Rémusat, bien plus que toutes les leçons de M. Fercoc. Il se montra, depuis, respectueux pour la mémoire de Napoléon ; mais il jugea toujours sans pitié cette société asservie, cette époque de découragement universel et d’abdication de la pensée. La France attristée en était venue à manquer de l’illusion des souhaits. Son gouvernement l’alarmait, et ne l’irritait pas. Elle n’en désirait pas la chute ; elle n’en espérait pas la réforme. Elle le regardait comme nécessaire et dangereux, et se sentait dans une égale impuissance de lui faire du mal ou du bien, de l’éclairer, de le contenir, ou de le renverser. Elle n’avait pas de but. « C’est un temps, dit-il avec amertume, où il fallait être soldat ou géomètre. » Pour lui, dès ce temps-là, encore enfant, à dix-sept ans qu’il avait alors, il fut et se sentit philosophe.
Vinrent les évènements de 1814. L’empereur, à son retour de l’île d’Elbe, trouva de l’enthousiasme dans les soldats et dans une partie du peuple, non chez les grands qu’il avait faits, ni chez les politiques. « Il revient pour nous déshonorer tous », dit M. de Barante en apprenant la nouvelle du débarquement. Le père de M. de Rémusat tenait le même langage. Il fut exilé à soixante lieues de Paris pendant les Cent jours. La seconde restauration le fit préfet, d’abord à Toulouse, et plus tard à Lille. Après l’orage qui dura du 31 mars 1814 au 21 juin 1815, nous retrouvons Charles de Rémusat à Paris où il fait ses études de droit.
Il avait déjà cette expérience que donnent le spectacle de la politique quand on le voit de près, et celui des révolutions. À mesure que le gouvernement s’écarta des promesses libérales de la Charte et revint aux idées et aux pratiques de l’ancien régime, Charles de Rémusat sentit croître son dégoût pour ce monde d’arrivés et de courtisans, qui fuyait les idées nouvelles comme des piéges, les idées générales comme des visions, et qui se reprochait d’avoir trop pensé pour son salut même en ce monde. Il s’était d’abord voué entièrement aux lettres, dans l’incertitude de ce que deviendrait la politique. « Mais, dit-il lui-même, la littérature de tous les siècles, prise dans son ensemble, est libérale ; elle habitue l’esprit à se compter pour beaucoup. D’ailleurs les évènements se précipitaient ; la restauration faisait la lumière sur elle-même. Nous ne savions pas la révolution, dit-il ; c’est la restauration qui nous l’apprit. Avec une rapidité singulière, la première vue de la restauration fit comprendre, même à ceux qui l’accueillaient sans vive inimitié, pourquoi l’ancien régime avait dû périr, pourquoi la révolution s’était faite. »
M. de Rémusat s’habituait, dès ce temps-là, à penser la plume à la main, comme il l’a fait toute sa vie. Ses articles étaient écrits pour lui-même, ou pour des conciliabules d’étudiants ; on en parlait dans le quartier des Écoles, et même dans les salons libéraux. Ils se ressentent, en bien et en mal, de la vingtième année ; mais bien peu d’hommes ont écrit et pensé ainsi à vingt ans. L’article sur la jeunesse est de 1817 ; l’année suivante, nous trouvons trois articles dont les titres mêmes racontent le mouvement de son esprit : la Situation des gouvernements, la Bonne Foi dans les opinions, la Révolution française. Ce dernier avait été inspiré par le livre de Mme de Staël, qui venait de paraître. On en parla à M. Guizot ; il le lut, et l’inséra avec quelques mots de présentation, dans les Archives, dont il était directeur. À partir de ce moment, les publications de M. de Rémusat se multiplièrent. Il traduisit le Traité des lois, de Cicéron, pour la grande édition de M. Victor Le Clerc, son ancien professeur, resté son ami ; il traduisit aussi le théâtre de Goethe avec M. de Guizard. La brochure sur la Procédure par jurés en matière criminelle parut en 1820. C’est plutôt un livre (200 pages) qu’une brochure, et même c’est un bon livre, et, pour l’époque, un livre courageux. Il écrivait dans le Lycée, dans les Tablettes universelles, un peu partout, un peu sur toutes choses ; défendant sans relâche la liberté, faisant la guerre aux hypocrites, aux apostats, et poursuivant de son invective éloquente la classe des esprits prétendus pratiques, prétendus positifs, qui se croient quittes envers leur conscience et envers leur pays parce qu’ils ont de la probité dans les affaires privées ; en un mot, la classe des honnêtes gens mauvais citoyens. « De quel prix serait la vie, s’écrie le jeune écrivain, de quel prix serait la vie avec les passions qui la corrompent et les chagrins qui la désolent, de quel intérêt serait la société, que l’erreur égare et que la force ravage, sans le besoin de chercher la vérité et le devoir de la dire ? »
Vers le même temps (1824), M. de Rémusat devient secrétaire général de la gauche. C’est l’année de la fondation du Globe. Le Globe n’était d’abord qu’un recueil purement littéraire et philosophique ; mais le groupe de jeunes libéraux qui l’avaient fondé aspiraient à régénérer la société par les lettres et par la philosophie, et ils entendaient bien refondre aussi la politique. Il y avait là des élèves de l’École normale, la plupart disgraciés, tous destinés à un grand avenir : Jouffroy, Damiron, Patin, Farcy ; des lettrés comme J.-J. Ampère, Magasin, Lerminier, des jeunes gens appartenant à ce qu’on pourrait appeler le grand monde libéral, Vitet, Duchâtel, M. Duvergier de Hauranne. M. Dubois (de la Loire-Inférieure) dirigeait cette brillante élite, aidé par Pierre Leroux, qui ne voulait encore transformer que la science et la religion. Sainte-Beuve et M. Barthélemy Saint-Hilaire vinrent aussi, mais plus tard. Au milieu de tous ces vaillants, M. de Rémusat était un des plus laborieux et des plus remarqués. Il devint sur la fin le principal rédacteur du Globe, transformé en journal politique. Sans le quitter, et à une époque même où il y écrivait quotidiennement, il entre à la Revue française fondée par M. Guizot. Au milieu de cette activité féconde et diverse, l’unité de sa vie et de son esprit se fait jour : il est le chef, l’un des chefs les plus en vue et les plus énergiques, de la réaction morale contre toutes les hypocrisies, et du mouvement libéral contre toutes les tyrannies. M. de Rémusat ne poursuivait pas le renversement de la restauration comme un but, mais il l’acceptait comme une chance. Il se défiait des improvisations en politique, précisément parce qu’il avait vu tous les partis improviser l’un après l’autre, et toutes les improvisations s’écrouler l’une après l’autre. Il disait que nous savons mieux bâtir que planter. Tous ses efforts tendaient à opérer une transaction entre le gouvernement et l’opposition libérale. Ce fut le roi Charles X qui voulut la guerre. Il la commença en en nommant le ministère Polignac. M. de Rémusat était alors directeur du Globe, pendant que le titulaire, M. Dubois (de la Loire-Inférieure), subissait un emprisonnement pour délit de presse. C’est comme directeur du Globe qu’il rédigea, de concert avec M. Thiers, la protestation contre les ordonnances. Pour dire la vérité exacte, je crois que le texte est tout entier de la main de M. Thiers ; qu’il fut seulement revu et modifié dans quelques passages par M. de Rémusat. Ce qui lui appartient en propre, c’est le Globe du 27 juillet 1830. J’en cite les premières paroles, parce qu’elles sont un acte. Elles ont été écrites au commencement du combat, et pouvaient coûter la vie à leur auteur. « Le crime est consommé ; les ministres ont conseillé au roi des ordonnances de tyrannie. Nous n’appelons que sur les ministres la responsabilité de pareils actes ; nous la demandons mémorable. Le moniteur que nous publions fera connaître à la France son malheur et ses devoirs. Nous ne céderons qu’à la violence, nous en prenons le solennel engagement. Le même sentiment animera tous les bons citoyens... »
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=5866#forumpost5866
Posté le : 08/06/2014 14:40
|
|
|
|
|
Jules Simon 2 (suite) |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Discours de réception de Jules Simon (suite)
Vous me pardonnerez, Messieurs, d’avoir longuement raconté la jeunesse de M. de Rémusat. J’ai toujours éprouvé, pour la jeunesse de la restauration, une admiration que les derniers évènements de notre histoire ont encore augmentée. Libérale et sensée ; amie de la révolution sans être révolutionnaire ; déployant dans tous les sens son activité féconde ; ne trouvant rien de trop hardi pour son courage, ni de trop difficile pour sa noble ambition ; voulant à tout prix avoir une croyance, mais une croyance librement formée, librement débattue ; aimant le plaisir comme le veut son âge, mais préférant le travail au plaisir ; un peu enfiévrée de ses succès, ce qui ne messied pas aux jeunes et aux combattants ; gardant au milieu de cette lutte ardente la grâce et la fleur des jeunes années ; refaisant la France par son travail mieux que les hommes d’État ne la refaisaient par leurs lois ; reprenant en Europe la direction de la pensée, avant même d’avoir discipliné sa propre pensée : voilà comme je la vois, et comme M. de Rémusat m’en représente la vive image. Combien de fois, nous tous, depuis nos désastres, avons-nous demandé à Dieu qu’il nous envoie une jeune génération digne de celle qui a lutté pour la France et pour la liberté de 1815 à 1830 !
« La révolution est finie ; elle est fixée aux principes qui l’ont fait naître. » À cette grande parole de Napoléon répond, après vingt-six ans de guerres et d’agitations, le mot célèbre de la Fayette, lorsque, sur le balcon de l’Hôtel de Ville, montrant le roi Louis-Philippe à la foule, il lui dit : « Voilà la meilleure des républiques ! » M. de Rémusat avait fait son choix avant la Fayette. Le général hésitait au premier moment. Il était entouré d’amis qui croyaient la république immédiatement possible. « Il n’y a, lui dit M. de Rémusat, de choix à faire qu’entre une république dont vous seriez le président, et une monarchie constitutionnelle avec le duc d’Orléans. Voulez-vous être président de la République ? — Assurément non. — Alors, la question est jugée... »
Était-ce la meilleure des républiques ? Ou, ce qui est un peu différent, était-ce la seule république possible en 1830 ? Vous m’approuverez, Messieurs, de ne pas discuter cette question. Je l’ai discutée hier, je la discuterai encore demain, et il ne s’agit ici que de la façon de penser de M. de Rémusat. Je viens de vous la dire. La monarchie de Juillet mit sur son drapeau : « Liberté, ordre public » ; une devise que quelques-uns trouvent vulgaire, et que, pour moi, je trouve très-belle, parce qu’elle est très-sage. C’était alors, ce fut toujours celle de M. de Rémusat. Il a servi la liberté toute sa vie, puisque vous avez vu qu’il la servait à vingt ans ; et il a cru toute sa vie qu’elle était inséparable de l’ordre. Il a pu, comme un pilote habile, se porter tantôt d’un côté du navire, tantôt de l’autre, selon qu’il fallait un contre-poids à droite ou à gauche ; mais, quand on parcourt l’ensemble de tous ses actes politiques, quand on relit ses discours et ses écrits, on trouve la preuve que la liberté n’a jamais eu de plus ardent et de plus intelligent défenseur, qu’il n’a pensé qu’à la France, jamais à son ambition et à sa fortune, et que, comme il mettait l’intérêt de la patrie au-dessus de tous les intérêts, il ne voyait aussi l’intérêt de la patrie que dans la liberté unie à l’ordre. Se posséder soi-même, c’est, pour un peuple et pour un homme, la règle, l’honneur et le bonheur. M. de Rémusat a été l’un des serviteurs les plus résolus, les plus fidèles et les plus libres du gouvernement de Juillet. Je ne vous raconterai pas cette période de sa vie. M. Duvergier de Hauranne en a fait un récit d’autant plus attachant qu’il parle d’évènements auxquels il a pris une grande part, et d’un homme qu’il a connu jusqu’au fond de l’âme ; car, pendant plus de quarante ans, M. Duvergier de Hauranne et M. de Rémusat ont agi et pensé à l’unisson : on peut dire que c’est un grand honneur pour l’un et pour l’autre. M. de Rémusat, porté par ses relations de famille, et par le rôle considérable qu’il avait joué dans toutes les affaires du parti, serait facilement et promptement arrivé au pouvoir, s’il n’avait pas eu l’ambition patiente. Il avait sans doute de l’ambition, comme tout homme politique, mais encore plus de fierté que d’ambition ; et ce qu’il désirait par-dessus tout, c’était le triomphe de sa cause, aimant mieux faire le bien que de paraître l’avoir fait. Il ne devint ministre qu’en 1840 ; mais, dans les dix premières années du règne, il agit par ses conseils sur la Fayette ; il fut le collaborateur de Casimir Périer ; à la Chambre, où il était entré avec M. Thiers et Odilon Barrot, on le comptait comme un des plus influents et des plus capables. Lorsqu’en 1833, M. Guizot voulut tracer aux instituteurs qu’il venait de créer leur ligne de conduite, il emprunta la plume de M. de Rémusat, qui écrivit à cette occasion une circulaire longtemps attribuée à M. Guizot lui-même, et dont je ferai l’éloge d’un mot : elle est digne de la loi qu’elle commente. M. de Rémusat fut un moment sous-secrétaire d’État dans le ministère Molé. Enfin, M. Thiers l’appela, en 1840, au ministère de l’intérieur ; et je ne doute pas un instant que cet écrivain, ce polémiste, ce traducteur de Goethe et de Cicéron, qui faisait des circulaires pour le ministre de l’instruction publique, et écrivait des drames en secret, n’eût été un grand ministre si le temps lui avait été laissé. Il apportait à cette tâche difficile la connaissance des questions, celle du personnel politique, qui n’est pas moins nécessaire ; beaucoup de modération, beaucoup de résolution ; des aptitudes variées, ce qui, quoi qu’on en dise, est un signe de force, et cette sérénité philosophique de l’esprit, qui règle et tempère la passion, sans l’étouffer. Il n’eut pas même le temps de s’essayer. En quittant le ministère au bout de huit mois, il entra, pour n’en plus sortir, dans les rangs de l’opposition libérale.
On a lieu de s’étonner que, pendant cette longue vie parlementaire, il ait très-rarement abordé la tribune. Habitué à la lutte presque dès son enfance, ayant constamment vécu dans la politique, très au courant de toutes les matières, courageux autant que personne, ferme et décidé dans ses opinions, parlant dans le monde avec une facilité admirable, aimant à parler, plein de traits, de mouvements, de ressources, il avait un vrai tempérament d’orateur ; avec cela, presque toujours silencieux. J’ose à peine dire qu’il était un peu timide. Quand il ne voyait pas un devoir précis et impérieux, il n’aimait pas à se mettre en avant. Il avait une qualité précieuse pour un philosophe, un peu gênante pour un député : il voyait l’objection, et ne se résignait pas à discourir avant de l’avoir résolue pour lui-même. Il parla cependant quelquefois, et de façon à faire regretter qu’il ne le fît pas plus souvent. Il défendit à plusieurs reprises la politique du 1er mars contre les attaques de M. de Lamartine. Il avait pris en main, dans les dernières années du règne, la cause des incompatibilités parlementaires. Trois fois il porta cette grande question à la tribune, avec un grand succès personnel, sans pouvoir triompher de l’obstination du ministère et de la Chambre. Il se tenait sur la fin un peu à l’écart, n’approuvant pas la politique suivie, ne voulant pas s’allier à la partie active de l’opposition, fidèle à ses opinions constitutionnelles et à la famille royale, dont il était honoré et aimé. Il fut appelé, au moment du péril, avec M. Thiers, M. Odilon Barrot, M. Duvergier de Hauranne ; mais à une heure où le talent et le courage devaient être impuissants. Il ne put qu’assister à la chute de ce gouvernement constitutionnel qu’il avait regardé si longtemps comme le gouvernement le plus capable de fonder la liberté et de garantir l’égalité. Il s’est demandé depuis comment cette combinaison savante et, suivant lui, si conforme aux principes, si appropriée à nos besoins, avait pu être détruite en quelques heures, comme un, nuage que le vent chasse devant lui. « Serait-ce qu’il faut aux nations, pour obtenir et garder la libre possession d’elles-mêmes, autre chose que l’intelligence et la volonté ? Peut-être. L’homme peut beaucoup de ce qu’il pense et de ce qu’il veut ; il ne peut pas tout ce qu’il veut ni tout ce qu’il pense. Bien que mille et mille fois plus fortes que les individus, les sociétés sont cependant comme eux sujettes aux conditions de l’humaine destinée. Pour maîtriser le sort, pour réaliser leurs rêves, il leur faut réunir certaines circonstances qui ne dépendent pas toujours d’elles. Dans leurs plus chères et plus hautes entreprises, il ne suffit pas, pour réussir, de leurs pensées animées par leurs passions. Il y a dans les choses des difficultés, dans les évènements des traverses qu’on ne surmonte pas sans une sagesse persévérante, ou plutôt sans certains heureux accidents que la sagesse même ne procure pas. Il faut à la cause des serviteurs, et à la cause, à ses plus dignes serviteurs, il faut encore un don qu’on méconnaît trop aujourd’hui, et ce que tous les grands hommes ont appelé par son nom, — la fortune ( 1). »
Élu en 1848 membre de l’Assemblée constituante, M. de Rémusat y fut entouré du respect universel. Ses ennemis politiques s’accordaient pour rendre hommage à la dignité de sa conduite, à l’élévation de son esprit, et à ses sentiments de vrai et profond libéralisme. Très-persuadé qu’il faut être d’un parti, ou se résigner à n’être rien, il vota le plus souvent avec ses anciens amis, et se sépara d’eux pourtant dans quelques occasions capitales. Il vota notamment pour la présidence du général Cavaignac. C’était, au fond, voter pour la République. Il le fit, comme il faisait toutes choses, simplement et ouvertement. Il faut peut-être avoir été longtemps député, et connaître la violence des partis, pour comprendre combien cette conduite était courageuse.
Il y avait alors quelqu’un qui le jugeait très-bien. C’est un homme d’infiniment d’esprit, que je ne veux pas nommer, car il est possible qu’il soit ici, et qu’il m’écoute. Il s’est converti depuis à la possibilité de la République ; mais il la croyait impossible dans ce temps-là, et il en donnait à M. de Rémusat cette raison singulière : « Comment voulez-vous que la République s’établisse ? Il n’y a dans cette assemblée que deux républicains, Tocqueville et vous. » Cela fait sourire, Messieurs ; et cela fait réfléchir.
Le prince Louis-Napoléon, qui pourtant connaissait le vote de M. de Rémusat, ayant à former son premier ministère, s’adressa d’abord à lui. Mais il refusa son concours, prévoyant dès lors la révolution, et fermement résolu à ne jamais entrer dans un gouvernement pour le combattre. Une seule fois, pendant ces tristes années, il sortit de son silence. Ce fut le jour où le président commença l’exécution de son plan par la destitution du général Changarnier. M. de Rémusat monta à la tribune et annonça à la Chambre les évènements qui se préparaient. « L’empire est fait ! » s’écria M. Thiers dans cette même séance. Quelques mois après, M. Thiers était conduit prisonnier à la frontière. Un décret bannit M. de Rémusat. On lui dit bien qu’un mot, un seul mot suffirait pour que la mesure fût rapportée ; mais il partit. Il habita d’abord la Belgique, puis l’Angleterre. Il parcourait la Suisse, lorsqu’un journal tombé par hasard entre ses mains lui apprit qu’il pouvait rentrer dans son pays.
Il hésita presque à profiter de la liberté qui lui était rendue. La France, qu’il avait si constamment et si passionnément aimée, l’attirait ; il rougissait de cette société française, si prompte à accepter la prospérité matérielle comme un dédommagement de la liberté. Il revint cependant, et put assister de près au réveil des idées libérales. Il y contribua puissamment. Exclu de la vie politique jusqu’à la fin de l’empire, il se livra avec une nouvelle ardeur à la philosophie et aux lettres.
Il avait commencé de bien bonne heure à écrire. Ses premières œuvres, Messieurs, furent des chansons. On en faisait beaucoup alors ; on n’en fait plus aujourd’hui. Il croyait, et je crois aussi, que c’est un tort. Il paraît qu’on a du plaisir à les faire ; on en avait, dans ma jeunesse, à les chanter. Il en a fait beaucoup, je n’en rougis pas pour lui, en me rappelant que Voltaire a dit de Newton : « Je l’admirerais davantage si seulement il avait fait un vaudeville. » Dans le recueil de M. de Rémusat, — car il y a un recueil, encore inédit, — on trouve des chansons amoureuses, des chansons satiriques et des chansons politiques. La première de toutes est fort jolie ; il avait treize ans quand il l’a faite. La date de la dernière, si j’osais vous la dire, vous étonnerait bien davantage. Vous vous rappelez qu’à vingt ans, il écrivait, sur la politique, des articles qui faisaient sensation. M. Royer-Collard lui dit, en parlant de son article sur la révolution : « Jeune homme, je vous ai relu. » Un tel mot, dans ce temps-là, où l’on savait encore admirer et respecter, était un grand et sérieux succès. Faites comme Royer-Collard, Messieurs, relisez l’article sur la révolution, et vous serez frappés de tant de maturité chez un si jeune homme. La réflexion et le bon sens étaient venus vite à M. de Rémusat. En revanche, la jeunesse ne l’abandonna jamais. Il y a de lui un mot que je trouve adorable ; c’est dans son article sur Jouffroy. Il rappelle que Schiller a dit quelque part que l’homme fait doit porter respect aux rêves de sa jeunesse ; et il ajoute : « La première marque de respect qu’on leur doive donner, c’est de ne pas dire qu’ils soient des rêves. »
En dehors du Globe, qui fut quotidien assez peu de temps, je ne vois pas que M. de Rémusat ait beaucoup écrit dans les journaux ; mais il a écrit toute sa vie dans les revues. Il a commencé, je le rappelais tout à l’heure, par les Archives ; puis il écrivit dans le Lycée, que dirigeaient MM. Villemain et Loyson ; dans les Tablettes universelles, avec M. Thiers ; dans le Globe, où il avait la haute main ; dans la Revue française, de M. Guizot. Il entra à la Revue des Deux-Mondes dès qu’elle fut fondée, et il y a écrit jusqu’au moment de sa mort. Le nombre de ses articles, si on les additionnait depuis son début en 1818, serait formidable. Il en a recueilli une partie sous forme de volumes. Il était déjà, comme vous le savez, Messieurs, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, et de l’Académie française, quand il quitta la France en 1851. Il avait succédé à Jouffroy, en 1842, comme membre de l’Académie des sciences morales. Il me disait pendant sa candidature, qui du reste ne suscita d’objections dans aucun esprit, si ce n’est dans le sien : « Je n’ai pas publié de livres ! » Il publia, cette année-là, ses Essais de Philosophie, en deux volumes. Il aurait pu faire des volumes à volonté, rien qu’en rééditant ses articles du Globe ; ces deux-là suffirent pour le tranquilliser. Même en ne tenant pas compte de ses autres écrits, on peut dire que bien peu de ses nouveaux confrères auraient pu citer des titres équivalents. Parmi les essais qui composent ces deux volumes, j’en signale un, qui a pour titre : De l’Esprit. C’est une démonstration systématique, comme il le dit lui-même, de l’existence de l’esprit. Il est vrai qu’aussitôt après la démonstration systématique vient la critique de la démonstration ; mais la conclusion finale est dogmatique, formelle ; car il était spiritualiste, Messieurs, vous n’en doutez pas, et ceux qui l’ont accusé d’être un sceptique n’en doutaient pas davantage. Ce sceptique n’a jamais douté ni de l’esprit ni de Dieu ; il a passé sa vie à affirmer la morale, à la démontrer, à s’indigner contre ceux qui la nient, et plus encore contre ceux qui l’affirment sans y croire. Un essai plus considérable que celui-là, à tous les points de vue, comme étendue, comme puissance métaphysique et comme originalité, c’est le précédent, l’Essai IX, qui a pour titre : De la Matière. Dire que l’étendue se résout en atomes, et le mouvement en forces simples ; que la force ne peut être ramenée à l’étendue, et que l’étendue peut être ramenée à la force, c’est reprendre, en la modifiant, la théorie des monades : ce n’est pas être original. L’originalité est surtout dans la forme de la démonstration. L’auteur de ce traité, qui à lui seul est un livre, a certainement sa place marquée parmi les métaphysiciens. La métaphysique remplit ces deux volumes aux dépens de la psychologie, et la psychologie, quand elle y paraît, y revêt la forme d’une critique très-pénétrante de la doctrine de Kant. Jouffroy, dont il prenait la place, ne se serait pas retrouvé dans tout cela. Ils avaient de commun, Jouffroy et lui, de ne pas avoir de système ; mais Jouffroy regardait les systèmes du dehors, et les avait en profond dédain ; M. de Rémusat, au contraire, les recherchait, y entrait, les étudiait de tous les côtés, et les repoussait après examen. Quelque temps avant de se présenter à vos suffrages, pour succéder à Royer-Collard, il publia deux nouveaux ouvrages : l’un sur Abélard, en deux volumes ; l’autre sur la philosophie allemande.
Ce livre sur la philosophie allemande était originairement un rapport fait à l’Académie des sciences morales et politiques à l’occasion d’un concours. Il avait été remarqué. M. de Rémusat y montre déjà, comme historien de la philosophie, trois qualités qu’il a eues plus tard à un degré plus élevé. D’abord, quand il parle d’un auteur, il lit consciencieusement, et dans l’original, tous ses ouvrages ; ensuite, vous me pardonnerez ce mot, qui ressemble à une épigramme, il comprend toujours ce qu’il expose ; et enfin, dans ses jugements, il est toujours d’accord avec le sens commun. Parmi les philosophes de profession, il en est qui, sans se l’avouer, lui font un crime de ces deux derniers mérites, et qui parlent de scepticisme, parce qu’il est tout à fait exempt de parti pris, d’engouement et de charlatanisme. Il faut souvent, pour être résolument d’une école, ou ne pas tout voir, ce qui est une faiblesse intellectuelle, ou ne pas avouer tout ce qu’on voit, ce qui est une faiblesse morale. Ce n’était pas le cas de M. de Rémusat, dont le caractère en philosophie était fait de curiosité et de sincérité. Il avait joint à son rapport une longue préface sur les doctrines de Kant, Fichte, Schelling et Hegel. Il y juge le panthéisme, dans la personne de ses plus illustres représentants, avec sévérité et respect. « La science de l’absolu, dit-il, se termine toujours par une apothéose de l’humanité ; mais, quelque grande quelque solennelle que soit toute philosophie de ce genre, je doute qu’elle satisfasse et persuade jamais ce qu’elle divinise. L’homme résistera toujours à cette violence faite à ses croyances fondamentales ; et c’est pourquoi la foule du public lettré, condamnant les principes par leurs conséquences, fait trop souvent porter à la philosophie la peine des systèmes philosophiques. »
Le livre d’Abélard, publié la même année que le précédent, m’oblige à revenir en arrière pour vous parler d’une partie très-intéressante et très-inconnue de la vie littéraire de M. de Rémusat. Tout le monde a dans les mains ses deux volumes sur Abélard, et personne ne les lira sans émotion et sans admiration ; mais on ne sait pas généralement qu’avant de les écrire, il avait traité le même sujet sous une autre forme. Il avait composé un drame d’Abélard. Ce drame est demeuré inédit, quoiqu’il fût l’objet des secrètes prédilections de l’auteur. M. de Rémusat l’a seulement lu dans quelques salons, avec un succès que M. Duvergier de Hauranne, juge compétent, appelle prodigieux. C’était, selon Sainte-Beuve, de toutes les œuvres de M. de Rémusat, celle qui donnait l’expression la plus entière et la plus vraie de son talent. Ce drame d’Abélard n’était pas le seul qu’il eût composé. Ses amis ne lui permirent jamais de publier ces sortes d’écrits. Ils pensaient qu’on ne saurait être à la fois homme d’État et auteur dramatique. Je connais un pays voisin où l’on peut avoir écrit de beaux romans et devenir premier ministre ; mais nous avons ici, au théâtre, le goût des unités, et, dans la vie, celui des spécialités. Je dirai pourtant, sans souci du préjugé, et avec votre permission, Messieurs, quelques mots du théâtre de M. de Rémusat ; et ce sera, pour beaucoup de personnes, une révélation ; car, parmi les auditeurs privilégiés de 1844, combien reste-t-il de survivants ? J’ai eu entre les mains quatre compositions dramatiques de M. de Rémusat. Les deux premières sont des ouvrages de sa jeunesse, écrits en quelques jours avec une facilité aimable. En voici les titres : Jean de Montciel, ou le Fief. Il l’appelle une tragédie ; en tout cas, c’est une tragédie en prose. Elle fut écrite en 1824. Il la lisait et même il la jouait ; car il jouait la comédie avec talent ; et il a eu souvent beaucoup de succès en jouant le rôle du Misanthrope. L’autre drame, qui est presque du même temps, a pour titre : l’Habitation de Saint-Domingue, ou l’Insurrection. Quatre ans plus tard, en 1828, il fit une tentative bien autrement sérieuse : il composa un drame historique sur la Saint-Barthélemy. Pour celui-là, il ne l’écrivit pas, comme les autres, en douze jours. On voit, en le lisant, que la plupart des mémoires du temps lui sont familiers. On retrouve à chaque instant les récits de Tavannes, de Villeroy, de Marguerite de Valois, ou ceux de Sully, Bouillon, Lanoue, Montluc et Brantôme. On y reconnaît jusqu’à leurs expressions. Ce n’est pourtant pas une marqueterie ; c’est un récit original, saisissant, où les causes des évènements sont parfaitement déduites, et dont le principal mérite est peut-être une appréciation exacte, et souvent profonde, des caractères. Je renonce, bien malgré moi, à vous en lire quelques pages qui vaudraient mieux,pour vous faire apprécier le talent dramatique de l’auteur, que l’analyse la plus fidèle.
Le drame d’Abélard, auquel je reviens, se rattache beaucoup plus que la Saint-Barthélemy aux études ordinaires de M. de Rémusat. Il s’est occupé pendant longtemps de la philosophie du XIIe siècle. Il avait conçu le plan d’un ouvrage qu’il voulait appeler les Quatre Abbés ; je ne sais si le titre était bien choisi, et il en doutait lui-même. Les quatre abbés étaient saint-Bernard, abbé de Clairvaux, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, Suger, abbé de Saint-Denis, et Abélard, abbé de Saint-Gildas. Il aurait pu aussi y joindre saint Anselme, sur lequel il a écrit tout un volume, et qui, avant d’être archevêque de Cantorbéry, avait été abbé du Bec. Mais, dans sa première conception, c’était le XIIe siècle qu’il voulait étudier. Il était sans doute, comme philosophe, très-préoccupé de la scolastique ; mais ce qu’il cherchait en elle, ce n’était ni des idées nouvelles, qui n’y abondent pas, ni des systèmes bien profonds, car à cette époque, où la religion est toute-puissante, aussi bien dans le monde temporel que dans le monde spirituel, les systèmes ne sont que des efforts tentés par la raison pour se distinguer de la foi en se faisant accepter ou amnistier par elle. Chacun de ces quatre abbés représentait à un degré éminent un des caractères du siècle ; à eux quatre ils représentaient d’une façon complète la pensée générale de leur temps. Saint Bernard, c’est la domination morale de l’Église, intervenant en maîtresse dans les principales affaires de la société. Suger est tout autre chose, c’est le moine transformé en homme politique, en hommes d’affaires ; ne se contentant pas d’influer sur les évènements, de les diriger de haut dans le sens des doctrines de l’Église, mais les gouvernant en détail de ses propres mains. L’abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, semble personnifier, sous une forme auguste, la vie religieuse ; il est, dit M. de Rémusat, l’idéal du moine. En lui vit comme une image de la religion, telle que l’entendent les nobles âmes, qui aiment mieux voir en elle une foi et une vertu qu’une doctrine et une puissance. Abélard, c’est la science, la science soumise à la foi, ou du moins voulant être soumise, quoique ayant en soi l’instinct de la résistance, s’appuyant autant sur les textes que sur le raisonnement, se croyant et se disant orthodoxe, même dans ses plus grandes témérités. M. de Rémusat commença par Abélard, qui l’attirait le plus, par la nature de ses travaux, par le roman de sa vie, par cette longue, éclatante et douloureuse lutte contre saint Bernard ; et finalement il s’y arrêta sans pousser plus loin son entreprise. Son ouvrage, publié en 1845, n’a pas moins de deux gros volumes. Le drame, composé auparavant, a presque la même étendue. Abélard en est le héros, mais le XIIe siècle y est tout entier. C’est le morceau capital, l’œuvre maîtresse de l’auteur. Si l’on voulait n’étudier M. de Rémusat que dans un de ses ouvrages, et le connaître à fond, c’est le drame d’Abélard qu’il faudrait prendre.
Ce drame, en dépit du nom que l’auteur lui donne, n’est pas fait pour la scène. Il est trop long ; il contient trop de parties que le public n’entendrait pas, et qui supposent dans le lecteur une science très-étendue des matières philosophiques ; on y trouve des scènes d’amour dont la représentation serait impossible, en France surtout, où le public applaudit les équivoques et les gravelures, mais ne supporterait pas le langage un peu brutal de la passion. Dernier obstacle : nous sommes à peu près guéris de la manie des trois unités, même de l’unité d’action, mais nous tenons à l’unité absolue des caractères, oubliant que les héros faits tout d’une pièce ne sont pas dans la nature. Nous voulons à toute force qu’un homme soit toujours, qu’il soit complètement ce qu’il est beaucoup. On peut sans doute essayer de grandir la nature, c’est le moyen de ne pas rester trop au-dessous d’elle ; mais la changer, c’est se tromper sur les véritables sources de l’émotion. L’Abélard de M. de Rémusat est un homme. Comme il l’a étudié à fond, il le peint tel qu’il était. C’est un homme, dis-je, avec ses diversités et ses défaillances, mais aussi avec un caractère, et l’un des caractères les plus fortement trempés, qu’il y ait dans l’histoire. Mettons donc, Messieurs, qu’il s’agit d’un drame, que vous lirez, je l’espère bien, mais que vous ne verrez jamais représenter sur aucun théâtre.
Il y a cinq actes, dont voici les titres : la Philosophie, la Théologie, l’Amour, la Politique, la Mort. Vous le voyez ; tout un monde. L’auteur n’a pas donné à cet ouvrage l’épigraphe qu’il a inscrite sur le titre de ses Essais de Philosophie : « Templa Serena. »
La première scène se passe dans le cloître de Notre-Dame. Les écoliers attendent la leçon de Guillaume de Champeaux, leur maître : un maître illustre, qu’ils appellent l’Aristote de Paris. Abélard, pour la première fois, est au milieu d’eux. Il vient de loin, d’un pays presque inconnu, de Bretagne. Il a laissé les armes, quitté son fief pour la dialectique. Il rêve d’autres batailles ; il aspire à une autre royauté. On le questionne. Il répond avec une modestie à travers laquelle perce, comme malgré lui, le sentiment de sa force. On ouvre les portes, les écoliers se précipitent, et Guillaume de Champeaux fait sa leçon. Notez qu’il la fait très-réellement ; ce n’est pas une leçon de comédie, c’est un exposé très-fidèle, et clair autant qu’il peut l’être, du système de la réalité des universaux. Après cela, il ne faut pas oublier que Guillaume de Champeaux est cet homme qui, quand il faisait du feu, remplissait la maison de fumée et n’y donnait pas de chaleur.
GUILLAUME (après sa leçon).
Avant de passer outre, je vous ferai une seule interrogation. Êtes-vous satisfaits ? Ne subsiste-t-il aucun nuage dans vos esprits ? En est-il un de vous qui conserve des doutes ? Qu’il les produise, je les dissiperai. Ut potero, explicabo.
Tous les écoliers se regardent et témoignent par un murmure approbateur qu’ils n’ont rien à dire. À peine le silence se rétablit-il, que, du milieu de la foule, Abélard lève la main et dit :
Je demande à répondre.
GUILLAUME (surpris).
Ah ! ah !... approchez. Je ne vous connais pas.
ABÉLARD.
Je suis inconnu.
GUILLAUME.
Ah ! ah ! Êtes-vous clerc ?
ABÉLARD.
Je ne suis rien.
GUILLAUME.
Que demandez-vous ?
ABÉLARD.
À parler.
GUILLAUME.
Ah ah !... Mais je ne sais si je dois permettre.
ABÉLARD.
Vous avez fait une question, j’y réponds. Vous avez dit : Quelqu’un a-t-il des doutes ? J’ai des doutes, je viens les dire...
GUILLAUME.
Soyez bref.
ABÉLARD.
Je dirai tout ce qu’il faut pour être compris, car je veux, moi, être compris. C’est à la raison de tous et de chacun que je m’adresse, et je ne réclame d’autre autorité que celle de la raison même. Mais c’est une grande autorité que celle-là...
GUILLAUME.
Première erreur. Poursuivez, et faites vite.
ABÉLARD.
Erreur, maître ? Où est l’erreur ? Nous ne sommes pas ici en théologie, nous ne traitons pas de matières de foi. De quoi traitons-nous ? De dialectique. Qu’est-ce que la dialectique ? C’est la raison armée de toutes pièces. Qu’est-ce que les luttes de nos écoles ? Une lice où la raison fait ses preuves. Vous-même, il n’y a qu’un instant, que faisiez-vous ? Vous raisonniez. Vous n’aviez pas, que je sache, dés éclairs dans les yeux, ni la foudre dans les mains ; non, votre seule arme était la parole, la parole, ce lien commun des intelligences qu’elle unit par le consentement de la raison. Que fais-je à présent ? Moi aussi, j’ai la parole, et j’essaye de raisonner à mon tour. Pour un moment, nous sommes égaux. La vérité fixe seule les rangs entre les intelligences. Toutes ne sont-elles pas émanées de la même lumière et plongées dans le même limon ?
Et la dispute continue, mais en forme, avec les arguments mêmes puisés dans les livres d’Abélard et dans les récits des historiens sur Guillaume de Champeaux, Abélard toujours plus vif et plus pressant, Guillaume de Champeaux embarrassé, irrité, et, sur la fin, remplaçant le raisonnement par des invectives. L’auditoire prend parti pour le jeune contre le vieux, pour l’inconnu contre l’illustre. Il veut faire descendre Guillaume de sa chaire et y faire monter Abélard.
Oh ! les insensés ! s’écrie le maître. Satan est entré ici.
ABÉLARD.
Non, Satan n’est point entré, ô mes amis. Rassurez-vous, l’hérésie n’est ni dans mon cœur ni sur mes lèvres... Guillaume de Champeaux, tu les entends. Je pourrais te renverser de cette chaire, mais je ne suis pas venu pour forcer personne à se taire, je suis venu pour rendre à chacun le droit de parler. Je rouvre le combat des intelligences. Garde ton école, rassemble tes disciples, mais souffre qu’un nouvel enseignement s’élève en face du tien. Et vous, ô mes auditeurs... dirai-je mes disciples ?
VOIX NOMBREUSES.
Oui ! oui !
ABÉLARD.
Choisissez. Qu’on se sépare. Que les uns restent au pied de cette chaire de doute et d’ignorance ; que les autres viennent avec moi chercher la vérité. La vérité, la vérité ! qui l’aime me suive !
(Presque tous les écoliers se lèvent.)
L’auteur nous montre ensuite Abélard assistant à une orgie d’étudiants assez grossière. Le maître se lève tout à coup, au milieu des brocs d’hydromel et des filles, et adresse aux écoliers à moitié ivres un véritable sermon sur les grandeurs de la philosophie. Les cris s’apaisent d’abord ; à l’étonnement succède l’admiration, puis l’enthousiasme et des transports de tendresse. Il part de là avec eux pour aller fonder l’école de Paris. L’école est ouverte ; la vaste salle peut à peine contenir les disciples qui ont quitté l’école de Guillaume et ceux qui accourent de toutes les parties de l’Europe. Un grand bruit s’élève au dehors : c’est la foule qui veut entendre le Maître Pierre. Fermez les portes, crient les écoliers. Non, ouvrez-les, dit-il ; ouvrez-les toutes grandes ; et, descendant de sa chaire, il vient sur le seuil enseigner, pour la première fois dans l’histoire du monde, la philosophie à la multitude. Bientôt la philosophie ne lui suffit plus à lui-même, ou du moins il sent que le vrai champ de bataille n’est pas dans les questions philosophiques. La plus grande école de théologie est celle d’Anselme, doyen de l’église de Laon. Abélard quitte Paris, au fort même de son triomphe, et va se confondre dans les rangs de l’auditoire d’Anselme. L’enseignement de ce nouveau maître est rempli de science et d’idées ; ce qui lui manque, c’est l’unité, la méthode, la lumière. C’est une forêt épaisse où l’on ne peut ni voir le jour, ni se frayer un chemin. Abélard s’y retrouve cependant, et bientôt, maître de la théologie comme il l’était déjà des sciences philosophiques, il devient le roi incontesté des écoles. Il n’est plus seulement le premier des maîtres, il est le seul maître. Il est l’idole non-seulement des étudiants, mais des lettrés, de la foule, des femmes. Il est jeune, il est beau, il est poète : on ne chante plus que ses chansons, et lui-même les chante avec un art admirable. La curiosité qui s’attache aujourd’hui au théâtre, aux journaux, aux livres, aux débats des assemblées, se concentrait sur lui seul. Il avait cent autres moyens d’attraction que ces leçons arides, dont il nous a laissé, dans ses ouvrages, le résumé assez rebutant ; et ces leçons étaient pourtant son attraction la plus puissante. Les questions qu’il y agite, sous une forme barbare, sont au fond les plus grandes questions du monde ; et il n’y avait alors ni d’autres questions, ni d’autre façon de les discuter. Le nominalisme, le conceptualisme, la réalité des universaux : sous tous ces noms, c’était l’autorité même de la raison qui se discutait. Tout le monde, sans exception, condamnait la liberté, et la moitié du monde luttait inconsciemment pour elle. Orgueil, vanité, joie du triomphe, tout portait Abélard, tout l’enivrait, tout lui cachait le péril prochain. Amant de la lutte autant que de la vérité, il avait quitté la Bretagne, tout enfant, pour venir jouter contre Guillaume de Champeaux ; victorieux, il s’était arraché à l’enthousiasme de ses disciples pour aller écouter Anselme, le provoquer et le renverser. Il voyait croître de jour en jour les défiances et les colères de l’abbé de Clairvaux, presque aussi maître de l’Église que le pape lui-même ; mais, loin de l’effrayer, la perspective de cet antagonisme redoublait sa joie. C’est dans cette puissance et dans cet éclat que le prend le troisième acte, un acte admirable, consacré tout entier à l’amour d’Héloïse ; une histoire qui commence comme une idylle et se termine comme une tragédie. Après la vengeance de Fulbert, la vie d’Abélard, jusque-là si triomphante, n’est plus qu’une longue agonie. L’auteur ne nous mène pas sur le rocher de Saint-Gildas, où le nouvel abbé gouverne des brigands plutôt que des moines, et se défend à grand’peine contre le poison et le poignard ; le quatrième acte, franchissant cet intervalle, s’ouvre par une description animée de cette colonie ou plutôt de cette cohue d’écoliers, accourus pour entendre Abélard dans une sorte de désert, et qui construisent de leurs propres mains l’oratoire du Paraclet. Nous passons de là ensuite sans transition dans la salle du concile de Sens.
Ce serait pour les yeux un spectacle plein de majesté ; les Pères du concile entrent les premiers processionnellement en chantant une hymne ; les évêques se placent sur leur trône. Alors paraissent avec leur suite le roi de France et le comte de Champagne. Le roi et l’archevêque de Sens sont assis aux places d’honneur ; mais tous les regards se portent sur l’abbé de Clairvaux, qui est l’âme du concile. Les portes du fond s’ouvrent : on aperçoit la multitude au-delà du parvis. Elle s’écarte avec horreur quand Abélard paraît. Ses disciples l’entourent ou plutôt le portent ; mais les archers croisent leurs piques, ils enlèvent Abélard du milieu de la foule ; les portes se ferment derrière lui, et le voilà seul, dans un vaste espace laissé vide en face de ses juges. L’accusateur se lève et fulmine l’accusation. Abélard veut protester ; mais à chaque nouvel effort on crie de toutes parts : Taisez-vous ! Repentez-vous ! Après l’accusateur, l’accusé n’aura-t-il pas son tour ? Le voilà venu pour lui, ce moment si désiré où il va défendre sa doctrine, non plus devant des milliers de disciples obscurs, mais devant l’Église elle-même ! Non ; on l’arrête encore dès le premier mot. Il ne parlera pas ; c’est la volonté de ses juges. N’avait-on pas dit : « Il faut briser cette bouche avec des bâtons ? » L’archevêque fait lire la liste des hérésies qu’on lui impute :
ABÉLARD.
Mais je n’ai pas dit...
— Silence ! Il suffit d’entendre ces paroles pour reconnaître que ce docteur, réunissant en lui toutes les erreurs de plusieurs hommes et de plusieurs siècles, parle de la Trinité comme Arius, de la grâce comme Pélage, et de Jésus-Christ comme Nestorius. Abélard, vous avez entendu vos hérésies. Déclarez que vous les détestez.
ABÉLARD.
Mais ce que je n’ai pas dit...
— Vous refusez... Saint archevêque, qu’on prononce la sentence.
(Le président fait lever tous les Pères, qui vont aux opinions en cercle autour de lui. Pendant ce temps, Abélard reste pensif, les yeux fixés vers la terre. Après que les Pères ont opiné, ils reprennent chacun leur place.)
L’ARCHEVÊQUE DE SENS.
Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous, etc. (Suit la sentence.)
ABÉLARD.
J’en appelle au saint-siége.
— L’appel ne suspend rien. (Abélard veut fuir.) Retenez-le... Le feu est-il prêt ?
(On dépose devant Abélard un réchaud rempli de braise allumée.)
Mon frère, vous avez entendu la sentence. Soumettez-vous avec humilité : expiez vos fautes par le repentir. L’indulgence du Ciel confirmera celle du concile.
ABÉLARD.
C’en est trop. J’atteste ce Ciel...
— Point de parjure à l’appui du blasphème. À genoux !
ABÉLARD.
Non !
— À genoux. Rétractez.
ABÉLARD (tendant les bras vers le roi).
O roi !...
— À genoux. Rétractez.
ABÉLARD.
Mais... je veux parler !
— Rétractez. Rétractez.
LE DIACRE.
Le feu brille.
— Donnez-lui son livre.
ABÉLARD.
Je veux parler... Par grâce !... (Il fond en larmes.)
— Qu’il le brûle. Prenez-lui la main de force.
(On ouvre les portes. La foule se précipite.)
Peuple, venez voir Ananias tomber devant saint Pierre.
ABÉLARD.
Ah ! je meurs... (Il tombe évanoui.)
On sait qu’Abélard maintint son appel, et que, malade, ou plutôt mourant, il partit à pied pour aller à Rome plaider lui-même la cause devant le souverain pontife ; mais les forces lui manquèrent en chemin. Nous le retrouvons, au cinquième acte à l’abbaye de Cluny, auprès du doux apôtre qui écrivait saint Bernard : « Vous remplissez les devoirs pénibles et difficiles qui sont de jeûner, de veiller, de souffrir ; et vous ne pouvez supporter le devoir facile, qui est d’aimer. » Rien de plus touchant que le contraste entre cette âme, a qui le repos a été éternellement refusé, et cette abbaye de moines pieux et tranquilles, unis sous la houlette de Pierre le Vénérable, qui veulent ignorer le monde, et ne le connaissent que pour l’aimer et le soulager. Abélard meurt parmi eux, encore troublé, sur son lit de mort, par la passion de la controverse. La controverse a été, à cette époque de l’histoire, la forme des guerres de religion.
Je ne sais si la plus belle partie de cette vaste composition n’est pas le troisième acte, celui que l’auteur appelle « l’amour ». Le sujet y est traité avec beaucoup de grâce dans les détails et, en même temps, avec une force singulière. L’auteur nous fait assister à une des leçons d’Abélard à Héloïse : c’est une leçon véritable, sans aucun ménagement pour ceux des lecteurs que pourraient effaroucher plus de cent vers latins, et les citations multipliées de la Bible et des Pères. L’amour se glisse parmi cette scolastique avec un art infini, et bientôt, comme c’est son droit, il efface tout le reste ; mais cet amour-là n’est pas celui que nous montrent les poëtes, même les plus hardis. Comment le dirai-je ? Tout cela n’est possible à raconter que parce qu’on sait que cela est vrai. C’est Héloïse. C’est elle-même, c’est son histoire ; c’est le style de ses incomparables lettres. M. de Rémusat, dans le drame comme plus tard dans son livre, préfère ouvertement Héloïse à Abélard. Il est même dur pour Abélard ; et je me suis permis, il y a aujourd’hui trente ans, de prendre la défense de son héros contre lui. Mais, quoiqu’il y ait une sorte d’injustice à reprocher à Abélard une apparente froideur, que démentent ses actes, et le vœu, exprimé au moment de mourir, que leurs cendres fussent un jour unies, comment ne pas réserver, comme M. de Rémusat, la première place à Héloïse ; à cette noble femme, si grande par son intelligence, plus grande encore par son amour, dont l’héroïque fermeté ne se démentit jamais parmi tant d’épreuves, qui, dans un siècle à demi barbare, inspira au monde entier une admiration attendrie, et rendit son amour même respectable à l’Église comme ses vertus ?
Le volume sur Saint Anselme de Cantorbéry suivit de près la publication d’Abélard. Saint Anselme est un des devanciers d’Abélard, qui cependant lui a peu emprunté. Il tient le premier rang parmi les écrivains du XIe siècle, au-dessus de Lanfranc de Pavie. Il a laissé beaucoup de livres. Le principal est sans doute le Monologium, qui, aujourd’hui encore, mérite d’être étudié. De divinitatis essentia monologium, Monologue sur l’essence de Dieu : c’est un effort pour se rendre compte de la nature de Dieu, uniquement par la force de la raison, et sans recourir aux saintes Écritures. Le Dieu auquel sa raison le conduit est celui que la foi révèle ; mais la méthode suivie est bien la méthode philosophique ; et il est impossible de ne pas être frappé de l’analogie qui existe entre la méthode de saint Anselme et celle de Descartes. On n’est pas moins surpris en trouvant, dans un autre écrit de saint Anselme, le célèbre syllogisme par lequel Descartes démontra l’existence de Dieu. Cet argument, proposé par Descartes sous une forme très-serrée, développé et fortifié par Leibniz, est tout entier dans saint Anselme. M. de Rémusat n’a pas tort de considérer l’auteur du Monologium comme un des plus éminents métaphysiciens du moyen âge. Devenu, après Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, saint Anselme défendit contre le pouvoir civil, avec douceur et fermeté, les droits de l’Église. C’est un des côtés par lesquels son histoire attirait M. de Rémusat, toujours préoccupé des luttes soutenues parle pouvoir spirituel, tantôt contre le pouvoir temporel, et tantôt contre les efforts de la raison.
Il connaissait bien l’histoire d’Angleterre, ou, pour parler plus exactement, l’histoire des idées en Angleterre. Quand la révolution du 2 décembre le bannit de son pays, il traversa seulement la Belgique, et passa assez longtemps en Angleterre, où tous les moyens d’étude lui furent prodigués. On peut presque dire que ce pays devint, à partir de ce moment, l’objet principal de ses études. Il publia successivement l’Angleterre au XIIIe siècle, deux volumes dont Bolingbroke, Walpole et Fox occupent la plus grande partie ; un grand ouvrage sur Bacon ; une étude neuve et curieuse sur lord Herbert de Cherbury ; enfin, une Histoire de la philosophie anglaise depuis Bacon jusqu’à Locke. À l’exception de la réfutation de Locke par M. Cousin, nous n’avons dans notre langue aucun ouvrage qui expose la philosophie anglaise avec autant d’érudition, de clarté et de sagacité. Je signale surtout, à cause de la nouveauté du sujet, le travail sur lord Herbert de Cherbury. M. de Rémusat a fait là, en quelque sorte, une découverte. On connaissait un peu le livre d’Herbert, et pas du tout sa vie. C’est un méditatif qui, pour arriver à penser en philosophie comme le jésuite Buffler et le pasteur de village Thomas Reid, a passé par les camps, la cour d’Élisabeth, celle des Stuarts, celle de Louis XIII et le long parlement : vie amusante et intéressante, après tout, quoiqu’elle ne rappelle en rien celle des héros de Diogène Laërce. Lord Herbert de Cherbury est tout simplement un homme qui a résumé la philosophie écossaise quelques années avant qu’elle prît naissance. Comme méthode, c’est la philosophie de l’observation et du bon sens ; comme conclusion, c’est la religion naturelle. Cela n’est pas original comme Descartes, ni étendu comme Leibniz, ni profond comme Kant et Fichte ; mais cela est peut-être vrai, et, s’il en est ainsi, M. de Rémusat n’a pas trop perdu son temps en le remettant en lumière.
Il me resterait à parler de trois ouvrages de M. de Rémusat : vous voyez que la liste était longue, et pourtant je n’ai pas tout cité, il y a des articles importants qu’il n’a-pas recueillis, par exemple, les notes d’un voyage en Italie, publiées dans la Revue des Deux-Mondes, et qui mériteraient bien de paraître en volumes. Ces trois ouvrages sont : Passé et présent, la Politique libérale, la Philosophie religieuse.
Passé et présent, réédité depuis sous le titre de Critiques et études littéraires, c’est le Globe, ou du moins ce sont des articles écrits à la fin de la Restauration et au commencement du règne de Louis-Philippe. En publiant ces trois livres, Passé et présent, la Politique libérale et la Philosophie religieuse, j’oserais presque dire que l’auteur a voulu résumer sa jeunesse, sa politique et sa philosophie. Nous sommes un peuple qui ne savons que nous résigner à l’excès ou courir aux révolutions. Il disait plaisamment : « Il y a en France une foule de gens qui n’ont que deux goûts, recevoir des coups de bâton et tirer des coups de fusil. Quand ils sont las d’un exercice, ils passent à l’autre. » Notre histoire ne lui donne que trop raison. Peu de peuples ont passé aussi souvent que nous de la servitude à la liberté, et de la liberté à la servitude, et, pour surcroît de malheur, quand nous établissons la liberté, nous laissons subsister au milieu de nous, faute de temps et de prévoyance, tous les instruments du despotisme. Ce sont ces instruments que M. de Rémusat prend à partie dans sa Politique libérale, et ce qu’il veut démontrer, c’est qu’ils ne sont pas ou qu’ils ne sont plus nécessaires à l’ordre. Le grand principe de la philosophie politique est en effet que toute restriction à la liberté humaine cesse d’être légitime le jour où elle cesse d’être nécessaire.
La Philosophie religieuse est le plus court des livres de M. de Rémusat. C’est une suite d’articles critiques sur des ouvrages français et anglais ayant pour objet la religion naturelle. Après ces discussions vient un dernier chapitre où l’auteur conclut en son propre nom.
Quelques moments avant de boire la ciguë, Socrate disait à ses disciples qu’il était sûr de la bonté divine. Puisque ces paroles ont été prononcées, ou du moins écrites, aux environs de la quatre-vingt-quatrième olympiade, il est difficile de refuser à la raison humaine la faculté de s’élever par ses propres forces à la certitude de l’existence de Dieu. Et comme on ne saurait apparemment parler de Dieu sans en concevoir quelque idée, cette notion, quelle qu’elle soit, est déjà, suivant l’étymologie du mot, une certaine théologie. Et comme cette théologie est due à la lumière naturelle, il est donc vrai qu’il y a une théologie naturelle. Ainsi l’ont pensé, d’accord avec les philosophes, les plus grands docteurs de l’Église. Il suffit de contempler l’ordre visible du monde pour avoir le droit d’assurer que la cause en est intelligente, et il suffit de lire dans la conscience humaine pour avoir le droit d’affirmer que Dieu est le souverain bien. L’ordre excellent qui résulte dans le monde physique de la puissance des lois naturelles, et de l’autorité de la raison dans le monde moral, réalise pour nous le double idéal de la beauté créée, et c’est dans ce sens que Kant a pu dire que le sublime éclate dans le ciel étoilé et la conscience du devoir.
Messieurs, cette énumération rapide ne donne pas une idée complète des œuvres de M. de Rémusat, qui a été un de nos plus féconds écrivains. Peu de personnes chez nous ont mieux connu la philosophie allemande et la philosophie anglaise ; bien peu ont étudié comme lui la scolastique ; personne peut-être ne se tenait avec plus de soin au courant des ouvrages nouveaux, et ne les étudiait plus sérieusement. L’histoire politique et littéraire ne lui inspirait pas une curiosité moins active et moins éclairée. Sa vie serait évidemment très-remplie, s’il n’avait été qu’un homme de cabinet et d’Académie, vivant avec les livres et au milieu des lettrés ; mais nous avons aussi parcouru sa carrière politique. Nous l’avons vu sous la Restauration à la tête de la jeunesse libérale ; prenant à la révolution de Juillet une part prépondérante ; conseiller de la Fayette, collaborateur de Casimir Périer ; député très-influent pendant le règne de Louis-Philippe, sous-secrétaire d’État et ministre de l’intérieur ; nous l’avons retrouvé, dans les assemblées républicaines qui ont précédé l’empire, aussi ferme que ses amis dans la défense de la société, plus favorable que la plupart d’entre eux à l’établissement d’un gouvernement républicain, fuyant alors les occasions de paraître que tant d’autres recherchaient, et se dévouant avec son ancienne vigueur, toutes les fois qu’il fallait affronter un péril. La difficulté lui était un attrait, comme pour tous les vaillants et les forts. On a dit très-bien de lui (2 ) « Il aimait hardiment la vérité, comme il aimait hardiment la liberté ; il était de la race française, généreuse, brillante et fortement trempée, qui cache sa fermeté sous la bonne grâce et fait les grandes choses simplement, parce qu’il ne lui coûte pas de les faire. »
Avec ces grandes affaires où il fut constamment mêlé, avec ses habitudes littéraires, sa collaboration constante à la Revue des Deux-Mondes, ses fréquents et importants discours et rapports académiques, son assiduité dans les salons, il trouvait encore le moyen d’être le plus obligeant du monde, et l’on sait ce que c’est que d’être obligeant, pour un homme en vue. Il ne faisait pas beau lui demander un service ; il voyait sur-le-champ l’objection, et il la disait ; de promesses, il n’en faisait pas. Il agissait pourtant, avec beaucoup d’énergie et d’habileté, quand la cause lui paraissait juste, soit qu’il eût, ou non, promis de le faire. On apprenait ensuite par d’autres la peine qu’il s’était donnée, jamais par lui. Non qu’il se retînt de le dire ; il ne lui venait pas à l’idée de chercher des remercîments, de se faire des clients. En se rappelant cette constante et féconde activité, en des genres si divers, ceux qui avaient le bonheur de le voir dans l’intimité ne pouvaient assez admirer de le trouver toujours prêt à écouter et à répondre, pourvu que le sujet et l’interlocuteur en valussent à peu près la peine. Personne ne l’a jamais vu affairé. Où travaillait-il ? Ses amis mêmes ne le savaient pas. Nul ne portait dans le monde, où il était très-répandu, une conversation plus animée, plus variée, plus nourrie de connaissances sérieuses, plus instructive par les anecdotes nombreuses et choisies, par la connaissance approfondie des événements et des caractères, plus attrayante par l’abondance des aperçus, et par un ton de bonne compagnie qu’il devait en partie à son éducation, mais qui chez lui était naturel et tenait à toutes les qualités et à toutes les habitudes de son esprit, En affaires, je dis dans les plus graves affaires, on le retrouvait le même : attentif, clairvoyant, alerte, un peu pessimiste, et, malgré cela, disposant librement de ses idées et de son langage. Sans les malheurs de son pays et un affreux malheur personnel (la mort de son fils aîné), on pourrait dire que la fortune lui a été propice et favorable en toutes choses. Il avait dans sa jeunesse tout juste ce qu’il faut de bien pour n’avoir ni tentations à vaincre, ni inquiétudes à éprouver. La position de sa famille ne le mettait pas d’emblée en évidence, mais elle lui procurait des relations avec les hommes les plus éminents dans la politique et les lettres. L’avantage qu’il prisait le plus, et avec raison, c’était d’avoir eu pour mère une femme telle que madame de Rémusat. Il avait été neveu par alliance de Casimir Périer. Un second mariage le rendit petit-fils de la Fayette et beau-frère de Jules de Lasteyrie. Il avait pour compagne une de ces femmes qui sont incapables, je ne dirai pas de conseiller, mais de pardonner une faiblesse. Enfin le Ciel lui avait donné deux fils dignes de lui.
Hélas ! de ces deux fils, un seul portera le glorieux poids de ce nom, qui est désormais un grand nom. L’aîné est mort par accident, enlevé à vingt-cinq ans, en pleine santé et en plein bonheur.
Horace Walpole a dit un jour que la vie est une comédie pour ceux qui pensent, et une tragédie pour ceux qui sentent. À voir M. de Rémusat, à causer avec lui, on pouvait croire qu’il ne connaissait que la comédie. C’est qu’il n’avouait que ce côté-là ; mais, dans les très-rares moments où il s’échappait jusqu’à parler de lui, et à laisser lire dans son fond, il était facile de voir que la souffrance avait été intolérable et qu’elle était durable. Il a écrit, quelques années après soir un article vraiment tragique sur les tristesses humaines. Ce n’est pas de la déclamation, c’est de l’observation. Il n’était ni avec les stoïciens, qui nient la douleur, ou du moins s’efforcent de la dédaigner, ni avec les mystiques, qui la proclament bonne à titre d’expiation ou à titre d’épreuve. « Loin que la douleur soit bonne, disait-il, il n’y a de bon que de la vaincre, ou plutôt de nous vaincre nous-mêmes en dépit d’elle. » Mais cette victoire dont il parle a pour effet d’empêcher la douleur de nous abattre, et non pas de l’empêcher d’exister. Nous gardons jusqu’à la fin le trait empoisonné. Le temps, qu’on appelle le grand consolateur, n’agit qu’en forçant peu à peu l’attention à se porter sur de nombreux objets. Souffrir et penser, voilà la vie. La voilà, dans sa misère et dans sa grandeur.
Il souffrit aussi, et beaucoup, comme homme public. Non-seulement il était passionné pour la liberté, mais il aimait la gloire française. Personne ne mérita plus que lui le nom de citoyen et de patriote. Ni les défaites de la liberté ni celles de la France ne pouvaient laisser son âme indifférente. Il parlait encore, avec une profonde amertume, dans un article publié le 15 décembre 1864, de nos malheurs de 1814 et de 1815. « La frontière deux fois violée, à moins de deux ans de distance, le sol envahi, le drapeau de l’étranger sur nos monuments. Le cœur se serre à ce souvenir, » disait-il. Il ne pensait pas, en écrivant ces paroles, que les douleurs et les hontes subies dans sa jeunesse seraient dépassées par celles que nous réservait l’avenir.
Ces sinistres événements, qui ont attristé les dernières années de M. de Rémusat, lui ont pourtant fourni l’occasion de rendre à son pays un service éclatant et de mettre le sceau à sa propre gloire. Quand la France remit, à Bordeaux, ses destinées entre les mains de M. Thiers, que tous les partis regardaient alors comme le seul homme qui pût nous sauver, M. de Rémusat accourut, mais il ne voulut pas accepter de fonctions publiques. L’ambassade d’Autriche lui fut vainement offerte ; il résista à toutes les instances. Plus tard, quand M. Jules Favre, qui avait déployé, pendant son ministère, tant d’habileté et un si héroïque courage, annonça l’intention formelle de quitter le portefeuille des affaires étrangères, M. Thiers s’adressa de nouveau à la vieille amitié et au patriotisme de M. de Rémusat. La négociation fut longue ; elle réussit cependant. Je crois sincèrement que l’énormité des difficultés fut le plus fort argument de M. Thiers. On était au lendemain de la Commune ; il s’en fallait que la paix fût faite dans les âmes. Sans la grande renommée de M. Thiers, sans la supériorité reconnue de son esprit, sans la fermeté de son caractère, sans son incomparable activité, toutes les sources de la vie nationale auraient été pour longtemps taries. Le péril a été si promptement conjuré, que nous n’en voyons plus la profondeur. Ce qui le redoublait, c’était la présence d’une armée ennemie sur notre sol. La moindre faute du plus infime agent compromettait la durée de la paix. Le ministre des affaires étrangères n’avait au dehors que des agents, nouveaux dans leur métier, humiliés par nos désastres, découragés et dévoyés par nos dissensions intestines, presque réduits au rôle de clients ; et, quant à la Prusse, contre laquelle il fallait défendre pied à pied les stipulations du traité de paix, et qui occupait en armes notre territoire, nous ne pouvions opposer à ses ombrages et à ses exigences que des raisons, je ne dis pas des prières. La présence dans nos départements de cette armée ennemie créait à elle seule une source inépuisable d’embarras et de dangers. Non-seulement les fautes de nos fonctionnaires, mais les colères et les impatiences, souvent trop légitimes, de leurs administrés, pouvaient donner lieu à une conflagration, pour le plus minime prétexte. Le chef de l’armée d’occupation était animé du meilleur esprit, homme éminent d’ailleurs, et dont la gloire sera d’avoir atténué de tout son pouvoir les conséquences de la situation ; mais enfin il était le vainqueur : il avait, en Allemagne, au-dessus ou à côté de lui, des rancunes et des hostilités terribles contre notre nation ; il maintenait, à grand’peine, dans le bon ordre, une armée dispersée sur un territoire immense. Le gouvernement français trouvait un énergique et patriotique appui dans la Chambre, toutes les fois qu’il pouvait invoquer son concours en faisant ouvertement connaître la situation ; mais il était obligé, dans l’intérêt du maintien de la paix, de cacher les plus grosses difficultés ; et alors c’étaient, dans le parlement, des hésitations, des reproches, quelquefois des refus. Les partis d’ailleurs étaient aux prises, et l’on sentait que l’existence du gouvernement était menacée dans l’Assemblée. En réalité, rien n’était solidement établi, ni le gouvernement, ni la République, ni la paix. Voilà dans quelles conditions M. de Rémusat acceptait le pouvoir. La joie de M. Thiers fut immense, quand il vit à côté de lui ce vieux compagnon de ses luttes, dont le nom seul était une force, dont le caractère imposait le respect, et qui portait dans les affaires les trois qualités maîtresses de l’homme d’État : la droiture, la science et le courage. Avec M. de Rémusat et M. Dufaure à côté de lui, avec M. le maréchal de Mac-Mahon à la tête de l’armée française, M. Thiers pouvait se dire qu’au moins la France était défendue par ce qu’elle avait de plus digne et de plus capable. Je ne veux pas même mentionner les incidents du ministère de M. de Rémusat, ni son échec à Paris qui a eu tant d’influence sur la politique courante : ce qui importe surtout à sa mémoire, c’est la part considérable qu’il a prise à l’exécution du traité de paix, et à la libération anticipée du territoire. S’il était là, mon cher et noble ami, il m’approuverait de dire que cette œuvre admirable est, avant tout, la gloire propre de M. Thiers. Il n’était pas de ces hommes qui s’exagèrent leur part, et qui marchandent, après coup, leur reconnaissance. Que de fois, pendant ces journées terribles, a-t-il parlé avec ses amis, de cette lutte d’un seul homme contre une force toute-puissante, comme s’il n’avait été qu’un spectateur ! L’histoire, qui lui donnera la première place au-dessous du libérateur du territoire, montrera combien son rôle a été grand, quelle était chez lui la connaissance des faits et des hommes, l’attention soutenue sur les grands événements et sur les petits détails, l’assiduité des nuits et des jours, le secret impénétrable, la fécondité des ressources, la noblesse des sentiments, et, ce qui a son prix dans les relations internationales, la fermeté, la dignité, l’habileté du langage. À certains jours, on croyait tout perdu ; et sans rien dire à ses plus intimes amis, sans autre confident que le ministre des affaires étrangères et le ministre de la guerre, le président préparait tout pour une guerre de désespoir. Quelquefois aussi, quand la mesure ne dépassait pas ce que l’honneur peut supporter, on se résignait, avec quelle amertume ! Dieu, qui l’a vu, leur en tiendra compte. Souffrez ces quelques paroles d’un homme qui n’a eu d’autre mérite que de voir de près une histoire qu’il n’est pas encore temps de raconter. Je termine ici un hommage que je voudrais de grand cœur avoir pu rendre plus éclatant, et je le termine par des paroles que je, lui emprunte à lui-même dans l’éloge qu’il a fait de Casimir Périer : « Ce n’est pas aux seules affections personnelles qu’il faut dédier le portrait de ceux dont le nom illustre le pays. Un pays libre doit aimer à connaître, à connaître personnellement, en quelque sorte, les citoyens qui l’ont noblement servi, les hommes d’État qui l’ont noblement gouverné. Songeons-y bien ; là où règnent des institutions nationales, chacun peut dire : L’État, c’est moi ! car l’État, c’est la patrie. Nos ministres, nos orateurs, nos capitaines, sont à nous, ils nous appartiennent. Leur éloquence prête une voix à tous, leur génie est l’interprète de la raison publique, leur courage sert de rempart à la France, et leur gloire est sa parure. Leur vie anime nos annales ; ils sont les héros du drame de notre histoire, et, du fond de la scène, nous devons, comme un chœur fidèle, intelligent, ému, pénétrer dans leur âme, saisir leurs pensées, deviner leurs souffrances, et couronner leur tombeau. »      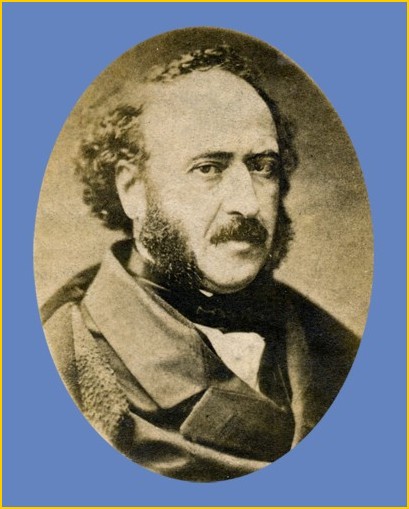  [img width=600]http://www.assemblee-nationale.fr/histoire
Posté le : 08/06/2014 14:38
|
|
|
|
|
Robert Desnos |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Le 8 juin 1945, à 44 ans, Robert Desnos meurt du typhus
au camp de concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie à peine libéré du joug de l'Allemagne nazie. Robert Desnos est un poète français du mouvement surréalisme, ses oeuvres principales sont Rose Sélavy 1922-1923, Demain en 1942,
Le souci en 1943, Le vin est tiré en 1943, il est né le 4 juillet 1900 à Paris .
Autodidacte et rêvant de poésie, Robert Desnos est introduit vers 1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 1922 l'aventure surréaliste. Il participe alors de manière éclatante aux expériences de sommeils hypnotiques et publie avec Rrose Sélavy 1922-1923 ses premiers textes qui reprennent le personnage créé par Marcel Duchamp.
En bref : dans les années 1924-1929, Desnos est rédacteur de La Révolution surréaliste mais rompt avec le mouvement quand André Breton veut l'orienter vers le Communisme. Il travaille alors dans le journalisme et, grand amateur de musique, il écrit des poèmes aux allures de chanson et crée avec un grand succès le 3 novembre 1933, à l'occasion du lancement d'un nouvel épisode de la série Fantômas à Radio Paris la Complainte de Fantômas .
Le poète devient ensuite rédacteur publicitaire mais concerné par la montée des périls fascistes en Europe, il participe dès 1934 au mouvement frontiste et adhère aux mouvements d'intellectuels antifascistes, comme l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires ou, après les élections de mai 1936, le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes.
En 1940 après la défaite de la France face à l'Allemagne nazie, il redevient journaliste pour le quotidien Aujourd'hui, et dès juillet 1942 fait partie du réseau de Résistance AGIR. Il poursuit ses activités de Résistance jusqu'à son arrestation le 22 février 1944. Il est déporté à Buchenwald et passe par d'autres camps avant de mourir à Theresienstadt Térézin, en Tchécoslovaquie : épuisé par les privations et malade du typhus, il y meurt le 8 juin 1945, un mois après la libération du camp par les Russes. La dépouille du poète est rapatriée en France, et Robert Desnos est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris.
Son œuvre comprend un certain nombre de recueils de poèmes publiés de 1923 à 1943 - par exemple Corps et biens 1930 ou The Night of loveless nights 1930 - et d'autres textes sur l'art, le cinéma ou la musique, regroupés dans des éditions posthumes.
Le surréalisme est un curieux mouvement littéraire : tous les grands écrivains qui en ont fait partie se sont réalisés après l'avoir quitté. Il semble ainsi que la notion de grand écrivain surréaliste ne corresponde à aucune réalité. Encore faut-il considérer que certains amis d'André Breton, et parmi les plus doués, sont morts très jeunes : René Crevel, Jacques Rigaut, ou se sont vite plongés dans un ombrageux silence, comme Benjamin Péret. Il existe pourtant un poète important qui sut rester profondément surréaliste après sa rupture avec André Breton, tout en élaborant une œuvre tout à fait personnelle : bien qu'assassiné à l'âge de quarante-cinq ans, et dans d'affreuses conditions, Robert Desnos n'a jamais cessé d'être Robert Desnos.
La révolte le conduisit vers le surréalisme, qu'il illustra par ses jeux verbaux Corps et Biens, 1930 autant que par son refus de toute entrave la Liberté ou l'Amour, 1927, récit érotique censuré. Par individualisme il quitta ce mouvement en 1930, donnant libre cours à un lyrisme nervalien qui ne refuse pas la versification classique, et recherchant l'expression populaire par le journalisme, le cinéma, la radio. L'amour et l'espérance animent ses poèmes clandestins ; sacrifiant sa vie à la Résistance, il mourut en déportation en laissant d'autres œuvres à succès Fortunes, 1942 ; Domaine public, 1953.
Amoureux de Paris, très attaché au quartier des Halles, où il est né et a passé son enfance, Desnos a la gouaille et la verve populaire de ses habitants. Aussitôt après avoir obtenu le brevet élémentaire, il exécute divers travaux d'écriture afin d'assurer son indépendance. Secrétaire de Jean de Bonnefon, le catholique anticlérical, il apprend à connaître le monde des lettres. Le service militaire qu'il accomplit au Maroc le tient éloigné de Dada, que son ami B. Péret lui avait fait découvrir. Son tempérament rebelle, ses attaches libertaires le conduisent vers le surréalisme. Il participe à une séance de sommeil hypnotique en 1922, où il se montre très doué, et dès lors alimente le groupe en poèmes et en dessins automatiques, prétendant être en correspondance mentale avec Rrose Sélavy, pseudonyme de Marcel Duchamp. Son aptitude aux jeux verbaux, son refus de toute entrave, son amour romantique et douloureux pour une vedette de music-hall, Yvonne George, en font un surréaliste exemplaire. Pourtant, son individualisme, son refus d'adhérer au parti communiste le conduisent à quitter le mouvement avec éclat, après la publication du Second Manifeste. Il donne alors libre cours à un lyrisme nervalien, qui ne refuse pas la versification classique. Il cherche à faire surgir l'expression populaire et la poésie du monde moderne à travers ses nouvelles activités : journalisme, radio, publicité, cinéma. La poésie et l'action se trouvent conciliés dans ses poèmes de la clandestinité qui affirment l'amour, l'espérance et la révolte contre l'envahisseur. Cette activité au service de la Résistance relance sa création littéraire : il publie des recueils de poèmes, un roman, Trente Chantefables pour les enfants sages et prépare le regroupement d'écrits antérieurs quand il est interné puis déporté : il meurt du typhus quelques jours après sa libération du camp. Son audience est assurée auprès d'un large public par la publication de ses poèmes dans Domaine public, complétée par Destinée arbitraire et Nouvelles Hébrides, qui regroupent ses écrits de 1922 à 1930.
Corps et Biens, recueil de poèmes. L'exploration des limites verbales produit les aphorismes et contrepèteries de « Rrose Sélavy , les à-peu-près et carambolages de l'Aumonyme et de Langage cuit, où le désir se travestit de poésie. Tandis que la confidence intime éclate dans À la mystérieuse , les Ténèbres et autres poèmes de l'ouvrage rapportent une cascade d'images rares des espaces du sommeil. L'ensemble constitue l'un des témoignages les plus marquants du premier surréalisme.
Années de jeunesse
Sa vie
Robert Desnos naît à Paris au 32, boulevard Richard-Lenoir. Il est le second enfant de Lucien Desnos et Claire Guillais. En 1902, la famille s'installe dans le quartier populaire des Halles où son père est mandataire pour la volaille et le gibier, mais également adjoint au maire de l'arrondissement. Ils habitent 11, rue Saint-Martin, dans ce coin de Paris qui sent le soufre où, jadis, les alchimistes et autres sorciers se livraient à d'étranges métamorphoses. Gérard de Nerval avait d'ailleurs trouvé là une source à ses voyages imaginaires.
En 1913, la famille déménage pour le 9, rue de Rivoli, un autre univers. Mais ce Paris interlope des artisans et des commerçants marque profondément l'enfant et apparaîtra abondamment dans son œuvre. Ses rêveries sont nourries par le spectacle insolite des rues, entre cloître Saint-Merri et Tour Saint-Jacques-la-Boucherie, et le monde varié des images que lui offrent aussi bien les affiches que les illustrations de L'Épatant et de L'Intrépide ou les suppléments illustrés du Petit Parisien et du Petit Journal.
À six ou sept ans, Desnos dessine d'étranges formes sur ses cahiers. À douze ans, il passe à la couleur, et son monde secret se teinte de fantastique. L'enfant se rêve enfant libre. Desnos fait sa première communion en 1911 en l'église Saint-Merri. À l'école, il n'est pas bon élève.
Il s'ennuie profondément et ne supporte pas le discours patriotique qui s'y développe. Il préfère lire Les Misérables de Hugo et s'embarquer avec les Marins de Baudelaire. Il se passionne aussi pour la culture populaire : romans – Émile Gaboriau, Eugène Sue, Jules Verne ou Ponson du Terrail –, et bandes dessinées, avec une affection particulière pour l'insaisissable Fantomas, dont les exploits sont relatés au cœur d'ouvrages bariolés. Il plonge avec délice dans ce romantisme de gare engendré par Les Mystères de New York, ou de Chicago, voire de Paris. Les surréalistes se retrouveront plus tard sur ce point en baptisant le merveilleux dans la naïveté populaire Poésie involontaire. Avec le cinéma, ses aventures livresques deviennent presque réalité. De tout cela, Desnos témoignera dans ses récits et ses critiques de films.
Pour l'heure, il n'est encore qu'adolescent lorsqu'en 1916, avec pour seuls bagages un certificat d’études acquis en 1913 et son brevet élémentaire, il décide de quitter l'école Turgot. Face à un père désireux de l'encourager à poursuivre ses études pour embrasser une carrière commerciale, il oppose son désir farouche de devenir poète. Mis en demeure de se débrouiller tout seul, relégué – mais il le veut aussi – dans une chambre de bonne, il multiplie les petits boulots. On le trouve, un temps, commis dans une droguerie de la rue Pavée6, mais le plus important est ailleurs : Desnos, buvant l'eau vive de ce qui s'offre à lui, se forge une solide et vaste culture autodidacte. Pendant que le premier conflit mondial s'éternise, il fréquente des jeunes gens en commune révolte contre cette boucherie des tranchées. Dès 1918, il a commencé à écrire quelques poèmes, dont certains sont publiés dans la Tribune des jeunes, une revue de tendance socialiste. Ses influences se nomment peut-être Apollinaire ou Rimbaud ; plus sûrement Laurent Tailhade, Germain Nouveau et, très certainement, ces anonymes putains des nuits de Saint Merri, que le garçonnet avait contemplées du haut de son sixième étage, au croisement de la rue des Lombards et de la rue Saint-Martin...
Les putains de Marseille ont des sœurs océanes
Dont les baisers malsains moisiront votre chair...
Ce Fard des Argonautes, daté de 1919, et publié la même année dans la revue d'avant-garde Le Trait d'union, oscille entre illuminations d'un certain Bateau Ivre et grand fourre-tout mythologique issu des magazines à sensation. D'ailleurs, côté alexandrins, Desnos s'embrouille souvent avec la métrique et certains de ses vers ont treize pieds... À ceux qui le lui feront remarquer, intellectuels ayant digéré leurs classiques, Desnos rétorquera : Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas métaphysicien... Et j'aime le vin pur. Le jeune homme n'a pas de culture savante ; il s'est construit en vrac, pataugeant dans l'immédiat de la vie qu'il mange à pleine dents, et les rêves des nuits qu'il note au tout premier réveil. Ce que les écrivains ont à dire s'adresse à tous, répète-t-il devant les langages obscurs et les amphigouris des poètes sérieux... Son éveil à la chair ne s'est également pas fait sérieusement. Pas d'amours adolescentes ni d'ombres de jeunes filles en fleurs : c'est en plein hiver à seize ans, dans les bras d'une imposante matrone, que tout cela s'est joué.
Dans cet immédiat après-guerre, Desnos devient secrétaire de Jean de Bonnefon et gérant de sa maison d'édition. Il fréquente des gens infréquentables, des anticonformistes clopinant du côté de l'hôtel de ville. Vers 1920, grâce à l'étonnant poète Louis de Gonzague-Frick, il est introduit dans les milieux littéraires modernistes. Chez Georges-Elzéar-Xavier Aubaut, homosexuel notoire et fort singulier personnage qui se farde comme Pierre Loti, se pare de bijoux et se dit ancien secrétaire de Huysmans, il rencontre Benjamin Péret et l'aventure Dada. Mais, malgré ses efforts, Desnos ne parvient pas à pénétrer ce milieu. Qui plus est, l'heure de son service militaire a sonné. Il part pour Chaumont puis au Maroc. Lorsqu'il reviendra, juste un an plus tard, les tempêtes dadaïstes auront déjà fait long feu.
Le surréalisme et les premiers écrits
Pendant qu'il joue les tirailleurs entre dattiers et palmiers en s'efforçant de tromper son ennui comme il peut, à Paris, les dynamiteurs de la pensée officielle comme de l'ordre social ont lancé leurs premières grenades. Entre 1920 et 1922, le peintre Francis Picabia ouvre la voie à la rupture et André Breton lance son célèbre Lâchez tout dans le second numéro de la revue Littérature. Dada mis au rancart, une nouvelle aventure commence. Benjamin Péret avait parlé de Breton à Desnos avant son départ pour l'armée. Il lui avait décrit les furieux éclats contre son temps de ce jeune homme de vingt-cinq ans. Sans doute est-ce au cours d'une permission que le troufion Desnos établit enfin le contact avec ces compteurs d'étoiles, selon le mot de Victor Hugo. Tout se passe alors au Certa, un bar du passage de l'Opéra aujourd'hui disparu. S'y retrouvent Aragon, Breton, Radiguet qui mourra en 1923, Tzara, Soupault, Cendrars, Vitrac- un ami - et quelques autres. Desnos monte dans la nacelle sans se faire prier, car il a déjà expérimenté à sa façon l'écriture automatique, forme d'expression aussi peu contrôlée que possible. En 1922, c'est certain, il a rejoint l'aventure Surréaliste.
L'élève se révèle fort doué. Il trouve une famille parmi tous ceux qui se reconnaissent dans Les nécessités de la vie et les conséquences des rêves, ouvrage publié par Paul Éluard en 1921. Voir au-delà ou au-dedans... Desnos s'impose immédiatement par ses exceptionnelles capacités verbales, un flot de paroles intarissable où les mots s'appellent par affinités sonores et met sa fougue à entrer dans les expériences les plus diverses. Il participe de manière éclatante aux expériences de sommeils hypnotiques, de récits de rêves ou de fantasmes.
De fait, il parle surréaliste à volonté
.Le rêve, cette porte ouverte sur l'inconnu, Desnos l'a déjà entrebâillée. Durant l'hiver 1918-1919, il avait noté sur son carnet : "Je suis couché et me vois tel que je suis en réalité. L'électricité est allumée. La porte de mon armoire à glace s'ouvre d'elle-même. Je vois les livres qu'elle renferme. Sur un rayon se trouve un coupe-papier de cuivre il y est aussi dans la réalité ayant la forme d'un yatagan. Il se dresse sur l'extrémité de la lame, reste en équilibre instable durant un instant puis se recouche lentement sur le rayon. La porte se referme. L'électricité s'éteint." Lorsqu'en 1924 paraîtra le premier numéro de La Révolution surréaliste, on pourra lire dans la préface signée Jacques André Boiffard, Paul Eluard et Roger Vitrac : "Le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l'intelligence n'entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté. Grâce au rêve, la mort n'a plus de sens obscur et le sens de la vie devient indifférent." De fait, Desnos est un voyant : il est ce medium qui, endormi, répond aux questions des assistants, amorce des poèmes ou des dessins. Lors de ces séances des sommeils, la première a lieu chez Breton le 25 septembre 1922 il est question d'aller retrouver la liberté première de la pensée ayant élu domicile dans cet état de somnolence/rêverie que Nerval avait nommé supernaturaliste. Il est aussi celui qui ira le plus loin dans l'amour de l'involontaire et du fabuleux. Fantomas revient, à la fois magicien et sorcier et pénètre les mots. C'est l'heure où Breton annonce :"Le surréalisme est à l'ordre du jour et Desnos est son prophète."
Desnos s'installe alors dans l'atelier du peintre André Masson au 45 de la rue Blomet, à Montparnasse, près du Bal Nègre qu'il fréquente assidûment. Il s'initie à l'opium. C'est le temps des trois forteresses surréalistes : Breton, rue Fontaine, Aragon, Prévert, Queneau et André Thirion, rue du Château et cette rue Blomet où Desnos compte Joan Miró et le dramaturge Georges Neveux parmi ses voisins. Clair, garni de bizarreries trouvées au marché aux puces et d'un gramophone à rouleaux, l'atelier de Desnos n'a pas de clé, seulement un cadenas à lettres dont il se rappelle la composition une nuit sur deux. De 1922 à 1923, il se livre là uniquement au travail de laboratoire dont doit résulter Langage cuit, ce que Breton appelle les mots sans rides, et à la recherche poétique. "Les Gorges froides" de 1922 en sont l'un des exemples marquants. Plus tard, c'est sans doute également dans cet antre qu'il écrira The Night of loveless nights.
Ce voyage expérimental vers le verbe nouveau est une impasse, et Desnos le sait. Lautréamont ne disait-il pas "une philosophie pour les sciences existe. Il n'en existe pas pour la poésie." ? Peu importe, il faut partir sur les routes, selon le mot de Breton. Sonne l'heure des poèmes de "L'Aumonyme" et des exercices de "Rrose Selavy". Suivent "Les Pénalités de l'Enfer" 1922 et "Deuil pour deuil" 1924 Ces enfants terribles que sont les surréalistes revendiquent un esprit en ébullition perpétuelle et, pour l'heure, encore un humour sans limites. Desnos incarne cela plus que tout autre. Une anecdote de 1925 mérite d'être rappelée : lors de la première représentation de "Locus Solus" de Raymond Roussel, la salle reste de marbre alors que le poète applaudit à tout rompre :
- Ah ! J'ai compris, lui dit son voisin, vous êtes la claque...
- Parfaitement !, répond-t-il, et vous, vous êtes la joue...
Dans les années 1924-1929, Desnos est rédacteur de La Révolution surréaliste. Mais il faut bien vivre : il travaillera comme comptable des publications médicales de la Librairie Baillère, écrira sur commande pour Jacques Doucet De l'érotisme, 1923, deviendra, pendant un moment, courtier de publicité pour un annuaire industriel, puis caissier du journal Paris-Soir. À partir de 1925, il se fait journaliste d'abord à Paris-Soir puis au journal Le Soir ; enfin à Paris-Matinal. Sur ce métier, il écrira un sanglant article pour la revue Bifur: "Le journalisme actuel n'est "journalisme" que par le nom. (...) Lecteurs, prenez garde ! L'annonce de huitième page du grand quotidien relative au fabricant de lits-cages influence le "papier" du chroniqueur de première page autant que les fameux fonds secrets et les subventions d'ambassade dont certains partis politiques ont tiré un argument facile pour discréditer leurs adversaires. Un journal, au surplus, s'écrit-il avec de l'encre ? Peut-être, mais il s'écrit surtout avec du pétrole, de la margarine, du ripolin, du charbon, du caoutchouc, voire ce que vous pensez... quand il ne s'écrit pas avec du sang !" Reste le cinéma. Desnos écrira de nombreux scénarios. S'il n'est pas un théoricien, il préconise quand même un accord entre le pamphlet, la métaphysique et la poésie. Le cinéma du rêve, Luis Buñuel ou Jean Cocteau, est encore trop pauvre pour le satisfaire, mais il fait affaire avec ce qu'il voit et multiplie les critiques.
Les années d'Amour
Desnos voue alors une passion à l'émouvante chanteuse de music-hall Yvonne George.
Elle est la mystérieuse qui hante ses rêveries et ses rêves et règne sur ses poèmes des Ténèbres. Il l'a probablement rencontrée en 1924. Si l'on en croit Théodore Fraenkel, l'ami fidèle, cet amour ne fut jamais partagé. Il le rêvera plus qu'il ne le vivra, source d'inspiration pour de nombreux poèmes, dont ceux de 1926, dédiés à la mystérieuse. Une occasion pour Desnos de renouer avec le lyrisme. Dès que lui parviennent ces poèmes, Antonin Artaud écrit à Jean Paulhan :
"Je sors bouleversé d'une lecture des derniers poèmes de Desnos. Les poèmes d'amour sont ce que j'ai entendu de plus entièrement émouvant, de plus décisif en ce genre depuis des années et des années. Pas une âme qui ne se sente touchée jusque dans ses cordes les plus profondes, pas un esprit qui ne se sente ému et exalté et ne se sente confronté avec lui-même. Ce sentiment d'un amour impossible creuse le monde dans ses fondements et le force à sortir de lui-même, et on dirait qu'il lui donne la vie. Cette douleur d'un désir insatisfait ramasse toute l'idée de l'amour avec ses limites et ses fibres, et la confronte avec l'absolu de l'Espace et du Temps, et de telle manière que l'être entier s'y sente défini et intéressé. C'est aussi beau que ce que vous pouvez connaître de plus beau dans le genre, Baudelaire ou Ronsard. Et il n'est pas jusqu'à un besoin d'abstraction qui ne se sente satisfait par ces poèmes où la vie de tous les jours, où n'importe quel détail de la vie journalière prend de l'espace, et une solennité inconnue. Et il lui a fallu deux ans de piétinements et de silence pour en arriver tout de même à cela. "
Cette mystérieuse, Desnos lui a donné un visage et une voix. Elle est cette Étoile de Mer offerte en 1928 à Man Ray. Elle est celle pour qui la plume du poète laisse couler :
J'ai tant rêvé de toi
Que tu perds ta réalité...
Et voici qu'elle n'est plus. Yvonne George meurt de tuberculose en 1930. Elle n'a que trente-trois ans. Desnos l'aimera désespérément au-delà de la tombe. En 1943, paraîtra l'unique roman de Desnos, Le vin est tiré, où le poète transpose son expérience tragique de la fréquentation d'un groupe
d'intoxiqués. Ce groupe est centré sur la très belle, et très droguée, Barbara. Au fur et à mesure du déroulement du récit, presque tous les personnages sont tués par les drogues qu'il consomment.
Quant à Youki Foujita, avec qui il vit depuis 1930, elle est représentée par la sirène. Partagé entre ces deux amours, l'impalpable et le tangible, Desnos s'est attribué la forme de l'hippocampe. En fait, il n'a jamais tranché et l'étoile est devenue sirène, ce qui se lit dans Siramour.
Il y a la chair, il y a l'amour. Entre les deux se glisse la pierre angulaire de l'érotisme. Le poète, qui a déjà narré ses convulsions sexuelles dans "Les Confessions d'un enfant du siècle" "Révolution Surréaliste" n°6 devient Corsaire Sanglot, le héros de La Liberté ou l'Amour 1927 où la liberté des sens est totale, dans un tintamarre d'images extraordinaires et de tempêtes en tous genres. C'est la prose du scandale. Pour la société, l'œuvre sera mutilée par un jugement du tribunal de la Seine, mais l'ouvrage déplaira aussi à certains Surréalistes, qui ne voient pas dans ce texte l'audace nécessaire à toute transgression. Desnos récupéré ? Toujours est-il qu'un clivage naît. Alors que Breton va lentement s'amidonner pour finir en statue de Commandeur, Desnos nage à contre courant, toujours plus loin...
Rupture avec le surréalisme
C'est en 1929 que s'amorce un changement radical. Certes, on pouvait déjà en sentir les prémices dans The Night of loveless nights et Siramour, mais la corde se rompt là. André Breton est devenu une sorte de Fouquier-Tinville qui agace certains de ses amis. Desnos, auquel ce dernier reproche son narcissisme, est de ces êtres libres qui, jamais, ne plieront devant qui ou quoi que ce soit, fût-ce le rêve du surréalisme. De plus, Breton reproche au poète de faire du journalisme, ce qui est une sorte de tare absolue. Il y a également le fait que Breton veut entraîner les siens vers le communisme et Desnos ne franchit pas cette ligne. On ne l'embrigade pas, on ne l'encarte pas. D'ailleurs, il se sent plus rad-soc.. Dans "La Révolution Surréaliste", le groupe des dissidents passe alors à l'action. Après avoir réglé leur compte à Anatole France et Maurice Barrès, ils ciblent dans Un Cadavre le Maître, devenu lion châtré, palotin du monde occidental, faisan, flic, curé, ou encore esthète de basse-cour. La querelle est totale, infantile certes, mais mortelle.
Aragon, chargé d'exécuter définitivement Desnos, écrit, entre autres, sous le titre de Corps, âmes et biens, dans Le surréalisme au service de la révolution : "Le langage de Desnos est au moins aussi scolaire que sa sentimentalité. Il vient si peu de la vie qu'il semble impossible que Desnos parle d'une fourrure sans que ce soit du vair, de l'eau sans nommer les ondes, d'une plaine qui ne soit une steppe, et tout à l'envi. Tout le stéréotype du bagage romantique s'adjoint ici au dictionnaire épuisé du dix-huitième siècle. On dirait une vaste tinette où l'on a versé les débris des débauches poétiques de Lebrun-Ecouchard à Georges Fourest, la scorie prétentieuse de l'abbé Delille, de Jules Barbier, de Tancrède de Visan, et de Maurice Bouchor. Les lys lunaires, la marguerite du silence, la lune s'arrêtait pensive, le sonore minuit, on n'en finirait plus, et encore faudrait-il relever les questions idiotes "combien de trahisons dans les guerres civiles ?" qui rivalisent avec les sphinx dont il est fait en passant une consommation angoissante. Le goût du mot "mâle", les allusions à l'histoire ancienne, du refrain dans le genre larirette, les interpellations adressées à l'inanimé, aux papillons, à des demi-dieux grecs, les myosotis un peu partout, les suppositions arbitraires et connes, un emploi du pluriel (...) qui tient essentiellement du gargarisme, les images à la noix, (...) ce n'est pas la façon de s'exprimer qui vaut à ce livre d'être à proprement parler un chef-d'œuvre..."
Pour Desnos, il est temps de constater que Breton est dépassé, vieux, abêti et sent, effectivement, le cadavre. Avec Corps et Biens, qui parait en 1930, Desnos dresse le bilan d'une belle aventure qui s'achève. La rupture est douloureuse, Desnos se retrouve solitaire mais son chemin continue.
Fantômas et la Drôle de guerre
Youki Foujita partage désormais la vie du poète. Elle en est la lumière, mais aussi le souci. Le couple quitte la rue Blomet pour la rue Lacretelle puis s'installe au 19, rue Mazarine où défilent Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, Felix Labisse, André Masson, Antonin Artaud ou encore Picasso. .
Pour Youki, il écrit des poèmes aux allures de chanson. Desnos est un grand amateur de musique. Le jazz, la salsa découverte lors d'un voyage à Cuba en 1928, le tango, le fado et les disques de Damia, Fréhel, Mistinguett et Maurice Chevalier, rengaines reflétant bien son Paris populaire, meublent sa discothèque. Mais on y trouve aussi les 78 tours de Mozart, Beethoven, Erik Satie et, surtout Offenbach. Comme pour la poésie, la musique doit parler à tous. Il s'improvise d'ailleurs chroniqueur musical. En 1932, grâce à Paul Deharme, Desnos se lance dans une carrière radiophonique où son imagination, son humour et sa parole chaleureuse vont faire merveille. Il devient vite assez célèbre et la radio lui offre des ressources que le journalisme de presse écrite il a quitté la plupart des quotidiens pour ne plus écrire que dans des hebdomadaires édités par la NRF ne lui assurent plus.
Le 3 novembre 1933, à l'occasion du lancement d'un nouvel épisode de la série Fantômas, il crée à Radio Paris la Complainte de Fantômas qui ponctue, sur une musique de Kurt Weill une série de vingt-cinq sketches évoquant les épisodes les plus marquants des romans d'Allain et Souvestre. Antonin Artaud qui assure la direction dramatique tient le rôle de Fantômas, tandis qu'Alejo Carpentier est responsable de la mise en onde sonore. Le succès est grand. Par ailleurs, il publie la série poétique des Sans Cou 1934. En 1936, il entreprend le tour de force de composer un poème par jour. Cet exercice de refonte des écrits automatiques de l'âge d'or dure un an. Certains poèmes paraissent dans Les Portes battantes. Ce sera la seule publication de ces années de succès radiophonique.
Grâce à Armand Salacrou, il entre à l'agence Information et publicité, où il anime une équipe chargée d'inventer des slogans publicitaires pour des produits pharmaceutiques la Marie-Rose, le vermifuge Lune, la Quintonine, le thé des familles, le vin de Frileuse. Le poète devient ensuite rédacteur publicitaire aux Studios Foniric et anime l'équipe qui invente et réalise au jour le jour les émissions diffusées sur Radio-Luxembourg et le Poste Parisien. Il cherche à la fois à faire rêver ses auditeurs grâce aux capacités suggestives de la radio et à les rendre actifs dans la communication en faisant appel à leurs témoignages. C'est ainsi qu'en 1938 Des songes remporte un grand succès en reprenant à l'antenne des récits de rêves envoyés par les auditeurs. L'expérience radiophonique transforme la pratique littéraire de Desnos : de l'écrit celle-ci se déplace vers des formes plus orales ou gestuelles. L'essentiel pour Desnos est maintenant de communiquer, et la littérature est un moyen parmi d'autres. Ainsi Desnos écrit-t-il diverses chansons de variété, interprétées par des gens comme le Père Varenne, Margo Lion, Marianne Oswald, Fréhel. Peu à peu ses projets deviennent plus importants : en collaboration avec le compositeur Darius Milhaud, il écrit des cantates comme la Cantate pour l'inauguration du Musée de l'Homme, les commentaires pour deux films de montage de J.B. Brunius Records 37 et Sources Noires, 1937 et travaille avec Arthur Honegger et Cliquet Pleyel pour des chansons de films.
Dans cette période heureuse Desnos est conscient de la montée du fascisme en Europe. S'il s'est brouillé avec Breton et ses amis en 1927 parce qu'il refusait de les suivre dans leur engagement au parti communiste, cela ne signifie pas qu'il se désintéresse de la politique. On peut le définir comme un radical-socialiste, épris de liberté et d'humanisme. Son engagement politique ne va cesser de croître dans les années 1930, avec la montée des périls. Dès 1934, il participe au mouvement frontiste et adhère aux mouvements d'intellectuels antifascistes, comme l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires ou, après les élections de mai 1936, le "Comité de vigilance des Intellectuels antifascistes". Passionné pour la culture espagnole, il est très choqué par la guerre d'Espagne et le refus du Sénat d'y engager la France. Alors que la conjoncture internationale devient de plus en plus menaçante, Desnos renonce à ses positions pacifistes : la France doit, selon lui, se préparer à la guerre, pour défendre l'indépendance de la France, sa culture et son territoire et pour faire obstacle au fascisme. Aussi, en compagnon de route, accepte-t-il de prêter son concours à des manifestations des Maisons de la culture, et accepte-t-il d'écrire des critiques de disques pour le journal communiste Ce soir.
Mobilisé en 1939 Desnos fait la drôle de guerre convaincu de la légitimité du combat contre le nazisme. Il ne se laisse abattre ni par la défaite de juin 1940, ni par l'occupation de Paris, où il vit avec Youki. Son activité radiophonique ayant cessé, il redevient journaliste pour Aujourd'hui, le journal d'Henri Jeanson et Robert Perrier. Après l'arrestation de Jeanson, le quotidien est rapidement soumis à la censure allemande mais Desnos ruse, surveille ses paroles et réussit à publier, mine de rien, selon son expression, des articles de littérature qui incitent à préparer un avenir libre.
Résistance et déportation
Pour Desnos, la lutte est désormais clandestine. Le 20 janvier 1940, il écrit à Youki : « J'ai décidé de retirer de la guerre tout le bonheur qu'elle peut me donner : la preuve de la santé, de la jeunesse et l'inestimable satisfaction d'emmerder Hitler ». Dès juillet 1942, il fait partie du réseau AGIR, auquel il transmet des informations confidentielles parvenues au journal, tout en fabriquant par ailleurs de faux papiers pour des Juifs ou des résistants en difficulté. Ses ennemis essaieront d'ailleurs de le faire passer pour Juif, ce qui signifie la mort.
En 1943, il est averti que ce réseau est infiltré, nombre de ses membres furent d'ailleurs dénoncés, arrêtés et déportés, mais il en demeure membre tout en se rapprochant, sous la recommandation du poète André Verdet, du réseau ACTION DIRECTE, créé par Marcel Taillandier. Dès lors, aux missions de renseignements qu'il effectue pour le premier s'ajoutent très certainement des missions bien plus directes et violentes.Sous son nom ou sous le masque de pseudonymes, il revient à la poésie. Après Fortunes 1942 qui fait le bilan des années trente, il s'adonne à des recherches où poème, chanson, musique peuvent s'allier. Ce sont les couplets d'État de veille 1943 ou les Chantefables 1944 à chanter sur n'importe quel air. Puis Le Bain avec Andromède 1944, Contrée 1944, et les sonnets en argot, comme Le Maréchal Ducono, virulente attaque contre Pétain, qui poursuivent, sous des formes variées, sa lutte contre le nazisme. "ce n'est pas la poésie qui doit être libre, c'est le poète", dit Desnos. En 1944, Le Veilleur du Pont-au-Change, signé Valentin Guillois, pousse son vibrant appel à la lutte générale, quand le poète est arrêté, le 22 février.
Ce jour-là, un coup de téléphone d'une amie bien placée l'avait averti de l'arrivée imminente de la Gestapo, mais Desnos avait refusé de fuir de crainte qu'on emmenât Youki, qui se droguait à l'éther. Interrogé rue des Saussaies, il finit à la prison de Fresnes, dans la cellule 355 de la deuxième division. Il y reste du 22 février au 20 mars. Après d'incroyables recherches, Youki retrouve sa trace et parvient à lui faire porter des colis. Le 20 mars, il est transféré au camp de Royallieu à Compiègne où il trouve la force d'organiser des conférences et des séances de poésie il y écrit Sol de Compiègne. De son côté, Youki multiplie les démarches dans de nombreux services de la police allemande et obtient que le nom de Desnos soit rayé de la liste des transports. Mais, le 27 avril, le poète fait partie d'un convoi de mille sept-cents hommes dont la destination est Buchenwald. Il y arrive le 12 mai et repart deux jours plus tard pour Flossenbürg : le convoi, cette fois, ne compte qu'un millier d'hommes. Les 2 et 3 juin, un groupe de quatre-vingt cinq hommes, dont Desnos, est acheminé vers le camp de Flöha, en Saxe où se trouve une usine de textile désaffectée reconvertie en usine pour carlingues de Messerschmitt fabriqués par les prisonniers. De ce camp, Desnos écrit de nombreuses lettres à Youki qui, toutes, témoignent de son ardente énergie comme de son désir de vivre. Le 14 avril 1945 sous la pression des armées alliées, le kommando de Flöha est évacué. Le 15 avril, cinquante-sept d'entre eux sont fusillés. Vers la fin du mois d'avril la colonne est scindée en deux groupes : les plus épuisés - dont Desnos - sont acheminés jusqu'au camp de concentration de Theresienstadt, à Terezin Protectorat de Bohème et Moravie, les autres sont abandonnés à eux-mêmes.
Theresienstadt, le poète retrouvé
À Theresienstadt, les survivants sont soit abandonnés dans les casemates et les cellules de fortune, soit expédiés au Revier, l'infirmerie. Desnos est de ceux-là. Les poux pullulent, le typhus fait rage.
Le 3 mai 1945, les SS prennent la fuite ; le 8 mai, l'Armée rouge et les partisans tchèques pénètrent dans le camp. Les libérateurs traînent avec eux quelques médecins et infirmiers afin de sauver qui peut l'être encore. Sur une paillasse, vêtu de l'habit rayé de déporté, tremblant de fièvre, Desnos n'est plus qu'un matricule.
Plusieurs semaines après la libération, un étudiant tchèque, Joseph Stuna, est affecté par hasard à la baraque n°1. En consultant la liste des malades, il lit : Robert Desnos, né en 1900, nationalité française. Stuna sait très bien qui est ce Desnos. Il connaît l'aventure surréaliste ; il a lu Breton, Éluard… Au lever du jour, l'étudiant se met à la recherche du poète au milieu de deux cent-quarante "squelettes vivants" et le trouve. Appelant à l'aide l'infirmière Aléna Tesarova, qui parle mieux le français que lui, Stuna veille et tente de rassurer le moribond au péril de sa vie. Desnos a tout juste eu la force de se relever en entendant son nom et de souffler" Oui, oui, Robert Desnos, le poète, c'est moi".
Ainsi Robert Desnos sort-il de l'anonymat… Leur a-t-il laissé un dernier poème, comme on le croira ? Rien n'est moins sûr.
Au bout de trois jours, il entre dans le coma. Le 8 juin 1945, à cinq heures du matin, Robert Desnos meurt.
Paul Éluard, dans le discours qu'il prononce lors de la remise des cendres du poète, en octobre 1945 écrit : " Jusqu'à la mort, Desnos a lutté. Tout au long de ses poèmes l'idée de liberté court comme un feu terrible, le mot de liberté claque comme un drapeau parmi les images les plus neuves, les plus violentes aussi. La poésie de Desnos, c'est la poésie du courage. Il a toutes les audaces possibles de pensée et d'expression. Il va vers l'amour, vers la vie, vers la mort sans jamais douter. Il parle, il chante très haut, sans embarras. Il est le fils prodigue d'un peuple soumis à la prudence, à l'économie, à la patience, mais qui a quand même toujours étonné le monde par ses colères brusques, sa volonté d'affranchissement et ses envolées imprévues."
Robert Desnos est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris.
Histoire et mythe d'un dernier poème
Après la guerre, est publié dans la presse française un dernier poème de Desnos, qui aurait été retrouvé sur lui par Joseph Stuna
Ombre parmi les ombres
J'ai tellement rêvé de toi
J'ai tellement marché, tellement parlé,
Tellement aimé ton ombre,
Qu'il ne me reste plus rien de toi,
Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres,
D'être cent fois plus ombre que l'ombre,
D'être l'ombre qui viendra et reviendra
Dans ta vie ensoleillée.
1945
En réalité, ce texte est le résultat d'une traduction approximative à partir du tchèque de la dernière strophe d'un poème de Desnos écrit en 1926 et dédié à Yvonne George : J'ai tant rêvé de toi :
J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé,
Couché avec ton fantôme
Qu'il ne me reste plus peut-être,
Et pourtant, qu'à être fantôme
Parmi les fantômes et plus ombre
Cent fois que l'ombre qui se promène
Et se promènera allègrement
Sur le cadran solaire de ta vie.
Corps et biens, 1930
On sait que dans l'infirmerie du camp et vu son état moribond, Desnos n'a eu ni physiquement ni matériellement la possibilité d'écrire quoi que ce soit. On sait aussi avec certitude que Joseph Stuna n'a rapporté que la paire de lunettes de Desnos. Alors, que s'est-il passé ?
Tout simplement un problème de traductions multiples qui donna naissance à un mythe.
Effectivement, la dernière strophe du poème, une première traduction du français en tchèque accompagne l'annonce du décès de Desnos dans le journal Tchèque "Svobone-Noviny" daté du 1er juillet 1945. Le 31 juillet, le même journal publie un article relatant les derniers jours du poète sous le titre Cent fois plus ombre que l'ombre avec, en plus, la fameuse dernière strophe de J'ai tant rêvé de toi. L'article, traduit du tchèque en français traduction de traduction, paraît le 11 août 1945 dans Les Lettres Françaises. Il n'en faut pas plus pour refaire l'histoire, le traducteur n'ayant pas reconnu, sous le nouveau titre, le poème de 1926. Mais comment expliquer que des gens aussi sérieux que Pierre Seghers et Henri Pouzol se soient enfoncés dans le mythe au mépris des multiples travaux - dont ceux de Marie-Claire Dumas - s'efforçant de rétablir la vérité? Sans doute parce que l'idée d'un dernier adieu a été plus forte que tout, couronnant, en quelque sorte, le martyre du poète... Un poème d'amour prémonitoire où se confirme la vérité des propos d'Alejo Carpentier qui disait toujours que l'avenir des poètes était écrit à l'avance dans leurs poèmes.
Ce court poème devient pour la conscience collective l'ultime message du poète. La voix de Robert Desnos résonne désormais dans un poème qui a cessé de lui appartenir pour devenir la voix de tous.
Une œuvre concise et diverse
On n'est évidemment pas surpris de constater que l'œuvre de Robert Desnos laisse une impression d'inachevé. Pourtant, sa minceur n'est pas seulement due à la disparition prématurée du poète : après tout, à quarante-cinq ans, Eluard, Aragon, Char, Queneau avaient déjà composé plusieurs volumes, et d'importance. Pour ne rien dire de ceux qui sont morts plus tôt. Il faut ajouter que cette existence, trop vite interrompue, fut passablement entravée par les médiocres nécessités de la vie quotidienne. On observera, par ailleurs, que cette œuvre est fort diverse, ce qui la rend malaisée à définir. Les dons exceptionnels de Robert Desnos, assortis d'une immense curiosité, l'ont poussé, d'une année à l'autre, dans des voies différentes. Ainsi, chaque recueil, chaque œuvre presque, manifeste un nouvel aspect de son talent ou de ses découvertes, comme s'il nous avait laissé, d'un plus vaste projet, quelques échantillons. Cette diversité apparaît à la fois dans les modes d'écriture et dans les thèmes d'inspiration.
Dès 1919, Le Fard des Argonautes, nous l'avons vu, est composé en alexandrins classiques, correctement rimés et disposés en quatrains. Cette forme grave convient évidemment fort bien au discours épique de ces vers de jeunesse. Desnos devait l'adopter de nouveau à deux reprises : en 1928, pour The Night of Loveless Nights, longue plainte romantique, qui rappelle à la fois la naïveté de Musset et le pessimisme baudelairien ; et, en 1943, dans certains poèmes d'État de veille, où l'expression du tragique, de nouveau nécessaire, s'accorde à un ample et profond mouvement de révolte.
Dès sa vingtième année, le jeune poète essaie d'apprivoiser le vers libre : l'ombre d'Apollinaire lui fait sans doute signe, au coin des rues de Paris. Ce sont, en effet, des images du quotidien que vont restituer ces vers légers, parfois groupés en longs tercets, comme des salves. Un quotidien tressé de rêves, d'humour et de mélancolie. Ici encore, la forme fera long feu : poèmes épars recueillis dans Corps et biens 1931, Les Sans-Cou 1934, Les Portes battantes 1936, Fortunes 1942, autant de témoignages d'un art qui fut, plus qu'aucun autre, à la mesure de Robert Desnos, de son éclat, de sa rapidité, de ses changements d'humeur.
La prose appartient, en revanche, à un moment plus facile à cerner : celui de la jeunesse, mais plus encore celui de l'exploration de l'inconscient. Elle soutient essentiellement trois séries de textes : les récits de rêves, réels ou supposés, comme Pénalités de l'Enfer 1922, in Littérature, Deuil pour deuil 1924 et La Liberté ou l'Amour 1927. Tous ces textes ont en commun une allure d'écriture automatique, qui détermine un halo d'onirisme ou de surnaturel. Dans le dernier d'entre eux, l'obsession érotique impose toutefois une brûlante cohérence au désordre apparent de la rêverie.
J'ai laissé de côté les attendrissants calembours de Rrose Sélavy, acrobaties verbales sans danger, réalisées, dit-on, pendant les sommeils hypnotiques qui impressionnaient si fort les jeunes surréalistes. Il s'agit évidemment d'exercices, qui ne manquaient sans doute pas d'un intérêt sulfureux en 1922, mais dont les vertus se sont sensiblement éventées depuis lors.
Du poète vers l'homme
L'évolution poétique de Robert Desnos a suivi celle de ses amis : quand il claque les portes du surréalisme, il passe de l'idée abstraite de Révolution au désir concret de changer le monde. S'il ne s'engage pas comme Aragon, Eluard ou Prévert dans l'action militante, il jette tout de même sa poésie dans la bataille humanitaire. Certes, il faudra la défaite et l'occupation allemande pour donner à cette bataille un sens politique précis. Mais, dès le début des années trente, et à travers une inspiration «quotidienne , le poète manifeste des préoccupations sociales. Comme Prévert, mais dans un style plus vigoureux, moins bon enfant, il parle de la misère, de la fraternité et des espoirs du peuple.
Aragon a bien dit, dans la préface des Yeux d'Elsa, comment l'invasion de la France par les troupes ennemies et l'urgence du combat clandestin ont tout d'un coup forgé une âme nouvelle aux poètes français : il devenait soudain nécessaire d'exprimer des sentiments simples et éternels, et de se faire entendre du plus grand nombre. Les grâces aristocratiques du Paysan de Paris ou de Deuil pour deuil perdaient alors toute importance.
Il est curieux, ou plutôt il est saisissant de voir avec quelle force et quel naturel Robert Desnos a retrouvé, dans Paris occupé, les sources vives de la poésie populaire. Les Couplets de la rue Saint-Martin, Le Veilleur du Pont-au-Change, signés du pseudonyme Valentin Guillois sont parmi les plus beaux poèmes inspirés par la Résistance, et ne trahissent en rien le commis de droguerie qui s'inventait, trente ans plus tôt, des aventures méditerranéennes.
À travers les différentes voies où il a cheminé, tout au long de sa vie, il semble bien qu'un sentiment prépondérant et obstiné ait toujours animé Robert Desnos : un amour passionné de la liberté, source ici d'enthousiasme et de générosité, là de révolte et de fureur. C'est ainsi que, par-dessus la solitude, l'amitié, l'amour d'une femme, la réussite sociale et l'infinie scélératesse des hommes, le veilleur du Pont-au-Change n'a jamais cessé de tendre la main aux marins conquérants d'une rêveuse adolescence.
Œuvres
Robert Desnos
Rrose Sélavy 1922-1923
Le Pélican
L’Aumonyme 1923
Langage cuit 1923
De l'érotisme. Considéré dans ses manifestations écrites et du point de vue de l'esprit moderne 1923, publication posthume en 1953
Deuil pour deuil 1924
Les gorges froides 1926
La Liberté ou l'Amour 1927
Les Ténèbres 1927
La Place de l'Etoile (1929, pièce de théâtre publiée dans le quotidien Le Soir
Corps et biens 1930
Sans cou 1934
Fortunes 1942
The Night of loveless nights
État de veille 1943
Le vin est tiré 1943
Contrée 1944
Le Bain avec Andromède 1944
L'Honneur des poètes 1943
Calixto suivi de contrée 1962, publication posthume
Chantefables et chantefleurs 1970, publication posthume
Destinée arbitraire 1975, publication posthume
Nouvelles-Hébrides et autres textes 1978, publication posthume
Rue de la Gaité / Voyage en Bourgogne / Précis de cuisine pour les jours heureux, œuvres illustrées par Lucien Coutaud 1947
La Complainte de Fantômas 1954, publication posthume.
Le Veilleur du pont-au-change
Le Souci 1943
Les hiboux 1938
Œuvres regroupées
Œuvres de Robert Desnos, sous la direction de Marie-Claire Dumas. Collection Quarto, éditions Gallimard, 2003.
Corps et Biens, Collection de poche Poésie/Gallimard.
Destinées arbitraires, Collection de poche Poésie/Gallimard.
Fortunes, Collection de poche Poésie/Gallimard.
La Liberté ou l'amour, Collection de poche L'Imaginaire/Gallimard.
Deuil pour deuil, Collection de poche L'Imaginaire/Gallimard.
Le vin est tiré..., Collection de poche L'Imaginaire/Gallimard.
Chantefleurs, éditions Gründ, 2000.
Chantefables, éditions Gründ, 2000.
La Ménagerie de Tristan, éditions Gründ, 2000.
Un beau navire porte son nom, dessins de Claude Stassart-Springer, éditions de la Goulotte, Vézelay, 2003
Œuvres diverses
Période surréaliste
Nouvelles Hébrides et autres textes 1922-1930, éditions Gallimard, 1978.
Écrits sur l'art
Écrits sur les peintres, éditions Flammarion, 1984.
Écrits sur le cinéma
Les Rayons et les ombres, éditions Gallimard, 1992.
Écrits sur la musique
Les Voix intérieures, Éditions du Petit Véhicule/l'Arganier, 2005.
Éditions en disques compacts
Textes de Robert Desnos, mélodies de Jean Wiener, Joseph Kosma, Francis Poulenc etc. Éditions Integral Distribution.
Anthologie poétique de Robert Desnos, lue par Eve Griliquez et Denis Lavant. Livret de Anne Egger. Éditions Frémeaux et Associés, 2001.
Poèmes
Coucher avec elle - Robert Desnos (1900-1945)
Coucher avec elle
Pour le sommeil côte à côte
Pour les rêves parallèles
Pour la double respiration
Coucher avec elle
Pour l'amour absolu
Pour le vice pour le vice
Pour les baisers de toute espèce
Coucher avec elle
Pour un naufrage ineffable
Pour se prostituer l'un à l'autre
Pour se confondre
Coucher avec elle
Pour se prouver et prouver vraiment
Que jamais n'a pesé sur l'âme
Et le corps des amants
Le mensonge d'une tache originelle
Coucher avec elle — Robert Desnos "Fortunes" (1942)
Liens
http://www.ina.fr/video/CPC99008650/r ... desnos-oeuvres-video.html I livre I jiour R.Desnos
http://www.ina.fr/video/I07189493/jul ... o-la-brutalite-video.html J. Gréco La brutalité texte de R. Desnos
http://www.ina.fr/video/I05063640/jul ... reco-la-fourmi-video.html J.Gréco "La fourmi" de R. Desnos
http://youtu.be/bgjtVWDh4SE Jamais d'autre que toi par S. Reggiani
http://www.ina.fr/video/CPF86641715/u ... qui-s-aimaient-video.html Un homme et une femme qui s'aimaient.
http://youtu.be/2letTH2gqug j'ai tant rêvé de toi
http://youtu.be/zfRQOyQ8yvs Il était une feuille
http://youtu.be/3jR22VdMXio Les espace du sommeil
http://youtu.be/GOF2EAt2Pkc Le pélican (par des enfants)
http://youtu.be/eQTXqgvBfrw Lisbonne de Robert Desnos
http://musicien-intervenant.net/page_compos_desnos.htm
          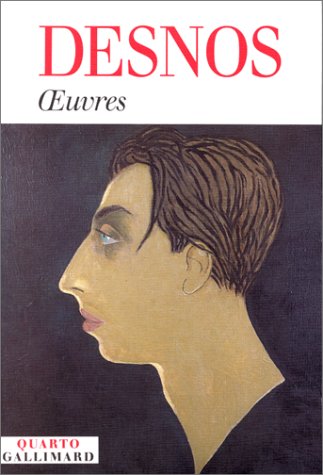 [img width=600]http://www.franceculture.fr/sites/default/files/oeuvre/images/2007/09/07/1024601/robert_desnos20100424.jpg?1272078531[/img]   
Posté le : 08/06/2014 13:09
|
|
|
|
|
Georges Sand 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Le 8 juin 1876 au château de Nohant-Vic meurt, à 71 ans, George Sand
pseudonyme d'Amantine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant, romancière, auteur dramatique, critique littéraire française, journaliste, appartenant au mouvement romantisme, née à Paris le 1er juillet 1804. Ses Œuvres principales sont, Indiana, Lélia, Mauprat, Consuelo, La Mare au diable, La Petite Fadette, Les Maîtres sonneurs, Le Meunier d'Angibault, Un hiver à Majorque, Histoire de ma vie
Elle compte parmi les écrivains prolifiques avec plus de soixante-dix romans à son actif, cinquante volumes d'œuvres diverses dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques.
Une bâtarde de bonne famille
Renan écrivait au lendemain des obsèques de George Sand, morte à Nohant : "Une corde est brisée dans la lyre du siècle [...]. Mme Sand traversa tous les rêves ; elle sourit à tous, crut un moment à tous ; son jugement pratique put parfois s'égarer, mais, comme artiste, elle ne s'est jamais trompée. Ses œuvres sont vraiment l'écho de notre siècle. "
Et pourtant la fortune posthume de Sand a été aussi perturbée que sa vie. Une partie de l'œuvre demeura longtemps dans un purgatoire immérité. Mais, depuis la publication de la Correspondance, on assiste à un vif regain d'intérêt et les rééditions se succèdent.
L'enfant Aurore Dupin qui voit le jour à Paris sera pendant toute sa jeunesse en porte à faux. Le lieutenant Maurice Dupin, descendant de la main gauche de Maurice de Saxe, lui-même bâtard de roi, vient tout juste d'épouser en cachette de sa mère, Sophie Delaborde, fille du peuple, rencontrée à l'armée d'Italie où elle suivait un adjudant-général. À peine née, Aurore est au centre d'un conflit sans fin, qu'aggravera la mort accidentelle de l'officier, en 1808. La grand-mère paternelle, qui détient la fortune, élèvera l'enfant, mais exige que Sophie se tienne à l'écart. Frustration déchirante, qui inspirera à Aurore ses premières rébellions. Elle aura pour compensation dix années d'enfance campagnarde, à Nohant, au fond du Berry dont elle s'imprègne et qu'elle décrira si poétiquement plus tard. Pensionnaire de 1818 à 1820 dans un couvent parisien, elle y traverse une crise de mysticisme. Revenue à Nohant avec sa grand-mère dont la santé et l'esprit déclinent, Aurore, presque livrée à elle-même, complète son instruction par la lecture, en particulier se prend de passion pour J.-J. Rousseau. Mue par son aversion pour sa belle-fille, Mme Dupin de Francueil révèle à l'adolescente bouleversée la vie peu édifiante de Sophie : ce choc brutal aura de profondes répercussions.
Aurore Dupin, au nom bien roturier, descend de l'une des plus grandes familles d'Europe, les Königsmark – une famille où, par tradition, toutes les filles s'appelaient Aurore. Aurora von Königsmark épouse, à la fin du XVIIe s., Auguste de Saxe, et en a un fils, Maurice. Passé au service du roi de France, Maurice, mercenaire de luxe, lui donne sa nièce en mariage – ce qui apparente ainsi la future George Sand à la famille royale de France. Maurice de Saxe, grand soldat, grand libertin, fait à la jeune Marie Rinteau une fille, Marie-Aurore, qui épouse Claude Dupin de Francueil, un financier représentant des fermiers généraux en Berry, dont elle a un fils, Maurice, soldat de la République et de l'Empire. Dans un camp de l'armée d'Italie, ce dernier trouve une fille à soldats, Sophie Victoire Delaborde, ma mère était de la race avilie et vagabonde des bohémiens de ce monde, écrira George Sand dans l'Histoire de ma vie, qu'il épouse, fortement enceinte d'une fille, dont elle accouche le 1er juillet 1804, et que l'on baptise Aurore, selon la tradition familiale. Quatre ans plus tard, le colonel Dupin se tue en tombant de cheval – laissant sa femme poursuivre ses galanteries à Paris, et la petite orpheline à Nohant, près de La Châtre, entre les mains de sa grand-mère Marie-Aurore Dupin de Francueil. Cette petite fille s'appellera, plus tard, George Sand.
Une jeune fille de bonne famille s'élève au couvent. Aurore entre, à Paris, dans celui des Dames augustines anglaises, dont elle sort à seize ans avec une solide connaissance de l'anglais, du goût pour les amitiés féminines et une religiosité diffuse, qui lui donnera toute sa vie une vision quelque peu quiétiste de Dieu – au grand dam de sa grand-mère, vraie femme du XVIIIe s., voltairienne jusqu'au bout des ongles. Rentrée à Nohant 1820, la jeune fille, belle brune aux grands yeux, s'habille volontiers en homme pour courir le lièvre, à cheval, et conquérir, en tout bien tout honneur, les jeunes gens du voisinage. Elle lit beaucoup : le Génie du christianisme, pour l'instinct de Dieu, puis tous les philosophes du XVIIIe s., contre-poison nécessaire, puis les grands génies des siècles précédents, de Virgile à Shakespeare. Rousseau enfin : elle apprend de lui la confusion savante des sentiments et de la vertu. Si le romantisme est le produit d'une compréhension partielle de Jean-Jacques et d'une lecture partiale de Chateaubriand, elle est, dès 1821, une vraie enfant du siècle.
À l'image de son arrière grand-mère par alliance qu'elle admire, Madame Dupin Louise de Fontaine 1706-1799, George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice.
George Sand a fait scandale par sa vie amoureuse agitée, par sa tenue vestimentaire masculine, dont elle a lancé la mode, par son pseudonyme masculin, qu'elle adopte dès 1829, et dont elle lance aussi la mode : après elle, Marie d'Agoult signe ses écrits Daniel Stern, 1841-1845, Delphine de Girardin prend le pseudonyme de Charles de Launay en 1843.
Malgré de nombreux détracteurs comme Charles Baudelaire ou Jules Barbey d'Aurevilly, George Sand contribue activement à la vie intellectuelle de son époque, accueillant au domaine de Nohant ou à Palaiseau des personnalités aussi différentes que Franz Liszt, Frédéric Chopin, Marie d'Agoult, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Eugène Delacroix, conseillant les uns, encourageant les autres. Elle a entretenu une grande amitié avec Victor Hugo par correspondance, ces deux grandes personnalités ne se sont jamais rencontrées.
Elle s'est aussi illustrée par un engagement politique actif à partir de 1848, inspirant Alexandre Ledru-Rollin, participant au lancement de trois journaux : La Cause du peuple, Le Bulletin de la République, l'Éclaireur, plaidant auprès de Napoléon III la cause de condamnés, notamment celle de Victor Hugo dont elle admirait l'œuvre et dont elle a tenté d'obtenir la grâce après avoir éclipsé Notre Dame de Paris avec Indiana, son premier roman.
Son œuvre est très abondante et la campagne du Berry lui sert souvent de cadre. Ses premiers romans, comme Indiana, 1832, bousculent les conventions sociales et magnifient la révolte des femmes en exposant les sentiments de ses contemporaines, chose exceptionnelle à l'époque et qui divisa aussi bien l'opinion publique que l'élite littéraire. Puis George Sand ouvre ses romans à la question sociale en défendant les ouvriers et les pauvres, Le Compagnon du Tour de France et en imaginant une société sans classe et sans conflit Mauprat, 1837 - Le Meunier d'Angibault, 1845.
Elle se tourne ensuite vers le milieu paysan et écrit des romans champêtres idéalisés comme La Mare au diable en 1846, François le Champi 1848, La Petite Fadette 1849, Les Maîtres sonneurs 1853.
George Sand a abordé d'autres genres comme l'autobiographie, Histoire de ma vie, 1855 et le roman historique avec Consuelo, 1843 où elle brosse, à travers la figure d'une cantatrice italienne, le paysage artistique européen du XVIIIe siècle, ou encore Les Beaux Messieurs de Bois-Doré, 1858 qui multiplie les péripéties amoureuses et aventureuses dans le contexte des oppositions religieuses sous le règne de Louis XIII.
Ascendance
Madame Dupin de Francueil achète le 23 août 1793, le château de Nohant dans l'Indre.
Amantine Aurore Lucile Dupin, future George Sand, nait le 1er juillet 1804 à Paris, anciennement au no 15 de la rue Meslay, no 46 actuellement, dans le 3e arrondissement. Fille de Maurice François Dupin de Francueil et de Sophie Victoire Delaborde, elle est, par son père, l'arrière-petite-fille du maréchal de France, Maurice de Saxe 1696-1750. Du côté de sa mère, elle a pour grand-père Antoine Delaborde, maître paulmier et maître oiselier, qui vendait des serins et des chardonnerets à Paris, sur le quai aux Oiseaux. Aurore a donc une double ascendance, populaire et aristocratique, qui la marque profondément. Deux origines sociales diamétralement opposées qui expliquent la personnalité d'Aurore Dupin et son engagement politique à venir :
"On n'est pas seulement l'enfant de son père, on est aussi un peu, je crois, celui de sa mère. Il me semble même qu'on l'est davantage, et que nous tenons aux entrailles qui nous ont portés, de la façon la plus immédiate, la plus puissante, la plus sacrée. Or, si mon père était l'arrière-petit-fils d'Auguste II, roi de Pologne, et si, de ce côté, je me trouve d'une manière illégitime, mais fort réelle, proche parente de Charles X et de Louis XVIII, il n'en est pas moins vrai que je tiens au peuple par le sang, d'une manière tout aussi intime et directe; de plus, il n'y a point de bâtardise de ce côté-là."
Son père, Maurice Dupin, incorporé dans les rangs de l'armée révolutionnaire, effectue de 1798 à 1808, toutes les guerres républicaines et impériales. Pendant les campagnes d'Italie, il s'éprend de Sophie Victoire Delaborde, qui partage alors la vie de l'intendant affecté aux subsistances, l'adjudant-général Claude-Antoine Collin, âgé de cinquante ans. Victoire suit Maurice à son retour en France. Madame Dupin de Francueil fait tout pour s'opposer à leur mariage ; c'est donc à son insu que le 5 juin 1804, moins d'un mois avant la naissance de la future George Sand, le capitaine Maurice Dupin signe devant le maire du IIe arrondissement ancien de Paris, l'acte de mariage avec Victoire Delaborde.
Maurice Dupin a eu précédemment une liaison avec la domestique du château de Nohant, Catherine Chatiron 1779-1866. Elle est entrée au service de Madame Dupin de Francueil, le 24 janvier 1797 pour une rémunération de 60 francs par an. Catherine donne le jour à La Châtre le 5 mai 1799, à un fils naturel et déclaré sous le nom de Pierre Laverdure. Maurice Dupin refuse de reconnaître l'enfant qui prend alors l'identité d'Hippolyte Chatiron, 1799-1848, le demi-frère d'Aurore. Marie-Aurore de Saxe congédie Catherine Chatiron, mais fait élever l'enfant par le précepteur de Maurice, François Deschartres.
Les trois premières années de la vie d'Aurore Dupin s'écoulent dans le petit logis de ses jeunes parents, rue de la Grange-Batelière. En avril 1808, Victoire, enceinte de sept mois, rejoint son mari en garnison à Madrid. Elle est accompagnée de sa fille Aurore et ce, malgré le désaveu de Maurice Dupin au vu de cette périlleuse expédition et de la situation militaire espagnole. Dans le palais de Godoy, Murat témoigne beaucoup d'affection à l'enfant. Victoire donne naissance à un fils, Auguste à Madrid le 12 juin 1808, mais il est aveugle. Les événements politiques se précipitent et l'heure de la retraite d'Espagne a sonné. Après un voyage éprouvant, la famille arrive dans l'Indre, chez la grand-mère paternelle. Aurore découvre pour la première fois le domaine de Nohant. Malheureusement, son petit frère ne va pas survivre au voyage et décède au château, le 8 septembre 1808. Une semaine plus tard, Maurice Dupin meurt accidentellement d'une chute de cheval à la sortie de La Châtre, le 16 septembre 1808.
D'Aurore Dupin à la baronne Dudevant
Aurore grandit à Nohant, d'abord avec sa mère et sa grand-mère. Toutefois, un désaccord apparaît entre les deux femmes à propos de l'éducation d'Aurore. Un compromis est trouvé et l'engagement est pris par écrit le 3 février 1809. Marie-Aurore de Saxe a la responsabilité de l'éducation d'Aurore qui passe la majeure partie de l'année à Nohant et peut voir sa mère, installée à Paris, en hiver. Victoire reçoit une rente de sa belle-mère augmentée par une compensation financière et elle est autorisée à se rendre à Nohant pendant l'été. La grand-mère confie Aurore à un précepteur, le vieux Deschartres, qui était déjà celui de son père Maurice Dupin. Marie-Aurore de Saxe préfère passer la mauvaise saison dans la capitale et elle demeure rue Neuve-des-Mathurins, à proximité du logement de Victoire. Malgré un droit de visite, la mère n'a pas la permission d'emmener sa fille chez elle. Cette application des accords est encore plus restrictive vis-à-vis de Caroline Delaborde, la fille aînée de Victoire. L'enfant ne doit pas approcher sa demi-sœur Aurore et encore moins de venir au domicile parisien de Madame Dupin de Francueil. Mais un incident se produit au cours de l'hiver 1810-1811. Caroline se présente chez Marie-Aurore malgré l'interdiction et elle est chassée sans ménagement par la maîtresse de maison. Aurore est traumatisée par cette injustice et en tombe malade. Prise de remords, Marie-Aurore décide d'emmener elle-même sa petite-fille une fois rétablie, chez Victoire. Au moment du retour à Nohant, Marie-Aurore propose à Victoire de l'accompagner, pour ne pas perturber davantage sa fille.
George Sand restera attachée toute sa vie à Nohant et à la campagne où elle peut s'échapper dans la nature pour laisser s'épanouir son imagination. Elle reprendra le thème de la vie pastorale dans ses romans champêtres. Aurore devenant peu assidue et rebelle, sa grand-mère la met en pension au couvent des Dames Augustines anglaises de Paris pour parfaire son enseignement, du 12 janvier 1818 jusqu'au 12 avril 1820. Elle traverse une crise de mysticisme dans cet établissement religieux, où sa mère et grand-mère étaient emprisonnées sous la Terreur. Marie-Aurore de Saxe, imprégnée des idées du siècle des Lumières, ne tarde pas à la retirer du cloître et la fait revenir à Nohant. La santé de sa grand-mère décline, consciente que son temps lui est compté. Marie-Aurore a pour dessein de marier sa petite-fille au plus tôt et de la faire son unique héritière, tant de ses biens que des terres et du domaine de Nohant. Au mois de janvier 1821, un projet de mariage est envisagé avec l'un des cousins d'Aurore, Auguste Vallet de Villeneuve, veuf depuis 1812 de Laure de Ségur et propriétaire du marquisat du Blanc. Mais il est âgé de 42 ans, alors que sa promise n'a que 16 ans…
Marie-Aurore de Saxe prodigue la plus grande attention à sa petite-fille et lui fait découvrir Jean-Jacques Rousseau. Cette affection est réciproque, Aurore apprécie sa grand-mère à l'esprit délicat et cultivé. L'enfant complète son instruction par la lecture. Si Rousseau la fascine, d'autres philosophes captivent la jeune prodige : Chateaubriand à travers le Génie du christianisme, mais également Aristote, Condillac, Montesquieu, Blaise Pascal, Jean de La Bruyère, Montaigne, Francis Bacon, John Locke, Leibniz, ainsi que les poètes Virgile, Alexander Pope, John Milton, Dante, et William Shakespeare. Marie-Aurore de Saxe meurt le 26 décembre 1821 à Nohant-Vic, quelques mois après une attaque d'apoplexie. Ses ultimes paroles sont pour sa petite-fille : tu perds ta meilleure amie. Au lendemain de l'enterrement de Madame Dupin de Francueil, la mère d'Aurore arrive à Nohant afin de prendre connaissance des dernières volontés de la défunte. Le frère aîné d'Auguste, le comte René, François Vallet de Villeneuve et possesseur du château de Chenonceau, est désigné pour être le tuteur d'Aurore, mineure et seule légataire, à la mort de sa grand-mère. La lecture du testament provoque une violente colère de Victoire Delaborde. Toute la rancœur contenue ces dernières années, se déchaîne brutalement à l'encontre de sa belle-mère et René Vallet de Villeneuve, par des paroles outrageantes. Elle exige que sa fille vienne vivre avec elle à Paris et c'est la rupture avec la famille paternelle.
Les relations entre la mère et la fille deviennent vite conflictuelles. Au printemps 1822, Victoire confie Aurore à des amis de Maurice Dupin, James et Angèle Roettiers du Plessis, qui vivent avec leurs cinq filles dans le château du Plessis-Picard près de Melun. Elle reste plusieurs mois dans cette famille où règne une excellente ambiance et y rencontre François Casimir Dudevant, avocat à la cour royale, qu'elle épouse à Paris le 17 septembre. La mère d'Aurore a la présence d'esprit d'imposer le régime dotal, Aurore conservant sa fortune personnelle de 500 000 francs et doit recevoir de son mari, une rente de 3 000 francs par an pour ses besoins personnels. Victoire se désiste de la tutelle de sa fille le 5 octobre 1822 au profit de Casimir Dudevant et les époux s’installent à Nohant.
Le 30 juin 1823, Aurore donne naissance à son fils Maurice 1823-1889 à Paris. En 1824, chez les du Plessis, Casimir gifle Aurore en public pour un motif futile. Les premières fêlures du couple et Aurore réalise que tout la sépare de son époux, grossier, peu cultivé, à l'éducation si dissemblable, dont les goûts diffèrent tellement des siens. Le hasard d'une rencontre en juillet 1825, lors d'un voyage avec Casimir à Cauterets dans les Pyrénées, permet à la jeune femme de renaître à la vie. Aurore fait la connaissance d'Aurélien de Seze, avocat de talent, substitut au tribunal de Bordeaux et neveu du défenseur de Louis XVI. Séduisant, intelligent, Aurélien a conquis le cœur d'Aurore, le temps d'une courte histoire d'amour, passionnée et platonique. Ils échangent une importante correspondance mais leurs rencontres sont rares et Aurore vient de retrouver un ami de jeunesse. Au cours de ses séjours à Nohant, elle noue une liaison avec Stéphane Ajasson de Grandsagne, originaire de La Châtre, de 1827 à 1828. La rumeur publique rattrape les amants et compromet l'équilibre précaire des époux Dudevant. Le 13 septembre 1828, Aurore met au monde une fille, Solange 1828-1899 à Nohant, dont la paternité est empreinte d'incertitude du fait de la fréquentation d'Aurore avec Stéphane Ajasson de Grandsagne. De son côté, Casimir se met à boire, devient odieux et entretient des relations avec les servantes. La situation conjugale se dégrade, les époux font chambre à part. Aurore veut son indépendance, souhaite travailler et gérer ses biens propres. Au même moment, elle engage une nouvelle idylle avec le romancier Jules Sandeau, et désire le rejoindre à Paris. Au mois de décembre 1830, une scène éclate entre Casimir et Aurore. Elle vient de découvrir le testament de son mari qui se résume à des critiques venimeuses et des rancunes envers sa femme. Leur séparation est inévitable, le divorce n'existe pas à cette époque et prononcée en sa faveur le 16 février 1836, le tribunal de La Châtre reconnaissant prouvés les injures graves, sévices et mauvais traitements. Face à la grande fermeté de son épouse, Casimir Dudevant s'incline et ne veut surtout pas perdre l'usufruit des possessions d'Aurore. Elle décide de vivre alternativement entre Paris et Nohant. Casimir doit lui verser une pension de 3 000 francs prévue par leur contrat de mariage. Dans un premier temps, Solange et Maurice restent auprès de leur père à Nohant. Une fois établie à Paris, Aurore emmène sa fille chez elle et Casimir Dudevant se laissera convaincre par la suite, de confier Maurice à sa mère. Le demi-frère d'Aurore, Hippolyte Chatiron, semble avoir joué un rôle dans le conflit qui oppose sa sœur et son beau-frère Casimir Dudevant, dont il partage le penchant pour la boisson et les fêtes.
Naissance de l'écrivain "George Sand"
Les 27, 28 et 29 juillet 1830 - journées dites les Trois Glorieuses - les insurrections parisiennes renversent les Bourbons. L'engagement politique d'Aurore Dupin et sa prise de conscience débutent véritablement à partir de cette période. Jusqu'alors, Aurore Dupin ne s'intéresse guère à la politique. Sa sensibilité est même bonapartiste en raison du souvenir et de la carrière militaire de son père. Elle s'est opposée avec son époux Casimir Dudevant, au candidat royaliste lors des élections censitaires de 1827 en soutenant activement le candidat républicain, Duris-Dufresne à La Châtre. Le 30 juillet 1830, Aurore Dupin rencontre Jules Sandeau au château du Coudray à Verneuil-sur-Igneraie. Une rencontre qui marque la jeune Aurore et qui va influer sa destinée. Le 4 janvier 1831, elle quitte Nohant pour rejoindre à Paris une petite société de jeunes Berrichons férus de littérature romantique et qu'elle fréquentait déjà dans l'Indre : Charles Duvernet, Alphonse Fleury et Jules Sandeau. Dans ce Paris de 1831, en pleine effervescence romantique après la révolution de Juillet où les jeunes artistes et poètes du quartier latin portaient des costumes extravagants, Aurore mène une vie de bohème avec ses compagnons, allant dans les théâtres, les musées et les bibliothèques. Ayant obtenu de la préfecture de police de l'Indre une permission de travestissement, elle adopte un costume masculin, plus pratique et moins coûteux : elle endosse une redingote-guérite, se noue une grosse cravate en laine, se fait couper les cheveux jusqu'aux épaules et met un chapeau de feutre mou41,42. Aurore affiche sa liaison avec Jules Sandeau. Ensemble, ils commencent une carrière de journalistes au Figaro, sous l'œil sévère mais bienveillant d'Henri de Latouche, le directeur du journal. Ils écrivent en commun un roman, Rose et Blanche, publié sous le pseudonyme de J. Sand.
Le roman Rose et Blanche est ébauché par Aurore mais refait entièrement par Jules Sandeau. L'ouvrage se voit attribuer par une fantaisie d'Henri de Latouche, le nom d'auteur de Jules Sand, qui évoque non seulement Jules Sandeau, mais aussi Karl Sand, l'étudiant bavarois assassin d'August von Kotzebue. Ce livre connaît un certain succès, au point qu'un autre éditeur se présente et commande un prochain roman sous le même nom. Comme Aurore vient d'écrire Indiana, à Nohant durant l'hiver 1831-1832, elle veut le donner sous le même pseudonyme mais Jules Sandeau, par modestie, n'accepte pas la paternité d'un livre auquel il est totalement étranger. Henri de Latouche est consulté et tranche par un compromis : le nom de Sand est conservé pour satisfaire l'éditeur et le prénom est modifié pour distinguer les deux auteurs. Aurore prend celui de George et qui lui semble synonyme de Berrichon. Étymologiquement, George signifie en effet celui qui travaille la terre. Sa première œuvre personnelle, Indiana, est publiée le 19 mai 1832 sous le nom de G. Sand et tous ses romans ultérieurs le seront sous le pseudonyme de George Sand qu'elle adopte définitivement.
Valentine, composée à Nohant et achevée pendant l'été de 1832, est éditée trois mois après Indiana. Ces deux romans assurent la renommée de l'écrivain et améliorent beaucoup sa situation financière. Elle quitte son petit logement du quai Saint-Michel pour aller s'installer dans un appartement plus confortable au no 19 quai Malaquais. François Buloz, le directeur de la Revue des deux Mondes lui assure par contrat une rente annuelle de 4 000 francs en échange de trente-deux pages d'écriture toutes les six semaines. Au début de 1833, elle rompt avec Jules Sandeau, coupable d'une infidélité. Elle a une brève relation avec Prosper Mérimée, très décevante et qu'elle regrette amèrement. C'est une période sombre pour George Sand, démoralisée par ces deux déceptions. Le 10 août 1833, paraît Lélia, une œuvre lyrique, allégorique et très originale, dont le succès est prodigieux.
Elle se lie d'amitié avec la comédienne Marie Dorval, qui collabore à l'écriture de Cosima, pièce de théâtre de George Sand créée le 29 avril 1840 à la Comédie-Française, avec Marie Dorval dans le premier rôle.
George Sand rencontre pour la première fois Alfred de Musset le 17 juin 1833, lors d'un dîner organisé par François Buloz pour ses collaborateurs de la Revue des deux Mondes, au restaurant Lointier, no 104 rue Richelieu à Paris. À la fin du mois de juillet, ils sont amants et Musset s'installe chez George Sand, quai Malaquais. Le couple se rend à Fontainebleau où ils séjournent du 5 au 13 août à l'hôtel Britannique au no 108 rue de France. Une nuit, lors d'une promenade en forêt aux roches de Franchard, Musset est la proie d'une hallucination, croyant voir apparaître son double. Cette scène est évoquée dans le roman Elle et Lui et décrite également par Musset dans la Nuit de Décembre. Ils conçoivent le projet d'un voyage en Italie. Ils partent le 12 décembre 1833 et font une partie de la traversée en compagnie de Stendhal, rencontré à Marseille et qui rejoint son poste de consul à Civitavecchia. À Gênes, George Sand souffre de fièvre et dysenterie. Ils parviennent à Venise le 31 décembre 1833 et descendent à l'hôtel Danieli, le 1er janvier 1834. Alors que George Sand est toujours souffrante et doit rester alitée deux semaines, Musset reprend sa vie de noctambule et s'abandonne à tous les plaisirs. Déjà à Gênes et à Florence, George Sand s'est plainte des inconduites de son compagnon et décide de lui fermer sa porte à Venise. Alfred de Musset tombe gravement malade à son tour, atteint d'une fièvre accompagnée de crises de délire. Les ressentiments oubliés en de tels instants, George Sand est à son chevet52. Elle fait appel aux soins d'un jeune médecin, Pietro Pagello, qui diagnostique une fièvre typhoïde. George Sand s'éprend de Pagello, alors que la santé de Musset s'améliore. Sa guérison assurée, Pagello lui avoue sa passion pour George Sand. Musset, stoïque, leur conserve son amitié, quitte Venise le 29 mars 1834 et rentre en France53. Il continue néanmoins d'entretenir une correspondance avec George Sand et celle-ci, restée avec Pagello, travaille énormément à plusieurs ouvrages. Elle écrit Mattea, Leone Leoni, André, Jacques, les premières Lettres d'un voyageur, puis revient en France avec Pagello. Le 14 août 1834, ils arrivent à Paris et George Sand revoit Musset dès le 17 août. En octobre, George Sand renoue avec Musset et Pagello, jaloux, repart pour l'Italie. La relation Sand-Musset se poursuit, orageuse, marquée par des plaintes, des reproches, des récriminations, jusqu'à leur rupture définitive le 6 mars 1835.
Cette relation inspire à George Sand les trois premières Lettres d'un voyageur et à Musset La Confession d'un enfant du siècle. Après la mort d'Alfred de Musset, George Sand fait paraître Elle et lui en 1859, qui raconte leur histoire. Le frère d'Alfred, Paul de Musset, riposte en publiant Lui et elle et Louise Colet, qui eut une liaison avec Alfred de Musset, renchérit par un Lui.
Michel de Bourges
George Sand entreprend les procédures judiciaires à l'encontre de son mari, Casimir Dudevant. Les rapports entre les époux se sont envenimés à cause du train de vie dispendieux de Casimir qui s'est engagé dans des opérations hasardeuses. George Sand craint à juste titre, qu'il ne provoque sa ruine. Des amis lui recommandent le célèbre avocat républicain Louis Michel, pour plaider sa séparation définitive avec le baron Dudevant. L'avocat, plus connu sous le pseudonyme de sa ville, Michel de Bourges, est doué d'un grand talent oratoire et intervient dans les procès politiques de la monarchie de Juillet. Le 9 avril 1835, George Sand le rencontre dans l'ancienne capitale du Berry et lui expose son affaire. Michel venait de lire son roman Lélia et sous le charme de George Sand, lui offre une plaidoirie impressionnante, en arpentant les rues de Bourges toute une nuit. La séduction est réciproque, George Sand le retrouve en mai à Paris et devient sa maîtresse. Avec Michel de Bourges commence une double passion, amoureuse et politique. Michel convertit George Sand, déjà sensible aux opinions républicaines, aux idées socialistes. L'engagement de l'écrivaine est tel que son appartement parisien est transformé en cénacle républicain et par voie de conséquence, sous surveillance policière. Michel gagne le procès en séparation de George Sand, au terme d'une longue procédure, le 16 février 1836. Il promet à George Sand de vivre avec elle, mais c'est un homme marié et qui va le rester. Peur de sa femme et de la forte personnalité de la romancière, leur liaison se délétère et prend fin au mois de juin 1837, après des reproches mutuels. Une séparation douloureuse qui déstabilise George Sand. Les liaisons qui suivent sont sans lendemain : Félicien Mallefille le précepteur de son fils Maurice, Charles Didier ou de l'acteur Pierre Bocage. Ce dernier lui restera fidèle en amitié.
George Sand dédie la sixième des Lettres d'un voyageur à Éverard, surnom qu'elle donne à Michel de Bourges. Il lui inspire également le personnage de l'avocat Simon, dans le roman du même nom en 1836. Un autre ouvrage intitulé Engelwald le Chauve n'est pas sans évoquer Michel de Bourges, mais l'œuvre ne sera jamais publiée et le manuscrit est détruit en 1864 par l'auteur.
Franz Liszt et Marie d'Agoult
Alfred de Musset présente George Sand à Franz Liszt, compositeur, pianiste virtuose et professeur de musique d'Herminie, la sœur du poète. Franz Liszt est transporté par le mouvement de 1830, influencé par les idées saint-simoniennes et enthousiasmé par Lamennais. La lecture de Leone Leoni, transposition de Manon Lescaut dans le mode romantique, a fait de lui un admirateur de George Sand61. Leur relation restera purement amicale. Le 28 août 1836, George Sand part de Nohant avec ses enfants, pour se rendre en Suisse où l'attendent ses amis Franz Liszt et Marie d'Agoult. Marie a quitté son mari et sa fille pour rejoindre Franz Liszt à Genève et la passion qui les unit plaît à George Sand. En octobre 1836, George Sand s'installe à l'hôtel de France, rue Laffitte à Paris, où résident Liszt et Marie d'Agoult. Le salon de la comtesse d'Agoult est fréquenté par Lamennais, Henri Heine, Mickiewicz, Michel de Bourges, Charles Didier et Frédéric Chopin. En février-mars et mai-juillet 1837, Franz Liszt et Marie d'Agoult séjournent à Nohant. C'est à Franz Liszt que George Sand adresse la septième des Lettres d'un voyageur, sur Lavater et la maison déserte. Liszt lui répond par ses trois premières Lettres d'un bachelier ès musique. En 1838, George Sand donne à Balzac le sujet d'un roman, les Galériens ou les Amours forcés. Ces Galériens de l'amour, sont Franz Liszt et Marie d'Agoult. C'est pourquoi George Sand ne peut écrire ce roman elle-même et le confie à Balzac. L'ouvrage figure dans la collection de La Comédie humaine sous le titre de Béatrix. Le personnage de la comtesse d'Agoult est celui de Béatrix et Liszt, celui du compositeur Conti. Quant à George Sand, elle apparaît dans le roman sous le nom de Félicité des Touches ou par son nom de plume androgyne, Camille Maupin. Les personnages sont parfaitement transparents et dans l’œuvre, Félicité des Touches est toujours comparée à Béatrix et lui est préférée. On voit que l'amitié des deux femmes s'est refroidie, à cause de l'engouement de George Sand pour Frédéric Chopin.
Félicité de Lamennais
L'abbé Félicité de Lamennais, devient le démocrate chrétien qui trouve dans l'Évangile, la loi de liberté, d'égalité et de fraternité. Loi recueillie par les philosophes et proclamée par la Révolution. Il est excommunié après la parution de son livre Paroles d'un croyant. Lamennais a une grande influence sur Franz Liszt et George Sand qui manifeste son enthousiasme pour ce prêtre, dans Histoire de ma vie. George Sand lui déclare : Nous vous comptons parmi nos saints … vous êtes le père de notre Église nouvelle. Lamennais se fixe à Paris, fonde un journal, Le Monde, auquel George Sand collabore bénévolement. Elle publie en 1837, Ingres et Calamatta, un article destiné à faire connaître le graveur Calamatta. Celui-ci réalise des portraits de George Sand, la gravure Une visite aux Catacombes, un petit fragment poétique, et enfin les célèbres Lettres à Marcie. Dans ces dernières, George Sand exprime ses idées sur le mariage, l'affranchissement de la femme et son égalité avec l'homme. L'audace de cette œuvre a dû effaroucher Lamennais, pour qu'il commente son auteur en ces termes : " Elle ne pardonne pas à saint Paul d'avoir dit : Femmes, obéissez à vos maris !" . Finalement, la publication s'interrompt lorsque Lamennais abandonne la direction du Monde.
Lamennais suscite à George Sand dans son roman Spiridion, le personnage du moine fondateur d'un couvent, chercheur intransigeant de la vérité. Le philosophe Pierre Leroux marque également de son empreinte, cet ouvrage.
Pierre Leroux
Charles-Augustin Sainte-Beuve 1804-1869, critique et écrivain, est le conseiller littéraire de George Sand. Il est aussi son confident, particulièrement au moment de ses amours avec Alfred de Musset. George Sand toujours en quête d'idéal et de ferveur réformatrice, demande son avis à Sainte-Beuve dans ce domaine. Après Félicité de Lamennais, elle cherche un nouveau mentor qui pourrait satisfaire son ardeur politique. En avril 1835, se tient à Paris le procès de 10 000 insurgés, à la suite de la révolte des Canuts et aux insurrections de 1834 qui ont éclaté dans la capitale et différentes grandes villes de France. Ce procès monstre offre une tribune inespérée à l'opposition républicaine et les convictions de George Sand s'affirment lors de son déroulement. Face à l'échec des révoltes, elle interroge Sainte-Beuve sur la révolution à faire. Celui-ci l'oriente vers deux hommes de doctrine : Pierre Leroux et Jean Reynaud qui participent à l’élaboration de l'Encyclopédie nouvelle. George Sand demande à rencontrer Pierre Leroux et au mois de juin 1835, elle lui pose la question sociale. Leroux subjugue George Sand et elle ne jure plus que par lui. Une profonde amitié naît de leur admiration mutuelle, le philosophe trouvant auprès de l’écrivain, une aide matérielle importante. Elle découvre dans les principes de Pierre Leroux, une synthèse des dogmes épars qu'elle emprunte au christianisme, à Jean-Jacques Rousseau, au saint-simonisme, à Michel de Bourges et à Lamennais. Compte tenu de l'influence des idées de Pierre Leroux sur l'œuvre de George Sand, il n'est pas inutile de résumer ici sa doctrine :
"L'homme est un animal transformé par la raison et indissolublement uni à l'humanité ; on ne peut concevoir un homme hors de l'humanité ; l'homme n'est pas seulement sensation, ou sentiment, ou connaissance, mais une trinité indivisible de ces trois choses".
"Nous sommes immortels ; à la mort, l'âme ne fait que se retremper en Dieu, se plonge dans l'oubli avant chaque nouvelle renaissance dans l'humanité ; il y a un cycle de renaissances et à chaque incarnation l'homme se perfectionne".
"Durant son incarnation, chaque être humain doit progresser indéfiniment, en communication complète avec la nature et avec ses semblables ; l'homme ne peut pas vivre sans société, sans famille, sans propriété, mais il faut combattre les abus de ces trois institutions qui empêchent l'homme de progresser indéfiniment ".
"Le progrès de l'humanité est infini et continu idée de Leibniz . Les religions sont incomplètes, car elles séparent le corps et l'âme, l'esprit et la matière ; or Dieu est partout, dans le matériel comme dans le spirituel, idée de Saint-Simon sur la sainteté de la matière. L'homme trouvera son salut lorsqu'il comprendra qu'il ne faut pas attendre le royaume de Dieu en dehors de ce monde, après la mort, mais tenter d'élever et sanctifier la vie charnelle et le labeur terrestre".
Leroux s'intéresse particulièrement de ce point de vue, à certaines sectes médiévales comme les lollards, les hussites et surtout les taborites.
Les idées de Pierre Leroux se manifestent dans toute une série de romans de George Sand : Spiridion, Consuelo, La Comtesse de Rudolstadt, Jean Zyska, Procope le Grand, Le Meunier d'Angibault, Le Péché de Monsieur Antoine, Horace, Le Compagnon du tour de France, Jeanne. Tous ces ouvrages apparaissent comme la mise en œuvre du programme de Leroux : lutte contre les triples abus : de caste, de famille et de propriété ; prédication de la doctrine du progrès continu et de son roman Le Compagnon du tour de France, publié en 1840. Ce roman prêchant l'un des dogmes de la théorie de Leroux, la guerre aux préjugés de caste et l'abolition des différends entre groupes sociaux, François Buloz, le directeur de la Revue des deux Mondes, propose tant de changements et de coupures que George Sand préfére reprendre son manuscrit et le publier en volume. Un an plus tard, il refuse de faire paraître son nouveau roman, Horace, dans sa revue.
En 1841, George Sand fonde avec Pierre Leroux et Louis Viardot la Revue Indépendante. De 1841 à 1844, elle publie dans cette revue des romans : Horace, Consuelo, Jean Zyska, Procope le Grand, La Comtesse de Rudolstadt, Isidora, ainsi que divers articles. Elle se lie d'amitié avec des poètes prolétaires, comme le maçon Charles Poncy de Toulon, le père Magu et son gendre, le serrurier Jérôme Gilland, pour lesquels elle écrit des préfaces à leurs ouvrages ; ils apparaissent comme une preuve visible de la théorie de Leroux sur le progrès continu et la perfectibilité de l'humanité82. Le père Magu inspire à George Sand le personnage d'Audebert dans son roman La Ville noire, publié en 1860.
Frédéric Chopin
George Sand rencontre Frédéric Chopin dans les tous derniers mois de 1836, par l'intermédiaire de Franz Liszt et de Marie d'Agoult. Leur liaison commence au mois de juin 1838. À cette époque, Eugène Delacroix peint le double portrait de Sand écoutant Chopin au piano.
À la fin de l'année 1838, George Sand et ses deux enfants partent pour Majorque et Frédéric Chopin les rejoint au cours de leur trajet à Perpignan. À Barcelone, George Sand visite le palais de l'Inquisition en ruines. Impressionnée par les lieux, elle y fait allusion dans son roman La Comtesse de Rudolstadt. Arrivés à Palma de Majorque, les voyageurs sont ravis par le cadre enchanteur de l'île, mais ils éprouvent de grandes difficultés pour se loger, en raison de l'absence d'hôtels et de chambres meublées. Atteint de phtisie, Chopin voit sa santé se détériorer. Les visiteurs sont chassés de leur logement par les majorquins qui pensaient que la maladie était contagieuse. Le 15 décembre, George Sand et Frédéric Chopin se rendent à l'ancienne Chartreuse de Valldemossa où ils sont hébergés dans des cellules monacales. Le site est magnifique, mais l'approvisionnement en nourriture est difficile, d'autant plus que les voyageurs sont en butte à l'hostilité des insulaires selon George Sand, parce qu'ils n'assistent pas aux offices religieux. Le 13 février, ils quittent l'île, rejoignent Barcelone après un périple éprouvant au cours duquel la santé de Chopin se dégrade encore. Leur séjour à Marseille permet au musicien de se rétablir et à la fin du mois de mai, ils arrivent à Nohant où ils passent tout l'été. George Sand publie un récit de ce voyage : Un hiver à Majorque sur ce que révèle cette expédition, se reporter au chapitre : Le voyage à Majorque.
George Sand et Chopin résident l'été à Nohant et l'hiver à Paris, d'abord rue Pigalle, puis à partir de l'automne de 1842, au Square d'Orléans, rue Taitbout. En raison de la maladie de Chopin, leur liaison se transforme en une relation mère-fils. Grâce à Chopin, le cercle des amis de George Sand s'élargit encore. Chopin reçoit des écrivains : Adam Mickiewicz, Julien-Ursin Niemcewicz, des musiciens : Giacomo Meyerbeer, Joseph Dessauer, Pauline Viardot et des membres de l'aristocratie polonaise en exil : Adam Jerzy Czartoryski, Delfina Potocka.
Mais Frédéric Chopin se comporte comme un compagnon absorbant et tyrannique. Les malentendus deviennent fréquents, d'autant plus que les enfants de George Sand grandissent et s'imposent comme des individualités. Maurice prend à cœur tous les désaccords entre sa mère et Chopin et les rapports entre le musicien et Maurice deviennent hostiles. À partir du printemps de 1846, George Sand héberge à Nohant une jeune cousine de sa famille maternelle, Augustine. Sa fille Solange et Chopin détestent Augustine tandis que Maurice, son ami d'enfance, est toujours prêt à la défendre.
Sur ce fond de discordes, des moments de détente sont privilégiés : pendant que Chopin improvise au piano, Solange, Augustine et Maurice miment des scènes et dansent des ballets comiques. Les hôtes séjournant à Nohant, comme Emmanuel Arago et Louis Blanc participent aussi à ces divertissements. Après le départ de Chopin pour Paris, ces pantomimes prennent le caractère de véritables pièces de théâtre, dans le genre de la commedia dell'arte. Elles seront publiées en recueil et sont à l'origine du théâtre de Nohant. Ce même théâtre est décrit en détail par George Sand dans son roman Le Château des Désertes où Maurice Sand lui inspire le personnage de Celio Floriani et Augustine celui de Cécile, qui interprète le rôle de la Donna Elvira. Citons également Frédéric Chopin, reconnaissable à travers le personnage du prince Karol, dans l'ouvrage de George Sand, Lucrezia Floriani, édité en 1846.
Au mois de novembre 1846, un projet de mariage s'ébauche entre Solange Sand et un hobereau berrichon, Fernand des Préaulx. En janvier 1847, George Sand est présentée au sculpteur Auguste Clésinger, pendant un séjour à Paris et visite son atelier. En février, George Sand et sa fille se voient proposer la réalisation de leur buste par l'artiste. Celui-ci s'éprend de Solange et la réciprocité est immédiate, alors que dans le même temps, George Sand prépare l'union de sa fille avec Fernand des Préaulx. Quelques semaines plus tard, Solange rompt ses fiançailles la veille de signer son contrat de mariage et impose son nouveau prétendant, malgré le désaveu de sa mère. George Sand s'incline et le 19 mai 1847, Solange épouse Auguste à Nohant. Le 11 juillet, le couple très endetté, demande en vain une aide financière à George Sand. À la suite de sa décision, une violente altercation se produit entre Auguste Clésinger et Maurice Sand et ce, malgré l'intervention de la romancière. George Sand congédie sur-le-champ, sa fille et son gendre. En raison de sa méfiance maladive, Frédéric Chopin donne crédit aux calomnies rapportées par Solange sur sa mère et met fin à sa liaison de dix années98 avec George Sand.
L'esprit imaginatif de George Sand transpose le tempérament de sa fille et le traitement qu'elle inflige à son premier fiancé, dans Mademoiselle Merquem en 1868. Dans cet ouvrage, une jeune fille dont le prénom masculin est féminisé, Erneste du Blossay, ressemble à Solange sous une forme caricaturale et aux traits forcés : ambitieuse, capricieuse, têtue et rusée. C'est une constante chez George Sand de faire apparaître dans son œuvre littéraire, des jeunes femmes qui ne sont pas sans rappeler la personnalité de Solange.
L'engagement politique
En 1844, George Sand fonde un journal local, l'Éclaireur de l'Indre, dont le premier numéro paraît le 14 septembre. Elle publiera dans ce journal plusieurs articles, notamment la Lettre d'introduction aux fondateurs de l'Éclaireur de l'Indre, un article sur les Ouvriers boulangers de Paris, la Lettre d'un paysan de la Vallée Noire écrite sous la dictée de Blaise Bonnin, la Lettre aux rédacteurs à propos de la pétition pour l'organisation du travail, trois articles sur la Politique et le Socialisme, un compte rendu de l'Histoire des dix ans de Louis Blanc, la Préface du livre de Jules Néraud : Botanique de l'enfance.
C'est à partir de cette époque que des relations amicales s'établissent entre Louis Blanc et George Sand, qui songea même à lui faire épouser sa fille, mais ce projet échoua. George Sand écrivit deux articles sur l'Histoire de la Révolution de Louis Blanc, en 1847 dans le Siècle et en 1865 dans l'Avenir national. En novembre 1844, Louis Blanc prie George Sand de collaborer au journal qu'il avait fondé, la Réforme. C'est dans ce journal que paraît en 1845 son roman Le Meunier d'Angibault et l'article sur la Réception de Sainte-Beuve à l'Académie, et en 1848 l'article sur l'Élection de Louis-Napoléon à la présidence de la République.
C'est aussi à cette époque que George Sand noue des relations épistolaires ou personnelles avec Barbès, Mazzini, Bakounine, Louis Bonaparte, Étienne et François Arago, Pauline Roland.
George Sand se réjouit en 1848 de la chute du roi Louis-Philippe et la fin de la Monarchie de Juillet, affichant son engagement politique socialiste. Mais après les journées de juin, où l'armée et la garde nationale écrasent dans le sang les insurgés, George Sand se retire à Nohant. Ses amis souhaitaient même pour sa sécurité, qu'elle quitte la France. L'échec de la révolution de 1848 et le coup d'État de 1851 marquent l'arrêt de son activité militante. Avec l'arrivée au pouvoir de Louis Napoléon Bonaparte, ce sont les arrestations, les déportations et la censure qui s'abattent sur le pays.
Les dernières années
George Sand est contrainte d'écrire pour le théâtre à cause d'embarras financiers. À Nohant, il lui arrive même d'exercer les fonctions de médecin de village, ayant étudié avec son premier précepteur, le docteur Deschartres, l'anatomie et les remèdes à base de plantes. Mais elle ne se cantonne pas à Nohant, voyageant aussi bien en France, et notamment chez son grand ami Charles Robin Duvernet au château du Petit Coudray, qu'à l'étranger.
Elle s'installe dans une relation apaisée avec un ami de son fils Maurice, Alexandre Manceau. Il est pendant quinze ans à la fois son amant et son secrétaire. Elle devient l'amie épistolaire de Flaubert et la seule femme admise aux dîners Magny, au cours desquels elle retrouve Théophile Gautier, les frères Jules et Edmond Goncourt, Sainte-Beuve, Taine…
Elle n'arrête pas d'écrire jusqu'à sa mort qui survient à Nohant, d'une occlusion intestinale, le 8 juin 1876, alors qu'elle a 71 ans.
Descendance
Sa belle-fille Lina Calamatta 1842-1901, donne naissance en 1863 à Marc-Antoine qui meurt en 1864, puis à Aurore en 1866, connue sous le nom d'Aurore Lauth-Sand et qui vivra jusqu'à l'âge de 95 ans.
La dernière petite-fille de George Sand est Gabrielle, née en 1868. Aurore Dudevant 1866-1961 épouse en 1889 Frédéric Lauth 1865-1922. Gabrielle Dudevant 1868-1909 épouse en 1890, Roméo Palazzi Arcevia 1853 - Rome 1932 professeur de dessin. Aurore et Gabrielle n'auront pas d'enfant.
Aurore Lauth-Sand a adopté Georges-André Smeets en 1958 en lui donnant son nom. Son épouse, Christiane Sand, est le défenseur actuel des droits moraux de George Sand.
Mémoire et Hommages
Honoré de Balzac l'a transposée dans le personnage de Félicité des Touches, l'illustre écrivain qui fume le narghilé , dans son roman Béatrix.
Victor Hugo a déclaré le 8 juin 1876 :" Je pleure une morte, je salue une immortelle !"
Fiodor Dostoïevski dans son Journal d'un écrivain en juin 1876 : "Les femmes de l’univers entier doivent à présent porter le deuil de George Sand, parce que l’un des plus nobles représentants du sexe féminin est mort, parce qu’elle fut une femme d’une force d’esprit et d’un talent presque inouïs. Son nom, dès à présent, devient historique, et c’est un nom que l’on n’a pas le droit d’oublier, qui ne disparaîtra jamais ".
Ernest Renan écrit au lendemain de la disparition de George Sand : "Une corde est brisée dans la lyre du siècle […] Madame Sand traversa tous les rêves ; elle sourit à tous, crut un moment à tous ; son jugement pratique put parfois s'égarer, mais comme artiste, elle ne s'est jamais trompée. Ses œuvres sont vraiment l'écho de notre siècle."
Solange Dudevant-Sand
Le 25 juillet 1883, la fille de George Sand, Solange 1828-1899 écrit à Émile Aucante 1822-1909, un ami très proche de la famille Sand. Malgré des relations difficiles, Solange a aimé sincèrement sa mère, comme en témoigne cette correspondance. En 1883, Solange a 55 ans et la voici dans la maison familiale à Nohant. George Sand est morte depuis sept ans et les souvenirs sont intacts. Face à la présence de l'absente, Solange n'a pas oublié :
"On a beau faire, les années s'accumulent et on est saisi par l'immense vide de cette gigantesque personnalité disparue. Une morne et incommensurable tristesse emplit cette maison, ce jardin, ces prairies. Derrière chaque porte qu'on ouvre, on s'attend à la voir. Au détour de chaque allée, on se dit : Où est-elle ! Pourquoi ne vient-elle pas ! Le soir surtout, sur cette terrasse, et le long de cette avenue du pavillon, quand l'ombre se fait sous les incertaines lueurs de la lune, on se figure qu'elle va enfin apparaître, cherchant un papillon ou une fleur préférée. Attente atroce qu'on sait vaine. Alors l'effroi de cette implacable absence vous glace. Le cœur se serre d'angoisse et de regret, dans la désespérance de l'impitoyable néant où s'est englouti un être si précieux, une âme si vaste et si élevée. Être à jamais perdu, génie pour toujours disparu ! Nohant est lugubre. Nohant sans George Sand, c'est la rivière sans eau, la prairie sans soleil, la montagne sans forêt, une chose matérielle, assez laide, sans poésie, sans attrait, sans rien qui fasse endurer une souffrance incessante et cruelle."
Études et regards critiques
La femme scandaleuse
Il n'est pas exceptionnel, au XIXe siècle, qu'une femme écrivain prenne un pseudonyme masculin pour écrire, les auteurs femmes étant méprisées111. En revanche, George Sand est la seule femme écrivain de son siècle dont les critiques parlaient au masculin et qui était classée non pas parmi les « femmes auteurs », mais parmi les « auteurs », au même rang que Balzac ou Hugo.
De même, George Sand n'était pas la seule femme de son époque à s'habiller en homme afin de forcer les limites imposées aux femmes et d'accéder à des lieux interdits - fosses de théâtre, bibliothèques restreintes, procès publics. D'ailleurs, George Sand, dans son autobiographie Histoire de ma vie, explique que ce fut d'abord pour des raisons pécuniaires qu'elle se mit à s'habiller en homme : se trouvant fort démunie à son arrivée à Paris son mari avait gardé l'autorité sur sa fortune et sa propriété de Nohant, et les frais d'habillement étant moindres pour les hommes que pour les femmes, il lui fut plus économique de s'habiller en homme. C'était aussi plus confortable. Autre précision : elle n'en faisait pas une habitude quotidienne, loin de là, et elle n'en restait pas moins femme, sachant plaire en tant que telle, contrairement à la travestie qu'on semble vouloir en faire de nos jours. S'il n'était pas exceptionnel qu'une femme se déguise en homme pour forcer les portes, la liberté d'esprit et de mœurs, la farouche indépendance, le refus total de l'idéal féminin imposé par les hommes de l'époque, le rejet du mariage, la force inaltérable de sa volonté, toutes ces caractéristiques de Sand, tenaient, elles, de l'exceptionnel en effet et d'une personnalité hors du commun. Elle provoqua également le scandale par ses positions anticléricales bien qu'elle fût croyante, par sa demande en séparation de corps d'avec son mari, l'avocat Casimir Dudevant, ou en fumant en public cigarettes et cigares.
Si aujourd'hui on la voit comme la bonne dame de Nohant, douce et sans danger, il faut savoir qu'à ses débuts elle fait scandale, et elle fait peur. Le scandale d'ailleurs concernait bien moins ses attitudes que ses écrits : ses trois premiers romans, Indiana, Valentine et l'abominable Lélia, comme l'appelait le critique Jules Janin dans son feuilleton du Journal des Débats, sont trois brûlots contre le mariage, dans lequel le mari est trompé, l'amant apparaît comme un lâche et la femme magnifiée par sa révolte contre les conventions sociales et le pouvoir masculin. Engagés pour la réhabilitation de la femme, ainsi que George Sand le formulait, ses romans s'ouvrent ensuite à la révolte sociale en faveur des ouvriers et des pauvres Le Compagnon du Tour de France, à la révolte politique contre la royauté et pour la République.
Le voyage à Majorque
Des aspects de l'œuvre de George Sand ou de son caractère sont cependant à nuancer. George Sand est désenchantée par son déplacement en Espagne en 1838, tant par l'accueil de ses habitants que par les conditions matérielles113. Dans son roman, Un hiver à Majorque, l'écrivain manifeste son incompréhension par une description négative. Elle se livre à une charge en règle et peu objective contre les majorquins, donnant ainsi à voir une forme d'intolérance, penchant qu'elle prétend pourtant combattre. Une posture qui élève une vague de protestations en Espagne, notamment celle de José María Quadrado ou plus récemment, l'auteur Llorenç Villalonga. Des journalistes soulignent également ce fait, comme Jules-Hippolyte Percher et Joséphine de Brinckmann.
D'autre part, à l'occasion de sa relation amoureuse avec le musicien, George Sand a dû contracter auprès de Chopin une part de l'antisémitisme que ce dernier a rapporté de Pologne, comme elle l'exprime dans sa correspondance et son ouvrage, Un hiver à Majorque.
La Commune de 1871
George Sand, républicaine et socialiste en 1848, rejoint en 1871, les écrivains qui condamnent la Commune de Paris comme Gustave Flaubert, Edmond de Goncourt, Théophile Gautier, Maxime Du Camp, Charles Marie René Leconte de Lisle, Alexandre Dumas fils, Ernest Renan, Alphonse Daudet, Ernest Feydeau, Émile Zola. Ce mouvement pour eux, est source de désordre : La secousse brutale que constitua la Commune pour la société bourgeoise du XIXe siècle, si bien incarnée par Thiers, ne pouvait en effet manquer d'amener les gens de lettres à réagir, à la fois en tant qu'individus appartenant à une classe sociale donnée, quoiqu'ils s'en défendent, et en tant qu'artistes, dont la conception de l'art est liée à un certain état social, à certaines valeurs remises en question par le mouvement révolutionnaire. George Sand manifeste une forte hostilité au mouvement de la Commune de Paris. Elle se démarque de Victor Hugo qui prend la défense des insurgés et n'hésite pas à critiquer sa prise de position. Les termes employés par George Sand sont extrêmement durs : Tout va bien pour les Versaillais. La déroute des Fédérés est complète. On ne peut plaindre l'écrasement d'une pareille démagogie […] Les exécutions vont leur train. C'est Justice et nécessité. Le 3 octobre 1871, George Sand cherche à justifier son attitude dans un article du journal Le Temps, en reprenant les arguments des conservateurs. La romancière propose comme solution l'éducation pour tous, afin d'éviter les dérives révolutionnaires. Mais la virulence des propos exprimés par les écrivains de l'époque, surprend encore aujourd'hui. George Sand redoute un retour de la monarchie et ne comprend pas que la Commune puisse prendre les armes contre la République naissante, même bourgeoise. Ses convictions légalistes ne voient dans la Commune que destructions, incendies et les exécutions des otages. Son soutien à Thiers et à la République conservatrice resteront incompris. C'est aussi le fossé qui se creuse entre Paris et la Province, entre les grandes cités et le monde rural. L'échec de la Révolution de 1848, les désillusions, le poids des années et la perte de la foi politique entraînent George Sand vers un repli sur elle-même.
Œuvres
Premières œuvres
La Fille d'Albano nouvelle, 1831
Le Commissionnaire avec Jules Sandeau, roman, 1831 sous le nom d’Alphonse Signol, auteur alors décédé
Rose et Blanche ou La Comédienne et la Religieuse avec Jules Sandeau, roman, 1831
Romans, récits, contes, nouvelles, textes diver
Manuscrit d'Un hiver à Majorque.
Indiana roman, 1832
Melchior nouvelle, 1832
Valentine roman, 1832
La Reine Mab poésie, 1832
Le Toast nouvelle, 1832
La Marquise nouvelle, 1832
Cora nouvelle, 1833
Lavinia ou Une vieille histoire nouvelle, 1833
Lélia roman, 1833, modifié en 1839
Aldo le Rimeur dialogue, 1833
Metella nouvelle, 1834
Le Secrétaire intime ou Quintilia roman, 1834
Garnier conte, 1834
Leone Leoni roman, 1834
Jacques roman, 1834
Journal intime posthume, journal intime, rédigé en 1834, publié en 1926
André roman, 1835
Myrza nouvelle, 1835
Mattea nouvelle, 1835
Simon roman, 1836
Lettres à Marcie La soeur cadette, Les trois soeurs politique, 1837
Le Dieu inconnu in Le Dodecaton ou Le Livre des douze nouvelle, 1837
Le Contrebandier histoire lyrique, 1837
Lettres d'un voyageur lettres, 1837
Mauprat roman, 1837
Les Maîtres mosaïstes roman, 1838
La Dernière Aldini roman, 1837
L'Orco nouvelle, 1838
L'Uscoque nouvelle, 1838
Spiridion roman, 1838
Les Sept Cordes de la lyre dialogue, 1839
Gabriel dialogue, 1839
Pauline nouvelle, 1839
Le Compagnon du tour de France roman, 1840
Georges de Guérin critique littéraire, 1840
Mouny Roubin nouvelle, 1841
Horace roman, 1841
Un hiver à Majorque récit de voyage, 1841
Consuelo roman, 1842
Carl nouvelle, 1843
Kourroglou nouvelle, 1843
Fanchette polémique, 1843
Jean Zyska roman historique sur la vie de Jan Žižka, chef de guerre hussite, 1843
La Comtesse de Rudolstadt roman, suite de Consuelo, 1843
Procope le Grand nouvelle, suite de Jean Zyska, 1844
Jeanne roman, 1844
La Fauvette du docteur nouvelle, 1844
Le Meunier d'Angibault roman, 1845
Isidora roman, 1845
Teverino roman, 1845
Le Péché de M. Antoine roman, 1845
La Mare au diable roman, 1846
La Noce de campagne étude, fait suite à La Mare au diable, 1846
Lucrezia Floriani roman, 1846
Le Piccinino roman, 1847
François le Champi
La Petite Fadette roman, 1849
Le Château des Désertes roman, suite de Lucrezia Floriani, 1851
Monsieur Rousset roman inachevé, 1851
Histoire du véritable Gribouille conte, 1851
Mont-Revèche roman, 1852
La Filleule roman, 1853
Les Maîtres sonneurs roman, 1853
Adriani roman, 1854
Histoire de ma vie autobiographie, 1855
Évenor et Leucippe ou Les Amours de l'Âge d'or roman, 1856
Le Diable aux champs roman, 1856
Autour de la table recueil d'articles, 1856
La Daniella roman, 1857
Les Dames vertes roman, 1857
Promenades autour d'un village 1857
Les Beaux Messieurs de Bois-Doré roman,
L'Homme de neige roman, 1859
Narcisse roman, 1859
Elle et lui roman autobiographique sur ses relations avec Musset, 1859
Flavie roman, 1859
Jean de la Roche roman, 1859
La Fée qui court conte, 1859
Constance Verrier roman, 1860
La Ville noire roman, 1860
Le Marquis de Villemer roman, 1860
Valvèdre roman, 1861
La Famille de Germandre roman, 1861
Tamaris roman, 1862
Antonia roman, 1862
Mademoiselle La Quintinie roman, 1863
Laura roman, 1864
La Confession d'une jeune fille roman, 1864
La Coupe nouvelle, 1865
Monsieur Sylvestre roman, 1865
Le Dernier Amour roman, suite de Monsieur Sylvestre, 1866
La Rêverie à Paris nouvelle, 1867
Cadio (roman dialogué, 1867
Mademoiselle Merquem roman, 1868
Pierre qui roule roman, 1869
Malgrétout roman, 1870
Le Beau Laurence roman, suite de Pierre qui roule, 1870
Césarine Dietrich roman, 1870
Journal d'un voyageur pendant la guerre journal, 1871
Francia roman, 1871
Nanon roman, 1872
Impressions et Souvenirs recueil, 1873
Contes d'une grand'mère première série 1873 Le château de Pictordu; La reine Coax; Le nuage rose; Les ailes de courage; Le géant Yéous
Ma sœur Jeanne roman, 1874
Marianne roman, 1875
Flamarande roman, 1875
Les Deux Frères roman, suite de Flamarande, 1875
La Tour de Percemont roman, 1875
Contes d'une grand'mère deuxième série 1876, Le chêne parlant; Le chien et la fleur sacrée; L'orgue du Titan; Ce que disent les fleurs; Le marteau rouge; La fée poussière; Le gnome des huîtres; La fée aux gros yeux
Légendes rustiques Les Pierres sottes ou pierres caillasses, Les Demoiselles, Les Laveuses de nuit ou lavandières, La Grand'Bête, Les Trois hommes de pierre, Le Follet d'Ep-Nell, Le Casseu' de bois, Le Meneu' de loups, Le Lupeux, Le Moine des Étangs-Brisses, Les Flambettes, Lubins et Lupins 1877
Dernières pages recueil, 1877
Nouvelles lettres d'un voyageur lettres, 1877
Questions d'art et de littérature recueil, 1878
Questions politiques et sociales recueil, 1879
Souvenirs de 1848 recueil, 1880
Pièces de théâtre
Une conspiration en 1537 posthume, essai dramatique rédigé en 1831, publié en 1921
Cosima ou la Haine dans l'amour drame en cinq actes et un prologue, 1840
Les Mississipiens proverbe en deux actes et un prologue, 1840
Le Roi attend prologue, 1848
François le Champi comédie en trois actes, 1849
Claudie drame en trois actes, 1851
Molière drame en cinq actes, 1851
Le Mariage de Victorine comédie en trois actes, 1851
Les Vacances de Pandolphe comédie en trois actes, 1852
Le Démon du foyer comédie en deux actes, 1852
Le Pressoir drame en trois actes, 1853
Mauprat drame en cinq actes, 1854
Flaminio comédie en trois actes et un prologue, 1854
Maître Favilla drame en trois actes, 1855
Lucie comédie en un acte, 1856
Françoise comédie en quatre actes, 1856
Comme il vous plaira comédie en trois actes, 1856
Marguerite de Sainte-Gemme comédie en trois actes, 1859
Le Marquis de Villemer comédie en quatre actes, 1864
Les Don Juan de village comédie en trois actes
Le Lis du Japon comédie en un acte, 1866
Cadio avec Paul Meurice, drame en cinq actes, 1867
Lupo Liverani 1869
L'autre comédie en quatre actes, 1870
Un bienfait n'est jamais perdu proverbe, 1872
Théâtre de Nohant Le Drac, Plutus, Le pavé, La nuit de Noël, Marielle
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=5859#forumpost5859
Posté le : 07/06/2014 23:39
|
|
|
|
|
Georges Sand 2 suite |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
George Sand et les arts
Cinéma
1923 : La Mare au diable, film français de Pierre Caron.
1926 : Mauprat, film français de Jean Epstein.
1990 : La note bleue, d'Andrzej Zulawski avec Marie-France Pisier et Sophie Marceau.
1991 : Impromptu, de James Lapine avec Judy Davis, Hugh Grant.
1999 : Les Enfants du siècle, de Diane Kurys avec Juliette Binoche et Benoît Magimel.
1999 : Exposition Sand–Musset/Histoire d'un film, Les Enfants du siècle, au musée de la Vie romantique, Paris.
2004 : Sand, de Jerzy Antczak avec Danuta Stenka.
Télévision
1966 : Indiana du roman de George Sand, téléfilm d'Edmond Tyborowski
1972 : Mauprat, téléfilm français de Jacques Trébouta
1972 : La Mare Au Diable, téléfilm français de Pierre Cardinal
1976 : François le Champi, téléfilm français de Lazare Iglesis pour lequel il aura le prix de la Fondation de France
1979 : La Petite Fadette, téléfilm français de Lazare Iglesis
1980 : Les maîtres sonneurs, téléfilm français de Lazare Iglesis pour lequel il aura le prix de la Fondation de France
2003 : Sand... George en mal d'Aurore121, réalisé par Françoise-Renée Jamet et Laurent Marocco avec Joséphine Serre, Christophe Vericel, Roger Rigaudeau, Chloé Thoreau et en voix off Lambert Wilson.
2004 : La Petite Fadette, téléfilm français de Michaëla Watteaux
2004 : George Sand, Histoire de sa vie, film documentaire, Claudine Cerf (scénario), Micheline Paintault (réalisation), coproduction France 5/SCEREN-CNDP.
2004 : George Sand, Une femme libre, film documentaire de Gérard Poitou-Weber avec Christine Citti (Les Films de l'Arlequin et France 3).
2010 : George et Fanchette, comédie dramatique de Jean-Daniel Verhaeghe avec Ariane Ascaride (George Sand), Anaïs Demoustier Fanchette, Philippe Chevallier (Gustave Papet), Raphaël Personnaz Maurice Sand, le fils, Alexis Loret Alexandre Manceau, Fabrice Pruvost (Frédéric Chopin), Nicolas Vaude (Eugène Delacroix), téléfilm en deux parties diffusé en mai 2010 sur France 3.
Théâtre
1996 : Sand, prénommée George ou l'Aurore d'une liberté…, spectacle de Pierrette Dupoyet (Création Festival d'Avignon).
2010 : Epopoiia, les arts chantés dans la nuit…, spectacle de Violaine Darmon et Anna Göckel.
Musique
1992 : Sand et les Romantiques Album et Comédie musicale de Catherine Lara.
1996 : George Sand est une chanson de François Hadji-Lazaro, texte de Roland Topor. Elle figure sur l'album François détexte Topor (Boucherie Production).
Bandes dessinées
2012 : La soupe au poivre, par Colonel Moutarde et Nathalie Dargent, éditions PLG,. Récit fantaisiste du séjour de Frédéric Chopin et George Sand à Majorque en 1838.
Botanique
Plusieurs roses portent son nom : Madame Dupin (obtenteur Foulard), Souvenir de George Sand (obtenteur Dücher), George Sand (obtenteur Gravereaux), George Sand II (obtenteur Meilland), George Sand III (obtenteur Laperrière-Robert)
Généalogie
Aurore Dupin (1804-1876) dite George Sand est l'arrière-petite-fille du maréchal de Saxe (1696-1750) lequel était (en ligne illégitime) le grand-oncle des rois de France Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, du roi d'Espagne Charles IV, du roi des Deux-Siciles Ferdinand Ier et de l'impératrice Marie-Louise, mère de l'empereur François Ier d'Autriche et grand-mère de l'impératrice des Français, Marie-Louise :
Frédéric-Auguste, électeur de Saxe et roi de Pologne 1670-1733
x (filiation naturelle) Aurore de Koenigsmark 1662-1728
│
└──> Maurice de Saxe (1696-1750)
x (filiation naturelle) Marie Rinteau (1730-1775) dite « Mademoiselle de Verrières »
│
└──> Marie-Aurore de Saxe (1748-1821)
x 1777 (d'abord à Londres, puis réhabilitation du mariage à Paris)
│ Louis Dupin de Francueil (1715-1786)
│
└──> Maurice Dupin de Francueil (1778-1808)
x 1804 Sophie Victoire Delaborde (1773-1837)
│
└──> Aurore Dupin (1804-1876) dite George Sand
Source : Joseph Valynseele et Denis Grando (préf. Jean Guitton), À la découverte de leurs racines, t. II, Paris, L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1988, 220 p. George Sand .
Par cette ascendance, George Sand était cousine au 7e degré civil des rois de France Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, qui étaient petits-neveux, dans la branche légitime, de Maurice de Saxe, et cousins issus de germain de son père, Maurice Dupin de Francueil.
Musées
Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, Paris, où sont exposés en permanence de nombreuses peintures, sculptures, objets d'art et memorabilia légués par sa petite fille Aurore Lauth-Sand - dont le célèbre moulage en plâtre de son bras droit, effectué par son gendre Auguste Clésinger. Une suite de ses dendrites complète l'ensemble : en peinture, la technique de la dendrite consiste à retoucher au pinceau ou à la plume une forme abstraite obtenue par pliage de taches d’encre ou de pigment projetées sur papier.
Le Domaine de George Sand, sa propriété à Nohant (Indre), dans la romantique vallée noire de la province du Berry.
Le Musée George Sand et de la Vallée Noire au no 71 rue Venôse à La Châtre, présente les souvenirs, œuvres littéraires et épistolaires de George Sand à travers des éditions originales, lettres autographes, manuscrits et portraits. Au mois de janvier 2014, le musée reverse une partie de ses collections sur la base numérique Joconde, dans le cadre de son accessibilité au public et de la sauvegarde du patrimoine.
La maison-musée de Gargilesse dans le Val de Creuse (Indre) où, avec son dernier amour Manceau, elle passera en villégiature de nombreuses années.
Bibliothèques
La Bibliothèque historique de la ville de Paris possède un fonds George Sand en partie constitué par la donation de la petite fille de l'écrivain en 1951 et enrichi par de nouvelles acquisitions.
Les Fonds patrimoniaux de la bibliothèque de La Châtre (Indre) possèdent un fonds George Sand comprenant notamment des originaux de sa correspondance.
Liens
http://youtu.be/WMo_ulk4bqk La maison de Georges Sand
http://youtu.be/JqvMv1HmPbw Un tour au pays de Georges Sand
http://youtu.be/MPa-jIu7hzA Une journée à Nohant chez Georges Sand et Chopin
http://youtu.be/nAlhPffKwT8 Visite au domaine de Georges Sand
http://youtu.be/9MjmU8bjhik Lettre de Georges Sand à Musset par Céline Dion        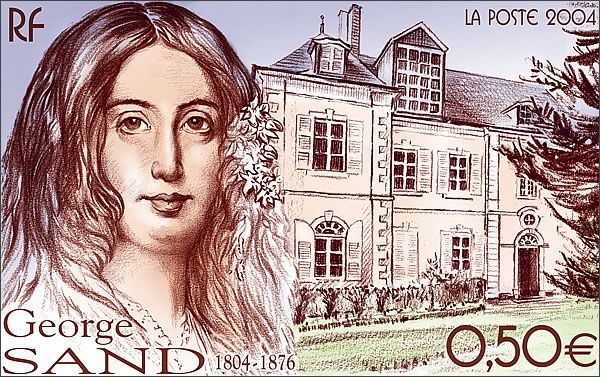  [img width=600]http://librelivre.net/img/covers/bp2/Indiana-(Oxford-monde-Classics).jpg[/img]   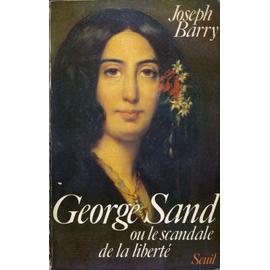  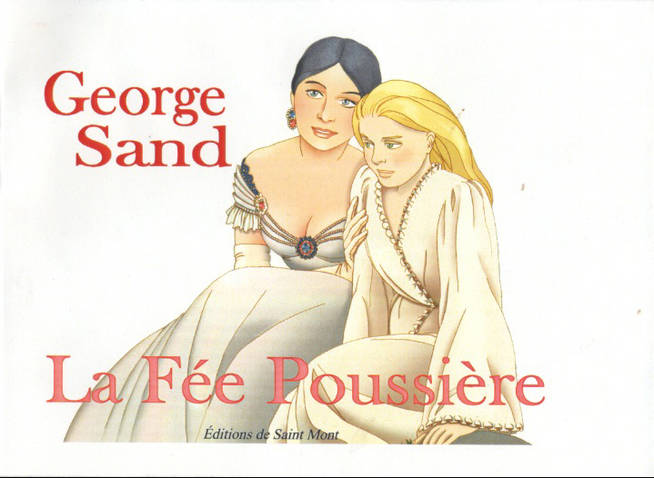 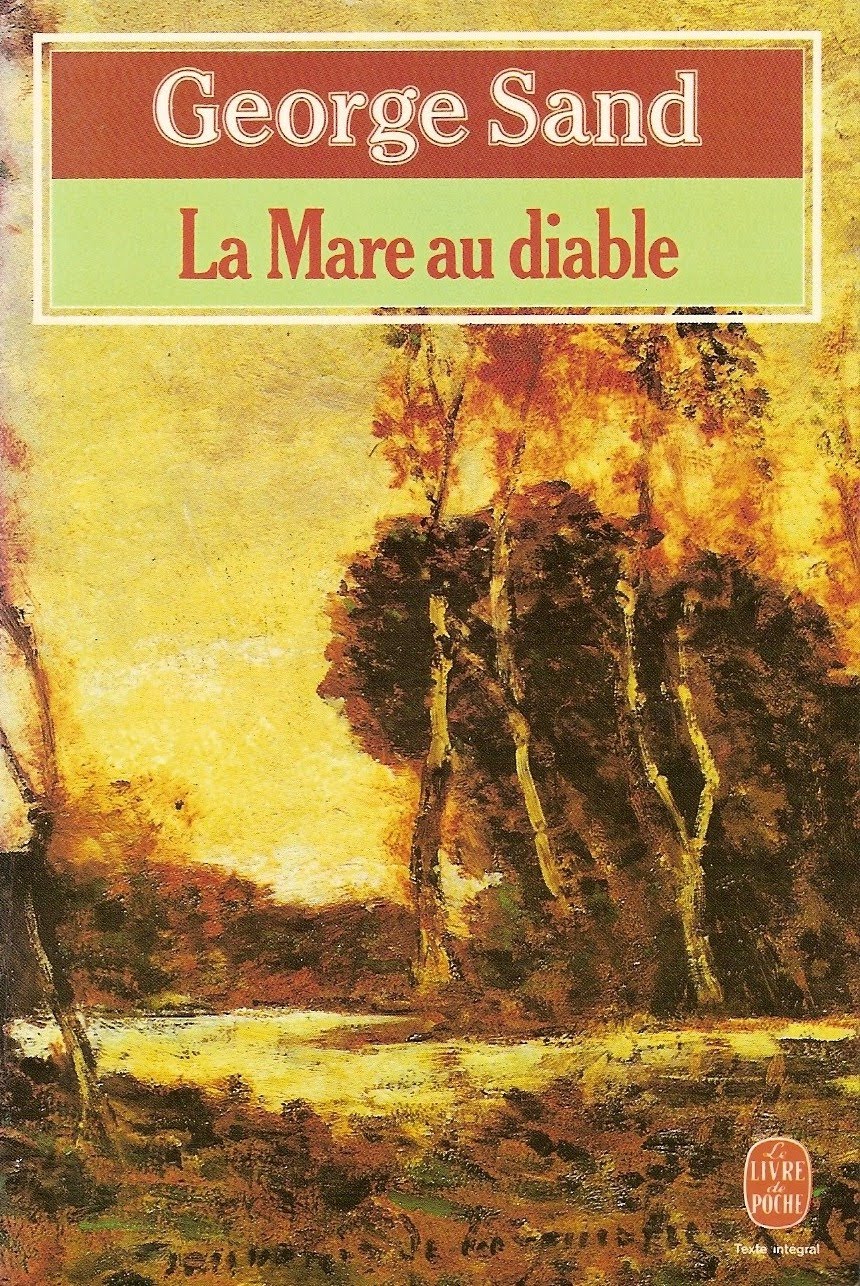
Posté le : 07/06/2014 23:36
|
|
|
|
|
Marguerite Yourcenar |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Le 8 juin 1903 à Bruxelles naît Marguerite Yourcenar
née Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, écrivaine française naturalisée américaine en 1947, auteur de romans et de nouvelles humanistes , ainsi que de récits autobiographiques. Elle fut aussi poète, traductrice, essayiste et critique littéraire, elles fut la première femme élue à l'Académie française au fauteuil n° 3 en 1980, Ses Œuvres principales sont : Alexis ou le Traité du vain combat en 1929, Nouvelles orientales en 1938, Mémoires d'Hadrien en 1951, L'Œuvre au noir en 1968, Mishima ou la Vision du vide en 1980, elle meurt à 84 ans, le 17 décembre 1987 à Bar Harbor, dans l'État du Maine aux États-Unis,
Si elle fut la première femme élue à l'Académie française, cette vieille institution machiste le 6 mars 1980, c'est grâce au soutien actif de Jean d'Ormesson, qui prononça le discours de sa réception, le 22 janvier 1981.
L'historien-poète et le romancier que j'ai essayé d'être : c'est ainsi que Marguerite Yourcenar tente elle-même de définir une entreprise complexe, variée dans son propos et dans son genre. La discrétion de son œuvre et de son existence, l'érudition et l'orientation plus particulière de ses travaux vers des thèmes historiques ou antiques n'ont pourtant pas empêché son succès grandissant comme romancière, poète, auteur dramatique, traductrice, essayiste et critique, notamment après deux romans qui l'ont rendue célèbre : Mémoires d'Hadrien en 1951 et L'Œuvre au noir pour lequel elle a reçu le prix Fémina en 1968. Elle est la première femme à avoir été élue à l'Académie française, en mars 1980.
Reçue à l'Académie royale de Belgique 1971, première femme à pénétrer sous la Coupole française 1980, Yourcenar exhume ses racines familiales dans un cycle généalogique intitulé le Labyrinthe du monde : Souvenirs pieux 1974 évoquent les ancêtres maternels ; Archives du Nord 1977, l'ascendance paternelle ; Quoi ? l'Éternité 1988 demeure inachevé. On lui doit aussi un autoportrait, les Yeux ouverts 1980, fruit d'entretiens accordés à Mathieu Galey. Entrée de son vivant dans la Bibliothèque de la Pléiade, elle jette un dernier regard, à la fois curieux et apaisé, sur le monde et la mémoire dans les nouvelles de Comme l'eau qui coule 1982 et dans les essais du Temps, ce grand sculpteur 1983.
L'historien-poète et le romancier que j'ai essayé d'être : c'est ainsi que Marguerite Yourcenar tente elle-même de définir une entreprise complexe, variée dans son propos et dans son genre. La discrétion de son œuvre et de son existence, l'érudition et l'orientation plus particulière de ses travaux vers des thèmes historiques ou antiques n'ont pourtant pas empêché son succès grandissant comme romancière, poète, auteur dramatique, traductrice, essayiste et critique, notamment après deux romans qui l'ont rendue célèbre : Mémoires d'Hadrien en 1951 et L'Œuvre au noir pour lequel elle a reçu le prix Fémina en 1968. Elle est la première femme à avoir été élue à l'Académie française, en mars 1980.
Reçue à l'Académie royale de Belgique 1971, première femme à pénétrer sous la Coupole française 1980, Yourcenar exhume ses racines familiales dans un cycle généalogique intitulé le Labyrinthe du monde : Souvenirs pieux 1974 évoquent les ancêtres maternels ; Archives du Nord 1977, l'ascendance paternelle ; Quoi ? l'Éternité 1988 demeure inachevé. On lui doit aussi un autoportrait, les Yeux ouverts 1980, fruit d'entretiens accordés à Mathieu Galey. Entrée de son vivant dans la Bibliothèque de la Pléiade, elle jette un dernier regard, à la fois curieux et apaisé, sur le monde et la mémoire dans les nouvelles de Comme l'eau qui coule 1982 et dans les essais du Temps, ce grand sculpteur 1983.
Sa vie
Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour — de Craincourt, domaine acquis par la famille, qui l'ajouta à son nom — est née dans une maison de l'avenue Louise, à Bruxelles, d'un père originaire de la Flandre française appartenant à l'ancienne bourgeoisie, la famille Cleenewerck de Crayencour, Michel Cleenewerck de Crayencour, et d'une mère belge, Fernande de Cartier de Marchienne, d'une famille noble belge, qui meurt dix jours après sa naissance, la jeune Marguerite est élevée par un père aristocrate qui lui transmet son goût des voyages et de la culture antique, l'orpheline est nourrie d'indépendance et d'humanités par un père aristocrate, aventurier qui aime les lettres et s'instruit par la vie, nomade qui lui fait partager son cosmopolitisme. Il lui apprend le latin et le grec, l'emmène au théâtre, lui transmet sa passion pour la culture c'est tout naturellement ensemble qu'ils inventeront son pseudonyme. La jeune fille fait son entrée en littérature par la poésie, avec le Jardin des chimères 1921, bientôt suivi par Les dieux ne sont pas morts 1922, qui trahit l'intérêt pour Nietzsche, à une époque de réflexions empreintes de philosophie et de métaphysique, voire de mysticisme en 1938, les Songes et les Sorts traiteront de communication avec l'au-delà et de destin.
Marguerite est élevée chez sa grand-mère paternelle Noémi Dufresne dont elle fait, dans Archives du Nord, un portrait à l'acide, par son père, anti-conformiste et grand voyageur; elle passe ses hivers à Lille et ses étés, jusqu'à la Grande Guerre, dans le château familial situé au Mont Noir dans la commune de Saint-Jans-Cappel Nord, construit en 1824 par son arrière-grand-père Amable Dufresne 1801-1875 et qui restera la propriété de la famille Dufresne jusqu'à la mort de Noémi en 1909. Michel Cleenewerck de Crayencour, le père de Marguerite Yourcenar, le vend en 1913, peu de temps après en avoir hérité. Le château sera détruit lors des combats de la Première Guerre mondiale villa Marguerite Yourcenar.
Installée à Paris 1912, elle apprend l'anglais à Londres, où elle se réfugie un an pendant la Première Guerre mondiale 1914, puis, après son retour en France, passe un baccalauréat latin-grec à Nice 1919. Elle fait son entrée en littérature avec deux recueils de poèmes : le Jardin des chimères 1921, qu'elle publie à compte d'auteur et qui sera bientôt suivi de Les dieux ne sont pas morts 1922. Ces premières publications sont signés Yourcenar, anagramme de Crayencour à l'omission d'un C près, qui deviendra son patronyme légal en 1947 lors de sa naturalisation comme américaine, en effet c'est à cette époque qu'elle invente, avec l'aide de son père, l'anagramme Yourcenar, qui deviendra son nom légal. Très rapidement, la jeune femme éprouve le besoin de varier ses sources d'inspiration. De 1921 à 1925, elle compose une vaste fresque romanesque, dont elle ne conservera que trois fragments qui paraîtront sous le titre La Mort conduit l'attelage 1934. Dès 1926, elle termine une biographie de Pindare publiée en 1932, inaugurant ainsi la veine des essais.
Elle accompagne son père dans ses voyages : Londres pendant la Première Guerre mondiale, le midi de la France, la Suisse, l'Italie où elle découvre avec lui la Villa d'Hadrien à Tivoli ; elle l'observe, assiste à ses amours dont elle fera la trame de Quoi ? L'Éternité.
En 1929, elle publie son premier roman, inspiré d'André Gide, d'un style précis, froid et classique : Alexis ou le Traité du vain combat. Il s'agit d'une longue lettre dans laquelle un homme, musicien renommé, confie à son épouse son homosexualité et sa décision de la quitter dans un souci de vérité et de franchise. La Monique du texte n'est autre que le grand amour du père de Yourcenar, par ailleurs ancienne condisciple de sa mère, Jeanne de Vietinghoff née Bricou fille d'Alexis Bricou 1825 ou 24-1877, négociant à Schaerbeek rue du Progrès, 121, déjà veuf en premières noces de Hermanie Koch et en seconde noces de Gesina Cornelia van Duura 1834/1835-1867. Après le décès de son père, en 1929 après qu'il a lu le premier roman de sa fille, Marguerite Yourcenar mène une vie bohème entre Paris, Lausanne, Athènes, les îles grecques, Constantinople, Bruxelles, etc. Marguerite Yourcenar est bisexuelle, elle aime des femmes et tombe amoureuse d'un homosexuel, André Fraigneau, écrivain et éditeur chez Grasset.
Elle publie les Nouvelles orientales, échos de ses voyages, Feux, composé de textes d'inspiration mythologique ou religieuse entrecoupés d'apophtegmes, où l'auteur traite sur différents modes le thème du désespoir amoureux et des souffrances sentimentales, repris plus tard dans Le Coup de grâce 1939, court roman sur un trio amoureux ayant pour cadre la Courlande pendant la guerre russo-polonaise de 1920.
Approche biographique
La tâche d'établir une biographie de Marguerite Yourcenar pourrait sembler facilitée par la publication en 1974 et en 1977 de Souvenirs pieux et Archives du Nord : ces deux ouvrages devaient faire partie d'une trilogie autobiographique qu'aurait complétée Quoi ?, l'éternité, restée inachevée. L'auteur y tente de retrouver sa double origine, belge par sa mère, française par son père ; la narration proprement autobiographique sera cependant esquivée ; l'être que j'appelle moi s'efface au profit d'une patiente recherche généalogique, à partir de la naissance de l'auteur à Bruxelles et de la mort de sa mère, onze jours plus tard, des suites de l'accouchement, pour remonter de cette mère inconnue, née de Cartier de Marchienne, vers la famille de celle-ci. La démarche s'inverse dans le second volume, où il s'agit pour Marguerite Yourcenar de redescendre le temps, des plus lointaines origines d'une région qui deviendra plus tard la Flandre française, jusqu'à la personnalité marquante de son père, à travers le réseau complexe des alliances et des générations. Travail d'archiviste et de romancière qui laisse de côté les éléments autobiographiques qu'il faut collecter ailleurs.
De son vrai nom Cleenewerck de Crayencour transformé en Yourcenar par l'anagramme du second patronyme, elle passera son enfance et son adolescence auprès de son père, entre le domaine de la famille paternelle, en Flandre française, et des séjours à l'étranger ou dans le midi de la France c'est à Aix-en-Provence qu'elle obtient son baccalauréat. Sa formation classique autant que ses goûts l'orientent vers les langues et les civilisations anciennes. En 1921, elle publie Le Jardin des chimères, un recueil de poésie. En 1929, son premier roman, Alexis ou le Traité du vain combat. Après la mort de son père, survenue la même année, Marguerite Yourcenar continue à voyager, en Suisse, en Italie, en Grèce, alternant la publication d'essais Pindare en 1932, de romans, Denier du rêve en 1934, de poésie, Feux en 1936, de traductions Les Vagues de Virginia Woolf en 1937. En 1939, elle gagne les États-Unis où elle enseignera quelque temps dans des universités et où elle choisira définitivement pour résidence l'île des Monts-Déserts, sur la côte est. En 1971, Marguerite Yourcenar a été reçue à l'Académie royale belge de langue et de littérature françaises et, en 1980, à l'Académie française.
Le sens de l'histoire
La diversité de l'œuvre, tant par ses thèmes que par les genres littéraires utilisés qui varient des aphorismes intimes de Feux au roman historique, peut être un obstacle à son approche, malgré le classicisme de son projet comme de son écriture. Sur les grandes lignes de sa démarche, Marguerite Yourcenar s'est expliquée à plusieurs reprises, notamment dans les préfaces écrites lors de la révision de certains ouvrages en vue d'une nouvelle édition. Plusieurs d'entre eux, en effet, ont fait l'objet d'une élaboration en deux temps, ou d'un remaniement ultérieur. Denier du rêve, qui représente un moment de révolte contre le fascisme italien et qui date de 1934, a été repris en 1959 selon une analyse quelque peu différente des événements historiques et des motivations des personnages ; la pièce de théâtre Qui n'a pas son Minotaure ?, composée en 1933, a été récrite en 1944 puis en 1957. Les Mémoires d'Hadrien, ébauchés avant la guerre, n'ont été menés à terme qu'en 1951. Quant à L'Œuvre au noir, qui sera publié en 1968, c'est la reprise et l'approfondissement d'un thème traité en 1934 sous la forme d'une nouvelle, D'après Dürer. Ces délais, ces relectures donnent lieu chez l'auteur à des analyses rétrospectives de sa démarche qui peuvent ainsi l'éclairer.
L'intérêt pour son propre passé d'écrivain, les scrupules éprouvés dans ce domaine témoignent que la forme définitive ne s'atteint que par une reconstruction de l'ancien : cette idée se retrouve, sur un plan général, dans l'utilisation si fréquente par l'auteur de thèmes, de personnages et de récits antiques. Ce mouvement de retour aux sources, de recherche d'un support dans des événements ou des textes antérieurs rejoint une tendance fondamentale de la tradition humaniste. Le point de départ, en effet, est presque toujours historique : Denier du rêve a pour centre un attentat antifasciste à Rome en l'an XI de la Dictature ; Le Coup de grâce relate un épisode du conflit russo-allemand dans les provinces baltes pendant la Première Guerre mondiale ; Mémoires d'Hadrien tente de cerner l'existence et la personnalité d'un empereur romain ; et L'Œuvre au noir emprunte à un certain nombre de philosophes, de médecins ou d'alchimistes authentiques du XVIe siècle les traits essentiels de son héros Zénon, dont la vie, les expériences et les préoccupations se trouvent ainsi soutenues par une réalité historique. Le romancier, écrit Marguerite Yourcenar, n'étudiera jamais avec assez de minutie passionnée le dossier de son héros. Mais il ne s'agit pas pour elle de prendre appui sur l'histoire afin de la romancer, de faire du passé le prétexte d'un bal costumé. Cette libre recréation d'un personnage réel ayant sa trace dans l'histoire, selon la formule qu'elle utilise pour Hadrien, peut être rapprochée de la démarche qu'elle effectue à propos de sa propre famille : démarche de compréhension du passé à force de sympathie imaginative, reconstruction, à travers différents moments du temps, de ce jeu compliqué de causes dont nous ressentons encore les effets. L'intérêt pour le passé est complexe, animé par des questions actuelles, conscient d'une fascination pour cette remontée vers l'obscur, l'abîme, la mort, ces spectres évoqués jalonnant une entreprise que l'auteur qualifie de quasi nécromantique ; mais porté d'autre part vers ce que ces existences et ces événements antérieurs présentent d'intemporel : documents humains toujours valables qui permettent comme dans Denier du rêve un glissement vers le mythe ou l'allégorie, saisissant dans la Rome de la dictature fasciste, la Ville où se noue et se dénoue éternellement l'aventure humaine.
Le poids du mythe
Le retour à l'origine n'est donc pas seulement une plongée dans l'histoire réelle. Le point de départ du travail littéraire, théâtral, romanesque ou poétique, peut être aussi bien la légende, ou, comme dans Nouvelles orientales, la fable grecque ou hindoue, l'apologue taoïste, la ballade balkanique, c'est-à-dire un texte antérieur, jouant le rôle des archives ou des arbres généalogiques pour les travaux d'historien. Mais l'utilisation du mythe, au-delà de sa diversité apparente, reconduit régulièrement Marguerite Yourcenar aux sources helléniques. « Toujours un fil grec court à travers la trame, qu'elle soit balte, espagnole, italienne ou hollandaise », remarque Carlo Bronne à son sujet. Nous touchons ici à une prédilection soutenue par cette conviction que « presque tout ce que les hommes ont fait de mieux a été dit en grec ». L'Antiquité n'a pas fini de proposer son modèle à la pensée, à la langue, comme aux rapports humains. C'est ainsi qu'un long essai sur Pindare précède le roman de La Nouvelle Eurydice qui déplace et renouvelle l'aventure d'Orphée dans un cadre contemporain ; modernisation du mythe que l'on retrouvera dans les poèmes de Feux, puis dans l'œuvre dramatique qui met en scène Alceste, Électre ou le Minotaure. Cette préférence a ses raisons. Le mythe n'a pas seulement une valeur esthétique, il véhicule une métaphysique de l'existence ; l'égale sensibilité à l'humain et au divin, le sens du tragique, l'importance de la lucidité, la valeur accordée à certaines formes de relation amoureuse mal tolérées ailleurs forment autant de thèmes que développera l'œuvre de Marguerite Yourcenar.
L'humain et le divin
C'est à l'empereur Hadrien que la romancière fait dire qu'il a lutté pour « favoriser le sens du divin dans l'homme, sans pourtant y sacrifier l'humain. Les Mémoires, présentés sous la forme d'une lettre fictive adressée au futur Marc Aurèle, sont écrits par l'empereur vieillissant, au seuil de la mort. Entamée pour l'informer des progrès de sa maladie, puis devenue délassement, cette lettre se transforme en examen de soi-même et bilan d'une existence féconde de chef d'État, d'administrateur, de militaire, de bâtisseur de villes et de murailles. Civilisateur, pacificateur, mais aussi philosophe, esprit ouvert aux sciences, à la magie, aux mystères religieux. Dès avant sa divinisation posthume, selon l'habitude de Rome à l'égard des Césars, cette apothéose de l'Empire, la multitude des tâches accomplies peuvent donner à l'homme le sentiment d'être Dieu. Rayonnement solaire du pouvoir bien exercé, même si par ailleurs les ombres du règne, les maladies du corps, l'emportement des passions, le suicide d'Antinoüs restituent l'empereur au monde humain.
La méditation sur le pouvoir du corps et des forces vivantes, sur le mystère de l'amour, du sommeil, des émotions rattache le personnage d'Hadrien à celui, fictif, du Zénon de L'Œuvre au noir. Philosophe, médecin et alchimiste, promenant ses curiosités et ses incertitudes à travers l'Europe du XVIe siècle, Zénon emprunte la plupart de ses traits à des personnalités authentiques, Paracelse, Érasme, Michel Servet, Ambroise Paré, Léonard de Vinci, Vésale, Campanella. La narration le suit de sa naissance illégitime à Bruges jusqu'à son suicide dans une prison de cette même ville, cinquante ans plus tard, traversant dans l'intervalle les événements marquants de l'époque. L'intérêt du XVIe siècle tient notamment à la saisie critique des rapports de l'homme au divin et à l'humain qui s'accomplit dans cette période : crises religieuses, hérésies diverses, écartèlements des esprits scientifiques entre deux voies, celle de l'empirisme matérialiste, et celle du panthéisme ou de l'hermétisme mystique des alchimistes. Ce que revendique le jeune Zénon : Il s'agit pour moi d'être plus qu'un homme, se transformera peu à peu en analyse et approfondissement de l'humain. Cette transformation des croyances et des habitudes mentales héritées des sciences antiques et de la théologie médiévale devient un équivalent symbolique de l'œuvre au noir, expérience alchimique de la dissolution des formes ; il s'agit bien en effet pour l'esprit d'une mort philosophique où vacillent toutes les anciennes structures et où se solidifient, en précipité calciné, les premières découvertes et les inquiétudes d'un esprit libre, même si le corps est promis au bûcher.
Lucidité et passion
Ce balancement entre le divin et l'humain se retrouve dans le difficile équilibre entre le goût pour la connaissance et les séductions de la chair. L'effort de lucidité d'Hadrien Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts se retrouve chez Zénon mais aussi dans les confessions d'Alexis ou d'Eric von Lhomond, le narrateur du Coup de grâce. Les difficultés rencontrées n'entravent pas seulement la démarche d'analyse, elles sont même un obstacle pour le langage : Le problème de la liberté sensuelle sous toutes ses formes est en grande partie un problème de liberté d'expression, écrit Marguerite Yourcenar dans la préface d'Alexis. Les susceptibilités et les interdits concernant la relation amoureuse touchent également la possibilité d'en parler. L'alternance de l'écrivain, dans la première partie de son œuvre, entre deux styles, celui de l'expressionnisme baroque, manière tendue et ornée, dont Feux donne une certaine image, et celui du récit classique tout en litotes, manifeste le désir de résoudre la difficulté. À cela, en effet, l'écriture peut apporter une solution, dans une langue progressivement dépouillée, à la fois circonspecte et précise, animée par le ferme propos de concilier sans bassesse l'esprit et la chair ; style de l'examen de conscience qui, comme elle le dit, réalise un compromis entre l'effort de clarté et l'épreuve de la passion. Le thème de la relation homosexuelle et de sa difficile expression développé par Alexis et par Eric devient ainsi chez Hadrien puis Zénon une tentative plus générale de sonder les mystères essentiels de l'esprit et du corps. L'écriture reflète alors cette tâche d'élucidation que, à travers les crises de l'érotisme, de la connaissance ou de la religion, les personnages de Marguerite Yourcenar s'efforcent d'accomplir. L'entreprise est en effet la même lorsqu'il s'agit de comprendre Piranèse ou Pindare, de traduire H. James, de scruter l'opacité des sentiments, celle des corps, ou celle du passé, qu'il soit historique, familial ou mythique.
Fin de vie
En 1939, dix ans après la mort de son père, l'Europe s'agite dangereusement. Marguerite Yourcenar part pour les États-Unis rejoindre Grace Frick, alors professeur de littérature britannique à New York et sa compagne depuis une rencontre fortuite à Paris en 19376. Les deux femmes vécurent ensemble jusqu'à la mort de Frick d'un cancer en 1979.
Elles s'installent à partir de 1950 sur l'île des Monts Déserts Mount Desert Island, dans le Maine, qu'elles avaient découverte ensemble en 1942, et nomment leur maison Petite-Plaisance. Yourcenar y passera le reste de sa vie ; citoyenne américaine en 1947, elle enseigne la littérature française et l'histoire de l'art jusqu'en 1953.
Sur la plaque funéraire de Marguerite Yourcenar. L'épitaphe est tirée de L'Œuvre au noir : Plaise à Celui qui Est peut-être de dilater le cœur de l'homme à la mesure de toute la vie.
Son roman Mémoires d'Hadrien, en 1951, connaît un succès mondial et lui vaut le statut définitif d'écrivain, consacré en 1970 par son élection à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, et dix ans plus tard, par son entrée à l'Académie française, grâce au soutien actif de l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson.
Des romans historiques aux mémoires autobiographiques, l'œuvre de Yourcenar s'inscrit en marge du courant engagé de son époque et se caractérise d'abord par sa langue, au style épuré et classique, et aussi par son esthétisme et le désir d'affirmer la finalité de la littérature : la narration. Inspirée par la sagesse orientale, et surtout par la philosophie gréco-latine, la pensée de l'écrivain ne s'est jamais éloignée de l'humanisme de la Renaissance :
Yourcenar est la première femme à siéger à l'Académie française. Elle dit avoir longtemps hésité, pour le choix de son sujet, entre l'empereur Hadrien et le mathématicien-philosophe Omar Khayyam. Sa vie se partage entre l'écriture dans l'isolement de l'île des Monts-Déserts et de longs voyages, parmi lesquels des périples autour du monde avec Jerry Wilson, son dernier secrétaire et compagnon dont les photographies en couleur illustreront La Voix des Choses, choix de textes par l'écrivain.
Elle meurt le 17 décembre 1987 à Bar Harbor et ses cendres ont été déposées au cimetière Brookside à Somesville, un des villages de Mount Desert, à côté de la petite maison en rondins qu’elle avait louée avec Frick pendant les trois premiers étés du couple dans le Maine.
"Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même : mes premières patries ont été les livres. "
— Mémoires d'Hadrien
Yourcenar lisait couramment le grec ancien et le latin et connaissait parfaitement les textes antiques. Pour la rédaction des Mémoires d'Hadrien, elle s'obligea à lire ou relire tous les textes majeurs de l'époque d'Hadrien8.
Son abondante correspondance a été publiée partiellement sous le titre Lettres à des amis et quelques autres Gallimard, 1995 puis par ce même éditeur trois volumes parus à ce jour pour 1951 à 1963.
Œuvres
1921 : Le Jardin des chimères poésie ;
1922 : Les dieux ne sont pas morts poésie ;
1929 : Alexis ou le Traité du vain combat roman, publié au Sans Pareil ;
1931 : La Nouvelle Eurydice roman ;
1932 : Pindare essai ;
1934 : Denier du rêve roma) ;
1934 : La mort conduit l'attelage ;
1936 : Feux poèmes en prose ;
1937 : Les Vagues, de Virginia Woolf traduction ;
1938 : Les Songes et les Sorts ;
1938 : Nouvelles orientales, nouvelles ;
1939 : Le Coup de grâce roman;
1947 : Ce que savait Maisie, d'Henry James traduction ;
1951 : Mémoires d'Hadrien roman ;
1954 : Électre ou la Chute des masques ;
1956 : Les Charités d'Alcippe La Flûte enchantée, Liège, poésies ;
1958 : Présentation critique de Constantin Cavafy 1863-1933, suivie d'une traduction intégrale des ses poèmes poésie, traduction;
1962 : Sous bénéfice d'inventaire essai ;
1962 : Ah, mon beau château étude historique sur le château de Chenonceau, repris sous forme de guide touristique en 1975 ?;
1963 : Le Mystère d'Alceste théâtre ;
1963 : Qui n'a pas son Minotaure ? ;
1964 : Hortense Flexner, suivi de poèmes choisis poésie, essai, traduction ;
1964 : Fleuve profond, sombre rivière poésie, traduction de negro spirituals ;
1968 : L'Œuvre au noir roman ;
1969 : Présentation critique d'Hortense Flexner, choix de poèmes traduction ;
1971 : Réception de Madame Marguerite Yourcenar à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique - Discours de M. Carlo Bronne et de Mme Marguerite Yourcenar discours ;
1971 : Théâtre I Rendre à césar, la Petite Sirène et le Dialogue dans le marécage, théâtre;
1972 : Entretiens Marguerite Yourcenar et Patrick de Rosbo entretien ;
1974 : Le Labyrinthe du monde. I, Souvenirs pieux récit ;
1977 : Le Labyrinthe du monde. II, Archives du Nord récit ;
1979 : La Couronne et la Lyre anthologie de poèmes traduits du grec ancien ;
1980 : Les Yeux ouverts : entretiens avec Marguerite Yourcenar de Matthieu Galey entretiens ;
Comment Wang-Fô fut sauvé.
1980 : Mishima ou la Vision du vide, Gallimard, essai ;
1981 : Discours de réception de Madame Marguerite Yourcenar à l'Académie française et réponse de Monsieur Jean d'Ormesson discours ;
1982 : Comme l'eau qui coule Anna, soror…, Un homme obscur, Une belle matinée ;
1982 : Œuvres romanesques pléiade ;
1982 : ... Si nous voulons encore essayer de sauver la Terre conférence ;
1982 : Sur quelques thèmes érotiques et mystiques de la Gita-Govinda - L'Andalousie ou les Hespérides essai ;
1983 : Le Coin des "Amen" de James Baldwin traduction ;
1983 : Le Temps, ce grand sculpteur
1984 : Blues et Gospels poésie, traduction ;
1984 : Cinq Nô moderne de Yukio Mishima traduction ;
1984 : Les Charités d'Alcippe, poème;
1985 : Le Cheval noir à tête blanche conte indien ;
1987 : La Voix des choses recueil de textes illustré de photos de Jerry Wilson ;
1988 : Le Labyrinthe du monde. III : Quoi ? L'Éternité récit ;
1988 : Les Trente-Trois Noms de Dieu-Le Livre d'Adresse essai d'un journal suivi par poésie;
1989 : En pèlerin et en étranger essai ;
1991 : Le Tour de la prison essai, voyages ;
1991 : Essais et Mémoires Pléiade ;
1992 : Écrit dans un jardin poème illustré par Pierre Albuisson ;
1993 : Conte bleu - Le Premier soir - Maléfice contes ;
1994 : Poèmes à la nuit, de Rainer Maria Rilke poésie, avec une préface de M. Yourcenar ;
1995 : Lettres à ses amis et quelques autres correspondance ;
1999 : Radioscopie de Jacques Chancel avec Marguerite Yourcenar' entretien ;
1999 : Sources II essai ;
1999 : Marguerite Yourcenar : Entretiens avec des Belges entretiens ;
2002 : Portrait d'une voix entretiens;
2004 : D'Hadrien à Zénon - Correspondance 1951-1956 ;
2007 : Une volonté sans fléchissement - Correspondance 1957-1960 ;
2008 : Marguerite Yourcenar en questions questionnaire ;
2011 : Persévérer dans l'être - Correspondance 1961-1963.
Études biographiques
1990 : Josyane Savigneau, Marguerite Yourcenar : l'invention d'une vie Gallimard, 1990;.
1995 : Michèle Sarde, Vous, Marguerite Yourcenar : la passion et ses masques Laffont, 1995;
1998 : Michèle Goslar, Yourcenar. Qu'il eût été fade d'être heureux Bruxelles, Racine, 1998;
Études sur l'œuvre
Il existe plusieurs milliers d'études sur l'œuvre de Marguerite Yourcenar, disponibles dans les bibliothèques des associations yourcenariennes.
2002 : La Promesse du seuil : un voyage avec Marguerite Yourcenar de Christian Dumais-Lvowski, photographies de Saddri Derradji, coll. Archives privées Actes Sud;
2008 : Marguerite Yourcenar : itinéraire d'un écrivain solitaire, de Antoine Gavory, Flagrant d'élie
1980 : Marguerite Yourcenar Blot, Jean Blot éditions Seghers;
Roman, histoire et mythe dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar, actes du colloque d’Anvers mais 1990, Simone et Maurice Delcroix éditions Tours, 524 pages, 1995;
Patrick de Rosbo, Entretiens radiophoniques avec Marguerite Yourcenar Mercure de France, 1972-1980;
Philippe Dasnoy, Dans l’île du Mont-Désert chez Marguerite Yourcenar, documentaire de Philippe Dasnoy et Jean Antoine, diffusé en avril 1975;
Les yeux ouverts, entretiens avec Mathieu Galey éditions Le Centurion Les interviews, 1980.
Bérengère Deprez, Marguerite Yourcenar et les États-Unis. Du nageur à la vague, Éditions Racine, 2012, 192 p.
Bérengère Deprez, Marguerite Yourcenar and the United States. From Prophecy to Protest, Peter Lang, coll. Yourcenar, 2009, 180 p.
Bérengère Deprez, Marguerite Yourcenar. Écriture, maternité, démiurgie, essai, Bruxelles, Archives et musée de la littérature/PIE-Peter Lang, coll. Documents pour l’histoire des francophonies, 2003, 330 p.
Donata Spadaro, Marguerite Yourcenar et l'écriture autobiographique : Le Labyrinthe du monde, bull. SIEY, no 17, décembre 1996, p. 69 à 83
La Fondation Marguerite Yourcenar
La Fondation Marguerite Yourcenar, sous l'égide de la Fondation de France fut créée en 1982, à l'initiative de Marguerite Yourcenar. Cette fondation a pour but de protéger la faune et la flore sauvages, et a contribué à la création d'une réserve naturelle dans les Monts de Flandre.
Autres actions
Le 24 février 1968, Marguerite Yourcenar écrit à Brigitte Bardot la lettre qui informera celle-ci de la cruauté du massacre des bébés phoques au Canada, et qui déclenchera par ce truchement une campagne mondiale de plusieurs années.
Articles connexes
Famille de Crayencour
Georges de Crayencour
Stéphanie Crayencour
Michèle Goslar
Femmes à l'Académie française
Villa Marguerite Yourcenar
Musée Marguerite Yourcenar
Liens
http://youtu.be/WUKgVUYmZvc Interview avec Pivot
http://youtu.be/PXEDqpavTU8 Marguerite Yourcenar par de Mishima
http://youtu.be/UXv923PTlJU Yourcenar parle de L'oeuvre au noir
http://youtu.be/F0N3EofaqkM La condition féminine 1
http://youtu.be/EH70vjRo1OQ La condition féminine 2
http://youtu.be/-jAOK0vdoUE La condition féminine 3
http://youtu.be/ovp90NAgkTs Yourcenar Le paradoxe de l'écrivain 1
http://youtu.be/HxL3unhjbcA Yourcenar Le paradoxe de l'écrivain 2
http://youtu.be/n0hGqdoZXQE le paradoxe de l'écrivain 3
http://youtu.be/-Ic1Cc0t7uc La mythologie des animaux    [img width=600]http://photos.lavoix.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=103987&g2_serialNumber=3[/img] [img width=6$00]http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1004109-Marguerite_Yourcenar.jpg[/img]      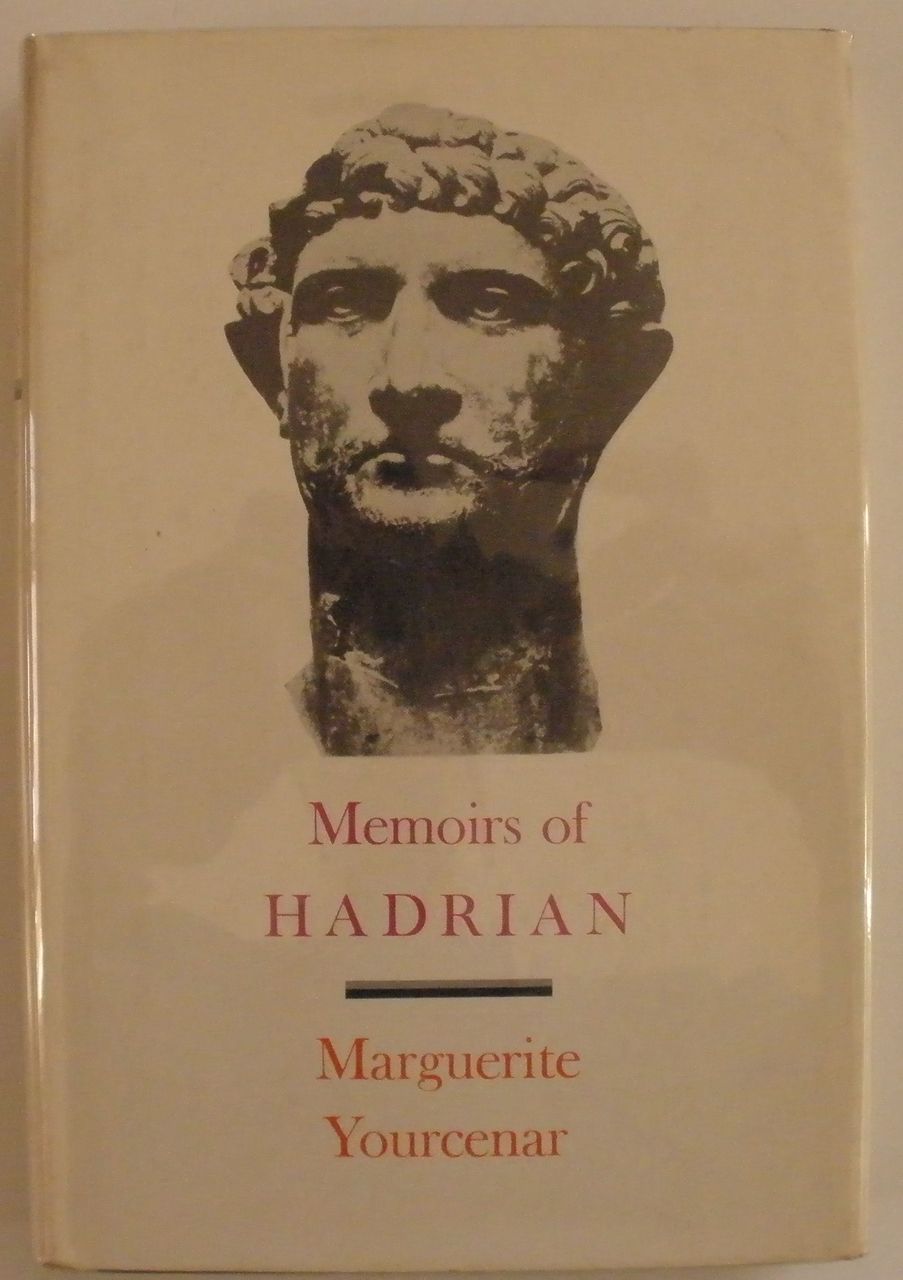  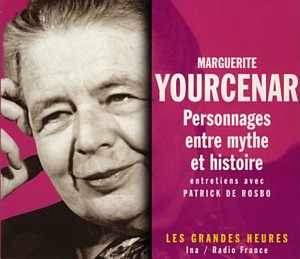  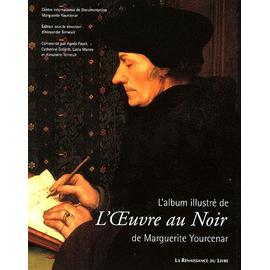  
Posté le : 07/06/2014 23:12
|
|
|
|
|
Honoré d'Urfé |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Le 1er juin 1625 à Villefranche-sur-Mer, à 58 ans meurt Honoré d'Urfé,
comte de Châteauneuf, marquis du Valromey, seigneur de Virieu-le-Grand, écrivain français et savoisien, auteur du premier roman-fleuve de la littérature française, L'Astrée, né le 11 Février 1567 à Marseille
Après avoir soutenu la Ligue, il gagna la confiance d'Henri IV et entreprit, tout en poursuivant une vie aventureuse, la composition de l'Astrée, roman mêlé de prose et de vers, dont l'influence fut considérable sur le goût de la société cultivée de la première moitié du XVIIe s. On lui doit également un poème pastoral : Sireine de messire, et des Épîtres morales.
Il laisse inachevé le livre qui l'a rendu célèbre, L'Astrée, dont la première partie avait paru en 1607. Roman pastoral, roman d'aventure, roman psychologique, cette longue épopée amoureuse raconte peut-être, comme l'a prétendu d'Urfé lui-même, son amour pour sa belle-sœur Diane. Les très complexes aventures du berger Céladon et de la bergère Astrée, qui finiront par un mariage, les évolutions de ces innombrables bergers, galants et philosophes, qui analysent interminablement sous les châtaigniers du Forez les moindres nuances et délicatesses de l'amour idéal, conçu comme une passion poétique, mélancolique et parfaite — tout cela peut sembler aujourd'hui pratiquement illisible. Mais ce roman, qui est véritablement le premier roman sentimental, a exercé une influence profonde tant sur la littérature classique, dont il est à l'origine, que sur les mœurs de l'époque, encore extrêmement grossières :
L'Astrée fournissait aux lecteurs du XVIIe siècle, fatigués des romans de chevalerie et aspirant à la peinture d'une existence tendre et tranquille, une sorte de code de l'amour et de la civilité où l'amour honnête, fondé sur l'estime et la morale, était réhabilité et où étaient proposées des valeurs nouvelles comme la fidélité, la discrétion, la décence, la patience, la maîtrise de soi. Le succès de L'Astrée fut immense et La Fontaine, qui en tira un médiocre opéra, pouvait dire : Étant petit garçon, je lisais son roman... Et je le lis encore ayant la barbe grise.
Sa vie
Né à Marseille dans une famille noble originaire du Forez, son père Jacques, est issu d'une ancienne famille du Forez, fils d'un ambassadeur en Italie et gouverneur des enfants d'Henri II, avait épousé Renée de Savoie-Tende, Honoré d'Urfé est apparenté à la Maison ducale de Savoie par sa mère, Renée de Savoie-Tende, venue alors à Marignane pour traiter de ses affaires avec Françoise de Foix, son oncle est gouverneur de la Provence. Honoré d'Urfé fait ses études chez les jésuites, au château de la Bastie en Forez, puis à Paris au collège de Tournon.
Encore tout jeune homme, il prend parti pour la Ligue catholique et demeurera fidèle au duc de Nemours, chef du mouvement dans sa province, même après que la Ligue aura été défaite.
Le 2 décembre 1592, le duc de Nemours prend Montbrison actuellement dans le département de la Loire. Honoré se remet alors au service du duc et rompt avec Anne d’Urfé, bailli de Forez, qui tente dès lors de pacifier la province.
Arrêté à deux reprises, d'Urfé doit quitter la France et trouve refuge en Savoie.
C'est là qu'il compose Sireine, un poème pastoral, publié en 1604, qui est une allégorie de ses amours, et des Épîtres nouvelles, où d'Urfé développe, dans une prose à la fois érudite et encombrée, une théorie platonicienne de l'amour.
À sa sortie de prison, le 26 juillet 1594, Nemours nomme Honoré lieutenant-général au gouvernement de Forez
Dès sa première jeunesse d'Urfé s'est épris de sa belle-sœur, Diane de Chateaumorand, l'épouse de son frère aîné. Lorsque ce mariage est dissous, Honoré, était déjà entré par désespoir et avant l'âge dans l'ordre des Chevaliers de Malte.
En 1600, le 15 février, Honoré revient au Forez pour épouser Diane de Châteaumorand, sa belle-sœur, après l'annulation de son mariage avec Anne d'Urfé. On voit aujourd'hui dans cette union moins le triomphe d'une passion contenue pendant dix-huit ans qu'un froid calcul économique
Mais cette union ne s'avère pas très heureuse, et ils se séparent bientôt, sans toutefois cesser de se voir et sans que les raisons de leur décision soient connues avec exactitude. Attaché au service du duc de Savoie, d'Urfé, qui est un homme d'action, partage son temps entre le Forez et la Savoie, où il fréquente ses amis François de Sales et Camus.
Puis il rentra peu à peu en grâce auprès de la cour de France : en 1603, il devint gentilhomme ordinaire d'Henri IV, en même temps qu'il publiait le second volume de ses Épîtres morales le premier avait paru en 1595, qu'il augmenta en 1608 et 1619.
Auteur d'un poème pastoral, sans doute écrit vers 1604, La Sireine, il défend sa vision de l'amour dans les Épîtres morales en 1603. Il conçoit avec la femme aimée une relation délicate et respectueuse dans une époque où la place de la femmes et son importance était des plus rustre.
Il fonde, vers 1606/1607, avec ses amis Antoine Favre, François de Sales et Claude Favre de Vaugelas, l'Académie florimontane, la première société savante de Savoie.
Il est surtout connu pour son roman précieux L'Astrée, roman d'amour en partie autobiographique paru entre 1607 et 1633.
Cette œuvre inachevée, publiée en quatre parties entre 1607 et 1627, s'inscrit dans la tradition des romans hellénistiques, de Virgile et des poètes courtois.
L'Astrée comporte plus de 5 000 pages, soit cinq parties divisées chacune en 12 livres.
Les trois premières parties sont publiées en 1607, 1610, et 1619, et, lorsque Urfé meurt en 1625, son secrétaire Balthazar Baro aurait achevé la quatrième partie et lui aurait donné une suite 1632-1633.
Selon Larousse en 1863, les cinquième et sixième parties auraient été composées par Pierre Boitel, sieur de Gaubertin, et éditées en 1626.
C'est l'un des plus considérables succès du siècle, qui n'aura pas de postérité véritable dans le genre du roman pastoral, mais une influence considérable sur le roman, le théâtre (Molière), l'opéra et les mentalités.
L'impact de ce roman se fait encore sentir aujourd'hui, puisque les porcelaines à glaçure verte, à l'origine venant de Chine et de Corée, sont encore appelées céladons de nos jours, en souvenir du nom du second personnage de ce roman, lequel était toujours en habits ornés de rubans vert tendre.
Cette influence s'exerce aussi dans le monde anglo-saxon.
Les épisodes de ce roman d'amour ont été nourris des quelques années passées en région forézienne, où la famille d'Urfé, installée vers l'an 1000 au-dessus de Champoly, avait construit dans la plaine du Lignon du Forez le Château de la Bastie d'Urfé, le premier des châteaux dits Renaissance.
Il a également laissé un recueil de poèmes, la Savoysiade 1609, une pastorale en cinq actes, La Sylvanire ou la Morte-vive 1625.
Une citation célèbre de ce lettré et esthète forézien, perdure chez les gens d'esprit :
Dieu, en créant les femmes, nous les a proposées en terre pour nous attirer par elles au ciel.
Il participe à plusieurs expéditions militaires, et c'est au cours d'une campagne menée par le duc de Savoie contre la république de Gênes que d'Urfé trouve la mort à Villefranche-sur-Mer, au cours d'une campagne militaire, en 1625, au cours de laquelle il mène les troupes savoyardes du duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie contre les Espagnols.
Son Œuvre
En 1607 paraît la première partie de l'Astrée ; deux autres sont publiées en 1610 et en 1619 ; la quatrième, complétée par son secrétaire, Baro, en 1627-1628 ; la cinquième, du seul Baro, en 1628. Ce roman pastoral retrace les amours contrariées puis triomphantes du berger Céladon et de la bergère Astrée.
La finesse des analyses psychologiques, la pureté et l'élégance de la prose avec de nombreux poèmes insérés, le refus du réel grossier au profit d'un rêve arcadien font de ce livre une des œuvres les plus significatives du genre. Dans une démarche à la fois lyrique et pédagogique, d'Urfé montre, à l'aide de nombreuses histoires insérées, selon quelles formes diverses se manifeste l'émotion amoureuse, et à quelles formes idéales elle doit tendre : l'amour n'échappe ni à la fatalité, ni à l'héroïsme, ni aux intermittences du cœur, mais, dans sa pleine expression, il est soumission absolue et rêve de fusion totale. Exploration du sentiment dans ses labyrinthes et dans ses confusions, l'Astrée fut lu et goûté durant tout le XVIIe s.
La Fontaine proclame pour lui son admiration comme un bréviaire de l'amour précieux ; mais, au-delà, le lettré érudit qu'était d'Urfé y développait une véritable métaphysique, et des thèses empruntées au néoplatonisme il cite Plotin, Léon l'Hébreu, Marsile Ficin, tout en témoignant pour la nature apaisée du Forez ou les paysages grandioses de la Savoie une sensibilité rare à son époque. On doit aussi à Honoré d'Urfé un recueil poétique la Savoysiade, 1609 et une fable bocagère, la Sylvanire ou la Morte vive, 1625.
Page de garde d'une édition de L'Astrée du XVIIe siècle.
La Triomphante Entrée de Magdeleine de La Rochefoucaud à Tournon, 1583 Texte en ligne
Épîtres morales, 1603 Texte en ligne
La Sireine, 1604 Texte en ligne
L'Astrée, 1607 Texte en ligne : parties I à III
La Savoysiade, 1609
Paraphrases sur les cantiques de Salomon, 1618
La Sylvanire ou la Morte-vive, 1625 Texte en ligne : pdf mode texte
Liens
http://youtu.be/4dGAQtzm8NsLa romance d'Astrée et de Céladon
    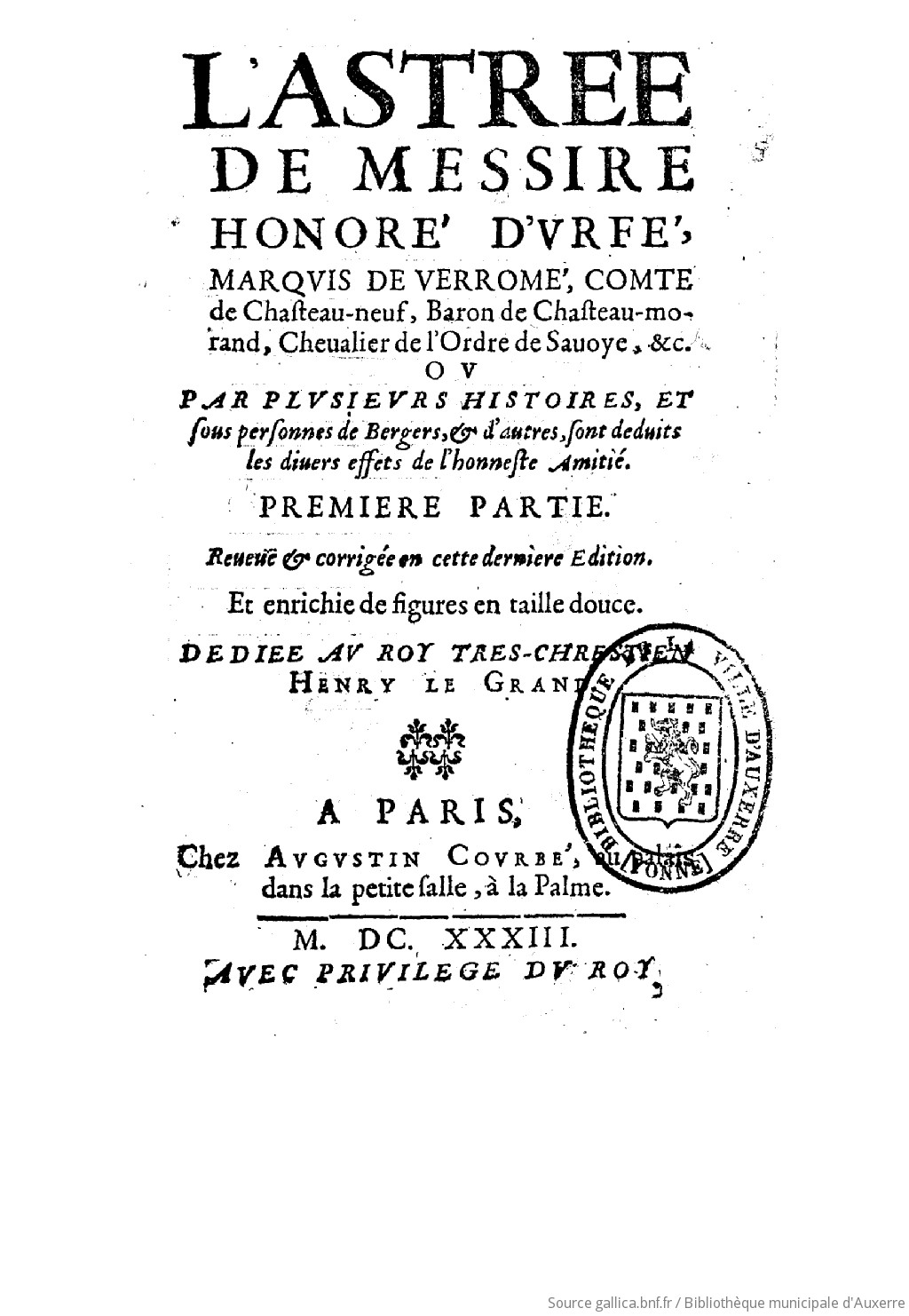      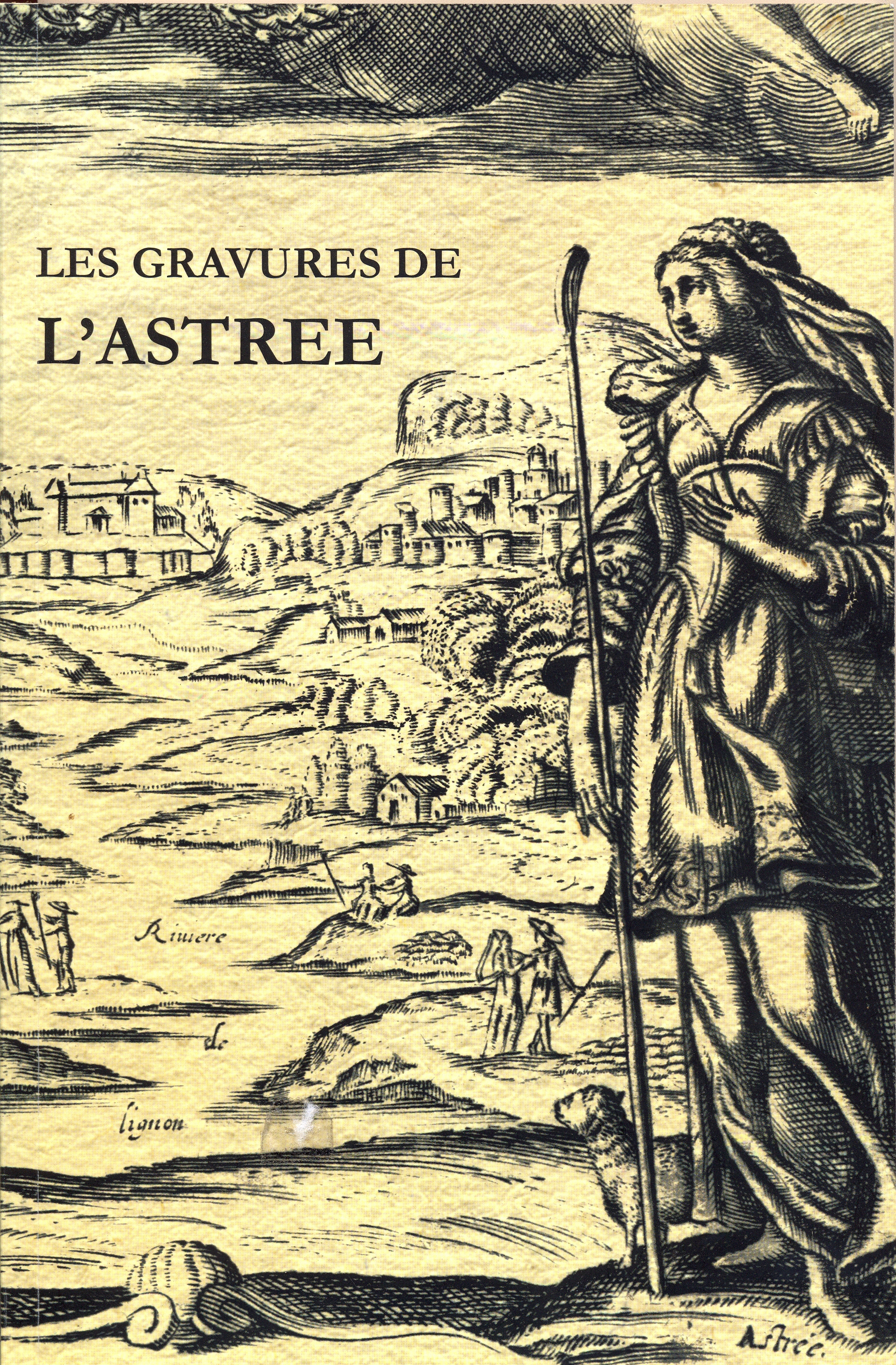 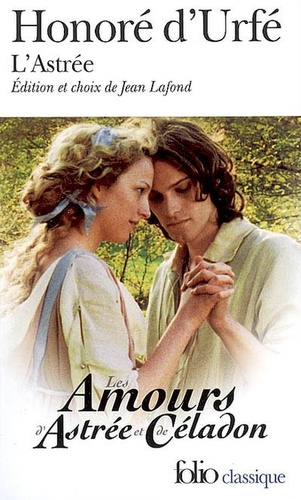 [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Page_de_garde_d'une_%C3%A9dition_de_L'Astr%C3%A9e_du_XVIIe_si%C3%A8cle.jpg[/img] 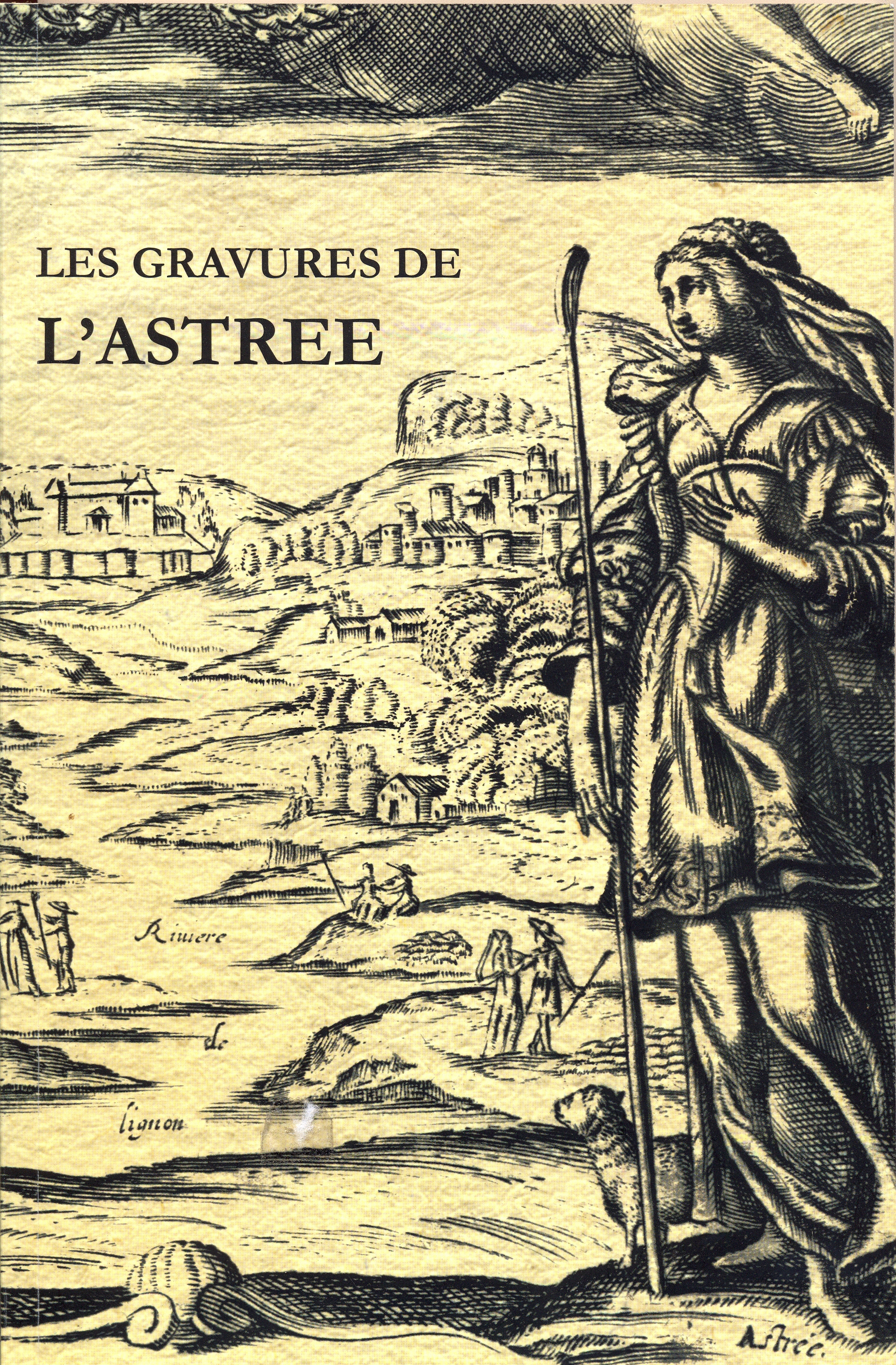
Posté le : 01/06/2014 17:13
|
|
|
|
|
Patrick Besson |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Le 1er juin 1956 à Paris 19 éme naît Patrick Besson,
écrivain et journaliste français, ses Œuvres principales sont "Dara" et " Les Braban"
Né d'un père russe d'origine juive et d'une mère monarchiste croate, Patrick Besson publie en 1974, à l'âge de dix-sept ans, son premier roman, Les Petits Maux d'amour.
Tout d'abord sympathisant communiste, il est chroniqueur littéraire au journal L'Humanité. Il collaborera ensuite à VSD, au Figaro, au Figaro Magazine, au Point à Voici et à Marianne tout en se déclarant toujours comme un communiste non pratiquant.
Il est depuis 2000 membre du jury du Prix Renaudot. Le 5 décembre 2012, il est décoré de la Médaille du drapeau serbe par Tomislav Nikolić.
Polémiques
En 2003, il publie un recueil d’interviews qu’il a menés pour le magazine Voici et intitule son livre La Cause du People aux éditions Fayard.
Il écrit également 28, Boulevard Aristide Briand, ouvrage dans lequel il raconte ses premières années à Montreuil.
Parmi ses titres les plus connus, on trouve notamment La Vie quotidienne de Patrick Besson sous le règne de François Mitterrand, à travers lequel il exprime sa déception vis-à-vis de la politique de Mitterrand, qu’il ne juge pas suffisamment socialiste ou encore Un Etat d’esprit, récit de ses débuts de romancier, avec ses joies, ses peines et ses expériences de jeunesse.
Habitué des critiques littéraires acerbes et des polémiques publiques, Patrick Besson a également collaboré au journal L'Idiot international, de Jean-Edern Hallier.
provocateur prolixe, il méprise ouvertement le milieu littéraire parisien et les écrivains qui ne savent pas écrire, tout en assumant parfaitement son statut de 'faux people'.
Il aime à passer pour un vieux con, donne des leçons à qui ne veut pas les entendre, refuse la 'révolte consensuelle' et la 'subversion doudou', passe son temps à lire, encourage les jeunes auteurs talentueux. Il publie en 2003 chez Fayard 'La Cause du people', un recueil d'interviews réalisées pour le tabloïd Voici et en 2006 'La Vie quotidienne de Patrick Besson sous le règne de François Mitterrand'.
Personnage à part entière, Patrick Besson a publié une quarantaine d'ouvrages chez quatorze éditeurs différents, alors que sa plume redoutée ne cesse de parcourir les pages des journaux et magazines.
Connu pour son tempérament de provocateur redouté, cynique et à l’humour grinçant, Patrick Besson est aussi et surtout un écrivain créateur d’une bibliographie de près de quarante titres.
Sa vie d’infatigable donneur de leçons commence en 1956, année où il voit le jour dans le XIXème arrondissement de Paris, d’un père russe et d’une mère croate. C’est dans cet arrondissement qu’il chérit encore aujourd’hui avec nostalgie, qu’il a développé durant sa jeunesse des idées communistes.
En 1985, il se voit décerner le Grand Prix du Roman de l’Académie Française pour son livre Dara, où il raconte l’histoire d’une Serbe ayant trouvé refuge en Italie après avoir fui sa Yougoslavie natale à l’arrivée de Tito au pouvoir.
Une dizaine d’année plus tard, il écrit Les Braban qui lui vaut le Prix Renaudot, dont il intégrera le jury en 2000.
Mais avant cela, il affûtera ses armes ou plutôt sa plume, même si dans son cas la différence est difficile à cerner, en travaillant pour plusieurs magazines tels que l’Humanité, Le Figaro, Voici, Marianne ou Le Point.
En défenseur inconditionnel de la Serbie, Patrick Besson n’hésite pas à monter au créneau durant la guerre qui secoue la région des Balkans en publiant Contre les calomniateurs de la Serbie. Ouvrage qui suscite d’ailleurs de vives réactions de la part de nombreux écrivains, dont le romancier et scénariste Didier Daeninckx, qui a droit a des représailles cinglantes avec la parution du livre pamphlétaire « Didier dénonce ».
Durant les guerres de Yougoslavie, Patrick Besson a soutenu la Serbie, en publiant notamment le livre Contre les calomniateurs de la Serbie, ce qui lui a valu des polémiques avec d'autres intellectuels de gauche comme Michel Polac, Romain Goupil et Didier Daeninckx. Attaqué par ce dernier, il lui a consacré un pamphlet en forme de roman, intitulé Didier dénonce éditions Gérard de Villiers.
Une chronique parue dans Le Point, début décembre 2011, critique Eva Joly, candidate de Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, en appuyant sur son origine étrangère et son accent. Cette chronique suscite de vives critiques de la classe politique et d'associations antiracistes.
Prêtant le flanc aux critiques les plus virulentes de la part de certains de ses pairs, il avoue se sentir très à l’aise dans ce rôle d’agitateur-polémiste. Il fait fréquemment part de son mépris pour la classe mondaine et intellectuelle parisienne, bien qu’il en fasse tout de même partie, mais apporte néanmoins son soutien indéfectible à de jeunes écrivains dont il apprécie le talent. Et Frédéric Beigbeder fait partie de ceux-là.
Patrick Besson reconnaît volontiers qu’il fredonne des chansons d’Eminem de temps à autre, ce qui pourrait étonner pour un quinquagénaire, mais qui surprend beaucoup moins lorsque l’on prend la peine de connaître davantage sa personnalité, à la fois faite de cynisme glacial et d’une sensibilité palpable en totale contradiction avec le reste de son caractère. A l’image du jeune rappeur de Detroit.
Il ne cache pas non plus la vie débridée qu’il mène, avec ses sorties nocturnes, les innombrables liaisons qu’on lui prête et sa phobie du travail.
À côté des chansons acides d’Eminem, Besson aime surtout se perdre dans les mélodies enivrantes de Maxime Chostakovitch, chef d’orchestre et pianiste russe. Il confie également qu’il est un grand admirateur de l’écrivain Gérard de Nerval, et garde toujours un exemplaire de Sylvie à portée de main.
Sa personnalité ambiguë s’exprime très clairement à travers ses premiers romans L'Ecole des absents, La Maison du jeune homme seul ou encore Vous n’auriez pas vu ma chaîne en or, où les personnages décrits lui ressemblent aussi bien par leur apparente aigreur que par leur poignante humanité.
Ses derniers romans de 2009 à 2013 évoquent tour à tour l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine et il publie en 2012 un récit autobiographique, Les jours intimes, où il narre sa relation père-fils mais aussi la rencontre avec sa femme d’origine suédoise.
En mai 2012, il est à l’origine d’une vaste polémique suite à la publication d’un papier du Point dans lequel il parle de Najat Vallaud-Belkacem comme d'une "ingénue libertaire", de Fleur Pellerin comme une "geisha intellectuelle" ou de Christiane Taubira comme un "tanagra guyanais".
En septembre 2012, une chronique parue dans Le Point s'en prend à Annie Ernaux pour avoir dirigé ce que Patrick Kéchichian nomme un appel collectif à l'encontre d'un seul homme, Richard Millet, et surtout une liste exhaustive de dénonciateurs qui restera dans l'histoire des lettres françaises comme la liste Ernaux. Il qualifie par ailleurs Annie Ernaux d'écrivain lamentable
Après avoir enflammé la twittosphère et le monde de gauche avec ces mots sur les femmes du Gouvernement, l’association des Chiennes de Garde a désigné l’éditorialiste Premier Dauphin du Prix du Macho de l’année 2013.
Œuvres
1974 : Les Petits Maux d'amour, Seuil
1976 : L'École des absents, Seuil
1979 : La Maison du jeune homme seul, Hachette
1983 : La Boum, avec Danièle Thompson, J'ai Lu
1985 : Dara, éditions du Seuil
1986 : La Chute de Saïgon : Théâtre, Messidor
1988 : Lettres d'Europe, avec (France) Symposium international sur l'identité culturelle européenne (1988), Albin Michel
1988 : La Statue du commandeur, Albin Michel
1989 : Ah ! Berlin et Autres récits, Gallimard
1989 : Un peu d'humanité, Messidor
1990 : Divers gauche, Messidor
1990 : La Paresseuse, Albin Michel
1990 : Le congrès de Tours n'aura pas, édition Messidor
1991 : Les Années Isabelle, éditions du Rocher ; réédition en 2010, Paris : Mille et une Nuits
1991 : Rot coco, R. Deforges
1991 : Les ai-je bien descendus ?, Messidor
1991 : Je sais des histoires, éditions du Rocher
1991 : Le Plateau télé
1992 : Julius et Isaac, Albin Michel
1993 : Le Deuxième Couteau, éditions Christophe Barrault
1993 : La Femme riche, Albin Michel
1993 : Le Viol de Mike Tyson, Scandéditions
1993 : L'Argent du parti, Le Temps des cerises
1993 : Pas trop près de l'écran, avec Éric Neuhoff, éditions du Rocher
1994 : Souvenir d'une galaxie dite nationale-bolchevique, éditions du Rocher
1995 : Les Braban, éditions Albin Michel
1996 : Sonnet pour Florence Rey et autres textes, L'Âge d'Homme
1996 : Folks, ou, [o kósmos], éditions du Rocher
1996 : Haldred: Récit, Calmann-Lévy
1996 : Amicalement rouge, Messidor
1997 : Didier dénonce, G. de Villiers
1998 : Dedans, dehors: Les nouvelles frontières de l'organisation, Vuibert
1998 : Lettre à un ami perdu, Jai lu
1999 : Belgrade 99, suivi de Contre les calomniateurs de la Serbie, L'Âge d'Homme
1999 : La Titanic, éditions du Rocher
2000 : Accessible à certaine mélancolie, Albin Michel
2001 : J'aggrave mon cas, éditions du Rocher
2001 : Lui, Points
2001 : Le Deuxième Couteau, Lgf
2001 : L'Orgie échevelée, Fayard
2001 : 28, boulevard Aristide-Briand, Bartillat
2002 : Un état d'esprit, Fayard
2002 : Vous n'auriez pas vu ma chaîne en or ?, La Table ronde
2003 : 28, boulevard Aristide-Briand, suivi de « Vacances en Botnie », J'ai lu
2003 : Tour Jade, Bartillat
2003 : Paris vu dans l'eau, Presses De La Renaissance
2003 : Les Voyageurs du Trocadéro, éditions du Rocher
2004 : Le Sexe fiable, Mille et une nuits
2004 : Encore que, Mille et une nuits
2004 : Solderie, Fayard
2004 : La Cause du people, Fayard
2005 : Le Dîner de filles, Le Serpent à Plumes
2005 : Les Frères de la Consolation, Grasset & Fasquelle
2005 : Ma rentrée littéraire, Cavatines
2005 : Saint-Sépulcre !, éditions Points
2006 : Le Corps d'Agnès Le Roux, Fayard
2006 : Marilyn Monroe n'est pas morte, Mille et une nuits
2006 : Défiscalisées, Mille et une nuits
2006 : Zodiaque amoureux, Mille et une nuits
2006 : Nostalgie de la princesse, Fayard
2007 : Belle-sœur, Fayard
2007 : La Science du baiser, Points
2007 : Accessible à certaine mélancolie, Points
2008 : Et la nuit seule entendit leurs paroles, Mille et une nuits
2008 : La Statue du commandeur, Points Publication
2009 : 1974, Fayard
2009 : Mais le fleuve tuera l'homme blanc, Fayard
2009 : La Haine de la Hollande, Infini Cercle Bleu
2010 : Le Plateau télé, Fayard
2011 : Le Hussard rouge, éditions le Temps des Cerises
2012 : Au point, Journal d’un Français sous l’empire de la pensée unique, Fayard
Liens
http://youtu.be/XEIQS1_rDKw Besson sur KTOTV
http://youtu.be/2VfOM9SY67c Les matins de France culture Patrick Besson
http://youtu.be/HGXDVHvqO0c Anti portrait Patrick Besson
http://youtu.be/Z565rFZAnp0 Les affranchis Patrick Besson
             
Posté le : 31/05/2014 18:24
|
|
|
|
|
Colleen Mac Cullough |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Le 1er juin 1937 à Wellington Australie dans l'ouest de la Nouvelle-Galles
du Sud naît Colleen Mc Cullough,
écrivaine australienne, auteur de romans d'amour, historiques, policiers. Elle est principalement connue pour son roman "Les oiseaux se cachent pour mourir" écrit en 1977. Elle a reçu l'Order of Australia.
Sa vie
Elle naît le 1er juin 1937 à Wellington Australie d'une mère néo-zélandaise et d'un père écossais. Durant son adolescence, elle emménage à Sydney ou elle étudie la médecine. À la suite d'une allergie la rendant inapte à ce métier, elle devient spécialiste en neurosciences.
Elle travaille dans différents hôpitaux à Sydney puis déménage à Londres en 1963 ou elle poursuit sa carrière. En 1967, elle part travailler au Service de Neurologie de la Yale Medical School à New Haven dans le Connecticut aux États-Unis ou elle enseigne et poursuit ses recherches. Pour arrondir ses fins de mois, elle se lance dans la peinture et l'écriture. En 1976, elle rentre à l'école d'infirmières de Londres.
Elle rentre en Angleterre où elle souhaite poursuivre sa carrière mais sa nouvelle notoriété l'en empêche. Elle devient écrivaine à plein temps
Devant le succès de son premier roman, "Tim", elle se lance dans l'écriture d'un second roman : "Les oiseaux se cachent pour mourir" avec lequel en 1977 elle rencontre un succès mondial.
Sans savoir que son roman faisait la une à travers le monde, elle décide de changer de carrière et dépose sa candidature pour être infirmière à l'hôpital St Bartholomew de Londres pour y poursuivre ses études.
Devant le succès de son roman, l'hôpital refuse d'intéger une personne aussi médiatique.
Colleen Mac Cullough ne supporte plus cette popularité devenue pesante elle se retire dans l'île de Norfolk en 1984 ou elle se marie et continue à écrire des romans.
Colleen Mac Cullough se passionne également pour le dessin, la peinture, le jardinage la cuisine et la broderie.
À la fin des années 1970, elle s'installe sur l'île de Norfolk où elle vit désormais avec son mari.
Elle est l'auteur de plusieurs romans mêlant Histoire et Amour. Entre 1990 et 2007, elle a écrit la série Les Maîtres de Rome consacré à l'histoire de la République romaine. En 2006, elle s'essaie au roman policier en mettant en scène l'inspectrice Carmine Delmonico qui est à l'honneur dans cinq romans.
Elle est membre de l'Académie des Sciences de New York.
Œuvres
Romans
Tim Tim 1974
En 1979, le film Tim en a été tiré
The Thorn Birds Les oiseaux se cachent pour mourir 1977
An Indecent Obsession Un Autre nom pour l'amour 1981
A Creed for the Third Millennium La Passion du Docteur Christian 1985
The Ladies of Missalonghi Les Dames de Missalonghi 1987
The Song of Troy Le Cheval de Troie 1998
Morgan's Run L'Espoir est une terre lointaine 2000
The Touch Le Temps de l'amour 2003
Angel Puss La Maison de l'ange 2004
The Independence of Miss Mary Bennet Les Caprices de miss Mary 2008
Bittersweet 2013
Série Les Maîtres de Rome
The First Man in Rome L'Amour et le Pouvoir 1990
The Grass Crown La Couronne d'herbe 1991
Fortune's Favourites Le Favori des dieux et La Colère de Spartacus 1993
Caesar's Women Jules César, la violence et la passion et Jules César, le glaive et la soie 1996
Caesar La Conquête gauloise et César imperator 1997
The October Horse César et Cléopâtre 2002
Antony and Cleopatra Antoine et Cléopâtre 2007
Série Carmine Delmonico
On, Off Corps manquants 2006
Too Many Murders Douze de trop 2010
Naked Cruelty Fleurs sanglantes 2010
The Prodigal Son 2012
Sins of the Flesh 2013
Biographie
The Courage and the Will: The Life of Roden Cutler VC 1999
Adaptations Au cinéma
1979 : Tim, film australien réalisé par Michael Pate d'après le roman éponyme, avec Mel Gibson et Piper Laurie.
1985 : An Indecent Obsession, film australien réalisé par Lex Marinos d'après le roman éponyme.
A la télévision
1983 : Les oiseaux se cachent pour mourir The Thorn Birds, mini-série américaine réalisé par Daryl Duke d'après le roman éponyme.
1996 : Les oiseaux se cachent pour mourir : Les Années oubliées The Thorn Birds: The Missing Years, mini-série américaine réalisé par Kevin James Dobson.
1996 : Mary et Tim Mary & Tim, téléfilm américain réalisé par Glenn Jordan.
Les maîtres de Rome
51 avant Jésus-Christ. En Gaule, les provinces insurgées ont toutes, l'une après l'autre, plié devant César. Pour le vainqueur d'Alésia, l'homme qui a défait Vercingétorix, le moment est venu de regagner Rome et de prendre le pouvoir. Le Sénat et le consul Pompée s'inquiètent. Le prestige de César, son ambition sans limites, n'en font-il pas le plus dangereux des rivaux ? Au terme d'âpres tractations, Pompée croit obtenir la garantie que l'ancien gouverneur de la Gaule ne s'opposera pas à lui. Mais c'est pour apprendre bientôt que César, à la tête d'une armée dévouée à sa cause, est en passe de franchir le Rubicon et de marcher sur Rome... Avec ce dernier volet de la fresque historique " Les Maîtres de Rome ", Colleen McCullough parachève son portrait du chef militaire le plus célèbre et le plus énigmatique de l'Antiquité - un " César Imperator " tantôt orgueilleux, tantôt en proie en doute. En un mot : humain.
Les oiseaux se cachent pour mourir Belfond, 1977 et Tim Belfond, 1978 l'ont fait connaître dans le monde entier. Mais Colleen McCullough est aussi une passionnée d'histoire. Dans son île de Norfolk, au large de la Nouvelle-Zélande, elle a constitué la plus vaste bibliothèque de l'hémisphère Sud consacrée à l'Antiquité. Depuis quinze ans, elle s'est attachée à faire revivre Rome au temps de la République, depuis l'avènement de Marius 110 av. J.-C.
Liens
http://youtu.be/E2insHptSV8 Les oiseaux se cachent pour mourir bande annonce
http://youtu.be/0HVpTARLrb0 Audition de violon de Collen Mac Cullough
http://youtu.be/ZygIpnLulp8 Tim le film Première partie
http://youtu.be/QVwTgX3TjFs Tim avec Mel Gibson
               
Posté le : 31/05/2014 15:49
|
|
|
|
|
Jérome Tharaud |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57687
|
Le 18 mai 1874 à Saint-Junien Haute-Vienne naît Jérôme Tharaud
de son vrai nom Ernest Tharaud, écrivain français, élu à l'académie française. mort le 23 janvier 1953 à Paris..
L'oeuvre
Ces deux fils d'un notaire de campagne voyagent à travers l'Europe, participent à la guerre de 1914-1918 et suivent Lyautey au Maroc. Cette expérience vécue sera la matière de tous leurs livres. Ils commencent par publier des reportages dans les Cahiers de Péguy, des récits modestes et simples où ils prétendent seulement peindre, sans ambition d'analyse historique ou politique, pour l'agrément du lecteur, des scènes d'exotisme. Le succès leur vient en 1902 avec Dingley, l'illustre écrivain, une sorte de roman d'actualité où ils retracent la guerre des Boers. Leur héros représente Rudyard Kipling. Puis leurs livres s'organisent en deux séries : l'une sur Budapest, où Jérôme fut lecteur à l'université, et les milieux juifs de l'Europe de l'Est, l'autre sur les pays musulmans et la colonisation française. À l'ombre de la Croix 1917 et L'An prochain à Jérusalem 1924 rendent compte de cette âme israélite qui se transforme en esprit national. La Fête arabe 1912 dit avec beaucoup de justesse l'impossibilité d'un accord franco-arabe harmonieux : la fête serait le rêve de la communion, conservation de l'exotisme et progrès de la civilisation. Leurs récits contribuent ainsi à faire connaître nombre de problèmes mondiaux et sensibilisent l'opinion ; ce sont avant tout des documentaires très sobres où un léger romanesque préserve le plaisir. Ils écrivent un seul vrai roman, La Maîtresse servante 1911 ; leur talent de conteur se met cette fois au service d'une étude sociale, celle de la ruine d'une grande famille du Limousin : un homme ramène chez sa mère, dans une propriété de province, son amante, une ouvrière de Paris. Leur analyse psychologique de cette femme qui devient prisonnière d'un milieu auquel elle n'appartient pas séduit par sa mesure. Ils écrivent encore un émouvant essai sur Péguy, Notre Cher Péguy 1927 ; ce sont leurs souvenirs de longues années d'amitié.
Ils ont atteint une manière de perfection dans le genre où ils s'étaient fixés, un réalisme stylisé, pittoresque et humain, le modèle du récit de voyage ou du documentaire littéraire. Leur collaboration fut sans défaut, puisant en l'expérience de l'un ou de l'autre ; et l'on dit que, quand l'un rédigeait, faisait œuvre d'imagination, l'autre, comme un premier lecteur, corrigeait.
Sa Vie
Jérôme 1874-1953 et Jean Tharaud 1877-1952, son frère, sont nés à Saint-Junien en Haute-Vienne dans ce Limousin que toute leur vie ils chériront.
Leurs prénoms de baptême sont Ernest et Charles, et c’est Charles Péguy qui leur donnera plus tard les prénoms de Jérôme et Jean, en référence au fondateur et à l’apôtre de l’Evangile, car celui-ci les voyait chacun dans ce rôle vis-à-vis de la société idéale à laquelle il rêvait. Ernest et Charles, ou Jérôme et Jean, quittent Saint-Junien à la mort de leur père en 1880; leur mère, jeune veuve, retourne vivre chez son père, alors proviseur du lycée d’Angoulême et ami de Victor Duruy. Tous deux font leurs études à Angoulême, puis à Paris. Jérôme est élève à l'École normale supérieure. Le Limousin et Saint-Junien en particulier ont profondément marqué les deux frères.
En 1939, quand Jérôme sera élu à l’Académie française, il émettra le vœu que le clocher de la vénérable collégiale de Saint-Junien figure sur l’une des faces de la poignée de son épée d’académicien. Il faut dire que les deux frères ont mobilisé toute leur ardeur, en 1922, quand le clocher central de la collégiale de Saint-Junien s’est effondré par manque d’entretien. Un érudit local, Jean Teilliet, artiste peintre, avait fait appel à eux et à leur notoriété pour recueillir des fonds destinés à la reconstruction. L’église fut reconstruite dans les années qui suivirent et les frères Tharaud furent fiers d’avoir contribué au sauvetage de l’église où ils avaient été baptisés.
En 1901, Jean devint le secrétaire de Maurice Barrès, poste qu’il occupa jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il signa ensuite de nombreux articles pour le Figaro, dont l'un, paru après la Seconde Guerre, porte sur la révélation des camps de concentration des tziganes en France.
Jérôme et Jean Tharaud vont pendant cinquante ans composer une œuvre à quatre mains, signant toujours de leurs deux prénoms. Le cadet se chargeait du premier jet, tandis que l’aîné, Jérôme, s'occupait de la mise au point du texte. Ils voyagent dans de nombreux pays, la Palestine, l’Iran, le Maroc, la Roumanie, et ramènent de leurs voyages la matière à reportages et à livres.
En 1919, de retour d’un voyage au Maroc, ils sont séduits par le charme de la vallée de la Rance et acquièrent le manoir des Auffenais en Le Minihic-sur-Rance. Ils y vécurent jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, période pendant laquelle cette demeure fut occupée par l’armée allemande. En conséquence et probablement pour des raisons pécuniaires, ils la vendirent en 19451. Leur œuvre, est notamment marquée par un esprit de conformisme aux valeurs du temps et par le racisme de l'époque qui n'exclut pas l'antisémitisme, le chapitre "un ghetto marocain" dans leur ouvrage de 1920 encore réédité en 1939 "Marrakech" et la célébration du colonialisme. Le 1er décembre 1938, Jérôme Tharaud est élu au 31e fauteuil de l’Académie française en remplacement de Joseph Bédier. La candidature de Jérôme Tharaud a posé aux académiciens un cas de conscience : l’écrivain, en effet, n’était que la moitié d’un couple d’auteurs et ils ne pouvaient pas élire simultanément les deux. Jean Tharaud y sera élu en 1946 et c'est Jean Cocteau qui lui succédera.
Œuvres
Les frères Tharaud en 1932
Ouvrages cosignés avec son frère Jean
Le Coltineur débile (1898)
La Lumière (1900)
Dingley, l'illustre écrivain (1902, prix Goncourt en 1906)
Les Hobereaux (1904)
L’Ami de l’ordre (1905)
Les Frères ennemis (1906)
Bar-Cochebas (1907)
Déroulède (1909)
La Maîtresse servante (1911)
La Fête arabe (1912)
La Tragédie de Ravaillac (1913)
La Mort de Déroulède (1914)
L’Ombre de la croix (1917), Plon 1920
Rabat, ou les heures marocaines (1918)
Marrakech ou les seigneurs de l’Atlas (1920)
Quand Israël est roi (1921)
L’invitation au voyage (1922)
La randonnée de Samba Diouf (1922)
La Maison des Mirabeau (1923)
Le Chemin de Damas (1923)
L’An prochain à Jérusalem (1924)
Rendez-vous espagnols (1925)
Un royaume de Dieu (1925)
Causerie sur Israël (1926)
Notre cher Péguy (1926)
La Semaine sainte à Séville (1927)
Petite histoire des Juifs (1927)
En Bretagne (1927)
Mes années chez Barrès (1928)
La Reine de Palmyre (1928)
La Chronique des frères ennemis (1929)
Fès ou les bourgeois de l’Islam (1930)
L’Empereur, le philosophe et l’évêque (1930)
L’Oiseau d’or (1931)
Paris-Saïgon dans l’azur (1932)
La Fin des Habsbourg (1933)
La Jument errante (1933)
Quand Israël n’est plus roi, Plon 1933
Versailles (1934)
Les Mille et un jours de l’Islam I : Les cavaliers d’Allah (1935)
Les Mille et un jours de l’Islam II : Les grains de la grenade (1938)
Le Passant d’Éthiopie (1936)
Cruelle Espagne (1937)
Alerte en Syrie (1937)
L’Envoyé de l’Archange (1939)
Les Mille et un jours de l’Islam III : Le rayon vert (1941)
Le Miracle de Théophile (1945)
Fumées de Paris et d’ailleurs (1946)
Vieille Perse et jeune Iran (1947)
Les Enfants perdus (1948)
Les Mille et un jours de l’Islam IV : La chaîne d'or (1950)
La Double confidence (1951)
Références à compléter
Petite histoire des Juifs (1927)
Vienne la rouge (1933)
La bataille de Scutarie d’Albanie (1913)
Le chemin de Damas
Les contes de la Vierge (1940)
Trois ouvrages sont présentés comme antisémites par Laurent Joly dans Vichy et la solution finale, Grasset 2006.
L’Ombre de la Croix, Plon 1920
Quand Israël est roi, Plon 1921
Quand Israël n’est plus roi, Plon 1933  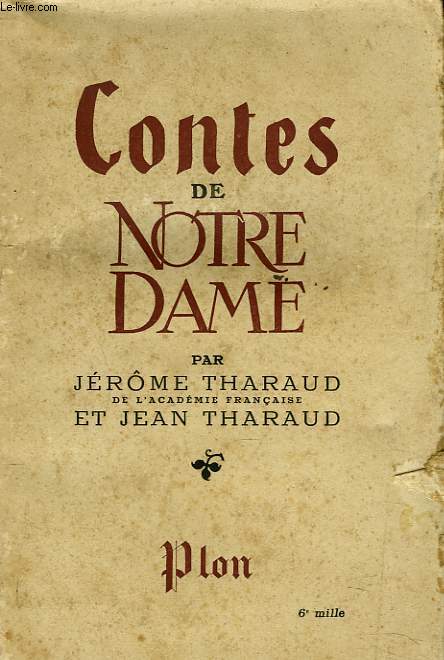  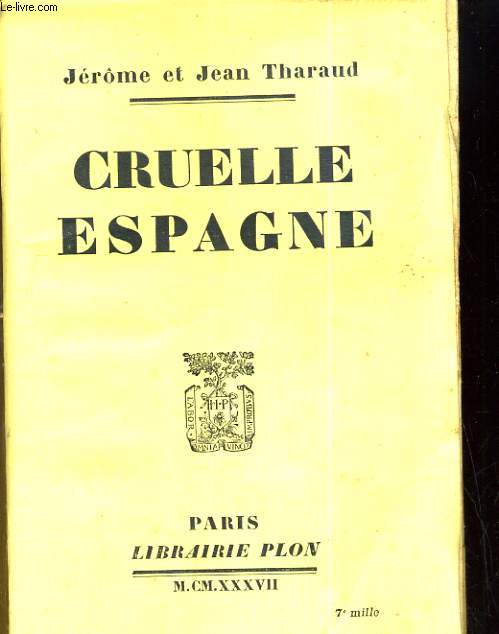   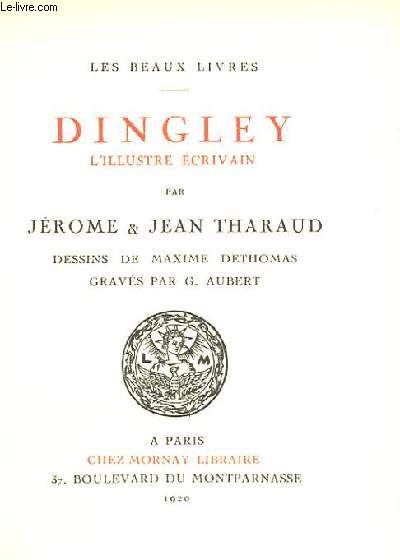   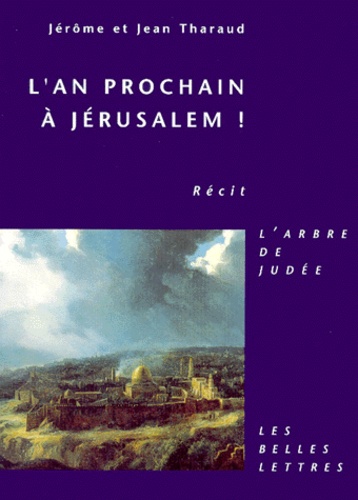 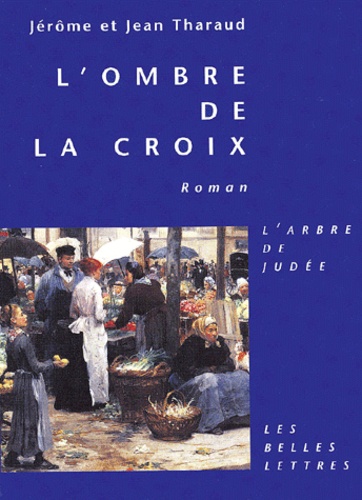  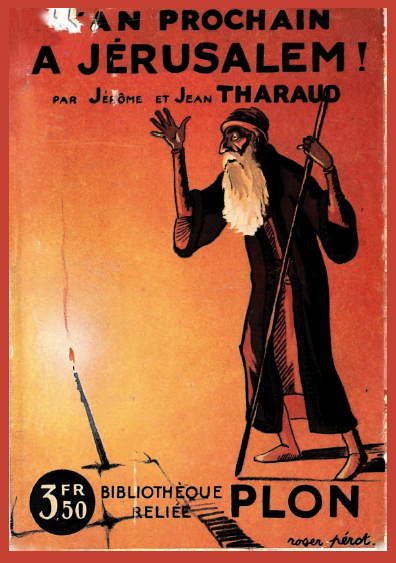 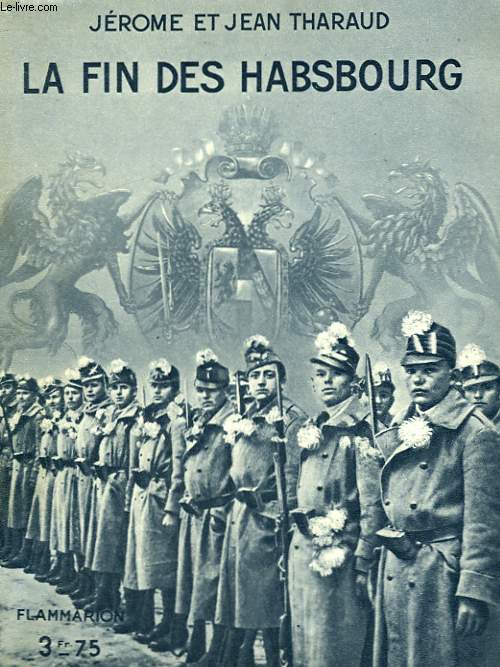
Posté le : 18/05/2014 21:30
Edité par Loriane sur 19-05-2014 15:07:38
Edité par Loriane sur 19-05-2014 15:12:03
Edité par Loriane sur 19-05-2014 15:13:53
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
64 Personne(s) en ligne ( 40 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 64
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages