 Tous les messages Tous les messages
#31
Jorge Manrique
Loriane
Posté le : 23/04/2016 17:58
Le 24 avril 1479 meurt Jorge Manrique
à Santa María del Campo Rus Cuenca en Espagne, né en 1440 à Paredes de Nava, Palencia, militaire et poète espagnol d'écriture Castillane. Il est l'auteur des Stances sur la mort de son père Coplas por la muerte de su padre, un des classiques de la littérature espagnole. En bref Neveu de Gómez Manrique, fils du comte Rodrigo de Paredes, qui fut maître de l'ordre de Calatrava, Jorge Manrique participa, sous le règne du roi Henri IV, aux luttes politiques contre les ennemis d'Isabelle la Catholique. Hernando del Pulgar a laissé le récit de sa mort glorieuse devant le château de Garci-Muñoz (Cuenca). Son Cancionero est assez réduit ; il contient des poésies amoureuses, souvent émouvantes et délicates : « Porque estando él durmiendo » (Comme il était endormi...), « Es una muerte escondida, C'est une mort cachée, « Muerte que muero... » (Mort dont je me meurs...). On y trouve aussi des poésies burlesques : « Coplas a una beoda » (« Couplets pour une femme ivre »), « Un convite que hizo a su madrastra » (« D'une invitation à sa marâtre ») ; des compositions allégoriques dans le goût de l'époque : Castillo de amor », « La profesión que hizo en la orden del amor » (« La profession qu'il fit dans l'ordre de l'amour »). Les stances fameuses qu'il composa à la mort de son père sont un des plus beaux poèmes de la littérature espagnole du Moyen Âge : Coplas por la muerte de su padre don Rodrigo publiées en 1480. Elles ont été traduites en plusieurs langues (Longfellow en a fait la version anglaise), imitées par Camoens, commentées et glosées par les plus grands écrivains, de Montemayor à Antonio Machado. Ce long lamento de plus de quarante strophes sur la toute-puissance de la mort, la vanité du monde, la fragilité de toutes choses, le destin éphémère des hommes, l'exaltation des valeurs spirituelles reprend des thèmes communs à l'époque. Le discours parfois n'est pas dépourvu d'emphase. Mais le poète obtient le plus souvent des effets bouleversants, surtout quand il évoque les splendeurs périssables des cours royales ou la noble figure et les hauts faits du comte Rodrigo, et sa sérénité d'âme lorsque forme métrique (strophes octosyllabiques de douze vers avec quatre quebrados de quatre syllabes : ABc ABc DEf DEf est admirablement adaptée au sentiment » selon le jugement de Menéndez Pelayo. L'effet de refrain assourdi que provoque régulièrement le vers brisé produit une sensation intense de glas funèbre en contrepoint de la lamentation. L'ensemble laisse une impression profonde de beauté, d'élégance, de douleur et de dignité. Bernard Sesé Sa vie On sait peu de chose sur son enfance et son adolescence. Ce qui est certain c'est qu'il assuma pleinement la ligne politique et militaire de sa vaste famille castillane, il était partisan de la guerre contre les Maures et participa aux intrigues entourant la montée sur le trône des Rois catholiques, Ferdinand et Isabelle. Son père, Rodrigo Manrique, comte de Paredes de Nava, était l'un des hommes les plus puissants de son époque. Il mourut d'un cancer qui le défigura en 1476. Sa mère mourut lorsqu'il était enfant. Son oncle, Gómez Manrique, était un poète et auteur dramatique éminent, il ne manqua pas dans la famille de Jorge Manrique d'hommes de lettres et d'armes. La famille des Manrique de Lara était l'une des plus anciennes familles nobles de Castille et possédait certains des titres les plus prestigieux, tels que le duché de Nájera, le comté de Treviño et le marquisat d'Aguilar de Campo, ainsi que plusieurs titres ecclésiastiques. Jorge Manrique fit ses humanités et suivit une instruction militaire propre aux militaires castillans. À 24 ans, il participa au siège du château de Montizón Villamanrique, Ciudad Real au cours duquel il gagne en prestige en tant que guerrier. Sa devise était je ne mens ni ne me repens, ni miento ni m'arrepiento. Il fut fait prisonnier durant quelque temps à Baza lors de l'assaut de la ville qui était aux mains des Benavides. Il s'enrôla ensuite dans le camp d'Isabelle la Catholique en lutte contre les partisans de Juana la Beltraneja. Lors de cette guerre en 1479, il meurt au cours d'une échafourrée près du château de Garcimuñoz à Cuenca qui était défendu par le marquis de Villena. On retrouva sur lui deux stances qui commençaient par "Oh monde !, alors tu me tues " ¡" Oh mundo!, pues que me matas ". Il fut enterré dans l'ancienne chapelle du monastère d'Uclès, auprès de son père. Son œuvre est succincte, à peine une quarantaine de compositions dont la plus remarquable est Stances sur la mort de son père, Coplas sobre la muerte de su padre). Lope de Vega a dit de ce poème qu'il mériterait d'être écrit en lettres d'or. En son honneur, on célèbre aujourd'hui encore en Castille-La Manche les journées du "Triangle de Manrique" "Triángulo manriqueño" en espagnol dans les localités de Garcimuñoz, Santa María del Campo Rus et Uclès. À propos de Jorge Manrique Le monastère d'Uclès où reposent les restes de Jorge Manrique. Il faut … remarquer la froideur, littéralement pré-machiavélienne, avec laquelle l’auteur des Coplas 1440-1479 parle des gens que les Manrique ont eux-mêmes abattus, comme de purs exemples du caractère changeant des destinées humaines, et de la fragilité de toutes les possessions. Guy Debord, Note de présentation des Stances Les Coplas résument la sensibilité de toute une époque, celle du déclin du Moyen Âge, avec ses thèmes dominants Gerald Brenan, The Literature of the spanish people Œuvres Stances sur la mort de son père.    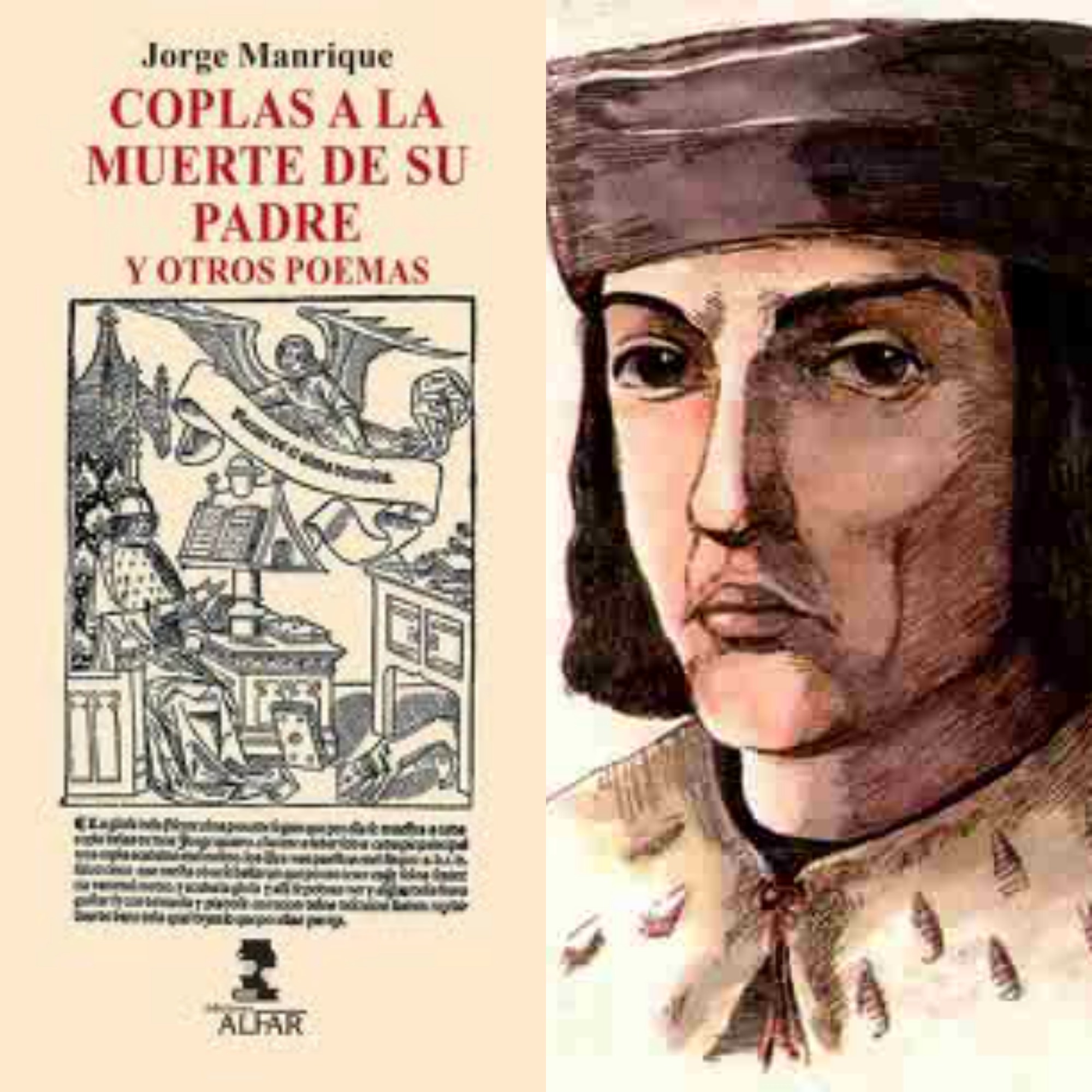
#32
Anthony Trollope
Loriane
Posté le : 23/04/2016 17:53
Le 24 avril 1815 naît Anthony Trollope
à Londres, mort, à 67 ans le 6 décembre 1882 l'un des romanciers britanniques les plus célèbres, les plus respectés et les plus prolifiques de l'époque victorienne. Parmi les écrits de Trollope, on distingue les Chroniques du Barsetshire, qui tournent autour du comté imaginaire de Barsetshire, et des romans sur des sujets politiques, sociaux et sentimentaux, et aussi sur les conflits de son époque. Trollope a toujours été un romancier populaire. Sir Alec Guinness qui ne voyage jamais sans un roman de A.Trollope, le premier Ministre britannique John Major, l'économiste John Kenneth Galbraith, l'écrivain américain de romans policiers Sue Grafton et l'écrivain Harding Lemay peuvent être comptés au nombre des admirateurs de Trollope. Sa réputation littéraire décline quelque peu pendant les dernières années de sa vie, mais il regagne l'estime des critiques vers le milieu du XXe siècle. romancier, nouvelliste, essayiste, biographie, auteur de langue anglaise dans les genres : roman, nouvelle, essai, biographie, récit de voyage, autobiographie. Son Œuvre principale est : Les Chroniques du Barsetshire de 1855 à 1867 En bref Romancier anglais né le 24 avril 1815 à Londres. Longtemps après sa mort, ses succès d'écrivain ont fait écran à la véritable nature de ses mérites littéraires. Plusieurs de ses livres se déroulent dans le comté imaginaire de Barsetshire et demeurent ses œuvres les plus populaires, mais il écrivit également d'excellentes fictions sur la vie politique, ainsi que des textes qui témoignent d'un talent remarquable pour l'observation psychologique. Il se distingua particulièrement dans la peinture solidement charpentée qu'il sut brosser de l'Angleterre victorienne, réinventée avec une force peu commune. Trollope était le fils d'un érudit, juriste à ses heures et hobereau désargenté. Sa scolarité dans les public schools de Winchester et de Harrow ne fut pas des plus heureuses. Les tourments de l'adolescence le poursuivirent bien au-delà de ses vingt ans. Petit employé au General Post Office de Londres, de 1834 à 1841, il obtient une promotion qui l'emmène en Irlande, où il commence à goûter les plaisirs d'une vie sociale. En 1844, il épouse Rose Heseltine, une Anglaise, et s'installe à Clonmel, comté de Tipperary. Il entame alors une carrière littéraire féconde, qui frappe par sa richesse et sa diversité. Le Pasteur 1855 fut sa première œuvre à être remarquée. Il y dresse le portrait saisissant d'un bedeau au service de vieilles personnes qui se voit accusé de tirer trop grand profit de sa besogne charitable. Durant les douze années qui suivirent, Trollope produisit pas moins de cinq livres, tous situés, comme Le Pasteur, dans le Barsetshire : Les Tours de Barchester 1857, Le Docteur Thorne 1858, La Cure de Framley (1861), The Small House at Allington 1864 et La Dernière Chronique de Barset en feuilleton, de 1866 à 1867, puis livre publié en 1867. Les Tours de Barchester se singularisent par leur drôlerie. Le Docteur Thorne est sans doute la meilleure fresque d'un système social fondé sur la naissance et la richesse foncière, tandis que La Dernière Chronique, qui retrace les souffrances de M. Crawley, pauvre vicaire d'une misérable paroisse, est son livre le plus pathétique. Les romans du cycle de Barsetshire regorgent de personnages hauts en couleur et dépeignent parfaitement la geste dévote de l'aristocratie terrienne. En 1859, Trollope rentra à Londres. En 1868, un an après avoir démissionné de ses fonctions dans le service public, il se présenta comme candidat libéral au Parlement ; sans succès. Dans l'intervalle, il avait trouvé le temps d'écrire dix-huit romans en dehors du cycle de Barsetshire. Il travaillait principalement avant l'heure du petit déjeuner, au rythme immuable de mille mots par heure. Parmi les œuvres de cette période se dégagent Orley Farm en feuilleton 1861-1862 ; puis 1862, qui illustre l'intrigue classique du testament contesté, et Peut-on lui pardonner ? en feuilleton, 1864-1865 ; puis 1865, son premier roman à caractère politique où apparaît le personnage de Plantagenet Palliser, appelé à devenir duc d'Omnium et dont la saga allait s'étendre sur plusieurs volumes, jusqu'à The Duke's Children en feuilleton, 1879-1880 ; puis 1880, une analyse subtile des déconvenues du mariage. Dans ses romans politiques, Trollope se montre moins intéressé par les idées que par le fonctionnement du système, la mécanique du pouvoir. Vers 1869 s'ouvre la dernière période créatrice du romancier, à bien des égards la plus intéressante. On peut trouver des indices de ce nouveau style dans la narration lente de He Knew He Was Right en feuilleton, 1868-1869 ; puis 1869, récit subtil de la jalousie obsessionnelle d'un homme riche envers sa femme innocente. Dans une veine purement psychologique, citons Sir Harry Hotspur of Humblethwaite en feuilleton, 1870 ; puis 1871. D'autres ouvrages plus tardifs, en revanche, sont franchement satiriques : Les Diamants Eustace en feuilleton, 1871-1873 ; puis 1873, une étude de l'influence de l'argent sur les rapports entre les sexes ; The Way We Live Now (en feuilleton, 1874-1875 ; puis 1875 pour son remarquable personnage d'anti-héros, le financier Melmotte ; et Mr. Sarborough's Family publication posthume, 1883 qui montre ce qui peut advenir lorsque le tempérament nihiliste d'un homme prend le pas sur ses droits de propriétaire. Les dernières années de sa vie, Trollope les passa en reclus dans un petit village du Sussex, confronté à la désaffection du public, une santé déclinante et l'enfoncement dans la mélancolie. Il s'éteignit à Londres, le 6 décembre 1882, après avoir subi une attaque de paralysie. Sa vie Le père d'Anthony Trollope, Thomas Anthony Trollope, est barrister avocat plaidant. Thomas Trollope, homme pourtant intelligent et ayant reçu une excellente éducation, en particulier au New College d'Oxford, ne réussit pas au barreau, sans doute en raison de son caractère colérique. De plus, il monte une entreprise agricole qui lui fait perdre de l'argent, et l'héritage qu'il attend d'un vieil oncle lui échappe quand, contre toute attente, ce monsieur se marie et a des enfants. Néanmoins, il vient de la bonne société et est lié à l'aristocratie des propriétaires terriens gentry. À ce titre, il tient à ce que ses fils soient éduqués en gentlemen et fréquentent l'université d'Oxford ou l'université de Cambridge. Le contraste existant entre l'extraction sociale de la famille et sa pauvreté est une source de souffrance pour le jeune Anthony, qui ne peut, par manque d'argent, accéder aux occupations et aux divertissements auxquels il aspire. Né à Londres, Anthony étudie à la Public School de Harrow, Harrow School, en qualité d'externe pendant trois ans à partir de sa septième année, établissement choisi pour son excellence et aussi sa proximité, la ferme paternelle se trouvant dans le voisinage. Après quelque temps passé dans une autre école privée, il suit son père et deux de ses grands frères à Winchester, Winchester College, où il reste trois ans. Il retourne ensuite à Harrow en qualité d'externe afin de réduire les frais de scolarité. Trollope est plutôt malheureux dans ces deux prestigieux établissements, où il souffre de la brutalité des anciens et de ses pairs, de son manque d'argent chronique et aussi, les deux étant sans doute liés, de la solitude car il ne peut s'y faire aucun ami. Il se réfugie dans le monde de l'imagination et construit des univers complexes qui sont vraisemblablement à l'origine de sa vocation littéraire. En 1827, sa mère, Frances Trollope, déménage aux États-Unis avec trois des frères d'Anthony ; elle ouvre un bazar à Cincinnati, qui fait faillite. Thomas Trollope les rejoint brièvement avant de retourner à la ferme de Harrow, mais Anthony, lui, reste en Angleterre. Sa mère revient en 1831 et se fait rapidement un nom en tant qu'écrivain, ce qui lui donne une réelle aisance financière. L'affaire du père périclite rapidement au point que ce dernier doit, en 1834, s'enfuir précipitamment pour la Belgique afin d'éviter la prison pour dettes. La famille tout entière emménage dans une maison près de Bruges, où elle vit grâce à l'argent que Frances gagne avec ses livres. En 1835, Thomas Trollope meurt. Alors qu'il vit en Belgique, Anthony travaille comme professeur assistant dans une école, où il suit des cours de français et d'allemand en vue d'obtenir un poste d'officier dans un régiment de cavalerie autrichien, poste qu'il occupe pendant six semaines. Puis il est recruté comme fonctionnaire des Postes de Sa Majesté, grâce à l'entremise d'une relation de sa mère. Il retourne donc à Londres où il vit seul, ses nouvelles fonctions lui apportant la respectabilité qu'il recherche mais des revenus très modestes. En Irlande Trollope vit dans diverses pensions de famille, restant à l'écart de toute vie sociale ; il qualifiera plus tard cette période comme ayant été son "hobbledehoyhood", jeu de mots qu'on pourrait traduire par sa période grand dadais, référence, sans doute, à sa gaucherie physique naturelle et aussi à sa précarité sociale. Professionnellement, en effet, il ne progresse guère, mais tout change en 1841 lorsque l'administration des Postes le nomme en Irlande. En 1844, il épouse une Anglaise, Rose Heseltine, avec laquelle il s'installe dans ce pays où ils vivent jusqu'en 1859. Sur son séjour, alors qu'il a connu au plus près la désastreuse famine qui a décimé la population, Trollope ne fait, dans son Autobiographie Autobiography, qu'un commentaire plutôt laconique : Somme toute, ce fut une vie très agréable que je menais en Irlande. Les Irlandais ne m'ont ni tué ni fracassé la tête. Je les ai trouvés agréables de caractère et intelligents - le peuple y est beaucoup plus intelligent qu'en Angleterre -, et en plus, ils sont économes et hospitaliers. Son travail d'Inspecteur des Postes lui fait rencontrer beaucoup d'Irlandais. Trollope se met à écrire lors des longs trajets en train qu'il doit effectuer pour son travail et qui le mènent d'un bout à l'autre de l'Irlande. Dès le départ, il s'est fixé des règles très strictes concernant le nombre de pages à écrire chaque matin, rattrapant le lendemain ce qu'il n'a pas accompli la veille. Cette discipline, à laquelle il ne faillit jamais, lui permet de devenir l'un des écrivains les plus prolifiques de tous les temps. Ses premiers romans sont inspirés par la boite dite des « lettres mortes dead letters, dans laquelle il pioche lorsqu'il en éprouve le besoin. Là se trouvent les lettres non-distribuées pour cause de décès ou d'adresse incorrecte. Beaucoup de ses premiers romans ont l'Irlande pour cadre, ce qui, pour d'évidentes raisons politiques, lui vaut un accueil plutôt distant et réservé de la part de la critique. Retour en Angleterre Boîte aux lettres Au milieu des années 1860, Trollope est élevé à un grade important dans la hiérarchie des Postes. L'histoire de cette administration lui attribue l'introduction de la pillar box, l'omniprésente boîte à lettres rouge qu'on trouvait partout au Royaume-Uni. C'est l'époque où ses romans commencent à lui rapporter des sommes importantes. De plus, il a plus ou moins surmonté sa gaucherie naturelle, bien qu'il se décrit toujours cf. son Autobiographie comme de grande taille, plutôt massif et lourd. Dès lors, Trollope fréquentent les cercles où ils rencontrent certains grands noms de la littérature. De plus, Il dispose des moyens lui permettant de s'adonner à sa passion pour les chevaux et, en particulier, pour la chasse à courre fox hunting. Il quitte l'Administration des Postes en 1867 pour faire campagne sous l'égide du Parti Libéral lors des élections générales de 1868, Parlement parti libéral. Comme il n'est pas élu député MP Member of Parliament de sa circonscription, il consacre le reste de sa vie à sa carrière littéraire. Les romans se succèdent rapidement et plusieurs sont publiés en feuilletons instalments dans le St Paul's Magazine dont il est devenu l'éditeur. Son premier grand succès est The Warden 1855, petit chef-d'œuvre dont l'action se déroule dans le comté fictif du "Barsetshire". Ce roman, qui a pour héros malheureux un membre du bas clergé, est suivi de nombreux autres exploitant la même veine. Cette série constitue ce qu'on appelle les Chroniques du Barsetshire. La satire comique de Barchester Towers 1857 vaut peut-être à ce roman de figurer parmi les plus populaires de Trollope. L'autre série majeure, les Romans de Palliser, traitent de sujets politiques, avec, comme protagonistes principaux, le riche aristocrate Plantagenet Palliser et sa femme Lady Glencora, délicieusement spontanée et encore plus riche que lui. Tout au long des deux séries, les protagonistes reviennent sur la scène, entourés de certains personnages déjà rencontrés et aussi de nombreux autres qui y commencent une carrière fictive, parfois poursuivie et parfois interrompue selon les besoins de l'intrigue. La popularité de Trollope et son succès critique pâlissent dans les dernières années de sa vie, mais il continue d'écrire avec la même verve. Son œuvre satirique Quelle époque ! The Way We Live Now, 1875 est considérée comme son chef-d'œuvre. En tout, Trollope a écrit quarante-sept romans, ainsi que des douzaines de nouvelles et quelques livres de voyage. Anthony Trollope meurt à Londres en 1882. Il est inhumé au Kensal Green Cemetery, près de son contemporain Wilkie Collins. Réputation Un an après sa mort, parait l'autobiographie Autobiography de Trollope. La critique s'est toujours étonnée de l'abondance de la production littéraire de cet écrivain qui enchaîne les romans l'un après l'autre. On admire, comme on le fait de Charles Dickens, le génie créateur, source intarissable de longs récits touffus à l'intrigue palpitante, aux personnages fouillés, aux dialogues étincelants. Mais voilà que l'autobiographie étale au grand jour des méthodes d'écriture peu ordinaires. Apprendre d'un coup que ces belles pages ont été comptabilisées matin après matin, écrites non pas sous l'emprise d'une divine inspiration mais avec la régularité métronomique d'un commis aux écritures, cela ne correspond plus au portrait idéalisé qu'on s'est fait. Trollope change de stature et devient une sorte de rond de cuir des lettres. Pis, il ne fait nul mystère du fait qu'il n'écrit pas par plaisir mais pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Chaque livre publié représente un capital minutieusement répertorié en livres sonnantes et trébuchantes, et les bilans, avec actif et passif dûment retranscrits au farthing près un farthing valait un quart de penny, chagrinent les professionnels des lettres et, dans une certaine mesure, découragent le public des abonnés. Bref, les illusions se sont envolées et Trollope est passé de mode. Il sait tout cela, avant et par delà son Autobiography, persuadé qu'il est que toute écriture, même de fiction, révèle ipso facto l'auteur qui la produit. Dans sa Vie de Cicéron Life of Cicero, il écrit : The man of letters is, in truth, ever writing his own biography. What there is in his mind, is being declared to the world at large by himself. And if he can write that the world at large shall care to read what is written, no other memoir will perhaps be necessary. Quant à lui, Henry James a exprimé des opinions partagées sur Anthony Trollope. De The Belton Estate, il écrit que c'est « un livre stupide, vide de toute réflexion ou d'idée, ... une sorte de "pabulum"2 mental." » Il ajoute qu'il n'en aime pas la méthode narrative ; les interpolations joyeuses du narrateur montrant à l'envi comment l'histoire peut prendre n'importe quelle direction selon la fantaisie de son auteur, nuisent, selon lui, à l'intégrité de l'artiste . Cela dit, il apprécie « l'attention méticuleuse au détail » et, dans un essai publié peu après le décès de Trollope, il lui rend un hommage d'autant plus remarquable que James, dans ses Préfaces et dans son œuvre, présente une forme de roman aux antipodes de celle de l'auteur victorien : Son grand, son incontestable mérite, c'est une totale compréhension du routinier... Trollope sentait en même temps qu'il la voyait, la multiplicité du quotidien et de l'immédiateté ; il la sentait d'une façon simple, directe et salubre, avec sa tristesse, ses joies, son charme, son côté comique .... Il restera l'un des plus sûrs, bien que n'étant pas le plus éloquent, des écrivains qui ont aidé le cœur de l'homme à se connaître lui-même... Chanceuse est la race qui, comme celle de l'Angleterre, possède le sens de l'imaginaire dont a fait preuve Trollope. Il n'en reste pas moins que le postier des lettres anglaises a pu avoir quelque influence sur lui ; son traitement des tensions familiales, par exemple, notamment entre pères et filles, trouve son écho dans certains romans de James. Ainsi, Alice Vavasor et son égoïste de père, dans Peut-on lui pardonner ? Can You Forgive Her ?, premier roman de la série Palliser, semble préfigurer Kate Croy et l'insupportable Lionel de Les Ailes de la colombe The Wings of the Dove. Des écrivains comme William Makepeace Thackeray, George Eliot et Wilkie Collins admirent Trollope dont ils sont l'ami. George Eliot note même qu'elle n'aurait jamais pu entreprendre un projet aussi ambitieux que Middlemarch sans l'existence du comté imaginaire de Barsetshire qu'il a créé. Alors que le roman s'oriente de plus en plus vers la subjectivité et l'expérimentation artistique, la réputation critique de Trollope se ternit peu à peu. Au cours des années 1940, ses admirateurs, car il en reste, s'efforcent de la redorer, si bien que Trollope connait un regain d'intérêt dans les années 1960 et aussi 1990. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des grands romanciers victoriens et on accorde particulièrement d'attention aux portraits de femme qu'il a créés. Déjà, de son vivant, on avait remarqué et parfois apprécié sa clairvoyance à l'égard de la condition féminine. Une Trollope Society existe au Royaume-Uni, 9 A North Street, London SW4, tout comme aux États-Unis. Adaptations de œuvres de Trollope à la télévision La BBC a réalisé plusieurs séries fondées sur les œuvres d'Anthony Trollope : The Pallisers, une adaptation en 26 épisodes des six Romans de Palliser, diffusée pour la première fois en 1974. L'adaptation fut réalisée par Simon Raven ; la distribution comprenait Philip Latham dans le rôle de Plantagenet Palliser et Susan Hampshire dans le rôle de Lady Glencora. The Barchester Chronicles, une adaptation en 1982, en 7 épisodes des deux premiers romans du Barsetshire, The Warden et Barchester Towers. Adapté par Alan Plater , la distribution comprenait Donald Pleasence dans le rôle du Révérend Septimus Harding, Nigel Hawthorne dans le rôle de l'Archidiacre Grantly, Alan Rickman dans le rôle du Révérend Obadiah Slope, et Geraldine McEwan et Susan Hampshire coffret double vidéo, BBCV4658, 355 minutes. The Way We Live Now, une adaptation en 4 épisodes du roman du même nom ; il fut adapté par Andrew Davies, et joué par David Suchet dans le rôle de Auguste Melmotte et Matthew Macfadyen dans le rôle de Sir Felix Carbury. He Knew He Was Right diffusé entre le 18 avril et le 9 mai 2004 sur BBC One en 4 épisodes de 60 minutes. Produit par BBC Wales, et adapté par Andrew Davies, sa distribution comprenait entre autres, Bill Nighy, Laura Fraser, David Tennant, et Geoffrey Palmer. Aux États-Unis, PBS a diffusé les quatre séries : The Pallisers seul, et The Barchester Chronicles, The Way We Live Now, et He Knew He Was Right comme partie du Masterpiece Theater. Adaptations de œuvres de Trollope à la radio La BBC commanda une adaptation radiophonique en quatre parties de The Small House at Allington, le cinquième roman des Chroniques du Barsetshire, qu'elle diffusa en 1993. Les auditeurs réagirent si favorablement que la BBC adapta les cinq autres romans de la série et BBC Radio 4 diffusa la série entière entre décembre 1995 et mars 1998. Dans cette adaptation, Stephen Moore acteur jouait le rôle de l'Archidiacre Grantlly. BBC Radio 4 diffusa une adaptation radiophonique en plusieurs épisodes de The Kellys and the O'Kellys, avec Derek Jacobi, entre le 21 novembre 1982 et le 2 janvier 1983. BBC Radio 4 diffusa The Pallisers, une nouvelle adaptation en douze parties des Romans de Palliser, de janvier à avril 2004, dans l'espace de diffusion Classic Serial du week-end. Œuvres Les titres indiqués sont les titres originaux accompagnés du titre de la traduction française s'il en existe une. Romans Les Chroniques du Barsetshire The Warden 1855 Publié en français sous le titre Le Directeur, traduit par J. Staquet, Bruxelles, Éditions la Boétie, 1946 ; nouvelle édition sous le titre La Sinécure, traduit par Louis Rocher, Paris, Nouvelles Éditions latines, coll. Les Maîtres étrangers, 1947 ; réédition dans une nouvelle traduction de Richard Crevier sous le titre Le Directeur, Paris, Aubier, coll. Domaine anglais, 1992 Barchester Towers 1857 Publié en français sous le titre Les Tours de Barchester, traduit par L. Martel, Paris, Hachette, 1885 ; réédition dans une nouvelle traduction de Christian Bérubé, Paris, Fayard, 1991 Doctor Thorne 1858 Publié en français sous le titre Le Docteur Thorne, Paris, Revue britannique, 1864 ; réédition sous le même titre dans une nouvelle traduction d'Alain Jumeau, Paris, Fayard, 2012 ; réédition en format poche, Paris, Points no 3276, 2014 Framley Parsonage 1861 Publié en français sous le titre La Cure de Framley, traduit préfacé et annoté par Alain Jumeau, Paris, Fayard, 2015 The Small House at Allington 1864 The Last Chronicle of Barset 1867 Série Palliser Can You Forgive Her? 1864 Publié en français sous le titre Peut-on lui pardonner ?, traduit par Claudine Richetin, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1998 Phineas Finn 1869 Publié en français sous le titre Phinéas Finn, traduit par Guillaume Villeneuve, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1992 The Eustace Diamonds 1873 Publié en français sous le titre Les Diamants Eustace, traduit par Denise Getzler, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1992 Phineas Redux 1874 Publié en français sous le titre Les Antichambres de Westminster, traduit par Françoise Du Sorbier, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1994 The Prime Minister 1876 Publié en français sous le titre Le Premier Ministre, traduit par Guillaume Villeneuve, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1995 The Duke's Children 1879 Publié en français sus le titre Les Enfants du duc, traduit par Alain Jumeau, Paris, Fayard, 2013 Autres romans The Macdermots of Ballycloran 1847 The Kellys and the O'Kellys 1848 La Vendée: An Historical Romance 1850 Publié en français sous le titre Vendée, traduit par Béatrice Vierne, Monaco, Éditions du Rocher, 1997 The Three Clerks 1858 Publié en français sous le titre Les Bertram, Paris, Charpentier, 1866 The Bertrams 1859 Castle Richmond 1860 Orley Farm 1862 The Struggles of Brown, Jones, and Robinson 1862 Rachel Ray 1863 Publié en français sous le titre Rachel Ray, traduit par L. Martel, Paris, Hachette, 1889 ; réédition dans la même traduction révisée et complétée par Laurent Bury, Paris, Éditions Autrement, 2011 Miss Mackenzie 1865 Publié en français sous le titre Miss Mackenzie, traduit par Laurent Bury, Paris, Éditions Autrement, 2008; réédition en poche, Paris, Le Livre de Poche. Biblio roman no 31966, 2010 The Belton Estate 1866 Publié en français sous le titre Le Domaine de Belton, traduit par Eugène Dailhac, Paris, Hachette, Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, 1875 ; réédition dans la même traduction révisée par Charlotte Robert sous le titre L'Héritage Belton, Paris, Archipoche. Classiques d'hier et d'aujourdhui no 293, 2014 The Claverings 1867 Nina Balatka 1867 Linda Tressel 1868 He Knew He Was Right 1869 The Vicar of Bullhampton 1870 Sir Harry Hotspur of Humblethwaite 1871 Ralph the Heir 1871 The Golden Lion of Granpère 1872 Harry Heathcote of Gangoil 1874 Lady Anna 1874 The Way We Live Now 1875 Publié en français sous le titre Quelle époque !, traduit par Alain Jumeau, Paris, Fayard, 2009 ; réédition en poche, Paris, J'ai lu no 9666, The American Senator1877 Is He Popenjoy? 1878 John Caldigate 1879 An Eye for an Eye 1879 Publié en français sous le titre Œil pour Œil, traduit par Amy Davy, Paris, Sandoz & Fischbacher, 1881 ; réédition sous le même titre dans une traduction de Victor Staquet, Toulouse, Éditions Ombres, 1999 Cousin Henry 1879 Publié en français sous le titre Le Cousin Henry, traduit par Mme Honorine Martel, Paris, Hachette, Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, 1881 Ayala's Angel 1881 Publié en français sous le titre L'Ange d'Ayala, traduit par Béatrice Vierne, Paris, L'Herne, 2013 Doctor Wortle's School 1881 The Fixed Period 1882 Kept in the Dark 1882 Marion Fay 1882 M. Scarborough's Family 1883 The Landleaguers 1883, roman inachevé An Old Man's Love 1884 Recueils de nouvelles Tales of All Countries—1st Series 1861 Tales of All Countries—2nd Series 1863 Lotta Schmidt, and Other Stories 1867 Tales of All Countries—3rd Series 1870 An Editor's Tales 1870 Why Frau Frohmann Raised Her Prices and Other Stories 1882 The Two Heroines of Plumpington(1882 Nouvelles isolées La Mère Bauche 1861 Publié en français sous le titre Un amour de jeunesse, traduit par Béatrice Vierne, Paris, L'Herne, 2011 The Château of Prince Polignac 1861 Publié en français sous le titre Le Château du prince de Polignac, traduit par Béatrice Vierne, Paris, L'Herne, Gentle Euphemia 1866 Katchen's Caprices 1866 Christmas at Kirkby Cottage 1870 Never, Nerver -- Nerver, Nerver 1875 Essais On English Prose Fiction as a Rational Amusement 1869 The Commentaries of Caesar 1870 Thackeray 1879 The New Zealander 1972 Théâtre Did He Steal It? 1869 The Noble Jilt 1923, pièce publiée de façon posthume Récits de voyages The West Indies and the Spanish Main 1859 North America 1862 Australia and New Zealand 1873 New South Wales & Queensland 1874 South Africa 1878 How the 'Mastiffs' Went to Iceland 1878 Iceland 1878 Autobiographie An Autobiography 1883 Publié en français sous le titre Autobiographie, traduit par Guillaume Villeneuve, Paris, Aubier, coll. Domaine anglais, 199 Autres publications Hunting Sketches 1865 Travelling Sketches 1866 Clergymen of the Church of England 1866 Life of Cicero 1880, biographie Lord Palmerston 1882, biographie London Tradesmen 1927, sketches posthumes  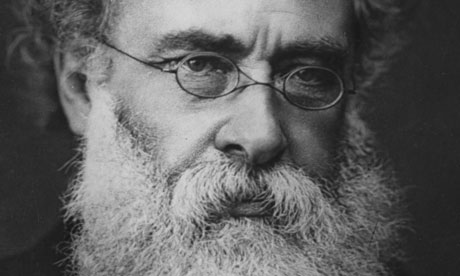 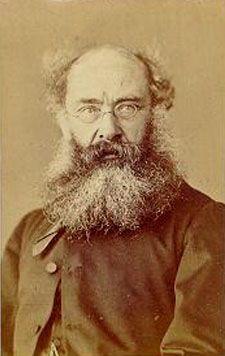 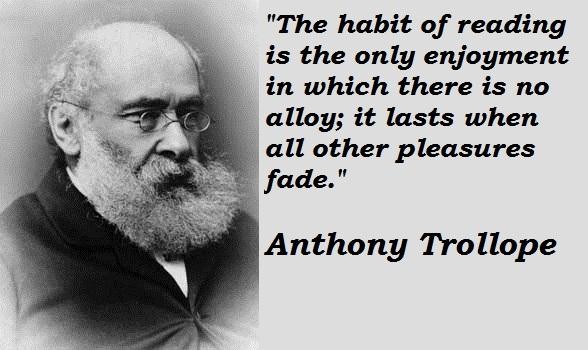 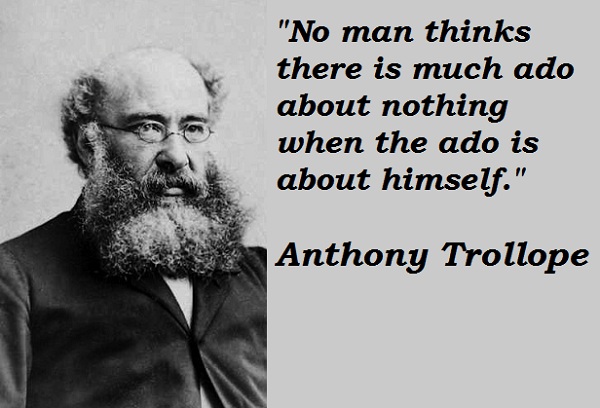  
#33
Alfred de Vigny
Loriane
Posté le : 26/03/2016 18:50
Le 27 mars 1797 naît Alfred Victor Vigny
comte de Vigny, à Loches Indre-et-Loire, et mort, à 66 ans le 17 septembre 1863 à Paris 8e écrivain, romancier, dramaturge et poète français, auteur de Poésie, théâtre, roman historique, roman romantique Ses Œuvres principales sont : Poèmes antiques et modernes, 1822, Cinq-Mars,1826, Chatterton, 1835. Figure influente du romantisme, il écrit parallèlement à une carrière militaire entamée en 1814 et publie ses premiers poèmes en 1822. Avec la publication de Cinq-Mars en 1826, il contribue au développement du roman historique français. Ses traductions versifiées de Shakespeare s'inscrivent dans le drame romantique, de même que sa pièce Chatterton 1835. Son œuvre se caractérise par un pessimisme fondamental, et une vision désenchantée de la société. Il développe à plusieurs reprises le thème du paria, incarné par le poète, le prophète, le noble, Satan ou bien le soldat. Sa poésie est empreinte d’un stoïcisme hautain, qui s’exprime en vers denses et dépouillés, souvent riches en symboles, annonçant la modernité poétique de Baudelaire, Verlaine et Mallarmé. Alfred de Vigny naît à la fin du xviiie siècle, au sein d’une famille issue de la vieille noblesse militaire. Après une vie de garnison monotone – il passe quinze ans dans l'armée sans combattre–, il fréquente les milieux littéraires parisiens et notamment le cénacle romantique de Victor Hugo. De 1822 à 1838, il écrit des poèmes Poèmes antiques et modernes, des romans comme Stello, des drames comme La Maréchale d’Ancre et des nouvelles Servitude et grandeur militaires qui lui apportent la célébrité. En 1838, après une rupture sentimentale avec Marie Dorval et la mort de sa mère, Alfred de Vigny s'installe pour la première fois au Maine-Giraud, son domaine situé en Charente. Il goûte à la solitude et prend soin de sa femme malade et constamment alitée. De retour à Paris, il se mêle de nouveau à la vie politique et littéraire. Il parvient en 1845 à se faire élire, au bout de la cinquième tentative, à l'Académie française. En revanche, candidat en Charente, il échoue à la députation lors des élections de 1848. Par la suite, il effectue plusieurs séjours au Maine-Giraud, avec Mme de Vigny pour seule compagnie, mais vit surtout à Paris. Il écrit peu, publie rarement, mais médite et lit beaucoup. Il meurt d’un cancer de l’estomac, après une lente agonie qu’il supporte avec patience et stoïcisme. Son recueil posthume Les Destinées est publié en 1864. Son Journal est révélé en 1867. En bref Vigny, muré, dès la quarantaine, dans un curieux silence, ne connut pas la gloire que ses succès littéraires semblaient lui promettre. Mais il ne s'adressa pas vainement à la postérité, en lui destinant, comme le naufragé qui jette la bouteille à la mer, une œuvre mieux faite pour durer que pour plaire. Au cours de sa destinée posthume, il pâtit beaucoup moins que Lamartine, Hugo ou Musset du discrédit jeté sur le romantisme par toute une culture positiviste dont nous vivons la ruine. Dans chacune des générations qui suivirent la sienne, des fidèles recueillirent son message et perpétuèrent son souvenir. Ce furent, parmi d'autres, Baudelaire, dont il avait reconnu le génie, Henri de Régnier, Charles Péguy, André Breton. Des armes aux lettres. Alfred de Vigny naquit à Loches, en Touraine. Il appartenait à une famille aristocratique et militaire, que les rigueurs de la Révolution n'avaient pas épargnée. Son père, déjà âgé, était un vétéran de la guerre de Sept Ans. Son grand-père maternel, marquis de Baraudin, avait servi dans la marine royale comme chef d'escadre. Vigny fut élevé, à Paris, par une mère qui avait lu Rousseau. Elle inculqua à son fils unique une religion tout intérieure, le goût de la musique et de la peinture plutôt que des belles-lettres. Mais au lycée Bonaparte, où il prépara, sans persévérance, le concours d'entrée à l'École polytechnique, l'adolescent conçut « un amour désordonné de la gloire des armes », commun à beaucoup d'« enfants du siècle ». Attaché à la monarchie par tradition, il revêtit l'uniforme rouge des mousquetaires du roi, lors du retour en France de Louis XVIII, qu'il escorta pendant les Cent-Jours sur la route de l'exil. Il entrait alors dans sa dix-huitième année. Le métier des armes, exercé non sur des champs de bataille mais dans des cours de caserne, déçut le jeune officier, qui lui préféra l'aventure d'une carrière littéraire et donna sa démission en 1827. Vigny publia, en 1820, son premier poème, Le Bal, suivi, deux ans plus tard, de son premier recueil. Les revues et les salons de la capitale saluèrent la naissance d'un poète qui alliait à la grâce de Chénier une fermeté déjà originale et une profondeur bien romantique. Serait-il, ce lecteur de la Bible, qui ne quittait pas son sac de fantassin, le rédempteur d'une mythologie chrétienne que Chateaubriand, dans Le Génie du christianisme, avait donnée pour modèle à la littérature du XIXe siècle ? Bien que le souffle de d'Aubigné ou de Virgile lui fît défaut, les Poèmes antiques et modernes (1826) furent applaudis. Mais Vigny ne se contenta point d'exceller dans le poème, conçu par lui comme la « mise en scène », dramatique ou épique, d'une « pensée philosophique ». Il révéla ses dons de narrateur dans Cinq-Mars (1826), roman historique que Walter Scott admira et dont la quatrième édition (1829) devait s'enrichir des très pertinentes Réflexions sur la vérité dans l'art, où se déclare la nécessité esthétique de « déserter le positif pour apporter l'idéal jusque dans les annales ». Il s'efforça aussi d'imposer à Paris, contre les préjugés de la jeunesse libérale, dénoncés par Stendhal, le théâtre de Shakespeare. Il adapta Othello, qui fut joué à la Comédie-Française le 24 octobre 1829, avec Mlle Mars dans le rôle de Desdémone, puis Shylock, qui ne fut pas monté. Pendant ces années de jeunesse, Vigny parut être un écrivain et un homme heureux. Lamartine, son aîné, l'assura de son estime. Hugo et Sainte-Beuve le traitèrent en ami, bien qu'il se tînt à l'écart du cénacle romantique. Il forma quelque temps avec la blonde Delphine Gay, « Muse de la patrie », un couple séduisant, avant d'épouser, en février 1826, Lydia Benbury, une Anglaise rencontrée à Oloron et qui passait pour une riche héritière. Sa vie Il naît dans une famille qui a connu un passé des plus brillants. Hugo de Vigny, le grand-oncle d'Alfred, est admis chevalier de l'ordre de Malte en 1717. Son grand-père maternel, Didier de Baraudin, est écuyer et chef d'escadre dans la marine royale. Son manoir du Maine-Giraud, situé près d'Angoulême, n'est pas un fief mais un domaine acheté en 1768. Son père est un ancien officier vétéran de la guerre de Sept Ans, âgé de soixante ans et infirme lorsqu'Alfred vient au monde. Sa mère, Marie-Jeanne-Amélie de Baraudin, âgée, pour sa part, de quarante ans à la naissance d'Alfred, a déjà donné naissance à trois enfants, tous morts en bas âge. Alfred incarne le dernier espoir de continuer la lignée. En 1799, après la fin de la Révolution, les Vigny quittent Loches et s'installent à l'Élysée-Bourbon, alors divisé en logements privés. Alfred, dès son plus jeune âge, suit une éducation exemplaire, dirigée par sa mère, suivant à la lettre les préceptes de L'Émile : bains glacés, régime sec, exercices physiques, notamment escrime et tir, enseignement des mathématiques, de la musique, de la peinture. Il est l'âme du foyer, objet d'une affection tyrannique. Les murs de l'appartement sont recouverts de portraits de l'enfant. Son père lui fait embrasser la croix de Saint-Louis chaque soir avant de se coucher mais, surtout, en homme du XVIIIe siècle doué d'un talent de conteur peu commun, il plonge l'enfant dans un passé qu'il embellit certainement. De ces récits naît, chez Vigny, le sentiment d'appartenir à une lignée, d'où l'importance excessive qu'il attachera, sa vie durant, à l'illustration de sa maison. Alfred de Vigny vers l'âge de dix-sept ans en uniforme de sous-lieutenant de la Maison du roi, portrait attribué à François Joseph Kinson, Musée Carnavalet En mars 1804, Napoléon ayant fait don de l'Élysée à Murat, les Vigny déménagent, 1 rue du Marché d'Aguesseau, puis ultérieurement au 68, rue du Faubourg-Saint-Honoré5. En 1807 il devient pensionnaire à l'institution Hix, rue Matignon, où ses bonnes manières et ses excellentes notes lui attirent l'hostilité de ses camarades. Il y expérimente la solitude. Au lycée Bonaparte, il prépare avec sérieux mais sans enthousiasme Polytechnique. Après la chute de l'Empire, il est affecté le 6 juillet 1814 à la première Compagnie rouge, celle des gendarmes du roi, avec le grade de lieutenant. Carrière militaire Sa carrière militaire dure plus de dix ans et n'est guère exaltante. Blessé au genou lors d'une manœuvre, il escorte néanmoins la calèche de Louis XVIII fuyant le retour de Napoléon pendant les Cent-Jours. En 1816, à la Seconde Restauration, il passe dans l'Infanterie de la Garde royale, au grade de sous-lieutenant. Il végète dans les compagnies rouges, mène la vie de garnison monotone et sans éclat. En 1822 il est nommé lieutenant titulaire de son régiment, l'équivalent de capitaine. Il espère prendre part à l'expédition d'Espagne en 1823, mais un autre bataillon est désigné pour partir. Toutefois il sent qu'il peut concrétiser là-bas ses rêves de gloire militaire. Le 55e régiment de ligne étant supposé franchir les Pyrénées, il accomplit les démarches nécessaires à sa mutation. Lors d'une étape à Angoulême, il prend huit jours de congé pour visiter une de ses tantes, qui a pris possession du Maine-Giraud. Cette distraction compromet ses plans. Lorsqu'il retrouve son régiment à Bordeaux, la guerre d'Espagne est pratiquement finie, Ferdinand VII ayant été rétabli sur le trône. Il ne se passe plus rien jusqu'en 1827, date à laquelle il jette l'éponge et quitte l'armée. Il tire profit de son temps libre pour lire et faire des vers, préparant son entrée dans le monde littéraire. La figure du romantisme Othello traduit en vers devient Le More de Venise Son premier texte publié est un essai sur l'œuvre de Byron, dont les œuvres complètes sont parues en 1820. Le Bal, son premier poème, est publié la même année. Les deux textes paraissent dans Le Conservateur littéraire, la revue de Victor Hugo. Vigny le fréquente, ainsi que Charles Nodier, Alexandre Soumet et le reste du Cénacle. Il devient ami de Victor Hugo et publie en 1822 un recueil de poésie, sous couvert d'anonymat. L'ouvrage passe inaperçu. Le 22 octobre de la même année il est témoin du mariage de Hugo avec Adèle Foucher. Il est reçu chez Sophie Gay, désireuse de le voir épouser sa fille Delphine, la Muse de la patrie », mais Mme de Vigny fait obstacle au projet. Son « aventure » espagnole est pour lui l'occasion de composer Le Trappiste, Dolorida et Eloa, poèmes bien accueillis qui contribuent à éclairer son nom. En 1824 il collabore à La Muse française, fréquente le salon de Virginie Ancelot et fait la connaissance de Marie de Flavigny, future comtesse d'Agoult. Alors qu'il est en garnison à Bayonne, il s'éprend d'une Anglaise, Lydia Bunbury, qu'il épouse l'année suivante. En 1826, il s'installe à Paris avec sa femme et publie Les poèmes antiques et modernes et Cinq-Mars, premier vrai roman historique à la française. Considéré comme le Walter Scott français, il s'essaye également au théâtre, avec une adaptation en vers d'Othello. La première représentation à la Comédie-Française, le 24 octobre 1829, est houleuse, et préfigure celle d’Hernani. Il assiste sagement à la création de la pièce le 25 février 1830, aux côtés notamment de Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Un mois plus tard, Christine d'Alexandre Dumas enfonce le clou du théâtre romantique. Après la première du 30 mars, Dumas prie Hugo et Vigny de corriger son texte, ce qui est chose faite dans la nuit même. Le dramaturge à succès La révolution de Juillet réveille en lui le pessimisme. Il réagit vivement devant les erreurs répétées des gouvernements de la Restauration. Les ordonnances du ministère Polignac le font douter de la politique. La Maréchale d’Ancre, représentée à l’Odéon le 25 juin 1831, avec laquelle il fait sa véritable entrée au théâtre, exprime ces doutes. À travers ce drame historique il se prononce pour l'idée de l’abolition de la peine de mort en matière politique. C'est à cette époque qu'il entame une liaison tumultueuse avec Marie Dorval, après lui avoir fait une cour respectueuse. Mais Vigny, d'un tempérament jaloux et possessif, s'accommode mal du mode de vie de l'actrice, sans cesse sur les routes au sein d'une troupe de comédiens ambulants. La promiscuité des chambres fait craindre le pire au poète. Dorval est alors célèbre pour ses rôles dans Antony ou Marion Delorme — drames romantiques par excellence. Comme elle a l'ambition de brûler les planches de la Comédie-Française, il lui écrit Quitte pour la peur 1833, gracieux proverbe qui doit prouver qu'elle peut tout jouer. Il écrit ensuite pour elle un drame cette fois : Chatterton. La pièce, écrite en douze jours et créée le 12 février 1835 à la Comédie-Française, rencontre un succès prodigieux. Sand, Musset, Sainte-Beuve, Du Camp, Berlioz figurent parmi le public et applaudissent en chœur l'auteur et la comédienne, qui triomphe dans le rôle de Kitty Bell. Marie Dorval joue ensuite le rôle dans de nombreuses villes de France où elle défend avec ferveur la pièce de Vigny. Désillusions et pessimisme Chatterton est tiré d'un roman philosophique que Vigny venait de publier : Consultations du Docteur Noir : Stello ou les Diables bleus 1832. Stello est un récit mêlé d’histoire, de philosophie et de roman qui rappelle Sterne et Diderot. À travers les trois exemples d'André Chénier, Nicolas Gilbert et Thomas Chatterton, Vigny développe, dans un ton amer et désabusé, l'idée que la vie moderne transforme le poète en paria. Le poète est un être à part, un génie malheureux, inadapté au quotidien, que le monde trivial fait souffrir, qui vit dans une profonde solitude. Écrasé par les matérialités de la vie, il est contraint, s'il veut subsister, d'accepter des fonctions utilitaires qui le détournent de sa mission. Cette conception amère de la poésie préfigure la vogue des poètes maudits. Servitude et Grandeur Militaires 1835, est une autre œuvre en prose. Vigny se penche sur la figure du soldat, autre paria de la vie moderne. Trois récits illustrent la condition humaine du militaire, écartelé par son devoir d'obéissance et sa conscience d'homme libre. L'avenir semble lui appartenir mais aux alentours de 1837 tout s'assombrit : la mort de sa mère, sa rupture avec Marie Dorval et des brouilles successives avec ses anciens amis du Cénacle le font quitter le devant de la scène. Il cesse brusquement de publier, à l'exception de quelques poèmes qui paraissent dans la Revue des deux Mondes en 1843-44, puis en 1854. La coupe du scepticisme Cependant, à partir de 1830, Vigny s'assombrit. La révolution de Juillet l'obligea à prendre conscience d'un pessimisme politique que les erreurs répétées des gouvernements de la Restauration avaient éveillé en lui et qui perçait dans Cinq-Mars, roman de la noblesse écrasée par le pouvoir monarchique. Devait-il reprendre du service et voler au secours d'un roi déconsidéré ? La rapidité du dénouement des Trois Glorieuses l'empêcha de conclure posément son examen de conscience. Engagé dans la garde nationale, dont il commanda, pendant deux années, une compagnie, il ne put accorder toute sa confiance à Louis-Philippe, hissé sur le trône par une bourgeoisie d'argent qu'il méprisait. Il espéra trouver un réconfort politique du côté des saint-simoniens et des chrétiens regroupés autour de Lamennais. Mais, dès 1831, il confessa son désappointement dans « Paris », composition d'un genre nouveau, plus ambitieuse que le « poème », qu'il appelait « élévation ». Il se sentait d'autant plus morose que, dans le même temps, il mesurait toute la distance qui le séparait désormais de la croyance en la divinité de Jésus. Il était bien le frère de ces « Amants de Montmorency » dont le suicide venait de lui inspirer une autre « élévation », amèrement conclue : « Et Dieu ? – Tel est le siècle, ils n'y pensèrent pas. » Il ne lui restait plus, pour vider la coupe du scepticisme, qu'à douter de l'amour humain. C'est la leçon qu'il tira de sa liaison avec Marie Dorval, laquelle créa, dans Chatterton (1835), le rôle de Kitty Bell. Déçu, trompé peut-être, il se persuada que la lutte des sexes était inscrite dans la destinée de l'humanité, et il se prit pour un nouveau Samson. Les œuvres contemporaines de cette crise décisive se signalent par leur lucidité et, le plus souvent, par leur noirceur. L'isolement du poète : telle est l'« idée » qui gouverne les trois récits de Stello (1832), selon la technique romanesque recommandée dans la préface de Cinq-Mars. La légèreté de Louis XV condamne Gilbert à mourir de faim. Le fanatisme de Robespierre, tyran républicain, mène Chénier à l'échafaud. L'égoïsme de Beckford, lord-maire de Londres, provoque le suicide de Chatterton. Le pouvoir, quel qu'il soit, frappe donc le poète d'un « ostracisme perpétuel ». Tout en dénonçant une malédiction qui le menaçait lui-même, Vigny entreprit de la comprendre et de la combattre. Au lieu de rejeter l'entière responsabilité du conflit sur les ennemis du poète, il soumit Stello à une sorte d'examen psychanalytique, mené par le « docteur Noir ». Ce dernier, qui traite la victime en malade, lui prescrit de « séparer la vie poétique de la vie politique » et d'observer vis-à-vis de la société une « neutralité armée ». Mais Vigny voulut aussi exorciser le mal en portant sur la scène l'agonie de Chatterton. Ce fut le triomphe de sa carrière d'homme de théâtre. Le drame de Chatterton éclipsa le mélodrame de La Maréchale d'Ancre (1831) et l'acte comique de Quitte pour la peur (1836). Le pessimisme de Stello et de Chatterton n'a d'égal que celui de Servitude et grandeur militaires (1835). Il convenait que Vigny rendît témoignage de ses déboires militaires comme de ses désillusions politiques. Il composa de nouveau un triple récit, dont il tirait l'argument de ses propres souvenirs. Du soldat il fit un frère du poète, un « paria », tenu à l'écart de la communauté par l'exercice de l'« obéissance passive » ou la fascination du séidisme. Mais il associa au constat de sa servitude la révélation de sa grandeur. Il donna en exemple à ses contemporains, accablés par le « naufrage universel des croyances », la destinée du capitaine Renaud, martyr de la non-violence, prophète d'une religion de la conscience, aïeul du « saint sans Dieu » d'Albert Camus. Sublimant l'abnégation requise par le métier des armes, il exalta l'honneur, « vertu tout humaine que l'on peut croire née de la terre, sans palme céleste après la mort [...] vertu de la vie ». Et il s'émerveilla, en sa double qualité de poète et de moraliste, que la parole d'honneur pût restaurer le pouvoir sacré du langage. Ce sursum corda ne suffit pourtant pas à contenir les progrès du doute. Tandis que le dramaturge et le romancier donnaient l'illusion de surmonter l'épreuve dans laquelle leurs personnages se débattaient, le poète se tenait dans une inquiétante réserve. Au vrai, l'orgueilleux Vigny, plutôt que de succomber comme un « faible » à la tentation du suicide, rêvait de prendre une retraite volontaire, où « l'âme puisse se recueillir en elle-même, jouer de ses propres facultés et rassembler ses forces pour produire quelque chose de grand ». Après avoir réédité ses Poèmes, conduit sa mère à sa dernière demeure et rompu avec Marie Dorval (1837-1838), il franchit le pas. Il s'enferma, sans bruit, dans sa « tour d'ivoire », selon l'expression malveillante de Sainte-Beuve. Il préféra de plus en plus au babillage parisien le calme de son manoir charentais du Maine-Giraud. Des accès de sociabilité le reprenaient parfois. En 1841, il mena toute une campagne pour la reconnaissance du droit de l'écrivain à disposer de ses écrits. Balzac l'approuva. Lamartine lui promit son aide au Parlement. L'article qu'il publia dans La Revue des Deux Mondes, du 15 janvier : « De Mlle Sédaine et de la propriété littéraire », émut l'opinion. Mais un projet de loi qui s'en inspirait fut repoussé par la Chambre le 29 mars. Vigny, soucieux de fortifier son autorité d'avocat d'une juste cause, posa sa candidature à l'Académie française. Il subit cinq échecs. Élu enfin, il fut accueilli sous la coupole par un discours perfide de Molé. Au jeu de la consécration sociale il manquait décidément d'efficacité. Il y fut tout à fait perdant sous la IIe République, puisqu'il n'obtint ni le poste d'ambassadeur à Londres ni même un modeste mandat de député de la Charente. Le second Empire ne le traita guère mieux. Napoléon III, qu'il avait rencontré, exilé, en 1839, négligea ses avances. Le désenchantement de Stello était-il sans remède ? Le poète de « L'Esprit pur » Avant de quitter ce monde, qu'il comparait à une prison, le solitaire du Maine-Giraud reçut la consolation d'un dernier amour. Il venait de dépasser la soixantaine. Alors qu'il soignait Lydia avec le dévouement d'un « frère hospitalier » et qu'il commençait à souffrir lui-même d'un cancer, il obtint les faveurs d'une jeune préceptrice, rencontrée peut-être dans le salon de Louise Colet, Augusta Bouvard. En la personne de sa compagne il reconnut l'Eva de ses rêveries. Mais il fallut bientôt lui dire adieu. Vigny mourut à Paris le 17 septembre, moins d'un mois après Lydia, dont il n'avait pas eu de descendance. Le 28 octobre, Augusta mit au monde un fils auquel certains vers de « L'Esprit pur », achevé le 10 mars, semblaient destinés : Jeune postérité d'un vivant qui vous aime !Mes traits dans vos regards ne sont pas effacés ;Je peux en ce miroir me connaître moi-même. Vigny laissait, entre les mains de son exécuteur testamentaire, Louis Ratisbonne, et de sa filleule, Louise Lachaud, née Ancelot, de nombreux et précieux inédits. La publication des Destinées (1864), du Journal d'un poète (1867), de Daphné (1913) et des Mémoires inédits (1958) permit de percer le secret d'un long silence qui n'avait été interrompu que par la publication, dans La Revue des Deux Mondes, de quelques « poèmes philosophiques » : « La Sauvage », « La Mort du loup » et « La Flûte » (1843), « Le Mont des Oliviers » et « La Maison du Berger » (1844), « La Bouteille à la mer » (1854). Il apparaît aujourd'hui que la retraite au Maine-Giraud ne cachait ni une démission de l'homme ni une défaillance de l'artiste. Le Journal retrace toute l'évolution intime du solitaire, depuis la dernière prière au Dieu de la Bible, le 21 décembre 1837, devant la dépouille d'une mère vénérée, jusqu'à l'annonce du règne de l'Esprit pur (mars 1863), en passant par les détours d'une méditation persévérante sur la fonction des rites, des idoles et des signes. Au cours de sa recherche, Vigny s'identifia, d'abord, à Julien l'Apostat, spiritualiste malheureux, vaincu par les barbares adorateurs de la Croix. Mais, au moment même où il relatait, dans Daphné, achevé dès 1837, la défaite de son héros, il convenait, dans le Journal, qu'« une religion sans culte serait comme un amour sans caresses » et que « l'image soutient l'âme dans l'adoration comme le chiffre dans le calcul ». Il se mit donc en quête, sans transiger avec son refus de l'idolâtrie, des symboles qui pourraient envelopper le trésor de l'Esprit d'un « cristal préservateur ». C'est ainsi qu'il inventa, à défaut d'une religion épurée, une poésie nouvelle, dépouillée de l'éloquence ou du pittoresque de ses premiers chants. Rare, parfois austère, elle s'anime dans le chef-d'œuvre des Destinées, « La Maison du Berger » ; elle s'y concentre aussi dans des formules qui la définissent : Poésie ! Ô trésor ! perle de la pensée !Ô toi des vrais penseurs impérissable amour ! Qui contesterait l'heureux résultat de l'ascèse que Vigny s'imposa ? Plusieurs des symboles qu'il chargea de « profondes pensées » : la Mort du loup, la Maison du Berger, la Bouteille à la mer, figurent dans la fable moderne. Le vœu formé par le poète de « L'Esprit pur » dans les derniers vers qu'il trouva la force de scander s'est accompli : Flots d'amis renaissants ! Puissent mes destinées Vous amener à moi, de dix en dix années, Attentifs à mon œuvre, et pour moi c'est assez ! Paul Viallaneix La retraite au Maine-Giraud Il fait alors quatre séjours dans son domaine de Charente, le logis du Maine-Giraud à Champagne-de-Blanzac renommée Champagne-Vigny en 1983, en 1838, 1846, 1848-49 et 1850-53, soit, au total, pendant cinq des vingt-cinq dernières années de sa vie. Là il veille sur sa femme Lydia, quasiment infirme et silencieuse. Au cours de ses passages en Charente, il s’intéresse à la vie du domaine, qu’il restaure et entretient, tandis qu’il poursuit son œuvre, rédigeant une partie de ses Mémoires de famille, puis de ses Mémoires politiques, et travaillant à quelques poèmes. C’est ainsi qu’en 1838 il met au net La Mort du loup dans sa tour du Maine-Giraud; en 1846, il y dresse le plan de La Bouteille à la mer qu'il termine, au même endroit, en 1853 ; en 1849, il y achève Les Destinées, texte qui donnera son titre au recueil de 186413. Éloigné des salons parisiens, il n'en demeure pas moins attentif à la vie littéraire et politique de son temps. En octobre 1852 il dîne même à Angoulême avec le prince-président Louis-Napoléon qui voyage en province à des fins de propagande les deux hommes s’étaient rencontrés en 1839, à Londres. Entre ses séjours charentais, Vigny se présente vainement à cinq reprises à l’Académie. Il endure les visites et réceptions des académiciens, pour la plupart hostiles au romantisme et à ses idées. Il est finalement élu le 8 mai 1845. La réception a lieu le 29 janvier 1846. Son discours, célébrant le romantisme, est d'une longueur inhabituelle. De plus il a refusé de faire, à cette occasion, l'éloge de la branche cadette et du roi Louis-Philippe. La réponse de Mathieu Molé est cinglante. Molé critique ouvertement le courant romantique et les œuvres du poète. Il ne se prive pas pour nier leur mérite et condamner leur manque de vérité, ce qui achève de mortifier l'auteur15. Par ailleurs, Vigny échoue à faire élire Balzac à l'Académie le 18 janvier 1849, malgré le soutien de Hugo. Le poète ne réussit pas davantage à se faire élire député de Charente, après s'être présenté deux fois aux élections en 1848 et 1849. Vigny retourne à Paris en octobre 1853. Il revoit le prince-président, rencontré l’année précédente, et devenu Empereur des Français. L'écrivain ne tarde pas à devenir partisan du Second Empire. Il reçoit par ailleurs la visite d'un Jules Barbey d’Aurevilly admiratif et de Charles Baudelaire lors de sa candidature à l'Académie, campagne qui se révèlera désastreuse. Les deux poètes sympathisent. À cette époque, il multiplie les liaisons amoureuses, avec Louise Colet, l'ancienne maîtresse de Flaubert et de Musset, puis avec Elisa Le Breton et enfin avec Augusta Bouvard, toutes deux à peine âgées de vingt ans. Vigny 1879 Quelques années plus tard, en décembre 1862, sa femme Lydia Jane Bunbury décède. Vigny la rejoint le 17 septembre 1863 à une heure du soir. Il souffrait depuis quelques années d’un cancer à l’estomac. Il meurt en son domicile, au 6, rue des Écuries d'Artois, son décès est déclaré le 18 par Louis Ratisbonne, homme de lettres, 36 ans, demeurant 121 avenue de Saint-Cloud Paris, 16e arrondissement et par son cousin Louis Joseph de Pierres, 36 ans, demeurant 11, rue de La Soudière Saint-Honoré. Il est enterré dans le cimetière de Montmartre à Paris 13e division. Nul autre, parmi les romantiques, n'est aussi personnel que Vigny : dans la plupart de ses poèmes, il exprime un « moi » hautain et jaloux. Cependant, il se met rarement en scène : Il est tantôt Moïse, tantôt Samson, tantôt Jésus même cf. le Mont des Oliviers, et ses plus belles pièces se présentent presque toutes comme des symboles; à l'expression de ses sentiments, il donne, en les détachant pour ainsi dire de sa personnalité, une valeur et une portée générales. La solitude, à laquelle condamnent le génie, l'indifférence des hommes, la trahison de la femme cf. sa relation avec Marie Dorval, l'impassibilité de la Nature et le silence de la Divinité en présence de nos maux, la résignation stoïque qu'il convient de leur opposer, telles sont les idées maîtresses de ce poète philosophe. On le dit souvent artiste laborieux et chagrin, l'invention verbale lui manquerait, et la veine, et le souffle. Il n'a fait, d'ailleurs, en tout, qu'une quarantaine de morceaux dont on a pu dire que beaucoup sont obscurs, entortillés. Dix ou douze seulement mériteraient de survivre, comme Moïse, la Bouteille à la mer, la Mort du loup, la Maison du berger, le Mont des Oliviers, la Colère de Samson, Eloa ou la sœur des anges, etc. Mais ceux-là valent ce que la poésie française a produit de plus beau. Le précurseur du roman historique Cinq Mars n'est pas le premier roman historique français. Victor Hugo, après avoir rédigé Bug-Jargal, l'histoire d'une romance sur fond de révolte des esclaves à Saint-Domingue en 1791 publié dès 1820, publie en 1823 Han d'Islande, un roman d'inspiration gothique. L'intrigue, située en Norvège en 1699, et les personnages sont conçus à partir « de matériaux historiques et géographiques. L'idée du livre est née des romans de Walter Scott. Les Waverley novels sont traduits par Defauconpret en France dès 1816. La popularité de Scott acquiert une dimension sans équivalent en France et en Europe. Hugo, comme Vigny, puis Balzac et Mérimée, est un héritier de Walter Scott. Il est le premier à s'emparer de cet héritage et à tenter d'adapter les conceptions de l'écrivain écossais au récit français, démarche louée par Vigny : « Vous avez posé en France les fondements de Walter Scott. Votre beau livre sera pour nous comme le pont de lui à nous et le passage de ses couleurs à celles de la France. » Cette lettre annonce son travail à venir sur Cinq Mars. En même temps qu'il loue le roman de Hugo, Vigny regrette qu'il n'ait pas fait un pas de plus et naturalisé le roman historique aux couleurs de la France. Il considère Han d'Islande comme une étape et une œuvre de transition. Il souhaite créer une œuvre en prose assez large, comparable aux grands poèmes épiques. Dans les romans de Scott, les personnages principaux sont fictifs, l'histoire et les grands hommes apparaissent en toile de fond du récit. Vigny renverse ce choix narratif et place les hommes illustres au premier plan, procédé qui contribue à créer un genre hybride entre le roman et l'histoire, mais aussi à créer un décalage entre le fait historique et l'action. De fait, Cinq-Mars cristallise l'épineux problème du rapport entre histoire et fiction, et de la vraisemblance narrative. Sainte-Beuve juge le roman « totalement manqué en tant qu'historique ». Il reproche à l'auteur de mal peindre l'histoire — reproche récurrent auquel n'a pas échappé Scott. Il relève, dans cet « ingénieux roman », « calculé comme une partie d'échec », « la fausseté de la couleur, le travestissement des caractères, les anachronismes de ton perpétuels ». Pour être le Walter Scott français, « M. Vigny n'eut jamais, pour réussir à pareil rôle, la première des conditions, le sentiment et la vue de la réalité. » Vigny publie sa théorie du roman historique dans la troisième édition de Cinq-Mars 1827, dans une préface intitulée « Réflexions sur la vérité dans l'art ». Il défend l'idée d'un récit qui « perfectionne l'évènement pour lui donner une grande signification morale ». Répondant aux critiques qui lui reprochent ses écarts d'imagination et de poésie, il affirme que la liberté qu'il prend avec l'histoire est « la liberté que les Anciens portaient dans l'histoire même », car « à leurs yeux l'histoire était aussi une œuvre d'art » — Clio était la Muse de l'Histoire sous l'Antiquité. En 1829, il aura l'honneur de certifier le mot lyrisme. Les poèmes philosophiques Réception et postérité Vigny est d'abord, pour la critique, le poète d'Éloa et de Moïse : Sainte-Beuve : « Il est de cette élite de poètes qui ont dit des choses dignes de Minerve. Les philosophes ne le chasseront pas de leur république future. », « il a eu le droit de dire à certains jours et de se répéter à son heure dernière : J'ai frappé les astres du front. » Éloa est qualifiée d'« acte de haute poésie », « éclatant produit d'un art tout pur et désintéressé. » Théophile Gautier : « Peu d'écrivains ont réalisé comme Alfred de Vigny l'idéal qu'on se forme du poète », Éloa étant qualifié de « poème le plus beau, le plus parfait peut-être de la langue française. » Gautier apprécie de manière générale « la proportion exquise de la forme et de l'idée. » Barbey d'Aurevilly : Vigny est « un de ces poètes pour lesquels on donnerait toutes les Académies de la terre. » Pour lui Vigny « avait résolu le problème éternel manqué par tous les poètes, d'être pur et de ne pas être froid. » Éloa représente « le fond incommutable de son génie », c'est « l'Athalie du romantisme ». Barbey, évoquant Moïse, parle de « grandeur du sentiment et de l'idée », d'« ineffable pureté des images », de la « solennité de l'inspiration », de la « transparence d'une langue qui a la chasteté de l'opale. » Leconte de Lisle : « La nature de ce rare talent le circonscrit dans une sphère chastement lumineuse et hantée par une élite spirituelle très restreinte, non de disciples, mais d’admirateurs persuadés. (...) De ce sanctuaire sont sortis, avec une discrétion un peu hautaine à laquelle j’applaudis, ces poèmes d’une beauté pâle et pure, toujours élevés, graves et polis comme l’homme lui-même. », « l’élévation, la candeur généreuse, la dignité de soi-même et le dévouement religieux à l’art, suffisent à l’immortalité de son nom. » Flaubert : « Ça m'a l'air d'un excellent homme, ce bon de Vigny. C'est du reste une des rares honnêtes plumes de l'époque : grand éloge ! Je lui suis reconnaissant de l'enthousiasme que j'ai eu autrefois en lisant Chatterton. (Le sujet y était pour beaucoup. N'importe.) Dans Stello et dans Cinq-Mars il y a aussi de jolies pages. Enfin c'est un talent plaisant et distingué, et puis il était de la bonne époque, il avait la Foi ! Il traduisait du Shakespeare, engueulait le bourgeois, faisait de l'historique. On a eu beau se moquer de tous ces gens-là, ils domineront pour longtemps encore tout ce qui les suivra. Rémy de Gourmont : «Vigny, au milieu de sa poésie incertaine et techniquement inhabile, a eu le bonheur de créer cinq ou six vers qui sont entrés et qui restent dans toutes les mémoires ; mais quand on se reporte au texte, ils sont trop souvent encadrés d’expressions assez médiocres. Il traîne après lui trop d’images usées, trop de déités, trop de songes livides, trop de savants penseurs et trop de fronts d’albâtre ! Ce romantique l’est vraiment resté bien peu, après avoir devancé dans la forme comme dans l’inspiration presque tous ses contemporains. Il les a influencés tous, et Victor Hugo, pour se faire une philosophie, n’a eu qu’à contredire celle de Vigny. Mais Hugo est tombé dans une grande banalité de pensée. Alfred de Vigny, du moins, n’est jamais banal, sa pensée est toujours haute en même temps que hautaine. On peut détester son parti pris, ses dédains, son mépris ; on ne lui reprochera jamais d’avoir humilié l’esprit, car il a écrit Le Cor, La Maison du berger, La Mort du loup, et, malgré quelques faiblesses de verbe, il y a peu de choses qui soient plus belles Le jeune Marcel Proust, dans son célèbre questionnaire, déclare que Baudelaire et Vigny sont ses deux poètes préférés31, jugement qu'il confirme à la fin de sa vie : « je tiens Baudelaire — avec Alfred de Vigny — pour le plus grand poète du xixe siècle. Parlant de La colère de Samson, il relève « l'extraordinaire tension » du poème. L'un des vers de ce poème servira d'épigraphe et fournira le titre de Sodome et Gomorrhe. Pour Proust, le mystère ajoute aux qualités du poète : «Tout aussi bien dans ses poésies calmes Alfred de Vigny reste mystérieux, la source de ce calme et de son ineffable beauté nous échappe. Distinctions Officier de la Légion d'honneur. Liste chronologique des œuvres Poèmes antiques et modernes, page de titre de l'édition 1829 Poèmes 1822 Éloa, ou La Sœur des Anges 1824 Poèmes antiques et modernes 1826 Cinq-Mars 1826 Roméo et Juliette 1828, traduction en vers de la pièce de Shakespeare Shylock 1828, adaptation en vers du Marchand de Venise Le More de Venise 1829, traduction en vers d'Othello, précédé de la Lettre à Lord *** La Maréchale d'Ancre 1830 L'Almeh Scènes du Désert 1831 inachevé Les Consultations du Docteur Noir : Stello ou les Diables bleus : première consultation 1832 Quitte pour la peur 1833 Servitude et grandeur militaires 1835 Chatterton 1835 Daphné : seconde consultation du Docteur Noir 1837 inachevé Les Destinées 1864 Journal d'un poète 1867 ; réédité par Gallimard dans la collection Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres complètes 1883-1885 Poésie Le cor I J'aime le son du Cor, le soir, au fond des bois, Soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois, Ou l'adieu du chasseur que l'écho faible accueille, Et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Que de fois, seul, dans l'ombre à minuit demeuré, J'ai souri de l'entendre, et plus souvent pleuré ! Car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques Qui précédaient la mort des Paladins antiques. O montagnes d'azur ! ô pays adoré ! Rocs de la Frazona, cirque du Marboré, Cascades qui tombez des neiges entraînées, Sources, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées ; Monts gelés et fleuris, trône des deux saisons, Dont le front est de glace et le pied de gazons ! C'est là qu'il faut s'asseoir, c'est là qu'il faut entendre Les airs lointains d'un Cor mélancolique et tendre. Souvent un voyageur, lorsque l'air est sans bruit, De cette voix d'airain fait retentir la nuit ; A ses chants cadencés autour de lui se mêle L'harmonieux grelot du jeune agneau qui bêle. Une biche attentive, au lieu de se cacher, Se suspend immobile au sommet du rocher, Et la cascade unit, dans une chute immense, Son éternelle plainte au chant de la romance. Ames des Chevaliers, revenez-vous encor? Est-ce vous qui parlez avec la voix du Cor ? Roncevaux ! Roncevaux ! Dans ta sombre vallée L'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée ! II Tous les preux étaient morts, mais aucun n'avait fui. Il reste seul debout, Olivier prés de lui, L'Afrique sur les monts l'entoure et tremble encore. "Roland, tu vas mourir, rends-toi, criait le More ; "Tous tes Pairs sont couchés dans les eaux des torrents." Il rugit comme un tigre, et dit : "Si je me rends, "Africain, ce sera lorsque les Pyrénées "Sur l'onde avec leurs corps rouleront entraînées." "Rends-toi donc, répond-il, ou meurs, car les voilà." Et du plus haut des monts un grand rocher roula. Il bondit, il roula jusqu'au fond de l'abîme, Et de ses pins, dans l'onde, il vint briser la cime. "Merci, cria Roland, tu m'as fait un chemin." Et jusqu'au pied des monts le roulant d'une main, Sur le roc affermi comme un géant s'élance, Et, prête à fuir, l'armée à ce seul pas balance. III Tranquilles cependant, Charlemagne et ses preux Descendaient la montagne et se parlaient entre eux. A l'horizon déjà, par leurs eaux signalées, De Luz et d'Argelès se montraient les vallées. L'armée applaudissait. Le luth du troubadour S'accordait pour chanter les saules de l'Adour ; Le vin français coulait dans la coupe étrangère ; Le soldat, en riant, parlait à la bergère. Roland gardait les monts ; tous passaient sans effroi. Assis nonchalamment sur un noir palefroi Qui marchait revêtu de housses violettes, Turpin disait, tenant les saintes amulettes : "Sire, on voit dans le ciel des nuages de feu ; "Suspendez votre marche; il ne faut tenter Dieu. "Par monsieur saint Denis, certes ce sont des âmes "Qui passent dans les airs sur ces vapeurs de flammes. "Deux éclairs ont relui, puis deux autres encor." Ici l'on entendit le son lointain du Cor. L'Empereur étonné, se jetant en arrière, Suspend du destrier la marche aventurière. "Entendez-vous ! dit-il. - Oui, ce sont des pasteurs "Rappelant les troupeaux épars sur les hauteurs, "Répondit l'archevêque, ou la voix étouffée "Du nain vert Obéron qui parle avec sa Fée." Et l'Empereur poursuit ; mais son front soucieux Est plus sombre et plus noir que l'orage des cieux. Il craint la trahison, et, tandis qu'il y songe, Le Cor éclate et meurt, renaît et se prolonge. "Malheur ! c'est mon neveu ! malheur! car si Roland "Appelle à son secours, ce doit être en mourant. "Arrière, chevaliers, repassons la montagne ! "Tremble encor sous nos pieds, sol trompeur de l'Espagne ! IV Sur le plus haut des monts s'arrêtent les chevaux ; L'écume les blanchit ; sous leurs pieds, Roncevaux Des feux mourants du jour à peine se colore. A l'horizon lointain fuit l'étendard du More. "Turpin, n'as-tu rien vu dans le fond du torrent ? "J'y vois deux chevaliers : l'un mort, l'autre expirant "Tous deux sont écrasés sous une roche noire ; "Le plus fort, dans sa main, élève un Cor d'ivoire, "Son âme en s'exhalant nous appela deux fois." Dieu ! que le son du Cor est triste au fond des bois !   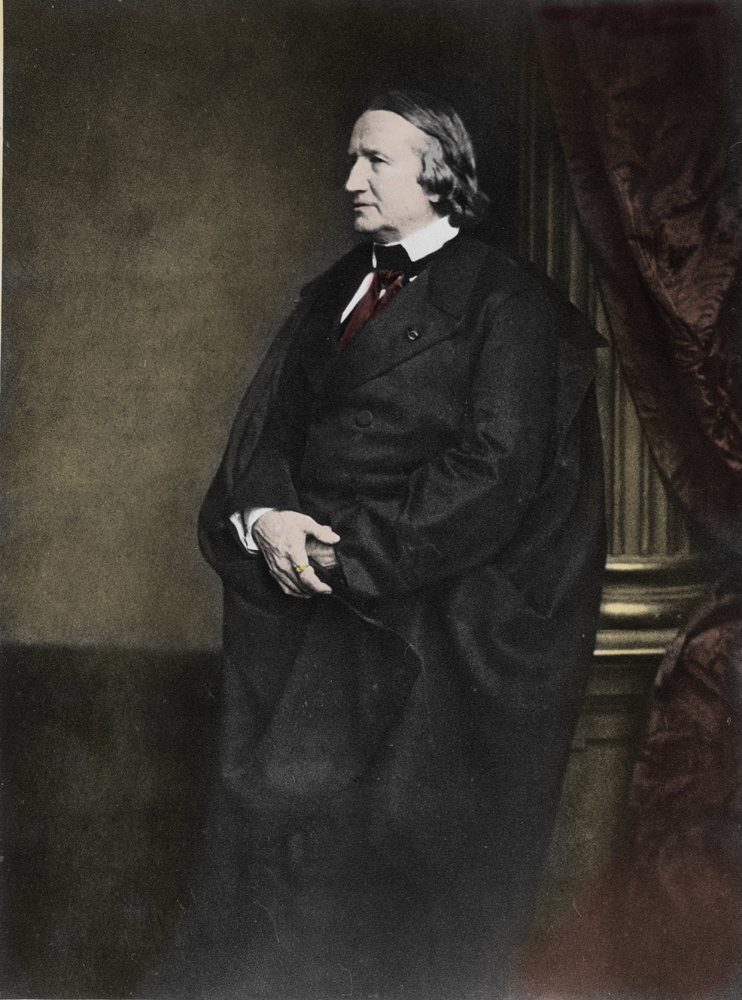 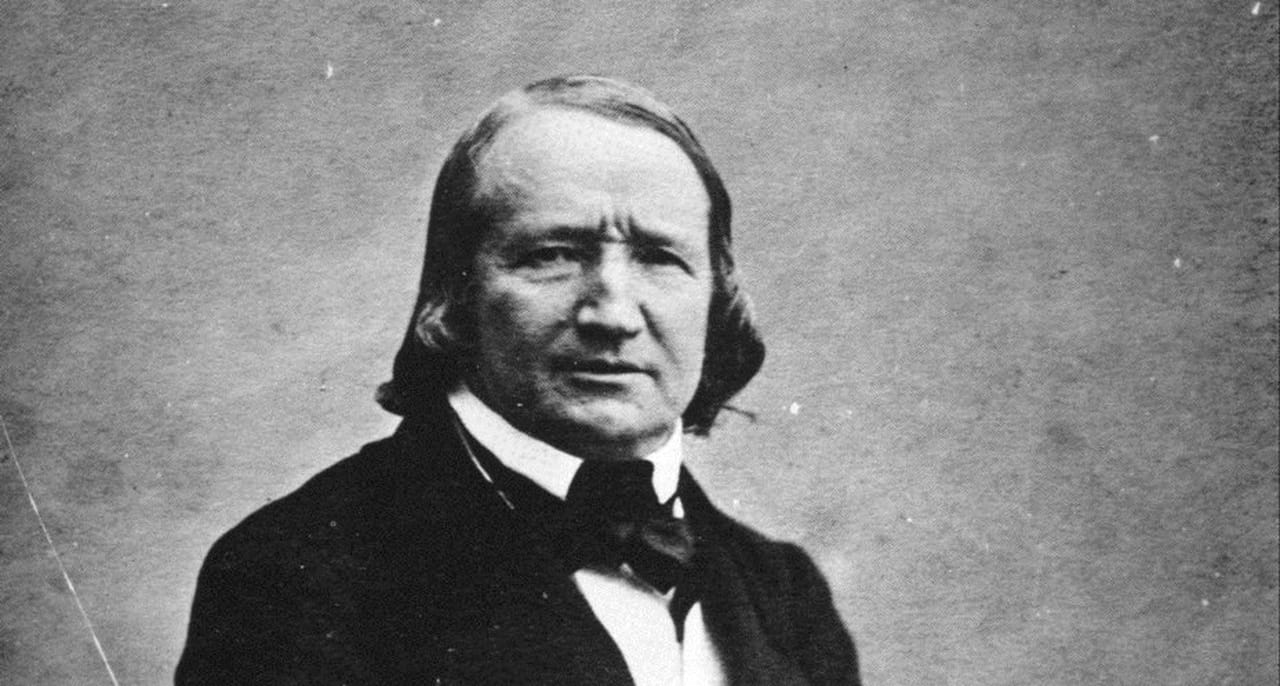  
#34
Bruno Bettelheim
Loriane
Posté le : 13/03/2016 18:20
Le 13 mars 1990 meurt Bruno Bettelheim
à Silver Spring dans le Maryland, né le 28 août 1903 à Vienne, pédagogue et psychologue écrivain, professeur d'université et psychiatre américain d'origine autrichienne il travaille à l'université de Chigago ou il es. Il reçoit sa formation à l' université de Vienne Il s'est rendu célèbre par la publication de livres de vulgarisation où il explique les théories pédagogiques et psychothérapiques, mises en œuvre à son École d'orthogénie de l'Université de Chicago qu'il a dirigée pendant trente ans. Son statut de psychanalyste est sujet à controverse. Il est décrit par certains comme psychanalyste autodidacte. Il est membre de l' académie américaine des arts et des sciences, national book award. En bref Psychanalyste américain d'origine autrichienne, Bruno Bettelheim fit des études de psychologie et de psychiatrie à l'université de Vienne, sa ville natale. Il acquit ensuite une solide formation psychanalytique. D'origine juive, il est déporté, en 1938, à Dachau puis à Buchenwald, expérience qui allait inspirer son étude ultérieure intitulée Individual and Mass Behavior in Extreme Situations (1943 ; Comportement individuel et comportement de masse dans les situations extrêmes), étude que rendit célèbre le général Dwight Eisenhower en la donnant à lire à tous ses officiers. On y trouve déjà les thèses qui seront développées dans The Informed Heart (1960 ; Le Cœur conscient, Paris, 1977) et dans Survival (1979), et qui analysent la dégradation de l'homme et les moyens de survie dans les camps de concentration nazis. Émigré aux États-Unis en 1939, Bettelheim devient en 1944 professeur de psychologie de l'éducation (puis, en 1963, professeur de psychiatrie) à l'université de Chicago. C'est en 1944 aussi qu'il prend la direction de l'institut Sonia-Shankman, qu'il réforme, en 1947, en s'inspirant de la psychanalyse freudienne et qui, sous le nom de Chicago Orthogenic School (École orthogénique de Chicago), le rendra célèbre. En 1973, sa collaboratrice la plus proche, Jaqui Sanders, le remplace à la tête de cette institution psychiatrique. Bettelheim, qui en a totalement repensé le fonctionnement, a voulu en faire un lieu où le malade mental réapprend à vivre et dont il peut sortir sans difficulté de réadaptation. Ce centre « orthogénique », décrit dans A Home for the Heart (1974 ; Un lieu où renaître, Paris, 1975), accueille des enfants autistes dont Bettelheim a montré qu'il était possible de les guérir. Celui-ci, dans son ouvrage The Empty Fortress (1967 ; La Forteresse vide, Paris, 1969), a remis en question les idées qui prévalaient au sujet de l'autisme infantile et exposé ses propres théories sur la constitution et la naissance du « soi ». L'École orthogénique offre aux enfants autistes un « milieu thérapeutique total », dont l'environnement, le cadre de vie et la solidarité qui unit soignants et patients constituent l'esprit et le « ciment ». Elle s'est donné une triple fonction : le traitement des enfants psychotiques ; la formation du personnel soignant et enseignant ; la recherche. Elle assume la première de ces tâches en s'occupant de l'enfant à la fois sur le plan affectif et sur le plan intellectuel. On ne peut, en effet, redonner à l'enfant une vie affective normale sans lui fournir les outils nécessaires à son bien-être socio-économique. Le traitement lui-même repose sur un principe essentiel, qui consiste à procurer à l'enfant un environnement à tout instant favorable, aucun détail même matériel n'étant laissé au hasard. Les pensionnaires y sont répartis en six groupes de huit (trois de garçons, trois de filles), en fonction de l'âge, de la nature des symptômes et des affinités. La vie quotidienne de l'institution se rapproche le plus possible de celle que l'enfant aurait dans une famille idéale et n'est soumise à aucune règle disciplinaire, le personnel devant respecter tout ce que fait l'enfant. Les seules interventions visent à protéger celui-ci, à le rassurer, et les seules interdictions posées sont celles dont on pense qu'elles auront un effet thérapeutique. Bettelheim a banni de son institution tout pouvoir hiérarchisé, car, dit-il, « le pouvoir corrompt ». Il estime que l'École fonctionne parce que le thérapeute est aussi engagé que le patient dans cette aventure communautaire : son grand principe est qu'à travers la guérison du patient quelque chose en chacun se transforme. Dans son ouvrage intitulé Truants from Life (1955 ; Évadés de la vie, Paris, 1973) et composé de quatre monographies thérapeutiques d'enfants ayant séjourné quatre ou cinq ans à l'École orthogénique, Bettelheim montre « comment et pourquoi les personnalités de ces enfants sont développées avec succès au cours des années qu'ils ont vécues à l'école ». La théorie et les perspectives thérapeutiques de Bettelheim se réfèrent à Freud, à Aichorn et surtout à Erikson (notamment au principe de la « sécurité fondamentale »). Dans Symbolic Wounds (1954 ; Les Blessures symboliques, Paris, 1969), l'auteur analyse la signification des rites d'initiation en se reportant aux grandes explications anthropologiques et psychanalytiques, en particulier à celles de Freud dans Totem et Tabou. Utilisant de manière éclectique les notions de la psychanalyse classique, il sait exposer son expérience et ses réflexions avec une aisance remarquable, sans exclure à l'occasion une note d'humour critique. Il écrit ainsi dans The Children of the Dream (1969 ; Les Enfants du rêve, Paris, 1971), livre consacré aux méthodes d'éducation des kibboutz israéliens : « Il est bien connu que les malades en traitement avec un analyste freudien ont tendance à faire des rêves freudiens, alors que ceux qui sont soignés par des analystes qui pratiquent la méthode de Jung font des rêves de type jungien. » La manière dont Bettelheim envisage le développement de la personnalité permet de le rattacher au courant, si vivace aux États-Unis, de la « psychologie du Moi ». Dans Dialogues with Mothers (1962 ; Dialogues avec les mères, Paris, 1973), il attire l'attention des mères de famille sur tous les menus faits qui, sans que l'on s'en doute, marquent la vie d'un enfant et décident de son destin. Sa Psychanalyse des contes de fées (Paris, 1976 ; The Uses of Enchantement, 1976 étudie le sens et l'importance des contes dans l'éducation, notamment pour la libération des émotions chez l'enfant. Une série d'émissions télévisées consacrées par Daniel Karlin, en 1974, à Bettelheim, et publiées sous le titre Un autre regard sur la folie 1975, a contribué à faire connaître le grand thérapeute au public français. Pamela Tytell Sa vie Bruno Bettelheim effectua son parcours universitaire en philosophie à Vienne Autriche, où est conservée sa thèse de doctorat. Il s'intéressa ensuite à la psychanalyse, se forma auprès des psychanalystes de l'École de Vienne et fut lui-même analysé par Richard Sterba disciple direct de Sigmund Freud. Son père étant mort prématurément de la syphilis, il lui succéda à la tête de son commerce de bois. Bettelheim fut l'un des derniers juifs à passer un doctorat à l'université de Vienne en esthétique, une des branches de la philosophie avant l'Anschluss de mars 1938. Arrêté par les nazis en mai, il fut déporté dans les camps de concentration de Dachau puis, après les accords de Munich, de Buchenwald. Libéré en mai 1939, il émigra aux États-Unis. Son expérience des camps de concentration sera une des clés de ses théories psychanalytiques, il écrira sur les phénomènes psychologiques à l'œuvre, selon lui, au sein des camps de détention, entre les prisonniers et leurs tortionnaires et publie en 1943 Comportement individuel et comportement de masse dans les situations extrêmes dont la lecture fut rendue obligatoire par le général Eisenhower à tout officier des états-major américain en Allemagne. Cette étude fut complétée plus tard pour en faire un livre : Le Cœur Conscient. Il enseigna à l'Université de Chicago, dirigea une école consacrée aux enfants émotionnellement perturbés dont certains étaient psychotiques ou autistes. Bettelheim fut aux États-Unis l'un des plus éminents et ardents défenseurs du livre Eichmann à Jérusalem de la philosophe Hannah Arendt. Ayant perdu sa femme et redoutant la dégradation de sa santé, il se suicida le 13 mars 1990 en enfermant sa tête dans un sac en plastique; il avait 86 ans. Peu après, une polémique se développa sur sa réelle compétence de psychanalyste. Il reste toutefois le fondateur de deux concepts majeurs, auxquels il est couramment fait référence : celui de « forteresse vide » pour désigner ces remparts que dressent autour d’eux les jeunes autistes pour se protéger de leur sentiment de néant, et le concept de situation extrême, pour désigner la sensation de mort imminente qui déclenche chez l’individu des comportements de défense à la mesure de l'angoisse ressentie. Aperçu de ses idées Bruno Bettelheim considère que l'angoisse est l'élément central de la psychose de l'enfant. Il détecte dans les troubles comportementaux des enfants de l'École orthogénique des carences affectives et l'angoisse de la mort. Sa thérapie se fonde sur la construction d'un environnement rassurant, matériel et affectif, préalable nécessaire à toute démarche thérapeutique. D'un point de vue purement pédagogique, Bettelheim rejoint en cela des idées développées par A. S. Neill à l'École de Summerhill. Il insiste sur l'idée que, quels que soient les symptômes manifestés par les patients, ils sont la meilleure réponse que ceux-ci aient trouvée à leur angoisse. Il expose ses recherches dans de nombreux ouvrages dont plusieurs connurent un grand retentissement dont La Forteresse vide, qui aborde les problèmes de l'autisme encore peu connus à l'époque, et Psychanalyse des contes de fées dans lequel il montre comment ces textes transmis de génération en génération répondent de façon précise aux angoisses du jeune enfant. Le Roi et la Reine sont une image inconsciente des « bons » parents, comme la marâtre, la sorcière, l'ogre, font partie des fantasmes de l'enfant qui voit en ses parents, parfois non plus les bonnes images, mais celle de parents méchants et frustrants. En 1974, une suite d’émissions télévisés est réalisée par Daniel Karlin. Elle est publiée en 1975 sous le titre de Un autre regard sur la folie et servira à le faire connaitre en France6. Autisme Psychanalysé par le praticien viennois Richard Sterba, Bruno Bettelheim se pose à la fois comme un fidèle des idées freudiennes et comme un éducateur. Il professe que, sans fondement organique démontré, l'autisme peut être réceptif à la psychothérapie. De son expérience des camps, il a acquis la conviction que sans une pédagogie centrée sur un milieu voué à l'écoute de l'enfant, ses angoisses et ses besoins, aucun enfant perturbé ne peut trouver les bases sur lesquelles construire une personnalité harmonieuse. Les camps de concentration ayant été pensés pour anéantir le moi, un environnement stable, lisible et positif pourrait à l'inverse créer les conditions favorables à son édification. Bruno Bettelheim reprend le terme et le concept de mère réfrigérateur, refrigerator mother de Leo Kanner, créateur de la notion moderne d'autisme. Alors que Kanner défendait l'idée d'une cause innée de l'autisme, revenant à une approche plus médicale, Bettelheim reprend l’expression pour orienter les thérapeutes vers l'idée d'une cause acquise et relative aux parents. Dans La Forteresse vide, Bettelheim cite à ce sujet Anna Freud pour dire : Heureusement, les psychanalystes commencent à dénoncer le spectre de la mère rejetante. Il ajoute que toutes les mères, et pas seulement les mères d'enfants autistes, ont des intentions destructrices à côté de leurs intentions aimantes... ainsi que tous les pères. Ce n'est pas l'attitude maternelle qui produit l'autisme, mais la réaction spontanée de l'enfant à cette attitude. Paradoxalement Bettelheim écrit : Tout au long de ce livre, je soutiens que le facteur qui précipite l'enfant dans l'autisme infantile est le désir de ses parents qu'il n'existe pas. Le positionnement thérapeutique de Bettelheim est né dans l'enfer des camps de concentration et d'extermination. Il a développé un sens aigu de l'impact des circonstances extérieures sur la réalité mentale des individus. Contrairement aux positions psychanalytiques antérieures, il met en avant le fait que ce n'est pas seulement le passé et l’inconscient qui jouent un rôle, comme le disent les théories freudiennes, mais également les expériences du présent. Le contexte jouant un rôle fondamental, il veut considérer que l'opération inverse doit être possible: la ré-humanisation par l'environnement. C'est ce qu'il mettra en place à travers l'école orthogénique. Certains ont tiré la comparaison et affirment que Bettelheim compare les mères d'enfants autistes à des nazis. Il faut noter que la définition actuelle de l'autisme et sa définition officielle dans le DSM remonte aux années 80, il avait alors cessé d'exercer depuis 10 ans. Lorsqu'il emploie le mot "autisme", il fait donc référence aux définitions antérieures qui catégorisaient l'autisme comme une schizophrénie infantile. La terminologie employée par Bettelheim doit donc être contextualisée. Les théories de Bettelheim concernant l'autisme sont aujourd'hui contestées, y compris par certains psychanalystes. Ainsi, la psychanalyste Marie-Christine Laznik avance : « Bettelheim était complètement à côté de la plaque. Les mères n'ont rien à voir avec l'origine de l'autisme. Controverses Maltraitance et escroquerie Dès sa mort, les théories de Bettelheim, sa personnalité même sont remises en question. Pour le psychanalyste Kenneth Colby, Bettelheim était « un vrai salaud, un des pires individus que la psychanalyse ait jamais produit. Darnton, dans le Newsweek du 10 septembre 1990, l'appelle Beno Brutalheim, et Alan Dundes dans celui du 18 février 1991, le surnomme Borrowheim l’emprunteur. Dans l'article du Washington Post du 26 août 1990, d’anciens patients et de membres de son personnel dénoncent sa brutalité et les mauvais traitements qu'il leur infligeait. Les entretiens de deux anciens patients et du frère d'un autre patient décrivent un tyran aux idées rigides, incapable d'autocritique, maltraitant ses patients. Plusieurs associations de parents d'enfants perturbés s’appuient sur ces témoignages pour promouvoir d'autres méthodes thérapeutiques. En 1998, Richard Pollak, frère d'un autiste soigné par Bettelheim, l'accuse d'être un escroc manipulateur, mythomane et despotique, disposant de puissants soutiens financiers et médiatiques pour réduire ses détracteurs au silence. Nina Sutton, biographe de Bettelheim, relativise ces accusations et donne des éléments de compréhension concernant l'attitude de Richard Pollak. Mensonges Des éléments de la biographie de Bruno Bettelheim et de ses résultats ont été contestés15 par Richard Pollak, journaliste, frère d'un ancien patient de l’École orthogénique. Psychanalyse des contes de fées a été dénoncé par l'anthropologue Alan Dundes comme un plagiat de A Psychiatric Study of Myths and Fairy Tales: their origin, meaning, and usefulness 1974 de Julius Heuscher. Psychanalyse des contes de fées est de ton comme de contenu très similaire au premier, cependant Julius E. Heuscher affirme qu’il ne croit pas au plagiat délibéré mais plutôt au concours de circonstances. Alan Dundes, lui-même auteur de livres sur le sujet des mythes, reproche à Bettelheim de ne pas citer les auteurs auxquels il emprunte éventuellement thèmes ou idées. Ouvrages Ouvrages traduits en français entre parenthèses la date d'édition en anglais. Expérience et éducation, Armand Colin éd., Paris 1968 1965 La Forteresse vide, NRF Gallimard éd., Paris, 1969 1967 L'Amour ne suffit pas, Fleurus éd., Paris 1970 1950 Les Enfants du rêve, Robert Laffont éd., Paris, 1971 1969 Les Évadés de la vie, Fleurus éd., Paris 1971 1955 Les Blessures symboliques, NRF Galimard éd., Paris 1971 1954 Le Cœur conscient, Robert Laffont éd., Paris, 1972 1960 Dialogue avec les mères, Robert Laffont éd., Paris, 1973 1962 Jeunesse à l'abandon, Privat éd., Paris 1973 1965 Un lieu où renaître, Robert Laffont éd., Paris, 1975 1974 Enfance et société, Delachaux et Niestlé éd., Paris 1976 1950 Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont éd., Paris, 1976 1976 rééd 1999 Survivre, Robert Laffont éd., Paris, 1979, rééd 1999: La Lecture et l'enfant, Robert Laffont éd., Paris, 1983 1982 Freud et l'âme humaine, Robert Laffont éd., Paris, 1984 1983 Pour être des parents acceptables, Robert Laffont éd., Paris, 1988 1987 Le Poids d'une vie, Robert Laffont éd., Paris, 1991 1990 Bibliographie Geneviève Jurgensen, La Folie des autres, Robert Laffont éd., Paris, 1974. Témoignage de la seule éducatrice française ayant travaillé à l'École orthogénique avec Bruno Bettelheim Stephen Eliot, La Métamorphose : Mes treize années chez Bruno Bettelheim, Bayard éd., Paris 2002. Nina Sutton, Bruno Bettelheim, une vie, coll. Pluriel, Hachette Littératures, Paris 1996. Biographie Rudolf Ekstein 1994 : Mein Freund Bruno 1903–1990. Wie ich mich an ihn erinnere. In : Kaufhold, Roland 1994: Annäherung an Bruno Bettelheim. Mainz Grünewald: 87–94. Ernst Federn 1994, Bruno Bettelheim und das Überleben im Konzentrationslager. In: Kaufhold, Roland 1999: Ernst Federn: Versuche zur Psychologie des Terrors. Gießen (Psychosozial-Verlag: 105–108. David James Fisher, Psychoanalytische Kulturkritik und die Seele des Menschen. Essays über Bruno Bettelheim coauteur : Roland Kaufhold, Gießen Psychosozial-Verlag Roland Kaufhold, Annäherung an Bruno Bettelheim. Mainz, 1994 Grünewald Roland Kaufhold, Bettelheim, Ekstein, Federn: Impulse für die psychoanalytisch-pädagogische Bewegung. Gießen, 2001 Psychosozial-Verlag. Richard Pollak, Bruno Bettelheim ou la fabrication d'un mythe livre polémique, Les empêcheurs de penser en rond / Autisme France Diffusion, trad. Agnès Fonbonne, Paris 2003. Biographie David James Fisher : Le suicide d'un survivant David James Fisher et Bruno Bettelheim : L'ultime conversation, François Gantheret : L'accusation. David James Fisher : Le suicide d'un survivant in Nouvelle Revue de Psychanalyse, no 43, 1991         
#35
Théodore de Banville
Loriane
Posté le : 13/03/2016 17:30
Le 13 mars 1891 meurt à 67 ans Théodore de Banville
de son nom complet Étienne Jean Baptiste Claude Théodore Faullain de Banvilleà 67 ans, à Paris 6ème né le 14 mars 1823 à Moulins Allier, poète, dramaturge et critique dramatique, journaliste français, auteur de langue française du mouvement Romantisme, symbolisme, Parnasse. Ses Œuvres principales sont Odes funambulesques en 1857, Les Exilés en 1867. Célèbre, donc pour ses Odes funambulesques et les Exilés, il est surnommé le poète du bonheur. Ami de Victor Hugo, de Charles Baudelaire et de Théophile Gautier, il est considéré dès son vivant comme l’un des plus éminents poètes de son époque. Il a notamment découvert le talent naissant d’Arthur Rimbaud. Théodore de Banville unit dans son œuvre le romantisme et le parnasse, dont il fut l’un des précurseurs. Il professait un amour exclusif de la beauté et la limpidité universelle de l’acte poétique, s’opposant à la fois à la poésie réaliste et à la dégénérescence du romantisme, contre lesquels il affirmait sa foi en la pureté de la création artistique. En bref Venu à Paris dans son enfance, Théodore de Banville se passionne très jeune pour le spectacle et pour la poésie. Avant vingt ans, il publie son premier recueil de vers ; il y manifeste déjà un talent sûr qui relève d'une conception de la poésie dont il ne se départira jamais. S'opposant vigoureusement à la nouvelle poésie réaliste, il professe un amour exclusif de la beauté : Les Cariatides (1842) ainsi que Les Stalactites (1846) sont l'expression de cet art. Selon lui, la poésie est d'abord affaire de langage, l'émotion et le sentiment ne pouvant naître que du travail sur le style, les mots, les mètres et les rimes. Il veut obtenir une forme parfaite et se compare volontiers au sculpteur qui lentement découvre, après bien des hésitations, le geste, le mouvement qui, de surcroît, se trouvera être l'expression d'un sentiment. Il refuse le lyrisme facile et larmoyant d'un bas romantisme effusif et emphatique ; comme nombre de romantiques entre 1850 et 1870 (Gautier en premier lieu, mais aussi bientôt le Hugo des Chansons des rues et des bois), il met l'accent sur les exigences de la technique pour réagir contre ce qu'on peut considérer comme une trahison de l'originalité romantique : le débordement flou des épanchements individuels, qui engendre une nouvelle convention poétique, le vague à l'âme tournant au poncif. Aux brumes nordiques il préfère la netteté grecque et se désigne comme un précurseur du Parnasse, tant par ses thèmes que par sa foi en la pureté formelle de l'acte poétique. Il fréquente les milieux littéraires les plus anticonformistes et se lie d'une solide amitié avec Baudelaire, avec lequel il partage le mépris d'une certaine poésie officielle et commerciale. Ses Odelettes et ses Odes funambulesques (1857) lui apportent la consécration et marquent une évolution vers plus de souplesse et de charme. Il devient une figure très importante du monde littéraire, à la fois critique dramatique, du Pouvoir (1850) puis du National (1869), et membre le plus écouté de la Revue fantaisiste (1861), où se retrouvent les poètes qui seront à l'origine du Parnasse et de tous les mouvements du siècle. Banville aura une influence déterminante sur des auteurs aussi différents que Mallarmé, Leconte de Lisle, Verlaine, Daudet, Coppée, Mendès, qu'il recevait régulièrement chez lui. Dans le même temps, il gagne en simplicité dans Les Exilés (1867) ou Les Occidentales (1869) ; mais il se détourne peu à peu de la poésie à la suite d'un violent désaccord avec le symbolisme. Il ressuscite de vieilles formes héritées du Moyen Âge, il rédige ses souvenirs, L'Ame de Paris, et donne des pièces en vers pour un théâtre réaliste. C'est néanmoins en prose qu'il donnera sa meilleure œuvre pour la scène avec Gringoire (1866) ; le jeune poète (plus imaginaire que réel) qui est le héros de cette courte pièce témoigne bien plus d'un lyrisme « engagé » que d'une gratuité esthétique de la forme : malgré son influence sur les parnassiens, Banville ne reniait pas son romantisme foncier. Mais, déjà, il semble que son heure soit passée, et ses efforts pour se mettre à l'école de ses anciens disciples ne sont couronnés d'aucun succès. Il est assurément, de tous les poètes du XIXe siècle, celui qui a le plus joué avec toutes les richesses de la poésie française, et le reproche qu'on lui a fait d'avoir manqué de sensibilité et d'imagination devrait s'effacer si l'on considère la perfection et le charme de ses vers, le bonheur et les trouvailles de ses évocations, l'influence enfin tout à fait salutaire qu'il a eue sur les poètes en les dégageant radicalement de la sensiblerie mièvre qui survivait au véritable romantisme. Antoine Compagnon Sa vie Fils du lieutenant de vaisseau Claude Théodore Faullain de Banville et de Zélie Huet, Théodore de Banville a fait ses études au lycée Condorcet à partir de 1830. Encouragé par Victor Hugo et par Théophile Gautier, il se consacra à la poésie, et fréquenta les milieux littéraires parmi les plus anticonformistes. Il méprisait la poésie officielle et commerciale, fut l’adversaire résolu de la nouvelle poésie réaliste et l’ennemi de la dérive larmoyante du romantisme. Il collabore aussi comme critique dramatique et chroniqueur littéraire aux journaux le Pouvoir 1850, puis le National 1869 ; il devient une figure très importante du monde littéraire et participe à la Revue fantaisiste 1861, où se retrouvent les poètes qui furent à l’origine du Parnasse et de tous les mouvements de ce siècle. Il rencontre Marie-Élisabeth Rochegrosse en 1862 ils se marieront treize ans plus tard, le 15 février 1875, et organise la première représentation de Gringoire en 1866. Il publie Les Exilés en 1867, recueil qu’il dédie à sa femme et qu’il considéra comme le meilleur de son œuvre. Âgé de 16 ans, Arthur Rimbaud, initié à la poésie de son temps par la revue collective Le Parnasse contemporain, lui envoie une lettre datée du 24 mai 1870, en y joignant plusieurs poèmes Ophélie, Sensation, Soleil et chair, dans l’espoir d'obtenir son appui auprès de l’éditeur Alphonse Lemerre. Banville répondit à Rimbaud, mais les poèmes ne sont pas publiés. En novembre 1871, Théodore de Banville héberge Arthur Rimbaud, mais dès le mois de mai, ce dernier dans ses lettres dites du voyant exprime sa différence et, en août 1871, dans son poème parodique, Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, exprime une critique ouverte de la poétique de Banville. En 1872, avec son Petit Traité de poésie française, Banville rompt avec le courant symboliste. Il publie presque une œuvre par an tout au long des années 1880, et meurt à Paris le 13 mars 1891, la veille de ses 68 ans, peu après la publication de son seul roman, Marcelle Rabe. Théodore de Banville a particulièrement travaillé, dans son œuvre, les questions de forme poétique, et a joué avec toutes les richesses de la poésie française. Il lui a été reproché d’avoir manqué de sensibilité et d’imagination, mais son influence salutaire permit à de nombreux poètes de se dégager de la sensiblerie mièvre qui survivait au véritable romantisme. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse 13e division. Œuvre Proses et poésie Féroce & rose, avec du feu dans sa prunelle Effronté, saoul, divin, c'est lui, Polichinelle Les Cariatides, poésies, 1842 Les Stalactites, poésies, 1846 Odelettes, poésies, 1856 Odes funambulesques et Le Sang de la Coupe, poésies, 1857. Ces recueils lui apportent la consécration et marquent une évolution vers plus de souplesse et de charme. Esquisses parisiennes, poésies, 1859 La Mer de Nice - Lettres à un ami, Poulet-Malassis, 1865 Contributions au Parnasse contemporain, 1866, 1871, 1876 Les Camées parisiens, 1866 en trois séries indépendantes, parues séparément, à petit nombre, entre 1866 et 1873 Les Exilés, poésies, 1867 Nouvelles odes funambulesques, poésies, 1869 Idylles prussiennes, 1870-1871 Petit Traité de poésie française, 1871. Texte à partir duquel il se détourne peu à peu de la poésie contemporaine à la suite d’un violent désaccord avec le symbolisme. Théophile Gautier, ode, 1872 Trente-six Ballades joyeuses, 1873 Rondels composés à la manière de Charles d’Orléans et Les Princesses, sonnets, 1874 Les Occidentales et Rimes dorées, 1875 Roses de Noël, 1878 Contes pour les Femmes, 1881 Contes féeriques, 1882 Mes souvenirs, 1882 Nous tous, 1883 Contes héroïques, 1884 Contes bourgeois, 1885 Lettres chimériques, 1885 Les Servantes, 1885. Le Forgeron, poème, 1887 Madame Robert, contes, 1887 Les Belles Poupées, 1888 Marcelle Rabe, roman, 1891 Sonnailles et clochettes, 1891 Théâtre Le Feuilleton d'Aristophane, en collaboration avec Philoxène Boyer, Théâtre de l'Odéon, 26 décembre 1852 Le Beau Léandre, Théâtre du Vaudeville, 27 septembre 1856 Le Cousin du Roi, Théâtre de l'Odéon, 4 avril 1857 Diane au bois, Théâtre de l'Odéon, 16 octobre 1863 Les Fourberies de Nérine, Théâtre du Vaudeville, 15 juin 1864 La Pomme, Théâtre Français, 30 juin 1865 Gringoire, comédie historique, Théâtre Français, 23 juin 1866. Dédiée à Victor Hugo, qui avait mis en scène un jeune poète dans Notre-Dame de Paris, publié en 1899 à la librairie Conquet-Carteret et Cie, 1899, avec des illustrations de Jacques Clément Wagrez. Florise, comédie en quatre actes, 1870 Deïdamia, Théâtre de l'Odéon, 18 novembre 1876 La Perle, Théâtre Italien, 17 mai 1877 Riquet à la houppe, 1884 Socrate et sa femme, Comédie-Française, 2 décembre 1885 Le Baiser, Théâtre-Libre, 23 décembre 1887 Ésope, 1893 Œuvres posthumes Dans la fournaise, poésies, 1892 Critiques, 1917 Édition Banville s’est aussi occupé avec Asselineau de la troisième édition des Fleurs du mal de Baudelaire. Hommages Statue de Théodore de Banville à Moulins Moulins, sa ville natale, lui a dédié une avenue, ainsi qu'un parc (près de la gare) où trône sa statue de bronze, œuvre du sculpteur Jean Coulon. Le plus ancien lycée de la ville porte son nom. Un square est dédié à Théodore de Banville dans le quartier du port de Nice, face à la mer. Citation gravée dans la pierre du square : « Les villes ont leur destinée écrite et le sort de Nice est de régner sans partage parmi ces filles de la Méditerranée qui sont vêtues de flots transparents et de roses fleuries. » Son buste, sculpté par Jules Roulleau, est exposé dans le Jardin du Luxembourg, à Paris. Georges Brassens a mis en musique son poème Le Verger du roi Louis. Sur son album Momente en 2012, le groupe autrichien L'Âme Immortelle a mis en chanson L'étang Mâlo, poème tiré des Stalactites. Une rue du 17e arrondissement à Paris porte son nom. Une compagnie de théâtre porte le nom d'un de ses célèbres poèmes : Le saut du tremplin. Citations « Théodore de Banville n’est pas précisément matérialiste ; il est lumineux. Sa poésie représente les heures heureuses. » Baudelaire, Fusées,  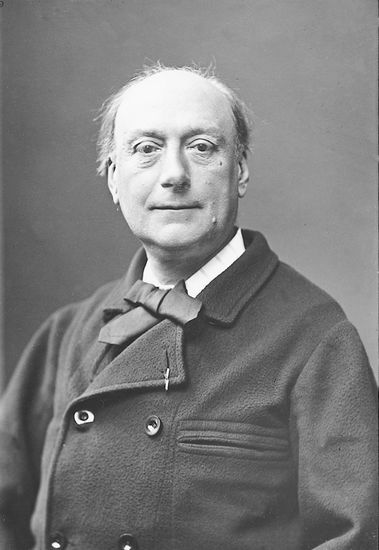     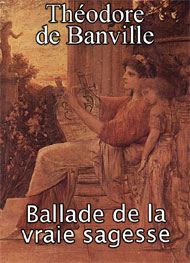
#36
Charles Hugo
Loriane
Posté le : 13/03/2016 17:01
Le 13 mars 1871 meurt à 44 ans, à Bordeaux, Charles Hugo
est le deuxième fils des cinq enfants de Victor Hugo et Adèle Foucher, né le 4 novembre 1826 à Paris. Il est écrivain, journaliste, sujet psi, élève au lycée Charlemagne. Il a pour frère François-Victor Hugo, pour Sœur Adèle Hugo, Léopoldine Hugo, il a pour enfants Georges-Victor Hugo, Jeanne Hugo Sa vie Bon élève au collège Charlemagne, Charles obtient le premier prix du concours général en thème latin le 31 juillet 1840. En février 1848, il est quelque temps secrétaire d'Alphonse de Lamartine. Le 1er octobre, il fonde avec son père, son frère François-Victor Hugo, Paul Meurice et Auguste Vacquerie, le journal politique L'Événement. Il soutient d’abord Lamartine, puis lui tourne le dos pour finir par approuver la candidature du prince Louis-Napoléon Bonaparte contre Louis Eugène Cavaignac. Il regrettera ensuite sa décision en 1849, dès l'arrivée au pouvoir de celui qui sera appelé « Napoléon le Petit » par son propre père. Le 16 mai 1851, il publie un article contre la peine de mort : il est alors poursuivi en justice et défendu par Victor Hugo. Condamné le 30 juillet à 6 mois de prison, il est incarcéré à la Conciergerie. Sorti de prison le 28 janvier 1852, il rejoint son père en exil à Bruxelles depuis le 14 décembre précédent, puis le suit à Jersey. Là, en compagnie de François-Victor et d'Auguste Vacquerie, il réalise des portraits de la famille Hugo et de son entourage, souvent sous la direction du poète. Charles joue également le rôle de médium lors des séances de spiritisme auxquelles son père participe. Le 17 octobre 1865, il épouse à Bruxelles Alice Lehaene mariage religieux célébré à Saint-Josse-ten-Noode, qui lui donnera trois enfants : Georges I 1867-1868, Georges II 1868-1925 et Jeanne Hugo 1869-1941, qui se mariera trois fois, avec Léon Daudet en premières noces puis qui épousera Jean-Baptiste Charcot. C'est avec ses petits-enfants Georges et Jeanne, que Victor Hugo exercera l'art d'être grand-père. Alice Lehaene se remariera en 1877 avec Édouard Lockroy 1838-1913 malgré l'opposition de Victor Hugo. Il subira encore des condamnations pour l'expression de ses idées jusqu'en 1870. Seul enfant de Victor Hugo qui laissera une postérité, aujourd'hui nombreuse, il sera notamment le grand-père du peintre Jean Hugo. En 1871, Charles meurt d'une apoplexie AVC foudroyante à Bordeaux, alors qu'il se rend en fiacre au restaurant Lanta aujourd'hui café Le Régent, place Gambetta, où l'attend son père. Victor Hugo notera dans ses carnets : « À six heures et demie, je suis allé au restaurant Lanta. MM. Bouvier, Mourot et Casse arrivent. Puis Alice, Charles se fait attendre. - Sept heures du soir. Charles est mort » — Victor Hugo, Choses vues, 13 mars 1871 Ses obsèques ont lieu le 18 mars 1871. Le cortège parcourt Paris de la gare d'Orléans au Père-Lachaise. Paris est en pleine insurrection et les insurgés saluent partout respectueusement Victor Hugo. François-Victor Hugo Jean Hugo Auguste Vacquerie Chronologie de Charles Hugo en 16 dates Cremieux, avocat, assiste Victor Hugo, dans la défense de son fils Charles, journaliste, qui est poursuivi devant la Cour d'assises de Paris, pour "avoir outragé la loi en décrivant l'exécution d'un braconnier guillotiné à Poitiers".France 1852 août Hugo s'embarque à Anvers pour Londres, accompagné de Charles et de Juliette qui voyage incognito.Belgique 1852 août Hugo, ayant quitté la Belgique, débarque à Jersey St-Hélier avec Charles et Juliette incognito.Royaume-Uni 1853 jan 3 Charles Hugo quitte Jersey avec Anaïs qu'il reconduit à Paris.Royaume-Uni 1853 Charles Hugo fils de Victor fait un séjour à Caen pour améliorer sa technique de photographe et acheter du matériel.France 1861 mar 25 Hugo, accompagné de son fils Charles et sa maîtresse Juliette, quitte Guernesey à bord de l'Aquila, pour se rendre en Belgique.(Royaume-Uni 1863 jan 3 La pièce "Les Misérables" 1ère partie, adaptée du roman éponyme de Victor Hugo, par Charles Hugo et Paul Meurice, est créé au Théâtre des Galeries St-Hubert à Bruxelles.Belgique 1865 oct 17 Victor Hugo assiste, à Bruxelles, au mariage de son fils Charles Hugo avec Alice Lehaené.Belgique 1867 mar 31 Charles Hugo fils de Victor Hugo et son épouse Alice Lehaené donnent naissance à Georges Hugo, à Bruxelles.Belgique 1867 juil 19 Hugo arrive à Bruxelles pour découvrir son petit-fils Georges.Belgique 1867 juil 25 Georges Hugo petit-fils de Victor est baptisé à Bruxelles.Belgique 1868avr 14 Georges Hugo petit-fils de Victor Hugo meurt d'une méningite à Bruxelles.Belgique 1868 juil 30 Hugo rejoint son fils Charles à Bruxelles.Belgique 1871 mar 13 Charles Hugo fils de Victor Hugo meurt à Bordeaux. 1871 mar 18 Charles Hugo fils de Victor Hugo est enterré au Père-Lachaise.France 1878 mar 22 La pièce "Les Misérables", adaptée du roman de Hugo par Charles Hugo et Meurice, est reprise au Théâtre de la Porte St-Martin à Paris.France  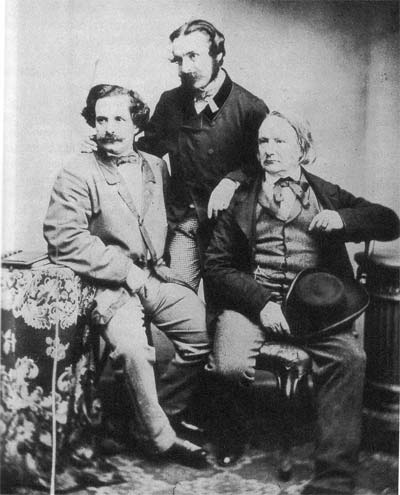  
#37
Augustin Cochin
Loriane
Posté le : 13/03/2016 16:52
Le 13 mars 1872 meurt à 48 ans Augustin Cochin
à Versailles né à Paris le 12 décembre 1823, écrivain et homme politique français. Membre de l'académie des sciences morales et politiques Sa vie Pierre Suzanne Augustin Cochin est le fils du baron Jean-Denis Cochin. Administrateur, il s'occupa comme son père de questions d'éducation et de philanthropie. S'intéressant très tôt aux questions économiques et politiques, il donna des articles aux Annales de Charité et au Correspondant. Ses publications le firent élire à l'Académie des sciences morales et politiques en 1865. En 1850, il fut élu adjoint au maire et, en 1854, maire du dixième arrondissement de Paris. Il démissionna de son mandat en 1858, à la suite d'une condamnation du Correspondant, il fut remplacé par un ancien notaire, M. de Fresne. L'une des figures du catholicisme libéral, ami d'Alfred de Falloux, de Charles de Montalembert et de Henri Lacordaire, il se présenta sans succès à la députation à Paris. Opposant au Second Empire, il cherchait à concilier le catholicisme et la liberté politique et dénonçait inlassablement les vices de la société bourgeoise, à commencer par la cupidité. En 1861, il publie un ouvrage sur l'abolition de l'esclavage dans lequel il relate le démantèlement du système esclavagiste et salue les initiatives menées depuis 1822 par le prince Victor de Broglie et ses alliés, à savoir Pierre-Antoine Berryer, Alphonse de Lamartine, Hippolyte Passy, Victor Destutt de Tracy, Charles de Rémusat et Alexis de Tocqueville1. Il y écrit que « l'esclavage est avant tout la négation de la famille », l'esclave étant toujours séparé des siens1. Mais pour lui l'abolition ne saurait avoir une vocation purement philosophique et n'est pas séparable du divin. À ce titre, dans son livre, il reproche à la séance du 16 pluviôse an II-4 février 1794, qui marque la première abolition française de l'esclavage, d'avoir ignoré Dieu, complètement absent d'après lui du discours de l'intervenant principal, Danton. En 1855, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur et est élu en 1864 à l'Académie des Sciences morales . Il est nommé en 1871 préfet de Seine-et-Oise . Il est enterré dans la chapelle de l'hôpital Cochin, fondé par sa famille à Paris. Deux de ses trois fils, Denys Cochin et Henry Cochin, furent des personnalités politiques et son petit-fils Augustin Cochin un historien et sociologue de la Révolution. Après de solides études en lettres et en philosophie, et un brillant passage à l'École des chartes (il y entre et en sort premier), Augustin Cochin s'est, de bonne heure, intéressé à un événement fondateur — la Révolution française — que le legs d'une culture familiale, chrétienne et nationale a conduit à examiner d'une façon originale. Tandis que l'histoire de défense républicaine, dominée par Alphonse Aulard, écartait les histoires locales et les témoignages privés (Mémoires et correspondances) pour s'en tenir aux actes officiels émanés de Paris, le jeune archiviste paléographe a fait porter sur la province et la société réelle une enquête qu'il a commencée en Bourgogne, poursuivie en Bretagne puis étendue à la France entière. La Campagne électorale de 1789 en Bourgogne (1904) et l'ouvrage rédigé entre 1904 et 1908, mais publié en 1925, Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne visaient à répondre à une question que les explications par l'arbitraire royal, les abus des nobles, le mécontentement populaire et l'ambition bourgeoise ne réglaient pas : qu'est-ce qui a abattu l'Ancien Régime ? Entreprise dans les archives de quarante et un départements, la collation des Actes du Gouvernement révolutionnaire (août 1793-juillet 1794), dont la Grande Guerre retarda la publication, tendait à résoudre un autre problème auquel ni la thèse des « circonstances », ni celle du « complot », n'apportaient de solution satisfaisante : comment « l'immense équarrissage » de la France a-t-il été réalisé ? À ces interrogations Taine avait répondu, dans ses Origines de la France contemporaine, par une psychologie du jacobinisme qui avait fait voir autrement le phénomène révolutionnaire, ce qu'on ne lui pardonna pas. Mais l'écrit le plus connu de Cochin, La Crise de l'histoire révolutionnaire. Taine et M. Aulard (1908), n'est pas une simple réfutation du Taine historien (1907) de ce dernier, il contient les éléments d'une « sociologie de la société démocratique » qui, selon son auteur, devait seule permettre de déchiffrer « l'énigme révolutionnaire ». Taine, en effet, décrit bien mais n'explique pas le « fanatisme de la Raison », le « mysticisme du Peuple », le « despotisme de la Liberté ». Pour comprendre le sens de ces expressions, il faut dépasser les intentions des acteurs, les généreuses illusions de 1789 et remonter assez haut dans l'histoire des mœurs du XVIIIe siècle, jusqu'à cette époque où le clergé laïc des philosophes, réuni en d'égalitaires sociétés de pensée, a dessiné la figure idéale d'un ordre nouveau et tracé les plans d'une « cité des nuées ». Là, dans ces petites assemblées de causeurs, s'est socialement formé un esprit public et s'est théoriquement fondée une société. Là a commencé à fonctionner une machine à produire des abstractions. Une méthode intellectuelle a été arrêtée : elle consistera à proclamer des principes ; une organisation s'est trouvée esquissée : elle permettra de forcer les faits. Ainsi la magie des mots a effacé le réel, l'opinion des particuliers a cédé devant l'opinion sociale, le Peuple a pris la place du peuple et la volonté générale celle du prince — car dans cette « société de sociétés » il ne peut y avoir ni maître ni meneurs : on doit seulement se conformer à ce mystérieux souverain, la force collective. En mettant en lumière l'antinomie révolutionnaire qui apparaît en 1789 avec « un peuple qui opprime le nombre, une liberté de principe qui détruit les libertés de fait, une philosophie qui tue pour des opinions, une justice qui tue sans jugement », et en montrant comment la machine sociale, avec son réseau de sociétés populaires, ses bureaux de surveillance, ses commissions de contrôle a pu automatiquement fonctionner dans la cité jacobine, Augustin Cochin a donné la première analyse des fondements et des contradictions du système totalitaire. Il a bien vu, en effet, ce que vaut l'octroi de libertés fictives (« pour le vrai démocrate, la meilleure garantie contre l'indépendance de l'homme c'est la liberté du citoyen ») et ce qui rendra constamment soupçonneuse une telle société inéluctablement vouée à faire surgir la figure d'un ennemi : la renaissance toujours possible des intérêts privés. Mieux que Les Sociétés de pensée et la démocratie (1921), recueil des opuscules précédemment cités, un autre texte posthume, La Révolution et la libre-pensée (1924), dévoile la logique du jacobinisme. Avec le philosophe de 1789, le patriote de 1792, le citoyen de 1793, ce sont successivement la pensée, la personne et les biens qui ont été socialisés. La socialisation, commencée dans les sociétés de pensée, les loges et les académies, sous l'égide de la vérité, s'est continuée dans les clubs, au nom de la liberté, pour s'achever au sein des assemblées sectionnaires, en vertu de la justice sociale. Par le secret, la corruption, la spoliation s'est effectué un asservissement intellectuel, moral et matériel. À la morale personnelle a été substituée une morale sociale, et un être fictif a remplacé l'individu réel. Contrairement à ce que des critiques ont soutenu, cette thèse n'est nullement contre-révolutionnaire. Si pour son auteur Thermidor a été une délivrance, « la libération de la société réelle n'est pas la contre-révolution, mais le terrain où la Révolution a perdu ». Le contresens s'explique autant par la persistance de l'apologétique jacobine que par l'état fragmentaire de l'explication proposée. Le 8 juillet 1916, le capitaine Cochin, déjà grièvement blessé à Verdun, mourait héroïquement sur la Somme. Il laissait inachevée son enquête sur les actes du Bureau de surveillance de l'exécution des lois, à propos de laquelle Mathiez lui-même disait que « jamais, l'on n'avait pénétré aussi avant dans la bureaucratie du régime ». Il l'avait conduite en constante référence à la société réelle et à la continuité de l'histoire nationale, dans la méfiance aussi des froides orthodoxies, des rationalisations a priori, des solutions radicales que cherchent souvent à imposer les moralistes sans foi, les philosophes sans expérience et les citoyens sans tradition. Bernard Valade Publications Augustin Cochin écrivain Essai sur la vie, les méthodes d'instruction et d'éducation, et les établissements de Pestalozzi, 1848 Lettre sur l'état du paupérisme en Angleterre, 1854 L'Abolition de l'esclavage, 2 vol., 1861 Texte en ligne : Tome 1. Résultats de l'abolition de l'esclavageTome 2. Le christianisme et l'esclavage Condition des ouvriers français, 1862 La Manufacture des glaces de Saint-Gobain de 1665 à 1865, 1865 Les Espérances chrétiennes, 1893 Conférences et mémoires Mettray en 1846, 1847 Lettre sur l'état du paupérisme en Angleterre, 1854 Progrès de la science et de l'industrie au point de vue chrétien, 1854 Rome, les martyrs du Japon et les évêques du XIXe siècle 1862 Quelques mots sur la vie de Jésus de Renan, 1863 Paris, sa population, son industrie, 1864 Abraham Lincoln, 1869 La Ville de Paris et le Corps législatif, 1869 Paris et la France, 1870 Le Comte de Montalembert, 1870 La Question italienne et l'opinion catholique en France, Bibliographie Alfred de Falloux, Augustin Cochin, Didier, Paris, 1875 Georges Picot, Antonin Cochin. Notice historique, Institut de France, Hachette, Paris, 1906 Henry Cochin, Augustin Cochin. Ses lettres et sa vie, 2 vol., Bloud et Gay, Paris, 1926 Correspondance d'Alfred de Falloux avec Augustin Cochin : 1854-1872, établie et annotée par Jean-Louis Ormières, H. Champion, Paris, 2003  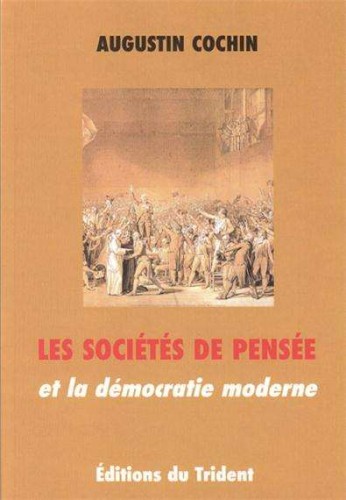 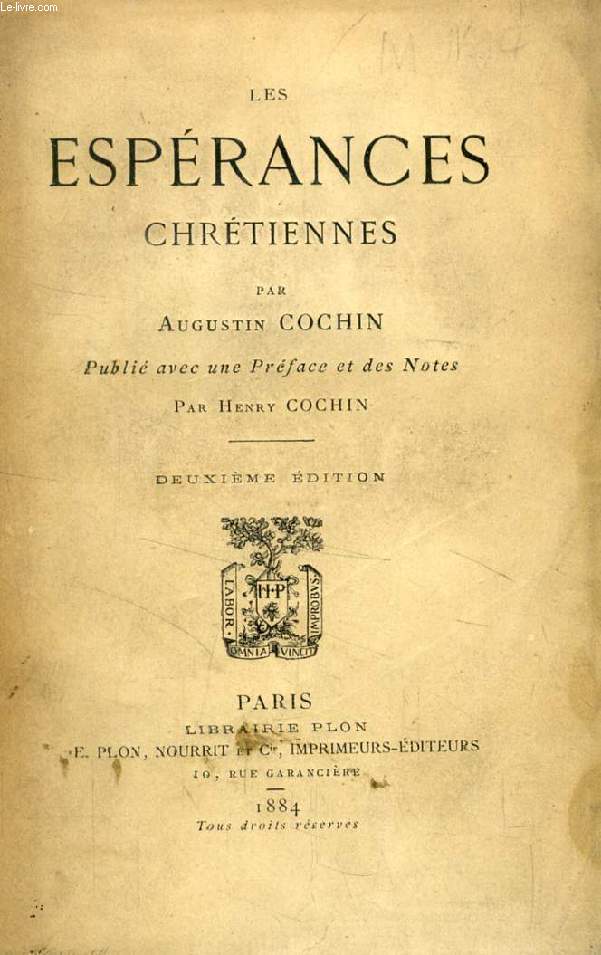 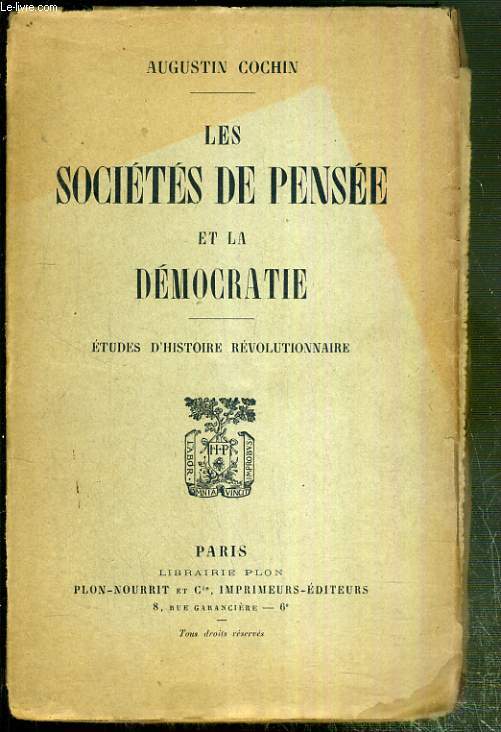  
#38
Charles-Guillaume Etienne
Loriane
Posté le : 13/03/2016 16:41
Le 13 mars 1845 meurt Charles-Guillaume Étienne
à Paris, né à Chamouilley le 5 janvier 1777 ou selon certaines sources en 1778 ou 6 Janvier 1770, auteur dramatique français. Deux fois élu à l'Académie française, il fut également journaliste, censeur, député et pair de France. Il occupa la fonction de député à l'Assemblée nationale française, puis pair de France écrivain, journaliste, homme politique. Membre de Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de l'académie française à partir de 1829. Il eut un fils : Henri Étienne Sa vie Il occupe diverses fonctions administratives pendant la Révolution et s'installe en 1796 à Paris où il est occupé à la rédaction de différents journaux. Il abandonne bientôt la presse pour le théâtre où le pousse sa véritable vocation. Il donne son premier opéra, Le Rêve, en 1799, et débute à la Comédie-Française avec une piquante comédie, Brueys et Palaprat, qui connaît le succès. En 1802, il publie une Histoire du Théâtre-Français, puis il devient secrétaire du duc de Bassano et accompagne Napoléon dans les campagnes d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche et de Pologne, tout en continuant à écrire pour la scène. Il est nommé 1810 censeur général de la police et des journaux et il est rédacteur en chef du Journal de l'Empire en remplacement de Joseph Fievée. Le succès de sa comédie Les Deux Gendres, jouée au Théâtre-Français en 1810, lui vaut d'être élu l'année suivante à l'Académie française. Cette pièce est toutefois vivement controversée et son auteur accusé de plagiat. Dans son discours de réception, prononcé le 7 novembre 1811, il s'attache à démontrer l'union étroite de la comédie et de l'histoire. Il donne ensuite au Théâtre-Français une comédie en 5 actes, L'Intrigante, qui remporte le succès mais doit être interrompue au bout de onze représentations, l'Empereur ayant été choqué par certains vers. La pièce ayant été interdite suscite une immense curiosité, et les exemplaires imprimés s'arrachent à prix d'or. En 1814, la Première Restauration rapporte l'interdiction, mais l'auteur refuse de profiter de cette mesure de bienveillance. Proscrit en 1816, par le comte de Vaublanc, alors ministre de l'intérieur, il est exclu de l'Académie, à laquelle il sera réélu en 1829. Il est sept fois député de la Meuse en 1820, 1822, 1827, 1830, 1831, 1834, 1837). Nommé pair de France le 7 novembre 1839, il termina au Luxembourg sa carrière parlementaire. Puis, s'étant retiré de la politique, il continue à produire des œuvres dramatiques et lyriques, souvent écrites en collaboration, avec notamment Charles Gaugiran de Nanteuil. Charles-Guillaume Étienne a également été deux fois président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de 1829 à 1831 et de 1843 à 1845. Alfred de Vigny rapporte dans son discours de réception à l'Académie que l'actrice Adrienne Lecouvreur lui légua sa bibliothèque. L'expression proverbiale : « On n'est jamais servi si bien que par soi-même. » provient de sa pièce Bruis et Palaprat 1807. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise 26e division. Œuvres Théâtre Le Rêve, opéra-comique en 1 acte et en prose, paroles du citoyen Étienne, musique du citoyen Gresnich, Paris, Opéra-Comique, 8 pluviôse an VII 1799 Rembrandt ou la Vente après décès, vaudeville anecdotique en 1 acte, par les citoyens Étienne, Morel, Servière et Moras, Paris, théâtre des Troubadours, 26 fructidor an VIII 1800 Le Chaudronnier, Homme d'État, comédie en trois actes et en prose, Paris, théâtre de l'Ambigu-Comique, 1er thermidor an VIII 1800 La Lettre sans adresse, comédie en 1 acte et en prose, mêlée de vaudevilles… par les citoyens Étienne et Moras, Paris, théâtre des Troubadours, 26 vendémiaire an IX 1800 L'Apollon du Belvédere ou l'Oracle, folie-vaudeville impromptue en 1 acte, par les citoyens Étienne, Moras et Gaugiran-Nanteuil, Paris, théâtre des Troubadours, 29, 30 brumaire, 1er, 2 et 3 frimaire an IX 1800 Pont-de-Veyle ou le Bonnet de docteur, vaudeville en 1 acte, par les citoyens Gosse et Étienne, Paris, théâtre des Variétés, 6 vendémiaire an X 1801 Désirée ou la Paix du village, allégorie en 1 acte, en vaudevilles, par les citoyens Gaugiran-Nanteuil, Moras et Étienne, Paris, théâtre Favart, 5 germinal an IX 1801 Le Grand Deuil, opéra-bouffon, paroles des C. J.-B. Vial et C.-G. Étienne, musique du citoyen H. Berton, Paris, Opéra-comique, 1er pluviôse an IX 1801 Le Pacha de Suresnes ou l'Amitié des femmes, comédie-anecdote en 1 acte et en prose, par les citoyens C.-G. Étienne et Gaugiran-Nanteuil, Paris, théâtre Louvois, 11 prairial an X 1802 La Petite École des pères, comédie en 1 acte et en prose, par C.-G. Étienne et Gaugiran-Nanteuil, Paris, théâtre Louvois, 8 nivôse an XI 1803 Le Pauvre Riche ou la Séparation de biens, comédie en trois actes et en prose faite en société avec M. Nanteuil, Paris, théâtre Louvois, en vendémiaire an XII 1803 Les Maris en bonne fortune, comédie en 3 actes, Paris, théâtre Louvois, 9 germinal an XI 1803 La Jeune Femme en colère, comédie en 1 acte et en prose, Paris, théâtre de l'Impératrice, 28 vendémiaire an XIII 1804 Isabelle de Portugal ou l'Héritage, comédie historique en 1 acte, en prose, par MM. Étienne et Gaugiran-Nanteuil, Paris, théâtre de l'Impératrice, 27 novembre 1804 Une heure de mariage, comédie en un acte et en prose mêlée d’ariettes, musique de Nicolas Dalayrac, créée à l'Opéra-Comique théâtre Feydeau, le 29 ventôse an XII 20 mars 1804 Gulistan ou le Hulla de Samarcande, comédie en trois actes et en prose mêlée d’ariettes, avec Poisson de La Chabeaussière tirée des Mille et une Nuits, musique de Nicolas Dalayrac, créée à l'Opéra-Comique théâtre Feydeau, le 8 vendémiaire an XIV 30 septembre 1805 Le Nouveau Réveil d'Épiménide, comédie épisodique en 1 acte, en prose, par MM. Étienne et Gaugiran-Nanteuil, Paris, théâtre de l'Impératrice, 5 février 1806 Le Carnaval de Beaugency ou Mascarade sur mascarade, comédie en 1 acte, en prose, par MM. Étienne et Gaugiran-Nanteuil, Paris, théâtre de l'Impératrice, 2 février 1807 Bruis et Palaprat, comédie en 1 acte et en vers, Paris, Théâtre-Français, 28 novembre 1807 Un jour à Paris ou la Leçon singulière, opéra-comique en 3 actes, mêlé de musique, paroles de M. Étienne, musique de M. Nicolo, Paris, Opéra-comique, 24 mai 1808 Cendrillon, opéra-féerie en 3 actes et en prose, paroles de M. Étienne, musique de M. Nicolo Isouard, Paris, Opéra-comique, 22 février 1810 Les Deux Gendres, comédie en 5 actes et en vers, Paris, Théâtre-Français, 11 août 1810 Le Chômeur naïf, comédie en 1 acte et en prose, Paris, Théâtre-Français, 12 mai 1812. L'Intrigante ou l'École des familles, comédie en 5 actes et en vers, Paris, Théâtre-Français, 6 mars 1813 L'Oriflamme, opéra en 1 acte, paroles de C.-G. Étienne et Baour-Lormian, musique de Méhul, Paer, Breton et Kreutzer, Paris, Académie impériale de musique, 1er février 1814 Joconde ou les Coureurs d'aventures, comédie en 3 actes, mêlée de chants, par M. Étienne, musique de Nicolo, Paris, théâtre de l'opéra-comique, 28 février 1814 Jeannot et Colin, comédie en 3 actes, mêlée de chants, par M. Étienne, musique de Nicolo, Paris, théâtre de l'opéra-comique, 17 octobre 1814 Racine et Cavois, comédie en 3 actes et en vers, Paris, Théâtre-Français, 26 avril 1815 Le Rossignol, opéra-comique en 1 acte, paroles de C.-G. Étienne, musique de Lebrun, Paris, Académie royale de musique, 23 avril 1816 L'Une pour l'autre, opéra-comique en 3 actes, par M. Étienne, musique de M. Nicolo, Paris, Opéra-comique, 11 mai 1816 Zéloïde ou les Fleurs enchantées, opéra en 2 actes, pParoles de C.-G. Étienne, musique de Lebrun, Paris, Académie royale de musique, 19 janvier 1818 Les Plaideurs sans procès, comédie en 3 actes et en vers, Paris, Théâtre-Français, 29 octobre 1821 Aladin ou la Lampe merveilleuse, opéra-féerie en 5 actes, Paris, Académie royale de musique, 6 février 1822 musique de Nicolo et Benincori Le Bénéficiaire, comédie en 5 actes et en 1 vaudeville, par MM. Théaulon et Étienne, Paris, théâtre des Variétés, 26 avril 1825 Le Chiffonnier ou le Philosophe nocturne, comédie-vaudeville en 5 actes et en une journée, par MM. Théaulon et Étienne, Paris, théâtre des Variétés, 6 janvier 1826 Une nuit de Gustave Wasa ou le Batelier suédois, opéra-comique en 2 actes, paroles de J.-M.-C. Leber et C.-G. Étienne, Paris, Opéra-comique, 29 septembre 1827 Arwed ou les Représailles, épisode de la guerre d'Amérique, drame en 2 actes, mêlé de couplets, de MM. Étienne, Varin et Desvergers, Paris, Vaudeville, 31 mars 1830 Divers Histoire du Théâtre français depuis le commencement de la Révolution jusqu'à la réunion générale par C. G. Étienne et A. Martainville 2 volumes 1802 Lettres sur Paris ou Correspondance pour servir à l'histoire de l'établissement du gouvernement représentatif en France 2 volumes 1820 Mémoires de Molé, précédés d'une notice sur cet acteur, par M. Étienne. Le Comédien, par M. Remond de Sainte Albine 1825 Œuvres 5 volumes 1846-1853    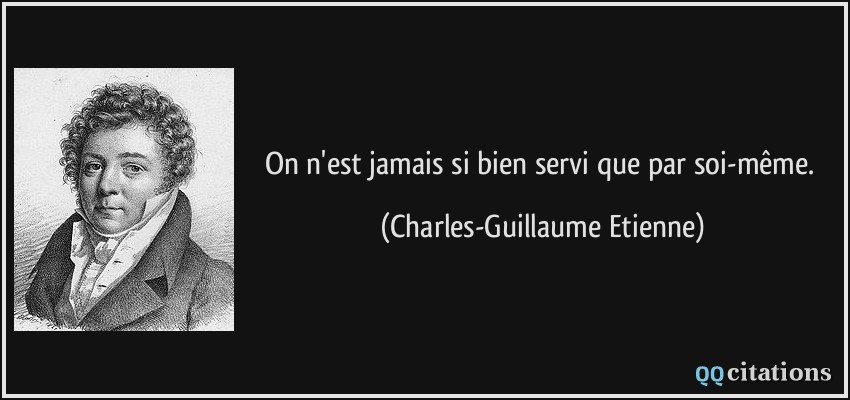  
#39
Paul Guth
Loriane
Posté le : 05/03/2016 23:35
Le 5 mars 1910 à Ossun naît Paul Guth
de son nom complet Joseph Marie Paul Guth, mort, à 87 ans le 29 octobre 1997 à Ville-d'Avray, romancier, Journaliste, dramaturge et essayiste français. Il fut président de l'Académie des provinces françaises. Romancier, essayiste, chroniqueur, mémorialiste, historien, pamphlétaire, il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages parfois teintés d'Histoire, d'anecdotes contemporaines ou de critiques sur ce qu'il considérait comme les maux de son siècle. Il fit partie des premiers comités de la Société des poètes et artistes de France à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Il reçoit le prix Courteline en 1953, le Grand prix du roman de l'Académie française en 1956, Prix Chateaubriand en 1985 Auteur de Roman, essai, chroniques, mémoires. Ses Œuvres principales sont les Mémoires d'un Naïf en 1953, Le Naïf aux quarante enfants en 1955, Le Naïf locataire en 1956, Une enfance pour la vie en 1985 Sa vie Paul Guth est né dans une famille modeste, son père Joseph Guth était mécanicien. Ses parents habitaient alors Villeneuve-sur-Lot. Sa mère, d'origine bigourdane, était alors venue accoucher dans la maison familiale d’Ossun, chef-lieu de canton des Hautes-Pyrénées. Paul Guth commence ses études à Villeneuve-sur-Lot. Il poursuit des études littéraires à Paris au lycée Louis-le-Grand avec comme condisciple Thierry Maulnier. Paul Guth l'appelle la Khâgne des Années folles, qui réunissait Robert Brasillach, Maurice Bardèche, Étiemble, Paul Guth lui-même, Robert Merle, Henri Queffélec, Roger Vailland, Georges Pompidou, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Louis Achille et le Vietnamien Pham Duy Khiem. Puis il fait des études supérieures à la Faculté de Lettres de Paris Sorbonne et deviendra agrégé des lettres en 1933. À cette date, il commence une carrière universitaire classique qui sera interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Il sera professeur de lettres pendant dix ans aux lycées de Dijon, Rouen et Janson-de-Sailly, à Paris. Après la guerre, il se consacre d'abord à la littérature puis au journalisme et à la radio. Il obtient même en 1946 le Prix du Théâtre pour Fugues. En 1953, Paul Guth publie Les Mémoires d'un Naïf, premier roman à succès d'une chronique qui comptera sept volumes. Il y raconte la vie de son personnage récurrent, le Naïf, professeur de français, qui sous une grande naïveté, cache une imagination fertile. Dans cette série, on retrouve Les Mémoires d'un Naïf 1953 - Prix Courteline, Le Naïf sous les drapeaux 1954, Le Naïf aux quarante enfants 1955, Le Naïf locataire 1956 - Grand prix du roman de l'Académie française, Le mariage du Naïf 1957, Le Naïf amoureux 1958 et enfin Saint Naïf 1959. Parallèlement, il collabore régulièrement dans les années 1955 à 60 à la revue d'art « Connaissance des arts » en publiant de nombreux articles. L'œuvre de Paul Guth comprend aussi une série romanesque de quatre volumes sur Jeanne la Mince qu'il publia entre 1960 et 1969 : Jeanne la mince, Jeanne la mince à Paris, Jeanne la mince et l'amour et enfin Jeanne la mince et la jalousie. Dans cette série, il retrace la vie d'une jeune femme, Jeanne la Mince, qui part à la découverte du monde. Sa protagoniste découvre ainsi l'insouciance de la jeunesse puis les années folles à Paris, fait son éducation sentimentale puis découvre l'amour et la jalousie dans les bras du brillant journaliste Paul Bagnac. Pris depuis douze ans par de grands travaux d'Histoire, Paul Guth revient au roman en 1977 avec Le chat Beauté, Dans ce livre, d'une brûlante actualité, il règle ses comptes avec lui-même, avec les autres, avec la vie. La même année, Paul Guth toujours aussi narquois et réactionnaire publie Notre drôle d'époque comme si vous y étiez dans lequel il accumule de nombreuses anecdotes sur la télévision, l'amour, la religion et bien d'autres thèmes, pour nous inviter à sourire de nos habitudes et de notre mode de vie. En 1976, les Lettres à votre fils qui en a ras le bol sont un cri d'amour pour les jeunes et d'espoir en leur bonheur et leur courage. Il évoque également sans détour la plupart des problèmes de la jeunesse : les rapports du présent avec le passé et l'avenir, la vie scolaire, le tabac, la sono, la sexualité, la majorité à dix-huit ans, l'homosexualité, la vitesse, la drogue, le chômage, le travail manuel, les filles, l'amour… Trois ans plus tard, dans Lettre ouverte aux futurs illettrés, il s'adresse à nouveau à la jeunesse, qu'il a appris à chérir durant ses années de pédagogue, pour dénoncer le génocide intellectuel que l'école inflige aux enfants. Paul Guth a également participé à la rédaction de livres pour enfants. Parmi eux, il publie Les Passagers de la Grande Ourse en 1944 en compagnie de Paul Grimault. Le livre raconte les mésaventures de Gô et de son petit chien Sniff à bord d'un aéroscaphe. Durant quelques années, il s'essaya aux romans historiques avec par exemple Moi, Joséphine, impératrice et en 1967, dans Histoire de la littérature française. Dans ce dernier livre, l'auteur, alors professeur de français, tente d'être aussi clair qu'un professeur, en expliquant le mécanisme de la création comme un auteur » et de conserver la posture d'émerveillement. Il se veut le « contemporain de chaque auteur mais s'arrête au seuil des vivants, à l'aube sanglante du vingtième siècle Au début des années 1980, Paul Guth participa souvent à l'émission Les Grosses Têtes sur la radio RTL et fut le partenaire de Sim dans l'interprétation de l'opéra Chinois. En 1988, Paul Guth critique une partie de la gauche dans Oui, le bonheur, inventaire des passions, indignations et recettes du bonheur. Il obtient en 1984 le Prix Chateaubriand pour son livre Une Enfance pour la vie. Enfin, en 1994, après cinquante ans de vie littéraire, c'est en philosophe qu'il livre ses réflexions sur notre société et ses contemporains. Son épouse née Juliette Loubère est décédée le 21 juin 2000. Anecdote En 1997, Paul Guth adressa aux adeptes de la scientologie ses félicitations pour la méthode éducative de Ron Hubbard. Il diffusa même une lettre auprès de ses collègues, les incitant à lire et relire ses ouvrages. Cette prise de partie accentue davantage encore l'idée qu'il ne cessa jamais de nourrir une vision décliniste de l'Occident. Romans 1948 : Les Sept Trompettes 1952 : Le Pouvoir de Germaine Calban. 1953 : Mémoires d'un naïf 1954 : Le Naïf sous les drapeaux 1955 : Le Naïf aux quarante enfants 1956 : Le Naïf locataire 1957 : Le Mariage du naïf 1958 : Le Naïf amoureux 1959 : Saint Naïf 1960 : Jeanne la mince 1961 : Jeanne la mince à Paris 1962 : Jeanne la mince et l'amour 1963 : Jeanne la mince et la jalousie 1975 : Le chat Beauté Flammarion 1985 : La Tigresse 1990 : Le Retour de Barbe Bleue Mercure de France Livres pour la jeunesse 1944 : Les Passagers de la Grande Ourse Gallimard 1945 : L'Épouvantail Gallimard 1950 : La Locomotive Joséphine 1958 : Moustique et le Marchand de sable 1960 : Moustique et Barbe-Bleue 1961 : Le Séraphin couronné 1962 : Henri IV 1963 : Moustique dans la lune 1982 : Cuic dans    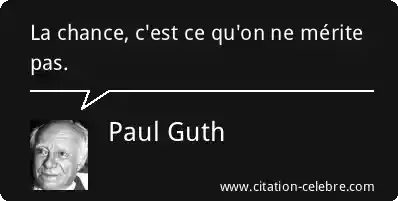   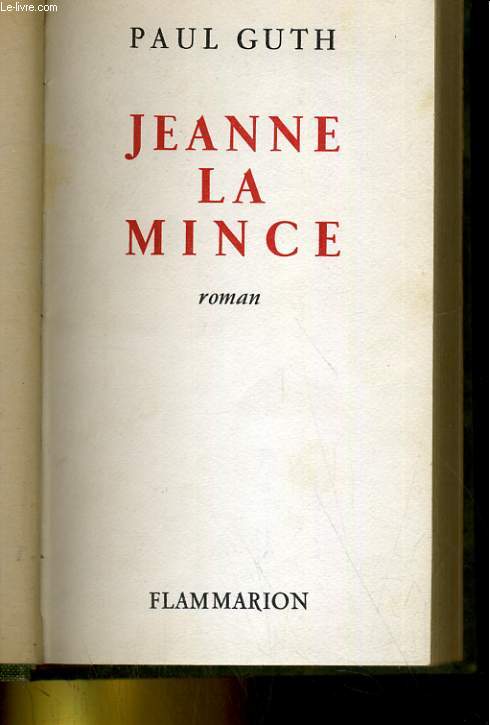
#40
Élisabeth Badinter
Loriane
Posté le : 05/03/2016 21:49
Le 5 mars 1944 naît Élisabeth Badinter
née Bleustein-Blanchet à Boulogne-Billancourt femme de lettres, philosophe, féministe et femme d'affaires française. Elle est surtout connue pour ses réflexions philosophiques qui interrogent le féminisme et la place des femmes dans la société, en accordant une place particulière aux droits des femmes immigrées.Ses Œuvres principales sont Madame du Châtelet, Madame d'Épinay ou l'Ambition féminine au XVIIIe siècle, Paris, Flammarion, 2006 Les Passions intellectuelles, 3 tomes, Paris, Fayard, 1999, 2002, 2007. Elle est l'épouse de Robert Badinter depuis 1966 actionnaire de Publicis Groupe Elle se définit elle-même comme idéologue. Sa vie Élisabeth Badinter est la fille du publicitaire Marcel Bleustein-Blanchet et de Sophie Vaillant, elle-même petite-fille d'Édouard Vaillant, député socialiste et communard. Agrégée de philosophie, spécialiste du siècle des Lumières, et auteur de biographies littéraires, elle a été conférencière à l'École polytechnique . Elle épouse en 1966 Robert Badinter, avec qui elle a trois enfants. Leur fille Judith est psychologue, et leurs deux fils Simon et Benjamin sont à la tête de Médias et régie Europe, une filiale de Publicis dont Élisabeth Badinter est également présidente du conseil de surveillance. Essais et prises de position Élisabeth Badinter s'est attachée à théoriser la notion de la ressemblance des sexes dont elle est l'auteur : La ressemblance des sexes est une telle innovation qu'on peut légitimement l'envisager en termes de mutation. Lors de la parution de Qu'est-ce qu'une femme ?, le journal Le Monde résumait ainsi sa position sur la question dans son édition du 17 mars 1989 : Élisabeth Badinter pense que l'humanisme rationaliste, l'accent mis sur la ressemblance entre les hommes et les femmes, sont historiquement porteurs du progrès de la condition féminine, alors que toutes les pensées de la différence sont potentiellement porteuses de discrimination et d'inégalité. Toutefois, ce rejet du différentialisme s'accompagne, dans le même temps, d'une prise de distance avec le constructivisme à tous crins, qui aboutirait à une déconstruction des genres et des sexes, selon Catherine Rodgers. Dans une lecture très critique de XY, De l’identité masculine, Guy Bouchard souligne des contradictions dans le discours de Badinter sur le débat entre constructivistes et différentialistes, dans la quête d'un homme androgyne. Il dénonce la vision, selon lui à la limite de la misandrie, et insuffisamment développée, d'un homme mou ... favorable à l'égalité de l'homme et de la femme, mais à qui il faut imposer cette égalité alors même qu'elle l'atteindrait dans la construction de sa masculinité. Lors du débat sur la parité en politique, elle s'était opposée à cette loi qui, selon elle, considérait que les femmes étaient incapables d'arriver au pouvoir par elles-mêmes. Son essai Fausse route, publié en 2003 et qui fustige la misandrie et la posture victimaire des féministes françaises contemporaines, ainsi que divers écrits critiques quant aux nouvelles lois concernant la parité politique ou le traitement des crimes et délits sexuels, ont suscité une vive polémique, et de nombreuses féministes lui contestent désormais l'épithète de féministe. De son côté, elle continue de s'en réclamer, arguant que la vocation du féminisme n'est pas de conduire à une guerre des sexes visant à une revanche contre les hommes. Dans cet ouvrage, elle dénonce aussi les enquêtes statistiques sur la violence conjugale où on n'interroge que les femmes et où on amalgame le subjectif et l'objectif, les pressions psychologiques et les agressions physiques, ce qui a pour effet d'établir une hiérarchie morale entre les sexes : À vouloir ignorer systématiquement la violence et le pouvoir des femmes, à les proclamer constamment opprimées, donc innocentes, on trace en creux le portrait d'une humanité coupée en deux peu conforme à la vérité. D'un côté, les victimes de l'oppression masculine, de l'autre, les bourreaux tout-puissants. Selon Élisabeth Badinter, le combat féministe doit aujourd'hui se concentrer essentiellement sur les populations immigrées ou maghrébines, car selon elle, depuis longtemps, dans la société française de souche, que ce soit le judaïsme ou le catholicisme, on ne peut pas dire qu’il y ait une oppression des femmes. Ce positionnement a été très critiqué, notamment par Christine Delphy pour qui ce discours conduit à la fois à légitimer le racisme et à négliger le sexisme existant dans la population non immigrée. En 2013, prenant position dans les discussions concernant le port du voile islamique, en particulier dans l'affaire de la crèche Baby Loup, Élisabeth Badinter estime nécessaire de défendre la laïcité, et incite le gouvernement à voter une loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans le secteur de la petite enfance, comme c’est le cas à l’école. Elle considère le port du voile comme un « étendard politique et communautaire, mais ses propos faisant l'amalgame entre une employée voilée et Mohammed Merah ont été dénoncés par l'association anti-raciste Les Indivisibles. La même année, elle signe la pétition du CRIF contre une résolution du Conseil de l'Europe assimilant la circoncision des mineurs à une atteinte à l'intégrité physique . Fortune et administration de Publicis Autres fonctions Élisabeth Badinter est présidente du conseil de surveillance de Publicis, fondé par son père, Marcel Bleustein-Blanchet. En 2014, elle est la deuxième actionnaire de ce groupe, dont elle détient 10,99 % du capital et 19,92 % des droits de vote. Ce rôle lui vaut des critiques concernant les représentations sexistes de la femme dans le domaine publicitaire. Du fait de sa proximité avec le Parti socialiste, elle se trouve au cœur de la polémique concernant le bonus de 16 millions d'euros touché par le patron de Publicis, Maurice Lévy, lors de la campagne présidentielle de 2012. Élisabeth Badinter justifie ce bonus en affirmant à propos de Maurice Lévy: Aucune entreprise n'a jamais eu un meilleur capitaine. Il est rassurant pour nous tous qu'il soit à la barre. Son expérience est indispensable et nous avons la certitude qu'il saura nous mener à bon port . En 2011, le magazine Challenges estime sa fortune à 652 millions d'euros, soit la 56e fortune de France, puis la 51e. En mars 2012, elle est classée par le magazine américain Forbes 13e personne la plus riche de France, avec une fortune familiale estimée à 1,1 milliard de dollars. En 2012, sa rémunération fixe pour présider le conseil de surveillance de Publicis s'élevait à 240 000 euros par an. Autres fonctions Elle est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence. Elle a également été nommée membre du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France en qualité de personnalité qualifiée, en 1998 et 2002. Décorations Commandeur de l'Ordre du mérite culturel Monaco 2011. Commandeur des Arts et des Lettres 2007 Docteur Honoris Causa de l'Université libre de Bruxelles 2013 Notoriété Une école d'Asnières-sur-Seine Hauts de Seine et le collège de Quint-Fonsegrives Haute-Garonne portent son nom. Le collège de la Couronne Charente porte son nom ainsi que celui de son mari, tout comme des écoles situées à Laval Mayenne et à Tomblaine. Œuvres L'Amour en plus, 1980 réimpr. 2010; Les Goncourt : Romanciers et historiens des femmes, préface de La Femme au xviie siècle d'Edmond et Jules de Goncourt, 1981 ; Émilie, Émilie, L'ambition féminine au XVIIIe siècle, 1988; Les Remontrances de Malesherbes 1771-1775, 1985 ; Cahiers Suzanne Lilar, Paris, Gallimard, 1986 , p. 15-26 ; L'Un est l'autre, 1986 ; Condorcet. Un intellectuel en politique, 1988, avec Robert Badinter ; Correspondance inédite de Condorcet et Madame Suard 1771-1791, 1988 ; Madame d'Épinay, Histoire de Madame de Montbrillant ou les Contreconfessions, préface d'Élisabeth Badinter, 1989 ; Thomas, Diderot, Madame d'Épinay : Qu'est-ce qu'une femme ?, débat préfacé par Élisabeth Badinter, 1989 ; Condorcet, Prudhomme, Guyomar : Paroles d'hommes 1790-1793, présentées par Élisabeth Badinter, 1989 ; XY, de l'identité masculine, 1992 ; Madame du Châtelet, Discours sur le bonheur, préface 1997 ; Les Passions intellectuelles, tome 1 : Désirs de gloire 1735-1751, 1999 ; Les Passions intellectuelles, tome 2 : L'exigence de dignité 1751-1762, 2002 ; Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute, 2002. Conférence d'Élisabeth Badinter, Jacques Lassalle et Lucette Finas, Fausse route : Réflexions sur 30 années de féminisme, 2003 ; Madame du Châtelet, Madame d'Épinay ou l'Ambition féminine au XVIIIe siècle, 2006 ; Les Passions intellectuelles, tome 3 : Volonté de pouvoir 1762-1778, 2007 ; Je meurs d'amour pour toi, Isabelle de Bourbon-Parme, lettres à l'archiduchesse Marie-Christine, 2008. Le conflit, la femme et la mère, 2010.        |
Connexion
Sont en ligne
165 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 165 Plus ... |
| Haut de Page |






