 Tous les messages Tous les messages
#21
Victor Hugo 1
Loriane
Posté le : 21/05/2016 17:54
Le 22 mai 1885 à Paris meurt Victor Marie Hugo
à 83 ans, né le 26 février 1802 à Besançon, poète, dramaturge et prosateur romantique considéré comme l’un des plus importants écrivains de langue française. Il étudie au Lycée Louis-le-grand ouù il passe ses diplômes.Son activité principale est écrivain, Romancier, Poète, Dramaturge, Pamphlétaire, Personnalité politique, Dessinateur, Pair de France et Sénateur. Il appartient au mouvement romantique et est l'auteur de Romans, poésies, Théatre, pamphlet que l'on dit hugolien ou hugolienne. Ses Œuvres principales sont : Ses Romans : Notre-Dame de Paris en 1831, Les Misérables en 1862, Les Travailleurs de la mer en 1866, Ses Poésies : Les Châtiments en 1853, Les Contemplations en 1856, La Légende des siècles en 1859, Son Théâtre : Hernani en 1830, Ruy Blas en 1838. Il est élu à l'Académie française et eut des funérailles nationales. Il est inhumé au Panthéon de Paris Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du XIXe siècle. Il occupe les fonctions de sénateur de la Seine du 30 janvier 1876 au 22 mai 1885. Il est élu le première fois le 30 janvier 1876, et il est ééélu le 8 janvier 1882 au groupe politique d'extrême gauche (différente de l'extrême gauche actuelle). Il est député de la Seine du 8 février 1871 au 1er mars 1871, élection le 8 février 1871 Il appartient au groupe politique d'extrême gauche du 4 juin 1848 au 2 décembre 1851. Première élection le 4 juin 1848, la réélection à lieu le 13 mai 1849 au groupe politique de droite. Victor Hugo occupe une place marquante dans l’histoire des lettres françaises au XIXe siècle, dans des genres et des domaines d’une remarquable variété. Il est poète lyrique avec des recueils comme Odes et Ballades 1826, Les Feuilles d'automne 1831 ou Les Contemplations 1856, mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments 1853 ou encore poète épique avec La Légende des siècles 1859 et 1877. Il est également un romancier du peuple qui rencontre un grand succès populaire avec notamment Notre-Dame de Paris 1831, et plus encore avec Les Misérables 1862. Au théâtre, il expose sa théorie du drame romantique dans sa préface de Cromwell en 1827 et l’illustre principalement avec Hernani en 1830 et Ruy Blas en 1838, mais aussi Lucrèce Borgia et Le Roi s'amuse.Son œuvre multiple comprend aussi des discours politiques à la Chambre des pairs, à l'Assemblée constituante et à l'Assemblée législative, notamment sur la peine de mort, l’école ou l’Europe, des récits de voyages; le Rhin, 1842, ou Choses vues, posthumes, 1887 et 1890, et une correspondance abondante. Victor Hugo a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre. Il a été admiré par ses contemporains et l’est encore, mais il a aussi été contesté par certains auteurs modernes. Il a aussi permis à de nombreuses générations de développer une réflexion sur l’engagement de l’écrivain dans la vie politique et sociale grâce à ses multiples prises de position, qui le condamneront à l’exil pendant les vingt ans du Second Empire. Ses choix, à la fois moraux et politiques, durant la deuxième partie de sa vie, et son œuvre hors du commun ont fait de lui un personnage emblématique, que la Troisième République a honoré à sa mort le 22 mai 1885 par des funérailles nationales, qui ont accompagné le transfert de sa dépouille au Panthéon de Paris, le 1er juin 1885. Sa vie Victor, Marie Hugo est le fils du général d'Empire Joseph Léopold Sigisbert Hugo 1773‑1828, créé comte, selon la tradition familiale, par Joseph Bonaparte, roi d'Espagne et en garnison dans le Doubs au moment de la naissance de son fils, et de Sophie Trébuchet 1772‑1821, jeune femme issue de la bourgeoisie nantaise. Benjamin d'une famille de trois enfants après Abel Joseph Hugo 1798‑1855 et Eugène Hugo 1800‑1837, il passe son enfance à Paris. De fréquents séjours à Naples et en Espagne, à la suite des affectations militaires de son père, marqueront ses premières années. Ainsi, en 1811, il est, avec ses frères Abel et Eugène, pensionnaire dans une institution religieuse de Madrid, le Real Colegio de San Antonio de Abad. Vers 1813, il s'installe à Paris avec sa mère qui s'est séparée de son mari, car elle entretient une liaison avec le général d'Empire Victor Fanneau de la Horie, parrain et précepteur de Victor Hugo auquel il donne son prénom. En septembre 1815, il entre avec son frère à la pension Cordier. D'après Adèle Foucher, son épouse qui fut aussi son amie d'enfance, c'est vers cet âge qu'il commence à versifier. Autodidacte, c'est par tâtonnement qu'il apprend la rime et la mesure. Il est encouragé par sa mère à qui il lit ses œuvres, ainsi qu’à son frère Eugène. Ses écrits sont relus et corrigés par un jeune maître d’études de la pension Cordier qui s’est pris d’amitié pour les deux frères. Sa vocation est précoce et ses ambitions sont immenses. Âgé de quatorze ans à peine, Victor, en juillet 1816, note sur un journal : Je veux être Chateaubriand ou rien. En 1817, il participe à un concours de poésie organisé par l'Académie française sur le thème Bonheur que procure l’étude dans toutes les situations de la vie. Le jury est à deux doigts de lui adresser le prix, mais le titre de son poème Trois lustres à peine suggère trop son jeune âge et l’Académie croit à un canular : il reçoit seulement une mention. Il concourt sans succès les années suivantes, mais gagne, à des concours organisés par l'Académie des jeux floraux de Toulouse, en 1819, un Lys d’or pour La statue de Henri IV et un Amaranthe d’or pour Les Vierges de Verdun, et un prix en 1820 pour Moïse sur le Nil. Encouragé par ses succès, Victor Hugo délaisse les mathématiques, pour lesquelles il a des aptitudes il suit les cours des classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand, et embrasse la carrière littéraire. Avec ses frères Abel et Eugène, il fonde en 1819 une revue, Le Conservateur littéraire, qui attire déjà l’attention sur son talent. Son premier recueil de poèmes, Odes, paraît en 1821 : il a alors dix-neuf ans. Les quinze cents exemplaires s’écoulent en quatre mois. Le roi Louis XVIII, qui en possède un exemplaire, lui octroie une pension annuelle de mille francs, ce qui lui permet d’envisager d’épouser son amie d’enfance Adèle Foucher. Jeune écrivain La mort de sa mère le 27 juin 1821 l’affecte profondément. En effet, les années de séparation d’avec son père l’avaient rapproché de celle-ci. Il épouse, le 12 octobre 1822, son amie d’enfance, Adèle Foucher, née en 1803, qui donne naissance à cinq enfants : Tombe de Charles et François-Victor au cimetière du Père-Lachaise. Léopold 16 juillet 1823 - 10 octobre 1823 ; Léopoldine 28 août 1824 - 4 septembre 1843 ; Charles 4 novembre 1826 - 13 mars 1871 ; François–Victor 28 octobre 1828 - 26 décembre 1873 ; Adèle 28 juillet 1830 - 21 avril 1915, la seule qui survivra à son illustre père, mais dont l’état mental, très tôt défaillant, lui vaudra de longues années en maison de santé. Ce mariage précipite son frère Eugène dans la folie, une schizophrénie qui conduira à son enfermement jusqu’à sa mort en 1837. Il commence la rédaction la même année de Han d'Islande publié en 1823, qui reçoit un accueil mitigé. Une critique de Charles Nodier, bien argumentée, est l’occasion d’une rencontre entre les deux hommes et de la naissance d’une amitié. À la bibliothèque de l'Arsenal, berceau du romantisme, il participe aux réunions du Cénacle, qui auront une grande influence sur son développement. Son amitié avec Nodier dure jusqu’à 1827-1830, époque où celui-ci commence à être très critique envers les œuvres de Victor Hugo24. Durant cette période, Victor Hugo renoue avec son père, qui lui inspirera les poèmes Odes à mon père et Après la bataille. Celui-ci meurt en 1828. Jusqu'en mars 1824, le couple habite chez les parents d'Adèle ; ils déménagent pour le 90, rue de Vaugirard, appartement où leur fille Léopoldine naît, en août 1824. Sa pièce Cromwell, publiée en 1827, fait éclat. Dans la préface de ce drame, Victor Hugo s’oppose aux conventions classiques, en particulier à l'unité de temps et à l'unité de lieu, et jette les premières bases de son drame romantique. L'arrivée de leur fils Charles en novembre 1826 fait déménager la famille l'année suivante dans une maison au 11, rue Notre-Dame-des-Champs. Le couple reçoit beaucoup et se lie avec Sainte-Beuve, Lamartine, Mérimée, Musset, Delacroix. François–Victor naît en octobre 1828. En mai 1830, la famille déménage pour la Rue Jean-Goujon. Adèle, leur dernier enfant, naît en juillet. Ils habiteront rue Jean-Goujon jusqu'en octobre 1832. Adèle, la mère, entretient une relation amoureuse avec Sainte-Beuve, qui se développe durant l’année 1831. De 1826 à 1837, la famille séjourne fréquemment au Château des Roches à Bièvres, propriété de Bertin l’Aîné, directeur du Journal des débats. Au cours de ces séjours, Hugo rencontre Berlioz, Chateaubriand, Liszt, Giacomo Meyerbeer, et rédige des recueils de poésie, dont les Feuilles d'automne. Il publie en 1829, le recueil de poèmes les Orientales. La même année, paraît Le Dernier Jour d'un condamné, court roman dans lequel Victor Hugo présente son dégoût de la peine de mort, sujet qu'il abordera à nouveau dans Claude Gueux en 1834. Le roman Notre Dame de Paris paraît en 1831. La Bataille d'Hernani Grandville, 1836 Années théâtre De 1830 à 1843, Victor Hugo se consacre presque exclusivement au théâtre, mais publie néanmoins des recueils de poésies : Les Feuilles d'automne 1831, Les Chants du crépuscule 1835, Les Voix intérieures 1837, Les Rayons et les Ombres 1840. Déjà en 1828, il avait monté une œuvre de jeunesse Amy Robsart. L'année 1830 est l'année de la création d’Hernani, qui est l'occasion d'un affrontement littéraire fondateur entre anciens et modernes. Ces derniers, au premier rang desquels Théophile Gautier, s'enthousiasment pour cette œuvre romantique – combat qui restera dans l'histoire de la littérature sous le nom de bataille d'Hernani. Marion de Lorme, interdite une première fois en 1829, est montée en 1831 au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, puis, en 1832, Le roi s'amuse au Théâtre-Français. La pièce sera dans un premier temps interdite, fait dont Hugo s'indignera dans la préface de l'édition originale de 1832. En 1833, il rencontre l'actrice Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse. Elle lui consacrera sa vie et le sauvera de l'emprisonnement lors du coup d'État de Napoléon III. Il écrira pour elle de nombreux poèmes. Tous deux passent ensemble chaque anniversaire de leur rencontre et remplissent, à cette occasion, année après année, un cahier commun qu'ils nomment tendrement le Livre de l'anniversaire. Mais Juliette ne fut qu'une de ses nombreuses maîtresses. Il y aura notamment Léonie d'Aunet avec qui il entretiendra une liaison de 1844 à 1851 ou l’actrice Alice Ozy en 1847. Lucrèce Borgia et Marie Tudor sont montées au Théâtre de la porte Saint-Martin en 1833, Angelo, tyran de Padoue au Théâtre Français en 1835. Il manque de salle pour jouer les drames nouveaux. Victor Hugo décide donc, avec Alexandre Dumas, de créer une salle consacrée au drame romantique. Aténor Joly reçoit, par arrêté ministériel, le privilège autorisant la création du théâtre de la Renaissance en 1836, où sera donné, en 1838, Ruy Blas. Hugo accède à l'Académie française le 7 janvier 1841, après trois tentatives infructueuses essentiellement dues à certains académiciens menés entre autres par Étienne de Jouy, opposés au romantisme et le combattant férocement. Il y prend le fauteuil no 14 de Népomucène Lemercier, l'un de ces opposants. Puis, en 1843, est montée la pièce Les Burgraves, qui ne recueille pas le succès escompté. Lors de la création de toutes ces pièces, Victor Hugo se heurte aux difficultés matérielles et humaines. Ses pièces sont régulièrement sifflées par un public peu sensible au drame romantique, même si elles reçoivent aussi de la part de ses admirateurs de vigoureux applaudissements. Le 4 septembre 1843, Léopoldine meurt tragiquement à Villequier, dans la Seine, noyée avec son mari Charles Vacquerie dans le naufrage de leur barque. Hugo était alors dans les Pyrénées, avec sa maîtresse Juliette Drouet, et il apprend ce drame par les journaux à Rochefort38. L'écrivain est terriblement affecté par cette mort, qui lui inspirera plusieurs poèmes des Contemplations – notamment, Demain, dès l'aube…. À partir de cette date et jusqu'à son exil, Victor Hugo ne produit plus rien, ni théâtre, ni roman, ni poème. Certains voient dans la mort de Léopoldine et l'échec des Burgraves une raison de sa désaffection pour la création littéraire. D'autres y voient plutôt l'attrait pour la politique, qui lui offre une autre tribune. Action politique Élevé par sa mère nantaise Sophie Trébuchet dans l'esprit du royalisme, il se laisse peu à peu convaincre de l'intérêt de la démocratie J'ai grandi, écrit-il dans le poème Écrit en 1846 en réponse à un reproche d'un ami de sa mère. Selon Pascal Melka, Victor Hugo a la volonté de conquérir le régime pour avoir de l'influence et permettre la réalisation de ses idées. Il devient ainsi confident de Louis-Philippe en 1844, puis pair de France en 1845. Son premier discours en 1846 est pour défendre le sort de la Pologne écartelée entre plusieurs pays, puis en 1847, il défend le droit au retour des bannis, dont celui de Jérôme Napoléon Bonaparte. Au début de la Révolution de 1848, il est nommé maire du 8e arrondissement de Paris, puis député de la deuxième République et siège parmi les conservateurs. Lors des émeutes ouvrières de juin 1848, Victor Hugo, lui-même, va participer au massacre, en commandant des troupes face aux barricades, dans l'arrondissement parisien dont il se trouve être le maire. Il en désapprouvera plus tard la répression sanglante. Il fonde le journal L'Événement en août 1848. Il soutient la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République en décembre 1848. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, il est élu en 1849 à l'Assemblée législative et prononce son Discours sur la misère. Il rompt avec Louis-Napoléon Bonaparte, lorsque celui-ci soutient le retour du pape à Rome, et il se bat progressivement contre ses anciens amis politiques, dont il réprouve la politique réactionnaire. Exil de Victor Hugo. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo tente d'abord de fuir, puis se constitue prisonnier, mais un commissaire français, flairant le piège, refuse de l'arrêter lui répondant M. Hugo, je ne vous arrête pas, car je n'arrête que les gens dangereux! . Il s'exile volontairement à Bruxelles, puis à Jersey. Il condamne vigoureusement pour des raisons morales le coup d'État et son auteur Napoléon III dans un pamphlet publié en 1852, Napoléon le Petit, ainsi que dans Histoire d'un crime, écrit au lendemain du coup d'État et publié 25 ans plus tard, et dans Les Châtiments. Le souvenir douloureux de Léopoldine sa fille — ainsi que sa curiosité — le pousse à tenter des expériences de spiritisme, consignées dans Les Tables tournantes de Jersey. Chassé de Jersey en 1855 pour avoir critiqué la reine Victoria, il s'installe à Guernesey dans sa maison, Hauteville House. Il fait partie des quelques proscrits qui refusent l'amnistie décidée quelque temps après. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ces années difficiles sont très fécondes. Il publiera notamment Les Châtiments 1853, œuvre en vers qui prend pour cible le Second Empire ; Les Contemplations, poésies 1856 ; La Légende des siècles 1859, ainsi que Les Misérables, roman 1862. Il rend hommage au peuple de Guernesey dans son roman Les Travailleurs de la mer 1866. Il reçoit quelques visites du continent, celle de Judith Gautier et, en 1860, celle de Boucher de Perthes. Le fondateur de la préhistoire le décrit alors comme un républicain gentilhomme …, fort bien installé, vivant en père de famille …, aimé de ses voisins et considéré des habitants. Retour en France et mort Napoléon III signe en 1859 une amnistie générale des prisonniers politiques, mais Victor Hugo refuse de profiter de cette grâce de l’usurpateur, de même que celle de 1869. Victor Hugo retourne en France en septembre 1870 après la défaite de l'armée française à Sedan et reçoit de la part des Parisiens un accueil triomphal. Il participe activement à la défense de Paris assiégé. Élu à l'Assemblée nationale siégeant alors à Bordeaux le 8 février 1871, il en démissionne le mois suivant pour protester contre l'invalidation de Garibaldi. En mars 1871, il est à Bruxelles pour régler la succession de son fils Charles lorsqu'éclate la Commune. C'est de Belgique qu'il assiste à la révolte et à sa répression, qu'il désapprouve si vivement qu'il est expulsé de ce pays. Il trouve refuge pendant trois mois et demi dans le Grand-Duché 1er juin-23 septembre. Il séjourne successivement à Luxembourg, à Vianden deux mois et demi, à Diekirch et à Mondorf, où il suit une cure thermale. Il y achève le recueil L'Année terrible. Il retourne en France fin 1871. Plusieurs comités républicains l'ayant sollicité, il accepte de se porter candidat à l'élection complémentaire du 7 janvier 1872. Apparaissant comme radical en raison de sa volonté d’amnistier les communards, il est battu par le républicain modéré Joseph Vautrain. La même année, Hugo se rend à nouveau à Guernesey où il écrit le roman Quatrevingt-treize. En 1873, il est à Paris et se consacre à l'éducation de ses deux petits-enfants, Georges et Jeanne, qui lui inspirent le recueil L'Art d'être grand-père. Il reçoit beaucoup, hommes politiques et littéraires, les Goncourt, Lockroy, Clemenceau, Gambetta… Le 30 janvier 1876, il est élu sénateur et milite pour l'amnistie. Il s'oppose à Mac Mahon quand celui-ci dissout l'assemblée. Dans son discours d'ouverture du congrès littéraire international de 1878, il se positionne pour le respect de la propriété littéraire, mais aussi pour le fondement du domaine public. En juin 1878, Hugo est victime d'un malaise, peut-être une congestion cérébrale. Il part se reposer quatre mois à Guernesey dans sa demeure de Hauteville House, suivi de son secrétaire bénévole Richard Lesclide. Ce mauvais état de santé met pratiquement fin à son activité d'écriture. Toutefois, de très nombreux recueils, réunissant en fait des poèmes datant de ses années d'inspiration exceptionnelle 1850-1870, continuent à paraître régulièrement La Pitié suprême en 1879, L'Âne, Les Quatre Vents de l'esprit en 1881, la dernière série de la Légende des siècles en septembre 1883…, contribuant à la légende du vieil homme intarissable jusqu'à la mort. Durant cette période, nombre de ses pièces sont de nouveau jouées Ruy Blas en 1872, Marion de Lorme et Marie Tudor en 1873, Le roi s'amuse en 1882. Sous la Troisième République, le gouvernement Ferry promulgue la loi du 30 juillet 1881, dite de réparation nationale, qui alloue une pension ou rente viagère aux citoyens français victimes du coup d'Etat du 2 décembre 1851 et de la loi de sûreté générale. La Commission générale chargée d'examiner les dossiers, présidée par le Ministre de l'Intérieur, est composée de représentants du ministère, de conseillers d'État, et comprend huit parlementaires, tous d'anciennes victimes : quatre sénateurs Victor Hugo, Jean-Baptiste Massé, Elzéar Pin, Victor Schœlcher et quatre députés Louis Greppo, Noël Madier de Montjau, Martin Nadaud et Alexandre Dethou. Jusqu'à sa mort, en 1885, il reste une des figures tutélaires de la république retrouvée — en même temps qu'une référence littéraire incontestée. Il meurt le 22 mai 1885, dans son hôtel particulier La Princesse de Lusignan, qui était situé au 50, avenue Victor-Hugo, à la place de l'actuel no 12466. Selon la légende, ses derniers mots sont : C'est ici le combat du jour et de la nuit… Je vois de la lumière noire. Conformément à ses dernières volontés, c'est dans le corbillard des pauvres qu'a lieu la cérémonie. Il est d'abord question du Père Lachaise, mais le premier juin, à la suite du décret du 26 mai 1885 lui accordant des obsèques nationales voté par 415 voix sur 418, il est finalement conduit au Panthéon, la jeune Troisième République profitant de cet événement pour retransformer l'église Sainte-Geneviève en Panthéon. Avant son transfert, son cercueil est exposé une nuit sous l'Arc de triomphe voilé obliquement par un crêpe noir ; des cuirassiers à cheval veillent toute la nuit le catafalque surmonté des initiales VH, selon l'ordonnancement de Charles Garnier. On considère qu’environ deux millions de personnes et 2 000 délégations se sont déplacées pour lui rendre un dernier hommage, le cortège vers le Panthéon s'étire sur plusieurs kilomètres. Il est alors l'écrivain le plus populaire de son temps et le demeure ; il est déjà depuis plusieurs décennies considéré comme l'un des monuments de la littérature française. ▼ Témoignage de Maurice Barrès dans Les Déracinés 1897▼ : Le Minutier central des notaires de Paris, département des Archives nationales, conserve des testaments et codicilles olographes de Victor Hugo, à la suite de son décès survenu en son domicile aujourd'hui 50, avenue Victor-Hugo, le 22 mai 1885, dans lesquels on trouve le testament mystique dicté par lui le 9 avril 1875, clos le 9 avril 1875 et déposé le 23 mai 1885 ; son testament olographe du 5 mai 1864, à Guernesey, déposé le 12 avril 1886, etc. Testament de Victor Hugo. Une œuvre monumentale L'ensemble des écrits de Victor Hugo, triés et organisés par ses exécuteurs testamentaires Paul Meurice et Auguste Vacquerie a été publié chez Jean-Jacques Pauvert et représente presque quarante millions de caractères réunis en 53 volumes. « L'ensemble de mon œuvre fera un jour un tout indivisible … Un livre multiple résumant un siècle, voilà ce que je laisserai derrière moi Victor Hugo a pratiqué tous les genres : roman, poésie, théâtre, essai, etc. – avec une passion du Verbe, un sens de l'épique et une imagination féconde. Écrivain et homme politique, Victor Hugo n'a jamais cherché à opérer une distinction entre son activité d'écrivain et son engagement. Ainsi mélange-t-il intimement, dans ses œuvres de fiction, développement romanesque et réflexion politique. Romancier inclassable Hugo a laissé neuf romans. Le premier, Bug-Jargal a été écrit à seize ans ; le dernier, Quatrevingt-treize, à soixante-douze. L'œuvre romanesque a traversé tous les âges de l'écrivain, toutes les modes et tous les courants littéraires de son temps, sans jamais se confondre totalement avec aucun ; en effet, allant au-delà de la parodie, Hugo utilise les techniques du roman populaire en les amplifiant et subvertit les genres en les dépassant82 : si Han d'Islande, en 1823, Bug-Jargal, publié en 1826, ou Notre-Dame de Paris, en 1831, ressemblent aux romans historiques en vogue au début du XIXe siècle ils en dépassent le cadre ; Hugo n'est pas Walter Scott et, chez lui, le roman se développe vers l'épopée et le grandiose. Le Dernier Jour d'un condamné en 1829 et Claude Gueux en 1834 engagent une réflexion directement sociale, mais ils ne sont pas plus aisés à définir. Pour Hugo lui-même, il faut distinguer romans de faits et romans d'analyse. Ces deux derniers sont des romans à la fois historiques et sociaux, mais sont surtout des romans engagés dans un combat – l'abolition de la peine de mort – qui dépasse de loin le cadre de la fiction. On peut en dire autant des Misérables, qui paraît en 1862, en pleine période réaliste, mais qui lui emprunte peu de caractéristiques. Ce succès populaire phénoménal embarrasse d'ailleurs la critique, car il louvoie constamment entre mélodrame populaire, tableau réaliste et essai didactique. De la même façon, dans Les Travailleurs de la mer 1866 et dans L'Homme qui rit 1869, Hugo se rapproche davantage de l'esthétique romantique du début du siècle, avec ses personnages difformes, ses monstres et sa Nature effrayante. Enfin, en 1874, Quatrevingt-treize signe la concrétisation romanesque d'un vieux thème hugolien : le rôle fondateur de la Révolution française dans la conscience littéraire, politique, sociale et morale du XIXe siècle. Il mêle alors la fiction et l'histoire, sans que l'écriture marque de frontière entre les narrations. Œuvre de combat Le roman hugolien n'est pas un divertissement : pour lui l'art doit en même temps instruire et plaire et le roman est presque toujours au service du débat d'idées. Cette constante traverse les romans abolitionnistes de sa jeunesse, elle se poursuit, dans sa maturité, au travers de ses nombreuses digressions sur la misère matérielle et morale dans Les Misérables. Poète ou romancier, Hugo demeure le dramaturge de la fatalité et ses héros sont, comme les héros de tragédie, aux prises avec les contraintes extérieures et une implacable fatalité ; tantôt imputable à la société Jean Valjean ; Claude Gueux ; le héros du Dernier jour d'un condamné, tantôt à l'Histoire Quatrevingt-treize ou bien à leur naissance Quasimodo. Le goût de l'épopée, des hommes aux prises avec les forces de la Nature, de la Société, de la fatalité, n'a jamais quitté Hugo ; l'écrivain a toujours trouvé son public, sans jamais céder aux caprices de la mode, et personne ne s'étonne qu'il ait pu devenir un classique de son vivant. Dramaturge Projet ambitieux Le théâtre de Victor Hugo se situe dans un renouveau du genre théâtral initié par Madame de Staël, Benjamin Constant, François Guizot, Stendhal et Chateaubriand. Dans sa pièce Cromwell qu'il sait être injouable à son époque pièce de 6 414 vers et aux innombrables personnages, il donne libre cours à son idée du nouveau théâtre. Il publie conjointement une préface destinée à défendre sa pièce et où il expose ses idées sur le drame romantique : un théâtre tout-en-un, à la fois drame historique, comédie, mélodrame et tragédie. Il se revendique dans la lignée de Shakespeare, jetant un pont entre Molière et Corneille. Il y expose sa théorie du grotesque qui se décline sous plusieurs formes : du ridicule au fantastique en passant par le monstrueux ou l'horrible. Victor Hugo écrit Le beau n'a qu'un type, le laid en a mille. Anne Ubersfeld parle à ce sujet de l'aspect carnavalesque du théâtre hugolien et de l'abandon de l'idéal du beau. Selon Victor Hugo, le grotesque doit côtoyer le sublime, car ce sont les deux aspects de la vie. Lors de la création de ses autres pièces, Victor Hugo est prêt à de nombreuses concessions pour apprivoiser le public et le mener vers son idée du théâtre. Pour lui, le romantisme est le libéralisme en littérature. Ses dernières pièces, écrites durant l'exil et jamais jouées de son vivant, sont d'ailleurs réunies dans un recueil au nom évocateur Théâtre en liberté. Le théâtre doit s'adresser à tous : l'amateur de passion, celui de l'action ou celui de la morale. Le théâtre a ainsi pour mission d'instruire, d'offrir une tribune pour le débat d'idées et de présenter les plaies de l'humanité avec une idée consolante. Victor Hugo choisit de situer ses pièces principalement dans les XVIe et XVIIe siècles, se documente beaucoup avant de commencer à écrire, présente souvent une pièce à trois pôles : le maître, la femme, le laid où se confrontent et se mélangent deux mondes : celui du pouvoir et celui des serviteurs, où les rôles s'inversent Ruy Blas, serviteur, joue le rôle d'un grand d'Espagne, où le héros se révèle faible et où le monstre a une facette attachante. Victor Hugo reste attaché à l'alexandrin auquel il donne cependant, quand il le souhaite, une forme plus libre et rares sont ses pièces en prose Lucrèce Borgia, Marie Tudor. Bataille d'Hernani. Victor Hugo, s'il possède d'ardents défenseurs de son théâtre comme Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Hector Berlioz, Petrus Borel, etc., a aussi rencontré de nombreuses difficultés dans la présentation de ses pièces. La première est une opposition politique. Sa remise en question des représentants du pouvoir ne plaît pas, Marion de Lorme est interdite, le Roi s'amuse l'est aussi après sa première représentation, Les Ultras attaquent Ruy Blas. La seconde est la contrainte économique : il n'existe sur Paris que deux théâtres susceptibles de représenter le drame, le Théâtre-Français et le théâtre de la Porte-Saint-Martin. Ces deux théâtres subventionnés ne roulent pas sur l'or et sont tributaires des subsides de l'État. Leurs directeurs hésitent à prendre des risques. Victor Hugo se plaindra du manque de liberté qu'ils offrent. C'est une des raisons qui lui font entreprendre l'aventure du théâtre de la Renaissance. La troisième et la plus importante est une opposition du milieu artistique lui-même. Les artistes et les critiques de son époque sont pour beaucoup hostiles à la transgression des codes culturels que représente le théâtre de Victor Hugo. Ils approuvent les grandes pensées qui élèvent l'âme, mais s'insurgent contre tout ce qui relève du grotesque, du vulgaire, du populaire ou du trivial. Ils ne supportent pas tout ce qui est excessif, lui reprochent son matérialisme et son absence de morale. Ils critiquent vigoureusement chaque pièce présentée et sont souvent à l'origine de leur arrêt prématuré. Le Roi s'amuse ne fut représenté qu'une seule fois, Hernani, pourtant forte de cinquante représentations à succès ne fut pas reprise en 1833, Marie Tudor n'est joué que 42 fois, Les Burgraves sont un échec. Ruy Blas est un succès financier, mais est boudé par la critique. Seule Lucrèce Borgia peut être considérée comme un plein succès. Devenir Florence Naugrette fait remarquer que le théâtre de Victor Hugo a été peu joué dans la première moitié du XXe siècle. Il est remis au goût du jour par Jean Vilar en 1954 qui monte successivement Ruy Blas et Marie Tudor. D'autres metteurs en scène suivent qui font revivre Lucrèce Borgia Bernard Jenny, Les Burgraves et Hernani Antoine Vitez, Marie Tudor Daniel Mesguich, les pièces du Théâtre en liberté L'Intervention, Mangeront-ils?, Mille Francs de récompense… sont montées dans les années 1960 et continuent à l'être. On peut lire aujourd'hui l'ensemble de ce Théâtre en liberté dans l'édition qu'en a procurée Arnaud Laster. Florence Naugrette souligne aussi les difficultés d'interprétation du théâtre hugolien, comment n'être ni grandiloquent, ni prosaïque, mais sans fausse pudeur, comment présenter le grotesque sans glisser vers la caricature et comment gérer l'immensité de l'espace scénique et rappelle le conseil de Jean Vilar : jouer sans pudeur en faisant confiance au texte de Victor Hugo. Poète Vers de jeunesse À vingt ans, Hugo publie les Odes, recueil qui laisse déjà entrevoir, chez le jeune écrivain, les thèmes hugoliens récurrents : le monde contemporain, l'Histoire, la religion et le rôle du poète, notamment. Par la suite, il se fait de moins en moins classique, de plus en plus romantique, et Hugo séduit le jeune lecteur de son temps au fil des éditions successives des Odes quatre éditions entre 1822 et 1828. En 1828, Hugo réunit sous le titre Odes et Ballades toute sa production poétique antérieure. Fresques historiques, évocation de l'enfance ; la forme est encore convenue, sans doute, mais le jeune romantique prend déjà des libertés avec le mètre et la tradition poétique. Cet ensemble permet en outre de percevoir les prémices d'une évolution qui durera toute sa vie : le chrétien convaincu s'y montre peu à peu plus tolérant, son monarchisme qui se fait moins rigide et accorde une place importante à la toute récente épopée napoléonienne ; de plus, loin d'esquiver son double héritage paternel napoléonien et maternel royaliste, le poète s'y confronte, et s'applique à mettre en scène les contraires ce que l'on appelle l'antithèse hugolienne pour mieux les dépasser : « Les siècles, tour à tour, ces gigantesques frères, Différents par leur sort, semblables en leurs vœux, Trouvent un but pareil par des routes contraires. Puis Hugo s'éloigne dans son œuvre des préoccupations politiques immédiates auxquelles il préfère – un temps – l'art pour l'art. Il se lance dans Les Orientalesl'Orient est un thème en vogue en 1829, l'année du Dernier jour d'un condamné. Le succès est important, sa renommée de poète romantique assurée et surtout, son style s'affirme nettement tandis qu'il met en scène la guerre d'indépendance de la Grèce le choix de présenter l'exemple de ces peuples qui se débarrassent de leurs rois n'est pas innocent dans le contexte politique français qui inspira également Lord Byron ou Delacroix. Première maturité Dès les Feuilles d'automne 1832, les Chants du crépuscule 1835 Les Voix intérieures 1837, jusqu'au recueil les Rayons et les Ombres 1840, se dessinent les thèmes majeurs d'une poésie encore lyrique – le poète est une âme aux mille voix qui s'adresse à la femme, à Dieu, aux amis, à la Nature et enfin avec les Chants du crépuscule aux puissants qui sont comptables des injustices de ce monde. Ces poésies touchent le public parce qu'elles abordent avec une apparente simplicité des thèmes familiers ; pourtant, Hugo ne peut résister à son goût pour l'épique et le grand. Ainsi, on peut lire, dès le début des Feuilles d'automne, les vers : Ce siècle avait deux ans ! Rome remplaçait Sparte Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte Créativité et puissance littéraire À partir de l'exil commence une période de création littéraire qui est considérée comme la plus riche, la plus originale et la plus puissante de l'œuvre de Victor Hugo. C'est alors que naîtront certains de ses plus grands poèmes. Les Châtiments sont des vers de combat qui ont pour mission, en 1853, de rendre public le crime du misérable Napoléon III : le coup d'État du 2 décembre. Prophète des malheurs qui attendent Napoléon III, exécuteur du neveu honni, Hugo s'y fait cruel, satirique, voire grossier pourceau dans le cloaque pour châtier le criminel. Mais Hugo se fait aussi poète de temps meilleurs comme dans Stella ; le poète prend alors des tons quasiment religieux. Quant à la forme des Châtiments, elle est d'une extrême richesse puisque Hugo recourt aussi bien à la fable, qu'à l'épopée, à la chanson ou à l'élégie, etc. Quelques années plus tard, Hugo déclare, à propos des Contemplations qui paraissent en 1856 : Qu'est-ce que les Contemplations ? – Les mémoires d'une âme. Apothéose lyrique, marquée par l'exil à Guernesey et la mort cf. Pauca Meae de la fille adorée : exil affectif, exil politique : Hugo part à la découverte solitaire du moi et de l'univers. Le poète, tout comme dans les Châtiments, se fait même prophète, voix de l'au-delà, voyant des secrets de la vie après la mort et qui tente de percer les secrets des desseins divins. Mais, dans le même temps, les Contemplations, au lyrisme amoureux et sensuel, contient certains des plus célèbres poèmes inspirés par Juliette Drouet. Les Contemplations : œuvre multiforme donc comme il convient aux «mémoires d'une âme. Enfin, la Légende des siècles, son chef-d'œuvre, synthétise l'histoire du monde en une grande épopée parue en 1859 ; L'homme montant des ténèbres à l'Idéal, c'est-à-dire la lente et douloureuse ascension de l'humanité vers le Progrès et la Lumière. Place à part dans son siècle Tantôt lyrique, tantôt épique, Hugo est présent sur tous les fronts et dans tous les genres: il a profondément ému ses contemporains, exaspéré les puissants et inspiré les plus grands poètes. Ainsi que le rappelle Simone de Beauvoir : Son 79e anniversaire fut célébré comme une fête nationale : 600 000 personnes défilèrent sous ses fenêtres, on lui avait dressé un arc de triomphe. L'avenue d'Eylau fut peu après baptisée avenue Victor-Hugo et il y eut un nouveau défilé en son honneur le 14 juillet. Même la bourgeoisie s'était ralliée. Le témoin voyageur Victor Hugo en voyage Victor Hugo a beaucoup voyagé jusqu'en 1871. De ses voyages, il rapporte des carnets de dessins et des notes. On peut ainsi citer le récit d'un voyage fait à Genève et dans les Alpes avec Charles Nodier. Il part aussi chaque année pour un voyage d'un mois avec Juliette Drouet découvrir une région de France ou d'Europe et en revient avec notes et dessins. De trois voyages sur le Rhin 1838, 1839, 1840, il rapporte un recueil de lettres, notes et dessins publié en 1842 et complété en 1845. Pendant les années 1860, il traverse plusieurs fois le Grand-Duché de Luxembourg comme touriste, alors qu'il se rend sur le Rhin allemand 1862, 1863, 1864, 1865. De retour à Paris en 1871, il cesse de voyager. Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=11040#forumpost11040
#22
Victor Hugo 2
Loriane
Posté le : 21/05/2016 17:53
Dessinateur
Aux nombreux talents de l'écrivain, il faut ajouter le dessin. L'artiste n'a certes pas éclipsé le poète, mais on continue néanmoins de redécouvrir le travail pictural de Victor Hugo – auquel on a consacré de nombreuses et prestigieuses expositions lors du centenaire de sa mort, en 1985, Soleil d'Encre au Petit Palais et Dessins de Victor Hugo place des Vosges dans la maison qu'il habita sous la Monarchie de Juillet ; mais aussi, plus récemment, à New York, Venise, Bruxelles, ou Madrid. En bon autodidacte, Hugo n'hésite pas à utiliser les méthodes les plus rustiques ou expérimentales : il mélange à l'encre le café noir, le charbon, la suie de cheminée, peignant du bout de l'allumette ou au moyen des barbes d'une plume. Ses œuvres sont, en général, de petite taille et il s'en sert tantôt pour illustrer ses écrits Les Travailleurs de la mer, tantôt pour les envoyer à ses amis pour le jour de l'an ou à d'autres occasions. Cet art, qu'il pratiquera toute sa vie, le divertit. Au début, ses travaux sont de facture plutôt réaliste ; mais avec l'exil et la confrontation mystique du poète avec la mer, ils acquerront une dimension presque fantastique Cette facette du talent d'Hugo n'échappera pas à ses contemporains et lui vaudra les louanges de, notamment, Charles Baudelaire : Je n'ai pas trouvé chez les exposants du Salon la magnifique imagination qui coule dans les dessins de Victor Hugo comme le mystère dans le ciel. Je parle de ses dessins à l'encre de Chine, car il est trop évident qu'en poésie, notre poète est le roi des paysagistes. Un certain nombre des dessins de Victor Hugo ont été gravés et publiés de son vivant, en particulier Dessins de Victor Hugo en 1863, préfacé par Théophile Gautier, et en tant qu'illustrations de ses œuvres littéraires Les Travailleurs de la mer et Le Rhin. Victor Hugo et la photographie Pendant l'exil à Jersey, Victor Hugo s'intéresse au médium de la photographie. Il collabore avec ses fils François-Victor et surtout Charles, ainsi qu'avec Auguste Vacquerie. Hugo leur délègue la partie technique, mais c'est lui qui met en scène les prises de vues. Ils produisent d'abord des daguerréotypes, puis des photographies d'après négatifs sur papier, portraiturant essentiellement le poète ou son entourage familial et amical. Ils prennent aussi des vues de Jersey, de Marine Terrace et de quelques dessins de Hugo. Ces images environ 350 œuvres, qui avaient valeur de souvenir ou de communication médiatique, furent diffusées dans le cercle des intimes ou au-delà, rassemblées en albums, insérées dans certains exemplaires des éditions originales de l'écrivain, mais n'ont jamais connu la diffusion commerciale d'abord envisagée par Victor Hugo. Pensée politique À partir de 1849, Victor Hugo consacre un tiers de son œuvre à la politique, un tiers à la religion et le dernier à la philosophie humaine et sociale. La pensée de Victor Hugo est complexe et parfois déroutante. Il refuse toute condamnation des personnes et tout manichéisme, mais n'en est pas moins sévère pour la société de son temps. Au fur et à mesure, sa pensée politique va évoluer, quitter le conservatisme et se rapprocher du réformisme. Politique intérieure Dans sa jeunesse, Victor Hugo est proche du parti conservateur. Pendant la restauration, il soutient Charles X. En cela, il s'inscrit dans la ligne politique de Chateaubriand. Lors de la Révolution française de 1848, Victor Hugo, pair de France, prend d'abord la défense de la monarchie le président du Conseil Odilon Barrot, le charge de défendre l'idée d'une régence de la Duchesse d'Orléans. Une fois la république proclamée, Lamartine lui propose un poste de ministre Instruction publique dans le gouvernement provisoire de 1848, mais il refuse. Lors des élections d'avril 1848, bien que non-candidat, il obtient près de 55 500 voix à Paris, mais n'est pas élu. Par contre, aux élections complémentaires du 24 mai, il est élu à Paris avec près de 87 000 voix. Il siège avec la droite conservatrice. Pendant les Journées de Juin 1848, il mène des groupes de forces gouvernementales à l'assaut des barricades dans la rue Saint-Louis. Il vote la loi du 9 août 1848, qui suspend certains journaux républicains en vertu de l'état de siège. Ses fils fondent le journal l’Événement qui mène une campagne contre le président du conseil, le républicain Cavaignac, et soutiendra la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à l'élection présidentielle de 1848. Étant contre le principe de l'Assemblée législative unique, il ne vote pas la Constitution de 1848. Au début de la présidence de Louis Napoléon Bonaparte, il fréquente le nouveau président. En mai 1849, il est élu à l'Assemblée législative. C'est à l'été 1849, que progressivement, il se détourne de la majorité conservatrice de l'Assemblée législative dont il désapprouve la politique réactionnaire. En janvier 1850, Victor Hugo combat la loi Falloux réorganisant l'enseignement en faveur de l'Église catholique romaine ; en mai, il combat la loi qui restreint le suffrage universel et, en juillet, il intervient contre la loi Rouher qui limite la liberté de la presse. En juillet 1851, il prend position contre la loi qui propose la révision de la Constitution afin de permettre la réélection de Louis-Napoléon Bonaparte. En juin 1851, au palais de Justice de Paris, il défend son fils qui est poursuivi pour avoir publié un article contre la peine de mort dans son journal, L'Évènement. Au soir du coup d'État du 2 décembre 1851, avec une soixantaine de représentants, il rédige un appel à la résistance armée. Poursuivi, il parvient à passer en Belgique le 14 décembre. C'est le début d'un long exil. Dès lors réformiste, il souhaite changer la société. S'il justifie l'enrichissement, il dénonce violemment le système d'inégalité sociale. Il est contre les riches capitalisant leurs gains sans les réinjecter dans la production : l'élite bourgeoise ne le lui pardonnera pas. De même, il s'oppose à la violence si celle-ci s'exerce contre un pouvoir démocratique, mais il la justifie conformément d'ailleurs à la déclaration des droits de l'homme contre un pouvoir illégitime. C'est ainsi qu'en 1851, il lance un appel aux armes– Charger son fusil et se tenir prêt – qui n'est pas entendu. Il maintient cette position jusqu'en 1870. Quand éclate la guerre franco-allemande, Hugo la condamne : il s'agit pour lui d'une guerre de caprice et non de liberté. Puis, l'Empire est renversé et la guerre continue, contre la République ; le plaidoyer de Hugo en faveur de la fraternisation reste sans réponse. Alors, le 17 septembre, le patriote prend le pas sur le pacifiste : il publie cette fois un appel à la levée en masse et à la résistance. Les élections du 8 février 1871 portent au pouvoir les monarchistes partisans de la paix avec Bismarck. Le peuple de Paris, quant à lui, refuse la défaite et la Commune commence le 18 mars ; on s'arrache les Châtiments. Commune En accord avec lui-même, Hugo ne pouvait être Communard : « Ce que représente la Commune est immense, elle pourrait faire de grandes choses, elle n'en fait que des petites. Et des petites choses qui sont des choses odieuses, c'est lamentable. Entendons-nous, je suis un homme de révolution. J'accepte donc les grandes nécessités, à une seule condition : c'est qu'elles soient la confirmation des principes et non leur ébranlement. Toute ma pensée oscille entre ces deux pôles : « civilisation-révolution ». La construction d'une société égalitaire ne saurait découler que d'une recomposition de la société libérale elle-même. » Depuis Bruxelles où il était allé s'installer, il renvoie dos à dos la Commune et le gouvernement d'Adolphe Thiers. Il écrit ainsi le 9 avril 1871 : « Bref, cette Commune est aussi idiote que l’Assemblée est féroce. Des deux côtés, folie. Mais la France et la République s’en tireront. » Devant la répression qui s'abat sur les communards, le poète dit son dégoût et prend la défense des Communards : « Des bandits ont tué soixante-quatre otages. On réplique en tuant six mille prisonniers ! Victor Hugo défend ainsi la demande de grâce de Louis-Nathaniel Rossel, le seul officier supérieur rallié à la Commune où il est ministre délégué à Guerre qui sera finalement exécuté le 28 novembre. Le 22 mai 1876, Victor Hugo demande au Sénat de voter l’amnistie des Communards survivants. Victor Hugo a correspondu avec et soutenu Louise Michel, qui fut déportée en Nouvelle-Calédonie à la suite de sa participation à la Commune de Paris. Il lui dédia un poème Viro Major. Il reste de cette relation épistolaire entre 1850 et 1879 une grande partie des lettres de Louise Michel à Victor Hugo qui ont fait l'objet de publications ultérieures. Combats sociaux Victor Hugo a pris des positions sociales très tranchées, et très en avance sur son époque. Son chef-d'œuvre, Les Misérables est un hymne à la misère et aux plus démunis. Question sociale Dénonçant jusqu'à la fin la ségrégation sociale, Hugo déclare lors de la dernière réunion publique qu'il préside : « La question sociale reste. Elle est terrible, mais elle est simple, c'est la question de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas ! ». Il s'agissait précisément de récolter des fonds pour permettre à 126 délégués ouvriers de se rendre au premier Congrès socialiste de France, à Marseille. Peine de mort Hugo est un farouche abolitionniste. Dans son enfance, il a assisté à des exécutions capitales et toute sa vie, il luttera contre ce châtiment. Le Dernier Jour d'un condamné 1829 et Claude Gueux 1834, deux romans de jeunesse, soulignent à la fois la cruauté, l'injustice et l'inefficacité du châtiment suprême. Mais la littérature ne suffit pas, Hugo le sait. Chambre des Pairs, Assemblée, Sénat : Victor Hugo saisira toutes les tribunes pour défendre l'abolition comme dans son discours du 15 septembre 1848. « ... Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme : l'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans ses lois. Tôt ou tard elles font plier la société sous leurs poids, elles dérangent l'équilibre nécessaire des lois et des mœurs, elles ôtent à la justice humaine ses proportions ; et alors il arrive ceci, réfléchissez-y, messieurs, que la loi épouvante la conscience ... » — Discours de Victor Hugo devant l'Assemblée constituante, 15 septembre 1848. Victor Hugo vers 1875.États-Unis d'Europe Victor Hugo a fréquemment défendu l'idée de la création des États-Unis d'Europe. Ainsi, dès 1849, au congrès de la paix, il lance : « Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. - Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le parlement est à l'Angleterre, ce que la diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France! » Victor Hugo conçoit une Europe axée sur le Rhin, lieu d'échanges culturels et commerciaux entre la France et Allemagne qui serait le noyau central de ces États-Unis d'Europe. Il présente une Europe des peuples par opposition à l'Europe des rois, sous forme d'une confédération d'États avec des peuples unis par le suffrage universel et l'abolition de la peine de mort. L'idée n'est pas neuve, elle fut défendue avant lui par Saint-Simon, Guizot et Auguste Comte, mais Victor Hugo en fut un de ses plus ardents défenseurs à une époque où l'histoire s'y prête peu. Considéré comme visionnaire ou fou, Victor Hugo reconnaît les obstacles qui entravent cette grande idée et précise même qu'il faudra peut-être une guerre ou une révolution pour y accéder. Colonisation et esclavage Victor Hugo et la conquête de l'Algérie. Victor Hugo s'est peu exprimé sur la question de la colonisation de l'Algérie, qui a constitué pourtant la principale aventure coloniale de la France de son époque. Ce silence relatif ne doit pourtant pas être trop rapidement assimilé à un acquiescement de la part de l'auteur des Misérables. En effet, si Hugo a été sensible aux discours légitimant la colonisation au nom de la civilisation, une analyse attentive de ses écrits — et de ses silences — montre qu'à propos de la question algérienne ses positions furent loin d'être dénuées d'ambiguïtés : sceptique à l'égard des vertus civilisatrices de la pacification militaire, il devait surtout voir dans l'Algérie colonisée le lieu où l'armée française s'est faite tigre, et où les résistants au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte ont été déportés. Sur la question de l'esclavage, celui qui, dans les années 1820, montrait à travers Bug-Jargal qu'il partageait dans sa vision des peuples noirs les mêmes préjugés que ses contemporains, et qui garda un silence étonnant lors de l'abolition de l'esclavage en 1848, devait intervenir pour demander la grâce de l'abolitionniste américain John Brown150. Notons que l'évocation des méfaits de son personnage Thénardier, le parvenu des Misérables n'oublie pas en fin d'ouvrage la traite des Noirs. Thénardier avec l'argent de Marius donné à titre de remerciement s'installa en Amérique où il y devint négrier. Féminisme En 1882, Victor Hugo accepte d'être président d'honneur de la Ligue française pour le droit des femmes, héritière de l'Association pour le droit des femmes, association féministe fondée par Léon Richer. La question de l'égalité des droits des hommes et des femmes avait été déjà traitée quelques années plus tôt dans le dernier chapitre de Quatre-Vingt-Treize. Droit d'auteur Victor Hugo fut tenant du droit d’auteur et de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques tout en reconnaissant l'importance de l'accès de tous au savoir : Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient – le mot n’est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. Discours Victor Hugo a prononcé pendant sa carrière politique plusieurs grands discours ; la plupart d'entre eux sont regroupés dans Actes et paroles : Pour la Serbie, 1876, Pour une Fédération Européenne; contre le travail des enfants Chambre des pairs, 1847 ; contre la misère Discours sur la misère, 9 juillet 1849 ; sur la condition féminine aux obsèques de George Sand, 10 juin 1876 ; contre l'enseignement religieux et pour l'école laïque et gratuite Discours à propos du projet de loi sur l'enseignement, 15 janvier 1850 ; plusieurs plaidoyers contre la peine de mort Que dit la loi ? Tu ne tueras pas. Comment le dit-elle ? En tuant ! ; plusieurs discours en faveur de la paix Discours d'ouverture du Congrès de la paix, 21 août 1849 ; lettre en 1861 contre le pillage de l'ancien palais d'été par les Français et les Anglais lors de la seconde guerre de l'opium ; pour le droit de vote universel ; sur la défense du littoral ; contre l'invalidation de l'élection de Garibaldi à l'Assemblée nationale en 1871, qui fut à l'origine de sa propre démission Contre l'invalidation de Garibaldi, Discours à l'Assemblée nationale, 8 mars 1871, Grands moments d'éloquence parlementaire. Convictions religieuses Selon Alain Decaux, Victor Hugo, élevé par un père franc-maçon et une mère qui n'est jamais entrée dans une église, se construit une foi profonde, mais personnelle. Victor Hugo n'a jamais été baptisé, a tenté l'expérience d'un confesseur, mais finit sa vie en refusant l'oraison des églises. Il reproche à l'Église le carcan dans laquelle celle-ci enferme la foi. Alain Decaux cite, à ce sujet, cette phrase prononcée par Olympio : Les dogmes et les pratiques sont des lunettes qui font voir l’étoile aux vues courtes. Moi je vois Dieu à l’œil nu. Son anticléricalisme transparaît dans ses écrits comme Religions et religion, La fin de Satan, Dieu, Le pape, Torquemada, ainsi que dans son adhésion à des mouvements anticléricaux. Victor Hugo reste cependant profondément croyant, il croit en un Dieu souffrant et compatissant, en un Dieu force infinie créatrice de l'univers, à l'immortalité de l'âme et la réincarnation. La mort de Léopoldine provoque un regain dans sa quête de spiritualité et lui inspire les Contemplations. La quête spirituelle de Victor Hugo l'entraîne à explorer d'autres voies que le catholicisme. Il lit le Coran, s'intéresse au druidisme, critique les religions orientales et expérimente le spiritisme. Comme Balzac et malgré les nombreuses différences entre les visions du monde et de la littérature des deux plus grands hommes du temps, Hugo considère que le principe swedenborgien de correspondance unit l'esprit et la matière. Victor Hugo se trouve en exil sur l'île de Jersey lorsque son amie Delphine de Girardin, qui se sait condamnée, l'initie en 1853 aux tables tournantes. Cette pratique issue du spiritualisme anglo-saxon, vise à tenter d'entrer en communication avec les morts. Hugo, pour qui les poètes sont également des voyants, est ouvert à ce genre de phénomènes. Ces expériences sont consignées dans Le Livre des tables. Durant deux ans, ses proches et lui interrogent les tables, s'émeuvent à l'idée de la présence possible de Léopoldine et enregistrent des communications d'esprits très divers, dont Jésus, Caïn, Dante, Shakespeare ainsi que des entités telles la Mort, la Bouche d'Ombre, Le Drame ou la Critique. S'ébauche ainsi une nouvelle religion dépassant le christianisme et englobant la métempsycose. Selon le docteur Jean de Mutigny, ces séances presque quotidiennes de tables tournantes révèlent une paraphrénie fantastique qui se retrouve dans les œuvres ultérieures de Victor Hugo, notamment le poème Ce que dit la bouche d'ombre des Contemplations. Par la suite, Victor Hugo affiche ses convictions concernant la survie de l'âme en déclarant publiquement : Ceux que nous pleurons ne sont pas les absents, ce sont les invisibles. Lors de l'enterrement de l'écrivain, cette phrase est inscrite sur une couronne de fleurs portée par une délégation de la Société Scientifique du Spiritisme qui considérait que Victor Hugo en avait été un porte-parole. Mais l'expérience spirite n'a été qu'un moment dans la quête par Hugo d'une vérité et ce moment a été dépassé par d'autres recherche à la poursuite du vrai. Son testament, lapidaire, se lit comme une profession de foi : « Je donne cinquante mille francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises ; je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Hugo et ses contemporains Estimé par certains et critiqué par d'autres, Victor Hugo reste une figure de référence de son siècle. Temps des rivaux Admirateur de Chateaubriand à qui il dédie plusieurs odes, il se détache peu à peu de son ancien maître qui lui reproche une littérature subversive. Il entretient des relations d'estime et d'admiration mutuelles avec Balzac un peu de méfiance, l'ego des grands créateurs y pourvoit, Nerval et Vigny et des relations d'amitié avec Dumas, son compagnon de romantisme, qui dureront, avec beaucoup de hauts et quelques bas, toute la vie. La rivalité est plus exacerbée avec Lamartine, auquel Hugo ne cesse de proclamer son admiration, mais ne lui concède plus, le succès venant, de réelle prééminence artistiqueet avec Musset qui lui reproche ses artifices et son engagement politique. Il détient en Barbey d'Aurevilly, Gustave Planche, et Sainte-Beuve à partir de 1835, des adversaires tenaces et constants, dans les frères Goncourt des lecteurs très critiques et en George Sand une commentatrice très perspicace. Mais il possède en Théophile Gautier un admirateur inconditionnel que Victor Hugo soutiendra jusqu'à sa mort. Les relations sont plus conflictuelles avec les admirateurs de la première heure, que Victor Hugo déçoit parfois par la suite et qui alternent éloges et critiques : Charles Baudelaire, Flaubert… D'autres revendiquent leur filiation avec Victor Hugo tout en empruntant des voies qui leur sont propres, se détachant même du romantisme : Théodore de Banville, Leconte de Lisle, Mallarmé, Verlaine… L'étiquette d'auteur engagé que lui vaut son exil participe à sa notoriété, mais lui aliène l'estime de poètes comme Baudelaire, et provoque sa rupture avec Vigny, fidèle à l'empereur. Quand il retourne en France après l'exil, il est considéré comme le grand auteur qui a traversé le siècle et comme un défenseur de la république. Les monarchistes ne pardonnent pas facilement à celui qui a trahi son milieu et si les républicains les plus à gauche doutent de sa conversion, il devient cependant un enjeu politique, adulé par la gauche républicaine qui organise pour l'anniversaire de ses 79 ans, une grande fête populaire. Les jeunes poètes continuent de lui envoyer leurs vers – tandis que d'autres se montrent volontiers irrévérencieux. Hugo : l'Homme apocalyptique, L'Homme-Ceci-tûra-cela, Meurt, gardenational épique ; Il n'en reste qu'un – celui-là — Tristan Corbière, Un jeune qui s'en va, Les Amours jaunes 1873 Ce culte hugolien exaspère ses pairs. Paul Lafargue écrit en 1885 son pamphlet La légende de Victor Hugo et Zola s'exclame : Victor Hugo est devenu une religion en littérature, une sorte de police pour le maintien du bon ordre …. Être passé à l'état de religion nécessaire, quelle terrible fin pour le poète révolutionnaire de 1830. Biographies et commentaires de : Jacques SEEBACHER, Pierre ALBOUY, Anne UBERSFELD, Philippe VERDIER Roman, critique, voyages, histoire dialoguent dans l'œuvre de Victor Hugo avec le lyrisme, l'épopée, le théâtre en un ensemble dont le « poète » a souvent proposé des articulations historiques, géographiques ou idéologiques plutôt qu'une périodisation. En règle générale, l'œuvre en prose a pour fonction de recueillir les éléments les plus secrets de l'œuvre poétique, de les composer en architectures prospectives ; plus neuve et plus audacieuse ainsi, elle peut servir de préface à toute la création hugolienne. Elle se distribue pourtant en trois masses : la mort de Léopoldine, en 1843, entre l'Académie (1841) et la Chambre des pairs (1845), marque une première rupture ; vers 1866-1868, c'est le tournant proprement historique et politique. Chacune de ces masses est caractérisée par la présence de romans ou quasi-romans (Han d'Islande, Bug-Jargal, Le Dernier Jour d'un condamné, Notre-Dame de Paris, Claude Gueux, pour la première ; Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, pour la deuxième ; L'Homme qui rit et Quatrevingt-Treize, pour la troisième), de textes mêlés d'histoire, de politique et de voyages (pour l'essentiel, respectivement : Le Rhin ; Choses vues et Paris ; Actes et Paroles et Histoire d'un crime) et enfin d'essais critiques, qui se fondent avec l'histoire militante dans la troisième période, en une vue rétrospective qu'annonçaient déjà Littérature et philosophie mêlées dans la première période et la somme du William Shakespeare dans la deuxième. La poétique de l'œuvre en prose s'inscrit donc dans un espace à quatre dimensions : le romanesque, le voyage, la politique, la réflexion critique sur le génie. À côté de l'évolution biographique et historique, c'est le William Shakespeare qui forme le centre de gravité du colosse. Poète usé par l'école de la IIIe République et la pratique des morceaux choisis, dramaturge qu'on croit mort avec le théâtre romantique en 1843 (échec des Burgraves), romancier méconnu parce que trop mesuré aux normes de Stendhal, Balzac ou Flaubert, Hugo apparaît de plus en plus dans sa singularité géniale, si l'on examine toute son œuvre à partir du fonctionnement de son intelligence critique, qui est, contre Sainte-Beuve, une réflexion sur le caractère absolu de la modernité. Jacques Seebacher La poésie hugolienne prend sa source dans la poésie légère du XVIIIe siècle ; elle revêt, d'abord, des allures post-classiques, puis elle parcourt, illustre, promeut chacun des aspects et des moments de la poésie romantique ; elle en réalise, elle seule, le rêve le plus grand, celui d'une épopée de l'humanité. Elle résume ainsi le XIXe siècle, jusque vers 1865, date où Les Chansons des rues et des bois s'accordent à la poésie fantaisiste, joyeuse et artiste d'un Théodore de Banville ; ensuite, Hugo devient, de son vivant même, anachronique. On aurait alors la tentation de résumer le XIXe siècle poétique avant Mallarmé et Rimbaud par Hugo et par Baudelaire, comme Goethe résumait le XVIIIe siècle par Voltaire et Rousseau, en laissant entendre qu'avec Les Fleurs du mal, en 1857, un monde commence tout comme avec Les Contemplations, en 1856, un monde finit. Une telle vision serait fausse. Il y a plus de fulgurations surréalistes dans Ce que dit la bouche d'ombre (ou dans les comptes rendus des séances de spiritisme) que dans toute l'œuvre de Baudelaire. Hugo ne résume pas seulement le romantisme, il en dégage, lui aussi, la modernité par l'audace d'une écriture poétique qui assume la totalité du réel et l'abolit dans son mouvement même. C'est une voix qui donne à entendre toutes les voix, puis le silence. Ce poète est le poète de Dieu. Il a voulu non point enfermer le monde dans son livre – cela lui était facile –, mais abolir le monde par la parole qui en rend compte, tout de même que Dieu est cette fuite vertigineuse qui, à la fois, crée le monde et l'anéantit incessamment. Hugo dit le monde et, ce faisant, le creuse et le dépasse. C'est ainsi qu'il faut l'écouter et l'entendre, voix multiple, sonore, retentissante ou en sourdine, et voix même du silence. Poète de toutes les présences et poète du vide. Poésie, excessivement difficile, de l'affirmation de l'être et de sa négation. On a pris pour rhétorique redondante ce qui était perpétuelle création et abolition – parole même de la transcendance. Hugo est le grand poète de la mort. Pierre Albouy Si Hugo est un grand poète lyrique, il s'est voulu aussi un grand dramaturge dont la longue carrière se déroule de ses quatorze à ses soixante-quatorze ans. Le besoin de cesser d'être celui qui dit Je, de devenir le On de la création dramatique obsède ce génie puissant. Or, on sait que la critique n'a jamais accepté le théâtre de Hugo, qu'elle a toujours été fort réticente devant des œuvres apparemment proches du mélodrame par la technique et par le contenu. Dès le début de sa carrière le problème se pose à lui moins de faire triompher le drame romantique contre la vieille tragédie que de faire coïncider son esthétique dramatique particulière avec les exigences de la scène et du public dans la première moitié du XIXe siècle. Or cette coïncidence ne se fait pas ou se fait fort mal. Si le drame romantique est généralement mal accueilli par la critique et même par le public, s'il ne réussit pas à s'imposer, le drame de Hugo rencontre des difficultés particulières. Très éloigné des conceptions littéraires et politiques d'un Alexandre Dumas ou même d'un Casimir Delavigne, Hugo se refuse à la moindre concession ; son théâtre ne relève, malgré les apparences, ni de la confession sous le couvert de personnages dramatiques, ni de la thèse politique ou sociale, mais d'une certaine forme de tragique dépendant des rapports nouveaux entre l'individu et l'histoire. Théâtre d'intention individualiste et bourgeoise, il traduit en fait l'impuissance de l'individu à trouver son être propre, à agir sur l'histoire, à dépasser les conflits des générations en rachetant la malédiction du passé. Ce qui paraît capital à Hugo, c'est la justification de l'être maudit, du monstre humain ou social, de l'individu marginal, révolté ou exilé de l'ordre social : « Car j'ai collé mon âme à toute âme tuée », dit le poète. De là l'usage qu'il fait de l'imaginaire, et plus particulièrement de ce qu'il appelle le grotesque. Après la renonciation au théâtre joué, fantaisie et grotesque s'épanouissent sans contrainte, dès 1843, dans cet énorme matériel que sont les fragments dramatiques et dans les merveilleux textes poétiques du Théâtre en liberté. Anne Ubersfeld Beaucoup d'inconnu et plus de malentendu encore recouvre l'image de Victor Hugo dessinateur, qui s'est servi de l'encre pour « fixer des vestiges » et des états de « rêverie presque inconsciente ». Quelque trois cent cinquante dessins illustrent sa légende d'artiste dans le musée de la place des Vosges. Ce que l'on retient surtout d'eux, c'est le tour de force de leur technique, celle d'un autodidacte qui improvisait sa matière – lavis brossés au tampon de papier, mixtures de sépia, de fusain, de marc de café, ou de café au lait, de suie – et qui dégradait ses outils, plumes faussées, allumettes brûlées. Ils continuent à faire figure de Marginalia en lisière de l'œuvre littéraire, selon le propre jugement de leur auteur (« Cela m'amuse entre deux strophes », lettre à Baudelaire, 19 avril 1860), et la réticence qui a fait dire à un de leurs premiers admirateurs, Théophile Gautier, que Victor Hugo n'a pas poussé plus loin qu'un « simple délassement » ces exercices en virtuosité parce qu'il était convaincu que « ce n'est pas trop de tout un homme pour un art ». Et encore une fois Victor Hugo se considérait comme « une bête de somme attelée au devoir », c'est-à-dire à la mission d'un mage devant qui le temps s'abrégeait (lettre à Philippe Burty, 18 avr. 1864). Cependant le cas de Hugo dessinateur-peintre, sculpteur et ébéniste, aquafortiste même, une fois, pour Juliette Drouet, aux étrennes de 1868, n'est pas assimilable à celui d'écrivains doués aussi pour les arts du dessin comme Baudelaire et Valéry, mais qui pourraient souscrire à l'aveu de Goethe : « J'ai essayé bien des choses, j'ai beaucoup dessiné, gravé sur cuivre, peint à l'huile, j'ai aussi bien souvent pétri l'argile... dans un seul art je suis devenu presque un maître : dans l'art d'écriture en allemand » (Épigrammes de Venise). L'art du dessin n'est pas une annexe de l'œuvre de Hugo écrivain, ni pure curiosité exploratrice d'un médium différent de l'écriture.Philippe Verdier Le prosateur L'arc oriental. Esthétique Après la préface de Cromwell (1827), qui s'enracine dans l'espace et le temps de la Genèse pour déboucher sur la modernité du drame shakespearien, Littérature et philosophie mêlées (1834) fait le premier bilan d'une période d'activité littéraire (1819-1834). Le passage du Journal... d'un jeune jacobite de 1819 au Journal... d'un révolutionnaire de 1830 commande l'anthologie soigneusement revue et corrigée de ses œuvres critiques, depuis le très ultra Conservateur littéraire jusqu'au ralliement à un libéralisme que la figure de Napoléon, prophétisée par Mahomet, relie, comme dans Les Orientales, à toutes les ambiguïtés du XIXe siècle. Le second volume explicite ainsi, de Voltaire à Mirabeau, l'ambition inquiète de prendre place parmi les génies prophétiques et maudits, en un étrange mélange de fantaisie provocatrice et d'humour prudent. La Grèce apparaît comme la plaque tournante des plus anciennes civilisations et de l'époque moderne, qu'il s'agisse de Chénier ou de Byron, de Lamartine entre Platon et Ossian, ou de Walter Scott qu'il faut « enchâsser dans Homère ». La préface avoue le « But de cette publication », en un texte qui combine l'examen de conscience et la réflexion théorique pour passer du « système » à l'« action », d'une appréhension de l'héritage des Lumières et de la Révolution à la construction d'un siècle neuf sur le principe de « la substitution des questions sociales aux questions politiques ». La thèse fondamentale réside dans le passage d'une esthétique classique (« Une idée n'a jamais qu'une forme, qui lui est propre ») à une esthétique fondée sur l'étude historique et linguistique du style (« Rien de plus consubstantiel que l'idée et l'expression de l'idée »). De là découle la nécessité globale du drame, dans sa pertinence à l'évolution des genres, à la révolution politique, aux réalités sociales d'un public qui fait l'art « populaire », bref à la rencontre exacte d'un génie et du génie de l'époque, en une dynamique critique. L'impossible roman C'est pourquoi le roman reste un genre « ironique et railleur », quand il n'est pas simplement lié aux circonstances de la polémique, sans parler de son utilité purement alimentaire. Cette époque se caractérise par les plus grandes hésitations à composer des romans. La rédaction de Han d'Islande (1823) n'a été achevée que pour faire vivre le poète qui venait de se marier. Notre-Dame de Paris (1831) a été écrit in extremis sous la menace de poursuites. Bug-Jargal, simple conte de 1819 pour le pari d'un dîner, prend corps en 1826 à l'occasion assez financière d'une édition de ses Œuvres complètes. Mais ce malaise du roman hugolien, qui s'associe chaque fois à une interrogation politique complexe, est à l'origine de sa vertu critique. Han caricature le roman de la quête chevaleresque en une Norvège qui hérite de toutes les perversions du roman noir anglo-saxon, Bug démarque la simplicité du roman sentimental sous la Restauration, se pare des couleurs de l'exotisme antillais, Notre-Dame bat Walter Scott sur son propre terrain. Cette rivalité caustique se retrouve à l'intérieur même de chacun de ces romans, qui devient ainsi un monstre autophage. Le résidu de cette dévoration littéraire, l'unité qui résulte de ce fourmillement archéologique et de cette fantaisie débridée, est la superposition d'un destin individuel et d'un grand mouvement de masse : le noble Ordener et les mineurs révoltés, Bug et les Noirs déchaînés, les Frollo, Quasimodo et un Gringoire inverse de Hugo devant les truands qui montent à l'assaut de la cathédrale. On a donc la figure constante d'un mythe double du génie et du peuple, combinée à une virtuosité romanesque qui repose sur « Ceci tuera cela » ( Notre-Dame de Paris, V, 2) : l'imprimerie tuera l'architecture, l'écriture romanesque démontera la fantaisie, la gratuité et la féminité du genre, l'exercice de la prose va dire la véritable poésie. À ce degré de réduction, Le Dernier Jour d'un condamné (1829) et Claude Gueux (1834), œuvres à peine romanesques du combat contre l'homicide légal, textes de la prison des lois, des corps et de l'âme, procurent la plus extrême tension de l'écriture, le monologue intérieur, l'origine de Dostoïevski et de Camus, le lent tournoiement d'obsessions justiciables de la psychanalyse. Critique puis autocritique, le roman n'attend plus que la marée lyrique, épique et contemplative pour devenir Les Misérables, par effacement de ce qui restait d'oriental dans le Paris du XVe siècle, de « mosquée » dans la cathédrale, de théologie dogmatique dans l'œuvre. L'œil écrit L'expérience personnelle qui alimente et informe cette évolution est certainement le voyage, dans les souvenirs qu'il laisse et que, de plus en plus, fixe la pratique épistolaire. Les souvenirs de Bayonne et de Madrid (1811-1812) avec le premier émoi amoureux, de Dreux (1821) dans l'espoir d'obtenir la femme de sa vie, de Reims (1825) pour le sacre de Charles X, de Chamonix (1825) avec Nodier en passant chez Lamartine, de la route de Brest (1834) à la poursuite de Juliette Drouet, avec retour par la Loire, de Champagne, Normandie, Bretagne et Belgique chaque année de 1835 à 1838 en compagnie de sa maîtresse attitrée désormais, marquent moins les vacances de la passion que la détermination progressive d'un espace intérieur de la vision à partir du regard des « choses vues » qui abolit, dans la netteté même du trait pittoresque, les risques de l'anecdote faussement réaliste à quoi l'archéologue, l'historien, le dessinateur, le père de famille, le poète intimiste n'eussent été que trop enclins. C'est à Montreuil-sur-Mer, lieu futur des Misérables, qu'il fixe, sur un fond inexplicable de tristesse, le 4 septembre 1837, six ans avant la mort de sa fille, et en songeant à elle, le principe de l'échelle des êtres et l'espace que forme en se dissolvant au rythme de la mer l'universelle analogie. S'installe alors une géographie du rêve et de l'action où les voyages vers l'est, en 1839 et 1840, recomposés pour Le Rhin (1842), viennent inscrire une politique européenne, dans le mythe d'un Empire où Charlemagne et Napoléon se tiennent à égale distance du despotisme oriental et du mercantilisme occidental. Ce qui germe donc, dans ces lettres, nées du choc entre le saisissement des choses et la discursivité des guides pour touriste, c'est une figure du destin : géographie et histoire se bloquent mutuellement, le voyage est exil, l'impossible épopée va faire naître les voix du silence. En 1843, le voyage aux Pyrénées, retour à l'enfance, produit les textes les plus aigus de notre littérature descriptive, la métaphysique de la négativité et du renversement y devient comme naturelle dans sa plénitude. Léopoldine se noie. L'écrivain se tait. Les occupations politiques et mondaines, le flamboiement de l'amour charnel aussitôt interdit que trouvé (constat d'adultère de juillet 1845) masquent désormais, pour dix ans, le lent travail de ressourcement d'une carrière finie l'année même où la pairie la consacre. C'est en 1845 qu'un Hugo misérable commence à écrire ce qui ne pourra devenir Les Misérables qu'au travers de l'exil. Babel est définitivement renversée. L'arc occidental L'âme. Entrepris peut-être sans projet bien défini, à une époque de difficultés financières que le roman pourrait bien une fois de plus pallier, Les Misérables sont abandonnés en février 1848, moins sans doute à cause de la révolution que parce qu'ils sont au bord de l'indicible, au point précis de l'aveu de l'inceste. Les discours de l'orateur politique ne culminent peut-être avec le discours sur la misère (9 juillet 1849), qui date le ralliement du conservateur à la gauche quasi républicaine, qu'en fonction d'un creusement de la misère personnelle à quoi l'exil politique devient indispensable. Quand la rage s'est vidée dans les Châtiments et dans Napoléon le Petit, l'histoire peut se faire intérieure et exemplaire avec Les Contemplations. De Bruxelles à Jersey, de Jersey à Guernesey, elle devient histoire universelle par La Légende des siècles et se transcende même en une immanence hors des temps (Dieu et La Fin de Satan) qui fait que tout l'Océan est toute l'âme. Sur son roc anglo-normand, Hugo contemple l'être : il peut reprendre Les Misérables, mais il lui faut se relire, constituer un corps de Philosophie (ou « préface philosophique » des Misérables). Cet essai restera inachevé parce que, le roman une fois publié, c'est William Shakespeare (1864) qui administre toutes les preuves de Dieu, de l'âme et de la responsabilité au seul niveau qui importe à Hugo et à ses lecteurs, celui de la littérature, c'est-à-dire de l'histoire, du génie, de l'action. Forme du génie La théorie de base, plus ou moins dissimulée pour des raisons d'opportunité politique, réside dans la fonction spontanément civilisatrice, voire révolutionnaire, du beau, parce qu'il n'y a pas d'autre fond à l'œuvre d'art que sa forme même. Puisque Les Contemplations ont repris en « Mémoires d'une âme » ce que Littérature et philosophie mêlées présentait en examen de conscience, le livre majeur de critique peut bien développer, comme d'outre-tombe, une théorie transcendante de la langue universelle du génie. Les « hommes océans » habitent la « région des Égaux ». Au-delà d'une certaine limite, la nature de l'art interdit toute comparaison. Le mouvement de l'histoire aligne cette galerie de portraits selon l'axe qui passe par Eschyle et Shakespeare, et que la révolution continue : le blocage de tous les éléments de la prose est ici parfait dans le mythe qui fait de l'œuvre d'art le modèle privilégié de toute existence historique et spirituelle, jusqu'à l'intériorisation du drame par un système de double action en reflet réciproque, par un jeu de miroirs qui ouvre sur l'ubiquité, sur l'immensité de la création. D'où le rapport entre « les esprits et les masses », « le beau, serviteur du vrai » et, pour finir, « la nature révolutionnaire » du XIXe siècle, qui est « de se passer d'ancêtres ». De même qu'on est passé de l'Inde et de la Grèce à l'Angleterre industrielle autant qu'océanique, en une sorte de tradition géographique, de même l'héritage historique fonde le droit du siècle à son indépendance, son devoir d'élaborer une théorie critique inséparable du progrès des masses et de la révolution : idéologie visionnaire d'un bourgeois républicain qui embrasse à la fois Jésus-Christ et le drapeau rouge, le William Shakespeare circonscrit le lieu poétique où naîtront les efforts les plus scientifiques de la recherche moderne. Cent ans d'historicisme n'ont pu empêcher « que l'histoire soit à refaire », à la frontière du paysage intérieur et des échappées sur la nature sociale. Tempêtes Les Misérables 1862 répondaient à cette dynamique. Analogue jusque dans sa composition aux Contemplations, le roman vaut par la manière dont toute une série de « digressions » déterminent, au contact de la destinée du forçat Jean Valjean qui subit les épreuves successives de sa régénération, les conditions critiques du siècle romantique. La réalité, le réalisme poétique, le résidu de tous les sentimentalismes et du roman-feuilleton, le paternalisme, la morale, tout est employé pour être nié par un fonctionnement original de l'ironie, qu'on aperçoit rarement et qui éclate dans les dialogues. De la catastrophe de Waterloo à l'écrasement de l'insurrection de 1832, le roman dit la négativité du siècle. De la mort de Fantine au mariage de Cosette, tendrement et cruellement placé au jour de naissance de l'amour pour Juliette Drouet (16 févr. 1833), Les Misérables crient l'insuffisance de l'amour. Et les différents personnages dans lesquels le romancier s'est peint, Marius en tête, sont menacés d'embourgeoisement stupide quand ils ne consentent pas à mourir pour l'avenir. Le gamin Gavroche, sur la barricade, meurt peut-être en transmettant la chanson du progrès, Voltaire et Rousseau, et tous les socialismes, de même que les flambeaux de l'évêque symbolisent la transmission de la charité. Tout s'évanouit, la tombe du martyr se recouvre d'herbe. Seul le poète y inscrit, au crayon, sa trace. C'est ailleurs, dans l'immensité de l'utopie, dans la réduction forcenée de la fatalité sociale à la fatalité de la nature, en plein océan, qu'il faut achever tout ce que l'œuvre poétique préparait dans le thème des marins perdus. De tous les romans de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer (1866) sont sans doute le plus poétique et le plus achevé. Réfection avouée de Notre-Dame de Paris, autobiographie mythique à peine dissimulée, le roman s'étend en préparations sur le jeu des deux abîmes, celui de la mer, celui du cœur, jusqu'à la précipitation de l'intrigue dans le sacrifice suprême, qui est à la fois suicide de Gilliatt et réintégration du héros, de l'auteur et de l'œuvre elle-même dans l'espace infini de la création. L'érotisme, la mort, le travail, la nature même ont été arrachés à leurs déterminations particulières pour se fondre en une sorte de surnature plus expérimentale que métaphysique. Le roman sécrète alors comme un prologue géographique et historique sur L'Archipel de la Manche, où l'« antiquaire » dénote en fait l'ensemble du livre comme un poème de l'utopie : le pessimisme de la dégradation des rochers, des mœurs et des hommes, l'entropie de la nature et de l'histoire se renversent en espoir spirituel. C'est l'aboutissement de toutes les « choses vues « : la multiplication des détails, l'incision du dessin font paradoxalement se dissoudre les barrières. Conquêtes De Guernesey ou de Serk, par la Belgique, le Luxembourg et la Rhénanie, les voyages, qui lui font rencontrer de plus en plus d'opposants au régime impérial, décrivent comme la limite de l'exil. De l'Angleterre à la Suisse, l'espace occidental de la démocratie guette Paris, cœur de la France, capitale des futurs États-Unis d'Europe, puisque l'esclavage et la sécession ont éclipsé les espoirs d'outre-Atlantique. Nous sommes, en 1867, au point où toutes les traditions, à partir d'une autobiographie enfin assumée, convergent vers la mission révolutionnaire de Paris (Introduction pour un guide de l'Exposition universelle) : l'avenir oriente le passé, le siècle romantique, commencé dans l'interrogation sur toutes les légitimités et tous les conflits, proclame, à la veille de la guerre, la suprématie de la paix à conquérir. La purgation des forces profondes s'est achevée dans la dilatation de l'espace poétique. Les fatalités sont mortes : l'histoire devient possible, l'écriture est action. L'axe historique Écrits; De part et d'autre de la convulsion politique et sociale (la guerre de 1870 et la Commune), Hugo s'engage. Pour la paix, pour la démocratie, pour l'amnistie aux communards, pour une république fondée sur la mystique de l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, trouvant dans une sorte de radicalisme la synthèse pratique de son paternalisme populaire et de son anarchisme bourgeois. Patriarche, sorte de Noé vénéré et vilipendé, sénateur de la République comme Sainte-Beuve l'avait été de l'Empire, il est la figure même de l'histoire. La publication de l'Histoire d'un crime contre les tentatives de coup d'État de Mac-Mahon (1877) peut symboliser l'indissolubilité de l'engagement littéraire et politique et le passage de l'exil au combat. La perfection narrative de ce livre écrit au lendemain du coup d'État de 1851 provient d'une double urgence : celle du vaincu qui plaçait sa rage dans le collage objectif des témoignages documentaires, celle du chef spirituel du parti démocratique qui sent à portée de sa main la victoire décisive sur la droite et les possibilités à gauche de ne pas être débordé par la foule. L'impassibilité de cette prose combine la perpétuelle présence du scripteur et son incessant effacement. Le combattant qui se justifie disparaît au profit d'une histoire qui n'est plus fatalité du passé, mais nécessité de l'action. Le juste retour des choses transforme la hantise de l'éternel retour en un texte, proposé aux masses, mais qui, comme les masses, doit d'abord se lire lui-même : le drame de l'histoire s'effectue en conscience critique et autocritique. Réduction du surréel Le cheminement romanesque obéit, au fil de cette période, à un schéma analogue. De L'homme qui rit (1869), roman baroque aux prodigieuses inventions apocalyptiques, à Quatrevingt-Treize (1874), où le rêve ne déborde plus de la réalité qu'il interprète, on est passé de l'aristocratie à la république, de l'exil militant au désengagement apparent, du symbolisme initiatique à l'histoire lue comme texte, écrite comme procès et progrès, de tous les héritages à la mort de la paternité, de l'empire maritime de Grande-Bretagne au dialogue français de Paris et de la « Vendée », des exploitations spiritualistes à l'urgence de la démocratie. Le roman intermédiaire qui avait été prévu, sur la monarchie française au XVIIIe siècle, n'a pas été écrit, peut-être parce que la « substitution des questions sociales aux questions politiques » s'est enfin comprise elle-même, parce que la souveraineté du moi s'est fondée dans une pratique de la disparition, parce que le XVIIIe siècle n'exerce plus sa fascination. Tout prend désormais figure pour l'aventure du XXe siècle, et c'est à la veille de l'attaque qui va mettre fin à sa carrière d'écrivain, en 1878, que Hugo célèbre en Voltaire un autre lui-même, qui meurt immortel, dans « la transparence [...] propre aux révolutions » – propre aussi à ce génie de la prose vers quoi tendait toute son œuvre poétique. Actes et Paroles marque peut-être, sous le plaidoyer personnel, la disparition du personnage encombrant l'horizon, du mythe politique, littéraire, social, de l'impérialisme hugolien, au bénéfice de cette « prose du monde » qui ouvre le champ de toute la modernité.Jacques Seebacher Le poète « Toute la lyre » En 1888, Paul Meurice intitulait deux volumes de poèmes posthumes de Hugo Toute la lyre. C'est sous ce titre qu'on peut traiter des débuts de Victor Hugo et de la première partie de sa carrière. Arraché aux Feuillantines et à sa mère par ordre paternel (ses parents sont séparés), Victor s'ennuie à la pension Cordier et, de 1815 à 1818, y remplit de vers trois cahiers. Beaucoup de pièces dans le goût de L'Almanach des Muses, des charades, des énigmes, des épigrammes, des fables. Des traductions du latin, aussi, de Virgile en particulier. En 1816, Victor Marie, en même temps que son frère Eugène, son rival en poésie, écrit une épopée en trois chants, Le Déluge, dont le merveilleux chrétien avoue l'influence du Génie du christianisme. Elle se mêle aux leçons de Virgile et s'accommode de la domination de Voltaire : comme sa mère, Victor est « royaliste voltairien », et, après que « Le Bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie », son premier poème publié, lui a valu, en 1817, l'« encouragement » de l'Académie française, les poèmes académiques et satiriques de 1819 font de cette année celle du « royalisme voltairien ». Le chef-d'œuvre en est assurément le poème du Télégraphe, qui raille les libéraux et les ministériels, avec une verve, un esprit, une bonne humeur qui font songer à Voltaire plus qu'à Joseph de Maistre. Mais déjà se multiplient les odes vengeresses où la lamentation sur l'hydre de l'anarchie se mêle à la prophétie du malheur. Rappelons encore qu'en plus de la poésie lyrique, de l'épopée et de la satire l'adolescent s'est exercé au théâtre et au roman, et, à lui seul, ou presque, assure, quinze mois durant, la rédaction d'une revue, Le Conservateur littéraire. Toute la lyre en vérité ! Le 8 juin 1822 paraît en librairie le premier livre de Victor Hugo, sous le titre d'Odes et poésies diverses. Le recueil ira s'enrichissant et se diversifiant jusqu'à l'édition dernière de 1828. Qu'il déplore la mort du duc de Berry ou célèbre le sacre de Charles X, Victor Hugo est le poète du royalisme ultra. Mais, du début à la fin, il mêle à ses odes politiques les odes « rêveuses » où il dit ses souffrances de fiancé séparé, sa joie et sa fierté d'époux qui se juge comblé. La poésie royaliste l'entraîne, en outre, à prendre l'attitude du prophète jetant l'anathème sur son temps ; en appelant du tribunal des hommes à celui de Dieu, il cultive le genre de la vision comme dans l'ode qui porte ce titre et qui, dans un décor miltonien, fait condamner par Jéhovah le siècle coupable de Voltaire et de Robespierre. Genre, attitude que Hugo pratique avec une sincérité plus entière dans les odes écrites en 1823 : alors, à l'influence de Chateaubriand succède celle de Lamennais ; on devine une première « crise mystique », qui l'autorise à s'écrier dans Action de grâces : « Mon esprit de Patmos connut le saint délire. » Les prophètes et l'Apocalypse au service d'une cause politique, c'est déjà, dans un parti opposé, le prélude aux Châtiments, cependant que l'inspiration cosmique et visionnaire, çà et là, à travers la forme vieillie, annonce Les Contemplations. En 1826, aux Odes s'ajoutent des Ballades : Moyen Âge, « mythologie » à la Nodier, avec des sylphes et des lutins, acrobaties rythmiques et verbales, c'est le temps de la fantaisie. Au début de 1829, Les Orientales achèvent de faire de Hugo le maître des deux domaines romantiques, l'Orient et le Moyen Âge, de la poésie pittoresque et de l'« école de l'art ». Le recueil, cependant, est plus mystérieux qu'on ne croirait : livre souvent nocturne que la lune éclaire davantage que le soleil, livre voluptueux et cruel... À vingt-sept ans, Hugo a parcouru tout l'espace poétique, essayé toutes ses voix. Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=11039#forumpost11039
#23
Victor Hugo 3
Loriane
Posté le : 21/05/2016 17:51
La voix du poète
Dans Les Feuilles d'automne (1831), Les Chants du crépuscule (1835), Les Voix intérieures (1837), Les Rayons et les Ombres (1840), une poésie très humaine, quotidienne, si l'on peut dire, réaliste même, étend son domaine. Les confidences très réservées sur une lassitude de vivre et un remords : mésentente conjugale, soupçons à l'encontre d'un Sainte-Beuve qui fut, sans doute, l'amant d'Adèle Hugo ; sur le renouveau apporté par l'amour : Juliette Drouet, en 1833 ; rien sur la jalousie qui ravagea le couple, ce semble, au moins l'année suivante, partage qu'il faut comprendre entre la maîtresse et l'épouse ; sur la famille : le père et la mère réconciliés dans la mort, le frère fou qui eut du génie et dont l'exil dans la folie et la mort ont peut-être acheté le droit redoutable de Victor à devenir le Poète, les enfants, enfin, que le cercle de famille applaudit, comme on sait, et dont l'un, la fille préférée, Léopoldine, rachète, par sa pureté, le père souillé par le péché de vivre (« La Prière pour tous ») – ces confidences sans indiscrétion, sans éclat, se mêlent à l'histoire, s'entourent du monde entier, nature et humanité, s'ouvrent à l'invisible selon « La Pente de la rêverie « : dans ce poème de mai 1830, un homme à sa fenêtre rêve, regarde, écoute des enfants jouer ; or la pente de cette rêverie des plus ordinaires descend la « spirale » « profonde » d'une tour de Babel renversée et intérieure où la vision de l'histoire, jusqu'au fond des temps, débouche sur l'abîme vide de l'« ineffable », de l'« invisible », de l'« éternité ». Plus tard, la poésie hugolienne tiendra l'intenable gageure de traduire en langage cette expérience de l'être même comme infinité, comme évanouissement hors de toute forme et de toute limite. Dès Les Feuilles d'automne, une poésie modeste investit l'univers et jusqu'à sa béance... Depuis l'ode « À la colonne de la place Vendôme », en 1827, Hugo s'est détaché du royalisme maternel, et, retrouvant son père, s'est mis, dès Les Orientales, à célébrer Napoléon. Il est libéral. La révolution de juillet 1830 le trouve attentif, ouvert, réservé. Dans Les Chants du crépuscule, il apparaît comme un modéré soucieux de progrès et de mesure, sensible à un nescio quid divini qu'il perçoit dans le peuple, mais redoutant les révolutions et suggérant que la source terrible et tarissable en pourrait être la misère... Il en est, en 1835, au moment du doute ; Les Chants du crépuscule établissent cette seule certitude « que nous avons le doute en nous ». Puis, dans les deux recueils suivants, la sérénité l'emporte. Depuis les temps du romantisme jusqu'à la photo de Nadar qui le représente sur son lit de mort, l'iconographie de Victor Hugo est considérable. Ici, un portrait de Victor Hugo jeune. Musée national du château de Versailles. Cette conquête d'une sagesse – « Sagesse » est le titre du dernier poème des Rayons et les Ombres – s'accompagne d'une définition de la nature et de la fonction du poète. « Qui parle ? » C'est, dirait-on, la question qui court à travers ces quatre recueils. La pièce initiale des Feuilles d'automne définit le poète comme un « écho sonore « : modestie, puisque la voix du poète est composée des voix des autres et de tout le reste, mais grandeur, car cet écho est « au centre de tout... ». Et, dans un des derniers poèmes, le poète est devenu Pan, l'homme à la tête cosmique, la voix même de la totalité. Le « Prélude » des Chants du crépuscule fait encore du poète l'écho – « triste et calme « – de son temps ; or ce temps incertain ne fait entendre que des bruits. Tout parle, mais l'humanité hurle ou dispute et la nature bégaie. De ces bruits, le poète fait des voix. Voix intérieures et, derechef, la préface du troisième recueil définit le poète comme un « écho intime et secret » ; cette voix intérieure s'ajoute à celles de la nature et de l'humanité, pour en faire la triple voix de la poésie ; la source est modeste et cachée, mais la poésie est « inépuisable » comme Dieu, et la voix du poète s'oppose aux bruits puissants et mensongers, elle les domine, elle se fait conseillère des rois et des peuples. Le personnage d'Olympio fait ici son apparition – façon de parler de soi et, plus encore, façon de parler à soi, dialectique entre le Moi et le Je. Les Rayons et les Ombres proclament alors l'ambition d'une poésie de la totalité et représentent l'assomption dans la sérénité de l'univers qui se constituait dès Les Feuilles d'automne. Ayant placé sa voix – au centre –, laissant parler à travers elle les voix contradictoires de la totalité, le poète, docile et puissant, impose aux voix multiples l'harmonie. Ici s'achève une aventure complète, celle d'un Orphée modeste, mais qui est Pan, celle d'un poète qui dit Je, mais qui, pour mieux parler, a aussi recours au personnage d'Olympio. La poésie totale Tout pouvait fort bien s'achever là, et, de fait, treize années séparent Les Rayons et les Ombres du prochain recueil poétique de Hugo, les Châtiments. Or c'est là la singularité de Hugo : ces deux carrières, cette seconde naissance. Elle se prépare par la mort, celle de Léopoldine, noyée dans la Seine, à Villequier, le 4 septembre 1843. Dès juin 1844, l'inspiration avait jailli, mais c'était pour célébrer, dans des pièces radieuses et triomphales, la joie de vivre auprès de Léonie Biard. On sait que Hugo se fit surprendre en flagrant délit d'adultère avec sa blonde maîtresse, le 5 juillet 1845, alors qu'il avait été nommé pair de France en avril, et un peu avant qu'il ne commence son roman des Misères. Puis, après la mort de la fille de Juliette, Claire Pradier, l'inspiration, derechef, jaillit. Réussite, scandale, sensualité, mort, le temps de la seconde naissance approche, annoncé par cette année 1846 où, en plus de six poèmes des Pauca meae, Hugo écrit deux « petites épopées » et médite sur la Bible. Mais il faut une autre épreuve encore, une autre forme de mort. Avec la révolution de 1848, l'évolution politique de Hugo se précipite en 1849 et l'amène dans les rangs des républicains et auprès de la barricade où Baudin est tué, le 3 décembre 1851 ; il tente de susciter la résistance au coup d'État de Louis-Napoléon et, le 11 décembre au soir, sous le déguisement et l'identité de Lanvin, ouvrier typographe, il prend le train pour Bruxelles ; en août 1852, il s'installe à Jersey. C'est l'exil. Le grand combat La première œuvre qui naît, dans le dernier trimestre de 1852, les Châtiments, parus fin novembre 1853, révèle cette seconde naissance à laquelle on doit le plus grand Hugo. Deux fois, Hugo a été visé au cœur : la mort de sa fille fait du père un demi-fantôme, un être dont la vie se fonde sur la mort, en qui la mort est comme l'instance suprême à quoi rapporter et le vain souci de vivre et le devoir et la joie même de vivre ; l'exil, mort civique, fait du proscrit un demi-fantôme, mort scandaleuse qui est l'humiliation du Juste par le Parjure, du poète au verbe divin par l'Homme à la parole mensongère. À quoi les Châtiments répliquent en érigeant un Ego Hugo immense ; le temps est passé d'Olympio ; Hugo dit Je, maintenant, parce que ce Je contient tous les autres. Retrouvant ses attitudes du temps des Odes royalistes, il est redevenu le prophète, armé de la « parole qui tue », participant à la puissance divine et de taille cosmique. La voix du poète ne se compose plus seulement des voix multiples dont elle dégage l'harmonie, elle est la loi même du monde, exprimant son devenir, prédisant et jugeant. À un tel poète répond une œuvre-univers et les Châtiments construisent l'univers que Les Contemplations, les épopées, Les Misérables et le William Shakespeare décriront plus complètement. Marche de la nuit « Nox » à la lumière « Lux », du nadir « L'Égout de Rome » au zénith, à l'espace ouvert d'un univers tout entier traversé par les rayons de l'étoile « Stella », cependant que l'Océan, force du mal, est, en même temps, capable de refléter les cieux ; cet univers en souffrance et en progrès est parcouru par un verbe poétique qui intègre toutes les formes (de la chanson à une petite épopée comme L'Expiation) et requiert tous les tons, de la prophétie extatique au grotesque caricatural, avec un accent propre à ce recueil et au 18-Brumaire de Louis Bonaparte, celui de la farce tragique, d'une épopée du sang et du vin, de la boue et de l'étoile. La « grande pyramide » Quand paraissent les Châtiments, voici deux mois que Hugo, sa famille et ses amis interrogent les esprits par le moyen des « tables mouvantes ». Expérience très singulière qui, par la rencontre d'un grand poète avec un médium exceptionnel, Charles Hugo, le fils de Victor, nous a valu des textes en prose et en vers qui sont parmi les plus puissants dans la littérature onirique. Les esprits apprennent peu au poète et le confirment plutôt dans ses idées et dans la conviction de sa mission. Il s'agit de poursuivre le combat des Châtiments en enseignant une religion nouvelle qui donne à la démocratie progressiste son plein accomplissement : le progrès ici-bas s'intègre au mouvement même de la création qui, séparée du créateur, s'en rapproche par une ascension lumineuse infinie. C'est ce que signifie La Fin de Satan, commencée au début de 1854, reprise et complétée en 1859-1860, abandonnée et restée inachevée. L'histoire est ouverte par la chute de l'archange révolté, se poursuit dans la fatalité, sous la forme de la guerre (Nemrod), du gibet (la crucifixion de Jésus), de la prison (la Bastille) ; Lilith-Isis, fille de Satan, déesse de l'ombre, préside à cette histoire, jusqu'au jour où, le 14 juillet 1789, l'autre fille de Satan, l'ange Liberté, née d'une plume de l'archange Lucifer et du regard de Dieu, la dissout dans sa lumière ; l'histoire tend alors vers son achèvement, par la réconciliation de Satan avec Dieu. Intégrée dans l'histoire d'un homme écrivant les Mémoires de son âme, l'histoire devient Les Contemplations, somme hugolienne, dont la pièce la plus ancienne remonte à 1834, qui s'enracine dans l'époque des Rayons et les Ombres, et s'est constituée en 1846, puis en 1854 et 1855. Ce livre, qu'il faut lire « comme on lirait le livre d'un mort », tout étant consommé, met en place le moi, le monde et Dieu. Avec lui, Hugo, comme il l'a dit, avait bâti sa « grande pyramide ». Au centre, un tombeau, la mort et la morte, l'absence omniprésente qui fonde la poésie comme langage du moi absolu (le Mage) et de l'autre absolu (la Morte ou la mort ou Dieu). Six livres qui, de « L'Aurore » au « Bord de l'infini », miment l'être dans sa totalité – et aussi sa transcendance à lui-même, ce vide aspirant où s'engouffre la poésie et qui est la présence absente de Dieu. La récapitulation de l'amour Cette présence absente, cette immanence de la transcendance, Hugo tente la gageure de l'égaler par le langage – et c'est l'épopée de Dieu. En 1855, l'année des « Mages », poème de Dieu forcé par l'esprit humain, du viol de l'Inconnu, de l'éventrement du Sphinx, Hugo écrit la seconde partie de son épopée, « Solitudines coeli « : à travers un espace que franchit son vol ascensionnel, le Voyant pourchasse Dieu de religions en religions ; la chasse se terminerait par la mort, si elle pouvait s'achever. L'année suivante, cependant qu'en avril paraissent Les Contemplations, Hugo écrit la première partie de son épopée, « Le Seuil du gouffre ». Au vol et à l'audace succèdent le piétinement et l'interdiction ; le monstre Esprit humain est l'être du Milieu et l'Infini lui est révélé seulement comme absence. L'espace devient alors le lieu indéfini où des Voix répètent cette impossibilité de saisir l'Absolu. Cela pourrait durer toujours et, de fait, l'épopée reste béante, inachevée, mal délimitée. Dans cet ensemble pullulant prend naissance, dans l'été de 1856 sans doute, l'étrange poème de L'Âne, complété en 1857, achevé en 1858, publié longtemps après ; le baudet Patience discute avec Kant des limites de la connaissance humaine ; son épopée est celle de l'Humanité, vue et jugée par la Bête. Avec le poème de « La Révolution », qui a fourni plus tard « Le Livre épique » des Quatre Vents de l'esprit, et les deux grands poèmes qui le complètent, « Le Verso de la page », morcelé ensuite, reconstitué naguère par P. Albouy, et « La Pitié suprême », méditation sur la violence dans l'histoire, les derniers mois de 1857 et les premiers mois de 1858 assurent le passage de l'épopée de Dieu à l'épopée de l'Homme. À partir du dernier trimestre de 1858, Hugo s'enfonce dans La Légende des siècles, qui paraît le 26 septembre 1859, épopée de l'humanité qui s'achève par ce commencement immense que serait la fin de l'histoire. Après avoir été la voix de l'indicible, la voix du poète atteint ici à sa plénitude, avec le chant du « Satyre », ce Prométhée-Orphée, qui est Pan. Puis, des Contemplations, où le moi et le tout s'accordent, à Dieu, où la voix se perd dans le vide de la transcendance ou la monotonie de l'immanence, et à La Légende, où la voix se récupère dans l'écho de l'histoire, on revient à la voix du moi avec Les Chansons des rues et des bois. Fruit de deux étés, celui de 1859, celui de 1865, et de l'automne chaleureux d'une vie, ce livre des amours gaillardes fit scandale – tout en ravissant les amateurs d'art et de poésie artiste. Hugo y raconte une jeunesse joyeuse, qui ne fut pas la sienne, mais où il transfère les amours de sa maturité, récupérant la sagesse prématurée (et un peu rechignée) de sa jeunesse réelle en une sagesse fondée, maintenant, sur la vie et l'amour : « Jeunesse » et « Sagesse » riment dans ce recueil, qui est ainsi l'histoire exemplaire d'une vie, l'épopée de l'humanité vue du côté des femmes, et un livre politique : la liberté de l'amour (de la sensualité) renvoie à l'immensité qui est source de la vie et qui est égalité : Vénus et Goton, le sage et le fou, le très petit et le très grand, s'équivalent dans l'immensité. L'immensité fonde ainsi la Liberté et l'Égalité et, bien sûr, la Fraternité. Du même coup, ce livre d'octosyllabes joyeux récapitule et achève la tentative de poésie totale qui a occupé ces années de l'exil. Les derniers échos Le 26 mai 1870, Hugo annonce à Paul Meurice qu'il a « une œuvre prête à être lancée à la mer », Les Quatre Vents de l'esprit, c'est-à-dire un recueil composé de poèmes écrits depuis longtemps, en particulier pendant les fécondes années 1854-1857. Le temps vient de l'accommodation des restes. L'événement, pourtant, va donner lieu à une œuvre fort originale, L'Année terrible (1872). Le siège de Paris, la Commune inspirent cette poésie au jour le jour, où le mythe romantique de l'Allemagne – et d'une Europe rêvée au temps du Rhin et des Burgraves – est abandonné, au profit du mythe de Paris, qui culmine ici. Un autre mythe encore se dessine, création du poète et du public, mythe de Victor Hugo – avec son képi de garde national épique et portant des joujoux à ses petits-enfants, grand-père de tout un peuple. Le mythe traverse les poèmes « Entre géants et dieux », écrits en 1875 et publiés dans la seconde série de La Légende des siècles : ces Titans démocrates sont autant de figures de Victor Hugo. Et le 12 mai 1877 paraît L'Art d'être grand-père, achèvement génial du mythe Victor Hugo. Construit sur l'antithèse de l'enfant et du vieillard, du très faible et du très fort, qui s'accordent et se rejoignent, le recueil dresse la stature géante du grand-père du siècle, tandis que la religion des métempsycoses, qui s'était exprimée jadis par La Bouche d'ombre, inspire maintenant le très étonnant « Poème du Jardin des plantes », méditation sur les âmes captives dans l'animalité. En un ultime moment créateur, en 1877-1878, Hugo écrit plusieurs pièces du « Groupe des idylles », qui prendra place dans la série complémentaire de La Légende des siècles, et publie Le Pape – rêve (invraisemblable) d'un vicaire du Christ selon le Christ. Mais, le 28 juin 1878, une congestion cérébrale a raison de ses facultés créatrices. Il va, cependant, continuer à publier, donnant l'illusion d'une activité productrice intacte ; en fait, les œuvres qui paraissent alors ont été écrites bien longtemps auparavant. La Pitié suprême, en 1879, est mise au jour au moment même où, le 28 février, Hugo prononce au Sénat un discours pour l'amnistie aux communards. Religions et Religion, qui combine avec une rédaction de 1870 des textes écrits en 1856, au moment des Voix du seuil, puis, la même année 1880, L'Âne (rédigé entre 1856 et 1858), réaffirment la double hostilité du vieil homme au catholicisme et à l'athéisme, qui se répand parmi les républicains. Les Quatre Vents de l'esprit, l'année suivante, la dernière série de La Légende des siècles en 1883, assurent en plein symbolisme une présence massive du romantisme – du « vrai », celui des années 1850, des années de Baudelaire et du Hugo de l'exil. Après les funérailles nationales du 1er juin 1885 commence une vie posthume fondée sur une contradiction qui ira s'aggravant entre la grande figure dont on célèbre le culte national et républicain, et le poète qu'on méconnaît de plus en plus – jusqu'à ce qu'après Claudel et le surréalisme on soit, enfin, plus à même d'apprécier, de recevoir la poésie du livre VI des Contemplations, de La Fin de Satan, de Dieu. Redécouverte en cours, qui s'accompagne de la publication des derniers inédits, fragments divers de la Boîte aux lettres, des Épîtres, de l'énorme manuscrit de Dieu, complétant les publications dues à Paul Meurice de Toute la lyre, des Années funestes, de La Dernière Gerbe, recueils, au demeurant, factices et que Jean Massin a préféré disperser tout au long de sa vaste édition chronologique. Ainsi ni l'érudition n'en a fini avec Hugo, ni la critique, trop longtemps en retard devant cette œuvre trop forte. Pierre Albouy Le dramaturge Théorie et pratique : « Cromwell » Dès 1825, les jeunes romantiques rêvent de s'emparer du théâtre, d'en renouveler les structures sclérosées, l'inspiration tarie. Projets singulièrement stimulés par la venue à Paris des comédiens anglais jouant Shakespeare. En 1826-1827, Hugo apporte avec son Cromwell et la préface qui le précède, ou plutôt qui le suit, le manifeste de la liberté au théâtre – une liberté non pas abstraite, mais réglée par trois éléments essentiels : l'utilisation et le respect de l'histoire éclairant à la fois le passé et la réalité contemporaine ; la grandeur poétique (rigueur du style, et usage du vers, machine à éloigner les philistins) ; enfin le grotesque, image mystifiée mais vivante de la réalité populaire introduite au cœur du drame. Le drame lui-même de Cromwell, œuvre géante de six mille vers, répond assez fidèlement à une telle vue, mélange de grandeur, de vue exhaustive de l'histoire, de présence populaire dans les personnages et dans le grotesque (chansons des fous, facéties burlesques de Rochester, dérision de la puissance). D'une part l'œuvre – théorie et pratique – apparaissait comme capable de renouveler le théâtre et de faire sauter les verrous de la vieille tragédie. D'autre part elle posait le problème de l'action politique et de la possibilité pour le grand homme de prendre en main, après une révolution, les destins d'un monde complexe et décadent. Le théâtre joué La bataille d'« Hernani » La victoire ne se remporte que sur le terrain ; Cromwell, trop vaste, ne pouvait être ni joué ni réduit. En 1830, le succès discuté d'Hernani permet à Hugo de défendre sa propre formule du drame romantique : drame de l'être double cherchant dans les luttes de l'histoire et les vicissitudes de l'amour, non seulement son identité, mais l'impossible réconciliation d'un moi déchiré (bandit-grand seigneur ; mauvais roi-bon empereur). La vigueur provocante du style, l'audace des situations, la grandeur paradoxale des personnages, l'amour impossible, la présence permanente de la mort ravirent une jeunesse qui voyait dans l'œuvre, outre l'exaltation napoléonienne du grand homme et le mépris libéral des rois (« Crois-tu que les rois à moi me sont sacrés ? »), l'étendard enfin brandi de la liberté dans l'art et ce mélange diffus d'espérance et de nostalgie qui précéda la révolution de 1830. La bataille d'Hernani, bien plus idéologique et littéraire que proprement littéraire, si elle se joue au niveau du public prend peut-être toute son acuité dans les démêlés de l'auteur avec ses comédiens. Toute victoire littéraire ne pouvait être, dans les conditions commerciales qui étaient celles du théâtre à l'époque, qu'une demi-victoire. Après Hernani, Hugo change de troupe et quitte la Comédie-Française ; c'est à la Porte-Saint-Martin, théâtre « populaire », moins conformiste, qu'il confie en 1831 Marion de Lorme, interdite par la censure de la Restauration en 1829 et libérée par le nouveau régime. Mais les grands acteurs du mélodrame, un Bocage, une Dorval, ne parviennent pas à arracher un vrai succès. À la recherche d'un public Hugo, parfaitement conscient des problèmes du théâtre, surtout après la révolution de 1830 et l'échec presque immédiat de ses espérances, s'efforce alors non seulement de trouver un public, mais de le créer un, à la fois bourgeois et populaire ; la formation de ce public serait une double tâche, littéraire et politique. Pendant l'été 1832, Hugo écrit presque simultanément deux pièces pour tenter de conquérir à la fois l'« élite » à la Comédie-Française et le public populaire de la Porte-Saint-Martin. La première, Le roi s'amuse, dont le héros est un grotesque, essuie au Théâtre-Français un échec retentissant : interdite par le pouvoir dès le lendemain, elle ne sera reprise que cinquante ans plus tard. La seconde, Lucrèce Borgia, inaugure la série de ces « grands mélodrames romantiques en prose » où Antonin Artaud voyait du vrai théâtre. Ce drame de l'amour incestueux et de la culpabilité fatale, dont le dernier acte est un chef-d'œuvre de construction poétique et de violence hallucinatoire, eut un succès immense sinon durable. Le drame en prose suivant, toujours à la Porte-Saint-Martin, Marie Tudor (1833), est peut-être la meilleure pièce de Hugo ; ce drame historique plus âprement sévère, transposition de la révolution de 1830, dérouta les spectateurs par sa complexité. Hugo déçu tente à nouveau sa chance au Théâtre-Français : Angelo (1835), œuvre de compromis d'où il se voit contraint d'éliminer presque totalement le grotesque et l'histoire, merveilleusement joué, ne rencontrera pas trop de résistances. Le théâtre de la Renaissance Pourquoi ne pas essayer de créer une scène nouvelle qui serait celle du drame romantique ? Avec Alexandre Dumas et grâce à l'amitié du duc d'Orléans, Hugo y parvient : c'est le théâtre de la Renaissance, pour l'inauguration duquel (nov. 1838) il écrit la plus célèbre sinon la meilleure de ses pièces, Ruy Blas, dont le mérite est à la fois de poser les problèmes politiques de l'agonie d'une monarchie, et de remettre à la scène un vigoureux personnage grotesque, César de Bazan. Mais le théâtre de la Renaissance, récupéré par le vaudeville, cesse bientôt de pouvoir abriter le drame. Les étapes du silence Après Ruy Blas, il tente d'écrire Les Jumeaux qu'il laisse inachevés (1839). Est-ce là renonciation au théâtre ? Après trois ans de silence, il revient à la scène avec une formule toute nouvelle, sa grande trilogie épique des Burgraves (1842), nommée « trilogie » non parce qu'elle est divisée en trois parties, mais parce que la dimension temporelle unit étroitement au conflit présent la tragédie passée et la rédemption future. Le mal individuel et le mal historique – symbolisés comme souvent chez Hugo par le fratricide – trouvent leur rachat dans la résurrection de l'empereur Barberousse. Perspective historique et perspective individuelle et familiale se rejoignent dans un drame dont le gigantisme statique et les « invraisemblances » barbares rebutèrent un public passablement superficiel. L'échec des Burgraves s'ajoute pour Hugo à cette rupture qu'est la mort de sa fille (1843) : il n'a plus envie ou plus besoin de croiser le fer avec des interprètes qui le refusent, avec un public qui ne répond pas. La verve dramatique cherche ailleurs son exutoire. Grandeur et limites du drame Le drame romantique de Hugo a toujours été mal accueilli ; même les reprises des années 1870-1875, compensant les interdictions de l'Empire, obtiennent plus facilement l'adhésion du public que les suffrages des doctes. Plus près de nous encore, son théâtre, malgré d'admirables représentations (celles de Marie Tudor avec Maria Casarès et de Ruy Blas avec Gérard Philipe au Théâtre national populaire, celles de Lucrèce Borgia au Vieux-Colombier, et, à la télévision, Les Burgraves et surtout l'étonnante Marie Tudor d'Abel Gance), il est encore de bon ton de tenir ces œuvres pour médiocres ou désuètes. Il semble que le théâtre de Hugo, justement par ce qu'il représente de particulier et peut-être de nouveau, réclame de ne pas être jugé suivant des normes classiques. Le héros Les mobiles des héros de Hugo s'éclairent à la lumière des approches freudiennes, de la « psychologie des profondeurs » pour qui désir incestueux et instinct de mort n'appartiennent pas à la seule mythologie. D'autre part, la « psychologie » de ses personnages ne réside pas dans leurs passions ou dans la conscience qu'ils en prennent, elle est diffuse dans le monde, dans leurs rapports avec le monde. Ils sont représentés comme pris dans le tissu d'événements qui les dépassent et dont ils attendent le sens de leur existence. Incapables de saisir leur propre unité, ce sont des individualités fracturées, des êtres que la fatalité historique a fait doubles ; tout le drame se lit dans l'effort admirable et vain qu'ils font pour ressaisir une unité qui leur échappe ; la fatalité historique redouble et conditionne leur fatalité intérieure : tels Hernani, Lucrèce Borgia, Triboulet, Ruy Blas. De là leur caractère à la fois moral et monstrueux, la « double postulation » dont ils sont le lieu et qui permet à ces drames d'échapper au manichéisme du mélo. L'histoire La nouveauté du théâtre de Hugo est de mettre l'accent sur le concret, sur le rapport de l'individu et de l'histoire, de rendre au spectacle sa violence tragique et mortelle, de mettre en question l'ensemble de la scène bourgeoise du XIXe siècle par l'introduction de lieux et de personnages de cour des miracles et par l'emploi provocant du grotesque. Par son goût du concret, de la couleur puissante, il rend au théâtre son statut de spectacle signifiant, aidé en cela par les admirables décors de Pierre Ciceri ; il joue des prestiges de l'objet, non seulement comme vêtement historique, mais comme relais symbolique des grandes lois du monde ; sur ce point, il est l'ancêtre de Brecht. Limites Cependant le théâtre de Hugo souffre de son inadéquation à son public : parfois le poète force le ton pour emporter l'adhésion, pour faire passer une invraisemblable et décisive vérité intérieure ou historique. Et surtout le rôle étrange dévolu chez lui à la parole, dévaluant entièrement le discours toujours inefficace et inadéquat à l'action, lui donne l'aspect déconcertant d'une parole vaine, d'une raison vouée au néant. En un sens, par-dessus un siècle de théâtre bourgeois, des deux Dumas à Jean Anouilh, il y a chez Hugo le pressentiment parfois maladroit d'un théâtre « autre », et – si contradictoire que cela paraisse – d'un Brecht par la volonté d'éclairer l'histoire, d'un Artaud par le sens de la cruauté, par une profondeur située au-dessous, en dehors, à côté de la rationalité du langage. « Le Théâtre en liberté » Hugo écrit non des centaines, mais des milliers de fragments dramatiques où se déploie toute une fantaisie à l'état naissant, tout un théâtre en miettes, un anti-théâtre essentiellement orienté vers le comique. Projets véritables d'une œuvre rêvée, ou simples étoiles filantes, ces fragments figurent une sorte d'immense commedia à personnages reparaissants, comme la comédie balzacienne, seigneurs, valets, filous, clochards, ingénues, grandes dames et courtisanes : Maglia le bohème, l'homme-Protée, les ducs et les gueux (Goulatromba, Gaboardo), Zubiri la coquette, Tituti l'étudiant. Ils contestent le mariage, la propriété, l'Académie ; ils justifient le vol et l'adultère ; ils chantent les instincts, la liberté, le plaisir, l'ivrognerie, le bonheur de manger quand on a faim. Simples répliques ou tirades construites, ils annoncent Le Théâtre en liberté, dont les premières saynètes datent de 1854 (Le Suicide, La Forêt mouillée), avant de s'épanouir dans ces chefs-d'œuvre que sont Les Deux Trouvailles de Gallus (1869), tragi-comédie de l'amour absolu, et Mangeront-ils ? (1867), merveilleuse fantaisie où le voleur Aïrolo fait pièce au Roi, le contraignant non seulement à lâcher les pauvres amoureux, ses victimes, mais même à abdiquer. La broderie baroque du langage, la virtuosité du vers ne simplifient pas la mise en scène de ces comédies qui furent pourtant jouées. À côté, deux tentatives de pièces populaires, la très courte saynète L'Intervention, et le curieux mélodrame « contestataire », Mille Francs de récompense (1866), dont le héros Glapieu consolide sardoniquement les colonnes de la morale bourgeoise. Peut-être est-ce dans ce théâtre de l'exil, écrit loin de toute scène concrète, qu'il faut chercher le plus pur de l'inspiration dramatique du poète. Enfin, il écrit son dernier drame, le plus puissant, le plus touffu, rassemblant l'essentiel de ses préoccupations : Torquemada 1869. Anne Ubersfeld Le dessinateur On estime aux alentours de trois mille (en tenant compte des œuvres perdues mais connues par des reproductions ou des références et en comptant séparément celles qui appartiennent à des recueils, carnets, albums, etc.) le nombre des dessins de toutes dimensions et de toutes techniques laissés par Victor Hugo, nombre considérable pour un homme qui avait, comme il le rappelait lui-même, « autre chose à faire ». Conservés, pour plus des deux tiers, à Paris, à la Bibliothèque nationale, à laquelle Hugo légua « tout ce qui sera trouvé écrit ou dessiné par moi », et à la Maison de Victor Hugo, ils se répartissent entre des vues de paysages et de monuments, dont un grand nombre de notes de voyages, une masse de croquis d'inspiration comique ou grotesque, qui ne sont pas tous à proprement parler des « caricatures », et des travaux plus délicats à situer parmi les catégories artistiques du temps, qui semblent surtout relever de l'expérimentation technique sans être pour autant vides de sens : taches d'encre plus ou moins reprises, découpages souvent utilisés comme pochoirs, empreintes de tissus ou d'éléments naturels, et toutes sortes de caprices graphiques. Ces pratiques alors peu orthodoxes, tout au moins chez les peintres de profession, sont également utilisées dans des dessins de facture plus traditionnelle, au lavis d'encre parfois relevé de fusain, de gouache ou d'aquarelle. Beaucoup d'autres sont simplement à la plume ou au crayon. Le tout forme un œuvre assez homogène, qui commence vers 1825 (mis à part les dessins d'enfant) par des pages au graphisme un peu grêle, et met une vingtaine d'années à trouver son répertoire et son style. Proche de l'imagerie romantique par le goût du pittoresque et la recherche d'effets dramatiques, il la dépasse par son dynamisme, sa liberté de moyens et un sentiment du mystère d'une profondeur exceptionnelle. Pendant trente ans, à partir de 1845 environ, ces traits dominants subsistent sans grands changements, tandis que la production se poursuit à un rythme irrégulier, se faisant parfois plus intense dans les pauses de l'écriture (1850), gagnant en fluidité à Jersey et à Guernesey, devant le spectacle du ciel et de l'océan, renouant dans les années 1860 avec la veine pittoresque et satirique des débuts, et s'épuisant, comme la production littéraire, après 1875-1877. Œuvres d'un écrivain célèbre, les dessins de Hugo ne tardèrent pas à susciter la curiosité, et, dès 1852, Théophile Gautier déclarait : « Victor Hugo, s'il n'était pas poète, serait un peintre de premier ordre. » Gautier parle aussi de « cauchemar » au sujet d'un grand dessin de 1850, tandis que, sept ans plus tard, Baudelaire oppose à la platitude de la peinture contemporaine de paysage « la magnifique imagination qui coule dans les dessins de Victor Hugo, comme le mystère dans le ciel ». De Huysmans à Claudel et à Breton, de Van Gogh à André Masson, de Gustave Geffroy à Henri Focillon et à Gaëtan Picon, cette prédominance du fantastique, le trouble qu'elle inspire au spectateur ont été fréquemment soulignés par des écrivains et des peintres doués d'une personnalité forte. Mais d'autres, plus conservateurs, soumettent les dessins de Hugo aux vieux critères académiques, soit pour déplorer leur caractère irréfléchi et leur manque de maîtrise technique (« il faut des journées de travail et de réflexion » pour transformer un lavis « peut-être inspiré » en « tableau digne de ce nom », observe André Lhote dans son Traité du paysage), soit au contraire pour promouvoir leur auteur au rang de « véritable artiste ». Il s'agit en somme de normaliser des créations passablement aberrantes. Ce point de vue transparaît longtemps dans le choix des exemples retenus pour la reproduction, qui élimine les dessins les plus déconcertants (quand on ne va pas jusqu'à les « corriger »), et dans la recherche obstinée de rapports d'illustration entre textes et dessins. « Mes dessins sont un peu sauvages » C'est faire peu de cas de l'opinion maintes fois exprimée par Hugo, qui montre et offre volontiers certains dessins à ses intimes, les encadre, les accroche sur ses propres murs, se dit « tout heureux et très fier » des lignes flatteuses de Baudelaire à leur sujet, les lègue enfin à la Bibliothèque nationale, mais s'est toujours défendu de toute incursion sur le terrain des « vrais » peintres et a résisté autant qu'il a pu aux admirateurs indiscrets qui allaient, non sans malice, jusqu'à préférer ses dessins à ses livres. Il entend ainsi parer à des opérations de diversion préjudiciables à son œuvre littéraire, mais il manifeste surtout la conscience qu'il a de la singularité de ses dessins. Les tours faussement désinvoltes qu'il emploie pour les désigner – « quelques espèces d'essais de dessins... », « ces choses qu'on s'obstine à appeler mes dessins... », « ces traits de plume quelconques, jetés plus ou moins maladroitement sur le papier... », « mes barbouillages... », « ce machin... » – disent bien sa perplexité devant des productions dont le vocabulaire et les concepts contemporains pouvaient difficilement rendre compte. Il s'y essaie néanmoins quand il écrit à Philippe Burty : « mes dessins [...] sont un peu sauvages », ou quand il parle des « heures de rêverie presque inconsciente » où il se laisse aller à dessiner : instants d'abandon – Gautier parle de « délassement » – où la main, libérée des cadres de la pensée comme des normes et des contraintes qui sont le lot du peintre ordinaire, joue avec les matériaux et laisse parler l'indicible. Sous leur air de modestie, ces indications expliquent fort bien l'audace des dessins de Hugo, que l'auteur évitait prudemment de confronter au conformisme contemporain, et aussi leur charge émotionnelle et leur pouvoir de révélation, celui d'une « écriture automatique » où les désirs et les failles de l'être transparaissent à l'abri de la censure. De fait, si beaucoup d'entre eux s'intègrent sans heurt à l'art de leur temps, beaucoup d'autres restent déroutants et ne sont devenus « lisibles » qu'à partir des révolutions esthétiques du XXe siècle, en particulier le surréalisme et l'art informel. « Sauvages », ces dessins le sont à la manière dont l'œuvre d'un Picasso le sera (toute proportion gardée) un demi-siècle plus tard, non par grâce de nature mais par rupture avec le code esthétique dominant. Hugo a appris à dessiner pendant ses études secondaires, notamment d'après des recueils de modèles, et possédait une bonne formation en matière de géométrie et d'optique. De rares portraits, quelques compositions reposant sur un effet de perspective illusionniste et la totalité des dessins de voyage montrent d'ailleurs qu'il était capable de dessiner « correctement ». C'est donc de façon délibérée qu'il écarte ce savoir scolaire au profit de techniques empiriques et aléatoires, où l'imagination s'affranchit des recettes du métier, de la réflexion, bref de la « maîtrise ». Quant à sa culture artistique, renforcée par ses relations d'amitié avec des peintres comme Louis Boulanger et Célestin Nanteuil, elle a pu laisser des traces dans ses dessins, mais seules quelques œuvres « en marge », avec lesquelles il se sentait en accord intime – surtout chez des graveurs : Rembrandt, Piranèse, Goya, sans doute Meryon –, l'ont affecté en profondeur. Il connaissait également des formes d'expression alors tenues pour mineures, comme les dessins de nonsense de Grandville, voire ignorées ou méprisées comme les dessins d'enfants et les graffiti, et il en a fait son profit, tout comme de certaines pratiques d'amateurs, notamment les découpages et les taches d'encre. Il y avait là une effervescence de trouvailles naïves ou provocantes, d'autant plus aiguës qu'elles semblaient sans conséquence, et qui, pourtant, entraient en concurrence avec l'art savant, y compris celui des grands peintres romantiques, nourris de culture classique et attachés aux procédures traditionnelles. La métamorphose et le jeu du sens C'est donc sous le signe de l'écart et du jeu qu'il convient de considérer l'œuvre graphique de Hugo dans ses manifestations originales. Écart par rapport aux formes « majeures » de l'art et à leurs disciplines et conventions ; jeu du corps et de l'imagination agissant librement sur les matériaux ou se laissant « agir » par eux, jeu interne des structures formelles et sémantiques, dont l'irrationnel et le mouvant forment le terrain privilégié. Tout est expansion et métamorphose ; le dynamisme et l'inachèvement des formes, le flottement ou la circulation du sens disent la dilatation continue de la conscience et de l'univers travaillés par l'infini. C'est en ce sens global, et donc au-delà des rapports d'illustration proprement dits, souvent plausibles mais presque toujours insaisissables, que la démarche du dessinateur s'accorde à celle de l'écrivain. Devant ce phénomène de diffusion et d'interaction généralisées, les distinctions couramment admises perdent beaucoup de leur pertinence. Le réel et l' imaginaire, les notions correspondantes d'observation et d'invention cessent de s'exclure, jusque dans des pages réputées « d'après nature » et dont l'objectivité semble garantie par des indications précises de date et de lieu. Beaucoup d'entre elles n'ont été exécutées que de mémoire, à partir de notes sur le motif. L'exemple le plus éloquent est sans doute la fameuse vue du Rhin datée et localisée « 27 7bre 1840. La Tour des rats », dont on sait par un document qu'elle a toutes chances de se situer sept ans plus tard. À l'inverse, une vue de ville médiévale qu'on avait toujours tenue pour purement imaginaire porte l'inscription suivante, longtemps cachée par l'encadrement : « Cologne. Vu le 27 août 1865, 7 h du soir. » On ignore si Hugo l'a dessinée telle quelle au jour et à l'heure indiqués, mais il est certain qu'une « chose vue » bien concrète se trouve à son origine. Les autres dessins de paysages et de motifs architecturaux, qu'ils passent pour être imaginaires ou d'après nature, se répartissent entre ces cas limites selon leur degré de fidélité au « réel », et le terme de « souvenir » que Hugo leur accole parfois est un guide incertain pour l'identification de leurs sources. Ainsi un seul et même motif, inspiré par une chapelle en ruine reconnaissable dans une photographie de Jersey, apparaît tour à tour dans quatre dessins avec des indications de lieux bien différents : un croquis (inédit) au crayon, apparemment pris sur le motif et annoté « 5 h 1/4 – 3 7bre – l'Hermitage » ; deux lavis « fantastiques », l'un daté du même jour que le premier, quoique probablement postérieur, l'autre de « 1855 » seulement, mais également intitulé par Hugo « l'Hermitage (Jersey) » ; un troisième, enfin, ne spécifiant ni lieu ni date, mais portant sur le cadre l'inscription suivante : « Souvenir de Suisse. Vedette de Guillaume Tell près d'Altorf » (un site vu par Hugo en 1839). Les souvenirs bien distincts de Suisse et de Jersey ont donc fusionné dans un signe unique, malgré l'origine clairement identifiable de celui-ci. « L'Hermitage » a d'ailleurs fait l'objet d'un découpage (et même de deux, sans variante notable mais de format différent), que Hugo a utilisé comme pochoir, opérant à partir de cette sorte de matrice un jeu complexe de variations et d'enchaînements. Le procédé, courant dans ses dessins à partir des années 1850, permet d'entrevoir toute une circulation d'impressions, d'idées, de souvenirs, de fantasmes (et l'on sent bien ce que ces termes d'origine rationaliste ont d'inadéquat) sans doute en partie inconsciente et qui doit largement nous échapper. De façon générale, et mis à part les vues d'après nature, parfois dessinées après coup mais dont les précisions de lieu sont rarement inexactes, les indications fournies par Hugo sur la signification de ses dessins, notamment sous forme de titre ou de légende, ne font souvent qu'indiquer une direction assez vague. Elles sont d'ailleurs peu nombreuses, de même que les rapprochements explicites entre des dessins et des textes susceptibles d'en fixer le sens. Le seul exemple d'une certaine ampleur est le manuscrit des Travailleurs de la mer (1865-1866). Hugo y a inséré une trentaine de dessins, dont quelques-uns seulement furent exécutés dans cette intention. L'emplacement de chaque pièce à proximité d'un passage du texte suggère une interprétation possible, mais bien des cas restent ambigus, et, le plus souvent, l'image, mise en regard d'une « scène » déterminée, tend à s'émanciper de la trame narrative pour rayonner largement. Ce glissement ininterrompu du détail à l'ensemble, ce mouvement général vers l'effacement des limites et la solidarité des formes, affecte à la fois le rapport texte/image et la technique même des dessins. Toutes les ressources élaborées par Hugo pour échapper à la figuration rationnelle, bornée et « composée », sont simultanément mises en œuvre. Les hachures à la plume et les traînées de lavis brouillent les contours ; les corps flottent, les plans ondulent ; les vues plongeantes écrasent la perspective, abolissent la hiérarchie conventionnelle du « sujet » et du « fond ». Presque partout, la tache, la coulée d'encre, sans limite, sans haut ni bas, principe d'un espace obscur et mouvant, modèle décliné par l'ombre, l'océan, les rochers, les nuages, les ruines de vieilles villes, les méandres de la pieuvre... Le manuscrit des Travailleurs de la mer, spécimen accompli de l'art de Hugo dessinateur, parcourt ainsi toutes les modalités du jeu des formes, inséparables du jeu du sens, participant à cette quête intuitive du tout qui est la plus haute ambition hugolienne et dont les « proses philosophiques » de la même époque formulent la théorie. Formes ouvertes à l'action du hasard et aux projections de la rêverie, les taches d'encre retravaillées ont pour équivalent dans l'ordre linéaire des improvisations fantastiques, concentrées pour la plupart dans des carnets de 1856-1857, silhouettes dentelées, griffonnées arbitrairement, puis complétées par l'adjonction de quelques détails plus intelligibles. La grande masse des « caricatures » entretient un rapport moins aléatoire avec le réel, bien qu'elle concerne rarement des modèles précis, mais il est évident que la fantaisie, le plaisir de l'invention y précèdent souvent l'intention satirique. Celle-ci n'intervient qu'après coup, généralement sous forme de légende, avec un mélange libérateur de virulence et de verve dont la bêtise et l'autorité sous toutes leurs formes font les frais. Le sens intervient donc a posteriori, tout au moins le sens explicite, car le concours aventureux du geste et du matériau qui paraît y préluder est sans doute moins aveugle qu'on ne l'imagine. « Ces griffonnages sont pour l'intimité et l'indulgence des amis tout proches. » Hugo délimite ainsi l'espace intime dans lequel son activité de dessinateur s'exerce loin du public et des circuits professionnels : un champ de recherche, ou plus exactement d'incitation aux découvertes, où l'artiste essaie de renoncer à son statut de « sujet » souverain. De là tant de secrets et de souvenirs, tant de « thèmes » imaginaires, à la fois transparents et obscurs, qui s'offrent et se dérobent au commentaire. « Une parole clandestine », selon la formule d'Anne Ubersfeld, s'y dit « dans la contrainte, comme si ce qu'elle véhicule ne pouvait se faire entendre que par bribes ». « Faire entendre » la « parole » des profondeurs a sans doute été l'un des principaux moteurs de cette vaste création graphique. L'ombre dans laquelle Hugo chercha toujours à la maintenir suggère que cette fonction ne lui était pas inconnue. Pierre Geogel Liste des œuvres Note : l'année indiquée est la date de la première parution Théâtre Les Burgraves, scène du 2e acte. 1816 : Irtamène 1819 ou 1820 : Inez de Castro 1827 : Cromwell 1828 : Amy Robsart 1830 : Hernani 1831 : Marion de Lorme 1832 : Le roi s'amuse 1833 : Lucrèce Borgia 1833 : Marie Tudor 1835 : Angelo, tyran de Padoue 1838 : Ruy Blas 1843 : Les Burgraves 1882 : Torquemada 1886 : Théâtre en liberté à titre posthume 1939 : Le château du diable pièce inachevée écrite en 1812 et publiée à titre posthume Romans Luc-Olivier Merson 1846-1920, illustration pour Notre-Dame de Paris, 1881. 1818 : Bug-Jargal 1823 : Han d'Islande 1829 : Le Dernier Jour d'un condamné 1831 : Notre-Dame de Paris 1834 : Claude Gueux 1862 : Les Misérables 1866 : Les Travailleurs de la mer 1869 : L'Homme qui rit 1874 : Quatrevingt-treize Poésies 1822 : Odes et poésies diverses 1824 : Nouvelles Odes 1826 : Odes et Ballades 1829 : Les Orientales 1831 : Les Feuilles d'automne 1835 : Les Chants du crépuscule 1837 : Les Voix intérieures 1840 : Les Rayons et les Ombres 1853 : Les Châtiments 1856 : Les Contemplations 1859 : Première série de la Légende des siècles 1865 : Les Chansons des rues et des bois 1872 : L'Année terrible 1877 : L'Art d'être grand-père 1877 : Nouvelle série de la Légende des siècles 1878 : Le Pape 1879 : La Pitié suprême 1880 : L'Âne 1880 : Religions et religion 1881 : Les Quatre Vents de l'esprit 1883 : Série complémentaire de la Légende des siècles Recueils posthumes : 1886 : La Fin de Satan 1891 : Dieu et 1941 Choix de poèmes parmi les manuscrits de Victor Hugo, effectué par Paul Meurice : 1888 : Toute la Lyre 1893, 1893, 1835-1937, 1893 : Nouvelle série de Toute la Lyre 1898 : Les Années funestes 1902 : Dernière Gerbe et 1941 le titre n'est pas de Victor Hugo 1942 : Océan. Tas de pierres Autres textes 1818 : A.Q.C.H.E.B. A quelque chose hasard est bon texte qualifié d'opéra-comique par son auteur 1834 : Étude sur Mirabeau 1834 : Littérature et philosophie mêlées 1836 : La Esmeralda livret d'opéra 1842 : Le Rhin, éd. J. Hetzel-A. Quantin Paris, 1884, t. 1 disponible sur Gallica et t. 2 disponible sur Gallica 1852 : Napoléon le Petit pamphlet éd. J. Hetzel Paris, 1877 disponible sur Gallica 1855 : Lettres à Louis Bonaparte 1864 : William Shakespeare 1867 : Paris-Guide 1874 : Mes fils 1875 : Actes et paroles - Avant l'exil 1875 : Actes et paroles - Pendant l'exil 1876 : Actes et paroles - Depuis l'exil 1877 : Histoire d'un crime - 1re partie 1878 : Histoire d'un crime - 2e partie 1883 : L'Archipel de la Manche Œuvres posthumes de Victor Hugo. 1887 : Choses vues - 1re série mémoires et commentaires pris sur le vif, le titre n'est pas de Victor Hugo 1900 : Choses vues - 2e série 1890 : Alpes et Pyrénées carnets de voyage 1892 : France et Belgique carnets de voyage 1896 : Correspondances - t. I 1898 : Correspondances - t. II 1901 : Post-scriptum de ma vie, recueil de textes philosophiques des années 1860 1934 : Mille francs de récompense, théâtre 1951 : Pierres fragments manuscrits 1964 : Lettres à Juliette Drouet suivi de Le livre de l'anniversaire Postérité Centenaire de la naissance de Victor Hugo à Paris 1902.Des cérémonies sont organisées dès le centenaire de sa naissance. La Poste française émet un timbre à son effigie le 11 décembre 1933. 5 nouveaux francs Victor Hugo imprimé de mars 1959 à novembre 1965. Au XXe siècle Au début du XXe siècle, Victor Hugo reste une gloire nationale et l'anniversaire de sa naissance donne lieu à de nombreuses manifestations officielles. Le milieu artistique a cependant pris un peu ses distances. Le mouvement parnassien et le mouvement symboliste, en remettant en cause l'éloquence dans la poésie, se sont posés en adversaires de l'école de Hugo et la mode en ce début de siècle est à une poésie moins passionnée. La phrase d'André Gide, Victor Hugo hélas, en réponse à la question Quel est votre poète ? à un questionnaire sur les poètes et leur poète, montre la double attitude des poètes du XXe siècle, reconnaissant à Victor Hugo une place prééminente parmi les poètes, mais exaspérés parfois aussi par ses excès. Charles Péguy, dans Notre patrie publié en 1905, n'est pas tendre envers le grand homme, l'accusant d'être un hypocrite pacifiste, disant de lui que Faire des mauvais vers lui est complètement égal, mais plus loin s'exclamant quels réveils imprévus, quel beau vers soudain et parlant d'entraînement formidable de l'image et du rythme. Saint-John Perse lui reproche d'avoir perverti le romantisme par son engagement politique. On retrouve de son influence aussi bien chez des admirateurs comme Dostoïevski que chez de violents détracteurs comme Jean Cocteau. Vers 1930, Eugène Ionesco écrit le pamphlet Hugoliade et reproche à Hugo une éloquence masquant la poésie ainsi que sa mégalomanie. Entre les deux guerres, c'est en sa qualité de révolutionnaire qu'il est apprécié par les gens de gauche Romain Rolland, Alain et exécré des réactionnaires Charles Maurras, c'est en sa qualité de visionnaire qu'il est apprécié des surréalistes. Il est admiré par Aragon, par Desnos. Durant la guerre, son image sert de porte-drapeau à la résistance. Au retour de la guerre, les passions s'assagissent, on découvre l'homme. François Mauriac déclare, en 1952 : Il commence à peine à être connu. Le voilà au seuil de sa vraie gloire. Son purgatoire est fini. Henri Guillemin publie une biographie très nuancée de l'écrivain. Jean Vilar popularise son théâtre. Victor Hugo est désormais adapté au cinéma, au théâtre et pour la jeunesse. Le centenaire de sa mort est fêté en grande pompe. Adaptations Les œuvres d'Hugo ont donné lieu à d'innombrables adaptations au cinéma, à la télévision ou au théâtre. Le héros hugolien le plus interprété demeure Jean Valjean, incarné, en France, par Harry Baur, Jean Gabin, Lino Ventura ou Gérard Depardieu. Cinéma Près d'une centaine d'adaptations au total dont plus d'une quarantaine pour Les Misérables, suivi de près par Notre-Dame de Paris. On peut y voir le caractère universel de l'œuvre d'Hugo, car les cinémas les plus divers s'en sont emparés : américain 1915, Don Caesar de Bazan, tiré de Ruy Blas ; The Man Who Laughs 1928, adaptation de L'Homme qui rit ; anglais, indien Badshah Dampati, en 1953, adaptation de Notre-Dame de Paris ; japonais en 1950 Re Mizeraburu : Kami To Akuma : adaptation dans un cadre japonais, sous l'ère Meiji ; égyptien ex :1978, Al Bo'asa adaptation des Misérables ; italien 1966, L'Uomo che ride, adaptation de L'Homme qui rit, etc. L'Histoire d'Adèle H. de François Truffaut est un des rares films biographiques qui évoque indirectement l'exil de Victor Hugo qui n'apparaît pas dans le film à travers le destin de sa fille Adèle Hugo. L'écrivain apparaît dans le film de Sacha Guitry Si Paris nous était conté interprété par Émile Drain. En 2016, le film documentaire Ouragan, l'odyssée d'un vent a repris le texte de Hugo intitulé La Mer et le Vent pour constituer l'essentiel de la narration, accompagnant les images dédiées à l'ouragan. Télévision Un nombre important d'adaptations d'œuvres de Victor Hugo a été réalisé pour la télévision. Pour la télévision française Jean Kerchbron réalisa les adaptations de Marion de Lorme, Torquemada et L'Homme qui rit, en 2000 Josée Dayan fit une adaptation des Misérables avec Gérard Depardieu, Christian Clavier et John Malkovich. Opéra Une centaine d'opéras ont été inspirés par l'œuvre de Victor Hugo. Signalons, entre autres, parmi les plus connus : 1833 : Lucrezia Borgia, de Gaetano Donizetti, d'après Lucrèce Borgia. 1837 : Il Giuramento, Saverio Mercadante, d'après Angelo, tyran de Padoue. 1844 : Ernani de Verdi, tiré de la pièce Hernani. 1851 : Rigoletto de Verdi, d'après la pièce Le Roi s'amuse. 1879 : Maria Tudor de Carlos Gomes, d'après le drama Marie Tudor 1885 : Marion Delorme d'Amilcare Ponchielli, d'après la pièce Marion de Lorme 1943 : Torquemada de Nino Rota, d'après la pièce Torquemada Sur ces opéras et d'autres, on se reportera au numéro hors série de L'Avant-scène opéra, Hugo à l'opéra, dirigé par Arnaud Laster, spécialiste des rapports de Victor Hugo avec la musique et des mises en musique de ses œuvres. Contrairement à ce que l'on a souvent prétendu, Victor Hugo n'était pas hostile à la mise en musique de ses poèmes ni aux opéras inspirés par ses œuvres sauf quand on ne signalait pas qu'il était l'auteur de l'œuvre adaptée. Néanmoins, lors des premières représentations d'Ernani, Hugo insista pour que le titre et le nom des personnages soient changés. Son ami Franz Liszt composa plusieurs pièces symphoniques inspirées de ses poèmes : Ce qu'on entend sur la montagne, tiré des Feuilles d'automne, et Mazeppa, tiré des Orientales. Mélodies De nombreux compositeurs ont mis en musique des poèmes de Victor Hugo : Gounod Sérénade, Bizet Guitare ; Les Adieux de l'hôtesse arabe, Lalo Guitare, Delibes Églogue, Jules Massenet Soleils couchants, Franck S'il est un charmant gazon, Fauré Le Papillon et la Fleur ; L'Absent ; Puisqu'ici bas, Wagner L'Attente, Liszt Ô quand je dors ; Comment, disaient-ils, Saint-Saëns Soirée en mer ; La Fiancée du timbalier, Maude Valerie White Chantez, chantez, jeune inspirée, Reynaldo Hahn Si mes vers avaient des ailes ; Rêverie. Thierry Escaich : Guernesey, cycles de trois mélodies pour ténor et piano d'après Victor Hugo, et Djinns, dans Les Nuits hallucinées pour mezzo-soprano et orchestre Comédies musicales 1980 : Les Misérables, adaptation d'Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg pour Robert Hossein, est devenue l'une des plus populaires comédies musicales à partir de 1985 où elle a été montée à Londres en anglais et où elle est toujours à l'affiche : jouée dans 40 pays, traduite en 21 langues et vue par plus de 55 millions de spectateurs au total, elle a été jouée en anglais au théâtre du Châtelet à Paris dans une mise en scène de Trevor Nunn et John Caird, en 2010. 1999 Notre-Dame de Paris, adaptation Luc Plamondon et Richard Cocciante. Films d'animation Plusieurs succès, dont les plus célèbres : 1996 : Le Bossu de Notre-Dame The Hunchback of Notre Dame, par les studios Disney 1979 : Les Misérables, film d'animation japonais. Chansons Plusieurs chanteurs ont repris des poèmes de Victor Hugo. Citons : Georges Brassens : Gastibelza, La Légende de la Nonne Julos Beaucarne : Je ne songeais pas à Rose Colette Magny : Les Tuileries, Chanson en canot Malicorne : La fiancée du timbalier Pierre Bensusan : « Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne » Gérard Berliner : composition théâtrale Mon Alter Hugo221, qui donnera aussi lieu à l'album Gérard Berliner chante Victor Hugo Serge Reggiani : La Chanson de Maglia, sur une musique de Serge Gainsbourg en 1961.        
#24
Mikhaïl Afanassievitch Boulgakov 1
Loriane
Posté le : 14/05/2016 19:25
Le 15 mai 1891 naît Mikhaïl Afanassievitch Boulgakov
en russe : Михаил Афанасьевич Булгаков, il naît le 3 mai du calendrier julien, calendrier de Russie, écrivain et médecin russe puis soviétique, mort à 48 ans, le 10 mars 1940 à Moscou qui est devenue la capitale de l'URSS, république soviétique de Russie. Mikhaïl Boulgakov travaille d'abord comme médecin durant la Première Guerre mondiale, la Révolution russe et la guerre civile russe. À partir de 1920, il abandonne cette profession pour se consacrer au journalisme et à la littérature, où il est confronté, tout au long de sa carrière, aux difficultés de la censure soviétique. Il devient romancier, dramaturge, librettiste, scénariste, acteur, il écrit des ouvrages fantastiques, science-fiction, satire, ses Œuvres principales sont : La Garde blanche, Le Roman de monsieur de Molière, Le Maître et Marguerite, Cœur de chien, Morphine. Mort à seulement 48 ans, il a écrit pour le théâtre et l'opéra, mais il est surtout connu pour ses œuvres de fiction comme les romans La Garde blanche, paru en 1925, et Le Roman de monsieur de Molière, achevé en 1933 publié en URSS, de manière expurgée, en 1962 et de manière intégrale en 1989, ou la nouvelle Cœur de chien achevée en 1925, mais publié en URSS en 1987. Mais malgré tout son œuvre la plus connue est Le Maître et Marguerite, roman plusieurs fois réécrit et retravaillé entre 1928 et 1940, publié en URSS dans son intégralité pour la première fois en 1973, dans lequel il mêle habilement le fantastique et le réel, de telle sorte que le fantastique passe pour réel, et le réel pour fantastique, ainsi que les époques et les lieux, Jérusalem au ier siècle, sous Ponce Pilate, et Moscou, dans les années 1930, sous la dictature stalinienne. En bref Né à Kiev, Boulgakov y mène jusqu'en 1916 une vie non exempte de chagrins (la mort de son père en 1907) et de soucis, des amours contrariées, un premier mariage alors qu'il est encore étudiant, mais rétrospectivement idéalisée. Le cadre familial, provincial et cultivé, de cette vie lui convient, ainsi que le régime tsariste dont s'accommode fort bien l'intelligentsia enseignante et médicale, d'origine cléricale, à laquelle il appartient. Éduqué dans la religion orthodoxe par un père croyant et historien des religions, il se convertit pendant ses études de médecine au darwinisme et à la « religion » du progrès. Ni la Première Guerre mondiale, lorsqu'il est mobilisé en 1916 comme médecin hospitalier à l'arrière, ni, bien qu'il en soit très affecté, l'abdication du tsar et le coup d'État bolchevique de 1917, ne le dissuadent de s'installer comme vénérologue à Kiev en 1918. C'est la guerre civile qui finit par le chasser de sa ville ; jusqu'en 1920, il assiste, à Kiev, à dix-sept changements de pouvoir entre nationalistes ukrainiens, occupants étrangers, forces blanches et forces rouges, tous rivalisant d'exactions sanglantes. Ces trois années auront fait pour lui du monde antérieur un amas de ruines, et mis fin sans retour à l'existence qui avait été la sienne. Boulgakov atteint du typhus en émerge en mars 1920, dans un Vladicaucase désormais bolchevique où il était arrivé cinq mois plus tôt, mobilisé comme médecin par l'armée désormais battue de Denikine. Pour occulter son passé de « blanc », il dissimule sa qualité de médecin, et c'est alors que s'impose à lui la vocation de l'écriture. Il survit de sa plume à Vladicaucase en confectionnant des pièces de propagande qu'il détruira et désavouera ultérieurement. Fortement tenté d'émigrer, il décide finalement de gagner Moscou en 1921. Là, il affronte d'abord la misère commune, spécialement dure pour un plumitif isolé. En 1922, il réussit à se faire un nom dans le journalisme satirique florissant sous la N.E.P. (Nouvelle Politique économique). Il s'y révèle excellent, dans des centaines de croquis et de chroniques d'actualité plus hilarants que critiques, et politiquement très prudents. En parallèle avec ces travaux alimentaires, il compose ses premières œuvres « véritables » : des souvenirs artistiquement désorganisés sur ses débuts d'écrivain, Notes sur des manchettes (deux parties publiées en 1922 et 1923) ; une nouvelle (Morphine) et sept récits médicaux tirés de son expérience antérieure de jeune médecin ; trois grandes nouvelles qualifiées par lui de « fantastiques », Endiablade (1924), Les Œufs du destin (1925), Cœur de chien – et un roman, La Garde blanche, sur la guerre civile à Kiev telle que sa famille et lui l'avaient vécue. Les premiers de ces écrits furent publiés, mais la parution d'Endiablade alerta le camp des extrémistes, les « critiques de gauche », très influents dans la presse et au comité de censure ; Boulgakov fut catalogué par eux, à tort et pour la vie, garde blanc. Cœur de chien fut refusé par la censure en 1925, tandis que la seule première partie de La Garde blanche était publiée dans une revue moribonde en décembre 1924 les deux parties du roman furent éditées à Paris en 1927 et 1929. En 1926, les manuscrits et le Journal de l'écrivain furent confisqués à son domicile par l'Oguépéou. Toujours en 1926, au moment même où sa prose est décrétée impubliable, Boulgakov, sollicité par le Théâtre d'art de Moscou que dirige Stanislavski, accède à la notoriété comme dramaturge avec la pièce Les Jours des Tourbine – une adaptation de La Garde blanche plusieurs fois remaniée pour satisfaire la censure. Jusqu'en 1929, malgré l'hostilité des confrères jaloux et les injures de la critique de gauche appuyée par Maïakovski et Meyerhold, alors vedettes incontestées du théâtre révolutionnaire, les pièces de Boulgakov obtiennent un immense succès public : après Les Jours des Tourbine, il fait jouer deux comédies désopilantes, L'Appartement de Zoïka 1926, satire de la N.E.P., et L'Île pourpre 1928, satire du théâtre de propagande et de la censure. Mais, au début de 1929, Staline, dans une célèbre lettre ouverte, condamne nommément le théâtre de Boulgakov, lui portant un coup fatal. Sa Cabale de dévots, centrée sur les rapports de l'artiste avec le pouvoir, rebaptisée Molière, autorisée par la censure au prix de refontes et de répétitions interminables 1929-1936, est retirée de l'affiche après sept représentations à bureaux fermés en février et mars 1936 ; La Fuite 1927-1928, qui montre le naufrage, dans l'émigration, des derniers héros de la résistance « blanche » en Crimée, ne put accéder à la scène. Dans la rude décennie de 1930 s'instaure méthodiquement une dictature idéologique sans faille, bientôt renforcée par le culte stalinien de la personnalité. Le modèle « esthétique » du réalisme socialiste est imposé à tous les écrivains et artistes ; ceux qui ne s'y plient pas sont privés de gagne-pain, dénoncés publiquement, contraints à des autocritiques spectaculaires ; ils se suicident ou sont déportés, exécutés. Boulgakov, privé de tout revenu, demande en vain à maintes reprises l'autorisation de quitter l'U.R.S.S. Mais Staline lui accorde une semi-protection assez perverse : il lui téléphone une fois, en avril 1930, intervient pour que le Théâtre d'art lui procure un poste d'assistant-metteur en scène, et autorise en 1932 la reprise des Jours des Tourbine qu'il avait jadis appréciés, s'attachant l'écrivain par la vague promesse d'autres dialogues qui n'eurent jamais lieu, de séjours à l'étranger qui ne furent jamais autorisés. Dès lors, aucune œuvre originale de Boulgakov ne verra plus le jour, même celles qui lui furent encore commandées au début des années 1930 : les pièces anti-utopiques, Adam et Eva et Béatitude, la comédie désopilante Ivan Vassilievitch (où l'on voit Ivan le Terrible transporté dans un appartement communautaire) ; une pièce historique, Alexandre Pouchkine, où apparaissent maints personnages historiques dont Nicolas Ier, mais jamais Pouchkine lui-même ; et Batoum, une pièce sur l'activité révolutionnaire du jeune Staline, écrite avec l'aval de celui-ci ; malgré l'extrême prudence politique de son auteur, cette œuvre fut interdite le jour même où l'écrivain partait avec la troupe pour Batoum. Outre ses activités de dramaturge, de metteur en scène, ses travaux de traduction (de L'Avare de Molière, et de plusieurs comédies de celui-ci compilées sous le titre de L'Extravagant Monsieur Jourdain), ses adaptations scéniques (des Âmes mortes, de Don Quichotte), ses livrets d'opéra (il en composa quatre), Boulgakov, revigoré par la rencontre d'Elena Chilovskaïa qu'il épouse en 1931 en troisièmes noces, écrit trois nouveaux romans : une Vie de monsieur de Molière (à la demande de Gorki qui la décréta impubliable en 1933), et deux autres voués au tiroir, Mémoires d'un défunt (Roman théâtral) – roman commencé en 1937 et laissé inachevé, sur les démêlés tragi-comiques d'un dramaturge débutant avec un théâtre célèbre –, enfin Le Maître et Marguerite, commencé en 1928-1929, inlassablement poursuivi et remanié pendant plus de dix ans, couronnement de toute son œuvre, que sa densité de sens et son intrigue très élaborée n'empêchent pas d'être follement divertissant. En février 1940, alité, aveugle, Boulgakov dicte encore à sa femme des corrections à ce « roman du couchant », moins d'un mois avant de mourir, le 10 mars 1940, de néphrosclérose, une maladie qu'il avait depuis longtemps diagnostiquée et qui avait emporté son père au même âge. Sa vie Mikhaïl Boulgakov est le fils aîné d'Afanassi Ivanovitch Boulgakov, fils d'un prêtre d'Orel et lui-même maître de conférence d'histoire des religions occidentales à l'académie de Kiev, et de Varvara Mikhaïlovna, née Pokrovskaïa, fille d'un archiprêtre de Karatchev à l'époque dans le gouvernement d'Orel, actuellement dans l'oblast de Briansk, qui a été enseignante avant son mariage. La grand-mère maternelle de Boulgakov est née Tourbine. Naissent ensuite quatre sœurs : Vera en 1892, Nadejda en 1893, Varvara en 1895 et Elena en 1902, et deux frères : Nikolaï en 1898 et Ivan Vania en 19001. En 1901, Mikhaïl entre au lycée Alexandrovski de Kiev. La même année, les Boulgakov font bâtir une datcha à Boutcha, à 30 kilomètres de Kiev, où ils se réunissent l'été et organisent des spectacles d'amateurs familiaux et amicaux. La famille aime et pratique la musique. Mikhaïl apprend le piano. À Kiev, après six déménagements, les Boulgakov s'installent, en 1906, dans un appartement loué au 13, descente Saint-André qui sera le cadre du roman La Garde blanche. Au début de l'année 1907, Afanassi Boulgakov se voit conférer par l'académie ecclésiastique le titre de docteur, le grade de professeur et une retraite correspondant à trente ans de service alors qu'il n'en a accompli que vingt-deux. Mais souffrant de graves complications d'une hypertension artérielle et devenu aveugle, il meurt en mars 1907 des suites d'une insuffisance rénale causée par une néphroangiosclérose. À l'été 1908, Boulgakov fait la connaissance de celle qui sera sa première épouse, Tatiana Tassia Lappa, fille du directeur des douanes de Saratov. En juin 1909, il termine ses études secondaires, qui ont été très honorables malgré un penchant marqué pour les mystifications et les surnoms. Il s'inscrit à la rentrée à la faculté de médecine de l'université de Kiev, où il obtiendra son diplôme de médecin en 1916. À cette époque, ses opinions sont monarchistes et libérales. Le centre de sa vie est le cercle familial, élargi à de nombreux cousins et camarades. Il a déjà une passion pour le théâtre et l'opéra et fréquente assidûment l'opéra de Kiev et le théâtre Solovtsov. En 1913, Boulgakov épouse Tatiana Lappa. L'année suivante, en vacances chez sa belle-famille à Saratov quand éclate la guerre, il travaille durant tout l'été à l'hôpital de secours fondé dans la ville pour accueillir les blessés. En avril 1916, il est reçu avec mention aux examens terminaux, anticipés en raison de la guerre et s'enrôle immédiatement comme médecin volontaire dans la Croix-Rouge. Médecin dans la guerre En septembre 1916, il est convoqué à Moscou, où on lui signifie son affectation, en qualité de réserviste de la défense territoriale de 2e classe dans un hôpital civil de la province de Smolensk, au village de Nikolskoïé, à quarante verstes du chef-lieu de district de Sytchovska expérience qui lui inspirera les Carnets d'un jeune médecin. Accablé de travail et de responsabilités très lourdes pour un jeune médecin isolé, il s'acquitte avec conscience de sa tâche. Par ailleurs, il devient morphinomane, à la suite d'une allergie au sérum antidiphtérique dont il a été soulagé par des injections de morphine. Au printemps 1917, il bénéficie de deux congés, l'un qu'il passe à Saratov, où il apprend les premiers événements de la révolution de Février à Petrograd, l'autre à Kiev. À l'automne, il est muté à hôpital de Viazma, où il est moins pris par son travail et commence à écrire plusieurs récits, dont aucun n'a été conservé : Maladie première version de Morphine, inspiré de sa morphinomanie, Le Dragon vert, Carnets d'un jeune médecin titre qui deviendra celui d'un ensemble de récits achevés en 1925-1926, Première floraison. En décembre, alors que les bolcheviks, arrivés au pouvoir à l'occasion de la révolution d'Octobre, ont été chassés de Kiev Nikolaï Boulgakov a participé, comme junker, à la résistance de la ville et que la Rada, assemblée nationaliste ukrainienne, proclame la République populaire ukrainienne, Boulgakov est à Moscou, occupé par des démarches pour se faire libérer du service militaire, sans résultat. De retour à Viazma, il attend jusqu'au 22 février 1918 pour être libéré de ses obligations militaires et rentre à Kiev par Moscou. Installé avec sa femme, ses frères et ses sœurs au 13, descente Saint-André, il ouvre un cabinet médical de vénérologie. Sa mère, remariée avec le docteur Voskressenski, habite au 56 de la même rue. Au printemps 1918, avec l'aide de sa femme et de son beau-père, Boulgakov parvient enfin à se libérer complètement de sa morphinomanie. À Kiev, il est témoin de l'évolution de la situation, entre le gouvernement de l'hetman Pavlo Skoropadsky, créature de l'occupant allemand, les nationalistes ukrainiens, dirigés par Simon Petlioura, l'Armée des volontaires future Armée blanche, organisée en octobre 1918 par le général Anton Ivanovitch Dénikine pour arrêter l'avance des bolcheviks, et le corps expéditionnaire franco-britannique envoyé en novembre en mer Noire. Kiev, à l'époque, sert de centre de ralliement de tous les réfugiés du nord fuyant le gouvernement communiste. Ces événements, et plus particulièrement la prise de Kiev par les troupes de Simon Petlioura, constituent la toile de fond de La Garde blanche et des Jours des Tourbine. Mobilisé par le Directoire d'Ukraine, dont les Français se sont institués protecteurs, en s'entendant avec les généraux monarchistes Dénikine et Krasnov, Boulgakov assiste à des scènes sanglantes, notamment des crimes antisémites, et à l'évacuation de Kiev par Petlioura, menacé d'encerclement par les bolcheviks, le 5 février 1919, événements dont on trouve la trace dans La Garde blanche, Les Aventures extraordinaires du docteur N. et La Nuit du 2 au 38. Il parvient à s'échapper de l'armée en déroute de Petlioura au bout de de deux jours, dans la nuit du 2 au 3 février 1919. Le 1er septembre, sous la double pression des nationalistes, qui organisent soulèvements et pogroms dans les campagnes ukrainiennes, et d'un corps de l'Armée des Volontaires, les bolcheviks évacuent Kiev, et Ivan et Nikolaï Boulgakov s'engagent dans l'armée de Dénikine. Boulgakov est hanté par les dangers que ses frères courent dans le Sud, hantise qui lui inspirera La Couronne rouge. Lui-même est réquisitionné par l'Armée blanche en tant que médecin, fin septembre ou début octobre, et rejoint Vladikavkaz. Le 13 novembre 1919, il publie dans Grozny, journal soutenant Dénikine, un article violemment antibolchvique, très pessimiste, intitulé Perspectives d'avenir, qu'il signe M. B.. Les débuts littéraires Mikhaïl Boulgakov en 1926. Le monocle et le nœud papillon le distinguent ostensiblement des écrivains prolétariens volontiers débraillés de la Russie soviétique11. En 1920, installé à Vladikavkaz, Boulgakov décide d'abandonner la médecine pour se consacrer à l'écriture. Il publie plusieurs récits Au café le 5 janvier, un récit sous-titré Tribut d'admiration le 6 ou le 7 février et collabore à un éphémère journal blanc. Atteint du typhus lors de l'installation des bolcheviks, il ne peut s'enfuir et demeure donc à Vladikavkaz. Fin mars, il se fait engager à la sous-section des Arts de la ville, dirigée par Iouri Sliozkine, un romancier à succès avant la Révolution, qui s'associe Boulgakov comme directeur du Lito département Littérature de cet organisme. Le 1er mai, un Théâtre soviétique est inauguré ; Boulgakov y présente des spectacles, organise des soirées culturelles, anime des débats, assure la critique littéraire et théâtrale dans la presse locale. Fin mai, il prend la direction du Téo département Théâtre et organise aussitôt un studio d'art dramatique. Le 3 juin est jouée sa première pièce, Autodéfense dont nous n'avons aucune trace, une humoresque en un acte. Durant l'été, il écrit un drame en quatre actes, Les frères Tourbine, sous-titrée L'heure a sonné, qui remporte un grand succès à partir du 21 octobre, mais dont il n'est pas content, ayant dû bâcler pour des raisons alimentaires un sujet qui lui tenait à cœur. De même, une pièce en trois actes, Les Communards de Paris, écrite en dix jours, est créée à Vladikavkaz entre janvier et mars 1921. À la même époque a lieu une polémique avec le quotidien local Kommounist Le Communiste, dont il n'a pas supporté que le directeur attaque Pouchkine lors d'un débat, et il est traité de bourgeois. Le 25 novembre, qualifié de blanc, Boulgakov est expulsé de la sous-section des Arts. Ne pouvant faire publier les récits qu'il écrit ni jouer sa comédie bouffe, Les Prétendants d'argile, il quitte Vladikavkaz en mai 1921 et pérégrine entre Bakou, Tiflis et Batoum, hésitant un moment à s'embarquer vers Constantinople, avant de partir sur les conseils du poète Ossip Mandelstam pour Moscou, à la fin de septembre 1921. Nullement fasciné par la Révolution d'Octobre, à la différence de nombre d'intellectuels, Boulgakov comprend néanmoins que le régime est durablement en place. À partir de son installation à Moscou, et jusqu'en 1925, il multiplie les travaux alimentaires et les petits emplois, tout en écrivant ou réécrivant ses premières nouvelles et un roman sur la guerre civile. Son ambition est de prendre place parmi les plus grands écrivains de la littérature russe. Engagé le 1er octobre au Lito de Moscou, il s'installe avec sa femme au 10, rue Bolchaïa-Sadovaïa et écrit plusieurs articles, qu'il a le plus grand mal à placer, à cause notamment de la censure. Après la dissolution du Lito, le 1er décembre 1921, il obtient un emploi modeste au Torgovo-promychlenny Vestnik, Le Courrier du Commerce et de l'Industrie, journal indépendant qui vient de se fonder dans le cadre de la NEP. Ce n'est qu'en 1922 qu'il entre dans le monde littéraire. Après la disparition du Vestnik, en janvier au bout de six numéros, il trouve un emploi dans les services éditoriaux d'un comité scientifique et technique dépendant de l'armée de l'air début février, puis est engagé comme journaliste dans un organe officiel du parti communiste, Rabotchi L'Ouvrier, dirigé par Nadejda Kroupskaïa, la femme de Lénine. De même, en avril, il entre en relation avec Nakanounié À la veille, organe de l'émigration russe de la tendance Changement de jalons, installé à Berlin, dont le supplément littéraire hebdomadaire est dirigé par Alexeï Tolstoï, et se fait embaucher comme rédacteur-réviseur au Goudok, Le Sifflet. En mai 1922 paraît Aventures extraordinaires du docteur N. dans le deuxième numéro du mensuel Roupor Le Porte-voix. De même, Nakanounié publie la première partie de Notes sur des manchettes le 18 juin, La Ville de pierres rouges le 30 juillet, les Aventures de Tchitchikov le 24 septembre histoire fantastique qui renvoie au roman Les Âmes mortes de Gogol, La Couronne rouge le 22 octobre, La Nuit du 2 au 3 le 10 décembre, le premier chapitre de La Capitale en bloc-notes le 21 décembre et La coupe de la vie le 31 décembre. De même, dans le numéro 2 de décembre de Krasny journal dlia vsekh, La Revue Rouge pour tous paraît Le 13, Immeuble Elpit - Commune ouvrière. Par ailleurs, dans son numéro 4 de décembre, la revue Rossia Russie fait figurer Boulgakov dans la liste de ses collaborateurs et, par lettre datée du 29 décembre, la rédaction de Nakanounié l'invite à collaborer régulièrement au journal. Entre journalisme et littérature Durant les années qui suivent, Boulgakov consacre une bonne part de son travail à publier dans la presse des articles de variété et des récits. Au Goudok, il devient ainsi, en février 1923, l'auteur attitré des récits humoristiques. Il y noue d'ailleurs des relations avec d'autres écrivains provinciaux débutants. Fin juillet, l'almanach Vozrojdenié Renaissance publie une seconde version de la première partie de Notes sur des manchettes, mais ne peut obtenir que le récit soit publié en volume, à cause du veto de la censure. En septembre, il noue des relations amicales avec Alexeï Tolstoï, rentré depuis un mois à Moscou, où il œuvre avec d'autres à consolider le mouvement Changement de jalons en Union soviétique. Durant l'automne et l'hiver, Boulgakov s'épuise dans des travaux qu'il juge alimentaires, l'assiduité obligatoire dans les bureaux du Goudok lui pèse, et les personnalités rassemblées autour de Nakanounié commencent à lui inspirer une méfiance inquiète20. En janvier 1924, lors d'une réception où l'on fête le retour définitif en Russie des auteurs de la tendance Changement de jalons, Boulgakov noue une idylle avec Lioubov Evguenievna Bielozerskaïa, revenue de Berlin avec son compagnon Vassilevski-Niéboukva, journaliste collaborateur de Nakanounié. Au début de cette année, il parvient à caser des textes dans d'autres périodiques que Goudok et Nakanounié. Fin février ou début mars, la nouvelle Endiablade paraît dans le numéro 4 de Niedra, que son directeur-fondateur, Nikolaï Angarski, rencontré vers la mi-octobre 1923, avait accepté sans hésiter. Elle est remarquée par Zamiatine qui en fait une critique nettement favorable. De même, la nouvelle Le Brasier du khan est publiée en février dans le numéro 2 de Krasny journal. L'Île pourpre paraît le 20 avril dans Nakanounié. En août 1924, Boulgakov et Tatiana Lappa, officiellement divorcés en avril, changent de logement dans le même immeuble ; ils occupent désormais une pièce dans l'appartement 34. En septembre, Boulgakov trouve un premier logement où cohabiter avec L. E. Bielozerskaïa, avec laquelle il s'installe, début novembre, au 9, traverse Tchisty ex-Oboukhov. Ils se marient le 30 avril 1925. En décembre est enfin publié, après bien des difficultés, car jugé trop favorable à la cause des blancs, dans le numéro 4 de Rossia le premier tiers chapitres I à VII de La Garde blanche, roman sur la guerre civile. Suit la deuxième partie chapitres VIII à XIII dans le numéro 5, fin avril 1925. La troisième partie chapitres XIV à XIX doit être éditée dans le numéro 6. Mais la revue cesse de paraître, fin octobre 1925, alors que la troisième partie n'a toujours pas été payée à Boulgakov et que l'éditeur ne lui a pas renvoyé le manuscrit. Celui-ci ne lui sera restitué qu'en mai 1926. Durant l'année 1925, Boulgakov publie dans Krasnaïa Niva Glèbble. un nouveau récit autobiographique, La bohème, le 4 janvier et rédige la nouvelle Cœur de chien qu'il ne parviendra jamais à publier. Fin juillet, un recueil de nouvelles intitulé Endiablade paraît à Moscou, mais le volume est confisqué par le Glavlit russie et retiré des librairies durant l'été. Théâtre et censure La même année, il commence une adaptation de son roman La Garde blanche pour le Théâtre d'art de Stanislavski, avec lequel il a de difficiles négociations en octobre. Le 26 mars 1926, il fait lire les deux premiers actes modifiés de La Garde blanche à Constantin Stanislavski, qui les accueille favorablement. En revanche, par une lettre du 19 mai, il fait savoir au Théâtre d'art qu'il refuse catégoriquement les importantes coupures que celui-ci veut apporter à son texte. Finalement présentée à la presse le 24 juin, la pièce déchaîne la hargne des critiques de gauche Vladimir Blum et Orlinski, proches de l'Association des écrivains prolétariens RAPP, contre Boulgakov ; ils font ajourner la pièce et accablent l'auteur d'accusations haineuses dans de nombreux articles et débats publics. Les répétitions de La Garde blanche, rebaptisée Les Jours des Tourbine le 10 septembre, reprennent finalement, après de nombreux remaniements, entre fin août et septembre. La générale a lieu le 2 octobre, suivie par un débat où Anatoli Lounatcharski, commissaire du Peuple à l'Éducation et à la Culture Narkompros, et Vladimir Maïakovski, bien que très critiques sur le plan idéologique pour l'un, sur le Théâtre d'art pour l'autre, se prononcent en faveur de l'autorisation, tandis qu'Orlinski juge la pièce politiquement inadmissible. Les représentations commencent le 5 octobre, avec un grand succès public. À l'hostilité des critiques de gauche, toutefois, s'ajoute celle des dramaturges et metteurs en scène d'avant-garde Vsevolod Meyerhold, Vladimir Maïakovski, Alexandre Taïrov ou jaloux Vladimir Bill-Bielotserkovski. Même si la polémique s'éteint bientôt, la pièce est retirée du répertoire le 15 septembre 1927, et il faut une intervention de Stanislavski et de Lounatcharski pour que le Politburo lève le 10 octobre cette mesure. De même, à partir de septembre 1925, il travaille sur L'Appartement de Zoïka pour le théâtre Vakhtangov, dont il donne lecture le 11 janvier 1926 elle est accueillie avec enthousiasme. Après une première répétition générale, le 24 avril, il lui est demandé de remanier la pièce. Invité à Krioukovo en juillet, il refond la comédie en trois actes. Autorisées le 21 octobre, les représentations commencent le 28, dans une version encore amendée à la demande du théâtre et de la censure. Par ailleurs, le 10 novembre, le Narkompros interdit de donner la pièce en province, interdiction qui sera finalement levée sept jours après. Bien que très critiquée par la presse, elle est jouée avec succès à Moscou, Leningrad et d'autres villes. En outre, à partir de janvier 1926, il travaille à une adaptation de sa nouvelle L'île pourpre pour le Théâtre de chambre de Moscou, qui évolue, vers la fin de l'année, après la polémique qui a entouré Les Jours des Tourbine en une comédie-pamphlet où il tourne en dérision ses détracteurs. Le manuscrit est remis le 4 mars 1927. Autorisée par le Glavrepertkom le 26 septembre 1928, sous la condition de quelques coupures, la première a lieu le 11 décembre. Aussitôt, une campagne de presse est montée pour obtenir son interdiction. L'Île pourpre sera tout de même jouée jusqu'en juin 1929. Parallèlement, il publie Tourmente de neige, récit sous-titré Carnets d'un jeune médecin les 18 et 25 janvier 1926, Ténèbres sur le pays d'Égypte, présenté comme un extrait du livre en préparation Carnets d'un jeune médecin les 20 et 27 juillet, L'éruption étoilée les 12 et 19 août, La Serviette au coq les 12 et 18 septembre, L'Œil votalisé, sous-titré Carnets d'un jeune médecin les 2 et 12 octobre, le récit J'ai tué les 8 et 12 décembre, tous dans la revue Meditsinski rabotnik Le Travailleur médical, et une nouvelle édition du recueil Endiablade, avec l'autorisation du Glavlit, fin avril, chez Niedra. En août 1926, il peut enfin quitter le Goudok. Toutefois, le 7 mai 1926, l'appartement des Boulgakov est perquisitionné par l'Oguépéou, dont les agents emportent le manuscrit de Cœur de chien en deux exemplaires et trois cahiers d'un journal intime de Boulgakov couvrant les années 1923 et 1924, qui ne seront restitués à leur propriétaire qu'en octobre 1929. À partir de cette date, Boulgakov ne tiendra plus de journal. De même, le 22 septembre, il est interrogé par l'Oguépéou sur les raisons pour lesquelles il ne s'intéresse pas, comme écrivain, aux paysans et aux ouvriers, et sur sa vision négative de la vie soviétique. Elle l'interroge à nouveau le 18 novembre, pour des raisons inconnues. Au début de 1927 paraît à Rīga une édition pirate de La Garde blanche avec une troisième fausse partie réécrite d'après le canevas des Jours des Tourbine. Pendant ce temps, les différents projets d'édition en URSS échouent les uns après les autres. En décembre 1927, une édition en volume, autorisée par l'auteur, correspondant chapitres parus dans les numéros 4 et 5 de Rossia, paraît aux éditions Concorde ; elle a pour titre Les Jours des Tourbine La Garde blanche. Le tome II chapitres XII à XX paraîtra en 1929 dans une édition déclarée par l'auteur définitive alors que Boulgakov avait pensé à l'origine à une trilogie, avec un dénouement largement modifié par rapport à la version de 1925 les épreuves de Rossia. La même année paraît dans Meditsinski rabotnik le récit Morphine les 9, 17 et 23 décembre. C'est la dernière publication intégrale d'une œuvre de Boulgakov. Fin 1926, Boulgakov se lance dans l'écriture d'une nouvelle pièce sur la guerre civile russe, intitulée d'abord Le Chevalier de Serafima Les parias et qui deviendra La Fuite. Une première lecture a lieu le 2 janvier 1928 au Théâtre d'art, en présence de Stanislavski. Mais la pièce est interdite à Moscou, le 9 mai. En août, un théâtre d'Odessa se propose tout de même de faire jouer la pièce, mais le Glavrepertkom fait annoncer par la Pravda son interdiction le 24 octobre. Le 31 janvier 1929, après que le dramaturge Bill-Bielotserkovski a demandé par lettre à Staline de se prononcer sur La Fuite, le Politburo entérine son interdiction, et, dans sa réponse à Bill-Bielotserkovski, signée le 2 février et aussitôt diffusée dans les milieux théâtraux, Staline critique durement La Fuite, Les Jours des Tourbine qu'il a pourtant déjà vue plusieurs fois et L'Île pourpre. Le 6 mars, le Glavrepertkom fait paraître dans Vetcherniaïa Moskva Moscou-Soir l'interdiction de tout le théâtre de Boulgakov. Le 17 mars a lieu la 198e et dernière représentation de L'Appartement de Zoïka déjà interdite en novembre 1927 et avril 1928 au théâtre Vakhtangov. En avril, Les Jours des Tourbine sont retirés du répertoire du Théâtre d'art. Enfin, début juin est jouée la dernière de L'Île pourpre au Théâtre de chambre. Pour conclure, le 7 décembre 1929, l'Union des dramaturges notifie officiellement l'interdiction des quatre premières pièces de Boulgakov. Interdit de vivre de son métier d'écrivain, Boulgakov adresse à Staline, au début de juillet 1929, une requête dans laquelle il demande l'autorisation de quitter, avec son épouse, l'URSS31. Dans une lettre à son frère Nikolaï (qui a émigré à la fin de la guerre civile datée du 24 août, il parle de son anéantissement en tant qu'écrivain. Le 3 septembre, faute de réponse, il écrit à Enoukidzé et à Gorki pour les prier de la soutenir. À la même époque, Zamiatine entreprend des démarches, par l'entremise de Gorki, pour obtenir l'autorisation d'émigrer. Cependant, le 28 février 1929, Boulgakov fait la rencontre d'Elena Sergueïevna Chilovskaïa, épouse d'un officier supérieur de l'état-major général et mère de deux enfants ; ils s'éprennent immédiatement l'un de l'autre. Elle sera sa troisième épouse et le modèle de Marguerite dans Le Maître et Marguerite. Le même jour, le GPU enregistre une information selon laquelle Boulgakov aurait entrepris un nouveau roman. Il s'agit d'un roman sur le diable, qui a été conçu en 1928, et dont Boulgakov a commencé la rédaction au début de l'année. Pendant l'été, Elena Sergueïevna part en cure à Iessentouki, et elle échange avec Boulgakov des lettres d'amour. De même, il écrit un récit inachevé, daté de septembre 1929 et dédié à Elena Sergueïevna, intitulé À ma secrète amie. D'autres ouvrages sont rédigés, durant cette année cruciale : les premiers chapitres ultérieurement détruits d'un roman intitulé Le Théâtre et une première version de la pièce d'anticipation Béatitude. En octobre 1929, Boulgakov commence une pièce sur Molière, La Cabale des dévots pour le Théâtre d'art, en remplacement de La Fuite. La première rédaction est achevée le 6 décembre. Présentée au début de 1930, elle est à son tour interdite, en mars, par le Glavrepertkom. Le jour de l'enterrement de Vladimir Maïakovski, le 17 avril 1939. Devant cette décision, le 28 mars 1930, Boulgakov envoie au gouvernement de l'URSS une longue lettre où il déclare, entre autres choses, avoir jeté au feu trois œuvres qu'il avait en chantier, le brouillon d'un roman sur le diable, celui d'une comédie et le début d'un deuxième roman, Le Théâtre, et demande soit qu'on lui fournisse un emploi en rapport avec le théâtre, soit d'agir avec lui comme il l'entendra, mais d'agir d'une manière ou d'une autre. En réponse, il obtient, le 3 avril, un emploi de consultant au TRAM Théâtre de la jeunesse ouvrière et, le 18 avril, lendemain du suicide de Vladimir Maïakovski, Staline l'appelle téléphoniquement. Pris de court, Boulgakov choisit non l'émigration, mais un emploi au Théâtre d'art. Un billet de Boulgakov à Staline, daté du 5 mai, restera, lui, sans réponse38. Le 10 mai, il est engagé au Théâtre d'art comme assistant-metteur en scène. Par la suite, il écrira plusieurs lettres directement à Staline, pour lui ou pour des amis car l'on s'imagine qu'il a l'oreille du dictateur, sans réponse. Au fil de ces lettres, l'écrivain perd de plus en plus de vue la personnalité de celui à qui il écrit. Dans ce contact, il retrouve les relations entre Molière et Louis XIV ou entre Pouchkine et Nicolas Ier, qu'il décrira dans ses dernières pièces, c'est-à-dire les relations entre l'artiste et le pouvoir qui peut protéger le premier de ses ennemis ou bien l'accabler de sa puissance. L'écrivain et le pouvoir Dès son entrée au Théâtre d'art, où seule la peur des réactions du pouvoir avait empêché d'agréer la demande d'emploi de Boulgakov, l'écrivain se lance dans une adaptation scénique du roman de son maître Nicolas Gogol, Les Âmes mortes. Après le rejet d'une première version, le 7 juillet 1930, il rédige une seconde version, lue le 31 octobre, elle-même refondue en novembre pour tenir compte des objections du Théâtre. Les répétitions commencent le 2 décembre, mais le Théâtre d'art, toujours insatisfait du texte, lui demande de modifier profondément sa structure. La première a lieu le 28 novembre 1932. Dans le même temps, il rédige une pièce pour le Théâtre rouge de Léningrad et le théâtre Vakhtangov de Moscou, Adam et Ève, qu'il achève le 22 août 1931. À Moscou, la pièce est refusée, à la demande du général Alknis, chef d'état-major de l'Armée de l'air sous prétexte qu'on y voit représentée la destruction de Léningrad. Pour le théâtre rouge, il ne parvient pas à obtenir l'aval de la censure locale, et la pièce n'est finalement pas jouée. Cependant, au printemps 1931, Boulgakov reprend par à-coups son travail sur son « roman sur le diable. De même, après introduction des modifications demandées, et sur l'intervention de Gorki, le Glavrepertkom autorise finalement, le 6 octobre 1931, la pièce Molière (nouveau nom de La Cabale des dévots, qui doit être jouée par le Grand Théâtre dramatique de Leningrad. Celui-ci dénonçant le contrat deux semaines avant la date prévue par la première, le 14 mars, la pièce est confiée au Théâtre d'art, qui le met en répétitions le 31 mars, et ce, jusqu'à leur interruption, le 25 novembre 1932. Par ailleurs, en septembre 1931, il se lance dans l'adaptation scénique de Guerre et Paix de Léon Tolstoï pour le Grand Théâtre dramatique de Léningrad. Achevée le 25 février 1932, cette adaptation ne sera jamais jouée. Sur le plan sentimental, le grand amour entre Boulgakov et Elena Sergueïevna connaît des moments difficiles à l'automne et l'hiver 1930, celle-ci ne pouvant se résoudre à briser sa famille. Fin décembre-début janvier 1931, ils passent quelques jours ensemble dans une maison de repos proche de Moscou. Le 25 février, menacée par son mari d'être séparée de ses enfants, elle se décide finalement à rompre leur liaison. Brusquement, le 15 janvier 1932, Boulgakov est informé par le Théâtre d'art de Moscou de la reprise prochaine des Jours des Tourbine, sur décision personnelle de Staline. Le 24 décembre 1931, après avoir assisté à une représentation privée de la pièce d'Alexandre Afinoguenov, La Peur, qui lui avait déplu, il avait dit aux responsables du théâtre : Vous avez une bonne pièce, Les Jours des Tourbine ; pourquoi ne la joue-t-on pas ?. Reprise le 18 février, la pièce sera inscrite en permanence au Théâtre d'art et jouée en tournée dans plusieurs villes de province. En juillet 1932, Boulgakov signe avec les éditions Jourgaz un contrat pour une Vie de Molière qui doit paraître au début de 1933 dans la collection Vies d'hommes remarquables fondée par Maxime Gorki et avec le studio-théâtre Zavadski un contrat pour une traduction du Bourgeois gentilhomme de Molière ; au lieu d'une traduction, Boulgakov écrira L'Extravagant M. Jourdain, libre adaptation de plusieurs pièces de Molière. Terminée le 18 novembre et aussitôt envoyée au théâtre Zavadski, elle ne sera jamais jouée. Pour la Vie de Molière, il l'achève et la remet à l'éditeur le 5 mars 1933. Toutefois, l'éditeur lui demande une refonte complète de l'ouvrage, qu'il refuse catégoriquement, le 12 avril. L'ouvrage ne sera pas édité de son vivant. Aux alentours du 1er septembre 1932, Boulgakov et Elena Sergueïevna renouent et décident de ne plus se quitter ; après un échange de lettres et une entrevue orageuse avec Chilovski, armé d'un pistolet, celui-ci accepte de divorcer : il gardera son fils aîné Evgueni, tandis que le cadet, Sergueï, alors âgé de 5 ans, vivra avec sa mère. Le divorce de Boulgakov et de Lioubov Evguenievna Bielozerskaïa est prononcé le 3 octobre, et, le lendemain, il fait enregistrer son mariage avec Elena Sergueïevna. Du 15 au 28 octobre, ils séjournent ensemble à Leningrad, où Boulgakov a des entretiens avec plusieurs théâtres susceptibles de donner Les Âmes mortes et La Fuite, et Boulgakov reprend le début son roman sur le diable rédaction qu'il poursuivra par à-coups jusqu'en octobre 1934. Fin octobre, Elena Sergueïevna et son fils Sergueï s'installent chez Boulgakov, rue Bolchaïa Pirogovskaïa. En mars 1933, La Fuite est mise en répétitions au Théâtre d'art, avec l'introduction en juin des changements demandés par le Glavrepertkom, mais le Théâtre d'art décide, le 29 novembre de l'exclure du programme des répétitions. À partir de mai 1933, Boulgakov travaille à Béatitude pour le music-hall de Leningrad. La première rédaction est achevée le 28 mars 1934, la seconde le 11 avril, la troisième déposée au théâtre le 23 avril. Le projet sera définitivement abandonné au début de juillet 1934. Le 9 décembre, il reçoit son premier et seul rôle de comédien au Théâtre d'art, celui du juge dans la comédie adaptée du roman de Dickens Les Papiers posthumes du Pickwick Club qu'il jouera jusqu'à fin de l'année 1935. Entre mars et août 1934, il s'attache à adapter Les Âmes mortes en scénario pour les studios Soïouzfilm, qui l'accepte le 12 août, avant de l'envoyer pour corrections le 15 septembre, puis de le rejeter le 27 novembre. Le 18 février 1934, Boulgakov emménage dans un nouveau logement de trois pièces au 3, rue traversière Nachtchokinski, dans un immeuble coopératif d'écrivains. Dans le courant de mars, en visite au Théâtre d'art, Staline s'enquiert de Boulgakov et déclare que Les Jours des Tourbine est le meilleur spectacle du répertoire. À partir de décembre 1934, Boulgakov se consacre aussi à la rédaction d'Alexandre Pouchkine, une pièce sur les derniers jours du grand écrivain russe qu'il coécrit d'abord avec son aîné et ami Vikenti Veressaïev, grand spécialiste de Pouchkine. Toutefois, en désaccord sur l'ouvrage, l'un réagissant en historien, l'autre en écrivain, Veressaïev se retire du projet, et Boulgakov termine seul l'ouvrage, en septembre 1935. Présentée devant le comité directeur du Bolchoï le 6 janvier 1936, proposée à différents théâtres, la pièce est d'abord victime de la censure, avant que le Glavrepertkom ne l'autorise définitivement, le 26 juin 1939. La première aura lieu le 10 avril 1943. Toutefois, Prokofiev, en octobre 1935, puis Chostakovitch, en janvier 1936, lui proposent de composer un opéra d'après la pièce, projet qui ne se réalisera pas. De même, fin novembre 1934, il commence Ivan Vassilievitch, une pièce d'anticipation autour du personnage d'Ivan le Terrible, achevée le 30 septembre 1935. Remise au Théâtre de la satire le 7 octobre, la comédie subit les 11 et 13 mai 1936 des représentations générales intentionnellement bâclées et est retirée de l'affiche. Dans le même temps, il rédige une traduction de L'Avare de Molière pour les éditions Academia de Léningrad, réalisée entre novembre 1935 et janvier 1936. Durant le printemps et l'été 1936 il écrit pour le Théâtre d'art une adaptation des Joyeuses commères de Windsor de Shakespeare. Mais, devant les instructions données par la direction sur cette pièce et son Molière, il abandonne la rédaction, puis donne sa démission du théâtre le 15 septembre 1936. Le 1er octobre, il est engagé comme librettiste-consultant au Bolchoï, pour lequel il va réaliser à l'été 1936 le livret de l'opéra Minine et Pojarski, sur une musique de Boris Assafiev ; le livret de La Mer Noire, opéra sur la bataille de Perekop 1920, entre octobre 1936 et mars 1937 ; le livret de l'opéra Pierre le Grand entre juin et septembre 1937 ; et une adaptation de la nouvelle de Maupassant Mademoiselle Fifi intitulée Rachel entre septembre 1938 et mars 1939. Par ailleurs, une adaptation scénique de Don Quichotte est écrite pour le théâtre Vakhtangov entre décembre 1937 et septembre 1938. Le 6 juillet 1936, Boulgakov ouvre un nouveau cahier d'adjonctions à son roman, appelé à devenir Le Maître et Marguerite. Entre novembre 1936 et septembre-octobre 1937, il travaille à un autre roman, Mémoires d'un défunt Roman théâtral, bilan sur son expérience théâtrale, souvent cocasse, qu'il laissera inachevé. L'hiver et le printemps 1938 sont essentiellement consacrés au Maître et Marguerite dont le titre apparaît pour la première fois le 23 octobre dans le journal d'Elena Sergueïevna. La dernière rédaction manuscrite est achevée dans la nuit du 22 au 23 mai 1938, avant d'être dactylographiée sous la dictée de l'auteur. Après quoi il se lance dans une nouvelle rédaction du roman. Le 2 mai, il en fait lire les trois premiers chapitres à l'éditeur Angarski, qui le déclare impubliable. Il n'en poursuit pas moins la révision jusqu'en avril 1939. Entre le 27 avril et le 15 mai, il lit en plusieurs séances l'intégralité du Maître et Marguerite devant un cercle d'amis. Pour cela, il travaille au début de mai, jusqu'au 14, sur l'épilogue. Durant l'année 1939, après une longue visite de Markov et de Vilenkine, délégués par le Théâtre d'art, dans la nuit du 9 au 10 septembre 1938, il travaille à une pièce sur Staline, Batoum, qui sera remise le 25 juillet. Le 14 août 1939, une délégation du Théâtre d'art incluant Boulgakov et sa femme part en repérage en Géorgie, mais, le 17, ils sont informés du veto imposé à la pièce par Staline et rentrent à Moscou. À la fin de 1939, l'état de santé de Boulgakov, depuis longtemps des plus médiocres, s'aggrave. Le 11 septembre, il connaît une baisse inquiétante de la vue. Les spécialistes consultés confirment bientôt le diagnostic de néphro-angiosclérose, la maladie qui avait emporté son père. Le 10 octobre, Boulgakov signe devant notaire un testament en faveur de sa femme, puis, le 14, une lettre lui confiant la gestion de son patrimoine littéraire. Lors d'un séjour dans une maison de repos à Barvikha, près de Moscou, il connaît une amélioration passagère et recouvre la vue, de même que le 13 janvier 1940. Le 25 janvier, il fait sa dernière sortie. Le 13 février, il dicte encore à sa femme quelques corrections pour Le Maître et Marguerite qu'il retravaille depuis le 4 octobre 1939. Pendant sa maladie, et jusqu'au début de mars, il reçoit la visite d'Anna Akhmatova et de Nikolaï Liamine clandestinement, car ils sont interdits de séjour à Moscou. Le 10 mars, à 16 h 39, il meurt à l'issue de plusieurs heures de souffrance. Deux jours plus tard, son corps est incinéré et ses cendres placées dans une urne au cimetière de Novodevitchi. L'unité de l'œuvre On est frappé par la diversité des formes, des genres, des intrigues, entre les œuvres de Boulgakov et aussi à l'intérieur de chacune d'elles ; toutes les formes de comique, du burlesque à l'humour de l'autodérision, y côtoient un pathétique intense et pudique ; plusieurs niveaux de lecture sont dissimulés dans les intrigues les plus extravagantes, et signalés au lecteur par des allusions en forme de clins d'œil. Mais l'unité de l'œuvre est évidente. Elle est faite d'un matériau unique, la réalité russe-soviétique des années 1918-1940 (même dans les œuvres dites historiques) et revient toujours, par des moyens renouvelés et imprévisibles, à cette question centrale : comment survit-on en Russie soviétique, dans un monde où a éclaté et continue de sévir une de ces catastrophes qui, périodiquement, font table rase des acquis de l'humanité ? Chez Boulgakov, tout est présenté de façon subjective. Aucune des œuvres n'est autobiographique stricto sensu, mais toutes s'inscrivent dans un « espace autobiographique » : les lieux où l'auteur a vécu (Kiev et le sud de la Russie dans les années de guerre, Moscou dans les années 1920 et 1930) ; et, plus largement, l'univers culturel de Boulgakov, modelé par son milieu d'origine, marqué par ses goûts personnels élargis au fil de ses expériences et de ses lectures. Partout, un protagoniste ou un narrateur évoque de quelque façon l'auteur lui-même : écrivain malchanceux et génial, ou bien inventeur prodigieux, dépassé par son œuvre, trahi par le pouvoir avec lequel il s'est compromis. Une écriture libre À partir du moment où l'existence eut perdu pour Boulgakov son sens et une grande part de son attrait, l'écriture devint sa vraie vie qui débuta, à l'en croire, le 15 février 1920 – date d'une victoire décisive remportée par l'Armée rouge dans le Caucase. Elle fut d'abord pour lui un substitut de la morphine à laquelle il s'était accoutumé en 1917-1918 ; l'écriture de La Garde blanche, puis des Jours des Tourbine le soulagea d'expériences intolérables jusque dans leur souvenir. D'autres tourments sont projetés dans l'écrit avec le même résultat bénéfique : la misère, la promiscuité du logement communautaire, les attaques visant l'écrivain, l'interdiction de voyager ou d'émigrer, la simple peur de disparaître, dans un Goulag ou ailleurs comme tant d'autres. En outre, la distance prise par l'écriture fait du monde soviétique mal supporté un objet de représentation délectable que Boulgakov « monte en spectacles » irrésistibles de drôlerie – dans ses pièces comme dans ses proses –, oscillant naturellement entre le réalisme et l'imaginaire, le fantastique, diabolique ou anti-utopique. Instrument d'un transfert libérateur, l'écriture lui offre aussi une vie libre et authentique partagée avec la fratrie supratemporelle des créateurs de l'art, écrivains et musiciens surtout, dont « les manuscrits ne brûlent pas ». Boulgakov les introduit dans son propre texte au moyen de citations ouvertes ou cachées, par des imitations, des parodies ludiques. En revanche, il traite férocement et va jusqu'à diaboliser, dans Le Maître et Marguerite, les apparatchiks de la culture soudoyés par l’État pour produire une pseudo-littérature du mensonge, ceux-là même qui l'ont malmené et finalement éliminé de son vivant. À l'encontre de ceux-ci, Boulgakov ne prétend par pour autant faire prévaloir quelque autre vérité. Au contraire, il présente de manière ambiguë, contradictoire, toutes les doctrines et valeurs à prétention universelle : le progrès, la religion établie, le rationalisme intégral, les certitudes acquises sur le bien et le mal. Tous les choix opérés par Boulgagov, à commencer par l'individualisme subjectif de son écriture, visent à démanteler la pensée unique, et spécialement le programme esthétique du réalisme socialiste. La dimension métaphysique Ainsi l'écriture, éprouvée comme un bien immense, s'oppose au mal que représentent, pour l'écrivain, la frustration des libertés vitales et les tracas insupportables de la vie soviétique. Dépassant le constat initial de « catastrophe », il aboutit à une première vision, cyclique, de l'histoire humaine, apparentée à celle de Tolstoï dans La Guerre et la Paix. À la fois intuitivement et en émule conscient de Gogol et de Dostoïevski, c'est au Diable qu'il impute les invasions massives et comme planifiées du Mal dans l'histoire. Présence inquiétante dans le sous-texte de toutes ses œuvres, le Diable est montré en pied et en pleine action dans Le Maître et Marguerite. Cela dit, son emprise s'étend au moyen de relais humains qui peuvent être des hommes supérieurs, des inventeurs, ou des réformateurs, les « Faust » des temps modernes ainsi que les plus grands pécheurs : fanatiques comme Caïphe, êtres vénaux comme Judas, lâches comme Pilate. Nouveau Faust, l'écrivain peut être réduit par la peur à désavouer son œuvre et à se détruire : cette tension entre l'hybris faustienne et l'extrême faiblesse humaine l'apparente au Crucifié. La seconde partie du « roman du couchant », écrite dans l'imminence de la mort, témoigne d'une élévation vraiment spirituelle : le « maître » franchit le cap de la mort, communique avec la Lumière grâce à des médiateurs et, surtout, se voit pardonné, ce qui l'autorise à accorder le pardon même à un Pilate. Exalté par les progrès de la science, ouvert à toutes les cultures, curieux de tous les horizons philosophiques, religieux et mystiques, Boulgakov a exercé l'écriture en vrai « moderniste » des premières décennies du XXe siècle. Il a notamment forgé une écriture du « réemploi », où les morceaux « cassés » préservent leur éclat dans le langage nouveau où ils sont inclus. Dans l'écriture, magnifiée par lui et surchargée de sens, il jouit d'une liberté absolue, et il le manifeste avec une allégresse exubérante qui se communique immédiatement à son lecteur. Françoise Flamant Postérité Entre 1940 et 1941, Don Quichotte est donné à Moscou et dans plusieurs villes de province, avant d'être repris au théâtre Vakhtangov. En 1955, deux ans après la mort de Staline, paraît un recueil intitulé M. Boulgakov. Les Jours des Tourbine, Les Derniers jours Alexandre Pouchkine, première parution de ces deux pièces. La Fuite est jouée pour la première fois à Stalingrad le 26 mars 1957. En 1958, c'est au tour de trois récits de Carnets d'un jeune médecin d'être publiés. En 1962 sont édités La Vie de M. de Molière largement censurée et M. Boulgakov. Théâtre, comprenant pour la première fois La Fuite et La Cabale des dévots. En 1963 paraît le recueil Carnets d'un jeune médecin six récits. En 1965, paraît le recueil M. Boulgakov. Un drame et des comédies, comprenant la première parution d’Ivan Vassilievitch en volume et Mémoires d'un défunt Roman théâtral en revue. La Russie découvre dans une version très largement censurée Le Maître et Marguerite, son œuvre majeure, qui avait fait l'objet de tant de réécritures, dans le numéro 11 de décembre 1966 et le numéro 1 de janvier 1967 de la revue Moskva Moscou. La première version non censurée paraîtra à Francfort, en Allemagne, en 1969. En Russie, il faudra attendre 1973. La première édition des Œuvres de Boulgakov, dans leur majeure partie, sinon dans leur totalité, paraît en cinq volumes à Moscou en 1989-1990, pendant la Perestroïka. Depuis, elles ne cessent de s'enrichir au fur et à mesure des rééditions. Entre 1989 et 1994, paraît la première édition complète du Théâtre de Boulgakov en deux volumes à Leningrad redevenue entre-temps Saint-Pétersbourg. Celui qui a tant peiné pour être accepté de son vivant est finalement devenu l'un des écrivains les plus lus de Russie et sa prose est traduite dans de nombreuses langues63. Une édition complète de ses œuvres est sortie à la Bibliothèque de la Pléiade en deux tomes. Les musées de Boulgakov à Moscou À Moscou, deux musées honorent la mémoire de Mikhaïl Boulgakov et Le Maître et Marguerite. Ils sont situés dans l’immeuble où Boulgakov vécut entre 1921 et 1924, dans la rue Bolchaïa Sadovaïa N⁰10, où se situent également des scènes importantes de son roman Le Maître et Marguerite. Depuis les années 1980, le bâtiment est devenu un lieu de rassemblement pour les admirateurs de Boulgakov. Différents types de graffiti ont été griffonnés sur les murs. Les nombreux dessins et quolibets qui les maculaient ont été presque totalement blanchis en 2003. Il existe une rivalité entre les deux musées, principalement maintenue par le Musée M.A. Boulgakov, qui se présente invariablement comme le premier et le seul musée commémoratif de Mikhaïl Boulgakov à Moscou. La Maison de Boulgakov La Maison de Boulgakov Музей - театр "Булгаковский Дом" est située au rez-de-chaussée et a été fondé comme une initiative privée le 15 mai 2004. Le patrimoine de la Maison de Boulgakov contient des effets personnels, des photos et des documents de Mikhaïl Boulgakov. Le musée organise plusieurs expositions liées à la vie de Boulgakov et ses œuvres. Diverses manifestations poétiques et littéraires sont souvent organisées, ainsi que des excursions au « Moscou de Boulgakov , dont certains sont animés avec des personnages du Maître et Marguerite. La Maison de Boulgakov gère également le Théâtre M.A. Boulgakov avec 126 sièges, et le Café 302-bis. Le Musée M.A. Boulgakov Dans le même bâtiment, dans l'appartement numéro 50 au quatrième étage, est situé un deuxième musée, le Musée M.A. Boulgakov ru russe: Музей М. А. Булгаков. Ce deuxième musée a été fondé à l'initiative du gouvernement le 26 mars 2007. Le patrimoine de la Maison de Boulgakov contient des effets personnels, des photos et des documents de Mikhaïl Boulgakov. Le musée organise plusieurs expositions liées à la vie de Boulgakov et ses œuvres. Œuvres Romans La Garde blanche Белая Гвардия - 1925 et 1927-1929 publié en URSS en 1966 La Vie de monsieur Molière ou Le Roman de monsieur de Molière Мольер - achevé en 1933 publié en URSS, de manière expurgée, en 1962, de manière intégrale en 1989 Le Roman théâtral еатральный роман, également publié sous le titre : Les Mémoires d'un défunt - inachevé, rédigé en 1936-1937 publié en URSS en 1965,en volume, en 1966 Le Maître et Marguerite Мастер и Маргарита - dernières corrections du 13 février 1940 publié en URSS, de manière intégrale, en 1973 Nouvelles Notes sur des manchettes Записки на манжетах - 1922-1924 publié en URSS, de manière intégrale, en 1982 La Bohème Богема - janvier 1925 réédition en URSS en 1986 Endiablade Дьяволиада - 1924 réédition en URSS en 1987 Les Œufs du destin ou Les Œufs fatidiques Роковые яйца, 1925 réédition en URSS en 1988 Cœur de chien Собачье сердце- achevé en 1925 publié en URSS en 1987 Carnets d'un jeune médecin Записки юного врача publié en URSS en 1963, comprenant: La Gorge en acier Стальное горло - 15 août 1925, La Serviette au coq Полотенце с петухом - 12 et 18 septembre 1926, Baptême de la version Крещение поворотом - 25 octobre et 2 novembre 1925, La Tourmente de neige Вьюга- 18 et 25 janvier 1926, Ténèbres sur le pays d'Égypte Тьма египетская- 20 et 27 juillet 1926, L'Éruption étoilée Звёздная сыпь - 12 et 19 août 1926, L'Œil votalisé Пропавший глаз - 2 et 12 octobre 1926. Morphine Морфий - décembre 1927 réédition en URSS, de manière intégrale, en 1988 Articles de variété et récits parus dans la presse soviétique de 1919 à 1927, dont: Les Aventures extraordinaires du docteur N. - mai 1922 réédition en URSS en 1975 Une séance de spiritisme - juillet 1922 réédition en URSS en 1985 Les Aventures de Tchitchikov - 24 septembre 1922 et en volume en 1925 réédition en URSS en 1966 La Couronne rouge - 22 octobre 1922 réédition en URSS en 1988 Le 13, immeuble Elpit-Commune ouvrière ou La Commune ouvrière Elpite N⁰13- décembre 1922 et en volume en 1925 réédition en URSS en 1987 La Nuit du 2 au 3 - 10 décembre 1922 réédition en URSS en 1988 Une histoire de Chinois - 6 mai 1923 et en volume en 1925 réédition en URSS en 1987 Un psaume Псалом - 23 septembre 1923 et 1926 réédition en URSS en 1988 Le Raid Бег - 25 décembre 1923 réédition en URSS en 198 Le Feu du khan Tougaï Ханский огонь - février 1924 réédition en URSS en 1974 L'Île pourpre Багровый остров - 20 avril 1924 réédition en URSS en 1988 J'ai tué - 8 et 12 décembre 1926 réédition en URSS en 1972 Théâtre Autodéfense, sketch en un acte, joué à Vladikavkaz le 3 juin 1920 Les Frères Tourbine, drame en quatre actes, joué le 21 octobre 1920 Les Communards de Paris, pièce en trois acte créée à Vladikavkaz entre janvier et mars 1921 Le Perfide paternel, pièce créée à Vladikavkaz en 1921 Les Prétendants d'argile, comédie-bouffe jouée en 1921 Les Fils du mollah, pièce créée le 15 mai 1921 et jouée trois fois66. Les Jours des Tourbine Дни Турбиных - 1926 publié en URSS en 1955 L'Appartement de Zoïka Зойкина квартира - deux versions : 1926 en quatre actes et 1935 en trois actes publié en URSS en 1982 L'Île pourpre Багровый остров - 1927 publié en URSS en 1987 La Fuite - 1928 (publié en URSS en 1962 Adam et Ève Адам и Ева - 1931 publié en URSS en 1987 Béatitude (Блаженство сон инженера Рейна - 1934 (publié en URSS en 1966 Alexandre Pouchkine Александр Пушкин - 1935 publié en URSS en 1955 Molière ou la Cabale des dévots Кабала святош - achevé en 1929 publié en URSS en 1962 Ivan Vassilievitch Иван Васильевич - 1935 (publié en URSS en 1965 Batoum (Батум) - achevé en 1939 (publié en URSS en 1988 Livrets d'opéra Minine et Pojarski, opéra en cinq actes et neuf tableaux, musique de Boris Assafiev, contrat le 21 juin 1936, abandonné en juin 1938 La Mer Noire, musique de Sergeï Pototski, contrat le 1er octobre 1936, abandonné en mars 1937 Pierre le Grand (Пётр Великий), musique de Boris Assafiev, commencé en juillet 1937, abandonné en janvier 1938 Rachel, musique de Dounaïevski, commencé en septembre 1938, inachevé en février 1940      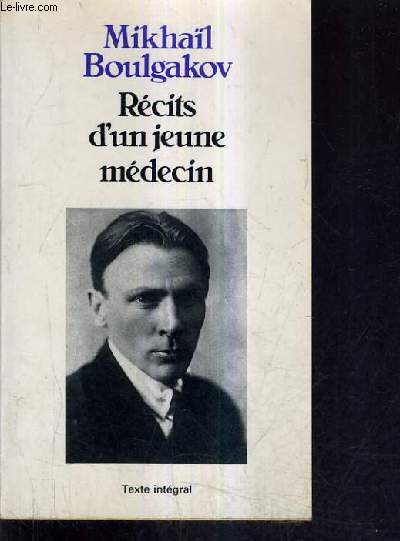
#25
Émily Dickinson 1
Loriane
Posté le : 14/05/2016 16:45
Le 15 mai 1886 à 55 ans meurt Emily Elizabeth Dickinson
à Amherst, Massachusetts, États-Unis, née le 10 décembre 1830 dans la ême ville, poétesse américaine. Née à Amherst dans le Massachusetts, dans une famille aisée ayant des liens communautaires forts, elle a vécu une vie introvertie et recluse. Après avoir étudié dans sa jeunesse, durant sept ans à l'académie d’Amherst, elle vit un moment au séminaire féminin du mont Holyoke avant de retourner dans la maison familiale à Amherst. Considérée comme une excentrique par le voisinage, on la connaît pour son penchant pour les vêtements blancs et pour sa répugnance à recevoir des visiteurs, voire plus tard à sortir de sa chambre. La plupart de ses amitiés seront donc entretenues par correspondance. Bien qu’ayant été un auteur prolifique, moins d’une douzaine de ses presque mille huit cents poèmes ont été publiés de son vivantN 1. Ceux qui furent publiés alors étaient généralement modifiés par les éditeurs afin de se conformer aux règles poétiques de l’époque. Les poèmes de Dickinson sont uniques pour leur époque : ils sont constitués de vers très courts, n’ont pas de titres et utilisent fréquemment des rimes imparfaites et des majuscules et une ponctuation non conventionnelle. Un grand nombre de ses poèmes traitent de la mort et de l’immortalité, des sujets récurrents dans sa correspondance avec ses amis. Même si la plupart de ses connaissances devaient savoir qu’Emily Dickinson écrivait, l’étendue de son œuvre ne fut connue qu’après sa mort, en 1886, quand Lavinia, sa plus jeune sœur, découvre sa cachette de poèmes. Son premier recueil est publié en 1890 par des relations personnelles, Thomas Wentworth Higginson et Mabel Loomis Todd, qui en altéreront fortement le contenu. Ce n’est qu’avec l’édition de Thomas H. Johnson en 1955, Les poèmes d’Emily Dickinson The Poems of Emily Dickinson, que paraît pour la première fois un recueil complet et pratiquement intact de son travail. Malgré des critiques défavorables et un grand scepticisme vis-à-vis de ses performances littéraires de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, les critiques considèrent à présent Emily Dickinson comme une poétesse américaine majeure. En bref Il a fallu attendre 1955 et la grande édition variorum de ses poèmes pour lire enfin l'œuvre de la poétesse américaine Emily Dickinson dans un texte sûr. Elle n'avait publié de son vivant que cinq poèmes qui passèrent inaperçus. Quatre ans après sa disparition, des amis et des parents rassemblèrent quelques centaines d'autres poèmes dont la transcription était loin d'être exacte. L'édition de Thomas H. Johnson (les poèmes en 1955 et les lettres en 1958) permet aujourd'hui de mesurer la stature de celle qu'on s'accorde à classer parmi les plus grands auteurs américains du XIXe siècle. Son œuvre est inégale, difficile, intensément personnelle, mais aussi parcourue d'éclairs de beauté. Sans rien devoir de très reconnaissable à aucun maître, elle se situe entre la tradition romantique américaine et la tradition calviniste de la Nouvelle-Angleterre. L'histoire d'Emily Dickinson est la chronique sans relief d'une célibataire provinciale dont toute la vie s'est déroulée à Amherst (Massachusetts) ; nul incident notable ne la signale. Fille d'un avoué, élevée dans la religion congrégationaliste, la poétesse fait des études bourgeoises à Amherst College, puis à Mount Holyoke Seminary ; avant la trentaine, elle se cloître chez son père et vit en recluse excentrique, vêtue de blanc, soignant son personnage et ses apparitions, écrivant des poèmes qu'elle montre à quelques intimes, puis qu'elle dissimule dans un coffre. Peu de gens en connaîtront l'existence : sa sœur et sa belle-sœur, le critique T. W. Higginson et l'écrivain Helen H. Jackson, qui seront ses confidents littéraires. Dès l'adolescence, Emily Dickinson fait preuve d'un esprit alerte et spirituel, d'un style pittoresque et mordant qui jongle volontiers avec les mots et expérimente avec le langage. Certains biographes ont fait cas d'une passion platonique que la poétesse aurait nourrie pour un pasteur marié, Charles Wadsworth, et qui aurait contribué à son inspiration ; les critiques plus récents tendent à minimiser l'incident et à souligner, en revanche, les angoisses métaphysiques de celle qui, vivant dans un monde encore très puritain, n'a jamais pu éprouver la grâce au point de se convertir. Les thèmes principaux, C'est le drame intérieur d'Emily Dickinson, ainsi que ses observations et ses réflexions sur le monde et sur l'homme qui forment le noyau de son œuvre. Mis à part les poèmes de circonstance et les fantaisies descriptives ou sentimentales, sa poésie se présente comme un faisceau de tensions et de brèves illuminations dont les thèmes sont le moi, la nature et la mort. Contrairement à Emerson ou à Whitman, Emily Dickinson conçoit un monde irrémédiablement dualiste et sans communication possible. La nature n'est qu'illusion fugitive et brillante, théâtre d'évanescences rebelle à l'homme ; les sujets souvent traités seront ceux qui dramatisent ou illustrent la fuite des apparences sensibles : animaux discrets et furtifs, jeux d'ombre et de lumière, passage des saisons. Tout cela est rendu d'un trait vif, par des métaphores brillantes, et non sans un accent yankee réaliste et ironique qui évite sentimentalisme ou convention. Une solitude existentielle, ponctuée de vains appels passionnés, marque les poèmes de l'exploration psychique. Saisi par une angoisse quasi névrotique où alternent extase et douleur, le moi est un espace clos où s'affrontent la conscience et son double, où se tapit un ennemi métaphysique diversement représenté. Il existe chez Emily Dickinson un malaise de l'être qui se traduit par des hallucinations qu'on dirait surréalistes. C'est une âme inquiète, hantée par la mort dont elle éprouve la terreur et la fascination au point d'en paraître morbide. Mais l'artiste sait dominer son obsession en lui donnant une forme esthétique et en la personnifiant, si bien qu'à son tour, le moi devient théâtre. La curiosité clinique d'Emily Dickinson, sa fascination devant l'instant de la mort et la « facticité » du cadavre où s'abolit la conscience malheureuse sont autant d'éléments originaux que rehausse un style visant à créer la surprise et le choc. Face au néant, Emily Dickinson ne peut s'affranchir d'une inquiétude religieuse sur l'au-delà, encore qu'elle ait traité avec peu de révérence dogmes et traditions. Son œuvre est tout entière tendue entre une foi naïve ou conditionnelle, et un doute qui ne recule pas devant le blasphème. Tel poème, À l'abri dans leur chambre d'albâtre (Safe in their Alabaster Chambers), où deux versions différentes évoquent, l'une les gisants attendant en confiance la résurrection, l'autre leurs atomes libérés gravitant dans un cosmos purement naturaliste, illustre bien cette ambiguïté de l'écrivain ; parallèlement, Emily Dickinson n'a pu partager le panthéisme optimiste de certains romantiques, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a su se résoudre à accepter le rude credo calviniste et sa stoïque incertitude du salut. Tendue et anxieuse, ou ironique et distante, éclatant à l'improviste en fleurs métaphoriques d'une grande beauté, cette méditation sur la vie et la mort, le fini et l'infini nous a valu les chefs-d'œuvre de la poétesse. L'expression, Pour tenter de sortir de son dilemme et compenser ce que la religion n'avait pu combler, Emily Dickinson s'est tournée vers la création artistique. De ses réflexions dispersées, comme de ses images, ressort une théorie personnelle : le poète crée, à partir d'un épicentre conscient, une « circonférence » imaginaire dont le but est de coïncider avec celle du réel. Cet effort reste vain dans la mesure où, comparées aux merveilles du moindre objet naturel, les splendeurs poétiques font figure de « ménageries », puisque aussi bien l'on ne peut qu'imiter de loin une création par essence étrangère, ou évoquer gauchement un absolu rebelle à l'expression. Mais il est aussi une magie des mots ; elle permet de construire un microcosme de beauté qui, à sa façon, atteint à une vérité absolue ; certes, comparée à l'orbe de l'univers, l'œuvre du poète paraît minuscule ; pourtant, elle reflète cet univers pour une vision humaine limitée dans le temps et dans l'espace. Les poèmes utilisent une métrique fondée sur celle qu'employaient des hymnes protestants comme ceux d'Isaac Watts (1674-1748). Le common meter y prédomine ; avec son schéma d'octosyllabes et d'hexasyllabes alternés et son rythme iambique, il est assez proche de la ballad anglo-saxonne et de certaines nursery rhymes. Mais ce modèle est fréquemment diversifié, et ce qui était froid et mécanique chez Watts devient chez la poétesse un instrument d'une grande souplesse, aux rythmes subtils, aux rimes capricieuses, libéré par la fantaisie individualiste de l'auteur. Certains poèmes sont des réussites parfaites ; dans beaucoup d'autres, on décèle quelque monotonie et une sorte de sécheresse aggravée par le trait rapide, l'extrême concision verbale et une sténographie grammaticale qui rend le sens parfois incertain. La forte originalité formelle d'Emily Dickinson tient plus à un vocabulaire riche et inattendu, à une constellation de métaphores mémorables, qu'à une maîtrise prosodique dont elle semble s'être, en définitive, assez peu souciée. Guy Jean Forgue Sa vie Environnement familial et enfance Dessin représentant Emily à 9 ans. D'après un portrait d'Emily, Austin et Lavinia enfants. Emily Elizabeth Dickinson est née à Amherst, le 10 décembre 1830, dans une famille qui, sans être très riche, est socialement en vue dans la Nouvelle-Angleterre4. Deux-cents ans plus tôt, avec la première vague migratoire puritaine, ses ancêtres avaient rejoint le Nouveau Monde – où ils prospéreront. Avocats, éducateurs et fonctionnaires politiques figurent dans l’arbre généalogique d’Emily : l’un de ses ancêtres a été secrétaire de la mairie de Wethersfield Connecticut en 1659. Samuel Fowler Dickinson, le grand-père d’Emily, bâtit pratiquement à lui seul l'Amherst College. En 1813, il construit la propriété familiale, une grande maison dans la rue principale de la ville, qui deviendra le centre de la vie de famille des Dickinson durant une grande partie du siècle. Il est, pendant quarante ans, juge du comté de Hampton Massachusetts, secrétaire de la mairie, représentant à la Cour générale et sénateur au Sénat d’État. Le fils aîné de Samuel Dickinson, Edward, avocat de l’université Yale, est juge à Amherst, représentant à la Chambre des députés du Massachusetts, sénateur à la capitale de l’État et, pour finir, représentant pour l’État du Massachusetts au Congrès de Washington. Pendant près de quarante ans, il est le trésorier d'Amherst College, et fonde la ligne ferroviaire Massachusetts Central Railroad. Le 6 mai 1828, il épouse Emily Norcross de Monson dans le Massachusetts. Ils ont trois enfants : William Austin Dickinson 1829–1895, que l’on appelle Austin, Aust ou Awe, Emily Elizabeth et Lavinia Norcross Dickinson 1833–1899, que l’on appelle Lavinia ou Vinnie. L’épouse d’Edward reste clouée au lit à la fin de sa vie et est à la charge de ses filles. Tout laisse penser qu’Emily est une petite fille sage. Lors d’une longue visite à Monson, alors qu’elle a deux ans, Lavinia, la tante d’Emily, la décrit comme parfaite et contente - Elle est une enfant charmante et facile »10. Elle note également l’attirance de l’enfant pour la musique et son talent particulier pour le piano, qu’elle appelle la moosic. Emily suit l’école primaire dans un bâtiment de deux étages sur Pleasant Street6. Son éducation est ambitieusement classique pour une enfant de l’époque victorienne. Son père tient à ce que ses enfants soient bien éduqués et suit leurs progrès même lorsqu’il est au loin pour son travail. Quand Emily a sept ans, il écrit à la maison, rappelant à ses enfants de continuer l’école, et d’apprendre, afin de me raconter, quand je reviendrai à la maison, combien de nouvelles choses vous avez apprises. Alors qu’Emily décrit constamment son père de manière chaleureuse, sa correspondance suggère que sa mère est souvent froide et distante. Dans une lettre à une de ses confidentes, elle écrit : si quelque chose m’arrivait, je courais toujours à la maison vers Awe Austin. Il était une mère épouvantable, mais il était mieux que rien . Le 7 septembre 1840, Emily et sa sœur Lavinia commencent ensemble au collège d'Amherst, une ancienne école de garçons qui avaient ouvert ses portes aux filles deux ans plus tôt. À la même époque, son père acquiert une maison sur North Pleasant Street. Austin, le frère d’Emily, décrira plus tard cette immense maison comme le château sur lequel il régnait avec Emily quand leurs parents étaient absents. La maison donne sur le cimetière d'Amherst, un cimetière sans arbre et menaçant selon le pasteur. Contexte historique Emily Dickinson naît dans la période précédant la guerre de Sécession, à un moment où de forts courants idéologiques et politiques s’affrontaient dans la haute et moyenne bourgeoisie américaine. Même les familles les plus aisées n'ont alors ni eau chaude ni salle de bains. Les tâches ménagères représentent une charge énorme pour les femmes même dans la famille Dickinson qui, en raison de sa position économique confortable, dispose d’une servante irlandaise. De ce fait la préoccupation d’Emily d’obtenir une bonne éducation constitue une exception dans la société rurale de la Nouvelle-Angleterre de son époque. La chorale de l’église est pratiquement la seule expression artistique acceptée par la sévère religion puritaine partout présente. L’orthodoxie protestante de 1830 considère les romans comme une littérature dissipée et interdit les jeux de cartes et la danse. Il n’existe pas plus de concerts de musique classique que de représentations théâtrales. Pâques et Noël ne sont pas célébrés jusqu'en 1864, année où la première Église épiscopale, qui y introduit ses coutumes, est établie à Amherst. Les réunions de femmes seules, autres que le thé quotidien entre voisines, ne sont pas tolérées non plus. Une fois l’Amherst College fondé par le grand-père et le père d’Emily, l’union entre celui-ci et l'Eglise commence à former des missionnaires qui partent d’Amherst pour propager les idéaux protestants dans les recoins les plus reculés du monde. Le retour occasionnel de certains de ces religieux aboutit à l’introduction de concepts, d’idées et de visions nouvelles dans la société conservatrice du village qui commence alors à établir un contact avec le monde extérieur et tend à abandonner les coutumes et croyances d’antan plus rapidement que dans les autres endroits de la région. Adolescence They shut me up in Prose — As when a little Girl They put me in the Closet — Because they liked me "still" — Still! Could themselves have peeped — And seen my Brain — go round — They might as wise have lodged a Bird For Treason — in the Pound — Ils m’ont enfermée dans la Prose — Comme lorsque j’étais une Petite Fille Ils m’enfermaient dans le Placard — Parce qu’ils me voulaient « calme » — Calme ! S’ils avaient pu jeter un œil — Et espionner dans mon esprit — le visiter — Ils auraient aussi bien pu enfermer un Oiseau Pour trahison — à la fourrière — Emily passe plusieurs années à l’Amherst Academy et suit les cours d’anglais, littérature classique, latin, botanique, géologie, histoire, philosophie mentale et arithmétique. Elle s’absente quelques trimestres pour cause de maladie ; sa plus longue absence a lieu entre 1845 et 1846, quand elle ne suivra les cours que pendant onze semaines. Dès son plus jeune âge, Emily est perturbée par la menace grandissante de la mort, et plus spécialement de celle de ses proches. Quand Sophia Holland, son amie proche et sa cousine au second degré, attrape le typhus et meurt en avril 1844, Emily est traumatisée. Deux ans plus tard, se remémorant l’évènement, Emily écrit : Il me semblait que je devais mourir aussi s’il ne m’était pas permis de veiller sur elle ni même de regarder son visage. Elle devient si mélancolique que ses parents l’envoient faire un séjour dans de la famille à Boston afin de se rétablir. Elle en revient guérie, physiquement et moralement, et retourne à ses études à l’Amherst Academy. Elle rencontre alors ceux qui deviendront des amis de toute une vie, comme Abiah Root, Abby Wood, Jane Humphrey et Susan Huntington Gilbert qui épousera plus tard Austin, le frère d’Emily. En 1845, un second Grand réveil Second Great Awakening a lieu à Amherst et entraine quarante-six confessions de foi parmi les proches d’Emily. L’année suivante, elle écrit à un ami : Je n’ai jamais connu une paix et un bonheur aussi parfaits que pendant la courte période où je pensais avoir trouvé mon sauveur. Elle poursuit en précisant que c’était son plus grand plaisir de communier avec Dieu le très haut et de sentir qu’il écoutait mes prières. Ce sentiment ne dure pas : Emily Dickinson ne fit jamais de déclaration de foi formelle et n’assistera aux services religieux que quelques années. Vers 1852, après sa phase religieuse, elle écrit un poème qui commence par : « Certains suivent le Sabbat en allant à l’église - / Je le suis, en restant à la Maison. Durant sa dernière année à l’Amherst Academy, Emily se lie d’amitié avec Leonard Humphrey, le jeune et populaire nouveau principal. Après avoir terminé son dernier trimestre scolaire le 10 août 1847, elle s’inscrit au séminaire du Mont Holyoke The Mount Holyoke Female Seminary, fondé par Mary Lyon l’établissement deviendra plus tard le Mount Holyoke College et situé à South Hadley, à 16 km d'Amherst. Elle reste au séminaire seulement dix mois. Et même si elle apprécie ses consœurs de Holyoke, Emily n’en conservera aucune amitié durable. Les explications concernant la courte durée de son séjour diffèrent considérablement : sa santé fragile, la volonté de son père de l’avoir auprès de lui, sa rébellion contre la ferveur évangélique de l’école, la discipline de ses professeurs ou, plus simplement, le mal du pays. Quelle que soit la raison de son départ, son frère Austin vient la chercher le 25 mars 1848 pour la ramener à la maison. De retour chez elle, Emily Dickinson se consacre aux activités domestiques. Elle se met à faire la cuisine pour sa famille et participe aux manifestations locales et aux activités de la ville universitaire naissante. Premières influences et premiers écrits Alors qu’Emily a dix-huit ans, la famille Dickinson se lie d’amitié à un jeune avoué, Benjamin Franklin Newton. D’après une lettre qu’écrira Emily après la mort de Newton, il a été avec mon père pendant deux ans, avant de partir pour Worcester – poursuivre ses études, et il demeurait beaucoup avec notre famille. Même si leur relation n’était probablement pas d’ordre sentimental, Newton eu une influence formatrice et deviendra le deuxième après Humphrey d’une longue série d’hommes plus âgés auquel Emily Dickinson fera référence en tant que tuteur, précepteur ou maître. Newton lui fait probablement découvrir les écrits de William Wordsworth et lui offre son premier livre de Ralph Waldo Emerson qui aura sur elle un effet libératoire. Elle écrira plus tard que celui « dont le nom me fut révélé par l’étudiant en droit de mon père, toucha un ressort secret. Newton la tient en haute estime et reconnaît en elle une poétesse. Alors qu’il est en train de mourir de la tuberculose, il lui écrit qu’il aimerait vivre jusqu’à ce qu’elle atteigne la grandeur qu’il perçoit. Les biographes d’Emily Dickinson pensent que cette déclaration de 1862 fait référence à Newton : Lorsque j’étais petite Fille, j’avais un ami, qui m’appris l’Immortalité – mais s’en approchant trop près lui-même, il ne revint jamais. Emily Dickinson connait non seulement la Bible mais également la littérature populaire contemporaine. Elle est probablement influencée par les Lettres de New York de Lydia Maria Child, un autre cadeau de Newton après l’avoir lu, elle s’enthousiasme : Ça c’est un livre ! Et il y en a plein d’autres ! Son frère lui apporte en secret, car son père risque de désapprouver, une copie de Kavanagh de Henry Wadsworth Longfellow et, fin 1849, un ami lui prête Jane Eyre de Charlotte Brontë. L’influence de Jane Eyre ne peut être mesurée mais quand Emily Dickinson adopte son premier et unique chien, un Terre-neuve, elle l’appelle Carlo d’après le chien du personnage St. John River39. William Shakespeare a également une forte influence sur sa vie. Se référant à ses pièces de théâtre, elle écrit à un ami : Pourquoi serrer d’autres mains que celle-ci ? et à un autre : Pourquoi aurait-on besoin d’un autre livre ? Âge adulte et réclusion Début 1850, Emily Dickinson écrit que « Amherst est vivant et amusant cet hiver… Oh, c’est une magnifique ville ! . Mais sa bonne humeur se transforme rapidement en mélancolie après un nouveau décès. Le principal de l’Amherst Academy, Leonard Humphrey, meurt brusquement à l’âge de 25 ans d’une congestion du cerveau. Deux ans après sa mort, elle révèle à son ami, Abiah Root, l’étendue de sa dépression : … certains de mes amis sont partis, et certains de mes amis sont endormis – endormis du sommeil du cimetière – l’heure du soir est triste – c’était jadis mon heure d’étude – mon maître a trouvé le repos, et les pages ouvertes du livre, et l’étudiant seul à l’école, me fait monter les larmes aux yeux, et je ne peux pas les balayer ; je ne le ferai pas si je le pouvais, car elles sont le seul hommage que je puisse rendre au défunt Humphrey . Durant les années 1850, Emily Dickinson entretient une relation intense et affectueuse avec Susan Gilbert. Jusqu’à la fin de leur relation, Emily lui enverra plus de trois cents lettres, plus qu’à la plupart de ses correspondants. En général, ses missives quémandent l’affection de Sue et s’effraient de la non-réciprocité de son admiration, mais comme Susan est souvent distante et désagréable, Emily est continuellement blessée par cette amitié tempétueuse. Cependant, Susan soutient la poétesse, jouant le rôle de « meilleure amie, autorité, muse et conseillère, dont Emily suit parfois les suggestions rédactionnelles ; elle joue un rôle fondamental dans le processus créatif d’Emily . Susan épouse Austin en 1856, après une cour de quatre ans, mais leur mariage n’est pas heureux. Edward Dickinson leur construisit une maison,the Evergreen, sur la partie ouest de la propriété familiale. Portrait supposé d’Emily Dickinson, l’une des deux photographies connues. Prise dans les années 1850 et découverte en 2000 sur eBay par Philip F. Gura, son authenticité n’est pas prouvée45. Jusqu’en 1855, Emily ne s’est jamais beaucoup éloignée d’Amherst. Au printemps de cette année-là, avec sa mère et sa sœur, elle entreprend ce qui sera son voyage le plus long et le plus lointain. Elles passent d’abord trois semaines à Washington, où son père représente le Massachusetts au Congrès. Les deux semaines suivantes, elles visitent de la famille à Philadelphie. Là, Emily rencontre Charles Wadsworth, un célèbre pasteur de l’église presbytérienne d'Arch Street The Arch Street Presbyterian Church, avec lequel elle liera une amitié solide qui durera jusqu’à sa mort en 188247. Après 1855, elle ne le reverra que deux fois il déménagea à San Francisco en 1862, mais elle se réfère à lui comme mon Philadelphie, mon Pasteur, mon plus cher ami sur terre et mon Berger de la Jeunesse . Dès le milieu des années 1850 et jusqu’à sa mort en 1858, la mère d’Emily est clouée au lit par de nombreuses maladies chroniques. Écrivant à un ami durant l’été 1858, Emily dit qu’elle lui aurait rendu visite si elle pouvait quitter la maison, ou mère. Je ne sors pas du tout, de peur que père puisse venir et que je le manque, ou que je manque quelque petit évènement que je pourrais oublier, si je venais à fuir – Mère est comme d’habitude. J’ignore qu’espérer pour elle. Alors que sa mère dépérit, les responsabilités domestiques d’Emily deviennent de plus en plus lourdes et elle se confine à l’intérieur de la propriété familiale. Emily fait sien ce rôle et trouvant agréable cette vie avec ses livres et dans la nature, continue à la vivre. Se retirant de plus en plus du monde extérieur, Emily commence en été 1858 ce qui sera son héritage. Révisant des poèmes qu’elle avait écrit auparavant, elle commence à recopier son travail au propre et assemble ainsi avec soin des livres manuscrits. Les quarante fascicules qu’elle crée de 1858 à 1865 contiendront finalement près de huit cent poèmes. Nul ne connaissait l’existence de ces livres, jusqu’à sa mort. À la fin des années 1850, les Dickinson se lient d’amitié à Samuel Bowles, le propriétaire et éditeur en chef du Springfield Republican, et à sa femme, Mary. Ils rendront régulièrement visite aux Dickinson durant les années suivantes. Pendant cette période, Emily enverra à Samuel plus de trois douzaines de lettres et près de cinquante poèmes. Leur amitié sera le terreau de certains de ses écrits les plus intenses et Samuel Bowles publiera quelques-uns de ces poèmes dans son journal. On pense que c’est entre 1858 et 1861 qu’Emily écrivit Les Lettres du Maître The Master Letters. Ces trois lettres, adressées à un inconnu simplement appelé Maître, continuent de faire l’objet de spéculations et de conflits parmi les spécialistes. Les premières années de 1860, après qu’Emily se sera largement retirée de toute vie sociale, seront ses plus productives en tant qu’écrivain. «Mes Vers sont-ils vivants ? En avril 1862, Thomas Wentworth Higginson, un critique littéraire, abolitionniste radical et ancien pasteur, écrit à la Une du The Atlantic Monthly un article intitulé : Lettre à un Jeune Journaliste Letter to a Young Contributor. Dans cet essai, il exhorte les aspirants écrivains à emplir leur style de vie, prodigue des conseils pratiques à ceux qui veulent être publiés. Recherchant un mentorat littéraire que personne près d’elle ne peut lui fournir, Emily lui envoie une lettre. M. Higginson, êtes-vous trop occupés pour me dire si mes Vers sont vivants ? L’Esprit est si proche lui-même – il ne peut voir, distinctement – et je n’ai personne à qui demander – Si vous pensez qu’ils respirent – et que vous ayez le loisir de me le dire, j’en ressentirais une prompte gratitude – Si je suis dans l’erreur – et que vous osiez me le dire – vous me feriez un honneur sincère – J’inclus mon nom – vous priant, s’il vous plait – Monsieur – de me dire ce qui est vrai– Il n’est pas nécessaire de vous demander – de ne pas me trahir – car l’Honneur est son propre garant - La lettre n’est pas signée, mais Emily joint dans l’enveloppe son nom sur une carte et quatre de ses poèmes. Higginson rend hommage à son travail mais lui suggère d’en retarder la publication jusqu’à ce qu’elle en ait écrit plus. Elle lui assure que publier lui est aussi étranger mais elle suggère que Si la gloire m’appelle, je ne peux lui échapper . Dans ses lettres à Higginson, Emily Dickinson se complaît dans des auto-descriptions théâtrales et mystérieuses. Elle dit d’elle-même : Je suis petite, comme le roitelet, et mes cheveux sont épais, comme la bogue du châtaignier, et mes yeux sont comme le sherry que laissent les invités au fond du verre. Elle accentue sa nature solitaire, affirmant que ses seuls compagnons sont les collines, le coucher du soleil et son chien, Carlo. Elle mentionne également que si sa mère ne s’intéresse pas à la Pensée, son père lui amène des livres, mais la supplie de ne pas les lire – car il a peur qu’ils perturbent l’Esprit. Emily apprécie ses conseils, elle l’appelle M. Higginson ou Cher ami et signe ses lettres : Votre Gnome et Votre disciple. L’intérêt qu’il porte à son travail lui apporta certainement un important soutien moral. Des années plus tard, Emily dira à Higginson qu’il lui a sauvé la vie en 1862. Ils correspondront jusqu’à sa mort. La femme en blanc Après avoir fait preuve d’une intense productivité au début des années 1860, Emily Dickinson écrit beaucoup moins de poèmes en 1866. En proie à ses deuils personnels, manquant d’aide dans les travaux domestiques, il est possible qu’elle ait trop à surmonter pour maintenir son niveau précédent d’écriture. Après l’avoir accompagné pendant seize ans, son chien Carlo meurt ; Emily ne le remplacera jamais. Malgré le départ de la domestique, partie pour se marier après neuf ans au service de la famille, il faudra attendre 1869 pour que les Dickinson la remplacent. Une fois encore, Emily hérite des corvées, cuisine comprise, activité dans laquelle elle excelle. A solemn thing – it was – I said – A Woman – White – to be – And wear – if God should count me fit – Her blameless mystery – Une chose solennelle – c’était – je vous le dis – Une Femme – Blanche – qui est - et qui porte – si Dieu me le permet – Son mystère irréprochable - À cette époque, le comportement d’Emily commence à changer. Elle ne quitte plus la propriété qu’en cas de nécessité absolue et, dès 1867, elle commence à parler à ses visiteurs à travers une porte plutôt que face à face. Elle acquiert une notoriété locale ; on la voit rarement, et quand on la voit, elle est généralement vêtue de blanc. La pièce de sa garde-robe qui lui a survécu est une robe blanche en coton, probablement cousue aux environs de 1878-1882. Peu d’autochtones, qui échangèrent des messages avec elle durant les quinze dernières années de sa vie, la virent en personne. Austin et sa famille commencent à protéger la solitude d’Emily, décidant de ne pas en faire un sujet de discussion avec des étrangers. Malgré sa réclusion physique, Emily est socialement active et s’exprime à travers ce qui constitue deux-tiers des notes et lettres qui nous sont parvenues. Lorsque des invités viennent à la propriété familiale ou à Evergreens, elle se retire souvent et envoie des petits cadeaux sous forme de fleurs ou de poèmes. Toute sa vie, elle entretient d’excellents rapports avec les enfants. Mattie Dickinson, le deuxième enfant d’Austin et Sue, dira plus tard que Tante Emily représente l’indulgence. MacGregor Mac Jenkins, le fils d’amis de la famille qui écrira en 1891 un court article appelé Un souvenir d’enfance d’Emily Dickinson A Child's Recollection of Emily Dickinson, se rappelle qu’elle offrait toujours son aide aux enfants du voisinage. Quand Higginson la presse d’aller à Boston en 1868 afin de pouvoir enfin la rencontrer, elle décline l’invitation et écrit : Je serais très heureuse s’il venait à votre convenance de voyager aussi loin qu’Amherst, mais, moi, je ne traverserai pas les terres de mon Père pour me rendre dans quelque Maison ou ville que ce soit. Ils ne se rencontreront qu’en 1870, lorsqu’il se rendra à Amherst. Plus tard, dans ce qui est la description la plus détaillée et la plus vivante que nous ayons d’Emily, il parle d’elle comme une petite femme ordinaire avec deux bandeaux lisses de cheveux roux… dans un piqué blanc clair et exquis et un châle bleu ouvragé en laine peignée. Il dit également qu’il n’a jamais été avec quiconque qui épuise autant mes nerfs. Sans la toucher, elle puise en moi. Je suis content de ne pas vivre auprès d’elle. Bouquets de fleurs et poésies Le professeur Judith Farr note que, de son vivant, Emily est peut-être plus connue comme jardinière que comme poète. Elle prend des cours de botanique dès l’âge de neuf ans et, avec ses sœurs, entretient le jardin de Homestead. Tout au long de sa vie, elle rassemble une collection de plantes séchées dans un herbier relié en cuir de soixante six pages. Il contient 424 spécimens de fleurs séchées qu’elle a cueillies, classées et étiquetées en utilisant le système de la nomenclature binominale. De son temps, le jardin de Homestead est connu et admiré. Mais il n’a pas survécu et Emily n’avait conservé aucun calepin de jardinage, ni liste de plantes. Cependant, on peut en avoir une bonne impression à travers les lettres et les souvenirs de sa famille et de ses amis. Sa nièce, Martha Dickinson Bianchi, se souvient de tapis de muguet et de pensées, de rangs de pois de senteur et de jacinthes, il y en avait suffisamment en mai pour donner la dyspepsie à toutes les abeilles de l’été. Il y avait des rubans de haies de pivoines et des amoncellements de jonquilles, des soucis à foison – un vrai rêve de papillon. Emily cultive notamment des fleurs exotiques parfumées, et écrit qu’elle peut vivre aux îles des épices simplement en traversant la salle à manger vers la serre, où les plantes sont accrochées dans des paniers. Elle envoie fréquemment à ses amis des bouquets de fleurs auxquels sont attachés des poèmes, et ils appréciaient les bouquets plus que la poésie. Décès des êtres chers Le 16 juin 1874, à Boston, le père d’Emily subit une attaque cérébrale et meurt. Pendant les obsèques qui se tiennent dans l’entrée de Homestead, Emily se cantonne dans sa chambre, la porte légèrement ouverte. Elle ne participe pas non plus à la cérémonie funèbre du 28 juin. Elle écrit à Higginson que le cœur de son père était pur et terrible et je crois qu’aucun autre comme lui n’existe. Un an plus tard, le 15 juin 1875, la mère d’Emily subit également une attaque qui la laisse paralysée d’un côté du corps et la fait souffrir de pertes de mémoire. Se plaignant des besoins croissant de sa mère, aussi bien sur le plan physique que mental, elle écrit : La Maison est si loin de la Maison. Though the great Waters sleep, That they are still the Deep, We cannot doubt – No vacillating God Ignited this Abode To put it out – Bien que les grandes Eaux sommeillent, Et soient encore Profondes On ne peut douter – Qu’aucun Dieu vacillant N’a enflammé cette Demeure Pour l’éteindre - Otis Phillips Lord, un vieux juge siégeant à la Cour suprême judiciaire du Massachusetts à Salem, fait la connaissance d’Emily Dickinson en 1872 ou 1873. Après la mort de sa femme, en 1877, son amitié avec Emily devint probablement une romance de vieillesse, mais ceci n’est qu’une supposition, la plupart de leurs lettres ayant été détruites. Emily trouve en Lord une âme sœur, notamment en termes d’intérêts littéraires communs, les lettres qui nous sont parvenues citent les œuvres de William Shakespeare comme Othello, Antoine et Cléopâtre, Hamlet et Le Roi Lear. En 1880, il lui offre Complete Concordance to Shakespeare de Cowden Clarke 1877. Emily écrit : Alors que d’autres vont à l’Église, je vais à la mienne, car n’êtes-vous pas mon Église, et n’avons-nous pas un cantique que seul nous connaissons ? Elle l’appelle Mon beau Salem et ils s’écrivent religieusement tous les dimanches. Emily attend ce jour avec impatience ; un fragment d’une de ses lettres fait état que Mardi est un jour profondément déprimant. Après avoir été gravement malade pendant de longues années, le juge Lord s’éteint en mars 1884. Emily se réfère à lui comme notre dernière Perte. Deux années auparavant, le 1er avril 1882, Charles Wadsworth, le Berger de la Jeunesse d’Emily, étaient également mort après une longue maladie. Déclin et mort Même si elle continue à écrire durant ses dernières années, Emily Dickinson arrête d’organiser ses poèmes et oblige sa sœur Lavinia à lui promettre de brûler ses papiers. Cette dernière ne se mariera pas et demeurera à Homestead jusqu’à sa mort en 1899. Les années 1880 sont difficiles pour les Dickinson. Se détachant irrémédiablement de sa femme, Austin tombe amoureux en 1882 de Mabel Loomis Todd, qui vient d’emménager récemment dans la région. Mabel n’a jamais rencontré Emily mais, intriguée, elle se réfère à elle comme « la femme que l’on appelle le Mythe. Austin se distancie de sa famille, faisant fructifier ses affaires, et sa femme en tombe malade de chagrin. La mère d’Emily meurt le 14 novembre 1882. Cinq semaines plus tard, Emily écrit : Nous n’avons jamais été proches… même si elle était notre Mère – mais les Mines d’une même Terre se rencontrent en creusant un tunnel et quand elle devint notre Enfant, l’affection survint. L’année suivante, Gilbert, le troisième et plus jeune enfant d’Austin et Sue – le préféré d’Emily – meurt de la fièvre typhoïde. Alors que les morts se succèdent, Emily Dickinson voit son monde s’effondrer. À l’automne 1884, elle écrit que les Décès ont été trop importants pour moi, et avant que mon cœur ait pu se remettre de l’un, un autre survenait. Cet été là, elle voit une grande obscurité arriver et s’évanouit en faisant la cuisine. Elle reste inconsciente jusque tard dans la nuit et tombe malade des semaines durant. Le 30 novembre 1885, sa faiblesse et ses autres symptômes sont si alarmants qu’Austin annule un voyage à Boston. Elle reste clouée au lit pendant quelques mois, mais parvient à envoyer quelques lettres au printemps. Ce qu’on pense être sa dernière lettre a été envoyée à ses cousines, Louise et Frances Norcross, et dit simplement Petites Cousines, j’ai été rappelée. Emily. Le 15 mai 1886, après plusieurs jours d’aggravation, Emily meurt à l’âge de 55 ans. Austin écrit dans son journal que la journée a été terrible… elle a cessé cette horrible respiration juste avant que la cloche de l’après-midi ne sonne six heures. Le médecin d’Emily attribue son décès au Mal de Bright qui aurait duré deux ans et demi. Emily Dickinson est enterrée dans un cercueil blanc, avec des héliotropes vanillées, des orchidées Calceolaria biflora et un bouquet de violettes. La cérémonie funéraire, qui se tient dans la bibliothèque de Hamstead, est simple et courte ; Higginson, qui ne l’a rencontré que deux fois, lit : No Coward Soul Is Mine Mon âme n’est pas lâche, le poème d’Emily Brontë que préférait Emily Dickinson. À la demande d’Emily, son cercueil ne fut pas conduit, mais porté à travers un champ de renoncules, jusqu’au carré familial à l’ouest du Cimetière sur Triangle Street.
#26
Émily Dickinson 2
Loriane
Posté le : 14/05/2016 16:44
Publications De son vivant Malgré l’écriture prolifique d’Emily Dickinson, moins d’une douzaine de ses poèmes fut publié de son vivant. Entre 1858 et 1868, quelques poèmes sont imprimés dans le Springfield Republican de Samuel Bowles. Ils sont publiés anonymement et fortement altérés, notamment avec une ponctuation plus conventionnelle et des titres formels.Le premier poème, Personne ne connaît la petite rose, a probablement été publié sans la permission d’Emily. Le Republican diffuse Un étroit Personnage dans l’Herbe sous le titre Le Serpent, En sécurité dans leurs chambres d’albâtre sous le titre Le Sommeil et Flamboyant d’or et apaisé de violet sous le titre Coucher de soleil. Le poème J’ai gouté une liqueur jamais distillée est un des exemples de version modifiée ; les deux dernières lignes de la première strophe ont été complètement réécrites pour correspondre aux rimes conventionnelles Texte original I taste a liquor never brewed – From Tankards scooped in Pearl – Not all the Frankfort Berries Yield such an Alcohol! Version du Republican I taste a liquor never brewed – From Tankards scooped in Pearl – Not Frankfort Berries yield the sense Such a delirious whirl! En sécurité dans leurs chambres d’albâtre - titré Le Sommeil, tel qu’il a été publié dans le Springfield Republican en 1862. En 1864, plusieurs poèmes sont modifiés et publiés dans Drum Beat, afin de lever des fonds pour les soins médicaux des soldats de l’Union. Un autre poème parait en avril 1864 dans le Brooklyn Daily Union. En 1870, Higginson montre les poèmes d’Emily à Helen Hunt Jackson, qui était à l'Amherst Academy à la même période qu’elle. Helen était très introduite dans le monde de l’édition et réussit à convaincre Emily de publier anonymement son poème Success is counted sweetest dans A Masque of Poets. Mais le poème est, encore une fois, modifié pour s’accorder aux goûts contemporains. Ce fut le dernier publié du vivant d’Emily Dickinson. Après que sa sœur, Lavinia, a découvert les recueils de près de huit cents poèmes, le premier volume de ses œuvres est publié quatre ans après sa mort. Jusqu’à la parution en 1955 de Complete Poems Poèmes complets de Thomas H. Johnson, sa poésie était considérablement révisée et modifiée par rapport à la version originale. Depuis 1890, Emily Dickinson n’a pas cessé d’être éditée. Posthume Après la mort d’Emily, Lavinia tient sa promesse et brûle une grande partie de sa correspondance. Cependant, elle n’avait laissé aucune instruction au sujet des quarante livrets et feuilles volantes rassemblés dans un coffre fermé à clé. Lavinia reconnait la valeur des poèmes et devient obsédée par leur publication. Elle demande alors de l’aide à la femme de son frère, Susan, puis à sa maîtresse, Mabel Loomis Todd. Une querelle s'ensuit, divisant les manuscrits entre les maisons de Mabel et de Sue, et empêchant la publication des œuvres complètes d’Emily pendant plus d’un demi siècle. Le premier volume des Poèmes d’Emily Dickinson, édité conjointement par Mabel Loomis Todd et T. W. Higginson, parait en novembre 1890. Même si Mabel Todd prétend que seuls des changements essentiels ont été faits, les poèmes ont été largement modifiés pour convenir aux standards de ponctuation et de majuscule de la fin du XIXe siècle, se permettant des réécritures occasionnelles pour diminuer les circonlocutions d’Emily. Le premier volume, rassemblant 115 poèmes, est un succès critique et financier, et sera réédité onze fois pendant deux ans. Poems: Second Series suit en 1891, déjà réédité cinq fois en 1893; une troisième série parait en 1896. En 1892, un critique écrit : Le monde ne sera pas satisfait tant que la moindre bribe de ses écrits, lettre ou œuvre littéraire n’aura pas été publié. Deux ans plus tard, deux volumes paraissent rassemblant des lettres d’Emily Dickinson fortement modifiées. En parallèle, Susan Dickinson place quelques poèmes d’Emily dans des magazines littéraires comme Scribner's Magazine ou The Independent. Entre 1914 et 1929, la nièce d’Emily, Martha Dickinson Bianchi, publie une nouvelle série de recueils, incluant de nombreux poèmes inédits, mais toujours avec une ponctuation et des majuscules normalisées. D’autres volumes suivront dans les années trente, édités par Mabel Todd et Martha Dickinson, rendant progressivement disponibles des poèmes inconnus jusque là. La première publication critique a lieu en 1955 sous la forme de trois nouveaux volumes publiés par Thomas H. Johnson. Ils seront la base de toute étude ultérieure de l’œuvre d’Emily Dickinson. Pour la première fois, les poèmes sont imprimés quasiment sous leur forme originale. Ils n’ont pas de titre, sont classés dans un ordre chronologique approximatif, parsemés de tirets et de majuscules irrégulières, et souvent extrêmement elliptiques. Trois ans plus tard, Thomas Johnson et Theodora Ward éditent et publient un recueil complet des lettres d’Emily. Poésie On peut diviser en trois périodes distinctes l’œuvre poétique d’Emily Dickinson. Avant 1861. Des poèmes conventionnels et sentimentaux120. Thomas H. Johnson, qui publia The Poems of Emily Dickinson, parvient à dater cinq poèmes avant 1858. Deux d’entre eux sont de faux billets de la Saint-Valentin écrits dans un style très alambiqué et humoristique et deux autres sont des poèmes conventionnels dont l’un parle de son frère, Austin, qui lui manque. Le cinquième poème, qui commence par I have a Bird in spring J’ai un oiseau au printemps, parle de son chagrin de perdre une amitié et a été envoyé à son amie Sue Gilbert. 1861–1865. Sa période la plus créative, ses poèmes sont plus énergiques et émotionnels. Johnson estime qu’elle a écrit 86 poèmes en 1861, 366 en 1862, 141 en 1863 et 174 en 1864. Il pense également que c’est à cette époque qu’elle développe pleinement les thèmes de la vie et de la mort. Après 1866. On estime que les deux-tiers de son œuvre poétique ont été écrits avant cette date. Principaux thèmes Comme Emily Dickinson n’a laissé aucun écrit quant à ses objectifs esthétiques et que ses thèmes étaient très éclectiques, son travail est difficile à attribuer à un genre quelconque. On la considère parfois comme une transcendentaliste proche de Ralph Waldo Emerson dont Emily admirait les poèmes. Cependant, Judith Farr rejette cette analyse en avançant que la poétesse a un esprit scrutant sans cesse… ce qui ne peut que dégonfler l’élévation aérienne des Transcendantaux. Elle utilise aussi souvent l’humour, les jeux de mots, l’ironie et la satire. Les thèmes principaux de l’œuvre d’Emily Dickinson sont les suivants : Fleurs et jardins. Judith Farr note que ses poèmes et ses lettres concernent pratiquement toujours les fleurs et que les allusions aux jardins font référence à un royaume imaginaire… dans lequel les fleurs font office d’emblèmes pour les actions et les émotions. Elle associe les fleurs comme la gentiane et l’anémone avec la jeunesse et l’humilité ; d’autres avec la prudence et perspicacité. Quand elle envoie ses poèmes à ses amis, ils sont souvent accompagnés de lettres et de petits bouquets. On remarque que l’un de ses premiers poèmes, écrit en 1859, assimile la poésie elle-même avec les bouquets : My nosegays are for Captives – Dim – long expectant eyes – Fingers denied the plucking, Patient till Paradise – To such, if they sh'd whisper Of morning and the moor – They bear no other errand, And I, no other prayer Mes bouquets sont pour des yeux Captifs - Incertains – et attendant depuis longtemps - Les Doigts refusent de cueillir, Patientent jusqu’au Paradis - Pour eux – s’ils doivent chuchoter Du matin et de la terre - Ils ne portent aucun autre message, Et moi, aucune autre prière Les poèmes au Maître. Emily Dickinson laisse un grand nombre de poèmes adressé à Signor, Sir et Master Seigneur, Monsieur, Maître qui est « l’amoureux d’Emily pour toute l’éternité ». Ses confessions poétiques sont souvent « brûlantes dans leur introspection », « poignantes pour le lecteur » et empruntent leurs métaphores aux textes et peintures contemporains d’Emily. La famille Dickinson pensait que ces textes s’adressaient à des personnes réelles, mais beaucoup de spécialistes ont rejeté depuis cette analyse. Judith Farr, par exemple, prétend que le Maître est une personne composite inatteignable, « humaine, avec des caractéristiques spécifiques, mais divine » et spécule que le Maître est une sorte de muse chrétienne. Le Macabre. Les poèmes d’Emily Dickinson reflètent sa « fascination précoce et permanente » pour la maladie, l’agonie et la mort. Surprenant pour une célibataire de Nouvelle-Angleterre, ses poèmes font allusion à la mort par de nombreuses méthodes : « crucifixion, noyade, pendaison, asphyxie, froid, ensevelissement vif, arme à feu, poignard et guillotine ». Ses idées les plus fortes sont réservées au « coup mortel porté par Dieu » et à l’enterrement intellectuel; elles sont souvent renforcées par des images de soif et de faim. Vivian Pollak, spécialiste d’Emily Dickinson, considère que ses références sont un reflet autobiographique de la « persona assoiffée et affamée » d’Emily, une expression externe de son image indigente d’elle-même : petite, mince et frêle. Ses poèmes les plus complexes psychologiquement explorent le thème de la perte de l'appétit pour la vie qui provoque la mort du soi et le considère comme un intermédiaire au meurtre et au suicide . Poèmes évangéliques. Tout au long de sa vie, Emily écrit des poèmes reflétant sa préoccupation pour les enseignements de Jésus Christ et beaucoup lui sont même adressés. Elle souligne la pertinence des Évangiles contemporains et les recrée, avec souvent de l’esprit et dans un langage plus familier. L’expert Dorothy Oberhaus pense que le trait saillant unissant les poètes chrétiens… est leur attention révérencieuse pour la vie de Jésus Christ » et soutient que les structures profondes d’Emily la placent dans « la tradition poétique de la dévotion chrétienne » aux côtés de Gerard Manley Hopkins, T. S. Eliot et W. H. Auden. Dans un poème sur la Nativité, Emily combine légèreté et esprit pour revisiter un ancien thème : The Savior must have been A docile Gentleman – To come so far so cold a Day For little Fellowmen The Road to Bethlehem Since He and I were Boys Was leveled, but for that would be A rugged billion Miles – Le Sauveur devait être ; Un Gentleman bien docile – Pour venir si loin en un jour si froid Pour de petits Semblables La Route de Bethléem Depuis que Lui et moi étions enfants A été aplanie, mais pour que cela soit il fallut Un milliard de rudes Miles – Le Continent Inexploré. L’universitaire Suzanne Juhasz considère qu’Emily Dickinson voit l’intellect et l’esprit comme des endroits tangibles que l’on peut visiter et elle y vécut la plus grande partie de sa vie. Souvent, elle se réfère à cet endroit intensément privé comme « le continent inexploré » et elle l’embellit avec une imagerie de la nature. À d’autres moments, l’imagerie est plus sombre et menaçante – châteaux et prisons, avec leurs corridors et salles -, créant une demeure pour le « soi » où on peut habiter avec tous les autres soi-même. Le poème suivant met en exergue plusieurs de ces idées : Me from Myself – to banish – Had I Art – Impregnable my Fortress Unto All Heart – But since myself—assault Me – Except by subjugating Consciousness And since We're mutual Monarch How this be Except by Abdication – Me – of Me? De Moi-même – me bannir - Si j’en avais l’Art - Imprenable ma forteresse De Tout Cœur - Mais puisque moi-même – je M’agresse - Sauf en soumettant La Conscience Et puisque Nous sommes notre Monarque mutuel Comment cela est-il possible Excepté par Abdication - par Moi – de Moi-même ? Emily Dickinson est inscrite au National Women's Hall of Fame. Extraits This is my letter to the World That never wrote to Me — The simple News that Nature told - With tender Majesty Her Message is committed To Hands I cannot see - For love of Her - Sweet - countrymen - Judge tenderly - of Me I’m nobody! Who are you ? Are you nobody, too ? Then there’s a pair of us — don’t tell ! They’d banish us, you know. How dreary to be somebody ! How public, like a frog To tell your name the livelong day To an admiring bog ! Œuvre Éditions anglaises (en) Thomas H. Johnson, The Complete Poems of Emily Dickinson, Boston: Little, Brown & Co., 1960 The Poems of Emily Dickinson, présenté par R. W. Franklin, Cambridge: Belknap Press.1999 Éditions françaises Vingt poèmes, Minard, 1963 Quarante-sept poèmes, traduction de Philippe Denis, Genève, La Dogana, 1987 Poèmes, Belin, 1989 Vivre avant l'éveil, Arfuyen, 1989 Une âme en incandescence, traduction et présentation de Claire Malroux, collection « Domaine romantique», José Corti, 1998 Autoportrait au roitelet, Hatier, 1990 Lettre au monde, Limon, 1991 Escarmouches, La Différence, 1992 Lettres au maître, à l'ami, au précepteur, à l'amant, traduction et présentation de Claire Malroux, collection Domaine romantique, José Corti, 1999 Avec amour, Emily, traduction et présentation de Claire Malroux, collection « Domaine romantique », José Corti, 2001 Y aura-t-il pour de vrai un matin, traduction et présentation de Claire Malroux, collection « Domaine romantique », José Corti, 2008 Quatrains et autres poèmes brefs, traduction et présentation de Claire Malroux, édition bilingue, Gallimard, coll. poésie, 2000 Car l'adieu, c'est la nuit, édition bilingue français-anglais, traduction et présentation de Claire Malroux, collection NRF, Gallimard, 2007 Lieu-dit, l'éternité : Poèmes choisis, édition bilingue français-anglais, traduction et présentation de Patrick Remaux, collection Points, Seuil, 2007 Poésies complètes, édition bilingue, traduction de Françoise Delphy, Flammarion, 2009 Menus abîmes, poèmes d’Emily Dickinson, traduit par Antoine de Vial 1ère partie)Orisons 2012 En Poussière honorée, traduction de Philippe Denis, La Ligne d'ombre, 2013 Nous ne jouons pas sur les tombes, édition bilingue, traduction de François Heusbourg, avant-propos de Caroline Sagot Duvauroux, Editions Unes, 2015 Hommages Barbara Eramo, italienne auteure compositeur, a publié en 2014 "Emly", mise en musique de poésies d'Emliy Dickinson Christian Bobin, écrivain français, a publié en 2007 aux éditions Gallimard un livre sur Emily Dickinson, intiltulé La dame blanche.[/b]     
#27
John Stuart Mill
Loriane
Posté le : 06/05/2016 19:37
Le 8 mai 1873 à Avignon meurt John Stuart Mill
à 66 ans, né le 20 mai 1806 à Londres, philosophe, logicien et économiste britannique. Parmi les penseurs libéraux les plus influents du XIXe siècle, il était un partisan de l'utilitarisme, une théorie éthique préalablement exposée par Jeremy Bentham, dont Mill proposa sa version personnelle. En économie, il fut l'un des derniers représentants de l'école classique. Féministe précurseur, Mill proposa en outre un système de logique qui opère la transition entre l'empirisme du XVIIIe siècle et la logique contemporaine. Il fut enfin l'auteur du premier grand traité sur la démocratie représentative intitulé : Considération sur le gouvernement représentatif 1861. De tradition Utilitarisme, empirisme, libéralisme. Ses principaux intérêts : Éthique, philosophie politique, économie, logique, épistémologie. ses Idées remarquables sont ; Séparation des sphères publique et privée, hiérarchisation des plaisirs dans la théorie utilitariste, émancipation des femmes, logique inductive. Ii est influencé par Épicure, Diogène, Hume, Bentham, James Mill, Comte, Tocqueville, et beaucoup d'autres. Il a influencé Henry Sidgwick, William James, Edmund Husserl, Bertrand Russell, Peter Singer et beaucoup d'autres. Son père est James Mill, il est marié à Harriet Taylor Mill En bref Au milieu du XIXe siècle, Mill, philosophe et économiste anglais, représente à la fois le couronnement de la pensée libérale et l'attirance vers le socialisme utopique de l'époque ; sa philosophie emprunte à l'empirisme de Hume, à l'utilitarisme de Bentham, à l'associationnisme de son père James Mill, à Saint-Simon, à Comte. En même temps, Mill souligne la portée limitée de leurs théories, car il pressent que la réalité est trop complexe pour être enfermée en une explication unique. « Il incarne en une grandiose synthèse, sous tous ses aspects et dans toute son ampleur, la conception atomistique de l'homme et du monde » (D. Villey). Partisan convaincu de la démocratie parlementaire, il craint qu'en pratique le conformisme de la masse ne devienne despotisme et n'écrase les individus. À son sentiment philanthropique vis-à-vis de l'humanité, on peut opposer ses vues pessimistes de la nature humaine, grossière et brutale. Son socialisme apparaît réservé à l'avenir, à une élite d'hommes supérieurs, lorsque « l'ignorance et la brutalité des masses » auront disparu. Comme pour l'utilité, le bonheur qu'il propose comme fin suprême de l'activité de l'homme n'a rien de bas, de sensuel, mais c'est un bonheur de qualité que l'homme doit rechercher. Une vie déchirée. Né à Londres, John Stuart Mill fut l'aîné de neuf enfants d'un ami et disciple de Bentham et de Ricardo. Désirant montrer que, suivant Helvetius, l'éducation est toute-puissante dans la formation de l'individu, James Mill en fit l'expérience sur John Stuart. Il réussit sans doute à en faire un enfant prodige, mais à quel prix ! S'astreignant à tout lui apprendre lui-même, il lui imposa une discipline de fer dans la vie et la pensée. À trois ans, John Stuart commence l'étude du grec ; à huit ans, il a lu Hérodote, Xénophon et Platon en partie ; il apprend le latin, est chargé de l'enseigner à ses frères. Pas de récréations, pas de jouets ; son père l'emmène dans ses promenades, et il doit alors lui résumer ses lectures de la veille, puis il l'écoute disserter sur la société et l'économie. Quant aux soirées, elles sont réservées à l'arithmétique. À douze ans, il étudie Aristote, la logique de Hobbes. À treize ans, il lit les Principes de Ricardo. Cette éducation rigide, toujours tendue, sans affection, sans amusements, le modela et le déforma profondément. Il en restera marqué pour la vie, certes enrichi intellectuellement, mais vieilli avant l'âge, ayant une avance d'un quart de siècle sur ses contemporains, esprit purement livresque, resté enfantin à certains égards. À quatorze ans, il est envoyé en France pour un an, passe à Paris, où il est reçu par J.-B. Say, et s'installe dans le Midi. Il respire enfin ; ce fut pour lui la révélation de « l'atmosphère libre et douce de la vie que l'on mène sur le continent . À son retour, après avoir lu le Traité de législation de P.-L. Dumont exposant les vues de Bentham, il se déclare disciple de ce dernier. Il fonde l' Utilitarian Society en 1822 et commence à écrire des articles sur le radicalisme philosophique. Il entre en 1823 à la Compagnie des Indes sous les ordres de son père ; il va y faire toute sa carrière : en 1856, il en deviendra le chef contrôleur et se retirera à sa dissolution en 1858. Cependant, l'influence dominante de son père commence à lui peser, et des doutes surgissent dans son esprit sur les idées de Bentham. En 1826, ses réflexions et les discussions à la Speculative Debating Society aboutissent à une crise de dépression. Il rejette le modèle utilitaire simple et s'éloigne de la doctrine de son père. Mais s'il s'émancipe d'un côté, c'est pour tomber sous l'emprise de Mme Taylor, dont il tombe follement amoureux en 1830, et dont il va se faire le fidèle chevalier servant durant vingt ans avant de l'épouser en 1851, après la mort de M. Taylor. À l'en croire, il aurait trouvé en elle cette sensibilité affective à laquelle il aspirait et une ouverture d'esprit, sur les questions humaines et sociales, qui lui manquait. Il déclare très haut lui devoir le meilleur de ses pensées. En dépit – ou à cause – de cette passion aveugle, on peut estimer qu'elle l'a simplement révélé à lui-même. Il avait, en effet, besoin de se sentir compris. Il a voué à Mme Taylor un amour exalté et romantique dont témoignent la curieuse lettre qu'il lui remet le jour de leur mariage, la touchante préface de son livre On Liberty, l'épitaphe dithyrambique et élégiaque qu'il fit graver sur son tombeau à Avignon lorsqu'elle y mourut en 1858. Désormais, il va se retirer dans une petite maison hors des remparts d'Avignon, à Saint-Véran, d'où il voit le cimetière où repose sa femme, qu'il ira rejoindre en 1873. Durant ces quatorze années, il publie de nombreux articles et livres d'ordre philosophique, politique, économique. En dépit des conditions qu'il avait posées : ne pas faire de campagne, ne pas s'occuper des affaires des électeurs, demander le vote des femmes, il fut élu à Westminster en 1865. Il y prit part aux discussions sur la question foncière en Irlande, la réforme électorale en faveur des Noirs de la Jamaïque, toujours en invoquant ses principes et en faisant fi des partis. Il ne fut donc pas surpris de ne pas être réélu en 1868. Il vécut alors entouré par sa belle-fille, Helen Taylor, dans sa petite maison de Saint-Véran, lisant, écrivant, discutant, faisant de longues courses botaniques. Sa vie Fils aîné de James Mill, il est né dans la maison parentale à Pentonville, Londres. Il a été instruit par son père, sur les conseils et avec l'assistance de Jeremy Bentham et David Ricardo. Il reçut une éducation extrêmement rigoureuse et fut délibérément protégé des relations avec les enfants de son âge. Son père, adepte de Bentham et défenseur de l'associationnisme, avait pour but avoué de faire de lui un génie qui pourrait poursuivre la cause de l'utilitarisme et de ses applications après sa mort et celle de Bentham. Il fut d'une intelligence et d'une culture exceptionnellement précoces ; son père lui avait appris à l'âge de trois ans l'alphabet grec et une longue liste de mots grecs avec leurs équivalents en anglais. À huit ans, il avait lu les fables d'Ésope, l'Anabase de Xénophon, tout Hérodote, il était à l'aise avec Lucien de Samosate, Diogène, Isocrate et connaissait six dialogues de Platon. Il avait aussi lu une grande quantité d'ouvrages sur l'histoire. Toujours à l'âge de huit ans, Mill commença le latin, étudia Euclide, l'algèbre et fut chargé de l'éducation des plus jeunes enfants de la famille. Ses principales lectures concernaient l'histoire, mais il lut tous les auteurs latins et grecs communément étudiés dans les collèges et les universités de l'époque. Il n'avait pas à composer en latin ou en grec et ne fut jamais un pur scolaire ; c'étaient des matières qu'il devait lire, et à dix ans il lisait Platon et Démosthène aisément. L'ouvrage de son père : Histoire des Indes, fut publié en 1818 ; immédiatement après, vers douze ans, John commença l'étude de la logique scolastique, tout en parcourant les traités de logique d'Aristote dans le texte. Les années suivantes, son père l'introduisit à l'économie politique par l'étude d'Adam Smith et de David Ricardo et, finalement, compléta sa vision économique avec l'étude des facteurs de production. À vingt ans, il est victime d'une dépression liée probablement au surmenage. Cet épisode de sa vie l'amène à reconsidérer l'utilitarisme de Bentham et de son père : il en vient à penser que l'éducation utilitariste qu'il avait reçue, si elle avait fait de lui une exceptionnelle « machine à penser », l'avait dans le même mouvement coupé de son moi profond et avait presque tari en lui toute forme de sensibilité. Dès lors, il tente de concilier la rigueur scientifique et logique avec l'expression des émotions. Ce sont les œuvres du poète Wordsworth qui, dans un premier temps, l'aident à développer une culture des sentiments, à faire resurgir en lui la vitalité du cœur, et l'amènent à se rapprocher de la pensée romantique. Sa charge de travail ne semble pas avoir handicapé Mill dans sa vie sentimentale : la famille qu'il forma avec sa femme, Harriet Taylor Mill, et sa belle-fille Helen Taylor, a été considérée par ses contemporains comme exceptionnellement réussie. Lui-même indique dans l'un de ses ouvrages que ceux-ci ne sont pas le travail d'un esprit, mais de trois. Notamment, il a décrit son essai De la liberté comme issu de la conjonction de l'esprit de sa femme Harriet, et du sien, et souligne dans des pages émouvantes de ses Mémoires combien l'amour qu'il lui portait se doublait d'une complicité intellectuelle intense : Lorsque deux personnes partagent complètement leurs pensées et leurs spéculations, lorsqu'elles discutent entre elles, dans la vie de tous les jours, de tous les sujets qui ont un intérêt moral ou intellectuel, et qu'elles les explorent à une plus grande profondeur que celle que sondent d'habitude et par facilité les écrits destinés aux lecteurs moyens ; lorsqu'elles partent des mêmes principes, et arrivent à leurs conclusions par des voies suivies en commun, il est de peu d'intérêt, du point de vue de la question de l'originalité, de savoir lequel des deux tient la plume. Celui qui contribue le moins à la composition peut contribuer davantage à la pensée ; les écrits qui en sont le résultat sont le produit des deux pris ensemble, et il doit souvent être impossible de démêler la part qu'ils y ont chacun, respectivement, et d'affirmer laquelle appartient à l'un, et laquelle, à l'autre. Ainsi, au sens large, non seulement durant nos années de vie maritale, mais encore durant les nombreuses années de complicité qui les précédèrent, toutes mes publications furent tout autant les œuvres de ma femme que les miennes... Mill et la France Il fut très affecté par le décès de sa femme à Avignon en 1858, morte d'une congestion pulmonaire, et il resta dès lors en France, pour demeurer près d'elle. Outre De la liberté, ses Considérations sur le gouvernement représentatif, qui reprennent notamment le système de représentation proportionnelle inventé par Thomas Hare afin d'assurer une représentation des minorités dans le cadre du suffrage universel, influença plusieurs auteurs français, dont le républicain-socialiste Louis Blanc, l'orléaniste Lucien-Anatole Prévost-Paradol, Joseph Guadet De la Représentation nationale en France, 1863, Alfred Le Chartier de Sedouy Réforme du suffrage universel, 1863 ou Hippolyte Passy Rapport sur un ouvrage de M. Stuart Mill, intitulé : Du Gouvernement représentatif, Séances et Travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1862 ; plusieurs articles de La Revue des deux Mondes, écrits par le duc d'Ayen ou Alfred Jacobs, rendent compte également cet ouvrage. Sa défense du droit de vote des femmes, qui donna lieu à un discours notable lors de la campagne pour le Reform Act de 1867, ainsi qu'à un ouvrage spécifique, eut moins de succès. Le jeune Clemenceau, enfin, traduit son livre Auguste Comte et le positivisme en échange de la publication de sa thèse de médecine. Il est enterré au cimetière Saint-Véran d'Avignon. La liberté : respect du non-conformisme Mill, esprit indépendant, individualiste avant tout, n'a toutefois pas d'unité de pensée ; il est plus ou moins tiraillé entre l'abstraction et l'utilitarisme de son père, et les élans parfois naïfs et romantiques de sa propre nature. Sa pensée est exposée avec clarté et force dans une œuvre extrêmement abondante et variée ; il a étudié tous les grands débats de son siècle. Sa pensée est très nuancée, si bien que parfois il est difficile de la saisir. S'il fallait cependant qualifier Mill par une formule rapide, nous dirions qu'il fut le non-conformiste de la liberté. Alors que son maître Bentham avait œuvré en moraliste, il raisonne en psychologue ; et tandis que le premier maintient la liberté dans l'État comme un élément de ce vaste édifice destiné à abriter la félicité humaine, Mill la situe en retrait, dans le petit temple individuel où chacun vient jouir de sa félicité personnelle. Sa conception de la liberté, il l'a exposée dans un livre, On Liberty, dont il n'est pas exagéré de dire qu'il a été l'un des bréviaires du libéralisme. La liberté, c'est la protection contre toute contrainte, et d'abord contre la plus redoutable de toutes, celle qu'exerce le groupe par l'entremise d'une opinion avide d'imposer ses coutumes, ses croyances et ses caractères. Aussi est-elle ici d'abord synonyme de droit à la dissidence et de non-conformisme. C'est ce non-conformisme qui invite Mill à refuser de confondre la liberté politique avec la loi du nombre. Sans doute, autrefois, lorsque la liberté et l'autorité étaient en conflit constant, entendait-on par liberté une protection contre la tyrannie des gouvernants. Pour l'assurer, on cherchait à assigner des limites au pouvoir de ceux-ci sur la communauté, soit en leur arrachant certaines immunités inscrites dans les chartes, soit, lorsque la technique gouvernementale se perfectionna, par l'établissement de freins constitutionnels impliquant le contrôle des gouvernés sur les décisions politiques. Un moment vint, cependant, où les gouvernés furent assez forts pour que le pouvoir fût exercé par leurs délégués, révocables à leur gré. Il semblait alors que la nation n'avait plus besoin d'être protégée contre sa propre volonté. Il n'y avait pas à craindre qu'elle se tyrannisât elle-même La Liberté, trad. M. Dupont-White. Cette idée que les peuples n'ont pas besoin de limiter un pouvoir qui procède d'eux ne fut pas ébranlée par la Révolution française dans laquelle on put voir une aberration temporaire. Mais, lorsque le gouvernement électif se fut établi durablement dans un grand pays – et Mill faisait allusion aux États-Unis –, « on s'aperçut que des phrases comme « le pouvoir sur soi-même » et « le pouvoir des peuples sur eux-mêmes » n'exprimaient pas le véritable état de choses ; le peuple qui exerce le pouvoir n'est pas toujours le même peuple que celui sur qui on l'exerce, et le gouvernement de soi-même dont on parle n'est pas le gouvernement de chacun par lui-même, mais de chacun par tout le reste ». Au surplus, on comprit que la volonté du peuple était, en fait, celle de la majorité. Bref, l'éventualité d'une tyrannie des assemblées dut être envisagée. Or cette tyrannie n'est, le plus souvent, qu'une manière d'être de l'oppression que le groupe entier tend à faire peser sur l' individu en imposant ses idées ou ses coutumes, en obligeant les caractères à se modeler sur ceux de la collectivité. Dès lors, pour Stuart Mill, la liberté résulte à la fois des limites à l'action de l'opinion collective sur l'indépendance individuelle et de la protection contre le despotisme politique. La seule liberté qui mérite ce nom est celle de chercher notre bien propre à notre propre façon, aussi longtemps que nous n'essayons pas de priver les autres du leur ou d'entraver leurs efforts pour l'obtenir . Pour une démocratie parlementaire Stuart Mill est pourtant trop profondément libéral pour s'accommoder d'une forme de gouvernement qui ne ferait pas sa place à la liberté politique. Mais liberté politique, c'est participation au pouvoir. La solution de cette contradiction entre la liberté désirable et la menace que comporte son accomplissement, c'est la démocratie gouvernée qui la fournit puisque, en acceptant le pouvoir du peuple, elle en canalise l'exercice par l'indépendance des gouvernants à l'égard des passions de la foule. C'est cette théorie de la démocratie gouvernée que Mill expose dans Considerations on Representative Government. Il s'efforce d'y établir qu'« une démocratie représentative... – où tous seraient représentés, et non pas seulement la majorité – où les intérêts, les opinions, les degrés d'intelligence qui sont en minorité seraient néanmoins entendus, avec chance d'obtenir, par le poids de leur réfutation et par la puissance de leurs arguments, une influence supérieure à leur force numérique – cette démocratie où se rencontreraient l'égalité, l'impartialité, le gouvernement de tous par tous, ce qui est le seul type véritable de la démocratie, serait exempte des plus grands maux inhérents à ce qu'on appelle mal à propos aujourd'hui la démocratie » (Le Gouvernement représentatif, trad. M. Dupont-White). L'utilitarisme anglais rejoint ainsi, par un détour, les conclusions du rationalisme français. On veut établir en maîtresse la volonté du peuple, mais on refuse de qualifier telle les passions de la foule ou les conséquences du nombre. On se refuse, avec une force égale, à voir la démocratie dans le gouvernement par une classe sociale, fût-elle la plus nombreuse. La démocratie n'est pas l'idéal de la meilleure forme de gouvernement [...] si elle ne peut être organisée de façon à ce qu'aucune classe, pas même la plus nombreuse, ne soit capable de réduire à l'insignifiance politique tout ce qui n'est pas elle, et de diriger la marche de la législation et de l'administration d'après son intérêt exclusif de classe. Trouver les moyens d'empêcher cet abus sans sacrifier les avantages caractéristiques du gouvernement populaire, voilà le problème ibid.. Option libérale et tendance socialiste On a souvent relevé l'orientation socialiste de la pensée de Mill. On doit souligner cependant l'originalité de ce socialisme si socialisme il y a qui se définit par la maîtrise de l'homme sur lui-même. Sans doute Mill ne condamne-t-il pas systématiquement l'intervention des gouvernants et, sur la fin de sa vie, dans les dernières éditions de ses Principles of Political Economy, l'envisage-t-il même avec faveur, afin de restreindre le droit de propriété. Mais plus que la question de savoir ce que les gouvernements doivent ou ne doivent pas faire, ce qui intéresse Mill, c'est le motif au nom duquel ils le font. Or, à cet égard, il pose un principe dont la valeur n'a cessé de s'imposer à sa pensée : Le seul objet qui autorise les hommes individuellement ou collectivement à troubler la liberté d'action d'aucun de leurs semblables, est la protection de soi-même. La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres. Elle n'en a pas une raison suffisante dans le bien de cet individu, soit physique, soit moral » (La Liberté). Ce respect de la spontanéité individuelle ne s'accompagne d'aucune arrière-pensée égoïste. Ce n'est pas au nom d'une quelconque sécurité bourgeoise qu'il s'impose. C'est parce qu'il est une condition du bonheur non seulement individuel mais collectif : ce n'est pas l'uniformité des pensées, des actes, des sentiments, qui crée le bonheur, c'est la diversité entre les hommes. La variété des opinions et des mœurs féconde la nature. Il n'est pas besoin de relever ce qu'a de spécifiquement anglais cette apologie de l'originalité. Il insiste toujours sur la nécessité de la liberté dans tous les domaines, car « l'unique source infaillible et permanente du progrès est la liberté ». Libertés économique et politique vont de pair, l'une ne pouvant exister sans l'autre. La concurrence, expression de la liberté, est à la fois facteur d'avancement de la société et moyen de développement de l'individu. Le libéralisme est dynamique et novateur. Mill entraîne l'école libérale non pas à la recherche de lois naturelles mais de recettes rationnelles en vue d'assurer le bonheur du plus grand nombre. Il s'écarte donc de la rigueur d'abstraction de Ricardo et se rapproche plutôt de Smith. Il adhère complètement au principe de population de Malthus ; la tendance de la population à dépasser les ressources disponibles à un moment donné explique la plupart des malheurs des hommes. D'où son combat en faveur de l'émancipation des femmes et l'éloge de la petite propriété paysanne en France. Il précise les avantages de la liberté des échanges internationaux par sa théorie des valeurs internationales. Mill a cru devoir faire une distinction entre les lois de la production et celles de la répartition ; les premières s'imposeraient à l'homme alors que les secondes seraient en grande partie exprimées par la législation. Acceptant l'analyse de la rente foncière de Ricardo d'après laquelle ce sont les propriétaires fonciers qui bénéficient à la longue du progrès, il propose un impôt spécial sur cet unearned increment (surplus non gagné). C'est un des points où se manifeste sa tendance sentimentale socialisante. Si Mill est plutôt pessimiste à court terme à cause des appétits brutaux des hommes, il est optimiste pour l'avenir : par suite de l'éducation des besoins, la société pourra parvenir à ce qu'il appelle l'état stationnaire. Il suppose qu'alors la population, aux goûts épurés, ne s'accroîtra pas et sera satisfaite de la quantité et de la nature des richesses matérielles produites ; le problème économique étant résolu, le problème social ne se posera plus. Les hommes n'emploieront pas leur vie à courir après les dollars, mais cultiveront les arts qui embellissent la vie ». Vue séduisante, si l'on accepte les prémisses. Par suite de la logique et de la clarté de leur exposition, ses écrits furent en honneur pendant un demi-siècle dans les universités anglaises. Mill est considéré avec sympathie par les libéraux et les interventionnistes, par les individualistes et les socialistes, parce qu'il refuse de se laisser enfermer dans une explication unique de la société. En dépit d'un certain flottement de sa pensée, sa vision d'une société idéale où, les problèmes économiques étant résolus, le bonheur de l'homme rassasié sera fait de plaisirs de qualité intellectuelle est peut-être prophétique. François Trévoux Principales œuvres Essays on economics and society, 1967 Système de logique déductive et inductive, 1843. Traduction française réalisée par Louis Peisse à partir de la 6e édition britannique de 1865. Paris : Librairie philosophique de Ladrange, 1866. Cet ouvrage n'est pas, malgré son titre, une répétition de la logique d'Aristote, ni un manuel supplémentaire pour une discipline codifiée. En réalité, le système est l'expression d'une philosophie nouvelle, chaînon indispensable qui relie David Hume à Bertrand Russell. Le système de logique nous offre sans doute un récapitulatif de tout ce qu'il faut entendre sous le terme de logique, mais il nous propose aussi une nouvelle théorie des sophismes, des noms propres, de la référence, et surtout de l'induction. On trouve chez Mill des réponses convaincantes au paradoxe de l'induction mis en évidence par Hume, comme l'on y lit la critique, devenue classique, de la déduction comme raisonnement circulaire, et condamné par nature à ne pouvoir remettre en cause, donc ne pas dépasser, ses axiomes et prémisses. Enfin, et ce n'est pas la moindre contribution de Mill, le système de logique met en place une théorie générale des sciences humaines et de leurs méthodes propres, nous rappelant ainsi que Mill est aussi l'auteur des Principes d'économie politique, et le contemporain de Karl Marx. Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, London, 1844 ; Principes d'économie politique, Londres, 1848, dans lequel il développe ses idées sur les droits sociaux et les libertés des travailleurs ; John Stuart Mill, interprète synthétique des classiques, livre ses « principes d'’économie politique ». Il définit les bornes du progrès des sociétés industrielles, notamment par la baisse tendancielle du taux des profits. Il constate que les mobiles d’agressivité et de gain ne sont utilisés que, faute de mieux, pour accroître les richesses matérielles ; leur déchaînement grevé d’un lourd passif, dégrade les hommes et leur ravit le loisir et la solitude. Les progrès économiques ne sont pas parvenus à engendrer les grands changements qui feraient, comme il convient, des inventions mécaniques la commune propriété du genre humain. Aussi, la société en vue du mieux-être de tous ses membres, peut-elle être réorientée et remodelée sans peur, même si elle doit pour cela perdre un peu de ses dynamismes matériels et manifestes. L’épanouissement de tout l’homme en chaque homme est desservi par les ruées d’êtres avilis sur une nature humiliée. L'humanité doit choisir l'état stationnaire avant que la nécessité ne l'y contraigne. Pour Heilbroner in Les Grands Économistes, il est l’auteur du « plus grand “mais” de l’histoire de la pensée économique ». En effet, Mill pose que la science économique s’applique à la production de biens et de services, permet d’utiliser au mieux les ressources, mais elle ne s’applique pas au champ de la répartition : c’est à la société de choisir le mode de répartition des richesses créées, ce qui laisse le champ libre à la politique, au rôle de l'État, à des choix de société, etc. De la liberté, titre en anglais : On Liberty, 1859. Première traduction française par Charles Brook Dupont-White, Paris : Guillaumin, 1860 ; Quelques mots sur la non-intervention, 1859. Essai de politique étrangère. Considerations on Representative Government, Londres, 1861 - Traductions françaises : Considérations sur le gouvernement représentatif par Patrick Savidan, Paris, Gallimard, 2009 / Considérations sur le gouvernement représentatif, par Malik Bozzo-Rey, Jean-Pierre Cléro, Claire Wrobel, Hermann, L'avocat du diable, 2014. Utilitarianism, Londres, 1863, Traduction française: L'utilitarisme ; An Examination of Sir Hamilton's Philosophy, Londres, 1865 ; Auguste Comte et le positivisme, Londres, 1865, Westminster Review ; première traduction française par Georges Clemenceau, rééd. chez Alcan, 1893 De l'assujettissement des femmes, 1869. Traduction française de Émile Cazelles. Paris : Éditions Avatar, 1992, 206 pages. Ouvrage dans lequel il défend la cause de l'émancipation des femmes et demande à ce qu'elles bénéficient elles aussi du suffrage, voir La Sujétion des femmes ; Autobiographie, Londres, 1873, traduction française ; Three Essays on Religion, Nature + Utility of Religion + Theism, Londres, 1874. Essais sur Tocqueville et la société américaine.     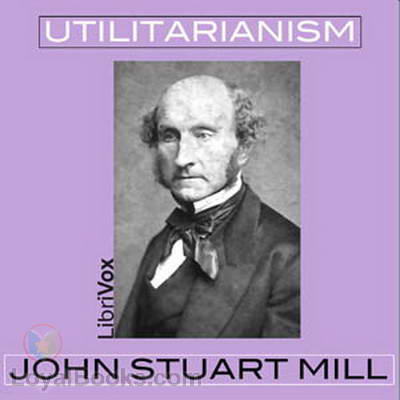 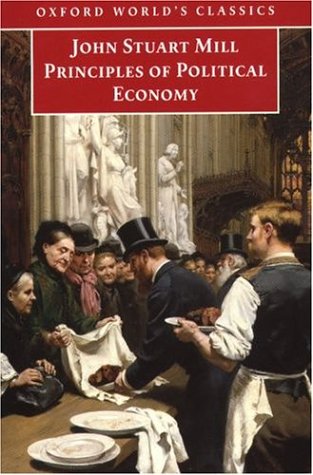
#28
Re: Jorge Manrique
Loriane
Posté le : 27/04/2016 18:16
Tu as eu la chance d'être allé à Cuenca, veinard !
Car ce n'est pas qu'un voyage, c'est surtout un merveilleux voyage dans le temps, l'âme castillane d'antan vit encore là-bas. Je suis très sensible à la musique de cette poésie, tiens je te la mets en Espagnol. Puis traduite (plutôt bien traduite d'ailleurs, la musique est moins présente en français mais le ressenti est là.) A la Muerte del Maestre de Santiago Don Rodrigo Manrique, Su Padre Jorge Manrique (1440–1479) • Recuerde el alma dormida, Avive el seso y despierte Contemplando Cómo se pasa la vida, Cómo se viene la muerte Tan callando ; Cuán presto se va el placer, Cómo después de acordado Da dolor, Cómo a nuestro parescer Cualquiere tiempo pasado Fue mejor. Y pues vemos lo presente Cómo en un punto s’es ido E acabado, Si juzgamos sabiamente, Daremos lo non venido Por pasado. Non se engañe nadie, no, Pensando que ha de durar Lo que espera Más que duró lo que vio, Porque todo ha de pasar Por tal manera. Nuestras vidas son los ríos Que van a dar en la mar, Que es el morir ; Allí van los señoríos Derechos a se acabar E consumir ; Allí los ríos caudales, Allí los otros medianos E más chicos ; Allegados, son iguales Los que viven por sus manos E los ricos. Invocación Dexo las invocaciones De los famosos poetas Y oradores ; Non curo de sus ficciones, Que traen yerbas secretas Sus sabores. A aquél solo me encomiendo, A aquél solo invoco yo De verdad, Que en este mundo viviendo, El mundo non conoció Su deidad. Este mundo es el camino Para el otro, qu’es morada Sin pesar ; Mas cumple tener buen tino Para andar esta jornada Sin errar. Partimos cuando nascemos, Andamos mientras vivimos, Y llegamos Al tiempo que fenecemos ; Así que cuando morimos Descansamos. Este mundo bueno fue Si bien usásemos d’él Como debemos, Porque, segund nuestra fe, Es para ganar aquél Que atendemos. Y aún el Hijo de Dios, Para sobirnos al cielo, Descendió A nascer acá entre nos. Y a vivir en este suelo Do murió. Ved de cuán poco valor Son las cosas tras que andamos Y corremos; Que en este mundo traidor Aun primero que muramos Las perdemos : D’ellas deshace la edad, D’ellas casos desastrados Que acaescen, D’ellas, por su calidad, En los más altos estados Desfallescen. Decidme: la hermosura, La gentil frescura y tez De la cara, La color e la blancura, Cuando viene la vejez ¿Cuál se para ? Las mañas e ligereza E la fuerza corporal De juventud, Todo se torna gaveza Cuando llega el arrabal De senectud. Pues la sangre de los godos, El linaje e la nobleza Tan crescida, ¡Por cuántas vías e modos Se pierde su grand alteza En esta vida ! ¡Unos por poco valer, por cuán baxos e abatidos Que los tienen ! ¡Otros que por no tener, Con oficios non debidos Se mantienen ! Los estados e riqueza Que nos dexan a deshora ¿Quién lo duda ? Non les pidamos firmeza Pues que son d’una señora Que se muda. Que bienes son de fortuna Que revuelve con su rueda Presurosa, La cual non puede ser una, Ni ser estable ni queda En una cosa. Pero digo que acompañen E lleguen hasta la huesa Con su dueño ; Por eso non nos engañen, Pues se va la vida apriesa Como un sueño : E los deleites d’acá Son en que nos deleitamos Temporales, E los tormentos d’allá Que por ellos esperamos, Eternales. Los placeres e dulçores D’esta vida trabajada Que tenemos, ¿Qué son sino corredores, E la muerte la celada En que caemos ? No mirando a nuestro daño Corremos a rienda suelta Sin parar ; Desque vemos el engaño E queremos dar la vuelta No hay lugar. Si fuese en nuestro poder Tornar la cara fermosa Corporal, Como podemos hacer El alma tan gloriosa Angelical, ¡Qué diligencia tan viva Tuviéramos cada hora, E tan presta, En componer la cativa, Dexándonos la señora Descompuesta ! Esos reyes poderosos Que vemos por escripturas Ya pasadas, Con casos tristes, llorosos, Fueron sus buenas venturas Trastornadas ; Así que no hay cosa fuerte ; Que a Papas y Emperadores E Prelados Así los trata la muerte Como a los pobres pastores De ganados. Dexemos a los Troyanos, Que sus males non los vimos, Ni sus glorias ; Dexemos a los Romanos, Aunque oímos o leímos Sus hestorias. Non curemos de saber Lo d’aquel siglo pasado Qué fue d’ello ; Vengamos a lo d’ayer, Que también es olvidado Como aquello. ¿Qué se hizo el Rey Don Joan ? Los Infantes de Aragón ¿Qué se hicieron ? ¿Qué fue de tanto galán, Que fue de tanta invención Que truxeron ? Las justas e los torneos, Paramentos, bordaduras E cimeras, ¿Fueron sino devaneos ? ¿Qué fueron sino verduras De las eras ? ¿Qué se hicieron las damas, Sus tocados, sus vestidos, Sus olores ? ¿Qué se hicieron las llamas De los fuegos encendidos De amadores ? ¿Qué se hizo aquel trovar, Las músicas acordadas Que tañían ? ¿Qué se hizo aquel dançar Aquellas ropas chapadas Que traían ? Pues el otro su heredero, Don Enrique ¡qué poderes Alcanzaba! ¡Cuán blando, cuán al agüero El mundo con sus placeres Se le daba! Mas verás cuán enemigo, Cuán contrario, cuán crüel Se le mostró, Habiéndole sido amigo, ¡Cuán poco duró con él Lo que le dio ! Las dádivas desmedidas, Los edificios reales Llenos d’oro Las baxillas tan febridas, Los enriques e reales Del tesoro ; Los jaeces, los caballos De su gente e atavíos Tan sobrados, ¿Dónde iremos a buscallos ? ¿Qué fueron sino rocíos De los prados ? Pues su hermano el inocente, Qu’en su vida sucesor Se llamó, ¡Qué corte tan excellente Tuvo e cuánto gran señor Le siguió ! Mas como fuese mortal, Metióle la muerte luego En su fragua. ¡Oh jüicio divinal ! Cuando más ardía el fuego Echaste agua. Pues aquel gran Condestable Maestre que conoscimos Tan privado, Non cumple que d’él se hable, Sino sólo que le vimos Degollado. Sus infinitos tesoros, Sus villas e sus lugares, Su mandar, ¿Qué le fueron sino lloros ? ¿Qué fueron sino pesares Al dexar ? E los otros dos hermanos, Maestres tan prosperados Como reyes, Qu’a los grandes e medianos Traxeron tan sojuzgados A sus leyes ; Aquella prosperidad Que tan alta fue subida Y ensalzada, ¿Qué fue sino claridad Que cuando más encendida Fue amatada ? Tantos Duques excellentes, Tantos Marqueses e Condes E Barones Como vimos tan potentes, Di, muerte, ¿dó los escondes E traspones ? Y sus muy claras hazañas Que hicieron en las guerras Y en las paces, Cuando tú, cruda, t’ensañas, Con tu fuerza los atierras E desfaces. Las huestes innumerables, Los pendones, estandartes E banderas, Los castillos impugnables, Los muros e balüartes E barreras, La cava honda chapada, O cualquier otro reparo ¿Qué aprovecha ? Cuando tú vienes airada Todo lo pasas de claro Con tu flecha. Aquel de buenos abrigo, Amado por virtuoso De la gente, El Maestre Don Rodrigo Manrique, tanto famoso E tan valiente, Sus grandes hechos e claros Non cumple que los alabe, Pues los vieron, Ni los quiera hacer caros, Pues qu’el mundo todo sabe Cuáles fueron. ¡Qué amigo de sus amigos ! ¡Qué señor para criados E parientes ! ¡Qué enemigo d’enemigos ! ¡ Qué Maestre de esforcados E valientes ! ¡Qué seso para discretos ! ¡Qué gracia para donosos ! ¡Qué razón ! ¡Cuán benigno a los subjetos ! ¡A los bravos e dañosos Qué león ! En ventura Octaviano ; Julio César en vencer E batallar ; En la virtud, Africano ; Aníbal en el saber E trabajar : En la bondad un Trajano; Tito en liberalidad Con alegría ; En su brazo, un Aureliano ; Marco Tulio en la verdad Que prometía. Antonio Pío en clemencia ; Marco Aurelio en igualdad Del semblante : Adriano en la elocuencia ; Teodosio en humanidad E buen talante. Aurelio Alexandre fue En disciplina e rigor De la guerra ; Un Constantino en la fe ; Camilo en el grand amor De su tierra. Non dexó grandes tesoros, Ni alcanzó muchas riquezas Ni baxillas, Mas fizo guerra a los moros, Ganando sus fortalezas E sus villas ; Y en las lides que venció Caballeros y caballos Se prendieron, Y en este oficio ganó Las rentas e los vasallos Que le dieron. Pues por su honra y estado En otros tiempos pasados ¿Cómo se hubo ? Quedando desamparado, Con hermanos e criados Se sostuvo. Después que fechos famosos Hizo en esta dicha guerra Que hacía, Hizo tratos tan honrosos, Que le dieron muy más tierra Que tenía. Estas sus viejas hestorias Que con su brazo pintó En juventud, Con otras nuevas victorias Agora las renovó En senectud. Por su grand habilidad, Por méritos e ancianía Bien gastada Aleançó la dignidad De la gran caballería Del Espada. E sus villas e sus tierras Ocupadas de tiranos Las halló, Mas por cercos e por guerras E por fuero de sus manos Las cobró. Pues nuestro Rey natural, Si de las obras que obró Fue servido, Dígalo el de Portugal, Y en Castilla quien siguió Su partido. Después de puesta la vida Tantas veces por su ley Al tablero ; Después de tan bien servida La corona de su Rey Verdadero ; Después de tanta hazaña A que non puede bastar Cuenta cierta, En la su villa d’Ocaña Vino la muerte a llamar A su puerta. (Habla la Muerte) Diciendo: « Buen caballero, Dexad el mundo engañoso E su halago ; Vuestro coraçon de acero Muestre su esfuerzo famoso En este trago ; E pues de vida e salud Fecistes tan poca cuenta Por la fama, Esfuércese la virtud Para sofrir esta afrenta Que vos llama. « No se os haga tan amarga La batalla temerosa Qu’esperáis, Pues otra vida más larga De fama tan glorïosa Acá dexáis : Aunque esta vida d’honor Tampoco no es eternal Ni verdadera, Mas con todo es muy mejor Que la otra temporal Perecedera. « El vivir qu’es perdurable Non se gana con estados Mundanales, Ni con vida delectable En que moran los pecados Infernales ; Mas los buenos religiosos Gánanlo con oraciones E con lloros ; Los caballeros famosos Con trabajos e aflicciones Contra moros. « E pues vos, claro varón, Tanta sangre derramastes De paganos, Esperad el galardón Que en este mundo ganastes Por las manos; E con esta confiança E con la fe tan entera Que tenéis, Partid con buena esperança Que’estotra vida tercera Ganaréis. » (Responde el Maestre) « Non tengamos tiempo ya En esta vida mezquina Por tal modo, Que mi voluntad está Conforme con la divina Para todo ; E consiento en mi morir Con voluntad placentera, Clara e pura, Que querer hombre vivir Cuando Dios quiere que muera Es locura. » Oración Tú que por nuestra maldad Tomaste forma servil E baxo nombre ; Tú que en tu divinidad Juntaste cosa tan vil Como el hombre ; Tú que tan grandes tormentos Sofriste sin resistencia En tu persona, Non por mis merescimientos, Mas por tu sola clemencia Me perdonas. Cabo Así con tal entender Todos sentidos humanos Conservados, Cercado de su mujer, E de sus hijos e hermanos E criados, Dio el alma a quien se la dio, (El cual la ponga en el cielo Y en su gloria), Que aunque la vida perdió, Nos dexó harto consuelo Su memoria. ************* À la Mort du Maître de Santiago Don Rodrigo Manrique, Son Père Jorge Manrique (1440–1479) • Que se rappelle l’âme endormie, S’avivant, en s’éveillant De percevoir Comment s’écoule la vie Comment s’approche la mort Silencieuse, Que vite fuit le plaisir, Qui à peine ressenti Devient douloureux souvenir, Et comment à notre avis Tout instant du passé Nous fut meilleur. Et si nous voyons le présent D’un coup il disparait Et s’achève. Si nous jugeons avec sagesse, Nous traiterons ce qui n’est pas advenu Comme le passé. Que personne ne se trompe En pensant que va durer Ce qu’il espère Plus qu’a duré ce qu’il a vu Parce que tout se passera Egalement. Nos existences sont des fleuves Qui se jetteront dans cette mer Qu’est le mourir; Là-bas s’en vont les hautes lignées Fatalement finir, S’anéantir, Là-bas, vont les immenses fleuves, Là-bas, les rivières modestes Là-bas les petits rus; A l’arrivée tous sont égaux Comme ceux qui vivent de leurs efforts Et les plus riches. Invocation J’oublie les invocations Des poètes de renom Et des orateurs ; N’aime guère leurs fictions, Eux qui ajoutent des drogues secrètes À leurs saveurs. Le seul à qui je me voue Le seul que moi, j’invoque A la vérité C’est celui qui, traversant notre monde, N’y a point été reconnu pour Sa déité. Par ce monde-ci nous cheminons Vers l’autre monde, notre demeure, Sans chagrin, Mais il faut raison garder Pour accomplir ce voyage Sans s’égarer. Nous partons dès notre naissance Nous marchons le temps de la vie, Et arrivons A l’heure où nous nous éteignons; Et c’est ainsi qu’avec la mort Nous est donné le repos. Agréable fut notre monde Si nous apprîmes à y vivre Comme il convient, Puisque, selon notre foi C’est pour gagner celui Auquel nous aspirons. Et même le Fils de Dieu, Pour nous élever dans les cieux, Est descendu vers nous. Naître parmi les nôtres Et vivre sur notre sol Où il mourut. Voyez ces choses infimes Après lesquelles nous marchons Et nous courons ; Dans ce bas monde traître Avant même que nous mourions Nous les perdons : Certaines l’âge les dégrade, Certaines se défont au jeu des crises Qui surviennent, D’autres, appartenant Aux instances les plus hautes S’évanouissent. Dites-moi donc, la beauté, La tendre fraîcheur, le teint Du visage, Sa couleur et sa candeur, Quand arrive la vieillesse Qu’en reste-t-il ? L’adresse et la légèreté Et la force corporelle De la jeunesse, Tout cela devient carcan Lorsqu’apparaît cette gueuse De vieillesse. Regardons le sang des seigneurs, La noblesse et le lignage Si puissant, Par combien de voies et manières Se dissout leur grande majesté De son vivant ! Certains pour leur peu de mérite, Pour bien bas et bien misérables Ils sont considérés ! D’autres qui n’en ont point, Par des emplois honteux Sont maintenus ! Les situations et les richesses Nous quittent avant l’heure, Quoi d’étonnant? Constance n’est point leur fort Puisqu’elles sont atours de grande dame A l’esprit changeant. Ces biens sont ceux de la Fortune Et avec sa roue se retournent Très vite. Elle qui ne saurait être unique, Ni stable ni posée, Un simple instant. Bien qu’elles veuillent s’accrocher Et jusqu’à la fosse accompagner Leur maître ; Elles ne sauraient nous leurrer, Car en un souffle file la vie Comme en un songe : Et les plaisirs de l’ici-bas Ceux dont nous nous réjouissons Sont temporels, Et les tourments de l’au-delà Qu’à cause d’eux nous attendons, Sont éternels. Les plaisirs et les douceurs De cette vie de dur labeur Qui est la nôtre, Ne sont-ils que des passages, Et la mort le traquenard Dans lequel nous tombons ? Sans imaginer notre perte Nous courons à bride abattue Sans un arrêt ; Dès que se montre l’embuscade Et que nous voulons reculer, Il est trop tard. Si nous avions le pouvoir D’embellir notre silhouette Corporelle, Et qu’ainsi nous puissions rendre Notre âme si glorieuse, Angélique, Quelle diligence si vivace Aurions-nous à chaque instant Et si avisée, Pour réparer la mauvaise part , Sans nous soucier de l’apparence Décomposée ! Ces monarques très puissants Dont nous lisons les chroniques Déjà passées, Dans de tristes faits, douloureux Furent leurs bonnes fortunes Bouleversées ; Ainsi, rien n’est assez fort ; Puisque Papes et Empereurs Et prélats La mort les bouscule aussi Comme ces pauvres gardiens Des troupeaux. Ne faisons pas cas des Troyens, Dont nous ne vîmes pas les maux Ni leurs gloires ; Et oublions donc les Romains Et les récits lus et parfois entendus De leurs histoires. Peu nous importe de savoir Les choses du siècle dernier Et ce qu’il y arriva ; Voyons plutôt les choses d’hier, Elles ont été autant oubliées Que celles-là. Où est passé le Roi Don Juan ? Et les Infants d’Aragon Qu’advint-il d’eux ? Où sont passés tant de galants, Que devinrent, tant de blasons Qui disparurent ? Et les joutes et les tournois, Les parures, les broderies Et les cimiers, Quoi d’autres que des bagatelles ? Tout cela ne fut que chimères, Éphémères ? Que sont belles dames devenues Et leurs toilettes et leurs atours, Et leurs parfums ? Que sont les flammes devenues De ces grands feux attisés Des amoureux? Mais où sont passés ces trouvères, Et leurs musiques bien tournées Qu’ils leur chantaient ? Où sont donc passées ces danseuses Et les robes de soie brodées Qui les vêtaient ? Et l’autre aussi, son héritier, Don Henri, que de pouvoirs Il possédait ! Qu’il était tendre et bien doux Le monde avec ses plaisirs Qu’il s’octroyait ! Mais tu verras combien ennemi, Si combatif et si cruel Il se montra, Qu’ayant été son ami Combien peu il fit durer Ce qu’il donna ! Présents accordés sans mesure Édificesroyaux Remplis d’or Vaisselles ouvragées Pièces d’or et deniers Du trésor ; Harnais, chevaux De ses soldats et leurs ornements Excessifs, Où irons-nous désormais les chercher ? Ils ne furent que rosée du matin Sur la prairie ? Et son frère, l’innocent Dont il fit, de son vivant, son successeur À ce qu’on dit, Quelle brillante cour Il eut où de nombreux seigneurs L’ont suivi ! Mais c’était un mortel Et la mort l’enfourna Dans sa forge. Ô, jugement divin ! Quand le feu brûlait plus fort Tu jetas l’eau. Alors ce grand Connétable Maître que nous avons connu Si familier, Il ne sied pas qu’on parle de lui, Sauf que nous l’avons vu Décapité. Ses inestimables trésors, Ses villes et ses bourgs, Son autorité, Ne devinrent-ils pas pour lui des pleurs ? Ne furent-ils que chagrins Pour leur perte ? Et ses deux autres frères, Des Maîtres si prospères Pareils à des rois, Qui, suzerains ou vassaux Assujettirent À leurs lois, Cette grande prospérité Venue de tellement haut Et exaltée, Que fut-elle sinon clarté Qu’au plus brillant éclat Fut matée ? Tant de ces excellents Ducs Tant de Marquis et de Comtes Et de Barons Que nous vîmes si puissants, Dis, la Mort, où les caches-tu Où les as tu endormis ? Que sont à présent les brillants exploits Qu’ils accomplirent au cœur des guerres Et dans la paix, Quand, toi, féroce, tu t’acharnes, De toutes tes forces, les terrasses Et les défais. Les troupes innombrables, Les bannières, les étendards Et les drapeaux, Les châteaux imprenables, Les hauts murs et les remparts, Les barreaux, La fosse profonde recouverte, Ou n’importe quel abri, Rien ne t’arrête : Quand tu viens aveuglée d’ire Ta flèche transperce tout De part en part. Et lui protecteur des bons, Aimé pour toutes ses vertus De tout son entourage, Le grand Maître Don Rodrigue Manrique, si renommé Et si vaillant, Ses hauts faits sont célèbres, Point nécessaire de les louer, Car tous les virent, Nul besoin d’exagérer Car chacun sait bien Ce qu’ils furent. Quel ami de ses amis ! Quel seigneur pour ses serviteurs Et ses parents ! Quel ennemi pour ses ennemis ! Quel Maître pour les preux Et les vaillants ! Quel esprit pour les sages ! Quelle grâce avec le bel esprit ! Quelle raison ! Qu’il fut aimable avec ses sujets ! Et contre fourbes et malfaisants, Quel lion ! Octave en sa félicité, Jules César pour sa force victorieuse Et ses batailles ; Scipion l’Africain, pour sa vertu ; Hannibal pour le savoir Et le goût du travail ; Pour la bonté, Trajan ; Titus pour sa générosité Et son allégresse ; Aurélien, par la vigueur de son bras ; Marc Antoine pour la valeur De ses engagements. Antoine Pie, pour sa clémence Marc Aurèle pour la ressemblance De son visage ; Hadrien par l’éloquence ; Théodose en humanité Et savoir vivre. Aurèle Alexandre Pour sa discipline et sa rigueur Au combat; Constantin pour sa foi ; Camille pour le grand amour De sa terre. Il ne laissa guère de grands trésors, Ni n’accumula mille richesses Ni vaisselles précieuses, Mais il fit la guerre aux Maures, S’emparant de leurs forteresses Et citadelles ; Dans les combats qu’il remporta Chevaliers et chevaux Nombreux jonchèrent le sol , Et par ses mérites gagna Les rentes et les vassaux Qui lui furent attribués. De son honneur et de son rang Dans d’autres périodes passées Qu’en fut-il donc ? Désemparé, sans protection Avec frères et serviteurs Il résista. Après les actions brillantes Accomplies dans cette guerre Qu’il faisait, Il conclut d’honorables traités Qui multiplièrent les terres Qu’il possédait déjà. Et ces vieilles histoires Qu’avec son bras il peint Dans sa jeunesse, Avec d’autres belles victoires Récemment en son vieil âge Il les refit. Par sa grande habileté, Par mérites et ancienneté Bien expérimentée Il rejoignit la dignité De la grande chevalerie De l’Épée. Et ses villes et ses terres Qu’il trouva Occupées par des tyrans Par les sièges et les guerres C’est par l’habileté de ses mains Qu’il les obtint. Ainsi notre Roi naturel, Par les œuvres qu’il accomplit Fut servi, Comme dit celui du Portugal Et en Castille celui là qui prit Son parti. Après avoir tant de fois Librement engagé sa vie Dans le jeu ; Et avoir si bien servi La couronne de son Roi, Fidèlement Après tant et tant d’exploits Qu’une simple addition Ne résumerait pas, Dans sa propre ville d’Ocaña Vint la mort le chercher, À sa porte. (La Mort parle) Elle lui dit : «Bon Chevalier, Quittez ce monde trompeur Et ses flatteries ; Que votre grand cœur d’acier Montre son élan fameux Dans ce malheur ; Et puisque de votre vie et de votre salut Vous fûtes si peu avare Pour la belle gloire , Que votre vertu accepte De souffrir cette humiliation Qui vous allez devoir subir. « Que ne vous soit pas trop amer Le redoutable combat Qui vous attend, Car une autre vie plus longue De renommée bien glorieuse Ici vous quittez : Quoique cette vie d’honneur Ne soit pas non plus éternelle Ni véritable, Elle demeure malgré tout bien meilleure Que cette autre vie temporelle Et périssable. « La vie éternelle Ne s’obtient pas par les Mondanités, Ni non plus dans un monde de plaisirs Domaine de tous les péchés; Infernaux ; Mais tous les bons religieux La gagnent par les prières Et les pleurs ; Les chevaliers renommés Par leurs luttes et leurs peines Contre les infidèles. « Et puisque, vous, noble guerrier, Tant de sang es Païens Vous avez versé ; Attendez-en la récompense Qu’en ce monde avez gagnée Par vos mains ; Ainsi nanti de cette confiance Et muni de la foi unique Qui sont vôtres, Allez avec force espérance Que cette autre vie, la troisième Vous l’atteindrez. » (Répond le Maître) « Alors ne perdons plus de temps Dans une existence mesquine Telle que celle-ci, Ma volonté est conforme A la volonté divine En toute chose ; Je consens à ma mort Librement et dans la joie, Je le veux ainsi ; Vouloir vivre pour un homme Quand Dieu veut qu’il meure Est pure folie. » Prière Toi, qui par nos péchés As pris forme servile Et humble nom ; Toi qui à ta divinité As adjoint une chose aussi vile Que l’homme ; Toi qui dans de si grands tourments As souffert sans résister En ta personne, Fais que non par mes mérites, Mais par ta clémence seulement Tu me pardonnes. Achèvement Ainsi en un tel accord De tous ses sens humains Dépouillé, Entouré de son épouse, De ses fils, de ses frères Et de ses serviteurs, Rendit son âme au Créateur, (Qu’il veuille la conserver au ciel Et dans sa gloire). Et bien qu’il ait perdu sa vie Nous laisse grand réconfort Sa mémoire. Merci pour ta présence.
#29
Re: Jorge Manrique
Istenozot
Posté le : 26/04/2016 19:51
Chère Loriane,
Je me suis revu dans la villed e Cuenca que j'ai revu avec bonheur dans le courant du mois de mai 2015. Il a peu écrit mais ses écrits sont très beaux, tant en langue espagnole que dans la traduction française. Encore merci pour tout ce travail de partage de savoir que j'admire. Je trouve cela impressionnant. Amitiés. Jacques
#30
Christiane Rochefort
Loriane
Posté le : 23/04/2016 17:59
Le 24 avril 1998 meurt à 80 ans au Pradet Var, Christiane Rochefort
Femme de lettres française, née le 17 juillet 1917 à Paris XIVe. Elle publia certains livres sous les pseudonymes de Benoît Becker et Dominique Féjos, avant le véritable début de sa carrière littéraire avec Le Repos du Guerrier, à 41 ans. Alias Dominique Fejos, Benoît Becker, Écrivain, journaliste, Auteur, elles publie romans, essais, traductions. Ses Œuvres principales sont : Le Repos du guerrier en 1958, Les Petits Enfants du siècle en 1961, Les Enfants d'abord en 1976, La Porte du fond en 1988. Militante féministe, elle est co-fondatrice du mouvement Choisir la cause des femmes En Bref Le nom de Christiane Rochefort demeure fermement lié aux années 1960 et 1970 qui l'ont vue apparaître sur la scène littéraire. De ces années, en effet, des évolutions que connaissait alors la société française – la consommation comme ultime forme de bonheur –, de ses immobilismes tout autant, la romancière s'est faite la contemptrice virulente, volontiers ironique, se taillant dès ses premiers livres une image d'anticonformiste rebelle à l'ordre, aux institutions quelles qu'elles soient, à l'autorité d'où qu'elle émane. Née le 17 juillet 1917, à Paris, Christiane Rochefort connaît une adolescence et une jeunesse vaguement désordonnées, selon ses propres termes. Étudiante en psychologie, elle pose pour des peintres pour gagner sa vie – parmi eux, entre autres, Chaïm Soutine –, puis tâte du journalisme à travers la critique cinématographique. Après la guerre, elle devient l'attachée de presse du festival de Cannes, fonction qu'elle occupera durant près de vingt ans, jusqu'en 1968, date à laquelle les organisateurs du festival décident de se séparer d'elle, arguant de sa participation aux troubles qui perturbent la manifestation cette année-là. À cinquante ans, Christiane Rochefort est déjà un écrivain célèbre. Son entrée en littérature date de 1953, lorsqu'elle publie son premier recueil de nouvelles (Le Démon des pinceaux. Mais c'est la parution, en 1958, du Repos du guerrier qui lui vaut son premier succès public. La romancière y met en scène une jeune femme bourgeoise qui rompt avec son époux et son milieu, pour vivre une intense liaison sexuelle avec un alcoolique. Le livre, jugé pornographique par certains critiques, fait scandale et voit sa sulfureuse notoriété s'accroître après l'adaptation à l'écran qu'en donne quatre ans plus tard Roger Vadim, avec Brigitte Bardot en tête d'affiche. Entre-temps, un nouveau roman est venu confirmer la réputation d'écrivain contestataire et iconoclaste qui ne quittera plus Christiane Rochefort. En 1961, en effet, paraît Les Petits Enfants du siècle où l'écrivain choisit pour narratrice une toute jeune adolescente qui grandit dans une cité de la banlieue parisienne et y fait ses premières expériences de la vie. Écrit dans une langue qui s'attache à demeurer proche du langage parlé, l'ouvrage choque une nouvelle fois, par la liberté des pensées et la verdeur du vocabulaire que Christiane Rochefort imagine pour son héroïne, également par la vision sans complaisance de la médiocrité de l'existence dans les grands ensembles urbains qui est ici dénoncée. La suite de la bibliographie de la romancière confirmera son esprit frondeur, son goût pour des thématiques susceptibles de bousculer la tranquillité d'esprit d'une société française qu'elle juge bâtie sur l'hypocrisie des conventions et des interdits moraux, sur l'injustice sociale, sur des formes multiples d'oppression dont sont victimes les femmes Les Stances à Sophie, 1963, les enfants La Porte du fond, prix Médicis 1988, les classes sociales défavorisées, ainsi que tous ceux que leur choix de vie contraint à la marginalité les homosexuels dans Printemps au parking, 1969. Ces thèmes, Christiane Rochefort les développera aussi dans des essais, le plus célèbre étant Les Enfants d'abord 1976, et dans son autobiographie, Ma Vie revue et corrigée par l'auteur 1978. Militante, on l'a vue également contribuer à la création en 1971 du mouvement féministe Choisir, avec Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, entre autres. En 1997, elle publie deux ultimes recueils, Adieu Andromède et Conversations sans paroles. Nathalie Crom Sa vie Après des études inachevées de psychiatrie, puis d'ethnologie et de psychologie à la Sorbonne, Christiane Rochefort effectua des emplois de bureau au ministère de l'Information et, pendant plusieurs années, du journalisme pour le Festival de Cannes d'où elle sera renvoyée. Elle a également travaillé avec Henri Langlois à la Cinémathèque de Paris. Artiste passionnée et aux talents variés, elle consacra une grande part de son temps à la musique, au dessin, à la peinture, à la sculpture ainsi qu'à l'écriture. Militante, elle participe activement au premier MLF et, en 1971, contribuera avec Simone de Beauvoir, Jean Rostand et quelques autres, à créer le mouvement féministe Choisir la cause des femmes. Elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise 22e division. Œuvre Son écriture à la fois précise, souvent fulgurante, volontiers excessive, souvent poétique, et dont les tonalités changent d'un roman à l'autre, fait de Christiane Rochefort une figure atypique de la littérature du dernier quart du vingtième siècle. Deux fois lauréate de prix littéraires prestigieux Prix de la Nouvelle Vague en 1958, Prix Médicis en 1988, elle élabore une œuvre composite où les études psychologiques Les Petits Enfants du siècle, 1961 côtoient les études de mœurs Le repos du Guerrier, 1958, Encore heureux qu'on va vers l'été, 1975 et des ouvrages parfois sidérants d'étrangeté créatrice et de génie pour le surnaturel et l'excessif baroques, tel Archaos ou le Jardin étincelant 1973, qui décrit, sous des allures de conte traditionnel sinon d'historiographie officielle imaginaire, et dans une langue aussi brillante que fleurie, la naissance et les aventures de celui qui deviendra, par succession héréditaire, le Roi du pays d'Archaos. Romans et nouvelles 1953 : Le Démon des pinceaux nouvelle in Les Œuvres libres, Fayard 1955 : Le Fauve et le Rouge-gorge nouvelle in Les Œuvres libres, Fayard 1956 : Cendres et Or, Éditions de Paris 1957 : Une fille mal élevée, Éditions de Paris sous le pseudonyme de Dominique Féjos 1958 : Tes mains, Éditions de Paris sous le pseudonyme de Dominique Féjos 1958 : Le Repos du guerrier, Grasset Prix de la Nouvelle Vague 1961 : Les Petits Enfants du siècle, Grasset 1963 : Les Stances à Sophie, Grasset 1966 : Une rose pour Morrisson, Grasset 1969 : Printemps au parking, Grasset 1972 : Archaos ou le Jardin étincelant, Grasset 1975 : Encore heureux qu'on va vers l'été, Grasset 1978 : Pardonnez-nous vos enfances nouvelles avec Denis Guiot, Denoël 1982 : Quand tu vas chez les femmes, Grasset 1984 : Le monde est comme deux chevaux, Grasset 1988 : La Porte du fond, Grasset Prix Médicis 1997 : Conversations sans paroles, Grasset Essais 1970 : C'est bizarre l'écriture, Grasset. Publié au Québec, sous le titre : Journal de printemps, récit d'un livre, Éditions de l'Étincelle, 1977 1976 : Les Enfants d'abord, Grasset 1984 : Le monde est comme deux chevaux, Grasset Traductions et adaptations 1965 : En flagrant délire tentative de traduction avec Rachel Mizrahi de In His Own Write de John Lennon, Robert Laffont 1966 : Le Cheval fini d'Amos Kenan traduction, Grasset 1974 : Les Tireurs de langue d'Amos Kenan et Pierre Alechinsky adaptation, Éditions Yves Rivière 1976 : Holocauste 2 d'Amos Kenan traduction, Flammarion Autres 1978 : Ma vie revue et corrigée par l'auteur autobiographie, à partir d'entretiens avec Maurice Chavardès 1997 : Adieu Andromède textes, Grasset 2015 Journal préposthume possible journal 1986-1993, éditions iXe Christiane Rochefort a utilisé le pseudonyme collectif de Benoît Becker pour des histoires écrites avec Guy Bechtel, Jean-Claude Carrière, Stéphan Jouravieff et José-André Lacour aux Éd. Fleuve Noir collection "Angoisse". Bibliographie Isabelle Constant, Les mots étincelants de Christiane Rochefort : langages d'utopie, Amsterdam Atlanta, GA, Rodopi, 1996 Filmographie partielle & théâtre 1960 : La Vérité de Henri-Georges Clouzot, scénario de Henri-Georges Clouzot, Véra Clouzot, Jérôme Géronimi et Christiane Rochefort. Avec Brigitte Bardot, Charles Vanel et Fernand Ledoux. 1961 Le Repos du guerrier : Raf Vallone l'adapte pour le théâtre, la pièce est créée en 1961 au Théâtre de Paris avec une mise en scène de Jean Mercure. 1962 Le Repos du guerrier : Roger Vadim réalise ce film en 1962 avec Brigitte Bardot, l'un des deux grands films qui 'lancera' Brigitte Bardot. 1971 : Les Stances à Sophie de Moshé Mizrahi, scénario de Moshé Mizrahi et Christiane Rochefort d'après son roman. Avec Bernadette Lafont, Michel Duchaussoy et Bulle Ogier. 1973 : La Ville bidon La décharge de Jacques Baratier, scénario de Jacques Baratier, Christiane Rochefort, et Daniel Duval. Avec Bernadette Lafont, Daniel Duval et Roland Dubillard.          |
Connexion
Sont en ligne
172 Personne(s) en ligne (96 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 172 Plus ... |
| Haut de Page |






