|
|
La Bruyère |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 10 mai 1696, à 50 ans, meurt Jean de La Bruyère
à Versailles, né à Paris le 17 août 1645, écrivain et moraliste français, il est un homme illustre du Louvre auteur d'une oeuvre magistrale et remarquable qui fît date : Les caractères ou les moeurs de ce siècle.
La Bruyère est devenu célèbre par cette œuvre unique, publiée en 1688. Cet ouvrage, constitué d’un ensemble de brèves pièces littéraires, compose une chronique essentielle de l’esprit du xviie siècle.
La Bruyère fut l’un des premiers écrivains à mettre en avant le style littéraire, en développant un phrasé rythmé dans lequel les effets de rupture sont prépondérants. Ce style incite à la lecture à haute voix, donnant ainsi à cette activité le statut de jugement moral grâce à l’effet rhétorique obtenu par la lecture orale sur les auditeurs. La Bruyère consacre au demeurant toute une section des Caractères, aux effets pervers de l’éloquence. Nombre d’écrivains ont suivi le chemin stylistique tracé par La Bruyère : depuis Marivaux jusqu'à Balzac et Proust, en passant par André Gide.
En bref
Né à Paris, La Bruyère appartient à la vieille bourgeoisie de la Cité, au monde de la procédure et de la finance : ses ancêtres paternels figurent parmi les fondateurs de la Ligue. Après des études de droit, il achète un office de trésorier des finances dans la généralité de Caen, mais vit à Paris, dans une indépendance studieuse et tranquille. Pour des raisons mal connues et sur la présentation de Bossuet, le Grand Condé le pria, en 1684, d'enseigner l'histoire à son petit-fils. Triste élève dont les « inapplications exercent l'opiniâtreté du maître ! La jeune mademoiselle de Nantes, fille adultérine de Louis XIV et de madame de Montespan, après son mariage avec le prince, assistait également aux leçons ; pour peu de temps, car la mort de Condé mit un terme à l'office du précepteur qui devient gentilhomme de monsieur le Duc et, comme tel, attaché à sa personne. Il continue donc à Versailles, à Chambord, à Fontainebleau, à Chantilly surtout, à observer les vices, les impertinences et les goûts de la cour, sans oublier pour autant la ville. Avec beaucoup de modestie, il résolut enfin de publier ses réflexions, distribuées sous un certain nombre de titres, à la suite des Caractères de Théophraste disciple d'Aristote du IVe siècle avant J.-C., qu'il avait traduits non sans s'autoriser un coup d'œil sur la version que J. Casaubon en avait donnée en latin en 1592. Les Caractères de Théophraste traduits du grec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle furent donc mis en vente en 1688. Le succès enhardit l'auteur qui enrichit son ouvrage jusqu'en 1694. Élu à l'Académie en 1693 en pleine guerre des Anciens et des Modernes, il éprouva l'année d'après le besoin de se jeter dans la querelle du pur amour en composant des Dialogues posthumes sur le quiétisme 1699 à la façon des Provinciales. Il mourut subitement à Versailles, d'une attaque d'apoplexie. Saint-Simon note dans ses Mémoires : Le public perdit ... un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes .... C'était d'ailleurs un fort honnête homme, de très bonne compagnie, simple, sans rien de pédant et fort désintéressé.
La Bruyère est l'homme d'un seul livre. C'est ce qui fait sa force, mais c'est aussi sa limite. Les Caractères eurent huit éditions entre 1688 et 1694 ; d'année en année, La Bruyère grossit son œuvre, qui passa de 420 à 1 120 remarques. Voilà la preuve d'une belle persévérance, qui dénote la singulière aptitude d'un esprit à enrichir un recueil sans jamais s'écarter du but proposé : peindre l'homme. Mais ce qui est peut-être faiblesse, c'est de ne point varier son talent, d'utiliser une formule à peu près constamment identique et de s'en tenir là. La densité du livre existe au détriment de sa liberté créatrice.
Appartenant à une famille de bonne bourgeoisie, La Bruyère, après des études de droit, achète en 1673 une charge de trésorier général de France en la généralité de Caen. Mais il réside à Paris et, comme sa charge lui laisse des loisirs, il en profite pour lire, méditer, observer. En 1684, probablement grâce à Bossuet, il est précepteur du duc Louis de Bourbon, petit-fils du Grand Condé. Tâche ingrate, que le caractère indocile et distrait de son élève ne facilite guère ; du moins, sa vie auprès des grands offre un champ d'observation à son regard pénétrant. Quand Louis de Bourbon devient duc d'Enghien décembre 1686, La Bruyère reste attaché aux Condé en qualité de gentilhomme de Monsieur le duc. Deux ans plus tard paraissent les Caractères, qui traduisent son expérience du monde et des hommes. Leur succès, dû en partie aux portraits, lui vaut, malgré deux échecs, d'être élu à l'Académie française 1693, où son discours de réception, qui ne loue que les partisans des Anciens, fait scandale.
On a l'impression que cette existence cèle des blessures secrètes, des rancœurs mal étouffées et que La Bruyère avait trop conscience de sa valeur pour ne pas souffrir de vivre dans une société qui, tout en l'admettant, ne lui faisait que trop sentir qu'il n'était pas des siens. On ne saurait en conclure que les Caractères sont un livre de revanche, un constat de déception. La Bruyère n'est pas aigri, il est désenchanté ; sa désillusion n'est pas le fruit de l'humiliation : il montre les hommes pour ce qu'ils sont, et la vision des moralistes n'est jamais réconfortante. Mais comment vaincre la monotonie des jours, sinon en livrant à la postérité les pensées qui tiennent à cœur ? Une grande naissance ou une grande fortune annonce le mérite, et le fait plus tôt remarquer. » La Bruyère sait bien, lui, qu'il ne peut compter que sur lui-même. Même si tout est dit et l'on vient trop tard », on peut panser ses plaies en puisant dans ses propres ressources : Le sage guérit de l'ambition par l'ambition même. Au fond de chacun, il est une sorte de confiance en soi, en son talent, et La Bruyère a la certitude de n'en être pas démuni. Lorsqu'il écrit : Il faut plus que de l'esprit pour être auteur, ne pense-t-il pas à lui-même et n'est-il pas sûr d'avoir la foi en son inspiration ? Tout ce que les Caractères cachent d'accent personnel sur le métier de faire un livre ne révèle, au total, en dépit des difficultés, que la croyance de leur auteur à être original.
Je rends au public ce qu'il m'a prêté.
Le but que La Bruyère se propose d'atteindre, dans le grand courant de pessimisme augustinien de son siècle, est de peindre l'homme. Conformément au génie de son temps, il vise à enseigner : On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l'instruction. Mais, fidèle à la lignée de tous les moralistes classiques, il s'attache à découvrir la permanence dans la nature humaine, à dégager, par-delà les traits particuliers, les caractères éternels. Je rends au public ce qu'il m'a prêté ; j'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage ; si les contemporains sont l'objet de son étude, La Bruyère se donne une tâche plus haute : dévoiler l'homme dans sa nature universelle. La préface est nette sur ce point : « Penser toujours, et toute la lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères et les mœurs de ce siècle que je décris ; car bien que je les tire souvent de la cour de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre à une seule cour, ni les renfermer en un seul pays. Déjà La Rochefoucauld disait qu'il est plus aisé de connaître l'homme en général qu'un homme en particulier. La Bruyère parvient-il à saisir l'homme dans sa généralité ? Constatons que, si les Caractères sont souvent le fait d'un écrivain qui juge avec recul, il est aussi d'autres pages où l'on découvre l'homme derrière l'auteur, c'est-à-dire une sensibilité.
Le livre semble, en effet, obéir à une triple orientation. Une bonne partie se compose d'aphorismes d'une clairvoyance désabusée, mais qui n'ont pas la cruauté des maximes de La Rochefoucauld. Peu d'indulgence, mais une générosité instinctive qui empêche La Bruyère de noircir son tableau. Chez lui, la sentence constate, affirme : elle ne juge pas, elle ne débouche pas sur la transcendance, elle n'obéit pas à des raisons métaphysiques. L'homme n'est pas, de par sa nature, corrompu. Il est tel qu'il se montre. Voilà une vision moins profonde que celle de La Rochefoucauld : au moins est-elle plus rassurante. À côté des sentences, les portraits, qui se glissent dans tous les chapitres. C'est là le domaine par excellence de La Bruyère : la variété corrosive de sa palette, le nombre de ses silhouettes, ce plaisir inavoué à étiqueter les êtres et à dénoncer leurs travers comme leurs ridicules offrent un plaisir rare à l'esprit. Mais remarquons que La Bruyère ne s'engage pas : l'acuité du trait, le goût pour la satire, l'humour froid divertissent sans provoquer l'émotion. L'auteur veut amuser en enseignant et il ne croit pas qu'il est possible d'amuser si l'on se montre trop sensible. Sa position est claire : L'étude de la sagesse a moins d'étendue que celle que l'on ferait des sots, et ce sot, cet autre nous-même, qui n'entre, ni ne sort, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n'est sur ses jambes, comme un homme d'esprit, est la matière de son enquête. Sentences et portraits se complètent par des passages d'indignation généreuse d'un homme scandalisé par l'organisation sociale et politique de son temps. C'est sans doute par là que La Bruyère nous touche le plus. L'écrivain cède la place aux mouvements du cœur ; la sympathie qu'il porte à ceux qui souffrent semble autre chose qu'un sentiment superficiel. Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. l y a sur la terre des misères qui saisissent le cœur …. De simples bourgeois, seulement à cause qu'ils étaient riches, ont eu l'audace d'avaler en un seul morceau la nourriture de cent familles. On sent une émotion vive, et sa sévère critique des grands, des institutions, de la guerre offre un accent de révolte nouveau en ce siècle.
Il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement, fortement, délicatement.
Avoir le naturel, la force, la délicatesse, telle est l'ambition de La Bruyère. Son sens de la formule ramassée, ses tours vifs et piquants, son choix des attitudes et des détails révélateurs ne sont pas la moindre qualité d'un art accompli. La Bruyère est un très grand styliste. C'est même le style qui donne à l'œuvre son unité. On peut déjà parler d'une « écriture artiste », grâce aux rythmes, au choix des mots, à l'agencement de la phrase. On a remarqué le caractère moderne des analyses de La Bruyère, qui tranchent sur la simplicité classique de ses prédécesseurs. La contrepartie en est qu'on peut déceler une certaine préciosité, un goût de la recherche qui n'est pas loin du procédé. À force de vouloir être incisif, La Bruyère exagère son dessein. Chez lui, remarquait déjà Sainte-Beuve, l'art est grand, très grand ; il n'est pas suprême, car il se voit et il se sent. On pense aussi à cette phrase de La Rochefoucauld, qui semble assez exactement s'appliquer aux Caractères : Le plus grand défaut de la pénétration n'est pas de n'aller point jusqu'au but, c'est de le passer.
N'exagérons pas non plus la portée politique de l'œuvre de La Bruyère. Si l'on reste très sensible à sa générosité, lorsqu'il s'indigne contre les excès de son temps, on ne saurait voir en lui un révolutionnaire. La Bruyère est loin d'avoir l'étoffe d'un réformateur. Disons qu'il a eu le courage de ses idées, mais cette sympathique franchise ne débouche pas sur une critique positive. Quand il parle des différentes formes de gouvernement, c'est pour conclure : Ce qu'il y a de plus raisonnable et de plus sûr, c'est d'estimer celle où l'on est né comme la meilleure de toutes et de s'y soumettre. Faut-il nécessairement exiger d'un sujet du Roi-Soleil, homme de cœur et capable de nous émouvoir, d'avoir les audaces constructives des philosophes du siècle suivant
Sa vie
On a des raisons de penser que Jean de La Bruyère est né dans un village voisin de Dourdan, où sa famille avait des attaches ; on a retrouvé son acte de baptême, qui établit qu’il a été baptisé le 17 août 1645 en l’église Saint-Christophe-en-la Cité, sur l'île de la Cité. Il est le fils aîné de Louis de La Bruyère, contrôleur général des rentes sur l’Hôtel de Ville, bourgeois de Paris, et d’Élisabeth Hamonyer. De nombreux documents attestent que l'écrivain appartient à une famille roturière du monde des procureurs, Son trisaïeul paternel était Jean de La Bruyère, apothicaire dans la rue Saint-Denis ; mais, contrairement à ce qu'avait cru Sainte-Beuve, son bisaïeul n'était pas le chef chef ligueur Mathias de La Bruyère, lieutenant civil de la prévôté et vicomté de Paris, qui n'est qu'un homonyme : les origines de la famille de La Bruyère ou Brière sont à chercher du côté du Perche où un de ses ancêtres était paysan.
Il est vraisemblablement élevé à l’Oratoire de Paris, et, à vingt ans, obtient le titre de licencié en droit à l’université d'Orléans, après la soutenance de ses thèses en juin 1665. On a la preuve qu'il connaît le grec ancien et l'allemand, ce qui est inhabituel à cette époque. Il revient vivre à Paris avec sa famille, dont la situation de fortune est modeste, et il est inscrit au barreau, mais plaide peu ou point. Il a longtemps été gêné financièrement ; il doit attendre l'héritage d'un oncle, en 1673, pour pouvoir acheter une charge de trésorier général de France au bureau des finances de la généralité de Caen, charge qui lui apporte un revenu : elle valait une vingtaine de milliers de livres et rapportait environ 12 350 livres par an ; elle conférait en outre l’anoblissement avec le titre d'écuyer.
Il effectue le voyage de Normandie pour son installation, en septembre 1674, puis, les formalités remplies, il retourne à Paris, et ne paraît plus à Caen. Il mène une existence de retraite studieuse, vivant petitement, rue des Augustins à Paris. En 1679, un vol de 2500 livres dans son secrétaire le laisse sans ressources. Il s'engage alors comme précepteur chez le marquis de Soyecourt. Il vend sa charge en 1686.
La Bruyère connaît ensuite une remarquable ascension sociale qui lui permet d'accéder aux hautes sphères de la société aristocratique française, et d'y obtenir une avantageuse protection. Depuis le 15 août 1684, il est en effet l’un des précepteurs du jeune duc de Bourbon, petit-fils du Grand Condé, ainsi que de Mademoiselle de Nantes, fille naturelle de Louis XIV et de Françoise de Montespan. Cet emploi est confié à La Bruyère, d’après l’abbé d’Olivet, sur la recommandation de Jacques-Bénigne Bossuet, qui fournissait ordinairement aux princes, a dit Fontenelle, les gens de mérite dans les lettres dont ils avaient besoin. La Bruyère fréquentait en effet l'évêque de Meaux depuis quelques années. Il s'installe chez son nouveau maître, à l'Hôtel de Condé, le 18 février 16856.
Le jeune duc de Bourbon était alors âgé de seize ans, et il venait d’achever sa seconde année de philosophie au collège de Clermont, qui était dirigé par les jésuites. C’est avec deux répétiteurs jésuites, les pères Alleaume et du Rosel, et avec le mathématicien Sauveur, que La Bruyère partage le soin d’achever l’éducation du jeune duc, auquel il est chargé d’enseigner, pour sa part, l’histoire, la géographie et les institutions de la France. La tâche est ingrate et l'élève, épileptique et inappliqué, traverse parfois des crises redoutables. Condé suit de près les études de son petit-fils, et La Bruyère, comme les autres maîtres, doit lui faire connaître le programme de ses leçons et les progrès de son élève, qui, à vrai dire, était assez médiocre. Le 24 juillet 1685, le duc de Bourbon épouse Mlle de Nantes, qui est âgée de onze ans et dix mois ; La Bruyère est invité à partager ses leçons entre les deux jeunes époux. Le 11 décembre 1686, le Grand Condé meurt à Fontainebleau, et l’éducation du duc de Bourbon, devenu duc d'Enghien, est considérée comme terminée. La Bruyère reste néanmoins dans la maison de Condé en qualité de gentilhomme ordinaire de Monsieur le Duc, chargé de la bibliothèque. Il loge à l'hôtel du Prince à Versailles, au Petit Luxembourg à Paris, et au château de Chantilly. Au sein de la maison des Condé, la morgue et le goût de l'esprit sont poussés parfois jusqu'à la plus extrême cruauté, comme en témoigne Saint-Simon. Sa férocité était extrême et se montrait en tout. C’était une meule toujours en l’air, qui faisait fuir devant elle, et dont ses amis n’étaient jamais en sûreté, tantôt par des insultes extrêmes, tantôt par des plaisanteries cruelles en face, et des chansons qu’il savait faire sur-le-champ, qui emportaient la pièce et qui ne s’effaçaient jamais… Il se sentait le fléau de son plus intime domestique… La Bruyère, qui a naturellement l’humeur sociable et le désir de plaire, a dû souffrir de sa condition obscure et de sa position subalterne de gentilhomme domestique, qui lui imposait l’obligation de défendre sa dignité. Il évita néanmoins les persécutions auxquelles était en butte le pauvre Santeul, mais on sent l’amertume de l’amour-propre blessé dans les plus âpres passages de son chapitre Des Grands.
Le succès
La première édition des Caractères paraît à Paris, chez Étienne Michallet, à l'automne de 1687, sous ce titre : les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. L'ouvrage comptait cent pages de traduction et deux cents pages originales. Le nom de l’auteur ne figura sur aucune édition publiée de son vivant. Cette première édition qui contenait surtout des remarques, et presque point de portraits, connut un succès très vif tout de suite. Dès lors, la biographie de La Bruyère se confond à partir de 1688 avec la vie de son ouvrage. Deux autres éditions parurent dans la même année 1688, sans que La Bruyère eût le temps de les augmenter notablement. En revanche, la 4e édition 1689 reçut plus de 350 caractères inédits ; la cinquième 1690, plus de 150 ; la sixième 1691 et la septième 1692, près de 80 chacune ; la huitième 1693, plus de 40, auxquels il faut ajouter le Discours à l’Académie. Seule la 9e édition 1696, qui parut quelques jours après la mort de La Bruyère, mais revue et corrigée par lui, ne contenait rien d’inédit. La vente de son ouvrage n’enrichit point La Bruyère, qui d’avance en avait destiné le produit à doter la fille de son libraire Michallet — cette dot fut de 100,000 F environ suivant certaines estimations, et de 200 000 à 3 000 000 F suivant d’autres.
La Bruyère à l’Académie.
Querelle des Anciens et des Modernes.
La Bruyère se présente à l’Académie en 1691, et c'est Étienne Pavillon qui est élu. Il se représente deux ans plus tard, chaudement recommandé par le contrôleur général Pontchartrain, et cette fois il est élu, le 14 mai 1693, en remplacement de l’abbé de La Chambre, et malgré l'opposition de Fontenelle, de Thomas Corneille et des Modernes. Son discours de réception, qu’il prononce le 15 juin de la même année, soulève des orages. Il y fait l’éloge des champions du parti des Anciens, Bossuet, Boileau, La Fontaine et Racine. En homme de progrès, cependant, il dénonce aussi les Partisans, P.T.S., ces parvenus ignorants et outrageusement enrichis, chargés du recouvrement des impôts. Mais en contestant, au sein de l'Académie, la valeur de Corneille comparé à Racine, il inflige un véritable camouflet au frère du dramaturge, Thomas Corneille, et à son neveu, Fontenelle, qui siègent tous deux comme académiciens. Il est alors violemment attaqué dans le Mercure Galant, le journal des Modernes, qu’il a placé jadis immédiatement au-dessous de rien ; les principaux rédacteurs de cette revue ne lui pardonnent pas d’avoir exalté Racine aux dépens de Corneille, et publient une critique au vitriol du discours de réception à l'Académie, dont toute l'assemblée a jugé qu'il “était immédiatement au-dessous de rien”, retournant ainsi contre La Bruyère les termes mêmes dont il s'était servi pour qualifier le Mercure Galant. La Bruyère réplique à l’article du Mercure dans la préface de son discours, et il se venge de Fontenelle en publiant, dans la 8e édition de son livre, le caractère de Cydias, dont tout le monde reconnut l’original.
La fin de sa vie
Les dernières années de la vie de La Bruyère sont consacrées à la préparation d’un nouvel ouvrage, dont il avait pris l’idée dans ses fréquents entretiens avec Bossuet, à savoir les Dialogues sur le Quiétisme, qu’il laissa inachevés. En philosophe chrétien, La Bruyère saisissait ainsi l'occasion d'attaquer la doctrine défendue par Madame Guyon et par Fénelon. Ces Dialogues ont été publiés après sa mort, en 1698, par l’abbé Elies du Pin, docteur en Sorbonne, qui compléta les sept dialogues trouvés dans les papiers de La Bruyère, par deux dialogues de sa façon. Il est probable qu’il ne se gêna point non plus pour remanier les sept premiers ; mais, avec cette réserve, l’authenticité des Dialogues, qui n’était point admise par Walckenaër, paraît certaine au plus récent éditeur de La Bruyère, Gustave Servois. Ajoutons que l’on a vingt lettres de La Bruyère, dont dix-sept sont adressées au prince de Condé, et nous aurons achevé l’énumération de ses œuvres complètes.
Il meurt à Versailles, dans la nuit du 10 au 11 mai 1696, d’une attaque d’apoplexie. Le récit de sa fin nous a été transmis par une lettre d’Antoine Bossuet, frère de l’évêque de Meaux. J’avais soupé avec lui le mardi 8, écrit-il ; il était très gai et ne s’était jamais mieux porté. Le mercredi et le jeudi même, jusqu’à neuf heures du soir, se passèrent en visites et en promenades, sans aucun pressentiment ; il soupa avec appétit, et tout d’un coup il perdit la parole et sa bouche se tourna. M. Félix, M. Fagon, toute la médecine de la cour vint à son secours. Il montrait sa tête comme le siège de son mal. Il eut quelque connaissance. Saignée, émétique, lavement de tabac, rien n’y fit… Il m’avait lu deux jours auparavant des Dialogues qu’il avait faits sur le quiétisme, non pas à l'imitation des Lettres Provinciales car il était toujours original, mais des dialogues de sa façon. C’est une perte pour nous tous ; nous le regrettons sensiblement. Bossuet lui-même écrivait de son côté le 28 mai : Toute la cour l’a regretté, et monsieur le Prince plus que tous les autres. Enfin, voici dans quels termes Saint-Simon a enregistré sa mort : Le public perdit bientôt après 1696 un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes : je veux dire La Bruyère, qui mourut d’apoplexie à Versailles, après avoir surpassé Théophraste en travaillant d’après lui, et avoir peint les hommes de notre temps, dans ses nouveaux caractères, d’une manière inimitable. C’était d’ailleurs un fort honnête homme, de très bonne compagnie, simple, sans rien de pédant, et fort désintéressé. Je l’avais assez connu pour le regretter, et les ouvrages que son âge et sa santé pouvaient faire espérer de lui.
La Bruyère mourut célibataire et pauvre. Sa mort, si prompte, si surprenante, suivant les expressions de son successeur à l’Académie, l’abbé Claude Fleury, fit naître le soupçon qu’il aurait été empoisonné.
Regards sur l'œuvre
On a souvent voulu faire de La Bruyère une sorte de réformateur, de démocrate, un précurseur de la Révolution française. Les passages abondent dans son livre où l’on voit qu’il partage, au contraire, et qu’il accepte toutes les idées essentielles de son temps, en politique comme en religion. Il critique les abus, mais il respecte les institutions. Son principe était de montrer aux gens leurs défauts afin qu'ils puissent se corriger. Il reconnaît même que certains maux sont inévitables. Il avait trop l’amour de son art pour être un révolté, et, comme l’a remarqué Nisard, il ne pouvait haïr ce qu’il peignait si bien. Cela posé, il reste que le ton des Caractères est presque constamment celui de la plus mordante satire. Il y avait en La Bruyère un mélange singulier d’orgueil et de timidité, d’ambition secrète et de mépris pour les ambitieux, de dédain des honneurs et de conscience qu’il en était digne; il ressentit profondément, malgré son affectation d’indifférence stoïcienne, l’inégalité de son mérite et de sa fortune. Et son grand grief contre la société du XVIIe siècle est précisément de ne pas faire sa place au mérite personnel. Domestique de ces Condé, dont nous avons indiqué d’après Saint-Simon le caractère détestable, il eut plus qu’un autre à se plaindre de la morgue des grands et de leur injustice à l’égard d’hommes qui les égalent par le cœur et par l’esprit et qui les passent quelquefois. Doué d’une sensibilité profonde et délicate, qui nous est attestée par certaines de ses réflexions sur l’amour et sur l’amitié, il n’est pas étonnant que La Bruyère, dont les instincts naturels étaient constamment froissés, finît par concevoir quelque amertume contre l’injustice du sort et l’épancha dans son livre.
Son humeur aigrie fut admirablement servie par un style incisif, âpre, nerveux, hardi jusqu’à la brutalité. Sa phrase, courte, brusque, saccadée, est déjà celle du XVIIIe siècle ; le réalisme de l’expression, la crudité de certains traits, la tendance à peindre l’extérieur, les gestes des personnages, sont presque du XIXe. Et il nous ressemble encore par un trait qui le distingue de ses contemporains; il est le premier écrivain pour qui le style ait eu une valeur propre, indépendante du sujet, et peut être vu comme le premier en date des stylistes cela est toutefois contestable : l'adresse au lecteur des Caractères rappelle en effet que pour La Bruyère, le style doit être soumis à un double souci, celui de plaire et de se conformer à la singularité d'un objet d'étude, et qu'une écriture seulement plaisante, ne reposant que sur l'artifice esthétique du style, est à bannir. Les premiers stylistes - si tout écrivain n'est pas styliste - seraient ainsi plutôt La Rochefoucauld ou même Pascal, du fait de leurs affirmations radicales quant à la vanité des choses humaines.
L'auteur des Caractères, qui vît une existence studieuse, s'inscrit dans cette lignée complexe de moralistes français qui, au XVIIe siècle, unis dans un même pessimisme, ont rivalisé de mépris pour l'inanité et le caractère hétéroclite du moi. Chrétiens fervents ou libertins, s'il leur est arrivé de célébrer parfois la grandeur de l'homme, ils ont préféré se pencher sur sa misère au point qu'à la fin du siècle Bossuet croira légitime de condamner cette fascination vertigineuse de notre néant : Il ne faut pas permettre à l'homme de se mépriser tout entier... À égale distance d'un Pascal qui fait servir la métaphysique à la religion ou d'un La Rochefoucauld qui a voulu attaquer partout l'amour-propre, La Bruyère et son expérience de l'homme se situent dans une double perspective : l'homme est un fantoche et le jouet de pulsions diverses – sociales ou individuelles – le plus souvent irraisonnées ; mais, quand bien même elle ne se manifesterait pas toujours, une justice existe, qui est la mesure de notre dérèglement.
Pour la postérité, toutefois, parce que nul n'a comme lui dépeint l'allure grotesque et la vilenie de l'individu dans les divers états qui pouvaient être les siens sous le règne du Roi-Soleil – mais aussi sous tous les rois et dans toutes les républiques –, parce que son cœur solitaire s'émeut de pitié devant les victimes et les faibles, La Bruyère, aux côtés de Fénelon, a souvent fait figure de précurseur des grands philanthropes du XVIIIe siècle. Sur le plan esthétique également, on s'est plu à voir un étrange discord entre son temps – qui est celui du goût tout classique de la composition – et la présentation impressionniste, moderne préfigurant Flaubert, Mérimée, les Goncourt de ses réflexions.
En fait, La Bruyère a, dans son attitude comme dans ses procédés, la pénétration rageuse mais aussi la pathétique tendresse des Timon d'Athènes : plus qu'à la charnière d'une époque où la conscience européenne est tout entière en crise, il appartient au royaume de Misanthropie ; c'est là ce qui explique pourquoi l'acharnement de son réalisme cruel n'altère pas sa fidélité aux grandes options classiques d'ordre, de décence, de beauté, de noblesse.
Le peintre
L'homme de lettres est trivial comme une borne au coin des places ; il est vu de tous et à toute heure, et en tous états, à table, au lit, nu, habillé, sain ou malade : il ne peut être important, et il ne le veut point être.
Ainsi La Bruyère peut-il juger de tout : de la ville, de la cour, du souverain, de la mode, de la chaire, des esprits forts. Son observation, toujours libre, saisit des instantanés de l'homme dans toutes les conditions, dans tous les états : et tant d'aperçus fragmentaires et disjoints reconstituent, cependant, un monde aussi organiquement vivant que ceux de Saint-Simon et de Proust.
En effet, La Bruyère concilie le sens le plus aigu de l'individuel et l'intuition des ressorts profonds des groupes humains. À première vue, Les Caractères représentent une suite d'originaux dont la bizarrerie défie toute réduction à un type fondamental : on cite l'amateur de tulipes, mais voici Hermippe, esclave de ses petites commodités, à la recherche de ce qu'on nommerait des gadgets ainsi les chaises volantes, ancêtres des ascenseurs ; Onuphre, Tartuffe subtil qui se garde bien des maladresses du dévot hypocrite de Molière ; Ménalque, distrait qui cumule tant de fantaisies qu'il en devient irréel.
Les contemporains ont essayé de nombreuses clefs sur le secret des Caractères. Souvent à faux ; l'auteur, en superposant ses observations, rendait le déchiffrage impossible. Ce talent d'impressionniste, ce génie de la caricature s'expriment en un style spontanément baroque. Rien n'est jamais attendu, pas plus la dissonance que l'accord parfait et le registre varie du burlesque au tragique ; souvent les deux tons se mêlent : Le sot est automate, il est machine, il est ressort ; le poids l'emporte, le fait mouvoir, le fait tourner et toujours dans le même sens et avec la même égalité ; il est uniforme ; il ne se dément point : qui l'a vu une fois, l'a vu dans tous les instants et dans toutes les périodes de sa vie ; c'est tout au plus le bœuf qui meugle, ou le merle qui siffle : il est fixé et déterminé par sa nature et, j'ose dire, par son espèce. Ce qui paraît le moins en lui, c'est son âme ; elle n'agit point, elle ne s'exerce point, elle se repose.
Avec les mondains de la fin du XVIIe siècle, La Bruyère a le goût de l'exagération et de la bouffonnerie et se rattache ainsi à ce courant souterrain qui va de Scarron au Marivaux du Télémaque travesti : Cliton, le gourmet, donnait à manger le jour qu'il mourut ; Diphile, l'amateur d'oiseaux, passe ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus à verser du grain et à nettoyer des ordures.
Mais, le plus souvent, le don de voir se fait précieux ; on respire avec le fleuriste ces tulipes aux beaux noms : l'Agathe, l'Orientale, la Veuve, le Drap d'or, la Solitaire, nuancée, huilée, bordée, à pièces emportées.... Avec le numismate Diognète, l'auteur admire une médaille et en estime le fruste, le flou et la fleur de coin.... Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux ? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son léopard, de sa plume ..., les vanter comme ce qu'il y a sur la terre de plus merveilleux, qu'il veut vendre ses coquilles ? Ce raffinement, joint à une désinvolture apparente dans la construction, explique que l'on ait pu voir en La Bruyère l'ancêtre de ce style ouvragé, que devaient cultiver, entre autres, Flaubert, les Goncourt et Proust...
Le moraliste
Tout en peignant la diversité des hommes en psychologue sensible, cet observateur libre a construit son ouvrage selon un ordre qui implique une métaphysique. Certes, il fait des problèmes sociaux la substance de ses réflexions, et ce sont les conditions De la cour, Des grands – non les catégories traditionnelles de la rhétorique –, les passions, les dispositions, les âges, les différences de fortune, lieu commun des moralistes, qui servent de titres aux chapitres des Caractères.
Cet ouvrage étincelant et à facettes dissimule le fil d'une méditation une, grave, serrée.
Écrivain, La Bruyère estime que la littérature vit une tension entre passé et présent Des ouvrages de l'esprit, mais surtout il défend le mérite personnel et les authentiques valeurs spirituelles face aux préjugés. La confidence se précise dans les chapitres Des femmes, Du cœur, où l'aveu est celui de la fidélité et du renoncement. Pour peindre la solitude, La Bruyère a des accents raciniens : Les hommes souvent veulent aimer et ne sauraient y réussir : ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer et, si j'ose ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres. Examine-t-il la société ? Las de ne point y trouver de politesse, il conseille le désert : Le sage parfois évite le monde de peur d'être ennuyé. À y regarder de plus près, les raisons s'ajoutent de fuir : la répartition des biens est inique, il convient de s'arracher à la ville et de vivre tel un laboureur, il faut éviter les grands qui nous corrompent par la jalousie stérile que – tout nuls qu'ils sont – ils nous inspirent. Mais La Bruyère ne serait pas un contemporain de Racine et de La Fontaine si le visage du souverain – en qui la Providence réunit les dons du ciel – n'éclairait ce monde d'intrigue et de cupidité.
La nature de l'homme est l'énigme qui, seule, explique les combinaisons infinies que propose la société. Au reste, avec sérénité et tristesse, il admet que la dureté, l'ingratitude, l'injustice, l'amour de nous-mêmes et l'oubli des autres constituent le fond de la nature humaine : la mort se fait sentir à tous les moments de la vie. Triste peinture : Je doute que le ris excessif convienne aux hommes, qui sont mortels. » Sous tant de caractères divers, la même certitude subsiste d'une issue fatale. Et ce n'est pas l'un des traits les moins cruels de l'auteur que cette fresque de vieillards déjà condamnés : Phidippe, qui craint la mort ; Gnathon, prisonnier de son vice et de ses terreurs ; Ruffin, jovial et sans cœur ; N..., qui bâtit pour lui seul et qui mourra demain ; Antagoras, haï de tous. Il n'y a qu'un seul remède : la solitude, pour nous rappeler à Dieu et à nous-mêmes.
Et pourtant La Bruyère, qui a fait l'inventaire des « puissances trompeuses », espère en la force du raisonnement quand il est utilisé pour l'apologétique. Aux antipodes d'un Pascal, il croit à l'entraînement des preuves et reprend l'enchaînement : Je pense, donc Dieu existe. Toutefois, cet homme tout en finesse rejette la subtilité : elle ne saurait nous introduire dans la compréhension du mystère ; à quoi bon, à mesure que l'on acquiert plus d'ouverture dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de sa religion ? L'existence du mal est, en effet, mystère : Les extrémités sont vicieuses et partent de l'homme ; toute compensation est juste et vient de Dieu.
Ainsi, la composition des Caractères est réelle : elle porte la marque de la personnalité de l'auteur que ses plongées dans le cœur humain ont convaincu de misanthropie. Tout au long de l'ouvrage, son désir de désert ne cesse de croître. Plus qu'un vain goût de littérature, il convient de situer les Caractères dans les perspectives du XVIIe siècle : comme les grands classiques, La Bruyère veut « instruire et plaire ; nul doute qu'il ne confie son véritable but quand il écrit : Quand on ne serait pendant sa vie que l'apôtre d'un seul homme, ce ne serait pas être en vain sur terre, ni lui être un fardeau inutile. Ce zèle l'a tiré de sa réserve : La Bruyère est un moraliste, non un philosophe.
Il est donc abusif d'extraire des Caractères une philosophie politique : c'est en honnête homme et en chrétien que La Bruyère condamne le régime social dont il est le témoin ; c'est en cœur généreux qu'il a pitié du peuple des champs – ces nimaux mâles et femelles –, non en précurseur des révolutionnaires. Il n'imagine pas une égalité parfaite et estime qu'un État doit conserver un grand mal plutôt que de susciter de nouveaux maux sans doute pires. Ce dont il rêve, c'est, après son ami Fleury, de réhabiliter les mœurs d'Athènes, et le Discours sur Théophraste, qui contient un panégyrique de la démocratie antique, éclaire sur ce point les Caractères.
En fait, La Bruyère, à la fois observateur et secret, homme du monde et solitaire, a peint dans ses Caractères tous les vices, toutes les manies, les faiblesses dont se recouvre notre vide. Mais son cœur restait pur, lyrique et tendre. À la cour, dans un pays où les joies sont visibles, mais fausses et les chagrins réels, mais cachés , l'auteur des Caractères a surtout constaté paradoxalement que les hommes n'ont point de caractère, ou, s'ils en ont, c'est celui de n'en avoir aucun qui soit suivi. Toutefois, malgré tant d'amertume, il respecte le mystère de la divine filiation et se rafraîchit au besoin dans l'admiration des vertus d'Arthénice : Il y a en elle de quoi faire une parfaite amie, il y a aussi de quoi vous mener plus loin que l'amitié.
À travers son œuvre, l'auteur, en fait, s'est peint lui-même, être d'émotions vives, épris de solitude, dont le don d'observateur et de peintre a fait l'un des talents les plus originaux de la littérature française. Jeanne-Lydie Goré-Caraccio
Citations
« J’ai pris un trait d’un côté et un trait d’un autre ; et de ces divers traits qui pouvaient convenir à une même personne, j’ai fait des peintures vraisemblables …Il faut que mes peintures expriment bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent à tant de particuliers ».
« Ceux enfin qui font des maximes veulent être crus: je consens, au contraire, que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l’on remarque mieux. »
Du cœur
« I2 (IV) L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir. »
« Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui. »
« C'est une grande difformité dans la nature qu'un vieillard amoureux. »
De la cour
«10 (VI) La cour est comme un édifice bâti de marbre : je veux dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis. »
« 22 (VI) L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt (…): quel moyen de demeurer immobile où tout marche, où tout se remue; et de ne pas courir où les autres courent? (…) question si épineuse, si embarrassée, et d’une si pénible décision, qu’un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non, et meurent dans le doute. »
« I0I (VI) La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville, et guérit de la cour.
(I) Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite. »
Des grands
« 22 (V) (…) Les grands sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font pas (…). »
« 29 (I) (…) ils songent à eux-mêmes, (…): cela est naturel. »
« 36 (IV) Tu es grand, tu es puissant : ce n’est pas assez; fais que je t’estime (…). »
« 56 (I) L’on doit se taire sur les puissants: il y a presque toujours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts. »
Posté le : 09/05/2015 15:58
|
|
|
|
|
François Albert-Buisson |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 mai 1881 à Issoire naît François Albert-Buisson
mort le 21 mai 1961 à Aix-en-Provence, fut tour à tour ou simultanément entrepreneur, industriel, magistrat consulaire, économiste, homme politique, historien français et membre de l'Académie française.
François Albert-Buisson Élu le 3 Mars 1955 au fauteuil 2 de l'académie française par 17 voix au fauteuil d'Emole Mâle, le même jour que Jean Cocteau et Daniel-Rops, François Albert-Buisson fut reçu le 10 novembre de la même année par Léon Bérard. Saluant avec humour son élection, l’un de ses nouveaux confrères aurait alors déclaré, en référence à ses activités dans l’industrie pharmaceutique, qu’avec Albert-Buisson l’aspirine faisait son entrée à l’Académie ! Il est fait Grand-croix de la Légion d’honneur en 1961. Homme politique, Historien, Magistrat.Membre de l’Académie des Sciences morales et politiques depuis 1936, il en devint secrétaire perpétuel en 1951. Ayant obtenu, en 1953, du ministre de l’Éducation nationale, André Marie, un décret qui transformait la fonction de secrétaire de la Commission administrative centrale de l’Institut en celle de chancelier de l’Institut de France, il fut élu à ce poste dont il fut le premier à porter le titre.
Petit-fils d’un fabricant de sabots, François Albert-Buisson entreprit des études de pharmacie à Paris. Reçu à l’internat des hôpitaux, docteur en pharmacie, il obtint également un doctorat de droit.
En bref
Albert-Buisson naquit le 3 mai 1881, à Issoire. Il fit de brillantes études primaires et secondaires. Après avoir été reçu bachelier à 17 ans, il décida d'entreprendre des études de pharmacie tout en s'inscrivant comme stagiaire à la Trésorerie générale de Thiers. En 1901, il s'inscrivit à l'Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris. Reçu à l'Internat en 1903, il entre à l'hôpital Broca où il fait la connaissance du Pr Delépine, qu'il prendra plus tard comme directeur scientifique, puis comme Président de Spécia. En 1905, il passe à l'hôpital Hérold, chez le Pr Goris.
Reçu pharmacien en 1906, Albert-Buisson prend la direction, deux ans plus tard de la grande pharmacie Dallier, au Mans , et créé, à côté de l'officine, une usine de produits chimiques où il fabrique des sels de magnésium. Dans son officine, il organise un centre de documentation gratuite à l'usage de ses clients, faisant ainsi déjà de l'éducation sanitaire. A la mort de son beau-père, qui possédait une usine d'engrais à Brest, Albert-Buisson vend la pharmacie du Mans et va se consacrer à la fabrication des superphosphates, créant en même temps à Paris, les Etablissements Albert-Buisson avec quatre spécialités : le Sédol, l'Ostreïne, le Véronidia, et le Feroxal.
Ayant entre-temps passé sa licence en droit, puis son doctorat en 1913, il entre comme juge suppléant au tribunal de commerce de la Seine.
Il est mobilisé en août 1914 et connaît la vie des tranchées. En 1915, à la suite d'une présentation d'un mémoire sur les poudres et qui lui vaut le prix de l'Académie des Sciences, il est rappelé à son usine de Brest pour fabriquer des oléums pour le service des poudres, ainsi que les premiers gaz asphyxiants. Atteint par les gaz, il est réformé et décoré de la légion d'honneur en 1916 à titre militaire. Après la guerre commence la carrière politique d'Albert-Buisson : il est élu maire d'Issoire, puis Conseiller Général et devient directeur de Cabinet au ministère des Finances dans le cabinet Herriot en 1924. Le gouvernement est renversé en 1926 et Albert-Buisson devient alors président de la Banque française du Commerce Extérieur puis, en 1930, de la BNCI. Il prendre la tête de Rhône-Poulenc en 1935.
En 1936, il est élu à l'Académie des Sciences morales et politiques, dans la section de Législation et droit public. Un an après, il est élu sénateur du Puy de Dôme. Tout au long de ces années, il accomplit plusieurs missions à l'étranger. Reçu par Hitler, il rapporte de son voyage une impression extrêmement pessimiste pour l'avenir de la France. C'est alors la guerre et l'occupation. Après la tourmente, Albert-Buisson rentre à Paris et se consacre à l'Institut et à Rhône-Poulenc, Spécia et Théraplix, à qui il fait attribuer par les Américains quelques grandes spécialités. En 1947, il est membre de la commission de la réforme du code du commerce et du droit des sociétés. En 1948, il est délégué par l'Académie à la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. En 1951, il est élu secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences morales et politiques, et en 1953, il devient chancelier de l'Institut, titre créé pour lui.
Enfin, pour couronner cette carrière, Albert-Buisson accède à l'Académie française en 1955.
Comme nous tous ici-bas, il naquit avec des dons et des travers. Ses dons furent nombreux : tout au long de sa vie, il s'employa à les cultiver et à leur assurer un plein emploi. Son goût de la représentation, il sut l'utiliser pour servir avec éclat les hautes fonctions dont il fut investi et toujours par la confiance de ses commettants ou de ses pairs J. Fougerolle
Sa vie
Fils d'artisans et petit-fils de paysans originaires d'Issoire, il part pour Paris après ses études secondaires et s'inscrit successivement à la faculté de pharmacie puis à celle de droit. Docteur en pharmacie, il obtient le prix Jules-Lefort de l'Académie française. Combattant de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1916, il soutient ensuite une thèse de droit sur Le chèque et sa fonction économique qui remporte le prix des thèses.
Nommé juge suppléant au tribunal de commerce de la Seine en 1913, il en devient président 1930-1934.
Créateur du laboratoire pharmaceutique Théraplix via l'entreprise Chimie et Atomistique, il est administrateur dans plusieurs entreprises industrielles et bancaires, devenant notamment président de la Banque nationale française pour le Commerce extérieur BNFCE et président fondateur de la BNCI, mais surtout président du conseil d'administration de Rhône-Poulenc de 19351 à 1959, après avoir été administrateur de Poulenc frères 1923 puis de Rhône-Poulenc 1928.
Directeur de cabinet d'Étienne Clémentel au ministère des Finances pendant le Cartel des Gauches en 1924-1925, il participe à plusieurs conférences économiques internationales, à Londres en août 1924 comme chef de la délégation financière, à Paris en janvier 1925, en 1926 comme délégué à la conférence économique franco-allemande.
Élu dans la foulée de la victoire du Cartel, en 1925, maire d'Issoire, il occupe cette fonction jusqu'en 1941. Élu conseiller général du canton d'Issoire le 3 mai 1928, il devient vice-président du Conseil général du Puy-de-Dôme.
Entré en janvier 1926 dans le conseil directeur du journal Le Moniteur du Puy-de-Dôme avant son rachat en 1927 par Pierre Laval, il se rapproche de ce dernier, l'accompagnant quand, Président du Conseil, il fait un voyage aux États-Unis en 1931. Candidat de la Fédération républicaine, radicale et radicale-socialiste du département lors des sénatorielles partielles du 8 août 1937, il est élu au premier tour de scrutin, avec le soutien de Laval, par 603 voix contre 394 à son principal adversaire, Georges Moreau, sur 1105 suffrages exprimés, en remplacement de Malsang, sénateur radical du Puy-de-Dôme décédé le 29 mai. Il occupe ces fonctions officiellement jusqu'en 1944. Lors de l'assemblée générale du 11 juin 1939, il est élu président d'honneur de la Fédération républicaine, radicale et radicale-socialiste du Puy-de-Dôme.
Siégeant au groupe de la Gauche démocratique, il appartient à la commission de la législation civile et criminelle et à celle des affaires étrangères, où il apporte ses compétences en matière de droit et d'économie politique. Le 10 juillet 1940, il vote les pleins pouvoirs à Pétain.
Sous le régime de Vichy, il se démet de sa fonction de maire 1941, mais préside de 1941 à 1942 la Commission administrative du Puy-de-Dôme. Puis il est nommé, avec Jacques Bardoux, vice-président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, présidé par le Dr Raymond Grasset, lui aussi radical et ancien fidèle de Clémentel à Riom lié à Laval.
Abandonnant ensuite toute vie politique, il se consacre désormais aux affaires privées et poursuit une carrière d'économiste et d'historien. Élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1936, il y occupe pendant cinq ans, à partir de 1951, les fonctions de secrétaire perpétuel. De même, il représente à partir de 1948 l'Institut de France à la délégation française de l'UNESCO. En 1953, les cinq académies de l'Institut créent en son honneur le poste de Chancelier, dont il est le premier dignitaire. Enfin, le 3 mars 1955, il est élu à l'Académie française, le même jour que Jean Cocteau et Daniel-Rops.
Cet homme polyvalent multiplia les activités. Créateur du laboratoire pharmaceutique Théraplix (via l’entreprise Chimie et Atomistique), il est administrateur dans plusieurs entreprises industrielles et bancaires, devenant notamment président de la BNFCE et président fondateur de la BNCI, mais surtout président du conseil d'administration de Rhône-Poulenc de 1936 à 1959.
Il fut également juge, puis président du tribunal de Commerce de Paris, avant de devenir directeur de cabinet au ministère des Finances, puis maire d’Issoire, sa ville natale, et sénateur du Puy-de-Dôme, avant la Seconde Guerre mondiale.
Il écrivit divers ouvrages de droit des affaires et de sciences économiques, ainsi que plusieurs monographies historiques consacrées à Michel de l’Hospital, au Cardinal de Retz. Il a écrit enfin un livre consacré aux Quarante au temps des Lumières.
Membre de l’Académie des Sciences morales et politiques depuis 1936, il en devint secrétaire perpétuel en 1951. Ayant obtenu, en 1953, du ministre de l’Éducation nationale, André Marie, un décret qui transformait la fonction de secrétaire de la Commission administrative centrale de l’Institut en celle de chancelier de l’Institut de France, il fut élu à ce poste dont il fut le premier à porter le titre.
François Albert-Buisson fut élevé en 1961 à la dignité de Grand-croix de la Légion d’honneur.
Il meurt subitement à Aix-en-Provence, où il se trouvait depuis une semaine, le 21 mai 1961, à l'âge de 80 ans. Il est enterré au cimetière de Passy. Son épouse est décédée en 1942.
Distinctions
Membre de l'Académie des sciences morales et politiques 1936
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques 1951
Chancelier de l'Institut de France 1953
Membre de l'Académie française 1955
Grand-croix de la Légion d'honneur 1961
Grand officier de la Couronne royale d'Italie
Grand officier de l'Ordre de Léopold
Chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre
Œuvres
Droit commercial et économie politique
Le Problème des poudres, au point de vue techniFrançois ALBERT-BUISSON Élu en 1955 au fauteuil 2
Grand-croix de la Légion d’honneur
Homme politique
Historien
Magistrat
Œuvresque, économique et national 1913
Le Chèque et sa fonction économique 1923
Les Crises économiques 1926
De la validité des clauses tendant à parer, dans les contrats, aux inconvénients de l'instabilité monétaire 1926
Le Nouveau Régime de l'administration municipale 1926
De la nature juridique des groupements d’obligataires et de la validité de leurs actes 1927
La transmission des « billets » de fonds et le privilège du vendeur 1928
Les Groupements d'obligataires. Étude juridique, économique et législative 1930
La Morale et les Affaires 1931
Le Statut de la faillite 1932
La Déviation du droit en période de crise économique 1932
Dynamisme économique et stabilité des lois 1933
La Sécurité juridique, condition de la prospérité économique 1934
Le Statut légal des fonds de commerce 1934
Histoire
Le Chancelier Antoine Duprat 1935
Michel de l'Hospital 1950
Le Cardinal de Retz 1955
Les Quarante au temps des lumières 1956

Posté le : 01/05/2015 20:13
|
|
|
|
|
Machiavel 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 mai 1469 naît à Florence Nicolas Machiavel en italien :
Niccolò di Bernardo dei Machiavegli ; Niccolò Machiavelli, penseur italien de la Renaissance, philosophe, théoricien de la politique, de l'éthique, de l'histoire et de la guerre, et mort à 58 ans le 21 juin 1527 dans la même ville.
Machiavel a donné en français naissance à plusieurs termes : machiavélisme et ses dérivés, qui font référence à une interprétation politicienne cynique de l’œuvre de Machiavel et machiavélien qui fait directement référence aux concepts développés par Machiavel dans son œuvre. Il produit des idées remarquables sur le Couple Fortune / Vertu, Conservation du pouvoir. Ses Œuvres principales sont : Le Prince, Discours sur la première décade de Tite-Live, La Mandragore. Il est influencé par Aristote, Tite-Live, César Borgia. Il a influencé la majeure partie de la philosophie politique ultérieure Adjectifs dérivés machiavélien, puis machiavélique sens dérivé
En bref
Niccolò Machiavelli doit à sa situation dans l'histoire et aux traits particuliers de son œuvre une fortune qui revêt plusieurs dimensions. Il fut homme de lettres et écrivit, entre autres, des pièces de théâtre. Il fut aussi un acteur de la Renaissance en Europe en tant que secrétaire, personnage assez important dans un État tel que la république de Florence. Toutefois, en ce qui touche sa présence engagée dans l'histoire et dans la politique, l'homme Machiavel connut en fait un assez petit destin, même si certains, comme Gramsci, voient en lui un patriote précoce et un utopiste de l'unité italienne. Homme de cour, homme d'étude : double vie, représentée par une double série d'images, le premier portrait, très largement posthume et ayant fixé quelques traits connus par ouï-dire, étant resté le plus célèbre, sous la brosse de Santi di Tito.
À l'évidence, cependant, l'essentiel est ailleurs. À propos de Machiavel, partout, on pense bien autre chose : universellement, il est reçu comme celui qui a formulé définitivement et aux yeux de tous ce qui est devenu dès lors le machiavélisme, c'est-à-dire la pratique politique, lorsqu'elle s'affranchit de toute règle autre que celle de la volonté de parvenir à ses fins. La consécration universelle de Machiavel, c'est la notion de machiavélisme, par laquelle il est arrivé à son nom propre ce qui pouvait lui arriver de mieux dans la vie collective : devenir la racine d'un nom commun. Comme toujours en pareil cas, il y a de la distance entre la notion, assez vague, que l'urgence du besoin de parler et de désigner a créée le machiavélisme, et le système d'idées que les chercheurs tentent patiemment de reconstituer : on a donc inventé le machiavélianisme pour désigner de façon érudite ce qu'a dû penser le Florentin. Dans cet article, on appellera néanmoins machiavélisme ce qu'il est possible d'exposer des idées de ce penseur de la politique.
Machiavel fait partie de ces hommes dont la renommée ultérieure a montré de façon récurrente qu'ils n'avaient pas apprécié correctement l'importance de ce qu'ils faisaient : ce qui l'a intéressé ne nous intéresse plus, et c'est dans l'ennui et le mauvais vouloir qu'il a écrit ce qui a fait de lui le père du machiavélisme. Il est devenu célèbre malgré lui. Si son destin avait été ce qu'il a constamment souhaité qu'il fût, au lieu d'écrire, il aurait été continuellement aux affaires de la république de Florence ville où il est né en 1469 et mort en 1527. Heureusement pour l'histoire de la pensée politique, il connut durant sa vie une assez longue période de disgrâce, à partir de 1512 – date du retour des Médicis à Florence – jusqu'à sa mort, avec de courtes interruptions. Il vécut cette période en exil dans sa propriété de Sant'Andrea in Percussina, à une vingtaine de kilomètres de Florence. Là il s'est plaint sans cesse de souffrir de l'inactivité, la seule inactivité qui le fit souffrir : celle de n'être plus qu'un écrivain, au lieu d'être encore le secrétaire de la Chancellerie des Très Hauts et Magnifiques Seigneurs de Florence (ce qu'il avait été pendant quatorze années, de 29 à 43 ans. Il a beau écrire un ouvrage politique majeur, les Discours sur la première décade de Tite-Live, concevoir une comédie, La Mandragore 1518, qui fait date dans l'histoire du théâtre italien, il est affligé de ne plus jouir de la confiance de ses seigneurs. Dès le prologue de la pièce, il s'excuse presque de l'avoir commise : « et si ce sujet vous semblait trop frivole et peu digne d'un homme qui veut paraître sage et grave, excusez-le, dans la pensée qu'il s'étudie à rendre plus doux, par ces vaines imaginations, ses jours de douleur ; car il ne sait pas où tourner ses regards ; on lui interdit de montrer dans d'autres travaux un autre talent, et il n'est point de récompense pour ses peines perdues. Pour sortir d'exil, rentrer en grâce, montrer qu'il pourrait être encore fort utile, Machiavel écrit en 1513 un petit livre, De Principatibus, devenu chez nous Le Prince. Il aurait volontiers donné les millions de lecteurs qui l'ont étudié pour n'en garder qu'un seul, son dédicataire, Laurent de Médicis, prince de Florence, auprès de qui il souhaitait retrouver un emploi, et qui ne l'a pas lu. S'il avait fait de sa vie ce qu'il voulut continuellement en faire, il serait maintenant aussi célèbre que les maîtres qu'il servit durant quinze ans, comme Piero Soderini, son supérieur direct, gonfalonier de Florence.
ll fut le témoin, dans sa jeunesse, des principaux bouleversements politiques qui allaient livrer l'Italie à la domination étrangère, et dont toute son œuvre ne cessera d'interroger les conséquences. Ses premiers écrits sont directement inspirés par son activité politique et diplomatique, qui commence en 1498 avec la charge de secrétaire de la seconde chancellerie, puis de la chancellerie des Dieci di Libertà e Balia, dont dépendaient les affaires militaires et la diplomatie. Après diverses légations, il est envoyé en 1502 à Urbin auprès de César Borgia, dont les conquêtes et le génie politique seront longuement cités en exemple dans le Prince. La répression du complot tramé contre César Borgia à Senigallia lui inspire, en 1503, l'Exposé de la manière dont le duc de Valentinois a abattu Vitellozzo Vitelli ; Oliverotto da Fermo, monsieur Pagolo et le duc de Gravina Orsini. Après l'élection pontificale de Giuliano della Rovere Jules II, 1503-1513, qui met un point final à l'aventure politique de Borgia, il place tous ses espoirs en Piero Soderini, élu en 1502 gonfalonier de Florence à vie et dont il est le confident et le bras droit. Dès lors, son activité se partage entre des missions diplomatiques, en France Rapport sur les choses de la France, 1510 et en Allemagne Rapport sur les choses d'Allemagne, 1512, et la création, à Florence, d'une armée autonome et non mercenaire, l' Ordinanza fiorentina, dont la chancellerie du commandement lui est confiée en 1506. Exilé au retour des Médicis, en 1512, Machiavel se retire dans sa petite propriété de Sant'Andrea in Percussina, près de San Casciano, où il écrit le Prince en 1513, mais publié en 1532, et amorce la rédaction des Discours sur la première décade de Tite-Live 1513-1521. Le Prince est sans doute l'œuvre qui a imposé Machiavel comme un théoricien de la politique incontournable depuis le XVIe s. jusqu'à aujourd'hui. Il est dédié à Laurent II de Médicis, petit-fils de Laurent le Magnifique pour l'exhorter à prendre la tête de la résistance italienne contre l'envahisseur étranger, français ou espagnol. Le Prince se propose moins de justifier théoriquement l'idée monarchique que d'affronter conjointement la théorie et la praxis du principat, à partir d'une réflexion (esquissée dans les 18 premiers livres des Discours sur la première décade de Tite-Live sur l'impossibilité d'une restauration républicaine dans la conjoncture italienne du début du xvie s. Il s'agit d'une conjoncture proprement révolutionnaire, par son caractère même de crise, exigeant l'instauration de nouvelles structures étatiques, autrement dit d'un nouveau principat, ayant son fondement dans la virtù du prince dont le portrait-robot, qui évoque César Borgia, est brossé dans les chapitres 15 à 23. Par virtù, Machiavel désigne le concept même de politique, qui consiste aussi bien dans l'art d'acquérir un État que dans celui, autrement périlleux, de s'y maintenir. Toutefois, cet effort pour regagner la faveur des Médicis, qui avait échoué auprès du dédicataire du Prince, Laurent II, aboutit en partie à la mort de celui-ci : sur la requête de Léon X Jean de Médicis, il écrit en 1519 le Discours sur les choses de Florence après la mort de Laurent, puis entreprend l'Histoire de Florence, 1525 sur l'histoire de la ville des origines à la mort de Laurent le Magnifique en 1492, à la demande du cardinal Jules de Médicis, le futur pape Clément VII. Ce retour en grâce, scellé par la représentation de la Mandragore 1520 et de la Clizia 1525, lui vaudra son dernier discrédit lors du rétablissement de la république en 1527, l'année du sac de Rome, peu de temps avant sa mort. Jusqu'au Prince inclus, la réflexion théorique de Machiavel, qui emprunte ses objets à l'histoire ou à l'actualité, est subordonnée à l'action politique. L'échec de son intervention auprès des Médicis, autrement dit l'échec politique du Prince, rejettera définitivement Machiavel de la politique vers l'histoire et la littérature. Les livres II et III des Discours, en particulier, tout en élaborant les principes d'une réforme politique à la dimension des grands États modernes, visent plutôt à fonder sur de nouvelles bases, au fil du commentaire de Tite-Live, l'histoire comme science, non sans plier souvent les faits à la violence créatrice d'une interprétation dont le scrupuleux Guichardin déplorait l' inexactitude. Et, si l'Histoire de Florence atteste encore abondamment l'engagement politique de Machiavel, son influence s'exercera surtout – et pour longtemps – dans le champ rhétorique du récit de l'histoire. Quant à l'œuvre proprement littéraire de Machiavel, elle se signale avant tout par la Mandragore, chef-d'œuvre du théâtre italien de la Renaissance. La trame est simple : pour obtenir un enfant, Messer Nicia, aussi riche que benêt, n'hésite pas à jeter sa femme dans les bras du premier venu, dupe qu'il est de la croyance que l'inconnu – en l'occurrence, l'amant éperdu de sa femme – en mourra, pourvu que celle-ci ait précédemment avalé une potion de mandragore. Cette géniale simplicité d'intrigue, la virulence du réalisme critique, l'exaltation de la vérité des sentiments et la séduction d'un langage qui a la verve d'un carnaval de l'intelligence ont déterminé le franc succès de cette pièce.
Sa vie
Né à Florence, dans une famille noble, Nicolas Machiavel est le fils de Bernard Machiavel, trésorier pontifical à Rome et docteur en droit, et de Bartolomea de' Nelli.
Ses études terminées, il est une première fois candidat à un poste de l'administration florentine le 19 février 1498 mais n'est pas retenu. Après la condamnation au bûcher de Jérôme Savonarole, il est nommé secrétaire de la deuxième chancellerie et prend officiellement son poste le 19 juin 1498. Il mène à ce titre des missions diplomatiques, en Italie comme à l’étranger, se forgeant ainsi déjà une opinion sur les mœurs politiques de son temps. Il rédige à ces occasions des dépêches diplomatiques, réunies sous le titre Les Relations diplomatiques, ainsi que des rapports Rapports sur les choses de l’Allemagne, Rapport sur les choses de la France. En 1512, les troubles à Florence le condamnent à l'exil. C'est à ce moment-là qu'il écrit Le Prince dans lequel on trouve les prémices de sa conception politique.
Les Médicis reviennent au pouvoir à Florence, à la suite de la défaite de Prato en 1512. Machiavel est soupçonné d’avoir participé à la conjuration fomentée par Pietro Paolo Boscoli it, il est emprisonné, torturé, puis interdit de quitter le territoire florentin pour un an, se retire ensuite dans sa propriété de Sant’Andrea in Percussina, frazione de San Casciano in Val di Pesa. Machiavel y commence son Discours sur la première décade de Tite-Live, où, parlant de l’Antiquité, il dresse en fait une critique de la situation politique italienne de son époque.
L’année suivante, il interrompt la rédaction des Discours pour écrire, en 1513, son ouvrage le plus célèbre, Le Prince en italien : Il Principe, qui doit être lu en parallèle avec ses Discours sur la première décade de Tite-Live, ouvrage explorant à la lumière de l'exemple de Rome les moyens nécessaires à l'édification en Italie d'une véritable république et la reconstruction d'une Italie unie les guerres internes et la politique pontificale étant selon lui les deux plus grandes plaies de l'Italie, responsables des misères du peuple et de la faiblesse du pays.
Le Prince, dédié à Laurent II de Médicis, est pour Machiavel une tentative de retrouver une place dans la vie politique de Florence. Dans ce livre, comme il l'écrit dans sa dédicace, il ose donner des règles de conduite à ceux qui gouvernent :
Il ne faut pas que l’on m’impute à présomption, moi un homme de basse condition, d’oser donner des règles de conduite à ceux qui gouvernent. Mais comme ceux qui ont à considérer des montagnes se placent dans la plaine, et sur des lieux élevés lorsqu’ils veulent considérer une plaine, de même, je pense qu’il faut être prince pour bien connaître la nature et le caractère du peuple, et être du peuple pour bien connaître les princes.
— Nicolas Machiavel, Dédicace du Prince à Laurent II de Médicis
Machiavel est un homme politique avant tout, qui loin des affaires de son pays se sent complètement inutile. Ouvrage intéressé donc, Le Prince contient néanmoins, entre les lignes de cet appel à la réunification de l'Italie fait aux Médicis, toutes ses théories républicaines qu'il y a dissimulées avec ruse. Machiavel, théoricien de la ruse, n'en manquait pas lui-même : Le Prince, de lecture simple en apparence, est un ouvrage d'une grande densité dans lequel des théories fortes et nouvelles sont inscrites.
Revenu à Florence en 1514, Machiavel écrit une comédie, La Mandragore, en 1518. À la demande du cardinal Jules de Médicis, il commence L’Histoire de Florence en 1520, et l’achève en 1526. C’est une nouvelle disgrâce pour lui à l’avènement de la république, en 1527, où on lui reproche sa compromission avec les Médicis. Il meurt cette même année à Florence.
Machiavel et le machiavélisme
Machiavel est aujourd'hui encore présenté comme un homme cynique dépourvu d’idéal, de tout sens moral et d’honnêteté, ce que définit l’adjectif machiavélique. Or, ses écrits montrent un homme politique avant tout soucieux du bien public, qui cherchait à donner à la République de Florence la force politique qui lui manquait à une période où, paradoxalement, elle dominait le monde des arts et de l’économie. Cependant il ne nourrissait aucune illusion sur les vertus des hommes : puisqu'il partait du présupposé que les hommes sont par nature mauvais.
L'adjectif machiavélique est apparu au cours du xvie siècle. Si Machiavel n'est pas un défenseur d'une idée du Bien en politique, qu'il juge naïve et incohérente, son but principal est l'efficacité de la politique du prince, pour le bien du prince et donc de sa nation.
Ainsi, les interprétations les plus courantes à son sujet, sinon les plus pertinentes, se divisent en celles qui en font le héraut du machiavélisme, pour qui la fin justifierait les moyens par exemple Léo Strauss ou tout le courant de l'anti-machiavélisme, tandis que d'autres en font un représentant éminent du courant du républicanisme, tel que, par exemple, Rousseau, qui écrit En feignant de donner des leçons aux rois, il en a donné de grandes aux peuples. Le Prince est le livre des républicains, ou Philip Pettit et Quentin Skinner.
En 1578, Innocent Gentillet publia un essai après le massacre de la Saint-Barthélemy pour réfuter l'œuvre de Machiavel. L'ouvrage obtint une diffusion considérable à travers toute l’Europe et contribua à établir les malentendus durables sur l’œuvre de Machiavel et ses interprétations. Comme si la révélation publique des ressorts du pouvoir rendait Machiavel responsable de sa corruption et des moyens de tout temps employés pour le conserver. En révélant ces mécanismes, éventuellement en recommandant leur usage lorsque la situation l'exige et que la faiblesse de caractère pourrait avoir des conséquences encore pires, Machiavel tentait de montrer une voie pour en sortir tout en n'évacuant jamais de ses raisonnements sa méfiance constante vis-à-vis de la nature humaine, c'est la naissance d'un point de vue unique d'un homme de terrain, d'un théoricien de génie, d'un écrivain dont Nietzsche fera l'éloge stylistique3, et d'une honnêteté pratique et intellectuelle complète. Althusser dira de lui qu'il était pour toutes ces raisons un penseur de l'impossible4.
Malgré cette réputation entachée par la méconnaissance et l’Église, Machiavel tient une grande place dans la pensée politique. Il est particulièrement apprécié dans son pays natal notamment à Florence, où l’on trouve un monument à sa gloire, érigé par le grand-duc Pierre-Léopold-Joseph, à côté des tombeaux de Galilée ou de Michel-Ange. Il y est inscrit :
Tanto nomini nullum par elogium
Nicolaus Machiavelli
Aucun éloge n'est digne d'un si grand nom
La pensée de Machiavel
Il existe donc un machiavélisme, assez cohérent si on fait abstraction des gauchissements qu'il a dus aux circonstances, assez constant en tout cas pour avoir inspiré continûment les textes commandés et pour avoir été explicitement thématisé dans les traités cardinaux de l'exil.
Les pôles de la pensée de Machiavel portent des noms : fortuna et virtù. La nature du politique en découle et, sans doute, ne peut être comprise qu'à partir de ces mots. Ils avaient été utilisés avant lui, sporadiquement ; mais c'est lui qui en a fait des concepts opératoires, porteurs d'un pouvoir organisationnel tel qu'ils ont inauguré, à partir de lui et pour la première fois, une élaboration de l'univers politique qui porte désormais son estampille. La rencontre de ces deux notions permet d'en comprendre une troisième, celle de pouvoir.
Philosophie
Pour Machiavel, la politique se caractérise par le mouvement, par le conflit et des ruptures violentes. Afin de prendre, conserver puis stabiliser son pouvoir dans un État, le Prince doit faire preuve de virtù, pour s'adapter au mieux aux aléas de la fortuna. En effet, la politique est l’art de bien gérer la cité mais aussi celui d'apprendre à se maintenir au pouvoir dans une situation ouverte à tous les retournements. " Si tu savais changer ton caractère, quand changent les circonstances, ta fortune ne changerait point . D'où l'importance centrale des notions machiavéliennes de fortuna et de virtù
Un écrivain décentré
On le voit, c'est dans une rupture douloureusement vécue que naît la prose de Machiavel. Ainsi, chaque écrit doit être compris par rapport à une genèse compliquée, ce qui justifie une bonne part de la théorie du double discours machiavélien mise en œuvre par Claude Lefort ou Leo Strauss : d'un côté, en effet, l'intelligence de Machiavel est assez présente, toujours, pour illuminer le moindre rapport diplomatique de traits généraux dont l'accumulation à travers l'œuvre constitue par sommation une pensée neuve ; mais, inversement, les traités qui semblent détachés des préoccupations de carrière sont dans le même temps des écrits de circonstance : Le Prince s'adresse à Laurent de Médicis en même temps qu'à tout lecteur ; de la même façon, les Discours sont écrits pour nous et pour les quelques républicains qui, dans le jardin de la villa Rucellai, mettaient au point la conjuration anti-médicéenne de 1522.
Pour comprendre la portée et la nature même des écrits, il faut donc les rapporter aux péripéties d'une vie qui ne fut pas, d'ailleurs, celle d'un grand aventurier. Ses années d'enfance ont donné lieu à peu de documents officiels, comme on peut s'y attendre pour un jeune homme dont les parents appartenaient petitement aux « arts majeurs c'est-à-dire à la bourgeoisie moyenne de la Florence d'alors. Depuis 1954 seulement, les Souvenirs de son père Bernardo, notaire et paysan, retrouvés et publiés par Olschki à Florence, permettent un peu de savoir ce que faisait cette famille par ailleurs ordinaire. La carrière publique de Machiavel commence en 1498, un mois après qu'a été brûlé Savonarole sur la place de la Seigneurie. Alors que les Florentins réinstallent une république délivrée de tout mysticisme, en se gardant bien de se donner une dynastie déguisée, comme cela avait été le cas avec les Médicis, Machiavel est élu parmi quelques candidats d'abord tirés au sort pour occuper le poste important de secrétaire de la Seigneurie, présidant aux travaux de la Deuxième Chancellerie. Dès le mois suivant, il est affecté en outre au secrétariat des « Dix de pouvoir, pour les relations étrangères. Sa carrière publique se terminera quinze années plus tard, deux mois après le retour des Médicis. Ces quinze « années de république, il les a passées à cultiver l'art de l'État, et il ne les a ni dormies ni jouées, comme il l'écrit à son ami Francesco Vettori dans une des premières lettres de sa période de disgrâce. Elles ont été occupées à des missions d'organisation à l'intérieur ainsi qu'à des voyages de négociations en Europe.
Durant le temps où il participe au gouvernement, Machiavel n'écrit pas d'œuvres dont l'objet serait explicitement général, mais d'assez nombreux rapports et notes diplomatiques. Tout ce qui a été retrouvé a fait l'objet d'une publication en français : quelque deux cents lettres officielles et familières, et, parmi les rapports, certains très significatifs pour qui veut comprendre. Entre autres : De la manière de traiter les populations du Val di Chiana révoltées 1504, le Rapport sur les choses de l'Allemagne 1508, un petit texte Sur la nature des Français, écrit vers 1500, et suivi en 1510 du Rapport sur les choses de la France... Plus tard, à Sant'Andrea in Percussina, il se consacre à l'écrit : théâtre La Mandragore, L'Archédiable Belphégor, 1518 et poésie L'Âne d'or, 1516, mais surtout, en quelques jours, le De Principatibus, dès la deuxième année de sa résidence forcée, interrompant ainsi la rédaction des Discours sur la première décade de Tite-Live qui, elle, l'occupe de 1513 à 1520, tout comme celle d'un autre traité important pour la compréhension du machiavélisme : L'Art de la guerre. Suivent encore deux textes majeurs : en 1520, une étude sur La Vie de Castruccio Castracani de Lucques, et les Histoires florentines 1520-1526, écrites à la demande du cardinal Jules de Médicis, futur Clément VII.
Un timide retour à la vie publique s'amorce : en 1525, on lui redonne le droit de tenir une charge à Florence. En 1526, il travaille aux fortifications de la ville. En mai 1527, pour la troisième fois, les Médicis qui avaient proscrit Machiavel sont chassés de Florence. Trop tard : aigri, usé, Machiavel ne peut faire bonne figure devant ce changement qui eut dû ne pas lui déplaire ; le temps des Médicis avait été trop long pour que l'ancien secrétaire ne se fût pas compromis par ses offres de service. À deux mois près, il eût été épargné : dans la République qui s'installait de nouveau, nul ne songea à confier quelque charge à cet ancien serviteur devenu louche. Il lui fut permis de venir mourir à Florence, ce qu'il fit le 22 juin de cette année 1527.
Fortuna, Virtù, notions indépendantes à l’origine de l’action politique ?
La fortuna est une force non humaine, la chance, bonne ou mauvaise, qui intervient dans les affaires humaines. La virtù traduit abusivement par vertu, principale qualité du prince, renvoie à une disposition humaine de réaction, ou de non réaction, face à l'évènement. S'exerçant dans et à travers la fortuna, la virtù est au cœur de l'art du prince. Les thèmes de la fortuna et de la virtù sont développés dans Le Prince de Nicolas Machiavel écrit en 1513, publié en 1532.
La Fortuna est une nécessité extérieure à laquelle il faut généralement répondre dans l'urgence. Cela illustre la part d'imprévisible avec laquelle les acteurs politiques doivent composer. Aussi l'action politique ne saurait se ramener uniquement à l'imposition d'une volonté, même la plus déterminée ; les intentions ne suffisent pas et la réussite de l'action politique suppose donc quelque chose de plus que la volonté. La fortuna dicte sa loi à ceux qui abdiquent devant elle et ne lui opposent rien : Là où défaille la virtù des hommes, la fortuna porte ses coups les plus efficaces. Je juge qu'il peut être vrai que la fortuna soit l'arbitre de la moitié de nos actions, mais aussi que l'autre moitié, ou à peu près, elle nous la laisse gouverner. Dans son œuvre Les Capitoli, Machiavel utilise une longue prosopopée pour définir la fortuna : Je suis l’occasion, je ramène devant moi tous mes cheveux flottants et je dévoile sous eux ma gorge et mon visage pour que les hommes ne me reconnaissent pas. Derrière ma tête, pas un cheveu ne flotte, et celui devant lequel je ne serais pas passée se fatiguerait en vain pour me rattraper.
La virtù définie par la Fortuna
La virtù du latin virtus le courage est l'autre versant de la pensée de l'action politique de Machiavel. Elle doit avant tout être comprise comme la capacité d'imposer sa volonté à la fortuna. Aussi, la virtù des acteurs politiques ne renvoie pas directement à leur caractère vertueux mais plutôt à leur vaillance, à la qualité avec laquelle ils abordent la fortuna et essayent de la maîtriser. C'est la souplesse plus que la rigidité que Machiavel entend défendre ; la virtù implique que les acteurs politiques sachent avant tout s'adapter aux circonstances. Ainsi Machiavel recommande une conduite pragmatique de l'action politique ; une conduite qui sache adapter l'action politique à la contingence des circonstances. L’analogie du fleuve déchaîné et des digues explique que la fortuna montre surtout son pouvoir là où aucune résistance n’était préparée cf. Le Prince, chap. XXV. La fortuna sans virtù est à l’image de la nature non maîtrisée, cf. Discours sur la première décade de Tite-Live, III, 12. Le rôle de la virtù est donc de prévoir les catastrophes, de les prévenir.
Le rapport Fortuna/Virtù
Dans le chapitre VI, Machiavel montre bien que la Virtù est la capacité d’imposer sa loi à la Fortuna. En effet, il y montre bien que ce que les grands fondateurs d’État durent à la fortune, ce fut l’occasion qui leur fournit une matière à laquelle ils purent donner la forme qu’ils jugèrent convenable. Elle est donc l’occasion de faire preuve de ses talents politiques ; sans elle, l’occasion eût pu disparaître. La Fortune vole au secours de qui sait ne pas s’illusionner et être habile. Là où la Virtù est à son maximum, la Fortuna n’a qu’un rôle d’appoint. Affrontée grâce à la lucidité, la Fortuna apparaît comme l’aiguillon de la nécessité : ce qui signifie qu’elle montre la nécessité d’agir, et d’analyser les rapports de force en présence. La Virtù est donc effort de lucidité en des circonstances particulières, effort intellectuel à l’œuvre dans le concret de l’histoire. Le concept de nécessité indique donc la place des circonstances incontournables, mais jamais totalement claires, sauf pour une pensée politique avisée.
Les concepts de Fortuna et Virtù dans la littérature et la philosophie
John Greville Agard Pocock, dans son œuvre The Machiavellian Moment 1970, présente la complexité et la richesse de l’opposition entre la virtù et la fortuna dans Le Prince. Cette opposition est selon lui au cœur du «moment machiavélien et de l’idée républicaine. Elle gagne d’ailleurs en épaisseur dans les écrits républicains de Machiavel.
Selon Helmuth Plessner contemporain de Heidegger la politique se définit, de manière très machiavélienne, comme l'art de l'instant favorable, de l'occasion propice, ce que les Grecs appelaient le kairos et ce pourquoi Machiavel associait la fortuna à la virtù nécessaire à l'homme politique.
Fortuna
La nature des choses est neutre en ce qui touche l'organisation politique des groupes humains. Il n'existe évidemment que la nature – en ce sens précis que n'existe aucun arrière-monde –, mais cette nature ne décide ni ne prédétermine rien. La notion de fortune remplit donc dans le système une fonction complexe, destinée à dégager le champ de l'action. On peut essayer de la caractériser, même s'il est difficile de lui donner une définition entièrement conceptuelle. D'abord, la fortune ne se présente jamais en personne à l'homme d'action, mais sous la forme de son corrélat pratique, qui est l'occasion de la fortune. Pour l'homme d'action, le réel est morcelé, fait de changements locaux, sans aucune aperception du Tout. La fortune est ce qui fragilise la pratique et la prive de toute emprise réelle , donc de toute garantie ; elle ne se conjugue jamais au futur, et dès qu'on veut en parler au présent, elle s'évanouit en s'atomisant sous les espèces de la pluralité des occasions disjointes.
Ensuite, l'homme de savoir lui-même, quand il entreprend de se mêler de l'action, ne peut que conseiller les Grands. Son savoir de la pratique n'a pas pour objet l'avenir : il ne contient jamais qu'une mémoire du passé. L'intellectuel est historien, et l'histoire est une discipline de la mémoire, non de l'intelligence inductive. L'historia, en effet, s'édifie à partir des ressemblances des faits et pratique des comparaisons. Le modèle en vient de loin, des historiae latines, grands récits édifiants et instructifs qui traitent de cas et d'hommes illustres, De viris illustribus, récits toujours ouverts à des récits ultérieurs. Le savoir ne sera jamais fait que de l'accumulation de cas racontés. Dès lors, pour le penseur, la fortune permet de formuler cette idée capitale, selon laquelle les événements pourront après-coup être intégrés dans un tout. Quoi qu'il arrive, et sans qu'on puisse rien prévoir, on doit penser que ce qui s'est produit peut être intégré dans la somme du pensable. Claude Lefort dans Le Travail de l'œuvre, Machiavel exprime ainsi l'abîme qui sépare l'intellectuel machiavélien de l'homme d'action : d'un premier point de vue, le théoricien paraît embrasser l'histoire dans toute son étendue .... Mais, d'un autre point de vue, nous voyons le théoricien condamné à raisonner sur le passé .... Le prince a le mérite ... de déchiffrer dans le présent les signes de ce que sera la figure des conflits à venir et de faire ainsi, dans la pratique de l'anticipation, l'épreuve du calcul infini .... Semblable au médecin dont la vertu est de formuler son diagnostic quand la maladie n'est encore qu'à son début, il l'emporte, nous dit Machiavel, sur celui qui, du fait qu'elle s'est développée, dispose de tous les éléments de certitude mais s'avère incapable d'en modifier le cours . Du point de vue de l'histoire qui se fait, c'est le prince qui fait figure de héros, et sûrement pas le scribe de l'histoire. Que l'homme virtuoso sache aujourd'hui que la fortune ne lui garantit rien, sans que pour autant il y ait scandale pour la pensée. Qu'il retienne ce que lui enseigne le Discours sur la première décade II, 24 : La fortune aveugle l'esprit des hommes quand elle ne veut pas qu'il s'oppose à ses desseins. Telle est la marche de la fortune : quand elle veut conduire un grand projet à bien, elle choisit un homme d'un esprit et d'une virtù tels qu'ils lui permettent de reconnaître l'occasion ainsi offerte. De même, lorsqu'elle prépare le bouleversement d'un empire, elle place à sa tête des hommes capables d'en hâter la chute.
Ainsi donc, la fortune est ce qui donne congé à l'intelligence globale des événements de ce monde, et donc à l'espérance pratique de prévoir inductivement les conséquences des l'action. Seule demeure l'invite à l'observation de ses faits fragmentaires indéfiniment répétés et porteurs de leçons partielles accumulées par l'exercice de la mémoire comparative. Littérairement, Machiavel a parlé de la Fortune comme d'une déesse changeante, capricieuse, fantasque ; façon de déplacer le champ de la réflexion, de le réorganiser. Pour lui, il le dit pour la première fois et cela restera attaché à son nom comme étant son message propre, la politique est l'art de calculer des moments en sachant qu'ils sont instables, précaires, rapidement changeants, parce qu'ils ne renvoient à rien d'autre qu'au caprice de la Fortune. Évidemment, Machiavel ne croit pas à la déesse Fortune : il nous signifie simplement que l'entrée en politique s'inaugure par l'acceptation d'une déroute de l'intelligence et par une promotion corrélative de la pure volonté d'agir.
Virtù
Cette volonté de pouvoir, détachée de toute condition qui la fonderait en en faisant un attribut « psychologique » ou « historique » qui serait alors lié par nature à quelques élus, c'est la virtù. La tradition philologique de la transmission des textes machiavéliens a rendu un fort mauvais service à la compréhension de cette notion. Cette tradition concerne l'ouvrage réputé majeur, d'un livre dont le titre original était un pluriel, De Principatibus, dont on a fait un singulier : Le Prince. D'un propos initial ayant un véritable contenu théorique au sujet des divers types d'États possibles, on a fait un portrait du prince idéal, comme s'il y en avait un qui soit prédestiné à l'être. C'est-à-dire que, sans doute pour dramatiser, la tradition moderne désigne l'appel circonstancié que Machiavel adresse à Laurent de Médicis avec le propos clairement exprimé de se placer au détriment d'un contenu évidemment moins ponctuel, dont le projet est tout au contraire une revue dans la lignée des taxinomies aristotéliciennes, et concernant les formes diverses que peut prendre la souveraineté.
La virtù est donc une volonté pure de pouvoir, surgie ex nihilo dans le destin des individualités multiples qui tissent l'histoire. On conçoit dès lors que la proposition : la virtù existe est de l'ordre de l'axiome. On ne peut que l'affirmer, et par la suite l'illustrer, c'est-à-dire en exhiber les diverses formulations.
Première illustration : bien loin d'être conditionnée par une psychologie qui serait un trait particulier de tel ou tel, la virtù rencontre au contraire la psychologie de l'individu comme un obstacle et comme sa principale limitation. Alors que la virtù, si elle pouvait exister sous la forme d'une force nue dégagée de toute condition d'ancrage subjectif, serait toujours adaptée aux occasions de la Fortune, elle se donne nécessairement à travers une nature humaine individuelle rigide et résistante. Deux choses s'opposent à ce que nous puissions changer : d'abord, nous ne pouvons pas résister au penchant de notre nature ; ensuite, un homme à qui une façon d'agir a toujours parfaitement réussi n'admettra jamais qu'il doit agir autrement. C'est de là que viennent pour nous les inégalités de la fortune : les temps changent et nous ne voulons pas changer Discours sur la première décade de Tite-Live, III,.
Deuxième formulation, exprimée par un trait d'un fantasme propre à Machiavel. S'il est vrai qu'il dédie le De Principatibus à un fils de famille Laurent de Médicis à qui il a été donné de régner, les deux véritables héros de sa réflexion sont loin d'avoir une aussi bonne extraction. Ce sont deux bâtards, que précisément rien ne destine au pouvoir parce qu'ils ont une ascendance honteuse. César Borgia, duc de Valentinois, est la première de ces figures peu avouables, car il est le fils du pape Alexandre VI. L'autre héros s'appelle Castruccio Castracani, condottiere qui s'est emparé du pouvoir à Lucques, par force et par ruse, et non par droit de succession. C'est l'obscurité même de sa bâtardise qui alimente l'admiration, fascine le secrétaire et justifie que sa Vie de Castruccio Castracani 1520 soit d'autant plus révélatrice des intérêts machiavéliens. C'est dans la promotion politique du bâtard que l'histoire des hommes révèle son ressort, comme nous en avertit le texte dès son début : C'est chose merveilleuse à considérer ... que la totalité ou la plupart de ceux qui ont accompli de grandes choses dans le monde et ont excellé parmi les hommes de leur temps ont eu une naissance ou des débuts humbles et obscurs, ou du moins fortement contrariés par la Fortune ; ou bien ils ont été exposés aux bêtes, ou bien ils ont eu un père si vil que, par vergogne, ils se sont déclarés fils de Jupiter ou de quelque autre dieu .... Je crois bien qu'en agissant de la sorte, la Fortune entend démontrer au monde que c'est elle, et non leur sagesse, qui fait les grands hommes, choisissant pour manifester son pouvoir le moment de leur vie où cette sagesse ne peut intervenir en rien, et où c'est à elle, Fortune, qu'il faut tout rapporter.
Pouvoir
Le pouvoir marque la rencontre, pour un temps nécessairement limité, d'une façon toujours précaire et inévitablement polémique, entre la virtù d'un prince et une occasion de la Fortune. Un pouvoir d'État donne réalité – une certaine réalité – à un groupe humain. Machiavel appelle cela l'instauration d'une nation qui, de virtuelle qu'elle était, se réalise dans l'histoire. Au niveau de ce qui se voit, le bruit et la fureur manifestent l'existence politique, comme les tribulations et les intrigues, les fracas de batailles et les chuchotements d'alcôves : cela fait beaucoup de mouvement. Envisagé dans sa globalité, cependant, le tout est immobile. Pour être bien certain que l'idée de progrès historique des politiques humaines n'a aucun lieu où se loger, Machiavel utilise à son tour – après Platon, les stoïciens et bien d'autres – l'image du cercle : l'histoire est circulaire, chaque régime se mue en sa caricature, devient son contraire et le cycle continue. L'une des premières caractéristiques de l'homme machiavélien concerne sa déréliction.
L'irruption sans cause de la virtù dans le cours des événements historico-politiques interdit au théoricien qui pense selon Machiavel toute recherche du côté d'une anthropologie qui s'apparenterait à quelque « psychologie des profondeurs » de l'homme d'État. Le politique machiavélien est un homme de calcul extraverti qui ne s'interroge pas sur ses motivations et qui n'a jamais à répondre des conditions du désir. Par ailleurs, l'absence d'étiologie objective de la nature des États limite drastiquement toute tentative pour fonder le politique. Seuls demeurent des appétits concurrents de régner, des désirs entrechoqués, des volontés tendues qui semblent ne sortir que d'elles-mêmes et ne tirer que de leur lutte les principes de leurs décisions. Parce que la politique est une catégorie autonome lorsqu'on entreprend de la penser, on ne peut dès lors que la raconter, en décrire les arcanes compliquées, l'agir ou en pâtir. C'est peu pour fonder une science politique ; cela peut même suffire à décourager une telle science en lui ôtant tout véritable objet épistémologique. C'est dire que l'autonomie du politique est beaucoup plus inconditionnée dans les textes de Machiavel que celle à laquelle la tradition populaire attache ordinairement le machiavélisme, à savoir l'indépendance du pouvoir à l'égard des règles réputées communes de la moralité publique ou personnelle, et même religieuse. Il est vrai que c'est cette indépendance qui est la plus immédiatement visible, la plus menaçante, la plus scandaleusement vécue, parce que la plus terrifiante. Mais on perd sans doute de vue l'essentiel de l'inspiration machiavélienne lorsqu'on porte cette distance-immoralité » au crédit de la scientificité.
Postérité du machiavélisme
Le Prince s'est répandu rapidement en Europe à travers les traductions latine ou française, et a connu une renommée considérable. Par la suite, ce qu'il est convenu d'appeler la tradition machiavélienne s'est déployé à plusieurs niveaux. Le plus politiquement immédiat de ces accès vécus à la lutte pour le pouvoir est, sans qu'il soit nécessaire pour personne de conduire de très longues recherches, la dénonciation du machiavélisme, considéré comme pratique de l'adversaire : elle s'appuie sur une permanence historiquement évidente des comportements détournés et calculateurs, des coups, des tromperies. C'est le sens le plus dégradé de l'estampille machiavélique . Ainsi, pour les penseurs de la Réforme, les machiavéliques sont les Jésuites ; pour chaque parti, à peu près continuellement, c'est l'autre... ; on raconte que, dans le même temps et dans le cadre de la même lutte pour le pouvoir, Mussolini dans ses palais et Gramsci dans sa prison lisaient tous les deux Le Prince.
Plus élaborées sans doute sont la recherche et la dénonciation des régimes machiavéliques notoires, c'est-à-dire ceux dont la congruence avec le corps social est inexistante et dont on ne peut plus du tout dire qu'ils en représentent l'émanation. Même si l'organisation politique n'est jamais réductible au social sans quelque gauchissement, détournement, transposition, tricherie, tous les régimes politiques ne sont pas également distants de la société dont ils sont plus ou moins la manifestation. Même si, de façon générale, un jugement sur le machiavélisme de l'autre n'est jamais sans polarité préférentielle, il est des périodes où la réprobation politique fait plus qu'affleurer : les figures majeures du théâtre élisabéthain, comme Marlowe ou Shakespeare, ne sont pas neutres en matière de conduite des affaires politiques et recourent volontiers au modèle machiavélien. C’est dans cette ambiance que le Diable a reçu un nom de baptême qui résiste bien dans le monde anglophone depuis 1643 : Old Nick, Vieux Nicolas...
L'analyse philosophique et politologique du machiavélisme renonce, on s'en doute, à toute dénonciation de type historique ou axiologique de tel ou tel régime. Ces jugements appartiennent à d'autres registres que celui de la seule compréhension. La méthode machiavélienne d'analyse, quand elle réfléchit sur les conditions de son exercice, révèle sa complexité, et c'est cette complexité elle-même qui à la fois la sauve et en pointe les limites. Comme type d'explication, elle s'est trouvée dépassée ; comme découverte d'un champ autonome d'explication, elle apparaît permanente.
Limites
Dépassée : la grille interprétative qui sous-tend le discours machiavélien est évidemment antérieure à l'apparition de la science politique et des sciences humaines en général ; nous entendons de moins en moins les réalités auxquelles nous renvoient fortuna et virtù. Tous les efforts de l'intelligibilité que nous appelons classique sont diamétralement opposés à l'affirmation machiavélienne d'un pouvoir comme phénomène premier. Pour nous, la politique n'est pas seulement une mainmise sur la socialité – même s'il est vrai que cela constitue l'un de ses inévacuables traits – ,elle est aussi une expression de la nature de cette société. Notre tentative de compréhension part désormais du principe épistémologiquement régulateur que Montesquieu a formulé, dès le début de L'Esprit des lois, sous une forme quasi canonique : Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Il existe même des espérances de type démocratique qui s'expriment sur un mode axiologique : comment une société peut-elle engendrer une politique qui lui ressemble sans qu'elle s'y trouve trompée, frustrée, et finalement rendue méconnaissable ? L'instrument en est le constitutionnalisme, et le mode intellectuel de structuration du réel politique est alors le contrat. L'espérance en est que l'État soit – idéalement, c'est-à-dire dans son devenir – pleinement pensable dans une transparence au social, semblable à lui au sens où l'on dit qu'un portrait ressemble à son modèle. La phénoménalité brute du pouvoir machiavélien, elle, ne permettait qu'une inutile dialectique du commandement et de l'obéissance, ce qui est peu prédictif et peu explicatif. Que pouvons-nous faire avec une définition aussi courte que celle qui ouvre le Rapport sur l'institution de la milice 1506 : ... chacun sait que dire Empire, Royaume, Principauté ou République, comme dire chef, en partant du rang le plus élevé pour descendre jusqu'au patron d'un brigantin, c'est dire justice et armes ?
Il a fallu moins de cinquante ans pour que Machiavel soit mis en perspective et jugé politiquement pauvre, bien que cette appréciation ait été présentée sous la forme d’une dénonciation morale. Inutile et platement cynique, tel apparaît Le Prince aux yeux de son premier censeur important : Jean Bodin. Bodin 1530-1596 appartient à la génération des politiques, comme le plus célèbre d’entre eux, Michel de l’Hospital, son aîné de vingt-cinq ans. Ces jurisconsultes ont entrepris de définir l’autonomie de l’État au sortir des luttes religieuses graves qui avaient opposé les catholiques de la Ligue aux calvinistes. Donner au roi de France Henri III, le dernier des Valois un rôle arbitral fut une novation intellectuelle qui a fondé ce que nous appelons depuis lors la laïcité de l’État. Cette novation du XVIe siècle fut possible parce que le pouvoir monarchique existait déjà comme un acquis réel du royaume de France : les Six Livres de la République 1576 se demandent par conséquent quelle est la fin principale de la république bien ordonnée, car il faut chercher en toutes choses la fin principale, et puis après les moyens d’y parvenir. L’interrogation machiavélienne avait été, évidemment, d’une nature plus technique, puisque Florence et à plus forte raison l’Italie était infirme d’un pouvoir réellement existant. Jugé par celui qui se pose la question française : que doit être le Roi que nous avons, le dernier chapitre du Prince, exhortation à délivrer l’Italie des barbares paraît englué dans la question des moyens à prendre.
Permanence
Permanence aussi, d'un certain mode. L'acuité phénoménologique des « récits explicatifs » machiavéliens assure à ces descriptions un à-propos qui n'est pas seulement superficiel, mais évidemment stratégique lorsqu'il est question d'organiser intelligemment les champs divers de l'exercice pragmatique, qu'ils soient politiques ou non. Dans cette optique, il est possible que les machiavéliens modernes les plus notoires ne soient plus intéressés directement par le seul univers politique, comme c'est le cas, par exemple, avec les écoles sociologiques qui analysent le fonctionnement des systèmes institutionnels en général Michel Crozier, par exemple : Le Phénomène bureaucratique, 1963 ; L'Acteur et le système, 1977. Les travaux de Claude Lefort, comme ceux de Marcel Gauchet, ont un objet machiavélien plus clairement centré sur la politique. Machiavel lui-même ne s'était réellement intéressé qu'à la pratique politique ; ce faisant, il en avait pointé des caractères manifestement constitutifs.
La première caractéristique de l'univers politique peut s'énoncer ainsi : produire du pouvoir, c'est produire de la différence et de l'hétérogénéité sociale. La concurrence est ici, au sens propre, essentielle, c'est-à-dire nécessaire, alors que dans d'autres domaines elle peut être tenue pour accidentelle : je peux vouloir que tout le monde soit en bonne santé, et pas seulement moi et que cela constitue une différence avec tous les autres. Si l'on pose, comme le fait Machiavel, que tous veulent le pouvoir ou du moins qu'il est prudent de partir de cette hypothèse, quitte à la rectifier au cas par cas, la victoire provisoire d'un des prétendants au pouvoir fait cesser pour un temps la guerre de tous contre tous. Cette guerre n'est pas close par cette victoire : la différence entre celui qui règne et ceux qui ne règnent pas réside seulement en ceci que, pour un temps, l'un a réussi alors que les autres ont échoué. Le prince, selon Machiavel, est plus proche de l'homme selon Clausewitz que de celui de Hobbes. Cent trente ans après la mort de Machiavel, l'auteur du Léviathan rechercha, lui, un principe de légitimité qui avait été étranger à l'horizon du Florentin.
La dialectique du pouvoir comme différence hante l'univers politique comme l'aporie congénitale qui le frappe d'une espèce de damnation. Le pouvoir politique, en effet, a ceci de très particulier qu'il ne peut ni complètement s'avouer ni complètement être tu. Il ne peut, en effet, ni dire ni laisser penser qu'il est le pouvoir par le jeu de la simple division des rôles sociaux : on n'est pas prince par une compétence locale, comme on est menuisier dans une société où les autres ne le sont pas parce qu'ils font autre chose. Dès lors, il est enfermé et condamné au mutisme, ou au bavardage, ce qui revient au même. D'un côté, il est le prince, nul autre ne l'étant dans le même temps que lui ; sous peine de se dissoudre, il lui faut la pompe et la majesté. Mais s'il insiste trop sur sa singularité et l'arbitraire de sa position, il met en danger son droit de légiférer au nom de tous. Trop transparent, il devient banal ; trop extérieur, il se découvre étranger, usurpateur ou occupant. L'enfer du politique est de ne pouvoir se donner dans une affirmation totalement révélatrice de soi : essence peu lisible donc, voilée et obscure, passage obligé des destins humains mais en même temps oblique, détourné, opaque et très imparfaitement conceptualisable.
L'autre caractéristique que le machiavélisme pointe avec une acuité qui lui est propre concerne le domaine de l'action en général l'action politique y étant concernée de façon exemplaire, mais non unique : il y a toujours de l'espace entre le calcul et la décision. La mise en paramètres ne débouche jamais sur une seule solution rationnellement assignable, ce qui renverrait toute autre solution du côté de l'irrationalité relative. Les solutions auxquelles arriverait le seul calcul comportent donc quelque élément qui les rend contingentes et frappées d'arbitraire, parce que d'autres raisons interviennent que celles que désigne la seule approche rationnelle. Les possibles, à un niveau déterminé de la décision, sont disposés sur un éventail dans lequel, d'un point de vue extérieur, plusieurs propositions sont concurrentes et le restent jusqu'à l'achèvement des processus de décision. Le rêve des pensées postérieures à celle de Machiavel, et que nous appelons classiques, s'il se réalisait, c'est-à-dire si, entre le calcul des faits sociaux et la désignation du personnel politique, il n'y avait aucun hiatus, ne laisserait nul espace pour l'habileté. Tout entière collective, la vie politique se réduirait ou à une science ou à une éthique. Mais la reconnaissance d'une nécessaire indétermination est dans le même temps la délimitation d'un lieu machiavélien incompressible, qui doit donc exister aussi théoriquement pour qui veut penser la politique en son avenir. Si, sur le fond d'un silence politique de la nature des choses, les hommes font du bruit et éprouvent de la fureur, c'est que leurs analyses ne peuvent épuiser le fait que, pour les hommes d'action, le désirable pouvoir demeure une récompense de l'audace. L'histoire est incertaine car elle est relativement autonome, au niveau de sa prédictibilité, et conserve donc en soi de l'aléatoire désirable. Le machiavélisme philosophique est ainsi traversé de part en part par l'exigence qu'on éprouve de l'énoncer pour exprimer qu'il dit une vérité, et dans le même temps de le dépasser pour exprimer qu'il est enfin devenu caduc, ce qui revient peut-être à vouloir l'exorciser sous la forme crue qu'il a prise chez le Florentin. Le dépasser en tout cas. Par la vertu du prince éclairé, comme l'écrivit Frédéric le Grand dans un Anti-Machiavel que Voltaire a préfacé en y croyant ou en faisant semblant d'y croire : nous sommes en 1740, avant la rupture entre les deux hommes. Par la vertu de l'Histoire : dans l'indétermination relative du devenir historique, il est possible de placer pratiquement la Révolution. L'Histoire n'est plus seulement un champ de forces, elle devient le lieu d'une praxis, d'une irruption de la conscience prolétarienne, etc. L’ironie de l’histoire des idées a fait preuve, en ce qui touche le machiavélisme, d’une belle impartialité : à l’amusement opposé à Frédéric II par celui qui affirma que le premier conseil que Machiavel adresse au prince est de jurer qu’il ne le reconnaît pas comme maître, répond comme par souci de symétrie l’ironie des évènements eux-mêmes, qui confia au procureur Vychinski le soin de prononcer la plus violente diatribe contre le machiavélisme politique des faibles à l’occasion d’un des procès de Moscou contre Kaménev.
Machiavel et la modernité
Le statut que notre modernité reconnaît désormais aux phénomènes de la culture limite sans doute le champ qu'il faut abandonner au machiavélisme. Ce faisant, il lui reconnaît une place : reconnaissance théorique que la pratique ne se laisse pas tout entière cerner. Les journaux politiques nous réservent des surprises, demain et les jours suivants ; et pourtant, dans les livres à venir, des politologues nous diront que tout fait partie du Tout. La puissance de l'esprit consiste en ceci qu'il peut subsumer après-coup la déroute elle-même. C'est cette image de Machiavel baroque, donc initiateur de notre modernité qui a intéressé, par exemple, Ezio Raimondi dans un maître livre, Politica e commedia. Dal Beroaldi al Machiavelli 1972 : À diriger le jeu de l'orchestre, il y a toujours les hommes légers, „charlatans et vains“, prêts à jouir de l'image d'une humanité de foire et prêts â faire l'expérience, dans le réseau des accidents et des intrigues, de la déroute de l'intelligence, de l'acuité de l'observation. Car l'une des toutes dernières démarches luxueuses de l'intelligence, c'est probablement de ne pas entretenir trop d'illusions sur elle-même.
Jean-François Lyotard l'exprime d'une façon équivalente, dans Au juste : « Si on me demande quels sont les critères de mon jugement, je n'aurai évidemment pas de réponse à donner. Car si j'avais des critères de jugement ... cela voudrait dire qu'il y a effectivement un consensus possible sur ces critères ... et qu'on ne serait donc pas dans la situation de modernité, mais qu'on serait dans le classicisme. Et justement ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que ces critères nous manquent, on est dans la modernité, où que ce soit.
Si l'on accepte de définir la modernité, par rapport au classicisme, comme une prise de conscience qui fait, comme toutes les prises de conscience, reculer des repères qu'on croyait acquis, Machiavel doit être admis parmi les premiers Modernes. Il a dit, en un langage emprunté à la tradition ce qui fait croire aussi bien qu'il est le dernier des Anciens, que le succès sans référence extrinsèque peut être, à un niveau qui existe aussi bien que celui de l'analyse explicative, une satisfaction et un objet digne du désir. Jean-François Duvernoy
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=8634#forumpost8634
Posté le : 01/05/2015 19:52
|
|
|
|
|
Machiavel 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Publications Œuvres de Machiavel en italien Principales œuvres
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, 3 vols., Discours sur la première décade de Tite-Live)1512-1517
Il Principe, 1513 Le Prince, publié en 1532
Autres ouvrages
Discorso sopra le cose di Pisa, 1499
Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, 1502
Del modo tenuto dal duca Valentino nell’ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, etc., 1502
Discorso sopra la provisione del danaro, 1502
Decennale primo poème en terza rima, Les décennales 1506
Ritratti delle cose dell’Alemagna, Rapports sur les choses de L'Allemagne 1508-1512
Decennale secondo Les décennales 1509
Ritratti delle cose di Francia, Rapports sur les choses de France 1510
Andria, comédie traduite de Térence, 1513
Mandragola,(La Mandragore, 1513
Della lingua, dialogue, 1514
Clizia, comédie en prose, 1515
Belfagor arcidiavolo, 1515
Asino d’oro, poème en terza rima, 1517
Dell’arte della guerra,
Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze, 1520
Sommario delle cose della città di Lucca, 1520
Vita di Castruccio Castracani da Lucca, 1520 La vie de Castruccio Castracani da Lucca
Istorie fiorentine, 8 livres, 1521-1525 Histoire de Florence
Frammenti storici, 1525.
Œuvres de Machiavel traduites en français
Œuvres complètes, éd. par Edmond Barincou, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1974.
Oeuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, introduction par Jean Giono, édition établie par Edmond Barincou, Paris, Gallimard, 1952.
Œuvres, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1999.
Discours sur la première décade de Tite-Live, coll. Champs, traduction de T.Guiraudet, notes d'A.pélissier, préface de Claude Lefort, Paris, Flammarion, 1985.
Le Prince, suivi de choix de Lettres, Paris, Le Livre de poche classique, 1972.
Le Prince, traduction de Christian Bec, commentaires de Marie-Madeleine Fragonard, Bordas, Pocket, Garnier, Paris, 1998.
Le Prince, traduction française de J. Gohory, 1571. Fac-similé de l'édition originale italienne, Blado, 1532. Traduction française de A.-N. Amelot de la Houssaye, 1683, éditions Ivrea, Paris, 2001.
Le Prince, col.Les Intégrales de Philo, notes et commentaires de Patrick Dupouey, Préface d’Étienne Balibar, Paris, Nathan, 1998.
De Principatibus. Le Prince, coll. de la politique traduction de Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, texte italien de G. Inglese,Paris, PUF, 2000.
Histoire du diable qui prit femme, trad. et postface par Joël Gayraud, Paris, Mille et une nuits, 1995.
Le Prince et autres textes, Gallimard, coll. Folio, 1986.
L'Art de la guerre, Paris, Flammarion, GF, 1991.
Le Prince, trad. par V. Périès, postface de Joël Gayraud, Paris, Mille et une nuits, 2003.
Il Principe / Le Prince, suivi de De Regnandi peritia / l'Art de régner d'Agostino Nifo. Nouvelle édition critique du texte par Mario Martelli, introduction et traduction de Paul Larivaille, notes et commentaires de Jean-Jacques Marchand. L'Art de régner : Texte latin établi par Simona Mercuri, introduction, traduction et notes de Paul Larivaille. Paris, Les Belles Lettres, 2008.
Mandragola / La Mandragore. Texte critique établi par Pasquale Stoppelli, introduction, traductions et notes de Paul Larivaille. Suivi d'un essai de Nuccio Ordine. Paris, Les Belles Lettres, 2008.
La Clizia, traduction et notes de Fanélie Viallon, Paris, éditions Chemins de tr@verse, 2013.
Lettres à Francesco Vettori, traduction de Jean-Vincent Périès, préface et notes de Joël Gayraud, Paris, Rivages, 2013.
Discographie livre audio
Lecture du Prince par Michel Galabru
Correspondance de Machiavel
Toutes les lettres de Machiavel. Présentation et notes par Edmond Barincou, Préface de Jean Giono. Deux tomes. Paris, Gallimard, coll. Mémoires du passé pour servir au temps présent, 1955.
Bibliographie
Études sur Machiavel
Maurice Bertrand, Machiavel ou l'illusion réaliste, coll. Questions Contemporaines L'Harmattan, 2014.
Edmond Barincou, Machiavel par lui même, coll. Ecrivains de toujours, Paris, Seuil, 1957.
Jean François Duvernoy, Machiavel, Paris, Bordas, 1986.
Claude Lefort, Le Travail de l'œuvre Machiavel, coll. Bibliothèque de Philosophie, Paris, Gallimard, 1972.
Georges Mounin, Machiavel, Club français du livre, 1958 ; Presses universitaires de France, 1964.
Charles Benoist, Le Machiavélisme de l’antimachiavel, Paris, Plon, 1915.
Augustin Renaudet, Machiavel, Paris, Gallimard, 1942.
F.Antal, The Florentine Painting and its Social Background, Kegan Paul, Londres, 1947.
Roberto Ridolfi, Vie de Nicolas Machiavel, Paris, Fayard, 1960.
Émile Namer, Machiavel, coll. Les grands penseurs, Paris, PUF, 1961.
Philippe Amiguet, L’Âge d’or de la diplomatie. Machiavel et les Vénitiens, Paris, Albin Michel, 1963.
Albert Chérel, La Pensée de Machiavel en France, Paris, L’Artisan du Livre, 1935.
Emmanuel Roux, Machiavel, la vie libre, Raisons d'Agir, coll. Cours et travaux, 2013.
Michel Bergès, Machiavel, un penseur masqué?, Éditions complexes, 2000.
Pierre Mesnard, L'Essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Vrin, Paris, 1969.
Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, Allia, 1998. 1re édition, A. Mertens et fils, Bruxelles, 1864
Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, édition numérique présenté par Sébastien Nadot, éd. An Zéro 2.0, 2013.
Louis Althusser, Solitude de Machiavel, PUF, coll. Actuel Marx Confrontations, 1998 aussi Toni Negri, Machiavel selon Althusser, in Futur Antérieur, avril 1997.
Louis Althusser, Écrits philosophiques et politiques II, Stock, Paris, 1995.
Louis Althusser, Machiavel et nous, Paris, Tallandier, 2009.
Denis Collin, Comprendre Machiavel, Armand Colin, 2008,
Marcel Brion, Machiavel, Albin Michel, coll. Génie et Destinée, 1948
Michel-Pierre Edmond, Machiavel ou l'usage intelligent du vice, Magazine littéraire, no 183, avril 1982.
Dirk Hoeges, Niccolò Machiavelli, Die Macht und der Schein, Munich, C.H. Beck, 2000.
Claude Lefort, Le travail de l'œuvre, Machiavel, Paris, Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1972 ; TEL, 1986.
Ugo Dotti, La Révolution Machiavel, Jérôme Millon, 2006,
Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli. Glencoe, The Free Press, 1958.Chicago University Press, 1995. Tr. fr. Pensées sur Machiavel. Paris, Payot, 1979.
Eugenio Garin, Machiavel entre politique et histoire, Giulio Einaudi 1993 trad. fr. Édition Allia 2006
Maurice Merleau-Ponty, Note sur Machiavel, dans Signes, Paris, Éditions Gallimard, NRF, 1960, pages 267 à 283, et dans Éloge de la philosophie. Leçon inaugurale faite au Collège de France le jeudi 15 janvier 1953, Paris, Éditions Gallimard, 1953, réédité en Folio/Essais. Texte d'une conférence présentée en septembre 1949, au Congrès Umanesimo e scienza politica, Rome-Florence.
Ezio Raimondi, Politica e commedia Dal Beroaldi al Machiavelli, Il Mulino, Bologne, 1972.
Friedrich Meinecke, L’Idée de Raison d’État dans l’histoire des temps modernes, Genève, Paris, Droz, 1973.
Donald Weinstein, Savonarole et Florence. Prophétie et patriotisme à la Renaissance, Paris, Calmann-Lévy, 1973.
F.T.Perrens, Jérôme Savonarole, Paris, Hachette, 1859.
Ralph Roeder, Savonarole, Paris, Armand Colin, 1933.
Verano Magni, Savonarole ou l’agonie de Florence, Paris, Denoël, 1941.
Alberto Tenenti, Florence à l'époque des Médicis, De la cité à l'État, coll. Questions d’histoire, Flammarion, Paris, 1968.
Hannah Arendt, Qu'est-ce que l'autorité, dans La Crise de la culture, traduction française P. Lévy, Gallimard, 1972, 1989 voir la fin de l'essai.
Hannah Arendt, Essai sur la révolution, traduction française M. Chrestien, Gallimard, 1967 – Tel, 1985.
Hannah Arendt, La Vie de l'esprit voir I. La pensée; Éd. PUF, Collection Quadrige.
Marina Marietti, Machiavelli l'eccezione fiorentina, Cadmo, 2005
Marina Marietti, Machiavel, Payot et Rivages, 2009
Thierry Ménissier, Machiavel ou la politique du Centaure, Éditions Hermann, 2010
Hubert Prolongeau, Machiavel, Folio Biographies, Éditions Gallimard, 234 p., 2010.
Étienne Thuau, Raison d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu, Paris, Armand Colin, 1966.
Jean Delumeau, La Civilisation de la Renaissance, Paris, Artaud, 1967.
Lucien Febvre, Le Problème de l’incroyance au XVIe siècle, Magazine L'Histoire Les classiques n°248, novembre 2000, page 98.
Ernest Weibel, Machiavel, Biographie Politique, Éditions Ellipses Marketing, 312 p., 2012
Michel Foucault, Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966.
Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, coll. Tel, Paris, Gallimard, 1978.
Alberto Tenenti, Florence à l’époque des Médicis. De la Cité à l’État, Pa-ris, Flammarion, coll. Questions d’histoire, 1968.
Robert Mandrou, Introduction à la France moderne 1500-1640. Essai de psychologie historique, coll. L’évolution de l’Humanité, Paris, Albin Michel, 1974.
Pierre Manent, Naissance de la politique moderne : Machiavel, Hobbes, Rousseau, Paris, Payot, 1977.
Bernard Guillemain, Machiavel. L’anthropologie politique, Paris, Genève, Droz, 1977.
Sébastien Brant, La Nef des fous, Strasbourg, éditions La Nuée bleue, 1977.
Paul Larivaille, La Vie quotidienne en Italie au temps de Machiavel, Paris, Hachette, 1979.
Piero Camporesi, Le Pain sauvage. L’imaginaire de la faim de la Renaissance au XVIIIe siècle, Paris, Le Chemin vert, 1981.
Mikhaïl Bakhtine, L’Oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, coll. « Tel », Paris, Gallimard, 1982.
Lucien Febvre, Au Coeur religieux du XVIe siècle, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essais », École des Hautes Études en Sciences sociales, 1983.
Lucien Febvre, Martin Luther, un destin, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1988.
Christian Bec, Machiavel, Paris, Balland, 1985.
Jacques Heers, Machiavel, Paris, Fayard, 1985.
Giuseppe Prezzolini, Vie de Nicolas Machiavel, Paris, Payot, 1985.
Roger H.Marijnissen, Jérôme Bosch. Tout l’oeuvre peint et dessiné, Paris, Fonds Mercator, Albin Michel, 1987.
Simone Goyard-Fabre, Philosophie politique XVIe-XXe siècles Modernité et humanisme, Paris, PUF, 1987.
A. Ehnmark, Les Secrets du pouvoir, essai sur Machiavel, Le Paradou, Actes Sud, 1988.
Quentin Skinner, Machiavel, Paris, Le Seuil, 1989.
Fernand Braudel, Le Modèle italien, Paris, Artaud, 1989.
Michel Senellart, Machiavélisme et Raison d’État, coll. Philosophies, Paris, PUF, 1989.
Machiavel dans les arts et la culture populaires
Machiavel apparaît dans les jeux Assassin's Creed II et Assassin's Creed: Brotherhood dans lesquels il figure parmi les chefs de la confrérie des Assassins. On peut également lire certaines de ses citations dans Medieval Total War 2.
Son personnage est également présent dans la série de livres de Michael Scott, Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel.
Machiavel, interprété par l'acteur, dramaturge et metteur en scène Jean-Pierre Ronfard, apparaît aussi dans Le confort et l'indifférence, documentaire du cinéaste québécois Denys Arcand. Le personnage y est utilisé à maintes reprises pour livrer des extraits du Prince dont le cinéaste se sert de manière analogique afin d'interpréter les circonstances de la première défaite référendaire sur l'indépendance du Québec en 1980.
Machiavel apparaît aussi, bien que nommé ainsi très tardivement, dans la série Da Vinci's Demon. Il est représenté comme le jeune apprenti timide de Léonard de Vinci. Il y est connu comme étant "Nico" et fait office d'aide pour Léonard de Vinci. Il faut attendre que le personnage évolue et s'impose pour qu'il se présente complètement comme Machiavel. Il y est incarné par Eros Vlahos.
Tupac Amaru Shakur se fit également connaître sous le nom de Makaveli à la fin de sa carrière, en l'honneur de Machiavel d'après ses fans.
Posté le : 01/05/2015 19:49
|
|
|
|
|
L'abbée Emmanuel Sieyes |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 mai 1748 naît Emmanuel-Joseph Sieyès ou l'abbé Sieyès
à Fréjus, mort à Paris, à 88 ans le 20 juin 1836 à Paris, homme d'Église, prêtre, homme politique et essayiste français, surtout connu pour ses écrits et son action pendant la Révolution française.
Issu d'un milieu de bonne bourgeoisie provençale son père est directeur des Postes, ce cadet de famille est destiné à la prêtrise, sans vocation aucune, peut-être en raison d'une santé délicate…, qui ne l'empêchera pas de vivre jusqu'à quatre-vingt-huit ans. Après des études à Fréjus, puis à Draguignan, il est admis successivement aux séminaires de Saint-Sulpice et de Saint-Firmin, d'où il sortira en 1772, une fois ordonné prêtre. Après quelques années passées à l'évêché de Tréguier, il suit à Chartres son évêque, M. de Lubersac, et reçoit les fonctions de vicaire général. On le voit cependant souvent à Paris, où il fréquente les clubs, les loges maçonniques, les salons philosophiques de Mmes de Condorcet, Helvétius, Necker. Pendant toute cette période, il réfléchit sur les institutions politiques et sociales, et surtout prend conscience de sa propre valeur.
Qu'est-ce que le tiers état ?
En bref
Né à Fréjus, fils d'un directeur de la poste aux lettres, Emmanuel Sieyès se voit refuser l'ordination au séminaire de Saint-Sulpice pour manque, au moins apparent, de vocation ; il réussit à se faire ordonner prêtre ailleurs et se retrouve grand vicaire de l'évêque de Chartres en 1787. En janvier 1789, il lance la brochure qui le rend aussitôt célèbre : Qu'est-ce que le tiers état ? — ce tiers état qui, de fait, est tout et qui, tenu pour rien, demande à devenir quelque chose. Rejeté par les électeurs de l'ordre du clergé, il se fait élire député de Paris par les électeurs du tiers. Durant tout le mois de juin 1789, lors du serment du Jeu de paume et de la constitution de l'Assemblée nationale comme telle, il joue le rôle le plus actif au premier rang. Et puis, très vite, il cesse de faire figure d'entraîneur et de leader : l'abbé Sieyès semble s'escamoter lui-même.
En surface, il ne se manifeste que par des intrigues assez souvent réactionnaires ; c'est qu'il met tous ses soins à proposer et à laisser se répandre son propre mythe : celui d'un très profond penseur qui élabore en grand secret et en parfaite sagesse la meilleure constitution imaginable. Le comique, c'est que, chaque fois qu'il proposera ouvertement un projet constitutionnel quelconque en 1791 à la Constituante, en 1793 et derechef en 1795 à la Convention, en 1799 à Bonaparte, ses idées seront jugées atrocement compliquées, péniblement imprécises, passablement ridicules, quelque chose comme Le Chef-d'œuvre inconnu du Frenhoeffer de Balzac, et chaque fois il réussira à conserver toujours intacte, dans le naufrage de son projet, son auréole d'oracle suprême en matière de droit constitutionnel.
Député de la Sarthe à la Convention, il siège au Marais, mais vote la mort de Louis XVI et se « déprêtrise » avec toute la solennité requise ; il réussit de la sorte — Robespierre l'appelait la taupe de la Révolution — à ne pas attirer l'attention sur lui pendant la Terreur. Il se retrouve, bien sûr, au premier rang des thermidoriens, par deux fois membre du Comité de salut public en 1795. Élu membre du Directoire exécutif dès la création du régime directorial, il refuse cette charge par dépit de n'avoir pu faire adopter ses vues constitutionnelles et poursuit ses intrigues aux Cinq-Cents ; le Directoire cherche à s'en débarrasser en l'envoyant comme ambassadeur à Berlin ; mais Sieyès est de nouveau élu membre du Directoire en mai 1799 ; cette fois, son heure semble venue.
Bien décidé à fomenter un coup d'État militaire qui lui assurerait le monopole du pouvoir civil, Sieyès jette d'abord ses vues sur Joubert le naïf, qui se fait tuer à Novi ; puis sur Moreau le circonspect, qui se dérobe ; puis, presque en désespoir de cause, sur Bonaparte : la taupe n'était pas de taille à régenter l'aigle. Consul provisoire au soir du 19 brumaire, Sieyès apporte à son collègue Bonaparte l'échafaudage mirobolant d'une constitution inapplicable ; au sommet de la pyramide préconisée devrait trôner un proclamateur-électeursans nul pouvoir réel ; Bonaparte s'esclaffe devant le rôle de cochon à l'engrais qu'entend lui réserver celui qu'il appelle par dérision le grand-prêtre. Un mois plus tard, Sieyès est écarté du Consulat au profit de Cambacérès.
Pourvu en dédommagement d'un fort beau domaine et bientôt président du Sénat, Sieyès passera le reste de sa vie à bouder. Proscrit par la seconde Restauration, il va vivre quinze ans à Bruxelles ; c'est alors que David fait de lui un portrait magnifique où l'âge donne une dignité inattendue à cet être retors. Rentré en France après juillet 1830, il tombe bientôt en enfance ; l'un de ses derniers mots, étonnamment suggestif, sera pour dire à son valet de chambre : Si M. de Robespierre vient, dites que je n'y suis pas. Jean Massin
Sa vie
Fils d'un employé des impôts et maître de poste, il fait ses études à Draguignan puis au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Il entre dans les ordres comme prêtre en 1774 mais sans vocation. Par la suite, il devient en 1775 chanoine de Tréguier, attaché comme secrétaire de l'évêque de Lubersac, l'aumônier de Madame Sophie, la tante de Louis XVI, puis vicaire général de Chartres en 1787 et conseiller commissaire à la chambre supérieure du clergé.
Sieyès devient célèbre dès 1788 par son Essai sur les privilèges. Mais c'est plus encore sa brochure de 1789 Qu'est-ce que le tiers état ?, texte fondateur de la Révolution française, qui obtint un grand retentissement et assure sa popularité. Il prend ainsi une part active à la Révolution française jusqu'à sa fin, par sa participation au coup d'État du 18 brumaire.
En 1789, élu député du tiers état aux États généraux, il joue un rôle de premier plan dans les rangs du parti patriote du printemps à l'automne 1789 et propose, le 17 juin 1789, la transformation de la Chambre du Tiers état en assemblée nationale. Il rédigea le serment du Jeu de paume et travailla à la rédaction de la Constitution.
Élu dans trois départements à la Convention, il siégea à la Plaine mais dans le procès du roi vota avec la Montagne contre l'appel au peuple pour la mort et contre le sursis. Il abandonna sa charge de prêtre selon les modalités en vigueur de la Constitution civile du clergé.
Pendant la préparation de la constitution de l'an III, le 20 juillet 1795 thermidor, il prononça un discours resté célèbre au cours duquel il proposa la mise en place d'un jury constitutionnaire, premier projet d'un contrôle étendu de la constitutionnalité des actes des organes de l'État.
Sous le régime politique du Directoire, il fut président, en 1797, du conseil des Cinq-Cents. En 1798, il fut envoyé comme ambassadeur à Berlin. En 1799, il se résolut à entrer au Directoire en tant que directeur. Il prépara le coup d'État du 18 brumaire selon lequel il démissionna de son poste de directeur, puis il fut nommé consul provisoire par Bonaparte. Il devint président du Sénat conservateur sous le Consulat. Il est nommé comte d'Empire en mai 1808. Pendant la seconde Restauration, c'est-à-dire après les Cent-Jours de la fin de 1815 à 1830, il s'exila durant quinze ans pour régicide à Bruxelles. Il ne rentra en France qu'en 1830.
Il a déjà publié deux brochures politiques lorsque, en janvier 1789, il lance son libelle au titre incendiaire : Qu'est-ce que le tiers état ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent ? Rien. Que veut-il devenir ? Quelque chose. Le succès de ce brûlot est immense : 30 000 exemplaires sont vendus en deux mois. Élu député du tiers et non du clergé à Paris, Sieyès arrive aux États généraux la tête pleine d'idées neuves. Cet homme au long nez, au teint pâle, aux épaules étroites ne possède certes pas la flamme oratoire d'un Mirabeau, mais il sait se faire écouter. Il réclame la réunion des trois ordres, rédige le texte du serment du Jeu de Paume, refuse, le 23 juin, d'obtempérer aux ordres du roi. Élu au comité de constitution, il présente un projet de Déclaration des droits de l'homme qui ne sera qu'en partie accepté. Sans se lasser, il propose de multiples réformes : mode de répartition des impôts, création des gardes nationales, division du pays en départements, réorganisation judiciaire, etc. Il s'oppose nettement au veto absolu, comme d'ailleurs à l'abolition de la dîme c'est à ce propos qu'il lance le mot fameux : Ils veulent être libres mais ne savent pas être justes et vote sans conviction la constitution civile du clergé. Son vœu serait de maintenir la révolution dans de sages limites. Il s'est éloigné du « Club breton, devenu club des Jacobins, et fréquente la Société de 89, plus modérée, mais refuse de se laisser entraîner par Mirabeau dans sa collusion avec la Cour. Lors de la fuite à Varennes, il demeure sur la réserve. S'il blâme le roi, il n'approuve pas la pétition républicaine du Champ-de-Mars. Il est encore partisan d'une monarchie constitutionnelle, mais devine que la Constitution de 1791 ne fera pas long feu.
Lorsque la Constituante se sépare, Sieyès se retire à Auteuil. Malgré bien des déceptions, il reste en contact avec ses anciens amis et s'en fait de nouveaux parmi la Gironde. Après la chute des Tuileries, il est élu à la Convention par trois départements et opte pour la Sarthe. Il siège au centre, mais vote la mort du roi, sans sursis. Ce geste ne lui vaut pas la reconnaissance de la Montagne. Il n'est pas non plus trop bien vu des Girondins, avec lesquels il commence à élaborer un projet de constitution. Son amitié pour Condorcet fléchit quand il voit celui-ci devenir le grand homme du Comité. Pourtant, la Constitution girondine sera balayée lors de l'élimination des Brissotins. Sieyès n'intervient pas dans la lutte entre les deux grands partis. Il ne travaille pas non plus à la Constitution de l'an I. La révolution qu'il a contribué à déchaîner lui fait peur. Il sait que Robespierre le déteste et l'appelle la taupe de la révolution. Pendant la Terreur, la taupe se terre en effet dans son trou. Lorsqu'on lui demandera ce qu'il a fait pendant cette période, il répondra : J'ai vécu.
Le Directeur
Après Thermidor, il reparaît. Inquiet des émeutes populaires, il préconise des mesures sévères contre les fauteurs de troubles. Mais le problème qui intéresse le plus ce doctrinaire est celui de la constitution future. Une commission se forme, où l'on appelle l'ancien constituant. L'oracle va-t-il remonter sur son trépied ? Il s'en garde bien, jugeant qu'on ne suivrait pas ses idées. Prié de donner son avis sur le projet adopté, il refusera avec un sourire dédaigneux : On ne m'entendrait pas. Il a cependant accepté de faire partie du nouveau Comité de salut public, où il s'occupe des relations extérieures. Il prône le principe des frontières naturelles, songe à remanier la carte de l'Allemagne et s'en va à La Haye imposer la paix à la Hollande.
Lorsqu'il revient, la Convention s'apprête à céder la place au Directoire. Élu député aux Cinq-Cents, son nom paraît dans dix-neuf départements !, il est également nommé au collège directorial, mais il repousse cet honneur. Sans doute ne croit-il pas à la solidité du régime. À ceux qui l'interrogent, il répond : Il m'est impossible de penser qu'un homme qui, depuis la Révolution, a été en butte à tous les partis puisse rallier toutes les confiances. Malgré cette apparente modestie, Sieyès reste amer, hautain, méprisant. Que désire-t-il ? On ne sait. Il ne favorise en tout cas pas la droite, puisqu'il approuve le coup d'État de Fructidor. Il devient président des Cinq-Cents, est appelé à l'Institut, mais souffre malgré tout de sentir son influence en baisse. Son nom a été pourtant remis en vedette lorsqu'il a été victime d'un attentat. L'agresseur, un ecclésiastique névropathe nommé Poulle, déclare avoir voulu venger la religion de ses pères. Légèrement blessé, Sieyès voit remonter sa popularité. En fait, le gouvernement le considère comme un gêneur et l'envoie en mission à Berlin mai 1798. Il en revient un an plus tard, car l'anarchie règne à Paris, où l'ancienne Montagne tente de resurgir de ses cendres et où les modérés cherchent un philosophe capable de remettre de l'ordre. Le grand homme accepte d'entrer dans le Directoire, préalablement épuré.
Rival de Barras, Sieyès sent que l'heure est venue de changer de régime, mais il lui faut l'appui d'un sabre. Le général Joubert, auquel il songe en premier lieu, est tué à Novi. Son choix se porte alors sur Bonaparte, qui vient de rentrer d'Égypte. Le jeune vainqueur des Mamelouks connaît l'art de la flatterie : Nous n'avons pas de gouvernement parce que nous n'avons pas de constitution, dit-il à Sieyès : c'est à votre génie qu'il appartient de nous en donner une. L'ex-abbé, satisfait, entre dans le complot de Brumaire et reçoit, après la victoire, le titre de deuxième consul provisoire. Il rédige alors, avec Antoine Boulay de La Meurthe, un projet de constitution… que le nouveau César s'empresse de remanier, transformant à son profit les dispositions prévues pour limiter les pouvoirs de l'exécutif.
Les dernières années
La Constitution autoritaire de l'an VIII, telle qu'elle est présentée aux Français, ne peut évidemment plaire à Sieyès. Aigri, mécontent, le dogmatique personnage refuse pourtant d'avouer qu'il a été dupé. À titre de consolation, il se voit nommé président du Sénat il démissionnera vite et accepte même le magnifique domaine de Crosne. Il a maintenant les mains liées, dit-on autour de lui. Pendant un temps, le nouveau maître de la France le fait surveiller, mais cette précaution est inutile. Sieyès n'ose même pas lancer un non lorsqu'on vote sur l'établissement de l'empire. Son existence se fait de plus en plus discrète. En 1809, cependant, il est nommé comte d'Empire par lettres patentes. Le comte Sieyès n'oserait sans doute plus affirmer que le tiers état, qui n'est toujours rien, devrait être tout…
En tout cas, son rôle politique est bien terminé. S'il est inscrit pendant les Cent-Jours sur la liste des pairs, il se voit exilé après Waterloo comme régicide. Il se retire alors à Bruxelles. La révolution de Juillet lui permettra de regagner Paris, où il mourra six ans plus tard, dans l'indifférence générale. Académie française, 1803.
Il est inhumé le 25 juin 1836 dans la division 30 du cimetière du Père-Lachaise.
Théories politiques et philosophiques
Benjamin Constant dit de lui : Personne jamais n'a plus profondément détesté la noblesse.
Ernest Seillière relève chez Sieyès une exhortation à l'opposition entre le tiers état, vu comme d'origine gallo-romaine, contre l'aristocratie, décrite comme étant d'ascendance germanique franque; Sieyès proposait de "renvoyer dans les forêts de la Franconie toutes ces familles nobles qui conservaient la folle prétention d'être issues de la race des conquérants et de succéder à leurs droits". Il faut cependant voir qu'il prenait en cela au mot les prétentions de théoriciens des droits de la noblesse comme Sainte-Pallaye, qui ont promu à la fin de l'ancien régime une vision de plus en plus essentialiste de l'origine du second ordre.
Il oppose le gouvernement représentatif qu'il promeut et le gouvernement démocratique qu'il rejette : Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie et la France ne saurait l’être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Discours du 7 septembre 1789. Sieyès est alors vu en science politique comme un contradicteur des théories de Jean-Jacques Rousseau : alors que Rousseau se prononçait pour la démocratie directe et fustigeait le modèle représentatif britannique, Sieyès, moins confiant dans le peuple que Rousseau, choisit de défendre le système représentatif. Dans le système représentatif, le peuple élit des représentants munis d'un mandat représentatif qui, eux, décident des lois qui s'appliquent, alors que la démocratie directe suppose que le peuple décide des lois qui lui sont appliquées et que les délégués qu'il élit lui sont soumis par des mandats impératifs. La doctrine juridique parle souvent de "souveraineté nationale" pour qualifier l'idée de Sieyès de gouvernement représentatif en l'opposant à celle de "souveraineté populaire", celle de démocratie directe, soutenue par Rousseau puis revendiquée par l'aile gauche du parti des Jacobins, celle dite des Montagnards dirigée par Robespierre.
Sieyès, de plus, s'est montré favorable au bicamérisme, mais il soutenait un bicamérisme différent de ceux britannique et américain ; il réclamait un bicamérisme pour éviter une dictature d'assemblée, sans chambre haute donc. Il a soutenu cette idée déjà dans des propositions pour la Constitution du 3 septembre 1791. Ce sont ses idées en plus de celles de Bonaparte qui servent à concevoir la Constitution de 1799 instituant le Consulat. Ainsi, Sieyès est souvent considéré comme un précurseur de la Révolution du fait de son ouvrage Qu'est-ce que le Tiers-état ?, mais aussi comme celui qui a déclenché le coup d’État mettant fin à la période révolutionnaire.
Sieyès était partisan du suffrage censitaire. Il considérait que le vote est une fonction et que par conséquent seuls les individus ayant les capacités, intelligence, niveau économique d'exercer cette fonction doivent y participer.
Académie française
En 1795, Sieyès fut en premier lieu membre de la classe des sciences morales et politiques, future Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France.
Lors de la réorganisation de 1803, il fut en outre élu dans la deuxième classe, qui succédait à l'Académie française après plusieurs années de disparition, et où il remplaça, au fauteuil 31, Jean-Sylvain Bailly, guillotiné le 12 novembre 1793.
Après la Seconde Restauration de 1815, Sieyès fut exclu de l'Académie, en 1816, en tant que régicide, et remplacé aussitôt par le marquis de Lally-Tollendal, nommé par ordonnance royale.
Sieyès et la sociologie
Dans un manuscrit, Sieyès forge le néologisme sociologie une cinquantaine d'années avant Auguste Comte. Sous sa plume, le terme reste peu conceptualisé, et pris dans le souci de développer un art social : la connaissance positive de la société doit servir à la gouverner.
Sieyès et l'art social
L’objet du physicien, déclarait Sieyès, c’est d’expliquer les phénomènes de l’univers physique. Puisque cet univers existe indépendamment de lui, le physicien doit se contenter d’observer les faits et d’en démontrer les rapports nécessaires. Mais la politique n’est pas la physique, et le modèle de la nature ne s’applique pas aux affaires humaines." Pour Sieyès, la société est une construction artificielle, un édifice ; la science de la société devrait donc être, à proprement parler, une architecture sociale.
De même que le jeune Marx devait reprocher à la philosophie hégélienne d’interpréter le monde, sans montrer comment le changer, de même le jeune Sieyès rejeta très tôt l’idée selon laquelle la seule tâche du philosophe serait d’énoncer les faits sociaux.
Sa critique avait d’abord pris pour cible le despotisme des faits sur les principes, qu’il décelait dans la physiocratie. À la veille des États Généraux, il trouva une nouvelle cible dans l’approche historique adoptée par les disciples de Montesquieu et dans leur vénération, leur extase gothique pour le modèle de la constitution anglaise.
— Keith Michael Baker, Condorcet. Raison et politique.
Sieyès participe activement aux travaux de la Convention sur la réforme de la carte administrative, et il propose d'adopter un découpage de la France en carrés de 5 km de côté pour les communes, et de 50 km de côté pour les départements.
Sieyès dans la littérature
Son nom est toujours associé à ceux de Fouché et de Talleyrand dans le brelan de prêtres selon l'expression ironique de Carnot. Il est mis en scène par Honoré de Balzac dans Une ténébreuse affaire où Henri de Marsay fait le récit du complot contre Napoléon auquel Sieyès participe : Fouché connaissait admirablement les hommes; il compta sur Sieyès à cause de son ambition trompée, sur monsieur de Talleyrand parce qu'il était un grand seigneur, sur Carnot à cause de sa profonde honnêteté. Un personnage portant ce nom est également présent dans l’œuvre La dernière campagne du Grand Père Jacques, d'Émile Erckmann, où il est cité comme créateur d'une constitution.
Stendhal cite Sieyès dans son roman Le Rouge et le Noir au début du chapitre XII : On trouve à Paris des gens élégants, il peut y avoir en province des gens à caractère .
Posté le : 01/05/2015 19:06
|
|
|
|
|
Pierre Emmanuel |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 mai 1916 naît Pierre Emmanuel
à Gan dans les Pyrénées-Atlantiques. Noël Mathieu plus connu sous le pseudonyme Pierre Emmanuel, mort le 24 septembre 1984 à Paris, poète français. Souvent perçu, par extrapolation, comme un poète d'inspiration chrétienne.
Il donne les plus hautes exigences spirituelles et le sens même de l'être pour horizons à sa méditation, à sa poésie, à ses essais. De formation scientifique, il enseigne, J.-C. Renard sera son élève, lit les mystiques, la Bible, les grands poètes dont Hölderlin, et sonde l'unité du monde le Goût de l'Un, 1963, qui a pour lui partie liée à l'incarnation du Christ. Dehors du monde et intériorité ne se séparent pas. Deux titres se répondent : Le monde est intérieur 1967 et la Vie terrestre 1976. La lecture de Jouve l'ouvre à l'érotisme et à un questionnement encore plus aigu. Tombeau d'Orphée 1942 est la liturgie d'un irréalisable amour. Dans le Poète et son christ 1942, il s'explique sur le tourment de Dieu, et dans Sodome 1944, sur le pêché de nostalgie. Chansons du dé à coudre 1947 donnent des vers plus brefs mais traversés des mêmes accents inquiets. Tu 1978 dit la seconde personne, et l'Autre 1980, cette présence de Dieu. Qui est cet homme ? 1947, 1970 retrace le parcours d'un poète pour qui la différence des sexes, les conflits entre désir et réalité sont des voies d'approche fécondes.
En Bref
Aucun poète français, depuis les grands romantiques, n'aura été aussi « engagé » dans son époque. « Écho sonore » de tous les conflits dont elle retentit et qui ont culminé en l'an 40. L'acte de naissance poétique de Pierre Emmanuel est à ce millésime.
Mais, à la différence de ses illustres devanciers, Pierre Emmanuel, si véhémentement qu'il le dénonce, ne s'en tient pas à l’évènement pour lui-même. Son lyrisme le prend au tragique – aussi bien a-t-on pu évoquer Agrippa d'Aubigné plus que Les Châtiments – comme signe accidentel d'une tragédie éternelle qui le dépasse. Il s'y appuie pour le pousser à la hauteur d'un symbole. Il l'insère – et pas seulement la guerre – dans une vision à la fois personnelle et universelle de l'histoire, de l'aventure humaine, dont le sens est chrétien.
Au commencement était le verbe. Il faut l'entendre d'abord de l'opération poétique, avant que l'identification mystique – le Verbe divin – fournisse à celle-ci un répondant et en fasse une épiphanie.
Ainsi résumerait-on un itinéraire de quarante années, jalonné par une trentaine d'ouvrages. Itinéraire spirituel et poétique, c'est tout un, gouverné par Le Goût de l'Un comme s'intitule l'essai 1963 qui le récapitule et en annonce les plus récents prolongement
Né à Gan, près de Pau, le 3 mai 1916, de mère béarnaise, fille d'un maître-maçon, et de père dauphinois, tôt émigrés aux États-Unis, Pierre Emmanuel a eu une enfance pratiquement orpheline chez les frères à Lyon. Voué au métier d'ingénieur, il songea cependant à devenir philosophe. Il eut révélation de la poésie par La Jeune Parque, grâce à son professeur de mathématiques en hypotaupe. Alors qu'il enseignait dans une institution libre de Pontoise et s'essayait à des poèmes imités de Paul Eluard, la rencontre et l'influence de Pierre-Jean Jouve furent décisives.
Son premier recueil, Élégies, édité par Les Cahiers des poètes, à Bruxelles, parut, si l'on peut dire, le 9 mai 1940.
Hormis les initiés des revues, on découvrit Pierre Emmanuel avec un volume à l'enseigne de Poésie 41, intitulé Tombeau d'Orphée, qui fit sensation. Quand même on pouvait être déconcerté par la forme abrupte, par le lyrisme torrentiel, les images violentes avec érection de majuscules – Sang, Sexe, Mort – et par ce que le thème recelait d'ésotérisme sous le tumulte éloquent, on ne doutait pas qu'un poète avait surgi, promis à la grandeur.
Sa vie
Noël Mathieu est le fils d'Emile Mathieu, originaire de la région de Corps en Isère et de Maria Juge Boulogne, originaire de Gan dans les Pyrénées-Atlantiques.
Tandis que ses parents émigraient aux États-Unis, il fut élevé par un oncle paternel. Après des études de lettres à l'université de Lyon, il entama une carrière d'enseignant. Venu à la poésie par la lecture de La Jeune Parque de Valéry, il se familiarisa avec les romantiques allemands Hölderlin et les auteurs anglais Hopkins, Hardy. C'est Pierre Jean Jouve, qu'il rencontra en 1937, qui devait le guider dans ses débuts poétiques : Élégies 1940, Le Tombeau d'Orphée 1941.
Réfugié dans la Drôme pendant l'Occupation, il poursuivit ses activités d'enseignant et participa à la Résistance, et écrivit : Jour de Colère, Combats avec tes Défenseurs, La Liberté guide nos pas.
En marge de ses activités de poète, Pierre Emmanuel exerça également le métier de journaliste en collaborant, comme chrétien de gauche, à Témoignage Chrétien, Réforme, Esprit. Divers textes et préfaces témoigneront aussi de ses sentiments gaulliens.
Chef des services anglais puis américains de Radiodiffusion-télévision française de 1945 à 1959, il donna plusieurs conférences aux États-Unis et au Canada, et fut visiting professor de différentes universités américaines. Engagé à plus d'un titre dans la vie culturelle de son temps, il fut encore président de l'Association internationale pour la liberté de la culture, président du PEN club français de 1973 à 1976, président de la commission des affaires culturelles pour le VIe Plan, président de l'Institut national de l'audiovisuel de 1975 à 1979 et administrateur du Festival d'automne.
Il proposa notamment la création d'un Conseil de développement culturel auquel participeront François-Régis Bastide, Jack Lang, François Billetdoux, Claude Santelli, Alfred Grosser ou encore Iannis Xenakis. Bien que peu actif ce conseil a probablement inspiré la politique d'intervention culturelle que pratiquera le futur ministre Jack Lang.
L'œuvre : deux images matricielles
Dans Notes sur la création poétique, Pierre Emmanuel appelle matricielles les images d'où procèdent toutes les autres. Dans sa poésie, il y en a deux qui se sont imposées à lui simultanément, à sa vingt-deuxième année. Il s'agit et d'une image du Christ, et d'une image d'Orphée. On parlerait aussi bien de mythologie personnelle, sous réserve de l'évolution religieuse du poète en ce qui concerne le Christ.
Christ au tombeau : l'image est fixée dès le « premier poème réel. Ce Christ d'entre le vendredi saint et Pâques est, mythiquement, entre la mort et la vie. C'est le Verbe qui le ressuscite, mais non pas en gloire : en douleur. Il reste « l'homme de douleur », symbole de l'angoisse humaine. L'image ne devait coïncider que trop bien avec l'événement, l'atrocité nazie, qu'elle semblait avoir pressentie. Aussi dominera-t-elle tous les poèmes de résistance écrits à Dieulefit Drôme. Jour de colère, Combats avec tes défenseurs, La liberté guide nos pas : c'est toujours la clameur horrifiée, indignée devant la Face humaine – en surimpression la Face de Dieu – qu'abîment les crimes, les dénis de justice, les tyrannies ; le Christ est omniprésent, exemplairement victime innocente et témoin implacable.
Orphée aux enfers : seconde image, elle aussi fixée tout de suite. Ici l'appropriation est plus intime : Orphée est le double du poète Pierre Emmanuel descendu aux enfers d'une passion malheureuse – et d'une connaissance ténébreuse –, pour y retrouver, grâce au verbe, son Eurydice. Il l'étreint ou croit l'étreindre ; mais il l'abandonne aux bras du Christ... qu'il n'aurait pas rencontré s'il n'avait eu la nostalgie de son absence.
Sans égard pour la chronologie, entre tous les gages de merveilleuse fécondité qu'aura donnés le poète, il convient de rattacher au mythe féminin, qu'impliquait déjà le thème d'Orphée, la superbe trilogie : Una ou la mort la vie 1978, Duel 1979, L'Autre 1980, composant Le Livre de l'homme et de la femme, histoire d'amour dans laquelle l'auteur reconstitue en soi-même le couple originel, d'avant le Paradis perdu.
Une synthèse, l'épopée de Babel : articulée sur les deux « images matricielles, Sodome 1944 remonte à l'Ancien Testament pour expliciter, dans un symbole collectif, le tourment personnel du poète, son sentiment de culpabilité et son aspiration à l'unité. Cette fois, c'est Abraham qui lui sert de truchement en prenant à son compte le mythe d'Adam, dédoublé en Ève par le Créateur et consommant sa dualité par la faute originelle. Mais Ève suscite le Verbe, donc la résurrection.
Plus ambitieux encore est le vaste, surabondant poème de Babel 1951 que le poète considère comme son livre : Je me crus de taille à bâtir une épopée spirituelle de l'histoire humaine, non point dans sa nouveauté, mais dans sa sempiternelle répétition. Non pas paraphrase, mais transposition mythique, Babel résume toutes les civilisations tôt ou tard insurgées contre leur principe et leur fin. C'est un étagement métaphysique et religieux des thèmes les plus actuels, de la mort de Dieu à l'avènement du surhumain inhumain.
L'officiant du Verbe
Le poème liminaire du premier recueil de Pierre Emmanuel, Élégies, s'intitule Naissance du verbe. Le passage de la minuscule parole humaine à la majuscule (référence divine) trace la Ligne de faîte, Choix de textes par lui-même, 1966 de l'auteur. Il a fait plusieurs fois le point de sa démarche dans des autobiographies spirituelles : à la trentaine, Qui est cet homme ? ou le Singulier universel 1948 ; vers la quarantaine, L'Ouvrier de la onzième heure 1954 ; à la cinquantaine, Le Goût de l'Un 1963 et La Face humaine 1965 qui exprime, en somme, un point d'arrivée : acte de foi positivement chrétienne.
Cette prose est à la même hauteur de langage que la poésie dont elle élucide les thèmes et les modes d'investigation. Le moins élégiaque des poètes se veut un officiant du Verbe : « Le langage n'est pas un instrument, c'est l'être même de l'homme... » Ce faisant, sa poésie est à la fois révolutionnaire et réactionnaire sur le plan de l'art. Révolutionnaire par le crédit créateur accordé aux mots, au pouvoir des métaphores inédites qui changent les apparences, renouvellent les rapports de l'homme avec les choses. Réactionnaire, par le refus du jeu, de la gratuité, par le besoin de signification intelligible, par l'opposition au détournement, à l'appauvrissement ou à l'avilissement du sens des mots.
Poésie oratoire, qui sait néanmoins se contenir dans les « cantos » de Chansons du dé à coudre, dans Visage nuage 1955, Versant de l'âge 1958 et, à l'extrême du dépouillement, dans Évangéliaire 1961. Poésie dont les défauts n'ont jamais été que des excès. Poésie qui préfère le rythme à l'incantation, la force au charme, qui en appelle plus à l'émotion intellectuelle qu'à la jouissance sensible et impose sa propre exigence : celle de l'attention au « langage vrai ». Luc Estang
Académie française
Pierre Emmanuel fut élu à l'Académie française, le 25 avril 1968, au fauteuil 4, succédant au maréchal Juin. Sa réception officielle eut lieu le 5 juin 1969. Après l'élection de Félicien Marceau, dont il dénonçait l'attitude collaborationniste, il se déclara démissionnaire de l'Académie en 1975 et cessa de siéger. Toutefois, ses confrères ne prirent pas acte de cette décision et attendirent sa disparition pour procéder à son remplacement, intervenu le 18 avril 1985 avec l'élection du professeur Jean Hamburger. Sa seconde épouse, née Janine Loo, est décédée le 23 avril 2013 à 92 ans. Elle est inhumée, avec Pierre Emmanuel, au cimetière du Père-Lachaise 57e division.
Liste des œuvres Œuvres en français
Elégies 1940
Tombeau d'Orphée, Éd. Poésie 41, Pierre Seghers, 1941
Jour de colère 1942
Combats avec tes défenseurs, Éd. Poésie 42, Pierre Seghers, 1942
Sodome 1944
Vercors 1944
Cantos 1944
La liberté guide nos pas 1945
Le Poète fou
Mémento des vivants
Poésie, raison ardente 1947
Le Poète et son Christ
Qui est cet homme 1947
Car enfin je vous aime
Babel 1951
L'ouvrier de la onzième heure 1953
La Colombe
Visage Nuage
Versant de l'Âge
Evangéliaire
Le Goût de l'un
La Nouvelle Naissance
La Face Humaine
Le monde est intérieur 1967
Jacob 1970
Sophia 1973
La Vie Terrestre
Tu 1978
Le Livre de l'Homme et de la Femme, trilogie : Una ou la Mort la Vie, Duel, L'Autre
L'Arbre et le Vent
Les Dents serrées
Le Grand œuvre, Cosmogonie 1984
Œuvres poétiques complètes, Lausanne, L'Âge d'homme, 2001, t. I, 1940-1963.
Œuvres poétiques complètes, Lausanne, L'Âge d'homme, 2003, t. II, 1970-1984.
Tombeau d'Orphée suivi de Hymnes orphiques, édition établie et préfacée par Anne-Sophie Andreu, Lausanne, L'Âge d'homme, coll. Amers, 2001.
Lettres à Albert Béguin : correspondance 1941-1952 (édition établie et annotée par Aude Préta-de Beaufort). Lausanne, Paris : L'Âge d'homme, coll. Cahiers Pierre Emmanuel no 2, 2005.
Œuvres en anglais
The Universal Singular: The Autobiography of Pierre Emmanuel traduit par Erik de Mauny, Grey Walls Press, London, 1950.
Bibliographie sélective
Alain Bosquet, Pierre Emmanuel, Paris, Seghers, coll. Poètes d'aujourd'hui, 1959.
Pettigrew, Damian et Christian Berthault. Les dernières interrogations de Pierre Emmanuel, Le Monde, 7 octobre 1984.
Olivier Clément, Le Grand œuvre de Pierre Emmanuel. Un point de convergence, in Les visionnaires, Paris, Desclée de Brouwer, 1986, p. 129-151.
Évelyne Frank, La naissance du oui dans l'œuvre de Pierre Emmanuel, Paris, PUF, 1998.
Anne-Sophie Andreu, Pierre Emmanuel, Paris, Les Éditions du Cerf, 2003.
Irène Grünberg-Bourlas, Pierre Emmanuel ou la Matière Spirituelle, Paris, Publibook, 2004.
Anne Simonnet, Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint, Parole et Silence, 2010.
Nunc no 24, Dossier Pierre Emmanuel, Éditions de Corlevour, 2012.
Discographie
Le jour Louange des heures , poèmes de Pierre Emmanuel mis en musique par Louis Thiry pour le chœur des moniales de l'Abbaye Sainte-Marie de Maumont aux Éditions Abbaye de Maumont.
Décorations
Officier de la Légion d'honneur
Grand officier de l'ordre national du Mérite
Commandeur des Arts et des Lettres
Honneurs posthumes
Il existe depuis 1985 une place Pierre-Emmanuel à Paris quartier des Halles, 1er arrondissement.
Posté le : 01/05/2015 18:48
|
|
|
|
|
Les jeux Floraux |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 mai 1324, création, à Toulouse, de l'académie des jeux floraux
de riches bourgeois organisent une joute poétique entre troubadours, trouvères et ménestrels de tous pays. Ainsi naît le premier concours de poésie d'Europe, sinon du monde. Le premier concours de poésie le 3 mai 1324 , naissance des Jeux Floraux
L'Académie des Jeux floraux en occitan, Acadèmia dels Jòcs Florals est une société littéraire fondée à Toulouse au Moyen Âge, sans doute la plus ancienne du monde occidental. D'abord appelée Consistoire du Gai Savoir, c'est la plus ancienne société littéraire connue. Elle doit son nom aux jeux floraux, fêtes célébrées à Rome en l'honneur de la déesse Flore. Lors de concours qui ont lieu chaque année, les membres de l'Académie, appelés mainteneurs, récompensent les auteurs des meilleures poésies en français et en occitan. Ces récompenses revêtent la forme de cinq fleurs d'or ou d'argent : la violette, l'églantine, le souci, l'amarante et le lys. Celle ou celui qui reçoit trois de ces fleurs porte le titre de maître des jeux.
L'institution fut fondée par plusieurs poètes qui se réunirent pour former ce qu'on appela le Consistori del Gay Saber ou Consistoire du Gai Savoir. Soucieux de rétablir un certain lyrisme après la croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle, de riches bourgeois toulousains organisèrent un concours littéraire en langue d'oc, récompensant chaque année un troubadour d'une violette dorée à l'or fin.
Le premier concours de poésie eut lieu le 3 mai 1324. Se déroulant tout d'abord au verger des Augustines, cette compétition devint peu après une fête locale financée par les Capitouls.
Après plusieurs tentatives, les jeux furent également instaurés à Barcelone en 1393 à l'initiative du roi Jean Ier d'Aragon et furent maintenus sous les auspices des monarques d'Aragon jusqu'à la fin du XVe siècle.
Concours poétique annuel institué à Toulouse, en 1323, par un groupe de poètes désireux de maintenir les traditions du lyrisme courtois. La légende de Clémence Isaure dame toulousaine qui serait à l'origine du Consistoire, née vers la fin du xve s., contribua beaucoup à la popularité des jeux. La compagnie prit le nom de Collège de rhétorique au XVIe s., admit la langue française à ses concours, d'abord conjointement avec la langue d'oc, puis de manière exclusive. Elle s'intéressa à la Pléiade, couronna Ronsard et Robert Garnier. En 1694, Louis XIV l'érigea en Académie des jeux Floraux. Favorable au romantisme, l'Académie revint en 1895, sous l'impulsion de Mistral, à ses anciennes traditions : de nouveau bilingue, elle recrute ses mainteneurs dans toutes les provinces de langue d'oc.
Près d'un siècle après la croisade contre les Albigeois qui avait mis à feu et à sang le Midi de la France, la ville de Toulouse retrouve son antique prospérité et sa joie de vivre...
Les concurrents doivent s'exprimer en langue d'oc, la langue du Midi toulousain. Cette langue, imprégnée de tournures latines ou romanes, se distingue de la langue du Bassin parisien, la langue d'oïl, d'où nous vient le français actuel leur nom respectif vient de ce que oui se disait oc à Toulouse et oïl à Paris.
Pour donner corps à leur initiative, les organisateurs du concours de poésie offrent une violette d'or au gagnant et donnent à leur groupe le nom de compagnie du gai savoir. Dans cet intitulé plein de gouaille perce déjà l'esprit de Rabelais !...
Les capitouls, bourgeois qui gouvernent la ville au nom du comte de Toulouse, ajoutent un souci d'argent et une églantine d'or aux prix qui seront décernés chaque année.
En 1515, la compagnie prend le nom de Compagnie des Jeux Floraux. Elle se place peu après sous le patronage de Clémence Isaure, une dame du siècle précédent qui lui aurait fait don de ses biens... mais dont l'existence n'est en rien avérée.
De la langue d'oc au français
En 1694, signe des temps, la Compagnie des Jeux Floraux renonce volontairement à la langue d'oc pour le français, qui a pour lui le prestige de la cour de Versailles. Elle se place sous la protection du roi Louis XIV et prend le nom d'Académie, en référence à une Accademia romaine et sans doute aussi pour concurrencer, autant que faire se peut, la jeune Académie française.
Le jury des Jeux Floraux a fait la preuve de sa sagacité en récompensant d'une Églantine Pierre de Ronsard en 1554 et d'un lys d'or le jeune Victor Hugo 19 ans. Chateaubriand a été également couronné. Et bien sûr le poète François Fabre d'Églantine qui nous a légué le calendrier révolutionnaire et «Il pleut, il pleut, bergère...la deuxième partie de son nom rappelle l'églantine d'argent remportée aux Jeux Floraux et dont il était très fier !.
L'Académie des Jeux Floraux est aujourd'hui hébergée dans le somptueux hôtel d'Assézat, une demeure de style Renaissance, en pierre et en brique, bâtie à la fin du XVIe siècle par un marchand enrichi dans le commerce du pastel.
Elle poursuit dans une relative discrétion la promotion de la langue d'oc depuis qu'en 1895, le poète provençal Frédéric Mistral réintroduisit cette langue en son sein elle est aujourd'hui faussement appelée occitan. André Larané
L'institution fut fondée en 1323 par plusieurs poètes qui se réunirent pour former ce qu'on appela le Consistori del Gay Saber ou Consistoire du Gai Savoir. Soucieux de rétablir un certain lyrisme après la croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle, de riches bourgeois toulousains organisèrent un concours littéraire en langue d'oc, récompensant chaque année un troubadour d'une violette dorée à l'or fin.
Le premier concours de poésie eut lieu le 3 mai 1324. Se déroulant tout d'abord au verger des Augustines, cette compétition devint peu après une fête locale financée par les Capitouls.
Après plusieurs tentatives, les jeux furent également instaurés à Barcelone en 1393 à l'initiative du roi Jean Ier d'Aragon et furent maintenus sous les auspices des monarques d'Aragon jusqu'à la fin du xve siècle.
Aujourd'hui :
Cadre et forme juridique : Association de loi 1901 dont le but est un concours littéraires, fondé en 1323 par 7 troubadours, le siège se trouve à l'Hôtel d'Assézat, à Toulouse. Constitué de 40 membres dit "mainteneurs" le slogan est HIS IDEM SEMPER HONOS Par ces fleurs toujours la même beauté Dissolution en 1790, rétablie en 1806
XVIe siècle
En 1513, des différends éclatent entre le Consistoire du Gai Savoir et les Capitouls. Les membres du Consistoire décidèrent alors de prendre leur indépendance : ils changèrent le nom de la société en Collège de rhétorique et réclamèrent à la municipalité le financement de leur manifestation. Pour appuyer leur demande, ils créèrent le personnage de Clémence Isaure, dont ils racontèrent qu'elle avait légué tous ses biens à la ville à condition que les Jeux floraux y soient organisés chaque année.
Afin de convaincre les magistrats, ils utilisèrent la sépulture de Bertrande Ysalguier, dont la statue expose dans ses mains jointes un iris symbolisant les fleurs du Gai Savoir. Parallèlement, ils lui inventèrent un passé, créant des archives de toute pièce. Cette statue sera modifiée un siècle plus tard afin de coller à la légende : la tête est remplacée, des fleurs sont substituées au chapelet dans la main droite, la charte des Jeux floraux est placée dans la main gauche, et le lion est supprimé.
XVIIe siècle
En 1694, sous l'impulsion de Simon de La Loubère, la Compagnie des Jeux floraux devint l'Académie des Jeux floraux, nom qu'elle a gardé jusqu'à aujourd'hui. Louis XIV édicta les statuts de l'Académie, qui seront modifiés plusieurs fois par la suite. La langue des poèmes soumis à concours devint le français.
XVIIIe siècle
Par lettres patentes du mois de mai 1725, le nombre des mainteneurs est porté de trente-six à quarante. De nouvelles lettres patentes datées du 28 septembre 1743 permettent la délivrance de lettres de maîtrise aux religieux qui obtiennent trois prix lors des quatre concours annuels. Cette organisation est en partie remaniée par un édit de 1773. Le 21 juin 1777, Monsieur, frère du roi Louis XVI et futur roi Louis XVIII, assiste à une séance de l'Académie et entend la lecture de trois odes de Géraud Valet de Réganhac, maître ès jeux depuis 1759. Peu après, la période révolutionnaire entraîna la dispersion des membres de l'Académie et la suspension de ses activités.
XIXe siècle
Rétablie officiellement en 1806, l'Académie des Jeux floraux continua tout au long du xixe siècle à être régie, malgré quelques changements mineurs à son règlement, par les statuts de 1694.
Depuis 1894, elle se réunit à l'hôtel d'Assézat, où se trouve la fameuse statue de Clémence Isaure, et elle continue d'attribuer des prix littéraires. Chaque 3 mai, dans la salle des illustres du Capitole, on fait l'éloge de l'inspiratrice et bienfaitrice des poètes. Le même jour a lieu dans la basilique de la Daurade une messe où sont bénies les fleurs du concours avant d'être présentées à la cérémonie de remise de prix.
En 1895, l'occitan est rétabli dans les concours, au côté du français.
En 1859, elle inspira l'instauration de nouveaux Jeux floraux à Barcelone puis à Valence.
Jeux floraux de 1819.Ces jeux, organisés à Toulouse, mettaient en compétition des poètes et des musiciens sous l'égide de la nymphe Flore. En 1819, l'un des lauréats fut Victor Hugo, alors âgé de dix-sept ans. Ce jeton peut donc être de cette émission, étant sans poinçon.
XXe siècle
Lors de sa visite à Toulouse, le 5 novembre 1940, le maréchal Pétain est intronisé « protecteur » de l’académie des Jeux Floraux et se voit remettre le bouton d’or par Jules Rozès de Brousse. Plusieurs hauts fonctionnaires du régime de Vichy font partie entre 1940 et 1944 de ses membres : Jean-Marie Charles Abrial comme mainteneur et Joseph Barthélémy, Charles Maurras et Pierre Lespinasse comme maîtres-es-jeux. Après la chute du régime de Vichy, Camille Soula propose la dissolution de l’académie4. En février 1942, le Secours national reçoit un don de l’académie5.
Mainteneurs et maîtres ès jeux[modifier | modifier le code]
Voir la liste des mainteneurs depuis 1694.
Les mainteneurs de l'Académie sont choisis exclusivement parmi des personnes domiciliées à Toulouse ou dans ses environs immédiats. La première femme mainteneur, Lise Enjalbert, n'a été élue qu'en 2005.
Les maîtres ès jeux, dont le lieu de résidence est libre et le nombre n'est pas limité, peuvent être aussi bien des femmes ou des hommes. On compte parmi eux Ronsard, Marmontel, Chateaubriand, Voltaire, Fabre d'Églantine, Alfred de Vigny, Victor Hugo, Firmin Boissin, Frédéric Mistral, Just François Raynouard, Henry de Rochegude, Carmen Sylva, Stéphen Liégeard, l'Abbé Salvat, le chanoine Nègre, Marie Noël.
Les fleurs
Fleurs d'argent
La Violette : couronne depuis 1324 aux poèmes, épîtres et discours en vers.
L'Églantine : instaurée en 1349, supprimée en 1806, restaurée en 1886, elle récompense les sonnets.
Le Souci : couronne depuis 1356 les églogues, idylles, élégies, ballades.
L 'Œillet : créé en 1607 pour les petits genres et comme prix d'encouragement.
L'Amarante : depuis 1694.
Le Lys : récompense depuis 1739 les hymnes à la Vierge.
La Primevère : fondée en 1846 par le président Boyer 1754-1853, pair de France et président à la Cour de cassation, elle couronne les fables et apologues.
L'Immortelle : créée en 1872 par le Conseil général de la Haute-Garonne grâce à une allocation annuelle, elle devait couronner un sujet d'histoire locale. Elle ne fut accordée qu'à quatre reprises jusqu'en 1900. Elle disparut pendant les guerres, mais elle fut rétablie en 1958, et devait récompenser la poésie française moderne. Cette fleur a été accordée régulièrement presque tous les ans, mais du fait de non-versement de la subvention elle n'a plus été décernée depuis 1987.
Le Narcisse : créé par le conseil municipal en 1959, et remis pour la première fois en 1960. Cette fleur est réservée à la langue d'oc.
La Rose d'argent : depuis 2004
Fleur de vermeil
Le Laurier de vermeil : fondé en 1922, peu avant sa mort, par Stephen Liégeard (1830-1925), le Sous-Préfet aux champs d'Alphonse Daudet, devenu maître ès jeux en 1866, le laurier est destiné à la meilleure pièce du concours annuel. Le laurier peut ne pas être accordé, si le niveau du concours est estimé trop bas ; c'est arrivé à quelques reprises.
Fleur en or
Le Liseron d'or : attribué pour la première fois en 1989 à Mme Pierre de Gorsse en mémoire de son mari, Pierre de Gorsse, ancien secrétaire perpétuel. Cette fleur nouvelle, qui résulte des dispositions testamentaires d'une lauréate de l'académie, doit couronner un grand écrivain dont l'œuvre aura enrichi son temps et glorifié la langue française. Elle peut être remise, à titre posthume, à la famille d'un écrivain défunt.
Prix spéciaux
Le Violier d'or : destinée à la demande du baron Guy Desazars de Montgailhard, mainteneur, à couronner le meilleur poème en langue d'oc, cette fleur devait commémorer celle décernée en 1324 qui, selon certains, n'était en fait pas une violette prix du 600e anniversaire de l'académie.
Le Muguet d'argent : offert grâce à une dotation spéciale du comte Bégouen, préhistorien, correspondant de l'Institut, mainteneur (prix du 600e anniversaire de l'académie.
Le Lys d'or : accordé deux fois seulement, en 1776 et 1819 Victor Hugo. Il n'avait été instauré que pour deux circonstances exceptionnelles, et n'a plus été attribué depuis.
La Violette d'or : créée en 1880 par le capitaine de Roquemaurel, elle n'a été accordée qu'en quatre occasions, trois fois à la fin du xixe siècle, et l'autre en 1916. Cette fleur d'or doit, tous les trois ans, couronner un poème sur sujet imposé, d'où la difficulté de son obtention.
L'Églantine d'or : instituée en 1874, elle n'a jamais été attribuée.
L'Amarante d'or : remontant à Louis XIV, dont les lettres patentes de 1694 la réservent aux odes, elle a été décernée au total 123 fois, pour la dernière fois en 1911 à Raymond Lizop.
Le Jasmin d'or : fondé en 1879 par Adélaïde-Louise d'Eckmühl de Blocqueville, maître ès jeux, sous la dénomination prix d'Eckmühl, il était destiné à couronner le meilleur discours en prose, mais n'était attribuable que tous les trois ans. Il n'a été décerné que trois fois, avant 1900.
Au moyen-âge
La poésie lyrique
À la fois parole, musique et jeu, le lyrisme médiéval, tel que le transmettent les manuscrits, reste difficile à lire et à interpréter. Vestiges pour ainsi dire archéologiques, les écrits, même lorsqu'ils comportent une notation musicale, ne livrent plus le secret de leur vie poétique. Le lecteur moderne peut néanmoins s'affranchir de quelques idées fausses, et d'abord des illusions romantiques sur l'inspiration et la création. Composition plus objective que subjective, le poème remplit une fonction sociale précise et soumet l'expression du sentiment aux exigences d'une doctrine morale.
S'il faut chercher une structure fondamentale, la constante sociologique, on peut caractériser le lyrisme par l'attitude de l'éloge, à quoi s'oppose celle du dénigrement, qui définit la satire. Mouvement positif d'adhésion, d'approbation, de participation, le lyrisme tend à l'extase, tandis que la satire, faite de refus, de critique, de libération, se fonde sur l'émotion du rire. Par le lyrisme, l'homme s'intègre à la communauté et au monde naturel qui l'entourent. Chargée d'idéaliser, d'embellir, d'exalter ou simplement de flatter, la poésie joue alors un rôle essentiel quand il s'agit d'invoquer Dieu, la nature, la société, la femme. Mais, pour situer le lyrisme plus exactement dans le contexte historique de la littérature médiévale, c'est à l'épopée qu'on le comparera. Différence thématique : la vision épique implique la guerre et voue le héros à la mort glorieuse, la vision lyrique s'inspire du désir et invite à l'amour. Différence de discours : l'épopée raconte, submergeant par la progression du récit les stances d'évocation, le lyrisme fixe l'aventure et la description par l'analyse, l'incantation et la chaîne de ses répétitions. Et, pourtant, il y a parenté de style, car dans les deux cas l'écriture se fait hyperbole pour grandir le geste ou sublimer le sentiment.
Styles, jeux et danses
La tradition du lyrisme médiéval s'explique-t-elle par la théorie des styles ? En se référant explicitement au style tragique pour définir la chanson d'amour, Dante rappelle les principes reconnus par les écrivains du Moyen Âge. Formés par la grammaire et la rhétorique latines, ils avaient une idée hiérarchique de leur art, conforme à l'image même qu'ils se faisaient de la société. Les trois styles gravis, humilis et mediocris avaient pour personnages types le chevalier (miles dominans), le berger pastor otiosus et le laboureur agricola. Dans la mesure où les poètes avaient reçu une formation savante, c'est-à-dire cléricale, ils devaient avoir tendance à transposer ces critères de leur langue de culture dans leur langue vulgaire. Nous connaissons, de fait, une abondante littérature en langue latine qui, de Fortunat VIe siècle à l'école de Chartres XIIe siècle, a cultivé un lyrisme sérieux, tant profane que religieux. Nous savons, d'autre part, que certains clercs, se détachant des normes et de la vie d'Église, menaient une vie libre, errante vagantes et dissolue goliards, rimant en latin des poèmes satiriques. Lettrés et jongleurs étaient souvent en contact étroit, sinon toujours formés par la même culture latine. En tout cas, l'influence de celle-ci fut favorisée par l'Église chants religieux, versus, séquences, hymnes.
Il est toutefois évident que le lyrisme médiéval utilise les ressources de plusieurs styles à la fois. Ainsi, la pastourelle, qui semble se rattacher au style humilis, ne dérive pas seulement du genre des Bucoliques, car elle met en présence et en dialogue la bergère et le chevalier, contre les villanescas et les serrallinas hispaniques. Ce mélange des styles nous empêche d'articuler simplement les genres poétiques sur les différentes catégories sociales. Des chansons de toile, d'allure archaïque, mettent en scène une femme qui rêve d'amour, à son ouvrage, et parfois se révolte assez vivement contre la surveillance maternelle ou la tyrannie du mari. À quel style attribuer cette simplicité, cette sentimentalité, ces refrains naïfs et pittoresques de Belle Aiglentine, Belle Doete, Belle Yolande ou Belle Aeliz, qui attendent leur prince charmant ? Il semble que la grammaire et la rhétorique ont surtout servi à nourrir les genres lyriques, leur fournissant ornements, figures, topoi, personnages, décors conventionnels, toutes les ressources du métier, mester de clerecia qui a enrichi le mester de joglaria. Mais c'est sur d'autres bases que s'est constitué le système des genres lyriques.
On songe alors aux conditions de la distraction, du jeu et de la célébration qui justifiaient le recours au poème lyrique. Les chansons de femme suggèrent l'ennui de l'existence dans un château féodal. L'aubade ou l'aube sert à réveiller les amants. D'autres thèmes de chansons impliquent un jeu collectif. C'est le cas pour la pastourelle, qui comporte un dialogue dramatique. Les reverdies, chantant le renouveau de la nature, font penser aux fêtes de mai, où l'on célèbre la joie, le désir, l'amour. Ainsi, les thèmes orientent notre interprétation. Cependant, la forme même, quand à la construction des strophes se mêle la répétition du refrain, indique une collaboration entre le soliste et le public, donc une manifestation sociale. D'autres formes métriques, éclairées par les structures musicales, s'expliquent en fonction de la danse qu'elles accompagnaient ; ainsi, les estampies, morceaux pour instruments auxquels on a ajouté des paroles, mais aussi ballades, virelais, rondeaux, dont les formes, au moins à l'origine, ont dû répondre à quelque type de danse.
Il faudrait, en confrontant les structures musicales, les formes strophiques et métriques, les thèmes, les styles, qui s'associent diversement, essayer de reconstituer tout le système du lyrisme européen. On pourrait ainsi distinguer les constantes sociologiques des variations dues aux différents milieux historiques. On pourrait aussi distinguer ce qui est vraiment filiation, développement continu d'un genre, par exemple, à partir du lyrisme latin, avec adaptation de la prosodie latine à la nature spécifique de chaque langue vulgaire, de ce qui est plutôt imitation, transposition discontinue de formes, de thèmes antiques ou exotiques, par exemple à partir du zadjal arabe. À cette époque, comme de nos jours, la poésie s'est développée par l'imitation et la réplique. Toute une activité lyrique a d'ailleurs consisté en débats, en jeux-partis, à l'occasion de rencontres entre poètes. Ceux-ci étaient souvent bilingues, et c'est ainsi que d'Andalousie jusqu'en Allemagne, de Sicile jusqu'en Angleterre, les airs, les idées, les images ont pu cheminer, par petites étapes, à travers l'Europe. Cheminement dont on ne connaît que quelques repères dans les siècles les plus anciens, tels les refrains romans des muwashshaḥs arabes au début du XIe siècle. Au contraire, à partir du XIIe siècle, on suit assez bien la diffusion du lyrisme qui domine tout le Moyen Âge, celui des troubadours.
Les troubadours
La poésie des troubadours est un bel exemple de réussite à la fois esthétique et idéologique. Leur art musical, qui semble avoir exploité les ressources du chant grégorien, parfois revigoré par des rythmes et des airs plus exotiques arabes, notamment, n'est pas compris, de nos jours, de la même façon par tous les musicologues. Mais il atteste un travail savant. Savante aussi leur versification, qui répand l'usage de la rime, associée au syllabisme, et le découpage du poème en strophes. La chanson d'amour devient le genre le plus distingué, avec cinq ou six strophes divisées en trois parties, et une tornada finale. Le langage lui-même fait l'objet d'une recherche qui aboutit le plus souvent à un hermétisme calculé : c'est le trobar clus. Le sens se dévoile à partir de quelques termes clés, mais avec des écarts qu'il est difficile d'apprécier, d'autant plus que, transposés dans les autres langues, ils ont pu exprimer des idées toutes différentes.
Une discipline de l'amour
La doctrine, telle qu'on essaie de la reconstituer, est essentiellement consacrée à l'amour. S'agit-il d'un érotisme sensuel ou spirituel ? L'expression la plus importante est celle de fin'amors. Elle s'oppose à fals'amors. Opposition du pur à l'impur, de l'authentique au fabriqué, mais aussi de ce qui est distingué et raffiné à ce qui est commun et vulgaire. Cette supériorité est interprétée différemment selon les poètes. Pour Marcabru, elle est sagesse. Pour d'autres, elle est douleur. Elle est surtout liée à un sentiment de noblesse choisie et conquise. Car c'est le souci de mérite pretz et valor qui anime l'amant. Transposition de la vertu guerrière de la proeza, avec pour souci de contrôler la vigueur de la jeunesse jovens par la maîtrise de soi mezura.
Cette discipline fait de l'amour une expérience et une aventure à la fois psychiques et physiques. Ainsi, l'épreuve assag de la chasteté temporaire en présence de la dame nue n'est pas une marque d'ascétisme religieux ! C'est un raffinement du désir et du sentiment. L'amour des troubadours ne doit pas être confondu avec l'amour chrétien caritas. Toutefois, il traduit un changement important dans la définition du couple. Le chevalier féodal, possessif et violent, y prend une attitude humble et soumise devant la dame. Ce renversement des rôles, dans une certaine mesure pathologique, n'a pu s'imposer que pour des raisons sociales. La mythologie de la dame hautaine et inaccessible, vécue avec intensité par les poètes de condition modeste, s'est répandue partout où la vie de cour s'est développée, peut-être parce que cette structure sociale impliquait une sévère répression de l'orgueil et de la violence guerrière. On sait que la religion elle-même, d'abord dominée par la figure du Père terrible, va voir se développer celle de la Mère, de la Vierge-Mère, confirmant la profondeur de la mutation mentale, dont la poésie des troubadours aura porté le signe avant-coureur.
Poètes-musiciens des pays d'oc
Derrière les grands thèmes de cette doctrine, on apprend à mieux connaître la pensée et le talent de chaque poète. Le premier des troubadours de langue d'oc fut un très grand seigneur, Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers 1071-1127. Héros d'épopée, mais qui profite d'une croisade pour envahir les terres du comte de Toulouse. Sa vie privée a fait scandale : amateur de femmes, il est excommunié pour avoir répudié son épouse légitime. On comprend que certains poèmes de Guillaume soient fortement teintés de libertinage, voire d'une franche sensualité. D'autres vouent déjà à la dame cette passion idolâtre qui caractérise l'amour dit courtois. On a parlé de conversion, de contradiction. Mais c'est la complexité de l'amour humain qui alors s'exprime à la faveur d'une liberté nouvelle. La hardiesse un peu incohérente de ces manifestes poétiques et érotiques s'explique par l'absence de codification. Les vieilles conventions féodales sont déjà rejetées ; les nouvelles conventions courtoises ne se sont pas encore imposées.
Dans ces pays où s'épanouit la civilisation la plus raffinée, en Limousin, en Languedoc, en Provence, en Catalogne, dans ces villes où la vie spirituelle a élaboré la religion cathare, autour de ces seigneurs plus pressés de jouir de la vie que de faire la guerre, l'art poétique varie selon les tempéraments et les circonstances, mais il se présente presque toujours comme une ambitieuse alchimie. Le poète cherche dans l'amour le secret d'une métamorphose qu'il croit nécessaire à l'homme. Réfléchissant sur le paradoxe du désir, cette souffrance agréable, il suggère les lois de la transmutation de la douleur en bonheur, du mal en bien.
Marcabru, de 1130 à 1140, formule dans un langage savant, tourmenté, le malaise d'un pessimiste devant l'immoralité de ses contemporains. Sa violence et son obscurité portent la marque d'une crise d'adaptation entre l'individu, il était sans doute de condition modeste et la haute société. À la même époque, Cercamon œuvres de 1135 à 1145 élabore avec plus de sérénité les thèmes qui vont caractériser la chanson d'amour : éloge de la Dame, soumission et timidité de l'amant, lutte contre les médisants lauzengador. Jaufré Rudel 1130-1170 pousse le raffinement du désir jusqu'à la rêverie de l'amour lointain et impossible. Bernard de Ventadour 1145-1180, fils de serviteur, a voulu surmonter par son mérite poétique la distance sociale qui le séparait d'une grande dame dont il était amoureux, Aliénor d'Aquitaine. Avec Arnaut Daniel 1180-1210, le travail du style poétique aboutit à des prouesses techniques, combinaison arithmétique des rimes valorisées par cette exigence de perfection qui fait de l'art la quintessence de la vie. Vers cette époque, on compte une quarantaine de troubadours assurant un magnifique rayonnement au lyrisme. Mais son ésotérisme, ses audaces, sa liberté spirituelle ne pouvaient que renforcer la méfiance du pouvoir politique et religieux dans la France du Nord. Le déclin de cette poésie coïncide avec la croisade contre les Albigeois qui, sous prétexte de détruire l'hérésie cathare, soumet les pays d'oc à une répression très sévère. Mais l'extraordinaire recherche poétique et la rêverie utopique qui l'inspira continuent à fasciner et à stimuler, ailleurs, l'imagination des poètes lyriques.
L'Espagne, dont le lyrisme connaît des genres lyriques analogues aux genres français chansons de mai, chansons campagnardes et qui naturellement se trouve en contact étroit avec la poésie arabe, a surtout subi l'influence des troubadours dans ses chansons d'amour cantigas de amor. En Sicile, à la cour de Frédéric II où se développe une intense activité culturelle, des lettrés imitent, vers 1230-1240, les thèmes amoureux et les images des troubadours, adaptant le vocabulaire d'emprunt à leur langage, sans d'ailleurs exactement le traduire, et se retournent vers la poésie latine pour élaborer un style plus scolastique. De là repartent, vers l'Allemagne, les Minnesänger souabes, également sensibles à la courtoisie française.
Les trouvères
La poésie courtisane
Ce sont surtout les poètes français en effet qui, au contact des troubadours, ont exploité méthodiquement les ressources techniques et idéologiques de la poésie occitane. La diffusion de ce lyrisme suit naturellement les axes de la civilisation de cour. Il apporte les cadres de pensée, les rites, le goût qui conviennent à ce type de vie sociale qui s'établit à Blois, en Champagne, autour des filles d'Aliénor d'Aquitaine. La force d'amour, dont les Méridionaux avaient fait le principe de leur révolution, est interprétée d'une manière plus conforme à la philosophie mystique. L'érotisme y semble, pour cette raison, plus platonique. Mais surtout la pression sociale se fait plus nettement sentir à l'égard des manifestations sexuelles : le désir est plus nettement sublimé. Néanmoins, l'ensemble de cette production poétique ne se confond pas avec une inspiration chrétienne qu'elle enrichit plutôt, et même menace, de certaines spéculations proches de l'hérésie. En tout cas, l'esprit mondain de ces poètes répond à la sensibilité, aux aspirations de la société aristocratique, en des termes fort différents de ceux de la théologie officielle. Cette mentalité courtoise se caractérise par un effort conscient et concerté pour dépasser la spontanéité du plaisir et la fatalité du malheur. D'où l'opposition au mythe de Tristan et Yseut, expressif de la vieille sentimentalité féodale. D'où aussi une grande réserve à l'égard de la sensualité, dont la poésie des troubadours n'était pas exempte.
L'initiateur de ce nouveau lyrisme semble avoir été Chrétien de Troyes 1135 env.-1183 env., qui compose à la cour de Marie de Champagne vers 1170. Il a bien montré comment le lyrisme du fin'amors se greffe sur l'autre tradition, qu'on peut appeler celtique :
Ains del beverage ne bui
Dont Tristans fut enpoisonez,
Car plus me fait amer que lui
Fins cuers et bone volontez.
Jamais ne n'ai bu le breuvage dont Tristan fut empoisonné, car, plus que le sien, mon amour est inspiré par un cœur pur et une volonté saine.
Dans le même milieu social, Gace Brûlé fin XIIe-début XIIIe s. transpose la plupart des thèmes mis à la mode par les troubadours. Il est le type même du pensif introverti et douloureux, inattentif au monde extérieur, dont le décor reste vague, tandis que les personnages des losengiers semblent assez caricaturaux. On retrouve, transformée en inquiétude, en nostalgie douloureuse, en torture d'amant martyr, la tristesse sentimentale des premières chansons françaises :
À minuit une douleur m'éveille
Qui m'ôte le lendemain l'envie de jouer et de rire.
Elle m'a dit, à juste titre, dans l'oreille
Que j'aime une femme qui me fait mourir en grand martyre.
Après la Champagne, ce sont l'Artois et la Picardie qui ont connu les premiers grands trouvères. Parmi ceux-ci, Conon de Béthune 1150 env.-1220 env., grand seigneur qui s'est illustré à la troisième et à la quatrième croisade. Il a composé des chansons de croisade, s'est opposé dans des débats au troubadour Bertrand de Born (1140 env.-1215 env.), mais semble avoir été initié par Huon d'Oisy † 1189 aux goûts de la cour de Champagne, où l'on raille cependant son langage et ses chansons. Autre Picard, Blondel de Nesle a composé avec finesse et harmonie sur les thèmes courtois. Quant au châtelain de Coucy, qui mourut au cours de la quatrième croisade, il a pu mériter par son talent la légende qui fait de lui l'amant tragique dont la maîtresse, la Dame du Fayel, se vit servir le cœur par un mari jaloux. Tous ces trouvères sont, on le voit, d'assez grands personnages. Ils joignent au talent d'écrivain celui de musicien. Ainsi, le lyrisme courtois reste un art complexe et expressif : il résume l'idéal spirituel de l'aristocratie française la plus évoluée.
Au XIIIe siècle, on constate une extension considérable du nombre des trouvères. Les chansonniers collectifs ont conservé, avec maintes œuvres anonymes, près de deux cents noms de poètes. Parmi les personnalités les plus importantes, mentionnons Thibaud IV de Champagne 1201-1253. Instable il changeait facilement d'avis et de parti, il a mis toute sa constance dans ses goûts poétiques. Comme Guillaume IX, il doit à sa haute condition une certaine aisance, assez d'humour dans le développement des thèmes amoureux, où l'on cherche en vain cette amertume et cette jalousie qui affectent parfois les trouvères de plus humble origine. Sa désinvolture donne déjà à son style une certaine préciosité : l'expérience amoureuse comporte pour lui une part de jeu. Il y a là une légèreté qui distingue le lyrisme français du lyrisme italien.
L'originalité du dolce stil novo, qui se développe entre Bologne et Florence de 1270 à 1310, tient d'abord à ses ambitions philosophiques et religieuses. Entre les troubadours et Gunizelli ou Cavalcanti, Guittone d'Arezzo a marqué de son spiritualisme moralisant le goût poétique. Le mouvement lyrique figure la conversion d'une âme qui s'élève au-dessus des plaisirs sensuels ou s'exile loin de la gente noiosa e villana. Le mérite de ce mysticisme est de récupérer les plus belles spéculations de la théologie tout en répondant aux aspirations du public cultivé. L'originalité tient aussi à la forme le sonnet, déjà pratiqué par les Siciliens et au style qui vise à la douceur et à la délicatesse. Là où les troubadours suggéraient un secret, les poètes italiens désignent l'ineffable.
La poésie française évolue selon d'autres principes. L'inspiration religieuse reste circonscrite à quelques poèmes, sauf chez Gautier de Coincy 1177 env.-1236, poète et musicien d'église. L'inspiration courtoise est perturbée par le talent personnel de ménestrels professionnels, musiciens itinérants, qui changent assez souvent de protecteurs. Ces trouvères ont quelque difficulté à rester dans les conventions de la fin'amour, et surtout à faire oublier leur propre condition. Ainsi Colin Muset XIIIe siècle, d'origine champenoise, cherche à divertir les seigneurs en chantant ses malheurs avec humour, ou en évoquant ses amourettes. La fantaisie dont il fait preuve, aussi bien dans l'adaptation des thèmes traditionnels que dans la construction des strophes, agrémente beaucoup sa poésie gaie, rêveuse, spontanée.
La poésie bourgeoise
Plus que la cour, c'est la ville qui favorise l'essor d'une poésie distincte de la tradition courtoise. Rutebeuf, † 1285, qui fit carrière à Paris, joue dans ses poèmes un personnage non conformiste, parlant avec entrain de son mariage, de sa pauvreté, de ses amitiés et surtout de ses rancœurs. La médiation du moi, le rôle assumé d'amuseur et de pitre entraînent vers une sorte de comédie poétique. Si tradition il y a, c'est celle des jongleurs, de ces amuseurs de tréteaux, fondée sur la verve, la fantaisie verbale. La distinction entre la satire et le lyrisme cesse d'être respectée. Rutebeuf donne un tour pathétique aux arguments de la critique sociale, confondant son destin personnel et sa vocation de moraliste. Tout en jouant la comédie du pauvre bougre, il s'interroge sur la valeur de son existence et sur celle de tous les hommes trop pauvres pour se mettre à l'abri du sort. Poésie bourgeoise, si l'on veut, mais dont le talent et la doctrine s'identifient malaisément avec la classe des marchands, et font plutôt penser au monde universitaire.
Ce sont bien des associations bourgeoises qui ont, cependant, favorisé, dans les villes du Nord, et en particulier à Arras, l'activité poétique. De Jean Bodel à Adam de la Halle, le monde des jongleurs arrageois se distingue en effet par sa cohésion, sa productivité, ses rapports avec la société locale. Quelle que soit la protection dont ils ont pu bénéficier de la part des patriciens, ils font preuve d'une assez grande indépendance d'esprit ; au reste, le thème lyrique par excellence est celui du congé, où nous retrouvons l'esquisse de l'exil. Comptant plus sur la parole que sur la musique, ils distillent une sorte de rhétorique agréable mais peu profonde, suivant de loin les apparences de la poésie d'oc, et visant surtout à un plaisir formel dont le mérite est parfois sanctionné par un prix, aux concours du puy académie. Ainsi, Arras connaît, entre 1240 et 1270, à l'époque de Jean Bretel, qui était lui-même un bourgeois, une abondante production poétique.
Poésie et musique
C'est toutefois un grand musicien, Adam de la Halle, qui fait la synthèse de tout l'héritage et oriente le lyrisme vers les genres qui s'imposeront à partir de 1280, notamment le rondeau, tout en adaptant au théâtre les genres du congé et de la pastourelle. Il transforme les habitudes des trouvères, qui pratiquaient un art mêlant mélodie, discussion scolastique et analyse du sentiment. Introduisant la polyphonie des motets dans les rondeaux et les ballades, il soumet plus étroitement la parole à l'architecture sonore. Tout un secteur de la poésie lyrique, et cela jusqu'à Guillaume de Machaut, se définit désormais selon les principes de cet art symphonique. Parallèlement, le discours poétique se développe librement dans des genres comme le congé, la parole se moulant sur la pensée personnelle, sur le message.
Aux XIVe et XVe siècles se renforce le rôle des cours princières dans la vie littéraire et artistique, sans que cela signifie la consolidation des doctrines courtoises par ces structures sociales. Néanmoins, le lyrisme, plus encore que les autres genres littéraires, est influencé par la vie culturelle que contrôle l'aristocratie. Un certain ton européen caractérise ainsi les grands chansonniers collectifs, qui juxtaposent les œuvres venues de différents pays.
En France, c'est encore un musicien, Guillaume de Machaut, qui, rassemblant dans son œuvre exemplaire toutes les formes de création poétique, codifie les genres et rajuste la doctrine. Le nouveau système lyrique qu'il transmet à ses successeurs est déterminé par l'évolution de la musique polyphonique ars nova. Le langage poétique semble subir une contrainte plus rigoureuse de la structure musicale, le texte étant soit écartelé, pour servir à une mélodie ornée qui se déploie sur chaque syllabe, soit écrasé par la superposition des voix qui chantent des paroles différentes. La lecture et l'intelligence immédiates d'une œuvre ainsi présentée sont à la rigueur impossibles. Cette conception de l'art, ordonnée simplement vers la perfection, ne fait aucune concession au grand public.
Autre conséquence de cette évolution de l'art musical : l'écart grandit entre les genres faits pour être dits et ceux destinés à être chantés. Dualité qui apparaît dans l'œuvre même du poète ; elle se répartit entre les dits, sorte de discours poétiques rimés mécaniquement, et les petits poèmes à forme fixe, rondeaux, virelais, ballades. Complaintes et lais assurent la transition, mais tendent à reporter sur la virtuosité du vers et les recherches métriques le travail proprement artistique.
Quant aux idées, leur présentation n'est plus essentiellement cet assemblage de thèmes, de motifs et de topoi par lequel les trouvères visaient moins à l'originalité de leurs propositions qu'à une sorte de plaisir formel. Les poèmes de Machaut sont davantage orientés vers les problèmes et les événements de son milieu social. Et son discours poétique doit confronter l'héritage courtois avec l'enrichissement humaniste : les exemples de l'Antiquité, mieux connus, se mêlent plus souvent aux clichés chrétiens ou courtois. La mythologie tend à devenir une substance poétique, la poétrie.
Finalement, la fonction du lyrisme est déterminée par les rapports des poètes avec les princes qui les protègent et qu'ils doivent instruire et consoler. Dans la mesure où cette tâche philosophique l'emporte sur la fonction traditionnelle de louange, le lyrisme tend à se confondre avec le didactisme. Mais c'est l'intervention du poète, de sa personnalité, de son moi, qui caractérise désormais le lyrisme proprement dit. Déjà, dans le Voir Dit, Machaut propose un commentaire autobiographique de certaines de ses plus belles œuvres, faisant sortir de l'anonymat ou de l'ambiguïté comique celui qui jusqu'alors, jongleur, trouvère ou ménestrel, devait surtout chanter les amours des autres.
Chroniques, satires et ballades
Encore musical chez Machaut, le lyrisme devient romanesque avec Froissart, le chroniqueur, qui rima des dits et de courts poèmes pour les cours d'Angleterre et du nord de la France. Le plus souvent, la convention courtoise l'amène à présenter l'amour de très jeunes gens, qu'il fait s'exprimer avec une grâce un peu mignarde. Cependant, il demande aux personnages des pastourelles de se faire l'écho des grands événements politiques.
Tandis que les chevaliers de la cour de Charles VI riment volontiers des ballades pour correspondre, échanger des idées sur l'amour ou se plaindre de leurs malheurs, Eustache Deschamps 1346 env.-1407 env. est plus tenté par la satire. La critique, chez ce petit officier de la cour royale, l'emporte en effet sur l'éloge. La leçon de morale se pare des prestiges de la fable, de la personnification, de l'allégorie. Mais, en définissant la poésie comme une musique naturelle, qu'il distingue de la musique artificielle ou instrumentale, Deschamps nous fait prendre conscience du changement qui affecte définitivement la poésie lyrique : séparée de la mélodie, elle repose entièrement sur l'art du langage.
Chez Christine de Pizan 1363-env. 1431 cet art est encore compris comme le travail de la forme strophique. La poétesse fait étalage de virtuosité en diversifiant ses figures de rimes. Cependant, elle a renoué avec la tradition purement sentimentale des chansons de toile en pleurant la mort de son mari qui l'a laissée seulete dans la dure société des hommes. Enfin, cette femme philosophe cherche à faire bénéficier ses vers de sa sapience, qui laisse prévoir, dès le début du XVe siècle, la poésie humaniste.
L'humanisme commence alors son cheminement depuis l'Italie, par Avignon. Pétrarque 1304-1374 a d'abord eu plus d'influence en France par ses écrits savants que par ses Rimes. Les nuances de sa spiritualité raffinée, chimérique, mélancolique, son platonisme même sont surtout imités par l'Espagne, notamment par Alfonso Álvarez de Villasandino et le marquis de Santillana. La France semble plus éprise d'éloquence, de raison, de philosophie morale : à la dure école de la guerre de Cent Ans, elle apprend, alors, à juger l'histoire.
Alain Chartier 1385-env. 1430, orateur et conseiller de Charles VII vers 1420-1430, l'oriente vers la rhétorique. Ceux qui l'admirent le plus, notaires et juristes de Tournai ou de Bourgogne, rédigent des arts de seconde rhétorique pour inventorier les ressources poétiques du langage. Les grands rhétoriqueurs exploiteront ces ressources avec une ingéniosité remarquable. Aboutissement logique du pur formalisme, mais aussi impasse. Alain Chartier est aussi célèbre pour avoir poussé jusqu'à l'absurde les théories de l'amour courtois en créant l'inquiétante figure de la Belle Dame sans merci : mythe de la beauté froide qui fascine la conscience coupable de ses contemporains. Enfin et surtout, Chartier élabore un style poétique qui adapte les ressources stylistiques de la grande allégorie didactique (le Roman de la Rose et l'œuvre de Dante à la brevitas du rondeau et de la ballade.
Il appartenait à un prince, à Charles, duc d'Orléans 1394-1465, d'écrire dans ce style allégorique les derniers chefs-d'œuvre de la tradition lyrique inaugurée par le duc d'Aquitaine. De son exil en Angleterre, il a rapporté un chansonnier composé un peu comme celui de Pétrarque : les ballades et les chansons qui se succèdent constituent moins l'histoire d'un amour que celle de tout amour. Après la mort de l'aimée, un poème allégorique de réflexion sur le temps justifie le renoncement à l'amour. Dans de nombreux poèmes, la métaphore, cultivée avec mesure, se développe logiquement, reprenant les images de la vie quotidienne pour figurer le monde des sentiments. Ainsi, le monde extérieur devient la représentation du monde intérieur, et l'ordre des choses naturelles ou des lois sociales permet de comprendre les mouvements de la pensée. Après son retour en France, sa poésie, où parfois se reflète une vie de cour plus joyeuse que riche, et plus raisonnable que joyeuse, se consacre à l'analyse des pensées, souvent mélancoliques, qui s'agitent en lui comme sur un théâtre imaginaire. De nombreux rimeurs de son entourage viennent tenter de l'arracher à sa solitude et reprennent à leur manière les images symboliques sur lesquelles il brode. C'est ainsi que, sur le thème Je meurs de soif auprès de la fontaine, un rimeur parisien, errant comme un jongleur, François Villon, un jour, compose une ballade. Rencontre éphémère, mais qui encourage à chercher dans les œuvres de Villon, de tour apparemment satirique, le sens profond du lyrisme, en l'occurrence la justification de sa conduite, de sa révolte, de ses fautes.
Finalement, on reste frappé, devant ce lyrisme médiéval, si riche en trouvailles artistiques et en recherches purement formelles, par l'appel qui s'y fait toujours entendre : appel de l'homme au jugement, à la justice, à la pitié, à la grâce. C'est le meilleur d'eux-mêmes que les poètes ont mis dans ces chansons, leurs aspirations les plus secrètes et les plus sublimes, bref, toute leur espérance. Daniel Poiron
Posté le : 01/05/2015 14:25
|
|
|
|
|
Daniel Defoé |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 ou 26 Avril 1731 meurt Daniel Defoe
de son vrai nom Daniel Foe, à Ropemaker’s Alley, Moorfields, cité de Londres. Né vers 1660 à Stoke Newington, Londres, aventurier, commerçant, agent politique et écrivain anglais, né en 1660 à Stoke Newington près de Londres Il est notamment connu pour être l’auteur de Robinson Crusoé et de Heurs et Malheurs de la fameuse Moll Flanders.
En bref
Après des études au séminaire de Stoke Newington, il devient mercier 1683, lutte aux côtés de Monmouth à Sedgemoor 1685 et favorise, en 1688, l'accession au trône de Guillaume III d'Orange. Armateur, il assure des navires qui coulent durant la guerre contre la France. Ruiné en 1693, auditeur au Bureau des droits 1695-1699, il devient administrateur d'une briqueterie près de Tilbury, il soutient les whigs, puis les tories. En 1697 Essai sur les projets : il élabore le premier projet d'assurances sociales.
En 1701, il prend la défense du roi étranger et proclame l'Anglais de pure race, il considère atteint de bâtardise universelle les "soi-disant Anglais".
En 1702, son traité ironique est pris à la lettre par les deux partis qui s'opposent : opposants et partisans de Jacques II d'Angleterre le poursuivent : il doit se cacher.
Arrêté, il connaît le pilori, mais la foule lui fait fête, et, tandis qu'on lui coupe les oreilles, il assiste au succès de son Hymne au pilori 1704.
Sa briqueterie ayant fait faillite durant son emprisonnement, il lance la Revue, puis le Mercator, qu'il animera jusqu'en 1713, au rythme de trois numéros par semaine. Premier journaliste moderne, il s'intéresse au commerce, à la vie des humbles. En 1706, la reine Anne le charge de négocier l'union avec l'Écosse.
Il publie l'Histoire de l'union des royaumes de Grande-Bretagne 1709, puis l'Histoire des guerres de Charles XII en 1715.
La désillusion politique le jette vers la forme la plus libre de moralisation populaire : à 60 ans, il débute dans le genre romanesque, en s'inspirant d'événements réels. Son succès, sa notoriété viendront avec " Robinson Crusoé " en 1719,
Ce roman deviendra vite un triomphe mondial, en créant le mythe du naufragé solitaire qui réinvente la civilisation sur son île. Viendront ensuite le Capitaine Singleton 1720 et Colonel Jack 1722. Dans Moll Flanders 1722, l'héroïne, seule au monde, va de mariage en mariage, de larcin en larcin, et vit le picaresque au féminin. La même année, Defoe publie, en 1722, son Journal narrant l'année terrible de la peste, une vision romancée de l'épidémie de 1664 qui tua les deux tiers de la population londonienne sans qu'un seul noble ou notable ne soit touché. "Lady Roxana, ou l'heureuse catin" en 1724 se présente comme la prétendue confession d'une jeune veuve qui passe du ruisseau au lit du roi. Malgré son repentir affiché, la froide Roxana ne pense qu'argent et pouvoir. Après ces romans, Defoe revient à son rôle de conseiller-guide, en Parfait négociant anglais entre 1725 et 1726 ; suivront ses Voyages en Grande-Bretagne, de 1724 à 1727 ; récit empreint de lubricité conjugale et de prostitution matrimoniale en 1727.
Il meurt en 1731 après quatre ans de silence.
Snobé par les grands Swift, Pope, il remporta, avec le mythe de Robinson, odyssée de l'individualisme bourgeois, une victoire que n'avaient pu lui assurer ni les affaires ni la politique. Son thème majeur reste la lutte pour la survie, au jour le jour. Le succès remplace la grâce : la vie spirituelle sera réduite chez Moll ou Robinson à la mauvaise conscience que soulagent une sorte de comptabilité intérieure et les bonnes œuvres. La moralisation dont rêve Defoe passe par la réforme des institutions de base le mariage notamment et la garantie des ressources. C'est la faim qui mène le monde, et la vanité. L'économique révoque sans les dissoudre les instances spirituelles : la morale sera le remords des faibles. Moll devient bonne dame. Robinson se retrouve colon. Defoe, par son attention passionnée au détail et le goût des bilans matériels et spirituels, invente l'aventure au quotidien.
Sa vie
Sa famille était originaire des Flandres. Son père, James, qui tenait une boutique de chandelles dans le quartier populaire de Cripplegate, était un protestant qui était à l’écart des puritains. Il confia l’éducation de son fils au révérend Charles Morton, qui dirigeait une institution privée à Newington Green, près de Londres.
Entraîné par son goût pour la politique et la littérature, il ne s’occupa guère que d’écrire. Appartenant au parti des Whigs et des Non-conformistes, il combattit dans plusieurs pamphlets virulents le gouvernement impopulaire de Jacques II d'Angleterre, et prépara de tout son pouvoir la Glorieuse Révolution de 1688. Il jouit de quelque faveur auprès de Guillaume III d’Orange, et obtient alors des emplois lucratifs. Il propose à Robert Harley, comte d’Oxford et speaker des Communes, un projet de services secrets, l’ébauche d’une police politique qui donnerait au gouvernement un état de l’opinion publique.
Mais sous le règne moins libéral de la reine Anne, il fut condamné en 1704 au pilori et à la prison pour avoir écrit contre l’intolérance de l’Église anglicane. Il publia de sa prison la Weekly Review une revue d'actualité qui eut un grand débit, entre 1704 et 1713 et finit par être éditée trois fois par semaine dès 1705.
Une fois que Defoe eut retrouvé sa liberté, Harley l'envoie dans tout le pays durant l’été 1704 sous le pseudonyme d’Alexander Goldsmith. Deux ans plus tard, le même Harley lui confie la tâche capitale de travailler à l’union de l’Écosse et de l’Angleterre. Il s’agissait de se rendre à Édimbourg pour préparer les négociations pour l’union des parlementaires anglais et écossais. Defoe, presbytérien comme beaucoup d’Écossais, devient rapidement un ami de l’Écosse et réussit dans cette mission. D’autres missions lui seront confiées par la suite en tant qu’agent secret.
Il organisera l’infiltration réussie des jacobites, les partisans des Stuarts, qui conspirent pour la restauration de cette maison. C’est lui également qui avertira en 1717 le ministre Charles Townshend de l’imminence d’une insurrection dans laquelle est impliquée la Suède. Mais des pamphlets lui ayant attiré de nouveau la disgrâce, il fut alors dégoûté de la politique et ne s’occupa plus que de littérature.
Son roman le plus célèbre, que certains disent être le premier en anglais, Robinson Crusoé 1719, raconte la survie d’un naufragé sur une île déserte. Il se serait inspiré de l’aventure d’Alexandre Selkirk, un marin écossais qui aurait débarqué sur l’île inhabitée de Más a Tierra archipel Juan Fernández où il survécut de 1704 à 1709.
Il publia dans les quinze dernières années de sa vie plusieurs ouvrages fort originaux qui obtinrent pour la plupart beaucoup de succès : l’Instituteur de famille, 1715, qui eut une vingtaine d’éditions ; la Vie et les Aventures de Robinson Crusoé, 1719 ; la Vie du capitaine Singleton ; Histoire de Duncan Campbell, — de Moll Flanders, — du colonel Jack, — de Roxane ; Mémoires d’un cavalier, 1720-1724 ; Histoire politique du Diable, 1726 ; Système de magie, 1729.
Defoe écrivit un récit sur la grande peste de 1665 à Londres, Journal de l’année de la peste 1720, Mémoire d’un cavalier, et une histoire picaresque, Moll Flanders 1722 sur la chute et la rédemption finale d’une femme seule dans l’Angleterre du XVIIe siècle. Elle apparaît comme une prostituée, bigame et voleuse, commettant l’inceste, mais parvient à garder la sympathie du lecteur. Un personnage comparable est dépeint dans Roxana, la maîtresse bienheureuse.
Ses nombreux livres sont des témoignages précieux sur le développement économique, social, démographique et culturel de l'Angleterre et l'Écosse du tournant des années 1700.
Robinson Crusoé a été traduit dans un grand nombre de langues. La première traduction française, par Thémiseul de Saint-Hyacinthe et Justus van Effen, parut dès 1720 mais une des plus fidèles traductions françaises est celle de Mme Amable Tastu en 1833. C'est cependant celle de Petrus Borel qui connaît, jusqu'à aujourd'hui, le plus grand nombre de rééditions.
On ne connait pas la cause de son décès en avril 1731.
Œuvres
Essais sur divers projets – An Essay upon Projects, 1695 ou 1697 : très en avance sur son époque, D. Defoe y prônait l’éducation « des femmes et des filles » ;
L'Anglais bien né – The True-born Englishman, 1701 : pamphlet ;
The History of the Kentish Petition, 1701 ;
La plus courte façon d'entrer en dissidence – The Shortest Way with the Dissenters, 1702 ;
L'Hymne au pilori – Hymn to the pillory, 1703 ;
Defoe fonde la Review en 1704 ;
L'Orage – The Storm, 1704 ;
Histoire de l'Union – History of the Union, 1709 ;
Robinson Crusoé – The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner (Robinson Crusoe), 1719 : le roman s'inspire de la vie d'un marin écossais, Alexandre Selkirk, abandonné à sa demande sur une île déserte (Juan Fernández) au large du Chili, en 1705 (ce qui avait alors suscité une vive indignation en Grande-Bretagne) ;
Mémoires d'un Cavalier – Memoirs of a Cavalier, 1720 ;
Captain Singleton, 1720 ;
Heurs et Malheurs de la fameuse Moll Flanders – The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders (Moll Flanders), 1722 : inspiré par un personnage historique, « Moll la coupeuse de bourse » ;
Journal de l'Année de la peste – A Journal of the Plague Year, 1722 ;
Colonel Jack, 1722 ;
Lady Roxana ou l'Heureuse Catin – The Fortunate Mistress, 1724 : histoire d'une aventurière de grand chemin ;
A Tour Through the Whole Island of Great Britain, 1724-1727 ;
Histoire générale des plus fameux pyrates – A General History of the Pyrates, 1724-1728 : un récit complet de la République de Libertalia ;
The Complete English Tradesman, 1725-1727 ;
Robinson Crusoé, éditions illustrées :
par Newell Coners Wyeth, Cosmopolitan, 1920, 14 ill. ;
par Valdemar Andersen, sans date ;
par Christophe Rouil, 1993 ;
par Pavel Zilak, Grund, 2000.
  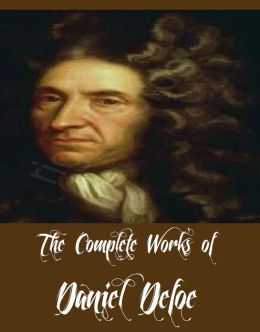 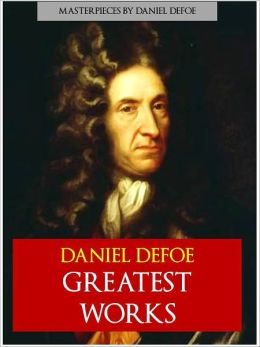 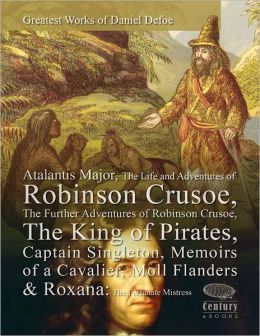  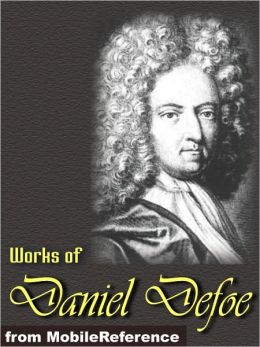 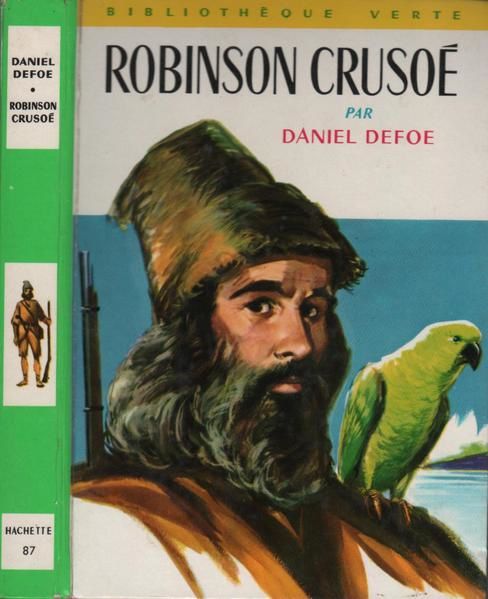    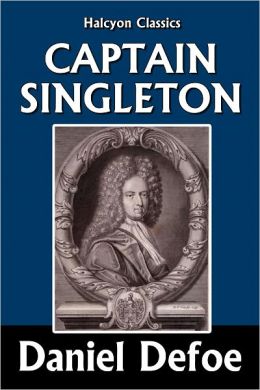
Posté le : 24/04/2015 21:41
|
|
|
|
|
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 26 avril 1711 naît Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
à Rouen, morte, à 69 ans,le 8 septembre 1780 à Chavanod, pédagogue, journaliste et écrivain française, auteur de nombreux contes comme La Belle et la Bête devenus des classiques de la littérature d’enfance et de jeunesse.
Sa vie
Une grande détermination malgré les épreuves
Fille de Jean-Baptiste Le Prince, et de Marie-Barbe Plantart, sœur du peintre Jean-Baptiste Le Prince, elle perd sa mère très jeune : son père se remarie avec Marie Anne Thérèse du Guillaud, puis Anne Gaultier, et elle passe dix ans 1725-1735 à la maison d'éducation des dames d'Ernemont et devient institutrice des petits.
Je me souviens d’une pensée qui me frappa à la mort de ma mère. Je n’avais que onze ans, et pourtant la bonne éducation que j’avais reçue me suggéra des pensées très justes. Ma mère, à trente-trois ans, avec le corps le mieux constitué, la santé la plus forte, se cassa une veine en jouant, et mourut sans maladie après avoir perdu tout son sang. Tout le monde la plaignit, excepté moi : nous touchions au moment d’une grande pauvreté et je soutins toujours que la mort de ma mère était un évènement heureux pour elle, puisqu’il l’arrachait à la douleur que lui aurait causé la dispersion de ses enfants et l’impossibilité de les établir selon leur état. Magasin des Jeunes Dames, 1764.
Elle renonce à la vie religieuse et obtient une recommandation pour la cour de Lorraine à Lunéville. Elle devient dame de compagnie, enseigne la musique, fait la classe aux petits. En 1743, elle épouse Antoine Grimard, marquis de Beaumont, capitaine des gardes, mais ce mariage n'est pas heureux, et son mari dilapide sa dot.
L’aumônier du roi Stanislas a lui-même des doutes sur la viabilité du mariage de Marie Jeanne : Nous avons béni dans la chapelle du palais en présence de trois bons amis du futur, le mariage d’un très jeune capitaine aux gardes, Grimard de Beaumont, avec la chanteuse de la musique du Roi, de la famille des Leprince de Rouen. Cette personne, de bon renom, a reçu de la Régente, princesse de Commercy, une somme considérable. Le jeune mari a-t-il des dettes, est-il intéressé ? Ce serait dommage pour cette personne, plus âgée que lui, mais de bonne bourgeoisie et de bonne mœurs. Lettre du deuxième aumônier du roi Stanislas à son neveu, étudiant à l’université de Pont-A-Mousson, dans le courant de l’été 1743, in M.-A. Reynaud, Mme Leprince de Beaumont.
Deuxième lettre de l’aumônier à son neveu étudiant à Pont-à-Mousson, été 1744: Hélas mes craintes se sont réalisées. Avec la dot de son épouse, le jeune marquis a d’abord éteint quelques dettes personnelles, puis s’est rendu acquéreur d’un hôtel dans la ville, s’y est installé sur un grand pied ; il y a reçu des amis de régiment de passage, des gens douteux. Deux Anglais ont ravi sa confiance, un soi-disant Montagu et un Digby que la police française surveillait, paraît-il. Ils jouaient tous un jeu effréné et les Anglais ont fini par s’enfuir en emmenant avec eux une femme de la société, amie du jeune ménage. M.-A. Reynaud, Mme Leprince de Beaumont, 1711-1780,
Après deux ans de mariage avec le marquis de Beaumont, et la naissance de sa fille Elisabeth, elle obtint l’annulation de son union en invoquant une maladie transmissible à sa postérité chez son mari. Cette maladie que vaut à son mari sa vie dissolue permet à la marquise de Beaumont de demander l’annulation de son mariage, mais elle conservera le nom de son mari.
Selon le témoignage de Marie Jeanne elle-même, en septembre 1745 : Monsieur de Beaumont, mon mari, serait paraît-il mort en duel, du fait d’une de ses victimes au jeu. On l’a trouvé agonisant dans une rue de Saint-Dié. Il n’a pas révélé le nom de celui qui l’avait frappé. Ses poches renfermaient des lettres que l’on m’a apportées et la liste exacte de ses créanciers. L’une d’entre elle m’était adressée. Il y fait amende honorable envers son beau-père et sa belle-mère : je mourrai à la société que j’ai scandalisée, dit-il je me rendrai à la Trappe. Consentez à mon sacrifice, joignez-y le vôtre. Le porteur m’a assuré que le père de Menoux, confesseur du roi, l’avait vu et entendu récemment. Le sort n’a sans doute pas voulu accepter son sacrifice de la façon dont il l’avait envisagée. Quant à moi, je dois gagner ma vie. Celle de mon enfant reste assurée par le reste de la dotation qui m’avait été faite. Lorsque mes ressources personnelles seront épuisées, je quitterai Nancy. Lettre d'Emerance à Lucie, L.de B., in M.-A. Reynaud, Mme Leprince de Beaumont, 1711-1780, p. 137.
En 1748, voulant démontrer la justesse du christianisme, elle publie à Nancy son premier roman, Le Triomphe de la vérité, qu’elle remet au beau-père de Louis XV, roi de Pologne et duc viager de Lorraine et de Bar, Stanislas Leszczyński, lors d’un séjour à la cour de Lunéville. Mais le roi ne la récompense pas.
Dépôt de ses derniers descendants, mariage de sa descendante avec le peintre Allongé. Dernier lien familial Marc Leprince-Allongé de Giers.
Gouvernante modèle à Londres
N’ayant pu obtenir de poste de gouvernante ou de charges à la cour de Lunéville, elle décide de quitter la France. C’est sur les conseils de Madame de Saint-Joire qu’elle décide de se rendre à Londres pour continuer son activité de gouvernante à l’usage des jeunes aristocrates anglaises, dont l’éducation était alors fort négligée on compte alors de nombreuses gouvernantes françaises dans la capitale anglaise. Ses qualités d’éducatrice expérimentée et ses dons de femme du monde ne pourraient manquer de lui ouvrir des portes. La connaissance approfondie de la langue était inutile dans une société qui tout entière entendait le français et le parlait. Elle confie sa fille Elisabeth à un pensionnat de religieuse et part pour Londres. Grâce à quelques relations dans les milieux jacobites, elle-même est profondément catholique dans un pays protestant, elle devient la gouvernante de la fille de John Carteret, Lord Grandville, ancien premier ministre, Sophie Carteret, âgée de quatre ans, qui sera l’enfant de son cœur. Sophie est orpheline de mère comme ses sept sœurs, depuis la mort de leur mère en 1743. Sophie avait épuisé plusieurs gouvernantes et Marie-Jeanne réussit là où tant d’autres avaient échoué. Elle se montre à la fois ferme lorsque l’enfant fait des caprices mais sait aussi lui pardonner en lui racontant un conte M.A. Reynaud, Madame le Prince de Beaumont, collection Publibook, 2002.
Femme écrivain, entre Rousseau et la comtesse de Ségur
À Londres, Marie-Jeanne Leprince de Beaumont écrivit - avec le soutien de Daniel Defoe, féministe, qui voyait dans l'absence d'éducation la seule cause des différences entre les sexes - des œuvres éducatives dont la philosophie annonce déjà Jean-Jacques Rousseau. Sa devise étant : Plaire à la jeunesse en l'instruisant, elle est considérée comme le premier écrivain à avoir volontairement adopté un style simple, réellement adapté aux jeunes lecteurs. Avant tout moraliste, elle donne, sous forme dialoguée, un traité complet d’éducation pour jeunes filles dans des ouvrages auxquels elle donne le titre de Magasins. Elle publie ainsi les Magasins des enfants, des adolescents et des pauvres, à Londres. Bien qu’elle exprime sa méfiance envers les contes qu’elle juge pernicieux pour les enfants, le Magasin des enfants comporte des contes destinés à charmer ses lecteurs. C’est dans l'édition de 1757, que figure un conte, abrégé de la première version écrite par une autre romancière, Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, qui lui apportera la renommée : La Belle et la Bête. C'est surtout grâce aux contes que Madame Leprince de Beaumont est passée à la postérité.
Mme Leprince Beaumont est l’éducatrice des filles de la haute société. Ce sont des années fructueuses où elle assure sa réputation et écrit des œuvres pédagogiques qui invitent avant tout à se corriger. Elle épouse un Français, Pichon, qui, devenu Anglais, avait pris le nom de Tyrrell. Finalement, elle reprend son enseignement. Après quinze années, elle rentre seule en France, achète une petite terre près d’Annecy 1763-1769. Là, elle continuera d’écrire, rédigeant nombre d’ouvrages religieux et moraux comptant environ soixante-dix volumes, ce qui, à son époque, constitue un exploit pour une femme écrivain. Elle se fixe ensuite à Avallon en 1770 et meurt vraisemblablement à Saint-Denis en 1780, près de sa fille Elisabeth et de ses six petits-enfants.
Le Magasin des enfants Londres 1757, abondante collection de contes de fées dont La Belle et la Bête est le plus connu, offre un panorama de l’histoire du monde, des leçons de géographie et de sciences naturelles.
Le Magasin des Adolescentes Londres, 1760, qui lui fait suite, mais sans féerie, contient d’autres contes, des récits de la Bible et de l’histoire romaine et des conseils moraux : les années les plus dangereuses commencent à quatorze et quinze ans ; il faut donc des mères et des gouvernantes instruites ; la réputation d’une femme ne souffre pas d’ambiguïté : Il ne suffit pas, ma chère, qu’une femme soit sage, il faut encore qu’elle le paraisse..
L’importance de bonnes lectures est illustrée dans une Instruction pour les jeunes dames qui entrent dans le monde, se marient… 1764 où le conte d’Henriette et de sa gouvernante met en scène deux femmes que perdent de mauvais romans.
Les Mémoires de la baronne de Batteville ou la Veuve parfaite 1766 racontent l’histoire d’une femme qui, croyant mort des Essarts, son fiancé, épouse un homme bon, bien plus âgé ; mais le fiancé, personnage héroïque qui avait survécu à la peste de Marseille, réapparaît. Devenue veuve, la baronne reste « fidèle aux cendres de M. de Batteville » et c’est sa fille qui épouse des Essarts.
L’héroïne de La Nouvelle Clarice 1767 trouve le bonheur après maintes aventures et malgré un père dénaturé. C’est un livre rempli de conseils de morale, de régime, d’organisation du travail.
En 1756, Madame Leprince de Beaumont avait écrit un roman épistolaire : Lettres de Madame du Montiers et de la marquise de *** sa fille*, rempli de rebondissements, de réflexions sur le mariage, des intrigues sur la cour de Savoie, où honneurs et disgrâces se succèdent. L’imagination de la romancière s’ajoute ici à beaucoup de pénétration psychologique.
Parmi ses dernières œuvres, le Magasin des Pauvres et gens de la campagne (1768), plaidoyer pour le retour à la terre, et le Magasin des dévotes 1778-1779. Mme Leprince de Beaumont a écrit plus de soixante-dix ouvrages dont la plupart ont été traduits et souvent réédités. Éducatrice dans l’âme, elle est de la lignée de ces auteurs féminins qui vont de Mme de Genlis à la comtesse de Ségur, et allient les connaissances aux principes d’une morale didactique
La Belle et la Bête.
Ce conte est un résumé tiré de la lecture d’un recueil de Mme de Villeneuve intitulé La Jeune Américaine et les contes marins 1740. Ci-dessous une analyse du conte de Mme Leprince de Beaumont par M.-A. Raynaud 1971 :
" Ce conte apprend aux enfants à distinguer la laideur morale de la laideur physique, à favoriser le rayonnement d’une intelligence, d’un cœur, d’une âme que rend timide un extérieur ingrat. ... Les deux sœurs de la Belle ont épousé deux gentilshommes dont l’un symbolise la beauté et l’autre l’intelligence ; ce n’est pas là le vrai fondement d’un amour solide, mais la bonté. Ainsi la Belle ne peut se défendre d’aimer la Bête à cause des attentions inlassables dont celle-ci l’entoure. Le don de soi est justifié par l’estime des bonnes qualités de la personne à laquelle on veut unir sa vie ; ainsi les jeunes filles apprennent l’usage du véritable amour. La Belle, voyant à quelle extrémité elle réduit par ses refus la pauvre Bête, passe sous l’impulsion de la compassion unie à l’estime, de l’amitié à l’amour. Des sentiments purs, estime, délicatesse, élégance morale, reconnaissance en sont les motifs. On trouve ici la justification des mariages fréquents à cette époque, entre hommes mûrs, souvent veufs, et filles très jeunes. Il ne restait à ces maris âgés qu’à entourer leur jeune épouse de tous les égards, et aux jeunes femmes à respecter la situation mondaine et la valeur des quadragénaires. "
— Marie-Antoinette Reynaud, Madame Leprince de Beaumont, vie et œuvre d'une éducatrice.
Œuvres
Le Triomphe de la vérité, et Mémoires de M. de La Villette, 1748 ;
Lettre en réponse à l’Année merveilleuse, 1748 ;
Le Nouveau Magasin françois, et Bibliothèque instructive et amusante, 1750-51 ;
Lettres de Mme Du Montier à la marquise de ***, sa fille, avec les réponses, où l’on trouve les leçons les plus épurées et les conseils les plus délicats... pour servir de règle dans l’état du mariage, 1756 ;
La Belle et La Bête, 1765
Magasin des adolescentes, et Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves de la première distinction, 1760 ;
Principes de l’histoire sainte, mis par demandes et par réponses, pour l’instruction de la jeunesse, 1761 ;
Instructions pour les jeunes dames qui entrent dans le monde et se marient, leurs devoirs dans cet état et envers leurs enfans, 1764 ;
Lettres d’Emerance à Lucie, 1765 ;
Mémoires de Madame la Baronne de Batteville, et la Veuve parfaite, 1766 ;
La Nouvelle Clarice, histoire véritable, 1767 ; roman épistolaire d’après le roman de Samuel Richardson, Clarisse Harlowe, 1748 ;,
Magasin des enfants, et Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves de la première distinction, dans lesquels on fait penser, parler, agir les jeunes gens suivant le génie, le tempérament et les inclinations d’un chacun... on y donne un abrégé de l’histoire sacrée, de la fable, de la géographie, etc., le tout rempli de réflexions utiles et de contes moraux, 1756-Londres ;
Magasin des pauvres, artisans, domestiques et gens de campagne, 1768 ;
Les Américaines, et la Preuve de la religion chrétienne par les lumières naturelles, 1770 ;
Éducation complète, et Abrégé de l’histoire universelle, mêlé de géographie et de chronologie, 1772 ;
Contes moraux, 1774 ;
La Dévotion éclairée, et magasin des dévotes, 1779.
La veuve et ses deux filles, Date inconnue
La belle et la bête film de Jean Cocteau
En 1930, Jean Cocteau 1889-1963, écrivain, poète, dramaturge, peintre, dessinateur, réalise Le Sang d'un poète. Aussitôt assimilé aux films surréalistes de Buñuel et de Dalí (Un chien andalou, 1929, L'Âge d'or, 1930, ce film sera vu dans le monde entier ; aux États-Unis, il influencera toute une génération de cinéastes indépendants, et Maya Deren ou Kenneth Anger s'en inspireront. Quinze ans plus tard, après avoir fait ses classes en participant notamment, en 1943, à la réalisation de deux films qu'il avait écrits, Le Baron fantôme Serge de Poligny et L'Éternel Retour Jean Delannoy, Cocteau dirige un long-métrage de fiction, d'un genre tout différent, qui inaugure une série de films singuliers, inclassables dans une école ou un style, mais qui, eux aussi, exerceront une grande fascination sur de jeunes cinéastes, en particulier ceux qui, tels Jacques Rivette et Jean-Luc Godard, furent d'abord critiques.
Un conte de terreur et de séduction
L'histoire se passe quelque part en France, à l'âge classique. Un veuf d'âge mûr a trois filles et un fils ; la plus jeune des filles, Belle, est traitée par ses deux sœurs comme une servante ; Avenant, l'ami de son frère, qui est amoureux d'elle, est un chenapan. Au retour d'un voyage d'affaires, le père s'égare et pénètre dans un château enchanté ; le maître des lieux, une bête effrayante, lui enjoint, s'il veut sauver sa vie, de lui envoyer sa plus jeune fille. Belle se rend au château, où la Bête lui offre le mariage. Au bout de quelque temps, la jeune fille obtient la permission de retourner voir son père, malade. Son frère et Avenant décident de partir tuer le monstre, mais tandis qu'ils sont en route, la Belle aperçoit dans un miroir magique la Bête en proie à une vive souffrance. Elle retourne au château, où elle la trouve agonisante mais encore en vie. Au même moment, Avenant, qui pénètre par effraction dans un pavillon du parc, est tué d'une flèche par une statue de Diane ; aussitôt, la Bête se transforme en prince – qui a exactement le visage d'Avenant. Il épousera la Belle et l'emmènera dans son royaume.
Du merveilleux au merveilleux : éloge du classicisme
Le film est adapté d'un conte de Jeanne Marie Leprince de Beaumont recueil Le Magasin des enfants, 1757 qui fut souvent publié à la suite de Peau d'âne, et que Cocteau choisit, au lendemain de la guerre, pour son caractère éminemment français. Son art aura été de rester fidèle à cette histoire, dont il conserve la trame d'ensemble et les qualités, morales et symboliques, des personnages, tout en apportant à une fable abstraite ce qui pouvait la faire exister : une chair. Le décor de Christian Bérard, inspiré de la peinture hollandaise, est entièrement crédible, et Cocteau et lui imaginèrent mille détails charmants, surtout dans le palais de la Bête, où les manifestations du merveilleux sont incessantes et toujours surprenantes. Quant aux personnages, ils sont d'un vraisemblable très contemporain, notamment par leur psychologie toute moderne.
Pour adapter un conte merveilleux, la solution la plus évidente, celle qu'adoptera la firme Disney en 1991 semble être de déréaliser l'ensemble. Cocteau s'en garde bien, et son souci du détail – significatif, gracieux ou touchant, mais toujours réaliste, même dans l'irréel – vise à affirmer implicitement que le cinéma, pour être authentiquement merveilleux, ne doit surtout pas abandonner ses prétentions au rendu réaliste du monde. Le monde de ce film est féerique, mais Cocteau refuse tout trucage de laboratoire et ne s'autorise que ceux qu'on peut réaliser au tournage ralenti, tournage à l'envers – parce qu'ils n'attentent pas à la nature de la prise de vues – et bien sûr, ceux qui résultent du montage. C'est donc aussi un bel exemple de ce que le cinéaste Lev Koulechov avait appelé dans les années 1920 la géographie créatrice : on passe du manoir de Rochecorbon, dans la vallée de la Loire, au parc de Raray près de Senlis... et au studio.
Depuis son poème surréalisant Le Sang d'un poète, Cocteau a considérablement changé sa conception du cinéma ; avec La Belle et la Bête, il revient à une forme classique, où la poésie surgit de l'excès même de limpidité et de simplicité. L'héritage de ce second Cocteau est aussi important que celui du Sang d'un poète. Sa conception du cinéma, qu'il exposa souvent, repose sur ce postulat central : La poésie doit venir on ne sait d'où, et non de l'intention de faire de la poésie Entretiens sur le cinématographe, 1951. Il faut fuir comme la peste toute velléité d'atteindre la poésie par une image trop travaillée ; l'image doit nous plaire par sa grâce, sa justesse, et par un je-ne-sais-quoi qui interdit tout expressionnisme. De cette leçon, un cinéaste comme Jacques Demy se souviendra toujours, mais on retrouve quelque chose de l'esprit de Cocteau chez bien d'autres cinéastes français, de Robert Bresson à Leos Carax. Jacques Aumont
   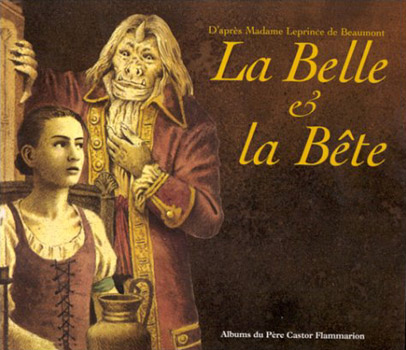 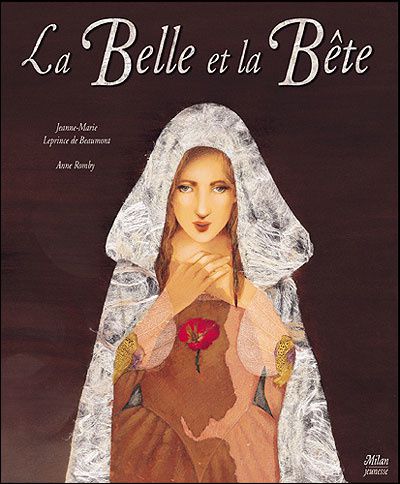 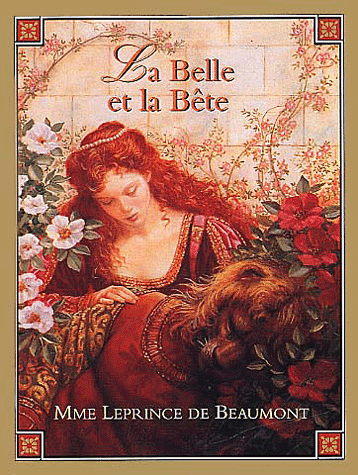   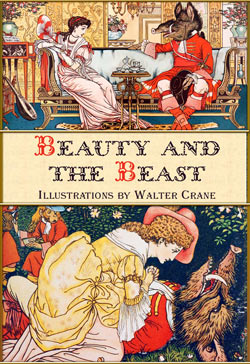  
Posté le : 24/04/2015 21:10
|
|
|
|
|
William Shakespeare 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 19 ou 23 avril 1564 meurt William Shakespeare
à 52 ans, à Stratford-upon-Avon, mort le 23 avril 1616 dans la même ville, est considéré comme l'un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la culture anglaise dans le théâtre élisabéthain. Il est réputé pour sa maîtrise des formes poétiques et littéraires, ainsi que sa capacité à représenter les aspects de la nature humaine.Il écrit comédie, tragédie, poésie, ses oeuvres principales sont : Roméo et Juliette,
Hamlet, Macbeth, Othello, Le Roi Lear, Antoine et Cléopâtre, Henri V, Jules César, Le Songe d'une nuit d'été, Beaucoup de bruit pour rien, Le Marchand de Venise, La Nuit des rois, La Tempête, Comme il vous plaira, Richard III
Figure éminente de la culture occidentale, Shakespeare continue d’influencer les artistes d’aujourd’hui. Il est traduit dans un grand nombre de langues et, selon l'Index Translationum, avec un total de 4 281 traductions, il vient au troisième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie et Jules Verne. Ses pièces sont régulièrement jouées partout dans le monde. Shakespeare est l’un des rares dramaturges à avoir pratiqué aussi bien la comédie que la tragédie.
Shakespeare écrivit trente-sept œuvres dramatiques, entre les années 1580 et 1613. Mais la chronologie exacte de ses pièces est encore discutée. Cependant, le volume de ses créations n'apparaît pas comme exceptionnel en regard de critères de l’époque.
On mesure l’influence de Shakespeare sur la culture anglo-saxonne en observant les nombreuses références qui lui sont faites, que ce soit à travers des citations, des titres d’œuvres ou les innombrables adaptations de ses œuvres. L'anglais est d'ailleurs souvent surnommé la langue de Shakespeare tant cet auteur a marqué la langue de son pays en inventant de nombreux termes et expressions. Certaines citations d'ailleurs sont passées telles quelles dans le langage courant.
En bref
Au sortir du chaos sanglant de la guerre des Deux-Roses, la dynastie des Tudor avait apporté à l'Angleterre la paix et la sécurité. La question religieuse, réglée par un compromis, était devenue secondaire. Un pasteur, qui fut l'un des premiers à écrire un mémoire biographique sur Shakespeare, conclut tranquillement : Il mourut papiste ; en rejetant l'autorité du pape, Henri VIII avait conquis pour le pays l'esprit de libre expérience comme celui de libre entreprise, liés à une infrastructure soudain très progressiste. La démarche souple et agile de l'âge nouveau se trouve dans les petits romans de Thomas Deloney proclamant la gloire modeste et efficace des patrons du textile aussi bien que dans les écrits de Francis Bacon préparant la science moderne par l'esprit d'expérience et d'induction. Autant que la manufacture progressait l'agriculture, en bonne partie grâce aux « clôtures »qui élargissaient le domaine privé aux dépens des communaux et commençaient l'éviction de la paysannerie. Shakespeare était des propriétaires fonciers qui eurent leur part de cette bonne affaire. Comme les bourgeois romains du temps de Menenius Agrippa et de Coriolan, il ne craignit pas, en temps de disette, de réserver des grains pour les vendre plus cher. Il fut, avec conviction, de son temps : celui d'une grande reine, savante, pragmatique, courageuse, énergique et prudente, dont la personnalité complexe domina son époque depuis son avènement, en 1558, jusqu'à sa mort, en 1603. Élisabeth Ire fut pour tout son peuple une idole, un mythe vivant, une Diane chrétienne, la Reine Vierge. Ses sautes d'humeur, ses fureurs l'humanisent, et Strindberg pense qu'elles sont passées dans la Cléopâtre de Shakespeare, dont elle est autrement l'opposé. L'âge l'assombrira : la Fortune n'a que des sourires contraints pour les vieilles coquettes, et son dernier favori, Essex, jeune étourdi intrépide, arrogant et fantasque, dont il semble que Shakespeare se soit souvenu pour camper la figure glorieuse et absurde de Hotspur en face d'Henri IV, et peut-être celle de Coriolan, n'était pas un bon choix. Dépité du mauvais succès de ses imprudentes entreprises, Essex finit par déclencher dans Londres une insurrection dont l'échec fut quasi ridicule, et la reine se résigna à le laisser condamner et décapiter, Bacon, qui n'est pas Shakespeare, fut son impitoyable accusateur. L'époque fut pour l'Angleterre un grand siècle, marqué par les débuts de l'expansion impérialiste, les découvertes et le premier pillage du monde. La dernière grande pièce de Shakespeare, la Tempête, pose sous forme de féerie le problème colonial.
Légende et biographie
Il serait passionnant de tracer la courbe de la réputation de Shakespeare, car aucune œuvre, la Bible mise à part, n'a suscité autant de commentaires, sollicité autant de chercheurs, donné lieu à autant de controverses. Mais le consensus sur la grandeur et la profondeur de l'œuvre est universel. Depuis le Folio qui a révélé cette œuvre au monde, sa gloire n'a cessé de grandir, si bien établie qu'elle fût déjà auprès de ses propres contemporains.
Certes, chaque pays, chaque époque s'est offert un Shakespeare bien à soi. Le XVIIIe siècle commence l'établissement du texte, l'amende et l'édulcore par endroits, l'adapte parfois à son goût, récrit ses pièces en les dépouillant de ses rugosités. En France, Voltaire le jalouse, l'insulte, mais l'imite, du moins le croit-il. Le Tourneur l'enrobe dans la phraséologie de l'époque avec des précautions infinies. Nos romantiques l'adoptent et proclament la révolution en son nom. C'est à la suite des représentations d'Othello par une troupe anglaise à Paris que Stendhal écrit son Racine et Shakespeare et s'écrie : « Il nous faut désormais un théâtre à nous. » Victor Hugo l'idolâtre et le mythifie. Il force son fils François à entreprendre la traduction de ses œuvres complètes pour laquelle il écrira son essai tonitruant. Depuis, Shakespeare fait partie de la conscience française au même titre que nos propres dramaturges. Il est le classique avec lequel on peut prendre toutes les libertés. On le traduit, on l'adapte, on le joue de toutes les façons. Il s'est emparé de nos scènes, il hante nos festivals, il est quasi devenu un des nôtres. Qui n'a pas son Shakespeare passe pour un illettré.
Et pourtant, c'est à peine si après les efforts démesurés des critiques anglo-saxons, auxquels nous commençons à prêter l'oreille, Shakespeare se met à émerger du brouillard des passions contemporaines sous des traits qu'on voudrait être les siens. Il ne suffit pas de faire de Shakespeare un précurseur de Kafka, un zélateur du gauchisme avant la lettre, ni un sociologue structuraliste. Gesticulation et vocifération ne suffisent pas non plus à lui donner sa vraie figure. Entre Brecht et la Comédie-Française, même sous la direction d'un metteur en scène anglais, il y a la place pour une relecture attentive et des réflexions avisées.
On en sait autant, et même plus, sur la vie de William Shakespeare que sur celle de la plupart de ses contemporains. Mais sa réputation a nourri encore plus de légendes et de mythes que l'historien n'a de faits authentiques sur lesquels se fonder.
Il naquit à Stratford-sur-Avon, aimable bourg du comté de Warwick, en 1564, et si l'on en croit la tradition, un 23 avril. C'est aussi un 23 avril qu'il mourut à Stratford même, où il s'était retiré quatre ans plus tôt. Ainsi fut bouclée la vie exemplaire d'un homme dont le génie réserva ses éclats au monde imaginaire qu'il peupla de ses créatures.
Son père, John Shakespeare, de paysan se fit gantier. Il épousa Mary Arden, de vieille souche bourgeoise, qui lui apporta du bien. Le voici citoyen respectable et respecté, propriétaire de la célèbre maison, dénommée the Birthplace, où William vit le jour. Il devint membre de la corporation municipale, alderman (échevin), et même juge de paix. Il alla jusqu'à solliciter des armoiries, que William lui fit obtenir en 1596, avec la devise Non sanz droict. Bref, ce fut un gentleman, qu'on suppose être resté dans la foi catholique.
William fut mis à la grammar-school de Stratford, où l'on enseignait le latin. On ne sait le temps qu'il y passa. Amoureux précoce, il épousa à dix-huit ans, en novembre 1582, Anne Hathaway, de huit ans plus âgée que lui, qui lui donna une fille, Suzanne, le 26 mai de l'année suivante. Puis vinrent deux jumeaux, le 2 février 1585, Judith et Hamnet. Ce fils unique mourut à l'âge de onze ans. Suzanne épousa le docteur John Hall en 1607 et mourut en 1649. Judith épousa Thomas Quiney, et disparut en 1662. Shakespeare aimait bien ses filles. Il leur donna la place d'honneur dans son testament, au détriment, dit-on volontiers, de sa femme, qui ne reçut que son deuxième meilleur lit – mais on oublie que le droit coutumier de l'époque attribuait à la veuve un tiers du revenu de la succession. Ligne directe ou collatérale, la famille Shakespeare s'éteignit avec Judith Quiney. Reste l'œuvre.
En 1592, le dramaturge Robert Greene se mit en fureur contre celui qu'il traita de Shake-scene, de Johannes fac totum, de corbeau parvenu, paré de plumes empruntées, dans son furieux pamphlet Un liard de malice Groats of Wit. On avait perdu la trace de Shakespeare depuis 1585, où il avait quitté Stratford et femme pour sa traversée du désert. S'évada-t-il avec une troupe d'acteurs itinérants ? Fut-il instituteur dans quelque village ? Dut-il fuir la colère de sir Thomas Lucy dont il aurait braconné les daims ? On ne sait. Mais lorsque Greene l'invective, il est à Londres, et déjà connu.
Acteur, ravaudeur de pièces, auteur lui-même, s'il a d'abord tenu les chevaux par la bride à la porte du théâtre, il règne au Globe, dont il est, avec les Burbage et d'autres comédiens, fondateur, sociétaire et fournisseur, membre de la troupe de lord Strange Henry Stanley, quatrième comte de Derby, puis de celle de lord Hunsdon, le lord chambellan ; enfin, après la mort d'Élisabeth 1603, de la troupe du roi King's Men. Ils sont à la fois le plus beau théâtre et la meilleure compagnie de Londres, qui fourmille d'entreprises de théâtre à cette époque. Ils rivalisent avec éclat avec la troupe de l'Amiral, dont Edward Alleyn fut la grande vedette, et ouvrent un second théâtre privé celui-là, le Blackfriars 1608, où furent jouées les dernières pièces. La vie de Shakespeare épouse alors étroitement la courbe de ses activités dramatiques, que biographes et critiques sollicitent de mille et cent façons.
Sagement, Shakespeare n'avait jamais, malgré ses incartades obscures, perdu le contact avec Stratford. En 1597, déjà nanti, il y avait acheté une belle maison, New Place. Il y installe sa famille, et des réserves de grain. Il achète d'autres biens, prend des intérêts dans la perception des dîmes tithes de la paroisse, s'intéresse aux fonds routiers : il veut être un stratfordien à part entière.
Et puis, après vingt ans de carrière théâtrale, il fait sa sortie, comme Prospero. Il jette sa plume magique, reprend le chemin de Stratford en 1612, réintègre son petit duché, fait son testament, et y rend l'âme quatre ans plus tard. On l'enterre avec les honneurs dans l'église de la Sainte Trinité. Quelques années plus tard, on lui élève un monument, avec effigie et inscription. Le dernier vers du quatrain de la pierre tombale maudit l'imprudent qui dérangerait ses os – Curst be he yt moves my bones. Les bonnes âmes disent qu'il n'est pas l'auteur de cette malédiction. Pourtant, Hamlet comme Macbeth n'ont-ils pas la nostalgie d'un sommeil que rien ne troublerait ?
Sa vie
La communauté scientifique s’accorde à reconnaitre qu’il existe désormais suffisamment de traces historiques pour définir globalement la vie de Shakespeare. Ces preuves sont constituées de documents officiels mais elles donnent un aperçu limité de la vie du dramaturge. La vie de Shakespeare a nourri de nombreuses légendes et de mythes. Même si certains chercheurs ont tenté de distinguer dans ses œuvres des reflets de sa vie intime, il est généralement admis que l'on ne connaît du personnage que des détails insignifiants. Cela n'est d'ailleurs pas particulier à Shakespeare, mais se retrouve chez beaucoup de ses contemporains, y compris de très célèbres comme Thomas Kyd ou John Webster.
Une minorité a prétendu que Shakespeare n'avait jamais existé, voir la question de l'identité de Shakespeare. Cependant, en se rendant à Holy Trinity Church dans la ville de Stratford Upon Avon, il est possible de voir sa tombe et de lire une copie du registre paroissial où figurent sa date de baptême et sa date d'enterrement. Une autre minorité prétend que le véritable auteur utilisa un nom d'emprunt pour signer ses livres en se faisant appeler Shakespeare. Exemple de théorie révisionniste, la théorie baconienne selon laquelle les textes du célèbre dramaturge auraient été écrits par Lord Bacon of Verulam. Mais il est vrai aussi que Shakespeare n'inventait pas le thème de ses pièces, qu'il empruntait à des ouvrages existant déjà dans le fonds traditionnel comme c'était la coutume à l'époque où l'on ne parlait pas de plagiat mais de tradition. On retrouve la trace de son inspiration dans des légendes ou des textes anciens.
Premières années
Devise des Shakespeare, étymologie secoue-lance et leur blason d'or à la bande de sable chargée d'une lance de tournoi, heaume avec lambrequins surmonté d'un cimier avec un tortil portant un faucon tenant de sa patte dextre une lance de tournoi en pal.
William Shakespeare naît à Stratford-upon-Avon dans le Warwickshire, dans le centre de l'Angleterre. Son acte de baptême est daté du 26 avril 1564 : on baptisait les nourrissons dans les jours qui suivaient leur naissance, et l’on s’accorde à citer le 23 avril comme la date de naissance du dramaturge. Il est le troisième enfant de la famille et l'aîné des garçons.
Son père, John Shakespeare, fils de paysan, est un gantier et marchand d'articles de maroquinerie, négociant de peaux et de laine prospère, tirant également profit de la spéculation foncière, propriétaire de la maison aujourd'hui dénommée the Birthplace. C'est un notable de la ville de Stratford : en 1568, il y est élu conseiller municipal, puis grand bailli ou maire en 1568. En 1557, il épouse Mary Arden, fille de l'aristocrate Robert Arden of Wilmcote, et le nouveau couple emménage dans une maison située sur Henley Street. La réussite de John Shakespeare le pousse à solliciter des armoiries, que William lui fait obtenir en 1596, avec la devise Non sanz droict Pas sans droit. On suppose que le père du dramaturge est resté dans la foi catholique.
Le milieu confortable dans lequel naît Shakespeare le conduit vraisemblablement à fréquenter, après le niveau élémentaire, l’école secondaire King Edward VI au centre de Stratford, où l’enseignement comprend un apprentissage intensif de la langue et la littérature latine, ainsi que de l’histoire, de la logique et de la rhétorique. Selon son contemporain et rival, Ben Jonson, il connaît pourtant peu le latin et encore moins le grec. En 1577, le jeune garçon est retiré de l'école, vraisemblablement pour gagner sa vie ou pour aider son père qui est dans une mauvaise passe
Le 28 novembre 1582, à Temple Grafton près de Stratford, Shakespeare, qui a alors 18 ans, épouse Anne Hathaway, fille d'un fermier de Shottery, de sept ou huit ans son aînée. Deux voisins de la mariée, Fulk Sandalls et John Richardson, publient les bans du mariage, pour signifier que l’union ne rencontre pas d’opposition. Il est vraisemblable que la cérémonie a été organisée en hâte, Anne étant probablement déjà enceinte, puisqu'elle donne naissance l'année suivante à leur première fille, Susanna, baptisée le 26 mai, soit moins de six mois plus tard.
Après son mariage, Shakespeare ne laisse que de rares traces dans les registres historiques. Le 2 février 1585, près de deux ans après le baptême de Susanna, des jumeaux, Hamnet et Judith, sont baptisés avec les prénoms de Hamnet Sadler, jeune boulanger de Stratford, et de sa femme Judith. Ceux-ci donneront en 1598 le prénom de William à l'un de leurs quatorze enfants, montrant que le lien de Shakespeare avec Stratford n'est pas rompu pendant ces années. Hamnet Sadler sera en 1616 un des témoins du testament de Shakespeare, dans lequel il sera cité.
Hamnet, l'unique fils de William, meurt à 11 ans et est inhumé le 11 août 15968. Beaucoup suggèrent que ce décès inspire au dramaturge sa tragédie Hamlet vers 1601.
La suite des années 1580 est connue comme l’époque des années perdues de la vie du dramaturge : entre 1585 et 1592, nous n’avons aucune trace de lui, et nous ne pouvons expliquer pourquoi il quitte Stratford pour Londres. Une légende, aujourd’hui tombée en discrédit, raconte qu’il avait été pris en train de braconner dans le parc de Sir Thomas Lucy, un juge de paix local, et qu'il s’était enfui pour échapper aux poursuites. Une autre théorie suggère qu’il aurait rejoint la troupe du Lord Chambellan, alors que les comédiens faisaient de Stratford une étape de leur tournée. Le biographe du XVIIe siècle, John Aubrey, rapporte le témoignage d’un comédien de la troupe de Shakespeare, racontant qu’il aurait passé quelques années en tant qu’instituteur dans le comté du Lancashire, recruté par Alexander Hoghton, propriétaire terrien catholique, reprenant une thèse selon laquelle Shakespeare aurait été de confession catholique. Sans plus de preuves historiques, d'autres légendes rapportent qu'il aurait été apprenti-boucher, homme de loi, médecin, soldat ou marin, en fonction uniquement des connaissances révélées dans ses œuvres.
Londres et le théâtre
On perd la trace de Shakespeare en 1585 : il quitte Stratford, il quitte sa femme, pour une traversée du désert. Une légende, aujourd'hui discréditée, veut qu'il réapparaisse à Londres en 1587 comme valet d'écurie, gardant les chevaux devant un théâtre. La seule preuve indiscutable de sa présence à Londres dans le milieu théâtral est, en 1592, la violente attaque de la part de Robert Greene, qui vient de mourir. Dans une lettre posthume ajoutée à son ouvrage intitulé A Groatsworth of wit bought with a million repentance et publié par Henry Chettle, Greene s'en prend à plusieurs dramaturges. Il accuse Marlowe de blasphème, et désigne Shakespeare comme un corbeau arrogant, embelli par nos plumes, dont le cœur de tigre est caché par le masque de l’acteur, et qui présume qu’il est capable de faire sonner le vers blanc aussi bien que les meilleurs d’entre vous : en plus d’être un misérable scribouillard, il se met en scène dans sa dramatique vanité Greene, dans son pamphlet, fait ici allusion à Henri VI, 3e partie, en reprenant le vers : Oh, cœur de tigre caché dans le sein d’une femme. On ne sait si Greene était jaloux de la réussite théâtrale de Shakespeare qu'il considérait comme un illettré, ou s'il avait été victime d'un plagiat de la part du jeune auteur. À l'époque, Shakespeare n'avait pourtant produit qu'une seule œuvre véritable, Henri VI, écrite en 1591. Il n'avait fait auparavant qu'adapter des pièces du répertoire existant, et exercer le métier d'acteur, activités dont il n'était pas très fier ainsi qu'il l'écrit au début de son sonnet 111 (vers 1 à 4) :
O! for my sake do you with Fortune chide,
The guilty goddess of my harmful deeds,
That did not better for my life provide
Than public means which public manners breeds.
Oh ! Grondez à mon sujet la Fortune,
Cette déesse coupable de tous mes torts,
Qui ne m'a pas donné mieux comme moyen d'existence
Que l'argent du public, ce qui donne des manières vulgaires.
Le théâtre du Globe à Londres
En 1594, Shakespeare est engagé en tant qu'acteur et dramaturge au Theatre dans la troupe de James Burbage, appelée alors la troupe de Lord Chamberlain, pour laquelle il va écrire exclusivement. La troupe tire son nom, comme le voulait l’époque, du mécène qui la soutient en l'occurrence le Lord Chambellan, ministre responsable des divertissements royaux ; ce titre a longtemps désigné la fonction de principal censeur de la scène artistique britannique.
The Theatre est le premier véritable théâtre de Londres. Il a été bâti en 1576 à Shoreditch, au-delà des murs nord de la Cité. En 1598, quatre ans après l'arrivée de Shakespeare, un désaccord entre le propriétaire du terrain, sur lequel s'élève le théâtre, et le propriétaire des murs et chef de la troupe, James Burbage, apparaît au moment du renouvellement du bail de location du terrain. Aucune solution ne peut être trouvée, le propriétaire foncier revendiquant la propriété totale du bâtiment. Cet épisode semble avoir marqué Shakespeare, car on en trouve une mention dans Les Joyeuses Commères de Windsor, acte II, scène 236, dans la bouche de Ford : Mon amour ressemblait à une belle maison bâtie sur le terrain d'un autre. Ainsi, pour m'être trompé de place, j'ai perdu mon édifice. Les fils Burbage opèrent par la ruse : le bâtiment en bois est démonté clandestinement, les matériaux sont transportés de l'autre côté de la Tamise à Southwark. Une nouvelle salle de spectacle, baptisée Théâtre du Globe, est construite avec les restes de l'ancien théâtre. En attendant que tout soit opérationnel, la troupe joue au Théâtre de la Courtine, qui a été construit en 1577 à Shoreditch, près de l'ancien The Theatre. L’emménagement dans une nouvelle salle et la mort de James Burbage donnent l'occasion de remanier profondément l'organisation de la troupe. À la place d'un chef unique, un directoire d'actionnaires est mis en place. Selon la somme versée par chacun dans l'entreprise, les fils de James Burbage, Cuthbert et Richard Burbage, disposent chacun d'une part double, Shakespeare et les principaux acteurs, John Heminges, Augustine Phillips et Thomas Pope, détiennent chacun une part simple. Par contre, le Lord Chambellan reste le patron de la troupe jusqu'en 1603, année de l'accession au trône de Jacques Ier, qui devient leur nouveau patron. À cette occasion, la troupe prend le nom des King's Men, la troupe du roi.
Shakespeare joue non seulement lui-même dans ses propres œuvres – on sait par exemple qu'il interprète le spectre du père dans Hamlet et Adam dans Comme il vous plaira –, mais il apparaît également en tête d'affiche de pièces de Ben Jonson : en 1598 dans Chaque homme dans son caractère, Every Man In His Humour et en 1603 dans Sejanus. La compagnie devient très populaire : après la mort d’Élisabeth Ire et le couronnement du roi Jacques Ier en 1603, le nouveau monarque adopte la troupe, et elle finit par devenir résidente du théâtre du Globe. La troupe de Shakespeare officie dans le plus beau théâtre et est réputée être la meilleure compagnie de Londres, qui fourmille d'entreprises de théâtre à cette époque. Elle rivalise brillamment avec la troupe de l'Amiral, dont Edward Alleyn est la grande vedette, et ouvre en 1608 un second théâtre, le Blackfriars. La vie de Shakespeare épouse alors étroitement la courbe de ses activités dramatiques.
En 1604, Shakespeare joue un rôle d’entremetteur pour le mariage de la fille de son propriétaire. Des documents judiciaires de 1612, date où l’affaire est portée au tribunal, montrent qu’en 1604, Shakespeare est locataire chez un artisan huguenot qui fabrique des diadèmes dans le nord-ouest de Londres, Christopher Mountjoy Montjoie. L’apprenti de Montjoie, Stephen Belott désirait épouser la fille de son patron ; Shakespeare devient donc l’entremetteur attitré, pour aider à négocier les détails de la dot. Sur ses propres promesses, le mariage a lieu. Mais huit ans plus tard, Belott poursuit son beau-père pour n’avoir versé qu’une partie de la dot. Shakespeare est appelé à témoigner, mais ne se souvient que très vaguement de l’affaire.
Plus tard, divers documents provenant des tribunaux ou des registres commerciaux montrent que Shakespeare est devenu suffisamment riche pour acheter une propriété dans le quartier londonien de Blackfriars rive nord de la Tamise. Alors qu'il vit à Londres, il ne perd jamais le contact avec Stratford. En 1597, il y achète une belle maison, New Place. Là il installe sa famille, constitue des réserves de grain. Il achète aussi d'autres biens dans sa ville natale.
Retraite et fin de vie
Vers 1611, Shakespeare décide de prendre sa retraite. Celle-ci s’avéra pour le moins agitée : il fut impliqué dans des démêlés judiciaires à propos de terrains qu’il possédait. À l’époque, les terrains clôturés permettaient le pâturage des moutons, mais privaient du même coup les pauvres de précieuses ressources. Pour beaucoup, la position très floue que Shakespeare adopta au cours de l’affaire est décevante, parce qu’elle visait à protéger ses propres intérêts au mépris des nécessiteux.
Pendant les dernières semaines de sa vie, le gendre pressenti de sa fille Judith – Thomas Quiney, un aubergiste – fut convoqué par le tribunal paroissial pour fornication. Une femme du nom de Margaret Wheeler qui venait d'accoucher prétendait que l’enfant était de l’aubergiste ; mais la mère et l’enfant moururent peu après ce sombre épisode. Quiney fut déshonoré, et Shakespeare corrigea son testament afin de préserver les intérêts de Judith.
Shakespeare mourut le 23 avril 1616, jour de son anniversaire à l’âge de 52 ans. Le 23 avril 1616, est aussi la date de l'enterrement de Cervantes, mais en réalité il y a 8 jours de décalage car l'Espagne était déjà passée au calendrier grégorien. Shakespeare était resté marié à Anne jusqu’à sa mort et ses deux filles lui survécurent. Susanna épousa le docteur John Hall, et même si les deux filles de Shakespeare eurent elles-mêmes des enfants, aucun d’eux n’eut de descendants. Il n’y a donc pas de descendant direct du poète.
Shakespeare est enterré dans l’église de la Sainte-Trinité à Stratford-upon-Avon. Il reçut le droit d’être enterré dans le chœur de l’église, non en raison de sa réputation de dramaturge, mais parce qu’il était devenu sociétaire de l’église en payant la dîme de la paroisse 440 £, une somme importante. Un buste commandé par sa famille le représente, écrivant, sur le mur adjacent à sa tombe. Chaque année, à la date présumée de son anniversaire, on place une nouvelle plume d’oie dans la main droite du poète.
Epitaphe de Shakespeare
À l’époque, il était courant de libérer de la place dans les tombeaux paroissiaux en les déplaçant dans un autre cimetière. Par crainte que sa dépouille ne soit enlevée du tombeau, on pense qu’il a composé cette épitaphe pour sa pierre tombale :
Mon ami, pour l’amour du Sauveur, abstiens-toi
De creuser la poussière déposée sur moi.
Béni soit l’homme qui épargnera ces pierres
Mais maudit soit celui violant mon ossuaire
— Épitaphe de W. Shakespeare.
La légende populaire veut que des œuvres inédites reposent dans la tombe de Shakespeare, mais personne n’a jamais vérifié, par peur sans doute de la malédiction évoquée dans l’épitaphe.
Iconographie
Portrait Cobbe présenté par le président du Shakespeare Birthplace Trust comme étant Shakespeare
Le seul portrait reconnu de Shakespeare est une gravure publiée en frontispice d'un recueil d’œuvres. L'ouvrage a été imprimé en 1622, soit six ans après la mort de l'écrivain. Il existe également un buste funéraire dans l'église de la Sainte-Trinité de Stratford-upon-Avon.
En mars 2009, le professeur Stanley Wells, président du Shakespeare Birthplace Trust, dévoile un portrait qu'il présente comme étant le seul portrait connu de Shakespeare réalisé de son vivant. Ce tableau est connu sous le nom de portrait Cobbe du nom de la famille qui en était originellement propriétaire. Son identification à Shakespeare est loin de faire l'unanimité.
Œuvres
Le canon shakespearien est l'ensemble des œuvres dont l'authentification est indiscutable. Les pièces sont traditionnellement classées en plusieurs catégories : les tragédies, les comédies et les pièces historiques, en suivant l’ordre logique de publication ; toutefois, depuis la fin du XIXe siècle, les critiques suivent Frederick Samuel Boas 1862-1957 et parlent de pièce à problème à propos de certaines œuvres du canon. Par exemple pour sa pièce Mesure pour mesure : l’expression était jusqu’alors réservée aux pièces qui semblaient défendre une thèse philosophique ou sociale ; elle désigne dorénavant les œuvres qui échappent à une catégorisation simple, qui vont manifestement à l’encontre des conventions classiques. En outre, les dernières comédies de Shakespeare sont communément appelées les romances.
Légende : La liste suivante donne les pièces dans leur ordre de classement d’après le premier Folio de 1623 la première édition complète des pièces dans un même volume. Un astérisque indique une pièce classée aujourd’hui en tant que romance ; deux astérisques indiquent celles considérées comme des pièces à problème – même si certaines comédies sont encore au centre du débat critique.
Chronologie des pièces de Shakespeare et Premier Folio.
Tragédies
Antoine et Cléopâtre Antony and Cleopatra
Coriolan Coriolanus
Hamlet, prince de Danemark Hamlet, Prince of Denmark
Jules César Julius Caesar
Macbeth
Othello ou le Maure de Venise Othello, the Moor of Venice
Roméo et Juliette Romeo and Juliet
Timon d'Athènes Timon of Athens
Titus Andronicus
Troïlus et Cressida Troilus and Cressida
Comédies
Beaucoup de bruit pour rien Much Ado About Nothing
La Comédie des erreurs The Comedy of Errors
Comme il vous plaira As You Like It
Les Deux Gentilshommes de Vérone The Two Gentlemen of Verona
Les Joyeuses Commères de Windsor The Merry Wives of Windsor
Le Marchand de Venise The Merchant of Venice
La Mégère apprivoisée The Taming of the Shrew autre traduction : La Sauvage apprivoisée
Mesure pour mesure Measure for Measure
La Nuit des rois Twelfth Night
Peines d'amour perdues Love's Labour's Lost
Le Songe d'une nuit d'été A Midsummer Night's Dream
Tout est bien qui finit bien All's Well that Ends Well
Pièces historiques
Édouard III Edward III
Richard II
Richard III
Henri IV, 1re partie, 2e partie Henry IV, Part 1, Part 2
Henri V Henry V
Henri VI, 1re partie45, 2e partie, 3e partie Henry VI, Part 1, Part 2, Part 3
Henri VIII Henry VIII
Le Roi Jean King John
Sir Thomas More
Romances tardives
Le Conte d'hiver The Winter's Tale
Cymbeline
Les Deux Nobles Cousins The Two Noble Kinsmen
Périclès, prince de Tyr Pericles, Prince of Tyre
La Tempête The Tempest
Poèmes
1re édition des Sonnets 1609
Les œuvres poétiques de Shakespeare comprennent :
La Complainte d'un amoureux
Longs poèmes
Moi et toi jusqu'aux mortels
Le Phénix et la Colombe The Phoenix and the Turtle
Pilgrim le passionné
Les Sonnets
Vénus et Adonis 1593
Le Viol de Lucrèce 1594
Pièces perdues
Peines d'amour gagnées Love’s Labour’s Won : un écrivain de la seconde moitié du XVIe siècle, Francis Meres, ainsi qu’une petite fiche de libraire attestent d’un titre similaire dans les œuvres récentes de Shakespeare, mais aucune pièce portant ce titre ne nous est parvenue. Elle pourrait avoir été perdue, ou le titre pourrait désigner une autre appellation d’une pièce existante, comme Beaucoup de bruit pour rien ou Tout est bien qui finit bien. L'épisode 180 de Doctor Who, célèbre série britannique, porte le titre de la pièce en français The Shakespeare Code en VO et est consacré entièrement à cette pièce perdue.
Cardenio, une composition tardive par Shakespeare et Fletcher, n’a pas survécu mais reste attestée dans plusieurs documents. La pièce s’inspirait d’une aventure de Don Quichotte. En 1727, Lewis Theobald publia une pièce intitulée Double Falshood, dont il prétendait qu’elle était basée sur trois manuscrits d’une pièce perdue de Shakespeare qu’il ne nommait pas. Double Falshood reprend en fait le sujet de Cardenio, et les critiques pensent que la pièce de Theobald est la seule trace qui reste de la pièce perdue.
Œuvres apocryphes
Edward III : Certains chercheurs ont récemment décidé d’attribuer cette pièce à Shakespeare, sur la base de la versification. D’autres refusent cette théorie en citant, entre autres, la mauvaise qualité du travail de création des personnages. Si Shakespeare était effectivement impliqué dans l'écriture de cette pièce, il ne travailla probablement que comme collaborateur.
Sir Thomas More : un travail d’équipe incluant peut-être Shakespeare. Son rôle exact reste inconnu.
A Funeral Elegy by W.S. ? : pendant longtemps, plusieurs chercheurs pensaient que Shakespeare avait composé cette élégie pour William Peter, en basant leurs théories sur des preuves stylistiques Donald Foster en chef de file. Toutefois, cette argumentation s’est révélée fallacieuse par la suite, et la plupart des spécialistes Foster y compris s’accordent à dire actuellement que le poème élégiaque est né sous la plume de John Ford.
Le Bible du roi Jacques King James Version : certains pensent que Shakespeare aurait contribué à la traduction de la version du Roi Jacques, en révisant certains passages pour les rendre plus poétiques ; leur théorie s’appuie sur le fait que le style de plusieurs versets ressemble à celui de Shakespeare. Ils citent le psaume 46, où le verbe shake, secouer apparaît 46 mots à compter du début du chant, et le mot spear, épieu, 46 mots à compter de la fin. Le débat est encore très vif et bien que la plupart des chercheurs réfute la théorie, Neil Gaiman s’en est inspiré dans sa bande dessinée The Wake.
Collaboration avec d’autres dramaturges
Comme la plupart des écrivains de son époque, Shakespeare n’écrivait pas toujours en solitaire : un certain nombre de ses œuvres résultent de collaborations, même si leur nombre exact est encore incertain. Pour certaines des attributions qui suivent comme Les Deux Nobles Cousins on possède une recherche scientifique très documentée ; d’autres pièces comme Titus Andronicus restent sujettes à controverse et dépendent des prochaines analyses linguistiques. Il est probable également que certaines pièces aient été en partie rédigées au cours des répétitions et contiennent la transcription d'apports personnels des acteurs.
Henri VI : probablement le fruit d’une équipe d’écrivains, dont on ne peut que suggérer les identités.
Titus Andronicus pourrait être issu d'une collaboration avec George Peele, comme coauteur ou relecteur. La paternité de cette œuvre a elle-même été mise en cause : si les premiers éditeurs de l'œuvre de Shakespeare la lui attribuèrent, dès 1687 l'adapteur Edward Ravenscroft déclarait que Shakespeare n'en était pas l'auteur. En 1905, J. M. Robertson tenta d'établir que cette pièce était l'œuvre de Peele, avec la collaboration probable de Christopher Marlowe. Il est néanmoins admis, de nos jours, que cette pièce a été effectivement écrite par Shakespeare, mais qu'elle a été hâtivement composée ou révisée.
Périclès, prince de Tyr : inclut un travail de George Wilkins, comme collaborateur ou relecteur.
Timon d'Athènes : la tragédie pourrait être le résultat d’une collaboration entre Shakespeare et Thomas Middleton ; cela pourrait expliquer les incohérences dans la narration et le ton général aux résonances étrangement cyniques.
Henri VIII : considérée comme une collaboration avec John Fletcher.
Les Deux Nobles Cousins : la pièce fut publiée en édition quarto en 1654 ; John Fletcher et William Shakespeare en sont les coauteurs, et collaborèrent pour la moitié du texte chacun.
Macbeth : Thomas Middleton a composé une révision de la tragédie en 1615, incorporant des séquences musicales additionnelles.
Mesure pour mesure : la comédie a probablement subi une légère révision par Thomas Middleton, à un certain stade de sa composition originale.
Style
L'influence de Shakespeare sur le théâtre moderne est considérable. Non seulement Shakespeare a créé certaines des pièces les plus admirées de la littérature occidentale, mais il a aussi grandement contribué à la transformation de la dramaturgie anglaise, ouvrant le champ des possibilités de création sur les personnages, la psychologie, l'action, le langage et le genre. Son art poétique a contribué à l'émergence d'un théâtre populaire, lui donnant d'être admiré autant par des intellectuels que par des amoureux du pur divertissement.
Le théâtre est en pleine évolution lorsque Shakespeare arrive à Londres vers la fin des années 1580 ou le début des années 1590. Précédemment, les formes habituelles du théâtre anglais populaire étaient les Moralités de l'époque Tudor. Ces pièces, qui mélangent piété, farce et burlesque, sont des allégories dans lesquelles les personnages incarnent des vertus morales prônant une vie pieuse, en incitant le protagoniste à choisir une telle vie plutôt que d'aller vers le mal. Les personnages et les situations sont symboliques plutôt que réalistes. Enfant, Shakespeare a probablement assisté à ce type de pièces avec des Mystères et Miracles. À la même époque, étaient représentées dans les universités des pièces basées sur la dramaturgie romaine. Ces pièces, souvent jouées en latin, utilisaient un modèle poétique plus académique que les Moralités, mais étaient également plus statiques, privilégiant les longs discours plutôt que l'action dramatique.
À la fin du XVIe siècle la popularité des Moralités et des pièces académiques s'affaiblit, alors que l'essor de la Renaissance anglaise et des dramaturges comme Thomas Kyd et Christopher Marlowe commence à révolutionner le théâtre. Leurs pièces mêlent moralité et théâtre académique pour former une nouvelle tradition. Ces nouveaux drames ont la splendeur poétique et la profondeur philosophique de la dramaturgie académique et le populisme paillard des moralités, avec cependant plus d'ambigüité et de complexité, et moins d'allégories morales simplistes. Inspiré par ce nouveau modèle, Shakespeare a hissé ce nouveau genre théâtral à un niveau élevé de qualité, créant des pièces qui non seulement résonnent émotionnellement pour le public mais qui, de plus, posent des interrogations fondamentales sur la nature humaine.
Postérité et influence littéraire
Les thèmes de Shakespeare ont trouvé de nombreux échos dans la littérature des siècles suivants. Son influence s'est étendue non seulement au théâtre, mais aussi au roman. L'exemple le plus souvent cité étant le rapport entre Balzac et Shakespeare.
De nombreux universitaires anglais et américains ont fait ce rapprochement, soulignant l'influence du dramaturge anglais sur l'auteur de La Comédie humaine. Certains allant même jusqu'à parler de plagiat s'agissant du Père Goriot et du Roi Lear, le personnage de Jean-Joachim Goriot ayant de multiples points communs avec Lear.
George Saintsbury considère que les filles de Jean-Joachim Goriot assassinent leur père tout comme les filles du roi Lear ont assassiné le leur. Il voit aussi dans La Cousine Bette, une version féminine du Iago d'Othello.
Visions modernes de l'œuvre
Jusqu'au XIXe siècle, les pièces de Shakespeare sont interprétées dans des costumes contemporains. À l'époque victorienne, les représentations théâtrales sont en revanche marquées par une recherche de reconstitution d'époque, les artistes ayant une fascination pour le réalisme historique.
La conception de Gordon Craig pour Hamlet en 1911 inaugure son influence cubiste. Craig abandonne son approche de scénographie constructiviste au profit d'un décor épuré constitué de simples niveaux, des teintes monochromes étendues sur des praticables de bois combinés pour se soutenir entre eux. Bien que cette utilisation de l'espace scénique ne soit pas nouvelle, c'est la première fois qu'un metteur en scène l'utilise pour Shakespeare. Les praticables pouvant être agencés dans de nombreuses configurations, cela permet de créer un volume architectural abstrait, adaptable à n'importe quel théâtre en Europe ou aux États-Unis. Cette conception iconoclaste de Craig ouvre la voie aux diverses visions de Shakespeare du XXe siècle.
En 1936, Orson Welles monte un Macbeth novateur à Harlem, transposant non seulement l'époque de la pièce mais aussi n'employant que des acteurs afro-américains59. Ce spectacle très controversé, surnommé Macbeth Vaudou, replaçait l'action en Haïti montrant un roi aux prises avec la magie noire africaine. Ce qui provoqua également le scandale est que, lorsque l'acteur principal est tombé malade, c'est Orson Welles lui-même qui décide de le remplacer, se grimant le visage en noir. La communauté noire soutint cette production, l'emmenant jusqu'à Broadway puis dans une tournée nationale. De nombreux spectacles depuis ont suivi cette tendance consistant à transposer l'action de pièces de Shakespeare dans un monde très contemporain et politique.
Shakespeare : le problème de l’édition
À la différence de son contemporain Ben Jonson, Shakespeare ne participait pas à l’édition et la publication de ses pièces. Les textes existants sont donc pour la plupart retranscrits de mémoire après la représentation sur scène, ou tirés du manuscrit autographe de l’écrivain. Il existait également une copie pour le régisseur prompt-book sur laquelle pouvait se baser l’éditeur.
Édition de Roméo et Juliette de 1599
Les premières impressions sont destinées à un public populaire, et les exemplaires sont réalisés sans grand soin. Le format utilisé est appelé le in-quarto, dont les cahiers sont obtenus en pliant les feuilles imprimées en quatre. Il arrive que les pages se retrouvent reliées dans le désordre.
La deuxième vague de publication est destinée à un public plus riche, et on attache plus d’importance à la présentation. On imprime donc sur des feuillets simples, et l’exemplaire prend donc le nom de folio. Le premier folio des œuvres de Shakespeare fut imprimé en 1623 : il est conservé à la bibliothèque de l'université Harvard.
Déterminer quel est le texte originel de Shakespeare est devenu le souci majeur des éditeurs modernes. Fautes d’impression, coquilles, mauvaises interprétations du copiste, oublis d’un vers : ces maladresses sont le lot habituel des in-quartos et du premier folio. En outre, à une époque où l’orthographe n’était pas encore fixée, le dramaturge employait souvent plusieurs graphies pour le même mot, ajoutant à la confusion du copiste. Les éditeurs modernes ont donc la lourde tâche de reconstruire les vers originaux et d’en éliminer les erreurs.
Dans certains cas, l’édition du texte ne pose pas tant de problèmes. Pour Macbeth par exemple, les critiques pensent qu’un dramaturge comme Thomas Middleton a adapté et raccourci le texte originel pour obtenir le texte existant dans le Premier folio, qui reste donc le texte officiel. Pour d’autres pièces, Périclès, ou Timon d’Athènes, le texte a pu être corrompu jusqu’à un certain point, mais nous n’avons pas d’autres versions à leur confronter. De nos jours, l’éditeur ne peut donc que régulariser et corriger les fautes de lecture qui ont survécu dans les versions imprimées.
Le problème peut parfois se compliquer. Les critiques modernes pensent que Shakespeare lui-même a révisé ses propres compositions à travers les ans, permettant donc à deux versions différentes de coexister. Pour arriver à un texte acceptable, les éditeurs doivent donc choisir entre la première version et sa révision, qui reste généralement la plus théâtrale.
Autrefois, les éditeurs réglaient la question en fusionnant les textes pour obtenir ce qu’ils croyaient être un texte-source, mais les critiques admettent maintenant que ce procédé est contraire aux intentions de Shakespeare. Dans Le Roi Lear par exemple, deux versions indépendantes, avec chacune leurs propres caractéristiques, coexistent dans l’édition in-quarto et le Premier folio. Les modifications de Shakespeare y ont dépassé les simples corrections pour toucher à la structure globale de la pièce. À partir de là, l’édition des œuvres de Shakespeare par l’université d’Oxford fournit deux versions différentes de la même pièce, avec le même statut d’authenticité. Ce problème existe avec au moins quatre autres œuvres de Shakespeare : Henry IV 1re partie, Hamlet, Troilus et Cressida et Othello.
Les polémiques
Le statut exceptionnel de Shakespeare sur la scène littéraire anglo-saxonne a naturellement entraîné un culte autour de sa personne, matérialisé par une recherche critique toujours plus pointue. La rareté des informations concernant sa biographie entraîna de nombreuses polémiques et remises en question, principalement autour de l’identité même du dramaturge. Nous ne rendons pas ici un résumé exhaustif de la question, mais nous dressons une liste des éléments les plus importants dans le débat général.
Réputation et recherche critique
La renommée de William Shakespeare a continué de grandir après l’époque élisabéthaine, comme le montre le nombre d’œuvres critiques qui lui furent dédiées dès le xviie siècle et par la suite. Pourtant, même s’il avait une excellente réputation de son vivant, Shakespeare n’était pas considéré comme le meilleur poète de l’époque. On l’intégrait dans la liste des artistes les plus en vue, mais il n’atteignait pas le niveau d'Edmund Spenser ou de Philip Sidney surtout parce que outre les critiques malveillants d'un entourage qui prétendait que les drames de Shakespeare n'avaient pas été écrits par lui, on s'opiniâtrait dans l'idée que l'homme n'était qu'un ignorant. Il est difficile d’évaluer sa réputation en tant qu’écrivain pour la scène : les pièces de théâtre étaient alors considérées comme des œuvres éphémères, d’indignes divertissements sans véritables valeurs littéraires. Toutefois, le Folio de 1623 et sa réédition neuf ans plus tard prouvent qu’il était tout de même passablement respecté en tant que dramaturge : les coûts d’impression opéraient une sorte de sélection préalable pour les auteurs publiables ; avant lui, Ben Jonson avait été un pionnier dans ce domaine, avec la publication de ses œuvres en 1616.
Après l’interrègne 1642-1660, pendant lequel le théâtre fut interdit, les troupes théâtrales de la Restauration eurent l’occasion de puiser dans un beau vivier de dramaturges de la génération précédente : Beaumont et Fletcher étaient extrêmement populaires, mais également Ben Jonson et William Shakespeare. Leurs œuvres étaient souvent adaptées pour la dramaturgie de la Restauration, alors qu'il nous semble aujourd’hui blasphématoire d’avoir pu mutiler les œuvres de Shakespeare. Un exemple célèbre concerne le Roi Lear de 1681, aseptisé par Nahum Tate pour se terminer en happy-end, version qui demeura pourtant jouée jusqu’en 1838. Dès le XVIIIe siècle, la scène anglaise jusque-là dominée par Beaumont et Fletcher fit place à William Shakespeare, qui la tient jusqu’à nos jours.
Si son entourage immédiat et son époque manifestèrent une certaine méfiance à son égard, les intellectuels, critiques littéraires et écrivains des siècles suivants lui rendirent très vite un hommage appuyé. Les règles rigides du théâtre classique, unité de temps, de lieu et d’action n’avaient jamais été suivies par les dramaturges anglais, et les critiques s’accordaient pour donner à Ben Jonson une poussive seconde place. Mais la médaille d’or fut immédiatement accordée à l’incomparable Shakespeare John Dryden, 1668, le naturel intuitif, le génie autodidacte, le grand peintre du genre humain. Le mythe qui voulait que les romantiques furent les premiers à apprécier Shakespeare à sa juste valeur ne résiste pas aux témoignages enthousiastes des écrivains de la Restauration et du XVIIIe siècle, comme John Dryden, Joseph Addison, Alexander Pope et Samuel Johnson. On doit aussi aux spécialistes de cette période l’établissement du texte des œuvres de Shakespeare : Nicholas Rowe composa la première édition académique du texte en 1709, et la Variorum Edition d’Edmond Malone, publiée à titre posthume en 1821 sert encore aujourd’hui de base aux éditions modernes. Au commencement du XIXe siècle, des critiques romantiques comme Samuel Taylor Coleridge vouèrent une admiration extrême pour Shakespeare la bardolâtrie, une adulation tout à fait dans la ligne romantique, vouant une révérence au personnage du poète, à la fois génie et prophète.
La question de l’identité
Articles connexes : Paternité des œuvres de Shakespeare, Théâtre élisabéthain et Édouard de Vere.
Les documents officiels prouvent qu’un certain William Shakespeare a bel et bien vécu à Stratford-upon-Avon et à Londres. La majorité des critiques s'accordent désormais pour identifier ce William Shakespeare comme l'auteur des pièces. Pourtant, il y eut autrefois une polémique passionnée sur l’identité du dramaturge, à laquelle ont même participé des écrivains comme Walt Whitman, Mark Twain, Is Shakespeare Dead ?, Henry James ou Sigmund Freud : tous doutaient que le citoyen de Stratford nommé William Shaksper ou Shakspere ait réellement composé les œuvres qui lui étaient attribuées.
Une signature de Shakespeare
Leurs arguments sont multiples : absence de mention d’œuvres littéraires dans son testament, inexistence de manuscrits littéraires d'époque, circonstances très floues des années de formation du jeune artiste, variation de l’orthographe de son patronyme, manque d'homogénéité du style et de la poétique des œuvres. Les spécialistes sont actuellement en mesure de réfuter ce genre d’argumentaire et pensent avoir éclairci le prétendu mystère de l’identité du poète, polémique qui, comme ils le font remarquer, commence au XIXe siècle avec des observations sur le supposé manque d’éducation de l’auteur, seuls des aristocrates ayant eu l'étoffe d'écrire de telles pièces mais ne pouvant les assumer, auraient utilisé Shakespeare comme prête-nom. Auparavant, les critiques n'étudiaient pas la question.
Les critiques s’appuient aussi sur l’extrême rareté des documents historiques et les mystérieuses contradictions dans sa biographie : même une vénérable institution telle que la National Portrait Gallery de Londres refusa d’authentifier le célèbre Flower Portrait de Stratford-upon-Avon, qui tomba en discrédit après qu’il se fut avéré qu’il s’agissait d’une contrefaçon du XIXe siècle. Certains francs-tireurs ont donc suggéré que des écrivains comme Francis Bacon, Christopher Marlowe, John Florio, la reine Élisabeth Ire ou le roi Jacques Ier d'Angleterre se cachaient derrière le pseudonyme de Shakespeare en tant qu’auteurs principaux ou coauteurs de tout ou partie des œuvres. Leurs origines aristocratiques expliquant la surprenante maîtrise stylistique du jeune homme de Stratford.
La thèse Bacon repose essentiellement sur un cryptogramme qui aurait été découvert dans l'édition originale des œuvres de Francis Bacon, notamment le De rerum organum : cette édition recelerait, cryptée et codée, une autobiographie de F. Bacon, lequel n'hésiterait pas à proclamer qu'il a réalisé des œuvres diverses, comédies, tragédies, qui ont connu une grande renommée sous le nom de Shakespeare. Ce texte contient cependant, par ailleurs, un nombre d'invraisemblances tel qu'on ne peut sérieusement lui accorder crédit.
D'autres anti-stratfordiens comme Abel Lefranc ou J. T. Looney pensèrent que les pièces devaient être l'œuvre d'un homme de cour. Le nom du comte de Derby est avancé par Abel Lefranc en 1918 dans Sous le masque de William Shakespeare : William Stanley, VIe comte de Derby, celui d'Édouard de Vere, le 17e comte d’Oxford, un noble familier de la reine Élisabeth, par J. T. Looney. Le comte de Rutland et l'un ou l'autre des comtes d'Essex sont aussi évoqués.
Ainsi, dans les années 192077, les partisans du comte d’Oxford ébauchèrent des théories s’appuyant sur des correspondances entre la vie de ce gentilhomme et les événements décrits dans les sonnets shakespeariens, théorie oxfordienne de la paternité de Shakespeare. En outre, Edward de Vere était considéré de son vivant comme un poète et écrivain talentueux qui possédait la culture et l’expérience que les partisans de cette thèse pensaient qu'on était en droit d'attendre d’un dramaturge de la stature de Shakespeare. Mais le comte était né quatorze ans avant Shakespeare et décédé douze ans avant lui.
En 1907, le critique allemand Karl Bleibtreu affirme dans Der Wahre Shakespeare que l'auteur des grandes pièces signées Shakespeare est Roger Manners, Lord Rutland, thèse reprise en 1912 par Célestin Demblon dans son ouvrage Lord Rutland est Shakespeare.
En 2007, c’est le tour de Sir Henry Neville, diplomate, membre du Parlement, qui, selon Brenda James et William Rubinstein, aurait demandé à Shakespeare de lui servir de prête-nom. Stimulé par cette théorie, John Casson se met au travail et affirme bientôt avoir découvert six nouveaux titres qui seraient des œuvres de Shakespeare-Neville, dont Arden of Faversham et Mucidorus.
L'œuvre de Shakespeare est aussi parfois attribuée à d'autres dramaturges : Chettle, Dekker, Robert Greene qui accuse Shakespeare de plagiat dans Greene's Groats-Worth of Wit, Middleton, Peele, Webster : tous ont eu des partisans plus ou moins convaincants.
Dès 1882, une bibliographie de la controverse est publiée. On arrive finalement à une liste de cinquante candidats en 2007 puis 77 en 2012, lesquels auraient travaillé séparément, ou collaboré, pour fabriquer cette œuvre composite qu'est le théâtre de Shakespeare.
La question corollaire à l’identité est celle de l’intégrité des textes : les critiques rencontrent des difficultés avec certaines pièces, voir notamment Henry VI première partie pour déterminer exactement quelle part du texte il faut attribuer à Shakespeare. À l’époque élisabéthaine, les collaborations entre dramaturges étaient fréquentes, et les spécialistes continuent d’étudier les textes de l’époque pour dessiner un contour plus précis de l’apport réel du poète82.
La religion de Shakespeare
Quelques chercheurs contemporains ont écrit que Shakespeare était aux marges de l'anglicanisme et avait de fortes inclinations vers la religion catholique.
Enfin, divers auteurs maçonniques ont affirmé que Shakespeare était membre des loges. Quelques-uns vont jusqu'à dire qu'il fut le créateur de la franc-maçonnerie.
La question est irrésolue : Shakespeare n'aurait pas pu être un bon catholique s'il était membre des loges, car la franc-maçonnerie a été fréquemment condamnée par les papes. De plus, l'anglicanisme était très proche du catholicisme sur de nombreux aspects et oscillait continuellement entre une branche catholique et une branche protestante.
Un livre d'un chercheur français paru en 2010, Shakespeare était-il juif ? Une nouvelle approche de sa vie et de son œuvre86 a apporté une preuve historique démontrant matériellement que le nom du père de William Shakespeare était en réalité Shapiro. Cet élément tendrait à accréditer les origines juives de la branche paternelle des Shakespeare.
La question de la sexualité
Le contenu des œuvres attribuées à Shakespeare a soulevé la question de son identité sexuelle. Son éventuelle bisexualité a scandalisé la critique internationale, eu égard à son statut d'écrivain célèbre.
La question de savoir si un auteur élisabéthain était homosexuel dans le sens moderne est anachronique, les concepts d'homosexualité et de bisexualité n'ont émergé qu'au XIXe siècle. Tandis que la sodomie était un crime à l'époque de Shakespeare, il n'y avait aucun mot pour désigner une identité exclusivement homosexuelle. Bien que vingt-six des sonnets de Shakespeare soient des poésies d'amour adressées à une femme mariée, connue comme la dark lady - la dame sombre, cent vingt-six sont adressés à un jeune homme connu comme le fair lord - le prince éclatant. La tonalité amoureuse du dernier groupe, qui se concentre sur la beauté du jeune homme, a été interprétée comme preuve de la bisexualité de Shakespeare, bien que d'autres considèrent que ces sonnets ne se rapportent qu'à une amitié intense, un amour platonique.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=8526#forumpost8526
Posté le : 24/04/2015 17:53
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
70 Personne(s) en ligne ( 33 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 70
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages