 Tous les messages Tous les messages
#151
Jean-Pierre Faye
Loriane
Posté le : 19/07/2015 16:21
Le 19 juillet 1925 naît Jean-Pierre Faye
dans le 6e arrondissement de Paris, écrivain, poète et philosophe français. Il reçoit le prix Renaudot en 1964 pour " L'écluse ".Inaugurée par la poésie, ses premiers textes sont publiés en 1946 dans les Cahiers de la Table ronde, son œuvre s'oriente ensuite vers le roman. Dans Entre les rues 1958, le personnage principal est un malade lobotomisé, présenté comme foyer problématique de la conscience du monde et d'un métadiscours sur le récit, car explorer l'espace de la narration, c'est entrer matériellement dans l'ossature et le cerveau connaissant. Cette veine déconcertante engage Faye dans la voie d'une esthétique de la divagation, confirmée par la Cassure 1961, Battement 1962, Analogues 1964 et l'Écluse 1964, où l'auteur s'oppose à la fois à l'illusion référentielle de la mimesis et à une littérature qui se voudrait autonymique. S'impose ainsi « la saisissante illustration littéraire d'une phénoménologie de la perception Olivier de Magny, servie par un réalisme subjectif qui explore l'imaginaire urbain des capitales de la douleur. Cet ensemble, complété par les Troyens 1970, forme le cycle de l'Hexagramme, qui s'accompagne d'une réflexion sur le Récit hunique 1967, en même temps que le romancier devient aussi dramaturge Théâtre et Hommes et pierres, 1964 ; les Grandes Journées du père Duchesne, 1983. Philosophe de formation, Faye est une figure importante de l'avant-garde littéraire des années 1960, en rupture avec l'engagement sartrien. Il participe aux travaux de Tel Quel à partir de 1963, quitte ce groupe en 1967, par refus de l'outrance et du dogmatisme, et fonde, l'année suivante, le collectif Change. Il y poursuit, dans une perspective marxiste, ses analyses sur le diptyque Théorie du récit – Langages totalitaires 1972 et ses essais Dictionnaire politique portatif en cinq mots : démagogie, terreur, tolérance, répression, violence, 1982, tandis que sa prosodie du désir Inferno, versions, 1975 ; l'Ovale, détail, 1975 ; Yumi, 1983 ; Grandes Narrations de Bourgogne, 1983, mêlant intrigue amoureuse, affaire criminelle et histoire politique, engendre une complexité métrique peu commune Couleurs pliées, 1965 ; Verres, 1978 ; Syeeda, 1980. Ce questionnement idéologique et littéraire sans cesse renouvelé Commencement d'une figure en mouvement, 1980 débouche finalement sur le retour à la poésie le Livre du vrai, événement violence, 1998. En bref Après avoir passé l'agrégation de philosophie en 1950, Jean-Pierre Faye, né à Paris, enseigne à Reims, Chicago, Lille. Entre 1958 et 1970, il publie six romans – Entre les rues 1958, La Cassure 1961, Battement 1962, Analogues 1964, L'Écluse prix Renaudot 1964 et Les Troyens 1970 – qui constituent L'Hexagramme, réseau de récits entrecroisés où le lecteur est convié à lire plus que ce qui lui est raconté, à soupçonner, au-delà de la narration, le mythe, l'histoire, le philosophie et la littérature. Grand lecteur d'Homère et de Dante, Jean-Pierre Faye a voulu donner à ses recherches sur le texte les plus modernes un souffle et une ampleur épiques. Outre L'Hexagramme, trois ensembles peuvent se distinguer à l'intérieur de cette œuvre éclectique et polymorphe : les essais sur le langage et le pouvoir du récit, les ouvrages d'analyses historiques, les poésies. Parmi les essais théoriques, deux titres s'imposent : Langages totalitaires 1972 et La Critique du langage et son économie 1973. Parallèlement au travail entrepris par un Noam Chomsky, par exemple, Jean-Pierre Faye élabore une critique littéraire qui s'inscrit, autant que son objet d'étude, dans le champ narratif. Lecture et écriture sont désormais considérées comme un seul état de la langue, à un moment donné de l'histoire. Dans Les Grandes Journées du père Duchesne, ses joyeuses et horribles narrations 1978, Jean-Pierre Faye a mis en évidence ce rapport étroit, ambigu, entre histoire et récit, c'est-à-dire entre la vérité et la fiction. Dans ses ouvrages plus spécifiquement consacrés à l'histoire contemporaine, il s'est attaché à démonter des systèmes sociaux, économiques ou politiques à partir du langage qui les portait Luttes de classes à Dunkerque, les morts, les mots, les appareils d'État, 1973 ; Migrations du récit sur le peuple juif, 1974 ; Le Portugal d'Otelo ; la révolution dans le labyrinthe, 1976 ; L'Europe une : les philosophes et l'Europe, 1992. Quant à sa poésie, influencée par Mallarmé, Hölderlin et une certaine tradition philosophique allemande, elle veut écrire la parole et le silence. Couleurs pliées 1965, Verres 1977, Syeeda 1977 ou Ode Europe 1992 témoignent de cette exigence. Mais si la philosophie cherche à instituer des vérités, la poésie, comme le roman, reconnaît au mensonge — aux rêves, aux fables, aux légendes — une valeur réelle. La multiplicité d'écritures de Jean-Pierre Faye traduit sans doute son souci de capter tous les discours humains et de s'approcher au plus près de leur source pour comprendre ce désir, original, d'écrire, de parler, de communiquer avec les autres hommes. Dans la logique de son livre Langages totalitaires, Jean-Pierre Faye a par ailleurs développé une réflexion d'une grande richesse sur le XXe siècle et ses dérives (La Déraison antisémite et son langage, 1913 ; Le Piège : La philosophie heideggerienne et le national-socialisme, 1994 ; Le Siècle des idéologies, 1996 ; Le Vrai Nietzsche : guerre à la guerre, 1998 ; Voies nouvelles de la philosophie, 2008 ; L’Histoire cachée du nihilisme, avec Michèle Cohen-Halimi, 2008 Après avoir été, à partir de 1963, membre du comité de rédaction de la revue Tel Quel, Jean-Pierre Faye fonde en 1967 la revue Change avec Maurice Roche et Jacques Roubaud. Placée sous le signe des formalistes russes, elle jouera jusqu’en 1985 un rôle important dans le domaine de l'expérimentation poétique. François Poirié. Sa vie Né à Paris, Jean-Pierre Faye prix Renaudot en 1964 pour L'Écluse passe, pour cause d'exode, son adolescence près d'Hendaye où il est marqué à la fois par l'afflux des réfugiés républicains espagnols et par les récits journaux, radio) des premiers bombardements nazis en Pologne, événements vus, lus ou entendus qui lui racontent l'histoire en train de se faire et sont les éléments déclencheurs de ses premiers poèmes dont certains seront publiés en 1945 par Les Cahiers de la Table ronde. Licencié en droit et sciences économiques 1947, Diplôme d'études supérieures 1948 avec Gaston Bachelard, Jean-Pierre Faye obtient, en 1950, son agrégation de philosophie, puis son Doctorat d'État en 1972. Il a également été l'élève de Claude Lévi-Strauss et André Leroi-Gourhan au Musée de l'Homme. Jean-Pierre Faye enseigne ensuite à Reims 1951, Chicago 1954-1955, Lille 1955 et Paris-Sorbonne 1956-1960. En 1964 il rejoint le CNRS dont il sera Directeur de recherche en 1983. De 1963 à 1967, il est membre du comité de rédaction de la revue Tel Quel et fait partie de l'avant-garde littéraire en rupture avec Sartre, auquel il reproche, entre autres, de ne pas connaître Saussure. En désaccord personnel avec Philippe Sollers et avec ce qu'il nomme la dictature structuraliste de cette publication, il la quitte pour créer, en 1967, la revue Change avec Maurice Roche et Jacques Roubaud. La dispute Sollers-Faye se poursuivra de longs mois, notamment dans les colonnes de L'Humanité en septembre 1969, chacun accusant l'autre d'inspiration fasciste et revendiquant la légitimité d’une référence à Derrida et, à travers lui, à Heidegger. À Change, Faye est rejoint par Philippe Boyer, Jean-Claude Montel, Jean Paris, Léon Robel, Mitsou Ronat, Saul Yurkiévich, Geneviève Clancy et Félix Guattari, il en est le directeur jusqu'en 1985. En se réclamant des formalistes russes et des linguistes tchèques; en ouvrant ses pages à la grammaire générative de Noam Chomsky, il y développe le Mouvement du change des formes, base de regroupements transversaux et de variations théoriques dont le but se comprend autour de cette formule : La langue, en se changeant, change les choses. Jean-Pierre Faye, octobre 2010 Le 21 mai 1968, Jean-Pierre Faye fonde l'Union des écrivains aux côtés notamment d'Alain Jouffroy, Bernard Pingaud, Nathalie Sarraute et Michel Butor. Ce regroupement de quelque 200 écrivains est conçu à la fois comme un mouvement solidaire des écrivains tchèques à Prague, soumis à une censure totale, et comme un lieu de réflexion sur le sens de la littérature dans un monde en crise. En 1977, il analyse encore le Printemps de Prague de 1968 essentiellement sous l'angle des conseils ouvriers. En septembre 1981, il conçoit avec Félix Guattari les bases d’une Université philosophique, qui sera fondée en 1983 comme Collège international de philosophie avec François Châtelet, Jacques Derrida et Dominique Lecourt. En 1985 le Collège international de philosophie est refondé comme Université européenne de la recherche dont il est, depuis lors, le Président. En 2013, lors des 30 ans du Collège international de philosophie, Jean-Pierre Faye suscite un esclandre en affirmant dans une Lettre sur Derrida éd. Germina que dès ses commencements le nazi Heidegger devient le maître à penser du Collège international de philosophie. Un collectif de philosophes condamne ce qu'il nomme un brûlot et une démonstration... aussi inconsistante que rapide. Selon ces philosophes, une rancune macérée depuis trente ans à l'égard de Derrida balaye la plus élémentaire précaution d’analyse. Spécialiste de la philosophie allemande, Jean-Pierre Faye est, aussi auteur d'essais sur les fonctions sociales et politiques du langage tels que Langages totalitaires—étude de la formation du système de discours propre aux idéologies fascistes; La raison narrative—réflexion sur les entrelacs entre énoncé philosophique et logique de la narrativité ou, encore, Migrations du récit sur le peuple juif—analyse des invariants sur le judaïsme, de la chrétienté médiévale aux temps modernes. Son œuvre se répartit également entre fictions éclatées sous l'appellation Hexagramme Entre les rues, La Cassure, Battement qui explorent la transformation des lieux, théâtre Les grandes journées du Père Duchesne et poésie Fleuve renversé, Couleurs pliées, Verres, Syeeda. Son fils, Emmanuel Faye, est professeur de philosophie à l'Université de Paris, Nanterre. Œuvres Fiction L'Hexagramme Entre les rues, Paris, Le Seuil, 1958. La Cassure, Paris, Le Seuil, 1961. Battement, Paris, Le Seuil, 1962. Analogues, Paris, Le Seuil, 1964. L'Écluse, Paris, Le Seuil, 1964 réédition, Paris, Hermann, 2009. Les Troyens, Paris, Le Seuil, 1970. L'Hexagramme. Autres Inferno, versions, Paris, Seghers /Laffont, 1973. L’Ovale détail, Paris, Robert Laffont, 1973. Les Portes des villes du monde, Paris, Belfond, 1977. Yumi, visage caméra, Paris, Lieu commun, 1983, réédition Notes de Nuit, 2012 La Grande Nap, Paris, Balland, 1992. Didjla, le Tigre, Paris, Balland, 1994, réédition Notes de Nuit/L'Harmattan La bataille de Léda, Paris, Hermann, 2008. Essais Introduction à Epicure, Paris, Hermann, 1965. Le récit hunique, Paris, Le Seuil, 1967. Langages totalitaires, Hermann, 1972; réédition augmentée, Paris, Hermann, 2004. Introduction aux langages totalitaires, Paris, Hermann, 1972, Poche, 2009. La critique du langage et son économie, Paris, Galilée, 1973. Migrations du récit sur le peuple juif, Paris, Belfond, 1974. Prague, la révolution des conseils ouvriers 1968-1969, avec Vladimir Claude Fišera, Seghers/Laffont, Paris, 1977, 287 p. Dictionnaire politique portatif, Paris, Gallimard, collection "Idées", 1982. La raison narrative, Paris, Balland, Metaphora, 1990; L’Europe une. Les philosophes et l’Europe, Paris, Gallimard, collection "Arcades", 1992. La déraison antisémite et son langage (avec Anne-Marie de Vilaine), Arles, Actes Sud, collection "Babel", 1993. Le piège. La philosophie heideggerienne et le nazisme, Paris, Balland, 1994. La frontière. Sarajevo dans l’archipel, Arles, Actes Sud, 1995. Le langage meurtrier, Paris, Hermann, 1996. Le siècle des idéologies, Paris, Armand Colin 1996, Pocket, 2002. Qu’est-ce que la philosophie ? Paris, Armand Colin, 1997. Le vrai Nietzsche : guerre à la guerre, Paris, Hermann, 1998. Dialogue et court traité sur le transformat avec Henri Maccheroni, Al Dante 2000. Nietzsche et Salomé. La philosophie dangereuse, Paris, Grasset, 2000. Journal du voyage absolu, Paris, Hermann, 2003. La philosophie désormais, Paris, Armand Colin, 2003. Voies nouvelles de la philosophie. Philosophie du transformat, Paris, Hermann, 2008. L’histoire cachée du nihilisme avec Michèle Cohen-Halimi, La Fabrique 2008 La crise, la bulle et l’avenir, suivi de La plus grande tragédie philosophique et la crise, Paris, Hermann, 2010. L'expérience narrative et ses transformations, Paris, Hermann, 2010. Poésie Fleuve renversé, GLM 1959 Couleurs pliées, Gallimard 1965 Verres, Seghers/Laffont 1977 Sacripant furieux, Change errant 1980 Syeeda, Shakespeare & Company 1980. Reliefs 1984 Le livre de Lioube, Fourbis 1992, dessins de Gérard Titus-Carmel Guerre trouvée, Al Dante 1995 Ode Europe, Imprimerie nationale 1992 Le livre du vrai . événement violence, L’Harmattan 1999 Herbe hors d’elle, Rémy Maure 2006, lithographies d’Anne Slacik désert fleuve respirés, L’Ariane 2005, estampes et dessins d’Arman Éclat rançon, La Différence 2007 Diwan Sertão, Notes de Nuit 2011, peintures d'Anne Slacik Anthologie Comme en remontant un fleuve anthologie poétique, L'Act Mem, 2010 Livre audio Choix de poèmes lus par l'auteur, Notes de Nuit, Éditions L'Harmattan, 2011 Traductions Hölderlin, Douze poèmes, G L M 1965, L’Amourier 2000 Jack Spicer, Langage, Seghers/ Laffont, Change 28. 1975 Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, Change errant 1979, Seghers 1985 Jerome Rothenberg, Poèmes pour le jeu du silence, Christian Bourgois 1978 Vasko Popa, La tour des crânes, Migrations littéraires, 1989 Eva Diamanstein, Matière de miroir, L’Harmattan 2000 Théâtre Théâtre Hommes et pierres, Latvia, Vitrine, Centre, Seuil 1964 Iskra, suivi de Cirque, Seghers/Laffont 1973 Les Grandes Journées du Père Duchesne, Seghers/Laffont 1981 La Fête de l’Ane de Zarathustra, L’Harmattan 2009, dessins de Vladimir Veličković Ouvrages collectifs Hypothèses, Seghers/Laffont 1972, avec Roman Jakobson, Noam Chomsky, Jacques Roubaud, Mitsou Ronat Les morts, les mots, les appareils d’Etat, Galilée 1973 Portugal : la révolution dans le labyrinthe, Lattès 1976 La Révolution des conseils ouvriers, Seghers/Laffont, Change 1977 Langue, théorie générative étendue, Hermann 1977, avec Mitsou Ronat Commencement d’une figure en mouvement, Stock 1980, avec Philipe Boyer Les chambres à gaz, secret d’Etat, Minuit 1984, E. Kogon, H. Langbein, A. Rückerl avec Germaine Tillion, Geneviève De Gaulle Paroles à la bouche du présent, Al Dante 1997, avec Natacha Michel, Alain Badiou Le transformat, le littoral, éd. Sils Maria : Concepts, 2003 Change, première suite, 10/18, 1974 Change de forme, I, 10/18, 1975 Change matériel, II, 10/18, 1975 Change, Seuil, et Seghers/Laffont, 1968/1985, 45 volumes La Sorte, Pleine Page collection L'un dans l'autre, 2007, avec Henri Maccheroni Divers « Ce que Change a fait », revue Faire Part no 16/17, 2005, 178 p. « Jean-Pierre Faye et la philosophie », revue Concepts no 7, Éditions Sils Maria, 2004, 206 p. contient 2 inédits de Jean-Pierre Faye : Goering et Carl Schmitt dans le IIIe Reich et un texte d'une soixantaine de pages, Le transformat, le littoral Scénarios Grandes narrations de Bourgogne, Publisud 1983, avec Hugo Santiago Amants et autre animaux, avec Stephen Hamel Mita’a, le danger d’or Études Maurice Partouche, Jean-Pierre Faye, Seghers, 1980 Mitsou Ronat, Faye, L'Âge d'homme, 1980. Marie-Christine Balcon, Lire Jean-Pierre Faye, L'œuvre narrative, entre poésie et philosophie : un terrain d'aventure. Fragments recueillis, coll. Espaces Littéraires, L'Harmattan, 2008, (ISBN 2-7475-9882-9), 302 p. Patrick Combes, Mai 68, les écrivains, la littérature, L'Harmattan, 2008, 350 p., chapitres II et VI sur Jean-Pierre Faye et l'Union des écrivains en 1968 Distinctions Chevalier de la Légion d'honneur Commandeur des Arts et des Lettres   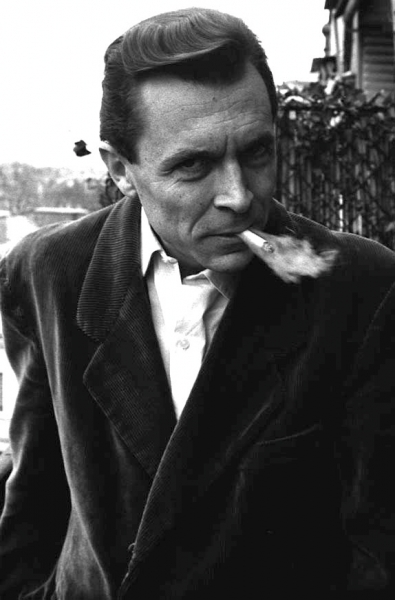 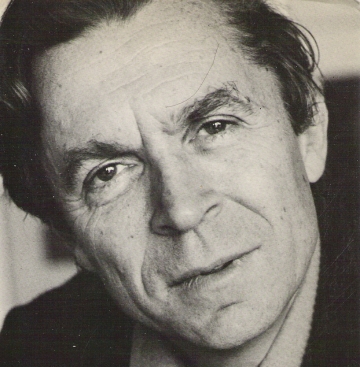 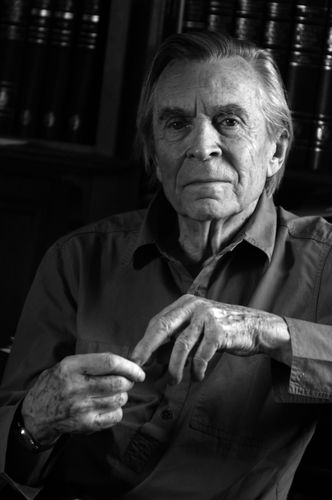     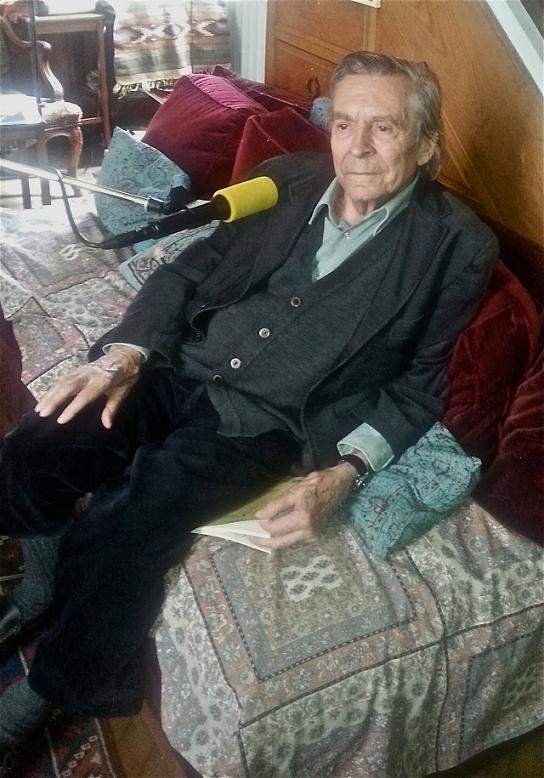 
#152
Robert Pinget
Loriane
Posté le : 19/07/2015 15:54
Le 19 juillet 1919 naît Robert Pinget
à Genève en Suisse, romancier et dramaturge français d'origine suisse, mort, à 78 ans le 25 août 1997 à Tours, indre et Loir. Robert Pinget parle de lui : " Une fois venu le moment de la rédaction, c'est en toute conscience que je déclenche le mécanisme ou, si l'on veut, que j'ouvre le robinet du subconscient, disons de la sensation. Ce travail est on ne peut plus volontaire. Une manière presque d'écriture automatique en pleine conscience, c'est-à-dire avec filtrage immédiat des possibles, de ce qui pourrait être développé, et dont je m'efforce de développer une minime partie malgré mon dégoût de tout développement, et du roman en particulier." Aux côtés de ses grands romans, Passacaille et L'Apocryphe, notamment, Robert Pinget a su donner place à ce qu'on pourrait appeler de petites formes, davantage à même de garantir cet espace du possible dont il parle dans ses Pseudo-principes d'esthétique. La fiction s'y donne alors comme passage, entrevision, fable suscitée au plus près de l'écriture. Ce qui, outre son goût pour l'écriture théâtrale, le rend proche de Beckett, dont il partage l'humour grinçant. En bref Né en 1919 à Genève où il fait ses études de droit, Robert Pinget abandonne une voie toute tracée pour suivre à Paris sa vocation artistique. Après trois années d'atelier et une exposition à Saint-Germain-des-Prés, il opte définitivement pour la littérature. En dépit de tout ce qu'on a pu écrire contre le terrorisme stérilisant des avant-gardes des années 1950, l'école du Nouveau Roman aura donné à Robert Pinget une rigueur certaine. Il n'est que de comparer ses premières tentatives littéraires, pleines de fantaisie, de désinvolture, de naïveté, de parodie de Entre Fantoine et Agapa, 1951, à Graal flibuste, 1956 aux textes portant véritablement l'estampille des éditions de Minuit pour voir la différence. Le Fiston 1959, Clope au dossier 1961, Quelqu'un prix Femina 1965 se caractérisent par la complexité de la composition. Le roman avance pour ainsi dire à reculons, l'exposé revenant à chaque instant sur lui-même pour introduire une variante, une hypothèse, un décalage temporel qui remettent en question l'ensemble du récit. Le comble de la virtuosité technique est atteint dans L'Inquisitoire 1962, l'œuvre phare de Pinget : le domestique sur la sellette improvise à mesure, sous la pression d'une voix énigmatique, une histoire labyrinthique d'une extraordinaire complexité, mêlant plusieurs centaines de personnages et de noms de lieux où l'interlocuteur perd le fil. Les romans qui accompagnent la période « dure » du Nouveau Roman, Passacaille, 1969, Cette Voix, 1975, L'Apocryphe, 1980 rivalisent avec la musique : composition presque abstraite, en forme de fugue, d'une intense poésie, rythmée par les saisons, les commérages, les deuils, les citations liturgiques. Plus de narrateur clairement identifiable, cette fois, mais une polyphonie de voix narratives se faisant concurrence, alternant sentences, clichés, allusions mythologiques ou anecdotes triviales. La mise en scène de l'écriture et de l'oralité, l'épurement du matériau narratif au profit du symbole, l'ambition métaphysique clairement affichée appellent le commentaire et la collaboration du lecteur. Les derniers textes de Robert Pinget, Monsieur Songe, 1982, et ses quatre carnets ; Théo, ou le Temps neuf, 1991 illustrent à leur façon le repli du Nouveau Roman sur l'autobiographie fictive. Monsieur Songe est un vieil écrivain raté, un double pâlot de Pinget qui aurait affronté sans succès l'expérience de la création. Le narrateur de Théo aspire à l'innocence enfantine, au non-savoir, pour exprimer la vérité qui le possède. Il ne s'agit plus de graver dans la pierre une sentence magistrale, mais de tracer sur une ardoise d'écolier une fugitive épitaphe. Cette apparente simplicité qui a conquis à l'écrivain un nouveau public, est en réalité retorse. Monsieur Songe est un composé de Ménalque, l'élégiaque berger virgilien et du sarcastique Monsieur Teste. Pinget retrouve la voie de l'aphorisme, la forme brève, la syntaxe rompue cultivée à l'époque classique. La contradiction logique, l'esprit d'indécision du sujet narrateur, si irritantes pour l'esprit cartésien, prend sa source dans les Confessions de saint Augustin. Sa vie Né le 19 juillet 1919 à Genève, Robert Pinget, après avoir terminé des études de droit, exerce le métier d'avocat à Genève durant un an. Il quitte la Suisse en 1946 pour Paris, où il entre aux Beaux-Arts. Il publie son premier ouvrage, Entre Fantoine et Agapa en 1951. En 1952, Robert Laffont publie son premier roman, Mahu ou le Matériau, sous l'impulsion de Georges Belmont. Ensuite c'est Le Renard et la Boussole chez Gallimard, en 1953, grâce au soutien d'Albert Camus, Alain Robbe-Grillet et surtout Samuel Beckett, qui restera un grand ami de Pinget, le conseillent à Jérôme Lindon, patron des Éditions de Minuit. Graal Flibuste paraît donc chez Minuit en 1956, après avoir été refusé par Raymond Queneau chez Gallimard. Désormais, Minuit sera l'éditeur de Pinget. Son roman intitulé Quelqu'un a remporté le prix Femina en 1965. En 1966, il acquiert la nationalité française et s'installe en Touraine, dans ce qu'il appelle sa chaumière, où il écrira la plupart de ses livres. Il y construit une tour, et invente ce qui est considéré comme sa dernière veine, à savoir la série des carnets, dont la parution commence en 1982, avec la publication de Monsieur Songe, du nom de ce personnage vieillissant dont Robert Pinget n'a jamais nié qu'il était une forme d'alter ego. Peu après le colloque qui lui est consacré à Tours, en 1997, il succombe à une attaque cérébrale dans cette même ville, le 25 août 1997. L'œuvre théâtrale Comme Nathalie Sarraute, Robert Pinget a su transposer à la scène son univers romanesque. Lettre morte 1959 est une adaptation du Fiston, montée au Théâtre Récamier en 1960 ; Architruc 1961, un doublon de Baga, créé par Olivier Hussenot en 1962 et repris à la Comédie-Française en 1971 ; La Manivelle 1960, un épisode de Clope au dossier, créé au théâtre de Lutèce en 1962 et repris à Avignon par la Comédie-Française en 1987, en même temps qu'Abel et Bela 1972, qui est un savoureux dialogue sur l'art dramatique entre deux faiseurs de théâtre. Deux pièces méritent une mention spéciale, parce qu'elles illustrent parfaitement ce théâtre des nouveaux romanciers et qu'elles témoignent de la solitude existentielle de l'auteur et de l'échec de l'artiste auprès de ses contemporains. L'Hypothèse a été jouée par Pierre Chabert en 1965 au théâtre de l'Odéon dans la mise en scène de Beckett. Une nouvelle version, interprétée par David Warrilow, en a été proposée par Joël Jouanneau au festival d'Avignon en 1987, en partie consacré à l'œuvre théâtrale de Pinget. C'est une conférence tragi-comique d'un auteur qui se voit peu à peu dépossédé de son texte et qui finit par l'anéantir ou par se supprimer lui-même. Autour de Mortin, pièce radiophonique à huit personnages, contemporaine de Quelqu'un, a été adaptée par Jacques Seiler en 1979 au Théâtre Essaïon et reprise avec un vif succès huit ans plus tard. Trois acteurs se partagent les divers rôles et portent sur l'écrivain disparu les jugements les plus contradictoires et les plus infamants, allant jusqu'à lui dénier la paternité de son œuvre. Robert Pinget est également l'auteur d'un important théâtre radiophonique. Il a toujours tenu sous le boisseau sa production poétique, jamais interrompue, et ses travaux critiques sur Max Jacob, Jules Renard, Samuel Beckett, saint Augustin..., en dehors de ses contributions aux colloques sur le Nouveau Roman Cerisy, 1971, et New York, 1982. Installé en Touraine depuis 1964, il laisse un important fonds manuscrit, partiellement déposé à la bibliothèque municipale de Tours. Jean-Claude Liéber et Madeleine Renouard Études de l'œuvre Textes inédits - Bibliographie - Mélanges : Recueil des actes du colloque de Tours Revue Europe Revue Histoires littéraires : dossier Robert Pinget Robert Pinget : matériau, marges, écriture Robert Pinget : inédits Monographies : Ecriture et intériorité dans quatre romans de Robert Pinget7: Passacaille, Fable, Cette voix, L'Apocryphe. Robert Pinget : Le vieil homme et l'enfant8 : vagabondage à travers les thèmes qu'aborde l'œuvre. Citation Il me semble que lorsqu'on est attiré par un écrivain, ce n'est pas sa biographie qui intéresse. Je m'étonne toujours qu'on aborde un écrivain avec des questions qui n'ont rien à voir, ou peu à voir, avec son œuvre. Je n'ai pas de vie autre que celle d'écrire. Mon existence est dans mes livres… — Entretien avec Louis-Albert Zbinden, Gazette de Lausanne, 4 décembre 1965 Œuvre Romans Mahu ou le matériau, 1952, roman Le Renard et la Boussole, 1953, roman Graal Flibuste, 1956, roman Baga, 1958, roman Le Fiston, 1959, roman Clope au dossier, 1961, roman L'Inquisitoire, 1962, roman Quelqu'un, 1965, roman. Prix Femina Le Libera, 1968, roman Passacaille, 1969, roman Cette voix, 1975, roman L'Apocryphe, 1980, roman Monsieur Songe, 1982, roman L'Ennemi, 1987, roman Mahu reparle, 2009, roman La Fissure, précédé de Malicotte-la-Frontière théâtre, 2009 Jean Loiseau, 2009, premier roman inédit, in Histoires littéraires no 40 Recueil de nouvelles Entre Fantoine et Agapa, 1951, nouvelles Théâtre Lettre morte, 1959, pièce en deux actes La Manivelle, 1960, pièce radiophonique L'Hypothèse, 1961, théâtre Ici ou ailleurs, Architruc-L'Hypothèse, 1961, théâtre Autour de Mortin, 1965, dialogues Abel et Bela, 1961, théâtre Identité, 1971, théâtre Paralchimie, suivi de Architruc-L'Hypothèse-Nuit, 1973, théâtre Un testament bizarre, et autres pièces Mortin pas mort, Dictée, Sophisme et sadisme, Le chrysanthème, Lubie, 1986, théâtre De rien, 1992, théâtre L'Affaire Ducreux, et autres pièces De rien, Nuit, Le bifteck, 1995, théâtre Autres publications Cette chose, 1967 Fable, 1971, récit Le Harnais, 1984, carnets Charrue, 1985, carnets Du nerf, 1990, carnets Théo ou Le temps neuf, 1991 Gibelotte, 1994 Taches, 1997, carnets Jérôme Lindon a réalisé sous le pseudonyme de Louis Palomb un pastiche de Robert Pinget publié par les Editions de Minuit         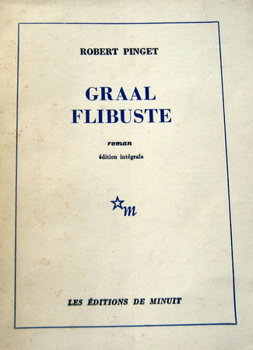   
#153
Ferdinand Brunetière
Loriane
Posté le : 18/07/2015 18:13
Le 19 juillet 1849 naît à Toulon Ferdinand Brunetière ,
de son nom complet, Vincent-de-Paul Marie Brunetière, mort à 57 ans à Paris le 9 décembre 1906, est un historien de la littérature et critique littéraire de langue française, il apparient au mouvement Classicisme rationaliste, Il est nommé à l'académie française Sa vie Fils d’un inspecteur général de la Marine, Brunetière s’éloigne rapidement de la Provence pour passer son enfance à Fontenay-le-Comte. Il échoue à l’École normale supérieure en 1869 et 1870, devient répétiteur dans des institutions privées. Il collabore à partir de 1875 à La Revue des Deux Mondes, dont il devient le secrétaire de rédaction de 1877 à 1893, puis le directeur en 1893. Il devient un proche de l'écrivain Paul Bourget. Maître de conférences à l’École Normale Supérieure en 1886, il est décoré, en 1887, de la Légion d'honneur. Il devient ensuite professeur à la Sorbonne. Élu membre de l’Académie française le 8 juin 1893, il succède à John Lemoinne au fauteuil 28. Il est reçu le 15 février 1894 par Paul-Gabriel d'Haussonville. En 1897, il donne des conférences aux États-Unis. Il se convertit au catholicisme en 1900. Brunetière était essentiellement un tenant du classicisme rationaliste du XVIIe siècle, ce qui l’amena à s’opposer parfois durement aux écoles littéraires de son époque. Il écrivit ainsi des articles contre Gustave Flaubert notamment pour Trois Contes, contre Zola dans Le Roman naturaliste et protesta en 1892 contre le projet d’un monument à Charles Baudelaire. Il était également hostile au scientisme dominant, ce qui l’a rapproché un temps d’un anarchiste comme Octave Mirbeau. Antidreyfusard, mais non antisémite, il a accusé, en 1898, les intellectuels dreyfusards de se dévoyer en intervenant sur un terrain qui n’était pas de leur compétence. Son amie Flore Singer, dreyfusarde, tenta à plusieurs reprises de lui faire changer positions1. Brunetière défendit une théorie de l’évolution des genres littéraires, inspirée des thèses de Darwin. Historien de la littérature et critique français, Ferdinand Brunetière poursuit une brillante carrière universitaire en enseignant d'abord à l'École normale supérieure, puis à la Sorbonne à partir de 1886. Dans le même temps, il collabore à La Revue des Deux Mondes, dont il devient directeur en 1893. Il critique sans aucune complaisance ses contemporains et, en 1883, dans Le Roman naturaliste, il condamne l'entreprise de Zola et son matérialisme scientifique, ainsi que ce qu'il appelle son mépris des valeurs morales et du Beau. Selon les convictions de Brunetière, on ne peut dissocier l'art et la morale. Aussi juge-t-il avec beaucoup de sévérité Baudelaire et tous ses successeurs du Parnasse, qui se réclament de la gratuité de l'art. Historien de la littérature, il manifeste le même dogmatisme ; il trouve dans le principe de l'évolution la méthode rigoureuse d'une critique systématique. Séduit par les théories de Darwin, il considère les genres littéraires comme des espèces vivantes soumises aux actions de la vie. Créant ainsi l'histoire des genres, il écrit successivement L'Évolution de la critique 1890, où il met au point son instrument dans l'étude de la critique elle-même, Les Époques du théâtre français 1892 et Évolution de la poésie lyrique au XIXe siècle 1894. Très attaché à l'idéal classique, il veut remettre à l'honneur le XVIIe siècle. Il y trouve la force morale et la vérité humaine dont il regrette l'absence chez les écrivains contemporains. Les aspirations spirituelles de Brunetière, jointes à un positivisme sans faille, rendent parfois ses jugements discutables. Très bon orateur, il retrouve dans son style l'ampleur et la fermeté de la période classique. Sa pensée et son style fortement architecturés fondent ses Études critiques 1880-1925 et son Manuel d'histoire de la littérature française 1898. Il aimait trop le XVIIe siècle pour ne pas se sentir attiré par le catholicisme ; dans cet attrait, les considérations sociales et politiques l'emportaient d'ailleurs, fort classiquement, sur le sens du mystère ou l'appel de la mystique. Sa conversion, tardivement parachevée, lui inspira Sur les chemins de la croyance 1905. Antoine Compagnon Il combattit à la fois la critique impressionniste et l'esthétique naturaliste Études critiques, 1880-1925 ; le Roman naturaliste, 1883. Académie française, 1893. Principales publications Études critiques sur l’histoire de la littérature française 1849-1906, 8 volumes, 1880-1907 : Première série : La littérature française du Moyen Âge, Pascal, Molière, Racine, Voltaire, La littérature française sous le premier Empire, le naturalisme au xviie siècle Deuxième série : Bossuet, Fénelon, Massillon, Marivaux, Diderot Troisième série : Descartes, Pascal, Le Sage, Marivaux, Voltaire, Rousseau Quatrième série : Alexandre Hardy, Pascal, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Madame de Stael Cinquième série : Bossuet, Bayle, etc... Sixième série : Maurice Scève, Corneille, Boileau, Bossuet, ... Septième série : Ronsard, Vaugelas, La Fontaine, Molière, Bossuet, Hugo, Balzac Huitième série: Montaigne, Molière, Bourdaloue, Joseph De Maistre Le Roman naturaliste, 1883 ; Histoire et littérature, 3 volumes, 1884 ; Questions de critique, 1888 ; Influence des femmes en littérature, Montesquieu, Schopenhauer, Théophile Gautier, Baudelaire, etc... Nouvelles questions de critique, 1890 ; Évolution de la critique, 1890 ; Évolution des genres dans l’histoire de la littérature, 2 volumes, 1890 : volume 1 : L'évolution de la critique depuis la renaissance jusqu'à nos jours, volume 2 : Epoques du théâtre français 1636-1850, 2 volumes, 1891-1892 ; Conférences de l'Odéon, 1892 Histoire de la littérature française classique 515-1830, 4 volumes, 1891-1892 ; tome 1: De Marot à Montaigne, Tome 2 : Le dix-septième siècle, Tome 3 : Le dix-huitième siècle, Tome 4 : Le dix-neuvième siècle Essais sur la littérature contemporaine, 1892 ; (la critique impressionniste, Alfred de Vigny, la philosophie de Schopenhauer, Sully-Prudhomme, Alexandre Vinet, le symbolisme contemporain, critique et roman, etc... Évolution de la poésie lyrique en France au dix-neuvième siècle, 2 volumes, 1892-1894 : Volume 1 : Objet, méthode et esprit du cours ; les origines du lyrisme contemporain ; Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand et André Chénier ; la poésie de Lamartine ; l'émancipation du moi par le Romantisme ; la première manière de Victor Hugo ; l'œuvre poétique de Sainte-Beuve ; Alfred de Musset ; la transformation du lyrisme par le roman. Volume 2 : Alfred de Vigny ; l'œuvre de Théophile Gautier ; la seconde manière de Victor Hugo ; la renaissance du naturalisme ; M. Leconte de Lisle ; MM. de Heredia, Sully Prudhomme et François Coppée ; le Symbolisme ; conclusions. Nouveaux essais sur la littérature contemporaine, 1895 ; (Bernardin de Saint Pierre, Lamennais, Victor Hugo, Octave Feuillet, Baudelaire, Leconte de Lisle, Paul Bourget,... Bases de la croyance, 1896 ; La renaissance de l'idéalisme, 1896 ; Manuel de l’histoire de la littérature française, 1898 ; Discours académiques 1894-1900, 1901 ; Les raisons actuelles de croire, 1901 ; Victor Hugo, 2 volumes, 1902 ; Variétés littéraires, 1904 ; Cinq lettres sur Ernest Renan, 1904 ; Sur les chemins de la croyance, 1904 ; Honoré de Balzac, 1799-1850, Calmann-Lévy, Paris, 1906. Discours de combat, 3 volumes : Première série, 1900 : la renaissance de l'idéalisme Besançon, 2 février 1896 ; l'art et la morale Paris, 18 janvier 1898 ; l'idée de patrie Tours, 23 février 1901 ; les ennemis de l'âme française Lille, 15 mars 1899 ; la nation et l'armée Paris, 26 avril 1899 ; le génie latin Avignon, 3 août ; le besoin de croire Besançon, 19 novembre 1898 ; Nouvelle série, 1903 : les raisons actuelles de croire Lille, 18 novembre 1900 ; l'idée de solidarité Toulouse, 16 décembre 1900 ; l'action catholique Tours, 23 février 1901 ; l'œuvre de Calvin Genève, 17 décembre 1901 ; les motifs d'espérer Lyon, 24 novembre 1901 ; l'œuvre critique de Taine Fribourg, 18 janvier 1902 ; le progrès religieux Florence, 8 avril 1902 ; Dernière série, 1907 : le génie breton ; la liberté d'enseignement dans la morale contemporaine ; les difficultés de croire ; l'évolution du concept de science ; la modernité de Bossuet ; la renaissance du paganisme ; l'action sociale du christianisme ; le dogme et la libre pensée ; la réunion des Églises. Écrit posthume Lettres de combat, 1912.      [img width=600]http://journaux-collection.com/phototag.php?ref=897366-1.jpg[/img] 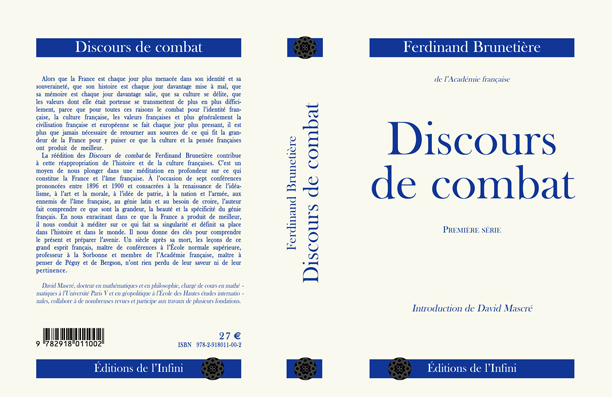
#154
A.J. Cronin
Loriane
Posté le : 18/07/2015 16:53
Le 19 juillet 1896 naît Archibald Joseph Cronin
à Cardross en Écosse, Médecin, romancier, dramaturge, auteur de langue anglaise, mort à 84 ans le 6 janvier 1981 à Montreux en Suisse, signant ses œuvres A. J. Cronin, est considéré comme un des plus grands écrivains écossais. Plusieurs de ses ouvrages sont considérés comme des chefs d'œuvre, en particulier La Citadelle et surtout Les Clés du royaume. Écossais catholique avec des origines irlandaises et une mère protestante, orphelin de père à sept ans, brillant élève, il est d'abord médecin des pauvres en milieu industriel, puis a une brillante clientèle à Londres. Son itinéraire et ses origines inspirent nombre de ses personnages romanesques. Au delà des personnages, ses romans contiennent de nombreux éléments biographiques, tel que le lieu où se déroule La Citadelle, l'un de ses plus grands succès. Médecin dans la marine, il dit la ténacité des hommes de bonne volonté, la loi morale sous un ciel vide, la droiture dans un monde vil le Chapelier et son château, 1935 ; Sous le regard des étoiles, 1934 ; les Clés du royaume, 1941 ; les Vertes Années, 1944 ; l'Arbre de Judas, 1961. La Citadelle 1937 reste son titre le plus connu : un médecin, pris entre son métier et la mine qui l'emploie, perd sa femme et sa foi, mais reconquiert in extremis son honneur et son idéal. Ses Œuvres principales sont : Le Chapelier et son château, La Citadelle, Les Clés du royaume, Sous le regard des étoiles, Les Vertes années, Le Destin de Robert Shannon Sa vie A. J. Cronin est né dans la maison Rosebank Rosebank Cottage à Cardross, dans le Dunbartonshire aujourd'hui dans l'Argyll and Bute en Écosse. Il est le fils de Patrick Cronin, agent d'assurances et représentant de commerce, catholique d'origine irlandaise, et de Jessie Cronin née Montgomerie, protestante, fille d'un chapelier. Archibald a sept ans lorsque son père meurt de tuberculose. Il déménage alors avec sa mère chez ses grands-parents maternels, à Dumbarton en Écosse. Sa mère devient la première femme inspectrice de santé en Écosse. Il est un élève précoce, remporte de nombreux prix et se distingue aussi en athlétisme et en football. Il devient médecin des pauvres dans une région industrielle du Pays de Galles, puis inspecteur des mines en 1924. Après sa thèse sur les anévrismes 1924, il s'installe à Londres avec une brillante clientèle. Un repos forcé lui donne alors l'occasion d'écrire en 1931 son premier roman : Le Chapelier et son château. Il publie ensuite une vingtaine de romans. Il écrit principalement des romans tragiques ; beaucoup sont adaptés au cinéma. On pourrait le rapprocher d'autres médecins écrivains à succès de la même époque comme Frank Gill Slaughter, Lloyd C. Douglas ou André Soubiran. Un de ses fils, Vincent Cronin, est également écrivain. Son épouse Agnès Mary est décédée le 10 juin 1981 à 83 ans. A. J. Cronin demeure l'un des romanciers les plus traduits, les plus diffusés, les plus adaptés par le cinéma et par la télévision. Citons quelques titres parmi les plus célèbres : The Citadel La Citadelle, 1937 ; film de King Vidor en 1938, The Stars Look Down, Sous le regard des étoiles, 1935 ; film de Carol Reed en 1939, The Keys of the Kingdom, Les Clés du royaume, 1941 ; film de John M. Stahl en 1944, etc. Ce romancier est le type même de l'écrivain qui, du fait de son expérience humaine, a quelque chose à dire et, par là, bénéficie – ou pâtit – d'une réputation de transparence, de limpidité, d'émotion directe qui ne s'embarrasse pas de complications d'ordre littéraire. D'origine irlandaise, Archibald Joseph Cronin est né à Cardross, Dumbartonshire, Écosse. Il suit des études de médecine à Glasgow, exerce dans la Royal Navy au cours de la Première Guerre mondiale, devient praticien en pays minier, puis médecin inspecteur au pays de Galles, chargé des maladies professionnelles relatives à l'industrie du charbon. En 1925, il soutient une thèse sur les anévrismes. En 1926, il s'installe à Londres. Pour raison de santé, il doit interrompre bientôt la médecine et se met à écrire. Lorsque paraît Hatter's Castle, Le Chapelier et son château, 1931, son premier roman, il a trente-cinq ans. Le roman bénéficie d'un accueil triomphal : Cronin ne sera plus qu'écrivain. Dans Adventures in Two Worlds Sur les chemins de ma vie, 1952, il raconte son cheminement personnel et les événements vécus qui vont former la matière essentielle de ses livres, matière plus ou moins romancée selon les titres. Cronin est un homme profondément marqué par l'intolérance. Au fil des pages, on trouve souvent de ces Irlandais catholiques tenus de vivre leur enfance en terre protestante, donc hostile. Ainsi de Robert Shannon, l'orphelin de The Green Years, Les Vertes Années, 1944, mais aussi de Francis Chisholm, le prêtre peu conformiste des Clés du royaume. Le fanatisme religieux est une tare en soi qui sera dénoncée tout autant chez la hiérarchie catholique que chez les protestants. Il demeure chez Cronin une religiosité humaniste que décrit ainsi Francis Chisholm, missionnaire peu zélé du point de vue des comptabilités de conversions et qui se réfère autant à Laozi et à Confucius qu'aux Évangiles. Autre thème fameux des romans de Cronin : la question sociale, les milieux de la mine... Mais n'est-ce pas essentiellement de réussite sociale que le romancier nous entretient ? Considérons ce personnage type : l'enfant doué des Vertes Années, originaire d'un milieu modeste où règnent souvent des individus incroyablement avares. Une malédiction de classe s'acharne sur Robert Shannon... jusqu'à ce qu'un miracle digne d'un conte de fées le sorte de sa condition. Au reste, Cronin n'est pas toujours aveugle aux conflits de classe ! La dénonciation contenue dans Sous le regard des étoiles est même assez surprenante, mais les problèmes socio-économiques finissent toujours par se réduire à des tares psychologiques simples qui, comme le bon sens, sont également partagées entre les ouvriers et leurs patrons. Les efforts de David Fenwick, élu député à la Chambre des communes pour défendre les revendications ouvrières, se soldent par un échec. La nationalisation des charbonnages n'est pas du goût de la Chambre et Fenwick, non réélu, retourne sans plus d'espoir à la mine. Nulle surprise, dès lors, que le héros positif des romans de Cronin soit ce curé-médecin ou ce médecin-curé, comme on voudra, plein de droiture, qui possède le pouvoir du guérisseur mais dont la sagesse lui interdit d'abuser, personnage de basse extraction, monté à la force du poignet malgré l'adversité, héros que la société peu ou prou décourage, mais qui garde pour lui son indéfectible honnêteté. Tout cela donne naissance à des personnages souvent fort conventionnels, sans zones d'ombre, promettant de s'opposer courageusement à la stupidité, à la bigoterie, à la cruauté. Dans leur réalisme moral peu ancré dans l'histoire, politiquement neutres, les meilleurs romans de Cronin valent surtout par la part de reportage et de souvenirs qu'ils comportent l'Écosse des Vertes Années ; le pays minier de Sous le regard des étoiles. C'est là ce qui les distingue positivement de toute une littérature qui se suffit d'être édifiante. Jacques Jouet Œuvres Romans Par ordre de publication originale Le Chapelier et son château Hatter's Castle, 1931, Albin Michel, 1940. Adapté au cinéma par Lance Comfort en 1941. Trois Amours Three Loves, 1932, Albin Michel, 1941 Aux Canaries Grand Canary, 1933, Albin Michel, 1938. Adapté au cinéma par Irving Cummings en 1934. Sous le regard des étoiles The Stars Look Down, 1935, Albin Michel, 1937. Adapté au cinéma par Carol Reed en 1939. La Dame aux œillets, 1935-36 Lady with Carnations, collection pourpre, 1941 et Éditions de la paix, 1945. La Citadelle The Citadel, 1937, Albin Michel, 1938. Adapté au cinéma par King Vidor en 1938. Sœurs Vigil in the Night, 1939, Éditions de la paix, 1947 : Nouvelle. Adapté au cinéma par George Stevens en 1940. Les Années d'illusion The Valorous Years, 1940, Albin Michel, 1952. Les Clés du royaume The Keys of the Kingdom, 1941, Albin Michel, 1959. Adapté au cinéma par John M. Stahl en 1944. Les Vertes années The Green Years, 1944, Éditions de la paix, 1946. Adapté au cinéma par Victor Saville en 1946. Le Destin de Robert Shannon Shannon's Way, 1948, Albin Michel, 1949. Le Jardinier espagnol The Spanish Gardener, 1950, Albin Michel, 1951. Adapté au cinéma par Philip Leacock en 1956. Deux Sœurs The Sisters, 1952, Albin Michel, 1961. Réécriture et réédition de « Sœurs, 1947, Éditions de la paix ». L'Épée de justice Beyond This Place, 1953, Albin Michel, 1954. Roman adapté au cinéma par Jack Cardiff en 1959. La Tombe du croisé Crusader's Tomb ; A Thing of Beauty, 1956, Albin Michel, 1956. La Lumière du nord The Northern Light, 1958, Albin Michel, 1958. Étranger au paradis The Native Doctor, 1959, Albin Michel, 1961. L'Arbre de Judas The Judas Tree, 1961, Albin Michel, 1962. Le Signe du caducée A Song of Sixpence, 1964, Albin Michel. La misère et la gloire A Pocketful Of Rye, 1969, Albin Michel, 1970. La neige enchantée Enchanted Snow, 1971, Albin Michel, 1977. Gracie Lindsay, Albin Michel, 1973. Le Chant du paradis The Minstrel Boy, 1975, Albin Michel, 1976. Le Porte-bonheur nouvelles, 1975. L'aventure de Bryan Harker, Albin Michel, 1978. Autres œuvres Chairs vives ou Kaléidoscope Kaleidoscope in 'K', 1933, Éditions de la paix, 1946. Les Confidences d'une trousse noire Adventures of a Black Bag, 1943, Éditions de la paix, 1948. Sur les chemins de ma vie Adventures in Two Worlds, 1952, Albin Michel, 1953. Autobiographie. Nouvelles confidences d'une trousse noire Further Adventures of a Black Bag 1964. Les Hommes proposent Jupiter Laughs 1940: Pièce en 3 actes. Adaptée au cinéma par Irving Rapper en 1941, puis adaptée par O.W. Fischer en 1955.           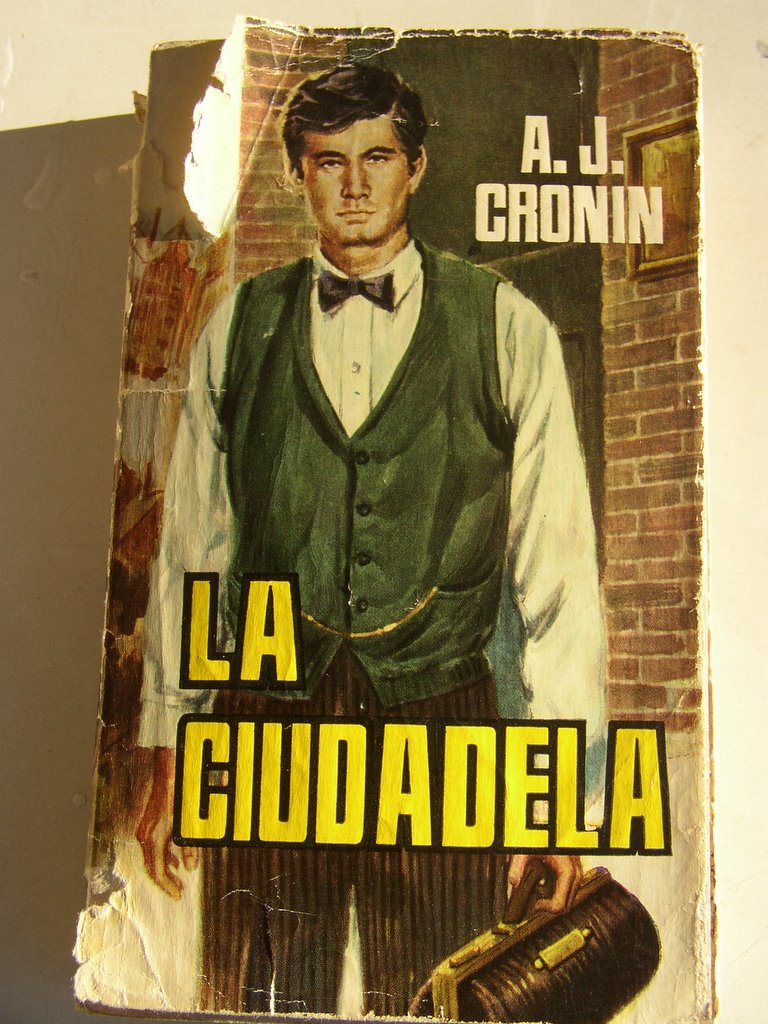 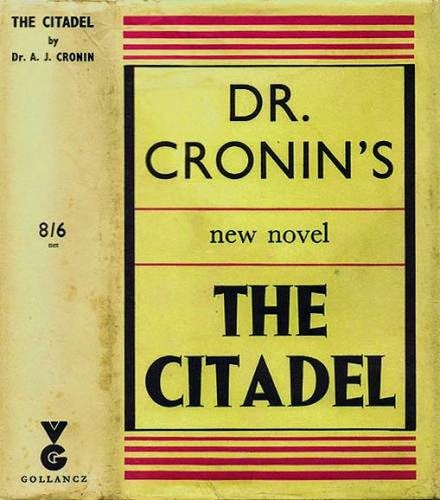
#155
Re: Henry-David Thoreau 2
Loriane
Posté le : 13/07/2015 21:13
Je me suis doutée que ça ne pouvait que t’intéresser.
Thoreau est ce que nous pouvons appeler une très belle personne. Ses livres sont d'une très grande profondeur et portent un message qui ne peut que nous toucher. Il m'a souvent fait rêver et son courage d'opposant tranquille était pour moi un bel exemple. Sa cabane de bois me reste toujours en mémoire, c'est vraiment mon univers. Vérité, profondeur, sensibilité, humanité et authenticité, cet amoureux de notre mère-nature est tout ce qui me parle. Il faut relire "Walking" : "I wish to speak a word for Nature, for absolute freedom and wildness, as contrasted with a freedom and culture merely civil—to regard man as an inhabitant, or a part and parcel of Nature, rather than a member of society". "Let me live where I will, on this side is the city, on that the wilderness, and ever I am leaving the city more and more, and withdrawing into the wilderness". " 'How near to good is what is fair.' So I would say: 'How near to good is what is wild.'" "Here is this vast, savage, hovering mother of ours, Nature, lying all around, with such beauty, and such affection for her children, as the leopard; and yet we are so early weaned from her breast to society, to that culture which is exclusively an interaction of man on man"... "So we saunter toward the Holy Land, till one day the sun shall shine more brightly than ever he has done, shall perchance shine into our minds and hearts, and light up our whole lives with a great awakening light, as warm and serene and golden as on a bankside in autumn". In Wildness is the preservation of the world. Merci pour l'échange Attacher un fichier:  5384806_orig.jpg (48.79 KB) 5384806_orig.jpg (48.79 KB)  iges.jpg (16.30 KB) iges.jpg (16.30 KB)
#156
Re: Henry-David Thoreau 2
emma
Posté le : 13/07/2015 20:23
Très sympa, cet article !
Nous avons tous été tôt ou tard, en contact avec Thoreau, même sans nous en rendre compte, ne serait-ce que par ces quelques vers magnifiques repris dans le film "le cercle des poètes disparus" : "Je m'en allais dans les bois Parce que je voulais vivre sans hâte Vivre, intensément, Et sucer toute la moelle de la vie Mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie Pour ne pas découvrir, à l'heure de ma mort Que je n'avais pas vécu" Ce "parce que je voulais vivre sans hâte", c'est un vers qui me hante. C'est d'une grande simplicité et d'une grande profondeur poétique. Thoreau est un auteur majeur de la littérature américaine. Il influence des œuvres modernes, riches et profondes comme le magnifique et dramatique : "into the wild" Merci pour le partage !
#157
Anne-Thérese de Marguenat de Courcelles
Loriane
Posté le : 11/07/2015 18:50
Le 12 juillet 1733 meurt Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles
à Paris, par son mariage elle devient madame de Lambert, marquise de Saint-Bris, généralement appelée la marquise de Lambert, née à Paris en 1647 femme de lettres et salonnière française. Sous la Régence, quand la cour de la duchesse du Maine, au château de Sceaux, s'amusait à des frivolités et quand celle du duc d'Orléans, au Palais-Royal, se livrait à des débauches, le salon de la marquise de Lambert passait pour le temple des bienséances et du bon goût, en réaction contre le cynisme et la vulgarité de l'époque. Pour les beaux esprits du temps, c'était un véritable honneur d'être admis aux célèbres mardis, où l'on respirait encore l'esprit de dignité et le bon ton du Grand Siècle. Sa vie Fille unique d'Étienne de Marguenat, seigneur de Courcelles, et de sa femme, Monique Passart † 1692, Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, perdit son père, maître-des-comptes à la chambre des comptes de Paris, en 1650, alors qu'elle n'était âgée que de trois ans. Elle fut élevée par sa mère, qui se signalait par la légèreté de ses mœurs, et par le second mari de celle-ci, le poète Bachaumont, qui lui inculqua l'amour de la littérature. Toute jeune, écrit son ami Fontenelle, elle se dérobait souvent aux plaisirs de son âge pour aller lire en son particulier, et elle s'accoutuma dès lors, de son propre mouvement, à faire des extraits de ce qui la frappait le plus. C'étaient déjà ou des réflexions fines sur le cœur humain, ou des tours d'expression ingénieux, mais le plus souvent des réflexions. Le 22 février 1666, elle épousa Henri de Lambert, marquis de Saint-Bris, officier distingué qui devait être lieutenant général et gouverneur du Luxembourg. Leur union fut très heureuse et ils eurent deux enfants1 : un fils, Henri François, et une fille, Marie-Thérèse †1731, par son mariage comtesse de Sainte-Aulaire. La marquise de Lambert devint veuve en 1686 et éleva ses deux enfants, encore jeunes, en soutenant de longs et pénibles procès contre sa belle-famille pour sauver leur fortune. En 1698, elle loua la moitié nord-ouest de l'hôtel de Nevers, situé rue de Richelieu, à l'angle de la rue Colbert. À partir de 1710, dans son beau salon décoré par Robert de Cotte, elle lança son célèbre salon littéraire. Selon son ami l'abbé de La Rivière : Il lui prit une tranchée de bel esprit ... C'est un mal qui la frappa tout d'un coup et dont elle est morte incurable. Elle recevait deux fois par semaine : les gens de lettres les mardis et les personnes de qualité les mercredis, sans chercher cependant à établir une barrière infranchissable entre les deux mondes ; tout au contraire, elle aimait intéresser la bonne société à la littérature et montrer aux écrivains les avantages de la fréquentation du monde, et les habitués pouvaient passer sans contrainte d'un jour à l'autre. Les mardis commençaient vers une heure de l'après-midi. Après le dîner, qui était très fin, avaient lieu des conférences académiques sur un thème de philosophie ou de littérature. Les discussions politiques ou religieuses étaient absolument proscrites. Chaque invité se devait d'émettre une opinion personnelle ou de lire quelques morceaux de ses dernières œuvres : dès le matin, dit l'abbé de La Rivière, les invités préparaient de l'esprit pour l'après-midi. La maîtresse de maison, qu'on comparait à Minerve, dirigeait ce que les plus critiques appelaient un bureau d'esprit. Elle encourageait les littérateurs à la meilleure tenue morale et contribuait à orienter le mouvement des idées vers les formes nouvelles : c'est de son salon que partirent les attaques de Houdar de la Motte contre la règle des trois unités, contre les vers ou contre Homère, que Mme de Lambert trouvait ennuyeux, ce qui ne l'empêchait pas de recevoir des partisans des Anciens comme Anne Dacier, le Père d'Olivet ou Valincour. Fort peu dévote, la marquise de Lambert soutint les Lettres persanes et parvint à faire élire Montesquieu à l'Académie française. Elle fut l'une des premières femmes du monde à ouvrir sa porte aux comédiens comme Adrienne Lecouvreur ou Michel Baron. Fontenelle et Houdar de la Motte étaient les grands hommes de son célèbre salon, où l'on pouvait croiser aussi Marie-Catherine d'Aulnoy, la poétesse Catherine Bernard, l'abbé de Bragelonne, le père Buffier, l'abbé de Choisy, Mme Dacier, le mathématicien Dortous de Mairan, Fénelon, le président Hénault, Marivaux, l'abbé Mongault, Montesquieu, l'avocat Louis de Sacy, l'un des favoris de la maîtresse de maison, le marquis de Sainte-Aulaire, la baronne Staal, Madame de Tencin qui recueillit les hôtes de la marquise à sa mort en 1733 ou encore l'abbé Terrasson. Le salon de la marquise de Lambert passait pour l'antichambre de l'Académie française. Selon le marquis d'Argenson, elle avait fait nommer la moitié des académiciens Mme de Lambert, dit Fontenelle, n'était pas seulement ardente à servir ses amis, sans attendre leurs prières, ni l'exposition humiliante de leurs besoins ; mais une bonne action à faire, même en faveur des personnes indifférentes, la tentait toujours vivement, et il fallait que les circonstances fussent bien contraires, si elle n'y succombait pas. Quelques mauvais succès de ses générosités ne l'avaient point corrigée, et elle était toujours également prête à hasarder de faire le bien. Œuvres Postérité littéraire Mme de Lambert s'intéressait particulièrement aux questions d'éducation. Elle a composé des Avis d'une mère à son fils 1726 et des Avis d'une mère à sa fille 1728 qui sont pleins de noblesse et d'une grande élévation de pensée, et dont elle a reconnu ce qu'ils devaient aux maximes de Fénelon : J'ai trouvé dans Télémaque les préceptes que j'ai donnés à mon fils et dans l’Éducation des filles les conseils que j'ai donnés à la mienne. Ses Réflexions sur les femmes n'étaient pas destinées à l'impression, et lorsqu'elles furent publiées sur la foi de copies destinées aux amis de l'auteur, celle-ci en fut vivement affligée et se crut déshonorée. Elle fit racheter une grande partie de l'édition pour la détruire, ce qui n'empêcha pas plusieurs réimpressions clandestines et même une traduction en anglais. Ce texte évoque avec finesse les paradoxes de la condition féminine : J'ai examiné si on ne pouvait pas tirer un meilleur parti des Femmes : j'ai trouvé des Auteurs respectables qui ont cru qu'elles avaient en elles des qualités qui pouvaient les conduire à de grandes choses ; comme l'imagination, la sensibilité, le goût : présents qu'elles ont reçu de la Nature. J'ai fait des réflexions sur chacune de ces qualités. Comme la Sensibilité les domine, et qu'elle les porte naturellement vers l'Amour, j'ai cherché si on ne pouvait point les sauver des inconvénients de cette passion, en séparant le Plaisir de ce qu'on appelle Vice. J'ai donc imaginé une Métaphysique d'amour : la pratiquera qui pourra. Sans rejeter les attraits de la féminité, l'auteur s'insurge contre la vanité de l'éducation des femmes, reprochant à Molière d'avoir attaché au savoir la honte qui était le partage du vice. Or, estime-t-elle, c'est la vacuité intérieure qui conduit à la dépravation morale : une éducation relevée est donc un rempart contre le vice. Elle a également publié des traités L'Amitié, La Vieillesse et quelques portraits et discours rédigés pour ses hôtes. Elle avait un véritable talent pour forger des maximes en leur donnant un tour neuf et original : C'est toujours bien pensé, écrit Sainte-Beuve4, mais c'est encore mieux dit. Pêchant parfois par excès de recherche, elle montre souvent de l'énergie et de la concision. Ses écrits sont remarquables, selon Fontenelle, par le ton aimable de vertu qui y règne partout et, selon Auger, par la pureté du style et de la morale, l'élévation des sentiments, la finesse des observations et des idées. La marquise de Lambert n'était nullement dévote, même si elle condamnait l'irréligion comme de mauvais ton : La religion de Mme de Lambert, note Sainte-Beuve, est plutôt une forme de l'esprit qu'une source intérieure et habituelle jaillissant du cœur, ou qu'une révélation positive. Elle annonce ainsi le Siècle des Lumières et ses idées philosophiques. Liste chronologique Lettre de madame la Marquise de ***, sur les Fables Nouvelles d'Antoine Houdar de La Motte. Avec la réponse servant d'apologie, Paris, 1719, in-12 Avis d'une mère à son fils, Paris, 1726, in-12 Réflexions nouvelles sur les femmes, ou Métaphysique d'amour, Paris, 1727, in-12 (réimpr. La Haye, 1729, in-12 ; Londres, chez J. P. Coderc, 1730, in-8) (texte intégral sur la base Gallica) Avis d'une mère à sa fille, 1728 Traité de l'Amitié, 1732 La Vieillesse, 1732 Lettres à diverses personnes, Paris, 1748, in-12 Les Avis d'une mère à son fils et les Avis d'une mère à sa fille ont été réimprimés ensemble sous le titre de Lettres sur la véritable éducation (Amsterdam, 1729, in-12 et souvent réédités, soit ensemble, soit séparément, notamment avec une préface et des notes par Mme Dufresnoy Paris, 1822, 2 vol. in-18. Les Œuvres de Mme de Lambert ont été publiées à diverses reprises : Lausanne, 1748, in-12 ; 1751, in-12 ; éd. Auger, 1808, in-8 ; éd. Robert Granderoute, Paris, Librairie Honoré Champion, coll. Classiques Français des Temps Modernes, 1990. Outre les ouvrages précités, elles renferment des écrits qui n'avaient pas été publiés en volume : Psyché, en grec Âme ; La Femme ermite, nouvelle ; des Portraits, Dialogues, Discours. Œuvres de Mme la marquise de Lambert, Paris, 1808 texte intégral sur la base Gallica Bibliographie Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • WorldCat Robert Dauvergne, La marquise de Lambert à l'hôtel de Nevers, 1947 Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Éloge de la marquise de Lambert Ch. Giraud, Le Salon de Mme de Lambert Robert Granderoute, Fénelon et Mme de Lambert, Revue d'Histoire Littéraire de la France, janvier-février 1987 Octave Gréard, L'Éducation des femmes par les femmes, 1886 Cardinal Georges Grente dir., Dictionnaire des lettres françaises. Le XVIIIe siècle, nlle. édition revue et mise à jour sous la direction de François Moureau, Paris, Fayard, 1995 P. de Lescure, Les Femmes philosophes, 1881 R. Marchal, Mme de Lambert et son milieu », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century no 289 E. Mc Niven Hine, Mme de Lambert, her Sources and her Circle, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century no 102 G. Menant-Artigas, Boulainvilliers et Mme de Lambert, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century no 219 Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, tomes III et IV « Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, dans Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1876, 2 volumes Jean de Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières. 1715-1789, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2003 Études littéraires sur la marquise de Lambert et Mme de Staal, Mémoires de l'académie d'Aix, 1873 Une amie de Fontenelle, Mémoires de l'Académie de Toulouse, 1878 Vie de la marquise de Courcelles, écrite en partie par elle-même, Suite de la vie de la marquise de Courcelles par le président Bouhier, ses lettres, correspondance italienne de Gregorio Leti relative à cette dame, publié par Chardon de La Rochette, Paris, Xhrouet, 1808   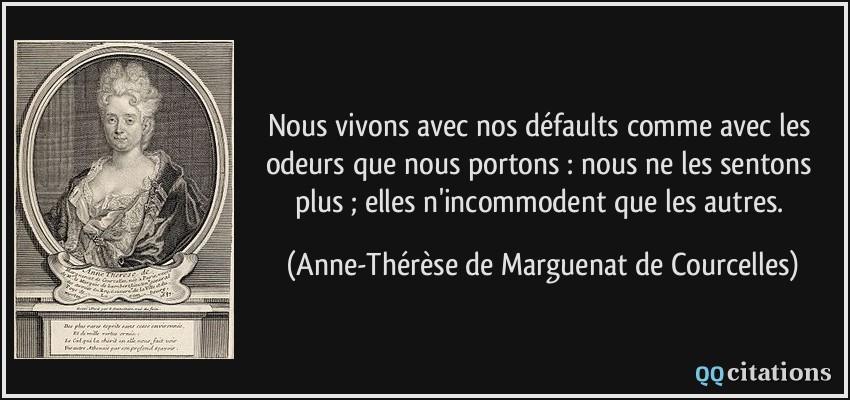     
#158
Henry-David Thoreau 1
Loriane
Posté le : 11/07/2015 18:47
Le 12 juillet 1817 naît Henry David Thoreau
à Concord Massachusssetts, de son vrai nom David Henry Thoreau, essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain, il appartient au mouvement transcendantalisme, il publie dans le genre essai, philosophie, poésie, récit de voyage, il est mort le 6 mai 1862 à 44 ans dans sa ville de naissance. Son œuvre majeure, Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, livre ses réflexions sur une vie simple menée loin de la société, dans les bois et à la suite de sa révolte solitaire. Le livre La Désobéissance civile 1849, dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Ses Œuvres principales sont A Week on the Concord and Merrimac Rivers en 1849, La Désobéissance civile en 1849, Walden ou la vie dans les bois en 1854, Les Forêts du Maine en 1864. Opposé à l'esclavagisme toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures politiques, spirituelles ou littéraires telles que Léon Tolstoï, Mohandas Karamchand Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le poète-naturaliste par son ami William Ellery Channing 1818-1901, Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. En bref Écrivain américain excentrique, penseur anticonformiste, Thoreau a produit une œuvre d'une grande diversité, composée de poèmes, de récits d'excursions, d'essais politiques, d'histoire naturelle, d'un journal monumental et d'un chef-d'œuvre, Walden, livre inclassable qui transcende les genres littéraires. Homme de lettres, philosophe, naturaliste et écologiste, Thoreau a créé un personnage iconoclaste de sage vivant dans les bois afin de mieux dénoncer les erreurs de l'Amérique du milieu du XIXe siècle, et ses manquements aux idéaux proclamés. Sa voix discordante l'a longtemps fait rejeter. Mais cet intellectuel contestataire a fini paradoxalement par représenter divers aspects de l'identité américaine : pionnier plein de ressources, fermier indépendant, rebelle aux institutions, amoureux de la nature sauvage, individualiste et moraliste intransigeant, il est devenu un héros culturel. La complexité du personnage, la variété des facettes de sa pensée, la densité noueuse de sa prose expliquent les fluctuations de sa réputation, chaque époque attachant plus d'attention à telle partie de son œuvre – les belles pages sur la nature, l'art de vivre simplement, la désobéissance civile, la philosophie de la vie ordinaire, ou les prémices de l'écologie. C'est au village de Concord, près de Boston, que Thoreau naît le 12 juillet 1817 et passe sa vie. Après des études à Harvard, il devient brièvement instituteur, puis décide de ne plus travailler que de façon discontinue, dans la fabrique familiale de crayons, chez Ralph Waldo Emerson comme factotum, pour le compte de fermiers ou en tant qu'arpenteur. Cette existence indépendante lui laisse le loisir d'observer quotidiennement la nature du Massachusetts, de collectionner des spécimens, de prendre des notes et de rédiger son journal 1837-1861, d'où il tire des conférences, des articles et des livres. L'amitié d'Emerson joue un rôle décisif dans sa vie. Au sortir de ses études, il fait la rencontre du philosophe qui s'entoure d'un cercle de penseurs, d'écrivains et de réformateurs : dans leurs réunions, à travers les articles du Dial 1840-1844, ils élaborent les principes du transcendantalisme, mouvement philosophique et littéraire, variante américaine du romantisme. Emerson apporte à son disciple une stimulation intellectuelle, lui ouvre les portes de sa bibliothèque et suggère des lectures éclectiques : Thoreau puisera tour à tour dans l'idéalisme allemand, les classiques grecs, la pensée orientale et la littérature anglaise du XVIIe siècle. À sa manière, il deviendra une incarnation de l'intellectuel américain dont Emerson a proposé le modèle dans sa conférence de 1837, The American Scholar, pour inciter à la création d'une culture nationale ; Thoreau y ajoutera un enracinement sensuel dans la nature de la Nouvelle-Angleterre. Emerson encourage son jeune ami à tenir un journal, à écrire des poèmes, et lui commande une Histoire naturelle du Massachusetts. Thoreau se laisse guider vers les lettres, en marge de la société, et s'engage dans l'observation de la nature pour y repérer des correspondances avec l'humanité. Malgré une attention soutenue portée aux mots, il abandonne la poésie, où il ne parvient guère qu'à exprimer de façon conventionnelle une spiritualité éprise d'absolu ; il se tourne alors vers une littérature documentaire, le récit d'excursion. Il raconte un voyage en barque effectué avec son frère John, décédé depuis lors, Une semaine sur les rivières Concord et Merrimack, A Week on the Concord and Merrimack Rivers, 1849. Entre les passages descriptifs où il s'efforce de déchiffrer les hiéroglyphes de la nature, il intercale un florilège de poèmes et des essais philosophiques explorant les thèmes de la pensée transcendantaliste. Avec ses digressions, ses transitions légères, la forme hybride du livre témoigne d'un désir de se libérer des contraintes génériques, de reproduire la souplesse de la conversation entretenue avec ses amis transcendantalistes, pour exprimer une pensée mouvante, sans souci de cohérence. Cet assemblage hétérogène, fragmentaire, pris dans les présupposés idéologiques du transcendantalisme, n'a guère de chance d'intéresser le lecteur moderne. Mais il laisse apercevoir le germe de l'œuvre à venir. Sa vie Thoreau accuse un silence autobiographique tout au long de son œuvre, souligne Michel Granger dans Henry David Thoreau. Néanmoins, grâce à son Journal et aux témoignages de proches tels William Ellery Channing, qui publie sa première biographie Thoreau the Poet-Naturalist, en 1873 ou Harrison Blake qui entretient une correspondance régulière avec Thoreau de mars 1848 à mai 1861 le fil de son existence est connu. Le témoignage de son ami et mentor Ralph Waldo Emerson, dans Thoreau, est également précieux. Le journal intime de Thoreau n'est par ailleurs publié qu'en 1906. Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire, explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner. Premières années 1817-1828 David Henry Thoreau, d'origine écossaise et française, naît le 12 juillet 1817, dans la ville de Concord, Massachusetts, comptant alors 2 000 habitants. David Henry est ainsi nommé en l'honneur d'un oncle paternel récemment décédé, David Thoreau. Il est le fils de John Thoreau et de Cynthia Dunbar. Il a un frère et une sœur aînés, John Junior et Helen et une sœur cadette, Sophia. La maison où il est né a été préservée, sur Virginia Road, après avoir été déplacée d'environ 275 mètres. Son grand-père paternel est d'origine française, né à Saint-Hélier, à Jersey. Il a quitté l'île en 1773 pour les États-Unis sur un bateau corsaire. Son grand-père maternel, Asa Dunbar, successivement enseignant, pasteur et avocat, a joué un rôle dans ce qui est nommé la rébellion de pain et de beurre, à Harvard, en 1766, et qui est la première manifestation d'étudiants de l'histoire des États-Unis. Selon son meilleur ami, William Ellery Channing, Thoreau a une ressemblance physique avec Jules César et, bien qu'il soit de taille moyenne, lui-même ne se juge pas beau, affublé d'un nez qu'il considère être son trait le plus proéminent. Le poète Nathaniel Hawthorne, quant à lui, le décrit ainsi : Thoreau est laid : un long nez ; une bouche étrange ; des manières rustiques quoique courtoises, qui correspondent très bien à son apparence extérieure. Mais sa laideur est quand même honnête et agréable, et lui sied mieux que la beauté. À partir de 1818, sa famille traverse des années de difficultés financières mais, en 1824, son père décide de créer une fabrique de crayons à Concord. Les Thoreau s'installent donc à Chelmsford, dans le Massachusetts puis, en 1821, ils emménagent à Boston. David Henry y entre bientôt à l'école. C'est en 1822 qu'il découvre l'étang de Walden, Walden Pond, lors d'un séjour chez sa grand-mère. Sa fibre littéraire commence alors à apparaître et, en 1827, le jeune Thoreau écrit son premier poème, Les Saisons. Années de formation 1828-1837 À partir de 1828, à l'école de Concord, il apprend le latin, le grec et diverses langues comme le français, l'italien, l'allemand avec Orestes Brownson mais aussi l'espagnol. En 1833, grâce à une bourse, il entre à l'université Harvard pour y étudier la rhétorique, le Nouveau Testament, la philosophie et les sciences. Par l'intermédiaire de Lucy Brown, la première femme qu'il a aimée, il y rencontre Ralph Waldo Emerson 1803-1882 qui devient son ami, puis son mentor, Emerson étant en effet le chef de file du mouvement transcendantaliste naissant. Dès 1835, en dehors des trimestres d’études à Harvard, il enseigne quelques mois dans une école primaire de Canton, dans le Massachusetts. Thoreau découvre véritablement le transcendantalisme en 1835 avant d'obtenir son diplôme en août 1837, célébration qui sera l'occasion de prononcer un discours contre la société intitulé L’esprit commercial des temps modernes et son influence sur le caractère politique, moral et littéraire d’une nation et qui contient toute sa pensée future. Une légende veut qu'il ait refusé de payer les cinq dollars nécessaires pour le diplôme ; en réalité, le master qu'il refuse d'acheter n'avait aucun mérite académique : l'université l'offrait aux étudiants qui ont prouvé leur santé physique en étant vivants trois années après avoir obtenu la licence, et par leurs économies, leurs dépenses, ou en héritant la qualité ou condition en ayant cinq dollars à donner à l'université. Thoreau devient un disciple de Ralph Waldo Emerson. Ce dernier, alors âgé de 34 ans, a déjà publié deux ouvrages importants dans l'histoire de la littérature américaine : Nature et L’intellectuel américain alors que Thoreau, âgé de 20 ans, n'a encore publié aucun texte. Néanmoins, les deux hommes deviennent rapidement très proches, nourrissant dès lors une amitié typique de la philosophie transcendantaliste. Emerson lui fait connaître un cercle d'auteurs et d’autres intellectuels qui fondent le Transcendental Club en 1836 dont : William Ellery Channing qui devient son meilleur ami, et qui l'initie à l'unitarisme, confession qui s'est alors récemment imposée et que Channing enseigne à Harvard, Margaret Fuller, Amos Bronson Alcott ou Jones Very. Tous s'installent à Concord, faisant de ce petit village le centre du rayonnement intellectuel du courant transcendantaliste. Thoreau est alors le seul natif de Concord parmi ces écrivains. Pour Michel Granger, il participe, durant ses années de formation et de production, approximativement entre 1835 et 1860, à ce que F. O. Matthiessen a appelé la Renaissance américaine et qui est en fait la naissance d'une littérature authentiquement nationale. Retour à Concord 1837-1844 Après avoir obtenu son diplôme, Thoreau devient instituteur à l'école publique de Concord mais il démissionne après quelques mois de service car il refuse d'appliquer les châtiments corporels alors en vigueur. Après sa démission, il ne retrouve pas d'emploi, en raison de la crise économique de 1837. À partir d'octobre 1837, Thoreau commence à écrire, sur une suggestion d'Emerson, un journal dans lequel il note ses observations sur la nature et élabore des critiques des livres qu'il lit. La première chose qu'il y écrit, en date du 22 octobre 1837, est une réflexion d'introspection à propos de l'intérêt de tenir ce journal : Qu'est-ce que tu fais maintenant ?. Puis il poursuit : Écris-tu un journal intime ? Ainsi ai-je mon premier passage dans ce journal. Thoreau tient ce journal à jour jusqu'en 1861. Celui-ci devient la source de nombre de ses publications et notamment de Walden. Parallèlement, et de son propre fait, il change l'ordre de ses prénoms et se dénomme maintenant Henri-David Thoreau. Pour Michel Granger, il souhaite signifier par ce geste sa volonté de réarranger sa vie et lui donner un sens propre. En 1838, ne trouvant pas d'emploi comme professeur, il ouvre une école privée chez lui. Son frère John le rejoint peu après. Ils intègrent plusieurs concepts progressistes dans leur programme scolaire, dont les nouveaux principes d’éducation prônés par Elizabeth Peabody, sorties d’éveil, herborisation, refus des sévices et association des enfants à la discipline, promenade dans les bois. Les Thoreau y enseignent jusqu'en mars 1841. La même année il donne une conférence intitulée La Société au Lyceum de Concord, discours faisant écho à celle d'Emerson, Discours de l'École de théologie donnée à Harvard et qui constitue une véritable charte philosophique du mouvement transcendantaliste . Seul, Thoreau effectue également cette année-là sa première excursion dans le Maine, en pleine nature sauvage. Il effectue une autre excursion en 1839, sur les rivières Concord et Merrimack, avec son frère John, en canoë, voyage qui forme la trame de Une semaine sur les rivières de Concord et Merrimack qui est édité en 1849 mais qui ne connaît qu'un très faible succès littéraire. En 1840 Thoreau publie un premier essai sur le poète épique latin : Aulus Persius Flaccus et un poème : Sympathy, les deux publiés dans The Dial Le Cadran, le journal transcendantaliste dirigé par Margaret Fuller. Pendant quatre ans, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, Thoreau fournit plusieurs textes à cette revue. Pour Michel Granger, c'est à ce moment que Thoreau réalise ce qu'il veut réellement faire dans la vie. Il s'émancipe quelque peu du transcendantalisme, devient moins malléable et, même, dépasse son initiateur et mentor Emerson. Mais Thoreau se voit avant tout comme un poète, ayant choisi de pratiquer le genre dès 1839 et ce jusqu'en 1842. Par ailleurs, Henri David et John tombent amoureux de la même jeune fille, Ellen Sewall. John lui propose de l'épouser puis Henry quelques mois plus tard mais celle-ci refuse les deux propositions, obéissant à son père et les éconduit l’un et l’autre. En 1841, l'école des frères Thoreau, bien qu'ayant un certain succès, ferme ses portes. Ce fut alors le dernier emploi stable occupé par Thoreau selon Gilles Farcet. Thoreau séjourne alors deux ans chez Emerson, à Concord, comme tuteur de son fils, Waldo, et travaille comme assistant éditorial et comme manœuvre-jardinier. Encouragé par Emerson et Fuller, il continue d'écrire dans la revue transcendantaliste The Dial mais aussi pour d'autres magazines. Cependant, s'il contribue à la revue transcendantaliste The Dial … jamais il n'envisage de se joindre aux communautés qui naissent alors aux alentours relativise Gilles Farcet. Il donne cependant des conférences au Lyceum de Concord, participant au développement du courant transcendantaliste. Il fait cette année-là la connaissance du poète américain Nathaniel Hawthorne qui vient de s'installer à Concord. Son frère John meurt du tétanos le 12 janvier 1842. Thoreau en est profondément affecté. Il publie la même année L'Histoire naturelle du Massachusetts, ouvrage en partie critique de livre et en partie essai d'histoire naturelle. Emerson et Thoreau sont alors très proches car au moment où ce dernier perd son frère, le fils d'Emerson, âgé de six ans, meurt de la scarlatine. En 1843 Thoreau quitte Concord pour Staten Island, dans l'État de New York où il devient le tuteur des enfants de William Emerson, le frère de Ralph. Il y apprécie la flore locale très différente de celle de son village et découvre l'océan et la ville de New York. Habiter chez William Emerson lui permet d'accéder à la New York Society Library où il découvre des œuvres de littérature orientale peu communes à l'époque aux États-Unis. Il rencontre aussi Horace Greeley, fondateur du New York Tribune, qui l'aide à publier certains de ses travaux et qui devient son agent littéraire. À la demande d'Emerson, Thoreau rédige un long article au sujet du livre de John Adolphus Etzler, Le Paradis à reconquérir Paradise to be regained, dans The United States Magazine, and Democratic Review, étude qui porte en germe toute la réflexion qui nourrit par la suite ses livres engagés. Après une année à New York, Thoreau se trouve peu d'affinité intellectuelle avec William Emerson, et Concord lui manque. Il y rentre donc pour travailler dans l'usine familiale de crayons. Il applique alors un processus produisant de meilleures mines de crayons, en utilisant de l'argile comme liant pour le graphite, technique exploitée dans le New Hampshire depuis la découverte de minerai supérieur, en 1821, par l'oncle de Thoreau, Charles Dunbar et qui a su exploiter le gisement aux alentours de Bristol. Plus tard, Thoreau transforme l'atelier en usine de production de graphite pour encre de machines de typographie. Il semble que l'air chargé en poussière de graphite ait endommagé ses poumons plus gravement que la tuberculose de laquelle il décèdera par la suite. En 1844, en avril, avec son ami Edward Hoar, il déclenche accidentellement un incendie qui ravage environ 120 hectares des bois de Walden, autour de l'étang. Il s'attire alors la méfiance des habitants, puis, souhaitant disparaître quelque temps, aide son père à construire une nouvelle maison familiale. Il parle souvent d'acheter ou de louer une ferme, afin de vivre de peu de moyens et dans la solitude, cadre idéal à la conception de son premier livre. Pour Thoreau, il devient en effet fondamental de gagner sa vie sans aliéner sa liberté ni exercer une activité incompatible avec son idéal, question cruciale formant la trame de Walden. Vie à Walden et excursions 1844-1849 Fin 1844, Emerson achète un terrain autour de l'étang de Walden et le met à la disposition de Thoreau qui souhaite se retirer au calme pour écrire. En mars 1845, il commence la fabrication d'une cabane de pin, sur les rives de l'étang, à 2,4 km de sa maison natale. C'est le début d'une expérience qui dure deux ans, menée en autarcie Thoreau a planté 1 hectare de pommes de terre, de fèves, de blé et de maïs, et qu'il raconte dans son livre Walden ou la vie dans les bois Walden or Life in the Woods. D'après Michel Granger, Thoreau fait une retraite à Walden Pond car il a cherché à disparaître momentanément de la vie de Concord, sa ville natale. Il débute aussi la rédaction de Une Semaine sur les rivières Concord et Merrimack A Week on the Concord and Merrimack Rivers, son premier succès littéraire. Thoreau veut vivre simplement et seul dans les bois, y mener une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité, et de confiance. Il dort dans sa cabane dès la nuit du 4 juillet 1845, jour anniversaire de la Déclaration d’Indépendance aux États-Unis. Pour Michel Granger, il s'agit de l'acte fondateur de sa célébrité qui tient à la décision de s'installer un peu à l'écart de Concord en 1845 : il s'est déplacé hors du village, s'est excentré symboliquement. Il ne s'agit alors pas d'une fugue ou d'une vie d'ermite, puisque l'écrivain revenait souvent voir ses amis, mais d'un choix délibéré qui rappelle par bien des côtés l'expérience faite par Jean-Jacques Rousseau dans la forêt d'Ermenonville. Thoreau donne à ses contemporains l'exemple d'un rapport actif avec la nature, en dehors de toute contemplation romantique et s'élève contre la société à laquelle il oppose le concept de simplicité volontaire. Le 25 juillet 1846, Sam Staples, agent de recouvrements des impôts locaux lui ordonne de payer six ans d'arriérés. Thoreau, qui refuse de payer ses impôts à un État qui admet l'esclavage et fait la guerre au Mexique, est arrêté alors qu'il se rend chez son cordonnier puis emprisonné durant une nuit, mais relâché le jour suivant, une de ses tantes ayant payé, contre son gré, les arriérés à sa place. Cet événement marque la pensée de Thoreau et nourrit ses réflexions qui constitueront son essai politique, La Désobéissance civile. En septembre il effectue une excursion dans le Maine puis, à son retour à Walden, il accueille dans sa cabane le 1er août, pour la commémoration de l’émancipation des esclaves aux Antilles, l’assemblée générale des anti-esclavagistes de sa commune. En août 1846, Thoreau quitte Walden pour aller au mont Katahdin dans le Maine, excursion racontée dans le premier chapitre de The Maine Woods, Ktaadn et qui représente un modèle d'écriture poétique dans la littérature américaine de l'époque. Thoreau quitte définitivement sa retraite de Walden Pond le 6 septembre 1847 et retourne habiter chez Emerson chez qui il reste jusqu'en juillet 1848. Pendant le voyage du philosophe en Angleterre, il s’occupe en effet de sa maison durant dix mois et commence à prendre des notes sur les Indiens d’Amérique. Il produit ainsi près de 3 000 pages de citations et de notes, entre 1847 et 1861. Il décide ensuite de retourner dans la maison de ses parents pour travailler et payer ses dettes, tout en révisant continuellement son manuscrit. Il donne la première de ses conférences sur son séjour à Walden, intitulée Histoire de moi-même, à Concord et qui procure à Thoreau les quelques éléments qui forment le début actuel de Walden. En janvier et février 1848 il fait une lecture célèbre, intitulée Les droits et les devoirs de l'individu en relation au gouvernement au Concord Lyceum. Amos Bronson Alcott y assiste et, dans son journal intime, donne de précieux renseignements sur ces conférences, même si Thoreau réécrit et modifie par la suite le texte de sa conférence pour son livre La Désobéissance civile, publié en mai 1849 par Elizabeth Peabody dans ses Aesthetic Papers. L'année suivante il retourne vivre chez ses parents et travaille avec son père. Ponctuellement il effectue des travaux d'arpentage et de peinture de bâtiments. Il marche aussi pendant de longues heures. Chaque année il donne des conférences à Concord et à Boston et même dans le Maine. Il publie également des essais dans des magazines de Nouvelle-Angleterre. Devenant quasiment un gourou, il reçoit des admirateurs, souvent jeunes, fascinés par l'aventure de Walden. Il complète le premier brouillon de Une Semaine sur les rivières Concord et Merrimack, une élégie dédiée à son frère John, décrivant leur voyage aux montagnes Blanches en 1839. Faute d'éditeur voulant publier cette œuvre, Emerson l'encourage à l'éditer à son propre compte, ce que Thoreau fait avec l'éditeur d'Emerson, Munroe. Ce dernier fait peu de publicité pour le livre, qui se vend donc mal et endette Thoreau qui finit par se brouiller avec son ancien ami Emerson. Néanmoins, en 1849, Thoreau annonce la publication prochaine de Walden dont il a déjà rédigé trois versions. Il rencontre H.G.O. Blake, un instituteur avec qui il entretient une abondante et riche correspondance et qui le soutient dans son projet d'écrire sur son séjour dans les bois. Il effectue enfin une excursion à cap Cod, en compagnie de William Ellery Channing. À cette époque, Thoreau est de nouveau endeuillé : sa sœur Helen meurt des suites d'une tuberculose. Dernières années 1850-1862 En 1850 la famille Thoreau emménage dans une maison de la rue principale de Concord. En juillet, l'auteur de Walden se rend à Fire Island pour rapatrier la dépouille de son amie transcendantaliste Margaret Fuller, morte au cours d'un naufrage. Il part ensuite au Québec avec William Ellery Channing toujours, en train. Il proteste, en 1851, contre les lois esclavagistes et aide même des esclaves à fuir vers le Canada. La même année, il admire le naturaliste William Bartram et surtout Charles Darwin dont il découvre et soutient les travaux ; il lit en particulier son livre, Le Voyage du Beagle. Fasciné par l'histoire naturelle et les livres de voyages ou d'expéditions, il se documente beaucoup sur la botanique. Son journal intime abonde en observations naturalistes, sur la flore surtout, celle des bois de Concord, et note diverses informations comme le temps que prennent les fruits pour mûrir, la profondeur fluctuante de l'étang de Walden, les dates des migrations aviaires. Il cherche même à mesurer et à anticiper les saisons. En 1852, il met la dernière main au manuscrit de Walden, écrit en partie grâce à son Journal. Il devient ensuite géomètre-expert et continue à remplir ses cahiers d'observations détaillées quant au paysage de Concord et ce sur une zone de 67 km2. Il tient aussi des carnets qui seront la base de ses écrits sur l'histoire naturelle, dont Autumnal Tints, The Succession of Trees, et Wild Apples, un essai sur la destruction d'espèces de pommes locales. Pour Donald Worster, après 1850, paradoxalement il est encore plus proche de la nature qu'à Walden du fait de ses observations minutieuses. En 1853, il publie la première partie du roman de voyage Un Yankee au Canada, définitivement édité en 1866. Par ailleurs l'entreprise paternelle connaît des difficultés : la fabrication de crayons est stoppée et son père ne produit plus que de la plombagine. Thoreau est lassé de cette activité qui le détourne de ses véritables occupations spirituelles. Il décline par ailleurs l'invitation de l'American Association for the Advancement of Science, ne se considérant pas comme scientifique et se méfiant de l'élitisme. Thoreau donne le 4 juillet 1854 une conférence qui forme les essais L'Esclavage dans le Massachusetts et La Vie sans principe. En février et mars il rédige la septième version de Walden et prépare le manuscrit pour l'éditeur. Il rend visite à Daniel Ricketson, un admirateur de New Bedford, qui rejoint par la suite le mouvement transcendantaliste. Il remet enfin la septième version de Walden à l'éditeur Ticknor and Fields, qui est publié en août 1854, tiré à 2 000 exemplaires, et qui raconte les deux ans, deux mois et deux jours passés dans la forêt aux alentours de l'étang de Walden, non loin de ses amis et de sa famille, à Concord. Le livre qui condense ces deux années en une seule, utilisant le passage des quatre saisons comme symbole du développement de soi. Walden est d'abord tiré à 2 000 exemplaires, vendu chacun pour 1 $48, mais le stock ne sera écoulé qu'en 1859. La première année, toutefois, 1 750 unités sont vendues, ce qui constitue le premier succès littéraire de Thoreau. En 1855, il reçoit d'un jeune anglais Thomas Cholmondeley, venu rencontrer Emerson, 44 livres orientaux. Thoreau se passionne en effet, depuis 1841 et grâce à Emerson, pour l'orientalisme et pour le bouddhisme, mais aussi pour la culture des Indiens d'Amérique. Il a ainsi pris connaissance des grands textes de la spiritualité indienne dont le Bhagavad-Gîtâ et le Manavadharmashastra. Il effectue des traductions de ces textes et en publie des passages dans The Dial. Thoreau a alors la plus belle bibliothèque orientale en Amérique. Thoreau publie ensuite ses premiers essais sur la péninsule de Cape Cod, où il se rend pour une troisième excursion. En novembre 1856, il rend visite au poète Walt Whitman, à Brooklyn, lors d'une excursion en compagnie d'Alcott à New York. Dans une lettre à Harrison Blake, du 19 novembre, Thoreau le décrit comme le plus grand démocrate que le monde ait connu. En 1857, il effectue sa quatrième excursion au Cape Cod, puis il se rend pour la dernière fois dans le Maine, en compagnie d'un guide indien, Joe Polis. Il rencontre à Concord le capitaine abolitionniste John Brown, dont il prend la défense par la suite. Son amitié avec Emerson prend fin en février. En 1858, le journal l’Atlantic Monthly publie son texte Chesuncook, en l'hommage de la beauté du lac du même nom, dans le Maine, qui forme la seconde partie des Forêts du Maine, publié en 1864. En 1859, le père de Thoreau meurt et celui-ci reprend la direction la fabrique de graphite. Il prend position en faveur de John Brown, après que celui-ci est capturé à Harpers Ferry, après l’attaque ratée de l’arsenal. Adoptant une attitude agressivement militante, il donne alors des conférences intitulées Le Martyre de John Brown. En 1859, Thoreau prononce l'éloge funèbre de l'abolitionniste, lors d'un office à Concord, le 2 décembre 1859, date de son exécution, puis à Boston et à Worcester. Le texte forme en partie l'ouvrage Plaidoyer pour John Brown. Thoreau fustige ceux du mouvement abolitionniste qui en sont venus à renier John Brown à la suite de son raid à Harpers Ferry. Une tuberculose contractée en 1835 se ravive en 1859 par une bronchite qui survient après une excursion de nuit où il était allé compter les cernes des chicots d'arbres tombés lors d'une tempête. Son état de santé empire durant trois ans, malgré de brefs rétablissements, jusqu'à ce qu'il ne puisse se mouvoir et qu'il soit obligé de s'aliter. Sentant sa fin venir, Thoreau passe les dernières années de sa vie à réviser et éditer ses œuvres non encore publiées, dont Excursions et The Maine Woods, ainsi qu'à demander à des maisons d'édition de rééditer A Week on the Concord and Merrimack Rivers et Walden. Thoreau publie en juillet 1860 Les Derniers jours de John Brown. Il effectue aussi sa dernière excursion, au mont Monadnock, dans le New Hampshire, en compagnie de son ami William Ellery Channing. Il donne des conférences concernant la succession des essences d'arbres, qui forme l'ouvrage La Succession des arbres en forêt. Apportant la preuve que l'on peut améliorer la couverture boisée autour du village, il contribue à la fois à accroître la rentabilité des forêts et à préserver l'espace naturel pour les générations à venir explique Michel Granger. La tombe d'Henry David Thoreau, au cimetière de Sleepy Hollow. De gauche à droite : John Thoreau, père de Henry David, Henry, Sophia, Cynthia sa mère. En décembre, son état de santé empire. De mai à juillet 1861, il voyage dans le Minnesota avec Horace Mann Jr., un botaniste. Il visite ainsi la région des Grands Lacs chutes du Niagara, Détroit, Chicago, Milwaukee, Saint Paul et l'île Mackinac. L'essai De la marche Walking est publié en 1862 dans la revue The Atlantic Monthly. Revenu à Concord très affaibli, Thoreau décide de préparer, avec l'aide de sa sœur Sophia, ses manuscrits en vue de leurs publications. Il passe beaucoup de temps à écrire des lettres et à poursuivre son journal intime jusqu'à ce qu'il soit trop frêle pour écrire. Ses amis sont étonnés de son aspect fort diminué et fascinés par son acceptation tranquille de la mort. Quand sa tante Louisa lui demande dans les dernières semaines de sa vie s'il avait fait sa paix avec Dieu, Thoreau lui répond tout simplement Je ne savais pas qu'on s'était disputé. Henry David Thoreau meurt le 6 mai 1862 à Concord, à 44 ans. Il est resté célibataire toute sa vie durant. Il est mis en terre le 9 mai. D'abord enterré dans le caveau familial du côté maternel les Dunbar, lui et ses parents immédiats sont transférés au cimetière de Sleepy Hollow, à Concord. C'est Ralph Waldo Emerson qui prononce son éloge funèbre56 dans lequel le philosophe résume la vie de l'auteur de Walden par cette phrase : En entendant formuler une proposition, on eût dit qu'un instinct le poussait d'emblée à la contester. La majorité de ses œuvres sont publiées de manière posthume : Les Forêts du Maine en 1864, Cape Cod en 1865, en 1894 ce sont onze volumes d’écrits qui sont publiés chez Riverside, puis en 1906 les Éditions Walden en vingt volumes récapitulent ses travaux. Son œuvre Principaux écrits L'ensemble des travaux de Thoreau peut se diviser en deux groupes : les essais politiques ou moraux et les récits de voyage à tendance naturaliste. Quatre œuvres constituent les écrits fondamentaux de Thoreau. Walden ou la vie dans les bois. Souvent abrégé par Walden, le récit Walden ou la vie dans les bois Walden or Life in the woods est l'œuvre majeure de Thoreau, celle que le public retient continuellement. Traduit par Louis Fabulet, par l'entremise d'André Gide, ce n'est ni un roman ni une véritable autobiographie mais une critique du monde occidental, le récit d'un voyageur immobile narrant sa révolte solitaire. Pour Kathryn VanSpanckeren, Walden est un guide de vie selon l’idéal classique. Mêlant poésie et philosophie, ce long essai met le lecteur au défi de se pencher sur sa vie et de la vivre dans l’authenticité. La construction de la cabane, décrite en détail, n’est qu’une métaphore illustrant l’édification attentive de l’âme, modèle du caractère américain. Fin 1844, le philosophe Ralph Waldo Emerson, ami et mentor de Thoreau, achète un terrain autour de l'étang de Walden localisé à Concord, dans le Massachusetts aux États-Unis et le met à sa disposition. Thoreau souhaite en effet se retirer au calme pour écrire mais il ne demeure pas toujours seul. De nombreux amis dont William Ellery Channing qui séjourne avec lui à l'automne 1845 ainsi que des admirateurs lui rendent souvent visite. D'après Michel Granger, Thoreau fait une retraite à Walden Pond car il a cherché à disparaître momentanément de la vie de Concord, sa ville natale. Il a en effet mis le feu par inadvertance à une partie de la forêt voisine. D'autre part et outre cette volonté de redevenir respectable, la plus forte motivation de Thoreau était de nature historique : il voulait reconstituer sa demeure dans l'état où elle était il y a trois siècles avant l'irruption de l'homme blanc sur le sol américain. Toutefois, selon Leo Stoller, c'est un profond dégoût pour la société des hommes, et particulièrement pour les habitants de Concord, qui conduit Thoreau à refuser leur existence occupée à poursuivre la subsistance quotidienne, pervertissant de fait leur liberté dans le désespoir. Le choix de Thoreau se porte donc sur l'étang de Walden, car il constitue un lieu ni trop à l'écart ni trop proche du monde des hommes. De plus, il en connaît l'existence depuis son enfance et demeure pour lui un lieu mystérieux. Il se retire donc dans une clairière sur les rives de l'étang, lieu intermédiaire à la fois emmuré Walled-in selon son expression et suffisamment vaste pour qu’il dispose d’une marge protectrice, mais ne soit pas pour autant séparé de la nature par une barrière. Dans cet espace baptisé en sa mémoire Thoreau's Cove, remarque Michel Granger, l’humain et le non-humain s’y interpénètrent et le lieu est propice aux personnifications romantiques ainsi les aiguilles de pin, par exemple, se dilatent pour lui témoigner leur sympathie lorsqu'il s'y installe. La Désobéissance civile C’est seulement en 1849, dans Résistance au gouvernement civil, intitulé ultérieurement, de façon posthume, La Désobéissance civile Civil Disobedience, que Thoreau met par écrit ses positions politiques et idéologiques. Prenant comme point de départ son incarcération de courte durée pour avoir refusé de payer l'impôt, il y prône la résistance passive en tant que moyen de protestation. Cet engagement passif se situe d’abord sur le plan individuel selon lui : La seule obligation qui m'incombe est de faire en tout temps ce que j'estime juste explique-t-il. Il y proclame son refus de soutenir le gouvernement américain, qui tolère l’esclavagisme et mène une guerre de conquête au Mexique, contre tous les droits individuels et contre toute morale. L’essai eut une grande influence sur deux personnalités de la non-violence : le Mahatma Gandhi et Martin Luther King, et, de façon générale sur tous les courants de résistance, y compris au Danemark, durant la Seconde Guerre mondiale, alors sous la domination nazie. Les Forêts du Maine et autres récits de voyage Dans Les Forêts du Maine, Henry David Thoreau a rassemblé les récits des voyages qu'il a menés dans les forêts du nord-est des États-Unis en 1846, 1853 et 1857. Il y décrit le mont Ktaadn de façon romantique et étudie la manière de vivre des pionniers et des Indiens. L'ensemble de ces ouvrages témoignent d'une connaissance botanique et naturaliste fine et éclairée, même si la vision de la nature y est toujours personnifiée ou idéalisée comme le montre le critique Roderick Nash, dans Wilderness and the American Mind. L’activité de naturaliste qui a occupé une grande partie de la dernière décennie de l’écrivain, même si celui-ci n'a pu en assembler les matériaux avant sa mort, y est très présente. Dans l'appendice des Forêts du Maine Thoreau liste des noms de plantes, d’arbres ou d’oiseaux, et relève des mots en langue algonquine, faisant par là, avant l'heure, œuvre d'ethnologue. Le recueil Wild Apples and Other Natural History Essays est une édition moderne des divers essais que Thoreau a consacré à la nature pendant une vingtaine d’années précédemment publiés sous le titre Excursions en 1962 et rassemblant les essais : Natural History of Massachusetts, A Walk to Wachusett, A Winter Walk, Walking traduit en français sous le titre De la marche, The Succession of Forest Trees, Autumnal Tints, Wild Apples et Night and Moonlight. Thoreau s'y dévoile comme étant un véritable scientifique, étudiant scrupuleusement les phénomènes naturels. Enfin Cape Cod publié en 1865 compile impressions naturalistes et étude de la faune et de la flore de la péninsule du même nom où Thoreau se rendit par trois fois. À ces textes il faut y ajouter, selon Michel Granger, les quelque 7 000 pages du Journal qui, à partir du début des années 1850 recueillent ses observations de la nature selon une approche de plus en plus empirique. Journal Le Journal est un ouvrage élaboré durant 20 ans, du 22 octobre 1837, sur la suggestion de Ralph Waldo Emerson, au 3 novembre 1861 et s'étalant sur 14 volumes. Thoreau, qui l'intitule in petto le calendrier des marées de l'âme y rassemble notes, poèmes, compte rendus, états d’âme, herborisations, réflexions morales ou politiques, tous matériaux nourrissant ses autres ouvrages ; pour Gilles Farcet il est sans doute le seul travail auquel il se consacra régulièrement, presque tous les jours de sa vie. Selon François Specq, le journal de Thoreau est d'un genre singulier : loin d'un journal intime voué à analyser les tours et détours de la personnalité de l'individu, il s'est donné pour unique objet … d'explorer la nature des environs de Concord, Massachusetts. Poétique et thématiques Poétique et stylistique Thoreau est un auteur protéiforme. Walden ou la vie dans les bois est ainsi à la croisée de plusieurs genres littéraires essai et roman mais aussi autobiographie ; c'est un patchwork textuel proche de la robinsonnade, qui alterne avec la description, la narration, et même avec l'épopée ; la vision du combat de fourmis comparées à des guerriers antiques en est un exemple. Michel Granger parle d'écologie littéraire dont Thoreau est véritablement le père. Le mélange d'essais, d'observations et de passages poétiques, désigné en littérature américaine sous le mot de nature writing, en fait par conséquent le précurseur du genre81 des romans naturalistes mais aussi des manuels d'art de vivre. D'un point de vue stylistique, Thoreau maîtrise les ressorts de la langue américaine. Utilisant le contraste entre l'élément primitif propre à la nature wilderness : le sauvage au sens d'espace vierge, et l'élément technique, propre à la société tameness : le domestique, il a souvent recours à l'étymologie et aux métaphores organiques, les plus proches des phénomènes naturels. Les textes de Thoreau sont souvent parsemés de passages poétiques, soit de sa confection, soit emprunté à d'illustres poètes. Cette prose travaillée devient pour Thoreau un instrument poétique supérieur qui lui permet de suggérer la diversité des phénomènes naturels, par la musicalité et parfois les onomatopées. La fonction des poèmes est aussi d'obliger le lecteur à faire une pause, afin d'ouvrir un temps nécessaire à la méditation. En dépit de ce rythme poétique, la pensée de Thoreau est très vive, toujours en mouvement, didactique et érudite, faites d'accumulation d'expressions frappantes et de paradoxes surtout telle la citation très connue : le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins. Les aphorismes que la conscience collective retient en effet sont souvent paradoxaux et percutants. Son souci est en effet d'établir les fondements d'une expression vraie. Thématiques Préserver l'environnement Bien qu'antérieur au mouvement écologiste, Thoreau est conscient que l'environnement doit être préservé et qu'il peut permettre à l'humanité d'atteindre le véritable progrès. Selon Donald Worster les sentiments envers la nature exprimés par Thoreau dans ces volumes constituent son leg le plus important aux générations futures. Il possède même une réelle érudition en la matière écologique naissante. Il a en effet lu divers ouvrages de botanique dont le Plants of Boston and Vicinity de Bigelowe et, à Harvard, il lit le traité physico-théologique de William Smellie, The Philosophy of Natural History. Ses modèles sont Gilbert White et Carl von Linné puis Alexander von Humboldt. Ainsi, dans un essai, Le Paradis à reconquérir, Thoreau passe en revue les sources d'énergie possibles, telles l'énergie des vagues, celle provenant du soleil ou l'éolien. Quand il découvre la théorie de l'évolution des espèces de Charles Darwin, par l'intermédiaire de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Thoreau l'adopte immédiatement. Ses propositions, notamment lors de la conférence sur La Succession des arbres, conférence donnée à l'exposition bovine de la Middlesex Agricultural Society en font également un protecteur de l'environnement. En effet, déjà à cette époque l'homme réduit les espaces boisés : en 1880, il ne restait plus que 40 % de terres boisées dans le Massachusetts. Thoreau avertit ses concitoyens de ce danger et milite en faveur d'une utilisation rationnelle des ressources et de la protection de la faune et de la flore. Thoreau se passionne ainsi l'écologie de la graine et, à force d'observations attentives, découvre que les écureuils, en transportant loin les graines, permettent de renouveler les espèces d'arbres. Par son désir de retrouver la forêt primitive, Thoreau appartient sans conteste à la tradition arcadienne de la pensée écologique. Sa biographie et son œuvre donnent un exemple parfait de l'attitude romantique envers la terre et de la philosophie de plus en plus complexe et sophistiquée de l'écologie. Thoreau constitue une remarquable source d'inspiration et de référence pour l'activisme subversif du mouvement écologique actuel explique Donald Worster. Éthique et nature La référence éthique à la nature traverse toutes ses œuvres, à tel point que Michel Granger parle, reliant cette adoration quelque peu naïve parfois aux éléments biographiques de l'écrivain, d'une sublimation compensatrice envers sa mère. Thoreau montre constamment que la distinction humain/non-humain, fondée sur des préjugés, est bien ténue ; dans sa vision, la nature s'humanise, tandis que l'homme valorisé se naturalise. Il insiste ainsi sur le caractère thérapeutique de la nature qui lui fournit aussi une sécurité affective96, notamment dans sa relation avec la femme. Cette proximité intime avec la nature, quasi personnifiée, lui permet de lutter contre toute tentation charnelle et l'aide à demeurer lié au réel. De cette position, Thoreau entrevoit une nouvelle éthique qui lui permettrait de se laver de la souillure pour aller vers la spiritualité en commençant par reconnaître le corps nié, réconcilier le divin et la brute en somme. Cette éthique est une synthèse plutôt qu'une rupture totale et misanthrope ; s'affichant comme un promeneur oisif au pays de l'éthique protestante du travail, insistant sur la primauté du loisir et de la contemplation, Thoreau ambitionne de créer une raison qui prétend aussi régenter, avec la même sûreté et un égal bonheur le champ de ce que l'on appelait naguère encore la vie morale. Cette éthique thoreauvienne est marquée par son puritanisme et s'affiche comme une véritable foi puisque le narrateur de Walden est profondément convaincu de l'omniprésence de la morale au cœur de toute existence. Économie de vie et résistance L'activité intellectuelle de Concord ne suffit pas à combler Thoreau qui trouve difficilement sa place dans une société où la religion manque de spiritualité et d'émotion, où le conformisme est oppressant et les préoccupations commerciales envahissantes. Sa vocation littéraire n'étant pas reconnue, il fait retraite, le 4 juillet 1845, dans une cabane construite de ses mains au bord du lac de Walden, à un mile de chez ses parents. Dans ce refuge pastoral, il disposera jusqu'en septembre 1847 du calme nécessaire pour se consacrer à l'écriture et jouir de l'immersion dans la nature. Son isolement intrigue ses concitoyens qui l'interrogent sur le sens de son mode de vie : Thoreau répond par une conférence qui servira d'embryon à Walden l854. Dans le long premier chapitre, Économie, il décrit comment gagner sa vie sans aliéner sa liberté, et explique quel dépouillement est nécessaire pour se dégager de l'emprise délétère de la société. Dans des pages polémiques, il détaille ses griefs contre la vie moderne et propose un contre-modèle que chacun devra adapter à son individualité. Il procède au renversement systématique de la hiérarchie des valeurs communément admises, décape les préjugés, replace les mots quotidiens au contact de la réalité nue. Ainsi, au pays de l'éthique protestante du travail, il transforme l'oisiveté en une vertu créatrice, parce qu'elle permet de s'éloigner de l'affairement lucratif. Le personnage partiellement fictif de Walden met en scène sa résistance à l'opinion dominante et s'arrache aux déterminations de la tradition. On reprochera à cette économie de vie son hypermoralisme rigide, ses certitudes qui étouffent l'écrivain plus nuancé du Journal. Mais il faut comprendre que les paradoxes provocateurs visent à réveiller le lecteur pour l'amener à penser par lui-même. Sa croyance transcendantaliste en la culture de soi conduit Thoreau à l'objection de conscience, refus intransigeant de compromettre sa pureté morale en collaborant avec un gouvernement inique : dans les années 1840, il cesse de payer l'impôt qui apporterait un soutien indirect à l'esclavage. Il est finalement emprisonné une nuit en 1846, et va faire de cet épisode le centre de Résistance au gouvernement civil, Resistance to Civil Government, 1849, geste significatif d'objection individuelle susceptible d'entraîner d'autres citoyens à bloquer la machine politique en ne la finançant pas ; il fournira ainsi un argumentaire pour la désobéissance civile de Gandhi et du pasteur King qui, eux, chercheront à déclencher un mouvement de masse. Cette résistance se révèle intenable face aux sudistes qui forcent le Nord à participer à la chasse aux esclaves en fuite. Dans la décennie suivante, Thoreau sort de son relatif apolitisme : il soutient l'action antiesclavagiste de John Brown et en vient dans Plaidoyer pour le capitaine John Brown A Plea for Captain John Brown, 1859 à accepter que l'on puisse recourir à la violence. En dehors de quelques conférences et articles, Thoreau ne milite pas pour la cause abolitionniste, et se refuse à participer à une action concertée. Lorsqu'il se sent responsable vis-à-vis de l'injustice sociale, il privilégie l'éducation politique de ses lecteurs, réduite à la dénonciation de l'esclavage intérieur. Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=9222#forumpost9222
#159
Henry-David Thoreau 2
Loriane
Posté le : 11/07/2015 18:45
Écriture de soi, écriture de la nature
Moins motivé par la transformation de la société que par le corps à corps avec le langage, Thoreau rédige sept versions de Walden de 1846 à 1854. Afin de raviver le pouvoir évocateur des mots, il recourt à l'étymologie, fait surgir des sens oubliés, définit ses termes, utilise un vocabulaire archaïque ou indigène ; il s'engage parfois dans une rêverie sur la sonorité des mots, sur la forme des lettres et leur expressivité. Ce travail poétique vise à créer une langue personnelle, sensuelle, qui permette l'énonciation de la subjectivité. L'écriture exploratoire s'ouvre aux zones d'ombre de l'écrivain, à ce qui n'est pas maîtrisé en lui et accepte le risque de l'obscurité. Le texte poétique fait craquer le carcan des intentions moralisatrices pour laisser entendre le deuil d'objets perdus, sur fond de désespoir contenu. La description des paysages dans lesquels il se projette l'aide à s'approcher de l'inconnu en lui. L'immense Journal révèle un besoin quotidien d'écriture. Après 1850, il devient un projet littéraire indépendant un journal météorologique de l'esprit où l'écrivain consigne les fluctuations de sa pensée au rythme des saisons, mais s'abstient de toute confidence. Dans ce qui devient le lieu d'une réflexion sur soi et sur sa relation à la nature, Thoreau s'interroge sur la perception du monde et sa représentation. L'écriture fragmentaire, instable, contradictoire, témoigne ici d'une pensée en mouvement. Thoreau a aussi pris le temps de canaliser sa pensée et de rédiger des récits de voyage pour des magazines ; ils ont été regroupés en livre après sa mort. Les Forêts du Maine The Maine Woods raconte ses excursions dans la nature primitive du Nord-Est, sa confrontation avec la montagne inhospitalière et ses contacts avec un guide indien dont il veut partager le savoir sur la forêt. Cap Cod offre la vision de l'horizontalité lugubre d'un paysage marin où il rencontre épaves et cadavres : de froides descriptions de plages rendent compte de cette vaste morgue ; il y joint des anecdotes sur les habitants et des considérations sur l'histoire de la province. Écologie littéraire Sa vie durant, Thoreau sera animé par la passion de la nature sauvage et il écrira un bel essai à sa gloire, Marcher (Walking). Il fera de la nature son principal sujet d'écriture au point qu'on lui reconnaît la paternité d'un genre littéraire : nature writing, où se mêlent sensibilité poétique, savoir scientifique et militantisme en faveur de la protection de l'environnement. Après 1855 surtout, le Journal abonde en descriptions détaillées, caractérisées par la nomination exacte des plantes, parfois complétées de petits schémas maladroits lorsque le langage manque de précision. Bien qu'il résiste à la professionnalisation de la science, Thoreau accorde moins de place à la subjectivité de l'observation : il prend appui sur le réel, méthodiquement perçu et mesuré. Influencé par ses contacts avec des botanistes de Harvard et ses lectures d'œuvres scientifiques, dont celle déterminante du naturaliste allemand Alexander von Humboldt, il dresse des inventaires de la faune et de la flore, date ses découvertes, insiste sur les phénomènes de transition, les variations, les répétitions : l'accumulation de faits bruts donne lieu à des listes et des tableaux. À force d'observations, il perçoit l'interaction entre plantes et animaux dans un biotope donné, avance des lois qui régissent un réseau de phénomènes comme la succession des arbres dans une forêt, ou la dispersion des graines. Le travail sur la fertilité de la nature l'amène à réfuter le créationnisme et l'idée de génération spontanée défendus par Louis Agassiz ; aussi, lorsqu'en 1860 il lit L'Origine des espèces, il accepte sans réserve l'hypothèse de Darwin. Naturaliste amateur, il participe au débat d'idées scientifiques, et ses études de limnologie et de phénologie seront reconnues. Son intérêt pour la nature conserve toujours une visée humaniste : il considère indispensable de sauvegarder cet environnement essentiel aux hommes. Dans l'essai sur les fruits sauvages Wild Fruits, il appelle à préserver le patrimoine sauvage et suggère de créer des parcs naturels, lieux de régénération pour l'humanité future. À l'heure où les Américains négligent les grands écrivains de la Renaissance américaine, Thoreau reste présent comme un précurseur de la dissidence écologique et un résistant aux pouvoirs économiques destructeurs de la nature. Michel Granger Solitude et émerveillement Accusé souvent de misanthropie, Thoreau prône un art de vivre fondé sur l'écoute de soi, ce qu'il nomme le matin intérieur, proche d'un état d'innocence. Pour Michel Granger, il est possible que Thoreau soit devenu solitaire en raison de sa responsabilité dans la destruction accidentelle par incendie d'une partie de la forêt de Concord, incident qui lui a valu la critique des autres habitants. Il décide en effet de s'installer à Walden juste après cet événement et dès lors il fait de la solitude une bonne compagnie. Demeurer seul permet non seulement d'étudier la nature mais aussi et surtout de s'émerveiller ; en effet pour Gilles Farcet, Thoreau est naïf en ceci qu'il n'a rien perdu de son aptitude à l'émerveillement. Célibataire toute sa vie durant, cet état d'ermite ne l'empêche pas d'avoir des sentiments philanthropiques puisqu'il défend avec empathie et sensibilité pour l'humanité souffrante, l'abolitionnisme et aide des esclaves à gagner leur liberté au Canada. Critique de l'économie et de la société industrielle Peu après l'expérience de Walden, Thoreau publie le texte d'une conférence, La vie gaspillée qui forme l'essai publié en 1854 de La Vie sans principe. Dans ce texte, il attaque vivement l'économie et la société industrielle. Il réaffirme les valeurs éthiques liées à l'individualisme contre celles véhiculées par l'État. Il dit ainsi dans La Désobéissance civile : Je pense que nous devons être des hommes, des sujets ensuite. Il ne voit face à cet envahissement de la sphère privée que deux solutions : la désobéissance civile d'une part, l'usage de la force d'autre part, possibilité qu'il n'évoque néanmoins que timidement. En ce sens, Thoreau a été considéré, par toute une frange des penseurs modernes de cette pensée, comme un anarchiste. Comme le rappelle Guillaume Villeneuve l'ambition de Thoreau est spirituelle, soucieuse de transformation intérieure : l'ennemi est en nous, non à l'extérieur. La violence doit d'abord s'exercer sur nous …. Sources et réception Sources d'inspiration Un héritage classique Thoreau a été influencé par ses lectures orientales sur le bouddhisme et l'hindouisme telles que la Bhagavad-Gîtâ. Dans Walden, il fait à de très nombreuses reprises référence aux mythologies grecque, romaine ou nordique. Comme l'a montré Stanley Cavell, Thoreau cite aussi beaucoup les évangiles. Ses théories sont également proches du cynisme on a ainsi souvent comparé Thoreau au philosophe Diogène et du stoïcisme. La pensée de Thoreau est modelée par deux héritages principaux selon Michel Granger. L'humanisme européen d'une part car, un peu comme les grands hommes de la Renaissance, Thoreau est à la fois philosophe, écrivain et naturaliste, chacune de ces facettes enrichissant les autres et le puritanisme américain d'autre part. La théologie calviniste l'a également imprégné, à Harvard, université fondée en effet par les puritains, et par le biais familial également. Pour Michel Granger, Thoreau fait preuve d'ambivalence envers l'héritage puritain, à la fois fasciné et rebuté. Transcendantalisme États-Unis. D'origine purement américaine, le transcendantalisme est un mouvement philosophique et littéraire créé par Ralph Waldo Emerson. Initié au transcendantalisme par l'auteur de Nature, dont la stature l'a longtemps éclipsé, Thoreau, du fait de son esprit d'indépendance, n'adhère cependant que partiellement au mouvement. Il tire de ce courant d'inspiration romantique européenne l'idée qu'il existe des correspondances entre l'homme et la nature. Le poète Kenneth White explique ainsi que c'est en quelque sorte une conscience première, débarrassée de toutes les couches secondaires morales, sociales, religieuses, etc., que le transcendantalisme veut atteindre, car tout, virtuellement, commence là, et tout peut recommencer là alors que le philosophe Stanley Cavell en fait le début de la modernité en philosophie américaine. En exaltant l'individualisme et une certaine forme d'oisiveté dans la communion avec la nature, Thoreau invite à explorer les provinces de l'imagination, thème transcendantaliste par excellence. Enfin, l'idée que l'écrivain peut être le moteur de la société et la source de son renouveau, par l'entremise de la figure du héros indépendant, a influencé la pensée de Thoreau. Néanmoins, conclut Michel Granger, Thoreau a su transformer cet héritage transcendantaliste à l'aune de sa propre réflexion. Influence et postérité Thoreau représente l'un des héros de l'américanité et son nom fait partie du bagage culturel minimum de l'Américain moyen qui en connaît quelques expressions ou précepte de célébrité. Politique Les écrits de Thoreau ont eu un rayonnement important après sa mort, à tel point que Gilles Farcet parle de la dimension prophétique de son œuvre. Des leaders politiques tels que le Mahatma Gandhi, l'ascétisme pratiqué par Gandhi s'inspire beaucoup de la pensée du poète américain, le président John F. Kennedy, le militant des droits civiques Martin Luther King, William O. Douglas, Thomas Merton, les continuateurs de Lanza del Vasto ont évoqué l'influence de l'œuvre de Thoreau sur leurs actions. Au sein de la pensée politique ou éthique, Thoreau a influencé nombre de personnalités tels : Murray Rothbard, Albert Jay Nock ou John Rawls. L'anecdote du refus de payer l'impôt et le concept de désobéissance civile ont ainsi servi de base de réflexion à l'auteur de Théorie de la justice. Écologie Le rayonnement de Thoreau a également été récupéré par l'écologie politique. L'expression de désobéissance civile est en effet reprise par les paysans du Larzac et par José Bové mais en mouvement plus violent. Des études modernes, dont celles de Lawrence Buell The Environmental Imagination : Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture, 1995 ont montré l'actualité de la pensée de Thoreau à ce propos, pensée qui nourrit jusqu'à l'écologie profonde, l'environnementalisme et le monde libertaire, celui de Murray Bookchin et de Paul Goodman. Ainsi, dans L'écologie technophobe de Thoreau, 11e volume de Contre-histoire de la philosophie, le philosophe Michel Onfray dévoile en quoi les tenant de l'écologie peuvent se revendiquer de l'héritage intellectuel de Thoreau. Les études scientifiques menées par Thoreau ont été réévaluées dans les années 1980 et ont été reconnues comme scientifiquement valables en limnologie et en phénologie explique Michel Granger. Thoreau marque également l'histoire du courant végétarien en considérant ce mode de vie comme un idéal de purification à atteindre même s'il ne semble pas avoir lui-même assidûment pratiqué ce régime. François Duban évoque l'influence moderne de Thoreau sur les politiques environnementales, dans L'écologisme aux États-Unis 2000. Sa philosophie serait ainsi à l'origine de l'aménagement du territoire américain pour Michel Granger. Pour François Specq la contribution de Thoreau à la naissance de l'idée de parc national, aux États-Unis, est réelle et date de 1858, dans le chapitre Chesuncook des Forêts du Maine 1864 Littérature En littérature, Walden inspira William Butler Yeats, le grand poète nationaliste irlandais, qui y fait référence dans son poème The Lake Isle of Innisfree dans le recueil The Countess Kathleen and Various Legends and Lyrics publié en 1893. Romain Rolland, qui parle de l'œuvre de Thoreau comme étant la Bible du grand Individualisme qui projetait une traduction qu'il abandonna, y fait référence dans sa Vie de Vivekananda. Le romancier Robert Louis Stevenson, bien qu'irrité par la philosophie de Thoreau, reconnaît l'influence de son style. L'auteur de Walden est en effet pour lui un maître du style, master of style. Jean Giono s’inspire lui du concept de désobéissance civile dans Refus d’obéissance. Léon Tolstoï découvrit l'essai de Thoreau La Désobéissance civile en 1894 grâce à un journal anglais et qui le traduisit en russe. Thoreau a inspiré d'autres personnalités du monde des arts et des lettres comme Henry Miller, Edward Abbey Down the River with Henry Thoreau, 1984, Willa Cather O Pioneers!, 1913, Marcel Proust mais aussi Sinclair Lewis The American Adam, 1959, Ernest Hemingway ou encore Elwyn Brooks White. L'architecte Frank Lloyd Wright explique que l'architecture moderne américaine serait incomplète sans la sage observation du sujet élaborée par Thoreau. L'influence de Thoreau et de Walden en particulier sur les écrivains écologistes concerne : John Burroughs, John Muir, E.O. Wilson, Edwin Way Teale, Joseph Wood Krutch, Rick Bass son roman Winter, publié en 1999, est organisé de manière semblable à Walden ou encore les poètes Seyhan Kurt, Kenneth White. Jim Harrison revendique également la paternité littéraire de Walden. Gandhi a lu, en prison, le livre La Désobéissance civile de Thoreau et en a tiré l'idée de résister par la non-violence ou ahimsa en hindi. Walden a également directement inspiré plusieurs œuvres littéraires. En 1948, le psychologue béhavioriste Burrhus Frederic Skinner écrit un roman à thèse, Walden Two dans lequel il imagine une communauté expérimentale utopique experimental community basée sur les idées de Thoreau. L'auteur suédois Stig Dagerman cite les noms de Thoreau et de Walden dans son essai Notre besoin de consolation est impossible à rassasier publié en 1952. Le photographe américain Ian Marshall a également écrit un livre de haïkus intitulé Walden by haiku 2009 dans lequel il s'arrête sur plusieurs citations de Thoreau. L'écrivain américain de science-fiction James Patrick Kelly décrit dans son roman Fournaise une société utopique implantée sur un monde nommé Walden afin d'y pratiquer le retour à la terre, et, d'une manière plus générale, à la Simplicité un mouvement philosophique s'opposant aux bouleversements introduits par la technologie. Musique En musique, Charles Edward Ives a intitulé Henry David Thoreau le quatrième mouvement de sa Concord Sonata qui est un hommage aux écrivains transcendantalistes. Son essai, Essay before a Sonata témoigne par ailleurs en quoi Walden est une profonde source d'inspiration pour lui et explique pourquoi Thoreau donne une importance fondamentale à la musique de la nature notamment lorsqu'il dit dans son Journal : Il y a de la musique dans chaque son. Enfin, le compositeur John Cage considère Thoreau comme son maître et, s'inspirant de son rythme poétique, il a composé Empty words 1973–1974 et 40 drawings by Thoreau. Cinéma et télévision L'œuvre de Thoreau est évoquée dans de nombreux films tels que : Tout ce que le ciel permet 1955, Madame croque-maris 1964, Into the Wild de Sean Penn 2007, The Great Debaters 2007 et aussi dans des séries à la télévision telles que : Dawson Dawson's creek saison 4 épisode 10, Young Americans saison 1 épisode 3, Les Experts saison 7 épisode 20, Numb3rs saison 3 épisode 7. Des passages de Walden sont cités à l'ouverture de chaque réunion secrète des membres du Cercle des poètes disparus Dead Poets Society dans le film éponyme de Peter Weir 1989, comme la célèbre citation sucer toute la moelle secrète de la vie et notamment la scène où il est annoncé que le secret de la vie est de saisir le jour carpediem. Dans Walden. Diaries, Notes, and Sketches 1969 le réalisateur d'origine lituanienne Jonas Mekas élabore un journal sous forme filmographique, de 43 minutes. Le second film du réalisateur américain Shane Carruth, Upstream Color 2013 contient de nombreuses références à Walden ou la Vie dans les bois avec lequel les personnages entretiennent un rapport privilégié. Le film s'inspire également du transcendantalisme. Arts graphiques Maximilien Le Roy et A. Dan mettent en scène Thoreau lors de son passage à Walden dans une bande dessinée intitulée Thoreau – La vie sublime 2012. Critiques De son vivant, Thoreau est considéré comme un arriéré et un original. Mais la principale critique vient d'un autre écrivain, l'auteur écossais Robert Louis Stevenson qui considère que la volonté de Thoreau de vivre simplement dans la nature, loin de la société moderne, lui donne un caractère efféminé et des manières snobs. Il écrit un essai publié dans le Cornhill Magazine en juin 1880, intitulé Henry David Thoreau: His Character and Opinions, traduit en français sous le titre Un roi barbare : essai sur Henry David Thoreau, dans lequel il dit être irrité par le puritanisme de Thoreau : On peut trouver une sorte de noblesse rustre, la noblesse d’un roi barbare, dans la confiance inébranlable que Thoreau a en lui-même et dans son indifférence aux désirs, aux pensées et aux souffrances d’autrui. Tout au long du XIXe siècle, Thoreau sera souvent rejeté comme un grincheux provincial hostile au progrès matériel. L'historien Ronald Creagh souligne qu'en tournant le dos au mythe du progrès » Thoreau s'est aliéné le XIXe siècle positiviste et scientiste. Rééditée en France dans les années 1960, son œuvre connaît un regain d'intérêt lors du mouvement de mai 68. La grève générale de mai redonne en effet une actualité politique à Walden ; fable moderne de l’individu excentrique cherchant à s’émanciper de la tradition, dénonçant le pouvoir de l’argent, la rigidité des conventions sociales et la violence des institutions, raillant le papotage des journaux et refusant de s’incliner devant le progrès technique l'œuvre de Thoreau proposait un modèle alternatif centré sur l’individu non-conformiste à l’esprit critique toujours en éveil dans lequel les jeunes générations se reconnaissaient alors. Cependant, l'épisode de Walden est perçu comme l'œuvre d'un idéaliste et d'un rêveur. Le poète John Greenleaf Whittier condamne ainsi Thoreau, le jugeant très mauvais et païen et expliquant que ce dernier cherche à renvoyer l'homme à une vie animale et dégradante. Pendant la Seconde Guerre mondiale et durant la Guerre froide, Thoreau est mis au pilori aux États-Unis. Considéré comme un un-American, un non-américain dans les années 1940 le public lui reproche son pacifisme. Une anthologie où il figure est interdite par Joseph McCarthy. En juillet 1946, le centenaire de sa nuit passée en prison pour refus de payer l'impôt n'est pas célébré comme à l'habitude alors que, durant la période du maccarthysme, le livre La Désobéissance civile est interdit dans certaines bibliothèques du pays. Dans les années 1960, la critique se veut davantage universitaire. On lui reproche en effet des propos rétrogrades et misogynes, critique émanant du milieu féministe américain. Œuvres traduites en français Éditions de Walden ou la vie dans les bois Henry David Thoreau trad. Louis Fabulet, Walden, ou la vie dans les bois Walden or Life in the Woods, Paris, Gallimard, coll L'Imaginaire no 239, 1990 1re éd. 1854, 377 Henry David Thoreau trad. Louis Fabulet, Walden, ou la vie dans les bois Walden or Life in the Woods, Paris, Aubier Montaigne, coll. Bilingues Toutes, Henry David Thoreau trad. Louis Fabulet, Je vivais seul dans les bois : Extrait de Walden ou La vie dans les bois Walden or Life in the Woods, Paris, Gallimard, coll. Folio 2, 2008 (1re éd. 1854, 119 p. Henry David Thoreau trad. Brice Matthieussent, préf. Jim Harrison, Walden Walden or Life in the Woods, Marseille, Le mot et le reste, coll. Attitudes, 2010 1re éd. 1854 Postface et notes de Michel Granger Essais et romans Henry David Thoreau trad. Didier Bazy et Sophie Fueyo, L'esprit commercial des temps modernes et son influence sur le caractère politique, moral et littéraire d'une nation [« The commercial spirit of modern times considered in its influence on the Political, Moral, and Literary, Le Grand Souffle Éditions, 2007 1re éd. 1837, 47 Postface de Michel Granger - édition bilingue Henry David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, Le paradis à reconquérir Paradise to be Regained, Mille et une nuits, coll. La petite collection, 2005 1re éd. 1843, Henry David Thoreau trad. Guillaume Villeneuve, La Désobéissance civile Civil Disobedience, Mille et une nuits, 1997 1re éd. 1849, 63 p. Henry David Thoreau, La Désobéissance civile Civil Disobedience, Le Passager Clandestin, 2007 1re éd. 1849, 75 p. Préface et direction de Noël Mamère, accompagné de l'article du Monde Diplomatique intitulé Jusqu'où obéir à la Loi daté d'avril 2006 Henry David Thoreau et Frederick Douglass trad. François Specq, De l'esclavage en Amérique Slavery in Massachusetts, Éditions Rue d’Ulm, coll. Versions Françaises, 2006 1re éd. 1854, 201 p. Postface de François Specq Henry David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, Plaidoyer pour John Brown A Plea for Captain John Brown, Mille et une nuits, coll. La petite collection, 2006 1re éd. 1860, 127 p. Intégré au recueil : De l'esclavage : Plaidoyer pour John Brown Henry David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, De la marche Walking, Mille et une nuits, coll. La petite collection, 2003 1re éd. 1862, 79 p. Henry David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, La Vie sans principe Life without principle, Mille et une nuits, coll. La petite collection, 2004 1re éd. 1863, 63 Henry David Thoreau (trad. Thierry Gillyboeuf, Couleurs d'automne Autumnal Tints, Mille et une nuits, coll. La petite collection, 2007 1re éd. 1862, 111 p. Intégré au recueil : Balade d'hiver, couleurs d'automne Henry David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, Balade d'hiver Winter, Mille et une nuits, coll. La petite collection, 2007 1re éd. 1888, 111 p. Intégré au recueil : Balade d'hiver, couleurs d'automne Henry David Thoreau trad. Simon Le Fournis, Un Yankee au Canada A Yankee in Canada, La Part Commune, 2006 1re éd. 1866, 187 p. Henry-David Thoreau trad. André Fayot, Les Forêts du Maine The Maine Woods , José Corti, coll. Domaine romantique, 2002 1re éd. 1864, 359 p. Henry-David Thoreau trad. François Specq, Les Forêts du Maine The Maine Woods, Editions Rue d'Ulm, 2004 1re éd. 1864, 521 p. Henry-David Thoreau, Les pommes sauvages Wild Apples: The History of the Apple Tree, Finitude, 2009 1re éd. 1862 Henry David Thoreau trad. Pierre-Yves Pétillon, Cap Cod Cape Cod, Imprimerie nationale, coll. La Salamandre, 2000, 319 Henry David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, Sept jours sur le fleuve, Fayard, 2012 Henry David Thoreau, Ecrits de jeunesse, Les Editions de Londres,2013 Henry-David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, Journal : volume I : 1837-1840, Finitude, 2012, 256 p. Henry-David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, Journal : volume 2 : 1841-1843, Finitude, 2013, 320 p. Correspondances Henry-David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, Je suis simplement ce que je suis : Lettres à Harrison G.O. Blake, Finitude, 2007 1re éd. 1848 et 1861 Henry-David Thoreau et Ralph Waldo Emerson, Correspondance, Sandre, 2009, 283 p Henry-David Thoreau trad. Régis Michaud et Simone David, Journal Journal, 1837-1861, Presses d'Aujourd'hui, coll. Romans Traduits, 1981, 216 p. Notes et préface de Kenneth White Recueils Henry-David Thoreau trad. Nicole Mallet, Essais, Le mot et le reste, coll. Attitudes, 2007, 426 p. Préface de Michel Granger Henry-David Thoreau trad. Thierry Gillyboeuf, La Moëlle de la vie : 500 Aphorismes, Mille et une nuits, coll. La petite collection, 2006, 111 p. Henry-David Thoreau trad. Léon Bazalgette, Désobéir, Aden, coll. Petite bibliothèque, 2013, 276 p. Henry-David Thoreau, Vivre comme un prince - Écrits de jeunesse, Climats, 2015, 204 p. Chronologie des œuvres originales complètes The commercial spirit of modern times considered in its influence on the Political, Moral, and Literary 1837 Aulus Persius Flaccus 1840 The Service 1840 Natural History of Massachusetts publié dans The Dial en juillet 1842 Paradise to be Regained 1843 The Landlord 1843 Sir Walter Raleigh 1844 Herald of Freedom 1844 Wendell Phillips Before the Concord Lyceum 1845 Reform and the Reformers 1846-8 Thomas Carlyle and His Works 1847 A Week on the Concord and Merrimack Rivers 1849 Civil Disobedience 1849 An Excursion to Canada 1853 Slavery in Massachusetts 1854 Walden or Life in the woods 1854 Remarks After the Hanging of John Brown 1859 The Last Days of John Brown 1860 A Plea for Captain John Brown 1860 Walking 1862 Autumnal Tints 1862 Wild Apples: The History of the Apple Tree 1862 Excursions 1863 Life without principe 1863 Night and Moonlight 1863 The Highland Light 1864 The Maine Woods 1864 Cape Cod 1865 Letters to Various Persons 1865 A Yankee in Canada 1866 Early Spring in Massachusetts 1881 Summer 1884 Winter 1888 Autumn 1892 Miscellanies 1894 Familiar Letters of Henry David Thoreau 1894 Poems of Nature 1895 The First and Last Journeys of Thoreau 1905, découvert tardivement parmi ses journaux et manuscrits inédits      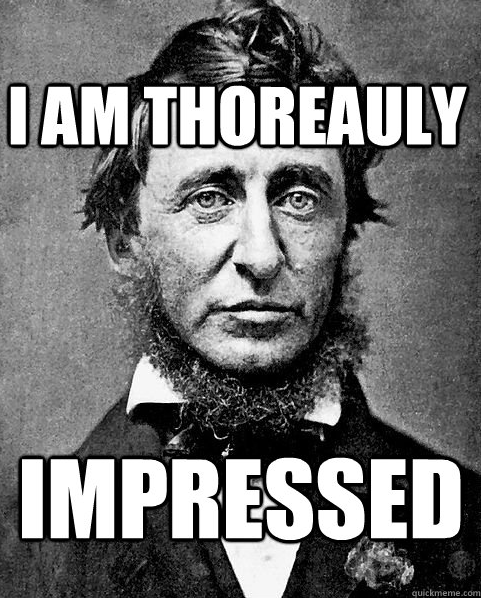   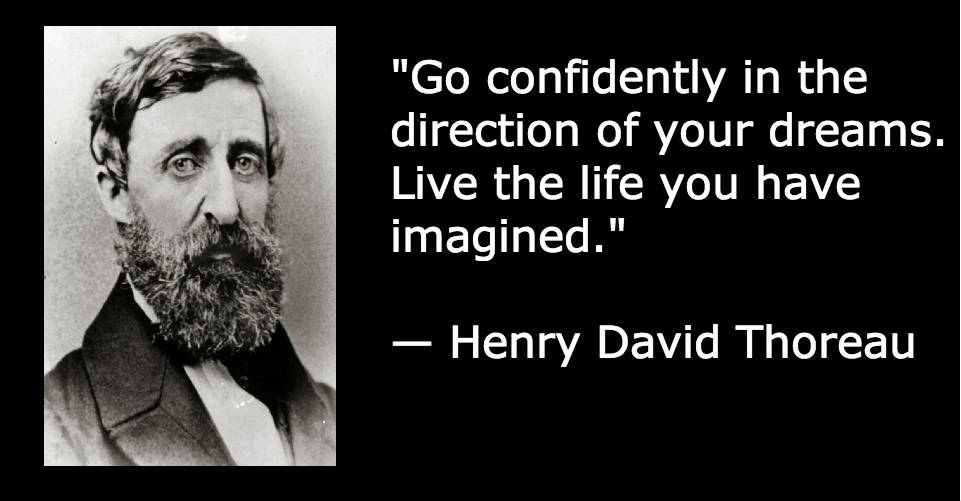  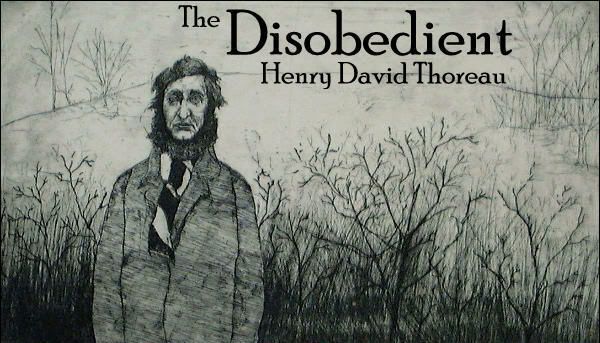
#160
Max Jacob
Loriane
Posté le : 11/07/2015 18:39
Le 12 juillet 1876 naît Max Jacob
à Quimper en Bretagne, il meurt à 67 ans, le 5 mars 1944, alors qu'il était emprisonné au camp de Drancy en Seine-Saint-Denis, poète, romancier, essayiste, épistolier et peintre français, il prend pour pseudonyme Léon David, Morven le Gaëlique, Œuvres principales 1916 : Le Cornet à dés 1921, Le Laboratoire central. Il mena une existence de bohème à Montmartre et se révéla dès ses premières publications, illustrées par son ami Picasso Œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel, mort au couvent de Barcelone, 1911, un précurseur du surréalisme le Cornet à dés, 1917. Il se convertit au catholicisme, voyagea à l'étranger et donna de nombreuses œuvres le Laboratoire central, 1921 ; le Roi de Béotie, 1921 ; le Terrain Bouchaballe, 1922 ; le Cabinet noir, 1922. Il se retira à Saint-Benoît-sur-Loire, où il vécut de ses peintures et de ses gouaches. Interné à Drancy par les Allemands, il y mourut. On lui doit encore l'Homme de cristal, 1947. En bref Personnage insolite de la génération qui, dans les débuts de ce siècle, a inventé une sensibilité nouvelle, Max Jacob est connu surtout comme recréateur du poème en prose : or, cela ne va pas sans injustice contre le reste de son œuvre poétique et romancière. On a peint souvent du dehors le personnage, fauteur et conteur d'anecdotes, commère, mystique, astrologue, en veste de garçon boucher et monocle, bavard montmartrois, solitaire, épistolier infatigable ; au physique, il s'accordait une vague ressemblance avec Baudelaire ou Marcel Schwob ; de toute façon, un personnage qui, du Bateau-Lavoir à Saint-Benoît, fait à jamais partie, entre ses amis – Picasso, Salmon, Apollinaire... – du tableau des arts et de la littérature en France dans la première moitié du XXe siècle. Reste à le peindre du dedans, et ce dedans est l'œuvre même, avec plus de quarante titres, sans parler du fonds épistolaire Né à Quimper, où il fait de brillantes études, Max Jacob entre à l'École coloniale de Paris, l'abandonne deux ans plus tard, se risque à la critique d'art, veut être peintre, rencontre Pablo Picasso, André Salmon et Guillaume Apollinaire, publie des contes pour enfants – Histoire du roi Kaboul Ier et du marmiton Gauvain 1903, Le Géant du Soleil 1904 –, campe dans la misère à bord du Bateau-Lavoir, au 7, rue Ravignan, a une première vision du Christ en 1909, écrit des ouvrages d'inspiration religieuse – Saint Matorel 1911, Œuvres burlesques et mystiques du frère Matorel 1912 –, réussit à se faire baptiser en 1915, après une seconde vision du Christ, édite à compte d'auteur Le Cornet à dés, en 1917. Désormais, le rythme de ses productions – gouaches, dessins, poèmes, romans, méditations, fantaisies – s'accélère ; il se retire à Saint-Benoît-sur-Loire de 1921 à 1928, vit à Paris de 1928 à 1937, revient à Saint-Benoît où il est arrêté par la Gestapo, comme Juif, le 24 février 1944, et meurt, quelques jours après, le 5 mars, à Drancy. L'œuvre de Max Jacob est une œuvre d'un bout à l'autre poétique où l'on passe de prosodie régulière à presque régulière, à libre, au poème en prose, au roman mêlé de vers La Défense de Tartufe, 1919, au roman ; où le style colloquial – du blagueur, de l'épistolier, du méditatif, du mondain – anime, en se diversifiant, tous les ouvrages ; où l'anecdote-éclair de certains poèmes en prose se développe ailleurs en aventures romanesques ; où le menu peuple du poète reparaît, parfois au milieu des mêmes décors Quimper ou la rue Gabrielle, dans les péripéties du Terrain Bouchaballe 1922, de Filibuth ou la Montre en or 1922, de L'Homme de chair et l'homme reflet 1924, dans la galerie de caractères du Cinématoma 1920, du Tableau de la bourgeoisie 1930, dans les lettres imaginaires du Cabinet noir 1922, semi-inventées des Conseils à un jeune poète 1945, ou réellement envoyées, etc. Mais placer une œuvre sous le signe du poétique ne signifie-t-il pas qu'elle l'emporte par ses poèmes ? Sans doute. Seul, peut-être, A. Thibaudet a estimé que Max Jacob avait mieux réussi dans le roman. L'avenir en décidera. Sa vie Max Jacob nait le 12 juillet 1876 rue du Parc à Quimper dans une famille juive mais non pratiquante. Il y passe une enfance heureuse. Max joue aux" rêves inventés". En 1894, il obtient le Prix de Français au concours général, et il s'installe alors à Paris pour entrer à l'École Coloniale. Il quitte l'École Coloniale en 1897, au grand scandale de sa famille, et vit de petits métiers. En 1902, il est clerc d'avoué, précepteur, employé à "l'Entrepôt Voltaire". À Paris, il fréquente notamment le quartier de Montmartre et se fait de nombreux amis. Il fait notamment la connaissance de Pablo Picasso qu'il rencontre en 1901, de Georges Braque, Henri Matisse et Amedeo Modigliani. En 1903, il rencontre André Salmon et Guillaume Apollinaire, c'est la misère noire. Pour vivre, Max essaie de vendre ses gouaches. En 1907, il s'installe au Bateau-Lavoir, au 7 rue Ravignan, où il retrouve ses amis Picasso, Juan Gris. C'est Max qui donne le nom de 'lavoir' à ce lieu, car il n'y a qu'un seul et unique point d'eau dans toute la maison. Le 22 septembre 1909, l'image du Christ lui apparaît le 22 septembre 1909 sur le mur de sa chambre au 7 rue Ravignan et il l'entoure d'un cercle. Le 16 décembre 1914, il a une seconde vision du Christ, durant une séance de cinéma. Juif de naissance, il se convertit alors au catholicisme. Le 18 février 1915, à l'âge de 40 ans, Cyprien Max Jacob se fait baptiser, au couvent de Sion, rue Notre-Dame des Champs, avec Pablo Picasso comme parrain. En 1913, il séjourne à Céret Pyrénées-Orientales avec le peintre Juan Gris. Il y réalise une série de dessins du village. En 1919, Max se lie avec le jeune Raymond Radiguet, qu'il présente à Jean Cocteau. En 1921, Max Jacob se lasse de lui-même et de Paris, et, sur les conseils d'un ami prêtre, il se retire à Saint-Benoît-sur-Loire, près de l'abbaye bénédictine. En 1928, il retourne à Paris, et s'installe dans un hôtel de la rue Nollet, où habite aussi le compositeur Henri Sauguet. En 1932, Max Jacob est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il travaille avec les musiciens Francis Poulenc, Henri Sauguet, Georges Auric... Max Jacob revient à Saint-Benoît-sur-Loire en 1936 pour s'y retirer définitivement, et y mène une vie exemplaire, quasi-monastique. Il se lie aux gens du village, entretient une nombreuse correspondance, écrit beaucoup, en particulier de longues méditations religieuses qu'il rédige de très bon matin et qui attestent une foi fulgurante. Il fait visiter la Basilique aux pèlerins de passage. En 1937, il se lie d'amitié avec les poètes et les peintres de la jeune génération, sur lesquels il a eu une grande influence : Michel Manoll, Lacôte, Cadou, Olivier Messiaen, Roger Toulouse, Jean Rousselot, Charles Trenet, et reçoit la visite de ses amis de longue date : Paul Eluard, Jean Cocteau, Maurice de Vlaminck, Fernand Léger, Pablo Picasso, Pierre Mac Orlan, Roland Dorgelès... En 1942, Max Jacob porte l'étoile jaune, signe distinctif des juifs. Cette année-là, sa sœur Julie-Delphine et son beau-frère Lucien Lévy meurent au camp de Compiègne. En 1943 son frère Gaston est déporté à Auschwitz et y meurt. En janvier 1944, sa sœur Myrté-Léa et son mari sont déportés et meurent à leur tour. Le 24 février 1944, vers 11h, Max Jacob est arrêté chez lui par la Gestapo d'Orléans et emprisonné à Orléans. Le 18 février, il est transporté au camp de Drancy. En route, il envoie un dernier message à l'abbé Fleureau le curé de Saint-Benoît-sur-Loire, et à Jean Cocteau. Ses amis, dont Jean Cocteau1 et Sacha Guitry, feront leur possible pour faire libérer le poète. Mais deux semaines plus tard, le 5 mars 1944 au matin, Max Jacob meurt d'épuisement au camp de Drancy. Max Jacob comptait parmi ses nombreux amis Jean Moulin, qui prend le pseudonyme de Max dans ses activités de résistant. Le 5 mars 1949, conformément à son vœu, Max Jacob est inhumé au cimetière de Saint-Benoît-sur-Loire. Sa tombe est ornée d'un de ses portraits réalisé en 1935 par son ami René Iché. Le 17 novembre 1960, il est déclaré officiellement Poète mort pour la France. À la Bibliothèque nationale, il est répertorié comme Poète - Romancier - Essayiste - Peintre . Il a aussi traduit des textes du catalan en français. Le poète en prose Parmi les recueils de poèmes, Le Cornet à dés est, de beaucoup, le plus célèbre, et cela ne va pas sans injustice à l'égard de recueils comme Le Laboratoire central 1921 et tous ceux que l'on a réunis sous le titre de Ballades 1970. Cette célébrité est due à une génération, celle de 1920, qui se sentait encore proche de ce que l'on a appelé le cubisme littéraire ou l'esprit moderne, et qui allait connaître le surréalisme. Plus durablement, le Cornet doit son privilège à son originalité en un genre où il paraissait difficile de faire du nouveau. Le genre, depuis Fénelon, restait voué à une manière d'écrire poétisante, esthète, cultivée, ciselée, ou se répandant en volutes harmonieuses ; et voici, soudain, le poème écrit au ras du sol, Michel Leiris dans la langue de chaque jour, mais nourri de prose classique, musical et cocasse, concertant et déconcertant, avec la maîtrise parfaite du jongleur où la difficulté paraît aller de soi ; et, très bref, ce poème, découpé dans le silence d'on ne sait quel sommeil, condensait en ses jeux de mots, par des relations internes rigoureuses se dérobant à l'analyse, les images les plus disparates, collages géométriques de Picasso ou onirisants de Max Ernst, avec, en arrière-fond, les petites forêts de Quimper, la famille provinciale, les silhouettes du vieux curé, de la concierge, du marin, du modeste employé, se révélait une modernité qui n'était plus celle que cherchait à capter Baudelaire sous le second Empire, mais celle des premiers aéroplanes. Points caractéristiques Pour en revenir à l'ensemble de l'œuvre, il serait sans doute possible de la cadrer par quatre éléments caractéristiques, composant un carré dont les critiques auront à combiner côtés et diagonales : populisme, jonglerie, onirisme, émotion. Simplifions. Qui, avant Max Jacob, a su lier aussi intimement le quotidien diurne et nocturne, la description pittoresque aux surprises du rêve inventé ? Est-il possible de dessiner plus vite les japonaises habillées d'un seul trait de plume, ou de nuancer sa palette avec plus de sensibilité qu'en diffractant le rouge, par exemple, en rouge sang, écarlate, feu, vermeil, vinaigre, mordoré, incarnat, rose bonbon, rose-blanc, aurore pâle ? Qu'y a-t-il de plus près du poème en prose – ou du rêve –, qu'y a-t-il de plus irréel que n'importe quel passage pris au hasard dans un roman ? Par exemple : Pourquoi chacun de ces deux messieurs était-il à Robinson ? et pourquoi n'y aurait-il pas été ? Pourquoi n'y étiez-vous pas vous-même ? M. Ballan-Goujart s'attirait sciemment la jalousie d'une jeune dame, qui buvait près d'une fenêtre, en fouettant les ânes qui passaient, et Mlle Estelle passa sur un âne. » Monologue dialogué, la prose romanesque de Max Jacob est si foisonnante, si sténographique avec ses oublis de noms, ses résistances, ses suspens, ses dérives, ses parleries où, sans cesse, l'on perd le fil qui se renoue ensuite, que la recherche d'une montre en or, la vente d'un terrain, le mariage de M. Maxime Lelong et d'Estelle, etc., ont le caractère obsédant de la dramaturgie du rêve ; et réciproquement, en poésie, le rêve est inventé ou réinventé avec tant d'exactitude qu'il passerait pour un récit de veille. C'est en poésie que triomphe la jonglerie verbale, les jeux de mots pour rire, souligner, incarner dans le son le vrai sens poétique, bref des expériences pour voir, donner à voir. Mais, en regard de cette jonglerie, il faudrait suivre l'émotion, tantôt, en sa mobilité, dans une ponctuation hérissée de points d'interrogation, d'exclamation, de suspension, de tirets et de parenthèses, tantôt, en son apaisement, dans la coulée d'une phrase ou d'un paragraphe sans virgule ou presque sans virgule : En descendant la rue de Rennes, je mordais dans mon pain avec tant d'émotion qu'il me sembla que c'était mon cœur que je déchirais, ou encore cet admirable : En revenant du bal, je m'assis à la fenêtre et je contemplais le ciel : il me sembla que les nuages étaient d'immenses têtes de vieillards assis à une table et qu'on leur apportait un oiseau blanc paré de ses plumes. Un grand fleuve traversait le ciel. L'un des vieillards baissait les yeux vers moi, il allait même me parler quand l'enchantement se dissipa, laissant les pures étoiles scintillantes. Grand poète et, peut-être, grand romancier, homme de chair, homme reflet, Max Jacob est entré dans l'histoire des lettres. Yvon Belaval. Œuvres 1903 : Histoire du roi Kaboul Ier et du marmiton Gauvain 1904 : Le Géant du Soleil 1911 : Saint-Matorel 1911 : La Côte 1912 : Œuvres burlesques et mystiques de Frère Matorel 1914 : Le Siège de Jérusalem‚ grande tentation céleste de Frère Matorel 1916 : Le Cornet à dés, qui lui apporte la notoriété 1918 : Le Phanérogame 1919 : La Défense de Tartufe. Ce livre devait dans un premier temps avoir pour titre Le Christ à Montparnasse 1920 : Cinématoma 1921 : Le Laboratoire central 1921 : Le Roi de Béotie 1922 : Le Cabinet noir 1922 : Art Poétique 1923 : Filibuth ou la Montre en or 1923 : Le Terrain Bouchaballe 1924 : Les Tabar in Sélection 3, décembre 1924, pp. 209-219 1924 : Visions infernales 1924 : L'Homme de chair et l'Homme reflet 1925 : Les Pénitents en maillots roses 1927 : Le Fond de l'eau 1929 : Le Tableau de la Bourgeoisie 1929 : Sacrifice impérial 1931 : Rivage 1932 : Bourgeois de France et d'ailleurs 1938 : Ballades 1945 : Derniers Poèmes Publications En plus de son nom d'état civil, Max Jacob a utilisé les pseudonymes suivants, répertoriés par la Bibliothèque nationale de France : Léon David Morven le Gaëlique 2003 : Bien aimé Raymond : dessins de Jean-Marie Queneau, éditions de la Goulotte - Vézelay. 1986 : Le Terrain Bouchaballe Max Jacob [Toulouse, Théâtre Daniel Sorano, 15 avril 1986] suivi de deux inédits : Paris province et le Journal de modes ou les ressources de Florimond : farce en un acte de Max Jacob ; et de La Tarentelle rouge pièce en un acte de Salvatore Cuffaro, L'Avant-scène, Coll. Théâtre no 798, Paris, 80 p. 1953 : Correspondance : 1 : Quimper-Paris : 1876-1921, Ed. de Paris, Paris, 229 p. 1985 : Lettres à Michel Manoll Max Jacob ; préf. de Michel Manoll ; texte établi et annoté par Maria Green, Rougerie, Mortemart 1964 : La défense de Tartufe : extases, remords, visions, prières, poèmes et méditations d'un Juif converti, nouv.éd. introd. et notes par André Blanchet, Gallimard, Note : Il en existe une première éd. de 1919, éd. Société littéraire de France, 213p. 1949 : Mendiantes professionnelles ; (suivi de) Jalousies, préf. de Georges Auric ; dessins de Max Jacob et Jacques Audiberti, sans indication d'édition, 16p. Notice 1936 : Saint Matorel, Le siège de Jérusalem, Les œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel, Gallimard, Paris, 300p. 1928 : Visions des souffrances et de la mort de Jésus Fils de Dieu : 40 dessins de Max Jacob, avec un portrait de l'auteur par lui-même,éd.Aux Quatre Chemins, Paris. Note : éd. limitée à 279 exemplaires. 1928 : article Deux lettres et un commentaire, dans la Revue hebdomadaire du 11 août 1928, p. 213-218. 1928 : article Max Jacob ou le poète de Saint-Benoît-sur-Loire. Textes et dessins inédits de Max Jacob - hommage de Saint Pol Roux - Vers et proses de Marcel Abraham, Jean Casson, Jean Cocteau..., dans la revue Le Mail, n °5, avril 1928, p. 221-272. 1923 : Filibuth, ou la Montre en or, Ed. de la N. R. F., Paris, 268 p. 4e éd. 1922 : article Poèmes burlesques, dans la revue des feuilles libres no 28 août-septembre 1922, p. 245-249. Correspondance et inédit Max Jacob Lettres à René Villard, suivies duCahier des Maximes; préface et notes de Yannick Pelletier; Rougerie, 1978 Bibliographie Christopher Wood, Max Jacob, 1929 Huile sur carton, 80,5x64, musée des Beaux-Arts de Quimper Béatrice Mousli, Max Jacob, Grandes biographies, Flammarion, 2005, Max Jacob, Jean Cocteau: correspondance 1917-1944, texte établi et présenté par Anne Kimball, Éditions Paris-Méditerranée, 2000. Louis Émié, Dialogues avec Max Jacob, éd. Corrêa/Buchet-Castel, 1954 ; rééd. éd. Le Festin, 1994 Jacob, poète et romancier, Actes du colloque du CRPC, Université de Pau, mai 1994, avec des lettres inédites de Max Jacob, Valery Larbaud et Jean Cocteau, textes réunis par Christine V. R. Andreucci. Christine Van Rogger-Andreucci, Poésie et religion dans l’œuvre de Max Jacob, Honoré Champion, 1994. Maria Green, avec la collab. de Christine Van Rogger Andreucci, Centre de recherches Max Jacob, Bibliographie des poèmes de Max Jacob parus en revue, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 1992, 126p. Spiritualité de Max Jacob, sous la direction de Jean de Palacio, La Revue des lettres modernes, 1981. Joseph Pérard, Max Jacob l'universel : étude, inédits, Colmar, Alsatia, 1974. Jean Rousselot, Max Jacob au sérieux, essai, Éditions Subervie, Rodez, 1958. Peintres juifs à Paris 1905-1939 École de Paris, Éditions Denoel, 2000 Esthétique : Lettres à René Guy Cadou, extraits, 1937 - 1944. Postface Olivier Brossard. Éditions Joca Seria, Nantes 2001. Yannick Pelletier, Max Jacob, le Breton errant, éditions Christian Pirot, 2004 Hommages Un prix de poésie, fondé en 1950, porte son nom : le prix Max-Jacob. En 1989, le théâtre municipal de la ville de Quimper, sa ville natale, prend le nom de Théâtre Max Jacob. Un collège et un pont y portent également son nom. En septembre et octobre 2006, le réalisateur Gabriel Aghion réalise Monsieur Max avec dans le rôle principal Jean-Claude Brialy dont ce fut le dernier rôle avant sa mort le 30 mai 2007. Depuis 2010, le poète, compositeur et chanteur Paul Dirmeikis a mis en chanson des poèmes de Max Jacob : Nocturne, Le Départ, Cimetière, Le Mariage, La Roue du moulin. En 2012, le chanteur et poète Melaine Favennec publie un album intitulé Émoi des mots, Melaine Favennec chante Max Jacob. Les Rendez-vous de Max, lectures et rencontres mensuelles de poésie, sont accueillis depuis février 2013 dans la maison d'enfance et de jeunesse de Max Jacob à Quimper, Chez Max cour Max Jacob, 8 rue du Parc. Citations Mes dix-huit ans buvaient aux sources de son génie... il était bon, fantasque, irréel, comme les personnages qu’il peignait... Cher ange ! — Charles Trenet à propos de Max Jacob, préface du livre de Marc Andry, Charles Trenet,Calmann-Lévy, 1953.          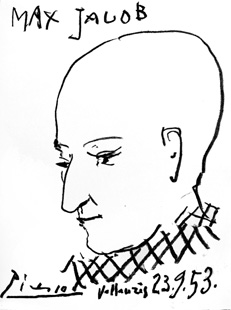 |
Connexion
Sont en ligne
58 Personne(s) en ligne (39 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 58 Plus ... |
| Haut de Page |






