 Tous les messages Tous les messages
#121
Eugène Pottier
Loriane
Posté le : 03/10/2015 18:29
Le 4 octobre 1816 à Paris naît Eugène Pottier
où il est mort le 6 novembre 1887, goguettier, révolutionnaire poète, homme politique, écrivain du Parti politique ouvrier socialiste d'Amérique . Il est membre de l'association internationale des travailleurs français, IL est l'auteur des paroles de L'Internationale. En bref Il fut sous l'Empire un des promoteurs du syndicalisme illégal et prit part à la Commune de Paris. Il est l'auteur des paroles de l'Internationale (1871). Le destin prodigieux de L'Internationale a rejeté dans l'ombre l'œuvre et la vie son auteur. Conséquence injuste, car Eugène Pottier est peut-être le chansonnier socialiste le plus important du XIXe siècle. Après une période d'inspiration épicurienne, où prévaut l'influence de Béranger La Jeune Muse, il s'oriente vers la chanson ouvrière. Ses textes reflètent largement les étapes de sa vie militante : il est babouviste, puis, après 1848, fouriériste ; ces influences idéologiques n'éclipsent cependant pas totalement la veine épicurienne première. Ne pouvant vivre de la vente de ses œuvres, publiées sur des feuilles volantes, dans des fascicules ou des journaux, Pottier n'abandonne jamais son métier de dessinateur sur étoffes. En 1871, il est élu membre de la Commune de Paris et fait partie de la commission des Services ainsi que de la Fédération des artistes. Réfugié aux États-Unis après la Semaine sanglante, il célèbre alors le souvenir d'une expérience qui le marque pour le reste de ses jours. L'orientation résolument socialiste, mais surtout le souffle épique qui anime ses meilleures chansons confèrent à la production de cette période une force que Jules Vallès compare à celle des Châtiments de Victor Hugo, En avant la classe ouvrière et Jean Misère, 1880 ; L'Insurgé, 1884 ; La Question sociale, 1885 ; Elle n'est pas morte, 1886. Pourtant la renommée ne l'atteindra qu'à la veille de sa mort, grâce à un recueil, Quel est le fou 1884, publié avec l'aide financière du chansonnier Gustave Nadaud. Malgré ses faiblesses, L'Internationale, écrite par Pottier en juin 1871 à Paris, est l'un de ses textes les plus riches du point de vue idéologique. Parce qu'« elle offre cet avantage qu'elle condense en six couplets les conceptions essentielles du prolétariat socialiste A. Zévaès et qu'elle est portée par une musique, composée par un ouvrier tourneur belge, Pierre Degeyter, en 1888 parfaitement adaptée aux nécessités d'un chant de combat, L'Internationale devint, en moins de trente ans, l'hymne du mouvement socialiste international. Jean-Claude Klein Sa vie Dessinateur sur étoffes, Eugène Pottier compose sa première chanson, Vive la Liberté, en 1830. En 1840, il publie Il est bien temps que chacun ait sa part. Il participe à la Révolution de 1848. Sous le Second Empire, il crée une maison d'impression sur étoffes et, en 1864, il est à l'origine de la création de la chambre syndicale des dessinateurs, qui adhère ensuite à la Première Internationale. Membre de la garde nationale, il participe aux combats durant le siège de Paris de 1870, puis il prend une part active à la Commune de Paris, dont il est élu membre pour le 2e arrondissement. Il siège à la commission des Services publics. Il participe aux combats de la Semaine sanglante. En juin 1871, caché dans Paris, il compose son poème L'Internationale et se réfugie en Angleterre. Condamné à mort par contumace le 17 mai 1873, il s’exile aux États-Unis, d'où il organise la solidarité pour les communards déportés. C'est de là aussi qu'il adhère à la franc-maçonnerie1, puis au Parti ouvrier socialiste d'Amérique. Ruiné et à demi paralysé, il revient en France après l’amnistie de 1880. Eugène Pottier fréquente les goguettes. En 1883 il présente une chanson au concours de la célèbre Lice chansonnière et remporte la médaille d'argent. Il retrouve à cette occasion le chansonnier Gustave Nadaud qu'il a croisé en 1848 et à qui il avait alors fait une forte impression. Grâce à ces retrouvailles une cinquantaine de chansons sont publiées pour la première fois en 1884 et sauvées de l'oubli par Nadaud qui admire beaucoup le talent poétique de Pottier tout en étant très loin de partager ses opinions politiques. Nadaud qui a financé l'impression du recueil de Pottier termine sa préface élogieuse par un distique : La politique nous sépare Et la chanson nous réunit. Cette initiative de Nadaud incitera les amis politiques de Pottier à publier en 1887 ses Chants révolutionnaires volume comprenant une préface de Henri Rochefort3, et incluant pour la première fois le texte de L'internationale. C'est la même année qu'un jeune professeur guesdiste, Charles Gros, lui-même poète, remarque le texte et le communique à la section lilloise du parti ouvrier. Le maire de Lille demande alors à Pierre Degeyter, autre lillois quoique né le 8 octobre 1848 à Gand Belgique de le mettre en musique. Eugène Pottier acquiert la célébrité un an après sa mort, en 1888. Jean Ferrat évoque Pottier dans sa chanson La Commune. Ses chansons sont reprises après sa mort, que ce soit par des artistes d'inspiration socialiste, communiste, anarchiste ou libertaire comme Pierre Degeyter. En 2010, Sébastien Ducret a mis en musique plus d'une vingtaine de textes d'Eugène Pottier4. Le premier disque entièrement consacré à Eugène Pottier est sorti en décembre 2011, il s'intitule Quel est le fou ?. Eugène Pottier est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Recueils de poèmes et chansons Poésies d'économie sociale et chants socialistes révolutionnaires, Paris : H. Oriol, 1884 Quel est le fou ? chansons, préface de Gustave Nadaud, Paris : H. Oriol, 1884 Chants révolutionnaires, préface de Henri Rochefort, appréciations de Gustave Nadaud et de Jules Vallès, Paris : Dentu, 1887 Œuvres complètes, rassemblées, présentées et annotées par Pierre Brochon, Paris : F. Maspero, 1966 Poèmes, chants & chansons, précédés d'une notice par Jules Vallès, illustré par Steinlen, Willette, Grün et al., Cœuvres-&-Valsery : Ressouvenances, 1997 Poèmes et chansons, choisis et présentés par Jacques Gaucheron, Pantin : Le Temps des cerises, 1999 Sources historiques Ernest Museux, Eugène Pottier et son œuvre : les défenseurs du prolétariat, Paris : J. Allemane, 1898 Ernest Museux, Almanach Eugène Pottier pour 1912, Paris, Saint-Quentin, s. n., s. d.        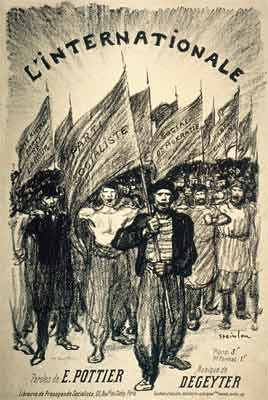 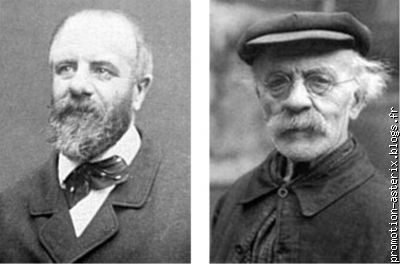  
#122
Edouard Corbière
Loriane
Posté le : 25/09/2015 21:00
Le 27 septembre 1875 meurt Jean Antoine René Édouard Corbière
à Morlaix, né à Brest Finistère le 1er avril 1793, marin, armateur, journaliste et écrivain français, considéré comme le père du roman maritime en France. En bref " On m'a manqué ma vie ", écrit celui qui dès l'adolescence fut voué par la maladie rhumatisme aigu, peut-être tuberculose à l'infirmité, à la difformité, à la mort précoce. Pires, la vie rognée par l'insomnie, et surtout, brusquement brisés, les rêves si vastes de naviguer, de dominer. Quelques mois en Italie, quelques séjours à Paris, une passion éphémère et mauvaise, des farces de rapin à Roscoff, cette résidence obligée pour son climat si doux : pitre et bourreau de soi-même, Corbière est rivé au dérisoire. Je suis là mais comme une rature..., écrit-il face au père puissant, Édouard 1793-1875, brillant auteur du Négrier, navigateur et notable, qui jamais, dit-on, ne lira la grande œuvre de Tristan, à lui dédiée, jamais n'entendra ce rire jaune des Amours jaunes 1873, son unique recueil. Celui-ci fut publié à compte d'auteur chez les frères Gladys en août 1873. Les Amours jaunes, de la couleur d'un rire glacé et grinçant, témoignent d'une œuvre de rupture, que seul Verlaine révélera dix ans après leur parution. Tout pouvait sembler rature et chaos dans les six parties de cette œuvre, où les thèmes de la mer, de la Bretagne ou de l'amour n'étaient pas l'essentiel : la désarticulation de la versification érigée en système, le lexique bariolé où l'archaïsme jouxte le néologisme et où triomphe un cosmopolitisme grotesque, la syntaxe brisée, et tout un langage presque prosaïque avec sa prédilection pour l'argot maritime, la complainte populaire ou l'exclamation triviale. Et pourtant, réduite à une quintessence osseuse, cette poésie qui condamne le chant, qui cultive l'absurde et l'humour railleur annonce aussi bien Laforgue, pour son goût du blasphème désespéré et cynique, que Joyce, T. S. Eliot, Céline et Queneau pour son recours au style oral, ou que les surréalistes, qui lui reconnurent d'ailleurs leur dette, pour ses vertus provocatrices. Sa dissonance même, Ses vers faux furent les plus vrais, qui la voue à l'imperfection, fonde, dans un nihilisme sans pathétique, sa modernité. Sa vie La famille Corbière est originaire du Haut-Languedoc le hameau de Valès, aujourd'hui sur la commune du Bez, à l'est de Castres, dans le Tarn. À la naissance d'Édouard, son père est capitaine d'infanterie de Marine. Sa mère, Jeanne-Renée Dubois, est née à Morlaix en 1768. Édouard est le troisième de quatre enfants. Orphelin de père en 1802, le jeune Édouard n'a alors d'autre choix que d'entrer dans la Marine pour subvenir aux besoins de sa famille. Mousse en 1804, novice en 1806, aspirant dès 1807, Édouard Corbière connaît la dure expérience d'un ponton britannique, celui de Tiverton Devon en 1811-1812. Il est écarté de la Marine à la Restauration en raison de ses opinions libérales. Les voyages Devenu pamphlétaire, il connaît quelques déboires avec la justice royale, d'abord à Brest en 1819, à cause de ses écrits dans La Guêpe, puis à Rouen en 1823, dans La Nacelle, qui le poussent à reprendre la mer, cette fois au commerce. Pendant cinq ans, il navigue surtout entre Le Havre et la Martinique, comme capitaine au long cours, sur un vieux trois-mâts de prise britannique, la Nina, ce qui lui vaudra de la part de ses critiques littéraires des accusations de s'être livré à la traite négrière. Les débuts littéraires Ayant définitivement posé sac à terre au Havre, en 1828, il est aussitôt sollicité par Stanislas Faure, gérant du Journal du Havre, pour en devenir le rédacteur en chef, poste qu'il occupe jusqu'en 1839. Il demeure dans l'équipe du journal jusqu'en 1843. Sous son impulsion, ce quotidien, qui n’était qu’une maigre feuille d’annonces , devient un organe d'information commercial et maritime de première importance. Entre-temps, il rédige plus de dix romans à succès dont le plus connu, Le Négrier 1832, lui confère une célébrité nationale. Il devient le maître français, aujourd'hui oublié, du roman d'aventure. En 1839 a lieu la création de la Compagnie des paquebots à vapeur du Finistère, qui assure la liaison entre Le Havre et Morlaix. Édouard Corbière en est l’un des administrateurs, puis le directeur, jusqu'à sa mort. Les dernières années En 1844, son mariage avec Marie-Angélique-Aspasie Puyo, fille cadette de son ami Joachim Puyo, négociant, entraîne son installation définitive à Morlaix. Il y lance des régates en 1851, puis propose, sans succès, l'ouverture d'une souscription nationale. Il souhaite en effet que la France aligne un yacht lors d'une régate autour de l'île de Wight, animée par le Royal Yacht Squadron. Le 22 août 1851, le schooner America remporte le trophée historique qui, depuis, porte le nom de coupe de l'America . Corbière est aussi membre du conseil municipal de Morlaix en 1855 et 1860. Entré à la Chambre de commerce en 1848, il en est le vice-président de 1866 à 1868, puis le président de 1868 à mars 1875. Il meurt le 27 septembre 1875. Quelques mois plus tôt, la disparition de son fils aîné, Édouard-Joachim, plus connu sous le nom de Tristan Corbière, l'a profondément affecté. La mort d'Édouard Corbière est ressentie comme un véritable deuil public tant au Havre qu’à Morlaix. Le Morlaix, de la Compagnie des paquebots à vapeur du Finistère, ainsi que tous les autres navires du port finistérien, mettent leurs pavillons en berne dès l'annonce du décès. Lors des obsèques, le cercueil est porté par des marins du Morlaix. En 1880, Le Havre honore sa mémoire en donnant son nom à une petite rue du centre ville. Plus tard, un hommage similaire est rendu par la ville de Brest. Morlaix et Roscoff font de même en 1905 et 1911. En 1906, le conseil d'administration de la Compagnie des paquebots à vapeur du Finistère décide de baptiser son cinquième et dernier vapeur Édouard Corbière. L'armement fondé par Édouard Corbière en 1839 disparaît en 1921, à défaut d'avoir été intégralement remboursé par l'État pour la perte de son dernier vapeur, torpillé en Méditerranée en 1917. Publications À la Liberté publique, dithyrambe, 1819 Le Dix-Neuvième Siècle, satire politique, 1819 La Marotte des Ultra, ou Recueil des chansons patriotiques, 1819 Trois Jours d'une mission à Brest, 1819 La Lanterne magique, pièce curieuse représentant la Chambre des Députés de 1819, 1819 Les Philippiques françaises, poème, 1820 Notre Âge, satire, 1821 Élégies brésiliennes, suivies de Poésies diverses, et d'une Notice sur la traite des noirs, 1823 Brésiliennes, 1825 Corbière à Corbière. Épître à Son Excellence le comte de Corbière, 1827 Poésies de Tibulle, traduites en vers français, 1829 Les Pilotes de l'Iroise, roman maritime, 1832 Contes de bord, 1833 Texte en ligne La Mer et les marins, scènes maritimes, 1833 Le Prisonnier de guerre, roman maritime, 1834 Le Négrier, aventures de mer, 4 vol., 1834 Scènes de mer, 2 vol., 1835 Le Banian, roman maritime, 2 vol., 1836 Les Folles-brises, 2 vol., 1838 Les Trois Pirates, 2 vol., 1838 Tribord et bâbord, roman maritime, 2 vol., 1840 Pelaio, roman maritime, 2 vol., 1843 Les Îlots de Martin Vaz, roman maritime, 2 vol., 1843 Cric-Crac, roman maritime, 2 vol., 1846 Pétition maritime à l'Assemblée nationale, 1848 Questions soumises à l'enquête sur la marine marchande, 1851     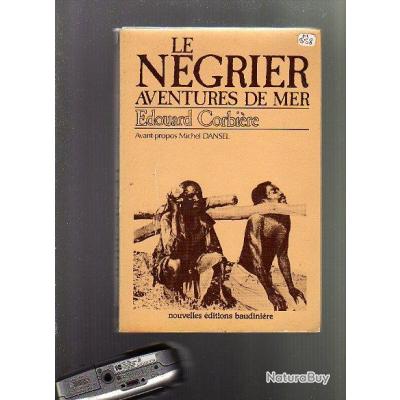   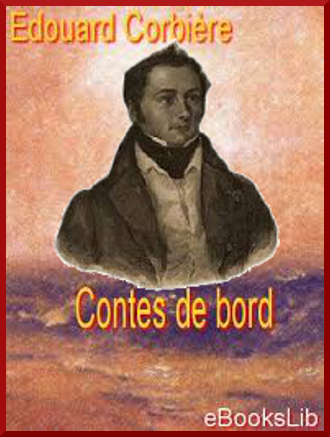   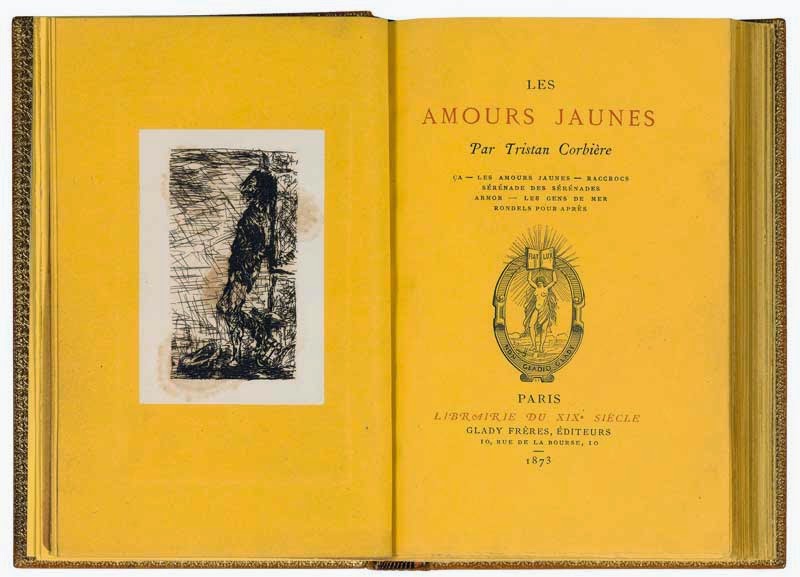   
#123
Bernard Manciet
Loriane
Posté le : 25/09/2015 20:54
Le 27 septembre 1923 naît Bernard Manciet
à Sabres, mort à Mont-de-Marsan le 3 juin 2005, écrivain originaire des Landes et un des plus importants auteurs gascons du XXe siècle. Il pratique d'abord l'ode Ode à notre Dame de la Peur, 1950, mais c'est avec Accidents 1955, évoquant un séjour prolongé dans l'Allemagne d'après-guerre, qu'il apporte un souffle véritablement nouveau à la poésie occitane. En 1972, avec Gesta, il se retourne contre l'occitanisme militant. Roncevaux 1977 dit l'attachement fort aux racines, en même temps que la fierté de la renaissance moderne d'une langue. Le lyrisme se déploie sur un mode épique dans cette sorte d'opéra monde qu'est l'Enterrement à Sabres 1989, son chef-d'œuvre, somme d'une vie organisée autour de la puissante figure, largement mythique, de la Dauna, épicentre d'un monde entre terre et ciel, entre nature panique et forces de la mort, entre petites gens et Dieu. Ses sonnets Sonets, 1996 au lyrisme baroque sont marqués par la lecture des poètes occitans du XVIIe siècle. En bref On pourrait croire que l'écriture de Bernard Manciet est essentiellement centrée autour du bourg de la Grande Lande où il est né, Sabres, et au voisinage duquel il a fini ses jours, après y avoir passé la plus grande partie de son existence. Son œuvre la plus connue n'est-elle pas un immense poème en seize chants, L'Enterrement à Sabres 1989 ? L'omniprésence du paysage landais et de ses habitants chez Bernard Manciet, comme l'usage quasi exclusif qui fut le sien, en littérature, de l'occitan gascon de ses origines, ne font pas de doute. On ne niera pas davantage que la trilogie romanesque composée du Jeune Homme de novembre 1964, mais son écriture est bien plus ancienne, du Chemin de terre 1976 et de La Pluie 1976, ainsi que, plus récemment, le court roman Hélène 1992 soient profondément marqués par ces lieux dont Manciet s'est constamment présenté comme le chantre, aussi bien dans ses essais en français Le Triangle des Landes, 1981 ; Le Golfe de Gascogne, 1987 que dans son œuvre occitane : Là subsiste, sache-le, une peuplade bafouée par l'Histoire. Moi, je lui donnerai mieux : de la légende. Sa vie À l'école publique de Sabres, puis au petit lycée de Talence où il passe trois années heureuses chez ses oncles curés à apprendre le latin et le grec malgré sa maladie au cœur, et enfin au lycée Montaigne de Bordeaux où il passe le bac un dimanche de juin 1940, il forge une grande érudition dont il n'aimait pas que l'on parle mais qui imprégnait la moindre des conversations avec lui. Cueilli par la tourmente de la guerre, il fait des études de lettres et de sciences politiques à Paris avant d'entrer dans la carrière diplomatique. Il part en Allemagne, dans l'administration française d'occupation : il est assistant de français à Spire, puis à Ludwigshafen, en 1947-1948 ; en 1949, il est chargé d'études générales à l'usine IG Farben de Ludwigshafen. Il devient haut-commissaire en Allemagne auprès de Koenig au moment de la reconstruction de l'État allemand.Le voici aussi au procès de Nuremberg. À côté du procès, comme il disait. En 1955, il poursuit sa carrière diplomatique qui le conduit quelques mois au Brésil puis à Montevideo en Uruguay. Il en gardera un regard géopolitique aigu. Il revient à Sabres pour se marier à Mme Marie-Geneviève Dayon, avoir cinq enfants Marie-Joseph, Jean-Romain, Marc, Anne ainsi que Claire, vivre dans une maison qu'il fit construire à Trensacq et gérer l'entreprise de sa belle-famille L'entreprise alors est appelée Manciet-Dayon dans le secteur du bois, laquelle fit faillite dix ans plus tard. Il anima la revue Òc mais refusa d'entrer dans le mouvement politique occitaniste, même s'il entretenait des relations amicales avec Robert Lafont et Max Rouquette. Cette prégnance bien réelle de la Lande et de ses habitants ne saurait cependant masquer l'essentiel : depuis ses premiers poèmes, publiés dès la fin des années 1940, et, plus encore, depuis son premier livre imprimé, un recueil de vers et de proses mêlés intitulé de façon lourde de sens Accidents (1955), Manciet est demeuré avant tout un franc-tireur, toujours fidèle aux failles et aux fractures qui ont sans relâche traversé et façonné en profondeur son écriture. Accidents, évocation apocalyptique de la « catastrophe allemande », que Manciet a connue de près, dès 1946, quand il y fut mobilisé, puis comme diplomate travaillant à la reconstruction pendant les années suivantes avant de partir pour l'Amérique du Sud, donne le ton de toute l'œuvre à venir. Et ce ton est celui de la rupture, de la transgression, du pas de trop qui fait pencher le poème ou le récit du côté du vide, de l'interdit, de ce qui fait peur ou risque d'anéantir. Esquisse autobiographique énonçant par avance la genèse de toute une aventure d'écriture, Le Jeune Homme de novembre dit la quête du souffle contre la maladie et l'effroi, et la guerre sans relâche livrée contre cet autre, créature du dedans et du dehors à la fois, qui hante le narrateur jusqu'à lui faire frôler la mort. Le poème, comme le récit, naît toujours chez Manciet d'une limite franchie ou d'une cassure, d'un tremblement du temps ou du corps qui repousse les frontières du dicible. Ce sont souvent les tempêtes du monde qui ont inspiré, littéralement, le poète : Aux portes de fer 2001, évocation de Belgrade bombardée sur fond de paysage biblique, Le Dire de Guernica 2001, Le Grand Vent 2002, Pour l'enfant de Bassora 2003 sont autant de déchaînements élémentaires dont le souffle se confond avec celui du verbe qu'ils font surgir. Mais ces tempêtes sont aussi tempêtes des corps, dont les attirances sont toujours luttes, et déflagrations : les Odes recueillies en 1984, Un hiver 1990 ou les Sonnets 1996, dans des genres différents, sont tous traversés par ces désastres intimes et cosmiques dont Accidents, déjà, explorait les retentissements. On ne s'étonnera pas que Manciet, le personnage comme l'œuvre, ait trouvé chez certains musiciens (Bernard Lubat, Michel Portal, Christian Vieussens... ou chez des hommes de théâtre Gilbert Tiberghien : une Iphigénie, un Orphée des alliés essentiels. Multiple et insaisissable, l'écriture de Manciet atteint sans doute son unité la plus authentique quand elle prend le temps de contempler les abîmes dont elle est issue comme dans les proses des Vigilantes réunies en 1999 et plus encore dans les très brefs récits rassemblés en 1986 puis 2005 sous le titre de Jardins perdus. Écrivain solitaire, fuyant les modes et les engouements passagers, mais toujours attentif aux écritures de son temps, proches ou plus lointaines, Bernard Manciet fut également à sa manière un militant opiniâtre de la langue et de la culture occitanes. Hostile par principe à toute orientation nationaliste de son combat culturel, et fidèle en cela aux idées constamment développées depuis les temps de la Libération par son ami l'essayiste et poète Félix-Marcel Castan, il a animé avec passion pendant plus de vingt-cinq ans, et jusqu'à sa mort, la rédaction de la revue littéraire Òc, créée en 1923 par un autre de ses compagnons en occitanisme, Ismaël Girard. Philippe Gardy Son œuvre Poète, romancier, auteur dramatique, essayiste, directeur de revue littéraire, peintre, performeur, Bernard Manciet laisse une œuvre aux multiples facettes mais dont le fil conducteur fut ce parler noir des Landes dont il se disait le "renard". Il montait aussi sur scène pour dire sa poésie : il a participé à des spectacles avec Bernard Lubat, à Uzeste, Eysines et Bordeaux notamment. En 1972 déjà, René Nelli écrivait à son propos dans l’anthologie en édition bilingue La poésie occitane parue aux éditions Seghers : Une étude d’ensemble sur l’œuvre de Manciet ne se fera pas attendre longtemps. Elle permettra peut-être de mieux cerner ce monstre d’originalité, dont le renouvellement verbal incessant et le jaillissement lyrique intérieur ne doivent rien aux dernières modes littéraires de Paris. Entre René Char et Quasimodo, Bernard Manciet est certainement l’un des grands poètes – méconnus – de l’Europe moderne. Du point de vue linguistique, Bernard Manciet reste fidèle au parler gascon très localisé de sa région des Landes. Une citation "Je ne parle guère, dit-il dans la présentation de Compresseur, que de la lumière de la forêt, du matin, de la nuit. Je vis dedans. Je suis du grand soleil, de la lumière de la nuit." Bernard Manciet Répliques "Antonio, à taoule !" Œuvres Bernard Manciet a écrit une œuvre importante, qui comprend des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre et des poèmes dont la plupart sont écrits à la fois en français et en occitan : Le Triangle des Landes, éditions Arthaud, 1981, et Éditions In 8 Serres-Morlaàs, 2005 nouvelle édition corrigée. L'Enterrament a Sabres, Éditions Ultreïa, Garein Landes, 1989; Éditions Mollat, 1996; Poésie/Gallimard, Paris, 2010. Accidents, I.E.O. Institut d'études occitanes, 1955 et Éditions L’Escampette, Bordeaux, 1999. Strophes pour Feurer, Éditions L’Escampette, 1995. Jeune Homme de novembre / Lo Gojat de noveme, Éditions Reclams / Escòla Gaston Febus, Pau, 1995 et Edicions Reclams, Pau, 2003. Per el Yiyo, Éditions L’Escampette, 1996. Véniels, Éditions L’Escampette, 1996. Impromptus, Éditions L’Escampette, 1998. Les Émigrants ou Iphigénie devant la gare Los Hòra-trèits o Ifigenia davant la gara, Éditions L’Escampette, Bordeaux, 1999. Accidents, Éditions L’Escampette, 1999. Les Vigilantes, Éditions L’Escampette, 1999. Compresseur, suivi de Poussière, Éditions L’Escampette, 2000. Pastel, alchimie du bleu, livre fait à la main, la part des anges éditions, 2001. Cobalt, Éditions Cadratins, Bagnères de Bigorre, 2002. Éloge de la Rose, Éditions L’Escampette, 2003. De nouveau Cordoue/'Cordoa enqüèra, Éditions Cadratins, Bagnères de Bigorre, 2004. Casaus perduts, novelas, Edicions Reclams, 2005. Jardins perdus, L'Escampette Éditions, 2005. Les Murmures du mal, L'Escampette Éditions, 2006. Ecorchés, photographies Eric Chabrely, la part des anges éditions, 2006. Lo Brèc, poèma, Edicions Reclams, 2006. L'Eau mate, Éditions L’Escampette, 2007. L'Enterrement à Sabres, Gallimard, Mollat, 2010 Il s'est longuement exprimé sur son parcours dans : Entre Gascogne et Provence - Itinéraire en lettres d'Oc, Entretiens réalisés par Jean-Luc Pouliquen avec Serge Bec et Bernard Manciet, Edisud, Aix-en-Provence, 1994.     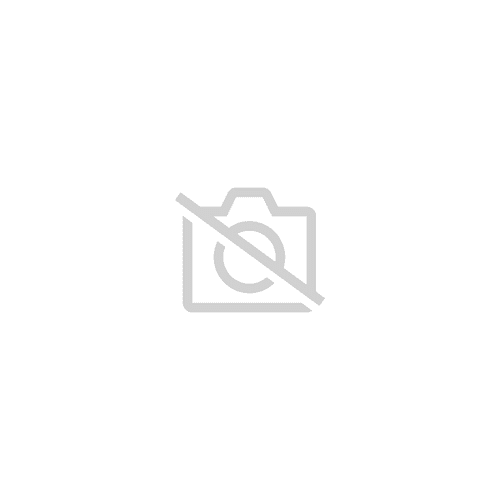 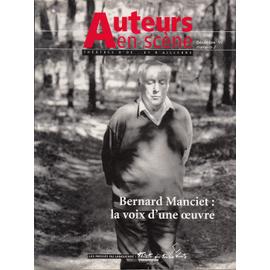 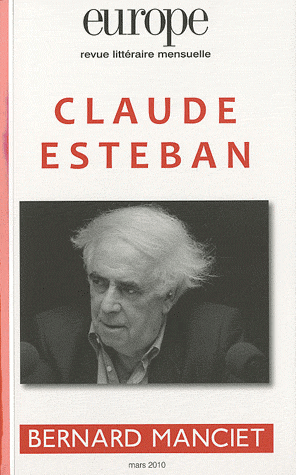   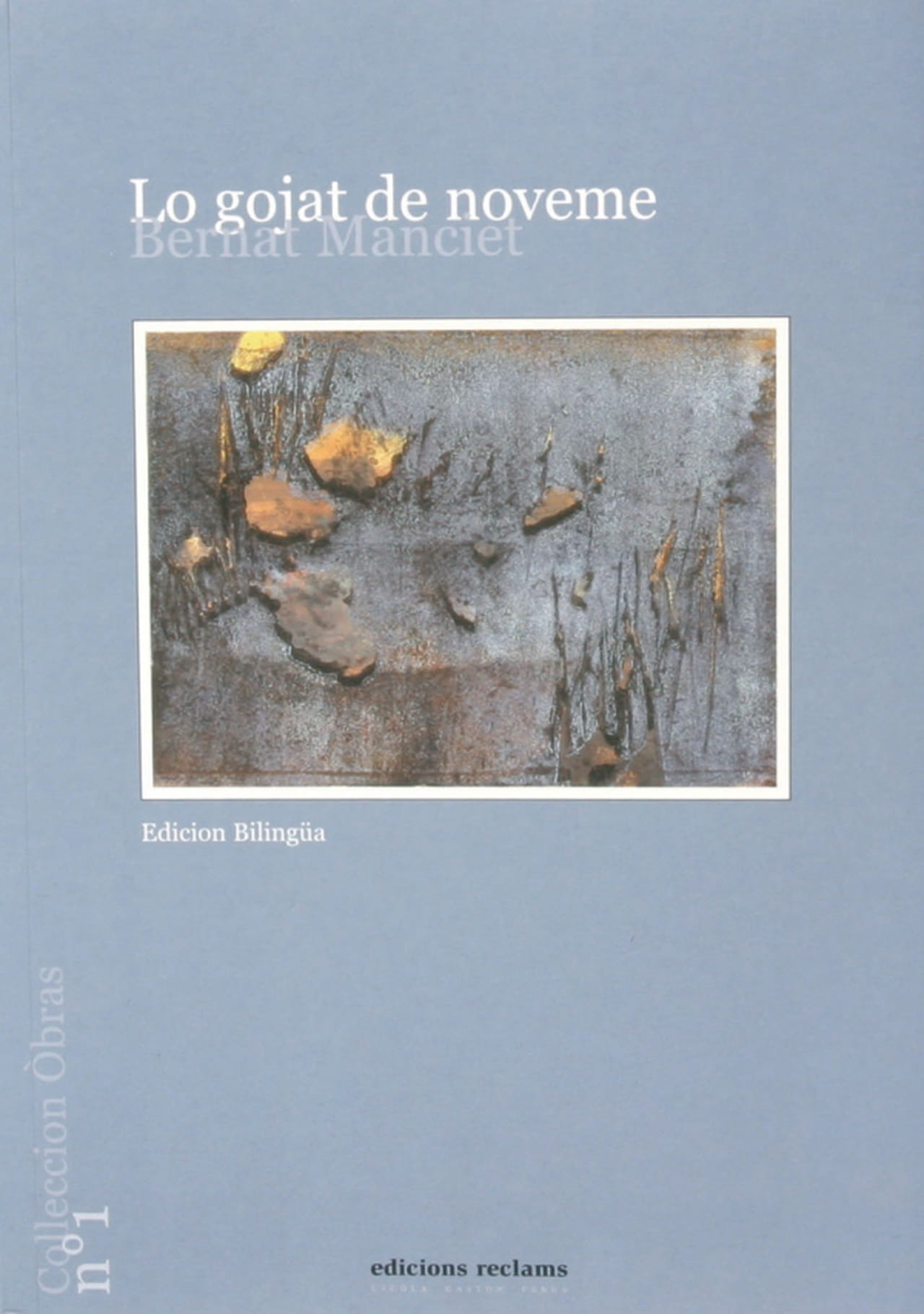 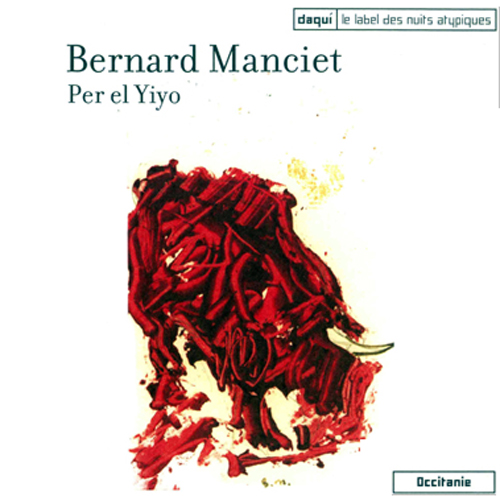  
#124
Georges R.R. Martin
Loriane
Posté le : 19/09/2015 13:54
Le 20 septembre 1948 naît Georges R.R. Martin
à Bayonne New Jersey, de son nom complet George Raymond Richard Martin, romancier, nouvelliste, scénariste, producteur de cinéma écrivain américain de science-fiction et de fantasy, également scénariste et producteur de télévision. Son œuvre la plus connue est la série romanesque du Trône de fer, adaptée sous forme de série télévisée par HBO sous le titre Game of Thrones. Il a été récompensé par de nombreux prix littéraires et a été sélectionné par le magazine Time comme l'une des personnes les plus influentes du monde en 2011. Il est aujourd'hui considéré comme le Tolkien américain. Il a reçu pour distinction le prix E. E. Smith Memorial, le prix Hugo, le pe prix Nebula, Prix Locus, le prix World Fantasy, le prix Bram Stoker. Ses Œuvres principales sont : L'Agonie de la lumière, Chanson pour Lya, Armageddon Rag, Cycle du Trône de fer En bref Auteur de fantasy américain, George R. R. Martin est surtout connu pour le cycle A Song of Ice and Fire, écrit à partir de 1996, traduit en français sous le titre Le Trône de fer, une sanglante saga qui oppose plusieurs factions en lutte pour le contrôle d'un royaume imaginaire. George Raymond Richard Martin, de son vrai nom George Raymond Martin naît le 20 septembre 1948, à Bayonne, New Jersey. Il étudie à la Northwestern University, où il obtient une licence 1970, puis une maîtrise 1971 en journalisme. Fan de science-fiction et de fantasy depuis son enfance, il fait paraître sa première nouvelle en 1971. Objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam, il effectue un service civil bénévole auprès d'une association d'assistance judiciaire à Chicago. Il gagne alors sa vie en organisant parallèlement des tournois d'échecs et en écrivant de courtes fictions. Il se rend par ailleurs régulièrement à des salons de science-fiction et de fantasy. George Martin remporte en 1974 le prix Hugo, décerné à des auteurs de ces deux genres, pour son court roman de science-fiction A Song for Lya, Chanson pour Lya. Deux ans plus tard, il accepte un poste au Clarke College de Dubuque Iowa, où il enseigne le journalisme. En 1977, il publie son premier long ouvrage de fiction, Dying of the Light L'Agonie de la lumière, un roman qui se déroule, le temps d'un festival, sur une planète à l'abandon. Deux ans plus tard, il s'installe à Santa Fe Nouveau-Mexique pour se consacrer à plein temps à l'écriture. Il reçoit le prix Hugo et le prix Nebula, lui aussi attribué à des auteurs de science-fiction et de fantasy, pour sa nouvelle Sandkings 1981, Les Rois des sables. Cette année-là, il fait également paraître Windhaven coécrit avec Lisa Tuttle, paru en France sous le titre Elle qui chevauche les tempêtes, puis réédité sous celui de Windhaven, où il brosse le portrait d'une enfant qui acquiert le pouvoir de voler. Sa carrière littéraire se poursuit avec deux romans : l'histoire de vampires Fevre Dream 1982, Riverdream et le récit d'épouvante The Armageddon Rag 1983, Armageddon rag, situé dans l'univers du rock. Bien que ce dernier ouvrage ne rencontre pas le succès escompté, un producteur en achète les droits cinématographiques. L'adaptation ne sera jamais réalisée, mais le producteur propose George Martin comme scénariste pour le remake en 1985 de la série The Twilight Zone, diffusée en France à l'origine sous le titre La Quatrième Dimension et relancée à cette occasion sous celui de La Cinquième Dimension. L'écrivain signe plusieurs épisodes avant d'accepter de travailler sur la série télévisée Beauty and the Beast 1987-1990, La Belle et la Bête, dont il sera par la suite l'un des producteurs. George Martin ne parvient cependant pas à vendre ses pilotes et ses scénarios et reprend l'écriture de fictions longues en 1991. Il signe notamment A Game of Thrones, 1996, traduit en deux volumes : Le Trône de fer et Le Donjon rouge, premier opus de ce qu'il conçoit au départ comme une trilogie, le cycle A song of Ice and Fire. Le récit se déroule dans un monde imaginaire, le royaume des Sept Couronnes, sur le continent de Westeros. Bien qu'il soit explicitement rattaché à la fantasy, ce cycle évite ostensiblement certaines des images les plus mièvres du genre, privilégiant un réalisme austère. La plupart des personnages – même les plus sympathiques – rencontrent souvent une fin sinistre, et les multiples trames du récit sont dominées par les intrigues politiques et la barbarie sans pitié des personnages partis à la conquête du trône. Au second opus, intitulé A Clash of Kings, 1999, paru en France en trois volumes : La Bataille des rois, L'Ombre maléfique et L'Invincible Forteresse, succède A Storm of Swords (2000, traduit en quatre volumes : Les Brigands réédité sous le titre Intrigues à Port-Réal L'Épée de feu, Les Noces pourpres et La Loi du régicide. Viennent ensuite le troisième volet, A Feast for Crows, 2005, traduit en trois volumes : Le Chaos, Les Sables de Dorne et Un festin pour les corbeaux, puis le quatrième, A Dance with Dragons, 2011, paru en France en trois volumes : Le Bûcher d'un roi, Les Dragons de Meereen et Une danse avec les dragons. La chaîne américaine H.B.O. adapte le cycle et le diffuse à partir de 2011. George Martin, co-producteur exécutif de la série, signe le scénario de plusieurs épisodes. Il dirige par ailleurs la publication de nombreuses anthologies de science-fiction et de fantasy, tandis que ses nouvelles sont rassemblées sous le titre GRRM : A RRetrospective 2003. Richard Pallardy Sa vie George Raymond Richard Martin grandit dans un milieu modeste, avec un père docker. Il a deux sœurs cadettes, Darleen et Janet. Au lycée, il développe un intérêt pour les comics, et notamment les histoires de super-héros de Marvel. Il écrit des fanfiction et remporte en 1965 un Alley Award, récompenses consacrées aux comics, de la meilleure fanfiction pour son histoire Powerman vs. the Blue Barrier. En 1971, il sort diplômé en journalisme de l'université Northwestern6 mais, après être retourné dans sa ville natale, il ne peut y trouver un emploi de journaliste et passe l'été à écrire des nouvelles, se découvrant une vocation d'écrivain. Objecteur de conscience, il accomplit au lieu de partir au Viêt Nam deux ans de volontariat dans le cadre du programme de la guerre contre la pauvreté entre 1972 et 1974. Entre 1973 et 1976, il est superviseur de tournois d'échecs, puis professeur de journalisme à la Clarke University de Dubuque de 1976 à 1978. Dans le même temps, il écrit des nouvelles de science-fiction qui lui valent une certaine reconnaissance. Il remporte en 1975 le prix Hugo du meilleur roman court pour Chanson pour Lya. En 1975, il se marie avec Gale Burnick mais le couple divorce en 1979. La même année, Martin devient écrivain à plein temps6. En 1980, il remporte le prix Hugo, le prix Locus et le prix Nebula pour sa nouvelle Les Rois des sables. Outre ses nombreux récits de science-fiction, Martin aborde aussi le genre de l'horreur avec ses romans Riverdream 1982 et Armageddon Rag 1983. Au milieu des années 1980, il travaille pour la télévision comme scénariste pour les séries télévisées La Cinquième Dimension et La Belle et la Bête, participant aussi à la production de cette dernière série. Une de ses nouvelles, Le Volcryn, est adaptée au cinéma avec le film Nightflyers en 1987. Parallèlement à ces travaux, il entame dès 1987 un travail d'éditeur avec une série nommée Wild Cards et composée de recueils de nouvelles et de romans de science-fiction mettant en œuvre des super-héros. Au début des années 1990, las de voir son imagination restreinte par les limitations imposées par le format télévisé, il revient à l'écriture en entamant le cycle de fantasy Le Trône de Fer A Song of Ice and Fire. Le prix Locus du meilleur roman de fantasy et la saga connaît un succès commercial grandissant. Martin connaît ensuite des difficultés pour écrire les volumes suivants, A Feast for Crows et A Dance with Dragons, qui sortent respectivement en 2005 et 2011 et se classent tous les deux à la première place de la liste des bestsellers du New York Times. A Dance with Dragons reçoit le prix Locus du meilleur roman de fantasy. En janvier 2007, la chaîne de télévision HBO acquiert les droits d'adaptation du Trône de fer dans l'intention d'en faire une série télévisée. Le pilote est tourné à la fin 2009 et la série commence à être diffusée en avril 2011. Martin participe à sa production et écrit le scénario d'un épisode par saison. Martin vit désormais à Santa Fe, où il possède un cinéma, et s'est marié le 15 février 2011 avec Parris McBride, sa compagne depuis les années 1980. Thèmes L'univers de Martin est souvent sombre et cynique et empreint de mélancolie. Ses personnages sont souvent malheureux ou au moins insatisfaits. Ils ont une dimension tragique et un sort fatal leur est souvent réservé. Cet aspect sombre et pessimiste peut être un obstacle pour certains lecteurs. Dans Le Trône de Fer, l’écriture de chaque chapitre met en scène un des personnages principaux, ce qui permet au lecteur de voir l’histoire progresser par différents lieux et points de vue. En outre, Martin en vient rapidement à utiliser les perspectives des méchants, renversant ainsi toute vision manichéenne qu'aurait pu avoir le lecteur puisque, bien souvent, les méchants eux aussi ont leurs raisons. Dans ses nouvelles de science-fiction, les principaux thèmes abordés sont la solitude, les relations humaines, l'amour tragique, le romantisme et l'opposition entre une dure vérité et un mensonge réconfortant. Œuvres Il existe une catégorie consacrée à ce sujet : Œuvre de George R. R. Martin. Auteur Cycle du trône de fer. Article détaillé : Le Trône de fer. Le Trône de fer, Pygmalion, 1998 A Game of Thrones 1/2, 1996 Réédité par J'ai lu en 2000 Le Donjon rouge, Pygmalion, 1999 A Game of Thrones 2/2, 1996 Réédité par J'ai lu en 2001 La Bataille des rois, Pygmalion, 2000 A Clash of Kings 1/3, 1998 Réédité par J'ai lu en 2001 L'Ombre maléfique, Pygmalion, 2000 A Clash of Kings 2/3, 1998 Réédité par J'ai lu en 2002 L'Invincible Forteresse, Pygmalion, 2000 A Clash of Kings 3/3, 1998 Réédité par J'ai lu en 2002 Les Brigands, Pygmalion, 2001 A Storm of Swords 1/4, 2000 Réédité par J'ai lu en 2003 sous le titre Intrigues à Port-Réal L'Épée de feu, Pygmalion, 2001 A Storm of Swords 2/4, 2000 Réédité par J'ai lu en 2002 Les Noces pourpres, Pygmalion, 2001 A Storm of Swords 3/4, 2000 Réédité par J'ai lu en 2004 La Loi du régicide, Pygmalion, 2003 A Storm of Swords 4/4, 2000 Réédité par J'ai lu en 2004 Le Chaos, Pygmalion, 2006 A Feast for Crows 1/3, 2005 Réédité par J'ai lu en 2007 Les Sables de Dorne, Pygmalion, 2006 A Feast for Crows 2/3, 2005 Réédité par J'ai lu en 2007 Un festin pour les corbeaux, Pygmalion, 2007 A Feast for Crows 3/3, 2005 Réédité par J'ai lu en 2008 Le Bûcher d'un roi, Pygmalion, 2012 A Dance with Dragons 1/3, 2011 Réédité par J'ai lu en 2013 Les Dragons de Meereen, Pygmalion, 2012 A Dance with Dragons 2/3, 2011 Réédité par J'ai lu en 2014 Une danse avec les dragons, Pygmalion, 2013 A Dance with Dragons 3/3, 2011 Réédité par J'ai lu en 2015 (en) The Winds of Winter À paraître (en) A Dream of Spring À paraître Préludes au Trône de fer Les Aventures de Dunk et de l’Œuf. Le Chevalier errant, 1999 The Hedge Knight, 1998 Parue dans l'anthologie Légendes aux éditions J'ai lu. Rééditée par J'ai lu en 2009 dans un volume de poche intitulé Préludes au Trône de fer, qui réunit Le Chevalier errant et L'Épée lige. L'Épée lige, 2005 The Sworn Sword, 2004 Parue dans l'anthologie Légendes de la fantasy T1 aux éditions Pygmalion et J'ai lu. Rééditée par J'ai lu en 2009 dans un volume de poche intitulé Préludes au Trône de fer, qui réunit Le Chevalier errant et L'Épée lige. L'Œuf de dragon, Pygmalion, 2014 The Mystery Knight, 2010 Parue dans l'anthologie Warriors The Princess and the Queen, 2013 Parue dans l'anthologie Dangerous Women et se déroulant à l'époque de la danse des dragons. The Rogue Prince or the King’s Brother, 2014 Parue dans l'anthologie Rogues et se déroulant durant les années antérieures aux événements relatés dans The Princess and the Queen. Chroniques du chevalier errant, Pygmalion, 2015 Recueil contenant les trois premières nouvelles, équivalent au recueil A Knight of the Seven Kingdoms, à paraître le 6 octobre 2015. Divers Games of Thrones - Le Livre des festins, Huginn & Muninn, 2014 A Feast of Ice and Fire: The Official Game of Thrones Companion Cookbook, 2012 Livre de recettes de cuisine Maximes et pensées de Tyrion Lannister, J'ai lu, 2014 The Wit and Wisdom of Tyrion Lannister, 2013 Recueil de citations Games of Thrones - Les Origines de la saga, Huginn & Muninn, 2014 The World of Ice and Fire : The Untold History of the World of A Game of Thrones, 2014 Game of Thrones - Les Cartes du monde connu, Huginn & Muninn, 2015 The Lands of Ice and Fire, 2014 Living Language Dothraki, 2014 Romans L'Agonie de la lumière, J'ai lu, 1980 Dying of the light/After the festival, 1977 Le Volcryn, Presses de la Cité, 1982 Nightflyers, 1980 Réédité par ActuSF en 2010 - Prix Locus du meilleur roman court 1981 Armageddon Rag, La Découverte, 1985 The Armageddon Rag, 1983 Réédité par Pocket en 2000 puis par Denoël en 2012 avec une nouvelle traduction de Jean-Pierre Pugi et les éditions Gallimard, collection Folio SF, en 2014 Riverdream, Mnémos, 2005 Fevre Dream, 1983 Réédité par J'ai lu en 2008 Le Voyage de Haviland Tuf, Mnémos, 2006 Tuf Voyaging, 1986 Réédité par J'ai lu en 2009 Skin Trade, ActuSF, 2012 The Skin Trade, 1989 Prix World Fantasy du meilleur roman court 1989 - Réédité par J'ai lu en 2014 Le Chasseur et son ombre, Bragelonne, 2008 Réédité aux éditions Gallimard, collection Folio SF, en 2013 Recueils de nouvelles Chanson pour Lya, J'ai lu, 1982 A Song for Lya and Other Stories, 1976 Prix Locus du meilleur recueil de nouvelles 1977 - Réédité en 2013 sous le titre Une chanson pour Lya et autres nouvelles Chanson pour Lya, 1982 A Song for Lya, 1974 Prix Hugo du meilleur roman court 1975 Au matin tombe la brume, 1982 With Morning Comes Mistfall, 1973 Il y a solitude et solitude, 1979 The Second Kind of Loneliness, 1972 Première parution française sous le titre Solitude du deuxième type dans l'anthologie Univers 17 aux éditions J'ai lu Pour une poignée de volutoines, 1982 Override, 1973 Le Héros, 1982 The Hero, 1971 L'Éclaireur, 1982 Dark, Dark Were the Tunnels, 1973 VSL, 1982 FTA, 1974 La Sortie de San Breta, 1982 The Exit to San Breta, 1972 Diaporama, 1982 Slide Show, 1973 Le Run aux étoiles, 2013 Run to Starlight, 1974 Des astres et des ombres, J'ai lu, 1983 Songs of Stars and Shadows, 1977 Tour de cendres, 1983 This Tower of Ashes, 1974 Saint Georges ou Don Quichotte, 1983 Patrick Henry, Jupiter, and the Little Red Brick Spaceship, 1976 La Bataille des Eaux-Glauques, 1983 Men of Greywater Station, 1976 Coécrit avec Howard Waldrop. Un Luth constellé de mélancolie, 1981 The Lonely Songs of Laren Dorr, 1976 Première parution française sous le titre Comme un chant de lumière triste dans l'anthologie Le Livre d'or de la science-fiction : Le Monde des chimères aux éditions Pocket La Nuit des Vampyres, 1983 Night of the Vampyres, 1975 Les Fugitifs, 1982 The Runners, 1975 Première parution française dans la revue Fiction no 330 aux éditions OPTA Équipe de nuit, 1983 Night Shift, 1973 « ... Pour revivre un instant », 1983 "...for a Single Yesterday", 1975 Sept fois, sept fois l'homme, jamais !, 1983 And Seven Times Never Kill Man, 1975 Elle qui chevauche les tempêtes, Denoël, coll.Lunes d'encre, 1999 Windhaven, 1981 Coécrit avec Lisa Tuttle. Réédité par J'ai lu en 2007 sous le titre Windhaven Tempête, 1999 The Storm of Windhaven, 1975 Première parution en France en 1978 dans la revue Futurs no 5 traduit par Charles Canet sous le titre Les Tempêtes de Port-du-Vent - Prix Locus du meilleur roman court 1976 Une-Aile, 1999 One-Wing, 1980 La Chute, 1999 The Fall, 1981 Les Rois des sables, J'ai lu, 2007 Sandkings, 1981 Prix Locus du meilleur recueil de nouvelles d'un auteur unique 1982 Par la croix et le dragon, 1981 The Way of Cross and Dragon, 1979 Nouvelle précédemment parue dans l'anthologie Univers 1981 aux éditions J'ai lu - Prix Hugo de la meilleure nouvelle courte et prix Locus de la meilleure nouvelle courte 1980 Âprevères, 2007 Bitterblooms, 1977 Vifs-amis, 2007 Fast-Friend, 1976 La Cité de pierre, 2003 The Stone City, 1977 La Dame des étoiles, 2007 Starlady, 1976 Les Rois des sables, 1981 Sandkings, 1979 Parue dans l'anthologie Univers 1981 aux éditions J'ai lu, sous le titre Rois des sables - Prix Nebula de la meilleure nouvelle longue en 1979, prix Hugo de la meilleure nouvelle longue et prix Locus de la meilleure nouvelle longue en 1980 Dans la maison du ver, 2013 In The House of The Worm, 1976 (fr) Dragon de glace, ActuSF, 2011 Le Dragon de glace, 2002 Ice Dragon, 1980 À paraître en un seul volume chez Flammarion-Jeunesse en octobre 2015 Dans les contrées perdues, 2003 In the Lost Lands, 1982 L'Homme en forme de poire, 2004 The Pear-Shaped Man, 1987 Prix Bram Stoker de la meilleure nouvelle longue 1987 Portrait de famille, 2011 Portraits of His Children, 1985 Prix Nebula de la meilleure nouvelle longue 1985 (fr) Au fil du temps, ActuSF, 2013 La Forteresse, 2013 The Fortress, 2003 Et la mort est son héritage..., 2013 And Death His Legacy, 2003 Week-end en zone de guerre, 2013 Weekend in a War Zone, 1977 Une affaire périphérique, 1983 A Peripheral Affair, 1973 Vaisseau de guerre, 1980 Warship, 1979 Coécrit avec George Florance-Guthridge. Variantes douteuses, 2013 Unsound Variations, 1982 Assiégés, 2013 Under Siege, 1985 La Fleur de verre, ActuSF, 2014 Fleur de verre, 2014 The Glass Flower, 1986 Une nuit au Chalet du Lac, 2013 A Night at the Tarn House, 2009 Cette bonne vieille Mélodie, 2014 Remembering Melody, 1981 Le Régime du singe, 2012 The Monkey Treatment, 1983 Prix Locus de la meilleure nouvelle longue 1984 Les Hommes aux aiguilles, 1982 The Needle Men, 1981 Y a que les gosses qui ont peur du noir, 2014 Only Kids Are Afraid of the Dark, 1967 On ferme !, 2014 Closing Time, 1982 Autres nouvelles Retour aux sources..., 1983 Meathouse Man, 1976 Parue dans l'anthologie Le Livre d'or de la science-fiction : Orbit, L'anthologie de Damon Knight aux éditions Pocket Gardiens, 1983 Guardians, 1981 Parue dans l'anthologie Univers 1983 aux éditions J'ai lu - Prix Locus de la meilleure nouvelle longue 1982 Partir à point, 2014 Shell Game, 1987 Parue dans le recueil Wild Cards aux éditions J'ai lu Un hiver bien long, 2015 Winter's Chill, 1987 Parue dans le recueil Aces High aux éditions J'ai lu Éditeur Série Wild Cards Wild Cards, J'ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, 2014 Wild Cards, 1987 Aces High, J'ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, 2015 Aces High, 1987 Jokers Wild, J'ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, 2015 Jokers Wild, 1987 Aces Abroad, J'ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, 2015 Aces Abroad, 1988 À paraître le 4 novembre 2015 Down & Dirty, 1988 Ace in the Hole, 1990 Dead Man's Hand, 1990 One-Eyed Jacks, 1991 Jokertown Shuffle, 1991 Double Solitaire, 1992 Roman écrit par Melinda Snodgrass Dealer's Choice, 1992 Turn of the Cards, 1993 Roman écrit par Victor Milán Card Sharks, 1993 Premier recueil de la trilogie New Cycle Marked Cards, 1994 Deuxième recueil de la trilogie New Cycle Black Trump, 1995 Troisième recueil de la trilogie New Cycle Deuces Down, 2002 Death Draws Five, 2006 Roman écrit par John J. Miller Inside Straight, 2008 Premier recueil de la trilogie Committee Busted Flush, 2008 Deuxième recueil de la trilogie Committee Suicide Kings, 2009 Troisième recueil de la trilogie Committee Fort Freak, 2011 Anthologie de nouvelles écrites par Paul Cornell, David Anthony Durham, Ty Franck, Stephen Leigh, Victor Milán, John Jos. Miller, Mary Anne Mohanraj, Kevin Andrew Murphy, Cherie Priest et Melinda Snodgrass Lowball, 2014 Anthologie de nouvelles écrites par Michael Cassutt, David Anthony Durham, Melinda Snodgrass, Mary Anne Mohanraj, David D. Levine, Walter Jon Williams, Carrie Vaughn et Ian Tregillis Chansons de la Terre mourante Songs of the Dying Earth, 2009 Chansons de la Terre mourante - 1, ActuSF, 2013 Robert Silverberg, Le Cru véritable d'Erzuine Thale The True Vintage of Erzuine Thale, 2009 Terry Dowling, La Porte Copse The Copsy Door, 2009 Glen Cook, Le Bon Magicien The Good Magician, 2009 Byron Tetrick, L'Université de maugie The Collegeum of Mauge, 2009 Walter Jon Williams, Abrizonde Abrizonde, 2009 George R. R. Martin, Une nuit au Chalet du Lac A Night at the Tarn House, 2009 Jeff VanderMeer, La Dernière Quête du mage Sarnod The Final Quest of the Wizard Sarnod, 2009 Chansons de la Terre mourante - 2, ActuSF, 2013 Tanith Lee, Evillo l'ingénu Evillo the Uncunning, 2009 Paula Volsky, Les Traditions de Karzh The Traditions of Karzh, 200 Tad Williams, La Tragédie lamentablement comique ou la comédie ridiculement tragique de Lixal Laqavee The Lamentably Comical Tragedy or The Laughingly Tragic Comedy of Lixal Laqavee, 200 Lucius Shepard, La Proclamation de Sylgarmo Sylgarmo's Proclamation, 2009 Matthew Hughes, Gorlion d'Almérie Grolion of Almery, 2009 Elizabeth Moon, Incident à Uskvosk An Incident in Uskvosk, 2009 John C. Wright, Guyal le Conservateur Guyal the Curator, 2009 Neil Gaiman, Invocation de l'incuriosité An Invocation of Incuriosity, 2009 Autres anthologies avec Gardner R. Dozois Warriors, 2010 Songs of Love and Death, 2010 Down These Strange Streets, 2011 Dangerous Women, 2013 Old Mars, 2013 Rogues, 2014 Old Venus, 2015 Récompenses Prix Bram Stoker Meilleure nouvelle longue 1987 pour L'Homme en forme de poire Prix Hugo Meilleur roman court 1975 pour Chanson pour Lya Meilleure nouvelle longue 1980 pour Les Rois des sables Meilleure nouvelle courte 1980 pour Par la croix et le dragon Meilleur roman court 1997 pour Blood of the Dragon Prix Locus Meilleur roman court 1976 pour Les Tempêtes de Port-du-Vent avec Lisa Tuttle Meilleur recueil de nouvelles 1977 pour Chanson pour Lya Meilleure nouvelle longue 1980 pour Les Rois des sables Meilleure nouvelle courte 1980 pour Par la croix et le dragon Meilleur roman court 1981 pour Le Volcryn Meilleure nouvelle longue 1982 pour Gardien Meilleur recueil de nouvelles 1982 pour Les Rois des sables Meilleure nouvelle longue 1984 pour Le Régime du singe Meilleur roman de fantasy 1997 pour A Game of Thrones Meilleur roman de fantasy 1999 pour A Clash of Kings Meilleur roman de fantasy 2001 pour A Storm of Swords Meilleure anthologie 2011 pour Warriors Meilleur roman de fantasy 2012 pour A Dance with Dragons Meilleure anthologie 2014 pour Old Mars Meilleure anthologie 2015 pour Rogues Prix Nebula Meilleure nouvelle longue 1979 pour Les Rois des sables Meilleure nouvelle longue 1985 pour Portrait de famille Prix World Fantasy Meilleur roman court 1989 pour Skin Trade Grand maître 2012 Meilleure anthologie 2014 pour Dangerous Women        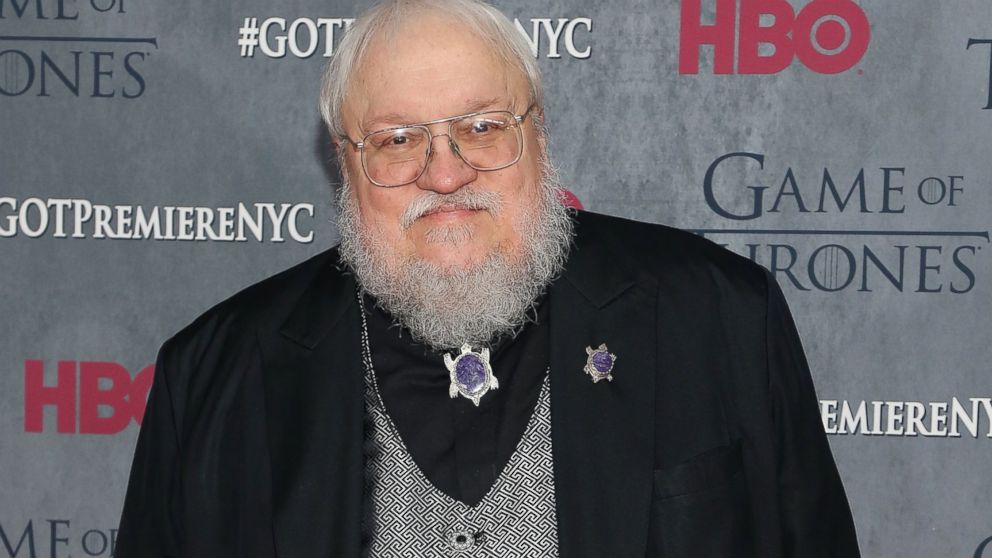
#125
Edmée de la Rochefoucauld
Loriane
Posté le : 18/09/2015 22:02
Le 20 septembre 1991 meurt à Paris Edmée de La Rochefoucauld
née Edmée Frisch de Fels le 28 avril 1895 à Paris, femme de lettres française, duchesse de La Rochefoucauld par son mariage avec le duc Jean de La Rochefoucauld. Sa vie Fille cadette du comte Edmond de Fels et de la comtesse, née Jeanne Lebaudy, Edmée Frisch de Fels est née à Paris XVII au 3 rue de Monchanin, et passera son enfance dans le splendide hôtel de Rigny, résidence de ses parents au no 135 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Elle a une enfance dorée dans un milieu très cultivé, passionné d'art son père fut un spécialiste de l'architecture du XVIIIe siècle et extrêmement fortuné par l'héritage maternel des sucres Lebaudy. Le 26 décembre 1917, Edmée de Fels épouse le comte Jean de La Rochefoucauld 1887-1970, qui deviendra le treizième duc de La Rochefoucauld à la disparition de son père en 1926, et dont elle aura quatre enfants : Isabelle, François, Philippe et Solange. Solange de La Rochefoucauld deviendra à son tour une femme de lettres, connue sous son nom d'épouse : Solange Fasquelle. Mathématiques et peinture d'art S'intéressant aux mathématiques, Edmée de La Rochefoucauld publie en 1926 Fonction de x et Nombre. Elle s'adonne également à la peinture, prenant les leçons du peintre symboliste Lucien Lévy-Dhurmer, qui lui enseigne les techniques du pointillisme et du chromatisme. Le portrait qu'elle peint de Paul Valéry obtient une mention au concours de la mairie de Paris et orne la couverture d'un des livres qu'elle lui a consacrés, Images de Valéry. Elle est l'auteur, entre autres, d'un portrait de l'abbé Mugnier. Féminisme Edmée de La Rochefoucauld dirige, à partir de 1927, l'Union nationale pour le vote des femmes et publie un manifeste féministe : La femme et ses droits. Littérature, philosophie et poésie Mais elle s'illustre surtout dans la littérature, notamment la poésie. Abel Bonnard qui l'encourage à publier ses poésies. Ses premiers recueils, suivis d'essais littéraires, paraissent chez l'éditeur Kra sous le pseudonyme de Gilbert Mauge. L'influence de Paul Valéry est manifeste dans une œuvre hantée par la mort et la fuite du temps, notamment dans des recueils comme : La Vie humaine 1928. Elle fut pendant des années la présidente du jury du prix Femina. Avec son frère André elle posséda la société éditrice de la Revue de Paris, revue littéraire. À la demande de Pierre de Boisdeffre, elle publie des études littéraires mettant à profit sa familiarité avec les écrivains de son temps : En lisant les cahiers de Paul Valéry 3 vol., 1964, un essai sur Léon-Paul Fargue, une biographie d'Anna de Noailles. Elle s'intéresse également à la philosophie morale avec des textes comme : Le Voyage dans l'esprit 1931, Les Moralistes de l'intelligence 1945, Pluralités de l'être 1957, Spectateurs 1972, De l'ennui 1976, L'Acquiescement 1978. Elle connut et fréquenta des gens aussi divers que le peintre Georges Mathieu, l'ethnologue Marcel Griaule ou l'écrivain André Malraux et s'intéressait aussi à la culture canaque. Trois volumes de mémoires paraissent en 1982, 1984 et 1989, sous le titre général de Flashes. Les anecdotes et les portraits y sont finalement peu abondants, alors que la duchesse de La Rochefoucauld a, pendant des décennies, reçu le Tout-Paris des lettres et de la pensée dans les salons de son hôtel particulier 8 place des États-Unis, réputé être l'antichambre de l'Académie française. Disparition Edmée de La Rochefoucauld est morte le 20 septembre 1991 à Paris et a été inhumée dans le caveau des La Rochefoucauld au château de Montmirail. Distinctions À partir de 1927 : dirige l'Union nationale pour le vote des femmes 1962 : élue à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique2 le 10 novembre. Présidente du jury du Prix Femina Depuis 2000 : le Prix Edmée-de-La-Rochefoucauld récompense chaque année un écrivain pour son premier roman. Œuvres sélection 1926 : Fonction de x et Nombre mathématique Images de Valéry 1928 : La Vie humaine philosophie morale aux éditions Kra sous le pseudonyme de Gilbert Mauge 1929 : Une enquête relative aux raisons qu'invoquent les Françaises pour obtenir le droit de suffrage, Paris, Alcan, 18 p. 1931 : Le Voyage dans l'esprit philosophie morale 1935 : A la veille du suffrage féminin, l'Avenir français, Paris, Pedone, 201 p. 1935 : "Le vote des femmes", L'encyclopédie française, t. X, chap. II. 1937 : "La capacité civile de la femme mariée", La Revue de Paris, 15 mars. 1939 : La femme et ses droits manifeste féministe 1945 : Les Moralistes de l'intelligence philosophie morale 1957 : Pluralités de l'être philosophie morale 1964 : En lisant les cahiers de Paul Valéry, Paris, éditions universitaires, 1964, 3 vol. 1964 : essai sur Léon-Paul Fargue 1964 : biographie d'Anna de Noailles. 1972 : Spectateurs philosophie morale 1976 : De l'ennui philosophie morale 1978 : L'Acquiescement philosophie morale 1982, 1984 et 1989 : Flashes mémoires en trois volumes      
#126
Jean-Pierre Claris de Florian
Loriane
Posté le : 13/09/2015 19:27
Le 13 septembre 1794 meurt Jean-Pierre Claris de Florian
à 39 ans à sceaux, né à Sauve dans le Gard le 6 mars 1755, auteur dramatique, romancier, poète et fabuliste français. Petit-neveu de Voltaire, il servit longtemps le duc de Penthièvre. Il laissa des chansons, dont la célèbre Plaisir d'amour, des pastorales Galatée, 1783, d'après Cervantès, des romans historiques Numa Pompilius, 1786, des Fables 1792, des Nouvelles. Académie française, 1788. Il écrivit d'abord des comédies sentimentales représentées en société le Bon Fils, 1785 ; la Bonne Mère, 1785. Auteur de chansons dont le célèbre Plaisir d'amour, de récits dans le genre pastoral Galatée, 1783 ou historique Numa Pompilius, 1786, Fables 1792, il donne à ses Nouvelles 1792 un rythme rapide et un style sobre. On lui doit aussi une traduction fortement abrégée de Don Quichote. En Bref Surtout connu pour ses Fables 1792 qui font de lui un disciple et un imitateur de La Fontaine, plus moralisateur et moins poète. En fait, son œuvre fut en son temps assez riche et variée, même s'il ne s'y trouve point de chef-d'œuvre de premier plan. Né au château de Florian, dans les basses Cévennes, il a même été considéré comme un écrivain languedocien et comme le premier des félibres. Sa famille s'était distinguée dans les armes et il s'oriente lui-même vers cette profession. Mais il sait bientôt se faire apprécier pour sa sensibilité littéraire. Un de ses oncles, époux d'une nièce de Voltaire, le conduit à Ferney et il reçoit les encouragements de l'écrivain consacré. Surtout, il est protégé par le duc de Penthièvre, qui lui permet de se livrer à son goût pour la littérature, dans les châteaux d'Anet et de Sceaux ou à Paris. Sa mère étant d'origine espagnole, il a le goût de cette langue, et ses premières œuvres, qui chantent l'amour pastoral, sont inspirées de Cervantès. C'est le cas de Galatée, qu'il publie en 1783 : l'ouvrage, parsemé de romances, obtint un grand succès. Sa pastorale Estelle et Némorin 1788, qui chante les innocentes mœurs cévenoles, fut moins bien reçue, sans doute parce que l'imminence des troubles politiques agitait les esprits de passions plus violentes ; Sainte-Beuve en a plaisanté l'excessive naïveté : Il faut lire Estelle à quatorze ans et demi ; à quinze ans, pour peu qu'on soit précoce, il est déjà trop tard. Florian a écrit aussi des pièces de théâtre : Les Deux Billets, Le Bon Ménage, Le Bon Père et La Bonne Mère, où l'auteur met en scène un personnage d'Arlequin à son image, naïf et doux. Numa Pompilius, roman chevaleresque paru en 1786, est une imitation un peu froide du Télémaque de Fénelon. Mais Gonzalve de Cordoue 1791, dans le même genre, paraît plus digne d'intérêt, d'autant qu'il comporte en introduction un Précis historique sur les Maures. Florian entre à l'Académie française en 1788, à l'âge de trente-trois ans. Mais la Révolution lui porte un coup fatal. Il perd son protecteur, se trouve lui-même obligé de quitter Paris en 1793 et, quoique réfugié à Sceaux, il est arrêté et emprisonné. Relâché après le 9-Thermidor, mais brisé par l'épreuve, il meurt en 1794 laissant inachevées une traduction de Don Quichotte ainsi que d'autres œuvres. Denise Brahimi Sa vie Issu d'une famille noble et vouée à la carrière des armes, il naît à Sauve dans le Gard, et passe sa prime jeunesse au château de Florian, sur la commune de Logrian, près de Sauve, au pied des Basses-Cévennes. Sa mère, d'origine espagnole meurt lorsqu'il est enfant et il est élevé au château de Florian. Son oncle ayant épousé la nièce de Voltaire, c'est à dix ans, en juillet 1765 lors d'un séjour à Ferney, qu'il est présenté au célèbre écrivain, son grand-oncle par alliance, qui le surnomme Florianet et parle de lui dans sa correspondance comme étant son neveu par ricochets. Il s'installe ensuite chez ses oncle et tante qui prennent en charge son éducation dans le quartier du Marais, à Paris. À treize ans, il devient page au service du duc de PenthièvreN 2 puis entre quelques années plus tard à l'école royale d'artillerie de Bapaume. À sa sortie, il sert quelque temps comme officier dans le régiment des dragons de Penthièvre. La vie de garnison ne lui convenant pas, il sollicite et obtient une réforme qui lui conserve son grade dans l'armée mais lui permet de suivre le duc de Penthièvre à Anet et Paris un petit appartement lui était réservé à l’hôtel de Toulouse et de s'adonner entièrement à la poésie. Le duc de Penthièvre, qui lui avait donné à sa cour le titre de gentilhomme ordinaire, resta sa vie durant son ami et son protecteur. En 1779, une première comédie écrite sur le mode des comédies italiennes (Les Deux Billets, lui vaut le succès. L'année suivante il fait jouer Jeannot et Colin, pièce inspirée du conte de Voltaire. Le poème satirique, Voltaire et le serf du Mont-Jura 1782, lui vaut la reconnaissance de l'académie qui lui attribue un prix. Florian condamne, dans cette œuvre la servitude et préconise son abolition. La même année, il revient au théâtre et obtient un véritable triomphe avec Les Jumeaux de Bergame. En 1783, Florian publie un conte en vers inspiré d'une nouvelle de Miguel de Cervantes, Galatée. L’œuvre est précédée d'une préface qui retrace la vie de Cervantes. il s'inspire de la Bible pour écrire un poème narratif, Tobie, et une églogue, Ruth, récompensée par l'académie française en 1784. Avec le succès, vient l'ambition : Florian se lance dans un roman épique Numa Pompilius qui soit digne de concurrencer le Télémaque de Fénelon. Ce sera un échec. Il est élu membre de l'Académie française en 1788. Contraint, en tant que noble, de quitter Paris lors de la Révolution française, il se réfugie à Sceaux. Il entreprend de traduire et d'adapter Don Quichotte de Cervantes. Malgré l'appui de son ami François-Antoine de Boissy d'Anglas, il est arrêté en 1794, l'épître dédicatoire de Numa Pompilius qu'il avait écrite à la reine huit ans plus tôt, le desservant devant le Comité de sûreté générale. Remis en liberté à la chute de Robespierre le 9 thermidor an II grâce à Boissy d'Anglas, il meurt subitement le 27 fructidor an II1, à l'âge de trente-neuf ans, probablement des suites de sa détention qui aggrava une tuberculose contractée plusieurs années auparavant. Il est enterré à Sceaux, . Sa tombe et son buste, entouré de ceux de célèbres Félibres, se trouvent dans le jardin des Félibres. Chaque année, à la fin du printemps s'y déroulent les Fêtes félibréennes de Sceaux. Héraldique Blasonnement : D’or à l’aigle éployée de sable, au chef d’azur chargé d’un soleil du champ (à la ville française Florian avec l'aigle contemplant le soleil pour la différence. Œuvre littéraire En 1792, Florian publie un recueil de cent fables réparties en cinq livres, auxquelles s’ajouteront 12 fables publiées à titre posthume. Ce sera son principal titre de gloire et la raison de sa survie littéraire. Ses fables sont unanimement considérées comme les meilleures après celles de Jean de La Fontaine. Le critique Dussault 1769-1824 écrit dans ses Annales littéraires : Tous ceux qui ont fait des fables depuis La Fontaine ont l’air d’avoir bâti de petites huttes sur le modèle et au pied d’un édifice qui s’élève jusqu’aux cieux : la hutte de M. de Florian est construite avec plus d’élégance et de solidité que les autres, et les domine de quelques degrés. L'académicien André Theuriet 1833-1907 est sensiblement du même avis. À propos de ces fables, il pense qu'elles l'ont sauvé. Après La Fontaine, il est le seul fabuliste qui ait surnagé. Cependant il se hâte d'ajouter qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre les deux. Taine lui reproche de ne pas bien connaître les animaux qu'il met en scène et pose un jugement extrêmement sévère sur la sentimentalité douce qui règne dans son recueil : Florian, en manchettes de dentelles, discret, gracieux, coquettement tendre, aimable comme le plus aimable des abbés de cour, proposait aux dames mignonnes et fardées, en façon de fables, de jolies énigmes, et leur arrangeait un bouquet de moralités fades; il peignait d'après l' Émile la tendresse conjugale, les leçons maternelles, le devoir des rois, l'éducation des princes. Florian était certes conscient de ne pas pouvoir rivaliser avec le divin La Fontaine et, dans son avant-propos, il se justifie de s'être malgré tout essayé au genre des fables, car beaucoup de places infiniment au-dessous de la sienne La Fontaine sont encore très belles. Il s'intéresse surtout au jeu de l'allégorie, comme le montre la fable qu'il place en tête de son recueil. Au lieu d'oppositions tranchées et irréconciliables entre les personnages, il recherche les dénouements heureux et les compromis. Pour son inspiration, même s'il invente quelques sujets, il puise surtout dans le fonds commun des fables que constituent les ouvrages d'Ésope, de Pilpay, d'Iriarte, de Gay et des fabulistes allemands, tout en prenant soin d'éviter les sujets déjà traités par La Fontaine. Les morales de certains de ses apologues sont encore citées couramment, comme Pour vivre heureux, vivons cachés Le Grillon, Chacun son métier, les vaches seront bien gardées Le Vacher et le Garde-chasse ou L'asile le plus sûr est le sein d'une mère La Mère, l'Enfant et les Sarigues. Quant aux expressions éclairer sa lanterne ou rira bien qui rira le dernier, elles sont tirées respectivement des fables Le Singe qui montre la lanterne magique et Les Deux Paysans et le Nuage. Outre ses fables, il a écrit des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des contes en prose ou en vers, une traduction très libre du Don Quichotte de Cervantès et de nombreux poèmes dont la plupart ont été mis en musique plus de deux cents partitions. La romance la plus connue est Plaisir d’amour, qui figure dans la nouvelle Célestine, mise en musique par Jean Paul Égide Martini. Bibliographie Fables Jean-Pierre Claris de Florian, Fables de M. de Florian : de l’académie françoise, de celles de Madrid, Florence, etc., Paris, impr. de P. Didot l'aîné, 1792, in-12°, 224 p. Jean Pierre Claris de Forian, Fables, introduction et notes de Stéphane Labbe, l'école des loisirs, Les Deux Billets 1779 Jeannot et Colin 1780 Les Jumeaux de Bergame, Le Bon Ménage 1782 Nouvelles Bliombéris, Nouvelle françoise – Pierre, Nouvelle allemande – Célestine, Nouvelle espagnole – Sophronime, Nouvelle grecque – Sanche, Nouvelle portugaise – Bathmendi, Nouvelle persanne 1784. Nouvelles nouvelles - 1792 - Selmours, Nouvelle angloise – Sélico, Nouvelle africaine – Claudine, Nouvelle savoyarde – Zulbar, Nouvelle indienne – Camiré, Nouvelle américaine – Valérie, Nouvelle italienne. Rosalba, Nouvelle sicilienne (publiée à titre posthume en 1800; Pastorales Galatée imité de la Galatée de Cervantès, 1783 Numa Pompilius roman imité de Télémaque, 1786 Estelle et Némorin 1788 Gonzalve de Cordoue 1791 précédé d’une étude Précis historique Ruth 1784 Œuvre couronnée par l'Académie française Tobie 1788 Contes Les Muses Le Vizir Inès de Castro Autres genres Voltaire et le Serf du Mont Jura 1782 Dialogue en vers entre Voltaire et un paysan, primé par l'Académie française. Le sujet est l’abolition de la servitude dans les domaines du roi. Don Quichotte traduction libre ; publication posthume en 1798 Guillaume Tell ou la Suisse libre publication posthume en 1800. Eliézer et Nephtali (publication posthume en 1803 Mémoires d'un jeune Espagnol 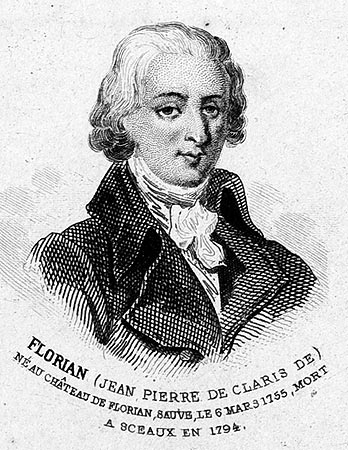 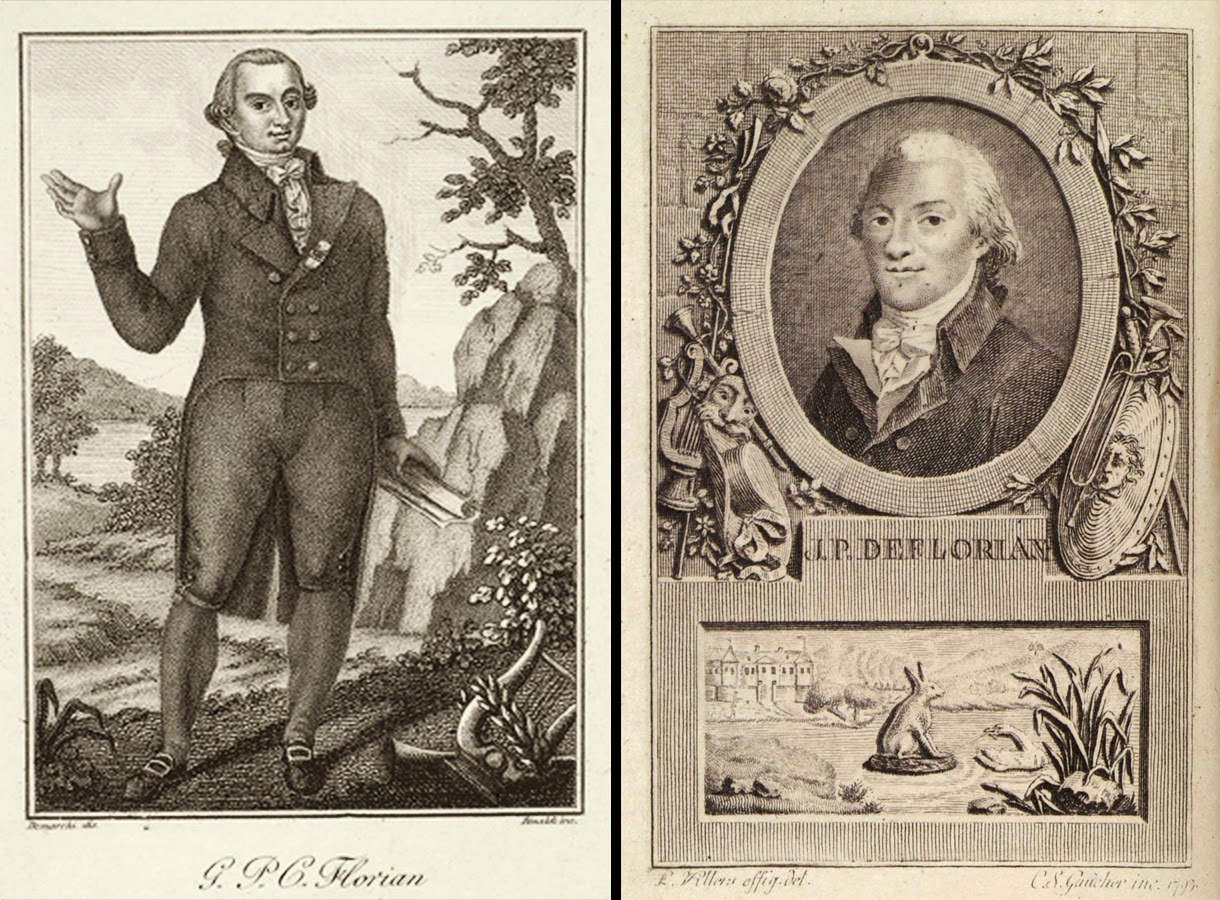 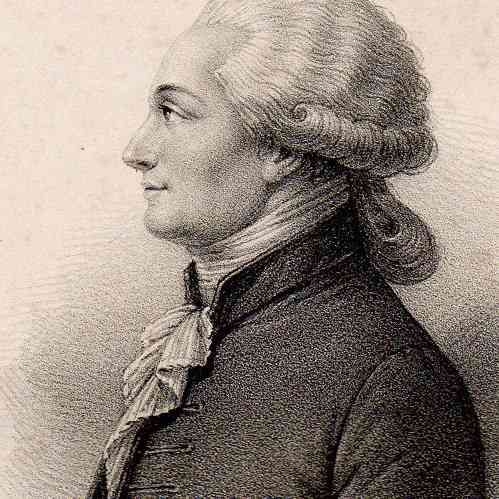  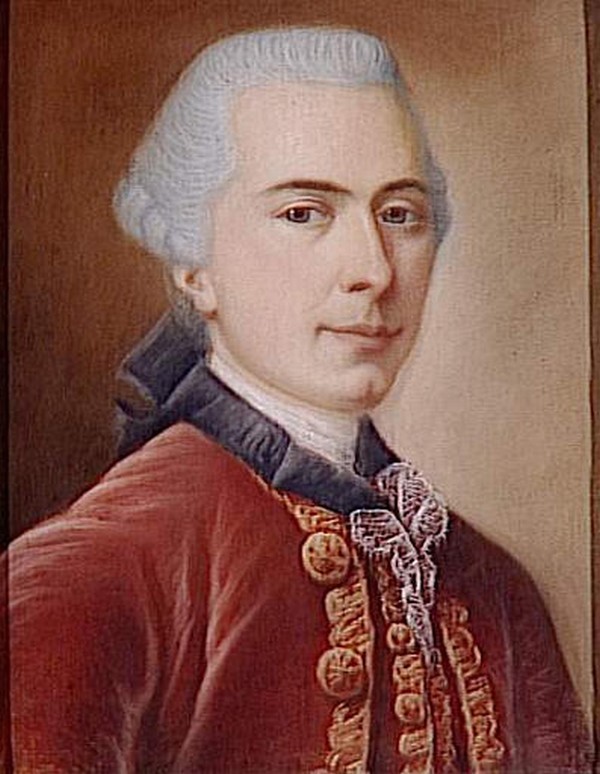  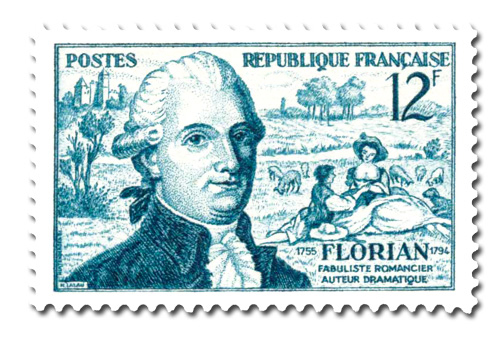 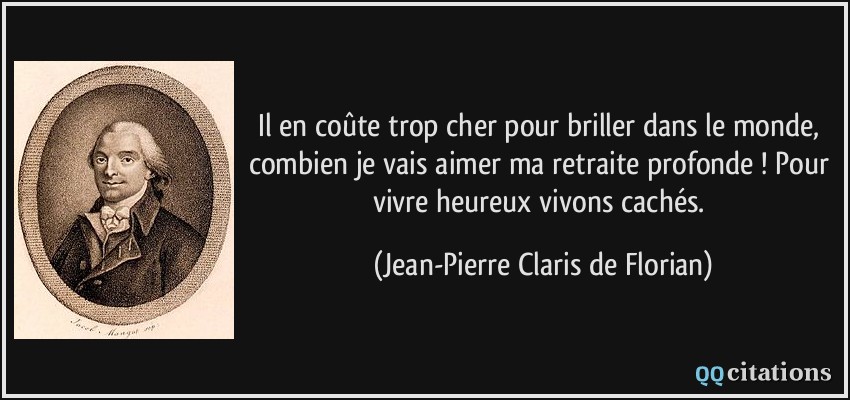  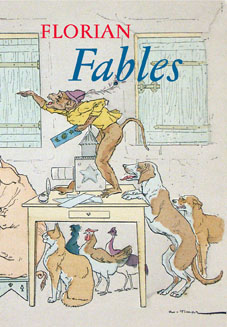  
#127
Julien Green
Loriane
Posté le : 04/09/2015 17:20
Le 6 septembre 1900 à Paris 17e naît Julien Green
né Julian Hartridge Green, mort à 97 ans, le 13 août 1998 à Paris 7e, écrivain américain de langue française, un des rares auteurs à avoir été publié dans la Bibliothèque de la Pléiade de son vivant. Ses romans Mont-Cinère, 1926 ; Adrienne Mesurat, 1927 ; Un mauvais lieu, 1977 ; les Pays lointains, 1987 ; les Étoiles du Sud, 1989 ; Dixie, 1995, son théâtre Sud, 1953 et son Journal à partir de 1938 expriment sa constante recherche de la pureté, à travers les deux fascinations de la grâce mystique et de la pesanteur charnelle. L'ensemble de son œuvre, où l'enfance tient une place privilégiée, reflète son amour de la langue le Langage et son double, 1985.Académie française, 1971. En bref " Courage, Green ! Votre œuvre est bonne." En 1926, Georges Bernanos, dont Sous le soleil de Satan venait d'assurer la notoriété, tenait, par cet encouragement paru dans Les Nouvelles littéraires, à faire connaître le premier roman d'un débutant, Mont-Cinère, qu'il trouvait « marqué du signe de la vérité. En 1998, le même Green est mort connu et reconnu, après une suite d'œuvres impressionnante. D'exceptionnelles consécrations ont accompagné son parcours : il fut le premier étranger à entrer à l'Académie française, où il succéda à Mauriac en 1972 ; la même année, commença la publication de ses Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade ; il est, de plus, le seul écrivain à avoir vu paraître l'album annuel sur lui-même que cette prestigieuse collection consacre à un de ses auteurs et à avoir pu y collaborer, quelques mois avant sa mort. Que de données complexes déterminent la trajectoire de Julien Green ! Américain ? Oui, mais né, en 1900, à Paris, où s'étaient fixés ses parents, loin du Sud, marqués par la défaite de la guerre de Sécession, patrie perdue dont ils transmirent le culte à leurs nombreux enfants, surtout peut-être au petit Julien, le benjamin. Écrivain français ? Oui encore, et des plus grands, mais resté citoyen américain, bien qu'il n'ait vécu loin de Paris, sa patrie de naissance et de langue, que pendant huit ans : trois années, passées à l'université de Virginie, offertes par un de ses oncles, de 1919 à 1922, puis cinq années d'attente et d'angoisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans sa vie morale et spirituelle également, Green fut voué aux partages et aux divisions, aux dépassements et aux conciliations. Élevé dans la religion anglicane par une mère fervente, il se convertit au catholicisme quelques mois après la mort de celle-ci, survenue en décembre 1914. Après un premier livre ardent, Pamphlet contre les catholiques de France 1924, il renonça aux pratiques religieuses, dont le détournaient des hantises charnelles, de nature homosexuelle, mais en gardant en lui le besoin du divin. De la même façon, son retour à l'Église, en 1939, n'abolit pas les autres facettes de sa nature. Ses compositions romanesques, son écriture, volontairement conventionnelles, rendent le réel sulfureux : l'angoisse surgit du quotidien, la cruauté de l'inoffensif et la grâce des ténèbres. Dans Mont-Cinère 1926, la haine et la folie mènent la danse comme dans Adrienne Mesurat 1927. Les mêmes obsessions, les mêmes soubresauts, aux confins de la psychologie et de la métaphysique, du mysticisme et de la débauche, se retrouvent dans Léviathan 1929 ou dans Épaves 1934. Ce regard d'ombre, qui mêle démence et désir, pèse sur les Histoires de vertige écrites de 1921 à 1932, parues en 1984. La mort est la réalité vraie du Visionnaire 1934, tandis que Minuit 1936 accentue le glissement du réalisme vers l'invisible et le fantastique. Varouna 1940 et Si j'étais vous 1947 font la part du bien et de la souillure. Moïra 1950 reprend le thème du combat de la chair et de la foi. La dimension pascalienne de l'œuvre se retrouve dans le Malfaiteur 1956, Chaque homme dans sa nuit 1960, l'Autre 1971, Un mauvais lieu 1977, les Étoiles du Sud 1989 : chacun de ces romans est celui d'un être jeté hors du chemin commun et contraint à la découverte de soi. Ce brûlant décapage, cette sensation de l'absurde à travers le tragique sont aussi les constantes du théâtre de Green : Sud 1953 est le drame d'un lieutenant homosexuel. Afin d'échapper à la souffrance d'une passion impossible, le héros provoque en duel l'être aimé et se laisse tuer. Folie ou noblesse de ce choix, qu'importe, semble dire l'auteur : Il a cherché la mort. Il la voulait de toutes ses forces. Il l'a trouvée. Suivront l'Ombre 1956, l'Automate 1985. Green a publié des livres sur sa jeunesse marquée par une éducation puritaine Partir avant le jour, 1963 ; Mille Chemins ouverts, 1964 ; Terre lointaine, 1966 ; Jeunesse, 1974, tandis que les seize tomes de son Journal, des Années faciles 1976 à Pourquoi suis-je moi ? 1996, donnent une suite à ces confessions. Après vingt-cinq ans passés à l'Académie française, il la quitte et, en 1997, publie un texte, écrit en 1922, Dionysos ou la chasse aventureuse. Son œuvre, à plusieurs voix le Langage et son double, 1985, est l'évocation d'une âme étonnée d'être aussi un corps. Le style, d'une simplicité aisée, donne l'apparence de la clarté à l'expression de sentiments complexes. Sa limpidité illusoire rend sensible la profondeur des tourments affectifs et spirituels de l'écrivain. Sa vie Julien Green est né à Paris, de parents américains, descendant du côté de sa mère du sénateur et représentant démocrate de la Géorgie au congrès américain Julian Hartridge 1829-1879 et dont Julien Green porte le nom Green a été baptisé Julian ; l'orthographe a été changée en Julien par son éditeur français dans les années 1920. Il grandit en France dans la commune d'Andrésy, dans les Yvelines. Après la mort de sa mère, une protestante pieuse, il se convertit au catholicisme en 1916, à la suite de son père et de toutes ses sœurs, ainsi qu'il le raconte dans Ce qu'il faut d'amour à l'homme, son autobiographie spirituelle. Alors âgé de seulement 17 ans, Julian Green réussit cependant à rejoindre les rangs de la Croix-Rouge américaine puis est détaché dans l’artillerie française en 1918 en tant que sous-lieutenant. Démobilisé en mars 1919, il se rend pour la première fois aux États-Unis en septembre de la même année et effectue trois ans d'études à l’université de Virginie, où il écrit son premier livre en anglais, avant de revenir vivre en France. À Paris, il peut vivre sa vie de couple homosexuel avec Robert de Saint-Jean et s'essaie à une carrière de peintre mais la reconnaissance obtenue en 1927 auprès de la NRF l'oriente définitivement vers celle d'un écrivain majeur de la littérature française du xxe siècle. En juillet 1940, après la défaite de la France, il retourne en Amérique. En 1942, il est mobilisé et envoyé à New York pour servir au Bureau Américain de l'information de guerre. De là, cinq fois par semaine, il s'adressait à la France dans l'émission de radio Voice of America, travaillant entre autres avec André Breton. Green revint en France juste après la Seconde Guerre Mondiale. Il est élu à l'Académie française le 3 juin 1971, au fauteuil 22, succédant à François Mauriac. C'est le premier étranger accédant à cet honneur. Le président de la République Georges Pompidou lui propose en 1972 la nationalité française mais l'académicien décline la faveur. La réception officielle a lieu le 16 novembre 1972. Julien Green est le père adoptif de l'écrivain Éric Jourdan qui lui resta filialement fidèle jusqu'à sa mort. En 1994, selon Éric Jourdan, Green décide de vivre à Forlì, en Italie, mais sa santé fragile ne lui permet pas de mettre le projet à exécution. Il est enterré le 21 août 1998 à Klagenfurt en Autriche dans l'église Saint Egid. Ému par une statue ancienne de la Vierge Marie lors d'une visite en 1990, l'écrivain avait émis le désir d'être inhumé dans une des chapelles de cette église, l’Église de France ayant refusé son inhumation en l’église d'Andrésy Yvelines. Analyse de l'œuvre Toute l'œuvre de Green, qui fut profondément marquée tant par son homosexualité que par sa foi catholique, est dominée par la question de la sexualité et celle du bien et du mal. La plupart des livres de ce catholique pratiquant traitent des problèmes de la foi et de la religion ainsi que de l'hypocrisie qui leur est liée. Plusieurs de ses livres ont traité des États-Unis du Sud, l'auteur se caractérisant dans ses écrits comme un Sudiste. Il a hérité ce patriotisme de sa mère, qui venait d'une famille distinguée du Sud. Quelques années avant la naissance de Julien, un choix de postes en Allemagne ou en France fut proposé au père de Julien qui était banquier. La mère de Julien appuya le choix de la France en raison du fait que les Français étaient aussi un peuple fier, récemment vaincus dans la guerre et nous nous comprendrons mutuellement, référence à la défaite française de 1871 dans la guerre franco-prussienne. En France, de son vivant et encore aujourd'hui, la célébrité de Julien Green repose non seulement sur ses romans, mais aussi sur son journal, publié en dix-neuf volumes qui couvrent la période de 1919 à 19984 . Ce Journal offre une chronique de sa vie littéraire et religieuse, et surtout un panorama unique de la scène artistique et littéraire à Paris sur près de 80 ans. Le style de Green, austère et résolument attaché à l'emploi du passé simple – quasiment abandonné par les auteurs qui lui sont contemporains –, trouvera la faveur de l'Académie française dont il sera membre. Son roman Si j'étais vous a inspiré la psychanalyste Mélanie Klein. L'écriture du fantastique Quant à son œuvre, multiforme et contrastée, la perspective chronologique reste celle qui permet le mieux de la saisir sans la trahir. Green a tant parlé de lui-même et apporté tant d'éclaircissements sur la genèse de ses romans, surtout à la fin de sa longue vie, qu'il est difficile de concevoir l'impression d'aérolithes qu'ils ont donnée lors de leur publication. Rendons aux premiers parus, Mont-Cinère 1926, Le Voyageur sur la terre 1926, Adrienne Mesurat 1927, Léviathan 1929, leur pouvoir de choc, dû à la force des situations, à la dureté du trait. Des passions forcenées y jettent implacablement les êtres les uns contre les autres et les vouent à l'autodestruction. Ensuite, la frénésie diminue, faisant place à l'insolite. Dans L'Autre Sommeil 1930 et dans Épaves 1932, situés dans un Paris envoûtant et non plus dans de petites villes d'Amérique ou de France, la rêverie l'emporte sur la réalité, l'inaccompli remplace la violence ; le héros de L'Autre Sommeil rêve sa vie et vit ses rêves, ceux du Visionnaire 1934, de Minuit 1936, de Varouna 1940, de Si j'étais vous... 1947 quittent le quotidien pour des aventures fantastiques, au sens plein du terme. Comment ne pas aimer, jusque dans certaines de leurs faiblesses, des livres si originaux ? Et comment ne pas admirer la rigueur d'un jeune auteur qui refuse d'exploiter la veine de ses premiers succès ? Pour trouver la vérité il faut travailler contre soi-même, contre sa pente, contre les facilités que donne l'habitude, contre le succès, contre le public ; il faut supprimer toutes les pages où l'amusement du lecteur est devenu le seul objet en vue. Tel est alors le credo artistique de Julien Green, consigné dans son Journal 7 février 1931. L'écriture du secret et de l'aveu Ce Journal, Green a commencé à le publier dès 1938. Les pages des premiers volumes sont devenues plus nombreuses lors des rééditions, mais le tri est resté sévère, écartant surtout les aventures charnelles et, plus tard, les expériences mystiques. Dans ses pages intimes comme dans ses romans, Green reste l'écrivain du secret. Il note « la couleur du temps anecdotes, vie quotidienne, événements historiques, il savoure les heures claires où se passent tant de choses et si peu de faits, il cherche à « emprisonner avec des mots l'instant qui passe 17 février 1943. Si intéressants que soient les passages concernant les lectures, les voyages, les amitiés et l'élaboration des œuvres, les plus personnels évoquent soit l'enfance de Green, soit ses déchirements entre l'aspiration à une vie exclusivement spirituelle et les exigences du désir. « Des deux personnages qui nous habitent les deux hommes dont parle saint Paul, chacun veut accomplir sa destinée et arriver à une sorte de perfection, au plus haut point de perfection qu'il lui soit donné d'atteindre, mais il est nécessaire pour cela que l'un de ces personnages tue l'autre, car il ne peut y avoir entre eux d'accord durable 9 avril 1944. Suppressions et réticences limitent le Journal au point que, pour dire sa vérité, pour savoir qui il est, Green, dans sa maturité, trouve plus satisfaisants les romans et les drames à partir des années 1950, il écrit aussi pour le théâtre, vers lequel Louis Jouvet souhaitait le pousser depuis longtemps. Un descellement s'y opère. L'obsession homosexuelle y déploie son cortège de fantasmagories, de frôlements, d'espoirs fous et de désespoirs sans recours. Dans Sud 1953, le lieutenant Ian, à la veille – au sens propre – de la guerre de Sécession, provoque en duel celui qu'il aime pour se faire tuer par lui ; dans ce drame, comme dans des romans aussi prenants que Moïra 1950 et Chaque homme dans sa nuit 1960, le protagoniste, à la fois obsédé et obsédant, suscite plus ou moins l'amour de tous ceux qui l'approchent, hommes et femmes. Mais on y trouve aussi des amours partagées par exemple entre Wilfred et Phœbé, dans Chaque homme dans sa nuit, séparés, il est vrai, par l'obstacle de l'adultère, des conversions salvatrices comme celle d'Élisabeth dans L'Ennemi, 1954 et, surtout, des êtres dont la vie se fonde sur l'amour pour Dieu comme Joseph Day, le protestant fanatique de Moïra, meurtrier par pureté, ou comme Wilfred, déjà nommé, fier d'être catholique romain, qui, avant de mourir, pardonne à son assassin. Les problèmes vécus par Green reçoivent une expression bouleversante ; ainsi, l'analyse du Journal citée à la fin du paragraphe précédent devient ce cri déchirant de Joseph Day dans Moïra : Je désire horriblement ce péché que je ne commets pas ... J'ai quelquefois l'impression d'être séparé d'avec ma chair, et c'est comme s'il y avait en moi deux personnes dont l'une souffrirait et l'autre regarderait souffrir. Un écrivain aussi soucieux de se comprendre devait aboutir à l'autobiographie. Il présente sa vie jusqu'à la dix-septième année dans Partir avant le jour 1963, son engagement dans l'armée américaine en Europe de 1917 à 1919 dans Mille Chemins ouverts 1964, ses années d'études en Virginie de 1919 à 1922 dans Terre lointaine 1966, son retour à Paris, sa prise et ses crises de conscience jusqu'à sa rencontre en 1924 avec Robert de Saint Jean, la plus constante affection de sa vie, dans Jeunesse 1974. Si Green laisse le plus possible la parole à l'enfant, puis au jeune homme dans leur découverte de la vie, émerveillée et angoissée, l'adulte mûri par l'expérience écrit la quête. Les deux premiers livres veulent retracer le passage de Dieu dans la vie d'un homme, dresser parfois « une mise en accusation . Mais rien de tel dans Terre lointaine, où l'auteur prend d'innombrables lecteurs comme confidents du grand amour de sa jeunesse, alors qu'il n'avait pas osé l'avouer à l'étudiant virginien qui l'avait inspiré : Je ne le renie pas, j'en suis fier ... Quand je n'aurais écrit ce livre que pour parler de lui, je ne le regretterais pas. Dans Jeunesse, le récit l'emporte sur l'examen de conscience. Avec L'Autre 1971, Julien Green prouve que la délivrance autobiographique ne le détourne pas de la fiction. Ce roman est même, à cette époque, le plus long qu'il ait écrit. Sa composition atteint presque la virtuosité, mais aux dépens de l'intensité. Chaleur et tremblement persistent, mais avec une coloration un peu édifiante. Le choix de l'isolement Au cours du dernier quart du siècle, Green va se montrer étonnamment actif, bien qu'il perde les deux personnes liées à lui depuis ses débuts littéraires : sa sœur Anne en 1979 et Robert de Saint Jean, l'ami des bons et des mauvais jours, en 1987. Après cinquante-six ans de fidélité aux éditions Plon, le voici au Seuil, qu'il laisse bientôt pour Fayard, avec lequel il rompt en 1998 pour rejoindre Gallimard. Il quitte l'Académie française, songe même à abandonner la France pour l'Italie, ou pour l'Autriche où il sera enterré, ou pour quelque autre pays, car il voyage avec acharnement, désireux de connaître de nouveaux lieux, ou de revoir ceux qu'il a aimés. Plus il vieillit, plus il publie, parfois dans des genres nouveaux : par exemple, Frère François (1983, biographie détaillée de saint François d'Assise, l'homme qu'il a toujours le plus admiré, et, après quelques pièces et récits qui prolongent sans l'égaler sa production antérieure, un roman-fleuve inattendu formé par Les Pays lointains 1986, Les Étoiles du Sud 1989 et Dixie 1995, où revit toute une préhistoire familiale autour de la guerre de Sécession. Que de surprises pour ses fidèles ! Lui qui écrivait difficilement cinquante lignes par jour, il écrit facilement en peu de temps des milliers de pages ! Lui qui regrettait que l'inspiration de Dostoïevski et de Dickens baisse quand ils multiplient les personnages, il se lance dans une fourmillante chronique où pullulent bals et banquets, où une histoire de pirates se glisse entre des remariages, où le mélodramatique et la prolixité remplacent le tragique et la densité ! Green reste égal à lui-même dans son Journal, particulièrement émouvant quand il se recueille lors de l'anniversaire, chaque année plus éloigné, de la mort de sa mère, dont il dit, après quatre-vingts années de séparation, qu'elle est la personne qui a le plus compté dans sa vie. Rédigé à partir de 1919, ce Journal couvre presque la totalité du XXe siècle, ce qui lui vaut une place à part dans la littérature. Comment résumer les traits qu'il donne à la figure de Green ? Dans le paysage littéraire du XXe siècle, c'est un auteur isolé, et qui veut rester isolé. Il a fréquenté Malraux, Cocteau, Mauriac, surtout Gide, et plus encore Maritain, mais a toujours refusé de s'engager, aussi bien du côté de Gide avant 1939, que du côté des écrivains catholiques après son retour à l'Église. Green a dès sa jeunesse cherché passionnément à savoir qui il était ; à plus de quatre-vingt-dix ans, il considère toujours cette question comme la plus importante pour lui ; le dernier tome de son Journal s'intitule même Pourquoi suis-je moi ? demande déjà lancée par Ian dans Sud et, avant lui, par Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. Hanté par le monde invisible, il est aussi infiniment touché par la beauté du monde sensible ; au titre du tome VIII, Vers l'invisible, répond le titre du tome XI, La Terre est si belle... Grave et tourmenté, il fait souvent aussi preuve d'humour : J'ai parfois le sentiment de vivre dans un roman de Julien Green et mon inquiétude croît de jour en jour 28 août 1993. Il ne cesse de se dire double ou deux, mais on peut lui appliquer une remarque de Nina Berberova dans C'est moi qui souligne : La personnalité soi-disant coupée en deux constitue en fait, au plus profond d'elle-même, une unité organique bipolaire. Green est aussi un auteur isolé dans le domaine de la forme. La transparence de son style, sa simplicité, sa pureté indémodable le distinguent d'autres grands écrivains tels que Bernanos ou Mauriac, Malraux ou Sartre, immédiatement reconnaissables par une couleur, un accent, des partis pris. On pourrait dire que le style de Green excelle avant tout par l'absence de caractérisation, si cette formulation n'était trop restrictive et négative, alors qu'il s'agit de définir positivement une limpidité radieuse. Dans les préfaces tardivement ajoutées à ses romans, Green tire ceux-ci, comme dans les derniers volumes du Journal, vers une interprétation autobiographique. Or Adrienne Mesurat et Joseph Day, le héros de Moïra, ses deux personnages préférés et on ne saurait lui donner tort, mais aussi ceux de Léviathan, de Minuit et de Chaque homme dans sa nuit résistent à toute interprétation réductrice, fût-elle de leur créateur. C'est d'ailleurs parce que les personnages créés par Green vivent une existence autonome que le plus profond de lui-même continue à vivre en eux. Jean Sémolué Postérité de l'œuvre Même si Green écrivait principalement en français, il a aussi écrit quelques ouvrages en anglais puisqu'il était parfaitement bilingue. Il a aussi traduit certaines de ses propres œuvres en anglais. Quelques-unes de ses traductions sont publiées dans Le langage et son double, en édition bilingue présentant le texte anglais en regard du texte français, ce qui facilite grandement la comparaison directe. Cependant, l'écrivain reste largement inconnu dans le monde anglo-saxon. Jusqu'à présent, trois de ses ouvrages ont été adaptés au cinéma : Léviathan 1962, dont il a écrit lui-même le script, en est le plus connu ; Adrienne Mesurat 1953 et La Dame de pique 1965 sont également tirés de son œuvre. L'ensemble des manuscrits et de la correspondance de Julien Green en tout cas, une cinquantaine de manuscrits autographes majeurs ont été mis en vente et dispersés par son fils adoptif le 27 novembre 2011 à Genève. Récompenses Son œuvre a été récompensée par de multiples prix, notamment : Le Prix Prince-Pierre-de-Monaco, en 1951. Le Grand Prix national des Lettres, en 1966. Le Grand Prix de Littérature de l'Académie française, en 1970. Le Grand Prix de littérature de Pologne, en 1988. Le Prix Cavour, grand prix de littérature italien, en 1991. Œuvres Journal en dix-neuf volumes, 1919-1998, Plon, Le Seuil, Fayard, Flammarion, Paris, 1938-2006. Pamphlet contre les catholiques de France, sous le pseudonyme de Théophile Delaporte, impr. de Darantière, Dijon, 1924. Mont-Cinère roman, Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1926. Adrienne Mesurat roman, Plon, Paris, 1927. Les Clefs de la mort, La Pléiade, Paris, 1927. Suite anglaise, Les Cahiers de Paris, Paris, 1927. Le Voyageur sur la terre, éditions de la Nouvelle Revue française, Paris, 1927, puis Le Livre de Poche, 1965 couverture du peintre Claude Schürr. Léviathan roman, Plon, Paris, 1929. L'autre sommeil roman, Gallimard, Paris, 1931. Épaves roman, Plon, Paris, 1932. Le Visionnaire roman, Plon, Paris, 1934. Minuit roman, Plon, Paris, 1936. Les Années faciles 1926-1934 journal I, Plon, Paris, 1938. Derniers beaux jours 1935-1939 journal II, Plon, Paris, 1939. Varouna roman, Plon, Paris, 1940. Memories of Happy Days Souvenirs des jours heureux, en anglais, 1942 Devant la porte sombre 1940-1943 journal III, Plon, Paris, 1946. Si j'étais vous roman, Plon, Paris, 1947. L'Œil de l'ouragan 1943-1945 journal IV, Plon, Paris, 1949. Moïra roman, Plon, Paris, 1950. Le Revenant 1946-1950 journal V, Plon, Paris, 1951. Sud théâtre, théâtre de l'Athénée, Paris, 1953. L'Ennemi théâtre, théâtre des Bouffes-Parisiens, Paris, 1954. Le Miroir intérieur 1950-1954 journal VI, Plon, Paris, 1955. Le Malfaiteur roman Plon, Paris, 1956. L'Ombre théâtre, théâtre Antoine, Paris, 1956. Le bel aujourd'hui 1955-1958 journal VII, Plon, Paris, 1958. Chaque Homme dans sa nuit roman Plon, Paris, 1960. Partir avant le jour autobiographie, 1900-1916, Grasset, Paris, 1963. Mille Chemins ouverts autobiographie, 1916-, Grasset, Paris, 1964. Terre lointaine autobiographie, 1919-1922, Grasset, Paris, 1966. Vers l'invisible 1958-1967 journal VIII, Plon, Paris, 1967. L'Autre roman, Plon, Paris, 1971. Ce qui reste du jour 1966-1972 journal IX, Plon, Paris, 1972. Jeunesse autobiographie, Plon, Paris, 1974. La Nuit des fantômes, Plon, Paris, 1976. La Bouteille à la mer 1972-1976 journal X, Plon, Paris, 1976. Le mauvais lieu roman, Plon, Paris, 1977. Ce qu'il faut d'amour à l'homme essai, Plon, Paris, 1978. Demain n'existe pas théâtre, 1979. L'automate théâtre, 1979-1980. La Terre est si belle… 1976-1978 journal XI, Le Seuil, Paris, 1982. Frère François, Le Seuil, Paris, 1983. La Lumière du monde 1978-1981 journal XII, Le Seuil, Paris, 1983. Paris, Champ Vallon, Paris, 1984. Le Langage et son double, Éditions de la Différence, Paris, 1985. Villes, Éditions de la Différence, Paris, 1985. Jeunes Années, autobiographie en 4 volumes, 1985. Les Pays lointains roman, Dixie I, Le Seuil, Paris, 1987. L'Arc-en-ciel 1981-1984 journal XIII, Le Seuil, Paris, 1988. Les Étoiles du sud roman, Dixie II, Le Seuil, Paris, 1989. Liberté chérie, Le Seuil, Paris, 1989. L'Expatrié 1984-1990 journal XIV), Le Seuil, Paris, 1990. L'Homme et son ombre, Le Seuil, Paris, 1991. Ralph et la quatrième dimension, Flammarion, Paris, 1991. L'Avenir n'est à personne 1990-1992 journal XV, Fayard, Paris, 1993. On est si sérieux quand on a 19 ans journal 1919-1924, Fayard, Paris, 1993. L'étudiant roux théâtre, 1993. Dixie roman, Dixie III, Le Seuil, Paris, 1994. Dionysos Édition originale, 7 eaux-fortes de Robert Clévier. 70 pages. Fayard-L’Atelier Contemporain, 1994. Pourquoi suis-je moi ? 1993-1996 journal XVI, Fayard, Paris, 1996. Dionysos ou La chasse aventureuse : poème en prose, Fayard, Paris, 1997. Jeunesse immortelle essai, Gallimard, Paris, 1998. En avant par-dessus les tombes 1996-1997 journal XVII, Fayard, Paris, 2001. Le grand large du soir 1997-1998 journal XVIII, Flammarion, Paris, 2006. Souvenirs des jours heureux, Flammarion, Paris, 2007. L'Inconnu et autres récits, Fayard, Paris, 2007 Bibliographie critique Carole Auroy, Julien Green : le miroir en éclats : étude sur l'autobiographie, Paris, Cerf, coll. Litterature, 30 septembre 2000, 173 p. Philippe Derivière, Julien Green : les chemins de l'errance, Le Roeulx, Talus d'approche, 1994 Marc Eigeldinger, Julien Green et la tentation de l'irréel, Éditions des Portes de France, Paris, 1947. Jean-Laurent Prévost, Julien Green ou l'âme engagée, Vitte, 1960 Yves Floucat, Julien Green et Jacques Maritain. L'amour du vrai et la fidélité du cœur, Paris, Éditions Pierre Téqui, 1997. Jean-Claude Joye, Julien Green et le monde de la fatalité, Arnaud Druck, Berne, 1964. Melanie Klein, "L'identification" Sur un roman de Julien Green : Si j'étais vous. in "Envie et gratitude". Paris, Gallimard-Tel, 1978. (en) Michael Dwyer, Julien Green : a critical study, Dublin, Ireland Portland, OR, Four Courts Press, 1997 . Annette Tamuly, Julien Green à la recherche du réel : approche phénoménologique, Naaman, Sherbrooke Canada, 1976. Wolfgang Matz, Julien Green, le siècle et son ombre. Traduit de l'allemand. Gallimard-Arcades, 1998. Louis-Henri Parias, Julien Green, corps et âme. Fayard, 1994 Valérie Catelain, Julien Green et la voie initiatique, Bruxelles, Le Cri Académie royale de langue et de littérature françaises, 2006. Anne Green, Mes jours évanouis, Paris, le Livre de poche, 1974. Noël Herpe, L’irrationnel chez François Mauriac et chez Julien Green, no 15 des "Cahiers Mauriac", Grasset, 1988. “François Mauriac et Julien Green, biographes de leur enfance”, no 17 des "Cahiers Mauriac", Grasset, 1990. “Moïra de Julien Green ou l’Enfer de la pureté”, no 20 de "La Licorne", Université de Poitiers, 1991. “Julien Green et le théâtre”, La Nouvelle Revue française, avril 1995.  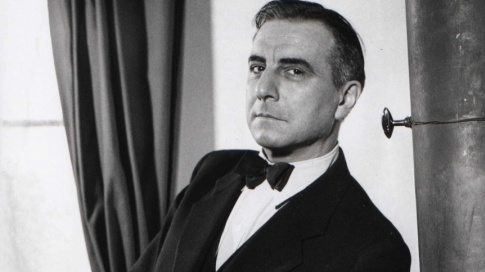 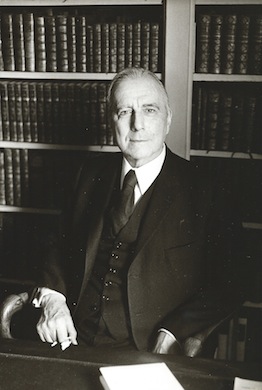    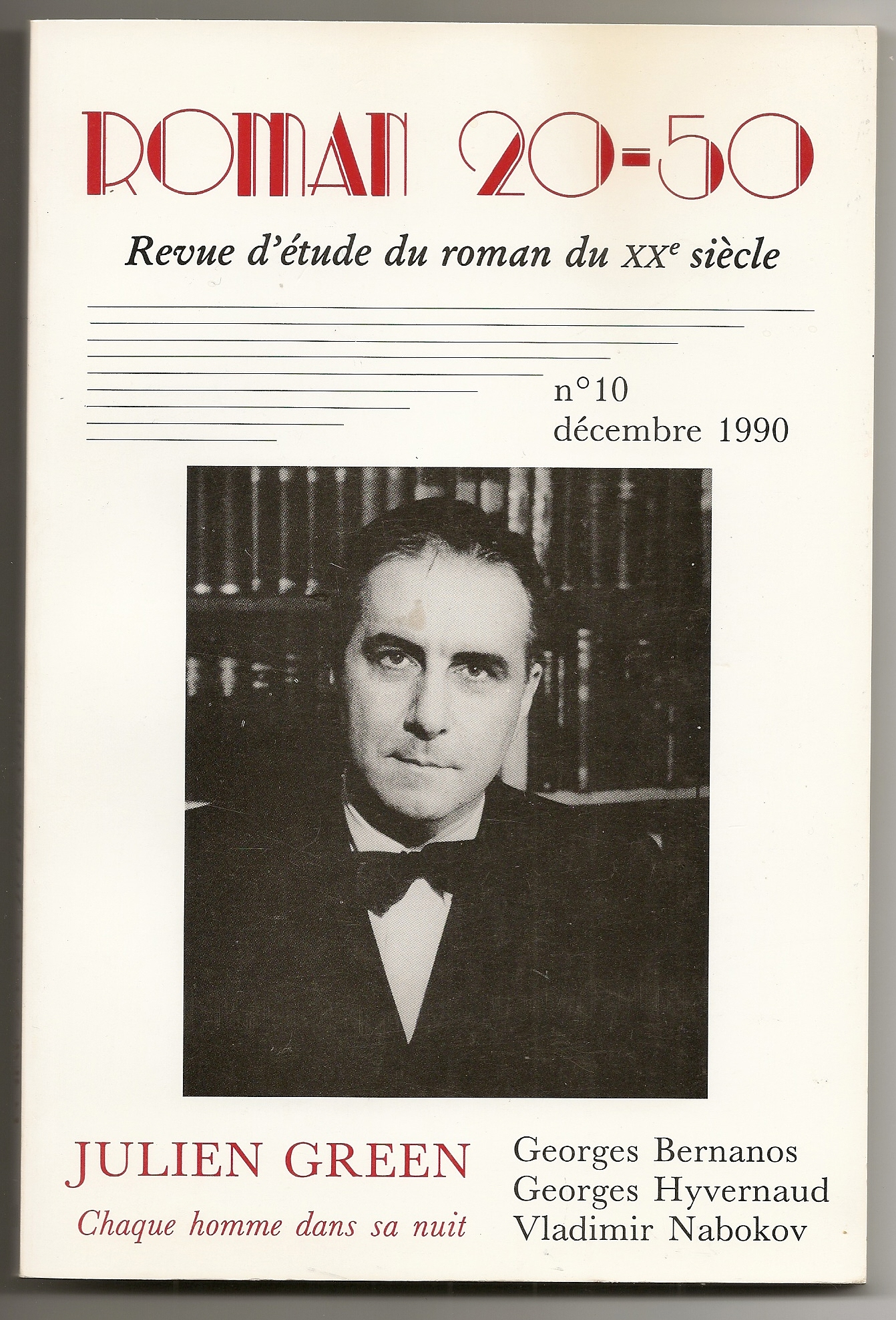   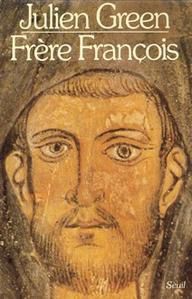 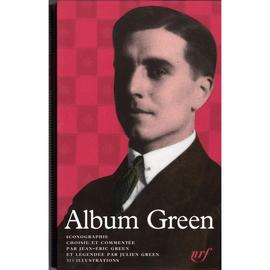   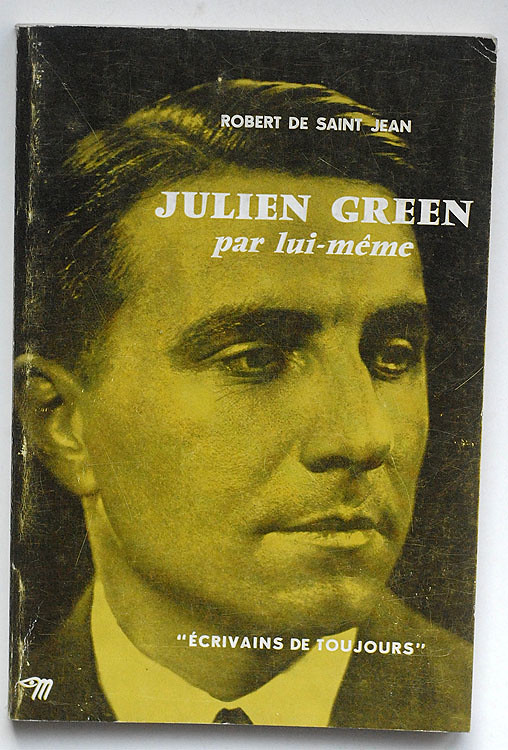
#128
Vincent de La Soudière
Loriane
Posté le : 04/09/2015 17:14
Le 6 septembre 1939 naît Vincent La Soudière
de son vrai nom Vincent de La Soudière à Port-d'Envaux en Charente-Maritime, écrivain et poète français et mort à Paris, à 53 ans, le 6 mai 1993. Bien qu’ayant beaucoup écrit, il ne fit paraître qu’un mince volume de proses poétiques, Chroniques antérieures, en 1978. Cet ouvrage ne pouvait laisser soupçonner l’ampleur de ses écrits et leur publication sera donc essentiellement posthume. Ses Œuvres principales, sont : Chroniques antérieures publiées, 1978, Brisants 2003, C'est à la nuit de briser la nuit, t.I 2010, Cette sombre ferveur, Lettres à Didier, t.II 2012, Le Firmament pour témoin, Lettres à Didier, t.III 2015 Sa vie Aîné de huit frères et sœurs, Vincent de La Soudière appartient à l’une des trente familles les plus anciennes de France, d’origine charentaise, les Regnauld de La Soudière. Il est né à Port-d’Envaux, petite commune près de Saintes, dans une imposante demeure fortifiée du Moyen Âge, une ancienne prison dite Prévôté. Son enfance est marquée par une éducation religieuse fondée sur la peur de l’enfer, dispensée par un père perçu comme absent, et par le suicide d’un oncle très aimé quand Vincent avait cinq ans, et qui aura joué pour lui le rôle d’un père attentionné. Il effectue sa scolarité au collège Sainte-Croix de Neuilly, dans la branche lettres et philosophie, puis commence des études à la Sorbonne, qu’il doit interrompre à cause de graves troubles nerveux. La vie intellectuelle a tendance à renforcer son déséquilibre psychique et sa nature introvertie. Il lui préfère la poésie et l’écriture poétique. Il est aussi très attiré par la vie spirituelle. Au début de l’année 1961, il décide de séjourner dans un monastère bénédictin situé dans les Pyrénées, Notre-Dame de Belloc. C’est à peu près à la même époque qu’il commence à écrire régulièrement. En septembre, il s’engage comme postulant. Ce postulat toutefois sera de courte durée. Il quitte l’abbaye dans des conditions douloureuses et gardera toute sa vie la nostalgie de la vie monastique. Il expliquera tardivement la raison de son départ, liée à une femme dont il était toujours amoureux. À sa sortie de Belloc, il concevra un projet de mariage avec une autre femme, projet cependant vite avorté. Sa vie amoureuse sera par la suite toujours instable et tourmentée. En 1964, il fait un séjour dans un monastère cistercien situé dans les îles de Lérins. C’est là qu’il fait la connaissance de Didier, qui deviendra son plus grand ami et son confident privilégié. Il entretiendra avec lui une correspondance prolifique durant près de trente ans, jusqu’à sa mort en 1993. Sur le conseil de divers amis qui l’invitent à suivre un traitement psychothérapeutique, il se rend à Aix-en-Provence en octobre 1964 et y habitera pendant cinq ans, jusqu’en 1969. Les nombreuses thérapies qu’il entreprendra durant sa vie n’auront jamais l’effet désiré et Vincent La Soudière portera un regard critique sur leurs possibilités de guérison, considérant en particulier au cours de ces années que l’analyse aggrave son déséquilibre. Il tient un journal et écrit beaucoup de poèmes au cours de cette période. Il ne conçoit sa vie qu’à travers l’écriture d’une œuvre, dont il attend une métamorphose de son être, une guérison et un remède à son incapacité à trouver une place dans le monde. Dans l’attente et l’espoir de la produire, il multiplie et multipliera à partir de cette époque les petits métiers occasionnels et les déplacements incessants. Il se rendra souvent en Espagne, pays de son cœur. Il fera aussi un long séjour au Danemark en 1971, dans la ferme d’un ami, pour écrire et reprendre ses textes en vue d’une publication. Mais il souffrira d’une impossibilité de se fixer en quelque lieu que ce soit et sa vie sera marquée par une instabilité et une précarité croissantes. En 1970, il décide d’entrer en relation avec Henri Michaux et lui écrit une lettre, qui convainc ce dernier de le rencontrer1. Ils se lient d’amitié et se verront souvent, s’écriront aussi quand Vincent La Soudière s’absentera de Paris. Michaux lui offrira diverses possibilités de publication et l’aidera à éditer quelques-uns de ses textes. Le premier, Au cœur de la meule, paraît en 1974 dans La Revue de Belles-Lettres dirigée John E. Jackson. C’est à l’occasion de cette première publication qu’il décide de supprimer la particule de son nom : Vincent de La Soudière devient Vincent La Soudière. Au cœur de la meule sera repris au début du seul recueil par lui conçu et publié de son vivant, Chroniques antérieures. C’est encore Henri Michaux qui l’aidera à le faire paraître en le mettant en relation avec Bruno Roy, directeur des éditions Fata Morgana, lui donnant également une lithographie pour le frontispice. Le recueil sera publié en 1978. Des extraits seront pré-publiés en 1976 dans la revue Argile, que dirigeait Claude Esteban. Malgré les bons échos recueillis par son livre, la période qui suit la publication des Chroniques antérieures est marquée par une crise grave, sans doute parce que son effet n’a pas été celui attendu. Suite à cette crise d’environ deux ans, Vincent La Soudière sombre dans une profonde dépression et se désintéresse du moins en apparence de l’écriture. Il désire se convertir. En 1974, il était revenu à la foi catholique après s’en être éloigné pendant quelques années. C’est vers cette même époque aussi, en 1976, que son ami Didier est ordonné prêtre. En 1978, il désire vivre une nouvelle conversion, tout en souffrant de ne pas pouvoir la réaliser : "Conversion" et reconstruction patiente me sont à présent ordonnées comme tâche humaine et devoir spirituel. Je ne suis plus en position de tergiverser. Le couteau sous la gorge, il faut choisir. Une alternative centrale, vitale, à laquelle je ne peux plus me dérober. L’enjeu est de vie ou de mort. Il attend une telle conversion, et la deuxième partie de sa vie sera placée sous le signe d’une attente indéfinie et d’un désir de renouvellement profond de son être. Il considère qu’il n’est pas encore né et voudrait connaître une nouvelle naissance. À partir des années de crise, ses lettres adressées à Didier sont marquées par un profond déchirement intérieur, une descente au shéol, dans les abîmes de la mort spirituelle, et le désir de connaître une vie nouvelle, fondée sur une union intime avec le Christ. En 1988, après dix ans de grande dépression, il reprend l’écriture, sous forme d’aphorismes c’est le mot qu’il emploie, c’est-à-dire de fragments plus ou moins développés. Il remplit plusieurs cahiers et carnets jusqu’en 1993, souhaitant faire des choix afin de composer un recueil, sans cependant y parvenir. Le 5 mai 1993, après des années de lutte pour survivre, il se jette dans la Seine, après avoir adressé une ultime lettre à Didier: Toutes les issues me sont fermées. J’ai donc décidé de me suicider. Cette lettre, particulièrement bouleversante, laisse cependant entendre qu’en se suicidant, il ne désirait pas tant mourir que commencer enfin à vivre. Un poète en marge En écrivant à Henri Michaux, Vincent La Soudière ne cherchait pas tant à pénétrer dans le milieu littéraire qu’à rencontrer un être dont l’expérience intérieure lui semblait authentique et proche de la sienne, et susceptible de la comprendre. C’est pour la même raison qu’il devient très proche de Cioran, rencontré en 1976 : Vincent et Cioran se rejoignent dans un commun désir de revenir à un état prénatal, sorte de paradis perdu dont l’attrait provoque un mouvement régressif vers l’antérieur, et un refus corrélatif de s’incarner dans une vie éprouvée comme maudite dans son essence. La relation est authentique, avec l’un comme avec l’autre. Éloigné de tout esprit de mondanité, Vincent La Soudière se tiendra toujours en marge du monde littéraire. Cioran le mettra aussi en relation avec un autre auteur qui s’est résolument tenu en retrait de ce monde, le poète et traducteur Armel Guerne, ayant perçu entre l’un et l’autre des affinités. Vincent La Soudière et Armel Guerne échangeront quelques lettres et le second consacrera son ultime texte aux Chroniques antérieures. Les relations avec d’autres auteurs se tissent à travers la lecture. Comme sa correspondance avec Didier l’atteste, Vincent La Soudière lit beaucoup et ses lettres évoquent certains livres précis, qu’il analyse souvent avec une pénétration singulière. Outre Cioran et Michaux, plusieurs auteurs marquent son esprit, notamment René Char, à qui il écrit en 1969 et auquel il restera toujours fidèle6 . En 1988, il écrit à Didier : « Quand je suis amené à voyager ou seulement me déplacer, les premiers livres à être embarqués dans ma valise sont Rimbaud, Baudelaire, Pierre Jean Jouve, René Char et les Psaumes. C’est devenu un réflexe. En 1978, à l’occasion d’une demande de bourse que fait Vincent La Soudière auprès du Centre national des lettres, Henri Michaux et Cioran écrivent chacun une lettre de recommandation afin d’appuyer sa candidature. Henri Michaux déclare : « Jamais je n’ai plus volontiers et sans réserve recommandé un écrivain. Homme de la vie intérieure, s’il en est un, Vincent La Soudière a, par scrupule assurément, tardé à publier, parce que, responsable des subtiles et graves réalités psychiques qu’il allait montrer, il voulait avoir dépassé le stade de la surprise et pouvoir écrire comme quelqu’un en qui d’emblée on a foi. ... L’ayant rencontré plusieurs fois je sais qu’il n’écrira jamais rien de gratuit. Ce qu’il fera connaître est important. À cela seul s’emploiera sa pénétration singulière. On ne l’imagine pas autrement. Quant à Cioran, il le recommande lui aussi dans ces termes : Il est l’auteur d’un livre de haute tenue littéraire, Chroniques antérieures, dont il me semble difficile de ne pas admirer l’unité de ton et de vision. Dès la première page, on s’aperçoit qu’il n’y a pas là la moindre trace de tâtonnement, d’interrogation timide ; c’est, au contraire, un aboutissement, une mise en accusation radicale, le tout d’une concision de verdict. En 1980, Cioran adressera une autre lettre de recommandation au président du Centre, écrivant notamment ceci : Il est l’auteur d’un livre remarquable, Chroniques antérieures. On lui a reproché de n’avoir rien écrit d’autre. Mais un ouvrage comme celui-là en vaut dix – me disait tout récemment Henri Michaux. Reconnaissance posthume Brisants Chroniques antérieures reçut un accueil discret, sa parution n’étant connue que du seul milieu littéraire. En 2001, à l’occasion de la préparation d’un Cahier de l’Herne consacré à Cioran, Sylvia Massias découvre les écrits laissés par cet écrivain de l’ombre. Elle en pressent immédiatement l’intérêt et entreprend de les publier. En 2003, après avoir obtenu une bourse du Centre national du livre pour ce projet, elle rassemble un choix d’aphorismes extraits des derniers cahiers et carnets de Vincent La Soudière qu’elle présente sous le titre de Brisants, réalisant le projet que ce dernier avait conçu à la fin de sa vie sans pouvoir le mener à bien. Le recueil est publié aux éditions Arfuyen. Dès parution du livre, la critique s’intéresse à cet inconnu. Jean-Yves Masson écrit dans Le Magazine littéraire : À peine achevé, le XXe siècle change de visage. Bientôt, nous ne le reconnaîtrons plus. Des auteurs dont l’existence nous aura échappé se révéleront essentiels, et Vincent La Soudière sera peut-être l’un d’eux. Ami proche de Michaux, de Cioran, qui lui témoignèrent à plusieurs reprises publiquement leur admiration, il laisse une œuvre manuscrite d’une ampleur considérable. Sylvia Massias, à qui l’on doit déjà l’édition des lettres d’Armel Guerne à Cioran, a recueilli les fragments que Vincent La Soudière accumulait dans les dernières années de sa vie. Elle en a tiré cette anthologie qu’elle présente avec tact, rigueur et finesse. … Toute de tendresse sévère et de lucidité, l’œuvre de Vincent La Soudière commence son chemin dans le monde. La plus belle surprise de cet automne en poésie, est la découverte de cet auteur secret. Marc Blanchet fait écho dans Le Matricule des Anges : L’horloge des reconnaissances posthumes nous donne un nouveau rendez-vous. … Aussi vrai qu’une histoire littéraire s’écrit au revers de l’officiel, souvent événements douteux ou articles de foire, les écrits de Vincent La Soudière auront eu quelques lecteurs confidentiels, dont deux qui ne sont pas sans importance : Cioran et Michaux. L’écrivain et poète Joël Vernet, qui a connu Vincent La Soudière à la fin de sa vie, écrit également : « Admirablement décrypté, mis en forme, commenté par Sylvia Massias, ce livre est d’ores et déjà une révélation dans le paysage éditorial qui n’apporte que rarement de très grandes surprises. Je dirai simplement que se dessine là une œuvre dénuée de mensonges, d’artifices, une œuvre incandescente. … Vincent La Soudière a traversé le feu. Lisons ses livres. Découvrons là un poète qui vécut dans l’Invisible. Ce n’est pas peu dans notre époque tonitruante. Jean-Luc Maxence déclare dans Monde et Vie : Il y avait longtemps, assurément, que nous n’avions point reçu un recueil de cette richesse intérieure, de cette beauté pathétique, de cette profondeur qui ne transige pas. le poète et traducteur Alain Suied considère Vincent la Soudière comme « l’une des surprises de la rentrée poétique », évoquant ainsi le recueil : Dans cette époque de "fatigue", de sommeil, de "fin", de nuit, le poète constate qu'aucune main "ne peut s'étendre vers une autre". Le néant personnel et le néant des espaces infinis écrasent l'humain. C'est la souffrance qui dirige. Cet homme de la "vie intérieure" ou antérieure ? a lu Paul, Platon mais on le devine sensible à d'autres Traditions… Il est sensible à l'invisible, à l'inconnu… "Le malheur m'échut" à la place de l'amour, semble dire et crier cet auteur – quel combat ! Ces "brisants" blessent et vous accompagnent longuement comme un compagnon de poésie qu'on voudrait consoler tout en sachant que le travail poétique réside désormais dans l'affrontement, ici très vif, avec l'impossibilité même de la Consolation! Richard Blin décrit Brisants dans les termes suivants : Des éclairs dans la nuit ; de l’âme qui tourne sur elle-même ; des emboîtements d’abîme dont le rayonnement obscur et le tremblement ont un parfum métaphysique ; Brisants, comme les blessures secrètes, les cicatrices intérieures d’un homme nu regardant en face ce qui le dépasse. » Nelly Carnet consacre une longue note de lecture au recueil dans la revue Europe : La Soudière est le penseur de l’anti-ego, de l’insatisfaction dirigée par la recherche de "l’amour inconnu". Toute sa vie il aura été un mystique profane, un homme d’existence parallèle. … Ses lecteurs deviennent ses frères d’âme. Correspondance La publication posthume de Vincent La Soudière, commencée avec Brisants, s’est poursuivie avec la considérable correspondance de près de huit cents lettres adressée à son ami Didier. Établie, présentée et annotée par Sylvia Massias, elle a été publiée en trois volumes aux Éditions du Cerf. Le premier tome, C’est à la nuit de briser la nuit, couvrant les années 1964 à 1974, a paru en 2010 ; le deuxième, Cette sombre ferveur (années 1975-1980), en 2012 et le troisième, Le Firmament pour témoin années 1981-1993, en 2015. En réalité, cette correspondance n’en est pas vraiment une : les lettres de Didier manquent. Par ailleurs, le choix a été fait de supprimer les mentions épistolaires d’introduction et de conclusion, ainsi que toutes les allusions privées concernant la vie de Didier. L’impression donnée aux lecteurs est celle d’un monologue intérieur, qui s’étire de 1964 à 1993, monologue rendu possible par cette amitié hors du commun. Une correspondance qui a des allures de journal, écrit Richard Blin, ajoutant : Le résultat est assez saisissant, puisque nous devenons l'interlocuteur privilégié d'un homme dont l'exigence de liberté et la révolte s'éprouvent au feu de la négation. À la suite de Brisants, les Lettres à Didier assurent à Vincent La Soudière un début de reconnaissance. Patrick Kechichian décrit cette interminable explication avec lui-même, cette "incomplétude" comme "source". Obscure, tâtonnante, souvent récusée, la quête de Dieu est néanmoins présente entre les lignes, lors des rémissions du "cancer spirituel qui dévore son âme"... "La Grande Rencontre n'a pas eu lieu - n'aura sans doute jamais lieu. Je vis du poids de son attente". Il conclut : Par la force et la sincérité, souvent la lucidité, de cette interrogation, une œuvre peu à peu se construit au fil de ces lettres, et sans doute de celles à venir. Elle peut bien être informe, elle n'en est pas moins vraie et belle. Matthieu Baumier salue l’écrivain marginal, terme entendu en son véritable sens d’aux marges de tous les systèmes, dont la correspondance fait jaillir la beauté exceptionnelle d’un cheminement intérieur chrétien, cheminement qui ressemble à celui d’un alchimiste égaré en la modernité, véritable acteur d’une profonde résistance spirituelle contre le Mal de ce monde ; et de conclure : Ces dix premières années ... sont l’œuvre au noir de l’athanor La Soudière découvrant l’œuvre qui s’écrit en lui, ou l’écriture comme abandon. À lire de toute urgence, pour vivre. Le poète et écrivain Jean-Luc Maxence dit avoir découvert un quêteur d'Absolu d'une richesse intellectuelle admirable. Juan Asensio, quant à lui, se livre à une analyse approfondie des lettres du premier tome dans son blog, considérant Vincent La Soudière comme un magnifique écrivain que le premier volume de sa correspondance … nous offre dans sa plus cruelle évidence et dont les lettres, lues durant plusieurs semaines, vous donnent l'impression qu'un ami s'adresse à vous, qu'il vit chez vous. Il poursuit son analyse en commentant les lettres du tome II, Cette sombre ferveur : Lire, année après année, les affres dans lesquelles Vincent est plongé, c'est ... nous enfoncer dans l'expérience réelle et pas seulement figurée ou symbolique, d'une nuit de l'âme …. La lecture de ces lettres est, selon lui, une expérience intellectuelle et spirituelle, mais aussi physique, éprouvante, et l'on en sort aussi bouleversé qu'épuisé, vidé même. En témoigne également son commentaire du troisième et dernier tome, Le Firmament pour témoin : Vincent La Soudière atteint dans ces dernières lettres des rivages où nous ne pouvons nous aventurer, sauf à prétendre rejouer sa vie, calquer la nôtre sur sa déveine consubstantielle, nous mettre dans les pas de cet horrible travailleur …. Au sujet du tome II, Gaëlle Obiégly fait remarquer que ces lettres adressées à un ami ont l’intensité d’un journal intime, un journal paradoxal puisque adressé , et que l’ambition de « cet écrivain vrai n’est pas d’être quelqu’un mais de communiquer à un niveau essentiel. Les lettres à Didier racontent ce vœu et son impossible réalisation. D’où la beauté de cette vocation. Sur Vincent La Soudière En 2015, suite à la publication du troisième et dernier tome des Lettres à Didier paraît un essai biographique de Sylvia Massias, Vincent La Soudière, la passion de l’abîme, aux Éditions du Cerf. Ce livre, dit-elle, est à la fois une biographie et une tentative de compréhension du drame de Vincent. Il s’agit de l’"histoire d’une âme"26 ». Elle précise avoir utilisé et cité maintes sources, non seulement la correspondance adressée à Didier, mais aussi des lettres écrites à d’autres correspondants, des écrits divers extraits de ses cahiers et carnets... et avoir eu le sentiment, en l’écrivant, d’exprimer et de livrer la substance du témoignage que Vincent La Soudière voulait donner au monde. À l’occasion de la double publication du dernier tome des Lettres à Didier et du livre de Sylvia Massias, la revue Florilettres revue de la Fondation La Poste a consacré son numéro de mai 2015 à Vincent La Soudière. Écrits inédits Vincent La Soudière a laissé de très nombreux écrits inédits, une centaine de cahiers, carnets et blocs, à quoi s’ajoutent de très nombreux feuillets manuscrits et environ trois cent cinquante textes dactylographiés correspondant à une mise au net parfois relative, certains d’entre eux étant très raturés. D’après Sylvia Massias, ces écrits « ne sauraient être publiés tels quels, conformément au vœu de Vincent La Soudière lui-même qui ne le souhaitait pas et voulait faire des choix. Après la publication de Brisants, elle explique avoir conçu, à la lumière de la correspondance adressée à Didier dont elle prit alors connaissance, un autre recueil de textes à partir de la totalité des écrits de Vincent La Soudière – un recueil qui lui semble résumer l’essentiel de son message et fait de lui le témoin d’une foi et d’une espérance indéfectibles, d’autant plus précieuses qu’elles sont nées au cœur de la plus sombre des nuits. Ce recueil est encore inédit à ce jour. Citations Brisants « J’aime marcher hors des pistes ; c’est d’ailleurs la figure de ma vie : être ailleurs. » Brisants, p. 35 « Les choses indicibles, qu’elles restent indicibles. Il faut bien quelque chose à soustraire au fleuve de mots qui nous inonde. » Brisants, p. 12 « On écrit des poèmes sans le vouloir, au-delà des remparts du désespoir. Dans l’effulgence de quelque transcendance... » Brisants, p. 14 « Tout me touche et m’émeut et en même temps tout m’est indifférent. Je ne défendrai aucune cause. » Brisants, p. 21 « Père, père, avant de mourir, dis-moi le mot que j’attends depuis ma naissance. » Brisants, p. 24 « Nous ne sommes plus à l’âge de l’éloquence, mais à celui de l’aboiement. » Brisants, p. 64 « Me trouver face à face avec une personne, constitue déjà un phénomène de masse. » Brisants, p. 93 « Jusqu’où pouvons-nous dire que nous avons tout raté, tout dévoyé, tout dévoré ? Il doit bien exister quelque part, ici ou là, des rescapés de la catastrophe d’exister et qui repartent avec courage sur des chemins défoncés. » Brisants, p. 23 « Je ne suis descendu aussi bas que pour remonter vers quelque étoile dansante. » Brisants, p. 25 « Oh ! cri cosmique, tu me vises ! Là est ma dernière chance. Cri décoché comme une flèche pour me blesser infiniment. Enfin, je crois en toi ! Je crois ton Amour capable de m’enflammer. Paisible massacre de mon être, portant une neuve Révolution au cœur de mon cœur. Vise ! Vise-moi ! » Brisants, p. 64-65 « Mon être est un luth dont personne ne s’est encore jamais servi. » Brisants, p. 38 « On l’emporte jusqu’à sa dernière demeure, comme s’il en avait trouvé, ne serait-ce qu’une, durant sa vie. » Brisants, p. 71 « Je cherche ma naissance devant moi ou derrière moi ; elle est au-dessus de moi. » Brisants, p. 89 « La "grande Aventure" nous aura échappé, mais nous restons les bras levés. En ce geste d’imploration aveugle seul réside notre honneur. "Brisants, p. 96 Lettres à Didier « Il existe peut-être un au-delà de la nuit qui est dans la nuit même. Éclair scellé. (Lettre 76 – 19 décembre 1968 ; t. I, p. 163) « Ce siècle qui est infiniment plus "athée" qu’il ne le croit. Qui – à la limite – ne croit plus au jeu divin de la circulation du sang dans nos artères. Pour un peu "ils" mettraient leur cœur (organe) en panne... jusqu’à plus ample informé. … Il nous faut la Foi des derniers temps pour nous préserver du grand rictus de l’âme. » (Lettre 116 – 17 février 1971 ; t. I, p. 256-257 « Ne me "parlent" que les choses de la nature : arbres, nuages, cailloux, fossés, chemins ; les animaux aussi qui sont dépouillés de toute nationalité, et les enfants qui, eux, osent encore regarder les choses sans parti pris. Lettre 118 – 11 mars 1971 ; t. I, p. 261 « Il m’apparaît que je n’ai rien. Rien de ce qui fait un homme au xxe siècle. Ni travail, ni femme, ni argent. L’écriture seule faisant contrepoids – mais elle n’est pas tout à fait de ce côté-ci du monde. S’il n’y avait pas cette musique en moi, sûrement je me tuerais. Lettre 141 – 14 juillet 1971 ; t. I, p. 329 « Je suis désœuvré et souffrant, plus que jamais cabré devant le monde des hommes, le monde indécent de l’action. » (Lettre 161 – 26 septembre 1971 ; t. I, p. 367 « Ah, la drogue ! Ah, les voyages ! Ah, les convulsions ! Eh bien non, rien de tout cela ne me semble digne de m’aider, ou seulement de m’accompagner. Je m’oblige à rester tout entier au centre de l’impossible écartèlement... pour voir, pour être prêt à voir. Mais, drogue pour drogue, nous sommes tous drogués à des degrés et à des titres divers. Michaux n’a-t-il pas écrit que "tout est drogue pour celui qui a choisi de vivre de l’autre côté". Lettre 200 – 4 mars 1972 ; t. I, p. 458-459 « Pour ma part en écriture, je sens qu’après m’être roulé tout mon saoul dans le soufre et le feu, j’atteindrai à une sorte de sérénité dans l’assentiment, la louange, l’hymne. J’ai besoin de cela. Mais avant, je dois passer par toutes les cavernes de l’enfer. Je crois que c’est Saint-John Perse qui écrit : "Oui, j’ai lieu de louer". Mon Apollinisme, ce sera sans doute de chanter le sourire du martyr derrière les flammes, le retour du calme après la tempête, le perpétuel accompagnement de vent parmi nos terreurs. Angoisse d’exister, mais sur fond d’espoir insensé. Chez moi, il n’y a jamais eu d’angoisse – aussi sombre, aussi compacte fût-elle – qui ne fît en même temps résonner quelque lointain cristal. Lettre 210 – 16 mai 1972 ; t. I, p. 483 « Chacun s’exténue dans son cachot. On voudrait des issues, ne seraient-elles qu’entraperçues entre deux claquements de porte. Chanter devrait être notre acte – ininterrompu ; chanter, ébranler le scintillement froid des étoiles. Attendrir les lointains qui se refusent. Nous sommes des fantômes à la recherche de leur corps. Lettre 220 – 3 juin 1972 ; t. I, p. 501 « Je termine la lecture des Lettres de Baudelaire à sa mère. Quels désarrois, quel désastre, quelle pitié que son existence. En voici deux lignes où, tristement, je me retrouve : "L’oisiveté absolue de ma vie apparente, contrastant avec l’activité perpétuelle de mes idées, me jette dans des colères inouïes." Le contraste entre mes capacités littéraires et mon inactivité est l’un des fléaux de ma vie, sinon le fléau unique. » (Lettre 295 – 20 mai 1974 ; t. I, p. 613) « Je viens de lire un livre sur Diogène le Cynique. Un franciscain sans Christ. Ah, le tonneau, la cellule, l’ermitage, la tunique rapiécée, le bâton. Il n’y a que ça de vrai ! Pauvre de moi, qui cherche… une maison, des livres, de l’argent ! » (Lettre 421 – 6 juillet 1977 ; t. II, p. 229) « Ton appréciation sur mon livre rejoint celle de Cioran, qui vient de m’envoyer une très belle lettre. Tout cela m’encourage grandement (parmi les hommes). Mais l’essentiel est, comme tu l’écris, que je "travaille dans l’absolu et devant Dieu". C’est lui mon premier et dernier auditeur. Oui, que ce soit pour lui – comme un psalmiste clandestin. Son psalmiste clandestin. » (Lettre 466 – 19 mai 1978 ; t. II, p. 302) « J’aspire, du plus profond de moi, à être changé, renouvelé de fond en comble – hormis ce qui a le droit de rester. Je sais bien que la mort sera ce grand renouvellement. Mais avant de mourir, je voudrais changer ; savoir, éprouver ce que ça peut être que de ne plus être confiné en moi-même (je suis ma propre géhenne). » (Lettre 489 – 6 janvier 1979 ; t. II, p. 378) « Déjeuné avec Michaux avant-hier. Nous avons parlé à cœur ouvert. Son point de vue (sur le rythme de "production" littéraire) équilibre celui du monde qui ne valide que l’action et la production. "On ne devrait publier, me dit Michaux, que des échantillons de ce qu’on écrit, et cela de loin en loin. Ainsi la qualité serait maintenue." Au lieu de quoi, on écrit à tour de bras et l’on publie tout ce qu’on écrit ; pressé, obsédé de remplir le temps de la vie. Cette entrevue m’a beaucoup rasséréné – et soulagé d’une partie de ma culpabilité vis-à-vis du monde et de ses injonctions. » (Lettre 523 – 7 novembre 1979 ; t. II, p. 449) « Ma vie est perdue. Elle ne l’est peut-être pas pour Dieu. Moi qui ai rêvé d’être archéologue, et moine. Si je n’étais chrétien, j’élèverais un autel au Destin. La vie a fait de moi de la chair à pâté. À présent, c’est l’autre versant. Mais toujours la foi obscure. Peut-on vivre (en chrétien) privé de quelques "consolations" de temps à autre ? Je ne désire plus que la Lumière du Ciel. Et toujours point d’"office" sur cette terre. Impossible de vivre cela sans l’assistance de Dieu, de mon ange gardien, de mon saint Patron et de ceux qui prient pour moi. » (Lettre 691 – 30 juin 1989 ; t. III, p. 243) « Pour qui est-ce que j’écris ? Pour quelqu’un qui est déjà parti. Pour Dieu, pour les astres scintillants. Simplement, pour m’exprimer. » (Lettre 741 – 11 juillet 1991 ; t. III, p. 358) « La course de mes jours s’achève, je l’espère. Tout ce que je puis donner aux autres, je le donnerai au Paradis. » (Lettre 794 – 23 mars 1993 ; t. III, p. 457) Œuvre publiée Poésie, correspondance Chroniques antérieures, Montpellier, Fata Morgana, 1978. L’Arrière-Garde29, poèmes, avec trois eaux-fortes de Gilles Alfera. Précédé d’un texte de Landry, Neauphle-le-Château, G. Alfera, 1988. Brisants. Texte établi et présenté par Sylvia Massias. Orbey, Arfuyen, 2003. C'est à la nuit de briser la nuit, Lettres à Didier I 1964-1974. Édition présentée, établie et annotée par Sylvia Massias. Paris, Ed. du Cerf, 2010. Cette sombre ferveur. Lettres à Didier II 1975-1980. Édition préfacée, établie et annotée par Sylvia Massias. Paris, Ed. du Cerf, 2012. Le Firmament pour témoin. Lettres à Didier III 1981-1993. Édition présentée, établie et annotée par Sylvia Massias. Paris, Ed. du Cerf, 2015. Textes divers Au cœur de la meule, Genève, La Revue de Belles-Lettres, no 1, 1974, p. 54-57. « Chroniques antérieures » extraits, Argile Maeght Éditeur, n° XI, automne 1976, p. 12-27. « Une dernière fois » et « Jugement par le son », dans Guitares. Chefs-d’œuvre des collections de France. Préface de François Lesure, photographies de Maurice Bérard. Paris, La Flûte de Pan, 1980. Texte français-anglais. « La Jérusalem d’En Bas », Argile, n° XXIII-XXIV, printemps 1981, p. 123-127. « Alliance », Paris, Noir sur blanc, no 3, printemps 1987, p. 69-71. « Élégie », Lyon, Jalouse pratique, no 2, juin 1993. Sur Vincent La Soudière Sylvia Massias, Vincent La Soudière, la passion de l’abîme. Paris, Ed. du Cerf, 2015.    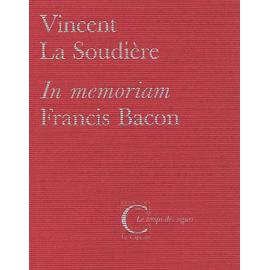  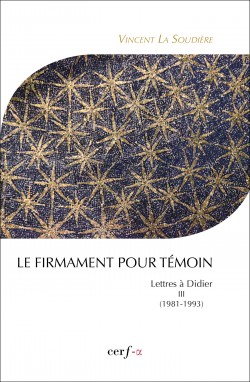
#129
Mario Praz
Loriane
Posté le : 04/09/2015 17:07
Le 6 septembre 1896 naît à Rome Mario Alcibiade Praz
mort dans la même ville le 23 mars 1982, écrivain italien, collectionneur, journaliste, historien de l'art et critique littéraire dont les ouvrages portent principalement sur les cultures française, anglaise, allemande, russe, espagnole et italienne. Journaliste, universitaire, traducteur, il a rassemblé une collection de mobilier et d'objets d'art de la période néoclassique, aujourd'hui accessible à son ancien domicile de Rome. Il a reçu la distinction de chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique En bref Mario Praz fut le plus savant humaniste, le chroniqueur et le critique le plus brillant et le plus délicat essayiste qu'ait connu l'Italie de son temps. Angliciste de profession, il fut partout chez lui dans le domaine des lettres, et il eut encore l'originalité d'être un des meilleurs connaisseurs du style Empire Goût néo-classique, trad. franç. 1989 et un collectionneur passionné, Histoire de la décoration d'intérieur, trad. franç. 1990. Voyageur de corps et d'esprit, il ne connut pas de frontières à l'intérieur de la civilisation occidentale nourrie à la source italienne. Il naquit à Rome, mais son enfance et son adolescence furent florentines. De sa personnalité naissante, il a laissé une image idéale dans Portrait d'un Épicurien, où le terme doit s'entendre dans le sens philosophico-esthétique que lui donne Walter Pater : c'est d'un culte du moi qu'il s'agit, d'un rapport mesuré du moi au monde, et d'une communion avec le beau qui est le fondement de la paix de l'âme. L'éveil irrésistible de sa vocation littéraire le mena d'abord à D'Annunzio. Il s'orientait incertainement vers l'Angleterre lorsqu'il fut conduit vers la plus florentine des Anglaises, Vernon Lee — Miss Bell, laide et gentille, du Lys rouge d'Anatole France. Auprès de cette déjà vieille dame, il connut un enchantement, une conversion. Quand il arriva à Rome en 1934, il retrouva au Palazzo Ricci l'appartement dont il avait rêvé en 1917, et c'est là qu'au fil des années il installa sa Casa della vita 1958, La Maison de la vie, trad. franç. 1994, ce musée domestique où tout un mobilier devient pour lui une féerie dormante de lions, de sphinx, de cygnes, qu'il imagine prêts à s'animer. Il semblait tout savoir, et sa forte personnalité le mettait au cœur de la vie culturelle du pays. En 1930, il analyse la littérature romantique dans La Chair, la Mort et le Diable. Ce qui importe à son travail critique, c'est que tout, dans sa mémoire, identifié et clair, soit disponible à tout appel. Un emblème surgit : Méduse, belle tête coupée sous une chevelure grouillante de serpents. La mort physique est obsédante, la décadence s'installe, les sexes s'embrouillent et se replient frileusement sur l'homosexualité et l'inceste. Gustave Moreau, comme Huysmans — les arts convergent toujours —, nous transporte à Byzance. Le concettisme, et notamment le marinisme, a représenté pour Praz un intérêt constant, la sensibilité dans le jeu des pointes et des traits du poète Richard Crashaw le touche. Au XVIe siècle, il voit naître le maniérisme d'un déséquilibre de la sensibilité, avec sa perversion inquiète des formes. Aussi à l'aise dans l'un que dans l'autre domaine, c'est en partant de la peinture qu'il traite de l'embourgeoisement du romantisme littéraire en Angleterre. Les peintres des Pays-Bas au XVIe et au XVIIe siècle ont offert toute la variété des scènes de genre qu'on retrouvera chez les romanciers anglais, de Scott à Eliot. Dans ses essais, l'invention se fait jour comme s'il se retenait à peine de passer du vécu à la fiction. Ne se souciant guère d'être notre contemporain, Mario Praz donnait libre cours à son aversion pour la déshumanisaton de l'art. Jean-Jacques MAYOUX Sa vie Son père, Luciano Praz, était un employé de banque dont la famille avait quitté Zermatt en 1825 pour s'installer dans le val d'Aoste. Sa mère, issue de la famille des comtes de Marsciano, se nommait Giulia Testa di Marsciano. Mario Praz passa ses premières années en Suisse, où travaillait son père. Né avec une malformation congénitale au pied droit, il fut opéré avec succès à l'Institut orthopédique Rizzoli de Bologne. Après la mort de son père, au cours de l'été 1900, sa mère l'emmena vivre à Florence chez son propre père, Alcibiade di Marsciano. Au terme d'une période de difficultés économiques, elle fit la connaissance d'un haut fonctionnaire qu'elle épousa en 1912. Son beau-père étant florentin, Mario Praz passa l'essentiel de son adolescence entre Rome et la Toscane. Après avoir terminé ses études secondaires au lycée de Rome, il fréquenta pendant un an la faculté de droit de l'Université de Bologne, puis emménagea à Rome en 1915 pour y poursuivre ses études. Ce fut là qu'il étudia la littérature anglaise avec son ami Vittorio Moschini, qui devint plus tard conservateur en chef des musées de Venise, et qu'il assista, par intérêt personnel, en compagnie de Bruno Migliorini, aux cours de philologie et de critique littéraire de Cesare De Lollis. La cour de La Sapienza et l'église Sant'Ivo Borromini En 1918, il soutint sa thèse de doctorat en droit international public sur la Société des Nations nouvellement créée. Cependant, il abandonna rapidement le droit pour se tourner vers les lettres, et il obtint deux ans plus tard un second doctorat, cette fois en littérature anglaise, à l'université de Florence en 1920. En 1923, grâce à une bourse d'études, il se rend en Grande-Bretagne et enseigne la littérature italienne à l'université de Liverpool, chaire qu'il occupe jusqu'en 1931. L'année suivante, il occupe le même poste à l'université de Manchester, puis il revient à Rome en 1934 pour enseigner la littérature anglaise et américaine à l'université La Sapienza. Il conservera ce poste jusqu'à sa retraite, en 1966. Marié avec l'une de ses étudiantes anglaises, Vivyan Eyles, de plusieurs années sa cadette, il a une fille, Lucia, née en 1938. Mais Vivyan Praz quitte son mari à la fin de la guerre et emmène leur fille en Angleterre. Fondateur de la première école italienne d'étude des lettres anglaises, Mario Praz aura comme disciples, notamment, Vittorio Gabrieli, Agostino Lombardo, Giorgio Melchiori, Gabriele Baldini et Masolino d'Amico. Il collabore à la revue Primato, fondée en 1940 par Giuseppe Bottai. En janvier 1945, il organise une exposition d'art contemporain qui rassemble des œuvres d'Alberto Savinio et de Fabrizio Clerici, entre autres. Juré à la Mostra de Venise en 1960, lauréat du prix Antonio Feltrinelli en 1960, membre de l'Accademia dei Lincei, en 1962 il reçoit de la reine Élisabeth II la dignité de chevalier commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. L'œuvre Critique littéraire, critique d'art, Mario Praz publie des dizaines de livres, des milliers d'articles, tous consacrés à l'histoire culturelle de l'Europe, qu'il étudie à travers les rapports qu'entretiennent entre eux les différents arts : la littérature, la peinture, la sculpture, mais aussi la décoration d'intérieur, qu'il place à égalité avec les arts majeurs. L'un de ses essais les plus célèbres, Romantic Agony, qu'il écrit d'abord en anglais, est une étude exhaustive du romantisme noir qui caractérise les auteurs européens des XVIIIe et xixe siècles. Auteur de nombreuses études sur Shakespeare, Edgar Poe, T. S. Eliot ou William Wordsworth, il traduit certains de ces écrivains en italien. Son œuvre critique porte sur l'Angleterre de la Renaissance à l'époque victorienne, mais également sur la littérature française, américaine, espagnole, allemande, russe ou italienne dont il définit le genre romanesque, au XIXe siècle, comme du « roman Biedermeier. Admiré par Philippe Jullian, W. H. Auden, Pietro Citati, Marc Fumaroli, Franco Maria Ricci ou Patrick Mauriès, celui que les Romains, pendant un demi-siècle, surnommèrent le professeur Praz, ou plus communément le Professeur sans même avoir besoin de préciser son nom, est en outre l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l'histoire de la décoration et d'un essai sur le sculpteur Antonio Canova. La collection Mario Praz est devenu collectionneur un peu par hasard, vers l'âge de seize ans, lorsque son beau-père lui a fait cadeau d'une commode Empire en acajou. Désireux de trouver des meubles et des objets susceptibles de s'harmoniser avec elle, il fait bientôt l'acquisition d'une série de douze chaises datant de la même période - et qui lui sont d'autant moins indispensables qu'il vit à cette époque dans un minuscule deux-pièces. Ainsi commence un processus de recherche et d'accumulation qui va durer jusqu'à sa mort, près de soixante-dix ans plus tard. À Rome, à Florence, à Londres, à Paris, en fait dans tous les endroits où il a l'occasion de se rendre, Mario Praz est un visiteur assidu des salles de ventes et des boutiques d'antiquités, avec une prédilection pour des ébénistes comme Jacob, Percier et Fontaine, ou des peintres comme Girodet. À Paris, il prend conseil auprès du collectionneur Paul Marmottan, et l'un de ses fournisseurs attitrés est le grand antiquaire André Fabius, père de Laurent Fabius et de François Fabius, qui avait repris la galerie paternelle. Animé par la volonté de s'entourer de beauté, voire de s'immerger dans cet univers esthétique qui le coupe de la réalité, Mario Praz réunit au fil des années plus de 1200 objets, tableaux, dessins, meubles, sculptures, tapisseries datant pour la plupart du Premier Empire. La majorité d'entre eux, de style néoclassique, sont d'origine française, mais d'autres proviennent d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne ou d'Angleterre. Autre élément caractéristique des goûts de Mario Praz, les conversation pieces, c'est-à-dire les tableaux du xviiie siècle représentant des scènes d'intérieur avec groupe de famille, ou encore les bas-reliefs de cire, en particulier ceux de Gaetano Zumbo, y occupent une place prépondérante. La collection aura deux adresses : les deux appartements successifs de Mario Praz dans le centre de Rome, d'abord au palais Ricci, via Giulia, de 1934 à 1969, puis au palais Primoli, via Zanardelli, de 1969 à sa mort en 1982. Il a légué sa bibliothèque à la fondation Primoli, qui abrite un musée napoléonien, et sa collection à la Ville de Rome. Après sa disparition, la collection fut entreposée durant des années dans les réserves du musée d'Art moderne de Rome, avant de regagner le palais Primoli en 1995. Chacun des 1200 objets a retrouvé sa place d'origine, selon la disposition minutieuse établie par Mario Praz, comme on peut le vérifier d'après les nombreuses photographies prises de son vivant. Depuis 1995, l'ensemble est accessible au public sous le nom de « musée Mario Praz . Mythologies de Mario Praz La fontaine de la via Giulia Son autobiographie, La Casa della vita La Maison de la vie, est considérée comme un chef-d'œuvre par Edmund Wilson, ainsi que par Charles Dantzig À propos des chefs-d'oeuvre, Grasset, 2013, p. 24. Œuvres Ouvrages traduits en français L'Ameublement : psychologie et évolution de la décoration intérieure, Tisné, 1964 Mnémosyne : parallèle entre littérature et arts plastiques, Salvy, 1986 Le Monde que j'ai vu, préface de Marc Fumaroli, Julliard, 1988 Le Pacte avec le serpent, 3 vol., Christian Bourgois, 1989, 1990, 1991 Goût néoclassique, Le Promeneur, 1989 Histoire de la décoration d'intérieur Philosophie de l'ameublement, Thames & Hudson, 1990 Une voix derrière la scène trad. de Voce dietro la scena, 1980, Le Promeneur, 1991 La Maison de la vie, préface de Pietro Citati, Gallimard/L'Arpenteur, 1993 La Chair, la Mort et le Diable : le romantisme noir, Gallimard/Tel, 1998 Choix d'ouvrages en langue italienne Essais Parmi la trentaine de titres non encore traduits en français, on pourra retenir : Secentismo e Marinismo in Inghilterra, 1925 Poeti inglesi dell'Ottocento, 1925 Penisola Pentagonale, 1926 Studi sul concettismo, 1934 Antologia della letteratura inglese, 1936 Studi e svaghi inglesi, 1937 Viaggio in Grecia, Diario del 1931, 1943 ; a cura di M.Staglieno, 1992 La Crisi dell'eroe nel romanzo vittoriano, 1952 Bellezza e bizzarria, 1960 Il giardino dei sensi, 1975 Panopticon romano secondo, 1978 Perseo e la Medusa, 1979 Traductions de l'anglais vers l'italien T. S. Eliot, La Terre vaine, Marche triomphale Edgar Allan Poe, Le Corbeau, Philosophie de la composition Ben Jonson, Volpone Charles Lamb, Essais d'Elia Jane Austen, Emma 1965 Citation « La maison, c'est l'homme, tel le logis, tel le maître ; en d'autres termes, dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. » Histoire de la décoration d'intérieur      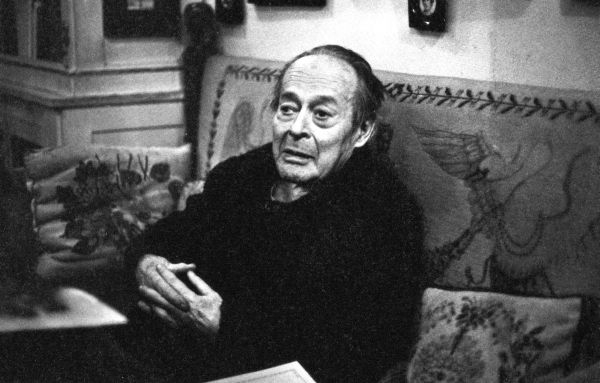   
#130
François Cheng
Loriane
Posté le : 29/08/2015 23:34
Le 30 Août 1929 naît François Cheng nom d'auteur
Chéng Bàoyī en chinois : 程抱一,transcription phonétique pinyin, à Jinan dans la province de Shandong écrivain, poète et calligraphe chinois naturalisé français en 1971. Écrivain essayiste, poète, calligraphe, romancier, universitaire, traducteur, académicien français, naturalisé en 1971 d'origine chinoise Nanchang 1929. Il a reçu le prix Femina en 1998, Grand prix de la francophonie de l'Académie française en 2001, membre de l'Académie française au fauteuil 34. Il quitte la Chine pour la France en 1948, fréquente l'EHESS et se lie avec R. Barthes, J. Lacan et J. Kristeva. Il s'impose comme spécialiste d'esthétique chinoise à travers plusieurs essais, dont Vide et plein : le langage pictural chinois 1979, Shitao, la saveur du monde 1998, prix André-Malraux, D'où jaillit le chant 2000, Cinq méditations sur la beauté 2006. Poète De l'arbre et du rocher, 1989 ; Saisons à vie, 1993 ; Double Chant, 1998, prix Roger-Caillois, traducteur et calligraphe, il publie son premier roman en 1998, le Dit de Tianyi prix Femina, à caractère autobiographique ; suivra L'éternité n'est pas de trop 2002, histoire d'une passion flamboyante à la fin de la dynastie Ming, qui prolonge une quête spirituelle engagée à travers une double culture chinoise et occidentale. Il est le premier écrivain d'origine asiatique à entrer à l'Académie française 2002. En bref Nom originel chinois : Cheng Chi-Hsien 程纪贤. Issu d'une famille de lettrés, après des études à l'Université de Nankin, François Cheng arrive à Paris avec ses parents en 1948 lorsque son père obtient un poste à l'Unesco. Alors que sa famille émigre aux États-Unis en 1949 en raison de la guerre civile chinoise, il décide de s'installer définitivement en France, motivé par sa passion pour la culture française. Il se consacre à l'étude de la langue et de la littérature française en vivant dans le dénuement et la solitude1 avant de faire dans les années 1960 des études universitaires, en préparant un diplôme de l'École pratique des hautes études EPHE. Il se lance aussi dans des traductions en chinois de poèmes français puis celles de poèmes chinois en français. Tout d'abord, il publie de la poésie en chinois à Taïwan et à Hong Kong. Ce n'est que tardivement en 1977 qu'il écrit en français, sur la pensée, la peinture et l'esthétique chinoises et aussi des ouvrages poétiques. Jugeant avoir acquis assez d'expérience, il peut ensuite se lancer dans l'écriture de romans. Il publie également un album de ses propres calligraphies. Depuis 2008, il est membre du comité d'honneur de la Fondation Chirac, créée pour agir en faveur de la paix dans le monde. Il est également membre d'honneur de l'Observatoire du patrimoine religieux OPR, une association multiconfessionnelle qui œuvre à la préservation et au rayonnement du patrimoine cultuel français. Son prénom français fait référence à saint François d'Assise. Il est le père de la sinologue Anne Cheng. Sa vie Poète, romancier et calligraphe, François Cheng est né en Chine, à Nanchang, le 30 août 1929. Issu d'une famille d'universitaires et de lettrés, le jeune homme, qui connaît la fin de la guerre et la guerre civile en Chine, entre à l'université de Nankin, avant de gagner la France en 1949. Il finit par s'y installer. Étudiant à la Sorbonne, il est un lecteur assidu à la bibliothèque Sainte-Geneviève où il fait sienne la littérature occidentale classique. Étudiant à l'École pratique des hautes études, il enseigne à son tour dans les années 1960 au Centre de linguistique chinoise – le futur Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale –, frayant avec Roland Barthes, Julia Kristeva, A. J. Greimas, au côté desquels l'assistant s'initie à la sémiologie. Le dialogue avec Jacques Lacan aura aussi son importance. C'est dans le sillage de cette réflexion qu'il va rédiger L'Écriture poétique chinoise, suivi d'une anthologie des poèmes des Tang 1977, et Vide et plein 1979, un essai sur le langage propre à la peinture chinoise. Le lien entre la calligraphie et l'écriture poétique est naturel ; il conduit à un art dont les traits expriment à la fois les formes des choses et les pulsions du rêve ; ils ne sont pas de simples contours ; par leurs pleins et leurs déliés, par le blanc qu'ils cernent, par l'espace qu'ils suggèrent, ils impliquent déjà volume jamais figé et lumière toujours changeante. Calligraphe, Et le souffle devient signe, 2001, François Cheng est persuadé de raviver le souffle qui anime l'Univers, celui-là même qui inspire sa main en sismographe de l'âme. Naturalisé français en 1971, François Cheng enseigne à partir de 1974 comme maître de conférences puis comme professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Ses travaux se composent de traductions des poètes français en chinois et des poètes chinois en français, de monographies consacrées à l'art chinois Chu Ta : le génie du trait, 1986 ; Shitao : la saveur du monde, 1998), de recueils de poésies, de romans. Dans la préface de À l'orient de tout 2005, qui rassemble les recueils Double chant, Cantos toscans, Le Long d'un amour, Qui dira notre nuit, Le Livre du vide médian, André Velter estime que François Cheng aura mis vingt ans pour devenir le poète qu'il entendait être, composant en français à partir des années 1980. Un pari prometteur, consistant à élargir considérablement le rayon de pensée et d'action d'un vocabulaire le plus souvent jaloux de ses limites en lui adjoignant l'immense espace physique, mental et spirituel de la Chine. Passeur entre l'Orient et l'Occident, il est à l'écoute de la vision organique et unitaire de l'univers vivant que propose la pensée taoïste. Un univers où tout se relie et se tient à partir de l'idée de souffle, unité de base et qui relie entre elles toutes les entités vivantes. On sait que le fonctionnement du souffle est ternaire : le yin, le yang et le vide médian. Ce dernier est le trois taoïste qui, né du deux et drainant la meilleure part du deux, permet à celui-ci de se dépasser et de s'engager dans la voie de la transformation entretien avec Lire, décembre 2001. La métaphore décrit le principe même de création du romancier tel qu'il s'exprime dans Quand reviennent les âmes errantes 2012, un drame épique évoquant une passion à trois – une femme, un musicien et un guerrier – dans la seconde moitié du IIIe siècle avant notre ère, quand la Chine se divisait en de multiples royaumes rivaux. Le roman devient ainsi le lieu d'un singulier échange où toute la vie se rassemble dans les douleurs et les joies jusqu'à l'au-delà de la mort, dans un réveil des âmes retrouvées grâce à la résonance universelle. L'Histoire est la toile de fond des drames intimes que raconte François Cheng. La vie humaine ne vaut rien, les hommes sont mobilisés par centaines de milliers pour la construction des palais et plusieurs millions sont déportés pour bâtir la Grande Muraille. La brutalité du monde et sa violence sont déjà présentes dans ses premiers romans, Le Dit de Tianyi 1998 et L'éternité n'est pas de trop 2002. Pour lui, l'amour entre les êtres – sentimental, sensuel et spirituel – est fondateur. Quand je trace le mot „harmonie“, je rentre dans l'harmonie, écrit François Cheng dans Et le souffle devient signe. Calligraphe-poète, il a fait de son art un mode de vie ascétique et fusionnel avec la nature : Mais l'oiseau point d'empreinte/ Ne laisse. Son empreinte est/ Son vol même. Nulle trace/ Autre que l'instant-lieu/ joie du pur avènement :/Lieu deux ailes qui s'ouvrent, /Instant un cœur qui bat Cantos toscans François Cheng a été élu à l'Académie française le 13 juin 2002. Véronique Hotte Honneurs et distinctions En 2000, il reçoit le prix Roger-Caillois pour ses essais et son recueil de poèmes Double Chant. En 2001, François Cheng reçoit le grand prix de la francophonie de l'Académie française. Le 13 juin 2002, il devient membre de l'Académie française; premier Asiatique élu, il est le vingtième récipiendaire du fauteuil. Il est membre du Haut Conseil de la Francophonie. Il a été promu Officier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2009. Œuvres Analyse formelle de l'œuvre poétique d'un auteur des Tang : Zhang Ruoxu 1970 Le Pousse-pousse, de Lao She traduction, 1973 L'Écriture poétique chinoise, Éditions du Seuil, 1977 et 1996 Vide et plein : le langage pictural chinois, Éditions du Seuil, 1979 L'Espace du rêve : mille ans de peinture chinoise, Phébus, 1980 Sept poètes français 1983 Henri Michaux, sa vie, son œuvre, 1984 Chu Ta : le génie du trait, Phébus, 1986 Some Reflections on Chinese Poetic Language and its Relation to Chinese Cosmology dans The Vitality of the Lyric Voice, 1986 The Reciprocity of Subject and Object in Chinese Poetic Language dans Poetics East and West, 1988 De l'arbre et du rocher, poèmes, Fata Morgana, 1989 Souffle-Esprit, Éditions du Seuil, 1989 et 2006 Entre source et nuage, Voix de poètes dans la Chine d'hier et d'aujourd'hui, Albin Michel, 1990 et 2002 Saisons à vie, poèmes, Encre marine, 1993 Trente-six poèmes d'amour, poèmes, Unes, 1997 Quand les pierres font signe, 1997 avec Fabienne Verdier Le Dit de Tianyi, Albin Michel, 1998 prix Femina Double chant, Encre Marine, 1998 prix Roger-Caillois Shitao : la saveur du monde, Phébus, 1998 prix André-Malraux Cantos toscans, Unes, 1999 D'où jaillit le chant, Phébus, 2000 Poésie chinoise, poèmes, Albin Michel, 2000 Et le souffle devient signe, Iconoclaste, 2001 Qui dira notre nuit, poèmes, Arfuyen, 2001 L'éternité n'est pas de trop, Albin Michel, 2002 Le Dialogue, Une passion pour la langue française, Desclée de Brouwer, 2002 Le Long d'un amour, poèmes, Arfuyen, 2003 Le Livre du vide médian, poèmes, Albin Michel, 2004 - édition revue et augmentée, 2009 Que nos instants soient d'accueil, avec Francis Herth, Les Amis du Livre contemporain, 2005 À l'orient de tout, poèmes, Gallimard, 2005 Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, 2006 Pèlerinage au Louvre, Flammarion et Musée du Louvre éditions, 2008 L'Un vers l'autre, Éditions Albin Michel, 2008 Œil ouvert et cœur battant, Desclée de Brouwer, 2011 Quand reviennent les âmes errantes, Albin Michel, 2012 Cinq méditations sur la mort. Autrement dit sur la vie, Albin Michel, 2013 Assise. Une rencontre inattendue, Albin Michel, 2014 Entretiens avec Françoise Siri, suivis de douze poèmes inédits, Albin Michel, 2015 La vraie gloire est ici, poèmes, Gallimard, à paraître en octobre 2015 Bibliographie Madeleine Bertaud, François Cheng. Un cheminement vers la vie ouverte, Éditions Hermann, 2009; et 2de édition, révisée et complétée, Hermann, 2011. Yinde Zhang, François Cheng ou dire la Chine en français, Revue de littérature comparée, 2/2007, n° 322, p. 141-152.   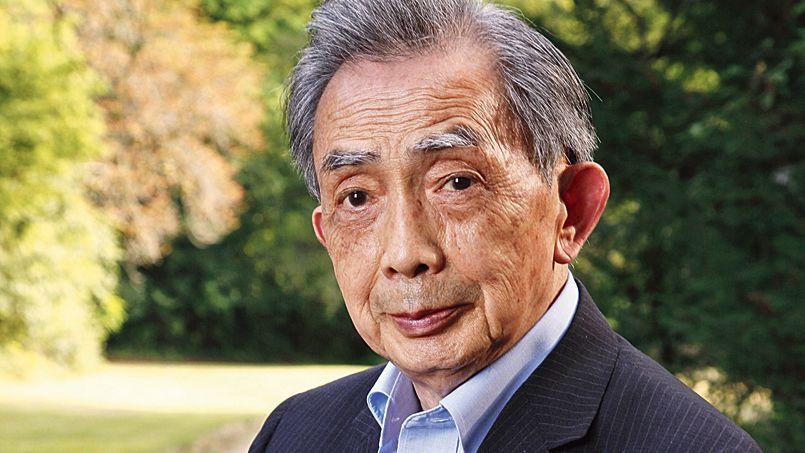     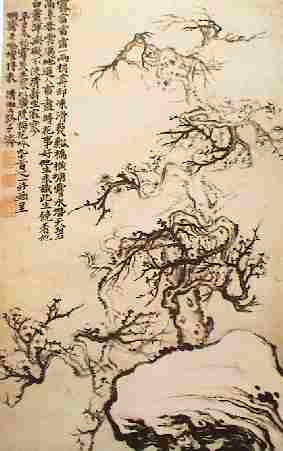   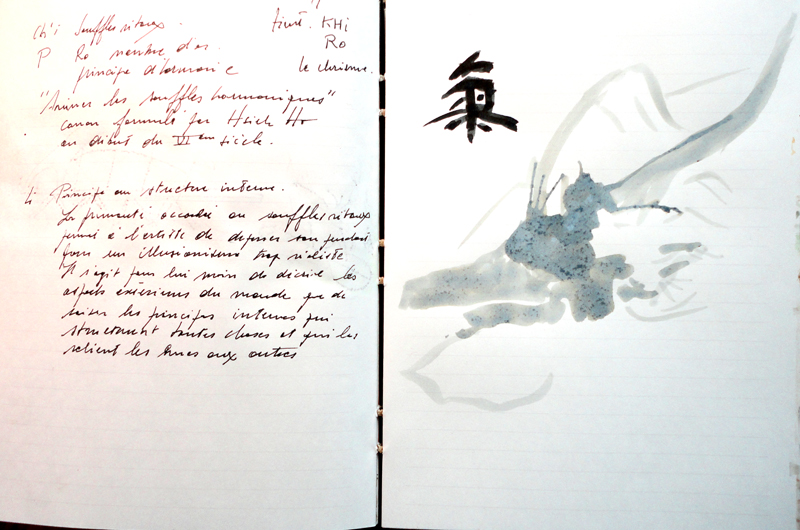 |
Connexion
Sont en ligne
62 Personne(s) en ligne (44 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 62 Plus ... |
| Haut de Page |






