 Tous les messages Tous les messages
#51
Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée
Loriane
Posté le : 13/02/2016 22:01
Le 14 février 1692 naît Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée
à Paris où il est mort le 14 mars 1754 auteur dramatique français, créateur d'un genre théâtral : la comédie larmoyante. Le révérend père La Chaussée ne va cependant pas jusqu’à appliquer les stricts principes moraux qu'il met en scène dans ses pièces à sa vie privée : il fréquente des cercles libertins et compose également des ouvrages grivois. Reçu à l’Académie française en 1736, il s'opposera constamment à l'admission d'Alexis Piron, ainsi qu'à celle de Jean-Pierre de Bougainville, lequel finira toutefois par lui succéder. La Chaussée a pavé la voie, avec sa comédie larmoyante qui ne visait plus le comique mais les larmes, au drame bourgeois. Brisant la séparation rigoureuse alors en vigueur entre la tragédie et la comédie, cette innovation s’inscrivait dans le fil des pièces de Marivaux et allait conduire tout naturellement au drame bourgeois de Diderot et de Sedaine. Cette innovation conquit le public mais suscita de vives oppositions dans le monde des lettres. Voltaire, qui ne négligea pourtant pas le genre de la comédie larmoyante avec L'Enfant prodigue, affirma qu'il démontrait l'incapacité de l'auteur à produire soit des comédies, soit des tragédies, et écrira : Sa vie La Chaussée a près de quarante ans lorsqu’il débute dans les lettres par un petit poème, une Épître de Clio, publiée à Paris en 1731, et dans laquelle il prend le parti de La Faye dans la controverse opposant ce dernier à Houdar de La Motte, qui soutenait que les vers n’étaient pas indispensables à la tragédie. Deux ans plus tard, il fait jouer sa première pièce, La Fausse Antipathie, en trois actes et en vers, représentée le 12 octobre 1733. Cette œuvre annonce le drame bourgeois, tout en conservant les règles canoniques de la comédie classique. C’est le premier essai d’un genre nouveau, qu’on appellera la comédie larmoyante ou comédie mixte, et qui n’est autre chose que le drame, mais bien modeste encore, respectant scrupuleusement les règles classiques des trois unités et la forme du vers. Le public prend simplement La Fausse Antipathie pour une comédie dépourvue de comique et La Chaussée lui-même n’avait peut-être fait qu’entrevoir le genre qu’il allait développer avec succès, surtout dans les cinq pièces suivantes, toutes en cinq actes et en vers, données comme des comédies sans comique, où le but était d’intéresser par le spectacle des infortunes domestiques. Le Préjugé à la mode 3 février 1735 tourne en ridicule l’idée reçue selon laquelle un homme de naissance ne peut manifester de l’amour pour sa femme. Dans L'École des amis 26 février 1737, le personnage principal, affligé de malheurs imaginaires, est placé entre trois amis dont un seul mérite ce nom. Mélanide 12 mai 1741 constitue le modèle de la comédie larmoyante. L'héroïne est séparée de l'époux de son choix par un arrêt du Parlement. Elle le retrouve longtemps après sur le point d’épouser la fille d’un ami, dont il dispute la main à son propre fils. Geoffroy l'appelait « Mélanide la dolente », parce qu’elle était constamment en larmes. L'École des mères 24 avril 1744 met en relief le danger de la prédilection aveugle des parents pour l'un de leurs enfants. Cette pièce avait la préférence de La Harpe « parce qu’elle réunit à l'intérêt du drame des caractères, des mœurs et des situations de comédie ». La Gouvernante 18 janvier 1747, enfin, prend pour base un fait réel arrivé à M. de La Faluère, premier président du parlement de Bretagne. Trompé par un secrétaire qui avait soustrait une pièce décisive, il fit rendre un arrêt injuste et ruina la personne qui perdait son procès. Instruit de son erreur, le magistrat remboursa sur sa propre fortune la somme perdue. Dans la pièce, le président, après avoir cherché la victime de son erreur, la retrouve dans une femme de qualité qui a changé de nom et qui est employée chez lui comme gouvernante. Tirant ses principaux effets de la triste situation de personnages qui ne sont pas au-dessus de l'ordre commun, La Chaussée leur prête dans tous les moments où l'action n'est pas très vive, un entretien sérieux dont la langueur va facilement à l’insipidité. Comme il a en vue l'instruction morale plus directement que dans la comédie véritable, les préceptes et les sentences sont multipliées au point que quelques scènes ne sont que des traités de morale dialogués. Avec ses tendances et ses défauts, La Chaussée fait alors face aux attaques des envieux, des amis du sel comique et de ceux qui voient dans ses œuvres une sorte de profanation à la fois contre la comédie et contre la tragédie. DRAME Drame bourgeois Le drame bourgeois naît au XVIIIe siècle du déclin de la tragédie classique. Il vise à la remplacer comme grand genre du théâtre sérieux. L'audience qu'obtiennent ces pièces est à mettre en relation avec l'évolution du public, elle-même liée à celle de la société. Chez les spectateurs, quelle que soit leur naissance, le goût s'embourgeoise. Le genre atteste les qualités de sérieux qui caractérisent l'amateur de théâtre au XVIIIe siècle : amour de la modernité, désir de réfléchir sur des problèmes réels, aspiration à la vertu – et un certain béotisme. Préparé, avant 1750, par les œuvres de Destouches et de La Chaussée, s'épanouissant dans la seconde moitié du siècle avec Diderot, Beaumarchais, Sedaine, Mercier, le drame, au siècle suivant, cesse de s'appeler« bourgeois », l'adjectif ayant pris une couleur par trop péjorative. Pourtant les prolongements se laissent facilement discerner chez Émile Augier, Dumas fils, Curel. À la fin du siècle, un renversement des valeurs se produit : la pièce à sujet bourgeois rencontre une chance nouvelle dans l'inspiration antibourgeoise, avec Henry Becque, Mirbeau, et jusqu'à nos jours. L'invention des bons sentiments • Les précurseurs De 1710 à 1754, Destouches produit des comédies qui s'intitulent Le Curieux impénitent, L'Ingrat, La Force du naturel, son « chef-d'œuvre » étant Le Glorieux (1732). Diplomate, il répugne à l'enjouement. Non moins qu'à la poésie l'esprit mondain, au XVIIIe siècle, nuit au comique. Destouches aime les analyses morales, et glisse de la morale à la moralité. Son Glorieux, en face d'un hobereau vaniteux, déploie l'éventail des vertus bourgeoises, jusqu'à la conversion du coupable. Un peu à son insu, Destouches redécouvre une source d'intérêt que connaissait Térence : ni la terreur, ni la pitié, ni le rire, mais une sympathie compatissante. Inventée par Nivelle de La Chaussée, la comédie larmoyante s'écarte davantage de la tradition classique. Cet homme d'argent et de plaisir a su voir dans une comédie de Voltaire le sujet moral que Voltaire n'avait pas vu. Il en tire son Préjugé à la mode (1735), l'un des grands succès du siècle, repris chaque année jusqu'à la Révolution. Le préjugé est celui que peindra Laclos : la gloire d'un homme se mesure au nombre de ses conquêtes ; quiconque aime sa femme se couvre de ridicule. Durval est donc honteux d'aimer son épouse qui l'aime. L'action se dénoue lorsque, bravant le préjugé, il a le courage de son sentiment. L'œuvre présente déjà deux caractères du drame bourgeois : elle est faiblement écrite ; elle oppose au libertinage aristocratique une pratique bourgeoise des vertus. Diderot Dès ses débuts, vers 1750, Diderot, chef de l'équipe encyclopédiste, prône, en même temps qu'une philosophie nouvelle, un art neuf. Contre la tragédie, ranimée par Voltaire mais définitivement morte après l'ultime succès de Tancrède (1760), il va créer un genre adapté à l'esprit moderne : le drame bourgeois. Il joint l'exemple au précepte. Avec Dorval et moi il publie les cinq actes en prose du Fils naturel (1757, joué en 1771 sans aucun succès) ; avec le Discours sur la poésie dramatique, il donne Le Père de famille (1758, joué avec un passable succès en 1761). Le plus intéressant en ces textes reste l'esthétique vériste. Diderot soutient que le drame du Fils naturel a été vécu. L'un des participants, Dorval, en tire une pièce jouée au salon par ceux-là mêmes qui furent mêlés à l'événement. Fiction étrange qui pose le problème de la transposition théâtrale. Une dramaturgie de la pantomime et du « tableau » est présentée comme plus vraie que celle des monologues, dialogues, coups de théâtre. Et l'œuvre, bien entendu, doit être écrite en prose. Les pièces nouvelles auront l'âpre saveur du réel. On traitera de la vie familiale. On montrera un père dans les « drames » suscités par les amours de ses enfants. On peindra la profession. Il ne suffira plus de porter à la scène des hommes ayant un métier : le sujet sera tiré de l'activité professionnelle même. On reconnaît la philosophie qui fit de l'Encyclopédie un dictionnaire des métiers. L'émotion naîtra des épreuves endurées par les gens de bien. L'effet sera fort moral. « C'est toujours la vertu et les gens vertueux qu'il faut avoir en vue quand on écrit. » Beaumarchais Beaumarchais, dans son Essai sur le genre dramatique sérieux, préface d'Eugénie (1767), reprend l'essentiel de cette poétique. Intérêt « plus pressant », affirme-t-il, celui d'un « malheur domestique », puisqu'un tel événement semble « nous menacer de plus près ». « Que me font à moi, sujet paisible d'un État monarchique du XVIIIe siècle, les révolutions d'Athènes et de Rome ? » Bizarrement, l'auteur du Barbier de Séville préfère au rire l'« attendrissement » qu'inspire la vertu persécutée. « Je sors du spectacle meilleur que je n'y suis entré, par cela seul que j'ai été attendri. » Qu'un génie aussi vigoureusement comique ait toujours penché vers le drame bourgeois (Beaumarchais débute avec Eugénie, poursuit avec Les Deux Amis, 1770, conclut avec La Mère coupable, 1792, après avoir glissé quelques tirades « dramatiques » dans Le Mariage de Figaro), quelle meilleure preuve de la vitalité du genre dans les décennies précédant la Révolution ? Le pathétique bourgeois Le drame bourgeois porte sa date. Personnage d'époque que son héros, cet homme « sensible ». L'émotion, accompagnée d'une conscience de l'émotion, s'épanouit en un expressionnisme véhément, théâtral, qui devait rapidement se démoder. Au tableau final, le Père de famille de Diderot bénit les quatre jeunes gens agenouillés et profère : « Oh ! qu'il est cruel... qu'il est doux d'être père ! » Les auteurs comme le public aspirent à un pathétique violent. À l'époque des adaptations de Ducis, on attend un Shakespeare bourgeois. C'est à propos du genre nouveau que Diderot écrit la phrase souvent citée : « La poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage... » D'ordinaire, cependant, la vie de famille, l'activité professionnelle ne comportent rien de tel. Cette sorte de sujets demande à être traitée avec discrétion, ainsi que l'a su faire Sedaine, qui a laissé des œuvres justes et vraisemblables, comme son Philosophe sans le savoir (1765). Mais Diderot, Beaumarchais s'évertuent à créer du pathétique par des moyens artificiels : style emphatique, ficelles usées de l'intrigue (enfants perdus et reconnaissances, lettres interceptées, hasards malencontreux). Fait exception pourtant Est-il bon ? Est-il méchant ? « le seul ouvrage très dramatique de Diderot » (Baudelaire), le seul qui aujourd'hui puisse être joué. Les valeurs bourgeoises L'illusion de poésie procédait sans doute de la ferveur inspirée alors par les valeurs bourgeoises. Le drame célèbre les mérites d'une classe en expansion. Les Deux Amis (sous-titre : ou le Négociant de Lyon) illustrent la probité d'un marchand, placé, le jour de l'échéance, à la suite du décès inopiné d'un notaire, dans une situation cornélienne ; sifflée à Paris, la pièce fut goûtée dans les villes d'affaires. Le Père de famille traite de la mésalliance ; Saint-Albin, espoir d'une dynastie bourgeoise, épousera-t-il Sophie, l'ouvrière dont il est épris ? Oui, car Sophie retrouve, à point nommé, des parents fort sortables. Dans une époque où la bourgeoisie s'affirmait comme classe d'opposition, le drame arbitrait à son profit le conflit avec l'aristocratie. Le « philosophe sans le savoir » de Sedaine, M. Vanderk, né noble, s'est fait commerçant : il loue, à l'encontre de l'oisiveté nobiliaire, les vertus laborieuses. Pareillement, dans La Mère coupable, conclusion de la trilogie figaresque, Beaumarchais montre un Almaviva ayant abjuré son rang de grand d'Espagne, pour vivre bourgeoisement à Paris. Le drame n'ignore pas les rapports du bourgeois avec ses inférieurs, domestiques ou salariés. Mais il n'y voit que matière à idylle. La Brouette du vinaigrier, de Louis Sébastien Mercier (1775), narre l'histoire du bon employé remettant ses économies à son patron ruiné. M. Delomer, négociant comme il se doit, a une fille, aimée sans espoir par le fils d'un vinaigrier, ancien domestique de la maison. Soudain Delomer perd toute sa fortune. Alors entre le vinaigrier, poussant sa brouette ; le petit baril qu'il roule contient non du vinaigre, mais des pièces d'or, amassées une à une. Le négociant, sauvé par ce pactole, donne sa fille au fils du bonhomme. Le rideau tombe sur une scène touchante : tout le monde s'embrasse. Le drame bourgeois ruisselle de bonne conscience. Son héros ne doute pas que l'avenir lui appartienne ainsi qu'à ses semblables. Diffusion du genre au XVIIIe siècle Si l'on veut apprécier le rayonnement du genre au siècle des Lumières, d'autres noms sont à citer. Marivaux fait intervenir une discrète sentimentalité bourgeoise dans une pièce comme Le Jeu de l'amour et du hasard (1730). Plus franchement, sa Mère confidente (1735) annonce le drame tel que le concevra Diderot. Voltaire, sensible aux ridicules du genre mais attentif à suivre le goût du public, s'y essaie avec L'Écossaise (1760). Parmi les auteurs de moindre importance, Fenouillot de Falbaire mérite une mention pour son Honnête Criminel (1767), drame d'un fils prenant aux galères la place de son père, protestant condamné pour cause de religion. En Europe, l'Angleterre en ce domaine comme en d'autres a devancé le continent. En 1722, Steele donne The Conscious Lovers (Les Amants réservés), drame moralisant. En 1731, The London Merchant (Le Marchand de Londres) de Lillo, pathétique histoire d'un vertueux commis corrompu par une courtisane, remporte un succès inouï. Parmi les Italiens, Goldoni, rompant par son réalisme avec la commedia dell'arte, tend vers l'esthétique du drame bourgeois. Mais c'est en Allemagne que le genre est le mieux accueilli. Goethe en témoigne : « Le Père de famille de Diderot, L'Honnête Criminel, Le Vinaigrier, Le Philosophe sans le savoir, Eugénie se conformaient au respectable esprit bourgeois de la famille qui commençait à prévaloir de plus en plus » (Poésie et Vérité). Le théâtre allemand renaît par le drame bourgeois, avec Gellert, auteur de Die zärtlichen Schvestern (Les Tendres Sœurs, 1747), touchant portrait de deux jeunes personnes de la bourgeoisie saxonne. Il y eut un Père de famille allemand de Gemmingen (1780), lequel « donnait une vision sentimentale des mérites de la classe moyenne et ravissait le public ». Goethe, qui s'exprime ainsi, tira lui-même un drame bourgeois, Clavigo (1774), d'un épisode narré par Beaumarchais. Bientôt Schiller, dans Kabale und Liebe (Intrigue et Amour, 1784), porte au paroxysme révolutionnaire le conflit, en Allemagne, de la cour et de la ville, de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Consolidation et critique au XIXe siècle Augier et Dumas fils Au XIXe siècle, le substrat social du genre ne cessant de se consolider, maintes œuvres, sous d'autres étiquettes, continuent à répondre à la définition du drame bourgeois. De Hugo à Montherlant le théâtre à sujets historiques exprime une volonté de poésie. Parallèlement se perpétue une tradition de pièces à idées, sur des problèmes familiaux, professionnels, sociaux... Le Gendre de Monsieur Poirier, d' Émile Augier (1854), répète l'inévitable confrontation du roturier enrichi par son travail (dans le commerce, selon l'habitude) avec le gentilhomme oisif. Maître Guérin (1864), du même auteur, montre dans l'exercice de ses fonctions un notaire, mais un notaire véreux. Dumas fils surtout obtint un long succès pour avoir porté à la scène les « problèmes » de son public. Il revient sur la question de la mésalliance, combinée avec le thème romantique de la courtisane rachetée par l'amour (La Dame aux camélias, 1852). Il traite La Question d'argent (1857) : puissance ou faiblesse de l'argent ? Ses personnages plaident les deux thèses. Pendant que Baudelaire proclame la séparation de l'art et de la morale, il affiche hautement ses intentions moralisantes : « Toute littérature qui n'a pas en vue la perfectibilité, la moralisation, l'idéal, l'utile en un mot, est une littérature rachitique et malsaine, née morte » ; cela dans la préface d'une pièce qui reprend un titre de Diderot, Le Fils naturel (1858). On discutait avec passion les argumentations de ses tirades bien enlevées, les paradoxes de ses mots à effet (« Les affaires, c'est l'argent des autres »). Seule échappe à l'oubli sa Dame aux camélias, transposée en mélodrame par le cinéma. Curel À la fin du XIXe siècle, le genre se ressent des critiques contre la société bourgeoise. Ce sont moins des valeurs que des intérêts que défend Le Repas du lion de François de Curel (1897). L'auteur, propriétaire d'un vaste domaine lorrain, apparenté à des maîtres de forges, ne simplifie pas un sujet qu'il connaît bien. Jean, rejeton d'une famille aristocratique qui désormais sur ses terres exploite une mine, veut réconcilier patrons et ouvriers grâce à la doctrine de l'Église. Situation fausse : Jean touche un fabuleux dividende (700 000 francs-or...). Et sa prédication inquiète son beau-frère, chef de l'entreprise. Invité par le syndicat à exposer ses idées, il développe non la doctrine d'Albert de Mun, mais un apologue : le repas du lion. Les ouvriers sont les chacals qui se nourrissent des restes du festin royal. Leur intérêt est de ne pas troubler le repas du fauve. Le chef syndicaliste réplique que les salariés ne ressemblent pas à des parasites ; ils sont ceux qui, par leur travail, créent la richesse du patron. Puis, le beau-frère ayant été assassiné, d'apôtre, Jean devient chef d'industrie. Il se trouve bientôt d'accord avec le ministre du Travail : la prospérité de la métallurgie permet d'octroyer de hauts salaires et de prévoir une participation aux bénéfices. Cette réflexion sur les rapports du capital et du travail intéresse encore, mais seulement dans la mesure où elle date. Les audaces de Curel paraissent timides. Le drame antibourgeois Bien avant la fin du siècle, un retournement s'était opéré, du drame bourgeois en drame antibourgeois. Après les pièces à thèse, volontiers non conformistes, de Dumas fils, le naturalisme accentue les tendances critiques du théâtre. La Parisienne d'Henry Becque (1885) est aussi cruelle qu'un conte de Maupassant. On préférera cependant Les Corbeaux (1882), œuvre de plus d'envergure. Becque y traite un drame socio-économique de son temps. Un industriel, à la tête d'une entreprise familiale, était peu à peu acculé à la faillite par la concentration capitaliste, lorsque subitement il meurt. Sa veuve, ses trois filles se débattent contre les hommes d'affaires qui profitent de leur ignorance. L'une d'elle se sacrifie ; elle épouse un « corbeau », vieil harpagon qui au moins protègera ces femmes. Pièce quelque peu désuète : le sujet suppose un état de la société où des femmes de la classe moyenne ne disposaient d'aucun moyen de gagner leur vie. Mais cette œuvre, d'un maître dramaturge, n'a rien perdu de son énergie qui fait penser à Balzac. Avec Les affaires sont les affaires d' Octave Mirbeau (1903), la critique sociale glisse au plan politique. Dans une ambiance révolutionnaire, le drame antibourgeois devient normalement drame prolétarien. Une continuité s'établit du Père de famille de Diderot à l'adaptation théâtrale de La Mère de Gorki (et à celle de Poudovkine au cinéma, en 1926). Les émotions familiales, les vertus d'une classe d'avenir sont virées au crédit du prolétariat. Mais des héros positifs, qui ne pouvaient apparaître dans le monde tout bourgeois d'un Henry Becque, d'un Octave Mirbeau, orientent désormais la critique vers une espérance révolutionnaire. Prolongements contemporains Anouilh D'autres prolongements sont discernables dans le théâtre du XXe siècle. Jean Anouilh fait défiler de grotesques figures dans la tradition du drame antibourgeois. Selon l'esprit du genre, la caricature fréquemment suggère ou dégage des idées. Le Voyageur sans bagages (1936) traite à ce niveau un sujet abordé sur un autre ton par Giraudoux (Siegfried, 1928) : l'amnésique de guerre à la recherche de son passé. Gaston, après dix-sept ans, retrouve la détestable famille bourgeoise qui fut la sienne. Il la repousse, se faisant accepter par un jeune Anglais qui, lui, a perdu tous ses parents. Illustration de « Familles ! je vous hais », à quoi aboutit, au siècle de la « mort du père », un genre dont la figure de proue avait été, à ses débuts, le « père de famille »... La Sauvage (1934), du même auteur, allait plus loin. Thérèse joue dans le minable orchestre de café que tiennent ses parents. Souillée, mais restée pure, elle est aimée de Florent, le grand pianiste. Il veut, en l'épousant, faire d'elle un être neuf ; pour préparer la mutation, il la transfère dans le milieu cossu de sa famille. Mais elle, la sauvage, se révolte. Elle fuit, restant fidèle au meilleur d'elle-même qu'elle sent lié à la misère incarnée dans son grotesque père, dans sa mère répugnante, dans son amoureux, le pitoyable Gosta, musicien sans talent, sans jeunesse, sans courage. Anouilh trouve ici l'occasion d'une de ses meilleures satires de la bourgeoisie, marquée par l'esprit « front populaire » de l'époque. Mais, par-delà, la révolte de la sauvage est située sur un plan où se devine la vieille entité métaphysique du Mal. C'est le bonheur de ceux qui n'ont jamais connu la vie humiliée qu'abomine cette Antigone de café-concert. Ainsi l'œuvre s'élève à une certaine qualité de tragique – de ce tragique que paradoxalement Jean Anouilh déprécie dans son Antigone (1944), lorsqu'il redéfinit l'opposition des genres : « C'est reposant, la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir, qu'on est pris [...] Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. » Thérèse, qui sait qu'elle est « prise », devient une héroïne tragique d'un drame bourgeois. Sartre Les pièces de J.-P. Sartre élèvent leurs débats à une autre hauteur que le théâtre d'idées du XIXe siècle. Ce n'est pas cependant diminuer ces œuvres que de marquer leur filiation. Elles restent dans la ligne du théâtre bourgeois antibourgeois, par la volonté de traiter des problèmes actuels (qui assez vite risquent de dater), comme par l'attention prêtée aux rapports sociaux des personnages. Les Séquestrés d'Altona (1960), de même que jadis le drame de Curel, met en scène une dynastie de hobereaux industriels pris dans le mouvement de l'histoire moderne – histoire qui prend la figure d'un destin, réduisant ces grands bourgeois aux données premières de la condition humaine. La pensée de Sartre élargit les horizons. Frantz interjette appel auprès du tribunal des siècles. Ici encore un certain tragique, plus manifeste, est atteint lorsque le héros constate : « Le témoin de l'homme, c'est l'homme. L'accusé témoigne pour lui-même... cercle vicieux. » L'histoire du drame bourgeois est dominée par la nostalgie de cette tragédie par rapport à laquelle il voulut, à l'origine, prendre ses distances. Genre des zones moyennes, il a laissé peu de grandes œuvres. Pour échapper aux lieux communs, il lui faut ou se renier ou se dépasser. Mais c'est là précisément ce qui fait sa valeur, et son importance historique. Il fut, et peut-être demeure-t-il encore, la matrice de tout un théâtre qui aspire à de plus exaltantes ambitions. René Pomeau Ainsi, Collé donne à l’auteur de Mélanide le surnom de « Cotin dramatique », et Piron plaisante les « homélies du révérend père La Chaussée », composant à son sujet plusieurs épigrammes qui resteront fameuses, dont celle-ci : « Connaissez-vous, sur l'Hélicon, L'une et l'autre Thalie ? L'une est chaussée et l'autre non, Mais c'est la plus jolie. L'une a le rire de Vénus, L'autre est froide et pincée : Salut à la belle aux pieds nus, Nargue de la chaussée. » (Alexis Piron, Épigrammes) Postérité littéraire « Souvent je bâille au tragique bourgeois, Aux vains efforts d’un auteur amphibie, Qui défigure et qui brave à la fois, Dans son jargon, Melpomène et Thalie. » Voltaire, Le Pauvre Diable Au-delà de leur intérêt dans l’histoire de la littérature, les pièces de La Chaussée sont aujourd’hui difficiles à lire et le seraient plus encore à représenter. Les personnages y sont très nombreux et insuffisamment caractérisés. La morale y est omniprésente et s'épanche en longues et ennuyeuses tirades. Le style, facile, parfois bien trouvé, est le plus souvent relâché et négligé. Œuvres Sablier a publié les Œuvres de Monsieur Nivelle de La Chaussée (Paris, Prault, 1762, 5 vol. in-12). Ont également été publiées des Œuvres choisies (Paris, 1813, 2 vol. in-18 ; 1825, in-18). Épître de Clio à M. de B*** au sujet des opinions répandues depuis peu contre la poésie, 1731 La Fausse Antipathie, comédie en 3 actes, en vers, 12 octobre 1733 Le Préjugé à la mode, comédie en 5 actes, en vers, 3 février 1735 L'École des amis, comédie en 5 actes, en vers, 26 février 1737 Maximien, tragédie, Paris, Comédie-Française, 28 février 1738 Mélanide, comédie en 5 actes, en vers, Paris, Comédie-Française, 12 mai 1741 Amour pour amour, comédie en 3 actes, en vers, avec un prologue, Paris, Comédie-Française, janvier 1742 Paméla, comédie en 5 actes, 1743 L'École des mères, comédie en 5 actes, en vers, 27 avril 1744 Le Rival de lui-même, comédie nouvelle en 1 acte, en vers, précédée d’un prologue, avec des divertissements, Paris, Comédie-Française, 20 avril 1746 La Gouvernante, Paris, Comédie-Française, 18 janvier 1747 L'Amour castillan, comédie en 3 actes, en vers, avec un divertissement, Paris, Théâtre-Italien, 11 avril 1747 L'École de la jeunesse, comédie en 5 actes, 1749 Élise ou la Rancune officieuse, comédie en un acte, 1750 Le Retour imprévu, comédie en 3 actes, Paris, Théâtre-Italien, 1756 Le Vieillard amoureux, comédie en 3 actes, non représentée, du moins par un théâtre de Paris L'Homme de fortune, comédie en 5 actes, non représentée Les Tyrinthiens, comédie en 3 actes, non représentée La Princesse de Sidon, tragi-comédie en 3 actes, non représentée Le Rapatriage, comi-parade en 1 acte, œuvre grivoise Contes en vers, œuvre grivoise  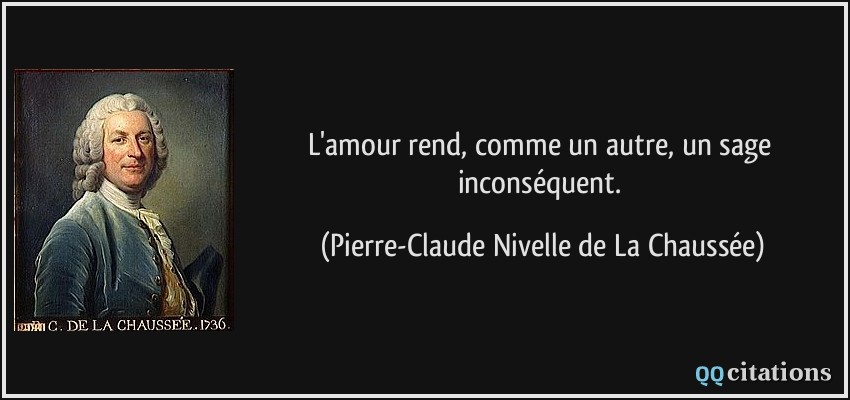    
#52
Claude-Prosper Jolyot de Crébillon
Loriane
Posté le : 13/02/2016 19:08
Le 14 février 1707 naît Claude-Prosper Jolyot de Crébillon
dit Crébillon fils, né à Paris le 14 février 1707 et mort dans la même ville le 12 avril 1777, écrivain, chansonnier et goguettier français, auteur de Romans épistolaires, Roman libertins, Romans à clef, Romans-mémoires Sa vie Claude-Prosper Jolyot de Crébillon est dit Crébillon fils pour le distinguer de son père Prosper Jolyot de Crébillon, Crébillon père, célèbre auteur dramatique, membre de l'Académie française. Les deux hommes étaient fort différents : alors que le père écrivait de sombres tragédies, le fils se spécialisa dans les contes et romans licencieux ; le père était un géant au large torse et à la figure rubiconde, tandis que le fils, selon son ami Louis-Sébastien Mercier tableau de Paris « était taillé en peuplier, haut, long, menu » Claude Prosper fait ses études chez les Jésuites du Collège de Louis-le-Grand. Le supérieur du collège, le R. P. Tournemine, tente vainement de l'attirer dans cet ordre. Dès 1729, il collabore à un recueil satirique, l’Académie de ces Messieurs et à quelques pièces et parodies d'opéras : Arlequin, toujours Arlequin, Le Sultan poli par l'amour, L'Amour à la mode, etc. Toujours en 1729, Crébillon fils est parmi les fondateurs de la célèbre goguette du Caveau. Il y rencontre notamment le peintre François Boucher, le musicien Jean-Philippe Rameau et d'autres encore. Il y retrouve son père. Il participe également aux activités de la société chantante de la Dominicale. Son premier conte, approuvé par la censure, Le Sylphe, est publié en 1730 et connaît un succès public. En 1732, Crébillon publie les Lettres de la marquise de M. au comte de R., une monodie épistolaire. En 1734, il publie Tanzaï et Néadarné, un conte licencieux qui remporte un vif succès mais dans lequel certains voient une satire de la bulle Unigenitus, du cardinal de Rohan et de la duchesse du Maine1. L'auteur est emprisonné quelques semaines à la prison de Vincennes. La duchesse du Maine a l'esprit non seulement de l'en tirer mais de l'admettre à Sceaux, ce qui lui ouvre les portes des salons parisiens. Il fréquente ceux de Mme de Sainte-Maure, où il rencontre celle qui deviendra sa maîtresse puis sa femme, Marie Henriette de Stafford, et de Mme de Margy, qui est longtemps sa maîtresse et sert de modèle à la marquise de Lursay dans Les Égarements du cœur et de l'esprit. Jusqu'en 1743, il est également un habitué des lundi de Mlle Quinault où il rencontre Marivaux et Mme de Graffigny. Dès cette époque, il écrit avec réticence, révisant sans cesse ses ouvrages, hésitant à publier. Sa parole était lente et sa conversation conventionnelle et sans charme, hors quelques rares fulgurances. D'ailleurs, Mlle de Beauvoisin, citée dans les prétendus Souvenirs de la marquise de Créqui, l'interpelle en ces termes peu amènes : « Pédant, vilain pédant, tu es si pédant, si sérieux, si sec, si gourmé, si composé, si empesé et si ennuyeux, que je ne veux pas que tu viennes souper avec moi chez Monticour. Les demoiselles Avrillet ont dit à Collé que tu n'avais pas trouvé autre chose à leur dire que j'ai l'honneur de vous présenter mon très-humble hommage, ou bien mes devoirs les plus respectueux, pour changer. Va donc ! tu n'es qu'un manche à balai galonné ! tu ne fais pas autre chose que des révérences à la vieille mode, etc. » En 1736, il publie Les Égarements du cœur et de l'esprit ou Mémoires de M. de Meilcour, roman dont l'un des protagonistes, M. de Versac, annonce le Valmont des Liaisons dangereuses. Une épigramme de Crébillon fils contre son père ne concourt pas peu à dissoudre la Société du Caveau qui disparaîtra en 1739. Un jour, alors qu'on lui demande quel était le meilleur de ses ouvrages, Crébillon père élude la question en montrant son fils et en déclarant : « Voici en tout cas le plus mauvais ! » À quoi Crébillon fils aurait répondu : « Pas tant d'orgueil, s'il vous plaît, monsieur, attendez qu'il soit décidé que tous ces ouvrages sont de vous. » Allusion à un ami qui aurait serré de près Mme de Crébillon. Une autre version dit qu'il aurait répliqué à son père : « C'est parce qu'il ne doit rien au Chartreux », une calomnie attribuant à l'époque les ouvrages de Crébillon père à un chartreux. La société ordonne en punition le verre d'eau pour tous deux. Crébillon fils boit le sien. Mais son père, fâché, quitte brusquement la société et depuis ce moment, rien ne peut le déterminer à y retourner. Après la publication du Sopha (1742), Crébillon fils est exilé à 30 lieues de Paris le 7 avril 1742. On lui reproche officiellement quelques audaces morales – certains croient reconnaître Louis XV dans le personnage ridicule et amusant du sultan Schah-Baham – mais son tort est surtout de laisser circuler ce conte pendant la période d'interdiction des romans. Il parvient à rentrer dans la capitale le 22 juillet en faisant valoir pour sa défense que l'ouvrage aurait été commandé par Frédéric II de Prusse et n'aurait été publié qu'à la suite d'une indiscrétion et contre sa volonté. Il récidive en 1746 avec Les Amours de Zeokinisul, roi des Kofirans2, dans lequel l'allusion au roi est transparente. Ce roman paraît sous le pseudonyme de Krinelbol. En 1744, il a une liaison avec Marie Henriette de Stafford, fille de Jean de Stafford, chambellan de Jacques II d'Angleterre, jeune fille de haute naissance, douce, dévote, mais aussi, selon Charles Collé (Journal, janvier 1750), « louche et d'une laideur choquante ». Il l'épouse à Arcueil le 23 avril 1748, après la naissance d'un fils en 1746. Il se montre un époux irréprochable, d'une parfaite fidélité. Son fils meurt en 1750, et il connaît au même moment des difficultés financières. Il obtient en 1753 une pension de 2 000 livres et un appartement de la part du duc d'Orléans qui devient en quelque sorte son mécène. Sa femme décède en 1755 et il n'hérite rien d'elle : ruiné, il est obligé de vendre sa bibliothèque. En 1758, il devient secrétaire du marquis de Richelieu pendant quelques semaines. À partir de 1759, il participe à la renaissance de la goguette du Caveau, deuxième du nom. En 1759, grâce à la protection de Madame de Pompadour, Crébillon est nommé censeur royal de la Librairie, fonctions que son père (qui meurt en 1762) avait également occupées et qu'il exerce honorablement, sort ironique pour un auteur libertin. En 1762, Madame de Pompadour lui accorde une pension de 2 000 livres sur sa cassette personnelle. En 1768 il publie les Lettres de la Duchesse, roman épistolaire qui ne rencontre pas de succès en France. Après la publication en 1771 des Lettres athéniennes, roman épistolaire polyphonique, libertin et politique, il cesse d'écrire, estimant qu'il a « perdu le fil de son siècle ». En 1772, de son vivant, une collection complète en sept volumes de ses œuvres est publiée, signe de sa reconnaissance en tant qu'écrivain. En 1774 il devient censeur de théâtre, pendant deux ans. Il meurt à Paris le 12 avril 1777 et La Place compose pour lui cette épitaphe : Dans ce tombeau gît Crébillon. Qui ? Le fameux tragique ? Non ! Celui qui le mieux peignit l'âme Du petit-maître et de la femme. Œuvres Postérité littéraire Les romans et les contes de Crébillon fils ont longtemps été décriés pour leur immoralité et pour un style souvent jugé languissant et obscur. Pourtant, on pense qu'Alfred de Musset se serait inspiré, dans Un Caprice, du Hasard du coin du feu, et Henri Heine confiait : « Avant d'écrire, j'ai relu Rabelais et Crébillon fils. » L'œuvre de Crébillon fils a été considérablement réévaluée au xxe siècle. Kléber Haedens affirme que « si l'on estime que la littérature licencieuse est plus divertissante que beaucoup d'autres et si l'on constate que Crébillon écrit dans une très bonne langue, qu'il est spirituel et fin, on ne peut s'empêcher de ranger ses contes parmi les œuvres les plus agréables du xviiie siècle. »3 Crébillon fils peint avec brio le relâchement des mœurs de son temps. Cynique, il ne croit ni à la vertu, ni à l'amour et leur préfère le plaisir : « il est rare qu'une jolie femme soit prude, ou qu'une prude soit jolie femme, ce qui la condamne à se tenir justement à cette vertu que personne n'ose attaquer et qui est sans cesse chagrine du repos dans lequel on la laisse languir. » (Le Sylphe) « Jadis [...] était grave, froid, contraint, et avait toute la mine de traiter l'amour avec cette dignité de sentiments, cette scrupuleuse délicatesse qui sont aujourd'hui si ridicules, et qui peut-être ont toujours été plus ennuyeuses encore que respectables. » Le Sopha Il est le peintre du libertinage, d'un monde d'hypocrisie, de duperie et de perfidie où perce à l'occasion un sentiment d'insatisfaction : « Nous voulons satisfaire notre vanité, faire sans cesse parler de nous ; passer de femme en femme ; pour n'en pas manquer une, courir après les conquêtes, même les plus méprisables : plus vains d'en avoir eu un certain nombre, que de n'en posséder qu'une digne de plaire ; les chercher sans cesse, et ne les aimer jamais. Le Sopha Liste chronologique Le Sylphe ou Songe de Madame de R***. Écrit par elle-même à Madame de S***, conte, 1730 Lettres de la marquise de M*** au comte de R***, roman épistolaire à une voix, 1732 Tanzaï et Néadarné (appelé quelquefois, à tort, L'Écumoire, histoire japonaise, 1734 Les Égarements du cœur et de l'esprit ou Mémoires de M. de Meilcour, roman-mémoires, 1736-1738 Le Sopha, conte moral, 1742 texte intégral sur la base Gallica Le dialogue des morts, 1745 Les amours de Zéokinisul, roi des Kofirans, 1746 attribution discutée Ah quel conte ! Conte politique et astronomique, 1754 Les Heureux Orphelins, histoire imitée de l'anglais, 1754 La Nuit et le moment ou les matines de Cythère : dialogue, 1757 Le Hasard du coin du feu. Dialogue moral, 1763 texte intégral sur la base Gallica Lettres de la Duchesse de *** au duc de ***, roman épistolaire à une voix, 1768 Lettres athéniennes. Extraites du porte-feuille d'Alcibiade, 1771 Éditions modernes Œuvres complètes, dir. Jean Sgard, 4 vol., Paris, Classiques Garnier, 1999-2002. Contes, édition intégrale des contes sous la direction de Régine Jomand-Baudry, avec la collaboration de Véronique Costa et Violaine Géraud. 1 vol., 1104 p., Éditions Honoré Champion, 2009. Il existe également des éditions partielles : Les plus belles pages de Crébillon fils, éd. J. Amoyal, Mercure de France, 1964 Œuvres, éd. Ernest Sturm et S. Pujol, Bourin, 1992 Enfin, il existe de nombreuses éditions d'ouvrages séparés : Les Heureux Orphelins 1754, Paris, Desjonquères, 1995 Lettres de la marquise de M*** au comte de R*** 1732 édition R. Henriot, Cercle du livre précieux, 1959 édition J. Rousset, Lausanne, 1965 édition Ernest Sturm et L. Picard, Nizet, 1970 édition Jean Dagen, Desjonquères, 1990 Les Égarements du cœur et de l'esprit ou Mémoires de M. de Meilcour 1736-1738 édition René Étiemble, in : Romanciers du xviiie siècle, vol. 2, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1965 édition Jean Dagen, Paris, Flammarion, 1985 Tanzaï et Néadarné 1734, éd. E. Sturm et M.C. Hubert, Nizet, 1976 Le Sopha 1742 édition Albert-Marie Schmidt, Union générale d'éditions, 1966 édition Jean Sgard, Desjonquères, 1984 La Nuit et le moment suivi de Le Hasard du coin du feu édition H. Coulet, Desjonquères, 1983 édition Jean Dagen, Paris, Garnier-Flammarion, 1993 et 1995 Tableau des mœurs dans les différents âges de la vie, Euredif, 1978 Version radiophonique 1965 : La Nuit et le Moment, adaptation radiophonique de Roger Pillaudin, avec les voix de Micheline Presle, Bernard Lavalette, Jean Vilar et Laurence Badie sur le site de FranceCulture. Adaptation cinématographique[modifier | modifier le code] 1995 : La Nuit et le MomenT The Night and the Moment), d'après sa pièce éponyme ; film de Anna Maria Tatò, coécrit par Jean-Claude Carrière, avec Lena Olin, Willem Dafoe et Jean-Claude Carrière CRÉBILLON PROSPER 1674-1767 & CLAUDE PROSPER 1707-1777 « Jamais la nature ne fit deux êtres plus voisins et plus dissemblables. » Le jugement est tranché, que Louis Sébastien Mercier, dans le Tableau de Paris, porte sur les deux Crébillon, père et fils, à la veille de la Révolution. Le premier aurait traité son fils du « plus mauvais de ses ouvrages » et le second confié à Mercier qu'il n'avait jamais pu achever la lecture des tragédies de son père. C'est que l'auteur tragique relève encore de l'esthétique classique, alors que le romancier choisit un genre libre où s'expérimentait un renouvellement de la littérature. Longtemps, on admira le grand Crébillon qui formait un quatuor avec Corneille, Racine et Voltaire, reléguant le fils dans les marges des Belles-Lettres, du côté des polissonneries et des livres dont on n'avoue qu'à mi-voix être l'auteur ou le lecteur. Le renversement de perspective est aujourd'hui accompli : plus personne ne lit ni ne joue le théâtre de celui qui est devenu Crébillon le père, tandis que l'auteur des Égarements du cœur et de l'esprit s'impose comme un des grands romanciers de son siècle et que ses dialogues sont de plus en plus fréquemment portés à la scène. Crébillon père : le goût du tragique Prosper Jolyot de Crébillon fut le grand rival de Voltaire : il triomphe avec quinze ans d'avance. Idoménée est applaudi en 1703, l'Œdipe de celui qui se met alors à signer Voltaire le sera en 1718. Si Voltaire entend renouveler le théâtre classique par la philosophie des Lumières, Crébillon prétend au même but en noircissant les sujets et en explorant les ressources de l'horreur. Atrée et Thyeste (1707) expose l'affreuse vengeance qu'Atrée tire de son frère Thyeste qui a séduit sa femme. Il sait que son fils est en fait celui de son frère. Après avoir poussé le jeune homme à frapper son père, il tue finalement le fils pour faire boire son sang à Thyeste qui n'a plus qu'à se suicider. Parricide, infanticide, fratricide, inceste, Crébillon charge à plaisir l'intrigue, aux limites de ce que peut clairement exprimer le français classique. Exclamations et interjections, apostrophes et invocations des dieux rythment le suspens tragique et décomposent l'alexandrin. Dans cette pièce, Crébillon a fixé son style. Électre (1708), Rhadamiste et Zénobie (1711), Sémiramis (1715), Pyrrhus (1726) et Catilina (1748) exploitent le même filon de haines familiales inexpiables qui conduisent à des violences consommées sur la scène. Rhadamiste tue son épouse et le père de celle-ci, il ne la retrouve pas moins, dix ans plus tard, bien vivante et il est frappé lui-même par un vengeur qui se révèle être son père. Passions et vengeances personnelles empêchent les enjeux politiques de transformer ces pièces en drames historiques, mais leurs outrances rappellent parfois en deçà des bienséances classiques le tragique antique ou élisabéthain. Le public français accueillit bien les pièces de Crébillon qui fut reçu à l'Académie française en 1731, mais, mal habitué à la présence directe de l'horreur, il s'en détourna bientôt. Ce théâtre n'est plus aujourd'hui qu'un objet de curiosité érudite. Crébillon fils, entre sensualisme et orientalisme « Si jamais le public honore mes faibles talents d'un peu d'estime, si la postérité, en parlant de vous, peut se souvenir que j'ai existé... » Les termes par lesquels le fils dédie à son père Les Égarements du cœur et de l'esprit étaient-ils ironiques ? Après avoir appris la rhétorique chez les jésuites de Louis-le-Grand et la vie chez les épicuriens, Claude Prosper donne, en 1730 son premier ouvrage, Le Sylphe, un conte qui substitue aux évanescences platoniciennes des réalités bien matérielles. En 1732, c'est le lamento féminin des Lettres de la marquise de M*** au comte de R***. Deux ans encore plus tard, L'Écumoire, ou Tanzaï et Néadarné, histoire japonaise joue trop lestement des décalages entre le mariage et le désir, et ne ménage pas les allusions à l'actualité. Une lettre de cachet expédiera l'auteur cinq jours à Vincennes. Viennent ensuite Les Égarements du cœur et de l'esprit, publiés en deux temps en 1736 et 1738, Le Sopha (1742), nouveau conte de fées pseudo-oriental qui vaut cette fois au romancier un exil de trois mois hors de la capitale, Les Heureux Orphelins et Ah quel conte ! en 1754, puis deux dialogues rédigés quelques années plus tôt, La Nuit et le Moment en 1755 et Le Hasard au coin du feu en 1763, enfin Les Lettres de la duchesse (1768) et les Lettres athéniennes (1771). À la fin de sa vie, Crébillon a le plaisir de voir une collection de ses œuvres publiée en sept volumes et de bénéficier comme son père d'une charge de censeur, transformée en pension sur le Mercure. Contes orientaux ou bien évocations de la société française contemporaine, recueils épistolaires, Mémoires à la première personne ou bien dialogues, les romans de Crébillon sont marqués par une profonde unité. Héritiers à la fois de l'analyse classique, qui applique à la connaissance du cœur la rigueur de la méthode cartésienne, et de la nouvelle philosophie sensualiste, qui place les réalités physiques et sensorielles à la base de toutes les manifestations sentimentales aussi bien qu'intellectuelles, ils décrivent une humanité soumise à l'inconstance du désir, aux exigences de l'amour-propre et aux subtilités du langage. La Princesse de Clèves célébrait la victoire de la raison sur l'amour, les fictions de Crébillon constatent la victoire de l'amour sur le devoir, du désir sur l'amour et souvent même de la vanité sur le désir. « Je ne veux pas aimer » : l'affirmation de la marquise de M*** dans la première de ses lettres ne résiste pas longtemps aux sollicitations du comte de R***. Le roman nous offre les seules missives de la marquise, disjointes des réponses de l'amant. « On assiste à un duo dont on n'entend qu'une voix » (Jean Rousset). Le lecteur est donc invité à reconstituer la part manquante du drame : le discours de l'homme à bonnes fortunes qui profite des infortunes conjugales de la marquise sans être capable de comprendre la passion qu'elle lui voue, encore moins d'y répondre. La différence de statut formel entre les deux épistoliers figure le déséquilibre psychologique et social entre deux partenaires auxquels les lois du monde n'accordent pas les mêmes droits : à l'homme les facilités du libertinage, à la femme le sombre bonheur d'une passion sans répondant. Dans ces pages qu'on a dites stendhaliennes, « l'émotion, selon la formule de Jean Dagen, coexiste avec la perception de l'artifice qui devrait l'abolir ». Les illusions dont se berce la marquise disent le besoin d'amour et l'impossibilité de le trouver dans les tourbillons de « la bonne compagnie ». Les Égarements du cœur et de l'esprit donnent la parole à un homme qui raconte sa vie ou, plus exactement, son entrée dans le monde et sa découverte des codes de la mondanité. Le récit se déroule en quinze jours, qui transforment un jeune naïf en un futur roué. Les sollicitations discrètes d'une femme qui a déjà vécu et qui pourrait être sa mère, les conseils cyniques d'un ami, Versac, passé maître dans l'art d'en imposer aux autres, ont bientôt raison de sa timidité. Il nourrit un chaste sentiment pour une jeune fille et découvre parallèlement que l'amour dans la société n'est qu'« une sorte de commerce où l'on s'engage souvent même sans goût, où la commodité est toujours préférée à la sympathie, l'intérêt au plaisir et le vice au sentiment ». Les grands mots risquent de n'être que le masque du libertinage, l'amour existe pourtant, et c'est parfois à travers les artifices et les illusions du langage qu'il s'insinue. Les Égarements s'achèvent par le dépucelage du jeune homme, ou plutôt restent inachevés : saura-t-il dépasser le vertige de la séduction pour accéder à la vérité d'un amour durable ? Le texte laisse la question en suspens. La Préface promettait de nous montrer le héros « rendu à lui-même, devoir toutes ses vertus à une femme estimable » et ajoutait : « Voilà quel est l'objet des Égarements. » Force est d'avouer que cet objet est manqué ou, du moins, qu'il manque au lecteur, ironiquement renvoyé à ses incertitudes. L'inachèvement du roman, comme celui du Paysan parvenu et de La Vie de Marianne de Marivaux, désigne un risque d'aporie. L'Écumoire narrait les aventures de Tanzaï, prince de Chéchian, qui découvrait au soir de ses noces qu'il avait « une écumoire attachée où Néadarné, son épouse, avait dû croire trouver moins, et mieux » et traversait, pour se désenchanter, « un labyrinthe qui n'est autre que celui du Désir », tel que le désigne la psychanalyse (Ernest Sturm). Le narrateur du roman de 1742, quant à lui, pour punition de sa frivolité, est tout entier transformé en sopha avec la promesse d'être délivré dès qu'un homme et une femme se consacreront, sur son dos, leurs prémices. Il est donc condamné à subir des étreintes insincères, des faux-semblants et des hypocrisies, à expérimenter les défaillances du corps masculin, pour finalement comprendre que, si les êtres humains sont faibles, l'amour est néanmoins leur seule promesse de bonheur. Crébillon propose du libertinage à la fois une condamnation motivée et un constat précis jusqu'à la complaisance. La description amusée des infidélités n'est compensée que par l'espoir fragile d'un nouvel équilibre amoureux. Les deux dialogues de La Nuit et le Moment et du Hasard au coin du feu écartent tout commentaire pour se livrer au seul scintillement du duel verbal, de la négociation qui a lieu entre deux consciences et deux désirs. Au-delà de la sincérité et du mensonge, le langage s'y affirme comme illusion et vérité comme dans le théâtre de Marivaux. Le moment caractérise l'instant où les volontés cèdent, où les arguments se défont, où la chair s'impose. Crébillon lègue ainsi à tout son siècle un vocabulaire et un style, capables de saisir les nuances et les gradations du cœur, à mi-chemin entre cynisme et moralisme. La leçon qui se dégage de ses œuvres est que l'amour peut être enfin délivré, sinon « de la boue du ciel », comme le voudra René Char, du moins de tous les obscurantismes. Il n'est de morale que fondée sur la connaissance du corps et de la sexualité, du cœur et de ses complications. Alors la profondeur et la permanence d'un sentiment restent possibles, à travers les intermittences du corps, dans le miroitement des illusions du cœur et de l'esprit. Michel Delon      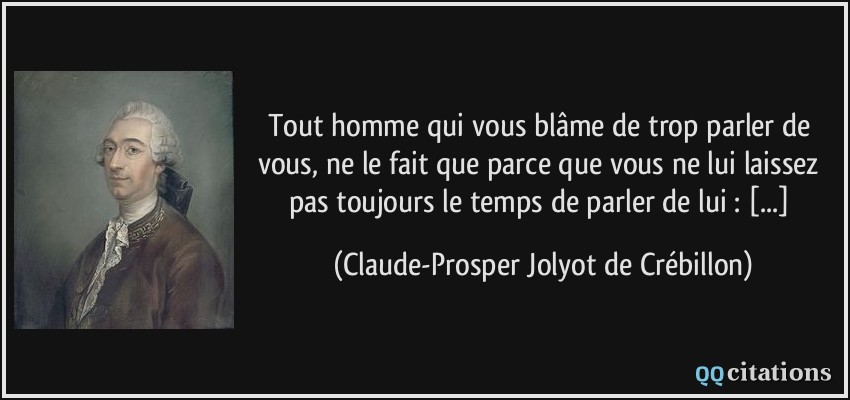   
#53
Edmond François Valentin About
Loriane
Posté le : 13/02/2016 18:51
Le 14 février 1828 naît Edmond François Valentin About
à Dieuze Moselle et mort, à 56 ans le 16 janvier 1885 à Paris, écrivain, journaliste et critique d'art français, membre de l’Académie française. Romancier, essayiste et surtout publiciste, Edmond About fait un séjour à l'École française d'Athènes à sa sortie de l'École normale supérieure. À son retour, il fait paraître La Grèce contemporaine 1855, une satire peu complaisante du régime de ce pays, et un roman, Talla, qui lui donne une rapide renommée : on l'accuse en effet de plagiat. Il tente alors sa chance au théâtre, sans grand succès, avant de revenir au roman. Les Mariages de Paris 1856, Le Roi des montagnes (1857), L'Homme à l'oreille cassée 1862, Le Nez d'un notaire 1862, œuvres d'accès assez facile, obtiennent une réussite populaire notable et sont encore lues aujourd'hui. Ce sont, autour d'une intrigue simple qui ménage quelques effets de suspense, de longues narrations où un auteur, qui a vraiment le goût d'écrire et une grande facilité, décrit ce qui lui plaît et ce qui plaira. Ce style clair et aisé le conduit naturellement au journalisme. Il est d'abord bonapartiste : son esprit frondeur s'adapte parfaitement au régime de l'empereur et, malgré le profond anticléricalisme qu'il manifeste par ailleurs et qui sera la seule constante de son existence, il se maintient toujours dans les faveurs des puissants. Sa seule impertinence sera un essai publié en 1861, La Question romaine, mais il y condamne tout pouvoir temporel à partir de l'exemple de la Rome antique, et les critiques du pouvoir politique contemporain deviennent ainsi tellement générales et imprécises que l'on ne peut lui en tenir rigueur. Républicain en 1870, il trouve meilleur emploi de son talent anticlérical, et c'est la grande époque pendant laquelle il ne cesse d'écrire dans Le Figaro, Le Gaulois, ou Le Moniteur. On l'a souvent comparé à Voltaire, pour le style et l'esprit, pour le talent de conteur aussi ; cependant les interventions d'Edmond About, pour libérales qu'elles aient été, ne nous sont pas parvenues comme vraiment originales. Ce clerc, élu à l'Académie française en 1884, écrivait un peu son autobiographie dans Le Roman d'un brave homme 1880 ; agile homme de lettres, il n'eut pas une pensée de la qualité de son écriture. Antoine Compagnon Fils d'épicier, il fait ses études au petit séminaire, puis entre au lycée Charlemagne où il devient un élève brillant et remporte le prix d'honneur de philosophie au Concours général. Il entre ensuite à l'École normale supérieure en 1848 et est reçu premier à l'agrégation de lettres de 1851 Il est nommé en 1851 membre de l'École française d'Athènes et séjourne deux ans en Grèce en compagnie de l'architecte Charles Garnier et du peintre Paul-Alfred de Curzon. Il séjourne en Égypte en 1867-1868. Il participe aussi au voyage inaugural de l'Orient-Express en 1883. Agacé par les outrances du philhellénisme alors à la mode et marqué par le mishellénisme de ses maîtres du petit séminaire, il tire de chacun de ses voyages des ouvrages satiriques marquants. La Grèce contemporaine 1854 remporte un grand succès tout en insistant sur l'écart entre le mythe grec fondé sur l'Antiquité et la réalité contemporaine. Le Roi des montagnes ridiculise le mythe romantique du pallikare, guerrier-bandit héros de la guerre d'indépendance grecque. Le Fellah décrit comment un paysan égyptien élevé en Europe devient une personnalité dans son pays et finit par épouser une Anglaise, fascinée par l'exotisme. De Pontoise à Stamboul parodie le célèbre Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand Edmond About est également un critique d'art acerbe, très disposé à railler les peintres d'avant-garde. Ses comptes rendus de Salon en 1855 et 1857, d'une savoureuse verve comique, éreintent notamment les prétentions du réalisme de Gustave Courbet et appellent à la prudence face à ce qu'il considère comme une brèche ouverte à l'anarchie dans l'art. Favorable au Second Empire, ce qui lui vaut les railleries du jeune Clemenceau, et violemment anticlérical, il se fait connaître comme polémiste. En 1871, il rallie la Troisième République et soutient la politique de Thiers. Il fonda alors Le xixe siècle dont il devient rédacteur en chef3. En 1881, il s'installe avec sa famille au château de Grouchy à Osny dans le Val-d'Oise. Franc-maçon, il est initié le 7 mars 1862 à la loge Saint-Jean de Jérusalem, Orient de Nancy. Franc-maçon du Grand Orient de France, dans le journal Le Siècle, il publie plusieurs articles hostiles aux hauts grades maçonniques, position courante dans la gauche républicaine Élu le 24 janvier 1884 membre de l’Académie française, il meurt moins d’un an plus tard, peu de temps avant le jour prévu pour sa réception, à l’âge de cinquante-six ans. Son discours de réception était déjà imprimé. Edmond About est aussi un auteur comique tant il sait manier la satire. Il connaît la célébrité grâce à ses nouvelles au style vif, clair et concis, et à ses romans qui évoquent des situations imaginaires, souvent inspirées par les progrès de la science. Mariages de Paris (856, Le Roi des montagnes 1857, L'Homme à l'oreille cassée 1862 ou Les Mariages de province (1868) sont autant de succès d'édition. Avec Francisque Sarcey et Henry Bauër, il possède en 1880 une des premières villas de la station balnéaire de Malo-les-Bains à l'est de Dunkerque. Une avenue porte son nom. Sa tombe au cimetière du Père-Lachaise est ornée d’une statue réalisée par le sculpteur Gustave Crauk qu'il avait apprécié dans ses commentaires du salon de 1857. Liste des œuvres Edmond About, ca.1880 Tolla 1855 La Grèce contemporaine 1855 Les Mariages de Paris 1856 Dont Les Jumeaux de l'hôtel Corneille, L'Oncle et le Neveu, Terrains à vendre, Le Buste,Gorgeon et La Mère de la Marquise . Le Roi des montagnes 1857 Germaine livre 1857 : Gallica - Projet Gutenberg Maître Pierre 1858 Trente et Quarante. Sans dot. Les parents de Bernard 1859 La Question romaine 1859 L'Empereur Napoléon III et la Prusse 1860 La Nouvelle Carte d'Europe 15 avril 1860 Rome contemporaine 1861 Ces Coquins d'agents de change Lettre à M. Keller 1861 Le Cas de M. Guérin 1862 L'Homme à l'oreille cassée livre 1862 : Gallica 2e édition, fichier pdf image - Projet Gutenberg e-books- Le Nez d'un notaire 1862 Théâtre impossible. Guillery. L'Assassin. L'Éducation d'un prince. Le Chapeau de Sainte Catherine 1862 Dernières Lettres d'un bon jeune homme à sa cousine Madeleine 1863 Madelon 2 volumes, 1863 Le Progrès 1864 Les Questions d'argent : les assurances 1865 Causeries, première et deuxième séries 1865-1866 La Vieille Roche. Le mari imprévu. Les vacances de la comtesse. Le marquis de Lanrose 3 volumes, 1865-1866 Le Turco. Le bal des artistes. Le poivre. L'ouverture au château. Tout Paris. La chambre d'ami. Chasse allemande. L'inspection générale. Les cinq perles 1866 L'Infâme 1867 ABC du travailleur 1868 Les Mariages de province. La fille du chanoine. Mainfroi. L'album du régiment. Étienne 1868 Le Fellah T Le Roman d'un brave homme 1880 De Pontoise à Stamboul. Le grain de plomb. Dans les ruines. Les œufs de Pâques. Le jardin de mon grand'père. Au petit Trianon. Quatre discours 1884 Nouvelles et souvenirs 1885 Le Dix 1892 Théâtre Guillery, comédie en 3 actes, en prose, Paris, Théâtre-Français, 1er février 1856 Risette : ou les Millions de la mansarde, vaudeville en 1 acte, Paris, théâtre du Gymnase, 8 août 1859 Le Capitaine Bitterlin, comédie en 1 acte, en prose, Paris, théâtre du Gymnase-Dramatique, 27 octobre 1860 Un mariage de Paris, comédie en 3 actes, avec Émile de Najac, Paris, théâtre du Vaudeville, 5 juillet 1861 Gaëtana, drame en 5 actes en prose, Paris, théâtre de l'Odéon, 3 janvier 1862 Nos gens, comédie en 1 acte, avec Émile de Najac, Paris, théâtre du Gymnase, 23 août 1866 Histoire ancienne, comédie en 1 acte, avec Émile de Najac, Paris, Théâtre-Français, 31 octobre 1868 Retiré des affaires, comédie en 2 actes, avec Émile de Najac, Paris, théâtre du Vaudeville, 11 octobre 1869 L'Assassin, comédie en un acte, Paris, théâtre du Gymnase-Dramatique, 29 septembre 1882 Critique d'art Voyage à travers l'Exposition des beaux-arts peinture et sculpture 1855 Nos artistes au Salon de 1857 1858 Salon de 1864 1864 Salon de 1866 1867 Le Salon de 1868 868 Salon de 1869 1869 Peintures décoratives exécutées pour le foyer public de l'Opéra par Paul Baudry 1874 Le Décaméron du Salon de peinture pour l'année 1881 1881 Quinze journées au Salon de peinture et de sculpture année 1883 1883 La Prusse en 1860 est une parfaite illustration de l'opinion favorable qu'Edmond About avait de l'Empire et de Napoléon III. Elle se manifeste en particulier par une germanophilie appuyée, qui se précise en austrophobie (État organisateur du traité de Vienne, clérical et en prussophilie État plus ouvert, dynamique. Ces opinions reflètent la politique menée par Napoléon III, qui se solda par un échec : Woerth, Gravelotte et Sedan modifièrent complètement dans l'opinion française l'image du Prussien. Postérité Tombe d'Edmond About au cimetière du Père-Lachaise. Sculpture de Gustave Crauk. Une rue de Paris porte son nom, ainsi qu'une rue à Dieuze 57, à Metz 57, à Malo-les-Bains 59, à Nancy 54, à Saverne 67, au Havre 76, à Limoges 87, à Grenoble 38. Saverne : La villa qu'il a habitée porte également son nom, qui figure aussi sur une plaque située en bordure de forêt.      
#54
Censure de l'encyclopédie
Loriane
Posté le : 06/02/2016 22:56
Le 7 février 1752 : L'Encyclopédie est censurée
Le 7 février Un arrêté du conseil du roi Louis XV interdit l'impression et la diffusion des deux premiers volumes de "L'Encyclopédie" ou "Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers". L'œuvre collective dirigée par Denis Diderot et d'Alembert est jugée subversive par les Jésuites qui la qualifie "d'athée et matérialiste". Le contenu politique et philosophique, plus que les parties techniques et scientifiques, est décrié. Les thèses développées par l'abbé de Prades, un des contributeurs de l'Encyclopédie, sont, selon les membres du conseil, "contaminées par l'esprit voltairien" Un arrêté du conseil de Louis XV interdit l'impression et la diffusion des deux premiers volumes de "L'Encyclopédie " ou "Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Elle est jugée subversive par les Jésuites qui la qualifie "d'athée et matérialiste". 7 février 1752 : L'Encyclopédie est censurée Monseigneur de Beaumont, fait interdire l'impression et la diffusion des deux premiers volumes de "L'Encyclopédie" ou "Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers". L'œuvre collective dirigée par Diderot et D'Alembert est jugée subversive par les Jésuites qui la qualifie "d'athée et matérialiste". Le contenu politique et philosophique, plus que les parties techniques et scientifiques, est décrié. Les thèses développées par l'abbé de Prades, un des contributeurs de l'Encyclopédie, sont, selon les membres du conseil, "contaminées par l'esprit voltairien". Les jésuites en voulaient d'abord à Diderot qui avait refusé leur collaboration à l'ouvrage, mais surtout ils ne lui pardonnaient pas de faire concurrence à un dictionnaire qu'ils venaient eux-mêmes de faire paraître. « Quels ennemis nous avons, soupirait Diderot, qu'ils sont constants ! Qu'ils sont méchants ! » Denis DIDEROT 5 octobre 1713 - 31 juillet 1784 Jean le Rond D'Alembert L'Encyclopédie L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est une encyclopédie française, éditée de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et D’Alembert. L’Encyclopédie est un ouvrage majeur du XVIIIe siècle et la première encyclopédie française. Par la synthèse des connaissances du temps qu’elle contient, elle représente un travail rédactionnel et éditorial considérable pour l’époque, mené par des encyclopédistes constitués en société de gens de lettres. Enfin, au-delà des savoirs qu’elle compile, le travail qu’elle représente et les finalités qu'elle vise, en font un symbole de l’œuvre des Lumières, une arme politique et, à ce titre, l’objet de nombreux rapports de force entre les éditeurs, les rédacteurs, le pouvoir séculier et ecclésiastique. Siècle des Lumières et Révolution copernicienne. La genèse et la publication de l'Encyclopédie se situent dans un contexte de renouvellement complet des connaissances. La représentation du monde communément admise au Moyen Âge était progressivement remise en cause par l'émergence au XVIe siècle du modèle héliocentrique de Copernic défendu au XVIIe siècle par Galilée à la suite de ses expérimentations avec sa fameuse lunette astronomique 1609. À la fin du XVIIe siècle, la théorie de la gravitation universelle de Newton fournit un formalisme mathématique en mesure d'expliquer le mouvement de la Terre et des planètes autour du Soleil Principia, 1687. La preuve optique du mouvement de la Terre fut définitivement apportée en 1728 par les travaux de James Bradley sur l'aberration de la lumière. Les théories de Newton furent diffusées dans les années 1720 - 1730 par Maupertuis hors d'Angleterre, puis par Voltaire en France. La nouvelle science astronomique nécessitait, pour expliquer le mouvement de la Terre, des expérimentations et un formalisme mathématique qui étaient étrangers à la méthode scolastique encore en vigueur dans les universités, et qui pour cette raison était déjà critiquée par Descartes. L'astronomie avait besoin du secours des mathématiques et de la mécanique pour sa théorisation. À terme, la plupart des sciences étaient touchées par ce changement, que le philosophe des sciences Thomas Kuhn appela une révolution scientifique. Aucune compilation d'ensemble des connaissances d'une envergure suffisante pour rendre compte de ce changement de paradigme n'avait été effectuée depuis la publication au XIIe siècle des grandes « encyclopédies médiévales notamment le Speculum maius de Vincent de Beauvais. Dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, d'Alembert expliqua les motivations de l'immense travail entrepris par l'équipe des encyclopédistes. Il critiqua sévèrement les abus de l'autorité spirituelle dans la condamnation de Galilée par l'Inquisition en 1633 en ces termes : Un tribunal ... condamna un célèbre astronome pour avoir soutenu le mouvement de la terre, et le déclara hérétique .... C'est ainsi que l'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence ; et peu s'en fallut qu'on ne défendit au genre humain de penser. L'encyclopédie fournit une compilation des connaissances de l'époque dont la cohérence était obtenue par la riche documentation des articles d'astronomie, et les renvois vers des articles de différentes disciplines. L’aventure éditoriale Un projet de traduction 1728-1745 À l’origine, l’Encyclopédie ne devait être que la traduction en français de la Cyclopædia d’Ephraïm Chambers, dont la première édition date de 1728. La France ne possédait alors aucun ouvrage de ce genre, les métiers et les arts mécaniques étant tenus pour mineurs. Savant renommé et membre de la Royal Societyn 1, Gottfried Sellius propose en janvier 1745 à l’éditeur parisien André Le Breton de traduire la Cyclopaedia. Jusqu'à sa mort pourtant, en 1740, Chambers avait refusé les offres alléchantes d'éditeurs français, sujets, comme beaucoup, à l'anglomanie. Sellius propose dans la foulée comme cotraducteur John Mills, un Anglais qui vivait en France. En février 1745, Mills, aidé par Sellius, rend à Le Breton un rapport d'audit où il prévoit que la traduction nécessitera 4 volumes de textes 1 000 pages en tout, 1 volume de 120 planches et enfin un supplément contenant un lexique français avec des traductions en latin, allemand, italien et espagnol réservé à l'usage des voyageurs étrangers. Dans la foulée, Mills réclame à l'éditeur de figurer en nom propre sur le document appelé privilège, laquelle mention lui garantissait des droits de propriété sur ses textes. L'éditeur promet de le faire. Quelque temps plus tard, Mills découvrait que Le Breton n'avait pas effectué la demande : une querelle s'ensuivit, car la date d'expiration de la demande était dépassée. De peur de voir le projet et ses revenus lui échapper, Mills céda une part de ses droits à Le Breton. Satisfait, celui-ci accomplit les formalités d'usage et la demande de privilège est enregistrée pour 20 ans le 27 février 1745. Le 5 mars 1745, Le Breton Sellius et Mills signent le contrat de traduction qui les liera. Un prospectus de souscription est diffusé dans la foulée ; il contient déjà quelques articles traduits en français atmosphère, fable, sang, annonce le premier tome comme disponible à la vente en juin 1746 au prix total de 135 livres et les volumes suivants pour décembre 1748. Les mois suivant, Mills se montre de plus en plus nerveux : avant de poursuivre le travail, il réclame une avance à Le Breton qui traîne des pieds. L'appel à souscription enregistrait un certain succès et fut clôt le 31 décembre 1745 à un niveau qui garantissait à Le Breton et à Mills de substantiels bénéfices. Sans doute décidé à se débarrasser de ce collaborateur trop encombrant, Le Breton argua que les traductions de Mills contenaient des contresens, des approximations et surtout une augmentation sensible du volume en termes de mots. Se pourrait-il que Mills ait eu recours aux éditions Chambers de 1741 ou de 1743, plus volumineuse que celle de 1728 ? Le document liant l'éditeur de Chambers et Le Breton reste imprécis sur ce point de l'édition de référence, toujours est-il que Le Breton se rend compte que l'audit de Sellius et Mills était en dessous des réalités économiques : la traduction du Chambers ne tiendra jamais en si peu de pages ! En janvier 1746, paniqué par le nombre croissant de pages à venir, Mills réclame de l'argent et cette fois menace d'un procès quand il se rend compte que Le Breton n'a pas du tout respecté l'accord de répartition. Malin, Le Breton fait alors annuler le document et en réclame un autre le 13 janvier à son nom et à celui de trois autres éditeurs, excluant de facto Mills. Dégoûté, se sentant escroqué, Mills en vient aux mains le 7 août et reçoit un violent coup de canne de la part de Le Breton. Un procès eut lieu, mais Le Breton fut acquitté en raison des circonstances. 1746-1750 : Un projet de plus grande ampleur Le 18 octobre 1745, Le Breton décide de s'associer à trois autres éditeurs, Antoine-Claude Briasson, Michel-Antoine David et Laurent Durand, pour pouvoir faire face à l'augmentation des coûts d'édition. Le 21 janvier 1746, les quatre associés se voient renouveler le privilège d'édition pour 20 ans. Diderot n'est pas inconnu des trois nouveaux associés de Le Breton : il était en train de cotraduire pour eux le Dictionnaire universel de médecine de Robert James dont le premier volume sort en 1746. Après avoir renvoyé Mills, et s’étant mis en quête d’un rédacteur en chef réellement capable de gérer la traduction on parle déjà d'une adaptation, Le Breton engage le 27 juin 1746 l’abbé Gua de Malves qui souhaitait embarquer dans l'aventure, entre autres, le jeune Étienne Bonnot de Condillac, Jean le Rond d'Alembert et Denis Diderot, ces deux derniers ayant signé le contrat en tant que témoins. Un grand dîner, le soir même, réunit les éditeurs, Gua de Malves, Diderot et D'Alembert ; Le Breton régla la note de 44 livres et porta la somme sur le registre des comptes relatif à l'Encyclopédie. Dans une lettre datée de mai-juin 1746, D'Alembert écrit au marquis d'Adhémar que, déjà, il traduit une colonne d'anglais par jour et qu'il est payé 3 louis par mois ». Le contrat stipule par ailleurs que Diderot a la possibilité de demander à refaire traduire tous les articles jugés inacceptables. Plus tard, dans son Discours préliminaire, il justifiera l'abandon d'une simple traduction d'abord parce que Chambers avait puisé dans des ouvrages français la plus grande partie des choses dont il a composé son Dictionnaire et aussi parce qu’il restoit beaucoup à y ajoûter. Au bout de treize mois, le 3 août 1747, Gua de Malves est renvoyé en raison de ses méthodes trop rigides et Le Breton place Diderot et d’Alembert officiellement à la tête d’un projet de rédaction d’une encyclopédie originale le 16 octobre 1747. Diderot gardera cette charge pendant les 25 années suivantes et verra l’Encyclopédie achevée. Sous leur impulsion, ce modeste projet prend rapidement une tout autre ampleur avec un désir de synthèse et de vulgarisation des connaissances de l’époque ; le Prospectus destiné à engager les souscripteurs, rédigé par Diderot, est publié à 800 exemplaires en novembre 1750. 1751 : parution du premier volume Discours préliminaire de l'Encyclopédie. Pour mener à bien leur projet, Diderot et D’Alembert, s’entourent d’une société de gens de lettres, visitent les ateliers, s’occupent de l’édition et d’une partie de la commercialisation. Le premier volume paraît en 1751 et contient le Discours préliminaire rédigé par D’Alembert. 1752-1753 : première interdiction En février 1752, les Jésuites font pression sur le Conseil d’État pour obtenir la condamnation et l'interruption de la publication de l'Encyclopédie - s'appuyant entre autres sur le scandale provoqué par la thèsen 3 présenté à la Sorbonne par l'abbé de Prades, collaborateur de l'Encyclopédie. Ils obtiennent gain de cause : le Conseil d'état interdit de vendre, d’acheter ou de détenir les deux premiers volumes parus. C'est par l'appui de Malesherbes, directeur de la librairie et chargé de la censure, mais défenseur du projet encyclopédique, que la publication peut reprendre en novembre 1753. D’Alembert, prudent, décide cependant de ne plus se consacrer qu’aux parties mathématiques. La levée de cette interdiction ne met cependant pas fin aux oppositions à l'ouvrage même si elles se confondent parfois avec les attaques portées en général contre le Parti philosophique. Le récollet Hubert Hayer et l'avocat Jean Soret publient de 1757 à 1763 un périodique appelé La Religion vengée ou Réfutation des auteurs impies. Abraham Chaumeix suit en 1758, avec ses Préjugés légitimes contre l’Encyclopédie et essai de réfutation de ce dictionnaire, en 8 volumes. 1756 : Les emprunts à La Description des Arts et métiers Illustration de l’Encyclopédie pour laquelle Duhamel du Monceau a écrit l'article Corderie Dès sa création, le roi demande à l’Académie de réaliser un appui au développement industriel et artisanal. En 1712, Réaumur est chargé d’un programme d'édition portant sur 250 arts, la Description des Arts et Métiers. Réaumur et l’Académie mettent au point les méthodes, élaborent le style des gravures et accumulent une immense documentation, mais le projet s’interrompt en 1725. L’infidélité et la négligence de mes graveurs, dont plusieurs sont morts, ont donné la facilité à des gens peu délicats sur les procédés de rassembler des épreuves de ces planches, et on les a fait graver de nouveau pour les faire entrer dans le Dictionnaire encyclopédique. J’ai appris un peu tard que le fruit d’un travail de tant d’années m’avait été enlevé — Réaumur, lettre à Samuel Forney, le 23 février 1756 Selon toute vraisemblance, Diderot et D'Alembert auraient fait reproduire des centaines de gravures dans leur Encyclopédie au point qu'un procès pour plagiat fut intenté par Pierre Patte contre Panckoucke qui, entre 1771 et 1783, les réimprimait au format in-4°, à Neuchâtel, en 19 volumes, avec des augmentations et annotations de J.-E. Bertrand. L'historien Maurice Tourneux conteste le plagiat et fait valoir que la maison d'édition Libraires associés avait racheté au moins les cuivres des planches en toute légalité, pour un montant équivalent à 250 000 F. Par ailleurs, poursuivant l’œuvre de Réaumur, Henri Louis Duhamel du Monceau relançait en 1757 la Description des Arts et Métiers à laquelle Diderot empruntera des éléments notamment pour les articles Agriculture, Corderie, Pipe et Sucre. 1759 : révocation du privilège Jusqu'en 1757, la publication des volumes 3 à 7 se poursuit, mais les opposants fulminent. Après la tentative d’assassinat de Robert François Damiens contre Louis XV le 5 janvier 1757, le parti dévot saisit l’occasion de signaler le laxisme de la censure. Il pense que le but de l’Encyclopédie est d’ébranler le gouvernement et la religion ce qui est en partie vrai, puisqu'on trouve dans l'Encyclopédie des attaques évidentes contre l'Église et le gouvernement en place. Planche d’anatomie. Le pape Clément XIII condamne l’ouvrage, il le met à l'Index, le 5 mars 1759, et il enjoint aux catholiques, sous peine d'excommunication, de brûler les exemplaires en leur possession. Le 8 mars 1759, à la suite des remous causés par la parution de De l’esprit de Claude-Adrien Helvétius, le privilège de l’Encyclopédie est révoqué. D’Alembert abandonne définitivement le projet. Lettre à D'Alembert. Dans le même temps, les libraires doivent aussi faire face à une accusation de plagiat de planches dessinées par l'Académie des sciences et destinées à la Description des arts et métiers. Dès septembre 1759, Malesherbes permet de contourner la suppression du privilège en obtenant la permission de publier des volumes de planches ; ils paraîtront à partir de 1762. La rédaction et la publication du texte se poursuivront clandestinement. 1762-1765 : achèvement du texte En 1762, le vent politique change : l’expulsion des Jésuites sur un arrêt du Parlement fait souffler un vent de liberté. Les volumes 8 à 17 paraissent, sans privilège et sous une adresse étrangère. En 1764, Diderot découvre la censure exercée par Le Breton lui-même sur les textes de l’Encyclopédie. En 1765, Diderot achève le travail de rédaction et de supervision, avec une certaine amertume. 1765-1772 : fin de la publication Les deux derniers volumes des planches paraissent sans difficulté en 1772. 1769-1778 : le procès de Luneau de Boisjermain À partir de 1769, les libraires, Briasson en particulier, et Diderot, durent encore se défendre au procès intenté par un souscripteur mécontent, Pierre-Joseph Luneau de Boisjermain, qui se plaignait de l'augmentation du prix de l'ouvrage par rapport à ce qu'annonçait le Prospectus de novembre 1750. En effet, le projet initial avait été largement dépassé par la fougue des Encyclopédistes et était passé de 10 à 26 volumes. En conséquence, les libraires avaient fait passer le prix à 850 livres au lieu des 280 livres du prix de souscription original. En 1771, les associés durent remettre au juge les documents pertinents, qui restèrent en sa possession jusqu'à l'énoncé du jugement. La question fut tranchée en 1778, en faveur des libraires, trois ans après la mort de Briasson. Après 1776 Supplément à l'Encyclopédie. En 1776-1777, Charles-Joseph Panckoucke et Jean-Baptiste-René Robinet font paraître un Supplément en 4 volumes de textes et 1 de planches. Deux volumes de tables paraissent en 1780. Il est à noter que Diderot ne participe pas en tant que rédacteur d'articles à cette entreprise voir dans l'article Encyclopédistes la liste des contributeurs au Supplément. Les 17 volumes initiaux, les 11 volumes de planches, le Supplément de 4 volumes, son volume de planches et les Tables de Mouchon en 2 volumes, constituent les 35 volumes de l'édition de base, dite de Paris, de l'Encyclopédie. Réédition, adaptations, contrefaçons Par ailleurs, l’édition originale fut rapidement suivie de rééditions, d’adaptations et d’éditions contrefaites. Déjà en 1770, un éditeur suisse entreprend la publication d'une encyclopédie similaire, d'inspiration plus européenne et protestante : l'Encyclopédie dite d'Yverdon. Une encyclopédie monumentale, issue de celle de Diderot et D’Alembert dont elle se veut une version améliorée et enrichie, paraît de 1782 à 1832 sous le nom d'Encyclopédie méthodique, dite Encyclopédie Panckoucke. Celle-ci comprend plus de 150 volumes de texte et plus de 50 volumes de planches. Ainsi, si la première édition fut tirée à 4 225 exemplaires, on compte près de 24 000 exemplaires, toutes éditions confondues, vendus au moment de la Révolution française. Dans sa forme "enrichie", l'Encyclopédie arriva en Angleterre en 1799, via Panckoucke qui vendit les droits. L’aventure économique Cet ouvrage, énorme pour l’époque, a occupé un millier d'ouvriers pendant vingt-quatre ans. Prix de vente Les conditions d’acquisition, énoncées à la dernière page du prospectus, sont les suivantes. Pour 10 volumes in-folio dont 2 de planches : 60 livres en acompte, 36 livres à la réception du premier volume prévue pour juin 1751, 24 livres à la livraison de chacun des suivants échelonnés de six mois en six mois, 40 livres à la réception du huitième volume et des deux tomes de planches. En tout, 372 livres. Vu le prix élevé, on peut en déduire que le lecteur était issu de la bourgeoisie, de l’administration, de l’armée ou de l’Église. La première édition in-folio revient finalement à un total de 980 livres, tandis que l'édition ultérieure in-quarto en coûtera 324 et l'in-octavo 2257. Pour mettre ces chiffres en perspective, il faut savoir que Diderot a gagné en moyenne 2 600 livres par an pendant ses 30 années de travail sur l'Encyclopédie et qu'un artisan spécialisé gagnait alors 15 livres par semaine, soit environ 750 livres par année. Tirage L'Encyclopédie fut tirée à 4 255 exemplaires - quantité très importante à une époque où un tirage courant ne dépassait pas les 1 500 exemplaires. De ce nombre, Robert Darnton estime qu'environ 2 000 exemplaires ont été diffusés en France et le reste à l'étranger. Vente de l'ouvrage Le prospectus de 1750 apporte un millier de souscriptions. L’interdiction temporaire des tomes 1 et 2 a attisé les curiosités sur l’ouvrage. On compte alors plus de 4 000 souscriptions. Suite aux remous causés par De l’esprit, à l’interdiction du privilège et l’interdiction papale, Le Breton est accessoirement condamné à rembourser les souscripteurs : aucun ne se présentera en ce sens. Il ne faut pas confondre les acheteurs et le lectorat. Comme les cabinets de lecture se multipliaient, il est probable qu’un public plus large y ait consulté l’ouvrage. L’esprit encyclopédique L’Encyclopédie est représentative d'un nouveau rapport au savoir. Elle marque la fin d'une culture basée sur l'érudition, telle qu'elle était conçue au siècle précédent, au profit d'une culture dynamique tournée vers l'activité des hommes et leurs entreprises. Elle permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder au savoir. Esprit philosophique Frontispice de l’Encyclopédie détail : on y voit la Vérité rayonnante de lumière; à droite, la Raison et la Philosophie lui arrachent son voile (peint par Charles Nicolas Cochin et gravé par Benoît-Louis Prévost en 1772 Frontispice entier Jules Michelet écrit : « l’Encyclopédie, livre puissant, quoi qu’on ait dit, qui fut bien plus qu’un livre, — la conspiration victorieuse de l’esprit humain. En ce siècle des Lumières, l’évolution de la pensée est liée à l’évolution des mœurs. Les récits de voyages — celui de Bougainville, par exemple — incitent à la comparaison entre les différentes civilisations : la morale et les habitudes apparaissent relatives à un lieu et à un temps. Les bourgeois viennent désormais frapper aux portes de la noblesse, ils deviennent la noblesse de robe par opposition à la noblesse d’épée. Mais la logique du déterminisme héréditaire et du libre arbitre s’opposent. De nombreux bourgeois se sentent frustrés que la situation soit bloquée en particulier par rapport au Royaume-Uni. De nouvelles valeurs s’imposent : la nature qui détermine le devenir de l’homme, le bonheur terrestre qui devient un but, le progrès par lequel chaque époque s’efforce de mieux réaliser le bonheur collectif. Le nouvel esprit philosophique qui se constitue est basé sur l’amour de la science, la tolérance. Il s’oppose à toutes les contraintes de la monarchie absolue et à la religion. L’essentiel est alors d’être utile à la collectivité en diffusant une pensée concrète où l’application pratique l’emporte sur la théorie, et l’actualité sur l’éternel. Esprit scientifique Cette évolution s’inspire de l’esprit scientifique. Les méthodes expérimentales, appliquées à des questions philosophiques, aboutissent à l'empirisme, selon lequel toute notre connaissance dérive, directement ou indirectement, de l’expérience par les sens. L’Encyclopédie marque aussi l’apparition des sciences humaines. En outre, l’esprit scientifique se manifeste par son caractère encyclopédique. Le xviiie siècle ne se spécialise pas, il touche à tous les domaines : science, philosophie, arts, politique, religion, etc. Ainsi s’explique la production de dictionnaires et de sommes littéraires qui caractérisent ce siècle et dont l'Encyclopédie est l’ouvrage le plus représentatif. On peut citer : L’Esprit des lois de Montesquieu 31 livres, l'Histoire naturelle de Buffon 36 volumes, l'Essai sur les origines des connaissances humaines de Condillac, le Dictionnaire philosophique de Voltaire 614 articles. Fin du XVIIe siècle, Fontenelle, dans Entretiens sur la pluralité des mondes 1686, et Pierre Bayle, dans le Dictionnaire historique et critique 1697, vulgarisaient déjà cette pensée fondée sur les faits, l’expérience et la curiosité pour les innovations. Esprit critique Quant à l’esprit critique, il s’exerce principalement contre les institutions. À la monarchie absolue, on préfère le modèle anglais de gouvernement monarchie constitutionnelle. La critique historique des textes sacrés attaque les certitudes de la foi, le pouvoir du clergé et les religions révélées. Les philosophes s’orientent vers le déisme qui admet l’existence d’un dieu sans église. Ils critiquent également la persécution des Huguenots par la monarchie française voir l’article Réfugiés. Le pendant positif de cette critique est l’esprit de réforme. Les encyclopédistes prennent parti pour le développement de l’instruction, l’utilité des belles-lettres, la lutte contre l’Inquisition et l’esclavage, la valorisation des arts mécaniques, l’égalité et le droit naturel, le développement économique qui apparaît comme source de richesse et de confort. Pour défendre leurs idées, les auteurs ont oscillé entre le ton polémique (voir l’article Prêtres de D’Holbach et des techniques d’autocensure qui consistaient à déguiser ses idées en s’appuyant sur des exemples historiques précis. L’examen scientifique des sources leur permettait une remise en question des idées léguées par le passé. L’abondance des annotations historiques décourageait une censure à la recherche d’idées subversives. Certains encyclopédistes ont préféré faire passer des vues iconoclastes par des articles apparemment anodins. Ainsi, l’article consacré au capuchon est l’occasion de ridiculiser les moines. Même si la quantité a parfois nui à la qualité, il faut souligner la singularité de cette aventure collective que fut l'Encyclopédie : pour la première fois, on y décrit à égalité avec les savoirs nobles tous les savoir-faire : la boulangerie, la coutellerie, la chaudronnerie, la maroquinerie. Cette importance accordée à l’expérience humaine est une des clefs de la pensée du siècle : la raison se tourne vers l’être humain qui en est désormais la fin. Esprit bourgeois Planche de l’Encyclopédie : Chambre obscure. L'article Encyclopédiste met en avant le profil du collaborateur moyen de l'Encyclopédie : il appartient à la classe émergente du xviiie siècle, la bourgeoisie. En particulier, Diderot et D'Alembert sont bourgeois, les éditeurs sont bourgeois, le lecteur moyen est bourgeois. Il n'est donc pas surprenant de retrouver cette tendance dans l'Encyclopédie. Les dimensions pratique et concrète de l'Encyclopédie en témoignent. le titre : dictionnaire des arts et métiers les planches le matérialisme tant reproché à certains auteurs L’article Réfugiés en est un exemple parfait. Il valorise le travail, la richesse, et l’industrie, par opposition aux valeurs de la noblesse, à savoir, les faits d’armes, le refus du négoce et de l’agriculture. La question de l'unité Ces caractéristiques esprit bourgeois, scientifique et critique sont des impressions globales qui se dégagent quand on tente d'appréhender globalement la ligne éditoriale de l'Encyclopédie. Il ne faut cependant pas croire que cela ressortisse à une intention ou une stratégie délibérée et qu'une quelconque unité ait été recherchée par les directeurs ou les éditeurs. Les dissensions entre Diderot et D'Alembert, ou avec les éditeurs, les renvois brisés voir ci-après et les articles contradictoires montrent à suffisance l'improvisation relative dans la conception générale du corpus. Si l'Encyclopédie fut bien la machine de guerre des Lumières, ainsi qu'on l'a dit, Ce n'est pas une machine de guerre cohérente où s'est exprimé le rôle historique de la bourgeoisie capitaliste, seule classe assurée de ses buts et de ses moyens, comme on l'a tant de fois affirmé ; son public ... est moins animé par la cohésion sociale et idéologique que par la généralisation extrêmement étendue d'un besoin de connaissance. Pour le public du XVIIIe siècle, toutefois, l'ouvrage représente un modèle de cohérence. Il montre que la connaissance est ordonnée et non chaotique, que le principe directeur est la raison opérant sur les données des sens et non la révélation parlant par l'intermédiaire de la tradition, enfin que les critères rationnels appliqués aux institutions contemporaines contribuent à démasquer l'absurdité et l'iniquité partout. Ce message imprègne le livre, y compris les articles techniques. Les renvois Pour échapper aux limitations du classement alphabétique, Diderot innove en utilisant quatre types de renvois : des renvois classiques dits de mots, pour une définition qui se trouve dans un autre article ; des renvois dits de choses, pour confirmer ou réfuter une idée contenue dans un article par un autre article; des renvois dits de génie, qui peuvent conduire à l’invention de nouveaux arts, ou à de nouvelles vérités . un quatrième type de renvois dits satiriques ou épigrammatiques, est une technique développée par les concepteurs pour contrer la censure. Ainsi, la critique des Cordeliers ne se trouve pas à l'article Cordeliers où les censeurs seraient susceptibles de la trouver, mais à l'article Capuchon auquel il renvoi. L'existence et la portée de ces renvois satiriques, en dépit des mots de Diderot, est remise en questio. La réflexion de Diderot sur les renvois et l'usage qu'il en a fait pour lier entre eux près de 72 000 articles,lui a valu d'être considéré comme l'ancêtre de l'hypertexte. La parution de cet ouvrage par volumes et selon l'ordre alphabétique fait que les articles sont souvent brouillons, un thème non abordé dans l'article dédié pouvant réapparaître dans une section d'un autre article, comme c'est le cas, par exemple, pour les travaux d'Isaac Newton qui se trouvent dans l'article sur Woolsthorpe, hameau où il est né. Le pic de célébrité de l'ouvrage fait que les tomes V à VIII correspondant aux quatre lettres E-F-G-H sont de loin plus développés, au-delà de la place utilisée dans un dictionnaire usuel. La publication séparée, chronologiquement, des schémas par rapport au texte, pose d'autres problèmes de compréhension les planches de l'article coniques étant publiées près de 14 ans après le texte lui-même. Certains textes sont copiés d'ouvrages antérieurs dont le contenu est ainsi éparpillé dans différents articles17 : tel est le cas des Elemens de physique de Pieter van Musschenbroek. Les sources de l’Encyclopédie L'Encyclopédie se compose de travaux originaux et de nombreux emprunts. Les travaux originaux L'Encyclopédie contient un certain nombre de travaux entièrement nouveaux, résultant de recherches originales. C'est particulièrement vrai dans le domaine des sciences et des techniques, au point de devenir par endroit, un lieu de polémique, les auteurs utilisant l'ouvrage pour exposer leur point de vue, ou se répondre d'un article à l'autre. Comme les termes techniques avaient été longtemps ignorés des encyclopédies, et n'étaient apparus qu'avec le Dictionnaire Universel de Furetière 1690, il n'existait que peu d'ouvrages de référence sur lesquels pût se baser pour la description des arts et des métiers, à l'exception de la collection Description des arts et métiers encore en cours. Diderot se réserva donc, en plus de la coordination générale, cette part du travail, la plus complexe et la moins recherchée : Diderot portait à un degré merveilleux les aptitudes de son rôle. Il n'avait pas seulement à son service une multitude d'idées originales, il possédait encore la puissance incroyablement rapide de s'assimiler ce qu'il tenait à savoir, et de l'apprendre d'aussi bonne foi que si sa vie entière en eût dépendu, ou que ses talents eussent dû s'y consommer sans fin. Qui ne sait, pour l'avoir lu souvent, comment il se rendit maître des arts mécaniques dont il s'était chargé d'être le démonstrateur, comment il s'en emparait pratiquement avant de les expliquer théoriquement? Afin de traiter en pleine autorité une si grande abondance de matières spéciales, il passait des journées entières au milieu des ateliers, il visitait les fabriques, il étudiait, et exerçait une foule de métiers. Plusieurs fois, il voulut se procurer les machines, les voir construire, mettre la main à la tâche, et se faire apprenti pour connaître, en ouvrier, le secret, de tant de manœuvres. Finalement, il n'ignorait plus aucun détail de l'art des tissus de toile, de soie, de coton, ou de la fabrication des velours ciselés, et les descriptions qu'il en donnait sortaient en droite ligne de ses expériences. Les emprunts À côté de travaux nouveaux, les collaborateurs ont aussi beaucoup emprunté à des ouvrages existants — allant de la citation en guise de référence, à l'article entier. Tantôt avoués, tantôt pas, ces emprunts sont progressivement identifiés par la recherche moderne. La liste des sources proposée ici est donc encore incomplète. Une question très pointue consiste aussi à déterminer avec précision l'édition de l'ouvrage concrètement utilisée. la Cyclopaedia d'Ephraïm Chambers le Lexicon-Technicum de John Harris le New General English Dictionary de Thomas Dyche la réédition par Fontenelle 1732 du Dictionnaire des termes des arts et des sciences de Thomas Corneille le Dictionnaire universel de commerce de Jacques Savary des Brûlons & Louis-Philémon Savary 1723-1730 Elemens de physique de Pieter van Musschenbroek. Pour les planches, sur le plan conceptuel : Théâtre de machines de Jacob Leupold19, Leipzig, 1724. La Description et perfection des arts et métiers 1704 Pour la Description des arts : Le Novum Organum de Francis Bacon La Description et perfection des arts et métiers 1704 Pour l'histoire des idées et de la philosophie : Historia critica philosophiae 1744 de Jacob Brucker Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle Autres personnages de référence Parmi les autorités citées comme référence dans l'Encyclopédie, sans en être des collaborateurs directs, on trouve les noms de Gottfried Wilhelm Leibniz et de l'abbé Claude Sallier, garde de la Bibliothèque royale. Réception de l’Encyclopédie Enthousiasme du public La publication de l'Encyclopédie a suscité dans le public un enthousiasme extraordinaire, qui s'est manifesté jusque dans les milieux des courtisans proches de Louis XV, comme en atteste une anecdote racontée par Voltaire en 1774 : « Un domestique de Louis XV me contait qu’un jour, le roi, son maître, soupant à Trianon en petite compagnie, la conversation roula d’abord sur la chasse, et ensuite sur la poudre à tirer. Quelqu’un dit que la meilleure poudre se faisait avec des parties égales de salpêtre, de soufre et de charbon. Le duc de La Vallière, mieux instruit, soutint que, pour faire de bonne poudre à canon, il fallait une seule partie de soufre et une de charbon sur cinq parties de salpêtre bien filtré, bien évaporé, bien cristallisé. Il est plaisant, dit M. le duc de Nivernais, que nous nous amusions tous les jours à tuer des perdrix dans le parc de Versailles, et quelquefois à tuer des hommes ou à nous faire tuer sur la frontière, sans savoir précisément avec quoi l’on tue. Hélas ! nous en sommes réduits là sur toutes les choses de ce monde, répondit Mme de Pompadour ; je ne sais de quoi est composé le rouge que je mets sur mes joues, et on m’embarrasserait fort si on me demandait comment on fait les bas de soie dont je suis chaussée. – C’est dommage, dit alors le duc de La Vallière, que Sa Majesté nous ait confisqué nos Dictionnaires encyclopédiques, qui nous ont coûté chacun cent pistoles ; nous y trouverions bientôt la décision de toutes nos questions. Le roi justifia sa confiscation ; il avait été averti que les vingt et un volumes in-folio, qu’on trouvait sur la toilette de toutes les dames, étaient la chose du monde la plus dangereuse pour le royaume de France, et il avait voulu savoir par lui-même si la chose était vraie, avant de permettre qu’on lût ce livre. Il envoya, sur la fin du souper, chercher un exemplaire par trois garçons de sa chambre, qui apportèrent chacun sept volumes avec bien de la peine. On vit à l’article POUDRE que le duc de La Vallière avait raison ; et bientôt Mme de Pompadour apprit la différence entre l’ancien rouge d’Espagne, dont les dames de Madrid coloraient leurs joues, et le rouge des dames de Paris. Elle sut que les dames grecques et romaines étaient peintes avec de la pourpre qui sortait du murex, et que, par conséquent, notre écarlate était la pourpre des anciens ; qu’il entrait plus de safran dans le rouge d’Espagne et plus de cochenille dans celui de France. Elle vit comme on lui faisait ses bas au métier, et la machine de cette manœuvre la ravit d’étonnement. – Ah ! le beau livre ! s’écria-t-elle. Sire, vous avez donc confisqué ce magasin de toutes les choses utiles, pour le posséder seul et pour être le seul savant de votre royaume. Chacun se jetait sur les volumes, comme les filles de Lycomède sur les bijoux d’Ulysse ; chacun y trouvait à l’instant tout ce qu’il cherchait. Quant à Diderot, il s'en remet à la postérité pour juger de son œuvre : Cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits, et j’espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n’y gagneront pas. Nous aurons servi l’humanité. Mais de son vivant et durant la publication protecteurs et opposants s'affrontent, parfois vivement. L'Encyclopédie n'est pas qu'un ouvrage de références ; elle est aussi une tribune, un manifeste et sa publication est donc aussi un acte politique, qui heurte. Opposants notoires Cacouac. Les Jésuites, qui sont la cible des attaques des encyclopédistes, auxquels ils répondent par le Journal de Trévoux, jusqu'à ce que leur ordre soit banni de France en 1763. Christophe de Beaumont, archevêque de Paris Omer Joly de Fleury, président à mortier du Parlement de Paris Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, poète en guerre avec Voltaire Élie Fréron, journaliste qui s'attaqua aussi à Voltaire Jacob-Nicolas Moreau, historien et écrivain, farouche partisan de l'Ancien Régime Palissot, écrivain adversaire des philosophes Clément XIII, qui met l'ouvrage à l'index le 5 mars 1759 et enjoint aux catholiques, sous peine d'excommunication, de brûler les exemplaires en leur possession. Les éditions subséquentes Le succès de cette publication suscite très vite projets concurrents, copies pirates et réimpressions diverses : Encyclopédie in-folio de Lucques 1758, sous la direction d'Ottaviano Diodati, tirée à 1 500 exemplaires. Encyclopédie in-folio de Livourne 1771-1775, sous la direction de Giuseppe Aubert, tirée à 1 500 exemplaires. Encyclopédie in-folio de Genève 1771-1773, sous la direction de Panckoucke, tirée à 4 000 exemplaires. Encyclopédie in-quarto de Genève et de Neuchâtel, également sous la direction de Panckoucke, tirée d'abord à 4 000 exemplaires, suivie de deux autres tirages de 2 000 exemplaires. Cette édition est connue sous le sigle STN Société typographique de Neuchâtel. Encyclopédie in-octavo de Berne et Lausanne 1778, similaire à l'édition Pellet de Genève, dont le tirage total est évalué entre 5 500 et 6 000 exemplaires. Encyclopédie d'Yverdon 1770-1780, publiée conjointement par la Société typographique de Berne et le libraire Pierre Gosse de La Haye, sous la direction de Fortuné-Barthélémy de Félice, qui transforme l'esprit de l'ouvrage original. Encyclopédie méthodique, projet mis en œuvre par Charles-Joseph Panckoucke en 1782, mais qui n'aboutira que 50 ans plus tard, avec 210 volumes. Robert Darnton estime à 24 000 exemplaires le nombre total d'exemplaires de l' Encyclopédie imprimés avant 1789 Principaux contributeurs Collaborateurs de l'Encyclopédie 1751-1772. Diderot signe des articles sur une grande variété de sujets, principalement de littérature et d'esthétique, mais aussi en archéologie, médecine, chirurgie, herboristerie, cuisine, théorie des couleurs, mythologie, mode, etc. Il manifeste un goût certain pour les religions éloignées du christianisme, les hérésies obscures, les secrets et les mystères, les croyances populaires et le merveilleux. Il a donné aussi des centaines d'articles sur la géographie. D'Alembert a fourni les grands textes d'introduction Discours préliminaire, Avertissement et quelque 1 600 articles. Le contributeur le plus prolifique est Louis de Jaucourt, aussi appelé chevalier de Jaucourt, qui a fourni un total de 17 395 articles, soit 28% du volume de texte. Le baron d'Holbach a produit 425 articles signés et un grand nombre d'articles non signés sur la politique et la religion. À ces noms s'ajoutent les contributions de quelque 160 collaborateurs provenant de milieux divers. Leur qualité est inégale, de l'aveu même de Diderot : Parmi quelques hommes excellents, il y en eut de faibles, de médiocres & de tout à fait mauvais. De là cette bigarrure dans l’ouvrage où l’on trouve une ébauche d’écolier, à côté d’un morceau de maître ; une sottise voisine d’une chose sublime, une page écrite avec force, pûreté, chaleur, jugement, raison, élégance au verso d’une page pauvre, mesquine, plate & misérable. » Denis Diderot Controverse entre Diderot et Rousseau au sujet de l'article Droit naturel Diderot a publié en 1755 l'article Droit naturel de l'Encyclopédie. À partir de 1757, les relations entre Diderot et Rousseau se détériorent, entre autres sur la question de la valeur de l'homme dans la société. Diderot en effet comprend mal le principe de solitude exprimé par Rousseau et écrit dans Le Fils naturel, que l'homme de bien est dans la société, et qu'il n'y a que le méchant qui soit seul. Rousseau, qui attribue à Diderot les indiscrétions sur sa liaison avec Louise d'Épinay, se sent attaqué. Dans la version de 1760 du Contrat social, dite « Manuscrit de Genève », il introduit un chapitre intitulé « La Société générale du genre humain », dans laquelle on trouve une réfutation de l'article « Droit naturel » écrit par Diderot. Voulant éviter toute polémique, Rousseau supprime le chapitre dans la version définitive du Contrat social publiée en 1762. Jean-Pierre Marcos a effectué une analyse de cette controverse. L’Encyclopédie en chiffres Extrait de la Table de Mouchon : la page Entendement. Imprimé à 4 255 exemplaires, l'ouvrage de base compte 17 volumes de texte, 11 volumes d’illustrations et 71 818 articles. Sa rédaction s'est étalée sur 15 ans et sa publication sur 21 ans. Le Supplément 1776-1777 compte 4 volumes d’articles et un volume d’illustrations. L'ensemble totalise 74 000 articles, 18 000 pages de texte et 21 700 000 mots. Le pasteur genevois Pierre Mouchon a produit une Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les XXXIII volumes in-folio du Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers32 en deux volumes 944 p., Paris et Amsterdam, 1780. Cette Table dite de Mouchon compte 75 000 entrées, 44 000 articles principaux, 28 000 articles secondaires et 2 500 illustrations. Détail de la publication Légende : T = volume de texte P = volume de planches S = volume du supplément B = volume de tables Les liens externes conduisent vers la version numérisée dans Gallica. Détails des volumes de l'Encyclopédie Tome Date de parution Contenu T 01 1751-06 A – Azymites T 02 1752-01 (daté 1751) B – Cézimbra T 03 1753-10 Cha – Consécration T 04 1754-10 Conseil – Dizier, Saint T 05 1755-11 Do – Esymnete T 06 1756-10 Et – Fne T 07 1757-11 Foang – Gythium T 08 1765-12 H – Itzehoa T 09 1765-12 Ju – Mamira T 10 1765-12 Mammelle – Myva T 11 1765-12 N – Parkinsone T 12 1765-12 Parlement – Polytric T 13 1765-12 Pomacies – Reggio T 14 1765-12 Reggio – Semyda T 15 1765-12 Sen – Tchupriki T 16 1765-12 Teanum – Vénerie T 17 1765-12 Vénérien – Zzuéné P01 1762 P 02 et P 02b 1763 P 03 1765 P 04 1767 P 05 1768 P 06 1769 P 07 1771 P 08 1771 P 09 1772 P 10 1772 S 01 1776 A – Blom-Krabbe S 02 S 03 S 04 1777 Naalol – Zygie 16 novembre 1717 - 29 octobre 1783 Mais, avant même la parution du premier volume, le succès commercial de l'Encyclopédie fut immense, puisque, dès le début du lancement, on recueillit 4300 souscriptions. Et bientôt, l'Encyclopédie se trouva dans toutes les bibliothèques, depuis celles des châteaux jusqu'à celles des petits curés de campagne. Devant un tel succès, le Parlement et le Haut Clergé s'inquiétèrent. Le roi Louis XV fit d'abord confisquer quelques exemplaires, puis accepta de condamner totalement l'ouvrage. C'était en réalité un geste purement officiel car l'Encyclopédie avait des partisans très haut placés : Mme de Pompadour et le Lieutenant de Police lui-même protégeaient sa parution clandestine et le chef de la censure, à la veille d'une saisie, offrait à Diderot de cacher les épreuves dans son propre bureau.       
#55
Gustave Flaubert
Loriane
Posté le : 06/02/2016 21:18
Le 7 Février 1857 Flaubert est acquitté par le tribunal de Paris
devant lequel il paraissait pour répondre de l'accusation d'avoir commis, par son oeuvre, des délits d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes moeurs. Jugement rendu lors du procès de monsieur Gustave Flaubert Le 7 Fèvrier 1857 Informations Le tribunal a consacré une partie de l'audience de la huitaine dernière aux débats d'une poursuite exercée contre MM. Léon Laurent-Pichat et Auguste-Alexis Pillet, le premier gérant, le second imprimeur du recueil pértodique La Revue de Paris, et M. Gustave Flaubert, homme de lettres, tous trois prévenus : 1° Laurent-Pichat, d'avoir, en 1856, en publiant dans les n° des 1er et 15 décembre de la Revue de Paris des fragments d'un roman intitulé Madame Bovary et, notamment, divers fragments contenus dans les pages 73, 77, 78, 272, 273, commis les délits d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes moeurs ; 2° Pillet et Flaubert d'avoir, Pillet en imprimant pour qu'ils fussent publiés, Flaubert en écrivant et remettant à Laurent-Pichat pour être publiés, les fragments du roman intitulé Madame Bovary, sus-désignés, aidé et assisté, avec connaissance, Laurent-Pichat dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé les délits sus-mentionnés, et de s'être ainsi rendus complices de ces délits prévus par les articles 1er et 8 de la loi du 17 mal 1819, et 59 et 60 du Code pénal. M. Pinard, substitut, a soutenu la prévention. Le tribunal, après avoir entendu la défense présentée par Me Sénard pour M. Flaubert, Me Desmarest pour M. Pichat et Me Faverie pour l'imprimeur, a remis à l'audience de ce jour 7 février le prononcé du jugement, qui a été rendu en ces termes : " Attendu que Laurent-Pichat, Gustave Flaubert et Pillet sont inculpés d'avoir commis les délits d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes moeurs ; le premier, comme auteur, en publiant dans le recueil périodique intitulé La Revue de Paris, dont il est directeur gérant, et dans les numéros des 1er et 15 octobre, 1er et 15 novembre, 1er et 15 décembre 1856, un roman intitulé Madame Bovary, Gustave Flaubert et Pillet, comme complices, l'un en fournissant le manuscrit, et l'autre en imprimant ledit roman ; " Attendu que les passages particulièrement signalés du roman dont il s'agit, lequel renferme prés de 300 pages, sont contenus, aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dans les pages 73,77 et 78 (n° du 1er décembre), et 271, 272 et 273 (n° du 15 décembre 1856) ; " Attendu que les passages incriminés, envisagés abstractivement et isolément présentent effectivement soit des expressions, soit des images, soit des tableaux que le bon goût réprouve et qui sont de nature à porter atteinte à de légitimes et honorables susceptibilités ; " Attendu que les mêmes observations peuvent s'appliquer justement à d'autres passages non définis par l'ordonnance de renvoi et qui, au premier abord, semblent présenter l'exposition de théories qui ne seraient pas moins contraires aux bonnes moeurs, aux institutions, qui sont la base de la société, qu'au respect dû aux cérémonies les plus augustes du culte ; "Attendu qu'à ces divers titres l'ouvrage déféré au tribunal mérite un blâme sévère, car la mission de la littérature doit être d'orner et de récréer l'esprit en élevant l'intelligence et en épurant les moeurs plus encore que d'imprimer le dégoût du vice en offrant le tableau des désordres qui peuvent exister dans la société ; " Attendu que les prévenus, et en particulier Gustave Flaubert, repoussent énergiquement l'inculpation dirigée contre eux, en articulant que le roman soumis au jugement du tribunal a un but éminemment moral ; que l'auteur a eu principalement en vue d'exposer les dangers qui résultent d'une éducation non appropriée au milieu dans lequel on doit vivre, et que, poursuivant cette idée, il a montré la femme, personnage principal de son roman, aspirant vers un monde et une société pour lesquels elle n'était pas faite, malheureuse de la condition modeste dans laquelle le sort l'aurait placée, oubliant d'abord ses devoirs de mère, manquant ensuite à ses devoirs d'épouse, introduisant successivement dans sa maison l'adultère et la ruine, et finissant misérablement par le suicide, aprés avoir passé par tous les degrés de la dégradation la plus complète et être descendue jusqu'au vol ; " Attendu que cette donnée, morale sans doute dans son principe, aurait dû être complétée dans ses développements par une ceraine sévérité de langage et par une réserve contenue, en ce qui touche particulièrement l'exposition des tableaux et des situations que le plan de l'auteur lui faisait placer sous les yeux du public ; " Attendu qu'il n'est pas permis, sous prétexte de peinture de caractère ou de couleur locale, de reproduire dans leurs écarts les faits, dits et gestes des personnages qu'un écrivain s'est donné mission de peindre ; qu'un pareil système, appliqué aux oeuvres de l'esprit aussi bien qu'aux productions des beaux-arts, conduirait à un réalisme qui serait la négation du beau et du bon et qui, enfantant des oeuvres également offensantes pour les regards et pour l'esprit, commettrait de continuels outrages à la morale publique et aux bonnes moeurs ; " Attendu qu'il y a des limites que la littérature, même la plus légère, ne doit pas dépasser, et dont Gustave Flaubert et co-inculpés paraissent ne s'être pas suffisamment rendu conapte ; " Mais attendu que l'ouvrage dont Flaubert est l'auteur est une oeuvre qui parait avoir été longuement et sérieusement travaillée, au point de vue littéraire et de l'étude des caractères que les passages relevés par l'ordonnance de renvoi, quelque répréhensibles qu'ils soient, sont peu nombreux si on les compare à l'étendue de l'ouvrage ; que ces passages, soit dans les idées qu'ils exposent, soit dans les situations qu'ils représentent, rentrent dans l'ensemble des caractères que l'auteur a voulu peindre, tout en les exagérant et en les imprégnant d'un réalisme vulgaire et souvent choquant ; " Attendu que Gustave Flaubert proteste de son respect pour les bonnes moeurs et tout ce qui se rattache à la morale religieuse ; qu'il n'apparaît pas que son livre ait été, comme certaines oeuvres, écrit dans le but unique de donner une satisfaction aux passions sensuelles, à l`esprit de licence et de débauche, ou de ridiculiser des choses qui doivent être entourées du respect de tous ; " Qu'il a eu le tort seulement de perdre parfois de vue les règles que tout écrivain qui se respecte ne doit jamais franchir, et d'oublier que la littérature, comme l'art, pour accomplir le bien qu'elle est appelée à produire, ne doit pas seulement être chaste et pure dans sa forme et dans son expression ; " Dans ces circontances, attendu qu'il n'est pas suffisamment établi que Pichat, Gustave Flaubert et Pillet se soient rendus coupables des délits qui leur sont imputés ; " Le tribunal les acquitte de la prévention portée contre eux et les renvoie sans dépens. " Gustave Flaubert Gustave Flaubert est un écrivain, romancier français du mouvement réalisme il écrit des Romans, des contes, ses Œuvres principales sont Madame Bovary en 1857, Salammbô en 1862, L'Éducation sentimentale en 1869, Trois contes en 1877 né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort à 58 ans à Croisset, lieu-dit de la commune de Canteleu, le 8 mai 1880.Prosateur de premier plan de la seconde moitié du XIXe siècle, Gustave Flaubert a marqué la littérature française par la profondeur de ses analyses psychologiques, son souci de réalisme, son regard lucide sur les comportements des individus et de la société, et par la force de son style dans de grands romans comme Madame Bovary 1857, Salammbô 1862, L'Éducation sentimentale 1869, ou le recueil de nouvelles Trois contes 1877. Sa vie Né dans une famille de la petite bourgeoisie catholique et d'ancêtres protestants2, Gustave Flaubert est le deuxième enfant d’Achille Cléophas Flaubert 1784-1846, chirurgien-chef très occupé à l'Hôtel-Dieu de Rouen, et de son épouse, Anne Justine Caroline Fleuriot 1793-1872, fille d’un médecin de Pont-L'Évêque. Il naît le 12 décembre 1821 après une sœur et deux frères décédés en bas âge4, et sera délaissé en faveur de son frère aîné, brillant élève admiré par la famille prénommé Achille comme son père à qui il succèdera d'ailleurs comme chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Gustave Flaubert passe une enfance sans joie, marquée par l'environnement sombre de l'appartement de fonction de son père à l'hôpital de Rouen aujourd'hui musée Flaubert et d'histoire de la médecine, mais adoucie par sa complicité avec sa sœur cadette, Caroline, née trois ans après lui. Adolescent aux exaltations romantiques, il est déjà attiré par l'écriture au cours d'une scolarité vécue sans enthousiasme comme interne au Collège royal, puis au lycée de Rouen, à partir de l'année 1832. Il y rencontre Ernest Chevalier avec qui il fonde en 1834 Art et Progrès, un journal manuscrit où il fait paraître son premier texte public7. Il est renvoyé en décembre 1839 pour indiscipline et passe seul le baccalauréat en 1840. Après avoir réussi l'examen, ses parents lui financent un voyage dans les Pyrénées et en Corse8, que Flaubert relatera dans l'ouvrage de jeunesse publié de manière posthume sous le nom de Voyage dans les Pyrénées et en Corse ou dans certaines éditions des Mémoires d'un fou. Le premier événement notable dans sa jeunesse est sa rencontre à Trouville-sur-Mer, durant l'été 1836, d'Élisa Schlésinger qu'il aimera d'une passion durable et sans retour. Il transposera d'ailleurs cette passion muette, avec la charge émotionnelle qu'elle a développée chez lui, dans son roman L'Éducation sentimentale, en particulier dans la page célèbre de l'apparition de Madame Arnoux au regard du jeune Frédéric et dans leur dernière rencontre poignante. Formation Dispensé de service militaire grâce au tirage au sort qui lui est favorable cela se pratiquait ainsi à l'époque, Flaubert entreprend sans conviction, en 1841, des études de Droit à Paris, ses parents souhaitant qu'il devienne avocat. Il y mène une vie de bohème agitée, consacrée à l'écriture. Il y rencontre des personnalités dans les mondes des arts, comme le sculpteur James Pradier, et de la littérature, comme l'écrivain Maxime Du Camp qui deviendra son grand ami, le poète et auteur dramatique Victor Hugo. Il abandonne le droit, qu'il abhorre, en janvier 1844 après une première grave crise d'épilepsie. Il revient à Rouen, avant de s'installer en juin 1844 à Croisset, au bord de la Seine, à quelques kilomètres en aval de Rouen. Il y rédige quelques nouvelles et une première version de L'Éducation sentimentale. En début 1846 meurent à peu de semaines d'intervalle, son père, puis sa jeune sœur deux mois après son accouchement — Gustave prendra la charge de sa nièce, Caroline. Son père laisse en héritage une fortune évaluée à 500 000 francs : il peut désormais vivre de ses rentes et se consacrer entièrement à l'écriture. C'est également, au printemps de cette année que commence sa liaison houleuse et intermittente sur une dizaine d'années avec la poétesse Louise Colet. Jusqu'à leur rupture — sa dernière lettre à Louise Colet est datée du 6 mars 1855 —, il entretient avec elle une correspondance considérable dans laquelle il développe son point de vue sur le travail de l'écrivain, les subtilités de la langue française et ses vues sur les rapports entre hommes et femmes. Gustave Flaubert au physique de plus en plus massif est cependant un jeune homme sportif : il pratique la natation, l'escrime, l'équitation, la chasse… Il se rend à Paris avec son ami Louis-Hyacinthe Bouilhet pour assister à la Révolution de 1848. Il lui porte un regard très critique que l'on retrouve dans L'Éducation sentimentale. Poursuivant ses tentatives littéraires, il reprend entre mai 1848 et septembre 1849 la première version commencée en 1847 de La Tentation de saint Antoine inspirée par un tableau qu'il a vu à Gênes en 1843 au cours du voyage de noces de sa sœur que la famille accompagnait. Puis Gustave Flaubert organise, avec Maxime du Camp un long voyage en Orient qui se réalise entre 1849 et 1852. Dans son carnet de voyage, il fait le pari de tout dire, depuis la descente éblouissante du Nil jusqu'à sa fréquentation des bordels. Ce voyage qui le conduit en Égypte et à Jérusalem en passant, au retour, par Constantinople et l'Italie, nourrira ses écrits ultérieurs de ses observations, de ses expériences et de ses impressions, par exemple dans Hérodias. Les premiers romans Le 19 septembre 1851, Flaubert, encouragé par ses amis Louis Bouilhet et Maxime Du Camp commence la rédaction de Madame Bovary, en s'inspirant d'un fait divers normand Delphine Delamare. Il achèvera son roman réaliste et psychologique en mai 1856 après 56 mois de travail. Il fréquente épisodiquement les salons parisiens les plus influents du Second Empire, comme celui de Madame de Loynes dont il est très amoureux ; il y rencontre entre autres George Sand. À la fin de l'année 1856, Madame Bovary paraît dans La Revue de Paris puis, après avoir rencontré l'éditeur Michel Lévy15, le roman sort en librairie en avril 1857 et fait l’objet d’un procès retentissant pour atteinte aux bonnes mœurs : Flaubert est acquitté grâce à ses liens avec la société du Second Empire et avec l'impératrice, ainsi qu'à l'habileté de son avocat, tandis que Baudelaire, poursuivi par le même tribunal, pour les mêmes raisons, après publication de son recueil Les Fleurs du mal dans la même année 1857, est condamné16. À partir de la parution de Madame Bovary Flaubert poursuit une correspondance avec Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, femme de lettres vivant à Angers, et dévouée aux pauvres. Flaubert se partage dès 1855 entre Croisset et Paris où il fréquente les milieux littéraires et côtoie les frères Goncourt, Sainte-Beuve, Baudelaire, Théophile Gautier puis, à partir de 1863, Tourgueniev et la Princesse Mathilde. Le 1er septembre 1857, Flaubert entame la rédaction de Salammbô, roman historique qui évoque la Guerre des Mercenaires à Carthage, conflit s'étant déroulé entre les première et seconde guerres puniques. Pour cela, il voyage au cours des mois d'avril et juin 1858 en Tunisie afin de se documenter et de voir Carthage. Le roman paraît après une longue maturation en 1862. Deux ans plus tard, le 1er septembre 1864, Flaubert entreprend la version définitive de L'Éducation sentimentale, roman de formation marqué par l'échec et l'ironie avec des éléments autobiographiques comme la première passion amoureuse ou les débordements des révolutionnaires de 1848. Le roman est publié en novembre 1869 : mal accueilli par la critique il ne s'en vend que quelques centaines d'exemplaires. Flaubert continue sa vie mondaine : il rencontre l'empereur, reçoit la Légion d'honneur en 1866 et resserre ses liens avec George Sand qui le reçoit à Nohant. En juillet 1869, il est très affecté par la mort de son ami Louis Bouilhet. Rien ne permet d'affirmer qu'il ait été l'amant de la mère de Guy de Maupassant, sœur de son ami d'enfance, Alfred Le Poittevin, bien que dans son livre, La Vie érotique de Flaubert, publié en 1984 par Jean-Jacques Pauvert, Jacques-Louis Douchin l'affirmât. Quoi qu'il en soit, Flaubert sera très proche du jeune Maupassant qui le considèrera comme un père spirituel. Les dernières années Durant l'hiver 1870-1871, les Prussiens occupant une partie de la France dont la Normandie et Croisset, Flaubert se réfugie avec sa mère chez sa nièce, Caroline, à Rouen ; sa mère meurt le 6 avril 1872. À cette époque, il a des difficultés financières liées à la faillite de son neveu par alliance : il vend ses fermes et quitte par économie son appartement parisien alors que sa santé devient délicate. Il achève et publie toutefois le 1er avril 1874 la troisième version de La Tentation de saint Antoine, juste après l'échec de sa pièce de théâtre Le Candidat en mars 1874. Sa production littéraire continue avec les Trois contes, volume qui comporte trois nouvelles : Un cœur simple, centré sur la figure de Félicité inspirée par Julie, nourrice puis domestique qui servira la famille Flaubert, puis Gustave seul jusqu'à la mort de ce dernier, - La Légende de saint Julien l'Hospitalier, conte hagiographique des temps médiévaux écrit en cinq mois en 1875, et Hérodias autour de la figure de saint Jean Baptiste, écrit dans l'hiver 1875-1876. La publication du volume le 24 avril 1877 est bien accueillie par la critique. De 1877 à 1880, il poursuit la rédaction de Bouvard et Pécuchet, qu'il avait entamée en 1872-1874 : l'œuvre satirique pour laquelle il réunissait une documentation immense restera inachevée, elle sera publiée en l'état dans l'année 1881, un an après sa mort. Ses dernières années sont assombries par la disparition de ses amis, les difficultés financières et par des problèmes de santé. Il meurt subitement le 8 mai 1880, à Canteleu, au hameau de Croisset, foudroyé par une hémorragie cérébrale. Son enterrement au cimetière monumental de Rouen se déroule le 11 mai 1880, en présence de nombreux écrivains importants qui le reconnaissent comme leur maître, qu'il s'agisse d'Émile Zola, d'Alphonse Daudet, d'Edmond de Goncourt, de Théodore de Banville ou de Guy de Maupassant, dont il avait encouragé la carrière depuis 1873. La Bibliothèque historique de la ville de Paris possède le manuscrit de l'Éducation sentimentale ainsi que 36 carnets de notes de voyages et de lectures écrites de la main de l'écrivain. Ce fonds a été légué par sa nièce en 1931. Les quatre piliers de l'œuvre flaubertienne Flaubert est le contemporain de Charles Baudelaire et il occupe, comme le poète des Fleurs du mal une position charnière dans la littérature du XIXe siècle. À la fois contesté pour des raisons morales et admiré de son temps pour sa force littéraire, il apparaît aujourd'hui comme l'un des plus grands romanciers de son siècle avec en particulier Madame Bovary, roman qui fonde le bovarysme, puis L'Éducation sentimentale ; il se place entre le roman psychologique Stendhal, et le mouvement naturaliste Zola – Maupassant, ces derniers considérant Flaubert comme leur maître. Fortement marqué par l'œuvre d’Honoré de Balzac dont il reprendra les thèmes sous une forme très personnelle L'Éducation sentimentale est une autre version du Lys dans la vallée, Madame Bovary s'inspire de La Femme de trente ans, il s'inscrit dans sa lignée du roman réaliste. Il est aussi très préoccupé d'esthétisme, d'où son long travail d'élaboration pour chaque œuvre il teste ses textes en les soumettant à la fameuse épreuve du gueuloir, qui consiste à les lire à pleine voix. Mais il est tellement obsédé par l'exemple d’Honoré de Balzac, son père littéraire, que l'on retrouvera dans ses notes cette injonction : s'éloigner du Lys dans la vallée, se méfier du Lys dans la vallée. On a également souvent souligné la volonté de Flaubert de s'opposer à l'esthétique du roman-feuilleton, en écrivant un roman de la lenteur. Enfin, son regard ironique et pessimiste sur l'humanité fait de lui un grand moraliste. Son Dictionnaire des idées reçues donne un aperçu de ce talent. Sa correspondance avec Louise Colet, George Sand, Maxime Du Camp et d'autres a été publiée en cinq volumes dans la Bibliothèque de la Pléiade. Madame Bovary Flaubert commence le roman en 1851 et y travaille pendant 5 ans, jusqu’en 1856. À partir d’octobre, le texte est publié dans la Revue de Paris sous la forme de feuilleton jusqu’au 15 décembre suivant. En février 1857, le gérant de la revue, Léon Laurent-Pichat, l’imprimeur et Gustave Flaubert sont jugés pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Défendu par l’avocat Jules Sénard, malgré le réquisitoire du procureur Ernest Pinard, Gustave Flaubert est blâmé pour le réalisme vulgaire et souvent choquant de la peinture des caractères, mais est finalement acquitté notamment grâce à ses soutiens dans le milieu artistique et politique, la notoriété de sa famille et la plaidoirie de son avocat. Le roman connaîtra un important succès en librairie. Honoré de Balzac avait déjà abordé le même sujet dans La Femme de trente ans en 1831 sous forme de nouvelle-roman qui parut en 1842 dans l’édition Furne de La Comédie humaine, sans toutefois faire scandale. Le récit débute ainsi. Après avoir suivi ses études dans un lycée de province, Charles Bovary s'établit comme officier de santé et se marie à une riche veuve. À la mort de celle-ci, Charles épouse une jeune femme, Emma Rouault, élevée dans un couvent, vivant à la ferme avec son père un riche fermier, patient du jeune médecin. Emma se laisse séduire par Charles et se marie avec lui. Fascinée par ses lectures romantiques d'adolescence, elle rêve d’une nouvelle vie, méprisant son mari, délaissant son rôle maternel et elle fait la rencontre d'amants méprisables qui vont faire basculer sa famille. Salammbô Salammbô vient après Madame Bovary. Flaubert en commence les premières rédactions en septembre 1857. Quelques mois plus tôt, après avoir gagné le procès qui avait été intenté contre Madame Bovary, il avait fait part dans sa correspondance lettre à Mlle Leroyer de Chantepie de son désir de s’extirper littérairement du monde contemporain, et de travailler à un roman dont l’action se situe trois siècles avant Jésus-Christ. En avril-juin 1858, il séjourne à Tunis pour s’imprégner du cadre de son histoire. Si l’intrigue est une fiction, il se nourrit des textes de Polybe, Appien, Pline, Xénophon, Plutarque, et Hippocrate pour peindre le monde antique et bâtir la couleur locale. Dès sa parution en 1862, le roman connaît un succès immédiat, en dépit de quelques critiques réservées Charles-Augustin Sainte-Beuve, mais avec d’appréciables encouragements Victor Hugo, Jules Michelet, Hector Berlioz. Le roman débute par le paragraphe intitulé « Le Festin ». Les mercenaires fêtent à Carthage la fin de la guerre dans les jardins d’Hamilcar, leur général. Échauffés par son absence et par le souvenir des injustices qu’ils ont subies de la part de Carthage, ils ravagent sa propriété ; Salammbô, sa fille, descend alors du palais pour les calmer. Mathô et Narr’havas, tous deux chefs dans le camp des mercenaires, en tombent amoureux. Spendius, un esclave libéré lors du saccage, se met au service de Mathô et lui conseille de prendre Carthage afin d’obtenir Salammbô. L’Éducation sentimentale Le roman, rédigé à partir de septembre 1864 et achevé le 16 mai 1869 au matin, comporte de nombreux éléments autobiographiques tels la rencontre de Madame Arnoux, inspirée de la rencontre de Flaubert avec Élisa Schlésinger. Il a pour personnage principal Frédéric Moreau, jeune provincial de dix-huit ans venant faire ses études à Paris. De 1840 à 1867, celui-ci connaîtra l’amitié indéfectible et la force de la bêtise, l’art, la politique, les révolutions d’un monde qui hésite entre la monarchie, la république et l’empire. Plusieurs femmes Rosanette, Mme Dambreuse traversent son existence, mais aucune ne peut se comparer à Marie Arnoux, épouse d’un riche marchand d’art, dont il est éperdument amoureux. C’est au contact de cette passion inactive et des contingences du monde qu’il fera son éducation sentimentale, qui se résumera pour l’essentiel à brûler, peu à peu, ses illusions. Bouvard et Pécuchet Le projet de ce roman remonte à 1872, puisque l'auteur affirme son intention comique dans un courrier à George Sand. Dès cette époque, il songe à écrire une vaste raillerie sur la vanité de ses contemporains. Entre l'idée et la rédaction interrompue par sa mort, il a le temps de collecter une impressionnante documentation : on avance le chiffre de mille cinq cents livres. Lors de l'écriture, Flaubert avait songé au sous-titre : encyclopédie de la bêtise humaine et c'est effectivement en raison du catalogue qu’il nous en propose que le roman est célèbre. Le comique vient de la frénésie des deux compères, à tout savoir, tout expérimenter, et surtout leur incapacité à comprendre correctement. Le roman est inachevé et ne constitue que la première partie du plan. L'accueil fut réservé, mais certains le considèrent comme un chef-d'œuvre. Par une chaude journée d'été, à Paris, deux hommes, Bouvard et Pécuchet, se rencontrent par hasard sur un banc et font connaissance. Ils découvrent que, non seulement ils exercent le même métier copiste, mais en plus qu'ils ont les mêmes centres d'intérêts. S'ils le pouvaient, ils aimeraient vivre à la campagne. Un héritage fort opportun va leur permettre de changer de vie. Ils reprennent une ferme dans le Calvados, non loin de Caen et se lancent dans l'agriculture. Leur inaptitude ne va engendrer que des désastres. Ils vont s'intéresser à la médecine, la chimie, la géologie, la politique avec les mêmes difficultés. Lassés par tant d'échecs, ils retournent à leur métier de copiste. Critiquant les idées reçues, Flaubert montre que contrairement à ce que pense Hegel, l'Histoire n'a pas de fin, elle est un éternel recommencement. Les deux compères, qui étaient copistes au début du roman, retournent à leur état. Œuvres Gustave Flaubert Un parfum à sentir, 1836 Rêve d'enfer, 1836 Mémoires d'un fou, 1838 Smarh, 1839 Madame Bovary, 1857 et 1930 éd. suivie des actes du procès Salammbô, 1862 et 1874 éd. définitive L'Éducation sentimentale, 1869 Le Candidat vaudeville, 1874 La Tentation de saint Antoine, 1874 et 1903 éd. définitive Trois contes : Un cœur simple, La Légende de saint Julien l'Hospitalier, Hérodias, 1877 Le Château des cœurs théâtre, 1880 Bouvard et Pécuchet inachevé, 1881 Par les champs et les grèves Voyage en Bretagne, 1886 Mémoires d'un fou, 1901 À bord de la Cange, 1904 Œuvres de jeunesse inédites, 1910 Dictionnaire des idées reçues, 1913 Premières œuvres, 4 vol., 1914-1920 Novembre, 1928 mais 1842 Souvenirs, notes et pensées intimes 1838-1841, 1965 Album, annoté par Jean Bruneau et Jean A. Ducourneau, 1972 Bibliomanie et autres textes 1836-1839, 1982 Lettres Lettre à la municipalité de Rouen, 1872 Lettres à George Sand, 1884 Correspondance, 4 vol., 1887-1893 Lettres à sa nièce Caroline, 1906 Lettres inédites à Georges Charpentier, 1911 Lettres inédites à la princesse Mathilde, 1927 Correspondance, 9 vol. 1926-1933 et Supplément, 4 vol. 1954 Lettres inédites à Tourgueneff, 1946 Lettres inédites à Raoul Duval, 1950 Lettres d'Orient, 1990 Lettres à Louise Colet, 2003 Correspondance, présentée, établie et annotée par Jean Bruneau, 6 vol. : tome I (1830-1851), 1973 ; t. II (1851-1858), 1980 ; t. III (1859-1868), 1991 ; t. IV 1869-1875, 1998 ; t. V 1875-1880, 2007 ; Index, 2007 (éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade). Édition en ligne-Université de Rouen Recueils Œuvres complètes, 8 vol., 1884 éd. Quantin Œuvres, 10 vol., 1874-1885 éd. Lemerre Œuvres complètes, 13 vol., 1926-33 éd. Conard Œuvres complètes illustrées, 10 vol., 1921-25 Œuvres, 2 vol. 1936, établies et annotées par Albert Thibaudet et René Dumesnil éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade Œuvres complètes, 1940-1957 éd. Les Belles Lettres Œuvres complètes, 2 vol. 1964 éd. Seuil Œuvres complètes, 18 vol., 1965, annotées par Maurice Nadeau Œuvres complètes, 16 vol., 1975 éd. Études littéraires françaises Œuvres complètes, 16 vol., 1971-1975, annotées par Maurice Bardèche Œuvres complètes, annotées par Claudine Gothot-Mersch et Guy Sagnes, 5 vol. : tome I, Œuvres de jeunesse, 2001 ; t. II, Œuvres complètes (1845-1851), 2013 ; t.III, Œuvres complètes 1851-1862, 2013 ; t. IV-V, en préparation (éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade Postérité Numismatique Gustave Flaubert figure sur une pièce de 10 € en argent édité en 2012 par la Monnaie de Paris pour représenter sa région natale, la Haute-Normandie. Cérémonies du centenaire Centenaire de la naissance de Gustave Flaubert : cérémonies du 12 décembre 1921 ; Discours de M. Edmond Haraucourt, Paul Bourget et Albert Mockel    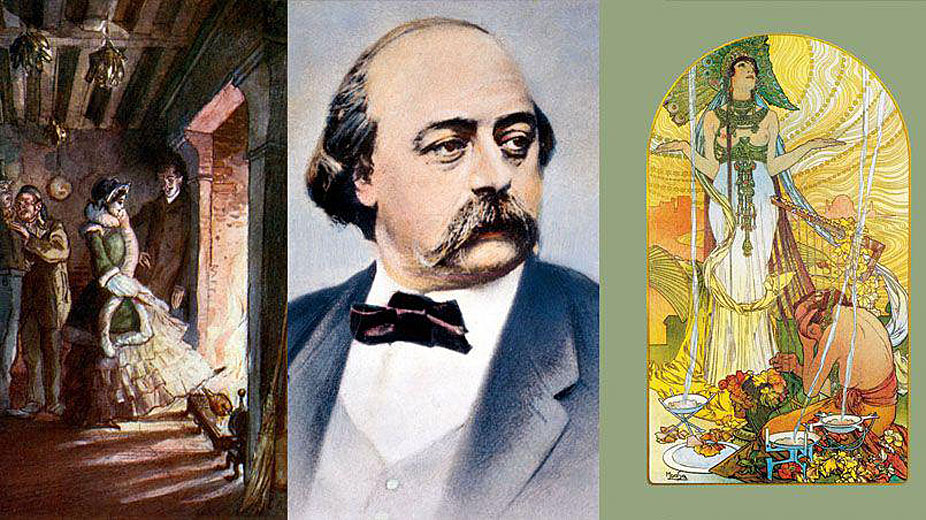  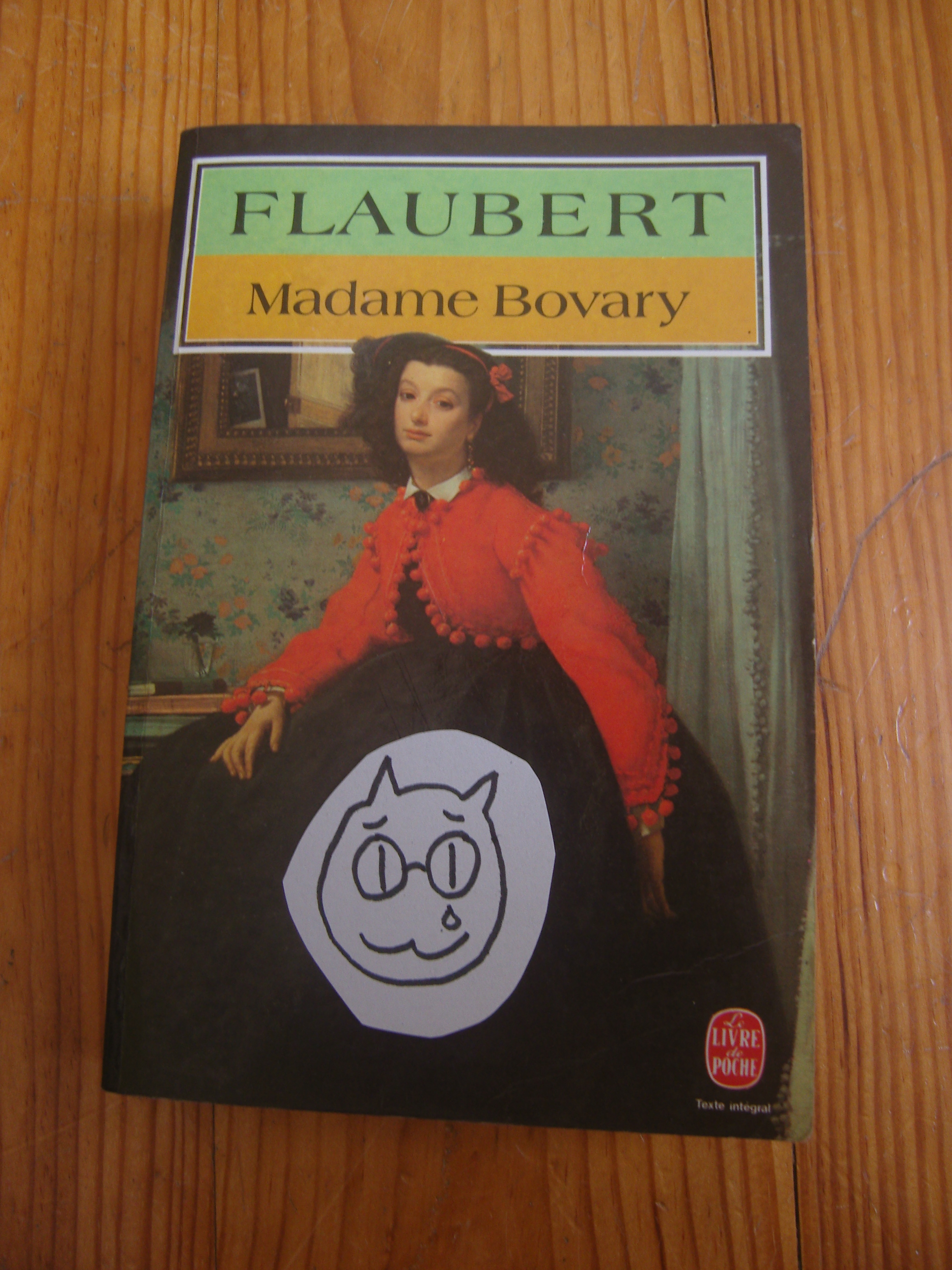 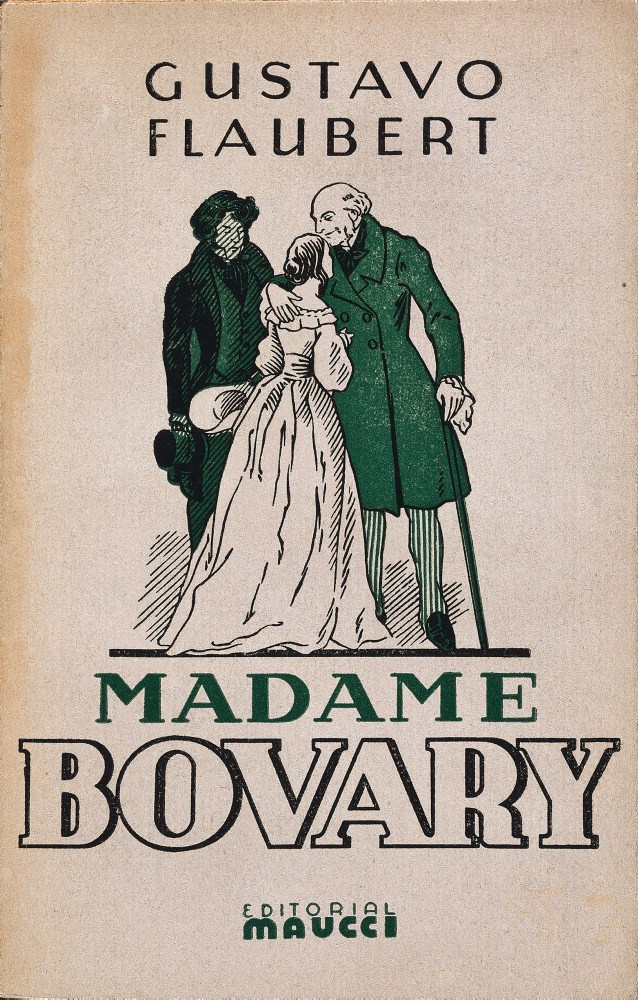 
#56
Jacques Chastenet de Castaing
Loriane
Posté le : 06/02/2016 20:02
Le 7 février 1978 à Paris 9e meurt Jacques Chastenet de Castaing
journaliste, diplomate, historien français né le 20 avril 1893 à Paris 8e. Il est membre de l'Académie française à partir de 1956 Son père est Guillaume Chastenet de Castaing LE TEMPS . Journal qui n'est plus guère connu aujourd'hui que comme l'antécédent du Monde. Le titre en était apparu en 1829, mais c'est en 1861 qu'il renaît pour devenir, après avoir été modérément oppositionnel sous l'Empire, l'organe le plus influent sous la IIIe République, prenant la place jusqu'alors tenue par le Journal des débats. Parmi ses directeurs, du fondateur Auguste Nefftzer à Jacques Chastenet (d'ailleurs historien de la IIIe République), c'est Adrien Hébrard qui, à la fin du XIXe siècle, lui imposa le plus sa marque : son conseil aux rédacteurs (à peu près tous pigistes) — « Messieurs, faites emmerdant » — est demeuré célèbre. Expression d'une recherche presque maniérée de l'austérité, mais aussi réaction salutaire contre la vulgarité ou la facilité des nouveaux grands de la presse quotidienne (Le Petit Parisien, Le Journal) et le sensationnalisme agressif et diffamatoire du Matin, dont le maître, Bunau-Varilla, affirmait sérieusement : « Mon fauteuil vaut deux trônes. » La réputation d'exactitude, dans l'information contribuera à l'autorité du journal, dont les positions seront généralement nuancées mais qui, non sans débats, s'affirme dreyfusard, puis, après l'affaire des Fiches, hostile au combisme. Les années passant, il apparaît, surtout après la Première Guerre mondiale, comme un organe officieux de la diplomatie française (André Tardieu sera chef du service étranger) et, dans les années 1930, comme celui de la grande industrie (Comité des forges). En 1938, il approuve les accords de Munich. Retranché en zone sud après l'armistice de 1940, avec moins de prudence que son confrère et concurrent Le Figaro, il attend pour se saborder la fin de novembre 1942 ; aussi figurera-t-il, malgré maintes interventions, au nombre des journaux interdits à la Libération. Ce n'en sont pas moins des collaborateurs du Temps qui fournissent au Monde ses premiers cadres. Pierre Albin Martel Sa vie Fils du député puis sénateur de la Gironde Guillaume Chastenet de Castaing, Jacques Chastenet, après des études secondaires au lycée Condorcet, étudie à la Sorbonne licencié ès lettres, en histoire , à la Faculté de droit et à l'École libre des sciences politiques, d'où il sort second de la section finances publiques. Mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, il sert comme officier d'artillerie et termine la guerre avec la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Il termine ensuite ses études: il est docteur en droit. Il réussit aussi le concours des affaires étrangères; il est reçu premier. Diplomate, hommes d'affaires, journaliste et directeur de journal Il entre ensuite dans la carrière diplomatique, durant quelques années, comme secrétaire d'ambassade. En 1921, il est secrétaire général de la Haute Commission militaire alliée des territoires rhénans. Il abandonne ensuite la "carrière" pour les affaires et le journalisme. Il se spécialise dans la politique étrangère: il est rédacteur diplomatique à l'Opinion 1924-30 puis à la Revue politique et parlementaire de 1930 à 1931. En même temps, il se met au service des industriels du charbon: il est sous-directeur du Groupement des houillères du Nord et du Pas-de-Calais puis directeur de 1924 à 1930 de l'Union des mines, une filiale financière du Comité central des houillères de France. Et aussi administrateur de diverses sociétés liées à l'Union des mines. C'est à ce double titre qu'il est choisi en 1931 par les propriétaires du quotidien Le Temps, – Henri de Peyerimhoff de Fontenelle, du Comité central des houillères de France, et François de Wendel, du Comité des forges, – pour devenir codirecteur de ce journal influent, aux côtés d'Émile Mireaux ; ce que d'aucuns, à l'époque, voient comme une mainmise du patronat houiller et sidérurgique sur le quotidien. Le 28 novembre 1942, en réponse à l'invasion allemande de la zone Sud, les deux codirecteurs "sabordèrent" le journal. Historien académique et engagé après la guerre Il est élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 1947 et à l’Académie française en novembre 1956. Il joue encore un rôle politique après guerre en étant notamment conseiller de l’Union française entre 1952 et 1958, désigné par le groupe des indépendants droite . Il collabore à plusieurs périodiques, Écrits de Paris, l'hebdomadaire anticommuniste Exil et liberté, Paris-Presse - il propose en 1953 un retrait partiel de l'Indochine et que les soldats français y soient remplacés par l'armée américaine - et aussi La Revue des deux mondes, fief de la droite académique. Membre du comité supérieur du Centre des hautes études américaines, il cosigne en 1954 et en 1962 les appels à l'union atlantique avec les États-Unis lancés par le Mouvement pour l'union atlantique. Il est aussi membre du Conseil français du Mouvement européen, vice-président puis président d'honneur de la Ligue européenne pour la coopération économique et président du Comité France-Amérique en 1967-6810. En octobre 1960, il signe un manifeste d'intellectuels partisans de l'Algérie française et hostiles au Manifeste des 1211. Il est ensuite membre du comité de patronage de l'Union française pour l'amnistie. Attaché à sa région d'origine, il possédait une propriété de famille près de Libourne Gironde, sur la commune de Saillans. Il fut nommé président d'honneur de la Société historique et archéologique de Libourne en 1957. Son épouse est décédée en 1987. Œuvres 1918 Du Sénat constitué en Cour de Justice 1941 William Pitt Fayard 1943 Godoy, Prince de la Paix Fayard 1945 Vingt ans d’histoire diplomatique, 1919-1939 (Le Milieu du monde 1945 Wellington Fayard 1946 Le Parlement d’Angleterre Fayard 1946 Les Grandes heures de Guyenne Colbert 1947 Le Siècle de Victori Julliard 1949 La France de M. Fallières Fayard 1952 Histoire de la IIIe République, Tome I. L’Enfance de la Troisième 1870--1879 Hachette 1953 Elisabeth Ire Fayard 1954 Histoire de la IIIe République, Tome II. La République des Républicains 1879-1893 Hachette 1955 Histoire de la IIIe République, Tome III. La République triomphante 1893-1906 Hachette 1956 Winston Churchill 1957 Histoire de la IIIe République, Tome IV. Jours inquiets et jours sanglants 1906-1918 Hachette 1958 Quand le bœuf montait sur le toit 1960 Histoire de la IIIe République, Tome V. Les Années d’illusion 1918-*1931 Hachette 1961 La vie quotidienne en Angleterre au début du Règne de Victoria, 1837-1851 Hachette 1962 Histoire de la IIIe République, Tome VI. Déclin de la Troisième 1931-1938 Hachette 1963 Histoire de la IIIe République, Tome VII. Le drame final 1938-1940 Hachette 1964 La guerre de 1914-1918 Hachette 1965 L’Angleterre d’aujourd’hui Calmann-Lévy 1966 La vie quotidienne en Espagne au temps de Goya 1967 Histoire de l’Espagne 1967 En avant vers l’Ouest. La conquête des États-Unis par les Américains 1968 Léon Gambetta 1970 De Pétain à de Gaulle Fayard 1970 Cent ans de République, 9 vol. Tallandier 1974 Quatre fois vingt ans Plon Distinctions et décorations Grand officier de la Légion d'honneur Grand-Croix de l'ordre national du Mérite Croix de guerre 1914-1918 Commandeur des Palmes académiques Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique Liens externes et sources Notice biographique de l'Académie française Réception de J. Chastenet à l'Académie: discours de Léon Bérard Discours prononcé pour la mort de J. Chastenet par le duc de Castries à l'Académie Notices d'autorité : Fichier d'autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale de la Diète • WorldCat 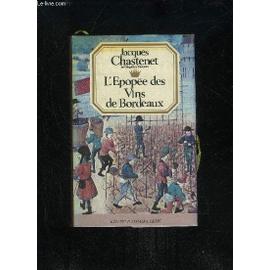   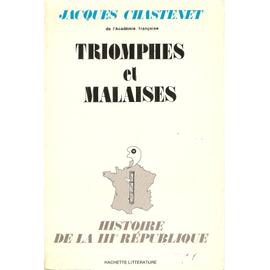 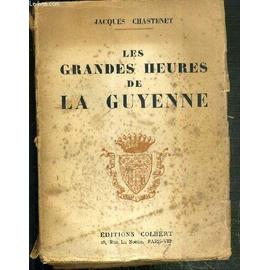 
#57
Laura Elisabeth Ingalls Wilder
Loriane
Posté le : 06/02/2016 19:07
Le 7 février 1867 naît Laura Elisabeth Ingalls Wilder
née à Pepin dans le Wisconsin, morte à Mansfield dans le Missouri le 10 février 1957, à 90 ans, écrivain américaine, auteur de la série de romans pour enfants La Petite Maison dans la prairie, inspirée par sa propre enfance au sein d'une famille de pionniers américains à la fin du XIXe siècle. Cette succession de livres a été popularisée par la série américaine La Petite Maison dans la prairie, dans laquelle l'actrice Melissa Gilbert jouait le rôle de Laura. Sa vie Fille de Charles et de Caroline Ingalls, Laura Elizabeth Ingalls naquit le 7 février 1867 près de Pepin, dans le Wisconsin. Elle est la deuxième de leurs cinq enfants : Mary, Laura, Carrie, Freddy et Grace. Bien qu’étant une élève intelligente et brillante, son éducation fut sporadique étant donné que sa famille déménagea de nombreuses fois à travers le Midwest et vivait souvent dans des endroits isolés où il n’y avait pas encore d’école. En 1868, les Ingalls quittèrent Pepin pour s’installer à Chariton County dans le Missouri. Un an plus tard, ils s’installèrent à Independence, dans le Kansas, où Laura apprit à écrire. En 1871, ils retournèrent à Pepin, où Laura et sa sœur Mary furent inscrites à la Barry Corner School. Au bout de trois ans, ils quittèrent définitivement la ville et partirent pour Walnut Grove, dans le Minnesota. Ils habitèrent d’abord dans une maison creusée dans la berge d’un ruisseau, jusqu’à ce qu’ils eussent fini de construire leur maison. Ils quittèrent brièvement la ville, de 1876 à 1877, pour vivre à Burr Oak, dans l’Iowa, où Charles travailla dans un hôtel puis dans un moulin, puis ils déménagèrent dans le Dakota où ils passèrent leurs hivers en ville, à De Smet. Laura commença alors à travailler comme couturière pour aider financièrement sa famille. Charles avait trouvé un travail dans une compagnie de chemin de fer. Suivit un hiver très difficile, où l’on mourait presque de faim. Laura fréquentait plus régulièrement l’école, où elle aimait particulièrement l’anglais, l’histoire et la poésie. Elle devint institutrice à l’âge de seize ans et fut engagée à la Bouchie School. Après trois ans de fiançailles, Laura épousa le frère de son ancienne institutrice, le fermier Almanzo Wilder, le 25 août 1885. Elle dut arrêter son métier, car à son époque, les femmes mariées n’étaient pas autorisées à enseigner. Leur fille, Rose, naquit le 5 décembre 1886. La petite Rose fut suivie d’un fils, mort rapidement après sa naissance, en août 1889. Cet événement tragique fut le premier d’une série, puisque Almanzo, atteint de la diphtérie, resta partiellement paralysé aux jambes et eut besoin d’une canne jusqu’à la fin de ses jours. Puis leur maison et leur grange furent détruites par le feu. Et enfin, plusieurs années de sécheresse les laissèrent endettés. Atteints par la maladie et par conséquent incapables de gagner leur vie, les Wilder restèrent une année chez les parents d’Almanzo à Spring Valley, dans le Minnesota, où ils purent se reposer. En 1891, ils s’installèrent brièvement à Westville dans le comté de Holmes Floride, où vivait le cousin de Laura. Le climat de Floride devait améliorer la santé d’Almanzo, mais Laura, qui avait l’habitude de vivre dans les plaines sèches, ne supportait pas la chaleur et l’humidité méridionale, et les Wilder retournèrent donc en 1892 à De Smet, où ils louèrent une petite maison. En 1894, ils se fixèrent définitivement à Mansfield, dans le Missouri. Ils y achetèrent une parcelle de terre où ils construisirent une maison, qu’ils appelèrent la Rocky Ridge Farm, où Laura et Almanzo finirent leur existence. Ils y élevèrent de la volaille et y cultivèrent des fruits. Laura commença à écrire des articles pour le Missouri Ruralist, ainsi que pour d’autres magazines. Sa fille, Rose, l’encouragea alors à écrire ses mémoires. Elle rédigea ainsi son autobiographie en 1930 et l’intitula Pioneer Girl2. Elle ne trouva pas d’éditeur, le récit était trouvé trop dur. Elle la réécrivit donc en partie et la publia sous le titre de La Petite Maison dans les grands bois3. Le livre rencontra un succès immédiat, ce qui encouragea Laura à écrire la suite de ses aventures et de celles de sa famille. Il en résulta la série télévisée La Petite Maison dans la prairie diffusée à partir de 1974. Almanzo mourut le 23 octobre 1949 à Mansfield, à l'âge de 92 ans. Laura s’éteignit pendant son sommeil le 10 février 1957 à la Rocky Ridge Farm. Elle avait alors 90 ans et trois jours. Bibliographie Melissa Gilbert enfant jouant le rôle de Laura Ingalls. 1932 : La Petite Maison dans les grands bois Little House in the Big Woods 1933 : Un enfant de la terre Farmer Boy 1935 : La Petite Maison dans la prairie Little House on the Prairie 1937 : Au bord du ruisseau On the Banks of Plum Creek 1939 : Sur les rives du lac By the Shores of Silver Lake 1940 : Un hiver sans fin The Long Winter 1941 : La Petite Ville dans la prairie Little Town on the Prairie 1943 : Ces Heureuses Années These Happy Golden Years 1962 : On the Way Home posthume, non traduit en français 1971 : Les Jeunes Mariés The First Four Years posthume 1974 : West From Home posthume, non traduit en français Filmographie 1974-1983 : La Petite Maison dans la prairie Little House on the Prairie de Michael Landon 2000-2002 : La Véritable Histoire de Laura Ingalls (Beyond the Prairie : The True Story of Laura Ingalls Wilder) de Marcus Cole 2005 : La Petite Maison dans la prairie Little House on the Prairie de David L. Cunningham       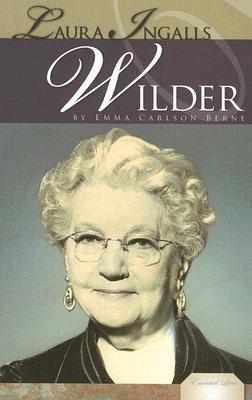
#58
Alexandro Jodorowsky
Loriane
Posté le : 06/02/2016 14:25
Le 7 février 1929 naît Alejandro ou Alexandro Jodorowsky
dit Jodo à Tocopilla Chili, réalisateur, romancier, poète, scénariste de bande dessinée, acteur, auteur d’une poignée de films ésotériques, surréalistes et provocateurs ; il est également auteur de performances Panique groupe actionniste qu’il crée avec Roland Topor et Fernando Arrabal, mime, romancier, essayiste, poète et prolifique scénariste de bande dessinée, chilien et français. Sa vie Alejandro Jodorowsky est né le 7 février 1929 d'une famille juive originaire de Iekaterinoslav actuellement Dnipropetrovsk, d'Elisavetgrad actuellement Kirovohrad ainsi que d'autres villes ukrainiennes de l'Empire russe, réfugiée au Chili pour fuir les pogroms. À l'âge de quatre ans, le premier mot qu'il a lu est œil. À partir de cet âge-là, il sait parfaitement lire et à 9 ans, il a fini de lire toute la bibliothèque municipale, surtout les romans d'aventures. À 19 ans, il découvre Franz Kafka et Fiodor Dostoïevski. Il crée ensuite un théâtre de marionnettes et fait le clown dans un cirque. Son père voulait qu'il devienne médecin mais en 1953, il quitte le Chili pour Paris, et travaille avec le mime Marceau pour lequel il écrit Le fabricant de masques. Il met ensuite en scène Maurice Chevalier. En 1962, il crée le groupe Panique avec Roland Topor et Fernando Arrabal, en réaction au mouvement surréaliste. En 1965, il fonde au Mexique le théâtre d’avant-garde de Mexico. Il y tourne trois films, Fando et Lis, El Topo et La Montagne sacrée, ce dernier inspiré du Mont Analogue de René Daumal. À partir des années 1980, il anime dans divers lieux de Paris comme une université, un bar ou un dojo une réunion ouverte hebdomadaire, intitulée « Le Cabaret mystique », où il témoigne — dans l’esprit d’une agora ouverte à ses auditeurs — de thèmes touchant à l’éveil intérieur comme la pratique du zen qu’il étudia avec Ejo Takata), les arts martiaux, la tradition chilienne, l’héritage spirituel de l’humanité, le massage, la sagesse des blagues, la psychanalyse, Carlos Castaneda… Les univers qu’il développe sont en général des univers de science-fiction, voire des mondes fantastiques. Ses histoires se caractérisent par la présence de nombreuses métaphores et symboles, auxquels il mêle souvent une description sociale ; on pense par exemple aux révoltes contre la dictature dans L'Incal, la reconstitution de la colonisation du Mexique par les conquistadores des crapauds dans La Montagne sacrée ou encore la description des bas-fonds d’une grande ville et des religions populaires dans Santa sangre. Son parcours singulier est retracé dans deux ouvrages autobiographiques, Le Théâtre de la guérison et La Danse de la réalité Albin Michel. Il est le père de cinq enfants, Brontis, acteur El Topo, La danse de la réalité, Teo, Cristobal psicoshaman et acteur Santa Sangre et personnage principal dans le film documentaire Quantum Men sur psicoshamanism, et musicien Adan Jodorowsky le plus jeune, connu sous le nom de scène de Adanowsk. Il a aussi une fille, Eugenia. Études et travaux sur le tarot Jodorowsky est également connu dans sa pratique du tarot divinatoire, pour lequel il a une approche plus jungienne, psychologique ou « psycho magique » qu’occultiste ou ésotériste. Son travail autour du Tarot dit de Marseille englobe de nombreuses conférences depuis les années 1980, et plusieurs ouvrages parmi lesquels on peut notamment citer La Voie du Tarot, en coécriture avec Marianne Costa. En outre il a créé – avec Philippe Tourrasse, dit Philippe Camoin descendant de Jean-Baptiste Camoin, qui avait en partie hérité par mariage et en partie racheté la fabrique des héritiers du célèbre cartier Nicolas Conver– une version modifiée et modernisée du tarot de Nicolas Conver à la fin des années 1990. La Voie du Tarot de Jodorowsky, éditions Albin Michel et la notice du Tarot de Marseille Jodorowsky-Camoin, éditions Camoin et Cie5, précisent quelques détails sur la création de ce jeu de tarot : entièrement redessiné informatiquement sur la base d'un tarot de Nicolas Conver pour modèle, avec des ajouts de détails provenant de divers autres jeux de tarots dit de Marseille, de Besançon et autres, ainsi que l'ajout de couleurs modernisées, ce jeu de tarot viserait – aux dires des auteurs – à « reconstituer le tarot tel qu'il était à son origine », mais cette affirmation ne cadre pas du tout avec l'état actuel des connaissances historiques sur les tarots. En effet, le modèle de Conver est une version assez tardive du motif dit de Marseille, les nouvelles couleurs utilisées par Jodorowsky et Camoin ne sont pas retrouvées sur les tarots anciens, des détails inédits ou issus de divers jeux ont été introduits, etc. Cinéma La carrière cinématographique de Jodorowsky commença en 1957, avec La Cravate, un court-métrage muet adapté d'une nouvelle, où Raymond Devos apparait. Il réalisa ensuite Fando et Lis en 1967, adaptant cette fois une pièce de théâtre de Fernando Arrabal, autre membre du mouvement Panique. Jodorowsky avait lui-même joué dans la pièce de théâtre au Mexique. Ce premier film, une adaptation très personnelle, levait le voile sur l'univers complexe du chilien. Fando et Lis projeté au festival du film d'Acapulco en 1968 provoqua une émeute où Alejandro Jodorowsky faillit être lynché. Ce premier accueil annoncait une carrière atypique. La dimension « mystique » grandissante de son œuvre lui apporta une certaine renommée. Ainsi, El Topo en 1970, sorte de western métaphysique, puis La Montagne sacrée en 1973 — très librement inspirée du Mont Analogue de René Daumal — allaient devenir des « films culte ». L'aura mystique unique d'El Topo attirait tous les soirs à minuit des spectateurs fervents, l'appellation de «Midnight movie» fut même créée pour El Topo. Le bouche à oreille fonctionna tellement bien que des stars comme John Lennon ou Andy Warhol vinrent voir le film à l'Elgin Theater. Allen Klein, le manager des Beatles en 1970, fut d'ailleurs le producteur de La Montagne Sacrée. Le film fut projeté au festival de Cannes en 1973 mais hors de la compétition officielle car aucun pays n'était attribué au film. Le tournage de La Montagne Sacrée au Mexique connut d'ailleurs les pires difficultés avec le gouvernement mexicain, qui demanda à Jodorowsky de ne pas mettre en scène une représentation quelconque de l'État ou de l'Église. Cette censure obligea Jodorowsky à fuir le Mexique pour les États-Unis. En 1975, Jodorowsky commença à travailler l'adaptation du roman Dune de Frank Herbert. Le projet comportait la participation d’Orson Welles, les décors de Mœbius et d'H.R. Giger, et des musiques de Pink Floyd, Tangerine Dream et Magma. Salvador Dalí avait accepté de jouer le rôle de l’empereur Padisha Shaddam IV. Malheureusement le projet tourna court quand les producteurs lâchèrent Jodorowsky. Quelques années plus tard, David Lynch tourna son propre Dune sans lien avec le projet de Jodorowsky6. Après Tusk 1978 et l’échec de l’adaptation de Dune, Jodorowsky s’éloigna du cinéma, réservant sa créativité pour la bande dessinée. Plus tard Santa Sangre 1989 et Le Voleur d'arc en ciel 1992, avec Peter O'Toole et Omar Sharif) lui permirent de renouer avec le cinéma et une nouvelle reconnaissance. Au début des années 2000, Jodorowsky, qui n’avait pas tourné depuis près de dix ans, tenta de donner une suite à El Topo : Les Fils d'El Topo The Sons of El Topo. À la suite de problèmes juridiques avec le producteur Allen Klein, le projet fut renommé AbelCain. Le réalisateur a affirmé plusieurs fois son intention de mener le projet à terme, mais on ignore si ce sera effectif. Dans la même période, Jodorowsky commença un autre projet, Triptyque Tryptych, encore inabouti. Un film coproduit par David Lynch, King Shot, était annoncé pour 2010. Marilyn Manson, Asia Argento et Nick Nolte étaient pressentis, mais, par manque de financement, le projet avorta . Alejandro Jodorowsky et l'écrivain espagnol Diego Moldes, Paris, 2008 En 2012, Jodorowsky fit un appel à dons par internet afin de produire un film autobiographique. La danza de la realidad, tourné dans son village natal, Tocopilla, sortit en septembre 2013, dans les circuits classiques de diffusion. Théâtre Le théâtre fut pour Alejandro Jodorowsky une véritable école, tout comme la pantomime et les marionnettes. Longtemps acteur avant d'être réalisateur, il interprèta le rôle principal de son second film El Topo et le rôle du maître alchimiste dans La Montagne Sacrée. Après avoir vécu à Paris, Jodorowsky vécut dans les années 1960 au Mexique, où il réalisa la majeure partie de ses films. Il y développa notamment le théâtre d'avant-garde de Mexico avec son ami Fernando Arrabal, complice du mouvement Panique dont il adapta la pièce Fando et Lis à l'écran, y créant des pièces de Samuel Beckett ou d'Eugène Ionesco. En 2001, Jodorowsky revint au théâtre, à la fois acteur, auteur et metteur en scène de son Opéra panique. En 2008 il écrivit L’École des ventriloques pour la Compagnie Point Zéro le spectacle est créé à Bruxelles en 2008 dans une mise en scène de Jean-Michel d'Hoop, et en 2009, pour son fils Brontis, Le Gorille, monologue inspiré de Communication à une académie de Franz Kafka, dont il assura la mise en scène création à Bruxelles en mai 2009. Bande dessinée Jodorowsky fit une première incursion dans la bande dessinée en 1966 avec Anibal 5, une saga illustrée par Moro. Mais c'est surtout dans les années 1980 que Jodorowsky travailla des scénarios de bande dessinée, principalement la série L'Incal, dessinée par Mœbius rencontré en 1975, avec lequel il travailla sur l’ébauche avortée de Dune. Associé au dessinateur Juan Giménez, il produisit La Caste des Méta-Barons, vaste saga du même monde que L’Incal, il y donne libre cours à ses théories sur l’importance de la lignée, le rôle de la paternité et de l’union entre deux amants. Une autre série, Les Technopères, en collaboration avec le dessinateur Zoran Janjetov (avec lequel il a déjà collaboré sur la série Avant l'Incal), reprend et développe ses mythes personnels. Il scénarise également la série Juan Solo, sorte de thriller où un jeune homme vit un parcours initiatique à travers la violence et l’immoralité dans une ville corrompue d’Amérique du Sud. Jodorowsky et Mœbius se retrouvèrent en 2000 pour réaliser Après l'Incal, qui aurait dû constituer le début de l’histoire de la troisième série dans la chronologie de L’Incal, mais qui reste inachevé avec un seul album Le Nouveau Rêve. Finalement, c'est en 2008 que Jodorowsky créa la dernière partie du triptyque de L'Incal, avec le premier tome de la série Final Incal dessinée par José Ladrönn. Il a été également le scénariste de la série du Lama Blanc dessiné par George Bess, racontant le parcours extraordinaire d'un enfant blanc, réincarnation du Grand Lama. Il a aussi collaboré avec François Boucq sur les séries Face de Lune et Bouncer ainsi qu’avec Arno, Covial et Marco Nizzoli sur deux séries – Les Aventures d'Alef-Thau et Le Monde d'Alef-Thau – dont le personnage principal, né enfant-tronc sans bras ni jambes, acquerra, au fur et à mesure des épisodes, une intégrité physique et spirituelle. De la collaboration avec le dessinateur Silvio Cadelo sont nés les deux volumes de la « saga d’Alandor », Le Dieu jaloux et l’Ange carnivore, combinant univers de fantasy baroque et quête spirituelle. Œuvres littéraires Bandes dessinées Séries Alandor Aliot Anibal Cinq Après l'Incal Avant l'Incal Les Aventures d'Alef-Thau Borgia Bouncer Castaka La Caste des Méta-Baron Le Cœur couronné Diosamante Face de lune Final Incal L'Incal Juan Solo Le Lama blanc Megalex Méta-Baron Le Monde d’Alef-Thau Ogregod Le Pape terrible Pietrolino Sang royal Showman Killer Les Technopères Le Lama Blanc Scénario : Alejandro Jodorowsky scénario& George Bess dessinateur - Dessin : Les Humanoïdes Associés 10/03/2010 Les Armes du Méta-Baron, Les Humanoïdes Associés, 2008 Scénario : Alejandro Jodorowsky - Dessin : Travis Charest et Zoran Janjetov Astéroïde hurlant, Les Humanoïdes Associés, 2006 Scénario : Alejandro Jodorowsky - Dessin et couleurs : collectif Griffes d’ange, Les Humanoïdes Associés, 1994 Scénario : Alejandro Jodorowsky - Dessin : Mœbius Le Trésor de l’ombre, Les Humanoïdes Associés, 1999 Scénario : Alejandro Jodorowsky - Dessin : François Boucq La vérité est au fond des rêves, Les Humanoïdes Associés, 1993 Scénario : Alejandro Jodorowsky - Dessin : Jean-Jacques Chaubin Les Yeux du chat, Les Humanoïdes Associés, 1978 Scénario : Alejandro Jodorowsky - Dessin : Mœbius Dramaturgie Opéra Panique, Métailié Suites, 42, Paris, 2001. Pièce contemporaine illustrant l’humour noir du mouvement Panique. L'École des ventriloques. Farce anarchiste et conte philosophique, écrit pour acteurs et marionnettes, pantins ou mannequins. Avant même la parution du texte en français éd. Maëlstrom, Bookleg, la pièce fut jouée en 2008 à Bruxelles au théâtre de la Balsamine bande annonce par la compagnie Point Zéro, dans une mise en scène de Jean-Michel d'Hoop, avec Natacha Belova à la création des costumes et marionnettes. Les Trois Vieilles, créé au Festival de Spa en 2009, mise en scène de Jean-Michel d'Hoop, avec Natacha Belova à la création des costumes et marionnettes. De nombreux textes pour le théâtre dont Jodorowsky est l’auteur n’ont été à ce jour ni traduits ni édités en français. Fables Les Araignées sans mémoire, Les Humanoïdes Associés, coll.La Bibliothèque Humanoïde, Paris, 1980; rééd. Albin Michel, 2010 Contes paniques, Le Relié, Gordes, 2006 Romans Le Paradis des perroquets, Flammarion Barroco, Paris, 1984 Enquête sur un chemin de terre, Acropole, Paris, L’Arbre du dieu pendu, Métailié Bibliothèque hispano-américaine, L’Enfant du Jeudi noir, Métailié Bibliothèque hispano-américaine, 2000 Albina et les hommes-chiens, Métailié Suites, 40, Paris, Poésie L’Échelle des anges, Le Relié, Gordes, 2001 ; rééd. Albin Michel, coll. Espaces libres, 2005 De ce dont on ne peut parler, Maelström, Bruxelles, 2002 Dire ne suffit pas, Le Veilleur, Paris Les Pierres du chemin, Maelström, Bruxelles, Le Veilleur, Paris, 2004 Solo de amor, Maelström, Bruxelles, 2007. Texte bilingue espagnol-français, traduction de Marianne Costa, David Giannoni et Laurence Tissot. Toutes les traductions de textes déjà publiés sont révisés Théâtre Théâtre sans fin, théâtre complet, Albin Michel, 2015 Essais La Sagesse des blagues, Éditions Vivez Soleil, Développement personnel, Genève, 1994 La Sagesse des contes, Vivez Soleil Développement personnel, Genève, 1997 ; réed. Albin Michel, coll. « Espaces libres », 2007 Le Doigt et la Lune, Albin Michel Espaces libres, 72, Paris, 1997 Un Évangile pour guérir, Le Relié, Gordes, Le Dieu intérieur, Le Relié, Gordes, 2003 Cabaret mystique, Albin Michel, Manuel de psychomagie, Albin Michel, Autobiographie La Tricherie sacrée entretiens avec Gilles Farcet, Dervy-Livres À mots ouverts, Paris, 1989. réédition augmentée Dervy, Paris, 2004 Le Théâtre de la guérison entretiens avec Gilles Farcet, Albin Michel, Paris, , réimp. 2001 La Danse de la réalité, Albin Michel, Paris, , réimp. 2004 Mu, le maître et les magiciennes, Éditions Albin Michel, , réed. 2008 De la cage au grand écran entretiens avec Jean-Paul Coillard, Éditions K-ïnite, 2009 Sur le tarot La Voie du tarot, en coécriture avec Marianne Costa Albin Michel, Paris, 2004 Le Chant du tarot, Le Relié, Gordes, Symbolique du tarot, Emeria, 2001, Gencod : 3760051680107 cédérom Filmographie Réalisateur Courts métrages 1957 : La Cravate 1965 : Teatro sin fin Longs métrages 1968 : Fando et Lis Fando y Lis 1970 : El Topo 1973 : La Montagne sacrée La Montaña sagrada 1980 : Tusk 1989 : Santa Sangre 1990 : Le Voleur d'arc-en-ciel The Rainbow Thief 2013 : La danza de la realidad Acteur Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 1957 : La Cravate de Alejandro Jodorowsky 1970 : El Topo de Alejandro Jodorowsky : El Topo 1973 : La Montagne sacrée de Alejandro Jodorowsky : L'alchimiste 2003 : Pas si grave de Bernard Rapp : Pablo 2006 : Musikanten de Franco Battiato : Ludwig van Beethoven 2012 : The Island de Kamen Kalev : Jodo 2013 : La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky : lui-même Discographie 1987 : Mariana Montalvo : Canta a Jodorowsky textes 2006 : Adanowsky : Étoile éternelle textes de deux chansons sur le disque de son fils Adan Prix et distinctions 1989 : Prix Harvey de la meilleure édition américaine d'une œuvre étrangère pour L'Incal(avec Mœbius. 1996 : Alph-Art du scénario au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême pour Juan Solo : Fils de flingue. 1998 : Prix Micheluzzi du meilleur volume réédition pour L'Incal lumière avec Mœbius. 2000 : Prix Micheluzzi de la meilleure bande dessinée pour La Caste des Méta-Barons avec Juan Giménez. 2001 : Prix Haxtur de la meilleure histoire longue pour La Cœur couronné avec Mœbius ; et de l'« auteur que nous aimons », pour l'ensemble de son œuvre 2003 : Éléphant d’Or du meilleur album de l’année et Prix du public pour Bouncer T, La Pitié des bourreaux Les Humanoïdes Associés. 2011 : Titre de « grand rectum » de l' Université de Foulosophie. 2013 : Prix Micheluzzi de la meilleure série étrangère pour Bouncer avec François Boucq. 2013 : L'astéroïde (261690) Jodorowsky est nommé en son honneur. Bibliographie et documentaires sur Alejandro Jodorowsk Livres Cobb, Ben (2007). Anarchy and Alchemy: The Films of Alejandro Jodorowsky (Persistence of Vision 6), ed. Louise Brealey, pref. de Alan Jones, introduction de Stephen Barber. London, 2007 / New York, 2007, Creation Books.(ISBN 1-84068-145-4) Coillard, Jean-Paul (2009), De la cage au grand écran. Entretiens avec Alejandro Jodorowsky, Paris. K-Inite éditions. (ISBN 2-915551-09-X) Chignoli, Andrea (2009), Zoom back, Camera! El cine de Alejandro Jodorowsky, Santiago de Chile, Uqbar Editores. Domínguez Aragonés, Edmundo (1980). Tres extraordinarios: Luis Spota, Alejandro Jodorowsky, Emilio “Indio” Fernández; Mexicali, Meexico DF, Juan Pablos Editor. p. 109-146. González, Házael (2011), Alejandro Jodorowsky: Danzando con la realidad, Palma de Mallorca, Dolmen Editorial. Larouche, Michel (1985). Alexandre Jodorowsky, cinéaste panique, Paris, ça cinéma, Albatros. (ISBN 2-7606-0661-9) Moldes, Diego (2012). Alejandro Jodorowsky, Col. Signo e Imagen / Cineastas, Ediciones Cátedra, Madrid. Prol. de A. Jodorowsky. (ISBN 978-84-376-3041-0) Monteleone, Massimo (1993). La Talpa e la Fenice. Il cinema di Alejandro Jodorowsky, Bologna, Granata Press. Documentaires consacrés à Jodorowsky 1994 : La Constellation Jodorowsky de Louis Mouchet (TV) 2005 : Midnight Movies de Stuart Samuels 2013 : Jodorowsky's Dune de Frank Pavich         
#59
Alban Nikolai Herbst
Loriane
Posté le : 06/02/2016 13:58
Le 7 février 1955 naît à Refrath, Alban Nikolai Herbst,
pseudonyme de Alexander Michael von Ribbentrop, Refrath est un quartier de Bergisch Gladbach, écrivain allemand, qui est également librettiste, critique et producteur de pièces radiophoniques. Alexander Michael von Ribbentrop est un descendant de Friedrich von Ribbentrop, 1768-1841. Fils d’une mère puéricultrice et d’un père représentant, il passe sa jeunesse à Traunstein, Brunswick et Brême, où il achève son apprentissage de commis d’avocat et d’étude notariale. Après son service civil, il fréquente les cours du soir du lycée de Brême et il entreprend à Francfort-sur-le-Main des études de philosophie, d’histoire et de sciences sociales. C’est sous son pseudonyme actuel qu’ont paru, dès 1981, ses premières œuvres. De 1987 à 1992, après avoir obtenu une licence d’agent de change, il est chargé de traiter directement avec les bourses américaines à partir de Francfort. En parallèle, il publie une revue littéraire Dschungelblätter feuilles de la jungle. Après la parution de son roman de mille pages Wolpertinger oder Das Blau, il abandonne ses activités d’agent de change et se consacre depuis entièrement à son œuvre. Il habite à Berlin depuis 1994. Œuvres Alban Nikolai Herbst, que Wilhelm Kühlmann considère comme « une des figures de proue de l’écriture postmoderne » et dont la poétique est qualifiée par Ralf Schnell de « paradoxe d’une esthétique numérique sous forme romanesque », tandis que Heinz-Peter Preusser parle de son côté d’une « forme postmoderne qui s’est révélée à elle-même », a commencé à écrire des textes dans la tradition réaliste prenant pour objet la vie quotidienne des petits bourgeois de la République fédérale. Mais il a alors développé son écriture sous la forme de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre et de pièces radiophoniques qui, en décrivant des situations apocalyptiques et un mélange constant de rêve et de réalité, comptent parmi les exemples les plus remarquables de la nouvelle littérature fantastique en langue allemande. Dans le même temps, son œuvre s’est emparée toujours davantage des nouveaux médias, auxquels il imprime sa marque poétique, lui donnant directement un aspect de medium d’actions fictives. Ce faisant, l’invention romanesque, les événements quotidiens réels et les nouvelles politiques de notre temps se recoupent étroitement ; réalité et fiction ne se différencient plus : « Les frontières d’une telle littérature sont poreuses(…) non seulement entre elles, mais aussi vers l’extérieur ; elles s’ouvrent aux nouvelles techniques, aux autres arts, aux textes d’autre nature, à la réalité ». Avec ce développement déjà engagé dans les romans et récits de ses débuts, il décide d’étendre son utilisation d’Internet. Mais désormais à l’intérieur de ses textes ce sont des personnages actifs qui s’installent en temps réel et ces avatars ne peuvent plus être différenciés de personnes existantes : le roman se déploie dans l’instant de son invention et les lecteurs le vivent comme un événement réel. C’est pourquoi Schnell et Reber, chacun de leur côté utilisent le concept d’autopoïesis lorsqu’ils veulent caractériser la poétique de l’auteur. Reber évoque une « structure en palimpseste » qui dans une métamorphose rhizomatique des ouvrages, progresse les uns dans les autres et demeure inséparable du monde réel. Ce constat laisse supposer une critique des médias, en particulier lorsqu’on étudie les essais politiques de l’auteur depuis le 11 septembre 2001. Mais il se peut aussi, comme le suggère Schnell, que ce phénomène traduise une prise en main poétique et résolument positive des nouveaux médias : « L’esthétique littéraire la plus élaborée de l’époque de la numérisation ». Ce mode d’écriture, qui mêle les réalités, a parfois suscité des critiques affirmant qu’il pratiquait l’accumulation d’histoires et qu’il n’était au fond rien d’autre qu’un colporteur moderne de ragots. De manière générale, les œuvres de Herbst font l’objet de jugements fortement contrastés et il se différencie en cela de tous les autres écrivains allemands ; on le considère tantôt comme un charlatan, comme un immense bavard impénitent », tantôt comme « le grand réaliste magique de langue allemande » et comme la pointe avancée de l’avant-garde. L’auteur lui-même, qui, à partir de 2001, dans son essai « Le Tremblement dans l’Espace de la Langue », s’est tourné aussi vers la poétique, répond aux reproches qui lui sont faits que, par principe, il est impossible de s’en tenir à la pure description. À ses yeux un réalisme « appuyé sur les faits » n’a aucun sens et il affirme qu’il s’agit bel et bien d’une idéologie en soi. Partant de ses premiers travaux en prose et de ses essais théoriques plus avancés qu’il a publiés essentiellement dans des revues littéraires comme Schreibheft, Horen, Kritische Ausgabe, etc., l’auteur a développé le concept de « réalisme cybernétique pour la dynamique duquel il revendique une poétique des possibilités ». C’est ainsi que Reber en vient à comparer sa poétique avec les Métamorphoses d’Ovide. Il est vrai que les dernières productions de l’auteur ont une poétique proche de l’Antiquité, usage de l’hexamètre par exemple, qu’il expérimente régulièrement dans ses publications et les variantes qu’il propose sur son site littéraire sponsorisé par Twoday l’hébergeur de son blog : Die Dschungel, Anderswelt. Son mélange radical de réalité et de fiction a connu des suites judiciaires. En 2003, une ancienne compagne a intenté une action provisoire contre la parution de son roman Meere. Elle voyait, en effet, dans cette œuvre un roman à clefs dont le contenu représentait pour elle une atteinte aux droits de sa personne. Cette affaire judiciaire suivait de peu un cas similaire, celui du roman Esra de Maxim Biller et tous deux débouchèrent sur une interdiction des ouvrages. Cependant, contrairement à l’affaire Biller, le procès contre « Meere » fut réglé, en mars 2007, par un accord juridique, si bien que le texte dans son entier parut en première impression, en avril 2007, dans une version légèrement modifiée dans la revue viennoise Volltext et fut ainsi redécouvert - ce qui, à lui seul, dans sa totalité, constitua un événement qui depuis les romans tournants de Rowohlt ne s’était jamais reproduit. Le retour apparent dans un réalisme autobiographique tel qu’on découvre dans Meere se révèle, en fait, comme un nouveau pas très concerté de l’esthétique des mélanges de l’auteur qui en vient même à transformer des procédures judiciaires objectives en phénomènes littéraires. À côté de son travail de conteur et de théoricien, l’auteur s’attache également à produire des pièces radiophoniques. Mais sa manière de procéder n’est guère différente : il fait en sorte de réunir étroitement des impressions subjectives et des compte rendus objectifs. Ses centres d’intérêt vont aussi bien à des phénomènes liés à la grande ville qu’à d’autre écrivains qu’il présente toujours comme ses ancêtres, sortes de devanciers littéraires, ainsi qu’il l’a fait par exemple avec Wolf von Niebelschütz, José Lezama Lima et Louis Aragon, mais également à des inconnus dont l’auteur affirme qu’ils ont été oubliés comme le poète et compositeur Carl Johannes Verbeen. Qu’il s’agisse de personnes réelles ou prétendues telles, ces auteurs sont présentés comme des personnages littéraires sortis de l’imagination d’Alban Nikolai Herbst. Mais dans le même temps, l’histoire de leur vie réelle ou imaginaire est décrite avec force détails et dans le cas de Verbeen la recherche de l’auteur est illustrée à l’aide d’extraits en tons authentiques. La structure des pièces radiophoniques ressemble plutôt à des compositions musicales qu’à des documents. Cette façon de procéder apparaît également de manière évidente dans ses romans. Lorsqu’il s’attache directement à la musique, l’auteur le fait en tant que librettiste, entre autres pour Caspar Johannes Walter et Robert HP Platz. Sa conception de la musique est influencée par Karlheinz Stockhausen. Il s’ensuit qu’Alban Nikolai Herbst ne cesse de se manifester comme critique d’opéra et de musique dans la presse ainsi que dans la rubrique des compte rendus de Opernnetz, du moins jusqu’à sa rupture avec cet organe en 2007. Une bonne introduction à l’œuvre de Alban Nikolai Herbst est le numéro 231 de Panoramas du monde-autre publié, en 2008, dans la revue de littérature et d’art die horen, qui présente surtout une vision globale des romans du monde-autre de notre auteur : Thetis. Anderswelt, Buenos Aires. Anderswelt, et Argo. Anderswelt ». Son volume de nouvelles paru en 2005 : Die Niedertracht der Musik constitue une introduction directe à son œuvre. Ces 13 nouvelles, qui ont été écrites entre 1972 et 2004, traversent toutes les phases de sa création depuis le réalisme des débuts la nouvelle inaugurale : Roses Triumph jusqu’au « réalisme cybernétique » qui se reflète dans ses œuvres plus tardives. Blog Die Dschungel. Anderswelt La Jungle. Un monde-autre. Depuis le printemps 2004, l’auteur rédige – le siège de publication se situe dans le forum de littérature de la Mousonturm à Francfort-sur-le-Main – un blog littéraire sous le titre : Die Dschungel. Anderswelt, dans lequel il ne se contente pas de proposer des textes sur son travail présent, mais où il expérimente aussi une réflexion littéraire et esthétique de la vie quotidienne, livrant son expérience pratique du développement de son travail et proposant des fragments théoriques. Son esthétique des mélanges l’amène à nommer sans cesse « roman » son blog littéraire. On retrouve ici le côtoiement d’influences réciproques entre réalité et fiction. Il y publie, à des fins d’expérimentation, récits et essais ainsi que des événements quotidiens, leur donnant une expression vive et des plus expressives, qu’il reprend dans le même temps dans un chapitre qui est constamment élargi : « Kleine Theorie des Literarischen Bloggens ». De plus et dans le même temps, l’auteur étend son blog littéraire comme une scène sans limites où la critique littéraire, artistique et musicale se retrouve et dans lequel il glisse ses notes de travail et des mentions personnelles ainsi que récemment des contributions originales d’autres participants, qui viennent le rejoindre et génèrent de leur côté des personnages fictifs. Ce blog littéraire est très étroitement lié aux romans parus sous la forme de livres dans la mesure où les titres des ouvrages portent dans leur titre la mention : Anderswelt : Thetis. Anderswelt, Buenos Aires. Anderswelt, et le blog mentionne également le même terme : Die Dschungel. Anderswelt. Participations, distinctions Alban Nikolai Herbst a appartenu, de 1976 à 1985, à l’Association des écrivains allemands ; il est membre du PEN club de la République fédérale. Parmi les bourses obtenues on citera : en 1981, bourse de Basse-Saxe pour les jeunes auteurs ; en 1995, le prix Grimmelshausen et le prix de Rome de la villa Massimo, qui est octroyé sous la forme d’un séjour d’un an ; en 1999, le prix de la littérature fantastique de la Ville de Wetzlar ; en 2000, il a été écrivain en résidence à l’université Keiō de Tokyo ; en 2006, on lui a octroyé pour son œuvre un séjour d’un an à la villa Concordia (Maison internationale des artistes de la villa Concordia, à Bamberg. À la suite de Louis Begley 2006, il a été appelé à occuper le poste de professeur de poétique de l’université Ruprecht Karl de Heidelberg. Bibliographie Notices d'autorité : Fichier d'autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • WorldCat Il y a encore peu des versions françaises de ses œuvres; toutes les traductions et articles critiques ont été effectués par Raymond Prunier Œuvres traduites en français Le Roman de Manhattan, Paris 2002 (original: In New York, Francfort-sur-le-Main 2000 Dem Nahsten Orient. Liebesgedichte / Très proche Orient, Francfort-sur-le-Main 2007 version bilingue de seize poèmes d’amour de l’auteur Œuvres en allemand Marlboro, Hanovre 1981 Die Verwirrung des Gemüts, Munich 1983 Die blutige Trauer des Buchhalters Michael Dolfinger, Göttingen et al. 1986 Joachim Zilts Verirrungen, Saint-Gall 1986 Die Orgelpfeiffen von Flandern, Francfort-sur-le-Main 1993 l’action de cette longue nouvelle se déroule à Paris Wolpertinger oder Das Blau, Francfort-sur-le-Main 1993 Eine sizilianische Reise, Francfort-sur-le-Main 1995 Undine, Francfort-sur-le-Main 1995 première le 6 juin 2010, Weberei Gütersloh Der Arndt-Komplex, Reinbek près Hambourg 1997 Wer bin ich? Notizen zu Paulus Böhmer, Francfort-sur-le-Main 1998 (avec Wolf Singer, Jehuda Amichai, Werner Söllner et Gerd-Peter Eigner Inzest oder Die Entstehung der Welt, Essen 2002 Schreibheft N°58, avec Barbara Bongartz Die Illusion ist das Fleisch auf den Dingen, Berlin 2003. Ce sont des pièces radiophoniques auteurs français : Céline et Aragon. Meere, Hambourg 2003. „Letzte, vervollständigte Ausgabe 2007“ Verlagsmitteilung im Titel: Francfort-sur-le-Main 2008 Die Dschungel. Anderswelt, blog littéraire, depuis 2004 Die Niedertracht der Musik, Cologne 2005. Série de treize nouvelles dont deux ont paru en France. La nouvelle titre : Misère de la Musique, in Rémanences, Bédarieux, 2007 ; et le Gräfenberg Club, in « L’Atelier du Roman » N°56, Flammarion 2008 Anderswelt. Roman-Trilogie: Thetis. Anderswelt, Reinbek près Hambourg 1998 Buenos Aires. Anderswelt, Berlin 2001 Argo. Anderswelt, in statu nascendi, que des extraits sur Internet Aeolia. Gesang/Stromboli. Gedichtzyklus, avec le peintre Harald R. Gratz, Bielefeld 2008 (livre d'art, limité, pas d'ISBN) Kybernetischer Realismus. Heidelberger Vorlesungen, Heidelberg 2008 Der Engel Ordnungen, Gedichte, Francfort-sur-le-Main 2008 Selzers Singen. Phantastische Geschichten und solche von fremder Moral, Kulturmaschinen Verlag, Berlin 2010 Éditions Dschungelblätter. Zeitschrift für die deutschsprachige Kulturintelligenz, Göttingen 1985-1989 Ein literarischer Gang an die Börse, Francfort-sur-le-Main 2000 avec Sabi      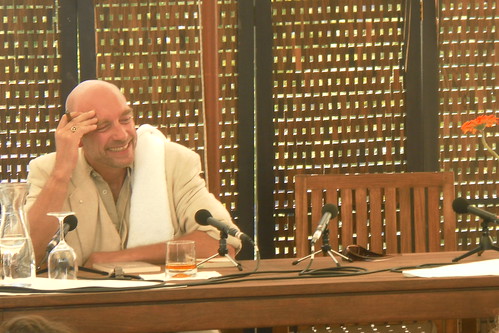  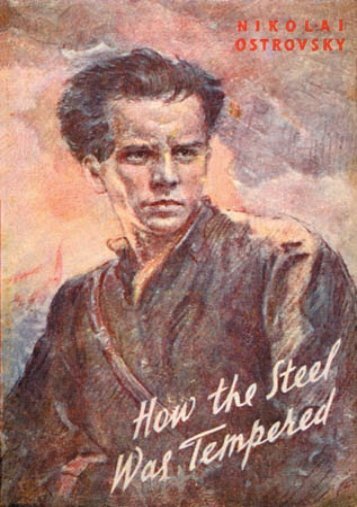
#60
Pierre Boulle
Loriane
Posté le : 30/01/2016 18:23
Le 31 janvier 1994 meurt Pierre Boulle
à 81 ans, à Paris 16ème, de son nom complet il naît Pierre François Marie Louis Boullené le 20 février 1912 à Avignon, écrivain Romancier, scénariste français. Agent de la France libre en Asie du Sud-Est pendant la Seconde Guerre mondiale, il est l’auteur du Pont de la rivière Kwai 1952 et de La Planète des singes 1963.Il reçoit Prix Sainte-Beuve en 1952 et le Grand prix de la nouvelle prix littéraire d’Évian en 1953, et le Grand prix de la Société des gens de lettres en 1976 En bref Avant de choisir la littérature, Pierre Boulle né à Avignon — connaît une vie aventureuse en Malaisie, où il entame à partir de 1938 une carrière d'ingénieur dans les plantations de caoutchouc. Il y demeure jusqu'en 1947 et combat sur place contre l'armée japonaise. On le décore de la croix de guerre et de la médaille de la Résistance. Rentré en France à partir de 1948, il devient alors un écrivain à temps plein. Les premiers romans de ce lecteur de Conrad et de Kipling utilisent le matériau de ses souvenirs, comme on le voit dans Le Sacrilège malais (1951). On retrouvera des traces du Sud-Est asiatique dans des textes ultérieurs comme Les Oreilles de jungle, écrit alors que les États-Unis sont enlisés dans la guerre du Vietnam. C'est encore un Asiatique qui est le héros du Jardin de Kanashima (1964). Cette veine romanesque, qui allie le décor de l'Asie et l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, lui vaudra son premier grand succès : Le Pont de la rivière Kwaï (1952), qui sera porté à l'écran par David Lean. Mais c'est dans un domaine très différent, celui de la science-fiction, qu'il connaît une popularité encore plus grande grâce à l'adaptation cinématographique d'un autre de ses romans, La Planète des singes (1963), par Franklin F. Schaffner. Vers la fin de sa vie, après avoir publié une vingtaine d'ouvrages, souvent proches du fantastique, il obtient, avec La Baleine des Malouines, le grand prix de la mer en 1984. Le Pont de la rivière Kwaï montre un Pierre Boulle fasciné par la singularité d'un comportement : comment, au nom des principes qui sont ceux de la dignité et de la parole donnée, au nom d'une sorte de fair-play entre gentlemen — et les militaires sont évidemment des gentlemen —, un officier anglais en vient à oublier la réalité du contexte de la guerre et à collaborer avec les Japonais, sans s'en rendre compte. Cette peinture exemplaire d'un cas de myopie idéologique permet de mieux saisir le piège par lequel peut s'entamer un processus de collaboration, au nom de valeurs éminemment respectables. Le roman présente un passage à la limite, où tragique et ironie se mêlent. Pierre Boulle écrira trois recueils dans lesquels il exerce son esprit d'observation et son ton voltairien, c'est-à-dire humoristique, à des fins de spéculation philosophique : Les Contes de l'absurde, grand prix de la nouvelle en 1953, on y savourera le récit d'une lune de miel en apesanteur, E = MC2 1957, puis Quia absurdum. Il retrouve cette veine en 1971 avec un roman, Les Jeux de l'esprit, sorte d'extrapolation des jeux télévisés et des spectacles sportifs, qui constituent le fondement d'un modèle de société particulière située dans un futur proche. Mais c'est avec La Planète des singes, avatar swiftien du quatrième voyage de Gulliver, que Pierre Boulle a donné la pleine mesure de son talent. Ce texte joue sur plusieurs tableaux. Il commence par subvertir les rapports habituels entre l'homme et les singes, puisque ceux-ci sont les maîtres de la planète, ce qui permet un regard critique sur le comportement humain, et plus particulièrement européen, dans ses rapports avec les peuples techniquement moins avancés. Boulle décrit des rapports humains étranges, médiatisés par la présence de l'antagonisme entre chercheurs et singes. Enfin, il laisse clairement entendre que cette planète est notre futur, après les désordres de toutes sortes consécutifs à une guerre atomique. Ce futur, le héros du livre l'atteignait après un voyage impromptu dans le temps, mais, jusqu'à la fin, il ignorait, comme le lecteur, qu'il se trouvait sur notre Terre. Un beau conte d'avertissement. Roger Bozzetto Sa vie Pierre Boulle est né à Avignon, le 20 février 1912. Son père, un avocat excentrique, écrit sur le théâtre dans un journal, avant d’épouser la fille du directeur de ce journal, Thérèse. Pierre a une grande complicité avec son père : tous deux adorent la littérature, les livres, la chasse et les jeux ; même la Première Guerre mondiale ne trouble pas son enfance. Boulle passe ainsi une enfance tranquille avec ses parents et deux sœurs, Suzanne et Madeleine. Vers la fin de la guerre, en 1918, il entre dans les petites classes au lycée d’Avignon. Son père meurt d’une maladie du cœur en 1926 : le jeune Pierre, âgé de 14 ans, est malgré lui projeté dans le monde adulte. Son but désormais est de devenir ingénieur avec une formation Supélec pour aider sa mère. À 24 ans, Boulle se retrouve dans une plantation d’hévéas de Malaisie, à 50 kilomètres de Kuala Lumpur. Pendant trois ans, il travaille comme un forcené, loin de l’Europe. Son expérience servira de trame à son roman Le Sacrilège malais. En 1941, Boulle est toujours en Asie du Sud-Est lorsque la Seconde Guerre mondiale fait rage, et la France est occupée. Il décide alors de rejoindre le mouvement gaulliste, dont un représentant, François Girot de Langlade, ancien planteur comme lui, se trouve dans la base militaire britannique de Singapour. Boulle devient officier de liaison sous-lieutenant du commandant Baron. Après un entraînement spécial et muni d’un faux passeport anglais, sous l’identité de Peter John Rule, il part en mission en Indochine contre les Japonais, alliés des Allemands, pour tenter de fomenter des révoltes, en faisant sauter les ponts. Cependant, dès son arrivée, en 1942, il est capturé par des militaires français fidèles à Vichy. Considéré comme un traître, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Deux ans plus tard, il parvient à s’évader de Saïgon, et rejoint la Force 136 du SOE, un service spécial britannique, à Calcutta. Il contera ces aventures dans un livre peu connu, Aux Sources de la Rivière Kwaï. Après la guerre, lorsqu’il retrouve sa patrie libérée, le général de Gaulle lui remet plusieurs médailles pour ses exploits. Aussitôt, il se cherche : que faire après avoir vécu tant d’aventures ? Un jour, sur un coup de tête, il décide de vendre tout ce qu’il possède, puis s’installe dans un petit hôtel à Paris pour écrire. Cette décision de devenir écrivain, dira-t-il plus tard, je l’ai prise en une heure, une nuit d’insomnie où les lucioles dansaient. L’aventurier est désormais un écrivain célèbre. Il habite chez sa sœur Madeleine devenue veuve, et s’occupe comme un père de sa petite nièce Françoise, à laquelle il racontait tous ses romans avant de les écrire. Resté un célibataire endurci, Boulle écrit tous les jours ; de 1950 à 1992, il publie un livre presque chaque année, dont deux romans qui sont publiés dans le monde entier et sont considérés comme des classiques : un roman d'aventures publié en 1952, Le Pont de la rivière Kwai – en partie inspiré des souvenirs de Boulle lorsque celui-ci a vécu dans en Asie du Sud-Est avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de témoignages qu’il a pu recueillir –, et un autre de science-fiction en 1963, La Planète des singes, le plus célèbre de ses romans, traduit dans plusieurs langues, et qui a notamment fait l’objet de nombreuses adaptations cinématographiques, dont la première en 1968, réalisée par Franklin J. Schaffner, avec Charlton Heston dans le rôle principal, et une autre en 2001, réalisée par Tim Burton, ainsi qu’une préquelle en 2011, intitulée La Planète des singes : Les Origines, réalisée par Rupert Wyatt, et sa suite en 2014, La Planète des singes : L’Affrontement, réalisée par Matt Reeves. Pierre Boulle a vécu ainsi jusqu’à la fin de ses jours, partageant son temps entre Paris et une maison de campagne à Autry-le-Châtel dans le Loiret. À écrire des livres où il se plaisait par-dessus tout à construire la rencontre entre deux choses : le simple et l’étrange. Pierre Boulle décède le 30 janvier 1994. Son urne funéraire est placée dans la case 40 598 du columbarium du cimetière du Père-Lachaise. En novembre 2002, ses cendres ont été déposées dans le caveau familial au cimetière Saint-Véran à Avignon5. Décorations Officier de la Légion d'honneur Croix de Guerre 1939-1945 Médaille de la Résistance 24/4/1946 Médaille des évadés Croix du combattant volontaire 1939-1945 Médaille coloniale avec agrafe Indochine Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de Résistance Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 avec agrafe Extrême-Orient Burma Star britannique War Medal 1939-1945 britannique Œuvre Accueil et perception de son œuvre William Conrad, son premier roman, est publié en 1950. Boulle avait alors 38 ans et aucune formation littéraire, mais l’histoire d’agents secrets a une aura d’authenticité qui séduit la critique. Deux de ses romans connaissent une notoriété mondiale, grâce à leurs adaptations cinématographiques : Le Pont de la rivière Kwaï et La Planète des singes, et à leur traduction en langue anglaise par Xan Fielding, ancien officier du Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Pont de la rivière Kwaï obtient le prix Sainte-Beuve. Inspiré d’une période de la vie de Boulle, engagé dans les FFL, le roman et le film de 1957 du même nom, réalisé par David Lean, assurent la célébrité de l’aventurier. Le photographe est adapté au cinéma par Jean-Claude Tramont sous le titre Le point de mire, en 1977. En 1976, pour l’ensemble de son œuvre, Boulle reçoit le grand prix de la Société des gens de lettres. Boulle est, avec Jacques Spitz, René Barjavel et José Moselli, un des pionniers de la science-fiction française. Dans une histoire écrite en 1949, Une Nuit Interminable, publiée dans le recueil Contes de l’absurde 1953, Boulle joue avec les paradoxes temporels, à la manière d’un Barjavel dans Le Voyageur imprudent, faisant preuve d’un étonnant modernisme. Ce recueil est par ailleurs le premier recueil de nouvelles de science-fiction françaises. Dans Un métier de Seigneur, il montre après la guerre un lâche, qui démasqué par ses anciens compagnons d'armes de la Résistance, meurt en héros pour ne pas avouer sous la torture sa couardise passée. Pierre Boulle est également l’un des auteurs français les plus traduits et les plus connus à l’étranger, plus particulièrement aux États-Unis, où ses romans connaissent un énorme succès, dopés par les adaptations cinématographiques du Pont de la rivière Kwaï et de La Planète des singes. Il est ainsi l’objet d’une étude littéraire, Pierre Boulle, écrite par Lucille Frackman Becker, parue chez Twayne Publishers et jamais traduite en français. Une autre étude, Pierre Boulle et son œuvre, écrite par Paulette Roy, est publiée en 1970 chez Julliard, à l’occasion de laquelle elle rencontre l’écrivain qui lui donne par lui-même de nombreux renseignements. Elle y présente ses œuvres et le situe avec de nombreux exemples dans la lignée de plusieurs auteurs pour la satire, la science, et tous les sujets les plus fréquents dans son œuvre. Par exemple, dans la série télévisée dérivée d’X-Files, The Lone Gunmen : Au cœur du complot, dans l’épisode Planet of the Frohikes, on trouve le Boulle Behavioral Institute, en hommage à l’auteur. Par ailleurs, dans l’épisode 4 de la première saison de X-Files (« le Diable du New Jersey, un ranger s’appelle Peter Boulle. La Planète des singes La Planète des singes, considéré comme un classique de la science-fiction et le livre le plus important de l’écrivain, connaît un grand succès à sa sortie en 1963. Depuis 1968, le roman connaît huit adaptations cinématographiques américaines dont la huitième, La Planète des Singes : L’Affrontement, sortie en 2014, deux séries télévisées en 1974 et 1975 et d’innombrables séries de bande dessinées. Dans le roman, le professeur Antelle organise une mission à destination de l’étoile Bételgeuse. Accompagné du physicien Levain et du journaliste – et protagoniste – Ulysse Mérou, il découvre une planète semblable à la Terre, appelée Soror, et décide de l’explorer. C’est ainsi qu’ils découvrent avec horreur qu’elle est dominée par des primates chassant les hommes comme des bêtes sauvages… Aucune des adaptations n’a été fidèle à la version de Boulle. Elles sont plutôt spectaculaires et réalistes, alors que le roman est plutôt à prendre au second degré les singes conduisent des avions, jouent au golf…. En 1968, après le premier volet au cinéma, Boulle écrit un script sous le titre La Planète des hommes ; refusé par les studios, ce scénario manuscrit fait partie des collections de la Bibliothèque nationale de France depuis 20076. La saga des années 1970 met en avant les dangers de la guerre nucléaire, très en vogue à l’époque dans le cinéma américain. Trois Américains échouent sur la Terre du futur après avoir traversé le temps lors d’un voyage spatial. L’astronaute Taylor découvre alors que les singes intelligents ont pris le contrôle de la planète après une guerre qui a transformé les continents en déserts et jungles, et l’Homme en un être inférieur et muet… Dans le film de 2001 réalisé par Tim Burton, une station spatiale s’écrase sur une planète inconnue. Des primates, utilisés pour le vol spatial habité, se rebellent contre les survivants humains pour ériger leur propre civilisation. Des siècles plus tard, Léo Davidson, un astronaute qui faisait partie de la station et qui a traversé le temps, se retrouve prisonnier des singes et tente de s’échapper… Dans La Planète des singes : Les Origines de 2011, un laboratoire développe un remède contre la maladie d’Alzheimer en testant un rétrovirus sur des singes. Le virus, mortel pour l’Homme, décuple l’intelligence d’un chimpanzé qui mène alors ses semblables à la révolte… Si l’on devait comparer les différentes adaptations, c’est la première version qui est la plus proche du roman, par le déroulement de l’histoire et sa présentation du comportement des singes chasse au fusil, prise de photos avec les trophées humains, expériences en laboratoire... vis-à-vis des hommes qui y sont muets comme dans le roman. Ses seules trahisons à l’œuvre de Boulle provient du lieu de l’action, que le film de Burton rétablit, ainsi que la fin avec la Statue de la Liberté échouée, ce dont Boulle ne voulait pas ; il écrit d'ailleurs au producteur Arthur P. Jacobs pour exprimer son désaccord6. Dans le livre original, l’action se passe sur une planète inconnue, et non sur la Terre. Et lorsque le héros rejoint la Terre à la fin du film, c’est pour découvrir que les hommes ont subi un sort similaire à ceux de la planète explorée comme dans le roman. Œuvres posthumes Cinq ans après la mort de Pierre Boulle, sa nièce, qu’il avait élevée comme sa propre fille, et son mari découvrent de nouveaux manuscrits inédits dans les archives de l’auteur. Presque illisibles, il a fallu repasser une à une les vingt mille pages découvertes pour les restaurer. À l’issue de ce fastidieux travail, un nouveau roman sort de l’oubli : L’Archéologue et le Mystère de Néfertiti, probablement écrit entre 1949 et 1951, et paru au Cherche-Midi en 2005, ainsi que des nouvelles inédites ou méconnues, réunies en un recueil : L’Enlèvement de l’Obélisque. Bibliographie des œuvres premières Romans Il existe une catégorie consacrée à ce sujet : Roman de Pierre Boulle. William Conrad Julliard, 1950 Le Sacrilège malais Julliard, 1951, en partie autobiographique. Le Pont de la rivière Kwaï Julliard, 1952 - Prix Sainte-Beuve 1952 La Face Julliard, 1953 Le Bourreau Julliard, 1954 L'Épreuve des hommes blancs Julliard, 1955 Les Voies du salut Julliard, 1958 Un métier de seigneur Julliard, 1960 La Planète des singes Julliard, 1963 Le Jardin de Kanashima Julliard, 1964 Le Photographe Julliard, 1967 Les Jeux de l'esprit Julliard, 1971 Les Oreilles de jungle Flammarion, 1972 - Les Vertus de l'enfer Flammarion, 1974 - Le Bon léviathan Julliard, 1977 - Les Coulisses du ciel Julliard, 1979 - L'Énergie du désespoir Julliard, 1981 - Miroitements Flammarion, 1982- La Baleine des Malouines Julliard, 1983- Pour l'amour de l'art Julliard, 1985 - Le Professeur Mortimer Éditions de Fallois, 1988 - Le Malheur des uns... Éditions de Fallois, 1990 - À nous deux Satan Julliard, 1992 - L'Archéologue et le mystère de Néfertiti Le Cherche-Midi - Œuvre posthume - Récits Aux sources de la rivière Kwaï Julliard, 1966 L'Ilon, souvenirs Éditions de Fallois, 1990 - roman autobiographique Recueils de nouvelles Si Pierre Boulle est célèbre pour ses romans, c'est pourtant dans ses nouvelles qu'il exprime le plus d'originalité et de force. Voici la liste des nouvelles qu'il a écrites, et les recueils dans lesquels on peut les trouver. Contes de l'absurde Julliard, 1953 - Grand Prix de la nouvelle Prix littéraire d'Évian 1953 Contient : L'Hallucination ; Une nuit interminable ; Le Poids d'un sonnet ; Le Règne des sages ; Le Parfait robot E = mc2 Julliard, 1957 Contient : Les Luniens ; L'Amour et la pesanteur ; Le Miracle ; E=mc² ou le roman d'une idée Un étrange évènement Éditions Florentin Mouret, 1957 Histoires charitables Julliard, 1965 Contient : Le Saint énigmatique ; L'Homme qui ramassait les épingles ; Histoire du bon petit écrivain ; L'Arme diabolique ; Le Compte à rebours ; L'Homme qui haïssait les machines Quia absurdum : sur la Terre comme au Ciel Julliard, 1970 Contient : Son Dernier Combat ; Le Plombier ; Interférences ; L'Affût au Canard ; Quand le Serpent échoua ; Les Lieux Saints ; Le Cœur et la Galaxie Histoires Perfides Flammarion, 1976 Contient : La Grâce Royale ; Le Palais Merveilleux de la Petite Ville ; Les Lois ; Les Limites de l'endurance ; Service Compassion ; L'Angélique Monsieur Edyh L'Enlèvement de l'Obélisque Le Cherche midi, 2007 - Œuvre posthume Contient : L'Enlèvement de l'Obélisque ; Un étrange événement ; Le Message chiffré ; Une mort suspecte ; Le 1er avril ; Le Coupable ; La Croisière de l'Alligator Nouvelles, novellas Un étrange événement Florentin Mouret éditeur, 1957. Pour F.M. & ses amis. In-12 broché. Tirage unique à 142 exemplaires sur pur fil après 1 japon & 7 shangai. Une nuit interminable 1953 Essais Le Siam Walt Disney, Payot, 1955 L'Étrange croisade de l'empereur Frédéric II Flammarion, 1968 L'Univers ondoyant Julliard, 1987 Pièce de théâtre William Conrad : pièce en quatre actes. L'Avant-scène théâtre, 1er février 1962, p. 8-36. Adaptation par l'auteur de son roman. Préfaces Pierre Boulle est par ailleurs l'auteur des préfaces des ouvrages suivants : Jane Werner Watson, Des pays et des hommes Walt Disney, Hachette, 1961. Marguerite Cassan, Histoires à côté : Nouvelles, Robert Laffont, 1963 Wim Dannau, Les Dossiers Espaces : no 1 L'Ère des Armes Secrètes V1-V2, Casterman, 1966 Annie Baury, Ma robe de chair morte Collection À pleine vie, Les Éditions ouvrières, 1978 Jean Coué, L'Homme de la rivière Kwaï, Gallimard, 1980 Anatole France, La Révolte des Anges, Calmann-Lévy, 1980 Henri Fauconnier, Malaisie, Stock, 1986 prix Goncourt en 1930 Frédéric Louguet, Échecs et Mips, Montrouge Dunod Technique, 1992 Compilations Quatre de ses six recueils de nouvelles ont été compilés en un volume paru en 1992 chez Julliard. Romans héroïques, Omnibus, 1996. Étrange Planète, Omnibus, 1998 réédité sous le titre La Planète des singes et autres romans, Omnibus, 2011. Œuvres secondes / adaptations, suites…Romans L'Or de la rivière Kwaï (SAS) / Gérard de Villiers. Paris : Plon, 1968, 252 p. La Planète des singes / une novélisation de John Whitman ; d’après un scénario de William Broyles Jr et Lawrence Konner & Mark D. Rosenthal ; trad. de l’américain par Pascal Loubet. Paris : Éditions J’ai lu, 2001, 158 p. J’ai lu ; no 6050. Édition junior illustrée. La Planète des singes / une novélisation de William T. Quick ; d’après un scénario de William Broyles Jr et Lawrence Konner & Mark D. Rosenthal ; trad. de l’américain par Paul Benita. Paris : Éditions J’ai lu, 2001, 253 p. J’ai lu ; no 6049. Bandes dessinées Planète des singes. Lyon : Éditions Lug, février 1977, no 1, 58 p. Contient : « Planète des singes » 1er épisode, scénario de Doug Moench, dessins de George Tuska et Mike Esposito p. 3-27. « Les proscrits de la planète des singes » (1er épisode), scénario Doug Moench, dessins Mike Ploog, p. 35-58. Planète des singes. Lyon : Éditions Lug, mars 1977, no 2, 58 p. Contient : « Planète des singes : Prisonniers chez les singes » 1er épisode, scénario de Doug Moench, dessins de George Tuska et Mike Esposito p. 3-22. « Les proscrits de la planète des singes : Terreur dans la zone interdite » 2e épisode, scénario Doug Moench, dessins Mike Ploog, p. 34-58. Planète des singes. Lyon : Éditions Lug, avril 1977, no 3, 58 p. Contient : « Planète des singes : l’homme traqué » 3e épisode, scénario de Doug Moench, dessins de George Tuska et Mike Esposito p. 3-22. « Les proscrits de la planète des singes : La Fosse aux mutants 3e épisode, scénario Doug Moench, dessins Mike Ploog, p. 35-58. Planète des singes. Lyon : Éditions Lug, mai 1977, no 4, 58 p. Contient : « Planète des singes : les juges » 4e épisode, scénario de Doug Moench, dessins de George Tuska et Mike Esposito p. 3-22. « Les proscrits de la planète des singes : Il était un petit navire » 4e épisode, scénario Doug Moench, dessins Mike Ploog, p. 31-58. Planète des singes. Lyon : Éditions Lug, juin 1977, no 5, 50 p. Contient : « Planète des singes : dans la zone interdite » 5e épisode, scénario de Doug Moench, dessins de George Tuska et Mike Esposito p. 3-22. « Les proscrits de la planète des singes : Malagueña la gitane » 5e épisode, scénario Doug Moench, dessins Mike Ploog, p. 33-50. Planète des singes. Lyon : Éditions Lug, juillet 1977, no 6, 50 p. Contient : « Planète des singes : le secret » 6e épisode, scénario de Doug Moench, dessins de George Tuska et Mike Esposito p. 3-22. « Les proscrits de la planète des singes : les Héritiers de la planète » 6e épisode, scénario Doug Moench, dessins Mike Ploog, p. 28-50 Planète des singes. Lyon : Éditions Lug, janvier 1978, no 12, 58 p. Contient : « Le secret de la planète des singes : Le Dernier holocauste 6e épisode, scénario de Doug Moench, dessins de Alfredo Alcala p. 3-23. « Homme parmi les singes », scénario Doug Moench, dessins Herb Trimpe, Dan Adkins et Sal Trapani, p. 31-50. Planète des singes. Lyon : Éditions Lug, avril 1978, no 15, 58 p Contient : « Les Évadés de la planète des singes : Un pavé dans la mare ! » (3e épisode), scénario de Doug Moench, dessins de Rico Rival p. 3-22. La Planète des singes : l’adaptation officielle du film de Tim Burton / Scénario Scott Allie ; dessin Davidé Fabbri ; trad. Jérôme Wicky. Semic comics, no 1, La Planète des singes : the Human war [#1-3] / Scénario Ian Edginton ; dessin Paco Medina et Adrian Sibar ; trad. Jérôme Wicky. Semic comics, no 2, novembre 2001, 76 p. La Planète des singes / de Pierre Boulle ; un extrait adapté par Michaël Le Gall ; dessiné par Patrick Deubelbeiss. Je Bouquine, janvier 2003, no 227, p. 65-76. Dossier de Véronique Gosselin p. 77-82. Films 1957 : Le Pont de la rivière Kwaï, un film de David Lean. 1968 : La Planète des singes de Franklin J. Schaffner, avec Charlton Heston. 1970 : Le Secret de la planète des singes de Ted Post 1971 : Les Évadés de la planète des singes de Don Taylor 1972 : La Conquête de la planète des singes de J. Lee Thompson 1973 : La Bataille de la planète des singes de J. Lee Thompson 1977 : Le Point de mire, un film de Jean-Claude Tramont, d'après Le Photographe. Avec Annie Girardot, Jacques Dutronc, Jean Bouise, Jean-Claude Brialy et Michel Blanc. 2001 : La Planète des singes de Tim Burton, avec Mark Wahlberg. 2011 : La Planète des singes : Les Origines de Rupert Wyatt, avec James Franco. 2014 : La Planète des Singes : L'Affrontement de Matt Reeves. 2017 : War for the Planet of the Apes de Matt Reeves. Téléfilms Not the Glory, d'après le roman William Conrad, série TV Playhouse 90, Saison 2, Épisode 32 réalisé par Robert Mulligan, 1958. Face of a Hero, d'après le roman La Face, série TV Playhouse 90, Saison 3, Épisode 13 réalisé par John Frankenheimer, 1959, avec Jack Lemmon. Porträt eines Helden, d'après le roman La Face, TV film réalisé par Michael Kehlmann, 1966. William Conrad, d'après le roman éponyme, TV film réalisé par André Charpak, 1973. La Planète des singes, d'après le roman La Planète des Singes, une série TV produite par la 20th Century Fox et CBS, 1974. The Miracle, d'après la nouvelle Le Miracle in E=mc², TV film réalisé par Dick Ross, avec Richard Chamberlain, 1985. Un Métier de Seigneur, d'après le roman éponyme, TV film réalisé par Édouard Molinaro, 1986, avec Pierre Arditi, Annie Girardot, et Christopher Lee. [img width=600]http://vignette2.wikia.nocookie.net/planetoftheapes/images/2/2d/Pboulle.gif/revision/latest?cb=20140805001759[/img]    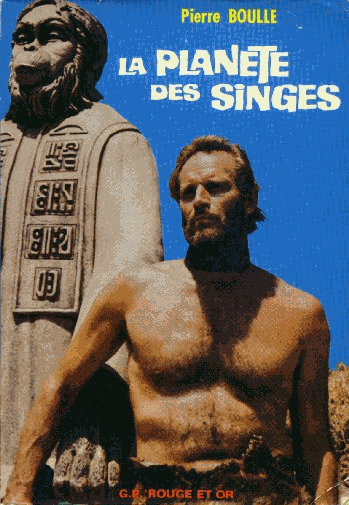  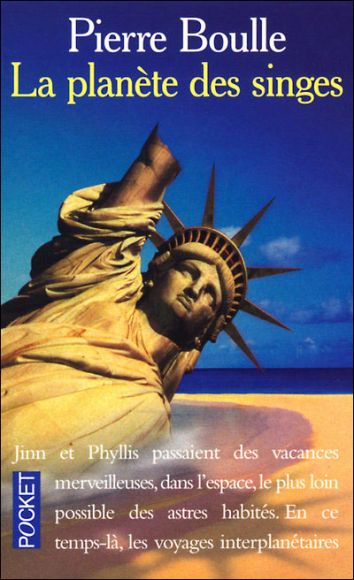  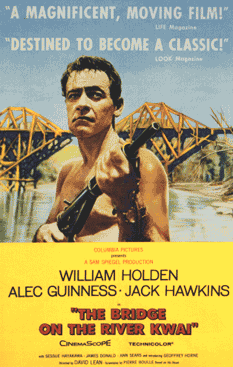  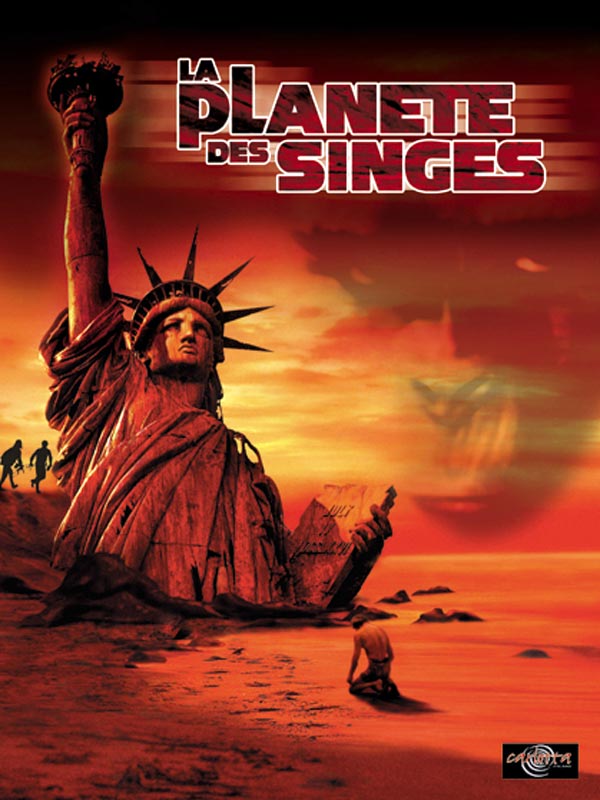 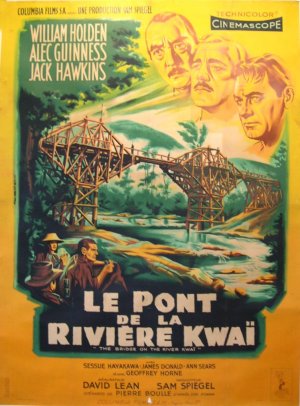 |
Connexion
Sont en ligne
148 Personne(s) en ligne (90 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 148 Plus ... |
| Haut de Page |






