|
|
Création de la fête des mères |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
25 mai 1941 Institution de la fête des mères
La fête des Mères a été officiellement instaurée en France par le régime de Vichy. C’était le 25 mai 1941.
L’événement n’avait rien d’anodin ou d’anecdotique. Dès son arrivée au pouvoir en juin 1940, Philippe Pétain avait placé les Françaises au cœur de la propagande de son régime. Le principal slogan fondateur de Vichy, Travail, Famille, Patrie, attestait bien de cette volonté de redonner à la France les valeurs destinées, selon Pétain, à raviver la force du pays.
Toute une propagande attribuait la défaite du pays à l’abaissement des valeurs morales et à la chute de la natalité au lendemain de la Première Guerre mondiale. Comme l’écrivent Éric Alary et Bénédicte Vergez-Chaignon dans leur Dictionnaire de la France sous l’occupation Éditions Larousse, la Journée nationale des mères de famille nombreuse, créé en 1920, devient une quasi-fête nationale à partir du 25 mai 1941.
Selon les deux auteurs, le régime de Vichy utilise cette fête pour créer un grand moment de consensus national. En glorifiant les mères, la propagande magnifie la Révolution nationale et son chef, Pétain. 80 000 affiches sont tirées pour cette première.
Citation :25 MAI 1941
Le maréchal Pétain prononce un discours à l'occasion de la "journée des mères"
Mères de famille françaises,
La France célèbre aujourd'hui la famille. Elle se doit d'honorer d'abord les mères.
Depuis six mois, je convie les Français à s'arracher aux mirages d'une civilisation matérialiste. Je leur ai montré les dangers de l'individualisme. Je les ai invités à prendre leur point d'appui sur les institutions naturelles et morales auxquelles est lié notre destin d'homme et de Français.
La famille, cellule initiale de la société, nous offre la meilleure garantie de relèvement. Un pays stérile est un pays mortellement atteint dans son existence. Pour que la France vive, il faut d'abord des foyers. Un foyer, c'est la maison où l'on se réunit. C'est le refuge où les affections se fortifient, c'est cette communauté spirituelle qui sauve l'homme de l'égoïsme et lui apprend à s'oublier pour se donner à ceux qui l'entourent.
Maîtresse du foyer, la mère, par son affection, par son tact, par sa patience, confère à la vie de chaque jour sa quiétude et sa douceur. Par la générosité de son cœur, elle fait rayonner autour d'elle l'amour qui permet d'accepter les plus rudes épreuves avec un courage inébranlable.
Mères de notre pays de France, votre tâche est la plus rude, elle est aussi la plus belle.
Vous êtes, avant l'État, les dispensatrices de l'éducation ; vous seules savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui fait les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne et voici qu'aujourd'hui dans nos deuils, dans nos misères, vous portez la plus lourde croix.
Mères de France, entendez ce long cri d'amour qui monte vers vous.
Mères de nos tués, mères de nos prisonniers, mères de nos cités qui donneriez votre vie pour arracher vos enfants à la faim, mères de nos campagnes qui, seules à la ferme, faites germer les moissons, mères glorieuses, mères angoissées, je vous exprime aujourd'hui toute la reconnaissance de la France.
Affiche pour lancer la fête des mère. Cette fete a pour obectif de promouvoir la politique familiale dans le cadre de la révolution nationale
Fête en l'honneur des mères dans le monde
La fête des Mères est une fête annuelle célébrée par les enfants en l'honneur de leur mère dans de nombreux pays.
À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école.
Cette fête est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leur mère.
La date de la fête des Mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai.
En France, la fête des Mères est célébrée le dernier dimanche de mai. Si ce jour coïncide avec la Pentecôte, alors la fête est repoussée au premier dimanche de juin.
Au Canada et en Australie, la fête des Mères est célébrée le deuxième dimanche de mai.
Histoire
Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique lors des cérémonies printanières en l'honneur de Rhéa ou Cybèle, la Grande Mère des dieux et notamment mère de Zeus. Ce culte était célébré aux Ides de Mars dans toute l'Asie Mineure.
Une fête religieuse romaine célébrait les matrones le 1er mars, lors des Matronalia matronales.
Au XVe siècle, les Anglais fêtaient le Mothering Sunday, d'abord au début du carême puis le quatrième dimanche du carême.
En 1908, les États-Unis développent la Fête des mères moderne telle qu'on la fête de nos jours, en instaurant le Mother's Day, en souvenir de la mère de l'institutrice Anna Jarvis.
Le Royaume-Uni adopte à son tour cette fête en 1914, puis l'Allemagne l'officialise en 1923. D'autres pays suivent comme la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Turquie ou l'Australie.
En France
Une affiche illustrée par Félix Régamey fait la promotion d'une Fête placée sous le patronage de toutes les mères françaises qui a eu lieu le 28 mai 1906 dans les salons de la mairie du 16e arrondissement de Paris.
Le village d'Artas revendique cependant être le berceau de la fête des Mères.
En effet le 10 juin 1906, à l'initiative de Prosper Roche, fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille méritants d'Artas, une cérémonie en l'honneur de mères de familles nombreuses eut lieu.
Deux mères de 9 enfants reçurent, ce jour-là, un prix de Haut mérite maternel. Le diplôme original créé par Prosper Roche est conservé dans la bibliothèque de l'Institut de France avec les archives de l'association.
En 1918, la ville de Lyon célèbre la journée des Mères en hommage aux mères et aux épouses qui ont perdu leurs fils et leur mari pendant la Première Guerre mondiale. En 1920 est élaborée une fête des Mères de familles nombreuses puis le gouvernement officialise une journée des Mères en 1929, dans le cadre de la politique nataliste encouragée par la République.
Ce n'est donc pas, contrairement à ce qui est souvent relayé dans les médias, une création du maréchal Pétain : en 1941, le régime de Vichy ne fait qu'inscrire la fête des Mères au calendrier, instaurant de façon officielle la fête des mères, le maréchal Pétain voulant redonner à la France les valeurs destinées, selon lui, à raviver la force du pays.
Après-guerre, la loi du 24 mai 1950 dispose que la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la Fête des mères, organisée par le ministre chargé de la Santé avec le concours de l'UNAF .
Elle en fixe la date au dernier dimanche de mai sauf si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, auquel cas elle est repoussée au premier dimanche de juin, et prévoit l'inscription des crédits nécessaires sur le budget du ministère. Ces dispositions ont été intégrées au Code de l'action sociale et des familles lors de sa création en 1956, et l'organisation de la fête a été assignée au ministre chargé de la Famille à partir de 2004.
Dates de la fête des mères dans le monde
Deuxième dimanche de février
Norvège
30 Shevat selon le calendrier hébreu, entre le 30 janvier et le 1er mars
Israël
3 mars Géorgie
8 mars Journée internationale des femmes
Albanie • Bulgarie • Moldavie • Roumanie • Serbie
Quatrième dimanche de Carême
troisième dimanche avant Pâques
Mothering Sunday
Irlande • Nigeria • Royaume-Uni
Équinoxe de mars
Arabie saoudite • Liban • Palestine • Qatar • Soudan • Syrie • Yémen
21 mars Égypte
25 mars Slovénie
7 avril Arménie
Premier dimanche de mai
Espagne • Hongrie • Lituanie • Portugal
8 mai Corée du Sud Fête des parents : les Coréens célèbrent les deux parents le même jour
10 mai Guatemala • Mexique •
Salvador Día de la Madre ou Día de las Madres
Deuxième dimanche de mai
Afrique du Sud • Allemagne Muttertag • Aruba • Australie • Autriche • Bahamas • Barbade • Bangladesh • Belgique sauf à Anvers • Belize • Bermudes • Birmanie • Bonaire • Brésil • Brunei • Burkina Faso8 • Canada9 • Chili • Chine • Chypre • Colombie • Croatie • Cuba • Curaçao • Danemark • Dominique • Équateur • Estonie • États-Unis • Finlande • Ghana • Grèce • Grenade • Honduras • Hong Kong • Inde • Islande • Italie • Jamaïque • Japon • Lettonie • Malaisie • Malte • Nouvelle-Zélande • Pakistan • Pays-Bas • Pérou • Philippines • Porto Rico • Sainte-Lucie • Singapour • Slovaquie • Suisse • Suriname • Taïwan • République tchèque • Trinité-et-Tobago • Turquie • Ukraine • Uruguay • Viêt Nam • Venezuela • Zimbabwe
14 mai Samoa
15 mai Paraguay
Día de la Madre ou Día de las Madres
26 mai Pologne
27 mai Bolivie
30 mai Nicaragua, Día de la Madre
Dernier dimanche de mai
Tunisie · Algérie · Côte d'Ivoire · République dominicaine · Haïti · Libye · Maurice · Mauritanie · Sénégal · Suède · Maroc
Dernier dimanche de mai ; si ce jour coïncide avec la Pentecôte, la fête est repoussée au premier dimanche de juin
Bénin • France •
République du Congo • Gabon • Madagascar • Monaco • Cameroun
1er juin
Mongolie la fête des Mères est célébrée le même jour que la fête des enfants
Deuxième dimanche de juin
Luxembourg Mammendag
Dernier dimanche de juin
Kenya
12 août Thaïlande même jour que l'anniversaire de la Reine Sirikit Kitiyakara
15 août, jour de l'Assomption
Belgique à Anvers, Costa Rica
Deuxième lundi d'octobre
Malawi
Troisième dimanche d'octobre
Argentine Día de la Madre ou Día de las Madres
Dernier dimanche de novembre Russie
8 décembre
Panama
Día de la Madre ou Día de las Madres
22 décembre Indonésie
Dates de la Fête des Mères en France
la Fête des Mères en France est prévue aux dates suivantes :
dimanche 25 mai 2014
dimanche 31 mai 2015
dimanche 29 mai 2016
La date est variable, chaque année elle a lieu le dernier dimanche de mai, sauf si celui-ci coïncide avec la Pentecôte. Dans ce cas, la Fête des Mères est décalée au premier dimanche de juin.
Dates de la Fête des Mères en Suisse, au Québec et en Belgique
Dans de nombreux pays du monde, y compris la Suisse, la Belgique et le Québec, la Fête des Mères est prévue aux dates suivantes :
dimanche 11 mai 2014
dimanche 10 mai 2015
dimanche 8 mai 2016
La date est variable, chaque année elle a lieu 2e dimanche de mai.
Célébration de la Fête des Mères Les cadeaux les plus fréquents
La fête des Mères est une journée spécialement consacrée à nos mamans. L'organisation en est généralement confiée à leurs enfants qui peuvent décider de leur préparer le repas. La complicité du papa leur permet de garder un effet de surprise.
On doit aux instituteurs le fameux collier de pâte et autres petits cadeaux fabriqués avec amour par les enfants tout fiers d'offrir ce cadeau. Quand ils grandissent, fleurs, parfum, bijoux remplacent ce présent traditionnel.
Chaque année, la Fête des Mères est l'occasion rêvée d'offrir un joli cadeau choisi avec minutie à sa maman. Pour vous aider dans cette tâche, voici quelques idées de cadeaux dont vous pourriez vous inspirer :
Plantes et fleurs : Les plantes et les fleurs sont des cadeaux appréciés qui sentent bon le printemps !
Un bouquet de fleurs : c'est un classique, mais les fleurs restent un cadeau indémodable qui fait toujours plaisir.
Une plante d'intérieur, plus ou moins grande, elle peut faire office de cadeau déco et donner une touche de verdure à un logement.
Une jardinière peut aussi être un cadeau sympa qui peut être une alternative viable au bouquet et ne nécessite pas de vase.
Pour trouver un fleuriste pour la fête des Mères, vous pouvez utiliser Fleuriste 365, mais aussi commander sur internet, consultez ce comparatif des sites livraisons de bouquet à domicile.
Carte de voeux : Une carte de voeux est une attention qui permet de coucher sur le papier quelques mots doux. Elle peut accompagner d'autres cadeaux, être faite main, de manière dactylographiée ou manuscrite.
Chocolats : Les chocolats peuvent facilement se trouver dans les moyennes surfaces ou dans une chocolaterie qui aura certainement des chocolats spéciaux pour la circonstance.
Bijoux : Les bijoux sont des cadeaux plus onéreux, mais qui gagnent en durée de vie (surtout par rapport au chocolat). Vous aurez alors tout un éventail de parures : paire de boucles d'oreilles, bague, bracelet, collier, pendentif ou montre.
Poème : Un poème est un cadeau qui pourra être offert par les plus petits comme par les plus grands, il pourra être orné d'un dessin ou mis en valeur par un bricolage.
Dessin et peinture : Les bricolage, dessin, peinture, origami ou paper-toy sont des cadeaux qui permettent de faire travailler sa créativité. Les créations faites soi-même gagnent en valeur sentimentalement et affectivement. Alors à vos colliers de pâtes !
Gâteau : Un gâteau peut aussi faire office de cadeau pour la fête des Mères, il peut être acheté en grande surface, fait maison ou commandé dans une pâtisserie.
Bouteille de vin : Une bonne bouteille de vin ou de spiritueux est un cadeau moins populaire que les fleurs ou les bijoux, mais ravira sans doute beaucoup de mamans !
Parfum : Le parfum est une bonne idée de cadeau pour peu que vous connaissiez les flagrances de prédilection de la personne concernée.
Crème ou maquillage : Un produit cosmétique comme une crème de jour ou du maquillage peut se révéler être un cadeau judicieux qui fera plaisir aux mères qui aiment prendre soin d'elles.
Livre : Un livre est un cadeau de fête des Mères à prix relativement raisonnable, vous pourrez par exemple offrir le dernier best-seller, un roman policier, un ouvrage spécialisé ou un livre de photos.
Sac à main : Les accessoires tels que les sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles ou parapluies sont des cadeaux originaux à offrir en fonction des besoins exprimés.
Coffret-cadeau : Un coffret-cadeau tel qu'en propose Smartbox, Vipbox, Dakotabox ou Wonderbox peut offrir une expérience, un séjour, un soin ou une activité insolite.
Chèque-cadeau : Un chèque-cadeau reste une solution viable si l'on veut laisser le champ totalement libre dans le choix de l'objet du cadeau.
Liens
http://youtu.be/GhK6lqPM4Dw une mère de Lynda Lemay
http://youtu.be/KFRR4lcWoGA Embrasse là de Pierre Bachelet
http://youtu.be/ANj6StScGYU Mama tu es la plus belle ... Luis Mariano
http://youtu.be/p9saK_-XLdc D'où vient la fête des mères
http://youtu.be/sY0hTcpwQ20 Cadeau de Marie Laforêt
http://youtu.be/g2mFMQsZ5FY C'es toi qui m'a fait François Fleldman
 [img width=-00]http://p3.storage.canalblog.com/39/07/978451/76292952.jpg[/img]   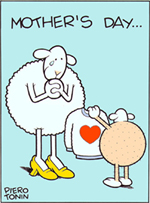  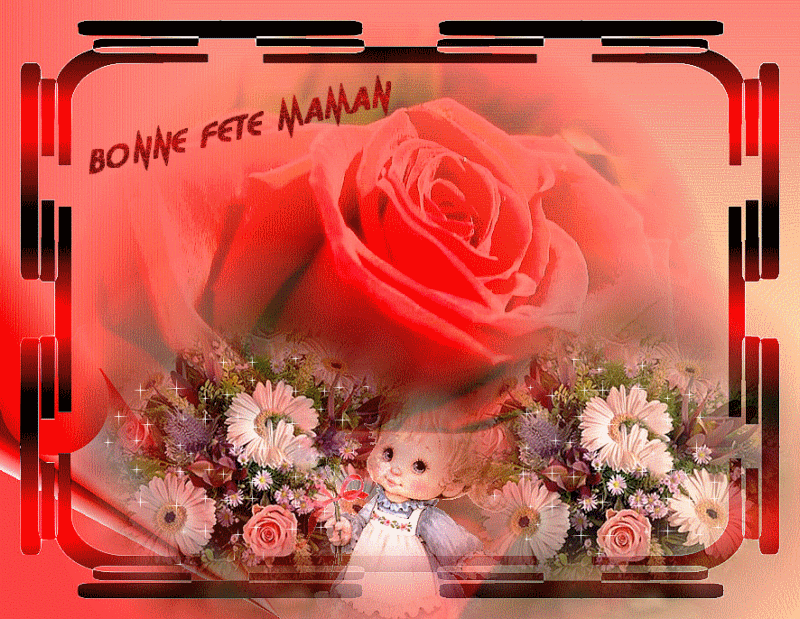    [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Mother's_Day_cake.jpg[/img]   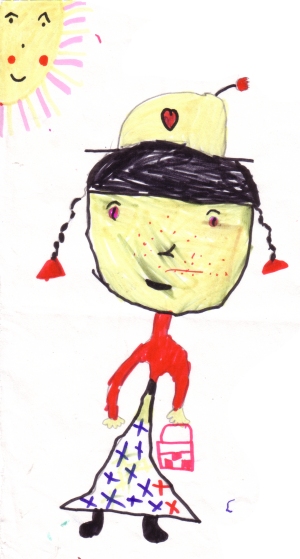       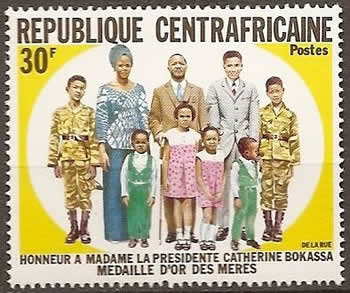 
Posté le : 17/05/2014 23:33
Edité par Loriane sur 20-05-2014 14:59:18
Edité par Loriane sur 25-05-2014 17:16:27
|
|
|
|
|
Haroun Tazieff |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 11 mai 1914 naît à Varsovie Haroun Tazieff, ingénieur agronome,
ingénieur géologue, ingénieur des mines, volcanologue et écrivain de nationalité russe naturalisé successivement belge puis français. Personnage médiatique, il a été l'un des pères de la volcanologie contemporaine et un pionnier du filmage des volcans pris sur le vif et de la communication entre les volcanologues et le grand public. Il meurt, à 83 ans, à Paris le 2 février 1998,
Haroun Tazieff a démontré la nécessité d'expéditions pluridisciplinaires sur les volcans actifs et les volcans en éruption. Avec les collaborateurs qu'il s'est choisis au long de quarante années d'expéditions, il a développé la recherche sur le rôle des gaz dans les dynamismes éruptifs, sur la présence d'eau dans les magmas, sur le volcanisme sous-marin, sur les techniques de mesure des variations de champ magnétique en liaison avec l'activité éruptive, sur l'observation directe de la dérive des continents, sur les échanges de masses et d'énergie entre les appareils volcaniques et l'atmosphère. Il a largement contribué à révolutionner une science qui n'était guère reconnue sinon quasiment inconnue en Belgique et oubliée en France.
Géologue et volcanologue français, Haroun Tazieff s'est consacré à l'étude des volcans à partir de 1948 et se trouve à l'origine de l'Institut international de recherches volcanologiques, dont le siège est à Catane. Outre des travaux de recherche, en particulier sur les mécanismes des éruptions et sur les gaz volcaniques, on lui doit des ouvrages de vulgarisation et des films documentaires.s'est notamment fait connaître du grand public par la réalisation de documentaires sur les volcans. Sa mère est polonaise, son père, médecin, est russe ; celui-ci meurt au cours de la Première Guerre mondiale. Les enfants de l'école primaire ne seront pas tendres avec ce jeune garçon à l'accent étranger. Il saura se servir de ses poings pour se défendre, ce qui, peut-être, l'amènera à aimer la boxe et à être sélectionné dans l'équipe belge pour les jeux Olympiques de Berlin. Par la suite, outre la boxe, il pratiquera de nombreux sports dont l'alpinisme, la spéléologie, le ski et le rugby. Tout en poursuivant ses études d'agronomie à Liège et une spécialité de géologie aux Mines, Haroun Tazieff participe activement à la résistance contre l'occupant nazi.
En 1948, une fissure sur le flanc sud-ouest du Nyamuragira dans la république démocratique du Congo s'ouvre en vomissant deux coulées de lave très spectaculaires. À cette époque, Haroun Tazieff est prospecteur dans cette région pour le Service géologique centrafricain. Il se précipite pour suivre l'éruption. Les jours et les nuits qu'il passe à observer ce phénomène grandiose vont bouleverser sa vie. De prospecteur, il deviendra volcanologue. Après cette éruption, il publie son premier livre, Cratères en feu en 1951.
Avec le peintre Pierre Bichet, de 1955 à 1957, il parcourt le monde, de volcan en volcan et en tire, en 1959, un premier film, Les Rendez-Vous du diable, et un livre du même nom. Cette même année, Haroun Tazieff épouse France Depierre, une amie d'université.
Sa vie
Haroun Tazieff est né en 1914 à Varsovie, alors partie de la Russie tsariste, d'un père tatar, né à Yangi-Yer ou Tachkent selon les sources, docteur en médecine, et d'une mère russe, née à Dvinsk qui était chimiste et docteur en sciences politiques. Son père mourut au front dès le début de la Première Guerre mondiale. Avec sa mère, il émigra en Belgique en 1921 où il résida quelque temps en apatride, avant de partir une année en France en 1922, puis de revenir en Belgique et d'y recevoir la nationalité belge en 1936.
Étudiant, footballeur affilié au Daring Club de Bruxelles Société Royale de 1930 à 1932 et, en 1935, à Gembloux Sport pendant ses études à la Faculté Agronomique, mais surtout joueur de rugby qu'il pratiqua en passionné. En 1958, alors qu'il était en expédition au Katanga, province du Congo belge, il adressa un télégramme d'encouragement à l'équipe de France de rugby à XV dont il connaissait certains membres et qui était en tournée en Afrique du Sud. Il fit aussi de la boxe et fut champion de Belgique universitaire, sélectionné pour les Jeux Olympiques de Berlin, en 1936, mais sa mère lui interdit de s'y rendre, il n'était pas question qu'il défile sous Hitler. Il fut aussi champion du Katanga, alors qu'il y travaillait comme ingénieur-prospecteur de gisements de minerais de zinc.
Haroun Tazieff fit ses études primaires successivement en Russie, principalement en Belgique puis en France. Après ses études secondaires à Bruxelles, il obtint le diplôme d'ingénieur agronome de la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux. En 1938, il effectue son service militaire dans l'armée belge et, en 1939, est mobilisé dans une unité d'élite de l'armée belge, les chasseurs ardennais pendant que la France était entrée dans la drôle de guerre. Il milita ensuite dans la Résistance et obtint, en 1944, son diplôme d'ingénieur géologue et d'ingénieur des mines de l'Université de Liège où il s'était inscrit après la fermeture de l'Université libre de Bruxelles.
Après la guerre, alors qu'il travaillait au Congo belge, il eut l'occasion d'observer au plus près l'éruption d'un volcan né quelques jours auparavant, qu'il a baptisé du nom du lieu-dit le plus proche, Kituro, cratère voisin du Nyamulagira et de découvrir le lac permanent de magma du Nyiragongo. Ce fut une révélation pour lui et, dès lors, il se consacra à la volcanologie, inaugurant avec son ami Armand Delsemme, un astronome belge qu'il avait rencontré à l'université de Liège, d'audacieuses descentes dans la bouche des volcans pour y effectuer des prélèvements de lave et de gaz et y prélever, par les soins de Delsemme, les premières spectrographies de flammes volcaniques jamais réalisées.
Il devint aussi le compagnon de Jacques-Yves Cousteau sur la Calypso, dès 1951. Suivent alors plusieurs campagnes d'étude au Congo belge et ailleurs dans le monde. De 1956 à 1958, il réalisa le film Les Rendez-Vous du Diable
Il s'installe en France en 1953, tout en poursuivant sa carrière de volcanologue sous le contrôle scientifique du professeur Ivan de Magnée de l'Université libre de Bruxelles dont il fut l'assistant à son retour du Congo en 1949. Il se décidera à demander la naturalisation française après le départ du Général de Gaulle et l'obtiendra en 1971, perdant automatiquement la nationalité belge.
En 1971, Haroun Tazieff est nommé directeur de recherche au C.N.R.S. et accepte la direction des observatoires volcanologiques de l'Institut de physique du globe de Paris (I.P.G.)
Son soutien à François Mitterrand au long de la traversée du désert de celui-ci, et sa renommée mondiale, lui valurent d'être chargé de la prévention des risques naturels et technologiques majeurs par le Président François Mitterrand en 1981. Dénonçant ce qu'il estimait être les excès de l'écologie politique au détriment d'une étude sérieuse de l'écologie et déçu par la politique politicienne, il retourna à ses recherches.
Il exposa celles-ci à l'intention du grand public dans une série de vingt-quatre ouvrages publiés de 1951 à 1996. Dans plusieurs d'entre eux, il a combattu le catastrophisme en vogue avec le trou de la couche d'ozone et le réchauffement climatique, phénomènes qu'il ne niait pas, mais dont il estimait les causes mal analysées et la menace surfaite. Il intitula ironiquement l'un de ces ouvrages La Terre va-t-elle cesser de tourner ?
À partir de 1978, il organisera deux expéditions en Antarctique pour étudier le lac de lave de l'Erebus, un des volcans les plus fabuleux de la planète. Il est nommé en 1981 commissaire à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs – plus tard délégation aux risques majeurs – et, en 1984, secrétaire d'État chargé de la Prévention des risques naturels et technologiques majeurs. Bien que maire de sa commune (Mirmande, Drôme) et conseiller général de l'Isère, ce n'était pas un politique : ses déclarations fracassantes le montrent bien.
Haroun Tazieff était avant tout un explorateur et un écrivain, promoteur d'une discipline, la volcanologie, comme le furent Paul-Émile Victor pour l'étude de l'Arctique et du continent Antarctique et Jacques-Yves Cousteau pour l'océanographie. Homme de communication, par ses nombreux livres accessibles à tous, par ses films spectaculaires et par de nombreuses émissions de télévision bien documentées, il a fait connaître et aimer les volcans à un très vaste public.
Mort le 2 février 19987, il est enterré au cimetière de Passy à Paris.
Carrière scientifique et politique.
Il fut successivement :
assistant de faculté en entomologie ;
assistant de minéralogie professeur E.M. Denaeyer à la faculté des sciences de l'université de Bruxelles en 1944 ;
assistant de géologie appliquée et de géophysique professeur I. de Magnée à la faculté des sciences de l'université de Bruxelles en 1945 ;
ingénieur aux mines d'étain du Katanga Congo belge, en 1945 ;
géologue au service géologique du Congo belge. L'éruption du Kituro volcan - qu'il étudia en 1948 - détermina sa passion pour la volcanologie, et il se lança dans l'étude, sur le vif, de la phénoménologie des éruptions et de leur prévision, et dans la vulgarisation de la volcanologie ;
assistant de géologie appliquée et de géophysique professeur I. de Magnée faculté des sciences de l'université de Bruxelles 1949 et 1950 ;
chargé de cours volcanologie à l'université libre de Bruxelles, de 1957 à 1960, où il crée et anime le Centre national de volcanologie ; H. Tazieff s'installe en France en 1953 ;
chargé de cours à la faculté des sciences de Paris, en 1958, il est nommé directeur du laboratoire de volcanologie de l'Institut de physique du globe de Paris. Il se consacra à une longue série d'expéditions volcanologiques vallée des Dix mille fumées en Alaska, dépression de l'Afar, Nyiragongo, Erta Ale, mont Erebus, et bien d'autres volcans comme l'Etna et le Stromboli, Faial, la Soufrière de la Guadeloupe, Mérapi… ;
expert de l'UNESCO au Chili 1961, au Costa Rica 1964, en Indonésie 1964-1965 et en Islande 1973 ;
chargé de cours volcanologie à la faculté des sciences de l'université de Paris VI en 1966 ;
responsable de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique en 1967 ;
maître de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique CNRS en 1969 ;
directeur de recherche au CNRS en 1972, au laboratoire de volcanologie du Centre des faibles radioactivités de Gif-sur-Yvette qui se spécialisait notamment dans les gaz éruptifs ;
président du conseil scientifique de l'Institut International de Recherches Volcanologiques I.I.R.V.Rome, Catane, Pise ;
responsable du service volcanologique de l'Institut de Physique du Globe de Paris et responsable de la surveillance de la Montagne Pelée à la Martinique et de la Soufrière Guadeloupe de 1973 à 1976 ;
commissaire à l'étude et à la prévention des catastrophes naturelles en 1981 ;
chargé de mission au ministère de la Recherche et de l'Industrie en 1981 ;
corédacteur avec Philippe Chartier du rapport Maîtriser l'énergie à destination du ministère de la Recherche et de l'Industrie en 1981. Ce rapport fut largement préparé par son collaborateur, le volcanologue Jacques Varet. Cette action aboutira à la création de l'Agence Française pour la Maîtrise de l’Énergie AFME dès 1982.
La direction scientifique du CEA a cautionné la démarche d’Haroun Tazieff et lui a accordé sans restriction son soutien financier et l'assistance de ses équipes de terrain, participant au programme de recherches coordonnées qu'il dirigeait en tant que Directeur de recherche au CNRS et responsable des observatoires de surveillance volcanologique des départements d'Outre-Mer.
D'un point de vue politique, Haroun Tazieff a également été conseiller municipal de la ville de Grenoble, maire de la commune de Mirmande dans la Drôme provençale, de 1979 à 1989, conseiller général de l'Isère de 1988 à 1994 et conseiller régional de Rhône - Alpes de 1992 au 1er janvier 1995, date de sa démission.
Le gouvernement Mauroy a créé un Commissariat à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs décret 81-1012 du 12 novembre 1981, à la tête duquel fut nommé Haroun Tazieff. Ce Commissariat est devenu par décret du 23 juillet 1984 relatif à la composition du gouvernement, le Secrétariat d'état aux risques naturels et technologiques majeurs. Enfin, le décret no 84-284 du 10 avril 1984 porte création d'une Délégation aux risques majeurs, secrétariat d’État et délégation étant rattachés au Premier ministre.
De 1984 à 1986, cet homme politique de gauche fut secrétaire d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs auprès de Laurent Fabius, Premier ministre de François Mitterrand. Ce poste de secrétaire d'État sera supprimé dans le gouvernement Chirac en 1986.
La loi no 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée - relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles art. L.125-1 à L.125-6 du code des assurances - a fixé pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale. Elle comporte cependant dans son article 5 l'obligation pour l'État d'élaborer et de mettre en application des Plans d'Exposition aux Risques Naturels prévisibles P.E.R..
Ces plans sont élaborés et révisés dans les conditions définies par le décret no 84-328 du 3 mai 1984. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés aux plans d'occupation des sols, conformément à l'article R 123-10 du code de l'urbanisme. Les risques pris en compte sont :
les inondations ;
les avalanches ;
les mouvements de terrain au sens large glissements de terrains, chutes de pierres, éboulements, effondrements et laves torrentielles ;
les séismes.
Il fut président du Comité supérieur des risques volcaniques de 1988 à 1995, et membre de la société Philomatique et de l'Explorers club de New York. Il obtint le Prix André de Saint-Sauveur de l'Académie des sports en 1971, pour exploit sportif exceptionnel et de caractère original. Il fut également président de l'association Mountain Wilderness.
Dès 1948, il se lance dans l'étude sur le vif de la phénoménologie des éruptions. Il révèlera l'importance des éruptions sous-marines, qu'il fut le premier à observer, décrire et analyser de 1957 à 1963 aux Açores Faïal, Capelinhos, expérience reprise lors de la formation de l'île de Surtsey en 1963, en Islande, puis lors de l'exploration de l'Afar Éthiopie et en Polynésie. Il fit de même pour les lacs de magma qu'il a découverts Nyragongo, Erta Ale, Erebus ainsi que pour les éruptions phréatiques Indonésie, Afar, Soufrière de la Guadeloupe, Dieng, lac Nyos.
Il est l'un des fondateurs de la volcanologie moderne, science dont il s'est fait l'apôtre du développement multidisciplinaire. Les innovations qu'il a apportées, suscitées ou favorisées portaient autant sur les concepts que sur les instruments de mesure, dont plusieurs sont restés des éléments de référence, ou sur les moyens d'accès aux bouches éruptives actives et la méthodologie de la protection des chercheurs de terrain, comme de la prévention des risques pour les populations locales.
Haroun Tazieff fut aussi l'un des pionniers de la validation de la théorie de la tectonique des plaques. À partir de 1967, les expéditions Tazieff en Afar Éthiopie, ont apporté la démonstration de l'origine océanique des systèmes volcaniques axiaux actifs de la région.
Initié dans les années 1940 aux travaux de Wegener par son professeur le tectonicien belge Paul Michot, Haroun Tazieff cherchait depuis 1948-49, après sa découverte du volcanisme dans la branche sud-occidentale du grand rift africain dans le Kivu, à en explorer la partie septentrionale, qu'il ne put explorer qu'en 1967, après plusieurs tentatives avortées. Les travaux de recherche décrivant les mécanismes d'expansion en Afar se sont poursuivis de 1967 à 1976, donnant lieu à une multitudes de publications. Franco Barberi et Jacques Varet, prenant le relais d'Haroun Tazieff et de Giorgio Marinelli, se sont vus décerner le prix L.R. Wager par la Royal Society et l'Association Internationale de Volcanologie et de Chimie de l'Intérieur de la Terre AIVCIT, 1972.
Haroun Tazieff était également un ami proche du dessinateur belge Hergé qu'il avait bien connu à Bruxelles. Le dessinateur le comparait à Jules Verne.
Tazieff et ses équipiers ont réalisé en Afar les premières mesures directes d'écartement des lèvres d'un rift océanique. Si l'ouverture augmente de 2 cm en moyenne par an, il s'agit en réalité d'une succession d'ouvertures brutales de segments actifs, à compter en mètres sur des espaces de temps de l'ordre de 100 ans. Les événements récents mesurés par interférométrie sur images satellites le long de la chaîne axiale de Manda Harraro sont venus confirmer ce type de phénomène en 2006.
L'apport de Barberi et Varet a été de démontrer que les chaînes volcaniques axiales de l'Afar étaient de type océaniques au plan tectonique et magmatique et assuraient le relais entre les vallées axiales de la Mer Rouge et celles du Golfe d'Aden. De sorte que la frontière des plaques entre l'Afrique et l'Arabie ne passe pas en mer par le détroit de Bab-el-Mandeb, mais à terre à travers l'Afar. La nature de la tectonique et du volcanisme de l'Afar se distingue ainsi de celle de la Vallée du grand rift africain, qui reste un rift continental n'ayant pas donné lieu à la génération de croûte océanique nouvelle. Varet et Barberi ont dû batailler avec leur ami Tazieff pour le convaincre de la nature océanique et non continentale des laves de l'Erta Ale.
Éruption de la Soufrière
Suite à des manifestations inquiétantes du volcan de la Soufrière en Guadeloupe en 1976, une violente polémique opposa Haroun Tazieff à Michel Feuillard, directeur de l'observatoire volcanologique de la Guadeloupe, et à Claude Allègre, alors son supérieur à l'Institut de physique du globe de Paris. Feuillard, Allègre et le professeur Brousse, sur place, se fondant sur des analyses alarmantes montrant de la présence de magma frais dans les laves et cendres recueillis après les éruptions du volcan, conseillaient l'évacuation de 70 000 habitants proches, tandis que Tazieff, de retour d'un déplacement en Équateur, et se fondant sur son expérience de terrain après une visite sur le site où il faillit être tué par une éruption de vapeur expulsant d'énormes blocs de lave ancienne affirmait que le volcan n'avait pas de magma frais, et qu'il n'y avait pas de risque imminent de nuées ardentes, ajoutant que la surveillance du volcan permettrait d'avoir vingt-quatre heures pour évacuer la zone habitée en cas de remontée de magma. Des mots peu aimables furent échangés, Claude Allègre cherchant à empêcher Tazieff et les membres de son équipe de communiquer les résultats de leurs analyses. Dans le doute, les pouvoirs publics préférèrent évacuer. Finalement, il s'avéra que les analyses montrant la présence de magma frais étaient erronées, et la Soufrière n'explosa pas, mais se calma sans provoquer de dégâts.
La polémique rebondit en partie quatre ans plus tard, en 1980, lors de l'explosion spectaculaire du Mont Saint Helens État de Washington, États-Unis survenue le 18 mai, qui tua 57 personnes. Haroun Tazieff avait en effet, quelques semaines plus tôt, qualifié le mont Saint Helens de Petite Soufrière mais s'était contenté d'un survol du volcan, à l'encontre de ce qu'il a toujours préconisé en matière de diagnostic : la répétition de longues observations au plus près du volcan. De même qu'il avait préconisé la surveillance de la Soufrière, indiquant que l'on aurait certainement vingt-quatre heures pour évacuer en cas de remontée de magma frais, lorsqu'il a affirmé que le St Helens était une petite Soufrière, c'était à la suite d'une éruption phréatique, bien avant la catastrophe. Ce n'était à l'évidence pas pour nier le risque ultérieur de montée de magma, puisque telle était son appréciation des risques à la Soufrière de Guadeloupe.
Ses adversaires le tinrent aussi à tort pour moralement responsable de la gestion de la crise du Nevado del Ruiz, en 1985, en Colombie, car cette crise fut en partie gérée par un conseiller qui avait vécu la polémique de la Soufrière, et qui ne voulait pas reproduire l'erreur de 1976. L'éruption du volcan provoqua un lahar, entraînant la mort de 25 000 personnes. En réalité, le conseiller en question, le volcanologue italien Franco Barberi, avait informé les autorités colombiennes sur les mesures à prendre, mais il ne fut pas écouté. Tazieff fut ensuite appelé par le président colombien pour évaluer le risque de nouveaux lahars. Il conclut de son inspection qu'il n'y avait plus de risque. Il n'y eut pas de second lahar.
Notoriété Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre
Les apports d'Haroun Tazieff à la volcanologie et à la politique de prévention des risques naturels et technologiques majeurs et l'actualité des enjeux au centre desquels il s'est trouvé fortement impliqué, font l'objet des travaux d'une association née en juillet 2008, le Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre, dont le siège social est à Arette, commune des Pyrénées Atlantiques où se trouve le célèbre gouffre de la Pierre Saint-Martin dont Tazieff fut l'un des explorateurs en 1951 et 1952, et dont le siège administratif est à Chaudeyrolles, en Haute-Loire, au cœur du massif volcanique du Mézenc-Gerbier-de-Jonc.
Une autre implantation majeure de l'association est prévue à Borée, sur le versant ardéchois du mont Mézenc, pour 2013.
Soutenue par de nombreux scientifiques, dont plusieurs anciens des équipes Tazieff, cette association inscrit son travail dans le terrain du développement local en zone rurale de moyenne montagne, notamment par des actions d'éducation populaire aux enjeux des sciences de la Terre. Elle est animée et présidée par le fils d'Haroun Tazieff, Frédéric Lavachery.
Depuis septembre 2011, le Centre Haroun Tazieff conduit avec Christine Hainaut, la directrice de l'école publique primaire Lancelot, à Privas, un projet intitulé Volcans et Paysages Européens qui a pour but de marier l'enseignement scolaire et l'éducation populaire. Ce projet a été distingué au printemps 2012, l'école Lancelot ayant reçu le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe et sa directrice, Christine Hainaut, le prix du Jury au 5e Forum des enseignants innovants.
APANAGE : Association PAtrimoine NAturaliste Géologique
Ebauchée dès 2000, cette association créée en 2009 en Auvergne milite pour le recensement, la sauvegarde et la promotion du patrimoine géologique, qu'il soit naturel ou issu des travaux des scientifiques et des naturalistes. Cette association est présidée par Thierry del ROSSO, ingénieur géologue professionnel diplômé de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy et membre notamment du conseil scientifique du Centre Haroun Tazieff, avec qui il travaille depuis 2009 au recensement, à l'acquisition, à la sauvegarde et à la valorisation de l'héritage scientifique et naturaliste laissé par Haroun Tazieff.
Mentions diverses
Dans le film Adieu Berthe de Bruno Podalydès, l'un des personnages, Haroun, explique que le célèbre volcanologue s'appelle en réalité Haroun Taziouff.
Haroun Tazieff est évoqué dans le 406e des 480 souvenirs cités par Georges Perec dans Je me souviens.
Bibliographie
Il a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation, ainsi que plus d'une centaine de publications scientifiques et réalisé plusieurs films documentaires.
Ouvrages
Cratères en feu - éd. Arthaud, 1951, 1956, 1957, 1961, 1967, 1970, 1973, 1974, 1976, 1978 et 1996.
Le gouffre de la Pierre Saint-Martin - éd. Arthaud, 1952, 1954, 1964 et 1966.
L'eau et le feu - éd. Arthaud, 1954, 1956, 1966 et 1967.
Les rendez-vous du diable illustrations de Jean Reschofsky - éd. Hachette, 1959, 1960, 1970 et 1975.
Volcans et éruptions - éd. Nestlé, 1960.
Les volcans - éd. Delpire, 1961 et 1964.
Quand la terre tremble - éd. Fayard, 1962, 1967, 1975 et 1981.
Histoires de volcans, illustrations de Jean Lavachery - éd. Le Livre de poche, 1964, 1972, 1975 et 1978.
15 aventures en montagne (le lac de lave), éd. Gautier - Langereau, série 15, 1966.
15 aventures sous terre auteurs : Clément Borgal, Norbert Casteret et Haroun Tazieff (Au gouffre de la Pierre Saint Martin, pp 175 à 188), illustrations de Georges Pichard - éd. Gautier-Languereau, série 15, 1970, 1971 et 1972
L'Etna et les volcanologues éd. Arthaud, 1971 et 1972
Les volcans et la dérive des continents - éd. Presses universitaires de France, 1972, 1973 et 1984.
De l'autre côté de la nuit de Eugene Oustiev - préface Haroun Tazieff, traduit du russe par Zenitta Tazieff-Vivier, Robert Vivier & Haroun Tazieff - 217 p. éd. Arthaud, 1973.
Vingt-cinq ans sur les volcans du globe, dessins de Pierre Bichet, 2 volumes - éd. Nathan, 1974 : apprentissage.
Vingt-cinq ans sur les volcans du globe, dessins de Pierre Bichet, 2 volumes - éd. Nathan, 1975 : volcanologues au travail.
L'odeur du soufre : expédition en Afar - éd. Stock, 1975 et 1976 (post-face sur la Soufrière).
Cordillères, séismes et volcans - éd. Laffont, 1975, coll. Laffont Les grands thèmes.
Niragongo ou le volcan interdit illustrations de Pierre Bichet - éd. Flammarion, 1975.
Jouer avec le feu, entretiens avec Jean Lacouture et Marine Barrere, éd. Seuil 1976 et 1977.
L'Etna - Uno del vulcani piu attivi del mondo 1977 et 1989.
Erebus, volcan antarctique - éd. Arthaud, 1978 et 1994.
La Soufrière et autres volcans - la volcanologie en danger - éd. Flammarion, 1978.
Ouvrez donc les yeux : conversations sur quelques points brûlants d'actualité conversations avec Claude Mossé - éd. Laffont, 1980.
Ça sent le soufre en collaboration avec Claude Villers - éd. Nathan, 1981.
Maîtriser l'énergie avec Philippe Chartier - la Documentation française, 1983.
Quand la terre tremble documentation Valérie Thomas, IIIe édition - éd. Fayard. 1986.
La prévision des séismes - éd. Hachette, 1989.
La terre va-t-elle cesser de tourner ? : pollutions réelles, pollutions imaginaires, IIè édition - éd. Seghers, 1989, 1991 et 1992.
Le volcanisme et sa prévention, en collaboration avec Max Derruau - éd. Masson, 1990.
Natura nostra - auteurs : Haroun Tazieff - Yann Le Pichon - Béatrice Becquart - Paul-Emile Victor - préface : Brice Lalonde - Great events éditions, 1990.
Sur l'Etna IIIe édition avec la collaboration de Bernard Amy et Florence Trystram - éd. Flammarion, 1991.
Les défis et la chance : ma vie - éd. Stock - L. Pernoud, c.1991-1992 et 1998. - 2 volumes : vol. 1 : De Pétrograd au Niragongo.
Les défis et la chance : ma vie - éd. Stock - L. Pernoud, c.1991-1992. - 2 volumes : vol. 2 : Le vagabond des volcans.
Volcans - éd. Bordas, 1996.
Documents de vulgarisation scientifique et résumés de conférences :
Où les volcans puisent-ils leur fantastique puissance ? - article Science et Vie no 398, p. 267 à 274, novembre 1950.
Les volcans et leur secret compte-rendu écrit Connaissance du monde, 1957.
Stromboli et autres volcans compte-rendu écrit Connaissance du monde, 1958.
Les volcans et leur secret compte-rendu écrit Connaissance du monde, 1961.
La vie secrète des volcans - Le Courrier de l'Unesco, octobre 1963.
Volcans sous-marins : la fantastique éruption des Açores, compte-rendu écrit Sciences et Voyages, 1964.
Les leçons du volcan Irazu - Le Courrier de l'Unesco, novembre 1965.
Le grand péril des volcans éteints, Le Courrier de l'Unesco, octobre 1967 (article repris en septembre 1969 et juin 1986).
Bibliothèque de travail BT sonore - no 8 Les tremblements de Terre - Publication École Moderne Française, 1973.
Bibliothèque de travail BT sonore - no 9 Sur les volcans du monde - Publication École Moderne Française.
Bibliothèque de travail BT sonore - no 838 (mai 1969) : sur les volcans du monde. 1.
Bibliothèque de travail BT sonore - no 839 (juin 1969) : sur les volcans du monde. 2.
Lac de feu au coeur de l'Afrique - compte-rendu écrit - Sélection du Reader's Digest - Terres vierges Mondes interdits, 1973.
Bibliothèque de travail BT sonore - no 870 (1978).
Bibliothèque de travail BT supplément mensuel - no 415 (décembre 1978).
Les forces violentes de la nature : les volcans, Revue trimestrielle de l'Unesco - impact science et société, no 32, 1982.
Connaissance des volcans - Dossier chocolat Poulain (1984 ?).
Objectif Terre : la tectonique des plaques, compte-rendu écrit du premier festival (à Digne) du film télévisé sur les Sciences de la Terre, 1985.
Les volcans - Le Courrier de l'Unesco, juillet 1986.
Les volcans - éd. Hachette - collection : en savoir plus no 22 (vulgarisation scientifique), 1987.
Préfaces d'Haroun Tazieff :
Le pays vierge - Robert Vergnes 1959
Idylle au pays des volcans - Jean Issarlès 1960
Sous le vent des bêtes sauvages - Dr James Lartizien 1967
La jeunesse - Une enfance - La maison brûle - Loyen - Marouzeau - Heron 1972
Les métiers de la nature - Anne Galey - Mady Caen 1973
De l'autre côté de la nuit de Eugene Oustiev 1973
Les volcans d'Auvergne - Aimé Rudel 1974
Le procès des étoiles - Florence Trystram 1979
140 dessins contre le nucléaire - 1980
L'ascension sur la mer - Christian Zuccareli 1980
Le pétrole on s'en fout - Vive(nt) les énergies naturelles - Pierre Kohler 1980
Nous sommes condamnés à vivre ensemble - Romulus 1981
Terre opération survie - Lucien matthieu 1981
Rivières sous la pierre - Jean-François Pernette 1983
Le sport à la Une - 1870 - 1914 - Nicole Priollaud 1984 -
Les 5 trésors de la grande neige - Pierre Beghin 1985
Des pyramides aux obélisques - Manuel Minguez 1985
Les forêts meurent aussi - Christian Kempf et Thierry Piantanida 1986
Séisme Côte d'Azur - René Leucart 1987
Urgence d'une nouvelle mentalité préventive - Elie Griguer 1987
Djibouti - Nation carrefour - André Laudouze 1989
Le parfum des étoiles - François Virot 1990
les incendies de forêt - Jérôme Strazzulla 1991
Pyrénées sauvages - François Merlet 1991
La grande peur de la Provence - Jean-Claude Rey 1992
L'air en péril - jacques Breton 1992
Ozone - Un trou pour rien - Maduro 1992
Tête brûlée - Houot 1995
Filmographie[modifier | modifier le code]
Grêle de feu, éruption du Kituro, 1948.
Stromboli, 1949.
Le Réveil de l'Etna, 1949.
Etna, 1950.
Le gouffre de la Pierre Saint Martin, 1953, documentaire 18 min, réalisé avec Michel Bernheim
Les Eaux souterraines, 1956, film 16 mm, 25 min, narrateur Bernard Blier - lauréat du prix documentaire au festival de Venise en 1957 - 1er prix université de Padoue.
Les Volcans, 1957.
Les Rendez-vous du diable, production indépendante, Bruxelles, 1958 - sortie janvier 1959, 80 min (Sakurajima, Aso-San, Taal, AnakKrakatoa, Sumbing, Mérapi, Izalco - Stromboli - Etna - Faïal des Açores) Prix Pellman du cinéma 1959, lauréat meilleur court métrage au festival international du film de Melbourne (Australie) en 1962.
Stromboli , Production Ciné-documents Tazieff, film 16 mm noir et blanc, 1963, 13 minutes.
Le Volcan interdit, 1966 Gaumont 90 min, film nominé aux oscars en 1967, catégorie meilleur documentaire - Grand prix du Cinéma pour la Jeunesse - Prix¨Parkin.
Erta Ale, 1973 Production Ciné-documents Tazieff - CNRS images, film 16 mm, 22 min.
Izalco + Stromboli - Etna - Faïal des Açores, Les Volcans, Film Office, 1974.
Niragongo et éruptions fantastiques, Film Office, 1974
Afar - la dérive des continents, 1975, Gaumont, 45 min.
Le Nyiragongo, 1976 Gaumont, 45 min.
L'Etna, 1977 Gaumont, 45 min.
L'Erebus - volcan antarctique, 1977, Gaumont, 45 min.
Gunung Merapi, 1980, CNRS images, film 16 mm, 54 min.
7 films documentaires pédagogiques CNDP : La naissance d'un volcan - Stromboli - Solfatares et fumerolles - Coulées de lave - Lac de lave - Explosions - La naissance d'un océan, 1982, 13 min.
La Terre, son visage de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 1, 52 min.
La Mécanique de la Terre de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 2, 50 min.
Les Colères de la Terre de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 3, 57 min.
Déserts arides et déserts de glace de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 4, 57 min.
Les Éléments naturels qui façonnent le paysage de la Terre de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 5, 50 min.
Haroun Tazieff et les volcans de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, 2 films - éd. Radio-France, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 6 et vol. 7, 57 min et 52 min.
Volcans d'Europe et de France, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 8.
Les mystères des abysses, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, 1984, 51 min.
Les profondeurs de la planète, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, 1984, 57 min.
Le cycle de l'eau, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, 1984, 52 min.
L'Etna 1989, sortie en 1990.
Retour à Samarkand - 1991 (série télévisée de quatre émissions de 52 min) : 1. Au Battistan, 2. En pays Hunza, 3. En Kashgarie, 4. En pays Ouzbek.
Le feu de la Terre 1 : Du volcan interdit à la montagne de Dieu (Tanzanie - Kenya - Zaïre), Gaumont, 1991, 52 min.
Le feu de la Terre 2 : Au royaume de Vulcain - Sur les traces d'Empédocle (Italie - Sicile), Gaumont 1991, 52 min.
Le feu de la Terre 3 : Le triangle de l'Afar (Éthiopie - Djibouti), Gaumont, 1991, 52 min.
Le feu de la Terre 4 : Le boulevard des volcans ou Cordillères des volcans (Chili - Guatemala), Gaumont 1991, 52 min.
Le feu de la Terre 5 : Java - Les cratères fertiles (Indonésie), Gaumont 1991, 52 min.
Le feu de la Terre 6 : Prévoir l'imprévisible (Japon - Philippines - Antilles - Antarctique), Gaumont 1991, 52 min.
Les volcans, Ciné Documents Tazieff Gaumont, 1992, 90 min.
Publications scientifiques
1949 : Premières explorations du cratère du Nyiragongo. - Ann. soc. belge de géologie, Bruxelles, t. LVIII, p. 165-172.
1950 : L’éruption du volcan Kituro (Kivu, Congo belge) de mars à juillet 1948. – mém. no 1 - Direction générale des affaires économiques, Service géologique. 158 p et 22 planches photos.
1952 : Une récente campagne océanographique dans la mer Rouge. - Bulletin de la soc. belge de géologie, Bruxelles, t. LXI, p. 84-90.
1953 : H. Tazieff, J.-Y. Cousteau et W. Nesteroff : coupes transversales de la mer Rouge. - Congrès géol. international Alger IV, p. 75-78.
1957 : M.E. Denayer et H. Tazieff : nature de la lave actuelle et de quelques laves plus anciennes de la caldère du Nyiragongo. - C. R. Acad. Sci. , Paris, t. 244, p. 218-221.
1958 : L’éruption de 1957-1958 et la tectonique de Faial, Açores. - Ann. Soc. belge de géologie. Bruxelles, t. LXVII, p. 14-49.
1960 : M. Chaigneau, H. Tazieff, et R. Fabre : Sur l’analyse des émanations volcaniques de l’archipel des Nouvelles-Hébrides - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 250, p. 1760-1765.
1960 : M. Chaigneau, R. Fabre et H. Tazieff : Composition des gaz volcaniques du lac de lave permanent du Nyiragongo (Congo). - C. R. Acad. Sci., Paris, 250, p. 2482-2485.
1960 : Exploration géophysique et géochimique du volcan Nyiragongo - Congo Belge - Bull. volc - vol. XXIII, p. 69-71.
1960 : M. Chaigneau, R. Fabre et H. Tazieff : Sur l’extraction et l’analyse des gaz occlus dans la lave du volcan Nyiragongo. - Ann. geophys, t. XVI, fasc. 4.
1960 : À propos de la signification tectonique des importants glissements de terrains provoqués par le grand séisme du Chili de mai 1960. - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 251, p. 2204-2206.
1960 : Interprétation des glissements de terrain accompagnant le grand séisme du Chili .- Bull. soc belge de géologie, t. LXIX, p. 374-384.
1961 : Cl. Blot et H. Tazieff : Quelques résultats de séismologie volcanique au volcan de Tanna, Nouvelles-Hébrides. - Bull. séances acad. royale sci. O.M (A.R.S.O.M.), t. VII, fasc. 2, p. 270-279.
1962 : Observations sur la crise volcano-sismique de mai 1960 au Chili. - Bull. volc. - vol. XXIV.
1962 : E. Perterschmitt et H. Tazieff : Sur un nouveau type de secousse volcanique enregistrée au Stromboli. - C. R. Acad. Sci., Paris. t. 255, p. 1971-1973.
1963 : B. Gèze et H. Tazieff : Le renouveau des études européennes sur les volcans actifs. - Bull. Soc. géol. France, t. V, p. 173-175.
1963 : Dissolved gases in East african lakes in Nature, London, t. 200, p. 1308.
1963 : H. Tazieff et F. Tonani : Fluctuations rapides et importantes de la phase gazeuses éruptive. - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 257, p. 3985-3987.
1963 : P. Bordet, G. Marinelli, M. Mittenbergher et H. Tazieff : Contribution à l’étude volcanologique du Katmaï et de la Vallée des Dix-Mille-Fumées.- Mém. de la Soc. Belge de Géologie. Série 8, no 7, p. 1-114.
1963 : Il vulcano Tinakula (Pacific occidentale). - Att. Soc. Toscana Sci. Nat. Vol 70, p. 443-451.
1963 : édition française traduite et introduite par H. Tazieff du livre d'Alfred Rittmann : les volcans et leur activité, éd. Masson.
1964 : I. Elskens, H. Tazieff et F. Tonani : A new method for gas analysis in the field.- I.U.G.G. Gen.Ass. Bull. Volc. XXVII. p. 1-4.
1965 : Convective Origin of Lunar craters. - Ann. of the New York Acad. of Sci. t. 123, p. 525-527.
1966 : Indonesia volcanological report. - Unesco p. 1-23.
1966 : Volcano Survey. - Earth Sciences Reviews I, volume 1, p. 235-299, Elsevier.
1966 : État actuel des connaissances sur le volcan Niragongo (République Démo. du Congo). - Bull. Soc. géol. France, t VIII, p. 176-200.
1967 : Turbidites - C. R. som. Soc. géol. fr., p. 1-20.
1967 : I. Gibson et H. Tazieff : Additional theory of origin of fiamme in ignimbrites. - Nature 215, 5109, p. 1473-1474.
1967 : I. Gibson et H. Tazieff : Genèse de l’ignimbrite pantelléritique de Fantalé - C. R. Acad. Sci, . Paris, t. 265, p. 950-953.
1967 : Menace of extinct volcanoes, Impact of Science on Society 1967, t. 17, p. 135-148.
1968 : Sur le mécanisme des éruptions sous-marines basaltiques à faibles profondeurs et la genèse d’hyaloclastites associées. - Géologische Rundschau, Vol 57.3, p. 955-966.
1968 : H. Tazieff, J.L. Boulay, M. Garand et J. Maulard : Mesure des variations rapides des paramètres thermiques des gaz éruptifs. - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 267, p. 1253-1256.
1968 : G. Marinelli et H. Tazieff : L’ignimbrite et la caldera du Batur (Bali, Indonésie) .- Bull. Volc. vol. XXXII, p. 89-120.
1968 : Rapports de la tectonique de l'Afar (Éthiopie)avec celle de la mer Rouge. - Compte-rendu sommaire des séances de la Soc. géol. France, vol. 6, p. 177.
1968 : Relations tectoniques entre l’Afar et la mer Rouge. -Bull. Soc. géol. France. t. X, p. 468-477.
1969 : Tectonique de l’Afar septentrional. - C. R. Acad. Sci. Paris, t. 268, p. 2030-2033.
1969 : Volcanisme sous-marin de l’Afar (Éthiopie). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 268, p. 2657-2660.
1969 : I. Elskens, H. Tazieff et F. Tonani : Investigations nouvelles sur les gaz volcaniques. - Bull. Volc. vol. XXXII, p. 522-574.
1969 : Potash-bearing evaporates, Danakil area, Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists, 64 ( 2 ), p. 228-229.
1969 : La Dankalie, point crucial de la tectonique des rifts, Bulletin des séances de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, Belgique, no 4.
1969 : H. Tazieff et M. Jatteau : Mesure dans l’infra-rouge de paramètres physiques des gaz éruptifs - C.R.A.S. , Paris, t. 268, p. 767-770.
1969 : H. Tazieff et M. Jatteau : Infrared measurement of physical parameters of eruptive gases - Geochemistry international, t. 6, p. 1171.
1969 : H. Tazieff, Boulay et Garand : Measurement of rapid variations of thermal parameters of eruptives gases, Geochemistry international t. 6, p. 1168.
1969: H. Tazieff et J. Varet : Signification tectonique et magmatique de l’Afar septentrional ( Éthiopie ), Revue de géographie physique et de géologie dynamique, t. XI.
1969: H. Tazieff, G. Marinelli, F. Barberi et J. Varet : Géologie de l’Afar septentrional, première expédition du CNRS France et du CNR Italie (décembre 67 - février 68). - Bull. Volc., vol. XXXIII-4, p. 1039-1072.
1969: H. Tazieff, G. Marinelli et F. Barberi : Geologia della Dancalia settentrionale, Rendiconti della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, 25(1), p. 170-172.
1970 : The mecanism of ignimbritic eruption, Geol. Jnl. special issue on mechanism of igneous intrusion no 2. Liverpool, p. 157-164.
1970 : New investigations on eruptive gases, Bull. Volc. vol. XXXIV, p. 421 - 438.
1970 : The Afar Triangle, Scientific American, vol 222-2, p. 32-40.
1970 : The Afar triangle Continents, Adrift: reading from Scientific American, p. 133-141, W. Freeman, San Francisco. (Sur l’expédition internationale de 1967).
1970 : I.L. Gibson et H. Tazieff : The structure of Afar and the northern part of the Ethiopian rift. - Philosophical Transactions of the Royal Soc. of London, t. 267, p. 331-388.
1970 : E. Bonatti et H. Tazieff : Submarine volcanoes in the Afar rift. - Amer. Geoph. Un Transactions.
1970 : E. Bonatti et H. Tazieff : Exposed guyot from the Afar Rift - Ethiopia, Science, Washington, 168, p. 1087-1089.
1970 : Tectonics of the northern Afar ( or Danakil ) rift ; in : Graben problems ( Muller J. H., Illies, St, editor ), E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, p. 280-283. (International upper mantle project science report no 27).
1970 : New investigations in Afar ( Ethiopia and French Somaliland ), Proceedings of the Geological Society of London, no 1663, p. 170-171.
1971 : Sur la tectonique de l’Afar Central - C. R. Acad. Sci., Paris . t. 272, p. 1055-1058.
1971 : F. Barberi, G. Giglia, G. Marinelli, H. Tazieff, J. Varet : Carte géologique de la dépression des Danakils ( Afar septentrional, Éthiopie ), au 1/50.0000ème, Paris, C.N.R.S.
1971 : H. Tazieff et F. Le Guern : Signification tectonique et mécanisme de l’éruption d’avril-mai-juin 1971 de l’Etna- C. R. Acad. Sci., Paris, t. 272, p. 3252-3255.
1971 : New investigations on Eruptive Gases - Bull. Volc. vol. XXXIV, p. 421-438.
1971 : Volcanisme et géothermie - Annale des mines, p. 123-133.
1971 : Volcanologie en Afar et en Italie, Le Courrier du C.N.R.S., no 1, p. 27-31.
1971 : About the paper « Volcanic activity related to the formation of the Kuroko-type deposits in the Kosaka district, Japan », Mineralium deposita, t. 6, p. 89 - 90.
1972 : About deep-sea volcanism - Geol. Rundschau, t. 61, p. 470-480.
1972 : P. Zettwoog, J. Carbonelle, F. Le Guern, H. Tazieff : Mesures de transferts d’énergie et de transferts de masse au volcan Erta’Ale (Afar, Éthiopie). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 274, p. 1265-1268.
1972 : H. Tazieff, J. Varet, F. Barberi et G. Giglia : Tectonic signifiance of the Afar (or Danakil) Depression. - Nature, London. vol. 235, no 5334, p. 144-147.
1972 : F. Barberi, S. Borsi, G. Ferrara, G. Marinelli, R. Santacroce, H. Tazieff et J. Varet : Evolution of the Danakil Depression (Afar, Ethiopia) in light of radiometric age determinations. - Jour. Geol., 80, p. 720-729.
1972 : Tectonics of Central Afar. - Jour. Earth. Sci. Leeds, 8, p. 171-181.
1972 : F. Barberi, H. Tazieff et J. Varet : Volcanism in the Afar Depression : its tectonic and magmatic significance. - Tectonophysics, Elsevier, 15, p. 19-29.
1972 : G. Marinelli, F. Barberi, J. Varet et H. Tazieff : Carte géologique de la Chaîne volcanique de l’Erta’Ale. - CNRS.
1972 : F. Le Guern, J. Cabonelle, P. Zettwoog et H. Tazieff : étude chimique des fluctuations des gaz éruptifs du volcan Erta ale (Afar, Éthiopie) C.R.A.S. série D 274 p. 1003 - 1006.
1972 : a dynamic approach to the problem of forecasting volcanic paroxysm - The surveillance and prediction of volcanic activity - A review of methods and techniques - UNESCO Paris Earth sciences no 8, p. 127 - 130.
1972 : Ethiopias geothermal possibilities.
1972 : Les volcans et la dérive des continents, Paris, PUF, coll. Sup., 136 p.
1973 : Tazieff et alii : La signification tectonique de l’Afar, numéro spécial de la revue de géographie physique et géologie dynamique sur l'Afar, 2ème série - XV, fascicule 4.
1973 : H. Tazieff et J. Varet : About air and space photo interpretation of Afar, Eos, Transactions , American Geophysical Union, 54 ( 4 ), p. 470.
1973 : P. Zettwoog et H. Tazieff : Instrumentation for Measuring and Recording Mass and Energy Transfer from Volcanoes to Atmosphere. - Bull. Volc. vol XXXVI, no 1, p. 1-19.
1973 : Structural implications of the 1971 Mount Etna eruption. - Phil. Trans. roy. Soc. Lond. t 274, p. 79-82.
1973 : F. Barberi, G. Marinelli, R. Santacroce, H. Tazieff, J. Varet, E. Chedeville, H. Faure, G. Giglia, Geology of northern Afar ( Ethiopia ), Rev. Géog. Phys. Géol. Dyn., série 2, vol. 15, no 4, p. 443-490.
1975 : F. Le Guern, W. Giggenbach, H. Tazieff et P. Zettwoog : Étude des fluctuations de la phase gazeuse à l’étang de lave de l’Erta’Ale (Éthiopie). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 280, p. 1959-1962.
1975 : F. Le Guern, W. Giggenbach et H. Tazieff : Equilibres chimiques des gaz éruptifs du volcan Erta’Ale (Éthiopie). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 280, p. 2093-2095.
1977 : An exceptional Eruption : Mount Niragongo, Jan. 10th, 1977 - Bull. Volc. vol XXXX, p. 189-200.
1977 : La Soufrière, volcanology and forecasting. - Nature, t. 269, p. 96-97.
1978 : L’éruption de l’Ardoukôba, Le Réveil de Djibouti, p. 5-6, 16 novembre 1978 et 23 novembre 1978 (colloque CCAR Djibouti).
1978 : J. Demange et H. Tazieff : L’éruption tectonique de l’Ardoukôba (Djibouti). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 287, p. 1269-1272.
1978 : About Antarctic hyaloclastites. - Bull. Volc., vol. XXXXI, p. 1-2.
1979 : P. Allard et H. Tazieff : Phénoménologie et cartographie thermique des principales zones fumeroliennes du volcan Mérapi (Indonésie). - C. R. Acad. Sci., Paris. t. 288, p. 747-750.
1979 : F. Le Guern, P. Biocchi, A. Nohl et H. Tazieff : Analyse directe des gaz volcaniques. - C. R. Acad. Sci., Paris. t. 288, p. 867-870.
1979 : Le volcanisme africain actuel, Colloque de Géologie Africaine à Montpellier du 25 au 27 avril 1979, Résumés, 10, p. 146-148.
1979 : What is to be forecast : outbreak of eruption or possible paroxysm ? The example of the Guadeloupe Soufrière. - Jour. Geol. Soc. Lond., 136, p. 327-330.
1979 : P. Allard, H. Tazieff et D. Dajlevic : Observations of sea floor spreading in Afar during the novembre 1978 fissure eruption. - Nature, vol 279, p. 30-33.
1979 : F. Le Guern, J. Carbonnelle et H. Tazieff : Erta’Ale lava lake : heat and gas transfer to the atmosphere. - Jour. Volc. Geoth. Res., t. 6, p. 27-48.
1980 : D. Westercamp et H. Tazieff : Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, La Desirade. Guides géologiques régionaux. Masson, Paris.
1980 : F. Le Guern, P. Morel, H. Tazieff et C. Vavasseur : Volcanic plume thermal radiation : 1972 eruption of Piton de la Fournaise, Réunion Island. - Jour. Volc. Geoth. Res., 12, p. 167-175.
1980 : P. Allard, H. Tazieff et D. Daljevic : Caractéristiques géochimiques des volatils émis par le volcanisme des zones de rift : l'éruption d'Ardoukoba, rift d'Assal, Djibouti, novembre 1978 - Institut national d'astronomie et de géophysique, Bulletin PIRPSEV, 35.
1980 : lettre à l'éditeur, Jour. of Volc. and Geoth. Research, v. 8, Issue 1, p. 3-6.
1982 : Dômes de magmas et dômes de laves. - C. R. Acad. Sci. , Paris. t. 294, II, p. 151-153.
1982 : F. Le Guern, H. Tazieff et R. Faivre - Pierret : An exemple of health hazard : People killed by gas during a phreatic eruption : Diëng plateau (Java, Indonesia), february 20 th 1979. Bull. Volc, vol. XXXXV, p. 153-156.
1982 : F. Le Guern, H. Tazieff, C. Vavasseur et P. Zettwoog : Resonance in the gas discharge of the Bocca Nuova, Etna (Italy), 1968-1969. - Jour. Volc. Geoth. Res., t. 12, p. 161-166.
1982 : Seismic and volcanic hazards, Impact of Science on Society, t. 32, p. 89 - 92.
1983 : H. Tazieff et J.C. Sabroux Eds : Forecasting volcanic events. Elsevier, Amsterdam, 635 p.
1984 : Mount Niragongo : renewed activity of the lava lake. - Jour. Volc. Geoth. Res. t. 20, p. 267-280.
1984 : Organisation des secours en situation de catastrophes majeures - Mai 1984 - Convergences médicales (Créteil), p. 529 - 540.
1984 : Délégation aux risques majeurs : rapport annuel au Président de la République présenté par M. Haroun Tazieff, délégué aux risques majeurs, le 17 juillet 1984.
1985 : Recent activity of Niragongo and lava lake occurences - Bull. Geol. Soc. Finland 57 part. 1-2, p. 11-19.
1986 : La catastrophe de Nyos, République du Cameroun, le 21 août 1986 - Ministère de la coopération, , SPI Paris, 76 p.
1986 : Médicalisation des secours lors de catastrophes majeures, Médecine et hygiène, t. 44, p. 2225 - 2226.
1986 : Le tremblement de terre du Chili en 1960, Geologia Applicata e Idrogeologia, t. 21, p. 27 - 30.
1986 : La désertification, facteur de risques, Aménagement et nature, t. 23, p. 4 - 8.
1989 : Mechanisms of the Nyos carbon dioxide disaster and of so-called phreatic eruptions. - Jour. Volc. Geoth. Res., t. 39, p. 109-116.
1990 : Etna 1989 - Bull. of Volc. Eruptions, Volc. Society of Japan.
1990 : H. Tazieff et M. Derruau. Le volcanisme et sa prévention. Masson. Paris 256 p.
1994 : Permanent lava lakes : observed facts and induced mechanisms. - Jour. Volc. Geoth. Res. t. 63, p. 3-11.
1996 : H. Tazieff, F. Le Guern et R.-X. Faivre Pierret : l’expertise en volcanologie. Colloque « Risques majeurs en géologie », Association des Géologues de Besançon, Besançon 30 mars 1996.
Liens
http://youtu.be/2GQ6cEl6I9c Scories et torchères
http://youtu.be/T2UNnMui4Pc Tazieff et Brice Lalonde
http://youtu.be/lTH_kMHUywc Tazieff par son fils
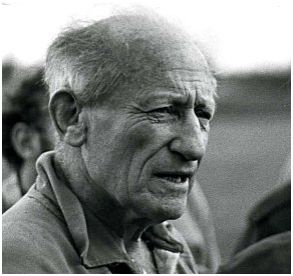    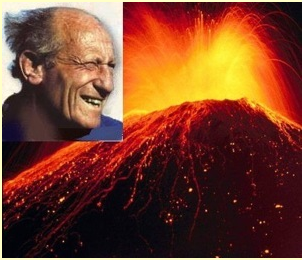   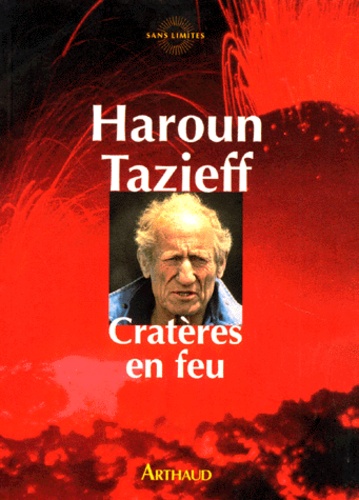   [img width=600]http://2.bp.blogspot.com/-emMFNu2ma_s/Ue3gemGAXiI/AAAAAAAAJY4/GjZEDSWU4o8/s1600/Une+interview+exclusive+de+Haroun+Tazieff+(27.10.1980).jpg[/img]           
Posté le : 09/05/2014 17:07
Edité par Loriane sur 10-05-2014 22:25:41
Edité par Loriane sur 11-05-2014 23:16:08
|
|
|
|
|
Incendie du bazar de la Charité 4 Mai 1897 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 4 Mai 1897, un incendie dramatique au bazar de la Charité "
Le Bazar de la Charité est une vente de bienfaisance mise sur pied en 1885 par Henri Blount et présidée par le baron de Mackau. Le principe en était de vendre des objets – lingerie et colifichets divers –, au profit des plus démunis.
Organisé rue Jean-Goujon à Paris, le Bazar est le théâtre, le 4 mai 1897, d'un dramatique incendie, causé par la combustion des vapeurs de l'éther utilisé pour une projection de cinématographe, encore une nouveauté à l'époque.
Le 4 mai 1897 une vente de bienfaisance se tient à Paris, bien connue des notables parisiens de l’époque sous le nom de Bazar de la Charité. A deux pas des Champs-Elysées, dans un vaste hangar en bois de plus de 1000 m², une foule allègre papillonne parmi les échoppes pittoresques d’un Vieux-Paris reconstitué. Un décor tout en poutrelles de bois, toiles peintes et bois blanc où se pressent les longues et riches robes de satin et velours et où se bousculent les élégantes cannes à pommeau des honnêtes hommes. Bordant la chaussée, une succession d’enseignes médiévales, d’auberges et de façades en trompe-l’œil accueille les comptoirs de dames de la haute aristocratie venues vendre bijoux, bibelots et breloques. Il est trois heures de l’après-midi quand le nonce apostolique fait un tour rapide et béni les lieux. A cette heure, parmi les 1200 visiteurs, nombreux sont ceux qui attendent fébrilement l’attraction principale de cette fête : l’attrayant cinématographe des frères Lumières. Une salle de projection a même été aménagée pour l’occasion. Partout on salue l’originalité de l’installation. On applaudit. Pour cinquante centimes versés aux nécessiteux, le gotha parisien assiste à la projection de La sortie des usines Lumière à Lyon, de L’arrivée du train en gare de La Ciotat et de L’arroseur arrosé.
Mais vers quatre heures vingt, la lanterne à lumière oxyéthérique du projectionniste prend feu. Aussitôt, la cabine du cinématographe s’embrase et la panique gagne immédiatement l’ensemble des spectateurs. L’incendie se propage à une vitesse inouïe parmi les tentures destinées à faire le noir dans la salle.
La catastrophe coûte la vie à plus de cent vingt personnes, la plupart étant des femmes charitables issues de la haute société parisienne. On retrouvera parmi les victimes, entre autres, Sophie-Charlotte, duchesse d'Alençon sœur de l'impératrice Sissi, la peintre et céramiste Camille Moreau-Nélaton et Madame de Valence et ses deux filles.
La catastrophe, qui a marqué bien des esprits de l'époque, a suscité de nombreuses réactions, dont certaines mettant en question l'avenir du cinéma – jugé responsable –, considéré alors non comme un art, mais comme un simple divertissement de foire.
Organisation et installation de l'évènement
Le Bazar de la Charité est, à l'origine, un consortium de plusieurs œuvres de bienfaisance, qui louent un local ou un espace d'exposition en commun, afin de réduire leurs dépenses et de permettre de grouper acheteurs et invités. Installé, de 1885 à 1887, rue du Faubourg-Saint-Honoré, en 1889 place Vendôme et, en 1888 et de 1890 à 1896, rue La Boétie, il est transféré en 1897, année du drame, au no 15 et 17 de la rue Jean-Goujon dans le 8e arrondissement, sur un terrain mis gracieusement à disposition par le banquier Michel Heine.
Ce terrain était alors occupé par un hangar en bois de quatre-vingts mètres de long sur treize de large, loué le 20 mars 1897 par le baron de Mackau au curé Delamair
Le 6 avril 1897, le baron de Mackau réunit les responsables du Bazar de la Charité : la duchesse d'Alençon, sa belle-fille, la duchesse de Vendôme – Henriette de Belgique, nièce du roi Léopold II et du roi Charles Ier de Roumanie –, la duchesse d'Uzès, la marquise de Saint-Chamans, la comtesse Greffuhle, la générale Février, la marquise de Sassenay, et leur annonce que le Bazar sera décoré pour représenter une rue de Paris au Moyen Âge avec ses éventaires, ses échoppes aux enseignes pittoresques, ses étages en trompe-l'œil, ses murs tapissés de lierre et de feuillage.
En prime, le Bazar proposera, sous un appentis, un spectacle de cinématographe où l'on pourra, pour cinquante centimes, voir les images animées des frères Lumière projetées par un appareil de 35 mm Normandin et Joly : La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat et L'Arroseur arrosé. Le bâtiment est organisé de la façon suivante : une porte à double battant ouvre sur une vaste allée, bordée de vingt-deux comptoirs en bois, d’une longueur de 80 mètres ; à gauche de l’entrée, une loggia accueille les bureaux, à droite se trouve le salon des dames.
Les comptoirs portent des noms évocateurs : À la tour de Nesle, À la truie qui file, Au lion d’or, Au chat botté. Face à l’entrée se trouve un buffet, assorti d’une cuisine et d’une cave. L’arrière du hangar donne sur une cour intérieure, bordée par l’« Hôtel du Palais » ; adossé à la façade arrière du hangar se trouve un local abritant le cinématographe.
Monsieur Normandin, l'entrepreneur chargé des représentations cinématographiques, n'est cependant pas très satisfait de ce local et s'en ouvre au baron de Mackau :
"Je n'ai pas assez de place pour loger mes appareils, les tubes d'oxygène et les bidons d'éther de la lampe Molteni. Il faut aussi séparer le mécanicien du public. Les reflets de la lampe risquent de gêner les spectateurs."
"Nous ferons une cloison en toile goudronnée autour de votre appareil. Un rideau cachera la lampe. Et mes bouteilles et mes bidons ? Vous n'aurez qu'à les laisser sur le terrain vague, derrière votre local."
Catastrophe
Les ventes sont organisées pour avoir lieu les 3, 4, 5 et 6 mai 1897.
La première journée, le lundi 3 mai, sera honorée par la présence de Mlle de Flores, fille de l'ambassadeur d'Espagne.
La vente du 4 mai sera, quant à elle, honorée de la présence de Sophie-Charlotte, duchesse d'Alençon. Belle-sœur de l'empereur d'Autriche, François-Joseph Ier et plus jeune sœur de la célèbre Sissi et de l'ex-reine des Deux-Siciles, ayant épousé un petit-fils du roi des Français, Louis-Philippe Ier, la princesse, qui vient de fêter ses cinquante ans, est apparentée à tout le gotha européen.
Les comptoirs sont tenus par des dames appartenant à la plus haute aristocratie française.
Le Bazar est béni par le nonce apostolique Mgr Eugenio Clari dès 15 heures : celui-ci vient, fait un tour rapide, et s'en va sans que la foule qui se presse là s'en rende bien compte.
Vers 16 heures, la duchesse d'Alençon, qui préside le stand des noviciats dominicains situé à une extrémité de la galerie, murmure à l'une de ses voisines, Mme Belin : "J'étouffe…" Mme Belin répond : " Si un incendie éclatait, ce serait terrible ! "
Le drame
Vers 16 h 30 survient l'accident fatal : la lampe de projection du cinématographe a épuisé sa réserve d'éther et il faut à nouveau la remplir.
Monsieur Bellac, le projectionniste, demande à son assistant Grégoire Bagrachow d'allumer une allumette, mais l’appareil est mal isolé, et les vapeurs d'éther s’enflamment.
Quelques instants après, alors que les organisateurs – parmi lesquels figurent le duc d'Alençon – ont été informés de l'accident et commencent déjà à faire évacuer, dans le calme, les centaines de personnes présentes dans le hangar, un rideau prend feu, enflamme les boiseries, puis se propage au velum goudronné qui sert de plafond au Bazar. Un témoin dira :
"Comme une véritable traînée de poudre dans un rugissement affolant, le feu embrasait le décor, courait le long des boiseries, dévorant sur son passage ce fouillis gracieux et fragile de tentures, de rubans et de dentelles."
Au grondement de l'incendie répondent les cris de panique des 1 200 invités qui tentent de s'enfuir en perdant leur sang-froid. Certaines personnes tombent et ne peuvent se relever, piétinées par la foule tâchant désespérément d'échapper aux flammes.
La duchesse d'Alençon dira à la jeune comtesse Mathilde d'Andlau :
" Partez vite. Ne vous occupez pas de moi. Je partirai la dernière. "
À l'extérieur, les pompiers arrivent sur les lieux cependant que des grappes humaines surgissent du bazar, transformé en brasier. Quelques-uns des visiteurs tentent de se sauver par la cour intérieure : ils seront sauvés grâce à l’intervention des cuisiniers de l’hôtel du Palais, MM. Gomery et Édouard Vaudier, qui descellèrent trois barreaux des fenêtres des cuisines pour les aider à s’extirper de la fournaise.
L'hôtel du Palais était la possession de la famille Roche-Sautier8.
Un quart d’heure à peine après le début de l’incendie, tout est consumé : le hangar n’offre plus l’aspect que d’un amoncellement de poutres de bois calcinées, mêlées de cadavres atrocement mutilés et carbonisés.
"On vit un spectacle inoubliable dans cet immense cadre de feu formé par l'ensemble du bazar, où tout brûle à la fois, boutiques, cloisons, planchers et façades, des hommes, des femmes, des enfants se tordent, poussant des hurlements de damnés, essayant en vain de trouver une issue, puis flambent à leur tour et retombent au monceau toujours grossissant de cadavres calcinés. "
Mort de la duchesse d'Alençon
La duchesse d’Alençon figure parmi les victimes. Demeurée au comptoir du Noviciat en compagnie de quelques fidèles, elle tente un moment de s'enfuir par la porte principale, croyant y retrouver son époux, puis elle rebrousse chemin.
Une religieuse vient s'effondrer à ses pieds :
"Ô Madame, quelle mort !"
; elle lui répond :
"Oui, mais dans quelques minutes, pensez que nous verrons Dieu !", qui seront ses dernières paroles.
Elle mourra en compagnie de la comtesse de Beauchamp, qu'elle prendra dans ses bras pour lui masquer la mort qui l'attend.
Nul ne sait si elle mourut asphyxiée ou brûlée vive, mais les contractions de son corps montrent qu'elle avait dû souffrir atrocement. Son corps, méconnaissable, sera finalement authentifié par son dentiste qui, seul, pourra reconnaître ses dents immaculées et son bridge en or.
Après cette identification ainsi que ceux de nombreuses autres victimes, par l’examen de sa mâchoire, les spécialistes de l’odontologie légale retiennent-ils la date du 4 mai 1897 comme celle de la naissance de cette spécialité.
Après une messe funèbre célébrée le 14 mai en l'église Saint-Philippe-du-Roule, elle sera inhumée dans la chapelle funèbre des Orléans, à Dreux.
Les victimes : presque toutes des femmes
Le nombre de victimes directes de l'incendie varie suivant les sources :
Le site officiel de l'association Mémorial du Bazar de la Charité donne 126 victimes et une liste nominative de 124 victimes 118 femmes et 6 hommes,
Dans La Terrible Catastrophe du 4 mai 1897.
Liste complète des victimes, des blessées et des blessés, des sauveteurs et des bienfaiteurs, ouvrage publié en juillet 1897, sont cités les noms de 132 victimes soit 123 femmes et 9 hommes, auxquelles il faut ajouter 3 corps non identifiés.
Dans son édition du 14 mai 1897, Le Petit Journal publie les statistiques officielles des victimes, service de la statistique municipale, liste arrêtée au 8 mai au soir, 106 morts pendant l'incendie et identifiés, 10 morts des suites de l'incendie, 5 morts pendant l'incendie et non identifiés au 8 mai, soit un total de 121 personnes 110 femmes, 6 hommes, 5 non identifiés13.
Parmi les morts, on compte une très large majorité de femmes, quasiment toutes de souche aristocratique, un enfant, un groom de douze ans et une petite poignée d'hommes quatre en tout : trois vieillards, et un médecin volontaire, la galanterie faisant souvent place à une brutalité sauvage comme dans la majorité de catastrophes maritimes.
Parmi les institutions victimes de cette tragédie se trouvait, au comptoir no 17, l’Œuvre des saints-anges dont la présidente, la baronne douairière de Saint Didier, et plusieurs autres membres périrent dans l’incendie. L’Œuvre des saints-anges survécut à ce drame et compte aujourd’hui parmi les rares institutions présentes lors de l'incendie du Bazar de la Charité encore en activité.
Une autre institution présente, de la famille de Saint-Vincent, n'a pas été épargnée : treize Dames de la Charité et trois Filles de la Charité ont péri dans les flammes.
Polémique
Comme toute catastrophe, l’incendie du Bazar de la Charité est suivi par son lot de polémiques et par ses vaines tentatives pour désigner un coupable. D’abord, on incrimine le cinématographe lui-même, jugé trop dangereux, au point que cette catastrophe manque de peu de faire avorter ce 7ème art naissant. Les projections sont officiellement interdites mais subsistent quelque temps dans des baraques foraines. Il faudra construire des salles réglementées et sécurisées pour rassurer et reconquérir un public devenu hostile.
Puis le scandale dans le scandale éclate : la disproportion entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les victimes. Très vite le comportement des hommes pendant la catastrophe est pointé du doigt : lâcheté, brutalité, veulerie. C’est une journaliste libertaire, Séverine, qui pose la dérangeante question : « Qu’ont fait les hommes ? ». Si quelques sauveteurs se distinguèrent par leur courage parmi la gent masculine, force est de constater que sur une liste nominative de 124 victimes, 118 sont des femmes. Le journal Le Matin raconte que les hommes ont majoritairement pris la fuite et se sont avérés « au-dessous de tout ». De nombreux témoignages de rescapés révèlent rapidement que les messieurs n’hésitèrent pas à frapper les femmes du pommeau de leur canne ou de leur poing pour gagner plus vite la sortie. Les femmes, gênées dans leurs déplacements par la longueur d’étoffe de leurs robes furent allègrement piétinées et frappées. Leurs précieuses toilettes, en effet, entravaient l’évacuation rapide des galants hommes. L’opinion publique relayée par la presse raille les « sires de Fiche-ton-Camp » et les « marquis d’Escampette ». Le clivage entre hommes et femmes n’est pas le seul sujet de débat. A l’occasion de la réception des sauveteurs à l’Hôtel de ville, M. Dubois, président du Conseil général de la Seine, avance la théorie suivante : l’héroïsme n’est pas lié au rang social mais à l’exercice d’une activité professionnelle, tandis que l’oisiveté conduit à la lâcheté. En réalité, le drame du Bazar de la Charité est probablement le produit d’un mouvement de foule et de panique collective aggravé par l’absence de réglementation sur la sécurité et une mauvaise configuration des lieux.
Liste des victimes
D'après La terrible Catastrophe du 4 mai 1897. Liste complète des victimes, des blessées et des blessés, des sauveteurs et des bienfaiteurs qui donne de plus 5 victimes indirectes :
Hélène Barassé (1874-1897)
Sophie-Charlotte en Bavière, duchesse d'Alençon (1847-1897)
Hélène Bernard-Dutreil (1878-1897)
Antonie de Bésiade d'Avaray, comtesse Audéric de Moustier (1825-1897)
Claire Beucher de Saint-Ange, générale Eugène Chevals (1829-1897)
Laure Beucher de Saint-Ange (1827-1897)
Élise Blonska (1835-1897)
Louise Boissié, Madame Eugène Chalmel (1835-1897)
Edmée Braun, Madame Étienne Moreau-Nélaton (1864-1897)
Clémence Capitaine, marquise d'Isle (1847-1897)
Cécile Carrière, Madame Edmond Cuvillier (1847-1897)
Pauline Carrière, Madame Frédéric Dillaye (1855-1897)
Jeanne Carteron (1862-1897)
Camille Chabot (1874-1897)
Madeleine de Clercq (1887-1897)
Marie de Commeau (1838-1897)
Dona Adélaïda Corradi y Anduga, Madame Florez (1847-1897)
Marguerite de Cossart d'Espiès (1847-1897)
Caroline Cosseron de Villenoisy (1828-1897)
Laure de Crussol d'Uzès, comtesse d'Hunolstein (1838-1897)
Ester Cuvillier (1892-1897)
Louise Dagneau, Madame Alphonse Gosse (1846-1897)
Amélie Daireaux, Madame Hugues de Carbonnel (1853-1897)
Claire Dalloyau, Madame Auguste Bouvyer (1838-1897)
Flore Damiens dit Fortin, Madame Paul Hauducœur (1845-1897)
Alfred David (1892-1897)
Lucie Dehondt, sœur Vincent des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul (1871-1897)
Hélène Delaune (1876-1897)
Suzanne Dephieu, Madame Alexandre Rabèry (1849-1897)
Berthe Deschamps, Madame Alfred Gohin (1862-1897)
Valérie Demazières, Madame Léopold Germain (1841-1897)
Thérèse Donon, baronne Maurice de Saint Didier (1857-1897)
Joseph Donon (1883-1897)
Marie du Quesne, vicomtesse de Bonneval (1857-1897)
Germaine Feulard (1887-1897)
Docteur Henri Feulard (1858-1897)
Alphonsine Fortin, Madame Eugène Vimont (1829-1897)
Jeanne Frémyn, Madame Léon Le Normand (1858-1897)
Annette Gabiot, Madame Firmin Goupil (1851-1897)
Eulalie Gariel, Madame Ferdinand Jauffred (1847-1897)
Église Saint-Philippe-du-Roule, Paris. Plaque commémorative de Marie Hoskier, Madame Eugène Roland-Gosselin, morte dans l'incendie du Bazar de la Charité.
Julie Garivet, sœur Marie-Madeleine des Sœurs aveugles de Saint Paul (1853-1897)
Louise Gérondeau (1870-1897)
Marie Gillet, Madame Louis Borne (1863-1897)
Anna Ginoux Defermon, sœur Marie des filles de la Charité de Saint Vincent de Paul (1863-1897)
Marie Glandaz, Madame Gustave Laneyrie (1854-1897)
Angèle Gosse (1877-1897)
Zoë Gosse (1878-1897)
Agnès de Gosselin, Comtesse Mimmerel (1874-1897)
Élisabeth Grenn de Saint-Marsault, baronne Caruel de Saint-Martin (1836-1897)
Marguerite Gros, Madame Gaston de Clermont (1850-1897)
Blanche Grossier, Madame Achille Chouippe (1852-1897)
Hélène Guérard, Madame Fernand Duclos de Varanval (1873-1897)
Marie Guérin, Madame Benjamin Delaune (1853-1897)
Elizabeth de Guillebon (1873-1897)
Léonie Guillemain (1868-1897)
Amélie Guyard-Delalain, Madame Alfred Carteron (1829-1897)
Hélène de Haber, comtesse de Horn (1831-1897)
Jenny Hartmann, Madame Nicolas Schlumberger (1828-1897)
Marie Louise Hatte de Chevilly (1876-1897)
Yvonne Hatte de Chevilly (1879-1897)
Madeleine Hauducœur (1870-1897)
Henriette d'Hinnisdael (1874-1897)
Marie Hoskier, Madame Eugène Roland-Gosselin (1858-1897)
Emma Hubert, Madame Eugène Legrand (1833-1897)
Hélène d'Isle (1875-1897)
Église Sainte-Rosalie, Paris. Plaque commémorative de Jeanne de Kergolay, vicomtesse de Poilloüe de Saint-Périer et de Mademoiselle Antoinette de Mandat-Grancey, mortes dans l'incendie du Bazar de la Charité.
Alice Jacqmin (1880-1897)
Emma Jaume, Générale Warnet (1830-1897)
Cécile Jullian, Madame François Buchillet (1845-1897)
Jeanne de Kergolay, vicomtesse de Saint-Périer (1849-1897)
Angélique de la Briffe, Madame Eugène Huzar (1833-1897)
Isabelle de Lassus, Madame Joseph de Carayon-Latour (1834-1897)
Mathilde Leclerc de Juigné, vicomtesse de Damas (1828-1897)
Lina Lefèvre-Finucane (1873-1897)
Laure Lejeune, Madame Abel Brasier de Thuy (1828-1897)
Marie Le Royer de la Tournerie, Vicomtesse de Malézieu (1869-1897)
Suzanne Le Sourd, Madame Pierre Cordoën (1869-1897)
Alix Loubaresse, Madame Adolphe Rivière (1848-1897)
Louise Lourmand (1868-1897)
Isabelle Maison, Madame Albert Lefèvre de Vatimesnil (1845-1897)
Antoinette de Mandat-Grancey (1876-1897)
Marie de Marbot, Madame Victor de Valence (1848-1897)
Eugénie Marlé, Madame Louis Chapuis (1853-1897)
Albert Masure (1832-1897)
Christiane Meilhac (1882-1897)
Laura Meinell, Vicomtesse d'Avenel (1855-1897)
Mathilde Michel, Madame Jules Pierre (1866-1897)
Claire Moisson (1855-1897)
Ernestine Moreau (1862-1897)
Général Gustave-Joseph Munier (1827-1897)
Camille Moreau-Nélaton, Madame Adolphe Moreau (1840-1897), artiste peintre et céramiste
Suzanne Nitot (1855-1897)
Jeanne Odart de Rilly d'Oysonville, comtesse Haward de la Blotterie (1850-1897)
Lydie Panon Desbassayns de Richemont, Madame Léon de Gosselin (1841-1897)
Louise Pedra, baronne de Saint-Didier (1816-1897)
Amélie Pellerin de Lastelle, Comtesse Sérrurier (1839-1897)
Marguerite Peretti, Madame Léon Valentin (1856-1897)
Pénélope Pétrocochino, Madame Vlasto (1836-1897)
Marie-Louise Picqué (1863-1897)
Hélène de Poggenpohl, Madame Jacques Haussmann (1854-1897)
Victor Potdevin (1825-1897)
Berthe Rabéry, Madame Louis Gentil (1873-1897)
Aline Ramboug, Madame Anatole Le Brun de Sesseval (1826-1897)
Marguerite Rémond, sœur Sainte Claire des sœurs aveugles de Saint Paul (1835-1897)
Louise de Rivière, comtesse Joseph-Louis de Luppé (1844-1897)
Docteur Ernest Rochet (1830-1897)
Marie Roubaud de Cournand, fille de Marie Roubaud de Cournand, Madame Maurice Lafitte de Canson (1844-1897)
Adèle Sabatier, sœur Joseph des filles de la Charité de saint Vincent de Paul (1830-1897)
Joséphine Saintin, Madame Charles Monti (1851-1897)
Antoinette Senez, Madame Auguste du Verdier de Suze (1842-1897)
Marie-Thérèse Simon (1874-1897)
Émilie Stiebel, Madame Louis Kann (1849-1897)
Louise Terre (1849-1897)
Virginie Thomazeau, sœur Electa des Filles de la Croix Saint André (1826-1897)
Lucy Touttain, Madame Émile Nitot (1863-1897)
Valèrie Tuquet de La Boisserie, vicomtesse de Beauchamp (1867-1897)
Antoinette de Valence de Minardière (1877-1897)
Marguerite de Valence de Minardière (1880-1897)
Sabine de Vallin (1838-1897)
Élodie Van Biervelet (1877-1897)
Valérie Verhasselt (1876-1897)
Julia de Villiers de La Noue, marquise de Bouthillier Chavigny (1844-1897)
Justine Waller, comtesse Jules Couret de Villeneuve (1857-1897)
Mathilde de Weisweiller, Madame Théodore Porgès (1854-1897)
Élise Weyer, Madame Émile Hoskier (1836-1897)
Germaine d'Yrenne de Lalanne, comtesse d'Isoard Vauvenargues (1867-1897)
Victimes indirectes :
le général Léon de Poillouë de Saint-Mars, une des têtes de turc favorites d'Alphonse Allais, meurt d'une crise cardiaque en apprenant la mort d'une proche dans l'incendie ;
le duc d'Aumale est terrassé par une crise cardiaque le 7 mai, après avoir rédigé une vingtaine de lettres de condoléances aux familles des victimes de la noblesse.
Réactions et hommage de la presse et des contemporains
La presse populaire exalte les sauveteurs et ironise sur les chevaliers de la Pétoche, les marquis de l'Escampette. À cette récupération politique s'ajoute la vision de la journaliste féministe Séverine qui titre un article Qu'ont fait les hommes ? en une de L'Écho de Paris du 14 mai 189717 et écrit dans Le Journal à propos de la fuite des hommes présents lors de la catastrophe.
Mais ces points de vue partisans sont toutefois contredits par l'analyse : l'incendie s'est propagé très rapidement du fait de l'absence totale de règles de sécurité, de la nature des matériaux des décors reconstituant une rue médiévale, bois blanc, papier-mâché, toile goudronnée, rideaux et, surtout, un velum goudronné, suspendu au-dessus du décor et qui, en flammes, est tombé sur la foule et de la mode féminine d'alors : les longues robes ont pris feu facilement et ont empêché une fuite rapide des femmes.
Cet incendie est à l'origine des réglementations sur la sécurité, l'évacuation et les matériaux de construction des lieux publics.
Interrogations de nature théologique
Dans son Journal, Léon Bloy, sur un ton qui dénote franchement par rapport aux différents hommages rendus aux victimes, écrit :
"Tant que le Nonce du Pape n'avait pas donné sa bénédiction aux belles toilettes, les délicates et voluptueuses carcasses que couvraient ces belles toilettes ne pouvaient pas prendre la forme noire et horribles de leurs âmes. Jusqu'à ce moment, il n'y avait aucun danger. Mais la bénédiction, la Bénédiction, indiciblement sacrilège de celui qui représentait le Vicaire de Jésus-Christ et par conséquent Jésus-Christ lui-même, a été où elle va toujours, c'est-à-dire au FEU, qui est l'habitacle rugissant et vagabond de l'Esprit-Saint. Alors, immédiatement, le Feu a été déchaîné, et tout est rentré dans l'ordre. … »
— Ctation de Léon Bloy, " Mon journal" 1892-1917
Dans ses mémoires d'enfance intitulées Comment j'ai vu 1900, la comtesse de Pange, qui avait onze ans lors de la tragédie, écrit :
" J'entendis âprement discuter le sermon que fit le père Ollivier à la cérémonie funèbre à Notre-Dame. Profitant de la présence des ministres et des ambassadeurs, il présenta le désastre comme un nécessaire holocauste offert au ciel en réparation des crimes du gouvernement. … Les journaux d'opposition soutenaient cette thèse avec violence, mais je me souviens que mon père blâmait le père Ollivier, disant que c'était maladroit de critiquer le gouvernement alors que les ministres anticléricaux faisaient un geste méritoire en assistant officiellement à une cérémonie religieuse. "
— Pauline de Broglie, "Comment j'ai vu 1900"
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation
Peu de temps après l'incendie, le terrain de la rue Jean-Goujon sera racheté à Michel Heine par le baron de Mackau.
Une souscription est lancée, à l'initiative du cardinal Richard, archevêque de Paris, pour acheter le terrain où avait eu lieu l'incendie, afin d’y construire une chapelle commémorative. Celle-ci sera édifiée par l’architecte Albert Guilbert.
La première pierre est posée en mai 1898, et la Chapelle Notre-Dame-de-Consolation est inaugurée en mai 1900 sous l’égide du cardinal Richard.
Cette chapelle d'expiation appartient à l'association Mémorial du Bazar de la Charité, composée de descendants des victimes de l'incendie du 4 mai 1897, et fait l’objet d’un classement au titre de monument historique depuis le 19 février 1982.
Monument au cimetière du Père-Lachaise
Elle est dédiée aux victimes dont cent vingt-six noms sont inscrits sur six plaques de marbre noir en lettres d'or dans la chapelle, et accueille la communauté catholique de langue italienne de Paris de 1953 à fin 2012. Le bail de location est alors renouvelé avec le "prieuré Saint-Denis", communément appelé chapelle Sainte-Germaine de Wagram de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.
L'arrêté préfectoral en date du 28 février 1899 octroie une concession gratuite aux victimes de l'incendie du 4 mai 1897.
La Ville de Paris fait élever un monument "Aux victimes non reconnues de l’incendie du Bazar de la Charité - 4 mai 1897 "au cimetière du Père-Lachaise dans la 92e division. Le monument est entretenu par la ville de Paris.
Impact sur le cinéma
Une fois les résultats de l'enquête connus, beaucoup considèrent la carrière du cinéma comme terminée. Sous la pression de la haute société, les projections sont d'ailleurs interdites un temps avant que l'intérêt de l'invention et son développement à l'étranger ne passent outre le ressentiment des victimes endeuillées.
Les frères Lumière mirent également au point un système de lampe électrique qui supprima le risque d'incendie.
Récit du drame de FRÉDÉRIC LEWINO ET GWENDOLINE DOS SANTOS
En fin d'après-midi, ce 4 mai 1897, une odeur de corps grillés se répand dans le 8e arrondissement de Paris. Curieux : aucun barbecue n'est prévu ce jour-là, simplement une réunion de bienfaisance au Bazar de la charité, au 17 de la rue Jean-Goujon. La fumée noire qui se répand dans le quartier provient bien du hangar en bois de 1 000 mètres carrés abritant la vente. Celui-ci s'est brutalement enflammé, piégeant toutes les dames de la haute dont les longues robes se transforment en torches. Hurlements de terreur ! Sauve-qui-peut général ! Agonies terribles ! Qui sème la charité récolte l'incinération. Et Dieu dans tout ça ? Comme d'habitude, il se tait...
Pourtant, cette journée avait merveilleusement bien débuté. Dès le matin, la foule de précipite dans le Bazar où les architectes ont reconstitué une rue de Paris au Moyen Âge, avec ses éventaires, ses échoppes aux enseignes farfelues, ses étages en trompe-l'oeil et ses murs tapissés de feuillages et de lierres. Les enseignes rappellent les temps anciens : "À la truie qui file", "Au lion d'or", "Au chat botté"... Au total, vingt-deux stands proposent lingerie, colifichets et objets en tout genre collectés pour la grande vente. Tous les bénéfices doivent être reversés aux pauvres, aux invalides, aux orphelins... En début d'après-midi, le hangar se remplit à vue d'oeil, près de 1 200 personnes sont déjà là. Surtout des femmes qui adorent, une fois par an, donner un peu de leur fric pour soigner leur réputation. Rien de nouveau sous le soleil. On reconnait Son Altesse royale la duchesse d'Alençon, épouse du petit-fils de Louis-Philippe Ier, soeur cadette de Sissi l'impératrice. Mais aussi la duchesse de Vendôme, la duchesse d'Uzès, la marquise de Saint-Chamans, la comtesse Greffulhe, la générale Février, la marquise de Sassenay, .. Bref, tout le gratin, la jet-set française.
L'allumette fatale
Pour ravir les aristos, le baron de Mackau, président de l'organisation caritative, a cru bon d'accueillir le tout nouveau cinématographe des frères Lumière. Chouette ! La salle de projection est installée dans une sorte d'appentis en bois, adossé au hangar, où, pour cinquante petits centimes, on peut assister à la projection de La sortie des usines Lumière à Lyon, de L'arrivée du train en gare de La Ciotat et de L'arroseur arrosé. Seulement voilà, l'entrepreneur Normandin, chargé des représentations cinématographiques, fait la gueule. Depuis deux jours il se plaint du réduit mis à sa disposition pour abriter l'invention du siècle, alors qu'un espace immense est consacré à la vente de ces fichus chiffons de bonnes femmes. À peine a-t-il assez de place pour loger ses appareils, ses bidons d'éther, ses tubes à oxygène, ses boîtes, ses bouteilles... tous très inflammables. Il s'est même demandé à un moment si le projectionniste et son assistant n'allaient pas finir sur les genoux des spectateurs.
Peu après 16 heures, la duchesse d'Alençon confie à une de ses voisines, Mme Belin : "J'étouffe..." Celle-ci lui répond : "Si un incendie éclatait, ce serait terrible !" Elle brûle sans le savoir : moins d'une demi-heure plus tard, dans la cabine du cinématographe, la lampe du projecteur qui brûle de l'éther est à sec. M. Bellac, le projectionniste, entreprend de faire délicatement le plein quand son assistant, Grégoire Bagrachow - un ancien bonze tibétain - ne trouve rien de mieux à faire que de craquer une allumette. Erreur fatale. Les vapeurs d'éther s'embrasent instantanément. Les deux acolytes tentent péniblement de contenir les flammes. Autant demander aux eaux de la mer Rouge de reculer.
Effondrement
Le duc d'Alençon, qui accompagne son épouse, est discrètement alerté de l'incendie. Aussitôt, il commence à faire évacuer des centaines de personnes par l'entrée principale. Soudain, un rideau du hangar prend feu. En quelques secondes les flammes se propagent à tout ce décor fait de bois blanc, de carton et de velum goudronné, agrémenté de tapisseries, de tentures, de dentelles, de rubans... Que de belles textures pour ravir les flammes !
Le calme cède à la terreur. Les femmes se prennent les pieds dans leurs longues robes, celles qui tombent finissent piétinées par la horde de fuyards hurlants qui se précipitent vers la sortie. Le hangar se transforme en brasier. Certains invités, voyant la sortie totalement bouchée, rebroussent chemin pour essayer de s'enfuir par la cour intérieure. C'est le cas de la duchesse d'Alençon, qui a voulu rester pour aider quelques personnes à sortir. Mais la cour se révèle un mortel cul-de-sac, car elle donne sur les cuisines de l'hôtel du Palais, dont toutes les fenêtres sont dotées de barreaux. Les cuisiniers parviennent à en desceller quelques-uns, permettant ainsi à une poignée de personnes de s'échapper. À l'intérieur du hangar, le faux plafond en velum goudronné s'effondre enflammé sur la foule. Un plombier nommé Piquet et un vidangeur nommé Dhuy, passant par là, se précipitent courageusement dans le Bazar de la charité pour secourir de nombreuses femmes et des enfants. "Deux bras se tendaient vers moi. Je les saisis, mais il ne me resta dans les mains qu'un peu de peau brûlée et un doigt", racontera Piquet au Petit Journal. Ceux ou celles qui sont restés piégés à l'intérieur se transforment en torches vivantes et se tortillent avant de tomber au sol, carbonisés au milieu des décombres calcinés. Quinze minutes après le début de l'incendie, l'édifice s'effondre déjà.
Peines de prison avec sursis
À l'extérieur, les pompiers s'efforcent d'éviter que l'incendie ne se propage aux bâtiments voisins. Dans la foule épouvantée, le duc d'Alençon cherche sa femme. En vain. Elle n'a pas réussi à s'enfuir. Son corps méconnaissable sera authentifié ultérieurement grâce à sa sublime denture et à un bridge en or. Ce jour-là, faire la charité coûte la vie à 126 personnes et des brûlures graves à plus de 250 autres. Les victimes sont essentiellement des femmes. Alors qu'au moins deux cents beaux mâles se pavanaient dans le Bazar, les victimes masculines se comptent sur les doigts d'une seule main ! Et encore, il s'agit de trois vieillards, d'un portier de 12 ans et d'un médecin. Les autres n'ont pas hésité à piétiner ces dames pour s'en sortir vivants ! Les lâches ! Les journaux à grand tirage s'emparent du drame, glorifiant les deux ou trois véritables héros et ironisant sur tous les autres, les "chevaliers de la Pétoche" ou les "marquis de l'Escampette". C'est comme si Brad Pitt s'était tranquillement barré sur la pointe des pieds en laissant cramer son Angelina Jolie dans le Bunker du Festival de Cannes en proie aux flammes. Impensable.
Une fois " tout le gratin décédé", on cherche le coupable. Les conspirationnistes débordent comme toujours d'imagination. Pour certains, c'est un attentat perpétré par un pays étranger ! Pour d'autres, c'est forcément la faute d'un juif ! Le pauvre Michel Heine, qui a gracieusement mis à disposition son terrain pour accueillir le Bazar de la charité, est montré du doigt. La calomnie est de très courte durée. Les causes de l'incendie sont formellement établies après l'interrogatoire des employés des frères Lumière, qui avouent leur maladresse. En août suivant, ils écoperont tous deux de peines de prison, mais avec sursis, car ils ont eu une attitude très courageuse pour sauver des vies pendant l'incendie. C'était quand même la moindre des choses.
Liens
http://youtu.be/RxArD3ZU6zM Gisant de la duchesse d'Alençon
  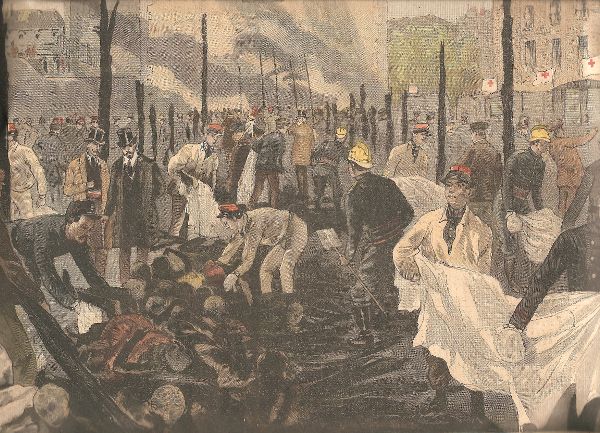   [img width=600]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7REFV_0yvXtbwAf9MwfA1W0ywwebhRb2GKEx_Ko3DXAWNwv6LaxbVLmBI9A[/img]  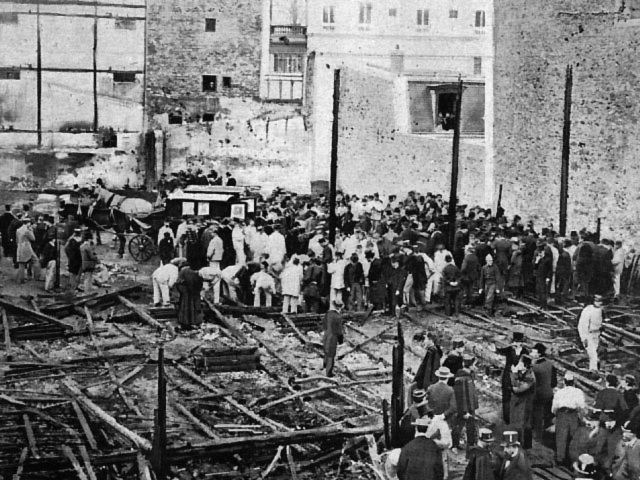 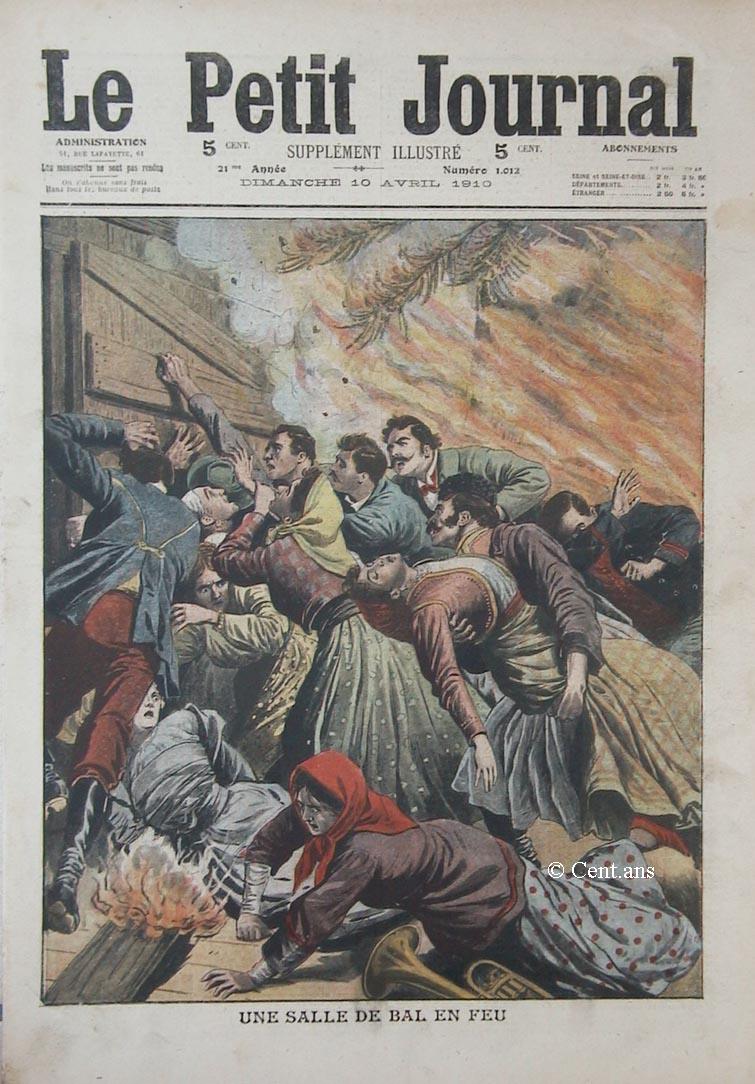 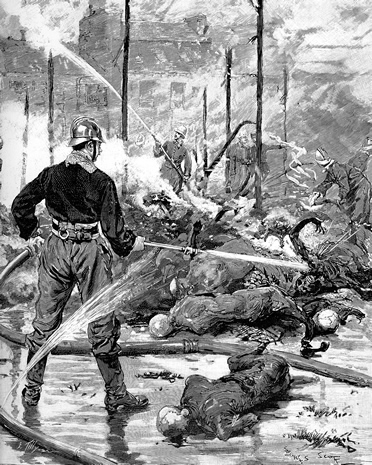    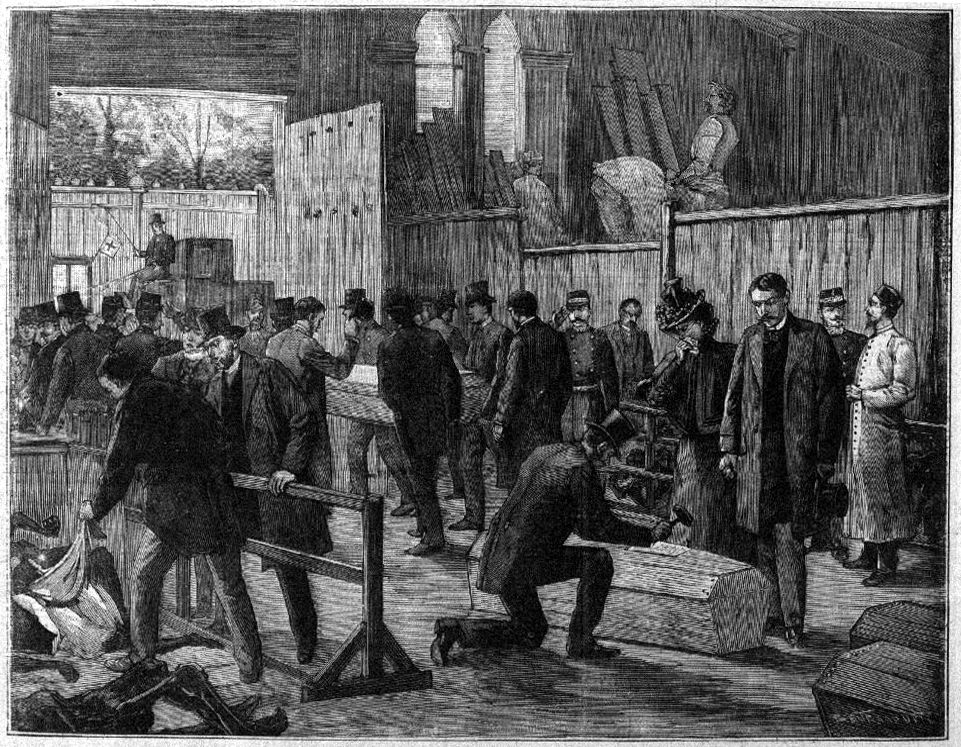    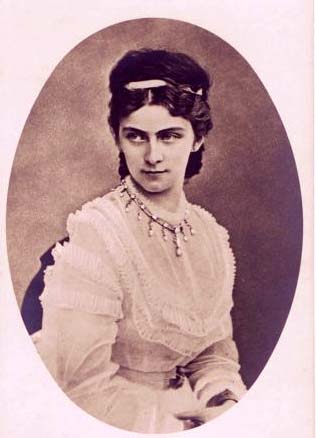
Posté le : 03/05/2014 19:26
|
|
|
|
|
Origine du 1 Mai |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 1 Mai 1886 massacre de Haymarket square, origine de la fête du travail
Le 1er mai 1886, aux États-Unis, 200.000 travailleurs obtiennent la journée de huit heures grâce à une forte pression des syndicats. Mais un affrontement avec la police cause la mort de plusieurs personnes.
En souvenir de cette victoire amère, les syndicats européens instituent quelques années plus tard une journée internationale des travailleurs ou Fête des travailleurs destinée à se renouveler tous les 1er mai. Cette journée est aujourd'hui appelée Fête du Travail, bien que l'expression prête à confusion, on ne fête pas le travail à proprement parler mais l'on honore les travailleurs.
L’origine et la signification libertaires du premier mai sont désormais tombées dans l’oubli. Car le premier mai, c’est bien un événement majeur de l’histoire du mouvement ouvrier, mais plus particulièrement de l’anarchisme que nous commémorons – désormais sans en connaître l’origine.
Nous sommes en 1886, à Chicago. Dans cette ville, comme dans tout le pays, le mouvement ouvrier est particulièrement riche, vivant, actif.
À Chicago, comme dans bien d’autres municipalités, les anarchistes sont solidement implantés. Des quotidiens libertaires paraissent même dans les différentes langues des communautés immigrées. Le plus célèbre des quotidiens anarchistes de Chicago, le Arbeiter-Zeitung, tire en 1886 à plus de 25 000 exemplaires.
Tout commence lors du rassemblement du 1er mai 1886 à l'usine McCormick de Chicago.
Cette année-là, le mouvement ouvrier combat pour la journée de huit heures.
C'est la jeune et encore faible Federation of Organized Trades and Labor Union : F.O.T.L.U. qui a appelé les ouvriers américains à faire grève en faveur de la journée de huit heures le 1er mai 1886. Le mouvement, toutefois, a été un succès en raison du renfort apporté par les Knights of Labor Chevaliers du travail, organisation héritière de traditions maçonniques, alors beaucoup plus puissante que les syndicats. La grève fut l'occasion de grands défilés ouvriers dans les rues des principales villes industrielles des États-Unis.
Les anarchistes y sont engagés, mais avec leur habituelle lucidité: la journée de huit heures pour aujourd’hui, certes, mais sans perdre de vue que le véritable objectif à atteindre est l’abolition du salariat. Le mot d’ordre de grève générale du premier mai 1886 est abondamment suivi, et tout particulièrement à Chicago. Ce jour-là, August Spies, un militant bien connu de la Ville des Vents, est un des derniers à prendre la parole devant l’imposante foule des manifestants.
Au moment où ceux-ci se dispersent, la démonstration, jusque là calme et pacifique, tourne au drame: 200 policiers font irruption et chargent les ouvriers. Il y aura un mort et des dizaines de blessés. Spies file au Arbeiter-Zeitung et rédige un appel à un rassemblement de protestation contre la violence policière. Elle se tient le 4 mai, au Haymarket Square de Chicago.
Cette fois encore, tout se déroule d’abord dans le calme. Spies prend la parole, ainsi que deux autres anarchistes, Albert Parsons et Samuel Fielden. Le maire de Chicago, Carter Harrison, assiste à la manifestation et, alors qu’elle s’achève, il est convaincu que rien ne va se passer. Il en avise donc le chef de police, l’inspecteur John Bonfield, et lui demande de renvoyer chez eux les policiers postés à proximité.
Il est dix heures du soir. Il pleut abondamment. Fielden a terminé son discours, le dernier à l’ordre du jour. Les manifestants se dispersent, il n’en reste plus que quelques centaines dans le Haymarket Square. Soudain, 180 policiers surgissent et foncent vers la foule. Fielden proteste. Puis, venue d’on ne sait où, une bombe est lancée sur les policiers. Elle fait un mort et des dizaines de blessés. Les policiers ouvrent le feu sur la foule, tuant on ne saura jamais combien de personnes. Une chasse aux sorcières est lancée dans toute la ville.
Les autorités sont furieuses. Il faut des coupables. Sept anarchistes sont arrêtés. Ce sont: August Spies, Samuel Fielden, Adolph Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Lingg et Oscar Neebe. Un huitième nom s’ajoute quand Albert Parsons se livre à la police, persuadé qu’on ne pourra le condamner à quoi que ce soit puisqu’il est innocent, comme les autres. En fait, seuls trois des huit suspects étaient présents au Haymarket Square le soir de ce 4 mai fatal.
Le procès des huit s’ouvre le 21 juin 1886 à la cour criminelle de Cooke County. On ne peut et on ne pourra prouver qu’aucun d’entre eux ait lancé la bombe, ait eu des relations avec le responsable de cet acte ou l’ait même approuvé.
D’emblée, une évidence s’impose pour tous: ce procès est moins celui de ces hommes-là que celui du mouvement ouvrier en général et de l’anarchisme en particulier. La sélection du jury tourne à la farce et finit par réunir des gens qui ont en commun leur haine des anarchistes. Y siège même un parent du policier tué. Le juge Gary ne s’y est pas plus trompé que le procureur Julius Grinnel qui déclare, dans ses instructions au jury:
"Il n’y a qu’un pas de la République à l’anarchie. C’est la loi qui subit ici son procès en même temps que l’anarchisme. Ces huit hommes ont été choisis parce qu’ils sont des meneurs. Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury: condamnez ces hommes, faites d’eux un exemple, faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société.
C’est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas vers l’anarchie, ou non. "
Le 19 août, tous sont condamnés à mort, à l’exception d’Oscar Neebe qui écope de quinze ans de prison. Le procès a été à ce point ubuesque qu’un vaste mouvement de protestation internationale se déclenche. Il réussit à faire commuer en prison à vie les condamnations à mort de Schwab et Fielden.
Lingg, pour sa part, se pend dans sa cellule.
Le 11 novembre 1887 Parsons, Engel, Spies et Fischer sont pendus. Ce sont eux que l’histoire évoque en parlant des martyrs du Haymarket. Plus de un demi-million de personnes se pressent à leurs funérailles.
C’est pour ne pas oublier cette histoire qu’il sera convenu de faire du premier mai un jour de commémoration. Neebe, Schwab et Fielden seront libérés officiellement le 26 juin 1893, leur innocence étant reconnue ainsi que le fait qu’ils ont été les victimes d’une campagne d’hystérie et d’un procès biaisé et partial.
Ce qui reste clair cependant, ce sont les intentions de ceux qui condamnèrent les martyrs de Chicago: briser le mouvement ouvrier et tuer le mouvement anarchiste aux États-Unis. Le jour même où avait été annoncée la condamnation à mort des quatre anarchistes, on avait communiqué aux ouvriers des abattoirs de Chicago qu’à partir du lundi suivant, ils devraient à nouveau travailler dix heures par jour.
Reste une question irrésolue jusqu’à ce jour: qui a lancé cette bombe? De nombreuses hypothèses ont été avancées, à commencer par celle accusant un policier travaillant pour Bonfield..
Trois ans après le drame de Chicago, la IIe Internationale socialiste réunit à Paris son deuxième congrès. Celui-ci se tient au 42, rue Rochechouart, salle des Fantaisies parisiennes, pendant l'Exposition universelle qui commémore le centenaire de la Révolution française au pied de la toute nouvelle Tour Eiffel.
Les congressistes se donnent pour objectif la journée de huit heures, soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé, sachant que jusque-là, il était habituel de travailler dix ou douze heures par jour, en 1848, en France, un décret réduisant à 10 heures la journée de travail n'a pas résisté plus de quelques mois à la pression patronale.
Le 20 juin 1889, sur une proposition de Raymond Lavigne, ils décident que :
" Il sera organisé une grande manifestation à date fixe de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à huit heures la journée de travail et d'appliquer les autres résolutions du congrès. Attendu qu'une semblable manifestation a été déjà décidée pour le 1er mai 1890 par l'AFL, dans son congrès de décembre 1888 tenu à Saint Louis, cette date est adoptée pour la manifestation."
Dès l'année suivante, le 1er mai 1890, des ouvriers font grève et défilent, un triangle rouge à la boutonnière pour symboliser le partage de la journée en trois travail, sommeil, loisir.
Le 1er mai 1891, à Fourmies, une petite ville du nord de la France, la manifestation rituelle tourne au drame. La troupe équipée des nouveaux fusils Lebel et Chassepot tire à bout portant sur la foule pacifique des ouvriers. Elle fait dix morts dont huit de moins de 21 ans. L'une des victimes, l'ouvrière Marie Blondeau, qui défilait habillée de blanc et les bras couverts de fleurs d'aubépine, devient le symbole de cette journée.
Avec le drame de Fourmies, le 1er mai s'enracine dans la tradition de lutte des ouvriers européens.
Quelques mois plus tard, à Bruxelles, l'Internationale socialiste renouvelle le caractère revendicatif et international du 1er mai. Elle est relayée en France par la Confédération Générale du Travail, un syndicat fondé le 23 septembre 1895 à Limoges.
L'horizon paraît s'éclaircir après la Première Guerre mondiale. Le traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919 fixe dans son article 247 «l'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où elle n'a pas encore été obtenue».
Les manifestations rituelles du 1er mai ne se cantonnent plus dès lors à la revendication de la journée de 8 heures. Elles deviennent l'occasion de revendications plus diverses. La Russie soviétique, sous l'autorité de Lénine, décide en 1920 de faire du 1er mai une journée chômée. Cette initiative est peu à peu imitée par d'autres pays... L'Allemagne nazie va encore plus loin : Hitler, pour se rallier le monde ouvrier, fait, dès 1933, du 1er mai une journée chômée et payée. La France l'imitera sous l'Occupation, en 1941 !...
Le 1er mai en France
En France, dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge. Celui-ci est quelques années plus tard remplacé par la fleur d'églantine. En 1907, à Paris, le muguet, symbole du printemps en Île-de-France, remplace cette dernière.
Le brin de muguet est porté à la boutonnière avec un ruban rouge .
Le 23 avril 1919, le Sénat français ratifie la journée de huit heures et fait du 1er mai suivant une journée chômée, mais à titre exceptionnel.
Les manifestations du 1er mai 1936 prennent une résonance particulière car elles surviennent deux jours avant le deuxième tour des élections législatives qui vont consacrer la victoire du Front populaire et porter à la tête du gouvernement français le leader socialiste Léon Blum.
C'est pendant l'occupation allemande, le 24 avril 1941, que le 1er mai est officiellement désigné comme la Fête du Travail et de la Concorde sociale, et devient chômé. Cette mesure est destinée à rallier les ouvriers au régime de Vichy.
Son initiative revient à René Belin. Il s'agit d'un ancien dirigeant de l'aile socialiste de la CGT, Confédération Générale du Travail qui est devenu secrétaire d'État au Travail dans le gouvernement de Philippe Pétain.
À cette occasion, la radio officielle ne manque pas de préciser que le 1er mai coïncide avec la fête du saint patron du Maréchal, Saint Philippe, aujourd'hui, ce dernier est fêté le 3 mai !
Le 30 avril 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération qui fait du 1er mai un jour férié et payé... mais pas pour autant une fête légale. Autrement dit, le 1er mai n'est toujours pas désigné officiellement comme Fête du Travail. Cette appellation n'est que coutumière.
L"'Iinternationale "se prononce de la même façon dans toutes les langues
Le Grand espoir : l'unité
L'Internationale est un chant révolutionnaire dont les paroles furent écrites en 1871 par Eugène Pottier et la musique composée par Pierre Degeyter en 1888.
Traduite dans de très nombreuses langues, L'Internationale a été, et est encore, le chant symbole des luttes sociales à travers le monde.
La version russe d'Arkady Yakovlevich Kots a même servi d'hymne national de l'URSS jusqu'en 1944.
Histoire
À l'origine, il s'agit d'un poème à la gloire de l'Internationale ouvrière, écrit par le chansonnier, poète et goguettier Eugène Pottier en juin 1871, en pleine répression de la Commune de Paris.
Suivant la tradition goguettière, L'Internationale de Pottier est à l'origine une chanson nouvelle à chanter sur un air connu. Ici, La Marseillaise, air qui a été utilisé pour quantité de chants revendicatifs et révolutionnaires. L'Internationale est dédiée à l'instituteur anarchiste Gustave Lefrançais.
L'histoire de ce poème et de son auteur est liée à celle des goguettes.
En 1883, Eugène Pottier présente une chanson au concours de la célèbre goguette de la Lice chansonnière et remporte la médaille d'argent.
Il retrouve à cette occasion le chansonnier Gustave Nadaud qu'il a croisé en 1848 et à qui il avait alors fait une forte impression.
Grâce à ces retrouvailles, une cinquantaine de chansons de Pottier sont publiées pour la première fois en 1884 et sauvées de l'oubli par Nadaud qui admire beaucoup son talent poétique tout en étant très loin de partager ses opinions politiques.
Cette initiative de Nadaud incite les amis politiques de Pottier à publier en 1887 ses Chants révolutionnaires avec une préface de Henri Rochefort. Au nombre de ceux-ci : L'Internationale.
Sans la Lice chansonnière et Nadaud, ce chant révolutionnaire célèbre et les autres œuvres de Pottier seraient aujourd'hui oubliées.
En 1888, un an après la première édition imprimée des paroles, la chorale lilloise du Parti Ouvrier Français demande à un de ses membres, Pierre Degeyter, de composer une musique originale pour L'Internationale. Le 23 juillet 1888, pour la première fois, la chorale de la Lyre des Travailleurs, réunie dans l'estaminet À la Vignette à Lille, interprète le chant de l'Internationale sur l'air nouveau de Degeyter. Sa partition est publiée en 18892.
Les quatre premières mesures , thème et harmonies sont sans doute extraites, vu leurs absolues similitudes, du final de l'opérette " les Bavards" , d'Offenbach, qui avait été créée avec un très grand succès populaire, au théâtre des Bouffes Parisiens, en 1863.
À partir de 1904, L'Internationale, après avoir été utilisée pour le congrès d'Amsterdam de la IIe Internationale, devient l'hymne des travailleurs révolutionnaires qui veulent que le monde change de base, le chant traditionnel le plus célèbre du mouvement ouvrier.
L'Internationale a été traduit dans de nombreuses langues.
Traditionnellement ceux qui la chantent lèvent le bras en fermant le poing.
L'Internationale est chantée par les socialistes dans le sens premier du terme, anarchistes, communistes, mais aussi des partis dits socialistes ou sociaux-démocrates et bien sûr par les syndicats de gauche, ainsi que dans des manifestations populaires.
Ce fut même l'hymne de ralliement de la révolte des étudiants et des travailleurs sur la place Tian'anmen en 1989.
Il fut l'hymne national de l'URSS, dans une version la plupart du temps expurgée du cinquième couplet jusqu'en 1944, et est toujours l'hymne de la majorité des organisations socialistes, anarchistes, marxistes ou communistes.
Dans de nombreux pays d'Europe, ce chant a été illégal durant des années du fait de son image communiste et anarchiste et des idées révolutionnaires dont elle faisait l'apologie.
Plus tard, certains groupes anarchistes utiliseront plus volontiers une adaptation : L'Internationale noire.
Dans le roman de George Orwell La Ferme des animaux, critiquant allégoriquement l'URSS sous couvert de narrer une révolution d'animaux, L'Internationale est parodiée sous le nom de Beasts of England et la révolution ouvrière spoliée par les bolchéviques, comme la modification des textes révolutionnaires par ceux-ci, y est également dénoncée.
Liens
http://youtu.be/s6CX_9oDwwk l'internationale
http://youtu.be/dcXNXKtu8z4 Anglais
http://youtu.be/2OPvWFDzDlA par Toscanini, malgré l'interdiction
http://youtu.be/Xaa7NrcHyD0 Espagnol
http://youtu.be/qm9aYRzCX48 Italien
http://youtu.be/kDwZAtE6yWY Allemand
http://youtu.be/XKTToVgAQlU en Chinois
http://youtu.be/L0td8s6AU_A Japonais
http://youtu.be/2H5sxLrt-xY Corée (on écoute, ce n'est plus le chant du peuple, mais pour le peuple)
http://youtu.be/i5VsVGlZJnA Bulgare
http://youtu.be/lwR_1tzUZrA Pologne
http://youtu.be/gPLMWwRn2UM Danemark
http://youtu.be/75kjRooehQU Arabie
http://youtu.be/MzOY43KTxJU Syrie
http://youtu.be/yBGH7CWCHow Portugais
http://youtu.be/FDmSzDtkZYw Cuba
http://youtu.be/MzOY43KTxJU Syrie
http://youtu.be/u8bFsNyqvqw Yiddish
http://youtu.be/K6GVsfOM1XA Zoulou
http://youtu.be/WCQQx5eMzZk meltingpot
Devenu
http://youtu.be/QKTYNknc3C4 Hymne national Russe
Liens
http://youtu.be/_OQxncb2ihQ Origine du massacre
http://youtu.be/ifK1Qw2WbMc Haymarket square history
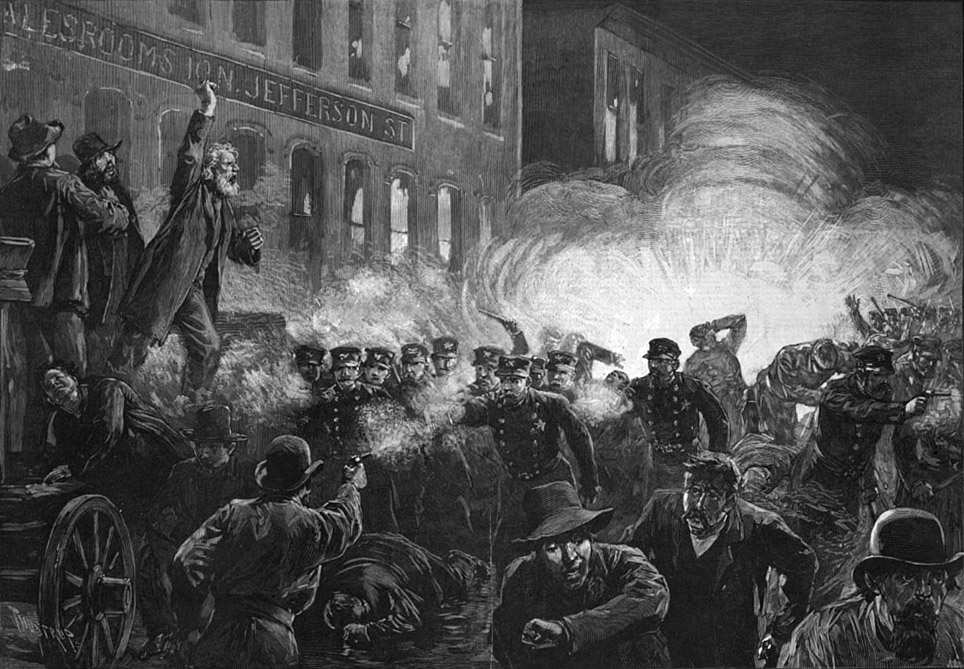 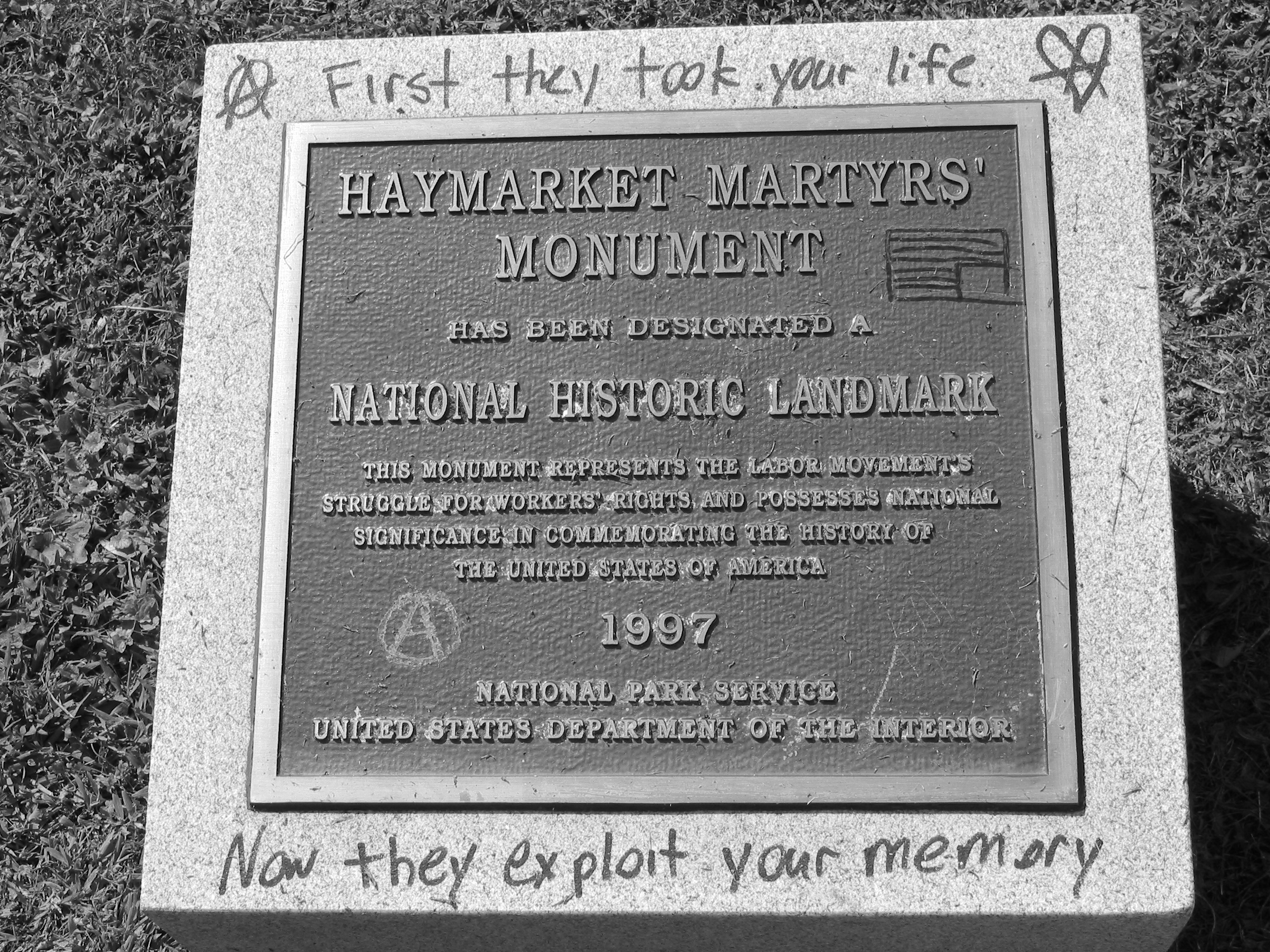 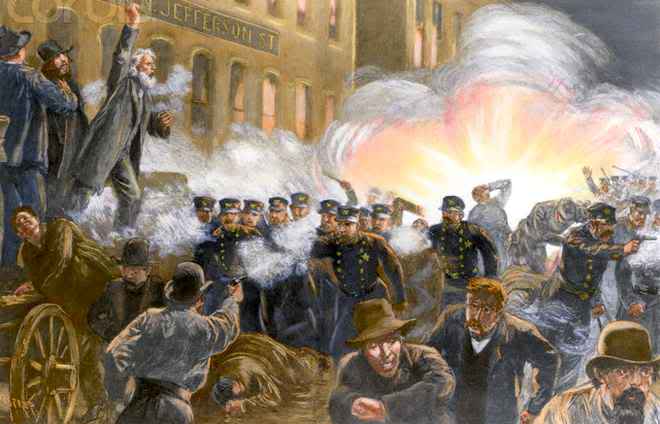 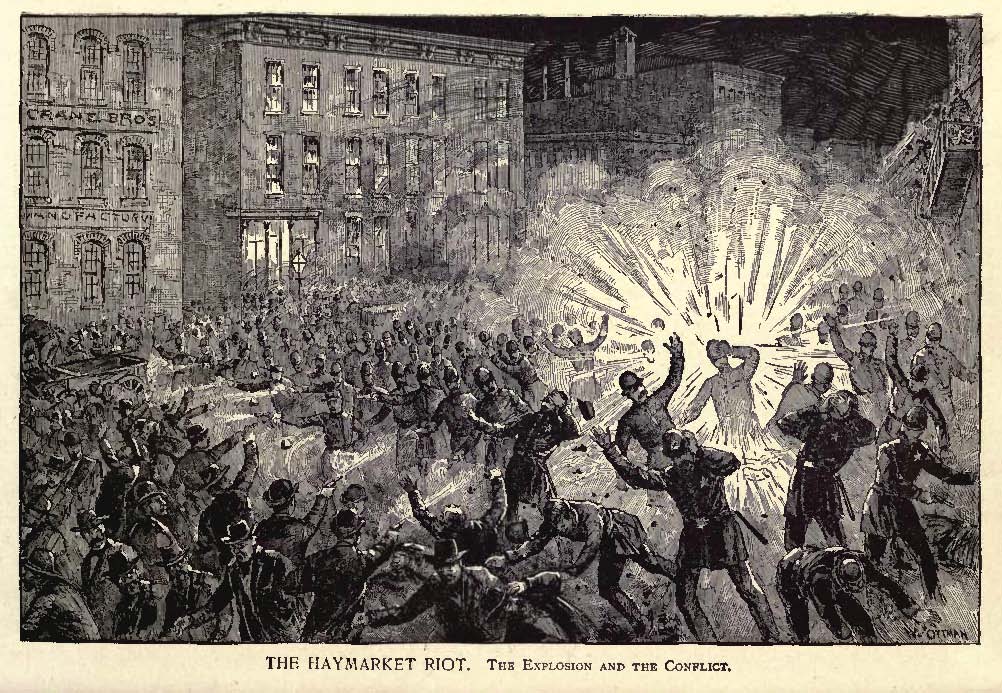  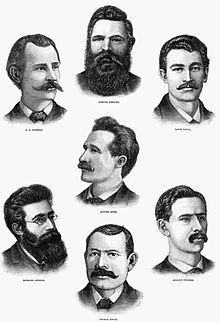        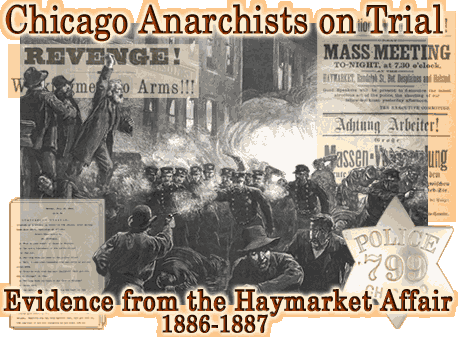 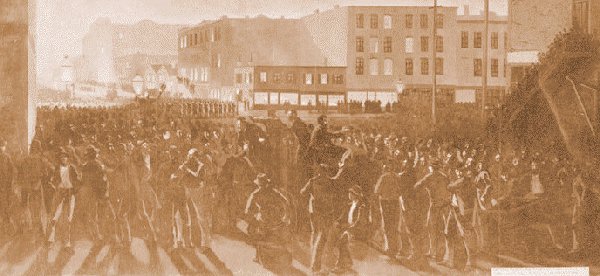 [img width=-00]https://maydaymarch.files.wordpress.com/2011/02/mayday-france-2.jpg[/img]
Posté le : 01/05/2014 13:02
Edité par Loriane sur 02-05-2014 23:19:59
Edité par Loriane sur 02-05-2014 23:20:37
Edité par Loriane sur 03-05-2014 18:52:49
|
|
|
|
|
Samuel Finley Breese Morse |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 27 avril 1791 à Charlestown dans le Massachusetts
aux états-unis naît Samuel Finley Breese Morse,
connu sous le nom de Samuel Morse, peintre et sculpteur américain, il développe d'un télégraphe électrique et de l'alphabet qui portent son nom. Il meurt le 2 avril 1872, à 80 ans, à New York.
Après des études à la Phillips Academy d'Andover Massachusetts, Samuel Finley Breese Morse poursuit son cursus à l'université de Yale. Peintre et sculpteur sa curiosité est éveillée par des conférences sur l'électricité, phénomène alors largement incompris. tandis qu'il se plaît à peindre des portraits miniatures. Diplômé de Yale en 1810, Morse travaille ensuite chez un éditeur, à Boston. Mais la peinture demeure son principal centre d'intérêt et, en 1811, ses parents l'aident à aller étudier cet art en Angleterre. Il accepte alors les canons artistiques anglais de l'époque, notamment ceux de la peinture historique qui représente des scènes romantiques, tirées de légendes et d'événements historiques, mettant au premier plan des personnages éclatants prenant la pose.
Sur le bateau de retour vers l'amérique, il imagine un télégraphe électrique après avoir entendu une conversation sur l'électroaimant tout juste inventé par André-Marie Ampère. Sans connaître les travaux que mènent alors les Britanniques William Cooke et Charles Wheatstone, Morse met au point son premier prototype fonctionnel en 1835. Il continue cependant à consacrer la majeure partie de son temps à la peinture, enseignant l'art à l'université de New York, et à la politique. Ce n'est qu'en 1837 qu'il porte toute son attention vers son invention, lorsque le mécanicien Alfred Vail, tout juste diplômé de l'université de New York, lui montre une description détaillée d'un autre modèle de télégraphe élaboré en 1831. Parallèlement, un ami propose à Morse de lui fournir le matériel et la main-d'œuvre nécessaires pour construire ses appareils dans l'usine sidérurgique de sa famille. Morse prend les deux hommes comme associés pour construire un appareil commercialisable. En 1838, il met au point un nouveau système de transcription de l'information, à base de points et de traits : le fameux code morse. Alors qu'il tente en vain d'amener le Congrès à financer la construction d'une ligne télégraphique, il prend l'un de ses membres comme associé supplémentaire. Morse ne parvient pas non plus à faire construire une ligne télégraphique en Europe. Il finit cependant par obtenir, sans la coopération de ses associés, le soutien financier du Congrès pour installer la première ligne de télégraphe aux États-Unis, de Baltimore à Washington, sur laquelle il envoie son premier message en mai 1844.
À la suite de plaintes de ses associés et d'autres inventeurs, Morse doit défendre ses droits de paternité pendant plusieurs années. La Cour suprême confirme en 1854 le brevet déposé par Morse. Ce dernier s'enrichit et devient célèbre à mesure qu'apparaissent des lignes télégraphiques transatlantiques. Si le télégraphe révolutionne les télécommunications du vivant de Morse, sa célébrité sera éclipsée après sa mort par l'invention de nouveaux appareils de communication (téléphone, radio, télévision). En revanche, sa réputation d'artiste grandira, le public redécouvrant la puissance et la sensibilité de ses portraits de grands personnages tel La Fayette.
Sa vie
Samuel finley Breese Morse est le fils du géographe Jedidiah Morse.
1811 Après des études à l'université Yale Connecticut où il obtient son diplôme en 1811, il travaille chez un éditeur à Boston tout en se consacrant à la peinture.
En 1811 ses parents lui offrent un Voyage à Londres pour y suivre des études artistiques auprès de Benjamin Franklin .
En 1813 il obtient un Médaille d'or de sculpture de la Société des arts Adelphi.
De retour aux États-Unis en 1815, Morse se rend compte que les Américains n'aiment pas ses toiles historiques. Il se lance alors à contrecœur dans le portrait pour gagner sa vie et devient peintre itinérant dans divers États, Nouvelle-Angleterre, New York, Caroline du Sud. Une fois installé à New York, il exécute, après 1825, quelques-uns des plus beaux portraits alors réalisés par un artiste américain. Maîtrisant parfaitement sa technique, il traduit, d'un trait sûr, le caractère de ses sujets avec une touche de romantisme héritée de l'Angleterre.
Au début de sa carrière, Morse côtoie des intellectuels, des personnalités fortunées, de fervents religieux et des conservateurs.
Il noue facilement des liens d'amitié, notamment avec le héros français de la révolution américaine, le marquis de La Fayette, et le romancier américain James Fenimore Cooper. Il fonde à New-york en 1826 une société des beaux-arts destinée à faire connaître les peintres américains, la National Academy of Design, qu'il préside jusqu'en 1845, soit pendant 16 ans
Samuel Morse part en 1829 pour un voyage en Europe dont trois ans en France et en Italie pour y étudier les beaux-arts.
C'est sur le Sully, navire qui le ramène aux États-Unis, en 1832, qu'il conçoit l'idée d'un télégraphe électrique après une conversation sur l'utilisation de l'électro-aimant et les travaux d'Ampère avec le géologue Charles Thomas Jackson.
Dans l'année 1835, alors qu'il est professeur de peinture et de sculpture à l'université de New York, il réalise la première maquette du télégraphe avec des moyens insuffisants.
1837 Avec l'aide de deux partenaires, Leonard Gale, un professeur de science à l'université de New York et Alfred Lewis Vail, plutôt porté sur la réalisation pratique, il cherche à concrétiser son idée. En fait c'est Vail qui trouve la solution du code composé de points et de barres. À l'origine Morse avait imaginé des codes composés uniquement de chiffres et un dictionnaire pour interpréter les messages reçus. Vail avait pressenti que les messages devaient être verbaux et donc composés de lettres et de signes. C’est en visitant une imprimerie typographique que Vail comprit que certaines lettres étaient plus utilisées que d'autres et que le code devait privilégier les lettres les plus fréquentes.
1838 Développement du code qui le rendit célèbre bien que ce soit strictement l'œuvre de Vail. Il tente sans succès d'intéresser le Congrès américain à son invention et se tourne vers l'Europe, où il échoue également.
Il dépose de le brevet pour son télégraphe en 1840 -la machine est simple et efficace.
Deux ans plus tard, en 1842, c'est la construction d'une ligne télégraphique sous-marine reliant l'île de Manhattan à Brooklyn et au Nouveau-Jersey, en association avec Samuel Colt.
Après des démarches opiniâtres, il réussit en 1843 à obtenir du Congrès une aide de 30 000 $ pour établir une ligne télégraphique entre Baltimore dans le Maryland et Washington.
Le 24 mai 1844 un premier message est transmis de la Cour suprême du Capitole vers le dépôt de chemin de fer de Baltimore.
1846 Développement du télégraphe de Morse par des sociétés privées.
Après plusieurs procès contre des rivaux, en 1854la Cour suprême américaine tranche en sa faveur et valide ses brevets.
Il meurt à 80 ans, le 2 avril 1872 mort à New York.
Télégraphe de Morse 1837
Manipulateur morse
L'œuvre
Samuel Morse n'a pas inventé le télégraphe : 50 ans auparavant en 1793, le télégraphe optique de Chappe permettait la transmission de dépêches à des centaines de lieues. Il n'a pas non plus inventé le télégraphe électrique : Soemmerring, Steinheil, Gauss et Weber en Allemagne, Ampère en France, Schilling à Saint-Pétersbourg, Richtie et Alexander en Écosse, Wheatstone en Angleterre, avaient déjà trouvé des solutions pour transmettre des messages à l'aide de l'électricité.
Le génie de Morse a été de concevoir une machine simple, pratique, efficace, bon marché, rustique et surtout de réussir à convaincre, non sans mal ses contemporains de réaliser une expérience suffisamment spectaculaire pour frapper les imaginations la liaison Washington-Baltimore, 40 miles soit 60 km.
On peut noter que le code dit Morse était à l'origine différent de celui qui est utilisé maintenant. C'est l'Allemand Friedrich Gerke qui simplifia ce code, dont une version modifiée sera adopté par l'UIT en 1865. Malgré l'adoption de ce standard international, deux codes restèrent en usage : le code américain, code originel qui a continué à être utilisé aux États-Unis et le code international, aussi appelé continental parce qu'utilisé principalement en Europe.
Si la machine fut détrônée par la suite par les télégraphes automatiques, téléscripteurs, etc. le code est toujours d'actualité chez les militaires quoique les transmissions numériques aient tendance à le supplanter et les radioamateurs qui profitent de sa très grande résistance aux bruits parasites dans leur trafic radio en télégraphie. Cette résistance aux bruits parasites est due à la faible bande passante des signaux morse et donc au meilleur rapport signal/bruit qui permet de passer des messages dans les pires conditions.
Morse était issu d'un milieu calviniste et avait écrit un tract en 1835 intitulé Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States sur un prétendu complot papal pour catholiciser les États-Unis.
Morse, inventeur du multiplexage spatial ?
Morse pensa quelque temps à faire transiter par le même fil au même moment plusieurs communications télégraphiques distinctes, chaque couple émetteurs/récepteur utilisant des vibreurs d’une fréquence propre, et des filtres permettant de les séparer à l’arrivée. Il s'agit peut-être de la première idée de multiplexage spatial. Il ne lui donna en fin de compte pas de suite.
L'Alphabet Morse
L’alphabet morse ou code morse, est un code permettant de transmettre un texte à l’aide de séries d’impulsions courtes et longues, qu’elles soient produites par des signes, une lumière ou un geste.
Ce code est souvent attribué à Samuel Morse, cependant plusieurs personnes démentent ce fait, et tendent à attribuer la paternité du langage à son assistant, Alfred Vail.
Inventé en 1832 pour la télégraphie, ce codage de caractères assigne à chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une combinaison unique de signaux intermittents. Le code morse est considéré comme le précurseur des communications numériques.
Aujourd’hui, le morse est principalement utilisé par les militaires comme moyen de transmission, souvent chiffrée, ainsi que dans le civil pour certaines émissions à caractère automatique : radiobalises en aviation, indicatif d’appel des stations maritimes, des émetteurs internationaux, horloges atomiques…, ou bien encore pour la signalisation maritime par certains transpondeurs radar et feux, dits à lettre morse par exemple, la lettre A transmise par un tel feu sous la forme .- signifie eaux saines. Le morse est également pratiqué par des amateurs comme de nombreux radioamateurs, scouts (morse sonore et lumineux, plongeurs ou alpinistes, morse lumineux ainsi que comme sonnerie par défaut de réception de message pour les gsm de marque Nokia : "SMS SMS" en morse.
Utilisation du morse
Le code peut être transporté via un signal radio permanent que l’on allume et éteint, onde continue, ou "continuous wave en anglais", généralement abrégé en CW, une impulsion électrique à travers un câble télégraphique, très rare de nos jours, un signal mécanique ou visuel, flash lumineux. L’idée qui préside à l’élaboration du code morse est de coder les caractères fréquents avec peu de signaux, et de coder en revanche sur des séquences plus longues les caractères qui reviennent plus rarement. Par exemple, le e, lettre très fréquente, est codé par un simple point, le plus bref de tous les signes.
Les 25 autres lettres sont toutes codées sur quatre signaux au maximum, les chiffres sur cinq signaux. Les séquences plus longues correspondent à des symboles les plus rares : signes de ponctuation, symboles et caractères spéciaux.
Parallèlement au code morse, des abréviations commerciales plus élaborées ont été créées codant des phrases complètes en un seul mot, groupe de 5 lettres.
Les opérateurs de télégraphie conversaient alors en utilisant des mots tels que BYOXO, "Are you trying to crawl out of it?", LIOUY "Why do you not answer my question?" et AYYLU "Not clearly coded, repeat more clearly.".
L’intention de ces codes était d’optimiser le coût des transmissions sur les câbles. Les radioamateurs utilisent toujours certains codes appelés Code Q et Code Z.
Ils sont utilisés par les opérateurs afin de s’échanger des informations récurrentes, portant par exemple sur la qualité de la liaison, les changements de fréquences et les télégrammes.
Service maritime
Les premières liaisons radiotélégraphiques sans fil utilisant le code morse datent du début du xxe siècle. En 1903, la conférence de Berlin attribue la longueur d’onde de 600 mètres, 500 kHz au trafic en radiotélégraphie morse en mer et officialise en 1906 le signal SOS comme appel de détresse.
Jusqu’en 19875, plusieurs conférences mondiales des radiocommunications définissent les bandes à utiliser pour les communications en télégraphie morse. Depuis le 1er février 1999, dans le cadre du SMDSM 1999, les services maritimes côtiers et mobiles de France et de nombreux autres pays ont abandonné la veille radiotélégraphique obligatoire et cessé les émissions en morse, notamment sur la fréquence de 500 kHz, maritime et aéronautique et sur la fréquence de 8 364 kHz, affectées au trafic de détresse ou d’appel en radiotélégraphie, depuis les années 1970, un système de satellites de télécommunication ayant pris le relais. À partir de ce moment, le trafic maritime radiotélégraphique et radiotéléphonique utilisant les ondes hertziennes commence à décliner lentement. Cependant, il existe encore à ce jour en 2010 des fréquences internationales affectées par l’UIT à la diffusion de l’heure, de la météo marine ou aux communications maritimes en radiotélégraphie, parmi d’autres, 4 182 kHz à 4 186,5 kHz, ou 4 187 kHz à 4 202 kHz pouvant aussi être utilisé par l’Aviation civile.
La bande des 600 mètres notamment reste utilisée par une vingtaine de pays dans le monde, parmi lesquels : l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Azerbaïdjan, le Cameroun, la Chine, la République du Congo, Djibouti, l’Érythrée, les États-Unis, l’Indonésie, l’Italie, l’Irlande, Oman, la Roumanie, la Fédération de Russie, les Samoa américaines et les Seychelles.
À quelques exceptions près, la plupart des stations maritimes encore en activité n’émettent plus en morse que leur indicatif d’appel et éventuellement leur fréquence d’émission. Aujourd’hui, certaines fréquences destinées au trafic en CW de la marine marchande ont encore une affectation, même si elles ne sont plus utilisées que par quelques pays et très rarement.
Depuis le début du XXe siècle et l’invention de la lampe Aldis, les bateaux peuvent également communiquer en morse lumineux.
Alors que la capacité à émettre de tels signaux reste exigée pour devenir officier de la marine marchande dans de nombreux pays, dont la France, cette pratique a tendance à devenir rare et ne se retrouve plus que dans la marine de guerre et chez certains plaisanciers.
Service aéronautique
Les premières liaisons radiotélégraphiques aéronautiques remontent au début du XXe siècle et ont cessé avant les années 1970, à une époque où les ballons dirigeables et les avions communiquaient en radiotélégraphie dans la bande aéronautique des 900 mètres, 333,33 kHz, en vol au-dessus des mers et des océans dans la bande marine des 600 mètres, 500 kHz, sur la longueur d’onde de radiogoniométrie de 450 mètres, 666,66 kH et jusqu’en 1930 pour un échange de correspondances transcontinental radiotélégraphique au-dessus des océans dans la bande des 1 800 mètres, 166,66 kHz.
En vol une antenne pendante longue de 120 mètres à 450 mètres était déroulée pour établir les communications radiotélégraphiques sur ces longueurs d’ondes.
À l’extrémité de l’antenne pendante un plomb de lestage porte l’indicatif radio de l’aéronef.
Une autre antenne tendue le long de la coque de l’aéronef était pour établir, à courte distance les communications radiotélégraphiques en vol et au sol sur la longueur d’onde de 900 mètres, 333,33 kHz et dès 1930 pour établir les communications radios NVIS.
Les fréquences utilisées autrefois par l’aviation pour les communications, notamment celles voisines de 300 kHz sont aujourd’hui attribuées aux radiobalises de type NDB qui émettent des signaux radiotélégraphiques automatisés, indicatif composé de deux à trois lettres, transmis en morse à intervalles réguliers.
L’aviation utilise également la sous-bande VHF pour d’autres types de radiobalises, systèmes VOR et ILS qui transmettent également leurs indicatifs, de 3 à 4 lettres en morse. Pour ce qui est des communications radiotéléphoniques, elles s’effectuent de nos jours sur les bandes VHF pour le trafic local, et HF pour le trafic transcontinental ou transocéanique.
Usage militaire
Dans certaines circonstances, la radiotélégraphie présente des avantages par rapport à la radiotéléphonie : par exemple, en cas de fort parasitage, il est plus aisé de reconnaître les signaux codés en morse que ceux, beaucoup plus complexes, transmis par la voix.
Également, la radiotélégraphie s’avère être un moyen de communication plus discret que la radiotéléphonie qui demande de prononcer les mots hautement et clairement. Pour ces raisons, la plupart des armées dans le monde forment des officiers radio maîtrisant la télégraphie et disposent de fréquences réservées par l’UIT.
Il arrive également que les navires de guerre, s’ils sont suffisamment proches, utilisent le morse lumineux pour communiquer à l’aide d’une lampe à signaux. C’est par exemple le cas lorsqu’ils sont contraints d’observer une période de silence radio.
Utilisation par les radioamateurs
Les radioamateurs utilisent assez fréquemment le code morse pour les communications de loisir en radiotélégraphie et jouissent à cet effet de fréquences allouées par l’UIT.
Jusque dans les années 1990, pour obtenir la licence de radioamateur aux États-Unis, de la FCC, il fallait être capable d’envoyer 5 mots encodés en morse par minute.
La licence avec le plus de droits exigeait 20 mots par minute. L’épreuve actuelle de lecture au son à l’examen, Jusque dans les années 2011 en France, uniquement pour la 1re classe de radioamateurisme requiert une vitesse minimum de 12 mots par minute. Les opérateurs radio militaires et radioamateurs entraînés peuvent comprendre et enregistrer jusqu’à 40 mots par minute.
Le Règlement des radiocommunications RR se compose de règles liées au service de radio amateur. Il est révisé tous les trois ans à la Conférence mondiale des radiocommunications CMR. La révision de l’article 25 du Règlement des radiocommunications à la Conférence de 2003, en particulier, a supprimé l’exigence de connaissance du code Morse à l’utilisation des fréquences inférieures à 29,7 MHz. Cela affecte la plupart des pays, mais certains, dont la Russie continuent en 2008 à l’exiger.
Autre
On connaît plusieurs cas avérés d’utilisation par les espions du code morse. On soupçonne d’ailleurs ces derniers d’effectuer régulièrement des communications chiffrées utilisant le morse.
Le code morse permet de transmettre un texte à distance à l’aide d’un signal lumineux. Il est à ce titre un passe-temps présent notamment chez les scouts et éclaireurs. Pour les mêmes raisons, le code a été adopté par certains sportifs que les activités amènent à être isolés : alpinistes ou plongeurs par exemple. Le morse peut entre autres servir à signaler une situation de détresse.
Il existe un exemple célèbre d'utilisation du code morse faite par un prisonnier de guerre, Jeremiah Denton, lors d'une l'interview télévisée de propagande réalisée par ses ravisseurs nord-vietnamiens en 1966. Tout en parlant, il énonça le mot TORTURE par une série de clignements des yeux.
Code morse international
Deux types de code morse ont été utilisés, chacun avec ses particularités quant à la représentation des symboles de l’anglais écrit. Le code morse américain13 a été utilisé dans le système télégraphique à l’origine de la première télécommunication à longue distance.
Le code morse international est le code le plus communément utilisé de nos jours.
C’est en 1838 que Friedrich Clemens Gerke créé un alphabet morse très proche de celui que nous connaissons actuellement. Il s'agit d'une modification du code morse originel, plus tard appelé code morse américain. Gerke simplifie le code en n'utilisant plus que de 2 longueurs standards, le point et le tiret. Auparavant, certains espaces étaient plus long que le point à l'intérieur même d'un caractère, ou le tiret pouvait être plus long, comme pour la lettre L.
Deux types d’impulsions sont utilisés. Les impulsions courtes notées "." , point qui correspondent à une impulsion électrique de 1/4 de temps et les longues notées "-" , trait à une impulsion de 3/4 de temps, les impulsions étant elles-mêmes séparées par 1/4 de temps, l’unité de temps élémentaire étant alors voisine de la seconde pour la manipulation et l’interprétation humaine.
Alors que se développent de plus en plus de variantes du code Morse dans le monde, l'ITU adopte en 1865, comme code morse international, l'alphabet morse de Gerke avec quelques modifications.
Il sera rapidement utilisé en Europe, continentale ?. Les compagnies de, radio télégraphie américaines continueront à utiliser le code originel, qui sera alors appelé code morse américain.
Le code morse international est toujours utilisé aujourd’hui, certaines parties du spectre radio sont toujours réservées aux seules transmissions en morse. Utilisant un simple signal radio non modulé, il demande moins d’équipement pour envoyer et recevoir que d’autres formes de communications radio.
Il peut être utilisé avec un bruit de fond important, un signal faible et demande très peu de bande passante.
Représentation et cadence
On utilise deux symboles positifs, appelés point et trait ou " ti " et " taah ", et deux durées d’espacement, la coupure élémentaire entre signaux et l’espace séparatrice des mots.
La durée totale d’émission d’un trait, y compris la coupure élémentaire entre signaux détermine la vitesse à laquelle le message est envoyé, elle est utilisée en tant que cadence de référence. Un message simple serait écrit où "▄" représente ti et "▄▄▄" représente taah :
▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄
C O D E / M O R S E /
Voici la cadence du même message = signifie signal actif , "·" signifie signal inactif , chacun ayant pour durée un " ti " :
===·=·===·=···===·===·===···===·=·=···=·······===·===···===·===·===···=·===·=···=·=·=···=
^ ^ ^ ^ ^
| ti ta | espace entre les mots 7 points
| espace entre les lettres 3 points
|
espace entre les symboles
Conventions de cadence :
Le rythme élémentaire est donné par la durée du point, le ti. Il se note par un point ..
Un taah est conventionnellement 3 fois plus long qu’un ti . Il se note par un trait horizontal – .
L’espacement entre les ti et taah dans une lettre a la longueur d’un ti . Il se note par le passage d’un symbole à l’autre.
L’espacement entre les lettres d’un mot a pour longueur un taah 3 ti. Il se note par un espace.
L’espacement entre les mots est d’au moins 5 ti 7 recommandés, comme ici. Il se note par une barre oblique / .
Les personnes familières du morse écriraient donc CODE MORSE ainsi : -.-. --- -.. . / -- --- .-. ... . et le prononceraient taahtitaahti taahtaahtaah taahtiti ti, taahtaah taahtaahtaah titaahti tititi ti.
Il existe d'autre forme de représentation, la représentation compressé, par exemple, qui associe au "ti" un point en bas, et au "taah" un point en haut ou encore le morse en dent de scie.
Génération des messages
Manipulateur de type pioche 1904.Manipulateur morse iambique.
Les opérateurs composent des messages en morse à l’aide de manipulateurs.
Les modules les plus simples pioches ne comportent qu’une seule touche : un signal est envoyé lorsque cette dernière est enfoncée. L’opérateur doit donc calibrer lui-même la durée des points et des traits, ce qui donne à chaque émission un caractère personnel, mais demande trois ou quatre mouvements de doigt par signe.
Les modèles plus évolués dit iambiques comportent deux palets, dont l’un génère les traits, et l’autre génère les points, l’appui simultané déclenchant l’alternance point-trait. Avec un tel manipulateur, un seul mouvement de doigt suffit par caractère, et c’est un circuit logique, en général incorporé à l’émetteur, qui génère intervalles, traits et points de durées appropriées.
La vitesse de manipulation s’exprime en mots par minute, et varie d’une dizaine de mots par minute pour un débutant ou une identification d’émetteur compréhensible par tous, à 60 mots par minute ou plus pour un manipulateur expert. Le record est détenu par Ted McElroy qui aurait atteint le score de 75.6 mots par minute au championnat mondial de 1939.
Il existe également des générateurs informatiques automatiques, qui sont généralement couplés avec des décodeurs automatiques.
Tables d’encodage
Voici quelques tables récapitulant l’alphabet morse et quelques signes communément utilisés.
Lettres
Lettres Mnémoniques Code international Lettre Mnémoniques Code international
A (a) A, ET .- ▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] N (n) N, TE -. ▄▄▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
B (b) B, DE, NI, TS -... ▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche] O (o) O, MT, TM --- ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche]
C (c) C, KE, NN, TR -.-. ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ? Écouter [Fiche] P (p) P, WE, AN, EG .--. ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
D (d) D, NE, TI -.. ▄▄▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche] Q (q) Q, DT, MA, TK --.- ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche]
E (e) E . ▄ ? Écouter [Fiche] R (r) R, AE, EN .-. ▄ ▄▄▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
F (f) F, UE, IN, ER ..-. ▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ? Écouter [Fiche] S (s) S, EI, IE ... ▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
G (g) G, ME, TN --. ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ? Écouter [Fiche] T (t) T - ▄▄▄ ? Écouter [Fiche]
H (h) H, SE, II, ES .... ▄ ▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche] U (u) U, EA, IT ..- ▄ ▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche]
I (i) I, EE .. ▄ ▄ ? Écouter [Fiche] V (v) V, ST, IA, EU ...- ▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche]
J (j) J, WT, AM, EO .--- ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] W (w) W, AT, EM .-- ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche]
K (k) K, NT, TA -.- ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] X (x) X, DT, NA, TU -..- ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche]
L (l) L, RE, AI, ED .-.. ▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche] Y (y) Y, KT, NM, TW -.-- ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche]
M (m) M, TT -- ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] Z (z) Z, GE, MI, TD --.. ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
Chiffres
Chiffre Code international Chiffre Code international
0 Zéro ----- ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] 5 Cinq ..... ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
1 Un .---- ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] 6 Six -.... ▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
2 Deux ..--- ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] 7 Sept --... ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
3 Trois ...-- ▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] 8 Huit ---.. ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
4 Quatre ....- ▄ ▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ? Écouter [Fiche] 9 Neuf ----. ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ? Écouter [Fiche]
Signes de ponctuation et symboles
Signe Mnémoniques Code international
. Point AAA, RK .-.-.- ▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄
, Virgule MIM, GW --..-- ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄
? Point d’interrogation IMI, UD ..--.. ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄
' Apostrophe WG .----. ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄
! Point d’exclamation KW
ou parfois MN en Amérique du Nord -.-.--
---. ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄
▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄
/ Barre oblique (slash) NR, XE -..-. ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄
( Parenthèse ouvrante NG, KN -.--. ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄
) Parenthèse fermante NQ, KK -.--.- ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄
& Esperluette (« et commercial », ampersand) AS .-... ▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄
: Deux-points OS ---... ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄
; Point-virgule NNN, KR -.-.-. ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄
= Signe égal NU -...- ▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ▄▄▄
+ Signe plus AR .-.-. ▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄
- Signe moins ou trait d’union DU -....- ▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄▄▄
_ Tiret bas underscore UK ..--.- ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄
" Guillemet droit indifférencié RR .-..-. ▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄
$ Symbole dollar ou peso SX ...-..- ▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄
@ Arrobase @ a été ajouté en 2004. Il combine le A et le C en un seul caractère.
SOS
Une erreur fréquente est de considérer le code de détresse international comme la succession des lettres « S O S » et de l’envoyer en tant que tel (=·=·=···===·===·===···=·=·=). La bonne façon de l’envoyer est en enchaînant les 9 éléments comme s’ils formaient une seule lettre (=·=·=·===·===·===·=·=·=).
En Chine, un autre système était utilisé, le code télégraphique chinois.
Références culturelles
La lettre V a été identifiée à la très célèbre cellule rythmique du premier mouvement Allegro con brio de la Symphonie n°5 en ut mineur de Beethoven. En voici la représentation notée établissant un lien avec celle en alphabet Morse :
Elle laisse entendre ti ti ti ta ...-. C’est ce premier mouvement de la symphonie qui servait usuellement d'indicatif aux émissions de la BBC adressées aux pays occupés par l'Allemagne, V signifiant victoire. En outre, pour cette raison, la symphonie fut diffusée sur Radio Londres en juin 1944 pour annoncer aux réseaux de Résistance le débarquement allié en Normandie.
Le refrain de la chanson Communication du chanteur et musicien de jazz Slim Gaillard est construit selon la répétition du préfixe général demandant l'attention, CQ. (Celui-ci précédait le D pour composer le signal radio de détresse CQD utilisé entre 1904 et 1906, avant l'adoption définitive du code SOS à la conférence internationale de Berlin, le 3 novembre 1906.
La musique Radioactivity 1975 du groupe de musique électronique allemand Kraftwerk fait intervenir le code Morse dans sa ligne mélodique.
Le musicien britannique Mike Oldfield a souvent caché des codes dans ses compositions. Ainsi, considérant un manque de soutien de la part de Virgin pour sa création musicale, il insère un message codé en Morse à destination de son PDG, Richard Branson dans son album Amarok paru en 1990. Le message apparaît vers la 48e minute et est le suivant : F.U.C.K. O.F.F. R.B. R.B. pour Richard Branson.
En 1987, le générique du journal Le Six’ de la chaîne M6 fait entendre M6 en morse --/-.....
La chanson Waves, issue de l'album Music Hole de Camille 2008, utilise le code Morse en tant que phrase rythmique répétée en ostinato. Celle-ci est scandée par un chœur de femmes l'oralisant selon la prononciation anglaise des deux symboles : dot point et dash trait. Cette phrase est la suivante et a pour signification :
Code Lettre
dot dot dot S
dot dot dot dot H
dash dash dash O
dot dash dash W
dash dash M
dot E
dash T
dot dot dot dot H
dot E
dot dash dash W
dot dash A
dot dot dot dash V
dot E
dot dot dot S
Une des sonneries proposées dans certains téléphones Nokia appelée Special est en fait le mot S M S en morse (.../--/...)21. Une autre sonnerie appelée Ascending est la phrase Connecting people, le slogan de Nokia.
Les sculptures de la bande de roulement des pneus de l'astromobile Curiosity contiennent le code Morse J, P et L22 du nom de son constructeur JPL (Jet Propulsion Laboratory. Le but des chercheurs de la NASA est d'utiliser les marques laissées par les roues sur la surface de Mars pour en observer par comparaison entre les distances calculées et celles réellement parcourues d'éventuels dysfonctionnements.
Liens
http://youtu.be/h2IAh3uIGcc Samuel Morse peinture
http://youtu.be/wGs57VQHt7M (Anglais)
http://youtu.be/oo0hSZ9R_Xk Morse en Anglais
 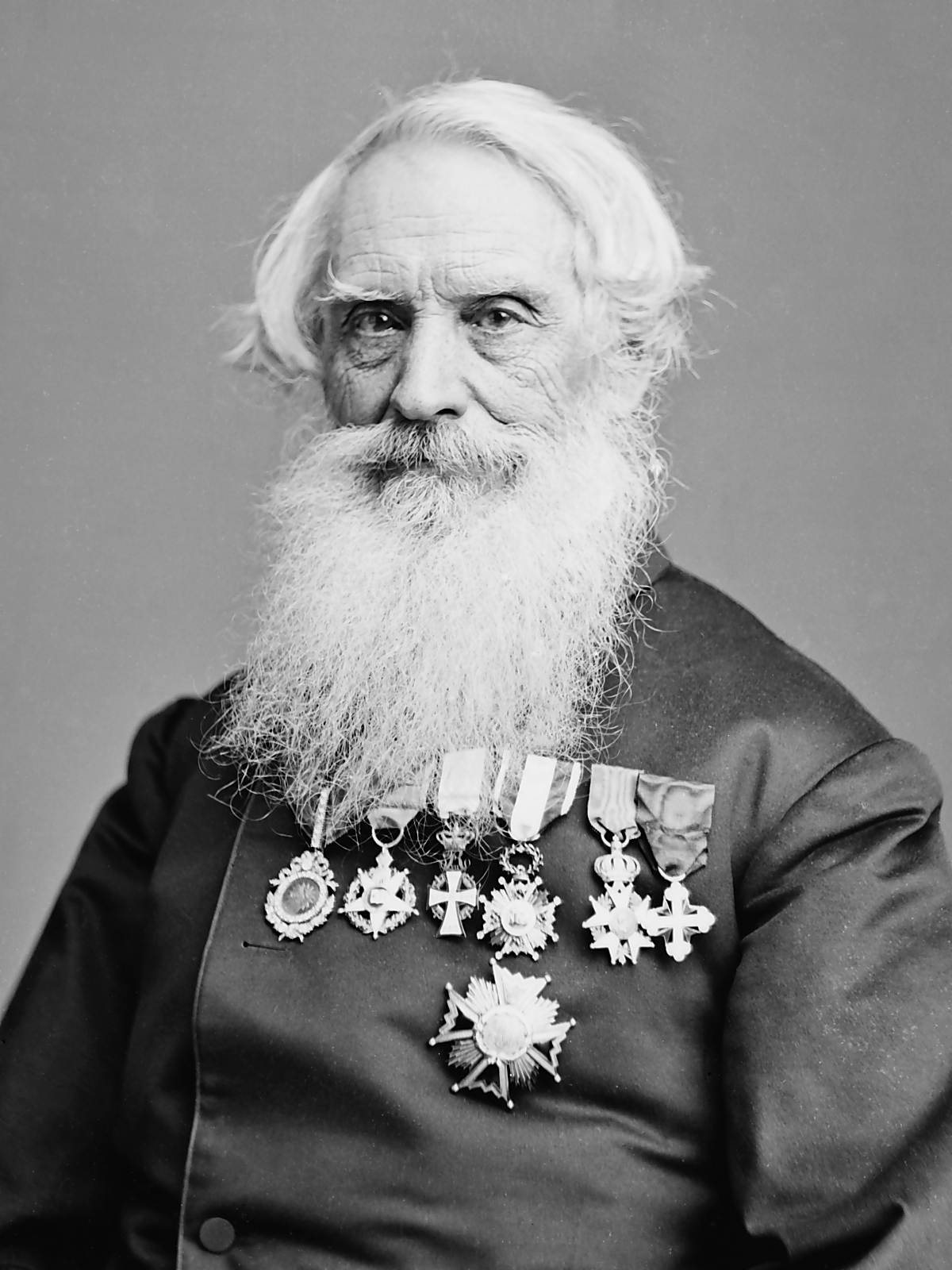  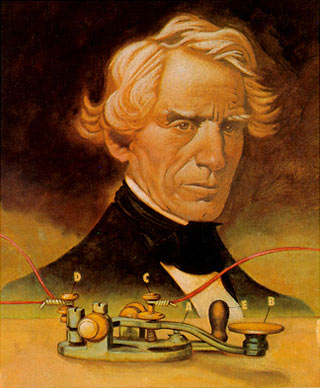     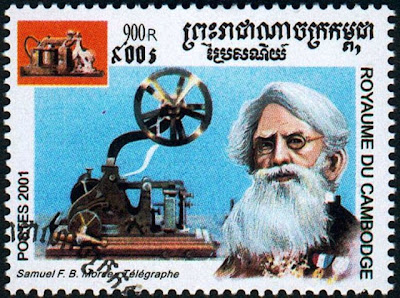 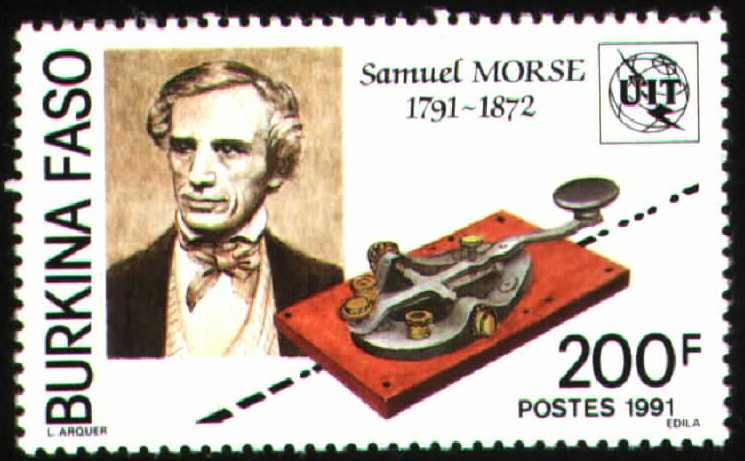   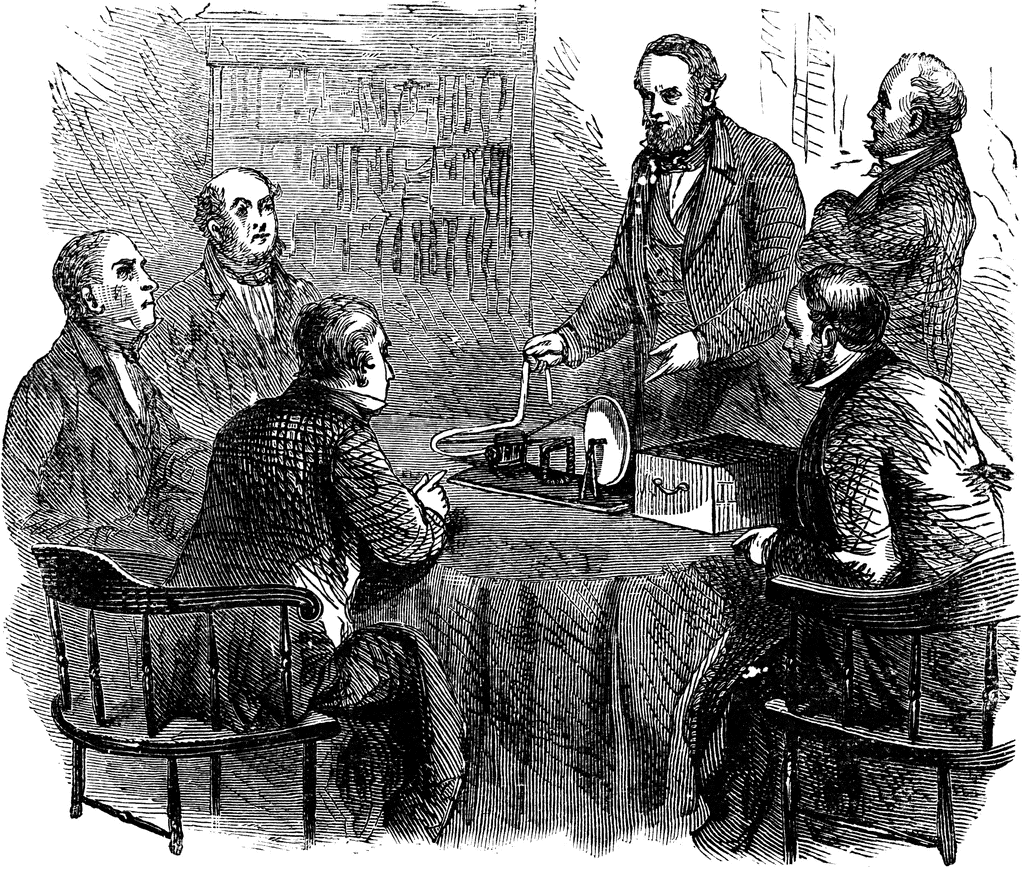 
Posté le : 26/04/2014 10:31
|
|
|
|
|
Pâques ici et ailleurs |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Pâques ici et ailleurs
La Semaine Sainte en Amérique Latine
Les célébrations de la Semaine Sainte en Amérique Latine datent de la conquête au XVII et XVIIème siècles.
La Semaine Sainte commémore, dans la religion catholique, la mort de Jésus et sa résurrection.
Cette tradition venue d’Espagne et du Portugal, y est bien vivante et pleine de ferveur. Elle nous montre à quel point le catholicisme, hérité des ibériques, s’est intégré aux religions locales des Andes, et des peuples mayas, pour se théâtraliser ensuite au contact des cultures indigènes avec lesquelles il a fusionné.
Cela donne lieu à de magnifiques festivités : processions, défilés religieux, cortèges dans les rues où des pénitents marchent en costumes traditionnels, les acolytes portant le lourd crucifix, de grandes statues de la vierge et des saints, des châsses richement ornées. Ces fêtes se déroulent en général du dimanche des Rameaux jusqu’au jour de Pâques et attirent de nombreux touristes.
Chaque pays d’Amérique Latine, chaque ville, chaque village a sa propre célébration de la Semaine Sainte, avec ses particularités.
Brésil
La Semaine Sainte tient une place prépondérante dans la vie des Brésiliens.
Les processions religieuses se produisent partout dans les villes et villages. A Salvador de Bahia, par exemple, la célébration dans le centre historique, le Pelourinho, est l’une des plus importantes.
Toutes les personnes, quel que soit leur niveau social, entrent dans la fête. Ce type d’événement se transforme vite en diverses attractions avec danses et musiques dans les rues… et comme toujours au Brésil la musique joue un grand rôle pendant la Semaine Sainte.
Plus qu’une fête religieuse, la Semaine Sainte au Brésil fait partie intégrante de la culture populaire du Pays. Et le Brésil n’est pas le moindre des pays d’Amérique latine avec ses près de 200 millions d’habitants, chrétiens à 89%, 64% d’entre eux étant catholiques !
Colombie
Popayan est la ville la plus religieuse de Colombie : elle possède le plus grand nombre d’églises datant des XVe et XVIème siècles. Les processions de la Semaine Sainte constituent ici l’une des plus anciennes traditions pratiquées en Colombie depuis l’époque coloniale.
Elles revêtent une qualité artistique indéniable : dorures, ébénisteries en sont les ornements. La préparation dure une année, selon un enseignement transmis de génération en génération, comme le rôle de porteur, considéré comme un privilège. Les rôles et responsabilités de chacun sont définis par une association, en collaboration avec les autorités de la ville.
Les cérémonies de la Semaine Sainte débutent le dimanche par la bénédiction des Rameaux dans la Chapelle de Belén. Les fidèles, agitant des mouchoirs blancs, proclament la royauté de Jésus et se rendent en procession à la Basilique, parmi les clameurs de la foule.
Le Mardi Saint à la nuit tombée, les porteurs, suivis d’un cortège d’acolytes en soutanes rouges, portent un grand crucifix, avec encensoirs et clochettes et emmènent, sur une musique de Requiem, quatre des statues, de l’église San Agustín au centre-ville. La procession du Vendredi Saint est la plus symbolique : elle reproduit le drame de la Passion avant la crucifixion.
L’image de La Mort est représentée par un squelette. Des hommes, portant marteaux et outils, symbolisent les outils qui ont servi à la descente de la croix du corps ensanglanté.
Finalement apparaît un cercueil, en "tagua", un ivoire végétal taillé et en corne, symbolisant le Saint Sépulcre dans lequel repose l’image du Christ.
Les festivités s’achèvent le samedi par une messe dans la cathédrale, après quoi les fidèles se rendent sur la place où se tient un marché, songeant à une nouvelle vie pleine d’espérance.
Guatemala
Ici, la religion est vécue d’une façon particulière, mêlant rites catholiques et croyances mayas ancestrales.
La Semaine Sainte débute le premier jour du carême, et dure jusqu’au jour de Pâques, elle est la plus longue de l’Amérique Latine. Dans tout le pays, des commémorations de la passion et de la mort du Christ, des messes et des processions sont organisées, mais c’est dans la vieille ville coloniale d’Antigua, que se déroulent les plus belles festivités.
Le Vendredi Saint est le jour le plus émouvant avec la reconstitution de la passion du Christ, c’est la ferveur de tout un pays qui se réveille et acquière toute son intensité, jusqu’au jour de Pâques où elles se terminent dans la joie avec la résurrection du Christ.
La vieille ville coloniale d’Antigua est le théâtre de somptueuses processions tout au long de la Semaine Sainte. L’une des caractéristiques propre à Antigua, ce sont ces magnifiques tapis aux couleurs vives, les "alfombras", fabriqués avec de la sciure colorée des fleurs et des fruits, pouvant aller jusqu’à dix mètres de long : ils recouvrent les rues pavées.
Ces extraordinaires compositions, aux motifs géométriques ou religieux, sont l’œuvre des habitants et de leurs amis qui, comme les touristes du monde entier, viennent admirer ces festivités uniques.
Mais le Vendredi saint en particulier, où l’on rejoue la passion et la mort du Christ, les rues d’Antigua sont le théâtre d’un spectacle étonnant. Il y a foule dans la ville, et la circulation est arrêtée.
Au cours de la nuit qui précède, des groupes d’étudiants, des familles ou des amis s’attèlent minutieusement à la fabrication des alfombras, véritables œuvres d’art éphémères.
Les délicates alfombras sont ensuite arrosées avec précaution pour éviter que le vent ne les disperse, ce qui sera fait de toute façon par les milliers de pèlerins qui les piétineront pendant les processions !
Mexique
La Semaine Sainte au Mexique est la fête la plus importante du calendrier catholique après la dévotion à la Vierge de Guadalupe, la plus célébrée dans le pays.
Elle commence le dimanche des Rameaux et se poursuit par les représentations du Jugement et de la Crucifixion pour se terminer le jour de Pâques. Elle donne lieu à des célébrations très colorées.
La plus marquante est celle qui rassemble plus de quatre cents mille fidèles réunis pour emprunter le chemin de croix du "Cerro de la Estrella", suivant le calvaire du Christ dans ce quartier Est de Mexico.
En fait, son origine date de l’époque terrible de l’épidémie de choléra en 1843 qui décima une grande partie de la population.
Désormais, cette fin soudaine de l’épidémie est associée par la croyance populaire à cette Semaine Sainte.
Depuis, chaque année, en remerciement, la population de tout le pays organise des représentions de la Passion pour invoquer les pouvoirs surnaturels et chaque participant procède à des actions de grâce pour améliorer sa vie quotidienne. Dans les villes de San Luis Potosi, Taxco, Pátzcuaro, Catemaco et Zinacantán, les processions aux chandelles qui défilent dans les rues sont célèbres.
Pérou
Parmi les innombrables fêtes et processions qui ont lieu au Pérou pendant la Semaine Sainte, celles d’Ayacucho, située au cœur des Andes, sont réputées pour être les plus fastueuses, mais aussi les plus pathétiques.
Cette exceptionnelle manifestation de ferveur religieuse constitue l’un des éléments fondamentaux de l’identité péruvienne, démontrant, comme au Guatemala, que la fusion des cultures, a pour résultats des représentations d’une grande originalité et intensité.
Comme presque dans toute l’Amérique Latine, la Semaine Sainte commence le jour des Rameaux ; chaque jour on assiste à une représentation différente, avec la Procession du "Seigneur des Rameaux", qui se rend du Monastère des Carmélite à la Place d’Armes, avec une curieuse représentation du Christ, monté sur un âne blanc au milieu d’un cortège de cierges allumés.
Le mardi, ce sont les effigies de Jésus de Nazareth et de la Vierge des Douleurs qui sont emmenées à l’Eglise Santa Clara, tandis que pendant la nuit se déroule la procession de la Sentence où l’on voit le Christ parcourir les rues, les mains liées, une couronne d’épines sur la tête avec des marques de flagellation sur le corps.
Le mercredi à huit heures du soir, on assiste à la "Procession del Encuentro" qui commémore la rencontre du Christ et de sa mère sur le chemin du Calvaire.
Les deux châsses s’arrêtent et " ils se parlent ", c’est le moment le plus fort et le plus intense, sublimé par les cantiques des fidèles et les nuages d’encens. Pour le passage de la procession, les habitants ont préparé de somptueux tapis de fleurs.
Le Vendredi Saint, en l’église Santo Domingo, une grande messe est célébrée dans la soirée, regroupant les autorités civiles et militaires, les membres des confréries et les porteurs, suivie des Processions du Saint Sépulcre et de la " Virgen Dolorosa"- L’effigie du Christ est allongée sur un lit de roses, tandis que la Vierge est accompagnée des dames de la ville en deuil.
Les cérémonies s’achèveront le samedi sur la Place d’Armes par une messe dans la cathédrale, suivi d’un lâcher de taureaux.
Coutume de Pâques Mille légendes, croyances ...
Le carême a donné des expressions amusantes : Face de carême : face amaigrie Tomber comme mars en carême : arriver inévitablement Semaine Sainte :
Le carême est une coutume religieuse des Chrétiens catholiques et orthodoxes.
Pour cela, ils font pénitence et jeûne, pour expier leurs péchés.
La tradition chrétienne a repris cette pratique pendant le temps du Carême : 40 jours de privation pour se purifier et aller vers la lumière.
Le mercredi des Cendres est le symbole des cendres qui dans la bible évoque le péché.
Les croyants demandent à Dieu le pardon de leurs péchés en faisant pénitence.
Les cendres que l'on utilise pour la célébration sont faites en brûlant les rameaux bénis de l'année précédente.
Le soir, dans les maisons, on nettoyait soigneusement la batterie de cuisine, car on ne devait pas utiliser de graisse jusqu’à Pâques.
Le Carême dans la tradition Catholique est aussi en souvenir d'Adam condamné "à retourner poussière" après son péché. Le Dimanche des Rameaux : C'est le dimanche qui précède celui de Pâques. Ce jour célèbre l'arrivée de Jésus monté sur un âne et entrant à Jérusalem, ses disciples l'ayant accueilli en parsemant des branches d'olivier à ses pieds comme tapis.
De nos jours, les catholiques vont à l'église ce jourlà pour faire bénir leurs rameaux qui sont souvent des branches de buis, en les accrochant au crucifix, ils pensent se protèger du mal pour l'année...
Le Jeudi Saint : Les catholiques célèbrent le souvenir de la Cène, qui donna lieu à de fabuleux tableaux, voir la peinture de Léonard de Vinci, réalisée de 1494 à 1498 pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan et qui était considérée jusqu'au milieu du XIXe siècle comme son chef-d'œuvre.
La Céne reproduit le dernier repas de Jésus, avec ses apôtres.
Le Vendredi Saint :est célébré cinq jours après le Dimanche des Rameaux. C'est un jour sombre, car Jésus a été crucifié ce jourlà.
C’est un jour férié dans de nombreux pays.
En Espagne, au Mexique et dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud, on organise des parades tous les jours de la semaine Sainte, celle du Vendredi Saint étant la plus triste. Les Mexicains punissent Judas pour sa trahison en pendant et brûlant sa représentation.
Chaque année la police de ces pays particulièrement religieux découvre des victimes de leur propre foi et qui sous l'effet d'un mysticisme excessif se font crucifiés avec des clous comme selon le fut Jésus, les croyances
Dimanche de Pâques : Pâques vient de "Pessah" en hébreu, du grec "paskha" signifiant passage.
La Pâque Juive célébre la libération des juifs et leur sortie d'Egypte.
Dans le christianisme, c’est ce dimanche de pâques, selon la croyance, que les disciples de Jésus découvrirent qu'il était ressuscité. C'est là, une promesse de vie nouvelle qui s’ouvrait à tous ceux qui auraient foi en lui.
Pâques fut aussi très longtemps une fête païenne universelle qui annonce l'éveil du printemps. Le retour à la vie
Lundi de Pâques : Le lundi de Pâques est dit jour humide par référence à certaines coutumes où l'eau était très présente, les jeunes filles étaient aspergées d'eau en signe de bonheur.
L'eau est associée au Lundi de Pâques depuis longtemps.
Jadis, on disait que les jeunes filles qui se lavaient le visage avec de l'eau de source ou de la rosée devenaient plus jolies ! Ou que boire l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau au lever du soleil le matin de Pâques avait des vertus thérapeutiques... Les traditions dans divers pays : Aujourd'hui, on cache les œufs en chocolat un peu partout pour que les enfants aillent les dénicher le matin de Pâques.
Les enfants d'Angleterre et de Hollande vont de maison en maison en quête d'œufs.
Les petits allemands eux, s'échangent des œufs mais aussi des lapins en chocolat.
En Italie, on sème du blé dans une coquille d'œuf le premier jour du Carême. Le blé en herbe aura rempli la coquille à Pâques, symbole de renouveau.
Faire ses Pâques : L'expression Faire ses Pâques signifie communier au moins une fois dans l'année.
Pâques est non seulement une fête joyeuse, mais c'est aussi une fête de famille.
L’agneau de Pâques : Dans la plupart des pays européens : France, Belgique, Allemagne, Italie, Grèce, Pologne, Norvège etc. , l'agneau, agneau pascal, est l'une des pièces maîtresse du repas du dimanche de Pâques.
Il rappelle l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour le Salut du monde.
L'agneau pascal en Allemagne et en Alsace désigne un biscuit en forme d'agneau décoré d'un étendard, un ruban autour du cou.
Dans divers pays : On mange des gâteaux en forme de colombes comme en Italie On décore les maisons pour la fête de Pâques.
En Allemagne On accroche des oeufs aux branches d'un arbuste, en Allemagne et en angleterre On mange du jambon.
En Angleterre On danse dans les rues ;
On fait les décorations en jaune, dans les pays scandinaves.
Les enfants se déguisent en sorcières la veille de Pâques, en Finlande et en Suède.
En Pologne, on asperge d'eau la famille et les amis et on asperge les champs d'eau bénite.
En Russie, on dépose des oeufs sur les tombes des parents au cimetière.
Le lys de Pâques : Une fleur originaire du Japon. Le lys est la fleur le plus souvent associée à Pâques et à l'arrivée du printemps. C’est aussi un symbole de pureté et de sainteté. Une vieille légende nous apprend que quand Jésus passait, toutes les plantes et les animaux de la terre inclinaient la tête en signe de respect. Sauf le lys, trop orgueilleux, qui se pensait beaucoup trop beau. Mais quand il vit Jésus sur la croix, le lys courba la tête pour la première fois. Et on dit que depuis ce jour, le lys a toujours la tète inclinée en guise de respect éternel.
En Angleterre on déguste le jambon de Pâques, il y a longtemps que l’on commença à manger du jambon le Dimanche de Pâques. Aujourd’hui cette coutume s’est répandue à travers le monde.
Dans plusieurs pays le porc est un symbole de chance.
Encore de nos jours les Allemands se souhaitent Bonne chance en dit " Schwein haben" expression signifiant : "Aie un cochon". Les Allemands croient que posséder un cochon porte chance.
Les brioches du carême : Dans plusieurs pays, on mange les brioches de Pâques, aussi appelées "Hot cross buns". C'est le seul temps de l'année où l'on peut se procurer ce genre de pâtisserie. Elles sont caractéristiques puisque la brioche est marquée d'une croix en sucre sur le dessus. C’est à un moine que l’on doit ces petits pains car il en fabriquait pour les donner aux pauvres en temps de carême.
Elles sont supposé apporter la santé tout au long de l'année à ceux qui les mangent.
Les vêtements neufs : A l'origine, une des premières raisons qu'avaient les gens de porter de nouveaux vêtements à Pâques était qu'ils en avaient assez des vêtements portés depuis le début de l'hiver. Les couleurs vives remplaçaient les couleurs ternes de l'hiver. Certains croyaient que de porter un nouveau vêtement la journée de Pâques, leur porterait chance tout au long de l'année.
L'arbre de Pâques : La coutume de l'arbre de Pâques nous vient d'Allemagne. Cet arbre est décoré à l'aide d'Oeufs décoré et peints de couleurs vives.
Pour cela il faut tout d'abord pour vider l’œuf, on perce un trou à chaque extrémité de la coquille, on le vide en soufflant par le trou, la coquille sera décorée de différentes couleurs pour ensuite être accrochée à l'arbre. Les petits poussins : Évidemment, les petits poussins sont le symbole d'une vie nouvelle.
Il y a très longtemps, certaines personnes trouvaient très surprenant de voir ces petits êtres vivants sortir d'un oeuf qu'il croyait mort.
La brebis de Pâques. La brebis a toujours eu une consonance religieuse et a depuis le commencement des temps représenté la pureté et l'innocence. Il y a très longtemps, la brebis était porteuse de chance.
Il existait une superstition à l'effet que le diable pouvait prendre la forme de n'importe quel animal à l'exception de la brebis.
Les oeufs de pâques
Le lundi de Pâques, la chasse aux œufs en chocolat s’est imposée comme une tradition qui puise ses origines dans l’Antiquité
On les voit fleurir au petit matin dans nos jardins. Bleus, verts, rouges, roses… Les œufs de Pâques colorent notre lundi et ravissent les enfants qui les chassent. Mais d’où vient cette tradition ?
Une coutume qui remonte à l'antiquité
L’œuf cosmique est un motif que l’on retrouve dans de nombreux récits mythologiques de diverses civilisations. Des coquilles d’œufs d’autruche vieux de 60 000 ans décorés de motifs animaliers, géométriques ou végétaux, ont été retrouvées dans des tombes en Égypte et en Afrique Australe.
Dans ces antiques théogonies, dont la plus ancienne retrouvée à ce jour se trouve être les écrits sacrés de l’Inde en Sanskrit, l’œuf est évoqué pour désigner l’univers, le cosmos, le fœtus doré ou encore l’Utérus d’or.
En somme, il est symbole d’origine du monde, de fécondité, et de perpétuité des êtres. Le judaïsme le voit encore aujourd’hui comme un emblème du cycle de la vie, perpétuant cette croyance en faisant de l’œuf dur le met principal du repas de deuil. Dans la mythologie chinoise, l’univers est perçu sous forme d’œuf, que le dieu Pangu brisa en deux, créant ainsi le ciel et la terre. Les exemples sont nombreux : l’œuf a toujours tenu une grande place symbolique dans les mysticismes.
Le christianisme et l'oeuf rouge
Une légende orthodoxe raconte que Marie de Magdala serait allée rapporter la résurrection de Jésus à l’empereur Tibère, et, devant son scepticisme, l’œuf qu’elle tenait en main serait devenu rouge.
Mais ce n’est qu’au XIIIe siècle que les œufs peints en rouge vif firent leur réelle apparition en Europe. Leur décoration commence le jeudi Saint – jeudi 17 avril cette année – le premier œuf peint devant être pondu ce jour. Rouges et décorés de devises ou de dessins, on se les échangeait pour fêter la fin du Carême et des privations de l’hiver.
À la Renaissance, l’œuf rouge est remplacé par l’œuf en or, notamment dans les cours des souverains européens. Décorés de métaux précieux, dont les motifs étaient parfois même réalisés par de grands peintres, ces objets connurent leur apogée avec les célèbres œufs de Fabergé à la cour de Russie, à la fin du XIXe.
Outre la fête religieuse, les œufs de Pâques seraient également des étrennes – des cadeaux que l’on s’offre en début d’année. Jusqu’à Charles IX, qui décida de faire commencer l’année le premier janvier, l’année débutait aux alentours du premier avril, lorsque le printemps revenait. Les œufs incarnaient l’équinoxe du Printemps et l’éveil de la nature.
Aujourd'hui les oeufs sont en chocolat
Les chocolatiers du XIXe siècle se sont emparés de la tradition, au moment de la démocratisation du cacao et du chocolat.
Les Frères Fry découvrent qu’en mélangeant du sucre, du beurre de cacao et du chocolat en poudre, on obtient une pâte malléable que l’on peut verser dans des moules.
L’œuf en chocolat est né. Peu à peu, on assimile l’œuf à la poule en réalisant des statuettes, et les progrès techniques en matière de moules permettent aujourd’hui une grande variété de sculptures en chocolat.
La chasse aux œufs puiserait quant à elle sa source en Alsace, Allemagne, Suisse et Autriche, où ce serait le lièvre de Pâques qui déposerait les œufs dans les jardins.
La référence à la fécondité est encore présente dans cette tradition, le lapin étant très prolifique au printemps. Selon les régions en France, l’histoire diffère : ce sont soit les cloches de Pâques, soit le Lapin de Pâques qui déposent les œufs.
Mais peu importe qui les a cachés, quand ils sont dans les jardins, les enfants partent à leur recherche avec enthousiasme, et les gourmands n’attendent qu’une chose : les croquer.
Conte pour petits et grands mangeurs d'oeuf en chocolat
Le secret des oeufs de Pâques
Il était une fois un petit pays tranquille où, lorsque le printemps s'annonçait, les gens, dans chaque village, organisaient un grand marché. Ils enfilaient leur costume de fête et s'installaient sur la place principale pour vendre ce qu'ils avaient produit de meilleur ou de plus beau :
des couronnes de brioche ou de pain doré, des oeufs, des outils de bois sculpté, des ceintures de cuir ...
La nature elle-même participait à l'événement. Les pommiers s'habillaient de blanc, les papillons défroissaient leurs ailes et les fleurs leurs pétales.
Un jour, au centre d'un de ces villages, comme d'habitude à cette époque, des fermières comparaient les oeufs de leur poulailler. C'était à qui aurait les plus gros, les plus ronds ou les plus blancs.
Seule une vieille femme se taisait. Elle ne possédait pour toute fortune qu'une petite poule maigrichonne qui ne lui avait donné que trois petits oeufs pas plus gros que des billes.
La vieille femme soupirait :
Je suis pauvre, ma poulette, que je t'ai mal nourrie et que tes oeufs sont tout juste bons à offrir aux enfants pour jouer aux billes.
Comme il faut cependant que je vende quelque chose afin de gagner quelques sous, c'est toi que je vais être obligée de mettre à l'étalage...
A ces mots, la petite poule se mit à crier :
Pitié, ma bonne dame ! Je ne veux pas finir rôtie. Si vous me gardez, je vous promets de pondre l'année prochaine les oeufs les plus extraordinaires !
La vieille femme n'en crut rien, mais elle se laissa attendrir et rentra chez elle avec sa poulette. Une année passa. Et la vieille femme, de plus en plus pauvre, n'avait que quelques poignées de riz à donner à sa petite poule en guise de nourriture.
Le jour du marché approchait et la petite bête dépérissait.
Elle comprit qu'elle ne pouvait pondre des oeufs plus gros que ceux de l'an passé et, désespérée, elle alla se cacher dans un champ pour se lamenter :
Que vais-je devenir si je ne suis pas capable de donner à ma maîtresse que trois petits oeufs tout juste bons à offrir aux enfants pour jouer aux billes ? Cette fois, elle sera forcée de me vendre, et je finirai dans l'assiette d'un gros fermier!
Toute à sa peine, elle ne se rendit pas compte que les fleurs et les papillons l'écoutaient.
Nous ne laisseront pas faire cela ! chuchotèrent-ils.
A la nuit tombée, les fleurs se couchèrent sur le sol, formant une sorte de litière multicolore au creux de laquelle se blottit la petite poule. Puis les papillons étendirent leurs ailes sur elle comme une couverture bruissante et bariolée.
Au matin, lorsqu'elle se réveilla, la poulette se sentit fraîche, dispose, et même si ragaillardie qu'elle se mit à chanter et pondit une demi-douzaine d'oeufs.
Et ces oeufs-là n'étaient pas ordinaires ! Ils n'étaient toujours pas bien gros, mais ils possédaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et même, à y regarder de près, on pouvait voir sur leur coquille de très jolis dessins comme on peut en admirer sur les ailes des papillons.
Toute heureuse, la petite poule courut chercher sa maîtresse. Celle-ci examina les oeufs un par un avant de les ranger dans son tablier :
Tu as tenu ta promesse. Ce sont bien les oeufs les plus extraordinaires que l'on puisse voir ! J'ai eu raison de ne pas te vendre !
Le jour du marché, les oeufs de la vieille femme attirèrent les curieux. On se bouscula pour les acheter et la pauvre fermière récolta plus de pièces d'argent qu'elle n'en avait jamais eues dans sa vie.
Depuis ce jour, chaque année, dans ce petit village, puis dans tout le pays, et même dans les contrées voisines, les gens essayèrent de copier les oeufs de la vieille dame en peignant et décorant les leurs. Mais ils ne réussirent jamais à les égaler en couleurs et en délicatesse, car la petite poule, les fleurs des champs et les papillons gardèrent bien leur secret.
C'est ainsi que, chaque année, lorsque s'annonce le printemps, on prit dans ce petit pays et ensuite dans le monde entier l'habitude de décorer les oeufs ....
Conte tiré de "Milles ans de contes" Histoires d'animaux, texte de Claude Clément
Le lundi de Pâques, la chasse aux œufs en chocolat s’est imposée comme une tradition qui puise ses origines dans l’Antiquité
On les voit fleurir au petit matin dans nos jardins. Bleus, verts, rouges, roses… Les œufs de Pâques colorent notre lundi et ravissent les enfants qui les chassent. Mais d’où vient cette tradition ?
Liens
http://youtu.be/7ePnSdONuQk La pâque juive "Passa'h"
http://youtu.be/qprAxp2-IyM Les pâques chrétienne
http://youtu.be/xv3cb_DD5XM L'agneau pascal
http://youtu.be/wrIq6Uz7sf4 D'ou vient le lapin de pâques ?
http://youtu.be/xNqYuQEtHiw D'où viennent les oeufs de pâques ?
http://youtu.be/FmRixqFEQo4 D'où viennent les cloches de pâques ?
http://youtu.be/BakBWele2wY Les chocolats de Pâques ?
http://youtu.be/4ySMKwOoEcw Coutume au Mexique
http://youtu.be/q30yN_gIs94 Crucifixion aux Philippine (les fous ne sont pas tous enfermés)
http://youtu.be/Tn_onfSqGD0 Crucifixion à St Fernando excès quui se reproduisent tous les ans
http://youtu.be/bKn1ECnEKBw Cloches de la cathédrale de Perpignan
http://youtu.be/zAu3UnA5zVY Nouvelles cloches de Notre Dame de Paris
http://youtu.be/u8cJRIud0KE Grand solennel de cloches de Notre Dame de Paris
Posté le : 18/04/2014 19:42
Edité par Loriane sur 20-04-2014 16:14:03
Edité par Loriane sur 20-04-2014 16:17:46
|
|
|
|
|
Re: Gary Kasparov |
|
Plume d'Argent  
Inscrit:
02/03/2014 16:08
Niveau : 19; EXP : 17
HP : 0 / 454
MP : 142 / 13718
|
Bonjour, j'ai l'occasion de temps en temps de faire une partie ou deux avec des amis , juste pour le plaisir, mais là nous sommes devant un monument une vraie légende de ce jeu (qui mets parfois à rude épreuve nos petites cellules grises ). Vraiment du lourd Mr Kasparof
Posté le : 13/04/2014 09:34
|
|
|
|
|
Gary Kasparov |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 avril 1963 à Bakou RSS d'Azerbaïdjan, URSS naît
Garry ou Garri ou Gary Kimovitch Kasparov
en russe : Гарри Кимович Каспаров, joueur d'échecs russe. Champion du monde d'échecs de 1985 à 2000 et vainqueur de nombreux tournois, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec Bobby Fischer, Emanuel Lasker, José Raul Capablanca, Alexandre Alekhine et Anatoli Karpov. Il est le premier joueur à avoir dépassé les 2 800 points Elo en janvier 1990 et a obtenu le classement Elo le plus élevé jamais enregistré avec 2 851 points en juillet 1999 et janvier 2000, un record finalement battu 13 ans plus tard par Magnus Carlsen.
Kasparov a, depuis 2005, renoncé à reconquérir son titre de champion du monde perdu en 2000 et à s'imposer face aux nouvelles générations de joueurs de plus en plus jeunes, pour s'engager de toutes ses forces en politique dans l'opposition à Vladimir Poutine et se consacrer à la rédaction de ses trois séries de livres sur les échecs : My Great Predecessors 2003-2006, Garry Kasparov on Modern Chess 2007-2010 et Garry Kasparov on Garry Kasparov 2011. Celui qui s'engage en poitique fut sucessivement, Grand maître international en 1980, Champion du monde junior en 1980, Champion d'URSS de 1981 à 1988, Champion du monde d'échecs de 1985 à 2000, Oscar des échecs de 1982 à 1983, de 1985 à 1996, de 1999, de 2001 à 2002, Champion de Russie en 2004
Garik Kimovitch Vaïnstein transcription allemande : Weinstein est né le 13 avril 1963 d'un père juif, Kim Moïssevitch Vaïnstein ou Weinstein et d'une mère d'origine arménienne du Haut-Karabagh, Klara Chaguenovna Kasparova. Ses parents s'étaient rencontrés au laboratoire industriel de Bakou en Azerbaidjan où ils travaillaient comme ingénieurs. Le père de Garik était issu d'une famille de musiciens. Le père de Kim, Moïsseï, mort en 1963 était un compositeur et chef d'orchestre.
Le frère cadet de Kim Vaïnstein, Léonide Vaïnstein, était compositeur en Azerbaïdjan. Le père de Garik, opposé à ce qu'il apprenne la musique, lui apprit les échecs lorsqu'il eut cinq ans. Il lui donna également le goût de la géographie. La mère de Garik lui transmit sa passion pour l'histoire.
Son père tomba malade pendant l'été 1970 et mourut en 1971, à l'âge de trente-neuf ans, du lymphome de Hodgkin. La mère de Garik ne l'emmena pas à l'enterrement et Garik raconta à son école que son père était parti en voyage d'affaires. Son grand-père maternel, Chaguen, un ouvrier du pétrole et fervent communiste, prit sa retraite en 1971 et s'occupa de Garik. Ils eurent ensemble de nombreuses conversations sur le régime soviétique. En 1975, Garik prit le nom de sa mère, qui avait gardé son nom lors du mariage en russifiant son nom, devenant Garri ou Garry Kasparov.
En janvier 1990, Kasparov fut victime des pogroms anti-arméniens de Bakou du 13 au 16 janvier et contraint de fuir la capitale azérie, comme des milliers d'autres personnes d'origines arméniennes, en direction de l'Arménie16.
Garri Kasparov a trois enfants : Polina (née en 1993 de sa première épouse, Macha – Maria Arapova – épousée le 3 mars 1989, Vadim, né en 1997, de sa deuxième épouse Julia et Aida, née en 2006, de sa troisième épouse Daria.
Carrière aux échecs, Débuts et formation aux échecs
Garik Vaïnstein avait appris à jouer aux échecs par son père, qui n'avait pourtant jamais été un joueur intéressé, tandis que sa mère était très douée. En septembre 1970, la mère de Kasparov était à Moscou, où son père était hospitalisé. Les oncles de Garik, Léonide Vaïnstein et Konstantin Grigorian, l'inscrivirent et l'emmenèrent au cercle d'échecs du Palais des pionniers de Bakou. À la fin de l'année, Kasparov atteignait le grade de joueur de troisième catégorie. En 1972, il donna une partie simultanée contre des ouvriers du pétrole de Bakou. En juin 1972, il atteignit la phase finale du championnat de blitz adulte de Bakou. Il avait marqué neuf points sur neuf dans le tour préliminaire. En conséquence de ce résultat, Garik reçut le grade de joueur de première catégorie à neuf ans20. En janvier 1973, il termina troisième du championnat junior de Bakou. En mars 1973, il marqua quatre points sur quatre lors d'une tournée de l'équipe junior d'Azerbaïdjan en Lettonie et Estonie. En juillet 1973, il participa aux Jeux soviétiques de la jeunesse à Vilnius où il fut remarqué par Alexandre Nikitine qui avait été désigné au début de l'année, entraîneur de l'équipe nationale d'échecs par le Comité d'État aux sports.
Kasparov à l'issue du championnat du monde junior en 1980.
En août 1973, Nikitine recommanda Kasparov à Mikhaïl Botvinnik, qui avait décidé, après trois ans d'interruption, de rouvrir l'école Botvinnik, la meilleure école de formation aux échecs d'URSS. Kasparov suivit les cours de Botvinnik, ancien champion du monde, de Nikitine, et de Mark Dvoretski, spécialiste des fins de parties. D'autres maîtres ont contribué à sa formation comme Alexandre Ivanovitch Chakarov, entre autres dans le domaine des ouvertures. Au fil des années, lors de ses passes d'armes pour le championnat du monde, il sera aidé d'une équipe de secondants comme Iossif Dorfman, Zurab Azmaiparashvili, Sergueï Dolmatov, Ievgueni Vladimirov et Iouri Dokoyan.
Changement de nom 1974-1975
En 1975, toujours sous le nom de Vaïnstein, Garik termina septième du championnat d'URSS junior, joueurs de moins de 18 ans. Le changement de nom en Garri Kasparov intervint en août 1975, lors d'un conseil des familles Vaïnstein et Kasparov. La décision revint à la mère de Kasparov, Klara Kasparova, mais c'est l'entraîneur Nikitine qui défendit le changement dans l'intérêt de la carrière de Garri qui pourrait être freinée à cause d'un mauvais nom (origine Juive) . Dès 1974, avec l'accord de Botvinnik, Garik avait commencé à en parler avec sa mère. En 1975-1976, les relations entre Israël et l'URSS étaient rompues. En 1976, l'URSS boycotta l'olympiade d'échecs de Haïfa, alors qu'elle avait envoyé son équipe à Tel Aviv en 1964.
Premiers succès en URSS 1975-1978
En octobre-novembre 1975, Garri, sous son nouveau nom, remporta la coupe de la ville de Bakou adultes et sa victoire fut relayée par l'hebdomadaire de Moscou, 64. En novembre 1975, Kasparov rencontra pour la première fois le nouveau champion du monde Anatoli Karpov alors âgé de 24 ans lors d'un tournoi de parties simultanées à Moscou. Karpov remporta la partie. En 1976 et 1977, Garri Kasparov devint le plus jeune champion d'URSS junior de l'histoire et fut envoyé en France pour disputer les premiers championnats du monde cadets moins de seize ans. Ce furent ses premiers voyages en dehors de l'URSS.
En janvier-février 1978, Kasparov remporta le mémorial Sokolski à Minsk, puis le tournoi de sélection de Daugavpils et il se qualifia pour la finale du championnat d'URSS adultes où il termina neuvième à Tbilissi.
Un goût acharné pour le travail, un don combinatoire et une mémoire sidérante transforment vite Garry Kasparov en un prodige des échecs. Il n'a que treize ans lorsqu'il gagne pour la première fois le championnat d'U.R.S.S. juniors, face à des adversaires plus âgés que lui. En 1979, à Banja-Luka Yougoslavie, il remporte son premier tournoi de grands maîtres alors que lui-même ne se verra accorder ce titre que l'année suivante, en devenant champion du monde junior. Les victoires se succèdent dans un style flamboyant. Kasparov est un attaquant-né, n'aimant rien tant que les positions dynamiques qu'il peut faire exploser grâce à des sacrifices calculés avec une précision confondante. Allié à un charisme et à une fougue rares dans ce milieu, ce style spectaculaire fait de Kasparov l'exact opposé de celui qui, depuis 1975, détient le titre de champion du monde, Anatoli Karpov né en 1951, incarnation de l'apparatchik soviétique.
L'affrontement entre les deux hommes est inéluctable tant ils dominent les soixante-quatre cases. La saga des rencontres Karpov-Kasparov va entrer dans la légende des échecs. Même si tous deux sont membres du Parti communiste, le premier représente le système tandis que le second préfigure la perestroïka de l'ère Gorbatchev. Leur première confrontation débute à l'automne de 1984, à Moscou. Le règlement prévoit que le vainqueur sera le premier à totaliser six victoires. Kasparov, fidèle à lui-même, part baïonnette au canon à l'assaut de la forteresse Karpov et se brise contre le jeu glacé du champion du monde.
Le challenger est dominé. Cinq défaites à zéro. Alors, l'Azerbaïdjanais joue la prudence et attend, accumulant les parties nulles. Face à lui, Karpov, dont le point faible a toujours été une constitution physique frêle, s'épuise et ne parvient pas à arracher le point décisif. Il s'étiole et Kasparov revient à la marque : 5-1, 5-2, 5-3. C'est à ce moment que le Philippin Florencio Campomanes, président de la Fédération internationale des échecs F.I.D.E., voyant Karpov tituber comme un boxeur au bord du K.O., arrête et annule le match, au mépris de toute éthique sportive, le 15 février 1985, après la 48e partie. La nouvelle finale se jouera au meilleur des 24 parties, un changement de règlement censé favoriser Karpov. Mais Garry Kasparov, moins téméraire, ne répète pas ses erreurs et, le 9 novembre 1985, à vingt-deux ans, devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. Par trois fois, en 1986, 1987 et 1990, Karpov revient à la charge ; par trois fois son cadet lui résiste.
Le Mur de Berlin tombe, l'U.R.S.S. l'imite. Garry Kasparov devient russe, ambassadeur planétaire des échecs et homme d'affaires. En 1993, il claque la porte de la F.I.D.E. pour fonder sa propre organisation, la Professional Chess Association P.C.A., qui vise à professionnaliser la discipline à l'instar d'autres sports. Avec le soutien de la firme Intel, la P.C.A. lance un circuit de compétitions richement dotées, dont certaines se jouent sur un rythme rapide, adapté à la télévision. En 1993 et en 1995, cette structure organise deux championnats du monde, au cours desquels Kasparov triomphe respectivement du Britannique Nigel Short et de l'Indien Viswanathan Anand.
Véritable modernisateur du jeu des rois, Kasparov va aussi passer à la postérité pour ses matches médiatiques contre le super-ordinateur d'I.B.M., Deep Blue. Le Russe gagne une première confrontation en 1996 en mettant en évidence certains défauts de la machine mais perd la revanche l'année suivante, pour des raisons plus psychologiques qu'échiquéennes. Avec cette retentissante défaite, quelque chose s'est cassé dans la belle mécanique Kasparov, même s'il survole encore les tournois auxquels il participe. Son prodigieux ego l'a progressivement coupé du reste de la famille des échecs. Intel cesse son partenariat avec la P.C.A., qui disparaît ; son site Internet fait faillite. En 2000, remettant une nouvelle fois son titre en jeu face à son compatriote et ancien disciple Vladimir Kramnik, il perd deux parties sans en gagner aucune, cédant sa couronne quinze ans presque jour pour jour après l'avoir conquise.
Pour la plupart des observateurs, il n'en demeure pas moins le numéro un. Divisé, comme la boxe, en championnats concurrents, le monde des échecs attend de Garry Kasparov un retour au sommet qui réunifierait les titres. Mais le 10 mars 2005, remportant ce jour-là, pour la neuvième fois, le tournoi espagnol de Linares, le Russe annonce sa retraite à la surprise générale : il va se consacrer à son autre passion, la politique. En juin naît le Front civique unifié qui se propose de restaurer la démocratie électorale en Russie. Un an plus tard, le mouvement contribue à fonder L’Autre Russie, coalition d’opposants à Vladimir Poutine. Plusieurs marches et manifestations se succèdent en 2007, qui valent à Garry Kasparov deux courts séjours en prison. Désigné pour représenter la coalition à l’élection présidentielle de 2008, celui-ci renonce toutefois à se présenter, dénonçant les obstacles suscités par le pouvoir contre sa candidature.
Premiers succès internationaux 1979-1983
En 1979, à l'âge de 16 ans et encore inconnu en Occident, Kasparov remporte son premier tournoi international de grands maîtres à Banja Luka en Yougoslavie, terminant invaincu avec 11,5 points sur 15 devant de grands noms de l'époque comme l'ancien champion du monde Tigran Petrossian, András Adorján, Jan Smejkal et Ulf Andersson.
En juillet, il obtient son premier classement Elo international, 2545, ce qui le place au 38e rang mondial.
En 1980, il remporte le championnat du monde junior et obtient le titre de grand maître international ; l'année suivante, en décembre 1981, il remporte le championnat d'URSS ex æquo avec Lev Psakhis. En 1982, il sort vainqueur du tournoi international de Bugojno et de l'interzonal de Moscou et entre ainsi dans le cycle des candidats au championnat du monde. Dans ce cycle, en 1983, il élimine Aleksandr Beliavski (+4 -1 =4) en quart de finale.
En 1983, la demi-finale des candidats contre Viktor Kortchnoï aurait dû se dérouler initialement à Pasadena en Californie sous les auspices de la FIDE. Cependant, les autorités soviétiques refusèrent de laisser Kasparov se rendre aux États-Unis et la FIDE le déclara perdant par forfait. Le président de la FIDE, le Philippin Florencio Campomanes, parvint cependant à organiser le match à Londres, avec l'accord de Kortchnoï qui obtint la fin du boycott organisé par la fédération soviétique et dont il faisait l'objet depuis sa défection en 1976. À Londres, Kasparov élimine Kortchnoï (+4 –1 =6), puis, à Vilnius dans la finale disputée en 1984, l'ancien champion du monde de 1957, Vassily Smyslov (+4 –0 =9).
En janvier 1984, Kasparov occupe la première place au classement Elo, devant le champion du monde Anatoli Karpov.
Kasparov dispute son premier championnat du monde en 1984 à Moscou contre Anatoli Karpov, le champion du monde en titre depuis 1975. Après 5 mois et 48 parties, aucun des deux joueurs ne parvenant à obtenir les 6 victoires nécessaires, ce match interminable est finalement interrompu par la Fédération internationale des échecs FIDE pour préserver la santé des joueurs . Cette interruption est critiquée par Kasparov alors qu'il était mené 5-3 après avoir été mené 5-0. Les éditions ultérieures prévirent un maximum de 24 parties.
C'est en 1985, lors du deuxième match contre Karpov, qu'il devient champion du monde, à l'âge de 22 ans sur le score de 13-11 (+5 =16 -3).
Défense du titre mondial 1986-1990
Championnat du monde d'échecs 1986, Championnat du monde d'échecs 1987 et Championnat du monde d'échecs 1990.
Après le match de 1985, Karpov avait droit à un match revanche l'année suivante. Kasparov conserva son titre (+5 =15 –4), toujours contre Karpov, en 1986 lors du championnat disputé dans deux villes : la première moitié à Londres et la fin à Léningrad.
En 1987, Karpov remporta la finale du tournoi des candidats. À la fin de l'année, les deux adversaires disputèrent leur quatrième match en quatre ans à Séville. Kasparov égalisa (+4 =16 –4) lors de la vingt-quatrième et dernière partie. Selon les conditions du match, en cas d'égalité au score (12–12) le champion du monde conservait son titre.
Trois ans plus tard, en 1990 à New York et Lyon, Kasparov retrouvait Karpov. Deux parties avant la fin du match, Kasparov était sûr de conserver son titre. Les deux dernières parties furent disputées pour décider la répartition des prix, score final : 12,5–11,5 (+4 =17 –3).
Victoire dans la coupe du monde GMA 1988-1989
En 1986, Kasparov estime que les intérêts des joueurs professionnels ne sont pas défendus au sein de la FIDE, et crée alors avec l'homme d'affaires et mécène néerlandais Bessel Kok une association de joueurs professionnels de haut niveau, la GMA Grand Master Association ; celle-ci organise entre 1988 et 1990 des compétitions prestigieuses comme les six tournois de la coupe du monde GMA 1988 — 1989, remportée par Kasparov. Des dissensions internes au sein de l'association, le retrait du principal sponsor, Bessel Kok, et la création de la PCA Professional Chess Association eurent raison d'elle au début des années 1990.
Coupe du monde GMA.
Scission avec la FIDE 1993-1995
Articles détaillés : Championnat du monde d'échecs 1993 classique et Championnat du monde d'échecs 1995 classique.
En 1993, Kasparov fonde la Professional Chess Association PCA avec le vainqueur du tournoi des candidats FIDE, le Britannique Nigel Short31. En septembre, la PCA organise à Londres un championnat du monde dit classique » en se revendiquant de la tradition commencée par Wilhelm Steinitz.
En septembre 1993, Kasparov l'emporte sur Short par le score de 12,5 à 7,5 (+6 =13 –1) dans le cadre d'un Championnat du monde organisé par la PCA, organisme non reconnu par la FIDE, ce qui lui vaut une exclusion provisoire.
Kasparov face à Anand en 1995
La FIDE ne reconnaît pas ce match et considère que les deux joueurs se sont exclus du cycle du championnat du monde ; elle organise un match entre Anatoli Karpov et Jan Timman pour le titre de Champion du monde FIDE. C'est le début d'un schisme qui dura jusqu'en 2006. Kasparov admit plus tard que cette séparation d'avec la FIDE était une grave erreur.
La FIDE exclut brièvement Kasparov et Short du classement Elo à titre de représailles mais les réintègre avant la fin de l'année 1993.
En 1995, Kasparov conserve son titre de champion du monde PCA en battant l'Indien Viswanathan Anand au World Trade Center à New York 10,5 à 7,5 (+4 =13 –1).
À la recherche de sponsors 1996–1999
À la suite du retrait du sponsor principal de la PCA en 1996 (Intel), l'organisation du championnat du monde est transférée à l'éphémère World Chess Council en 1998 ; les droits furent ensuite revendus à une organisation privée, Brain Games Network en 2000, puis rachetés en 2002 par le Einstein Group et finalement transférés à Dannemann en 2004.
En 1998, Alekseï Chirov bat Vladimir Kramnik dans un match de 10 parties (+2 –0 =7), mais Kasparov estime qu'il n'est pas possible de trouver de sponsor pour un match contre Chirov (dont le score contre Garry Kasparov est très mauvais) en raison du peu de suspense lié à un tel match.
En juillet 1999, après ses victoires à Wijk aan Zee janvier, Linares février-mars et Sarajevo mai, Kasparov atteint un classement Elo record avec 2 851 points qui ne seront dépassés qu'en janvier 2013 par le Norvégien Magnus Carlsen. Indépendamment du titre de champion du monde, il est resté no 1 mondial au classement Elo de la FIDE de 1984 jusqu'à sa retraite en 2005, soit pendant plus de 20 années consécutives, partageant seulement la première place avec Vladimir Kramnik au classement de janvier 199632. Il a été surnommé l'ogre de Bakou et le monstre aux cent yeux qui voient tout.
Kasparov contre le monde.
De juin à octobre 1999, Kasparov joua une partie via Internet contre le reste du monde, au rythme de un coup par jour. Face à lui, 50 000 joueurs de 75 pays, conseillés par quatre joueurs professionnels, dont le Français Étienne Bacrot. Il gagna en 62 coups.
Perte du titre mondial 2000
Championnat du monde d'échecs 2000 classique.
En 2000, Kasparov remporta une deuxième fois consécutivement les tournois de Wijk aan Zee, de Linares ex æquo avec Kramnik et de Sarajevo sans perdre une partie. Après avoir annoncé un match contre Anand en 1999, c'est finalement contre Kramnik qu'il défend son titre de champion du monde en 2000 à Londres. Kasparov perd ce match +0 –2 =13
Après sa défaite, en 2000, Kasparov multiplie les victoires en tournoi, malgré des contre-performances au tournoi de Linares où il est devancé pour la première place par Kramnik ou Lékó en 2003 et 2004. Entre 2000 et 2005, les diverses tentatives pour réunifier le titre mondial dont la plus sérieuse est l'accord de Prague en 2002 ou d'organiser un match-revanche contre Kramnik échouent.
Retraite des échecs depuis 2005
Le 11 mars 2005, après avoir gagné le prestigieux tournoi de Linares pour la neuvième fois de sa carrière, Kasparov annonce qu'il se retire du monde des échecs professionnels. Son nom a été rayé du classement Elo en avril 2006 suite à une inactivité de plus d'un an, comme le veut le règlement FIDE.
Kasparov a également écrit une autobiographie Et le fou devint roi 1987)= et plusieurs ouvrages échiquéens dont la série de livres My Great Predecessors Sur mes grands prédécesseurs, en cinq tomes 2003-2006 et la série Kasparov on Modern Chess Sur les échecs modernes, quatre tomes parus de 2007 à 2010.
En 2008 durant le Corsican Circuit, il affronte cinq joueurs corses en simultanée et gagne 5-0.
En 2009 et 2010, Kasparov a entraîné Magnus Carlsen et lui a permis de parvenir à la première place du classement mondial en janvier 2010
Deep Blue. Matchs contre les ordinateurs 1985-2003
Dès 1985, Kasparov s'est passionné pour les jeux d'échecs sur ordinateur et après avoir participé à l'élaboration de la première version de Chessbase sur Atari ST il en est devenu le premier utilisateur officiel en 1987 et en a fait un outil d'entrainement décisif 38,39,40
En 1989, Kasparov défait facilement par le score sans appel de 2-0 Deep Thought, un superordinateur spécialisé dans le jeu d'échecs et capable de calculer 720 000 coups par seconde.
En 1994, Fritz 3 tournant sur un Pentium à 90 MHz gagne une partie de blitz dans un tournoi contre Garry Kasparov et ils terminent ex æquo. Kasparov le bat dans les parties de départage : 4-1. Kasparov affronte aussi Chess Genius 2.9 tournant sur un Pentium à 100 MHz au grand Prix d'Intel à Londres en semi-rapide 30 min. la partie et perd 1.5-0.5.
En février 1996, Kasparov affronte Deep Blue, développé par Feng-hsiung Hsu chez IBM en six parties, perd la première partie du match, mais en gagne trois ensuite et annule les autres.
En mai 1997, il perd le match revanche contre Deeper Blue ; c'est la première fois qu'un ordinateur bat officiellement un champion du monde en match singulier à cadence normale de compétition. Deeper Blue était capable de calculer de 100 millions à 300 millions de coups par seconde, et a défait Kasparov 3,5 à 2,5 dans un match de six parties.
En janvier 2003, Kasparov affronte Deep Junior, un programme qui tourne sur un micro-ordinateur multiprocesseur, dans un match de championnat du monde homme-machine sous les auspices de la FIDE, avec une bourse d'un million de dollars américains41 ; Avec une victoire de part et d'autre le match se solde finalement par un nul 3-3 (+1 -1 =4). Pour la première fois un programme PC gagne une partie avec les noirs contre le champion du monde à une cadence de tournoi.
En novembre 2003, Kasparov joue un match de quatre parties contre le programme X3D Fritz, dont le classement Elo est estimé à 2 807, en utilisant un échiquier virtuel, des lunettes stéréoscopiques et un système de reconnaissance de la parole. Le match se solde à nouveau par un nul (+1 -1 =2) et Kasparov emporte la bourse de 175 000 dollars.
Engagement politique, Années 1980 et 1990
En 1987, Kasparov était élu au Komsomol, organisation de jeunesse du Parti communiste de l'Union soviétique. Il quitte le parti en 1990, soutient Boris Eltsine au nom du Parti démocratique de Russie, et est décoré du Keeper of the Flame award, décerné par le cercle de réflexion Center for Security Policy, proche des milieux néoconservateurs américains. Il a entretenu des liens avec des cercles de réflexion de la même obédience, comme l’Hudson Institute.
En juin 1993, Kasparov fut impliqué dans la création du bloc de partis Choix de la Russie » qui participa aux élections législatives de décembre 1993. Ce mouvement fut suivi de 1994 à 2001 par le choix démocratique de la Russie. Kasparov prit part en 1996 à la campagne électorale de Boris Eltsine.
Depuis 2005 Meeting de Solidarnost
En 2005, Kasparov abandonna la compétition échiquéenne après sa neuvième victoire au tournoi de Linares. Il poursuit depuis une carrière politique en Russie. Fondateur du Front civique unifié, il est l'un des chefs du mouvement L'Autre Russie, une coalition d'opposants à Vladimir Poutine. Il a été notamment brièvement interpellé lors d'une manifestation du mouvement à Moscou le 14 avril 2007
Il a été arrêté une nouvelle fois le 24 novembre 2007 lors d'une manifestation à Moscou contre la tenue le 2 décembre 2007 d'élections législatives russes qu'il juge injustes et condamné en comparution immédiate à cinq jours d'emprisonnement pour manifestation non autorisée et refus d'obéir aux ordres de la police. Son avocate, Me Mikhaïlova, a précisé qu'elle avait déposé plainte contre cette arrestation arbitraire.
Notre but est le démantèlement de ce régime qui couvre le pays de honte et le déteste. … Nous allons sortir de ce marécage de corruption et de mensonge et nous gagnerons !, avait lancé à la foule Garry Kasparov peu avant son interpellation.
Depuis son engagement politique en opposition contre le président Poutine, Kasparov se dit inquiet pour sa vie. Il a par exemple en permanence cinq gardes du corps et ne voyage plus avec la compagnie Aeroflot. Kasparov est également un des défenseurs de la théorie historique de la Nouvelle Chronologie de l'académicien russe Anatoli Fomenko.
Le 30 septembre 2007, il avait été désigné comme le candidat du mouvement d'opposition L'Autre Russie à l'élection présidentielle de 2008 en Russie. Le 12 décembre 2007, il annonce son retrait de la course à la présidence, s'estimant victime d'ostracisme. Le 18 janvier 2008, Kasparov publie dans Le Monde un article dans lequel il critique durement la complaisance de Nicolas Sarkozy envers Vladimir Poutine et les dangers que celle-ci présente à ses yeux51. Le 19 août 2008, Kasparov, Boris Nemtsov et d'autres personnalités de l'opposition, dénoncent la décision aventuriste du président Dmitri Medvedev de lancer une invasion de la Géorgie au-delà de l'Ossétie du Sud. Elle risque selon eux d'isoler la Russie sur la scène internationale.
Le 13 décembre 2008, Kasparov annonce la naissance de son nouveau parti politique : Solidarnost. Le parti rassemble des membres de l'union des forces de droite ainsi que des partisans de l'ancien premier ministre Mikhaïl Kassianov.
Le 24 décembre 2011, l'ancien champion du monde participa au troisième rallye de l'opposition à Moscou pour contester les résultats des élections législatives russes de 2011.
Le 17 août 2012, Kasparov est interpellé puis relâché par la police russe après des échauffourées devant le tribunal après le verdict condamnant le groupe punk les Pussy Riot à deux ans de prison.
Palmarès
Kasparov en 1980 (vainqueur du tournoi de Bakou)
Les tables suivantes donnent les résultats et les scores de Garry Kasparov dans les tournois55,56,57. La notation (+5 –2 =17) signifie : cinq victoires, deux défaites et dix-sept parties nulles.
Tournois et matchs à cadence lente
1975 – 1982 : champion d'URSS et champion du monde junior
Dans toute la carrière de Kasparov58, les seuls tournois individuels à cadence lente où il ne se classa pas parmi les trois premiers, furent le championnat d'URSS junior 1975 il finit 7e-10e, le tournoi de maîtres de Bakou 1976, la ligue supérieure du championnat d'URSS 1978 il finit neuvième et le tournoi international de Tilburg 1981 il termina 6e-8e.
Le tournoi de maîtres de Bakou 1976, le tournoi de qualification junior de Léningrad en 1977, les championnats d'URSS 1978 et 1979 et le tournoi international de Tilburg 1981 sont les seuls tournois dans la carrière de Kasparov où il perdit plus de deux parties.
Lors des olympiades d'échecs, Kasparov reçut la médaille de bronze individuelle à Malte en 1980 (2e remplaçant) et à Lucerne en 1982 (2e échiquier).
Année Vainqueur Deuxième à neuvième
1975 Coupe de la ville de Bakou adultes27 Championnat d'URSS junior (7e-10e) : 5,5 / 9 (+4 -2 =3)
(Vilnius, tournoi remporté par Ievgueni Vladimirov)
1976 Championnat d'URSS junior (Tbilissi) : 7 / 9 (+5 =4)
(vainqueur au départage Bucholtz devant Z. Sturuanote 2)
Bakou (tournoi de maîtres59,60) : 6,5 / 13 (+4 −4 =5)
Coupe du monde cadetsnote 3 (3e-6e) : 6 / 9 (+5 -2 =2)
(Wattignies, coupe remportée par Grinbergnote 4)
1977 Championnat d'URSS junior (Riga) : 8,5 / 9
Match URSS-Australie par télex (1-0)
(échiquier junior) Léningrad (juniorsnote 5) (2e) : 6,5 / 12 (+4 -3 =5)
(tournoi de sélection remporté par Youssoupov)
Championnat du monde cadetsnote 3 (3e) : 8 / 11 (+6 -1 =4)
(Cagnes-sur-Mer, tournoi remporté par Arnason)
1978 Minsk (mémorial Sokolski) : 13 / 17 (+11 -2 =4)
Daugavpils (tournoi de sélectionnote 6) : 9 / 13
(ex æquo avec Igor Ivanov) Championnat d'URSS (9e) (Tbilissi) : 8,5 / 17 (+4 -4 =9)
(championnat remporté par Tal et Tsechkovski)
1979 Banja Luka : 11,5 / 15 (+8 =7)
Spartakiade d'URSS (Moscou) : 5,5 / 8 (+4 –1 =3) Championnat d'URSS (3e-4e) (Minsk) : 10 / 17 (+6 -3 =8)
(tournoi remporté par Geller devant Youssoupov)
1980 Championnat d'Europe par équipes (Skara) : 5,5 / 6
Tournoi international de Bakou : 11,5 / 15 (+8 =7)
Championnat du monde junior
(Dortmund) : 10,5 / 13 (+8 =5) Olympiade de Malte : 9,5 / 12 (+8 -1 =3)
(3e au 2e échiquier de réserve)
1981 Moscounote 7 (tournoi des générations) : 4 / 6 (+3 -1 =2)
Olympiade universitaire (Graznote 8) : 9 / 10 (+8 =2)
Championnat d'URSS (Frounzé) (1er-2e)
(ex æquo avec Lev Psakhis) : 12,5 / 17 (+10 -2 =5) Moscou (2e-4e) : 7,5 / 13 (+3 -1 =9)
(tournoi international remporté par Karpov)
Tilburg (6e-8e): 5,5 / 11 (+3 -3 =5)
(tournoi international remporté par Beliavski
devant Petrossian, Portisch et Timman)
1982 Tournoi de Bugojno : 10,5 / 13 (+6 =7)
Tournoi interzonal de Moscou : 10 / 13 (+7 =6) Coupe d'URSS par équipes (Kislovodsk) : 4 / 7 (+3 –2 =2)
Olympiade de Lucerne (3e au 2e éch.) : 8,5 / 11 (+6 =5)
1983 – 1990 : la conquête du championnat du monde[modifier | modifier le code]
De décembre 1981 (championnat d'URSS d'échecs) à décembre 1990 (championnat du monde d'échecs), Kasparov termina premier (seul ou ex æquo) des quinze tournois individuels auxquels il participa et vainqueur de tous ses matchs (la victoire dans la dernière ronde du championnat du monde de Séville en 1987, lui permit d'égaliser et de conserver son titre mondial). Son seul échec fut le premier match contre Karpov, disputé en 1984 – 1985, qui fut interrompu et annulé par la FIDE alors que Kasparov était mené sur le score de trois victoires, cinq défaites et quarante parties nulles ; le match fut rejoué en octobre – novembre 1985.
En décembre 1985, au lendemain de la fin de son match contre Timman, Kasparov disputa une simultanée à la pendule contre une équipe de huit joueurs du club de Hambourg. Il gagna deux parties, perdit trois autres et fit trois nulles. Il prit sa revanche en février 1987, remportant six parties et ne concédant que deux nulles.
Dans les compétitions par équipes, Kasparov reçut la médaille d'or au premier échiquier aux olympiades 1986 et 1988 et il réalisa également la meilleure performance Elo de la compétition.
Le sacre de Kasparov en 1985
Année Seul vainqueur ou ex æquo
1983 Spartakiade d'URSS : 1 / 2 (+0 −0 =2) contre Beliavski et Tal
Tournoi de Niksic : 11 / 14 (+9 −1 =4)
Tournoi des candidats (Moscou et Londres) :
(Moscou) Quart de finale contre Beliavski : 6 – 3 (+4 −1 =4)
(Londres) Demi-finale contre Kortchnoï : 7 – 4 (+4 −1 =6)
1984 (Vilnius) Finale des candidats contre Smyslov : 8,5 – 4,5 (+4 −0 =9)
(Londres) Match URSS - Reste du monde contre Timman : 2,5 – 1,5 (+1 =3)
(Londres) Partie simultanée à la pendule : 8,5 / 10 (+7 =3)
1984-1985 (Moscou) : match interrompu contre Karpov : 23 – 25 (+3 −5 =40)
1985 (Hambourg) Match contre Hübner : 4,5 – 1,5 (+3 =3)
(Belgrade) Match contre Andersson : 4 – 2 (+2 =4)
Championnat du monde contre Karpov (Moscou) : 13 – 11 (+5 −3 =16)
(Hilversum) Match contre Timman : 4 – 2 (+3 −1 =2)
1986 (Bâle) Match contre Miles : 5,5 – 0,5
Championnat du monde contre Karpov : 12,5 – 11,5 (+5 −4 =15)
(Londres et Léningrad, match revanche)
Olympiade de Dubaï (meilleure performance Elo) : 8,5 / 11 (+7 −1 =3)
Bruxelles (tournoi OHRA) : 7,5 / 10 (+6 −1 =3)
1987 Bruxelles (tournoi SWIFT) : 8,5 / 11 (+6 =5) (ex æquo avec Ljubojevic)
Simultanée à la pendule contre Hambourg : 7 – 1 (+6 =2)
Championnat du monde contre Karpov (Séville) : 12 – 12 (+4 −4 =16)
(Kasparov conserva son titre)
1988 Amsterdam (tournoi Optieburs) : 9 / 12 (+6 =6)
Belfort (Coupe du monde GMA) : 11,5 / 15 (+9 −1 =5)
Championnat d'URSS (Moscou) : 11,5 / 17 (+6 =11) (ex æquo avec Karpov)
Reykjavik (Coupe du monde GMA) : 11 / 17 (+6 −1 =10)
Olympiade de Thessalonique (meilleure performance Elo) : 8,5 / 10 (+7 =3)
1989 Barcelone (GMA) : 11 / 16 (+7 −1 =8) (ex æquo avec Ljubojevic)
Skelleftea (GMA) : 9,5 / 15 (+4 =11) (ex æquo avec Karpov)
Tournoi de Tilburg61 : 12 / 14 (+10 =4)
Belgrade62 : 9,5 / 11 (+8 =3)
1990 Tournoi de Linares : 8 / 11 (+6 −1 =4)
Match exhibition télévisé contre Hansen au Château de Valdemar : 1,5–0,5
Match d'entrainement contre Psakhis à Murcie : 5 – 1 (+4 –0 =2)
Championnat du monde contre Karpov
(New York et Lyon) : 12,5 – 11,5 (+4 −3 =17)
1991 – 1998 : champion du monde PCA
En 1991, lors du tournoi de Linares, Vassili Ivantchouk fut le premier joueur à battre Karpov et Kasparov dans le même tournoi. En définitive, il devança le champion du monde d'un demi-point, mettant fin à la série ininterrompue de victoires en tournois de Kasparov qui durait depuis plus de neuf ans. À Amsterdam, Kasparov finit troisième ex æquo avec Karpov, devancé par Short et Salov. Après un autre échec à Reggio-Emilia en 1991-1992, il remporta deux fois de suite le tournoi de Linares (devant Karpov), gagna le tournoi de Dortmund, reçut la médaille d'or à l'olympiade de 1992 et battit Short en finale du championnat du monde. En 1994, Kasparov fut devancé par Karpov à Linares et ne termina que 17e du classement individuel lors de l'olympiade de Moscou. En 1996, il remporta le super-tournoi de Las Palmas où participaient les meilleurs joueurs du monde, à l'exception de Gata Kamsky — 6e joueur mondial, remplacé par le 7e joueur au classement mondial : Veselin Topalov. En 1997, Kasparov remporta les trois tournois auxquels il participa, mais il perdit le match revanche contre Deep Blue.
1998 fut une année de faible activité pour Kasparov avec un seul super-tournoi disputé : le tournoi de Linares où il occupa la troisième-quatrième place, tandis que Viswanathan Anand remportait les tournois de Wijk aan Zee (ex æquo avec Kramnik), Linares (devant Chirov et Kasparov), Madrid et Tilburg. En 1997, puis en 1998, pour la première fois depuis 1985, Kasparov ne reçut pas l'Oscar du meilleur joueur d'échecs de l'année qui fut décerné à Anand. En 1998, Kasparov disputa un match Advanced Chess contre Topalov à León match assisté par ordinateur : six parties à la cadence de 60 minutes par joueur (+2 -2 =2), suivies d'un départage blitz en trois parties sans ordinateur que Kasparov remporta63. Auparavant, Kasparov avait battu Topalov 4-0 dans un match rapide organisé par Eurotel à Prague. En 1998 et 1999, les tentatives pour organiser un match de championnat du monde contre Chirov, puis contre Anand échouèrent.
Année Seul vainqueur ou ex æquo Deuxième ou troisième
1991 Tilburg : 10 / 14 (+7 –1 =6)
(devant Short, Anand, Karpov, Kamsky et Timman) Linares 2e après Ivantchouknote 9 : 9 / 13 (+6 –1 =6)
Amsterdamnote 10 (3e-4e) : 5,5 / 9 (+2 =7)
(tournoi remporté par Short et Salov devant Karpov)
1992 Linares : 10 / 13 (+7 =6)
Dortmund : 6 / 9 (+5 –2 =2) (ex æquo avec Ivantchouk)
Olympiade de Manillenote 11 : 8,5 / 10 (+7 =3)
Championnat d'Europe par équipes (Debrecen) : 6 / 8 (+4 =4) 1991-1992 : Reggio Emilia (2e-3e) : 5,5 / 9 (+3 –1 =5)
(tournoi remporté par Anand devant Guelfand)
1993 Linares : 10 / 13 (+7 =6) (devant Karpov et Anand)
Championnat du monde PCA contre Short
(Londres) : 12,5 — 7,5 (+6 –1 =13)
1994 Amsterdam : 4 / 6 (+3 –1 =2) (devant Ivantchouk)
Novgorod : 7 / 10 (+4 =6) (ex æquo avec Ivantchouk)
Horgen : 8,5 / 11 (+6 =5) (devant Chirov et Youssoupov) Linares (2e-3e) : 8,5 / 13 (+6 –2 =5)
(tournoi remporté par Karpov devant Chirov)
1995 Riga (mémorial Tal) : 7,5 / 10 (+5 =5)
(tournoi remporté devant Anand, Ivantchouk et Kramnik)
Novgorod : 6,5 / 9 (+4 =5)
Championnat du monde PCA contre Anand
(New York) : 10,5 — 7,5 (+4 –1 =13) Amsterdam (2e après Lautiernote 12) : 3,5 / 6 (+3 –2 =1)
1996 (Philadelphie) Match contre Deep Blue : 4–2 (+3 –1 =2)
Amsterdamnote 13 : 6,5 / 9 (+5 –1 =3) (ex æquo avec Topalov)
Olympiade de Erevannote 14 : 7 / 9 (+5 =4)
Las Palmas : 6,5 / 10 (+3 =7) (tournoi remporté
devant Anand, Kramnik, Topalov, Ivantchouk et Karpov) Dos Hermanas (3e-4e) : 5 / 9 (+2 –1 =6)
(tournoi remporté par Topalov et Kramnik devant Anand)
1997 Linares : 8,5 / 11 (+7 –1 =3) (devant Kramnik)
Novgorod : 6,5 / 10 (+4 –1 =5) (devant Kramnik)
Tilburg : 8 / 11 (+6 –1 =4) (ex æquo avec Kramnik et Svidler) (New York) Match contre Deep Blue : 2,5–3,5 (+1 –2 =3)
1998 (Prague) Match contre Timman : 4-2 (+2 –0 =4)
(trophée Eurotel) Linares (3e-4e) : 6,5 / 12 (+1 =11)
(tournoi remporté par Anand devant Chirov et Kramnik)
1999 – 2005 : numéro un mondial
En 1999, le champion du monde fit son retour à la compétition en participant pour la première fois au tournoi de Wijk aan Zee. De 1999 à 2002, Kasparov remporta les dix super-tournois à cadence lente auxquels il participa64 : trois fois consécutivement Wijk aan Zee, quatre fois de suite Linares, deux fois de suite Sarajevo et, en 2001, le tournoi d'Astana devant Kramnik qu'il battit. Il ne partagea la première place qu'avec Kramnik à Linares en 2000 et il ne concéda qu'une défaite lors de ces dix tournois (+53 -1 =61), contre Ivan Sokolov à wijk Aan Zee en 1999, partie perdue après une série de sept victoires consécutives65. Kasparov termina l'année 2002 en réalisant la meilleure performance à l'olympiade de Bled. Sa série de succès en tournoi fut interrompue en 2003 à Linares où Kasparov termina seulement troisième ex æquo et perdit une partie contre Radjabov.
L'année 1999 fut celle de tous les succès et Kasparov obtint le plus haut classement Elo jamais atteint avec 2 851 points, un record qui ne fut battu que treize ans plus tard par Magnus Carlsen en janvier 2013. Outre ses succès à Wijk aan Zee, Linares et Sarajevo, Kasparov remporta également le tournoi de blitz de Wijk aan Zee devant Anand, Kramnik, Ivantchouk et Topalov ainsi que le tournoi rapide des géants à Francfort, battant Anand, Kramnik et Karpov sur le même score de 2,5 à 1,5. Cependant, en novembre 2000, Kasparov, qui avait partagé la première place du tournoi de Linares avec Kramnik, perdit son titre de champion du monde face à Kramnik. À la fin de l'année, l'oscar des échecs pour l'année 2000 fut décerné à Kramnik, pour sa victoire sur Kasparov et ses premières places à Linares ex æquo avec Kasparov et au tournoi de Dortmund ex æquo avec Anand ; Kasparov était absent à Dortmund. Malgré cette défaite, Kasparov conserva sa première place au classement Elo mondial jusqu'à sa retraite en 2005 et reçut l'oscar des échecs en 2001 et 2002. Entre la défaite contre Ivan Sokolov à Wijk aan Zee en 2000 et celle lors de la deuxième partie du championnat du monde de 2000, Kasparov fut invaincu pendant soixante trois parties.
En 2003 et 2004, l'oscar des échecs fut décerné à Anand qui avait remporté le tournoi de Wijk aan Zee, puis en 2005 à Topal
Année Vainqueur ou ex æquo Deuxième ou troisième
1999 Tournoi de Wijk aan Zee : 10 / 13 (+8 –1 =4)
Linares : 10,5 / 14 (+7 =7)
Sarajevo : 7 / 9 (+5 =4)
Partie « Kasparov contre le monde » : 1-0
2000 Wijk aan Zee : 9,5 / 13 (+6 =7)
Linares : 6 / 10 (+2 =8) (ex æquo avec Kramnik)
Sarajevo : 8,5 / 11 (+6 =5)
Championnat du monde contre Kramnik
(Londres) : 6,5–8,5 (+0 –2 =13)
2001 Wijk aan Zee : 9 / 13 (+5 =8)
Linares : 7,5 / 10 (+5 =5)
Astana : 7,5 / 10 (+5 =5)
(Moscou) Match exhibition contre Kramniknote 15
(parties lentes : +0 −0 =4)
2002 Linares : 8 / 12 (+4 =8)
Olympiade de Bled : 7,5 / 9 (+6 =3)
(meilleure performance Elo)
2003 (New York)
Match contre Deep Junior : 3–3 (+1 –1 =4)
Match contre Fritz X3D : 2–2 (+1 –1 =2) Linares (3e-4e) : 6,5 / 12 (+2 –1 =9)
(victoire de Leko et Kramnik devant Anand)
2004 Championnat de Russie
(Moscou) : 7,5 / 10 (+5 =5) Linares (2e-3e) : 6,5 / 12 (+1 =11)
(tournoi remporté par Kramnik devant Leko)
2005 Linares : 8 / 12 (+5 –1 =6)
vainqueur au départage devant Topalov
Tournois de Linares 1990 – 2005
Kasparov a remporté neuf fois le tournoi de Linares en quatorze participations, dont quatre victoires consécutives de 1999 à 2002.
L'édition de 1995 fut la seule où Kasparov fut absent de 1990 à sa retraite, en 2005. Kasparov ne concéda que sept défaites lors de ses quatorze participations, et seulement deux parties perdues lors des huit dernières participations de 1998 à 2005.
Année Classement Score Adversaires battus Défaites Début du classement et notes
1990 Vainqueur 8 / 11 (+6 –1 =4) Ivantchouk, Short, Youssoupov,
Spassky, Portisch et Illescas Goulko 1er : Kasparov
2e : Gelfand (7,5 / 11) ; 3e : Salov
1991 Deuxième 9 / 13 (+6 –1 =6) Beliavski, Ljoubojevic, Gourevitch,
Gelfand, Kamsky et Ehlvest Ivantchouk 1er : Ivantchouk (9,5 / 13) ;
3e : Beliavski
1992 Vainqueur 10 / 13 (+7 =6) Timman, Karpov, Gelfand, Short,
Youssoupov, Ljubojevic et Illescas 1er : Kasparov avec 2 points d'avance
2e-3e : Ivantchouk et Timman (8 / 13)
1993 Vainqueur 10 / 13 (+7 =6) Karpov, Anand, Bareev, Kamsky,
Timman, Gelfand et Ljubojevic 1er : Kasparov avec 1,5 point d'avance
2e-3e : Karpov et Anand (8,5 / 13)
1994 2e-3e 8,5 / 13 (+6 -2 =5) Bareev, Kamsky, Anand,
Ivantchouk, Illescas et J. Polgar Lautier,
Kramnik 1er : Karpov (11 / 13) ; 2e-3e : Chirov
Performance record de Karpov (+9 =4)
En 1995, année du championnat du monde contre Anand, Kasparov ne disputa pas le tournoi, remporté par Ivantchouk.
En 1996, le tournoi fut remplacé par le championnat du monde féminin.
1997 Vainqueur 8,5 / 11 (+7 –1 =3) Kramnik, Adams, Topalov,
J. Polgar, Anand, Nikolic, Chirov Ivantchouk 1er : Kasparov avec 1 point d'avance
2e : Kramnik (7,5 / 11) ; 3e : Adams
1998 3e-4e 6,5 / 12 (+1 =11) Anand 1er : Anand (7,5 / 12) ; 2e : Chirov ;
3e-4e : Kramnik
1999 Vainqueur 10,5 / 14 (+7 =7) Anand, Topalov, Svidler,
Ivantchouk (2 fois) et Adams (2 fois) 1er : Kasparov avec 2,5 points d'avance
2e-3e : Kramnik et Anand (8 / 14)
2000 Covainqueur
avec Kramnik 6 / 10 (+2 =8) Anand et Chirov 1er-2e : Kramnik
3e-6e : quatre autres joueurs (4,5 / 10)
2001 Vainqueur 7,5 / 10 (+5 =5) Karpov, Chirov, Leko
et Grichtchouk (2 fois) 1er : Kasparov avec 3 points d'avance
2e-6e : cinq autres joueurs (4,5 / 10)
2002 Vainqueur 8 / 12 (+4 =8) Ponomariov, Adams, Chirov
et Vallejo Pons 1er : Kasparov avec 1,5 point d'avance
2e : Ponomariov (6,5 / 12) ;
3e-5e : Ivantchouk, Anand et Adams
2003 3e-4e 6,5 / 12 (+2 –1 =9) Anand, Ponomariov Radjabov 1er-2e : Leko et Kramnik (7 / 12), 3e-4e : Anand
2004 2e-3e 6,5 / 12 (+1 =11) Vallejo Pons 1er : Kramnik (7 / 12) ; 2e-3e : Leko
2005 Vainqueur 8 / 12 (+5 –1 =6) Adams (2 fois), Kazhimdzanov,
et Vallejo Pons (2 fois) Topalov Vainqueur au départage devant Topalov
2e : Topalov ; 3e : Anand (6,5 / 12)
Total Neuf victoires 113,5 / 168 (+66 –7 =95)
Compétitions par équipes, Olympiades d'échecs
À chaque participation de Kasparov aux olympiades, son équipe remporta la médaille d'or par équipes.
Résultats avec l'équipe d'URSS ou de Russie aux olympiades d'échecs
Année Lieu Échiquier Classement individuel Score Défaites Composition de l'équipe d'URSS
ou de Russie
1980 Malte 2e remplaçant médaille de bronze 9,5 / 12
(+8 –1 =3) Georgiev
(Bulgarie) Karpov, Polougaïevski, Tal, Geller ;
réserve : Balachov et Kasparov
1982 Lucerne deuxième
échiquier médaille de bronze 8,5 / 11
(+6 =5) Karpov, Kasparov, Polougaïevski, Beliavski ;
réserve : Tal et Youssoupov
En 1984, Kasparov et Karpov disputaient leur premier match marathon.
1986 Dubaï premier échiquier
de l'URSS médaille d'or,
meilleure performance Elo 8,5 / 11
(+7 -1 =3) Seirawan
(États-Unis) Kasparov, Karpov, Youssoupov, Sokolov ;
réserve : Vaganian et Tsechkovski.
1988 Thessalonique médaille d'or,
meilleure performance Elo 8,5 / 10
(+7 =3) Kasparov, Karpov, Youssoupov, Beliavski ;
réserve : Ehlvest et Ivantchouk.
En 1990, Kasparov et Karpov disputaient leur cinquième et dernier match.
À partir de 1992, Kasparov conduisit l'équipe de Russie à la victoire sans la participation de Karpov.
1992 Manille premier échiquier
de la Russie médaille d'or,
2e meilleure performance Elo 8,5 / 10
(+7 =3) Kasparov, Khalifman, Dolmatov, Dreïev ;
réserve : Kramnik et Vyjmanavine.
1994 Moscou 17e 6,5 / 10
(+4 –1 =5) Topalov
(Bulgarie) Kasparov, Kramnik, Bareïev, Dreïev ;
réserve : Tiviakov et Svidler.
1996 Erevan meilleure performance Elo,
médaille d'argent 7 / 9
(+5 =4) Kasparov, Kramnik, Dreïev, Svidler ;
réserve : Bareïev et Roublevski.
En 2000, Kasparov et Kramnik disputaient leur match de championnat du monde.
2002 Bled premier échiquier
de la Russie meilleure performance Elo
4e au 1er échiquier 7,5 / 9
(+6 =3) Kasparov, Grichtchouk, Khalifman,
Morozevitch ; réserve : Svidler et Roublevski.
Matchs URSS (ou Russie) contre le Reste du monde
Lors du match URSS - Reste du monde de 1984 à Londres, Kasparov battit Timman 2,5 à 1,5 (une victoire et trois nulles).
En décembre 1988, Kasparov participa à un match de bienfaisance URSS - Reste du monde, disputé en parties rapides à Madrid. Il marqua 5,5 points sur 8 (+3 =5) et l'URSS (ans Karpov remporta le match.
En 2002, un match Russie - Reste du monde fut organisé à Moscou en parties rapides. Kasparov finit avec un score négatif : 4 points sur 10 (+1 –3 =6) et l'équipe de Russie perdit le match.
Championnats inter-clubs
Championnat d'Azerbaïdjan par équipes
1977 : Bakou : 4 / 6 (+2 =4)
Coupe d'URSS par équipes
1982 : Kislovodsk, deuxième échiquier du Spartak : 4 / 7 (+3 −2 =2)
Championnat de France par équipes (Nationale 1)
1993 : Auxerre, premier échiquier d'Auxerre : 3 / 4 (+2 =2) (le championnat fut remporté par Lyon)
Coupe d'Europe des clubs
1994 : Lyon, premier échiquier du Bosna Sarajevo : 1,5 / 3 (+1 −1 =1) (Sarajevo et Lyon partagèrent la coupe)
1995 : Ljubljana, premier échiquier du Bosna Sarajevo : 1,5 / 2 (+1 =1)
2003 : Réthymnon, premier échiquier du Ladya Kazan-1000 : 4,5 / 6 (+4 −1 =1)
2004 : Çeşme (province d'Izmir), premier échiquier du Max Ven Ekaterinburg : 3,5 / 7 (+1 −1 =5)
Compétitions blitz et rapides
En octobre ou novembre 1975, à douze ans, Kasparov remporta la coupe de Bakou rapide. La victoire fut relatée dans l'hebdomadaire de Moscou .
1983 à 1996
En 1988, lors du championnat du monde de blitz à Saint-Jean, Kasparov fut éliminé en quart de finale par Kiril Georgiev, 3 à 1.
Année vainqueur ou ex-æquo Deuxième ou troisième
1983 Herceg Novi (tournoi blitz) : 13,5 / 16 (+12 −1 =3)
1987 (Londres) Match rapide contre Short : +4 −2
Bruxelles (championnat du monde de blitz non officiel)
1988 Match semi-rapide (1h) contre Hort (Cologne) : 2,5–0,5
Madrid (tournoi rapide) (1er-33e) : 5,5 / 8 (+3 =5)
(match-tournoi URSS - Reste du monde)
1989 Londres (championnat d'Europe rapide Infolink)
(éliminé en demi-finale par Speelman : 0-1)
1990 Paris70 (tournoi rapide), finale contre Short : +2 −1
1991 Paris70 (tournoi rapide), finale perdue 0,5–1,5 contre Timman
1992 Moscou (tournoi super-blitz) : 11,5 / 14
Paris70 (tournoi rapide, finale contre Anand, +3 −1)
Match tv contre Hübner : rapide 1,5–0,5 et blitz : 1,5–0,5
1993 (Londres) Exhibition rapide contre Short (4-0) (Londres) Exhibition rapide thématique contre Short (+0 −1 =2)
1994 Parisnote 16 (rapide, finale contre Nikolic, 2-0)note 17 New-York (tournoi rapide, finale perdue 0,5 - 1,5 contre Kramnik)
1995 New York (rapide, finale contre Ivantchouk, 2-0)
Paris (rapide+blitz, finale contre Kramnik)note 18 Moscou (tournoi rapide, demi-finale contre Anand, 0,5 - 1,5)
1996 Moscou (rapide+blitz, finale perdue contre Kramnik, +0 −1 =3)
Genève (rapide+blitz, finale perdue contre Anand, +1 −2 =2)
1998 à 2011[modifier | modifier le code]
Année vainqueur ou ex-æquo Deuxième ou troisième
1998 (Sofia) Match contre Topalov (rapide) : 4–0
(Moscou) Match contre Kramnik (blitz) : 12 - 12 Francfort (rapide) (3e-4e derrière Anand et Kramnik) : 2,5 / 6
(3e après un départage blitz gagné contre Ivantchouk, +1 =3)
1999 Wijk aan Zee (tournoi blitz) : 10,5 / 13 (+9 −1 =3)
(devant Anand, Kramnik, Ivantchouk et Topalov)
Francfort (tournoi rapide à quatre) : 7,5 / 12 (+3 =9)
(Kasparov marqua 2,5–1,5 contre Anand, Karpov et Kramnik)
2000 Kopavogur (rapide, finale contre Anand, +2 =2) Grand Prix KasparovChess (2e) (rapide sur Internet)
(finale perdue contre Jeroen Piket : +0 −2 =8)
Francfort (rapide) (2e derrière Anand) : 6 / 10 (+3 −1 =6)
2001 Coupe du monde rapide, Cannes (finale contre Bareev : 1,5–0,5)
(Batoumi) Match rapide Europe-Asie : 11 / 12
(Moscou) Match rapide et blitz contre Kramnik
(Mémorial Botvinnik) : 9,5 - 6,5
(+4 −1 =5) en parties rapides et (+1 −1 =4) en blitz Zurichnote 20 (tournoi semi-rapide, 70')
(finale perdue contre Kramnik, +0 −1 =1)
2002 Moscou (tournoi rapide, finale contre Radjabov, 1,5–0,5) (Moscou) Tournoi-match rapide Russie-Reste du Monde (+1 −3 =6)
(New York) Match rapide contre Karpov : 1,5–2,5 (+1 −2 =1)
2003 (Panormo) Match rapide contre Azmaïparachvilinote 21 (2-0)
2004 Reykjavik (tournoi rapide, finale contre Short, +1 =1)
2006 Zurich (tournoi blitz, ex-æquo avec Karpov)
2009 (Valence) Match rapide et blitz contre Karpov : 9 - 3
(+3 −1, rapide) et (6 à 2, blitz)
2011 (Clichy) Match blitz contre Vachier-Lagrave : 1,5 – 0,5
(Louvain) Match blitz contre Short : 4,5 – 3,5
Style échiquéen et parties remarquables
Style échiquéen[modifier | modifier le code]
Mikhaïl Botvinnik, le père de l'école d'échecs soviétique, a qualifié Garry Kasparov de « joueur-chercheur », le considérant de ce fait comme son plus digne héritier. Le style de Kasparov est empreint de nombreux sacrifices, comme le montre la partie suivante :
Deeper Blue - Kasparov, New York 1997, 2e partie
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.O-O Fe7 6.Te1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 h6 10.d4 Te8 11.Cbd2 Ff8 12.Cf1 Fd7 13.Cg3 Ca5 14.Fc2 c5 15.b3 Cc6 16.d5 Ce7 17.Fe3 Cg6 18.Dd2 Ch7 19.a4 Ch4 20.Cxh4 Dxh4 21.De2 Dd8 22.b4 Dc7 23.Tec1 c4 24.Ta3 Tec8 25.Tca1 Dd8 26.f4 Cf6 27.fxe5 dxe5 28.Df1 Ce8 29.Df2 Cd6 30.Fb6 De8 31.T3a2 Fe7 32.Fc5 Ff8 33.Cf5 Fxf5 34.exf5 f6 35.Fxd6 Fxd6 36.axb5 axb5 37.Fe4 Txa2 38.Dxa2 Dd7 39.Da7 Tc7 40.Db6 Tb7 41.Ta8+ Rf7 42.Da6 Dc7 43.Dc6 Db6+ 44.Rf1 Tb8 45.Ta6 1-0.
Kasparov a été déstabilisé par le refus de la machine d'accepter son sacrifice.
Exemples de parties
Seizième partie du match Karpov-Kasparov, 1985
Article détaillé : Karpov - Kasparov (Moscou, 1985, partie 16).
L'Informateur d'échecs no 68, paru en 1996, choisit la 16e partie du match de Championnat du monde de 1985 entre Karpov et Kasparov avec les Noirs, comme la meilleure partie publiée lors des 30 premières années de la revue (1967–1996). En 2009, Nicolas Giffard a considéré qu'il s'agissait de la plus belle victoire de Kasparov contre Karpov.
Vingtième partie du match Kasparov-Karpov, 1990
Article détaillé : Kasparov - Karpov Lyon, 1990, partie 20.
Dixième partie du match Kasparov-Anand, 1995
Kasparov-Anand, avant 14. Fc2!! Dxc3 15. Cb3!!
Durant sa carrière, Kasparov fut généralement considéré comme le joueur le mieux préparé au monde sur le plan des ouvertures. Sa capacité à produire des nouveautés théoriques qui n'étaient pas seulement de simples améliorations, mais renversaient l'analyse d'une position en faveur de l'autre camp, était remarquable72. Un exemple notable fut donné par sa 10e partie jouée avec les Blancs lors du championnat du monde d'échecs 1995 contre Viswanathan Anand. Au 15e coup, Kasparov offrit une tour pour obtenir une attaque gagnante :
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6 5. 0-0 Cxe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 8. dxe5 Fe6 9. Cbd2 Cc5 10. c3 d4!? (le coup le plus agressif, mais aussi le plus risqué; 10…Fg4 est plus sûr) 11. Cg5!? dxc3? (coup douteux, mais qui était alors considéré comme satisfaisant depuis la 10e partie entre Anatoli Karpov et Viktor Kortchnoï du Championnat du monde de 1978) 12. Cxe6 fxe6 13. bxc3 Dd3 14. Fc2!! (un coup extraordinaire, basé sur un sacrifice de Tour ; l'idée elle-même n'était pas neuve, car elle avait déjà été évoquée par l'ancien champion du monde Mikhaïl Tal dans ses annotations de la partie entre Anatoli Karpov et Viktor Kortchnoï, mais c'est Kasparov qui a mis la touche finale à la variante, sonnant ainsi le glas du coup 11... dxc3 à haut niveau73) ...Dxc3 15. Cb3!! Cxb3 16. Fxb3 Cd4 (temps de réflexion d'Anand pour jouer ce coup : près d'une heure) 17. Dg4! Dxa1 18. Fe6 Td8 19. Fh6! Dc3 20. Fxg7 Dd3 21. Fxh8 (temps total de réflexion de Kasparov jusqu'à ce moment : près de six minutes, ce qui prouve son extraordinaire travail de préparation des ouvertures) ...Dg6 22. Ff6 Fe7 23. Fxe7 Dxg4 24. Fxg4 Rxe7 25. Tc1 c6 26. f4 a5 27. Rf2 a4 28. Re3 b4 29. Fd1 a3 30. g4 Td5 31. Tc4 c5 32. Re4 Td8 33. Txc5 Ce6 34. Td5 Tc8 35. f5 Tc4+ 36. Re3 Cc5 37. g5 Tc1 38. Td6 1-0.
Kasparov-Anand, Linares, 1993
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4. Cc3 dxc4 5. a4 Ff5 6. e3 e6 7. Fxc4 Fb4 8. 0-0 Cbd7 9. Ch4 Fg6 10. h3!?! 0-0 11. Cxg6 hxg6 12. Dc2 Tc8 13. Td1 Db6 14. e4 c5 15. d5 Ce5 16. Fe2 exd5 17. Cxd5 Cxd5 18. Txd5 Cc6 19. Fc4 Cd4 20. Dd3 Tcd8 21. Fe3 Txd5 22. Fxd5 Td8 23. Dc4 Td7 24. Tc1 Df6 25. Td1 Ce6 26. Db3 a5 27. Td3 Cf4 28. e5 Df5 29. Fxf4 Dxf4 30. e6 Td8 31. e7 Te8 32. Tf3 Dc1+ 33. Rh2 Txe7 34. Fxf7+ Rh7 35. Fxg6+ Rh6 36. Dd5 Dg5 37. Ff5 g6 38. h4 Df6 39. Fd3 De5+ 40. Dxe5 Txe5 41. Tf6 c4 42. Fxc4?! Fe7 43. Tb6 Fc5 44. Tf6 Te4 45. Fd3 Tg4 46. Rh3 Fe7 47. Te6 Txh4+ 48. Rg3 Td4 49. Txg6+ Rh5 50. Ff5 Fd6+ 51. Rf3 Fc5 52. g4+ Rh4 53. Th6+ Rg5 54. Tg6+ Rh4 55. Fe4 Td6 56. Tg7 Tf6+ 57. Ff5 Tb6 58. Th7+ Rg5 59. Th5+ Rf6 60. Fd3 Fd4 61. g5+ Rg7 62. Th7+ Rf8 63. Fc4 Txb2 64. Tf7+ Re8 65. g6 1 - 0 (il peut suivre: 66. g7, et 65…Txf2+ 66. Re4 Fc5 67. Txf2 Fxf2 68. g7).
Kasparov-Topalov, Wijk aan Zee, 1999
Kasparov-Topalov après 23...Dd6
Quand on demande à Kasparov quelle était sa meilleure partie, il cite celle qu'il a jouée avec les Blancs contre Topalov au tournoi de Wijk aan Zee en 1999. Cette dernière74 montre en effet une de ses meilleures combinaisons. Il semble cependant que le remarquable sacrifice de Tour de Kasparov au 24e coup ne lui aurait seulement assuré le partage du point si Topalov avait joué au mieux.
Après les coups : 1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Fe3 Fg7 5.Dd2 c6 6.f3 b5 7.Cge2 Cbd7 8.Fh6 Fxh6 9.Dxh6 Fb7 10.a3 e5 11.0-0-0 De7 12.Rb1 a6 13.Cc1 0-0-0 14.Cb3 exd4 15.Txd4 c5 16.Td1 Cb6 17.g3 Rb8 18.Ca5 Fa8 19.Fh3 d5 20.Df4+ Ra7 21.The1 d4 22.Cd5 Cbxd5 23.exd5 Dd6 (voir diagramme), Kasparov joua :
24.Txd4!
Il suivit: 24…cxd4 25.Te7+! Rb6 (Dxe7? 26.Dxd4+ Rb8 27.Db6+, suivi du mat) 26.Dxd4+ Rxa5 27.b4+ Ra4 28.Dc3 Dxd5 29.Ta7 Fb7 30.Txb7 Dc4 (la menace des Blancs était Ff1, suivi de Fxb5) 31.Dxf6 Rxa3 32.Dxa6+ Rxb4 33.c3+! Rxc3 34.Da1+ Rd2 35.Db2+ Rd1 36.Ff1! Td2 (Dxf1 37.Dc2+, suivi du mat) 37.Td7! Txd7 38.Fxc4 bxc4 39.Dxh8 Td3 40.Da8 c3 41.Da4+ Re1 42.f4 f5 43.Rc1 Td2 44.Da7 1-0
Partie Kasparov contre le monde jouée en 1999 par internet
Kasparov contre le monde.
Incidents de jeu
En 1994, au tournoi de Linares, dans une partie qui l'oppose à Judit Polgár il joue un coup de cavalier 36…Cc5note 22 pour le reprendre aussitôt et jouer 36…Cf875, ce qui est contraire aux règles du jeu. Judit Polgár ne proteste pas, croyant qu'il n'y avait pas de témoins. L'incident a cependant été filmé.
En 2003, à Linares Jaén, il est dans une position désespérée face au jeune Teimour Radjabov, et plutôt que d'abandonner et de serrer la main de son adversaire comme c'est l'usage, il préfère quitter l'aire de jeu et perdre au temps. Il crée un nouvel incident lors de la cérémonie de clôture, alors que le prix de beauté est décerné à Radjabov.
En 2004, toujours à Linares, il quitte l'aire de jeu sans autorisation pendant une partie pour se rendre dans sa chambre d'hôtel afin, dit-il, de prendre des médicaments.
Liens
http://youtu.be/ZIcZymAzifM Kasparov/ Deep blue
http://youtu.be/AZrQQs1ze1U Victoire de l'homme sur la machine.
http://youtu.be/wPm9k6ul9EI (anglais)
http://youtu.be/JBUBLUnD2eU Kasparov/Karpov
Posté le : 12/04/2014 21:11
|
|
|
|
|
Cristobal Balenciaga |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 23 mars 1972 à Xàbia meurt Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, né le 21 janvier 1895 à Getaria, petit village de pêcheurs de la côte basque espagnole grand couturier.
Son style classique et épuré lui vaut de compter parmi ses clientes fidèles les Reines d'Espagne et de Belgique, la Princesse Grace de Monaco et la Duchesse de Windsor. Son travail a influencé de nombreux couturiers, tels que Oscar de la Renta, André Courrèges qui travailla dans son atelier, Emanuel Ungaro et Hubert de Givenchy. En 1968, le couturier décide de se retirer. La marque, appartenant de nos jours à Kering, est actuellement sous la direction de Alexander Wang depuis décembre 2012.
Après avoir fondé plusieurs maisons de couture en Espagne, il s'installa à Paris en 1937. Ses créations sobres, parfois même austères, comme ses fameuses robes noires, ou la somptuosité de ses robes du soir marquèrent les créateurs ultérieurs;
Sa vie
Début
Encouragé dans son enfance par la marquise de Casa Torres, la femme la plus élégante de son village natal, Guetaria, Cristobal Balenciaga, après un apprentissage chez un tailleur madrilène, ouvre un atelier personnel à Saint-Sébastien.
Devenu, peu avant la Première Guerre mondiale, chef d'atelier aux Magasins du Louvre à Saint-Sébastien, il se familiarise avec les modèles parisiens au cours de ses premiers voyages d'affaires en France. L'ouverture à Saint-Sébastien d'une maison Balenciaga vers 1915, puis à Madrid, marque une période de prospérité pour le couturier jusqu'en 1931, date de l'abdication du roi d'Espagne, Alphonse XIII. La fin de la vie de cour entraîne en effet pour Balenciaga la disparition des clientes fortunées.
Âgé de quarante ans, il ouvre une nouvelle maison à Barcelone 1935, baptisée Eisa, du nom de sa mère. La guerre civile qui déchire bientôt l'Espagne met un terme au développement de ce salon de couture. Décidé à faire carrière ailleurs qu'en Espagne, le couturier se rend en 1936 à Londres, et s'établit finalement à Paris en 1937.
Les premières collections parisiennes de Balenciaga font sensation. Il exploite, dans une série de robes du soir, toutes les ressources optiques du jeu des rayures verticales, horizontales, diagonales, croisées ou contrariées. La Seconde Guerre mondiale, qui marque pour certains couturiers parisiens la clôture de leurs maisons de couture, n'interrompt pas la progression de Balenciaga. Sa puissance de travail lui permet d'assurer, en une seule journée, l'essayage de cent quatre-vingts modèles, avec leurs accessoires. À la différence de beaucoup d'autres, il est, compte tenu de son apprentissage, capable de réaliser et de monter lui-même une toile prototype d'un modèle, de la coudre, puis d'exécuter le modèle avec ses finitions. Pendant la guerre, Balenciaga crée en particulier des robes de ville avec pouf drapé à l'arrière ou sur les hanches, des robes du soir dotées de boléros brodés comme ceux des toréadors, et compose des manteaux imperméables en fibranne, une étoffe de remplacement créée par Bucol. Balenciaga s'impose par sa maîtrise de la coupe et de la construction d'un vêtement.
Après avoir relancé l'emmanchure kimono, lancée par Poiret, il remet en question le rapport entre le vêtement et le corps : tandis que le new-look a apporté des robes aux corsages ajustés et aux tailles étranglées, Balenciaga définit peu à peu un style de tailleurs, de manteaux plus ou moins décollés du corps. Parmi les formules alors créées on notera les manteaux et tailleurs creusés devant et bombés derrière, baptisés ronde-bosse en 1951. Puis le couturier accentue son évolution vers une silhouette libre, dégageant le cou, aux épaules élargies, et effaçant la taille.
Au printemps de 1955, il présente la robe-tunique, étape majeure de cette émancipation du vêtement : le décolleté est rond et sans col, les manches trois quarts sont étroites, et la tunique sept huitièmes se porte sur un fourreau court ou long selon qu'il s'agit d'une tenue de ville ou du soir. Dans un genre tout autre, Balenciaga propose également des robes à danser, courtes, dont les jupes, froncées et bouillonnées, se drapent sur des jupons de dentelle, des manteaux de cocktail en faille, très amples, et des robes volantées, d'un esprit très flamenco.
En 1957, l'influence de Balenciaga est à son apogée : la robe-tunique, rebaptisée robe-sac, est copiée par tous les confectionneurs de prêt-à-porter. Cette proposition n'a pourtant qu'un succès limité auprès des femmes accoutumées aux mièvreries du new-look ; cette expérience illustre les limites de l'influence de la haute couture sur le prêt-à-porter.
La suprématie de Balenciaga s'est affirmée avec la disparition des ténors du new-look, Jacques Fath en 1954, Christian Dior en 1957. Chanel, revenue à Paris depuis 1954, prône également une mode dégagée des contraintes et des artifices. À partir de 1960, la coupe Balenciaga a atteint un tel degré de perfection et de simplicité qu'elle n'évolue presque plus. Citons pourtant les robes du soir courtes devant et plongeant en arrière, les tailleurs ceinturés de cuir, les ensembles en daim portés avec des bottes vernissées noires, les vestes-blousons sans col, ainsi que des robes du soir d'une grande audace formelle qui font ressembler les femmes à de grands insectes déployant leurs élytres, et surtout une fameuse robe de mariée en forme de cône, comportant une seule couture...
Cristobal Balenciaga, taciturne, austère, a toujours évité la publicité tapageuse. Sa maison de couture se signalait par deux règles : pas de robe prêtée ; pas de prix de faveur. Par opposition aux mannequins aguichants des autres couturiers, il a choisi pour mannequins des femmes élancées, plutôt hautaines, auxquelles il était interdit de sourire aux clientes : ce qui frappe le plus, dans les partis pris du couturier, c'est ce hiératisme farouche, très hispanique, qui peut, paradoxalement, s'exprimer à travers une somptuosité sensuelle ou une ostentatoire sobriété.
Ayant fermé sa maison de couture en 1968, Cristobal Balenciaga a créé une dernière robe en 1972, la robe de mariée de la petite-fille du général Franco.
Repères biographiques
1895 : naissance de Cristóbal Balenciaga à Getaria en Espagne1.
1907-1911 : installé à Saint-Sébastien, il devient apprenti tailleur.
1911 : à seize ans, il commence à travailler comme tailleur aux Grands magasins du Louvre à Saint-Sébastien, avant d'être nommé chef d'atelier de confection pour dames deux ans plus tard.
1914 : il part s'installer à Bordeaux et travaille un temps avec des amis.
1917 : revenu à Saint-Sébastien, il fonde sa propre entreprise, C. Balenciaga, sur la rue Vergara. L'année suivante, les sœurs Benita et Daniela Lizaso s'associent à lui et injectent des capitaux dans son entreprise qui portera désormais le nom de Balenciaga y Compañía.
1919 : ouverture de sa première maison de couture à Saint-Sébastien.
1924 : il installe une boutique de Couture sur l'avenue de la Liberté.
1925 : la renommée de Balenciaga s'accroît. Des membres de la famille royale et de la Cour font partie de sa clientèle.
1927 : il élargit sa clientèle en ouvrant une autre boutique plus traditionnelle, Eisa Costura sur la rue Oquendo, toujours à Saint-Sébastien.
1931 : des difficultés économiques obligent Balenciaga à revoir sa stratégie commerciale.
1932 : ouverture d'une maison de couture à Madrid, puis d'une autre à Barcelone, en 1935. Elles portent le nom d'Eisa, en référence à Eisaguirre, nom de sa mère.
Paris
1936 : Balenciaga fuit la guerre d'Espagne et arrive à Paris, après un détour par Londres, délaissant pour un temps ses trois boutiques espagnoles.
1937 : en juillet, il ouvre sa maison de couture au 10, avenue George-V1, en partenariat avec Nicolas Bizcarrondo et Wladzio Jaworowski d'Attainville. Le 5 août, Balenciaga présente sa première collection. Le succès est immédiat.
1939 : un autre défilé, où il présente cette fois une collection inspirée du Second Empire français, remporte lui aussi un vif succès.
1943 : il introduit l'usage de la broderie et la passementerie dans ses robes su soir. Durant la Seconde guerre mondiale, il continue son activité, mais ce sont les années après guerre qui lui apportent le plus de succès.
1947 : lancement de sa ligne tonneau qui attire l'attention du public et de son premier parfum, baptisé Le Dix, allusion à l'adresse de sa maison de couture à Paris.
1948 : ouverture de la boutique Balenciaga, toujours au 10 avenue George-V, boutique conçue par le décorateur Christos Bellos. La collection de cette année là est encensée par Carmel Snow, qui décidera alors de ne plus porter que du Balenciaga toute sa vie.
1949 : lancement du second parfum : La Fuite des Heures.
1950 : ses créations font appel aux manches melon, aux jupes ballon et à des tissus volumineux et lourds. L'année suivante, Balenciaga revient à des lignes plus fluides, avec des tailleurs semi-ajustés, cintrés devant et vague derrière ; cette ligne sera appelée par Carmel Snow du Harper's Bazaar la semi fitted look.
1955 : présentation de la tunique, robe étroite deux pièces aux lignes droites et épurées. Création de son troisième parfum : Quadrille .
1958 : le 12 mai, Balenciaga est fait Chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution à l'industrie de la mode. Il crée la même année les robes Baby Doll et en queue de paon, longues derrière et courtes devant.
1962 : lancement du parfum Eau de Balenciaga. Les parfums Balenciaga resteront une activité très annexe pour la maison.
1963 : Balenciaga lance une élégante ligne de vêtements de style sport et introduit les premières bottes haute couture.
1966 : Le Yorkshire Post titre La bombe Balenciaga.
1967 : son style devient de plus en plus épuré - à l'instar de la robe de mariée qu'il dessine cette année-là - et est acclamé par la presse internationale.
1968 : Balenciaga décide de se retirer en Espagne, et ferme sa maison de couture à Paris. Les années Courrèges et de la mini-jupe, son refus de pratiquer le prêt-à-porter qui a révolutionné la mode depuis quelques années, auront eu raison de sa créativité et il présente sa dernière collection haute couture.
1969 : le projet initié en janvier 1968 voit le jour : les uniformes des hôtesses de l'air navigantes de la compagnie Air France, dessinés par Cristóbal Balenciaga qui s'est engagé pleinement dans cette commande, sont mis en service au milieu de cette année là. Deux ans plus tard, la maison équipe le personnel au sol d'une tenue différente. Malgré tout, dès le début, les uniformes rencontrent de nombreuses critiques.
1972 : il crée la robe de mariage de Carmen Martínez-Bordiú y Franco.
Il meurt à Xàbia, le 23 mars. Balenciaga est enterré dans le petit cimetière de Getaria.
Cristóbal Balenciaga est largement reconnu par ses pairs durant et après sa carrière ; Christian Dior l'appelle notre Maître à tous. Reconnu également par les historiens de la mode comme l'un des plus grands, il est un couturier disposant d'une technique et d'une créativité immense.
Durant sa carrière, le couturier refuse la mode pour ce qu'elle est, préférant le travail de coupe et le dessin de la silhouette. Les parutions dans les plus grands magazines de mode, grâce entre autres au soutient clairement affiché des influentes Diana Vreeland et Carmel Snow qui le désigne comme le nec plus ultra de la mode, les photos d'Henry Clarke ou Louise Dahl-Wolfe, feront du couturier espagnol une légende de la mode à l'influence très importante, symbole des années 1950.
Rachat
1986 : acquisition de Balenciaga par le groupe Jacques Bogart.
1995 : premiers pas de Nicolas Ghesquière chez Balenciaga
1997 : Nicolas Ghesquière est nommé à la direction artistique, puis présente sa première collection de prêt-à-porter féminin. Il va transformer la marque dans les années suivantes.
2001 : acquisition de la Maison par la marque italienne Gucci, qui sera intégrée deux ans plus tard au département luxe du groupe PPR.
2011 : ouverture du musée Balenciaga au Pays basque.
2012 : arrivée de Alexander Wang à la direction artistique
L'œuvre
Considéré comme un des grands couturiers du xxe siècle, l'œuvre de Balenciaga a accompagné de près l'évolution vestimentaire de la femme durant la première moitié du siècle. Son style se caractérise par la sobriété, les combinaisons de couleurs audacieuses et son inspiration espagnole, comme les robes infante.
Durant les années quarante, il introduit des broderies et de la dentelle. Balenciaga puise dans le passé pour ses robes aux formes amples et arrondies, à l'opposé des silhouettes cintrées de Christian Dior.
Durant ses plus grandes années, vers 1950, il sera souvent opposé, avec ses lignes fluides, au New Look de Dior qui triomphe alors à Paris et dans le monde1 à partir de 1947. Viennent ensuite les lignes tonneau, au dos arrondi et à la taille décentrée, semi-ajustée, en 1951, la veste ballon en 1953 enveloppant le haut du corps dans un cocon, la robe tunique deux ans plus tard, et la robe-sac en 1957.
À la fin de sa carrière, son style évolue vers de plus en plus de sobriété, sans ornements superflus, où il fait montre de sa profonde connaissance des tissus.
Musée
Le Cristóbal Balenciaga Museoa a été inauguré en 2011 à Getaria, la ville natale de Balenciaga. Il occupe deux bâtiments, l'ancien Palais Aldamar construit au xixe siècle et une annexe moderne conçue par l'architecte Julián Argilagos. Le musée présente dans six salles la vie et l'œuvre de Balenciaga.
Tableau de son chien
Cristóbal Balenciaga avait un chien nommé Plume, un Yorkshire Terrier qui fut portraituré par Bernard Buffet en 1963, huile sur toile vente Alcala, Madrid 18-19 février 2009, lot .
Liens
http://youtu.be/jINBWTVVti8 Prèt à poter chez Balenciaga
http://youtu.be/a2eSrVBYX-4 Défilé Prèt à porter 2001
http://youtu.be/01CIgSA3FNs prèt à porter 2001
http://youtu.be/D_RI0dyvN4c Prèt à porter Automne 91
http://youtu.be/pY-IZCtrZ6E 95/95
http://youtu.be/W-8zPO7uHdc Défilé Hte coutre 50/60
http://youtu.be/-40FgSFrfoY Hte couture 1960
http://youtu.be/ecLSjFS7TzE Hommage à Balenciaga
Posté le : 22/03/2014 22:54
|
|
|
|
|
Marcel Griaule |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 23 Février 1956, à Paris, meurt Marcel Griaule, né à Aisy-sur-Armançon dans l'Yonne le 16 mai 1898, ethnologue français célèbre pour ses travaux sur les Dogons.
Professeur à la Sorbonne, conseiller de l'Union française, cet ethnologue avait une prédilection pour les recherches de terrain, il effectua de nombreux voyages d'étude en Afrique, notamment en Abyssinie, au Soudan français, au Tchad et en Oubangui-Chari, il est chargé d'une mission en Abyssinie en 1928-1929 et organise la traversée de l'Afrique centrale d'ouest en est.
Il organisa et dirigea, à la tête d'une importante équipe, la mission Dakar-Djibouti en 1931-1933, traversée qui permit d'accumuler une très vaste documentation ethnographique. Il fut le précurseur, en France, d'une nouvelle méthode d'enquête fondée en premier lieu sur l'observation exhaustive et continue d'une même population, ensuite sur l'analyse des systèmes de représentations élaborés par celle-ci pour rendre compte de son propre fonctionnement. Il consacra lui-même l'essentiel de ses efforts à l'étude intensive des Dogons des falaises de Bandiagara, dans la boucle du Niger, dont il chercha à restituer méthodiquement la pensée cosmologique et le savoir religieux. Griaule fut titulaire, à partir de 1942, de la première chaire d'ethnologie à la Sorbonne. Il fut conseiller de l'Union française dès la fondation de celle-ci en 1946. Il a publié notamment : Les Flambeurs d'hommes, Paris, 1934 ; Jeux dogons, Paris, 1938 ; Masques dogons, ibid. ; Dieu d'eau, entretiens avec Ogotemmêli, Paris, 1948, réédité en 1966 ; " L'Alliance cathartique " , in Africa, vol. XIX, Londres, 1948 ; "Remarques sur l'oncle utérin au Soudan", in Cahiers internationaux de sociologie, vol. XVI, Paris, 1954 ; Méthode de l'ethnographie, Paris, 1957 ; en collaboration avec avec Germaine Dieterlen Le Renard pâle, Le Mythe cosmogonique, publié à Paris en 1965, la création du monde selon les Dogons.
C'est au cours de cette mission qu'il observe les Dogons des falaises de Bandiagara an Mali, auxquels il consacrera l'essentiel de ses recherches : les Flambeurs d'hommes en 1934 ; Masques dogons 1938 ; Dieu d'Eau en 1949 ; le Renard pâle.
Sa vie
Marcel Griaule est issu d'une famille auvergnate du côté de son père et briarde du côté de sa mère. Il prépare le concours de l'École polytechnique en mathématiques spéciales au lycée Louis-le-Grand avant que la Première Guerre mondiale ne le pousse à interrompre ses études. Il suit une formation à l'école d'application d'artillerie de Fontainebleau et s'engage en 1917 dans l'aviation comme observateur aérien. Il reste au sein de l'armée de l'air jusqu'en 1921 où il participe en Syrie à la campagne contre les troupes turques.
En 1922, il reprend des études de langues et d'ethnologie à l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO et à l'École pratique des hautes études EPHE notamment auprès de Marcel Mauss et de Marcel Cohen. Après lui avoir délivré son diplôme d'amharique en 1927, ce dernier, qui a fait le voyage en 1910, l'envoie pour l'Éthiopie pour plusieurs mois en 1928 - 1929.
À son retour d'Abyssinie, Marcel Griaule publie avec l'aide de l'abbé Jérôme Gabra Moussié la traduction du Livre de recettes d’un dabtara abyssin que son maître avait ramené de son voyage de 1910 puis organise la traversée de l'Afrique d'ouest en est : c'est la mission Dakar-Djibouti de mai 1931 à février 1933, dont il prend la direction, accompagné de Michel Leiris, André Schaeffner et d'autres ethnologues, inaugurant à cette occasion l'ethnologie française de terrain.
Il rapporte de cette expédition plus de 3500 objets qui enrichiront les collections du Musée du Trocadéro et étudie pour la première fois les Dogons sur lesquels il fit la grande majorité de ses recherches par la suite de 1935 à 1939 au cours de cinq expéditions cumulant plus de 85 000 km parcourus.
À l'été 1933, une première exposition du fruit de cette mission se tient au Musée de l'Ethnographie.
Marcel Griaule rompt alors avec Michel Leiris qui publie simultanément le journal qu'il a tenu durant la mission, Afrique fantôme, dans lequel il dénonce la collecte et même le vol des objets à des fins non scientifiques. La même année, Marcel Griaule publie Silhouettes et graffiti abyssins et l'année suivante Les Flambeurs d’Hommes qui reprend trois articles parus dans la revue Documents et relatant son expédition en Abyssinie.
En 1936, il publie La Peau de l’Ours, réponse au Manifeste des intellectuels pour la défense de l’Occident de Maulnier, Gaxotte, Monseigneur Baudrillart, Béraud, Brasillach, Maurras et quelques autres soutenant l’agression de l’Éthiopie par l’Italie mussolinienne.
Dès 1935, il privilégie l'étude des Dogons. Il s'attache alors pour sa thèse de doctorat, qui paraît en 1938, à décrire les Jeux dogons et les Masques dogons1.
La Seconde Guerre mondiale l'oblige une nouvelle fois à interrompre son travail.
Il intègre comme capitaine dans l'aviation où il est décoré de la Croix de Guerre le 30 juin 1940. Démobilisé, il retourne à l'enseignement de l'ethnologie à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris à partir de décembre 1940 et devient secrétaire général de cet institut en décembre 1941, puis sous-directeur du Musée de l'Homme. En 1941, il remplace à l'INALCO son ancien professeur d'amharique, Marcel Cohen, interdit d'enseigner par les lois antisémites. En 1942, il est nommé directeur du laboratoire d'ethnologie de l'EPHE et en octobre de la même année directeur de la première chaire de la discipline enseignée à la Sorbonne.
De 1944 à 1946, il est remobilisé comme commandant dans l'aviation tout en continuant à dispenser ses cours.
Après la guerre, il se réinvestit intensément dans l'étude des peuples de la boucle du Niger. Toujours très attaché au peuple Dogons, il décrit alors leur richesse culturelle en particulier au niveau de leur cosmogonie spécifique qu'il qualifie d'aussi riche que celle d'Hésiode, une métaphysique et une religion qui les met à la hauteur des peuples antiques. Il publie alors de nombreux ouvrages sur ses recherches.
En 1947, il est également conseiller de l'Union française dont il présidera la Commission des Affaires culturelle jusqu'à sa mort. Au Mali, il participe au développement de la région en construisant en particulier un barrage d'irrigation pour la culture de l'oignon et du piment dans la région de Sangha. Ce barrage, toujours opérationnel, porte aujourd'hui son nom.
Il a travaillé, entre autres, avec Germaine Dieterlen et sa fille Geneviève Calame-Griaule. À sa mort en 1956, il fut l'un des rares ethnographes à bénéficier de funérailles traditionnelles africaines.
Apports scientifiques
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Un de ses apports essentiels, relatif à l'ethnographie est d'avoir démontré que la cosmogonie dogon, orale est au moins aussi importante que les cosmogonies occidentales. Il sera toutefois très critiqué pour avoir sous-estimé l'influence occidentale dans les connaissances astronomiques des Dogons.
Ces critiques provenaient de personnes tendant à sous-estimer systématiquement les connaissances et la valeur propre des systèmes symboliques africains.
Il a eu raison de les relier aux systèmes égyptiens anciens, quoique le chemin réel du transport des thèmes constitutifs de la cosmogonie africaine aille plutôt à l'inverse de ce qu'il envisageait, de l'Afrique vers l'Égypte et non de la vallée du Nil vers l'Afrique soudanaise.
Ouvrages
Silhouettes et graffiti abyssins, préface de Marcel Mauss, éditions Larose, 1933.
Les Flambeurs d'hommes, éditions Calmann-Levy, 1934.
Masques dogons, 1938. 4e édition 1994, réimprimée en 2004. Publications Scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle. 890 p. + XXXII.
Jeux dogons, 1938.
Les Sao légendaires, éditions Gallimard, 1943.
Dieu d'eau, entretiens avec Ogotemmeli, ouvrage qui révèle les structures de la pensée sacrée dogon), 1948.
Les Grands Explorateurs, 1948
Méthode de l'ethnographie, 1957.
Renard pâle, ethnologie des Dogons, Institut d'Ethnologie, 1965/1991, en collaboration avec Germaine Dieterlen.
Descente du troisième Verbe, éditions Fata Morgana, Collection Hermès, 1996.
Liens
http://youtu.be/4bZXYB3U2FM the west africain M. Griaule
http://youtu.be/Eo0HwPT0Zng Les Dogons aujourd'hui
http://youtu.be/4S1M7cb1CIA les Dogons (Anglais)
http://youtu.be/pfvr6PczyAo Traditions funérailles
Posté le : 21/02/2014 14:27
Edité par Loriane sur 22-02-2014 23:10:51
Edité par Loriane sur 22-02-2014 23:17:38
Edité par Loriane sur 22-02-2014 23:22:39
Edité par Loriane sur 22-02-2014 23:24:56
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
55 Personne(s) en ligne ( 46 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 55
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages