|
|
Une histoire aux poils |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Beauté Poils et barbe, que d'histoires !
Il suffit de se promener dans les rues pour le remarquer : le poil est de retour ! Ce nouveau béguin n'est qu'une étape de plus dans une histoire longue et particulièrement touffue.
Avant l'arrivée, au pied du sapin, du barbu préféré des enfants, penchons-nous de près sur cet accessoire de séduction masculine.
La barbe à laquelle il ne faut pas s’accrocher…
Bien sûr, c’est celle du père Noël ! Il l’aurait héritée de saint Nicolas qui, en tant qu’évêque du IIIe siècle, avait une fort belle toison certainement blanche, symbole de sagesse et de bonté. N’avait-il d’ailleurs pas ressuscité des enfants ? Il devint logiquement le protecteur des plus jeunes et acquit une immense popularité dans les pays germaniques qui le fêtent toujours le 6 décembre.
Arrivé dans le Nouveau Monde dans les bagages des migrants hollandais du XIXe siècle, il est renommé Santa-Claus (déformation du néerlandais Sinter-Klaas) et apparaît sous diverses apparences, vieil homme ou lutin.
C’est en 1931 qu’il prend son aspect définitif de grand-père bienveillant grâce au talent de Haddon Sundblom. Celui-ci, jusque-là connu pour ses dessins de pin-up, est à la recherche d’un personnage attachant pour faire la publicité de Coca-Cola. Il va s’inspirer des représentations déjà existantes d’un vieux barbu débonnaire, en lui associant les couleurs symboliques de la marque. Cette création géniale va nourrir de façon incroyable la légende du père Noël, qui va certainement continuer longtemps à envahir pacifiquement nos mois de décembre.
Nos ancêtres velus
Rhinocéros, mammouth... tous ont été qualifiés de velus par les spécialistes admiratifs de leur toison impressionnante.
Et l'homme de cette époque ?...
Paradoxalement, celui-ci n'a pratiquement plus un poil sur le dos. Si son ancêtre Homo erectus, il y a 2,5 millions d'années, était protégé par une fourrure particulièrement dense, ce n'est plus le cas pour Homo sapiens.
Ce « singe nu » (Desmond Morris) aurait perdu la plus grande partie de sa toison en s'exposant à la fournaise de la savane, pour aider la peau à respirer !
Ce dépouillement lui aurait aussi permis de chasser les parasites, nombreux dans les régions tropicales... et d'attirer et séduire les femelles.
Le processus se serait poursuivi lors de son émigration sous des cieux plus septentrionaux, où sa peau aurait eu besoin de mieux capter les rayons ultraviolets...
Ou est-ce l’effet dévastateur du frottement des premiers vêtements sur les poils ? Cette hypothèse évolutionniste semble bien improbable : pourquoi en effet les cinq millions petits follicules qui continuent à protéger nos zones érogènes et crâniennes auraient-ils dans ce cas échappé à l'hécatombe ?
Dis-moi combien tu as de poils...
Le poil a alimenté nombre de thèses plus ou moins racistes lorsque les explorateurs et les scientifiques se sont aperçus que les groupes humains étaient plus ou moins velus.
La découverte de l'Amérique et de ses habitants imberbes, en particulier, les a plongés dans une grande perplexité. Voici l'explication de Georges Buffon, au XVIIIe s. : « Le Sauvage est faible et petit par les organes de la génération ; il n'a ni poils, ni barbe, ni nulle ardeur pour sa femelle […]. » Le faible peuplement de l'Amérique serait donc dû à l'absence de poils, révélateur d'une vigueur sexuelle défaillante...
Un siècle plus tard, Charles Darwin avance l'hypothèse d'un retour à un stade inférieur : « [ …] il ne faut pas supposer que les races les plus velues, telles que celle des Européens, ont conservé leur condition primordiale d’une façon plus complète que les races nues, tels que les Kalmouks ou les Américains. Il est plus probable que la pilosité des premiers soit due à un retour partiel […]. Nous avons vu que les idiots sont souvent très velus et qu’ils ont tendance à faire retour, pour d’autres caractères, à un type animal inférieur » (La Filiation de l’Homme et la sélection liée au sexe, 1877).
Aujourd’hui on met en avant un mélange de génétique et de climat pour expliquer les différences de pilosité à travers le monde. Plus d’harmonie aurait-il bouleversé le cours de l’Histoire ? On peut se le demander quand on sait, comme l’explique Montaigne, que les habitants du Nouveau Monde ont été terrifiés « de voir arriver aussi inopinément des gens barbus, différents d'eux par le langage, la religion, par l'aspect extérieur et le comportement » (Essais, 1580). Si Colomb avait eu un rasoir, la face du monde en aurait peut-être été changée !
Barbes, bouclettes et balayettes
Une chose est sûre : dès l'arrivée des premières civilisations, le poil commence à en voir de toutes les couleurs. Il rappelle en effet l'animal en nous, qu'il faut apprivoiser à force de tresses et de coups de rasoirs.
À Babylone, le roi se doit lors de son couronnement d'être pur, c'est-à-dire parfaitement imberbe : le mot « rasé » est d'ailleurs utilisé pour indiquer sa consécration en tant que souverain. Cet exemple rappelle la phobie du poil dans le monde sacerdotal, toujours d'actualité dans certaines religions, notamment dans l'Asie bouddhiste.
Pour les nobles, la barbe fait office de carte de visite : bichonnée pendant des heures, elle est disposée en de multiples boucles sur une grande partie du visage et peut descendre au milieu de la poitrine dans de savants entrelacs.
Les Assyriens vont suivre cette mode en portant une attention toute particulière à la moustache, qu'ils n'hésitent pas à collectionner comme trophée de guerre.
Mais pas de pitié pour les vaincus : ils doivent balayer le sol avec leur barbe, en signe de total respect. On ne plaisante pas en effet avec la portée symbolique des poils du visage : ne sont-ils pas symboles de virilité et de puissance ?
Les poils entrent en religion
C'est clair : « Tu ne couperas pas les coins de ta barbe » (Lévitique, 19, 27). Les Hébreux en effet la chérissaient au point de lui confier leur honneur. C'est pourquoi le roi David, dont les émissaires avaient eu la barbe coupée à moitié par le roi des Ammonites qui craignait qu'ils ne soient des espions, refusa de les recevoir tant que leurs poils n'auraient pas repoussé. On ne plaisante pas avec le protocole !
Difficile de savoir précisément quelle était la mode de l’époque faute de représentation iconographique de l’Homme, interdite par les textes. On sait par contre à quoi ressemble Dieu ! L’Homme n’a-t-il pas été formé à son image ? Barbu, donc… tout comme sera représenté le Christ.
Cela n’a pourtant pas toujours été le cas : à l’origine, on le trouve très souvent imberbe sous les traits du Bon Pasteur.
Mais alors, pourquoi cette barbe qui nous est si familière ? Il semble qu’elle soit apparue à Byzance après la crise iconoclaste qui avait vu disparaître pendant plus de 100 ans (723-843) les images divines.
Pour représenter de nouveau Jésus, les peintres se seraient simplement inspiré du modèle parfait du croyant : le moine.
Par opposition aux eunuques et aux jeunes hommes glabres, considérés comme attirants, les religieux avaient choisi de laisser disparaître leur visage sous une énorme barbe.
Un peu plus loin à la même époque, en terres d’islam, le prophète Mahomet l’aurait lui aussi adoptée, encourageant dans un hadith (communication orale) ses fidèles à faire de même.
Notons que, même si le culte des reliques est interdit dans le monde musulman, on conserve au palais de Topkapi à Istanbul des poils qui seraient issus de la barbe du Prophète. Aujourd’hui la barbe est pour beaucoup d’Occidentaux perçue comme un des premiers signes de radicalisation et d’appartenance à l’islam radical, au point d’avoir donné naissance au surnom de « barbus » pour désigner les extrémistes musulmans.
Honni soit le poil
L'Égypte, célèbre pour son raffinement, ne pouvait que faire la guerre aux poils.
Priorité est donnée aux peaux parfaitement nettes, que ce soit celle des prêtres bien sûr, mais aussi de tout un chacun. Pas trace d'un reflet de moustache sur les représentations !
Pourtant les anciens Égyptiens avaient bien compris la charge symbolique de la barbe puisqu'ils en imposaient le port à leurs pharaons comme ci-contre l'immortel Toutânkhamon, mais il ne s'agissait que de postiches !
Même Hatshepsout ne put prévaloir de sa féminité pour y échapper !
De l'autre côté de la Méditerranée, en Grèce, le poil retrouve un peu de son lustre sous la forme de belles barbes bien viriles qui vont agrémenter les joues des dieux et des héros comme Ulysse.
Ne dit-on pas que les guerriers de Sparte coupaient la moitié de la moustache de leurs hommes accusés de lâcheté ?
Les philosophes ne sont pas en reste : « Plus le menton est broussailleux, plus la sagesse est grande » aurait pu dire Socrate, surnommé « le maître poilu ».
Par contre, si l'on accepte la représentation de quelques toisons pubiennes masculines, pas question de détailler le moindre duvet intime chez la femme ! Vous ne trouverez également pas de jambes velues, à l'exception des belles gambettes des satyres : à l'exemple des gymnastes, tous multiplient les séances d'épilation par application de noix brûlantes ou arrachage avec de la résine. Il faut souffrir pour être beau !
Je te tiens par la barbichette !
Il suffit d'une bataille pour voir le poil disparaître des joues des Hellènes...
Alexandre le Grand, lui-même glabre et néanmoins rusé, se rendit compte un jour que l'ennemi n'hésitait pas à s'accrocher aux barbes de ses soldats pour mieux les immobiliser.
Qu'à cela ne tienne : il ordonna à toute la troupe de passer chez le barbier avant le choc de la plaine de Gaugamèles (ou Arbèles) contre Darius. Victoire !
Rome ne suivit pourtant pas l'exemple, allant jusqu'à faire du premier coup de rasoir une cérémonie solennelle marquant l'entrée dans l'âge adulte.
Ce n'est qu'après 49 ans que l'on redécouvrait le feu de la lame, pour paraître plus jeune !
Par la suite, les habitudes ne cessèrent de varier : les intellectuels ou ceux qui voulaient passer comme tels continuèrent à chérir la pilosité même au point que Plutarque dut rappeler que « la barbe ne fait pas le philosophe ».
Pour les nobles, si chaque grande demeure devait avoir son tonsor à domicile, il ne fallait tout de même pas devenir phanérophobique, comme l'apprit César à ses dépens : « Il portait le soin de lui-même jusqu'à la gêne : on lui reprocha de se faire arracher les poils après qu'on l'avait rasé » (Suétone, Vie des douze Césars, 121 ap. J.-C.).
Il faut attendre l'empereur Hadrien, au IIe siècle, pour voir réapparaître de belles barbes dans un but de dissimulation : l'empereur souhaitait recouvrir en effet d'un voile efficace les cicatrices ou taches qui le défiguraient. Ses descendants suivirent son exemple, comme Julien l'Apostat (331-363) surnommé Capella (la chèvre) lors de son séjour dans l'imberbe Antioche. Pour se venger, celui qui voulait ressembler aux philosophes antiques rédigea une satire intitulée Misopogon (L'Ennemi de la barbe). Comme quoi les affaires de poils peuvent occuper au plus haut sommet de l'État !
Autoportrait d'un empereur poilu
« Et d'abord commençons par le visage. La nature, j'en conviens, ne me l'avait donné ni trop beau, ni agréable, ni séduisant, et moi, par une humeur sauvage et quinteuse, j'y ai ajouté cette énorme barbe, pour punir, ce semble, la nature de ne m'avoir pas fait plus beau. J'y laisse courir les poux, comme des bêtes dans une forêt : je n'ai pas la liberté de manger avidement ni de boire la bouche bien ouverte : il faut, voyez-vous, que je prenne garde d'avaler, à mon insu, des poils avec mon pain. Quant à recevoir ou à donner des baisers, point de nouvelles : car une telle barbe joint à d'autres inconvénients celui de ne pouvoir, en appliquant une partie nette sur une partie lisse, cueillir d'une lèvre collée à une autre lèvre cette suavité dont parle un des poètes inspirés de Pan et de Calliope, un chantre de Daphnis. Vous dites qu'il en faudrait faire des cordes : j'y consens de bon cœur, si toutefois vous pouvez l'arracher et si sa rudesse ne donne pas trop de mal à vos mains tendres et délicates. Que personne de vous ne se figure que je suis chagriné de vos brocards : j'y prête moi-même le flanc, avec mon menton de bouc, lorsque je pourrais, ce me semble, l'avoir doux et poli comme les jolis garçons et comme toutes les femmes à qui la nature a fait don de l'amabilité. [...] Mais pour moi ce n'est pas assez de cette longue barbe, ma tête aussi n'est pas bien ajustée : il est rare que je me fasse couper les cheveux ou rogner les ongles, et mes doigts sont presque toujours noircis d'encre. Voulez-vous entrer dans les secrets ? J'ai la poitrine poilue et velue, comme les lions, rois des animaux, et je ne l'ai jamais rendue lisse, soit bizarrerie, soit petitesse d'esprit. II en est de même du reste de mon corps ; rien n'en est délicat et doux. Je vous dirais bien s'il s'y trouvait quelque verrue, comme en avait Cimon ; mais c'en est assez ; parlons d'autre chose » Julien, Misopogon, .
(...)
Posté le : 22/12/2015 16:30
|
|
|
|
|
Maximilien de Sully |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 décembre 1559 naît Maximilien de Béthune, duc de Sully
né à Rosny et mort à Villebon le 22 décembre 1641, pair de France, maréchal de France, prince souverain d'Henrichemont et de Boisbelle, baron puis marquis de Rosny, marquis de Nogent-le-Rotrou, comte de Muret et de Villebon, vicomte de Meaux, est un militaire protestant et un compagnon d'armes du roi Henri IV de France dont il devint l'un des principaux conseillers.
Ses grades militaires sont Maréchal de France, il participe aux conflits de Guerres de religion, guerre franco-savoyarde, ses faits d'armes sont la bataille de Coutras, la bataille d'Arques, la bataille d'Ivry, le siège d'Amiens, le siège de Charbonnières, le siège de Montmélianses distinctions sont Pair de France, ses autres fonctions sont surintendant des finances en 1598, grand maître de l'artillerie de France en 1599, grand voyer de France en 1599, gouverneur de la Bastille en 1602, surintendant des fortifications. Il appartient à la maison de Béthune, son père est François de Béthune, sa mère Charlotte Dauvet, il a pour épouse Anne de Courtenay, puis Rachel de Cochefilet, ses enfants sont Maximilien, François, Marguerite et Louise
En bref
L'une des figures les plus populaires de l'histoire française, Sully est devenu presque légendaire avec sa phrase sur le labourage et le paturage. Cadet d'une famille protestante, il prend part aux campagnes du jeune Henri IV, ce qui lui vaut une ascension politique rapide : directeur des Finances et surintendant général en 1596, grand maître de l'artillerie et des fortifications ainsi que grand voyer en 1599, surintendant des Bâtiments en 1604, gouverneur du Poitou, enfin duc et pair en 1606. L'historien doit nuancer une image trop classiquement univoque : souple plus qu'on ne l'a dit, capable d'entrer en négociations secrètes avec les Guise, Sully a été poussé au pouvoir par Gabrielle d'Estrées. Tallemant des Réaux, qui ne l'aime guère, assure que « jamais il n'y eut surintendant plus rébarbatif. Comme il est ladre et intéressé, sa politique financière manque de dynamisme. Il faut, cependant, mettre à son actif une stricte économie qui permet de réaliser, à partir de 1600, des excédents budgétaires notables. Les moyens utilisés sont très empiriques. La réduction réelle mais temporaire de la taille est compensée par une conversion de la dette, procédé classique, indispensable et efficace, mais mené sans ménagement aucun, surtout pour les petits rentiers. L'augmentation des recettes provient de celle des impôts indirects. Au-delà de ces mesures techniques, Sully est un terrien ne voyant de prospérité que par la terre : il encourage les réformes de l'agriculture et l'élevage du ver à soie préconisés par Olivier de Serres. Sully se méfie des innovations commerciales, mais facilite la circulation des marchandises par l'abolition de nombreux péages et la construction de ponts et de routes. Il est responsable, avec Paulet, de l'institution de l'impôt intitulé la paulette 1604 qui légalise progressivement l'hérédité des charges. Cet impôt constitue l'une des innombrables ressources extraordinaires dont Sully fait usage. Après l'assassinat de Henri IV, Sully fit partie du conseil de Régence jusqu'en 1616. Quoique directement visé par la création de la Chambre royale de 1617 et refusant d'abjurer le protestantisme, il s'abstient de participer aux révoltes des Rohan et utilise ses loisirs pour rédiger son autobiographie justificatrice, intitulée Mémoires des sages et royalles économies d'estat, domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand. Il s'y attribue un rôle extraordinaire. Dans la réalité, Henri IV a toujours su équilibrer dans son entourage tous les courants importants, quitte à imposer sa volonté. Jean Meyer
Sa vie
Né le 13 décembre 1559 au château de Rosny-sur-Seine, il appartient à la branche cadette, peu fortunée et calviniste, d'une famille descendante des comtes souverains d'Artois, apparentée aux comtes de Flandres. Second fils de François de Béthune et de Charlotte Dauvet1, il devient l’héritier de la baronnie de Rosny à la mort de son frère aîné, Louis de Béthune, en 1578. En 1572, élève au collège de Bourgogne, à Paris, il échappe au massacre de la Saint-Barthélemy, et devient le compagnon du roi Henri III de Navarre, futur roi de France, qu'il suit dans toutes ses guerres. À ses côtés il se distingue par son intrépidité. En 1576, il combat dans les armées protestantes en Hollande pour récupérer la vicomté de Gand dont il n'avait pu hériter de son parrain, un catholique convaincu.
En 1583, au château de Bontin, le seigneur de Rosny épouse Anne de Courtenay, une riche héritière. Des spéculations commerciales très heureuses, comme le commerce des chevaux pour l'armée, voire les dépouilles des villes prises par les Protestants l’enrichissent en peu de temps. En 1580, il devient chambellan ordinaire, puis membre du Conseil de Navarre. Il est chargé de négocier avec Henri III de France, afin de poursuivre une lutte commune contre la Ligue des Guise. Mais le traité de Nemours en 1585 rapproche le roi de France des Guise aux dépens du roi de Navarre. En 1587 commence son compagnonnage avec le roi Henri de Navarre, il combat à côté d'Henri de Navarre à Coutras, puis devant Paris, ensuite à Arques en 1589, puis à Ivry en 1590 où il est blessé. Il est de nouveau blessé à Chartres en 1591. Devenu veuf, il épouse en 1592 Rachel de Cochefilet, fille de Jacques de Cochefilet seigneur de Vaucelas. Entretemps le roi Henri III de France a été assassiné.
Le ministre
En 1593, Sully conseille au nouveau roi de se convertir au catholicisme, afin de pacifier le royaume, mais refuse lui-même d’abjurer. Il négocie alors le ralliement de quelques chefs de la Ligue, marquis de Villars, duc de Guise. Lors du siège d'Amiens en 1597, il s'illustre à la tête de l’artillerie.
Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598, surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.
Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures, l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'histoire de la soie par la plantation de millions de mûriers.
Il fait rentrer un arriéré fiscal considérable, paie des dettes écrasantes près de 30 millions de livres, suffit aux dépenses des guerres en Espagne et en Savoie, et à l'achat des places qui restent encore aux mains des chefs ligueurs. En 1598, il fait annuler tous les anoblissements décrétés depuis 20 ans. Il supprime les petits offices de finances et judiciaires. Il crée de grands approvisionnements de guerre, lutte contre l'abus et les prodigalités et amasse un trésor, 300 000 livres tournois par an, soit 4 millions d'euros actuels tout en diminuant les impôts. Il fait restituer au roi une partie du domaine royal qui avait été aliénée. L’arrivée en Europe des métaux précieux américains, depuis le début du siècle, a permis à Sully comme à ses prédécesseurs de bénéficier de rentrées fiscales, mais lui va équilibrer le budget et faire des économies. Il se fait nommer gouverneur de la Bastille en 1602, où il entrepose une partie du trésor royal qui s'élève à 12 millions de livres.
Aux environs du 25 août 1600, durant la guerre franco-savoyarde, le Roi Henri avait envoyé le duc de Sully visiter plusieurs citadelles qui étaient investies. Sully vint coucher à Bourg-en-Bresse où il fut bien accueilli par Biron. Le jour de son départ pour Lyon, Sully reçut un avis qu'un groupe de 200 hommes ennemis venaient d'arriver dans un château proche du lieu où il devait passer la nuit. Sully demanda à Biron de lui donner une escorte jusqu'à Lyon. Biron donna comme escorte ses propres gardes qui accompagnèrent Sully jusque Villars où l'escorte le quitta. Je fis recharger mes mulets et fis encore environ 4 lieues et ne m'arrêtai qu'à Vimy ou je me crus en sûreté. Le doute que j'avais, que Biron avait entrepris de me livrer au duc de Savoie, se changea alors en certitude. Trois heures après que je fut parti de Villars, les 200 hommes vinrent fondre sur la maison ou ils croyaient que j'étais, et parurent très fâchés d'avoir manqué leur coup.
Le 29 août, Sully est à pied d’œuvre lors du siège du château de Charbonnières en tant que grand maître de l'artillerie de France.
La paulette est instaurée en 1604, pour instituer l'hérédité des offices et augmenter les recettes de l'État.
En 1599, il est nommé Grand maître de l'artillerie de France et Grand voyer de France, il contrôle alors toutes les voies de communication. Les routes principales sont retracées, remblayées, pavées. En prévision des besoins en constructions et de la marine, il fait planter des ormes aux bords des routes les fameux ormes de Sully.
Il encourage surtout l'agriculture en répétant une phrase devenue célèbre : Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou. Dans ce but, il proclame la liberté du commerce des grains, et abolit un grand nombre de péages qui sont autant de barrières entre les provinces, il ouvre de grandes voies de communication, et il fait creuser plusieurs canaux, notamment le canal de Briare qui relie la Seine à la Loire, commencé en 1604 et terminé en 1642.
Il va pousser les paysans à produire plus que nécessaire afin de vendre aux autres pays. Pour cela, il décide d'augmenter la surface cultivée en faisant assécher des marais. Afin de les protéger du fisc, il interdit la saisie des instruments de labour et accorde aux paysans une remise sur les arriérés de la taille. Il va aussi faire cesser la dévastation des forêts, étendre la culture de la vigne…
Comme surintendant des fortifications il fait établir un arsenal et fortifie les frontières. En 1606, il est nommé duc et pair de Sully et acquiert, la même année, le château de Montrond, le rénove entièrement pour en faire la plus forte place du Berry.
La mise à l'écart
Mémoires, édition originale de 1639
Il était devenu impopulaire, même parmi les protestants, et auprès des paysans qu'il avait dû accabler d'impôts pour faire face aux dépenses en vue de la guerre contre l'Espagne
Après l'assassinat d'Henri IV en 1610, il est nommé membre du Conseil de régence et prépare le budget de 1611. En complet désaccord avec la régente Marie de Médicis, il démissionne de ses charges de surintendant des finances et de gouverneur de la Bastille 1611 ; il conserve cependant le gouvernement du Poitou. En 1616, il abandonne la majeure partie de ces fonctions et vivra désormais loin de la cour, d'abord sur ses terres de Sully puis surtout en Quercy, tantôt à Figeac et plus précisément à Capdenac-le-Haut tantôt sur sa seigneurie de Montricoux, à quelques lieues de Montauban. Il se consacre à la rédaction de ses mémoires, mais reste très actif sur le plan politique et religieux. Son fils François de Béthune, comte d'Orval est le gouverneur de Figeac, place de sûreté calviniste.
Ce dernier épouse Jacqueline de Caumont, fille du marquis de la Force, qui commande la défense militaire de Montauban en 1621.
Cette même année, il est intervenu en conciliateur et a intercédé en modérateur dans les luttes entre les protestants français et la royauté, après les 96 jours du siège de Montauban par Louis XIII, en 1627-1628, lors du siège de La Rochelle et avant la reddition de Montauban. Proche du réseau diplomatique de Richelieu, il a été nommé maréchal de France en 1634.
Il décède au château de Villebon Eure-et-Loir le 22 décembre 1641. Son tombeau est à Nogent-le-Rotrou7.
Alliances et descendance
Maximilien de Béthune se marie deux fois :
en 1583, avec Anne de Courtenay 1564-1589, à l'église Saint-Eustache de Paris dont :
Maximilien II de Béthune, qui continue la lignée ;
en 1592, avec Rachel de Cochefilet, veuve du seigneur de Châteauperse 1562-1659, dont :
François de Béthune, duc d'Orval ;
Marguerite qui épouse Henri II de Rohan, et postérité ;
Louise qui épouse Alexandre de Lévis Mirepoix, maréchal de la Foi.
Sources manuscrites
Les papiers personnels de Maximilien de Béthune sont conservés aux Archives nationales sous la cote 120AP.
Sources imprimées
Les Œconomies royales de Sully, éditées par David Buisseret et Bernard Barbiche, tome I 1572-1594, tome II 1595-1599, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1970-1988. Consultable sur Google Livres
Travaux historiques
Bernard Barbiche et Ségolène de Dainville-Barbiche, Sully, l'homme et ses fidèles, Paris, Fayard, 1997.
Isabelle Aristide, La fortune de Sully, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, collection Histoire économique et financière de la France, 1990.
Laurent Avezou, Sully à travers l'histoire. Les avatars d'un mythe, École des Chartes, collection « Mémoires et documents de l'École des Chartes, 2001.
Laurent Avezou, Du retour aux sources à la nostalgie du bon vieux temps. Sully dans les arts de Louis XVI à Louis-Philippe, in Bibliothèque de l'école des chartes, no 163-1, 2005, p. 51-78.
Collectif, Sully tel qu'en lui-même. Journée d'études tenue à Sully-sur-Loire le 23 octobre 1999, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, collection « Histoire économique et financière de la France , 2004.
Germán A. de la Reza, La invención de la paz. De la República cristiana del duque de Sully a la Sociedad de naciones de Simón Bolívar, Siglo XXI Editores, México, 2009 170 p..
Divers
Hôtel de Sully
Maison de Béthune
Château de Sully-sur-Loire
Principauté souveraine de Boisbelle
Henrichemont
Sully a sa statue parmi les Hommes illustres Louvre
Chronologies
Maximilien de Béthune duc de Sully Précédé par Suivi par Nicolas de Harlay sieur de Sancy Surintendant des finances, Guillaume de L'Aubespine, Pierre Jeannin, Jacques-Auguste de Thou création du poste
Ministre Principal d'Henri IV 1589-1610
      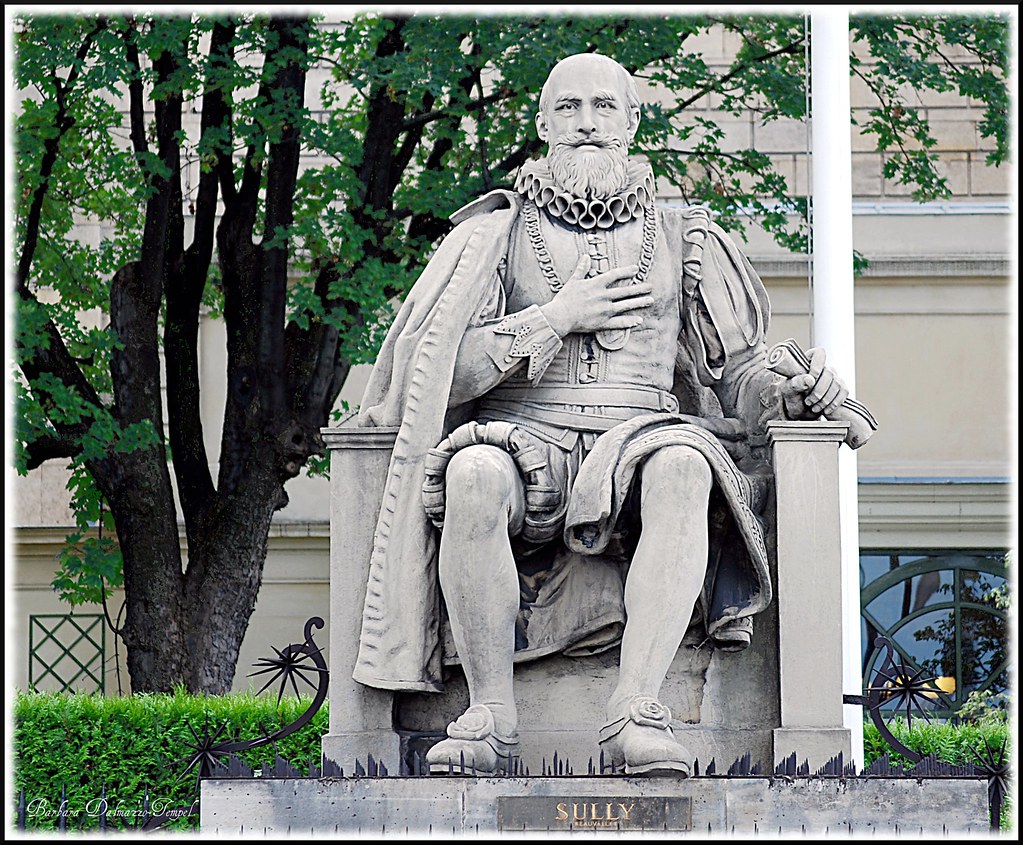 
Posté le : 12/12/2015 21:22
Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:11:20
|
|
|
|
|
Henri IV 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 décembre 1553 à Pau naît Henri IV
surnommé Henri le Grand, né Henri de Bourbon et assassiné le 14 mai 1610 à Paris, roi de Navarre Henri III de Navarre, 1572-1610 puis roi de France et de Navarre 1589-1610, premier souverain de la branche dite de Bourbon de la dynastie capétienne.
Il était le fils de Jeanne III, de son nom patronymique Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, descendant du roi Louis IX et premier prince du sang. En vertu de la loi salique cette filiation fera d'Henri le successeur naturel du roi de France à la mort de François, duc d'Anjou frère et héritier du roi Henri III, en 1584.
Roi de France du 2 août 1589 au 14 mai 1610 soit 20 ans 9 mois et 12 jours. Le Couronnement a lieu le 27 février 1594, en la cathédrale de Chartres son premier ministre est Maximilien de Béthune. Son prédécesseur est Henri III. son successeur Louis XIII. Il est Roi de Navarre sous le titre Henri III du 9 juin 1572 au 14 mai 1610 durant donc 37 ans 11 mois et 5 jours. Son prédécesseur est Jeanne III, son successeur est Louis XIII. Il appartient à la maison de Bourbon. Son père est Antoine de Bourbon, duc de Vendôme et sa mère est Jeanne III de Navarre. Il épouse Marguerite de Valois de 1572 à 1599, puis Marie de Médicis de 1600 à 1610. Ses Enfantsspnt Louis XIII, Élisabeth de France, Christine de France, Monsieur d’Orléans, Gaston de France, Henriette de France, Héritier Charles de Bourbon 1589-1590, Henri de Bourbon-Condé
dr1590-1601, Louis de France de 1601 à 1610. Il a sa résidence au Palais du Louvre
Confronté aux guerres de religion, il y fut d'abord impliqué en tant que prince du sang et chef protestant avant d'accéder au trône de France baptisé catholique à sa naissance, il changea plusieurs fois de religion avant son accession au trône. Pour être accepté comme roi de France, il se reconvertit à sa religion d'origine, le catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, traité de paix tolérant dans certaines limites le culte protestant, qui mit fin à deux décennies de guerres de religion. Alors qu'il préparait une guerre contre l'Espagne, il fut assassiné le 14 mai 1610 par un fanatique charentais, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris.
En bref
Nul roi ne fut, de son vivant, plus passionnément discuté. Nul non plus ne fut, mort, plus pleuré, adulé. Nul crime politique n'a tant « choqué » les contemporains que l'assassinat du 14 mai 1610. Personnalité complexe, Henri IV est entré dans l'histoire française comme le symbole d'un monarque idéal, tel que pouvait le rêver l'opinion française de 1789 ; de même, il a servi de porte-drapeau à la Restauration.
En fait, ce Gascon était capable des pires coups de tête. Sceptique, indulgent, politique sachant pardonner, chef de guerre avisé payant de sa personne, il est, tout autant, l'autoritaire né. Peu porté à croire aux hommes, il s'est tourné passionnément vers les femmes, qu'il a aimées au point de leur donner, par moments, barre sur sa politique. Il serait aisé de multiplier ces contradictions. Suivre le destin de l'homme, le confronter à l'atmosphère générale d'une France en pleine crise, dont la moins grave n'est pas celle des mentalités : telle est la double nécessité qui, d'emblée, s'impose. Plus que l'atavisme, plus que les doctrines, ce sont les circonstances qui ont forgé le monarque. Et cependant, l'étonnant personnage qu'il s'est, en partie et très complaisamment, forgé lui-même domine une génération troublée. La conquête du royaume De l'adolescent au chef de parti : Né à Pau en 1553, il tient de son père Antoine de Bourbon (1518-1562) sa versatilité. Les trois conversions du roi ont été précédées par celles de son père, d'abord passé au protestantisme, puis retourné en 1560 au catholicisme. Mais il est surtout marqué par sa mère, Jeanne d'Albret, huguenote énergique et souveraine efficace d'une Navarre défendue contre vents et marées. Dès 1568, elle emmène l'adolescent de quinze ans participer au siège de La Rochelle, puis, en 1570, à la défense de la Navarre, pour le conduire enfin, le 18 août 1572, à ce mariage manqué d'avance avec Marguerite de Valois. Orphelin de père depuis 1562, sa mère morte peu de jours avant son mariage, Henri IV se retrouve sans famille. Il finira par faire annuler en 1599 ce mariage raté, et la raison d'État, ici financière, lui fera épouser l'année suivante l'acariâtre Marie de Médicis. Son premier mariage eut, du moins, l'avantage de le sauver de la Saint-Barthélémy, au prix, il est vrai, d'une première abjuration et d'une longue captivité dorée à la cour, dont il réussit à s'échapper au bout de quatre ans, en 1576. Il se retrouvait à vingt-trois ans chef du parti protestant écrasé par l'événement de 1572, quand, en juin 1584, mourut le duc d'Alençon. Henri IV devenait l'héritier virtuel du trône de France. La guerre civile rebondit. Par-delà les épisodes de ce soubresaut suprême, la décennie 1584-1594 marque l'apogée d'une Ligue hostile à tout roi protestant. Le chef de guerre eut beau prouver son efficacité, battre le duc de Joyeuse à Coutras (1587), s'allier aux protestants allemands ou anglais, la Ligue, aidée par l'Espagne et la Savoie, bloquait l'accès d'un trône au demeurant chancelant. D'où le rapprochement avec Henri III qui, sur son lit de mort, le désignait comme seul héritier légitime 1er août 1589. Le roi en quête de capitale : Face à l'homme de trente-six ans mûri sur les champs de bataille, la France se dresse divisée en trois partis : le protestant, le catholique, le « mal content ». Il fallait, dans une première étape, souder catholiques et « mal-contents », transformer ces derniers en catholiques loyaux, amalgamer ces éléments hétérogènes en une armée cohérente. Les grands qui, presque par hasard, le soutenaient, n'entendaient pas jouer perdant. Une aisance personnelle déconcertante, un panache militaire éclatant, une prise directe sur les hommes lui permirent de réussir. Au surplus, la déclaration de Saint-Ouen lui avait rallié quelques évêques, dont celui de Nantes et l'archevêque de Bourges. Politique partielle qui devait, pensait le « roi titulaire », se décider par la prise de la capitale. Il tenta trois fois l'aventure : deux sièges (1589, 1590) soldés par un double échec, mal compensé par les brillantes victoires remportées sur le duc de Mayenne à Arques (23 sept. 1589) et à Ivry (14 févr. 1590). La décision militaire se révélant impossible, il fallait laisser jouer les divisions du parti adverse, attendre le moment propice. La manœuvre fut double. D'une part, le roi gagna progressivement le monde parlementaire et la haute bourgeoisie parisienne, épouvantés par les excès de la Ligue. D'autre part, le roi abjura le 25 juillet 1593 à Saint-Denis, pour se faire sacrer à Chartres le 27 juin 1594. Il pouvait, de ce fait, entrer enfin à Paris le 22 mars 1594.
On a longuement épilogué sur cette conversion. Qui ne connaît la phrase fameuse : « Paris vaut bien une messe » ? Il serait vain de méconnaître le caractère politique de l'opération, recommandée par Sully, lui-même protestant convaincu. Il serait tout autant hasardeux de ne pas croire à la sincérité du roi. Quoi qu'il en soit, la reddition de Paris, si elle ne signifia pas la fin de la guerre, marquait cependant le début du règne effectif. Le « roi de droit et fort peu de fait, monarque d'un double parti jaloux l'un de l'autre » devenait le roi tout court. La fin de la guerre étrangère : La situation demeurait trouble. Toute une partie de l'opinion catholique ne désarmait pas. Le 27 décembre 1594, Jean Châtel manquait tuer le roi. L'absolution pontificale de Clément VIII (17 sept. 1595) contribua à apaiser les consciences. Le calme ne fut, cependant, jamais général. Les paysans, victimes des exactions militaires et accablés de charges, se révoltaient (Croquants du Limousin, du Périgord, du Languedoc, etc.). Les Espagnols, installés en Bretagne et dans le Nord, restaient menaçants. Combiner la négociation avec l'achat des « consciences », pardonner sans illusions, séduire toujours ne suffisait pas. La victoire de Fontaine-Française (5 juin 1595), l'expulsion par le maréchal d'Aumont des Espagnols hors de la presqu'île de Roscanvel et, enfin, l'épuisement complet des deux adversaires en présence, décidèrent de la paix. Le 2 mai 1598, le traité de Vervins confirmait la paix de Cateau-Cambrésis. Une expédition militaire eut raison de la dernière résistance du duc de Mercœur en Bretagne, et la chevauchée royale s'acheva par l'acte hautement politique de l'édit de Nantes, signé le 13 avril 1598 dans l'ancien château des ducs. Le règne effectif La remise en ordre : La reprise en main du royaume devait, nécessairement, s'appuyer sur un certain nombre de forces politiques. Apparemment, trois groupes coexistèrent : le parti protestant, le groupe des catholiques royalistes, celui des catholiques ligueurs ralliés à temps, composé des parlementaires parisiens et des puissances « féodales », princes et grands nobles redoutables par leurs clientèles. Il existait entre ces groupes un consensus politique (l'urgence de la paix et de la reprise des affaires) et un support social commun (propriétaires seigneuriaux et acquéreurs d'offices). Enfin, la bourgeoisie d'affaires se retrouvait à la fois dans le camp protestant, catholique et parlementaire. Les divergences de détail restaient innombrables, les oppositions fondamentales profondes. Mais, momentanément, le dénominateur commun de la paix intérieure incarnée en Henri IV, ressenti comme une nécessité étatique par tous ceux qui étaient sensibles au « bien public », allait dans le sens de l'action royale. Le gouvernement de Henri IV représente donc une coalition de riches, regroupant provisoirement tous les détenteurs de grandes fortunes, ce qui explique la présence d'un entourage des plus composites. On y trouve le fidèle Sully, entré en 1596 au Conseil des finances (en droit seulement en 1601), grand voyer et grand maître de l'artillerie en 1599. Il n'occupe pas encore la première place au Conseil. À ses côtés, l'autre personnage protestant de marque est Barthélemy de Laffemas qui, dès 1596, exposait ses vues mercantilistes à l'assemblée des notables de Rouen. Face aux protestants, Villeroy, rallié de 1594, est chargé des affaires étrangères. Il est secondé par le président Jeannin, négociateur du traité de Vervins. Ainsi s'établit un premier équilibre de forces, les catholiques détenant le gage capital de la direction de la politique extérieure, qu'ils infléchissent souvent dans un sens pro-espagnol. L'économie et les finances reviennent aux protestants. Le personnage de premier plan est Pomponne de Bellièvre. Chancelier en 1599, l'ancien conseiller du Sénat de Savoie est devenu, pour un temps, une sorte de Premier ministre, marquant l'accord avec les Parlements.
À l'hétérogénéité de cet entourage politique correspond celui de la cour. Le mariage florentin, acte non seulement financier, mais aussi d'engagement politique catholique, a renforcé le groupe italien déjà solidement implanté depuis Catherine de Médicis. Pourtant le raffinement de l'ancienne cour des Valois est singulièrement compromis par l'arrivée en force des anciens chefs de guerre, bretteurs, querelleurs, avides au jeu. Henri IV s'entoure d'un sérail mêlé, où dominent les Gabrielle d'Estrées, Jacqueline de Bueil, Charlotte des Essarts, la marquise de Verneuil, toutes sensibles aux intrigues politiques. Cohabitant, sans trop de difficultés, avec ces aimables pécheresses, la cohorte des réformateurs religieux, tribu fort bien traitée, tente, non sans succès, d'influencer le roi. Parmi eux, la figure exceptionnelle d'un François de Sales ou d'un Bérulle annonce le « renouveau » de l'Église de France.
Il est difficile de qualifier cette politique. Elle est faite de pardons, de générosités calculées au plus juste, d'achats de consciences, tragi-comédie qu'interrompt parfois un indispensable coup de force du maître. La finesse narquoise du prince excelle à ces jeux subtils qui, cependant, l'impatientent de plus en plus. Partout « l'œuvre » progresse.
Au-dehors, Lyon, deuxième ville du royaume, restait très exposée. De plus, l'une des grandes voies royales de l'empire espagnol, conduisant de Milan aux Flandres par l'intermédiaire de la Franche-Comté, longeait la France. Une promenade militaire, amplement justifiée par la non-restitution du marquisat de Saluces et les incessantes intrigues savoyardes, aboutit au traité de Lyon (1601). La Bresse, le Bugey, le Valromey et le pays de Gex parurent aux contemporains une médiocre compensation à l'abandon du marquisat de Saluces. Mais Lyon était désormais mieux protégée, et la route espagnole occidentale coupée.
À l'intérieur, Sully procédait aux trop classiques mesures de rétablissement des finances : annulation des lettres de noblesse accordées entre 1578 et 1598, économies, ventes d'offices, mais aussi diminution progressive des tailles (1598-1609), entérinée par le règlement de 1604. En même temps, il réussissait à reconstituer l'intégrité du domaine royal, plus ou moins démantelé aux époques précédentes. L'essentiel du règne se trouve cependant ailleurs. Les gouverneurs de province, dont les guerres de la Ligue avaient révélé le danger, voient se restreindre leurs prérogatives. Doublés par des lieutenants généraux, quelques-uns regimbent. En 1602, il fallut exécuter le maréchal de Biron, gouverneur de Bourgogne, puis, plus tard, ramener à raison le duc de Bouillon : l'un était catholique, l'autre protestant. La grande nouveauté est la systématisation du procédé d'envoi de commissaires départis, ancêtres des intendants. La monarchie centralisatrice s'installe. jean Meyer
Sa vie
Henri IV naît dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553 à Pau, alors capitale de la vicomté souveraine de Béarn, dans le château de son grand-père maternel le roi de Navarre. Henri d’Albret désirait depuis longtemps que sa fille unique lui donnât un héritier mâle. Selon la tradition rapportée par les chroniqueurs Jean-Baptiste Legrain, André Favyn, Henri, aussitôt né, est donc remis entre les mains de son grand-père qui l'emmène dans sa chambre, lui frotte les lèvres avec une gousse d'ail et lui fait respirer une coupe de vin, sans doute de Jurançon, où le roi de Navarre possédait une vigne achetée en 1553. Ce baptême béarnais est une pratique courante avec les nouveau-nés, dans le but de prévenir les maladies et ce type de bénédiction persiste les siècles suivants pour les baptêmes des enfants de la maison de France. Henri d’Albret lui offre une carapace de tortue, qu'on montre encore dans une pièce du château de Pau qu'une tradition incertaine donne pour être la chambre d'Henri IV qui faisait partie de l’appartement de Jeanne d'Albret. Suivant l'usage de la couronne de Navarre, il reçoit en tant que fils aîné le titre de prince de Viane.
Le futur Henri IV est baptisé dans la religion catholique quelques semaines après sa naissance, le 6 mars 1554, dans la chapelle du château de Pau, par le cardinal d'Armagnac. Ses parrains sont le roi de France Henri II et Henri II de Navarre d'où le choix du prénom Henri , ses marraines sont la reine de France Catherine de Médicis et Isabeau d'Albret, sa tante, veuve du comte de Rohan. Pendant la cérémonie, le roi de France Henri II est représenté par le cardinal de Vendôme, frère d'Antoine de Bourbon.
Henri passe une partie de sa petite enfance dans la campagne de son pays au château de Coarraze. Il fréquente les paysans au cours de ses parties de chasse, et acquiert le surnom de meunier de Barbaste. Fidèle à l'esprit du calvinisme, sa mère Jeanne d'Albret prend soin de l'instruire dans cette stricte morale, selon les préceptes de la Réforme.
À l'avènement de Charles IX en 1561, son père Antoine de Bourbon l'amène vivre à la cour de France. Il y côtoie le roi et les princes de la maison royale qui sont de son âge. Ses parents s'opposent sur le choix de sa religion, sa mère désirant l'instruire dans le calvinisme, et son père dans le catholicisme.
Durant la première guerre de religion, Henri est placé par sécurité à Montargis sous la protection de Renée de France. Après la guerre et le décès de son père, il est retenu à la cour comme garant de l'entente entre la monarchie et la reine de Navarre. Jeanne d'Albret obtient de Catherine de Médicis le contrôle de son éducation et sa nomination comme gouverneur de Guyenne 1563.
De 1564 à 1566, il accompagne la famille royale durant son grand tour de France et retrouve à cette occasion sa mère qu'il n'avait pas revue depuis deux ans. En 1567, Jeanne d'Albret le fait revenir vivre auprès d'elle dans le Béarn.
En 1568, Henri participe à titre d'observateur à sa première campagne militaire en Navarre. Il poursuit ensuite son apprentissage militaire durant la troisième guerre de religion. Sous la tutelle de l'amiral de Coligny, il assiste aux batailles de Jarnac, de La Roche l'Abeille et de Moncontour. Il combat pour la toute première fois en 1570, lors de la bataille d'Arnay-le-Duc.
Roi de Navarre À la cour de France
En 1572, succédant à sa mère Jeanne d'Albret, Henri de Navarre devient roi de Navarre sous le nom de Henri III. Le 18 août 1572, il est marié à Paris à la sœur du roi Charles IX, Marguerite de Valois davantage connue à partir du XIXe siècle sous le sobriquet romancé de reine Margot Ce mariage auquel s'était opposée Jeanne d'Albret dans un premier temps, a été arrangé pour favoriser la réconciliation entre catholiques et protestants. Comme Marguerite de Valois, étant catholique, ne peut se marier que devant un prêtre, et que Henri ne peut entrer dans une église, leur mariage fut célébré sur le parvis de Notre-Dame. C'était d'ailleurs coutume au Moyen Âge que le mariage fût célébré devant le porche de l'église. S'ensuivent plusieurs jours de fête.
Cependant, dans un climat très tendu à Paris, et à la suite d'un attentat contre Gaspard de Coligny, le mariage est suivi quelques jours plus tard du massacre de la Saint-Barthélemy. Épargné par les tueries du fait de son statut de prince du sang, Henri est contraint quelques semaines plus tard de se convertir au catholicisme. Assigné à résidence à la cour de France, il se lie politiquement avec le frère du roi François d'Alençon et participe au siège de La Rochelle 1573.
Après sa participation aux complots des Malcontents, il est retenu prisonnier avec le duc d'Alençon au donjon de Vincennes Avril 1574. La clémence du roi lui fait éviter la peine de mort mais il reste retenu à la cour. À l'avènement de Henri III, il reçoit à Lyon un nouveau pardon du roi et participe à la cérémonie de son sacre à Reims.
La cour de Nérac
Après avoir passé plus de trois ans comme otage à la cour, il profite des troubles de la cinquième guerre de religion pour s'enfuir, le 5 février 1576. Ayant rejoint ses partisans, il renoue sans éclat avec le protestantisme, en abjurant le catholicisme le 13 juin. Il soutient naturellement la cause des Malcontents association de catholiques et de protestants modérés contre le gouvernement, mais animé d’un esprit modéré, il ne s’entend pas avec son cousin le prince de Condé qui, d’un tempérament opposé, se bat avec zèle pour le triomphe de la foi protestante. Henri de Navarre entend ménager la cour de France et s'assurer en Guyenne la fonction de gouverneur représentant administratif et militaire du roi. En 1577, il participe timidement à la sixième guerre de religion menée par son cousin.
Henri est désormais confronté à la méfiance des protestants qui lui reprochent son manque de sincérité religieuse. Il se tient à l’écart du Béarn qui est fermement tenu par les calvinistes. Henri est plus encore confronté à l’hostilité des catholiques. En décembre 1576, il manque de mourir dans un piège organisé dans la cité d’Eauze ; Bordeaux, pourtant capitale de son gouvernement, refuse même de lui ouvrir ses portes30. Henri s’installe alors le long de la Garonne à Lectoure et à Agen qui a l’avantage d’être situé non loin de son château de Nérac. Sa cour est composée de gentilshommes appartenant aux deux religions. Ses conseillers sont essentiellement protestants, tels Duplessis-Mornay et Jean de Lacvivier.
D’octobre 1578 à mai 1579, la reine mère Catherine de Médicis lui rend visite pour achever la pacification du royaume. Espérant le maintenir plus facilement en obéissance, elle lui ramène son épouse Marguerite.
Pendant plusieurs mois, le couple Navarre mène grand train au château de Nérac. La cour s’amuse notamment en parties de chasse, de jeux et de danses, ce dont se plaignent amèrement les pasteurs. Sous l’influence de l’idéal platonique imposé par la reine, une atmosphère de galanterie règne sur la cour qui attire également un grand nombre de lettrés comme Montaigne et Du Bartas. Henri se laisse aller lui-même aux plaisirs de la séduction — il s'éprend tour à tour de deux filles de la reine : Mlle Rebours et Françoise de Montmorency-Fosseux.
Henri participe ensuite à la septième guerre de religion relancée par ses coreligionnaires. La prise de Cahors, en mai 1580, où il réussit à éviter pillage et massacre malgré cinq jours de combats de rue, lui vaut un grand prestige à la fois pour son courage et son humanité.
Henri de Navarre entretient entre 1582 et 1590 une relation avec la catholique Diane d'Andoins à laquelle il promet le mariage et qui le soutient financièrement, la seule de ses maîtresses à être associée à ses affaires : elle semble avoir joué le rôle tant de conseillère politique que de confidente36. Les aventures féminines du roi créent la discorde au sein du couple qui n'a toujours pas d'enfants et provoquent le départ de Marguerite pour Paris. Le coup d'éclat de Marguerite à Agen 1585 consommera leur rupture définitive.
Héritier du trône de France
En 1584, le frère cadet du roi de France, François d'Anjou, meurt sans héritier. N'en ayant pas lui-même, le roi Henri III envisage de confirmer Henri de Navarre comme son héritier légitime. Il lui envoie le duc d'Épernon pour l'inviter à se convertir et à revenir à la cour. Mais quelques mois plus tard, contraint par les Guise de signer le traité de Nemours, il lui déclare la guerre et met hors la loi tous les protestants. La rumeur dit qu'en une nuit, la moitié de la moustache du futur Henri IV blanchit.
Commence alors un conflit où Henri de Navarre affronte à plusieurs occasions le duc de Mayenne. Relaps, Henri est de nouveau excommunié par le pape, puis il doit affronter l'armée royale qu'il bat à la bataille de Coutras en 1587.
Plusieurs revirements apparaissent en 1588. La mort du prince Henri de Condé le place clairement à la tête des protestants. L'élimination violente du duc de Guise l'amène à se réconcilier avec Henri III. Les deux rois se retrouvent tous les deux au château de Plessis-lèz-Tours et signent un traité le 30 avril 1589. Alliés contre la Ligue qui contrôle Paris et la plus grande partie du royaume de France, ils parviennent à mettre le siège devant Paris en juillet. Le 1er août 1589, avant de mourir le lendemain des blessures que vient de lui infliger le moine fanatique Jacques Clément, le roi Henri III reconnaît formellement son beau-frère et cousin issu de germain le roi de Navarre comme son successeur légitime, et celui-ci devient le roi Henri IV.
Pour Henri IV commence la longue reconquête du royaume, car les trois quarts des Français ne le reconnaissent pas pour roi. Les catholiques de la Ligue refusent de reconnaître la légitimité de cette succession.
Roi de France : la reconquête du royaume
La guerre contre la Ligue
Conscient de ses faiblesses, Henri IV doit d’abord commencer par conquérir les esprits. Les royalistes catholiques lui demandent d’abjurer le protestantisme, lui qui à neuf ans avait déjà changé trois fois de religion. Il refuse, mais dans une déclaration publiée le 4 août, il indique qu’il respectera la religion catholique. Beaucoup hésitent à le suivre, certains protestants comme La Trémoille quittent même l’armée, qui passe de 40 000 à 20 000 hommes.
Affaibli, Henri IV doit abandonner le siège de Paris car les seigneurs rentrent chez eux, ne voulant pas servir un protestant. Appuyés par l'Espagne, les ligueurs relancent les hostilités, le contraignant à se replier personnellement à Dieppe, en raison de l'alliance avec la reine Élisabeth Ire d'Angleterre, tandis que ses troupes refluent partout.
Cependant, Henri IV est victorieux de Charles de Lorraine, duc de Mayenne, le 29 septembre 1589 lors de la bataille d'Arques. Au soutien des nobles, huguenots et politiques rassurés par ce chef de guerre solide et humain, s’ajoutent ceux de Conti et Montpensier princes du sang, Longueville, Luxembourg et Rohan-Montbazon, ducs et pairs, des maréchaux Biron et d’Aumont, et d’assez nombreux nobles Champagne, Picardie, Île-de-France.
Il échoue par la suite à reprendre Paris, mais prend d’assaut Vendôme. Il arrive devant Le Mans, après avoir pris en passant quelques villes de Touraine. Là aussi, il veille à ce que les églises restent intactes, et à ce que les habitants ne souffrent pas du passage de son armée. Grâce à cet exemple, toutes les villes entre Tours et le Mans se rendent sans combat. La plupart des villes voisines, suite à la chute du Mans, n'essaient pas de résister. Beaumont, Sablé, Château-Gontier ouvrent leurs portes. Guillaume Fouquet de La Varenne est dépêché dans le Maine et l'Anjou pour y répandre la nouvelle de ce succès. Laval se rend à son tour, Henri de Navarre y entre le 9 décembre 1589. En quittant Laval, Henri se dirige vers Mayenne dont il s'assure, puis vers Alençon où Biron l'attend.
Il bat à nouveau les Ligueurs et les Espagnols à Ivry le 14 mars 1590, assiège Dreux sans succès puis affame Paris, mais ne peut prendre la ville, qui est ravitaillée par les Espagnols. L'approche du duc de Mayenne et du duc de Parme lui fait lever le siège.
Les protestants lui reprochent de ne pas leur donner la liberté de culte : en juillet 1591, il rétablit par l’Édit de Mantes à ne pas confondre avec l'Édit de Nantes de 1598 les dispositions de l’édit de Poitiers 1577, qui leur donnait une liberté très limitée du culte. Le duc de Mayenne, alors en guerre contre Henri IV, convoque les États généraux en janvier 1593, dans le but d’élire un nouveau roi. Mais il est déjoué : les États négocient avec le parti du roi, obtiennent une trêve, puis sa conversion. Encouragé par l'amour de sa vie, Gabrielle d'Estrées, et surtout très conscient de l'épuisement des forces en présence, tant au niveau moral que financier, Henri IV, en fin politique, choisit d'abjurer la foi calviniste. Le 4 avril 1592, par une déclaration connue sous le nom d'expédient, Henri IV annonce son intention d'être instruit dans la religion catholique.
Henri IV abjure solennellement le protestantisme, le 25 juillet 1593 en la basilique Saint-Denis. On lui a prêté, bien à tort, le mot selon lequel Paris vaut bien une messe » 1593, même si le fond semble plein de sens. Afin d’accélérer le ralliement des villes et des provinces et de leurs gouverneurs, il multiplie les promesses et les cadeaux, pour un total de 25 millions de livres. L’augmentation des impôts consécutive multiplication par 2,7 de la taille provoque la révolte des croquants dans les provinces les plus fidèles au roi, Poitou, Saintonge, Limousin et Périgord.
Au début de 1594, Henri IV assiège avec succès Dreux puis il est sacré le 27 février 1594 en la cathédrale de Chartres : il est l'un des trois rois de France sacrés ailleurs qu'à Reims et Paris, qui étaient en effet tenus par l'armée de la Ligue. Son entrée dans Paris le 22 mars 1594, l'expression de son pardon royal[pas clair et, pour finir, l'absolution accordée par le pape Clément VIII le 17 septembre 1595, lui assurent le ralliement progressif de toute la noblesse et du reste de la population, malgré des réticences très fortes des opposants les plus exaltés, tel ce Jean Châtel qui tente d'assassiner le roi près du Louvre le 27 décembre 1594. Il bat de manière définitive l'armée de la Ligue à Fontaine-Française.
Le développement économique
Sur le plan économique, Henri IV fait appel à Olivier de Serres. En 1601, vingt mille mûriers sont plantés dans les jardins des Tuileries. Mieux encore – et ceci témoigne d'une conception nouvelle de l'action administrative – le chapitre « sériciculture » du Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres est tiré à part, à raison de 16 000 exemplaires, un par paroisse. En 1599, Laffemas fait venir l'ingénieur hollandais Humfroy Bradley. En douze ans, la petite Flandre du bas Médoc et la partie aval des marais poitevins sont asséchées. Les édits mercantilistes se succèdent, tout comme fleurissent les essais d'industries nouvelles : tapisserie des Gobelins, verrerie de Melun, soierie de Dourdan, dentelles de Senlis, draperies de Reims et de Senlis. Le but est clair : diminuer les importations coûteuses d'étoffes de luxe, faire du pays un exportateur de ces mêmes produits. En 1602, Laffemas devient contrôleur général du commerce. Les corporations elles-mêmes n'échappent pas à la réglementation, limitée, il est vrai, par les privilèges et les monopoles accordés aux artisans et aux manufacturiers novateurs (édit de 1597 sur l'extension des maîtrises et des corporations).
Le renforcement de l'autoritarisme royal
L'équilibre précaire des forces antagonistes ne pouvait durer longtemps. Dès 1602, les signes de crise se multiplient. En fait, les ultras des deux bords s'accommodaient d'autant plus mal de l'état de choses existant qu'il ne manquait pas, dans l'Europe, de boutefeux intéressés. La paix avec l'Espagne faillit être rompue en 1604 ; Henri IV céda. Mais l'allié hollandais, déçu, réclama un soutien financier accru. Expéditions internes préventives, accroissement de l'effort d'équipement militaire français, exigences financières des alliés de l'intérieur et de l'extérieur ne pouvaient que compromettre les effets du redressement financier. Dès 1603, il faut de nouveau recourir aux expédients, aux traitants. Villeroy passe au second plan tandis que s'impose l'autorité bougonne de Sully. Gouverneur du Poitou en 1604, il prend la première place au Conseil l'année suivante. Sa mission est de trouver de l'argent. Le plus spectaculaire des expédients est, toujours en 1604, la création de la paulette, concession majeure accordée aux parlementaires. À longue échéance, la mesure marque tout aussi profondément la monarchie française que celles qui concernent les commissaires départis. Elles sont contradictoires entre elles et contiennent virtuellement quelques-unes des raisons majeures de l'écroulement de l'Ancien Régime. Mais Henri IV pouvait-il faire autrement ? Face à l'instabilité de la situation extérieure, face aux dangers intérieurs, le renforcement de la bureaucratie royale et la diminution des pouvoirs traditionnels, il fallait lâcher du lest. La garantie donnée par l'édit de la Paulette aux propriétaires d'offices devenus propriété privée, constituait la concession indispensable.
Le renforcement de l'autorité royale, inscrite dans les faits, correspond bien à l'évolution de la personnalité du souverain. En 1604, Henri a cinquante et un ans. Il éprouve, après huit ans d'exercice du pouvoir, une sorte d'impatience devant l'accumulation des obstacles. Il s'accommode de plus en plus mal des réticences, discute moins, ordonne plus. Bellièvre perd son poste de chancelier en 1605, quitte le Conseil en 1607. L'étoile de Sillery, l'adversaire de Sully, monte. C'est vraisemblablement le signe de la nécessité qu'éprouve le roi de donner des gages. Le rappel des Jésuites, en 1603, procède de cette même optique, tout comme le choix du père Coton comme confesseur. La pression financière s'accentue. Les réserves sont constituées au prix d'acrobaties financières discutables. Plus que jamais, les grands financiers se tiennent dans l'ombre du trône, dont ils sont l'un des plus sûrs soutiens. Les dépenses non politiques diminuent, l'effort mercantiliste se ralentit.
La guerre contre l'Espagne puis la Savoie
En 1595, Henri IV déclare officiellement la guerre à l'Espagne. Le roi éprouve alors d'énormes difficultés à repousser les attaques espagnoles en Picardie. La prise d'Amiens par les Espagnols et le débarquement d'une troupe hispanique en Bretagne, où le gouverneur Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, cousin des Guise et beau-frère du feu roi Henri III, ne reconnaît toujours pas Henri IV pour roi, laisse celui-ci dans une situation périlleuse.
Le roi perd également l'appui de la noblesse protestante. À l'imitation de La Trémoille et de Bouillon, elle s'abstient de paraître au combat. Choqués par sa conversion et par les nombreuses personnalités qui l'imitent, les protestants en plein désarroi reprochent au roi de les avoir abandonnés. Ils se réunissent régulièrement en assemblée pour réactiver leur organisation politique. Ils vont jusqu'à se saisir de l'impôt royal pour leur propre compte.
Après avoir soumis la Bretagne et avoir repris Amiens aux Espagnols, Henri IV signe, le 13 avril 1598, l'Édit de Nantes qui met en place une paix entre protestants et catholiques. Les deux armées étant à bout de forces, le 2 mai 1598 est signée la paix de Vervins entre la France et l'Espagne. Après plusieurs décennies de guerres civiles, la France connaît enfin la paix.
Toutefois, l'article de la paix de Vervins concernant le duc de Savoie devint la cause d'une nouvelle guerre. Le 20 décembre 1599, Henri IV reçut Charles-Emmanuel Ier de Savoie à Fontainebleau afin de régler le différend. En mars 1600, le duc de Savoie demanda un délai de réflexion de trois mois et repartit pour ses États. Le terme de trois mois étant écoulé, Henri IV fit sommer Charles-Emmanuel de se déclarer. Le prince répondit que la guerre lui serait moins préjudiciable qu'une paix comme celle qu'on lui offrait. Immédiatement, Henri IV lui déclara la guerre, le 11 août 1600.
Posté le : 12/12/2015 18:50
|
|
|
|
|
Henri IV 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Guerre franco-savoyarde . Roi de France : la pacification Le mariage
Henri IV approche de la cinquantaine et n'a toujours pas d'héritier légitime. Depuis quelques années, Gabrielle d'Estrées partage sa vie mais, n'appartenant pas à une famille régnante, elle ne peut guère prétendre devenir reine. Se comportant tout de même comme telle, Gabrielle suscite de nombreuses critiques, tant de l'entourage royal que des pamphlétaires, qui la surnomment la duchesse d'Ordure. Sa mort survenue brutalement en 1599, sans doute d'une éclampsie puerpérale, permet au roi d'envisager de prendre une nouvelle épouse digne de son rang.
En décembre 1599, il obtient l'annulation de son mariage avec la reine Marguerite, et épouse, à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, le 17 décembre 1600, Marie de Médicis, fille de François Ier de Médicis et de Jeanne d'Autriche, et nièce de Ferdinand Ier, grand-duc de Toscane alors régnant. La naissance d'un dauphin l'année suivante assure l'avenir de la dynastie de Bourbon.
Henri IV compromet son mariage et sa couronne en poursuivant sa relation extraconjugale, commencée peu de temps après la mort de Gabrielle d'Estrées, avec Henriette d'Entragues, jeune femme ambitieuse, qui n'hésite pas à faire du chantage au roi, pour légitimer les enfants qu'elle a eus de lui. Ses requêtes repoussées, Henriette d'Entragues complote à plusieurs reprises contre son royal amant.
En 1609, après plusieurs autres passades, Henri se prendra de passion pour la jeune Charlotte-Marguerite de Montmorency.
Reconstruction et pacification du royaume
Henri IV s'appuie, pour gouverner, sur des ministres et conseillers compétents comme le baron de Rosny, futur duc de Sully, le catholique Villeroy et l'économiste Barthélemy de Laffemas. Les années de paix permettent de renflouer les caisses. Henri IV fait construire la grande galerie du Louvre qui relie le palais aux Tuileries. Il met en place une politique d'urbanisme moderne. Il poursuit ainsi la construction du Pont Neuf commencé sous son prédécesseur. Il fait bâtir à Paris deux nouvelles places, la place Royale aujourd'hui Place des Vosges et la place Dauphine.
Son règne voit cependant le soulèvement des paysans dans le centre du pays et le roi doit intervenir à la tête de son armée.
En 1601, après la guerre franco-savoyarde, le traité de Lyon établit un échange territorial entre Henri IV et Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie : le duc céda à la France les territoires de la Bresse et du Bugey et en plus les pays de Gex et de Valromey, de plusieurs siècles possession du Duché de Savoie, au lieu du marquisat de Saluces, situé en territoire italien. Après le traité, Henri IV doit faire face à plusieurs complots dirigés depuis l'Espagne et la Savoie. Il fait ainsi exécuter le duc de Biron et embastiller le duc d’Angoulême, le dernier des Valois, fils bâtard de Charles IX.
Pour rassurer les anciens partisans de la Ligue, Henri IV favorise également l'entrée en France des jésuites qui pendant la guerre avaient appelé à l'assassinat du roi, crée une « caisse des conversions » en 1598. Il se réconcilie avec le duc de Lorraine Charles III et marie avec le fils de celui-ci, sa sœur Catherine de Bourbon. Henri IV se montre fervent catholique — sans être dévot — et pousse sa sœur et son ministre Sully à se convertir aucun d'eux ne le fera.
Une période d'essor économique et des arts et métiers
Petit à petit, la France doit être remise en état. La production agricole retrouve son niveau de 1560 en 1610. Le désir de paix est unanime : il favorise la mise en place de l’édit de Nantes, la reconstruction, dans le Languedoc et le Nord de la France, a un effet d’entraînement sur toute l’économie.
La manufacture des Gobelins est créée, les arts et techniques encouragés. Barthélemy de Laffemas et le jardinier nîmois François Traucat s'inspirent des travaux de l'agronome protestant Olivier de Serres et jouent un rôle majeur dans l'histoire de la soie en faisant planter des millions de mûriers dans les Cévennes, à Paris et d'autres régions.
Le canal de Briare reliant la Seine et la Loire pour le développement agricole est le premier canal de transport fluvial creusé en France. D'autres projets sont préparés mais ensuite abandonnés à la mort d'Henri IV. Le roi n'institua pas la poule au pot comme le plat national français comme on l'a dit. Mais dans une querelle avec le duc de Savoie, il aurait prononcé son désir que chaque laboureur ait les moyens d'avoir une poule dans son pot. Le duc de Savoie, en visite en France, apprenant que les gardes du roi ne sont payés que quatre écus par mois, propose au roi de leur offrir à chacun un mois de paye ; ce à quoi le roi, humilié, répond qu'il pendra tous ceux qui accepteront, et évoque alors son souhait de prospérité pour les Français, symbolisé par la poule au pot. Son ministre Sully explique dans ses mémoires intitulés Les Œconomies royales sa conception de la prospérité de la France, liée au développement de l'agriculture : « pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France.
La société reste cependant violente : les soldats congédiés forment des bandes organisées militairement qui écument les campagnes, et qui doivent être poursuivies militairement pour disparaître progressivement dans les années 1600. La noblesse reste elle aussi violente : 4 000 morts par duel en 1607, les enlèvements de jeunes filles à marier provoquent des guerres privées, où là aussi le roi doit intervenir.
Implantation française en Amérique
Dans la continuité de ses prédécesseurs, Henri soutient les expéditions navales en Amérique du Sud et favorise le projet d'une implantation au Brésil. Mais c'est en Nouvelle-France que les Français parviennent à se fixer durablement. Dès 1599, le roi accorde le monopole du commerce des fourrures à Tadoussac, en Nouvelle-France, à François Dupont-Gravé et à Pierre Chauvin. Par la suite, Henri IV donne le monopole du commerce des fourrures et charge Pierre Dugua de Mons protestant de monter une expédition, sous les ordres de Samuel de Champlain, et d'établir un poste français en Acadie. Ce sera en premier sur l'Île Sainte-Croix maintenant Dochet Island au Maine), en 1604 et par la suite à Port-Royal, en Nouvelle-France au printemps 1605. Mais le monopole est révoqué en 1607, ce qui mettra fin à la tentative de peuplement. Le roi charge Samuel de Champlain de lui faire rapport de ses découvertes. En 1608, le monopole est rétabli pour un an seulement. Champlain est envoyé, avec François Dupont-Gravé, pour fonder Québec, qui est le départ de la colonisation française en Amérique, pendant que de Mons reste en France pour faire prolonger le monopole.
L'assassinat de Henri IV, rue de la Ferronnerie à Paris
La fin du règne d'Henri IV est marquée par des tensions avec les Habsbourg et la reprise des hostilités contre l'Espagne. Henri IV intervient dans le conflit de succession qui oppose l'empereur de confession catholique aux princes allemands protestants qu'il soutient, dans la succession de Clèves et de Juliers. La fuite du prince de Condé en 1609 à la cour de l'infante Isabelle ravive les tensions entre Paris et Bruxelles. Henri IV estime son armée prête à reprendre le conflit qui s'était arrêté dix ans plus tôt. Le 25 avril 1610, François de Bonne de Lesdiguières, représentant d'Henri IV de France dans le château de Bruzolo en Val de Suse, signe le traité de Bruzolo, avec Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie.
Le déclenchement d'une guerre européenne ne plaît ni au pape, soucieux de la paix entre princes chrétiens, ni aux sujets français, inquiets de leur tranquillité. Ne pouvant accepter une alliance avec des princes protestants contre un souverain catholique, des prêtres ravivent par leurs sermons les esprits échauffés des anciens Ligueurs. Le roi voit également un parti qui s'oppose à sa politique au sein même de l'entourage de la reine. Le roi est dans une position fragile qui n'est pas seulement le fait des catholiques, puisque les protestants cherchent à maintenir grâce à l'édit de Nantes leurs privilèges politiques.
Tout en préparant la guerre, on s'apprête au couronnement officiel de la reine à Saint-Denis qui se déroule le 13 mai 1610. Le lendemain, Henri IV meurt poignardé par François Ravaillac, catholique fanatique, dans la rue de la Ferronnerie à Paris. L'enquête conclut à l'action isolée d'un fou. Un examen des archives au XXie siècle suggère pourtant l'idée d'un possible complot.
Après autopsie et embaumement son cœur placé dans une urne de plomb contenue dans un reliquaire d'argent est envoyé à l’église Saint-Louis de La Flèche, le roi ayant promis sa relique royale au collège des jésuites de La Flèche, le corps est exposé dans une chambre de parade du Louvre puis son effigie dans la salle des Cariatides.
Henri IV est enterré à la basilique Saint-Denis le 1er juillet 1610, à l'issue de plusieurs semaines de cérémonies funèbres qui commencent déjà à faire naître la légende du bon roi Henri. Au cours du lit de justice tenu le 15 mai, son fils aîné Louis futur Louis XIII, âgé de neuf ans, proclame la régence de sa mère la reine Marie de Médicis
Ascendance d'Henri IV de France
Enfants légitimes et Enfants légitimes
Son premier mariage avec Marguerite de France fut stérile. Le roi était en effet atteint d'une malformation congénitale des organes reproducteurs connue sous le nom d'hypospadias ayant pour conséquence une courbure de la verge accompagnée d'un phimosis. Sa malformation ne fut corrigée que par une opération alors que le roi avait plus de quarante ans. Henri IV eut six enfants de son mariage avec Marie de Médicis :
Louis XIII 27 septembre 1601-14 mai 1643, roi de France de 1610 à 1643 épouse en 1615 Anne d'Autriche, infante d'Espagne 1601-1666 ;
Élisabeth de France 22 novembre 1602-6 octobre 1644, épouse Philippe IV 1605-1665, roi d'Espagne le 25 novembre 1615 à Bordeaux ;
Christine de France 10 février 1606-27 décembre 1663, épouse Victor-Amédée Ier de Savoie 1587 - 1637 le 10 février 1619 à Paris ;
Monsieur d’Orléans, à tort prénommé « Nicolas » par certains auteurs, mort avant d'avoir été solennellement baptisé et nommé, titré à sa naissance duc d'Orléans 13 avril 1607-17 novembre 1611 ;
Gaston de France, duc d'Anjou puis d'Orléans à la mort de son frère 24 avril 1608-2 février 1660, épouse en 1626 Marie de Bourbon 1605-1627 puis en 1632 Marguerite de Lorraine 1615-1672 ;
Henriette de France 25 novembre 1609-10 septembre 1669, épouse Charles Ier d'Angleterre le 13 juin 1625, à la Cathédrale de Cantorbéry.
Descendants illégitimes Henri IV eut également au moins 12 enfants illégitimes :
Un seul avec Louise Borré :
Hervé Borré 1576-1643.
Un seul avec Françoise de Montmorency-Fosseux:
Une fille mort-née en 1581.
Un seul avec Esther Imber ou Ysambert, rochelaise :
Gédéon, dit Gédéon Monsieur, né fin 1587 ou début 1588 et mort le 30 novembre 1588.
Trois avec sa maîtresse Gabrielle d'Estrées : ces trois enfants furent légitimés :
César de Bourbon, 1594-1665, duc de Vendôme,
Catherine Henriette de Bourbon 1596-1663, dite Mademoiselle de Vendôme, mariée à Charles II de Lorraine, duc d'Elbeuf ;
Alexandre de Vendôme 1598-1629, dit le Chevalier de Vendôme.
Trois également avec Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, marquise de Verneuil :
Henri de Verneuil, né en 1600, mort peu après ;
Henri de Bourbon, duc de Verneuil 1601-1682, évêque de Metz ;
Gabrielle-Angélique de Verneuil 21 janvier 1603-1627, Mademoiselle de Verneuil, qui épouse Bernard de Nogaret de La Valette d'Epernon.
Un seul avec Jacqueline de Bueil :
Antoine de Bourbon-Bueil 1607-1632, comte de Moret.
Deux avec Charlotte des Essarts :
Jeanne-Baptiste de Bourbon 11 janvier 1608-1670, abbesse de Fontevrault ;
Marie Henriette de Bourbon 1609-1629, abbesse de Chelles.
La légende du bon roi Henri Un culte tardif
Dès son règne, à la demande de ses conseillers tel Philippe Duplessis-Mornay, Henri IV utilise des imprimeries itinérantes pour diffuser portraits et tracts tentant de le faire passer pour un prince idéal. Néanmoins les catholiques le considèrent comme un usurpateur, certains protestants l'accusent de trahison puisqu'il a changé six fois de religion et le peuple voit en lui un tyran prélevant de nombreux impôts. Son assassinat par François Ravaillac le transforme en martyr.
C'est au XVIIIe siècle que s'est formée et développée la légende du bon roi Henri. Icône devenue si populaire qu'elle en est restée une image d'Épinal. En l'honneur d'Henri IV, Voltaire écrit en 1728 un poème intitulé La Henriade.
Malgré cette image positive, son tombeau de Saint-Denis n'échappe pas à la profanation en 1793, due à la haine des symboles monarchiques sous la Révolution française. La Convention avait ordonné l'ouverture de toutes les tombes royales pour en extraire les métaux. Le corps d'Henri IV est le seul de tous les rois à être trouvé dans un excellent état de conservation en raison de son exsanguination. Il est exposé aux passants, debout, durant quelques jours. Les dépouilles royales sont ensuite jetées, pêle-mêle, dans une fosse commune au nord de la basilique, excepté quelques morceaux de dépouilles qui sont conservés chez des particuliers. Louis XVIII ordonnera leur exhumation et leur retour dans la crypte, où elles se trouvent encore aujourd'hui.
Dès 1814, on pense à rétablir la statue équestre du roi détruite sous la Révolution. Fondue en 1818, la nouvelle statue équestre a été réalisée à partir du bronze de la statue de Napoléon de la colonne Vendôme. Le siècle romantique pérennisera la légende du Bon Roy Henry, roi galant, brave et bonhomme, jouant à quatre pattes avec ses enfants et grand chantre de la fameuse Poule-au-pot.
En fait, l'État avait, après les troubles récents, grand besoin de restaurer, une image positive de la Monarchie ; Chilpéric et Charlemagne semblaient trop lointains ; les Louis :… VII, VIII, X, XII étaient trop obscurs ou mieux trop pâles ; Louis IX jugé, sans doute, trop religieux. Les autres Louis : XI, XIII, XIV, etc. éveillaient de bien mauvais souvenirs… Il fallait donc dans une véritable opération publicitaire trouver un monarque qui recueillît le maximum de suffrages : le bon Roy tint ce rôle pour la postérité. Alexandre Dumas en fait ainsi un héros épique dans son œuvre Les Grands Hommes en robe de chambre : César, Henri IV, Richelieu en 1856.
Le château de Pau continue de cultiver la légende du bon roi Henri. On peut encore y voir son berceau fait d'une carapace de tortue de mer. C'est dans la tradition béarnaise que son premier baptême se fit : ses lèvres furent humectées de vin de Jurançon et frottées d'ail, ceci pour lui donner force et vigueur. Il doit son surnom de Vert-galant à son ardeur envers ses 73 maîtresses officielles recensées, lui donnant 22 enfants légitimes ou non reconnus qui vivent à la Cour.
Dans le premier chapitre de L'Homme aux quarante écus, Voltaire mentionne pour le peuple un âge d'or sous Henri IV et Louis XIII en raison de la modicité relative de l'impôt.
Plus récemment, l'historiographie contemporaine a rétabli l'image d'un roi qui fut peu apprécié par ses sujets et qui eut beaucoup de mal à faire accepter sa politique. De plus, ses allées et venues d'une confession à l'autre, l'abjuration d'août 1572 et celle solennelle du 25 juillet 1593, lui valurent l'inimitié des deux camps. Ce roi en avait bien conscience et on lui prête vers la fin de sa vie les paroles suivantes : « Vous ne me connaissez pas maintenant, vous autres, mais je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez lors ce que je valais.
Un objet de haine
Avant d'être aimé du peuple, Henri IV fut donc l'un des rois les plus détestés, surtout par le parti catholique, son effigie brûlée et son nom associé au diable ou à l'Antéchrist comme dans les sermons fanatiques du ligueur Jean Boucher. À cause du martèlement quotidien des prêtres ligueurs durant la dernière guerre de religion, on dénombre pas moins d'une douzaine de tentatives d'assassinat, contre lui, dont le batelier orléanais Pierre Barrière arrêté à Melun armé avec intention déclarée le 27 août 1593 et qui fut roué et brulé sur la place du Martroy à Melun et Jean Châtel qui, lui, blessa le roi au visage rue saint-Honoré, chez sa maîtresse, le 27 décembre 1594. Son assassinat par Ravaillac est même vécu par certains comme une délivrance, au point qu'une rumeur d'une nouvelle Saint-Barthélemy se répand durant l'été 1610.
Attaques incessantes : physiques ou morales ou religieuses… sans même parler de l'affaire Marthe Brossier grossièrement montée par la Ligue (voir la : « Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France », de Joseph Fr. Michaud, Jean Joseph François Poujoulat - 1838 - France.
Une popularité essentiellement posthume
Vitrail de Linard Gontier provenant de l'ancien hôtel des arquebuses de Troyes XVIIe siècle
La popularité croissante du roi peut tenir à son attitude lors des sièges : il veille à ce que les villes prises ne soient pas pillées, et leurs habitants épargnés et ce, dès le siège de Cahors en 1580. Il se montre magnanime également avec ses anciens ennemis ligueurs, notamment après la reddition de Paris. Il préfère acheter les ralliements, que faire la guerre pour conquérir son royaume. L'historiographie contemporaine a également confirmé l'attachement réel du roi pour le catholicisme après sa conversion, malgré un recul marqué à l'égard des dogmes religieux qu'ils soient catholiques ou protestants.
Ayant été le dernier comte de Foix, Henri IV est à ce titre resté un roi d'une grande importance pour les Ariégeois et souvent cité dans l'histoire locale.
La chanson Vive Henri IV ! qui a été écrite en son honneur a été durablement populaire en France à partir de 1774. Sous la Restauration, son air est fréquemment joué dans les cérémonies se déroulant hors de la présence du Roi et de la famille royale. Il fait alors figure de chanson quasi-officielle de la monarchie.
La fin d'un règne
On voit à quel point la réalité du règne correspond mal aux images d'Épinal : la vision idyllique du paysan trouvant chaque dimanche sa « poule au pot », la phrase fameuse « labourage et pâturage, mamelles de la France ». Contrainte à un jeu d'équilibre constant entre deux idéologies toujours prêtes à s'affronter, toujours méfiantes, s'appuyant sur une coalition temporaire d'intérêts provisoirement attachés au même maître, la royauté n'a guère la possibilité d'avoir une action profonde sur le pays.
L'abandon de la masse paysanne
Composer d'un côté, imposer de l'autre, à tour de rôle ; la victime de cette nécessité est le peuple des campagnes. Le monde urbain, surtout le parisien, en souffre moins. Au relâchement du mercantilisme créateur correspond (cause ou effet ?) une véritable politique de rénovation urbaine. La sensibilité artistique du roi n'est probablement guère en cause. Il cherche, tout simplement, à relancer la construction. D'où le plan grandiose de la place Royale, conçue primitivement pour les ouvriers d'une manufacture de soie et de fils d'argent ; d'où encore l'aménagement de la place Dauphine, la construction du pont Neuf (1609), du pont Marchant (1608) et des lotissements des bords de Seine. Parallèlement, la vogue des châteaux privés s'exaspère. La grande vague de pierre qui s'apprête à recouvrir la France débute : signe qui témoigne de l'enrichissement des « classes » nouvelles et de l'exploitation du monde rural. Le fragile équilibre politique paraît s'être traduit par un abandon partiel de la masse rurale aux politiques économiques rurales nouvelles, résumées entre autres par la métairie. L'ambassadeur anglais Carew écrivait en 1609 : « On tient les paysans de France dans une telle sujétion qu'on n'ose pas leur donner des armes [...]. On leur laisse à peine de quoi se nourrir. » Pour sombre que paraisse l'affirmation, elle ne laisse pas de correspondre à quelque réalité. Il convient donc de ramener l'importance des mesures prises par la royauté en faveur des paysans à de plus justes proportions ; ce sont des mesures de circonstances destinées à pallier les effets des abus les plus criants : abaissement de la taille (pas toujours durable), restitution des communaux aux paysans, encouragements divers – dont on peut se demander quelle a été leur efficacité. À la vérité, le redressement rural est le fait de la paix retrouvée, parfois aussi des efforts de reconstruction des propriétaires.
En même temps, la reprise du mouvement démographique s'amorce. Ainsi, dans le comté nantais, le règne correspond au redressement de la courbe de natalité rurale, en baisse depuis les années 1560-1570. Dans le Languedoc, même reprise démographique, sur un rythme ralenti par rapport au XVIe siècle. Dans le Beauvaisis, l'époque 1580-1645 doit être considérée comme un « plafond démographique ». La tendance à la reprise paraît donc nette, mais d'ampleur variable de région à région.
Au surplus, il n'existe pas encore de véritable unité économique française. Par la force même des choses, le rythme de la respiration économique, partant de celui des prix et des crises, est orienté, dans le nord de la France, par celui des grands foyers de la Méditerranée nordique, de l'Angleterre au Sund, en passant par la Hollande. Dans l'Ouest, en revanche, les liens de causalité sont plutôt ceux que déterminent les convois d'argent américain, alors que le Midi est soumis, de plus en plus, aux pulsations très particulières d'un monde méditerranéen qui a perdu de son importance. Ces domaines s'imbriquent et se superposent : les moyens d'action royaux restent, face à ces courants fondamentaux, des plus restreints. Finalement, l'activité royale permet la paix, la création d'embryons d'industries de luxe plus ou moins solides, la mise en chantier de quelques grands travaux de communication : canal de Briare, routes royales bordées d'ormes. La paysannerie peut d'autant moins apprécier ces réalisations que la royauté, s'appuyant sur les forces nobiliaires et bourgeoises en pleine crise de réadaptation structurelle, est obligée de composer avec elles. L'écart de fait, sinon institutionnel, entre les deux groupes, a provisoirement diminué à la suite de la pénétration de la noblesse terrienne par une bourgeoisie en plein essor. Non que la première ait été, nécessairement, en déclin, comme on s'est hâté de l'affirmer. Il ne fait cependant pas de doute que la bourgeoisie s'installe dans l'État, et surtout par les offices. Que la guerre extérieure reprenne, la superposition des charges rurales nouvelles aux exigences accrues de la fiscalité royale crée, à la fois, un climat révolutionnaire, et, rétrospectivement, l'image fausse d'un paradis perdu.
L'assassinat
L'assassinat se situe au moment précis où la reprise de la guerre européenne, quasi certaine, compromet, aux yeux de beaucoup, le modus vivendi établi depuis 1594. Bien des choses sont remises en question. La paix des consciences catholiques est troublée par l'alliance protestante, la lutte anti-espagnole. L'effort de guerre peut, à juste titre, sembler démesuré. Or, le temps n'a pu encore jouer en faveur de l'effacement des théories théologico-politiques antiroyales, tant des Ligueurs que des protestants. La disparition du roi est souhaitée par beaucoup. Le coup de couteau de Ravaillac n'est pas un accident. La postérité n'a gardé toutefois du Vert-Galant qu'une image idéalisée et consacrée par le martyre, image qui a été celle des contemporains le lendemain de l'assassinat, mais non point celle de la veille. Certes le règne n'a été marqué de « nul mécompte national », et s'il constitue une étape décisive dans l'instauration de la monarchie dite absolue, les mesures de circonstance y sont pour beaucoup. Il reste, provisoirement, l'acquis de l'édit de Nantes, dicté lui aussi par la nécessité. La gloire réelle d'Henri IV réside sans doute dans cette soumission exceptionnelle aux événements, qui lui a permis de les infléchir. Jean Meyer
Controverse autour de la tête d'Henri IV 2010-2013
En 2010 et 2012, une équipe de scientifiques rassemblée autour du médecin légiste Philippe Charlier serait parvenue à authentifier la tête momifiée du roi qui aurait été séparée de son corps à la Révolution - même si aucun document d'archives ne le rapporte. Sous la Terreur, le tombeau du roi à la basilique de Saint-Denis fut, comme ceux des autres monarques, profané. Son corps, exposé au public durant deux jours, fut ensuite jeté, avec celui des autres rois, dans une fosse commune. Au début du xxe siècle, un collectionneur prétendait posséder la tête momifiée du roi. Il fallut attendre le quadricentenaire de l'assassinat du roi en 2010 pour que des analyses scientifiques soient effectuées sur la présumée relique.
Une première étude aurait trouvé trente points de concordance confirmant que l'identité de la tête embaumée était bien celle du roi Henri IV avec, selon les auteurs de cette étude, 99,99 % de certitude. Cette conclusion fut confirmée en 2012 par une seconde étude à l'Institut de biologie évolutive de Barcelone qui parvint à extraire de l'ADN et à le comparer avec l'ADN supposé de Louis XVI à partir d'un mouchoir qui aurait été trempé dans le sang du roi le jour de son exécution. À l'occasion de l'annonce des résultats, une image du visage royal créé virtuellement en 3D fut présentée au public.
Cette authentification est contestée par plusieurs historiens, généticiens, médecins-légistes, archéologues et paléoanthropologues, comme Joël Cornette, Jean-Jacques Cassiman, Geoffroy Lorin de la Grandmaison, Yves de Kisch, Franck Ferrand, Gino Fornaciari74 ou Philippe Delorme.
En décembre 2010, le prince Louis de Bourbon s'adresse au président Nicolas Sarkozy pour obtenir la réinhumation de la tête présumée de son aïeul dans la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Selon Jean-Pierre Babelon, Nicolas Sarkozy prévoit initialement une cérémonie pour mai 2012. Cependant, la controverse autour de la relique et la campagne présidentielle repoussent la date de la célébration et le projet est ensuite abandonné par François Hollande.
Le 9 octobre 2013, un article scientifique publié dans l’European Journal of Human Genetics, cosigné par les généticiens Maarten Larmuseau et Jean-Jacques Cassiman de l'université catholique de Louvain, ainsi que par l'historien Philippe Delorme, a démontré que le chromosome Y de trois princes de la maison de Bourbon actuellement vivants différait radicalement de la signature ADN trouvée dans la tête comme dans le sang analysés au cours de l'étude de 2012. La conclusion de cet article est qu'aucune de ces deux reliques n'est authentique.
Dans les arts
Armoiries de Navarre du premier roi de la dynastie des Bourbon : parti d'azur à trois fleurs de lys d'or et de gueules aux chaînes d'or posées en orle, en croix et en sautoir, chargées en cœur d'une émeraude au naturel.
En littérature
François Bayrou, Henri IV : le Roi libre, éd. Flammarion, 1999
George Chapman 1559-1634, The Conspiracy and Tragedy of Byron 1608, éd. John Margeson Manchester: Manchester University press, 1988.
Abel Hugo, La Naissance de Henri IV, nouvelle dans la revue Le Conservateur littéraire, 1820
Heinrich Mann, Le roman d'Henri IV, Paris, Gallimard NRF, 1972, 3 vol
Michel Peyramaure, Henri IV, Robert Laffont, 1997, 3 vol.
M. de Rozoy, Henri IV, Drame lyrique, 1774.
Marcelle Vioux Le Vert-Galant, vie héroïque et amoureuse de Henri IV ; illustré par le fac-similé de portraits et tableaux historiques Fasquelle, 1935
Au cinéma
La Bouquetière des innocents 1922, film français réalisé par Jacques Robert.
Le Vert galant 1924, film français réalisé par René Leprince. Ce film retrace le parcours qui mena Henri de Navarre jusqu'au trône de France.
La Reine Margot 1954, film français réalisé par Jean Dréville. Rôle interprété par André Versini.
Vive Henri IV, vive l’amour 196), film français réalisé par Claude Autant-Lara. Rôle interprété par Francis Claude. Ce film montre un roi populaire, franc buveur, solide mangeur, paillard et grivois, heureux dans ses bonnes fortunes.
La Reine Margot 1994, film français réalisé par Patrice Chéreau. Rôle interprété par Daniel Auteuil.
Henri 4 2010, film allemand réalisé par Jo Baier, d’après Le Roman d’Henri IV de Heinrich Mann. Rôle interprété par Julien Boisselier.
Au théâtre
Henri IV le bien-aimé, écrit et mis en scène par Daniel Colas, avec Jean-François Balmer et Béatrice Agenin, Théâtre des Mathurins, 2010
Dessins, peintures Sculptures
1834 - 1838 - Henri IV statue équestre en bronze du roi coiffé de lauriers par le sculpteur Philippe Joseph Henri Lemaire. Vestige de l'incendie de l'Hôtel de Ville de Paris par les Communards en 1871, aujourd'hui au Musée Carnavalet
Numismatique
Le billet 5 000 francs Henri IV 1957-1959 et le billet 50 nouveaux francs Henri IV 1959-1961.
      
Posté le : 12/12/2015 18:33
Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:19:23
|
|
|
|
|
Michel de L'Hospital |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 Décembre 1578 meurt Michel de l'Hospital
au château de Bélesbat à Boutigny-sur-Essonne, né vers 1506 au château de la Roche à Aigueperse dans le Puy-de-Dôme, conseiller au parlement de Paris 1537, ambassadeur au concile de Trente, maître des requêtes, surintendant des finances 1554, chancelier de France 1560 et poète latin. Son nom reste associé aux tentatives royales de pacification civile durant les guerres de religion. « … le plus grand homme de France, si ce titre est dû au génie, à la science et à la probité réunies. » écrivit Voltaire, Éssai sur les mœurs et l'esprit des nations ch. 172 p. 522
En bref
Ayant commencé une brillante carrière de juriste humaniste à l'université de Padoue, d'abord comme étudiant, puis comme professeur de droit civil, Michel de L'Hospital fait un long séjour en Italie (il a été, entre autres, auditeur de la Rote à Rome) qui lui vaut une grande réputation de savant. Délégué aux Grands Jours de justice de Moulins (1540), de Riom (1542) et de Tours (1546), il devient premier président de la Chambre des comptes de Paris. Sa carrière politique débute en 1560, quand Catherine de Médicis l'appelle pour mener une politique de réconciliation entre catholiques et protestants. Rêvant d'un concile national impossible, il se heurte rapidement aux Guise qui ont arraché aux états généraux de Fontainebleau la condamnation des Rohan, qu'il refuse de signer. Après la mort du roi François II, il trace son programme dans le célèbre discours des états généraux d'Orléans en 1560, dont le premier volet est formé par la diminution du nombre des officiers (ordonnance de janvier 1561). Le second volet (ordonnance d'avril 1561), libéral vis-à-vis des protestants, se heurte aux réticences du Parlement. L'Hospital essaie alors d'harmoniser les points de vue des uns et des autres au Colloque de Poissy en 1561 ; il échoue totalement. Abandonné, puis rappelé par Catherine de Médicis, il s'attaque au problème financier en faisant vendre des biens du clergé pour une valeur de 100 000 écus de revenu, mesure qui procura, en cinq ans, quelque 100 millions à la royauté. Importante et mal étudiée sur le plan de ses conséquences sociales, la vente ne suffit cependant pas à compenser les effets de l'inflation des prix de la seconde moitié du XVIe siècle. La fixation autoritaire du taux de l'intérêt à 5 p. 100 réussit encore beaucoup moins. Il est plus heureux avec la création des consulats (tribunaux spécialisés dans les affaires commerciales) et l'ordonnance de Moulins (1566) qui contribue à fixer le droit français. Michel de L'Hospital est cependant, avant tout, le symbole de la politique de tolérance. En dépit de l'appui de Ronsard, en dépit aussi du grand voyage de présentation du jeune Charles IX à son peuple (1564-1566), qui montre combien le gouvernement se préoccupe encore de contacts personnels, le champion de l'accord entre Français échoue complètement. La décennie 1560-1570 montre d'une manière décisive que la France bascule définitivement du côté catholique, rendant ainsi un affrontement sanglant inévitable. On en rendit L'Hospital responsable. Celui-ci se retire en 1568. Écrivain très renommé (ses Épîtres furent comparées à celles d'Horace), il est le grand protecteur de la Pléiade. Mais sa politique a échoué parce qu'elle venait trop tôt. Jean Meyer
Sa vie
Michel de l'Hospital est le fils de Jean de l'Hospital, premier médecin et conseiller de Charles duc de Bourbon connétable de France par la suite celui de sa sœur Renée, Duchesse de Lorraine et de Bar, bailli de Montpensier et auditeur des comptes. Jean de Galuccio, son ancêtre, était originaire du Royaume de Naples. Arrivé en France, il fut adopté par Jean de l'Hospital, clerc des Arbalétriers de France dont il prit le nom et les armes en 1349 grâce à des Lettres de Naturalisation. Les armes de la famille de l'Hôspital sont : « d'azur à la tour d'argent, posée sur un rocher de même, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or ».
Avocat sans le sou, il ne peut prétendre à une place de conseiller au parlement. Un ami, Pierre Le Filleul, archevêque d'Aix et gouverneur de Paris, ancien président de la Cour des comptes, lui conseille de se marier. C'est ainsi, qu'en 1537, il épouse, Marie Morin, fille de Jean, lieutenant criminel du Châtelet, ayant obtenu en reconnaissance de services rendus au roi un office de conseiller clerc au parlement de Paris pour la dot de sa fille. De leur union naquirent trois filles, dont seule la fille aînée Madeleine accédera à l'âge adulte, et sera éduquée en protestante, sa mère s'étant nouvellement convertie au culte réformé.
Il habitait sa terre du Vignay, commune de Gironville canton de Milly. Au début de l'année 1573, il se rend à 10 km, au château de Belesbat, demeure depuis 1556, de sa fille Madeleine et de son gendre Hurault de Belesbat, maître des requêtes, avec leurs 9 enfants. Il expédie deux lettres à Charles IX, avec l'acte de démission de sa fonction de chancelier, et fait rédiger son testament par son petits-fils Michel Hurault. Il meurt peu après, le 13 mars, à l'âge d'environ 70 ans, en pleine guerres de Religion, il est enterré en pleine nuit dans l'église Sainte-Madeleine de Champmotteux (à une vingtaine de kilomètres d'Étampes où l'on peut encore voir son tombeau.
Une formation de juriste
Michel de l'Hospital est avant tout un juriste. Humaniste de son temps, l'Italie est pour lui un passage obligé. Il y fait ses études et y voyage beaucoup. Il débute sa formation en Italie à l'université de Padoue, où il deviendra professeur de droit civil. Cette formation peut en partie expliquer l'ampleur des réformes judiciaires voulues par Michel de l'Hôspital. Il s'est également rendu à Rome, lieu de pèlerinage traditionnel où il a été, entre autres, auditeur de la Rote, ce qui lui vaut une grande réputation de savant. Sa carrière de juriste se poursuit lorsqu'il est nommé délégué aux Grands Jours de justice de Moulins en 1540, de Riom en 1542 et de Tours en 1546, et plus particulièrement quand il devient premier président de la Chambre des comptes de Paris.
L'œuvre politique L'œuvre législative
Juriste de formation, Michel de l'Hospital, nommé Chancelier de France le 1er mai 1560 par le roi François II, est le principal collaborateur de la régente Catherine de Médicis. Il convoque les représentants des religions catholiques et réformées au Colloque de Poissy 1561 et essaie d'harmoniser les points de vue des uns et des autres. Confronté au fanatisme des deux camps, il échoue totalement.
Extrait du discours des États d'Orléans : « Tu dis que ta religion est meilleure. Je défends la mienne. Lequel est le plus raisonnable, que je suyves ton opinion ou toy la mienne ? Ou qui en jugera si ce n'est un saint concile ? Ostons ces mots diaboliques, noms de parts, factions et séditions, luthériens, huguenots, papistes. Ne changeons le nom de chrestien. ».
Le 17 mai 1563, Michel de l'Hospital rend compte de la situation financière du royaume devant le parlement de Paris pour le pousser à accepter un édit : La France, en la personne du jeune roi Charles IX, a 50 millions de livres de dettes, dont cinq sont nécessaires pour payer les troupes et expulser les Anglais hors du Havre. Les recettes de l'année précédente sont de 850 000 livres environ et les dépenses de 18 millions. L'édit du 13 mai 1563 prévoit de vendre les biens du clergé pour créer des rentes de 100 000 écus par an. Le Parlement d'abord hostile finit par accepter.
Michel de l'Hospital œuvra pour la simplification du droit français. La tradition attribue une grande partie des édits promulgués entre 1563 et 1567 au chancelier dont la généralisation en 1565 des tribunaux des juges et des consuls, les actuels tribunaux de commerce, le premier ayant été créé à Paris en 1563. Il aurait joué un rôle décisif dans l'assemblée du Conseil élargi où siègent les princes de sang, grands officiers, présidents des parlements qui s'ouvre à Moulins en 1566 et qui débouche sur l'ordonnance de Moulins. Selon cette ordonnance, les parlements ne pourront refuser d'enregistrer les édits ou ordonnances ni de les faire appliquer, même si les remontrances qu'ils pourront présenter sur ses lois seront rejetées. L'édit de Moulins quant à lui affirme l'inaliénabilité du domaine royal sauf les apanages. C'est le promoteur des édits de Fontainebleau sur l'arbitrage et la transaction. Après la mort de François II 1560, il a pour projet de diminuer le nombre d'officiers.
La question de la majorité royale
La minorité de Charles IX de France est un handicap sérieux, l'autorité d'un roi mineur n'a pas le même poids que celle d'un roi adulte. La référence en matière de majorité est l'ordonnance de Charles V de 1374 qui fixe la majorité des rois de France à « 13 ans révolus ». Cependant, à la mort de son auteur, elle n'a pas été appliquée et sa valeur est critiquée par les conjurés d'Amboise. Les termes de cette ordonnance sont ambigus : la quatorzième année est-elle le lendemain du treizième anniversaire ou le jour du quatorzième ? La première des innovations du 17 août 1563 consiste à déclarer la majorité du jeune souverain lors d'un lit de justice non au Parlement de Paris mais dans un parlement de province, celui de Rouen. La seconde est l'interprétation que le chancelier fait de l'ordonnance de Charles V : la quatorzième année doit être commencée et non accomplie. Cette déclaration de majorité est aussi l'occasion pour le chancelier de rappeler deux principes qui lui sont chers, le principe de la continuité monarchique et celui du roi législateur la souveraineté réside dans le pouvoir de faire les lois et seul le roi a ce pouvoir.
Les guerres de religion
Huguenot dissimulé aux yeux des catholiques de son temps, il est partisan de l'unité et de la tolérance. Bien qu'il doive sa première carrière à une protectrice de la Réforme, Marguerite de Berry, sœur d'Henri II, et bien que sa femme et sa fille se soient converties, c'est grâce à l'influence du cardinal de Lorraine, un catholique, qu'il est promu chancelier en 1560. Influencé au départ par les idées de concorde religieuse de ce dernier, après l'échec du colloque de Poissy, son évolution le conduit à accepter une tolérance civile, solution politique qui correspond à son profond respect des libertés de conscience. Son gallicanisme le pousse à tenir des positions fermes concernant l'indépendance temporelle de l'Église et de la couronne vis-à-vis du pape, et explique sa rupture en 1564 avec le cardinal de Lorraine qui, revenu du concile de Trente, voulait en faire accepter les décrets en France. Sa volonté de maintenir l'équilibre instauré par l'édit d'Amboise le pousse à une certaine violence. En 1566, on lui reproche même de n'être pas passé par le Conseil pour envoyer des lettres patentes autorisant les protestants à appeler des pasteurs à leur chevet. Il aurait voulu supprimer la vénalité des offices.
Cependant, il échoue dans ses tentatives d'apaisement du conflit. Rêvant d'un concile national impossible, il se heurte rapidement aux Guise qui ont arraché aux États généraux de Fontainebleau la condamnation des Rohan, qu'il refuse de signer, à la difficulté d'application de l'édit d'Amboise et au manque de tolérance de ses compatriotes.
La paix de Longjumeau apparaît comme une ultime tentative pour sauver sa politique de tolérance civile. Elle suscite une flambée de la colère catholique. Michel de l'Hospital tente alors l'impossible pour s'opposer aux intransigeances. Il refuse ainsi le sceau à la publication d'une bulle papale autorisant une deuxième aliénation des biens du clergé parce que la condition en est l'engagement du roi de France à extirper l'hérésie. Les sceaux lui seront retirés peu après alors que la troisième guerre a déjà commencé. Le nouveau garde des sceaux, Jean de Morvillier, est un modéré proche du chancelier, mais le départ de Michel de l'Hospital marque l'échec de la politique de tolérance civile.
Un philosophe de son temps Un partisan de la tolérance
Michel de L'Hospital est avant tout, le symbole de la politique de tolérance. Malgré l'appui de Ronsard et le voyage de présentation du nouveau roi à son peuple, sa politique de réconciliation échoue totalement. Dès 1560, le pouvoir bascule définitivement du côté ultra-catholique, rendant ainsi un affrontement sanglant inévitable. On en rendit Michel de L'Hospital responsable. Il se retire en 1568 pour s'établir dans sa propriété de Vignay, sur la paroisse de Champmotteux. Lors de la Saint-Barthélemy, il aurait fait ouvrir les portes de son château à une foule fanatique, qui lui laissa la vie sauve. Michel de l'Hospital reste encore aujourd'hui un symbole de tolérance; ainsi, il figure parmi les quatre statues d'hommes illustres placées devant le Palais Bourbon.
« Le couteau vaut peu contre l'esprit ».
Un protecteur de la Pléiade
Ronsard fréquentait les proches du roi : Marguerite, Jean de Morel (1510-1581), Jean de Brinon mais aussi Michel de l'Hospital. Les Amours de Ronsard sont publiés avec son Cinquième Livre des Odes dans lequel on trouve une Ode à Michel de l'Hospital. À partir de 1551, des poètes courtisans, dont Mellin de Saint-Gelais, raillèrent auprès du roi les métaphores pindariques et les obscurités des Odes. Mais, protégé par Marguerite de Navarre et Michel de L'Hospital, Ronsard finit par se réconcilier avec ses rivaux et revient à une inspiration plus simple, à la fois moins érudite et moins ésotérique, en abandonnant Pindare et sa conception du poète inspiré.
Un écrivain
Michel de l'Hospital fut considéré comme un écrivain talentueux. Ses Épîtres furent comparées à celles d'Horace. Il écrit des poésies, mais la majorité de ses œuvres sont cependant en rapport avec son rôle politique : Traité de la réformation de la justice, Harangues, mercuriales et remontrances, Mémoire sur la nécessité de mettre un terme à la guerre civile 1570, Le but de la guerre et de la paix 1570, Discours pour la majorité de Charles IX et trois autres discours.
Œuvres
Harangues 1560
Traité de la réformation de la justice
Harangues, mercuriales et remontrances
Mémoire sur la nécessité de mettre un terme à la guerre civile 1570
Le but de la guerre et de la paix 1570
Poésies 1585, 1732. Édition critique du livre I: Michel de l’Hospital. Carmina. Livre I. Édité, traduit et commenté par Perrine Galand et Loris Petris, avec la participation de David Amherdt. Genève, Droz, 2014.
Discours pour la majorité de Charles IX et trois autres discours, édition établie, présentée et annotée par Robert Descimon, Paris : Imprimerie Nationale coll. Acteurs de l'histoire, 1995.
Établissement qui porte son nom
Collège Michel-de-l'Hospital à Riom 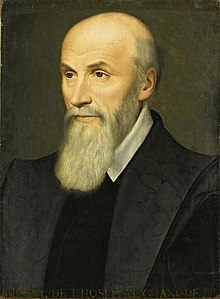   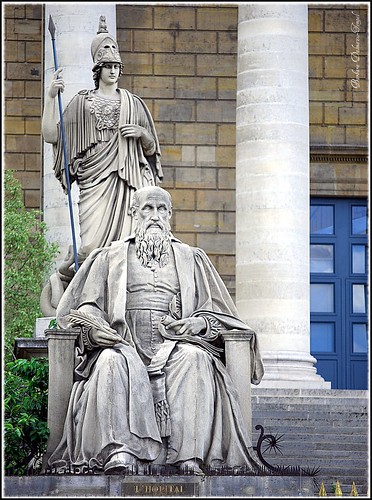 
Posté le : 12/12/2015 17:34
Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:02:25
Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:03:40
|
|
|
|
|
Louis Blanc |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 6 décembre 1882 à 81 ans meurt Louis Jean Joseph Blanc
à Cannes né à Madrid, journaliste et historien français, qui fut membre du gouvernement provisoire de 1848 et député sous la Troisième République. Il naît à Madrid le 29 octobre 1811, enterré au cimetière du père Lachaise.
Socialiste de l'École/tradition. Ses principaux intérêts sont la politique, l' histoire, l'économie? Ses idées remarquables sont le Droit au travail, les ateliers sociaux. son Œuvre principale est l'organisation du travail en 1839. Il a été influencé par John Stuart Mill, Robert Owen, le comte de Saint Simon. Il a influencé Les communistes libertaires, Proudhon, Bakounine, Kropotkine. Il est célèbre pour avoir été républicain de la veille : - Membre de la campagne des Banquets, - Pdt. de la Commission du Luxembourg, - Fondateur des Ateliers sociaux,- Contre les « républicains du lendemain . Citation De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins.
Promoteur de l'aphorisme communiste De chacun selon ses facultés à chacun selon ses besoins : « L'égalité n'est donc que la proportionnalité, et elle n'existera d'une manière véritable que lorsque chacun […] produira selon ses facultés et consommera selon ses besoins. » Organisation du travail, 1839 repris par Étienne Cabet Voyage en Icarie, 1840 puis plus tard par les communistes libertaires. Socialiste et républicain, il participe à la campagne des Banquets en faveur du suffrage universel et se distingue, après la Révolution de 1848, en proposant la création des Ateliers sociaux afin de rendre effectif le droit au travail. Mais il est finalement contraint de s'exiler à Londres après les Journées de Juin car tenu pour responsable de l'émeute du 15 mai. Il y demeura jusqu'à la fin de la guerre franco-prussienne de 1870, entrant de nouveau à l'Assemblée nationale en 1871, où il siège une dizaine d'années à l'extrême gauche.
En bref
Né à Madrid, où son père est inspecteur général des Finances du roi Joseph Bonaparte, Louis Blanc se rend à Paris peu après la révolution de 1830, qui ruine sa famille. À Paris, un ami de son père lui donne des cours de droit. Contraint de gagner sa vie, il est précepteur pendant deux ans à Arras où il collabore au Progrès du Pas-de-Calais. Revenu à Paris, il travaille au National et au Bon Sens dont il devient le rédacteur en chef en 1837. Sa réputation commence alors à s'établir, notamment avec la campagne pour l'extension du suffrage universel, qu'il mène dans la Revue du progrès 1839-1842 puis dans le journal La Réforme. Il publie ensuite des travaux historiques — Histoire de dix ans, 1830-1840, Histoire de la Révolution française (dans laquelle il prend la défense de Robespierre) — qui remportent un grand succès.
Journaliste et historien à une époque où ces deux activités constituaient pour un homme de gauche le plus sûr moyen d'accéder à la notoriété, Blanc devient célèbre grâce à sa brochure L'Organisation du travail, publiée en 1839 dans la Revue du progrès, et qui connaîtra dix éditions entre 1841 et 1848. Selon Louis Blanc, trois principes dominent l'histoire des sociétés : l'autorité, vaincue en 1789, l'individualisme, qui lui a succédé, et la fraternité. Pour instaurer celle-ci, il faut supprimer la concurrence sauvage dans l'économie et entre les hommes en créant des coopératives ouvrières de production, les ateliers sociaux. L'État fournirait le capital nécessaire à leur démarrage et nommerait l'encadrement. Le gouvernement jouerait ainsi un rôle de régulateur du marché, qui, lui, ne disparaîtrait pas mais serait assaini. L'importance qu'il accorde à l'intervention de l'État amène Blanc à affirmer l'interdépendance des réformes politique et sociale, « car la seconde est le but, la première le moyen ». Ses conceptions étatistes lui valent l'hostilité déclarée de Proudhon pour qui Blanc « représente le socialisme gouvernemental, la révolution par le pouvoir, comme (lui-même) représente le socialisme démocratique, la révolution par le peuple ». Comme il s'exprime de façon claire et élégante, Blanc parvient à rendre ses idées accessibles à un large public d'ouvriers et d'artisans. La révolution de 1848 le porte au gouvernement provisoire, où il forme avec l'ouvrier Albert l'aile gauche. Il voit alors ses idées « descendre dans la rue ». Il réclame la création d'un ministère du Travail. Vainement. Nommé à la direction de la commission du gouvernement pour les travailleurs, dite commission du Luxembourg, il peut enfin réaliser ses projets, et contribue à la formation des premiers ateliers sociaux. Mais son idée est rapidement dénaturée, et les ateliers nationaux créés par le gouvernement ne sont plus que des sociétés de travaux publics destinées à éloigner de Paris la masse flottante des chômeurs. Les résultats des travaux de la commission sont en définitive assez minces et, selon la formule de Marx, « Pendant qu'au Luxembourg on cherchait la pierre philosophale, on frappait à l'Hôtel de Ville (siège du gouvernement) la monnaie qui avait cours ».
Les socialistes subissent un grave échec lors des élections à l'Assemblée constituante du 18 mars ; Blanc est élu, mais loin derrière Lamartine. Il doit alors quitter le gouvernement. Le 15 mai, il désapprouve l'invasion de l'Assemblée par les manifestants car, pour lui, la révolution doit être pacifique et ne doit pas porter atteinte à la fraternité entre les classes sociales. Mis en accusation par le parti de l'ordre, il prend les devants et s'enfuit en Angleterre. Il demeure à Londres jusqu'à la chute de l'Empire et se consacre à ses travaux historiques ; son Histoire de la révolution de 1848, qui paraîtra en 1870, est une défense de son attitude durant la révolution. Il revient à Paris après le 4 septembre 1870, et prône l'union et la guerre à outrance contre les Prussiens. Élu premier représentant de la Seine en 1871, le « héros de 48 » condamne la Commune de Paris : « Je pense que la Commune a violé la légalité pour laquelle je suis. Je réprouve les actes de la Commune », déclare-t-il à l'Assemblée de Versailles le 26 avril. Il est réélu en 1876 par plusieurs arrondissements. En 1879, il soutient à la Chambre les projets d'amnistie des communards et se rapproche des radicaux. À sa mort des obsèques nationales lui sont faites à Paris. Élisabeth Cazenave
Sa vie
Fils d'un haut fonctionnaire impérial, Jean Charles Louis Blanc, et frère de Charles Blanc, Louis Blanc fait de brillantes études au collège de Rodez lorsqu'il perd sa mère. Son père devient fou. Chef de famille à 19 ans, il quitte le collège et se rend, avec son frère, à Paris. Lors de son voyage la nouvelle de la Révolution de Juillet 1830 le surprend.
Pour survivre, le jeune Louis Blanc donne des cours et effectue des travaux de copie. Puis grâce à des relations familiales il trouve une place de précepteur dans la famille d'un industriel d'Arras, foyer de la Révolution industrielle en France. Ce poste (1832-1834) lui permet de visiter la fonderie Hallette 600 employés, qui fabrique des locomotives et des presses hydrauliques.
Témoin des conditions de vie du prolétariat, il abandonne définitivement ses positions légitimistes royalistes en s'approchant des idées socialistes. Revenu à Paris, il devient journaliste, collaborant au quotidien Le Bon Sens, journal d'opposition à la Monarchie de Juillet. Puis il collabore au National, où il essaie de gagner la petite et moyenne bourgeoisie à la prise de conscience de sa propre perte au profit de la haute bourgeoisie financière dans un schéma concurrentiel. Il y développe l'idée d'un véritable suffrage universel. L'insurrection lyonnaise de 1834 voit l'écrasement du mouvement républicain par le gouvernement. Louis Blanc s'associe à cette démarche et publie des articles en faveur des accusés.
En 1839, il fonde la Revue du Progrès, publiant la même année L'Organisation du travail1, dans lequel il présente l'Association comme réponse à la question sociale. Il s'y attaque en effet à la concurrence anarchique, préconisant un système d'associations à but lucratif contrôlées par l'État démocratique la première année seulement. Selon lui, ce système est nécessaire, car la concurrence entre entrepreneurs mène inéluctablement au monopole et, parallèlement, à la paupérisation de la collectivité, tandis que la concurrence sur le marché du travail crée une spirale appauvrissante.
Avec la Revue du Progrès, Louis Blanc ambitionne d'en faire une tribune ouverte aux diverses tendances de l'opinion républicaine, mais il ne parvient pas à avoir une large audience dans les classes populaires. Les doctrines défendues par la Revue sont très avancées, Louis Blanc défendant un système parlementaire démocratique suffrage universel s'exprimant annuellement et monocaméral l'Assemblée nationale représentant fidèlement la Nation. Il se fonde sur le mode de scrutin proportionnel élaboré par Hare, défend la responsabilité politique de l'Assemblée qui nomme en son sein les membres de l'exécutif, ainsi que le double examen en matière législative (double lecture et vote par l'Assemblée. Globalement, il défend dans son œuvre un projet de social-démocratie en préconisant la réorganisation du travail et le partage équitable des profits certes, mais également des pertes le cas échéant.
Il rencontre d'ailleurs Louis Napoléon Bonaparte emprisonné au fort de Ham et, pensant l'avoir convaincu de la pertinence de ses idées, va le défendre devant la chambre des pairs après sa tentative putschiste de Boulogne en 1840.
Louis Blanc se fait aussi une réputation d'historien pamphlétaire en publiant en 1841 L'histoire de dix ans (1830 à 1840), très critique à l'égard des premières années de règne de Louis-Philippe et encensant au contraire les Républicains.
En 1843 il entre au comité de direction du journal La Réforme aux côtés de républicains tels que Ledru-Rollin, Lamennais, Schœlcher ou Cavaignac. Il y développe ses deux idées centrales, l'Association et le Suffrage universel.
1848 : l'heure de l'engagement concret
Révolution ouvrière
La Réforme et Le National espèrent voir s'ouvrir les cercles du pouvoir jalousement gardés par le gouvernement Guizot dont la majorité est confirmée par les élections de 1846 grâce à un mode de scrutin spécifique[Quoi ?]; d'où une propagande accrue pour revendiquer la réforme électorale à travers la Campagne des Banquets. Ces réunions dans toute la France réunissent différents courants: Louis Blanc est à la tête des négociateurs radicaux, défendant le suffrage universel et la représentation proportionnelle de la Nation par l'Assemblée nationale.
Les talents d'orateur de Louis Blanc sont célébrés durant le banquet de Dijon où il déclare : « Quand les fruits sont pourris, ils n'attendent que le passage du vent pour se détacher de l'arbre ».
La campagne des Banquets prend alors une allure que nombre de ses fondateurs n'a pas prévue. Un banquet doit avoir lieu à Paris le 22 février 1848 mais le gouvernement l'interdit. Sous l'impulsion de Louis Blanc, les membres les plus engagés se réunissent néanmoins, et le banquet se prolonge le jour suivant, renforcé par l'appui de la garde nationale. Guizot démissionne. Le soir même éclate une fusillade devant le ministère des Affaires étrangères. Les barricades gagnent toute la ville.
Louis-Philippe Ier abdique en faveur de son petit-fils, le comte de Paris et part en Normandie. Un gouvernement provisoire composé de Dupont de l'Eure, Ledru-Rollin, Flocon, Marie, Garnier-Pagès, Lamartine et Louis Blanc est formé. Cette liste résulte d'un compromis avec les membres du journal Le National et de La Réforme. Ils se rendent à l'Hôtel de ville et proclament la République souhaitée par les insurgés.
Le droit au travail et les Ateliers sociaux
Ateliers sociaux.
Sous la pression d'ouvriers parisiens dans la salle des Séances le gouvernement provisoire publie un décret rédigé à la hâte par Louis Blanc auquel s'oppose Lamartine garantissant le droit au travail :
« Le gouvernement provisoire de la République s'engage à garantir l'existence des ouvriers par le travail. Il s'engage à garantir le travail […] à tous les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. »
Le gouvernement provisoire ne fait rien pour essayer de tenir sa promesse. La Révolution a pourtant été faite en ce sens. Une manifestation éclate le 28 février. On y réclame, de nouveau, l'organisation du travail et un ministère du Progrès. La majorité du gouvernement s'oppose à ces nouvelles revendications.
Les manifestants doivent se contenter d'une Commission pour les travailleurs, laquelle doit siéger au palais du Luxembourg. Après négociations, Louis Blanc accepte à contrecœur la présidence de cette Commission du Luxembourg, privée de budget propre, alors qu'il demandait, conformément aux vœux des révolutionnaires, un Ministère du travail doté d'un budget spécifique.
Dans l'esprit de Louis Blanc, ce devait être une sorte de « parlement du travail » pour annoncer les lois sociales que l'assemblée constituante n'aurait plus qu'à ratifier. Louis Blanc s'y voue totalement et parvient, avec beaucoup de difficultés, à mettre en place de nombreux projets. Des milliers d'associations ouvrières de production sont créées, le papier monnaie utilisé pour les échanges entre les associations est aussi utilisé dans les commerces à Paris notamment)
Par ailleurs, dès la première séance au Luxembourg Louis Blanc s'attache à limiter la journée de travail à 10 heures par jour à Paris et à 11 heures en Province et supprime le marchandage à moins qu'il ne soit du fait des ouvriers. Il obtient la suppression du livret d'ouvrier, et arbitre également de nombreux conflits entre entrepreneurs et employés.
Enfin, la Commission propose la formation d'ateliers sociaux dont la mise en place passerait par un crédit d'État à taux zéro et dont l'objectif serait d'assurer un emploi aux travailleurs correspondant à leur compétence. De surcroît, le partage à égalité des bénéfices entre associé-travailleurs est un préalable à l’aide publique.
Or, Marie est chargé de la réalisation, en parallèle et contre Louis Blanc, des ateliers nationaux dont l'objectif à court terme est d'apporter du travail aux pauvres : travaux de terrassement par exemple, non productifs et ne correspondant pas à la formation des personnes qui y travaillent. Ceci n'a rien à voir avec les ateliers sociaux dont l'objectif est de proposer du travail correspondant au savoir des travailleurs dans une dynamique industrielle à long terme. Louis Blanc et ses ateliers sociaux s'inscrivent dans la logique économique de l'époque.
Néanmoins, Louis Blanc se heurte très rapidement aux aspirations des membres du gouvernement provisoire. En effet, face à l'influence croissante de Louis Blanc ceux-ci souhaitent sa chute. Le Luxembourg devait prouver l'inefficacité des solutions qu'il propose. Ce n'est pas le cas. Dès lors, ce jeune journaliste est à abattre par tous les moyens. La calomnie fait rage dans les journaux. Il échappe de justesse à deux attentats. Les ateliers nationaux sont abondamment financés tandis que les ateliers sociaux ne bénéficient d'aucune aide.
Louis Blanc revient sur ces événements dans son Histoire de la Révolution de février 1848 : les causes profondes sont, selon lui, à chercher dans le machinisme qui conduit mécaniquement à la hausse du chômage et à la massification du prolétariat des faubourgs. Blanc décrit ainsi un tableau social proche de celui présenté par le docteur Villermé dans son Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie 1840.
Blanc interroge le triptyque républicain Liberté, Égalité, Fraternité à la lumière de cet état de faits : comment parler de liberté chez celui qui est esclave de la faim et de l'ignorance? Où est l'Égalité lorsque le travail des uns fait fructifier l'argent des autres? Comment comprendre la Fraternité lorsque le législateur fait des lois non pas pour protéger les plus faibles dans le sens du contrat social, c'est-à-dire afin de garantir la vie et pour lutter contre la misère mais bien au contraire pour garantir au plus fort une liberté dont il est le seul à pouvoir jouir?
La fermeture des « Ateliers nationaux » et l'exil sous le Second Empire
Après le succès des conservateurs aux élections du 23 avril 1848 pour l'Assemblée nationale, il est écarté de la Commission exécutive qui succède au gouvernement provisoire le 10 mai. La majorité conservatrice (ou Parti de l'Ordre, en particulier Jules Favre, tente de le poursuivre en le tenant responsable des manifestation du 15 mai 1848.
Le rôle de Louis Blanc est pratiquement nul pendant les Journées de juin 1848. Il se rend à l'Assemblée qui s'est déclarée en permanence tandis que Falloux propose la dissolution immédiate des Ateliers nationaux.
Louis Blanc n'apprécie guère le général Cavaignac à qui l'on vient de confier la mission de contenir la Révolution. Il n'y retrouve pas les sentiments républicains de son frère (lui qui d'ailleurs va par la suite l'accuser d'avoir laissé la situation s'aggraver pour permettre à l'armée d'effacer sa défaite de février). La situation est extrêmement tendue si bien que Louis Blanc manque d'être tué par des gardes nationaux qui voient en lui le promoteur des Ateliers nationaux. Le président de l'Assemblée, Philippe Buchez, lui offre un refuge au Palais Bourbon.
Une commission est alors nommée pour enquêter sur les journées de juin et elle décide presque aussitôt de remonter aux événements qui se sont déroulés depuis février 1848. Louis Blanc et Ledru-Rollin sont directement visés et le procureur général demande la levée de l'immunité parlementaire de Louis Blanc. Après un discours de Cavaignac, celle-ci est accordée à 6 heures du matin par 504 voix contre 252.
Louis Blanc part à Saint-Denis pour la Belgique. Il gagne Gand. Il y est arrêté puis expulsé pour débarquer en Grande-Bretagne. C’est le début d'un exil de vingt ans.
En avril 1849, la Haute Cour de justice de Bourges, qui juge les participants à la manifestation du 15 mai 1848, condamne par contumace Louis Blanc et cinq autres inculpés à la déportation. Son projet d'ateliers sociaux est ainsi amalgamé par la propagande antisocialiste avec les Ateliers nationaux dont la fermeture provoqua les Journées de Juin.
En 1859, il refuse l'amnistie accordée par un gouvernement qu'il ne reconnaît pas. Le succès considérable de l'Empire inquiète les exilés républicains.
À Londres, Louis Blanc fait des conférences et donne des cours notamment sur la Révolution française dont il écrit l'histoire entre 1847 et 1862. Il devient ami du philosophe John Stuart Mill, auteur des Considérations sur le gouvernement représentatif 1861. Le déroulement de la Révolution de 1848 et l'avènement au pouvoir, par les urnes, de Bonaparte, l'incitent à réviser ses conceptions concernant le mode de scrutin2. Dans Le Temps, il présente ainsi le système de Mill3, qu'il défendra ouvertement en 1873 « De la Représentation proportionnelle des minorités ». Blanc s'intéresse par ailleurs à la politique anglo-saxonne, s'indignant par exemple du soutien moral apporté par certains conservateurs britanniques aux Sudistes lors de la guerre de Sécession5.
Activité maçonnique
Durant son exil il sera initié à la loge « Les sectateurs de Ménés », à Londres. En 1854 il est installé comme 93e du Rite de Memphis et orateur du Souverain Conseil de ce grade. En 1882 il apparaît comme membre actif de la loge « Humanité de la Drôme » à Valence et comme membre d'honneur de la loge « Les libres penseurs du Pecq »
Le retour de Louis Blanc
Louis Blanc photographié par Louis Victor Paul Bacard vers 1865.
Toutefois, la défaite de 1870 et la captivité de l'Empereur met une fin brutale au Second Empire. Dès le 5 septembre au soir, Louis Blanc se rend à Paris et y apprend la formation du gouvernement provisoire par Gambetta.
De retour sous la Troisième République il n’aura plus le prestige d’antan même s'il effectue sur le terrain partout en France un travail considérable. Louis Blanc est resté très populaire Quoi ? malgré vingt-deux ans d'exil. Son nom est inscrit sur la liste du gouvernement. C'est une charge qu'il refuse. Aux élections à l'Assemblée constituante qui ont lieu pendant l'armistice, il est élu député avec un nombre d'électeurs dépassant même celui de Victor Hugo ou de Gambetta.
Il part ensuite à Bordeaux où il défend le maintien des frontières contre les partisans de la paix immédiate. Ceux-ci l'emportent et Louis Blanc revient siéger à Versailles. Une méfiance réciproque dresse les ruraux défenseurs de la paix et les Parisiens aigris par leurs souffrances inutiles et l'installation du pouvoir politique à Versailles.
Louis Blanc a peu d'influence auprès de ses collègues et les modérés voient en lui, à tort, le dangereux révolutionnaire de 1848: l'homme des Ateliers nationaux. Dans le camp républicain, ses idées d'association sous l'égide de l'État paraissent dépassées en raison de l'influence de Proudhon et de Marx, qui voient dans l'État une superstructure bourgeoise hostile au peuple. Par ailleurs, l'idée de l'Union des classes en raison de leur interdépendance car du travail de l'un dépend la vie de l'autre, d'où la nécessité d'un partage équitable des profits est concurrencée par l'idée de lutte des classes. L'évolution du débat est perceptible dans le Manifeste de la Commune auquel Louis Blanc est hostile car il supprime toute politique centralisatrice et équitable. L'unité de la France serait détruite au profit d'un chacun pour soi dévastateur. Même s'il refuse de prendre part à la Commune car il en condamne l'idéologie, il prend la défense du mouvement après la défaite. Il se dresse contre les excès de la répression et dès septembre 1871 il dépose un projet de loi portant amnistie des délits politiques. Il renouvelle sa demande en 1872 puis en 1873. Son âge et son long exil ont atténué son influence. Il arrive cependant avec Gambetta à repousser un projet de loi qui cherche à restreindre, de nouveau, le suffrage universel.
Il est réélu en 1881. Toutefois, du fait de sa santé délicate, il laisse souvent à Clemenceau le soin de défendre leurs idées communes. Il doit bientôt partir se reposer à Cannes où il meurt des suites d'un refroidissement à l'âge de 71 ans. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise 67e division.
Le projet politique et juridique issu de ses analyses économiques et historiques
Une réorganisation et une clarification du contenu est nécessaire. Discutez des points à améliorer en page de discussion.
Le projet des « Ateliers sociaux »
Louis Blanc remarque que les employés et les employeurs sont soumis aux aléas du marché du travail (employeurs victimes de la concurrence anglaise, et employés victimes de la concurrence des plus pauvres qu'eux) et propose que l'État protège ceux qui souhaitent le rejoindre en créant les ateliers sociaux. C'est un univers d'échange économique basé sur la complémentarité plutôt que sur la concurrence. La fraternité plutôt que l'individualisme. Dans tous les cas, et pour éviter les situations extrêmes de pauvreté et de richesse, il propose de nationaliser la banque. L'État démocratique quant à lui serait contrôlé par le suffrage universel et mettrait au profit du peuple ses pouvoirs. Les élus sont, dans son projet, les serviteurs des électeurs et sont responsables de leur mandat.
Son but est de réguler la concurrence pour lutter contre la misère par la création d'ateliers sociaux dans les branches les plus importantes de l'industrie nationale dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, le projet a vocation à s'étendre suivant la volonté des acteurs.
Pour bénéficier de l'emprunt à taux zéro de l'État ou d'un contrôle du fonctionnement équitable de l'industrie par exemple, les associations doivent rédiger des statuts qui reconnaissent la démocratie d'entreprise, la souveraineté des travailleurs, le souhait de sortir de l'état de nature des relations économiques. Dans le cas contraire, libre à eux de créer une entreprise et de travailler dans l'univers libéral, concurrentiel, qui continue à exister en parallèle du projet de Louis Blanc. D'ailleurs, pour Louis Blanc, l'univers libéral serait complètement libéralisé. Il n'y aurait plus de droit au travail pour eux, plus de contrôle tout au plus un simple et modeste impôt forfaitaire pour la participation à la gestion du domaine public.
Le capital prêté par l'État à taux zéro aux associations est destiné à l'achat de matériel. Tous les ans les profits seraient répartis entre les membres de l'association. Alors, « déduction faite du montant des dépenses consacrées à faire vivre le travailleur, des frais d'entretien et de matériel, le bénéfice serait ainsi réparti :
Un quart pour l'amortissement du capital avancé par l'État
Un quart pour l'établissement d'un fonds de secours destiné aux vieillards, aux malades, aux blessés, etc.
Un quart à partager entre les travailleurs à titre de bénéfice
Un quart enfin pour la formation d'un fonds de réserve.
Ainsi serait constitué l'association dans un atelier »
Par ailleurs, le problème du machinisme serait résolu par l'emploi progressif des machines pour réduire le coût de production et pour faire baisser le temps de travail. Le progrès technique, qui était pesant pour l'ouvrier, deviendrait alors un facteur d'amélioration de ses conditions de vie, de sa Liberté. Ce programme était un succès considérable. À Paris comme en province l'union des classes est souhaitée. Le but est d'en attendre l'amélioration des conditions de vie et de travail avec une augmentation des salaires par la participation directe aux résultats de l'entreprise associative en cas de profits (en cas de perte, la solidarité est la même. C'est là, une alternative directement applicable pour soulager les maux qui touchent l'ensemble de la société. « L'organisation du travail » en est la formule.
Présentation
Tour à tour historien, économiste, théoricien politique et juridique, et homme politique, c'est à partir d’une étude historique qu’il dégage des thèmes économiques fondamentaux, à partir desquels il élabore un projet social appelant la création en droit d’associations par l’impulsion d’un État démocratique.
Connu principalement comme théoricien socialiste, son propos est cependant plus étendu. Parallèlement au projet d'organisation associative du travail, qu'il tente de concrétiser via les Ateliers sociaux, Blanc développe une réflexion institutionnelle au sujet de la souveraineté et de la démocratie, de la décentralisation et des lois (principalement sur le travail). En conséquence, un droit particulier s’applique en raison du caractère démocratique du régime souhaité. D’ailleurs, dans son esprit, le droit est un outil au service d’une politique que les Constitutions révèlent.
En matière d'histoire, alors que « la démarche des saint-simoniens et de Fourier avait conduit à une critique radicale de la Révolution de 1789, révolution négative.», Louis Blanc la perçoit comme profondément socialiste. Dans son esprit, c’est une étape fondamentale vers l’affranchissement de tous les travailleurs qu'il convient de poursuivre :
« La révolution de 1789 fut certainement une révolution socialiste … puisqu’elle modifia la constitution économique de la société au profit d’une classe très nombreuse et très intéressante de travailleurs ; mais la révolution de 1789 laissa beaucoup à faire pour la classe la plus nombreuse et la plus pauvre ! (…) Elle déblaya la route de la liberté ; mais elle laissa sans solution la question, très importante pourtant, de savoir si beaucoup de ceux qui étaient à l’entrée de la route n’étaient pas condamnés par les circonstances du point de départ à l’impuissance de la parcourir. »
Selon le commentateur Francis Demier, pour Louis Blanc :
« les classes ne sont pas condamnées à s’affronter et la lutte de classes, contrairement à l’idée qui se développe de Guizot à Marx, n’est pas le moteur de l’histoire. (…) Le marché ne fait que des victimes, il est une force anonyme, sans visage, sa logique échappe aux individus qu’ils soient ouvriers ou patrons. »
Si sa philosophie de l’histoire ne prend pas en compte l’idée d’une lutte des classes en tant que moteur de l'histoire13, celle-ci n'est cependant pas ignorée. L’histoire du xixe siècle est, d'après lui « le martyrologe des républicains.» Par ailleurs, comme Marx, Louis Blanc considère les structures effectives de l’organisation de la production comme déterminant l’ordre social et politique.
Sur le plan économique, Blanc distingue la place de l’individu dans un système de libre concurrence et dans un système associatif. Sa méthode d’analyse part systématiquement de l’Homme, de son droit fondamental à vivre pour comprendre les influences du monde économique sur la Liberté. Dans son esprit, le travail est tout aussi vital que l'air. Dès lors, la puissance des règles économiques sur le quotidien doit être analysée afin d’établir un projet politique. La logique de l’accaparement, du profit, qui a pour conséquence l’appauvrissement général de la population, n’a aucun sens. Les chômages, les spéculations sur les denrées alimentaires vitales, sont des injustices criminelles. Il condamne cette logique au nom de la liberté :
« Dieu en soit loué ! On n’est pas encore parvenu à s’approprier exclusivement les rayons du soleil. Sans cela, on nous aurait dit : « Vous paierez tant par minute pour la clarté du jour » et le droit de nous plonger dans une nuit éternelle, on l’aurait appelé Liberté ! »
Dans son esprit, un choix doit être proposé aux Travailleurs (entrepreneurs et employés) de l’industrie et du monde agricole : soit la concurrence individuelle complètement libéralisée, soit l’entente concertée au sein d’associations soutenues la première année par l’État. Or, Louis Blanc constate que ce choix n’existe pas dans la France de la première moitié du xixe siècle. Dans son projet politique coexistent alors une organisation concurrentielle du travail, une organisation associative du travail (qui emporte son adhésion) et un service public. L’État ne doit pas favoriser telle ou telle dogme économique, mais permettre au citoyen de librement choisir le mode d’organisation du travail qui lui convient.
Louis Blanc tente de mettre en œuvre ce projet en 1848, à la Commission du Luxembourg, puis sous la Troisième République. Dès lors – au-delà d’une vision dogmatique abstraite à la fois économique et politique s’inscrivant dans une perspective historique et idéologique qui doit être saisie par le droit – la confrontation de son système avec la réalité l’amène à proposer un projet social et démocrate éclairé par l’expérience.
L’évolution de sa pensée, entre ses années de jeunesse parisienne et sa retraite forcée en Angleterre17, est continue et régulière18. Ses années de jeunesse forment le fond de sa philosophie générale qui s’est vue ensuite perfectionnée avec le temps.
L’unité du projet politique
Francis Demier a souligné le faible nombre de travaux récents consacrés à Louis Blanc. La plupart se consacrent à L'Organisation du travail et, plus spécifiquement, aux ateliers sociaux industriels, agricoles et littéraires
Or ces institutions ne sont que les outils d’un projet plus global. L’unité du projet de L. Blanc comprend trois éléments complémentaires :
un aspect social incarné par l’organisation du travail ;
un aspect moral qui propose une perception de l’intérêt individuel en société ;
un aspect politique prenant forme à travers le projet démocratique. Travail, morale et démocratie convergent ainsi vers la République sociale démocrate.
Ainsi, au-delà de l’organisation du travail liberté économique, qui est le socle, la « révolution morale » permet au système de fonctionner durablement, tandis que le projet démocratique garantit institutionnellement le pouvoir souverain du peuple (liberté politique). Ceci forme l’unité républicaine de Louis Blanc qui peut être au service du socialisme si telle est la volonté du peuple souverain. En effet, celui-ci doit s’exprimer par le suffrage universel via un mode de scrutin permettant à l’Assemblée d’être la représentation fidèle de la Nation.
Sur le plan économique, si Blanc défend le principe associatif, source du progrès véritable et de la fraternité, il n'exige pas la suppression du système concurrentiel23. De son silence à l'égard de ce secteur, on pourrait dire qu'il laisse le libéralisme à lui-même, en ne fixant aucune règle à la concurrence. Certainspourraient même soutenir qu'il défend un libéralisme extrême dans les relations commerciales en désengageant totalement l’État des entreprises qui ont fait le choix de l’individualisme concurrentiel.
En effet, lorsque Louis Blanc évoque l’organisation du travail, il ne pense pas aux entreprises existantes. Il cherche simplement à créer un nouvel espace d’échange, basé sur la complémentarité et non sur l’antagonisme. C’est d’ailleurs ce qui se passe en février 1848 lorsqu’il engage les réformes à la tête de la commission du Luxembourg.
Ainsi, tout en facilitant la réalisation des vœux les plus chers des libéraux, il propose à ceux qui le souhaitent une organisation du travail basée sur un contrat social transposé à l’économie. Dans son esprit, s’il faut sortir de l’état de nature des relations économiques - de la barbarie criminelle et archaïque que cette situation induit, de l’absence de liberté, d’égalité et de fraternité dans ce système – s’il est impératif que la monarchie financière tombe à jamais pour enfin pouvoir vivre dans une vraie démocratie, il ne faut cependant violenter personne.
En ce sens, si ses préférences vont dans le sens d’un socialisme pragmatique, s'il dénonce avec force les conséquences du libéralisme pendant tout le XIXe siècle, le principal pour lui est que « deux modes de relations industrielles soient mis en présence. (…) [afin que] l’expérience décide lequel des deux modes est le meilleur, (…) sans commotion, par la seule puissance de l’attrait. Rien ne doit venir gêner le développement concret de l’un ou l’autre système « économico-philosophique » qui, du reste, aspirent tous deux à un mieux vivre ensemble.
Cette position permet à Blanc de faire des ateliers sociaux associations industrielles, agricoles et littéraires les seules entreprises qui peuvent légitimement bénéficier du soutien de la collectivité, c'est-à-dire de l’État. L’aide publique est conditionnée au respect de certaines valeurs, l’État et les associations s’entendent dans le cadre d’un projet unitaire et démocratique. Dans son esprit, le droit du travail, les commandes de l’État, le contrôle d’un fonctionnement équitable de l’entreprise inspection du travail, la protection de la propriété collective dans le travail et privée dans la famille, l’emprunt gratuit, etc., ne concernent que le monde du travail associatif. Les interventions de la puissance publique dans le travail sont l’apanage des associations industrielles, des colonies agricoles et des associations littéraires.
Pour Blanc, le progrès de la civilisation se comprend par un idéal républicain qui se caractérise par une exigence précise d’humanisation de la société et qui passe, avant de proposer une alternative, par la critique radicale du système économique libéral. Dans son esprit, le libre jeu du capitalisme la concurrence laisse le revenu des ouvriers comprimé par la loi du marché et parfois carrément annulé en temps de crise. Mais cette concurrence ne favorise pas non plus la bourgeoisie qui se voit remplacer par une oligarchie financière omnipotente et inique. Se dessine alors un ennemi commun, le monde de la finance, contre lequel notre auteur appelle à la Révolution :
« la féodalité territoriale et militaire a disparu, il faut que la féodalité financière disparaisse. (…) La royauté de l’argent, l’aristocratie de l’argent, voilà bien effectivement ce qui est en question. »
Par ailleurs, la situation de dépendance des « travailleurs » entrepreneurs et salariés, qu'il oppose systématiquement aux financiers, « brasseurs d’affaires », par rapport à l’intérêt porté au capital prêté est intolérable au regard de la Liberté
« L’intérêt du capital représente le privilège accordé à certains membres de la société de voir, tout en restant oisifs, leur fortune se reproduire et s’accroître ; il représente le prix auquel les travailleurs sont forcés d’acquérir la possibilité de travailler ; il représente leur asservissement à une condition que, le plus souvent, ils ne peuvent débattre, et que jamais ils ne peuvent éluder. »
Louis Blanc cherche à y remédier en proposant une intervention sociale et publique à la fois28. Seul l’État, « une réunion de gens de bien, choisis par leurs égaux pour guider la marche de tous dans les voies de la liberté », peut remplir ce rôle d’émancipation du Travail en soutenant la propriété associative des outils de production. C’est au souverain qu’incombe la responsabilité et le pouvoir de donner le crédit et non à le recevoir. Ceci passe inévitablement par une nationalisation de la banque et un crédit gratuit aux associations. C’est l’aspect associatif (partage des bénéfices à égalité) de l’entreprise qui compense le taux d’intérêt que l’entreprise libérale devra payer à l’État banquier.
Selon Blanc, le pouvoir financier du moment conditionne l’asservissement des individus à des taux dont ils ne peuvent discuter. Bien souvent, plus l’emprunt est nécessaire plus le taux augmente ce qui est absolument contre-productif socialement. Aussi, si aucune parité ne peut être faite entre le capital et le travail – car lorsque le travailleur meurt son travail disparaît avec lui tandis que le capital survit au capitaliste - le capital peut alors très bien appartenir aux travailleurs associés, indépendamment du capitaliste.
En prônant la doctrine du laisser-aller dans le travail concurrentiel, et sans organisation associative, « la misère devient pour le plus grand nombre un fait inévitable », tant le rapport de force est inégal et la violence inéluctable. Ceci va à l’encontre du premier des droits fondamentaux, le droit à la vie :
« « Est-il vrai, oui ou non, que tous les hommes apportent en naissant un droit à vivre ? Est-il vrai, oui ou non, que le pouvoir de travailler est le moyen de réalisation du droit de vivre ? Est-il vrai, oui ou non, que si quelques-uns parviennent à s’emparer de tous les instruments de travail, à accaparer le pouvoir de travailler, les autres seront condamnés, par cela même, ou à se faire esclaves des premiers, ou à mourir ? »
Un concept central : l’organisation du pouvoir
C’est afin de garantir la vie des individus qu’il demande une organisation du pouvoir car le système concurrentiel ne peut remplir cette mission. Or, dans son esprit, « c’est une œuvre trop vaste et qui a contre elle trop d’obstacles matériels, trop d’intérêts aveugles, trop de préjugés, pour être aisément accomplie par une série de tentatives partielles »33. Dès lors, seul l’État a la puissance nécessaire d’impulsion permettant la mise en place concrète d’un mode alternatif de répartition - le mode de production reste le même - au sein de la société actuelle.
La mission économique de l'État démocratique reste simple : en parallèle du système concurrentiel laissé à lui-même, le principe de fonctionnement est très précis :
« je n’ai jamais entendu faire l’État producteur et le charger d’une besogne impossible. Qu’il devienne le commanditaire et le législateur des associations, je ne lui demande que cela. »
Ce projet demeure, aux yeux de Blanc, de l'ordre d'une proposition soumise au débat :
« c’est à la nation …, par ses mandataires, si telle est sa pensée, de jeter au milieu du système social actuel, les fondements d’un autre système, celui de l’association. »
Une distinction dans le travail s’opère alors au sein de l’État entre le communisme communauté, rouge, le socialisme association, bleu et le libéralisme l’individu, blanc. Ce sont trois couleurs, trois systèmes à égalité, dans la même unité.
Par le biais d'exclamations rhétoriques, Blanc justifie ainsi l'intervention publique dans le secteur associatif :
« il n’est pas interdit d’améliorer le régime des prisons, et il le serait de chercher à améliorer le régime du travail ! Il n’y a pas de tyrannie à tendre la main à des compagnies de capitalistes, et il y en aurait à tendre la main à des associations d’ouvriers ! (…) Nous avons un budget de la guerre, et il serait monstrueux d’avoir un budget du travail! »
Le concept d’organisation impulsé par un État démocratique est central car, « les obligations sociales ne sont pas tellement simples, elles ne se concilient pas si facilement avec le principe d’égoïsme aveugle qui est au-dedans de nous, qu’on puisse repousser dédaigneusement l’initiation aux saintes maximes du dévouement »37. C’est alors à l’État d’organiser une alternative non antagoniste de fonctionnement ; d’établir juridiquement trois espaces économiques distincts.
Blanc partage une anthropologie pessimiste, plus proche de Hobbes que de Rousseau. L'égoïsme naturel requiert ainsi le cadre associatif afin d'éviter le chaos. Avec l'État appuyant ce secteur, chaque homme peut ainsi choisir de devenir un individu social:
« [Louis Blanc est] convaincu que, parmi ceux qui, dans la lutte, cherchent à vaincre coûte que coûte, il est des hommes dont le cœur souffre des moyens qu’ils mettent en usage. Mais le régime économique où ils vivent plongés est là qui les y condamne. Il faut qu’ils tâchent de ruiner autrui, sous peine d’être ruinés eux-mêmes. »
Perverti par le système économique actuel, l'égoïsme pourrait être mis au service de la cause de l'humanité. Il est, de fait, fondé sur une mauvaise perception des individus: selon Blanc, l'intérêt rationnel des individus pousse à l'association plutôt qu'à la concurrence. Seule une oligarchie financière qui profite de cet état de violence perpétuelle.
Seule une solution politique, toutefois, c'est-à-dire collective, peut permettre la mise en place d'un nouvel ordre économique:
« ce sont les imperfections du régime économique existant qui sont coupables. C’est donc à elles surtout qu’il convient de s’en prendre, et les faire graduellement disparaître est affaire, non de haine et de colère, mais d’étude, non de violence, mais de science »
Selon l'historien Maurice Agulhon, ainsi, pour Louis Blanc:
« ce n’est pas organiser l’économie par une sorte de planification, c’est organiser les travailleurs, les inviter à s’associer en coopératives, et à gérer les échanges sur cette base autogestionnaires avant la lettre40. »
En effet, dans ce projet, l’État joue un rôle d’impulsion et de contrôle interne la première année, après cela, il est le gardien externe de la propriété collective comme il est le gardien de la propriété privée. Il la préserve sans l’accaparer.
Dans un second temps, organiser, ce n’est pas non plus, en ce qui concerne l’État, ordonner le politique par une sorte d’autoritarisme venant du sommet, c’est organiser les citoyens, les inviter à s’associer à travers les communes et dans des réunions publiques, c’est-à-dire à gérer les échanges politiques sur cette base, avant de prendre part à l’élection des mandataires au suffrage universel. En effet, à défaut d’avoir le temps et l’envie de gérer directement les affaires de l’État, le peuple souverain agit à travers ses serviteurs responsables et révocables.
Le mode de scrutin, système de Thomas Hare, choisi par Louis Blanc est un moyen d’optimiser la représentativité de l’Assemblée en fonction des divergences nationales et permet à celle-ci d’être le résumé vivant de la nation. L’Assemblée nationale se voit ainsi composée des personnes jugées par leurs semblables les plus aptes à les servir. Elle devient le lieu de résolution des conflits sociaux (toujours préférable à la rue pour la bonne marche de l’économie. À Londres, Blanc s'initie à la pensée de J.S. Mill, ce qui le pousse à préconiser un système de représentation proportionnelle permettant aux minorités de se faire entendre.
C’est le concept d’État serviteur qui domine sa démonstration et non la vision d’un État maître comme chez Pierre Leroux ou de l’État anarchique de Proudhon. De plus, comme le précise Francis Demier, l’idée d’une révolution de classe, d’un scénario qui pousserait une avant-garde ouvrière à s’emparer du pouvoir pour transformer la société est complètement étrangère à la pensée de Louis Blanc.
Suffrage universel et association
Un moyen d’organisation et une idée à mettre en place
Le suffrage universel est pensé comme moyen d'organiser tant la sphère politique qu'économique, dans un contexte de Modernité caractérisé par l'éloignement du pouvoir central. Le vote devient le moyen d’expression permettant de mandater des personnes pour servir les intérêts des individus à différentes échelles (travail, commune, État). Le citoyen travailleur devient souverain dans ces deux univers.
« Le suffrage universel est l’instrument d’ordre par excellence. Et pourquoi ? parce qu’il est la légitimité dans la puissance, et que là où il est pratiqué, l’État est le « moi » de Louis XIV prononcé non plus par un homme, mais par le peuple. »
Dès lors, en raison de la communauté d’intérêts et de valeurs, c’est bien l’unité républicaine qui est mise en avant. L'idée associative oriente ce projet, se concrétisant dans les ateliers sociaux (industriels et agricoles; le projet d’atelier social littéraire obéit à une autre logique), la commune et l’Assemblée nationale:
« la commune représente l’idée d’unité tout aussi bien que l’État. La Commune, c’est le principe d’association ; l’État, c’est le principe de nationalité. L’État, c’est tout l’édifice ; mais la Commune, c’est la base de cet édifice. »
Ces associations, garanties de l'exercice de la liberté, sont perçues comme le prolongement naturel de la famille, perçue comme forme d'association originelle. Les délégués mandatés par le suffrage ont pour mission de gérer les affaires courantes de la cité ou de l’industrie pour le compte des individus qui, occupés quotidiennement par leur travail et leur famille, ne peuvent intervenir directement et en permanence.
En somme, dans le système qu’il propose, l’individu ne puise plus dans la concurrence les sources du progrès mais dans l’association, organisation qu’il considère comme moins conflictuelle, plus stable économiquement donc moins sujette à une faillite ou à un chômage et, en conséquence, plus enrichissante au niveau macroéconomique:
« Si l’on considère, d’un côté, la force du principe association, sa fécondité presque sans bornes, le nombre des gaspillages qu’il évite, le montant des économies qu’il permet ; et, d’un autre côté, si l’on calcule l’énorme quantité de valeurs perdues que représentent, sous l’influence du principe contraire, les faillites qui se déclarent, les magasins qui disparaissent, les ateliers qui se ferment, les chômages qui se multiplient, les marchés qui s’engorgent, les crises commerciales, (…) il faudra bien reconnaître que, par la substitution du premier principe au second, les peuples gagneraient en richesse ce qu’ils auraient gagné en moralité. »
De plus, au niveau microéconomique, un intérêt purement financier s’ajoute au gain social global en raison de la participation proportionnelle de tous les travailleurs aux résultats économiques de l’entreprise.
Cette idée de proportionnalité se retrouve à l’Assemblée nationale, institution unique d’où tous les pouvoirs découlent car mandatée par le souverain populaire. Les mandataires sont responsables et révocables. Au service du peuple souverain, l'Assemblée devient le lieu de résolution des conflits nés de la pluralité d’opinions. Par ailleurs, un pouvoir administratif autonome est confié aux communes, tandis qu'il faut :
« déclarer supérieurs au droit des majorités et absolument inviolables la liberté de conscience, la liberté de la presse, les droits de réunion et d’association, et, en général, toutes les garanties qui permettent à la minorité de devenir majorité, pourvu qu’elle ait raison et qu’elle le prouve. »
Et c’est en ce sens aussi, qu’il soutient, avec Lamartine, l’abrogation de la loi sur la peine de mort en matière d'infraction politique le 26 février 1848.
Dès lors, l’ensemble du projet s’accompagne inévitablement d’une révolution idéologique car la conscience des interdépendances relève d’un changement de perspective qui nécessite un nouveau prisme de lecture de l’intérêt personnel. Pour lui, « les affections humaines ne sont pas assez vastes pour embrasser dès l’abord l’humanité tout entière »47, ce qui nécessite la participation démocratique, pédagogique (de la même façon que chez Mill), des travailleurs à des niveaux toujours plus étendus : association, commune et Assemblée. Pour lui, briser un seul de ces anneaux c’est détruire ce qui permet à l’Homme de devenir citoyen.
La fin des antagonismes :
prise de conscience de l’inévitable solidarité et moralisation des échanges
La prise en compte des intérêts individuels réels qui, depuis la Révolution industrielle, sont plus que jamais mêlés, nécessite une vision dépassant les clivages traditionnels. À cette fin il va s’attacher à prouver combien les antagonismes sont construits, selon la maxime « diviser pour mieux régner ».
Pour Louis Blanc, que ce soit entre les employés ou les employeurs, le législatif ou l’exécutif, la commune ou l’État, les hommes ou les femmes, les jeunes ou les anciens, les projets sociaux et leurs financements, toutes ces oppositions n’ont aucun sens car les intérêts convergent.
Dans son esprit, les employeurs et les employés s’associent pour produire, l’exécutif doit être une émanation sous contrôle du législatif lui-même au service et sous contrôle du souverain populaire, la centralisation politique s’accompagne d’une autonomie administrative des communes, les femmes gèrent la famille (et en cela doivent avoir des droits civils) tandis que les hommes gèrent le foyer (entendu comme structure économique), la fougue de la jeunesse s’accompagne de la sagesse de l’âge. Et, suivant le même principe, les projets sociaux comme l’éducation nationale laïque, gratuite et obligatoire par exemple, trouvent leur légitimité dans une perspective à moyen et à long terme.
Qui plus est, en ce qui concerne le financement du projet social de Louis Blanc, la réduction des dépenses – notamment celles concernant l’Église et les prêtres, et celles attribuées aux préfectures et sous-préfectures, considérées comme une superfétation tout à la fois ridicule et coûteuse – serait une avancée significative. Réduction des dépenses auxquelles s’ajoutent les revenus spéculatifs de la banque nationale et ceux notamment de la mise sur le marché d’une assurance d’État couvrant l’ensemble des activités des individus.
Sa théorie défend alors un système démocratique cherchant plus à unir ses forces qu’à les opposer de façon à lutter ensemble contre la misère. Pour lui, de la même manière où dans le passé les forces se sont rassemblées pour protéger la vie, ce qui a pris la forme d’un contrat social, à présent le temps est venu de transposer ce contrat au monde économique de façon à, là aussi, sortir de l’état de nature pour protéger la vie. En veillant sur les pauvres les bienfaits se feront ressentir sur l’ensemble de la collectivité:
« En demandant justice pour les pauvres, nous veillons sur ce riche que les coups du sort peuvent demain faire tomber dans la pauvreté. En demandant protection pour les faibles, nous songeons aussi à vous, puissants du jour, que le souffle des vicissitudes humaines peut d’un instant à l’autre dépouiller de votre force. Oui, tous les hommes sont frères ; oui, tous les intérêts sont solidaires. La cause de la démocratie, c’est la cause de la liberté bien entendue, qui ne peut exister là où n’est pas l’unité. La démocratie est comme le soleil, elle brille pour tous. »
C'est ainsi que pour Francis Demier: « l'originalité de Louis Blanc tient à l’articulation étroite qui s’établit entre l’avènement de la démocratie qui s’impose après l’effondrement du système ancien miné par les effets pervers de la concurrence, et le changement de société que représente l’« Atelier social . »
D’ailleurs, Louis Blanc fait le pari que la conséquence de la démocratie sera l’avènement du socialisme.
Le projet d'établir les ateliers sociaux, la Commune et l'Assemblée nationale ne peuvent se concrétiser, à long terme, sans changement moral. L'absence de morale actuelle est ainsi souligné par Blanc:
« on ne prétendra pas (…) que la morale trouve son compte (…) dans la baisse systématique des prix, la falsification des marchandises, les réclames mensongères, les ruses de toute espèce pour grossir sa clientèle aux dépens de celle du voisin, (…) dans l’objectif de ruiner autrui sous peine d’être ruiné soi-même54 . »
Ce déficit moral s’accompagne de nombreuses souffrances chez ceux qui sont obligés d’appliquer ces règles:
« Je suis convaincu que, parmi ceux qui, dans la lutte, cherchent à vaincre coûte que coûte, il est des hommes dont le cœur souffre des moyens qu’ils mettent en usage. Mais le régime économique où ils vivent plongés est là qui les y condamne. Il faut qu’ils tâchent de ruiner autrui, sous peine d’être ruinés eux-mêmes55. »
Or, elle est soutenue par l'idéologie libérale qui conçoit l’individualisme et la concurrence comme le terme de toute évolution politique. Celle-ci affecte toute la société, y compris les familles: une sorte de schizophrénie touche les individus qui, solidaires en famille, doivent se battre à l’extérieur, parfois même en détruisant d’autres familles. Dès lors, selon F. Demier,
« dans une dialectique implacable et mécaniste, c’est tout le progrès qui est perverti par la logique de la concurrence dans la mesure où ce qui pourrait être un bien se transforme en aliénation. »
C’est pourquoi il fixe quelques principes moraux, devant servir de repères à la construction concrète du projet. « L’évangile en action » évoqué dans Le Catéchisme des socialistes caractérise ainsi le socialisme. Sans être clérical et tout en défendant la laïcité, il pense néanmoins que « le socialisme a pour but de réaliser parmi les hommes ces quatre maximes fondamentales de l’Évangile : 1° Aimez-vous les uns les autres ; 2° Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on fit à vous-mêmes ; 3° Le premier d’entre vous doit être le serviteur de tous les autres ; 4° Paix aux hommes de bonne volonté ! ».
On pourrait y ajouter un cinquième principe, qu’il décrit comme une loi écrite en quelque sorte dans son organisation par Dieu lui-même, qui consiste à « produire selon ses facultés et à consommer selon ses besoins ».
L’objectif de toute politique est, selon lui, « d’élever la condition intellectuelle, morale et physique de tous ; (…) de rendre les hommes plus éclairés, plus heureux et meilleurs. » Pour Louis Blanc, d’un point de vue moral, lorsque l’action de l’État va dans ce sens elle est un bien, lorsqu’il agit en sens inverse, elle est un mal:
« Si l’État (…) manque à son devoir quand il intervient pour mettre obstacle au développement de l’autonomie individuelle, il remplit, au contraire, le plus sacré de ses devoirs lorsqu’il intervient pour écarter les obstacles que mettent à l’essor de la liberté, chez le pauvre, la misère, résultat d’une civilisation imparfaite, et l’ignorance, résultat de la misère. »
Hommages toponymiques
Par ordre alphabétique des villes :
Une rue Louis Blanc à Aigues-Mortes
un boulevard Louis-Blanc à Alès
une avenue Louis-Blanc à Amiens
une rue Louis-Blanc à Angers
une rue et un cabinet médical Louis-Blanc à Anzin
une place Louis-Blanc à Arles
une place Louis-Blanc à Boulogne-sur-Mer
un cours Louis Blanc au Bouscat
une rue Louis-Blanc à Brest
une rue Louis-Blanc à Cannes
une rue Louis Blanc à Courcelles-les-lens
une place Louis-Blanc à Cusset
une rue Louis-Blanc à Dijon
une avenue Louis-Blanc à Draguignan
une place Louis-Blanc à Elne
une rue Louis-Blanc à Grenoble
une rue Louis-Blanc à Hellemmes
une rue Louis-Blanc à La Garenne-Colombes
un boulevard Louis-Blanc à La Roche-sur-Yon
une rue Louis-Blanc et deux école (maternelle/élémentaire) Louis Blanc au Havre
une rue Louis-Blanc à Lille
un collège à La Varenne Saint-Hilaire : voir Saint-Maur-des-Fossés
un quai de la Sarthe-Louis-Blanc au Mans
une rue Louis-Blanc au Pré-Saint-Gervais
une rue Louis-Blanc à Levallois-Perret
un boulevard Louis-Blanc à Limoges
une rue Louis-Blanc à Lyon
une rue Louis-Blanc à Malakoff
une rue Louis-Blanc à Montataire
un boulevard Louis-Blanc et une station de tramway (ligne 1 et 4) à Montpellier
une rue Louis-Blanc à Nantes
une rue Louis-Blanc à Neuville-sur-Saône
une station du métro Louis Blanc (lignes 7 et 7bis), un collège Louis-Blanc, une rue Louis-Blanc64 ainsi qu'un bassin Louis Blanc du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris
une rue Louis-Blanc à Périgueux
une rue Louis-Blanc à Rouen
une rue Louis Blanc à Saint-Brice-Courcelles
une rue Louis-Blanc à Saint-Laurent-de-la-Salanque
un collège Louis-Blanc à Saint-Maur-des-Fossés
une école primaire Louis-Blanc à Saint-Tropez
une place Louis-Blanc à Sainte-Maxime
une place Louis-Blanc à Salon-de-Provence
une rue Louis-Blanc à Sanary
une rue Louis-Blanc à Sète
une place Louis-Blanc à Toulon
une rue Louis-Blanc à Tours
Critiques
Les doctrines de Louis Blanc ont été critiqués par l'un de ses contemporains, l'économiste libéral Frédéric Bastiat, dans une brochure intitulée Individualisme et Fraternité et dans un article du Journal des Économistes titré Propriété et Loi en 1848. Il le prend également à partie dans son pamphlet La Loi.
Œuvres
Organisation du travail [1839], Bureau de la Société de l’Industrie Fraternelle, Paris, 1847, 5 édition.
Histoire de dix ans, 1830-1840, Pagnerre, Paris, 1842, 2e édition. Texte en ligne en anglais.
Révélations historiques, Méline, Cans et compagnie, Éditeurs, Bruxelles, 1859.
Histoire de la révolution française, Langlois et Leclercq, Paris, 1847-1862, 12 vols; Furne et Cie - Pagnerre, Paris, 1857-1870, 12 vols., 2e édition, avec une préface de George Sand.
Histoire de huit ans, 1840-1848, Pagnerre, Paris, 1871, 3e édition, 3 vols.
Avec Jacques Crétineau-Joly, la contre-révolution, partisans, vendéens, chouans, émigrés 1794-1800.
Lettres sur l'Angleterre 1866-1867.
Dix années de l'Histoire de l'Angleterre 1879-1881.
Questions d'aujourd'hui et de demain 1873-1884.
Quelques vérités économiques, Les Temps nouveaux, Révélations historiques, 1911.
 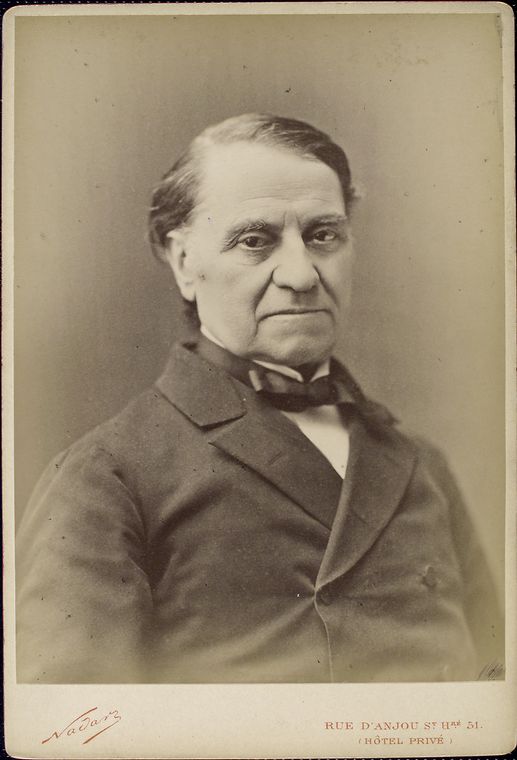     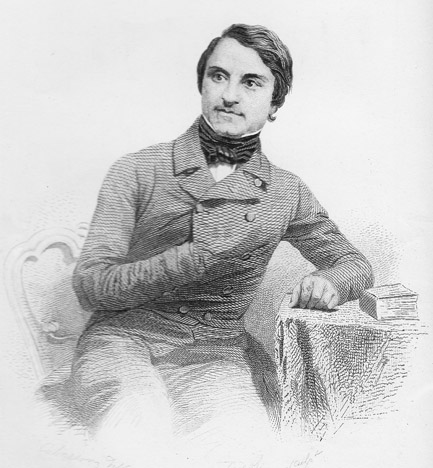     
Posté le : 05/12/2015 17:13
|
|
|
|
|
John Fitzgerald Kennedy |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 Novembre 1960 est élu John Fitzgerald Kennedy
dit Jack Kennedy, souvent désigné par ses initiales JFK, né le 29 mai 1917 à Brookline Massachusetts et mort le 22 novembre 1963 à Dallas Texas, est le 35e président des États-Unis. Entré en fonction le 20 janvier 1961 à l'âge de 43 ans, il est assassiné le 22 novembre 1963 à l'âge de 46 ans. Il est président des us durant 2 ans, 10 mois, et 2 jours,Plus jeune président élu1, il est aussi le plus jeune à mourir en cours de mandat, assassiné moins de trois ans après son entrée à la Maison-Blanche. Il reste à ce jour le seul président américain de confession catholique.
Son Vice-président était Lyndon B. Johnson, son prédécesseur Dwight D. Eisenhower et son successeur Lyndon B. Johnson. Il fut auparavent sénateur du Massachusettsdu 3 janvier 1953 au 22 décembre 1960 son prédécesseur était Henry Cabot Lodge, Jr, son successeur Benjamin A. Smith II, il était représentant du 11e district du Massachusetts du 3 janvier 1947 au 3 janvier 1953. Son prédécesseur était James Michael Curley, son successeur, Tip O'Neill
Il appartenait au Parti démocrate. Son père était Joseph Patrick Kennedy, sa mère Rose Fitzgerald Kennedy, il était marié à Jacqueline Kennedy. Il est diplômé de Université Harvard et sa religion est le Catholicisme romain
En raison de son énergie, de son charisme et de son style, mais aussi par son assassinat en 1963, John F. Kennedy reste l'un des personnages les plus populaires du XXe siècle et, à l'instar d'Abraham Lincoln, un président modèle pour les États-Unis. Comme pour le président Lincoln, la disparition brutale de JFK participa, en grande partie, à cette image.
En bref
Parce que, trois ans après avoir été élu, il est mort assassiné à Dallas dans des conditions encore mal éclaircies, et avant d'avoir atteint aucun des objectifs qu'il avait proposés à l'Amérique ; parce que son frère Robert, décidé à briguer à son tour la candidature du parti démocrate à la présidence des États-Unis, a lui aussi été assassiné moins de cinq ans plus tard, John Fitzgerald Kennedy, trente-cinquième président des États-Unis – du 20 janvier 1961 au 22 novembre 1963 –, est devenu et demeure pour beaucoup d'Américains un personnage de légende. Fascinant à bien des égards de son vivant même, il a été vite transfiguré par la mort. La haine qu'il avait suscitée est devenue plus difficile à exprimer ; l'admiration s'est atténuée ; mais pour un grand nombre de personnes, surtout dans la jeune génération, il reste la tristesse d'avoir perdu un homme politique qui essayait de comprendre leurs aspirations. Et à chaque nouvelle crise la question surgit : comment Kennedy aurait-il agi ? Pourquoi était-il, contrairement à ses successeurs, capable d'apprendre, de tirer de ses échecs et surtout de ses fautes des enseignements utiles ?
La personnalité du premier catholique élu président des États-Unis reste quelque peu énigmatique. L'abondante littérature qui lui a été consacrée (en particulier les très minutieux et éclairants récits de deux des plus proches collaborateurs du président, T. Sorensen et A. Schlesinger) ne répond pas à toutes les questions posées à son sujet, et l'évolution des États-Unis depuis 1963 rend l'objectivité difficile.Une personnalité exceptionnelle, plus sans doute que des objectifs précis, c'est le goût de la politique, l'ambition personnelle et le désir de voir son pays exercer dignement les responsabilités découlant de sa prospérité et de sa puissance qui expliquent la volonté de John Fitzgerald Kennedy d'accéder à la présidence. Encouragé par son père et par toute sa famille, le « clan Kennedy », très influent à Boston, servi par une fortune considérable, il a dû néanmoins faire preuve d'une intelligence, d'une ténacité et d'un charme hors de pair pour se faire élire en 1952, à 35 ans, sénateur du Massachusetts, et s'imposer en 1960 comme candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Il succédait à Dwight Eisenhower, président républicain 1953-1961.
Auteur de plusieurs livres à succès, doté d'une exceptionnelle capacité d'assimilation, il se sent parfaitement à l'aise parmi les intellectuels et les spécialistes des sujets les plus divers, et les impressionne par l'étendue de sa curiosité et par la conscience très nette qu'il a de ses propres limites. L'équipe qu'il rassemble est brillante et lui est dévouée.
Pour le public américain, l'image de cet homme jeune et gai, ayant à maintes reprises prouvé son courage physique, appelant son pays à faire des sacrifices pour retrouver l'équilibre et la fierté, a peut-être plus d'importance que les mesures qu'il préconise en vain, ou que les crises qu'il règle. Mais, en dehors d'une conception volontariste du pouvoir et de la présidence, Kennedy, élu à une très faible majorité, savait-il avec précision ce qu'il voulait ? Moins bien, sans doute, que lui-même ne le croyait – encore qu'il faille se rappeler l'humour avec lequel il se considérait, et que son aversion à l'égard du style idéologique l'ait peut-être conduit à ne pas donner à ses sentiments la force qu'ils avaient parfois. Réagissant contre l'immobilisme de l'administration républicaine, il cherche avant tout à « remettre l'Amérique en mouvement » pour qu'elle règle ses problèmes sociaux et économiques, et à la rendre capable non seulement de protéger ses alliés du danger soviétique, mais aussi de stabiliser la situation internationale pour éloigner le risque d'une guerre nucléaire. Par formation, par goût, par nécessité, croit-il, c'est à la politique extérieure qu'il accorde la priorité. Mais la question demeure de savoir quelle était, dans ce domaine, sa marge de liberté.
Pour éviter l'holocauste / L'héritage d'Eisenhower était, ou paraissait, bien lourd. Pendant sa campagne électorale, Kennedy avait affirmé que les États-Unis étaient en train de perdre la course aux armements nucléaires : le missile gap en fait imaginaire risquait d'encourager l'U.R.S.S. à se montrer agressive. Une erreur de calcul soviétique à propos de Berlin-Ouest, sans cesse menacé, pouvait déclencher une guerre mondiale. Enfin, Fidel Castro était installé à Cuba, et les services américains avaient préparé contre son régime une opération militaire dont ils garantissaient le succès. Kennedy ne perdrait-il pas son autorité encore mal assurée, aux États-Unis comme sur la scène internationale, s'il ne mettait pas à exécution les projets élaborés sous l'administration Eisenhower ? Après avoir beaucoup hésité, et imposé une révision des plans qui réduit très sensiblement la participation directe des forces américaines aux côtés des émigrés cubains, il donne, en mars 1961, le feu vert à l'opération qui se termine par la catastrophe de la baie des Cochons. Il assume la pleine responsabilité de cette défaite, et ne fera plus jamais confiance aux militaires, à la C.I.A. (Central Intelligence Agency) et au département d'État. Paradoxalement, sa popularité monte.
Cet échec accroît sa hantise de l'erreur de calcul soviétique. À Vienne, en juin 1961, il essaie de persuader Khrouchtchev que les Américains se battraient pour Berlin. À la même époque, les accords de neutralisation du Laos semblent réduire les risques de conflit en Asie ; en Amérique latine, l'« Alliance pour le progrès » (1961) cherchera, en soutenant les régimes à la fois démocratiques et réformateurs, à isoler la révolution cubaine et à rendre le terrain moins favorable à qui voudrait l'imiter. La découverte, en octobre 1962, des fusées que l'U.R.S.S. était en train d'installer à Cuba montre à Kennedy que Khrouchtchev ne l'a pas compris, et que l'erreur de calcul qui l'obsède est sur le point d'être commise.
Comment réagir dans cette deuxième crise de Cuba ? Peut-être Kennedy et ses conseillers ont-ils exagéré le danger que présentaient les fusées soviétiques, ou se sont-ils mépris sur les intentions de l'U.R.S.S. La maîtrise dont a alors fait preuve le président des États-Unis, sa détermination et sa modération, son souci d'éviter à l'adversaire de perdre la face et de trouver une solution acceptable pour les deux superpuissances ont sans doute permis d'écarter la guerre. Les dirigeants soviétiques ont eux aussi alors mesuré le danger, et l'accord voulu par Kennedy peut dès lors être envisagé.
Après des mois de pourparlers, dans son discours prononcé le 10 juin 1963 à l'American University, Kennedy exprime clairement sa hantise et cherche éloquemment à persuader les dirigeants soviétiques de la bonne foi américaine. La conclusion en 1963 des accords sur l'interdiction des explosions nucléaires dans l'atmosphère, puis sur la non-dissémination des armes nucléaires, les négociations sur la limitation des armements montrent que, dans ce domaine au moins, la présidence Kennedy marque un tournant ; les présidents Johnson et Nixon garderont la même orientation.
Désireux de rendre plus durable et plus profond l'intérêt que les Américains portent aux problèmes internationaux, et notamment aux pays dont ils devraient faciliter le développement, créateur du Peace Corps dans lequel des dizaines de milliers de jeunes Américains ont combattu la misère du Tiers Monde, Kennedy est aussi l'homme qui a décidé de renforcer la présence américaine au Vietnam. Aurait-il, mieux que Johnson, évité l'enlisement qu'a été, à partir de 1964, l'escalade ? C'est ce que pensent ses admirateurs ; mais rien ne permet de l'affirmer.
Sa vie
John Fitzgerald Kennedy, surnommé Jack, est né le 29 mai 1917 à Brookline Massachusetts une banlieue huppée de Boston. Il est le second d'une famille qui compte neuf enfants : Joseph Jr., John F., Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean Ann et Edward.
Ses parents, Joseph Patrick Kennedy, qui a fait fortune dans les années 1930 et Rose Fitzgerald ; fille de John Francis Fitzgerald 1863–1950, dit Honey Fitz, maire de Boston et de Mary Josephine Hannon 1865-1964, sont les descendants de familles originaires d'Irlande. Son père soutient Franklin Delano Roosevelt lors de l'élection de 1933, envisage de se présenter à sa succession et devient ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni en 1938 après avoir été un des piliers des grandes réformes de Roosevelt dans la banque et la finance.
Le jeune Kennedy reçoit une éducation dans la Choate School, une des meilleures écoles privées à Wallingford, Connecticut où son frère aîné Joseph Patrick Kennedy Jr. l'a précédé. En septembre 1935, il intègre la London School of Economics sous la supervision du professeur Laski, mais doit interrompre ses études, car il est atteint de jaunisse. Il intègre ensuite l'université de Princeton mais doit de nouveau interrompre ses études après seulement six semaines, et se fait hospitaliser à l'hôpital Brigham de Boston où les médecins diagnostiquent une possible agranulocytose ou leucémie. L'année suivante, en septembre 1936, il intègre Harvard. Ses principales matières sont l'économie, l'histoire et la politique américaine.
Quand son père s'installe à Londres, il visite l'Europe, en particulier l'Allemagne nazie, et profite d'un nègre pour rédiger son mémoire de fin d'études sur Neville Chamberlain et la participation britannique aux accords de Munich. Son mémoire est reçu avec mention et grâce au soutien financier de son père, est publié avec une introduction de Henry Luce, sous le titre Pourquoi l'Angleterre dormait. À 23 ans, Kennedy est ainsi l'auteur d'un relatif succès de librairie qui semble le destiner au journalisme. Son père est alors déconsidéré par sa position favorable à la négociation avec Hitler. Ce livre permet à son fils de paraître comme favorable à l'entrée en guerre des États-Unis.
Il doit, en 1941, sous la pression de son père et du FBI, mettre fin à sa liaison avec Inga Arvad, une journaliste danoise mariée à Paul Fejos, ancienne miss Danemark qui a couvert les jeux olympiques de Berlin en 1936 et proche des dignitaires nazis tel qu'Hermann Goering, ce qu'a démontré de manière irréfutable le FBI. JFK est rappelé sur le continent en Caroline du sud mais Inga le suit et ils continuent à se voir.
Service militaire et période après-guerre
Au printemps 1941, Kennedy veut s'enrôler dans l'armée, mais est déclaré inapte en raison de ses problèmes de dos : né avec une colonne vertébrale instable, ce qui l'obligera toute sa vie à utiliser des béquilles cachées au public, à se reposer fréquemment dans son rocking-chair devenu légendaire et à porter un corset dorsal de 20 centimètres. Il est de plus atteint de la maladie d'Addison, une sorte de déficience encore mortelle à son époque des glandes surrénales, lesquelles produisent des hormones anti-douleurs osseuses. Pour soulager ses douleurs, il reçoit régulièrement des injections de cortisone, de novocaïnes et de stéroïdes, il prend des amphétamines, ce cocktail médicamenteux lui permettant de déployer une énergie hors du commun et d'assouvir une libido hyperactive. D'abord mobilisé à l'arrière, il obtient de servir sur plusieurs navires de la flotte américaine du Pacifique et devient commandant d'un patrouilleur avec le grade de Lieutenant.
Le 2 août 1943 à deux heures du matin, son patrouilleur une vedette lance-torpilles, le PT 109, est coupé en deux par le destroyer japonais Amagiri au large des îles Salomon. Kennedy est projeté sur le pont et se blesse au dos, ce qui aggrave ses douleurs ; en mer, il réussit malgré tout à haler un membre de son équipage blessé sur près de cinq kilomètres et à mettre pied sur une île, d'où il nage pour donner l'alerte : son équipage est récupéré. Ce fait d'armes lui vaut la médaille de la Marine avec la citation suivante :
Pour sa conduite extrêmement héroïque comme officier commandant de la vedette lance-torpilles PT 109, après la collision et le naufrage de ce vaisseau, sur le théâtre de la guerre du Pacifique, les 1er et 2 août 1943. Peu soucieux du danger personnel, le lieutenant Kennedy a bravé sans hésitation les difficultés et les risques de l'obscurité pour diriger les opérations de sauvetage, nageant plusieurs heures pour trouver de l'aide et de la nourriture après avoir réussi à ramener son équipage à terre. Son remarquable courage, sa ténacité et ses qualités de chef ont permis de sauver plusieurs vies, conformément aux plus hautes traditions de la Marine des États-Unis.
Il participe également à l'évacuation de Marines encerclés par les Japonais lors du raid sur Choiseul le 2 novembre 1943. Kennedy reçoit d'autres décorations pendant la guerre, dont la Purple Heart. Il est démobilisé au début de 1945 quelques mois avant la capitulation du Japon. Un film de propagande raconte son aventure. Le décès de son frère aîné et les erreurs politiques de son père qui était favorable au maintien de la paix avec Hitler font de lui l'espoir politique de la famille.
Il est contraint de se faire opérer à plusieurs reprises en raison de problèmes de dos et reçoit même l'extrême onction à trois reprises. Pendant cette période, il publie un livre Profiles in Courage Portraits d'hommes courageux où il fait la biographie de huit sénateurs qui ont risqué leur carrière pour défendre leurs points de vue. Ce livre, dont la paternité est aujourd'hui accordée à Ted Sorensen, bras droit de Kennedy et auteur de ses plus grands discours, recevra le prix Pulitzer en 1957.
Carrière politique
Après la Seconde Guerre mondiale, Kennedy débute donc une carrière politique en se faisant élire en 1946 à la Chambre des représentants dans une circonscription à majorité démocrate. Il est réélu deux fois en 1948 et 1950, largement malgré ses positions qui ne sont pas toujours en accord avec celles du président Harry S. Truman ou du Parti démocrate.
En 1952, il est candidat au siège de sénateur avec le slogan : Kennedy en fera plus pour le Massachusetts. Avec l'appui de son père et de tout le clan familial, il réussit à battre son concurrent républicain, le sénateur sortant Henry Cabot Lodge Jr en obtenant 51,5 % des voix. Cependant, il ne s'oppose pas au sénateur Joseph McCarthy, un ami de la famille, qui mène une campagne agressive dans le but d'extirper les prétendus espions communistes au sein du gouvernement. Il profite d'un séjour à l'hôpital pour ne pas voter la motion de censure contre McCarthy en 1954, ce qui lui sera longtemps reproché par l'aile gauche du Parti démocrate, Adlai Stevenson et Eleanor Roosevelt en tête. En 1958, il est réélu sénateur avec 73,2 % des suffrages face au républicain Vincent J. Celeste.
Vie familiale
John Kennedy est connu pour ses multiples maîtresses et conquêtes féminines, dont Marilyn Monroe en 1962, ainsi que Judith Campbell Exner, maîtresse simultanément de Kennedy et du parrain de la mafia de Chicago Sam Giancana ou encore Gunilla von Post, Marlene Dietrich. En 1961, lors d'une rencontre officielle avec le premier ministre britannique Harold Macmillan, il lui confie : Trois jours sans faire l'amour et c'est le mal de tête garanti. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, Harold.
Le 12 septembre 1953, il épouse Jacqueline Bouvier en l'église St Mary à Newport Rhode Island. Le mariage est considéré comme l'évènement mondain de la saison avec quelque 700 invités à la cérémonie et plus de 1 000 à la somptueuse réception qui suit à Hammersmith Farm, domaine de son beau-père Hugh D. Auchincloss.
Jacqueline Kennedy fait une fausse couche en 1955, puis donne naissance à une petite fille mort-née, le 23 août 1956, que ses parents auraient voulu prénommer Arabella. Cet évènement conduit à une brève séparation du couple qui se réconcilie peu après. Le couple devient ensuite parents d'une fille Caroline en 1957, puis d'un fils John en 1960. Un second fils Patrick nait prématurément le 7 août 1963 et meurt deux jours plus tard.
Peu de temps après l'assassinat de John F. Kennedy, les restes d'Arabella et de son jeune frère Patrick sont transférés le 5 décembre 1963, au cimetière national d'Arlington. Sa dalle mortuaire n'indique pas de prénom, mais simplement la mention daughter, fille, en anglais et la date du 23 août 1956.
Élection
Kennedy se déclare candidat pour succéder à Eisenhower le 2 janvier 1960. Dans sa déclaration de candidature, Kennedy insiste sur la nécessité d'un désarmement mondial, qualifiant la course aux armements de fardeau.
Le Parti démocrate doit choisir entre lui et les sénateurs Hubert Humphrey, Lyndon B. Johnson et Adlai Stevenson. Kennedy remporte les élections primaires dans certains États clés, comme le Wisconsin et la Virginie-Occidentale et obtient la nomination de son parti à la convention nationale. Son colistier est Lyndon B. Johnson, soutenu par les États du sud. Pendant la campagne électorale, les débats tournent autour du rôle des États-Unis dans le monde, du problème de la pauvreté, de l'économie et de l'équilibre de la terreur face aux missiles porteurs d'armes nucléaires de l'Union soviétique, mais aussi sur la religion catholique pratiquée par le candidat.
En septembre et en octobre 1960, Kennedy et le candidat républicain Richard Nixon débattent pour la première fois à la télévision. Nixon apparaît nerveux, en sueur et mal rasé. De plus, une douleur récurrente au genou le fait souffrir. Par conséquent, on entend dire que face à un Kennedy calme et maître de lui, Nixon passe mal à l'écran et ressort affaibli de la confrontation télévisée, alors que les citoyens ayant suivi le débat à la radio estiment que Nixon était légèrement plus convaincant. Cependant, quelques sociologues, dont Michael Schudson et l’équipe de chercheurs de David L. Vancil et Sue D. Pendell, se sont penchés sur la question, déclarant, pour leur part, qu’il n’y a aucun élément pour étayer cette seconde affirmation. Ces débats restent tout de même considérés comme fondateurs d'une certaine politique moderne car, pour la première fois, la manière de se tenir face à une caméra devient un élément important dans une élection.
La politique de Kennedy, appelée Nouvelle Frontière, prévoit la détente envers l'URSS, l'envoi d'un homme sur la Lune, l'égalité des Noirs et des Blancs, la relance de l'économie, la lutte contre la pègre et l'arrêt de l'expansion communiste dans le monde.
L'élection a lieu le 8 novembre 1960 ; Kennedy bat Nixon de seulement 120 000 voix. Des rumeurs circulent par la suite sur le fait que son père, Joe, aurait utilisé ses liens avec la mafia américaine pour que certains comtés décisifs votent bien. À 43 ans, Kennedy est le plus jeune président élu : Theodore Roosevelt était plus jeune lors de son accession à la présidence, mais il succédait à William McKinley, décédé en cours de mandat. Il est aussi le premier président des États-Unis de religion catholique et toujours le seul à ce jou
Rendre son dynamisme à l'économie
Loin d'utiliser à plein ses ressources, l'économie américaine, gérée avec pusillanimité par les ministres d'Eisenhower, connaît un taux de croissance médiocre, un taux de chômage élevé et des poches de misère déshonorantes pour les États-Unis. Kennedy est persuadé qu'on peut insuffler à l'économie un plus grand dynamisme par une gestion plus audacieuse, tournant le dos à des dogmes tels que celui de l'équilibre budgétaire annuel, cher aux banquiers et à certains dirigeants de grandes entreprises. Il veut pratiquer temporairement une politique de déficit budgétaire systématique, lutter contre la pauvreté, modifier la répartition des dépenses publiques de façon à satisfaire en priorité certains besoins collectifs.
Dans ce domaine, sa campagne d'éducation ne suscite guère d'écho. Trop d'hommes d'affaires et de membres du Congrès sont attachés aux « mythes » qu'il dénonce ; bien des chefs d'entreprise éprouvent à son égard une antipathie qu'il leur rend (on s'en aperçoit le plus clairement lors de la courte guerre qu'il livre, et gagne, en 1962 contre le président de l'United States Steel Corporation pour l'empêcher de relever le prix de l'acier). Le président Johnson, bien plus habile que Kennedy dans ses rapports avec le Congrès, réalisera ses projets, et lancera l'économie américaine dans la direction indiquée avant que la guerre du Vietnam crée de nouveaux problèmes.
Réaliser l'égalité raciale
Conscient de l'urgence des solutions à apporter au problème noir, le président Kennedy choisit néanmoins une stratégie à moyen terme : les problèmes internationaux et ceux de l'économie américaine sont à ses yeux prioritaires, et pour les régler, il a besoin, au Congrès, de l'appui des démocrates du Sud.
L'administration Kennedy décide de faire porter l'essentiel de ses efforts dans ce domaine sur l'amélioration de la situation économique des Noirs, et sur l'octroi d'une protection fédérale efficace pour leur inscription sur les listes électorales : c'est par leurs bulletins de vote que les Noirs parviendront progressivement à se faire respecter par les hommes politiques.
Or, deux ans et demi après son arrivée à la Maison-Blanche, Kennedy doit reconnaître que la situation appelle une intervention fédérale directe, destinée à accélérer l'évolution : dans le Sud, le conflit est devenu aigu et difficile à dominer. Jusqu'au début de juin 1963, il se voit reprocher l'inefficacité de son action ; ce n'est que le 11 juin qu'il s'adresse à la nation pour poser enfin le problème en termes moraux et idéologiques. Il réclame alors une loi permettant de lutter contre la ségrégation ; sa mort et la détermination du président Johnson assurent, en 1964, le vote d'un texte proche de celui qu'il avait proposé. La mémoire de Kennedy n'en est pas moins vénérée par de très nombreux Noirs – cette vénération est considérée par les militants du « Pouvoir noir » comme une mystification de plus.
L'héritage
Le président Kennedy aimait à dire, et peut-être n'en excluait-il pas totalement la possibilité, qu'il était le fondateur d'une dynastie : ses frères, un jour son fils, gouverneraient eux aussi l'Amérique ; mais la fatalité paraît s'acharner sur la famille Kennedy... Qu'en est-il de l'« héritage » de Kennedy ? Dans la crise sociale et politique que traversèrent les États-Unis autour des années soixante-dix, l'œuvre qu'il a voulu réaliser, et après lui son frère Robert, a-t-elle encore une signification ? Comment interpréter ces trois années de vie politique passionnante, mais qui n'ont réglé aucun problème important ? Peut-on, ailleurs qu'en politique étrangère, faire l'économie d'une orientation idéologique plus cohérente et plus précise ? Un style et une personnalité suffisent-ils à inspirer confiance ?
La réponse est difficile à donner. Peut-être, malgré notre scepticisme, une action comme celle qu'a menée Kennedy n'est-elle pas inadaptée aux problèmes actuels de la société américaine. Peut-être le véritable héritage reçu par le peuple américain consiste-t-il surtout en un « esprit », une façon nouvelle pour chacun de concevoir sa propre responsabilité politique. Son influence reste réelle aujourd'hui, aussi bien parmi ses anciens collaborateurs que parmi les pauvres, les jeunes... Ainsi, remarque T. Sorensen, John Kennedy a « essayé de prouver à l'Amérique et au monde qu'on pouvait réaliser pacifiquement des changements de nature littéralement révolutionnaire » susceptibles, pense-t-il, de réparer les injustices liées à la nature du système économique et des relations entre les peuples. Serge Hurtig
Présidence Chronologie
1961
Kennedy serre la main de Dwight Eisenhower après sa nomination, le 20 janvier 1961.
20 janvier : entrée en fonction de John F. Kennedy comme 35e président des États-Unis. Son discours est resté dans la mémoire des Américains : Vous qui, comme moi, êtes Américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous qui, comme moi, êtes citoyens du monde, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour le monde, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le monde.
2 février : Kennedy propose au Congrès sa politique sociale afin de mettre fin à la récession économique. Elle inclut un programme de tickets-nourriture et un accroissement des allocations pour les chômeurs et les personnes sans ressources.
1er mars : Kennedy signe un décret créant les Corps de la Paix, l’une des institutions les plus marquantes de son gouvernement. Il en confie la direction à son beau-frère Sargent Shriver.
28 mars : Il lance un programme d’armement parmi les plus importants en temps de paix. Il double le nombre de missiles nucléaires balistiques intercontinentaux Polaris, augmente le nombre de bombardiers stratégiques et augmente celui des autres missiles; il accroît aussi le nombre de divisions en état d’alerte et quadruple les unités de luttes anti-guérillas.
16-18 avril : le gouvernement Kennedy tente d'appliquer un plan initialement préparé par Dwight Eisenhower, pour renverser Fidel Castro, le président cubain communiste. Avec l'aide de la CIA, 1 500 exilés cubains retournent dans l'île et tentent de rallier la population ; c'est un échec qui est connu sous le nom de l'invasion de la baie des Cochons. En moins de deux jours, Kennedy refusant tout appui aérien, le gouvernement castriste tue ou fait prisonnier les exilés et Kennedy doit négocier leur libération. Elle sera obtenue après 20 mois au prix de 53 millions USD en nourriture et médicaments. Kennedy, dans un discours, se déclare seul responsable du désastre, mais en privé, il déclare que la CIA lui a menti et l'a manipulé pour qu'il donne l'ordre de l'invasion totale de Cuba. Allen Welsh Dulles, directeur de la CIA, sera limogé et le reste du mandat de Kennedy sera marqué par une certaine méfiance envers la communauté des services de renseignements CIA
25 mai : Kennedy prononce le fameux discours qui donne le coup d’envoi du programme lunaire américain. Notre nation doit s’engager à faire atterrir l’homme sur la Lune et à le ramener sur Terre sain et sauf avant la fin de la décennie.
Il répond ainsi à l’URSS qui, en pleine guerre froide, avait pris plusieurs longueurs d’avance dans la conquête spatiale. Il conforte le concept de Nouvelle Frontière de l'espace, qu'il avait déjà évoqué dans un discours d'investiture comme candidat à l'élection présidentielle, le 15 juillet 1960.
John F. Kennedy prononce le discours annuel sur l'état de l'Union, en 1963. Assis derrière lui, le vice-président Lyndon Johnson et le président de la Chambre, John McCormack.
13 août : le gouvernement est-allemand, sous le contrôle de l'URSS, débute la construction du Mur de Berlin séparant les secteurs Est et Ouest de la ville afin d'empêcher l'exode de la population vers l'Ouest. Bien que cet acte soit contraire à l'accord entre les quatre grandes puissances, Kennedy ne l'empêche pas, car il est en vacances et ne jugera pas utile d'interrompre son voyage. Il ne fera pas grand chose non plus lors de l'extension de la frontière entre la RDA et la RFA sur 155 km.
3 septembre : Kennedy signe la loi sur le salaire minimum et étend son domaine d’application.
30 septembre : un étudiant noir, James H. Meredith, s’inscrit pour la première fois à l’université d’État du Mississippi ; des manifestants s’opposent à la déségrégation et le ministre de la justice, Robert Kennedy — frère du président — utilise 23 000 agents fédéraux pour contrer les manifestants. Les échauffourées font deux morts parmi les manifestants et 160 blessés parmi les forces de l’ordre.
1962
12 septembre : dans le cadre de la course à l'espace, il prononce son discours We choose to go to the Moon, qui influence de façon majeure la politique spatiale américaine.
14 octobre : des avions espions américains U2 photographient des sites de missiles soviétiques en construction à Cuba. Kennedy est confronté à un dilemme : soit il attaque les sites en risquant une confrontation nucléaire avec l'URSS, soit il ne fait rien et les États-Unis doivent vivre sous la menace d'armes nucléaires tactiques près d'eux. Kennedy décide un blocus de l'île et entame des négociations avec le président du Conseil des ministres soviétique Nikita Khrouchtchev. Un accord sera trouvé après plusieurs semaines de négociations diplomatiques, les États-Unis s'engageant à ne pas envahir Cuba mais refusent publiquement les demandes de la part de l'U.R.S.S. de retirer leurs missiles implantés en Turquie. Ces demandes lui seront cependant accordées secrètement en avril 1963 par Robert Kennedy.
5 juillet : John Fitzgerald Kennedy prononce un discours félicitant l'indépendance de l'Algérie.
1963
11 juin : À la suite de la crise qui oppose le gouverneur de l'Alabama George Wallace, qui refuse l'inscription de deux jeunes étudiants noirs à l'université d'Alabama, au gouvernement fédéral, Kennedy prononce un discours sur les droits civiques : Nous sommes, à la fois en tant que pays et en tant que peuple, face à une crise des valeurs morales.
26 juin : Kennedy visite Berlin Ouest et prononce avec Willy Brandt et Konrad Adenauer un discours resté célèbre durant lequel il lancera la phrase Ich bin ein Berliner Je suis un Berlinois.
28 août : Kennedy rencontre Martin Luther King Jr et les autres dirigeants du mouvement pour les droits civiques après une manifestation, qui rassemble plus de 250 000 Américains, devant le mémorial au président Lincoln.
30 août : Nouvel accord Kennedy-Khrouchtchev : mise en place d'un téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin.
Octobre : Kennedy envisage un désengagement des conseillers militaires américains au Viêt Nam et un accroissement de l’aide pour l’entraînement des forces sud-vietnamiennes.
7 octobre
Kennedy signe le 7 Octobre 1963, le Traité d’interdiction des essais nucléaires, élaboré à Moscou le 5 août 1963, le premier permettant d’envisager un désarmement.
21 novembre : Il prépare sa politique de lutte contre la pauvreté pour son programme d’action à mettre en œuvre en 1964.
22 novembre : Il entame la campagne pour sa réélection par un voyage au Texas. L'avion présidentiel Air Force One atterrit sur l'aéroport de Dallas Love Field, où Kennedy et son épouse sont accueillis chaleureusement. À 12 heures 30, alors que le cortège présidentiel traverse Dealey Plaza, plusieurs coups de feu sont tirés, le gouverneur du Texas, John Connally, est touché, Kennedy est atteint en pleine tête. Il décède peu de temps après à l'hôpital Parkland. Son assassinat reste à ce jour, pour beaucoup, non résolu, alimentant les rumeurs et les hypothèses les plus folles. Le 27 septembre 1964, la commission d’enquête désignée par Lyndon Johnson, connue sous le nom de Commission Warren, conclut que Lee Oswald a agi seul dans l'assassinat du président et la blessure du gouverneur du Texas.
25 novembre : le président est enterré au cimetière militaire d'Arlington.
Politique étrangère
Rencontre de Kennedy et Khrouchtchev à Vienne, en 1961.
Ich bin ein Berliner ! .
Le mandat de Kennedy est marqué par la guerre froide entre l’Union soviétique et les États-Unis et les crises majeures destinées à contrer l’expansion communiste. Au début de sa présidence, il pense que le monde peut s'améliorer par des moyens pacifiques et il crée les régiments de la paix. Ce programme, qui existe toujours, permet à des volontaires américains d'aider les pays en développement dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de la santé et du bâtiment.
Kennedy développa des liens d'amitié étroits avec le Royaume-Uni et la RFA. Cependant, les relations avec le Canada seront faibles, John Diefenbaker ne supportant pas Kennedy et réciproquement. Le prochain premier ministre canadien Pearson s'entendra en revanche très bien avec lui et acceptera l'installation de bases nucléaires américaines au Canada.
Les relations avec la France de Charles de Gaulle sont constantes mais tendues, mais les deux dirigeants ont un grand respect l'un pour l'autre et le peuple français a une certaine admiration pour les Kennedy ; ils sont notamment fiers que sa femme, Jacqueline Bouvier de son nom de jeune fille, ait des racines françaises. La volonté de Charles de Gaulle d’accroître la puissance militaire et économique de la France produit de vives tensions entre les deux hommes : d'après Ted Sorensen, dans un moment de colère Kennedy aurait traité De Gaulle de salopard.
La crise des missiles de Cuba montre que le risque d'une guerre nucléaire n’est pas négligeable et que les États-Unis et l'URSS sont « au bord du gouffre », d’où une attitude plus mesurée en Europe. Cette attitude est d'ailleurs déjà effective avant cette crise, comme le prouve le fait que les Américains restent passifs lorsque l’Allemagne de l’Est lance la construction du mur de Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961 et que les pays du bloc de l’Est rendent leurs frontières quasiment étanches. Après une tentative de retrait, Kennedy essaie malgré tout de contenir l'expansion soviétique en envoyant des conseillers militaires, puis des troupes, au Viêt Nam. En octobre 1963, il signe un mémorandum ordonnant le retrait de 1 000 soldats du Viêt Nam avant la fin de 1963 car il pensait la guerre bientôt gagnée. Ce mémorandum sera annulé par Lyndon B. Johnson.
Kennedy signe un traité d'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère pour lutter contre la prolifération des armements et contre les effets à long terme des retombées radioactives. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS en seront les premiers signataires et Kennedy considérera qu'il s'agit là d'une des actions majeures de son gouvernement.
Politique intérieure
Rencontre avec les leaders des droits civiques en 1963. Kennedy milite contre la ségrégation raciale, en prenant pour modèle Abraham Lincoln. Il soutient Martin Luther King, et le rencontre lors de sa marche sur Washington en 1963.
L'un des problèmes les plus importants auquel Kennedy doit faire face est celui de mettre fin aux mesures discriminatoires contre les minorités ethniques qui restent légales dans certains États. Un arrêt de 1954 de la Cour suprême des États-Unis interdit la ségrégation dans les écoles publiques, mais est resté lettre morte dans de nombreux États du sud. Par ailleurs, des mesures discriminatoires restent toujours en vigueur dans d'autres lieux publics, tels que les transports urbains, les cinémas et les restaurants. Il fait beaucoup pour la conquête de l'espace, en lançant le programme Apollo We choose to go to the moon.
Sur le plan social, son programme Nouvelle Frontière vise à améliorer le sort des classes modestes et des droits civiques de ses concitoyens noirs. Sur ces objectifs, Kennedy se heurte souvent, ce qui est courant aux États-Unis, à un Congrès dont la majorité n'est pas celle de son courant politique. Ici, cependant, le Congrès est en majorité démocrate, mais cette dernière est dominée par les démocrates du sud, conservateurs sudistes hostiles à la disparition de la ségrégation.
Bilan et historiographie
Si les presque trois ans de présidence de Kennedy se sont accompagnés de plusieurs mesures notables conquête de l'espace, début de la déségrégation, Peace Corps, les historiens sont partagés sur l'importance du mandat de Kennedy dans l'histoire américaine. Élu de justesse, il a accru l'engagement des États-Unis au Vietnam, a initié le débarquement de la Baie des Cochons, n'a pas empêché la construction du mur de Berlin, a approuvé la mise sur écoute par le FBI de Martin Luther King, soutenu des coups d'État et l'assassinat de dirigeants étrangers en Amérique latine, en Irak et au Vietnam, avait des liens avec la mafia et n'a pas mené à bien la baisse d'impôts qu'il avait initialement promise. De ce fait, s'il est souvent cité comme étant le plus populaire des présidents qu'a compté le pays, cela est plus le reflet de son charisme, de sa jeunesse, de sa bonne connaissance des médias et des conditions tragiques de son décès.
L'historiographie post-1963 a d'abord été marquée par des ouvrages hagiographiques écrits par ses anciens conseillers, Ted Sorensen et Pierre Salinger. Un regard plus critique survient dans les années 1980 avec The Kennedy Imprisonment de Garry Willis, où Kennedy est décrit comme un improvisateur se reposant sur son charisme et prenant de mauvaises décisions, et un obsédé sexuel se mettant lui-même en danger du fait des risques de chantage que cela implique. Depuis 1963, 40 000 ouvrages ont été écrits à son sujet.
Assassinat de John F. Kennedy.
Le 22 novembre 1963, lors d'une visite pré-électorale de John F. Kennedy à Dallas, le cortège présidentiel traverse la ville à petite vitesse, salué par la foule amassée. Alors que la limousine décapotée du président passe sur Dealey Plaza vers 12 h 30, des coups de feu éclatent. Le président est d'abord blessé au cou, tandis que le gouverneur Connally, assis devant lui, est blessé à la poitrine, puis une balle atteint le président à l'arrière de la tête, endommageant gravement la partie arrière supérieure de son crâne, et ressort probablement par la tempe droite. Aussitôt transporté au Parkland Hospital, le président est déclaré mort à 13 h après de vains efforts de réanimation. Le monde est consterné en apprenant la nouvelle.
Selon les enquêtes officielles, Lee Harvey Oswald a assassiné le président, mais la 2de enquête mandatée par la Chambre des Représentants — l'enquête du HSCA — estime en 1979 qu'il y a eu au moins deux tireurs, donc conspiration.
La garde d'honneur se prépare à plier le drapeau au-dessus du cercueil de John F. Kennedy, au cimetière national d'Arlington, le 25 novembre 1963.
Sa femme Jacqueline, lors du transport du cercueil à bord de l'avion Air Force One, lui organise des obsèques nationales impressionnantes sur le modèle de celles d'Abraham Lincoln. Le président Kennedy repose au cimetière national d'Arlington, près de Washington.
Anecdotes
Les sections Anecdotes, Autres détails, Le saviez-vous ?, Citations, etc., peuvent être inopportunes dans les articles.
Pour améliorer cet article il convient, si ces faits présentent un intérêt encyclopédique et sont correctement sourcés, de les intégrer dans d’autres sections.
19 mai 1962 : Marilyn Monroe, vêtue d'une robe en gaze de soie rose cousue à même la peau, chante Happy Birthday, Mr. President pour célébrer le 45e anniversaire du président au Madison Square Garden, dix jours avant sa date exacte. Cette séquence enregistrée par la télévision fait partie des grands moments de la petite histoire et alimente les potins sur la liaison entre elle et Kennedy.
Lors du voyage officiel du président accompagné de son épouse à Paris, en juin 1961, le succès de Jackie est tel que le président s'est présenté de la façon suivante lors d'une réception : Je suis l'homme qui accompagne Jacqueline Kennedy à Paris.
Un mythe médiatique voit en Kennedy un second roi Arthur, les thèmes abordés dans la pièce Camelot jouée à Broadway en 1960 reflètent les idéaux de Kennedy pour l'Amérique. On prétend qu'il ne serait pas mort, mais tombé dans le coma et emmené en bateau par sa femme sur une île secrète où il aurait été soigné et dont il ne serait jamais parti, son Avalon.
Kennedy était un grand joueur d'échecs et admirateur de Mozart.
Quant à Barack Obama, il est parfois comparé à Kennedy en raison de son caractère de nouveauté et de jeunesse, de sa différence par rapport à la majorité de la population Kennedy était catholique et Obama est le premier président noir de l'histoire des États-Unis et surtout par rapport à son charisme et à sa télégénie.
John Kennedy est resté durant son mandat un président très populaire. Pour preuve, pendant toute la durée de son mandat, il n'a jamais connu de sondages inférieurs à 50 % d'opinions favorables. Il est d'ailleurs le seul à ce jour.
Lors des obsèques officielles, le jeune fils de Kennedy, John, effectue un salut militaire devant le cercueil de son père. Officiellement, c'est John lui-même qui a pris l'initiative de ce salut.
Postérité
Lors de la mort de Kennedy, les trois grands réseaux de télévision américains ont suspendu leurs émissions pour rapporter toutes les nouvelles concernant le président du 22 au 25 novembre 1963, ce qui fait de la couverture télévisée de cet événement la plus longue de l'histoire télévisée américaine 70 heures jusqu'à celle des attentats du 11 septembre 2001 72 heures. Les reportages filmés sur ses obsèques nationales consacreront la domination de la télévision française sur les autres médias et la fin des actualités filmées au cinéma.
À l'occasion du cinquantième anniversaire de sa mort, des milliers d'articles et des centaines de livres sont sortis, ajoutant aux plus de 40 000 ouvrages déjà publiés à travers le monde sur la vie de Kennedy.
Hommages
Le portrait de JFK est gravé sur la pièce d'un demi-dollar.
Son nom a été donné à de très nombreux sites, bâtiments, rues, boulevards, avenues tels que l'aéroport international de New York JFK Airport, le théâtre de Washington Kennedy Center, une autoroute de Chicago Kennedy Expressway, un boulevard de la ville française de Valence boulevard Kennedy ou encore le centre de tir spatial de Floride Kennedy Space Center ou Centre spatial Kennedy.
Dans le Yukon, au Canada, une montagne a été baptisée en 1965 Mont Kennedy en son honneur. Cette montagne de 4 238 mètres a été escaladée pour la première fois en mars 1965 par Robert Bobby Kennedy son frère, George Senner et Jim Wittaker, les premiers Américains à avoir atteint le sommet de l'Everest. Une fois au sommet, Robert Kennedy y a déposé un tube métallique contenant le discours d'investiture de JFK.
Un premier porte-avions a été nommé en son honneur en 1968 : le USS John F. Kennedy CV-67, un second porte-avions prendra son nom lors de son lancement en 2015 : le USS John F. Kennedy CVN-79.
Il est représenté en tant que personnage jouable dans le mode « Zombie » du jeu vidéo Call of Duty: Black Ops.
Au cinéma et à la télévision
1991 : JFK, film américain, version romancée d'une enquête tentant de faire la lumière sur l'assassinat de Kennedy
2000 : Treize jours Thirteen Days, film américain, version romancée de la crise des missiles de Cuba vue du côté américain, joué par Bruce Greenwood
2011 : Les Kennedy de Jon Cassar, joué par Greg Kinnear
2013 :
Le Majordome de Lee Daniels, joué par James Marsden
Parkland de Peter Landesman
Killing Kennedy, téléfilm américain basé sur le livre éponyme de 2012 écrit par Bill O'Reilly et Martin Dugard, joué par Rob Lowe
Pan Am, série américaine basée sur l'histoire d'une compagnie aérienne où le Président fait une petite apparition à Berlin et à l'aéroport de Berlin
Bibliographie
Georges Ayache, Une histoire américaine, Paris, Éditions Choiseul, 2010, environ 230 p.
John Fitzgerald Kennedy trad. Jean Bloch-Michel, Stratégie de la paix The strategy of peace, Paris, Calmann-Lévy, 1961, environ 220 p.
Frédéric Kiesel, Dallas, un crime sans assassin, Bruxelles, Pierre De Meyère, 1966
André Kaspi, Kennedy. Les mille jours d'un président, Paris, Armand Colin, coll. Biographies, 1993, 309 p.
Jean-Baptiste Thoret, 26 secondes, l'Amérique éclaboussée. L'assassinat de JFK et le cinéma américain, Rouge Profond, 2003
Geoffrey Perret, Kennedy, une vie comme aucune autre, Paris, Éditions Encre de Nuit, coll. « Document », 2003, 415 p.
André Kaspi, John F. Kennedy. Une famille, un président, un mythe, Bruxelles, Complexe, coll. « Destins », 2007, 369 p
François Forestier, Marilyn et JFK, Paris, Albin Michel, coll. « Essais Doc. », 2008, 297 p.
Thomas Snégaroff, Kennedy. Une vie en clair-obscur, Paris, Armand Colin, 2013, 240 p.
Brigitte Duranthon, JFK affaire classée, Paris, Connaissance et savoir, 2008, 176 p.
Frédéric Martinez, John Fritzgerald Kennedy, Editions Perrin, 2013, 340 p.
Pierre Lunel, Les vies secrètes de JFK, First, 2013, 203 p.
Philippe Legrand, Kennedy, le roman des derniers jours, Le Passeur Editeur, 2015,
Voir aussi
Articles connexes
Assassinat de John F. Kennedy
Discours de JFK
Doctrine Kennedy
Cinq cents John Kennedy, premier timbre américain en hommage à Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy National Historic Site, musée dans sa maison natale de Brookline
Libéralisme contemporain aux États-Unis
Les Kennedy mini-série
Coïncidences entre Lincoln et Kennedy
Kennedy Compound
 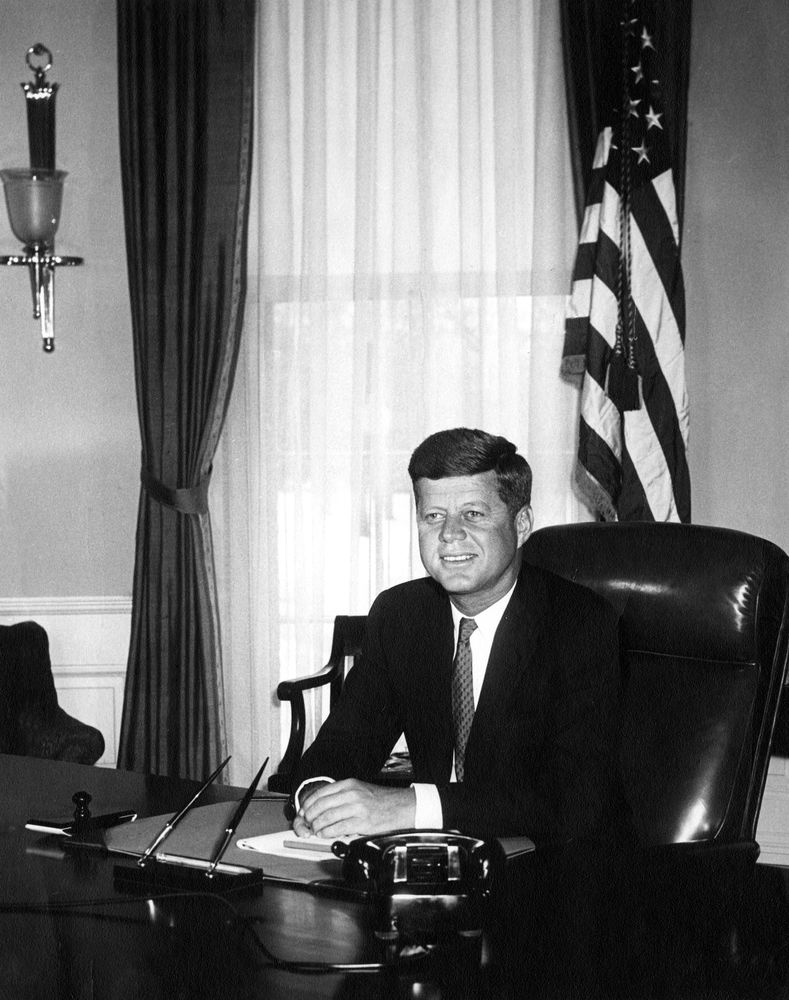   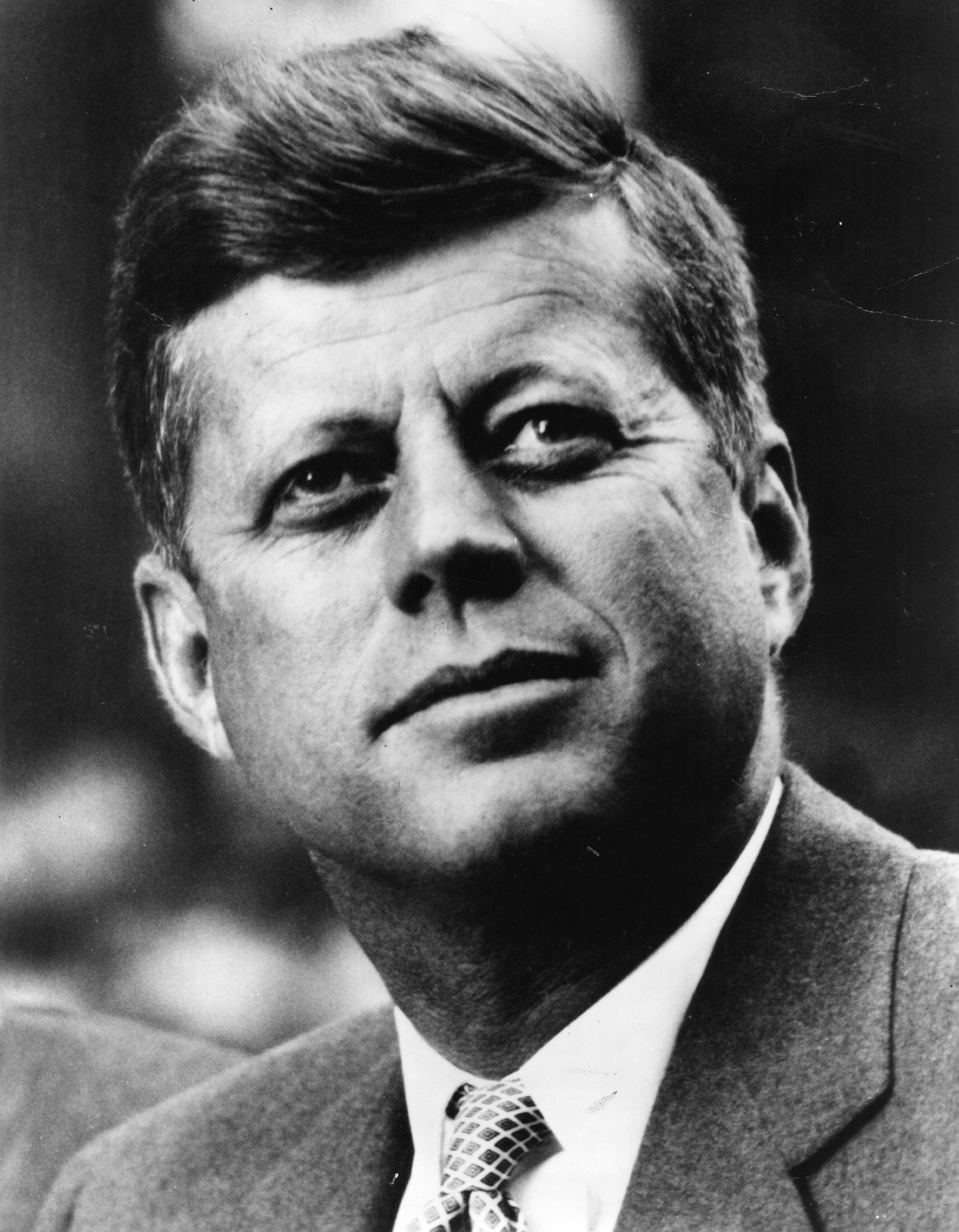 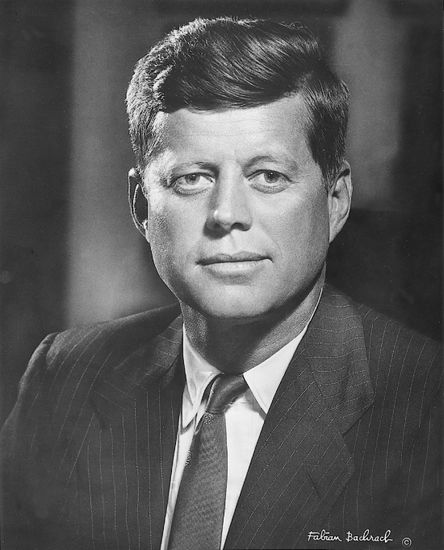 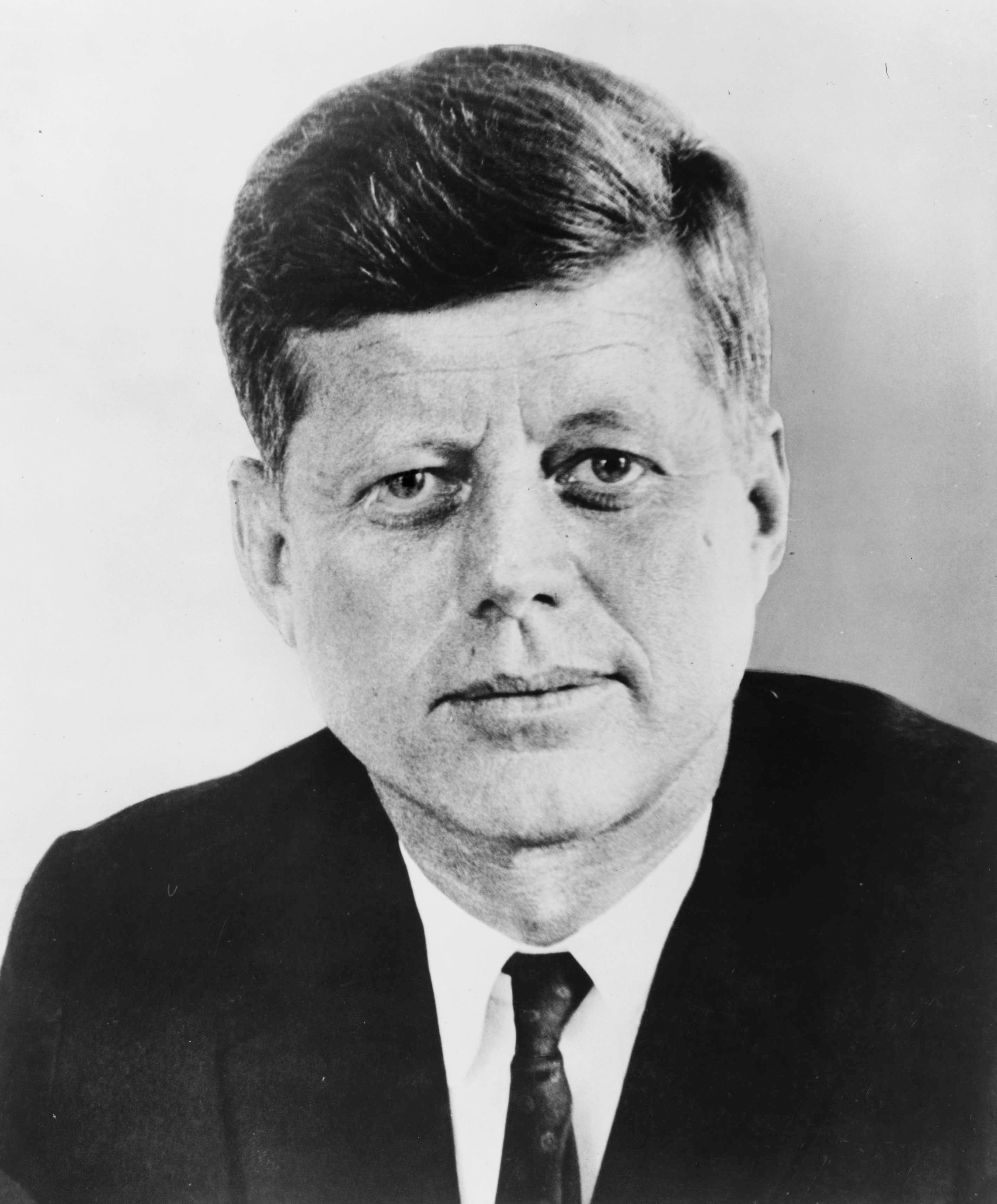 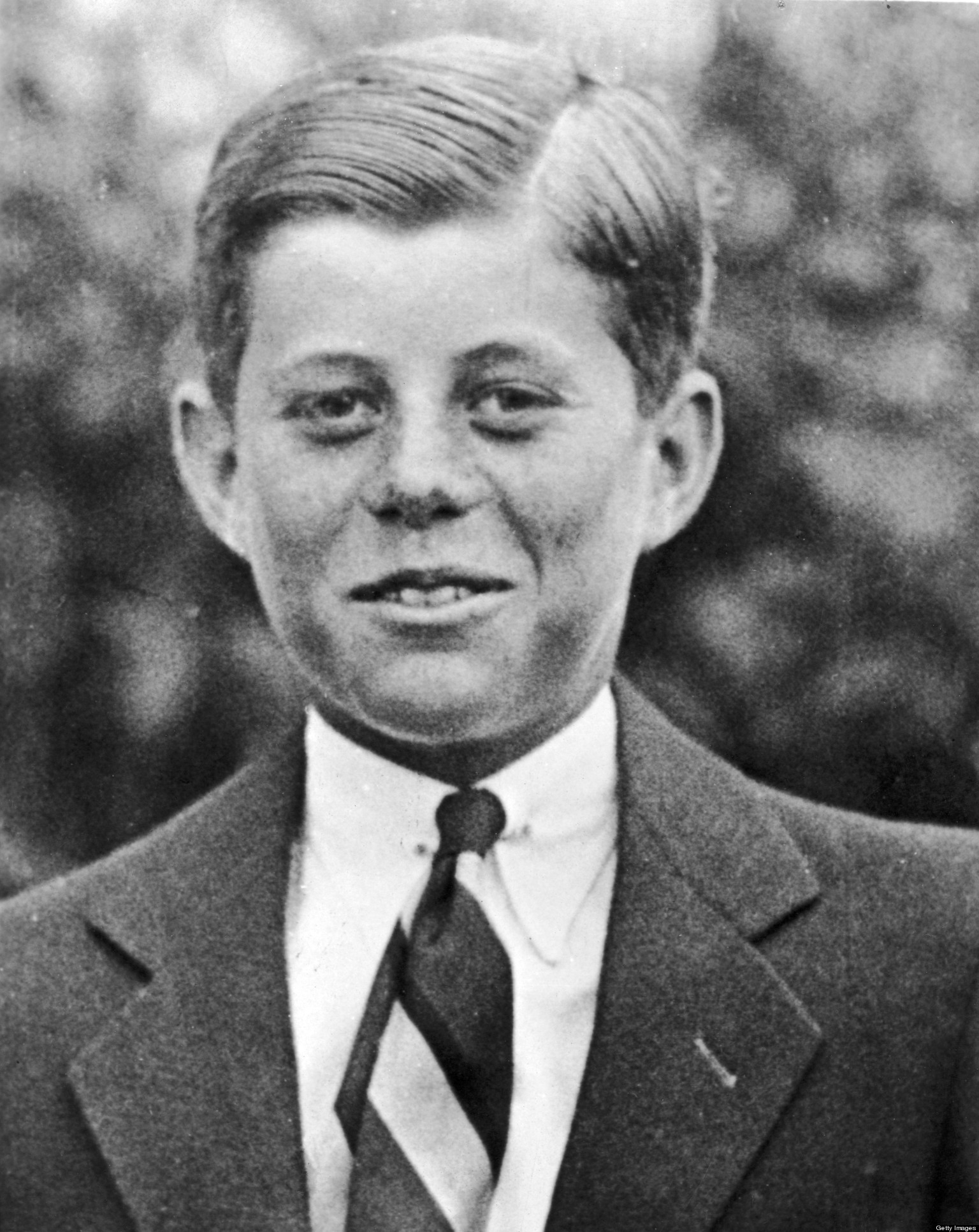   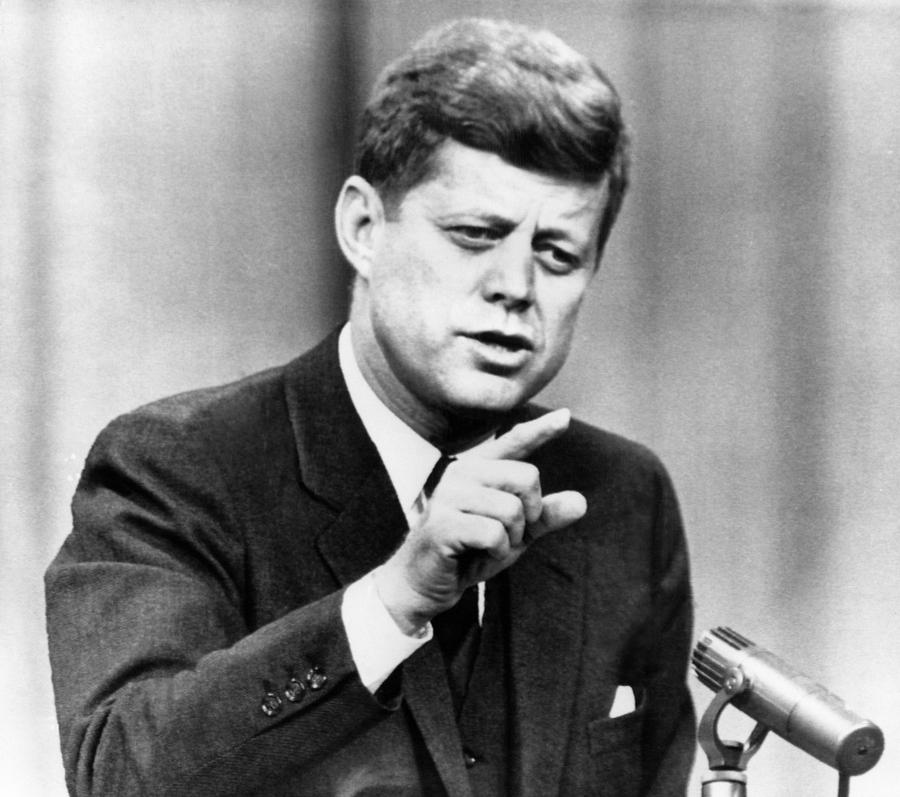  
Posté le : 07/11/2015 23:55
|
|
|
|
|
Georges Herbert Walker Busch (père) |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 novembre 1988 est élu président George Herbert Walker Bush
plus couramment appelé George Bush père, né le 12 juin 1924 à Milton dans le Massachusetts, États-Unisilm a aujourd'hui 91 ans, homme politique américain membre du Parti républicain, il est d'abord vice-président sous Ronald Reagan entre 1981 et 1989. En 1988, il bat Michael Dukakis et devient le 41e président des États-Unis du 20 janvier 1989 au 20 janvier 1993 soit pendant 4 ans, son vice-président est Dan Quayle du gouvernement Administration G.H.W. Bush, son prédécesseur est Ronald Reagan, son successeur Bill Clinton. Il est 43e vice-président des États-Unis du 20 janvier 1981 au 20 janvier 1989 soit pendant 8 ans. Le président est Ronald Reagan, gouvernement Reagan, prédécesseur Walter Mondale, son successeur Dan Quayle. Il fut 11e directeur de la CIA du 30 janvier 1976 au 20 janvier 1977 pendant donc, 11 mois et 21 jours, le président était Gerald Ford, son prédécesseur William Colby, son successeur Stansfield Turner. Son père est Prescott Bush, sa mère, Dorothy W. Bush, sa conjointe est Barbara Bush, ses enfants : George W. Bush, John Ellis Bush. Il est diplômé de l'Université de Yale, il est homme d'affaires dans l'industrie pétrolière, sa religion est l'Église épiscopale.
Il entrera en fonction le 20 janvier 1989. Battu par Bill Clinton en 1992, il quitte la Maison-Blanche lors de l'Inauguration Day le 20 janvier 1993. Il est le père de George W. Bush. Il est actuellement le plus âgé des anciens présidents américains le plus ancien président est quant à lui Jimmy Carter, élu en 1977.
En bref
Quarante et unième président des États-Unis. George Herbert Walker Bush représente un croisement complexe du patriciat de l'Est, dont il est un des produits les plus achevés, et du monde des entrepreneurs du Sud-Ouest où il est allé chercher une sorte de seconde légitimité. Il est né le 12 juin 1924 à Milton (Massachusetts) dans une famille d'athlètes férus de compétition. Son père, Walter Prescott Bush, un banquier d'affaires de Wall Street, fut sénateur républicain du Connecticut de 1952 à 1963. Pourtant le futur président n'est pas simplement le rejeton d'une famille riche ou le produit de l'enseignement élitiste mais exigeant de l'Est la Phillips Academy d'Andover. Son aura personnelle sinon intellectuelle durant ses études, ses prouesses athlétiques, ses exploits de plus jeune aviateur américain pendant la Seconde Guerre mondiale cinquante-huit missions de combat durant l'une desquelles son appareil est abattu suggèrent d'indéniables qualités que sa carrière ultérieure tend à confirmer.
En 1945, George Bush épouse Barbara Pierce, la fille d'un éditeur de magazines ; le couple aura six enfants. Après avoir obtenu en 1948 une licence d'économie à Yale, il part pour la frontière orientale du Texas où il attrape la fièvre du pétrole. En 1958, il devient président de la Zapata Off-Shore Company, qui s'assurera une forte réputation dans le développement du forage et de la production de pétrole en mer.
Ayant acquis une certaine aisance financière, il décide, en 1964, de se consacrer à la chose publique. Dès 1966, il est élu représentant du Texas et réélu deux ans après. Tiraillé, comme il le sera tout au long de sa carrière, entre ses instincts centristes et les penchants ultra-conservateurs d'une partie de son électorat, il éprouve déjà des difficultés à définir une ligne politique, ce qui lui vaut sans doute d'être battu quand il brigue le Sénat en 1970.
Richard Nixon, qui l'appellera à la tête du parti républicain (début 1973-été 1974) à l'approche de la tourmente du Watergate, lui ouvre alors une nouvelle carrière : la politique étrangère. Bush est successivement représentant des États-Unis auprès de l'O.N.U. (fin 1970-début 1973), chef du bureau de liaison des États-Unis en Chine (septembre 1974-décembre 1975) et directeur de la C.I.A. (janvier 1976-janvier 1977).
En 1980, il s'affirme comme le rival le plus dangereux pour Ronald Reagan dans la course à l’investiture. Avant la convention, son ami (et futur ministre des Affaires étrangères), James Baker, le convainc de se rallier à l'ancien gouverneur de Californie, qui le choisit alors comme vice-président. À ce poste, il sait se montrer loyal, mais aussi discret, et parachève sa connaissance des problèmes de sécurité. Reconduit avec Reagan en 1984, il est élu président quatre ans plus tard, avec 54 p. 100 des suffrages, face au démocrate Michael Dukakis, à la suite d’une campagne dont la férocité lui a souvent été reprochée. Il est à ce prix le premier vice-président en exercice à l'emporter, depuis Martin Van Buren en 1836.
Son bilan à la Maison-Blanche (janvier 1989-janvier 1993) reste mitigé. En janvier 1991, cette ambivalence lui vaut d'être le premier à être nommé par l'hebdomadaire Time « Homme de l'année » à la fois pour l'ampleur de ses échecs (en politique intérieure) et de ses succès (à l'étranger).
Rompu aux arcanes de la scène internationale, élitiste et secret, Bush excelle à nouer des contacts avec les dirigeants étrangers. D'abord hésitant face aux intentions de l'autre camp, il a su très vite gérer la fin de la guerre froide avec habileté, ne jamais permettre aux nationalistes russes d'exploiter les concessions de Gorbatchev contre ce dernier, conclure avec lui les traités S.T.A.R.T.-I (juillet 1991) et S.T.A.R.T.-II (janvier 1993) mais aussi s'assurer le maintien dans l'O.T.A.N. de l'Allemagne réunifiée. Longtemps porté à une compréhension exagérée envers un Saddam Hussein perçu comme le meilleur rempart face à l'islamisme iranien, il réussit à mettre sur pied puis à maintenir une coalition internationale des plus hétérogènes pour le contraindre à se retirer du Koweït. Malgré sa victoire dans la guerre du Golfe (janvier-février 1991), il n’est pas réélu en 1992, n’obtenant que 38 p. 100 des voix, face au démocrate Bill Clinton, qui en recueille 43 p. 100. Le candidat indépendant Ross Perot en obtient 19 p. 100.
Son échec tient partiellement au fait qu’il n’a pas su tirer profit de ses succès à l'étranger. Il pâtit de son impuissance à briser Saddam Hussein, de la fin d'une guerre froide à laquelle son image était associée et, dans la nouvelle ère géoéconomique qui paraît commencer, de son apparente incapacité à matérialiser sur le plan commercial une suprématie américaine par ailleurs incontestée.
En ce qui concerne la politique intérieure, sa présidence s’identifie à une récession (1990-1992). Écartelé entre ses réflexes de patricien du Nord-Est et ses efforts pour se faire accepter par l'aile conservatrice radicale de son parti, le président est mal à l'aise sur les grandes questions de société comme l'avortement qui déchirent le pays. Il ne réussit guère à se dégager, face au ralentissement de l'économie, des « menottes » que constituent pour lui le surendettement de l'État, le déficit du budget et la domination de l'opposition au Congrès. Contrairement à l’engagement qu’il avait pris en 1988 no new tax, il relève la fiscalité et ne peut atténuer les conséquences douloureuses, pour les cadres et les cols blancs, de la restructuration des grandes sociétés. Enfin, les émeutes du printemps de 1992, au cours desquelles le centre de Los Angeles est dévasté par des Noirs et des Hispaniques exaspérés, amplifient les carences d'une politique sociale qui a laissé les inégalités entre races et classes se creuser. Ses adversaires reprochent volontiers à George Bush d'avoir joué les Jules César à l'étranger et les « Néron » dans une Amérique embrasée.
Il laisse le souvenir d'un conservateur éclairé, dont le bilan en politique étrangère force le respect, mais que son immobilisme intérieur a handicapé. Pierre Melandri
Sa vie
George Bush est le fils de Prescott Bush, sénateur républicain modéré du Connecticut et homme d'affaires qui construit la fortune familiale dans la banque et la finance, et de sa femme, née Dorothy Walker.
George Bush, pilote de bombardier torpilleur durant la guerre du Pacifique
George Bush grandit à Greenwich au Connecticut et fait ses études à la Phillips Academy à Andover, dans le Massachusetts, de 1936 à 1942. Il est capitaine de l'équipe de baseball et membre d'une fraternité très fermée, la Auctoritas, Unitas, Veritas Autorité, unité, vérité. Mais, bien qu'admis à Yale, il décide à la suite de l'attaque de Pearl Harbor en 1941 de s'engager le 12 juin 1942, au lendemain de son baccalauréat, dans la US Navy, dont il est alors le plus jeune pilote.
Il effectue cinquante-huit missions aériennes dans le Pacifique au cours desquelles il est abattu à quatre reprises et quatre fois secouru. La dernière fois, le 2 septembre 1944, alors qu'il sert sur le porte-avions USS San Jacinto, son Grumman TBF Avenger est atteint par la défense anti-aérienne japonaise et il est sauvé par le sous-marin USS Finback. À la suite de ce dernier incident, il est démobilisé. Ainsi, reçut-il, durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses décorations, dont la Distinguished Flying Cross, l'Asiatic-Pacific Campaign Medal et la World War II Victory Medal.
Après la guerre, il entre à l'université Yale où il rejoint la fraternité Delta Kappa Epsilon et est, tel son père Prescott Bush 1917 puis son fils George W. Bush 1968, admis en 1948 dans la très secrète Skull and Bones Society ce qui lui permet d'initier la construction d'un solide réseau politique. Il sort diplômé BA en économie en 1948.
Il épouse Barbara Pierce le 6 janvier 1945. Ensemble, ils ont six enfants : George Walker, Robin décédée à l'âge de 4 ans des suites d'une leucémie, John Jeb, Neil, Marvin et Dorothy. Suivant les traces de leur père et de leur grand-père en politique, George Walker est élu gouverneur du Texas de 1995 à 2000 puis président en 2000, John quant à lui, fait fortune dans l'immobilier et est élu gouverneur de Floride en 1999.
Après la guerre, George Bush se lance dans l'industrie du pétrole au Texas et créé la Zapata Petroleum Company en 1953, avec un ancien agent de la CIA, Thomas. Devine. Il travaille pour la société Dresser Industries qui fusionne en 1998 avec la société Halliburton Energy Services dont Dick Cheney, qui deviendra son ministre de la Défense, était à l'époque le président-directeur général. Après avoir quitté la CIA en 1977, Georges H. W Bush devint un des dirigeants des laboratoires pharmaceutiques Eli Lilly et membre du conseil d'administration ; à ce sujet, en tant que Vice-Président à partir de 1981 il a activement défendu les intérêts des industriels pharmaceutiques au travers, notamment, du Texas Medication Algorithm Project
Carrière politique
Son engagement dans la politique date de juin 1940, lorsqu'il assiste au discours de Henry Stimson, Secrétaire à la Guerre du président Roosevelt, venu à la Phillips Academy, parler du chancelier Adolf Hitler et du rôle que devraient tenir les États-Unis dans la défense des valeurs démocratiques occidentales.
Les débuts 1964-1976
En 1964, George Bush entre en politique en se présentant contre le sénateur démocrate Ralph Yarborough au Texas. Sa campagne est notamment axée sur le vote de Yarborough en faveur du Civil Rights Act de 1964, auquel tous les politiciens du sud des États-Unis se sont opposés. Il taxe Yarborough d'extrémiste et de démagogue gauchiste, celui-ci se défend en le taxant d'opportuniste. Bush perd sa première élection lors de la défaite républicaine de 1964.
Cependant, il est finalement élu en 1966 et 1968 à la Chambre des représentants dans le 7e district du Texas. Durant son mandat, il est perçu comme un centriste et vote en faveur du Voting Rights Act prévoyant l'abaissement à dix-huit ans de l'âge requis pour le droit de vote. En 1970, il est candidat au Sénat des États-Unis avec James Baker comme directeur de campagne. Cependant, il échoue dans sa tentative face au candidat démocrate Lloyd Bentsen. Il se retrouve alors sans fonction élective.
En 1971, Richard Nixon le nomme comme ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies. Son choix est unanimement approuvé par les sénateurs. C'est à ce poste qu'il expose un projet d'une force internationale visant à garantir la paix au Proche-Orient et s'oppose à ce que le régime de Pékin occupe le siège de la Chine, au détriment du gouvernement de Taïwan.
Tout au long des années 1970, sous les présidences de Richard Nixon et Gerald Ford, il occupe de nombreux autres postes politiques, dont ceux de président du Comité national républicain (Republican National Committee) en 1973, d'envoyé des États-Unis en République populaire de Chine en 1974-1975.
Directeur de la CIA
Entre janvier 1976 et janvier 1977, il devient Directeur du Renseignement Central. À cette occasion, il restaure le moral du personnel très atteint par les suites du scandale du Watergate et les investigations de la Commission Church. Il rencontre régulièrement Jimmy Carter, d'abord comme candidat, ensuite comme président-élu, pour l'informer de l'état du monde. Lors du scandale du Watergate, il est par ailleurs soupçonné, parmi d'autres, d'être « Gorge profonde », le fameux indicateur des deux journalistes du Washington Post qui ont mis l'affaire au grand jour.
En 1977, après l'élection du démocrate Jimmy Carter à la présidence, George Bush décide de se mettre pour quelque temps en retrait des affaires politiques et de prendre la présidence du comité exécutif de la First International Bank (en) à Houston, poste qu'il occupe jusqu'en 19791.
Les responsabilités exercées comme représentant à l'ONU, à Pékin puis à la tête de la CIA, lui confèrent une excellente expérience internationale qui le crédibilisera en 1980 aux yeux de Ronald Reagan pour être son vice-président.
Vice-présidence 1981-1989
George Bush, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev à New York en 1988.
En mai 1979, George Bush est candidat aux élections primaires républicaines de 1980 face à Ronald Reagan. Il doit vite s'incliner face à l'ancien gouverneur de Californie. Celui-ci, après avoir hésité, notamment en faveur de Gerald Ford, choisit finalement George Bush comme colistier pour le poste de vice-président, car il estime qu'il pouvait être un compagnon précieux ; républicain modéré, il pouvait apporter son expérience internationale auprès des Nations unies et de la Chine, ainsi qu'une vision de l'intérieur de la CIA.
En novembre 1980, Ronald Reagan est élu président face à Jimmy Carter. En janvier 1981, George Bush entre à ses côtés à la Maison-Blanche en tant que vice-président.
En 1981, George H.W. Bush est le premier vice-président à assurer un intérim pour la présidence lorsque Ronald Reagan est victime d'une tentative d'assassinat par un déséquilibré. Cet intérim se renouvellera en 1985, lors de la deuxième présidence, lorsque Reagan est opéré pour un cancer du côlon.
Ronald Reagan est réélu pour un second mandat le 6 novembre 1984, remportant 49 États 525 grands électeurs et 58 % du vote populaire contre 1 seul à Walter Mondale et 41 % du vote populaire.
Durant ces deux mandats, le vice-président parcourt plus de soixante-dix pays où il représente l'administration Reagan et expose la politique des États-Unis.
Campagne présidentielle de 1988
Carte électorale du 8 novembre 1988. Les états en rouge sont ceux remportés par George Bush.
Il fut convenu très tôt avec ses conseillers que George Bush allait se lancer dans la campagne présidentielle de 1988, et une campagne de fonds fut lancée dès 1985, récoltant plus de 2 millions de dollars.
Le 12 octobre 1987, George Bush se lance de nouveau dans la campagne présidentielle. Il rafle l'investiture républicaine face au sénateur du Kansas Bob Dole et au pasteur Pat Robertson, avec le soutien de Ronald Reagan.
Le 18 août 1988, après avoir sélectionné le sénateur de l'Indiana, Dan Quayle, pour candidat à la vice-présidence, il est officiellement investi par son parti à la convention républicaine de La Nouvelle-Orléans. Ils ont alors pour adversaire le candidat démocrate Michael Dukakis, gouverneur du Massachusetts et son colistier, Lloyd Bentsen, sénateur du Texas.
Le 8 novembre 1988 remporte l'élection présidentielle face à Michael Dukakis, arrivant en tête dans les principaux États Californie, Floride, Ohio, Pennsylvanie, Texas) avec 426 grands électeurs et 53 % du vote populaire.
Il est proclamé président des États-Unis le 8 janvier 1989 par le Congrès, après l'officialisation des résultats du collège de grands électeurs.
Président des États-Unis 1989-1990 Administration G.H.W. Bush.
La côte de popularité du président Bush tout au long de son mandat.
George H.W. Bush est investi le 20 janvier 1989 sur les marches du Capitole à Washington, D.C. Il poursuivit la politique menée par son prédécesseur, Ronald Reagan, surtout en matière de politique étrangère.
Politique nationale Économie
Lorsque George Bush devient président des États-Unis, le budget du pays est déficitaire, dû à la politique étrangère de Ronald Reagan qui avait relancé la course aux armements pour revenir à hauteur de l'Union soviétique et à la baisse massive de la fiscalité, atteignant 220 milliards de déficits en 1990. Il tente de convaincre Congrès des États-Unis à majorité démocrate de réduire les dépenses fédérales sans pour autant augmenter les impôts. Mais le Congrès obligea le président Bush à une augmentation des dépenses fédérales, avec une augmentation légère des impôts. Ce compromis lui aliène le soutien des républicains conservateurs, qui lui reprochent de revenir sur sa promesse électorale de 1988 de ne pas augmenter la pression fiscale, Read my lips: no new taxes. Il ne retrouvera jamais les soutiens qu'il a perdu à ce moment-clé de sa présidence.
Au même moment, il doit gérer les conséquences financières de la grave crise des caisses d'épargne.
Il déclare en 1990 au cours d'une conférence de presse aux journalistes qu'il trouvait la politique étrangère plus importante, ce qui accentua la perte de ses soutiens.
En effet, en 1992, 7,8 % de la population active américaine est au chômage. Cela constitue un record depuis 1984, sous la présidence de Ronald Reagan. On lui reprocha d'avoir négligé la politique intérieure pour la politique étrangère, et ses plans pour sortir le pays de la récession économique divisent au Congrès, au sein de son propre parti.
Droits civiques
Son mandat sur le plan intérieur est aussi marqué par une réforme du droit civil en faveur des personnes handicapées, l'accroissement des fonds publics destinés à l'éducation et la protection de l'enfance et dans l'adoption du Clean Air Act pour lutter contre la pollution.
Il a également l'occasion de nommer deux juges à la Cour suprême des États-Unis David Souter et Clarence Thomas.
L'aggravation de l'insécurité, la forte augmentation des crimes constatés sur le territoire + 20 % durant son mandat, les graves émeutes de Los Angeles en 1992 et l'absence de réponse claire de l’administration accentuera impopularité du président et la perte du soutien des républicains conservateurs.
Libre échange
Signature de l'accord de libre échange nord-Américain.
Enfin, il conclut avec le Canada et le Mexique un Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui entra en vigueur le 1er janvier 1994.
Politique étrangère Chute du Mur de Berlin
En 1989 la chute du mur de Berlin marque un premier pas vers la fin de la Guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. George Bush soutient la marche vers la réunification allemande tout en maintenant le dialogue avec Mikhaïl Gorbatchev et en poursuivant la baisse du stock d'armes nucléaires des États-Unis.
Intervention au Panama Invasion du Panama par les États-Unis.
En décembre 1989, il autorise une intervention militaire américaine au Panama pour destituer le président Manuel Noriega dont le régime menace les intérêts américains. Celui-ci, d'abord réfugié à l'ambassade du Vatican, se livre finalement et est ramené en Floride pour y être jugé et emprisonné pour trafic de drogue et corruption.
Intervention en Irak Guerre du Golfe.
Lorsque le 2 août 1990, l'Irak, gouverné par Saddam Hussein, envahit l'émirat voisin du Koweït, le gouvernement Bush réagit alors avec la plus grande fermeté. Avec l'aval du Congrès et des Nations unies, George Bush envoie des troupes dans le Golfe et convainc les dirigeants saoudiens d'accepter sur leur sol des forces défensives nord-américaines. D'une formation défensive, la coalition passe à l'offensive après quelques mois d'embargo économique total sur l'Irak destiné à faire plier le raïs irakien.
L'opération Tempête du désert débute dans la nuit du 16 au 17 janvier 1991 avec pour but de prévenir l'invasion de l'Arabie saoudite. Cette première guerre du Golfe contre l'Irak est alors une vaste opération armée menée sous l'égide de l'ONU.
Après un mois de bombardements intenses, l'offensive terrestre ne dure que quelques jours et des centaines de milliers de soldats irakiens sont faits prisonniers. L'opération est un succès pour la coalition. Cette dernière ne soutient toutefois pas les insurgés qui menacent alors le pouvoir de Saddam Hussein, déstabilisé par sa défaite au Koweït. Craignant vraisemblablement une trop grande instabilité dans cette région exportatrice d'hydrocarbures et l'éclatement de l'Irak, la communauté internationale laisse faire la répression menée par les troupes bassistes à l'encontre des populations Kurdes et des chiites. Une zone d’exclusion aérienne dans les territoires kurdes du nord du pays est néanmoins placé sous couverture aérienne de la coalition. En août 1992 une autre zone d’exclusion arienne est mise en place dans le sud de l'Irak.
Les partisans de la destitution de Saddam Hussein reprocheront alors à George Bush de ne pas avoir poursuivi jusqu'à Bagdad afin de renverser le dictateur irakien, En 1998, cinq ans avant le déclenchement de la guerre en Irak par son fils George W Bush, il répondra à ces critiques expliquant dans un livre intitulé un monde transformé co-écrit avec son ancien conseiller à la sécurité nationale Brent Scowcroft que l'invasion de l'Irak aurait eu un coût humain et financier incalculable. Par ailleurs, le mandat que la coalition avait reçu de l'ONU ne prévoyait pas une invasion militaire de l'Irak et un changement de régime par la force armée à Bagdad.
L'administration Bush s'inquiétait également des événements qui se déroulaient dans les Balkans et qui menaçaient gravement leur stabilité.
Éclatement de l'URSS
Quelques mois plus tard, en août 1991, lors du putsch de Moscou en Union soviétique et la séquestration en Crimée de Mikhail Gorbatchev, il apporte immédiatement son soutien au président russe Boris Eltsine, immédiatement suivi par le Royaume-Uni, alors que Helmut Kohl en Allemagne apporte son soutien à Gorbatchev et que la France par l'entremise de François Mitterrand reste dans l'expectative, allant même dans un premier temps vouloir attendre les intentions des nouveaux dirigeants soviétiques reconnaissant de facto le gouvernement issu du putsch.
La crise se dénoue finalement par la fuite des putschistes et l'implosion de l'URSS privant les États-Unis de leur ennemi légendaire, donnant naissance, selon George Bush, à un nouvel ordre mondial New World Order dans lequel les États-Unis, de facto l'unique superpuissance mondiale, doivent commencer à redéfinir leur rôle. Cette tâche ardue n'était pas achevée dans sa totalité à la fin du mandat de George Bush.
Lors de l'annonce de l'initiative nucléaire présidentielle du 17 septembre 1991, il annonce l'élimination des armes nucléaires tactiques et du retrait des ogives nucléaires américaine à l'étranger hormis quelques centaines de bombes pour avions qui restent sur des bases de l'USAFE dans quelques pays européens de l'OTAN.
Campagne présidentielle de 1992
Le président Bush ne rencontre pas d'adversaire dangereux lors des primaires du Parti républicain, remportant la totalité des État devant Pat Buchanan. Il est reconduit candidat à la présidence du parti lors de la convention républicaine qui se tint à Houston du 17 août au 20 août 1992 ainsi que Dan Quayle comme candidat à la vice-présidence. Il reçut le soutien de Ronald Reagan qui tenait son dernier discours public.
Néanmoins, sa candidature est affaiblie par la situation économique du pays ainsi que la présence de Ross Perot, homme d'affaires Texan conservateur qui fut soutenu par de nombreux républicains, reprochant à George Bush de ne pas avoir tenu ses promesses électorales au sujet de la fiscalité. Le discours de Pat Buchanan sur la guerre des cultures et la prise de position du président du parti amenèrent de nombreux républicains libéraux et centristes modérés à se diriger vers Bill Clinton. La dominance républicaine à la Maison-Blanche depuis 1981 à également raison de lui. Il souffrait également de l'absence de son directeur de campagne de 1988, Lee Atwater décédé l'année précédente d'un cancer.
Son adversaire démocrate Bill Clinton et son colistier Al Gore tous deux sudistes peuvent ainsi récupérer les États sudistes confédérés acquis aux républicains depuis 1968 excepté en 1976. Les détracteurs de Clinton lui reprochèrent de n'avoir pas accompli son service militaire pendant la guerre du Viêt Nam et d'avoir fumé de la marijuana.
L'absence de Ross Perot dans la campagne jusqu'en septembre relance la campagne du président sortant. Mais la présence de Perot lors des débats présidentiels et l'affichage d'une certaine impatience lorsque Clinton avait la parole le décrédibilisa à nouveau.
Le 3 novembre 1992, Bill Clinton remporte l'élection présidentielle arrivant en tête dans les principaux États Californie, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvanie et dans certains États dans lesquels était ancré le parti républicain Colorado, Maine, Maryland, Montana, Nevada, Nouveau-Mexique, Vermont.
Après la présidence
Depuis la fin de son mandat, il a continué d'exercer diverses responsabilités professionnelles. Relativement discret sur la scène internationale, il a néanmoins continué à faire des apparitions publiques. Ainsi le 11 juin 2004, il prononce un discours en l'honneur de Ronald Reagan dont il fut le vice-président pendant huit ans, lors de ses obsèques nationales. Malgré leurs affrontements lors de leur carrière politique, George Bush est devenu proche de l'ancien président Bill Clinton. Ils apparurent ensemble lors de spots télévisés en 2004 pour promouvoir l'aide aux victimes du Tsunami dans l'océan Indien, puis de nouveau en 2005 lors de l'ouragan Katrina.
Le 18 février 2008, il soutint officiellement le sénateur John McCain dans la course à la présidence des États-Unis6 ce qui provoqua un sursaut dans la campagne du sénateur de l'Arizona à un moment où celui-ci faisait face à des critiques parmi le milieu conservateur
Le 10 janvier 2009, George H. W. Bush et son fils, George W. Bush, étaient présents pour la mise en service du porte-avions USS George H. W. Bush.
Sa personnalité
Les anciens présidents américains Bill Clinton, George Bush père et George W. Bush et Silvio Berlusconi, le 7 avril 2005 lors des funérailles du pape Jean-Paul II.
Il est l'ami du prédicateur Billy Graham, qu'il consulte à la veille du déclenchement des hostilités contre l'Irak en janvier 1991. Pour lui, la guerre du Golfe c'est encore ni plus ni moins qu'un affrontement entre le bien et le mal, confie-t-il au magazine U.S. News & World Report. C'est pour cela qu'il a tenu à donner à la guerre, toutes les apparences d'une croisade pour le droit, laissant au second plan les autres justifications : protection des approvisionnements en pétrole de l'Occident, protection de l'État d'Israël et prévention de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques dans les pays jugés dangereux.
Sa croyance en la primauté du droit l'a poussé à multiplier les procédures de négociations internationales vote de douze résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et le jeu diplomatique alliance sans précédent de vingt-huit nations, avant de s'engager dans l'action.
George H. W. Bush a toujours pris soin de donner de lui une image dynamique, par exemple en célébrant ses 75e, 80e, 85e et 90e anniversaires en sautant en parachute au-dessus de sa résidence du Maine.
Dans la fiction
1991 : Y a-t-il un flic pour sauver le président ?, de David Zucker, joué par John Roarke
2008 : W. : L'Improbable Président, d'Oliver Stone, joué par James Cromwell
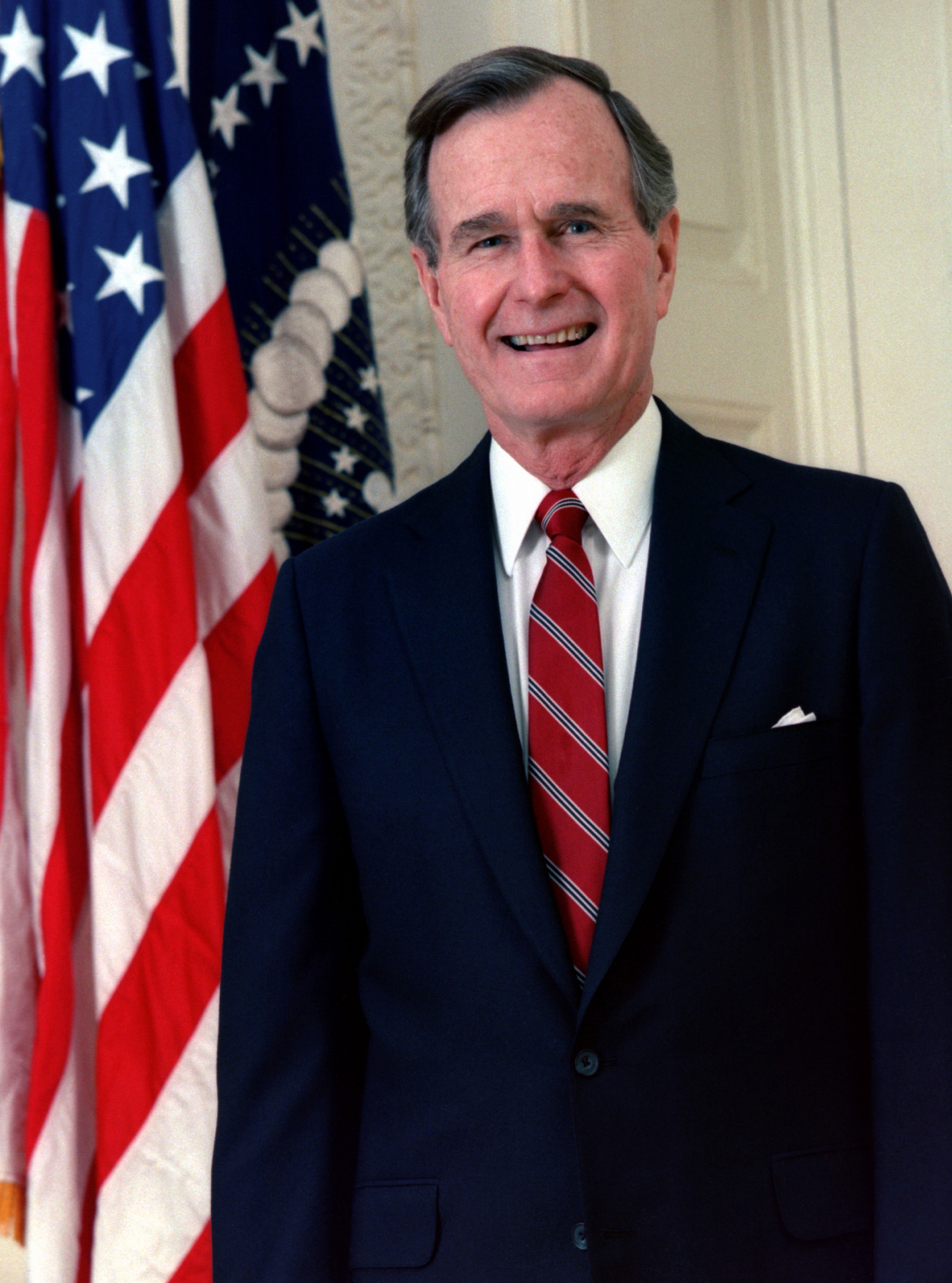 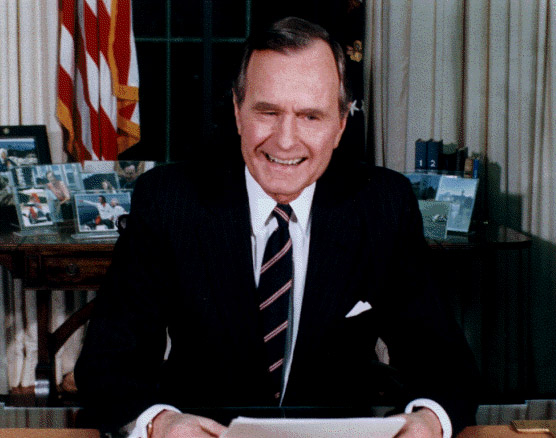 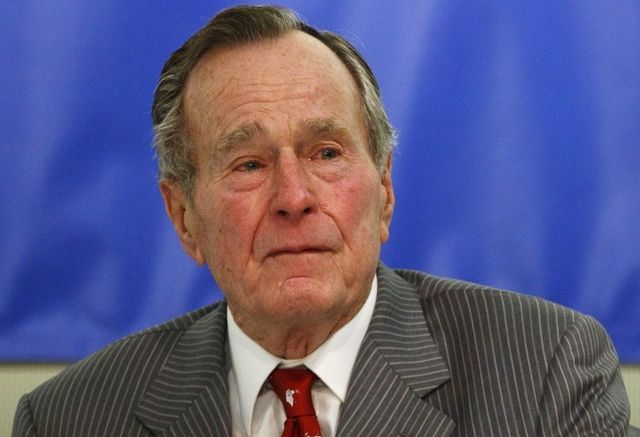 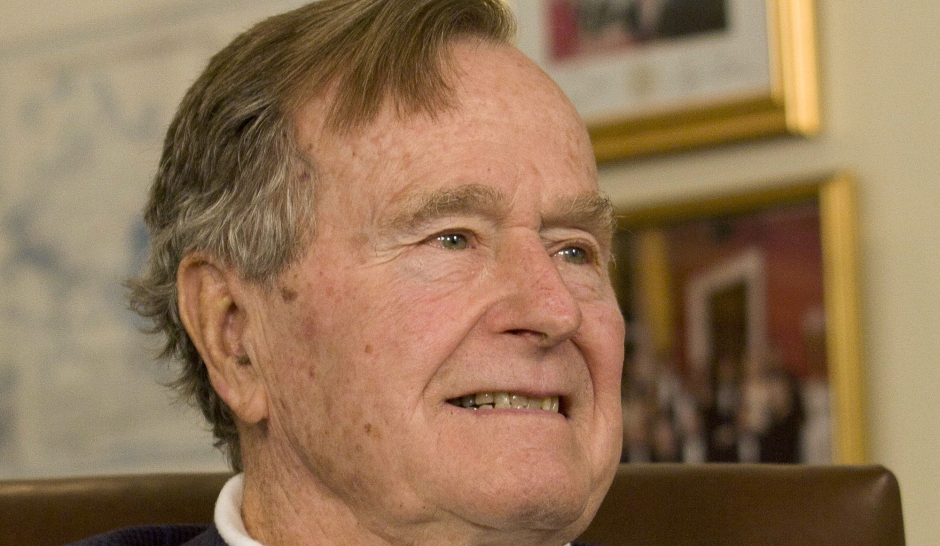  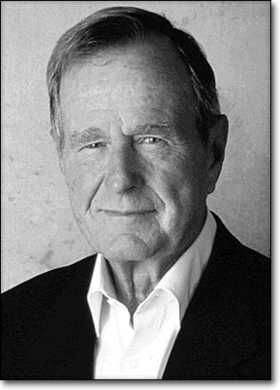    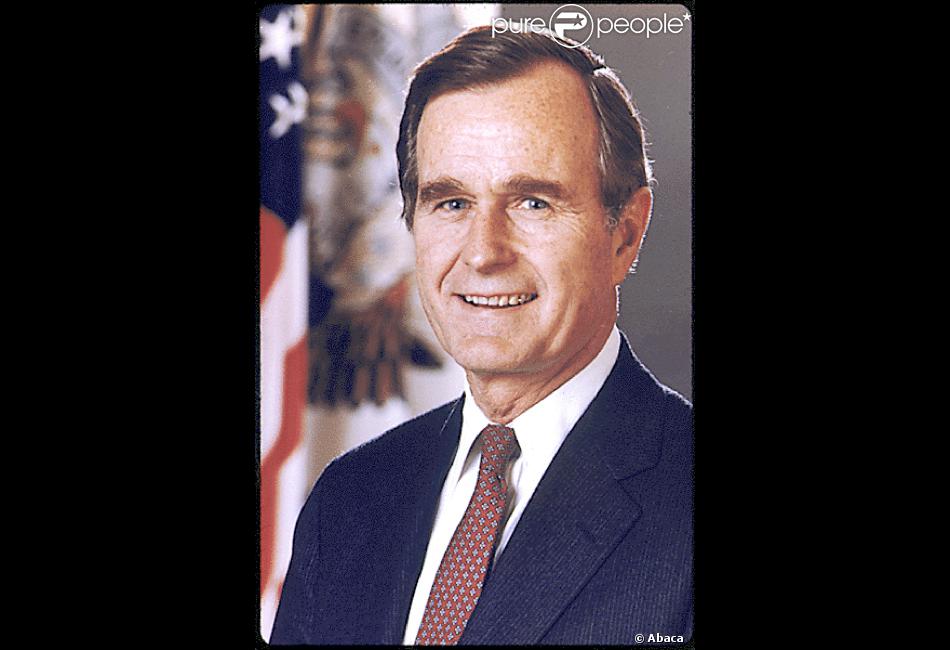 
Posté le : 07/11/2015 23:35
|
|
|
|
|
Franklin delano Roosevelt 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 novembre 1932 est élu le président Franklin Delano Roosevelt
ˈɹoʊzəvɛlt, né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, dans l’État de New York, et mort à 63 ans, le 12 avril 1945 à Warm Springs, dans l’État de Géorgie, homme d'État américain, trente-deuxième président des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945, soit 12 ans 1 mois et 8 jours, élection le 8 novembre 1932, réélection le 3 novembre 1936, le 5 novembre 1940, le 7 novembre 1944. Le Vice-président sont John Garner 1933–1941, Henry Wallace 1941–1945, Harry S. Truman 1945. Son prédécesseur à la présidence est Herbert Hoover, son successeur Harry S. Truman. Il fut 48e gouverneur de l'État de New York du 1er janvier 1929 –au 31 décembre 1932, son prédécesseur était Al Smith, son successeurfut Herbert H. Lehman. Il appartient au parti politique, démocrate, son épouse est Eleanor Roosevelt. Il est diplômé de l' Université Harvard, sa profession est Juriste et sa religion est celle de l'église épiscopale. Figure centrale du XXe siècle, il fut le seul président américain à être élu à quatre reprises. Il ne fit qu'entamer son quatrième mandat, emporté par la maladie quelques mois après le début de celui-ci.
Confronté à la Grande Dépression, Roosevelt mit en œuvre le New Deal, un programme de relance de l’économie et de lutte contre le chômage. Il réforma le système bancaire américain, et fonda la Sécurité sociale. Il créa de nombreuses agences gouvernementales telles que la Works Progress Administration, la National Recovery Administration ou l’Agricultural Adjustment Administration. Il réussit à élaborer un nouveau mode de présidence, plus interventionniste et plus actif grâce à son équipe de conseillers, appelée Brain Trust. Roosevelt fut l’un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale et rompit avec l’isolationnisme traditionnel de son pays. Avant l’entrée en guerre des États-Unis, il lança le programme Lend-Lease afin de fournir les pays alliés en matériel de guerre. Après l’attaque de Pearl Harbor, il assuma pleinement ses fonctions de commandant en chef de l’armée américaine et prépara largement la victoire des Alliés. Il tint un rôle de premier plan dans la transformation du monde au sortir du conflit, et inspira notamment la fondation de l'ONU. Critiqué par les uns, admiré par les autres, il a laissé une très forte empreinte dans l'histoire de son pays et celle du monde.
En bref
Franklin Delano Roosevelt, trente-deuxième président des États-Unis 1933-1945, accède au pouvoir dans le contexte de la dépression économique mondiale qui a suivi le krach de Wall Street de 1929. Conscient que la crise est autant psychologique qu'économique, il entend redonner confiance aux Américains et met rapidement en œuvre une série de mesures, le New Deal, destinées à redresser l'économie. Alors que la situation internationale se dégrade, Roosevelt doit, dans un premier temps, composer avec la tradition isolationniste de l'opinion, qui l'empêche de soutenir pleinement les démocraties menacées par l'expansionnisme nazi ou japonais. C'est l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, en décembre 1941, qui lui permet d'engager son pays dans la Seconde Guerre mondiale. Sa mort, le 12 avril 1945, l'empêche de voir la fin des hostilités et d'effectuer le quatrième mandat pour lequel il venait d'être réélu.
Le président des États-Unis Franklin Roosevelt 1882-1945, lors d'une inspection des installations militaires de Hawaii, en 1944. Il est accompagné du général MacArthur 1880-1964 et de l'amiral Nimitz 1885-1966.
Les 100 jours. Issu d'une famille aisée, Franklin Delano Roosevelt fréquente les meilleures écoles privées, l'université Harvard puis celle de Columbia. En 1905, il se marie avec une cousine lointaine, Eleanor, nièce du président Théodore Roosevelt. Mais, à la différence de son oncle par alliance, Roosevelt est démocrate et se présente sous cette étiquette aux élections sénatoriales de l'État de New York en 1910. Élu, il se range aux côtés des progressistes et se rallie en 1912 à la candidature de Woodrow Wilson. Le succès de son chef de file lui permet d'entrer dans le cabinet, comme secrétaire adjoint à la Marine (1913-1921). Fidèle wilsonien, Roosevelt est, à l'élection de 1920, le candidat démocrate à la vice-présidence, néanmoins il ne peut empêcher la victoire des républicains. En 1921, il est frappé par la poliomyélite mais recouvre partiellement l'usage de ses jambes. Dès lors, avec l'aide de sa femme, il entreprend une lutte énergique contre les effets de la maladie. Loin d'abandonner la vie politique, il y trouve l'occasion de manifester le goût de l'effort. À demi-paralysé, mais plus mûr, plus instruit, il incarne paradoxalement l'optimisme. En 1928, il est élu gouverneur de l'État de New York et réélu en 1930. Les mesures qu'il a prises pour combattre le chômage le font connaître dans le pays tout entier. Le Parti démocrate, écarté du pouvoir depuis onze ans, le désigne comme son candidat à la présidence ; il est élu triomphalement en 1932, avec 57,3 p. 100 des voix et l'appui d'un Congrès à majorité démocrate.
Franklin D. Roosevelt. Le président Roosevelt 1882-1945 en Georgie, en 1932, lors de la première de ses quatre victoires électorales.
Les 100 jours qui suivirent son accession à la présidence furent marqués par une série de mesures économiques et financières spectaculaires. Roosevelt fit fermer toutes les banques et ne leur permit de rouvrir que sous le contrôle du Banking Act. Puis, après avoir abandonné l'étalon or, il fit adopter un certain nombre de mesures dont les plus connues concernent l'établissement de l'Agricultural Adjustment Act A.A.A., la commission sur les opérations boursières, le National Industrial Recovery Act N.I.R.A., le Public Works Administration P.W.A., la Tennessee Valley Authority. D'autres mesures devaient contribuer à reconstruire l'économie et les finances et transformer profondément la législation sociale Fair Labor Standard Act, National Labor Relations Act, Social Security Act.
Ces mesures, élaborées par une équipe, dont le fameux brain trust composé au départ de cinq professeurs, d'un juge et d'un juriste, n'ont pas été de simples réponses « pragmatiques » à une situation de crise. Elles révèlent des choix et des orientations politiques et économiques bien précises : restructuration de l'économie capitaliste, intervention croissante de l'État dans l'économie, intégration des organisations syndicales, etc. Ces mesures devaient susciter l'opposition croissante de la Cour suprême, qui déclara inconstitutionnelles de nombreuses lois votées alors par le Congrès. Pour faire échec à la Cour suprême, Franklin D. Roosevelt mit à la retraite anticipée certains de ses membres et nomma des juges favorables à sa politique.
Lors des élections de 1936, Roosevelt fut réélu avec une majorité sans précédent. Mais la deuxième présidence fut marquée par une récession sévère, par des oppositions croissantes à l'intérieur du Parti démocrate et par la montée des périls sur la scène internationale.
Roosevelt dans la guerre. Au milieu de ces difficultés, le président fut réélu une troisième fois sur la base d'un programme qui affirmait : « Pas de troupes américaines outre-Atlantique. » Au même moment, Roosevelt prenait un certain nombre de mesures permettant aux États-Unis de jouer le rôle d'« arsenal de la démocratie ». En mars 1941, il signait la loi du prêt-bail, puis faisait adopter par le Congrès des mesures concernant la défense nationale. En août 1941, Roosevelt et Churchill élaboraient la charte de l'Atlantique et, en novembre, le président autorisait l'armement de la marine marchande américaine.
Après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, Roosevelt organisa la production de guerre américaine dans un temps record, profitant du soutien du Congrès et de la nation. Au cours de la guerre, Roosevelt participa à un certain nombre de conférences avec ses alliés pour mettre au point une stratégie et des objectifs à long terme : en janvier 1943, la Conférence de Casablanca réunit Roosevelt, de Gaulle, Giraud et Churchill. En août, Roosevelt vit Churchill à Québec et en septembre à Washington. En novembre, il rencontra Churchill et Tchiang Kai-chek en Afrique du Nord, Churchill et Staline à Téhéran, puis Churchill et Ismet Inönü au Caire. En février 1945, à la Conférence de Yalta, des plans furent faits pour la défaite de l'Allemagne, l'entrée en guerre de l'U.R.S.S. contre le Japon, l'organisation des États-Unis, la division de l'Allemagne en zones et la reconnaissance de zones d'influence des deux grandes puissances. À l'époque de la guerre froide, les ennemis de Roosevelt lui reprocheront d'avoir fait la part trop belle aux Soviétiques dans les accords de Yalta. Mais sa mort brutale survenue le 12 avril 1945, à quelques mois de la fin de la guerre, empêche de dire comment il aurait abordé les problèmes nouveaux de la capitulation germano-japonaise et de la paix.
Churchill et Roosevelt lors de la conférence de Casablanca, 1943
Le Premier ministre britannique Winston Churchill 1874-1965 et le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt 1882-1945 lors de la conférence de Casablanca, au Maroc, en janvier 1943. Ils décident notamment d'exiger la capitulation sans condition des puissances de l'Axe.
Conférence du Caire, 1943. Tchiang Kai-chek, Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill se rencontrent du 22 au 26 novembre 1943, lors de la conférence du Caire (Égypte), pour régler des questions de stratégie militaire en Asie, et notamment contre le Japon.
Conférence de Yalta, 1945 C'est au bord de la mer Noire, à Yalta, en Crimée, que se tient, entre le 4 et le 11 février 1945, la principale des conférences réunissant les futurs vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Le principe de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie étant établi, le Britannique Winston Chu…
Pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré les assurances fréquemment réitérées au « camp démocratique », la politique de Roosevelt fut singulièrement attentiste et même parfois louvoyante. S'il est vrai que le soutien à l'allié d'abord le plus menacé, le Royaume-Uni, fut un de ses traits caractéristiques, il n'en fut pas toujours de même des autres alliés, puissants ou diminués. Une partie des difficultés de l'après-guerre est incontestablement due aux mesures tour à tour traditionalistes et progressistes prises par le président et par son équipe durant les phases successives du conflit mondial.
Sur le plan de la politique intérieure, la présidence de Roosevelt représente un moment crucial dans l'histoire des États-Unis. Elle est marquée par un très net renforcement du pouvoir présidentiel, par l'extension des pouvoirs du gouvernement fédéral au détriment du droit des États et par la remise en marche du capitalisme par des initiatives planistes. Loin d'avoir été une révolution, le New Deal a assuré la survie de l'ordre existant. Marianne Debouzy
Sa vie
Franklin Delano Roosevelt est né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, une localité de la vallée de l’Hudson située à environ 160 km au nord de New York. Ses parents appartenaient à deux vieilles familles patriciennes de New York.
Parmi les ancêtres de celle-ci figure Philippe de La Noye de famille wallonne installée aux Pays-Bas du nord à la suite de sa conversion au protestantisme. Émigré en Amérique du Nord avec les colons financés par la compagnie d'Amsterdam sous la direction de Pierre Minuit de Tournai, Philippe de La Noye eut des descendants qui s'allièrent aux Roosevelt hollandais. Le nom de La Noye s'étant altéré en Delano, la famille Delano Roosevelt se réclamait de cette vieille ascendance, James Roosevelt Sr, père du futur président et riche entrepreneur faisait remonter la fondation de la famille à l'ancêtre hollandais, Nicholas Roosevelt, installé à la Nouvelle-Amsterdam. La descendance de celui-ci donnera un autre président américain, Theodore Roosevelt. Le futur président Franklin Delano épousera la nièce de Theodore, Eleanor.
C'est par sa mère, Sara Ann Delano, qu'il avait des ancêtres wallons, le père de celle-ci Warren Delano Jr, qui avait fait fortune dans le commerce de l’opium avec la Chine descendait de Philippe de La Noye 1602-1681, issu de l'illustre Maison de Lannoy issue du Brabant Wallon et l’un des passagers du Fortune qui accosta à Plymouth en novembre 1621, rejoignant les premiers colons du Mayflower. Parmi la nombreuse descendance de Philippe de La Noye, il y eut quelques décennies auparavant un autre président des États-Unis, le général Ulysses. Grant. Franklin s'était quant à lui convaincu de descendre d'une des familles les plus anciennes du Grand-Duché de Luxembourg, les Comtes de Delannoy, comme la grand-mère maternelle de Charles de Gaulle,
Franklin Roosevelt était fils unique ; il grandit sous l’influence d’une mère possessive et eut une enfance heureuse et solitaire. Il passait souvent ses vacances dans la maison familiale de l'île de Campobello située au Canada. Grâce à de nombreux voyages en Europe, Roosevelt se familiarisa avec les langues allemande et française. Il reçut une éducation aristocratique, apprit à monter à cheval, pratiqua de nombreux sports comme le polo, l’aviron, le tennis et le tir.
À l'âge de quatorze ans, il entra dans un établissement privé et élitiste du Massachusetts, la Groton School. Pendant ses études, il fut influencé par son maître, le révérend Endicott Peabody, qui lui enseigna le devoir chrétien de charité et la notion de service pour le bien commun. En 1899, Franklin Roosevelt continua ses études d'abord à Harvard où il résida dans la luxueuse Adams House et obtint un diplôme de Bachelor of Arts. Il entra dans la fraternité Alpha Delta Phi et participa au journal étudiant The Harvard Crimson. Il perdit son père qui mourut en 1900. À cette époque, son cousin lointain et oncle par alliance Theodore Roosevelt accéda à la présidence des États-Unis et devint son modèle en politique. C'était le début de l'ère progressiste Progressive Era qui remodelait profondément le paysage politique américain, et c'est au sein du Parti démocrate qu'il entra en politique. Il appartenait aussi à la franc-maçonnerie et fut initié à New York le 11 octobre 1911.
En 1902, au cours d’une réception à la Maison-Blanche, Franklin Roosevelt fit la connaissance de sa future épouse Anna Eleanor Roosevelt, qui était aussi la nièce du Président Theodore Roosevelt. Eleanor et Franklin Roosevelt avaient un ancêtre commun, le Hollandais Claes Martenzen van Roosevelt, qui débarqua à la Nouvelle-Amsterdam future New York dans les années 1640. Ses deux petits-fils, Johannes et Jacobus, ont fondé les deux branches de la famille, celle de l’Oyster Bay et celle d’Hyde Park. Eleanor et Theodore Roosevelt descendaient de la branche aînée, alors que Franklin Roosevelt était issu de la branche cadette, celle de Jacobus. En 1904, Franklin Roosevelt entra à l’école de droit de l’université Columbia mais abandonna son cursus en 1907 sans diplôme. Il passa avec succès l’examen du barreau de l’État de New York et fut engagé dès 1908 dans un prestigieux cabinet d’affaires de Wall Street, la Carter Ledyard & Milburn.
Famille
Franklin et Eleanor Roosevelt en 1935.
Franklin Roosevelt épousa Eleanor le 17 mars 1905 à New York, malgré l’opposition de sa mère. Lors de la cérémonie, Theodore Roosevelt remplaçait le père défunt de la mariée, Elliott Roosevelt. Le jeune couple s’installa ensuite sur le domaine familial de Springwood à Hyde Park. Alors que Franklin était un homme charismatique et sociable, sa femme était à cette époque timide et se tenait à l’écart des mondanités pour élever ses enfants :
Anna Eleanor 1906 – 1975
James 1907 – 1991
Franklin Delano Jr. 3 mars 1909 – 7 novembre 1909
Elliott 1910 – 1990
Franklin Delano, Jr. 1914 – 1988
John Aspinwall 1916 – 1981
Franklin Roosevelt eut plusieurs aventures amoureuses pendant son mariage : il entretint dès 1914 une liaison avec la secrétaire de son épouse, Lucy Page Mercer Rutherfurd. En septembre 1918, Eleanor trouva la correspondance écrite des amants dans les affaires de son mari. Elle menaça ce dernier de demander le divorce. Sous la pression de sa mère et de sa femme, Roosevelt s’engagea à ne plus voir Lucy Mercer et le couple sauva les apparences. Eleanor s’établit dans une maison séparée à Valkill, tout en continuant à voir son époux.
Les enfants du couple ont eu quant à eux des existences tumultueuses : 19 mariages, 15 divorces et 22 enfants pour l’ensemble des cinq enfants. Les quatre fils ont participé à la Seconde Guerre mondiale comme officiers et ont été décorés pour leur bravoure au combat. Après le conflit, ils ont mené des carrières dans les affaires et la politique. Franklin Delano Roosevelt Jr. a représenté l’Upper West Side au Congrès pendant trois mandats et James Roosevelt pour le 26e district de Californie pendant six mandats.
Débuts politiques 1910-1920
Roosevelt n'aimait pas particulièrement sa carrière juridique et ne termina pas ses études de droit commencées à l'université Columbia. Il se tourna vers la politique à la première occasion. En 1910, il se présenta au poste de sénateur démocrate pour le 26e district de l’État de New York. Il fut élu et entra en fonction le 1er janvier 1911 au Sénat d’Albany. Il prit rapidement la tête d’un groupe parlementaire de réformistes qui s’opposait au clientélisme du Tammany Hall, la machine politique du Parti démocrate à New York. Roosevelt devint un personnage populaire parmi les démocrates de l'État et fut réélu le 5 novembre 1912 grâce au soutien du journaliste Louis Howe, avant de démissionner le 17 mars suivant. En 1914, il se présenta aux élections primaires pour le poste de sénateur mais fut battu par le candidat soutenu par le Tammany Hall, James W. Gerard.
En 1913, Roosevelt fut nommé secrétaire adjoint à la Marine par le président Woodrow Wilson et travailla pour Josephus Daniels, le secrétaire à la Marine des États-Unis. Entre 1913 et 1917, il s’employa à développer la marine américaine et fonda la United States Naval Reserve. Pendant la Première Guerre mondiale, Roosevelt fit preuve d’une attention particulière pour la marine et milita pour le développement des sous-marins. Afin de parer les attaques sous-marines allemandes contre les navires alliés, il appuya le projet d’installer un barrage de mines en mer du Nord, entre la Norvège et l’Écosse. En 1918, il inspecta les équipements navals américains en Grande-Bretagne et se rendit sur le front en France. Pendant sa visite, il rencontra Winston Churchill pour la première fois. Après l’armistice du 11 novembre 1918, il fut chargé de superviser la démobilisation et quitta son poste de secrétaire-adjoint à la Marine en juillet 1920.
En 1920, la convention nationale du Parti démocrate choisit Franklin Roosevelt comme candidat à la vice-présidence des États-Unis, aux côtés du gouverneur de l’Ohio James M. Cox. Dans un discours prononcé à Butte Montana le 18 août 1920, il mit en avant son rôle dans la rédaction de la constitution imposée à Haïti en 1915 : J’ai écrit moi-même la constitution de Haïti, et je pense que cette constitution est plutôt bonne. Le ticket Cox-Roosevelt fut battu par le républicain Warren Harding qui devint président. Après cet échec, il se retira de la politique et travailla à New York : il fut vice-président d’une société de vente par actions et directeur d’un cabinet d’avocats d’affaires.
Traversée du désert et maladie 1921-1928
En août 1921, pendant ses vacances à l'île Campobello, Roosevelt contracta une maladie que l’on pensait être à l’époque la poliomyélite. Il en résulta une paralysie de ses membres inférieurs : il avait alors 39 ans. Il ne se résigna jamais à accepter la maladie, fit preuve de courage et d’optimisme. Il essaya de nombreux traitements : en 1926, il acheta une propriété à Warm Springs en Géorgie, où il fonda un centre d’hydrothérapie pour les patients atteints de la poliomyélite, le Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation, qui est toujours en activité. Le jour de sa première investiture présidentielle, il reçut personnellement des enfants paralytiques. Pendant sa présidence, il participa à la création de la National Foundation for Infantile Paralysis. Roosevelt cacha la dégradation de son état de santé pour pouvoir être réélu. En public, il marchait avec des attelles orthopédiques ou une canne ; en privé, il se déplaçait en fauteuil roulant. Lors de ses apparitions publiques, il était soutenu par l’un de ses fils ou par un auxiliaire. Une étude de 2003 a démontré que Roosevelt n’était pas atteint par la poliomyélite mais par le syndrome de Guillain-Barré.
Roosevelt gouverneur de New York 1928-1932
Roosevelt prit bien soin de rester en relation avec le Parti démocrate et s’allia avec Alfred E. Smith, ancien gouverneur du New Jersey. Il se rapprocha du Tammany Hall et fut finalement élu gouverneur de l'État de New York à une courte majorité et dut cohabiter avec un Congrès à majorité républicaine.
Il prit sa charge de gouverneur en 1929 et entama aussitôt une politique novatrice et audacieuse pour l'époque : il agit en faveur des campagnes reboisement, conservation du sol, établit des programmes sociaux comme l'office temporaire des secours d'urgence Temporary Emergency Relief Administration qui accordait des aides financières directes aux chômeurs. Deux concepts forts, outre un remarquable pragmatisme, dominaient son action publique. Tout d'abord l'idée qu'il était souvent nécessaire de substituer la liberté collective à la liberté individuelle, mais aussi sa grande méfiance envers l'idée de concurrence sans contrainte la coopération doit intervenir là où cesse la concurrence et celle-ci peut être utile jusqu'à une certaine limite mais pas au-delà. C'est ainsi qu'il réduisit la durée du temps de travail pour les femmes et les enfants, lança un programme d'amélioration des hôpitaux, des prisons et renforça l'autorité publique.
Ses détracteurs l'accusèrent d'être socialiste, dans un sens péjoratif. Roosevelt fit en effet preuve d'une grande tolérance sur les thèmes de l'immigration et de la religion, tolérance qui se manifesta par ses réserves sur la politique des quotas, sur la prohibition et sur les querelles internes au Parti démocrate entre juifs, catholiques et protestants.
C'est à cette époque que Roosevelt commença à réunir une équipe de conseillers parmi lesquels Frances Perkins et Harry Hopkins, en prévision de son élection au poste de président. Le principal point faible de son mandat fut la corruption de la Tammany Hall à New York. Roosevelt fut réélu en 1930 contre le républicain Charles Egbert Tuttle pour un deuxième mandat de gouverneur de l'État de New York.
La même année, les Boy Scouts of America BSA lui décernèrent la plus haute distinction pour un adulte, la Silver Buffalo Award, en l’honneur de son engagement pour la jeunesse. Roosevelt soutint le premier Jamboree scout et devint président honoraire des BSA.
L'élection présidentielle de 1932
Roosevelt remplaça le catholique Alfred E. Smith à la tête du Parti démocrate de New York dès 1928. La popularité de Roosevelt dans l’État le plus peuplé de l’Union fit de lui un candidat potentiel à l'élection présidentielle de 1932. Ses adversaires à l'investiture, Albert Ritchie, le gouverneur du Maryland et W. H. Murray, celui de l'Oklahoma, étaient des personnalités locales et moins crédibles. John Nance Garner, candidat de l’aile conservatrice du Parti, renonça à la nomination en échange du poste de vice-président, charge qu’il assuma jusqu’en 1941. Roosevelt resta confronté à l'hostilité affichée du président du parti, John Raskob, mais reçut le soutien financier de William Randolph Hearst, de Joseph P. Kennedy, de William G. McAdoo et d’Henry Morgenthau.
L’élection présidentielle se déroula dans le contexte de la Grande Dépression et des nouvelles alliances politiques qui en découlaient. En 1932, Roosevelt avait récupéré physiquement de sa maladie, si ce n'est l'usage de ses jambes, et il n'hésita pas à se lancer dans une épuisante campagne électorale. Dans ses nombreux discours électoraux, Roosevelt s’attaqua aux échecs du président sortant Herbert Hoover et dénonça son incapacité à sortir le pays de la crise. Il s’adressa en particulier aux pauvres, aux travailleurs, aux minorités ethniques, aux citadins et aux Blancs du Sud en élaborant un programme qualifié de New Deal nouvelle donne : il avait prononcé cette expression lors de la Convention démocrate de Chicago le 2 juillet 1932. Il développa surtout les questions économiques et proposa une réduction de la bureaucratie et une abolition partielle de la Prohibition. Le programme de Roosevelt n'obéissait à aucune idéologie, bien qu'il fut d'inspiration social-démocrate et keynésienne, et n'était pas précis quant aux moyens qui devraient être mis en œuvre pour aider les Américains les plus pauvres.
Résultats électoraux de 1932.
La campagne de Roosevelt fut un succès pour plusieurs raisons. Tout d'abord le candidat fit preuve de pédagogie et sut convaincre les Américains par ses talents d’orateur. Il parcourut près de 50 000 kilomètres à travers tout le pays pour convaincre ses électeurs. De plus, Roosevelt avait mûri politiquement sous l'influence de personnalités comme Louis Howe, l'un de ses associés, ou Josephus Daniels, son ministre de tutelle à la Marine. Il ne faut pas négliger non plus le rôle des conseillers du gouverneur qu'il fut, tels Raymond Moley, Rexford Tugwell, Adolf Berle, tous les trois chercheurs et universitaires, généralement de Columbia, pressentis par Samuel Rosenman le rédacteur des discours de Roosevelt. Ces hommes, avec Bernard Baruch, un financier ancien chef du War Industries Board durant la Première Guerre mondiale, ou encore Harry Hopkins, son confident, qui constituèrent ensuite le célèbre « Brain Trust » du président. Mais le succès de Roosevelt fut surtout dû à l'extrême impopularité du président Hoover et de sa politique de laisser-faire ayant largement aggravé la crise de 1929.
Le 8 novembre 1932, Roosevelt recueillit 57 % des voix et le Collège électoral lui était favorable dans 42 États sur 48. Le Congrès était acquis au Parti démocrate. Les États de l’Ouest, du Sud et les zones rurales le plébiscitèrent. Les historiens et les politologues considèrent que les élections de 1932-1936 ont fondé une nouvelle coalition autour des démocrates et le 5e système de partis.
Le 15 février 1933, Roosevelt échappa à un attentat alors qu’il prononçait un discours impromptu depuis l'arrière de sa voiture décapotable à Bayfront Park à Miami en Floride. L’auteur des coups de feu était Joseph Zangara, anarchiste d’origine italienne dont les motivations étaient d’ordre personnel. Il fut condamné à 80 ans de réclusion, puis à la peine de mort, car le maire de Chicago Anton Cermak mourut des blessures reçues pendant l’attentat.
Présidence 1933-1945 Grande Dépression.
Lorsque Franklin Roosevelt prit ses fonctions de Président des États-Unis le 4 mars 1933, le pays était plongé dans une grave crise économique : 24,9 % de la population active, plus de 12 millions de personnes étaient alors au chômage et deux millions d’Américains étaient sans-abri. Entre 1930 et 1932, 773 établissements bancaires firent faillite. Le Glass-Steagall Act a ainsi permis de détruire les comptes spéculatifs, qui faisaient pression sur la société américaine. Lors de son discours inaugural, Roosevelt dénonça la responsabilité des banquiers et des financiers dans la crise ; il présenta son programme directement aux Américains par une série de discussions radiophoniques connues sous le nom de fireside chats causeries au coin du feu. Le premier cabinet de l'administration Roosevelt comprenait une femme pour la première fois de l'histoire politique américaine : il s'agissait de Frances Perkins, qui occupa le poste de secrétaire au Travail jusqu'en juin 1945.
Premier mandat 1933-1937 Le premier New Deal 1933-1934
L'aigle bleu, Blue Eagle, symbole de la NRA.
Au début de son mandat, Roosevelt prit de nombreuses mesures pour rassurer la population et redresser l’économie. Entre le 4 mars et le 16 juin, il proposa 15 nouvelles lois qui furent toutes votées par le Congrès. Le premier New Deal ne fut pas une politique socialiste et Roosevelt gouverna plutôt au centre. Entre le 9 mars et le 16 juin 1933, période de Cent Jours qui correspond à la durée de la session du Congrès américain, il fit passer un nombre record de projets de loi qui furent facilement adoptés grâce à la majorité démocrate, au soutien de sénateurs comme George Norris, Robert F. Wagner ou Hugo Black, mais aussi grâce à l’action de son Brain Trust, l'équipe de ses conseillers issus pour la plupart de l'université Columbia. Pour expliquer ces succès politiques, les historiens invoquent également la capacité de séduction de Roosevelt et son habileté à utiliser les médias.
Comme son prédécesseur Herbert Hoover, Roosevelt considérait que la crise économique résultait d’un manque de confiance qui se traduisait par une baisse de la consommation et de l’investissement. Il s’efforça donc d’afficher son optimisme. Au moment des faillites bancaires du 4 mars 1933, son discours d'investiture, entendu à la radio par quelque deux millions d'Américains, comportait cette déclaration restée célèbre : The only thing we have to fear is fear itself, la seule chose que nous ayons à craindre, c’est la crainte elle-même. Le jour suivant, le président décréta un congé pour les banques afin d’enrayer la panique causée par les faillites, et annonça un plan pour leur prochaine réouverture.
Le 9 mars 1933 passe l'Emergency Banking Act approximativement : Loi de secours bancaire au Congrès, suivi le 5 avril de l'Ordre exécutif présidentiel 6102 requérant des possesseurs de pièces d'or de le retourner au Trésor américain. En trente jours, un tiers de l'or en circulation est retourné au Trésor. Le 28 août le Président Roosevelt publie une autre ordonnance enjoignant à tout possesseur d'or d'enregistrer ses avoirs auprès du Trésor public.
Roosevelt poursuivit le programme de Hoover contre le chômage placé sous la responsabilité de la toute nouvelle Federal Emergency Relief Administration FERA. Il reprit également la Reconstruction Finance Corporation pour en faire une source majeure de financement des chemins de fer et de l’industrie. Parmi les nouvelles agences les plus appréciées de Roosevelt figurait le « corps de préservation civile Civilian Conservation Corps - CCC -, qui embaucha 250 000 jeunes chômeurs dans différents projets locaux. Le Congrès confia de nouveaux pouvoirs de régulation à la Federal Trade Commission et des prêts hypothécaires à des millions de fermiers et de propriétaires. En outre, le 19 avril, les États-Unis abandonnaient l’étalon-or, ce qui eut pour effet de relancer l’économie.
Les réformes économiques furent entreprises grâce au National Industrial Recovery Act NIRA de 1933. Cependant la cour suprême le déclara anticonstitutionnel par une décision du 27 mai 1935. Le NIRA établissait une planification économique, un salaire minimum et une baisse du temps de travail ramené à 36 heures hebdomadaires40. Le NIRA instaurait également plus de liberté pour les syndicats.
Roosevelt injecta d'énormes fonds publics dans l’économie : le NIRA dépensa ainsi 3,3 milliards de dollars par l’intermédiaire de la Public Works Administration sous la direction de Harold Ickes. Le Président travailla avec le sénateur républicain George Norris pour créer la plus grande entreprise industrielle gouvernementale de l’histoire américaine, la Tennessee Valley Authority TVA : celle-ci permit de construire des barrages et des stations hydroélectriques, de moderniser l’agriculture et d’améliorer les conditions de vie dans la vallée du Tennessee. En avril 1933, l'abrogation du Volstead Act qui définissait la prohibition, permit à l’État de lever de nouvelles taxes.
Roosevelt essaya de tenir ses engagements de campagne sur la réduction des dépenses publiques : mais il souleva l’opposition des vétérans de la Première Guerre mondiale en diminuant leurs pensions. Il fit des coupes sévères dans le budget des armées ; il baissa le salaire et le nombre des fonctionnaires par l'Economy Act le 20 mars 1933. Il réduisit également les dépenses dans l’éducation et la recherche.
Le relèvement de l’agriculture fut l’une des priorités de Roosevelt comme en témoigne le premier Agricultural Adjustment Administration AAA qui devait faire remonter les prix agricoles. Son action fut critiquée car elle imposait de détruire les récoltes alors qu'une partie de la population était mal nourrie. Par ailleurs, le Farm Credit Act fut voté pour réduire l'endettement des agriculteurs.
À la suite des rigueurs de l’hiver 1933-1934, la Civil Works Administration fut fondée et employa jusqu’à 4,5 millions de personnes ; l'agence engagea des travailleurs pour des activités très diverses telles que des fouilles archéologiques ou la réalisation de peintures murales. Malgré ses réussites, elle fut dissoute après l’hiver.
Le deuxième New Deal et le Welfare Staff.
À partir de 1934, la politique de Franklin Roosevelt s’orienta à gauche avec la création de l’État-providence Welfare State.
Les élections législatives de 1934 donnèrent à Roosevelt une large majorité aux deux chambres du Congrès. Le président put continuer ses réformes afin de relancer la consommation et de faire baisser le chômage. Cependant, le taux de chômage restait à un niveau très élevé 12,5 % en 1938. Le 6 mai 1934, le président crée l'Administration chargée de l'avancement des travaux Works Progress Administration, dirigée par Harry Hopkins. Elle employa jusqu'à 3,3 millions de personnes en 1938a 29 sur des chantiers divers : réalisation de routes, de ponts, de bâtiments publics… Les professeurs enseignaient la langue anglaise aux immigrants, les acteurs jouaient des pièces de théâtre jusque dans les petites villes, les peintres comme Jackson Pollock recevaient des commandes. L'Administration nationale de la jeunesse (National Youth Administration fut fondée en juin 1935 pour faire baisser le chômage des jeunes et les encourager à faire des études. L'Administration pour la réinstallation Resettlement Administration, créée en avril 1935, fut placée sous la direction de Rexford Tugwell pour réduire la pauvreté des agriculteurs. Elle fut remplacée par l'Administration pour la sécurité agricole Farm Security Administration en 1937.
Le 28 mai 1934, Roosevelt rencontra l’économiste anglais Keynesa 30, entrevue qui se passa mal, ce dernier estimant que le président américain ne comprenait rien à l'économie.
Le 6 juin 1934, le Securities Exchange Act permit la création de la Securities and Exchange Commission Commission des titres financiers et des bourses qui règlementait et contrôle les marchés financiers. Roosevelt nomma Joseph P. Kennedy, le père de John F. Kennedy, comme premier président de la SEC.
Le Social Security Act prévoyait pour la première fois à l’échelon fédéral la mise en place d’une sécurité sociale pour les retraités, les pauvres et les malades. La loi sur les retraites fut signée le 14 août 1935. Le financement devait reposer sur les cotisations des employeurs et des salariés pour ne pas accroître les dépenses de l'État fédéral.
Le sénateur Robert Wagner rédigea le Wagner Act, qui fut ensuite adopté sous le nom de National Labor Relations Act. Cette loi signée le 5 juillet 1935 établissait le droit au niveau fédéral pour les travailleurs d’organiser des syndicats, d’engager des négociations collectives. Elle fondait le Bureau national des relations au sein du travail National Labor Relations Board qui devait protéger les salariés contre les abus des employeurs. Le nombre de syndiqués augmenta fortement à partir de ce moment.
Le deuxième New Deal fut attaqué par des démagogues tels que le père Coughlin, Huey Long ou encore Francis Townsend. Mais il suscita également l’opposition des démocrates les plus conservateurs emmenés par Al Smith. Avec l’American Liberty League, ce dernier critiqua Roosevelt et le compara à Karl Marx et Lénine. Le 27 mai 1935, la Cour suprême des États-Unis s'opposa à l’une des lois du New Deal, donnant au gouvernement fédéral des pouvoirs sur les industriels. Elle décréta unanimement que le National Recovery Act NRA n'était pas constitutionnel car il donnait un pouvoir législatif au président. Ce fut un premier échec pour Roosevelt mais aussi pour le gouvernement fédéral face aux États et aux intérêts individuels. Le monde des affaires se montra également hostile au type de la Maison-Blanche. Enfin, Roosevelt était critiqué pour avoir creusé le déficit du budget fédéral, qui passa de 2,6 milliards de dollars en 1933 à 4,4 milliards de dollars en 1936.
Favorable à la retraite par répartition, Roosevelt déclara à un journaliste qui lui suggérait de financer les retraites par l’impôt : Je suppose que vous avez raison sur un plan économique, mais le financement n’est pas un problème économique. C’est une question purement politique. Nous avons instauré les prélèvements sur les salaires pour donner aux cotisants un droit légal, moral et politique de toucher leurs pensions …. Avec ces cotisations, aucun fichu politicien ne pourra jamais démanteler ma sécurité sociale.
Deuxième mandat 1937-1941 Réélection
Élection présidentielle américaine de 1936.
Après quatre ans de présidence, l'économie avait progressé mais restait encore fragile. En 1937, 7,7 millions d'Américains étaient au chômage soit 14 % de la population active. Aux élections présidentielles de novembre 1936, Roosevelt fut confronté à un candidat républicain sans réelle envergure, Alfred Landon, dont le parti était désuni. Il réussit à réunir sous sa bannière l'ensemble des forces opposées aux financiers, aux banquiers et aux spéculateurs imprudents . Cet ensemble électoral multi-ethnique, multi-religieux essentiellement urbain devint ensuite le réservoir de voix du Parti démocrate. Roosevelt fut réélu pour un deuxième mandat. Sa victoire écrasante dans 46 États sur 48, obtenue avec un écart de 11 millions de voix, contredisait tous les sondages et les prévisions de la presse. Elle indiquait un fort soutien populaire à sa politique de New Deal et se traduisit par une majorité démocrate dans les deux Chambres du Congrès.
Politique intérieure
Par rapport à la période de son premier mandat, peu de grandes législations furent adoptées lors du second mandat : ainsi l’United States Housing Authority qui faisait partie du New Deal 1937, un deuxième ajustement pour l’agriculture ainsi que le Fair Labor Standards Act FLSA de 1938 qui créa un salaire minimum. Lorsque l’économie se détériora à nouveau fin de l’année 1937, Roosevelt lança un programme agressif de stimulation de celle-ci en demandant au Congrès 5 milliards de dollars pour lancer des travaux publics dans le but de créer 3,3 millions d’emplois en 1938.
La Cour suprême des États-Unis était l’obstacle principal empêchant Roosevelt de réaliser ses programmes. Roosevelt étonna le Congrès en 1937 en proposant une loi lui offrant la possibilité de nommer cinq nouveaux magistrats. Cette demande fut accueillie par une large opposition comprenant même des membres de son propre parti dont le vice-président John Nance Garner car il semblait aller à l’encontre de la séparation des pouvoirs. Les propositions de Roosevelt furent ainsi rejetées. Des décès et des départs à la retraite de membres de la Cour suprême permirent néanmoins à Roosevelt de nommer assez rapidement de nouveaux magistrats avec peu de controverse. Entre 1937 et 1941, il nomma huit magistrats à la Cour suprême.
Le marché boursier connut une rechute dans l'été 1937, la production s'effondra et le chômage grimpa à 19 % de la population active en 1938. En 1938, le Président réagit en demandant une rallonge financière au Congrès, en présentant une loi sur l'aide au logement, en aidant les agriculteurs deuxième AAA en février 1938. Le 25 juin 1938 fut votée la loi sur les salaires et la durée du travail Fair Labor Standards Act. La durée hebdomadaire du travail fut abaissée à 44 heures puis à 40 heures .
Roosevelt obtint le soutien des communistes américains et de l’union des syndicats qui connaissaient alors une forte progression mais ceux-ci se séparèrent à la suite de querelles internes au sein de l'AFL et du CIO mené par John L. Lewis. Ces querelles affaiblirent le parti lors des élections de 1938 à 1946.
Oppositions
Le deuxième mandat de Roosevelt a été marqué par la montée des oppositions. Ces dernières s'exprimèrent d'abord dans les contre-pouvoirs, la Cour suprême et le Congrès, y compris dans les rangs démocrates, mais aussi dans les journaux où les caricatures et les éditoriaux n'hésitaient pas à critiquer l'action présidentielle. La presse fit état des scandales qui touchaient la famille du président. Les conservateurs l'accusaient d'être trop proche des communistes et attaquèrent la WPA. Les groupuscules et leaders fascistes tels que le Front chrétien du père Coughlin, lancèrent une croisade contre le Jew Deal mais qui trouva peu d'écho.
Déterminé à surmonter l’opposition conservatrice chez les démocrates du Congrès pour la plupart en provenance des États du Sud, Roosevelt s’impliqua lui-même lors des primaires de 1938 en apportant son soutien aux personnes favorables à la réforme du New Deal. Roosevelt ne réussit qu'à déstabiliser le démocrate conservateur de la ville de New York. Il dut préserver l'équilibre politique pour pouvoir conserver sa majorité et ménagea les Démocrates du Sud du pays en ne remettant pas en cause la ségrégation contre les Noirs.
Lors des élections de novembre 1938, les démocrates perdirent sept sièges au sénat et 71 sièges au Congrès. Les pertes se concentraient chez les démocrates favorables au New Deal. Lorsque le Congrès fut réuni en 1939, les républicains menés par le sénateur Robert Taft formèrent une coalition conservatrice avec les démocrates conservateurs du Sud du pays ce qui empêchait Roosevelt de transformer ses programmes en lois. La loi de 1938 sur le salaire minimum fut ainsi la dernière réforme du New Deal à être entérinée par le Congrès.
Lire la suite ->http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10167#forumpost10167
Posté le : 07/11/2015 23:15
Edité par Loriane sur 08-11-2015 19:00:06
|
|
|
|
|
Franklin Denlano Roosevelt 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Bilan du New Deal
Franklin Roosevelt utilisait souvent la radio pour expliquer sa politique aux Américains.L'efficacité du New Deal en matière économique reste discutée aujourd'hui, puisque cette politique visait au premier chef à lutter contre la crise et que celle-ci perdura jusqu’à ce que l’Amérique mobilise son économie pour la Seconde Guerre mondiale. Son succès fut en revanche indéniable au niveau social. La politique menée par le président Franklin Roosevelt a changé le pays par des réformes et non par la révolution.Sur le plan économique, la situation était meilleure qu'en 1933 qui avait constitué le moment le plus difficile de la crise : la production industrielle avait retrouvé son niveau de 1929. En prenant comme base 100 la situation de 1929, le PNB en prix constants était de 103 en 1939 pour le PNB/hab. Cependant, le chômage était toujours massif : 17 % de la population active américaine se trouvait au chômage en 1939 et touchait 9,5 millions de personnes. Ils recevaient une allocation chômage, ce qui représentait un progrès par rapport à l'avant New Deal. La population active avait augmenté de 3,7 millions de personnes entre 1933 et 1939.
Le New Deal inaugurait en outre une période d'interventionnisme étatique dans de nombreux secteurs de l'économie américaine : bien qu'il n'y avait pas eu de nationalisations comme dans la France du Front populaire, les agences fédérales avaient développé leurs activités, employé davantage de fonctionnaires issus de l'université. Ainsi, les mesures du New Deal ont posé les bases de la future superpuissance américaine. Sur le plan politique, le pouvoir exécutif et le cabinet présidentiel avaient renforcé leur influence, sans pour autant faire basculer le pays dans la dictature. Roosevelt avait su instaurer un lien direct avec le peuple, par les nombreuses conférences de presse qu'il avait tenues, mais aussi par l'utilisation de la radio causeries au coin du feu hebdomadaires et ses nombreux déplacements. Le New Deal a permis une démocratisation de la culture et la réconciliation des artistes avec la société. L'esprit du New Deal a imprégné le pays : le cinéma et la littérature s'intéressaient davantage aux pauvres et aux problèmes sociaux. La Works Projects Administration 1935 mit en route de nombreux projets dans le domaine des arts et de la littérature, en particulier les cinq programmes du fameux Federal One. La WPA permit la réalisation de 1 566 peintures nouvelles, 17 744 sculptures, 108 099 peintures à l’huile et de développer l'enseignement artistique. À la fin du New Deal, le bilan était mitigé : si les artistes américains avaient été soutenus par des fonds publics et avaient acquis une reconnaissance nationale, cette politique culturelle fut interrompue par la Seconde Guerre mondiale et la mort de Roosevelt en 1945.
Politique étrangère 1933-1941 Entre isolationnisme et interventionnisme
Lois des années 1930 sur la neutralité.
Le président Roosevelt accueille le président des Philippines Manuel Quezon, à Washington DC.
Entre l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et l'entrée en guerre des États-Unis, Roosevelt dut prendre position sur les différentes questions internationales en tenant compte du Congrès et de l'opinion américaine. Il fut partagé entre l'interventionnisme défini par le président Wilson et l'isolationnisme qui consistait à tenir son pays en dehors des affaires européennes. La politique étrangère de Roosevelt fit l'objet de nombreuses controverses.
Franklin Delano Roosevelt connaissait bien l'Europe, l'Amérique latine et la Chine. Au début de sa carrière politique, il fut d'abord partisan de l'interventionnisme et soucieux de l'influence américaine à l'étranger : dans les années 1920, il était favorable aux idées wilsonniennes. En 1933, il choisit comme secrétaire d'État Cordell Hull, qui s'oppose au protectionnisme économique et au repli des États-Unis. Le 16 novembre 1933, le gouvernement américain reconnut officiellement l’Union soviétique et établit des relations diplomatiques avec ce pays.
Cependant, Roosevelt changea rapidement de position sous la pression du Congrès, du pacifisme ou du nationalisme de l'opinion publique, et fit entrer les États-Unis dans une phase d'isolationnisme, tout en condamnant moralement les agressions des dictatures fascistes.
Politique de bon voisinage
Le président inaugura la politique de bon voisinage Good Neighboring policy avec l'Amérique latine et s'éloigna de la doctrine Monroe qui prévalait depuis 1823. En décembre 1933, il signa la convention de Montevideo sur les Droits et Devoirs des États, et renonça au droit d'ingérence unilatérale dans les affaires sud-américaines. En 1934, il fit abroger l'amendement Platt qui permettait à Washington d'intervenir dans les affaires intérieures de la République de Cuba. Les États-Unis abandonnaient le protectorat sur Cuba issu de la Guerre contre l’Espagne. La même année, les Marines quittèrent Haïti et le Congrès vota la transition vers l’indépendance des Philippines qui ne fut effective que le 4 juillet 1946. En 1936, le droit d'intervention au Panama fut aboli, mettant fin au protectorat américain sur ce pays.
La neutralité américaine
Face aux risques de guerre en Europe, Roosevelt eut une attitude qui a pu paraître ambiguë : il s'évertua officiellement à maintenir les États-Unis dans la neutralité, tout en faisant des discours qui laissaient entendre que le Président souhaitait aider les démocraties et les pays attaqués.
Le 31 août 1935, il signa la loi sur la neutralité Neutrality Act des États-Unis au moment de la seconde guerre italo-éthiopienne : elle interdisait les livraisons d'armes aux belligérants. Elle fut appliquée à la guerre entre l’Italie et l’Éthiopie, puis à la guerre civile en Espagne. Roosevelt désapprouvait cette décision car il estimait qu'elle pénalisait les pays agressés et qu'elle limitait le droit du Président américain d'aider les États amis. La loi de neutralité fut reconduite avec davantage de restrictions le 29 février 1936 interdiction des prêts aux belligérants et le 1er mai 1937 clause Cash and Carry - payé – emporté- qui autorisait les clients à venir chercher eux-mêmes les marchandises aux États-Unis et à les payer comptant. En janvier 1935, Roosevelt proposa que les États-Unis participassent au Tribunal permanent de justice internationale ; le Sénat, pourtant majoritairement démocrate, refusa d'y engager le pays.
Face à l'isolationnisme du Congrès et à sa propre volonté d'intervenir qui brouillaient la politique étrangère américaine, Roosevelt déclara : Les États-Unis sont neutres, mais personne n'oblige les citoyens à être neutres. En effet, des milliers de volontaires américains ont participé à la guerre d'Espagne 1936-1939 contre les franquistes dans la brigade Abraham Lincoln; d'autres se sont battus en Chine dans l'American Volunteer Group qui formaient les Les Tigres volants de Claire Chennault et plus tard les volontaires de la Eagle Squadron au sein de la RAF dans la bataille d'Angleterre. Lorsque la guerre sino-japonaise 1937-1945 se déclencha en 1937, l’opinion publique favorable à la Chine permit à Roosevelt d’aider ce pays de plusieurs façons.
Préparation à la guerre
Le 5 octobre 1937 à Chicago, Roosevelt prononça un discours en faveur de la mise en quarantaine de tous les pays agresseurs qui seraient traités comme une menace pour la santé publique. En décembre 1937, au moment du massacre de Nankin en Chine, les avions japonais coulèrent la canonnière américaine Panay sur le Yang-tseu-Kiang. Washington obtint des excuses mais la tension monta rapidement entre les États-Unis et l'Empire du Soleil Levant. En mai 1938, le Congrès vota des crédits pour le réarmement. Le président américain fit publiquement part de son indignation face aux persécutions antisémites en Allemagne Nuit de Cristal, 1938. Il rappela son ambassadeur à Berlin sans fermer la représentation diplomatique64. À partir de 1938, l'opinion américaine se rendit progressivement compte que la guerre était inévitable et que les États-Unis devraient y participer. Roosevelt prépara dès lors le pays à la guerre, sans entrer directement dans le conflit. Ainsi, il lança en secret la construction de sous-marins à long rayon d’action qui auraient pu bloquer l’expansionnisme du Japon.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale se déclencha en septembre 1939, Roosevelt rejeta la proposition de neutralité du pays et chercha des moyens pour aider les pays alliés d’Europe. Il fit du 11 octobre 1939 le Pulaski Day en soutien des Polonais. Le 4 novembre 1939, Roosevelt obtint l'abrogation de l'embargo automatique sur les armes et les munitions. Il commença aussi une correspondance secrète avec Winston Churchill pour déterminer le soutien américain au Royaume-Uni.
Roosevelt se tourna vers Harry Hopkins qui devint son conseiller en chef en temps de guerre. Ils trouvèrent des solutions innovantes pour aider le Royaume-Uni comme l’envoi de moyens financiers à la fin de 1940. Le Congrès se ravisa petit à petit en faveur d’une aide aux pays attaqués et c’est ainsi qu’il alloua une aide en armements de 50 milliards de dollars à différents pays dont la République de Chine et la Russie entre 1941 et 1945. Contrairement à la Première Guerre mondiale, ces aides ne devaient pas être remboursées après la guerre. Toute sa vie, un des souhaits de Roosevelt était de voir la fin du colonialisme européen. Il se forgea d’excellentes relations avec Churchill qui devint Premier ministre du Royaume-Uni en mai 1940.
Au mois de mai 1940, l’Allemagne nazie envahit le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, et la France en laissant seul le Royaume-Uni face au danger d’une invasion allemande. Très vite, on se mit d’accord pour agrandir l’enveloppe des dépenses pour l’aide aux pays attaqués en sachant que le pays risquait d’entrer en guerre contre l'Allemagne à cause de cette aide. Roosevelt mit au pouvoir deux chefs républicains Henry L. Stimson et Frank Knox comme secrétaire de guerre et secrétaire de la Navy. La chute de Paris choqua l’opinion américaine et le sentiment d'isolationnisme tomba. Tout le monde se mit d’accord pour renforcer l’armée américaine mais certaines réticences à l’entrée en guerre eurent la dent dure encore un moment. Roosevelt demanda au Congrès de faire la première conscription de troupes en temps de paix du pays en septembre 1940. Il recommença en 1941. Roosevelt usa de son charisme pour que le public fût favorable à une intervention militaire du pays. Le pays devait devenir l’arsenal de la démocratie. Au mois d’août 1940, Roosevelt viola ouvertement l’acte de neutralité avec l’accord Destroyers for Bases Agreement qui devait donner 50 bateaux destroyers des États-Unis au Royaume-Uni en échange de terres appartenant à ce pays dans les Caraïbes. Cet acte fut précurseur des aides massives qui suivirent en mars 1941 envers le Royaume-Uni, la Chine et la Russie.
Le 29 décembre 1940, Roosevelt évoqua dans un discours radiodiffusé la conversion de l'économie américaine pour l'effort de guerre : le pays devait devenir l'arsenal de la démocratie The Arsenal of Democracy. Le 6 janvier 1941, il prononça son discours sur les Quatre libertés présentées comme fondamentales dans son discours sur l'état de l'Union : la liberté d'expression, de religion, de vivre à l'abri du besoin et de la peur. Le lendemain, le président créa le Bureau de la gestion de la production Office of Production Management ; d'autres organismes furent fondés par la suite pour coordonner les politiques : Bureau de l’administration des prix et des approvisionnements civils Office of Price Administration and Civilian Supply, Bureau des priorités d’approvisionnement et des allocations Supplies Priorities and Allocation Board dès 1941 ; Service de la mobilisation de guerre Office of War Mobilization en mai 1943. Le gouvernement fédéral renforça ainsi ses prérogatives ce qui suscita des réactions parmi les Républicains, mais aussi dans le propre camp de Roosevelt : ainsi, en août 1941, le sénateur démocrate Harry Truman rendit un rapport sur les gaspillages de l'État fédéral.
Le programme Lend-Lease programme prêt-bail en français devait fournir les Alliés en matériel de guerre sans intervenir directement dans le conflit. La loi Lend-Lease fut signée le 11 mars 1941 et autorisa le Président des États-Unis à vendre, céder, échanger, louer, ou doter par d'autres moyens tout matériel de défense à tout gouvernement dont le Président estime la défense vitale à la défense des États-Unis.
Le 7 juillet 1941, Washington envoya quelque 7 000 marines en Islande pour empêcher une invasion allemande. Les convois de matériel à destination de l’Angleterre furent escortés par les forces américaines.
En août 1941, Roosevelt rencontra le Premier Ministre britannique Winston Churchill lors de la conférence de l'Atlantique, tenue à bord d'un navire de guerre au large de Terre-Neuve. Les deux hommes signèrent la Charte de l'Atlantique le 14 août 1941, qui reprenait et complétait le Discours des quatre libertés de Roosevelt, entreprend de jeter les fondements d'une nouvelle politique internationale.
Le 11 septembre 1941, Roosevelt ordonna à son aviation d’attaquer les navires de l’Axe surpris dans les eaux territoriales américaines. Cinq jours plus tard, le service militaire obligatoire en temps de paix était instauré. Le 27 octobre 1941, après le torpillage de deux navires de guerre américains par des sous-marins allemands, Roosevelt déclara que les États-Unis avaient été attaqués. À la différence de la Première Guerre mondiale, les États-Unis avaient eu le temps de se préparer au conflit. Il ne restait qu'à attendre l'étincelle qui déclencherait l'entrée en guerre : elle vint du Japon et non de l'Allemagne nazie comme le pensait Roosevelt.
L'attaque japonaise et l'entrée en guerre Attaque de Pearl Harbor.
Roosevelt s'adresse au Congrès américain le 8 décembre 1941.Le président américain Roosevelt signant la déclaration de guerre contre le Japon.
Le 26 juillet 1941 les forces militaires philippines, encore sous contrôle américain, furent nationalisées et le général Douglas MacArthur fut nommé responsable du théâtre Pacifique. Les relations avec le Japon commençaient à se détériorer.
En mai 1941, Washington accorda son soutien à la Chine par l’octroi d’un prêt-bail. À la suite du refus du Japon de se retirer de l'Indochine et de la Chine, à l'exclusion du Manchukuo, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas décrétèrent l’embargo complet sur le pétrole et l’acier ainsi que le gel des avoirs japonais sur le sol américain.
Le 7 décembre 1941, les forces japonaises bombardèrent Pearl Harbor à Hawaii, la plus grande base navale américaine dans l'océan Pacifique. L'attaque fit 2 403 morts et 1 178 blessés68. De nombreux navires et avions de guerre furent anéantis. Les forces japonaises attaquèrent aussi ce même jour non seulement Hong-Hong et la Malaisie, mais aussi Guam, les îles de Wake et des Philippines. Au matin du 8 décembre, les Japonais lancèrent aussi une attaque contre Midway.
Les Japonais firent une déclaration de guerre officielle mais à cause de divers contretemps, elle ne fut présentée qu'après l'attaque. Le 8 décembre 1941, le président Roosevelt déclara à la radio : Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera dans l'Histoire comme un jour d’infamie, les États-Unis ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'empire du Japon.
Le Congrès américain déclara la guerre au Japon à la quasi unanimité et Roosevelt signa la déclaration le jour même. Le 11 décembre, l’Allemagne et l’Italie déclaraient la guerre aux États-Unis.
Avec la loi sur la conscription du 20 décembre 1941, la mobilisation s'élargit à tous les Américains entre 20 et 40 ans. Le 22 décembre 1941 débuta la conférence Arcadia au cours de laquelle Churchill et Roosevelt décidèrent d'unir leurs forces contre l'Allemagne nazie. La Déclaration des Nations unies du 1er janvier 1942 prévoyait la création de l'ONU. L'entrée en guerre des États-Unis marquait un tournant dans la mondialisation du conflit.
Une thèse controversée affirme que Roosevelt était au courant de l'attaque sur Pearl-Harbor et qu'il laissa faire pour provoquer l'indignation de la population et faire entrer son pays dans la guerre. Cette théorie fut d'abord avancée par les officiers déchus par les commissions d'enquête : Husband Kimmel se dit victime d'un complot visant à cacher la responsabilité du gouvernement et de l'état-major. Il diffusa cette idée dans ses Mémoires parues en 1955. Cette thèse fut ensuite reprise par les adversaires de Roosevelt et de sa politique extérieure. Plus tard, plusieurs historiens américains, tels que Charles Beard et Charles Tansill ont essayé de prouver l'implication du président.
Les faits cités à l'appui de cette théorie sont notamment l'absence supposée providentielle des trois porte-avions en manœuvre le jour de l'attaque et qui ne furent donc pas touchés, le fait que les nombreux messages d'avertissement aient été ignorés et enfin les négligences locales. Certains soupçonnent le gouvernement américain d'avoir tout fait pour ne recevoir la déclaration de guerre japonaise qu'après le bombardement. Les partisans de cette thèse sont convaincus que Roosevelt a poussé les Japonais à la guerre tout au long des années 1930 afin de convaincre le peuple américain partisan de la neutralité.
Il est cependant difficile d'imaginer que Roosevelt ait laissé détruire autant de bâtiments de la marine juste pour engager son pays dans la guerre. En effet, la valeur tactique des porte-avions était méconnue en 1941, même si d'évidence, compte tenu des investissements réalisés, les Japonais et les Américains fondaient de gros espoirs sur cette nouvelle unité marine. C'était encore le cuirassé qui faisait figure de navire principal dans les flottes de guerre et même l'amiral Yamamoto envisageait la confrontation finale entre les deux pays sous la forme d'un combat entre cuirassés. Dès lors, tout officier au courant de l'attaque aurait fait en sorte de protéger les cuirassés qui seraient alors partis au large en sacrifiant les porte-avions.
Par conséquent, rien ne permet d’affirmer que Roosevelt était au courant de l'attaque de Pearl Harbor, même s'il fait peu de doute qu'il a accumulé les actes contraires à la neutralité durant les années 1930. Cependant, les sanctions économiques visaient avant tout les Allemands75 et le président américain donnait la priorité au théâtre d’opérations européen comme le montre par exemple la conférence Arcadia, et la guerre contre le Japon ne fut jamais sa priorité.
Si Roosevelt et son entourage étaient conscients des risques de guerre provoqués par la politique de soutien au Royaume-Uni, à l'URSS et à la Chine, il n'y a pas d'indication qu'il ait souhaité l'attaque de Pearl Harbor. Le désastre fut provoqué par la préparation minutieuse des Japonais, par une série de négligences locales et par des circonstances particulièrement défavorables aux Américains.
Troisième et quatrième mandats 1941-1945 Les élections de 1940
Élection présidentielle américaine de 1940 et Élection présidentielle américaine de 1944.
La tradition d'une limite maximale de deux mandats présidentiels était une règle non écrite mais bien ancrée depuis que George Washington déclina son troisième mandat en 1796. C'est ainsi que Ulysses S. Grant et Theodore Roosevelt furent attaqués pour avoir essayé d'obtenir un troisième mandat non consécutif de président. Franklin Delano Roosevelt coupa pourtant l'herbe sous les pieds des secrétaires d'État Cordell Hull et James Farley lors de l'investiture démocrate aux nouvelles élections. Roosevelt se déplaça dans une convention de Chicago où il reçut un fervent soutien de son parti. L'opposition à FDR était mal organisée malgré les efforts de James Farley. Lors du meeting, Roosevelt expliqua qu'il ne se présenterait plus aux élections sauf s'il était plébiscité par les délégués du parti qui étaient libres de voter pour qui ils souhaitaient. Les délégués furent étonnés un moment mais ensuite la salle cria Nous voulons Roosevelt... Le monde veut Roosevelt ! Les délégués s'enflammèrent et le président sortant fut nommé par 946 voix contre 147. Le nouveau nommé pour la vice-présidence était Henry A. Wallace, un intellectuel qui devint plus tard secrétaire à l'Agriculture.
Le candidat républicain, Wendell Willkie, était un ancien membre du Parti démocrate qui avait auparavant soutenu Roosevelt. Son programme électoral n'était pas véritablement différent de celui de son adversaire. Dans sa campagne électorale, Roosevelt mit en avant son expérience au pouvoira 62 et son intention de tout faire pour que les États-Unis restent à l'écart de la guerre. Roosevelt remporta ainsi l'élection présidentielle de 1940 avec 55 % des votes et une différence de 5 millions de suffrages. Il obtint la majorité dans 38 des 48 états du pays à l'époque. Un déplacement à gauche de la politique du pays se fit sentir dans l'administration à la suite de la nomination de Henry A. Wallace comme vice-président en lieu et place du conservateur texan John Nance Garner qui était devenu un ennemi de Roosevelt après 1937. Le 27 juin 1941, pour la première fois peut-être depuis la fin de la guerre de sécession, une mesure fédérale d'interdiction de la ségrégation raciale fut promulguée. Mais elle concernait seulement l'emploi dans l'industrie de la défense.
Roosevelt dans la guerre 1941-1945
Si dans les institutions américaines, le président est le chef des armées, Roosevelt ne se passionnait pas pour les affaires strictement militaires. Il délégua cette tâche et plaça sa confiance dans son entourage, en particulier George Marshall et Ernest King. Une agence unique de renseignements fut mise en place en 1942 Office of Strategic Services qui fut remplacée par la CIA en 1947. Le président créa par la suite l’Office of War Information Bureau de l’information de guerre qui mit en place une propagande de guerre et surveilla la production cinématographique. Il autorisa le FBI à utiliser les écoutes téléphoniques pour démasquer les espions. Le 6 janvier 1942, Roosevelt annonça un programme de la Victoire Victory Program qui prévoyait un effort de guerre important construction de chars, avions.
Enfin, Roosevelt s'intéressa au projet Manhattan pour fabriquer la bombe atomique. En 1939, il fut averti par une lettre d'Albert Einstein que l'Allemagne nazie travaillait sur un projet équivalent. La décision de produire la bombe fut prise en secret en décembre 1942. En août 1943 fut signé l'Accord de Québec, un accord anglo-américain de coopération atomique. Selon le secrétaire à la Guerre Henry Stimson, Roosevelt n’a jamais hésité sur la nécessité de la bombe atomique. Mais ce fut son successeur Harry Truman qui prit l'initiative des bombardements nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki, plusieurs mois après la mort de Roosevelt.
La question juive
Dès avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt avait dénoncé l’oppression et les lois de Nuremberg. Pourtant, il considérait également qu'il ne pouvait intervenir directement dans les affaires internes de l'Allemagne. Il ne fit pas pression sur le Congrès pour augmenter l'accueil des réfugiés juifs. Pendant la guerre, le président américain n'a pas cherché à aider les Juifs d'Europe, considérant que le principal objectif devait être l'écrasement du régime nazi. Malgré la pression des Juifs américains, de sa femme et de l'opinion publique américaine, le président ne dévia pas de cette direction. Il ne fut pas mis au courant des projets de bombardements d’Auschwitz ou des voies ferrées.
Roosevelt et ses alliés Conférences inter-alliées.
Conférence de Téhéran, 1943 : Staline, Roosevelt et Churchill.Conférence de Yalta, 1945.
Roosevelt fut l'un des principaux acteurs des conférences inter-alliées et tenta d'y défendre les intérêts des États-Unis tout en faisant des compromis. En 1942, il donna la priorité au front européen tout en contenant l'avancée japonaise dans le Pacifique. Il subit la pression de Staline qui réclamait l'ouverture d'un second front à l'ouest de l'Europe, alors que Churchill n'y était pas favorable et préférait la mise en œuvre d'une stratégie périphérique.
Roosevelt eut le grand mérite, bien que l'implication de son pays dans cette guerre ait résulté avant tout de l'attaque japonaise, d'orienter prioritairement la riposte américaine en direction de l'Europe, une fois le conflit équilibré sur le front du Pacifique par la victoire aéronavale des Îles Midway.
Son évaluation à sa juste mesure de l'énormité du danger hitlérien et de la nécessité d'empêcher l'URSS de sombrer justifiait certes ce choix. Mais il dut néanmoins pour l'imposer surmonter les préférences post-isolationnistes de la majorité des Américains pour lesquels l'ennemi principal était le Japon. C'est ainsi que fut mise sur pied une vigoureuse entrée en ligne des États-Unis aux côtés des Britanniques, d'abord vers l'Afrique du Nord par l'opération Torch, puis vers l'Europe par les débarquements successifs en Italie et en France.
À la conférence d'Anfa Casablanca, janvier 1943, Roosevelt obtint d'exiger la reddition sans condition des puissances de l'Axe. Les Alliés décidèrent d'envahir l'Italie. Les 11-24 août 1943, Roosevelt et Churchill se rencontrèrent au Canada pour préparer le débarquement en France prévu au printemps 1944. Au cours de la conférence de Téhéran novembre 1943, plusieurs décisions majeures furent prises : organisation d'un débarquement en Normandie, rejet par Staline et Roosevelt du projet britannique d’offensive par la Méditerranée et les Balkans. Sur le plan politique, Staline accepta le principe de la création d'une organisation internationale, proposé par Roosevelt. Les Trois Grands s'entendirent également sur le principe d'un démembrement de l’Allemagne. Ils ne fixèrent pas précisément les nouvelles frontières de la Pologne, car Roosevelt ne voulait pas heurter les millions d'Américains d’origine polonaise. Entre le 1er et le 22 juillet 1944, les représentants de 44 nations se réunirent à Bretton Woods et créèrent la Banque mondiale et le FMI Fonds monétaire international. La politique monétaire de l’après-guerre fut fortement affectée par cette décision. À la conférence de Dumbarton Oaks août-octobre 1944, Roosevelt réussit à imposer un projet auquel il tenait beaucoup : les Nations unies.
Ce fut à l'initiative de Roosevelt que se tint de la conférence de Yalta en février 1945. Le président arriva dans la station balnéaire de Crimée très fatigué et malade. Il dut faire d'importantes concessions à l'URSS car il avait besoin de Moscou pour vaincre les Japonais. Roosevelt faisait alors confiance à Staline. Si je lui donne i. e. à Staline, estima-t-il, tout ce qu'il me sera possible de donner sans rien réclamer en échange, noblesse oblige, il ne tentera pas d'annexer quoi que ce soit et travaillera à bâtir un monde de démocratie et de paix.
Les Alliés reparlèrent également de l'ONU et fixèrent le droit de veto du conseil de sécurité, le projet auquel tenait beaucoup Roosevelt. Ils s'entendirent sur la tenue d'élections libres dans les États européens libérés, l’entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon après la défaite de l'Allemagne, la division de l'Allemagne en zones d'occupation, le déplacement de la Pologne vers l'ouest.
Après la conférence de Yalta, Roosevelt s'envola pour l'Égypte et rencontra le roi Farouk ainsi que l'empereur d'Éthiopie Hailé Sélassié Ier à bord de l'USS Quincy. Le 14 février, il s'entretint avec le roi Abdulaziz, fondateur de l'Arabie saoudite.
Roosevelt et la France
De la situation complexe de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt écrivit à Churchill qu'elle était leur « mal de tête commun. Sa politique étrangère fut largement contestée et soumise aux pressions du département d'État et par ses diplomates Leahy et Murphy. Dans un premier temps, le président américain qui n'aimait guère la France garda des contacts diplomatiques avec l'État français : il pensait ainsi éviter que la flotte française ne tombât aux mains du Troisième Reich et avoir des renseignements sur la France. Il refusait en outre de reconnaître l'autorité et la légitimité du général de Gaulle auquel il vouait une antipathie personnell. Au début de 1942, il s'opposait à ce que la France libre participât aux Nations unies avant les élections en France. Dès 1941 pourtant, une partie des Américains protesta contre la complaisance du Département d’État envers le régime de Vichy. La presse américaine était par ailleurs favorable à la France libre.
Mais en avril 1942, le retour de Laval au pouvoir entraîna le départ de l'ambassadeur américain. Washington ouvrit alors un consulat à Brazzaville. Mais la méfiance vis-à-vis de De Gaulle ne se dissipa pas : pour le département d’État, le personnage n'était qu' apprenti-dictateur et Roosevelt était persuadé que les gaullistes divulgueraient les opérations secrètes des armées alliées. Roosevelt soutint successivement l'amiral Darlan, puis le général Giraud, malgré leur maintien des lois vichystes en Afrique libérée, et il tenta de bloquer l'action du Comité français de la Libération nationale d'Alger, puis de placer la France libérée sous occupation militaire américaine AMGOT.
De Gaulle ne fut mis au courant du débarquement en Normandie qu'à la dernière minute. Roosevelt ne reconnut le GPRF qu'en octobre 1944. La France ne fut pas invitée à la conférence de Yalta. Churchill insistait pour que la France fût responsable d'une zone d'occupation de l'Allemagne. Mais le président américain se rendit compte finalement que De Gaulle était l'homme qui pouvait contrer la menace communiste en France. Profondément anticolonialiste avec un bémol pour l'Empire britannique, il souhaitait que l'Indochine française fût placée sous la tutelle des Nations unies, après avoir un temps proposé à Tchang Kaï-chek de l'envahir, mais il dut finalement abandonner cette idée sous la pression du département d'État, des Britanniques et du général de Gaulle.
Les États-Unis pendant la guerre
Sur le plan économique, Roosevelt prit des mesures contre l'inflation et pour l'effort de guerre. Dès le printemps 1942, il fit accepter la loi du General Maximum visant à augmenter l'impôt sur le revenu, à bloquer les salaires et les prix agricoles pour limiter l'inflation. Cette politique fiscale fut renforcée par le Revenue Act en octobre 1942. La conversion de l'économie se fit rapidement : entre décembre 1941 et juin 1944, les États-Unis produisirent 171 257 avions et 1 200 navires de guerre, ce qui entraîna la croissance du complexe militaro-industriel. Cependant, les produits de consommation courante et d'alimentation furent insuffisants, sans que la situation fût aussi difficile qu'en Europea 84. Une économie mixte, alliant capitalisme et intervention de l'État fut mise en place pour répondre aux nécessités de la guerre. Sur le plan social, les campagnes connurent un exode rural et une surproduction agricole. Les Afro-américains du Sud migrèrent vers les centres urbains et industriels du Nord-Est. Dans le monde ouvrier, la période fut agitée par de nombreuses grèves à cause du gel des salaires et de l'augmentation de la durée du travail. Le chômage baissa à cause de la mobilisation et le taux d'emploi des femmes progressa.
Les discriminations à l'égard des Afro-américains persistèrent jusqu'au sein de l'armée, ce qui explique l'ordre exécutif 8802 qui les interdisaient dans les usines de défense nationale. Après l'attaque de Pearl Harbor, le sentiment antijaponais aux États-Unis prit de l'ampleur. Dans ce contexte, 110 000 Japonais et citoyens américains d'origine japonaise88 furent rassemblés et surveillés dans des camps d'internement War Relocation Centers. Le 14 janvier 1942, Roosevelt signa un décret de fichage des Américains d’origine italienne, allemande et japonaise soupçonnés d'intelligence avec l’Axe. Le décret présidentiel 9066 du 19 février 1942 fut promulgué par Roosevelt et concerna l'ouest du pays où se concentraient les populations japonaises, regroupés dans des camps surveillés.
Le 7 novembre 1944, Franklin Roosevelt se présenta à la Présidence avec le soutien de la quasi-totalité de son parti. Il fut de nouveau opposé à un candidat républicain, Thomas Dewey, dont le programme n'était pas en contradiction totale avec la politique de Roosevelt. Ce dernier, malgré son âge et sa fatigue, mena campagne en demandant aux Américains de ne pas changer de pilote au milieu du gué. Roosevelt fut réélu pour un quatrième mandat avec une courte majorité de 53 %51 25 602 505 voix mais plus de 80 % du vote du collège électoral 432 mandats.
Mort de Roosevelt
Lors de son discours devant le congrès le 1er mars 1945, Roosevelt apparut amaigri et vieilli ; il partit pour Warm Springs le 30 mars pour prendre du repos avant la conférence des Nations Unies. Le 12 avril 1945, il s'écroula se plaignant d'un terrible mal de tête alors qu'Elizabeth Shoumatoff était en train de peindre son portrait. Il mourut à 15h35 à l'âge de 63 ans d'une hémorragie cérébrale.
Lucy Mercer Rutherfurd, l'ancienne maîtresse du président, était présente aux côtés de Roosevelt et partit rapidement pour éviter le scandale. Eleanor Roosevelt prit le premier avion pour se rendre à Warm Springs. Le corps du président fut transporté en train jusqu'à la capitale : des milliers de personnes, notamment des Afro-américains, se rassemblèrent le long de la voie ferrée pour lui rendre hommage. Le cercueil fut déposé à la Maison-Blanche puis dans la maison familiale de Hyde Park. Les fils de Franklin Roosevelt étant mobilisés, ils ne purent assister à la cérémonie funèbre sauf Elliott. Le président fut enterré au Franklin D. Roosevelt National Historic Site le 15 avril 1945.
La mort de Roosevelt souleva une grande émotion dans le pays et à l'étranger. Son état de santé avait été caché par son entourage et par les médecins de la Maison-Blanche. Roosevelt était président depuis plus de 12 ans, une longévité jamais égalée par aucun président américain. En URSS, le drapeau soviétique fut bordé de noir et les dignitaires assistèrent à la cérémonie à l’ambassade. Staline pensait que le président américain avait été empoisonné. Le président du conseil italien décréta trois jours de deuil. En Allemagne, la nouvelle rendit Goebbels joyeux, et on ne connaît pas la réaction d’Hitler.
Conformément à la constitution américaine, le vice-président Harry Truman devint le 33e président des États-Unis alors qu'il avait été tenu à l’écart des décisions politiques et qu'il ne s'était pas rendu à Yalta. Truman dédia la cérémonie du 8 mai 1945 à la mémoire de Roosevelt.
Caractère
Les traits principaux du caractère de Roosevelt apparaissent dès l'époque de sa première campagne présidentielle : son optimisme, notamment face à la gravité de sa maladie puisqu'il avait la volonté de s'en remettre ; également son exigence vis-à-vis de lui-même comme de ses collaborateurs. Son optimisme se nourrissait également de sa foi puisqu'il était profondément religieux. L'un de ses films préférés était Gabriel over the White House de Gregory La Cava 1933 qu'il se faisait projeter à la Maison-Blanche. Côté distractions, il appréciait peu le théâtre et collectionnait les timbres-poste.
Roosevelt était quelqu'un d'intuitif, de chaleureux et même charmeur, toujours souriant et sachant désarmer les critiques par l'humour1. Roosevelt était doué pour la communication et même capable d'éloquence, moins en meeting qu'en petits comités d'où l'incontestable succès de ses causeries au coin du feu fireside chat dans lesquelles il s'adressait de façon simple et directe aux Américains. En 1939, Roosevelt devint le premier président à apparaître à la télévision. Il utilisa aussi beaucoup la radio. Avec sa voix chaude et mélodieuse, il savait s'adresser au public ainsi qu'aux journalistes.
Il se souciait réellement des Américains les plus défavorisés et était sensible aux injustices et à l'oppression sous toutes ses formes. Sur ce plan, il bénéficia de la popularité de sa femme. Mais Roosevelt pouvait être également un politique hésitant, un tacticien manipulateur, capable de ne pas s'embarrasser de sentiments pour parvenir à ses fins, souvent secret, égoïste et attaché à son indépendance. Son Secrétaire à l'Intérieur, Harold Ickes lui dit un jour : Vous êtes quelqu'un de merveilleux, mais vous êtes un homme avec lequel il est difficile de travailler. … Vous ne parlez jamais franchement même avec les gens qui vous sont dévoués et dont vous connaissez la loyauté.
Franklin Roosevelt avait le souci de l'opinion publique : il s'intéressa d'ailleurs aux sondages de l'Institut Gallup. Devenu président des États-Unis, ses décisions étaient motivées par un souci de pragmatisme et le respect scrupuleux de la démocratie, motif de sa méfiance à l'égard de De Gaulle.
Héritage et hommages
Selon un classement dressé par des historiens pour le magazine The Atlantic Monthly, il est le troisième Américain le plus influent de l'Histoire, derrière Lincoln et Washington. Cependant, Roosevelt est considéré comme le plus grand président américain du XXe siècle. Il modernisa les institutions américaines : il fit voter le XXe amendement en 1933 qui avançait l'entrée en fonction du président nouvellement élu de début mars au 21 janvier. Il renforça le pouvoir exécutif en le personnalisant et en le faisant entrer dans l'ère de la technostructure : le nombre de fonctionnaires augmenta de façon très importante. L'héritage de Roosevelt a été considérable sur la vie politique américaine : il consacra la fin de l’isolationnisme, la défense des libertés et le statut de superpuissance des États-Unis. Mais Roosevelt fut également très contesté à la fois par les républicains et la Nouvelle Gauche américaine qui estimait que le New Deal n'avait pas été assez loin. Roosevelt resta un modèle dans la deuxième moitié du XXe siècle. Eleanor Roosevelt continua d'exercer son influence dans la politique américaine et dans les affaires mondiales : elle participa à la conférence de San Francisco et défendit ardemment les droits civiques. De nombreux membres de l'administration Roosevelt poursuivirent une carrière politique auprès de Truman, Kennedy et Johnson.
Truman essaya de marcher dans les pas de son prédécesseur en lançant le Fair Deal. Mais ce fut Johnson qui fut le plus rooseveltien des présidents américains et il aimait comparer sa politique sociale au New Deala.
La maison natale de Roosevelt est classée site national historique et abrite la bibliothèque présidentielle. La résidence de Warm Springs Little White House est un musée géré par l'État de Georgie. La villa de vacances de Campobello Island est administrée par le Canada et les États-Unis Roosevelt Campobello International Park. Elle est accessible, depuis 1962, par le Franklin Delano Roosevelt Bridge.
Le Roosevelt Memorial se trouve à Washington D.C., juste à côté du Jefferson Memorial. Les plans furent dessinés par l'architecte Lawrence Halprin105. Les sculptures en bronze représentent les grands moments de la présidence, accompagnées de plusieurs extraits des discours de Roosevelt.
De nombreuses écoles portent le nom du président, ainsi qu'un porte-avions. Le réservoir situé derrière le barrage Grand Coulee dans l'État de Washington est appelé lac Franklin D. Roosevelt, qui présida à l'achèvement de l'ouvrage. À Paris, son nom a été donné à une avenue du rond-point des Champs-Élysées, et consécutivement à la station de métro qui le dessert Franklin D. Roosevelt. Le temple de la Grande Loge de France porte son nom, ce qui rappelle que le président américain a été franc-maçon.
Le lycée Joli-Cœur de Reims en France, lieu de signature de la reddition allemande, fut renommé Lycée Franklin-Roosevelt en son honneur.
Roosevelt est l'un des présidents les plus représentés dans les œuvres de fiction américaine. L'écrivain John Dos Passos en fait un homme manipulateur dans son roman The Grand Design 1966. Dans Le Maître du Haut Château 1962, Philip K. Dick imagine que Roosevelt meurt dans l'attentat de Miami en 1933, événement qui constitue le point de divergence de son uchronie.
Le portrait de Franklin Roosevelt apparaît sur la pièce de 10 cents. Monaco a émis plusieurs timbres d'hommage pendant la seconde moitié des années 1940. L'un d'eux représente Roosevelt devant sa collection de timbres-poste. Or, ce timbre comporte une erreur : la main qui tient les brucelles a été dessinée dotée de six doigts. Roosevelt est un des dirigeants de la civilisation américaine dans le jeu Civilization IV, avec George Washington.
Dans le film La Chute de Berlin 1949, son rôle est interprété par Oleg Frvelich, dans Pearl Harbor 2001, par Jon Voight et dans Week-end royal 2013, par Bill Murray.
  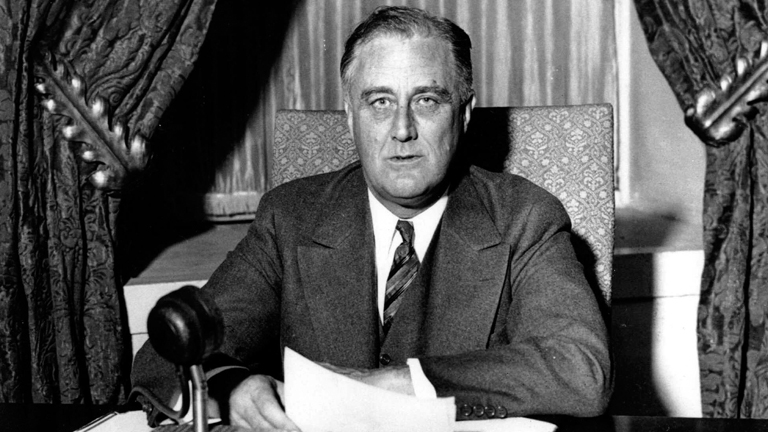       
Posté le : 07/11/2015 23:12
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
107 Personne(s) en ligne ( 79 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 107
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages