|
|
La Marseillaise |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 Février 1879 La Marseillaise est décétée Hymne national
sous la IIème république. La Marseillaise est un chant patriotique de la Révolution française, appelé aussi chant de guerre pour l'armée du Rhin, écrit en 1792 sur la musique de Rouget de Lisle, adopté par la France comme hymne national : une première fois par la Convention pendant neuf ans du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis définitivement en 1879 sous la Troisième République.
Les six premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle en 1792 pour l'Armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. Dans ce contexte originel, la Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère.
La Marseillaise est décrétée chant national le 14 juillet 1795 26 messidor an III par la Convention, à l'initiative du Comité de salut public. Abandonnée en 1804 sous l’Empire et remplacée par le Chant du départ, elle est reprise en 1830 pendant la révolution des Trois Glorieuses qui porte Louis-Philippe Ier au pouvoir. Berlioz en élabore une orchestration qu’il dédie à Rouget de Lisle.
La IIIe République en fait l'hymne national le 14 février 1879 et, en 1887, une version officielle est adoptée en prévision de la célébration du Centenaire de la Révolution. Le 14 juillet 1915, les cendres de Rouget de Lisle sont transférées aux Invalides.
Pendant la période du régime de Vichy, bien qu'elle soit toujours l'hymne national, elle est souvent accompagnée par le chant Maréchal, nous voilà !2. En zone occupée, le commandement militaire allemand interdit de la jouer et de la chanter à partir du 17 juillet 1941.
Son caractère d’hymne national est à nouveau affirmé dans l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 par la IVe République, et en 1958 — par l’article 2 de la Constitution de la Cinquième République française.
Valéry Giscard d'Estaing, sous son mandat de président de la République française, fait diminuer le tempo de la Marseillaise afin de retrouver le rythme originel.
Histoire Création et contexte historique
Elle est écrite par Claude Joseph Rouget de Lisle, capitaine du Génie alors en poste à Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 à la suite de la déclaration de guerre à l'Autriche du 20 avril 1792.
Différents titres pour un même chant
Elle porte initialement différents noms, tous éphémères : Chant de guerre pour l'armée du Rhin ; Chant de marche des volontaires de l'armée du Rhin.
Le Dr François Mireur, futur général des armées d'Italie et d'Égypte, venu à Marseille afin d'organiser la marche conjointe des volontaires du Midi Montpellier et Marseille, publie ce chant, à Marseille, pour la première fois, avec un nouveau titre : Chant de guerre des armées aux frontières. De fait, ce sont les troupes des Fédérés marseillais qui, l'ayant adopté comme chant de marche, l'entonnent lors de leur entrée triomphale, aux Tuileries, à Paris, le 30 juillet 1792. Immédiatement, la foule parisienne, sans se préoccuper de ses différents noms, baptise ce chant : La Marseillaise. Ce titre, outre sa simplicité, a l'avantage de marquer de Strasbourg à Marseille, de l'Est au Midi, l'unité de la Nation.
Circonstances de sa création
Le maire de Strasbourg, le baron Philippe-Frédéric de Dietrich, demande à Rouget de Lisle, en garnison à Strasbourg d'écrire un chant de guerre. Retourné en soirée à son domicile, rue de la Mésange entre la place de l'Homme-de-Fer et la place Broglie, Rouget de Lisle compose un Hymne de guerre dédié au maréchal Bavarois de Luckner qui commande l'armée du Rhin. Cette scène est immortalisée, notamment dans le tableau d'Isidore Pils, présenté au musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Le chant retentit ensuite publiquement pour la première fois sur la place Broglie, devant l'hôtel de ville de Strasbourg.
L'historien strasbourgeois Claude Betzinger conteste cependant le lieu de la première exécution de la Marseillaise : elle aurait eu lieu chez le maire, Philippe-Frédéric de Dietrich, domicilié alors au 17, rue des Charpentiers à Strasbourg et non à la maison familiale des Dietrich.
Le texte est fortement inspiré d'une affiche apposée à l'époque sur les murs de Strasbourg par la Société des amis de la constitution9 ou la municipalité10. L'expression les enfants de la Patrie fait référence aux engagés volontaires du Bas-Rhin, dont faisaient partie les deux fils du maire. De même, un parent de Rouget de L'Isle rapporte qu'il aurait affirmé, lors d'une réunion, s'être inspiré d'un chant protestant de 1560 exécuté lors de la conjuration d'Amboise. Enfin, certains ont suggéré que Rouget a pu songer à l'ode de Nicolas Boileau sur un bruit qui courut, en 1656, que Cromwell et les Anglais allaient faire la guerre à la France.
En ce qui concerne les influences, la Marseillaise compte peu de précédents, contrairement aux hymnes anglais ou allemand. En 1889, Wilhelm Tappert, un musicologue allemand, prétend que plusieurs airs allemands font penser à La Marseillaise mais que Rouget de Lisle ne les a sans doute pas entendus. Il réfute par ailleurs la thèse selon laquelle elle serait l'œuvre de Holtzmann, maître de chapelle dans le Palatinat — on a parlé du Credo de la Missa solemnis no 412 —, de Grisons — l’air du début de l'Oratorio Esther, intitulé Stances sur la Calomnie a été évoqué— ou d'autres. La première phrase allons enfants de la patrie apparaît dans deux trios, La Flûte enchantée et l'allegro maestoso du concerto pour piano no 25 datant de 1786 de Wolfgang Amadeus Mozart.
L'origine de la musique est plus discutée, puisqu'elle n'est pas signée contrairement aux autres compositions de Rouget de Lisle. Plusieurs écrivains et musiciens émettent des doutes sur la paternité de Rouget de Lisle réputé être un amateur incapable de composer un hymne dont la valeur musicale est reconnue. Même si son ami André Grétry juge que l'air des Marseillais a été composé par un amateur qui n'a que du goût et ignore les accords, d'autres comme Louis Garros et Philippe Barres avancent qu'il peut s'agir d'Ignace Pleyel, par ailleurs compositeur de L'Hymne de la liberté, dont Rouget de Lisle a écrit les paroles. Toutefois, il est absent de Strasbourg en décembre 1791 pour diriger les Professional Concerts à Londres, où il va résider jusqu'en mai 1792. Plus tardivement, en 1863, François-Joseph Fétis prétend que Guillaume Navoigille est l'auteur de la musique.
La cinquième strophe évoque les complices de Bouillé, général en chef de l'armée de Sarre et Moselle de 1790 à 1791, à qui on reproche alors son rôle dans l'affaire de Nancy et la fuite du roi. Rouget de Lisle écrit le chant neuf jours seulement après la libération, le 15 avril, des Suisses de Nancy emprisonnés à Brest. De son côté, le Courrier de Strasbourg du 4 septembre 1792 a imprimé les complices de Condé. Puis, le 5 décembre, François Boissel propose au club des Jacobins de remplacer le vers par Mais ces vils complices de Motier.
Le septième couplet, dit couplet des enfants, a été ajouté en octobre 1792 par Gossec lors de la représentation à l'Opéra de l'Offrande de la liberté, scène religieuse sur la chanson des Marseillais ; le poète normand Louis Du Bois et l'abbé Antoine Pessonneaux en ont revendiqué la paternité, qui a également été attribuée à André Chénier ou à son frère Marie-Joseph.
Du chant révolutionnaire à l'hymne national
Le 22 juin 1792, un délégué du Club des amis de la Constitution de Montpellier, le docteur François Mireur, venu coordonner les départs de volontaires du Midi vers le front, entonne pour la première fois à Marseille ce chant parvenu de Strasbourg à Montpellier par un moyen incertain les historiens estiment que la circulation de voyageurs a pu contribuer à ce que les milieux patriotes de Montpellier aient eu connaissance de ce chant, donné à l'occasion de funérailles au printemps 1792. Après un discours prononcé le 21 juin devant le Club des amis de la Constitution de Marseille, rue Thubaneau, Mireur est l'invité d'honneur d'un banquet le lendemain et, prié de prononcer un nouveau discours, il entonne le chant entendu à Montpellier quelques jours ou semaines plus tôt. Dans l'ardente atmosphère patriotique de l'heure, Mireur suscite l'enthousiasme et le chant est imprimé dès le lendemain par le journal des départements méridionaux daté du 23 juin 1792 et dirigé par Alexandre Ricord. Ce périodique donne sur sa seconde colonne de sa quatrième et dernière page le texte du Chant de guerre aux armées des frontières sur l'air de Sarguines. Cette édition locale de la future Marseillaise pose un problème par son titre et par sa référence à l'opéra-comique de Nicolas Dalayrac21. Il est probable que les rédacteurs du journal ont voulu indiquer un air connu de leur lecteur qui offre quelque ressemblance avec celui de Rouget de Lisle. En juillet 1792 un tiré à part de ce chant sera distribué aux volontaires marseillais qui l'entonneront tout au long de leur marche vers Paris en juillet 1792.
De la rue Thubaneau aux Champs-Élysées, le chant de Rouget de Lisle devient l'hymne des Marseillais et bientôt La Marseillaise. De fait, on lui attribue souvent à tort d'avoir été écrite à Marseille mais elle a bien été écrite à Strasbourg, rue de la Mésange. François Mireur, lui, parti de Marseille en avant des Marseillais pour rejoindre le bataillon des volontaires de l'Hérault, fera une brillante carrière militaire et mourra général, en Égypte, à l'âge de 28 ans.
La Marseillaise est déclarée chant national le 14 juillet 1795. Mais elle est concurrencée au début par un autre chant patriotique écrit en 1795 en réaction contre la Terreur : il s'agit du Réveil du Peuple.
Interdite sous l'Empire qui lui préfère Veillons au salut de l'Empire mais aussi le Chant du départ et la Marche consulaire puis la Restauration qui essaye de lui substituer l'hymne de la monarchie française Vive Henri IV !, elle est reprise après la révolution de 1830. En 1871, la Marseillaise de la Commune de Mme Jules Faure devient l'hymne de la Commune de Paris. Les élites politiques de la IIIe République, soucieuses d'ordre moral dans le début des années 1870, considèrent la Marseillaise comme une chanson blasphématoire et subversive et, après maintes hésitations, commandent en 1877 à Charles Gounod la musique d'un hymne qu'il compose sur des paroles du poète patriote Paul Déroulède, Vive la France, un chant de concorde plus pacifique que la Marseillaise. Mais, craignant un retour de la monarchie, les députés républicains redécouvrent les vertus émancipatrices de la Marseillaise et en font l'hymne national par la loi de 14 février 1879 — le Président de la République de l'époque était alors Jules Grévy — qui indique que le décret du 14 juillet 1795 est toujours en vigueur. Une version officielle est adoptée par le ministère de la guerre en 1887. Maurice-Louis Faure, ministre de l'Instruction Publique, instaure en 1911 l'obligation de l'apprendre à l'école. Une circulaire de septembre 1944 du ministère de l'Éducation nationale préconise d'en pratiquer le chant dans toutes les écoles, pratique qui est dorénavant obligatoire à l'école primaire proposition de loi du 19 février 2005, adoptée le 23 avril 2005, modifiant l'article L321-3 du Code de l'éducation. Les Constitutions de 1946 IVe République et de 1958 Ve République conservent La Marseillaise comme hymne national article 2 de la Constitution de la Cinquième République française.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marseillaise est interdite dans la Zone occupée mais reste autorisée dans la Zone libre, quoique sous une forme amendée. Le chef de l'État, Philippe Pétain, choisit de ne conserver qu'un certain nombre de strophes en fonction de leur pertinence par rapport à son projet politique Travail, famille, patrie, notamment celles commençant par Amour sacré de la patrie et Allons enfants de la patrie. On jouait l'hymne chaque fois que le Maréchal faisait un discours ou qu'il se rendait dans une ville. En 1941, François Darlan, chef du gouvernement de Vichy, demande que l'hymne et le drapeau soient honorés comme il sied à des symboles de la nation. Une demande d'autorisation sera désormais exigée pour chanter l'hymne sauf, toutefois, si un représentant du gouvernement est présent. Cette mesure vise à donner au régime le monopole de l'hymne et à empêcher la Résistance de se l'approprier. Cela n'empêchera pas pour autant les boîtes de nuit parisiennes de mêler quelques bribes de Marseillaise à leurs morceaux en défi à l'occupant allemand.
Avec les évolutions actuelles de la société individualisation, démythification du roman national français, la Marseillaise a tendance aujourd'hui à être parfois désacralisée et remise en question.
Dans le monde
La Marseillaise n'est pas seulement l’hymne français. Comme chant révolutionnaire de la première heure, elle est reprise et adoptée par nombre de révolutionnaires sur tous les continents.
Il existe une version vénitienne Bibioteca Civica A. Hortis Trieste Italie datant de juin 1797 publiée à Padoue à la même date en langue italienne texte original italien pour fêter la chute de la république Serenissima des doges de Venise en mai 1797 précipitée par le général Napoléon Bonaparte.
Une adaptation en russe, la Marseillaise des Travailleurs, publiée en 1875, est réalisée par le révolutionnaire Piotr Lavrovitch Lavrov. Vers 1900, ceux qui la chantent en public en Russie sont arrêtés par la police. Ce qui explique qu'après la Révolution d'Octobre, les bolcheviks l'adoptent pour hymne en 1917, avant de reprendre un autre chant révolutionnaire français : L'Internationale. En avril 1917, lorsque Lénine retourne en Russie, il est accueilli à Pétrograd au son de la Marseillaise. L'Internationale remplace progressivement La Marseillaise chez les révolutionnaires socialistes, parce qu'étant devenue l'hymne national français, elle est maintenant associée au pouvoir étatique de la France.
En 1931, à l'avènement de la Seconde République espagnole, certains Espagnols ne connaissant pas leur nouvel hymne Himno de Riego accueillent le nouveau régime en chantant La Marseillaise, dans une version espagnole ou catalane. Durant la Seconde Guerre mondiale, la loge maçonnique Liberté chérie, créée dans les camps de concentration nazis, tire son nom de cet hymne des combattants de la liberté.
Arsène Wenger, ancien entraîneur de l'équipe de football Nagoya Grampus, de Nagoya Japon, lui ayant fait gagner la Coupe du Japon de football, les supporters de cette équipe encouragent encore aujourd'hui leur équipe sur l'air de La Marseillaise.
Le carillon à l'hôtel de ville de Cham Bavière sonne La Marseillaise pour commémorer Nicolas Luckner.
Paroles La Marseillaise
La Marseillaise interprétée par Fédor Chaliapine
En réalité, la version complète de la Marseillaise ne compte pas moins de 15 couplets, mais le texte a subi plusieurs modifications. On compte aujourd'hui 6 couplets et un couplet dit des enfants. Seul le premier couplet est chanté lors des événements. Deux couplets les couplets des enfants ont été ajoutés ultérieurement ; l'un d'eux a depuis été supprimé de la version officielle. Enfin, eu égard à son caractère religieux, le 8e couplet a été supprimé par Joseph Servan, ministre de la Guerre, en 1792. Un autre couplet a été supprimé car il a été jugé trop violent.
Sur un manuscrit autographe de Rouget de Lisle, on voit clairement le refrain noté comme deux alexandrins : Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, / Marchez, qu'un sang impur abreuve vos sillons, les verbes marchez et formez étant tous deux à la 2e personne du pluriel. La transcription officielle » est pourtant sur cinq vers avec une 1re personne du pluriel Marchons, marchons, qui tenterait d'établir une rime avec bataillons et sillons.
En réalité, Rouget de Lisle était capitaine. En qualité d'officier, il commandait ses hommes, d'où la formule impérative. Néanmoins, la Marseillaise est une marche et on peut imaginer que les soldats en manœuvre en reprenaient le refrain, en chantant marchons et non marchez. Cette version se serait imposée par transmission orale.
La version dite officielle est la suivante :
La Marseillaise
Premier couplet
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé, bis
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !
Refrain :
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
Couplet 2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? bis
Français, pour nous, ah ! quel outrage !
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !
Refrain
Couplet 3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! bis
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !
Refrain
Couplet 4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! bis
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre !
Refrain
Couplet 5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. bis
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
Refrain
Couplet 6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! bis
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
Refrain
Couplet 7
dit couplet des enfants »
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus bis
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre
couplet pour les enfants 2e
Enfants, que l'Honneur, la Patrie
Fassent l'objet de tous nos vœux !
Ayons toujours l'âme nourrie
Des feux qu'ils inspirent tous deux. bis
Soyons unis ! Tout est possible ;
Nos vils ennemis tomberont,
Alors les Français cesseront
De chanter ce refrain terrible :
Refrain
Le septième couplet dit des enfants
Rouget de Lisle n’ayant écrit que six couplets, le site officiel de l’Élysée indique que l’auteur du 7e couplet reste inconnu.
Dans son ouvrage posthume Sous le bonnet rouge de sa collection La Petite Histoire, paru en 1936, G. Lenotre rapporte la rumeur viennoise traditionnelle, selon laquelle ce couplet aurait été composé par l’abbé Antoine Pessonneaux. Cette version a été reprise par Claude Muller dans Les Mystères du Dauphiné. Selon lui, l'abbé, professeur de rhétorique au collège de Vienne de 1788 à 1793 né à Lyon le 31 janvier 1761, jugeant que le texte était incomplet, puisqu'il n'évoquait pas les nouvelles générations, écrivit le couplet des enfants qu'il fit chanter par les élèves lors de la fête de la fédération du 14 juillet 1792 en présence de la population et de soldats de bataillon de fédérés marseillais alors en transit dans la ville. Ce couplet passa ensuite à Paris, grâce au député Benoît Michel de Comberousse. Traduit devant le tribunal à Lyon — le 1er janvier 1794 12 nivôse an II selon G. Lenotre —, l'abbé aurait été sauvé de la mort en se présentant comme l'auteur du septième couplet de la Marseillaise. L'abbé Pessonneaux mourut le 10 mars 1835.
Un autre personnage, Louis Du Bois, ancien sous-préfet né à Lisieux le 16 novembre 1773, mort le 9 juillet 1855, en a clairement revendiqué la paternité dans sa Notice sur la Marseillaise publiée en 1848 : Au mois d'octobre 1792, j'ajoutai un septième couplet qui fut bien accueilli dans les journaux : c'est le couplet des Enfants, dont l'idée est empruntée au chant des Spartiates, rapporté par Plutarque »35. Cette revendication est également mentionnée par Claude Muller.
Statut légal
L'article 2 de la Constitution de la République française affirme :
La langue de la République est le français ;
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge ;
L'hymne national est La Marseillaise ;
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité ;
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Le 24 janvier 2003, l'ensemble des députés adopte, dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure Lopsi, un amendement créant le délit d'outrage au drapeau français et à l'hymne national, La Marseillaise. Délit sanctionné par un emprisonnement de 6 mois et 7 500 euros d'amende. Un certain nombre de citoyens et d'associations de défense des droits de l'homme se sont insurgés contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte manifeste à la liberté d'expression et contre le flou entretenu par le mot outrage.
Le Conseil constitutionnel en limite les possibilités d'application :
[...] Sont exclus du champ d'application de l'article critiqué les œuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle privé, ainsi que les actes accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités publiques ou non réglementées par elles ; que l'expression manifestations réglementées par les autorités publiques, éclairée par les travaux parlementaires, doit s'entendre des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent.
La loi Fillon, visant à réformer l'éducation et adoptée en mars 2005, a rendu obligatoire l'apprentissage de La Marseillaise dans les classes maternelles et primaires à partir de la rentrée 2005, conformément à la loi du 23 avril 2005. On retrouve l'obligation d'enseigner l’hymne national dans d'autres pays, comme les États-Unis, la Serbie ou encore l’Autriche.
Interprètes, adaptations, réutilisations
Pierre Dupont 1888-1969, chef de la musique de la Garde républicaine de 1927 à 1944, compose l'arrangement officiel de l'hymne national. C'est cette version qui est encore actuellement en usage.
Mais La Marseillaise a eu de nombreux interprètes, dont :
Fédor Chaliapine qui l'a chantée plusieurs fois en Russie ou en France mais en a fait un seul enregistrement entre 1911 et 1914 ;
Johnny Hallyday, le 14 juillet 1963 à Trouville ;
The Beatles, ils ne la chantent pas mais les premières notes de l'hymne national français sont jouées cuivres pour l’introduction de leur titre de 1967 All You Need Is Love, immédiatement suivies des mots love, love, love ;
Intro et petite évocation aussi sur le titre "Frog princess" du groupe The divine comedy 1996 ;
Michel Sardou 1976 et 1988 ;
Marc Cerrone, à la fin de son titre Rocket in the Pocket tiré de l'album Je Suis Music 1978, en référence à ses concitoyens français l'ayant déprécié, à l'inverse des États-Unis où il s'est depuis établi.
Serge Gainsbourg 1979 sous le titre de Aux armes et cætera. Il s'agit d'une version reggae qui déclencha de nombreux émois. Le 4 janvier 1980, à Strasbourg, au cours de l'une de ses représentations, des parachutistes le prirent à partie et distribuèrent des tracts auprès du public, mais Gainsbourg, prit le micro, énonça être un insoumis, avoir dû annuler le concert du fait de la désaffection de ses musiciens jamaïcains effrayés par l'ambiance ainsi que par des alertes à la bombe et après avoir déclaré redonner son "sens initial" à La Marseillaise l'entonna a cappella, contraignant ainsi plusieurs dizaines de porteurs de bérets rouges à se mettre au garde à vous. Gainsbourg termina la prestation en leur adressant un bras d'honneur avant de se retirer. En décembre 1981, Serge Gainsbourg acheta le manuscrit original du Chant de guerre de l'armée du Rhin lors d'une vente aux enchères : J'étais prêt à me ruiner, déclara-t-il ;
Oberkampf, version punk en 1983 ;
Jessye Norman, pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution 1989 ;
Nino Ferrer, avec les Voix des Gens de Montcuq en Quercy, 45 tours 1989 ;
Claude Bolling, version jazz, The Victory Concert, 1994 ;
Jean-Loup Longnon, version brésilienne dans l’album Cyclades, 1996 ;
Big Red 1999 avec le titre Aux armes etc. tiré de l'album Big Redemption. C'est une version reggae-ragga en clin d'œil à celle de Gainsbourg ;
Yannick Noah avec les Enfoirés pour Les Restos du cœur de 1999 ;
Rohan, version enfant 2005 ;
Laibach sur l'album Volk, sorti en 2006, chants partiellement en anglais ;
Amel Bent 2007; sous le titre Nouveau Français ;
Mireille Mathieu l'interprète sur la scène du Bolchoï à Moscou avec les Chœurs de l'Armée rouge en 1976, avec la garde républicaine le 14 juillet 1989 à l'Arc de triomphe de l'Étoile et le 6 mai 2007 sur la place de la Concorde après l'élection de Nicolas Sarkozy ;
Psy 4 de la Rime introduction de Jeunesse France, sorti en 2008 ;
Lââm, le 14 octobre 2008, a interprété la Marseillaise sous les sifflets lors d'un match de football France - Tunisie ;
Stéphane Grappelli et Django Reinhardt au sein du quintette du Hot Club de France, titre traduit en anglais Echoes of France ;
Marcel Mouloudji ;
Marc Ogeret ;
Édith Piaf ;
Placido Domingo ;
Pierre Rodriguez, avec l'orchestre de la musique des équipages de la flotte de Toulon. France productions 2006 ;
Graeme Allwright, dans une version où les paroles sont changées et adoptent des propos de paix et de liberté ;
Ben Heppner, sur un disque d'airs français ;
Roberto Alagna, dans un récital d'airs français ;
Carl Davis à la tête du Wren Orchestra de Londres, Teaching the Marseillaise, pour la présentation du film d'Abel Gance Napoleon Silva Screen, FILMCD 149 ;
Igor Stravinsky en a fait une transcription pour le violon solo ;
Angelo Debarre et Boulou Ferré sur Django 100 ;
Coco Briaval dans une version pour guitares manouches en 1979, La Marseillaise-L'Internationale 45 tours Unidisc, censurée par l'ORTF ;
Valéry Giscard d’Estaing avec son accordéon ;
William Sheller reprend le refrain Allons enfants de la patrie, le jour de gloire... dans sa chanson La navale, sur l'album Albion 1994 ;
Vincent Niclo.
Sarah Schachner, dans la bande originale du jeu vidéo Assassin's Creed Unity. La Marseillaise peut être entendue en fond musical dans le titre Rather Death Than Slavery 2014
Olivier Latry, organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 novembre 2015, lors de la messe "en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et pour la France".
Paternité et antériorité
De nombreux compositeurs ou critiques ont cherché à attribuer la musique de la Marseillaise à un autre auteur. Le seul cas indécidable, selon Frédéric Robert, serait celui de l'introduction d'Esther, un oratorio de Jean-Baptiste Grisons, contredisant ainsi l'avis de Constant Pierre, pour qui Esther est postérieur à la Marseillaise. Toutefois, Robert constate que dès 1786, « des accents, des rythmes, des figures mélodiques annoncent la Marseillaise On trouve l'ébauche de la mélodie de La Marseillaise dans le concerto pour piano et orchestre no 25 ut majeur kV 503 de Mozart composé en 1786 : les douze premières notes de l'hymne sont jouées au piano par la main gauche à la fin du premier mouvement allegro maestoso. Jacques-Gabriel Prod’homme retrouve les quinzième et seizième mesures de la Marseillaise dans les mesures 7 et 8 du Chant du 14 juillet 1791 de François-Joseph Gossec.
Réemplois non parodiques
À partir d'un certain moment, l'air et la trame de construction de la Marseillaise étaient connus d'un large public. Il était tentant et commode d'inscrire des couplets proches, sur le même air, pour la défense et l'illustration d'une cause. C'est ce que firent certains auteurs qui, en agissant ainsi, ne prétendaient pas nécessairement parodier l'hymne original. Ce fut, par exemple, le cas de Léo Taxil, en 1881, qui rédigea Le chant des électeurs, plus connu sous le nom de la Marseillaise anticléricale. C'était une chanson politique, comique, violemment anticléricale, appelant à voter aux élections pour le Parti radical.
Dès 1792, de très nombreux compositeurs se livrent à des adaptations du thème outre l'harmonisation, sont apparus en France et à l'étranger : variation, insertion, superposition contrapuntique et même développement symphonique avec Le Patriote de Cambini.
Claude Balbastre écrit des variations sur le thème : Marche des Marseillois et l’Air Ça ira / Arrangés pour le Forte Piano / Par le Citoyen C. Balbastre / Aux braves défenseurs de la République française l’an 1792 1er de la République.
Giuseppe Cambini a pris le thème à Airs patriotiques pour deux violons, où il est cité et repris avec variations, avec d'autres mélodies patriotiques. On trouve aussi dans la même période Jean-François Gossec avec Offrandes à la liberté 1792, Giovanni Battista Viotti avec Six quatuors d'air connus, dialogués et variés, op. 23 1795, aux côtés de Ferdinand Albert Gautier, Albert Gautier, et de nombreux autres.
L'air de l'hymne officieux du Royaume de Wurtemberg rappelle la Marseillaise mais les paroles dues à Justinus Kerner sont d'une tout autre inspiration. Cet hymne a pour titre : Preisend mit viel schönen Reden ou Der rechte Fürst.
Au Stade Félix-Bollaert à Lens, la Marseillaise lensoise accompagne l'entrée des joueurs en première mi-temps et reprend le premier couplet ainsi que le refrain, l'adaptant à un chant de supporter.
En 1830, Hector Berlioz arrange l'hymne dans une première version pour grand orchestre, double chœur, et « tout ce qui a une voix, un cœur et du sang dans les veines. Il en réalise une seconde version pour ténor solo, chœur et piano, en 1848.
En 1839, Schumann l'a inclus aussi dans le premier mouvement du Carnaval de Vienne, par défi envers Metternich, qui avait interdit la Marseillaise à Vienne. Schumann l'évoquera également dans l'Ouverture d'Hermann et Dorothée en 1851 opus 136
En 1848, la Marseillaise des cotillons est un hymne féministe de L. de Chaumont publié dans La République des femmes, journal des cotillons et organe des Vésuviennes, jeunes femmes suivant la tradition saint-simonienne d'émancipation féminine.
En 1871, le texte du célèbre hymne communiste l'Internationale a été écrit à l'origine sur l'air de la Marseillaise. Il a fallu attendre 1888 pour que soit composé l'air actuel de l'Internationale par Pierre Degeyter. En 1979, Coco Briaval enregistra ces deux œuvres sur un disque 45 tours, La Marseillaise - l'Internationale, paru chez Unidisc.
En 1872, le compositeur hongrois Franz Liszt a composé une fantaisie pour piano sur l'air de la Marseillaise.
En 1880, le thème de La Marseillaise a été repris par Piotr Ilitch Tchaïkovski dans son Ouverture 1812 opus 49 célébrant la victoire russe de 1812 sur les armées napoléoniennes. On peut y entendre les premières notes de la mélodie utilisées comme motif mélodique récurrent, en opposition aux thèmes mélodiques de différents chants patriotiques russes.
Vers 1888 une version boulangiste fut composée.
À l'occasion du 1er mai 1891, le mineur Séraphin Cordier a écrit La Nouvelle Marseillaise des mineurs, hymne de protestation contre l'exploitation des mineurs.
En 1914, Erik Satie introduit une brève citation des premières notes de la Marseillaise dans « Les Courses », treizième morceau de Sports et Divertissements.
Durant la Première Guerre Mondiale, une version corse, La Corsica, fut composée par Toussaint Gugliemi :Adieu, Berceau de Bonaparte / Corse, notre île de Beauté….
En 1929, Dmitri Chostakovitch l'a utilisé dans sa musique pour le film La Nouvelle Babylone, en la superposant parfois avec le french cancan d'Offenbach. De la même manière, en 1999, le compositeur polonais Wojciech Kilar a repris des fragments du thème de la Marseillaise dans le film Pan Tadeusz - Quand Napoléon traversait le Niémen, également dans le passage intitulé Rok 1812 L'année 1812.
En 1942, un arrangement au ton dramatique de la Marseillaise sert de générique au film américain Casablanca de Michael Curtiz avec une musique de Max Steiner. Le thème est réutilisé au cours du film dans différents tons. Une des scènes du film voit par ailleurs la confrontation entre la Marseillaise et Die Wacht am Rhein, hymne officieux de l'Allemagne nazie.
En 1967, dans la chanson All You Need Is Love, les Beatles se sont servis de l'intro de la marseillaise pour illustrer le début de leur chanson.
En 1981, Mel Brooks en a aussi fait une reprise, en introduction, sur son morceau It's Good To Be The King.
En 2006, Charlélie Couture a repris le thème musical dans une chanson intitulée Ma Marseillaise à moi.
L'APRA, principal parti politique péruvien, a repris l'air de la Marseillaise pour son hymne.
Le Parti socialiste du Chili utilise également la musique de la Marseillaise pour son hymne La Marseillaise socialiste.
Les fans de l'équipe de football de Manchester United reprennent encore aujourd'hui l'air de la Marseillaise en l'honneur d'Éric Cantona, remplaçant Aux armes citoyens ! par Oh ah, Cantona !.
Parodies
Comme tout chant ou chanson célèbre, la Marseillaise a été souvent parodiée par divers artistes ou confréries, à des fins humoristiques ou politiques. On peut citer, comme exemples :
Le Retour du soldat, connue sous le nom de la Marseillaise de la Courtille, œuvre d'Antignac, parue en 1792, chez l'éditeur Frère.
Le 5 juillet 1793, La Marseillaise des Montagnards s'adresse aux sans culottes des fédérés bretons.
En 1867, Camille Naudin à la Nouvelle Orléans écrit La Marseillaise noire.
En 1888, on trouve La Marseillaise des libres penseurs, chanson anonyme.
En 1891, Émile Voillequin écrit La Marseillaise fourmisienne.
En 1893, Louis Pinède de Vals-les-bains écrit La Marseillaise des catholiques.
En 1911, Gaston Couté écrit La Marseillaise des requins, qui dénonce le colonialisme.
L'hymne de Springfield dans Les Simpson - Le Film en 2007.
En 2008, Karl Zero oppose La Marseillaise et L'Internationale dans son film Sego et Sarko sont dans un bateau.
En 2009, Chanson Plus Bifluorée interprète la Marseillaise de la Paix. Selon les auteurs, cette version de la Marseillaise fut d’abord chantée dans l’orphelinat expérimental de Cempuis Oise dirigé par le pédagogue libertaire Paul Robin 1837-1912.
On trouve aussi Le chant des blancs, une Marseillaise milanaise, En avant peuple d'Italie, la Marseillaisa dos Peréreus, la Marseillaise des femmes, etc.
Une version rugby anglais existe également.
Réemplois du nom de « Marseillaise
Le nom même de Marseillaise a été employé au sens d' hymne, dans divers textes ou chansons. Ainsi :
La Marseillaise des vidangeurs est le nom alternatif, attesté en 1911, de la célèbre chanson estudiantine La Pompe à merde, mais celle-ci n'utilise ni l'air ni la structure de l'hymne national.
Accueil et appréciations
« L’hymne qu’on aime le plus reprendre en chœur »
Selon une étude faite par deux musicologues, l’air entraînant de La Marseillaise, le fait que le public puisse chanter à pleins poumons sans crainte de se tromper, rendent particulièrement accessible ce chant national. Ces chercheurs ayant comparé six hymnes nationaux sur la base d’une trentaine de variables effort vocal requis, longueur des strophes, vocabulaire, etc., il s'avère que La Marseillaise, devant les hymnes australien, allemand et canadien, se distingue par sa facilité à être chantée ; les hymnes américain et britannique étant, pour leur part, qualifiés par les musicologues de véritables épreuves.
Qu'un sang impur abreuve nos sillons, polémiques et critiques
L’hymne national français est un chant guerrier hérité des guerres révolutionnaires et un hymne à la liberté. Le 20 avril 1792, l’Assemblée législative déclare la guerre à l’empereur romain germanique Léopold II. Dans la nuit du 25 au 26 avril, Rouget de Lisle compose le Chant de guerre pour l’armée du Rhin, destiné à encourager les troupes.
En France, certaines paroles de La Marseillaise, notamment le vers Qu'un sang impur abreuve nos sillons, n'ont pas été sans susciter des polémiques et des critiques.
Selon une théorie défendue par Dimitri Casali62 ou Frédéric Dufourg, ces vers font référence indirectement au sang bleu des aristocrates, sang noble et pur, les révolutionnaires se désignant par opposition comme les sangs impurs, prêts à donner leur vie pour sauver la France et la République trahies par la famille royale.
Cependant pour les historiens Jean Jaurès66, Jean-Clément Martin, Diego Venturino, Élie Barnavi et Paul Goossens, aux yeux de Rouget de Lisle et des Révolutionnaires, le « sang impur » est celui de leurs ennemis. De même, les discours et les déclarations des révolutionnaires de l'époque attribuent le sang impur aux contre-révolutionnaires.
C'est au Dieu des armées que nous adressons nos vœux : notre désir est d'abreuver nos frontières du sang impur de l'hydre aristocrate qui les infecte : la terreur est chez eux et la mort part de nos mains. Citoyens ! nous serons vainqueurs
— Lettre écrite par 45 volontaires du 3e bataillon de la Meurthe à la municipalité de Lunéville, le 10 août 1792.
J’ai démontré la nécessité d’abattre quelques centaines de têtes criminelles pour conserver trois cent mille têtes innocentes, de verser quelques gouttes de sang impur pour éviter d’en verser de très-pur, c’est-à-dire d’écraser les principaux contre-révolutionnaires pour sauver la patrie.
— Jean-Paul Marat, Journal de la République française, le 7 novembre 1792.
Cette partie de la République française présente un sol aride, sans eaux et sans bois; les Allemands s'en souviendront, leur sang impur fécondera peut-être cette terre ingrate qui en est abreuvée
— Discours de Dumouriez devant la Convention nationale, le 10 octobre 1792.
Nous sommes ici à exterminer le restant des chouans, enfouis dans des bois ; le sang impur des prêtres et des aristocrates abreuve donc nos sillons dans les campagnes et ruisselle à grands flots sur les échafauds dans nos cités. Jugez quel spectacle est-ce pour un républicain animé, comme je le suis, du plus pur amour du feu le plus sacré de là liberté et de la patrie qui brûle dans mes veines.
— Lettre de Cousin à Robespierre, à Cossé le 27 nivôse an II 16 janvier 1794.
Eh bien, foutre, il n'en coûtera pas plus pour anéantir les traîtres qui conspirent contre la République. La dernière heure de leur mort va sonner; quand leur sang impur sera versé, les aboyeurs de l'aristocratie rentreront dans leurs caves comme au 10 août.
— Jacques-René Hébert, Le Père Duchesne
Quel espoir peut rester à l’empereur et au roi d’Espagne depuis que la justice nationale a scellé la liberté française par le sang impur de ses tyrans?
— Discours de Jacques Nicolas Billaud-Varenne devant la Convention nationale, le 20 avril 1794.
« Par toute la France le sang a coulé mais presque partout cela a été le sang impur des ennemis de la Liberté, de la Nation et qui depuis longtemps, s'engraissent à leurs dépens.
— Napoléon Bonaparte, lettre écrite à son frère Joseph, le 9 août 1789.
En 1903, Jean Jaurès publie une défense des chants révolutionnaires socialistes, et notamment de l'Internationale, à laquelle ses détracteurs opposent la Marseillaise. Admirateur de la Marseillaise, Jaurès en rappelle cependant la violence et critique le couplet sur le sang impur, jugé méprisant envers les soldats étrangers de la Première Coalition :
Mais ce n'est pas seulement sur la forme que porte la controverse ; c'est sur les idées. Or, je dis que la Marseillaise, la grande Marseillaise de 1792, est toute pleine des idées qu'on dénonce le plus violemment dans L'Internationale. Que signifie, je vous prie, le fameux refrain du sang impur? — Qu'un sang impur abreuve nos sillons !, l'expression est atroce. C'est l'écho d'une parole bien étourdiment cruelle de Barnave. On sait qu'à propos de quelques aristocrates massacrés par le peuple, il s'écria : Après tout, le sang qui coule est-il donc si pur? Propos abominable, car dès que les partis commencent à dire que le sang est impur qui coule dans les veines de leurs adversaires, ils se mettent à le répandre à flots et les révolutions deviennent des boucheries. Mais de quel droit la Révolution flétrissait-elle de ce mot avilissant et barbare tous les peuples, tous les hommes qui combattaient contre elle ?
Quoi! tous ces Italiens, tous ces Autrichiens, tous ces Prussiens qui sous le drapeau de leur gouvernement combattent la France révolutionnaire, tous les hommes qui, pour obéir à la volonté de leurs princes, c'est-à-dire à ce qui est alors la loi de leur pays, affrontent la fatigue, la maladie et la mort ne sont que des êtres vils ? Il ne suffit pas de les repousser et de les vaincre; il faut les mépriser. Même la mort ne les protège pas contre l'outrage; car de leurs larges blessures, c'est « un sang impur » qui a coulé. Oui, c'est une parole sauvage. Et pourquoi donc la Révolution l'a-t-elle prononcée? Parce qu'à ses yeux tous les hommes qui consentaient, sous le drapeau de leur roi et de leur pays, à lutter contre la liberté française, espoir de la liberté du monde, tous ces hommes cessaient d'être des hommes ; ils n'étaient plus que des esclaves et des brutes. ...
Et qu'on ne se méprenne pas : toujours les combattants ont essayé de provoquer des désertions chez l'ennemi. Mais ici il y a quelque chose de nouveau : c'est qu'aux yeux de la Révolution, le déserteur, quand il quitte le camp de la tyrannie pour passer dans le camp de la liberté, ne se dégrade pas, mais se relève au contraire; le sang de ses veines s'épure, et il cesse d'être un esclave, une brute, pour devenir un homme, le citoyen de la grande patrie nouvelle, la patrie de la liberté, les déserteurs, bien loin de se méfier d'eux, elle les traite en citoyens. Elle ne se borne pas à leur jeter une prime, elle leur assure sur les biens nationaux des petits domaines et elle les inscrit, par là, dans l'élite révolutionnaire ; elle les enracine à la noble terre de France, elle leur réserve la même récompense qu'elle donne aux vétérans de ses propres armées. Bien mieux, elle les organise en bataillons glorieux, elle les envoie en Vendée pour combattre la contre-révolution, non pas comme des mercenaires mais comme des fils en qui elle met sa complaisance. Seul Marat, avec son bon sens irrité et son réalisme aigu, rappelle la Révolution à plus de prudence. Que pouvez-vous attendre, écrit-il, des hommes qui, quoique vous en pensiez, ne sont venus à vous que pour de l'argent?
— Jean Jaurès, La Petite République socialiste, 30 août 1903.
Selon Diego Venturino, l'expression sang bleu est inexistante au XVIIIe siècle, à cette époque avoir le sang pur est synonyme de vertu et le sang impur est synonyme de vice : Lorsque les Révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle chantaient marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, voulaient-ils discriminer le sang pur de la race française du sang impur des étrangers ? ou bien évoquer les traîtres à la patrie et les ennemis des valeurs de la révolution en particulier, ces hommes qui sont devenus impurs par leur refus de la nouvelle religion révolutionnaire. Il s'agit là d'une genèse historique non biologique de la pureté ou de l'impureté.
Pour Élie Barnavi et Paul Goossens Rouget de Lisle utilisera cette notion de sang impur dans La Marseillaise mais sans l'associer à un peuple. Pour lui, le sang impur est celui de l'ennemi.
Pour Jean-Clément Martin, les paroles de La Marseillaise sont à replacer dans le contexte de l'époque, où les diverses factions révolutionnaires sont fortement divisées et rivales. Rouget de Lisle, révolutionnaire monarchien, surenchérit dans la violence des paroles pour s'opposer à Marat et aux Sans-culottes :
Le Chant de guerre de l'armée du Rhin, devenu quelques mois plus tard la Marseillaise, est une chanson initialement proposée en alternative aux couplets jugés dangereux de La Carmagnole qu'il fallait contrer dans l'esprit du compositeur Rouget de Lisle et de son promoteur le Strasbourgeois Dietrich. La chanson est popularisée, sur les routes vers Paris, par les fédérés marseillais, autant fervents patriotes que fermement opposés à Marat ! Selon un schéma fréquent au sein de toute période révolutionnaire, les divisions, d'origine politiques, sociales, culturelles, régionales aussi, ne jouent donc pas entre deux camps mais aussi à l'intérieur de chacun. Il faut ainsi comprendre la véhémence des paroles de la Marseillaise dénonçant la horde d'esclaves et poussant à répandre le sang impur des complices de Bouillé et des traîtres. Dans la lutte contre les barbares, le plus révolutionnaire est le plus radical. On attend aussi que les troupes étrangères se rallient à la Révolution, rejoignant leurs frères véritables. Ce ne sera que par la suite que l'ennemi sera identifié à l'étranger et que la Révolution s'engagera dans une défense de l'identité nationale.
— Jean-Clément Martin, Violence et Révolution: Essai sur la naissance d'un mythe national.
Le ministre Éric Besson a rappelé le sens de ces paroles de la Marseillaise sur France-Inter le 8 février 2010 :
Sur la Marseillaise, … je pense que tous nos concitoyens et notamment les plus jeunes d’entre eux, doivent comprendre et connaître les paroles de la Marseillaise, et notamment pour une raison qui ne vous a pas échappé, c’est que la formule, la phrase qu’un sang impur abreuve nos sillons en 2010, elle n’a rien d’évident. Qu’est-ce qu’il faut expliquer ? Que le sang impur ce n’est pas le sang des étrangers, c’est historiquement le sang de ceux qui voulaient abattre la Révolution française, le sang de ceux qui voulaient mettre fin à notre République.
Propositions de révision du texte
Nombreuses furent les tentatives de réécriture du texte. Ainsi peut-on citer la version d'Alphonse de Lamartine, celle de Victor Hugo, de Serge Gainsbourg, et de Graeme Allwright.
Pour une Marseillaise de la Fraternité fut une initiative conduite dans les années 1990 par le Père Jean Toulat pour obtenir une révision des paroles avec le soutien de personnes telles que l'Abbé Pierre et Théodore Monod.
En octobre 2007, Christine Boutin, présidente du Forum des républicains sociaux, a proposé de changer l'ordre des couplets de La Marseillaise en cas d'élection à la fonction présidentielle, afin de rendre l'hymne national moins sanguinaire et moins révolutionnaire.
Aujourd'hui, plusieurs personnes et associations proposent des textes de révision de la Marseillaise
Irrespect lors des matchs de football
Outrage aux symboles nationaux en France.
L'interprétation de l'hymne en accompagnement de manifestations sportives auxquelles participent des représentants français a été, depuis les années 1990, l'occasion de certaines polémiques, principalement dans le domaine du football.
Une controverse, épisodique mais récurrente, concerne l'interprétation de l'hymne par les joueurs de l'équipe de France de football avant le début des rencontres. En 1996, durant le championnat d'Europe, Jean-Marie Le Pen déplore qu'une partie des membres de l'équipe de France, venus selon lui de l'étranger, ne reprennent pas en chœur l'hymne national. Dans le courant des années 2000, la polémique autour de la nécessité ou non, pour des athlètes français, d'entonner la Marseillaise, refait surface au point de devenir un sujet de débat régulier. En 2010, la secrétaire d'état aux sports Rama Yade et sa ministre de tutelle Roselyne Bachelot s'expriment ainsi sur le sujet, la première jugeant qu'il ne faut pas imposer aux joueurs de chanter l'hymne avant les rencontres, la seconde émettant le souhait qu'il soit chanté. Une partie de la classe politique française réclame que les Bleus entonnent systématiquement la Marseillaise ; en 2010, le sélectionneur Laurent Blanc incite ses joueurs à reprendre l'hymne, soulignant que les gens sont très sensibles à ce sujet. Michel Platini rappelle pour sa part qu'il n'a jamais, au cours de sa carrière, chanté la Marseillaise, précisant qu'il aime la France mais pas cet hymne guerrier qui n'a rien à voir avec le jeu En 2012, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, déplore que des joueurs de l'équipe de France ne chantent pas la Marseillaise, ce qui lui apparaît comme un problème de savoir-vivre, de culture, de respect »96, et dit souhaiter que l'hymne, sinon chanté, soit au moins ressenti,.
Parallèlement aux controverses sur l'attitude des sportifs représentant la France envers leur hymne national, la Marseillaise est à plusieurs reprises, durant les années 2000, victime d'outrages dans le contexte de matches de football, ce qui entraîne d'importantes polémiques publiques, puis des conséquences législatives. Le 6 octobre 2001, lors du match France – Algérie au stade de France qui a été par la suite interrompu par l'irruption sur le terrain des spectateurs, La Marseillaise avait été sifflée par une partie du public ; ceci avait provoqué une vive réaction à travers le pays. Au printemps 2002, certains supporters corses du Sporting Club de Bastia avaient sifflé à nouveau l'hymne national à l'occasion de la finale de la Coupe de France, provoquant l'ire du président Jacques Chirac, qui avait décidé en conséquence de boycotter la remise du trophée au vainqueur. À la suite de ces affaires, en mars 2003, un amendement à la loi pour la sécurité intérieure crée en France le délit d'outrage au drapeau ou à l'hymne national.
Ce type d'événement s'est reproduit lors des matchs amicaux de football lors d'un déplacement en 2005 en Israël. Comptant pour les qualifications pour le Mondial 2006, les spectateurs du stade Ramat-Gan de Tel-Aviv sifflent l'hymne français et conspuent Fabien Barthez tout au long de la partie.
Ce type d'événement s'est reproduit lors des matchs amicaux de football France – Maroc, le 17 novembre 2007, et France – Tunisie, le 14 octobre 2008, là encore au stade de France. L'ambassade de Tunisie en France, sollicitée par la presse, émet un communiqué dont le dernier point invite à éviter les amalgames afin de ne pas donner du grain à moudre aux intolérants de tous bords.
Michel Platini, ancien capitaine international français et président de l'UEFA estime que ces sifflets représentent des manifestations contre un adversaire d'un soir, en l'occurrence l'équipe de France et ne sont pas une insulte à la France. Il déplore ce qu'il appelle la récupération politique qui est faite de ces sifflets, inhérents au monde du football et du sport en général. Il rappelle les manifestations de joie au lendemain de la victoire des Black-Blancs-Beurs de la coupe du monde de 1998, les drapeaux français tenus à bout de bras et la Marseillaise chantée par les supporters français.
La Marseillaise a également été sifflée, de même que le sélectionneur Raymond Domenech lors de l'apparition de son portrait sur écran géant dans le stade, par des supporters italiens lors du match Italie-France le 8 septembre 2007 et Tunisie-France en 2008, dans le cadre d'une rencontre de qualification pour l'Euro 2008 disputée à San Siro Milan. Ces sifflements ont été commis en réponse aux attaques répétées du sélectionneur français dans la presse contre la sélection italienne avant ce match. Selon le sociologue Emmanuel Todd, ce type de manifestation lors des matchs de football qui survient en pleine crise financière en 2008 serait instrumentalisé par les hommes politiques pour masquer les réels problèmes que connaît la France comme la crise de la démocratie » et les menaces qui pèsent sur son industrie.
  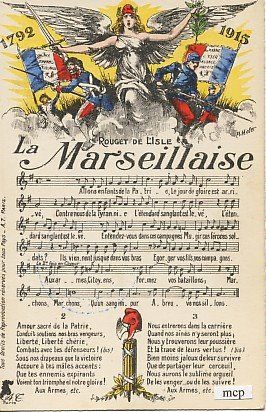  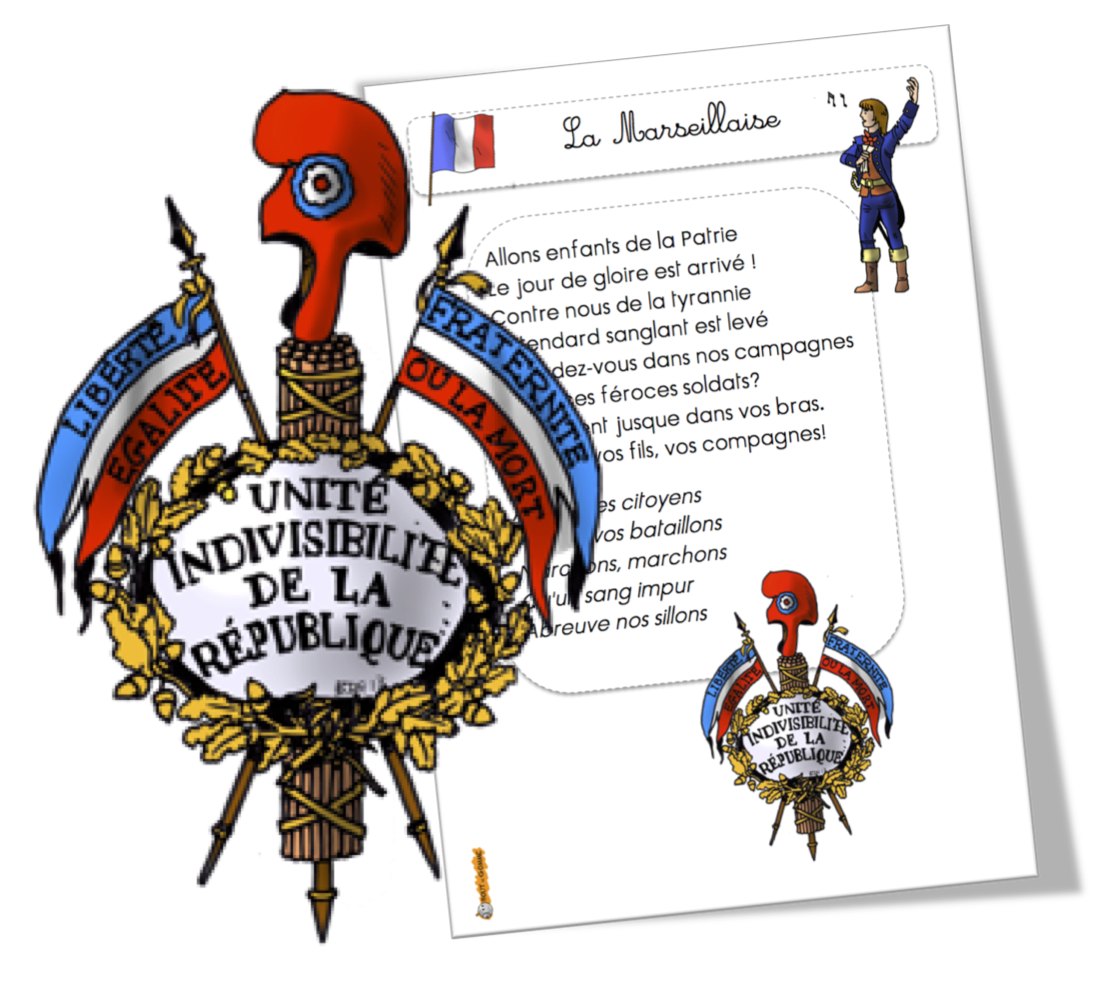  
Posté le : 14/02/2016 17:17
|
|
|
|
|
Pogrom de Strasbourg |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 février 1349 Pogrom de Strasbourg
le massacre par des habitants de Strasbourg de plus de 900 des 1 884 habitants juifs de la ville, il a lieu le jour de la Saint-Valentin. Il est connu aussi sous la désignation de massacre de la Saint-Valentin.
Dès le printemps 1348, de nombreux pogroms se produisent tout d'abord en France faisant des milliers de victimes parmi la population juive, puis à partir de novembre, par la Savoie, ils se propagent à de nombreuses villes du Saint-Empire2, en particulier de Rhénanie. En janvier 1349 le Pogrom de Bâle a lieu ainsi qu'un autre à Fribourg-en-Brisgau où dans les deux cas les Juifs sont envoyés par centaines au bûcher. Le 14 février, c'est au tour de la communauté juive de Strasbourg d'être anéantie. Le 21 mars 1349 viendra ensuite la destruction de la communauté d'Erfurt lors du Massacre d'Erfurt.
A Strasbourg, cet événement tragique est étroitement lié à la révolte des corporations de métiers qui se déroule cinq jours auparavant et qui renverse le pouvoir en place depuis 1332, composé de riches bourgeois dont le juge Sturm et Conrad Kuntz von Winterthur, les deux stadtmeister équivalents au maire de la ville et Pierre Schwaber, l'ammeister chef des corporations de métiers, qui garantissaient jusqu'alors une protection aux Juifs de la ville. Les artisans, aidés par une grande partie de la population, se sont insurgés plus particulièrement contre Schwaber, jugeant son pouvoir trop important, et sa politique envers les Juifs trop favorable.
Pogrome ou Pogrom
Terme russe désignant un assaut, avec pillage et meurtres, d'une partie de la population contre une autre, et entré dans le langage international pour caractériser un massacre de Juifs en Russie. Perpétrés entre 1881 et 1921, les pogromes furent si nombreux qu'une typologie a pu être établie à leur propos. Ils survenaient lors d'une crise politique ou économique et s'effectuaient grâce à la neutralité parfois aussi grâce à l'appui discret des autorités civiles et militaires.
Le première vague de pogromes eut lieu entre 1880 et 1884 : les principaux sont ceux d'Elisabethgrad l'actuelle Kirovohrad 15 avr. 1881, de Kiev 26 avr., d'Odessa 3-5 mai 1880, de Varsovie déc. 1881-janv. 1882, de Balta 22 mars 1882. Partout l'assaut était donné par des employés et des ouvriers, rejoints par des paysans des alentours. Le gouvernement russe prit prétexte des pogromes pour limiter les droits économiques des Juifs et les expulser des villages. En pleine crise révolutionnaire, entre 1903 et 1906, la deuxième vague de pogromes fut marquée par ceux de Kichinev 6 avr. 1903, de Jitomir mai 1905, de Bialystok 1er juill. 1906. La troisième vague, la plus féroce, fut consécutive à la guerre civile en Russie 1917-1921. L'Ukraine indépendante en fut le théâtre majeur : des bandes de paysans en lutte contre l'Armée rouge massacrèrent les Juifs, sous la conduite de leurs ataman et avec l'appui des troupes ukrainiennes et du Premier ministre Simon Petlioura, dans maintes villes, en particulier Proskourov 15 févr. 1919. En Russie même, l'Armée blanche de Denikine organisa plusieurs pogromes, notamment à Fastov 15 sept. 1919. La victoire de l'Armée rouge y mit fin.
Le bilan des pogromes est malaisé à établir : on peut dénombrer quelque 887 pogromes majeurs et 349 mineurs, qui auraient fait plus de 60 000 morts. Les conséquences des pogromes sont parfois contradictoires. Celui de Kichinev inspira au poète hébreu H. N. Bialik son poème Dans la ville du massacre, par lequel il appelait son peuple à se défendre avec ses propres forces ce qui était interdit depuis 1903 par une circulaire du gouvernement de Plehve. Un des objectifs russes fut en partie atteint : l'émigration juive vers l'Occident s'accrut brusquement. Le sionisme apparut alors comme la seule solution à proposer aux masses juives en danger de disparition violente. Lors de la troisième vague des années 1918-1921, les pogromes placèrent les Juifs aux côtés des Soviets. Enfin, conséquence lointaine des pogromes, Simon Petlioura fut assassiné à Paris, en 1926, par Shalom Schwarzbard, dont les parents avaient péri durant les pogromes ukrainiens. Défendu par Henri Torrès, Schwarzbard fut acquitté.
Sur les pogromes, on dispose d'ouvrages d'érudition et de reportages, cf. Die Judenpogrome en Russland, rapport de la Commission d'enquête de l'Organisation sioniste de Londres, Cologne-Leipzig, 1909-1910 ; et le livre de Bernard Lecache, Au pays des pogromes, quand Israël meurt, Paris, 1927. Gérard Nahon
Les faits détaillés La haine des Juifs dans la population
Les raisons du développement de la haine des Juifs sont facilement identifiables. Au cours des siècles, elles trouvèrent un terreau favorable dans le ressentiment religieux et sociétal à l'encontre des juifs qui était basé sur des accusations récurrentes comme le meurtre du Christ, la profanation d'hosties, les meurtres rituels, le complot juif, le vol et l'usure.
Souvent dans l'interdiction de pratiquer d'autres métiers, les Juifs exercent le rôle de prêteur et assurent ainsi une position importante dans l'économie urbaine. Mais cette activité leur attire de nombreuses inimitiés. Les chroniqueurs relatent que les Juifs font l'objet de nombreux griefs: ils sont considérés comme présomptueux, durs en affaires et ne désirent s'associer avec personne. Ce manque d'égard apparent des Juifs n'est pas dû à une dureté particulière, mais trouve sa véritable raison dans l'énormité des droits et taxes qui leur est imposée pour l'octroi d'une protection. Les Juifs formellement appartenaient toujours à la maison du roi, mais celui-ci avait depuis longtemps fait don des droits à la ville. En 1347, Charles IV avait reconfirmé l'attribution des droits à la ville Strasbourg reçoit donc la plus grande partie des impôts juifs, mais en contrepartie doit prendre à sa charge la protection des Juifs. Le montant exact des impôts est fixé dans une lettre datant de 1338, à la suite des rançonnements et des massacres de Juifs en Alsace par les bandes d'Armleder. Pour pouvoir répondre aux exigences pécuniaires de la ville, les Juifs devaient se montrer très stricts sur leurs créances, ce qui provoquait la haine de la population et surtout de leurs débiteurs.
Dans ce contexte déjà tendu, survient la menace de la peste noire, une épidémie de peste bubonique qui fit en tout près de 25 millions de morts en Europe. Les Juifs sont accusés d'empoisonner les puits. En ce début de 1349, la peste n'a pas encore atteint Strasbourg, mais les nouvelles de sa propagation à travers l'Empire germanique, créent un climat de panique parmi la population, climat entretenu par certains provocateurs dont le but inavoué est de se libérer des dettes contractées auprès des Juifs et de s'approprier leurs biens. Le peuple réclame leur extermination.
La protection politique des Juifs par le gouvernement
Contrairement à la grande majorité de la population, le conseil de la ville et le chef des corporations de métiers appliquent une politique de retenue et de protection des Juifs, et tentent de calmer le peuple afin d'empêcher le déclenchement d'un pogrom incontrôlé et sanguinaire.
Mesures tactiques
Le Conseil essaye tout d'abord d'infirmer la rumeur d'empoisonnement des puits par les Juifs. Il procède à l'arrestation de plusieurs Juifs et les fait torturer pour qu'ils avouent leurs fautes. Comme prévu, il n'obtient aucune confession des accusés, malgré le supplice de la roue. En plus, le quartier réservé aux Juifs est gardé par des gens en armes afin de les protéger et écarter tout excès de la population. Le gouvernement désire respecter la voie légale vis-à-vis des Juifs pour éviter que la situation dégénère et que leur pouvoir même soit remis en question. Un pogrom peut dégénérer facilement en soulèvement populaire incontrôlable comme cela s'était produit une dizaine d'années auparavant avec la révolte d'Armleder.
Une lettre du 12 janvier 1349 du conseil municipal de Cologne adressée à la mairie de Strasbourg, met en garde contre le risque très élevé d'une rébellion, en avertissant que dans d'autres villes, le peuple s'était révolté et qu'il en était résulté déjà de nombreux maux et de grandes dévastations. En outre, les opposants pouvaient profiter des troubles pour s'emparer du pouvoir. Les bourgeois eux-mêmes, de façon similaires aux hommes politiques, pouvaient profiter des querelles ouvertes entre les familles nobles des Zorn et des Müllenheim pour accéder au pouvoir.
La protection des Juifs
En tant que suzerain effectif des Juifs, la ville se doit de les protéger, d'autant plus que ceux-ci versent pour cela en contrepartie des sommes considérables. Peter Schwaber attire l'attention que la ville en étant payée a donné par une lettre frappée de son sceau, des gages de sécurité et qu'elle a donc un devoir à l'égard de sa minorité juive. Aussi, il ne peut approuver et refuse tout massacre de la population juive, avec en plus la crainte que cela pourrait avoir des conséquences économiques négatives pour la ville. Un affaiblissement de la ville conduirait immanquablement à un affaiblissement du patriciat bourgeois qui gère la politique de la ville de façon à pouvoir assurer une économie saine. En plus, les Juifs jouaient un rôle important en prêtant de l'argent pour tous les investissements importants et par leurs activités financières interrégionales assuraient une balance commerciale positive à la ville de Strasbourg et remplissaient les caisses de la municipalité. Il y avait donc suffisamment de raisons pour que la municipalité protège les Juifs.
La chute du conseil
La motivation des Meisters est considérée comme suspecte par les autres citoyens de Strasbourg. Pour eux au contraire, la cause évidente de la bienveillance du conseil à l'égard des Juifs, est que les maîtres se sont fait séduire par les Juifs et qu'ils agissent ainsi contre la volonté du peuple. C'est la raison pour laquelle le peuple va tout d'abord chasser les Meisters avant de se retourner contre les Juifs.
La révolte des artisans
Grâce aux récits faits par les chroniqueurs, nous possédons une chronologie assez détaillée des événements qui ont conduit à la destitution des Meisters. Le lundi 9 février, les artisans se réunissent devant la cathédrale et déclarent aux Meisters que le peuple rassemblé ne veut plus d'eux car ils ont trop de pouvoir. Cette action semble avoir été préméditée et concertée entre les différentes corporations, car tous les artisans se retrouvaient regroupés sous la bannière de leur corporation. Les Meisters essayent de leur côté de disperser le rassemblement mais sans succès et ils n'envisagent nullement dans un premier temps d'obtempérer aux exigences des séditieux.
Les artisans décident alors de nommer un nouveau conseil, mais en y incluant, à côté des artisans, des chevaliers, des employés municipaux et des bourgeois. Cette fois ci, les anciens Meisters sont conscients que plus personne ne les soutient et décident alors de rendre leur charge. Betscholt le Boucher, un artisan, est nommé Ammeister chef des corporations de métier. Ainsi, les corporations ont atteint pleinement leurs objectifs : le dernier obstacle sur la voie de l'extermination des Juifs a été éliminé et ils ont obtenu une plus grande participation dans la gestion politique de la ville. Jusqu'à présent, cela leur avait été refusé, bien que depuis 1332 le patriciat bourgeois leur avait théoriquement procuré une telle prédominance.
Les hommes derrière ce renversement
La noblesse écartée du pouvoir au profit des patriciens joue un rôle non négligeable au cours de ce soulèvement. Les familles Zorn et Müllenheim veulent récupérer leurs anciennes prérogatives même si pour cela elles doivent s'allier avec les artisans. Les chroniqueurs relèvent que les nobles se sont rassemblés en arme sur la place de la cathédrale en même temps que les artisans, qu'ils ont participé aux discussions et imposé leurs exigences aux Meisters au nom des artisans. Les nobles ne s'associent pas seulement avec les corporations, mais aussi avec l'évêque de Strasbourg. Un jour seulement avant le soulèvement, ils avaient rencontré l'évêque et discuté du problème juif. Lors de cette réunion, la discussion avait porté sur la façon de se débarrasser des Juifs, et non sur le fait de savoir si on devait se débarrasser des Juifs. Ce point était déjà décidé un mois auparavant.
Lors de cette réunion qui s'est déroulée le 8 février à Benfeld, l'évêque de Strasbourg, des représentants des villes de Strasbourg, de Fribourg et de Bâle, ainsi que des représentants de l'autorité alsacienne discutent du comportement à adopter vis-à-vis des Juifs. Tous les participants avaient en 1345 scellé entre eux une alliance de paix dans le but déviter toute forme de révolte. Peter Schwaber met en garde l'évêque et la noblesse terrienne alsacienne concernant la Question juive, en les avertissant que toute action contre les Juifs aurait de graves répercussions. Mais il ne peut convaincre personne.
Le résultat du renversement
Le renversement du conseil profite à tous les participants: les nobles retrouvent une grande partie de leurs anciens pouvoirs, les corporations participent à la vie politique, et enfin une solution rapide peut être trouvée à la Question juive. De 1332 à 1349, aucun noble n'avait un poste de Meister de la ville. Dorénavant deux des quatre Meisters sont des nobles. En plus, il est demandé une réduction du pouvoir des Meisters. Les anciens Meisters sont punis: les deux Stadtmeisters ne peuvent être élus au Conseil pendant dix ans. Quant à Peter Schwaber, particulièrement détesté, il est chassé de la ville et ses biens sont confisqués. Le Conseil est dissous et un nouveau conseil est constitué dans les trois jours qui suivent, et un jour plus tard, la Question juive est traitée.
Le pogrom Le déroulement
La passerelle des Juifs se trouve près de la Porte des Juifs de l’ancienne enceinte de Strasbourg qui menait au cimetière où furent brûlés les Juifs de la ville.
Le pogrom est résumé par un des chroniqueurs, Closener page 130, en vieil allemand,: An dem fritage ving man die Juden, an dem samestage brante man die Juden, der worent wol uffe zwei tusend alse man ahtete.Le vendredi on a capturé les juifs, le samedi on les a brûlés, ils étaient environ deux mille comme on les a estimés. Les nouveaux dirigeants décident de traiter rapidement la question juive en les exterminant, sans tenir compte de l'accord de protection signé par la ville, ni des conséquences financières pour la ville de Strasbourg. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le quartier juif est cerné et ses habitants conduits au cimetière de la communauté. Là, on bâtit un immense bûcher où ils sont brûlés vifs. Certains autres sont enfermés dans une maison en bois à laquelle on met le feu. Celui-ci dure six jours. Seuls échappent au massacre, ceux qui abjurent leur foi, les petits enfants et quelques belles femmes. ’
Bilan
Toutes les dettes dues aux Juifs sont automatiquement effacées et les gages et lettres de crédit que possédaient les Juifs rendus à leurs débiteurs. Puis après la mort des Juifs, il s'agit de distribuer leurs avoirs. Le chroniqueur Twinger von Königshofen voit là la véritable raison de l'assassinat des Juifs : S'ils avaient été pauvres et si les nobles ne leur devaient rien, ils n'auraient pas été brûlés. Le meurtre des Juifs permet ainsi à de nombreux débiteurs de se rétablir financièrement. Beaucoup de ceux qui ont favorisé le renversement du conseil avaient des dettes chez les Juifs. À côté des nobles et des bourgeois de Strasbourg, il y a l'évêque Berthold II de Bucheck, dont les droits chez les Juifs étaient insignifiants par rapport à ses dettes, mais aussi des nobles terriens et des princes tels que le margrave de Bade et les comtes de Wurtemberg. L'argent liquide des Juifs, est selon la volonté du Conseil, réparti entre les artisans, comme une sorte de récompense pour leur soutien à la destitution des anciens Meisters. Cette promesse d'une partie de la richesse des Juifs, sans doute surestimée, qui leur avait été faite auparavant, les avait donc encouragés au massacre. La mauvaise conscience semble cependant avoir tourmenté certains.
 [img width=600]http://www.harissa.com/forums/file.php?56,file=13289,filename=Strasbourg.jpg[/img]  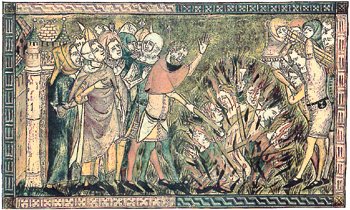  
Posté le : 14/02/2016 16:24
|
|
|
|
|
Nicolas Pache |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 février 1793 Nicolas Pache
est proclamé maire de Paris avec 11 881 suffrages sur 15 191 votants. À la commune de Paris, il retrouva Hébert élu peu de temps auparavant substitut du procureur.
Jean-Nicolas Pache, né à Verdun le 5 mai 1746 et mort à Thin-le-Moutier Ardennes le 18 novembre 1823 à 77 ans, est un homme politique français, actif pendant la Révolution. ministre de la Guerre du 3 octobre 1792 au 31 janvier 1793, dansle Groupe politiquehébertiste, puis maire de Paris du 14 février 1793 au 10 mai 1794 représentant le Groupe politique hébertiste. Né le 5 mai 1746 à Verdun dans la Meuse. Il décède le 18 novembre 1823 à 77 ans à Thin-le-Moutier Politique Français, son père est Nicolas Pache et sa mère Jeanne Lallemand, sa conjointe est Marie-Marguerite Valette 1746-1786, ses enfants sont Marie-Sylvie 1777.
Sa vie
Son père, Nicolas Pache, originaire d’Oron en pays de Vaud, est venu s’installer en Lorraine où il se maria avec Jeanne Lallemand. Jean-Nicolas Pache est né à Verdun le 5 mai 1746. On ignore presque tout de son enfance sinon que son père a été garde suisse au service de la comtesse de La Marck, puis gardien de l'hôtel du maréchal de Castries.
Le maréchal de Castries s’intéressa au jeune Pache comme s’il était son fils, l'emmena en 1774 à l’École royale du génie de Mézières où il connut Gaspard Monge. Cette rencontre fut le point de départ d'une longue amitié entre les deux hommes, Gaspard Monge et Jean-Nicolas Pache. Le duc de Castries l'employa aussi, dans les années 1770, comme précepteur de ses enfants.
Lorsqu'il devint ministre de la Marine, Castries offrit à son protégé un emploi de Premier secrétaire et de munitionnaire général des Vivres qu'il quitta en 1784 tout en continuant à recevoir un traitement.
La protection de Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries tenait beaucoup au fait qu'on avait prévu de marier le jeune homme à Marie-Marguerite Valette 1746-1786, la fille naturelle de Castries et de Marie-Anne Françoise de Noailles 1719-1793 ce qui fut fait. Le couple eut une fille, Marie-Sylvie, née en 1777, puis un fils, Jean, né en 1779 qui prit le nom de Marin-Pache. Mais Mme Pache mourut en 1786 et la mère du futur maire de Paris, Jeanne Lallemand, s’occupa de l’éducation des deux petits-enfants.
Probablement par la famille Curchod, Pache était en relation avec les représentants de la banque suisse à Paris et avec le plus célèbre d'entre eux, Jacques Necker, qui le fit pensionner avec l'emploi de contrôleur de la Maison du roi. Ces fonctions ne convenaient pas au caractère de Jean-Nicolas Pache, qui démissionna en 1784, et se retira quelques années avec les siens en Suisse, probablement à Genève, où deux ans plus tard il perd son épouse.
Revenu à Paris, peu après la Révolution de 1789, sous l'injonction de Gaspard Monge, Pache occupa avec sa mère et ses deux enfants un appartement dans l'hôtel du maréchal de Castries. Or ce dernier était connu pour son hostilité fondamentale à la Révolution. Une émeute envahit cet hôtel au début de la Révolution et le mit au pillage.
Pache avait, auprès de certains de ses contemporains la réputation d’un personnage calme épris des idées de Jean-Jacques Rousseau, bon père de famille que rien ne semblait prédisposer à devenir un des hommes politiques et révolutionnaires de la Commune de Paris
En août 1791, alors qu'il n'avait encore aucune fonction officielle, il fit l'acquisition d'une ancienne abbaye, de ses dépendances et des terres agricoles, à Thin-le-Moutier, petite commune des Ardennes. C'était un bien ayant appartenu au Séminaire de Reims, vendu comme bien national et revendu aux enchères, le premier acquéreur n'ayant pu effectué les versements. Pache est désigné dans l'acte de vente comme simple citoyen de Paris, et ancien premier Secrétaire de la Marine.
Les débuts politiques
Membre de la section du Luxembourg, il créa en janvier 1792 la société patriotique du Luxembourg où furent reçus ses amis les scientifiques Gaspard Monge, Meusnier de la Place et Vandermonde, également Hassenfratz. Les statuts de cette société précisent qu’elle agissait pour répandre dans le peuple la connaissance des devoirs et du rôle de chaque citoyen dans le fonctionnement de la Constitution. Il habitait rue de Tournon au n° 1133, l'actuel n°6. Il s'agit de l'ancien hôtel Terrat appelé par la suite hôtel de Brancas, lequel appartient jusqu'en l'an VIII à Louis Paul de Brancas et son épouse Marie-Anne Grandhomme de Gisieux. Pendant cette période Pierre-Simon Laplace y est aussi noté comme locataire.
Jean-Marie Roland le prit comme chef de cabinet dans le premier ministère girondin composé par Dumouriez et accepté par Louis XVI. Bien que d'opinion plus radicale, il avait attiré l'attention de Monsieur Roland, comme de Madame, par son calme, par sa capacité de travail, et par sa simplicité. Madame Roland, dans ses Mémoires, le décrit arrivant tous les jours à sept heures du matin, un morceau de pain dans la poche. Puis Pache assista Joseph Servan dans son ministère, à la demande de ce dernier, submergé de travail. En juin 1792, il partagea la disgrâce de ces ministres girondins avec lesquels il avait pris ses distances, et retourna à sa section. Il refusa ultérieurement plusieurs postes, dont l'intendance du garde-meuble.
Le ministre de la guerre
En septembre 1792, Jean-Nicolas Pache fut sollicité pour devenir ministre de la Marine, mais il refusa, proposant son ami Gaspard Monge. À la demande de ce dernier, il accepta une mission à Toulon. Puis, le 3 octobre 1792, alors qu'il se trouvait toujours à Toulon, il fut nommé ministre de la Guerre sur les recommandations de Jean Marie Roland qui le croyait sans doute attaché à sa personne, mais dont il s'écartait de plus en plus en termes d’idées : Mme Roland le lui reprocha amèrement dans ses Mémoires.
Au ministère, il fit procéder à des recrutements d’hommes se consacrant avec passion aux événements révolutionnaires, alors que s'opérait dans l'armée un renouvellement similaire des cadres. Le plus célèbre des nouveaux entrants au ministère était Jacques-René Hébert, auteur du journal le Père Duchesne qui fut témoin, à la mi-janvier 1793, au mariage de la fille de Pache, Sylvie avec François-Xavier Audouin. Ce dernier, révolutionnaire devenu haut fonctionnaire du ministère de la guerre, y avait été nommé également par son futur beau-père. Le ministre réforma également l'administration des vivres, celle des hôpitaux, celle de l'habillement, et celle de l'armement, réformes critiquées par ses adversaires politiques et par le général Dumouriez, alors à la tête de l'armée de la République.
Pache s'employa également à contenir dans son rôle militaire ce général Dumouriez, ayant de grandes ambitions politiques, et auréolé de son succès de Valmy puis de Jemmapes. Ce militaire intriguait au sein des milieux politiques parisiens et gardait également des contacts avec les puissances étrangères alors opposées à la République Française. Plus encore que La Fayette et bien avant Napoléon Bonaparte, il tentait d'inventer une figure nouvelle dans la politique française, de général, dernier recours des politiques, mettant à bas la frontière entre la chose militaire et la chose politique, et critiquant son ministre. Pache a réussi à se maintenir quatre mois au ministère alors que huit ministres s'étaient succédé à ce poste en 1792 avant son arrivée en octobre de la même année.
Pour un de ses adversaires politiques, le conventionnel Louis Sébastien Mercier, son rôle a été plus néfaste aux intérêts du pays que toutes les armées de la coalition. Pourtant, nommé ministre un mois après Valmy, il a su accompagner les succès des armées révolutionnaires. Celles-ci, après Jemmapes, occupèrent la Belgique et la rive gauche du Rhin, dépassant les limites naturelles que l'ancienne monarchie avait vainement tenté d'obtenir par le passé. Il s'est battu pour maintenir les prérogatives des politiques vis-à-vis de la hiérarchie militaire. Il a renouvelé l'encadrement du ministère pour en garantir le contrôle politique, ce qui bénéficiera à ses successeurs. Par contre, les révolutionnaires qu'il a introduit au sein de ce ministère, et dont il a favorisé l'ascension, se sont souvent comportés en apparatchiks.
Finalement, fin janvier 1793, les Girondins, ayant subi la démission de Jean-Marie Roland du ministère de l'Intérieur, firent partir Pache du ministère de la Guerre et le remplacèrent, le 4 février 1793, par un ami de Dumouriez, Beunonville.
Le maire de Paris
Au moment même où il quitta le ministère du travail, Nicolas Chambon, un Girondin, maire de Paris difficilement élu quelques mois auparavant, démissionna, ouvrant la porte à de nouvelles élections. Les élections municipales d'octobre-novembre 1792 puis de février 1793 furent les seules élections municipales tenues au suffrage élargi, c'est-à-dire sans condition fiscale ou de ressources, pendant la décennie révolutionnaire. Il y eut 50 % de plus de votants qu'aux élections précédentes de 1791, même si la proportion de votants représentent moins du dixième des électeurs potentiels. Le 11 février 1793, Pache était élu puis, le 14 février, proclamé maire de Paris avec 11 881 suffrages sur 15 191 votants. À la commune de Paris, il retrouva Hébert élu peu de temps auparavant substitut du procureur.
À peine élu, il fut confronté à une crise des subsistances et à une augmentation des prix des denrées. Ce sujet restera d'actualité toute la durée de son mandat. À peine arrivé à la tête de la commune, un groupe de femmes le sollicita ainsi pour qu'il les autorise à pétitionner à l'assemblée sur les prix de la nourriture et la punition des accapareurs. Il leur répondit qu'elles n'avaient pas besoin de son autorisation pour exercer leur droit de pétition, mais les encouragea à le faire dans le calme. Mais ce mouvement s'amplifia. Le lendemain 25 février, des pillages commencèrent rue des Lombards et se propagèrent, alors que le commandant de la garde nationale, Santerre, se trouvait à Versailles. Pache procéda à une proclamation appelant au calme et se porta à la rencontre d'un des attroupements perturbateurs, rue de la Vieille Monnaie, sans grand succès. Il dut arrêter de sa main un gendarme qui pillait lui-même. Le calme mit plusieurs jours à revenir.
Tribunal révolutionnaire
Constamment, Pache exhorta à se méfier des agitateurs, tout en faisant pression sur la Convention pour limiter la liberté économique des négociants. Il expliqua aussi de façon simple et laconique, par affichage, que s'en prendre aux arrivages de marchandises était contraire au bon approvisionnement de Paris.
Plus symboliquement, il fit inscrire sur les frontons des établissements publics de la capitale la devise proposée par Momoro : Liberté, Égalité, Fraternité.
Il se trouva confronté régulièrement à des manifestations et mouvements des sections parisiennes. Ainsi, le 10 mars 1793, il repoussa les députations d'un mouvement insurrectionnel qui voulait s'en prendre, physiquement, aux 22 députés girondins de la Convention. Ce jour-là, la commune n'osa pas favoriser un mouvement auquel les esprits n'étaient pas assez préparés, elle s'en indigna même très sincèrement.
En avril et mai 1793, la tension continuait à monter entre Montagnards et Girondins. Le 15 avril, une pétition demandant l'expulsion des 22 girondins de la Convention fut adoptée par 35 des 43 sections de la Commune. Pache la signa après quelques hésitations et, prenant la tête du cortège des commissaires de section, la porta à la barre de la Convention.
Le 18 mai, la Convention, où de nombreux Montagnards étaient absents, réagit en désignant une commission de 12 députés chargés d'examiner les actes de la Commune depuis un mois, mesure qui excita encore les passions. Le 20, les sections parisiennes firent pression sur Pache pour qu'il prenne la tête d'un mouvement visant à enlever immédiatement les 22 girondins au sein de la Convention. Pache replaça ce qu'on exigeait de lui dans la limite de la loi et de ses fonctions, et limita les délibérations de la municipalité à la constitution d'une liste de suspects. Il s’éleva aussi contre les actes de violence. Il restait ainsi fidèle à sa ligne directrice : assurer le succès de la Révolution en évitant les affrontements violents, et épargner à la Capitale les convulsions d'une guerre civile, comme elle en avait connues sous l'égide d'un de ses prédécesseurs avec les massacres de Septembre 1792, ou comme elle les connaîtra avec la réaction thermidorienne.
Le 24 mai 1793, la commission des 12 députés fit arrêter Hébert. À partir du 31 mai, une émeute menée par des sans-culottes des quartiers populaires et une majorité de sections municipales, avec à leur tête un quasi-inconnu, Claude-Emmanuel Dobsen, encercla l'Assemblée Nationale. Ils avaient avec eux la garde nationale commandée par François Hanriot. Hébert fut libéré. Hébert et Pache s'employèrent à modérer les esprits. La Convention supprima la commission des 12, sans que ceci suffise. Et le 2 juin, toujours encerclée, la Convention céda et fit arrêter en son sein 29 députés girondins. Dans les semaines et mois qui suivent, près d'une centaine de Girondins, députés, ministres et diverses personnalités, furent également arrêtés.
Le 19 août 1793, dans une proclamation, Pache s'en prit à nouveau aux agitateurs qui utilisaient la question des subsistances. Il évoqua dans cette proclamation des malveillants ayant des visées contre-révolutionnaires.
Le 24 octobre 1793, Pache fut le premier témoin cité à comparaître au procès des Girondins, devant le Tribunal révolutionnaire. Il se montra prudent et évasif. Il n'énonça aucun fait contre les accusés prouvant un complot prémédité de leur part. Il se contenta de citer des refus de fonds financiers et des menaces d'arrestation à l'égard d'officiers municipaux.
À partir de décembre 1793, une opposition apparut de plus en plus entre les amis politiques de Robespierre d'une part, et les hébertistes d'autre part. Des rumeurs sur un projet de Vincent, Ronsin, Chaumette, Momoro ou Hébert circulaient dans Paris, projet qui comportait l'établissement d'un grand juge. Si chacun des principaux membres de cette faction espérait peut-être s'arroger à terme cette magistrature suprême, la fonction aurait été initialement dévolue à Pache, sans qu'il soit prouvé que celui-ci ait été consulté sur cette perspective qui l'exposait dangereusement. Le 4 mars 1794, à une séance du Club des Cordeliers, les hébertistes annoncèrent une insurrection prochaine. Velléités ou réel complot insurrectionnel ? Robespierre, Saint-Just et le Comité de salut public se devaient de réagir. Après s'être assuré de la neutralité du club des Cordeliers, Saint-Just présenta un rapport à la Convention. Et le soir même, dans la nuit du 13 au 14 mars 1794, Hébert et ses amis furent arrêtés. Rapidement condamnés, ils furent exécutés le 22 du même mois.
Le spectre de la guillotine
Bien que son nom ait été associé aux projets des Hébertistes, Pache ne fut pas emporté dans cette charrette. Dès le 19 mars 1794, il était d'ailleurs à la barre de la Convention venu affirmer son respect des institutions et protester de la pureté de ses intentions. Plus tard, Lecointre de Versailles, porte-parole de ses collègues conventionnels, accusa le Comité de sûreté générale d'avoir dans l'affaire d'Hébert, Vincent et autres, arrêté l'effet d'un mandat d'arrêt lancé contre Pache. Il l'accusait aussi d'avoir non seulement empêché Fouquier de mettre le mandat à exécution mais de ne pas permettre qu'il soit parlé de Pache, d'où il est résulté que la parole a été interdite aux témoins qui ont voulu parler de Pache et même aux accusés lorsqu'ils ont demandé qu'il parût.
Paradoxalement c'est un incident survenu au domicile de son ami Gaspard Monge, dans le prolongement de ces événements, qui provoqua la fin de sa carrière politique. Gaspard Monge recevait régulièrement des hommes politiques dans son salon rue des Petits-Augustins. Le 9 mai 1794 au soir, la fille de Pache, Mme Audoin, présente ce soir-là, se querella avec Lazare Carnot, Prieur de la Côte d'Or et d'autres membres du Comité de salut public, à propos du procès des Hébertistes encore très récent. Dénoncés par Lazare Carnot, tous les membres de sa famille furent arrêtés — à savoir Pache, sa fille Sylvie et son gendre Audouin, également son jeune fils, sa mère et un couple d'amis. Pache fut placé en détention, tandis qu'on le remplaçait par Fleuriot-Lescot à la mairie de Paris.
Les membres de la famille Pache furent volontairement disséminés dans différentes prisons, et discrètement protégés par leurs amis, qui restaient nombreux. Ils attendirent ainsi la chute de Robespierre et furent tous épargnés. Ils furent libérés dès le 14 thermidor an II et les scellés apposés au domicile des Pache levés le lendemain. Sylvie, la fille de Pache, fut libérée le 20 thermidor.
Pache fut encore cité dans une mise en accusation le 19 prairial an III au Tribunal criminel du département d’Eure-et-Loir chargé de juger les auteurs de l'insurrection du 1er prairial an III et les anciens montagnards suspectés d'être à l'origine de ce mouvement populaire contre la Convention. Mis en prison à Chartres, il bénéficia de la loi d'amnistie du 4 brumaire an IV 2 octobre 1795 et fut de nouveau remis en liberté. Revenu à Paris, il y resta huit jours, et décida rapidement de quitter la ville, soumise à la Terreur Blanche.
Sa retraite à Thin-le-Moutier
Il possédait un toit à Thin-le-Moutier et décida d'en faire son refuge. Il quitta la capitale qu'il avait administrée caché dans une voiture chargée de paille, puis continua habillé en paysan, jusqu'à la porte du fermier qui exploitait ses terres. Son arrivée ne fit pas sensation dans ce petit village des Ardennes, loin de l'agitation parisienne. Il évita de se montrer et de se manifester pendant plusieurs mois, et dut subir des tracasseries juridiques et des citations à comparaître jusqu'au coup d'État du 18 fructidor an V 4 septembre 1797, qui priva ses adversaires les plus acharnés de moyens de lui nuire.
Son mode de vie, son habillement, son mobilier étaient modestes
Avec l'accord bienveillant de l'administration départementale, il devint quelque temps membre de la Société d'agriculture, arts et commerce du département des Ardennes. Mais, suite au coup d'État du 18 brumaire, il se retira complètement de la scène publique, par prudence probablement, mais aussi sans doute par déception.
En 1803, le Premier Consul Napoléon Bonaparte se rendit en visite en Ardennes, accompagné de Gaspard Monge. Celui-ci vint un soir à Thin-le-Moutier au domicile de son ami Pache, porteur d'une lettre de Bonaparte avec des propositions4. Pache raccompagna son visiteur, le lendemain matin, jusqu'à la sortie de la vallée et ils s'embrassèrent une dernière fois.
L'ancien conventionnel, et ministre de la Guerre, Dubois-Crancé, installé dans une autre petite commune des Ardennes, vint également à Thin-le-Moutier partager quelques instants avec lui, mais sans avoir d'autre objectif que le plaisir de le revoir4. Ses enfants et ses petits-enfants lui restèrent attentifs et vinrent régulièrement lui rendre visite, même si sa fille Sylvie et son gendre Audoin étaient devenus royalistes après 1815. Il mourut d'une pleurésie en 1823.
  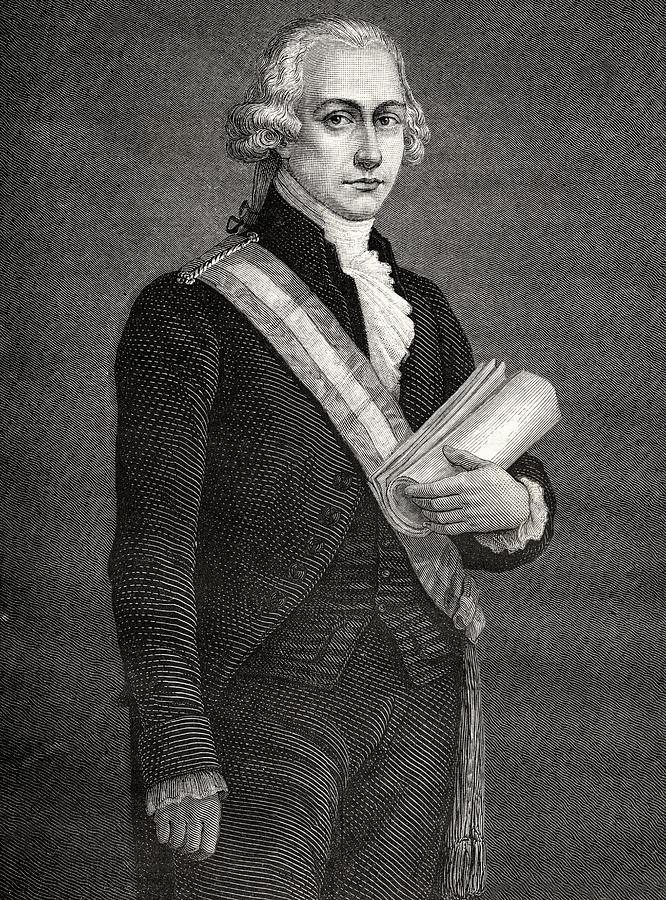  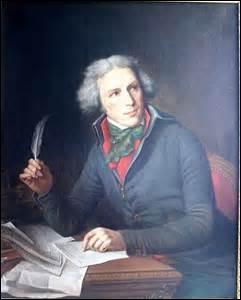
Posté le : 13/02/2016 23:05
Edité par Loriane sur 14-02-2016 22:39:40
Edité par Loriane sur 14-02-2016 22:41:52
|
|
|
|
|
Otton III 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 ou 23 janvier 1002 meurt Otton III
ou Othon III à Paterno Latium sur le mont Soracte en Italie, né en juin ou juillet 980 dans la forêt royale de Kessel Ketil, près de Clèves, en Italie. Prince de la lignée ottonienne, il est roi des Romains à partir de 983 et empereur des Romains de 996 à 1002.
Roi de Francie Orientale Germanie de 983 à 1002, son prédécesseur est Otton II du Saint-Empire, son successeur est Henri II du Saint-Empire, empereur du Saint-Empire
de 996 – 1002 son prédécesseur est son père Otton II son successeur est Henri II. il est Roi d'Italie de 996 – 1002, son prédécesseur est Otton II du Saint-Empire, son successeur est Arduin d’Ivrée
Sa mère est Théophano, après la mort de son père Otton II du saint empire, survenue le 7 décembre 983, il est couronné roi des Romains le 25 décembre 983 à Aix-la-Chapelle, à l'âge de trois ans. Le prince Henri le Querelleur l'enlève alors et tente de se faire attribuer sa tutelle. Mais l'archevêque de Mayence Willigis, soutenu par d'autres grands, condamne cette usurpation et impose la régence de sa mère, la princesse byzantine Théophano. Après le décès de celle-ci, en 991, c'est Adélaïde, grand-mère de l'empereur, qui assure sa tutelle.
En 995, Otton est majeur et prend officiellement le pouvoir ; il rêve de fonder un empire universel qui réunirait d'abord tous les peuples chrétiens d'Occident. Il intervient dans les affaires de l'Église et impose contre l'avis des cités rebelles de la péninsule italienne ses propres candidats au trône papal. Il y fait ainsi placer son homme de confiance, par ailleurs son cousin, Brunon de Carinthie, premier pape d'origine germanique, sous le nom de Grégoire V. Couronné empereur par ce dernier le 21 mai 996, Otton installe sa cour à Rome : sous son règne, l'Italie redevient le siège du gouvernement impérial.
Avec l'aide de Gerbert d'Aurillac, l'écolâtre de Reims qui fut son précepteur et qu'il fait élire pape en 999, Otton se rapproche de la Pologne et fait parvenir à Étienne de Hongrie la première couronne royale de ce pays.
Dans un texte de janvier 1001, les rapports entre le pape Sylvestre II et l'empereur sont redéfinis. Otton III refuse de confirmer le Privilegium Ottonianum accordé par Otton Ier en 962. L'empereur accorde au souverain pontife huit comtés de la Pentapole. Otton III se voit comme Esclave des Apôtres, le représentant direct de Pierre et le responsable de son patrimoine. Il souhaite gouverner la chrétienté et se met sur le même plan que le pape, avec lequel il veut présider les synodes. Mais les deux hommes se trouvent bientôt chassés de Rome par la population et la tentative d'unir le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel tourne court. Otton meurt en 1002, à l'âge de 22 ans, et son corps est ramené d'Italie en Germanie pour être inhumé à Aix-la-Chapelle.
En bref
OTTON III 980-1002 et l' empereur germanique 996-1002 Empereur germanique 983-1002, né en juillet 980 près de Clèves, mort le 23 janvier 1002, près de Viterbe Italie.
Fils d'Otton II 955-983 et de l'impératrice Théophano v. 955-991, Otton est élu roi des Germains en juin 983 et couronné à Aix-la-Chapelle en décembre de la même année, peu après la mort de son père. Durant son enfance, il est enlevé par Henri le Querelleur, le duc de Bavière déposé par son père, qui espère ainsi s'assurer la régence, voire le trône. En mai 984, la diète impériale contraint cependant Henri à restituer l'enfant à sa mère, laquelle assumera la régence jusqu'à sa mort en 991. La grand-mère d'Otton, l'impératrice douairière Adélaïde, prend alors le relais jusqu'à la majorité du roi, en 994.
Répondant à l'appel du pape Jean XV qui lui demande de l'aider à mater une rébellion conduite par le noble romain Crescentius II, Otton III traverse les Alpes en 996. Déclaré roi de Lombardie à Pavie, il atteint Rome après la mort du pape. Il fait alors élire au Saint-Siège son cousin de vingt-trois ans, Bruno de Carinthie, qui prend le nom de Grégoire V. Premier pape germanique, celui-ci sacre Otton empereur le 21 mai 996. Lorsque ce dernier rentre en Germanie, Crescentius chasse Grégoire de Rome et le remplace par Jean XVI. Otton III retourne alors en Italie à la fin de l'année 997. Après s'être emparé de Rome en février 998, il exécute Crescentius, dépose Jean XVI et restaure le pape Grégoire.
Rêvant de faire renaître la gloire et la puissance de l'ancien Empire romain, Otton ambitionne de créer un État chrétien universel gouverné depuis Rome et dans lequel le pape serait soumis à l'autorité de l'empereur tant pour les questions religieuses que civiles. Il s'attelle ainsi à faire de Rome sa résidence officielle et le centre administratif de l'empire. Instituant un cérémonial de cour byzantin élaboré et rétablissant d'anciennes traditions romaines, il se nomme « serviteur de Jésus Christ », « esclave des apôtres » et « empereur du monde » et se considère comme le souverain de la chrétienté. Lorsque Grégoire V meurt en 999, Otton fait élire à sa place le Français Gerbert d'Aurillac, son ancien précepteur qui accepte son concept d'empereur théocratique, et prend le nom de Sylvestre II.
En l'an 1000, Otton se rend en pèlerinage sur la tombe de l'archevêque mystique Adalbert de Prague, à Gniezno, et fait de la ville l'archevêché de Pologne. Lorsqu'en janvier 1001 Tibur Tivoli, en Italie s'insurge contre Otton, l'empereur assiège la ville et la force à se rendre avant de donner son pardon à ses habitants. Furieux de cette décision, les Romains, qui voulaient voir cette rivale détruite, se révoltent à leur tour contre Otton en février 1001 et assiègent son palais. Après avoir momentanément apaisé les rebelles, Otton se retire au monastère de Saint-Apollinaire, près de Ravenne, afin de faire pénitence. Incapable de reprendre le contrôle de la cité impériale, il demande une aide militaire à son cousin Henri de Bavière, qui lui succédera comme roi des Germains puis comme empereur sous le nom de Henri II le Saint. Otton III meurt peu après l'arrivée des troupes bavaroises dans son campement.
Sa vie
L'Europe ottonienne
Pendant la seconde moitié du xe siècle, les Ottoniens sont la dynastie la plus puissante d'Occident. Otton Ier, grâce à une puissante clientèle, a pu mettre fin aux incursions des Magyars, en leur infligeant une sévère défaite à la bataille du Lechfeld en 955. À la suite de cette victoire face aux Hongrois, Otton Ier rétablit, au sud de la Germanie, les marches d'Ostmark la future Autriche, dont les Babenberg vont devenir les margraves jusqu'au XIIIe siècle. Otton Ier reconstitue aussi la marche de Carinthie, et apparaît ainsi comme le défenseur de la chrétienté. La même année, il bat les Slaves Abodrites en Mecklembourg.
Ces victoires lui permettent aussi de jouer un rôle majeur sur le plan européen. Il obtient l'allégeance des rois de Bourgogne. Face aux Slaves, il conduit une véritable politique d'expansion vers l'est. Il établit des marches à l'est de l'Elbe : marche des Billung, autour de l'évêché d'Oldenbourg, Nordmark ancien nom du Brandebourg et trois petites marches chez les Sorbes. En 968, il fonde l’archevêché de Magdebourg, avec des évêques suffrageants à Meissen, Mersebourg et Zeitz, dans le but de convertir les peuples slaves de l'Elbe. Mieszko Ier, premier souverain historique de la Pologne, lui rend hommage en 966. En Germanie, Othon Ier rend la Bohême tributaire et vainc les ducs de Franconie et de Lotharingie.
Le pape Jean XII, menacé par les projets expansionnistes du roi de Lombardie Bérenger II, doit demander la protection d'Otton Ier6. Celui-ci peut ainsi se faire couronner empereur et promulguer, le 13 février 962, le Privilegium Ottonianum, qui accorde au souverain pontife les mêmes privilèges que ceux que les Carolingiens avaient reconnus à la papauté, à savoir les donations faites par Pépin le Bref et Charlemagne, mais oblige tout nouveau pape à prêter serment auprès de l'empereur ou de son envoyé avant de recevoir la consécration pontificale. Tout en donnant des avantages au Saint-Siège, le Privilegium Ottonianum place la papauté sous tutelle impériale. Le pape ayant essayé de s'opposer à cette mainmise en s'alliant au fils de Béranger et aux Byzantins, Otton revient en Italie à la tête de son armée et le fait déposer le 4 décembre 963. Jean XII est remplacé par un laïc, qui prend le nom de Léon VIII. Otton Ier fait également jurer aux Romains qu'ils n'éliraient ni n'ordonneraient aucun pape en dehors du consentement du seigneur Otton ou de son fils. Les Ottoniens contrôlent alors totalement l'élection du pape et la collaboration du pontife garantit l'autorité impériale sur les Églises locales du Saint-Empire. Comme Charlemagne, Otton reçoit de Rome la mission de défendre l'ordre et la paix de la chrétienté.
Le nouvel empereur accroît sa puissance sur la Francie occidentale en portant son attention sur l'ensemble des évêchés frontaliers Reims, Verdun, Metz. L'archevêque de Reims qui assure le choix des rois de Francie Adalbéron tend ainsi à afficher ses sympathies impériales.
À la mort de leurs pères en 954 et 956, Lothaire, le nouveau roi des Francs, n'a que 13 ans et Hugues Capet, l’aîné des Robertiens, seulement 15. Otton Ier entend alors mettre sous tutelle la Francie, ce qui lui est possible puisqu'il est l'oncle maternel des deux adolescents. Le royaume de Francie, en 954, et la principauté robertienne, en 956, sont donc mis sous la tutelle de Brunon, archevêque de Cologne et duc de Lotharingie, frère d'Otton Ier. Son objectif est de maintenir l'équilibre entre les Robertiens, les Carolingiens et les Ottoniens. La tutelle d'Hugues Capet est doublée par celle de Lothaire. En 960, le roi des Francs consent à rendre à Hugues l'héritage de son père, avec le marquisat de Neustrie et le titre de duc des Francs. Mais, en contrepartie, le duc doit accepter la nouvelle indépendance acquise par les comtes de Neustrie pendant la vacance du pouvoir. Son frère Otton n'obtient que le duché de Bourgogne. Sous la tutelle de Brunon de Cologne, la Francie est de plus en plus satellisée par Aix-la-Chapelle. En 965, Lothaire fait ainsi pâle figure au rassemblement des vassaux et parents d'Otton.
L'empire : puissance économique
Avoir une clientèle suffisamment puissante pour contrôler l'empire nécessite de grandes ressources financières. Avec la généralisation du denier d'argent par les Carolingiens, une révolution économique est en cours : les surplus agricoles deviennent commercialisables et on assiste, dans tout l'Occident, à l'accroissement de la productivité et à la multiplication des échanges. En réunissant Italie et Germanie dans un même empire, Otton Ier contrôle les principales voies de commerce entre l'Europe du Nord et la Méditerranée. Le trafic commercial avec Byzance et l'Orient transite en effet de la Méditerranée vers l'Italie du Sud et surtout le bassin du Pô et rejoint celui du Rhin via les voies romaines traversant les cols alpins. Cette voie est, à l'époque, plus utilisée que la traditionnelle voie rhodanienne parce que l'Adriatique est plus sûre que la Méditerranée occidentale, où sévissent les pirates sarrasins. Les Ottoniens ont su garder la mainmise sur les péages prélevés sur ce trafic et développer les marchés nécessaires à son augmentation. Ainsi, contrairement à ce qui se passe en Francie, ils gardent le monopole de la frappe monétaire et font ouvrir des mines d'argent près de Goslar. Or, la création d'un atelier monétaire dans une ville ou une abbaye entraîne la création d'un marché où peut être prélevé le tonlieu. Cette puissance commerciale leur permet d'acheter la clientèle qui est la base de leur pouvoir, mais aussi d'étendre leur influence à la périphérie de l'Empire : les marchands italiens ou anglais ont besoin de leur soutien, les Slaves adoptent le denier d'argent...
L'Église, clef de voûte de l'administration ottonienne
Sous les Carolingiens, la mise en place progressive de l'hérédité des charges avait fortement contribué à l'affaiblissement de leur autorité. Pour éviter une pareille dérive, les Ottoniens s'appuient sur l'Église germanique qu'ils comblent de bienfaits mais qu'ils assujettissent.
Les évêques et les abbés constituent l'armature de l'administration ottonienne. L'empereur s'assure la nomination de tous les membres du Haut clergé de l'Empire. Une fois désignés, ils reçoivent du souverain l'investiture symbolisée par les insignes de leur fonction, la crosse et l'anneau. En plus de leur mission spirituelle, ils doivent remplir des tâches temporelles que leur délègue l'empereur. L'autorité impériale se trouve ainsi relayée par des hommes compétents et dévoués. Cette Église d'Empire ou Reichskirche, assure la solidité d'un État pauvre en ressources propres. Elle permet de contrebalancer le pouvoir des grands féodaux ducs de Bavière, Souabe, Franconie, Lotharingie. L'évêché d'Utrecht constitue, jusqu'aux environs de 1100, l'entité la plus puissante des Pays-Bas du Nord, comme ceux de Liège et Cambrai pour les Pays-Bas du Sud. Le pouvoir impérial choisit ses hauts dignitaires de préférence dans sa parentèle, proche ou élargie. Celle-ci bénéficie des plus hautes charges épiscopales ou monastiques. Le meilleur exemple en est le propre frère d'Otton, Brunon de Cologne, archevêque de Cologne, qui impose la règle de l'abbaye de Gorze à tous les monastères de son diocèse. On peut citer aussi Thierry Ier, cousin germain d'Otton, évêque de Metz de 965 à 984 ; un parent proche d'Otton, le margrave de Saxe Gero, qui fonde l'abbaye de Gernrode vers 960-961, en Saxe ; Gerberge, nièce de l'empereur, abbesse de Notre-Dame de Gandersheim.
L’empire en l'an mil.
Royaume de Germanie
Royaume d'Italie
États pontificaux
Royaume de Bourgogne indépendant
Les marches sont figurées en hachuré
La puissance des grands féodaux
L'empire ottonien est cependant relativement décentralisé et, contrairement aux évêques dont la charge est remise entre les mains de l'empereur après leur mort, les grands féodaux jouissent d'une transmission héréditaire de leurs possessions. Dès lors, le souverain n'a que peu de contrôle sur eux et de grandes familles aristocratiques soutenues par de fortes clientèles sont en mesure de contester son pouvoir.
Otton II doit ainsi faire face au puissant duc de Bavière, son cousin Henri le Querelleur. En effet, les ducs de Bavière disposent des évêchés du sud de la Germanie qu'ils attribuent à des membres de leur famille. La Bavière impose sa suzeraineté à une grande partie de l'Autriche actuelle et au sud, jusqu'à la mer Adriatique et au lac de Garde. Allié à Boleslav II de Bohême, à Mieszko Ier de Pologne, aux Danois et à des minorités slaves, Henri est en mesure de menacer le jeune Otton II qui doit le vaincre militairement, ainsi que ses alliés, pour prendre effectivement le pouvoir. Ce danger ressurgit à chaque affaiblissement du pouvoir impérial. C'est le premier défi auquel sont confrontés Otton III et sa mère, la régente Théophano, à la mort d'Otton II.
Des frontières menacées
Durant tout son règne, Otton II doit lutter à ses frontières. À l'ouest, les Carolingiens veulent récupérer leur berceau familial qui pourrait leur permettre de revendiquer la couronne impériale : la Lotharingie. Au nord, les Danois ou, à l'est, les Slaves s'allient à ses ennemis. Au sud, il doit lutter contre les Byzantins et les Sarrasins pour le contrôle du sud de la péninsule. C'est donc d'un empire plus fragile qu'il n'y paraît qu'hérite Otton III en 983.
Période de régence Des débuts difficiles
La Couronne d'Otton III, probablement ceinte lors du couronnement à Aix-la-Chapelle, est conservée depuis des siècles dans le trésor de la cathédrale d'Essen.
Otton III n'a que deux ans en juillet 982, quand l'armée impériale est anéantie en Calabre par les Sarrasins à la bataille du cap Colonne. Son père Otton II est alors en grande difficulté et doit demander des renforts en Germanie. Il est courant, à l'époque, de faire sacrer son successeur de son vivant surtout quand le souverain est à la tête de l'armée pour que le pays ne subisse pas de remous politique en cas de décès sur le champ de bataille : Otton II est ainsi associé à la couronne par son père Otton Ier dès 967 ; de même Hugues Capet fait couronner Robert le Pieux dès le début de son règne car il doit prêter secours à son vassal Borrell II dont le comté de Barcelone est menacé par les Sarrasins.
Otton III est donc élu roi des Romains par les grands de Germanie et d’Italie dès l'âge de trois ans, du vivant de son père, lors d'un ban royal à Vérone en mai 983. Les sources ne nous disent pas pourquoi il a fallu, à ce moment précis, assurer la succession au trône du fils mineur du souverain, mais il est possible que la défaite du cap Colonne ait fragilisé la position de l'empereur vis-à-vis de ses vassaux et qu'il ait voulu conforter la succession dynastique dont le principe n'est nullement garanti par le système électif utilisé dans le Saint-Empire. Après avoir pris congé des princes électeurs du ban, Otton III traverse les Alpes pour être couronné à Aix-la-Chapelle, ville traditionnelle du sacre des Ottoniens. Lorsque l'enfant est couronné roi à Aix-la-Chapelle à la Noël de l'an 983 par l'archevêque de Mayence Willigis et par Jean de Ravenne, son père Otton II est déjà mort depuis trois semaines. Ce n'est qu'après les fêtes de couronnement que la cour apprend la mort du souverain, ce qui « met un terme aux réjouissances.
L'anéantissement de l'armée impériale à la bataille du cap Colonne a aussi des conséquences graves à la périphérie. Les Slaves, qui supportent mal leur christianisation forcée, y voient l'occasion de se soulever19. Ils détruisent les évêchés de Brandebourg et Havelberg et menacent Magdebourg. Apprenant que le nouveau roi n'est qu'un enfant, ils redoublent leurs incursions : les évêchés de Schlesvig et d'Oldenbourg sont anéantis à leur tour. En liaison avec les Danois, les Sorabes atteignent Hambourg. Les premiers succès des missionnaires chrétiens à l'est de l'Elbe sont effacés par le soulèvement des Slaves. La seule présence germanique subsistant à l'est du fleuve est le poste avancé de Meissen. La mort d'Otton II provoque de nombreux soulèvements contre les représentants du pouvoir royal en Italie.
Cette situation précaire incite de nombreux évêques à prendre leurs distances vis-à-vis de l'enfant roi alors qu'ils forment la colonne vertébrale du pouvoir ottonien : nommés par l'empereur qui récupère leur charge à leur mort, ils constituent normalement une clientèle fidèle qui garantit la puissance de l'empereur vis-à-vis de ses grands vassaux.
La guerre de succession
En tant que chef de la maison de Bavière, Henri le Querelleur est le plus proche parent d'Otton. Il est emprisonné à Utrecht à la suite d'une rébellion armée. L'évêque Folcmar lui rend sa liberté dès qu'est connue la mort d'Otton II. L'archevêque de Cologne, s'appuyant sur leur lien de parenté jus propinquitatis, lui remet immédiatement le jeune roi. Cela n'est pas surprenant, car outre la mère d'Otton, Théophano, sa grand-mère Adélaïde de Bourgogne et sa tante Mathilde de Quedlinbourg sont alors en Italie.
Les menées du Querelleur visent moins à accaparer la régence qu'à s'assurer un véritable partage du pouvoir avec l'enfant à la tête du royaume. Pour Lothaire, roi des Francs carolingiens, le contrôle de la Lotharingie - berceau des Pippinides - lui permettrait de revendiquer l'empire. N'ayant pu assurer la tutelle impériale, Lothaire renonce au rapprochement qu'il a négocié vis-à-vis des Ottoniens pour neutraliser son rival Hugues Capet, et décide de reprendre l'offensive contre la Lotharingie en janvier 985 à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Il prend Verdun en mars et fait prisonnier le comte Godefroy Ier de Verdun frère d'Adalbéron de Reims, Frédéric fils de Godefroy Ier, Sigefroid de Luxembourg oncle de Godefroy et Thierry Ier de Lorraine neveu de Hugues Capet.
Hugues Capet se garde bien de faire partie de l'expédition. Henri organise sans retard une rencontre à Brisach avec Lothaire, parent du jeune Otton III au même degré que lui. Mais Henri, redoutant ce face-à-face avec son rival pour la couronne impériale, quitte précipitamment Cologne, où il a enlevé le jeune Otton, et part en Saxe via Corvey. Là, il invite tous les grands de l'empire à fêter les Rameaux à Magdebourg. Sa proposition ouverte à proclamer son avènement reçoit un accueil mitigé chez ses convives. Il trouve toutefois suffisamment de partisans pour gagner Quedlinbourg et pour fêter Pâques avec une suite de fidèles dans la grande tradition des Ottoniens. Henri s'efforce par des tractations avec les princes présents d'obtenir son élévation à la royauté et parvient à ce que plusieurs lui prêtent serment d'honneur et d'aide comme leur roi et suzerain. Parmi ses partisans, il faut citer Mieszko Ier de Pologne, Boleslav II de Bohême et le prince slave Mistivoï.
Pour barrer la route d'Henri vers le trône, ses opposants quittent Quedlinbourg et, réunis au château d'Asselburg, forment une conjuration. Lorsqu'il a vent de cette conjuration, Henri mène ses troupes à Werla, non loin de ses ennemis, pour les intimider ou tenter de les raisonner. Il dépêche vers eux l'évêque Folcmar d'Utrecht pour négocier. Mais lors des pourparlers, il apparaît clairement que ses adversaires ne sont pas prêts à lui prêter serment en tant que leur roi. Il n'obtient que la promesse de reprise des pourparlers ultérieurement à Seesen. Sur ces entrefaites, Henri gagne la Bavière, où il obtient la reconnaissance de tous les évêques et de quelques comtes. Après son demi-échec en Saxe et l'appui de la Bavière, tout dépend à présent de la position des princes francs, qui ne veulent à aucun prix revenir sur le sacre d'Otton III. Redoutant l'issue d'un éventuel conflit, Henri renonce au trône et remet l'enfant roi à sa mère et à sa grand-mère le 29 juin 984 à Rohr Thuringe.
La régence des impératrices 985–994
L'impératrice Adélaïde, qui a une cinquantaine d'années, a la carrure politique pour prétendre à la régence car elle a été associée à la gestion de l'Empire consors imperii pendant le règne de son mari Otton Ier, comme en témoignent une bonne partie des actes émis par la chancellerie. Mais Théophano s'impose de par son exceptionnelle personnalité et Adélaïde se contente d'une délégation de pouvoir en Italie : de 985 à sa mort en 991, la mère d'Otton III exerce donc pleinement le pouvoir.
Théophano s'établit au nord des Alpes. Elle s'efforce de rétablir l'évêché de Mersebourg, que son mari Otton II a dissous en 981. Elle réorganise la chapelle royale d'Otton II et en confie la direction à l'évêque chancelier Hildebold de Worms et à l'archevêque Willigis de Mayence. Par leur loyalisme, ces deux prélats parviennent à s'assurer le rôle de premiers conseillers de l'impératrice.
En 986, Otton III, alors âgé de six ans, fait organiser les festivités de Pâques à Quedlinbourg. Le service du roi est confié à quatre ducs : Henri le Querelleur en tant qu'écuyer tranchant, Conrad de Souabe en tant que chambellan, Henri de Carinthie le Jeune en tant qu'échanson et Bernard de Saxe en tant que maréchal. On a déjà mis en scène ce service des ducs lors des sacres d'Otton le Grand en 936 et d'Otton II en 961 : les grands manifestant ainsi leur loyauté envers le jeune roi. En particulier, Henri le Querelleur tâche de faire oublier sa tentative d'usurpation manquée deux ans plus tôt et montre sa soumission à la dignité royale.
Au cours de la régence de Théophano éclate la querelle de Gandersheim, opposant l'évêché d'Hildesheim à l'archevêché de Mayence pour l'administration de l'abbaye. La querelle éclate lorsque Sophie, la propre sœur du roi, refuse de recevoir l'habit de moniale des mains du père supérieur d'Hildesheim, l'évêque Osdag, lui préférant l'archevêque de Mayence Willigis. La menace d'un scandale en présence du roi Otton III et de la régente peut être évitée par un compromis : les deux évêques doivent remettre l'habit à la princesse, tandis que les autres moniales d'Osdag prennent seules l'habit.
Si les marches orientales du royaume sont calmes tout le temps que dure l'affrontement avec Henri le Querelleur pour la succession au trône, le soulèvement des Slaves n'en représente pas moins un échec pour la politique d'évangélisation. Par la suite, des armées saxonnes partent en campagne contre les Slaves de l'Elbe en 985, 986 et 987; Otton, à six ans, s'associe à la seconde de ces campagnes. Le duc de Pologne Mieszko appuie à plusieurs reprises les Saxons par la mobilisation d'une armée importante et prête serment à Otton lors de cette campagne, lui offrant en cadeau un chameau
À l’ouest, la mort de Lothaire en mars 986 met fin à ses prétentions sur la Lotharingie berceau des Carolingiens et dont la possession permet de revendiquer l'Empire)29. Son fils et successeur, Louis V, a à peine le temps de prendre le pouvoir et de consentir à faire la paix lorsqu'il meurt d'un accident de chasse en forêt de Senlis, fin mai 987. L'archevêque de Reims, fervent soutien des Ottonniens, fait élire Hugues Capet contre le prétendant légitime Charles de Basse-Lotharingie, frère du défunt. L’arrivée des Capétiens sur le trône de France instaure une nouvelle dynastie et les Carolingiens, évincés du pouvoir, ne sont plus un danger pour l'Empire ni pour la Lotharingie. À l'est, les relations avec la Bohême sont consolidées sans que la Pologne n'en prenne ombrage. Les dangers extérieurs neutralisés, Otton, qui n'a rien à craindre des princes germaniques, peut se laisser aller au rêve qu'a dû entretenir sa mère, de porter la couronne d'un Empire d'Occident réunifié.
En 989, Théophano prend le chemin de Rome sans son fils pour prier pour le salut de l'âme de son époux Otton II le jour anniversaire de sa mort. Parvenue à Pavie, elle confie les rênes du pouvoir à son homme de confiance, Jean Philagathos, qu'elle a fait archevêque de Plaisance. Théophane meurt à Nimègue le 15 juin 991, un an après son retour d'Italie, avec Otton III à son chevet. Elle est inhumée dans la crypte de la basilique Saint-Pantaléon de Cologne. On ignore quels sont les derniers conseils de Théophano au jeune roi. La basilique que Théophano voulait ériger à la mémoire de son époux Otton II, et dont elle avait confié la direction à sa nièce, l'abbesse Mathilde d'Essen, fille du duc Ludolphe de Souabe, n'est commencée par Otton III qu'en 999, à l'occasion de la translation des reliques de saint Marsus. Le roi, quant à lui, ne fait pas d'efforts comparables pour le salut de sa mère. Il la qualifie dans ses actes de « mère bien-aimée », et fait de riches dons au diocèse de Cologne.
Lors des dernières années de minorité d'Otton, sa grand-mère Adélaïde assume la régence, largement secondée par l'abbesse Mathilde de Quedlinbourg, sa tante paternelle, et l'archevêque Willigis de Mayence. C'est sous sa régence que le monnayage du royaume atteint son apogée34. Par contre, alors que Théophano voulait de toute force rétablir le diocèse de Mersebourg, Adélaïde n'y tient pas. Otton, rompu au métier des armes, dirige la reconquête du Brandebourg. À quatorze ans, il est prêt pour prendre en main les rênes du pouvoir.
L'éducation d'Otton
Otton III recevant son livre de prières. Manuscrit offert par sa mère ou Willigis pour son éducation. Vers 983-991, Bibliothèque d'État de Bavière, Clm 30111.
Otton III reçoit une instruction solide : ses maîtres sont Hoico, un comte saxon chargé de lui enseigner l'art de la guerre et les rites et usages de la - future - chevalerie, Willigis qui reste l'un de ses principaux conseillers, un clerc saxon Bernard d'Hildesheim de 987 à 993 et l'évêque calabrais Jean Philagathos, le futur antipape, qui lui enseigne quelques rudiments de grec.
En 996, arrivé à l’adolescence et alors qu’il règne déjà, il se sent insuffisamment instruit. Il demande à Gerbert d'Aurillac, alors archevêque de Reims, considéré comme le plus grand esprit de son temps, de venir compléter son instruction. Ce dernier est en position délicate vis-à-vis du Saint-Siège car il a pris la tête de l'épiscopat de Francie occidentale dans le conflit qui oppose Hugues Capet dont Gerbert est secrétaire à Arnoul qui a le soutien du pape. Gerbert est alors sous la menace d'une excommunication ainsi que les évêques ayant siégé au concile de Sainte-Basle de Verzy. Cette excommunication collective ouvre la voie à un schisme entre l'Église des Gaules et celle de Rome. Le roi, Robert le Pieux, cherche à ménager le pape car il s'est marié avec sa cousine sans l'approbation du Saint-Siège, et lâche Gerbert qui fut son précepteur et dont il est très proche. Gerbert préfère abandonner et répond favorablement à la demande du jeune empereur, cette solution lui permet d'échapper à l'excommunication et évite le schisme.
Précepteur de l'empereur, il l’initie à l’arithmétique, à la musique et à la philosophie. Devenu son conseiller, il souhaite voir appliquer les principes de la philosophie à la vie politique : car l'usage de la raison enseigne la modération et la maîtrise des passions. Il rédige pour l'empereur un traité de logique sur Le Raisonnable et l'Usage de la raison qui s’ouvre sur un programme de rénovation de l'Empire romain, considérant que l'empereur, mi-grec par sa mère, est à même de reconstruire un empire universel.
Le début du règne.
En 994, Otton III a quatorze ans ce qui, pour les canons de l'époque, signifie qu'il est adulte : au haut Moyen Âge, un acte rituel, l'adoubement, sanctionne normalement ce passage. Mais dans le cas d'Otton, l'adoubement aurait signifié la fin de la régence et le début du règne personnel, ce dont les sources ne font pas état. Un diplôme du 6 juillet 994, par lequel Otton offre à sa sœur Sophie le fief d'Eschwege, est parfois considéré comme le premier acte personnel du règne du roi. Quoi qu'il en soit, Otton fait un grand nombre de donations alors qu'il est encore mineur.
Otton prend ses premiers décrets et nomme, contre l'usage, un Germain à la tête des affaires italiennes de la chancellerie : son homme de confiance, l'archevêque Héribert de Cologne. La même année, à Ratisbonne, Otton confère la mitre d'évêque à son chapelain Gebhard, au lieu du prélat Tagino, élu par le chapitre de Ratisbonne.
Au cours de l'été 995, il convoque le ban à Quedlinbourg et, avec l'aide de contingents de Bohême et de Pologne, se lance au cours de l'hiver 994-995 puis à nouveau au printemps 995 dans une campagne militaire plus au nord contre les slaves rebelles de l'Elbe, expéditions qui, depuis le soulèvement de 983, reprenaient presque chaque année. À son retour, il élargit considérablement le diocèse de Meissen et multiplie ainsi les bénéfices de la dîme. Au mois de septembre 995, on dépêche l'archevêque Jean Philagathos et l'évêque Bernard de Wurtzbourg à Byzance pour demander la main d'une princesse de la part d'Otton IIIN 5. Les négociations avec Byzance n'aboutissent que peu de temps avant la mort d'Otton ; on ignore le nom de la princesse qui lui était promise mais certaines sources proposent Zoé la Porphyrogénète.
L'empereur Otton III
Le couronnement impérial et la première campagne d'Italie
Otton III se rend en Italie afin de se faire couronner, mais aussi pour répondre à l'appel à l'aide du pape Jean XV, agressé et chassé de Rome par le préfet Crescentius et ses partisans. Otton quitte Ratisbonne et se met en marche pour Rome en mars 996.
À Vérone, il accepte de devenir le parrain d'un fils du doge Pietro II Orseolo inaugurant ainsi les relations traditionnellement cordiales entre les Ottoniens et Venise. À Pavie, Otton reçoit une délégation romaine qui lui confie le choix du successeur du défunt pape Jean XV. Il n'est encore qu'à Ravenne lorsqu'il nomme comme souverain pontife son parent et chapelain privé Brun de Carinthie, et le fait accompagner par l'archevêque de Mayence Willigis et l'évêque Hildebold jusqu'à Rome, où il est le premier pape d'origine germanique à recevoir la tiare pontificale.
Le lendemain de son arrivée à Rome, Otton est joyeusement acclamé par le Sénat et la noblesse. Le 21 mai 996, jour de l'Ascension, il est couronné empereur des Romains par le pape qu'il a nommé.
Avec la nomination du pape lui-même, Otton III est allé au-delà des espérances de son grand-père Otton Ier, dans la mesure où il ne se contente plus d'agréer l'issue d'un vote mais impose son propre candidat à la Curie romaine. Mais, du fait de cette nomination discrétionnaire, le pape n'a plus de partisans déclarés à Rome et dépend d'autant plus de l'appui de l'empereur. Déjà, sous le règne d'Otton Ier, ces circonstances avaient opposé les papes fidèles à l'empereur et les candidats de la noblesse romaine. L'influente dynastie patricienne des Crescentii devait ainsi son autorité à la cession des droits pontificaux et des bénéfices tirés de la province de Sabine aux premiers papes italiens.
Au milieu de l'agitation des cérémonies du couronnement, on décide de convoquer un synode, au cours duquel la coopération étroite entre l'empereur et le pape se manifeste par la coprésidence du synode et la double signature des décrets. Ce synode met aussi Otton en relation avec deux personnalités hors du commun, qui vont fortement influencer le reste de sa vie. Gerbert d'Aurillac, archevêque de Reims, proche de l'empereur qui rédige plusieurs lettres en son nom, et Adalbert de Prague, un représentant du courant ascétique et érémitique qui fait de plus en plus d'adeptes à l'approche de l'an mil.
Gerbert d'Aurillac, en délicatesse avec l'ancien pape Jean XV, trouve là l'occasion d'obtenir le soutien impérial. La situation est très tendue entre la papauté et l'église de France car Gerbert a été nommé évêque de Reims grâce à Hugues Capet sans l'approbation papale, on est ainsi proche du schisme entre la papauté et l'église. Pris de court, le nouveau pape évite de trancher lors du synode mais, influencé par sa chancellerie, il décide de rester ferme vis-à-vis de Gerbert. Lorsque Hugues Capet meurt le 24 octobre 996, Robert le Pieux épouse sa cousine Berthe de Bourgogne alors que cette union consanguine a été interdite par le pape. C'est l'occasion d'obtenir du nouveau roi de France qu'il arrête de soutenir Gerbert.
Grégoire V est le premier pape d'origine étrangère et non désigné parmi l'aristocratie romaine. Les Romains et, en particulier, les Crescentii vivent d'autant plus mal cet empiètement sur leurs prérogatives que le nouveau pape est particulièrement peu diplomate. Rapidement, il s'aliène la noblesse romaine.
Dans les derniers jours du mois de septembre 996, quelques mois seulement après avoir sur l'intercession du pape Grégoire V été gracié par Otton III, qui se prévaut de la clementia des césars, un concept-clef de l'exercice du pouvoir chez les Ottoniens, Crescentius entreprend de faire chasser Grégoire V de Rome. Crescentius complote avec l'archevêque de Plaisance et ancien conseiller de Théophane, Jean Philagathos, pour faire élire un antipape. Mais Otton III, plutôt que d'intervenir immédiatement, donne la priorité à la sauvegarde des frontières saxonnes. Il regagne la Germanie. De décembre 996 à avril 997, il séjourne en Rhénanie, notamment à Aix-la-Chapelle. Mais, on ne connaît pas le détail de cette partie de son règne, comme la tenue de bans. Il lance, à l'été 997, une nouvelle campagne contre les Slaves de l'Elbe. Une fois couronné empereur, Otton III
Le synode se réunit à Pavie, où Grégoire V s'est réfugié après avoir été chassé de Rome par Crescentius. Il y est décidé que Robert le Pieux et sa femme doivent venir s'expliquer et être éventuellement excommuniés. Ce synode condamne aussi les évêques du concile de Saint-Basle qui ont destitué Arnoul. S'il est vrai que l'empereur se défie d'abord de Gerbert d'Aurillac, il demande, quelques mois plus tard, à l'archevêque de Reims d'entrer à son service : il s'agit d'aider Otton III à se dépouiller de sa grossièreté rusticitas saxonne, et de le faire accéder à la finesse subtilitas grecque.
La seconde campagne d'Italie
Ce n'est qu'en décembre 997 qu'il retourne en Italie. On ignore l'effectif exact de son armée, mais il est accompagné des princes et prélats de tout l'Empire, à l'exception de sa très chère sœur dilectissima soror Sophie, qui l'a accompagné lors de son sacre à Rome, et qui réside auprès de lui à Aix-la-Chapelle. Il n'est plus jamais question désormais de sa présence à la cour.
Lorsqu'Otton III pénètre en Italie en février 998, les Romains adoptent une attitude conciliante et le laissent marcher sur Rome sans combattre. Entretemps, le préfet Crescentius Ier Nomentanus se barricade dans le château Saint-Ange. L'antipape Jean XVI s'enfuit de Rome et se réfugie dans un donjon, mais il est capturé par un détachement de l'armée impériale. Grégoire V est sans pitié pour celui qui a usurpé sa fonction : il lui fait crever les yeux, couper le nez et arracher la langue. Otton III ne fait rien pour sauver ou adoucir la peine de celui qui fut son précepteur et cela malgré l'intercession de l'ermite Nil de Rossano, qui vient implorer la grâce papale puis impériale. Ramené à Rome, Jean Philagathos est jugé par un synode et traîné dans les rues de la ville juché sur un âne pour que chacun sache ce qu'il en coûte de remettre en cause la nomination du pape par l'empereur.
Le comportement cruel de l'empereur et du pape est cependant contreproductif : ils sont critiqués dès cette époque, ce qui nuit fortement à leur crédit. C'est ainsi que le vieil abbé Nil de Rossano part pour Rome dès qu'il apprend la mutilation de l'antipape, pour l'héberger dans son monastère. Mais Grégoire V et Otton III repoussent cette requête. Nil aurait alors appelé l'éternelle punition divine sur l'empereur en quittant Rome :
« Si vous, n'avez pas eu pitié de celui qui a été livré entre vos mains, le père céleste ne vous remettra pas davantage vos péchés »
— Nil de Rossano à l'envoyé de l'empereur Probablement Gerbert d'Aurillac.
De la même manière, lorsque, après un siège acharné, l'armée impériale parvient à se saisir de Crescentius au retour d'une entrevue avec l'empereur, le rebelle est décapité50. Son cadavre est d'abord pendu aux créneaux du château Saint-Ange, puis finalement, avec les corps de douze de ses comparses, suspendu par les pieds sur le Monte Mario, où il est exposé aux outrages du public.
La volonté d'Otton III d'imposer un nouvel Empire romain en dépit des désirs d'indépendance romaines ne fait aucun doute : il se fait construire un palais sur le Mont Palatin, où les empereurs romains résidaient autrefois, et organise sa cour à la façon byzantine50. Sur un décret impérial d'Otton III, daté du 28 avril 998 et concernant l'abbaye d'Einsiedeln, dont la date coïncide avec l'exécution de Crescentius, apparaît pour la première fois un sceau portant la devise Renovatio imperii Romanorum Restauration de l'Empire romain. Cette nouvelle devise figure ensuite systématiquement sur les décrets impériaux jusqu'au retour d'Otton III de Gniezno, avant d'être remplacée, à partir de janvier 1001, par la formule Aurea Roma Rome d'or, rayonnante Rome. Soucieux d'apaiser la noblesse romaine, il gratifie l'aristocratie locale de charges au palais50. Cependant, celle-ci n'oublie pas les terribles châtiments qu'ont subi Jean XVI et Crescentius.
Le séjour d'Italie 997–999
Otton III assoit l'autorité impériale et tente, avec le soutien du pape, de mener à bien la réforme de l'Église, affaiblissant ainsi l'aristocratie, prompte à user de simonie. Il délivre des diplômes aux évêchés et aux abbayes et oblige l'aristocratie laïque à restituer les biens de l'Église dont elle s'était emparée. La lutte contre un parent de Crescentius, un comte de Sabine du nom de Benoît, s'inscrit dans ce cadre : ils le contraignent par la force à rendre les biens confisqués au monastère de Farfa.
Dans la droite ligne de ses prédécesseurs, Otton attribue les évêchés à des hommes de confiance. Les charges épiscopales, contrairement aux charges comtales, sont restituées à l'empereur au décès de l'évêque, ce qui permet d'éviter l'affaiblissement du patrimoine impérial et donc de conserver de l'autorité sur sa clientèle.
Lorsque meurt l'évêque Hildiward d'Halberstadt, naguère un des instigateurs de la dissolution de l'évêché de Mersebourg en novembre 996, Otton III et Grégoire V s'attaquent à la reconstitution de ce diocèse et justifiant cela par une motion qu'ils font adopter par un synode de la Noël 998-99, selon laquelle la dissolution prononcée en 981 était une infraction au droit ecclésiastique : le diocèse aurait été dissout sine concilio sans vote. Ce n'est toutefois qu'en 1014, sous le règne du successeur d'Otton, l'empereur Henri II, que le diocèse de Mersebourg est rétabli.
En 999, Otton délaisse quelque temps les affaires pour un pèlerinage en Bénévent sur le mont Gargano, que Romuald, prêcheur d'Einsiedeln, lui aurait imposé en expiation des atrocités commises envers Crescentius et Jean Philagathos. En chemin, Otton apprend que Grégoire V vient de mourir à Rome. Aussi cherche-t-il à rendre visite au père Nil en rémission de ses péchés. Mais, loin de contribuer à retrouver son crédit, cette démarche est perçue comme une preuve de vulnérabilité.
Dès son retour, il élève à la dignité papale son précepteur Gerbert d'Aurillac, qui prend le nom de Sylvestre II. Pour la seconde fois d'affilée, le pape nommé est un non-romain Gerbert est franc. À Rome, il continue de renforcer son pouvoir en attribuant les évêchés à ses proches. C'est ainsi qu'il nomme son propre chapelain, Léon, évêque de Verceil, lui confiant un diocèse difficile, car son prédécesseur Petrus de Verceil vient d'être assassiné par le margrave Arduin d’Ivrée. En 999, un synode romain condamne Arduin à faire amende honorable. Il lui est demandé de déposer les armes et de ne pas passer la nuit deux fois de suite au même endroit, dans la mesure où sa santé le lui permet. Il peut s'exonérer de cette peine en entrant dans les ordres. Otton attribue aussi la succession de l'évêque Everger de Cologne à son chancelier Herbert.
Posté le : 23/01/2016 19:41
|
|
|
|
|
Otton III 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Intervention en Europe orientale
L'empereur entouré des princes d'Empire et des évêques ; à sa gauche, les 4 nations la Slavonie, la Germanie, les Gaules et Rome lui rendent hommage en tant que successeur à l'imperium miniature du scriptorium de Reichenau, Évangéliaire d'Otton III, XIe siècle.
En décembre 999, Otton quitte finalement Rome pour un pèlerinage à Gnesen : il veut prier sur la tombe de son ami Adalbert. Les hagiographies laissent entendre qu'Otton serait allé à Gnesen pour accaparer des reliques d'Adalbert. Toutefois, les motifs du monarque sont essentiellement religieux. À son arrivée dans la ville, Otton se fait mener pieds nus jusqu'au tombeau d'Adalbert par l'évêque de Posen Unger et, par ses prières en larmes, supplie les martyrs d'intercéder pour lui auprès du Christ. Puis il élève la ville au rang d'archevêché, fondant par là l'Église autonome de Pologne. L'archidiocèse de Cracovie et les nouveaux évêchés de Kolberg et Breslau sont rattachés à la nouvelle province ecclésiastique de Gnesen où siégerait un évêque métropolite. Le royaume de Boleslas Chrobry se trouve ainsi doté d'une Église indépendante.
Les autres activités d'Otton à Gnesen sont controversées. L'Histoire de Pologne de Gallus Anonymus, qui n'a été rédigée qu'au XIIe siècle, offre le seul récit détaillé des événements. Elle rapporte avec force comment Otton III a fait roi Boleslas, ce que les sources saxonnes passent systématiquement sous silence. Le fait qu'un couronnement ait pu avoir lieu est aujourd'hui très débattu. La thèse de Johannes Fried, un historien allemand, selon laquelle Gnesen aurait été le théâtre de la création purement civile d'un roi, a été récemment combattue par Gerd Althoff, pour qui le couronnement de Boleslas à Gnesen n'est que la célébration particulièrement fastueuse du pacte d'amitié avec l'empereur Otton III.
Pour son retour en terre d'Empire, Boleslas confie à l'empereur un équipage fastueux et l'accompagne via Magdebourg jusqu'à Aix-la-Chapelle. Là, Otton lui aurait offert le trône de Charlemagne.
Retour à Rome
Otton fête les Rameaux à Magdebourg et Pâques à Quedlinbourg. Puis, passant par Trebur, il rentre à Aix-la-Chapelle, la ville qu'il aimait le plus après Rome. Au cours de ces quelques mois, il appelle à l'occasion de plusieurs synodes tenus à Magdebourg, Quedlinbourg et Aix-la-Chapelle à la renaissance de l'évêché de Mersebourg, sans parvenir à arracher la décision. À Aix-la-Chapelle, il fonde une église en l'honneur de son ami Adalbert, martyrisé en Prusse, et lui fait don des reliques du missionnaire. Il fait aussi rechercher et ouvrir le tombeau de Charlemagne. Même aux yeux de ses contemporains, ce comportement passe pour une violation de sépulture, pour laquelle Dieu l'aurait puni d'une mort prématurée. Actuellement on interprète l'action d'Otton comme un premier pas vers la création du culte de Charlemagne.
D'Aix, il retourne à Rome au cours de l'été de l'an mil. C'est à ce moment que reprend la querelle de Gandersheim, qui oppose l'évêque de Mayence Willigis à l'évêque Bernard d'Hildesheim : la consécration d'une nouvelle église à Gandersheim rend inévitable une décision sur le rattachement de la paroisse à l'un des deux évêchés. L'évêque Bernard prend le temps d'aller à Rome pour y faire valoir sa cause devant Otton III et un synode romain. En conséquence de la démarche de Bernard, deux nouveaux synodes se réunissent presque simultanément pour trancher l'affaire de Gandersheim : l'un, provincial, à Gandersheim même, et l'autre, impérial, à Rome, sous la présidence de l'empereur et du pape. Toutefois, ni ces deux conclaves, ni celui qui suit, à Pöhlde, ne parvient à décider du parti à prendre. Cette querelle occupe alors plusieurs empereurs et de multiples synodes, avant d'être finalement tranchée en 1030.
L'empereur passe la fin de l'année en Italie sans qu'il en ressorte d'initiative politique significative. Il faut attendre le début de l'année 1001 pour que le pouvoir se manifeste à nouveau, et cela à l'occasion d'un soulèvement des habitants de Tivoli contre l'autorité impériale. Otton assiège donc cette ville, bien que la Vita Bernwardi, un éloge de l'évêque Bernard composé par son professeur Thangmar, vante plutôt le rôle de Bernard dans la soumission durable des rebelles. Le mois même où ce siège de Tivoli a lieu, survient un autre événement inhabituel, à savoir la publication d'un acte de donation impérial au bénéfice du pape Sylvestre. Cette donation met brutalement un terme à la politique habituelle des papes qui, déchus de leurs propres territoires par leur insouciance et leur incompétence, ont essayé, hors de tout cadre juridique, de s'y approprier les droits et les devoirs de l'imperium. Par cet acte, Otton est considéré comme le défenseur de l'autorité impériale contre la Papauté. Il dénonce comme mensongères les prétentions territoriales de l'Église romaine exprimées dans la donation de Constantin, y compris la donation elle-même ou sa restitution par Jean Diacre, tout en abandonnant à Saint Pierre par pure bienveillance impériale huit comtés de la Pentapole italienne.
Dans les semaines qui suivent la publication de cet acte de donation, un soulèvement éclate à Rome. On a attribué la cause de cette émeute à l'indolence excessive du pouvoir après les événements de Tivoli. Elle est contenue pacifiquement au bout de quelques semaines par voie de négociation. Le doyen du chapitre d'Hildesheim, Thangmar, qui, en 1001, avait accompagné son évêque Bernard d'Hildesheim à Rome, rapporte la teneur d'un discours fameux adressé par Otton aux Romains au cours de ces négociations, par lequel l'empereur aurait exprimé à la foule son amour pour Rome et son renoncement complet à ses attaches saxonnes. Émus aux larmes par cette profession de foi, les Romains se saisissent de deux hommes qu'ils molestent cruellement pour manifester leur regret et leur souhait de retour à la paix civile. Malgré ces gestes d'apaisement, la versatilité de l'opinion inspire la méfiance aux conseillers de l'empereur, qui l'engagent à s'éloigner des dangers et à regrouper ses troupes autour de Rome.
La mort de l'empereur
Otton III et le pape Sylvestre II s'éloignent de Rome et prennent la direction du Nord vers Ravenne. Par la suite, Otton recevant une ambassade de Boleslaw Chobry, conclut avec la délégation hongroise la création d'une nouvelle province de l'Église avec pour métropole l'évêché de Gran et s'assure que le nouvel archevêque, Astericus, couronne roi le prince Étienne de Hongrie. Otton fait aussi en sorte de resserrer encore les liens avec le doge de Venise.
Mais les sources hagiographiques Vie du Bienheureux Romuald » de Pierre Damien et la Vie des Cinq Frères de Brun de Querfur donnent au même moment plutôt l'image d'un monarque abattu moralement. La détresse reflétée par ces témoignages culmine avec la promesse d'Otton de renoncer aux choses terrestres et d'entrer dans les ordres. Il aurait en tout cas voulu prendre encore trois ans pour corriger les erreurs de son règne : on ignore cependant de quelles erreurs il s'agissait.
Vers la fin de l'année 1001, il rejoint Rome avec l'appui des contingents de quelques évêques de l'Empire, qui n'ont pu rallier l'Italie que très lentement. Ayant contracté une fièvre violente, il décède le 23 janvier 1002, au château de Paterno, situé à Faleria, non loin de Rome. Plusieurs témoignages rapportent la mort apaisée et édifiante du prince chrétien.
La mort de l'empereur est d'abord tenue secrète, jusqu'à ce que sa garde personnelle soit informée et mise en état d'alerte. L'armée, continuellement entourée d'ennemis, quitte l'Italie afin d'exaucer les dernières volontés d'Otton d'être inhumé à Aix-la-Chapelle. En février 1002, alors que le convoi, parti de Paterno, traverse Lucques et Vérone et pénètre en Bavière, le duc Henri II le prend en charge à Polling et exige des évêques et des nobles, par des menaces et des promesses, qu'ils le proclament roi. Cependant, aucun de ceux qui accompagnent le convoi, à l'exception de l'évêque Siegfried d'Augsbourg, n'aurait pris le parti d'Henri. On ignore au juste quelles préventions les collaborateurs d'Otton éprouvent à l'égard d'Henri. Quelques semaines plus tard, pendant les célébrations de la mort de l'empereur, ces hommes confirment leur refus, car de leur avis, Henri, à bien des égards, n'est pas apte à gouverner le royaume. Ainsi, alors qu'en Italie, dès le 15 février 1002, les barons lombards ont acclamé roi, à Pavie, Arduin d’Ivrée, adversaire d'Otton III, le duc Henri II continue à se débattre au milieu d'interminables négociations et de querelles privées.
La succession d'Otton III
Dès le début de son règne, Henri II permet les célébrations pour le salut de l'âme de son prédécesseur, son oncle bien-aimé, et pour la mémoire du « bon empereur Otton. Il fait connaître les dernières volontés et les legs d'Otton et, comme lui, il célèbre les Rameaux en 1003 à Magdebourg, sur la tombe d'Otton Ier, ainsi que la fête de Pâques à Quedlinbourg, lieu de sépulture d'Henri Ier et de son épouse Mathilde. Mais avant tout, Henri II fait de la Saxe le nouveau centre du pouvoir. Il se laisse ainsi au moins une décennie, avant de s'en prendre à son rival en Italie.
On a longtemps vu dans l'abandon par Henri II de l'inscription d'Otton III : Renovatio imperii Romanorum (Renaissance de l'empire romain sur les sceaux impériaux au profit de Renovatio regni Francorum Renaissance du royaume des Francs un virage décisif de la politique des empereurs. Mais, plus récemment Knut Görich, historien allemand, a attiré l'attention sur le nombre des sceaux concernés : il faut en effet rapporter les vingt-trois décrets d'Otton III aux quatre décrets d'Henri II. Ainsi, l'emploi occasionnel et éphémère de l'apostille franque, qui n'apparaît que de façon circonstancielle après une succession réussie à la tête du royaume en janvier et février 1003, n'est qu'une formule d'authentification parmi toutes celles qui nous sont parvenues et est bientôt elle-même abandonnée.
En revanche, c'est bien un tournant que représente la politique extérieure d'Henri II en ce qui concerne les affaires polonaises ; car si, en l'an mil, Boleslas Chobry est gratifié de l'épithète de frère et appui de l'empereur, d'ami et allié du peuple romain fratrem et cooperatorem imperii constituit et populi Romani amicum et socium appelavit, la politique d'Henri II tourne à une confrontation armée, seulement rythmée par les trois traités de paix successifs de Posen 1005, Mersebourg 1013, et Bautzen 1018.
Bilan du règne Politique économique et monétaire
Les Ottoniens doivent leur prospérité et celle de leur empire à l'encouragement et à l'accompagnement des échanges entre l'Europe du Nord et de l'Est et la Méditerranée, via les bassins du Rhin, de la Meuse et du Danube et leur connexion à celui du Pô par les routes passant par les cols alpins. Ils développent les échanges en créant des ateliers de monnayage et, de ce fait, facilite les marchés. Ils alimentent ces ateliers de frappe monétaire par l'exploitation de mines d'argent. C'est sous la régence d'Adélaïde que le monnayage atteint son apogée en Germanie. Otton III s'inscrit dans cette politique économique et monétaire en autorisant, par exemple, l'évêque de Freissing à fonder un marché quotidien et place la fréquentation de ce marché sous le ban de la paix impériale.
L'autre moyen de remplir les caisses est de créer des cours de justice. Celles-ci sont sources d'entrées financières sous forme de réparations : le wergeld. Comme la monnaie, elles permettent de manifester l'autorité impériale dans tout l'Empire. Ainsi, Otton III établit une cour à Ravenne, qui est un riche archiépiscopat qui régente toute l'Italie du Nord et commerce avec Venise et Pavie.
Politique religieuse
Si, depuis Otton Ier, l'Église est assujettie aux empereurs, le soutien de ces derniers à la réforme monastique fait que ce sont les clercs qui éduquent les princes et acquièrent en retour une réelle influence politique. Otton III, élevé par sa mère grecque dans le souvenir de Byzance et entouré de prêtres depuis sa plus tendre enfance, nourrit à la fois une très haute idée de l'empire et une aspiration à la perfection monastique. Pendant sa minorité, le pouvoir impérial est gravement menacé par les grands féodaux, menés par le duc de Bavière Henri le Querelleur. Celui-ci contrôle en effet les évêchés du sud de la Germanie et donc une puissante clientèle lui permettant de rivaliser avec le pouvoir impérial. Otton s'emploie donc à affaiblir cette concurrence en obligeant l'aristocratie laïque à restituer les biens de l'Église dont elle s'est emparée.
Il profite pour cela du mouvement de réforme monastique en cours, promu par Cluny ou des monastères lotharingiens tels que Gorze. Cette réforme lutte contre la simonie et souhaite n'avoir à répondre qu'à l'autorité pontificale. L'empereur y est d'autant plus favorable qu'il a été éduqué par des érudits proches de ce mouvement réformateur. C'est pourquoi il délivre des diplômes aux évêchés et aux abbayes qui les libèrent de l'autorité des grands féodaux. La régente Théophano puis l'empereur lui-même œuvrent à la création de puissantes principautés ecclésiastiques en concédant des évêchés renforcés de comtés et d'abbayes à des fidèles. Les exemples les plus probants sont Notger qui se voit attribuer une véritable principauté à Liège en adjoignant à l'évêché les comtés de Huy et de Brunengeruz, ou Gerbert d'Aurillac qui reçoit l'archiépiscopat de Ravenne dont dépendent 15 évêchés : il contrôle tout le nord de l'Italie. De fait, c'est l'autorité impériale qu'il renforce ainsi : c'est sous le règne d'Otton III que l'emprise de l'empereur sur le Saint-Siège est la plus grande car il nomme les papes sans en référer aux Romains. Il va au-delà de la main mise sur l'Église de son grand-père Otton Ier, dans la mesure où il ne se contente plus d'agréer l'issue d'un vote, mais où il impose son propre candidat à la Curie romaine.
Paradoxalement, Otton III met fin à la décadence de la papauté en l'associant à ses projets d'empire universel : il choisit, pour cela, des papes brillants et en phase avec son projet politique et culturel. Cependant, le pape nommé à discrétion et étranger Grégoire V est germain et Sylvestre II franc n'a que peu de soutien à Rome et dépend d'autant plus de l'appui de l'empereur. Ce pouvoir, Otton l'obtient par la pression militaire en descendant, en 996, en Italie pour soutenir Jean XV chassé par les Romains. Plutôt que d'entrer en conflit avec l'empereur, les Romains préfèrent lui confier le choix du successeur du défunt pape Jean XV. Cette pratique se perpétue avec ses successeurs qui descendent régulièrement en Italie avec l'Ost impérial pour y ramener l'ordre et y influer sur le choix du pape.
Cependant, cet état de fait est mal accepté par la noblesse romaine qui n'a de cesse d'intriguer pour reprendre ses prérogatives dès que l'empereur et son armée sont éloignés de la péninsule italienne.
Politique culturelle
Renaissance ottonienne, art ottonien et architecture ottonienne.
Les Ottoniens sont également des commanditaires de manuscrits de luxe, mais ne semblent pas avoir réuni des artistes à la cour : les manuscrits de luxe sont réalisés à Corvey, à Fulda et surtout à Reichenau d'où proviennent l'évangéliaire d'Otton III et l'évangéliaire de Liuthar, aux représentations impériales de grande valeur pour leur soin et leur sens politique Offrandes des quatre provinces de l'Empire, apothéose d'Otton III représentant en fait peut-être Otton Ier.
Enfin, certaines réalisations architecturales notables, dans le domaine religieux essentiellement, sont marquées par la double inspiration carolingienne et byzantine, et participent à l'émergence du roman. C'est sous Otton III qu'est réalisé le chef-d'œuvre de l'architecture ottonienne, Saint-Michel d'Hildesheim, construction confiée au précepteur de l'empereur, l'évêque Bernward.
Politique diplomatique Restauration d'un empire universel
Otton III, qui est grec par sa mère Théophano, n'essaie pas simplement comme son grand-père Otton Ier de restaurer l'empire carolingien, mais tente de restaurer un empire universel. Son rêve est un empire qui aurait la dignité de celui de Byzance et l'efficacité de celui de Charlemagne. Adalbert ouvre l'esprit d'Otton vers l'instauration d'un empire universel, mais c'est Gerbert d'Aurillac qui le théorise : il rédige pour l'empereur un traité sur le raisonnable et l'usage de la raison qui s’ouvre sur un programme de rénovation de l'Empire romain, considérant que l'empereur, mi-grec par sa mère, est à même de reconstruire un empire universel. L'idée est celle d'une union de pays organisés de manière identique, indépendants du royaume germanique, ayant Rome pour capitale spirituelle et politique : la chrétienté latine doit retrouver son unité sous la double impulsion du pape et de l'empereur. Ce vaste projet d'empire fédéral composé de peuples unis par leur commune adhésion au christianisme, en dehors de toute soumission vassalique, explique que Gerbert d'Aurillac et Otton aient soutenu l'apparition de royaumes chrétiens indépendants de la Germanie en France, en Pologne, en Hongrie ou en Catalogne. Le basileus n'ayant pas d'héritier mâle, il dépêche l'évêque de Milan pour demander la main d'une princesse byzantine, ce qui ouvrirait la voie à une réunification des deux moitiés de l'Empire romain. Cependant, il meurt trop vite pour que ce projet puisse se concrétiser.
Royaume de Pologne
En l'an mil, Otton III est reçu à l’assemblée de Gniezno. Il marie sa fille avec le fils de Boleslas et les charges imposées à Mieszko sont supprimées, ce qui signifie la reconnaissance de l’indépendance polonaise. Le pays est organisé en province ecclésiastique autonome avec un archevêché à Gniezno et trois évêchés à Cracovie, Wroclaw et Kolobrzeg. Boleslas reprend à l’empereur le droit d’investiture et de nomination des évêques, garantissant ainsi l’émancipation de l’Église polonaise84.
Royaume de Hongrie
Le rôle de la bataille du Lechfeld 955 dans l'arrêt des invasions hongroises est en fait limité, le peuple magyar ayant déjà commencé sa sédentarisation. Le prince Géza, séduit par la puissance et l'influence culturelle de la renaissance ottonienne, œuvre pour un rapprochement avec l'Occident. De nombreuses missions de christianisation sont menées avec son soutien. Elles s'interrompent à la mort d'Otton Ier en 973, mais peuvent reprendre une fois passées les difficultés de la régence impériale vers 983. Elles sont animées par des clercs germaniques mais aussi tchèques, dans le sillage du missionnaire Adalbert de Prague, maître et ami intime d'Otton III, qui aurait baptisé le futur Étienne Ier vers 995. Poursuivant sa politique de christianisation et de rapprochement avec l'Occident, le prince Géza fonde, vers 996, le monastère bénédictin de Pannonhalma ainsi que le premier évêché de Hongrie à Veszprém. Pour renforcer les liens naissants avec l'Empire, il marie son fils Étienne à Gisèle, fille d'Henri le Querelleur. la contrepartie de cette union est l'attribution d'une bande de territoires au nord de la Leitha et la promesse d'achever sans tarder l'évangélisation de son peuple. À la mort de Géza 997, les chefs tribaux tentent de mettre un terme aux réformes amorcées. Ils opposent au jeune Étienne, pourtant désigné comme son successeur par Géza, son vieux cousin Koppany qui, satisfaisant aux critères traditionnels de transmission du pouvoir princier chez les Hongrois, se présente comme le champion de la réaction magyare contre les dangereuses innovations venues d'Occident.
Mais il est vaincu par Étienne en quelques mois grâce à l'aide militaire apportée par les chevaliers bavarois, qui sont récompensés par l'autorisation de s'installer en Hongrie. Il considère que son avenir politique passe par l'appropriation des méthodes occidentales. Il se considère déjà comme roi, titre que les sources écrites attribuent avant lui à son père et à son grand-père ; mais il a besoin d'un symbole faisant de lui un roi chrétien, l'oint du Seigneur, comme le sont les rois francs puis les empereurs germaniques, dans la continuité des rois bibliques. Il envoie une délégation auprès du pape, qui est d'autant mieux reçue que sa démarche correspond au projet d'empire fédéral caressé par Sylvestre II et Otton III. Le détail a son importance : Étienne n'aurait jamais voulu faire ce qu'avaient fait les ducs tchèques quelques décennies plus tôt, c'est-à-dire prêter allégeance à l'empereur germanique en échange de la reconnaissance de leur autorité monarchique. La seule contrepartie à fournir est l'engagement d'achever la conversion des Magyars.
En 1000 le 25 décembre ou 1001 le 1er janvier, fort de la bénédiction pontificale, le prince Étienne est couronné roi à Esztergom, avec la couronne qu'il a reçue de Sylvestre II. Le jeune roi s'acquitte aussitôt de ses engagements en relançant les missions de conversion. Il impose à ses sujets une pratique religieuse régulière et l'entretien du clergé local : la loi veut que les habitants construisent eux-mêmes par groupes de dix villages les églises qui leur servent de lieu de culte chaque dimanche85. Il fonde une Église nationale, placée sous la direction de l'archevêque d'Esztergom. D'abord limitée à la Transdanubie, que contrôlent depuis longtemps les princes arpadiens, elle comprend une petite dizaine de diocèses à la fin du règne. Étienne fait achever le monastère de Pannonhalma et le dote généreusement, comme en témoigne la charte de 1002 dont le texte a été conservé. Il multiplie les fondations monastiques bénédictines et comble les nouveaux établissements de biens fonciers.
Alliance avec Venise
C'est sous l'impulsion de Venise que le christianisme progresse le long de la côte dalmate. L'alliance de Venise, qui cherche à s'émanciper de l'empire Byzantin, est toute naturelle. Elle est matérialisée par le doge qui fait d'Otton le parrain de son fils et de sa fille.
L'image d'Otton III Les témoignages d'époque
La politique italienne d'Otton suscite visiblement l'incompréhension de ses contemporains.
Selon les Annales de Quedlinbourg, qui reflètent fidèlement le point de vue des monastères ottoniens et de leurs abbesses royales, à savoir la tante et la sœur d'Otton III, l'empereur veut marquer sa préférence pour les Romains sur les autres peuples. Mais elles s'abstiennent de critiquer la politique d'Otton III ; sa mort, qui apparaît comme la conséquence de ses propres péchés ou de ceux des étrangers, est déplorée par la terre entière.
Dithmar, évêque de Mersebourg ou encore Thietmar, ou Dietmar, dont le récit est imprégné de l'idée que la dissolution de l'évêché de Mersebourg a été une injustice profonde, désapprouve la politique italienne d'Otton III. C'est ainsi que, selon lui, l'empereur aurait, dans son palais, dîné sur une table en demi-cercle portée par ses proches, un usage tout contraire aux habitudes des cours franques et saxonnes.
Plus tard encore, Bruno de Querfurt reproche à l'empereur d'avoir voulu faire de Rome sa résidence ordinaire et de l'avoir considérée comme sa véritable patrie. Selon les propos de Bruno, qui vise à l'hagiographie, Rome symbolise le dépassement des cultes païens par les croyances chrétiennes ; avec son monarque païen, la Ville aurait perdu son rayonnement spirituel universel, elle qui, depuis la Donation de Constantin, est la ville des apôtres, sur laquelle plus aucun monarque profane ne doit régner. C'est pourquoi la répression exercée contre le siège des apôtres constitue pour Bruno un péché si grave que la mort prématurée de l'empereur est perçue comme un châtiment inévitable. Cependant Bruno de Querfurt salue certains traits agréables chez l'empereur, comme son tempérament chaleureux : encore enfant et livré aux errements de son comportement, il fit un bon empereur, un Imperator Augustus d'une profonde humanité.
Aussi Otton III, avec sa culture inaccoutumée et sa finesse reconnue, ne tarde-t-il pas à faire l'admiration de tous et est surnommé, aussi bien en Germanie qu'en Italie, Merveille du Monde.
Historiographie
Les jugements critiques des cercles dirigeants contemporains déteignaient d'ordinaire sur l'œuvre des historiens du xixe et du début du xxe siècle. L'opinion sur Otton III fut longtemps celle exprimée par Wilhelm von Giesebrecht dans son Histoire du Saint-Empire Geschichte der deutschen Kaiserzeit, qui critiquait fondamentalement l'absence du sentiment national chez Otton III et lui reprochait ses rêveries et son manque de pragmatisme. Pire même, Otton III aurait dilapidé un gros héritage par sa frivolité, aurait poursuivi des chimères et se serait commis avec des intellectuels et des étrangers. Giesebrecht forgea les conceptions des historiens nationalistes pour des décennies.
Au début du XXe siècle, plusieurs objections concrètes remirent en cause ces idées reçues. Avec son ouvrage intitulé Kaiser, Rom und Renovatio 1929, l'historien Percy Ernst Schramm a imposé une nouvelle image d'Otton III. Son nouveau portrait de l'empereur, contredisant l'image traditionnelle du souverain non-germanique, bigot et évaporé, constituait une réhabilitation dans la mesure où Schramm essayait de saisir Otton III dans la tourmente religieuse de son époque. La nouveauté résidait avant tout dans une interprétation historico-religieuse de la politique d'Otton III, selon laquelle la politique de renaissance de Rome constituait la véritable motivation du gouvernement de l'empereur. Schramm donnait comme preuve essentielle de cette politique de renaissance l'adoption, à partir de 998, de la fameuse devise Renovatio imperii Romanorum sur les sceaux.
Robert Holtzmann, historien allemand, rejoignait encore, en 1941, dans son Histoire des empereurs saxons Geschichte der sächsischen Kaiserzeit le point de vue de Giesebrecht et concluait : L'État d'Otton le Grand vacillait sur ses bases lorsqu'Otton III mourut. Si cet empereur avait vécu plus longtemps, son empire se serait effondré. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les opinions sur Otton III dans la veine d'Holtzmann sont devenues plus rares.
Mathilde Uhlirz, historienne autrichienne, compléta en 1954 le point de vue de Schramm, en considérant la politique de l'empereur plutôt sous l'angle d'une consolidation du pouvoir du prince dans les régions méridionales de l'Empire, et en prêtant ainsi à Otton III l'intention d'y renforcer son autorité. Contrairement à Schramm, Uhlirz mettait l'accent sur la collaboration entre l'empereur et le pape, lequel était surtout soucieux de gagner la Pologne et la Hongrie à la Chrétienté de spiritualité romaine. Par la suite, il apparut une synthèse entre les points de vue de Schramm et d'Uhlirz, qui voit dans les efforts de consolidation de l'autorité impériale au Sud, autant que dans le rapprochement avec la Pologne et la Hongrie les grandes lignes de la politique d'Otton III. Mais la tentation persistait d'expliquer la politique d'Otton III par son caractère et ses traits de personnalité.
Ces dernières années, le sens que Schramm a donné au terme de renovatio a été contesté à plusieurs reprises. D'après Knut Görich, il faut analyser la politique italienne et les campagnes contre Rome plutôt comme une préoccupation de pérennité de la papauté que comme un programme de régénération de l'Empire romain.
Gerd Althoff s'est plus récemment détourné des concepts politiques employés en histoire médiévale, qu'il juge anachroniques, dans la mesure où la place de l'écrit et les équivalences institutionnelles nous échappent pour comprendre la royauté au Moyen Âge. En outre, d'après Althoff, les sources invoquées à l'appui sont ambivalentes. On ignore s'il faut les rattacher à la tradition de la Rome antique ou à celle de la Rome chrétienne.
Otton III dans la poésie et les romans
Un poème du xie siècle, dans lequel le conseiller impérial Léon de Verceil chante la collaboration de l'empereur et du pape, évoque la reconstitution de l'Empire romain par Otton III. Ce poème commence surtout par une invocation au Christ, afin qu'il daigne porter les yeux sur Rome et lui rendre son lustre, pour qu'elle puisse prospérer sous le règne du troisième Otton.
Depuis le XVIe siècle, Otton III, de par sa vie courte et les événements dramatiques qui ont émaillé son règne, sert de personnage-titre à de nombreux témoignages littéraires ; mais bien peu ont pu survivre par leur valeur littéraire.
Dans son poème intitulé La Complainte de l'empereur Otton III Klagelied Kaiser Otto III., August von Platen-Hallermünde rabaisse Otton III par pur nationalisme. L'historienne et philosophe Ricarda Huch, dans son livre intitulé Römisches Reich Deutscher Nation 1934, compare Otton III à Otton Ier : son rejet d'Otton III s'appuie sur les idées de Giesebrecht. Mais les jugements favorables à la carrière d'Otton III s'expriment aussi dans la littérature. Ainsi paraissent, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux romans historiques sur l'empereur ottonien. Gertrude Bäumer, politicienne allemande du Mouvement de libération des femmes, donne à sa reconstitution de la vie d’Otton III le titre Le jeune homme au manteau d'étoiles : grandeur et tragédie d'Otton III Der Jüngling im Sternenmantel. Größe und Tragik Ottos III. Et simultanément, Albert H. Rausch Henry Benrath, son pseudonyme, auteur allemand, essaie de saisir la personnalité d’Otton III de façon plus subjective et avec davantage d’emphase. Il s'agit pour lui d’appréhender citation|la spiritualité dans la vie d'un monarque ».
Ascendance
Ancêtres d'Otton III du Saint-Empire
Sources primaires et vit
Theodor Sickel, Ottonis II. et Ottonis III. Diplomata, Hanovre, Monumenta Germaniae Historica, coll.Diplomata, 1893
Johann Friedrich Böhmer et Mathilde Uhlirz, Res gestae Imperii II, 3. Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III, Vienne, 1956
Sources littéraires
Arnulf de Milan trad. W. North, dir. Claudia Zey, Liber gestorum recentium, vol. 67, Hanovre: Hahn, Monumenta Germaniae Historica,
Monumenta Germaniae Historica Diplomata, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 8: Annales Hildesheimenses. Éd. de Georg Waitz. Hanovre 1878
Georg Heinrich Pertz, Annales Quedlinburgenses, Hanovre, Monumenta Germaniae Historica, 1839, p. 22
Bruno Georg Waitz et Wilhelm Wattenbach trad. W. Hartmann, Vita quinque fratrum eremitarum, vol. Supplementa tomorum I-XII, pars III. Supplementum tomi XIII pars II, Hanovre, Monumenta Germaniae Historica, 1888, p. 709
réimpr. par W. Hartmann sous le titre Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. vol. 1, Stuttgart 1995, p. 202–204.
Die Jahrbücher von Quedlinburg, trad. par Eduard Winkelmann Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit 36, Leipzig 1891.
Herman de Reichenau et Werner Trillmich dir. trad. Rudolf Buchner, Chronicon, Darmstadt, Monumenta Germaniae Historica, coll. Quellen des 9. und 10. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches, series in Folio 13, Mélanges Baron vom Stein, 1961. Texte en latin dans les Monumenta Germaniae Historica, Scriptores: Supplementa tomorum I-XII, pars I. Ed. par Georg Waitz et al. Hanovre 1881, p. 61
Dithmar et Robert Holtzmann dir. trad. Werner Trillmich, Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, Darmstadt, Monumenta Germaniae Historica, 1935 réimpr. 957
Thangmar: Vita Bernwardi episcopi Hildesheimensis. In Monumenta Germaniae Historica, Scriptores in Folio 4: Annales, chronica et historiae aevi Carolini et Saxonici. éd. par Georg Heinrich Pertz et al. Hanovre 1841, p. 754–782
Bibliographie Présentations générales
Pierre Riché, Les Grandeurs de l'an mille, Bartillat, édition 2008.
Francis Rapp, Le Saint-Empire romain germanique, Éditions du Seuil, coll. Points Histoire, 2003
Robert Folz, La Naissance du Saint-Empire, ed. Albin Michel, 1967
Gerd Althoff: Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat. 2e éd. augm., Kohlhammer Taschenbücher, Stuttgart u. a. 2005,
Helmut Beumann: Die Ottonen. 5e éd. Stuttgart 2000,
Hagen Keller: Ottonische Königsherrschaft, Organisation und Legitimation königlicher Macht. Darmstadt 2002,
Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter: Otto III. – Heinrich II. Eine Wende?. Sigmaringen 1997,
Biographies
Gerd Althoff: Otto III. Gestalten des Mittelalters und der Renaissance. Darmstadt 1997,
Ekkehard Eickhoff: Theophanu und der König. Otto III. und seine Welt. Stuttgart 1999
Ekkehard Eickhoff: Kaiser Otto III. Die erste Jahrtausendwende und die Entfaltung Europas. 2e éd. Stuttgart 2000,
Knut Görich: Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus: kaiserliche Rompolitik und sächsische Historiographie. Sigmaringen 1995, .
Percy Ernst Schramm: Kaiser, Rom und Renovatio. Darmstadt 1962 réimpr. de l'éd. de 1929.
Mathilde Uhlirz: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. Zweiter Band: Otto III. 983–1002, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1954.
Articles d'encyclopédie
Knut Görich, Otto III in Neue Deutsche Biographie, vol. 19 1999 p. 662–665.
Tilman Struve, Otto III in Lexikon des Mittelalters, vol. 6 1999
[ 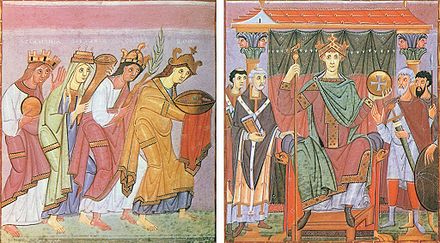 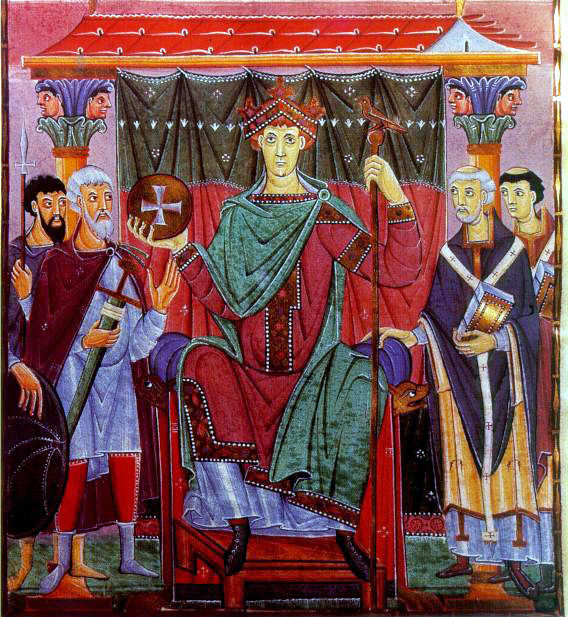  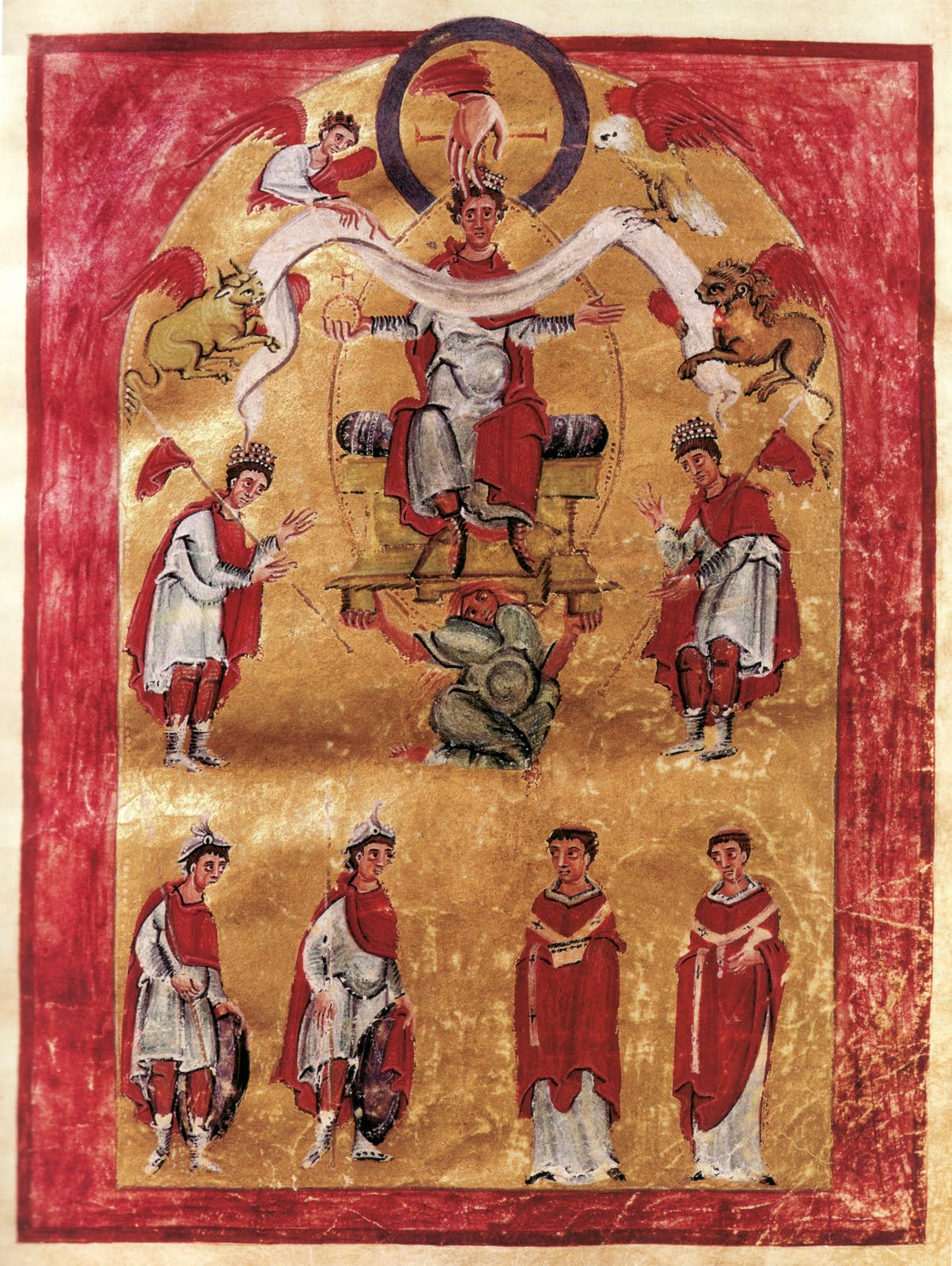        
Posté le : 23/01/2016 19:40
Edité par Loriane sur 24-01-2016 19:24:43
|
|
|
|
|
Benjamin Franklin |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 17 janvier 1706, à Boston naît Benjamin Franklin
dans la baie du Massachusetts, mort à 84 ans le 17 avril 1790 à Philadelphie en Pennesylvannie, imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur et homme politique américain.Il appartient au parti indépendant. Il est l'époux de Deborah Read, leurs enfants sont William Franklin, Francis Folger Franklin, Sarah Franklin Bache. Il est 6e président de Pennsylvanie du 18 octobre 1785 au 5 novembre 1788, avec pour Vice-président Charles Biddle et Thomas Mifflin, le prédécesseur est John Dickinsonon successeur Thomas Mifflin. Il est ministre plénipotentiaires des États-Unis en France du 14 septembre 1778 au 17 mai 1785, son successeur est Thomas Jefferson. Il est ministre plénipotentiaires des États-Unis en Suède du 28 septembre 1782 au 3 avril 1783, son successeur est Jonathan Russell il est 1er Postmaster General des États-Unis du 26 juillet 1775 au 7 novembre 1776. Il a pour successeur Richard Bache
Il participe à la rédaction de la déclaration d'indépendance des États-Unis, dont il est un des signataires, ce qui fait de lui l'un des Pères fondateurs des États-Unis. Pendant la Révolution américaine, il négocie en France en tant que diplomate non seulement le traité d'alliance avec les Français, mais aussi le traité de Paris. Délégué de la Convention de Philadelphie, il participe à l'élaboration de la Constitution des États-Unis.
La vie de Benjamin Franklin est en grande partie caractérisée par la volonté d'aider la communauté. La fondation des premiers sapeurs-pompiers volontaires à Philadelphie, la première bibliothèque de prêt des États-Unis et l'invention du poêle à bois à combustion contrôlée illustrent son ambition d'améliorer la qualité de vie et l'accès à l'éducation de ses concitoyens. Avec l'invention du paratonnerre, il parvient à écarter le danger que représentait jusqu'à présent ce phénomène naturel.
Fils d'un marchand de suif et de chandelles, Benjamin Franklin mène une carrière d'imprimeur, avant de se retirer du milieu des affaires à l'âge de 42 ans pour entrer en politique. Son ascension sociale - rapportée à travers les nombreuses éditions de son autobiographie - restera longtemps un exemple de réussite par le travail et la discipline.
En bref
Né à Boston, Benjamin Franklin est élevé dans une atmosphère puritaine : Il est d'abord imprimeur-journaliste et publie avec son frère le New England Courant, puis à Philadelphie La Gazette de Pennsylvanie. Il édite aussi un almanach, dans lequel il écrit, sous le pseudonyme du bonhomme Richard, des adages, des maximes et toutes sortes de conseils. Franc-maçon, Franklin fonde un club qui, en 1743, devient la Société philosophique américaine ; en 1731, il crée la première bibliothèque par abonnement ; quelques années plus tard, il met sur pied l'Université de Pennsylvanie. Il s'intéresse aussi aux expériences scientifiques, en particulier sur l'électricité, ce qui le conduit en 1752 à démontrer la similitude de l'électricité contenue dans les nuages avec celle qu'il a fabriquée ; il invente le paratonnerre.
Les affaires politiques n'ont cessé de retenir son attention. Il participe d'abord à la vie politique de la Pennsylvanie ; puis, à mesure que les colonies américaines de la Grande-Bretagne prennent conscience de leur personnalité propre, il s'efforce de trouver des compromis et finit par se rallier au mouvement d'indépendance. Il siège au Congrès continental qui, en 1776, adopte la Déclaration d'indépendance à l'élaboration de laquelle il a participé. La jeune République l'envoie en mission à Paris pour obtenir l'appui du roi de France. Sa mission est un succès : il séduit l'opinion éclairée du royaume, est reçu par Louis XVI qui reconnaît la République des États-Unis. Il rentre en Amérique en 1785, couvert de gloire. À quatre-vingt-un ans, il assiste à la convention de Philadelphie qui met au point la Constitution fédérale. À bien des points de vue, il symbolise l'Amérique des lumières. André Kaspi
Sa vie
Ce modeste fils de marchand de suif et de chandelles a été, parfois en même temps ou successivement, patron imprimeur, journaliste et publiciste, éditeur de livres, de journaux et d'almanachs populaires, homme de lettres bibliophile, fondateur d'associations notamment à vocations philanthropiques ou d'entraide telle La Junte, bibliothécaire inventeur des premières bibliothèques par abonnement en 1731, puis des premières bibliothèques mobiles, fondateur de diverses sociétés savantes dont l'activité est à l'origine de l'Université de Pennsylvanie, pompier créateur de la première compagnie statutaire de Philadelphie, puis physicien et inventeur du paratonnerre, philosophe et moraliste, homme politique et diplomate reconnu. Il a été nommé maître des Postes de la colonie de Pennsylvanie, puis de l'ensemble des Treize colonies par sa gracieuse Majesté. Réformateur remarquable de ce service régalien, par une distribution efficace, il peut s'imposer à l'échelon politique. Membre puis président d'honneur de l'assemblée de Pennsylvanie, ce représentant des États-Unis, premier maître des Postes, compte aussi parmi les tout premiers officiers artilleurs créateur d'une compagnie militaire pennsylvanienne, ambassadeurs, écrivains, philosophes précurseur de l'utilitarisme et scientifiques américains.
Histoire
Cet apprenti-imprimeur fuyant Boston à 17 ans, largement autodidacte, devenu imprimeur à Philadelphie, se fait connaître par le succès de son journal Pennsylvania Gazette et par ses almanachs Poor Richard, qui, vendus à plus de 10000 exemplaires, l'enrichissent. Attaché à la liberté, homme des Lumières complet, franc-maçon de la tradition britannique, précurseur des encyclopédistes et inventeur, il démontre la nature électrique de la foudre. Administrateur dévoué, philanthrope promoteur de rassemblement associatif et représentant élu de Philadelphie, il représente, à Londres, les colons majoritairement quakers de Pennsylvanie en procès contre les seigneurs privilégiés, fils héritiers du brillant créateur de la colonie, William Penn. Nommé Maître des postes des douze colonies, il réussit par sa protestation au nom des colons à Londres contre les taxes britanniques à les faire abroger par le parlement. Humilié par l'attorney général Wedderburn du conseil privé du Roi à Londres, à la suite du soulèvement du Massachusetts, ce généreux serviteur du souverain britannique, amis de nombreux Anglais, hommes d'esprit ou scientifiques, se cloître six semaines chez lui pour prendre la décision de rejoindre l'insurrection rebelle, en abandonnant la famille de son fils William, gouverneur du New Jersey. Il y apporte son réseau des postes, un des facteurs fondamentaux de la longue résistance des insurgés.
Corédacteur avec Thomas Jefferson et signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, il est l'un des pères fondateurs des États-Unis. Le Congrès de l'indépendance le nomme Maître Général des Postes, le charge de faire imprimer timbres et billets Continental currency dollar, de fabriquer de la poudre à canon tout en veillant à l'organisation militaire. Puis, comprenant l'urgence d'un soutien militaire, il le nomme premier ambassadeur en France1.Cette ultime et cruciale ambassade du vieux diplomate roué et chenu en a fait en son temps, de fin 1776 à 1785, le plus célèbre et adulé des Américains auprès d'un public français conquis par l'idée de liberté. Elle est couronnée de succès, car elle convainc d'abord le ministre Vergennes de renforcer un soutien d'armement et de mercenaires toujours discret, de prêter deux millions de livres, puis en 1780 de donner un véritable appui financier, maritime et terrestre à l'armée américaine et permettre la victoire définitive entre 1781 et 1783 de l'alliance franco-américaine. En découle la création en 1787 de l'État fédéral des États-Unis, présidé par l'officier virginien George Washington, vieil ami de Benjamin Franklin.
Son nom a été donné au Franklin Institut de Pennsylvanie, l'un des plus vieux et prestigieux organismes associatifs américains dévoués à la recherche
Naissance, enfance et adolescence à Boston
Benjamin Franklin est né le 17 janvier 1706, sur Milk Street, à Boston. Dernier né d'une fratrie de dix-sept enfants au sein d'une famille modeste, marquée par une atmosphère puritaine et conformiste, vivant de la fabrication de chandelles et de savons, il est le fils d'un immigré anglais Josuah Franklin.
On avait prévu qu'il fasse des études pastorales. Pour le préparer à Harvard, son père, avec l'appui de son oncle, l'envoya à la South Grammar School à l'âge de huit ans. Malgré ses très bons résultats son père en vint à croire qu'il n'avait ni la vocation ni les qualités propres à la vie ecclésiastique.
Il est alors envoyé jusqu'à l'âge de dix ans dans une école d'écriture et d'arithmétique, la George Brownell’s English school, où il acquiert une belle écriture, mais ne brille pas en arithmétique.
Le père, placé devant le coût d'une scolarisation peut-être inutile alors que ses grands fils ont tous appris un solide métier manuel, le rappelle à l'âge de dix ans pour travailler dans son magasin comme artisan en bougies et savons. Cette activité étant loin de satisfaire le jeune Franklin, son père lui accorde alors de découvrir de nombreux métiers : maçon, tonnelier, chaudronnier, qui lui permettent d'acquérir des compétences multiples qui se révéleront utiles dans ses travaux scientifiques. Mais ce sont surtout ses derniers jeux enfantins qui sont restés légendaires : Benjamin s'échappe vers les marais et la rivière avec quelques compagnons d'aventure. En bonne saison, ils nagent comme des indiens dans les étangs et font du canoë sur la rivière. Ils construisent des chaussées pierreuses à travers les marais pour s'avancer en des points d'observation ou de havre sans se mouiller, les moellons ayant été dérobés à un chantier voisin. Par grand vent au printemps ou en automne, ils font virevolter leurs cerfs-volants. Benjamin, précurseur d'un kite-surf rudimentaire, utilise même la propulsion d'un cerf- volant pour franchir plus vite et plus facilement qu'à la simple nage un plan d'eau.
Le jeune Benjamin Franklin était surtout intéressé par les livres ; à tel point que dans son Autobiographie, il raconte qu'il ne se souvient pas n'avoir jamais été sans savoir lire. Cela pousse son père Josiah, en 1718, à envoyer le jeune Benjamin travailler chez son autre fils James, récemment installé imprimeur à Boston après son retour de Londres. le père paie pour son contrat d'apprentissage, qui comporte vivre et couvert chez son frère. Mais James est un patron sévère et acariâtre, prêt à s'emporter en de furieuses colères. Néanmoins, Benjamin, lorsqu'il n'est pas terrorisé, commence réellement à écrire et à lire. Les rencontres avec les clients de l'imprimerie lui ouvrent discrètement les portes de nombreuses bibliothèques, à moins qu'il n'emprunte le soir à la dérobée les ouvrages à l'atelier de reliure.
En 1724, James entreprend l'édition d'un journal, le New England Courant sous le pseudonyme de Dame Silence Dogood litt. « Silence Faitdubien ». Le personnage du rédacteur inventé par Benjamin était une vieille veuve, sainte-nitouche, habitant à la campagne. Sous ce pseudonyme il écrit plusieurs articles, qu'il glisse sous la porte de l'atelier de son frère chaque nuit. Lequel ignore alors qui est l'auteur de ces articles.
Ses textes connaissent immédiatement un grand succès auprès du public. Lorsque James est emprisonné pour avoir critiqué les autorités, pour rappeler la liberté d'expression de la presse, Benjamin publie une citation d'un journal britannique :
… sans liberté de pensée, il ne peut y avoir de sagesse ; et pas de liberté du peuple sans liberté d'opinion ; celle-ci est le droit de chaque homme tant qu'il ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui.
Pendant la période d'emprisonnement de son frère, Benjamin Franklin publie seul le New England Courant avant que le titre ne soit interdit. Un subterfuge qui clôt précocement l'apprentissage de Benjamin permet à son frère James interdit de publication de continuer à publier le journal sous le seul nom de Benjamin Franklin en évitant la censure. Mais il ne traite pas mieux son cadet qui reste un apprenti insolent à ses yeux, et mérite selon lui d'être battu. La rédaction d'un nouveau contrat d'apprentissage, caché, est à l'origine d'une terrible dispute avec son frère James. Cela pousse Benjamin Franklin âgé de 17 ans à vouloir quitter l'entreprise de son frère pour une autre. Mais James répand sur lui de viles méchancetés, apprenti en rupture d'autorité, en avertissant les autres imprimeurs locaux. Josiah Franklin s'efforce de réconcilier ses deux fils. Mais James, désagréable, pousse Benjamin à quitter Boston pour New York. Il n'y trouve pas d'emploi d'ouvrier imprimeur anglophone. Le vieil imprimeur Bradford, désolé du désarroi de Benjamin, l'héberge gratuitement. Il indique que sa ville a toujours l'âme en grande partie néerlandaise. L'imprimeur cependant lui recommande d'aller à Philadelphie, où il savait que son fils Andrew Bradford également imprimeur avait une activité plus grande.
Très jeune, Benjamin Franklin comprend que l’écriture est le meilleur moyen de répandre ses idées ; aussi perfectionne-t-il sa prose souple, non pour le principe mais pour se forger un outil. Écris comme les savants, disait-il, et parle comme le vulgaire. Il se conforme au conseil donné par la Royal Society en 1667, recommandant « une manière de parler naturelle, sans fioritures.
Lorsqu’il quitte New York pour Philadelphie, en Pennsylvanie, terre des quakers pacifistes anti-esclavagistes, son bagage intellectuel était celui des couches sociales supérieures. Mais il avait les vertus puritaines du travail soigné, de l’auto-examen minutieux et du désir de s’améliorer. Toutes ses vertus se retrouvent dans son Autobiographie, qui se veut aussi un livre à l'usage de son fils. La section la plus connue de ce récit décrit son programme scientifique d’amélioration personnelle. Une liste de treize vertus : tempérance, silence, ordre, détermination, frugalité, industrie, sincérité, justice, modération, propreté, tranquillité, chasteté et humilité, et qui s’accompagne pour chacune d’une maxime. Pour la tempérance par exemple : Ne mange pas jusqu’à la somnolence. Ne bois pas jusqu’à la griserie. Ses écrits louant l'honnêteté, la prudence envers la chance et le travail ont été cités par Max Weber dans L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme.
En 1722, Benjamin Franklin s'affirme végétarien. Il écrit sur son carnet les consignes suivantes :
« Ne pas manger de viande »
« Ne boire que de l'eau »
« Ne pas mentir »
« Ne pas dire du mal des autres »
« Faire de son mieux ce qu'on entreprend »
« S'instruire toutes les fois qu'il est possible »
Proverbes de Poor Richard Almanack
Sans le moindre argent, il s'établit alors à Philadelphie, où il trouve une place d'apprenti-imprimeur chez Keimer, grâce à l'appui du fils Bradford.
Le hasard veut qu'il rencontre rapidement le gouverneur de la Pennsylvanie, Sir William Keith, qui lui adresse force louanges sur la qualité de son travail et lui propose de fonder sa propre imprimerie à Philadelphie. Sir Keith, le prenant sous son patronage, rédige une lettre de recommandation pour convaincre le père de Benjamin Franklin de l'aider financièrement. Le retour de Benjamin prodigue à Boston en 1724 est un échec complet. Le père refuse l'avance financière et Benjamin ne parvient pas à se réconcilier avec son demi-frère James. Le gouverneur lui promet alors des lettres de crédit pour lui permettre d'acheter le matériel d'imprimerie à Londres en Angleterre.
Benjamin Franklin part en Angleterre, mais le gouverneur ne lui fait jamais parvenir les lettres de crédits. Le gouverneur était réputé pour ses promesses, qu'il avait pour habitude de ne jamais tenir, ce que Franklin apprit trop tard. Grâce à l'appui et l'affection paternelle du vieux marchand quaker Denham, Franklin ne desespère pas. Toujours animé par l'idée de créer sa propre imprimerie, Benjamin Franklin travaille alors dix-huit mois à Londres comme imprimeur chez Samuel Palmer, où il accumule une petite épargne, surtout en donnant des cours de natation en fin de semaine. Terminant sa formation, il apprend surtout les dernières techniques en matière d'impression et s'initie à la science, notamment à la physique et la chimie, l'optique et la mécanique. Franklin se sent bien à Londres, mais le bon Denham qui repart vers l'Amérique lui rappelle de manière paternelle son premier objectif. Plusieurs rencontres lui permettent de revenir en Amérique en tant que commerçant avec un Anglais pour associé.
De retour à Philadelphie, la disparition brutale du bon marchand Denham qui s'était associé à son projet condamne et son activité marchande et son installation faute de capital suffisant. Elle le force à reprendre une activité d'ouvrier imprimeur à l'imprimerie Keimer dans laquelle il avait été apprenti. Une dispute à propos de son salaire le décide définitivement à fonder sa propre imprimerie. Auparavant, chez Keimer, un ouvrier issu d'une famille fortuné, Meredith, s'associe à part égale avec lui pour fonder son entreprise. Il lui prête en premier lieu l'argent qui lui faisait défaut afin de faire venir le matériel d'impression d'Angleterre. En attendant, pendant une période de trois mois il travaille toujours pour son ancien patron et imprime des billets de banque pour la colonie du New Jersey.
Le métier d'imprimeur le met en contact avec les rudes réalités de l'entreprise. Modeste, contraint de rembourser ses emprunts, il n'est que le directeur et homme à tout faire alors que Meredith, insouciant, se contente de vivre de ses revenus.
En 1729, il fait l'acquisition de l'imprimerie et du journal d'un concurrent, la Gazette de Pennsylvanie. Ceci lui permet de publier régulièrement des chroniques et des éditoriaux qui en font bientôt le quotidien le plus lu de l'Amérique coloniale.
Pour développer l'économie de Philadelphie il défend l'idée d'y imprimer aussi du papier monnaie de l'État de Pennsylvanie, et par la même occasion en obtient le marché. Ce contrat très lucratif lui permet de rembourser ses dettes. Il parvient même à racheter les parts de son partenaire imprimeur, Meredith. Par la même occasion, il ouvre une boutique vendant du papier, des parchemins et divers autres articles.
Le 30 janvier 1730, il est élu imprimeur officiel du gouvernement de la Pennsylvanie.
Cette même année, il accepte d'épouser une veuve, dont le nom de jeune fille est Deborah Read. Ce n'est pas une inconnue. Il s'agit de la fille de la famille de Philadelphie qui l'avait hébergé durant les premiers temps après sa venue de Boston. Avec ce mariage qui lui donne deux enfants, son fils William et sa fille Sally, il conforte sa position sociale.
Parallèlement, il se lance dans plusieurs activités sociales et culturelles. Il fonde la Junte, groupe de discussion se réunissant chez lui les vendredis de chaque semaine pour débattre de sujets philosophiques et créer une réelle entraide entre vingt membres et au-delà de se soucier de tous les citoyens. Mais le succès est tel qu'il est contraint d'inciter à la multiplication de ce genre d'association, ne pouvant accueillir chez lui tous ceux qui voudrait y prendre part. Il décide de fédérer les associations et de leur donner des objectifs communs ou spécifiques. Il a l'idée de mettre en commun les livres de tous les membres afin de créer une bibliothèque.
Cela lui donne alors l'idée de fonder la première bibliothèque municipale en 1731. La bibliothèque était accessible à tous contre une modique souscription annuelle. En 1742, la bibliothèque s'enrichit de nouveaux membres et surtout de livres et prend le nom de Compagnie de la bibliothèque de Philadelphie. À cette époque, la bibliothèque comptait environ 8 000 livres, des instruments et outils de physique, une collection d'objets d'histoire naturelle, ainsi que des collections d'arts et quelques terres autour de Philadelphie. Le modèle de la bibliothèque est copié à la grande joie de Benjamin Franklin dans tout l'État de Pennsylvanie, et dans les autres colonies. L'idée de rendre accessible les livres au plus grand nombre réjouissait Benjamin Franklin, qui y voyait un moyen de transmettre les idéaux de liberté.
À partir de 1732, il publie un almanach sous le pseudonyme de Richard Saunders un astrologue britannique qui devient simplement le bonhomme Richard ou le pauvre Richard. Il continuera à le publier annuellement durant vingt-cinq ans, sous le titre L'Almanach du Bonhomme Richard (Poor Richard's Almanack). Franklin publie sous ce pseudonymes des proverbes, des adages et des conseils. Ils sont choisis et souvent adaptés par ses soins :
« Il n'y a pas de petits ennemis »
« Une seule pomme pourrie gâte ses voisines du panier »
« Chat ganté n’attrape pas de souris »
« L'école de l'expérience coûte cher, mais les sots n'en connaissent pas d'autres »
« Un œuf aujourd'hui vaut mieux qu'une poule demain »
Il apprend aussi plusieurs langues étrangères parmi lesquelles le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Cet almanach était aussi un recueil de maximes et de textes vantant les progrès de l'industrie et donnant des conseils économiques. La première édition se vend à 10 000 exemplaires.
Le 24 juin 1734, Benjamin Franklin est élevé au rang de grand maître de la grande loge maçonnique de Pennsylvanie.
Loge maçonnique de Philadelphie
Le Frère Mc Calla de la R. L. Keystone trouva le grand livre authentique de sir John's Lodze, renfermant des détails sur les membres de cet Atelier depuis juin 1731 jusqu’en juin 1738. D'après ce livre, il ressort que Benjamin Franklin fut élevé au troisième degré dans cette Loge le 24 juin 1731. La ville de Philadelphie est à juste titre considérée comme le berceau de la Maçonnerie aux États-Unis. Mais c'est à Boston que la première Loge possédant une constitution fut installée.
L'homme politique
Ses activités d'imprimeur et d'écrivain, et surtout de publiciste et de fondateur d'association, permettent à Benjamin Franklin de se lancer en politique. La société des Amis contrôle l'espace politique pennsylvanien par des dirigeants intransigeants. Mais Benjamin, animateur d'associations ouvertes, tolérantes et appelant au bien public, possède un grand capital de sympathie auprès de la foule des modestes quakers. Par son sens du concret et de l'utile, Benjamin et ses amis rassemblent toutes les confessions, et même rêvent d'unir amicalement les différentes colonies, profondément divisées, irrémédiablement distantes, fiers de leurs particularismes et haineusement jalouses sur tous les plans économiques, sociaux, religieux et politiques. Pour vouloir accepter de régler les innombrables jonctions de transports et d'échanges, ne faut-il pas avoir cet idéal de fraternité fixé au cœur ?
1736 : Nommé secrétaire de l'assemblée générale de Pennsylvanie, il est réélu tous les ans avant de devenir représentant de la ville de Philadelphie.
1737 : il obtient le titre de Maître des Postes. Cette fonction importante facilite la diffusion de ses journaux et ses idées, et lui permet en outre d'être en lien avec les autres colonies.
1738 : il met en place la première compagnie de pompiers américaine à Philadelphie, la "Union Fire Company". Plusieurs compagnies concurrentes se créèrent alors à Philadelphie, mais il réussit à les fusionner. Philadelphie ne connaît pas de grand incendie durant cette période. Avec la même idée, il crée aussi une compagnie d'assurance contre le feu.
1743 : il fonde un club qui est à l'origine de la Société américaine de Philosophie American Philosophical Society. La société édite une revue savante, le Journal of American Philosophical Society.
1744 : alors que l'Assemblée était incapable de mettre en place un plan pour défendre la colonie des incursions indiennes les Amérindiens étaient alors alliés des Français, il réussit à créer une association volontaire pour la défense du pays. Le nombre de volontaires s'élève rapidement à 10 000.
1747 : il est élu, par la ville de Philadelphie, membre de l'Assemblée Générale de la province il batailla souvent contre les propriétaires qui demandaient toujours plus d'avantages tout en refusant les impôts.
1748 : Vivant dans l'aisance depuis le succès de ses almanachs, il se retire de la vie professionnelle à la fin de l'année en cédant son imprimerie. Désormais, l'honorable rentier peut se consacrer à la vie associative et politique pennsylvannienne, tout en maintenant une intense activité de recherche et en gardant ses fonctions officielles au service de la couronne britannique.
1749 : il crée avec ses amis le premier collège Academy of Philadelphia aujourd'hui université de Pennsylvanie. Il est aidé financièrement en cela par la famille Penn, descendants du fondateur de la ville de Philadelphie, William Penn. Il en devient immédiatement le président.
Le Join, or Die, dessin prônant l'Union des colonies attribué à Benjamin Franklin
1751 : il est élu membre de l’Assemblée de Pennsylvanie.
1752 février : il crée et ouvre le Pennsylvania Hospital à Philadelphie.
Le 10 août 1753, il est élu Deputy Postmaster General of North America. Cela lui permet d'avoir des contacts avec l'ensemble des 13 colonies. Sa réforme du système instaura des liaisons postales hebdomadaires entre Phildadelphie et Boston, ce qui permit de diviser par deux les délais de livraison.
1754-1755 : il tente d'unifier les colonies pour se défendre plus efficacement face aux Français, en prélude à la Guerre de Sept Ans qui oppose la Grande-Bretagne et la France, en particulier pour le contrôle de la vallée de l'Ohio. Au cours de l'hiver 1754-1755, Benjamin Franklin, représentant de l'assemblée de Pennsylvanie, s'inquiète de la présence militaire française à Fort Duquesne. Au printemps, il s'efforce d'apporter une aide efficace aux troupes du général Edward Braddock. Après l'écrasement de celles-ci par les Français, la défense des frontières pennsylvaniennes est confiée au colonel Franklin, qui instaure une section d'artillerie, destinée à impressionner les indiens.
1756 : il réforme la police de Philadelphie, en mettant en place un nouveau règlement visant à mieux protéger les citoyens tout en préservant leur vie privée. Il met en place un éclairage public dans les rues de Philadelphie. Il a alors cinquante ans.
1757 : l'assemblée de Philadelphie l'envoie à Londres pour régler les problèmes entre les propriétaires terriens la famille Penn et le gouvernement.
1760 : L'assemblée de Pennsylvanie gagne à Londres son long procès contre les propriétaires Penn. Ceux-ci, s'inclinant devant l'autorité royale qui les déclare contributeurs, demande à Benjamin Franklin de veiller à une répartition équitable de l'impôt pennsylvannien ainsi qu'à l'établissement de taxes justes. À l'instar des autres colonies américaines, la politique royale d'exploitation et de contrôle des ressources y est observée en première ligne.
1761 : voyages en Belgique et en Hollande.
1762 : après une escale à Madère, il est de retour en Pennsylvanie le 1er novembre.
1763 : une grande tournée d'inspection des bureaux de poste est organisée entre juin et novembre 1763 dans le New Jersey,New York et en Nouvelle-Angleterre.
Le 1er octobre 1764, il perd son siège à l'assemblée de Pennsylvanie ; il est accusé par ses adversaires d'être favorable au gouvernement royal, parce qu'il convoiterait le poste de gouverneur.
Il est nommé agent des colonies à Londres, soit l'ambassadeur de fait non seulement de la Pennsylvanie, mais aussi du Massachusetts, du New Jersey et de la Géorgie. Il est de retour en Angleterre le 9 décembre, où il accoste à l'île de Wight. Il reste onze ans à ce poste.
1765 : il demande l'abrogation du Stamp Act.
1767 : lors d'un voyage à Paris entre août et octobre, il est présenté à Louis XV.
1769 : il est élu président de la Société américaine de philosophie. Nouveau voyage en France.
L'ambassadeur, père fondateur des États-Unis
Signataire de la Déclaration d'Indépendance
Il rentre de Grande-Bretagne où il était représentant des colonies, chargé d'empêcher l'application du Stamp Act. Son accueil est salué puisqu'il a réussi, non sans s'être fait humilier par le conseil privé du roi après les troubles du Massachusetts. Il retourne tristement à Philadelphie, où, après moultes hésitations, il se range parmi les partisans de l'indépendance, au contraire de son fils William, gouverneur du New Jersey depuis 1762. Il ne peut désavouer, malgré la violence provocatrice propagée après le Boston tea party, la conscience américaine libre. Malgré sa délicate situation personnelle et familiale, il rejoint le mouvement d'indépendance. En 1776, il préside la Convention constitutionnelle de Philadelphie. Il est membre de la Commission des Cinq, avec notamment Thomas Jefferson chargée par le Second Congrès continental de rédiger le texte de la Déclaration d'Indépendance. Il en est un des signataires au côté de représentants des Treize Colonies.
Ambassadeur en Europe
En octobre 1776, Franklin part pour Paris, afin de servir d'ambassadeur officieux des États-Unis en France11, accompagné de Silas Deane ami et diplomate et Arthur Lee, diplomate plus jeune qui l'accompagne.
Accompagné de ses deux petits-enfants, il traverse sur le vaisseau Reprisal l'Atlantique malgré les navires militaires britanniques. Il essaie en plongeant un thermomètre dans l'eau de trouver des indices d'un puissant fleuve maritime chaud qui mène vers les côtes d'Europe selon la croyance des vieux navigateurs. Mais dénutri et malade, il voit les côtes de France le 3 décembre 1776. Le lendemain, il débarque à Auray dans le port de Saint-Goustan. La délégation américaine gagne Nantes puis Paris par la route. Entre temps, remis sur pied, Benjamin a lu la description stéréotypée que font de lui les journaux, entretenant une attente frénétique. Il garde ses lunettes, le bonnet de fourrure du philosophe américain, son simple bâton de marche. Sans épée, sans perruque poudrée, l'ambassadeur républicain vêtu de manière simple fait sensation. Le savant qui parle français avec accent et lenteur, si ce n'est avec difficulté, entreprend avec patience une carrière diplomatique des plus réussies. Il est là pour appeler les Français à soutenir les Américains dans leur guerre d'indépendance. Porté aux nues par la communauté scientifique et littéraire parisienne, il est vu comme l'incarnation des valeurs humanistes des Lumières. À une réunion de l’Académie française, Franklin et Voltaire, pourtant très malade mais attiré par la grande célébrité du penseur américain, se lient d'amitié et s'embrassent publiquement. Turgot exprime lui aussi son admiration pour le diplomate. Il choisit de résider dans une grande résidence desservie par de nombreux serviteurs à Passy, entretenant une douce amitié avec une gent féminine ravissante, telle mesdames Helvétius ou Brillon. Sa vie se partage ainsi entre badinages en français et rapports scientifiques, entre promenade au bois de la Muette et études dans son cabinet avec ses secrétaires. Il y invite à dîner ses voisins autant que les personnalités les plus en vue du Royaume.
Au ministère des Affaires étrangères, Benjamin Franklin se rend compte qu'en dépit du désir des Français d'obtenir une revanche sur la Grande-Bretagne, et de la sympathie que la cause américaine suscite, le royaume hésite à s'engager tant la situation des rebelles américains est encore vulnérable. Franklin met donc en place un dispositif diplomatique pour parvenir à ses fins : il multiplie les contacts, court-circuite la diplomatie britannique, développe ses relations avec les hommes politiques français.
Mais les nouvelles de la résistance américaine sont mauvaises. À l'annonce de la prise de Philadelphie par Lord Howe durant l'été 1777, Benjamin rétorque sur un ton poli pour ne pas perdre la face en rappelant que sa chère ville n'est pas une modeste bourgade : c'est plutôt Philadelphie qui a pris Howe. L'inquiétude est pourtant terrible. De plus, le vieillard désormais bien nourri est souvent terrassé par la goutte. Comme les Français adulent encore plus le représentant des perdants, il a coutume de répliquer ça ira, ça ira, une expression qui passe à la mode.
En février 1778, après la nouvelle de la défaite britannique de Saratoga, les trois représentants américains parviennent à signer un accord avec la France. Deane et Lee rentrent aux États-Unis, laissant Franklin seul ambassadeur à Versailles. La reconnaissance auprès du souverain Louis XVI de la nouvelle République est acquise, ainsi que l'alliance militaire et économique nécessaire. La mission diplomatique est un succès, mais l'avenir de la République reste encore bien incertain.
La même année 1778, il devient membre de la loge maçonnique des Neuf Sœurs. Il en sera élu vénérable l'année suivante, puis réélu en 1780.
Après une nouvelle défaite britannique à la bataille de Yorktown en Virginie, il ébauche les premières négociations de paix avec les représentants du pouvoir britannique. Durant l'été 1782, alors que John Adams et John Jay prennent le chemin de Paris, Franklin rédige les grandes lignes du traité qui fera autorité : il réclame l'indépendance totale, l'accès aux zones de pêche des nouveaux territoires, l'évacuation par les forces britanniques des zones occupées et l'établissement d'une frontière occidentale sur les rives du Mississippi.
Signataire du Traité de Paris 1783
Signature du Traité de Paris, 1783
En 1783, Adams, Jay et Benjamin Franklin, alors âgés de plus de soixante-dix ans, signent pour les États-Unis un traité de paix qui garantit l'Indépendance. Ce traité met fin à la guerre d'indépendance.
Signataire de la Constitution américaine
De retour aux États-Unis en 1785, sa popularité est à son comble : il est élu de nouveau président de l'État de Pennsylvanie pour trois ans. Il participe aussi à la rédaction de la Constitution américaine.
Il devient ainsi le seul père fondateur de l'Amérique founding father à signer les trois documents fondateurs des États-Unis : la Déclaration d'Indépendance, le traité de Paris et la Constitution américaine.
L'inventeur et le scientifique
Expérience du cerf-volant de Franklin.
Les expériences scientifiques de Franklin
À côté de ses activités d'imprimeur, d'homme politique et de diplomate, Benjamin Franklin conduit après 1750 un grand nombre d'activités scientifiques dont les résultats participent de sa renommée en Europe.
Le souci des autres citoyens au sein des associations philadelphiennes a permis d'accroître son attention sur les transports, la sécurité civile, notamment la lutte contre l'incendie et les catastrophes naturelles. Le pompier bénévole Franklin qui porte seau et couverture, a été frappé par l'embrasement violent qui faisait disparaître les granges et maisons paysannes touchées par la foudre au voisinage de Philadelphie. L'eau pompée et transportée au seau, les couvertures tendues pour récupérer, sans dommages, bien matériel et personnes piégées aux étages n'étaient d'aucune utilité.
Il est particulièrement célèbre pour ses travaux dans le domaine de l’électricité, notamment ses expériences sur l'électricité dans les nuages et son explication de la foudre. En 1750, il rédige le protocole d'une expérience célèbre avec un cerf-volant. Afin de prouver à ses contradicteurs de la Royal Society que les éclairs étaient de simples décharges de nature électrique, il propose de faire voler un cerf-volant dans le passage de nuage orageux. La corde du cerf-volant une fois humidifiée sera mise à distance d'une clef métallique, ainsi devront être libérées des étincelles. Pour éviter les moqueries et limiter le danger, il décide de conduire l'expérience en privé. L'expérience présente d'évidents risques d'être fatale aux deux expérimentateurs. Elle connaît pourtant un grand intérêt en Europe et des expériences similaires sont menées, notamment par le Français Thomas-François Dalibard.
Ces recherches conduisent à l'invention du paratonnerre, dont les premiers exemplaires sont installés sur sa maison, sur l'Independence Hall ainsi que sur l'académie de Philadelphie. Aux recherches sur la nature de l'électricité, on doit par exemple des termes aussi courants que batterie, positif, négatif,charge condenseur condensateur» etc.
Il a également placé lui-même des paratonnerres ; par exemple, en 1782, Benjamin Franklin a installé un paratonnerre sur la flèche du clocher de l'Église Saint-Clément Arpajon, en France.
La Royal Society lui décerne la médaille Copley en 1754.
Il est aussi un chercheur pionnier dans le domaine de la météorologie cloches de Franklin et même un des premiers hommes à monter dans une montgolfière. En effet, au moment du vol de la première montgolfière 1783, sa maison est voisine du terrain d'envol. Il en fit une description dans une correspondance privée, et rencontra même le marquis d'Arlandes et un frère Montgolfier. L'analyse du vol par ballon à air chaud et à gaz qu'il fit à cette occasion est fascinante de clairvoyance.
Au cours de son voyage à Londres, motivé par le procès contre la famille Penn, les lenteurs et incessants reports de la procédure juridictionnelle britannique entre 1758 et 1760, lui laisse l'oisiveté de fréquenter les sociétés savantes et les universités anglaises. Il peut s'adonner continûment à la science expérimentale tout en fréquentant les cercles de pouvoir londoniens et en multipliant les voyages instructifs jusqu'en 1762. En 1762, il invente le glassharmonica, instrument à clavier composé de verres frottés.
Il est aussi l'inventeur des lunettes à double foyer et du poêle à bois à combustion contrôlée, qui porte encore son nom et est en usage répandu à la campagne. Comme Thomas Edison, c'est le côté concret et pratique de la philosophie, de la science et des techniques qui l'intéresse. En 1770, il est le premier à cartographier le courant marin du Gulf Stream qui longe le littoral est des États-Unis.
En 1768, dans un texte intitulé A Scheme for a New Alphabet and Reformed Mode of Spelling, il propose une réforme de l'orthographe pour la langue anglaise avec un nouvel alphabet phonétique. Cette invention ne rencontrera pas de succès.
Franklin place toutes ses inventions dans le domaine public et indique clairement dans ses écrits qu'il s'agissait là d'une volonté délibérée. « … de même que nous profitons des avantages que nous apportent les inventions d'autres, nous devrions être heureux d'avoir l'opportunité de servir les autres au moyen de nos propres inventions ; et nous devrions faire cela gratuitement et avec générosité.
Franklin est aussi le premier à proposer une expérience permettant de calculer la taille d'une molécule. Il verse une cuillère à café d'huile à la surface d'un étang à Clapham, près de Londres et s'aperçoit que la tache d'huile s'étend sur un demi-acre (approximativement 2 000 m²)18. Il observe que les vaguelettes provoquées par le vent ne se propageaient pas sur l'huile. Dans un premier temps, il ne saisit pas l'ampleur de cette simple expérience mais Lord Rayleigh se rend compte cent ans plus tard en divisant le volume d'huile par la surface d'étalement que l'on trouvait une valeur de l'ordre du nanomètre.
Il est en 1784 le premier à évoquer l'idée de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie19, idée qui sera sans suite jusqu'au vingtième siècle et le passage à l'heure d'été.
Ses dernières années Lutte contre l'esclavage
Durant ses dernières années, il est un fervent partisan de l'abolition de l'esclavage. En 1751, il publie Observations relatives à l'accroissement de l'humanité dans lequel il avance que l'esclavage affaiblit le pays qui le pratique. Il affranchit ses esclaves dès 1772.
De toutes ces activités, il affirmera qu'il préfère que l'on dise de lui il a eu une vie utile plutôt que il est mort très riche.
Quelque temps après 1785, Benjamin Franklin est devenu le président de la Pennsylvania Abolition Society. La société lui a demandé d'amener la question d'esclavage à la Convention Constitutionnelle de 1787. Il l'a fait en 1790.
Son testament
Il meurt à Philadelphie le 17 avril 1790, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. À l'annonce de sa mort, l'assemblée constituante française de 1789 décrète trois jours de deuil national.
Dans son premier testament Benjamin Franklin voulut donner une partie de sa fortune 2 000 livres sterling pour permettre la réalisation de travaux afin de rendre navigable le Skuylkil. Cependant, il révise son testament, car cette somme semblait être bien insuffisante pour réaliser les travaux.
Discours du Comte de Mirabeau au cours de la séance du 11 juin 1790 sur la mort de Benjamin Franklin
Finalement, il cède une partie de sa fortune aux villes de Boston et Philadelphie 1 000 livres sterling chacune. Cet argent devait être prêté à des artisans pour permettre leur installation. Il comptait sur les intérêts (5 %) pour faire augmenter la somme initiale. D’après ses calculs, au bout de cent ans, la somme devait s’élever à 131 000 livres sterling.
Il souhaite alors dans son testament qu’une partie de cette somme 100 000 livres sterling soit utilisée pour construire des hôpitaux, infrastructures, fortifications, écoles… L’autre partie devant à nouveau être prêtée. Au bout de 200 ans la somme devant s’élever à 4 061 000 £ sera à la disposition du gouvernement de l’État.
Pour Philadelphie, il prévoit le même mécanisme, au bout de cent ans la somme devait servir à construire un aqueduc pour amener de l’eau potable en ville et à rendre comme il le souhaitait initialement le Skuylkil navigable.
Par ailleurs, il lègue à George Washington son bâton de pommier sauvage avec lequel il avait pour habitude de se promener.
Ses livres sont quant à eux cédés à différentes institutions et à ses petits-fils.
Ses créances sont données à l’hôpital de Pennsylvanie, en espérant que les personnes qui lui devaient de l’argent auront l’impression de faire une bonne action en payant leur dette à l’hôpital.
Il a souhaité avoir une cérémonie d’enterrement avec le « moins de cérémonie et de dépense possible ».
Hommages
Des médailles à l'effigie de Franklin ont été exécutées par le graveur Augustin Dupré en 1784 et 1786. La légende du revers avait été composée par Turgot : "ERIPUIT COELO FULMEN SCEPTRUMQUE TYRANNIS" Il a enlevé la foudre au ciel et le sceptre aux tyrans . Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet ND 1110.
Billet de 100 $.
Statue de Benjamin Franklin au Benjamin Franklin National Memorial de Philadelphie.
En tant que « père fondateur » du pays, son effigie a figuré sur plusieurs timbres d'usage courant, dont le cinq cents brun, un des deux premiers timbres des États-Unis.
Son effigie apparaît aussi sur le billet de cent dollars.
D'innombrables rues, ponts, établissements scolaires ou monuments portent son nom :
à Philadelphie :
Benjamin Franklin Parkway
Pont Benjamin Franklin
Benjamin Franklin Square
Benjamin Franklin Institut
à Paris dans le 16e arrondissement :
Rue Benjamin-Franklin
à Versailles dans le quartier des Chantiers :
Rue Benjamin-Franklin
USS Benjamin Franklin, navire de guerre de l'US Navy.
Un astéroïde découvert le 2 septembre 1986 par l'astronome Antonín Mrkos est baptisé 5102 Benfranklin en son honneur.
En 2006, à Philadelphie, de nombreuses manifestations ont été organisées pour célébrer le 300e anniversaire de la naissance de Benjamin Franklin. En France, une exposition lui est consacrée au Conservatoire national des arts et métiers.
En géologie, son nom est à la racine du minéral franklinite, un oxyde naturel complexe de Zn, Fe et Mn, de la famille des spinelles. La franklinisation désignait autrefois en médecine le traitement médical par des sources d'électricité.
Épitaphe
Benjamin Franklin écrivit son épitaphe Mock Epitaph à l'âge de vingt-deux ans :
The body of
B. Franklin, Printer
Like the Cover of an Old Book
Its Contents torn Out
And Stript of its Lettering and Gilding
Lies Here, Food for Worms.
But the Work shall not be Lost;
For it will (as he Believ'd) Appear once More
In a New and More Elegant Édition
Revised and Corrected
By the Author.
Le corps de
B. Franklin, imprimeur,
telle la couverture d'un vieux livre
dépouillée de ses feuilles,
de son titre et de sa dorure
Repose ici, pâture pour les vers.
Mais l'ouvrage ne sera pas perdu
et reparaîtra, c'est la foi de Franklin,
dans une nouvelle édition, plus élégante,
revue et corrigée
par l'Auteur.
Cette épitaphe n'a pas été employée. Sur sa tombe, ne figurent que quelques mots : Benjamin and Deborah Franklin 1790.
Œuvres
Correspondance de Benjamin Franklin, Tome 1, 1757-1775 disponible sur Gallica.
La science du bonhomme Richard et Conseils pour faire fortune disponible sur Gallica Poor Richard's Almanack, 1732-1758
Mélanges de morale, d'économie et de politique, extraits des ouvrages de Benjamin Franklin disponible sur Gallica, par Charles Renouard, 1826.
Moi, Benjamin Franklin - Citoyen Du Monde, Homme Des Lumières The Autobiography of Benjamin Franklin, 1793 Dunod, 2006
L'Art de choisir sa maîtresse et autres conseils indispensables, trad. Marie Dupin, Éd. Finitude, 2011
Benjamin Franklin, naissance d'une nation, choix de lettres par Gérald Stehr, TriArtis Éditions, mai 2013 -           
Posté le : 16/01/2016 23:28
Edité par Loriane sur 17-01-2016 15:14:11
|
|
|
|
|
Joseph Joffre 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 3 janvier 1931 à Paris 7e meurt Joseph Jacques Césaire Joffre
à 78 ans, né le 12 janvier 1852 à Rivesaltes Pyrénées-Orientales, officier général français de la Première Guerre mondiale, artisan de la victoire alliée lors de la bataille de la Marne et de la stabilisation du front nord au début de la guerre. Il est nommé maréchal de France en 1916.
C'est aussi un des responsables militaires les plus controversés du XXe siècle, notamment en raison de l'emploi de la stratégie militaire de l'offensive à outrance, extrêmement coûteuse en vies humaines pour des résultats relativement médiocres sur le terrain, notamment lors de la bataille des frontières et de la bataille de la Marne. En 1916, il est remplacé par le général Nivelle. En 1918, il est élu à l'Académie française au fauteuil 35. Il a le grade Général de division de 1869 à 1916 pendant le conflit de la première Guerre mondiale, puis il est commandement Généralissime de 1914 à 1918, ses faits d'armes en 1887 est la prise de Ba-Dinh, en 1894 : Prise de Tombouctou, en 1914 : Bataille de la Marne, en 1916 : Bataille de Verdun
Ses distinctions sont Chevalier de la Légion d'honneur en septembre 1885, commandeur de la Légion d'honneur en avril 1903, grand-croix de la Légion d'honneur le 11 juillet 1914, il reçoit la médaille militaire en décembre 1914, puis en décembre 1016 il est fait maréchal de France, et reçoit la croix de guerre 1914-1918
En bref
Fils d'un petit propriétaire viticulteur, Joseph Joffre fait de brillantes études et, grâce à l'aide de ses compatriotes, prépare l'École polytechnique où il entre, benjamin de sa promotion. Lieutenant, puis capitaine au 1er génie à Versailles, il participe à la reconstruction de l'enceinte fortifiée de Paris. Prématurément veuf, il demande à servir en Extrême-Orient. À Formose, en 1885, il fortifie Keelung, puis, chef du génie à Hanoï, il organise les travaux de défense du Haut-Tonkin et prend part aux sièges de Ba Dinh et Ma Kao. Rentré en France, il est chargé des cours de fortification à l'école d'application de Fontainebleau où il ne brille pas. Appelé au Soudan pour diriger la construction du chemin de fer de Kayes à Bamako, il reçoit le commandement de la région nord-ouest. Au début de 1894, il pénètre en force à Tombouctou et organise le pays en dépit de l'hostilité du gouverneur Grodet. Il part pour Madagascar en janvier 1900, réclamé par Gallieni, pour créer le camp retranché de Diégo-Suarez. Général de brigade en 1902, il est ensuite nommé directeur du Génie à Paris et reçoit sa troisième étoile en 1905. C'est à l'époque un homme de cinquante-trois ans, corpulent, méthodique, ponctuel et assidu, peu loquace et pourvu d'un solide bon sens. En 1910, quoique non breveté, il entre au Conseil supérieur de la guerre dont, en 1911, il est vice-président. La même année, la réorganisation du haut commandement fait de lui, avec le titre de chef d'état-major général, le chef incontesté de l'armée française. Auteur d'un plan de mobilisation connu sous le nom de plan XVII, qui avait sur les précédents l'avantage d'envisager la violation de la neutralité belge, Joffre se préoccupe de réorganiser l'armée, divisée par l'affaire Dreyfus et les influences politiques. Il fait établir des thèmes de travail et des règlements que l'on expérimente lors de manœuvres sur le terrain. Tous les échelons y participent et les chefs incapables sont éliminés. Il préconise la loi de trois ans que le parlement vote le 18 juillet 1913. Grâce à lui, lorsque la guerre éclate (2 août 1914), l'armée française a comblé une partie de son handicap, face à la puissante armée allemande.
Les premiers revers aux frontières n'entament ni le calme ni la détermination du commandant en chef. Devant la manœuvre allemande de débordement par la gauche, Joffre réussit une retraite générale stratégique sans rupture du front allié et, le 6 septembre, profitant d'une erreur de l'état-major ennemi qui le croit battu, il donne l'ordre d'attaquer sur l'ensemble du front. C'est la victoire de la Marne à laquelle participe Gallieni ; Paris est sauvé. Viennent ensuite la série d'opérations destinées à stopper la « course à la mer » et la stabilisation des fronts, marquée de part et d'autre par de furieuses et sanglantes attaques, en Artois au printemps et à l'automne de 1915, à Verdun et sur la Somme en 1916. Depuis le début de la guerre, la fermeté inébranlable de Joffre a fait de lui le pilote sûr qu'il fallait à l'armée, le temps que les ressources des empires français et anglais entrent en jeu. Mais le général en chef, qui refuse toute immixtion extérieure dans son commandement, n'a pas que des amis dans les milieux politiques. La pression de ses adversaires sur le gouvernement ne cesse de croître et, les résultats de l'offensive de la Somme ayant été jugés insuffisants, Joffre est remplacé par Nivelle en décembre 1916. C'est la disgrâce. Il est cependant élevé à la dignité de maréchal de France le 25 du même mois, mais il n'a pratiquement plus aucun pouvoir. En 1917, il effectue, avec Viviani, une mission aux États-Unis pour préparer l'entrée en guerre de ce pays. Le maréchal y reçoit un accueil triomphal. Les Parisiens aussi l'ovationnent quand, le 14 juillet 1919, il défile sous l'Arc de triomphe à la tête des armées alliées, aux côtés de Foch et de Pétain.
Après la guerre et son élection à l'Académie française, il effectue de nombreuses missions de prestige à l'étranger. Rentré en France, il rédige ses Mémoires qui, terminés en 1928, ne seront publiés qu'après sa mort. Le pays lui fait des funérailles nationales grandioses et le Parlement vote une loi qui déclare que « Joseph Joffre, maréchal de France, a bien mérité de la Patrie ». André DAUBARD
Sa vie
Joseph Joffre naît à Rivesaltes, le 12 janvier 1852, à 8 heures du matin. La famille est aisée, nombreuse et catalane : le père, Gilles Joffre 1823-1899, est tonnelier et sa mère, Catherine Plas 1822-1899, mère au foyer. Élève brillant, il fait d'abord ses études secondaires au lycée François-Arago de Perpignan, puis en 1868 au lycée Charlemagne à Paris en classe préparatoire aux grandes écoles. Classé 14e sur 132 au concours d’entrée à l'École polytechnique de juillet 1869, il est le benjamin de sa promotion car il n'a que dix-sept ans. Un de ses amis dira de lui : Il avait vraiment bon air, sous le frac, avec ses galons d'or tout neufs.
Il suit l'instruction militaire depuis quelques mois quand la guerre franco-prussienne éclate durant l’été 1870. Il est aussitôt affecté au bastion 39, près de La Villette. Il est déçu par la médiocrité de la défense française. Joseph Joffre participe à la guerre comme sous-lieutenant des 8e, 4e et enfin 21e régiments d'artillerie. En mars 1871 seulement, il retrouve l'École polytechnique avec ses camarades. Durant la Semaine sanglante, Joffre se montre hostile à la Commune de Paris.
En juillet 1871, il retrouve une nouvelle fois l'École. À sa sortie de Polytechnique, il choisit le génie militaire et est affecté au 2e régiment à Montpellier en novembre 1871. Promu lieutenant en 1872, il est détaché à l'École d'application de l'artillerie et du génie à Fontainebleau. Il fait la connaissance d'une jeune veuve, Marie-Amélie Pourcheiroux de six ans son aînée, qu'il épouse le 11 octobre 1873 mais qui meurt en couches quelques mois après, le 3 avril 1874 à Montpellier. Il demande sa mutation.
Joffre est affecté au 1er régiment à Versailles au cours du printemps 1874. Il participe à la reconstruction de l'enceinte fortifiée de Paris puis il dirige la construction du fort de Montlignon Seine-et-Oise, 1874. Initié franc-maçon en 1875, il fait partie de la loge Alsace-Lorraine. Nommé capitaine, le jeune officier part pour Pontarlier travailler aux fortifications du Jura en 1876, puis à celles de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent dans les Pyrénées-Orientales de 1883 à 1884.
Sa demande de partir en Extrême-Orient est acceptée quelques mois après son dépôt, à la fin de l'année 1884.
Service dans les colonies françaises
De retour à Paris, le capitaine Joffre reçoit sa mutation en Extrême-Orient, où la France cherche depuis plusieurs années à accroître son emprise économique et militaire. En janvier 1885, il embarque à Marseille et arrive sur l'île de Formose un mois et demi plus tard. Là-bas, il est nommé chef du génie sous les ordres de l'amiral Amédée Courbet. Chargé de fortifier la base de Chilung organiser la communication, fortifier et loger, Joffre suit l'objectif de remporter la mainmise sur le Tonkin dans la guerre franco-chinoise.
Deux ans plus tôt, en avril 1883, l'Annam avait accordé un protectorat français sur le Tonkin contre l'avis de la Chine. Nommé chef du génie à Hanoï, Joseph Joffre organise les postes de défense du Tonkin septentrional en juillet 1885. Il tente d'améliorer les hôpitaux, d'ouvrir de nouvelles routes, des digues et des bureaux pour l'armée française. Son supérieur écrit :
Officier très intelligent et instruit. Capable, zélé, tout dévoué à son service. A déjà eu l'occasion de faire de grands travaux de fortification […]. Par son mérite, par sa manière de servir, cet officier est digne d'arriver aux grades élevés de l'armée du génie.
Au mois de septembre suivant, la Chine abandonne toute prétention sur le Tonkin. Très satisfait de son subalterne, Courbet fait décorer l'officier du génie de la Légion d'honneur le 7 septembre. En janvier 1887, le capitaine Joffre obtient sa première citation pour sa participation, au sein de la colonne Brissaud, aux opérations contre la position retranchée de Ba Dinh. Il y dirige les travaux de sape contre la citadelle assiégée et joue un rôle dans la victoire : il est cité à l'ordre de la division du Tonkin mars 1887. En janvier 1888, il quitte le Tonkin pour faire le tour du monde, Chine, Japon et États-Unis.
De retour en France en octobre 1888, il est attaché au cabinet du directeur du génie et promu au grade de commandant l'année suivante. Chef de bataillon, il est affecté au 5e régiment du génie à Versailles où il se spécialise dans la logistique ferroviaire. En 1891, on le retrouve chargé de cours à l'École d'application de l'artillerie et du génie à Fontainebleau. En octobre 1892, le commandant Joffre est envoyé en Afrique dans la région du Soudan français aujourd'hui le Mal réclamé par le colonel Louis Archinard. Là, son objectif est de diriger la construction d'une ligne de chemin de fer entre Kayes, la capitale de la région depuis 1892, et Bamako.
En décembre 1893, Louis Albert Grodet succède au général Archinard comme gouverneur du Soudan français. Paris lui demande d'étendre la conquête française, mais de manière pacifique à la différence de son prédécesseur. En déplacement à Tombouctou avec son secrétaire le lieutenant Boiteux en janvier 1894, Grodet est irrité par les officiers français. Prétextant un danger réel et malgré le refus du gouverneur, le lieutenant-colonel Bonnier envoie deux colonnes de troupes, terrestre et navale, pour les protéger. La colonne terrestre est confiée au commandant Joffre alors mêlé à la campagne de 1894. Bonnier ayant péri au cours d'une bataille contre les Touaregs, ce sont les hommes de Joffre qui prennent avec succès Tombouctou le 12 février. Le commandant supérieur du Soudan français déclare : D'un esprit élevé, d'un caractère conciliant et très droit, Joseph Joffre a su mettre de côté toutes les questions de peu d'importance qui auraient pu soulever quelques difficultés et compromettre la bonne entente avec les chefs de service […] .
Après la prise et la pacification de Tombouctou, Joffre est promu commandant supérieur de Kayes-Tombouctou avec le grade de lieutenant-colonel en mars 1894. À son départ, la région semble pacifiée. En mars 1895, il est affecté à l'état-major du génie et devient secrétaire de la commission d'examen des inventions pour l'Armée. Il revoit une ancienne connaissance, Henriette Penon, mariée, avec qui il a une liaison. Un enfant, Germaine, nait le 1er janvier 1898 : nul ne saura jamais si l'enfant est bien de Joffre ou du mari de sa maîtresse. Nommé colonel deux ans plus tard, il participe sous les ordres du général Joseph Gallieni, gouverneur général de Madagascar, à la campagne de colonisation de l'île lancée depuis les années 1895 et 1896. Joffre est alors chargé de la fortification du port de Diego-Suarez pour lutter contre la poche de résistance malgache qui irrite beaucoup Gallieni. À cause d'intrigues politiques, il est contraint de repartir en métropole en janvier 1901. Entre-temps, il est promu général de brigade et rappelé par Gallieni. Joffre est de retour à Madagascar pour achever sa mission en avril 1902. Son travail exécuté, il retourne en France au cours du printemps 1903 ; il est fait commandeur de la Légion d'honneur.
LMire La suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10417#forumpost10417
À la tête de l'Armée française
Après un bref passage comme commandant de la 19e brigade de cavalerie à Vincennes, il est nommé directeur du génie au ministère de la Guerre en janvier 1904. Le 26 avril 1905, âgé de cinquante-trois ans, il épouse civilement Henriette Penon. La même année, il obtient sa troisième étoile de général de division et devient en 1906 le nouveau chef de la 6e division d'infanterie à Paris, puis il est nommé inspecteur permanent des écoles militaires en janvier 1907. En mai 1908, le divisionnaire prend en charge le commandement d'un corps d'armée : le 2e corps d'armée à Amiens. Le général Joffre devient membre du Conseil supérieur de Guerre en mars 1910. Il prend une part active dans l'élaboration des plans de stratégie militaire contre l'Allemagne.
Le 19 juillet 1911, le général Victor-Constant Michel, chef d'État-Major et président du Conseil supérieur de guerre, présente son plan XVI. Celui-ci propose une attente défensive et un élargissement du front jusqu'à la Belgique en mobilisant tous les réservistes. Il est rejeté à l'unanimité par les membres du Conseil. Le 28 juillet, qualifié d'incapable par le ministre de la Guerre Adolphe Messimy, il est destitué de ses fonctions en Conseil des ministres.
Messimy réforme le haut commandement militaire français. Les fonctions de chef d'État-Major général et de généralissime ne font plus qu'une. Dans un premier temps, le général Gallieni, 62 ans, est consulté pour prendre la tête de l'Armée ; mais il refuse en faisant état de la limite d'âge 64 ans et de sa santé fragile. Deux autres généraux sont proposés : Paul Pau et Joseph Joffre. Le général Pau refuse pour deux raisons : son âge également de 62 ans et le fait que le gouvernement aura son mot à dire sur la nomination de ses officiers généraux. Par défaut, c'est Joffre qui est nommé le 28 juillet 1911.
À 59 ans, il est un des plus jeunes généraux de l'époque, également un des rares officiers de haut rang à avoir une expérience internationale Formose en 1885, Japon en 1888 et enfin il a été un des brillants artisans de l'enracinement de la France dans tous les territoires d'outre-mer Tonkin, Soudan français, Madagascar. Le 2 août 1911, le généralissime exige la nomination du remuant général Édouard de Castelnau pour le seconder à la tête de l'État-Major.
En août 1911, éclate le coup d'Agadir : il y a danger de guerre. Le président du Conseil Joseph Caillaux se renseigne auprès de Joffre :
« Général, on dit que Napoléon ne livrait bataille que lorsqu'il pensait avoir au moins 70 % de chances de succès. Avons-nous 70 % de chances de victoire si la situation nous accule à la guerre ? »
« Non, je ne considère pas que nous les ayons » répond Joffre.
« C'est bien, alors nous négocierons… » décide Caillaux
Conscient que le conflit est proche et de dimension mondiale, Joffre réorganise l'Armée. Il obtient des financements importants, met en place les aspects logistiques, les infrastructures indispensables et enfin il mise sur de nouvelles unités : l'artillerie lourde et l'aviation. En dernier lieu, le généralissime consolide durant l’année 1913 les rapports avec la Russie et l'Angleterre, avec qui la France s'est engagée militairement au sein de la Triple-Entente depuis août 1907.
Au cours de l’été 1914, l'Armée française achève de combler une partie de son handicap face au puissant voisin grâce à l'organisation du généralissime Joffre. Le 11 juillet, le généralissime est fait grand-croix de la Légion d'honneur.
L’offensive à outrance La coopération franco-britannique
En juillet 1911, à la suite de la crise d'Agadir occasionnée par l'envoi d'une canonnière allemande, le général Henry Hughes Wilson, directeur des opérations au ministère de la Guerre, se rend à Paris pour suivre les manœuvres françaises. Les Anglais coopèrent avec la France mais ils poussent Caillaux à réagir fermement vis-à-vis de l'Allemagne. Joffre témoigne :
« C'est … du début de cette période que datent les premières conversations entre l'État-Major français et l'État-Major britannique. Le général Wilson vint en France travailler avec nous et préparer le débarquement éventuel d'un corps expéditionnaire britannique. Il fut le premier et bon ouvrier de cette collaboration. »
Au fil des mois, le rapprochement des Français et des Britanniques se précise. On décide du volume de soldats britanniques disponibles, qui seraient prêts à intervenir en cas de conflit et à quel moment :
« Nous souhaiterions savoir si les relations établies entre états-majors sont la conséquence d'un traité ou d'un accord verbal entre les deux gouvernements, ou bien s'ils résultent d'un consentement tacite entre ceux-ci. En outre, peut-on admettre que, selon toutes probabilités, l'Angleterre serait à nos côtés dans un conflit contre l'Allemagne ?
Le chef d'État-Major exige que l'Armée soit profondément réformée la doctrine militaire, les règlements, le matériel, le haut commandement et la mobilisation, alors qu'elle est divisée par l'affaire des fiches et les influences politiques. D'ailleurs, le 19 juillet 1913 une loi instituant le service militaire à trois ans est votée. Le nouveau haut commandement élabore divers plans d'offensive dont le fameux plan XVII. Ce dernier est l'œuvre d'un des stratèges de l'État-Major qui donne des conférences au centre des hautes études militaires, le colonel Louis Grandmaison pour qui — comme pour beaucoup d'officiers français — l'objectif primordial est la récupération de l'Alsace-Lorraine perdue en 1871. Joffre fait également établir des thèmes de travail et des règlements qu'on expérimente lors des manœuvres sur le terrain.
Le 21 février 1912 a lieu une réunion secrète au Quai d'Orsay à Paris, à laquelle le général Joffre est présent : l'objectif est la mise en commun des différentes mesures des États-Majors russes, britanniques et français. Rapidement la question de la neutralité belge arrive dans les débats. En janvier 1912 à ce sujet, le président du Conseil Raymond Poincaré conseille à Joffre de se montrer prudent afin de ménager l'opinion anglaise :
En tout état de cause, il faudrait assurer qu'un plan de pénétration française en Belgique ne déterminerait pas le gouvernement britannique à nous retirer son concours.
Joffre prévoit dans son plan XVII une pénétration préventive en Belgique mais le gouvernement l'en dissuade. En effet, en novembre 1912, la Belgique est toujours neutre en vertu des traités de 1831 et 1839. Ceux-ci lui font un devoir de se défendre contre toute intrusion militaire et d'appeler immédiatement ses garants qui sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Dans le cas d'une initiative militaire française, la Belgique se trouverait ipso facto obligée d'appeler l'Angleterre à son secours, mais aussi l'Allemagne. Donc si la France violait la première la neutralité belge, il en résulterait un embarras diplomatique avec l'Angleterre et cela donnerait un avantage numérique consolidé à la Triplice.
Mise en place du plan XVII
Le plan XVII esquisse une stratégie : la victoire dépend de la supériorité des forces morales. Il s'agit pour la plupart des généraux de reprendre les provinces perdues uniquement grâce à l'esprit combatif et à la volonté des soldats seulement armés de fusils à baïonnette accompagnés du canon de 75 : la guerre à outrance. Stratégiquement, pour Joffre la clé de la victoire c'est de rompre le front adverse pour déboucher sur les vastes espaces où la vraie guerre pourrait avoir lieu. Pourtant certains se montrent plutôt hostiles à la proposition du généralissime : c'est le cas du capitaine Bellanger, du général Estienne, du général Lanrezac et du colonel Pétain.
Ces derniers préconisent plutôt la puissance matérielle de l'artillerie, la manœuvre et l'initiative. D'autant que l'État-Major général sous-estime la puissance militaire allemande. Helmuth von Moltke dirige une armée rapide, facilement manœuvrable et surtout une double stratégie à la fois offensive et défensive mitrailleuses. Joffre est à la base un officier du génie qui n'a pas reçu les enseignements de l'École de guerre. Il n'a qu'une maigre expérience de la direction d'une armée et il fait confiance aveuglément au plan XVII en minimisant le rôle de l'artillerie lourde.
Depuis 1904, l'État-Major français est en possession du plan Schlieffen fourni par un officier allemand félon, qui prévoit la prise de Paris et la défaite française en quarante-et-un jours. Le général Joffre, qui dirige les opérations sur le terrain, est persuadé que les Allemands ne vont pas utiliser toutes leurs réserves — comme le prétendait le général Michel — et qu'ils ne pourront pas à la fois mener une grande offensive en Belgique, comme leur plan le prévoit, et repousser les assauts du plan XVII en Lorraine. Ce que le généralissime n'a pas prévu, c'est qu'en Lorraine l'ennemi a rassemblé des forces importantes et qu'il a la supériorité du feu mitrailleuses et artillerie lourde. La plupart des officiers français, eux, ne veulent pas entendre parler de ces armes modernes ; ils les jugent superflues… Excepté le canon de 75, l'artillerie française est très inférieure à l'allemande. Début 1914, l'artillerie lourde française est constituée de 280 pièces pour 848 à l'artillerie allemande.
Échec du plan XVII : Surtout, pas d'affolement !
Principales erreurs stratégiques françaises au début de la Première Guerre mondiale.
Le 29 juillet 1914, l'Angleterre demande à la France et à l'Allemagne si elles s'engagent à respecter la neutralité belge en cas de guerre : la France accepte. Le lendemain, Joffre obtient l'autorisation du ministre de la Guerre de replier les troupes de couverture à dix kilomètres de la frontière afin d'éviter toute provocation. Grâce à cette tactique, si les armées allemandes veulent entrer au contact des armées françaises, elles devront franchir la frontière, assumant le rôle d'agresseur. La France pourra alors stigmatiser l'Allemagne et s'assurer la faveur de l'opinion anglaise et l'aide militaire future de la Grande-Bretagne. Ceci d'autant plus que celle-ci est tenue, par son engagement de garante de la neutralité belge, d'intervenir contre l'Allemagne qui a elle-même garanti la neutralité belge. En attendant, l'Angleterre reste réservée, attendant l'initiative allemande.
Le 1er août 1914, l'Allemagne et la France décrètent la mobilisation générale. Le 3, l'ambassadeur d'Allemagne von Schoen se présente au président du Conseil René Viviani pour lui remettre la déclaration par laquelle l’Allemagne déclare la guerre à la France. Le 3 août, l'Allemagne lance un ultimatum à la Belgique d'avoir à laisser passer ses troupes qui vont attaquer la France suivant le plan Schlieffen. Le 4 août, le roi des Belges Albert 1er et le gouvernement belge soutenus par le Parlement, rejettent l'ultimatum et annoncent que la Belgique se défendra. L'Angleterre annonce le lendemain son intention de se battre aux côtés de la Belgique pour honorer sa garantie à la neutralité belge. Le 5 août, la Ire armée de von Kluck déferle sur Liège où l'armée belge de campagne résiste à un contre trois en manœuvrant par contre-attaque dans les intervalles des forts. Le 8 août, Joffre, qui ne vole pas au secours des Belges, laisse les Allemands dérouler leur stratégie et ordonne aux 1re et 2e armées françaises de passer à l'offensive en Lorraine, en Alsace et dans les Ardennes pour attaquer de front les troupes allemandes : c'est la bataille des Frontières. Quant aux Anglais, ils entrent en Belgique et placent à Mons leur armée limitée à quatre divisions car ils ne sont pas en force pour s'aventurer plus à l'Est et au Nord pour aider les Belges.
Fonction Responsable Durée
Commandant en chef des opérations Gal Joseph Joffre 2 août 1914 - 26 décembre 1916
Major général Gal Émile Belin 2 août 1914 - 22 mars 1915
1er aide major général Gal Henri Berthelot 2 août 1914 - 22 novembre 1914
2e aide major général Gal Céleste Deprez 2 août 1914 - 21 août 1914
Directeur de l'Arrière Gal Édouard Laffon de Ladébat 2 août 1914 - 30 novembre 1914
L'organisation sur le terrain du général Joffre au 2 août 1914
Armée française Commandant en chef Secteur Durée
1re armée Gal Auguste Dubail Vosges 2 août 1914 - 5 janvier 1915
2e armée Gal Édouard de Castelnau Lorraine orientale 2 août 1914 - 21 juin 1915
3e armée Gal Pierre Xavier Emmanuel Ruffey Lorraine occidentale 2 août 1914 - 30 août 1914
4e armée Gal Fernand Langle de Cary Aisne-Ardennes 2 août 1914 - 11 décembre 1915
5e armée Gal Charles Lanrezac Ardennes-Belgique 2 août 1914 - 3 septembre 1914
armée des Alpes Gal Albert d'Amade Alpes 2 août 1914 - 17 août 1914
armée d'Alsace Gal Paul Pau Alsace 11 août 1914 - 28 août 1914
Alsace
Joffre confie le commandement de l'armée d'Alsace à l'un de ses proches collaborateurs, le général Pau, dont l'objectif est de libérer en quelques semaines la province perdue. Une partie de la 1re armée dirigée par le général Auguste Dubail entre en Alsace par Belfort puis s'établit sur le bord du Rhin le 4 août 1914. Le VIIe corps d'armée entre à Thann le 7 et à Mulhouse le 8. À Paris on félicite Joffre :
Mon général, l'entrée des troupes françaises à Mulhouse, aux acclamations des Alsaciens, a fait tressaillir d'enthousiasme toute la France. La suite de la campagne nous apportera, j'en ai la ferme conviction, des succès dont la portée militaire dépassera celle de la journée d'aujourd'hui. Mais, au début de la guerre, l'énergique et brillante offensive que vous avez prise en Alsace nous apporte un précieux réconfort. Je suis profondément heureux, au nom du Gouvernement, de vous exprimer toute ma gratitude.
Cependant, la contre-offensive allemande est terrible et rapide, le général Pau est contraint d'évacuer l'ensemble de l'armée d'Alsace le 25 août. Seules Thann et sa région restent françaises jusqu'à la fin de la guerre. Cette nouvelle provoque un vent d'inquiétude dans toute la France.
Lorraine
La Lorraine française est quadrillée d'un réseau de places fortifiées conçu par le général Séré de Rivières au lendemain de la guerre de 1870 places de Verdun, de Toul, d'Épinal et de Belfort. Joffre ordonne à la 3e armée d'avancer jusqu'à Sarrebruck puis de lancer une offensive sur le Luxembourg. La 2e armée dirigée par Castelnau s'engage sur le secteur de Morhange le 19 août. C'est un véritable carnage : l'infanterie française perd 8 000 hommes en deux jours bataille de Morhange. Le 20 août, Castelnau ordonne le repli sur Lunéville.
L'autre partie de la 1re armée de Dubail est impliquée dans la bataille de Sarrebourg, où le commandant parvient à maintenir ses positions ; mais faute de renfort à l'ouest par la 2e armée, il doit se replier également. Forts de leurs contre-offensives, les Allemands se lancent sur Nancy, où ils sont repoussés par le 20e corps d'armée dirigé par le général Foch.
Ardennes
Lorsque Joffre apprend que les troupes allemandes pénètrent en Belgique, il réoriente la 5e armée du général Lanrezac vers le nord pour couvrir les autres armées du mouvement tournant sud-sud-ouest prévu par le plan Schlieffen. Joffre ordonne à la 5e armée d'attendre devant Mézières et d'affronter la IIe armée de von Bülow à son arrivée. Plus à l'ouest, le corps expéditionnaire britannique affronte la Ire armée allemande de Moltke à Mons. Cependant manquant d'hommes, Lanrezac fait appel à une division de réserve, qui arrive trop tard. Le 14 août, Lanrezac rencontre Joffre en personne et lui expose une seconde fois sa crainte d'une grosse offensive allemande sur l'ouest.
Le généralissime rétorque : Nous avons le sentiment que les Allemands n'ont rien de prêt par là. J. Joffre, 14 août 1914.
Les Belges, quant à eux, qui ne peuvent compter, à ce stade de la guerre, sur l'arrivée des Anglais et des Français, se replient le 19 août après avoir retenu 150 000 Allemands devant les forts de Liège puis en les battant lors d'une bataille d'arrêt dite bataille de la Jette. Quant aux Anglais, n'étant pas en nombre suffisant pour participer offensivement à la bataille commune avec quatre divisions, ils tentent d'affronter l'armée allemande à Mons le 23 août. C'est au soir de ce même jour que Lanrezac ordonne, de son propre chef, la retraite de son armée vers Maubeuge pour éviter un nouveau Sedan, c'est-à-dire un enveloppement complet de son armée par l'ennemi. Joffre est furieux.
Le bilan à la fin du mois d’août 1914 est lourd pour l'État-Major français. Ses différentes attaques se sont révélées inutiles et surtout désastreuses : on estime les victimes à plus de 100 000 morts côté français, des soldats en capote bleue et au pantalon rouge qui attaquent de front face aux mitrailleuses allemandes. Quasiment toutes les armées françaises battent en retraite et sont dans l'ensemble désordonnées. Joffre ordonne qu'on pourchasse et qu'on exécute non seulement les fuyards mais également tout officier faisant preuve « d'insuffisance et de faiblesse, mais encore d'incapacité ou de lâcheté manifeste devant l'ennemi. Depuis le 3 août, le gouvernement autorise le commandement militaire à faire exécuter les sentences de mort. Devant ce qui peut laisser augurer une défaite française, l'État-Major allemand décide de se diriger sans tarder sur Paris, pensant que la prise de la capitale pourrait entraîner l'effondrement de la France.
« Nos troupes si visibles avec leurs culottes rouges, nos officiers plus visibles encore avec leur tenue différente de celle de la troupe et l'obligation que leur faisait le Règlement de se tenir nettement hors du rang, s'étaient aventurées sur des polygones parfaitement repérés, où artillerie et infanterie tiraient à coup sûr. »
L'erreur de nos états-majors dirigeants a été de ne croire qu'à la guerre de mouvement et de nier la guerre de siège, de la nier non seulement avant, mais pendant la guerre elle-même.
Je ne sais qui l’a gagnée, mais je sais qui l'aurait perdue. J Joffre
La bataille de Guise
Joffre ordonne à la 5e armée de Lanrezac le lancement d'une offensive de flanc contre la IIe armée allemande autour de Guise afin de soulager d'une part le corps expéditionnaire anglais épuisé et d'autre part pour reprendre Saint-Quentin. Le 28 août, le général Douglas Haig fait savoir que son corps ne pourra pas renforcer Lanrezac à Saint-Quentin.
À l'est, les hommes du général Langle de Cary 4e armée se battent héroïquement face aux Allemands. Le commandant en chef vient en personne au QG de Lanrezac ; il est très optimiste et il espère une belle offensive sur Saint-Quentin :
Pousser l'attaque à fond, sans s'inquiéter de l'Armée anglaise.
Le 29 août, Bülow lance une grande offensive sur Guise. Le 10e corps d'armée et la 51e division de réserve sont contraints de reculer. L'attaque sur Saint-Quentin est désormais impossible, sinon la 5e armée risque d'être prise en écharpe. Joffre revient au QG de Lanrezac qui doit modifier l'avancée. Au lieu d'attaquer Saint-Quentin, le 3e corps d'armée oblique sur la droite pour attaquer Guise par l'ouest. Ce dernier est aidé par le retour du 10e corps qui attaque par le sud. La supériorité numérique allemande est écrasante, et Bülow est maître de l'Oise.
Le 1er corps du général Franchet d'Esperey est dépêché sur place. Il dirige l'assaut contre les troupes et les ponts : le Xe corps allemand est arrêté puis l'ensemble de l'armée allemande bat en retraite vers le nord. Le 18e corps français s'arrête aux portes de Saint-Quentin. Le commandant allemand appelle alors son homologue von Klück afin qu'il vienne en renfort à la tête de sa Ire armée. Cette dernière, qui se dirigeait sur Paris, change sa direction et bifurque vers le sud-est, offrant son flanc aux armées françaises. C'est à ce moment que manquent les 150 000 hommes retenus en Belgique par le siège de la place forte d'Anvers, la plus grande du genre en Europe avec ses trois ceintures de forteresses, depuis laquelle les Belges lancent trois sorties successives entre la fin août et la mi septembre, empêchant le commandement allemand de renforcer ses armées qui marchent sur Paris et dans l'Est de la France.
Stratégie de Joffre L'organisation sur le terrain du général Joffre au 3 septembre 1914
Armée française Commandant en chef Secteur Durée
1re armée Gal Auguste Dubail Vosges 2 août 1914 - 5 janvier 1915
2e armée Gal Édouard de Castelnau Lorraine orientale 2 août 1914 - 21 juin 1915
3e armée Gal Maurice Sarrail Lorraine occidentale 30 août 1914 - 22 juillet 1915
4e armée Gal Fernand Langle de Cary Aisne-Ardennes 2 août 1914 - 11 décembre 1915
5e armée Gal Louis Franchet d'Esperey Ardennes-Belgique 3 septembre 1914 - 31 mars 1916
6e armée Gal Michel Maunoury Paris 17 août 1914 - 13 mars 1915
9e armée Gal Ferdinand Foch Autour de Paris 29 août 1914 - 7 octobre 1914
Le 1er septembre 1914, Joffre esquisse la nouvelle situation stratégique. Il a la bonne idée de déplacer l'aile gauche de la 5e armée sur Paris, puisque les Allemands ont pour objectif la capitale française et l'enveloppement des armées. Le commandant en chef en profite pour rencontrer Lanrezac au QG de la 5e armée à Sézanne. Accompagné du commandant Maurice Gamelin, il lui annonce qu'il est obligé de lui enlever le commandement de l'armée, où il sera remplacé par Franchet d'Esperey :
« Vous faites des observations à tous les ordres qu'on vous donne !
Lanrezac dira à la suite de cette entrevue :
« À la place du général Joffre, j'aurais agi comme lui ; nous n'avions pas la même manière de voir les choses, ni au point de vue tactique ni au point de vue stratégique ; nous ne pouvions pas nous entendre.
Pourtant, dès le début de la guerre Joffre avait observé :
« Si je venais à manquer, c'est Lanrezac qui devrait me remplacer »
Le généralissime prépare un piège à l'ennemi :
Si les Allemands attaquent Paris et Verdun, ils affaiblissent leur centre.
S'ils négligent au contraire ces forteresses et qu'ils attaquent les lignes françaises, ils exposent leurs flancs à une double manœuvre enveloppante préparée entre Paris et Verdun.
Joffre met son plan en marche :
Verdun est renforcé et prêt à soutenir un siège.
la 6e armée est créée des suites de l'armée d'Alsace 26 août 1914 ; l'objectif de son commandant, le général Maunoury est double : couvrir Paris et envelopper par la gauche les armées ennemies ;
la 9e armée est créée avec des éléments des 3e et 4e armées 5 septembre 1914 ; l'objectif de son commandant, le général Foch, est de lancer des offensives centrales, appuyées par la 4e armée de Langle de Cary ;
la 3e armée confiée au général Maurice Sarrail a également un double objectif : envelopper par la droite les armées ennemies et gérer la défense des forts de la Meuse Verdun ;
Joffre prend personnellement le commandement du camp de Paris.
Le 3 septembre, Franchet d'Esperey arrive à proximité de la Marne avec sa 5e armée. Le général Maunoury dirige la protection de la capitale extra muros pendant que la protection intérieure est organisée par le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris. Sarrail s'apprête à enrayer la Ve armée du Kronprinz. Quant à Joffre, qui transfère son Quartier général de Vitry-le-François à Bar-sur-Aube, il organise l'ensemble avec un calme imperturbable.
Face à la menace, le gouvernement a quitté Paris pour Bordeaux. Durant la journée, un avion d'observation de la 6e armée décèle un changement important dans la marche des armées allemandes : une colonne ennemie se détourne de Paris pour se rabattre sur Meaux. Gallieni, qui vient de comprendre la manœuvre d'enroulement allemande en informe le GQG et demande l'autorisation de lancer la 6e armée dans le flanc de cette armée ennemie.
Le 4 septembre, après plusieurs heures de réflexion et un problème de coordination avec Gallieni, le général Joffre est décidé : il va attaquer. Le 6 au matin, il lance toutes les armées à l'attaque.
Gallieni me demandait au téléphone. Il venait de rentrer de son quartier général. Il avait trouvé mon télégramme lui prescrivant de porter la 6e armée sur la rive gauche de la Marne, au sud de Lagny. Cette prescription venait modifier les ordres que Gallieni lui-même avait donnés à Maunoury pour le lendemain après-midi. Je le rassurai en lui faisant connaître que, depuis l'envoi de mon télégramme de treize heures, j'avais pris la résolution d'engager une offensive générale à laquelle la 6e armée devait participer […]
Bataille de la Marne Première bataille de la Marne.
La tactique de Joffre est claire : les ailes gauche 6e armée, appuyée par la 5e armée et l'armée anglaise et droite 3e armée ont pour mission d'envelopper les armées allemandes et le centre 9e et 4e armées de les déstabiliser par des offensives frontales. Le 5 septembre, dans l'après-midi, le général Maunoury lance ses hommes dans une attaque enveloppante entre l'Ourcq et Château-Thierry. Les hommes de French, de Franchet d'Esperey et de Foch appuient cette attaque. Le commandant en chef prend le soin d'envoyer un message aux troupes :
Au moment où s'engage une bataille d'où dépend le salut du Pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis, et se faire tuer sur place, plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée
L'ensemble des armées lance l'offensive le lendemain à l'aube. Sur l'aile gauche, von Klück, occupé avec le mouvement enveloppant de Maunoury, n'arrive pas à venir à bout de l'armée de Foch pourtant épuisée mais qui tient bon. Sur l'aile droite, Sarrail est en mauvaise posture entre Paris et Verdun, ses corps sont durement touchés, le chef de la 10e division est mort au combat. Le 7 septembre, les Allemands arrivent même à ouvrir une brèche entre la 3e et la 4e armée. La situation est critique pour Sarrail. Le lendemain, le 15e corps de la 2e armée lui arrive en renfort. Au soir du 8, les armées sont épuisées et le bilan est un statu quo :
La clé de la victoire vient de l'arrière français : l'armée de French et la 5e armée de Franchet d'Esperey sont encore fraîches alors que les Allemands n'ont plus de réserves pour le moment. Le 9, von Klück lance des assauts désespérés contre Maunoury, qui est mis à mal mais qui obtient des renforts en hommes et en matériels de Gallieni par le biais des fameux taxis de la Marne. De son côté, Foch est appuyé par le 10e corps de la 5e armée et par la division marocaine du général Humbert. Les Allemands entament leur retraite. Le 9, Franchet d'Esperey envoie alors l'ensemble de ses lignes à la poursuite de l'ennemi et libère Château-Thierry et Montmirail.
Le 13 septembre, Joffre annonce la victoire au gouvernement :
« Notre victoire s'affirme de plus en plus complète. Partout l'ennemi est en retraite. À notre gauche, nous avons franchi l'Aisne en aval de Soissons, gagnant ainsi plus de cent kilomètres en six jours de lutte. Nos armées au centre sont déjà au niveau de la Marne et nos armées de Lorraine et des Vosges arrivent à la frontière. »
La paternité de la victoire de la Marne est complexe. À la base elle a été permise grâce au général Lanrezac, un officier de génie non reconnu par Joffre qui, par sa victoire à Guise, a neutralisé en partie l'armée de von Bülow qui devait rejoindre von Klück sur Paris. Bien entendu, elle a découlé des conceptions de l'État-Major général, à la base de la création des 6e et 9e armées qui ont eu un rôle majeur, mais elle n'a pas suivi la tactique d'enveloppement de départ préparée par Joffre. Les généraux Gallieni et Maunoury, véritables artisans sur le terrain de la victoire, ont obligé l'ennemi à découvrir son centre droit, où une brèche s'est ouverte pour les hommes de French et de Franchet d'Esperey.
Stabilisation du front Première gloire
La bataille de la Marne couvre de gloire le général Joffre qui, aux yeux de tous, est le véritable vainqueur. Face aux quelques polémiques, le général Pétain dit : Que cela plaise ou non, Joffre est à jamais le vainqueur de la Marne. Le commandant en chef a permis de sauver Paris et d'éviter à l'Armée française l'anéantissement. Dans tout le pays ainsi que chez les Alliés, Joffre jouit d'une très grande popularité. Le vainqueur de la Marne fait l'objet d'un véritable culte qui va se maintenir jusqu'à sa mort. Une certaine joffrolâtrie s'installe en France. De nombreuses images d'Épinal montrent le chef comme le vainqueur ayant écarté le danger. Des poèmes, des assiettes, des statuettes à son effigie mettent en avant sa gloire. Des centaines d'enfants sont prénommés Joffre ou Joffrette tant en France qu’au Canada ou aux États-Unis. Il incarne le Père tranquille et protecteur qui tient dans ses bras la République allégorie du journal Le Rire rouge, automne 1914.
Pourtant, l'ennemi renaît rapidement de ses cendres sur l'Aisne. L’État-Major français comprend alors que la guerre, qu'on pensait conclure en quelques semaines, risque d'être plus longue que prévue. Une seconde responsabilité incombe à Joffre : préparer la France à une guerre longue et éprouvante. Il commence par envoyer à Limoges et à assigner à résidence cent trente-quatre généraux qui lui semblent incompétents de là naîtra le verbe limoger et le nom limogeage, il multiplie les inspections sur le terrain, il renforce les contacts avec les forces alliées pour constituer différents fronts d'attaque et enfin il tente de résoudre des problèmes proprement militaires.
.Joffre continue de veiller aux progrès de l'aéronautique, qui a une place à part entière dans le conflit. Le 8 octobre 1914, il affirme :
« Ces résultats montrent que l'aviation est à même de rendre les plus grands services et de justifier la confiance que le commandement place en elle
Il doit aussi faire face à une crise des munitions, à un manque de canons lourds, à l'absence de l'artillerie qui se font sentir au cours de la bataille de l'Aisne.
De la Course à la mer aux batailles du Nord
La bataille de l’Aisne 13 septembre - 24 septembre 1914
Après leur défaite sur la Marne, les divisions allemandes se replient vers le nord, sur l'Aisne, entre le 10 et le 14 septembre. Quant à Joffre, il veut profiter de sa posture de vainqueur et ordonne aux armées françaises et britanniques d'attaquer les armées ennemies le 13. Encore une fois, il préconise la tactique d'enveloppement du flanc droit allemand. Sur le Chemin des Dames, déjà en 1914, le corps expéditionnaire et la 6e armée ne parviennent pas à venir à bout d'un ennemi équipé d'une puissante artillerie lourde.
Le 17, la manœuvre de Joffre est un échec, les Allemands renforcent leur droite avec la VIIe armée de von Heeringen venue en renfort. Mais décidé à en finir en enveloppant par le nord-ouest, il appelle une partie des troupes de Castelnau, stationnées en Lorraine. Le 20, une énergique offensive française est lancée entre Noyon et Péronne. En vain. Les lignes françaises manquent de matériel pour lancer des offensives efficaces munitions, stocks divers, nourriture, artillerie lourde. Le commandant des forces allemandes, von Bülow, a imaginé un efficace retranchement de ses troupes et lance à son tour des contre-manœuvres qui obligent l'armée française à s'allonger sans cesse vers le nord. Cet étalement du front jusqu'à Dunkerque, c'est le début de la Course à la mer qui réunit les Belges du roi Albert aux Français de Ronarc'h. Le roi accepte de placer son armée sous le commandement de Joffre qui dirige, dès lors, une stratégie globale réunissant les franco-anglo-belges.
À partir du 18 septembre, les combats continuent autour du massif de l'Aisne ; l'armée anglaise essuie de lourdes pertes. Trois jours après, le général Castelnau fait son entrée à Noyon, mais il ne peut s'y maintenir longtemps. Cependant, les lignes allemandes sont contenues. Le 22, il faut désormais déloger l'ennemi de ses positions : la 4e brigade du Maroc tirailleurs sénégalais et algériens se lance avec beaucoup de courage dans les bois et permet de gagner du terrain. Les prochaines attaques se révèlent infructueuses.
De Noyon à Dunkerque 24 septembre - 4 novembre 1914
La 2e armée subit un ralentissement de son avancée de jour en jour. Joffre rappelle Castelnau à l'ordre :
Rectifiez la marche de vos deux corps de gauche orientée trop à l'est, et redressez-la franchement vers le nord !
En effet, c'est toujours plus vers le nord que tout se joue. Là-bas, la cavalerie allemande du général von Marwitz harcèle les lignes françaises dans le secteur de Ham. Le 24, Joffre prend connaissance du fait que les Allemands ont amené toutes les forces qu'ils avaient en Belgique après avoir échoué à écraser l'armée belge. Il écrit au ministre de la Guerre Alexandre Millerand :
Le moment est venu pour l'armée belge d'agir sur les communications de l'ennemi.
Mais c'est ce que les Belges faisaient depuis le mois d'août en adoptant la tactique de l'avant-garde générale, chère à Napoléon, qui consiste à manœuvrer sur les flancs et les arrières ennemis en les attaquant pour gêner ses communications et, surtout, pour l'empêcher de réunir ses forces en un seul corps. C'est cela qui a fait que 150 000 hommes, ainsi que de l'artillerie lourde, manquèrent aux Allemands lors de la bataille de la Marne.
À partir du 26 septembre, l'ensemble des divisions françaises se heurtent à des forces ennemies considérables. Il faut des renforts autour d'Amiens. Joffre organise efficacement la venue de nouvelles divisions par camions et par trains en provenance de Compiègne. Le général Castelnau se maintient péniblement dans le Sud. Il organise plutôt efficacement la situation sur le long terme, mais il n'a pas assez de moyens matériels et d'hommes pour lutter contre von Bülow. Le 2 octobre, les combats font rage au nord d'Arras vers Lens et Béthune. L'objectif du commandement allemand est d'empêcher la remontée des troupes françaises vers le nord avec l'arrivée de nouveaux renforts.
Le 3 et le 4 octobre, le 10e corps d'armée de Castelnau subit plusieurs échecs en Artois. Il prévoit de reporter ses troupes en arrière. Mais Joffre lui ordonne d'aller de l'avant, car sinon cela donnerait l'impression d'une défaite. Le corps est bombardé dans les faubourgs d'Arras. Joffre préconise aux commandants français qu'ils doivent veiller à ce que l'inviolabilité du front soit maintenue. Il télégraphie aux généraux d'armée :
Fortifiez-vous le plus possible sur tout votre front. Agissez avec le maximum d'énergie. Nous étudions les moyens de vous amener des renforts.
Le commandant en chef envoie des renforts, surtout des troupes anglaises et belges dans les Flandres. Les Belges ont pu quitter Anvers après un mois de siège en évitant l'encerclement. rejoignant la côte avec le concours d'une unité française, les fusiliers marins de l'amiral Ronarc'h. Le roi Albert Ier déclare même qu'il est prêt à recevoir les instructions de Joffre. L'objectif est d'aider les Belges à se maintenir sur l'Yser afin d'empêcher toute offensive allemande contre Dunkerque et Calais. Au début de novembre 1914, la sécurité de l'armée française dans le Nord est consolidée surtout avec l'arrivée de la 42e division puis du 9e corps d'armée.
La bataille des Flandres mi-octobre – mi-novembre 1914
L'État-Major allemand ordonne la prise de Calais. Les alliés Français, Anglais et Belges mettent tout en œuvre pour défendre la région. C'est le début de la guerre de tranchées. Les Belges tendent des inondations en ouvrant les vannes qui protégeaient la plaine de Flandre de la mer. Les premières lignes d'assaut allemandes s'enlisent et reculent en catastrophe, on se bat pour des îlots de boue, des positions sont disputées pendant des jours et des jours, des villages sont ravagés et, à Ypres, les Anglais prennent, perdent et reprennent plusieurs fois la ville qui est ravagée. C'est le général d'Urbal qui commande les troupes françaises et son armée devient l'armée de Belgique. Au GQG, les généraux Belin et Berthelot, adjoints de Joffre, organisent admirablement les mouvements de troupes entre les divers points du front.
Finalement, l'Allemagne est vaincue dans les Flandres. La seule bataille d'Ypres lui coûte plus de 150 000 hommes. Dunkerque et Calais ne sont plus menacés. Après la victoire de la Marne, celle des Flandres popularise davantage le général Joffre. Mais la guerre n'est pas finie.
Nouvelles offensives : Artois et Champagne
«Le silencieux : Joffre
Il ne dit rien mais chacun l'entend.
Dessin de Charles Léandre paru dans
Le Rire Rouge du 19 décembre 1914.
La stratégie du général Joffre
À partir de l'hiver 1914-1915, le front occidental se stabilise de la mer du Nord à Belfort sur près de 750 km. Le conflit a déjà occasionné la perte de 850 000 hommes aux différents belligérants, que ce soit en morts, disparus, blessés ou prisonniers. Depuis l'épisode de la Marne, Erich von Falkenhayn remplace Moltke à la tête de l’État-Major allemand et en novembre 1914, les lignes allemandes sont en difficulté sur le front russe. Falkenhayn ordonne l'envoie de renforts sur le front oriental. Joffre, qui a connaissance de ce transfert, veut une percée sur le front ouest pour déstabiliser l'ennemi. Le 8 décembre 1914, il met au point deux offensives principales : en Artois et en Champagne ; les opérations seront exécutées par la 4e armée de Langle de Cary et la 10e armée de Maud'huy. En prévision, le généralissime garde à sa disposition deux divisions à Compiègne, une à Soissons, une autre à Bar-le-Duc et enfin les divisions du Gouvernement militaire de Paris. Pour Joffre, il les grignote et encore une fois l'année 1915 est marquée par la volonté d'obtenir la rupture.
Il prévoit également des offensives secondaires en Flandres, en Argonne et en Meuse. Le but est de détourner l'adversaire des zones principales d'attaque d'Artois et de Champagne. Il s'agit principalement des Flandres et de La Boisselle, respectivement confiées à la 8e armée du général d'Urbal et à la 2e armée du général Castelnau. Enfin, le dernier dispositif de Joffre réside dans la présence de deux armées défensives : la 6e armée de Maunoury et la 5e armée de Franchet d'Esperey dans l'Aisne et à Reims.
L'opération en Artois 17 décembre 1914 - 15 janvier 1915
L'offensive artésienne a pour but de libérer définitivement le territoire national envahi.
Le général Maud'huy, qui est installé à Cambligneul, lance l'attaque le 17 décembre 1914. Ses objectifs sont Vimy et la route Arras-Souchez. Pour désorienter l'ennemi, on commence l'offensive sur La Bassée. Le général Foch, le commandant du groupe du Nord, arrive le 17 pour prendre les opérations en main. Le 21, il lance une attaque sur Carency, mais le terrain se révèle très difficile, les tranchées sont inondées, les hommes épuisés et les fusils enrayés : les pertes françaises sont lourdes. Finalement, l'artillerie française tient tête aux attaques allemandes. Après de nouvelles attaques meurtrières et inutiles, le général Joffre décide de limiter l'action de la 10e armée à des entreprises ponctuelles et de mettre au repos les troupes le 15 janvier 1915.
Il est à noter que cette opération artésienne n'est mentionnée ni dans les Mémoires de Joffre ni ceux de son adjoint Foch. Pour le général Fayolle : Ce projet me paraît stupide, insensé.
Les opérations en Champagne 20 décembre 1914 - 9 janvier 1915
D'après le dispositif de Joffre, la 4e armée du général de Langle de Cary est couverte à droite par celle du général Sarrail entre l'Argonne et la Meuse. Le Ier corps colonial est le premier à s'élancer le 20 décembre. Il repousse une contre-attaque ennemie, mais les pertes sont lourdes.
Dès le 22, on se contente d'organiser le terrain conquis et de repousser les contre-attaques allemandes. Le 24 suivant, la 33e division prend des positions importantes de la région. Pourtant, le 25, le commandant des opérations modifie son plan et ordonne une poussée vers l'est Perthes-Massiges. Le 30 décembre, il n'y a plus de progression possible, le temps est exécrable et le GQG n'envoie pas assez de munitions. Au total 5 256 soldats ont été tués et la ligne est remontée de deux kilomètres vers le nord
.
Les offensives secondaires Flandres et La Boisselle
En Flandre, Joffre préconise l'attaque à d'Urbal lorsque l'artillerie sera prête. Néanmoins, les Anglais sont tellement impatients que l'attaque est lancée le 14 décembre 1914. Les résultats se révèlent rapidement insuffisants. Le 17, le 20e corps s'empare de 500 m2 de tranchées mais ailleurs, l'ennemi semble invincible. Le terrain est tellement impraticable que Joffre propose au commandant d'adopter la défensive lorsque c'est nécessaire.
Plus au sud, à La Boisselle, Castelnau ordonne l'attaque le 17 décembre sans même lancer l'artillerie. La contre-attaque allemande est meurtrière, les pertes sont lourdes et les gains faibles. Castelnau suspend l'offensive jusqu'au 24. Ce jour, le 118e régiment prend en partie La Boisselle malgré une violente attaque allemande et garde ses positions.
En Argonne, le général Dubail dirige la 1re et la 3e armée. Du 7 au 12 décembre, l'offensive ne rencontre aucun obstacle et s'empare des tranchées ennemies. Mais une contre-attaque provoque 250 morts. Le 13, le terrain est également impraticable dans la Woëvre ; comme ailleurs aucune offensive n'est possible. Le 20, l'infanterie prend avec beaucoup de difficultés Boureuilles, mais menacée d'enveloppement, elle doit se retirer. Globalement, les opérations sont un échec.
Enfin, les armées défensives subissent elles aussi de graves revers. Dans l'Aisne, la 6e armée de Maunoury attaque le plateau de Loges, mais elle subit de lourdes pertes 1 600 morts. À Reims, les hommes de Franchet d'Esperey doivent maintenir les forces allemandes pour soulager la 4e armée française mais aucune offensive ne réussit.
En Artois comme en Champagne, les offensives sont stériles, aucune avancée marquante en cet hiver 1914-1915. Joffre persiste, le plan est maintenu pour le printemps 1915.
Joffre et l’opinion publique
Le Grand Quartier général GQG de Joffre au 22 mars 1915
Fonction Responsable Durée
Commandant en chef des opérations Gal Joseph Joffre 2 août 1914 - 26 décembre 1916
Commandant en chef adjoint des opérations Gal Ferdinand Foch 4 octobre 1914 - 13 juin 1915
Major général Gal Maurice Pellé 22 mars 1915 - 20 décembre 1916
1er aide major général Gal Alphonse-Pierre Nudant 22 mars 1915 - 23 juin 1915
2e aide major général Gal Frédéric Hellot 22 mars 1915 - 23 juin 1915
3e aide major général et responsable de l’arrière Cel Camille Ragueneau 30 novembre 1914 - 4 mai 1917
L’organisation sur le terrain du général Joffre au 22 mars 1915
Armée française Commandant en chef Secteur Durée
1re armée Gal Pierre Auguste Roques Vosges 5 janvier 1915 - 25 mars 1916
2e armée Gal Édouard de Castelnau Lorraine orientale 2 août 1914 - 21 juin 1915
3e armée Gal Maurice Sarrail Lorraine occidentale 30 août 1914 - 22 juillet 1915
4e armée Gal Fernand Langle de Cary Aisne-Ardennes 2 août 1914 - 11 décembre 1915
5e armée Gal Louis Franchet d'Esperey Ardennes-Belgique 3 septembre 1914 - 31 mars 1916
6e armée Gal Pierre Dubois Autour de Paris 13 mars 1915 - 26 février 1916
7e armée Gal Henri Putz ? 7 septembre 1914 - 2 avril 1915
Détachement armée de Lorraine Gal Georges Humbert Lorraine occidentale 9 mars 1915 - 24 juillet 1915
10e armée Gal Louis de Maud'huy Artois 1er octobre 1914 - 2 avril 1915
Armée de Paris Gal Joseph Gallieni Paris 26 août 1914 - 29 octobre 1915
Au 1er janvier 1915, Joffre a, de nouveau, limogé de nombreux généraux. Depuis le début de la guerre on en est à 162 dans la zone des armées dont 3 commandants d'armée, 24 de corps d'armée, 71 de division, etc.. Les raisons sont multiples : soit le commandant a échoué dans sa mission, soit il est incapable d'assumer ses fonctions, soit encore il fait partie des nombreux officiers généraux républicains placés par le général Louis André lorsqu'il était ministre de la Guerre 1900-1902, au cours d'une époque très anticléricale.
En ce début d'année 1915, la situation militaire est nouvelle : les deux armées sont bloquées face-à-face ; aucune manœuvre n'est possible. Les généraux sont formés à l'attaque mobile, aux manœuvres mais pas à une guerre de tranchées. Joffre qui dispose désormais de 2 250 000 hommes, de 286 000 Britanniques et de 110 000 Belges ordonne la reprise de l'offensive pour percer le front allemand et revenir à une guerre mobile comme au début du conflit. Certains de ses subordonnés, tel le général Gallieni, proposent plutôt la défensive, plus appropriée à ce type de conflit. Le lieutenant-colonel Messimy, ancien ministre de la Guerre 1911-1912 devenu chef de corps sur le front, écrit :
« Ces offensives prises partout au hasard, sans idée d'ensemble, sans plan stratégique !
Joffre n'en démord pas. Il est hanté à l'idée d'une défaite russe sur le front oriental. Pourtant, malgré des moyens énormes en Champagne, la 4e armée essuie échec sur échec. La percée est ratée en décembre 1914, de nouveau en janvier 1915, de nouveau en mars. Les pertes françaises sont au total de 92 000 morts. En mai, Foch conduit en vain la deuxième offensive artésienne avec sept corps d'armée, appuyés par 780 pièces d'artillerie légère, 213 d'artillerie lourde et plusieurs escadrilles aériennes.
La troisième offensive de Champagne 24-29 septembre 1915
En Artois, une nouvelle offensive est lancée le 9 septembre 1915 entre Loos-en-Gohelle et Arras contre la VIe armée du prince Rupprecht. Malgré l'aide des Anglais, les violentes offensives françaises restent stériles : deux semaines plus tard, à peine 600 mètres de terrain sont conquis. Le 16 septembre, une dernière offensive généralisée est lancée, mais les soldats sont épuisés et les pertes sont une nouvelle fois énormes : au total, 2 260 officiers et 100 300 soldats y laissent la vie. Joffre ordonne la suspension de l'offensive. Le commandant en chef est sévèrement critiqué à Paris.
Après l'échec en Artois, zone trop étroite, Joffre veut concentrer ses attaques sur la Champagne qui semblerait être le secteur de prédilection de l'armée française. On se bat également en Argonne, où la 3e armée de Sarrail prête main forte sur l'aile droite de la 4e armée. Ici aussi, une seconde fois, les combats sont sanglants. Le 24 septembre, Joffre donne à lire une déclaration à tous les soldats :
« Soldats de la République ! Après des mois d'attente qui nous ont permis d'augmenter nos forces et nos ressources, tandis que l'adversaire usait les siennes, l'heure est venue d'attaquer pour vaincre et pour ajouter de nouvelles pages de gloire à celles de la Marne et des Flandres, des Vosges et d'Arras. Derrière l'ouragan de fer et de feu déchaîné grâce au labeur des usines de France, où vos frères ont nuit et jour travaillé pour vous, vous irez à l'assaut tous ensemble, sur tout le front, en étroite union avec les armées des Alliés. Votre élan sera irrésistible. Il vous portera d'un premier effort jusqu'aux batteries de l'adversaire au-delà des lignes fortifiées qu'il nous oppose. Vous ne lui laisserez ni trêve ni repos jusqu'à l'achèvement de la victoire. Allez-y de plein cœur pour la délivrance du sol de la patrie, pour le triomphe du droit et de la liberté. Joffre.
L'attaque est lancée le 24 à 9 h 45. Les soldats portent le nouvel uniforme bleu horizon et un casque. Joffre a nommé le général Castelnau responsable de la manœuvre. Ce dernier dirige la 2e armée du général Pétain et la 4e de Langle de Cary. Pétain commence par lancer le corps colonial, mais les réserves arrivent avec du retard. Les pertes sont lourdes. Langle de Cary attaque à gauche, mais la situation est encore pire. Le 27, la situation n'a progressé que de quelques mètres. Pétain suspend l'attaque. Castelnau la relance le 28 mais l'élan est brisé par les gaz asphyxiants. Pris d'urgence, Castelnau doit abandonner l'offensive le 29. Les munitions manquent toujours terriblement :
En définitive, la lutte sur le front franco-anglo-belge pendant l'année 1915 apparaît comme une course entre notre matériel offensif chaque jour grandissant, et les organisations défensives allemandes de jour en jour plus solides.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10417#forumpost10417
Posté le : 04/01/2016 15:50
|
|
|
|
|
Joseph Joffre 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Les opérations en Orient mars - octobre 1915
En février 1915, le président de la République Raymond Poincaré, déçu des échecs à répétition, propose une percée ailleurs qu'en France, en Serbie par exemple. Joffre y est catégoriquement opposé et menace de démissionner. Poincaré cède. Pourtant l'aventure des Dardanelles revient sur le tapis et c'est Winston Churchill qui en est l'artisan. Il prévoit de rétablir la liaison avec la Russie, de porter un coup contre l'Autriche-Hongrie, d'influencer les Balkans et l'Italie et enfin d'installer l'Angleterre sur les détroits. Joffre ainsi que French et Wilson ne sont pas du même avis. La mission a néanmoins lieu le 18 mars. C'est un échec sanglant pour les Alliés et l'Angleterre : 20 000 tués sur les 28 000 soldats britanniques partis au front.
À la suite de nombreux échecs en Argonne et aux rapports houleux entre les deux hommes, Joffre retire à Sarrail le commandement de 3e armée. Il est accusé de dissimuler ses erreurs de manœuvre et de ne pas avoir fortifié suffisamment les forteresses dont il avait la charge ; il est remplacé par le général Humbert. Sarrail traite Joffre de dictateur en puissance. Cependant, l'ancien commandant a de nombreuses relations au Parlement : on lui propose l'armée de Lorraine ; mais Joffre refuse. Commence une furieuse campagne contre le commandant en chef : Clemenceau, Viviani, Lyautey, Doumer, Painlevé lui sont hostiles. En août 1915, Sarrail accepte de prendre le commandement de l'armée d'Orient dont l'objectif est d'entrer à Salonique. L'opération échoue dès novembre. Le 16 janvier 1916, Joffre est contraint de confier à Sarrail le commandement des troupes interalliées de Macédoine.
Le généralissime reste optimiste et rassure le ministre :
Nous devons avoir la conviction que, en augmentant nos ressources en munitions, en perfectionnant notre organisation matérielle, en donnant plus d'ampleur encore à nos attaques, nous parviendrons à briser les lignes allemandes que nos dernières opérations ont réussi à entamer si largement. Contraints de lutter sur deux fronts, nos adversaires ne pourront pas se constituer des disponibilités aussi fortes que les nôtres, tant que nous n'aurons de notre côté qu'un front à alimenter.
Verdun et la Somme : l’épuisement du chef
La préparation de 1916 : une nouvelle année offensive
Les conférences de Calais et de Chantilly décembre 1915
Les principaux chefs alliés se réunissent d'abord à Calais sous la direction du président du Conseil Aristide Briand. La France prévoit l'envoi de renforts à l'armée d'Orient à Salonique, mais la Grande-Bretagne déclare qu'elle retire ses troupes avant de revenir sur ses positions. Il est aussi décidé d'évacuer la zone des Dardanelles où au total, 225 000 Britanniques et 40 000 Français ont péri pour rien. Enfin le général Joffre souligne qu'à son goût, la coopération interalliée est nettement insuffisante et il réclame une aide majeure dans la guerre économique.
Les jours suivants, ces mêmes chefs se retrouvent à Chantilly pour superviser les plans militaires de l'année à venir. Joffre défend le projet d'une nouvelle offensive — décisive — sur la Somme. Depuis quelques jours, il a une autorité plus importante. Il dirige désormais l'opération de Salonique, il a été nommé commandant de tous les fronts français et il se proclame chef interallié.
La tactique de Joffre
Une nouvelle fois, le président Poincaré met en garde Joffre sur les offensives à venir. Il serait selon lui plus sage de lancer des attaques sûres et non plus au hasard. Car au 1er janvier 1916, les pertes françaises depuis le début de la guerre sont de 600 000 hommes. L'opinion continue de gronder. Le général Joffre se défend : sans offensive, Falkenhayn en aurait déjà fini avec les Russes ; on ne peut laisser la France immobile et être envahie ; durant l'offensive de Champagne, les Allemands étaient prêts à lâcher. Foch a la responsabilité de préparer une vaste offensive dans la Somme au moyen de trois armées durant l'été 1916.
Sur les conseils des généraux Pétain, Fayolle et Maud'huy, le généralissime tire les leçons des échecs de 1915 et présente une nouvelle tactique d'attaque. Il faut profiter de la guerre immobile pour reprendre son souffle, dit-il. Désormais on va chercher « l'usure de l'ennemi » ; une attaque frontale le déstabilisera, l'artillerie lourde attaquera ses points faibles. D'autre part, on établit également « la décision » : l'effort n'interviendra que si l'usure semble suffisante. Ces nouveautés entraînent une réorganisation totale de l'artillerie à l'échelle de la France. Trois centres de formation pour officiers ouvrent même leurs portes à Châlons, Amiens et Toul. En un an, la production de canons lourds est passée de 740 à plus de 2 000 et celle d'obus de 4 000 à 11 000 par jour. Joffre reconnaît ses erreurs et ne souhaite plus les réitérer.
La bataille de Verdun : le début de la fin pour Joffre
Article détaillé : Bataille de Verdun 1916.
Le Grand Quartier Général GQG de Joffre au 1er février 1916
Fonction Responsable Durée
Commandant en chef des opérations Gal Joseph Joffre 2 août 1914 - 26 décembre 1916
Major général Gal Maurice Pellé 22 mars 1915 - 20 décembre 1916
1er aide major général Cel Louis Poindron 22 janvier 1916 - 21 janvier 1918
2e aide major général Cel Henri Claudel 22 janvier 1916 - 2 mai 1917
3e aide major général et responsable de l'arrière Cel Camille Ragueneau 30 novembre 1914 - 4 mai 1917
L’organisation sur le terrain du général Joffre au 1er février 1916
Armée française Commandant en chef Durée
1re armée Gal Pierre Auguste Roques 5 janvier 1915 - 25 mars 1916
2e armée Gal Philippe Pétain 21 juin 1915 - 1er mai 1916
3e armée Gal Georges Humbert 22 juillet 1915 - 15 octobre 1918
4e armée Gal Henri Gouraud 11 décembre 1915 - 14 décembre 1916
5e armée Gal Louis Franchet d'Esperey 3 septembre 1914 - 31 mars 1916
6e armée Gal Pierre Dubois 13 mars 1915 - 26 février 1916
7e armée Gal Étienne de Villaret 3 novembre 1915 - 19 décembre 1916
Détachement Armée de Lorraine Gal Céleste Deprez 5 novembre 1915 - 31 décembre 1916
10e armée Gal Victor d'Urbal 2 avril 1915 - 4 avril 1916
Armée de Paris Gal Michel Maunoury 5 novembre 1915 - 6 avril 1916
Armée d'Orient Gal Maurice Sarrail 3 octobre 1915 - 11 août 1916
Le 15 décembre 1915, le général Gallieni met en garde Joffre :
« Toute rupture du fait de l'ennemi survenant dans ces conditions engagerait non seulement votre responsabilité mais celle du gouvernement ! »
Le généralissime trouve scandaleux que de telles craintes circulent sans son consentement. Le 5 août 1915, le GQG avait trouvé nécessaire de désarmer en partie les forts de la Meuse pour y transférer les canons sur la Somme. Il ne manque pas de rappeler à Gallieni qu'il a, lui seul, la conduite des opérations. À ceux qui trouvent cela risqué il répond : « Mais non ! Les Allemands n'attaqueront pas dans ce secteur ! ». Le lieutenant-colonel Émile Driant, député et commandant des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied, est l'un de ceux qui sont réputés alarmistes : Joffre menace de le déférer en Cour martiale.
De son côté, Falkenhayn se rend compte que la situation est critique pour l'Allemagne, dans les domaines militaire comme économique : il faut saigner l'ennemi à tout prix. Dans un premier temps, il choisit Belfort, puis redoutant la réaction helvétique, il se concentre sur Verdun. C'est une place forte stratégique française mais qui manque de communications : il sait qu'une partie du chemin de fer est de l'autre côté du front, les renforts français n'arriveront que par une petite voie au compte-gouttes. En parallèle, la 2e armée s'engagera en Champagne et la 3e sur la Somme. L'attaque est lancée le 21 février 1916.
Joffre et Foch, très occupés à la préparation de l'offensive sur la Somme, sont totalement pris au dépourvu. Les Allemands bombardent Verdun sans arrêt pendant trois semaines. Le fort de Douaumont est pris le 23 février et en quelques jours, les pertes françaises sont hallucinantes : 25 000 soldats hors de combat, 150 pièces d'artillerie détruites, une bande de 7 km perdue. Pourtant les Poilus tiennent le coup. À son tour, le fort de Brabant est pris le 24 et le général Herr, responsable de la région fortifiée, est débordé. Le général Langle de Cary, qui commande le groupe d'armées du Centre, ordonne le repli sur la rive gauche de la Meuse. Le généralissime reste calme et ordonne fermement de ne pas abandonner la rive droite de la rivière.
Joffre nomme le général Pétain commandant de la défense de Verdun et il envoie Castelnau sur place pour diriger les opérations. Dès le 27 février, Pétain organise ses forces afin de prendre en tenaille l'avance allemande ; le lendemain, la 3e armée du général Humbert est même placée sous son commandement direct. Le général en chef télégraphie à Pétain
Tout chef qui dans les circonstances actuelles donnera un ordre de retraite sera traduit devant un Conseil de guerre !
Enfin il ordonne à Pétain une contre-offensive et à Dubail une attaque par le flanc sud. Le 1er mars, Pétain frappe avec 660 pièces d'artillerie lourde. La Voie sacrée permet l'acheminement de 23 000 tonnes de munitions et de 190 000 soldats. Le 6, nouvel assaut de Falkenhayn qui provoque de grosses pertes côté français. Joffre est critiqué au Parlement. Gallieni, ministre de la Guerre entre en conflit avec le généralissime et évoque publiquement les erreurs commises à Verdun. Pourtant Briand ne le suit pas et il doit démissionner. Le général Roques, un ami personnel de Joffre, le remplace. Le haut commandement allemand échoue, ses attaques sur la rive droite de la Meuse sont endiguées et ne donnent pas de meilleurs résultats sur la gauche. Pétain s'exclame : Courage, on les aura ! Le 11 mars Joffre écrit à ses soldats :
« Soldats de l'armée de Verdun ! Depuis trois semaines, vous subissez le plus formidable assaut que l'ennemi ait tenté contre vous. L'Allemagne escomptait le succès de cet effort qu'elle croyait irrésistible et auquel elle avait consacré ses meilleures troupes et sa plus puissante artillerie. Elle espérait que la prise de Verdun raffermirait le courage de ses alliés et convaincrait les pays neutres de la supériorité allemande. Elle avait compté sans vous ! Nuit et jour, malgré un bombardement sans précédent, vous avez résisté à toutes les attaques et maintenu vos positions. La lutte n'est pas encore terminée, car les Allemands ont besoin d'une victoire. Vous saurez la leur arracher. Nous avons des munitions en abondance et de nombreuses réserves. Mais vous avez surtout un indomptable courage et votre foi dans les destinées de la République. Le pays a les yeux sur vous. Vous serez de ceux dont on dira : Ils ont barré aux Allemands la route de Verdun.
Au mois de juillet 1916, Joffre trouve Pétain finalement trop défensif et il décide de le remplacer par le général Robert Nivelle. Le 15 juillet, le général Mangin lance sa 37e division et approche de Douaumont. Globalement chacun reste sur ses positions. Le 13 septembre, le généralissime se rend à Verdun pour planifier avec Nivelle et Mangin une nouvelle attaque. L'assaut est donné le 24 octobre, tout se passe comme prévu. On progresse de trois kilomètres et le 2 novembre, le général Mangin parvient à reprendre le fort de Vaux. Joffre est ébloui : Magnifique, incomparable Mangin ! Le 15 décembre, huit divisions reprennent le haut de la Meuse et 25 000 Allemands sont mis hors de combat. La bataille de Verdun est terminée.
L’offensive sur la Somme
Les plans ont été mis au point par les généraux Foch, Joffre et Haig. Il faut attaquer sur les deux rives. Joffre est irrité par les renforts toujours croissants demandés par Pétain à Verdun. Foch qui voulait 42 divisions et 1 700 pièces d'artillerie lourde aura finalement 22 divisions et 540 pièces. Bien entendu, en terrain découvert, la préparation n'échappe pas au haut commandement allemand. Foch envisage deux attaques : une « à cheval » sur la Somme pour appuyer une offensive britannique. Le général Fayolle rappelle qu'il faut mener un assaut organisé et conduit d'objectif en objectif, précédé d'une préparation de l'artillerie lourde. Le généralissime abandonne définitivement l'offensive à outrance.
Le 1er juillet, l'attaque est lancée à l'aube. La 6e armée de Foch avance de dix kilomètres et fait 8 000 prisonniers, en revanche les Britanniques peinent à franchir les premières positions allemandes. Le général Haig ordonne leur repli ce qui rend Joffre furieux : « Vous attaquerez ! Je le veux ! » crie-t-il. Finalement, les Anglais sont renvoyés sur le front et Falkenhayn doit transférer des batteries de Verdun à la Somme. Le 15 juillet, les chars blindés sont utilisés. En août 1916, Joffre écrit à ses soldats :
« Le moment approche où sous la poussée commune s'effondrera la puissance militaire allemande. Soldats de France, vous pouvez être fiers de l'œuvre que vous avez accomplie déjà. Vous êtes décidés à l'accomplir jusqu'au bout ; la victoire est certaine.
Rapidement un conflit naît entre les commandements français et britannique. Haig se décharge des ordres de Joffre. Le généralissime lui demande de se reprendre, en vain. La grande bataille prévue n'aura pas lieu. Dès septembre, les combats ralentissent et le mois suivant, la bataille est quasiment terminée. Joffre et Foch sont déçus, ils ont aéré Verdun, ils ont saigné les Allemands Falkenhayn est remplacé par Paul von Hindenburg, mais ils n'ont pas brisé l'énergie ennemie. Les Britanniques estiment que le coût est encore une fois lourd pour de faibles résultats : 140 000 morts et 210 000 blessés. Durant le mois d'octobre, les armées françaises combattent seules, mais sans Londres rien n'est possible.
Bien qu'en certains endroits le front ait progressé d'une dizaine de kilomètres à l'avantage des Alliés, l'enlisement de la Somme reste globalement un échec, tout comme Verdun, une victoire amère. À l'est, les Roumains déclarent la guerre aux Empires centraux et Joffre leur envoie le général Berthelot. Cependant, la Roumanie est rapidement écrasée. À Salonique, l'armée de Sarrail ne donne aucun résultat. À Verdun, les Allemands recadenassent la ville. On estime le bilan des batailles : au moins 170 000 Français morts à Verdun, 216 000 blessés et autant sur la Somme. Joffre est sérieusement critiqué.
De la disgrâce à la fin de la guerre Maréchal de France malgré lui
Joffre impute à Pétain le défaitisme ambiant qui règne à Paris à la suite des résultats des batailles de 1916. Selon lui, ce ne serait pas Pétain le « sauveur de Verdun » ; pour lui c'est Nivelle le véritable génie. Dans tous les cas, l'opinion est sérieusement remontée contre le généralissime et dès le mois de juin, le Parlement s'est réuni secrètement afin d'envisager la réorganisation du haut commandement français. Joffre répond :
« Je ne me laisserai pas tirer dans les pattes. Soit ! Ces messieurs iront où ils voudront, mais flanqués d'officiers de mon État-Major. Je ne puis admettre qu'ils aillent se fournir d'arguments contre mon commandement auprès de certains de mes subordonnés.
Le généralissime est aussi en conflit avec Londres. Les Britanniques lui rappellent que, étant donné leur poids dans l'armée alliée, ils pourraient très bien prendre la tête du commandement interallié. L'organisateur de la Somme, le général Foch, est sujet à une vive polémique. Le ministre de la Guerre, le général Roques, dit de lui qu'il est trop vieux et le député Augagneur affirme qu'il sacrifie ses troupes. Enfin, le Parlement fait remarquer à Joffre qu'il n'a pas donné tous les moyens nécessaires à l'armée d'Orient de Sarrail.
Le président du Conseil, Aristide Briand, propose de confier au général Nivelle, un proche de Poincaré, le commandement en chef des armées et de conférer à Joffre le titre honorifique de général en chef des armées françaises, comme conseiller technique du gouvernement. Le généralissime comprend qu'on veuille le mettre dans l'ombre, mais pour lui seul Foch peut lui succéder. Le 7 décembre 1916, Briand annonce à la Chambre Assemblée nationale, que le GQG va être réorganisé prochainement. Joffre et Foch sont remplacés. Une véritable intrigue se met en place, orchestrée par Poincaré et Briand.
Au même moment, le président du Conseil contacte le général Lyautey gouverneur du Maroc pour lui proposer le ministère de la Guerre. Véritable ennemi de Joffre, Lyautey n'accepte pas que ce dernier soit nommé conseiller au sein du ministère de la Guerre. Le 26 décembre, Briand informe Joffre qu'il doit renoncer à toute fonction au gouvernement. L'ancien généralissime est contraint de s'incliner. En échange, il est fait maréchal de France ; le dernier à avoir reçu cette distinction était le maréchal Edmond Le Bœuf élevé au maréchalat en 1870. Ce titre honorifique lui est conféré pour éviter tout scandale politique.
Mission aux États-Unis Les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale.
À la suite de la déclaration de guerre du Congrès américain à l'Allemagne, le ministre de la Guerre Alexandre Ribot propose à Joffre de prêter « son inégalable prestige » et d'accompagner Viviani aux États-Unis. Après avoir hésité, Joffre accepte. En effet, n'ayant pas d'ennemis et n'étant plus en guerre depuis la fin de la guerre de Sécession, les Américains n'ont qu'une armée balbutiante de 120 000 hommes. L'objectif donné à Joffre est de convaincre le président Woodrow Wilson de préparer son armée à la guerre. La mission embarque à bord du Lorraine II le 15 avril 1917
Au bout de neuf jours de mer, la mission arrive à New York le 24 avril. L'amiral Mayo, chef de la flotte américaine de l'Atlantique s'exclame : « Sir, votre présence ici est le plus grand honneur qui puisse être rendu à mon pays ! » Dans les rues, la foule crie « Joffre ! Joffre ! » L'homme est accueilli en héros national. Tous les journaux américains rendent hommage au « vainqueur de la Marne » et on va jusqu'à le comparer à La Fayette. Joffre donne une conférence à l'École de guerre sur la situation militaire de l'Europe : il demande les moyens les plus rapides pour une intervention américaine. À Mount Vernon, il dépose sur la tombe de George Washington la palme offerte aux soldats morts pour la patrie.
Enfin, il désire convaincre le président Wilson qu'il rencontre longuement. Avec lui, il passe en revue chaque détail du conflit : les effectifs français et allemands, l'organisation de l'armée américaine, le transport et le débarquement, l'organisation du commandement… Au ministère de la Guerre, on lui présente le commandant des forces américaines, le général John Pershing. Au total, dans un premier temps, une division composée de quatre régiments d'infanterie, de douze batteries de campagne et de six batteries lourdes s'embarquent début juin. Le 24 mai, le maréchal Joffre est de retour en France ; il est nommé inspecteur général des troupes américaines. Une nouvelle polémique émerge : contrairement à ce qui était prévu, c'est-à-dire que les Américains servent dans leur armée, le gouvernement Painlevé veut placer des paquets de soldats américains dans les armées franco-britanniques. Joffre refuse et énonce que la parole de la France aux États-Unis est en jeu. Le 13 juin, Pershing est accueilli par Joffre à Paris ; les deux officiers sont reçus triomphalement par les Parisiens.
Foch à la tête des Alliés
Cependant, il y a toujours énormément de tensions entre les commandements français et anglais. Certains regrettent le départ de Joffre. En août 1917, Painlevé accuse le maréchal de vouloir prendre le pouvoir. Ailleurs en Europe, les Russes se décomposent définitivement et cherchent à signer la paix avec les Allemands, l'armée d'Orient est figée à Salonique et les Italiens sont écrasés à Caporetto novembre 1917. Face à une situation politique intérieure et extérieure délicate, Poincaré décide de nommer, malgré lui, son rival Georges Clemenceau à la tête du Conseil des ministres.
Le maréchal n'a plus de rôle dans le commandement militaire français, mais on lui demande son avis sur le nom du futur commandant en chef : choisir entre Pétain le défensif et Foch l'offensif. Admirant les deux généraux, Joffre choisit Foch, car il estime que la France ne peut pas rester les bras croisés. Autre point important, le commandement unique. Depuis le départ de Joffre à la tête du commandement français, les Alliés franco-anglais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le sort de l'Europe ennemie : les empires ottoman et austro-hongrois, la Pologne et l'Allemagne. Le 8 janvier 1918, le président Wilson présente ses quatorze points.
En mars, la situation devient préoccupante avec la signature d'un traité de paix entre la Russie et l'Allemagne. Hindenburg peut désormais déplacer toutes ses troupes sur le front occidental : 192 divisions d'infanterie contre 172 chez des Alliés (France, Grande-Bretagne, Belgique, Portugal et États-Unis) sans commandement uni. Le 21 mars, Hindenburg et Ludendorff lancent une série d'offensives ; ils sont rapidement à Ham et Péronne. À Amiens, les Britanniques sont en déroute et Clemenceau pense quitter Paris. De son côté, Joffre supplie la présidence de faire nommer Foch généralissime. Trois conférences se tiennent au cours de la fin mars : les Alliés ne se mettent pas d'accord et enfin lors d'une quatrième à Beauvais le 15 avril, le général Foch est nommé généralissime de toutes les armées alliées. Joffre lui écrit :
« Mon cher ami, j'ai appris avec satisfaction que l'on s'était enfin décidé à vous donner les pouvoirs de commandant en chef des armées alliées. Vous avez une tâche très lourde […]. Quelles que soient les difficultés de votre tâche, je suis persuadé que vous la mènerez à la bonne fin. Ce que vous avez fait sur l'Yser et dans les Flandres répond du succès de vos opérations actuelles. Tous mes vœux sont avec vous. Joffre »
En août-septembre 1918, Foch lance trois grandes offensives et deux mois plus tard les Allemands entament une retraite générale. L'armistice est signé le 11 novembre.
L’après-guerre : la seconde gloire du maréchal Joffre
Hommage de la France
Clemenceau ne souhaite pas inviter Joffre parmi les personnalités présentes lors de l'entrée officielle des troupes françaises à Metz et Strasbourg. Mais Pétain parvient à le faire venir. Quelques mois plus tôt, le maréchal Joffre avait été élu à l’Académie française le 14 février 1918 au fauteuil de Jules Claretie. Cependant il est reçu, en uniforme de général, à la Coupole le 19 décembre et les présidents Wilson et Poincaré sont présents pour l'occasion. Dans son discours, il commence par faire l'éloge de l'Armée, de ses chefs, de Foch, des soldats français, des Alliés, des soldats britanniques, des soldats russes… Voici son discours :
« Pour louer de tels soldats, les mots sont impuissants et seul mon cœur s'il pouvait laisser déborder l'admiration dont il est pénétré pour eux, traduirait l'émotion que j'éprouve… Je les ai vus, couverts de poussière et de boue, par tous les temps et par tous les secteurs […] toujours égaux à eux-mêmes, bons et accueillants, affectueux et gais, supportant les privations et les fatigues avec bonne humeur, faisant sans hésitation et toujours simplement, le sacrifice de leur vie
En février 1919, il retourne en cure dans le Roussillon à Amélie-les-Bains, puis à Rivesaltes, où le maire le reçoit officiellement. Il se recueille devant sa maison natale puis sur la tombe de ses parents. À Paris, le 14 juillet, la foule le réclame afin qu'il défile aux côtés du maréchal Foch à cheval, lors du défilé de la Victoire. Les deux militaires sont accueillis triomphalement. En octobre, c'est la ville de Perpignan qui lui rend hommage, il défile en voiture, la foule est là encore une fois. Le poète catalan Janicot lui écrit même un poème. Dans les autres villes de France, il préside des centaines de banquets d'anciens combattants, des meetings de veuves de guerre, des réunions de grands invalides de guerre, il inaugure des monuments aux morts.
Popularité internationale
De retour à Paris en janvier 1920, il doit partir en Roumanie remettre la médaille militaire au roi Ferdinand Ier et la Croix de guerre à la ville de Bucarest. À cette occasion, un pâtissier roumain a créé un gâteau au chocolat qu'il nomme Joffre, en l'honneur du maréchal. Le maréchal représente aussi la France à Belgrade et à Lisbonne, où il inaugure le monument du Soldat inconnu portugais. Enfin, il se rend à Madrid où est remise la médaille militaire au roi Alphonse XIII. Il termine son périple par Barcelone, où il est pris en porte-à-faux lors de manifestations catalanes et anti-espagnoles : il doit écourter son séjour et part le 7 mai 1920.
Le 11 novembre 1921, il embarque sur le paquebot Porthos à Marseille. Joffre débarque d'abord aux États-Unis, où il a pour mission de renouer l'amitié franco-américaine. Début décembre, il accoste à Saïgon, puis visite les ruines d'Angkor et le 1er de l'an 1922, il arrive en Annam, où il revient à Ba-Dinh là-même où il fit un siège en 1887, lorsqu'il était officier du génie en Extrême-Orient. Quelques jours plus tard, le maréchal entre à Hanoï, où il remet la croix de grand officier de la Légion d'honneur au général Puypéroux. Il termine son tour du monde par le Japon, à Yokohama puis Tokyo, où il rencontre le prince impérial Hirohito, et enfin la Chine à Pékin et Shanghai. Partout où il passe, la foule l'accueille triomphalement.
Fin de vie
Il rentre en France, au début de l'année 1922 pour terminer tranquillement une vie bien chargée, âgé de 70 ans. Joffre achète avec sa femme et sa fille une châtaigneraie à Louveciennes à l'ouest de Paris, où il fait bâtir un bungalow – type colonial – précédé d'une façade aux colonnades blanches à la manière du Mount Vernon de Washington. En 1928, il termine ses Mémoires entamés huit ans auparavant, où il raconte ses responsabilités de 1910 à 1917 en deux tomes qui seront édités post mortem selon sa volonté. C'est à cette époque qu'il perd deux de ses amis : le maréchal Fayolle le 27 août 1928 et le maréchal Foch le 20 mars 1929.
Le 21 juin 1930, le maréchal Joffre fait sa dernière apparition publique à l'occasion de l'inauguration de sa statue à Chantilly, où il a tenu son QG pendant la Grande Guerre. Il est très affaibli, car depuis plusieurs mois il a une artérite des membres inférieurs et peine à se déplacer. Le 19 décembre, d'atroces douleurs aux jambes l'emmènent à l'hôpital : les médecins, René Leriche et René Fontaine, doivent l'amputer de la jambe droite. Quelques jours plus tard il tombe dans le coma. Le 3 janvier 1931 à 8 h 0, il aurait prononcé ces derniers mots : J'ai beaucoup aimé ma femme et je n'ai jamais fait de mal à personne, puis il s'éteint à 8 h 23 à 78 ans à la clinique des frères de Saint-Jean-de-Dieu au 19 rue Oudinot dans le VIIe arrondissement de Paris.
Des obsèques nationales lui sont organisées le 7 janvier. Le service religieux est célébré en l'église Saint-Louis-des-Invalides à Paris, ainsi qu'en l'église Saint-Louis-des-Français de Rome et en l'église Saint-Polycarpe de Smyrne95. Quelques jours plus tard, le 11, le Parlement vote une loi déclarant que Joseph Joffre, maréchal de France, a bien mérité de la Patrie. Il repose dans un mausolée situé dans sa propriété de La Châtaigneraie à Louveciennes Yvelines. Henriette Joffre meurt en 1956 à 92 ans.
Un personnage controversé
Joseph Joffre est une personnalité controversée. De son vivant, certains le vénéraient, d'autres le détestaient. Au début du xxie siècle, la Grande Guerre est à la mode dans l'historiographie internationale et le maréchal, longtemps oublié, revient sur le devant de la scène. Joffre est parfois vu comme le vainqueur de la Marne, ou au contraire comme le massacreur de 14. Son rôle réel dans la victoire de la Marne est très discuté. Durant la guerre et jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les partisans de Gallieni affrontaient ceux de Joffre.
Le 28 septembre 2004, à l'occasion du 90e anniversaire de la victoire de la Marne, le ministre délégué aux Anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, citant le général de Gaulle, rend hommage au maréchal Joffre au seuil de son tombeau à Louveciennes :
[...] Si la guerre sanctionne impitoyablement les déficiences et les défaillances, elle ne ménage pas le succès à la valeur et à la vertu. Ce fut la fortune de la France que son armée, demeurée solide en dépit du revers initial, eût alors à sa tête un chef qui ne perdit point l'équilibre.
Joffre est avant tout un bâtisseur. Il exerce brillamment sa spécialité, le génie militaire, en particulier durant ses missions coloniales Formose, Tonkin, Soudan français et Madagascar. En 1911, il accède aux plus hautes fonctions de l'Armée, principalement parce que personne ne le concurrence pour obtenir cette haute responsabilité. Il limite le retard de l'armée à l'entrée en guerre, mais il s'avère un général d'armée relativement médiocre. Aucun de ses plans d'attaque n'est une grande réussite, la victoire de la Marne étant due en grande partie à une grave erreur stratégique allemande. En août 1914, Joffre a près de quarante ans de retard en stratégie militaire sur des généraux comme Lanrezac ou Pétain. Et contrairement à ces derniers, il n'a pas fait l'École de guerre.
Sa vision de la guerre est obsolète, il l'envisage comme tenante de l'offensive et héritière de l'épopée napoléonienne. Il ne perçoit pas les problèmes que rencontrent ses commandants d'armée : les troupes d'assaut, en raison de la lenteur de leur progression, s'avèrent incapables de provoquer la rupture tant attendue, alors que les réserves adverses arrivent beaucoup plus rapidement chemin de fer et camion. À la suite des échecs cuisants que connaît son armée en août-septembre 1914, Joffre en vient même à douter de la furie française. Il ne comprend pas pourquoi les combattants ne chargent pas comme on l'a toujours fait. Il méconnaît l'avantage de la défensive tranchées, multiples lignes de défense, barbelés sur l'offensive exposition des fantassins à l'artillerie, absence de moyens d'assaut réellement efficaces jusqu'à l'arrivée des chars. Ne percevant pas les conséquences et les capacités nouvelles qu'offrent les dernières évolutions technologiques sur les champs de bataille, il en retourne la responsabilité sur les hommes de troupe.
Il est le responsable — de par sa position au sommet de la hiérarchie militaire — de centaines de milliers de morts causés par ses offensives aveugles, souvent critiquées en vain par certains de ses généraux, Fayolle et Foch entre autres. A contrario, il s'avère plutôt bon diplomate dans ses relations avec les Alliés britannique et surtout américain pendant la guerre mais également comme représentant de la France à l'étranger durant les années 1920. Son rôle dans la bataille de la Marne de septembre 1914, découle de sa fonction de commandant en chef des armées du Nord-Est à qui incombait la conduite stratégique de la guerre et la coordination avec l'armée anglaise. Il était le seul à pouvoir assumer l'arrêt de la retraite et à décider du jour de la contre-offensive, mais la tactique en elle-même relève naturellement de ses généraux d'armées : Maunoury, Gallieni, Franchet d'Esperey, Foch, Langle de Cary, Sarrail, Castelnau et Dubail qui ont leur part dans cette victoire.
En outre, Joffre est le symbole de la promotion sociale au plus haut niveau de l'État. Au cours de sa vie, il a toujours su être au bon endroit au bon moment et prendre ses responsabilités : nomination au poste de chef d'État-Major 1911, bâton de maréchal reçu pour éviter tout scandale politique 1916. Pour l'anecdote, des admirateurs, après la bataille de la Marne, se référant à l'exemple napoléonien, firent une demande en Conseil d'État afin que lui soit attribué le titre de duc de la Marne. Cette demande fut rejetée mais le Conseil d'État indiqua qu'il lui était possible de changer son nom en Joffre de la Marne. Il n'en fit rien et préféra garder le nom sous lequel il était né.
Honneurs
Les distinctions françaises
Chevalier de la Légion d'honneur 7 septembre 1885
Officier de la Légion d'honneur 26 décembre 1895
Commandeur de la Légion d'honneur 11 juillet 1903
Grand officier de la Légion d'honneur 11 juillet 1909
Grand-croix de la Légion d'honneur 11 juillet 1914
Médaille militaire 26 novembre 1914
Croix de guerre 1914-1918 avec une palme
Médaille coloniale avec agrafe « Sénégal-Soudan » 1894
Médaille commémorative de l'expédition du Tonkin mars 1887
Officier de l'ordre du Dragon d'Annam 1887
Médaille commémorative de la guerre 1870-1871 1871
Les distinctions étrangères
Distinguished Service Medal États-Unis
Doctor honoris causa des universités de Harvard (États-Unis), de Porto Portugal et de Coimbra Portugal
Grand-croix du Ouissam alaouite chérifien Maroc
Chevalier grand-croix de l'ordre du Bain Royaume-Uni
Sceptre de Jade de l'empereur Khai-Dinh Annam, 1922
Grand-croix de l'ordre royal du Cambodge
Hommages
Son nom ou un dérivé de son nom a été attribué de multiples façons en hommage aux services qu'il a rendus à la Nation, sous les diverses formes suivantes :
le prénom de Joffrette a été utilisé, particulièrement entre 1915 et 1918 en l'honneur du vainqueur de la Marne ;
en 1918, il est élu à l'Académie française, au fauteuil 35, cet hommage donne ensuite naissance à l'expression une élection de maréchal, c'est-à-dire une élection non justifiée par les talents d'écrivain du postulant100 ;
son nom a été donné à un gâteau roumain en janvier 1920 à l'occasion de sa venue dans le pays ;
une statue équestre à son effigie est inaugurée à Rivesaltes le 22 novembre 1931, en présence d'André Maginot, alors ministre de la Guerre101 ;
son nom est donné à deux établissements d'enseignement se trouvant dans sa région d’origine : le collège Joffre de Rivesaltes, son village natal des Pyrénées-Orientales, ainsi qu'au prestigieux lycée Joffre de Montpellier, ancien « Grand-lycée-impérial » ;
en 1933, son nom est donné à un paquebot des Messageries maritimes, le Maréchal Joffre ;
de nombreuses lieux géographiques, places ou voies urbaines portent son nom :
un sommet du massif du Canigou des Pyrénées-Orientales, le pic Joffre102, d’altitude 2 362 mètres et situé au nord du pic du Canigou ;
une ville malgache, Joffreville ;
le parc de Charny à Québec au Canada,
un pont à Orléans dans le Loiret,
une place d'Amiens, dans la Somme, avec sa statue placée au milieu d'un vaste rond-point,
la route qu'il a aménagée entre Masevaux et Thann, pour la libération de Thann en août 1914,
une avenue à Bruxelles,
une rue de Malo-les-Bains depuis le 23 mars 1919103.
une rue à Liège,
une rue à Rennes,
un boulevard à Dijon,
une avenue à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne,
un grand boulevard de la ville de Tamatave, à Madagascar,
un bâtiment servant de logement aux élèves dans l'enceinte de l'École polytechnique (installée à Palaiseau depuis 1976)
le Joffre est un jeu de cartes populaire dans Bellechasse Québec, Canada ;
il donne son nom à la promotion 2003-2006 du lycée François-Arago de Perpignan dont il est issu ;
enfin, de manière anecdotique, il est cité dans plusieurs albums de la bande dessinée Achille Talon.
  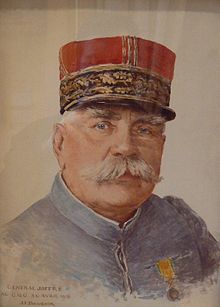   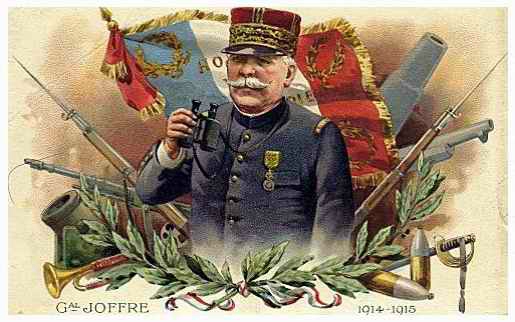 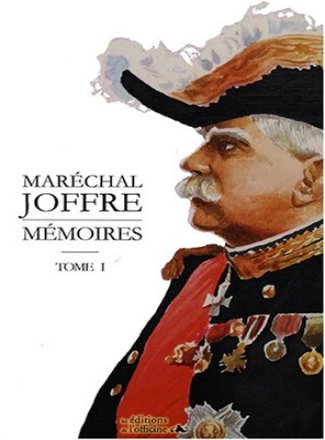   
Posté le : 04/01/2016 15:23
Edité par Loriane sur 05-01-2016 20:01:49
|
|
|
|
|
Comptage du temps, chronologie des calendriers |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Les premiers calendriers, entre Lune et Soleil
IIIe millénaire avant JC à 622
C'est aux Chaldéens, anciens habitants de l'Irak actuel, que l'on doit la première mesure du temps. L'unité principale, l'année, correspondait à peu près à la durée d'une rotation de la Terre autour du Soleil. Elle était divisée en autant de mois que de rotations de la Lune autour de la Terre.
Les Hébreux et les Grecs ont emprunté aux Chaldéens ce calendrier «lunaire» aligné sur le cycle de la Lune.
Ils l'ont corrigé quelque peu pour faire en sorte que l'année coïncide avec la durée d'une rotation de la Terre autour du Soleil.
Jules César a participé à cet effort mais c'est seulement avec le pape Grégoire XIII, sous la Renaissance, il y a environ 500 ans, que l'on y est arrivé.
Le calendrier grégorien s'est imposé dans le monde entier pour son caractère pratique sans cesser d'être en concurrence avec d'autres représentations du temps à caractère religieux
Le dictionnaire de l'Histoire calendrier, temps, ère chrétienne
Les Chaldéens, habiles astronomes de Mésopotamie, élaborent la première mesure du temps avec un calendrier «lunaire» aligné sur le cycle de la Lune et une semaine de sept jours six jours de travail, un jour de repos. Le calendrier «solaire» aligné sur le cycle du Soleil a été mis au point par les habiles jardiniers que furent les Égyptiens de l'époque pharaonique. Il comporte douze mois de trente jours avec un complément de cinq jours dits «épagomènes». Comme le calendrier grégorien, fondé sur le cycle solaire, la semaine est aujourd'hui d'application universelle.
En 532 de notre ère, au temps de l'empereur Justinien, un moine scythe réfugié à Rome, Denis le Petit, a situé l'année de la naissance du Christ 753 ans après la fondation légendaire de Rome. Deux siècles plus tard, sous Charlemagne, le moine anglo-saxon Bède le Vénérable a l'idée de compter les années à partir de «l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur» et non plus de l'intronisation du souverain régnant.
L'année qui précède le moment précis où serait né le Christ devient ainsi une année bissextile de 366 jours qualifiée d'An 1 avant Jésus-Christ ou avant JC. Les Anglo-Saxons écrivent en abrégé BC Before Christ, avant le Christ. La période postérieure est par convention qualifiée d'«ère chrétienne». Elle débute avec l'An 1 après Jésus-Christ en abrégé après JC ; les Anglo-Saxons emploient l'expression AD, du latin Anno Domini qui signifie en l'an du Seigneur. Comme on peut le voir, il n'y a pas d'année zéro dans ce calendrier pour la simple et bonne raison que le zéro était encore inconnu en Occident du temps de Bède le Vénérable.
Les géologues et les préhistoriens, qui n'en sont pas à quelques centaines d'années près, notent les années à partir d'aujourd'hui. Par exemple : Lascaux, 18.000 BP de l'anglais Before Present, Avant le Présent.
Et l'on inventa l'ère chrétienne
532 à 726 Invention de l'ère chrétienne... et oubli de l'An zéro
Dans les temps anciens, on comptait généralement les années à partir de l'année d'intronisation du souverain régnant ce système prévaut encore dans l'empire du... Japon.
Les Romains préféraient toutefois les compter à partir de la fondation de Rome, selon l'expression latine AUC - ab urbe condita, ce qui signifie : depuis la fondation de la ville. Devenu chrétien, l'empire romain conserve cette tradition et ce sont des querelles de clercs qui vont y mettre fin..
Pour fixer la date de Pâques, principale fête chrétienne, qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ trois jours après sa mort sur la croix, les premiers chrétiens s'en remettent à la tradition juive, fondée sur un calendrier lunaire. Mais cette solution finit par déplaire à l'Église, désireuse de prendre son autonomie par rapport au judaïsme.
- Denis le Petit date la naissance du Christ :
Désireux de mettre un terme aux «querelles pascales» qui agitent l'Église, quelques moines se mettent en quête d'une passerelle entre le calendrier lunaire des juifs et le calendrier solaire des Romains.
C'est ainsi qu'en 532 de notre ère, au temps de l'empereur Justinien, un moine scythe réfugié à Rome, Denis le Petit, situe l'année de la naissance du Christ 753 ans après la fondation de Rome, l'année de référence des anciens Romains...
NB : on pense aujourd'hui qu'il s'est trompé de 5 ans, le roi Hérode, contemporain de la naissance du Christ, étant mort en l'an 750 de la création de Rome ; le Christ serait donc né entre l'An 3 et l'An 6 avant l'ère chrétienne.
- Bède le Vénérable christianise le temps :
Le calendrier et les tables de Denis connaissent une obscure diffusion dans les îles britanniques où l'on voit apparaître les premiers actes datés de «l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur».
Deux siècles plus tard, au temps de Charlemagne, un moine anglo-saxon resté dans la postérité sous le nom de Bède le Vénérable envisage de généraliser cette pratique à la manière des Romains qui comptaient à partir de la fondation de leur ville. À sa suite, on prend l'habitude de dater l'année en cours à partir de l'année de naissance présumée du Christ. C'est une façon de christianiser le temps.
Les coptes préfèrent les martyrs
L'Église copte d'Égypte, aujourd'hui encore, se distingue de ses consoeurs en datant les événements à partir, non de la naissance du Christ, mais de l'«ère des martyrs» qu'elle fait débuter en l'an 284 de la Nativité, au plus fort des persécutions. Bien entendu, ce calendrier n'est en usage que dans le domaine liturgique.
- Bède le Vénérable rapporte toutes les années à la Nativité :
Bède le Vénérable ne s'en tient pas là. Il a aussi l'idée d'un décompte négatif pour les années antérieures à la naissance du Christ. Ainsi écrit-il dans son Historia ecclesiastica gentis anglorum, publiée en 726 : «Dans la soixantième année avant l'Incarnation du Seigneur, Caius Julius Caesar fut le premier Romain à faire la guerre aux Britanniques».
L'année qui précède le moment précis où serait né le Christ devient ainsi une année bissextile de 366 jours qualifiée d'An 1 avant Jésus-Christ ou avant JC. Les Anglo-Saxons écrivent en abrégé BC Before Christ, avant le Christ.
La période postérieure à la naissance du Christ est par convention qualifiée d'«ère chrétienne». Elle débute avec l'An 1 après Jésus-Christ en abrégé après JC ; les Anglo-Saxons emploient l'expression AD, du latin Anno Domini qui signifie en l'an du Seigneur.
Selon ce nouveau calendrier, l'ère chrétienne est supposée commencer au moment précis où serait né le Christ il ne s'agit encore que d'une convention qui n'a rien à voir avec la commémoration par l'Église de la Nativité, le 25 décembre.
Les années sont découpées en mois selon le principe de Sosigène d'Alexandrie retenu par Jules César et qui sera modifié à l'initiative du pape Grégoire XIII pour donner le calendrier grégorien aujourd'hui en usage dans la vie courante sur toute la planète.
Bien-pensance moderne
Si personne dans le monde ne conteste aujourd'hui sérieusement le calendrier de Bède le Vénérable, des voix s'élèvent toutefois aux États-Unis, pays du «politiquement correct», pour dénoncer la référence au Christ et à une religion particulière.
C'est ainsi que la formule après JC - en anglais AD Anno Domini - est remplacée par EC de l'Ère Commune, en anglais CE Common Era. La formule avant JC - en anglais BC Before Christ - est quant à elle remplacée par AEC Avant l'Ère Commune, en anglais BCE Before Common Era.
Vers une nouvelle représentation du temps
Le calendrier de Bède le Vénérable substitue à la représentation cyclique du temps, qui se renouvelle à chaque intronisation d'un souverain, une représentation linéaire avec des années s'ajoutant les unes aux autres... Et corrélativement, à l'idée que rien ne change, il substitue l'idée d'un progrès indéfini de l'humanité.
La nouvelle datation entre très vite en faveur à la cour de Charlemagne et de ses successeurs où l'on prend l'habitude de dater les actes publics à partir de la naissance de Jésus-Christ. Le mot date lui-même vient du latin «data» employé à propos d'un acte donné ou délivré tel jour. De la même racine viennent les mot Datum allemand, data italien... L'espagnol fecha dérive quant à lui du latin «facta» fait tel jour (*).
Il va s'écouler de longues décennies avant que le mode de datation des chancelleries ne se diffuse dans la pratique quotidienne. C'est ainsi que les Européens ordinaires de l'An Mil n'ont encore aucune conscience de la durée qui s'est écoulée depuis la naissance du Christ d'où le caractère mythique de la «Grande Peur de l'An Mil»... Rien de tel aujourd'hui.
Le calendrier de Bède le Vénérable est pleinement entré dans les moeurs. À preuve le succès planétaire des festivités du 31 décembre 1999, qui ont marqué l'entrée dans le IIIe millénaire il n'empêche que celui-ci n'a vraiment débuté que le 1er janvier 2001 et non 2000. André Larané -
Oubli de l'An zéro
Selon le calendrier de Bède le Vénérable, le premier siècle de notre ère a commencé le 1er janvier de l'An 1 et fini le 31 décembre de l'An 100...
Les siècles suivants débutent le 1er janvier du millésime 1. Ainsi, le Xe siècle débute le 1er janvier 901. Le XIe siècle débute, de même que le IIe millénaire, le 1er janvier 1001. Quant au deuxième millénaire, il a débuté le 1er janvier de l'An 1001 et s'est terminé le 31 décembre de l'An 2000.
Soulignons que le 31 décembre de l'An 1 avant Jésus-Christ a été suivi du 1er janvier de l'An 1 après Jésus-Christ.Comme on peut le voir, il n'y a pas d'année zéro dans ce calendrier pour la simple et bonne raison que le zéro était encore inconnu en Occident du temps de Bède le Vénérable.
Cet oubli ne gêne en aucune façon les historiens. Mais il en va différemment des... astronomes qui ont besoin d'additionner et soustraire des périodes. Or, quiconque est passé par le collège sait bien que le zéro est indispensable à ces opérations, surtout quand interviennent des nombres négatifs.
C'est pourquoi les astronomes ont choisi de numéroter les années avant JC par 0, -1... en introduisant l'équivalence :
- An 0 de l'astronomie = An 1 avant JC de l'Histoire,
- An -1 de l'astronomie = An 2 avant JC,
Notons pour être complet que les géologues et les préhistoriens, qui n'en sont pas à quelques centaines d'années près, notent les années à partir d'aujourd'hui. Par exemple, Lascaux, 18.000 BP de l'anglais Before Present, Avant le Présent.
Avec l'aimable contribution de Philippe Filliatre, astrophysicien
Le calendrier Julien, premier calendrier solaire
1er janvier 45 avant JC Naissance du calendrier julien
Le 1er janvier de l'an 708 de la fondation de Rome l'an 45 avant JC entre en vigueur à Rome un nouveau calendrier conçu sous l'égide de Jules César.
Ce calendrier a été employé sans modification pendant près de deux millénaires et c'est une version à peine modifiée en 1582 par le pape Grégoire XIII qui s'est aujourd'hui imposée sur toute la planète.Jean-François Zilberman
La lune défaite par le Soleil
Aux premiers temps de Rome, la mesure du temps se fondait sur les cycles de la lune celle-ci tourne autour de la Terre en 29 jours et demi environ.
Au début, l'année comportait 304 jours répartis en dix mois inégaux de 30 ou 31 jours Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December.
Il s'y est ajouté deux mois, Januarius et Februarius, de façon que l'année coïncide avec le cycle solaire et respecte le rythme des saisons. Pour les Romains, peuple de pasteurs et d'agriculteurs à l'esprit pratique, il était en effet essentiel que les travaux agricoles,labours, semailles, moissons... reviennent toujours aux mêmes dates
Plusieurs mois étaient dédiés aux dieux :
– le premier au dieu de la guerre, Mars ;
– le troisième à Maïa, une amante de Jupiter les chrétiens ont plus tard dédié ce mois mai à la Vierge Marie ;
– le quatrième juin à Junon, épouse de Jupiter à moins que ce ne fût à Junius Brutus, l'un des fondateurs de la République romaine ;
– le onzième janvier à Janus, un dieu à double face ;
– le dernier mois février était le mois des morts ; il était consacré à des purifications et réputé néfaste.
Jusqu'en 153 avant JC, l'année débutait donc le 1er mars, d'où les noms de septembre, octobre, novembre et décembre que portent encore les anciens mois de rang 7, 8, 9 et 10.
Trois jours importants rythmaient les mois : les Calendes 1er jour, les Nones le 5e ou le 7e et les Ides le 13e ou le 15e.
Il était habituel aux Romains de payer les intérêts de leurs dettes le premier jour de chaque mois. C'est ainsi que, de ce jour appelé Calendes, nous est venu le mot «calendrier». Ce mot a d'abord désigné le registre où étaient inscrits les comptes puis la mesure du temps elle-même.
Malgré les deux mois complémentaires de janvier et février, l'année calendaire dérivait par rapport au cycle solaire et les Pontifes, qui réglaient à Rome les affaires religieuses, devaient affiner le calendrier en ajoutant tous les deux ans quelques jours supplémentaires. Ils usaient de ce privilège en fonction de leurs intérêts, pour allonger ou raccourcir le mandat des consuls, ces derniers étant élus pour une année non renouvelable.
Jules César domestique le temps
En 46 avant JC, Jules César décide d'en finir avec les fantaisies pontificales. Il introduit un judicieux calendrier mis au point par l'astronome Sosigène d'Alexandrie.
Le maître de Rome impose une année de 365 jours divisée en 12 mois de longueur inégale. Il la fait aussi débuter le 1er janvier cette règle est tombée en désuétude à la fin de l'empire romain et n'allait s'imposer en Occident qu'au XVIe siècle seulement.
Pour réduire l'écart entre l'année calendaire et la rotation de la Terre autour du soleil, on convient d'ajouter un jour au calendrier une fois tous les quatre ans. Ce 366e jour est introduit après le 24 février. Comme les Romains nomment les jours ordinaires d'après le jour important qui les suit, il est désigné par l'expression : sexto ante calendas martii, sixième jour avant les calendes de mars. Le 366e jour est en conséquence appelé bis sexto ante... D'où le nom de bissextile qui est encore donné aux années correspondantes !
La mise en place du nouveau calendrier intervient donc le 1er janvier de l'an 708 AUC, ab urbe condita, en français : depuis la fondation de la ville, autrement dit 708 ans après la fondation de Rome selon le calcul des années en vogue à l'époque. Elle est précédée par une «année de confusion» de 445 jours en vue de réaligner une bonne fois pour toutes le début de l'année sur l'équinoxe de printemps.
Auguste ne vaut pas moins que Jules
Sur une proposition du Sénat de Rome, le cinquième mois de l'année Quintilis est renommé Julius le nom s'est transformé en juillet dans notre langue pour remercier Jules César d'avoir réformé le calendrier.
Plus tard, son successeur Auguste remet la réforme sur les rails. Il supprime les années bissextiles sur une période de 12 ans pour gommer un léger décalage entre le calendrier de son prédécesseur et le cycle solaire. Flatteur, le Sénat décide en conséquence de donner son nom au sixième mois de l'année Augustus, qui devient août en français... Mais dans le calendrier initial, ce mois avait 30 jours contre 31 pour Julius !
Afin de mettre César et Auguste sur un pied d'égalité, on enlève donc un jour à février pour le donner au mois d'août... et l'on attribue 30 jours au lieu de 31 aux mois de septembre (le septième mois dans l'ancien calendrier romain et de novembre, ainsi que 31 jours au lieu de 30 aux mois d'octobre et de décembre.
Le calendrier julien dominera l'Occident pendant 16 siècles jusqu'à la réforme du pape Grégoire XIII.
La réforme de Jules César
À Rome, l'année débutait en mars et comportait 355 jours et dix mois.
Les Romains payaient leurs dettes au début de chaque mois, ces jours étant appelés calendes ou calendae. D'où le mot calendrier qui désigne le registre où sont inscrits les comptes puis la mesure du temps elle-même.
En 46 avant JC, Jules César donne à l'année 365 jours et 12 mois. Il la fait débuter le 1er janvier et prévoit des années bissextiles. Ce nouveau calendrier est dit julien en référence à son promoteur. L'Église, au Moyen Âge, lui demeure fidèle tout en faisant remonter le décompte des années à la naissance du Christ ce décompte s'est aujourd'hui imposé à toute la planète.
Mais sous la Renaissance, les astronomes s'aperçoivent que l'année calendaire dépasse l'année solaire de... 11 minutes 14 secondes. Le cumul de cette avance quinze siècles après la réforme julienne se monte à une dizaine de jours avec pour conséquence de plus en plus de difficultés à fixer la date de Pâques !
15 octobre 1582 Naissance du calendrier grégorien
Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582, les Romains se réveillèrent le vendredi... 15 octobre 1582. Cette nuit du 4 au 15 octobre 1582 avait été choisie par le pape Grégoire XIII pour l'entrée en application de sa réforme du calendrier julien, ainsi nommé d'après Jules César.
La réforme de Grégoire XIII
Grégoire XIII décide donc d'attribuer désormais 365 jours, et non 366, à trois sur quatre des années de passage d'un siècle à l'autre. Les années en 00 ne sont pas bissextiles sauf les divisibles par 400 : 1600, 2000, 2400...
Cette modeste réforme ramène à 25,9 secondes l'écart avec l'année solaire une broutille.
Par ailleurs, le pape décide de rattraper les dix jours de retard du calendrier julien entre le 4 et le 15 octobre 1582.
La réforme va s'étendre peu à peu à l'ensemble des pays. Le calendrier grégorien est aujourd'hui d'application universelle ou à peu près.
Calendrier révolutionnaire
24 novembre 1793 Naissance du calendrier révolutionnaire
Le 24 novembre 1793, à Paris, la Convention publie le calendrier républicain, aussi appelé « calendrier des Français ».
Les députés menacent de la guillotine quiconque s'exprimerait selon l'ancien calendrier, hérité de Jules César et modifié par le pape Grégoire XIII.
Ils veulent de cette façon déraciner les rites chrétiens, en particulier le repos dominical et les fêtes religieuses.
Le calendrier républicain est l'oeuvre du poète François Fabre d'Églantine, qui s'est rendu célèbre en composant l'immortel tube : Il pleut, il pleut, bergère... !
Les jours ne sont plus consacrés à des saints mais à des produits du terroir : châtaigne, tourbe, chien, radis, chèvre, abeille, sarcloir... ».
Les semaines sont portées à dix jours primidi, duodi, tridi... et prennent le nom de décades.
Quant aux mois, ils ont chacun 30 jours et reçoivent des noms évocateurs des saisons : vendémiaire, brumaire, frimaire, nivôse, pluviôse, ventôse, germinal, floréal, prairial, messidor, thermidor, fructidor. Ils sont complétés par cinq ou six jours consacrés à des fêtes patriotiques, les sanculottides .
Jour de l'an premier
Chez les peuples usant d'un calendrier solaire, le début de l'année a toujours été fixé par pure convention. Ainsi, l'année romaine commençait avec le mois de mars les noms de nos quatre derniers mois de l'année, tout comme leurs abréviations anciennes, rappellent clairement qu'ils occupaient, dans ce premier calendrier romain, les positions sept septem, 7bre, huit octo, 8bre, neuf novem, 9bre et dix decem, 10bre. Jules César, sur les conseils de Sosigène d'Alexandrie, avança de trois mois cette date : l'an 709 de Rome — 45 des chronologistes, — 44 en notation algébrique des astronomes commença le 1er janvier, et c'est la date initiale de la réforme julienne, que Rome – et avec elle les nations soumises à sa domination – appliqua pendant 345 ans...
Mais, au fil des siècles, l'année n'a pas commencé partout au 1er janvier, et son début a varié au gré des Églises, des époques et des pays. Pour ne citer d'abord que la France, l'année commençait le 1er mars dans nombre de provinces aux VIe-VIIe siècles ; à Noël au temps de Charlemagne et en certains lieux, tel Soissons, jusqu'au XIIe s. ; le jour de Pâques sous les Capétiens, ce qui donnait des années de longueur très variable usage quasi général aux XIIe-XIIIe s., jusqu'au XVIe s. dans certaines provinces ; toutefois, en quelques régions, l'année commençait à date fixe, le 25 mars, jour de l'Annonciation. C'est ainsi qu'on peut lire, dans la Généalogie des rois de France 1506 de Bouchet : « Charles VIII alla à trépas au chasteau d'Amboise le samedi 7 avril 1497 avant Pasques le 15 avril cette année-là, à compter l'année à la feste de Pasques ainsi qu'on le fait à Paris, et en 1498 à commencer à l'Annonciation de Nostre-Dame ainsi qu'on le fait en Aquitaine. Ce n'est qu'en 1564 que, par édit de Charles IX, le début de l'année fut obligatoirement fixé en France au 1er janvier ; et les fausses étrennes et poissons d'avril sont un lointain souvenir des dates révolues.
La République ayant été proclamée le 22 septembre 1792, date qui se trouvait être le jour équinoxial d'automne, le calendrier républicain fixa le début de l'année au jour civil où tombe l'équinoxe d'automne au méridien de Paris.
En Russie, l'an commençait le 1er septembre ; à compter du règne de Pierre le Grand, il commença le 1er janvier. Quant à l'Angleterre, où l'an débutait le 25 mars, elle n'accepta le 1er janvier qu'avec la réforme grégorienne : l'année anglaise 1751 ne comporta que neuf mois et une semaine ! Pierre Deligny
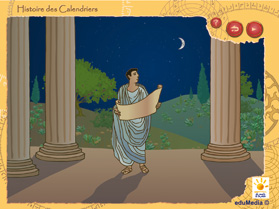   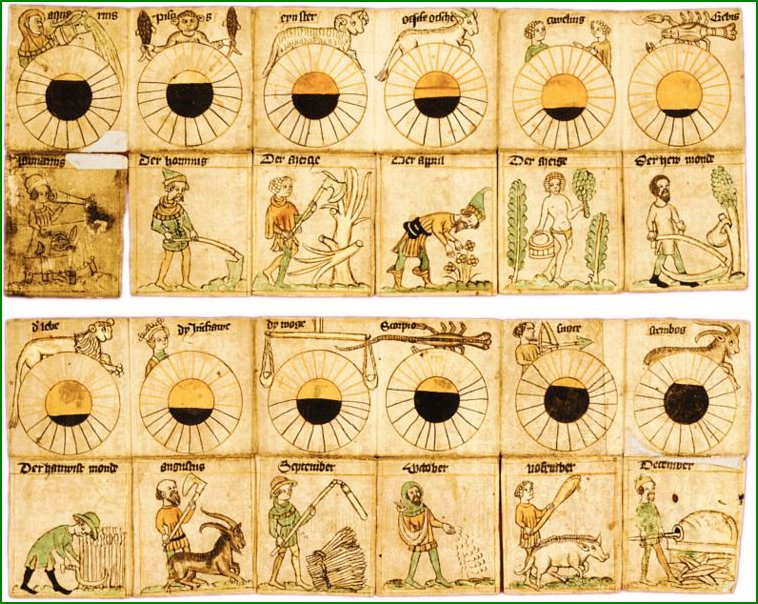   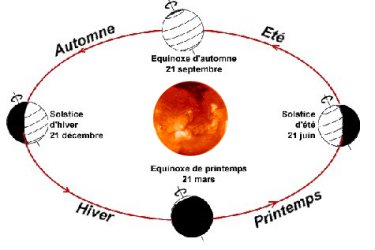  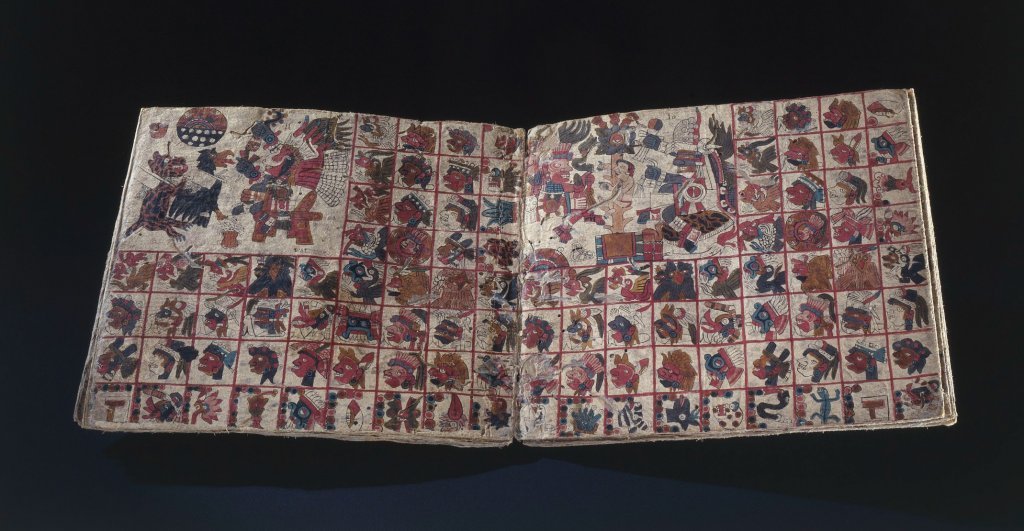 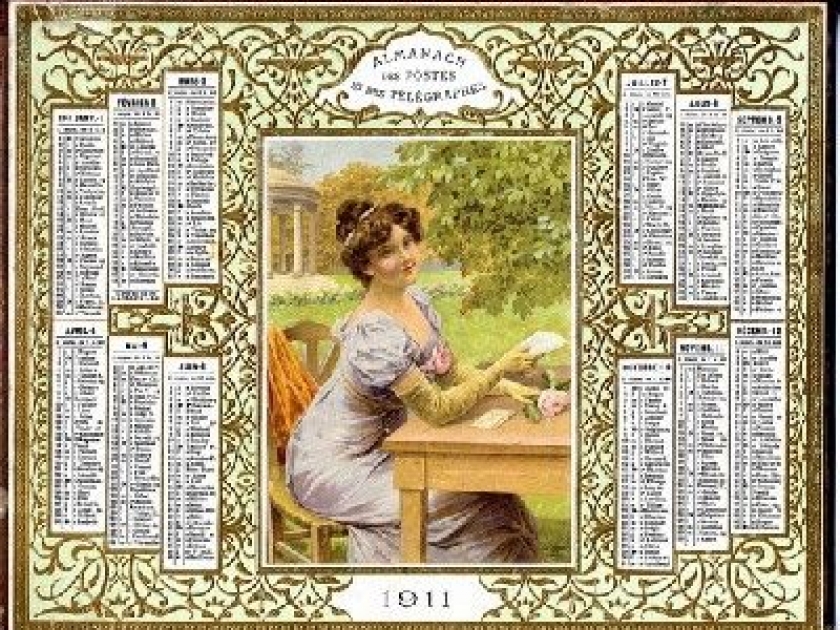 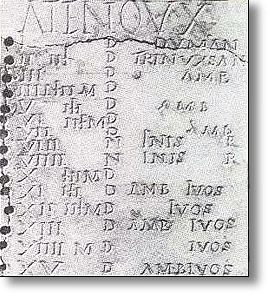 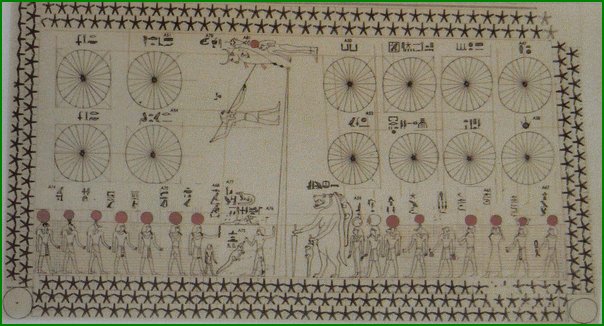 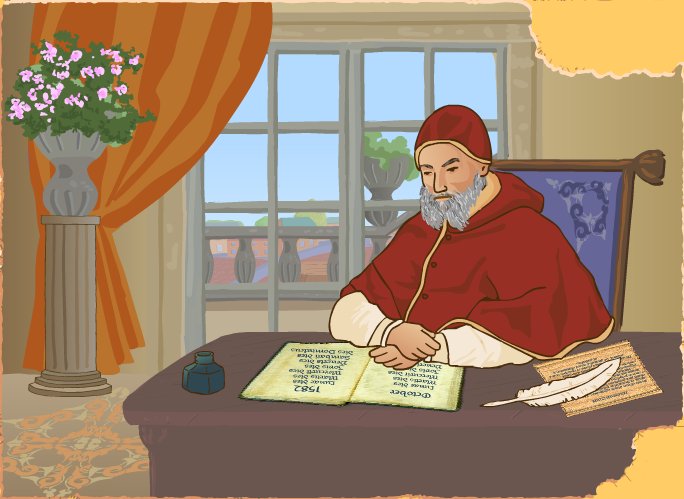 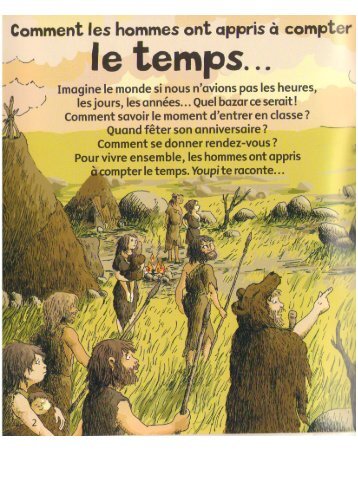      
Posté le : 23/12/2015 20:42
Edité par Loriane sur 27-12-2015 22:26:01
Edité par Loriane sur 31-12-2015 17:31:51
|
|
|
|
|
Naissance de l'union latine |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
23 décembre 1865 Naissance de l'Union latine
Le 23 décembre 1865, la Belgique de Léopold II, la France de Napoléon III, l'Italie de Victor-Emmanuel II et la Suisse signent une convention monétaire à l'initiative de l'Empereur des Français. C'est la naissance de la première union monétaire de l'Histoire : l'Union latine.
Le principe en est simple : les monnaies de référence de chaque pays de l'Union ont le même poids d'or fin tout en gardant leur nom (franc français, franc suisse, lire...) et leur symbole national. Ces monnaies et leurs subdivisions principales peuvent de la sorte circuler indifféremment dans tous les pays de la convention: il devient possible de payer à Bruxelles ou Paris ses achats avec des lires ou des francs suisses !
La convention exclut de son champ les pièces dites « de billon », dont la valeur faciale est inférieure à 20 centimes, ainsi que le papier-monnaie dont la circulation est encore confidentielle.
Un avatar de la Révolution
Le précurseur de l'Union latine est Napoléon 1er, qui a imposé dans les pays soumis à la France une référence monétaire commune : le Napoléon, une pièce de 5,801 grammes d'or fin, d'une valeur de 20 francs.
Dans une lettre à son frère Louis, roi de Hollande (et père du futur Napoléon III), en 1806, il écrit : « Mon frère, si vous faites frapper de la monnaie, je désire que vous adoptiez les mêmes divisions de valeur que dans les monnaies de France et que vos pièces portent, d'un côté, votre effigie et, de l'autre, les armes de votre royaume. De cette manière, il y aura dans toute l'Europe uniformité de la monnaie, ce qui sera d'un grand avantage pour le commerce ».
Après Waterloo et l'effondrement de l'Empire napoléonien, la référence au Napoléon est provisoirement abandonnée. Mais la Belgique, en prenant son indépendance, en1830, y revient d'elle-même dans le souci d'asseoir sa monnaie sur une base solide. L'Italie fait de même en procédant à son unification. Enfin, la Suisse, en 1851, introduit à son tour une pièce de 20 francs suisses ayant les mêmes caractéristiques que ses consoeurs (5,801 grammes d'or fin).
La convention de 1865 entérine ces évolutions. Elle laisse à ses signataires le droit de se retirer de l'Union à leur guise. Dans les faits, de nombreux pays la rejoignent, à commencer par la Grèce, le 8 octobre 1868.
Au total, 26 pays adhèrent à l'Union latine, de l'Argentine à la Finlande (à l'exception notable de l'Angleterre et de l'Allemagne) ! Les États-Unis eux-mêmes envisagent de la rejoindre.
La convention admet, à côté de pièces en or, des monnaies divisionnaires en argent. Mais ce bimétallisme est mis à rude épreuve suite à l'enchérissement de l'argent par rapport à l'or. Cet enchérissement de l'argent est la conséquence de l'arrivée en Europe de grandes quantités d'or, du fait de la découverte d'importants gisements aurifères en Californie, Sibérie, Australie et Afrique du Sud.
Une Union européenne avant la lettre
L'Union latine a fonctionné néanmoins de manière très satisfaisante pendant plusieurs décennies, illustrant le très haut niveau d'intégration atteint par l'Europe à la fin du XIXe siècle...
Ce fut l'une des périodes où les Européens ont au plus haut point le sentiment d'appartenir à une communauté de civilisation, unie par des valeurs et des croyances identiques. Ce sentiment s'est déjà rencontré au XIIIe siècle (le temps des cathédrales) et au début de la Renaissance. On l'a connu aussi à l'époque de Jean Monnet et de la construction européenne...
La Grande Guerre (1914-1918) va porter le coup de grâce à l'Union latine et celle-ci s'éteint pour de bon le 1er janvier 1927.
Joseph Savès
Posté le : 22/12/2015 16:37
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
54 Personne(s) en ligne ( 36 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 54
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages