|
|
Jeanne D'Arc boute les anglais 4 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Les enseignes
Envoyée à Tours par le roi pour y prendre livraison de son armure avant de se diriger vers Orléans, Jehanne d'Arc réside dans la ville du 5 au 21 avril 1429 et se fait faire deux enseignes : une petite qui fut brûlée accidentellement au moment de l’entrée à Orléans et une grande qu'elle tenait toujours au moment de sa capture par les Bourguignons à Compiègne. Cette dernière n'était plus disponible lors de son procès et Pierre Cauchon ne l'avait pas vue, puisqu'il en demande à Jehanne une description détaillée. On a conservé, au 13e compte de Hémon Raguier, trésorier des guerres du roi Charles VII, la mention de la dépense: Et a Hauves Poulnoir, paintre demorant a Tours, pour avoir paint et baillé estoffes pour ung grant estendart et ung petit pour la Pucelle, 25 livres tournois.
L'étendard : les voix conduisirent Jeanne d'Arc à substituer à l'oriflamme de Reims un étendard de couleur blanche avec sur le premier tiers de la hampe une représentation de l'apocalypse par Hauves Poulnoir « l'image de notre Sauveur assis en jugement dans les nuées du ciel et un ange tenant une fleur de lys avec inscrit Jhésus Maria description de Jean Pasquerel ; selon les déclarations de Jeanne d'Arc, lors du procès, le champ était blanc semé de fleurs de lys, sur lequel se trouvait " le monde figuré et deux anges sur les côtés, et il était de couleur blanche, de toile blanche ou boucassin, et étaient là ces devises : Jhésus Maria, ainsi qu’il lui semble, et les franges étaient de soie. Selon la représentation courante des apocalypses à cette époque, l'ange de droite tenant un lys est celui de la miséricorde et le second ange, placé à gauche tenant une épée, est celui de la justice. L'inscription Jhesus Maria mentionnée par la déposition de Jeanne d'Arc est confirmée par le Journal du siège... Selon la manière dont ces bannières se faisaient, le verso représentait les mêmes motifs et les mêmes inscriptions à l'envers mais, selon Perceval de Cagny qui la décrit lors de la bataille de Jargeau, la mandorle du Christ était remplacée par un écu d'azur semé de fleurs de lys d'or : La Pucelle prit son étendard auquel était peint Dieu en majesté ... manque et de l'autre côté un écu de France tenu par des anges.
Le pennon fanion de forme triangulaire : sur ce pennon, on pouvait voir Notre-Dame ayant devant elle un ange lui présentant un lys. Selon le témoignage du greffier de La Rochelle en 1431, ce pennon portait aussi un cri de guerre : Par le Roi du Ciel.
En 1894, un étendard fut réalisé pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, en suivant le mieux possible les indications de Jeanne d'Arc et des autres témoins du temps.
En 1909, le conservateur du musée Jeanne-d'Arc d'Orléans fit fabriquer une nouvelle restitution s'inspirant de l'étendard de Notre-Dame et de la représentation de la bannière de Jehanne d'Arc se trouvant sur la tapisserie d'Azeglio découverte et achetée en 1858 à Lucerne par le Marquis d'Azeglio, ministre plénipotentiaire de Sardaigne en Angleterre et sur deux autres miniatures découvertes ensuite près de Strasbourg. L’actuel étendard des fêtes de Jeanne d’Arc date de 1936 et reprend la disposition de l’étendard réalisé en 1909.
Une copie du drapeau de Jehanne d'Arc a été remise par Lord Tyrrell, ambassadeur d'Angleterre à M. Paul Doumer le 1er janvier 1932. Cet exemplaire de très grande taille, destiné à la cathédrale de Reims, est placé dans une chapelle absidiale derrière la statue de Jeanne sculptée par Prosper d'Épinay en 1901.
D'autres essais de reconstitutions ont été faits, par Henri de Barenton en 1909, pour les fêtes de la canonisation, etc. Une étude approfondie et critique de toutes les sources avec leurs variantes a été faite par le colonel Ferdinand de Liocourt en 1974.
L'armure
Charles VII paya à Jeanne une armure coûtant 100 écus, soit 2.500 sols ou 125 livres tournois. Cette somme n'est pas extraordinaire, il suffit de la rapprocher de l'inventaire établi par Jeanne lors de son procès : Elle dit ensuite que ses frères ont ses biens, ses chevaux, épées, à ce qu'elle croit, et autres qui valent plus de 12.000 écus. Elle répondit qu'elle avait dix ou douze mille écus qu'elle a vaillant… Le comte de Laval par témoignage nous apprend qu'il s'agissait d'un harnois blanc, c'est-à-dire de pièces d'armure d'un seul tenant, et non d'une brigandine. Par comparaison, cette armure valait deux fois le prix de l'équipement le moins coûteux, et huit fois moins que le plus cher. Cette armure fut offerte à Saint-Denis en ex-voto après l'échec de l'assaut sur Paris. À partir de ce moment, elle porta une armure prise sur un Bourguignon, sans qu'on connaisse la valeur de ce nouvel équipement. L'armure de Saint-Denis ne fut certainement pas détruite mais a peut-être subi le sort de l'épée qui fut déposée à Sainte-Catherine de Fierbois par un soldat et empruntée par Jeanne.
Sur la tapisserie d'Azeglio, Jeanne d'Arc qui fait son entrée à Chinon est montée sur un cheval blond clair, et armée de toutes pièces; elle porte une huque vermeille, frangée de jaune, et un chaperon de même couleur avec aigrette, par-dessus lequel est posé une chapeline de fer; ses cheveux sont entièrement enveloppés et cachés; à la main droite elle tient son étendard...".
L'épée
L'épée qui accompagna Jeanne d'Arc pendant toutes ses batailles fut découverte sur son indication sous les dalles de l'église de Sainte-Catherine-de-Fierbois (Indre-et-Loire), parmi d'autres épées enterrées par des soldats de passage. Cette épée fort ancienne était décorée de cinq croix. La rouille qui la recouvrait aurait disparu aussitôt que Jeanne d'Arc eut l'épée en main.
Jean Chartier, dans Journal du siège et Chronique de la Pucelle, mentionne l'épée et les circonstances de son acquisition par la Pucelle : le roi voulut lui donner une épée, elle demanda celle de Sainte-Catherine de Fierbois, on lui demanda si elle l'avoit oncques veue, et elle dit que non. Un forgeron fut envoyé depuis Tours et découvrit l'épée parmi plusieurs ex-voto déposés là, apparemment dans un coffre derrière l'autel. Jeanne brisa cette épée sur le dos d'une prostituée, à Saint-Denis, selon le duc d'Alençon, vraisemblablement après la tentative manquée contre Paris. Il semble qu'elle ait pris l'habitude de frapper avec cette épée sur le dos des filles de joie qu'elle rencontrait, de tels incidents étant précédemment mentionnés à Auxerre par le chroniqueur Jean Chartier et par son page, Louis de Coutes, pour l'étape Château-Thierry. Charles VII se montra très mécontent du bris de l'épée. Celle-ci avait en effet pris des allures d'arme magique parmi les compagnons de Jeanne, et sa destruction passa pour un mauvais présage. On n'a aucun indice sur ce que sont devenus les morceaux.
Suivant une légende locale, Lyonnel de Wandonne récupéra l'épée de Jeanne d'Arc qu'il emmura dans l'église de Wandonne.
Il ne faut pas confondre l'épée réelle et l'épée virtuelle qui se trouve décrite et dessinée dans les armoiries de la famille d'Arc. Dans le blason de Jeanne, l'épée est représentée avec cinq fleurs de lys alors que les textes concernant l'épée de Fierbois ne mentionnent que cinq croix.
Les anneaux de Jeanne d'Arc un événement en cours.
Ces informations peuvent manquer de recul, ne pas prendre en compte des développements récents ou changer à mesure que l’événement progresse. Le titre lui-même peut être provisoire. N’hésitez pas à l’améliorer en veillant à citer vos sources.
Dernière modification de cette page le 2 mai 2016, à 18:11.
Le jeudi 1er mars 1431, lors de la cinquième séance du procès de condamnation à Rouen, les juges demandent à Jeanne d'Arc si les saints qu'elle déclare avoir vu portaient des anneaux. Ils l'interrogent ensuite au sujet de ses propres anneaux. S'adressant à Pierre Cauchon, la Pucelle rétorque que l'évêque en détient un qui lui appartient ; elle demande que cet objet — cadeau de son frère — lui soit rendu, avant de charger son juge d'en faire don à l'Église. En outre, la prisonnière déclare qu'un autre de ses anneaux a été gardé par les Bourguignons. Elle décrit ce second bien, cadeau de son père ou sa mère, comme portant l'inscription « Jésus Marie » Jhesu Maria, sans aucune pierre précieuse. Jeanne d'Arc affirme n'avoir jamais utilisé ses anneaux pour guérir quelqu'un.
L'après-midi du samedi 17 mars 1431, les juges s'intéressent derechef à l'anneau gardé par les Bourguignons, questionnant Jeanne d'Arc au sujet de sa matière. La Pucelle répond de manière imprécise, ne sachant pas si l'objet est en or pas d'or fin dans ce cas, précise-t-elle ou en laiton. Outre les noms Jésus Marie, elle précise que l'anneau porte également trois croix et pas d'autre signe.
Le mardi 27 mars 1431, le promoteur autrement dit le procureur Jean d'Estivet expose à Jeanne d'Arc les soixante-dix articles composant le réquisitoire à son encontre. Le vingtième chef d'accusation affirme que la Pucelle a ensorcelé son anneau ainsi que son étendard et l'épée de Sainte-Catherine.
Il existe un anneau présenté comme celui porté au doigt par Jeanne d’Arc jusqu'à son procès. En vermeil, décoré de trois croix, il porte les inscriptions I et M et IHS et MAR pour Jhesus Maria. D'après le journaliste Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine, l'histoire de cet anneau serait la suivante : censément confisqué au cours du procès par l’évêque Cauchon, il aurait été vendu ou donné au cardinal anglais Henri Beaufort. Porté par le roi Henri VI d’Angleterre, il serait demeuré la propriété des Anglais depuis 1431. Cet anneau devint ensuite la propriété d’Ottoline Morrell, une aristocrate anglaise, qui en fit cadeau à son conjoint de l’époque, le peintre Augustus John qui le vendit en 1914 à un gardien des armoiries royales. Le dernier propriétaire, le fils d'un médecin ayant servi le général de Gaulle et les Forces françaises libres à Londres durant la Seconde Guerre mondiale, l'a présenté au cours d’une vente aux enchères le 26 février 2016, à Londres. Prévenu de cette vente par l'avocat et écrivain Jacques Trémolet de Villers, auteur d'un ouvrage sur le procès de condamnation de Jeanne d'Arc103, Philippe de Villiers transmet l'information à son fils Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, qui rachète l'anneau pour la somme de 376 833 € afin de l'exposer dans son parc d'attraction à thème historique.
Cependant, l'historien médiéviste Olivier Bouzy ainsi que le comité scientifique de l'Historial Jeanne d'Arc de Rouen émettent des doutes sur l'authenticité de la relique, soulignant la différence entre la nature du métal de l'anneau en vermeil vendu aux enchères et celui en laiton ou en or — mais pas en or fin — décrit par Jeanne elle-même lors de son procès. De surcroît, Bouzy indique que les indications fournies par la Pucelle — la nature du métal, l'inscription Jésus Marie, Jhesu Maria, les trois croix, l'absence de pierre précieuse — correspondent à l'anneau gardé par les Bourguignons et non à celui détenu par l'évêque Cauchon, pour lequel il n'existe aucune description. Enfin, l'historien médiéviste estime que rien ne prouve que les Bourguignons ... ont donné l'anneau au cardinal anglais Henri Beaufort, avant de rappeler l'imprécision inhérente aux expertises de métaux antérieurs au XVIe siècle, établissant à cette fin une comparaison avec les nombreuses armures censément associées à Jeanne d'Arc.
L'historienne médiéviste Colette Beaune se montre également circonspecte quant à l'historique de l'objet, sinon quant à sa datation : Tous les trois ou quatre ans des fausses épées, armures ou reliques de Jeanne d'Arc apparaissent. On m'avait demandé il y a quelques années de donner mon avis sur un bocal à Chinon, en fait c'était de la momie égyptienne... Il faut être prudent, dans ce cas l'analyse scientifique semble sérieuse mais si l'on peut prouver qu'une bague est bien du XVe siècle, il est plus difficile d'établir par quelles mains elle est passée.
Les rapports d'experts du Puy du Fou confirment que l'anneau semble bien dater du XVe siècle et qu'il aurait été plaqué or, ainsi qu'en attestent des traces de métal jaune » en plusieurs endroits. Le parc d'attraction identifiait initialement l'objet acheté aux enchères au bijou offert à Jeanne d'Arc par son frère, anneau que l'héroïne réclamait à l'évêque Cauchon lors du procès rouennais. Se ravisant, le président du Puy du Fou associe désormais le bien acquis en Grande-Bretagne à l'autre anneau de Jeanne d'Arc, cadeau de son père ou de sa mère, dont la description nous est parvenue par le biais des questions insistantes que les juges rouennais posaient à la Pucelle. Celle-ci affirmait, lors de son procès, que l'objet était détenu par les Bourguignons, vraisemblablement à la suite de sa capture à Compiègne en mai 1430. Nicolas de Villiers conjecture que les sujets du duc de Bourgogne auraient vendu simultanément l'héroïne et son anneau aux Anglais, nonobstant les affirmations de Jeanne d'Arc elle-même à ce sujet.
Outre cette contradiction, le dossier d'archives obtenu par le parc d'attraction ne permet pas d'établir le suivi de la transmission du bijou puisque ces documents évoquent uniquement ses propriétaires présumés, presumed owners. De surcroît, ce même dossier indique que l'anneau a été agrandi et modifié vraisemblablement au XIXe ou XXe siècle. Les historiens médiévistes Olivier Bouzy et Philippe Contamine soulignent que ces multiples incertitudes ne permettent pas de trancher quant à l'authenticité ou non de l'objet.
Lors d'une cérémonie d'hommage au Puy du Fou le 20 mars 2016, Philippe de Villiers proclame que l’Arts Council England, conseil national des Arts se réservait la possibilité de préempter, pour le compte de l'État britannique, l'anneau. L'organisme en question est chargé, entre autres, de gérer les autorisations d'exportation d'objets d'arts en Grande-Bretagne pour le compte du gouvernement britannique. Tout objet d'art bijoux inclus dont la valeur dépasse une certaine somme ne peut être exporté que muni d'une autorisation d'exportation, procédure non accomplie par le Puy du Fou. En conséquence, l’Arts Council England demande simultanément le retour de l'anneau sur le territoire britannique et au propriétaire de se mettre en règle. Il n'existe pas en Grande-Bretagne de droit de préemption de l'État dans les ventes aux enchères.
Reliques
Jeanne au bûcher
Hermann Anton Stilke.
De prétendues reliques de Jeanne d'Arc sont conservées au musée d'art et d'histoire de Chinon. Propriété de l'archevêché de Tours, elles ont été mises en dépôt dans ce musée en 1963. Le bocal de verre qui les contient a été découvert à Paris en 1867 dans le grenier d'une pharmacie, située rue du Temple, par un étudiant en pharmacie, M. Noblet. Le parchemin qui fermait l'ouverture du bocal portait la mention : Restes trouvés sous le bûcher de Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans.
Le bocal contient une côte humaine de dix centimètres de long recouverte d'une couche noirâtre, un morceau de tissu de lin d'une quinzaine de centimètres de longueur, un fémur de chat et des fragments de charbons de bois.
Le médecin-légiste français Philippe Charlier, spécialiste de pathographie, qui a analysé les restes à partir de février 2006 avec son équipe de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches Hauts-de-Seine, conclut qu'il s'agit de restes de momies, à la fois momie humaine et momie animale, d'origine égyptienne datés de la Basse époque et qui auraient pu faire partie soit de la collection d'un cabinet d'amateur soit de la pharmacopée d'un apothicaire, avant d'être employés à la confection de ces pseudo-reliques.
Une analyse microscopique et chimique du fragment de côte montre qu'il n'a pas été brûlé, mais imprégné d'un produit végétal et minéral de couleur noire. Sa composition s'apparente plus à celle du bitume ou de la poix qu'à celle de résidus organiques d'origine humaine ou animale ayant été réduits à l'état de charbon par crémation.
Les nez de grands parfumeurs Guerlain et Jean Patou ont notamment décelé sur le morceau de côte une odeur de vanille. Or ce parfum peut être produit par la décomposition d'un corps, comme dans le cas d'une momification, pas par sa crémation.
Le tissu de lin, quant à lui, n'a pas été brûlé, mais teint et a les caractéristiques de celui utilisé par les Égyptiens pour envelopper les momies.
D'autre part, concernant le pollen, il a été noté une grande richesse de pollens de pin, vraisemblablement en rapport avec l'usage de résine en Égypte au cours de l'embaumement.
Enfin, une étude au carbone 14 a daté les restes entre le vie et le IIIe siècle av. J.-C., et un examen spectrométrique du revêtement à la surface des os a montré qu'il correspondait à ceux de momies égyptiennes de cette période tardive.
Œuvres inspirées par Jeanne d'Arc
L'Inspiration et la Vision de Jeanne d'Arc
Louis-Maurice Boutet de Monvel 1911.
Les œuvres inspirées par la Pucelle sont innombrables dans tous les domaines des arts et des médias : architecture, bande dessinée, chansons, cinéma, radio et télévision, jeux vidéo, littérature poésie, roman, théâtre, musique notamment opéras et oratorios, peinture, sculpture, tapisserie, vitrail, etc.
Œuvres inspirées par Jeanne d'Arc. Œuvres littéraires
Le personnage, dans son ambivalence et sa grande complexité, a fasciné les écrivains et les dramaturges à travers les époques.
Charles Péguy en fit la figure centrale de son œuvre écrite. Jeanne d'Arc, bataillant à la réalisation sur terre de la cité harmonieuse, et incarnant en plus du salut, l'âme paysanne et pieuse de la France. Plusieurs volumes sont consacrés à des périodes distinctes de son existence. D'abord un drame, en trois actes, puis une épopée en trois parties distinctes publiée dans les cahiers de la Quinzaine. Enfin, la fresque des trois mystères, débutée par "le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc".
Les pièces les plus connues qui offrent une large diversité d'interprétation sur sa vie, ont été écrites par Shakespeare Henri VI, Voltaire La Pucelle d'Orléans, Schiller La Pucelle d'Orléans, George Bernard Shaw Sainte Jeanne, Jean Anouilh L'Alouette et Bertolt Brecht Sainte Jeanne des abattoirs. En 1894, Thérèse de Lisieux écrit une pièce de théâtre inspirée par la Pucelle d'Orléans, dont elle interprète aussi le rôle.
Samuel Clemens a écrit une biographie de fiction sous le nom de plume de Sieur Louis de Conte, sans utiliser son pseudonyme de Mark Twain. Thomas de Quincey, qui est l'un des seuls Anglais à prendre la défense de Jeanne d'Arc, a écrit une Jeanne d'Arc en 1847. Louis-Maurice Boutet de Monvel en fit un livre d'illustration pour enfants en 1896 qui connut un grand succès.
Adaptations à l'écran
Jeanne d'Arc Joan the Woman de Cecil B. De Mille, 1916.
Jeanne d'Arc a inspiré près d'une centaine de films et téléfilms :
Cinéma muet
1898 : Jeanne d'Arc, court métrage muet de Georges Hatot.
1899 : Domrémy, court métrage des Frères Lumière.
1899 : Jeanne d'Arc, court métrage muet de Georges Méliès, avec Bleuette Bernon.
1909 : La Vie de Jeanne d'Arc d'Albert Capellani.
1913, Italie : Giovanna d'Arco d'Ubaldo Maria Del Colle et Nino Oxilia, tourné à Turin.
1916, États-Unis : Jeanne d'Arc Joan the Woman de Cecil B. De Mille, avec Geraldine Farrar - Ce film fut conçu pour convaincre les Américains du bien-fondé de leur intervention aux côtés des alliés dans la Grande Guerre.
1928 : La Passion de Jeanne d'Arc, de Carl Theodor Dreyer, avec Renée Falconetti - Inspiré du roman Jeanne d'Arc de Joseph Delteil.
1929 : La Merveilleuse Vie de Jeanne d'Arc, fille de Lorraine, de Marco de Gastyne, avec Simone Genevois
Cinéma parlant
1935, Allemagne : Das Mädchen Johanna, de Gustav Ucicky, avec Angela Salloker.
1948, États-Unis : Jeanne d'Arc Joan of Arc, de Victor Fleming, avec Ingrid Bergman.
1953 : Destinées, film à sketches - séquence réalisée par Jean Delannoy, avec Michèle Morgan
1954, Italie : Jeanne au bûcher Giovanna d'Arco al rogo, de Roberto Rossellini, avec Ingrid Bergman qui reprend donc le rôle qu'elle avait déjà tenu en 1948
1957, États-Unis : Sainte Jeanne Saint Joan, d'Otto Preminger, avec Jean Seberg, d'après la pièce Sainte Jeanne de George Bernard Shaw 1924.
1962 : Procès de Jeanne d'Arc, de Robert Bresson, avec Florence Delay. Les mots de Jeanne sont scrupuleusement tirés des minutes du procès.
1970, Russie : Le Début de Gleb Panfilov avec Inna Tchourikova.
1989 : Jeanne d'Arc, le pouvoir de l'innocence, téléfilm en 3 parties de Pierre Badel d'après le livre de Pierre Moinot, avec Cécile Magnet.
1994 : Jeanne la Pucelle, de Jacques Rivette, avec Sandrine Bonnaire - film divisé en deux époques : les Batailles et les Prisons sur plus de 5 heures et demie.
1999 : Jeanne d'Arc, de Luc Besson, avec Milla Jovovich.
1999 : Jeanne d'Arc, film-TV de Christian Duguay, avec Leelee Sobieski.
2011 : Jeanne captive, de Philippe Ramos avec Clémence Poésy.
Philatélie
En 1929, un timbre de 50 centimes bleu est émis à l'occasion du 5e centenaire de la délivrance d'Orléans. Jeanne y est représentée à cheval.
En 1946, un timbre de 5 f surtaxé 4 f outremer appartient à la série Célébrités du XVe siècle. Ce timbre grand format est un portrait.
En 1968, sur un timbre de 30 centimes surtaxé 10 centimes, brun et violet, elle est représentée pour illustrer l'œuvre de Paul Claudel Jeanne d'Arc au bûcher, sujet principal dont on célébrait le centenaire de sa naissance.
La même année, la poste en fait le sujet principal dans un timbre à 60 centimes, gris-bleu, bleu et brun pour représenter le départ de Vaucouleurs en 1429. Ce timbre fait partie de la série Grands noms de l'Histoire.
Astronomie
L'astéroïde Johanna a été nommé en son honneur.
Botanique
La rose Jeanne d'Arc obtenteur Vibert
        
Posté le : 05/05/2016 21:26
Edité par Loriane sur 07-05-2016 15:29:53
Edité par Loriane sur 07-05-2016 15:31:45
|
|
|
|
|
Jeanne d' Arc boute les anglais 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Jeanne d'Arc, son procès le 15 mars 1431 Condamnation, exécution
Le 24 mai, au cimetière Saint-Ouen de Rouen, les juges mettent en scène un simulacre de bûcher pour effrayer Jeanne et la presser de reconnaître ses fautes. Jeanne, sous la promesse orale donc invérifiable du tribunal de l'incarcérer dans une prison ecclésiastique, signe d'une croix alors qu'elle savait écrire son nom l'abjuration de ses erreurs, reconnaissant avoir menti à propos des voix et se soumet à l'autorité de l'Église. Elle est alors renvoyée dans sa prison aux mains des Anglais. S'estimant trompée, elle se rétracte deux jours plus tard, endosse de nouveau des habits d'homme dans des conditions obscures.
Le tribunal la déclare relapse retombée dans ses erreurs passées, la condamne au bûcher et la livre au bras séculier. Le 30 mai 1431, après s'être confessée et avoir communié, Jeanne en tunique de toile soufrée est conduite vers neuf heures, sous escorte anglaise, dans la charrette du bourreau Geoffroy Thérage, place du Vieux-Marché à Rouen où l'on a dressé trois estrades : la première, pour le cardinal Winchester et ses invités, la seconde pour les membres du tribunal civil représenté par le bailli de Rouen Raoul le Bouteiller ; la troisième, pour Jeanne et le prédicateur Nicolas Midi, docteur en théologie. Après le prêche et la lecture de sa sentence, les soldats la conduisent au bûcher dressé en hauteur sur une estrade plâtrée pour qu'elle soit bien vue.
Le supplice de Jeanne suscite de nombreux témoignages de mythographes comme celui du chevalier Perceval de Caigny qui prétendent que sur le bûcher, un écriteau décrivant ses péchés masquait Jeanne, ou que Jeanne était coiffée de la mitre d'infamie qui dissimulait son visage. Ces témoignages donnent naissance quelques années plus tard à la légende survivantiste selon laquelle Jeanne aurait survécu au bûcher grâce à la substitution d'une autre condamnée.
Le cardinal de Winchester avait insisté pour qu'il ne reste rien de son corps. Il désirait éviter tout culte posthume de la pucelle. Il avait donc ordonné trois crémations successives. La première vit mourir Jeanne d'Arc par intoxication par les gaz toxiques issus de la combustion, dont notamment le monoxyde de carbone. Le bourreau écarta les fagots, à la demande des Anglais qui craignaient qu’on ne dise qu’elle s’était évadée, pour que le public puisse voir que le cadavre déshabillé par les flammes était bien celui de Jeanne. La seconde dura plusieurs heures et fit exploser la boîte crânienne et la cavité abdominale dont les morceaux furent projetés sur le public en contrebas, laissant au centre du bûcher les organes calcinés à l'exception des entrailles et du cœur organes plus humides brûlant moins vite restés intacts. Pour la troisième, le bourreau ajouta de l'huile et de la poix et il ne resta que des cendres et des débris osseux qui furent dispersés à quinze heures par Geoffroy Thérage dans la Seine non pas à l'emplacement de l'actuel pont Jeanne d'Arc, mais du pont Mathilde, jadis situé près de l'emplacement de l'actuel pont Boieldieu afin qu'on ne puisse pas en faire de reliques ou des actes de sorcellerie.
Procès en nullité de la condamnation
Peu après qu'il eut repris Rouen, Charles VII publia, le 15 février 1450, une ordonnance où il était dit que les ennemis de Jeanne l'ayant fait mourir contre raison et très cruellement, il voulait savoir la vérité sur cette affaire. Mais il fallut attendre que Calixte III succédât à Nicolas V pour qu'un rescrit papal ordonnât enfin, en 1455 et sur la demande de la mère de Jeanne, la révision du procès. Le pape avait ordonné à Thomas Basin, évêque de Lisieux et conseiller de Charles VII, d'étudier en profondeur les actes du procès de Jeanne d'Arc. Son mémoire fut la condition juridique du procès en réhabilitation. Celui-ci aboutit à casser le premier jugement pour corruption, dol, calomnie, fraude et malice grâce au travail de Jean Bréhal, qui enregistra les dépositions de nombreux contemporains de Jeanne, dont les notaires du premier procès et certains juges. Le jugement, prononcé le 7 juillet 1456, déclare le premier procès et ses conclusions nuls, non avenus, sans valeur ni effet et réhabilite entièrement Jeanne et sa famille. Il ordonne également l'apposition d'une croix honnête pour la perpétuelle mémoire de la défunte au lieu même où Jeanne est morte. La plupart des juges du premier procès, dont l'évêque Cauchon, sont morts entre-temps. Aubert d'Ourches, ancien compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, comparait à Toul comme vingt-huitième témoin, voici sa déposition du 14 février 1456 lors de la neuvième séance : La Pucelle me parut être imbue des meilleures mœurs. Je voudrais bien avoir une fille aussi bonne… Elle parlait moult bien.
Jeanne d'Arc et son époque : enjeux et problèmes
Statue de Jeanne d'Arc à Paris : le modèle de la femme guerrière s'inspire du De mulieribus claris de Boccace
Problèmes des sources historiques
Les deux sources principales sur l'histoire de Jeanne d'Arc sont le procès de la condamnation de 1431, et le procès en nullité de la condamnation de 1455-1456. Le procès-verbal, l’instrumentum publicum, est rédigé quelques années plus tard sous le contrôle du principal greffier Guillaume Manchon par Thomas de Courcelles59. Étant des actes juridiques, elles ont l'immense avantage d'être les retranscriptions les plus fidèles des dépositions. Mais elles ne sont pas les seules : des notices, des chroniques ont également été rédigées de son vivant, telle que la Geste des nobles François, la Chronique de la Pucelle, la Chronique de Perceval de Cagny, la Chronique de Monstrelet ou encore le Journal du siège d'Orléans et du voyage de Reims, le Ditié de Jeanne d'Arc de Christine de Pizan, le traité de Jean de Gerson. Il faut ajouter également les rapports des diplomates et autres informateurs écrits de Jacques Gelu à Charles VII, registres du greffier du Parlement de Paris Clément de Fauquembergue. C'est Jules Quicherat qui rassemblera de manière quasi exhaustive, en cinq volumes, l'historiographie johannique entre 1841 et 1849. Entre le XVe siècle et le XIXe siècle, une foule d'écrivains, de politiciens, de religieux se sont approprié Jeanne d'Arc, et leurs écrits sont nombreux. Il faut donc être prudent dans la manipulation des sources : peu lui sont contemporaines et elles réinterprètent souvent les sources originelles dans le contexte de leur interprète.
Les procès sont des actes juridiques. Les deux procès ont la particularité d'avoir subi une influence politique évidente, et la méthode inquisitoire suppose bien souvent que l'accusée et les témoins ne répondent qu'aux questions posées. De plus le procès de 1431 fut retranscrit en latin vraisemblablement à l'insu de Jeanne, alors que les interrogatoires étaient en français.
Philippe Contamine, au cours de ses recherches, a constaté une abondance d'écrits dès 1429, et le formidable retentissement au niveau international dont cette abondance témoigne. Il remarque également que Jeanne d'Arc fut d'emblée mise en controverse et suscita le débat parmi ses contemporains. Enfin, dès le début des légendes coururent à son sujet, concernant son enfance, ses prophéties, sa mission, les miracles ou les prodiges dont elle était l'auteur. Au commencement était le mythe.
Il apparaît donc qu'aucun document contemporain de l'époque — hormis les minutes des procès — n'est à l'abri de déformation issue de l'imaginaire collectif. Au cours du procès de réhabilitation, les témoins racontent d'après des souvenirs vieux de 26 ans.
Aucune source ne permet de déterminer exactement les origines de Jeanne d'Arc, ni ses dates et lieu de naissance : les témoignages d'époque sont imprécis, Domrémy ne possédait pas de registre paroissial, et les discussions restent nombreuses sur ces points, néanmoins sa biographie peut s'établir à partir des réponses de Jeanne d'Arc aux questions des juges à son premier procès de condamnation sur son éducation religieuse et ses occupations ainsi que les souvenirs des habitants de Domrémy qui veulent convaincre les juges du procès en réhabilitation de sa piété et sa bonne renommée.
L'anoblissement accordé à Jeanne d'Arc par le roi Charles VII pose un autre problème. Il ne reste en effet aucune charte originale pour l'attester, mais uniquement des documents attestant de cet anoblissement rédigés postérieurement. Ces documents dont nous ne savons s'ils sont faux ou déforment une partie de la vérité historique font apparaître que Jeanne d'Arc avait été anoblie par Charles VII et avec elle ses parents, comme il était d'usage pour asseoir la filiation nobiliaire sans contestation, et par conséquent la filiation présente et à venir de ses frères et sœur. En 1614, la descendance fort nombreuse de la famille d'Arc montra qu'elle s'établissait uniquement vers la roture, et le roi leur retira leur titre de noblesse. Par ailleurs, le trésor y gagna en nombreuses pensions, car chaque membre de la lignée pouvait prétendre à indemnisation de la part du trésor pour le sacrifice de Jeanne d'Arc.
Une des copies de la charte d'anoblissement qui nous est parvenue dit que le roi Charles VII la fit Jeanne dame du Lys, sans lui concéder un pouce de terre, ni à elle ni à ses frères et sœur, ce qui était contraire à l'usage de l'anoblissement, car le titre visait à asseoir la propriété de façon héréditaire. En d'autres termes, la faisant dame du Lys, le roi Charles VII la liait au royaume et à la nation mais puisqu'elle s'était vouée à la chasteté et à la pauvreté, il ne lui allouait aucun bénéfice terrestre, ce qui privait du même coup sa parentèle de la possibilité d'user convenablement de cet anoblissement puisqu'elle demeurait sans possibilité de s'élever dans la société nobiliaire. Les d'Arc restèrent des roturiers par la force des choses.
Lettres d'anoblissement accordées à Jehanne la Pucelle et à sa famille
Jeanne d'Arc et ses contemporains
Jeanne d'Arc fut très populaire de son vivant, la chevauchée vers Reims la fait connaître également à l'étranger. Le caractère exceptionnel de son épopée nourrit d'innombrables rumeurs en France, et même au-delà. Elle commence à recevoir des courriers sur des questionnements théologiques venant de nombreuses contrées. On lui demandera son avis sur lequel des papes, alors en concurrence, est le vrai. Jeanne se rapproche des ordres mendiants. Elle était une des nombreux prédicateurs en cette époque se disant directement envoyés de Dieu. Même si l'objet principal de sa mission est la restauration du trône de France, la Pucelle prend parti de fait sur le plan théologique et fait débat. Les conflits d'intérêts autour d'elle dépassent la rivalité politique entre les Anglais et les partisans du dauphin.
Ainsi l'université de Paris, qui était remplie des créatures du roi d'Angleterre ne la voit pas d'un bon œil, à l'opposé des théologiens de Poitiers, composée des universitaires parisiens exilés par les Anglais, et également à l'inverse de l'archevêque d'Embrun, des évêques de Poitiers et de Maguelonne, Jean de Gerson auparavant chancelier de l'université de Paris, l'Inquisiteur général de Toulouse, ou encore l'Inquisiteur Jean Dupuy qui ne voyait que comme enjeux à savoir la restitution du roi à son royaume et l'expulsion ou l'écrasement très juste d'ennemis très obstinés. Ces gens d'Église, et autres, soutenaient la Pucelle.
Pour l'éminente autorité religieuse qu'était alors la Sorbonne, le comportement religieux de Jeanne dépasse l'enjeu de reconquête du royaume, et les docteurs en théologie de cette institution la considèrent comme une menace contre leur autorité, notamment à cause du soutien des rivaux de l'université à Jeanne, et pour ce qu'elle représente dans les luttes d'influence à l'intérieur de l'Église.
Jeanne n'a pas eu non plus que des amis à la Cour du Dauphin. Au Conseil du Dauphin, le parti du favori – La Trémouille – dont était Gilles de Rais s'opposa régulièrement à ses initiatives. Cependant, de nombreux clercs du roi, notamment son confesseur Jean Girard, soutinrent la jeune fille, notamment après la prise d'Orléans, jusqu'à commander à l'archevêque d'Embrun, Jacques Gélu, une défense argumentée de Jeanne d'Arc.
Son rôle dans la guerre de Cent Ans
Jeanne d'Arc, à elle seule, n'a pas influé sur la phase finale de la guerre, qui s'est achevée en 1453. Elle n'a pas été non plus inexistante dans le rôle tactique et stratégique de sa campagne : Dunois parle d'une personne douée d'un bon sens indéniable et tout à fait capable de placer aux points clés les pièces d'artillerie de l'époque. Les faits d'armes sont donc à porter à son crédit. Elle fut en outre un chef indéniablement charismatique.
Sur le plan géopolitique, le royaume de France, privé de tout ce qui était situé au nord de la Loire et à l'ouest de l'Anjou-Auvergne, bénéficiait de ressources humaines et matérielles à peu près identiques à celles de l'Angleterre, proprement dite, qui était moins peuplée. Mais l'Angleterre tirait de ses possessions selon les Anglais de ses conquêtes selon les Français du Nord et de l'Ouest du royaume de France, des ressources en hommes et en impôts largement supérieures à celle du roi de Bourges, Charles VII. De plus, l'Angleterre était à l'aise pour mobiliser ses ressources continentales, car les Anglais connaissaient parfaitement tout le Grand Ouest de la France, lequel était leur domaine avant confiscation par Philippe Auguste un siècle plus tôt. Les Anglais n'ont jamais eu de difficulté pour lever des troupes et des fonds. La tactique de Charles V et de Du Guesclin, qui misaient sur le temps, en évitant les combats frontaux, et en assiégeant une par une les places fortes, tactique que Charles VII a adoptée faute de moyens, a parfaitement montré son efficacité. Cette tactique avait déjà montré les limites de l'invasion anglaise sous Charles V. Charles VII, avec l'appui de Jeanne, puis, après, des frères Gaspard et Jean Bureau, en a confirmé l'efficacité.
Cependant, avant l'intervention de Jeanne d'Arc, les Anglais bénéficiaient d'un avantage psychologique extrêmement important lié à plusieurs raisons :
la réputation d'invincibilité de leurs troupes ;
le traité de Troyes qui déshéritait le dauphin Charles et mettait en doute sa filiation à l'égard du roi Charles VI ;
un état d'abattement et de résignation de la population ;
l'alliance avec la Bourgogne.
L'avantage numérique du royaume de France pesait peu. Cette situation faisait qu'en 1429 la dynamique était anglaise.
Jeanne a eu indéniablement le mérite d'inverser l'ascendant psychologique en faveur de la France, en remontant le moral des armées et des populations, en légitimant et sacrant le roi, et en montrant que la réputation d'invincibilité des Anglais était fausse. Charles VII a eu, lui, l'initiative de se raccommoder avec les Bourguignons, étape indispensable pour la reconquête de Paris. Jeanne d'Arc visiblement ne portait pas les Bourguignons dans son cœur à cause de leur proximité avec son village de Domrémy et des heurts qu'il avait pu y avoir.
Le pape Pie II évoqua Jeanne d'Arc en ces termes :
… Ainsi mourut Jeanne, l'admirable, la stupéfiante Vierge. C'est elle qui releva le royaume des Français abattu et presque désespéré, elle qui infligea aux Anglais tant et de si grandes défaites. À la tête des guerriers, elle garda au milieu des armées une pureté sans tache, sans que le moindre soupçon ait jamais effleuré sa vertu. Était-ce œuvre divine ? était-ce stratagème humain ? Il me serait difficile de l'affirmer. Quelques-uns pensent, que durant les prospérités des Anglais, les grands de France étant divisés entre eux, sans vouloir accepter la conduite de l'un des leurs, l'un d'eux mieux avisé aura imaginé cet artifice, de produire une Vierge divinement envoyée, et à ce titre réclamant la conduite des affaires ; il n'est pas un homme qui n'accepte d'avoir Dieu pour chef ; c'est ainsi que la direction de la guerre et le commandement militaire ont été remis à la Pucelle. Ce qui est de toute notoriété, c'est que, sous le commandement de la Pucelle, le siège d'Orléans a été levé ; c'est que par ses armes a été soumis tout le pays entre Bourges et Paris ; c'est que, par son conseil, les habitants de Reims sont revenus à l'obéissance et le couronnement s'est effectué parmi eux ; c'est que, par l'impétuosité de son attaque, Talbot a été mis en fuite et son armée taillée en pièces ; par son audace le feu a été mis à une porte de Paris ; par sa pénétration et son habileté les affaires des Français ont été solidement reconstituées. Événements dignes de mémoire, encore que, dans la postérité, ils doivent exciter plus d'admiration qu'ils ne trouveront de créance.
Mémoires du pape Pie II, traduites et citées par Quicherat
L'enjeu de sa virginité
Si pucelle signifiait à l'époque simplement fille et pas particulièrement vierge, Jeanne mettait aussi en avant sa virginité pour prouver, selon les mœurs de son temps, qu'elle était envoyée de Dieu et non une sorcière et affirmer clairement sa pureté, aussi bien physiquement que dans ses intentions religieuses et politiques.
Si vous connaissez le sujet dont traite l'article, merci de le reprendre à partir de sources pertinentes en utilisant notamment les notes de fin de page. Vous pouvez également laisser un mot d'explication en page de discussion.
L'opinion de cette époque était en effet formée à ces miracles où la Vierge et les saints venaient délivrer les prisonniers ou sauver des royaumes, comme le prophétisaient Merlin, Brigitte de Suède ou la recluse d'Avignon66. Dès lors vérifier sa virginité devient un enjeu important, étant donné l'importance politique des projets de Jeanne : restaurer la légitimité du roi Charles VII et l'amener au sacre.
Par deux fois, la virginité de Jeanne fut constatée par des matrones, à Poitiers en mars 1429, mais aussi à Rouen, le 13 janvier 1431. Pierre Cauchon celui-là même qui la fit brûler avait ordonné ce deuxième examen pour trouver un chef d'accusation contre elle, en vain.
Il est en revanche difficile de savoir ce qui s'est passé entre le jugement et le constat de relapse, période où Jeanne a été durement maltraitée, défigurée, par ses geôliers. Selon Martin Ladvenu, un lord anglais aurait essayé de la forcer dans sa prison, en vain.
Les autres pucelles
Jeanne des Armoises et Jeanne de Sermaises
On trouve une représentation de Jeanne d'Arc portant armure et coupe en sébile 1937 dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.
Plusieurs femmes se présentèrent comme étant Jeanne d'Arc affirmant avoir échappé aux flammes. Pour la plupart, leur imposture fut rapidement décelée, mais deux d'entre elles parvinrent à convaincre leurs contemporains qu'elles étaient réellement Jeanne d'Arc : il s'agit de Jeanne des Armoises et de Jeanne de Sermaises.
D'après une source tardive (trouvée en 1645 à Metz par un prêtre de l'oratoire le père Jérôme Viguier et publiée en 1683 par son frère Benjamin Viguier, La Chronique du doyen de Saint-Thiébaud, Claude, dite Jeanne des Armoises apparut pour la première fois le 20 mai 1436 à Metz où elle rencontra les deux frères de Jeanne d'Arc, qui la reconnurent pour leur sœur. Il semble impossible d'affirmer s'ils crurent vraiment qu'elle fut leur sœur ou non. La belle-sœur de son mari Alarde de Chamblay devenue veuve s'était remariée en 1425 avec Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs. Claude-Jeanne guerroya avec les frères d'Arc et Dunois dans le sud-ouest de la France et en Espagne. En juillet 1439, elle passa par Orléans, les comptes de la ville mentionnent pour le 1er août : À Jehanne d'Armoise pour don à elle fait, par délibération faite avec le conseil de ville et pour le bien qu'elle a fait à ladite ville pendant le siège IICX lp, soit 210 livres parisis. Elle mourut vers 1446 sans descendance.
En 1456, après la réhabilitation de la Pucelle, Jeanne de Sermaises apparut en Anjou. Elle fut accusée de s'être fait appeler la Pucelle d'Orléans, d'avoir porté des vêtements d'homme. Elle fut emprisonnée jusqu'en février 1458, et libérée à la condition qu'elle s'habillerait honnêtement. Elle disparaît des sources après cette date.
Les consœurs
Jeanne d'Arc n'est pas un cas unique, bien qu'on fasse à l'époque plus confiance à des enfants ayant des visions qu'à des hommes ou femmes prophètes les prophétesses sont des mulierculae, petites bonnes femmes dans le traité De probatione spirituum de 1415 de Jean de Gerson, théologien qui déconsidère notamment Brigitte de Suède ou Catherine de Sienne et met au point des procédures d'authentification des vraies prophétesses car désormais seule l'Église a le jugement d'autorité en matière de visions, apparitions et prophéties. En 1391, l'université de la Sorbonne et en 1413 l'université de Paris publient une affiche appelant à tous ceux qui ont des visions et se croyant appelés à sauver la France à leur communiquer leurs prophéties, les vrais prophètes selon les critères de l'époque devant être humbles, discrets, patients, charitables et avoir l'amour de Dieu. Le Journal d'un bourgeois de Paris rapporte un sermon entendu le 4 juillet 1431 faisant référence à trois autres femmes :
Encore dist il en son sermon qu'ilz estoient IIII, dont les III avoit esté prinses, c'est assavoir ceste Pucelle, et Perronne et sa compaigne, et une qui est avec les Arminalx Armagnacs, nommée Katherine de La Rochelle ; … et disoit que toutes ces quatre pouvres femme frère Richart le cordelier … les avoit toute ainsi gouvernées ; … et que le jour de Noel, en la ville de Jarguiau Jargeau, il bailla à ceste dame Jehanne la Pucelle trois foys le corps de Nostre Seigneur … ; et l'avoit baillé à Peronne, celui jour, deux fois …
De ces trois autres femmes, le même Bourgeois de Paris relate l'exécution de Piéronne, qui estoit de Bretaigne bretonnant et fut brûlée sur le parvis de Notre-Dame le 3 septembre 1430. Et s'il ne la nomme pas, le Formicarium du frère Jean Nider semble décrire la même exécution.
Interrogée au sujet de Katherine de La Rochelle lors de son procès, Jeanne d'Arc déclara l'avoir rencontrée et lui avoir répondu qu'elle retournât à son mari, faire son ménage et nourrir ses enfants. Elle ajouta : Et pour en savoir la certitude, j'en parlai à sainte Marguerite ou sainte Catherine, qui me dirent que du fait de cette Catherine n'était que folie, et que c'était tout néant. J'écrivis à mon Roi que je lui dirais ce qu'il en devait faire ; et quand je vins à lui, je lui dis que c'était folie et tout néant du fait de Catherine. Toutefois frère Richard voulait qu'on la mît en œuvre. Et ont été très mal contents de moi frère Richard et ladite Catherine.
Avec l'essor de l'astronomie et de la futurologie à la fin du Moyen Âge, les cours à cette époque aimaient s'entourer de ces prophètes, parfois pour les instrumentaliser à des fins politiques. Ainsi, une bataille autour des prophètes eut lieu notamment entre les Anglais et les Français, chaque camp fabriquant de fausses prophéties.
Sa reconnaissance
Reconnaissance littéraire et politique Mythes de Jeanne d'Arc.
Le culte de son vivant ayant rapidement décliné, les siècles suivants ne lui portent qu'un intérêt inconstant. C'est principalement à partir du xixe siècle que la figure historique de Jeanne d'Arc a été reprise par de nombreux auteurs pour illustrer ou cristalliser des messages religieux, philosophiques ou politiques.
Christine de Pisan est un des rares auteurs contemporains à avoir fait l'éloge de Jeanne d'Arc, la nouvelle Judith. Villon mentionne en deux vers, parmi les Dames du temps jadis, Jeanne la bonne Lorraine / Qu'Anglois brûlèrent à Rouen . Avant le XIXe siècle, l'image de Jeanne d'Arc est défigurée par la littérature. Seule la notice d'Edmond Richer, surtout prolifique sur le plan théologique, apporte un volet historique cependant entaché d'inexactitudes. Chapelain, poète officiel de Louis XIV, lui consacre une épopée malheureusement très médiocre sur le plan littéraire. Voltaire ne consacre qu'un vers et demi à la gloire de Jeanne d'Arc dans son Henriade, chant VII «… Et vous, brave amazone, La honte des Anglais, et le soutien du trône. et en consacra plus de vingt mille à la déshonorer. La figure de Jeanne d'Arc connaît son âge d'or sous la Restauration des Bourbon.
Depuis le XIXe siècle, les exploits de Jeanne d'Arc sont usurpés pour servir certains desseins politiques au mépris de l'histoire. Les arcanes de cette exploitation d'une héroïne qui symbolise la France de façon mythique, voire mystique sont innombrables. On retint surtout les thèses évoquées lors de son procès : la mandragore suggérée par Cauchon, l’instrument politique destiné à jeter la terreur dans les troupes anglaises, et la si romanesque main de Dieu qu’on y voit de l’hérésie ou des desseins monarchiques.
Jeanne d'Arc a été réhabilitée en 1817, dans le livre de Philippe-Alexandre Le Brun de Charmettes : Histoire de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans, tirée de ses propres déclarations, de cent quarante-quatre dépositions de témoins oculaires, et des manuscrits de la bibliothèque du roi de la tour de Londres. Le travail scrupuleux de cet historien, fondé sur des enquêtes rigoureuses, et l'étude de documents originaux, a souvent été réutilisé comme base de travail par des écrivains français et étrangers, tels Jules Quicherat ou Joseph Fabre, qui ont contribué à redonner ses titres de noblesse à la Pucelle d'Orléans.
Les enjeux politiques et religieux du XIXe siècle expliquent l'émergence de thèses révisionnistes : la théorie surviviste ou survivaliste se développe avec l'ouvrage en 1889 La Fin d'une légende, vie de Jeanne d'Arc de 1409 à 1440 d'Ernest Lesigne alléguant que Jeanne fut sauvée du bûcher par substitution avec une autre femme et devenue Jeanne des Armoises. Cette théorie est reprise par des auteurs laïcs comme Gaston Save qui cherchent à minimiser le rôle de Jeanne d'Arc et enrayer son processus de canonisation. La théorie bâtardisante apparaît sur le plan littéraire pour la première fois en 1805 naît avec Pierre Caze qui écrit la pièce de théâtre La Mort de Jeanne d'Arc : la Pucelle y serait une bâtarde royale mise en scène à dessein, et dont la mère aurait été Isabeau de Bavière et le père Louis d'Orléans. Dans son livre La vérité sur Jeanne d'Arc en 1819, Caze développe cette théorie qui est généralement relayée par des monarchistes comme Jean Jacoby Le secret de Jeanne, pucelle d'Orléans en 1932 pour qui le peuple ne serait pas en mesure de donner naissance à des héros. La théorie « survivo-bâtardisante fusionne les deux précédentes en faisant de Jeanne une princesse royale qui a échappé au bûcher et survécu sous le nom de Jeanne des Armoises. Lancée par Jean Grimod Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée, 1952, elle est reprise par des auteurs comme Maurice David-Darnac, Étienne Weill-Raynal, Robert Ambelain, André Cherpillod Les deux mystères de Jeanne "d'Arc": sa naissance, sa mort, 1992 ou Marcel Gay et Roger Senzig L'affaire Jeanne d'Arc, 2007.
Reconnaissance par l'Église catholique Canonisation
La délégation pour la canonisation de Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc est béatifiée le 18 avril 190978 et canonisée le 16 mai 1920. Sa fête religieuse est fixée au 30 mai, jour anniversaire de son martyre. Pie XI la proclame sainte patronne secondaire de la France en 1922.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... hp?topic_id=4583&forum=24
Posté le : 05/05/2016 20:29
|
|
|
|
|
Jeanne D'Arc boute les anglais 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Contexte politique du royaume de France 1407-1429
1429
Territoires contrôlés par Henri VI d'Angleterre
Territoires contrôlés par le duc de Bourgogne
Territoires contrôlés par le dauphin Charles
Principales batailles
Raid anglais de 1415
Itinéraire de Jeanne d'Arc vers Reims en 1429
Sujet à des crises intermittentes de maladie mentale suivies de phases de rémissions, le roi de France Charles VI, dit le Fol, se voit fréquemment contraint de délaisser le pouvoir au profit de son Conseil, devenu bientôt le siège de sourdes luttes d'influences entre son frère Louis d'Orléans et son oncle Philippe de Bourgogne, dit Philippe le Hardi.
L'affrontement entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne s'intensifie lorsque Jean sans Peur, fils de Philippe le Hardi, succède à son père. Le nouveau duc de Bourgogne finit par faire assassiner son rival et cousin Louis d'Orléans en novembre 1407, acte déclencheur d'une guerre civile entre les Bourguignons et les Orléans. Ces derniers sont ultérieurement appelés Armagnacs en raison de l'engagement de Bernard VII d'Armagnac en faveur de son beau-fils Charles d'Orléans, fils et successeur du défunt duc Louis.
Profitant de ce conflit, Henri V, roi d'Angleterre relance les hostilités en brisant une longue trève franco-anglaise. La seconde phase de la Guerre de Cent Ans se caractérise donc par une guerre étrangère couplée à une guerre civile. Le monarque de la dynastie usurpatrice des Lancastre débarque en Normandie en 1415. La chevalerie française subit un désastre à Azincourt, face au Corps des Long Bow, archers gallois. En effet, les Anglais disposent d'un corps gallois ayant une maîtrise meurtrière de l'arc long longbow. Toujours bien abrités des charges de cavalerie par des pieux disposés à l'avance, ces gallois déciment sous une pluie de flèches la chevalerie française, dont les chevaux ne sont pas encore protégés. Ils vont ainsi devenir maîtres des batailles à terrain découvert malgré leur nette infériorité numérique. Mais après Orléans, Jeanne ayant obtenu des chefs militaires français — sur sa grande insistance — de poursuivre les troupes anglaises, le Corps des Long Bow est surpris faisant une pause à Patay et, inorganisés, quasiment tous ses archers sont massacrés par des charges de cavalerie. Le Corps ne sera pas reconstitué et sera totalement éliminé une décennie plus tard par l'apparition de l'artillerie nouvelle des frères Gaspard et Jean Bureau - notamment l'artillerie de campagne - aux batailles de Formigny et Castillon, avantages combinés qui mettront fin au conflit.
À Domrémy, on apprend que le duc Édouard III de Bar, son frère, Jean de Bar, seigneur de Puysaye et son petit-fils le comte de Marle, sont tombés au combat. Le duché échoit au frère survivant du duc défunt, Louis, évêque de Verdun, lequel est un temps contesté par le duc de Berg, gendre du feu duc.
Lors de l'entrevue de Montereau, le 10 septembre 1419, le dauphin Charles et Jean sans Peur doivent se réconcilier pour faire face à l'ennemi. Cependant, le duc de Bourgogne est poignardé au cours de cette rencontre, peut-être à l'instigation du dauphin lui-même et de certains de ses conseillers dont Tanneguy III du Chastel, entre autres motifs par vengeance de l'assassinat du duc Louis d'Orléans. En réaction à cet assassinat, le fils de Jean sans Peur et nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, se rallie aux Anglais, imité en cela par la puissante université de Paris.
Alliés au puissant duc de Bourgogne, les Anglais peuvent imposer en 1420 le traité de Troyes, signé entre le roi Henri V d'Angleterre et Isabeau de Bavière, reine de France et régente. Selon les termes de ce traité, Henri V se marie à Catherine de Valois, fille de Charles VI. À la mort de Charles VI, la couronne doit revenir à leur descendance, réunissant les deux royaumes.
Ce traité est contesté par la noblesse française car il spolie le Dauphin - stigmatisé en tant qu'assassin du duc de Bourgogne - de son droit à la succession. À la mort de Charles VI en 1422, la France n'a donc plus de roi ayant été sacré. La couronne de France est alors revendiquée par le roi d'Angleterre encore mineur, Henri VI qui vient de succéder à son père.
La situation territoriale devient alors la suivante : le Sud-Ouest du territoire français est contrôlé par les Anglais de même que la plupart des régions du Nord, excepté le duché de Bretagne, État indépendant, qui se remet d'une guerre de succession et dont la neutralité réglée par le traité de Guérande de 1381 se poursuivra sous le règne de Jean V. La Bretagne jouera néanmoins un rôle décisif dans la dernière phase de cette guerre de Cent Ans en assurant le blocus de Bordeaux.
Traité de Troyes. De Domrémy à Chinon : 1428 - février 1429
À treize ans, Jeanne affirme avoir entendu dans le jardin de son père les voix célestes des saintes Catherine et Marguerite et de l'archange saint Michel lui demandant d'être pieuse, de libérer le royaume de France de l'envahisseur et de conduire le dauphin sur le trône. Dès lors, elle s'isole et s'éloigne des jeunes du village qui n'hésitent pas à se moquer de sa trop grande ferveur religieuse, allant jusqu'à rompre ses fiançailles probablement devant l'official de l'évêché de Toul. Elle craint le pillage et les massacres pour son village de Domrémy : les intrusions anglo-bourguignonnes menacent toute la Lorraine. Ses expériences mystiques se multiplient à mesure que les troubles dans la région augmentent mais, effrayée, elle ne les révèle à son oncle, Durand Laxart en fait, un cousin qu'elle appelle oncle car plus âgé, qu'à l'âge de 16 ans. Après beaucoup d'hésitations, son oncle l'emmène — sans permission parentale — rencontrer Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, forteresse voisine de Domrémy, sous prétexte d'aller aider aux relevailles d'une cousine germaine. Demandant à s'enrôler dans les troupes du Dauphin pour répondre à une prophétie locale qui voulait qu'une pucelle des Marches de Lorraine sauvât la France, elle demande audience à Robert de Baudricourt en vue d'obtenir de lui la lettre de crédit qui lui ouvrirait les portes de la Cour. Le seigneur local la prend pour une affabulatrice ou une illuminée et conseille Laxart de ramener sa nièce chez ses parents avec une bonne gifle.
L'année suivante, les Anglo-bourguignons attaquent Domrémy ; avec sa famille, elle se réfugie à Neufchâteau. Jeanne tenace revient s'installer à Vaucouleurs en 1429 pendant trois semaines. Elle loge chez Henri et Catherine Le Royer, famille bourgeoise, et la population — avide en ces temps troublés de prophéties encourageantes — l'adopte et la soutient. Dotée d'un grand charisme, la jeune paysanne illettrée acquiert une certaine notoriété de guérisseuse lorsque le duc malade Charles II de Lorraine lui donne un sauf-conduit pour lui rendre visite à Nancy : elle ose promettre au souverain de prier pour sa guérison en échange de l'abandon par le duc de sa maîtresse la belle Alison Du May et d'une escorte menée par René d'Anjou, gendre du duc et beau-frère du Dauphin Charles pour libérer la France. Elle finit par être prise au sérieux par Baudricourt après qu'elle lui a annoncé par avance la journée des Harengs et l'arrivée concomitante de Bertrand de Poulengy, jeune seigneur proche de la maison d'Anjou et de Jean de Novellompont, dit de Metz. Il lui donne une escorte de six hommes : les deux écuyers Jean de Metz et Bertrand de Poulengy qui resteront fidèles à Jeanne tout au long de son aventure, ainsi qu'un courrier, le messager royal Colet de Vienne, chacun accompagné de son serviteur Julien et Jean de Honnecourt ainsi que Richard L'Archer. Avant son départ pour le royaume de France, Jeanne se recueille dans l'ancienne église de Saint-Nicolas-de-Port, dédiée au saint patron du duché de Lorraine.
Portant des habits masculins et arborant la coupe en écuelle ou en sébile à la mode masculine de l'époque, autrement dit la chevelure taillée en rond au-dessus des oreilles, avec la nuque et les tempes rasées — ce qu'elle fera jusqu'à sa mort, excepté pour sa dernière fête de Pâques — elle traverse incognito les terres bourguignonnes et se rend à Chinon où elle est finalement autorisée à voir le Dauphin Charles, après réception d'une lettre de Baudricourt. La légende raconte qu'elle fut capable de reconnaître Charles, vêtu simplement au milieu de ses courtisans. En réalité, arrivée à Chinon le mercredi 23 février 1429, elle n'est reçue par le roi que deux jours plus tard, non dans la grande salle de la forteresse mais dans ses appartements privés lors d'une entrevue au cours de laquelle elle parle au Dauphin de sa mission, la grande réception devant la Cour à l'origine de la légende n'ayant lieu qu'un mois plus tard. Jeanne est logée dans la tour du Coudray. Jeanne annonce clairement quatre événements : la libération d'Orléans, le sacre du roi à Reims, la libération de Paris et la libération du duc d'Orléans.
Après l'avoir fait interroger par les autorités ecclésiastiques à Poitiers où des docteurs en théologie réalisent son examen de conscience et où des matrones, supervisées par la duchesse douairière d'Anjou, belle-mère du Dauphin, constatent sa virginité exigence pour une envoyée de Dieu ? Vérification qu'elle n'est pas un homme ? Pour ne pas donner prise à ses ennemis qui la qualifient de putain des Armagnac, et après avoir fait une enquête à Domrémy, Charles donne son accord pour envoyer Jeanne à Orléans assiégée par les Anglais.
Campagnes militaires avril - décembre 1429 Orléans
En avril 1429, Jeanne d'Arc est envoyée par le roi à Orléans, non pas à la tête d'une armée, mais avec un convoi de ravitaillement. Ses frères la rejoignent. On l'équipe d'une armure et d'une bannière blanche frappée de la fleur de lys, elle y inscrit Jesus Maria, qui est aussi la devise des ordres mendiants les dominicains et les franciscains. En partance de Blois pour Orléans, Jeanne expulse ou marie les prostituées de l'armée de secours et fait précéder ses troupes d'ecclésiastiques. Arrivée à Orléans le 29 avril, elle apporte le ravitaillement et y rencontre Jean d'Orléans, dit le Bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois. Elle est accueillie avec enthousiasme par la population, mais les capitaines de guerre sont réservés. Avec sa foi, sa confiance et son enthousiasme, elle parvient à insuffler aux soldats français désespérés une énergie nouvelle et à contraindre les Anglais à lever le siège de la ville dans la nuit du 7 au 8 mai 1429.
Siège d'Orléans 1428-1429.
En raison de cette victoire encore célébrée à Orléans au cours des Fêtes johanniques, chaque année du 29 avril au 8 mai, on la surnomme la Pucelle d'Orléans, expression apparaissant pour la première fois en 1555 dans l'ouvrage Le Fort inexpugnable de l'honneur du sexe féminin de François de Billon.
Reims
Après le nettoyage de la vallée de la Loire grâce à la victoire de Patay où Jeanne d'Arc ne prit pas part aux combats, le 18 juin 1429, remportée face aux Anglais, Jeanne se rend à Loches et persuade le Dauphin d'aller à Reims se faire sacrer roi de France.
Pour arriver à Reims, l'équipée doit traverser des villes sous domination bourguignonne qui n'ont pas de raison d'ouvrir leurs portes, et que personne n'a les moyens de contraindre militairement. Selon Dunois, le coup de bluff aux portes de Troyes entraîne la soumission de la ville mais aussi de Châlons-en-Champagne et de Reims. Dès lors, la traversée est possible.
Chevauchée vers Reims et Bataille de Patay.
Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, en la présence de Jeanne d'Arc, Charles VII est sacré par l'archevêque Regnault de Chartres. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, en tant que pair du royaume, est absent ; Jeanne lui envoie une lettre le jour même du sacre pour lui demander la paix. L'effet politique et psychologique de ce sacre est majeur. Reims étant au cœur du territoire contrôlé par les Bourguignons et hautement symbolique, il est interprété par beaucoup à l'époque comme le résultat d'une volonté divine. Il légitime Charles VII qui était déshérité par le traité de Troyes.
Cette partie de la vie de Jeanne d'Arc constitue communément son épopée : ces événements qui fourmillent d'anecdotes où les contemporains voient régulièrement des petits miracles, le tout conforté par leurs références explicites dans les procès, ont grandement contribué à forger la légende et l'histoire officielle de Jeanne d'Arc. La découverte miraculeuse de l'épée dite de Charles Martel sous l'autel de Sainte-Catherine-de-Fierbois, en est un exemple. Le mythe de la chef de guerre commandant les armées de Charles VII en est un autre. C'est le duc de Bedford, régent du royaume de France pour les Anglais, qui lui attribue le rôle de chef de guerre de l'ost du roi envoyé par le diable, pour minimiser la portée de la délivrance d'Orléans et des défaites ultérieures. Les conseillers du roi se méfiant de son inexpérience et de son prestige, ils la font tenir à l'écart des décisions militaires essentielles tandis que le commandement est successivement confié à Dunois, au duc d'Alençon, à Charles d'Albret ou au maréchal de Boussac36. Les historiens contemporains la considèrent soit comme un porte-étendard qui redonne du cœur aux combattants, soit comme un chef de guerre démontrant de réelles compétences tactiques.
Siège de Paris 1429.
Dans la foulée du sacre, Jeanne d'Arc tente de convaincre le roi de reprendre Paris aux Bourguignons et aux Anglais, mais il hésite. Jeanne mène une attaque sur Paris mais elle est blessée lors de l'attaque de la porte Saint-Honoré ; l'attaque est rapidement abandonnée et Jeanne est ramenée au village de la Chapelle. Le roi finit par interdire tout nouvel assaut : l'argent et les vivres manquent et la discorde règne au sein de son conseil. C'est une retraite forcée vers la Loire, l'armée est dissoute.
La prise de Jeanne d'Arc à Compiègne
Jeanne repart néanmoins en campagne : désormais elle conduit sa propre troupe et se considère comme une chef de guerre indépendante, elle ne représente plus le roi. Entraîneur d'hommes qu'elle galvanise par son charisme et son courage elle est plusieurs fois blessée, elle dispose d'une maison militaire avec une écurie de coursiers. Ses troupes lutteront contre des capitaines locaux, mais sans beaucoup de succès. Le 4 novembre 1429, la Pucelle et Charles d'Albret s'emparent de Saint-Pierre-le-Moûtier. Le 23 novembre, ils mettent le siège devant La Charité-sur-Loire pour en chasser Perrinet Gressart. Pour Noël, Jeanne a regagné Jargeau à la suite de l'échec du siège.
Capture par les Bourguignons et vente aux Anglais 1430
Jeanne est alors conviée à rester dans le château de La Trémoille à Sully-sur-Loire. Quittant le roi sans prendre congé, elle s'échappe rapidement de sa prison dorée pour répondre à l'appel à l'aide de Compiègne, assiégée par les Bourguignons. Finalement, elle est capturée par les Bourguignons lors d'une sortie aux portes de Compiègne le 23 mai 1430. Elle essaie de s'échapper par deux fois, mais échoue. Elle se blessa même sérieusement en sautant par une fenêtre au château de Beaurevoir. Elle est vendue aux Anglais le 21 novembre 1430, pour dix mille livres tournois, et confiée à Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et allié des Anglais. Les Anglais l'emmènent à Rouen où se situe leur quartier-général.
Capture de Jeanne d'Arc par les Bourguignons.Le procès et la condamnation 1431
Le procès
Tour Jeanne-d'Arc, donjon du château de Philippe-Auguste à Rouen, où elle fut amenée pour être soumise à la question.
Lors de son procès qui dura du 21 février au 23 mai 143142, Jeanne d'Arc était accusée d'hérésie. Elle fut emprisonnée dans une tour du château de Philippe Auguste à Rouen, dite plus tard tour de la Pucelle » ; seul le donjon de la construction est parvenu jusqu'à nous. Il est appelé à tort tour Jeanne-d'Arc, cependant les substructions de la tour de la Pucelle ont été dégagées au début du xxe siècle et sont visibles dans la cour d'une maison sise rue Jeanne d'Arc. Jugée par l'Église, Jeanne d'Arc resta néanmoins emprisonnée dans cette prison civile, au mépris du droit canon.
L'enquête préliminaire commence en janvier 1431 et Jeanne d'Arc est interrogée sans ménagement à Rouen. Si ses conditions d'emprisonnement étaient particulièrement difficiles, Jeanne n'a néanmoins pas été soumise à la question, bien qu'elle en ait été menacée.
Le procès débute le 21 février 1431. Environ cent vingt personnes y participent, dont vingt-deux chanoines, soixante docteurs, dix abbés normands, dix délégués de l'université de Paris. Leurs membres furent sélectionnés avec soin. Lors du procès de réhabilitation, plusieurs témoignèrent de leur peur. Ainsi, Richard de Grouchet déclare que c'est sous la menace et en pleine terreur que nous dûmes prendre part au procès ; nous avions l'intention de déguerpir. Pour Jean Massieu, il n'y avait personne au tribunal qui ne tremblât de peur. Pour Jean Lemaître, Je vois que si l'on n'agit pas selon la volonté des Anglais, c'est la mort qui menace.
Une dizaine de personnes sont actives lors du procès, tels Jean d'Estivet, Nicolas Midy et Nicolas Loyseleur. Mais les enquêteurs, conduits par l'évêque de Beauvais Pierre Cauchon, ne parviennent pas à établir un chef d'accusation valable : Jeanne semble être une bonne chrétienne, convaincue de sa mission, différente des hérétiques qui pullulent dans un climat de défiance vis-à-vis de l'Église en ces temps troublés. Le tribunal lui reproche par défaut de porter des habits d'homme, d'avoir quitté ses parents sans qu'ils lui aient donné congé, et surtout de s'en remettre systématiquement au jugement de Dieu plutôt qu'à celui de l'Église militante, c'est-à-dire l'autorité ecclésiastique terrestre. Les juges estiment également que ses voix, auxquelles elle se réfère constamment, sont en fait inspirées par le démon. Soixante-dix chefs d'accusation sont finalement trouvés, le principal étant Revelationum et apparitionum divinorum mendosa confictrix imaginant mensongèrement des révélations et apparitions divines.L’université de Paris Sorbonne, alors à la solde des Bourguignons, rend son avis : Jeanne est coupable d'être schismatique, apostate, menteuse, devineresse, suspecte d'hérésie, errante en la foi, blasphématrice de Dieu et des saints. Jeanne en appelle au Pape, ce qui sera ignoré par les juges.
Sur l'amour ou la haine que Dieu porte aux Anglais, je n'en sais rien, mais je suis convaincue qu'ils seront boutés hors de France, exceptés ceux qui mourront sur cette terre.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10944#forumpost10944
Posté le : 05/05/2016 20:23
|
|
|
|
|
Jeanne d'arc boute les anglais 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 8 mai 1429 Jeanne D'arc " boute " les anglais hors d'Orléans
et met fin au siège de la ville qui durait depuis 1428. En raison de cette victoire encore célébrée à Orléans au cours des Fêtes johanniques, chaque année du 29 avril au 8 mai, on la surnomme la Pucelle d'Orléans, expression apparaissant pour la première fois en 1555 dans l'ouvrage " Le Fort inexpugnable de l'honneur du sexe féminin " de François de Bienne. Elle s'illustre pendant le conflit de la Guerre de Cent Ans, elle participe au Siège d'Orléans, à la bataille de Jargeau, à la bataille de Meung-sur-Loire et à la chevauchée vers Reims. Elle est la fille de Isabelle Romée et de Jacques d'Arc; elle a 3 frères et 1 sœur : Jacques, Jean, Pierre, et Catherine d'Arc.
En avril 1429, Jeanne d'Arc est envoyée par le roi à Orléans, non pas à la tête d'une armée, mais avec un convoi de ravitaillement. Ses frères la rejoignent. On l'équipe d'une armure et d'une bannière blanche frappée de la fleur de lys, elle y inscrit Jesus Maria, qui est aussi la devise des ordres mendiants les dominicains et les franciscains. En partance de Blois pour Orléans, Jeanne expulse ou marie les prostituées de l'armée de secours et fait précéder ses troupes d'ecclésiastiques. Arrivée à Orléans le 29 avril, elle apporte le ravitaillement et y rencontre Jean d'Orléans, dit le Bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois. Elle est accueillie avec enthousiasme par la population, mais les capitaines de guerre sont réservés. Avec sa foi, sa confiance et son enthousiasme, elle parvient à insuffler aux soldats français désespérés une énergie nouvelle et à contraindre les Anglais à lever le siège de la ville dans la nuit du 7 au 8 mai 1429.
Jeanne d'Arc, née vers 1412 à Domrémy village du duché de Bar en Lorraine actuelle,et dont une partie relevait du royaume de France pour le temporel et de l'évêché de Toul pour le spirituel actuellement dans le département des Vosges en Lorraine, et morte, à 19 ans sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie alors possession du royaume d'Angleterre, est une héroïne de l'histoire de France, chef de guerre et sainte de l'Église catholique, surnommée depuis le XVIe siècle la Pucelle d'Orléans et, depuis le XIXe siècle, mère de la nation française.
Au début du XV e siècle, cette jeune fille de dix-sept ans d'origine paysanne affirme avoir reçu de la part des saints Michel, Marguerite d'Antioche et Catherine la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Elle parvient à rencontrer Charles VII, à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans et à conduire le roi au sacre à Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent Ans.
Capturée par les Bourguignons à Compiègne en 1430, elle est vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg, comte de Ligny, pour la somme de dix mille livres. Elle est condamnée à être brûlée vive en 1431 après un procès en hérésie conduit par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et ancien recteur de l'université de Paris. Entaché de nombreuses irrégularités, ce procès voit sa révision ordonnée par le pape Calixte III en 1455. Un second procès est instruit qui conclut, en 1456, à l'innocence de Jeanne et la réhabilite entièrement. Grâce à ces deux procès dont les minutes ont été conservées, elle est l'une des personnalités les mieux connues du Moyen Âge.
Béatifiée en 1909 puis canonisée en 1920, Jeanne d'Arc est devenue une des quatre saintes patronnes secondaires de la France. Sa fête nationale est instituée par la loi en 1920 et fixée au 2e dimanche de mai.
Elle est dans le monde entier une personnalité mythique qui a inspiré une multitude d’œuvres littéraires, historiques, musicales, dramatiques et cinématographiques.
En bref
Jeanne d'Arc qui, grâce à la documentation d'une exceptionnelle richesse constituée par les dossiers de ses deux procès (condamnation en 1431, réhabilitation en 1456), est l'un des personnages les mieux connus du XVe siècle reste pourtant mystérieuse. Cela tient d'abord au contraste qui rend son action et les sources historiques qui la présentent déconcertantes. Paysanne qui ne sait ni lire ni écrire, dont tout le bagage savant se limite à la récitation du Pater, de l'Ave et du Credo et aux échos de sermons et de conversations entendus, elle est portée ou se porte (l'initiative de son action paraît bien lui revenir) au premier rang de la société.
Les procès ont bien consigné ses déclarations authentiques, mais ils sont rédigés dans la langue des juristes et des théologiens, alors que les paroles de Jeanne expriment une mentalité, une culture populaires. Ce contraste a rendu Jeanne incompréhensible ou suspecte à la plupart de ses contemporains (de Charles VII à ses juges) et des historiens, du XVe siècle à nos jours. Mais ceux qui ont saisi l'importance du caractère populaire de son comportement, de ses idées, de ses croyances ont faussé l'image de la Jeanne d'Arc historique soit par leur conception erronée du peuple (en partie Michelet, et surtout Péguy), soit par leur ignorance de la culture et de la mentalité populaires dans la France du début du XVe siècle.
Le fossé culturel séparant Jeanne de son entourage politique, militaire et ecclésiastique au XVe siècle et, depuis lors, de ses historiens a permis toutes les interprétations. L'historiographie de Jeanne d'Arc est ainsi devenue le condensé de l'évolution historiographique du XVe siècle à nos jours. Pour l'historien d'aujourd'hui, cette évolution n'est pas moins intéressante que l'histoire même de Jeanne. Il y a notamment une Jeanne d'Arc gothique, une Jeanne d'Arc Renaissance, une Jeanne d'Arc classique, une Jeanne d'Arc des « Lumières », une Jeanne d'Arc romantique, une Jeanne d'Arc nationaliste, etc.
Les deux caractères qui, au XXe siècle, sont passés au premier plan : la sainteté et le nationalisme, sont liés au moment historique et chargés d'équivoques et d'erreurs de perspective historique. Jeanne d'Arc, au XVe siècle, ne pouvait apparaître comme une sainte à personne et l'idée n'a effleuré aucun de ses plus chauds partisans. L'interprétation qui a été faite de paroles prononcées par certains témoins qui l'auraient traitée de « bona et sancta persona » repose sur un contresens. L'expression ne signifie pas « bonne et sainte personne », mais « personne de bonnes mœurs et de religion droite ». S'il est vrai que Jeanne a été animée par un sentiment « national » et a suscité des passions « nationales » en son temps, elle n'a ni créé ni même cristallisé ce sentiment qui existait en France bien auparavant, notamment dans les milieux populaires ; la nature du « nationalisme » du XVe siècle est différente de celle du nationalisme moderne et contemporain.
Si la plupart des interprétations de Jeanne d'Arc depuis le XVe siècle sont issues de déformations de bonne foi dues à l'outillage mental et scientifique de l'époque, si l'on comprend comment, de son vivant, ses ennemis, mal intentionnés sans doute, ont pu cependant confondre, plus ou moins de bonne foi, piété populaire et hérésie ou sorcellerie, il faut dénoncer les entreprises modernes qui, au mépris des textes les plus clairs et des données les plus certaines, reprennent inlassablement certaines erreurs. Il en est trois surtout, qui sont autant de contre-vérités assurées. Jeanne n'était pas une bâtarde royale ou noble, fruit par exemple des amours secrètes de la reine Isabeau de Bavière et du duc d'Orléans. Jeanne a bien été brûlée à Rouen, et les fausses Jeanne apparues après 1431 sont des folles ou des imposteurs. Jeanne n'a pas été démonolâtre, n'a pas appartenu à une secte « luciférienne » et, elle l'a dit sans ambiguïté, si elle partageait les traditions de son entourage paysan (fêtes autour d'un « arbre de fées », légendes du « Bois chenu »), elle « n'y croyait pas » comme le faisaient des compagnes et des compagnons d'une mentalité plus traditionnelle. Sa « simplicité » était celle d'une chrétienne du peuple très « orthodoxe ». Il est piquant de noter que les anthropologues anglais qui, au XXe siècle, ont eu le souci de replacer les croyances de Jeanne dans un cadre de mentalités traditionnelles sont tombés dans le piège de la sorcellerie. Une fausse science a renoué – innocemment – avec les superstitions savantes de leurs compatriotes mal intentionnés, ennemis de Jeanne au XVe siècle. En revanche, on peut penser que, à côté de l'histoire des mentalités et traditions populaires, les tentatives ébauchées par des spécialistes de l'histoire comparée des religions, de la psychiatrie et de la psychanalyse contribueront à mettre en lumière la vérité d'un personnage qui reste, en son temps et dans l'histoire, exceptionnel et, à travers les documents authentiques, souvent bouleversant.
Les événements. Jeanne est née probablement le 6 janvier 1412 dans un bourg du Barrois, Domrémy. Ses parents étaient des « laboureurs », c'est-à-dire des paysans assez aisés. Le nom de famille est écrit dans les documents d'époque Darc, Tarc, Dare, Day, etc. Le nom de Jeanne d'Arc apparaît pour la première fois dans un poème en 1576. De son enfance on connaît ce qu'elle-même et certains témoins en ont évoqué aux procès : sa dévotion, marquée par l'enseignement des ordres mendiants (confession et communion fréquentes, pratique des œuvres de miséricorde – surtout aumône aux pauvres –, culte spécial à certains saints et surtout à la Vierge et au nom de Jésus qu'elle prononcera sur le bûcher) ; sa participation aux fêtes et aux jeux de ses compagnons, à l'égard de qui elle manifestait toutefois une certaine distance, inspirée par sa piété et son goût pour la solitude. Domrémy, dans la vallée de la Meuse, était situé sur une route fréquentée par les marchands, les pèlerins, les clercs voyageurs, les soldats – le monde médiéval de la route, colporteur de nouvelles, de légendes et d'histoires plus ou moins savantes qui se mêlaient au fonds traditionnel local.
Les événements qui touchent Jeanne sont liés à la guerre de Cent Ans. Au lendemain du traité de Troyes (1420) et de la mort de Charles VI (1422), le royaume de France est divisé entre un roi légal, l'Anglais Henri VI – un enfant – qui, de Paris, ne tient que la France du Nord et doit beaucoup au soutien du duc de Bourgogne, et un roi qui se dit seul légitime, le dauphin Charles, « roi de Bourges », qui tient le Midi. Domrémy se trouve à la frontière entre les deux France et, dans la châtellenie de Vaucouleurs, non loin des possessions bourguignonnes et de l'Empire, c'est un des rares bourgs qui, dépendant du roi de France, soit resté fidèle à Charles. En 1425, les habitants doivent abandonner une première fois le village devant la menace bourguignonne et, en 1428, quand les Anglo-Bourguignons mettent le siège devant Vaucouleurs, qui résiste, Jeanne, avec les siens, se réfugie à Neufchâteau. C'est dans ce contexte qu'elle a commencé à entendre des « voix » – celles de saint Michel, de sainte Catherine et de sainte Marguerite – qui lui ordonnent d'aller en France, d'en chasser les Anglais et de faire sacrer Charles à Reims. Les Anglais en Angleterre, les Français en France, et le roi légitime sacré à Reims, en signe de lieutenance du vrai roi, Dieu : voilà l'essentiel du modèle de « monarchie chrétienne nationale » reçu par Jeanne. Après de longues hésitations, aidée par un parent, elle va trouver en mai 1428 le représentant du roi à Vaucouleurs, le capitaine Robert de Baudricourt, qui la traite de folle et la renvoie chez elle. Désormais elle sera aidée par des gens qui croiront en la réalité de sa mission et de ses voix, et elle se heurtera à l'incompréhension ou à l'hostilité de ceux qui la croiront folle, ou intrigante et menteuse, ou pis encore sorcière. Entre les deux, beaucoup hésiteront à se prononcer, oscilleront entre l'indifférence, la méfiance ou un intérêt sceptique. C'est qu'une longue tradition médiévale fait surgir un peu partout – et plus que jamais en ce début du XVe siècle à la faveur de la guerre, de la peste, du schisme – des prophètes savants ou populaires que l'Église rejette pour la plupart dans les cohortes maudites de Satan : sorciers ou pseudo-prophètes. Tel est le monde interlope, social et mental, dans lequel se trouve Jeanne en 1428-1429.
Le 12 février 1429, elle fait une nouvelle tentative auprès de Baudricourt. Sous la pression de partisans de Jeanne, après une séance d'exorcisme d'où elle sort victorieuse, Baudricourt cède. Il lui accorde une escorte armée. En onze jours la petite troupe, partie le 13 février de Vaucouleurs par la porte de France, arrive à Chinon, résidence du « roi » Charles. Celui-ci, très réticent, la reçoit le 25 février au soir. Elle passe l'épreuve avec succès, reconnaît le roi parmi son entourage et, dans un entretien particulier, le convainc de sa mission par un « signe » qu'elle refusera toujours de révéler au procès. Charles la soumet à l'interrogatoire des théologiens de l'université de Poitiers. Elle leur fait quatre prédictions : les Anglais lèveront le siège d'Orléans, le roi sera sacré à Reims, Paris rentrera dans l'obéissance au roi, le duc d'Orléans reviendra de sa captivité en Angleterre. Après un examen de virginité et une enquête de moralité, Jeanne, par une décision de Charles en conseil, est autorisée à participer aux opérations militaires. Munie d'une bannière (avec l'inscription « Jhesus Maria »), d'un prénom, d'une armure complète et d'une épée trouvée, sur ses indications, en la chapelle de Sainte-Catherine-de-Fierbois près de Tours, d'un écuyer, de deux pages, et d'un religieux augustin comme chapelain, elle prit part aux opérations qui aboutirent à la levée du siège d'Orléans par les Anglais, le 8 mai 1429. Ce fut ensuite la reprise de Jargeau, de Meung, de Beaugency, la victoire de Patay, le 18 juin. Son nom se répandit dans toute la France. Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris, dans un petit traité du 14 mai, se prononça en faveur de la mission divine de Jeanne, et Christine de Pisan, dans un poème du 31 juillet, voyait en elle la réalisation des prophéties de la Sibylle, de Bède et de Merlin : la France sauvée par une vierge.
Le 17 juillet, Charles VII fut sacré par l'archevêque de Reims selon le cérémonial traditionnel. Jeanne se tenait près du roi, avec sa bannière dont elle dira qu'« ayant été à la peine, il était juste qu'elle fût à l'honneur ». Jeanne allait échouer dans sa troisième prédiction. L'armée commandée par le duc d'Alençon livra le 8 septembre un assaut contre Paris, qui fut repoussé, dans lequel Jeanne fut blessée. Des opérations limitées auxquelles participa Jeanne aboutirent à la reprise de Saint-Pierre-le-Moûtier, mais à un échec devant La Charité-sur-Loire (décembre). Le 24 décembre, Charles VII anoblit Jeanne et sa famille. Jeanne passa l'hiver 1429-1430 dans le Berry, à Bourges et à Sully. À la fin de mars elle se rendit dans le nord de l'Île-de-France avec une petite troupe pour combattre les Bourguignons. Le 23 mai, alors qu'elle tentait de faire lever le siège de Compiègne, elle fut faite prisonnière par les hommes de Jean de Luxembourg, condottiere au service du duc de Bourgogne. L'archevêque de Reims, Regnaut de Chartres, qui administrait pour Charles VII les régions conquises, écrivit aux Rémois pour les rassurer. La prise de la Pucelle, disait-il, ne changeait rien : déjà un jeune berger du Gévaudan venait de se manifester qui en ferait autant qu'elle. Tout le contraste est là, entre le « rationalisme » du clerc savant et la croyance populaire. Jeanne va en mourir.
Les procès. Jeanne échoua dans une tentative d'évasion du château de Beaulieu-en-Vermandois, elle se jeta du haut d'une tour, ce qui lui fut reproché à son procès comme une tentative de suicide. Dès le 26 mai, l'Université de Paris avait réclamé qu'elle fût jugée comme hérétique par le tribunal de l' Inquisition. Ce corps, représentant suprême en France de la culture et des préjugés savants et de la collaboration avec les Bourguignons et les Anglais, s'avérait être le principal ennemi de Jeanne. Les Anglais, qui voulaient la condamnation de Jeanne, l'achetèrent à Jean de Luxembourg, mais la remirent à la justice d'Église, tout en déclarant qu'ils la reprendraient si elle n'était pas déclarée hérétique. Un tribunal ecclésiastique fut constitué, par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, diocèse sur le territoire duquel Jeanne avait été prise ; son diocèse étant aux mains des Français, cet universitaire parisien, devenu une créature des Anglais, était replié à Rouen. Depuis longtemps gagné aux Bourguignons, il était l'un des rédacteurs de l'ordonnance « progressiste » de 1413, dite ordonnance « cabochienne ». Il s'adjoignit, malgré les réticences de celui-ci, un dominicain, frère Jean le Maître, vicaire de l'inquisiteur de France à Rouen. Ce furent les deux seuls juges de Jeanne, entourés d'un certain nombre de conseillers et d'assesseurs à titre consultatif.
Le procès de Jeanne fut donc un procès d'« inquisition en matière de foi ». On lui reprochait le port de vêtements d'homme, qui tombait sous le coup d'une interdiction canonique, sa tentative de suicide, ses visions considérées comme une imposture et un signe de sorcellerie, son refus de soumission à l'Église militante, et divers griefs mineurs. Le procès s'ouvrit à Rouen le 9 janvier 1431. Malgré quelques entorses aux règlements ou à la tradition, il est conforme à la légalité inquisitoriale, les juges se montrant soucieux de se mettre à l'abri de cas d'annulation. La partialité se manifestera surtout dans la façon de conduire les interrogatoires et d'abuser de l'ignorance de Jeanne. Des déclarations de celle-ci on tire douze articles soumis à l'Université de Paris qui, le 14 mai, en assemblée solennelle, ratifie les conclusions des facultés de théologie et de droit. Les théologiens ont déclaré Jeanne idolâtre, invocatrice de démons, schismatique et apostate. Les canonistes l'ont dénoncée comme menteuse, devineresse, très suspecte d'hérésie, schismatique et apostate. Ou elle abjurera publiquement ses erreurs, ou elle sera abandonnée au bras séculier. Dans un moment de faiblesse, Jeanne, qui a résisté aux menaces de torture, « abjure » le 24 mai au cimetière de Saint-Ouen. Elle se ressaisit bientôt et, en signe de fidélité envers ses voix et Dieu, elle reprend le 27 mai ses habits d'homme. Un nouveau procès est expédié et, le 30 mai 1431, Jeanne hérétique et relapse, est brûlée sur le bûcher sur la place du Vieux-Marché de Rouen.
En 1437, la troisième prophétie de Jeanne s'était accomplie : les troupes de Charles VII avaient repris Paris. Le 10 novembre 1449, Charles VII entra à Rouen et, le 15 février 1450, il fit procéder à une enquête sur la façon dont s'était déroulé le procès de Jeanne. Cette enquête n'eut pas de suite. En 1452, pour plaire à la cour française, le cardinal d' Estouteville, légat pontifical, fit rouvrir l'enquête sans plus de résultat immédiat. En 1455, à la demande de la mère de Jeanne, débuta un nouveau procès d'inquisition, où le nouveau grand inquisiteur de France, le dominicain Jean Bréhal, se dépensa en faveur de la mémoire de Jeanne. Le 7 juillet 1456, dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, les commissaires pontificaux, sous la présidence de Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, déclarèrent le procès de condamnation de Jeanne et la sentence « entachés de vol, de calomnie, d'iniquité, de contradiction, d'erreur manifeste en fait et en droit y compris l'abjuration, les exécutions et toutes leurs conséquences » et, par suite, « nuls, invalides, sans valeur et sans autorité ». La décision fut publiée solennellement dans les principales villes du royaume. Décision d'annulation, purement négative, qui se contentait de lever une hypothèque sur le destin posthume de Jeanne.
Jeanne après Jeanne .Jeanne avait de son vivant connu une célébrité due surtout à l'étonnement de voir la Pucelle « passer de la garde des brebis à la tête des armées du roi de France ». Au lendemain de sa mort son souvenir fut tantôt honoré, tantôt exploité, bien que, à la cour et au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, on fût porté à faire silence sur elle pour attribuer à Dieu seul et à son intérêt pour la monarchie française les événements provoqués par l'action de Jeanne. Des villes comme Bourges et surtout Orléans firent célébrer une messe de requiem à l'anniversaire de sa mort. À Orléans, une pièce de théâtre, ébauchée en 1435-1439, mise en forme en 1453-1456, le Mistère du siège d'Orléans, fut jouée à plusieurs reprises. Une fausse Jeanne, Jeanne ou Claude du Lis, apparut dans la région de Metz en 1436, épousa un pauvre chevalier, Robert des Armoises, et cette Jeanne des Armoises, qui fut reconnue par les frères de Jeanne – aberration ou calcul ? – donna le change jusqu'en 1440 où elle fut démasquée – ironie du sort – par l'Université et le Parlement de Paris.
L'époque humaniste voit une éclipse de Jeanne. L'historiographie officielle minimise l'importance de l'héroïsme au profit de la monarchie qui, par la volonté de Dieu, a été la véritable salvatrice de la France. Un courant rationaliste voit dans Jeanne la création et la créature d'un groupe de politiques avisés et cyniques (par exemple Girard du Haillan : De l'estat et mercy des affaires de France, 1570). D'autres la placent simplement dans la galerie à la mode des « femmes vertueuses ». Rares sont ceux qui, comme François de Belleforest (Les Grandes Annales, 1572) ou Étienne Pasquier (Les Recherches de la France, 1580), s'efforcent à une objectivité érudite. Pourtant, certains curieux s'intéressent au texte des procès puisqu'une trentaine d'exemplaires manuscrits ont été conservés pour la période de la Renaissance. D'autre part, avec les guerres de religion, Jeanne, vilipendée par les protestants (ils avaient détruit en 1567 le monument qui lui avait été élevé à Orléans), tendait à devenir la patronne des catholiques et en particulier des catholiques extrémistes, les ligueurs.
Le XVIIe siècle serait aussi une époque négative pour Jeanne d'Arc, dont le caractère « gothique » choquait l'esprit classique, si Jean Chapelain ne lui avait consacré une longue épopée, La Pucelle, ou La France délivrée (1656), qui fut « attendue comme une Énéide » et consterna les meilleurs amis du poète. Les libertins cependant ne voyaient en Jeanne qu'une « subtilité politique » et prétendaient qu'elle n'avait été brûlée qu'en effigie. Cette veine rationaliste semble triompher au siècle des Lumières. Jeanne est une des cibles favorites de Voltaire, qui cherche à la ridiculiser dans l'épopée héroï-comique de La Pucelle (composée en 1738, éditée en 1762), peu estimée aujourd'hui, mais très admirée par les milieux éclairés du XVIIIe siècle. Voltaire n'était pas seul de son bord. Beaumarchais, dans Les Lettres sérieuses et badines (1740), l'Encyclopédie ne voyaient en Jeanne qu'une malheureuse « idiote » manœuvrée par des fripons. Montesquieu la réduisait à une « pieuse fourberie ». Pourtant une abondante littérature catholique d'édification chantait ses louanges, le nombre des gravures la représentant en guerrière atteste sa popularité. Des esprits indépendants étaient sensibles à son personnage : Rousseau offrit à la république de Genève un texte des procès. Le mythe de Jeanne d'Arc doit beaucoup au romantisme et à deux poètes étrangers, l'Anglais Robert Southey (1795) et l'Allemand Schiller qui dans la pièce Die Jungfrau von Orléans fit de Jeanne une des plus touchantes héroïnes romantiques. La Restauration, la monarchie de Juillet, le second Empire voient le mythe de Jeanne s'épanouir avec le « patriotisme moderne ». Trois hommes firent beaucoup pour la légende, la connaissance et le culte de Jeanne. Michelet dans le tome V de l'Histoire de France (1841), puis dans une Jeanne d'Arc séparée (éditions critiques par G. Rudler, 1925 et par R. Giron, 1948) donna de Jeanne un inoubliable portrait, moins éloigné des documents authentiques qu'on ne l'a dit. Un érudit, Jules Quicherat, donna des procès et des documents annexes une édition qui fait encore autorité (1841-1849). Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans depuis 1849, prépara enfin l'opinion catholique à l'idée de la sainteté de Jeanne. Peintre de la bourgeoisie et de la société établie, Ingres sacrifia à la mode en peignant une insipide Jeanne assistant au sacre du roi Charles VII dans la cathédrale de Reims (1854).
Après la guerre de 1870, Jeanne devint « la bonne Lorraine », symbole de l'espérance et de la revanche. Ses images – statues saint-sulpiciennes, lithographies, gravures – pullulent. Tous les artistes officiels et pompiers lui sacrifient (Jules Barbier, Charles Gounod, J. E. Lenepveu, Sarah Bernhardt, Théodore de Banville, François Coppée, Sully Prudhomme). Une même idéologie chauvine et cléricale inspirait jusqu'aux travaux historiques sérieux, telle la Jeanne d'Arc d'Henri Wallon (1860). Les voix plus ou moins discordantes sont rares. Bernard Shaw fait de Saint Joan (1923) la première protestante mais ne l'en admire que davantage. Anatole France, dans sa Vie de Jeanne d'Arc (1908), tout en voyant en Jeanne une hallucinée, instrument d'une faction d'ecclésiastiques, sut reconnaître la « fille des champs naïve et pure » à la « dévotion sincèrement visionnaire » et il est en définitive un de ceux qui ont le mieux senti son caractère populaire, historique, authentique. Monarchistes et républicains, catholiques et laïcs favorisaient à qui mieux mieux le culte de Jeanne. Cependant, le déchaînement des passions nationalistes avant et après la guerre de 1914-1918, orchestré par Péguy et par Barrès, était ratifié par l'Église qui proclamait l'héroïne nationale française bienheureuse en 1909 (le culte de Jeanne était dans la ligne de la spiritualité de Pie X), puis sainte et patronne de la France en 1920 (Benoît XV tenait à effacer auprès des Français vainqueurs l'attitude peu bienveillante du Vatican pendant la Grande Guerre). Depuis, au milieu de l'embaumement patriotique et religieux, certains artistes ont donné de Jeanne une interprétation plus simple et profonde à la fois, tels, au cinéma La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer (1927) et, au théâtre, l'oratorio de Honegger, Jeanne au bûcher.
On peut avancer aujourd'hui que Jeanne d'Arc a été une paysanne qui a ressenti avec une intensité extraordinaire les sentiments inspirés aux gens de son milieu par le drame de la France déchirée entre « Français français » et « Français anglais » et livrée aux misères matérielles et spirituelles de la guerre, et qui a manifesté avec une force exceptionnelle les croyances qui fournissaient à ces sentiments leur contenu affectif et irrationnel et des instruments d'action : vocation divine de certains élus comme elle, vocation divine des princes « nationaux », recours à certains moyens pour parvenir à ces fins divines, tels que la préservation de sa virginité à l'instar de Marie, l'observance du port symbolique du costume masculin pendant le temps de sa mission, la pratique des actes fondamentaux à ses yeux de la religion chrétienne confession, assistance à la messe, communion, mais aussi, et sans contradiction, prière individuelle et soumission aux ordres divins transmis par les voix. Pour réaliser sa mission dans un milieu soit réticent par distance sociale et culturelle du côté français, soit hostile à cause des formes militaires et politiques de son action du côté anglais, elle avait absolument besoin du succès. L'échec que fut sa capture fit disparaître son charisme. Toutes les réhabilitations, de 1456 à nos jours, sont plus des témoignages sur les préoccupations idéologiques de divers milieux et de diverses époques que sur la Jeanne historique. Jacques Le Goff
Sa vie
La naissance de Jeanne d'Arc se situe vraisemblablement en 1412 dans la ferme familiale du père de Jeanne attenante à l'église de Domrémy, village situé aux marches de la Champagne, du Barrois et de la Lorraine, pendant la guerre de Cent Ans qui opposait le Royaume de France au Royaume d'Angleterre.
Au début du XVe siècle, Domrémy se trouve imbriquée dans un territoire aux suzerainetés diverses. Sur la rive gauche de la Meuse, elle peut relever du Barrois mouvant, pour lequel le duc de Bar, par ailleurs souverain dans ses États, prête hommage au roi de France depuis 1301. Mais elle semble être plutôt rattachée à la châtellenie de Vaucouleurs, sous l'autorité directe du roi de France qui y nomme un capitaine le sire de Baudricourt, au temps de Jeanne d'Arc. Enfin, l'église de Domrémy dépend de la paroisse de Greux, au diocèse de Toul dont l'évêque est prince du Saint-Empire germanique.
L'historienne médiéviste Colette Beaune précise que Jeanne est née dans la partie sud de Domrémy, côté Barrois mouvant, dans le bailliage de Chaumont-en-Bassigny et la prévôté d'Andelot. Les juges de 1431 corroborent cette origine, de même que les chroniqueurs Jean Chartier et Perceval de Cagny. Seul Perceval de Boulainvilliers considère pour sa part qu'elle est née dans la partie nord, qui relevait de la châtellenie de Vaucouleurs et donc du royaume de France dès 1291.
Incertitudes sur la date de naissance
L'âge exact de Jeanne demeure inconnu. La version officielle, construite à partir du procès qui s'est tenu à Rouen, nous transmet que Jeanne a dit être née à Domrémy, et qu'elle a 18 ou 19 ans au moment de son procès. Une lettre du conseiller royal Perceval de Boulainvilliers en date du 21 juin 1429 constitue l'unique source faisant naître Jeanne la nuit de l'Épiphanie, autrement dit le 6 janvier, sans précision de l'année. La date de cette venue au monde saluée par le chant des coqs, à en croire Boulainvilliers, n'est pas authentifiée par les historiens médiévistes, qui soulignent plutôt la valeur symbolique de la nuit des rois mentionnée dans la missive.
Les chroniques médiévales se révèlent en fait souvent imprécises et les appréciations testimoniales sur les dates des naissances d'autant plus approximatives lorsque celles-ci ne sont pas illustres. Pour Jeanne d'Arc, les dates de naissance données par les chroniqueurs s'échelonnent entre 1399 et 1417 mais la Pucelle, lors de son premier interrogatoire le 21 février 1431 dit qu'elle croit avoir environ 19 ans et lorsqu'elle retrace sa vie, elle reste relativement cohérente. De plus, lors de son procès en nullité, les témoins, à l'exception de son amie d'enfance Hauviette et de Jean d'Aulon, concordent pour lui donner comme âge en 1431, 18, 19 ou 20 ans, ce qui la ferait naître vers 1412.
Famille
Jacques d'Arc et Isabelle Rommée, parents de Jeanne vue d'artiste par l'Union internationale artistique de Vaucouleurs. Statues érigées en 1911 sur le parvis de la basilique du Bois-Chenu à Domrémy-la-Pucelle Vosges.
Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Rommée, elle faisait partie d'une famille de cinq enfants : Jeanne, Jacques, Catherine, Jean et Pierre.
L'usage de la particule n'indique rien quant à de possibles origines nobles, une particule pouvant être portée tant par des roturiers que par des nobles, en outre son nom est orthographié de différentes manières Dar, Darc, Day, d'Ay, Tare, Tarc, Tard, Dart, etc. dans la documentation relative à l'époque, sachant que l'usage de l'apostrophe n'est pas d'un emploi général au XVe siècle. Le nom d'Arc apparaît dans un sonnet anonyme, imprimé en 1576 à Orléans, qui célèbre la noblesse conférée par Charles VII à la Pucelle et déclenche la redécouverte littéraire de ce personnage.
Le patronyme d'Arc tire peut-être son origine d'Arc-en-Barrois en Champagne mais aucun document ne l'atteste. De arco signifie de l'arche ou du pont équivalent des patronymes courants Dupont ou Dupond, ce qui se rapporte probablement à un microtoponyme disparu.
Le père de Jeanne, Jacques, est désigné comme pauvre laboureur par des témoins du procès de réhabilitation de la Pucelle dans les années 1450. Cependant, l'historien médiéviste Olivier Bouzy note qu'un laboureur n'est pas pauvre puisque ce type de paysan aisé possède des terres et des bêtes. L'état des biens de Jacques d'Arc n'est pas connu avec précision. Bien que construite en pierre, sa maison comporte uniquement trois pièces pour toute sa famille. Bénéficiant vraisemblablement d'une certaine notoriété à Domrémy, le père de Jeanne représente à plusieurs reprises la communauté des villageois.
Jeanne ou Jeannette, comme on l'appelait à Domrémy où elle grandit fut décrite par tous les témoins comme très pieuse ; elle aimait notamment se rendre en groupe, chaque dimanche, en pèlerinage à la chapelle de Bermont tenue par des ermites garde-chapelle, près de Greux, pour y prier. Les témoignages de ses voisins lors de ses futurs procès rapportent qu'à cette époque, elle fait les travaux de la maison ménage, cuisine, du filage de la laine et du chanvre, aide aux moissons ou garde occasionnellement des animaux quand c'est le tour de son père, activité loin du mythe de la bergère qui utilise le registre poétique de la pastourelle et le registre spirituel du Bon berger de la Bible16. Cette légende de la bergère résulte probablement de la volonté des Armagnacs de transmettre cette image plus symbolique qu'une simple fille de paysan à des fins de propagande politico-religieuse pour montrer qu'une simple d'esprit pouvait aider le chef de la chrétienté du royaume de France et guider son armée, illuminée par la foi.
Les réponses qu'elle a faites à ses juges, conservées dans les minutes de son procès, révèlent une jeune femme courageuse, dont le franc-parler et l'esprit de répartie se tempèrent d'une grande sensibilité face à la souffrance et aux horreurs de la guerre, comme devant les mystères de la religion.
Une plaque apposée en 1930 sur le parvis de la cathédrale de Toul indique qu' elle comparut ici lors d'un procès matrimonial intenté par son fiancé en 1428.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10942#forumpost10942
Posté le : 05/05/2016 20:17
|
|
|
|
|
Histoire du 1 Mai fête du travail |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 1 Mai 1886 massacre de Haymarket square, origine de la fête du travail
Le 1er mai est le seul jour férié et chômé reconnu par notre code du travail, mais combien, parmi nous, se rappellent de l’origine de cette fête ? On sait que le premier mai est la fête du travail, mais d’où vient-elle ? Voici un petit historique de cette fête...
Parmi ceux qui continuent à défiler chaque 1er mai, combien savent qu’ils commémorent en fait, la grève sanglante du 3 mai 1886 aux usines McCormick, à Chicago, pour l’instauration de la journée de huit heures, et le meeting de protestation qui s’ensuivit le lendemain à Haymarket au cours duquel une bombe tua huit policiers.
Le 1er mai 1886, aux États-Unis, 200.000 travailleurs obtiennent la journée de huit heures grâce à une forte pression des syndicats. Mais un affrontement avec la police cause la mort de plusieurs personnes.
En souvenir de cette victoire amère, les syndicats européens instituent quelques années plus tard une journée internationale des travailleurs ou Fête des travailleurs destinée à se renouveler tous les 1er mai. Cette journée est aujourd'hui appelée Fête du Travail, bien que l'expression prête à confusion, on ne fête pas le travail à proprement parler mais l'on honore les travailleurs.
L’origine et la signification libertaires du premier mai sont désormais tombées dans l’oubli. Car le premier mai, c’est bien un événement majeur de l’histoire du mouvement ouvrier, mais plus particulièrement de l’anarchisme que nous commémorons – désormais sans en connaître l’origine.
Nous sommes en 1886, à Chicago. Dans cette ville, comme dans tout le pays, le mouvement ouvrier est particulièrement riche, vivant, actif.
À Chicago, comme dans bien d’autres municipalités, les anarchistes sont solidement implantés. Des quotidiens libertaires paraissent même dans les différentes langues des communautés immigrées. Le plus célèbre des quotidiens anarchistes de Chicago, le Arbeiter-Zeitung, tire en 1886 à plus de 25 000 exemplaires.
Tout commence lors du rassemblement du 1er mai 1886 à l'usine McCormick de Chicago.
Cette année-là, le mouvement ouvrier combat pour la journée de huit heures.
C'est la jeune et encore faible Federation of Organized Trades and Labor Union : F.O.T.L.U. qui a appelé les ouvriers américains à faire grève en faveur de la journée de huit heures le 1er mai 1886. Le mouvement, toutefois, a été un succès en raison du renfort apporté par les Knights of Labor Chevaliers du travail, organisation héritière de traditions maçonniques, alors beaucoup plus puissante que les syndicats. La grève fut l'occasion de grands défilés ouvriers dans les rues des principales villes industrielles des États-Unis.
Les anarchistes y sont engagés, mais avec leur habituelle lucidité: la journée de huit heures pour aujourd’hui, certes, mais sans perdre de vue que le véritable objectif à atteindre est l’abolition du salariat. Le mot d’ordre de grève générale du premier mai 1886 est abondamment suivi, et tout particulièrement à Chicago. Ce jour-là, August Spies, un militant bien connu de la Ville des Vents, est un des derniers à prendre la parole devant l’imposante foule des manifestants.
Au moment où ceux-ci se dispersent, la démonstration, jusque là calme et pacifique, tourne au drame: 200 policiers font irruption et chargent les ouvriers. Il y aura un mort et des dizaines de blessés. Spies file au Arbeiter-Zeitung et rédige un appel à un rassemblement de protestation contre la violence policière. Elle se tient le 4 mai, au Haymarket Square de Chicago.
Cette fois encore, tout se déroule d’abord dans le calme. Spies prend la parole, ainsi que deux autres anarchistes, Albert Parsons et Samuel Fielden. Le maire de Chicago, Carter Harrison, assiste à la manifestation et, alors qu’elle s’achève, il est convaincu que rien ne va se passer. Il en avise donc le chef de police, l’inspecteur John Bonfield, et lui demande de renvoyer chez eux les policiers postés à proximité.
Il est dix heures du soir. Il pleut abondamment. Fielden a terminé son discours, le dernier à l’ordre du jour. Les manifestants se dispersent, il n’en reste plus que quelques centaines dans le Haymarket Square. Soudain, 180 policiers surgissent et foncent vers la foule. Fielden proteste. Puis, venue d’on ne sait où, une bombe est lancée sur les policiers. Elle fait un mort et des dizaines de blessés. Les policiers ouvrent le feu sur la foule, tuant on ne saura jamais combien de personnes. Une chasse aux sorcières est lancée dans toute la ville.
Les autorités sont furieuses. Il faut des coupables. Sept anarchistes sont arrêtés. Ce sont: August Spies, Samuel Fielden, Adolph Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Lingg et Oscar Neebe. Un huitième nom s’ajoute quand Albert Parsons se livre à la police, persuadé qu’on ne pourra le condamner à quoi que ce soit puisqu’il est innocent, comme les autres. En fait, seuls trois des huit suspects étaient présents au Haymarket Square le soir de ce 4 mai fatal.
Le procès des huit s’ouvre le 21 juin 1886 à la cour criminelle de Cooke County. On ne peut et on ne pourra prouver qu’aucun d’entre eux ait lancé la bombe, ait eu des relations avec le responsable de cet acte ou l’ait même approuvé.
D’emblée, une évidence s’impose pour tous: ce procès est moins celui de ces hommes-là que celui du mouvement ouvrier en général et de l’anarchisme en particulier. La sélection du jury tourne à la farce et finit par réunir des gens qui ont en commun leur haine des anarchistes. Y siège même un parent du policier tué. Le juge Gary ne s’y est pas plus trompé que le procureur Julius Grinnel qui déclare, dans ses instructions au jury:
"Il n’y a qu’un pas de la République à l’anarchie. C’est la loi qui subit ici son procès en même temps que l’anarchisme. Ces huit hommes ont été choisis parce qu’ils sont des meneurs. Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury: condamnez ces hommes, faites d’eux un exemple, faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société.
C’est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas vers l’anarchie, ou non. "
Le 19 août, tous sont condamnés à mort, à l’exception d’Oscar Neebe qui écope de quinze ans de prison. Le procès a été à ce point ubuesque qu’un vaste mouvement de protestation internationale se déclenche. Il réussit à faire commuer en prison à vie les condamnations à mort de Schwab et Fielden.
Lingg, pour sa part, se pend dans sa cellule.
Le 11 novembre 1887 Parsons, Engel, Spies et Fischer sont pendus. Ce sont eux que l’histoire évoque en parlant des martyrs du Haymarket. Plus de un demi-million de personnes se pressent à leurs funérailles.
C’est pour ne pas oublier cette histoire qu’il sera convenu de faire du premier mai un jour de commémoration. Neebe, Schwab et Fielden seront libérés officiellement le 26 juin 1893, leur innocence étant reconnue ainsi que le fait qu’ils ont été les victimes d’une campagne d’hystérie et d’un procès biaisé et partial.
Ce qui reste clair cependant, ce sont les intentions de ceux qui condamnèrent les martyrs de Chicago: briser le mouvement ouvrier et tuer le mouvement anarchiste aux États-Unis. Le jour même où avait été annoncée la condamnation à mort des quatre anarchistes, on avait communiqué aux ouvriers des abattoirs de Chicago qu’à partir du lundi suivant, ils devraient à nouveau travailler dix heures par jour.
Reste une question irrésolue jusqu’à ce jour: qui a lancé cette bombe? De nombreuses hypothèses ont été avancées, à commencer par celle accusant un policier travaillant pour Bonfield..
Trois ans après le drame de Chicago, la IIe Internationale socialiste réunit à Paris son deuxième congrès. Celui-ci se tient au 42, rue Rochechouart, salle des Fantaisies parisiennes, pendant l'Exposition universelle qui commémore le centenaire de la Révolution française au pied de la toute nouvelle Tour Eiffel.
Les congressistes se donnent pour objectif la journée de huit heures, soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé, sachant que jusque-là, il était habituel de travailler dix ou douze heures par jour, en 1848, en France, un décret réduisant à 10 heures la journée de travail n'a pas résisté plus de quelques mois à la pression patronale.
Le 20 juin 1889, sur une proposition de Raymond Lavigne, ils décident que :
" Il sera organisé une grande manifestation à date fixe de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à huit heures la journée de travail et d'appliquer les autres résolutions du congrès. Attendu qu'une semblable manifestation a été déjà décidée pour le 1er mai 1890 par l'AFL, dans son congrès de décembre 1888 tenu à Saint Louis, cette date est adoptée pour la manifestation."
Dès l'année suivante, le 1er mai 1890, des ouvriers font grève et défilent, un triangle rouge à la boutonnière pour symboliser le partage de la journée en trois travail, sommeil, loisir.
Le 1er mai 1891, à Fourmies, une petite ville du nord de la France, la manifestation rituelle tourne au drame. La troupe équipée des nouveaux fusils Lebel et Chassepot tire à bout portant sur la foule pacifique des ouvriers. Elle fait dix morts dont huit de moins de 21 ans. L'une des victimes, l'ouvrière Marie Blondeau, qui défilait habillée de blanc et les bras couverts de fleurs d'aubépine, devient le symbole de cette journée.
Avec le drame de Fourmies, le 1er mai s'enracine dans la tradition de lutte des ouvriers européens.
Quelques mois plus tard, à Bruxelles, l'Internationale socialiste renouvelle le caractère revendicatif et international du 1er mai. Elle est relayée en France par la Confédération Générale du Travail, un syndicat fondé le 23 septembre 1895 à Limoges.
L'horizon paraît s'éclaircir après la Première Guerre mondiale. Le traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919 fixe dans son article 247 «l'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où elle n'a pas encore été obtenue».
Les manifestations rituelles du 1er mai ne se cantonnent plus dès lors à la revendication de la journée de 8 heures. Elles deviennent l'occasion de revendications plus diverses. La Russie soviétique, sous l'autorité de Lénine, décide en 1920 de faire du 1er mai une journée chômée. Cette initiative est peu à peu imitée par d'autres pays... L'Allemagne nazie va encore plus loin : Hitler, pour se rallier le monde ouvrier, fait, dès 1933, du 1er mai une journée chômée et payée. La France l'imitera sous l'Occupation, en 1941 !...
Le 1er mai en France
En France, dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge. Celui-ci est quelques années plus tard remplacé par la fleur d'églantine. En 1907, à Paris, le muguet, symbole du printemps en Île-de-France, remplace cette dernière.
Le brin de muguet est porté à la boutonnière avec un ruban rouge .
Le 23 avril 1919, le Sénat français ratifie la journée de huit heures et fait du 1er mai suivant une journée chômée, mais à titre exceptionnel.
Les manifestations du 1er mai 1936 prennent une résonance particulière car elles surviennent deux jours avant le deuxième tour des élections législatives qui vont consacrer la victoire du Front populaire et porter à la tête du gouvernement français le leader socialiste Léon Blum.
C'est pendant l'occupation allemande, le 24 avril 1941, que le 1er mai est officiellement désigné comme la Fête du Travail et de la Concorde sociale, et devient chômé. Cette mesure est destinée à rallier les ouvriers au régime de Vichy.
Son initiative revient à René Belin. Il s'agit d'un ancien dirigeant de l'aile socialiste de la CGT, Confédération Générale du Travail qui est devenu secrétaire d'État au Travail dans le gouvernement de Philippe Pétain.
À cette occasion, la radio officielle ne manque pas de préciser que le 1er mai coïncide avec la fête du saint patron du Maréchal, Saint Philippe, aujourd'hui, ce dernier est fêté le 3 mai !
Le 30 avril 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération qui fait du 1er mai un jour férié et payé... mais pas pour autant une fête légale. Autrement dit, le 1er mai n'est toujours pas désigné officiellement comme Fête du Travail. Cette appellation n'est que coutumière.
L"'Iinternationale "se prononce de la même façon dans toutes les langues
Le Grand espoir : l'unité
L'Internationale est un chant révolutionnaire dont les paroles furent écrites en 1871 par Eugène Pottier et la musique composée par Pierre Degeyter en 1888.
Traduite dans de très nombreuses langues, L'Internationale a été, et est encore, le chant symbole des luttes sociales à travers le monde.
La version russe d'Arkady Yakovlevich Kots a même servi d'hymne national de l'URSS jusqu'en 1944.
Histoire
À l'origine, il s'agit d'un poème à la gloire de l'Internationale ouvrière, écrit par le chansonnier, poète et goguettier Eugène Pottier en juin 1871, en pleine répression de la Commune de Paris.
Suivant la tradition goguettière, L'Internationale de Pottier est à l'origine une chanson nouvelle à chanter sur un air connu. Ici, La Marseillaise, air qui a été utilisé pour quantité de chants revendicatifs et révolutionnaires. L'Internationale est dédiée à l'instituteur anarchiste Gustave Lefrançais.
L'histoire de ce poème et de son auteur est liée à celle des goguettes.
En 1883, Eugène Pottier présente une chanson au concours de la célèbre goguette de la Lice chansonnière et remporte la médaille d'argent.
Il retrouve à cette occasion le chansonnier Gustave Nadaud qu'il a croisé en 1848 et à qui il avait alors fait une forte impression.
Grâce à ces retrouvailles, une cinquantaine de chansons de Pottier sont publiées pour la première fois en 1884 et sauvées de l'oubli par Nadaud qui admire beaucoup son talent poétique tout en étant très loin de partager ses opinions politiques.
Cette initiative de Nadaud incite les amis politiques de Pottier à publier en 1887 ses Chants révolutionnaires avec une préface de Henri Rochefort. Au nombre de ceux-ci : L'Internationale.
Sans la Lice chansonnière et Nadaud, ce chant révolutionnaire célèbre et les autres œuvres de Pottier seraient aujourd'hui oubliées.
En 1888, un an après la première édition imprimée des paroles, la chorale lilloise du Parti Ouvrier Français demande à un de ses membres, Pierre Degeyter, de composer une musique originale pour L'Internationale. Le 23 juillet 1888, pour la première fois, la chorale de la Lyre des Travailleurs, réunie dans l'estaminet À la Vignette à Lille, interprète le chant de l'Internationale sur l'air nouveau de Degeyter. Sa partition est publiée en 1889.
Les quatre premières mesures , thème et harmonies sont sans doute extraites, vu leurs absolues similitudes, du final de l'opérette " les Bavards" , d'Offenbach, qui avait été créée avec un très grand succès populaire, au théâtre des Bouffes Parisiens, en 1863.
À partir de 1904, L'Internationale, après avoir été utilisée pour le congrès d'Amsterdam de la IIe Internationale, devient l'hymne des travailleurs révolutionnaires qui veulent que le monde change de base, le chant traditionnel le plus célèbre du mouvement ouvrier.
L'Internationale a été traduit dans de nombreuses langues.
Traditionnellement ceux qui la chantent lèvent le bras en fermant le poing.
L'Internationale est chantée par les socialistes dans le sens premier du terme, anarchistes, communistes, mais aussi des partis dits socialistes ou sociaux-démocrates et bien sûr par les syndicats de gauche, ainsi que dans des manifestations populaires.
Ce fut même l'hymne de ralliement de la révolte des étudiants et des travailleurs sur la place Tian'anmen en 1989.
Il fut l'hymne national de l'URSS, dans une version la plupart du temps expurgée du cinquième couplet jusqu'en 1944, et est toujours l'hymne de la majorité des organisations socialistes, anarchistes, marxistes ou communistes.
Dans de nombreux pays d'Europe, ce chant a été illégal durant des années du fait de son image communiste et anarchiste et des idées révolutionnaires dont elle faisait l'apologie.
Plus tard, certains groupes anarchistes utiliseront plus volontiers une adaptation : L'Internationale noire.
Dans le roman de George Orwell La Ferme des animaux, critiquant allégoriquement l'URSS sous couvert de narrer une révolution d'animaux, L'Internationale est parodiée sous le nom de Beasts of England et la révolution ouvrière spoliée par les bolchéviques, comme la modification des textes révolutionnaires par ceux-ci, y est également dénoncée.
Liens
http://youtu.be/s6CX_9oDwwk l'internationale
http://youtu.be/dcXNXKtu8z4 Anglais
http://youtu.be/2OPvWFDzDlA par Toscanini, malgré l'interdiction
http://youtu.be/Xaa7NrcHyD0 Espagnol
http://youtu.be/qm9aYRzCX48 Italien
http://youtu.be/kDwZAtE6yWY Allemand
http://youtu.be/XKTToVgAQlU en Chinois
http://youtu.be/L0td8s6AU_A Japonais
http://youtu.be/2H5sxLrt-xY Corée (on écoute, ce n'est plus le chant du peuple, mais pour le peuple)
http://youtu.be/i5VsVGlZJnA Bulgare
http://youtu.be/lwR_1tzUZrA Pologne
http://youtu.be/gPLMWwRn2UM Danemark
http://youtu.be/75kjRooehQU Arabie
http://youtu.be/MzOY43KTxJU Syrie
http://youtu.be/yBGH7CWCHow Portugais
http://youtu.be/FDmSzDtkZYw Cuba
http://youtu.be/MzOY43KTxJU Syrie
http://youtu.be/u8bFsNyqvqw Yiddish
http://youtu.be/K6GVsfOM1XA Zoulou
http://youtu.be/WCQQx5eMzZk meltingpot
Devenu
http://youtu.be/QKTYNknc3C4 Hymne national Russe
Liens
http://youtu.be/_OQxncb2ihQ Origine du massacre
http://youtu.be/ifK1Qw2WbMc Haymarket square history
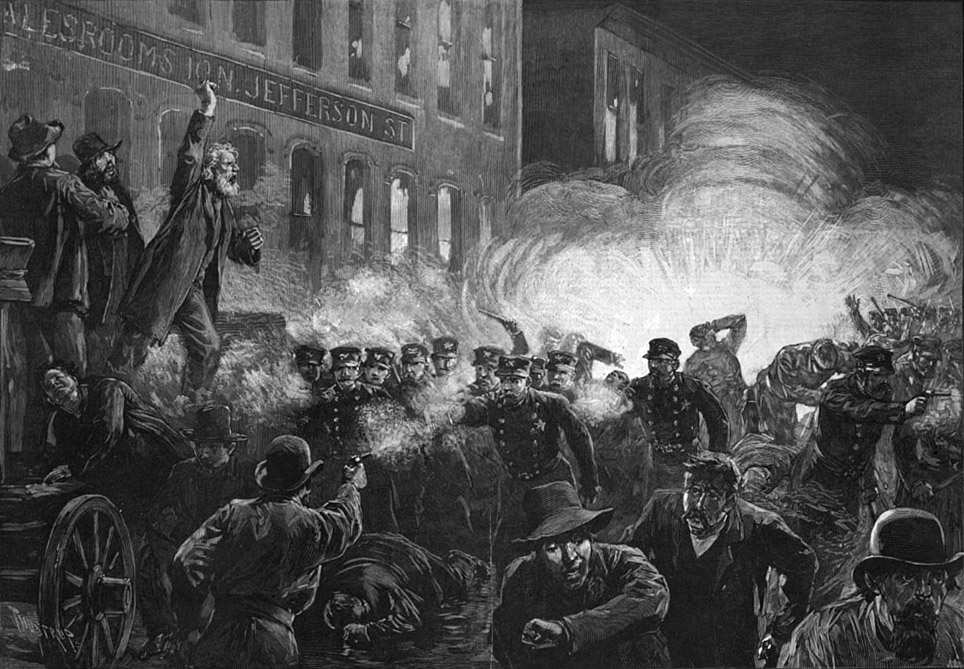 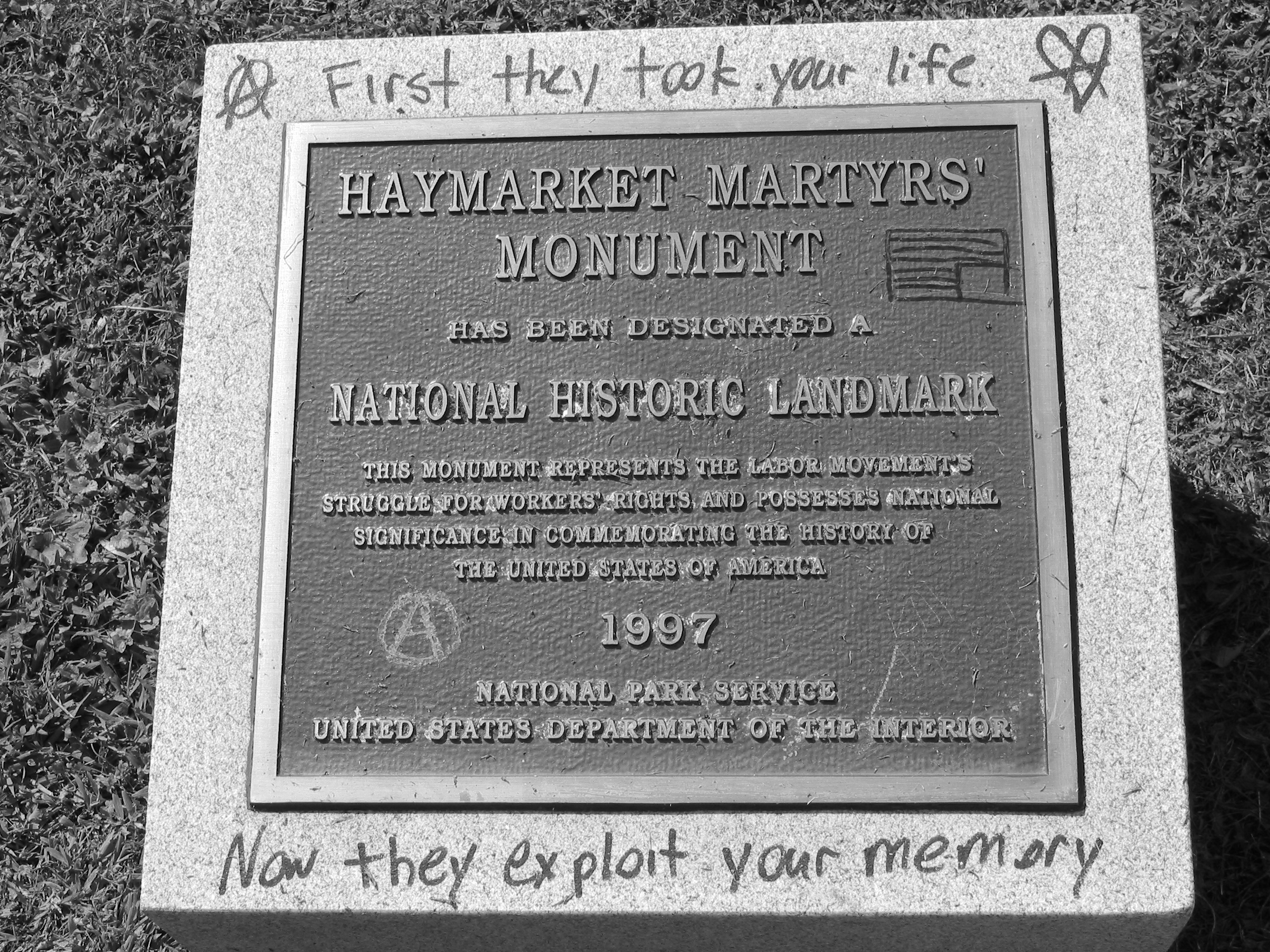 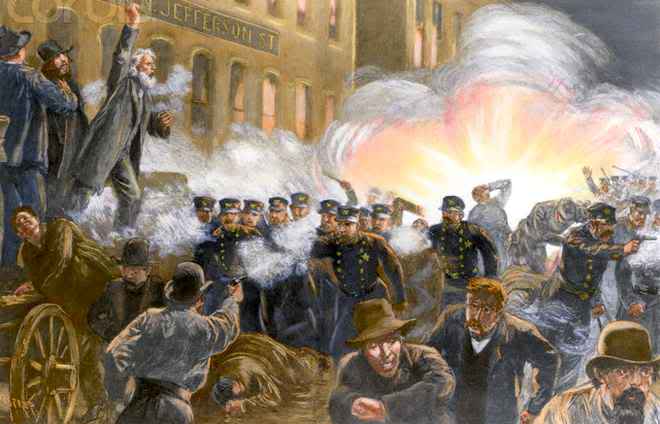 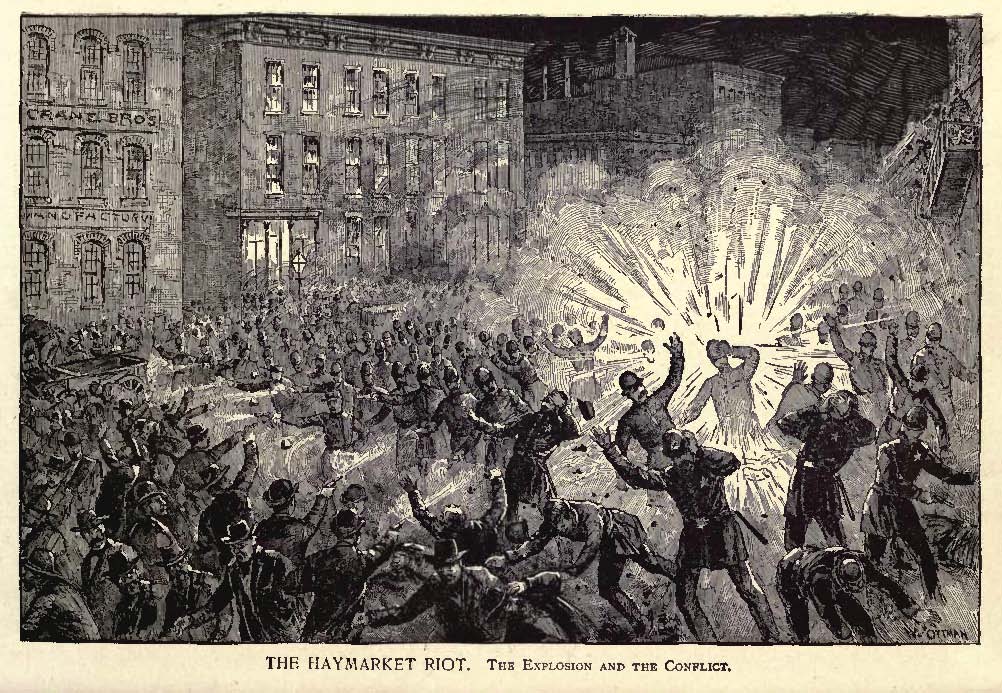  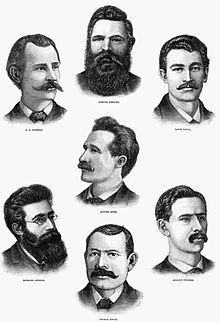        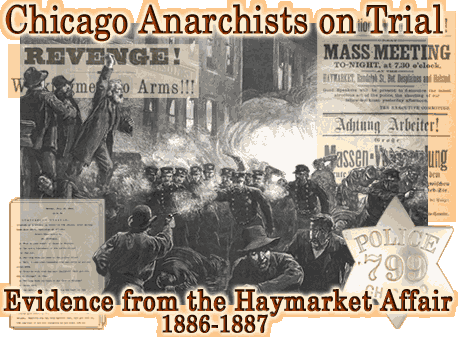 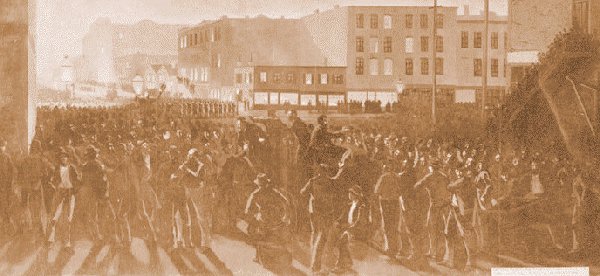 [img width=-00]https://maydaymarch.files.wordpress.com/2011/02/mayday-france-2.jpg[/img]
Posté le : 01/05/2016 16:04
|
|
|
|
|
Histoire de la fête du muguet |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le muguet du premier Mai
Cette tradition fête cette année ces 453 printemps, nous la devons à Charles IX.
Muguet en Mai : tous les 1er Mai, la fête du travail est toujours accompagnée d'une belle fleur qui symbolise le printemps : le muguet. Le muguet est une magnifique fleur qui ravit tous ceux et toutes celles qui la reçoivent. Le muguet au mois de mai, un dossier et une enquête sur les origines de cette coutume et sur le business du muguet ...
Le Muguet en Mai : Historique de la coutume !
Le muguet une fleur de Mai
En 1561, le roi Charles IX a décidé d'offrir des muguets aux dames de la cour en guise de porte-bonheur. Grâce à cet acte royal, la tradition est née car les habitants du palais ainsi que les paysans ont également choisi d'en offrir à leur entourage. Le muguet, appelé également lys des vallées, Clochette des bois, lis de mai, muguet des bois, muguet à clochettes et… gazon du Parnasse… En effet, la légende nous raconte que le muguet fut créé par Apollon, l’un des grands dieux de l’Olympe, afin de donner à fouler aux neuf muses qui l’entouraient, un gazon digne de leurs pieds. De nos jours, on offre à ceux qu’on aime un brin de muguet censé leur porter bonheur et joie.
Le muguet est planté en Europe depuis le Moyen Age. En effet, la plante à clochettes est d'origine japonaise. Les celtes le considéraient comme porte-bonheur.
Le premier Mai des celtes, fête de Beltane.
La fête de Beltane, se disait également Belteine ou Beltaine
À l'époque celtique, on divisait l'année en 2 principales saisons :
- L'hiver commençait à une date qui correspond au 1er novembre : Avec la fête de Samain et le réveillon, c'est aujourd'hui la nuit d'Halloween.
- L'été commençait le 1er mai avec la fête de Beltaine, littéralement le feu de Bel. Bel désigne le principal dieu celte Lug et exprime l'idée de lumière. On retrouve cette racine dans le nom du dieu gaulois Belenos, ou la déesse gauloise Belisama, la très brillante.
En gaélique, la fête porte le nom de Bealtaine : Lá na Bealtaine : premier mai
Cette fête commémore l'union symbolique, de la Déesse Mère et du Dieu Cerf, le dieu Bel des Celtes, devenu chez les Gaulois Belenos et Cermunnos le cornu, divinité gauloise à la tête ornée de bois de cerf.
Dans les pays celtiques, on allume des bûchers la veille de Beltaine, Oíche Bhealtaine, l'opposé d'Oíche Shamhna Halloween.
On peut constater que les deux principales fêtes celtiques, Samain, le 1er novembre, et Beltaine, le 1er mai, sont aujourd'hui des jours fériés.
Cette fête fait le lien avec l'été qui s'approche, elle est la fête du Feu. Beltane est un des sabbats majeurs de la tradition païenne. Elle porte divers noms selon les contrées et on l’appelle également: Fête du premier mai, Veille de mai, Roodmas, Nuit de Walpurgis, Cethsamhain, Whitsun or Old Bhealltainn, Bealtinne, Walburga, Eté celte ... Beltane était fêtée lors de la première floraison de l’aubépine.
Au delà des croyances Européennes, le muguet a toujours symbolisé le printemps et le beau temps. La jolie fleur à clochettes et qui sent bon protège les personnes que l'on aime, et à qui on l'a offerte, jusqu'au prochain 1er Mai. La plante est également associée aux rencontres amoureuses. Il est à savoir que les fleurs du muguet, qui sont blanches au printemps, sont rouges en été. Ceci est le signe de la fraîcheur et d'innocence, le printemps est synonyme de renaissance et des amours naissants.
Ainsi, en Europe, à l'époque de la sa floraison, étaient organisés les bals du muguet. Les jeunes filles à marier s'habillaient en blanc pour aller à la rencontre des jeunes hommes célibataires. Ces derniers ornaient un brin de muguet sur leur boutonnière. Les jeunes avaient, ce que l'on appellera aujourd'hui la permission de minuit et s'amusaient avec les débuts des beaux temps. Avant de l'offrir, sachez qu'il est préférable de cueillir des muguets au niveau de leurs tiges puisque les arracher avec leurs racines serait empêcher la plante de faire des fleurs l'année suivante.
Autres légendes et coutumes
Au XVII siècle le muguet désignait les jeunes gens de la cour aux penchants homosexuels.
L'archange Gabriel annonce à Marie la naissance de Jésus en lui tendant un brin de muguet. Heureuse, Marie, chante l'hymne "je suis le muguet la fleurs des humbles"
Le muguet est l'emblème natonal de la Finlande depuis 1967.
Et si parfois le muguet est appelé Notre-Dame-Des-Larmes c'est parceque selon la légende chrétienne ce lys de la vallée est l'image des larmes d'Eve apréès avoir été éconduite avec Adam du jardin d'Eden
Le Muguet : une Fleur magnifique, mais Fragile !
Une fleur de muguet
Et comment se présente le travail du muguet alors ? En fait, cette fleur à petites clochettes blanches est vraiment délicate et difficile à travailler. Pendant les deux premières années, aucune récolte n'est possible. Le muguet ne peut fleurir que dans sa troisième ou quatrième année, voire même la cinquième. Fréquemment dans les régions où la plantation du muguet est importante, la culture se fait sous châssis. Cette race s'appelle Grandiflora.
D'autres peuvent être cultivés sous serre, ce qui est moins fréquent, ils s'appellent « Muguets fortins ». Tout est calculé pour que le muguet ne fleurisse ni trop en avance, ni trop en retard. La fleur à clochettes est programmé pour être sur le marché le 1er Mai, ni avant, ni après. Si les maraîchers du muguet s'aperçoivent que la fleur fleurit trop vite, ils couvrent et aèrent les plantes. Ainsi, ces dernières vont ralentir dans leur croissance. Tout est bon pour les cacher du soleil, que ce soient des paillassons ou des planches. Il y a même des fois où mettre de la glace sur le châssis est nécessaire.
Si la plante persiste encore à continuer sa croissance, les glaces sont mis sous les châssis, vraiment à côté de la fleur. Pour réaliser le travail, plusieurs ouvriers maraîchers sont indispensables. Puisque la plante est fragile, une présence humaine s'avère incontournable. Le muguet a besoin de beaucoup d'attention, mais le porte-bonheur du 1er Mai, ainsi que la beauté de la plante, en vaut la peine !
Les maraîchers, les ouvriers du muguet ...
Bouquet de muguet
Les maraîchers du muguet commencent leur saison courant octobre. Pendant trois mois à peu près, le gros du travail consiste à trier les racines du muguet. Il faut en effet différencier les plants, qui sont destinés à être gardés pour l'année prochaine, des griffes, qui peuvent fleurir pour le 1er Mai de la saison en cours. Les maraîchers doivent être polyvalents, et il n'y a pas de différenciation entre l'homme et de la femme. Les ouvriers de la terre, un jour, peuvent faire du tri des racines, et se retrouver le lendemain au lavage. Résister au froid et à l'eau reste le principal atout pour finir son contrat dans la bonne santé. Ils peuvent également être dehors, dans les champs, soit à planter, soit à arracher les racines.
Courant janvier et février, le froid peut très vite affaiblir, raison pour laquelle il leur faut une vraie résistance au froid. Vers la fin du mois de février et au mois de Mars, les maraîchers s'activent à mettre les bâches pour couvrir les muguets, pour qu'ils soient à l'abri du vent. Les plantes vont grandir et fleurir tranquillement.
Entre temps, les petits pots, dans lesquels d'autres racines vont être mises, font l'objet d'un travail à la chaîne très intense. Le nombre de petits pots dépend des commandes que les patrons ont reçues. Jusqu'au 15 Avril à peu près, le rythme est un peu plus calme car la fleur est en train de grandir et il faut juste vérifier si n'a besoin de rien et si elle pousse correctement. Le plus gros du travail se situe entre le 15 et le 31 Avril, le moment de la cueillette.
Toutes les fleurs doivent être cueillies avant la fin Avril pour être disponibles le 1er Mai. Vaillants et courageux, les maraîchers n'abandonnent pas et sont bien conscients de l'enjeu. Et enfin, le 1er Mai, nous avons tous nos bouquets de muguets dans nos magasins. Ne sont pas t-elles admirables les fées des clochettes ?
Liens:
http://youtu.be/93Jm6OQYZVU Francis Lemarque Le temps du muguet
http://youtu.be/heRlEiWUneM Yvan Rebroff le temps du muguet
http://youtu.be/BcqIIhzYpKI Tout ça parce qu'au bois de Chaville y'avait du muguet
http://gauterdo.com/ref/tt/tout.ca.parce.qu.au.bois.html Piere Destailles
http://youtu.be/_gUToHvv8rI j'ai ratissé large et j'ai trouvé ça
http://youtu.be/mU5J4y5Nt-k et ça
      
Posté le : 01/05/2016 16:00
|
|
|
|
|
Sébastien Le pestre de Vauban 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Qu'est-ce que la Dîme royale ?
En effet, la contribution majeure de Vauban à la réforme des impôts question lancinante tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution française de 1789 est la publication en 1707 malgré son interdiction de cet ouvrage publié à compte d'auteur, intitulé :
Projet d'une dixme royale qui, supprimant la taille, les aydes, les doüanes d'une province à l'autre, les décimes du Clergé, les affaires extraordinaires et tous autres impôts onéreux et non volontaires et diminuant le prix du sel de moitié et plus, produiroit au Roy un revenu certain et suffisant, sans frais, et sans être à charge à l'un de ses sujets plus qu'à l'autre, qui s'augmenteroit considérablement par la meilleure culture des terres
Dans cet ouvrage, il met en garde contre de forts impôts qui détournent des activités productives. Vauban propose dans cet essai de remplacer les impôts existants par un impôt unique de dix pour cent sur tous les revenus, sans exemption pour les ordres privilégiés le roi inclus. Plus exactement, Vauban propose une segmentation en classes fiscales en fonction des revenus, soumises à un impôt progressif de 5 % à 10 %42. L'impôt doit servir une politique, les classes fiscales doivent être plus ou moins favorisées à fins d'enrichir la société et par conséquent l’État.
Bien qu'interdit, cet ouvrage bénéficie de nombreuses éditions à travers toute l'Europe - une traduction anglaise paraît dès 1710 - et ce texte alimente les discussions fiscales pendant une grande partie du XVIIIe siècle.
Mais, contrairement à la légende, le projet :
n’est pas révolutionnaire : Boisguilbert avait déjà fait des propositions analogues, dont Vauban s’inspire ainsi que de son secrétaire, l'abbé Vincent Ragot de Beaumont, et la capitation, impôt très semblable, est établi en 1695, et l'impôt du dixième, en 1710 ;
n'est pas ignoré par le pouvoir. Le contrôleur général Chamillart a lu la Dîme royale sans doute à la fin de l’année 1699. De même, en août 1700, le premier président au Parlement de Paris, Achille III de Harlay. Et enfin et surtout, en 1700 toujours, Vauban présente au roi, en trois audiences successives - qui ont lieu dans la chambre de madame de Maintenon- la première version de sa Dîme royale par écrit et oralement. C’est ce qu’il explique dans sa lettre à Torcy :
J’en ai présenté le système au roi à qui je l’ai lu, en trois soirées de deux heures et demie chacune, avec toute l’attention possible. Sa Majesté, après plusieurs demandes et réponses, y a applaudi. M. de Chamillart, à qui j’en ai donné une copie, l’a lu aussi, de même que M. le premier Président Achille de Harlay à qui je l’ai aussi fait voir tout du long. Je ne me suis pas contenté de cela. Je l’ai recommandé au Roi de vive voix et surtout d’en faire faire l’expérience sur quelques-unes des petites élections du royaume, ce que j’ai répété plusieurs fois et fait la même chose à M. de Chamillart.
Bref, j’ai cessé d’en parler au roi et à son ministre pour leur en écrire à chacun une belle et longue lettre bien circonstanciée avant que partir pour me rendre ici, où me trouvant éloigné du bruit et plus en repos, j’y ai encore travaillé de sorte qu’à moi, pauvre animal, cela ne me paraît pas présentement trop misérable.
Et Nicolas-Joseph Foucault, intendant de Caen, note à la date du 6 novembre 1699 : M. Chamillart m’a envoyé un projet de capitation et de taille réelle, tiré du livre de M. Vauban . Une expérimentation est tentée en Normandie qui se traduit par un échec : ce projet, ajoute-t-il, sujet à trop d’inconvénients, n’a pas eu de suite.
En fait, ce qui déplait, c’est la publication et la divulgation publique en pleine crise militaire et financière. Vauban transgresse un interdit en rendant publics les mystères de l’État et lui dit-on se mêle d’une matière qui ne le regarde pas… C’est bien ce qu’explique Michel Chamillart, qui cumule les charges de contrôleur général des finances et de secrétaire d’État à la Guerre :
Si M. le maréchal de Vauban avait voulu écrire sur la fortification et se renfermer dans le caractère dans lequel il avait excellé, il aurait fait plus d’honneur à sa mémoire que le livre intitulé La Dîme royale ne fera dans la suite. Ceux qui auront une profonde connaissance de l’état des finances de France et de son gouvernement n’auront pas de peine à persuader que celui qui a écrit est un spéculatif, qui a été entraîné par son zèle à traiter une matière qui lui était inconnue et trop difficile par elle-même pour être rectifiée par un ouvrage tel que celui de M. de Vauban.
Et il avoue :
j’ai peine à croire, quelque soin que l’on ait de supprimer les exemplaires et puisque ce livre a passé à Luxembourg et qu’il vient de Hollande, qu’il soit possible d’empêcher qu’il n’ait cours.
— Lettre au comte de Druy, gouverneur de Luxembourg, 27 août 1707
Effectivement, en 1708, un éditeur de Bruxelles imprime le livre avec un privilège de la cour des Pays-Bas et en 1710 une traduction parait en Angleterre. Et en France, un marchand de blés de Chalon-sur-Saône vante en 1708 une espèce de dîme royale, et un curé du Périgord écrit en 1709 : On souhaiterait fort que le Roi ordonnât l’exécution du projet de M. le maréchal de Vauban touchant la dîme royale. On trouve ce projet admirable …. En ce cas, on regarderait ce siècle, tout misérable qu’il est, comme un siècle d’or, cité par Émile Coornaert dans sa préface à l’édition de La Dixme royale, Paris, 1933, p. XXVIII.
son échec est plutôt à attribuer à son mode de recouvrement en nature, choix coûteux il est nécessaire de construire des granges et désavantageux en temps de guerre où on préfère un impôt perçu en argent.
Grosso modo, pour tous ceux qui connaissaient la question en vue d'une application directe, le projet de Vauban n'était pas faisable et mal pensé, Au contraire, pour tous ceux qui n'avaient pas à gérer immédiatement la chose fiscale, il fut un slogan au moins, une utopie, une solution, au plus, d'autant plus séduisante qu'elle n'était pas approfondie.
Où et comment la Dîme royale a-t-elle été imprimée ?
Peut-être à Rouen hypothèse Boislisle, peut-être à Lille, peut-être même en Hollande (hypothèse Morineau.
Nous sommes donc à la fin de l'année 1706 et au tout début de l'année 1707. Ce que nous savons, c’est qu’une demande de privilège de librairie pour un in-quarto intitulé Projet d’une Dixme royale a été déposée, sans nom d’auteur, auprès des services du chancelier, le 3 février 1707.
Cette demande est restée sans réponse. L’auteur n’est pas cité, mais à la chancellerie, il est connu puisque nous savons que le chancelier lui-même est en possession du manuscrit. Sans réponse de la chancellerie, Vauban décide de poursuivre quand même l’impression. À partir de ce moment et de cette décision, il sait bien qu’il est hors-la-loi : son amour du bien public vient de l’emporter sur le respect de la loi.
L’impression achevée, sous forme de feuilles, est livrées en ballots. Mais comment les faire entrer à Paris, entourée, on le sait, de barrières, bien gardées ? L’introduction de ballots suspects aurait immédiatement éveillé l’attention des gardes, et tous les imprimés non revêtus du privilège sont saisis.
Aussi, Vauban envoie deux hommes de confiance Picard, son cocher, et Mauric, un de ses valets de chambre, récupérer les quatre ballots enveloppés de serpillières et de paille et cordés, au-delà de l’octroi de la porte Saint-Denis. Chaque ballot contient cent volumes en feuilles.
Les gardiens de la barrière laissent passer, sans le visiter, le carrosse aux armes de Vauban, maréchal de France. À Paris, rue Saint-Jacques, c’est la veuve de Jacques Fétil, maître relieur rue Saint-Jacques, qui broche la Dixme royale, jusqu’à la fin du mois de mars 1707, sous couverture de papier veiné, et relia quelques exemplaires, les uns en maroquin rouge pour d’illustres destinataires, les autres plus simplement en veau, et même en papier marbré 300 sans doute en tout. Ce sont des livres de 204 pages, in-quarto. Vauban en distribue à ses amis et les volumes passent de main en main les jésuites de Paris en détiennent au moins deux exemplaires dans leur bibliothèque… À noter qu’aucun exemplaire n’est vendu : aux libraires qui en demandent, Vauban répond qu’il n’est pas marchand.
Voici le témoignage de Saint-Simon :
Le livre de Vauban fit grand bruit, goûté, loué, admiré du public, blâmé et détesté des financiers, abhorré des ministres dont il alluma la colère. Le chevalier de Pontchartrain surtout en fit un vacarme sans garder aucune mesure et Chamillart oublia sa douceur et sa modération. Les magistrats des finances tempêtèrent et l’orage fut porté jusqu’à un tel excès que, si on les avait crus, le maréchal aurait été mis à la Bastille et son livre entre les mains du bourreau.
Le 14 février 1707, le Conseil, dit conseil privé du roi se réunit. Il condamne l’ouvrage, accusé de contenir « plusieurs choses contraires à l’ordre et à l’usage du royaume. Et le roi ordonne d’en mettre les exemplaires au pilon et défend aux libraires de le vendre. Pourtant aucun auteur n’est mentionné. Cette première interdiction n’affecte pas, semble-t-il, Vauban qui, tout au contraire, dans une lettre datée du 3 mars à son ami Jean de Mesgrigny, gouverneur de la citadelle de Tournai, manifeste sa fierté face au succès de son livre :
… Le livre de la Dixme royale fait si grand bruit à Paris et à la Cour qu’on a fait défendre la lecture par arrest du Conseil, qui n’a servi qu’à exciter la curiosité de tout le monde, si bien que si j’en avois un millier, il ne m’en resteroit pas un dans 4 jours. Il m’en revient de très grands éloges de toutes parts. Cela fait quez je pourray bien en faire une seconde édition plus correcte et mieux assaisonnée que la première…
Et nous apprenons en même temps que l’abbé Vincent Ragot de Beaumont l'homme de l’ombre qui a joué un rôle capital dans la rédaction de la Dixme royale, installé à Paris près de Vauban, prépare cette seconde édition :
… L’abbé de Beaumont est ici qui se porte à merveille, et je le fais travailler depuis le matin jusqu’au soir. Vous savez que c’est un esprit à qui il faut de l’aliment, et moi, par un principe de charité, je lui en donne tout autant qu’il en peut porter…
Un second arrêt est donné le 14 mars. Louis Phelypeaux, comte de Ponchartrain 1674-1747, en personne, le chancelier, a lui-même corrigé le texte de l’arrêt, dont l’exécution est cette fois confiée au lieutenant-général de police de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson. Et Pontchartrain ajoute en marge de l’arrêt : le dit livre se débite encore, c’est-à-dire, au sens exact du mot, se vend facilement et publiquement. Au même moment, Vauban continue la distribution de son livre : ainsi, Jérôme de Pontchartrain, le fils du chancelier, et secrétaire d’État à la marine, accuse réception, le 20 mars, d’un exemplaire qui lui a été adressé le 16 mars.
Les derniers jours de Vauban
Antoine Étex, Mausolée de Vauban 1852, où est déposé le cœur de Vauban. Paris, hôtel des Invalides.
Grâce aux dépositions de son valet de chambre, Jean Colas, de la veuve Fétil, de sa fille et de leur ouvrier Coulon, il est possible de savoir comment se sont passés les derniers jours de Vauban.
Colas, le valet de Vauban, qui fut interné pendant un mois au Châtelet, raconte dans une déposition conservée aux archives la réaction du vieux maréchal, le 24 mars, quand il commence à s’inquiéter : Toute cette après-dînée, le Maréchal parut fort chagrin de la nouvelle que M. le Chancelier faisait chercher son livre. Sa réaction fut d’ordonner à son valet d’aller promptement chez la veuve Fétil retirer les quarante exemplaires restés chez elle. Toute la journée, il reste assis dans sa chambre, en bonnet, près du feu. Deux dames lui ont rendu visite ce jour-là la comtesse de Tavannes et Madame de Fléot, femme du major de la citadelle de Lille et il a accordé sans doute, à chacune d’elle un exemplaire de sa Dixme. Sur le soir, la fièvre le prend. Il se met au lit, et fut fort mal le vendredi et samedi suivant…
Le dimanche, la fièvre est légèrement tombée : ce dimanche matin, explique Colas, il donne ordre de prendre dans son cabinet deux de ses livres et de les porter au sieur abbé de Camps, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, et de le prier de les examiner, et de lui en dire son sentiment.
Et le soir même, il en fait aussi porter un aux Petits-pères de la place des Victoires, et un autre à son confesseur, un frère jacobin qui prêche pendant le cours de cette année au couvent de l’ordre, rue Saint-Honoré, et ne donnant ledit livre [à son valet le dit sieur maréchal lui dit qu’il priait ce frère de le lire et de lui dire si, en le composant, il n’avait rien fait contre sa conscience.
Le mercredi 30 mars, dit Colas, sur les neuf heures trois-quarts du matin, le Maréchal mourut….
Dès l’instant de sa mort, les exemplaires restants sont retirés, par Ragot de Beaumont, qui logeait dans une chambre de l’hôtel Saint-Jean, hôtel mitoyen et dépendant de celui de Vauban. Et dans cette chambre, explique Colas, on y monte par un escalier qui débouche dans le cabinet du Maréchal.
Vauban meurt dans une maison aujourd'hui détruite qui se situait au no 1 de la rue Saint-Roch actuelle. En 1933, à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Vauban, la ville de Paris y fait apposer une plaque commémorative.
Le no 1 de la rue Saint-Roch
À gauche l'emplacement de la maison où mourut Vauban en 1707 et à droite la plaque, posée en 1933, qui rappelle son souvenir.
C’est Saint-Simon, on le sait, qui a fait naître l’idée que Vauban serait mort de chagrin : Vauban, réduit au tombeau par l’amertume . Et surtout, ce passage :
Le roi reçut très mal le maréchal de Vauban lorsqu’il lui présenta son livre, qui lui était adressé dans tout le contenu de l’ouvrage. On peut juger si les ministres à qui il le présenta lui firent un meilleur accueil. De ce moment, ses services, sa capacité militaire, unique en son genre, ses vertus, l’affection que le roi y avait mise jusqu’à se croire couronné de lauriers en l’élevant, tout disparut à l’instant à ses yeux ; il ne vit plus en lui qu’un insensé pour l’amour du bien public, et qu’un criminel qui attentait à l’autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne ; il s’en espliqua de la sorte sans ménagement :
Testament de Sébastien Le Prestre de Vauban, rédigé le 23 mars 1702. Archives nationales de France.
L’écho en retentit plus aigrement dans toute la nation offensée qui abusa sans ménagement de sa victoire ; et le malheureux maréchal, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître, pour qui il avait tout fait, et mourut peu de mois après, ne voyant plus personne, consommé de douleur et d’une affliction que rien ne put adoucir, et à laquelle roi fut insensible, jusqu’à ne pas faire semblant de s’apercevoir qu’il eût perdu un serviteur si utile et si illustre. Il n’en fut pas moins célébré par toute l’Europe et par les ennemis mêmes, ni moins regretté en France de tout ce qui n’était pas financier ou suppôt de financier.
Mais tout cela est une légende : Vauban n’a été ni inquiété ni disgracié et il est bien mort de maladie, d’une pneumonie fluxion de poitrine, des conséquences de ce rhume » dont il ne cesse de se plaindre depuis des dizaines d’années dans sa correspondance.
Reste que la Dixme royale est bel et bien une affaire, l’ultime recours d’un homme qui a voulu, par tous les moyens, se faire entendre… Et les mesures de censure n’ont pas réussi à empêcher la diffusion et le succès du livre, comme l’atteste cette lettre de Ponchartrain du 14 juin 1707 à l’intendant de Rouen Lamoignon de Courson :
Nonobstant les deux arrests du conseil dont je vous envoie copie qui ordonne la suppression du livre de feu le maréchal de Vauban, la Dixme royale, ce même livre n’a pas cessé d’être imprimé à Rouen en deux volumes in 12. On soupçonne le nommé Jaure de l’avoir fait imprimer, ce particulié ayant esté chassé de Paris pour avoir imprimé plusieurs livres défendus.
Effectivement, nous savons que les libraires de Rouen ont imprimé le Projet d’une dixme royale de Vauban en 1707, 1708, 1709… Et à partir de Rouen, le livre est diffusé dans toute l’Europe : le 9 septembre 1707, un éditeur néerlandais demande à Antoine Maurry l’imprimeur de Rouen qui a fabriqué le livre six Dixme royale de Vauban in quarto… Et en 1713, Jérôme de Pontchartrain, secrétaire d’État de la Marine et de la Maison du roi expédiait à Michel Bégon, intendant du Canada un exemplaire de la Dixme royale en lui recommandant d’étudier avec Vaudreuil, le gouverneur, les possibilités d’appliquer au Canada les principes développés par Vauban.
Et c’est la Régence, avec l’expérience de la polysynodie, qui confirme l’actualité, toujours présente, et réformatrice de Vauban : dans le Nouveau Mercure galant, organe officieux du gouvernement, on peut lire, en octobre 1715 p. 258 que « S.A.R le Régent travaille tous les jours pendant trois heures à examiner les Mémoires de feu M. le duc de Bourgogne, de même que ceux de M. de Vauban »…
Vauban est inhumé dans l'église de Bazoches, petit village du Morvan proche du lieu de sa naissance et dont il avait acheté le château en 1675. Mais son cœur est aux Invalides depuis la décision de Napoléon en 1808.
Héritage Un bon Français
Louis XIV reconnait en Vauban un bon Français. Et à sa mort, contrairement à une légende tenace de disgrâce légende dont Saint-Simon est en partie responsable, il parle de lui avec beaucoup d’estime et d’amitié et déclare à l’annonce de sa mort : Je perds un homme fort affectionné à ma personne et à l’État. Vauban est un homme de caractère, qui paie de sa personne, exigeant dans son travail et très soucieux du respect de ses instructions.
Mais c'est aussi un humaniste, qui se passionne pour la justice sociale : on rapporte par exemple qu'il partage ses primes et ses soldes avec les officiers moins fortunés, et prend même parfois sur lui les punitions des soldats sous son commandement lorsqu'il les trouve injustes…
Il mène une vie simple et ses rapports avec son entourage sont très humains, qu'il s'agisse de ses proches ou des gens de sa région natale, où il aimait à revenir lorsqu'il le pouvait c'est-à-dire rarement !. Son père, Urbain le Prestre l'a éduqué très jeune dans le respect des autres, quelles que soient leurs origines. Ses origines modestes — famille de hobereaux provinciaux désargentés — ont sans doute contribué à forger l'humanité de son caractère.
On peut dire aussi que Vauban est un noble malcontent. Mais au lieu d’emprunter le chemin de la révolte armée comme le font les gentilshommes du premier XVIIe siècle, il utilise la plume et l’imprimé, au nom d’un civisme impérieux, pleinement revendiqué, au service de la nation France et de l’État royal qu’il veut servir plus que le roi lui-même. Toute son œuvre de pierre et de papier en témoigne : son action ne vise qu’un but, l’utilité publique, en modelant le paysage, en façonnant le territoire, en transformant l’ordre social.
Vauban, apôtre de la vérité, apparaît, avec quelques autres contemporains Pierre de Boisguilbert, par exemple, ou l’Abbé de Saint-Pierre, comme un citoyen sans doute encore un peu solitaire. Mais au nom d’idées qu’il croit justes, même si elles s’opposent au roi absolu, il contribue à créer un espace nouveau dans le territoire du pouvoir, un espace concurrent de celui monopolisé par les hommes du roi, l’espace public, et à faire naître une force critique appelée à un grand avenir : l’opinion.
Par ses écrits progressistes, Vauban est considéré comme un précurseur des encyclopédistes, des physiocrates et de Montesquieu.
Bilan de ses fortifications
Selon Napoléon, la fontière de fer édifiée par Vauban a sauvé la France de l'invasion à deux reprises : sous Louis XIV lors de la Bataille de Denain, puis sous la Révolution.
Hommages
Timbres
Timbre à l'effigie de Vauban, série célébrités , Dessin de André Spitz, d'après Rigaud. Graveur: Claude Hertenberger, impression taille-douce France No 1029, catalogue Yvert & Tellier année d'émission 13 juin 1955.
Timbre à l'effigie de Vauban et une fortification en arrioère-plan valeur 0,54 € France No 4031, catalogue Yvert & Tellier, année 2007.
vignette commémorative sans valeur postale
De nombreuses rues et établissements publics portent le nom du Maréchal, à travers la France.
Monnaies
La monnaie de Paris pour célébrer l'année Vauban a émis quatre monnaie créées par Fabienne Courtiade
En or 1/4 once massif, à valeur faciale de 10 € et à tirage limité à 3 000 exemplaires
En, argent 5 once, en BE, BU
Pièce de 20 €
Armoiries
Figure Blasonnement
D'azur, au chevron d'or, surmonté d'un croissant d'argent et accompagné de trois trèfles du second.
Propriétés
Château d'Epiry, provient de sa femme
Domaine de Creuzet, voisin d'Epiry lui est adjugé le 15 février 1676 par décret du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, pour remboursement de la dette de 15,000 livres contractée par le comte de Crux, en 1671, soit 120 arpents de bois 41 hectares, avec la justice à la Collancelle, attenants à Epiry et au Creuset
Château de Bazoches, acquis en 1675 soit 130 hectares de terre et de prés ainsi que 400 hectares de bois, acquis aux enchères par un certain Lemoyne le 17 août 1679 pour le compte de Vauban. Cette vente avait pris quatre ans avant de se faire.
seigneurie de Pierre-Perthuis acquise en 1680 au comte de Vitteaux soit 30 hectares de terre et 12 hectares de vignoble, le fief, le château en ruine ainsi que le moulin de Sæuvres
Seigneurie de Cervon, acquise en 1683
Château Vauban à Bazoches, manoir familial qu'il achète 4 700 livres en 1684, à laquelle son père fut contraint de renoncer en 1632, et qu'il achète à son cousin Antoine Le Prestre de Vauban endetté, soit 500 hectares de terre et de brousailles avec le château.
En 1693, il achète à comte de Nevers:Philippe Mancini 1641-1707, la seigneurie de Neuffontaines à l'ouest de Bazoches, comprenant le domaine d'Armance, ainsi que 110 hectares de terre et prés
Le Manoir de Champignolles qui jadis propriété des Le Prestre, était passé par mariage aux Magdelenet, revient dans son patrimoine par son secrétaire Friand le 17 juillet 1704, qui se fait rembourser une dette contractée par le président de l'élection de Vézelay: Jean Magdelenet.
Seigneurie de Domecy, acquise en 1690 à Claude La Perrière, représentant 3 fermes et 70 hectares de terres et de prés.
La Chaume, achetée en 1690
En 1693 il possède 1 200 hectares de terres dont quatre cents de bois. Dont plus de la moitié des 91 actes d'affaires agricoles des Le Prestre passés devant maître Ragon, notaire à Bazoches de 1681 à 1705, signés par Jeanne d'Osnay épouse de Vauban qui lui a donné une procuration.
Sources
Les papiers personnels de Sébastien Le Prestre de Vauban sont conservés aux Archives Nationales sous la cote 260Ap et 261AP. Ils sont consultables sous forme de microfilms.
Bibliographie
Luc Mary, Vauban, le maître des forteresses, Paris, Éditions de l'Archipel, 2007, 277 p;
Bernard Pujo, Vauban, Albin Michel, 1991 ;
Anne Blanchard, Vauban, Fayard, 1996 ;
Joël Cornette, Le Roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris, Payot, coll. Petite bibliothèque, Payot, 2000, 1993, 488 p;
Michèle Virol, Vauban : De la gloire du roi au service de l’État, Champ Vallon, 2003 réimpr. 2007;
Arnaud d'Aunay, Vauban, génie maritime, Gallimard, 2007;
Michel Parent et Jacques Verroust, Vauban, Jacques Fréal, 1971, 319 p. OCLC 306446;
Lieutenant-colonel Pierre Lazard, Vauban, Paris, 1934
thèse de doctorat ;
Émilie d' Orgeix, Victoria Sanger et Michèle Virol, Vauban. La pierre et la plume, Paris, Éditions du Patrimoine, Gérard Klopp, 2007;
A. Allent, Histoire du corps impérial du génie, vol. 1 seul paru : Depuis l'origine de la fortification moderne jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, Paris, 1805, p. 45-526 Étude sur Vauban ;
Franck Lechenet, Plein Ciel sur Vauban, Éditions Cadré Plein Ciel, 2007
Livre de 240 pages de photographies sur une centaine de sites Vauban en vue aérienne. Textes historiques ;
Guillaume Monsaingeon, Vauban un militaire très civil, Éditions Scala, 2007
150 lettres de Vauban entre 1667 et 1707 ;
Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant, Vauban, l'intelligence du territoire, Paris, Service historique de la défense et Nicolas Chaudun, 2006 réimpr. 2007;
Les Oisivetés de Monsieur de Vauban, ou ramas de plusieurs mémoires de sa façon sur différents sujets, Champ Vallon, 2007
Édition intégrale établie sous la direction de Michèle Virol, Seyssel Il s'agit de la première édition intégrale des vingt-neuf mémoires laissés à l'état manuscrit par Vauban. Chaque mémoire est préfacé et annoté par un historien spécialiste.
Guillaume Monsaingeon, Les Voyages de Vauban, Marseille, Parenthèses, 2007
Édition brochée de 190 pages couleurs et mêmes quelques photographies…
Daniel Auger, Vauban sa vie son oeuvre, Association "Les Amis de la Maison Vauban", 1998
Daniel Auger, Bibliographie des ouvrages de Vauban ou concernant Vauban, Association "Les Amis de la Maison Vauban", 2007
Vauban 1633-1707 : 6 octobre-24 octobre 2007/Guy Thuillier ;Carnet de dessins Arnaud d'Aunay.-Nevers :Bibliothèque Municipale de Nevers et Société Académique du Nivernais, 2007
Vauban : Traité de l'attaque et de la deffence des places Manuscrit
Vauban: Le directeur general des fortifications
Alain Monod, Vauban ou la mauvaise conscience du roi, Riveneuve Editions, coll. Bibliothèque des idées;
Arnaud de Sigalas, Guide du château de Bazoches-en-Morvan, rédigé et publié par A. de Sigalas, cahiers de 34.p. s.d.,
Luc-Normand Tellier, Face aux Colbert : les Le Tellier, Vauban, Turgot… et l'avènement du libéralisme, Presses de l'Université du Québec, 1987, 816 pages.Etexte
Lucien Bély, Dictionnaire Louis XIV, éditions Robert Laffont, coll. Bouquins, 2015, 1405 p.
Robert Dauvergne, Vauban et la détresse économique dans la région de Vézelay, Clamecy, Impr. générale de la Nièvre, 1954, 7 p.
Iconographie
Angers, École supérieure d'Application du Génie : Louis-Eugène Larivière, Portrait de Vauban, huile sur toile, copie d'après ? ;
Aunay-en-Bazois, château d'Aunay :
Le Maréchal de Vauban XIX siècle, buste en plâtre ;
Anonyme, Portrait de Vauban, huile sur toile ;
Avallon, place Vauban : Auguste Bartholdi, Monument à Vauban, inauguré le 9 septembre 1873 ;
Bazoches, château de Bazoches :
Antoine Coysevox, Vauban, buste en terre cuite ;
Hyacinthe Rigaud, Portrait de Vauban, huile sur toile ;
Anonyme, Portrait de Vauban, huile sur toile ;
Briançon : Vauban, buste à mi-corps en marbre blanc ;
Cambrai : Vauban à Cambrai, non signé, non daté, huile sur toile ;
Dijon, musée des beaux-arts : anonyme, Portrait de Vauban, huile sur toile , copie d'après Hyacinthe Rigaud ;
Gap : Augustin Lesieux 1877-1964, Vauban, 1937, sculpture en pierre, conseil général des Hautes-Alpes ;
Paris, département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France :
Portrait de Vauban de trois-quart, en armure, dans un ovale, gravure éditée chez E. Desrochers ;
Nicolas-Gabriel Dupuis 1695-1771, Portrait de Vauban, gravure ;
Pierre François Bertonnier, Portrait de Vauban, gravure ;
Robert Bonnart 1652-1733, Portrait de Vauban, en pied prenant une prise de tabac, estampe éditée chez N. Bonnart rue Saint-Jacques ;
Paris, hôtel des Invalides :
Antoine Étex, Mausolée de Vauban, 1846-1847 ;
Paris, Monnaie de Paris : Michel Petit, Vauban, médaille 41 mm ;
Paris, musée du Louvre :
Antoine Étex, Vauban, buste en plâtre, esquisse pour le Mausolée de Vauban commandé par le ministère de l'Intérieur le 6 juin 1843 et destiné à l'hôtel des Invalides, érigé en 1852 dans le bras du transept de l'église du Dôme des Invalides. Le 22 décembre 1855, la commission refuse sa statue pour la façade des places Napoléon et du Carroussel ;
Antoine Coysevox, Vauban, buste en plâtre ;
Paris, place Salvador-Allende : Henri Bouchard, Monument au maréchal Vauban, 1962 ;
Saint-Léger-Vauban : Anatole Guillot, Monument à Vauban, bronze, inauguré le 10 décembre 1905 par Bienvenu Martin, ministre de l'Éducation et ces cultes ;
Valenciennes, musée des beaux-arts : Gustave Crauk , Statuette en pied de Vauban, esquisse pour la statue destinée à la façade du palais du Louvre en 1855-1856 ;
Verdun, hôtel Vauban : Lucien Lantier, Portrait du maréchal Vauban, vers 1923, huile sur toile ;
Versailles, musée de l'Histoire de France :
Charles-Antoine Bridan, Statue de Vauban ;
Atelier de François de Troy, Portrait de Vauban, huile sur toile ;
Vincennes, bibliothèque du Génie, service historique de la Défense : Charles Le Brun, Portrait de Vauban, pastel
   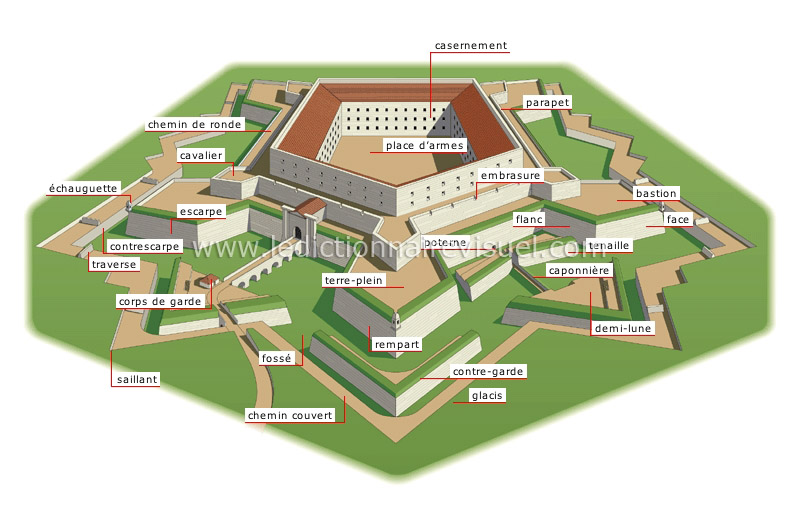     
Posté le : 30/04/2016 19:07
|
|
|
|
|
Sebasteine Lepestre de Vauban 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
La frontière de fer
Le nom de Vauban reste attaché à la construction d'une frontière de fer qui a durablement protégé le royaume contre les attaques ennemies.
Afin de construire une frontière plus linéaire et cohérente, Vauban voulut avant tout rationaliser le système de défense déjà mis en place avant lui, en particulier dans le Nord, car il fallait répondre à la principale préoccupation stratégique du roi : protéger Paris souvenir de l'année 1636, celle de Corbie, qui avait vu les troupes espagnoles avancer jusqu'à Pontoise. Par un jeu savant d'abandon et de restitution de villes fortifiées, le traité de Nimègue, en 1678, permit de diminuer les enclaves coûteuses et d'assurer ainsi une plus grande régularité du tracé de la frontière.
Vauban a multiplié les lettres, les rapports, les mémoires adressés à Louvois ou au roi ; dans ses lettres, rapports, mémoires, Vauban avait violemment dénoncé les méfaits de ce qu'il appelait l'« emmêlement de places ». En novembre 1678 par exemple, rédigeant un Mémoire des places frontières de Flandres qu'il faudroit fortifier pour la sûreté du pays et l'obéissance du Roi, il insistait sur la nécessité de « fermer les entrées de notre pays à l'ennemi, et de faciliter les entrées dans le sien. Aussi, pour le Nord du royaume, proposait-il d'installer deux lignes de places fortes se soutenant mutuellement, à l'imitation des ordres de bataille.
La première ligne, la ligne avancée, serait composée de treize grandes places et de deux forts, renforcée par des canaux et des redoutes, suivant un modèle déjà éprouvé dans les Provinces-Unies.
La seconde ligne, en retrait, comprendrait aussi treize places. Louvois lut le mémoire à Louis XIV qui souhaita aussitôt que la même politique défensive fût appliquée de la Meuse au Rhin. Cette année-là aussi, Vauban avait été nommé commissaire général des fortifications.
Si le Nord et l'Est furent l'objet d'un soin défensif particulier, l'ensemble des frontières du royaume bénéficia de la diligence de l'ingénieur bâtisseur : partout, imitant la technique mise au point en Italie puis en Hollande et en Zélande par les Nassau, Vauban conçut le réseau défensif à partir du modelé du terrain et des lignes d'obstacles naturels les fleuves, les montagnes, la morphologie du littoral, adaptant au site chaque construction ancienne ou nouvelle. Il accorda une particulière attention au cours des rivières, à leurs débits, à leurs crues. Dans tous les cas, après une longue observation sur le terrain, il rédigeait un long rapport afin de résumer les obstacles et les potentialités de chaque site :
En avril 1679, par exemple, il rédigea pour Louvois un mémoire sur les fortifications à établir en Cerdagne au contact de la frontière espagnole : Qualités des scituations qui ont été cy devant proposées pour bastir une place dans la plaine de Cerdagne. Examinant six emplacements possibles, il en élimina cinq, découvrant enfin la scituation idéale … justement à la teste de nos défilés comme si on l'y avoit mise exprès … ; les rochers, les meulières et fontaines du col de la Perche forment autant de remparts naturels : la situation choisie offre de nombreux avantages, et elle épargne au moins les deux tiers de remuement de terre, et plus d'un tiers de la maçonnerie et en un mot la moitié de la dépense de la place.
Dans la plupart des cas, comme dans cet exemple de la Cerdagne il s'agissait du projet réalisé de la ville-citadelle de Mont-Louis, parce qu'il est nécessaire d'assujettir le plan au terrain, et non pas le terrain au plan, il transforma les contraintes imposées par la nature en avantage défensif, dressant des forteresses sur des arètes rocheuses, ou les bâtissant sur un plateau dégagé pour barrer un couloir en zone montagneuse. Une des réussites les plus éclatantes fut celle de Briançon musée des Invalides et des plans reliefs : les chemins étagés sur les flancs de la montagne furent transformés en autant d'enceintes fortifiées et imprenables. Soit en les créant, soit en les modifiant, Vauban travailla en tout à près de trois cents places fortes. Sa philosophie d'ingénieur-bâtisseur tient en une phrase : l'art de fortifier ne consiste pas dans des règles et dans des systèmes, mais uniquement dans le bon sens et l'expérience .
L’État des places fortes du royaume, dressé par Vauban en novembre 1705, se présente comme le bilan de l’œuvre bâtie suivant ces principes : il compte 119 places ou villes fortifiées, 34 citadelles, 58 forts ou châteaux, 57 réduits et 29 redoutes, y compris Landau et quelques places qu’on se propose de rétablir et de fortifier.
La liberté d'esprit de ce maréchal lui vaudra cependant les foudres du roi. Vauban meurt à Paris le 30 mars 1707 d'une inflammation des poumons. Il est enterré à l'église de Bazoches dans le Morvan et son cœur, sur l'intervention de Napoléon Ier, est conservé à l'hôtel des Invalides de Paris, en face de Turenne, depuis 1808.
Un acteur du Grand Siècle, un précurseur des Lumières
Vauban est apprécié à son époque et jugé depuis comme un homme lucide, franc et sans détour, refusant la représentation et le paraître, tels qu’ils se pratiquaient à la cour de Louis XIV. Il préfère au contraire parler le langage de la vérité :
… je préfère la vérité, quoi que mal polie, à une lâche complaisance qui ne serait bonne qu’à vous tromper, si vous en étiez capable, et à me déshonorer. Je suis sur les lieux ; je vois les choses avec appréciation, et c’est mon métier que de les connaître ; je sais mon devoir, aux règles duquel je m’attache inviolablement, mais encore plus que j’ai l’honneur d’être votre créature, que je vous dois tout ce que je suis, et que je n’espère que par vous … Trouvez donc bon, s’il vous plaît, qu’avec le respect que je vous dois, je vous dise librement mes sentiments dans cette matière. Vous savez mieux que moi qu’il n’y a que les gens qui en usent de la sorte qui soient capables de servir un maître comme il faut.
— Lettre à Louvois, le 23 novembre 1668
Ses supérieurs, le ministre de la Guerre comme le roi, l’encouragent d’ailleurs, dans un intérêt bien compris de part et d’autre. Vauban est un « sésame aux multiples portes » comme l’écrit Michèle Virol, un lieu de mémoire de la nation France à lui tout seul, un homme à multiples visages : stratège réputé preneur de villes, il a conduit plus de quarante sièges, poliorcète il a construit ou réparé plus de cent places fortes, urbaniste, statisticien, économiste, agronome, penseur politique, mais aussi fantassin, artilleur, maçon, ingénieur des poudres et salpêtres, des mines et des ponts et chaussées, hydrographe, topographe, cartographe, réformateur de l’armée substitution du fusil au mousquet, remplacement de la pique par la baïonnette à douille. En un mot, une sorte de Léonard de Vinci français du Grand Siècle… Il a même écrit en 1695, pendant son séjour à Brest il s’agissait de repousser une attaque anglaise un Mémoire concernant la caprerie, dans lequel il défend la guerre de course par rapport à la guerre d’escadre c’était là un grand débat depuis la bataille de la Hougue en 1692 qui avait vu nombre de navires français détruits.
Tous ces métiers ont un point commun : le maréchal ingénieur du Roi Soleil s'est toujours fondé sur la pratique, et il a toujours cherché à résoudre et à améliorer des situations concrètes au service des hommes : d’abord, ses soldats dont il a voulu à tout prix protéger la vie dans la boue des tranchées ou dans la fureur sanglante des batailles. Mais Vauban n’a cessé aussi de s’intéresser aux plus humbles sujets du roi, accablés de taille, de gabelle, et encore plus de la famine qui a achevé de les épuiser 1695.
C’est pour ces hommes et ces femmes, tenaillés par la misère et par la faim, qu’il a écrit ce mémoire intitulé Cochonnerie, ou le calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant dix années de temps. Dans ce texte singulier, d'abord titré Chronologie des cochons, traité économique et arithmétique, non daté, destiné à adoucir les rudesses de la vie quotidienne des sujets du roi, trop souvent victimes de la disette, Vauban voulait prouver, calculs statistiques à l'appui sur dix-sept pages, qu'une truie, âgée de deux ans, peut avoir une première portée de six cochons. Au terme de dix générations, compte tenu des maladies, des accidents et de la part du loup, le total est de six millions de descendants dont 3 217 437 femelles ! Et sur douze générations de cochons, il y en aurait autant que l’Europe peut en nourrir, et si on continuait seulement à la pousser jusqu’à la seizième, il est certain qu’il y aurait de quoi en peupler toute la terre abondamment . La conclusion de ce calcul vertigineux et providentiel était claire : si pauvre qu'il fût, il n'était pas un travailleur de terre « qui ne puisse élever un cochon de son cru par an, afin de manger à sa faim.
Dans ses Mémoires, Saint-Simon, toujours imbu de son rang, qualifiait l'homme de petit gentilhomme de Bourgogne, tout au plus, mais ajoutait aussitôt, plein d'admiration pour le personnage, « mais peut-être le plus honnête homme et le plus vertueux de son siècle, et, avec la plus grande réputation du plus savant homme dans l'art des sièges et de la fortification, le plus simple, le plus vrai et le plus modeste… jamais homme plus doux, plus compatissant, plus obligeant… et le plus avare ménager de la vie des hommes, avec une valeur qui prenait tout sur soi, et donnait tout aux autres. Par ailleurs, on ne peut être que frappé par la multitude de ses compétences, de ses centres d’intérêt, de ses pensées, de ses actions :
Il fut un précurseur des Encyclopédistes par sa façon d'aborder les problèmes concrets, ainsi le budget d'une famille paysanne, par exemple, ou sa Description géographique de l'élection de Vézelay de janvier 1696 dans laquelle il propose de lever un vingtième, sans exemption, et qui se différencie en un impôt sur le bien-fonds et sur le bétail, sur les revenus des arts et métiers, sur les maisons des villes et des bourgs ;
Il est aussi dans le grand mouvement de penseurs précurseurs des physiocrates il lit Boisguilbert ; à la même époque, écrivent Melon, Cantillon par son intérêt pour l'agronomie et l'économie il insiste notamment sur la circulation de la monnaie et l’idée du circuit économique dont il est un des précurseurs. Il prône les valeurs qui seront défendues au XVIIIe siècle par Quesnay, et il encourage les nobles à quitter la cour pour le service des armes, mais aussi la mise en valeur de leurs domaines dans un mémoire intitulé Idée d’une excellente noblesse et des moyens de la distinguer par les Générations.
Il fut encore un précurseur de Montesquieu par sa conception d'un État chargé avant tout d'assumer la protection de tous et leur bien-être : il veut lutter contre la misère, la corruption, l’incompétence, le mépris du service public.
Hyacinthe Rigaud, Sébastien Le Prestre de Vauban.
Dans tous les cas, Vauban apparaît comme un réformateur hardi dont les idées se situaient à contre-courant de ce que la majorité de ses contemporains pensait. Son contact avec le Roi lui permettait de soumettre directement ses idées, comme le Projet de Dîme royale, qui fut bien reçu. Louis XIV lui rendait bien cette franchise, cette liberté de parole et de jugement, en lui accordant une confiance absolue en matière de défense du royaume, comme en témoigne cette lettre dans laquelle il lui confie la défense de Brest, visé par les Anglais en 1694 :
Je m’en remets à vous, de placer les troupes où vous le jugerez à propos, soit pour empêcher la descente, soit que les ennemis fassent le siège de la place. L’emploi que je vous donne est un des plus considérables par rapport au bien de mon service et de mon royaume, c’est pourquoi je ne doute point que vous ne voyiez avec plaisir que je vous y destine et ne m’y donniez des marques de votre zèle et de votre capacité comme vous m’en faites en toutes rencontres.
Avant tout connu de ses contemporains pour sa maîtrise de l'art de la guerre et de la conduite de siège ainsi que pour ses talents d'ingénieur, Vauban ne se limite donc pas à ces quelques domaines. C’est bien, à chaque fois, le même homme dont toute l’œuvre, de pierre et de papier, témoigne d’une même obsession : l’utilité publique, que ce soit par le façonnement du paysage et la défense du territoire avec la construction de la ceinture de fer enfermant la France dans ses bornes naturelles, point au-delà du Rhin, des Alpes, des Pyrénées, des deux mers 1706, la transformation de l’ordre social au moyen d’une réforme de l’impôt, quand bien même, en bravant tous les interdits, faudrait-il, pour se faire entendre, passer par la publication clandestine de la Dîme royale, en 1707… Je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble, écrivait-il à Louvois dans une lettre datée du 15 septembre 1671 à propos d’une accusation lancée contre deux de ses ingénieurs. Et il ajoutait : La fortune m’a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France ; mais en récompense, elle m’a honoré d’un cœur sincère si exempt de toutes sortes de friponneries qu’il n’en peut même soutenir l’imagination sans horreur.
Activités militaires
Apports à la poliorcétique poliorcétique. tracé à l'italienne.
Frontispice de Conduite des sièges de Vauban, 1672.
Les progrès de l'artillerie révolutionnent la guerre de siège : depuis la Renaissance, l'augmentation d'épaisseur des murailles ne suffit plus pour résister aux effets de l'artillerie. Les tirs de mitraille rendant extrêmement périlleux les assauts frontaux, l'assaillant approche les fortifications par des réseaux de tranchées. Les ingénieurs italiens inventent les fortifications bastionnées et remparées : les murailles deviennent très basses, obliques et précédées d'un fossé.
Vauban, que son contemporain Manesson Mallet juge incomparable en l'Art de fortifier et d'attaquer les places, apporte trois innovations majeures décisives aux techniques d'attaque des places fortes :
Il codifie la technique d'approche en faisant creuser trois tranchées parallèles très fortifiées reliées entre elles par des tranchées de communications en ligne brisée pour éviter les tirs défensifs en enfilade technique des parallèles inventée au siège de Maastricht en 1673.
creusée hors de portée de canon à boulet sphérique métallique portée utile de 600 m à l'époque mais cassant tout à 100 m et très fortifiée, la première tranchée sert de place d'armes et prévient une attaque à revers par une armée de secours ;
à portée de tir, la deuxième tranchée permet d'aligner l'artillerie que l'on positionne vers un point de faiblesse des fortifications ;
à proximité immédiate des fortifications, la troisième tranchée permet le creusement d'une mine ou l'assaut si l'artillerie a permis d'ouvrir une brèche dans la muraille. Le retranchement doit être suffisant pour interdire une sortie des défenseurs.
L'éperon des forteresses bastionnées créant une zone où l'artillerie de l'assiégé ne peut tirer à bout portant, il est possible de disposer des levées de terre devant la tranchée immédiatement au contact des fortifications assiégées très basses pour éviter les tirs d'artillerie. Ces surélévations qu'il appelle cavaliers de tranchées conçus lors du siège de Luxembourg, en 1684, permettent aux assaillants de dominer les positions de tir des assiégés et de les refouler à la grenade vers le corps de place et de s'emparer du chemin couvert.
En 1688 au siège de Philippsburg, il invente le tir à ricochet : en disposant les pièces de manière à prendre en enfilade la batterie adverse située sur le bastion attaqué et en employant de petites charges de poudre, un boulet peut avoir plusieurs impacts et en rebondissant balayer d'un seul coup toute une ligne de défense au sommet d'un rempart, canons et servants à la fois.
Codification des attaques des places fortes par Vauban.
Trois tranchées parallèles reliées entre elles par des tranchées de communications en zigzags pour éviter les tirs en enfilade. Chaque tranchée est une place d'armes qui permet de rapprocher l'infanterie sur toute la largeur du front d’attaque ; la première est hors de portée de tir des défenseurs et permet de résister à un assaut à revers ; la troisième est au pied du glacis. L’artillerie est placée sur des cavaliers, relié au réseau par des tranchées plus courtes. Des redoutes protègent les extrémités de chaque tranchée.
Sa philosophie est de limiter les pertes en protégeant ses approches par la construction de tranchées, même si cela demande de nombreux travaux. Il est pour cela souvent raillé par les courtisans, mais il est soutenu par le roi. Il rédige, en 1704, un traité d'attaque des places pour le compte de Louis XIV qui souhaite faire l'éducation militaire de son petit-fils le duc de Bourgogne. Il invente le « portefeuille de casernement casernes modèles destiné à remplacer le logement du soldat chez l'habitant.
Le défenseur du " pré carré "
Une coupe des fortifications Vauban, suivant la ligne capitale passant par une demi-lune :
Citadelle de Besançon en Franche-Comté.
Tour Vauban à Camaret en Bretagne.
Étoile de Vauban de la citadelle de Lille.
Vauban va ainsi pousser le roi à révolutionner la doctrine militaire défensive de la France en concentrant les places fortes sur les frontières du Royaume c’est la ceinture de fer qui protège le pays : le pré carré du roi.
Fort de son expérience de la poliorcétique, il révolutionne aussi bien la défense des places fortes que leur capture. Il conçoit ou améliore les fortifications de nombreux ports et villes français, entre 1667 et 1707, travaux gigantesques permis par la richesse du pays. Il dote la France d'un glacis de places fortes pouvant se soutenir entre elles : pour lui, aucune place n'est imprenable, mais si on lui donne les moyens de résister suffisamment longtemps des secours peuvent prendre l'ennemi à revers et le forcer à lever le siège.
À l’intérieur du pays, où le danger d’invasion est moindre, les forteresses sont démantelées. Paris perd par exemple ses fortifications, d’une part, pour libérer des troupes devenues inutiles qui peuvent être transférées aux frontières et d’autre part, pour éviter que des révoltes puissent trouver asile dans l’une d’elles comme cela avait été le cas lors de la Fronde.
Au total, Vauban crée ou élargit plus de 180 forteresses et donne son nom à un type d'architecture militaire : le système Vauban. Système qui est largement repris, même hors de France, voir les fortifications de la ville de Cadix.
Il participe aussi à la réalisation d'autres ouvrages, tels que le canal de Bourbourg. Entre 1667 et 1707 Vauban améliore les fortifications d'environ 300 villes et dirige la création de trente-sept nouveaux ports dont celui de Dunkerque et forteresses fortifiées.
Édifié sur un emplacement stratégique, à partir de 1693, Mont-Dauphin est un avant poste chargé de protéger le royaume des intrusions venues d’Italie : le village-citadelle constitue l’archétype de la place forte et fait entrer les Alpes dans la grande politique de défense de la nation France.
Liste des villes fortifiées par Vauban
Liste des citadelles de Vauban
Liste des villes créées par Vauban
Liste des forts de Vauban
Il refuse de créer le fort Boyard, selon lui techniquement inconstructible, que Napoléon Ier tente de recréer lors de son règne à partir de ses plans sans plus de succès néanmoins. Finalement, sous Louis-Philippe agacé par des tensions entretenues avec les Britanniques, le Fort Boyard voit le jour, grâce à une technique de construction du socle avec des caissons de chaux.
Maquettes et Plans-reliefs
Plan-relief de 1703 de la citadelle du Château-d'Oléron, Paris, musée des Plans-reliefs.
Les plans-reliefs réalisés à partir du règne de Louis XIV sont conservés au musée des Plans-reliefs, au sein de l'hôtel des Invalides à Paris où 28 d'entre eux sont présentés. Une partie de la collection 16, est, après un long débat, présentée au palais des beaux-arts de Lille. Vauban est intervenu sur la plupart des places représentées. Les maquettes donnent une excellente vue du travail réalisé.
Activités civiles : Vauban critique et réformateur
Vauban a également construit l'aqueduc de Maintenon tout en s'opposant au grandiose aqueduc à la romaine voulu par Louis XIV et Louvois, qu'il jugeait d'un prix beaucoup trop élevé : il militait pour un aqueduc rampant. Il s'est intéressé à la démographie et à la prévision économique. Il conçut des formulaires de recensement et publia un ouvrage intitulé La Cochonnerie ou calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant dix années de temps.
Entre l'amour du roi et le bien public
Vauban a pris, à partir de la fin des années 1680, une distance de plus en plus critique par rapport au roi de guerre, en fustigeant une politique qui lui semble s’éloigner de ses convictions de grandeur et de défense de sa patrie, le tout au nom du bien public.
Ce divorce est particulièrement apparent dans son Mémoire sur les huguenots, dans lequel il tire les conséquences, très négatives, de la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, en soulignant que l’intérêt général est préférable à l’unité du royaume quand les deux ne sont pas compatibles. D’autant que travaillant sur le canal du Midi en 1685-1686, il a vu les effets des dragonnades sur la population. Dans ce mémoire, Vauban estime le nombre des protestants sortis du royaume à :
80 000 ou 100 000 personnes de toutes conditions, occasionnant la ruine du commerce et des manufactures, et renforçant d’autant les puissances ennemies de la France.
L’itinéraire de Vauban, une pensée en mobilité constante à l’image de ses déplacements incessants dans le royaume réel, font de lui un penseur critique tout à fait représentatif de la grande mutation des valeurs qui marque la fin du règne de Louis XIV : le passage, en quelque sorte, du roi État, incarné par Louis XIV, à l’État roi, indépendant de la personne de celui qui l’incarne.
Fontenelle, dans l’éloge funèbre qu’il rédige pour Vauban, l’a très bien exprimé :
Quoique son emploi ne l’engageât qu’à travailler à la sûreté des frontières, son amour pour le bien public lui faisait porter des vues sur les moyens d’augmenter le bonheur du dedans du royaume. Dans tous ses voyages, il avait une curiosité, dont ceux qui sont en place ne sont communément que trop exempts. Il s’informait avec soin de la valeur des terres, de ce qu’elles rapportaient, de leur nombre, de ce qui faisait leur nourriture ordinaire, de ce que leur pouvait valoir en un jour le travail de leurs mains, détails méprisables et abjects en apparence, et qui appartiennent cependant au grand Art de gouverner …. Il n’épargnoit aucune dépense pour amasser la quantité infinie d’instructions et de mémoires dont il avoit besoin, et il occupoit sans cesse un grand nombre de secrétaires, de dessinateurs, de calculateurs et de copistes
— Fontenelle, Éloge de Monsieur le Maréchal de Vauban
Et, à la fin de sa vie, on sent Vauban profondément écartelé entre sa fidélité au roi et son amour de la patrie au nom du bien général qui ne lui semble plus devoir être confondu avec celui du roi. Cet écartèlement, il l’exprime dès le 26 avril 1697 dans une lettre au marquis de Cavoye :
Je suis un peu têtu et opiniâtre quand je crois avoir raison. J’aime réellement et de fait la personne du roi, parce que le devoir m’y oblige, mais incomparablement plus parce que c’est mon bienfaiteur qui a toujours eu de la bonté pour moi, aussi en ai-je une reconnaissance parfaite à qui, ne plaise à Dieu, il ne manquera jamais rien. J’aime ma Patrie à la folie étant persuadé que tout citoyen doit l’aimer et faire tout pour elle, ces deux raisons qui reviennent à la même.
Dans une certaine mesure la Dîme Royale, publiée en 1707, parce qu’elle dissocie le roi et l’État, peut être lue comme le résultat très concret de la tension et de la contradiction entre l’amour du roi et l’amour de la patrie…
Les années de misère : l'observateur lucide du royaume réel
Depuis longtemps, en effet, Vauban s'intéressait au sort des plus démunis, attentif avant tout à la peine des hommes. Ses déplacements incessants dans les provinces (Anne Blanchard estime la distance parcourue à plus de 180 000 km pour 57 années de service, soit 3 168 km par an ! sont contemporains des années les plus noires du règne de Louis XIV, en particulier la terrible crise des années 1693-1694. Et il a pu observer, comme il l’écrit en 1693, les vexations et pilleries infinies qui se font sur les peuples. Sa hantise c’est le mal que font quantité de mauvais impôts et notamment la taille qui est tombée dans une telle corruption que les anges du ciel ne pourraient pas venir à bout de la corriger ni empêcher que les pauvres n’y soient toujours opprimés, sans une assistance particulière de Dieu. Vauban voyage à cheval ou dans sa basterne, une chaise de poste qui serait de son invention et suffisamment grande pour pouvoir y travailler avec son secrétaire, portée sur quatre brancards par deux mules, l’une devant, l’autre derrière. Pas de roues, pas de contact avec le sol : les cahots sur les chemins de pierres sont ainsi évités, il peut emprunter les chemins de montagne, et Vauban est ainsi enfermé avec ses papiers et un secrétaire en face de lui. En moyenne, il passe 150 jours par an sur les routes, soit une moyenne de 2 à 3 000 km par an le maximum : 8 000 km de déplacement en une année !.
Il est fortement marqué par cette crise de subsistances des années 1693-1694, qui affecta surtout la France du Nord, provoqua peut-être la mort de deux millions de personnes. Elle aiguisa la réflexion de l'homme de guerre confronté quotidiennement à la misère, à la mort, à l'excès de la fiscalité royale : la pauvreté, écrit-il, ayant souvent excité ma compassion, m'a donné lieu d'en rechercher la cause.
L'homme de plume
Pendant ces années terribles 1680-1695 marquées par trois années de disette alimentaire sans précédent au cours des hivers 1692-93-94, l’homme de guerre se fait homme de plume :
Oisivetés ou ramas de plusieurs sujets à ma façon.
C’est Fontenelle, qui révèle dans son éloge de Vauban, l’existence de ce recueil de mémoires reliés et collationnés en volumes au nombre de douze… C’est sans doute à partir de la mort de Colbert 1683, qu’il rédige ce ramas d’écrits, extraordinaire et prolifique document, souvent décousu, dans lesquelles il consigne, en forme de vingt-neuf mémoires manuscrits soit 3 850 pages manuscrites en tout ses observations, ses réflexions, ses projets de réformes, témoignant d’une curiosité insatiable et universelle. Une brève note de Vauban, incluse dans un agenda, daté du 4 mai 1701, éclaire le recueil alors en cours de constitution :
Faire un deuxième volume en conséquence du premier et y insérer le mémoire des colonies avec la carte et celui de la navigation des rivières avec des figures de far et d’escluses calculées ; y ajouter une pensée sur la réduction des poids et mesures en une seule et unique qui fut d’usage partout le Royaume.
La vie errante que je mène depuis quarante ans et plus, écrit-il dans la préface de la Dîme royale, m’ayant donné occasion de voir et visiter plusieurs fois et de plusieurs façons la plus grande partie des provinces de ce royaume, tantôt seul avec mes domestiques, et tantôt en compagnie de quelques ingénieurs, j’ai souvent occasion de donner carrière à mes réflexions, et de remarquer le bon et le mauvais état des pays, d’en examiner l’état et la situation et celui des peuples dont la pauvreté ayant souvent excité ma compassion, m’a donné lieu d’en rechercher les causes.
Les Oisivetés, pour la première fois publiées éditions Champ Vallon, sont détenues par la famille Rosanbo. L’ensemble représente 68 microfilms de papiers et mémoires en tout 29 mémoires importants, plus de 2 000 pages, auxquels il faut ajouter 47 microfilms de correspondance.
Description géographique de l'élection de Vézelay.
Parmi les multiples mémoires, qui sont souvent autant d’exemples des statistiques descriptives, l'ouvrage est sans doute le plus abouti : Il décrit les revenus, la qualité, les mœurs des habitants, leur pauvreté et richesse, la fertilité du pays et ce que l’on pourrait y faire pour en corriger la stérilité et procurer l’augmentation des peuples et l’accroissement des bestiaux.
Le Projet de Capitation 1694
Et ce qui domine dans cette écriture prolifique, c’est la notion d’utilité publique, au service des plus démunis. Et le tout conduit bientôt Vauban à imaginer une réformation globale, capable de répondre au problème de la misère et de la pauvreté, auquel il est sans cesse confronté. Ainsi, dès 1694, Vauban présente un Projet de capitation, fruit de multiples réflexions et de débats, notamment avec Boisguilbert, lieutenant-général à Rouen qui publie en 1695 son Détail de la France que Vauban a lu et apprécié. Et parallèlement, Vauban profite de multiples entretiens avec un grand nombre de personnes et des officiers royaux de toutes espèces qui suivent le roi.
Le Projet de capitation annonce son futur essai : il y propose un impôt levé, sans aucune exemption, sur tous les revenus visibles les produits fonciers, les rentes, les appointements…et condamne la taille, tombée dans une telle corruption que les anges du ciel ne pourraient venir à bout de la corriger. Dans ce Projet, il dénonce l’accablement des peuples, poussé au point où nous le voyons.
En conséquence, il écrit la capitation doit être imposée sur toutes les natures de biens qui peuvent produire du revenu, et non sur les différents étages des qualités ni sur le nombre des personnes, parce que la qualité n’est pas ce qui fait l’abondance, non plus que l’égalité des richesses, et que le menu peuple est accablé de tailles, de gabelles, d’aides et de mille autres impôts, et encore plus de la famine qu’ils ont soufferte l’année dernière, qui a achevé de les épuiser.
L'année suivante, le 18 janvier, le pouvoir royal met effectivement en place une capitation, un impôt auquel, en théorie, tous les sujets, des princes du sang aux travailleurs de terre, sont assujettis, de 1 à 2 000 livres, en fonction de leur fortune. Mais contrairement à l'idée de Vauban, cet impôt s'ajoute aux autres, et la plupart des privilégiés, par abonnement ou par rachat, ont tôt fait de s'en faire dispenser.
L'homme politique
Bien qu'il soit militaire, Vauban n'hésite pas à donner son avis dans les affaires de l'État, ainsi, en 1683, il propose un traité de paix avec l'Allemagne en en précisant les conditions soit la cession pure et simple de la part de l'empereur des pays nouvellement réunis aux trois évêchés, de toute l'Alsace et notamment de la ville de Strasbourg. En échange, Louis XIV donnerait les villes de Brisach et de Fribourg. Cette proposition est loin d'être innocente puisque d'après l'intéressé, ces deux places sont plus une charge qu'autre chose pour le royaume de France. Cette proposition lui vaudra une remontrance de Louvois par un courrier du 24 août 1683 : … je vous répondrai en peu de paroles que si vous étiez aussi mauvais ingénieur que politique, vous ne seriez pas si utile que vous êtes au service du roi.
1703-1706 : De l'amertume à la transgression
En octobre 1706, Vauban se trouve à Dunkerque, une ville forte qu’il considère comme sa plus belle réussite et qu’il a transformée en une cité imprenable : un formidable ensemble de forts de défense, de bâtiments, de jetées, de fossés remplis d’eau, et d’un bassin pouvant contenir plus de quarante vaisseaux de haut bord toujours à flot, même à marée basse, grâce à une écluse. Du reste, à propos de son Dunkerque, le 16 décembre 1683, il écrit à Louvois, en faisant preuve, une fois n’est pas coutume, de peu de modestie :
Dès l’heure qu’il est, ce port et son entrée me paraissent une des plus belles choses du monde et la plus commode, et si je demeurais six mois à Dunkerque, je ne crois pas que ma curiosité ni mon admiration seraient épuisées quand je les verrais tous les jours une fois.
Pourquoi est-il à Dunkerque ? Parce que le roi lui confie le commandement de la frontière maritime des Flandres alors sérieusement menacée. Il a l’autorisation de construire un camp retranché à Dunkerque, puis un deuxième entre Dunkerque et Bergues. Mais les fonds nécessaires n’arrivent pas et il s’en plaint au maréchal de Villeroy, qui lui répond le 17 juillet :
vous être le seul à pouvoir obtenir de la cour l’argent et les moyens nécessaires pour terminer les travaux des camps retranchés qui sont bien utiles.
Vauban écrit à Chamillard, le ministre de la Guerre et des Finances, le 10 août :
si M. Le Pelletier s’obstine davantage sur ce que je lui demande il n’envoie pas les fonds, je serai obligé d’en écrire au roi et de le prier de me retirer d’ici. »
Ce qu’il fait à soixante-treize ans : c'est là, à Dunkerque, à son Dunkerque, que Vauban demande à être relevé de son commandement : J'ai hier demandé mon congé, écrit-il de Dunkerque, le 25 octobre 1706, car je ne fais rien ici, et le rhume commence à m’attaquer rudement. Quelques jours plus tard, il insiste auprès de Chamillard pour être relevé de son commandement :
quand on sort d’un cinquième ou sixième accès de fièvre tierce qui s’est converti en double tierce, on n’est plus en état de soutenir la gageure. Je vous prie de trouver bon que je vous demande M. d’Artagnan pour me venir relever ici pour l’hiver.
Il souffre depuis longtemps d’un rhume récurrent, en fait une forme de bronchite chronique, et vient effectivement de subir de violents accès de fièvre (et sa présence à Dunkerque, dans les marais des plaines du Nord, n’est pas faite pour le guérir !.
Mais il y a des raisons plus profondes, sans doute, plus intimes, à cette demande insistante de retrait. En fait, Vauban est plein d’amertume depuis le siège de Brisach, en 1703, le dernier siège dont il a le commandement : il enseigne à cette occasion au duc de Bourgogne, le petit-fils du roi, les choses de la guerre et écrit, à son intention -sur ordre de Louis XIV-, un traité De l’attaque et de la défense des places afin de parfaire son éducation militaire qui constitue le huitième tome des Oisivetés.
La grâce que j’ose vous demander, Monseigneur, est de vouloir bien vous donner la peine de lire ce Traité avec attention, et qu’il vous plaise de le garder pour vous, et de n’en faire part à personne, de peur de quelqu’un n’en prenne des copies qui, pouvant passer chez nos ennemis, y seraient peut-être mieux reçues qu’elles ne méritent.
épître dédicatoire. Ce qui n’empêche pas la circulation de nombreux manuscrits : plus de 200, déplore en 1739 Charles de Mesgrigny, le petit-fils de Vauban…
Mais après ce siège, plus rien ne lui est proposé. Et il s’en inquiète auprès de Chamillart :
… tout le monde se remue ; il n’y a que moi à qui on ne dit mot. Est-ce que je ne suis plus propre à rien ? Quoique d’un âge fort avancé, je ne me condamne pas encore au repos, et quand il s’agira de rendre un service important au roi, je saurai bien mettre toutes sortes d’égards à part, tant par rapport à moi qu’à la dignité dont il lui a plu m’honorer, persuadé que je suis que tout ce qui tend à servir le roi et l’État est honorable, même jusqu’aux plus petits, à plus forte raison quand on y peut joindre des services essentiels tels que ceux que je puis rendre dans le siège dont il s’agit… Ce qui m'oblige à vous parler de la sorte est qu'il me paraît qu'on se dispose à faire le siège sans moi. Je vous avoue que cela me fait de la peine, mettez y donc ordre.
Chamillart lui répond qu’il a lu sa lettre à Louis XIV, qui a résolu de faire le siège de Landau. Mais il ajoute dans sa lettre du 6 octobre 1703 : Elle m’ordonne de vous dire en même temps qu’elle a résolu d’en laisser la conduite entière à M. le maréchal de Tallart… Opportunément, Vauban est convoqué à Paris, chargé de l'instruction du duc de Bourgogne. Ce qui ne l'empêche pas de rédiger ses préconisations pour le siège en préparation.
L’amertume pour Vauban est alors à son comble. Et il exprime ses craintes dans une autre lettre écrite à Chamillard en 1705. Cette lettre accompagne un mémoire consacré au siège de Turin, car Vauban continue à suivre de très près les opérations militaires, et il n’est pas satisfait de leur déroulement. Aussi multiplie-t-il avis et conseils. Après de nombreux détails techniques, Vauban ajoute ces lignes, des lignes particulièrement émouvantes, dans lesquelles le vieux maréchal continue à offrir ses services :
Après avoir parlé des affaires du roi par rapport à la lettre de M. Pallavicini et à ce qui est de la portée de mes connaissances, j’ose présumer qu’il me sera permis de parler de moi pour la première fois de ma vie.
Je suis présentement dans la soixante-treizième année de mon âge, chargé de cinquante-deux ans de service, et surchargé de cinquante sièges considérables et de près de quarante années de voyages et visites continuelles à l’occasion des places et de la frontière, ce qui m’a attiré beaucoup de peines et de fatigues de l’esprit et du corps, car il n’y a eu ni été ni hiver pour moi. Or, il est impossible que la vie d’un homme qui a soutenu tout cela ne soit fort usée, et c’est ce que je ne sens que trop, notamment depuis que le mauvais rhume qui me tourmente depuis quarante ans s'est accru et devient de jour en jour plus fâcheux par sa continuité ; d’ailleurs, la vue me baisse et l’oreille me devient dure, bien que j’ai la tête aussi bonne que jamais. Je me sens tomber et fort affaibli par rapport à ce que je me suis vu autrefois. C’est ce qui fait que je n’ose plus me proposer pour des affaires difficiles et de durée qui demandent la présence presque continuelle de ceux qui les conduisent. Je n’ai jamais commandé d’armée en chef, ni comme général, ni comme lieutenant général, pas même comme maréchal de camp, et hors quelque commandement particulier, comme ceux d’Ypres, Dunkerque et de la basse Bretagne, dont je me suis, Dieu merci, bien tiré, les autres ne valent pas la peine d’être nommés. Tous mes services ont donc roulé sur les sièges et la fortification ; de quoi, grâce au Seigneur, je suis sorti avec beaucoup d’honneurs. Cela étant, comme je le dis au pied de la lettre, il faudrait que je fusse insensé si, aussi voisin de l’état décrépit que je le suis, j’allais encore voler le papillon et rechercher à commander des armées dans des entreprises difficiles et très épineuses, moi qui n’en ai point d’expérience et qui me sens défaillir au point que je ne pourrais pas soutenir le cheval quatre heures de suite ni faire une lieue à pied sans me reposer.
Il faut donc se contenter de ce que l’on fait et du moins ne pas entreprendre choses dans l’exécution desquelles les forces et le savoir-faire venant à me manquer pourraient me jeter dans des fautes qui me déshonoreraient ; ce qu’à Dieu ne plaise, plutôt la mort cent fois.
Quant à ce qui peut regarder mon ministère touchant la conduite des attaques, je pourrais encore satisfaire bien que mal aux fatigues d’un siège ou deux par campagne, si j’étais servi des choses nécessaires et que l’on eût des troupes comme du passé. Mais quand je pense qu’elles ne sont remplies que de jeunes gens sans expérience et de soldats de recrues presque tous forcés et qui n’ont nulle discipline, je tremble, et je n’ose désirer de me trouver à un siège considérable. D’ailleurs la dignité dont il a plu au Roi de m’honorer m’embarrasse à ne savoir qu’en faire en de telles rencontres. En de telles rencontres, je crains le qu'en-dira-t-on de mes confrères, de sorte que je ne sais point trop quel parti prendre, ni comment me déterminer.
Je dois encore ajouter que je me suis défait de tout mon équipage de guerre il y a quatre ou cinq mois, après l’avoir gardé depuis le commencement de cette guerre jusque-là.
Après cela, si c’est une nécessité absolue que je marche, je le ferai au préjudice de tout ce qu’on en pourra dire et de tout ce qui en pourra arriver, le roi me tenant lieu de toutes choses après Dieu. J’exécuterai toujours avec joie ce qui lui plaira de m’ordonner, quand je saurais même y devoir perdre la vie, et il peut compter que la très sensible reconnaissance que j’ai de toutes ses bontés ne s’épuisera jamais ; la seule grâce que j’ai à lui demander est de ménager un peu mon honneur.
Je suis bien fâché, Monsieur, de vous fatiguer d’une si longue lettre, mais je n’ai pas pu la faire plus courte. Je vous l’aurais été porter moi-même si le rhume que m’accable ne me contraignait à garder la chambre.
Bientôt, dans les derniers jours de l’année 1706, il rentre à Paris dans son hôtel de la rue Saint-Vincent dans la paroisse Saint-Roch loué aux neveux de Bossuet, où il s’est installé à partir de 1702 dans l’actuelle rue de Rivoli : Une plaque y commémore la présence de Vauban il y a trois siècles.Il y retrouve, semble-t-il, Charlotte de Mesgrigny, sa fille. Il souffre, il tousse, plus que jamais sa bronchite chronique n’a fait qu’empirer, son vieux corps est miné, mais son esprit a gardé toute sa vivacité.
C’est alors qu’il décide, peut-être incité par l’abbé Vincent Ragot de Beaumont, qui fait fonction de secrétaire, d’imprimer son livre, cette Dîme royale, celui, de tous ses écrits, qu’il estime le plus.
Posté le : 30/04/2016 19:07
|
|
|
|
|
Sébastien Lepreste de Vauban 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 1er mai 1633 naît Sébastien Le Prestre marquis de Vauban
à Saint-Léger-de-Foucheret, aujourd'hui Saint-Léger-Vauban, mort à 73 ans le 30 mars 1707 à Paris est un ingénieur, architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français. Il est nommé maréchal de France par Louis XIV.
Vauban préfigure, par nombre de ses écrits, les philosophes du siècle des Lumières. Comme le souligne Fontenelle dans l'éloge funèbre prononcé devant l'Académie, Vauban a une vision scientifique, sinon mathématique de la réalité et en fait un large usage dans ses activités.
Militaire du Génie, il est élevé à la dignité d'État , Maréchal de France Il participe aux conflits de la Fronde, Guerre de Dévolution, Guerre de la Ligue d'Augsbourg, Guerre de Hollande, Guerre de Succession d'Espagne. Faits d'armes 49 prises de ville, défense de Camaret
Ses distinctions Chevalier de l'ordre de Saint-Louis, il est Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, Il reçoit l'Hommages des l'Hommes illustres Louvre, Ingénieur et architecte militaire, Gouverneur de Lille de 1668 à 1707 Commissaire général des fortifications de 1678 à 1703 Membre de l'Académie des sciences
Expert en poliorcétique c'est-à-dire en l'art d'organiser l'attaque ou la défense lors du siège d'une ville, d'un lieu ou d'une place forte, il donne au royaume de France une ceinture de fer pour faire de la France un pré carré — selon son expression — protégé par une ceinture de citadelles. Il conçoit ou améliore une centaine de places fortes. L'ingénieur n'a pas l'ambition de construire des forteresses inexpugnables, car la stratégie consiste alors à gagner du temps en obligeant l'assaillant à immobiliser des effectifs dix fois supérieurs à ceux de l'assiégé. Il dote la France d'un glacis qui la rend inviolée durant tout le règne de Louis XIV — à l'exception de la citadelle de Lille prise une fois — jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, période où les forteresses sont rendues obsolètes par les progrès de l'artillerie.
La fin de sa vie est marquée par l'affaire de La Dîme royale : dans cet essai, distribué sous le manteau malgré l'interdiction qui le frappe, Vauban propose un audacieux programme de réforme fiscale pour tenter de résoudre les injustices sociales et les difficultés économiques des « années de misère de la fin du règne du Roi Soleil 1692-93-94 sont des années de disette alimentaire épouvantables, qui font 3 millions de morts, soit un dixième de la population.
Douze ouvrages de Vauban, regroupés au sein du réseau des sites majeurs de Vauban, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2008. Le musée des Plans-reliefs aux Invalides à Paris, contient un nombre important de maquettes et de plans-reliefs de ces places.
En bref
La carrière de Vauban correspond à l'apogée de la fortification bastionnée en France, dont les nombreuses guerres du règne de Louis XIV favorisent le développement. Vauban est né à Saint-Léger de Foucheret (actuellement Saint-Léger-Vauban, Yonne) dans une famille de petite noblesse nivernaise. Après des études chaotiques, il commence son apprentissage militaire en 1651 dans le régiment du prince de Condé, en rébellion contre le pouvoir royal. Deux ans plus tard, il est fait prisonnier par les troupes du roi, mais sa bravoure et son efficacité sur le terrain sont déjà connues et Mazarin l'envoie au service du chevalier de Clerville, alors commissaire général des fortifications. Il y apprend le métier d'ingénieur militaire et en obtient le brevet en 1655.
Dès lors, il participe à la plupart des campagnes militaires de Louis XIV, dont le règne personnel vient de commencer. Gouverneur de Lille en 1668, brigadier en 1673, maréchal de camp en 1676, commissaire général des fortifications en 1678, lieutenant des armées du roi en 1688, Vauban n'accédera au maréchalat qu'en 1703.
Ces titres ne rendent pas compte de son action sur le terrain ni de son sens politique. Cet ingénieur militaire est en effet à l'origine de l'aménagement de plus d'une centaine de places fortes situées aux frontières du royaume et au-delà, de la construction d'une trentaine d' enceintes nouvelles et de citadelles, comme celle de Lille, son premier grand projet urbanistique réalisé à partir de 1667. Vauban, ingénieur militaire : Mettant à profit les acquis de ses prédécesseurs, notamment ceux de Blaise de Pagan (1604-1655), Vauban perfectionne les méthodes d'attaque et de défense des places. Il veut à tout prix éviter les pertes en hommes en réduisant la durée des sièges. Et, pour ce faire, il s'inspire des moyens alors utilisés par l'armée ottomane pour investir une place et conçoit un système de tranchées souterraines tracées en ligne brisée et reliées entre elles par des parallèles ceignant les fortifications de la ville. La progression des assiégeants se fait alors par étapes successives, grâce à l'utilisation de batteries d' artillerie qui ont pour mission d'exécuter des brèches. Vauban augmente aussi l'efficacité de ces batteries en inventant le tir à ricochet qui permet aux boulets de faire plusieurs rebonds et de démolir en un seul tir les défenses et les canons ennemis. Il dote enfin les fantassins d'armes mieux adaptées à leurs actions, comme la baïonnette. La modernisation des principes d'attaque fait évoluer la construction des fortifications. Vauban estime que la place forte doit commander le terrain environnant, de façon à permettre des observations tactiques et à empêcher les tirs plongeants de l'ennemi. Il conçoit donc des ouvrages épais, renforcés par d'importants volumes de remblai et maintenus par des maçonneries à l'épreuve des tirs. Il prévoit des remparts munis de bastions convenablement espacés pour éviter des tirs flanquants et protégés par des contregardes et par des ouvrages échelonnés en profondeur. Ces derniers sont destinés à multiplier les obstacles que l'assaillant devra franchir l'un après l'autre.
Vauban est aussi un pragmatique. Il se rend compte que le relief de la place en commande le tracé bastionné, qu'il est impossible de fortifier de la même manière une place de plaine et une place de montagne : les perfectionnements qu'il apporte à la fortification, comme les tours bastionnées à casemates (tour Rivotte à Besançon), ou le doublement des ouvrages au-dehors de la place, dont un des meilleurs exemples est fourni par la place alsacienne d'Huningue, sont toujours introduits en fonction du site. Il constate que la citadelle, lieu de commandement de la place et réduit pour la garnison dans la phase ultime d'un siège, doit, comme à Lille, être éloignée de la cité : cela implique l'agrandissement du périmètre fortifié des places modernisées par Vauban qui veut alors englober tous les organes défensifs dans le même tracé bastionné. Ce qu'on a appelé les « trois systèmes » de Vauban, selon la doctrine établie par le Génie en France aux XVIIIe et XIXe siècles, n'est donc qu'une désignation a posteriori des aménagements variés mis au point par l'ingénieur en vue d'augmenter efficacement la résistance d'une place. L'originalité de Vauban est d'avoir su tirer toutes les conséquences logiques des principes de l'attaque pour construire ou pour rénover les places.
Toujours dans une optique défensive, doublée du souci de stabiliser les frontières nord-est du royaume, Vauban conçoit une double ligne de places fortes qu'il nomme pré carré, destinées à verrouiller les passages les plus vulnérables. Vauban, urbaniste militaire. Pendant les guerres de la ligue d'Augsbourg et de la succession d'Espagne, Vauban se consacre aussi à la défense des côtes et met au point un type de petit fort semi-circulaire adapté aux tirs rasants sur l'eau. L'un des exemples les mieux conservés en est la tour Vauban à Camaret (Finistère). Vauban accorde aussi beaucoup d'attention au front terrestre des fortifications maritimes comme à Blaye Gironde. Il préconise encore l'installation de phares constitués d'une tour principale et d'une tourelle d'escalier, comme celui du Stiff à la pointe ouest de l'île d'Ouessant Finistère. Il encourage le développement de certains ports de guerre : il construit entièrement Dunkerque qu'il relie par un canal à la haute mer pour le garantir de l'ensablement. En montagne, notamment à Briançon, la nature fortement accidentée du terrain l'oblige à renoncer aux dispositions habituelles de la fortification bastionnée pour reprendre celles de la fortification médiévale afin d'échelonner ses enceintes. En plaine, Vauban utilise souvent l'eau pour améliorer le système défensif d'une place : il y fait réaliser des écluses dans le but d'inonder artificiellement celle-ci et d'arrêter la progression de l'ennemi. L'adjonction d'une citadelle érigée à distance de la ville (Arras : 1668 ; Besançon : 1674-1687 ; Strasbourg : 1681) a entraîné la construction en damier de nouveaux quartiers séparés de la citadelle par une zone interdite à la construction, appelée esplanade.
Ainsi, dans les neuf places qu'il crée de toutes pièces pour protéger les frontières (Huningue, Longwy, Phalsbourg : 1679 ; Sarrelouis : 1680 ; Montlouis : 1681 ; Fort-Louis-du-Rhin : 1687, détruite en 1794 ; Montroyal, rasée en 1702 ; Montdauphin : 1692 ; Neufbrisach : 1698), Vauban applique des principes urbanistiques simples et normalisés en matière de construction. Une enceinte le plus régulière possible : le tracé octogonal de Neufbrisach, en est l'application la mieux réussie. Une organisation urbanistique qui réponde aux exigences militaires : ce qui implique un plan en damier et une distribution fonctionnelle des bâtiments publics et des habitations groupés autour d'une place centrale carrée destinée aux manœuvres et aux parades. Les lieux du commandement militaire se combinent harmonieusement avec les lieux voués aux activités civiles (hôtel de ville, halles) et religieuses (église). Les casernes, dont les pavillons situés aux extrémités sont réservés aux officiers, et les magasins à poudre sont construits sur les remparts. La superficie de ces places est délimitée par une enceinte, dont l'extension n'est pas prévue. La construction des bâtiments militaires, qu'il s'agisse des arsenaux ou surtout des casernes, suit des normes strictes, où seuls les matériaux employés changent suivant les régions. Il en est de même pour les constructions civiles. Seules les portes de ville échappent à cette rigueur constructive car Vauban tient à leur conserver un décor sculpté à la gloire du roi.
Comme beaucoup d'hommes de son temps, Vauban a eu l'habitude de consigner ses actions et ses projets par écrit : Le Traité de l'attaque des places et Le Traité de défense des places, publiés l'un et l'autre en 1706, sont passés rapidement à la postérité. En complément à cette œuvre sur le terrain, Vauban poursuit l'initiative de Louvois et fait exécuter les plans en relief des places qu'il construit ou restructure. Ces maquettes, réalisées à l'échelle d'un pied pour cent toises correspondant dans le système métrique au 600e, reproduisent avec soin une place et les travaux prévus. Elles sont ensuite fabriquées sur place par les ingénieurs militaires chargés des travaux de fortification. Une fois achevées, elles sont transportées au Louvre où, propriété personnelle du roi, elles sont gardées aussi jalousement que des secrets militaires. Il reste une trentaine de maquettes fabriquées du vivant de Vauban sur les cent deux encore conservées. Cet ensemble, qui présente un intérêt historique et urbanistique exceptionnel, forme une collection publique appartenant à l'État, partagée depuis 1986 entre Paris hôtel des Invalides, musée des Plans-Reliefs et Lille musée des Beaux-Arts. Vauban, inventeur, penseur et réformateur. En dehors de son œuvre militaire, Vauban est à l'origine de nombreuses réalisations dans des domaines aussi variés que l'agronomie, la démographie ou encore les travaux publics. Ses connaissances techniques le conduisent à s'intéresser à la navigation fluviale qu'il considère comme essentielle au développement de l'économie française. Il essaie de faire comprendre au roi que certains travaux, comme l'aqueduc de Maintenon destiné à alimenter Versailles en eau, sont trop onéreux et pourraient aisément être remplacés par des solutions moins prestigieuses et moins coûteuses.
Comme il connaît admirablement le royaume de France qu'il traverse continuellement, Vauban se rend compte des difficultés auxquelles est confrontée sa population, en particulier les paysans, accablés par les guerres et par les impôts. Il cherche avec lucidité des solutions, qu'il consigne tout au long de sa vie dans de nombreux mémoires ou traités intitulés : Mes Oisivetés, ou Pensées d'un homme qui n'avait pas grand-chose à faire. Ces écrits, consacrés aux sujets les plus divers et réunis en une douzaine de volumes, témoignent non seulement des multiples facettes de son intelligence, mais aussi de son esprit de tolérance. Les thèmes y foisonnent et concernent aussi bien les méthodes de construction que le travail dans les mines. Les méthodes préconisées y sont parfois audacieuses : pour connaître la géographie de la région entourant ses terres dans le Morvan (Description géographique de l'élection de Vézelay, 1696), il conduit son enquête en utilisant, c'est une innovation, des formulaires de statistiques. En politique, Vauban demeure pourtant soucieux de l'autorité du roi, tout en étant conscient des erreurs commises par Louis XIV, notamment lors de la révocation de l'édit de Nantes. Dans le Mémoire pour le rappel des huguenots (1686), il énumère les conséquences tragiques pour la France, tant sur le plan humain que sur le plan économique, de cette décision arbitraire.
Soucieux de plus d'équité, Vauban en vient à s'attaquer aux inégalités fiscales, tout d'abord avec son Projet de capitation (1694), puis en rédigeant en 1698 son Projet d'une dixme royale, publié seulement en 1706 et sans l'autorisation du roi. Conclusion logique de l'évolution généreuse et lucide du maréchal, l'ouvrage préconise un impôt fiscal proportionné au revenu et l'abandon des privilèges du clergé et de la noblesse. Louis XIV condamne le livre : Vauban en meurt de chagrin quelques semaines plus tard. En prononçant son éloge funèbre devant l'Académie des sciences en 1707, Fontenelle souligne la clairvoyance du maréchal. Les générations suivantes et notamment les encyclopédistes n'ont pas saisi la modernité de la pensée économique de Vauban. Il faudra attendre le début du XXe siècle et surtout les années 1970-1980 pour que soit enfin reconnue l'originalité des travaux de Vauban dans le domaine économique. Catherine Brisac
Sa vie
Sébastien Le Prestre de Vauban, né le 1er mai fut baptisé le 15 mai 1633 en l’église de Saint-Léger-de-Foucherets, dans le Morvan un décret impérial transforma le nom en Saint-Léger-Vauban en 1867. Le nouveau-né était issu d’une famille de nobles nivernais récemment agrégés à la noblesse quatrième génération pour l'ascendance paternelle : les origines lointaines sont obscures et les brûlements et les pillages des guerres de religion ont permis, quand il fallut répondre aux enquêtes de noblesse ordonnées par Colbert, de camoufler l’absence de documents plus anciens.
Bazoches
Les Le Prestre furent probablement d’anciens marchands : des Le Prestre s’installèrent à Dun-les-Places, puis à Bazoches où ils dirigèrent un flottage de bois vers Paris par la Cure, l’Yonne et la Seine. Nous savons aussi qu'Emery Le Prestre, l’arrière-grand-père paternel de Vauban, a acquis, en 1555, le château de Bazoches, située à une lieue de Bazoches, et que Vauban rachètera… D’Hozier, examinant en 1705, les preuves de noblesse de Vauban, dira : quelle qualité que celle d’un bailli de village pour le père d’un chevalier du Saint-Esprit ? Et quelles alliances pour des tantes du maréchal que Millereau et Lambert ?7…
On ignore exactement où était située sa maison et en quoi consistait son aménagement intérieur… Vauban, écrira Saint-Simon, toujours cruel et qui pourtant lui reconnaît bien des qualités, petit gentilhomme de campagne tout au plus …. Rien de si court, de si nouveau, de si plat, de si mince.
Son père il a trente ans à sa naissance, Albin ou Urbain Le Prestre suivant les généalogistes, qualifié d’ ecuyer sur le registre de baptême de son fils, appartenait à une lignée noble depuis trois générations, mais cousinait par sa mère avec des maisons d’ancienne chevalerie, les Montmorillon et les Chastellux. Ce fut un homme discret, peu causant, dont la passion principale semble avoir été la greffe des arbres fruitiers il a laissé à la postérité les pommes et les poires Vauban…
Quant à la mère de Vauban, damoiselle Edmée de Carmignolles ou Cormignolles, fille de Jehan Carmignolle, escuyer, âgée de vingt-deux ans à sa naissance, elle sortait d’une famille de marchands et de paysans enrichis, des principaux du village, comme le mentionnent les documents. C'est elle qui apporte en dot une demeure paysanne à Saint-Léger-de-Foucherets.
De son enfance et de son adolescence, on ignore à peu près tout. Nous pouvons simplement supposer qu’il a été élevé à la dure et que, très tôt, il apprit à monter à cheval pour devenir le parfait cavalier qu’il fut longtemps. Et qu’il a vécu toute son enfance dans une ambiance de guerre c’est en 1635 que la France entre dans la guerre de Trente Ans, avec son cortège de violences et de maladies les troupes provoquent dans leur sillage des épidémies de peste : en 1636, on compte plus de cent villages détruits dans la vallée de la Saône.
On peut supposer aussi qu’entre 1643 et 1650, Sébastien Le Prestre aurait fréquenté le collège de Semur-en-Auxois, tenu par les carmes. Il y fait ses humanités : il y a appris le latin, la grammaire, les auteurs antiques, notamment Cicéron et Virgile. Il dit de lui dans son Abrégé des services du maréchal de Vauban, qu’il avait reçu, à l’orée de sa carrière, une assez bonne teinture de mathématiques et de fortification, et ne dessinant d’ailleurs pas mal. On devine donc, pour la suite de sa vie, une enfance plutôt pauvre, au contact des campagnards, mal vêtus, été comme hiver, de toile à demi pourrie et déchirée, chaussés de sabots dans lesquels ils ont les pieds nus toute l’année Description de l’élection de Vézelay, 1696. C’est parmi eux qu’il a mesuré l’âpreté de la vie et c’est eux sans doute qui lui ont transmis le goût de la terre : toute sa vie, il s’appliquera, avec persévérance, à se constituer un domaine, lopin par lopin.
Les guerres domestiques de la Fronde : Vauban condéen
Et puis c’est la Fronde 1648-1652. Vauban est présenté au prince de Condé par un oncle maternel qui est dans son état-major. Le voici engagé dans la rébellion : au début de 1651, probablement vers avril, à 17 ans, il entre comme cadet dans le régiment d’infanterie du prince de Condé, chef du parti frondeur, en suivant l’exemple de nombreux parents et voisins qui ont suivi, par fidélité quasi féodale, les Condé, qui sont gouverneurs de Bourgogne depuis 1631.
En novembre 1652, alors que Vauban expérimente, sur le terrain, ses talents d’ingénieur militaire, il se trouve impliqué dans le siège de Sainte-Menehould prise le 14 novembre par le prince de Condé, et il se distingue par sa bravoure : dans son Abrégé des services le récit de sa carrière, il signale qu’il a été félicité par les officiers du prince pour avoir traversé l’Aisne à la nage sous le feu des ennemis. La place est finalement prise par les Frondeurs. Et Vauban est promu maistre (sous-officier dans le régiment de Condé cavalerie.
Au début de 1653, alors que le prince de Condé est passé au service de l'Espagne, le jeune Vauban, lors d'une patrouille, face aux armées royales fit sa capitulation , mais avec les honneurs il n'est pas démonté, on l'autorise à garder ses armes et il est conduit au camp de Mazarin, qui le fait comparaître, l'interroge et se montre séduit par ce Morvandais râblé et trapu, vigoureux, plein de vie, à la vivacité d’esprit et la repartie remarquable. Le cardinal ministre n’a, semble-t-il, aucune peine à le « convertir. Vauban change de camp. C’est là un décisif déplacement de fidélité : il passe de la clientèle de Monsieur le Prince à celle de Mazarin, c’est-à-dire à celle du roi
Au service du roi
Il se trouve bientôt placé comme volontaire auprès de Louis Nicolas de Clerville, ingénieur et professeur de mathématiques, chargé du siège de Sainte-Menehould la ville qui avait vu Vauban se distinguer dans l’armée rebelle. La ville capitule le 25 novembre 1653, et Vauban, chargé de réparer cette place forte, est nommé lieutenant au régiment d’infanterie de Bourgogne, bientôt surnommé le régiment des repentis, car il recueillait beaucoup d’anciens frondeurs de la province.
Dans les années qui suivent, placé sous la tutelle du chevalier de Clerville Colbert créa pour lui la charge de Commissaire général des fortifications, il servit en Champagne et participa à de nombreux sièges : notamment Stenay siège dirigé par le marquis Abraham de Fabert d'Esternay, une place forte lorraine que le prince de Condé avait obtenue, en 1648, en contrepartie de l’aide qu’il avait apportée à l’État royal, pour en jouir souverainement comme en jouissait Sa Majesté elle-même ». Pour le jeune roi, qui venait d’être sacré à Reims, le 14 juin, prendre Stenay, c’est, d’une certaine manière, outre accompagner l’onction divine d’un sacre militaire, achever la Fronde par la prise de cette ville au centre du territoire contrôlé par le prince de Condé. Le siège dura trente-deux jours et Vauban est assez sérieusement blessé au neuvième jour du siège. Rétabli, il est chargé de marquer l’emplacement où le mineur placera sa mine et il est à nouveau blessé, cette fois-ci par un coup de pierre alors que les assiégés allumaient un grand feu au pied du bastion de la gauche, devant le trou du mineur, qui l’en chassa sans retour. La ville est finalement prise en présence de Louis XIV, le 6 août.
Au lendemain de ce siège, il est promu capitaine ce qui lui vaut une solde de 50 livres, que lui verse chaque mois le trésorier des fortifications au titre de sa fonction d'ingénieur ordinaire, puis il participe au secours d’Arras août 1654, au siège de Clermont-en-Argonne novembre 1654, à la prise de Landrecies juin-juillet 1655 – il est fait alors ingénieur ordinaire du roi par brevet du 3 mai 1655, alors qu’il a vingt-deux ans. L’année suivante, en 1656, il participe au siège de Valenciennes juin-juillet, qui voit l’affrontement des troupes de Turenne pour le roi et de Condé pour les Espagnols. Vauban, blessé au début du siège, a porté un jugement sévère sur cette opération la ville fut obligée de se rendre, faute de vivres, dans son Mémoire pour servir d’instruction à la conduite des sièges. C’est, pour lui, une des opérations les plus mal dirigées par Monsieur de la Ferté auxquelles il ait participé :
Il n’est pas concevable combien les Français y firent de fautes ; jamais les lignes ne furent plus mal faites et plus mal ordonnées, et jamais ouvrage plus mal imaginé que la digue à laquelle on travailla prodigieusement pendant tout le siège, et qui n’était pas encore achevée lorsqu’on fut obligé de le lever.
Puis, en juin-juillet 1657, c’est le siège de Montmédy, en présence du roi, où Vauban est de nouveau blessé : ce fut un siège long – quarante-six jours de tranchée ouverte – particulièrement coûteux en vies humaines.
Vauban évoqua ce siège dans son Traité de l’attaque des places de 1704 :
Il n’y avait que 700 hommes de garnison qui furent assiégés par une armée de 10 000 hommes, que de quatre ingénieurs que nous étions au commencement du siège, destinés à la conduite des travaux, je me trouvais le seul cinq à six jours après l’ouverture de la tranchée, qui en dura quarante-six ; pendant lesquels nous eûmes plus de 300 hommes de tués et 1 800 blessés, de compte fait à l’hôpital, sans y comprendre plus de 200 qui n’y furent pas ; car dans ces temps là, les hôpitaux étant fort mal administrés, il n’y allait que ceux qui ne pouvaient faire autrement, et pas un de ceux qui n’étaient que légèrement blessés ; il faut avouer que c’était acheter les places bien cher…
Il a critiqué avec force la manière dont ce siège sanglant a été mené : elle la citadelle pouvait être emportée en quinze jours si elle eût été bien attaquée. Désormais, et ce sera son obsession tout au long de sa carrière militaire, il fera tout pour épargner le sang des hommes : Il ne faut tenir pour maxime de ne jamais exposer son monde mal à propos et sans grande raison.
Il est encore à Mardyck en septembre 1657, à Gravelines dans l’été 1658, puis à Oudenarde, où il a été fait prisonnier, libéré sur parole, puis échangé. Il est enfin à Ypres, en octobre, sous les ordres de Turenne. La ville est rapidement enlevée, ce qui lui vaut un nouvel entretien avec Mazarin, que Vauban rapporte ainsi : Il le gracieusa fort et, quoique naturellement peu libéral, lui donna une honnête gratification et la flatta de l’espoir d’une lieutenance aux gardes. En fait, cette promotion se fera attendre comme bien d’autres promotions… : contrairement aux promesses de Mazarin, il ne sera nommé lieutenant aux gardes que dix ans plus tard, en 1668.
À vingt-cinq ans, il a déjà le corps couturé de multiples blessures, mais sa bravoure et sa compétence sont reconnues, notamment par Mazarin.
La vie familiale
Après la paix des Pyrénées le 8 novembre 1659 – il a alors vingt-sept ans -, un congé d’un an lui permet de rentrer au pays pour épouser le 25 mars 1660, une petite parente, demi-sœur de cousins germains, Jeanne d’Osnay ou d’Aunay, fille de Claude d'Osnay baron d'Epiry. Elle a 20 ans et est orpheline de mère, le jeune couple s'installe dans le château d'Epiry. À peine marié depuis deux mois, Vauban est rappelé par le service du roi pour procéder au démantèlement de la place forte de Nancy rendue au duc de Lorraine. En fait, par la suite il ne revit plus sa femme, que le temps de brefs séjours (en tout, pas plus de trois ans et demi soit 32 mois sur 44912!) et lorsque Jeanne, en juin 1661 met au monde une petite fille, Charlotte, son mari est à Nancy.
Mais ces rares séjours dans ses terres morvandelles, il y tient par dessus-tout, comme il l’explique au printemps 1680 :Le roi ne pouvait me faire un plus grand plaisir que de me permettre d’aller deux mois chez moi, même si la saison est peu propice à séjourner dans un si mauvais pays que le mien, j’aimerai beaucoup mieux y estre au cœur des plus cruels hivers que de ne point y aller du tout.
Un de ses plus longs séjours à Bazoches eut lieu en 1690 : le roi l’autorisa à y rester presque toute l’année pour soigner une fièvre et une toux opiniâtres. Mais même à Bazoches, il ne cesse de travailler : tout au long de l’année 1690, Louvois lui adressa de multiples mémoires…
Sa femme lui donnera deux filles survivantes la progéniture mâle a prématurément disparu, ce qui fut un drame intime pour Vauban :
Charlotte, née en juin 1661, épousera, le 26 mars 1680, en l’église d’Epiry, en Morvan, Jacques-Louis de Mesgrigny, neveu de Jean de Mesgrigny, grand ami de Vauban, compagnon de siège, ingénieur, lieutenant général et gouverneur de la citadelle de Tournai. Jean-Charles de Mesgrigny, comte d’Aunay 1680-1763, fils de Charlotte Le Prestre de Vauban et de Jacques de Mesgrigny, reçut les papiers de Vauban en héritage dont les manuscrits des Oisivetés, désormais dans la famille de Louis Le Peletier de Rosanbo, président à mortier au parlement de Paris et héritier de Charlotte de Mesgrigny dans la mesure où il a épousé sa fille unique, Marie-Claire Edmée de Mesgrigny, en 1738. Les manuscrits sont aujourd’hui conservés dans le château familial de Rosanbo dans les Côtes d’Armor et microfilmés aux Archives nationales. Le couple eut 11 enfants et un seul Jean-Charles eu une descendance avec deux filles et un garçon. Seule Marie-Claire Aimée de Mesgrigny fut la seule à survivre. Elle est née vingt-cinq ans après la mort. Elle épouse en 1738 Louis Le Peletier de Rosambo, et de cette union naissent trois enfants.
Jeanne-Françoise, la cadette se mariera, le 8 janvier 1691, en l’église Saint-Roch de Paris, avec Louis Bernin, marquis de Valentinay, seigneur d'Ussé, apparenté au contrôleur général des finances Claude le Pelletier, à deux intendants des finances, à des membres de la cour des comptes et à des trésoriers généraux des finances. Ce qui rapproche Vauban du monde des officiers de la finance et des parlementaires. Vauban séjournera souvent à Paris dans le faubourg Saint-Honoré, chez sa fille, tout en ne cessant de demander au roi une maison parisienne. Elle meurt bizarrement à 35 ans au château de Bazoches et son fils unique Louis Sébastien Bernin de Valentinay meurt en 1772 sans enfant.
D’autres unions, de sa part, et passagères, engendreront une demi-douzaine d’enfants naturels, parsemés le long de ses voyages dans les provinces du royaume (sur ce sujet, nous disposons d’un testament émouvant dans lequel il prévoit de laisser des sommes d’argent aux femmes qui disent avoir eu un enfant de lui. Il lègue la coquette somme de 14,000 livres à cinq jeunes femmes avec enfants Grand voyageur, il fait des journées de 30 à 35 kilomètres chacune, avec une record de 250 jours en 1681, grande année d'inspection durant laquelle il parcourt 7 500 kilomètres, à cheval ou dans sa basterne, une chaise de poste qui serait de son invention et suffisamment grande pour pouvoir y travailler avec son secrétaire.
Ingénieur royal : le preneur de villes
Ingénieur militaire responsable des fortifications
Ses talents sont alors reconnus et le 3 mai 1655, à l'âge de 22 ans, il devient ingénieur militaire responsable des fortifications» et, en 1656, il reçoit une compagnie dans le régiment du maréchal de La Ferté. De 1653 à 1659, il participe à 14 sièges et est blessé plusieurs fois. Il perfectionne la défense des villes et dirige lui-même de nombreux sièges. En 1667, Vauban assiège les villes de Tournai, de Douai et de Lille, prises en seulement neuf jours. Le roi lui confie l'édification de la citadelle de Lille qu'il appellera lui-même la "Reine des citadelles". C'est à partir de Lille qu'il supervise l'édification des nombreuses citadelles et canaux du Nord, lesquels ont structuré la frontière qui sépare toujours la France de la Belgique. Il dirige aussi le siège de Maastricht en 1673. Enfin, il succède le 4 janvier 1678 à Clerville au poste de commissaire général des fortifications.
1673. Le siège de Maastricht
Maastricht était une place stratégique, située au confluent du fleuve Meuse et de son affluent la Geer, protégée par d’importantes fortifications et d’énormes travaux extérieurs l’enserrant dans une quadruple ceinture de pierres. L’effectif des assiégeants se montait à 26 000 fantassins et 19 000 cavaliers. L’artillerie disposait de 58 pièces de canon, un chiffre énorme pour l’époque, et les magasins renfermaient pour plus de dix semaines de vivres et de munitions. Jamais un aussi grand appareil de forces n’avait été déployé en vue d’un siège. Et pour la première fois, la direction supérieure des travaux était soustraite aux généraux et confiée à un ingénieur : Vauban, qui avait sous ses ordres le corps du génie tout entier et il était entièrement responsable de la conduite de tous les travaux du siège. Appuyé sur le corps du génie, il inaugure un nouveau mode d’approche des prises de places. Tout alors fut différent : jusqu’alors, les travaux d’approche consistaient en une tranchée unique fort étroite, derrière laquelle s’abritaient les travailleurs, mais qui ne donnait pas aux troupes un espace suffisant pour se mouvoir, et provoquait de terribles boucheries. “ Du temps passé, écrit dans ses Mémoires le comte d’Aligny, alors officier aux mousquetaires, c’était une boucherie que les tranchées ; c’est ainsi qu’on en parlait. Maintenant, Vauban les fait d’une manière qu’on y est en sûreté comme si l’on était chez soi ”. Vauban rationalisa, en effet, le procédé d'attaque mis au point par les Turcs lors du long siège de Candie qui s'acheva en 1669.
Les douze phases du siège
L’ensemble du siège, union de tactiques traditionnelles et nouvelles, se décompose en douze phases :
- Phase 1. Investissement de la place. Il faut agir rapidement et par surprise. L'armée de siège coupe la place en occupant toutes les routes d'accès et en la ceinturant rapidement de deux lignes de retranchement parallèles un vieux procédé, mis au point par les Romains.
- Phase 2. Construction de deux lignes de retranchement autour de la place investie :
Une ligne de circonvallation, tournée vers l'extérieur et qui interdit toute arrivée de secours ou de vivres et de munitions venant de l'extérieur.
Une ligne de contrevallation est construite, tournée vers la place, elle prévient toute sortie des assiégés. Elle est située environ à 600 mètres, c'est-à-dire au-delà de la limite de portée des canons de la place assiégée.
L'armée de siège établit ses campements entre ces deux retranchements.
-Phase 3. Phase de reconnaissance. Intervention des ingénieurs assiégeants qui effectuent des reconnaissances pour choisir le secteur d'attaque qui est toujours un front formé de deux bastions voisins avec leurs ouvrages extérieurs (demi-lune, chemin couvert et glacis. Il faut souligner le rôle des ingénieurs dans cette phase et l'importance des études de balistique, de géométrie, de mathématiques. On oublie parfois que les premiers travaux de l'académie des sciences, fondée par Colbert en 1665, furent consacrés à des études qui avaient des relations directes avec les nécessités techniques imposées par la guerre. Colbert suscita ainsi, en 1675, des recherches sur l'artillerie et la balistique afin de résoudre la question de la portée et de l'angle des tirs d'après les travaux de Torricelli qui prolongeaient ceux de Galilée. L'ensemble aboutit à la rédaction du livre de François Blondel, L'art de jeter les bombes, publié en 1683. Depuis 1673, l'auteur donnait des cours d'art militaire au Grand Dauphin.
- Phase 4. Travaux d'approche. Cette fois, il s’agit des nouveautés introduites par Vauban. Les travaux d’approche s'effectuent à partir de la contrevallation et ils se présentent sous la forme de deux tranchées et non plus une seule creusées en zig zag ce cheminement brisé évitant les tirs d'enfilade des assiégés qui s'avancent progressivement vers les deux saillants des bastions en suivant des lignes qui correspondent à des zones de feux moins denses de la part des assiégés. Vauban s'inspire des tranchées en zig zag utilisées par les ottomans sous la direction d'un ingénieur italien au siège de Candie, les multiplie et les rationalise .
- Phase 5. Construction d'une première parallèle ou place d’armes. À 600 mètres de la place limite de portée des canons, les deux boyaux sont reliés par une première parallèle au front attaqué, appelée aussi place d’armes, qui se développe ensuite très longuement, à gauche et à droite, jusqu'à être en vue des faces externes des deux bastions attaqués et de leurs demi-lunes voisines. Cette première parallèle est une autre innovation de Vauban, inspirée d’une technique turque au siège de Candie. Pelisson écrit que Vauban lui a avoué qu’il avait imité des Turcs dans leurs travaux devant Candie Lettres historiques, III, p. 270 La parallèle a plusieurs fonctions :
Relier les boyaux entre eux, ce qui permet de se prêter renfort en cas de sortie des assiégés sur l'un d'entre eux, et de masser à couvert des troupes et du matériel.
Placer des batteries de canons qui commencent à tirer en enfilade sur les faces des bastions et des demi lunes choisies pour l'assaut.
Le système des parallèles, fortifiées provisoirement, a l'avantage de mettre l'assaillant à couvert pour l'approche des défenses.
Louis XIV, lui-même, en témoigne, dans ses Mémoires :
La façon dont la tranchée était conduite, empêchait les assiégés de rien tenter ; car on allait vers la place quasi en bataille, avec de grandes lignes parallèles qui étaient larges et spacieuses ; de sorte que, par le moyen des banquettes qu’il y avait, on pouvait aller aux ennemis avec un fort grand front. Le gouverneur et les officiers qui étaient dedans n’avaient encore jamais rien vu de semblable, quoique Fargeaux [le gouverneur de Maastricht] se fût trouvé en cinq ou six places assiégées, mais où l’on n’avait été que par des boyaux si étroits qu’il n’était pas possible de tenir dedans, à la moindre sortie. Les ennemis, étonnés de nous voir aller à eux avec tant de troupes et une telle disposition, prirent le parti de ne rien tenter tant que nous avancerions avec tant de précautions.
- Phase 6. La progression des deux tranchées. Elle reprend, jusqu'à 350 mètres de la place, distance où l'on établit une deuxième parallèle tout à fait comparable à la première et jouant le même rôle.
- Phases 7, 8, 9. Progression à partir de la construction de trois tranchées : les deux précédentes, plus une nouvelle, suivant l'axe de la demi lune visée. Plus construction de tronçons de parallèles qui servent à faire avancer au plus près des canons.
- Phase 10. Tirs à bout portant sur les escarpes parois des fossés et les bastions pour les faire s'effondrer et pratiquer la brèche qui permettra l'assaut.
- Phase 11. Ouverture de la brèche par mine. Il s'agit là d'un travail de sape, long et dangereux pour les mineurs spécialisés dans ce type d'ouvrage.
- Phase 12. Assaut. Montée à pied sur l'éboulement de la brèche au sommet de laquelle on établit un "nid de pie" pour être sûr de bien tenir. À ce stade, le gouverneur de la place assiégée estime souvent que la partie est perdue, et il fait battre la chamade : offre de négociation en vue d'une reddition honorable.
Qu'est-ce qu'un siège à la Vauban ?
Au total, on le voit, le siège à la Vauban est une méthode raisonnée dans laquelle l'ingénieur mathématicien coordonne tous les corps de troupe. Ce qui n’évita pas de nombreux morts d’Artagnan notamment. Parmi les ingénieurs, beaucoup sont tombés sous les yeux de Vauban : Je crois, écrivait-il à Louvois au début du siège, que Monseigneur sait bien que le pauvre Regnault a été tué roide, dont je suis dans une extrême affliction. Bonnefoi a été aussi blessé ce soir au bras. J’ai laissé tous les autres en bon état ; je prie Dieu qu’il les conserve, car c'est bien le plus joli troupeau qu’il est possible d’imaginer.
À Maastricht, Vauban innova de plusieurs manières :
Il procéda, on l'a vu, selon un système de larges tranchées parallèles et sinueuses pour éviter le tir des assiégés et permettre une progression méthodique et efficace des troupes, la moins dangereuse pour elles ;
Il ouvrit la brèche au canon ;
Il perfectionna le tir d'enfilade ;
Il multiplia les tranchées de diversion ;
Surtout, il élargit les tranchées par endroits, en particulier aux angles et aux détours, pour former des places d'armes et des redoutes d'où les assiégeants pouvaient se regrouper, de cinquante à cent soldats, à l'abri des feux des canons et des mousquets. Il put ainsi réduire la place avec une rapidité qui étonna ses contemporains Treize jours de tranchée ouverte, diminuant au minimum les pertes humaines, l'obsession qui, toute sa vie, poursuivit Vauban : la conservation de cent de ses sujets écrit-il à Louvois en 1676, lors du siège de Cambrai, lui doit être plus considérable que la perte de mille de ses ennemis.
Dans son traité de 1704, Traité des sièges et de l’attaque de places, Vauban a parfaitement décrit sa propre fonction en expliquant le rôle joué par le directeur des attaques :
Tout siège de quelque considération demande un homme d’expérience, de tête et de caractère, qui ait la principale disposition des attaques sous l’autorité du général ; que cet homme dirige la tranchée et tout ce qui en dépend, place les batteries de toutes espèces et montre aux officiers d’artillerie ce qu’ils ont à faire ; à qui ceux-ci doivent obéir ponctuellement sans y ajouter ni diminuer. Pour ces mêmes raisons, ce directeur des attaques doit commander aux ingénieurs, mineurs, sapeurs, et à tout ce qui a rapport aux attaques, dont il est comptable au général seul.
Et comme à son habitude, Vauban fit de ce siège une relation détaillée assortie de remarques critiques : il soulignait que ce siège fut fort sanglant à cause des incongruités qui arrivèrent par la faute de gens qu’il ne veut pas nommer. Et il termine par cette observation : Je ne sais si on doit appeler ostentation, vanité ou paresse, la facilité que nous avons de nous montrer mal à propos, et de nous mettre à découvert sans nécessité hors de la tranchée, mais je sais bien que cette négligence, ou cette vanité comme on voudra l’appeler a coûté plus de cent hommes pendant le siège, qui se sont fait tuer ou blesser mal à propos et sans aucune raison, ceci est un péché originel dont les Français ne se corrigeront jamais si Dieu qui est tout puissant n’en réforme toute l’espèce.
La gloire du roi de guerre
Vauban reçut 80 000 livres, ce qui lui permit de racheter le château de Bazoches en février 1675.
Mais à Versailles, sur les peintures de la Galerie des glaces, Charles Le Brun fit du roi le seul bénéficiaire de cette victoire Masstricht, prise en treize jours dont Vauban, jamais représenté, n'était qu'un docile et invisible exécutant. Au début du mois de juillet 1673, Louis XIV écrivait à Colbert : maître d'œuvre de ce fameux siège, vantant sa prudence à régler seul les attaques, son courage à les appuyer et les soutenir, sa vigueur dans les veilles et les fatigues, sa capacité dans les ordres et dans les travaux.
Le 10 août, Vauban fit faire au prince de Condé, de passage dans la ville prise, le tour complet, par le dehors et par le dedans. Condé trouva les projets de Vauban très séduisants : Le poste me paraît le plus beau du monde et le plus considérable, et plus je l’ai examiné plus je trouve qu’il est de la dernière importance de le fortifier. M. de Vauban a fait deux dessins, le grand dessin est la plus belle chose du monde.
Commissaire général des fortifications : le bâtisseur.
Il continue à ce poste de diriger les sièges : par exemple lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, les sièges de Philippsbourg en 1688, de Mons en 1691 et de Namur en 1692. En 1694, il organise avec succès la défense contre un débarquement anglais sur les côtes de Bretagne à Camaret.
C'est la victoire de Maastricht qui pousse le roi à lui offrir une forte dotation lui permettant d'acheter le château de Bazoches en 1675. Vauban est nommé commissaire des fortifications» en 1678, lieutenant général en 1688, puis maréchal de France, en 1703. Il devint si fameux que l'on dit même : Une ville construite par Vauban est une ville sauvée, une ville attaquée par Vauban est une ville perdue.
Posté le : 30/04/2016 19:05
|
|
|
|
|
Fête celtes de Beltane. 1 Mai |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Premier Mai, fête Celtes de Beltaine, 
c'est le passage de la saison de l'ombre à la lumière, les aubépines fleurissent, le sureau, beaucoup de fleurs blanches et ... le muguet. Beltaine ou Bealtaine, Beltane ou Beilteine, est la troisième des quatre grandes fêtes religieuses de l'année celtique. Elle marque la fin de la saison sombre et le début de la saison claire.
Beltane est un des sabbats majeurs de la tradition païenne.
Traditionnellement célébrée la nuit du 30 avril au 1er mai.
On l’appelle aussi : Fête du premier mai, Veille de mai, Roodmas, Nuit de Walpurgis, Cethsamhain, Whitsun or Old Bhealltainn, Bealtinne, Walburga, Eté celte…
Elle était en fait célébrée lors de la première floraison de l’aubépine.
Pour cette fête comme pour les toutes les autres célébrations de notre culture occidentale, nous voyons la religion catholique imposer ses fêtes en lieu et place des réjouissances, aux dates des croyances populaires païennes, polythéistes, animistes, chamanistes, etc, manifestations que la religion officielle introduite par Rome a tenté d'interdire et d'éradiquer. Les racines de l'Europe occidentale, avant d'être chrétiennes, sont Celtes. Le christianisme est une religion venue du Moyen Orient qui s'imposa en diabolisant les anciennes coutumes dites "païennes". Le christianisme a vu de nombreux saints et saintes ayant le cerf comme animal totémique, survivance du celtisme dévoyé de ses racines. Chacun sait que, selon la Légende, Merlin pouvait se transformer en cerf.
Fête de Beltane
La fête de Beltane Belteine ou Beltaine le 1er mai célèbre l'union symbolique, de la Déesse Mère et du Dieu Cerf, le dieu Bel des Celtes, devenu Bélénos et Cermunnos le cornu, divinité gauloise à la tête ornée de bois de cerf. Cette fête fait le lien avec l'été qui s'approche, elle est la fête du Feu. Beltane est un des sabbats majeurs de la tradition païenne. On l’appelle aussi : Fête du premier mai, Veille de mai, Roodmas, Nuit de Walpurgis, Cethsamhain, Whitsun or Old Bhealltainn, Bealtinne, Walburga, Eté celte ... Beltane était fêtée lors de la première floraison de l’aubépine.
La représentation, sur une plaque du chaudron de Gundestrup, du dieu aux bois de cerf, assis dans la posture bouddhique, tenant le torque d'une main, un serpent de l'autre, et entouré d'animaux, dont un cerf, laisserait à penser que Cermunnos est le Jupiter, Zeus gaulois dans l'aspect de maître des animaux.
Selon l'archiviste paléographe Anne Lombard-Jourdan, le dieu père des Gaulois auquel Jules César donne le nom d'un dieu romain, Dis pater, nom archaïque de Pluton, le dieu du monde souterrain et des richesses comme pourrait l'être Cermunnos.
Le dieu que Jules César nomme Dis pater pourrait avoir été honoré sous des formes et des dénominations variées selon des qualités divines mises en avant par les druides locaux. Il pourrait être ainsi une désignation du dieu que Jules César nomme dis pater.
Cermunnos est tantôt représenté jeune et imberbe, tantôt comme un vieillard à la barbe fournie. Il est parfois entouré d’animaux, ce qui pourrait en faire un Maître du règne animal. Le serpent à tête de bélier lui est souvent associé et bénéficiait d'une grande popularité dans toute l'Europe celtique et en Gaule, illustrant l'unité culturelle réalisée par les Celtes au terme de leur expansion. Cermunnos a été assimilé à Gwynn au Pays de galles et aussi à Herne le chasseur en Angleterre. Cernunnos est souvent représenté sur le chaudron de Gundestrap
Ces Dieux Celtes étaient fort célèbres pour leur "Chasse Sauvage", ils sortaient des Enfers ou plus simplement de la forêt accompagnés de leur meute de chiens des Enfers pendant la saison de chasse hivernale. La posture bouddhique et sa présence sur un sceau de la civilisation de l'Indus représentation d'un dieu à cornes, assis en tailleur, entouré d'animaux pourrait faire penser à une origine indo-européenne.
Histoire
Contrairement à Samonios, Beltane n’est pas la fête des trois fonctions de la société celtique. C’est une fête sacerdotale.
Beltane, Belteine ou Beltaine est la fête du feu et de la lumière.
Bel signifie "brillant" mais fait certainement référence à Belenos et Belisama, le couple brillant des Dieux gaulois. Tous deux représentent la jeunesse, le soleil et le feu.
Teine signifie "feu".
De fait, nous sommes en présence d’une fête rituelle en l’honneur du renouveau de la lumière rayonnante, la victoire du jour. Nous entrons dans la partie claire de l’année qui durera jusqu’à Samonios.
Les celtes avaient pour habitude de célébrer la nuit.
On tend à penser aussi qu’ils devaient fêter Beltane lors de la pleine de lune de mai.
Cette fête est attestée en Irlande mais aussi en Gaule.
Le feu - la tradition
Le Feu de Bel est un feu bénéfique. Les druides le créaient par leur magie et leurs incantations. Et il était d’usage en Irlande qu’ils fassent passer les troupeaux de bétail entre deux feux pour qu’ils les protègent toute l’année.
Le Feu de Beltane est un feu puissant, sacré et fort, celui qui l’allume est une personne de pouvoir. Sa fonction est loin d’être anodine…
Les druides sacrifient aussi à Beltane d’où, comme pour Samonios, l’intérêt de l’offrande aux Dieux lors de la cérémonie.
Beltaine marque une rupture dans l’année, on passe de la saison sombre à la saison claire, lumineuse, c’est aussi un changement de vie puisque c’est l’ouverture des activités diurnes : reprise de la chasse, de la guerre, des razzias, des conquêtes pour les guerriers, début des travaux agraires et champêtres pour les agriculteurs et les éleveurs.
Beltaine est la période de prédilection pour les rites de passage entre les périodes froide et chaude, entre l’obscurité et la lumière, entre la mort psychique symbolique et la renaissance spirituelle.
De manière générale, Beltaine est la fête du changement du rythme de vie. Du rythme hivernal, on passe au rythme estival. La fête marque ce passage tant physiquement que spirituellement. Beltane est aussi la période de prédilection pour les rites de passage entre les périodes froide et chaude, entre l’obscurité et la lumière, entre la mort psychique symbolique et la re-naissance spirituelle. Peut-être que les rites anciens d’enfermement dans les chambre des dolmens se passaient durant la nuit de Beltane. Cela demeure une excellente manière de faire l’expérience du passage. Il y a fort à parier que le lieu vous donnera des enseignements…
La tradition veut que l’on se lève avec le soleil pour cueillir des fleurs, des rameaux verts symbole de la Déesse pour servir de décoration rituelle ou pour se parer.
Une autre coutume consistait à faire passer les troupeaux entre deux feux, dans lesquels brûlaient si possible des branches de chêne. Le bétail était alors protégé des épidémies jusqu'à l'année suivante, et on pouvait l'emmener paître dans les prés. On sautait entre deux feux pour s’assurer une bonne destinée, un bétail en bonne santé, de la prospérité, et la fertilité au sens propre comme au figuré. Les gens dansaient pour célébrer le retour du soleil, de la nature fertile et vivante, les espoirs réalisés etc. Ils se promenaient aussi avec des torches pour encourager le soleil à continuer son ascension en réchauffant la Terre.
Les feux de Beltane ont des vertus purificatrices et fertilisantes.
La lumière et le feu
Beltane est nous le voyons la période de prédilection pour les rites de passage entre les périodes froide et chaude, entre l’obscurité et la lumière, entre la mort psychique symbolique et la re-naissance spirituelle. Peut-être que les rites anciens d’enfermement dans les chambre des dolmens se passaient durant la nuit de Beltane. De manière générale, c'est la fête de changement du rythme de vie. Du rythme hivernal on passe au rythme estival.
BEL signifie brillant mais fait certainement référence à Belenos et Belisama, le couple brillant des Dieux gaulois. Tous deux représentent la jeunesse, le soleil et le feu. Teine signifie feu. De fait, nous sommes en présence d’une fête rituelle en l’honneur du renouveau de la lumière rayonnante, la victoire du jour. Nous entrons dans la partie claire de l’année qui durera jusqu’à Samonios.
Cette fête est attestée en Irlande mais aussi en Gaule. Le Feu de Bel est un feu bénéfique. Les druides le créaient par leur magie et leurs incantations. Et il était d’usage en Irlande qu’ils fassent passer les troupeaux de bétail entre deux feux pour qu’ils les protègent toute l’année. Ceci ne prouve pas que Beltane est une fête agraire car le bétail était trop important pour toute la communauté celtique, cette habitude n’est qu’un détail.
On suppose que la célèbre assemblée des druides dans la forêt des Carnutes attestée par César dans La guerre des Gaules, se tenait à l’époque de Beltane. Une bonne période pour faire le point sur les objectifs de la période claire… Le Feu de Beltane est un feu puissant, sacré et fort, celui qui l’allume est une personne de pouvoir.
Beltane est l’exaltation du feu, élément druidique par excellence. BEL ou enus est un surnom de Lug vu dans son aspect de lumière, opposé symétriquement au Lug de Samain préparant dans la chaleur et la lumière des festins, à l’hiver et à l’obscurité, opposé aussi au Lug de Lugnasad, vu dans son aspect de roi suprême faisant bénéficier les hommes de la fécondité de la terre et des troupeaux. Les druides sacrifient aussi à Beltane d’où, comme pour Samonios, l’intérêt de l’offrande aux Dieux lors de la cérémonie.
Astronomie des druides
La constellation du Serpentaire, Ophiucus servait jadis chez les druides comme marqueur de l'initiation du nouvel an, c'est-à-dire au moment de l'entrée du Soleil en Scorpion. Cermunnos porte toujours des cornes de cerf car il est la constellation du Cerf liée au moment de Samain. Une des raisons de cet attribut, qui n'a rien d'une survivance totémique, est justement son rôle vernal.
Ce sont les cornes d'Elembius, signe du premier mois de l'année gauloise, mois du Bélier de notre sphère. Pour certaines raisons, cette constellation se nommait non le Bélier mais le Cerf *Elembho terme quasi identique au grec Elaphos qui a donné son nom au mois Elaphebolion.
Dans le folklore, le Cerf est lié à l'eau, et au serpent. Ce que l'on retrouve par exemple dans la mythologie nordique et le Cerf Eikhyrnirerf, épine de chêne dont les bois sont la source des sources. Le Soleil passe dans la constellation celte du Cerf, association de la constellation de la balance et du scorpion d'octobre à novembre avec l'équinoxe du soleil mourant de l'ouest, la lumière de l'eau, après Samonios, quand la pleine lune est en opposition à ce soleil et donc dans le taureau.
Beltane est l'inverse, c'est le Soleil qui est dans le taureau, et la Lune dans le Cerf, c'est l'aspect lunaire du Cerf qui s'exprime et émane ce qui éventuellement tendrait a aller vers la symbolique de l'aspect masculin de la Lune. La symbolique du Cerf est donc à prendre dans sa nature solaire. Les constellations interviennent aussi dans la roue en fonction des étoiles à l'instar du cerf, du lion, du taureau, etc., et non des animaux physiques.
Coutumes et symbolisme
En Europe avant que le 1er mai devienne la fête du travail on avait pour coutume de planter un arbre le premier mai en symbole de prospérité.
Jadis, en Angleterre, on plantait des arbres de mai dans la Terre mère en tant que symbole phallique célébrant l’union de la Déesse et du Dieu.
C’est le commencement de l’été celte. L’arbre de mai était un pin communal que l’on avait décoré lors de Yule et qui avait perdu la plupart de ces branches à cette période de l’année. On y accrochait en hauteur des rubans rouges et blancs on peut y mettre aussi des fleurs, des guirlandes de plantes etc. En effet le rouge peut représenter le Dieu du Soleil ou la Déesse dans son aspect Femme-Mère, sang/règles/perte de virginité/accouchement et le Blanc la Déesse Vierge.
Les participants prenaient un ruban rouge pour les hommes et blancs pour les femmes) et dansaient autour du mat. Les rubans tissaient ainsi une sorte de canal symbolique de la naissance entourant le mat phallique. Le tout étant l’emblème de l’Union du Dieu et de la Déesse.
C’est l’époque traditionnelle du mariage païen.
C’est en premier lieu une fête de fertilité soulignant la renaissance de nature que devient évidente. Le pouvoir des esprits élémentaires, fées, elfes, gnomes, ondines, salamandres etc. devient plus important et atteint son apogée lors de la fête du Solstice d’été.
C’est un moment magique qui, comme Samhain, voit le voile entre les mondes se lever pour nous permettre de rencontrer le petits peuples et faciliter l’entrée dans les états modifiés de conscience.
Le visage de la Déesse lors de Beltane
Le principal aspect de la Déesse à cette période est celui de la femme fertile, humide, attirante et lumineuse. La jeune fille éclatante d’Imbolc est à présent une femme prête à concevoir en son sein.
La fête de Beltane appelle à faire l’amour dans la forêt dont les énergies grisantes du printemps aiguisent les sens. La joie étant omniprésente lors de la fête, les enfants conçus cette nuit, sentiront à quel point, ils sont aimés et désirés. D’ailleurs, attention ! Si vous ne souhaitez pas concevoir cette nuit là, évitez de faire l’amour de manière rituelle, les moyens de contraceptions ont tendance à faire défaut dans cette situation.
Autrement, c’est une bonne période pour faire ensemble un enfant avec conscience et Amour, sous l’oeil protecteur de la Déesse.
Beltane peut être une bonne période pour réfléchir à notre comportement sexuel d’une manière générale. Il existe plusieurs manières de vivre sa sexualité, certainement autant que d’individus. Cependant, il est important de garder le respect de soi. A chacun de voir ce que cela signifie pour lui.
En tant que prêtresse ou prêtre, le corps est aussi le Temple de la Déesse et des Dieux, se laisser aller à avoir des relations avec de nombreuses personnes en recherchant le sexe pour le sexe, risque de ne pas vous permettre d’obtenir les résultats escomptés…
Pourtant Beltane se prête tout à fait à un moment de partage charnel qui peut ne pas déboucher sur une relation. Mais il n’est pas forcément nécessaire de vivre une histoire longue pour passer un moment d’amour physique et spirituel avec quelqu’un.
Le paganisme sanctifie l’amour physique pour diverses raisons : les centres énegétiques en ont besoin, l’esprit aussi, la libération des hormones endorphines pendant l’orgasme permettent à la fois de se libérer des tensions et de gagner en énergie, le naturel de l’acte rapproche de la nature et de notre être primordial, la magie de la conception d’un enfant : le fruit de l’amour et du partage…etc.
En somme, les rituels de Beltane seront axés sur l’offrande aux Dieux Belenos et Belisama, à la Déesse en général, sur les rituels de prospérité de chance et de réussite pour l’année claire et donc active qui vient, sur les rites de fertilité, les rites de passage adolescence, premiers sangs, unions/mariages etc., les rites d’initiation divers etc.
Les déités à célébrer :
Flora : déesse romaine des fleurs
Diane : déesse de la Lune
Pan : le dieu grec des bois et de la fertilité
Plantes
Les fleurs du moment, celle qu’on trouve dans la forêt à cette période.
Jacinthe des bois, rose, souci, maguerite, primevère, lila, muguet, violette, campanule, bouton d’or, arbres fruitiers, bouleau, romarin, aubépine, toutes les plantes en fleurs à ce moment de l’année...
Encens
Utilisez la base verveine/oliban citée pour la fête de Samonios, y ajouter de l’aubépine en fleur, de l’écorce de chêne, des fleurs de pommier séchées, du jasmin, des feuilles d’orties séchées etc.
Encens de Beltane :
3 parties d’oliban
1 partie d’aspérule odorante
1 parties de pétales de rose
quelques gouttes d’huile de jasmin
quelques gouttes d’huile de Néroli
ou :
4 parties d’oliban
½ parties d’oseille sauvage
1 parties de fleurs d’aubépine
½ parties de fleurs de primevères
½ parties de fleurs de pommier
1 parties d’écorce de chêne (vert ou blanc)
Couleurs de la fête de Beltane
Le Blanc, le vert, le rose, le jaune, le rouge etc.
Idée de décoration
Une très grosse chandelle décorée avec des rubans roses, verts, jaunes et mauves.
Une couronne de fleurs, comme des marguerites.
Les fleurs appropriées sont les fleurs sauvages du printemps comme les violettes, les primeroses et les boutons d'or.
Une très jolie invocation aux 4 éléments :
Nourriture
Lait, Miel, Fraises, avoine.
Amandes, asperges, orties, laitues, carottes et tout ce qui est à maturité au jardin ou en vente chez les producteurs bio de qualité (éviter les tomates d’Espagne et autres fruits ou légumes qui n’est pas de saison)
          
Posté le : 30/04/2016 15:20
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
58 Personne(s) en ligne ( 36 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 58
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages