|
|
Apollo 11, le 21 Juillet 1969 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 21 Juillet 1969 l'Amérique décrochait la Lune
Des hommes ont marché sur la lune !!...
La science l'a fait, le rêve inaccessible, le fantasme des poètes, des rêveurs, est devenu ce jour là, réel, il nous ébranlait comme un choc qui atteint toute l'humanité, le nez au ciel, à imaginer l'incroyable, ce miracle qui avait lieu là-haut au dessus de nos têtes d'humains, d'humains si petits, tout petits, et soudain si puissants.
Nous avions atteint le ciel, pendant que nos radios, nos télévisions, envahies de voix nasillardes, de ces voix désincarnées et aussi étranges que celles de robots, échangeaient des messages venus de l'au-delà, nous, humains du vingtième siècle nous étions, à l'instar des dieux, propulsés à cet instant dans les étoiles, dans l'inconnu du firmament.
Ce jour du 21 Juillet 1969, reste en mémoire de tous ceux qui étaient nés à cette époque, ce jour là, la terre est devenue plus petite et notre pouvoir plus grand.
L’évènement fût sidérant, incroyable à ce point que l'incrédulité naquit chez beaucoup et fut à l'origine d'un fort scepticisme, de négations, de doutes, de légendes, de thèses, d'hypothèses, de démonstrations parfois plus farfelues encore que ce fait inimaginable qu'est l'alunissage de trois astronomes, sur notre satellite éloigné. Comment concevoir, la possibilité, d'une proximité avec ce morceau de ciel trop distant, pensaient et pensent encore les adeptes d'une mystification.
"Décrocher la lune" est sans conteste synonyme d'impossibilité et pour les esprits qui doutent ce dicton ne peut qu'être réalité, fondé, et notre lune, elle, ne peut que rester lointaine, et fille de l'autre monde hors de portée humaine.
Malgré les partisans de la négation de cet exploit scientifique hors pair, l'Amérique a fêté, récemment, ses héros de la conquête lunaire avec, en point d'orgue, la réception à la Maison-Blanche des trois astronautes de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins qui ont été honorés par le président Barack Obama en personne.
La Nasa a contribué à l’évènement en publiant sur son site Internet les photos de cinq des six sites d'alunissage des missions Apollo.
Ces documents inédits, où l'on voit nettement la partie du module lunaire, le LEM, abandonnée sur la Lune, ont été pris par la sonde LRO lancée le mois dernier par la Nasa. I
ls apportent, s'il en était encore besoin, un cinglant démenti à tous ceux qui, depuis 40 ans, doutent que l'homme a bel et bien marché sur la Lune.
Le Figaro revient en quatre questions sur cette singulière épopée.
Pourquoi être allé sur la Lune ?
Pour des raisons essentiellement politiques. En pleine guerre froide, les États-Unis ne pouvaient laisser indéfiniment l'Union soviétique lui damer le pion dans la course à l'espace. Après les succès de Spoutnik en 1957 et surtout du premier vol orbital de Youri Gagarine, en avril 1961, le président Kennedy décidait, le mois suivant, «de mettre un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie». Pari tenu. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront les premiers hommes à marquer le sol lunaire de leurs empreintes. Ils seront suivis, jusqu'en 1972, par dix autres de leurs compatriotes. Pour réussir cet exploit, les Américains, forts de leur prospérité et de leur avance technologique, investiront dans l'ensemble du programme Apollo la bagatelle de 25,4 milliards de dollars, soit l'équivalent de 150 milliards de dollars actuels (106 milliards d'euros) ! Mais la compétition entre les deux superpuissances de l'époque n'explique pas tout. En marchant sur la Lune, les astronautes de la Nasa ont réalisé l'un des plus vieux rêves de l'humanité qui, de Christophe Colomb à Magellan, en passant par Alexandre le Grand et Marco Polo, a toujours cherché à repousser les limites de l'inconnu.
• Pourquoi n'y est-on pas retourné depuis ?
Depuis la mission Apollo 17, en décembre 1972, plus aucun homme n'a foulé la surface de l'astre sélène.
Plusieurs raisons à cela. Après l'émotion planétaire suscitée par les premiers pas d'Armstrong, les missions suivantes n'eurent pas le même impact auprès du public.
En outre, «les États-Unis, une fois l'exploit réalisé, n'avaient plus rien à démontrer au reste du monde», explique François Spiero, responsable des vols habités au Centre national d'études spatiales (Cnes). Parallèlement, le projet de navette spatiale commençait à émerger et la Nasa n'avait plus les moyens d'assumer de front deux projets aussi coûteux. « Au début des années 1970, la notion d'espace utile montait en puissance avec l'observation de la Terre, les télécommunications et bien sûr l'espionnage militaire.
L'orbite basse fut donc privilégiée au détriment des vols habités », poursuit M. Spiero. Résultat : les trois dernières missions initialement prévues après Apollo 17 furent annulées.
• Pourquoi projette-t-on d'y revenir ?
Pour pouvoir mieux aller sur Mars… Le programme Constellation, lancé par l'ancien président George W. Bush en 2004, conçoit la Lune comme une étape intermédiaire sur le chemin de la planète rouge. Il est notamment question d'installer sur notre satellite des bases lunaires occupées en permanence par des équipes d'astronautes se relayant tous les six mois. « L'exploration lunaire permettra de tester nos technologies, nos systèmes, nos opérations de vols spatiaux et d'explorer des techniques qui réduiront le risque et le coût potentiel de futures missions humaines vers des astéroïdes, Mars et au-delà », estime la Nasa. L'installation de grands radiotélescopes ainsi que l'exploitation de certaines ressources, comme l'hélium 3 un isotope de l'hydrogène utilisé dans la fusion nucléaire, sont également évoquées.
Pour le moment, le grand retour sur la Lune est prévu avant 2020. Le tout au moyen du nouveau système de lancement Ares-Orion, largement inspiré du programme Apollo.
Mais le développement a pris du retard et les coûts se sont envolés. Une commission d'experts indépendants mise sur pied au printemps dernier par le président Barack Obama pour évaluer le programme Constellation doit rendre ses conclusions fin août, sur fond de crise économique et de creusement du déficit fédéral. Alors que les Américains s'interrogent sur l'ampleur de leur futur programme spatial et sur le prix qu'ils sont prêts à y mettre, d'autres pays affichent leurs ambitions. À commencer par les Chinois, qui rêvent d'envoyer leur premier taïkonaute sur la Lune avant que les Américains n'y retournent… Sans oublier les Russes mais aussi les Japonais et les Indiens qui viennent chacun d'envoyer un petit orbiteur autour de l'astre de la nuit.
À moins que l'exploration planétaire prenne une dimension internationale. C'est en tout cas l'option prise par l'Europe, et notamment la France, qui plaident pour une coopération approfondie entre les puissances spatiales autour d'un projet commun.
• À quoi cela a-t-il servi ?
Selon certains, à pas grand-chose. N'aurait-il pas mieux valu dépenser tous ces milliards dans la lutte contre la faim et la misère ? Certes. Mais c'est oublier que la conquête spatiale a permis le développement de technologies qui bénéficient aujourd'hui au plus grand nombre, y compris dans les pays pauvres.
S'exprimant en avril, devant l'Académie américaine des sciences, M. Obama a tenu lui-même à rappeler que « le programme Apollo a produit des technologies qui ont amélioré les systèmes de dialyse rénale et d'assainissement de l'eau, des capteurs pour tester des gaz dangereux, des matériaux de construction permettant des économies d'énergie, et des tissus résistant au feu utilisés par les pompiers et les soldats ».
Sans oublier les cellules photovoltaïques, les piles à combustible, la navigation par satellites (GPS) ou encore les matériaux composites, dérivés eux aussi de l'industrie spatiale. Enfin, comme le rappelle Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration planétaire au Cnes, « l'analyse des 382 kilos de roches ramenées par les missions Apollo a permis de connaître l'origine de la Lune dont la formation est due à l'impact d'un astéroïde géant avec la Terre », il y a plus de 4 milliards d'années.
Apollo 11 est une mission du programme spatial américain Apollo au cours de laquelle pour la première fois des hommes se sont posés sur la Lune le 20 juillet 1969. Apollo 11 est la troisième mission habitée à s'approcher de la Lune, après Apollo 8 et Apollo 10, et la cinquième mission habitée du programme spatial américain Apollo.
Par cet exploit, l'agence spatiale américaine, la NASA, remplit l'objectif fixé par le président John F. Kennedy en 1961, qui était de poser un équipage sur la Lune avant la fin des années 1960 et démontre sans contestation possible la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans le domaine des vols spatiaux habités. Apollo 11 est l'aboutissement d'un projet qui a mobilisé des moyens humaiIl y a 40 ans, l'Amérique décrochait la Lunens et financiers considérables permettant à l'agence spatiale de rattraper son retard sur l'astronautique soviétique puis de dépasser celle-ci.
La mission est lancée depuis le centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969 par la fusée géante Saturn V développée pour ce programme.
Elle emporte un équipage composé de Neil Armstrong, commandant de la mission et pilote du module lunaire, Buzz Aldrin qui accompagne Armstrong sur le sol lunaire et Michael Collins pilote du module de commande qui restera en orbite lunaire. Armstrong et Aldrin, après un atterrissage comportant quelques péripéties, séjournent 21 h 30 à la surface de la Lune et effectuent une sortie extravéhiculaire unique d'une durée de 2 heures 30.
Après avoir redécollé et réalisé un rendez-vous en orbite lunaire avec le module de commande, le vaisseau Apollo reprend le chemin de la Terre et amerrit sans incident dans l'Océan Pacifique à l'issue d'un vol qui aura duré en tout 195 heures.
Au cours de la mission Apollo 11 sont collectés 21,7 kg de roche et de sol lunaire et plusieurs instruments scientifiques sont installés sur la surface de notre satellite.
Bien que l'objectif scientifique d'Apollo 11 ait été limité par la durée du séjour sur la Lune et la capacité d'emport réduite de la version des vaisseaux spatiaux utilisés, la mission fournit des résultats substantiels.
Le déroulement de la mission et en particulier les premiers pas sur la Lune filmés et retransmis en direct par une caméra vidéo constituent un évènement planétaire suivi sur toute la planète par des centaines de millions de personnes.
Le programme Apollo
Le programme Apollo est lancé par le président John F. Kennedy en 1961 avec comme objectif de faire atterrir un homme sur la Lune ; il s'agit de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans le domaine spatial, devenu un enjeu politique dans le contexte de la Guerre froide qui oppose les deux superpuissances de l'époque. L'objectif semble particulièrement ambitieux car à cette date aucun vol orbital habité américain n'a encore été réalisé. Pour remplir l'objectif fixé par le président, l'agence spatiale américaine, la NASA, lance plusieurs programmes spatiaux destinés à préparer les futures expéditions lunaires : le programme Gemini pour mettre au point les techniques de vol spatial et des programmes de reconnaissance, Programme Surveyor, Ranger, etc. pour, entre autres, cartographier les zones d'atterrissage et déterminer la consistance du sol lunaire.
Pour atteindre la Lune, les responsables finissent par se rallier à la méthode audacieuse du Rendez-vous en orbite lunaire, qui nécessite de disposer de deux vaisseaux spatiaux dont le module lunaire destiné à l'atterrissage sur la Lune. La fusée géante de 3 000 tonnes Saturn V, capable de placer en orbite basse 118 tonnes, est développée pour lancer les véhicules de l'expédition lunaire. Le programme draine un budget considérable, 135 milliards de dollars US valeur 2005 et mobilise jusqu'à 400 000 personnes. L'incendie au sol du vaisseau spatial Apollo 1, dont l'équipage périt brûlé, entraine un report de près de deux ans du calendrier.
Les missions spatiales préparatoires : d'Apollo 7 à Apollo 10
Après plusieurs missions sans équipage destinées à tester en orbite terrestre basse la fusée Saturn V et les deux vaisseaux spatiaux, la NASA lance dans un laps de temps très court de 7 mois quatre missions avec équipage qui permettent d'achever la qualification des vaisseaux en effectuant une répétition des différentes phases d'une mission lunaire hormis l'atterrissage. Toutes ces missions se déroulent sans anomalie majeure :
Apollo 7 octobre 1968 est la première mission habitée du programme Apollo.
Son but est de valider les modifications effectuées sur le vaisseau spatial à la suite de l'incendie d’Apollo 1, CMS version 2.
Une fusée Saturn 1B est utilisée car le module lunaire ne fait pas partie de l'expédition.
Au cours de son séjour en orbite, l’équipage répète les manœuvres qui seront effectuées lors des missions lunaires.
Apollo 8 décembre 1968 est le premier vol habité à quitter l’orbite terrestre.
À ce stade d'avancement du programme, il s'agit d'une mission risquée car une défaillance du moteur du vaisseau Apollo au moment de sa mise en orbite lunaire ou de son injection sur la trajectoire de retour aurait pu être fatale à l'équipage d'autant que le module lunaire a été remplacé par une maquette.
Mais les dirigeants de la NASA redoutent un coup d'éclat des Soviétiques pour la fin de l'année et décident de courir le risque.
Les astronautes font au total 10 révolutions autour de la Lune. Durant ce vol, ils réalisent de nombreux clichés de la Lune dont le premier lever de Terre.
Apollo 8 permet pour la première fois à un homme d'observer directement la « face cachée » de la Lune.
L'une des tâches assignées à l'équipage consistait à effectuer une reconnaissance photographique de la surface lunaire, notamment de la mer de la Tranquillité où doit se poser Apollo 11.
Apollo 9 mars 1969 constitue le premier essai en vol de l’ensemble des équipements prévus pour une mission lunaire : fusée Saturn V, module lunaire et vaisseau Apollo.
Les astronautes effectuent toutes les manœuvres de la mission lunaire tout en restant en orbite terrestre. Le module lunaire simule un atterrissage puis réalise le premier rendez-vous réel avec le vaisseau Apollo.
Les astronautes effectuent également une sortie extravéhiculaire de 56 minutes pour simuler le transfert d'équipage du module lunaire au vaisseau Apollo en passant par l'extérieur, manœuvre de secours mise en œuvre en cas d'amarrage infructueux entre les deux vaisseaux.
En outre, ils testent l'utilisation du module lunaire comme « canot de sauvetage » dans la perspective d'une défaillance du vaisseau Apollo.
Avant le lancement d'Apollo 10 mai 1969 les dirigeants de la NASA ont envisagé que cette mission soit celle du premier atterrissage sur le sol lunaire, car l'ensemble des véhicules et des manœuvres ont été testés sans qu'aucun problème majeur n'ait été détecté. Mais, dans la mesure où les Soviétiques ne semblent pas préparer de mission d'éclat, ils préférèrent opter pour une dernière répétition au réalisme encore plus poussé. Une fois le train spatial placé en orbite autour de la Lune, le module lunaire, surnommé « Snoopy », entame la descente vers le sol lunaire qui est interrompue à 15,6 km de la surface. Après avoir largué l'étage de descente non sans quelques difficultés dues à une erreur de procédure, le LEM réalisa un rendez-vous avec le vaisseau Apollo.
L'équipage d'Apollo 11
Les trois astronautes de l'équipage Apollo 11 se familiarisent avec la disposition des équipements à l'intérieur du module de Commande
L'équipage d'Apollo 11 est composé de Neil Armstrong, qui commande la mission et qui doit piloter le module lunaire jusqu'à la surface lunaire, Buzz Aldrin, deuxième membre de l'équipage à aller sur le sol lunaire et Michael Collins qui est le pilote du module de commande.
Neil Armstrong, diplômé de l'Université Purdue débute sa carrière comme pilote de chasseur dans la Marine américaine entre 1949 et 1952 et participe à la guerre de Corée. Il rentre en 1955 comme pilote d'essai à la NACA, l'ancêtre de la NASA où il vole sur de nombreux prototypes dont l'avion-fusée X-15.
Il est recruté comme astronaute par la NASA en 1962. Il est le commandant de la mission Gemini 8 qui réussit le premier amarrage avec un autre vaisseau spatial.
Il décède le 25 août 2012, à 82 ans suite à des complications cardiovasculaires.
Buzz Aldrin, après des études à l'académie militaire de West Point, devient pilote de chasse dans l'Armée de l'Air. Il participe à la guerre de Corée.
En 1959, il entame un cycle d'études supérieures en Ingénierie spatiale au MIT (MIT) et décroche en 1963, un doctorat en sciences astronautique avec une thèse sur les « techniques de rendez-vous orbital entre vaisseaux avec équipage ». Il est sélectionné en 1963 par la NASA dans le groupe 3 des astronautes.
En 1966 il est le commandant et le pilote de la mission Gemini 12 dont le principal objectif est de démontrer qu'un astronaute peut travailler dans l'espace.
Michael Collins, après des études à l'académie militaire de West Point, devient pilote de chasse dans l'Armée de l'Air. Il est sélectionné comme astronaute par la NASA en 1963 dans le même groupe qu'Aldrin. Il participe à la mission Gemini 10 au cours de laquelle il effectue deux sorties extravéhiculaires.
En cas de défaillance de l'équipage titulaire avant l'envol, maladie, accident,..., celui-ci doit être remplacé par Jim Lovell commandant, Fred Haise, copilote du module lunaire et Bill Anders, pilote du module de commande.
Support au sol
Durant le déroulement de la mission, une équipe installée au centre de contrôle des vols habités à Houston maintient le contact avec l'équipage en transmettant les instructions des techniciens et des scientifiques au sol et en répondant aux demandes des astronautes d'Apollo 11. Les hommes qui forment cette équipe, baptisés CAPCOM , Capsule Communicator interlocuteur vaisseau, sont des astronautes qui se relaient pour assurer une couverture permanente 24 heures sur 24 : Charles Moss Duke, Jr., Ronald Evans, Owen Garriott, CAPCOM, Don L. Lind, Ken Mattingly, Bruce McCandless II, Harrison Schmitt, Bill Pogue, Jack Swigert.
Les responsables au sol de la mission, chargés de prendre les décisions importantes en cas d'imprévu, sont Cliff Charlesworth (lancement et activité extravéhiculaire), Glynn Lunney, Gene Kranz, (Atterrissage sur la Lune) et Milt Windler.
Les objectifs de la mission Apollo 11
Apollo 11 est la première mission Apollo à poser des hommes sur le sol lunaire et même si une partie de son déroulement a fait l'objet d'une répétition au cours du vol Apollo 10, des phases cruciales comme l'atterrissage et le décollage de la Lune ainsi que l'utilisation de la combinaison spatiale sur le sol lunaire n'ont encore jamais été réalisées et présentent des risques importants.
Dans ce contexte la recherche scientifique joue un rôle secondaire dans la mission : l'équipage d'Apollo 11 a pour objectif principal de réaliser une sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire et de revenir sain et sauf sur Terre. Il aura ainsi atteint le but fixé par le président John F. Kennedy dans son discours du 25 mai 1961 : déposer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie.
Les objectifs secondaires de la mission sont :
Fournir des éléments permettant de valider les solutions techniques retenues pour l'atterrissage examen du train d'atterrissage, le séjour sur la Lune et les sorties extravéhiculaires,
Évaluer les capacités et les limitations d'un équipage humain se déplaçant sur le sol lunaire,
Déterminer les coordonnées du site d'atterrissage,
Collecter des échantillons du sol et des roches lunaires à proximité immédiate du module lunaire, tester la résistance mécanique du sol, évaluer la visibilité,
Déployer 4 instruments scientifiques puis récupérer les résultats de deux des expériences :
Le sismomètre passif est un des deux composants de l'Early Apollo Scientific Experiments Package.
Il s'agit d'un prototype de l'instrument qui fera partie de la suite instrumentale ALSEP des quatre missions Apollo suivantes.
Cet équipement d'une masse de 47,7 kg comporte 3 capteurs à longue période (15 secondes) disposés orthogonalement pour mesurer les déplacements de la surface à fois dans le plan vertical et horizontal et un capteur à courte période pour mesurer les déplacements verticaux à haute fréquence (période de résonance de 1 seconde).
L'instrument comprend un système de télécommunications qui permet de recevoir une quinzaine de types d'instruction préparés par les scientifiques sur Terre et de transmettre les données sismiques recueillies vers les stations terrestres.
L'étalonnage de l'instrument (verticalité des sismomètres avec une précision de 2 secondes d'arc - est effectuée depuis la Terre en agissant sur des moteurs télécommandés.
L'instrument est alimenté en énergie par deux panneaux solaires qui fournissent jusqu'à 46 Watts d'électricité. Durant la longue nuit lunaire où la température chute à -170 °C, l'instrument est maintenu à une température supérieure à -54 °C grâce à la décomposition radioactive de deux pastilles de 34 grammes de plutonium 238 qui génèrent 15 Watts de chaleur.
Le réflecteur laser est le deuxième composant de l'EALSEP.
Il s'agit d'un dispositif optique passif qui permet de réfléchir une impulsion lumineuse dans la direction exacte de sa source.
Un faisceau lumineux homogène et concentré est émis à l'aide d'un laser vers l'emplacement du rétroréflecteur ; en mesurant le temps mis par ce rayon pour revenir vers sa source, on peut déterminer avec une grande précision la distance entre l'émetteur et le réflecteur.
En mesurant la distance Terre-Lune avec une précision qui devrait atteindre 15 cm au lieu des 500 mètres à la date de l'expérience, les scientifiques devraient obtenir de manière indirecte de nombreuses informations sur la Terre telles que l'évolution de sa vitesse de rotation, le déplacement des pôles ainsi que sur la physique de la Lune (libration, déplacement du centre de masse, taille et forme).
Le réflecteur installé par l'équipage d'Apollo 11 comporte 100 coins de cube en quartz de 3,8 cm de diamètre disposés en 10 rangées de 10.
Le sismomètre passif.
Le site d'atterrissage sur la Lune devait répondre à un grand nombre de contraintes:
Le site doit se situer sur la face de la Lune visible depuis la Terre pour permettre les échanges radio entre l'expédition et le contrôle au sol et sur la partie éclairée de celle-ci.
La quantité de carburant consommée par les vaisseaux Apollo durant les manœuvres lunaires est d'autant plus importante que la latitude du site d'atterrissage est élevée.
La latitude du site retenu est pour cette raison inférieure à 5°.
La zone d'atterrissage ne doit pas être cernée de falaises, de reliefs trop élevés ou de cratères profonds qui pourraient fausser les mesures du radar d'atterrissage du module lunaire chargé de déterminer l'altitude du vaisseau.
La zone d'atterrissage ne doit pas comporter un trop grand nombre de cratères, ni de rochers et la pente doit être inférieure à 2 % pour limiter le risque d'un atterrissage violent qui pourrait interdire le décollage et être donc fatal à l'équipage.
Pour que le pilote du module lunaire puisse repérer le site retenu pour l'atterrissage, il doit bénéficier de conditions d'éclairage très particulières :
Le Soleil doit éclairer le sol depuis l'est sous un angle compris entre 4° et 14° pour que les ombres des cratères permettent à l'équipage d'identifier ceux-ci.
La fenêtre de lancement résultante est de 16 heures tous les 29,5 jours pour un site d'atterrissage donné l'élévation du Soleil change à une vitesse de 0,5° par heure.
Les responsables du programme souhaitent disposer de plusieurs fenêtres de lancement par mois, pour limiter le décalage du calendrier de lancement en cas de report du tir pour des raisons techniques.
Le site d'atterrissage primaire doit donc se situer à l'est pour qu'un ou plusieurs sites de rechange puissent être trouvés plus à l'ouest.
Trente sites d'atterrissage avaient été passés en revue par un comité de sélection interne de la NASA en s'appuyant sur les observations réalisées à l'aide de télescopes terrestres.
Les sondes lunaires du programme Lunar Orbiter ont effectué entre 1966 et 1967 une reconnaissance photographique de la Lune des sites présélectionnés.
Un seul site, situé dans la mer de la Tranquillité, parvient à satisfaire l'ensemble des contraintes énoncées ci-dessus.
Le déroulement de la mission
Le décollage
Le 16 juillet 1969 à 13 h 32 UTC 9 h 32 heure locale le lanceur Saturn V, pesant plus de 3 000 tonnes, décolle du complexe de lancement 39 de Cap Canaveral.
Près de un million de personnes ont fait le déplacement pour assister à cet évènement.
Après une phase propulsée sans incident le troisième étage de la fusée Saturn le Module de commande et de service (CSM) et le Module Lunaire (LEM) se placent en orbite basse autour de la Terre pour attendre que le positionnement relatif de la fusée, de la Terre et de la Lune permettent d'arriver à proximité de la Lune à la distance et au moment prévus.
Deux heures trente plus tard conformément au planning et alors que le vaisseau Apollo a effectué une révolution et demi autour de la Terre, le troisième étage est rallumé durant six minutes, manœuvre de TLI Translunar Injection pour permettre au « train spatial » de s'arracher à l'attraction terrestre et le placer sur une trajectoire qui doit le conduire à proximité de la Lune.
Le transit entre la Terre et la Lune
Environ une demi-heure après cette manœuvre, le Module de Commande et de Service (CSM) se détache du reste du train spatial puis pivote de 180° pour venir repêcher le module lunaire Eagle (le LEM) dans son carénage.
Après avoir vérifié l'arrimage des deux vaisseaux et pressurisé le LEM, les astronautes déclenchent par pyrotechnie la détente des ressorts situés dans le carénage du LEM : ceux-ci écartent le LEM et le CSM du troisième étage de la fusée Saturn à une vitesse d'environ 30 cm/s.
Le troisième étage va alors entamer une trajectoire divergente qui le place en orbite autour du Soleil.
Après un périple de près de trois jours, le vaisseau Apollo se place en orbite lunaire.
Le module lunaire Eagle, après avoir réalisé treize révolutions autour de la Lune, se sépare du CSM désormais occupé par le seul Collins et entame sa descente vers le sol lunaire.
Atterrissage de Eagle
Le module lunaire Eagle se pose dans la mer de la Tranquillité, après une phase d'approche finale plus longue que prévue.
Le site sélectionné pour l'atterrissage est dépassé de 7 km à la suite de problèmes rencontrés durant la descente. Neil Armstrong a été gêné par des alarmes de l'ordinateur de bord qui gère le pilote automatique et assure la navigation. L'ordinateur, qui a une puissance équivalente à celle d'une calculatrice bas de gamme des années 2000, est saturé par des signaux en provenance du radar de rendez-vous, conséquences d'une erreur de conception.
Accaparé par ces alarmes, Neil Armstrong laisse passer le moment où, selon la procédure, il aurait dû exécuter une dernière manœuvre de correction de la trajectoire.
Le LEM s'approchant d'un site encombré de rochers, Armstrong doit prendre le contrôle manuel du module lunaire et survoler à l'horizontale le terrain afin de trouver un site adapté à l'atterrissage. Cette manœuvre entame dangereusement la faible réserve de carburant qui subsiste : il ne reste plus que 45 secondes du propergol réservé à l'atterrissage lorsque l’appareil se pose à 7 km du lieu prévu à l'origine.
S'ensuit alors une longue séquence avant la sortie des astronautes : listes de vérification, pose des combinaisons spatiales et vérifications, dépressurisation du LEM.
Sortie des astronautes
Dans les premiers plans établis pour cette première mission sur la Lune la sortie extravéhiculaire devait durer 4 heures soit la durée maximale autorisée par les réserves d'oxygène et d'énergie électrique des combinaisons spatiales A7L.
Ce temps était nécessaire notamment pour installer l'ensemble des instruments scientifiques de la station ALSEP.
Le développement de celle-ci ayant pris du retard, elle avait été remplacée pour Apollo 11 par l'ensemble EALSEP limité à deux instruments et la durée de la sortie avait été ramenée à deux heures même si les combinaisons spatiales permettaient une durée double.
Armstrong effectue ses premiers pas sur la Lune le 21 juillet 1969 à 2 h 56 UTC (3 h 56, heure française) ou le 20 juillet 21 h 56 à Houston, devant des millions de téléspectateurs écoutant les premières impressions de l'astronaute.
Celui-ci en posant le pied sur le sol lunaire lance son message resté célèbre « C'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité ».
Premiers pas sur la Lune
La consistance du sol lunaire avait été la source de beaucoup d'interrogations depuis le lancement du programme Apollo toutefois les observations effectuées par les sondes lunaires du programme Surveyor avaient fourni des indications importantes sur sa consistance et avaient en particulier permis d'écarter à priori le scénario d'un engloutissement des engins spatiaux par une épaisse couche de poussière.
Néanmoins pour certains une part de mystère subsistait. Armstrong avant de poser son pied sur le sol lunaire constate que celui-ci semble poudreux.
Après avoir posé son pied tout en se tenant fermement à l'échelle, il observe que l'empreinte de sa semelle s'est parfaitement moulée dans le sol.
En grattant celui-ci avec sa chaussure il constate que le matériau lunaire adhère sur celle-ci comme du charbon de bois pulvérisé.
Armstrong fixe ensuite sur son torse un appareil photo Hasselblad que Aldrin lui a descendu à l'aide d'une corde depuis l'intérieur du module lunaire puis, après s'être éloigné de quelques mètres du LEM, il collecte rapidement un peu de régolithe et quelques petites roches lunaires en utilisant une petite pelle pliable munie d'un sac à échantillons : le prélèvement est effectué en grattant superficiellement la surface car le sol est très ferme à quelques centimètres de profondeur.
L'objectif de cette collecte rapide est que les scientifiques à Terre soient certains de disposer d'échantillons de sol au cas où les astronautes auraient à décoller prématurément.
Armstrong tente d'enfoncer le manche de son instrument dans le sol mais il est stoppé dans ses efforts à environ 15 cm de profondeur.
Quinze minutes après son coéquipier, Buzz Aldrin descend à son tour l'échelle du module lunaire. Sa sortie est photographiée par Armstrong. Alors qu'il pose le pied sur le sol lunaire il s'exclame « Belle vue » avant de préciser son sentiment par un « Magnifique désolation ».
Armstrong se joint alors à lui pour dévoiler une plaque commémorative apposée sur un des pieds de l'étage de descente qui doit rester sur la Lune après le départ des astronautes. Sur celle-ci figure le dessin des deux hémisphères terrestres, un texte avec le nom et la signature des trois astronautes et du président Richard Nixon. Armstrong lit le texte à haute voix : « Ici des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969 ap JC.
Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. ».
Armstrong enlève ensuite la caméra de télévision de son support sur l'étage de descente d'où elle avait filmé les premiers pas sur la Lune ; il l'installe sur un pied tripode à 20 mètres au nord ouest du module lunaire pour que les activités de l'équipage puissent être filmés.
Le déploiement des instruments scientifiques
Aldrin transporte les deux instruments scientifiques de l'EASEP jusqu'au site d'installation.
Les astronautes disposent de relativement peu de temps pour accomplir le volet scientifique de leur mission. Aldrin déploie le capteur de particules du vent solaire SWC qui se présente sous la forme d'une feuille d'aluminium tendue par une hampe.
Malgré la fermeté du sol, Aldrin parvient à planter le dispositif à la verticale en orientant la feuille vers le Soleil.
Pendant ce temps, Armstrong déroule et plante dans le sol le drapeau américain qui en l'absence d'atmosphère et donc de vent est maintenu tendu par une baguette.
Cet acte ne reflète pas une revendication territoriale mais a pour objectif de marquer cette "victoire" américaine dans la course à l'espace engagée avec l'Union soviétique.
Tandis que Armstrong déballe les deux petites valises qui doivent être utilisées pour stocker les échantillons de sol lunaire, Aldrin réalise conformément au programme un ensemble d'exercices destinés à tester sa mobilité sur le sol lunaire.
Il effectue plusieurs allers et retours devant la caméra vidéo en courant : il ne ressent aucune gêne pour se déplacer mais lorsqu'il change de direction il doit prendre en compte que son centre de gravité se situe plus haut que sur Terre.
Les astronautes doivent interrompre leurs tâches pour un échange téléphonique de quelques minutes avec le président des États-Unis Richard Nixon qui suivait la retransmission télévisée de l'atterrissage sur la Lune depuis la Maison-Blanche.
Les astronautes reprennent leur travail : tandis que Armstrong collecte rapidement des échantillons avec sa pelle, Aldrin effectue une série de photos : une empreinte de botte sur le sol lunaire, des images du train d'atterrissage du module lunaire pour permettre d'évaluer son comportement ainsi que plusieurs photos panoramiques du site. L'équipage a accumulé à ce stade 30 minutes de retard par rapport à l'horaire prévu.
Armstrong effectue des prises de vue stéréoscopiques de la surface avec un appareil dédié tandis que Aldrin décharge les deux instruments scientifiques de l'Early Apollo Scientific Experiments Package, EALSEP qui sont stockés dans la baie arrière gauche de l'étage de descente du LEM baptisée MESA, Modularized Equipment Stowage Assembly Il les transporte rapidement à 20 mètres au sud-ouest du module lunaire et commence à installer le sismomètre tandis que Armstrong le rejoint pour mettre en place le réflecteur laser. Ce dernier, complètement passif, doit simplement être orienté vers la Terre avec une précision de 5°. L'installation du sismomètre nécessite par contre plus de manipulations : Aldrin doit d'abord orienter les panneaux solaires correctement vers le Soleil puis placer l'appareil parfaitement à l'horizontale ce qu'il a réalise avec quelques difficultés.
Le fonctionnement de l'appareil est immédiatement vérifié par les opérateurs sur Terre : ceux-ci constatent que le sismomètre est suffisamment sensible pour détecter le déplacement des deux astronautes.
Normalement les deux astronautes devaient disposer ensuite de 30 minutes pour effectuer une collecte d'échantillons de sol et de pierres lunaires dans leur contexte géologique c'est-à-dire en les photographiant sur le sol avant de les ramasser. Mais avec le retard pris sur l'horaire, MCCandless, leur interlocuteur au centre de contrôle, ne leur accorde que 10 minutes.
Aldrin a la charge de prélever une carotte du sol mais, malgré les vigoureux coups de marteau assénés sur le tube prévu à cet effet, il ne parvient pas à enfoncer celui-ci. Les ingénieurs ont conçu l'instrument en partant de l'hypothèse que le sol serait peu compact et un renflement à l'intérieur du tube, qui est destiné à empêcher la carotte de retomber, gêne l'enfoncement dans le sol ferme rencontré.
Aldrin effectue une nouvelle tentative trois mètres plus loin avec le même résultat. Finalement il renonce à enfoncer le tube jusqu'au bout.
Aldrin ramène ensuite la carotte obtenue ainsi que la feuille d'aluminium du collecteur de particules jusqu'à la MESA pour qu'Armstrong puisse les inclure dans le paquetage.
Après avoir été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par MCCandless, Aldrin réintègre l'habitacle du module lunaire. Durant ce temps, Armstrong décide d'aller voir de plus près le cratère qu'il a dû éviter immédiatement avant l'atterrissage et qui se situe à seulement 45 mètres du module lunaire.
Il se dirige rapidement vers le rebord du cratère sans commenter sa décision. Parvenu sur le rebord du cratère, il constate que celui-ci est suffisamment profond pour que des morceaux du socle rocheux situé sous la couche de régolithe aient été arrachés par l'impact.
Il ne ramasse aucune de ces pierres mais effectue un panorama du cratère avec le module lunaire en arrière-plan. Il collecte ensuite rapidement plusieurs rochers qu'il place dans une des deux valises à échantillons qu'il cale en ajoutant 6 kg de régolithe.
Il hisse ensuite les deux valises d'échantillons avec un système à poulie jusqu'au niveau du sas de l'habitacle où celles-ci sont récupérées par Aldrin. Puis Armstrong réintègre sans un mot l'habitacle.
Les astronautes ont récolté 21,7 kg d'échantillons de sol lunaire et la sortie extravéhiculaire a duré 2 h 31 durant laquelle ils ont parcouru 250 mètres. Alors que Buzz Aldrin réintègre le module lunaire, il casse par inadvertance dans l'habitacle étroit l'interrupteur permettant de mettre à feu le moteur de l'étage de remontée du LEM. Comme il s'agit d'un bouton poussoir, il se servira de la pointe d'un stylo pour l'enclencher, et permettre aux deux astronautes de quitter la Lune.
Retour sur Terre
Les astronautes sont restés 21 heures et 36 minutes sur la Lune.
Le LEM effectue avec succès la manœuvre de Rendez-vous en orbite lunaire avec le module de commande et de service resté en orbite lunaire avec Collins à bord.
Le module de service est largué 15 minutes avant d'entamer la rentrée atmosphérique.
Le vaisseau pénètre dans l'atmosphère à environ 11 km/s et amerrit 15 minutes plus tard à 16 h 50 min 59 s TU dans l'Océan Pacifique à 3 km du point visé : l'amerrissage a lieu à 2 660 km à l'est de l'atoll de Wake et à 380 km au sud de l'Atoll Johnston.
Le porte-avion USS Hornet chargé de récupérer l'équipage se trouve à 22 km du point d'amerrissage (13° 19′ N 169° 9′ O).
Il s'est écoulé 195 heures et 19 minutes depuis que le vaisseau a décollé.
Conclusion
Les trois astronautes sont mis en quarantaine pendant 21 jours, une pratique qui perdura pendant les trois missions Apollo suivantes, avant que la Lune ne soit déclarée stérile et sans danger de contamination.
Le 21 juillet, la sonde soviétique Luna 15, qui devait aussi ramener des échantillons de Lune, s'écrase sur le sol lunaire après 52 révolutions autour de l'astre, témoignant de l'avance prise par les Américains dans la course à l'espace.
Chronologie de l'ensemble de la mission
Temps
écoulé Date (UTC) Événement Remarques
00h00 16/7 à 13h32 Décollage du centre spatial Kennedy
00h12 Insertion en orbite basse Premier arrêt du troisième étage Saturn V
02h44 Injection orbite transit vers la Lune Rallumage 3ème étage Saturn V durant 6 minutes
03h15 Début du largage du troisième étage Manœuvre de retournement et amarrage au module lunaire
75h50 19/7 à 17h22 Insertion en orbite lunaire Propulseur principal utilisé durant 6 minutes et demi
100h12 20/7 à 17h44 Séparation du LEM et du CSM
102h46 20/7 à 20h18 Atterrissage du LEM sur la Lune
124h22 21/7 à 17h54 Décollage du LEM de la Lune
128h3 21/7 à 21h35 Amarrage du LEM et du CSM
130h10 21/7 à 23h42 Largage du LEM
135h24 22/7 à 4h56 Insertion sur une orbite de retour vers la Terre
194h49 24/7 à 16h21 Largage du module de service
195h19 24/7 à 16h51 Amerrissage de la capsule Apollo
Retransmission en Mondovision;
Article détaillé : Mondovision.
Une caméra fixe est installée sur le hublot droit du LEM et permet de voir la plateforme de départ, l'échelle, le pied du LEM et une partie du sol lunaire. C'est cette caméra qui retransmet les premières images de la Lune. Elle est activée par Neil Armstrong pendant sa descente des neuf marches du LEM.
Retransmis en direct sur l'ensemble de la planète, on estime que 500 millions de téléspectateurs et d'auditeurs ont suivi l'atterrissage et la marche du premier homme sur la Lune.
Trente-six chaînes de télévision sont présentes au centre de Houston, dont celle de la télévision publique roumaine, seul pays du bloc de l'Est présent.
La salle de presse de Houston a accueilli 3 497 journalistes accrédités dont des délégations étrangères composés de 111 journalistes japonais, 80 italiens, 64 britanniques, 57 français, 44 allemands, 38 argentins, 38 mexicains, 32 canadiens, 21 australiens, 20 espagnols et 19 brésiliens.
Les images et sons en provenance de l'Eagle depuis la mer de la Tranquillité sont récupérés par le Goldstone Deep Space Communications Complex.
En août 2006, la Nasa a annoncé avoir égaré les cassettes contenant les vidéos et les éléments télémétriques d'origine de la mission Apollo 11 et ne plus disposer que d'enregistrements résultant des conversions dans des formats plus récents. L'agence a nommé une équipe chargée de les retrouver.
La Nasa a indiqué en juillet 2009 ne pas avoir retrouvé les cassettes originales de l'enregistrement.
À défaut, elle a récupéré auprès de diverses sources - chaînes de télévision notamment - des retransmissions de la mission Apollo 11, qui ont été restaurées.
Résultats scientifiques
Étude des roches lunaires
Échantillon de roche lunaire conservé dans le laboratoire de Houston.
Au retour de la mission les échantillons de roches et du sol lunaire ramenés par l'équipage d'Apollo 11 sont stockés et examinés dans le laboratoire LRL, Lunar Receiving Laboratory créé à cet effet à Houston et conçu pour empêcher toute diffusion d'éventuels organismes extraterrestres.
Des échantillons de roche lunaire sont confiés pour analyse à 150 spécialistes scientifiques sans distinction de nationalité. Les pierres lunaires de taille importante se révèlent être des basaltes riches en fer et en magnésium qui se sont cristallisés il y a 3,57 à 3,84 milliards d'années.
Ils sont très proches dans leur composition des roches terrestres bien que plus riches en titane : cette particularité est à l'origine de la couleur plus foncée des mers lunaires.
Leur existence constitue la preuve que la Lune est un corps différencié invalidant la théorie d'une Lune constituée du matériau primitif du système solaire défendue par Urey.
Une des caractéristiques les plus frappantes est l'absence de minéraux hydratés.
La faible proportion en sodium a entraîné une grande fluidité des laves qui ont formé le basalte ce qui explique l'absence de relief à la surface des mers lunaires.
Mesures sismiques
Le sismomètre passif a été installé le 21 juillet 1969. Il a fonctionné durant une journée lunaire complète, survécu à une nuit lunaire mais est tombé en panne le 27 aout 1969 à la suite d'une défaillance du système de réception et de traitement des commandes transmises depuis la Terre. L'instrument a été opérationnel durant 21 jours, il ne fonctionnait pas durant la nuit lunaire faute d'énergie.
Les données fournies ont permis de démontrer que l'activité sismique de la Lune était très faible : la composante verticale du bruit de fond sismique est de 10 à 10000 fois plus faible que celui de la Terre.
Du fait des limitations du prototype, dont la correction était planifié avant même le débarquement sur la Lune, sur le sismomètre embarqué par Apollo 12, aucune donnée exploitable n'a pu être obtenue sur la structure interne de la Lune. Plusieurs recommandations émergent du rapport scientifique rédigé quelques mois après la mission.
Les phénomènes de dilatation/contraction de la structure de l'étage de descente du module lunaire resté sur la Lune ont été source d'un bruit de fond qui a perturbé les mesures : il est recommandé pour les missions suivantes que le sismomètre soit disposé le plus loin possible du module lunaire.
Du fait de la faiblesse de la sismicité de la Lune, il est nécessaire d'augmenter la sensibilité de l'instrument.
Pour la même raison, il est recommandé de recourir à la génération d'ondes sismiques artificielles en faisant s'écraser sur la Lune l'étage Saturn ou le module de remontée du module lunaire.
Mesure de la distance Terre-Lune à l'aide du réflecteur laser
Le réflecteur laser installé par l'équipage d'Apollo 11 est utilisé de manière continue depuis 1969.
Des tirs laser sont effectués depuis plusieurs observatoires installés sur Terre en direction des réflecteurs laser déposés par la mission Apollo 11 ainsi que par les missions Apollo 14 et 15.
Au cours des premières années la précision de la distance entre la Terre et la Lune est passée grâce à ces tirs d'environ 500 mètres à 25 cm. En améliorant les techniques utilisées, de nouvelles mesures ont permis de ramener cette incertitude à 16 cm en 1984.
L'Observatoire McDonald aux États-Unis puis l'Observatoire de la Côte d'Azur en France se sont dotés d'équipements spécifiques qui ont permis de réduire l'imprécision à 3 cm à la fin des années 1980/début des années 1990.
Enfin depuis mi 2005 l'observatoire du Point Apache au Nouveau-Mexique a pris le relais en utilisant un équipement encore plus perfectionné et effectue des mesures avec une précision inférieure au millimètre.
Liens
http://youtu.be/Tbd2bpEdWUE Le film complet de Apollo 11
http://youtu.be/HBhzRY6UuVA post interview
http://youtu.be/JC-cyoqKjpQ moonwalk one
 
Posté le : 20/07/2013 23:15
|
|
|
|
|
Achévement de la grand muraille de Chine |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
ACHÈVEMENT DE LA GRANDE MURAILLE DE CHINE
La Grande Muraille fut achevée sous les Ming par un dernier tronçon construit au nord de Lanzhou (Gansu) en 1598. C'était l'aboutissement d'une entreprise ayant connu de très longues périodes d'interruption, mais commencée dès l'époque des Printemps et des Automnes (vers — 500) par les Chinois pour se protéger de leurs voisins du Nord. Son tracé a changé au cours des siècles. Aussi l'expression « Grandes Murailles » conviendrait-elle mieux pour définir cet ensemble dont la longueur dépasse 5 000 kilomètres, si on en additionne les différents tronçons qui suivent la crête des collines. Couvrant une distance d'environ 2 700 kilomètres depuis le golfe de Bohai, au nord-est de Pékin (passe de Shanhaiguan), jusqu'à Jiuquan au Gansu (passe de Jiayuguan), la Grande Muraille des Ming coupe en biais la boucle du fleuve Jaune et suit le couloir du Gansu. Sa construction se compose de deux parements de pierres enserrant un blocage de pierrailles et de terre. Son sommet, que recouvrent des briques, est bordé de murs crénelés et forme une voie large d'environ 5 mètres. À intervalles plus ou moins réguliers – compte tenu des accidents du terrain –, elle comprend des passes fortifiées, des bastions et des tours d'alarme. De caractère défensif, elle servait également de voie de communication et de voie de transmission des messages à longue distance.

Posté le : 18/07/2013 23:39
|
|
|
|
|
Mazarin |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 Juillet 1602 naquit Jules Mazarin
De son nom de naissance, Giulio Mazzarino, Mazarini, ou Mazzarini,
nom qu'il il francisa pendant son ministère en France en écrivant simplement "Mazarin", malgré tout il signera encore Mazarini, à l'italienne, à la fin de sa vie, au bas du Traité des PyrénéeS.
Il est né dans une famille modeste, à Pescina, dans les Abruzzes devenue aujourd'hui une province Italienne.
Mieux connu sous le nom de cardinal Mazarin, il fut un diplomate et homme politique, dans un premier temps, il fut au service de la Papauté, puis il servit les rois de France Louis XIII et Louis XIV, succédant à Richelieu en tant que principal ministre de 1643 à 1661.
Il passa son enfance à Rome où ses parents demeuraient. Son père, Pietro Mazzarini, avait coutume d'aller de temps en temps chez son beau-frère, l'abbé Buffalini, lequel convia son épouse Hortensia, enceinte, à venir passer les dernières semaines de sa grossesse loin des miasmes de l'été romain.
Elle accoucha ainsi de son premier fils qui naquit coiffé et doté de deux dents.
On pensait alors que de tels signes présageaient d'une haute fortune. Plus tard, le cardinal s'en prévalait souvent.
La famille Mazzarini était d'origine génoise. Le grand-père de Mazarin, Giulio, partit s'installer en Sicile et s'établit en tant que simple citoyen palermitain, non noble. L'oncle Hieronimo et le père du cardinal, Pietro Mazzarini, eux, naquirent en Sicile. La relative réussite de la famille dans l'artisanat ou le commerce, les sources sont imprécises, permit d'envoyer les fils à l'école.
À quatorze ans, le fils de Pietro fut envoyé à Rome afin de terminer ses études, muni de lettres de recommandation pour Filippo Colonna, connétable du Royaume de Naples.
Mazarin fut d'ailleurs toujours reconnaissant envers la famille Colonna, répétant toujours que sa fortune lui était venue de la faveur de cette maison.
Fort de ses recommandations, son père sollicita en effet un emploi. Pietro plut au connétable, mais les fonctions qu'il exerça au départ pour ce dernier sont inconnues.
Sans doute lui confia-t-il la gestion de certains de ses domaines. Par sa conduite habile et prudente, Pietro se vit proposer par son maître de réaliser un beau mariage avec Hortensia Buffalini, filleule du connétable, appartenant à une famille noble mais désargentée de Città di Castello en Ombrie. La jeune fille avait une réputation de beauté et de vertu. Le couple eut deux fils et quatre filles.
Sa famille d'origine
Pietro Mazzarini Palerme, 1576 - Rome, 13 novembre 1654.
En 1600 il épouse Hortensia Buffalini . Sept enfants suivent.
Le 1er janvier 1645 il épouse Portia Orsini. Sans postérité.
Enfants du premier lit :
1. Geronima, née à Rome le 11 janvier 1601 et morte dans l'été qui a suivi.
2. Giulio, né à Pescina le 14 juillet 1602. Cardinal. Mort à Vincennes le 9 mars 1661.
3. Alessandro, baptisé à Pescina le 1er septembre 1605.
En religion, Michele Mazzarini, dominicain, cardinal de Sainte-Cécile. Mort à Rome le 31 août 1648.
4. Margarita Rome, 14 octobre 1606 - Rome, 1687. épouse le 16 juillet 1634 Geronimo Martinozzi mort en septembre 1639, fils du comte Vicenzo Martinozzi mort le 1er octobre 1646. Dont 2 filles :
Laure Martinozzi Rome, début 1636 - Rome, 1687. épouse en 1655 Alphonse IV, duc de Modène, 1634-1662. Deux de leurs enfants survécurent :
un fils, François II, duc de Modène 1660-1694,
une fille, Marie Béatrice 1658-1718, épouse en 1672 Jacques II, roi d'Angleterre.
Anne-Marie Martinozzi Rome, 1637-Paris, 1672, épouse en 1654 Armand de Bourbon, prince de Conti 1629-1666. d'où deux fils.
5. Anna-Maria (d'abord nommée Geronima en souvenir de la petite morte), née à Rome le 14 janvier 1608. Morte en 1669. Religieuse.
6. Cléria, Rome le 10 avril 1609 baptisée le 13 avril- vers le 12 juillet 1649, épouse en avril 1643 Pietro Antonio Muti, fils du marquis Fabrizio Muti. Sans postérité.
7. Geronima Mazzarini, dite Girolama, Rome, 29 décembre 1614 baptisée le 2 janvier 1614- Paris le 29 décembre 1656 épouse le 6 août 1634 le baron Lorenzo Mancini mort en octobre 1650. Neuf enfants :
Vittoria, dite Laure Mancini Rome, 1635 - Paris, 8 février 1657, épouse en 1651 Louis II de Vendôme, duc de Mercœur 1612-1668. Trois fils.
Paolo, dit Paul Mancini 1637 - Paris, 18 juillet 1652.
Olympe Mancini Rome, 1638 - Bruxelles, 9 octobre 1708, épouse le 20 février 1657 Eugène-Maurice de Savoie-Carignan, comte de Soissons 1635 - 1673. Entre autres enfants, deux fils :
Louis-Thomas de Savoie-Carignan, 4e comte de Soissons, né le 1er août 1657 - Landau, 14 août 1702.
Eugène de Savoie-Carignan, 1663 - 1736, capitaine et diplomate au service de l'Autriche.
Marie Mancini Rome, 28 août 1639 - Madrid, 1715, épouse en 1661 Lorenzo Onofrio Colonna, connétable de Naples 1636 - 15 avril 1689). Trois fils.
Philippe Mancini 26 mai 1641 - Rome, 8 mai 1707, duc de Nevers. épouse le 15 décembre 1670 Diane-Gabrielle de Damas-Thianges, nièce de Madame de Montespan. Deux fils et deux filles.
Alphonse Mancini Rome, 1644 - Paris, 5 janvier 1658.
Hortense Mancini Rome, 6 juin 1646 - Chelsea, Angleterre, 1699, épouse le 28 février 1661 Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye, puis duc de Mazarin, duc de Mayenne 1632 - 9 novembre 1713. Trois filles et un fils.
Une fillette, en 1647, qui meurt à l'âge de deux ans.
Marie Anne Mancini Rome, 1649 - 1715. épouse en 1662 Godefroy Maurice de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon et neveu de Turenne. Dix enfants.
Une enfance d’élève brillant
Bien qu’elle demeure peu documentée, l’enfance de Mazarin laisse déjà deviner un garçon doué, remarqué dès son plus jeune âge pour son habileté à séduire et son aisance intellectuelle. C’est là ce qui fera tout au long de sa jeunesse la force du futur cardinal : une étonnante capacité à plaire et à savoir se rendre indispensable.
À sept ans, le petit prodige entra au Collège romain tenu par les Jésuites. Élève brillant, il eut à soutenir sa thèse de fin d’études sur la comète qui provoqua tant de polémiques en 1618 sur l’incorruptibilité des cieux et conduisit Galilée à publier le célèbre Saggiatore, L'Essayeur. Mazarin sut manifestement éviter les nombreux pièges que le sujet comportait et obtint l’approbation unanime du jury.
Mazarin grandit avec les enfants de la Famille Colonna ce qui lui permit, sans qu’il en fasse partie, de fréquenter le grand monde et ses palais. Il semble que dès son adolescence, Giulio a développé une passion pour le jeu qui ne l’a jamais quitté. Sans doute ce vice lui offrit d’abord un moyen de gagner ce que l’on appellerait aujourd’hui de l’« argent de poche ».
Il est établi que le futur cardinal passa trois ans en Espagne de 1619 à 1621 ? pour accompagner Jérôme-Girolamo Colonna qui sera nommé cardinal le 30 août 1627 par Urbain VIII et qu'il y termina ses études de droit civil et canon à l'université d'Alcalá de Henares. De cette expérience, Mazarin tira une maîtrise parfaite de l’espagnol qui devait s’avérer très utile tout au long de sa carrière. Les légendes sont nombreuses quant à la vie du jeune homme en Espagne. Une chose est certaine, il dut rentrer en Italie car son père, accusé de meurtre, avait été contraint de se tenir à l’écart de Rome pendant quelque temps. Cet épisode fit basculer Mazarin dans le monde des adultes : il était à présent tenu de soutenir sa famille. Il s’engagea alors dans des études de droit canon, qu’il termina en avril 1628, renonçant à une carrière artistique pour laquelle il présentait pourtant des dispositions. Comme la plupart des jeunes Romains, il s’engagea ensuite au service du pape et devint secrétaire du nonce apostolique à Milan, voie qui lui offrait les meilleures perspectives.
Au service du Pape
Durant la guerre de Trente Ans, un conflit opposa la France à l’Espagne au sujet de la vallée de la Valteline dans les Grisons. Le pape Urbain VIII envoya des troupes en tant que force d’interposition. Mazarin se vit offrir une commission de capitaine d’infanterie au sein du régiment équipé par la famille Colonna.
Il fit, avec sa compagnie, quelques séjours à Lorette et à Ancône. Sans jamais avoir à mener de combat, il montra dans l'exercice de ses fonctions, et notamment dans la gestion des troupes et des vivres, la supériorité de son esprit et un grand talent pour discipliner les soldats.
Il se fit alors remarquer par le commissaire apostolique Jean-François Sacchetti. Le Traité de Monzón en 1626 régla temporairement la situation sans que les troupes du Pape ne soient intervenues.
En 1627 éclata en Italie du nord le conflit appelé guerre de succession de Mantoue. Il opposait d'une part, l'empereur Ferdinand II, le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier et la maison des Gonzague de Guastalla, représentée par Ferdinand II de Guastalla, candidat des Habsbourg au duché et, d'autre part, le roi de France Louis XIII venu secourir Charles Gonzague, duc de Nevers, candidat français à l'héritage de la branche aînée des Gonzague. Une légation papale fut envoyée à Milan afin d'apaiser le conflit qui menaçait de dégénérer.
Elle fut conduite par Jean-François Sacchetti, en tant que nonce extraordinaire. Mazarin l'accompagna en qualité de secrétaire.
La légation arriva trop tard et surtout Sacchetti dut rentrer rapidement à Rome. Une autre légation fut programmée, dirigée cette fois par le neveu du pape Urbain VIII, Antonio Barberini, mais elle tarda à se mettre en place. Ce fut la chance de Mazarin qui resta à Milan et continua le travail entrepris, sachant parallèlement provoquer en sa faveur une réelle campagne de publicité à Rome, relayée par sa famille, les Sacchetti et les Colonna. Il bombarda le Saint-Siège de rapports, espérant attirer la bienveillance papale. En préparation de l'arrivée de la nouvelle légation, Mazarin fut finalement chargé en septembre 1629 de sonder les vues des parties prenantes. Il faisait son entrée officielle dans la diplomatie.
Lorsque le légat pontifical arriva dans le Montferrat, pour traiter de la paix entre la France et l'Espagne, Giulio resta attaché à la légation au titre de secrétaire. Le légat apostolique négociait la paix avec grand zèle. Mazarin, comme secrétaire, allait d'un camp à l'autre, pour hâter la conclusion d'un traité. Le jeune homme avait l'avantage d'avoir pris la mesure des évolutions en Europe : le rêve papal d'un retour à l'unité de l'Église n'aboutirait pas et la paix en Europe ne pourrait reposer que sur un équilibre des puissances.
À court terme, il ne mit pas longtemps à s'apercevoir que le marquis de Santa-Cruz, qui représentait la couronne d'Espagne, avait une peur violente de perdre son armée, et un ardent désir d'arriver à un accommodement.
Comprenant tout le parti qu'il pouvait tirer de cette faiblesse, il pressa le général espagnol, lui représentant avec exagération la force des Français. Pour éviter les conflits, Mazarin lança son cheval au galop entre les deux armées, et agitant son chapeau, criait « Pace ! Pace ! ».
Cette intervention empêcha la bataille. Après le « coup » de Casale, en octobre 1630, la tâche du diplomate pontifical qu'est devenu Mazarin consiste à faire respecter les trêves conclues entre Espagnols, Impériaux, Français et Savoyards, puis à jeter les bases d'un traité de paix, spécialement entre Louis XIII et son beau-frère de Turin.
Les négociations de Mazarin comme ambassadeur extraordinaire en Savoie d'Abel Servien aboutirent le 6 avril 1631 au traité de Cherasco par lequel l'empereur et le duc de Savoie reconnaissaient la possession de Mantoue et d'une partie du Montferrat à Charles Gonzague et surtout l'occupation française de la place forte de Pignerol, porte de la vallée du Pô. Elles apportèrent à Louis XIII et au cardinal de Richelieu une telle satisfaction que celui-ci en regarda l'auteur comme un homme inépuisable en ressources, fécond en ruses et stratagèmes militaires et qu'il en conçut le vif désir de le connaître personnellement.
Il le manda à Paris, où Mazarin se rendit avec un plaisir inexprimable. Richelieu l'accueillit avec de grandes démonstrations d'affection, l'engagea par les plus belles promesses, et lui fit donner une chaîne d'or avec le portrait de Louis XIII, des bijoux et une épée d'une valeur considérable.
Ses premiers contacts avec la France
Il est d’abord vice-légat d'Avignon en 1634, puis nonce à Paris de 1634 à 1636), où il déplut par ses sympathies pour l'Espagne, ce qui le fit renvoyer à Avignon en 1636 et l'empêcha, malgré les efforts de Richelieu, de devenir cardinal.
Richelieu, se sentant accablé par l'âge, bien qu'il fût infatigable au travail, pensa que Mazarin pouvait être l'homme qu'il cherchait pour l'aider au gouvernement.
Dès son retour en France après un bref voyage à Rome, il retint Mazarin près de lui et lui confia plusieurs missions dont il s'acquitta fort honorablement, puis il le présenta au roi qui l'aima beaucoup. Mazarin s'établit alors dans le palais royal.
Toujours très habile au jeu, un jour qu'il gagnait beaucoup, on accourut en foule pour voir la masse d'or qu'il avait amassée devant lui.
La reine elle-même ne tarda pas à paraître.
Mazarin risqua tout et gagna. Il attribua son succès à la présence de la reine et, pour la remercier, lui offrit cinquante mille écus d'or et donna le reste aux dames de la cour. La reine refusa d'abord, puis finit par accepter, mais quelques jours après, Mazarin reçut beaucoup plus qu'il n'avait donné.
Mazarin envoya à son père, à Rome, une grosse somme d'argent et une cassette de bijoux pour doter ses trois sœurs et s'affermit dans l'idée de servir la Couronne, dont la faveur, pensait-il, était le plus sûr moyen d'obtenir la pourpre, car seul moyen pour lui étant sans naissance d'accéder aux responsabilités auxquelles il aspirait.
Mais Richelieu, qui l'estimait beaucoup et le jugeait digne du chapeau de cardinal, n'avait pas hâte de le combler.
Un jour, il lui offrit un évêché avec trente mille écus de rente.
Mazarin, craignant de se voir enterré loin de Paris et des affaires, ne voulut pas courir le risque d'arrêter là sa fortune et refusa aimablement.
Il attendit encore longtemps puis, las d'attendre, rentra en Italie en 1636, pensant qu'à Rome, au service du cardinal Antonio Barberini, neveu du pape, il serait plus en mesure d'avoir la pourpre.
La carrière de Mazarin fut donc d'abord romaine et, même s'il devint ensuite un serviteur incontestablement fidèle de la monarchie française, il conserva des goûts et un style de vie romains et son habileté diplomatique doit beaucoup à la formation qu'il avait reçue à la cour pontificale.
Mazarin fut un pur produit de la Rome baroque dont la culture et le décor s'éloignaient de la raideur dogmatique et artistique des deux grands papes de la Contre-Réforme que furent dans la seconde moitié du XVIe siècle pie V et Sixte Quint.
À partir de 1623 et pendant seize ans la carrière de Mazarin se déroula essentiellement au service de la diplomatie pontificale, en particulier comme négociateur dans la difficile succession de Mantoue et comme nonce à Paris.
Ces missions le mirent en rapport dès 1630 avec Richelieu et Louis XIII qui apprécièrent son charme, son intelligence son habileté, sa puissance de travail et la générosité de ses cadeaux.
Richelieu, grand collectionneur, le mit de plus en plus à contribution pour réaliser en Italie des acquisitions d'antiques et autres œuvres d'art destinées à son palais parisien et à son château du Poitou. Lorsque, en 1639, Mazarin, appelé par Louis XIII et Richelieu, quitta définitivement Rome pour la France, il fit embarquer " 50 statues antiques de marbre et d'autres gentillesses... pour les donner à Sa Majesté Chrétienne, au Seigneur cardinal de Richelieu et aux autres grands de cette cour ".
Ministre en France
En avril 1639, naturalisé français, il retourne à Paris et se met à la disposition de Richelieu. En décembre 1640, il fait un heureux début en gagnant à la cause française les princes de Savoie ; un an plus tard, le pape lui accordait le chapeau de cardinal.
Lors de la conspiration de Cinq-Mars et du duc de Bouillon, celui-ci n'obtint sa grâce qu'en livrant la Principauté de Sedan ; Mazarin signa la convention et vint occuper Sedan.
Le 5 décembre 1642, lendemain de la mort de Richelieu, Mazarin fut nommé Principal Ministre de l'État, comme l'avait recommandé Richelieu qui voyait en lui son digne successeur.
Louis XIII le choisit comme parrain du dauphin, futur Louis XIV.
Après la mort de Louis XIII, il créa la surprise en obtenant le soutien de la régente. Longtemps opposée à Richelieu et estimée comme favorable à un rapprochement avec l'Espagne, étant elle-même espagnole, Anne d'Autriche fait volte-face à la surprise de la plupart des observateurs de l'époque.
En réalité, le rapprochement entre Mazarin et la régente fut antérieur à la mort de Louis XIII et de son principal ministre. Le souci de préservation de la souveraineté de son fils et la conscience des dommages qu'aurait causés pour celle-ci un rapprochement avec Madrid, furent des arguments de poids dans sa décision de poursuivre la politique du feu roi et du cardinal de Richelieu – et donc d'appuyer Mazarin.
Les inestimables compétences de ce dernier en politique extérieure furent un prétexte pour justifier ce soutien. Mazarin sut par la suite très vite se rendre indispensable à la régente, se chargeant habilement de compléter son éducation politique et l'incitant à se décharger entièrement sur lui du poids des affaires.
Ainsi, à partir de 1643, à la mort de Louis XIII, alors que Louis XIV n'est encore qu'un enfant, la régente Anne d'Autriche nomme Mazarin Premier Ministre.
En mars 1646, il devient également « surintendant au gouvernement et à la conduite de la personne du roi et de celle de Monsieur le duc d'Anjou ».
À Rome, Mazarin avait vécu jusque-là dans l'entourage des cardinaux-neveux successifs, à la fois ministres des papes et grands amateurs d'oeuvres d'art. L'un d'eux, Antonio Baberini, fut son principal padrone romain.
Son exemple l'a certainement marqué. Avant même d'être promu cardinal mais déjà au service de la France Mazarin acheta à Rome le prestigieux palais Bentivoglio qui aurait pu lui servir de lieu de repli en Italie en cas de nécessité mais où, en fait, il n' a pas vécu, conservant toutefois d' étroites relations avec la ville des papes où il avait des agents et son père.
Un de ses proches lui écrivait lors de cet achat : " Ce palais est le plus beau de Rome ; mais, à vrai dire, plus celui d'un grand cardinal que celui d'un prélat ". À quoi Mazarin répondit : " servant un grand roi et jouissant de la protection de Son Eminence le cardinal-duc (de Richelieu), je crois ne pas devoir entreprendre des choses ordinaires ". En fait Mazarin, qui reçut en 1639 des " lettres de naturalité " françaises, espérait certainement devenir bientôt cardinal. Ce qui effectivement advint dès 1641 sur proposition de Richelieu. Or en 1630 Urbain VIII Barberini avait octroyé aux cardinaux le titre d'" éminentissimes " qui faisait d'eux sur le plan protocolaire des princes de l'Église et les égaux des rois ou chefs de gouvernement. Être cardinal constituait donc une promotion considérable, même pour un ministre et, le cas échéant, une brillante position de repli: Un cardinal était quasiment intouchable. C'est pourquoi les ennemis de Mazarin, au temps de la Fronde, demandèrent au Pape de l'appeler à Rome, de lui faire un procès et de le priver de son cardinalat. Si cette procédure avait abouti, Mazarin ne s' en serait sans doute pas relevé.
À l'époque il n'était pas nécessaire d'être prêtre pour devenir cardinal.
Mazarin reçut seulement la tonsure en 1632, ce qui faisait de lui un " clerc " et lui permettait de se faire conférer des bénéfices ecclésiastiques.
Peu après Urbain VIII le fit prélat dit "monsignore" avec obligation de porter la soutane et l'intégra au collège des " protonotaires apostoliques ".
Ceux-ci avaient peu d'obligations mais, dans les cérémonies romaines, ils venaient à égalité avec les évêques.
Cardinal en 1641, Mazarin, bénéficiant de dispenses constamment, mais souvent tardivement renouvelées, n'effectua pas la visite ad limina, ne reçut jamais les ordres même mineurs, ni l'anneau de cardinal, ni le chapeau, ne prit jamais possession de son titulus, le vieux sanctuaire de Rome affecté à chaque cardinal.
Le pape dut lui envoyer la " barrette rouge " que Louis XIII lui remit solennellement le 26 février 1642 dans la cathédrale de Valence.
Mazarin ne s'est donc habillé de pourpre qu'à partir de quarante ans et il aurait pu, comme d'autres le firent en son temps, renoncer au cardinalat pour se marier.
En revanche son frère Michele, dominicain, lui aussi cardinal, était prêtre et fut archevêque d'Aix-en-Provence.
En résumé, Mazarin fut au service de la diplomatie papale jusqu'en 1639.
Il resta ensuite " romain " aux yeux de l' administration pontificale. Mais ses " lettres de naturalité " donnaient à cet étranger le droit de posséder, d'acquérir et de léguer des biens et des revenus en France, y compris des bénéfices ecclésiastiques.
La première abbaye que Mazarin reçut en commende fut celle de Saint Médard de Soissons.
En un temps où l'Église et l'État, dans le système de chrétienté , étaient imbriqués l'une dans l'autre Mazarin, premier ministre du roi de France, eut évidemment à prendre des décisions ayant des incidences religieuses.
On peut globalement affirmer que, dans ce type de difficultés, son souci majeur fut celui de l'autorité royale et de la tranquillité de l'État et que son statut d'homme d'Église ne fut jamais sa première considération, soit dans la politique extérieure, soit dans les affaires intérieures.
S'agissant de la première, il continua l'action de Richelieu et, durant la guerre de Trente ans, cette série de conflits européens, puis dans le conflit avec l'Espagne, au grand dam du parti dévot en France, il maintint les alliances protestantes, s'entendant même avec le régicide Cromwell pour mettre un terme à la guerre contre l'Espagne : ce qui scandalisa beaucoup de catholiques.
Mazarin et le protestantisme
Dans les négociations qui conduisirent aux traités de Westphalie il considéra Innocent X Pamphili, il est vrai pro-espagnol et qu' il détestait, comme quantité négligeable, imposa le français comme langue diplomatique à la place du latin et fit triompher un statut de l'empire qui consacrait la consolidation du protestantisme en Allemagne, le calvinisme y étant, en outre, reconnu désormais officiellement à côté du luthéranisme.
Le pape protesta en vain.
Comme son maître Richelieu qui, lui, était évêque, Mazarin fit donc passer ce qui lui paraissait l'intérêt de la France avant celui du catholicisme.
De même, à l'intérieur, son attitude dans les questions religieuses fut essentiellement dictée par la volonté de faire respecter le pouvoir royal.
Dans la mesure où les protestants, vaincus militairement depuis la Paix d'Alès (l629), faisaient désormais preuve de fidélité envers le roi, il ne chercha pas à les faire rentrer dans le giron de l'Église romaine.
En 1643 et, encore en 1652 en pleine Fronde, il fit renouveler l'Édit de Nantes par déclarations royales.
Dans celle de 1652 on pouvait lire : " nos sujets de la Religion Prétendue Réformée nous ont donné des preuves de leur fidélité, notamment dans les circonstances présentes, dont nous demeurons très satisfait ".
Sept ans plus tard, au moment du synode réformé de Loudun, Mazarin écrivit aux délégués : " Je vous prie de croire que j'ai une grande estime pour vous, étant de si bons et si fidèles serviteurs du roi ".
Quelles qu'en fussent les raisons, guerre à l'extérieur, troubles à l'intérieur, relative indifférence personnelle, Mazarin resta sourd aux demandes de l'assemblée du clergé de France qui, en 1651, avait suggéré une tactique au gouvernement pour que " ce mal " le protestantisme ne fasse pas de progrès : si le roi ne peut " l'étouffer tout d'un coup ", qu'il le rende " languissant " et le fasse " périr peu à peu par le retranchement et la diminution de ses forces ".
Mazarin fit de Bartélemy Hervart, homme d'affaires depuis longtemps en relation avec lui, un contrôleur général des finances. Or Hervart était protestant et refusa d'abjurer.
Toutefois certains indices conduisent à se demander si, à la fin de son gouvernement, Mazarin, désormais assuré de la paix intérieure et extérieure, ne songeait pas à une application plus rigoureuse de l'édit de Nantes.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas au protestantisme que Mazarin se heurta, mais au jansénisme. Il n'avait, certes, aucun penchant personnel pour le rigorisme, notamment celui des jansénistes.
D'autre part, il ne semble pas avoir eu le goût des discussions théologiques. Quand il qualifia le jansénisme de " calvinisme rebouilli ", il ne retenait que la doctrine de la prédestination sans voir que les jansénistes maintenaient les sept sacrements, les rites et la hiérarchie de l'Église romaine.
Mazarin et le jansénisme
Mais Mazarin, politiquement, rencontra le jansénisme sur sa route, Car il lui parut plus ou moins lié aux cercles frondeurs, donc dangereux pour la paix publique et l'autorité du roi.
Aussi bien Richelieu avait-il fait emprisonner Saint-Cyran, ami de Jansénius et de la famille Arnauld et favorable à une politique extérieure pro-espagnole. Mazarin libéra Saint-Cyran qui mourut bientôt.
Mais, durant les Frondes successives, Mazarin dut constater que, si les défenseurs déclarés de l'Augustinus n'étaient pas eux mêmes frondeurs, leurs amis l'étaient, à commencer par son ennemi personnel, Paul de Gondi, bientôt cardinal de Retz.
Mazarin rangea donc les jansénistes parmi les contestataires de l'autorité royale.
Mais il avait une autre raison de les combattre.
A une époque où ses relations avec Rome étaient détestables en raison de la continuation de la guerre avec la catholique Espagne il trouvait dans le conflit doctrinal avec les jansénistes une occasion de faire une bonne manière au pape et de diminuer ses rancoeurs à l'égard de la politique française.
Aussi appuya-t-il la demande du syndic de la Sorbonne et de 93 évêques français qui, en 1651, souhaitèrent voir Rome se prononcer sur cinq propositions tirées de l'Augustinus et, à leurs yeux , suspectes d'hérésie. Mazarin fut ravi de voir ces propositions condamnées par la bulle cum occasione de 1653 et il fit immédiatement le nécessaire pour que la bulle fût reçue en France.
À quoi les jansénistes répondirent par la distinction du droit et du fait : les cinq propositions sont bien hérétiques, mais, dirent-ils, nous ne les trouvons pas dans le livre de Jansénius.
D'où l'idée de faire signer aux prêtres, religieux et religieuses et même aux enseignants laïcs un " formulaire " d'obéissance aux décisions romaines sur les cinq propositions.
Mazarin réunit en 1655 une quinzaine d'évêques qui proposèrent ce formulaire, lequel fut approuvé par l'assemblée du clergé de France en 1656 et par le pape l'année suivante.
Il est vrai qu'il ne fut vraiment exigé qu'après la mort de Mazarin qui, sans doute impressionné par le succès des Provinciales, semble avoir pris du champ par rapport au problème janséniste dans les dernières années de sa vie. Mais, auparavant, il avait tout de même contribué à poser une bombe à retardement dans ce conflit religieux.
L'attitude de Mazarin face au jansénisme est à rapprocher de sa défiance à l'égard de la Compagnie du Saint-Sacrement. Créée vers 1630 par le duc de Ventadour, celle-ci voulait promouvoir le culte de l'eucharistie, suivre les consignes du concile de Trente, secourir les pauvres, lutter contre la prostitution et toutes les formes d'immoralité. Saint Vincent de Paul, saint jean eudes, Bossuet notamment en firent partie.
Mais, " pour se conformer à la vie cachée de Jésus-Christ au Très-Saint Sacrement " et pour fuir tout amour propre la société voulait rester secrète. En outre, elle était surtout composée de laïcs, plus difficiles à contrôler que des ecclésiastiques.
Vers 1660 elle émit des critiques sur le style de vie de Mazarin. Celui-ci fit prendre par le Parlement un arrêt qui interdisait toute réunion à Paris sans l'autorisation du roi.
La compagnie disparut définitivement en 1666.
On sait, par ailleurs, que les rapports entre Mazarin et saint-Vincent-de-Paul ne furent pas excellents.
M. Vincent souhaitait, dans l'esprit du concile de Trente, que les candidats aux fonctions ecclésiastiques fussent animés de motivations seulement spirituelles.
Mais, selon le concordat de Bologne de 1516, c'est le roi de France qui choisissait les titulaires de la plupart des évêchés et abbayes du royaume. Richelieu avait créé un " Conseil de conscience " pour s'occuper de l'ensemble des affaires ecclésiastiques et, notamment, des candidatures aux charges épiscopales et abbatiales.
M. Vincent y fut nommé.
Devenu régente, Anne d'Autriche maintint ce conseil auquel participait, bien entendu, Mazarin. Mais le cardinal se méfiait du fondateur des Lazaristes, selon lui, trop lié avec Paul de Gondi et trop écouté d'Anne d'Autriche.
En outre, sa stratégie de nominations ecclésiastiques ne rejoignait pas les idéaux de M. Vincent. Il s'arrangea donc pour réunir de plus en plus rarement le Conseil de conscience, en fait pour en écarter quelqu'un qui venait en travers de ses projets.
C'est ici le lieu de rappeler que Mazarin, imitant Richelieu, accumula un nombre impressionnant de bénéfices ecclésiastiques. On l'a surnommé " le cardinal aux vingt-cinq abbayes ".
Parmi celles-ci figuraient notamment, lors de sa mort, les plus célèbres et les plus riches du royaume : Saint-Denis, Cluny, Saint-Médard de Soissons Moissac, Saint-Etienne de Caen, La Chaise-Dieu, Saint-Germain d'Auxerre, Saint-Honorat de Lérins.
Il s'agit d'un record dans l'histoire de France.
Plusieurs indices conduisent à penser qu'à la fin de sa vie Mazarin songea à devenir prêtre, à un moment où la Paix des Pyrénées avait porté sa gloire au zénith et où il avait réussi à réconcilier les deux grandes puissances catholiques.
Prêtre, il aurait pu se faire élire pape à un prochain conclave. Alexandre VII était en mauvaise santé et Mazarin avait ses chances.
Mais Alexandre VII vécut jusqu'en 1667 et Mazarin, au contraire, mourut dès 1661 à cinquante-neuf ans.
A bien des égards Mazarin est une énigme et tout jugement simpliste sur l'homme paraît anti-historique.
Ainsi, abbé commendataire de Cluny, il essaya réellement mais, il est vrai, sans succès d'y rétablir la discipline monastique.
Sa vie privée a, bien sûr, fait l'objet de " mazarinades ", mais contradictoires entre elles.
Tantôt on l'a accusé en termes orduriers d' être l' amant d' Anne d' Autriche, tantôt au contraire on a raillé sa virilité défaillante.
Les historiens s’interrogent sur la nature exacte des relations de Mazarin et d'Anne d’Autriche. Des lettres échangées depuis son premier exil, utilisant des codes, sont parfois très sentimentales, bien que ce soit le style de l’époque d’écrire avec beaucoup d’emphase.
« Au pis aller, vous n'avez qu'à rejeter la faute du retardement sur ... (qui signifie Anne) , qui est…(illisible) (signe pour Anne) (signe pour Mazarin) jusques au dernier soupir. L'enfant vous mandera toutes choses. Adieu, je n'en puis plus. (signe pour Mazarin) lui sait bien de quoi. »
Leur relation fut en tous cas très étroite. Elle a sans doute été renforcée par leur isolement politique lors de la Fronde. La question de savoir si Mazarin et Anne d'Autriche s'aimèrent est controversée. Certains ont analysé leur correspondance de sorte qu'ils ont cru pouvoir y déceler une liaison (voire un mariage secret), qui reste hypothétique, entre l'homme d'Église et la reine-mère.
De nombreux amants ont été attribués à Anne d'Autriche. Le duc de La Rochefoucauld disait, pendant la Fronde, que Mazarin rappelait sûrement à la reine le duc de Buckingham.
Son éventuelle paternité de Louis XIV, comme des historiens l'ont avancé, est aujourd'hui démentie par l'analyse génétique.
La correspondance de Mazarin
Ces lettres de la reine, nous ne les avons plus la série de 11 lettres autographes qui a subsisté ne commence qu'en 1653, mais on peut juger de leur ton par celui qu'employait Mazarin lui-même.
Lettres à la reine du 11 mai 1651 :
Mon Dieu, que je serais heureux et vous satisfaite si vous pouviez voir mon cœur, ou si je pouvais vous écrire ce qu'il en est, et seulement la moitié des choses que je me suis proposé. Vous n'auriez pas grand-peine, en ce cas, à tomber d'accord que jamais il n'y a eu une amitié approchante à celle que j'ai pour vous.
Je vous avoue que je ne me fusse pu imaginer qu'elle allât jusqu'à m'ôter toute sorte de contentement lorsque j'emploie le temps à autre chose qu'à songer à vous : mais cela est, à tel point qu'il me serait impossible d'agir en quoi qui en pût être, si je ne croyais d'en devoir user ainsi pour votre service.
Je voudrais aussi vous pouvoir exprimer la haine que j'ai contre ces indiscrets qui travaillent sans relâche pour faire que vous m'oubliez et empêcher que nous ne nous voyions plus ...La peine qu'ils nous donnent ne sert qu'à échauffer l'amitié qui ne peut jamais finir.
Je crois la vôtre à toute épreuve et telle que vous me dîtes ; mais j'ai meilleure opinion de la mienne, car elle me reproche à tout moment que je ne vous en donne pas assez de belles marques et me fait penser à des choses étranges pour cela et à des moyens hardis et hors du commun pour vous revoir. Si mon malheur ne reçoit bientôt quelque remède je ne réponds pas d'être sage jusqu'au bout, car cette grande prudence ne s'accorde pas avec une passion telle qu'est la mien
Ah ! que je suis injuste quand je dis que votre affection n'est pas comparable à la mienne ! Je vous en demande pardon et je proteste que vous faites plus pour moi en un moment que je ne saurais faire en cent ans : et si vous saviez à quel point me touchent les choses que vous m'écrivez, vous en retrancheriez quelqu'une par pitié, car je suis inconsolable de recevoir des marques si obligeantes d'une amitié si tendre et constante, et d'être éloigné.
Je songe quelquefois s'il ne serait pas mieux pour mon repos que vous ne m'écrivissiez pas, ou que, le faisant, ce fût froidement ; que vous dissiez que j'ai été bien fou à croire ce que vous m'avez mandé de votre amitié, et enfin que vous ne vous souvenez plus de moi comme si je n'étais au monde. Il me semble qu'un tel procédé, glorieux comme je suis, me guérirait de tant de peines et de l'inquiétude que je souffre et adoucirait le déplaisir de mon éloignement. Mais gardez-vous bien d'en user ainsi ! Je prie Dieu de m'envoyer la mort plutôt qu'un semblable malheur, qui me le donnerait mille fois le jour : et si je ne suis pas capable de recevoir tant de grâces, il est toujours plus agréable de mourir de joie que de douleur"
Voici donc la première lettre autographe connue de la reine à Mazarin ; elle n'est pas datée, mais elle est antérieure à celle du 26 janvier 1653, qui suivra:
Ce dimanche au soir,
Ce porteur m'ayant assuré qu'il ira fort sûrement, je me suis résolue de vous envoyer ces papiers et vous dire que, pour votre retour, que vous me remettez, je n'ai garde de vous en rien mander, puisque vous savez bien que le service du roi m'est bien plus cher que ma propre satisfaction ; mais je ne puis m'empêcher de vous dire que je crois que, quand l'on a de l'amitié, la vue de ceux que l'on aime n'est pas désagréable, quand ce ne serait que pour quelques heures. J'ai bien peur que l'amitié de l'armée ne soit plus grande que toutes les autres. Tout cela ne m'empêchera pas de vous prier d'embrasser de ma part notre ancien ami et de croire que je serai toujours telle que je dois, quoi qu'il arrive.
Le 26 janvier, Mazarin n'étant pas encore revenu, Anne lui écrit :
Je ne sais plus quand je dois attendre votre retour, puisqu'il se présente tous les jours des obstacles pour l'empêcher. Tout ce que je vous puis dire est que je m'en ennuie fort et supporte ce retardement avec beaucoup d'impatience, et si Mazarin savait tout ce que souffre sur ce sujet, je suis assurée qu'il en serait touché. Je le suis si fort en ce moment que je n'ai pas la force d'écrire longtemps ni ne sais pas trop bien ce que je dis. J'ai reçu de vos lettres tous les jours presque, et sans cela je ne sais ce qui arrivera. Continuez à m'en écrire aussi souvent puisque vous me donnez du soulagement en l'état où je suis. J'ai fait ce que vous m'avez mandé touchant[signes indéchiffrables. Au pis aller, vous n'aurez qu'à rejeter la faute du retardement sur elle, qui est un million de fois et jusques au dernier soupir. L'Enfant Ondedeï vous mandera toutes choses. Adieu, je n'en puis plus et lui, Mazarin, sait bien de quoi.
Deux jours plus tard, le 28 janvier, Anne écrit encore à Mazarin.
C'est qu'elle a reçu de lui quelques reproches voilés pour avoir, sur l'instance de Molé, annulé une mesure de bannissement à l'encontre de quatre mauvais esprits du Parlement. Aussi s'excuse-t-elle en ces termes :
Votre lettre, que j'ai reçue du 24, m'a mis bien en peine, puisque elle a fait une chose que vous ne souhaitiez pas ... Suivent de longues explications, après lesquelles la reine conclut : Voilà comme l'affaire s'est passée véritablement et, si elle vous a déplu, vous pouvez croire que ce n'a pas été nullement à ce dessein-là, puisque elle n'a ni n'est capable d'en avoir d'autres que ce que lui et lui témoigner qu'il n'y a rien au monde pareil à l'amitié que elle a pour, et elle ne sera point en repos qu'il ne sache que n'a pas trouvé mauvais ce qu'il a fait, puisque non seulement, en effet, il ne voudrait pas lui déplaire, même seulement de la pensée, qui n'est employée guère à autre chose qu'à songer à la chose du monde qui est la plus chère à qui est. J'en dirais davantage si je ne craignais de vous importuner par une si longue lettre et, quoique je sois bien aise de vous écrire, je m'ennuie si fort que cela dure que je voudrais fort vous entretenir autrement. Je ne dis rien là-dessus, car j'aurais peur de ne pas parler trop raisonnablement sur ce sujet."
Sur le sujet de la vie privée de Mazarin la modération du cardinal de Retz peut surprendre. Il semble pencher pour l'opinion de Mme de Chevreuse qui jugeait qu'il n'y avait entre le cardinal et Anne d'Autriche qu'une " liaison intime d'esprits ".
La note dominante des " mazarinades " est autre.
Elle porte sur la " tyrannie " exercée par un étranger " lâche, ingrat, perfide et voleur ", " perturbateur du repos public " et " infracteur des lois ". Selon Paul de Gondi " il porta le filoutage dans le ministère ".
Il ajoute que " le fort de M. le cardinal Mazarin était proprement de ravauder, de donner à entendre, de faire espérer ; de jeter des lueurs (et) de les retirer ; de donner des vues et de les brouiller ", autrement dit, de promettre sans tenir ses promesses.
Toujours selon le cardinal de Retz Mazarin " se moqua de la religion ". Lourde accusation.
Ce que l'on peut constater avec plus de retenue est que le grief de " machiavélisme " vint sous la plume de ses détracteurs.
Ce terme péjoratif, apparu en français à la fin du XVIe siècle aussi bien sous des plumes protestantes que sous des plumes catholiques, signifiait le cynisme politique plaçant la raison d'État avant la morale chrétienne. Le parti pro-espagnol l'utilisa contre Richelieu et Mazarin.
En France, l'un des principaux défenseurs du comportement machiavélique fut Gabriel Naudé, auteur en 1639 de Considérations politiques sur les coups d'État.
Dans ce livre Naudé affirmait que ce qu' interdit la justice " naturelle, universelle, noble et philosophique " est parfois requis pour le bien de l'Etat.
Or Naudé était l'un des proches de Mazarin et son bibliothécaire. En outre Mazarin, que Louis XIII avait choisi comme parrain de son fils, désigna parmi le précepteurs du jeune Louis XIV Naudé et La Mothe Le Vayer qui, l'un et l'autre, appartenaient au cercle des " libertins érudits ".
Les Mazarinades
Cyrano de Bergerac d'abord contre Mazarin, puis en sa faveur
Les mazarinades, feuilles d'informations de quelques pages et de toutes origines (celles qu'inspira Condé sont parmi les plus audacieuses contre la monarchie), parfois pamphlets grossiers et creux, mais aussi parfois savants et ironiques (le cardinal de Retz en écrivit quelques-uns), l'attaquèrent très souvent sous cet angle, fustigeant le « voleur de Sicile ».
Quelques titres de Mazarinades parmi plus de 5 000 autres :
La gueuserie de la Cour ;
La Champagne désolée par l'armée d'Erlach ;
Plainte du poète champêtre ;
Mémoires des besoins de la campagne ;
Plainte publique sur l'interruption du commerce ;
Le dérèglement de l'État ;
Le manifeste des Bourdelois ;
Dialogue de Jodelet et de Lorviétan sur les affaires du temps ;
Que la voix du peuple est la voix de Dieu.
On n'a donc pas fini de se poser la question de la religion de Mazarin, un dossier rempli d'éléments contradictoires entre eux. Car l' iconographie religieuse prédominait dans sa riche collection de tableaux.
Mais elle était minoritaire dans les sculptures, les tapisseries et l'orfèvrerie. Les " nudités " de certaines oeuvres exposées chez lui choquèrent certains frondeurs et, plus encore, son légataire universel le duc Mazarin, qui, en 1670, animé d'une sainte fureur et armé d'un marteau, en fit un massacre.
Mais on aurait pu agir pareillement dans le palais romain des cardinaux Farnèse au début du XVIIe siècle.
Nicolas Fouquet
Au long de sa carrière de Premier Ministre, Mazarin s’enrichit. À sa mort, il dispose d'environ trente-cinq millions de livres. Cela lui procura une grande souplesse financière, qui se révéla vite indispensable pour remplir ses objectifs politiques.
Progressivement Mazarin abandonne la gestion de sa fortune personnelle à Nicolas Fouquet et Jean-Baptiste Colbert, issu de la clientèle de Michel Le Tellier et qui venait d'épouser une Charron, cent mille livres de dot. Ils sont les véritables artisans de la démesure de sa fortune après la Fronde.
Bien que les sommes en question, en raison de la virtuosité du concerné et de ses aides, Fouquet et Colbert, dépassent de loin tout ce qui pouvait se voir à cette époque, il est nécessaire de relativiser le caractère exceptionnel de telles pratiques financières.
Mazarin, aussi peu populaire chez les nobles dont il sapait l'autorité que chez le peuple dont il prolongeait les souffrances issues de la guerre, souffrit d'une large hypocrisie sur ce point.
Postérieurement à la Fronde, période où il put mesurer toute la fragilité de sa position, Mazarin n’eut de cesse de consolider sa position. N'ayant aucun quartier de noblesse, son pouvoir était assujetti au bon vouloir d’une régente disposant elle-même d’un pouvoir contesté.
Seule sa dignité de cardinal d’ailleurs révocable lui permettait de prétendre aux fonctions qu'il occupait. Sans une situation financière solide, une disgrâce aurait tôt fait de le descendre au bas de l’échelle sociale. Ce point explique en partie l’acharnement de Mazarin à s’enrichir de manière exponentielle.
Malgré les succès militaires et diplomatiques mettant enfin un terme à la guerre de Trente Ans (traité de Westphalie-1648), les difficultés financières s'aggravèrent, rendant les lourdes mesures fiscales de Mazarin de plus en plus impopulaires. Ce fut l'une d'elles qui déclencha la première Fronde, la Fronde Parlementaire de 1648.
Paris est assiégée par l'armée royale, qui ravage les villages de la région parisienne : pillages, incendies, viols… N'obtenant pas la soumission de la capitale, les partis concluent la paix de Saint-Germain (1er avril 1649). Ce ne fut qu'un répit.
La Fronde des princes qui dura de 1650 à 1652 lui succéda, déclenchée par l'arrestation de Condé avide de récompenses, défiant ainsi la primauté naissante et fragile de l'autorité royale promue par Mazarin.
Ce dernier fut obligé de s'exiler à deux reprises en 1651 et 1652, tout en continuant de gouverner par l'intermédiaire d'Anne d'Autriche et de fidèles collaborateurs comme Hugues de Lionne et Michel Le Tellier.
La région parisienne fut à nouveau ravagée, par les armées et par une épidémie de typhoïde répandue par les soldats, lors d'un été torride qui entraîna au moins 20 % de pertes dans la population.
Son épuisement facilita le retour du roi, acclamé dans un Paris soumis, puis bientôt, celui de Mazarin.
Les critiques contre Mazarin concernaient en partie son origine italienne et roturière, mais surtout le renforcement de l'autorité royale, condition nécessaire à la mise en place d'un état moderne, au détriment des grands du royaume.
La guerre contre l'Espagne, mal comprise et mal acceptée par l'opinion publique, entraîna une formidable et impopulaire augmentation des impôts.
Ayant brisé toutes les oppositions, dirigeant le pays en véritable monarque absolu, il est resté premier ministre jusqu’à sa mort au château de Vincennes, le 9 mars 1661 des suites d'une longue maladie.
Deux jours avant sa mort, il fait appeler les trois ministres du Conseil, Michel Le Tellier, Nicolas Fouquet et Hugues de Lionne, et les recommande chaudement au roi.
Mais le lendemain, veille de sa mort, sur les conseils de Colbert, il revient sur ses propos concernant Fouquet jugé trop ambitieux et conseille au roi de s'en méfier et de choisir Colbert comme Intendant des finances.
Sur les derniers jours de Mazarin nous possédons un récit précieux qui dormait dans les archives de Rome et qui n'a été redécouvert qu'en 1955.
Il fut rédigé par un théatin italien vivant à Paris, le P.Bissaro, en qui Mazarin avait toute confiance.
Ce récit n'était pas destiné à la publication.
Il a été révélé par Raymond Darricau et Madeleine Laurain-Portemer.
Le P. Bissaro déclare dans sa Relation :
"S.E. a toujours vécu en France avec une dignité et une intégrité telles que jamais personne n'a pu la taxer de grave scandale et cette justice, ses ennemis eux- mêmes la lui rendent.
Mais, comme elle était toujours distraite par les affaires politiques et les très lourdes occupations de la guerre, elle ne paraissait pas s'acquitter d'une manière satisfaisante des manifestations vraies de la piété à laquelle elle était tenue de par sa condition ecclésiastique.
Toutefois au fond de son coeur, elle eut toujours des sentiments solides de piété... ".
Bissaro, voyant que Mazarin, déjà sérieusement malade, sans doute d'un œdème pulmonaire, se faisait un peu trop lire des ouvrages " de navigation et d'histoires étranges ", lui conseilla des livres de spiritualité, notamment ceux de Louis de Grenade qu'on lui lisait en espagnol langue que Mazarin affectionnait.
Sa mort
Mazarin meurt le 9 mars 1661 en laissant une Europe en paix. Louis XIV ne protégera pas cet héritage de Mazarin, bien au contraire : soucieux d'affirmer sa grandeur par de vastes conquêtes, le roi trouvera dans les traités de paix, si difficilement obtenus par le Cardinal, les prétextes qui justifieront ses innombrables guerres. La Fronde est alors finie depuis plus de huit ans 1653.
Le cardinal, qui garda sa lucidité jusqu'au bout, reçut en toute conscience les sacrements de l'Église catholique--confession, extrême-onction, viatique. Il embrassa tous ses proches, " le visage serein et égal en se recommandant à leurs prières ".
Une mort classique au grand siècle.
Son héritage spirituel et matériel
Par testament, Mazarin fit réaliser le Collège des Quatre-Nations, devenu l'Institut de France. L'acquisition, en août 1643, de la bibliothèque du chanoine Descordes constitue l'acte fondateur de celle-ci : la Bibliothèque Mazarine, issue de la bibliothèque personnelle du cardinal.
La réussite de Mazarin constitua un véritable outrage à l'ordre social de son époque. La formidable réussite d'un homme sans naissance et de condition modeste ne pouvait que s'attirer les foudres d'une noblesse censée seule avoir été dotée par Dieu des vertus et qualités propres au commandement. Le souci de Mazarin de renforcer l'autorité royale attisa le ressentiment des nobles, et celui de poursuivre une guerre mal comprise celui du peuple. Les mazarinades diffusées pendant son ministère, ainsi que la qualité littéraire de nombre d'entre elles, contribuèrent à ruiner durablement sa réputation. Ses origines étrangères ne plaidèrent pas non plus en sa faveur. Ainsi, en dépit des indéniables réussites que compta sa politique, Mazarin ne laissa pas un bon souvenir dans la mémoire du peuple français, les mémorialistes préférant mettre en avant ses pratiques financières douteuses plutôt que ses victoires politiques.
La richesse du Cardinal Mazarin et sa volonté de se lier à la haute aristocratie par les mariages avantageux de ses nièces (moyen pour les Grands de bénéficier des grâces royales) créèrent une dynastie.
Les sœurs Olympe, Marie, Hortense et Marie Anne Mancini furent célèbres pour leur beauté, leur esprit et leurs amours libérées.
Marie Mancini fut le grand et platonique amour de jeunesse de Louis XIV, qui renonça à elle pour épouser sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche.
Hortense épousa le 28 février 1661 Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye, duc de Mayenne, puis duc de Mazarin.
Il est l’un des grands personnages de l’histoire de Mayenne. Il a acheté le duché en mai 1654.
Puis, par alliances successives, le duché passa dans d’autres familles jusqu’à échoir à Louise d'Aumont, épouse d’Honoré IV de Grimaldi, prince de Monaco, ancêtre de l’actuel souverain de la principauté Albert II de Monaco.
Olympe Mancini, comtesse de Soissons, était la mère du fameux Prince Eugène, passé au service des Habsbourgs, et tant de fois vainqueur des armées de Louis XIV.
Leur frère Philippe épousa Diane de Thianges, nièce de Madame de Montespan ; ils furent les grands-parents de l'académicien Louis-Jules Mancini-Mazarini et également des ancêtres des actuels Grimaldi.
Pour avoir conté les amours des nièces avec Louis XIV, Abraham de Wicquefort s'est retrouvé embastillé.
Blasonnement
Blason de Jules Mazarin (1602-1661)
Armes du cardinal Mazarin :
D’azur au faisceau de licteur d’or lié d’argent, la hache du même, à la faces de gueules brochant sur le tout chargée de trois étoiles d’or.
Oeuvres inspirées par Mazarin
Bréviaire des politiciens, ouvrage publié aux éditions Arléa, présenté par Umberto Eco qui indique que la première parution date de 1684. Umberto Eco indique que Dumas a dû en entendre parler et n’avoir qu’un résumé de ce bréviaire, ce qui expliquerait le personnage dont il a tracé le portrait dans Vingt ans après
Personnage de fiction
Alexandre Dumas le met en scène dans Vingt ans après. D'Artagnan ainsi que Porthos deviennent ses créatures. Athos et Aramis se glissent du côté des princes, opposés au cardinal.
Dumas le remet en scène dans Le Vicomte de Bragelonne : Mazarin y sépare Louis XIV de Marie de Mancini, marie le roi de France à l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse, puis meurt en 1661.
Mazarin, série de 4 téléfilm, réalisé pour FR3-Telecip par Pierre Cardinal - scénario de Pierre Moinot sur une continuité historique de Philippe Erlanger. Mazarin : François Perier / Anne d'Autriche Martine Sarcey. Mazarin apparaît ici comme l'antithèse de Richelieu. Richelieu avait fait régner la terreur pour décapiter les factions. Mais de l'excès de terreur était née la révolte, la guerre civile. Mazarin plus politique fut un pacificateur. Selon la formule de Lamartine : « C'est Mazarin qui fut grand ministre, c'est Richelieu qui fut grand vengeur ». Passionnément dévoué à la France à laquelle il s'était identifié, il le fut encore plus à son filleul, cet enfant dont il fit un roi / texte de la série édité chez Gallimard en 1978.
Le téléfilm La Reine et le Cardinal, diffusé en février 2009 sur France 2, traite de ses relations avec la régente Anne d'Autriche. Ce dernier met l'accent sur une relation d'amants entre la Régente et Mazarin, ce qui n'a jamais été prouvé historiquement, même si la découverte d'une correspondance codée assez intime entre les deux a porté certains historiens à pencher pour cette version.
Le Diable rouge est une pièce de théâtre écrite par Antoine Rault et mise en scène par Christophe Lidon. La pièce retrace les derniers mois de la vie de Mazarin.
Quelques interprétations de Mazarin au cinéma et à la télévision :
Samson Fainsilber dans Si Versailles m'était conté... (1954).
Enrico Maria Salerno dans Le Masque de fer (1962).
Sergio Nicolaï dans D'Artagnan amoureux, mini-série en cinq épisodes (1977).
François Périer dans Mazarin, mini-série en cinq épisodes (1978).
Philippe Noiret dans Le Retour des Mousquetaires (1989).
Paolo Graziosi, dans Louis, enfant roi (1993).
Luigi Proietti dans La Fille de d'Artagnan (1994).
Jean Rochefort dans Blanche (2002).
Gérard Depardieu dans La Femme mousquetaire, téléfilm (2005).
Philippe Torreton dans La Reine et le Cardinal, téléfilm (2009).
Jean-Pol Dubois dans Le Roi, l'Écureuil et la Couleuvre, téléfilm (2010).
Liens à écouter
http://youtu.be/MQvjH6diV0I Mazarin par simone Bertière
http://youtu.be/jE5suj15IYA 2000 mille ans d'histoire 1
http://youtu.be/Xte5yFjTOsY 2000 mille ans d'histoire 2
http://youtu.be/varr2IgH1t8 2000 mille ans d'histoire 3
http://youtu.be/xlncuk4LYh0 1/4
http://youtu.be/oRVPzGPKNe4 2/4
http://youtu.be/f6k0yryOqqs 3/4
http://youtu.be/dHDzEQoRfw4 4/4
Posté le : 14/07/2013 14:28
|
|
|
|
|
Origine de la fète du 14 Juillet |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Origine de la Fête nationale Française
Le 14 Juillet, qui cette année tombe méchamment un dimanche, est le jour de la fête nationale, un jour férié, chômé et payé, qui nous laisse donc le temps de nous replonger dans l'histoire de cet évènement fondateur de la République Française
Le 14 Juillet comme tous les ans sera donc la fête de la France et de tous les Français.
Nous fêtons aujourd'hui le traditionnel 14 juillet : le défilé militaire sur les Champs-Elysées, feux d’artifices, bals des pompiers…
Petit aparté, sachez qu’un petit village (gaulois) résiste depuis plus de 130 ans – car ce jour férié a été fixé en 1880, voir plus bas – à l’enthousiasme révolutionnaire, et célèbre le 14 juillet… au mois d’août : le petit village de Viriat, à côté de Bourg en Bresse, fête effectivement le 14 juillet après la moisson. D’après certaines sources, ce décalage serait dû à la lenteur des représentants locaux du Tiers-Etat, qui auraient mis 15 jours à apporter à Viriat l’information de la prise de la Bastille : personnellement, je n’y crois pas une seconde, ou ce n’est du moins pas une explication suffisante car sinon il n’y aurait pas deux dates communes dans l’Hexagone (la simultanéité, tout ça…).En dehors de Viriat, la France fête donc le 14 juillet chaque 14 juillet (c’est un scoop !). Mais que fête-t-on exactement ?
A l’instar de l’excellentissime article sur le 8 mai, vous serez peut-être surpris d’apprendre que contrairement à ce que l'on pense d'ordinaire, la fête du 14 juillet n’est pas un hommage à la prise de la Bastille. Et oui…
Petit rappel historique :
La fête du 14 Juillet est la conjonction de divers évènements historiques. Peu de gens le savent, mais le 14 juillet ne commémore pas seulement la prise de la Bastille de 1789, elle célèbre avant tout la fête de la fédération, qui a eu lieu l’année suivante, en 1790. Ce jour est déclaré férié, (chomé, payé) pas de chance, cette année, il tombe un Dimanche !
Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille
Cet été là, une grande agitation règne à Paris. Face au mécontentement populaire, le roi a réuni les Etats généraux, une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état qui comprend donc les péons de base mais également la petite bourgeoisie. Ces derniers demandent une réforme profonde des institutions et, le 9 juillet, se proclament Assemblée nationale constituante. L’initiative inquiète le roi qui fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. La rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, un orateur harangue la foule qu’il appelle à réagir : ce député est Camille Desmoulins, qui monté sur un tonneau, annonce une « Saint Barthélemy des patriotes ».
Au matin du 14 juillet, des Parisiens en colère vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent vers la vieille forteresse royale de la Bastille, en quête de poudre. Pour la grande majorité des Français, fêter le 14 Juillet dans les pétarades et les feux d'artifice commémore la chute de la Bastille, cette imposante forteresse où les rois emprisonnaient ceux qui leur déplaisaient par simple lettre de cachet. Ce jour-là, en plein été 1789, une foule de Parisiens parvient à investir la place forte en négociant avec son gouverneur : il aura la vie sauve contre l'ouverture du pont-levis. Les émeutiers promettent tout ce que l'on veut, ils veulent à tout prix récupérer la poudre pour utiliser leurs fusils contre les troupes du roi qui se font menaçantes.
On connaît la suite : la garnison se fait écharper, le gouverneur est traîné dans les rues, une épaule ouverte par un coup d'épée. Il supplie qu'on l'achève, ce qui est fait à coups de baïonnette, tandis qu'un garçon cuisinier s'applique à découper sa tête pour en garnir une pique. On libère les prisonniers du "despote" : deux fous - vite renfermés à Charenton -, quatre faussaires et un dangereux pervers, noble de surcroît... Mais qu'importe ! Un symbole de l'arbitraire, de l'ancien règime est tombé, Versailles tremble, les princes de sang prennent le large, la Révolution est cette fois bien lancée.
Le 14 juillet 1790 : fête de la Fédération
Un an plus tard, il s'agit donc de célébrer l’évènement de la prise de la bastille, et d'en faire perdurer le succès. Que faire ?
Depuis l’été 1789, partout dans les provinces françaises le gouvernement central autrefois fort s'est délité et se sont créées des « fédérations » régionales de gardes nationaux, réaction à l’affaiblissement du pouvoir central. Afin de contrôler ce mouvement spontané, la Commune de Paris, sous l’impulsion de Lafayette, décide de fonder une grande Fédération nationale regroupant des représentants des fédérations locales et de les réunir à Paris le 14 juillet. La cérémonie est censée célébrer la prise de la Bastille bien sûr, mais aussi apporter un semblant d’ordre et d’unité dans un pays en crise. Le jour dit, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille jusqu’au Champ-de-Mars
Le roi est toujours là, aimé du peuple, la République n'est pas encore proclamée.
Le 14 juillet 1790, une grande fête de la Fédération est organisée sur le Champ-de-Mars, en face de l'école militaire. L'idée est de symboliser l'unité nationale autour des députés et du souverain. Sur la grande esplanade, entourée d'immenses tribunes où se pressent des dizaines de milliers de Français, se dresse l'autel de la patrie. Sur cette plate-forme de six mètres de haut, le cauteleux Talleyrand, alors évêque d'Autun, célèbre une grand-messe, assisté par trois cents prêtres et de quatre cents enfants de choeur ! Te Deum, coups de canon, défilés des représentants des départements français...
À la fin de la grandiose cérémonie, le roi s'avance et jure de maintenir la Constitution et d'être fidèle aux lois : «Moi, roi des Français, je jure d’employer le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de l’État, à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi et à faire exécuter les lois». La reine, se levant et montrant le Dauphin dira également : «Voilà mon fils, il s’unit, ainsi que moi, aux mêmes sentiments».
Marie-Antoinette soulève son fils, la famille royale est acclamée, ainsi que le dauphin.
Ce sera l'une des dernières manifestations populaires d'adhésion à la royauté, dans un grand mouvement d'unité nationale.
En réalité, la réconciliation nationale sera de courte durée : deux ans plus tard, le roi est arrêté à Varenne alors qu’il cherchait à rejoindre les royalistes en exil, et condamné à mort.
Devant le renforcement de la majorité républicaine aux élections de 1879, le royaliste Mac-Mahon, découragé, démissionne de la présidence de la République et est remplacé par un vieux républicain modéré, Jules Grévy (1807-1891).
Désormais à toutes les commandes du pouvoir, les républicains prennent simultanément des mesures symboliques : transfert du siège des pouvoirs publics de Versailles en 1871, à Paris en 1879, amnistie accordée aux condamnés de la Commune le 10 juillet 1880, adoption de La Marseillaise comme hymne national en 1879 et du 14 juillet pour fête nationale le 6 juillet 1880.
Il fallut bien du temps et une volonté politique infaillible pour effacer les divisions et les effets négatifs de la révolution française. Cette première fête nationale se veut donc à la mesure des Evénements, à Paris comme en province, il est important de veiller à ménager les opinions locales comme par exemple, à Angers, dans le Maine-et-Loire, département catholique et conservateur.
Le vote pour la « République » a rassemblé les partisans de la liberté et de la laïcité qui veulent établir sans délai l’égalité par le suffrage universel et une véritable souveraineté populaire.
Cependant la France de 1880 n’est ni unanime ni paisible, et les nouveaux gouvernants n’affichent pas ouvertement leur doctrine : l’heure n’est pas à la propagande, mais à l’opportunisme républicain
1880 : le 14 juillet devient fête nationale
Pendant près d’un siècle, la commémoration du 14 juillet est abandonnée. Elle réapparaît en 1880, sous la IIIe République.
La fête nationale est née, mais ne survivra pas longtemps aux aléas de l'histoire, elle sera remplacée par des fêtes opportunistes durant un certain temps.
Les révolutionnaires multiplieront par la suite les fêtes symboliques, dont celle du 1er vendémiaire (septembre) en l'honneur de la République.
Ensuite, Bonaparte établira la Saint-Napoléon, vite reprise par son neveu l'empereur Napoléon III, arrivé au pouvoir.
Et lorsque les députés de la IIIe République naissante décident d'instaurer une fête nationale, la question divise la Chambre.
On cherche d'abord des dates et des symboles : le serment du Jeu de paume, la Déclaration des droits de l'homme ou encore l'instauration de la Ire république en septembre 1792 ?
Car si le 14 juillet est une date symbolique, une date que l’on reprend souvent dans les cours du secondaire, avec moult images, il n’allait pas de soi qu’on choisisse cette date précise : cela pouvait être l’anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août ou encore l’anniversaire de la I ère République le 21 septembre 1792, c'était là des concurrents sérieux !
Alors… quoi ? De fait, la commémoration du 14 juillet est abandonnée jusqu’à ce que les Républicains de la IIIème république, et notamment le grand personnage que fut Gambetta, cherchent à solidariser le peuple français au nouveau régime, et décident de célébrer ses fondements. C’est sur proposition du député de la Seine, Benjamin Raspail, que la loi du 6 juillet 1880 fait du 14 juillet la fête nationale de la République.
Que commémore-t-elle ? Non pas la prise de la Bastille en elle-même, mais la "fête de la Fédération", du 14 juillet 1790, qui, elle-même, reprend le souvenir de 1789.
En fait, Lorsqu'en en 1880, le député de la Seine, Benjamin Raspail, dépose une loi pour adopter le 14 juillet comme jour de fête nationale. Les débats font rage...
Faut-il célébrer l'émeute de la Bastille, sanglante et au final peu glorieuse aux yeux de certains, ou bien honorer la fête de la Fédération, qui symbolise davantage l'esprit national ? Finalement, les élus acceptent la deuxième solution : évoquer et perpétuer une grande fête pacifique qui célébrait elle-même une émeute populaire. "Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l'histoire de France, et peut-être de toute l'histoire !" s'enflamment les sénateurs. "Cette seconde journée n'a coûté ni une goûte de sang ni une larme... Elle symbolise l'union fraternelle de toutes les parties de la France." Le subtil compromis emporte les suffrages. C'est ainsi que, chaque 14 juillet, nous célébrons d'abord une ancienne fête patriotique, bénie par l'Église et présidée par un ancien roi de France...
Le régime, pour se consolider, cherche à construire un nouvel imaginaire national, autour de symboles républicains. C’est ainsi que la Marseillaise devient hymne officiel, et le 14 juillet fête nationale. Mais la proposition qui émane du député de la Seine Benjamin Raspail n’est pas accueillie unanimement par l’Assemblée, certains députés mettant en cause la violence du 14 juillet 1789.
Et c’est finalement autour du 14 juillet 1790 que se fait le consensus.
La commémoration du 14 juillet 1790, fut retenue car était symbolique d’une union nationale qui selon les débat du Sénat :
« n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme » : « cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole de l’union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin accomplie l’unité nationale, préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité garde un souvenir reconnaissant ».
Depuis cette date, tous les 14 juillet, des troupes défilent sur les Champs Elysées, des cérémonies militaires sont organisées un peu partout dans le pays, ainsi que des feux d’artifice, cette journée symbolise pour les Français la fin de la monarchie absolue et le début de la République.
Partout le programme de la fête adopte le même rituel : concerts dans les jardins, décoration de certaines places, illuminations, feux d’artifice et distributions de secours aux indigents. À Paris doit dominer la distribution des nouveaux drapeaux à l’armée, à Longchamp. J
En 1880, pour la première fête nationale, la République fait les choses en grand.
Le ministre de l'Intérieur prescrit aux préfets de veiller à ce que cette journée "soit célébrée avec autant d'éclat que le comportent les ressources locales". Un défilé militaire est organisé sur l'hippodrome de Longchamp devant 300 000 spectateurs, en présence du Président Jules Grévy. Cette remise des drapeaux à l’hippodrome de Longchamp a visiblement été imaginée sans connaître le déroulement de la fête grandiose qu’illustrera Édouard Detaille.
Il s'agit de montrer le redressement de l'armée française après la défaite contre la Prusse en 1870. Ce défilé militaire, toujours en vigueur, s'inspire aussi du défilé des gardes fédérés de 1790.
Cette année là, on inaugure également le monument surmonté de la statue de la place de la République, et partout sont donnés concerts et feux d'artifices. "La colonne de Juillet" qui surplombe la place de la Bastille, elle, ne se réfère pas au 14 juillet 1789. Elle porte le nom des victimes des journées révolutionnaire de juillet 1830, les "Trois glorieuses".
Le 14 juillet 1880 à Paris
Cet exemplaire est même enjolivé de pastilles d’argent rehaussant les initiales républicaines. Marianne qui représente la République préside à la cérémonie en arborant le drapeau tricolore et l’épée, mais son bonnet phrygien orné d’une cocarde tricolore constitue un signe plus frappant pour les contemporains.
Cet attribut révolutionnaire de la Liberté encore officiellement interdit, même si la couronne de lauriers l’atténue quelque peu, révèle l’audace du courant radical et expressionniste qui porte alors la République dans la capitale. À Paris, l’opinion de la rue dépasse en hardiesse les hommes politiques : on expose la Marianne partout, sur les appuis de fenêtre, sur les marchés, et on l’y met avec son bonnet.
La cérémonie se veut le symbole du renouveau de l’armée française au lendemain de la guerre de 1870. Les régiments reconstitués après la chute de la Commune avaient reçu un drapeau provisoire en 1871. Leur emblème définitif n’est choisi qu’au début de 1879, et c’est le 14 juillet 1880 qu’ils reçoivent du président de la République les emblèmes qui sont encore aujourd’hui ceux de l’armée française.
Entre les nuages du ciel et ceux des canons d’artillerie, la prise de la Bastille commémore une aurore.
Mais la date qui vient d’être choisie pour fête nationale correspond malgré tout dans tous les esprits, à l' événement fondateur de 1789 et non à la fête de la Fédération nationale du 14 juillet 1790, invoquée lors des débats au Sénat.
La fête du 14 Juillet de 1880 à nos jours
Programme de la fête nationale du 14 juillet 1880
Distribution de secours aux indigents. Grands concerts au jardin des Tuileries et au jardin du Luxembourg. Décorations de certaines places, notamment de la place de la Bastille et de la place Denfert où l’on verra le fameux Lion de Belfort qui figurait au Salon de cette année, monument élevé au colonel Denfert-Rochereau, de glorieuse mémoire - illuminations, feux d’artifices - ajoutons les fêtes locales, comprenant des décorations, des trophées, des arcs de triomphe et le tout organisé par les soins des municipalités de chaque arrondissement avec le concours des habitants.
Deux cérémonies importantes doivent dominer toute la fête : la distribution des nouveaux drapeaux à l’armée et l’inauguration, sur l’ancienne place du Château d’eau, du monument surmonté de la figure de la République, monument qui a fait l’objet d’un concours ouvert l’année dernière par la Ville de Paris.
Les célébrations des années suivantes
Après 1790, le 14 juillet fut célébré mais il fut souvent estompé par d’autres évènements : l’anniversaire du 10 août 1792 date de la destitution de Louis XVI et création de la commune insurrectionnelle de Paris et/ou celui du 9 thermidor (27 juillet 1794).
Après les célébrations de 1790, Mirabeau se met au travail et prépare un rapport sur les fêtes publiques nationales et militaires, qui n'aura pas de suite.
La Fête de la Fédération, en tant que telle, n'est pas non plus reprise : le 14 juillet 1791, au lendemain de la fuite à Varennes, l'Assemblée ne s'y associe pas.
En 1792, la patrie a été déclarée en danger le 11 juillet : la fête a lieu, mais sans éclat.
En 1793, la fête est limitée à l'enceinte de l'Assemblée qui apprend alors la mort de Marat.
La fête est célébrée le 10 août, jour où le public court à Saint-Denis pour disperser les os du Roi de France.
Ce sera la dernière tentative de la période révolutionnaire. en attendant la décision du Sénat en 1880
En 1796, le Directoire décide de célébrer pèle-mêle les 27 et 28 juillet,
les anniversaires des 14 juillet,
10 août et 9 thermidor.
Ces jours-là, le cortège, qui défila dans Paris, comprenait notamment des jeunes gens et des jeunes filles de " 18 ans au moins ".
En 1797 a lieu la première cérémonie militaire.
Le 14 juillet est célébré par les troupes dans les pays conquis, notamment en Italie.
En 1799, le 14 juillet n’est plus celui de la " liberté " mais de la " Concorde " et se résume à un défilé militaire.
Le 14 juillet 1800, la garde consulaire défile des Tuileries au Champ de Mars.
Après 1804, le 14 juillet s’efface devant le 15 août, date de naissance de Napoléon.
Après 1814, c’est le 5 août, fête de Saint-Louis, qui lui est préféré.
Après la révolution de 1830, Louis-Philippe associe le souvenir de la " grande victoire nationale " du 14 juillet 1789 à la pose solennelle de la première pierre de la colonne érigée en l’honneur des martyrs de juillet sur la place de la Bastille, le 27 janvier 1831.
Chaque année, se déroulent les " Fêtes de juillet ".
La Deuxième République ne rétablit pas le 14 juillet mais fête la Première République par des discours et des banquets le 22 septembre.
Le Second empire fixe la date de la fête nationale au 15 août, date de la naissance de Napoléon Bonaparte.
Le 14 juillet reste célébré par les Républicains.
Malgré la proclamation de la République le 4 septembre 1870, il faudra encore attendre dix ans pour que le 14 juillet soit proclamé " Fête nationale ".
La Seconde Guerre mondiale
Pour cette première fête nationale, la République fait les choses en grand. Le Champ de Mars est abandonné au profit de l’hippodrome de Longchamp où se déroule désormais le défilé militaire qui marque la réconciliation de la République et de l’armée.
Devant 300 000 spectateurs et en présence du Président de la République Jules Grévy, le ministre de la guerre distribue de nouveaux drapeaux et étendards.
"Deux cérémonies importantes doivent dominer toute la fête : la distribution des nouveaux drapeaux à l'armée, et l’inauguration, sur l’ancienne place du Château d’eau, du monument surmonté de la figure de la République, monument qui a fait l’objet d’un concours ouvert l’année dernière par la Ville de Paris."
Extraits du programme de la célébration du 14 juillet 1880.
Egalement au programme : décorations de certaines places, notamment de la place de la Bastille, illuminations, feux d'artifices...
Et un grand concert au jardin du Luxembourg ! C'est en effet en 1880 que le Sénat s'installe au Palais.
Une fois la fête instituée, les célébrations se suivent, apportant leur lot de surprise et d'innovations.
Le 14 juillet 1886, par exemple, défile pour la première fois une femme, cantinière du 131e régiment d’infanterie, qui vient de recevoir la médaille militaire.
Le 14 juillet 1888, le nouveau Président de la République, Sadi Carnot, offre un banquet à tous les maires des chefs-lieux d’arrondissements et de cantons. 4.000 répondent à l’invitation.
Le 14 juillet 1915, pour la première fois, les troupes défilent sur les Champs Elysées.
De 1915 à 1917, la fête n’a, provisoirement, qu’un caractère " exclusivement patriotique et commémoratif ".
Après l'armistice du 11 novembre 1918, le traité de paix qui conclut quatre années de guerre mondiale est signé le 28 juin 1919.
Le 14 juillet 1919 coïncide donc avec le défilé de la victoire qui réunit sur les Champs-Elysées, les forces des pays alliés. : "c’était beau comme le tonnerre et les éclairs".
En 1936 : après le défilé militaire, un million de personne défile à l'appel des organisations syndicales.
De 1939 à 1945 : dans le Paris occupé, la journée n'est pas célébrée.
Le 14 juillet 1940, à Londres, le général de Gaulle réitère ses appels à la résistance.
En juillet 1945, on célèbre la Libération partout en France.
Toutes les armées alliées défilent dans l’ordre alphabétique. L’armée française clôt le défilé.
Les festivités du 14 juillet 2013 partout en France
Le 14 juillet est l'occasion de festivités au succès populaire. Dans de nombreuses villes, un défilé militaire a lieu dans la journée. Le soir, des bals et concerts sont organisés dans toutes les communes de France, suivis généralement d'un feu d'artifice. Les dates peuvent varier selon les communes : généralement le 13 juillet est consacré au bal populaire et le 14 au feu d'artifice, mais il peut arriver que le feu d'artifice soit tiré le 13 juillet dans certaines communes, de façon à ne pas interférer avec les festivités d'autres villes aux alentours. Si vous vous y prenez bien, vous pourrez donc assister à deux feux d'artifice dans deux endroits différents !
Les festivités parisiennes du 14 juillet 2013
En prélude au feu d’artifice, tiré depuis le Trocadéro, la Mairie de Paris, France Télévisions et Radio France créent un grand rendez-vous de la musique classique dès 21h30 avec « le Concert de Paris », organisé sur le Champ de Mars.
Le soir venu, nous pourrons assister au Feu d'artifice d’artifice qui commence à 23h. L'accès se fait par le Champ de Mars. Le thème 2013 est "Liberté, égalité, fraternité". Des effets visuels seront mis en place pour l'occasion : plus de 100 projecteurs de lumière, des projections d’images, un drapeau tricolore géant déployé sur la Tour Eiffel…
La veille, le 13 juillet, les casernes parisiennes vous ouvrent leurs portes pour les traditionnels bals des Pompiers de Paris.
----------------------------------------------------------
Séance du Sénat du 29 Juin 1880
relatif au projet de loi ayant pour objet l'établissement d'une fête nationale
Rapport
Projet de loi
Programme du 14 juillet 1880
Rapport:
On connaît rarement l'année - 1880 - qui marque pour la France la consécration du 14 Juillet comme fête nationale. Voici les textes fondateurs : comme le dit Henri Martin, rapporteur au Sénat de la loi du 6 juillet faisant du 14 juillet une "journée Fête Nationale annuelle", "ce jour-là, le 14 juillet 1790, a fait, je ne veux pas dire l’âme de la France [...] mais la révolution a donné à la France conscience d’elle-même".
En 1878, le ministère Dufaure avait fixé au 30 juin une fête parisienne en l’honneur de la République. Elle est immortalisée par un tableau de Claude Monet. Le 14 juillet 1879 prend un caractère semi-officiel. Après une revue des troupes à Longchamp (le 13 juillet), une réception est organisée le 14 à la Chambre des députés à l’initiative de Gambetta qui la préside, une fête républicaine a lieu au pré Catelan en présence de Louis Blanc et de Victor Hugo. Dans toute la France, note Le Figaro : "on a beaucoup banqueté en l’honneur de la Bastille" (16 juillet 1879).
Le 21 mai 1880, Benjamin Raspail dépose une proposition de loi signée par 64 députés, selon laquelle " la République adopte comme jour de fête nationale annuelle le 14 juillet ". L’Assemblée vote le texte dans ses séances des 21 mai et 8 juin ; le Sénat l’approuve dans ses séances des 27 et 29 juin 1880 à la majorité de 173 contre 64, après qu’une proposition en faveur du 4 août eut été refusée.
La loi est promulguée le 6 juillet 1880. Le ministre de l’intérieur prescrit aux préfets de veiller à ce que cette journée " soit célébrée avec autant d’éclat que le comportent les ressources locales ".
La fête célébrée cette année-là fut à la mesure de l’évènement.
Documents Sénat, séance du 29 juin 1880
Discussion du projet de loi ayant pour objet l'établissement d'une fête nationale
M. Le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Martin, rapporteur. Messieurs, nous ne pouvons que remercier l'honorable orateur, auquel je réponds, de l'entière franchise, de l'entière loyauté avec laquelle il a posé la question comme elle doit être posée, entre l'ancienne société et la société nouvelle, issue de la Révolution.
Cette ancienne société, cette monarchie, messieurs, nous vous l'avons dit bien des fois, nous en acceptons tout ce qui a été grand, tout ce qui a été national, tout ce qui a contribué à faire la France.
Mais où en était-elle, à la veille du 14 juillet 1789 ?
Vous le savez : la royauté, arrivée au pouvoir le plus illimité qu'on ait vu en Europe, était devenue incapable d'en user ; elle-même se vit contrainte d'en appeler à la nation, après un siècle et trois quarts d'interruption des Assemblées nationales de l'ancien régime. (C'est vrai ! - Très-bien ! à gauche.)
Je n'ai pas la prétention de vous refaire l'histoire de cette grande année 1789 ; mais enfin, puisqu'on vient de faire ici le procès du 14 juillet, puisqu'on a symbolisé, dans ce petit acte de guerre qu'on appelle la prise de la Bastille (Rires ironiques à droite) et qui est un très-grand évènement historique, tout l'ensemble de la Révolution, il faut bien que nous nous rendions compte, en quelques mots, de la situation où étaient alors Paris et la France.
Le 17 juin 1789, le Tiers Etat s'était déclaré Assemblée nationale. Le 20 juin, la salle de l'Assemblée nationale fut fermée par ordre de la cour. Vous savez où se transporta l'Assemblée, à la salle du Jeu de Paume ! Vous savez aussi quel serment elle y prononça ! L'ère moderne tout entière est sortie de ce serment.
Le 23, déclaration du roi annulant tous les actes de l'Assemblée nationale et la sommant de se séparer.
L'Assemblée ne se sépara pas. La cour parut céder. Mais, le 11 juillet, le ministre populaire, qui était l'intermédiaire entre la cour et le pays, M. Necker, fut congédié, remplacé par un ministère de coup d'Etat ; en même temps, on appela, on concentra autour de Paris une armée entière, une armée, ne l'oubliez pas, messieurs, en très-grande partie étrangère.
A gauche. C'est vrai ! Très-bien !
M. le rapporteur. Et le même jour, le nouveau conseil décida l'émission de cent millions de papier-monnaie, attendu qu'il ne pouvait plus espérer obtenir des ressources de l'Assemblée nationale. C'était la préface de la banqueroute, comme la préface d'un coup d'Etat.
Le malheureux Louis XVI était retombé dans les mains de ceux qui devaient le mener à sa perte. Eh bien, le même jour, dans Paris, vous vous rappelez ce qui se passa au Palais-Royal, cet épisode fameux d'où sortit le grand mouvement des trois journées qui suivirent. Cette petite action de guerre à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, en manifestant la force populaire, mit à néant tout les projets arrêtés contre l'Assemblée nationale ; cette petite action de guerre sauva l'avenir de la France. Elle assura l'existence et la puissance féconde de l'Assemblée nationale contre toutes les tentatives de violence qui la menaçaient (Nouvelle approbation sur les mêmes bancs).
On parlait de conflit du peuple et de l’armée, dont il ne fallait pas réveiller le souvenir ; mais contre qui le peuple, soutenu par les gardes françaises, avait-il été engagé, dans les rues, sur les places de Paris, durant les deux journées qui ont précédé le 14 juillet ? Qu’est-ce qu’il y avait autour de Paris et surtout dans Paris ? De l’infanterie suisse, de la cavalerie allemande, de la cavalerie hongroise, dix régiments étrangers, peu de troupes françaises, et c’est contre ces régiments étrangers que les gardes-françaises avaient défendu le peuple et l’Assemblée.
Laissons donc ces souvenirs qui ne sont pas ceux d’une vraie guerre civile.
Il y a eu ensuite, au 14 juillet, il y a eu du sang versé, quelques actes déplorables ; mais, hélas ! dans tous les grands événements de l’histoire, les progrès ont été jusqu’ici achetés par bien des douleurs, par bien du sang. Espérons qu’il n’en sera plus ainsi dans l’avenir. (Très bien ! à gauche. - Interruptions à droite.)
A droite. Oui, espérons !
M. Hervé de Saisy. Nous n’en sommes pas bien sûrs !
M. le rapporteur. Nous avons le droit de l’espérer. Mais n’oubliez pas que, derrière ce 14 juillet, où la victoire de l’ère nouvelle sur l’ancien régime fut achetée par une lutte armée, n’oubliez pas qu’après la journée du 14 juillet 1789 il y a eu la journée du 14 juillet 1790. (Très-bien ! à gauche.)
Cette journée-là, vous ne lui reprocherez pas d’avoir versé une goutte de sang, d’avoir jeté la division à un degré quelconque dans le pays, Elle a été la consécration de l’unité de la France. Oui, elle a consacré ce que l’ancienne royauté avait préparé.
L’ancienne royauté avait fait pour ainsi dire le corps de la France, et nous ne l’avons pas oublié ; la Révolution, ce jour-là, le 14 juillet 1790, a fait, je ne veux pas dire l’âme de la France, - personne que Dieu n’a fait l’âme de la France, - mais la Révolution a donné à la France conscience d’elle-même (Très-bien ! sur les mêmes bancs) ; elle a révélé à elle-même l’âme de la France. Rappelez-vous donc que ce jour-là, le plus beau et le plus pur de notre histoire, que d’un bout à l’autre du pays, les Pyrénées aux Alpes et au Rhin, tous les Français se donnèrent la main. Rappelez-vous que, de toutes les parties du territoire national, arrivèrent à Paris des députations des gardes nationales et de l’armée qui venaient sanctionner l’œuvre de 89. Rappelez-vous ce qu’elles trouvaient dans ce Paris : tout un peuple, sans distinction d’âge ni de sexe, de rang ni de fortune, s’était associé de cœur, avait participé de ses mains aux prodigieux préparatifs de la fête de la Fédération ; Paris avait travaillé à ériger autour du Champ-de-Mars cet amphithéâtre vraiment sacré qui a été rasé par le second empire. Nous ne pouvons plus aujourd’hui convier Paris et les départements sur ces talus du Champ-de-Mars où tant de milliers d’hommes se pressaient pour assister aux solennités nationales.
M. Lambert de Sainte-Croix. Il faut faire dire une messe !
M. le rapporteur. Nous trouverons moyen de remplacer le Champ-de-Mars. Un peuple trouve toujours moyen d’exprimer ce qu’il a dans le cœur et dans la pensée ! Oui, cette journée a été la plus belle de notre histoire. C’est alors qu’a été consacrée cette unité nationale qui ne consiste pas dans les rapports matériels des hommes, qui est bien loin d’être uniquement une question de territoire, de langue et d’habitudes, comme on l’a trop souvent prétendu. Cette question de nationalité, qui a soulevé tant de débats, elle est plus simple qu’on ne l’a faite. Elle se résume dans la libre volonté humaine, dans le droit des peuples à disposer de leur propre sort, quelles que soient leur origine, leur langue ou leurs moeurs. Si des hommes associés de sentiments et d'idées veulent être frères, ils sont frères. Contre cette volonté, la violence ne peut rien, la fatalité ne peut rien, la volonté humaine y peut tout. Ce qu’une force fatale a fait, la libre volonté le défait. Je crois être plus religieux que personne en proclamant cette puissance et ce droit de la volonté humaine contre la prétendue force des choses qui n’est que la faiblesse des hommes. (Très-bien ! très-bien à gauche.)
Si quelques-uns d’entre vous ont des scrupules contre le premier 14 juillet, ils n’en ont certainement pas quant au second. Quelles que soient les divergences qui nous séparent, si profondes qu’elles puissent être, il y a quelque chose qui plane au-dessus d’elles, c’est la grande image de l’unité nationale, que nous voulons tous, pour laquelle nous nous lèverions tous, prêts à mourir, si c’était nécessaire. (Approbation à gauche.)
M. le vicomte de Lorgeril. Et l’expulsion de demain ? (Exclamations à gauche.)
M. le rapporteur. Oui, je ne doute pas que ce soit là un sentiment unanime, et j’espère que vous voterez unanimement cette grande date qu’aucune autre ne saurait remplacer ; cette date qui a été la consécration de la nationalité française et qui restera éternellement gravée dans le cœur des Français.
Sans doute, au lendemain de cette belle journée, les nuages s’assemblèrent de nouveau, la foudre en sortit : la France, en repoussant d’une main l’étranger, se déchira de l’autre main, mais, à travers toutes les calamités que nous avons subies, à travers tous ces courants d’action et de réaction qui ont si longtemps désolé la France, cette grande image et cette grande idée de la Fédération n’ont pas cessé de planer sur nos têtes comme un souvenir impérissable, comme une indomptable espérance.
Messieurs, vous consacrerez ce souvenir, et vous ferez de cette espérance une réalité. Vous répondrez, soyez-en assurés, au sentiment public, en faisant définitivement du 14 juillet, de cette date sans égale qu’a désignée l’histoire, la fête nationale de la France. (Applaudissements à gauche.)
Rapport
fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet l’établissement d’un jour de fête nationale annuelle, par M. Henri Martin, sénateur.
Messieurs, le Sénat a été saisi d’une proposition de loi votée, le 10 juin dernier, par la Chambre des députés, d’après laquelle la République adopterait la date du 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle.
La commission, qui m’a fait l’honneur de me nommer son rapporteur, a délibéré sur le projet de loi dont vous avez bien voulu lui confier l’examen.
Deux de nos collègues ont combattu, non la pensée d’une fête nationale, mais la date choisie pour cette fête. Ils ont proposé deux autres dates, prises dans l’histoire de la Révolution, et qui, toutes deux, avaient, suivant eux, l’avantage de ne rappeler ni luttes intestines, ni sang versé. L’un préférait le 5 mai, anniversaire de l’ouverture des Etats généraux en 1789 ; l’autre recommandait le 4 août, dont la nuit fameuse est restée dans toutes les mémoires.
La majorité, composée des sept autres membres de la commission, s’est prononcée en faveur de la date votée par la Chambre des députés. Le 5 mai, date peu connue aujourd’hui du grand nombre, n’indique que la préface de l’ère nouvelle : les Etats généraux n’étaient pas encore l’Assemblée nationale ; ils n’étaient que la transition de l’ancienne France à la France de la Révolution.
La nuit du 4 août, bien plus caractéristique et plus populaire, si grand qu’ait été le spectacle qu’elle a donné au monde, n’a marqué cependant qu’une des phases de la Révolution, la fondation de l’égalité civile.
Le 14 juillet, c’est la Révolution tout entière. C’est bien plus que le 4 août, qui est l’abolition des privilèges féodaux ; c’est bien plus que le 21 septembre, qui est l’abolition du privilège royal, de la monarchie héréditaire. C’est la victoire décisive de l’ère nouvelle sur l’ancien régime. Les premières conquêtes qu’avait values à nos pères le serment du Jeu de Paume étaient menacées ; un effort suprême se préparait pour étouffer la Révolution dans son berceau ; une armée en grande partie étrangère, se concentrait autour de Paris. Paris se leva, et, en prenant la vieille citadelle du despotisme, il sauva l’Assemblée nationale et l’avenir.
Il y eut du sang versé le 14 juillet : les grandes transformations des sociétés humaines, - et celle-ci a été la plus grande de toutes, - ont toujours jusqu’ici coûté bien des douleurs et bien du sang. Nous espérons fermement que, dans notre chère patrie, au progrès par les Révolutions, succède, enfin ! le progrès par les réformes pacifiques.
Mais, à ceux de nos collègues que des souvenirs tragiques feraient hésiter, rappelons que le 14 juillet 1789, ce 14 juillet qui vit prendre la Bastille, fut suivi d’un autre 14 juillet, celui de 1790, qui consacra le premier par l’adhésion de la France entière, d’après l’initiative de Bordeaux et de la Bretagne. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme, cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole de l’union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin accomplie l’unité nationale, préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité garde un souvenir reconnaissant. Fédération, ce jour-là, a signifié unité volontaire.
Elles ont passé trop vite, ces heures où tous les coeurs français ont battu d’un seul élan ; mais les terribles années qui ont suivi n’ont pu effacer cet immortel souvenir, cette prophétie d’un avenir qu’il appartient à nous et à nos fils de réaliser.
Votre commission, pénétrée de la nécessité de donner à la République une fête nationale ;
Persuadée par l’admirable exemple qu’a offert le peuple de Paris le 30 juin 1878, que notre époque est capable d’imprimer à une telle fête un caractère digne de son but ;
Convaincue qu’il n’est aucune date qui réponde comme celle du 14 juillet à la pensée d’une semblable institution,
Votre commission, messieurs, a l’honneur de vous proposer d’adopter le projet de loi voté par la Chambre des députés.
L’un de nos collègues avait pensé qu’il serait utile d’ajouter la qualification de légale à celle de nationale que la Chambre des députés a appliquée à la fête du 14 juillet, et ce afin de préciser les conséquences juridiques qui découleront de l’adoption de la présente loi.
Comme une fête consacrée par une loi est nécessairement une fête légale, votre commission a pensé que cette addition n’avait point d’utilité, et qu’il n’y avait pas lieu de modifier la rédaction du projet de loi qui vous est présenté ainsi qu’il suit.
Projet de loi
Article unique. - La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle
liens
HISTOIRE
http://youtu.be/bNGSmK3j-qc L'ombre d'un doute Fête Nationale
http://youtu.be/FDOligI_Nic création de la fête nationale
http://youtu.be/TpaO7d7rCV0 fête de la fédération
http://youtu.be/Yjrw1koSh9c le 14 Juillet 1789 (1)
http://youtu.be/76xp3WzP590 le 14 Juillet 1789 (2)
http://youtu.be/VX9k_ZAPkmc le 14 Juillet 1789 (3)
MUSIQUE
http://youtu.be/4K1q9Ntcr5g la marseillaise²sdfghhgfghgfdsqhttp://www.youtube.com/watch?v=tz8Z4C ... e&list=PLE1C4F03CAF604FC0 la légion étrangère
http://youtu.be/uEGoEjlorIc Le boudin
http://youtu.be/V5bBE1ywuek chants marquisiens
http://youtu.be/27n5NaIkCEg Chants guerriers pacifica
http://youtu.be/CrAOw5i9UwM la marseillaise de Giansbourg
http://youtu.be/-mW8D0UNyLk La Marseillaise de Berlioz
http://youtu.be/1kascyn7O74 Tchaïkovski et la Marseillaise
http://youtu.be/w23P4OimgqE on n'est pas là pour se faire engueuler
.    [img width=600]http://www.saphirnews.com/photo/art/default/1345893-1776877.jpg?v=1289442038[/img]    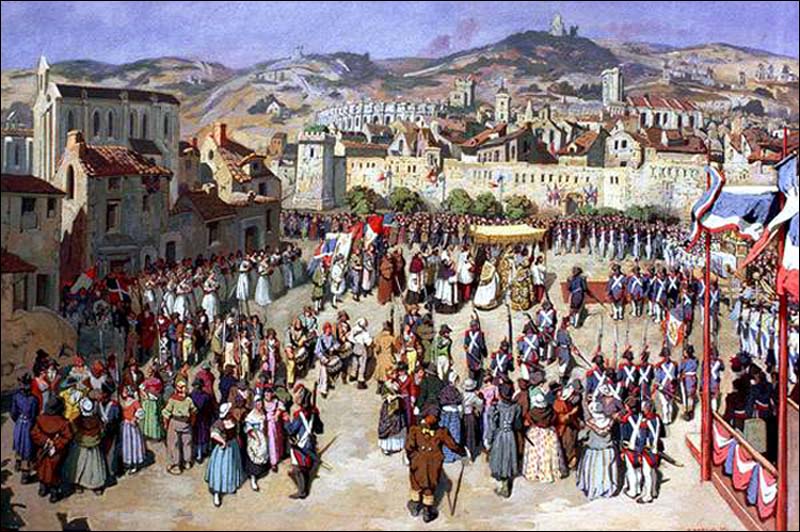  
Posté le : 13/07/2013 22:48
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:12:24
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:43:18
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:47:59
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:48:59
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:50:43
Edité par Loriane sur 14-07-2013 13:51:23
|
|
|
|
|
La réhabilitation de Jeanne d'Arc |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 7 Juillet 1456, sous l'impulsion de Charles VII, se conclut le procès de
réhabilitation de Jeanne D'Arc
La réhabilitation - Le second procès de Rouen
Entre ces honneurs et ces outrages prodigués tour à tour à celle qui avait pris le nom de Jeanne, que devenait sa mémoire ? Le temps venait de dissiper les ombres qui pouvaient voiler aux yeux des politiques la vérité de sa mission : la prédiction de Jeanne s'était accomplie : les Anglais étaient chassés de France.
Après la mort de la Pucelle, leur parti avait d'abord obtenu quelques succès. Barbazan qui, de la Champagne, menaçait déjà la Bourgogne, avait succombé avec René de Bar en voulant l'aider à prendre possession de la Lorraine ; dans la bataille engagée contrairement à ses conseils, il fut tué et René fait prisonnier (Bulgneville, 2 juillet 1431). Poton de Xaintrailles avait été pris aussi dans une embuscade, aux portes de Beauvais, avec le pastourel que l'archevêque de Chartres avait eu l'idée de substituer à Jeanne d'Arc (4 août). La Hire en fin s'était laissé prendre, comme il sortait de Louviers pour aller lui quérir des secours, et la ville avait dû capituler (25 octobre). Mais les échecs suivirent bientôt. Vainement chercha-t-on à raffermir les affaires de Henri VI en le faisant couronner à Paris (16décembre 1431) : la cérémonie ne fit qu'indisposer davantage les Parisiens par les mécomptes qu'ils y trouvèrent. Tout conspire dès lors contre les Anglais. En 1433, Richemont fait enlever la Trémouille de la cour : c'était un moyen d'y rentrer bientôt lui-même. En 1434, la Normandie commence à se soulever. La Bourgogne aussi supportait impatiemment la guerre, et les liens qui rattachaient le duc aux Anglais s'étaient fort relâchés par la mort de la duchesse de Bedford, sa sœur, et le nouveau mariage du régent (1432). Dès le commencement de 1435, Philippe le Bon accueille le projet d'un congrès à Arras; et quand il vint à Paris au temps de Pâques, les Parisiens eux-mêmes et l'Université la première insistèrent auprès de lui pour qu'il le fît aboutir à la paix. Bedford, par un reste d'ascendant, y faisait encore obstacle : mais il meurt le 14 septembre, et le 21 la paix est signée à Arras entre le duc de Bourgogne et le roi de France. Les Anglais, refusant et la paix avec la France et la neutralité de la Bourgogne, sont attaqués par les deux puissances à la fois, et le 13 avril 1436 Dunois, Richemont et l'Isle-Adam, entrent à Paris.
Ainsi la parole de Jeanne était vérifiée. Au terme qu'elle avait marqué, les Anglais, comme elle le disait, « avaient laissé un plus grand gage que devant
Orléans. » Paris leur était enlevé : c'était le gage de leur entière expulsion. En 1449, Rouen était pris à son tour, et bientôt la Normandie conquise; en 1452 et 1453, Bordeaux et toute la Guyenne. Calais seul leur devait rester encore pendant un siècle, comme un souvenir de leur domination et un signe de leur impuissance. Il ne fallait pas attendre jusque-là pour reconnaître que Jeanne avait dit vrai, quand elle se donnait comme envoyée de Dieu pour les mettre dehors : car tout le mouvement qui aboutit à cette fin procédait de l'impulsion qu'elle avait donnée. Aussi, dès son entrée à Rouen, Charles, mieux entouré désormais et servi par les hommes qu'il lui aurait fallu au temps de Jeanne, ordonna une enquête sur le procès moyennant lequel les Anglais, par grande haine, « l'avoient fait mourir iniquement et contre raison très-cruellement. »
Le soin d'en recueillir les pièces et les documents de toute sorte et d'en faire un rapport au grand Conseil fut confié à Guillaume Bouillé, un des principaux membres de l'Université de Paris et du conseil du roi (15 février 1450). Bouillé procéda à cette enquête et entendit sept témoins : Jean Toutmouillé, Isambard de la Pierre et Martin Ladvenu, qui avaient assisté Jeanne dans ses derniers moments; Guillaume Duval, un des assesseurs; Manchon, le greffier; Massieu, l'huissier, et « vénérable et circonspecte personne » maître Jean Beaupère, l'un des principaux auxiliaires de P. Cauchon, celui qui, au début, dirigea pour l'évêque les interrogatoires. Ces premières dépositions écrites tiennent aussi le premier rang parmi toutes celles qu'on a recueillies depuis. Mais le procès avait été fait au nom de l'Église : c'est par l'Église qu'il devait être aboli. Le roi mit à profit l'arrivée en France du cardinal d'Estouteville, légat du saint-siége, et en même temps archevêque de Rouen, pour lui faire commencer par lui-même une enquête sur un fait que les Anglais avaient précisément rattaché à son diocèse. Le cardinal, assisté de l'un des deux inquisiteurs de France, Jean Bréhal, ouvrit d'office l'instruction (ex officio mero); puis, forcé de partir, il remit ses pouvoirs au trésorier de la cathédrale, Philippe de la Rose; et celui-ci, assisté du même Jean Bréhal, donna une nouvelle extension à l'enquête par les articles qu'il ajouta au formulaire des interrogatoires, et par les témoins nouveaux qu'il appela (1452). »
L'Église se trouvait donc engagée dès lors dans la révision du procès par ses représentants les plus compétents : l'inquisiteur et l'archevêque de Rouen, légat du Pape. Mais le Pape n'y était point lié lui-même : car ce n'était pas l'objet de la mission du légat. Le cardinal avait été envoyé pour rapprocher les rois de France et d'Angleterre, et les amener à défendre en commun l'Europe menacée par les Turcs : or, ce n'était pas faire grande avance à l'Angleterre que de soumettre à une révision le procès de la Pucelle : on n'en pouvait soulever les voiles sans en mettre au jour les violences, ni l'abolir sans frapper de réprobation aux yeux du monde ceux qui l'avaient dirigé. L'enquête demeurait donc sans résultat, et la révision semblait devoir avorter, quand Charles VII imagina d'écarter ce qu'il y avait de politique dans une instance formée au nom d'une cour contre un jugement rendu au nom d'une autre : ce ne fut plus le roi de France qui se mit en avant, ce fut la famille de Jeanne, renouvelant auprès du souverain Pontife cet appel que les juges de la Pucelle n'avaient point accueilli. L'affaire redevenait privée, et rien n'empêchait plus le Pape de faire justice, sans qu'il parût prendre parti pour la France contre l'Angleterre. Or, tout criait contre l'arrêt de Rouen, car on n'avait pas seulement pour voir clair dans cette iniquité les dépositions recueillies soit par Guillaume Bouillé, soit par le cardinal d'Estouteville et par son délégué : on avait le procès même de la Pucelle. Ce procès, les interrogatoires officiels de Jeanne, et non plus seulement les douze articles, avaient été soumis à leur tour à des docteurs impartiaux, et ils avaient rendu des avis qui pouvaient, comme le reste des pièces juridiques, être soumis à l'examen du souverain Pontife. Dans le nombre, le procès de révision a gardé deux mémoires, l'un de Théodore de Leliis, auditeur de rote en cour romaine, l'autre de Paul Pontanus, avocat au consistoire apostolique; et le premier est déjà une réhabilitation de la Pucelle. Le grave docteur, rapprochant de chacune des allégations comprises aux douze articles les faits établis par le procès, donne dès lors tous les arguments de bon sens et de bonne foi qui renversent cet échafaudage de diffamation et d'hypocrisie, et ne laissent plus voir que l'innocence, la vertu et la grandeur de Jeanne d'Arc, à l'éternelle confusion de ses juges et de ses bourreaux.
Ce fut Calixte III, élu le 8 avril 1455, qui, le 11 juin de la même année, accueillit la requête de la mère de Jeanne et de ses deux frères : par un rescrit adressé à l'archevêque de Reims et aux évêques de Paris et de Coutances, il les désigna pour réviser le procès, en s'adjoignant un inquisiteur.
Le procès s'ouvrit avec une grande solennité. Le 7 novembre 1455, l'archevêque de Reims, l'évêque de Paris et l'inquisiteur Jean Bréhal, siégeant à Notre-Dame de Paris, Isabelle, mère de Jeanne, accompagnée de son fils Pierre et d'un nombreux cortége d'hommes honorables, ecclésiastiques ou séculiers, et de femmes, se présente et dépose devant eux sa requête et le rescrit du souverain Pontife qui l'avait accueillie. Les commissaires désignés l'appelèrent à part dans la sacristie, l'interrogèrent, promirent de lui faire droit, mais lui remontrèrent toutes les difficultés de la tâche qu'elle s'était donnée, et l'engagèrent à prendre conseil et à y réfléchir. Puis, rentrés en séance, ils s'ajournèrent au 17 novembre pour ouvrir l'instance, si elle y persistait. Les deux prélats, non plus que personne, n'avaient point douté qu'elle n'y persistât. Le 17, la vieille mère se présenta devant la même assemblée : Pierre Maugier, son avocat, exposa sa requête, et remit aux mains des commissaires désignés le rescrit original de Calixte III. Après que lecture en eut été donnée publiquement, l'avocat reprit la parole, pour marquer précisément dans quelles limites se renfermait la plainte. Il ne s'agissait pas de mettre en cause ceux qui, par leur présence ou par leurs avis, avaient plus ou moins pris part au procès de Jeanne : on attaquait le procès dans la personne des deux juges, l'évêque de Beauvais, Pierre Cauchon, et le vice-inquisiteur, Jean Lemaître, et dans celle du promoteur Jean d'Estivet, particulièrement désigné dans le rescrit du Pape comme l'auteur des fraudes qui le viciaient.
Les deux évêques présents, acceptant alors la mission qui leur était donnée, s'adjoignirent, conformément aux prescriptions du Pape, l'inquisiteur Jean Bréhal, et arrêtèrent que les personnes nommées dans l'acte pontifical, ou tout ayant cause, seraient, par assignation, mises en demeure de contredire au rescrit d'abord, puis au fond de l'affaire. Pierre Cauchon et Jean d'Estivet étaient morts; Jean Lemaître aussi, croyait-on : mais leurs familles pouvaient avoir intérêt à paraître au procès; et non-seulement leurs familles, mais l'autorité au nom de laquelle le procès avait été poursuivi : c'est pourquoi le vice-inquisiteur et le promoteur actuels du diocèse de Beauvais étaient spécialement désignés dans le rescrit. Avec ces deux ecclésiastiques, l'évêque présent de Beauvais lui-même et tous ceux que l'affaire pouvaient toucher étaient, par assignation publiée tant à Rouen qu'à Beauvais, sommés de comparaître devant les commissaires le 12 et le 20 décembre au palais archiépiscopal de Rouen.
Le 12, l'archevêque de Reims, l'évêque de Paris et Jean Bréhal se trouvèrent au lieu désigné, mais personne ne se présenta, que le procureur de la famille de Jeanne, demandant défaut contre les non-comparants. On surseoit jusqu'au 15; le 15, même situation. Les commissaires, après avoir ouï l'avocat Maugier et reçu les conclusions du procureur Prévosteau, nomment leurs officiers, et remettent au samedi suivant, 20 décembre, pour entendre, sans nouveau délai, ceux qui voudraient décliner leur compétence.
Cette séance fut d'ailleurs marquée par un incident grave. Prévosteau, procureur de la famille, et Chapiteau, que les juges venaient de choisir pour promoteur, ayant demandé aux greffiers du premier procès s'ils avaient l'intention d'en prendre la défense, Manchon s'en excusa ; et, sommé de remettre aux juges ce qu'il pourrait avoir concernant cette affaire, il déposa sur le tribunal la minute française du procès entier, écrite de sa main. On lui présenta, à son tour, et il reconnut les signatures et les sceaux apposés à l'original latin. A ces pièces on joignit, sur la requête du promoteur, les informations faites par le cardinal d'Estouteville ou par son délégué de concert avec Jean Bréhal, un des juges présents; et il fut ordonné qu'on les mît à la disposition des greffiers et des assesseurs du premier procès qui les voudraient connaître.
Plusieurs actes furent encore accomplis en attendant le 20 décembre. Le 16, Prévosteau, appuyé du promoteur, demanda et obtint que l'on assignât immédiatement plusieurs témoins déjà âgés ou infirmes, demeurant à Rouen ou dans les environs, et qui, si l'on différait beaucoup à les entendre, pourraient bien ne plus être entendus.
Le 18, il remit sa requête.
Après avoir défini l'objet du procès et les limites où se renfermait la plainte, il aborde le fond de la question et défend Jeanne sur tous les points où on l'a condamnée. Ses visions : Dieu seul en connaît l'origine, et nul sur la terre n'a le pouvoir d'en juger; le signe du roi : allégorie permise et justifiée par l'exemple de Moïse devant Pharaon; l'habit d'homme : justement défendu quand il procède du libertinage, mais bien légitime quand il protége la pudeur; la soumission à l'Église : l'Église la réclame pour le dogme, laissant, quant au reste, une entière liberté. Jeanne n'y était donc pas tenue en ce qui touche ses révélations comme fait: et pourtant elle s'est soumise à l'Église ; elle a demandé d'être renvoyée au Pape, elle a accepté le jugement du concile général, acceptation que l'évêque de Beauvais a défendu d'inscrire au procès-verbal. Mais ce n'est là qu'un exemple des faux qui vicient le procès. Le procureur rappelle l'altération des interrogatoires de l'accusée dans les douze articles ; la formule d'abjuration lue à Jeanne dans le tumulte, sans qu'elle l'ait pu entendre, et que l'évêque, malgré l'avis des assesseurs, ne lui a pas relue. C'est donc à tort qu'on l'a déclarée relapse : et la preuve qu'on l'estimait bonne chrétienne, c'est qu'avant de la faire mourir on lui a donné la communion. Aussi demande-t-il, non pas seulement l'annulation de la sentence, mais toutes les réparations que réclame, après un si cruel supplice, sa mémoire outragée.
Le 20 décembre, jour assigné pour dernier délai aux oppositions, il ne se présenta qu'une seule personne : le procureur de la famille de P. Cauchon. Il déclarait en son nom qu'elle n'entendait pas soutenir la validité du procès de Rouen, mais repoussait toutes les conséquences que l'on en voudrait tirer contre elle-même, et il invoquait l'amnistie proclamée par le roi après la conquête de la Normandie. Lecture faite de cette pièce, le procureur prit de nouveau défaut contre les non-comparants, et le promoteur, après avoir prêté serment, fit son réquisitoire à son tour.
Il appelait l'attention des juges 1° sur les instruments et les actes du procès incriminé; 2° sur ses préliminaires ; 3° le procès lui-même.
Il signale parmi les causes qui le vicient :
1° Dans les instruments : l'interposition de faux greffiers; les douze articles soumis aux consultent pour tenir lieu du procès entier; les additions ou les omissions des procès-verbaux.
2° Dans les préliminaires : la partialité de l'évêque de Beauvais, qui s'entremet pour que Jeanne soit vendue aux Anglais; qui la laisse dans leur prison, quoique remise à l'Église; qui fait informer sur sa vie antérieure, constater sa virginité, et qui supprime les résultats de ces deux enquêtes comme étant favorables : procédés illégaux et dont il a senti l'illégalité lui même en se faisant donner des lettres de garantie.
3° Dans le procès même : la demande d'un tribunal composé de clercs des deux partis mise à l'écart; la récusation de l'évêque; le vice-inquisiteur appelé seulement le 19 février, et ne venant que par l'effet des menaces ; l'interrogatoire transféré de la salle publique dans la prison devant un petit nombre d'assesseurs, parce que les autres paraissaient mécontents; les questions captieuses qui signalent cet interrogatoire ; les douze articles extraits des soixante-dix et entachés d'omissions ou d'additions frauduleuses; les menaces aux consulteurs sincères; les faux conseillers ; les manœuvres employées et pour rendre suspecte la soumission de Jeanne à l'Église, et pour lui faire reprendre l'habit d'homme après une abjuration obtenue par la séduction et par la contrainte ; enfin sa condamnation comme relapse sans cause légitime ; et, quand elle a été livrée au bras séculier, son exécution sans jugement.
Voilà les points que les nouveaux juges avaient à constater par leur enquête : et le promoteur demandait en particulier qu'on refît dans le pays originaire de Jeanne cette information sur sa vie antérieure faite et supprimée par les premiers juges.
Les commissaires firent droit à sa demande, consignèrent au procès la déclaration par laquelle ils se constituaient juges et déclaraient les noncomparants contumaces; puis ils les assignèrent au premier jour plaidoyable après le premier dimanche de Carême, pour répondre aux articles que les demandeurs venaient de déposer.
Le jour fixé, 16 février 1456, deux nouveaux personnages répondirent à l'assignation : Me Reginald Bredouille, procureur de l'évêque présent de Beauvais, et de son promoteur, et frère Jacques Chaussetier, prieur du couvent d'Évreux, au nom des frères prêcheurs de Beauvais. L'audience ayant été remise au lendemain, les juges commencèrent par faire donner lecture des articles, au nombre de cent un, posés par les demandeurs.
C'est le résumé, ou, pour parler plus justement, l'exposition la plus complète de tous les moyens allégués à diverses reprises contre le procès, tant par le procureur et l'avocat de la famille de Jeanne que par le promoteur et les légistes auxquels le procès avait été soumis. En supprimant les répétitions ou les inutilités pour ramener le débat à ses points principaux, on y voit clairement établi ce qui condamne les juges et ce qui relève leur victime : car ce titre lui est suffisamment acquis par les nullités de toutes sortes signalées au procès.
Les juges n'étaient que les instruments des Anglais, et c'est par le seul effet de la crainte que l'un des deux, le vice-inquisiteur, s'est associé à l'autre. Tout prouve leur partialité contre Jeanne : la prison civile où ils la gardent quand elle doit être remise à l'Église qui la juge ; les séances publiques faisant place à des interrogatoires dans la prison, en présence des Anglais et d'un petit nombre d'assesseurs; les questions difficiles, captieuses même, où l'on cherchait à l'embarrasser, les menaces faites à ceux qui la voulaient éclairer : plusieurs ont dû fuir pour éviter la mort ; et les rigueurs de la prison, les chaînes, les entraves qui faisaient de son état comme une torture perpétuelle. Ses juges voulaient sa mort, et sa mort par exécution publique : ils l'ont prouvé en témoignant tant de crainte quand ils l'ont vue malade , et tant d'empressement à reprendre les interrogatoires lorsqu'à peine elle était guérie. Mais leur sentence même les condamne : Jeanne l'eût-elle méritée par ses actes, son jeune âge, auprès de juges impartiaux, commandait qu'on l'adoucît .
Jeanne était-elle donc coupable ? Les défenseurs de sa mémoire rappellent ses bonnes mœurs, sa piété, sa charité, son zèle à observer les lois, à remplir les pratiques de la vie chrétienne et à les faire observer autour d'elle et cette lumière d'une âme droite et pure qui l'éclaira parmi tous les détours du procès. Ils reprennent l'un après l'autre, pour les dissiper et en montrer la vide, tous les crimes qu'on lui imputait : son départ pour la guerre , départ qu'elle a caché à ses parents; l'habit d'homme pris et gardé en campagne et en prison, et à quelle condition elle était prête à le quitter ; le nom de Jésus inscrit dans ses lettres ; le saut de Beaurevoir , le signe du roi, ainsi que toute l'histoire de ses visions. Puis ces autres griefs que l'accusation, faute d'en trouver de suffisants dans sa vie active, voulut tirer de ses paroles et de ses actes depuis qu'elle était aux mains de ses juges : ce qu'elle croyait de son salut, de sa délivrance; si sainte Catherine et sainte Marguerite aimaient les Anglais, etc, et tout particulièrement, à l'occasion de ses visions, son prétendu refus de se soumettre à l'Église. Ses visions ne venaient pas du mauvais esprit, mais de l'esprit divin : la pureté de Jeanne, son humilité, sa simplicité, sa charité, sa foi vive et sincère, le prouvent, comme les lumières qu'elles lui ont données et les actes qu'elles lui firent accomplir. Eussent-elles été des illusions, Jeanne, dans ces conditions, était excusable d'y croire.. Mais, y croyant ainsi, pouvait-elle les laisser mettre en doute? Ce sont choses dont l'Église elle-même renvoie la décision à Dieu. Et d'ailleurs Jeanne n'a pas refusé de se soumettre à l'Église. Elle n'a point accepté le jugement de ces hommes d'Église en qui elle n'avait que trop raison de voir des ennemis; et son ignorance l'aurait dû excuser de ne pas entendre l'Église autrement. Quand elle sut ce qu'était l'Église, elle s'y est soumise : elle s'est soumise au Pape et au concile, demandant qu'on l'y renvoyât. Elle n'a donc pas été hérétique; elle n'a pas été relapse, puisqu'elle n'était point tombée : et cette abjuration qu'elle prononça sans l'entendre, elle déclara qu'elle ne l'avait prononcée que pour sauver sa vie, protestant ainsi qu'elle n'avait jamais été ce qu'on l'accusait d'être, Les juges eux-mêmes l'ont reconnu, en lui accordant la communion avant la mort ; et sa mort a été chrétienne comme toute sa vie.
Qu'est-ce donc que ce procès qui a pu aboutir à une pareille sentence ? Un acte de violence et de fraude ; un tissu de mensonges et de faux. Les juges ont procédé sans l'enquête préalable exigée en matière d'hérésie (le promoteur a montré que l'information a été faite et qu'elle a été supprimée, ce qui est bien plus grave encore). Ils ont fait examiner si elle était vierge, et la déclaration qui le constatait a disparu comme l'information préalable . Ils ont refusé ses témoins, ils lui ont refusé un conseil : comme conseil ils lui ont envoyé un traître qui entretenait son ignorance touchant l'Église et la poussait à une résistance d'où l'on voulait faire sortir sa condamnation . Ils l'ont jugée, rejetant son appel au Pape en des matières qui, par leur nature, sont spécialement du ressort du Pape ; ils l'ont jugée, quoique mineure, sans qu'elle fût défendue . Mais sur quoi l'ont-ils jugée ? sur des pièces fausses. Ils ont altéré le procès-verbal, apostant de faux greffiers, contraignant les greffiers officiels à ne point écrire ce qui était à sa décharge . Bien plus, à ce procès-verbal des interrogatoires, si mutilé qu'il fût, ils ont substitué, comme base du jugement, un prétendu résumé de ses réponses en douze articles : articles que Jeanne n'a ni avoués, ni même connus; où l'on accumule ce qui la charge, où l'on supprime ce qui la justifie; articles qui dérivaient de faux procès-verbaux, ou qui faussaient ses dépositions véritables par le retranchement de ses plus importantes déclarations, notamment de son appel au Pape et de sa soumission à l'Église . C'est ce qui fait l'excuse des consulteurs , mais c'est ce qui entraîne la nullité du jugement. Et quel est le mode de procéder dans ce jugement ? On la fait abjurer, et l'on substitue une autre formule à la formule de son abjuration . On la déclare réconciliée à l'Église, et on la condamne à la prison perpétuelle .
Puis on la renvoie à la prison des Anglais, et, pour mieux la rendre relapse, pour qu'elle retombe au moins dans l'hérésie de son habit, on tente de lui faire violence dans cette prison anglaise ; on lui reprend son habit de femme : ne l'eût-elle pas voulu, n'y fût-elle pas forcée par la défense de son honneur, il fallait qu'elle reprît l'habit d'homme. C'est ainsi que l'on est arrivé à la juger une deuxième fois comme relapse et à la livrer à la justice : il est plus exact de dire ici au bras séculier, car le juge séculier l'envoya à la mort sans prendre le temps de prononcer la sentence .
La lecture des articles achevée, le procureur du nouvel évêque de Beauvais, Me Bredouille, prit la parole et déclara qu'il n'y pouvait pas croire; qu'il était impossible que Pierre Cauchon eût ainsi procédé. Du reste, il s'en référait au procès et ne s'opposait point à ce qu'on assignât les témoins, s'en remettant à la conscience des juges. Jacques Chaussetier avait une mission plus simple encore : il venait, au nom du couvent de Beauvais, déclarer qu'on n'y connaissait pas le vice-inquisiteur incriminé avec Pierre Cauchon, et prier les juges d'épargner désormais au couvent les assignations qu'on y envoyait à son adresse, non sans jeter le trouble dans les études de la maison. Les juges accueillirent ces déclarations, et, donnant acte aux héritiers de Pierre Cauchon de leurs réserves, ils admirent au procès les articles des demandeurs, et ordonnèrent la continuation de l'enquête. Le rapport en devait être fait le premier jour plaidoyable après la Quasimodo, dans la ville de Rouen.
L'enquête se continua à Rouen, à Paris, à Orléans et dans le pays de Jeanne ; et le jeudi 13 mai, après plusieurs ajournements, les procès-verbaux en furent reçus par les juges et mis à la disposition de quiconque y voudrait contredire. Assignation fut donnée pour le faire au 1er juin .
La lumière brillait enfin de tout son éclat sur Jeanne et sur ses juges. De toute part s'étaient élevées des voix qui rendaient témoignage à la Pucelle. Les anciens de son pays, les compagnes de son enfance, les compagnons de sa vie militaire : Dunois, le duc d'Alençon, le vieux Raoul de Gaucourt, Louis de Contes son page, d'Aulon son écuyer, Pasquerel son confesseur; et ceux qui l'assistèrent dans la prison et jusque sur le bûcher : Isambard de la Pierre, Martin Ladvenu; les assesseurs mêmes et les officiers de ses juges, le greffier Manchon, l'huissier Massieu, venaient tour à tour reproduire quelque trait de cette belle figure. On retrouvait dans leurs dépositions la vie pure, simple et retirée de la jeune fille au foyer paternel jusqu'au moment où elle se vit appelée à délivrer la France; la même pureté de mœurs, la même simplicité qui était de sa nature, avec la fermeté de langage et l'accent d'autorité qu'elle tenait de son inspiration, tout le temps qu'elle parut soit à la Cour, soit à l'armée; et depuis qu'elle tomba aux mains de ses ennemis, sa constance dans les rigueurs de la prison, sa hardiesse dans les épreuves du tribunal, avec ces illuminations soudaines qui jetaient un jour accablant sur les machinations de ses juges; enfin sa ferme croyance à la mission qu'elle avait reçue, jusqu'au jour où, après avoir payé le tribut à la faiblesse de la femme devant les apprêts du supplice, elle se releva par un sacrifice volontaire d'une défaillance plus apparente que réelle, et couronna sa vie de sainte par la mort d'une martyre .
Au jour fixé, Jean Lefebvre ou Fabri, évêque de Démétriade, et Hector de Coquerel, official de Rouen, ouvrirent la session, par délégation des commissaires. Après de nouveaux ajournements jugés nécessaires pour déclarer l'information acquise au débat, prononcer le défaut et passer outre , le procureur Prévosteau et le promoteur produisirent devant les juges tout l'ensemble des pièces où se fondait la cause : le bref du Pape, les informations du cardinal d'Estouteville et de son vicaire, les enquêtes accomplies depuis le commencement de l'instance. Ils y joignirent une feuille de la main de Guillaume Manchon, contenant les corrections à faire aux douze articles, et, pour prouver la falsification de ces articles, cinq feuilles de papier de la main de Jacques de Touraine, où on les retrouvait sous une autre forme, surchargés d'additions et de corrections. Ils produisaient aussi les originaux du premier procès, requérant qu'on les insérât sans transcription parmi les pièces du nouveau, afin qu'on les pût voir avec leurs additions et leurs diversités dans leur forme réelle; et en outre les lettres de garantie que les juges avaient obtenues du roi d'Angleterre, preuve de plus qu'ils n'avaient agi que pour le compte et à la requête des Anglais. Prévosteau demandait que l'on examinât aussi divers mémoires écrits soit à l'arrivée de la Pucelle, soit après son jugement, pour soutenir la divinité de sa mission ou prouver l'iniquité de ses juges. En ce qui touche les premiers, le mémoire de Gerson figure seul dans la transcription du procès .
Personne ne se présenta pour contester ces pièces. Elles furent donc reçues (10 juin), et on assigna au 1er juillet pour entendre les conclusions .
Le 1er juillet, l'archevêque de Reims, les évêques de Paris et de Coutances et Jean Bréhal reprirent eux-mêmes leurs fonctions de juges; et le lendemain, toute partie adverse continuant de faire défaut, le promoteur et les demandeurs présentèrent les moyens de droit à l'appui de la cause. Le promoteur lut un mémoire où, résumant les raisons fournies par les nombreux documents de la procédure, il déclarait qu'il approuvait en tout point les conclusions des demandeurs. Les demandeurs montraient combien, même devant le droit strict, Jeanne était justifiable dans ses paroles et dans ses actes, et ses juges perfides ou violents dans leur manière d'agir : ils concluaient donc à l'annulation du procès, à la réhabilitation de la Pucelle, espérant que la plainte de sa mère et de ses frères, favorablement accueillie du souverain Pontife, trouverait sa légitime satisfaction dans la sentence des juges auxquels le saint-siège l'avait renvoyée .
Les juges avaient consacré le mois de juin à examiner, avec l'assistance d'un grand nombre de docteurs, tant l'ancien procès que les pièces du nouveau déjà déposées ; et ils avaient chargé leur collègue Jean Bréhal de résumer en quelques articles les points sur lesquels le premier leur paraissait attaquable dans le fond ou dans la forme. C'est un nouveau traité, mais cette fois un traité officiel composé sur toutes les pièces des deux procédures, où le chef de l'Inquisition en France, et, par l'approbation qu'ils y ont donnée, les trois évêques commissaires du Pape, composant avec lui le tribunal, établissent qu'au procès de Jeanne la vraie doctrine n'a pas été moins lésée que la justice ; en résumé, que Jeanne doit être lavée de tout reproche touchant les faits mis à sa charge (les visions, l'habit d'homme, la soumission à l'Église, etc.), et son jugement cassé : pour l'incompétence et la partialité de son juge ; pour la récusation qu'elle en fit, et son appel au Pape, appel suffisant dont il a refusé de tenir compte ; pour toutes les traces de violence ou de fraude que révèlent le choix de la prison, l'adjonction du vice-inquisiteur, les douze articles, la formule d'abjuration, le jugement comme relapse et toute la matière du procès .
C'était déjà un jugement motivé. Il ne s'agissait plus que de le mettre en sa forme et de le rendre public.
Le 7 juillet, les commissaires se réunirent dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, et là, en présence de Jean d'Arc, de Prévosteau, représentant Isabelle, la mère de Jeanne, et Pierre d'Arc, son autre frère, du promoteur Chapiteau et de P. Maugier, avocat de la famille, personne ne se présentant pour combattre les conclusions du promoteur, ils déclarèrent la partie adverse contumace. Puis, jugeant au fond, après avoir énuméré toutes les pièces de procédure sur lesquelles ils avaient formé leur opinion, ils prononcèrent d'abord que les douze articles, l'unique base de la sentence rendue contre Jeanne, étaient faux, altérés et calomnieux, et ordonnèrent qu'ils fussent arrachés du procès, et lacérés judiciairement. De là ils passaient aux deux sentences, et, après avoir signalé les principaux moyens de droit tant de fois opposés aux procédés des premiers juges, adoptant l'avis des docteurs et des prélats qui n'ont vu dans tout le procès aucun fondement à l'accusation, ils déclaraient le procès et les sentences entachés de dol et de calomnie, et par conséquent nuls et de nul effet ; ils les cassaient et les annulaient, déclarant que Jeanne ni aucun des siens n'en avaient reçu aucune note d'infamie, et les lavant de toute tache semblable, autant que besoin était. Ils ordonnaient que la sentence serait immédiatement publiée à Rouen en deux endroits : sur la place de Saint-Ouen, à la suite d'une procession avec sermon solennel, et le lendemain au Vieux-Marché, au lieu où Jeanne avait été si cruellement brûlée. Cette seconde publication devait être suivie d'un autre sermon et de la plantation d'une croix destinée à perpétuer sa mémoire et à solliciter les prières des fidèles et la sentence publiée dans toutes les autres villes ou lieux du royaume qu'il semblerait bon.
La sentence reçut immédiatement son exécution, à Rouen d'abord, puis dans plusieurs autres villes, notamment à Orléans, où l'évêque de Coutances
et l'inquisiteur Jean Bréhal vinrent de leur personne présider aux cérémonies ordonnées. Les Orléanais n'avaient pas eu besoin de ce jugement pour rendre à la mémoire de Jeanne les honneurs qui lui étaient dus. Ils avaient recueilli sa mère, voulant s'acquitter au moins auprès de sa famille de leur dette envers elle; et plus tard, à la place de la croix érigée conformément à la sentence, ils lui élevèrent, à leurs frais, sur le pont même, en face du lieu où elle avait accompli l'acte décisif de leur délivrance, un monument qui, mutilé par les guerres religieuses, supprimé par la Révolution, s'est relevé en un autre lieu et sous une autre forme, attestant, parmi ces vicissitudes, leur invariable attachement à sa mémoire. Mais ce qui mieux que les statues et les inscriptions consacrera la gloire de Jeanne d'Arc, c'est le procès de réhabilitation lui-même, ce sont les témoignages recueillis par toutes ces enquêtes, et fixés à jamais parmi les actes du procès .
Ce procès, qui révise et annule le jugement de Jeanne d'Arc, a subi une sorte de révision, de notre temps. Le contradicteur que les juges commissaires ont tant de fois assigné sans le voir jamais paraître s'est levé enfin, et nul ne contestera sa compétence : c'est celui qui a publié les deux procès. Assurément personne moins que lui ne défend la légitimité de la sentence de Jeanne et ne s'oppose à la réhabilitation de sa mémoire. L'édition qu'il a donnée et les documents de toute sorte qu'il y a joints forment, sans contredit, le plus beau et le plus durable monument élevé en son honneur. Il est admirateur passionné de la Pucelle, mais il est critique, et c'est à ce titre qu'il a jugé et comparé les deux procès.
Que le premier l'emporte sur l'autre par la forme de la rédaction et par l'ordre des matières, c'est ce que le savant éditeur n'a point de peine à établir. Qu'il l'emporte par l'habileté avec laquelle il a été mené, c'est ce qu'on pourrait présupposer encore avant tout examen. Le second procès n'a pas eu de contradicteur; les commissaires avaient à juger une cause dont l'évidence frappait tous les yeux. Ils pouvaient donc ne pas étendre leur enquête sur tous les points où s'était passée la vie de Jeanne. Ils pouvaient même, sans qu'on leur en fît un crime, laisser de côté plusieurs témoins; et ils le pouvaient d'autant mieux, qu'ils faisaient un procès moins aux personnes qu'aux choses. Les principaux coupables étaient morts; P. Cauchon était désavoué même par ses héritiers. Quant aux assesseurs encore vivants, on les cita, on les entendit, mais le premier soin des demandeurs avait été de les mettre hors de cause. Les juges ont donc pu passer avec quelque négligence sur des faits qu'ils n'avaient point à juger; et si des arguments plus ou moins hasardés ont été produits devant eux dans les requêtes de la famille, ce n'était point à eux d'y contredire : il suffisait qu'ils cherchassent ailleurs la base de leur jugement .
Le premier procès, au contraire, était contradictoire ; le juge se trouvait, il est vrai, en présence d'une simple jeune fille sans défenseur, sans conseil : mais cette jeune fille était Jeanne, et son conseil, elle l'a bien prouvé. Celui qu'elle avait eu pour guide dans les batailles. Plus son innocence et sa vertu jetaient d'éclat, plus le juge, qui était un ennemi, était obligé, s'il ne voulait être vaincu dans cette lutte nouvelle, de déployer les ressources de son génie ; et d'ailleurs, derrière Jeanne il entrevoyait un autre tribunal devant lequel, tôt ou tard, il y aurait appel de son procès. Il ne faut donc pas, on l'a dit justement, le supposer assez malhabile et insensé pour commettre, en quelque sorte, de gaîté de cœur, ces illégalités flagrantes qui eussent invalidé le jugement, même à l'égard du plus grand coupable. Mais, si l'accusée est Jeanne, une sainte et brave fille au moins, sinon une envoyée de Dieu, et si l'on veut arriver à la condamner, il faudra bien, si habile qu'on soit, faire pour cela violence au droit écrit : car les formes de droit établies dans les jugements ne seraient bonnes qu'à être supprimées, si elles n'offraient une garantie à l'accusée contre le bon plaisir du juge.
Nous admettrons donc, si l'on veut, contre les demandeurs, que Pierre Cauchon, en tant qu'évêque de Beauvais, était juge compétent; qu'en s'associant le vice inquisiteur comme juge, et les principaux docteurs du clergé de Rouen et de l'Université de Paris comme assesseurs, il a donné à son procès toutes les apparences d'une bonne justice. Nous admettrons que les usages de l'Inquisition aient paru légitimer des procédés justement réputés contraires au droit commun. Mais nous n'admettrons pas que l'iniquité flagrante de ce procès soit en tout point couverte par la loi. Pierre Cauchon était juge compétent comme évêque de Beauvais, mais dans l'esprit même de la loi il devait s'abstenir comme ennemi capital : car, si la loi refusait aux ennemis capitaux la faculté d'être témoins, combien plus le pouvoir d'être juges ! La Pucelle, prisonnière de guerre, était de droit gardée par les Anglais : mais en la soumettant au jugement de l'Église ils la devaient remettre en la prison de l'Église, sauf à eux à garder la prison. La loi était formelle ici; et quant au point où on l'invoque en un autre sens, il y a encore plus d'une réserve à faire. Si l'Inquisition laissait au juge le pouvoir d'écarter toutes les formes protectrices de l'accusé, elle ne lui commandait pas de les bannir; et quand il en usait, il n'était plus libre d'en rejeter les résultats selon qu'ils trompaient son attente : car elle ne lui supposait point de parti pris.
Et une preuve, on pourrait dire en termes d'école un argument ad hominem, contre la légitimité du procès au point de vue du droit inquisitorial, c'est que le personnage placé au premier rang parmi ceux qui le poursuivirent et le révoquèrent, ce fut l'un des deux inquisiteurs de France, Jean Bréhal .
Le juge de Rouen pouvait donc, si l'on veut (et le point est contesté), se passer de faire des informations préalables : mais il en fît; cela est établi, contre l'assertion des demandeurs, par les textes du premier procès, comme par les témoignages recueillis au second. Seulement il ne les produisit pas, ou du moins, si à l'origine il les communiqua à quelques assesseurs pour en tirer la matière d'un interrogatoire, il ne les garda point au procès, comme il y garda d'autres pièces d'un intérêt moins grave, sans doute. Il les a supprimées, car c'est en vain qu'on prétend les retrouver du moins par extraits dans les soixante-dix articles : un réquisitoire n'a jamais tenu lieu d'un procès-verbal d'enquête. Il les a supprimées, et en vain dit-on qu'il le fit, n'en pouvant user sans recoler les témoins, ni assigner ceux-ci sans les compromettre ; il les a supprimées parce qu'elles le gênaient : les témoignages recueillis au procès de révision donnent toute force, en ce point, à l'argument du promoteur. Peu importe donc que le juge ait pu se passer de cette enquête. Il pouvait de même se dispenser de faire examiner Jeanne par des matrones, mais, s'il n'a pas rougi d'ordonner cet examen, il aurait dû ne se point faire scrupule d'en consigner le résultat au procès : son silence en ce point prouve autre chose que sa pudeur .
L'Inquisition, dit-on encore, autorisait Pierre Cauchon à ne point donner à Jeanne d'avocat : mais elle commandait de lui donner, vu son âge, comme mineure de vingt-cinq ans, un curateur qui devait ratifier ses aveux et pouvait aussi parler pour elle ; et quand le droit inquisitorial eût supprimé ici le droit commun, autorisait-il l'évêque à forcer au silence, en les menaçant de mort, ceux qui tentaient d'éclairer Jeanne dans le cours du procès, comme il arriva tant de fois, au témoignage de ceux-mêmes qui ont subi ces violences ? Après cela, quand il offrit à Jeanne de lui donner un conseil parmi ceux qui l'entouraient, n'avait-elle pas raison de le repousser par cette noble réponse qu'elle s'en tiendrait à son conseil, c'est-à-dire Dieu qui la soutenait ?
L'Inquisition autorisait Pierre Cauchon (et ici même le texte est suspect) à surprendre ses aveux par le moyen d'un faux confident : mais l'autorisait-elle à revêtir ce confident des formes du confesseur, et à user de ses conseils pour jeter Jeanne dans une résistance qui, depuis que le jour s'était fait sur sa vie tout entière, devenait le seul moyen de la perdre ? Or, quoique cette résistance n'ait point été jusqu'au point que l'on dit, c'est Loyseleur qui l'y affermissait, sans lui suggérer cette distinction qu'elle trouva d'elle-même pour concilier sa volonté d'être soumise à l'Église, et sa résolution parfaitement légitime de ne pas prendre pour l'Église et, à ce titre, pour juges de ses révélations, les ennemis qui la jugeaient .
L'Inquisition, enfin, autorisait Pierre Cauchon à procéder sans prendre avis que de lui-même : mais il voulut s'appuyer de l'opinion de nombreux assesseurs ; il voulut consulter même des docteurs étrangers au procès. Or, dès ce moment, il était tenu de les éclairer; et que fit-il ? Après les premières
séances, il écarta des interrogatoires les assesseurs, sous prétexte de ne les point fatiguer ; il ôta de leur vue le spectacle de cette jeune fille soutenant avec tant de vigueur une lutte en apparence si inégale. Il en transporta la scène du tribunal dans la prison, et ne laissa plus la parole de Jeanne arriver jusqu'à eux que par l'organe des greffiers. Je me trompe : la parole de Jeanne ne leur parvint même pas en la teneur du procès-verbal. Les interrogatoires allèrent, on l'a vu, se transformer et se fondre dans les soixante-dix articles de l'accusation; et quand il s'agit de délibérer, on en tira ces douze articles qui, corrigés ou non (le débat n'a point ici d'importance), n'en étaient pas moins un résumé, non des aveux de Jeanne, mais des imputations de son accusateur, l'attaque sans la défense; une pièce que non-seulement Jeanne n'avait pas avouée, mais qu'elle n'avait même pas connue. C'est sur cette base, radicalement fausse, que porta la délibération de l'Université de Paris et des docteurs de toute origine ; et c'est sur cette délibération que les juges prétendirent appuyer leur sentence, ajoutant, pour leur compte, la fraude à l'erreur où ils avaient induit les autres .
Voilà le premier jugement. Et que dire du second ? de ce germe qu'on en déposa dans le premier par cette abjuration substituée à celle qu'on avait obtenue de Jeanne sur l'échafaud de Saint-Ouen, entre le juge qui lisait la sentence et le bourreau prêt à l'exécuter ? Que dire de l'occasion qu'on en fit naître, en la rendant, malgré les plus solennelles promesses, à la prison anglaise, et en usant de violence et de fraude pour lui faire reprendre l'habit d'homme qu'elle avait déposé ? Ce sont-là des nullités de fait que ne peut couvrir la procédure la plus régulière. Disons-le donc : si les juges, comme le dit Isambard de la Pierre dans le second procès, observaient assez bien les formes du droit (satis observabant ordinem juris), ils n'en usaient que pour couvrir sciemment les injustices les plus criantes : cela est prouvé par les efforts qu'ils firent constamment, depuis le commencement jusqu'à la fin, dans l'enquête préalable, dans les interrogatoires, dans les douze articles, dans l'abjuration, même et dans la visite qui suivit la reprise de l'habit d'homme, pour fuir, pour étouffer la lumière sitôt qu'ils la voyaient poindre. Ils l'ont condamnée comme hérétique, sachant qu'elle ne l'avait jamais été; ils l'ont condamnée comme relapse, sachant qu'elle n'était tombée que dans le piége tendu par eux sous ses pas; et ils se sont condamnés eux-mêmes en lui accordant, avant de la frapper, la communion. Ici encore on cite le droit inquisitorial : « S'ils se repentent, après leur condamnation, et que les signes de leur repentir soient manifestes, on ne peut leur refuser les sacrements de pénitence et d'Eucharistie, en tant qu'ils les demanderont avec humilité. » Mais les termes du décret repoussent l'opinion qu'on y veut appuyer. C'est après et non avant la condamnation qu'il accorde les sacrements au coupable. Condamner comme hérétique, déclarer excommunié de l'Église celui qu'on vient de recevoir à la communion, ce serait retrancher l'Église même de la communion de Jésus-Christ !
Nous ne parlons point du jugement civil, puisqu'il n'y en eut point. Mais comment alors Jeanne a-t-elle pu être brûlée ? L'arrêt des juges ecclésiastiques ne faisait que remettre la condamnée à une autre justice, et par ses termes il excluait la peine de mort ! La mort, pour qu'elle suivît, devait être au moins prononcée par quelqu'un. Que dirait-on, si, après le verdict du jury, un président d'assises se bornait à dire aux gendarmes de mener l'accusé au supplice ? C'est pourtant ce qui est arrivé à Jeanne, au témoignage de tout Rouen, et du lieutenant du bailli lui-même, quand après la sentence ecclésiastique le juge civil qui la devait condamner se contenta de dire aux sergents : « Emmenez, emmenez .»
Il ne faut donc rien diminuer de la juste réprobation qui frappe le procès tout entier : on pouvait être de bonne foi en le commençant, on ne pouvait pas l'être en le finissant de la sorte. Point d'excuse à l'iniquité de la sentence; point d'excuse aux illégalités de la procédure, et l'on cherche vainement la preuve qu'elle fut régulière dans le silence qui se fit sur Jeanne parmi ceux qui devaient le plus avoir à cœur de venger sa mémoire. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que les fraudes du procès n'étaient pas encore connues et ne le furent que quand les pièces en vinrent aux mains du roi, après l'expulsion des Anglais. Dès ce moment la réparation est assurée. Le roi parle, il agit avec cette prudence, mais en même temps avec cette suite et cette fermeté qui présidèrent à ses résolutions dans la seconde partie de son règne. Après avoir flétri l'inqualifiable abandon où il souffrit que la libératrice d'Orléans, l'ange du sacre de Reims, succombât devant Compiègne et mourût à Rouen, il est juste de faire honneur à Charles VII d'avoir su, au risque d'appeler l'attention sur les circonstances qui le condamnent lui-même, provoquer et mener à bonne fin le jugement qui la réhabilita.
Le second procès retracé et commenté par Henri Wallon
http://youtu.be/mXjKK9TGeZI Henri guillemin
http://youtu.be/YdaTr65CZ
http://youtu.be/AYi3BajrJt4
http:/youtu.be/UHVwwlg9ERQ
http://youtu.be/XHDA9pdIfyY
http://youtu.be/TwQLjTbTlk4
http://youtu.be/a79-VzVxrxY
http://youtu.be/vb2zh2DzUtk
http://youtu.be/cfD6WrYTBPI
http://youtu.be/NJu2BkgRVXo
http://youtu.be/9MI_xTzwI0k
http://youtu.be/4W5sTfdSvpc
http://youtu.be/_6r9QH3K4fQ
http://www.youtube.com/watch?v=mXjKK9 ... pwk1rOXjt0CTKnER7h2dDLeoI treize vidéos
http://youtu.be/wD5H4SmnYFU secret d'histoire
http://youtu.be/mXjKK9TGeZI
http://youtu.be/YdaTr65CZ
http://youtu.be/AYi3BajrJt4
http://youtu.be/bbR9t9CFmOo
http://youtu.be/XHDA9pdIfyY
http://youtu.be/TwQLjTbTlk4
http://youtu.be/a79-VzVxrxY
http://youtu.be/vb2zh2DzUtk
http://youtu.be/cfD6WrYTBPI
http://youtu.be/NJu2BkgRVXo
http://youtu.be/9MI_xTzwI0k
http://youtu.be/4W5sTfdSvpc
http://youtu.be/_6r9QH3K4fQ
http://www.youtube.com/watch?v=mXjKK9 ... pwk1rOXjt0CTKnER7h2dDLeoI 13 vidéos
http://youtu.be/pIiNxGvQLm0 l'ombre d'un doute
A écouter
Arthur Honegger Jeanne au bucher
http://www.youtube.com/watch?v=rKXiYI ... e&list=PL6DDA79AF80203AE5
http://youtu.be/wD5H4SmnYFU secret d'histoire
http://www.youtube.com/watch?v=wwp0iM ... GjIUWtZhigkcplIV31uRZ0wn5 7 vidéos
http://youtu.be/YGwAQS62ZWI Ste Jeanne d'Arc 1film
http://youtu.be/rlpJPIUl0zM Ste Jeanne d'arc 2 film
http://youtu.be/L4wtvpCKdfY la vraie vie de Jeanne d'Arc
http://youtu.be/CxJSGMK9yRE la passion de Jeanne d'Arc film de 1928
http://youtu.be/dtiX_uvxvNo Jeanne d'Arc film de Victor Flemming
http://youtu.be/k5KPmeejomQ Saint Joan of Arc de jesse Janmes
Posté le : 07/07/2013 01:20
|
|
|
|
|
Re: Explosion sur la Taïga le 30 Juin 1908 |
|
Plume d'Argent  
Inscrit:
25/03/2013 18:58
Niveau : 15; EXP : 93
HP : 0 / 373
MP : 96 / 12287
|
Un article très intéressant. Merci pour cela.
J'ai aussi trouvé les photographies très belle.
Posté le : 30/06/2013 14:38
|
|
|
|
|
Explosion sur la Taïga le 30 Juin 1908 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 30 Juin 1908 l'Evénement de la Toungouska
Le 30 Juin 1908, survient un évènement dans la Toungouska, vers 7H 13, une explosion survient en Sibérie centrale, dans l'empire russe. L'onde de choc, équivalant à plusieurs centaines de fois celle qu'aura généré la bombe d'Hiroshima 37 ans plus tard, a détruit la forêt sur un rayon de 20 kilomètres et fait des dégâts jusqu'à une centaine de kilomètres.
Plusieurs hypothèses scientifiques ont été émises sur l'origine du phénomène : météorite, foudre, méthane échappé de conduits volcaniques… L'hypothèse la plus plausible, et retenue au début du XXIe siècle, est celle de l'impact d'un objet céleste, un petit corps du Système solaire de caractéristiques encore inconnues, ayant explosé à une altitude comprise entre 5 et 10 kilomètres. Ceci fait de l’évènement de la Toungouska la plus grosse explosion connue de l'histoire humaine due à la rencontre d'un tel corps avec la Terre.
La première expédition n'a pu intervenir qu'en 1927 et n'a pu trouver de cratère d'impact ni de restes de la météorite. Il existe encore de grandes inconnues sur cet évènement : petit astéroïde ou comète, taille de cet objet, puissance de l'explosion, etc.
Dans la matinée du 30 juin 1908, correspondant au 17 juin du calendrier julien, alors en usage dans l'empire russe, quelques témoins voient passer une boule de feu dans le ciel sans nuage de la Sibérie centrale.
Celle-ci explose à une altitude comprise entre 5 et 10 kilomètres, au-dessus de la rivière Toungouska pierreuse, à 63 km nord-nord-ouest du village de Vanavara à 7 h 14 locale.
Cette explosion est enregistrée, sous forme de séisme de magnitude 4,5 à 5, à 7 h 17 min 11 s, à l'observatoire magnétique d'Irkoutsk, à 1 000 km de là.
L’explosion détruisit intégralement la forêt dans un rayon de plus de 20 km, abattant 60 millions d'arbres ; le souffle fit des dégâts sur plus de 100 km et la déflagration fut audible dans un rayon de 1 500 km. De nombreux incendies se déclenchèrent, brûlant des zones forestières pendant plusieurs semaines.
Un vortex de poussières et de cendres se forma et fut entraîné jusqu'en Espagne par la circulation atmosphérique, créant des halos dans la haute atmosphère, qui s'étendirent sur tout le continent. On put observer des couchers de soleil très colorés et une luminosité exceptionnelle en pleine nuit fut constatée pendant plusieurs jours en Europe occidentale, à tel point qu'on pouvait lire un journal de nuit. Les scientifiques pensèrent à l'éruption d'un volcan, comme le Krakatoa en 1883, qui avait injecté d'énormes quantités de poussières dans l'atmosphère et, de ce fait, avait généré des phénomènes lumineux semblables.
La région
La région où s'est produit cet évènement fait partie du district d'Évenkie, dans le kraï de Krasnoïarsk en Sibérie centrale (Russie).
Elle se trouve sur le plateau de Sibérie centrale et, est traversée par des affluents du grand fleuve sibérien l'Ienisseï : la Toungouska pierreuse, long de 1 865 kilomètres et la Toungouska inférieure, long de 2 989 kilomètres.
Elle se situe à près d'un millier de kilomètres de la ville d'Irkoutsk et du lac Baïkal. C'est une région de collines recouvertes par la taïga sibérienne.
Elle est peu peuplée, principalement par des éleveurs de rennes d'un peuple toungouse.
Un long mystère
L'onde de choc fut enregistrée en Europe occidentale et aux États-Unis qui pensèrent immédiatement à une météorite, mais l'éloignement de la région et les troubles en Russie ne permirent une étude sur place qu'en 1927.
Sur les lieux, les scientifiques découvrirent stupéfaits qu'il n'y avait ni cratère, ni trace d'impact, ni débris.
Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, puis de la Guerre froide, seules deux expéditions purent retourner enquêter en 1958 et 1961. On découvrit une multitude de petites sphères de métal et de silicates dispersées dans le sol de la région, ce qui permit d'émettre quelques hypothèses.
Une étude américaine en 1993 avança qu'il s'agissait d'un petit noyau cométaire, essentiellement composés de gaz gelés qui ont fondu et explosé entre 6 et 9 km d'altitude, le reste de la matière étant dispersé en une pluie de sphérules.
Lac Cheko
Le lac Cheko est un lac d'eau douce, près de la rivière Toungouska pierreuse. Il a une forme d'un rectangle aux coins arrondis d'une longueur de 708 mètres, d'une largeur de 364 mètres et d'une profondeur d'environ 50 mètres.
Il est situé à environ 7 kilomètres au nord-ouest de l'hypocentre, et son grand-axe est orienté vers ce point.
Il semble inconnu avant 1908, et sa première référence cartographique date de 1928.
Des spécialistes estiment qu'il pourrait être un cratère d'impact d'un morceau du bolide.
Luca Gasperini, géologue italien, a entrepris des études sur les sédiments de ce lac en juillet 1999, et pense que c'est un cratère formé par un impact secondaire dans un marais alluvial.
S'opposant à lui, d'autres spécialistes mettent en avant la forme de ce lac plutôt elliptique qui n'est pas analogue aux autres cratères d'impact qui présentent une forme de bol avec un fond rond et du matériau chaotique tout autour.
Astéroïde ou comète ?
La question de la nature de cet objet se pose toujours : petit astéroïde ou comète ? Cet objet est dénommé souvent TCB (Tunguska Cosmic Body ou Corps cosmique de Toungouska), et surnommé parfois Ogdy, nom du dieu du feu des Évenks.
Ses caractéristiques furent d'abord estimées aux alentours de 50 mètres de diamètre et 10 millions de tonnes avant qu'une nouvelle simulation présentée en 2007 par les laboratoires Sandia ne réduisent l'estimation à 62 000 tonnes.
Des études ont été menées en 2007 pour rechercher le parent de cet objet : des similitudes ont été trouvées avec la comète 97P/1906 V2 et avec l'astéroïde (106538) 2000 WK63, découvert le 26 novembre 2000 par LINEAR.
En 2010, l'expédition menée par Vladimir Alexeev pour l'institut Trinity lève le voile sur la nature ambiguë de l'objet à l'origine du choc.
Les résultats découlant de l'expédition indique qu'une météorite pierreuse, fragment d'une comète d'une cinquantaine de mètres de diamètre, traversa l’atmosphère terrestre à la vitesse de 80 000 km/h, avant de se désintégrer à 8 000 m d'altitude. Ceci fut à l'origine d'une onde de choc ayant détruit la taïga sur 2 000 km2.
Autres hypothèses
De nombreuses hypothèses de toutes sortes ont été émises sur ce phénomène mystérieux :
-Une météorite d'un kilogramme d'antimatière se serait annihilée lors de son entrée dans l'atmosphère selon Clyde Cowan, Chandra R. Atluri et Willard Frank Libby, en 1965 ;
-Ce serait une boule de foudre d'un kilomètre de diamètre , pour Anthony Lawton, en 1977;
-Dix millions de tonnes de méthane se seraient échappés de conduits volcaniques et se seraient embrasés, version de Wolfgang Kundt, en 2001.
Alors que d'autres relèvent plus de la science-fiction :
-Un tir malencontreux du rayon de la mort de Nikola Tesla ;
-Un micro trou noir : 1021 grammes, soit 1015 tonnes dans un volume correspondant à quelques atomes aurait pénétré la Terre à la Toungouska et serait ressorti, 12 minutes plus tard dans l'Atlantique Nord thèse de Al Jackson, Mike Ryan,en 1973 ;
-Une explosion nucléaire d'origine extraterrestre ;
-Un OVNI (à propulsion nucléaire) se serait écrasé ;
-Un astéroïde de matière noire, invisible aurait explosé en altitude selon Robert Foot, en 2002.
Récit de témoins
Le 30 Juin 1908, Sergei Semenov habitait le village de Vanarava, situé à 60 km de l'endroit.
Il raconta avoir aperçu, juste avant l'explosion, un objet énorme et étincelant, gros comme la moitié du Soleil, fendre le ciel à la vitesse de l'éclair.
L'objet, suivi par un long sillage de poussière et de fumée, dégagea bientôt une chaleur telle que les vêtements de Semenlov commencèrent à prendre feu.
Terrorisé, l'homme eut le temps de courir se réfugier dans sa maison afin d'éteindre les flammes.
D'autres témoins affirment avoir vu s'élever ensuite un énorme champignon de fumée noire, coupant littéralement le ciel en deux.
Région parmi les plus hostiles, la Tunguska comptait encore moins d'habitants à l'époque que de nos jours.
Si les dégâts matériels furent énormes, on déplora donc simplement quelques blessés et brûlés. Mais ce fut un miracle.
A 22 km au nord de Vanarava, les nomades des tribus Tungouzes transhumant dans les forêts pensèrent que la fin du monde était venue. Leurs huttes, arrachées du sol comme des fêtus de paille, s'envolaient aux quatres vents et, pire encore, ils perdirent des milliers de leurs rennes, gravement brûlés.
A Nizhne-Karelinsk, qui est à 200 miles de l'épicentre de l’évènement.
Dans le village de Nizhne-Karelinsk au Nord-Ouest bien au-dessus de l'horizon, les paysans voient un corps briller très fortement, trop brillant pour l'oeil nu avec une lumière blanc bleutée.
Il se déplace verticalement vers le bas pendant environ 10 mn.
Le corps a la forme d'un "tuyau" .
Le ciel est sans nuages, à l'exception d'un qui est bas sur l'horizon en direction duquel ce corps luisant est observé, un petit nuage sombre est observé. Il faisait chaud et sec et lorsque le corps brillant approcha le sol il sembla se pulvériser et à sa place un énorme nuage de fumée noire se forma et un fracas bruyant, pas comme le tonnerre mais comme la chute de grandes pierres ou comme un coup de feu, est entendu.
Toutes les constructions tremblèrent et au même moment, une langue fourchue de feu traversa le nuage. Les vieilles femmes pleurèrent, tout le monde pensa que le fin du monde approchait.
Des personnes entendent l'explosion jusqu'à 500 miles de distance.
Ce jour-là, la déflagration fut si énorme que l'on l'entendit à 1500 km à la ronde, jusqu'au cercle arctique. Outre des secousses sismiques qui se déclenchèrent par vagues dans le monde entier, d'incroyables phénomènes lumineux se produisirent alors. Ce jour-là, la nuit ne se coucha pas dans la région de Tunguska... et pas d'avantage dans presque toute l'Europe, où des nuits d'une blancheur irréelle s'installèrent plusieurs semaines durant.
Quelque chose a explosé avec la puissance de 1000 fois la bombe Hiroshima, dévastant plus de 2000 km2 d'arbres et de faune.
Le lendemain à minuit, 5 h après cette explosion du bout du monde, la Grande-Bretagne est éblouie par un coucher de Soleil étincellant.
Le Times relata l’évènement : la nuit est si claire que les londoniens peuvent lire leur journal dans la rue, à minuit, sans avoir recours à l'éclairage de la ville ! Un journaliste décrit ainsi cette nuit du 30 juin : Le ciel était clair comme en plein jour et sillonné de nuages de lumière rose ; de ma vie, je n'ai assisté à quelque chose d'aussi stupéfiant.
Un nuage luminescent s'étendit sur toute l'Europe et il y eut une luminosité inhabituelle pendant environ 2 mois.
Enquêtes Hypothèse de Nikola Tesla
Plus tard, certains compareront cette explosion avec un projet Nikola Tesla, qui semblait receler lui aussi une puissante de destruction terrifiante.
Que se passerait-il en effet si au lieu d'être répartie équitablement sur la planète, toute l'électricité était dirigée en un seul point du globe ?
Selon les calculs de Tesla, l'émetteur pourrait fournir une puissance représentant 100 milliards de watts.
Focalisée pendant une courte période sur une seule fréquence, cela reviendrait à produire une force de 10 000 000 000 000 000 joules ! Ce qui correspond à 10 mégatones de TNT... soit à peu près la puissance de l'explosion qui eut lieu à Toungouska.
Ainsi tenait-il sans doute au bout de ses doigts une arme redoutable, aussi puissante que la bombe nucléaire, qui pouvait être dirigée vers n'importe quel point du globe.
Kulik
Avec les évènements du début du siècle comme la triste purge politique, puis première guerre mondiale, la Russie ne semble pas capable d'enquêter avant 1921.
Cette année-là Leonid Kulik est sélectionné par l'Académie des Sciences Soviétique pour déterminer ce qui s'est passé. Ce dernier commence à collecter les récits de témoins visuels de l’évènement.
En mars 1927 Kulik franchit la voie ferrée du trans-siberien à Tayshet et se dirige vers le village de Vanavara.
Il s'agit d'un vieux village, contrairement à Bratsk qui semble composé de trentenaires déplacés depuis la région de Moscou. Il recrute un guide nommé Il'ya Potapovich, dont le frère a ressenti les effets de l'explosion 19 ans avant, sa tente ayant été soufflée à 75 miles de l'épicentre.
A la mi-avril Kulik et son guide ont atteint la rivière Merkirta et ils peuvent observer les premiers signes de dévastation. Depuis la rivière de petits monticules peuvent être observés, complètement vidés de leurs arbres. Kulik monte sur une des plus hautes collines et voit sur au moins 12 miles devant lui les arbres abattus, tous dans la même direction. Le rude hiver l'empêche d'aller plus loin. Il écrit dans son journal des ruines aussi loin que l'oeil peut voir, que cela aurait-il été si c'était Saint Petersbourg ?
En juin, Kulik revient et suit la ligne des arbres dévastés pour finalement atteindre ce qui va appeler le "chaudron".
Là, les arbres sont tombés de manière radiale vers l'extérieur.
Il se trouve dans une légère dépression avec un diamètre irrégulier d'environ 1 mile.
De là, la forêt brûlée et abattue s'étend sur 20 miles derrière lui, et 37 miles dans un éventail face à lui.
Familier du grand cratère d'Arizona, il cherche en vain le reste d'une météorite.
Il voit de nombreux petits trous plats, mais il ne sait à l'époque s'il s'agit d'une caractéristique naturelle de la région.
Kulik effectuera 3 autres expéditions, en 1928, 1929 et 1938/1939, avant sa mort comme prisonnier de guerre le 14 avril 1942, défendant son pays contre les allemands.
Il ne trouvera jamais de trace d'impact ni de fragments. Quoi que soit il semble que cela ait explosé en l'air et disparu totalement.
Kazantsev
En 1946, A. Kazantsev décrit dans une nouvelle de science-fiction que l'affaire de Tunguska en 1908 serait due à l'explosion d'un vaisseau "martien" propulsé par énergie nucléaire. Une idée qui sera aussi défendue par Matest Agrest.
Nucléaire
En 1961 En URSS, une communication de l'Académie des Sciences indique que le désastre de la Tunguska en 1908 présentait tous les caractères d'une explosion nucléaire.
Zolotov en 1969
Effectivement le scientifique russe Alexei Zolotov a déclaré avoir trouvé de la radioactivité sur le site de l'"impact".
Ce professeur de physique a organisé avec son école diverses expéditions sur le site de Tunguska et a effectué une série d'annonces de "radioactivité anormale".
Cependant d'autres expéditions ne trouvèrent pas de radiation anormale en dehors des traces de retombées des essais de bombe H des soviétiques.
Après une enquête de 17 ans, Zolotov expose donc la théorie de l'explosion nucléaire en supposant qu'elle ait été causée par la visite d'un appareil extraterrestre.
D'après lui, un appareil contrôlé par des êtres d'autres mondes pourrait avoir provoqué l'explosion de 1908.
Il imagine un appareil propulsé par nucléaire explosant accidentellement en raison d'une défaillance technique.
Zolotov admet aussi les problèmes de cette théorie, réalisant que des dispositifs de sécurités permettraient sans doute de prévenir de telles mésaventures, et observation que la zone réelle de destruction est une démonstration incroyable d'une précision et d'un humanitarisme précis.
Le 3 décembre 1994, Alexandre Rempel, chercheur de Vladivostock qui a enquêté sur l'affaire de la Tunguska, les ovnis et les divers cultes proliférant en Russie, disparaît.
Nul se sait ce que sont devenus ses archives et tous ses dossiers.
A partir de 1999, une équipe de l'institut de science marine de Bologne en Italie se rend au lac Cheko, à 8 km au nord/nord-ouest de l'épicentre déterminé par Kulik afin de rechercher dans les dépôts du lac d'éventuels marqueurs géochimiques et sédimentologiques de l’évènement.
Cependant, à mesure que leur travail progresse, un 2ème objectif se dégage : trouver des éléments accréditant ou réfutant l'hypothèse que le lac soit installé en fait sur un cratère d'impact du bolide.
Au fil de cette 2ème enquête, l'équipe constate qu'on ne trouve pas trace écrite de la présence du lac avant 1908.
De plus, l'aspect du lac semble peu compatible avec un processus tectonique ou d'érosion/déposition.
Le bolide de Tunguska aurait donc bien pu s'écraser là.
En prenant en compte l'épicentre de Kulik, sa trajectoire aurait alors été bien plus sud-nord que est-ouest. Mais que dire alors du site de Shishkov ou du cratère de Voronov ?
Par la suite d'autres explications astéroïdales ou cométaires seront encore proposées .
La théorie de Uranov, hypothèse scientifique ou légende ?
Que s'est-il passé à Tunguska en juin 1908 et existe-t-il une gigantesque installation souterraine dont la construction remonte peut-être à l'aube de l'humanité ? Ce sont les questions auxquelles Valery Uvarov a tenté de répondre. Pour y arriver, le scientifique a retrouvé un grand nombre de témoignages dans des archives mais aussi en rencontrant les descendants des habitants de cette région sibérienne peuplée de russes mais aussi de clans de l'ethnie des Yacoutes.
Comme on a pas vraiment trouvé de débris, on pense que l'explosion de la météorite ou plutôt d'un noyau cométaire eut lieu en altitude, entre 6 à 9 km. L'énergie dégagée aurait été équivalente à celle de 1000 fois Hiroshima. De cet incident, il ne serait resté qu'une multitude de petites sphères de métal et de silicate que l'on a retrouvé éparpillées sur le sol de la région. Ceci pour la version officielle. Mais Uvarov, s'appuyant sur une multitude de récits, de témoignages mais également de légendes des peuplades Yacoutes nous livre une histoire incroyable et totalement vraisemblable.
Selon l'enquêteur russe, la gigantesque météorite n'a pas percuté la terre car elle a été détruite en haute altitude, non par son entrée dans notre atmosphère mais parce qu'elle a été interceptée par une technologie que nos scientifiques n'oseraient même pas rêver, une technologie générant de l'énergie électromagnétique et produisant d'immenses « boules de lumières », des « boules de feu » ou de plasma d'au moins 60 mètres de diamètre.
Les récits des shamans et des anciens des clans Yacoutes de la région semblent avoir complètement intégré dans leur univers l'existence de cette technologie qui se serait « manifestée » non seulement en 1908 mais bien avant encore.
Selon la tradition des ethnies locales, un siècle quasi jour pour jour avant la venue d'un évènement majeur de l'amplitude de celui qui s'est manifesté en 1908, l'installation « se réveille » et effectue comme une sorte d'entraînement en émettant des boules de feu de plus petites tailles.
En 1908, 2 mois avant la catastrophe, les shamans avaient averti les tribus de la région en leur demandant de quitter l'endroit et de ne pas effectuer leur trajet migratoire habituel.
De nombreux témoignages de l'époque évoquent le fait que tous les animaux avaient évacué, fuient les alentours de Tunguska qui étaient devenus totalement déserts : plus un oiseau, plus un mammifère, toute la faune s'était déplacée en laissant déserte une surface de plusieurs dizaines de milliers de km2, nous affirme Uvarov.
Au total, une série de 14 explosions seront entendues dans la région et des sphères lumineuses furent aperçues par des témoins situés jusqu'à 1500km de l'épicentre de la catastrophe. Il ne pouvait s'agir des météorites car ces sphères semblaient commandées à distance : elles volaient à des vitesses variables, changeaient de trajectoire, ralentissaient puis se sont arrêtées pendant un moment avant de se propulser à des vitesses incroyables, probablement à la rencontre de l'ennemi, la météorite destructrice dont l'impact aurait pu sans doute provoquer un cataclysme fatal pour notre planète. Selon Uvarov, ces sphères qu'il a baptisées « Terminators » ont coordonné leur trajectoire entre elles avant d'entrer dans la phase d'action finale. « Dans un rayon de 800 km, il y avait différents objets dans le ciel, poursuivant différentes trajectoires à partir de directions différentes parallèles à la surface de la terre, parfois s'arrêtant, changeant de direction et de vitesse.
En d'autres termes, ces objets manoeuvraient, ce qui exclut totalement le fait que les objets aperçus soient des météorites ou des comètes. Des milliers d'observateurs n'ont pas pu se tromper ce matin là…
Ces objets se sont dirigés vers un certain point de reconnaissance… A certains moments de leur vol, les sphères ajustèrent leur position en vue de la météorite qui arrivait puis, avec un vrombissement terrible, elles prirent leur essor à une vitesse extraordinaire pour rencontrer la météorite »
Lire « Mysteries of Siberia's ‘Valley of Death' Part » dans Nexus magazine Jan 2005.
Pour Uvarov, qui se base sur une série de témoignages concordants, la météorite a littéralement été vaporisée par les « terminators » à une altitude d'environ 10 km ou à tout le moins, « l'objet dans le ciel donnait l'impression de fondre ».
A une cinquantaine de kilomètres de l'interception par les Terminators et donc de l'explosion dans le ciel, les personnes témoins de la scène furent victimes d'un gigantesque dégagement de chaleur :
« leurs vêtements se consumèrent et une chaleur insupportable venant de l'altitude inonda la Taïga glacée ». Le sol devint brûlant sur un rayon de 60km.
« Sur un rayon de 600 km, l'intensité du flash de lumière surpassa la lumière du soleil » .
Un instant avant le flash, des arbres furent déracinés, les sommets des collines furent soufflés et les yourtes des nomades Yacoutes s'envolèrent, ce qui donne une idée de l'ampleur de l'énergie dégagée par l'interception du corps céleste par les Terminators.
La météorite détruite en plusieurs phases, des victimes comme protégées
En fait, selon Uvarov, il n'y eut pas une seule explosion mais plusieurs : une explosion principale qui fit fondre la météorite et la brisa en plusieurs morceaux qui furent alors interceptés par plusieurs autres « Terminators » qui étaient restés en vol stationnaire pendant la première explosion pour ensuite se précipiter sur les débris restants.
Uvarov retient trois sites distinctifs d'explosions par les Terminators, des zones séparées par une centaine de kilomètres de distance : Shishkov (site 1), Kulik (site 2) et enfin le cratère de Voronov (site 3).
Les arbres ne furent pas abattus par un projectile mais brûlés et projetés au sol par la puissance du souffle des explosions et du dégagement de lumière et de chaleur.
Le noyau de la météorite aurait été vaporisé au dessus du site 2 de Kulik et un dernier fragment fut intercepté au dessus du site 3 dont l'impact causa un gigantesque tremblement de terre ainsi qu'un cratère de 20 mètres de profondeur. Certaines de ces explosions furent si puissantes que des victimes s'évanouirent et perdirent connaissance pendant plusieurs jours.
Le soir après l'explosion, des témoins notèrent la présence d'autres boules de feu que les scientifiques de l'époque interprétèrent comme étant d'autres météorites.
Pour Uvarov, au vu de la façon dont ces boules de feu volaient, il devait s'agit de « Terminators » de réserve, des « sphères secondaires » de sécurité.
Uvarov note également d'étranges variations dans les témoignages quant à la perception de l'intensité de l'interception de l'objet célèste, suivant le lieu où ces personnes se situaient.
Très paradoxalement, dans certaines régions très proches du site de l'explosion céleste principale, les témoins ne notèrent pas la présence d'une détonation énorme et ne ressentirent aucun tremblement de terre alors que dans d'autres lieux situés à 600 km de l'interception, les maisons tremblèrent sur leurs fondations, des fenêtres volèrent en éclats et les gens furent aveuglés par l'éclat de l'explosion.
En d'autres termes, selon Uvarov, « la vague principale de la déflagration a été compensée d'une manière ou d'une autre de telle façon à ce qu'un minimum de personnes ne souffre de l'incident même s'il est impossible de prouver qu'on pouvait éviter des victimes parmi les animaux (des milliers de rennes périrent) et les hommes .
Tous les hommes n'avaient pas écouté les avertissements des shamans leur enjoignant de quitter la région ».
Uvarov souligne qu'il existe des technologies permettant de compenser ou de limiter les dégâts généré par des forces explosives.
Pour le chercheur russe, l'utilisation de technologies de « compensation » permettant de limiter certains types de dégâts ne fait aucun doute et laisse penser à « l'implication de forces intelligentes qui ont dirigé tout ce qui est arrivé ».
Mais pourquoi cette région est-elle si particulière ? On ne peut que se laisser aller à des spéculations.
Mais Uvarov souligne que des spécialistes d'une revue scientifique russe estimaient en 1984 que la Sibérie et plus particulièrement, la zone de Tunguska, s'avérait être une « zone géomagnétique à part sur la planète ».
Elle était qualifiée « d'anomalie magnétique de la Sibérie orientale ».
J-10 : "L'installation " entre en activité
La destruction ou la déviation de météorites et astéroïdes semble être obtenue au moyen d'un champ de force véhiculé sous forme concentrée par des sortes des structures électromagnétiques semblables à des sphères lumineuses incandescentes.
Cela s'apparente au phénomène de la foudre en boule, à ceci près que la taille de la plus grosse foudre en boule connue de la science mesurait environ deux mètres de diamètre, alors que les sphères qui seraient utilisées pour dévier ou détruire des météorites auraient des dimensions gigantesques : quelques 60 mètres de diamètre !
Ce que des milliers de personnes ont vu en 1908, dans une large partie de la Sibérie était le vol de ces sphères, que ces témoins ont identifiées à un essaim d'énormes foudres en boules.
Ces «sphères de plasma» sont apparemment produites par une centrale énergétique enfouie profondément sous terre en un lieu délibérément choisi, associé à une zone géophysique particulière de la planète : l'anomalie magnétique de l'est sibérien. La revue Teknika Molodiozhi (n°1, 1984) la désigne comme «une super-anomalie magnétique dont la source se situe à une profondeur égale à la moitié du rayon terrestre». En d'autres termes, cette centrale tirerait son énergie de la planète et serait, en somme, elle-même la cause de l'anomalie magnétique.
Une dizaine de jours avant l’évènement, selon un grand nombre de témoignages qui furent récoltés bien plus tard, en 1927, à l'occasion de la première enquête sur la catastrophe, la région fut le siège d'activités totalement étranges et inhabituelles.
Pour Uvarov, « l'installation était en début de phase d'activité ». On enregistrait d'intenses perturbations électromagnétiques caractérisées par des sortes d'aurores boréales, par des nuages de couleur argentée, une luminescence étrange, des évènements qui furent même perçus dans des pays européens limitrophes de la Russie.
Le professeur Weber de l'Université de Kiel en Allemagne prit note avec étonnement de ces phénomènes lumineux et électromagnétiques.
Puis, une trentaine de minutes avant l'arrivée de la météorite, les événements s'accélérèrent. Des témoins qui vivaient dans des zones éloignées les unes des autres racontent le même genre d’évènements : un grand pilier de lumière sort du sol en émettant un bruit, une sorte de ronronnement très puissant mais surtout très effrayant.
Tous les témoins s'accordent pour affirmer que l'atmosphère même suait la terreur.
Il y eut à ce moment là des tremblements de terre puis trois ou quatre séries de trois détonations très puissantes. A chacune des détonations, le pilier de lumière émettait une sphère lumineuse énorme. Un des témoins se souvient que l'énergie dégagée avait fait trembler la terre et brisé les vitres de la ferme où il vivait avec son grand-père alors qu'ils étaient relativement éloignés du lieu d'où avait émergé ce pilier.
La boule de feu émettait une lumière plus vive que le soleil et semblait plus grosse que la lune.
Un autre témoin situé dans une autre région se souvient qu'il se trouvait à côté d'un lac.
Il se rappelle avoir été envahi par un sentiment absolu de terreur avant que quoi que ce soit ne se passe.
L'eau du lac baissa au point que le lac se vida de son contenu, laissant apparaître le fond, constitué de deux sortes de plaques séparées entre elles par un interstice dentelé. Les deux plaques s'écartèrent pour laisser émerger à nouveau un de ces énormes piliers de lumière.
Le témoin avait fui aussi loin que possible, ce qui n'avait pas empêché l'intéressé d'être brûlé au visage et aux oreilles et ses vêtements de se consumer.
Les légendes Yacoutes font état de récits totalement analogues mais bien plus anciens que ceux de 1908.
Ce qui impressionne le lecteur dans l'enquête d'Uvarov est que tous les témoignages récoltés sont concordants, à une époque où les médias étaient inexistants et l'isolement était tel que ces témoins ne pouvaient communiquer entre eux.
Les conséquences étonnantes selon Uvarov.
Ce jour-là, la déflagration fut si énorme que l'on l'entendit à 1500 km à la ronde, jusqu'au cercle arctique. Outre des secousses sismiques qui se déclenchèrent par vagues dans le monde entier, d'incroyables phénomènes lumineux se produisirent alors.
Ce jour-là, la nuit ne se coucha pas dans la région de Tunguska...
Bien entendu, une immense région boisée fut dévastée mais la végétation et les cultures repoussèrent à une vitesse incroyable. La gigantesque décharge électromagnétique qui survint eut des effets profonds sur l'environnement et des cultures et Uvarov parle même de distorsions spatio-temporelles, ce qui semble assez logique lorsqu'il y a un tel dégagement d'énergie électromagnétique.
Ces effets feraient partie de la technologie « compensatoire » des dégâts causés par l'explosion en elle-même. Les témoins de Tunguska mettent en lumière certains faits que l'on retrouve fréquemment lors d'une apparition d'un Ovni dont la technologie est sensée également dégager d'importants phénomènes électromagnétiques.
Selon les informations collectées par Uvarov auprès des descendants directs des victimes de Tunguska, des animaux mais également des hommes furent tout simplement délocalisés instantanément et « relocalisés » à une certaine distance du lieu où ils se trouvaient.
En d'autres termes, ils furent « transférés » au moment de la décharge électromagnétique. Comme si l'espace et le temps s'étaient « pliés». Un autre phénomène étrange se produisit. N'oublions pas que nous sommes en plein mois de juin et que le jour de l’évènement, le ciel était bleu et limpide.
Au moment de la catastrophe, des témoins virent le ciel s'ouvrir en deux et purent voir la voûte céleste, les étoiles et le firmament comme s'ils s'étaient retrouvés dans l'espace. Tout cela en plein jour.
La nuit se ne coucha pas d'avantage dans presque toute l'Europe, où des nuits d'une blancheur irréelle s'installèrent plusieurs semaines durant.
Et l'histoire continue ...
Avant 1908
L'affaire de Tunguska n'est, selon Uvarov, qu'un épisode de la vie de cette mystérieuse installation qui bouleverse cette immense région du Nord-Est russe. En effet, il existe des témoignages (certes plus rares) et aussi les récits et légendes des peuplades Yacoutes qui décrivent des événements similaires (piliers de lumières, boules de feu, interception d'un objet céleste) dans des périodes bien antérieures à 1908. Mais il semble bien que la mystérieuse installation ait reprit du service à plusieurs reprises ces dernières années.
1984, Chulym
Le 26 février 1984, les passagers d'un bus qui circulait dans l'Est sibérien près de Myrni observèrent au loin l'émergence d'un « fin pilier de feu » puis l'objet entama une série d'étranges métamorphoses géométriques.
A ce moment, une météorite situé à une altitude de 100 km poursuivait exactement la même trajectoire que celle décrite en 1908. Des pêcheurs des environs virent s'élever dans les airs à partir des collines environnantes deux énormes sphères lumineuses qui prirent graduellement de la vitesse, s'élevèrent ensuite verticalement pour disparaître à toute allure derrière les nuages.
Les nuages se mirent à luire d'une étrange lueur pendant un certain moment. « Ensuite, sans pour autant toucher le sol, le bolide explosa en une pluie d'étincelles dans la région située au dessus de la rivière Chulym » nous raconte Uvarov. Comme à Tunguska en 1908. Une expédition envoyée sur les lieux ne trouva aucuns débris de la météorite, mis à part des fragments de minuscules sphérules de magnétite et de silicate.
L'explosion ayant eu lieu à très haute altitude, les arbres ne furent pas touchés. Comme en 1908, la météorite, très certainement de plus petite taille, avait été vaporisée en altitude.
2002, Bodaibo
En septembre 2002, tout se déroula selon un modèle désormais familier, commençant par la migration de la faune locale. Les chasseurs interrogés rapportèrent avoir vu les animaux quitter la zone de Vitim peu avant l'explosion.
Trente minutes auparavant, le complexe énergétique entra dans sa phase la plus active.
Apparitions des piliers et tirs des fameux Terminators, ces larges boules de lumière qui ont disparues rapidement cette fois derrière les nuages car la météo était assez mauvaise.
Anecdote non dénuée d'intérêt : l'un des témoins avait remarqué que son chien était inquiet et s'était mis à gémir trente minutes avant l'explosion !
Durant la nuit du 24 septembre 2002, un objet a explosé au-dessus de la Sibérie, dans le district de Bodaibo situé au nord-est d'Irkoutsk et du lac Baïkal, ravageant près de 100 km2 de taïga.
Aucune autre information ne transpirait de cet évènement.
Michael Nazarov du Laboratoire des Météorites de l'Institut Vernadsky de Géochimie et de Chimie analytique notait que "la station séismique de Bodaibo avait enregistré un signal qu'ont ne pouvait pas aisément interpréter".
Les autres stations séismiques situées plus loin n'avaient rien enregistré, indiquant que si l'objet avait survécu à la rentrée atmosphérique et frappé le sol, l'impact dû être relativement faible. Comme à l'accoutumée la presse invoqua un impact météoritique, mais sans disposer de la moindre preuve.
Par chance, le Département de la Défense américain (DoD) avait suivi la chute de l'objet entre 62 et 30 km d'altitude.
Il a estimé son énergie à 200 tonnes de TNT, soit 100000 fois inférieure à l'énergie libérée dans l’évènement de la Tunguska.
L'information ne fut publiée dans la presse qu'en juillet 2003 car ce n'est qu'au mois de mai de l'année suivante qu'une équipe scientifique de l'Académie des Sciences de Moscou constituée d'une dizaine de personnes, y compris des médecins, a pu localiser et atteindre l'épicentre de la zone située dans une région semi-montagneuse et boisée. "Sur une superficie d'environ 100 km2, rapporte le chef d'expédition Vadim Tchernobrov, les arbres sont cassés d'une manière caractéristique d'effets de souffle très puissants.
Pour donner un ordre d'idée, l'explosion de la météorite, qui s'est désintégrée avant de toucher le sol, et dont les fragments n'ont laissé pour cette raison, selon nos observations, qu'une vingtaine de cratères ayant jusqu'à vingt mètres de diamètre, équivalait à la puissance d'une bombe atomique de taille moyenne".
La nature de l'objet ainsi que son origine demeurent inconnus.
L'objet, pourrait être un astéroïde de la famille des NEO ou tout simplement un astéroïde isolé un plus gros que les bolides ordinaires.
Qui est derrière l'installation ?
Quant à savoir qui a bâti cette installation, quand et pourquoi, Uvarov ne répond pas à cette question, sans doute la plus fascinante, dans cette série d'articles. Il promet une suite à ses recherches sans toutefois donner de dates.
On peut spéculer que les extraterrestres sur lesquels on a le plus d'informations textuelles sont les fameux Annunakis qui se seraient installés à Sumer il y a des milliers d'années.
Leur installation ne se serait d'ailleurs pas limitée au bassin irakien mais ils auraient également colonisé l'Afrique du Sud et de l'Est, pour les mines.
Alors pourquoi pas la Sibérie ?
Les textes sumériens nous parlent d'extraterrestres très interventionnistes qui, pour des raisons de pur opportunisme, et pas simplement « humanistes » étaient capables de mettre au point et d'installer de telles technologies.
Nous sommes bien entendu très curieux de connaître le contenu des conclusions d'Uvarov sur l'identité des constructeurs de cette installation tout comme nous aimerions vraiment savoir pourquoi des expéditions bien équipées n'ont pas été rapidement envoyées sur les lieux pour scanner les entrailles de la terre sur base de premiers relevés par satellites.
Interview de Valery Uvarov
Le Dr Valery Mikhailovich Uvarov a consacré plus de quatorze années à l'ufologie ainsi qu'à l'étude des legs des civilisations anciennes. Il est l'auteur de nombreux articles sur la paléotechnologie et les paléosciences ainsi que sur l'ufologie et l'ésotérisme, publiés dans la presse russe et étrangère.
Il est l'initiateur de plusieurs expéditions en Inde et en Egypte, aux quelles il a participé, à la recherche de preuves matérielles de connaissances antiques.
Il participe régulièrement à des rencontres internationales d'ufologie et donne des conférences et des séminaires en Russie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Scandinavie. Il a pris la parole aux congrès Nexus d'Amsterdam et de Brisbane en 2004 et en 2005.
Les passages suivants sont une transcription d'une interview filmée de Valery Uvarov, de la National Security Academy de Russie, réalisée par Graham W. Birdsall, éditeur de la revue britannique UFO Magazine en 2003 :
Graham Birdsall (GB) : Quel est votre titre officiel ?
Valery Uvarov (VU) : Je suis chef du service de recherches et d'informations scientifiques et techniques sur les OVNIS de la National Security Academy, basée à St. Petersbourg, en Russie.
GB : Il s'agit d'une agence gouvernementale russe officielle ?
VU: Absolument. Je suis sous les ordres de deux personnes, lesquelles doivent rendre des comptes à leur supérieur direct qui n'est autre que notre Président (Poutine).
GB : En quoi consiste exactement votre travail ?
VU: Nos activités de recherche se divisent en deux parties. Tout d'abord, nous analysons constamment des données nous parvenant du monde entier. Nous extrayons alors de notre base de données les informations que nous jugeons les plus intéressantes, après leur avoir attribué un code de couleur (rouge ou jaune). Ces informations sont ensuite diffusées dans divers services à travers la Russie.
L'autre aspect de nos recherches découle de la question suivante: les OVNIS existent-ils ou pas ? Nous sommes sûrs qu'ils existent mais qu'est-ce qui se cache derrière leur activité, quel est leur intérêt ?
C'est pour nous le point le plus important et celui sur lequel nous concentrons principalement nos investigations.
GB : Il y a une coopération active entre la NASA et les responsables du domaine aérospatial russe, d'un point de vue technique, scientifique et peut-être même militaire. Êtes-vous en contact ou avez-vous des liens avec des organisations étrangères similaires à la vôtre ?
VU: Je peux vous dire, en toute honnêteté, que deux jours avant de m'envoler pour les États-Unis, j'ai eu une entrevue avec mes... disons, mes patrons. Et ils se sont dits très intéressés par une coopération avec d'autres organisations... disons, nos amis occidentaux. Je peux donc vous dire que cette mission particulière n'en est qu'à ses débuts. Je suis chargé de trouver les bonnes personnes. Une fois que ce sera fait, et que l'étape suivante sera activée, nous pourrons faire quelques avancées concrètes.
GB : Un peu plus tôt, hors caméra, vous avez fait allusion à certains développements importants concernant l'explosion de Tunguska de 1908. Pouvez-vous officiellement nous dire pourquoi vous pensez désormais en connaître la cause ?
VU: Ce n'est pas simplement une supposition; nous en connaissons la cause. C'était un météore, mais un météore qui a été détruit par... disons, un missile. Ce missile avait été généré par une installation matérielle. Nous ne savons pas qui l'a construite mais elle a été construite il y a très longtemps et se situe en Sibérie, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Tunguska. Je peux vous dire que notre enquête a révélé qu'il y avait eu plus d'une explosion à Tunguska. Permettez-moi de vous faire partager l'une de nos informations. La dernière fois que cette installation a tiré un missile c'était les 24 et 25 septembre de l'an dernier. Les Américains... ils possèdent trois bases... ont, eux aussi, remarqué cette explosion.
GB : Pardonnez-moi mais certains diront que cela a des airs de science-fiction.
VU: Graham, vous savez que lorsque nous parlons des vérités qui se cachent sous ce sujet, nous ne le faisons qu'avec ceux qui comprennent la responsabilité inhérente au sujet. Et vous savez que nous avons affaire à une technologie bien plus avancée que la nôtre, à une technologie capable de faire des choses qui nous sont impossibles.
GB : Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur l'emplacement de cette installation ?
VU: Recherchez le site de l'explosion de Tunguska. Au sud-est se trouve le célèbre grand Lac Bâikal. Au-delà, vers le nord, un immense territoire stérile pratiquement inhabité s'étend sur 100 000 km². On n'y trouve ni ville ni village. C'est là que nous avons localisé l'installation...
GB : Êtes-vous au courant d'histoires étranges ou de rumeurs concernant ce que l'on appelle la «Planète X» ? Si un nouveau corps céleste était entré dans notre système solaire, les astronomes l'auraient sûrement détecté et auraient signalé sa présence.
VU: Je ne sais pas ce qu'il en est pour les astronomes occidentaux-mais les nôtres affirment que nous n'avons rien à craindre. J'ai entendu des gens parler d'une rotation de 3 600 années pour cette planète, qui se trouve sur une orbite similaire à celle de la Terre mais derrière le Soleil. Nous savons que cette planète et l'installation de Sibérie ont un lien étroit. Permettez-moi de dire que je crois que l'installation maintient cette planète sur une orbite stable. Si cette planète venait à bouger, à changer d'orbite, tout le système solaire deviendrait instable. Au sein de l'association, nous sommés sûrs que cette planète est habitée et que l'installation est conçue pour protéger à la fois ses habitants et nous-mêmes. Nous sommes persuadés que rien de dangereux ne surviendra. Tout est sous contrôle. Nos investigations ont montré que la Terre avait une impulsion - une fréquence parfaitement réglée qui affecte absolument tout, toute chose vivante. Il y a quelque 12 500 ans, cette impulsion correspondait aux 360 jours de l'année - étudiez l'ancien calendrier égyptien - mais c'est alors qu'un astéroïde a frappé la Terre. Nous pensons que l'orbite de la Terre a été modifiée, artificiellement, pour contrebalancer cela. Notre planète s'est éloignée du Soleil, jusqu'à atteindre une impulsion de fréquence de 365.
Cela nous a amenés à penser que nous avons des amis - des amis qui veillent sur nous, en silence. Ils n'ont pas laissé, et ne laisseront pas non plus à l'avenir, une planète, une comète ou un astéroïde frapper et détruire la Terre. C'est, pour nous, un point parfaitement clair aujourd'hui.
Et dire qu'il y en a qui souhaitent doter l'espace d'armes... pour vous dire la vérité, cela fait mal au coeur de tous ceux d'entre nous qui sont impliqués dans ce projet: Nous sommes là, en train d'enquêter sur cette installation, et sur d'autres choses, des choses matérielles, construites ni par les Russes ni par les Américains mais par quelqu'un d'autre, quelqu'un originaire de l'espace extra-atmosphérique. Quelle tristesse d'imaginer ce qui pourrait arriver si l'espace était doté d'armes.
Je vais vous parler franchement. Cette installation possède un système électrique, une source d'énergie. Nous l'avons localisé. C'est pendant le conflit en ex-Yougoslavie que nous avons pour la première fois remarqué une augmentation de cette énergie. Cela nous paraissait incroyable mais nous savons maintenant que cette installation réagit aux conflits et bouleversements sociaux.
Une partie de nos recherches impliquant de fouiller d'anciens registres et documents d'archives, nous sommes tombés sur les textes de l'Echutin Apposs Alanhor [sic]. Nous les appelons l'Alanhor et ils remontent au moins à 4 000 ans. Ils décrivent l'installation, en termes scientifiques, relativement à ce qu'il s'y passait. C'est stupéfiant.
Je me suis rendu là-bas deux fois. La première fois, notre équipe a détecté des niveaux élevés de rayonnement. Je dois avouer que c'était très dangereux, nous ne pouvions pas nous protéger. Les rares habitants de la région avaient bien sûr entendu parler de l'installation et nous l'ont décrite. Ils ont parlé de structures semblables à du métal et nous les ont dessinées. Nous avons tout relevé sur une carte. Mais ces gens, leurs familles et les animaux souffraient de maladies dues à l'irradiation.
Les niveaux de rayonnement sont continuellement contrôlés depuis six ans et aujourd'hui tout le monde - y compris les animaux - a déserté la forêt. Laissez-moi vous confier quelque chose à propos de l'explosion de Tunguska - quelque chose dont on n'a jamais parlé auparavant. Deux mois avant l'explosion, tous les animaux ont fui la région. On aurait dit que l'installation s'était mise sous tension pour s'occuper de l'astéroïde. Cela s'est accompagné d'une augmentation du rayonnement. La même chose se produit actuellement, aujourd'hui même.
GB : A-t-on prévu de monter une autre expédition dans la région et de visiter l'installation ?
VU: Le rayonnement est un facteur à prendre en compte mais, oui, une autre expédition est prévue pour un peu plus tard dans l'année. Ecoutez, nous ne voulons rien cacher. Nous serons heureux d'accueillir des participants du monde entier mais les personnes que nous invitons doivent être responsables aux yeux du monde. Nous voulons des gens honnêtes, ouverts et transparents, désireux de coopérer et d'échanger puis de diffuser les informations scientifiques. Je vous invite, Graham, à venir en Russie et à visiter l'installation au titre d'observateur.
GB : Ce serait un grand honneur. Merci.
VU: Vous pouvez dire à tout le monde que nous, les Russes, avons décidé qu'il était temps que d'autres personnes soient au courant, et pas juste un petit nombre.
Source : Planète
Liens
http://youtu.be/HXfvhJoNi90 événement sur la Toungouska
http://youtu.be/dP4gvhYJ7o4 les catastrophes (français)
http://youtu.be/V46DC8ThEuo Historia Channel 1 (Espagnol)
http://youtu.be/WQlcwisC7dw Historia channel 2 (espagnol)
  
Posté le : 29/06/2013 22:58
|
|
|
|
|
Le siège de Maastricht |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 30 Juin 1673 la forteresse de Maastricht battu par vauban,
se rend et signe sa reddition.
Les 13 jours de Maastricht
On savait la ville difficile à prendre. Il suffit pourtant de treize jours à Louis XIV pour s'emparer de Maastricht, en juin 1673. Grâce à une nouvelle technique de siège mise au point par Vauban.
Si Vauban est resté célèbre comme « preneur de villes », il le doit au siège de Maastricht, pendant la seconde campagne de la guerre de Hollande 1672-1678. « Prise en treize jours » , indique fièrement la légende du tableau de la galerie des Glaces à Versailles qui illustre l'événement. Il est vrai qu'en 1579 Maastricht avait résisté deux mois durant aux assauts du prince de Parme.
En ce mois de juin 1673, l'ingénieur a mis au point une technique qui sera appliquée jusqu'à la guerre franco-allemande de 1870 : le « siège à la Vauban ». Un siège méthodique, « dramaturgique » unité de lieu, d'action, de temps, mélange de tragédie classique et de raison cartésienne, avec une gestion des hommes et des moyens particulièrement efficace : d'abord tenue secrète, mais vite éventée, la méthode sera bientôt diffusée dans toute l'Europe...
Située au confluent des fleuves Jaar et Meuse, la ville de Maastricht était protégée par d'importantes fortifications l'enserrant dans une quadruple ceinture de pierres. Pour s'en emparer, Louis XIV pouvait compter sur 26 000 fantassins et 19 000 cavaliers. L'artillerie disposait de 58 pièces de canon - un chiffre énorme pour l'époque -, et les magasins renfermaient pour plus de dix semaines de vivres et de munitions. Jamais un aussi grand appareil de forces n'avait été déployé en vue d'un siège. Et, pour la première fois, la direction supérieure des travaux était soustraite aux généraux pour être confiée à un ingénieur.Vauban, qui avait sous ses ordres le corps du génie tout entier et il était entièrement responsable de la conduite de tous les travaux du siège. Appuyé sur le corps du génie, il inaugure un nouveau mode d’approche des prises de places.
Jusqu'alors, les travaux d'approche consistaient à creuser une tranchée unique, qui n'accordait pas aux troupes un espace suffisant pour se mouvoir, provoquant de terribles massacres : « Du temps passé , écrit dans ses Mémoires le comte d'Aligny, alors officier aux mousquetaires, c'était une boucherie que les tranchées ; c'est ainsi qu'on en parlait. Maintenant, Vauban les fait d'une manière qu'on y est en sûreté comme si l'on était chez soi. »
A Maastricht, le coup de génie de Vauban consista à rationaliser le procédé d'attaque mis au point par les Turcs lors du long siège de Candie Crète, achevé en 1669. L'ensemble des opérations, union de tactiques nouvelles et traditionnelles elles remontent aux Romains, se décompose en une dizaine de phases.
D'abord, il faut investir la place au plus vite en occupant toutes les routes d'accès. Puis, il s'agit de ceinturer la ville de deux lignes de retranchement parallèles : une ligne de circonvallation, tournée vers l'extérieur pour interdire toute arrivée de secours ou de vivres ; une ligne de contrevallation, tournée vers l'intérieur, pour prévenir toute sortie des assiégés. Cette dernière ligne est située à environ 600 mètres de la place assiégée, c'est-à-dire au-delà de la limite de portée de ses canons ; l'armée assiégeante établit ses campements entre les deux lignes de retranchement.
Puis vient la phase de reconnaissance : des ingénieurs choisissent le meilleur secteur d'attaque, habituellement un front formé de deux bastions voisins avec leurs ouvrages extérieurs demi-lune, chemin couvert et glacis. Ce choix du lieu d'attaque - stratégique ! - est l'objet d'une maxime dont Vauban était fier : « Attaquer une place par son plus faible et jamais par son plus fort, afin de ne pas donner lieu à une méchante place de faire la résistance d'une bonne. »
Succèdent les travaux d'approche, à partir de la contrevallation. A Maastricht, au matin du 16 juin 1673, Vauban utilise un chemin creux comme ligne de départ pour creuser deux tranchées en zigzag pour éviter les tirs d'enfilade des assiégés qui s'avancent progressivement vers les deux saillants des bastions. Puis les deux boyaux sont reliés par une première parallèle au front attaqué, appelée aussi « place d'armes », qui se développe ensuite très longuement, à gauche et à droite, jusqu'à être en vue des faces externes des deux bastions à attaquer et de leurs demi-lunes voisines.
La parallèle répond à plusieurs fonctions : relier les boyaux entre eux, afin de permettre aux soldats de se prêter secours ; masser à couvert des troupes et du matériel ; placer des batteries de canons qui commencent à tirer en enfilade sur les faces des bastions et des demi-lunes choisies pour l'assaut final.
Ensuite, la progression des deux tranchées reprend, jusqu'à 350 mètres de la place, distance où une deuxième parallèle est creusée. Les phases suivantes sont marquées par une progression à partir de la construction de trois tranchées : les deux précédentes, plus une nouvelle, suivant l'axe de la demi-lune visée.
Puis viennent les tirs à bout portant sur les escarpes parois des fossés et les bastions pour les faire s'effondrer et pratiquer une brèche. Ouverte par une mine, cette brèche, qui permettra l'assaut terminal, nécessite un travail de sape, long, dangereux, meurtrier, car tout près des assiégés. Pour cette raison, il est effectué de nuit par les mineurs munis de pelles et de piques, cibles, comme l'explique Vauban, « du feu jeté du haut du bastion attaqué, qui est ordinairement accompagné d'une nuée de grosses pierres, de bombes, de grenades, de poudres, de fagots, de paille, de gros bois et d'une infinité de fascines goudronnées et autres ingrédients poissés et préparés pour les feux d'artifices, ce qui non seulement brûle les mineurs ou les chasse de leur trou, mais embrase le fond du fossé et brûle très souvent les épaulements » .
Dans la nuit du 27 au 28 juin, l'assaut est ordonné : tambours, feu, cris, choc, fumée, pénombre, odeurs, blessures, râles, sang, frayeur, panique, tuerie, carnage... Après trois heures de lutte acharnée et furieuse, le gouverneur de la place assiégée estime que la partie est perdue : il fait « battre la chamade », ce qui signifie qu'il attend une offre de négociation en vue d'une reddition honorable. Et c'est ainsi que Maastricht se rendit le30 juin, après treize jours de tranchée ouverte...
Le siège de Maastricht permit à Vauban d'acquérir une célébrité européenne, l'estime de Louis XIV et une petite fortune, sous la forme d'une gratification de 80 000 livres avec laquelle il acheta, quelques années plus tard, le château de Bazoches, autrefois à sa famille.
Mais à Versailles, sur les peintures du plafond de la galerie des Glaces, Charles Le Brun fit du roi l'unique bénéficiaire de cette victoire dont Vauban, jamais représenté, n'était qu'un docile et invisible exécutant... Au Roi-Soleil seul tout l'éclat de la gloire de Maastricht !
Mais malgré tout les talents indéniables de Vauban sont alors reconnus par le rois et le 3 mai 1655, à l'âge de 22 ans, il devient «ingénieur militaire responsable des fortifications» et, en 1656, il reçoit une compagnie dans le régiment du maréchal de La Ferté. De 1653 à 1659, il participe à 14 sièges et est blessé plusieurs fois.
Il perfectionne la défense des villes et dirige lui-même de nombreux sièges.
En 1667, Vauban assiège les villes de Tournai, de Douai et de Lille, prises en seulement neuf jours.
Le roi lui confie l'édification de la citadelle de Lille qu'il appellera lui-même la "Reine des citadelles". C'est à partir de Lille qu'il supervise l'édification des nombreuses citadelles et canaux du Nord, lesquels ont structuré la frontière qui sépare toujours la France de la Belgique.
Il dirige aussi le siège de Maastricht en 1673. Enfin, il succède le 4 janvier 1678 à Clerville au poste de commissaire général des fortifications.
1673. Le siège de Maastricht.
Les douze phases du siège
L’ensemble du siège, union de tactiques traditionnelles et nouvelles, se décompose en douze phases :
- Phase 1. Investissement de la place. Il faut agir rapidement et par surprise. L'armée de siège coupe la place en occupant toutes les routes d'accès et en la ceinturant rapidement de deux lignes de retranchement parallèles (un vieux procédé, mis au point par les Romains).
- Phase 2. Construction de deux lignes de retranchement autour de la place investie :
Une ligne de circonvallation, tournée vers l'extérieur et qui interdit toute arrivée de secours ou de vivres et de munitions venant de l'extérieur.
Une ligne de contrevallation est construite, tournée vers la place, elle prévient toute sortie des assiégés.
Elle est située environ à 600 mètres, c'est-à-dire au-delà de la limite de portée des canons de la place assiégée.
L'armée de siège établit ses campements entre ces deux retranchements.
-Phase 3. Phase de reconnaissance. Intervention des ingénieurs assiégeants qui effectuent des reconnaissances pour choisir le secteur d'attaque qui est toujours un front formé de deux bastions voisins avec leurs ouvrages extérieurs (demi-lune, chemin couvert et glacis). Il faut souligner le rôle des ingénieurs dans cette phase et l'importance des études de balistique, de géométrie, de mathématiques. On oublie parfois que les premiers travaux de l'académie des sciences, fondée par Colbert en 1665, furent consacrés à des études qui avaient des relations directes avec les nécessités techniques imposées par la guerre. Colbert suscita ainsi, en 1675, des recherches sur l'artillerie et la balistique afin de résoudre la question de la portée et de l'angle des tirs d'après les travaux de Torricelli qui prolongeaient ceux de Galilée. L'ensemble aboutit à la rédaction du livre de François Blondel, L'art de jeter les bombes, publié en 1683. Depuis 1673, l'auteur donnait des cours d'art militaire au Grand Dauphin.
- Phase 4. Travaux d'approche. Cette fois, il s’agit des nouveautés introduites par Vauban. Les travaux d’approche s'effectuent à partir de la contrevallation et ils se présentent sous la forme de deux tranchées (et non plus une seule) creusées en zig zag (pour éviter les tirs d'enfilade des assiégés) qui s'avancent progressivement vers les deux saillants des bastions en suivant des lignes qui correspondent à des zones de feux moins denses de la part des assiégés.
- Phase 5. Construction d'une première parallèle (ou place d’armes). À 600 mètres de la place (limite de portée des canons), les deux boyaux sont reliés par une première parallèle (au front attaqué), appelée aussi “ place d’armes ”, qui se développe ensuite très longuement, à gauche et à droite, jusqu'à être en vue des faces externes des deux bastions attaqués et de leurs demi-lunes voisines. Cette première parallèle est une autre innovation de Vauban, inspirée d’une technique turque au siège de Candie. Pelisson écrit que “ Vauban lui a avoué qu’il avait imité des Turcs dans leurs travaux devant Candie ” (Lettres historiques, III, p. 270) La parallèle a plusieurs fonctions :
Relier les boyaux entre eux, ce qui permet de se prêter renfort en cas de sortie des assiégés sur l'un d'entre eux, et de masser à couvert des troupes et du matériel.
Placer des batteries de canons qui commencent à tirer en enfilade sur les faces des bastions et des demi lunes choisies pour l'assaut.
Le système des parallèles, fortifiées provisoirement, a l'avantage de mettre l'assaillant à couvert pour l'approche des défenses.
Louis XIV, lui-même, en témoigne, dans ses Mémoires :
“ La façon dont la tranchée était conduite, empêchait les assiégés de rien tenter ; car on allait vers la place quasi en bataille, avec de grandes lignes parallèles qui étaient larges et spacieuses ; de sorte que, par le moyen des banquettes qu’il y avait, on pouvait aller aux ennemis avec un fort grand front.
Le gouverneur et les officiers qui étaient dedans n’avaient encore jamais rien vu de semblable, quoique Fargeaux [le gouverneur de Maastricht] se fût trouvé en cinq ou six places assiégées, mais où l’on n’avait été que par des boyaux si étroits qu’il n’était pas possible de tenir dedans, à la moindre sortie. Les ennemis, étonnés de nous voir aller à eux avec tant de troupes et une telle disposition, prirent le parti de ne rien tenter tant que nous avancerions avec tant de précautions ”.
- Phase 6. La progression des deux tranchées. Elle reprend, jusqu'à 350 mètres de la place, distance où l'on établit une deuxième parallèle tout à fait comparable à la première et jouant le même rôle.
- Phases 7, 8, 9. Progression à partir de la construction de trois tranchées : les deux précédentes, plus une nouvelle, suivant l'axe de la demi lune visée. Plus construction de tronçons de parallèles qui servent à faire avancer au plus près des canons.
- Phase 10. Tirs à bout portant sur les escarpes (parois des fossés) et les bastions pour les faire s'effondrer et pratiquer la brèche qui permettra l'assaut.
- Phase 11. Ouverture de la brèche par mine. Il s'agit là d'un travail de sape, long et dangereux pour les mineurs spécialisés dans ce type d'ouvrage.
- Phase 12. Assaut. Montée à pied sur l'éboulement de la brèche au sommet de laquelle on établit un "nid de pie" pour être sûr de bien tenir. À ce stade, le gouverneur de la place assiégée estime souvent que la partie est perdue, et il fait « battre la chamade » : offre de négociation en vue d'une reddition honorable.
Qu'est-ce qu'un « siège à la Vauban » ?
Au total, on le voit, le siège à la Vauban est une méthode raisonnée dans laquelle l'ingénieur mathématicien coordonne tous les corps de troupe.
Ce qui n’évita pas de nombreux morts dont notamment d’Artagnan.
Parmi les ingénieurs, beaucoup sont tombés sous les yeux de Vauban : “ Je crois, écrivait-il à Louvois au début du siège, que Monseigneur sait bien que le pauvre Regnault a été tué roide, dont je suis dans une extrême affliction. Bonnefoi a été aussi blessé ce soir au bras.
J’ai laissé tous les autres en bon état ; je prie Dieu qu’il les conserve, car c'est bien le plus joli troupeau qu’il est possible d’imaginer ”.
À Maastricht, Vauban innova de plusieurs manières :
Il procéda, on l'a vu, selon un système de larges tranchées parallèles et sinueuses pour éviter le tir des assiégés et permettre une progression méthodique et efficace des troupes, la moins dangereuse pour elles.
Il ouvrit la brèche au canon.
Il perfectionna le tir d'enfilade.
Il multiplia les tranchées de diversion.
Surtout, il élargit les tranchées par endroits, en particulier aux angles et aux détours, pour former des "places d'armes" et des redoutes d'où les assiégeants pouvaient se regrouper, de cinquante à cent soldats, à l'abri des feux des canons et des mousquets.
Il put ainsi réduire la place avec une rapidité qui étonna ses contemporains ("Treize jours de tranchée ouverte"), diminuant au minimum les pertes humaines, l'obsession qui, toute sa vie, poursuivit Vauban : “ la conservation de cent de ses sujets écrit-il à Louvois en 1676, lors du siège de Cambrai, lui doit être plus considérable que la perte de mille de ses ennemis ”.
Dans son traité de 1704, Traité des sièges et de l’attaque de places, Vauban a parfaitement décrit sa propre fonction en expliquant le rôle joué par le “directeur des attaques” :
“ Tout siège de quelque considération demande un homme d’expérience, de tête et de caractère, qui ait la principale disposition des attaques sous l’autorité du général ; que cet homme dirige la tranchée et tout ce qui en dépend, place les batteries de toutes espèces et montre aux officiers d’artillerie ce qu’ils ont à faire ; à qui ceux-ci doivent obéir ponctuellement sans y ajouter ni diminuer. Pour ces mêmes raisons, ce directeur des attaques doit commander aux ingénieurs, mineurs, sapeurs, et à tout ce qui a rapport aux attaques, dont il est comptable au général seul ”.
Et comme à son habitude, Vauban fit de ce siège une relation détaillée assortie de remarques critiques : il soulignait que “ ce siège fut fort sanglant à cause des incongruités qui arrivèrent par la faute de gens qu’il ne veut pas nommer ”. Et il termine par cette observation : “ Je ne sais si on doit appeler ostentation, vanité ou paresse, la facilité que nous avons de nous montrer mal à propos, et de nous mettre à découvert sans nécessité hors de la tranchée, mais je sais bien que cette négligence, ou cette vanité (comme on voudra l’appeler) a coûté plus de cent hommes pendant le siège, qui se sont fait tuer ou blesser mal à propos et sans aucune raison, ceci est un péché originel dont les Français ne se corrigeront jamais si Dieu qui est tout puissant n’en réforme toute l’espèce ”.
La gloire du roi de guerre
Vauban reçut 80 000 livres, ce qui lui permit de racheter le château de Bazoches en février 1675.
Mais à Versailles, sur les peintures de la Galerie des glaces, Charles Le Brun fit du roi le seul bénéficiaire de cette victoire ("Masstricht, prise en treize jours") dont Vauban, jamais représenté, n'était qu'un docile et invisible exécutant.
Au début du mois de juillet 1673, Louis XIV écrivait à Colbert : maître d'œuvre de ce fameux siège, vantant sa prudence à "régler seul les attaques", son courage "à les appuyer et les soutenir", sa vigueur "dans les veilles et les fatigues", sa capacité "dans les ordres et dans les travaux".
Le 10 août, Vauban fit faire au prince de Condé, de passage dans la ville prise, le tour complet, “ par le dehors et par le dedans ”.
Condé trouva les projets de Vauban très séduisants : “ Le poste me paraît le plus beau du monde et le plus considérable, et plus je l’ai examiné plus je trouve qu’il est de la dernière importance de le fortifier. M. de Vauban a fait deux dessins, le grand dessin est la plus belle chose du monde ”
Commissaire général des fortifications : le bâtisseur
Il continue à ce poste de diriger les sièges : par exemple lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, les sièges de Philippsbourg en 1688, de Mons en 1691 et de Namur en 1692.
En 1694, il organise avec succès la défense contre un débarquement anglais sur les côtes de Bretagne à Camaret.
C'est la victoire de Maastricht qui pousse le roi à lui offrir une forte dotation lui permettant d'acheter le château de Bazoches en 1675.
Vauban est nommé «commissaire des fortifications» en 1678, lieutenant général en 1688, puis maréchal de France, en 1703.
Il devint si fameux que l'on dit même : "Une ville construite par Vauban est une ville sauvée, une ville attaquée par Vauban est une ville perdue".
La frontière de fer
Le nom de Vauban reste attaché à la construction d'une "frontière de fer" qui a durablement protégé le royaume contre les attaques ennemies.
Afin de construire une frontière plus linéaire et cohérente, Vauban voulut avant tout rationaliser le système de défense déjà mis en place avant lui, en particulier dans le Nord, car il fallait répondre à la principale préoccupation stratégique du roi : protéger Paris en souvenir de l'année 1636, celle de Corbie, qui avait vu les troupes espagnoles avancer jusqu'à Pontoise.
Par un jeu savant d'abandon et de restitution de villes fortifiées, le traité de Nimègue, en 1678, permit de diminuer les enclaves coûteuses et d'assurer ainsi une plus grande régularité du tracé de la frontière.
Vauban a multiplié les lettres, les rapports, les mémoires adressés à Louvois ou au roi ; dans ses lettres, rapports, mémoires, Vauban avait violemment dénoncé les méfaits de ce qu'il appelait l'"emmêlement de places".
En novembre 1678 par exemple, rédigeant un Mémoire des places frontières de Flandres qu'il faudroit fortifier pour la sûreté du pays et l'obéissance du Roi, il insistait sur la nécessité de "fermer les entrées de notre pays à l'ennemi", et de "faciliter les entrées dans le sien".
Aussi, pour le Nord du royaume, proposait-il d'installer deux lignes de places fortes se soutenant mutuellement, "à l'imitation des ordres de bataille".
La première ligne, la "ligne avancée", serait composée de treize grandes places et de deux forts, renforcée par des canaux et des redoutes, suivant un modèle déjà éprouvé dans les Provinces-Unies.
La seconde ligne, en retrait, comprendrait aussi treize places. Louvois lut le mémoire à Louis XIV qui souhaita aussitôt que la même politique défensive fût appliquée de la Meuse au Rhin.
C'est cette année-là que Vauban fut nommé commissaire général des fortifications.
Si le Nord et l'Est furent l'objet d'un soin défensif particulier, l'ensemble des frontières du royaume bénéficia de la diligence de l'ingénieur bâtisseur : partout, imitant la technique mise au point en Italie puis en Hollande et en Zélande par les Nassau, Vauban conçut le réseau défensif à partir du modelé du terrain et des lignes d'obstacles naturels, tels les fleuves, les montagnes, la morphologie du littoral, adaptant au site chaque construction ancienne ou nouvelle.
Il accorda une particulière attention au cours des rivières, à leurs débits, à leurs crues. Dans tous les cas, après une longue observation sur le terrain, il rédigeait un long rap¬port afin de résumer les obstacles et les potentialités de chaque site :
En avril 1679, par exemple, il rédigea pour Louvois un mémoire sur les fortifications à établir en Cerdagne au contact de la frontière espagnole : Qualités des scituations qui ont été cy devant proposées pour bastir une place dans la plaine de Cerdagne.
Examinant six emplacements possibles, il en élimina cinq, découvrant enfin
"la scituation idéale, justement à la teste de nos défilés comme si on l'y avoit mise exprès ..." ; les rochers, "les meulières et fontaines du col de la Perche" forment autant de remparts naturels : la situation choisie offre de nombreux avantages, et elle "épargne au moins les deux tiers de remuement de terre, et plus d'un tiers de la maçonnerie et en un mot la moitié de la dépense de la place".
Dans la plupart des cas, comme dans cet exemple de la Cerdagne, où il s'agissait du projet réalisé de la ville-citadelle de Mont-Louis, "parce qu'il est nécessaire d'assujettir le plan au terrain, et non pas le terrain au plan", il transforma les contraintes imposées par la nature en avantage défensif, dressant des forteresses sur des arètes rocheuses, ou les bâtissant sur un plateau dégagé pour barrer un couloir en zone montagneuse.
Une des réussites les plus éclatantes fut celle de Briançon, dont on peut voir les plan au musée des Invalides et des plans reliefs : les chemins étagés sur les flancs de la montagne furent transformés en au¬tant d'enceintes fortifiées et im¬pre¬nables.
Soit en les créant, soit en les modifiant, Vauban travailla en tout à près de trois cents places fortes.
Sa philosophie d'ingénieur-bâtisseur tient en une phrase : "l'art de fortifier ne consiste pas dans des règles et dans des systèmes, mais uniquement dans le bon sens et l'expérience".
L’État des places fortes du royaume, dressé par Vauban en novembre 1705, se présente comme le bilan de l’œuvre bâtie suivant ces principes : il compte “ 119 places ou villes fortifiées, 34 citadelles, 58 forts ou châteaux, 57 réduits et 29 redoutes, y compris Landau et quelques places qu’on se propose de rétablir et de fortifier ”.
La liberté d'esprit de ce maréchal lui vaudra cependant les foudres du roi. Vauban meurt à Paris le 30 mars 1707 d'une inflammation des poumons.
Il est enterré à l'église de Bazoches (dans le Morvan) et son cœur, sur l'intervention de Napoléon Ier, est conservé à l'hôtel des Invalides de Paris, en face de Turenne, depuis 1808.
Notes de Joel Cornette
----------------------------------------
Histoire de la ville de Maastricht
MAASTRICHT doit son importance stratégique et sans doute son origine à un pont qui, jusqu'au milieu du XIXe siècle, était le dernier pont permanent sur la Meuse avant son embouchure. Ce pont fut bâti au IIIe s. par les Romains pour la chaussée de Boulogne à Cologne et devint au Moyen Age le passage obligé de la route commerciale dont dépendait en grande partie le commerce des Flandres et du Brabant.
Alors qu'elle appartenait à l'origine au Prince-évêque de Liège, elle fut partiellement donnée en fief par l'empereur au duc de Brabant Henri Ier (1202). D'où il résulte que Maastricht dépendit jusqu'en 1795 de deux seigneurs, les droits des ducs de Brabant étant passés successivement aux rois d'Espagne et au Etats-Généraux des Provinces-Unies.
Les premiers remparts et la première enceinte en maçonnerie, dont il subsiste d'appréciables fragments, furent élevés au milieu du XIIIe s., mais, déjà à la fin de ce siècle, elle devint trop étroite, de sorte que l'on éleva vers 1300 une nouvelle enceinte, d'abord simplement terrassée.
On travailla tout au long du XIVe et du XVe s. à munir cette enceinte d'un mur avec tours et portes et à l'entretien de ces ouvrages.
Dès la fin du XVe s. et dans la première moitié du XVIe, ces remparts furent progressivement adaptés à l'emploi de l'artillerie par des travaux d'une conception nouvelle.
Avant de poursuivre l'aperçu du développement des fortifications, il nous paraît utile de préciser quelques aspects militaires de l'assiette de la ville d'un plan de la ville, si le lecteur en a un à sa disposition.
Comme la plupart des villes situées au bord d'une rivière assez large en terrain peu accidenté, comme voir Anvers, Cologne, etc.), le vieux Maastricht s'est développé en forme d'un demi-cercle fort irrégulier, dont le côté plat est appliqué à la rivière. Un faubourg - qui ici s'appelle WIJCK - se développa parallèlement sur l'autre rive (en l'occurrence la rive droite ou orientale). Comme ce faubourg n'a conservé aucune trace de ses fortifications, il n'en sera plus question ici.
Sur la rive gauche de la Meuse, le terrain s'élève progressivement vers l'ouest pour atteindre, en dehors des limites de la ville ancienne, des hauteurs dont !e CABERG (+/- 70 m), au nord-ouest, et la Montagne Saint-Pierre (+/- 100 m), au sud, auront une certaine importance pour nous. En raison de ces différences de niveau, la partie occidentale, la plus élevée de l'enceinte, se trouve en site sec et a un fossé sec.
C'est pourquoi cette partie a reçu le nom de "Hoge Fronten" (fronts hauts) tandis que le nord et le sud se trouvent en "site aquatique" avec fossé humide et possibilités d'inondations de l'avant terrain. Ces inondations pouvaient être réalisées au sud, au bas de la Montagne Saint-Pierre, avec les eaux du Geer qui pénètre en ville de ce côté-là, tandis que les fossés du front nord - "Bossche Fronten" ou fronts de Bois-le-Duc - étaient alimentés par la Meuse et seulement à partir du XVIIe s., par le Geer grâce â une conduite souterraine en dessous du fossé des "Hoge Fronten".
Le système de fortification hollandais étant essentiellement adapté aux travaux en site aquatique, les "Hoge Fronten" de Maastricht allaient poser des problèmes particuliers aux ingénieurs hollandais et ceci peut sans doute expliquer pourquoi les fortifications de cette ville diffèrent assez bien des types classiques rencontrés ailleurs. De plus, la guerre souterraine de mines et contre-mines, impraticable en site aquatique, y est largement appliquée à partir du XVIe s.
Les "Hoge Fronten" étant donc plus accessibles par l'assaillant, il importait de les munir de fortifications plus complètes. Ainsi, au cours des nombreux sièges de la ville, les travaux d'approche furent dirigés contre les "Hoge Fronten" (Portes de Tongres et de Bruxelles) en 1579 (Alexandre Farnése, duc de Parme), en 1632 (Louis XIV avec Vauban), tandis qu'en 1676 (Guillaume III d'Orange), en 1748 (Français sous le maréchal de Saxe), en 1793 et 1794 (Français sous Miranda et Kléber), les tranchées furent ouvertes en face des portes "Lindenkruis" et de Bois-le-Duc. Seuls les fronts sud ne furent jamais attaqués.
C'est avec son enceinte moyenâgeuse "améliorée" que Maastricht subit son siège le plus sanglant - celui de 1579 -, résistant pendant quatre mois aux assauts des troupes de Farnèse. La ville fut prise d'assaut le 29 juin 1579 - cas exceptionnel parmi les sièges de Farnèse qui généralement se terminèrent par des capitulations - et, comme l'autorisaient dans un cas pareil les lois de la guerre de ce temps, elle fut pillée de fond en comble. Après cela, la ville resta quelque 50 ans aux mains des Espagnols qui firent restaurer l'enceinte et y ajoutèrent quelques "dehors", notamment un chemin couvert. Ces ouvrages subirent le siège du 9 juin au 21 août 1632, permettant à la garnison de repousser tous les assauts jusqu'à ce que les habitants forcent le gouverneur à la capitulation.
Après cela, les fortifications de Maastricht connurent une extension considérable. Le vieille enceinte de la ville fut maintenue mais entourée d'une chaîne â ouvrages "modernes" du type "ancien-hollandais" comprenant un ravelin, quatre bastions revêtus, quatre derni-lunes et six grands ouvrages à cornes, plus un certain nombre de redoutes carrées. Comme dans beaucoup d'autres villes des Pays-Bas méridionaux (Bruxelles, Louvain, Tournai, etc.) ces ouvrages étaient placés dans ou devant le fossé du rempart et n'étaient pas reliés par une courtine.
A la suite des traités de 'Westphalie (1648), les fortifications de Maastricht, comme celles des autres places fortes des Provinces-Unies, furent laissées à l'abandon jusqu'à ce que la guerre avec la France (guerre de Hollande, 1672 -1673) amène une hâtive remise en état.
Le siège de 1673 par l'armée de Louis XIV, forte de 40.000 hommes, au cours duquel Vauban fut chargé de la conduite des travaux d'approche, ne dura qu'une bonne quinzaine de jours. Il est généralement admis que c'est au cours de ce siège que Vauban mit en oeuvre pour la première fois sa méthode d'attaque enveloppante devenue classique par la suite.
Plan des attaques de Maastricht (1673) conduites par Vauban contre la Portes de Tongres. La "demi-lune des Mousquetaires" se trouve à droite de la "Batterie avancée de 12 pouces".
Durant l'occupation française de 1673 à 1678, les fortifications de Maastricht furent améliorées suivant des plans essentiellement dus à Vauban.
Il s'agit d'une série de lunettes (ou bastions détachés) situés de 200 à 300 m du rempart, d'une amélioration des inondations, de la conduite souterraine amenant les eaux du Geer dans le fossé des fronts nord et de l'extension des ouvrages souterrains. Une tentative de Guillaume III d'Orange pour reprendre la ville (juillet-août 1676) échoua devant ces nouvelles fortifications.
Que celles-ci ne satisfaisaient pas encore leur auteur, ressort de la correspondance entre Louvois et Vauban. Ce dernier attribuait ces défauts au fait que les ouvrages édifiés lors des entreprises de construction successives l'avaient été sans plan général, d'où il devait résulter un ensemble confus et incohérent. Vauban établira pour Louis XIV, lequel espérait conserver Maastricht lors de la paix à venir, un plan de rénovation générale de la place forte. Cette rénovation fut à peine entamée et, lorsque Maastricht, rendue aux Provinces-Unies en 1678, devint une base importante dans les deux longues guerres de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697) et de la succession d'Espagne (1702-1713), de nombreux nouveaux ouvrages (entre autres les bastions Waldeck, Saxe et Holstein et le Fort Saint-Pierre dont il sera question plus loin), vinrent s'ajouter à ce système déjà fort compliqué; toutefois, la place ne fut pas assiégée.
En transférant le long de notre frontière méridionale la barrière de forteresses des Provinces-Unies, le traité d'Utrecht (1714) créa un tel sentiment de sécurité dans la République, qu'une fois de plus, il parut superflu d'entretenir les forteresses de l'intérieur du pays. La chute rapide des forteresses de la Barrière au cours de la guerre de Succession d'Autriche (1741-1748) nécessita la remise en état précipitée de Maastricht qui, assiégée, opposa une résistance honorable et n'ouvrit ses portes aux Français qu'après les préliminaires de la Paix d'Aix-la-Chapelle (mai 1745). La brève période d'occupation qui suivit fut mise à profit par des ingénieurs français pour faire les levés nécessaires au plan-relief de Maastricht qui fait partie de la collection de l'Hôtel des Invalides à Paris. Une bonne copie de ce précieux document se trouve au "Bonnefanten Museum" à Maastricht. Elle donne une image saisissante de l'étendue des ouvrages fortifiés au milieu du XVIIIe siècle.
Le piètre comportement des forteresses de la Barrière, qui furent d'ailleurs en grande partie rasées avant leur évacuation par les Français en 1748, incita les Provinces-Unies à consacrer plus d'attention à l'avant-poste stratégique que constituait Maastricht. On redécouvrit les défauts constatés par Vauban 75 ans plus tôt, résultat de l'accumulation d'ouvrages sans plan d'ensemble: la protection insuffisante du rempart principal (du XIVe s.), le flanquement défectueux des ouvrages extérieurs trop écartés les uns des autres et ne disposant pas de communications abritées.
Un premier projet de modernisation générale établi en 1751 par le colonel ingénieur P. de la Rive fut approuvé à La Haye, mais ne put être exécuté, les moyens financiers disponibles devant être affectés en priorité à Namur, forteresse de la Barrière. Lorsqu'enfin quelques fonds purent être appropriés, ils servirent à des améliorations fragmentaires, e.a. à l'inondation du Geer et aux ouvrages qui la contrôlaient, aux bastions devant les portes de Tongres et de Bruxelles qui furent agrandis et pourvus de couvre faces, et enfin à quelques petits ouvrages des fronts nord.
Tous ces ouvrages furent exécutés dans le style bastionné classique repris à Vauban et aux ingénieurs de son école, mais le tout demeurait un assemblage incohérent d'ouvrages de nature différente qui contrastait avec la régularité des forteresses de Vauban le long de la frontière du nord de la France.
Le successeur de P. de la Rive, le colonel ingénieur Carel Diederich Du Moulin, qui ne resta en fonction que de 1772 à 1774 pour devenir ensuite Directeur général des fortifications nationales, produisit une oeuvre qui serait à la fois plus originale et plus durable. Lui aussi commença par établir un plan d'ensemble assez ambitieux pour "établir une fois pour toutes cette forteresse comme une formidable place frontière pour l'Etat", critiquant la situation existante, l'absence de plan d'ensemble, le nombre excessif d'ouvrages extérieurs généralement non revêtus et mal couverts par des fossés sec peu profonds. Il se risqua même à attribuer ce triste état à l'esprit d'économie mal compris du pouvoir central, d'où il résultait que les dépenses faites par bribes et morceaux depuis le début du XVIIIe s. pour améliorer les fortifications auraient largement suffit pour mettre la forteresse en "un état de défense formidable" s'ils avaient été affectés à une seule campagne de travaux.
Son grand projet de 1775, auquel un commencement avait été donné dès 1773, englobait tous les "Hoge Fronten" à partir du bastion Holstein. A côté de cela, il fallait rénover complètement les fronts nord (fronts de Bois-le-Duc) et construire un grand fort en forme d'ouvrage à cornes sur le Caberg. La rénovation des fronts nord et le fort de Caberg ne verraient le jour qu'après 1815 et alors, sous une forme tout à fait différente.
On peut toutefois admettre que la place forte se trouvait vers la fin du XVIIIe s., sinon dans un état de défense idéal, du moins dans un état respectable, lorsqu'une armée républicaine française, commandée par le général Miranda vint l'encercler en 1793. Dégagée par une contre-offensive autrichienne après huit jours de bombardement, elle fut de nouveau assiégée en octobre 1794, cette fois défendue par une garnison autrichienne. Lors des deux sièges, l'assaillant ne se préoccupa guère d'employer les méthodes d'attaque classiques, comptant sur la terreur provoquée par les bombardements pour amener la reddition, ce qui se fit le 4 novembre 1794 après la destruction de 2.000 bâtiments.
Pendant cette nouvelle occupation française, Maastricht servit de point d'appui et de dépôt pour une éventuelle ligne de défense le long du Rhin. Les ingénieurs français se montrèrent assez critiques pour les "systèmes particuliers des anciens ingénieurs hollandais" et le tracé "exécuté dans le goût du sistème (sic) de Coehorn". Toutefois, ils n'exécutèrent aucun de leurs projets, sauf une lunette devant les fronts du nord.
Tout changerait après 1814 et la chute de Napoléon. Maastricht vint à occuper une position-clé dans la Barrière de Wellington, à l'extrémité gauche de la deuxième ligne de places qui, partant d'Ostende, passait par Gand, Termonde, Anvers et une place en Campine qui ne fut jamais créée et aboutissait à Maastricht. En même temps, elle constituait un chaînon dans la ligne des forteresses qui dominaient la Meuse. Dinant, Namur, Huy, Liège, Maastricht, Venlo. Puisque cette fois-ci on ne manquerait pas de moyens - la France devait payer l'essentiel et les Alliés apporteraient leur contribution - on élabora des projets ambitieux. Pour accélérer les travaux, on se servit, suivant les directives de Wellington, de projets établis sous l'occupation française pour les travaux nouveaux, comportant pour l'essentiel:
1) la construction du Fort "Koning Willem Ier" sur le Caberg,
2) l'amélioration du Fort Saint-Pierre,
3) la restauration des maçonneries des ouvrages existants,
4) la remise en état des ouvrages souterrains,
5) la construction de fronts du nord (Lossche Fronten) entièrement nouveaux.
Ces derniers comporteraient quatre grands bastions avec une courtine revêtue continue, trois ravelins et un chemin couvert avec glacis et réduits dans les places d'armes rentrantes, le tout suivant le "tracé moderne" de Cormontaigne, soit le système Vauban "amélioré" auquel les ingénieurs français - et les ingénieurs hollandais formés au service de la France - restaient fidèles, tandis qu'ailleurs (Allemagne, Autriche), des systèmes plus modernes: tenailles, perpendiculaires ou polygonaux, étaient mis en pratique. Cette campagne de construction qui se poursuivit jusque dans les années 1320, fut le dernier grand effort de modernisation de la place forte et il est paradoxal qu'elle se fit suivant des méthodes largement dépassées.
Maastricht sera encore mis en état de défense lors de la révolution belge et le blocus qui s'ensuivit de 1830 à 1839, au cours duquel l'énergique général Dibbets parvint à conserver la place, complètement isolée, au pouvoir des Hollandais.
Tout comme les forteresses du système de 1815 situées en Belgique, et qui avaient été construites suivant les mêmes méthodes surannées, la place forte de Maastricht cessa de jouer ce rôle vers le milieu du XIXe siècle. Son démantèlement fut décidé en 1867, soit à la même époque que celui des places de la frontière sud de la Belgique, au moment où les Pays-Bas, tout comme la Belgique, optèrent pour le système du réduit national par l'érection, d'une part, de la "Vesting Holland", d'autre part, de la place forte d'Anvers.
les enceintes moyenageuses
Maastricht a conservé de sa première enceinte du XIIIe s., divers fragments partiellement incorporés dans des constructions ultérieures et partiellement encore bien visibles, e.a. le long du "Lang Gracht" et le long du ou "Onze-Lieve-Vrouwal" (rempart Notre-Dame). Ce dernier tronçon qui fit partie du mur longeant la Meuse, demeura en service comme partie de l'enceinte jusqu'à la suppression de la place forte en 1870 et fut à ce titre régulièrement entretenu et réparé, la dernière restauration ayant lieu en 1977. Egalement de cette première enceinte subsistent la porte dénommée "Hellepoort" (perte d'enfer) et le "Jekertoren" (tour du Geer). La plupart des fragments conservés sont exécutés en appareil irrégulier de grès carbonifère, les portes et les tours étaient d'une exécution plus soignée. Certaines de ces parties présentent des réparations ultérieures; ainsi les murs près de la "Hellepoort" sont visiblement une reconstruction récente.
La deuxième enceinte du XIVe s. est présente par la tour dite "achter de Feilzusters" (derrière les Soeurs Voilées) ou "Pater Vincktoren" (tour du Père Vinck), et par un tronçon de 500 à 600 m depuis la porte Saint-Pierre (disparue) jusqu'à la porte de Tongres (également disparue). Seule la première tour a conservé son aspect moyenâgeux, surtout grâce à la restauration du XXe siècle. Les autres parts ont gardé l'aspect résultant de la "modernisation" intervenue à partir de 1542 pour répondre à l'emploi de l'artillerie. A cet effet, on a élevé contre la face intérieure du mur un rempart de terre destiné à accroître sa résistance et à créer un chemin de ronde plus large, permettant l'installation de bouches à feu. Ce rempart est encore présent sur sa plus grande longueur. Là où il a été enlevé, la structure intérieure du mur est rendue visible.
Le mur portait à l'origine des créneaux qui furent remplacés par un gros parapet de briques. La hauteur du mur varie entre 6 et 7 mètres. Depuis l'angle sud-ouest du mur, près de la Porte de Tongres jusqu'à la Meuse en aval, le mur s'élevait sur un talus par endroits d'une hauteur considérable, talus qui doit avoir été la première forme de l'enceinte. Les tours qui se trouvent dans le mur ont également été modifiées au XVIe siècle. Les toits pointus ont disparu et les tours ont été arasées jusqu'au niveau du mur. L'intérieur en a été comblé au moyen de terre et de débris, de manière à permettre l'installation de bouches à feu au sommet.
La différence des matériaux de construction des murs indique les périodes de construction successives. Les parties les plus anciennes sont exécutées en appareil irrégulier de grès carbonifère mélangé à du calcaire, les parties les plus récentes, en pierre marneuse et en pierre de taille dite de Namur. A certains endroits, des réparations ont été effectuées en briques, celles-ci étant utilisées également pour les parapets. La porte d'eau "de Reek" qui laisse entrer le Geer dans la ville est une construction assez remarquable avec ses deux tours et les batardeaux qui séparent les eaux du Geer de celles des fossés.
Les fortifications de Nieuwstad (ville neuve) constituent une partie distincte de l'enceinte. Elles couvrent une petite partie de la "Franchise de Saint-Pierre" appartenant à la Principauté de Liège et annexée à la ville au XVe siècle. Ce territoire situé devant l'angle sud-est de la deuxième enceinte, reçut une protection distincte qui se rattachait au nord à la première enceinte près de la tour du Geer (Jekertoren) et à l'ouest, à la deuxième enceinte près de la porte Saint-Pierre. Les fragments conservés sont représentatifs d'une architecture militaire influencée par l'emploi de l'artillerie mais datant d'avant l'introduction généralisée du système bastionné; ils témoignent des recherches en cours à cette époque. La solution adoptée en l'occurrence paraît assez conventionnelle: un mur massif en pierre de taille adossé à un large rempart de terre (la passerelle au-dessus de la rue est moderne!) et des "rondelen" (boulevards ou tours à canon), bas et massifs, contenant des casemates avec embrasures flanquantes. Le cordon en forme de frise et les inscriptions de la tour occidentale dénommée "Haat en Nijd" (haine et envie), qui a conservé son parapet d'origine, lui donnent encore un aspect moyenâgeux.
Le mur de la seconde enceinte prend un aspect tout différent à son extrémité occidentale. Ce n'est certainement plus le mur original du XIVe s.; le fruit (*) de ce mur et l'appareil: pierre de taille à la base, chaînage de pierres marneuses et de briques, renvoient à une date plus récente (fin du XVIe s.?).
(*) Fruit: obliquité donnée, du dehors en dedans, au parement extérieur d'une construction. (Petit Larousse illustré)
L'angle aigu formé par les faces sud et ouest du mur a déjà l'aspect d'un saillant de bastion. Cet angle portait le cavalier (**) dit "de Tongres" dont subsiste la poudrière.
(**) Cavalier: ouvrage surélevé installé sur un fort pour accroître ses vues et son champ de tir. (Petit Larousse illustré)
Nous nous trouvons ici à un des points les plus vulnérables de l'enceinte d'où il était possible de prendre la porte de Tongres en écharpe. Il fut le théâtre des opérations principales des sièges de 1579 en de 1673 ainsi qu'en témoigne la brèche, réparée en pierre marneuse, qui date de ce dernier siège.
Il subsiste à cet endroit quelques fragments des ouvrages extérieurs dont une partie de la face gauche du bastion "`Wilhelmina" de 1768 situé le long du Geer et quelques fragments de la lunette "Dreuthe" de 1776 située au nord du bastion Waldeck.
Le bastion Waldeck
Ce bastion fut établi en couverture avancée d'un ravelin plus ancien devant la porte de Tongres. II remplaça une lunette de 1673 qui fut au centre des combats lors du siège de cette année. A cette occasion, les Français y enga gèrent le corps de Mousquetaires qui subit de lourdes pertes, parmi lesquelles le célèbre d'Artagnan. C'est pourquoi les Français le rebaptisèrent "demi-lune des mousquetaires".
Le nouveau bastion de 1690 - qui reçut le nom du comte de Waldeck, à cette époque gouverneur militaire de Maastricht - possède toutes les caractéristiques du style dit de Vauban, des faces de 45 m à revêtement de briques et montants en pierre marneuse formant un saillant de +/- 90 degrés et des flancs légèrement rentrants de 22 m.
A l'origine, la gorge était fermée par un mur crénelé comme il était d'usage pour un ouvrage détaché; il s'agissait en effet d'une lunette plutôt que d'un bastion, puisqu'à l'époque, il était situé bien en avant de la ligne de défense principale et n'était pas flanqué par d'autres ouvrages. Ce bastion subit d'importantes modifications en 1775 lorsque Du Moulin voulut transformer les "Hoge Fronten" en un ensemble cohérent. Le mur crénelé de la gorge fut démoli et, à chaque flanc, on ajouta des remparts en terre, aujourd'hui disparus, respectivement longs de 60 et 70 m et parallèles aux faces du bastion.
En face du saillant, on établit dans la contrescarpe une galerie crénelée, dénommée "caponière à revers", destinée au flanquement des faces. Cet organe de flanquement - que nous retrouverons dans les lignes de Du Moulin - est le précurseur des coffres de contrescarpe qui joueront un rôle important dans la fortification des XIXe et XXe siècles.
La galerie de contrescarpe est reliée au système de galeries de mines et de communication qui se trouve sous le bastion et qui se prolonge sous les autres ouvrages, existants ou disparus, dés "Hoge Fronten". Cet énorme complexe de galeries maçonnées fut épargné lors du démantèlement de la ville et fut aménagé en abris au cours de la deuxième guerre mondiale. Bien restauré dans les années 1967-1968, le bastion Waldeck offre l'exemple d'une bonne intégration d'un ancien ouvrage fortifié dans un jardin public.
Le Fort St Pierre
Plan des souterrains du fort Saint-Pierre avant les transformations en 1815
Ce fort n'est en fait qu'une grande lunette. La valeur militaire de la Montagne Saint-Pierre était connue depuis le XVIe s. et l'armée du duc d'Albe s'y retrancha pour interdire Maastricht et son pont à Guillaume d'Orange lors de l'incursion manquée de 1568. Vauban, de son côté, semble avoir reconnu, en 1673, la nécessité de fortifier les deux hauteurs de la Montagne Saint-Pierre au sud et du Caberg au nord-ouest. C'est finalement en 1701 que fut approuvé le plan d'un ouvrage en forme de bastion établi par l'ingénieur baron von Dopff, lequel avait déjà travaillé aux "Hoge Fronten" en 1690.
Etant essentiellement destiné à empêcher l'ennemi de prendre les fronts méridionaux de la place sous le feu de l'artillerie qu'il placerait à cet endroit, le fort fut établi à l'extrémité nord de la Montagne Saint-Pierre. Il en résultait que le fort était dominé par le terrain plus élevé vers le sud, ce qui en diminuait considérablement la valeur, et, par la suite, on s'efforcera de remédier à cet inconvénient par des expédients plus ou moins efficaces.
Complètement isolé, sans possibilité de flanquement de l'extérieur, le fort est conçu pour assurer sa propre sécurité rapprochée. Celle-ci est fournie par une galerie crénelée circulaire qui suit toute l'escarpe. Au saillant, sur les faces et à la gorge, cette galerie est pourvue d'une double rangée de meurtrières dont la rangée supérieure bat le chemin couvert et la rangée inférieure, le fossé. Chaque meurtrière a trois débouchés, celles du saillant en ont cinq. En outre, une galerie crénelée de contrescarpe se trouvait en face du saillant et flanquait également le fossé.
Les flancs, tournés vers l'arrière, étaient pourvus d'embrasures pour canon, indiquant ainsi que la fonction principale du fort était de tenir sous son feu le terrain devant les fronts méridionaux de la place. A l'origine, il y avait huit embrasures au flanc droit, c'est-à-dire en direction de la porte de Tongres qui, comme il a été dit, constituait un point sensible de la place. Le flanc gauche n'avait que quatre embrasures, ce que l'on estimait suffisant pour couvrir les fronts inondables et la Meuse.
A remarquer le système de ventilation de cette galerie : les voûtes de la galerie et des niches pour le recul sont pourvues à distances régulières de trous d'aération et à l'extrémité de chaque galerie à canons, le mur de gorge est pourvu d'une porte d'aération devant assurer une bonne circulation d'air. Il est probable que ces aménagements sont à mettre au crédit des méthodes de construction de Coehoorn. Le maître hollandais était en effet partisan des casemates ou caves à canon et était parvenu à résoudre de manière satisfaisante le problème essentiel de l'évacuation de la fumée, alors que l'école française resta jusqu'au XIXe siècle fidèle à l'artillerie uniquement placée en plein air. Il n'est donc pas étonnant, qu'en 1748, un technicien français s'émerveilla en voyant ces trous qui "sont si heureusement pratiqués qu'on y tire du canon sans se trouver incommodé de la fumée".
Intérieurement, le fort possédait encore des couloirs en forme de croix, un certain nombre de casemates, un puits, et était relié aux galeries des carrières de la Montagne Saint-Pierre. Il était entouré d'une contrescarpe avec chemin couvert tandis que le front de gorge était couvert par une enveloppe et disposait d'une communication enterrée avec le front sud de la place.
Il était néanmoins admis par la plupart des ingénieurs du XVIIIe s. que ce fort n'avait qu'une capacité défensive réduite, ce que prouva le siège de 1794: la superstructure d'où devait être effectuée la contrebatterie dut être abandonnée très rapidement.
Les plans établis par les Français entre 1794 et 1814 ne connurent même pas un commencement d'exécution, mais ils donnèrent des idées aux ingénieurs hollandais qui en entreprirent la modernisation en 1815. Les embrasures pour canon furent ramenées à quatre dans chaque flanc. Le chemin couvert et la galerie de contrescarpe au saillant disparurent mais quatre nouvelles galeries de contrescarpe furent établies en face des angles d'épaule et de gorge; les deux dernières étant également pourvues de meurtrières du côté de la ville. L'escarpe, haute à l'origine de 8,40 m, fut rehaussée de 3 m afin de porter la crête du parapet sensiblement au niveau du sommet de la Montagne Saint-Pierre. On créa sur la superstructure du fort une batterie couverte pour canons et mortiers. La batterie â mortiers se trouvait dans une casemate enterrée à la pointe du saillant. II est à regretter que la démolition de l'avant de cette casemate ne permette plus de se faire une idée précise de cet ouvrage assez rare. La batterie à canons était en deux parties: une aile courbe face à l'est (donc vers la Meuse), comportait 7 casemates, une aile droite face au sud (vers le sommet de la montagne) en avait 5. Toutes ces casemates, à deux prés, étaient ouvertes à l'arrière de sorte qu'il n'y avait pas de problème de ventilation.
Les lignes de Du Moulin
Il a déjà été question du grand projet de 1775 du colonel ingénieur C. D. Du Moulin destiné à transformer les "Hoge Fronten" avec leurs multiples ouvrages d'époques différentes en un ensemble cohérent. Pour la partie située entre le bastion Waldeck et la porte de Bruxelles maintenant complètement disparue, il fut surtout fait usage des ouvrages existants qui furent peu ou prou adaptés et complétés. Par contre, le tronçon entre la porte de Bruxelles et le bastion Holstein, qui a été en grande partie sauvé, est plus original de conception et peut être considéré comme unique de son espèce.
Ce qu'il est convenu d'appeler "les lignes de Du Moulin" consiste actuellement, partant du côté de la campagne, en un glacis, un chemin couvert avec trois places d'armes appelées lunettes et une contrescarpe revêtue. Il y a ensuite le fossé sec dans lequel se trouve un couvre-face, puis l'enveloppe composée de trais ouvrages reliés entre eux et que l'on a appelé bastions. Derrière cette enveloppe subsiste une partie d'un second fossé sec au-delà duquel quatre bastions détachés (dont un seul, le bastion "Saxe", subsiste) et une tenaille couvraient le vieux rempart de la ville.
Le plan des ouvrages encore existants indique clairement que Du Moulin a été forme à l'école de Coehoorn. En comparant les bastions et le ravelin, on remarquera en effet, les similitudes entre l'oeuvre de du Moulin et la "deuxième manière" de Coehoorn telle qu'il l'a exposée dans son ouvrage "Nieuwe Vestingbouw" de 1683 et qu'il a entre autres appliquée aux fronts nord de la forteresse- (disparue) de Bergen-op-Zoom.
La caractéristique principale de l'enveloppe se trouve dans le fait qu'à chacun des "soi-disant bastions" dont elle est composée, les faces et les flancs sont de chaque côté situés dans le prolongement l'un de l'autre mais que le flanc présente une courbure rentrante. Cette courbure peut répondre à deux fonctions: briser la longue ligne de la face prolongée afin de la soustraire à l'enfilade et concentrer en un point le feu des armes placées sur la courbure. Hormis cette courbure, on se trouve devant un tracé tenaillé tel que Coehoorn l'a appliqué entre autres dans la "Hoge Linie" près de Doesburg et qui connaîtra de multiples applications, en Prusse et en Rhénanie (entre autres à Mayence) au début du XIXe siècle. Les lunettes à flancs retirés et le couvre-face devant un des "bastions" correspondent également aux idées de Coehoorn.
Méritent en autre notre attention:
- les galeries crénelées de contrescarpe ou caponnières à revers qui flanquent chacun des saillants de l'enveloppe ou du couvre-face, comme cela a déjà été vu au bastion Waldeck. Toutes ces galeries sont connectées entre elles, ainsi qu'avec les ouvrages de l'enveloppe, par des souterrains et se trouvent au départ d'un système de contre-mines très développé. Une galerie similaire existe au front de gorge du bastion Holstein qui flanquait le saillant de l'ouvrage "van Welderen" démoli en 1818.
- les quatre passages du fossé sec arrière vers le fossé sec avancé à travers l'enveloppe. Trois de ces passages dénommés "Royales Sorties" sont suffisamment larges pour permettre le passage de la cavalerie et de l'artillerie afin d'exécuter des contre-attaques dans les fossés. Chaque passage est pourvu de dispositifs de sécurité très élaborés.
- le plan général de ces lignes est d'une irrégularité assez surprenante : abstraction faite des lunettes et du chemin couvert, aucun ouvrage n'est pareil à un autre, ce qui contraste avec la régularité des enceintes bastionnées classiques. La raison première et sans doute principale en est le fait que des ouvrages plus anciens comme les bastions "Hostein" et "Saxe" durent être incorporés moyennant certaines adaptations, notamment aux flancs. Les différences de niveau, le terrain s'élevant sensiblement d'est en ouest, aura également influencé le tracé, et on peut enfin se demander s'il n'y avait pas aussi l'intention de compliquer la tâche de l'assaillant dans la détermination de sa direction d'attaque.
Quoi qu'il en soit, les ingénieurs français de formation classique n'eurent aucune indulgence pour les lignes de Du Moulin. L'un d'entre eux les décrivit en 1794 comme "des ouvrages défendus par des revêtement presque tous neuves (sic); il est malheureux que leur tracé, exécuté dans le goût du sistème (sic) de Coehoorn, présente beaucoup de parties mortes, d'autant plus susceptibles d'escalades que les escarpes sont basses".
En dépit de ce jugement fort sévère, on peut dire qu'il s'agit d'un morceau d'architecture militaire assez exceptionnel, marquant une étape dans le développement de l'art de la fortification, non seulement à cause de l'originalité du plan, mais surtout parce que l'on y retrouve nombre d'éléments de la méthode de Coehoorn dont il ne subsiste pratiquement plus d'oeuvres originales.
Conscientes de la valeur de ce monument culturel, les autorités de Maastricht ont fait reprofiler les terrassements en 1946-1952 et ont entrepris en 1977 la restauration totale des maçonneries, entreprise qui, malheureusement, a dû être suspendue en 1981 par manque de crédits.
Liens
http://youtu.be/HD8Wj21OcJs les fortifications de Vauban
http://youtu.be/hRTCOawLq1I Vauban le vagabond de Louis XIV
             
Posté le : 29/06/2013 21:13
|
|
|
|
|
Insurrection du 23 Juin 1848 à Paris |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
23 juin 1848 : Insurrection ouvrière à Paris
Le 23 juin 1848 éclatent à Paris de violentes émeutes de la faim provoquées par la fermeture des Ateliers nationaux.
Ces ateliers de bienfaisance avaient été créés quelques mois plus tôt par le gouvernement provisoire de la IIe République. Ils avaient pour vocation de procurer aux chômeurs un petit revenu en échange d'un travail symbolique.
Dans la foulée, le gouvernement provisoire avait même publié un décret réduisant d'une heure la durée de la journée de travail pour tous les salariés parce que, selon ses termes, «un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la santé mais en l'empêchant de cultiver son intelligence porte atteinte à la dignité de l'homme».
C'est ainsi que la journée de travail était tombée à... dix heures à Paris et à onze en province (serait-ce que le travail est plus éprouvant à Paris qu'ailleurs ?).
La République trahit les ouvriers.
Une Assemblée constituante est élue le 13 avril dans la précipitation pour mettre en place les institutions de la IIe République.
Le suffrage universel amène à l'Assemblée une forte majorité de notables provinciaux, très conservateurs et méfiants à l'égard du peuple ouvrier de Paris.
Dans l'attente d'une Constitution, c'est une Commission exécutive issue de l'Assemblée qui dirige le pays.
Elle décide le 20 juin de supprimer les Ateliers nationaux avec l'espoir d'étouffer ainsi l'agitation ouvrière. C'est le contraire qui se passe. Sur 120.000 ouvriers licenciés par les Ateliers nationaux, 20.000 descendent dans la rue le 23 juin 1848.
Ils forment jusqu'à 400 barricades. La Commission exécutive charge le général Louis-Eugène Cavaignac de la répression. Celle-ci est terrible, à la mesure de l'effroi qu'éprouvent les bourgeois de l'Assemblée. Le 25 juin 1848, les insurgés résistent encore à l'Est de la capitale, entre Bastille et Nation.
Monseigneur Denis Affre, archevêque de Paris (55 ans), s'interpose entre les insurgés et la troupe, sur une grosse barricade, à l'angle des rues de Charenton et du faubourg Saint-Antoine.
Un crucifix à la main, cet homme d'un naturel timide appelle les frères ennemis à la réconciliation. Les coups de feu s'interrompent. Mais un roulement de tambour réveille les pulsions de mort.
Les coups de feu reprennent. L'archevêque s'écroule. Il murmure avant de mourir : «Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis».Le lendemain, le général Lamoricière prend d'assaut cette barricade ainsi que toutes celles qui suivent (autotal 65 entre Bastille et Nation !). C'est la fin de l'insurrection.
Au total, du 23 au 26 juin, en trois jours de combats dans l'ensemble de la capitale, on relève 4.000 morts parmi les insurgés et 1.600 parmi les forces de l'ordre.
Le gouvernement républicain arrête 15.000 personnes et en déporte des milliers sans jugement. Les journées de Juin 1848 coupent la IIe République de sa base populaire. Signe des temps, le 9 septembre 1848, le décret du 2 mars sur la journée de dix heures est abrogé.
Aux élections présidentielles de décembre 1848, l'absence d'une opposition républicaine de gauche et le discrédit dans lequel sont tombés les républicains permettent au
prince Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'Empereur, de se faire élire président de la République sans trop de mal, en promettant la paix et des réformes sociales.
Silence forcé. - Désolation.
Nous ne voulons pas irriter les passions, et par conséquent il nous est impossible de dire toute la vérité.
Nous avons d'ailleurs l'âme trop désolée, trop oppressée par la douleur pour que nous puissions nous expliquer librement aujourd'hui.
De quelque côté que soient les torts, les excès, les souffrances, nous en sommes navré.
Folie ou crime, c'est toujours un malheur que nous déplorons pour la Patrie et pour l'Humanité.
Et loin de vouloir envenimer le mal, nous voudrions pouvoir, même au prix de notre vie, trouver le moyen d'y remédier.
Horrible situation.
C'est la misère pesant sur toutes les classes, sur le fabricant et le négociant comme sur l'ouvrier, qui a déterminé la Révolution de février.
Après la victoire, le Peuple s'est montré généreux et humain.
Il ne demandait que la justice et l'ordre, ses droits en respectant ceux des autres, d'abord du travail et du pain, puis des améliorations successives en conciliant tous les intérêts, puis le bien-être en travaillant, sans oppression, ni spoliation, ni exploitation pour personne.
Qu'il était facile alors de consolider la République en la faisant aimer !
Mais l'inexpérience, l'incapacité, la faiblesse, l'hésitation, le défaut de cœur et d'amour dans de téméraires et ambitieux gouvernans ont tout perdu ou tout compromis.
Et voici les partis reformés, les passions allumées, la confusion et le chaos, la discorde et la guerre !
Nous voici lancés dans toutes les horreurs de la guerre civile par une insurrection née de la faim et du désespoir !
Peut-être 250,000 soldats contre 20,000 ouvriers ! D'effroyables fusillades et d'effroyables canonnades, comme dans une grande bataille !...
Même un bombardement !
Et ce sont des Français contre des Français, des frères contre des frères !...
Et le sang coule à flots des deux côtés !
Quel courage perdu dont la France aurait pu se glorifier !
Et après...? Si les travailleurs sont écrasés par le nombre, ceux qui survivront seront-ils plus contens ! La misère aura-t-elle disparu ? Les vainqueurs seront-ils tranquilles et heureux ?
Quel avenir, si l'étranger veut profiter de nos divisions !
En tuant tant d'hommes de courage, nous nous suicidons !
Hâtons-nous donc de diminuer le mal, au lieu de l'aggraver : c'est évidemment l'intérêt de tous !
Misère générale.
Comment le contester ? La misère est partout ; 100,000 ouvriers peut-être dans Paris ne travaillent plus depuis quatre mois, par conséquent ne gagnent plus rien et n'ont rien ! On ne conçoit vraiment pas comment le plus grand nombre peut vivre ! Ceux qui avaient quelques économies les épuisent ; la Caisse d'épargne a fait banqueroute à beaucoup ; l'avenir est affreux pour tous ! Et les fabricans, les négocians, le petit commerce surtout, ne sont pas plus heureux !
Ateliers nationaux.
Plus de 100,000 ouvriers font partie des ateliers nationaux à Paris ; mais leur salaire, considérable pour le trésor public, est insuffisant pour eux, surtout pour ceux qui ont de la famille ; les travaux qu'on leur a confiés ont été mal choisis, sont généralement inutiles et les dégoûtent par leur inutilité.
Puis on les a insultés, irrités, désespérés, en les traitant de fainéans et de voleurs, en les menaçant de dissolution et de dispersion s'ils refusaient de s'enrôler dans l'armée.
Quelques milliers étaient déjà partis sans trouver le travail qu'on leur avait promis ; beaucoup étaient revenus pour en prévenir leurs camarades ; d'autres milliers étaient désignés pour partir le 24 juin ; des demandes présentées par eux au Gouvernement le 22 n'avaient pas été accueillies.
Et c'est dans cette situation qu'éclate l'insurrection du 23.
Et tout cela c'est la faute du Gouvernement depuis le 24 février, qui a mal organisé les ateliers nationaux, et qui a laissé dilapider les ressources financières de l'État.
Intrigues des Prétendans.
Que les partis d'Henri V, de la Régence, de Napoléon, aidés plus ou moins par l'or étranger, aient cherché à exploiter la misère et le désespoir des travailleurs, c'est ce qui ne peut être douteux pour personne : l'argent trouvé sur plusieurs des insurgés, la présence d'anciens gardes municipaux aux barricades, les cris proférés souvent auparavant, plusieurs drapeaux blancs arborés et saisis, mille autres preuves, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard.
Et si les manœuvres des prétendans et de l'étranger ont pu égarer une partie de ces malheureux ouvriers, c'est encore la faute du Gouvernement provisoire et du Pouvoir qui l'a remplacé.
Insurrection du 23 juin.
Ce n'est pas une émeute, mais une insurrection.
Dès le matin du vendredi 23, l'insurrection commence dans les faubourgs Saint-Jacques et Saint-Marceau, puis s'étend rapidement sur la moitié de Paris, comprenant toute la partie de l'est et du centre, les faubourgs Saint-Antoine, du Temple, Popincourt, Saint-Martin, Saint-Denis, Poissonnière et la Cité.
Elle paraît se diriger sur l'Hôtel-de-Ville et la Préfecture de police, pour marcher ensuite sur le palais Bourbon.
Partout s'élèvent d'innombrables et formidables barricades, et les insurgés s'emparent des maisons voisines pour attaquer et s'y défendre avec acharnement.
Mais, en s'enfermant ainsi, les insurgés ne pourront ni répandre leurs proclamations dans l'autre moitié de Paris, ni avoir aucune communication avec elle, ni en recevoir aucun secours.
On laisse d'abord faire.
Jusqu'à 10 et 11 heures, l'insurrection ne rencontre aucun obstacle pour ses barricades : Pourquoi ? Est-ce ignorance de la part du Pouvoir ? Mais tant de négligence, tant d'incurie, une si grande faute, au milieu d'une situation si agitée, n'est pas possible, et pas croyable, ou serait inexcusable.
On a bien dit que quelques hommes du Pouvoir avaient laissé échapper ces mots : « Il faut en finir avec les Ouvriers ; il faut leur donner une leçon. » Si le fait était vrai, il indiquerait qu'on croyait la chose plus facile et la leçon moins coûteuse ; mais quelle responsabilité envers les vainqueurs comme envers les vaincus !
Ce n'est que vers 10 et 11 heures que la générale ou le rappel se fait entendre partout pour réunir la Garde nationale, qui n'accourt généralement qu'en petit nombre, tandis que, dans plusieurs quartiers, elle reste immobile et que, dans les quartiers insurgés, elle prend plus ou moins part à l'insurrection.
Le Public ne sait rien.
Cette insurrection éclate comme une bombe ; le public, même les hommes qui devraient être avertis et connaître, ne savent rien, ni la résolution, ni la force, ni le plan, ni le but.
Les insurgés font imprimer quelques proclamations dans le faubourg Saint-Antoine ; mais elles restent inconnues, sans d'ailleurs s'expliquer assez.
Ainsi, qui commence l'insurrection, sont-ce des ouvriers isolés ou les Ateliers nationaux en corps ? Combien sont à peu près les insurgés ? Ont-ils des armes, des munitions, du canon ? Que veulent-ils, Henri V, ou Napoléon, ou la Régence, ou la République ? Quelle République ? Quels sont leurs chefs ? Quel est leur Gouvernement désiré ? - On ignore tout.
On fait croire que la République est menacée.
Le gouvernement fait croire à la garde mobile, à l'armée, à la garde nationale, au public, que les insurgés sont des agens d'Henri V, surtout de Napoléon.
Aussi la Garde mobile se précipite au cri de vive la République ! comme si l'insurrection menaçait la République.
Partout les républicains restent incertains, paralysés, immobiles.
Faux bruits.
Mille faux bruits circulent pour rendre les insurgés odieux, pour irriter les Gardes mobiles, les soldats et les Gardes nationaux.
Par exemple, on affirme que les insurgés ont coupé la tête à cinq Gardes mobiles faits prisonniers, qu'ils ont coupé les poignets à d'autres, qu'ils en ont pendu, scié, etc., etc.
Un grand journal réactionnaire affirme même, le 27, que les insurgés avaient inscrit sur leurs drapeaux : Viol et Pillage.
Un autre journal réactionnaire annonce un autre bruit également faux.
Faux bruit sur le citoyen Cabet.
Dans le journal l'Assemblée nationale du 25, répété par le Drapeau national du 26, on lit :
« Minuit. - La Bastille. - Les chefs. De l'église protestante Sainte-Marie, rue Saint-Antoine, à la maison de face qui forme angle de la place de la Bastille, une immense barricade est dressée. Le faubourg Saint-Antoine et la place de la Bastille appartiennent aux ouvriers, leurs chefs sont avec eux, tous les ordres partent de là, - le mot d'ordre et de ralliement est celui-ci : Mourir en combattant ou vivre en travaillant. - Les noms des chefs sont ceux-ci : Hubert, Cabet, Louis Lebon, etc. - Les derniers ont donné les ordres de dresser pendant la nuit le plus de barricades possible, - de faire mettre dans les rangs des gardes nationaux beaucoup d'ouvriers, afin de savoir parfaitement ce qui se passe de leur côté, et à un moment donné, de mettre ainsi la garde nationale entre deux feux. »
On sent combien une pareille assertion est dangereuse pour le citoyen Cabet, contre qui la garde nationale a déjà poussé tant de cris de mort ! Eh bien, c'est une fausseté matérielle, comme, quand on a affirmé qu'il était au Champ-de-Mars le 16 avril et même qu'il était à cheval à la tête d'une armée de factieux, comme quand on a dit ensuite qu'il était à Marseille.
Aussitôt que le citoyen Cabet a connaissance de cet article, il fait écrire à beaucoup de journaux pour le démentir : mais rien ne peut leur arriver pendant plusieurs jours ! On aurait le temps d'être fusillé cent fois avant de pouvoir réclamer ; et plusieurs journaux, notamment le Siècle, refusent de publier la réclamation.
Immenses préparatifs du Pouvoir.
Depuis longtemps, les troupes de toutes armes (infanterie, cavalerie, artillerie, génie militaire, sapeurs, mineurs et pompiers) étaient concentrées à Paris et dans les environs, 100,000 hommes peut-être, en y comprenant 24,000 hommes de la garde mobile, et cette armée jointe à plus de 150,000 gardes nationaux de Paris et à des milliers de gardes nationaux appelés ou accourus d'un grand nombre de villes, était assurément l'une des plus grandes armées mises en mouvement dans les grandes batailles.
Grande bataille.
C'est en effet une grande bataille que celle qui a duré quatre jours, du 23 au 26, et dans laquelle plus de dix généraux ont figuré à la tête d'une aussi grande armée. On a tiré plus de 2,000 coups de canon et plusieurs millions de coups de fusil. Les combats de juillet 1830 et de février 1848 étaient peu de chose comparés au dernier. C'était effroyable ! Et un bombardement pour incendier ou pour écraser le faubourg Saint-Antoine !.... Ah ! le récit détaillé fera frémir d'horreur !
Entre qui la guerre.
Ainsi, la guerre existe entre l'insurrection et l'Assemblée nationale, défendue par la Garde nationale, par la Garde mobile et par l'Armée.
État de siège. - Dictature.
L'Assemblée nationale discutait un projet de décret pour la dissolution, sous trois jours, des Ateliers nationaux, lorsque, le 23, on vient lui annoncer que les barricades ont commencé. Garnier-Pagès, au nom de la Commission exécutive, déclare qu'elle a pris les mesures nécessaires pour en finir avec les agitateurs et qu'elle ne manquera pas de vigueur et d'énergie pour faire rentrer dans l'ordre les Ateliers nationaux et les forcer à l'obéissance.
Lamartine demande qu'on ait confiance dans la Commission, en promettant d'agir vigoureusement et d'aller mêler son sang, s'il le faut, à celui de la Garde nationale pour abattre les barricades.
On demande que l'Assemblée se porte elle-même sur les barricades : mais elle se borne à se déclarer en permanence.
Bientôt, à la séance du soir, on annonce que le général Clément Thomas vient d'être blessé ; mais que Lamartine et Arago viennent d'enlever chacun une barricade à la tête de la Garde nationale et de la troupe.
Arago déclare aux insurgés, qui veulent négocier, qu'on n'entendra rien tant qu'ils n'auront pas déposé les armes.
C'est en vain que Considérant, Caussidière et Beaune proposent une proclamation de l'Assemblée aux insurgés dans l'espoir de faire cesser l'insurrection ; on leur crie qu'ils favorisent l'émeute et qu'on veut au contraire en finir avec les émeutiers.
Garnier-Pagès vient annoncer à 11 heures du soir que les insensés et les factieux vont être réduits et ramenés à l'ordre ; que le faubourg Saint-Antoine donne seul encore de l'inquiétude ; mais qu'il espère que demain on en finira avec les insurgés, qui n'ont d'autre drapeau que l'anarchie et le pillage.
Le 24, à huit heures du matin, le président annonce que la garde nationale de la banlieue arrive en masse ; que toutes les troupes montrent la plus grande énergie, et que dans la journée, et dans deux heures peut-être, l'insurrection sera dominée.
Par un décret, l'Assemblée déclare que la République adopte les enfans et les veuves des gardes nationaux tués dans le combat.
Peu après, à 9 heures 35 minutes, sur la proposition de Pascal Duprat, et malgré la protestation de plus de 60 représentans, l'Assemblée déclare Paris en état de siège, et concentre tous les pouvoirs exécutifs entre les mains du général Cavaignac, en se maintenant elle-même en permanence.
La Commission exécutive se trouve ainsi tacitement supprimée ou destituée, sans qu'on lui fasse l'honneur de parler d'elle : Quelle fin !
Soixante représentans sont désignés pour porter ce décret aux mairies et aux principaux postes de la garde nationale.
Cependant l'état de siège s'exécute : dans tous les quartiers non-occupés par l'insurrection, la Garde nationale, toujours de plus en plus nombreuse, fait fermer les portes et les croisées, empêche toute circulation et toute communication. Paris n'est plus pour ses habitans qu'une vaste prison, tandis que ses rues, etc., ne sont plus qu'un vaste corps-de-garde ou qu'une vaste citadelle.
Bientôt onze journaux sont suspendus par le motif, dit une note officielle communiquée à tous les journaux, que leur rédaction était de nature à prolonger la lutte. Ces onze journaux sont : la Presse, - l'Assemblée nationale, - la Liberté, - la Vraie République, - l'Organisation du travail, - le Napoléon républicain, - le Journal de la Canaille, - le Lampion, - le Père Duchêne, - le Pilori, - la Révolution de 1848.
Courage.
Il paraît que tout le monde, soldats, Garde mobile, Garde Républicaine, Garde nationale de Paris, de la Banlieue et des villes voisines, montrent, comme les Ouvriers, un admirable courage, au-dessus de toute expression, les uns pour attaquer de formidables barricades défendues par un feu meurtrier dirigé depuis les croisées des maisons adjacentes, les autres pour les défendre contre le canon, contre d'effroyables fusillades et contre des attaques répétées presque sans interruption par des forces bien supérieures.
Quelle gloire et quel bonheur pour la France si ce courage était employé pour la Patrie et pour l'Humanité contre les agressions du despotisme étranger !
Quel affreux malheur qu'il s'épuise dans la guerre civile !
Pertes.
On se bat, des deux côtés, avec tout l'acharnement, avec toute la fureur que peut enfanter la guerre civile : c'est affreux, c'est horrible !
Des deux côtés aussi, les pertes sont immenses : vingt mille hommes peut-être périssent ou sont estropiés ; mais les vainqueurs ont encore plus souffert que les vaincus. Dans la Garde mobile surtout, des compagnies entières, des bataillons presqu'entiers ont disparu sous le feu des barricades.
Beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers, beaucoup des principaux citoyens de Paris, chefs ou soldats dans la Garde nationale, ont été tués ou blessés.
Plusieurs Représentans ont été blessés. L'un d'eux a été tué.
L'Archevêque est mort d'une blessure reçue, on ne sait encore d'où, au moment où il s'avançait entre les combattans pour faire cesser le combat.
On ne voit que des corbillards.
Et dans les faubourgs, que de ruines par le canon ! Que de désastres !
Que de deuil dans la ville, que de misères partout !
C'est affreux ! c'est horrible !
Cessation du combat.
Partout le combat cesse faute de munitions, de direction et de chefs.
Les faubourgs Saint-Jacques et Saint-Marceau capitulent le 24, les autres quartiers le 25, le faubourg Saint-Antoine le 26, pour éviter la destruction dont il est menacé.
Prisonniers.
On parle de 6 à 7,000, sans compter ceux qui périssent à l'instant même.
On les amène dans l'intérieur par bandes de 100, de 200, etc., presque tous les mains attachées derrière le dos.
Ce sont des ouvriers dont le vêtement annonce la misère, quelques jeunes gens, quelques gardes mobiles, quelques Gardes nationaux…
Que de bruits sur eux ! Que de cris contre eux !
On conçoit l'irritation après tant de pertes ; mais qu'elle est horrible, cette guerre civile, qui déchaîne et allume toutes les passions !
Revenons sur nos pas, et voyons les actes de l'Assemblée nationale et du général Cavaignac :
Dès le 23 juin au soir, le Représentant V. Considérant rédige le projet de proclamation suivante :
Projet de Proclamation présenté par V. Considérant.
L'Assemblée nationale aux Ouvriers de Paris.
« Ouvriers nos frères !
Une affreuse collision vient d'ensanglanter les rues de la Capitale.
Une partie d'entre vous ont contraint le Gouvernement, pour sauver la République, de tourner contre eux des armes françaises...
Des Républicains, des frères ont versé le sang de leurs frères !
Au nom de la Patrie, au nom de la Révolution qui doit vous émanciper, au nom de l'Humanité dont nous voulons tous assurer et organiser les droits sacrés, jetez, jetez ces armes fratricides.
Est-ce pour nous entre-déchirer que nous avons conquis la République ? que nous avons proclamé la loi démocratique du Christ, la sainte Fraternité ?
Frères, écoutez-nous, écoutez la voix des représentans de la France entière : Vous êtes victimes d'un malentendu fatal !
Pourquoi vous êtes-vous soulevés ? Les souffrances que nous ont léguées dix-huit mois de crise industrielle et dix-sept années de corruption monarchique, n'atteignent-t-elles pas toutes les classes ?
Écoutez-nous : Ici, ce sont des chefs d'industrie qui accusent les ouvriers et les ateliers nationaux de la ruine des affaires ; là, des ouvriers accusent les chefs d'industrie de leur détresse.
Cette accusation réciproque n'est-elle pas une erreur funeste ? Pourquoi accuser les hommes et les classes ? pourquoi nous accuser, les uns les autres, de souffrances engendrées par la fatalité des choses ; de souffrances, héritage d'un passé que tous nous voulons transformer ?
Est-ce en nous massacrant que nous nous enrichirons ? Est-ce en nous égorgeant que nous fonderons l'Ère de la Fraternité ? Depuis quand la haine et la guerre civile sont-elles productives et fécondes ? Où sera le travail si l'émeute agite incessamment Paris ? Où sera le pain pour tous, si toutes les industries sont arrêtées par la terreur sanglante de la rue ?
Ouvriers nos frères ! nous vous le répétons, vous êtes victimes d'un malentendu fatal...
Ouvriers, on vous trompe ! on vous inspire contre nous le doute, la défiance et la haine ! On vous dit que nous n'avons pas au cœur le saint amour du Peuple ; que nous n'avons pas de sollicitude pour votre sort ; que nous voulons étouffer les développemens légitimes du principe social de la Révolution de Février : on vous trompe, frères, on vous trompe !
Sachez-le, sachez-le bien : Dans son âme et dans sa conscience, devant Dieu et devant l'Humanité, l'Assemblée nationale vous le déclare : elle veut travailler sans relâche à la constitution définitive de la Fraternité sociale.
L'Assemblée nationale veut consacrer et développer par tous les moyens, possibles et pratiques, le droit légitime du peuple, le droit qu'a tout homme venant au monde, de vivre en travaillant.
L'Assemblée nationale veut consacrer et développer, par des subventions et des encouragemens de toutes sortes, ce grand principe de l'Association, destiné à unir librement tous les intérêts, tous les droits.
L'Assemblée nationale veut, comme vous, tout ce qui peut améliorer le sort du Peuple dont elle émane ; relever la dignité du travailleur ; rapprocher fraternellement tous les membres du grand corps national.
Frères, frères ! laissez à vos représentans le temps d'étudier les problèmes, de vaincre les obstacles, de reconstruire démocratiquement tout un ordre politique et social renversé en trois jours par une victoire héroïque : et cessez, oh ! cessez de déchirer par des collisions sanglantes les entrailles de la Patrie ! ! »
Ce projet, répandu dans l'Assemblée, est adopté et signé par une soixantaine de Représentans ; mais l'Assemblée ne veut pas en entendre la lecture à la tribune, et préfère la proclamation de son Président Sénard, adressée à la Garde nationale et dirigée contre le Socialisme.
L'Assemblée nationale à la Garde nationale.
« Gardes nationaux,
Vous avez donné hier, vous ne cessez de donner des preuves éclatantes de votre dévouement à la République.
Si l'on a pu se demander un moment quelle est la cause de l'émeute qui ensanglante nos rues, et qui, tant de fois, depuis huit jours, a changé de prétexte et de drapeau, aucun doute ne peut plus rester aujourd'hui, quand déjà l'incendie désole la cité, quand les formules du communisme et les excitations au pillage se produisent audacieusement sur les barricades.
Sans doute la faim, la misère, le manque de travail, sont venus en aide à l'émeute.
Mais, s'il y a dans les insurgés beaucoup de malheureux qu'on égare, le crime de ceux qui les entraînent et le but qu'ils se proposent sont aujourd'hui mis à découvert.
Ils ne demandent pas la République. - Elle est proclamée.
Le suffrage universel ! - Il a été pleinement admis.
Que veulent-ils donc ? - On le sait maintenant : Ils veulent l'anarchie, l'incendie, le pillage.
Gardes nationaux ! unissons-nous tous pour défendre et sauver notre admirable capitale !
L'Assemblée nationale s'est déclarée en permanence. Elle a concentré dans la main du brave général Cavaignac tous les pouvoirs nécessaires pour la défense de la République.
De nombreux représentans revêtent leurs insignes pour aller se mêler dans vos rangs et combattre avec vous.
L'Assemblée n'a reculé, elle ne reculera devant aucun effort pour remplir la grande mission qui lui a été confiée. Elle fera son devoir comme vous faites le vôtre.
Gardes nationaux, comptez sur elle comme elle compte sur vous.
Vive la République !
Le Président de l'Assemblée nationale,
Le 24 juin 1848. Sénard. »
Remarquons d'abord que l'Assemblée nationale reconnaît que, parmi les insurgés, il y a beaucoup de malheureux égarés, et que le manque de travail, la misère et la faim sont une des principales causes de l'insurrection.
Puis, la proclamation prétend que l'émeute est la même que celle qui, depuis huit jours, a souvent changé de prétexte et de drapeau, arborant tantôt le nom de Napoléon, tantôt celui d'un autre prétendant.
Enfin, elle affirme que l'émeute voulait, non pas un prétendant quelconque, mais l'anarchie, l'incendie et le pillage.
N'est-ce pas autant de contradictions ?
Le rédacteur de la proclamation présente le Communisme comme la véritable cause de l'émeute ; mais comment a-t-il pu écrire une assertion aussi grave et aussi dangereuse sans remords de conscience ?
Il prétend que les excitations au pillage et à l'incendie se sont produites sur les barricades ; mais où en est la preuve ? Est-il permis d'affirmer légèrement un fait aussi grave, surtout quand, au contraire, on affirme de tous côtés que le cri général aux barricades était : Vivre en travaillant ou mourir en combattant, avec cet autre cri plus général encore : Vive la République démocratique et sociale !
Le rédacteur affirme encore que l'incendie et le pillage sont les formules du Communisme ; mais c'est une erreur bien grave, bien dangereuse et bien inconcevable dans un pareil acte, une erreur contre laquelle nous ne pouvons trop protester et contre laquelle nous avons adressé au Président la protestation suivante :
Au Président de l'Assemblée nationale.
25 juin 1848.
Citoyen Président,
Au milieu des calamités publiques qui doivent causer à tous une profonde douleur, me sera-t-il permis de réclamer contre l'erreur infiniment dangereuse commise dans votre proclamation du 24 juin à la Garde nationale au nom de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans un acte que son caractère investit d'une autorité presque toute puissante.
Si cette erreur ne compromettait que moi, je ne réclamerais pas aujourd'hui, quoique le danger puisse être grand pour moi dans un moment où une autre erreur répandue par un journal, qui sera probablement répété par d'autres, me signale faussement comme un des chefs de l'insurrection au faubourg Saint-Antoine ; mais cette double erreur peut compromettre un grand nombre de citoyens qui partagent mes sentimens, et réclamer dans leur intérêt est pour moi un devoir dont les hommes de cœur apprécieront l'accomplissement.
D'ailleurs, le Président de l'Assemblée nationale, comme l'Assemblée nationale elle-même, ne peut vouloir d'autre triomphe que celui de la justice et de la vérité.
Or, dans votre proclamation vous dites « qu'aucun doute ne peut exister aujourd'hui sur la cause de l'émeute, quand déjà l'incendie désole la cité, quand la formule du Communisme et les excitations au pillage se produisent sur les barricades. »
Eh bien ! avec toute la déférence due au Président d'une Assemblée qui parle au nom de la Nation française, je proteste que la violence, l'incendie, le pillage, la loi agraire, ne sont nullement la formule du Communisme ; je proteste que la formule du Communisme Icarien que je professe est complètement opposée, puisqu'elle est celle du Christianisme et de l'Evangile, basée sur la fraternité, sur l'ordre, sur la propagande légale et pacifique, en un mot sur la volonté nationale.
Du reste, je suis prêt à rendre compte de toutes mes doctrines comme de tous mes actes devant la Justice régulière du pays.
Je vous prie de donner communication de ma lettre à l'Assemblée nationale.
Salut et fraternité.
CABET.
Mais l'état de siège m'a empêché de faire parvenir cette protestation le 25 ; je n'ai pu la faire remettre que le 27 à un Représentant.
Voici, du reste, une proclamation des insurgés du faubourg Saint-Antoine qui détruit l'assertion du Président.
Proclamation des insurgés.
Nous trouvons dans l'Estafette du 28, la Proclamation suivante, affichée dans le faubourg Saint-Antoine :
« Aux armes !
Nous voulons la République démocratique et sociale !
Nous voulons la souveraineté du Peuple !
Tous les citoyens d'une République ne doivent et ne peuvent vouloir autre chose.
Pour défendre cette République, il faut le concours de tous. Les nombreux démocrates qui ont compris cette nécessité sont déjà descendus dans la rue depuis deux jours.
Cette sainte cause compte déjà beaucoup de victimes ; nous sommes tous résolus à venger ces nobles martyrs ou à mourir.
Alerte ! citoyens ! que pas un seul de nous ne manque à cet appel,
En défendant la République, nous défendons la propriété.
Si une obstination aveugle vous trouvait indifférens devant tant de sang répandu, nous mourrons tous sous les décombres incendiés du faubourg Saint-Antoine.
Pensez à vos femmes, à vos enfans, et vous viendrez à nous ! »
Ainsi, les insurgés n'attaquaient ni la propriété, ni la République ; ils défendaient, au contraire, la République démocratique et sociale.
D'autres proclamations étaient rédigées dans le même sens : aucune n'excitait au pillage ni à l'incendie.
Quelques-uns de leurs drapeaux saisis et apportés à l'Assemblée portaient même cette inscription : Respect à la propriété ! Mort aux voleurs !
Et sur presque toutes les maisons on lisait ces mots écrits à la craie : Mort aux voleurs !
Le général Cavaignac aux insurgés.
au nom de l'assemblée nationale.
« Citoyens,
Vous croyez vous battre dans l'intérêt des ouvriers, c'est contre eux que vous combattez, c'est sur eux seuls que retombera tant de sang versé. Si une pareille lutte pouvait se prolonger, il faudrait désespérer de l'avenir de la République, dont vous voulez tous assurer le triomphe irrévocable.
Au nom de la patrie ensanglantée,
Au nom de la République que vous allez perdre,
Au nom du travail que vous demandez et qu'on ne vous a jamais refusé, trompez les espérances de nos ennemis communs, mettez bas vos armes fratricides, et comptez que le gouvernement, s'il n'ignore pas que dans vos rangs il y a des instigateurs criminels, sait aussi qu'il s'y trouve des frères qui ne sont qu'égarés, et qu'il rappelle dans les bras de la patrie. »
Paris, le 24 juin 1848.
Général CAVAIGNAC.
Ainsi, le Gouvernement reconnaît que les insurgés sont des frères égarés ; qu'ils veulent le triomphe de la République ; qu'ils demandent du travail ; et qu'ils croient se battre dans l'intérêt des ouvriers.
L'insurrection n'est donc pas dirigée contre la République ; ce sont donc des Républicains, des ouvriers demandant du travail, des frères égarés qui vont combattre.
Et ils seront combattus par les soldats qui sont leurs frères, qui ont été ouvriers comme eux et qui redeviendront ouvriers ! Ils seront combattus par la garde mobile qui s'est battue avec eux aux barricades de Février et qui est composée d'ouvriers, de Parisiens, de camarades et de frères...!
Comment trouver assez d'expressions pour déplorer un pareil malheur !
Le général Cavaignac à l'armée.
« Soldats,
Le salut de la patrie vous réclame ! C'est une terrible, une cruelle guerre que celle que vous faites aujourd'hui. Rassurez-vous, vous n'êtes point agresseurs ; cette fois, du moins, vous n'aurez pas été de tristes instrumens de despotisme et de trahison. Courage, soldats, imitez l'exemple intelligent et dévoué de vos concitoyens ; soyez fidèles aux lois de l'honneur, de l'humanité ; soyez fidèles à la République ; à vous, à moi, un jour ou l'autre, peut-être aujourd'hui, il nous sera donné de mourir pour elle. Que ce soit à l'instant même, si nous devons survivre à la République ! »
Paris, 24 juin 1848.
CAVAIGNAC.
Cette proclamation doit faire croire aux soldats que l'insurrection menace la République. Aussi les bataillons s'élancent au cri de : Vive la République, tandis que la proclamation précédente reconnaît que les insurgés veulent le triomphe de la République !
Reconnaissons-le néanmoins, le Général recommande aux soldats l'Humanité.
Le général Cavaignac aux soldats.
« Citoyens soldats,
Grâce à vous l'insurrection va s'éteindre ! Cette guerre sociale, cette guerre impie qui nous est faite tire à sa fin ! Depuis hier nous n'avons rien négligé pour éclairer les débris de cette population égarée, conduite, animée par des pervers. Un dernier effort, et la Patrie, la République, la société tout entière seront sauvées !
Partout il faut rétablir l'ordre, la surveillance. Les mesures sont prises pour que la justice soit assurée dans son cours. Vous frapperez de votre réprobation tout acte qui aurait pour but de la désarmer. Vous ne souffrirez pas que le triomphe de l'ordre, de la liberté, de la République, en un mot, soit le signal de représailles que vos cœurs repoussent.
Paris, 26 juin 1848.
Signé général Cavaignac. »
Ainsi, c'est une guerre sociale ; c'est une population égarée dont il ne reste que des débris ; et ces débris sont tellement menacés d'exécution militaire que le général se croit dans la nécessité de demander que l'on attende les sentences des tribunaux, au lieu de fusiller sans jugement !
À la garde nationale et à l'armée.
« Citoyens soldats,
La cause sacrée de la République a triomphé ; votre dévouement, votre courage inébranlable ont déjoué de coupables projets, fait justice de funestes erreurs. Au nom de la Patrie, au nom de l'humanité tout entière, soyez remerciés de vos efforts, soyez bénis pour ce triomphe nécessaire.
Ce matin encore, l'émotion de la lutte était légitime, inévitable. Maintenant, soyez aussi grands dans le calme que vous venez de l'être dans le combat. Dans Paris, je vois des vainqueurs, des vaincus ; que mon nom reste maudit, si je consentais à y voir des victimes ! La justice aura son cours ; qu'elle agisse, c'est votre pensée, c'est la mienne.
Prêt à rentrer au rang de simple citoyen, je reporterai au milieu de vous ce souvenir civique, de n'avoir, dans ces graves épreuves, repris à la liberté que ce que le salut de la République lui demandait lui-même, et de léguer un exemple à quiconque pourra être à son tour, appelé à remplir d'aussi grands devoirs.
Cavaignac. »
Ainsi, voilà la population divisée en vainqueurs et en vaincus ! Et le Général qui vient d'obtenir la victoire se croit forcé de flatter les passions pour les calmer, pour sauver les vaincus, pour empêcher les vainqueurs d'en faire des victimes !
Suites de la victoire.
Nous avons vu onze journaux suspendus. On remet en vigueur les lois sur les affiches, les afficheurs, les crieurs, et la Presse. - On laisse cependant paraître encore les journaux sans timbre ni cautionnement ; mais il est probable que de nouvelles lois seront bientôt présentées à ce sujet.
Ceux des Clubs qui sont réputés dangereux sont fermés.
Les 12ème légion (quartier Saint-Jacques) et 9ème (quartier voisin de l'Hôtel-de-Ville), sont licenciées et désarmées. - La 8ème légion, quoique non licenciée, est désarmée. - Dans toutes les légions, tous les Gardes nationaux qui n'ont pas pris les armes pour combattre l'insurrection sont désarmés. - La moitié peut-être de la Garde nationale de Paris va se trouver désarmée. - Les Ouvriers en masse se trouveront désarmés partout.
On dit que les ateliers nationaux vont incessamment être dissous.
Pendant le combat, le général Cavaignac avait ordonné que tous les auteurs et fauteurs de l'insurrection fussent jugés par un Conseil de guerre. Après la victoire, l'Assemblée décrète que, par mesure de sûreté générale, les chefs seuls seront jugés, et que la masse sera transportée dans des îles françaises avec leurs femmes et leurs enfans qui le demanderont.
Cette disposition en faveur des femmes et des enfans est ajoutée sur la demande de Pierre Leroux, qui seul ose invoquer la religion et l'humanité.
C'est le général Cavaignac qui reconnaîtra et décidera ceux qui devront être transportés.
On considère comme chefs ou fauteurs ceux qui ont donné ou fait donner de l'argent ou des armes ou des munitions.
L'Assemblée nomme une commission d'enquête, composée de 15 membres, qui fera une enquête sur l'insurrection et même sur le 16 mai. C'est Odilon-Barrot qui en est Président !
Le général Cavaignac ayant déposé son pouvoir dictatorial, l'Assemblée décrète qu'il a bien mérité de la Patrie, ainsi que l'Archevêque, la Garde nationale, la Garde mobile, l'Armée, etc.
Puis, elle nomme le général Cavaignac Président de la République avec le droit de choisir son Conseil de ministres.
Le général Cavaignac compose à l'instant le nouveau ministère ainsi qu'il suit : Général Bedeau, affaires étrangères ; - Goudchaux, finances ; - Sénard, intérieur ; - Bethmont, justice ; - Tourette, commerce ; - Recurt, travaux public ; - général Lamoricière, guerre ; - Bastide, marine ; - Carnot, instruction publique ; - général Changarnier, commandant de la Garde nationale.
Cependant, l'état de siège n'est pas encore levé ; mais la circulation est rétablie, et l'Assemblée adopte la proclamation suivante :
Proclamation de l'Assemblée nationale,
« Français,
L'anarchie est vaincue, Paris est debout et justice sera faite. Honneur au courage et au patriotisme de la Garde nationale de Paris et des départemens, honneur à notre brave et toujours glorieuse armée, à notre jeune et intrépide garde mobile (bravo !), à nos écoles, à la garde républicaine et à tant de généreux volontaires qui sont venus se jeter sur la brèche pour la défense de l'ordre et de la liberté. (Très bien.)
Tous, au mépris de leur vie et avec un courage surhumain, ont refoulé de barricade en barricade, poursuivi jusque dans leur dernier repaire, ces forcenés qui, sans principe, sans drapeau, semblaient ne s'être armés que pour le massacre et le pillage. (C'est vrai !) Famille, institutions, liberté, patrie, tout était frappé au cœur, et sous les coups de ces nouveaux barbares, la civilisation du 19ème siècle était menacée de périr.
Mais non, la civilisation ne peut pas périr ; non, la République, œuvre de Dieu, loi vivante de l'Humanité, la République ne périra pas ; nous le jurons ! la France tout entière repousse avec horreur les doctrines sauvages où la famille n'est qu'un nom et la propriété un vol ; (très bien) nous le jurons par le sang de tant de nobles victimes tombées sous des balles fratricides.
Tous les ennemis de la République s'étaient ligués contre elle et dans un effort violent et désespéré ; ils sont vaincus, et désormais aucun d'eux ne peut tenter de relever leur sanglant drapeau. (Très bien !) Le sublime élan, qui de tous les points de la France a précipité à Paris ces milliers de citoyens, dont l'enthousiasme nous laisse encore tout émus, ne nous dit-il pas assez que sous le régime du suffrage universel et direct, le plus grand des crimes est de s'insurger contre la souveraineté du Peuple ! (Très bien !)
Et les décrets de l'Assemblée nationale ne sont-ils pas là aussi pour confondre de misérables calomnies, pour proclamer que dans notre République il n'y a plus de classes, plus de privilèges possibles, que les ouvriers sont nos frères, que leur intérêt a toujours été pour nous l'intérêt le plus sacré, et qu'après avoir rétabli énergiquement l'ordre et assuré une sévère justice, nous ouvrons nos bras et nos cœurs à tous ceux qui travaillent et qui souffrent parmi nous.
Français, unissons-nous donc dans le saint amour de la patrie, effaçons les dernières traces de nos discordes civiles, maintenons fermement toutes les conquêtes de la liberté et de la démocratie ; que rien ne nous fasse dévier des principes de notre révolution ; mais n'oublions jamais que la société veut être dirigée, que l'égalité et la fraternité ne se développent que dans la concorde et dans la paix, et que la liberté a besoin de l'ordre pour s'affermir et se défendre de ses propres excès. (Bravo !)
C'est ainsi que nous consoliderons notre jeune République, et que nous la verrons s'avancer vers l'avenir, de jour en jour plus grande et prospère, et puisant une nouvelle force, une nouvelle garantie de durée dans l'épreuve même qu'elle vient de traverser. »
Après cette lecture, l'Assemblée tout entière se lève au cri de : Vive la République ! vive l'ordre !
Mais nous, nous ne pouvons nous empêcher de protester contre les déplorables erreurs de cette proclamation : non, ces insurgés n'étaient pas de nouveaux barbares, mais de malheureux ouvriers égarés par la misère et le désespoir ! Non, le Socialisme ne menace ni la famille, ni la civilisation ! C'est au contraire lui qui sauvera la France et l'Humanité, en criant à tous amnistie, amnistie !
AMNISTIE, AMNISTIE !
Vivre en travaillant ou mourir en combattant, voilà le mot des insurgés du 23 juin. C'est moins une insurrection politique qu'une insurrection sociale, une insurrection pour du travail et pour l'existence.
C'est une insurrection spontanée, subite, déterminée par le manque de travail, par l'inquiétude de l'avenir, par le désespoir.
Le remède au mal n'est pas la violence, mais la sagesse, la prudence, la conciliation de tous les intérêts, l'humanité.
La violence ne guérirait rien, ne remédierait à rien, perpétuerait l'irritation et la discorde, achèverait de détruire pour longtemps la confiance et le crédit, le commerce et l'industrie, nous plongerait toujours davantage dans la confusion et le chaos, nous livrerait peut-être à la discrétion de l'étranger, et ouvrirait devant nous un abîme de calamités.
Oui, vous les vainqueurs, réfléchissez, consultez la raison et votre propre intérêt.
Vous êtes vainqueurs... ; mais la victoire vous a coûté cher ! et où en seriez-vous avec quelques victoires pareilles ?
On ne tue pas le Peuple, pas plus que les idées... Le Peuple peut perdre dix et vingt batailles... Mais que la victoire coûte toujours cher à ses vainqueurs !... Et si, après tant de défaites, le Peuple est une fois vainqueur lui-même !...
Voyez ! c'était la MISÈRE auparavant ; et maintenant, c'est encore la MISÈRE, et plus forte, et plus redoutable !...
Si vous restez dans la voie des haines et des vengeances, ce seront les haines et les vengeances partout, s'irritant et grandissant chaque jour... Ne sera-ce pas un état perpétuel de guerre ?... La guerre n'existera-t-elle pas non seulement entre la Bourgeoisie et le Peuple, mais dans la Bourgeoisie elle-même, entre les diverses légions de la Garde nationale et même entre les Gardes nationaux dans chaque légion ? N'êtes-vous pas effrayés de la nécessité de licencier deux légions, d'en désarmer trois, et de désarmer la moitié de la Garde nationale entière ? Êtes-vous sûrs que la guerre n'éclatera pas entre les Gardes nationaux qui vont rester armés ? Pourrez-vous dormir tranquilles ? Aurez-vous désormais quelque sécurité, quelque repos ? Cette vie ne sera-t-elle pas un enfer ?
Et les affaires ? Est-ce que la confiance et le crédit pourront renaître ? Est-ce que le commerce et l'industrie vont reprendre ? Est-ce que les faillites ne vont pas se multiplier et se précipiter ?...
Et la misère ? Est-ce qu'elle ne sera pas affreuse dans les faubourgs canonnés, bombardés, saccagés ?... Est-ce que le petit commerce et la petite industrie ne seront pas ruinés ?...
Et le désespoir ? Est-ce que vous ne l'entendez pas répéter : Mieux vaut mourir d'une balle que de faim ?
Entendez la voix de la justice, de l'humanité, de la religion, qui vous crient que les vaincus sont vos frères ! Entendez du moins la voix de votre intérêt qui vous crie que vous vous perdez en perdant la Patrie.
Mais l'oubli du passé et la réconciliation ne sont pas encore impossibles ; nous avons tous assez souffert pour unir nos douleurs, tous commis assez de fautes pour être indulgens, tous montré assez de courage pour pouvoir nous estimer encore...
Notre intérêt à tous est de ne voir partout qu'un mal-entendu, un MALHEUR au lieu d'un crime.....
Pour tous amnistie donc, amnistie !
Amnistie comme gage de réconciliation !
Amnistie au nom de la Fraternité !
Amnistie pour ramener l'ordre !
Amnistie dans l'intérêt de l'industrie et du commerce !
Amnistie dans l'intérêt de nos femmes et de nos enfans !
Amnistie dans le véritable intérêt de tous !
Amnistie dans l'intérêt de la République !
Amnistie pour le salut de la Patrie, que nos discordes prolongées pourraient livrer épuisée à la fureur des ennemis de la France !
CABET.
Ce qui précède devait paraître dans le Populaire du 25 juin et du 1er juillet : mais il nous a été impossible de publier notre journal. Le Populaire devait aussi contenir l'article suivant, qui est à la fois la défense du Peuple et la condamnation du Pouvoir.
NOUS PRENONS ACTE DES AVEUX DE M. LAMARTINE.
Le 12 juin, dans un débat solennel, M. Lamartine a dit :
« La France a pris la République au sérieux ; elle la veut, elle la défendra contre tous. Nous l'avons prise au sérieux, nous la défendrons de tous les périls qui pourraient lui être suscités ; je le répète, au nom même des souvenirs les plus glorieux et les plus légitimes : nous ne laisserons jamais la France s'avilir, et elle ne s'avilira pas.
Citoyens, il vous reste un seul et dernier problème à résoudre, de tous ceux que nous avons essayé de dénouer ou de trancher, et dont la plupart ne sont, en effet, qu'à demi résolus ; il vous reste le problème du Peuple lui-même qui a concouru, avec tant de dévouement, avec tant d'énergie, avec une patience si méritoire, et dont moi, plus qu'un autre, j'ai été témoin tous les jours avec attendrissement, dans ces glorieuses journées de l'Hôtel-de-Ville.
Là, citoyens, nous voyons des corporations tout entières nous apporter successivement l'offrande de leurs sueurs, leurs demi-journées de travail, les gouttes de leur sueur quotidienne, pour les besoins et le salut de la République, et descendre dans la rue le lendemain pour venir passer ces revues triomphales de l'ordre, où, non pas seulement les hommes qui ont à sauver dans la propriété un intérêt, mais ceux qui ont à sauver dans la propriété un principe, se dévouaient au prix de leur temps, de leur journée, à défendre ces biens mêmes qu'ils ne possédaient pas.
Il ne faut pas avoir vu ce peuple comme nous, il faut avoir embrassé ces multitudes comme je l'ai fait deux mois, homme par homme, il faut l'avoir entendu parler, l'avoir vu sentir, pour se faire une juste idée du désintéressement et de la grandeur de la nation française, quand elle est émue par les grandes choses, par la liberté, par la patrie, par la fraternité ! Oh ! quel peuple ! citoyens, nous lui ferons la République assez belle, si nous lui faisons la République à son image !
Sachez seulement le connaître et l'aimer. Souvenons-nous des promesses que la révolution de février lui a faites, et dont il saura attendre aussi l'accomplissement réfléchi et graduel ! Ne lui faisons jamais dire, en retardant involontairement les lois nécessaires à son instruction, à sa moralité, à son armement, à son travail surtout, que la République n'est qu'un mot de déception et de mensonge de plus dans la langue politique, et qu'après s'être servi de ses mains pour l'inaugurer, nous le rejetons en arrière, et nous oublions ses intérêts nombreux et sacrés pour nous occuper exclusivement des intérêts moins urgents et moins généreux. »
Voilà de belles paroles : mais M. Lamartine était dictateur ou membre principal d'une dictature, et il pouvait faire tout ce qu'il indique ici ; pourquoi donc n'a-t-il rien fait ? Est-ce qu'il n'avait pas prodigué les promesses au Peuple depuis le 24 février ? Est-ce que le Peuple ne se plaint pas que les promesses n'ont été que des déceptions et des mensonges ?
« La première constitution c'est le bonheur de ce Peuple ; la première politique ce sont des lois populaires et pratiques. »
Et où est aujourd'hui le bonheur du Peuple ? Quelles sont les lois populaires et pratiques ? Sont-ce les lois pour l'impôt de 45 cent. et contre les attroupemens, etc. ? Est-ce le projet pour le rétablissement du cautionnement et du timbre ?
« Nous vous en avons apporté, nous vous en apporterons tous les jours encore ; votre sage initiative en augmentera le nombre. Nous comblerons, avec des lois d'utilité populaire, avec des lois de travail, avec des lois émancipatrices du prolétariat, avec des lois de propriété multipliée, croissante dans les mains de tous ; nous comblerons de vérités et de bienfaits cet ABÎME que CERTAINES UTOPIES ont comblé, dans les imaginations, de fallacieuses promesses, de mensonges et d'erreurs. »
Mais vous avez le pouvoir à votre disposition ; pourquoi donc n'avez-vous pas présenté ces lois populaires et bienfaisantes, ces lois de vérité, ces lois qui doivent multiplier successivement la propriété pour le prolétaire maintenant accablé par la misère ? Faites donc ces lois, faites-les, ne perdez pas un instant pour les faire ! Pas tant de poésie, pas tant de phrases, et plus d'actes, plus de faits, plus de réalités ! Hâtez-vous de combler de vérités et de bienfaits, comme vous le dites pompeusement, l'abîme qui menace de tout engloutir !
Mais pourquoi donc attaquer toujours certaines utopies, en indiquant clairement que c'est le Communisme que vous attaquez ? Est-ce généreux de frapper le Communisme, quand vous êtes au pouvoir et quand on pousse contre lui des cris de mort ? Comment pouvez-vous reprocher au Communisme des promesses fallacieuses, quand il ne fait aucune promesse et surtout aucune promesse fallacieuse, puisqu'il n'est pas au pouvoir ? N'est-ce pas vous plutôt, vous dictateur, qu'on peut accuser de promesses fallacieuses et mensongères ?
Voilà ce que disait M. Lamartine le 12 juin, et voilà ce que nous lui répondions avant le 23 : mais aujourd'hui, nous pouvons lui dire, ainsi qu'à Ledru-Rollin et aux autres, qu'il n'est pas un de nos malheurs dont ils ne soient responsables envers la France et l'Humanité.
Et de nouveau nous prenons acte des aveux de M. Lamartine pour prouver que le malheureux Peuple méritait un autre sort.
Lire la suite --> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=2730#forumpost2730
Posté le : 23/06/2013 09:12
|
|
|
|
|
Insurrection du 23 Juin 1848 à Paris (Suite) |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 juin, dans ma cachette, ne sachant ce qui m'arriverait, j'écrivis ce qui suit :
UN DERNIER MOT PEUT-ÊTRE.
Voici la guerre civile commencée et Paris en état de siège : personne ne peut dire quel sera son sort ; et je puis, moins que tout autre peut-être, prévoir quel sera le mien, moi contre qui l'on a répandu et l'on répand encore tant de calomnies[3], moi contre qui l'on a poussé tant de cris homicides.
Je me hâte donc de laisser deux mots pour la Vérité.
Je n'ai point de haine. Je suis un homme de philanthropie, d'amour et de fraternité.
J'aime l'Humanité ; je suis prêt à me dévouer pour elle ; mais je combats les mauvaises institutions qui la rendent malheureuse.
Je m'intéresse surtout aux prolétaires, parce qu'ils sont les plus nombreux, les plus opprimés, les plus misérables ; et je me dévoue pour eux malgré leur ignorance, leur injustice et leur ingratitude, parce que tous leurs vices sont moins leur faute que le crime de la Société ; et même, plus ils sont vicieux et malheureux, plus je me sens disposé à me dévouer pour eux, parce que ce sont les malades les plus en danger qui ont le plus besoin de médecin, et parce que la maladie se perpétuerait et s'aggraverait si personne ne se dévouait pour la guérir.
Mais je m'intéresse en même temps à toutes les classes sans exception, parce que toutes sont plus ou moins malheureuses, parce que leurs vices à toutes sont le résultat d'une mauvaise organisation sociale, parce que toutes sont victimes des mauvaises institutions.
M'élevant donc aussi haut que possible au-dessus de tous les partis dans l'Humanité, me dégageant de toutes les mauvaises passions humaines, c'est le bonheur de tous les hommes que je désire, surtout le bonheur des faibles, des enfans, des femmes et des vieillards. Je demande que le sort du pauvre soit amélioré, mais je ne demande pas que le sort du riche soit détérioré ; je veux que le Peuple ne soit plus spolié et opprimé, mais je ne veux pas qu'il devienne spoliateur et oppresseur ; je ne veux plus d'oppression ni de spoliation pour personne ; je repousse comme une iniquité ce mot ôte-toi de là que je m'y mette. Si les rôles étaient seulement changés, si les opprimés devenaient oppresseurs, tandis que les oppresseurs deviendraient opprimés, c'est aux nouveaux opprimés de demain que je m'intéresserais contre les nouveaux oppresseurs.
Encore une fois, c'est le bonheur de tous sans exception que je cherche, et personne n'est plus ennemi du désordre et de l'anarchie, plus ami de l'ordre, de l'organisation et de la justice.
La Fraternité a toujours été mon principe, ma boussole et mon guide.
Quarante années d'étude, d'observation et de méditation, et cinq années de travail dans la solitude de l'exil, m'ont confirmé dans ces sentimens.
L'histoire montrant l'Humanité malheureuse partout sur la terre et dans tous les temps, j'en ai recherché la cause, et j'ai acquis la conviction que cette cause était l'individualisme ou l'égoïsme, qui sert de principe et de base à toutes les sociétés civiles.
Par contre, je suis arrivé à cette autre conviction, que le remède au mal ne pouvait se trouver que dans le principe opposé servant de base à la nouvelle organisation sociale, c'est-à-dire dans le Communisme, ou l'association solidaire, ou l'intérêt public et commun, ou la Communauté.
Pour moi, la Communauté doit être basée sur la Fraternité (qui comprend nécessairement l'Égalité et la Liberté), sur l'Éducation, le Travail et la Famille.
Pour moi, la Communauté est l'association la plus parfaite, la plus favorable à la production et à l'abondance, à l'ordre et à la paix, à la concorde et à l'union, au bien-être et au bonheur de tous.
Pour moi, la Communauté est une assurance mutuelle contre tous les désastres, tous les fléaux, tous les malheurs.
Pour moi, la Communauté c'est la République, c'est la Démocratie, c'est le Christianisme dans sa pureté primitive.
Et tous mes écrits (plus de quarante publiés depuis dix ans) prouvent que je n'ai jamais demandé l'établissement du Communisme par la violence, par l'émeute et par la révolution ; qu'au contraire, j'ai toujours combattu la violence sous toutes ses formes ; que je n'ai fait appel qu'à la discussion, à la propagande légale et pacifique, à la persuasion, à la conviction, à l'Opinion publique, au consentement de chacun et à la volonté nationale ; que je me suis attaché surtout à former des hommes et des citoyens en m'efforçant d'instruire et de moraliser le Peuple par la pratique de la fraternité.
S'il y a eu des exagérations, des excès et des abus commis par quelques individus qui prenaient le titre de Communistes, ces excès ont été commis malgré moi ; je les ai toujours combattus ; je me suis même séparé de leurs auteurs en prenant un autre titre, celui de Communiste Icarien.
On a souvent reconnu et l'on reconnaîtra toujours davantage que j'ai rendu un grand service à la société en instruisant et en moralisant une grande partie du Peuple.
Mais quoique la partie du Peuple instruite et moralisée fût plus grande qu'à aucune autre époque, la masse était encore à mes yeux trop ignorante, trop crédule, trop vicieuse et trop facile à égarer (l'expérience ne vient malheureusement que de le trop démontrer) pour que je fusse impatient de voir une Révolution.
Je n'étais pas impatient par une autre raison, c'est que la tête du Parti Républicain me paraissait composée d'hommes trop égoïstes, trop viveurs, trop ambitieux et trop incapables (et l'expérience ne l'a que trop démontré encore) pour faire prospérer une Révolution populaire.
Je préférais que la Révolution n'arrivât que quand la nation serait mieux préparée.
Cependant, comme la misère pouvait faire éclater inopinément cette Révolution, j'avais toujours accepté d'avance, pour ce cas, un Régime transitoire qui durerait plus ou moins longtemps, qui serait tout simplement la République démocratique et sociale, conduisant successivement et progressivement au régime complet de la Fraternité, de l'Egalité et de la Communauté.
Et pour mieux préparer l'expérience sans rien troubler en France, j'avais résolu d'aller fonder une grande Communauté, la Communauté d'Icarie, dans le Texas, en Amérique.
Une masse de généreux Icariens, pacifiques et dévoués comme moi à l'Humanité, avaient adopté ma proposition avec enthousiasme.
Une première avant-garde de 69 était déjà partie et une deuxième se disposait à la rejoindre, lorsqu'éclata comme une bombe la Révolution du 24 Février.
Fidèle à mes principes, complètement désintéressé, sans ambition, je ne demandai rien, ni pour moi, ni pour le Communisme ; je reconnus le Gouvernement provisoire et la République exhortant tous les Icariens à les reconnaître également et à les aider.
Si je l'avais bien voulu, j'aurais pu être membre du Gouvernement provisoire ou occuper quelque autre poste important.
Si j'avais été membre du Gouvernement provisoire, j'ai la conviction que j'aurais tout sauvé.
J'aurais d'abord rassuré complètement sur le Communisme en l'expliquant, en le faisant connaître et apprécier, en l'ajournant pour ne parler que de Démocratie et de République, comme s'il n'avait jamais été question d'autre chose.
J'aurais demandé la réalisation de la République démocratique et sociale, en organisant l'ordre et la paix, en conciliant tous les intérêts, en marchant prudemment et progressivement.
J'aurais tout fait pour rétablir la confiance et le crédit, le commerce l'industrie, l'union et la concorde.
Je suis convaincu que la chose était possible, facile même, avec de la résolution et de la fermeté, jointes à la modération et à la justice.
Je suis convaincu encore que la Bourgeoisie se serait résignée.
Mais le Gouvernement provisoire ne m'a pas appelé ; et les préventions que le National et la Réforme avaient répandues contre le Communisme m'ont paralysé.
D'ailleurs, malgré mes défiances et mes craintes, j'espérais que le Gouvernement sauverait la Révolution et la République.
Comment croire en effet qu'il pourrait montrer tant d'incapacité et faire tant de fautes !
C'est lui, le Gouvernement, c'est le National, c'est la Réforme, ce sont surtout Ledru-Rollin et Lamartine, qui ont tout perdu.
À eux toute la responsabilité des catastrophes ! Que de malédictions leur réserve la Postérité !
Que de fautes commises par les chefs secondaires du Parti Démocrate !...
Enfin, voici la guerre civile avec toutes ses fureurs et toutes ses horreurs .... !
C'est la guerre sociale !
C'est la guerre de la misère, de la faim et du désespoir !
C'est la guerre entre le Peuple et la bourgeoisie,
Et les ouvriers, les travailleurs, les producteurs, ceux qui ont fait la révolution, les républicains les plus dévoués, qui ont montré tant de générosité, à qui l'on a prodigué tant d'éloges, vont être écrasés par la puissance gouvernementale.
Et ce sont des soldats qui vont massacrer des ouvriers leurs frères ! C'est la Garde mobile qui va massacrer ses camarades des barricades !... C'est la Garde républicaine qui va massacrer des républicains !
Quelle confusion ! Quel chaos !
Et quel avenir pour la France ! que de haines, que de divisions, que de misères nouvelles, quel abîme de calamités pour tout le monde !
C'est précisément cet abîme que je voulais éviter à jamais par la réalisation des doctrines de fraternité, d'ordre et de paix.
Et cependant, moi qui suis étranger aux journées de juin, comme à celles de mai et d'avril, je serai peut-être victime ; car une Proclamation du Président de l'Assemblée nationale excite la colère des Gardes nationaux contre les Communistes en dénonçant le Communisme comme étant la cause de l'insurrection, tandis qu'un journal me signale comme étant à la tête des insurgés.
Mais si je succombe sous la violence, je serai victime de l'erreur et de la calomnie.
Je serai martyr pour mes idées régénératrices et pour mon dévouement à l'Humanité.
Et je pardonne d'avance à mes meurtriers ; car ils ne sauront certainement pas qu'ils frapperont un des meilleurs amis des vainqueurs comme des vaincus.
CABET.
OBSERVATION.
Tout ce qui précède devait être publié pendant l'état de siége mais l'état de siége est une chose si horrible que nous avons préféré laisser passer le monstre.
Aujourd'hui qu'il est passé, nous publions notre travail en le complétant, pour dire toute la vérité.
Loin de nous cependant l'intention d'irriter et de blesser ! Nous ne voulons que tirer des leçons utiles.
Nous dirons donc tout ce que nous croyons vrai et instructif ; nous le dirons sur les partis et sur les hommes comme sur les choses ; mais, si nous parlons avec franchise, cette franchise sera vraiment philosophique, sans haine et sans partialité comme sans crainte ; car, qu'on ne l'oublie jamais, serviteur dévoué de l'Humanité, nous ne nous intéressons pas plus au Peuple en général qu'à la Bourgeoisie, pas moins à la Bourgeoisie qu'au Peuple.
Du reste, la chose nous est facile, et nous sommes dans une position exceptionnelle pour être impartial et calme ; puisque nous partons pour Icarie, nous pouvons juger l'insurrection du 23 juin et même la Révolution du 24 février comme s'il s'agissait d'une insurrection et d'une révolution anciennes de quelques milliers d'années à Rome ou en Chine.
Misère.
La Réaction crie partout que c'est la République qui produit la Misère et que la Monarchie ramènerait bientôt les capitaux et l'abondance : mais c'est un mensonge, une calomnie !
La Misère a pour cause le développement de l'industrie dans le monde entier depuis trente à quarante ans, et par suite la diminution toujours croissante du travail et du salaire.
Elle a pour cause aussi la mauvaise organisation Sociale.
Elle est générale en Europe.
Elle a été une des principales causes de la Révolution de février.
Au lieu d'être l'effet de la République, elle en a été la cause.
La République en aurait été le remède si elle avait été bien conduite, si elle avait été une vraie République, une République démocratique et sociale.
Si la misère n'a pas disparu, c'est la faute du Gouvernement provisoire et de la Réaction.
La victoire de la Réaction l'a beaucoup augmentée par les fusillades, par la canonnade, par le bombardement, par la tuerie, par les arrestations, par la dissolution des Ateliers nationaux, par l'état de siège, etc.
Que de veuves et d'orphelins ! Que d'ouvriers et de petits boutiquiers ruinés ! Que de locataires dans l'impossibilité de payer leurs loyers, et que de propriétaires dans l'impossibilité de payer leurs impôts ! Que d'ouvriers quittent leurs quartiers pour fuir les dénonciations ! Que de riches fuient Paris et ses dangers ! Que de Provinciaux en retirent leurs enfans ! Que de boutiques, de magasins, d'ateliers, fermés ou qui vont se fermer tous les jours !
Nous le prédisons depuis plusieurs années, et notre prédiction ne se réalise que trop, il n'y aura bientôt pas une maison de commerce ou d'industrie qui ne succombe sous la misère générale.
Il n'y aura bientôt peut-être pas un jeune homme de science ou d'art, pas un ouvrier de l'intelligence ou des bras, qui ne soit réduit à s'écrier : « Mourir en combattant, puisqu'on ne peut plus vivre en travaillant ! »
Mais le remède :
Le Remède ?
Le grand mal, le mal principal, il ne faut pas se le dissimuler, c'est la Misère.
C'est donc la Misère qu'il faut faire disparaître.
Mais comment faire disparaître la Misère ?
Ce n'est ni l'Henriquinquisme, ni le Bonapartisme, ni la Régence, ni une République bourgeoise ou châtrée, ni surtout l'invasion étrangère, qui pourra ramener l'oubli du passé, la concorde, l'union, la fraternité, la confiance, le crédit, le travail, l'abondance et la satisfaction générale ; et la chose est trop manifeste pour qu'il faille la démontrer.
Il faut s'arrêter dans la funeste voie de la Réaction, même revenir sur ses pas, accepter franchement la Révolution et la République démocratique et sociale, et commencer par une AMNISTIE générale et sans exception.
Il faut dissoudre l'Assemblée, après avoir établi pour un temps suffisant un Directeur ou une Dictature qui puisse obtenir la confiance universelle, et qui s'occuperait principalement à réconcilier les Partis, à ranimer le travail et à assurer toutes les existences.
Il faut réorganiser impartialement la Garde nationale, appeler une nouvelle Assemblée constituante qui puisse représenter véritablement la Nation…
Il faut… Mais c'est un rêve nous crie-t-on !… C'est impossible !… La Réaction n'y consentira jamais !… Dans ses habitudes de vanité, d'orgueil, de suprématie, de commandement et de privilège, elle ne peut supporter ni Égalité, ni Fraternité !… Elle veut marcher en avant, consommer la contre-révolution, brider, bâillonner, garrotter le Peuple bien plus qu'auparavant et perpétuer pour lui l'état de siège, préférant le despotisme et les Cosaques ou les Bédouins à la Démocratie !…
Eh bien alors, nous avons l'âme navrée, déchirée, désespérée… Nous n'apercevons dans l'avenir que divisions, haîne, désirs de vengeance, ruines, guerres, invasions peut-être, insurrections et révolutions… Quel hiver pour le pauvre prolétaire… ! Avant deux mois peut-être la banqueroute sera générale ; car personne ne recevant, personne ne pourra payer ; l'industrie va se désorganiser, se rouiller et se perdre ; le commerce extérieur va se déplacer et s'anéantir…
Oui, nous marchons à une dissolution de la Société, à un cataclysme social…
Et nous le répétons, nous en sommes navré, dans l'intérêt de la Bourgeoisie comme dans l'intérêt du Peuple, parce que, quoique nous intéressant davantage au Peuple, qui se trouve actuellement plus malheureux, nous nous intéressons bien vivement aussi aux autres classes, dans lesquelles nous avons pris l'habitude de ne voir que des Français, des hommes et des frères, dont tous les égaremens, toutes les passions, tous les vices, tous les excès, sont, comme ceux du Peuple, le résultat de l'Organisation sociale.
Nous sommes tous presque également victimes de la confusion, des malentendus, d'une sorte de vertige !
Et la Bourgeoisie est peut-être plus menacée que le Peuple ; car le Peuple est plus nombreux et plus fort ; on a beau massacrer des Ouvriers, on ne tue pas le Peuple ; et les Travailleurs sont bien autrement habitués et endurcis aux privations et aux souffrances que la Bourgeoisie et l'Aristocratie……
Quelque peu d'espérance que nous puissions avoir de faire écouter nos vœux, nous ne cesserons donc pas de répéter au nom du salut de tous : Amnistie, Amnistie, Réconciliation et Fraternité !
Paris, le 25 octobre 1848.
CABET.
Liens :
http://youtu.be/EFay8KW8GFI chansons Journées de Juin 1848
http://youtu.be/Ca7pvRFP7Os révolution en Février
http://youtu.be/DDYfFu7k0Mw La France début Juin 1848
Posté le : 23/06/2013 09:04
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
124 Personne(s) en ligne ( 78 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 124
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages