|
|
Le port de l'étoile jaune 1 Septembre 1941 1ère partie |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
le 1 septembre 1941 un décret instaure le port de l'étoile jaune pour les juifs.
L'étoile jaune est une pièce de tissu en forme d'étoile de David et de couleur jaune, comme son ancêtre la rouelle, imposée par l'Allemagne nazie comme signe vestimentaire distinctif aux Juifs d'Allemagne d'abord, puis à ceux des zones conquises au cours de la Seconde Guerre mondiale en France, Pays-Bas, etc..
Elle devait y être cousue de façon inamovible, en évidence, soit sur le côté gauche, soit à l'avant et à l'arrière, selon les directives locales.
Dans certains pays, était inscrit au centre de l'étoile, en caractères imitant la calligraphie hébraïque, le mot désignant les Juifs dans la langue locale : Jude en Allemagne, Juif en France, Jood aux Pays-Bas, un simple J en Belgique, qui signifiait Jood pour les néerlandophones, et Juif pour les francophones en Slovaquie.
Outre son rôle primaire, discriminatoire, l'étoile jaune eut une fonction de marquage, désignant les Juifs aux nazis lors des rafles, etc.
Instauration
L'étoile jaune a été instaurée par un décret du 1er septembre 1941, signé par Reinhard Heydrich, alors à la tête de l'Office supérieur de la Sécurité du Reich : Reichssicherheitshauptamt.
Tous les Juifs âgés de plus de six ans durent alors la porter de manière bien visible chaque fois qu'ils se montraient en public, sans quoi ils s'exposaient, même par négligence, à une amende ou de la détention.
Dans sa finalité, l'étoile se voulait une adaptation plus récente du principe de la rouelle de 1215. Elle en reprend d'ailleurs la couleur, le jaune, symbole de trahison ou de folie aux yeux des chrétiens du Moyen Âge.
En France : la 8e ordonnance allemande
Le 5 mai 1942, lors de la venue à Paris de Reinhard Heydrich, l’adjoint de Himmler à la tête des SS, une réunion avec Dannecker, chef, à Paris, de la section IV J de la Gestapo, chargé de la question juive, Otto Abetz, ambassadeur d’Allemagne, et Carl-Theo Zeitschel, chargé des questions juives à l’ambassade, précisera la formulation du texte de la huitième ordonnance allemande en cours d’élaboration et promulguée le 29 mai 1942.
Elle sera imposée à tous les juifs de plus de six ans, aux Juifs de la zone occupée.
L'ordonnance entrera en vigueur le dimanche 7 juin 1942.
En l'espace de deux semaines, trois étoiles par personne seront distribuées dans les commissariats par la police française, à environ 83 000 exemplaires sur Paris et sa banlieue, en échange d'un point textile sur les cartes de rationnement.
L'ordonnance entrera en vigueur le dimanche 7 juin 1942.
De rares dérogations
Des dispositions dérogatoires existaient : l'ordonnance indiquait que lors de circonstances spéciales, dans l'intérêt du Reich, des dérogations à l'ordonnance peuvent être prévues dans des cas isolés.
Les exemptions devaient se limiter aux étrangers issus des pays belligérants : Grande-Bretagne, États-Unis, états ennemis d'Amérique Centrale ou du Sud, pays neutres : Suisse, Espagne, Brésil, Canada et des pays alliés de l'Allemagne : Italie, Grèce, Turquie, Bulgarie, pour éviter les représailles contre les ressortissants allemands ainsi que les interventions des pays neutres.
Dans sa lettre du 29 mai 1942 à l'ambassadeur de France, Fernand de Brinon, le général Karl Oberg, chef de la SS en France occupée, souligne qu'il se réserve la possibilité dans des cas particuliers, de procéder à des exceptions. Dans ces cas, le Juif exempté du port de l’insigne devra porter sur lui un certificat établi par le chef de la police de Sûreté et du service de Sûreté.
Seront également exemptés les Juifs vivant en mariage mixte, si leurs enfants étaient reconnus comme non-juif.
Une note du 25 août 1941 de Heinz Röthke, chef du service Juif à la SS de Paris, dresse une liste de 26 juifs, officiellement exemptés du port de l'étoile jaune. Lisette de Brinon, née Franck, est inscrite en tête de liste.
Elle est l'épouse de Fernand de Brinon, ambassadeur du gouvernement de Vichy à Paris.
Suivent trois exemptions sollicitées par le Maréchal Pétain.
Dans une lettre du 12 juin 19429, adressée à Brinon, Pétain écrit :
Mon attention vient d'être attirée à plusieurs reprises sur la situation douloureuse qui serait créée dans certains foyers Français si la récente Ordonnance des Autorités d'Occupation, instituant le port d'un insigne spécial pour les juifs, était appliquée sans qu'il soit possible d'obtenir des discriminations naturelles et nécessaires.
Je suis convaincu que les Hautes Autorités Allemandes comprennent parfaitement elle-mêmes que certaines exemptions sont indispensables ; le texte de la 8e ordonnance les prévoit d'ailleurs.
Et cela me semble nécessaire pour que de justes mesures prises contre les israélites soient comprises et acceptées par les Français.
Je vous demande donc d'insister auprès du Général Commandant les Troupes d'Occupation en France pour qu'il veuille bien admettre le point de vue que vous lui exposerez de ma part pour que M. le Commissaire Général aux Questions Juives puisse promptement obtenir la possibilité de régler par des mesures individuelles et exceptionnelles certaines situations particulièrement pénibles qui pourraient nous être signalées.
Une inscription manuscrite du SS-Obersturmführer Beumelburg, chef de la Gestapo, précise en Allemand qu'il s'agit de cent cas.
Le 3 juillet 1942, le Docteur Ménétrel, l'éminence grise de Pétain, transmettra à Brinon seulement deux demandes précises d'exemptions :
Madame de Chasseloup-Laubatnote .
Madame de Langladenote .
" Je pense qu'à ces demandes pourrait être jointe celle de Mme la Générale Billotte, dont je vous avais adressé la lettre reçue par le Maréchal, ainsi que copie de la réponse que je lui ai faite précise le courrier".
À la différence de sa sœur, Lucie Langlade n'obtiendra pas d'exemption ni le protecteur statut d‘aryenne d'honneur. Arrêtée, elle ne sera pas libérée malgré des interventions, et mourra en déportation.
Le 20 janvier 1944, elle fera partie du convoi n° 66 pour Auschwitz et sera envoyée à la chambre à gaz le 24 janvier.
Parmi les autres exemptions accordées, la comtesse Suzanne de Sauvan d'Aramonnote .
Outre les demandes relationnelles considérées comme indispensables, la note de Röthke fait état de huit cas où l'exemption est accordée pour de pressants motifs économiques .
Sept autres exemptions relèvent de demandes de l'AST : Abwehrstell, les services de contre-espionnage ; six exemptions concernent des Juifs « travaillant avec la police anti-juive ». Parmi ces derniers, se trouvait Moszek : Maurice Lopatka, né à Varsovie en 1883.
Léon Poliakov le considère comme le plus terrible des informateurs juifs, employé par les services anti-juifs tant allemands que français. Responsable de l’arrestation de centaines de juifs qu’il faisait chanter avant de les dénoncer pour toucher des deux côtés .
L'ambassade d'Allemagne à Paris avait examiné d'autres demandes lors d'une réunion tenue le 17 juin 194212.
L'ambassadeur Abetz, avec Oberg, Rudolf Rahn, Zeitschel, Knochen et Hagen, discuteront des demandes d'exemption pour Louise Neuburger, veuve du philosophe Henri Bergson ainsi que pour Maurice Goudeket marié en 1935 à la célèbre écrivaine Colette; il sera également question du pianiste Konstantin Konstantinoff, pilier de la programmation musicale de Radio Paris.
Si aucune décision ne sera prise pour ces célébrités, en revanche Marcel Lattès bénéficie d'une exemption à compter du 15 mai 1943, jusqu'au 15 septembre 1943, qui lui a permis de travailler. Mais, le 15 octobre 1943, la police vient le chercher à son domicile parisien.
Il sera déporté à Auschwitz par le convoi n°64 du 7 décembre 1943 et mourra le 12 décembre à 57 ans .
Les marchands d'art Allan Loeblnote Emmanuel Loebl, et Hugo Engel obtiennent des exemptions sur intervention de Hans Poss, chargé par Hitler des acquisitions pour son musée de Linz en Autriche .
La situation qui restait favorable à certaines nationalités évoluera très vite : début juillet 1942, les juifs hongrois sont astreints à l’étoile par un complément à la 8e ordonnance.
Les Juifs russes vivant en France doivent aussi porter l’étoile, qu’ils viennent ou non des territoires occupés. En septembre, suivront les Juifs bulgares et roumains.
L'étoile jaune et la zone libre
L'étoile jaune n'a pas été portée en zone libre, jusqu'à ce qu'elle soit envahie le 11 novembre 1942 par les Allemands et les Italiens suite au débarquement allié en Afrique du Nord.
En septembre 1942, Röthke, lors d'un entretien avec Jean Leguay, secrétaire général de la police, avait évoqué la déportation en zone libre en proposant la dénaturalisation des Juifs.
Pétain se serait opposé au port de l'étoile jaune en zone libre mais il fit apposer le tampon «Juif» sur les papiers d'identité. "Moi vivant, l’étoile juive ne sera pas portée en zone libre" aurait-il dit au grand rabbin Schwartz.
L'étoile jaune et les religions
Le pasteur Marc Boegner, président de la Fédération protestante de France, écrira à Pétain le 12 juin 1942 pour lui exprimer la douloureuse impression éprouvée par les Églises de son ressort devant les nouvelles mesures prises par les autorités d'occupation à l'égard des Israélites.
Et le pasteur André Bertrand, un de ses vice-présidents, adressera une lettre aux pasteurs de la zone occupée rappelant l'égalité des races devant Dieu.
L'archevêque de Paris, le cardinal Suhard, plaidera pour des demandes d'exemptions.
Dans son sermon du 7 juin 1942, à la Sainte-Chapelle, le suppléant du cardinal prendra position contre l'étoile, rappelant que « les Juifs et les Chrétiens sont des frères ".
À Vichy, rapporte Georges Wellers, "le RP Victor Dillard, devant ses fidèles de l'église Saint-Louis, les invite à prier pour les 80.000 juifs que l'on bafoue en leur faisant porter l'étoile jaune ".
L'abbé Jean Flory, curé de Montbeliard, lors de la messe de minuit de 1942, en présence d'Allemands en uniforme, avait fait porter par les enfants de chœur en procession, un enfant Jésus à l'étoile jaune. Dans la crèche, Joseph et Marie portaient aussi l'étoile.
L'affaire n'aura pas de suite.
Le statut des Juifs obligea l'archimandrite de Meudon, Serge Feffermann, haut dignitaire de l'église russe orthodoxe, à porter l'étoile jaune. Dans une lettre au CGQJ du 17 décembre 1942, il demande à ne plus porter l'étoile, après avoir rappelé avoir quatre grands parents juifs et sa conversion à 16 ans :
"Un demi-siècle passé au service de l'Eglise catholique orthodoxe pouvait me faire croire que jamais rien ne me rappellerait ma lointaine origine israélite.
Or, actuellement, à cause de règlements, peut-être trop rigoureusement interprétés, je suis astreint à porter l'étoile de Sion, que j'ai reniée à jamais, et qui comporte le plus douloureux sacrifice qui puisse être imposé à un prêtre, celui de ne pouvoir participer à la célébration de service religieux".
Sa demande sera rejetée le 27 février 1943.
Les juifs sépharades, qui figuraient parmi les dérogations du second statut des juifs accordées aux anciens combattants, ont fait l'objet de demandes d'exemption générale des mesures anti-juives. En juillet 1942, le directeur du Statut des personnes au Commissariat général des questions juives, demandera même conseil au consul général d'Espagne à Paris. Bernardo Rolland répondra que "la loi espagnole ne fait aucune distinction du fait de leur confession entre ressortissants espagnols", et il prônera de ne pas appliquer le statut aux sépharades.
Les mères israélites sépharadiques adressèrent une lettre au maréchal Pétain en ce sens.
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, mettra un terme aux hésitations en septembre 1943, en décidant l'application du statut.
Ils ont refusé l'étoile
Volontairement, Robert Debré n'a pas porté l'étoile jaune.
Dans ses mémoires, il revient sur son choix :
Personnellement j’étais bien décidé à ne pas obéir à cette mesure nouvelle pas plus qu’aux précédentes écrit-il.
Pour éviter toute complication, Élisabeth de La Panouse de La Bourdonnaye, qui sera sa seconde épouse, retira une étoile jaune au commissariat de police.
Elle avertit le commissaire de police que je ne la porterais point.
Il enregistra cette déclaration, et je rangeai le petit morceau d’étoffe dans un tiroir où devait le rejoindre plus tard, parmi les objets du souvenir, mon brassard FFI arboré pendant la libération de Paris.
J’étais convaincu, comme plusieurs d’entre nous, que cette désobéissance n’augmenterait guère les risques car nous fûmes assez nombreux à prendre cette attitude.
Sans nous être entendus, agirent de même les deux autres membres de ma famille astreints à cette obligation et alors présents à Paris :
" le professeur Jacques Hagueneau, mon cousin, qui échappa de justesse un peu plus tard à la Gestapo, et un autre cousin, Paul Dennery, qui fut arrêté place de la Madeleine et dont on n’eut plus jamais de nouvelles."
En mai 1943, il sera inquiété par la police française alors qu’il se rend sans étoile à l’Académie de médecine.
Dans son rapport d’enquête, l’inspecteur Henri Soustre, indique avoir interrogé le médecin à son domicile :
"Le Pr Debré déclare être Juif et ne pas porter l’étoile et avoir été relevé de toutes les interdictions portées au statut des Juifs par décret du 5 janvier 1941 pris en Conseil des ministres".
L’enquêteur précise que ce décret n’est pas signé de Pétain mais du secrétaire d’État à l’éducation nationale, Jérôme Carcopino, le 11 juillet 1941, réintégrant le Pr Debré dans ses fonctions à l’Académie avec effet rétroactif.
"D’après ses dires, ces faits seraient connus des autorités occupantes qui auraient toujours fait exception pour lui."
Le rapport poursuit :
"Récemment son téléphone ayant été supprimé à la suite d’une dénonciation, les autorités occupantes le lui ont fait remettre immédiatement.
Le Pr Debré ajoute qu’il s’est présenté à plusieurs reprises dans les bureaux allemands sans porter l’étoile.
Au moment du port de l’étoile, une demande à la préfecture de police a été faite, il lui aurait été répondu qu’il était dans un cas spécial en vertu de ce même décret".
La profession médicale protestera contre l’étoile jaune : en juin 1942, les professeurs Leriche et Lemierre, président et vice-président de l’Ordre des médecins, s’adresseront au CGQJ : Commissariat Général aux Questions Juives pour obtenir une exemption en faveur de Mme le Dr Widal, la veuve du célèbre Fernand Widal.
Une réponse sèche de dix lignes indiquera qu'il ne pouvait être donné une suite favorable.
Chez les avocats et notaires Juifs, certains envisageront une action collective de protestation.
Le 5 juin 1942, Zeitchel, expert aux Questions Juives à l’ambassade d’Allemagne, s’adresse en ces termes à Dannecker : "Le Comte de Brinon, Secrétaire d’État, a appris que les avocats et notaires Français projettent un manifeste et recueillent des signatures dans l’intention de faire exempter leurs collègues juifs du port de l’étoile jaune. Darquier de Pellepoix a l’intention de faire arrêter tous les avocats qui prendront part à cette action.
L’ambassade n’y voit pas d’inconvénient. Prière au SD de prêter son appui à cette mesure énergique en faveur des ordonnances allemandes."
En marge la mention "À Drancy ! " sera rajoutée à la main.
Le 15 juillet 1942, Röthke demandera une enquête qui n'aboutira pas en raison des vacances judiciaires et le bâtonnier Jacques Charpentier refusera de faire appliquer la 8e ordonnance.
Il répondra que douze à quatorze avocats juifs sont encore en fonctionner qu'ils " ne portent pas l'étoile, volontairement, malgré les observations faites ".
Chez les pompiers, le port de l'étoile sera évoqué par Oberg dans une lettre du 15 juin 1942 au colonel Simonin, commandant du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, lui indiquant qu'il ne peut pas accorder d'exemption aux 28 caporaux et sapeurs juifs.
Max Jacob, le poète à l'étoile
Né de confession juive, converti à 40 ans, Max Jacob, 1876-1944 a été surnommé le poète à l’étoile .
"Deux gendarmes sont venus enquêter sur mon sujet, ou plutôt au sujet de mon étoile jaune. Plusieurs personnes ont eu la charité de me prévenir de cette arrivée soldatesque et j’ai revêtu les insignes nécessaires "
écrit-il dans une lettre alors qu’il s’est réfugié à Saint-Benoît-sur-Loire.
Dans son poème Amour du prochain, il écrit :
"Qui a vu le crapaud traverser une rue ? C’est un tout petit homme, une poupée n’est pas plus minuscule. Il se traîne sur les genoux : il a honte, on dirait…? Non ! Il est rhumatisant. Une jambe reste en arrière, il la ramène ! Où va-t-il ainsi ? Il sort de l’égout, pauvre clown.
Personne n’a remarqué ce crapaud dans la rue. Jadis personne ne me remarquait dans la rue, maintenant les enfants se moquent de mon étoile jaune. Heureux crapaud, tu n’as pas l’étoile jaune.
Finalement, il est arrêté par la Gestapo d'Orléans le 24 février 1944, avant d'être déporté au Camp de Drancy, où il meurt d'épuisement deux semaines plus tard.
Ne pas porter l'étoile : quels risques ?
L'étoile jaune devait être solidement cousue.
Ne pas la porter ou même la dissimuler constituaient des infractions à l'ordonnance allemande, et un motif suffisant de déportation. Un Juif sans étoile prenait également un risque accru de dénonciation.
Ce sera le cas pour Louise Jacobson, une lycéenne de 17 ans, arrêtée chez elle, rue des Boulets, dans le XIe arrondissement de Paris, par la police française.
Incarcérée à Fresnes le 1er septembre 1942… Drancy, Beaune-la-Rolande, elle sera déportée par le convoi no 48 du 13 février 1943 et mourra gazée à son arrivée à Auschwitz.
Louise a laissé six mois de lettres émouvantes écrites pendant sa captivité, que sa sœur publiera en 1989, adaptées au théâtre sous le titre "Les lettres de Louise Jacobson".
Dans certaines circonstances, ne pas porter l'étoile a pu aussi sauver la vie.
Dans le Mémorial des enfants juifs déportés de France, Serge Klarsfeld cite le témoignage de Sarah Lichtstein, arrêtée à 14 ans, avec sa mère, lors de la rafle du Vél d'Hiv', le 16 juillet 1942 26 : " Je ne porte pas l'étoile jaune.
Des autobus arrivent sans cesse et, pendant que la police s'occupe des nouveaux venus, je m'avance un peu sur le trottoir. Un agent s'approche de moi et me demande : " Qu'est-ce que vous faites là ? " Je réponds : " Je ne suis pas juive, je suis venue voir quelqu'un ".
" Foutez moi le camp, vous reviendrez demain " dit-il ... " Je prends la rue Nocard, en face du Vél d'Hiv' et là, je la suis n'osant me retourner, tremblant qu'on me rappelle et le cœur lourd d'avoir laissé maman.
Au bout de la rue un agent arrête les gens qui veulent entrer. Je m'avance le cœur battant, mais il me laisse passer croyant que j'habite un immeuble de cette rue ". Sarah retrouvera sa mère qui avait pu s'échapper une demi-heure après.
Après deux années de répit, dénoncées, elles seront déportées à Auschwitz par le convoi n° 75 du 30 mai 1944, mais elles ont survécu.
Port de l'étoile jaune par des non-juifs
En France, par défi, un certain nombre de non-Juifs, en particulier les zazous, se sont affichés avec une étoile jaune portant l'inscription Swing à la place du mot Juif .
Une légende veut que, durant l'occupation du Danemark par l'Allemagne nazie, le roi Christian X, voire selon les versions, la population non-juive dans son ensemble, portaient aussi l'étoile jaune afin de soutenir leurs concitoyens juifs en rendant inefficace la mesure de l'occupant.
Toutefois, la mesure n'a pas été imposée au Danemark ; cette histoire est par conséquent fausse.
On retrouve la même légende avec le sultan Mohammed V du Maroc, alors que le territoire marocain ne fut jamais sous occupation allemande.
Il refusa de promulguer l'ordonnance allemande dans le protectorat français en répondant au représentant de l'administration coloniale : Il n'y a pas de juifs au Maroc, il y a seulement des sujets marocains .
Néanmoins, il avait signé un dahir, en octobre 1940, instaurant le numerus clausus dans les professions libérales.
Les dérogations contestées de Papon
À la 68e journée d'audience de son procès, Maurice Papon, l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, évoquera ses interventions pour sauver des juifs .
Il estimera à au moins 150 personnes libérées ou exemptées des convois entre 1942 et 1944 et assura que son service des questions juives accorda 1 182 dérogations au port de l'étoile jaune, ce qui donnait une chance supplémentaire aux juifs d'échapper aux Allemands .
Ces dérogations auraient concerné 951 Français et 231 étrangers. Michel Slitinsky, partie civile à l'origine du procès, contestera ces chiffres en les ramenant à seulement 11 dérogations accordéesnote.
Autres signes distinctifs imposés par le reischtag
En Pologne, les Allemands obligèrent les Juifs de plus de douze ans à porter un brassard blanc avec une étoile de David bleue au centre, sur le bras droit. En Croatie, le brassard était jaune avec une étoile noire au centre.
En Roumanie, à partir du 3 septembre 1941, le port de l'étoile sera étendu à l'ensemble du pays : une étoile noire sur fond blanc. Dans l'armée, le grade des juifs est représenté par des étoiles jaunes, le port des feuilles de chêne sur la casquette leur étant interdit.
Témoignages
Le compositeur Serge Gainsbourg, faisant allusion à l'Occupation où, enfant, il fut obligé de porter l'étoile jaune, dira avec ironie mais non sans ressentiment que c'était une étoile de shérif dans sa chanson Yellow Star.
Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie 2002 :
"Alors que les juifs devaient porter l'étoile jaune et respecter un couvre feu à six heures, je rentrais tard après avoir été jouer avec des camarades chrétiens. Alors que je marchais dans la rue, un soldat allemand s'approche. Il portait l'uniforme noir des SS que l'on m'avait appris à craindre plus que tout. Alors que j'accélérais le pas, arrivant à son niveau, je notais qu'il me regardait intensément. Il s'est penché vers moi, m'a pris puis serré dans ses bras. J'étais terrifié qu'il ne remarque mon étoile sous mon chandail.
Il me parlait avec émotion, en allemand.
Il a desserré son étreinte, ouvert son porte-monnaie, montré la photographie d'un petit garçon et donné de l'argent. Je suis rentré à la maison, plus convaincu que jamais que ma mère avait raison :
"les gens sont infiniment compliqués et intéressants ".
Marcel Aymé, s'est révolté contre le port de l'étoile. Henri Jeanson rapporte :
"L’apparition de l’étoile jaune souleva la colère des Parisiens et ils surent la manifester, cette colère, à leurs risques et périls. Je me souviens très bien que Marcel Aymé, dont l’impassibilité n’était qu’apparente, écrivit alors sous le coup d’une émotion, qu’il ne put ni ne voulut maîtriser, un article d’une violence inouïe contre les responsables de ces mesures ignobles et humiliantes qui nous atteignaient tous.
Cet article, il le proposa en toute innocence à un journal.
L’article fut accepté, composé et soumis à l’obligatoire censure allemande qui, comme prévu, en interdit la publication. à l’imprimerie, les typos en tirèrent alors de nombreuses épreuves à la brosse et se firent un devoir de les distribuer autour d’eux avec prière de faire circuler.
Apparitions dans la culture
En 1973, dans le roman Un sac de billes de Joseph Joffo, le narrateur, un écolier, échange son étoile jaune contre un sac de billes, qui donne son titre à l'œuvre.
En 1986, dans son sketch On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle ?, l'humoriste Pierre Desproges incarne, au second degré, un personnage antisémite qui présente l'étoile jaune avec une évidente mauvaise foi comme un objet de fierté pour les Juifs, qu'ils instituèrent eux-mêmes :
"On ne m'ôtera pas de l'idée que, pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux Juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, cachaient mal une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste pour bien montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu
Dans la chanson Petit Simon, Simon étant un prénom d'origine hébraïque de Hugues Aufray figure le refrain " Les étoiles ne sont pas toujours belles / Elles ne portent pas toujours bonheur / Les étoiles ne sont pas toujours belles / Quand on les accroche sur le cœur" .
Dans d'autres pays
-Belgique : Le port de l'étoile sera imposé par l'ordonnance du 1er juin 1942. Les bourgmestres de l'agglomération de -Bruxelles écriront le 5 juin aux autorités allemandes :
"Vous ne pouvez exiger de nous une collaboration à son exécution. Un grand nombre de Juifs sont belges, et nous ne pouvons nous résoudre à nous associer à une prescription qui porte atteinte aussi directement à la dignité de tout homme quel qu'il soit ".
-Îles Anglo-normandes : La 8e ordonnance a été enregistrée le 30 juin 1942 par le tribunal royal de Guernesey mais, sur intervention du gouverneur et du procureur général, elle ne sera pas enregistrée à Jersey par le bailli Alexander Coutanche premier citoyen, chef du législatif et du judiciaire.
Passant outre, l'OKVR Wilhelm Casper adressera au Haut commandement SS à Paris, la liste des Juifs des deux îles, et demandera si les Juifs anglais, comme ceux d'autres nationalités, devaient porter l'étoile, avec la mention Jew
L'antisémiste
Dans un pamphlet publié en 1879, La Victoire du judaïsme sur la germanité, le journaliste et agitateur politique allemand Wilhelm Marr utilise les mots de "sémitisme" et d' "aryanisme", dérivés des classifications de la linguistique et de l'anthropologie physique de la seconde moitié du XIXe siècle.
La même année, il fonde la Ligue antisémite, qui consacre l'entrée du terme antisémitisme Antisemitismus dans le vocabulaire politique.
Produite directement par les idéologies nationalistes et racistes alors en pleine expansion, cette expression nouvelle de la haine contre les juifs n'est cependant pas sans liens avec ce que Hannah Arendt désigne, dans la Préface de Sur l'antisémitisme, par haine religieuse du Juif religious Jew-hatred qu'on appelle aujourd'hui antijudaisme, hostilité repérable dès l'Antiquité, qui va se prolonger et s'amplifier au Moyen Âge dans l'Occident chrétien, et finalement perdurer jusqu'au XXe siècle.
L'antijudaïsme ne naît certes pas avec le christianisme, même si sa version chrétienne comporte une dimension théologique absente dans les sociétés païennes, déterminante pour comprendre les conditions spécifiques d'apparition de l'antisémitisme contemporain dans la culture occidentale.
Il nous faut donc nécessairement faire retour sur cette « préhistoire » de l'antisémitisme avant d'aborder en tant que telles les causes immédiates de sa naissance et de son développement, aux XIXe et XXe siècles.
L'antijudaïsme de l'Antiquité au Moyen Âge
L'Antiquité païenne et chrétienne
L'hostilité aux juifs n'avait pas de caractère systématique dans les empires de l'Antiquité, qui étendaient leur domination sur de multiples peuples aux cultes les plus divers.
En Perse, en Grèce ou à Rome, les tensions ne procédaient pas principalement d'une mise en accusation de la religion juive ni d'une volonté de la société dominante de démontrer les erreurs des juifs par rapport à ses propres croyances.
La persécution déclenchée à partir de — 167 par Antiochus IV Épiphane, qui entend interdire la pratique de la religion juive en Judée et force les juifs à participer aux rites païens, fait de ce point de vue figure d'exception.
La profanation et le pillage du Temple de Jérusalem, les massacres et conversions forcées et l'instauration, dans le Temple, du culte de Zeus Olympien traduisent, combinés aux intentions politiques, des motifs expressément religieux qu'on ne retrouve pas par exemple chez les Romains, lorsqu'ils répriment les insurrections juives des Ier et IIe siècles.
On peut cependant repérer, chez les lettrés grecs et romains, la constitution précoce d'un discours a priori hostile aux juifs. Depuis Hécatée d'Abdère à la fin du IVe siècle av. J.-C. jusqu'à Dion Cassius, 155-235, en passant par Diodore de Sicile, Cicéron, Sénèque ou Tacite, les Anciens ont colporté des récits sur l'origine, les croyances et les rites du peuple juif où le mépris le dispute à l'ignorance.
L'opprobre frappant ce peuple de lépreux expulsés d'Égypte, son inconcevable prétention à ne reconnaître qu'une seule divinité sans effigie, ses pratiques irrationnelles avérées, circoncision, sabbat ou inventées pour la circonstance (adoration d'un âne, meurtre rituel), enfin la menace que représenterait son influente diaspora, tels sont les principaux motifs ressassés par les auteurs païens pour le stigmatiser.
L'antijudaïsme chrétien procède de mobiles différents.
Né de la prédication au Ier siècle de Jésus de Nazareth et de ses disciples, le christianisme est l'une de ces nombreuses sectes messianiques et apocalyptiques juives qui surgissent à l'époque, au sein d'un judaïsme profondément divisé sur l'attitude à adopter face à l'occupant romain et à l'hellénisation qui progresse grâce à lui.
Il en conserve évidemment de nombreux traits, comme le montrent les communautés judéo-chrétiennes du Ier siècle, qui entendent continuer d'observer la loi juive, circoncision, sabbat, interdits alimentaires, etc..
Il ne s'en sépare définitivement qu'à l'issue des deux guerres juives de 66-70 et de 132-135, qui scellent la faillite du messianisme séculier et confortent le judaïsme des pharisiens, qui ont condamné l'hérésie chrétienne.
Du côté chrétien, la priorité donnée, en particulier par l'apôtre Paul, à la prédication des Gentils, les non-juifs, conduit aussi à insister sur les différences et à créer la plus grande distance possible entre les deux communautés.
Dans les écrits des pères de l'Église grecs et latins, à partir du IIe siècle, la condamnation des valeurs religieuses et culturelles juives occupe une place de choix, comme l'illustre le Contre les Juifs de Tertullien, env. 200.
Le stéréotype du peuple déicide, assassin du Christ, devient alors un argument pour les dresser l'une contre l'autre, notamment chez Eusèbe de Césarée, Grégoire de Nysse et Jean Chrysostome. Au IVe siècle, un changement radical se produit.
Par suite de l'alliance passée entre l'empereur Constantin Ier et le parti chrétien, le christianisme devient la religion prépondérante de l'Empire et s'érige en Vrai Israël , selon l'esprit, Nouvelle Alliance, face à un Israël déchu, resté attaché à l'ancienne loi, selon la chair : Ancienne Alliance.
Lorsque le christianisme est proclamé religion de l'Empire par Théodose Ier, en 380, les grandes lignes de la théologie chrétienne sont définitivement arrêtées à l'égard des juifs.
Si la religion juive est la seule à conserver le statut de religio licita accordé sous l'empire païen aux multiples religions orientales, cultes d'Isis, de Mithra, etc., c'est uniquement parce qu'Israël est considéré comme peuple-témoin d'une erreur et que sa conversion, à terme, s'inscrit dans l'eschatologie chrétienne.
Il n'en reste pas moins que les juifs, qui n'ont reconnu ni la messianité ni la divinité de Jésus, portent la responsabilité de sa crucifixion, qu'ils ont été rejetés par Dieu, chassés de leur terre et condamnés à l'errance.
Les chrétiens s'affirment les seuls héritiers et interprètes légitimes de l'Écriture, laquelle témoigne contre les juifs.
Les interprétations que font ces derniers du texte sacré sont réputées insensées, comme l'énoncera en 553 une loi de l'empereur Justinien, la novelle 146.
L'Occident médiéval
Tout au long du Moyen Âge, le sort réservé aux communautés juives variera selon les périodes et les contextes : protection relative et maintien dans une condition dépendante et humiliante, campagnes de conversion par la persuasion, persécutions violentes, conversions forcées et expulsions, diabolisation et ségrégation systématiques. L'évolution n'est pas uniforme dans l'ensemble du monde chrétien, mais une nette aggravation peut être repérée à partir du XIIe siècle.
Durant le haut Moyen Âge, l'Église s'applique à réduire la place qu'occupent encore les juifs dans la société, héritée de leur statut de citoyens sous l'Empire romain.
Elle interdit aux clercs de s'attabler avec les juifs, à ces derniers de sortir en public pendant la période de tension religieuse allant du Jeudi saint à la fin des Pâques, ou de se mêler à la population chrétienne.
Elle prohibe les mariages mixtes, jusque-là relativement fréquents, en particulier sous les Mérovingiens.
Les fonctions de percepteur d'impôts et de juge sont fermées aux juifs. Les décisions réitérées des conciles locaux, entre le VIe et le VIIe siècle, montrent en même temps que l'Église peine à les faire appliquer rigoureusement.
Elle s'attelle aussi à la tâche de ramener sur la bonne voie les juifs perfides – l'expression apparaît au VIIe siècle, l'adjectif latin étant alors utilisé au sens d' infidèle –, par la conversion au christianisme en usant davantage de la persuasion que de la contrainte, comme le préconisait le pape Grégoire le Grand.
Ces mesures de l'Église n'altèrent pas encore en profondeur la condition des juifs dans le royaume franc, malgré la précarité qu'elles lui impriment, et n'apparentent nullement leur sort à celui de leurs coreligionnaires de l'Espagne wisigothique, après la conversion au christanisme des souverains de ce pays. Néophytes zélés, ceux-ci vont redoubler de rigueur à l'égard des juifs.
Finalement, le roi Sisebut les oblige en 613 à recevoir le baptême.
Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans des terres plus hospitalières, notamment en Provence.
La période des croisades marque un tournant dans l'antijudaïsme chrétien d'Occident.
En 1095, l'appel à la première croisade entraîne une vague de violences contre les juifs, dans une moindre mesure en France mais surtout dans la vallée du Rhin.
Des communautés sont massacrées à Spire, Mayence, Worms, Ratisbonne. La pratique des conversions forcées provoque des suicides collectifs pour échapper à l'apostasie.
Les récits juifs des persécutions qui ont accompagné le passage des croisés font état de la protection accordée par certains évêques. En tout état de cause, l'Église ne peut être tenue responsable des massacres commis.
Elle condamne derechef les violences similaires déclenchées par la deuxième croisade, en 1146.
La bulle Sicut Iudeis prise par le pape Calixte II en 1122 ou 1123, qui garantissait la protection des juifs, fut réitérée par plusieurs de ses successeurs jusqu'au XVe siècle.
Le resserrement de l'étau
Aux XIIe et XIIIe siècles apparaissent un peu partout en Occident chrétien des symptômes inquiétants d'une dégradation de la condition juive.
Les juifs dépendent de plus en plus du seul bon vouloir du prince qui peut disposer d'eux à sa guise.
C'est ainsi que Philippe Auguste expulse les juifs du domaine royal en 1182 pour mettre la main sur leurs biens et renflouer le Trésor, avant d'autoriser leur retour en 1198.
Le règne de Saint Louis est quant à lui marqué par toute une série de mesures dirigées contre les juifs et par le brûlement du Talmud : 1242 ou 1244.
C'est aussi l'époque où resurgit la calomnie du meurtre rituel.
Dans cette nouvelle version, les juifs sont accusés d'utiliser le sang de chrétiens sacrifiés pour la confection des pains azymes consommés pendant la fête de Pâque.
La première de ces accusations est proférée en 1144 à Norwich en Angleterre.
Malgré la dénonciation expresse de ce mensonge par Innocent IV dans sa lettre Lacrimabilem Iudaeorum adressée aux évêques en 1247, l'accusation se répétera. À Blois, en 1277, elle aboutit à l'anéantissement presque total de la communauté locale.
Elle est suivie de bien d'autres.
Depuis le quatrième concile du Latran, en 1215, le juif doit porter sur lui la marque de sa différence : la rouelle en France, un chapeau particulier en Allemagne, un signe en forme de tables de la Loi en Angleterre.
À la longue, l'antijudaïsme, justifié en dernière instance par la science théologique, a gagné à la fin du XIIIe siècle l'ensemble de la société chrétienne.
Une nouvelle période d'expulsions s'ouvre pour les juifs d'Europe. En 1290, ce sont les communautés d'Angleterre et de Gascogne qui sont chassées.
Des expulsions locales sont décidées en Allemagne et en Italie.
En 1306, Philippe le Bel expulse une nouvelle fois les juifs du royaume de France.
Le Moyen Âge finissant est marqué par de profonds bouleversements.
Les famines et les épidémies sont plus fréquentes.
Les populations sont décimées.
L'Occident est traversé par des crises sociales, économiques, politiques et religieuses.
Tandis que les interdictions faites aux chrétiens de pratiquer l'usure se font de plus en plus rigoureuses, la spécialisation progressive du groupe juif dans le prêt à intérêt contribue à accentuer sa différence, même s'il est bien loin d'en avoir le monopole, banquiers cahorsins et lombards.
Il devient la cible d'une certaine frange de la société, qui constitue sa clientèle, en particulier en période de famine ou de crise économique, où il est livré à la vindicte populaire.
Les années 1320-1321 voient déferler une croisade de pauvres, essentiellement des bergers, la croisade dite « des pastoureaux ». Elle donne lieu à des persécutions et des massacres de juifs dans le Midi, puis en Touraine et dans le Berry, où ces derniers sont accusés, avec les lépreux, d'empoisonner les puits. En 1336 et 1339, des bandes de paysans pauvres, les Judenschlager : tueurs de juifs, réunies autour d'un chef qu'ils appellent le roi Armleder, font régner la terreur de l'Alsace à la Souabe.
Pendant la grande épidémie de peste noire de 1348 à 1352, les juifs sont tenus pour responsables de la propagation du fléau et sont massacrés dans nombre de localités. Les persécutions s'étendent à toute l'Europe.
Les expulsions du royaume de France se multiplient à cette époque, jusqu'à l'expulsion définitive décidée par Charles VI, en 1394.
En revanche, dans le Midi et dans les territoires qui ne sont pas encore rattachés à la couronne, les juifs continuent à mener une vie relativement paisible.
Dans les royaumes d'Espagne voisins, les grandes persécutions de 1391 portent un coup fatal au judaïsme ibérique et entraînent des conversions forcées massives au christianisme qui créent la catégorie stigmatisée des conversos : convertis.
Entre 1450 et 1520, de nombreuses villes allemandes expulsent leurs juifs, puis les rappellent ; les princes agissant de même. Toutefois, l'absence, dans l'Empire germanique, d'une autorité centrale susceptible de prononcer une expulsion globale limite l'impact de ces mesures.
À la fin du XVe siècle, il est mis fin à la présence juive en Provence, annexée au royaume de France à la mort du roi René en 1480.
En 1492, les souverains espagnols expulsent définitivement les juifs de leur pays, lesquels trouvent refuge dans l'Empire ottoman et dans une moindre mesure en Afrique du Nord.
L'antijudaïsme en terre d'islam
Comparé à cette dégradation sensible observée dans le monde chrétien, le statut et la condition des juifs en terre d'islam sont restés dans l'ensemble plus stables et nettement plus cléments.
Les relations entre musulmans et non-musulmans étaient régies par le pacte de la dhimma, un terme qui signifie à la fois garantie, foi, protection, contrat et pacte.
La présence en terre d'islam de non-musulmans, à condition qu'ils puissent se réclamer de la Bible, est expressément prévue par le Coran et la tradition, qui interdisent de les convertir par la contrainte et règlent en détail leur statut par une série de clauses qu'aucune autorité terrestre n'est censée pouvoir abroger ni modifier.
Grâce à ces clauses, de fortes minorités chrétiennes et juives ont vécu longtemps au milieu des sociétés musulmanes en jouissant du statut de dhimmi, de protégés , astreints au paiement de l'impôt de capitation.
Leur infériorité se définit en termes sociaux et religieux. Les juifs sont obligés de se distinguer des musulmans par leur costume, leur coiffure, leurs montures et même par le choix de leurs noms.
En contrepartie de ces restrictions, ils obtiennent la garantie de leur vie et de leurs biens et jouissent d'une grande liberté dans tout ce qui touche leurs affaires intérieures.
La compétition religieuse était moindre entre l'islam et le judaïsme, malgré des poussées d'hostilité virulente à l'endroit des juifs la persécution des Almohades au XIIe siècle en fournissant le pire exemple.
Les formes précitées de l'antijudaïsme médiéval chrétien ne se manifesteront donc pas en terre d'islam.
Cette relative quiétude des relations entre les deux religions se maintiendra jusqu'à l'époque coloniale.
L'antijudaïsme de la Renaissance au XVIIe siècle
Dans l'Espagne du XVe siècle, la suspicion permanente et la jalousie entretenue à l'encontre des conversos et de leur descendance, aussi appelés nouveaux chrétiens ou marranes, fait naître l'idée chez certains vieux chrétiens d'exiger des statuts de pureté du sang : estatutos de limpieza de sangre pour l'accès aux offices publics.
Le premier de ces statuts, arrêté par la ville de Tolède en 1449, fut condamné catégoriquement la même année par la bulle Humani generis inimicus du pape Nicolas V, en pure perte.
Rapidement étendus aux ordres religieux, aux corporations de métier, officialisés en 1501 par deux pragmatiques des Rois Catholiques pour les fonctionnaires royaux, les statuts de pureté de sang, qui viseront aussi les chrétiens d'ascendance musulmane : Moriscos ou hérétique, deviennent une obsession en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles.
Après le milieu du XVIe siècle, en raison de ces statuts, bien des secteurs de la vie politique et économique furent réservés à des vieux chrétiens au sang pur : sangre limpia.
Cette loi discriminatoire, abolies au Portugal en 1773, sévira en Espagne jusqu'au XIXe siècle.
L'Inquisition, instaurée en 1478 en Espagne et en 1547 au Portugal, se chargera pour sa part de traquer les moindres pratiques judaïsantes chez les conversos et leurs descendants jusqu'au XVIIIe siècle.
Ni la Renaissance ni la Réforme ne parviennent à modifier l'image et la condition dégradées des juifs d'Europe.
Le développement de l'imprimerie en Europe contribue puissamment à la propagande des stéréotypes antijuifs. Un humaniste comme Érasme ne leur applique guère ses principes de tolérance.
Dépité qu' ils n'aient pas adhéré à sa nouvelle doctrine, Luther publie en 1543 trois pamphlets Von den Juden und ihren Lügen :À Propos des juifs et de leurs mensonges, qui non seulement reprend les calomnies médiévales, mais appellent ouvertement à la violence contre les juifs, à brûler leurs synagogues et à les bannir.
En raison du rejet par Luther de la doctrine de la transsubstantiation – qui affirme la présence réelle du Christ dans l'eucharistie –, les calomnies de meurtre rituel et de profanation d'hostie tendent en revanche à disparaître dans le monde protestant européen.
C'est le courant calviniste, davantage ancré dans l'Ancien Testament, qui se montre finalement le plus accueillant à leur égard.
Les nouveaux chrétiens fuyant la péninsule Ibérique créent à partir du XVIe siècle de nouvelles communautés dans le nord de l'Europe, en des lieux qui n'en abritaient pas jusque-là, notamment à Amsterdam,.
C'est le puritain Cromwell qui autorise finalement en 1656 le retour des juifs en Angleterre, d'où il avaient été bannis en 1290 par un édit d'Edouard Ier.
Dans l'Europe catholique, les territoires relevant de la papauté, Comtat Venaissin, Avignon et domaine pontifical italien sont les seuls encore, au début du XVIe siècle, en mesure de garder leurs juifs ou d'en accueillir de nouveaux.
Mais la Contre-Réforme, en raison de son retour à l'orthodoxie doctrinale catholique, réaffirme avec vigueur son hostilité aux juifs infidèles et meurtriers du Christ.
Cette période correspond à l'apparition des ghettos, conséquence de lois contraignant les juifs à habiter dans un quartier unique et fermé, et mesure qui contribue à les marginaliser davantage. Le premier d'entre eux est implanté à Venise en 1516.
Cette ségrégation restera effective durant tout le XVIIe siècle.
Absents du royaume de France, mis à part dans le Sud-Ouest, où ils sont tolérés dès le XVIe siècle en tant que marchands portugais ou en Lorraine et en Alsace, avec l'entrée des troupes françaises à la même époque puis l'annexion de ces régions au XVIIe siècle, les juifs n'en continuent pas moins de rester la cible privilégiée de l'hostilité à la moindre crise.
Le Parlement de Paris juge ainsi nécessaire, en 1615, de renouveler l'édit d'expulsion de 1394.
Les Lumières et l'antijudaïsme
Les philosophes des Lumières ont eu en général peu de contacts suivis avec des juifs, ce qui les a laissés en partie réceptifs aux préjugés hostiles traditionnels qui se maintiennent encore au XVIIIe siècle.
Il faut replacer leurs propos dans le cadre de leur conception de la rationalité comme force libératrice, qui leur commandait de soustraire l'individu au joug oppressant de la religion, quelle qu'elle fût.
Dans les pamphlets antireligieux qui circulent à l'époque, juifs et catholiques sont ainsi souvent logés à la même enseigne.
À défaut de sympathie, Montesquieu invite néanmoins à la tolérance à l'égard des juifs dans les Lettres persanes en 1721, ce qui ne l'empêche pas de manifester de l'hostilité tant à l'égard du Talmud que des rabbins.
Dans L'Esprit des Lois en 1748, il s'insurge contre les inquisiteurs d'Espagne et du Portugal et va jusqu'à demander la création d'une ville de refuge, à Saint-Jean-de-Luz ou à Ciboure, pour les juifs persécutés de la péninsule Ibérique.
L'Encyclopédie, 1751-1772 contient des critiques contre le judaïsme – biais pour combattre le christianisme –, mais elle renferme également des articles, notamment l'article Juif, rédigé par le chevalier de Jaucourt et Diderot faisant preuve d'une ouverture inédite à l'égard de la réalité juive.
Aujourd'hui oublié, le marquis d'Argens, dont les écrits étaient largement diffusés, conviait lui aussi à la tolérance dans ses Lettres juives, 1736-1737, tout en s'opposant à l'enseignement talmudique et aux rabbins.
Voltaire ne distingue pas entre un jésuite et un juif pieux ashkénaze, tous deux symboles d'un passé dont les philosophes comptent abolir les vestiges.
Son combat antireligieux ne pouvait pas ne pas s'en prendre au judaïsme, source du christianisme.
Pour Voltaire, la Bible comporte des superstitions comme n'importe quel autre texte sacré ; il était naturel qu'elle focalise ses critiques, et, avec elle, le peuple qui y puisait son enseignement.
Reste que, sous l'ironie voltairienne, on reconnaît les préjugés du christianisme et du paganisme, repris et amplifiés. Plusieurs chapitres de l'Essai sur les mœurs en 1753 et nombre des cent dix-huit articles du Dictionnaire philosophique en 1764 contiennent des attaques virulentes contre les juifs.
Rousseau, quant à lui, se situe nettement dans la tradition de tolérance ouverte par les milieux érudits calvinistes au siècle précédent, illustrée par Pierre Bayle et son Traité de tolérance universelle en 1686 et par le Rouennais Jacques Basnage, 1615-1695.
Tout en rejetant le judaïsme et ses prescriptions, ce dernier manifeste une claire sympathie à l'égard des juifs, victimes eux aussi de l'Église romaine et de son intolérance. Il préconise de fonder pour eux des écoles, des universités et aussi un État, parce qu'il les considère comme les tenants de la religion naturelle.
D'une manière générale, les philosophes, imbus de rationalisme et d'universalisme, sont peu favorables au judaïsme et au peuple juif. Hostiles à l'oppression et à la discrimination, ils revendiquent bien pour lui davantage d'humanité, mais sans pour autant vraiment connaître et respecter la spécificité du monde juif.
Plus que de la reconnaissance du juif en tant que juif, les apôtres des Lumières sont surtout soucieux de sa régénération par l'éducation et l'exercice de métiers considérés comme plus utiles à la société que le prêt à intérêt et le colportage.
Dans le même esprit, l'abbé Grégoire dénonce dans son Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs de 1787 la propension des juifs à se multiplier, leur dégénérescence, dénigre le Talmud, prône la disparition de la langue yiddish, demande de combattre le pouvoir des rabbins et espère en dernière analyse leur conversion.
Malesherbes se situe dans la même mouvance.
À la fin du XVIIIe siècle, les termes ainsi posés du problème juif se retrouvent jusque chez les réformateurs juifs. Notable juif alsacien, Isaac Cerf-Berr Hirtz de Bischheim, 1726-1793 finance le plaidoyer en faveur des juifs de l'historien protestant Christian Wilhelm Dohm, 1751-1820, Ueber die buergerliche Verbesserung der Juden, écrit à la demande de Moses Mendelssohn, principal figure du mouvement de la Haskala, les Lumières juives.
Paru à Berlin en 1781, il est traduit par Jean Bernoulli en 1782 sous le titre De la réforme politique des juifs.
Mirabeau reprend quelques-unes des idées contenues dans l'ouvrage et publie en 1787, à Londres, une brochure intitulée Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des juifs et en particulier sur la Révolution tentée en leur faveur en 1753 dans la Grande-Bretagne. L'ère des réformes, de fait, s'annonçait déjà en Europe avec l'édit de Tolérance :Toleranzpatent pris en 1781-1782 par Joseph II à la tête du Saint-Empire.
Éclosion de l'antisémitisme au XIXe siècle
Aboutissement politique des réflexions engagées par les Lumières, la loi relative aux Juifs adoptée par l'Assemblée nationale le 27 septembre 1791 et promulguée par Louis XVI le 13 novembre apporte à la question juive une réponse qui consacre pour la première fois en Europe le principe de l'égalité en droit des juifs.
Le choc de l'émancipation
L'émancipation des Juifs en Francede 1790-1791 suscite des réactions diverses.
Il y a ceux qui craignent que les juifs ne remplissent pas leurs obligations à l'égard de la nation qui les a reconnus comme citoyens à part entière.
Il y a aussi ceux qui par principe refusent cette entrée dans la nation, les partisans de l'ordre ancien, fondé sur la ségrégation et les discriminations.
L'émancipation s'était accompagnée de l'octroi de facilités de remboursement aux débiteurs chrétiens des juifs et de l'annulation de nombre de créances. Les méthodes de l'Ancien Régime n'avaient pas tout à fait disparu. Par la suite, la Terreur, avec sa politique antireligieuse dirigée contre les prêtres réfractaires, n'épargne pas non plus les juifs.
Au fil de ses victoires, Napoléon étend l'émancipation en Europe.
Au niveau de l'organisation du culte, son règne ouvre une phase nouvelle.
En 1808, il crée les consistoires, parallèlement aux consistoires protestants. Reste que d'un point de vue juridique, la période napoléonienne constitue une régression.
En 1808 toujours, l'Empereur prend un décret par la suite qualifié de décret infâme, qui instaure un système d'inégalité juridique pour les juifs en reprenant quelques-unes des pratiques discriminatoires de l'Ancien Régime.
Il reste en vigueur pendant dix ans. Après 1848, l'émancipation des juifs s'impose un peu partout en Europe.
Les trois sources modernes du rejet
Dominant la société d'Ancien Régime dans son ensemble, l'antijudaïsme hérité du christianisme se politise en se réduisant peu à peu à la droite monarchiste antilibérale et à sa clientèle paysanne, opposées au capitalisme industriel et financier.
L'Église romaine reste quant à elle inflexible dans son hostilité religieuse, comme l'illustre tristement, en 1858, l'affaire Mortara : baptisé secrètement par une servante chrétienne, Edgardo Mortara est enlevé en toute légalité canonique à ses parents juifs à l'âge d'un an pour être élevé catholiquement puis ordonné prêtre, en dépit des protestations internationales.
Dans l'imagerie populaire et rurale correspondant à ce courant, le juif est l'agent de la Révolution, le persécuteur du clergé, le fossoyeur de la religion et de la civilisation chrétiennes, accusations réactivées lors de la révolution russe. L'antijudaïsme religieux du XIXe siècle est donc nettement contre-révolutionnaire, associé au clan « ultra ». Il est plus virulent que jamais sous la IIIe République, à partir de 1879, en réaction au programme de laïcisation de l'éducation entrepris par le nouveau régime.
Le juif est considéré non seulement comme l'artisan de la Révolution et de l'anticléricalisme, mais aussi comme le persécuteur du clergé, le fossoyeur de la religion et de la civilisation chrétiennes. Dès le début du siècle, cet antijudaïsme a produit une abondante littérature.
Il prend de l'ampleur sous le second Empire, avec la parution, en 1869, de l'ouvrage du chevalier Henri Gougenot des Mousseaux, Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens, qui deviendra une référence de l'antisémitisme.
La gauche apporte sa propre contribution au renouvellement du discours de haine contre les juifs. Les premiers théoriciens de la révolution industrielle et de la classe ouvrière, tels Charles Fourier, Pierre Joseph Proudhon et Auguste Blanqui, dénoncent les conséquences de cette révolution ainsi que le cortège d'injustices qu'elle entraîne et préconisent le retour au stade préindustriel.
À l'exception notable du mouvement saint-simonien, cet anticapitalisme socialiste vire très facilement à l'antisémitisme économique : le juif devient alors ce parasite qui infeste, d'après Fourier, les fonctions improductives du commerce, qui investit dans les machines destructrices de travail, qui détourne le revenu des classes laborieuses.
Déclaré hier ennemi du vrai Dieu par les chrétiens, le voici métamorphosé en ennemi du peuple par le millénarisme socialiste à son tour en quête de coupable.
Dans cet avatar athée de morale chrétienne, les juifs seront globalement assimilés aux Rothschild, agents du mal absolu : l'égoïsme et l'injustice capitalistes. Dans Les Juifs rois de l'époque : histoire de la féodalité de l'époque, ouvrage en deux volumes publié en 1845, Alphonse Toussenel, un disciple de Fourier, stigmatise le règne de l'argent.
Ses formules tendancieuses sur les juifs inspireront nombre d'antisémites extrémistes comme Édouard Drumont, ainsi qu'un antisémitisme conservateur et rural qui trouve plus tard son expression dans l'Action française.
Au début de la IIIe République, les plus importants écrits se tendance antisémite sont dus à la plume de socialistes tels Albert Regnard, Gustave Tridon, ou Auguste Chirac.
Il faudra attendre l'affaire Dreyfus pour que la gauche républicaine rompe finalement avec cette tradition.
Alfred Dreyfus
L'officier français Alfred Dreyfus, 1859-1935. Accusé à tort de trahison, en 1894, il est emprisonné à l'île du Diable. Il sera gracié en 1899 et réhabilité en 1906.
Crédits: Hulton Getty Consulter
Si certains socialistes de la première heure confondent juifs et banquiers juifs avec capitalisme, d'autres deviennent antisémites en raison de positions antireligieuses.
Les Rothschild nourrissent le fantasme des antisémites de droite et de gauche, avec son corollaire, la hantise du pouvoir juif occulte.
C'est l'ère de la dénonciation du complot juif qui s'ouvre, un thème récurrent supposé expliquer tous les troubles sociaux et politiques, bientôt indissociable de son jumeau, le complot franc-maçon.
Le troisième discours moderne de rejet des juifs qui se met en place au cours du siècle n'est pas d'ordre religieux ou socio-économique, mais d'ordre pseudo-scientifique.
Détournant à son profit les catégories de la linguistique, de l'anthropologie physique et de la biologie évolutionniste, l'antisémitisme pseudo-scientifique dresse des hiérarchies entre les races, idéalise l'aryen et fait du sémite son négatif, affligé des signes physiques visibles de son infériorité.
Cette science récente qu'est alors l'anthropologie était très imprégnée des idées de race, de sélection et de hiérarchie naturelles : Paul Broca en France, Ernst Haeckel en Allemagne, Herbert Spencer et Francis Galton en Grande-Bretagne fondent toute leur science sociale sur la mesure des différences biophysiques.
Anthropométrie et craniométrie fournissent les armes de cette anthropologie physique, prétexte à une hiérarchisation des cultures reposant en dernière instance sur le postulat raciste de la supériorité blanche.
Mais ce sont des figures beaucoup plus obscures, et pour tout dire marginales, que l'on tient pour les véritables pères de la raciologie.
Dénuées de tout projet de restauration de la race supérieure, les élucubrations pessimistes d'un Gobineau, dans son Essai sur l'inégalité des races humaines, paru de 1853 à 1855, sur la déchéance irréversible des Arians condamnés au métissage, n'en dressent pas moins la première histoire raciste de l'humanité construite autour du mythe aryen.
Dans ses Lois psychologiques de l'évolution des peuples, paru en 1894, Gustave Le Bon propose quant à lui une hiérarchie psychologique des races et ironise sur cette obscure petite tribu de Sémites qui n'a jamais rien apporté à la civilisation.
Enfin Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) reprend le mythe aryen de Gobineau en l'appareillant de données anthropométriques qu'il combine à l'eugénisme de Galton pour en tirer un véritable programme politique dans L'Aryen, son rôle social en 1899, où les Juifs sont présentés comme les seuls concurrents dangereux des Aryens.
Cet antisémitisme raciste trouve d'ardents défenseurs en Allemagne et en Grande-Bretagne.
En France, c'est Édouard Drumont qui réussit à donner à cette tendance de l'antisémitisme une large diffusion, lui adjoignant des références à Taine et à Renan. Maurice Barrès, à son tour, fonde sur elle son antisémitisme.
Ses prétentions scientifiques sont par contre rapidement anéanties par la critique des sociologues durkheimiens, qui sont aussi dreyfusards.
Deux décennies de convulsions
L'Europe des années 1880 connaît une grave récession économique.
Les mutations politiques, sociales et économiques déstabilisant les sociétés d'Europe vont précipiter le rapprochement des diverses tendances antijuives, donnant naissance à l'antisémitisme moderne.
En France, avec l'arrivée des républicains anticléricaux, le clergé et les milieux aristocratiques sont écartés du pouvoir. On est en pleine guerre de religions entre catholicisme et rationalisme. Le complot juif fournit l'explication imparable de leurs déboires.
Ainsi le krach, en 1882, de l'Union générale, banque catholique créée en 1878 par Paul-Eugène Bontoux, ancien employé des Rothschild, est attribué à l'action de ces derniers, alors même que le procès condamne son fondateur pour opérations frauduleuses.
La droite et la presse catholiques se déchaînent contre les juifs.
Dix années plus tard, le scandale de Panamá, affaire de corruption politique impliquant parmi beaucoup d'autres quelques hommes d'affaires juifs, se solde à nouveau par la ruine de milliers de petits épargnants.
Dès lors, l'antisémitisme se déploie fiévreusement sous toutes ses formes, et antirépublicanisme et antisémitisme se confondent.
L'ouvrage du journaliste Édouard Drumont, La France juive, cristallisant toutes les tendances de l'antisémitisme, paraît en 1886, entre le krach et le scandale de Panamá, en deux volumes totalisant 1 200 pages.
C'est un formidable succès éditorial.
En deux mois, plus de 70 000 exemplaires sont vendus et plus de 100 000 avant la fin de l'année.
Le livre connaît ultérieurement des dizaines de rééditions et des suites.
L'antisémitisme prôné par Drumont fédère les forces opposées des catholiques et des ouvriers dans le combat contre la République, supposée capitaliste, enjuivée et anticatholique. Il devient une idéologie et une pratique politique capables d'expliquer et de résorber crises et mécontentements.
Il cristallise l'identité nationale dans un rapport d'opposition au juif, perçu comme une menace pour l'intégrité de la nation.
L'extrême droite en fait désormais le plus large usage.
En 1892, Drumont fonde son propre journal, La Libre Parole, qui fait éclater publiquement le scandale de Panamá et se distingue par un antisémitisme d'une extrême violence.
Dans la presse catholique officielle, les différentes éditions parisiennes et régionales de La Croix, contrôlé par les pères assomptionnistes, et du Pèlerin, avec leurs 500 000 exemplaires, enfin la revue Civilisation catholique des jésuites concourent également à l'essor de cet antisémitisme de plume.
À quoi il faut ajouter l'impact des ligues comme la Ligue antisémitique, qui compte finalement 11 000 militants en juillet 1898.
La passion antisémite est à son comble le 5 janvier 1895, lors de la cérémonie de dégradation du capitaine Dreyfus, faussement accusé de trahison.
L’évènement allait fortement impressionner le futur fondateur du sionisme, Theodor Herzl.
Des violences antisémites se produisent simultanément en province et en Algérie. Personne alors ne doute de la culpabilité du premier officier juif entré à l'état-major des armées.
Ce n'est qu'à partir de 1896, avec la mise en évidence des faux versés comme pièces à conviction par l'état-major au procès que l'affaire va véritablement éclater, mobiliser l'opinion.
Au départ, il ne s'était agi que d'un fait relativement insignifiant. Mais l'Affaire finit par constituer un tournant dans l'histoire du pays. De ce point de vue, on ne saurait la réduire à une simple affaire juive.
L'antisémitisme n'en avait pas moins joué un rôle important dans la condamnation du capitaine Dreyfus, finalement réhabilité et réintégré dans l'armée en 1906.
La suite --> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=3108#forumpost3108
     
Posté le : 31/08/2013 13:38
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:15:40
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:18:33
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:24:34
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:32:58
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:35:48
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:37:53
Edité par Loriane sur 02-09-2013 12:03:34
Edité par Loriane sur 02-09-2013 12:04:19
Edité par Loriane sur 02-09-2013 13:13:35
|
|
|
|
|
Invasion de la Pologne 1 Septembre 1939 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le Premier Septembre 1939 à 5 heures du matin, la Wehrmacht envahit la Pologne
en quelques heures la violence de l'Allemagne nazie se déchaîne sur la Pologne.
"La Pologne est entre les dents du chien nazi" Et personne ne lui portera secours, l'Ouest est trop content de voir l'est attaqué.
Pour l'opinion mondiale, il ne fait guère de doute que cette agression sans déclaration de guerre préalable marque le début de la Seconde Guerre mondiale
L'invasion de la Pologne par la Wehrmacht : armée de terre commence le 1er septembre 1939 à 5 heures, sans mobilisation préalable et sans déclaration de guerre ; un groupe de SS , Schutzstaffel, brigade de protection, déguisés en soldats polonais, a justifié l'invasion par un simulacre de raid polonais en territoire allemand.
Les Allemands possèdent l'arme de la guerre éclair : la Panzerdivision, unité autonome disposant d'environ 300 chars, de troupes d'assaut motorisées, d'une artillerie tractée ; ravitaillée par air, agissant en étroite liaison avec l'aviation, elle allie mobilité et puissance.
L'invasion de la Pologne par la Wehrmacht : armée de terre commence le 1er septembre 1939 à 5 heures, sans mobilisation préalable et sans déclaration de guerre ; un groupe de SS , Schutzstaffel, brigade de protection, déguisés en soldats polonais, a justifié l'invasion par un simulacre de raid polonais en territoire allemand.
Les Allemands possèdent l'arme de la guerre éclair : la Panzerdivision, unité autonome disposant d'environ 300 chars, de troupes d'assaut motorisées, d'une artillerie tractée ; ravitaillée par air, agissant en étroite liaison avec l'aviation, elle allie mobilité et puissance.
La montée des tensions
Bien que gouvernés par des colonels proches de l'extrême-droite, les Polonais s'inquiètent de la menace allemande après l'occupation de Prague par la Wehrmacht, le 15 mars 1939.
Fort de ses premiers succès sur la scène internationale, Hitler ne tarde pas à revendiquer Dantzig, Gdansk en polonais, port polonais sur la mer Baltique qui coupe en deux le territoire du IIIe Reich et isole la Prusse orientale du reste de l'Allemagne.
Ce corridor de Dantzig est un non-sens issu du traité de Versailles de 1919 qui était fatalement appelé à devenir une pomme de discorde entre les deux pays.
Dès le 31 mars, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain proclame son soutien à la Pologne.
De son côté, le chef d'état-major français Maurice Gamelin rassure ses homologues polonais sur la détermination de la France à les aider de tout son poids...
Pour Londres comme pour Paris, il n'est plus question de reculer face à Hitler comme à Munich à propos de la question sudète.
L'écrasement de la Pologne
Avant même que la mobilisation française fût achevée et le corps expéditionnaire britannique débarqué, les troupes polonaises – dans lesquelles la cavalerie jouait encore un grand rôle – étaient bousculées, puis anéanties et faites prisonnières. Cinq armées allemandes, dont quatre divisions blindées, convergent vers Varsovie par Bromberg, Łódz et la haute Vistule.
Tandis que l'aviation du Reich incendie des villes sans défense, dont la capitale polonaise, une « cinquième colonne » joue un rôle actif en Posnanie au profit des envahisseurs.
Dès le 9 septembre s'engage la bataille pour Varsovie, la Wehrmacht attaquant l'armée polonaise, qu'elle a tournée, de l'est vers l'ouest.
Le 17 septembre, en application du pacte germano-soviétique, l'Armée rouge envahit la Pologne orientale.
Varsovie, assiégée, bombardée, résiste quelques jours ; le 27 septembre, privée d'eau, elle se rend.
Le 28 septembre a lieu le cinquième partage de la Pologne, cette fois entre l'Allemagne et l'U.R.S.S.
Le gouvernement et quelques milliers de soldats polonais ont réussi à passer en Roumanie, d'où la plupart gagneront le Proche-Orient.
Hitler annexe au Reich Dantzig et la Posnanie.
Autour de Varsovie, il crée un gouvernement général, où sévit le racisme nazi (national-socialiste) et s'instaure la terreur.
Le martyre de la Pologne a commencé.
La drôle de guerre
À l'ouest, l'armée française a lancé une timide offensive dans la forêt de la Warndt, et conquis quelques centaines de kilomètres carrés.
Mais les quatre divisions britanniques n'ont pris position en France que le 3 octobre. Certes, la France et le Royaume-Uni ont rejeté, le 6 octobre, les propositions de paix de Hitler qui reconnaissaient le fait accompli en Pologne.
Le 16 octobre 1939, une contre-offensive allemande ramène les troupes françaises à leur point de départ, et même un peu au-delà, car Forbach est évacué.
Commence alors ce qu'on a appelé la drôle de guerre, c'est-à-dire un intermède de huit mois, marqué par des opérations de faible portée militaire ou diplomatique.
Les hostilités se limitent à des expéditions sur la mer contre les corsaires allemands, à des escarmouches de patrouilles, à une garde symbolique sur le Rhin. Cette inaction mine le moral des soldats mobilisés.
Tout en exécutant scrupuleusement les obligations du pacte qui la lie au Reich, l'U.R.S.S. s'efforce d'obtenir des contre-parties aussi avantageuses que possible.
Pour retrouver les anciennes frontières de la Russie, autant que pour créer un glacis entre elle et son inquiétant partenaire, l'U.R.S.S. occupe l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ; mais, la Finlande ayant refusé de lui céder des bases navales, terrestres et aériennes, l'Armée rouge envahit le territoire finlandais le 30 novembre.
À la surprise générale, la campagne d'hiver ne permettant pas de vastes opérations et les troupes soviétiques n'étant engagées que par petits groupes, l'armée finlandaise résiste jusqu'au mois de mars 1940.
La faiblesse militaire de l'U.R.S.S. paraît ainsi démontrée ; les gouvernements français et britannique envisagent une double attaque visant l'Allemagne à travers l'U.R.S.S. : un corps expéditionnaire qui irait au secours de la Finlande et un raid vers le pétrole du Caucase par l'aviation française stationnée en Syrie sous le commandement du général Weygand. En définitive, l'opération se limite à l'exclusion définitive de l'U.R.S.S. de la Société des Nations le 14 décembre 1939.
Accusé de mollesse dans la conduite de la guerre, Daladier a cédé la présidence du conseil des ministres à Paul Reynaud, le 21 mars.
Mais l'opinion française demeure divisée, intoxiquée par la propagande de Joseph Goebbels, ministre allemand de l'Information.
Contre l'Allemagne elle-même, le haut commandement franco-britannique se borne à supputer les intentions de la Wehrmacht en échafaudant des plans répondant à diverses hypothèses.
Il apparaît clairement qu'il faudrait devancer les Allemands en Belgique, mais le gouvernement belge accepte seulement une entrée des troupes alliées en Belgique après une attaque allemande.
Tirant partiellement les leçons de la déroute polonaise, l'état-major décide la création de quatre divisions blindées, dont la constitution, l'armement et l'entraînement s'effectuent lentement et difficilement ; elles ne comprennent que 170 chars en moyenne chacune, les autres blindés – dont le nombre total est sensiblement égal à celui des blindés allemands – demeurant éparpillés entre les unités.
Le blocus naval ne donne guère de résultat, l'Allemagne recevant de l'U.R.S.S. les matières premières dont elle a besoin. Cependant, la guerre sous-marine a commencé à l'initiative allemande : c'est un contre-blocus qui risque de gêner beaucoup l'armement et le ravitaillement du Royaume-Uni par les convois venus des dominions ou des États-Unis.
L'Italie s'étant placée en état de non-belligérance, l'état-major français ne peut pas porter la guerre dans la plaine du Pô, comme le général Gamelin l'avait un moment envisagé.
L'armée allemande se renforce sans cesse, le nombre des Panzerdivisionen passant de 5 à 12. La supériorité aérienne de l'Allemagne est écrasante ; les chasseurs britanniques valent certes les chasseurs allemands, mais ils sont inférieurs en nombre ; les bombardiers alliés font cruellement défaut.
Siège de Varsovie en 1939.
Le siège de Varsovie oppose la Armia Warszawa en garnison et retranchée dans la capitale de la Pologne, Varsovie, et l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
La bataille débute par un grand bombardement aérien de la ville par la Luftwaffe le 1er septembre 1939.
Les combats terrestres commencent le 8 septembre quand la première unité de blindés allemands arrive dans l'arrondissement de Wola et la banlieue sud-ouest de la ville.
Malgré les émissions de radio allemandes qui annoncent la capture de Varsovie, l'attaque est arrêtée peu après et Varsovie mise en état de siège.
Ce dernier dure jusqu'au 28 septembre, date de la capitulation de la garnison polonaise.
Le 26 septembre, Rómmel envoie un émissaire et les Polonais capitulent le 28 septembre à 13h15.
Avec la prise de Varsovie, 120 000 prisonniers dont 16 000 blessés ont été capturés.
Dans le secteur de Kock, près de Lublin, la 13e division d'infanterie motorisée allemande est surprise par le Groupe opérationnel indépendant de Polésie du général Franciszek Kleeberg, qui flanque les fantassins à l’aide de sa cavalerie. Les derniers coups de feu polonais sont tirés le 6 octobre.
La Bataille de Kock — la dernière de cette guerre — durera quatre jours, mais le 6 octobre des renforts vont venir à bout des dernières unités polonaises qui capitulent, à court de munitions, de moyens de transport et de ravitaillement.
Bilan
Il aura fallu un peu plus d'un mois — exactement 35 jours — aux armées allemande et soviétique pour venir à bout de la Pologne. Le gouvernement polonais ne demanda ni ne conclut d'armistice avec les forces d'invasion.
Les forces militaires qui purent s'échapper reformèrent rapidement une armée polonaise à l'étranger pour continuer le combat.
Par voie terrestre, 30 000 soldats polonais réussiront à s'enfuir par la Roumanie, que sa flotte transporte, par la mer Noire et l'Égée, à Alexandrie, en territoire britannique.
Soixante mille autres Polonais, dont de nombreux soldats, fuient par la Slovaquie, la Hongrie et la Yougoslavie : beaucoup de ces exilés rejoindront, par l'Adriatique ou par la Grèce, l'armée polonaise reconstituée en France.
Ces routes d'exil se ferment en juin 1940, après l'effondrement de la France, lorsque tous ces pays rejoignent l'orbite allemande ; dès lors, les réfugiés polonais y sont internés.
Lors de la campagne polonaise, les pertes allemandes se chiffrent à 16 660 morts ou disparus et 32 000 blessés. Ils perdent également 832 chars, toutes causes comprises dont 34112 de manière définitive.
Une autre source donne 419 chars perdus parmi lesquels 236 sont irrécupérables.
Les Polonais, quant à eux, perdent 66 300 tués, 133 700 blessés et 680 000 prisonniers, 580 000 capturés par les Allemands et plus de 100 000 capturés par les Soviétiques.
L'Etoile Rouge du 17 septembre 1940 donne les chiffres de prisonniers polonais suivants : 12 généraux, 8 000 officiers, plus de 200 000 soldats.
Les Soviétiques perdirent 737 hommes et eurent 1 125 blessés ; enfin, les Slovaques eurent 30 morts ou disparus et 46 blessés.
À ces pertes militaires s'ajoutent les pertes civiles. En effet, dès les premiers jours du conflit, on compte des morts civils, à l'image des Allemands, entre 100 et 1 000 tués lors du Dimanche sanglant de Bromberg , le 3 septembre ; ces morts sont mis en avant par le commandement allemand et servent de prétexte aux crimes dont se rendent coupables les Allemands en Pologne : incendies de villages, exécutions de civils par balle ou à la grenade.
De plus, l'armée allemande connaît la psychose du franc-tireur, particulièrement exacerbée, favorisée par la rapidité de l'avance des unités motorisées et par l'inexpérience des soldats allemands.
Ainsi, des ordres rappellent les sanctions encourues par les civils en cas de détention d'armes, en cas de tirs sur les troupes à partir de leur maison, mais aussi les prérogatives des juges en ce qui concerne les civils polonais.
Le 3 octobre 1939, Lavrenti Beria signe le décret 16/91-415 du Politburo autorisant le NKVD à échanger avec les Allemands, du 24 octobre au 23 novembre 1939, 46 000 prisonniers polonais contre 44 000 en sens inverse.
Cet échange sera unique .
Aujourd'hui
Les commémorations du 70e anniversaire respectivement de l'invasion allemande de la Pologne le 1er septembre 2009 puis du massacre de plus de 20 000 officiers polonais à Katyn par le NKVD soviétique le 7 avril 2010, enfin reconnu officiellement par Moscou, ont été l'occasion d'un grand pas sur le chemin de la réconciliation polono-russe malgré le tragique accident de l'avion présidentiel le 10 avril 2010, à Smolensk tout près de Katyn, qui coûte la vie à une centaine de hauts personnages de l'État venus pour la suite de la commémoration. Cette tragédie – en relançant en interne l'image d'une Pologne martyrisée par l'histoire – a suscité un élan d'unité nationale et une émotion partagée par les autorités russes. J. Buzek – ancien dirigeant de Solidarnosc, ancien Premier ministre libéral modéré soutenu par le PPE – est élu président du Parlement européen : le fait qu'il soit le premier Est-européen à occuper ce poste renforce l'image européenne de la Pologne.
Avec une croissance économique positive en 2009, le pays fait figure d'exception : il renonce même à utiliser le crédit ouvert par le FMI et en fournit à l'Islande.
La rigueur financière, le flottement du zloty, la taille du pays, une base industrielle peu dépendante des importations, le faible endettement des ménages, l'étroit contrôle public du système bancaire et financier, la multiplication des micro-entreprises dans les services et, enfin, l'importance des fonds structurels communautaires efficacement gérés sont autant de facteurs explicatifs.
Mais le pays doit faire face à de nombreux défis avec un taux de pauvreté de 17 %, la difficile pérennité des chantiers navals de Gdynia et de Szczecin, le mauvais état des infrastructures routières qui participe d'une forte mortalité ou la revente de l'usine Dell de Lodz – délocalisée d'Irlande en 2009 – au taïwanais Foxconn.
La démographie polonaise a basculé d'une forte natalité à un non-renouvellement générationnel.
Pour y faire face, la prime à la naissance et l'aide aux familles nombreuses ont été revalorisées alors que les débats sur l'avortement interdit par la loi de 1993 et sur la fécondation in vitro ont repris, sur fond de violente hostilité de l'épiscopat. L'émigration de deux millions d'actifs depuis l'entrée dans l'UE est victime de la crise des Îles britanniques alors que de nombreux Russes, Ukrainiens, Chinois ou Coréens travaillent illégalement sur le territoire polonais et que la frontière orientale voit affluer illégaux et réfugiés, Géorgiens, Tchéchènes, provoquant des tensions xénophobes et posant la question de l'identité nationale.
Liens
http://youtu.be/MZy4iKJ7Nn8 invasion de la Pologne
http://youtu.be/o8a6CMOZwwM L'attaque sur la Pologne
http://youtu.be/LBN5ZeDHlRA La wehrmacht 1
http://youtu.be/IQRyE2ZJh_c La Wehrmacht 2
http://youtu.be/oxzzaaZY4DE La Wehrmacht 3
p://youtu.be/Bnm9SruYd98 La Wehrmacht 4
http://youtu.be/083mGHzLXbg La guerre éclair 5
http://youtu.be/gZkB-LoMVbE début de la guerre         [img width=600]http://s3.timetoast.com/public/uploads/photos/4188377/Slide_8.jpg?1372265325[/img] 
Posté le : 31/08/2013 13:12
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:52:00
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:57:14
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:57:43
Edité par Loriane sur 02-09-2013 11:58:17
|
|
|
|
|
André Leroi-Gourhan |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 25 Août 1911 à Paris naît André Leroi-Gourhan, ethnologue, archéologue, préhistorien,
membre de l'Institut, et historien français, spécialiste de la Préhistoire. C'est aussi un penseur de la technologie et de la culture, qui sait allier précision scientifique et concepts philosophiques.
André Leroi-Gourhan
... "l'homme préhistorique ne nous a laissé que des messages tronqués" ...
Enfance
André, Georges, Léandre, Adolphe Leroi voit le jour le 25 août 1911 à Paris. Son père décède dans les premiers jours de la guerre de 14, sa mère disparaît aussi assez rapidement, si bien qu’André et son frère cadet, pupilles de la nation, sont recueillis par leurs grands-parents maternels qui vont les élever complètement.
Quelques années plus tard André, reconnaissant, ajoutera leur nom à son patronyme.
Sa grand-mère le conduit fréquemment au Jardin des Plantes et au Muséum d’Histoire Naturelle où la Grande Galerie de l’Evolution exerce sur lui un attrait particulier. Les squelettes de grands animaux, les dinosaures le fascinent.
Le troisième étage recèle également des trésors, le crâne de l’homme de Cro-Magnon entre autres. A Moret-sur-Loing avec son grand-père paternel, trésorier de l’Association des naturalistes, il court les bois, observe la nature et rencontre même quelques préhistoriens prospectant dans la région de Nemours.
La scolarité est des plus médiocres, le futur A. Leroi-Gourhan se décrit lui-même comme un "cancre reconnu ", seuls le français et les sciences naturelles l’intéressent, il est totalement sourd aux mathématiques et il le restera.
Dès qu’il atteint l’âge de 14 ans son grand-père, quelque peu lassé, lui signifie qu’il est temps pour lui de gagner sa vie et le place comme apprenti dans la bonneterie.
Toujours apprenti il change de branche et entre dans l’édition puis la librairie.
Il fait à cette époque deux rencontres déterminantes : une femme qu’il désigne comme sa " marraine " et son chef du personnel.
Sa marraine le fait baptiser et lui offre "Les Hommes fossiles" de Marcellin Boule, qui vient de paraître ; son chef du personnel le fait travailler, en particulier sur ce livre.
Etudes
Incité par sa "marraine" et son chef du personnel, il reprend ses études et donc parallélement Leroi-Gourhan fréquente l’Ecole d’Anthropologie et prépare son bac.
En 1928 sa marraine le présente à Paul Boyer administrateur de l’Ecole des langues orientales qui le recrute comme secrétaire adjoint, puis en temps qu' aide-bibliothécaire.
Son bac en poche et toujours tout en travaillant il décide de poursuivre ses études.
Son souhait est d’apprendre le russe, Paul Boyer lui conseille le chinois, langue qui doit lui permettre de rentrer dans la diplomatie et de bien gagner sa vie tout en se consacrant à ce qui l’intéresse le plus : l’ethnologie.
Qu’à cela ne tienne il étudie les deux langues et en 1931, âgé de vingt ans il obtient son diplôme de russe.
Très tôt attiré par la diversité des cultures, il suit les cours de Paul Pelliot et d'André Mazon à l'École nationale des langues orientales vivantes où il obtient donc, un diplôme de russe à vingt ans et de chinois à vingt-trois ans.
Rien ne l’arrêtera plus, en 1933 il obtient en plus de son diplôme de chinois, et prépare une licence de lettres.
Parallèlement il suit à l'École pratique des hautes études les cours de Marcel Granet. Il participe ensuite à la transformation de l'ancien Musée d'ethnographie du Trocadéro en Musée de l'Homme où il travaille dès 1933, ainsi qu'au département d'ethnographie du British Museum.
L'aventure professionnelle
En 1933-34 il est pensionnaire de la Maison de l’Institut de France à Londres où il travaille au département d’ethnographie du British Museum et du Victoria Museum.
De retour à Paris son service militaire lui laisse de nombreux loisirs qu’il emploie au tout nouveau Musée de l’Homme en qualité "d'attaché bénévole".
En 1936 paraissent ses deux premiers livres : Bestiaire du bronze chinois et La civilisation du renne.
Il publie l'année suivante "Le Mammouth dans la zoologie des Esquimaux", et "Le Kayak et le Harpon des Esquimaux", enfin, en 1937, paraît "La Zoologie mythique des Esquimaux". Cet intérêt pour les civilisations du Grand Nord et pour l'évolution de l'art et des techniques annonçait peut-être déjà son cheminement dans l'univers de la préhistoire
En 1937, le Musée de l'Homme et les Musées nationaux l'envoient en mission au Japon d'où il ramènera, en 1939, les matériaux pour sa thèse de doctorat ès-lettres dirigée par Marcel Mauss et consacrée à L'Archéologie du Pacifique Nord; Cette mission ethnologique et archéologique le conduira jusque chez les Aïnous de Hokkaïdo
La même année André Leroi-Gourhan se marie, il épouse Arlette, fille de Paul Boyer.
En 1937-38 il est au Japon en qualité de "chargé de mission du Musée de l’Homme et des Musées Nationaux".
Dès son retour il est mobilisé comme simple soldat, puis, ses compétences ayant été reconnues, comme officier traducteur dans la marine.
Il sera ainsi démobilisé à Toulon sans avoir combattu ni avoir été fait prisonnier.
Le conservateur adjoint du Musée Guimet, Philipe Stern de religion juive, ayant été obligé de s’enfuir, le poste est proposé à André Leroi-Gourhan qui accepte et rentre à Paris.
A la même époque, il est nommé conservateur par intérim du Musée Guimet de 1940 à 1944, et exerce également comme chercheur au CNRS.
Cette année-là, il est envoyé au château de Valençay pour veiller sur certaines œuvres évacuées du Louvre, dont la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace.
Il participe aux activités de la Résistance, ce qui lui vaudra en 1945 la médaille de la résistance, la croix de Guerre et la croix de la Légion d'Honneur.
Il participe ensuite à la libération de Châteauroux et termine la guerre décoré.
A la Libération André Leroi-Gourhan devient sous-directeur du Musée de l'Homme.
En 1946 il est nommé maître de conférence en ethnologie coloniale à l'université de Lyon sur une chaire créée par le Ministère des colonies, il doit y assurer un cours "d’ethnologie coloniale".
Il y développe entre autres un enseignement de technologie comparée à partir de l’étude de collections d’objets ethnographiques de différents musées lyonnais. Ne concevant pas l’ethnologie sans une part de terrain, il sillonne le Mâconnais avec des étudiants qu’il initie à ce qu’il appellera plus tard l’ethnologie préhistorique.
Il n’en reste pas moins parisien, attaché en même temps, au Musée Cernuschi et en 1946 sous-directeur au Musée de l’ Homme, il ne cessera de faire des aller-retour entre les deux villes.
Faute de pouvoir offrir à ses étudiants une formation de terrain en Afrique ou ailleurs il les entraîne à un chantier de fouilles à la grotte des Fortins, à Berzé-la-Ville près de Mâcon.
Il y développe entre autres un enseignement de technologie comparée à partir de l’étude de collections d’objets ethnographiques de différents musées lyonnais.
Ne concevant pas l’ethnologie sans une part de terrain, il sillonne le Mâconnais avec des étudiants qu’il initie à ce qu’il appellera plus tard l’ethnologie préhistorique.
Thèses
C'est à cette période qu' il termine sa thèse de lettres : Archéologie du Pacifique nord et Documents pour l’art comparé de l’Eurasie septentrionale.
Chercheur au C.N.R.S en 1940 il soutient une thèse de troisième cycle puis en 1945, une thèse d'état, de doctorat ès lettres en Sorbonne : Archéologie du Pacifique nord, fruit de ses recherches en France et au Japon, consacrées à l'étude des témoins matériels des populations bordant les rives du Pacifique, depuis le Japon jusqu'à la Colombie britannique, et à un essai de synthèse sur les populations nord-sibériennes et esquimaudes.
Le domaine esthétique est abordé dans sa thèse complémentaire : Documents pour l'art comparé d'Eurasie septentrionale, suite de quatre études sur l'évolution morphologique et sémantique des thèmes populaires, de l'âge du bronze au XIXe siècle, études fondées sur l'analyse de vingt-cinq mille documents.
La même année en 1945, paraît "Milieu et Technique", second volume de l'ouvrage "Évolution et Techniques" dont le premier, "L'Homme et la Matière" de 1943, était une classification générale des techniques de fabrication.
Dans "Milieu et Technique", sont étudiées les techniques d'acquisition et de consommation. L'ouvrage se termine par une réflexion générale sur les contacts entre civilisations et sur les problèmes d'emprunts et de diffusion dans les sociétés préindustrielles.
"Évolution et Techniques" restera un ouvrage fondamental, tant par la nouveauté et l'efficacité de son analyse des techniques traditionnelles que par l'abondance de sa documentation ethnographique qui couvre l'ensemble des sociétés préindustrielles.
Il enseigne également à Paris à l’Institut d’ethnologie, à l’Ecole Normale de Saint-Cloud, à l’Ecole des langues orientales…. tout en complétant sa formation.
Maître de conférence
En 1954 il soutiendra une thèse de science : "Les tracés d’équilibre mécanique du crâne des vertébrés terrestres et Etude des restes humains fossiles provenant des grottes d’Arcy-sur-Cure. " où l'occupation humaine s'étend du Paléolithique moyen au Magdalénien récent, et du site de plein air de Pincevent en Seine-et-Marne, depuis 1964, où vécurent, il y a quelque douze à quinze mille ans, des chasseurs de rennes magdaléniens dont on retrouve les vestiges de campements protégés sous un épais dépôt de limons d'inondation.
Le "cancre reconnu" a bel et bien disparu.
En 1956 André Leroi-Gourhan rentre complètement à Paris pour succéder à Marcel Griaule à la Sorbonne, à la chaire d'Ethnologie générale et Préhistoire, puis est élu à la chaire de Préhistoire du Collège de France de 1969 à 1982 et membre de l'Institut de France.
Il développe une importante carrière d’enseignant et de chercheur qui lui vaudra rapidement une audience nationale, puis internationale, et en 1969 une nomination au Collège de France.
En 1973, il reçoit la médaille d'or du CNRS.
Parmi ses élèves, on dénombre le chanteur Nino Ferrer, passionné d'archéologie, et l'archéologue François Beaudouin.
Sa bibliothèque et ses manuscrits de travail sont conservés à la Bibliothèque municipale de Périgueux.
Énumérer les différentes étapes de cette carrière, les thèmes des enseignements, les groupes de recherche animés et chantiers de fouilles dirigés serait fastidieux, mieux vaut tenter de situer les grandes lignes d’une œuvre peu commune.
Deux axes principaux ont occupé l’esprit et le temps d’André Leroi-Gourhan tout au long de sa vie : les fouilles et l’art préhistorique.
La fouille.
Lorsque la Préhistoire balbutie encore la fouille se pratique avec une sorte de gros crochet, qui aujourd’hui paraît monstrueux, quand ce n’est pas à l’aide d’ouvriers munis de pelles et de pioches, le but et de découvrir un bel objet.
Dès ses débuts, en effet, la préhistoire s'est préoccupée d'établir un cadre chronologique en se fondant sur la stratigraphie des gisements, l'identification de la faune et la description des outils mis au jour dans chacun des niveaux et considérés comme des "fossiles directeurs".
Dans la période suivante la fouille devient verticale, il s’agit de dégager une tranche nette permettant de bien voir la succession des différentes couches et de définir une chronologie relative.
Si la chronologie reste importante l’idée se dégage peu à peu que l’emplacement d’une pièce est aussi, sinon plus importante que sa qualité.
alors, André Leroi-Gourhan développe alors, cette perspective en préconisant la conduite horizontale maxima des fouilles.
Il propose une approche radicalement nouvelle de l'interprétation de l'art pariétal paléolithique, basée sur un retour aux documents eux-mêmes, à l'analyse des relations de voisinage des œuvres et de leur position par rapport à la topographie des cavités.
Il procède à un traitement statistique des représentations et aboutit à une lecture symbolique des figurations, pictogrammes, mythogrammes interprétées comme des symboles masculins ou féminins.
Renonçant aux interprétations traditionnelles, magie, chamanisme, totémisme…, il conclut que les grottes ornées paléolithiques sont des sanctuaires religieux, emportant la conviction de la plupart des préhistoriens. Ses plus proches héritiers sont M. Lorblanchet, B. et G. Delluc.
Il participe au début de la "paléoethnologie" appelée aussi "palethnologie", l'étude des hommes préhistoriques dans leur milieu.
Avec Leroi-Gourhan, on voit que la fouille, a considérablement progressé depuis son origine dans ses résultats et ses moyens d'investigation : datations absolues à partir de radio-éléments, analyse des indices climatiques, etc.
Elle ne permet cependant pas, hormis la simple étude fonctionnelle des outils ainsi mis au jour, d'atteindre à la compréhension ethnologique de ces sociétés préhistoriques.
L'étude horizontale, microtopographique, des anciens sols d'occupation, grâce à un décapage et à un enregistrement méticuleux de tous les vestiges, même fugaces, et l'étude de leurs relations spatiales permettent, au contraire, de préciser non seulement la structure des anciens sites d'habitation mais également les activités qui s'y déroulaient, et d'élaborer une esquisse de l'organisation sociale.
Chaque pièce d’os, de silex, de pierre, de charbon, d’ocre… même la plus minuscule est repérée dans les trois dimensions, dessinée, photographiée en place avant d’être relevée, inventoriée, classée.
Viennent ensuite les analyses, les essais de remontages etc.…Les chantiers de fouilles deviennent ainsi des entreprises collectives importantes, André Leroi-Gourhan dit curieusement avoir pris goût à la vie collective dans la résistance, et pluridisciplinaires : spécialistes de l’os de la pierre, des pollens….
Cette perspective de fouille, issue de Russie, va être défendue, développée, appliquée et enseignée par André Leroi-Gourhan tout au long de sa carrière.
Au cours des fouilles qu'il a dirigées à la grotte des Furtins en 1945, dans les grottes d'Arcy-sur-Cure entre 1946 et 1963, mais surtout sur le site magdalénien de Pincevent à partir de 1964, André Leroi-Gourhan a contribué à renouveler les méthodes de fouilles archéologiques.
Le site exceptionnellement conservé de Pincevent lui a permis de développer une analyse spatiale des habitats préhistoriques, grâce à la fouille par décapages, à l'origine de l'ethnologie préhistorique française.
Après les grottes d’Arcy-sur-Cure le chantier de Pincevent, poursuivi pendant plus de vingt ans du vivant du "Patron" et toujours actif, lieu de toutes les expérimentations et de tous les enrichissements, est devenu une référence.
Ce travail a un but ultime : arriver, autant que faire se peut, à reconstituer le mode de vie de l’homme paléolithique, ou en d’autres termes faire accéder la fouille à une dimension ethnologique.
Le professeur/ le pédagogue
André Leroi-Gourhan fut un grand pédagogue tant en ethnologie qu'en archéologie.
Son œuvre fut donc poursuivie par de nombreux chercheurs, parmi eux : Robert Cresswell, Hélène Balfet, Christian Pelras, Pierre Lemonnier, Christian Bromberger, Giulio Angioni en Italie, Jean-Pierre Digard, Aliette Geistdoerfer, Bruno Martinelli, ce qui constitue une école française d'ethnologie des techniques plus reconnue comme telle dans les pays anglo-saxons et en Italie que dans l'hexagone.
Plusieurs équipes de recherche s'inscrivent dans la tradition de pensée d'André Leroi-Gourhan : le groupement de recherche "Matières et manières" successivement dirigé par Hélène Balfet, C. Pelras et Bruno Martinelli et l'équipe de "Technologie culturelle" longtemps dirigée par Robert Cresswell puis Aliette Geistdoerfer, connue aussi sous le nom de sa revue Techniques et culture, revue fondamentale pour la définition du champ disciplinaire.
André Leroi-Gourhan a aussi une influence importante dans le champ du travail, avec l'analyse pluridisciplinaire des situations de travail d'Y. Schwartz, la clinique de l'activité initiée par son élève Yves Clot, et la sociologie du travail qui va de Pierre Naville à François Vatin notamment.
En sociologie, il constitue plus largement une référence pour le renouveau des théories de l'action, chez Jean-Claude Kaufmann, Laurent Thévenot, Nicolas Dodier, Giulio Angioni, Albert Piette et, quoique sur un registre plus polémique, Bruno Latour.
Sa méthode de classification et ses concepts ont exercé une grande influence sur la philosophie des techniques de Gilbert Simondon.
Il est nommé professeur à la Sorbonne en 1956 dans la section "ethnologie générale et préhistoire", puis au Collège de France en 1968. Il y occupe la chaire de préhistoire créée pour l'abbé Breuil en 1929 et qui était restée vacante, au moins pour la préhistoire, depuis vingt ans.
Il est aujourd'hui peu d'ethnologues et de préhistoriens français, voire étrangers, chercheurs confirmés ou débutants, qui n'aient été formés à son école, dans les domaines théoriques comme sur le plan pratique.
André Leroi-Gourhan a consacré une partie de son œuvre à l'anthropologie des techniques, fournissant à la fois des principes théoriques, les concepts de tendances et de faits techniques, de milieu technique, de milieu favorable à l'invention et à l'emprunt, des cadres méthodologiques que sont les méthodes d'analyse des degrés du fait et de la chaîne opératoire et une classification générale de l'action technique.
Ces apports fondamentaux à l'épistémologie de ce champ disciplinaire sont réunis dans différents ouvrages d'André Leroi-Gourhan tels que
"L'Homme et la matière" 1943/1971,
"Milieu et techniques" 1945/1973 ou
"Le Geste et la parole" vol.1 :
"Technique et langage", 1965 ; vol. 2 :
"La mémoire et les rythmes", 1965.
Les bases de l'ethnologie
Cette ethnologie largement préoccupée du passé supposait aussi une approche anthropologique et paléontologique. Dès 1947, Leroi-Gourhan publie un premier essai, Esquisse d'une classification craniologique des Esquimaux, puis, en 1949, une analyse craniométrique des sujets burgondes et francs recueillis dans la basilique Saint-Laurent à Lyon et, en 1954, un premier travail sur l'équilibre mécanique de la face. Cela le conduit à présenter, la même année, une thèse de doctorat ès sciences sur Le Tracé d'équilibre mécanique du crâne des vertébrés terrestres, dont les résultats constituent l'une des charpentes d'un ouvrage en deux volumes, Le Geste et la Parole. Le premier volume, en effet, Technique et Langage (1964), repose d'abord sur une étude des processus de l' hominisation et de leurs antécédents évolutifs chez les diverses espèces animales ; cette hominisation conduit – par la station verticale, la libération de la main, le raccourcissement de la face et le développement corrélatif du cerveau – à la conscience, au progrès des techniques et à l'organisme social. L'analyse de ce développement technico-économique et social est suivie d'une étude de l'émergence et de l'évolution, propres à l'Homo sapiens, et des systèmes matériels de fixation de la pensée. Le second volume, La Mémoire et les Rythmes (1965), complète le précédent en présentant d'abord une théorie de l'évolution technique, conçue comme dépassant l'évolution biologique, et en développant l'analyse de l'évolution des symboles et des rythmes dans la maîtrise collective de l'espace et du temps. Cette analyse nouvelle – aussi dense que précise et aux approches multiples – de la spécificité humaine et de son évolution depuis les premiers Anthropiens jusqu'à l'homme moderne pose enfin le problème du devenir de l'Homo sapiens, après ses "libérations" successives des contraintes écologiques et biologiques, dans un monde aujourd'hui entièrement humanisé et largement démystifié.
L'art préhistorique
Dans "Le Geste et la Parole", André Leroi-Gourhan fait une large place à l'art préhistorique, à sa chronologie et à sa valeur sémantique, poursuivant ainsi, en la renouvelant, l'œuvre de l'abbé Breuil.
Ces recherches constituent une part importante de son enseignement et il y consacre par ailleurs, depuis 1958, de nombreux articles et communications à des congrès internationaux. En 1965, paraît sa Préhistoire de l'art occidental.
C'est d'abord le corpus illustré des œuvres d'art paléolithiques actuellement connues dans l'ensemble de l'Europe, étudiées du point de vue de leur évolution stylistique au cours des vingt millénaires qui séparent les premiers "griffonnages" du Chatelperronien de l'apogée de l'art figuratif magdalénien, jusqu'à son extinction à l'aube des temps post-glaciaires.
C'est aussi la synthèse d'une recherche méthodologique pour l'interprétation de cet art du Paléolithique supérieur. Celle-ci renouvelle entièrement les conceptions qu'on pouvait en avoir en un temps où le comparatisme ethnographique semblait pouvoir animer les silences de la préhistoire ; la connaissance, très superficielle encore, des sociétés primitives actuelles permettait en effet d'expliquer les comportements préhistoriques en général et les mobiles des manifestations artistiques, en particulier, qui relèvent de satisfactions naïves d'un instinct esthétique, ou de pratiques magico-religieuses.
La connaissance de ces sociétés contemporaines s'est depuis lors approfondie, révélant aussi bien la diversité que la complexité de leur organisation sociale et de leur pensée religieuse. Dans le même temps, nombre de documents paléolithiques, pariétaux ou mobiliers ont été découverts, qui offrent une plus ample matière à un essai d'interprétation moins aventureux. Délaissant la voie d'une reconstitution quasi impossible de la religion et des rites paléolithiques, Leroi-Gourhan s'est tourné vers l'étude statistique de la répartition topographique des figures pariétales et de leurs associations : images d'animaux et d'hommes (celles-ci très peu nombreuses) et signes abstraits. Il est ainsi apparu que ces compositions répondaient à une conception dualiste : figures et symboles féminins, d'une part (bisons et aurochs, triangles, ovales, rectangles et signes claviformes), et figures et symboles masculins, d'autre part (chevaux, bouquetins, cervidés et mammouths, points, bâtonnets et signes barbelés).
Il est également apparu que ces compositions pariétales obéissaient, quelles que soient les variantes spatio-temporelles de chacun de leurs éléments, à un schéma structural constant, les deux ensembles étant associés dans les zones centrales, alors que les symboles masculins occupent seuls les périphéries ainsi que les entrées, les passages difficiles et le fond des grottes où apparaissent des thèmes complémentaires : hommes, félins, rhinocéros.
On a pu critiquer cette interprétation sexuelle des figurations animales ou abstraites, bien qu'elle repose sur un inventaire statistique important dont fait également partie l'art mobilier.
L'essentiel est néanmoins d'avoir mis en lumière l'organisation structurale des sanctuaires paléolithiques, de leurs « mythogrammes », en sortant, par là même, de l'impasse des interprétations magico-religieuses des débuts de ce siècle. L'intérêt de la méthode est également qu'elle est toujours perfectible et qu'elle peut aussi aider à comprendre la réalité formelle d'ensembles rupestres et pariétaux plus proches de l'histoire mais muets quand à leur signification profonde, sociologique ou mythologique.
Les méthodes archéologiques
Cette étude des grottes ornées, André Leroi-Gourhan la mena sur le terrain depuis 1945, en France et en Espagne.
C'est également sur le terrain qu'il affina peu à peu les méthodes de fouilles, et leur donna une orientation nouvelle.
Dans un premier temps André Leroi-Gourhan se livre à une critique rigoureuse de la comparaison ethnographique.
Il constate ensuite l’absence de toute définition satisfaisante de la notion de religion et propose une définition partielle mais adaptée à l’objet de sa recherche : est considéré comme religieuse toute manifestation d’une préoccupation paraissant dépasser l’ordre matériel.
Après une critique méthodique des documents ayant conduit à la description de soi-disant religions paléolithiques, culte de l’ours etc.…. André Leroi-Gourhan retient quelques indices solides, mais en nombre limité, permettant de concevoir l’existence d’une pensée religieuse ou magique au Paléolithique: les inhumations attestées pour des Néandertaliens dès la fin du Paléolithique moyen, le crâne du Mont Circé de la même époque, et au Paléolithique supérieur, l’usage de l’ocre, l’existence même de l’art, sa localisation dans la profondeur des grottes et son caractère organisé, le crâne du Mas d’Azil.
Dès ses débuts, en effet, la préhistoire s'est préoccupée d'établir un cadre chronologique en se fondant sur la stratigraphie des gisements, l'identification de la faune et la description des outils mis au jour dans chacun des niveaux et considérés comme des "fossiles directeurs".
Cette préhistoire, que l'on peut qualifier de verticale, est naturellement indispensable pour différencier chaque culture matérielle et la localiser dans le temps. Elle a considérablement progressé depuis son origine dans ses résultats et ses moyens d'investigation : datations absolues à partir de radio-éléments, analyse des indices climatiques, etc. Elle ne permet cependant pas, hormis la simple étude fonctionnelle des outils ainsi mis au jour, d'atteindre à la compréhension ethnologique de ces sociétés préhistoriques.
L'étude horizontale, microtopographique, des anciens sols d'occupation, grâce à un décapage et à un enregistrement méticuleux de tous les vestiges, même fugaces, et l'étude de leurs relations spatiales permettent, au contraire, de préciser non seulement la structure des anciens sites d'habitation mais également les activités qui s'y déroulaient, et d'élaborer une esquisse de l'organisation sociale.
Les premiers résultats ainsi obtenus le furent dans la grotte du Renne à Arcy-sur-Cure, où Leroi-Gourhan et son équipe mirent au jour les témoins d'une hutte construite sous l'auvent de la grotte : une aire dallée et entourée de trous destinés à fixer au sol des défenses de mammouth qui en constituaient la charpente.
L'intérêt ethnologique d'une telle démarche méthodologique a trouvé sa confirmation la plus évidente dans l'étude de Pincevent, l'un des principaux sites magdaléniens d'Europe. Dans ce domaine encore, l'influence des travaux et de l'enseignement de Leroi-Gourhan aura été déterminante, non seulement pour les préhistoriens mais également pour les archéologues des périodes historiques, la mise au jour des anciens monuments, figurés ou non, et des objets les plus remarquables d'un point de vue chronologique ou esthétique n'étant plus leur seule préoccupation scientifique.
L'art Préhistorique
L’art préhistorique constitue l’autre préoccupation constante.
Dans ce domaine deux livres, très différents par leur taille, surnagent à une myriade d’articles devenus plus ou moins inaccessibles :
Ouvrages remarquables à lire :
-Les religions de la Préhistoire, PUF 1964, 153 pages format, 11,5x17,5.
Les religions de la Préhistoire.
-Préhistoire de l’art occidental, Mazenod 1965, 482 pages, format 32x26
-"Le geste et la parole" 1 et 2" 1964 1965 ce double ouvrage de réflexion, hors normes, ne semble pas avoir eu de retentissement exceptionnel si l’on en juge par l’absence de traduction
-Préhistoire de l’art occidental, communément appelé PAO est un monument en même temps qu’un évènement éditorial. La qualité des photos, pour la plus part dues à Jean Vertut, est à cette époque sans égal.
Le chemin parcouru depuis l’ouvrage de l’abbé Breuil : 400 Siècles d’art pariétal, paru en 1952, est saisissant.
Le texte est encore plus remarquable, André Leroi-Gourhan décrit méthodiquement la quasi totalité des grottes ornées alors connues et expose ses idées sur la chronologie et l’interprétation.
Après avoir réfuté l’évolution en deux phases soutenue par l’abbé Breuil il propose une évolution progressive du simple au complexe, en quatre styles, qui restera le modèle de référence jusqu’à la découverte de la grotte Chauvet et la mise en œuvre des datations directes en 1994.
Le point de vue d’André Leroi-Gourhan sur l’interprétation de l’art pariétal est encore plus novateur.
Pour lui le désordre des figures et des signes sur les parois n’est qu’apparent. L’enregistrement précis de chaque figure par rapport à la topographie de la grotte comme par rapport aux figures voisines fait apparaître un ordre grâce à une méthode statistique simple, au départ il s’agissait de cartes perforées.
Cette démarche lui permet de décrire des figures d’entrée et des figures de fond ainsi que dans chaque panneau des figures centrales et périphériques.
L’ensemble dessinerait une dualité bison aurochs/cheval avec une connotation mâle/femelle. André Leroi-Gourhan exploite cette perspective en même temps qu’une de ses élèves A. Laming-Emperaire.
Comme lui elle aboutira à une dualité bison/cheval à connotation sexuelle mais de polarité inverse.
Dans "Le Geste et la Parole", André Leroi-Gourhan fait une large place à l'art préhistorique, à sa chronologie et à sa valeur sémantique, poursuivant ainsi, en la renouvelant, l'œuvre de l'abbé Breuil.
Ces recherches constituent une part importante de son enseignement et il y consacre par ailleurs, depuis 1958, de nombreux articles et communications à des congrès internationaux. En 1965, paraît sa "Préhistoire de l'art occidental".
C'est d'abord le corpus illustré des œuvres d'art paléolithiques actuellement connues dans l'ensemble de l'Europe, étudiées du point de vue de leur évolution stylistique au cours des vingt millénaires qui séparent les premiers "griffonnages" du Chatelperronien de l'apogée de l'art figuratif magdalénien, jusqu'à son extinction à l'aube des temps post-glaciaires.
C'est aussi la synthèse d'une recherche méthodologique pour l'interprétation de cet art du Paléolithique supérieur.
Celle-ci renouvelle entièrement les conceptions qu'on pouvait en avoir en un temps où le comparatisme ethnographique semblait pouvoir animer les silences de la préhistoire ; la connaissance, très superficielle encore, des sociétés primitives actuelles permettait en effet d'expliquer les comportements préhistoriques en général et les mobiles des manifestations artistiques, en particulier, qui relèvent de satisfactions naïves d'un instinct esthétique, ou de pratiques magico-religieuses.
La connaissance de ces sociétés contemporaines s'est depuis lors approfondie, révélant aussi bien la diversité que la complexité de leur organisation sociale et de leur pensée religieuse. Dans le même temps, nombre de documents paléolithiques, pariétaux ou mobiliers ont été découverts, qui offrent une plus ample matière à un essai d'interprétation moins aventureux. Délaissant la voie d'une reconstitution quasi impossible de la religion et des rites paléolithiques, Leroi-Gourhan s'est tourné vers l'étude statistique de la répartition topographique des figures pariétales et de leurs associations : images d'animaux et d'hommes , celles-ci très peu nombreuses, et signes abstraits.
Nous avons vu que pour Leroi-Gourhan, il apparaît que ces compositions répondent à une conception dualiste : figures et symboles féminins, d'une part, bisons et aurochs, triangles, ovales, rectangles et signes claviformes, et figures et symboles masculins, d'autre part, chevaux, bouquetins, cervidés et mammouths, points, bâtonnets et signes barbelés.
Il est également apparu que ces compositions pariétales obéissaient, quelles que soient les variantes spatio-temporelles de chacun de leurs éléments, à un schéma structural constant, les deux ensembles étant associés dans les zones centrales, alors que les symboles masculins occupent seuls les périphéries ainsi que les entrées, les passages difficiles et le fond des grottes où apparaissent des thèmes complémentaires : hommes, félins, rhinocéros.
On a pu critiquer cette interprétation sexuelle des figurations animales ou abstraites, bien qu'elle repose sur un inventaire statistique important dont fait également partie l'art mobilier.
L'essentiel est néanmoins d'avoir mis en lumière l'organisation structurale des sanctuaires paléolithiques, de leurs " mythogrammes", en sortant, par là même, de l'impasse des interprétations magico-religieuses des débuts de ce siècle.
L'intérêt de la méthode est également qu'elle est toujours perfectible et qu'elle peut aussi aider à comprendre la réalité formelle d'ensembles rupestres et pariétaux plus proches de l'histoire mais muets quand à leur signification profonde, sociologique ou mythologique.
L'influence des travaux et de l'enseignement de Leroi-Gourhan aura été déterminante, non seulement pour les préhistoriens mais également pour les archéologues des périodes historiques, la mise au jour des anciens monuments, figurés ou non, et des objets les plus remarquables d'un point de vue chronologique ou esthétique n'étant plus leur seule préoccupation scientifique.
André Leroi-Gourhan s’éteint le 19 février 1986 à Paris après une brève retraite, de quatre années seulement, marquée par une maladie de Parkinson de plus en plus invalidante.
Liens
écouter regarder,
http://youtu.be/XVE4B6TxlfM Le geste et la parole
http://youtu.be/DU9TyP-rcTM Site Magdalénien "Pincevent"
http://youtu.be/3Qiwvy48-4s L'aventure humaine
http://youtu.be/JT4RXEAWHCo des bisons , des chevaux et des signes
http://youtu.be/ILBbCccxcYw de Pech Merle à Rouffignac en passant pas cougnac
http://youtu.be/k3VYpo4fi-o Les premiers pas de l'homme
http://youtu.be/b2l0znHJUKA l'homme de Néanderthal
http://youtu.be/goFvAA14JD4 Lascaux
http://youtu.be/ov4TldGaPhA Le Néandertal en nous
  [img width=600]http://historycompassjournal.files.wordpress.com/2010/09/americas.jpg?w=800[/img] [img width=600]http://i1.wp.com/lizalimcomposer.files.wordpress.com/2013/03/lespugue74_2sm.jpg?fit=1000,1000[/img] 
Posté le : 25/08/2013 13:51
|
|
|
|
|
Saint Louis est canonisé un 11 Août |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Louis IX est canonisé Le 11 Août 1297
Connu et reconnu pour sa grande piété, le roi de France Louis IX est canonisé par le pape Boniface VIII le 11 août 1297. Dès lors, ce souverain épris de justice prend le nom post mortem de Saint-Louis.
Issu de la dynastie des Capétiens, il voit le jour le 25 avril 1214 à Poissy (Yvelines).
Fils de Louis VIII dit le Lion et de la reine Blanche de Castille, il est, dans sa jeunesse, un temps tourmenté par les grands barons du royaume.
Mais fin d’esprit et bon diplomate, il leur impose finalement son autorité sans coups férir.
Ils le suivent même comme un seul homme dans chacune des deux croisades : VIIe et VIIIe croisade qu’il mène en Orient. C’est du reste au cours de la seconde d’entre elles que Louis IX, atteint de dysenterie, trouve la mort sous les remparts de Tunis (Tunisie) le 25 août 1270.
Durant son règne, notamment grâce à la Sorbonne qui a contribué à faire du pays le centre des arts et de la vie intellectuelle des chrétiens du XIIIe siècle, la France connaît sa plus importante prospérité économique et politique de tout le Moyen-Âge.
La mort de Louis IX
Le roi de France, Louis IX (1226-1270), a pris la croix, pour la seconde fois, en 1267.
La huitième croisade, en 1270, se dirige vers Tunis et non vers l'Orient comme les précédentes.
Le roi espère convertir au christianisme l'émir hafside al-Mustansir et, peut-être, faire de l'Ifrīqiyya, c'est à dire la Tunisie une base d'attaque vers l'Égypte mamelouk qui contrôle la Terre sainte.
Mais, surtout, Louis IX, qui n'envisage pas son retour en France, accomplit ainsi un dernier pèlerinage expiatoire, même si l'expédition a été sérieusement préparée.
Embarquée à Aigues-Mortes, l'armée royale arrive le 17 juillet à La Goulette, mais il apparaît très vite que l'émir n'a aucune intention de se convertir.
La dysenterie ou le typhus, mais non la peste comme on l'écrit souvent fait des ravages dans les troupes et atteint la famille royale.
Louis IX, touché à son tour, meurt, le 25 août 1270 à Carthage.
Son fils, Philippe III le Hardi, lui succède et organise le retour du corps de son père et de l'armée en France.
L'époque des grandes croisades est définitivement close ; l'expédition de Tunis est déjà apparue anachronique à de nombreux contemporains, tel Joinville.
Dès 1271, une enquête est lancée par le Saint-Siège en vue de la canonisation de Louis IX qui deviendra Saint Louis en août 1297.
Et le 11 août 1297 le pape Boniface VIII canonise Louis IX pendant une accalmie au cours de la lutte qui l'oppose à Philippe le Bel, mais cette décision de circonstance avait été préparée par une longue enquête et un véritable procès de canonisation.
L'enquète
Sitôt après la mort du roi Louis IX, l'Église instruit son procès en canonisation.
Celle-ci est prononcée par le pape Boniface VIII le 11 août 1297, sous le règne de son petit-fils Philippe IV le Bel.
La monarchie capétienne est alors à son maximum de prestige et la France figure comme le royaume le plus puissant et le plus prospère de la chrétienté.
La vie de Saint Louis et les vertus du roi nous sont surtout connues par le chroniqueur Jean de Joinville.
Saint Louis sa vie
Louis IX roi de France, 1226-1270.
Petit-fils de Philippe Auguste et grand-père de Philippe le Bel, Louis IX – plus connu sous le nom de Saint Louis – est l’un des maillons essentiels de l’histoire de la dynastie des Capétiens.
Son règne a contribué à fonder l’idée de l’incarnation d’un pouvoir politique et spirituel en un homme singulier et non plus seulement en un Dieu universel.
Si son action politique a atténué les excès de la féodalité au profit de la notion d’intérêt général, l’idée de justice, profondément associée à sa personne, et les croisades ont pour leur part assuré la postérité spirituelle de Louis IX.
La minorité de Louis IX Blanche de Castille, régente du royaume
Né le 25 avril 1214 à Poissy, le futur monarque est le troisième enfant de Louis VIII le Lion et de Blanche de Castille.
Héritier du trône après la mort de son frère aîné, Louis est âgé de douze ans lorsqu’il succède à son père le 7 novembre 1226.
Il est sacré à Reims le 29 novembre de la même année.
Louis IX est proclamé majeur en 1234, mais il laisse à sa mère la conduite des affaires au moins jusqu’en 1242.
Jusqu’à cette date, et de nouveau de 1248 à 1252, pendant la croisade d’Égypte, le sort du royaume est ainsi entre les mains de l’énergique Espagnole qu’est Blanche de Castille.
La régente maintient en place les conseillers expérimentés de Philippe Auguste et de Louis VIII, frère Guérin, chancelier de France, et Barthélemy de Roye, chambrier de France et fait appel aux membres des familles seigneuriales d'Île-de-France depuis longtemps attachées à la dynastie capétienne, Gautier Cornu, archevêque de Sens et remarquable ministre ; Mathieu de Montmorency, connétable de France et habile homme de guerre.
Elle bénéficie en outre des conseils d’un Italien, Romain Frangipani, cardinal de Saint-Ange et légat du pape.
La soumission du Languedoc
Depuis 1209, la situation en pays cathare est préoccupante, tout comme l’attitude du comte Raimond VII de Toulouse.
Par le traité de Paris du 11 avril 1229, qui met un terme définitif à la croisade des albigeois, la régente impose au comte de Toulouse d’accepter l’annexion au domaine royal des sénéchaussées de Nîmes-Beaucaire et de Béziers-Carcassonne, et de donner en mariage sa fille et unique héritière Jeanne de Toulouse au frère du jeune roi, Alphonse de Poitiers.
La révolte des barons
Sacre de Saint Louis
Avec le concours de son conseiller italien Romain Frangipani, la régente brise la révolte de Philippe Hurepel, fils de Philippe Auguste et d’Agnès de Méran, auquel se joignent les barons hostiles à ce que la régence soit exercée par une femme, surtout étrangère : le comte de Champagne, Thibaud IV et surtout le baillistre de Bretagne, Pierre de Dreux, dit Mauclerc.
Ébauchée à l'automne 1226, marquée par d’inquiétantes abstentions au sacre de Louis IX le 29 novembre, une première coalition féodale échoue dès le printemps 1227.
Mais elle se reconstitue presque aussitôt.
Mis en échec par les Parisiens, qui prennent sous leur protection le jeune roi, vaincus dans le Perche en janvier 1229, privés de l’appui du comte de Toulouse en avril 1229, les révoltés reprennent les armes en 1230 avec l’appui du roi d'Angleterre Henri III, qui est accueilli à Saint-Malo le 3 mai par Pierre Mauclerc.
La soumission de Philippe Hurepel en septembre, le retour outre-Manche du Plantagenêt en octobre mettent fin à la révolte avant que la paix avec l’Angleterre et la Bretagne ne soit consolidée, par les trêves de juillet 1231, qui laissent à Louis IX Bellême et Angers où il fait édifier un château fort.
Ces trêves sont confirmées par les accords de Paris de novembre 1234 avec Pierre Mauclerc et d'août 1235 avec Henri III ; elles permettent à Blanche de Castille de léguer à son fils un royaume en paix.
Le règne personnel de Louis IX
La réforme administrative du royaume
La réforme administrative du royaume, inaugurée par Philippe Auguste et par Louis VIII, est poursuivie avec vigueur par Louis IX.
Maintenant en place l’Échiquier, les vicomtes et les sergents institués par les Plantagenêt en Normandie, le souverain subordonne les uns et les autres à la Curia Regis et à des officiers originaires de l’Île-de-France ou de l’Orléanais, auxquels il fait également appel pour renforcer son autorité dans les pays de la Loire.
Prévôts et baillis y sont donc introduits, ces derniers cessant alors d’être des inspecteurs itinérants pour devenir des administrateurs nommés, payés et révoqués par le roi pour exercer leurs fonctions dans le cadre d’une vingtaine de circonscriptions bien distinctes entre lesquelles est désormais divisé le vaste domaine royal : les bailliages, appelés sénéchaussées dans le Centre-Ouest et le Midi languedocien, et, plus simplement, mais exceptionnellement, prévôté à Paris.
Recrutés soit dans la petite noblesse locale, soit dans la bourgeoisie, tel Étienne Boileau, prévôt de Paris de 1258 à 1267, ces officiers se constituent alors en dynasties, dont la plus célèbre est celle des Beaumanoir, père et fils : ils sont tour à tour baillis en Gâtinais vers 1240-1250 et à Clermont-en-Beauvaisis vers 1280.
Ces officiers sont contraints de respecter de strictes règles de gestion, définies par l’ordonnance de 1254.
Les officiers royaux sont étroitement surveillés par des enquêteurs qui ont pour mission de fixer les droits et les devoirs de chacun et de transmettre par écrit toutes les plaintes à Paris, où la cour du roi commence à se subdiviser en sections spécialisées : le Conseil, qui traite plus spécialement des affaires politiques ; la Curia in parliamento, qui s’érige alors en parlement, ayant à la fois le rôle de cour suprême dans certaines affaires et surtout de juridiction d’appel des décisions des tribunaux de bailliage ; la Curia in compotis, enfin, berceau de la future Cour aux comptes.
Les grandes ordonnances
C’est dans le sens d’un affermissement des prérogatives royales que s’inscrivent les ordonnances de 1263 et de 1265. Désormais, la monnaie royale jouit d’un cours forcé sur tout le royaume, et dès 1266 on frappe deux nouvelles monnaies : un gros d’argent et une pièce d’or.
Le règne de Louis devient celui de la bonne monnaie qu’évoqueront avec nostalgie les générations suivantes.
Ces décisions, impopulaires chez les barons, répondent à un souci d’ordre moral tout en affirmant la supériorité du pouvoir royal.
Et c’est bien là l’originalité du règne de Louis IX : la combinaison de la spiritualité et de l’intérêt du royaume, en l’occurrence celui de la monarchie.
Louis IX est également à l’initiative des nombreuses autres grandes ordonnances, notamment celles de 1254, interdiction des jeux de hasard et d’argent, de 1258, interdiction du duel judiciaire et de la guerre privée et de 1262, confirmant la tutelle royale sur les villes.
L’extension du domaine royal
Louis IX doit faire face au soulèvement cathare en Languedoc en 1240, et surtout à l’intervention anglaise consécutive au défi que lui adresse Hugues de Lusignan le 25 décembre 1241. Vaincu à Taillebourg et à Saintes le 31 juillet 1242, le roi Henri III d’Angleterre se réfugie à Blaye, tandis que Raimond VII signe la paix de Lorris, qui confirme en janvier 1243 les clauses du traité de Paris de 1229 et permet aux troupes royales de faire tomber les dernières places albigeoises : Montségur en 1244, Quéribus en 1245.
À partir de 1256, Louis IX place sous sa dépendance étroite son gendre le comte Thibaud V de Champagne, auquel il rachète ses droits sur les comtés de Blois, de Chartres, de Châteaudun et de Sancerre afin d’étendre le domaine royal – qu’il a en revanche amputé du Poitou et de l’Anjou pour constituer les apanages de ses frères Alphonse et Charles afin de respecter les vœux ultimes de son père Louis VIII.
Reconnaissant sa puissance au traité de Paris, le 28 mai 1258, ratifié en décembre 1259, le roi d’Angleterre Henri III consent à redevenir l’homme lige du roi de France et à lui céder définitivement la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine et le Poitou en échange de la restitution de ses fiefs et domaines dans les diocèses de Limoges, de Cahors et de Périgueux, et de l’expectative des biens que possède Alphonse de Poitiers en Agenais et en Saintonge au sud de la Charente.
Enfin, dans le même esprit que pour le traité de Paris, Louis IX signe en 1258 le traité de Corbeil avec le roi d’Aragon : il renonce à ses droits sur le Roussillon et Barcelone, tandis que le souverain aragonais abandonne toute prétention sur la Provence et le Languedoc, Narbonne exceptée, par son mariage avec Marguerite de Provence, Louis IX avait acquis un droit de regard sur la France du Sud et ouvrait ainsi de nouvelles perspectives à la monarchie capétienne.
La symbolique du pouvoir
Souverain convaincu de la dignité royale et des devoirs inhérents à sa charge, Louis IX a développé toute une symbolique du pouvoir.
Ainsi organise-t-il la nécropole royale à Saint-Denis après 1239 : dans le chœur reconstruit de l’abbatiale apparaissent exclusivement les tombeaux des rois et des reines ayant régné sur la France depuis les Carolingiens, témoins de la supériorité du sang royal et de la continuité des dynasties.
C’est également au nom de cette très haute idée de la fonction royale que le roi conduit ses relations avec les autres souverains européens.
Pour exemple, Louis IX – chrétien, mais épris d’équité – ne se croit pas contraint de soutenir la papauté contre l’empereur germanique Frédéric II, mais prend sous sa protection le concile de Lyon au cours duquel Innocent IV excommunie solennellement l’empereur en 1246-1247. De même, le roi de France condamne par la "mise d’Amiens" de 1264 les barons anglais révoltés qui ont imposé à Henri III les provisions d’Oxford.
Louis IX, un roi croisé
La VIIe croisade
Louis IX
En décembre 1244, à la suite d’une grave maladie, Louis IX fait le vœu personnel de se croiser.
Aucune remontrance de son entourage ne parvient à le détourner de son projet, quelles que soient les inquiétudes que suscite une inévitable régence.
Le pape Innocent IV réunit à Lyon un concile qui se tient en août 1245 et envoie un légat prêcher la croisade.
Louis va consacrer trois ans à préparer son expédition et à réorganiser son administration.
En 1247, une grande enquête est confiée à des moines mendiants pour relever toutes les injustices commises auprès des populations et y porter remède.
Le roi se montre aussi soucieux d’assurer la paix intérieure que la paix extérieure.
Espérant convaincre les Mongols de l’intérêt d’une alliance militaire contre les sarrasins, il leur envoie une ambassade menée par André de Longjumeau.
La prise de Damiette, en 1249, par saint Louis, septième croisade
Le roi, accompagné de son épouse, de son frère Charles d’Anjou et du légat pontifical, quitte le royaume le 25 août 1248, laissant la régence à sa mère Blanche de Castille.
Il a été convenu de diriger l’attaque vers l’Égypte, et l’armée royale débarque près de Damiette après avoir fait étape à Chypre.
Pour des raisons qui tiennent au choix du terrain et à la division des forces occidentales, et en dépit du succès initial de la prise de Damiette, l’expédition est un échec certain : le roi est fait prisonnier à Mansourah le 5 avril 1250. Avec l’aide de son épouse, qui tient Damiette, Louis négocie sa rançon et celle de ses chevaliers, dont Damiette et 500 000 livres sont offertes au sultan d’Égypte et obtient une trêve de dix ans avec l’Égypte.
Louis ne rentre pas pour autant immédiatement en France et aide les villes chrétiennes de Jaffa, Sidon, Acre à renforcer leur défense et leur administration.
Ce n’est qu’après avoir appris la mort de sa mère Blanche de Castille s’éteint en décembre 1252, mais la nouvelle ne parvient aux croisés qu’au printemps 1253 que le roi accepte de rentrer en France.
Louis IX entre à Paris le 7 septembre 1254, après six années d’absence.
La VIIIe croisade et la mort
Toutefois, Louis IX n’abandonne pas l’espoir de prendre sa revanche en Terre sainte.
En mars 1267, il prend de nouveau la croix, trois ans avant de s’embarquer, le 1er juillet 1270, pour Tunis, dont il pense que l’émir al-Mustansir Bi-llah est disposé à se convertir et à lui apporter son aide militaire contre l’Égypte.
Mais la nouvelle était fausse : lors du siège de la ville, l’armée est décimée par la peste, qui emporte Louis le 25 août.
Charles d’Anjou ramène en France, avec son armée, le corps du roi, qui est enterré à Saint-Denis auprès de ses ancêtres.
La canonisation de Saint Louis
Aussitôt après sa mort, Louis IX apparaît comme un saint aux yeux de son entourage et de ses sujets.
Aussi, dès 1272, une demande de canonisation est-elle déposée auprès du pape.
En 1278, Nicolas III ordonne une enquête, et c’est pendant le pontificat de Boniface VIII, en 1297, qu’est accordée la canonisation. Cette décision répond à un souci politique et sert les intérêts de la monarchie capétienne, fière de compter désormais un saint dans ses rangs.
Tout en reconnaissant les vertus du roi, l’Église a surtout voulu sanctifier un laïc, un homme de son temps qui a su mener sans ostentation une vie édifiante.
C’est ainsi que passe à la postérité l’image de Saint Louis, roi juste et pieux.
Saint Louis, un homme de son siècle
Des élans spirituels
Saint Louis lavant les pieds des pauvres
Élevé noblement par sa mère dans la crainte du péché mortel, Louis IX fait preuve dès son avènement d’une profonde piété. Grand et mince, mais de santé délicate, il s’astreint pourtant à assister chaque jour à la totalité de l’exercice divin.
Fortement inspiré par les ordres mendiants – le souverain apprécie la compagnie des dominicains et des franciscains –, il est un auditeur passionné de sermons.
Il aime citer des exemples et des anecdotes qui lui permettent d’affirmer sa foi.
Sa piété s’appuie sur les œuvres, sur des aumônes généreuses, comme sur la participation aux travaux de construction de l’abbaye de Royaumont, fondée grâce à un legs de son père. Louis est également très attaché aux reliques : en 1239, il rachète aux Vénitiens celles de la Passion, la couronne d’épines, un clou du Christ en croix, que ces derniers avaient reçues en gage de Baudouin II ; afin de leur donner un cadre digne d’elles, il fait construire entre 1241 et 1248 la Sainte-Chapelle, à Paris.
Une personnalité complexe
Mince, de haute taille mais de santé fragile, le roi est blond et élégant.
Son caractère est volontiers emporté, et il a le sentiment très vif de son autorité.
S’il écoute sa mère, c’est parce qu’il est convaincu de la pertinence de ses conseils plutôt que par docilité.
Peu expansif dans ses témoignages d’affection, il semble avoir été très attaché à Marguerite de Provence, qu’il épouse le 27 mai 1234, alors qu’il vient d’atteindre sa majorité.
Le couple aura onze enfants ; le roi restera toujours attentif à leur éducation.
Il demeure également proche de ses frères : Robert, auquel il confie l’Artois ; Alphonse, nanti de l’apanage du Poitou et soutien efficace ; Charles, enfin, installé en Anjou et qu’il doit, à plusieurs reprises, rappeler à l’obéissance.
Chroniqueurs et biographes
Les témoignages des contemporains sont exceptionnellement abondants, et c’est là, certainement, l’une des raisons de la célébrité de Saint Louis.
Jean de Joinville, proche du roi lors de la septième croisade (1248-1254), rédige en 1309 un Livre des saintes paroles et des bons faits de notre roi Louis.
Au lendemain de la mort du roi, son confesseur, Geoffroi de Beaulieu, et son chapelain, Guillaume de Chartres, qui l’a accompagné lors de ses deux croisades, s’attachent également à relater sa vie.
Par ailleurs, Guillaume de Saint-Pathus, confesseur de Marguerite de Provence, puis de sa fille Blanche, a écrit une Vie de Louis.
Outre-Manche, le témoignage du chroniqueur Matthew Paris utilise largement les souvenirs du roi Henri III d’Angleterre, compagnon de Louis IX lors de la septième croisade.
Enfin, le roi lui-même a laissé des Enseignements, rédigés lors du siège de Tunis, à l’attention de son fils Philippe qui lui succède sous le nom de Philippe III le Hardi.
Liens
http://youtu.be/SEXi6_tKFeg Histoire le temps des cathédrales saint Louis
http://youtu.be/4iWOtH88gUY
Les rois de France
http://youtu.be/Wxw1R_eWbKw 1
http://youtu.be/vyqec8IHv7g 2
http://youtu.be/mGC889B_-dQ 3
http://youtu.be/3ImR8XQfP_8 4
         [img width=600]http://templars.files.wordpress.com/2007/10/stlouissmall.jpg?w=500[/img]  
Posté le : 10/08/2013 21:10
|
|
|
|
|
La nuit du 4 août |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
La nuit du quatre Août 1789 ... Abolitions des privilèges
Dans la nuit du 4 août 1789 disparaît l'ancienne France fondée sur le privilège et les vieilles structures de la féodalité.
Dans la nuit du 4 août 1789, les députés de l'Assemblée nationale constituante, dans un bel élan d'unanimité, proclament l'abolition des droits féodaux et de divers privilèges.
Ce moment de grande ferveur nationale s'inscrit parmi les grands évènements mythiques de la Révolution française.
La séance du 4 août 1789 de l'Assemblée nationale est la conséquence de la Grande Peur, qui jette les paysans contre les châteaux.
Le soulèvement des campagnes rappelle aux députés le problème paysan.
Les révoltes agraires ne touchent pas seulement les intérêts de la noblesse, mais également ceux de la bourgeoisie, qui avait acquis de nombreux biens fonciers. Faut-il défendre la propriété par la force ou faire des concessions ?
Nobles libéraux et bourgeois penchent finalement pour la dernière solution.
Le 4 août au soir, le vicomte de Noailles, un seigneur ruiné, réclame l'abolition des privilèges fiscaux, la suppression des corvées et de la mainmorte.
Il est appuyé par le duc d'Aiguillon. L'Assemblée, d'abord réticente, se laisse entraîner par un véritable délire qui a frappé tous les contemporains.
"On pleurait, on s'embrassait. Quelle nation ! Quelle gloire ! Quel honneur d'être français ! ", note un témoin. Disparaissent d'un coup, dans l'élan qui emporte l'Assemblée, les corvées, les justices seigneuriales, les dîmes, la vénalité des offices, les privilèges fiscaux des provinces, des villes et des individus.
C'est reconnaître l'égalité de tous devant l'impôt et devant l'emploi et achever l'unité de la nation.
"Nous avons fait en dix heures, écrit un député, ce qui devait durer des mois".
En réalité les décrets des 5 et 11 août n'abolissent que les servitudes personnelles, les corvées et le droit de chasse, tandis que les droits réels pesant sur la terre ne sont déclarés que rachetables à un taux onéreux.
L'abolition de la vénalité des offices s'accompagne d'une indemnisation qui permet aux anciens titulaires de réinvestir l'argent dans l'achat de biens nationaux.
Quant aux corporations, l'article 10 du décret du 11 août se borne à leur interdire de nommer des représentants particuliers pour défendre leurs intérêts devant la municipalité.
Elles ne disparaîtront qu'avec la loi d'Allarde, le 2 mars 1791.
La nuit du 4 août doit être ramenée, en dépit de son retentissement, à de plus modestes proportions, car elle a eu surtout pour but de calmer les jacqueries qui menaçaient les intérêts de la bourgeoisie autant que ceux des nobles.
Elle n'en a pas moins consacré l'abolition du régime féodal et des privilèges.
La Nuit du 4 août 1789 est un évènement fondamental de la Révolution française, puisque, au cours de la séance qui se tenait alors, l'Assemblée constituante met fin au système féodal.
C'est l'abolition de tous les droits et privilèges féodaux ainsi que de tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations, à l'initiative du Club des Jacobins.
Depuis la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 s'est développée en France, notamment dans les campagnes, une vague de révoltes appelée la Grande Peur.
Dans certaines régions, des paysans s'en prennent aux seigneurs, à leurs biens et à leurs archives, en particulier les terriers qui servent à établir les droits seigneuriaux.
La Nuit du 4 août est une réponse à cette insurrection.
L'Assemblée constituante est en train d'élaborer la future constitution ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsqu'elle reçoit des récits inquiétants à propos de l'instabilité qui sévit en France.
Face à cette crise, deux solutions sont alors envisagées.
La première veut réaffirmer les valeurs de la propriété, et donc contrôler la révolte. Cette solution est vite rejetée, car elle n'aurait fait que renforcer l'opposition des paysans au système féodal.
La seconde solution envisage d’instaurer un réseau de bureaux de secours, qui permettraient d'aider les plus pauvres. Mais cette solution ne répond pas à l’urgence de la situation.
C’est donc pour sortir de ce blocage que naît l’idée de l'abolition des droits seigneuriaux, laquelle a probablement été pensée lors d'une réunion du Club breton, petit groupe de députés qui avaient pris l'habitude de discuter entre eux.
L'effervescence des évènements
Le 3 août 1789, le duc d'Aiguillon lance au Club breton l'idée d'une abolition des droits seigneuriaux.
Le lendemain, en fin de soirée, le vicomte de Noailles propose à l'Assemblée nationale de supprimer les privilèges pour ramener le calme dans les provinces.
Le duc d'Aiguillon propose l'égalité de tous devant l'impôt et le rachat des droits féodaux.
Tour à tour, dans une ambiance indescriptible, Le Guen de Kérangal, le vicomte de Beauharnais, Lubersac, l'évêque de La Fare vont surenchérir en supprimant les banalités, les pensions sans titre, les juridictions seigneuriales, le droit de chasse, les privilèges ecclésiastiques.
Le marquis de Foucault fait une motion vigoureuse contre l'abus des pensions militaires et demande que
" le premier des sacrifices soit celui que feront les grands, et cette portion de la noblesse, très opulente par elle-même, qui vit sous les yeux du prince, et sur laquelle il verse sans mesure et accumule des dons, des largesses, des traitements excessifs, fournis et pris sur la pure substance des campagnes".
Le vicomte de Beauharnais propose "l'égalité des peines sur toutes les classes des citoyens, et leur admissibilité dans tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires".
Cottin demande l'extinction des justices seigneuriales ainsi que celle de
"tous les débris du régime féodal qui écrase l'agriculture".
L'évêque de Nancy Anne Louis Henri de La Fare, s'emparant de la parole, après l'avoir disputée à l'un de ses confrères, demande, "au nom du clergé", que les fonds ecclésiastiques soient déclarés rachetables et
"que leur rachat ne tourne pas au profit du seigneur ecclésiastique, mais qu'il en soit fait des placements utiles pour l'indigence ".
L’évêque de Chartres, présentant le droit exclusif de la chasse comme "un fléau pour les campagnes ruinées depuis plus d'un an par les éléments", en demande l'abolition, et en fait l'abandon pour lui,
"heureux, dit-il, de pouvoir donner aux autres propriétaires du royaume cette leçon d'humanité et de justice ".
De Richer, revenant sur l'extinction des justices seigneuriales, demande la gratuité de la justice dans tout le royaume,
" sauf les précautions tendant à étendre l'esprit de chicane et la longueur indéfinie des procès .
Le duc du Châtelet propose alors qu'une taxe en argent soit substituée à la dîme,
"sauf à en permettre le rachat, comme pour les droits seigneuriaux".
"Tout semblait fini. Une scène non moins grande commençait. Après les privilèges des classes, vinrent ceux des provinces.
Celles qu’on appelait Pays d’État, qui avaient des privilèges à elles, des avantages divers pour les libertés, pour l’impôt, rougirent de leur égoïsme, elles voulurent être France, quoi qu’il pût en coûter à leur intérêt personnel, à leurs vieux et bons souvenirs.
Le Dauphiné, dès 1788 Vizille après la journée des Tuiles, l’avait offert magnanimement pour lui-même et conseillé aux autres provinces. Il renouvela cette offre.
Les plus obstinés, les Bretons, quoique liés par leurs mandats, liés par les anciens traités de leur province avec la France, n’en manifestèrent pas moins le désir de se réunir.
La Provence en dit autant, puis la Bourgogne et la Bresse, la Normandie, le Poitou, l’Auvergne, l’Artois.
La Lorraine, en termes touchants, dit qu’elle ne regretterait pas la domination de ses souverains adorés qui furent pères du peuple, si elle avait le bonheur de se réunir à ses frères, d’entrer avec eux dans cette maison maternelle de la France, dans cette immense et glorieuse famille ! Puis ce fut le tour des villes."
(extrait de Jules Michelet)
Enfin, Lally-Tollendal termine la séance en apothéose en proclamant Louis XVI "restaurateur de la liberté française ". En une nuit, les fondements du système par ordres s'effondrent.
Les jours suivants, le clergé tente de revenir sur la suppression de la dîme, mais le président de l'Assemblée, Isaac Le Chapelier, n'ayant accepté que des discussions sur la forme, les décrets du 4 août sont définitivement rédigés le 11.
Dès le lendemain, Louis XVI écrit à l’archevêque d’Arles :
"Je ne consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai pas ma sanction à des décrets qui les dépouilleraient ; c’est alors que le peuple français pourrait m’accuser d’injustice et de faiblesse. Monsieur l’archevêque, vous vous soumettez aux décrets de la Providence ; je crois m’y soumettre en ne me livrant point à cet enthousiasme qui s’est emparé de tous les ordres, mais qui ne fait que glisser sur mon âme. Si la force m’obligeait à sanctionner, alors je céderais, mais alors il n’y aurait plus en France ni monarchie ni monarque."
Louis XVI n'accorde sa sanction à ces décrets que contraint et forcé, le 5 octobre.
Ainsi disparaissent les privilèges des ecclésiastiques, des nobles, des corporations, des villes et des provinces.
Toutefois, les droits féodaux sont déclarés rachetables le 15 mars 1790, et leurs détenteurs ne sont pas tenus d'en prouver l'origine, ce qui, en pratique, conduit à leur maintien.
Toutefois, devant le refus de nombreuses communautés paysannes, l'Assemblée législative supprime le rachat, sauf présentation du titre primitif, pour les droits casuels le 18 juin 1792, puis pour l'ensemble des droits le 25 août suivant. Enfin, le 17 juin 1793, la Convention vote leur abolition complète, sans indemnité, et le brûlement des titres féodaux
Entrée en vigueur des décrets du 4 août 1789
L'abolition du régime féodal avait certainement été prononcée par les décrets que l'Assemblée nationale constituante avait pris les 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, et dont l'article premier débutait par la disposition suivante :
"L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal."
Mais ces décrets ne pouvaient pas "faire loi par eux-mêmes " : il fallait encore qu'ils fussent sanctionnés par le roi, et envoyés, de son ordre exprès, aux tribunaux et aux corps administratifs, pour être transcrits sur leurs registres.
C'est ce que l'Assemblée nationale constituante elle-même reconnaît le 14 septembre 1789, et c'est pourquoi elle prend, le même jour, un décret portant
"que M. le président se retirera par-devers le roi, pour présenter à S. M. les arrêtés des 4, 6, 7, 8 et 11 août dernier [...], pour lesdits décrets être sanctionnés".
En exécution de ce décret du 14 septembre, ceux des 4 août et jours suivants seront présentés, le lendemain même, 15 septembre, à la sanction du roi.
Le 18 septembre, une longue lettre du roi est remise et lue à l'Assemblée nationale constituante.
Elle contient des observations sur chacun des articles des décrets dont la sanction était réclamée.
Le résultat de ces observations est que le roi ne peut pas, quant à présent, sanctionner ces décrets, parce qu'ils ne forment que le texte de lois qui étaient encore à faire.
On y remarque notamment une forte répugnance à sanctionner l'abolition pure et simple du régime féodal, même lorsqu'elle serait expliquée et développée par des lois de détail.
« J'invite, écrit Louis XVI, l'Assemblée nationale à réfléchir si l'extinction du cens et des droits de lods et ventes convient véritablement au bien de l'État ; ces droits, les plus simples de tous, détournent les riches d'accroître leurs possessions de toutes les petites propriétés qui environnent leurs terres, parce qu'ils sont intéressés à conserver le revenu honorifique de leur seigneurie. Ils chercheront, en perdant ces avantages, à augmenter leur consistance extérieure par l'étendue de leurs possessions foncières ; et les petites propriétés diminueront chaque jour ; cependant il est généralement connu que leur destruction est un grand préjudice pour la culture."
L'Assemblée nationale constituante ne prend pas le change sur le but secret de ces observations.
Les regardant comme des prétextes mis en avant pour ajourner indéfiniment la promulgation officielle de ses décrets et, par ce moyen, en neutraliser les dispositions principales, elle prend, le 19 septembre, un décret qui charge son président "de se retirer sur-le-champ par-devers le roi, pour le supplier d'ordonner incessamment la Promulgation des arrêtés des 4 août et jours suivants, assurant à S. M. que l'Assemblée nationale, lorsqu'elle s'occuperait des lois de détail, prendrait dans la plus grande et la plus respectueuse considération, les réflexions et observations que le roi a lien voulu lui communiquer".
De la nouvelle démarche prescrite par ce décret résulte une lettre du roi, du 20 septembre, à l'Assemblée nationale.
Voici comment elle était conçue :
« Vous m'avez demandé, le 15 de ce mois, de revêtir de ma sanction vos arrêtés du 4 août et jours suivants ; je vous ai communiqué les observations dont ces arrêtés m'ont paru susceptibles : vous m'annoncez que vous les prendrez dans la plus grande considération, lorsque vous vous occuperez de la confection des lois de détail qui seront la suite de vos arrêtés. Vous me demandez en même temps de promulguer ces mêmes arrêtés : la promulgation appartient à des lois rédigées et revêtues de toutes les formes qui doivent en procurer immédiatement l'exécution ; mais comme je vous ai témoigné que j'approuvais l'esprit général de vos arrêtés, et le plus grand nombre des articles en leur entier ; comme je me plais également à rendre justice aux sentiments généreux et patriotiques qui les ont dictés, je vais en ordonner la publication dans tout mon royaume. La nation y verra, comme dans ma dernière lettre, l'intérêt dont nous sommes animés pour son bonheur et pour l'avantage de l’État ; et je ne doute point, d'après les dispositions que vous manifestez, que je ne puisse, avec une parfaite justice, revêtir de ma sanction toutes les lois que vous décréterez sur les divers objets contenus dans vos arrêtés."
Cette lettre distingue clairement deux choses qu'il était facile, pour l'Assemblée nationale constituante, de confondre à première vue, mais que le conseil de Louis XVI, comme la suite le prouvera, avait discernées parfaitement : elle fait la distinction entre la promulgation et la publication.
L'Assemblée nationale avait demandé la promulgation des décrets du 4 août.
Le roi répondait ou, du moins, il laissait entendre qu'il ne pouvait pas les promulguer, et il en donnait sur-le-champ la raison : c'est que la promulgation appartenait à des lois rédigées et revêtues des formes qui devaient en procurer immédiatement l'exécution.
Cependant, il ajoutait qu'il allait en ordonner la publication dans tout son royaume, c'est-à-dire qu'il aller les faire connaître, mais sans employer aucune des formes requises pour les faire exécuter immédiatement.
L'Assemblée nationale constituante ne s'aperçoit pas du piège qui lui est adroitement tendu par le ministère.
Elle applaudit, dans sa séance du 21 septembre, à la nouvelle lettre du roi et, le même jour, Louis XVI met au bas de l'expédition des décrets du 4 août, un ordre ainsi conçu : « Le roi ordonne que les susdits arrêtés seront imprimés, pour la Publication en être faite dans toute l'étendue de son royaume. »
Un mois se passe avant que l'Assemblée nationale constituante soit informée que cette publication n'a pas été faite dans le sens qu'elle y avait d'abord attaché ; qu'à la vérité, les décrets du 4 août ont été imprimés à l'Imprimerie royale, mais qu'il n'en a été adressé officiellement aucun exemplaire aux tribunaux ni même aux municipalités.
De là, le décret du 20 octobre 1789, portant que "les arrêtés des 4 août et jours suivants, dont le roi a ordonné la publication, seront envoyés aux tribunaux, municipalités et autres corps administratifs, pour y être transcrits sur leurs registres, sans modification ni délai, et être lus, publiés et affichés".
Le même décret ordonne que le Garde des sceaux soit mandé
"pour rendre compte des motifs du retard apporté à la publication et promulgation de ces décrets".
Dès le lendemain, le Garde des sceaux satisfait à la disposition de ce décret qui le concerne.
Il se présente à la séance de l’Assemblée nationale et, après lui avoir fait observer qu’elle n'avait réglé que par un décret du 5 octobre la forme de la promulgation et de l’envoi des décrets sanctionnés ou approuvés par le roi, il ajoute :
" C'est par cette raison que vos célèbres arrêtés du 4 août et jours suivants ont été imprimés à l'Imprimerie royale, avec l'ordre signé du roi, qui en ordonne l'impression et la publication [...] ; il ne m'est pas connu que vous ayez jamais demandé au roi d'adresser vos arrêtés, soit aux tribunaux, soit aux municipalités. Cependant je crois être sûr que MM. les secrétaires d'État en ont envoyé dans toutes les provinces avec profusion."
S'expliquer ainsi, c'était bien avouer que les décrets du 4 août n'avaient pas encore reçu le sceau d'une promulgation légale, et c'est ce que le ministre reconnaît expressément dans la suite de son discours, en disant :
" Dans les formes anciennes, les lois ne s'adressent qu'aux seuls tribunaux ; et la publicité qui est la suite de leur enregistrement, suffit pour astreindre légalement tous les corps et tous les particuliers à l'observation des lois. "
Ces explications sont, pour l'Assemblée nationale constituante, de nouveaux motifs de persister dans le décret qu'elle avait rendu la veille, pour faire ordonner l'envoi des décrets du 4 août aux tribunaux, ainsi qu'aux municipalités.
Cet envoi sera enfin ordonné par des lettres-patentes du 3 novembre 1789.
Que résulte-t-il de tous ces détails ?
Une chose fort simple : c'est que les décrets du 4 août 1789 ne sont devenus lois que par la promulgation qui en a été faite en exécution des lettres-patentes du 3 novembre suivant.
Et c'est ce que l'Assemblée nationale constituante elle-même déclare par l'article 33 du titre 2 de son décret du 15 mars 1790, explicatif de l'abolition du régime féodal prononcée par les décrets du 4 août :
"Toutes les dispositions ci-dessus, y est-il écrit, auront leur effet, à compter du jour de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789."
Décrets d'application des décrets du 4 août 1789
La mise en œuvre des décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 requérait des décrets d'application.
Décret du 15 mars 1790, relatif aux droits féodaux
Le 15 mars 1790, l'Assemblée nationale prend un décret général relatif aux droits féodaux.
Il est formé de la réunion de plusieurs décrets partiels nous dirions, aujourd'hui, de leur codification : les décrets respectivement du 24, 25, 26 et 27 février, 1er, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 15 mars 1790. Sanctionné par lettre-patente, le 28 mars 1790,
le décret du 15 mars 1790 devint la loi des 15 = 28 mars 1790, relative aux droits féodaux .
Son préambule résume ainsi les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 :
aux termes de l'article 1er des décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, le régime féodal est entièrement détruit ;
[...] à l'égard des droits et devoirs féodaux ou censuels, ceux qui dépendaient ou étaient représentatifs, soit de la main-morte personnelle ou réelle, soit de la servitude personnelle, sont abolis sans indemnité ;
[...] en même temps, tous les autres droits sont maintenus jusqu'au rachat par lequel il a été permis aux personnes qui en sont grevées de s'en affranchir, et qu'il a été réservé de développer par une loi particulière les effets de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction des droits abolis d'avec les droits rachetables .
Son titre Ier précise les effets généraux de la destruction du régime féodal ; son titre II énumère les droits seigneuriaux qui sont supprimés sans indemnité ;
et son titre III, les droits seigneuriaux rachetables.
Décret du 3 juillet 1790, relatif au rachat de divers droits féodaux sur lesquels il avait été réservé de statuer[modifier
L’abolition des droits seigneuriaux
"Les circonstances malheureuses où se trouvent la noblesse, l’insurrection générale… Les Provinces de Franche-Comté, de Dauphiné, de Bourgogne, d’Alsace, de Normandie, de Limousin, agitées des plus violentes convulsions et en partie ravagées ; plus de cent cinquante châteaux incendiés, les titres seigneuriaux recherchés avec fureur, l’impossibilité de s’opposer au torrent de la Révolution, les malheurs qu’entraînerait une résistance inutile… Tout nous indiquait la conduite que nous devions tenir. Il n’y eut qu’un mouvement général, le clergé et la noblesse se levèrent et adoptèrent toutes les motions proposées."
lettre du marquis de Ferrières, député de la noblesse
La nuit du 4 août doit être ramenée, en dépit de son retentissement, à de plus modestes proportions, car elle a eu surtout pour but de calmer les jacqueries qui menaçaient les intérêts de la bourgeoisie autant que ceux des nobles. Elle n'en a pas moins consacré l'abolition du régime féodal et des privilèges.
Ces privilèges étaient des droits hérités et le symbole d’appartenance à la noblesse. Ils étaient pour les paysans qui les subissaient humiliants et économiquement insupportable.|
Il fallut pratiquement 4 ans après la date symbole du 4 Août avant qu’ils ne soient définitivement abolis.
Et ils ne le furent pas pour des raisons philanthropiques mais par nécessité comme le montre la lettre du marquis de Ferrières.
**********************************
Les décrets d’Août 89
Art. 1 - L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle et personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité: tous les autres sont déclarés rachetables, et le prix et le mode du rachat seront fixés par l’Assemblée nationale. Tout ceux desdits droits qui ne seront point supprimés par ce décret continueront à être perçus jusqu’au remboursement;
Art. 2 - Le droit exclusif des fuies (petites volières) et colombiers est aboli
Art. 3 - Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes et pareillement aboli et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier. M. le Président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse.
Art. 4 - Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans indemnité
Art. 5 - Les dîmes de toutes natures et les redevances qu en tiennent lieu sous quelque dénomination qu’elles soient connues et perçues… sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d’une autre manière à la dépense du culte divin, à l’entretien des ministères des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations des églises et presbytères…Et cependant jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, l’Asemblée nationale ordonne que lesdites dîmes continuent d’être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée.
Art. 6 - Toutes les rentes perpétuelles soit en nature, soit en argent …seront rachetables ; les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, le seront pareillement au taux qui sera fixé par l’Assemblée.
Art. 7 - La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement.
Art. 11 - Tous les citoyens sans distinction de naissance pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires…
Le 11 août 1789, avec le décret général sur l’abolition du régime féodal c’est la fin officielle de la société par ordres de l’ancien régime. Le servage est définitivement aboli, cela d’autant plus facilement qu’il ne concerne plus personne.Tous les autres droits sont rachetables. Louis XVI n’accepta de promulguer ce décret que le 3 Novembre 1789.
Les seigneurs acceptèrent l’abolition des droits qui ne rapportaient rien . Les autres étaient rachetables. La dîme fut abolie mais en attendant de trouver une solution au financement de l’Eglise, elle dut continuer d’être payée.
La Constituante organisa le rachat des droits en Mars et en Mai 1790 soit neuf mois plus tard. Les circonstances du rachat venaient si tard et étaient si compliquées que les paysans eurent vraiment le sentiment de s’être fait avoir et ne s’y retrouvaient pas.
Alors à travers la France, les paysans recommencèrent à attaquer les châteaux et à détruire les documents qui leur tombaient sous la main. Cette agitation dura jusqu’en 1793. Les paysans voulaient que l’abolition de ce qui causait leur malheur ne soit pas un vain espoir mais une réalité.
Liens Cliquez
http://youtu.be/9HDO2xTuoDs nuit du 4 Août et déclaration des droits de l'homme le 26 Août.
http://www.ina.fr/video/CPB78050066/1788-video.html vie d'un village de Beauce en 1788
 [img width=600]http://lh3.ggpht.com/_KKTCT60suEU/TTCEBWhNkGI/AAAAAAAACbM/6rgHbxJo-gA/assemblea%20nacional.jpg?imgmax=640[/img] 
Posté le : 04/08/2013 12:02
|
|
|
|
|
Robespierre |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
* Le 28 Juillet 1794 est guillotiné Robespierre
Maximilien Marie Isidore de Robespierre, ou Maximilien Robespierre est un avocat et un homme politique français, né le 6 mai 1758 à Arras et mort guillotiné le 28 juillet 1794 à Paris, place de la Révolution.
Aîné d'une fratrie de cinq enfants, il perd sa mère à l'âge de six ans. Puis son père abandonne ses enfants, et il est pris en charge par son grand-père maternel. Après d'excellentes études au collège d'Arras et au collège Louis-le-Grand de Paris, licencié en droit, il devient avocat et s'inscrit en 1781 au Conseil provincial d'Artois, occupant même une charge d'avocat
Robespierre incarne la Révolution française dans sa tendance démocratique et ses méthodes terroristes, ce qui lui vaut, selon la règle, des admirateurs et des détracteurs. Toutefois, les premiers sont longtemps demeurés rares, parce que Robespierre déplaisait à beaucoup de révolutionnaires en raison de ses convictions morales et religieuses.
Les détracteurs au contraire ont toujours abondé, parce que Robespierre dès sa chute a servi de bouc émissaire.
Entre ces deux courants, des flottements se sont produits au gré des fluctuations de l'histoire et des idéologies de 1794 à nos jours.
Enfance et jeunesse;
Par ses origines, Maximilien de Robespierre se rattache à la petite bourgeoisie de robe qui peupla les assemblées révolutionnaires, en même temps qu'il s'en distingue par les infortunes de sa famille. Il naquit à Arras, quatre mois après le mariage de ses parents ; il perdit sa mère dès 1764, son père délaissa les enfants et disparut, ses grands-parents moururent trop tôt pour l'élever.
Il lui manqua l'affection, la considération et la richesse.
Boursier, il s'acharna au collège pour conquérir ce qui lui faisait défaut.
Maximilien de Robespierre était le fils ainé de Maximilien-Barthélémy-François de Robespierre né en 1732, avocat au Conseil supérieur d'Artois, et de Jacqueline-Marguerite Carraut née en 1735, fille d'un brasseur d'Arras.
Après leur rencontre en 1757, les deux jeunes gens s'étaient mariés le 2 janvier 1758.
Né à Arras le 6 mai suivant, Robespierre fut donc conçu hors mariage.
Par son père, il descendait d'une famille de gens de robe artésiens: son grand-père Maximilien 1694-1762 était également avocat au Conseil supérieur d'Artois, son bisaïeul Martin 1664-1720 procureur à Carvin, son trisaïeul Robert notaire à Carvin et bailli d'Oignies.
Le couple eut encore quatre autres enfants :
Charlotte en 1760, Henriette-Eulalie-FrançoiseEulalie-Françoise en 1761 et Augustin en 1763 ; le puîné vit le jour le 4 juillet 1764.
Mais la mère mourut huit jours plus tard, à vingt-neuf ans, suivie de près par le nouveau-né.
Robespierre avait six ans. À en croire les Mémoires de Charlotte, François de Robespierre aurait abandonné ses enfants peu après la mort de son épouse.
En revanche, selon Gérard Walter, on trouve des traces de lui à Arras jusqu'en mars 1766, puis de nouveau en octobre 1768. Ensuite, deux lettres de François de Robespierre, envoyées de Mannheim, confirment qu'il vivait en Allemagne en juin 1770 et en octobre 1771.
L'année suivante, d'après le registre d'audiences du Conseil d'Artois, il était de retour à Arras, où il plaida quinze affaires du 13 février au 22 mai.
Enfin, en mars 1778, à la mort de son beau-père, un jugement de l'Échevinage d'Arras indique qu'étant absent, il s'était fait représenter. Par la suite, si l'on prête foi à ce document, on perd sa trace.
L'abbé Proyart qui semble avoir connu personnellement le père de l'Incorruptible) prétend qu'après avoir habité quelque temps à Cologne, il aurait annoncé le dessein de se rendre à Londres, et de là aux Îles, où il serait possible qu'il vécût encore en 1795, mais cette hypothèse, discutée par Albert Mathiez, est rejetée par Auguste Paris et Gérard Walter. Un acte d'inhumation le fait mourir à Munich le 6 novembre 1777, version reprise par Henri Guillemin ou Catherine Fouquet Après la mort de leur mère, les deux filles furent recueillies par leurs tantes paternelles, les garçons par leur grand-père maternel, Jacques Carraut 1701-1778.
Maximilien entra, en 1765, au collège d'Arras ancienne institution jésuite qui n'appartenait pas encore aux Oratoriens, étant gérée par un comité local nommé par l'évêque.
Charlotte, dans ses Mémoires, affirme que l'attitude de Maximilien avait connu un grand changement, à l'époque et que, conscient d'être en quelque sorte le chef de la famille, il avait pris un tour plus grave et sérieux.
En 1769, grâce à l'intervention du chanoine Aymé auprès de l’évêque d’Arras, Louis-François-Marc-Hilaire de Conzié, il obtint une bourse de 450 livres annuelles de l'abbaye de Saint-Vaast et entra au collège Louis-le-Grand, à Paris.
Malgré son extrême dénuement, il fit de brillantes études au collège Louis-le-Grand 1769-1781, où il eut pour condisciples Camille Desmoulins et Louis-Marie Stanislas Fréron.
Son nom fut plusieurs fois proclamé aux distributions de prix du Concours général : deuxième prix de thème latin et sixième accessit de version latine en 1772, quatrième accessit de vers latins et de version latine en 1774, deux seconds prix en latin et le quatrième accessit de version grecque en 1775, le premier prix de rhétorique en 1776, etc..
D'après l'abbé Proyart, préfet du collège, c'était un élève studieux, se consacrant uniquement au travail, solitaire et rêveur, peu expansif.
Très bien vu par ses maîtres, il fut choisi, en 1775, pour prononcer le compliment en vers du nouveau roi Louis XVI. Il rencontra Jean-Jacques Rousseau à la fin de sa vie, entre 1775 et 1778 - ou l'aperçut, selon Gérard Walter.
Selon les Mémoires posthumes de Brissot, témoignage rejeté par Gérard Walter comme invraisemblable pour des raisons chronologiques, il aurait été un temps clerc chez le procureur Nolleau fils, où le futur girondin l'aurait croisé.
Reçu bachelier en droit de la faculté de Paris le 31 juillet 1780, il obtint son diplôme de licence le 15 mai 1781 et s'inscrivit sur le registre des avocats du Parlement de Paris deux semaines après.
Le 19 juillet, sur rapport du principal du collège, une récompense de 600 livres lui fut octroyée. Par ailleurs, sa bourse passa à son frère Augustin.
À vingt-deux ans, il terminait donc, ses études pourvu d'un certificat de bonne conduite, d'une gratification et d'une licence en droit. Avocat, il avait rétabli sa position sociale et ses chances quand il s'installa à Arras.
Son séjour prolongé à Paris au collège Louis-le-Grand l'avait ouvert à la philosophie des Lumières, détaché du catholicisme et engagé sur les traces de Rousseau avec une ferveur de disciple admiratif : "Homme divin, tu m'as appris à me connaître bien jeune, tu m'as fait apprécier la dignité de ma nature et réfléchir aux grands problèmes de l'ordre social. "
Il parut pourtant s'intégrer aisément à cet ordre. Il se fit une réputation d'avocat, de lettré, de bel esprit.
Il entra à l'académie d'Arras et à la société des Rosati, comme Lazare Carnot ; comme lui et comme Rousseau, il concourut pour gagner les prix et la notoriété des académies provinciales.
La réussite fut imparfaite, les lauriers trop rares, et les confrères déjà parvenus faisaient peser une lourde tutelle sur les jeunes. Il s'en indignait en 1788, tout comme Carnot déplorant la stagnation des jeunes talents dans le corps des ingénieurs militaires. Le climat de 1788 était à la contestation.
Mais Robespierre étendait ses griefs à la société tout entière et projetait de libérer les pauvres de l'oppression et de l'injustice.
À cette époque, il se défendait contre certaines tendances profondes de sa nature, pressentant qu'elles l'empêcheraient d'aboutir : "Une idée absolue de perfection, de pureté, déclarait-il, ne peut être qu'une erreur politique."
Il se limitait à des vues réformistes et plaçait ses espérances en Necker.
La convocation des états généraux lui fournit l'occasion d'agir.
Député du tiers état
Élu député, il se sentit soudain revêtu de toute l'autorité que donnait une souveraineté du peuple toute neuve, en même temps qu'investi d'une haute mission, celle de régénérer la nation dans sa structure et son esprit.
Du coup Robespierre devint un homme nouveau, libéré de la timidité et du souci des autorités, si apparents dans ses mémoires de concours.
D'emblée, il sentait la puissance des résistances opposées à ses aspirations, comprenait l'un des premiers qu'il faudrait combattre farouchement et se persuadait de l'existence et de la force d'un "complot des ennemis du peuple ".
Il lui appartenait de dénoncer inlassablement, énergiquement, tout ce qui s'opposait à la promulgation et à l'application des "principes , des axiomes qui guideraient l'action révolutionnaire et sur lesquels s'édifierait la société nouvelle, harmonieuse et définitive : singulièrement l'égalité de droits, la bonté et la quasi-infaillibilité du peuple, l'efficacité souveraine de la vertu pour assurer le bonheur.
Orateur inlassable, minutieux et inflexible, il devint l'un des chefs des démocrates, censurant l'oubli des principes, réclamant le suffrage universel, l'admission de tous dans la garde nationale, dans les jurys des tribunaux, s'opposant à la répression brutale des mouvements populaires.
Il gagna ainsi l'admiration du jeune Saint-Just, dès 1790, les acclamations des Parisiens et des Arrageois à la fin de l'assemblée et l'offrande de son buste couronné par les Jacobins.
Chemin faisant, à la suite d'échecs répétés, il avait perdu toute considération pour la plupart des députés, il s'était convaincu de la nocivité des factions, il avait récusé la valeur immuable du verdict de la majorité.
Il lui préférait la pureté des principes, l'incorruptibilité du caractère, le respect et l'application des "saintes maximes de l'égalité et de la morale publique ", la confiance en l'Être suprême, grâce à quoi un ordre nouveau serait établi "pour des siècles et pour l'univers ", à la fois idéaliste et quelque peu rigide.
Le Jacobin, membre de la Commune de Paris
Ce fut donc avec une autorité intacte que, de septembre 1791 à septembre 1792, n'étant plus député, selon une règle qu'il avait fait accepter, il milita sans trêve au club des Jacobins.
Il adjurait les frères et amis des clubs de toute la France, les députés démocrates, d'être " toujours armés d'une salutaire défiance ".
La déclaration de guerre l'opposa vigoureusement aux Brissotins, elle lui paraissait imprudente et criminelle, faisant le jeu du roi et des généraux en cas improbable de succès.
Avec les défaites, un sursaut patriotique éclata, en même temps que grandissait l'action des sans-culottes ;
Robespierre appuya le mouvement qui aboutit à la chute du roi, le 10 août ; il devint membre de la Commune de Paris et commença de tenir un rôle de premier plan.
Non seulement il fut élu député de la Convention, mais il orienta le choix des autres députés de Paris par le vote oral et public et l'épuration des candidats.
Lié désormais aux démocrates parisiens, il fut éclaboussé par les massacres de septembre, dont il n'était pas responsable bien qu'il ait failli y exposer Brissot.
À la Convention et aux Jacobins, Robespierre combattit farouchement les Girondins, bourgeois égoïstes, privilégiés par la fortune et par l'éducation, hostiles au peuple et surtout à celui de Paris.
C'est ainsi qu'il les voyait, comme tant de Montagnards et de démocrates.
Pourtant cette dialectique des riches et des pauvres lui apparaissait simpliste et trompeuse ; le critère de la vertu et de la croyance en l'Être suprême rejetait les athées corrompus et corrupteurs, fussent-ils Montagnards.
D'autre part, les relations avec les sans-culottes n'étaient pas seulement affectées par la prise de position morale et religieuse, mais encore par les divergences de politique sociale et économique.
Robespierre refusait au domaine économique et financier un rôle fondamental : grâce à la Providence, la France était largement pourvue de richesses ; il suffirait que la vertu élimine l'égoïsme et la spéculation pour que chacun soit assuré du nécessaire. C'était donc le refus de l'intervention, de la taxation, du contrôle, réclamés par les sans-culottes.
Déjà déçu par les parlementaires, Robespierre se défiait des porte-parole du peuple et admettait que, si le peuple n'avait jamais tort en principe, il pouvait cependant être induit en erreur et que, de ce fait, l'insurrection, arme suprême, risquait de tourner à l'aventure.
Finalement Robespierre jouissait d'un prestige plus éclatant que solide, plus assuré dans la lutte contre les ennemis communs que dans l'édification d'une France nouvelle.
S'il imposa son point de vue pour la mort du roi, quand il lutta contre les Girondins après la trahison de Dumouriez en avril 1793, il dut faire des concessions aux sans-culottes.
Il alla jusqu'à proposer de définir la propriété comme "la portion de biens garantie par la loi", il proclama le "droit à l'existence ", ce qui impliquait de profondes réformes.
Il obtint ainsi l'appui des sections armées de Paris, dont les canons décidèrent l'éviction des principaux Girondins le 2 juin 1793. Près de deux mois plus tard, le 26 juillet 1793, Robespierre entrait au grand Comité de salut public : ce fut l'apogée de sa carrière.
Le délai de deux mois s'explique-t-il par une hésitation ?
Robespierre eut-il conscience qu'il maniait mieux les clubs que les députés, et mieux les députés qu'un petit groupe de personnages fortement trempés ?
Dictateur ou un membre contesté du Comité de salut public ?
La conjoncture était catastrophique, tant au-delà des frontières qu'à l'intérieur de la République, les ennemis étaient déchaînés et victorieux, les révolutionnaires demeuraient divisés.
Le Comité de salut public organisa une lutte implacable contre les ennemis déclarés, mais il fallut louvoyer pour éviter les ruptures entre révolutionnaires.
Robespierre accepta lui aussi, sous la pression des Enragés, le maximum, la législation contre les accapareurs, la levée en masse, l'armée révolutionnaire parisienne.
Il s'efforça d'enrayer la déchristianisation.
Il parvint à faire mettre en place un gouvernement d'exception doté de rouages révolutionnaires, tandis que la constitution était mise en sommeil.
Ce fut la Terreur. S'il n'en était pas le seul responsable, il était convaincu de sa nécessité ; il ne put cependant la mener à son gré, en dépit de ce qu'on a souvent nommé, à l'époque et depuis, sa dictature.
Il se défendit jusqu'à son dernier souffle d'avoir été dictateur. Était-ce à juste titre ?
Assurément aucune magistrature comportant les pleins pouvoirs ne lui fut attribuée, jamais d'ailleurs il ne le demanda. Robespierre était membre d'un comité puissant, mais il n'y était soutenu que par Couthon et Saint-Just, les autres membres n'approuvaient pas sa politique.
De plus, le comité dépendait de la Convention et, là non plus, Robespierre n'était pas sûr de rallier la majorité.
D'autre part, le Comité de sûreté générale, sauf deux de ses membres, ne soutenait pas Robespierre.
En revanche, il n'est pas douteux que Robespierre disposait d'un immense prestige et d'une vaste audience auprès des démocrates, des Jacobins, des sans-culottes de Paris et de province, grâce à quoi il pouvait souvent imposer ses vues.
Enfin, Robespierre tenait de plus en plus souvent un langage de dictateur détenteur de la vérité :
"Nous sommes intraitables comme la vérité, inflexibles, uniformes, j'ai presque dit insupportables comme les principes. "
Il était profondément convaincu de la justesse de ses vues, ceux qui ne les partageaient pas ne pouvaient être que des traîtres à la cause du peuple, ils devaient être éliminés.
Ainsi, tour à tour, ceux qu'on dénomma hébertistes et dantonistes furent guillotinés, respectivement le 24 mars et le 5 avril 1794.
À cette occasion, deux décrets, les décrets de ventôse, avaient décidé le séquestre des biens des suspects au profit des patriotes indigents, mesure dont l'audace fut tempérée par l'opportunité dans la décision et aussi dans l'application.
Dans le précieux carnet qu'il portait le 9 thermidor, on lit bien que les " bourgeois " étaient les ennemis, mais il n'était pas question d'un transfert de propriété.
Robespierre décevait Babeuf.
La chute
La Grande Terreur ne fut pas l'œuvre du seul Robespierre, bien que les tentatives d'assassinat qu'il essuya l'aient précipitée. Grâce aux revers subis par les ennemis du dehors puis du dedans, Robespierre crut pouvoir entamer l'œuvre d'édification de la société qu'il croyait la seule conforme aux principes, donc légitime et définitive.
Il annonçait la liberté, le bien-être, l'essor du commerce et des arts, la disparition de la richesse excessive et de la corruption, en somme le bonheur général.
Le moyen était la vertu, favorisée par des institutions neuves et efficaces.
Cet épanouissement des âmes s'accomplirait sous les auspices de l'Être suprême, garant de l'harmonie.
Lorsque Robespierre pontifia au cours de la fête fameuse du 8 juin, le processus était engagé qui devait conduire à la république démocratique et vertueuse des petits propriétaires, libres, égaux en droit et en considération, tous dévoués au bien commun.
Les possibilités et les risques ne lui apparurent pas nettement.
Mal informé, obstiné, malgré les instances d'amis et de correspondants, fatigué aussi par un surmenage prolongé provoquant des dépressions, il ne vit pas grandir l'inquiétude de ceux qui, traversant ses desseins, se sentaient menacés.
Il ne comprit pas non plus que les victoires militaires rendaient la Terreur moins acceptable.
Il voulut épurer ses ennemis au Comité de salut public en s'appuyant sur la Convention, les clubs et les comités révolutionnaires.
Il cessa de participer aux séances du comité, laissant le champ libre à ceux qu'il avait humiliés et menacés.
Il perdit du temps. Lorsqu'il intervint à la Convention le 26 juillet, il ne fut pas suivi.
Attaque à la maison de la commune de Paris (hôtel de ville actuel)
Il croit, cependant, qu'il domine encore la Convention.
Le 8 thermidor, c'est à dire ce 26 juillet, il monte à la tribune, attaque le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale, et surtout lance un long réquisitoire contre les "traîtres" et les "fripons" …, qu'il refuse de nommer.
Imprudence fatale.
Cette diatribe sème l'inquiétude dans les rangs et permet aux conjurés de rallier les indécis du Marais ou de la Plaine : les centristes.
Le lendemain, Saint-Just ne peut lire à la Convention le rapport qu'il a rédigé.
En revanche, Billaud-Varenne et Tallien dénoncent la tyrannie de Robespierre, ce "nouveau Cromwell ".
Celui-ci essaie, mais en vain, de se défendre : Collot d'Herbois et Jacques Thuriot , successivement présidents de l'Assemblée, l'empêchent de se faire entendre en agitant leur sonnette, et la Convention décide l'arrestation de Maximilien et de ses amis.
Apprenant la nouvelle, la Commune essaie de réagir : elle se déclare en insurrection et fait délivrer les prisonniers.
En réponse, l'Assemblée déclare hors-la-loi tout le groupe des robespierristes qui voulurent protéger leur chef.
Dans la nuit, les sections modérées, conduites par Barras, marchent sur l'Hôtel de Ville, où se sont réfugiés les proscrits. Robespierre ne cherche pas à se défendre : il attend son salut de la légalité et non de la violence.
En voyant arriver les hommes en armes, il se tire un coup de pistolet et se brise la mâchoire, à moins qu'il n'ait été atteint par le coup de feu du gendarme "Méda ou Merda" ?.
Mis hors la loi, il refusa de patronner l'insurrection populaire, peut-être même tenta-t-il de se suicider.
Le lendemain, lorsque, ce 9 thermidor, Robespierre est empêché de parler, et qu'il se sent perdu, il ne peut que dire : "Les brigands triomphent… ", mot révélant l'importance, chez lui, du point de vue moral dans l'analyse d'une situation politique. Transporté sanglant aux Tuileries et sommairement pansé, il demeurera pendant de longues heures couché sur une table avant d'être guillotiné avec ses fidèles, parmi lesquels son frère Augustin, Couthon, Le Bas, Saint-Just.
Exécution publique, place de la concorde du 10 thermidor an II, 28 juillet 1794.
Le grand artisan de la Révolution française a été sacrifié : sa mort marque la fin de la Convention montagnarde.
Cette fin souligne la complexité de l'homme, le manque de contacts avec ce peuple qu'il aimait plus qu'il ne le fréquentait, ses hésitations et ses scrupules dans l'action, qui contrastaient avec sa résolution pour défendre les principes dans la législation et la justice révolutionnaires.
Sa foi, sa sincérité, son incorruptibilité ne suffisaient pas à l'œuvre exaltante qu'il avait entamée cinq ans plus tôt.
Cette œuvre elle-même manquait à la fois d'assises économiques et de conscience historique, mais Robespierre lui avait donné une signification morale et culturelle.
Le jour de L’exécution
Ainsi Robespierre fut condamné sans procès et guillotiné l'après-midi même du 10 thermidor, sous les acclamations de la foule, en compagnie de vingt et un de ses amis politiques, dont Saint-Just et Couthon ainsi que son frère, Augustin Robespierre.
Les vingt-deux têtes furent placées dans un coffre en bois, et les troncs rassemblés sur une charrette.
On jeta le tout dans une fosse commune du cimetière des Errancis et l’on répandit de la chaux, afin que le corps du "tyran" Robespierre ne laisse aucune trace.
Le lendemain et le surlendemain, 83 partisans de Robespierre furent également guillotinés.
Une épitaphe posthume est imaginée par un anonyme à son sujet :
"Passant, ne t'apitoie pas sur mon sort
Si j'étais vivant, tu serais mort."
En 1840, des partisans de Robespierre fouillèrent le sol du cimetière des Errancis, alors fermé depuis une trentaine d’années, sans découvrir aucun corps.
Sa chute contribua, dans les jours et semaines qui suivirent, à un démantèlement progressif du gouvernement révolutionnaire, emporté par la réaction thermidorienne : adoption, dès le 11 thermidor,
du renouvellement par quart tous les mois des comités, les membres étant inéligibles pendant un mois ;
nomination de dantonistes et de modérés au sein des comités de salut public et de sûreté générale ;
rattachement, le 1er fructidor, 24 août, de chacune des douze commissions exécutives remplaçant depuis le 1er floréal, 20 avril le Conseil exécutif aux douze principaux comités, et non plus au seul comité de salut public, et cantonnement des compétences de ce dernier et du comité de sûreté générale aux domaines de la guerre et de la diplomatie, pour l'un, de la police, pour l'autre, le comité de législation récupérant l'administration intérieure et la justice;
suppression de la loi de Prairial ;
réduction du nombre de comités de surveillance révolutionnaire à un par district en province et douze à Paris, au lieu de quarante-huit, limitation de leurs prérogatives et modification des conditions d'accès dans un sens défavorable aux sans-culottes.
Ce démantèlement du système de l'an II, et particulièrement de l'appareil répressif n'aboutit pas, cependant, à la mise en accusation de tous ceux qui avaient organisé la Terreur et en avaient largement profité en mettant la main sur les biens des nobles et des banquiers exécutés, ces derniers chargeant Robespierre de tous leurs méfaits et n'hésitant pas à falsifier les documents historiques.
Elle conduisit également à la remise en cause de la politique dirigiste, démocratique et sociale pratiquée par ce gouvernement afin de satisfaire le mouvement populaire des sans-culottes.
Dès sa chute, tous les Duplay furent emprisonnés ; la femme de Maurice Duplay, âgée de 59 ans, fut, quant à elle, retrouvée pendue dans son cachot le 11 thermidor.
Éléonore Duplay ne se maria jamais et vécut le reste de sa vie dans le regret de son grand homme.
Marie-Éléonore Duplay, dite Cornélie, est la fille de Maurice Duplay et de Françoise-Éléonore Vaugeois, qui accueillirent Maximilien de Robespierre chez eux de 1791 à sa mort en 1794.
Nous savons peu de choses sur elle. Elle avait un caractère droit et fier, d'où son surnom de Cornélie en référence à la mère des Gracques mais semblait un peu inhibée dans son rôle d'aînée.
Elle étudiait la peinture sous Jean-Baptiste Regnault et se révélait assez douée mais n'ambitionnait pas d'en faire son métier.
Selon la légende de la famille Duplay, Éléonore serait devenue la fiancée de l'Incorruptible pendant son séjour dans leur famille.
L'aprés Robespierre
Au lendemain du 9-Thermidor, devant des manifestations de sympathie à l'égard des vaincus – plusieurs suicides ou tentatives de suicide, apparition de chansons pleurant la mort de Robespierre, diverses manifestations d'hostilité à l'encontre de chanteurs antirobespierristes –, les Thermidoriens favorisèrent le développement d'une campagne de presse et de pamphlets à l'origine de la légende noire de Robespierre.
Juste après l'exécution des robespierristes, Jean Joseph Dussault fit paraître dans plusieurs journaux un portrait dans lequel il tenta d'expliquer son ascendant par une capacité à profiter avec adresse de circonstances qu'il aurait été incapable de créer.
Le lendemain, un article anonyme d'inspiration girondine le décrivit comme un mauvais patriote, protecteur des prêtres, fanatique lui-même, despote en devenir, insistant comme Dussault sur ses "talents médiocres" et 'une grande flexibilité aux circonstances, la science d'en profiter, sans savoir les faire naître ".
Le Journal de Perlet expliqua que Robespierre envisageait une nouvelle épuration qui l'aurait conduit vers le trône.
Le Journal des Lois, peut-être le premier, tenta de la faire passer pour un Tartuffe et un Sardanapale, faisant de Cécile Renault une maîtresse délaissée dont il aurait voulu se débarrasser.
Le Perlet évoqua de prétendues orgies dans une maison d'Issy et un projet de mariage avec Marie-Thérèse de France, destiné à le faire reconnaître comme roi.
Cette dernière affirmation fut reprise par Barras à la barre de la Convention, qui présenta la fille de Louis XVI comme la maîtresse de l'Incorruptible.
Dans son numéro du 7 fructidor, 24 août, le Journal des Lois accusa encore Robespierre d'être un affameur du peuple. Autre affirmation de cette presse :
Robespierre aurait machiné, en accord avec le " tyrans étrangers ", la Terreur pour dégoûter les autres peuples des principes révolutionnaires.
Une commission dirigée par Edme-Bonaventure Courtois fut chargée de donner rapport des papiers saisies chez les robespierristes, afin de donner corps aux accusations de conspiration qui avaient justifié leur mise en accusation.
Celui-ci fut distribué aux députés le 28 pluviôse an III, 16 février 1795, déclenchant aussitôt une vive polémique, de nombreuses pièces ayant disparu.
Des députés s'étaient entendus avec Courtois pour faire disparaître des documents estimés compromettants.
Par ailleurs, Courtois avait conservé des papiers, qui furent saisis à son domicile sous la Restauration.
Parallèlement, l'ancien constituant Pierre-Louis Roederer fit paraître une mince plaquette, le Portrait de Robespierre, rédigée à la hâte et signée Merlin de Thionville ;
le premier, il considérait que le cas Robespierre tenait de la pathologie, celui d'un tempérament mélancolique devenu trabilaire .
En nivôse an III, Galart de Montjoie publia une Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre, biographie mêlant des "révélations" issues de la presse thermidorienne, des racontars issu des Actes des Apôtres et des résumés des comptes rendus parlementaires.
En 1795 parut une brochure anonyme intitulée Vita del despota sanguinario della Francia Massimiliano Roberspierre et traduite "du français en italien", sans doute rédigée par un ecclésiastique réfractaire réfugié en Italie.
Le récit sur son enfance y était particulièrement fantaisiste, l'apparentant avec Damiens à la suite des Actes des Apôtres.
À la même époque parut à Hambourg une brochure, La Vie et les crimes de Robespierre surnommé le Tyran, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, œuvre de l'abbé Proyart signée M. Le Blond de Neuvéglise, colonel d'infanterie légère .
Si son information n'était pas toujours de première main et si son authenticité laissait souvent à désirer , l'auteur réfutait plusieurs fables imprimées en France.
Dans son histoire de la Révolution, Jacques Necker évoqua lui aussi Robespierre, qu'il avait connu au début de sa carrière politique et dont il n'envisageait pas sans amertume le degré d'élévation auquel il était parvenu, supérieur à celui de l'ancien ministre de Louis XVI.
Le premier, il fit de Robespierre " l'inventeur de l'exécrable et fameuse journée du 2 septembre ".
Dans le même temps, il condamnait les inventions des thermidoriens et des émigrés, qui avaient échoué à percer le mystère de Robespierre.
Autre ministre de Louis XVI, Antoine François Bertrand de Molleville s'attacha également à l'énigme Robespierre dans son Histoire de la Révolution de France, parue entre l'an IX et l'an XI.
Jugeant son rôle aussi étonnant qu'exécrable, il ne trouva d'autre explication, pour justifier sa brusque élévation, que sa haine à l'égard d'un Ancien Régime qui ne laissait aucune chance favorable à son ambition et sa lâcheté, qui l'incitait à commettre les assassinats sans nombre dont il se rendit coupable.
En 1815 parurent trois ouvrages rédigés sous l'Empire mais saisis par la police : l’Histoire de la Révolution de l'abbé Papon, l’Essai historique et critique de la Révolution de Pierre Paganel et les Considérations de Germaine de Staël.
Au contraire de leurs prédécesseurs, ces auteurs jugeaient que Robespierre marquerait durablement l'histoire, sa figure émergeant seule de cette période. Insistant également sur ses tendances égalitaires, l'abbé Papon jugeait qu'il se distinguait par l'austérité et le désintéressement dont il faisait montre.
Dans ses écrits consacrés à la Révolution "Mes réflexions" en 1816, le Cours de philosophie positive en 1830-1842, le Système de politique positive en 1851-1854 Auguste Comte décrivit Robespierre comme un personnage au caractère essentiellement négatif, auquel il reprochait d'avoir promu un déisme légal, inspiré de Jean-Jacques Rousseau et associé au régime concordataire de Napoléon Ier, et l'opposa au mouvement encyclopédique de Denis Diderot et à Danton.
Dans le même temps, il témoigna de son admiration pour la conception du gouvernement révolutionnaire instauré par la Convention.
Après sa mort, le positiviste Pierre Laffitte reprit fidèlement cette analyse dans les conférences qu'il donna à la Bibliothèque populaire de Montrouge, résumées dans La Révolution française de Jean François Eugène Robinet, ainsi que dans le cadre des célébrations du centenaire de la Révolution.
La première tentative de réhabilitation de Robespierre fut l'œuvre de Guillaume Lallement, auteur anonyme, entre 1818 et 1821, d'une compilation de l'ensemble des discours et rapports des assemblées parlementaires de la Révolution éditée par Alexis Eymery ;
le tome XIV, consacré à l'an II, donnait une large place à Robespierre, dont il faisait le portrait en préalable aux événements du 9-Thermidor. Puis, en 1828, Paul-Mathieu Laurent, dit Laurent de l'Ardèche, publia sous le pseudonyme de "Uranelt de Leuze" une Réfutation de l'histoire de France de l'abbé de Montgaillard, parue l'année précédente, ardent panégyrique de Robespierre.
À la veille de la révolution de 1830 parurent de faux Mémoires de Robespierre, généralement attribués à Auguste Barbier et Charles Reybaud, mais peut-être commencés par Joseph François Laignelot, qui avait été un intime de Charlotte de Robespierre.
Cet écrit témoignait de l'opinion de la génération de 1830 sur Robespierre.
Selon l'auteur, l'opinion selon laquelle Robespierre avait pu être un agent de l'étranger était tout à fait discréditée ;
son incorruptibilité ne faisait aucun doute ; enfin, son intention, dans les derniers mois de sa vie, était de mettre fin à la Terreur et de purger la Convention de ses membres les plus criminels.
Cette entreprise de réhabilitation connut une avancée décisive avec Albert Laponneraye, qui entreprit en 1832 la publication des discours de Robespierre en fascicules, avant d'éditer les Mémoires de Charlotte Robespierre sur ses deux frères en 1835 puis les Œuvres de Maximilien Robespierre en quatre volumes en 1840, qu'il contribua largement à diffuser.
La génération de 1848 bénéficia, quant à elle, de la publication de l’Histoire parlementaire, 1834-183, de Philippe Buchez et de Pierre-Célestin Roux-Lavergne, et de l'achèvement de la réimpression de l’ancien Moniteur, 1840-1845 par Léonard Gallois, qui vinrent contrebalancer les mémoires et témoignages, subjectifs, des contemporains. Cet apport documentaire favorisa un renouvellement historiographique, avec l’Histoire des Girondins, 1847 d'Alphonse de Lamartine, l’Histoire de la Révolution française, 1847-1853 de Jules Michelet et celle de Louis Blanc, 1847-1855, qui firent toutes de Robespierre "le centre de leurs investigations", même si seul Louis blanc lui était plus nettement d'emblée favorable.
Sous le Second Empire, Ernest Hamel publia une Histoire de Robespierre, 1865-1868 considérée comme hagiographique, mais très bien documentée.
Sous la Troisième République, les auteurs se détournèrent de Robespierre, assimilant la Terreur à la Commune de Paris (1871), comme Hippolyte Taine dans Les Origines de la France contemporaine, 1875-1893, ou faisant de Robespierre un " pontife", adversaire de l'athéisme, de la libre-pensée et de la laïcité, comme Alphonse Aulard.
Lors du centenaire de la Révolution de 1889, l'épopée militaire fut privilégiée, avec les figures de Carnot, Hoche, Marceau, Desaix et surtout Danton.
Jean Jaurès contribua à ramener Robespierre au devant de la scène avec son Histoire socialiste de la Révolution française, tout en ouvrant vers les Hébertistes et les Enragés.
En 1907, l'érudit Charles Vellay créa la Société des études robespierristes, qui publia à partir de 1908 les Annales révolutionnaires, devenues en 1924 les Annales historiques de la Révolution française, ainsi que les Œuvres complètes de Robespierre en dix puis onze volumes.
L'un de ses premiers et principaux membres, Albert Mathiez fut le principal acteur de ce mouvement, qui fit de Robespierre la figure centrale de la Révolution, s'opposant à Aulard, son ancien maître, dans une lutte demeurée fameuse.
À sa suite, on trouvait La Révolution française Georges Lefebvre ou le Robespierre de Gérard Walter, qui pointaient les limites de Robespierre sur les questions sociales et financières.
Ce dernier ouvrage, selon Joël Schmidt, n'a pas été dépassé par l'abondance de sa documentation.
Par la suite, si le rôle de Robespierre dans la Révolution ne fut pas remis en cause, la recherche historique ouvrit de nouveaux champs, avec l'exploration du mouvement sans-culotte, des Hébertistes et des Enragés, sous l'influence d'Albert Soboul.
En 1956, au lendemain des élections législatives, l'Assemblée nationale vota une résolution invitant le gouvernement à, à organiser avec le maximum d'ampleur la célébration du deuxième centenaire de la naissance de Robespierre en 1958, en particulier à organiser, en son honneur, un hommage solennel, une journée dans les écoles et les universités, à favoriser par de larges subventions les travaux historiques, les expositions et les œuvres dramatiques.
Dans les années 1960, en parallèle à une contestation du modèle communiste et soviétique, qui s'étaient affirmés les héritiers de la Révolution, l'école révisionniste ou libérale, emmenée par François Furet, Denis Richet et Mona Ozouf, contribua à remettre en cause cette image de Robespierre.
Ainsi, François Furet écrivait le 7 juillet 1989 dans L'Express : Dans cette sagesse fin de siècle, Robespierre n’a pas vraiment été réintégré dans la démocratie française.
Le droite veille sur cet ostracisme en brandissant les mauvais souvenirs.
Mais l’Incorruptible a plus à craindre de ses amis que de ses ennemis.
En l’embrassant trop étroitement, l’historiographie communiste l’a entraîné dans un redoublement de désaffection.
Les travaux de Patrice Gueniffey et de Laurent Dingli se situent dans leur droite ligne.
En 1986, en prévision de l'aboutissement commémoratif de cette réaction antirobespierriste, dans l'historiographie progressiste non marxiste, Max Gallo fit paraître sa Lettre ouverte à Maximilien Robespierre sur les nouveaux muscadins.
Oublié des célébrations nationales du Bicentenaire de la Révolution, Robespierre demeure une figure majeure de l'histoire française, comme en témoigne la floraison des associations – les Amis de Robespierre pour le Bicentenaire de la Révolution, créés à Arras en 1987, l'Association Maximilien Robespierre pour l'idéal démocratique, AMRID, fondée en 1988 par Marianne Becker – et publications depuis 1989, et un personnage controversé, partagé entre les tenants de l'école jacobine et ceux des écoles néo-libérale et contre-révolutionnaire, entre des avocats et des procureurs.
Ainsi, la mise en vente chez Sotheby's le 18 mai 2011 d'un lot de manuscrits, comprenant des discours, des projets d’articles de journaux, des brouillons de rapports devant être lus à la Convention, un fragment du discours du 8 thermidor et une lettre sur la vertu et le bonheur, conservés par la famille Le Bas après la mort de Robespierre a suscité une mobilisation parmi les historiens et dans le monde politique ; Pierre Serna a publié un article intitulé : Il faut sauver Robespierre ! dans Le Monde, et la Société des études robespierristes lancé un appel à souscription, tandis que le PCF, le PS et le PRG alertaient le ministère de la Culture.
Lors de la vente, l’État a fait valoir son droit de préemption pour acquérir le lot à 979 400 euros au nom des Archives nationales.
Ces manuscrits sont désormais en ligne sur le site des Archives nationales
Postérité
Héritage politique.
Le robespierrisme est un terme pour désigner une réalité mouvante ou pour qualifier des hommes qui partageaient ses idées. Plus généralement, il désigne toutes les personnes qui se réclament de la personne ou de la pensée de Maximilien de Robespierre.
Parmi ceux qui se sont réclamés de Robespierre, figurent notamment le mouvement chartiste anglais, un certain nombre de républicains et de socialistes français des années 1830-40 – on a parlé de néo-robespierrisme – comme Albert Laponneraye, éditeur des Œuvres de Robespierre et des Mémoires de Charlotte de Robespierre, Philippe Buchez, qui a publié une Histoire parlementaire de la Révolution, Étienne Cabet, auteur d'une Histoire populaire de la Révolution française de 1789 à 1830 ou Louis Blanc, qui a écrit une Histoire de la Révolution française, instruits par Philippe Buonarroti, mais aussi les mouvements socialiste et communiste avec la monumentale Histoire de la Révolution française de Jean Jaurès ou les travaux de l'historien Albert Mathiez.
Littérature.
Charles Nodier a consacré à Robespierre un article, intitulé « De la littérature pendant la Révolution. Deuxième fragment. Éloquence de la tribune. Robespierre , dans la Revue de Paris en septembre 1829. Il a été repris, sous le titre Robespierre l'aîné, dans ses Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la Révolution et de l'Empire (1831) puis, sous le titre La Montagne, dans Recherches sur l'éloquence révolutionnaire dans le tome 7 des Œuvres de Charles Nodier.
Même s'il présente Robespierre comme un personnage médiocre « exhaussé par l'opinion et les événements » et brosse un portrait de l'orateur conforme aux stéréotypes du temps pour ne pas trop heurter son public devant l'audace de son analyse, Nodier lui sait gré d'avoir, avec son frère Augustin, entrepris de canaliser, « dans le sens d'un ordre politique relativement viable, les forces génératrices de chaos », à travers notamment l'instauration du culte de l'Être suprême. De même, il lui reconnaît un supériorité d'ordre esthétique dans l'éloquence et affirme « qu'il faut chercher peut-être dans [ses] discours (...) presque tout ce qu'il y avait de spiritualisme et de sentiments humains dans l'éloquence conventionnelle ». En particulier, il fait montre d'admiration pour le discours du 7 prairial, où Robespierre affirme faire peu de cas de sa propre vie, après les tentatives d'assassinat d'Henri Admirat et de Cécile Renault, et celui du 8 thermidor, où il retrouve le dessein de pacification et de restauration de l'ordre public qu'il lui attribue264
Honoré de Balzac traite Robespierre comme un personnage à part entière dans Les Deux Rêves, paru dans La Mode en mai 1830 puis intégré dans Sur Catherine de Médicis.
Dans ce texte, Catherine de Médicis apparaît en songe à Robespierre et justifie le massacre de la Saint-Barthélemy, qui n'a pas été motivé, explique-t-elle, par une animosité personnelle ou le fanatisme religieux, mais pour le salut de l'État. Fréquent dans la littérature royaliste de l'époque, le rapprochement entre ce massacre et ceux de la Révolution contribue à expliquer ces derniers en voulant réhabiliter la politique de la reine.
Il ne lui reproche pas la Terreur, mais de l'avoir exercée au nom d'un principe démocratique.
En dehors de ce texte, la figure de Robespierre dans l'œuvre de Balzac est uniformément antipathique, l'archétype du tyran sans cœur et sans scrupule, même si, jusqu'à la Révolution de 1848, il témoigne d'une réelle admiration devant la grandeur de sa destinée.
Il figure ainsi parmi les génies qui ont changé la face du monde dans l'édition de 1846 de la lettre d'adieu de Lucien de Rubempré à Vautrin, avant de passer dans le rang de ceux dont le rôle a été uniquement destructeur, dans son exemplaire personnel.
Robespierre apparaît dans des ouvrages historiques d'Alexandre Dumas, Louis XVI et la Révolution, Le Drame de 93, ainsi que dans plusieurs de ses romans fleuves : le cycle des Mémoires d'un médecin, on trouve quelques allusions dans Le collier de la reine, Le Chevalier de Maison-Rouge et surtout dans La Comtesse de Charny et les deux parties de Création et rédemption, Le Docteur mystérieux et particulièrement La Fille du marquis.
C'est également le cas dans la nouvelle La Rose rouge.
S'appuyant particulièrement sur les ouvrages historiques de Jules Michelet et Alphonse de Lamartine, Dumas s'inspire surtout du premier pour le présenter comme un personnage qui ne sait pas vivre, rongé par la jalousie et l'ambition, sans lui reconnaître la même grandeur, son principal reproche étant 'incapacité de Robespierre pour la jouissance et le bonheur.
Dans Histoire de ma vie, George Sand prend la défense de Robespierre, victime à ses yeux des calomnies de la réaction .
S'appuyant sur les écrits de Lamartine, elle le juge le plus humain, le plus ennemi par nature et par conviction des apparentes nécessités de la terreur et du fatal système de la peine de mort, mais aussi le plus grand homme de la révolution et un des plus grands hommes de l'histoire.
Si elle lui reconnaît des fautes, des erreurs, et par conséquent des crimes, elle s'interroge :
Mais dans quelle carrière politique orageuse l'histoire nous montrera-t-elle un seul homme pur de quelque péché mortel contre l'humanité? Sera-ce Richelieu, César, Mahomet, Henri IV, le maréchal de Saxe, Pierre le Grand, Charlemagne, Frédéric le Grand, etc., etc.? Quel grand ministre, quel grand prince, quel grand capitaine, quel grand législateur n'a commis des actes qui font frémir la nature et qui révoltent la conscience? Pourquoi donc Robespierre serait-il le bouc-émissaire de tous les forfaits qu'engendre ou subit notre malheureuse race dans ses heures de lutte suprême?
Dans Les Misérables, Enjolras, le chef des étudiants révolutionnaires, exprime son admiration à l'égard de Jean-Jacques Rousseau et Robespierre.
Dans son dernier roman, Quatrevingt-treize 1874, Victor Hugo met en scène la rencontre imaginaire entre trois grandes figures de la révolution française: Marat, Danton et Robespierre.
Jules Vallès offre de Robespierre une image foncièrement négative, concomitante à l'empreinte qu'il exerce sur lui. Avant 1871, Robespierre apparaît comme un visage pâle, paternel, celui de la violence froide et de la mort, un corps raide, hiératique, un héritier de Plutarque et de Jean-Jacques Rousseau, porteur du déisme du XVIIIe siècle.
Cette critique devient une autocritique dans les années 1865-1866, sous l'influence de Pierre-Joseph Proudhon.
Après l'expérience de la Commune, jugeant la génération 1848 et se jugeant lui-même à la lumière de Robespierre, il dénonce la tyrannie du patrimoine culturel classique enseigné dans les collèges et le système éducatif du XIXe siècle, se reprochant d'avoir imité des imitateurs de l'Antiquité, à travers Rousseau et Robespierre.
Pourtant, signale Roger Bellet, la hargne de Vallès à l'égard de Rousseau n'est pas automatiquement réversible sur Robespierre ; son déisme voulait sans doute être à usage populaire, celui d'une religion non ecclésiastique, Vallès pouvait partager sa critique du philosophisme, sa critique d'un « monde de scolastique philosophique et émeutier » est plus proche de Robespierre que d'Hébert.
En 1912, Anatole France met en scène Évariste Gamelin, un jeune peintre jacobin, fidèle de Marat et de Robespierre, dans son roman Les dieux ont soif.
L'Incorruptible apparaît lui-même dans le chapitre XXVI, peu avant le 9-Thermidor.
L'épisode de la promenade dans les Jardins Marbeuf, lieu à la mode à l'époque, avec Brount, son chien danois, et de l'échange avec le petit Savoyard est déjà présent dans l’Histoire de la Révolution française de Louis Blanc et l’Histoire de Robespierre d'Ernest Hamel, qui l'ont tiré des mémoires manuscrits d'Élisabeth Le Bas.
Théâtre
Dès après sa mort, Robespierre a été le héros ou l'un des personnages principaux de nombreux drames ou tragédies : 49 pièces ont été recensées entre 1791 et 1815, 37 entre 1815 et 1989.
Deux images de Robespierre s'en détachent : une majorité lui est hostile, sans nuance, l'autre partie est réhabilitatrice, voire célébratrice.
Entre Thermidor et l'Empire se développe la légende noire de Robespierre, à travers les faibles drames de Godineau La Mort de Robespierre, ou la Journée des 9 et 10 thermidor, 1795 ou d'Antoine Sérieys La Mort de Robespierre, 1801.
En décembre 1830, le Robespierre d'Anicet Bourgeois présente encore la même caricature de tyran sanguinaire, laconique et peureux.
D'autres pièces font clairement allusion à Robespierre, ainsi Manlius Torquatus ou La discipline romaine pièce d'inspiration jacobine, jouée en février 1794 de Joseph Lavallée, Pausanias représenté en mars 1795, édité en 1810 de Claude-Joseph Trouvé, Quintus Fabius ou La discipline romaine interprété au théâtre de la République, fin juillet 1795 de Gabriel Legouvé ou Théramène ou Athènes sauvée 1796 d'Antoine Vieillard de Boismartin.
En Angleterre, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey et Robert Lovell écrivent un drame en vers intitulé The Fall of Robespierre en août 1794 ; Coleridge rédige le premier acte, Southey le deuxième, Lovell le troisième ; mais Southey, jugeant cette dernière partie non conforme, la réécrit.
Les auteurs s'appuient pour l'essentiel sur les comptes-rendus des événements parus dans la presse. Édité sous le seul nom de Coleridge en octobre 1794 par Benjamin Flower, il est tiré à 500 exemplaires et distribué à Bath, Cambridge et Londres.
Si le Thermidor 1891 de Victorien Sardou est d'inspiration girondine,
le Robespierre 1845 de Rudolf Gottschall,
le Maximilien Robespierre 1850 de Robert Griepenkerl,
le Danton und Robespierre 1871 de Robert Hamerling,
Le Neuf Thermidor (1871) de l'avocat nîmois Gaston Crémieux,
le Robespierre ou les drames de la Révolution (1879) de Louis Combet,
Le Monologue de Robespierre allant à l'échafaud (1882) d'Hippolyte Buffenoir,
Le Dernier songe de Robespierre (1909) d'Hector Fleischmann,
L'Incorruptible, chronique de la période révolutionnaire (1927) de Victor-Antoine Rumsard et
le Robespierre 1939 de Romain Rolland sont robespierristes.
Leur premier enjeu, selon Antoine de Baecque, est de transformer le corps, souffrant, blessé, défiguré de Robespierre le 10 thermidor, présenté par les thermidoriens comme un cadavre monstrueux, en un corps de héros ,
une figure christique.
Fascinée par Robespierre, auquel elle attribue ses opinions communistes, Stanisława Przybyszewska (1901-1935) lui consacre deux pièces :
L'Affaire Danton, redécouverte par le metteur en scène Jerzy Krakowski en 1967 et adaptée au cinéma par Andrzej Wajda sous le titre Danton, ainsi que
Thermidor, demeurée inachevée.
Avec le temps, les auteurs tendent de plus en plus à problématiser le personnage théâtral, ainsi Georg Büchner, qui ne prend pas parti pour ou contre lui dans
La Mort de Danton 1835, mais s'interroge sur la possibilité de la révolution.
Le même questionnement apparaît chez Romain Rolland, qui passe, entre Danton (1900) et Robespierre (1938), de la justification et de l'exaltation du personnage à l'expression des souffrances morales d'un Robespierre déchiré devant le problème du sang versé.
Le Bourgeois sans culotte de Kateb Yacine, joué au festival d'Avignon de 1988 puis au palais Saint-Vaast d'Arras en 1989 et sur le carreau de la mine désaffectée de Loos-en-Gohelle en octobre 1990, présente Robespierre comme le seul des révolutionnaires français à avoir su imposer la suppression de l'esclavage, l'inspirateur permanent d'une révolution mondiale des maltraités , et voit en lui un modèle, un martyr vivant de la république , victime de ceux à qui il portait ombrage.
Liens
http://youtu.be/XiM74n8I2Gc Henri Guillemin Robespierre 1
http://youtu.be/Fpx5Gj-boRo Henri Guillemin Robespierre 2
http://youtu.be/dRqLQdctMZU L'ombre d'un doute Robespierre
http://youtu.be/PhHH9G6mUcQ Robespierre La chute création de la légende noire
http://youtu.be/_ssIznJZ-hw Robespierre par Laurent Dingli
   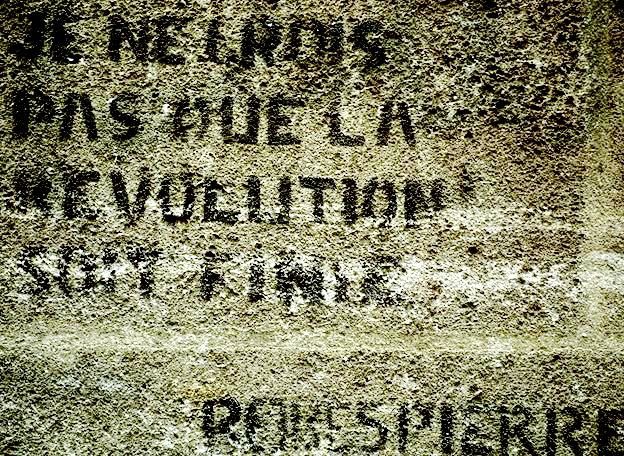 [imgwidth=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Harriet_-_La_Nuit_du_9_au_10_thermidor_an_II,_Arrestation_de_Robespierre.jpg[/img]   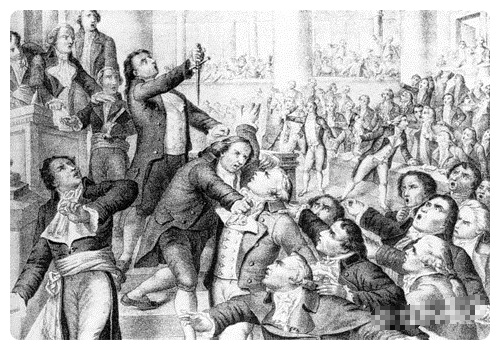
Posté le : 27/07/2013 17:18
Edité par Loriane sur 28-07-2013 15:19:15
Edité par Loriane sur 28-07-2013 15:40:21
|
|
|
|
|
Re: Fète nationale Belge Abdication du roi 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Merci couscous. Tu as lu tout l'article ?
Difficile de traiter un si vaste sujet, et surtout sans se laisser entraîner dans des considérations inutiles sur l'opposition des communautés.
L'histoire de la Belgique est si ancienne et si complexe que faire court n'était pas facile.
Merci de ton passage.
Posté le : 24/07/2013 21:37
|
|
|
|
|
Re: Fète nationale Belge Abdication du roi 2 |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35550
|
Merci Loriane pour ce magnifique historama de ma chère Belgique.
Posté le : 24/07/2013 20:13
|
|
_________________
Belge et drôle et vice versa.
|
|
|
Fète nationale Belge et abdication dur roi 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 21 juillet est le jour de la fête nationale Belge.
La Belgique est le plus petit pays d'Europe, il a mis près de deux mille ans à se rassembler et aujourd'hui encore il lutte pour son unité.
La Belgique, État improbable, n'en finit pas de s'interroger sur son identité, son passé, son présent et son avenir.
Il est à noter sur ce point du désaccord entre les deux "belligérants" linguistiques que ce fait à pour résultat de contraindre celui qui souhaite rédiger un article sur l'histoire de la Belgique à une prudence de sioux.
Il est regrettable de constater combien selon que l'auteur soit Flamand ou Wallon la version, purement historique, est différente. En effet il y a une quasi impossibilité d'exclure ce conflit d'un écrit, pour qui écrit sur l'histoire de la Belgique la neutralité impose un exercice de la plus grande complexité, car pour qui se refuse à toute polémique, il est ardu de trouver des renseignements fiables et non entachés de manipulations historiques. Ce conflit entre les deux peuples s'invite donc dans tous les documents, et fait douter du sérieux des sources et de leur fiabilité, celles-ci devenant rapidement des arguments de propagande politique. De ce fait, nous devons sans cesse naviguer entre deux vérités qui s'opposent.
J'ai donc tenter ici une synthèse des diverses sources, contradictoires, toutes plus passionnées et donc partiales.
La Belgique, il est vrai est un curieux État, guère plus étendu que la Bretagne, 30.000 km2, mais trois fois plus peuplé, composée de 10 millions d'habitants, né en 1830 de la scission des Pays-Bas.
À défaut d'une d'une langue commune, les Belges partagent un art de vivre original, tissé d'humour et d'épicurisme. Au carrefour de toutes les cultures ouest-européennes, ils ont en commun la bande dessinée et le football, la bière et le cyclisme, les Brueghel, Paul Rubens et René Magritte, Hans Memling et Charles Quint... ce qui n'est pas rien !
L'histoire
La Belgique est un état jeune dans un pays vieux. Si le royaume moderne des Belges, tel que nous le connaissons aujourd'hui ne fut fondé qu'en 1830, ce pays malgré tout prend ses racines dans l'antiquité romaine, et même selon l'historien médiéviste belge, Henri Pirenne la création de l'état Belge constitue la phase finale d'un processus commencé avec les celtes.
Les premiers peuples installés sur le territoire de la Belgique furent sans doute des Indo-Européens. Les archéologues ont trouvé des traces de populations tant celtiques à l’ouest que germaniques au nord.
Si l’on tient compte des fouilles archéologiques, on peut conclure que le territoire actuel de la Belgique, de même que le nord de la France, a pu être une zone de transition entre les cultures celtique et germanique.
Par ailleurs, les écrits d’Hécatée de Milet vers 550 à vers 480 et d’Hérodote -484 à -425 nous apprennent également que les Celtes habitaient originairement une région qui s’étendait de l’ouest de la France jusqu’au sud-est de l’Allemagne, mais qui pourrait exclure le nord de la Belgique.
Constitués en tribus autonomes et rivales, ces peuples étaient unis par la religion druidique et la langue celtique.
C'est avec la conquête de Rome que les Belges entrèrent dans l'histoire.
En 57 avant notre ère, Jules César, lors de la guerre des Gaules, fit pénétrer ses légions dans la «Gaule belge».
Dès cette époque, César faisait la distinction entre les Celtes ou Gaulois, les Aquitains et les Belges.
César croyait que les peuples belges étaient issus des Germains. Il a même fait une énumération de ces Belges qui, sous le nom de Germani
Cette assimilation des Belges aux Germains n’a pas empêché César de considérer les Belges comme des Gaulois c'est à dire un peuple celte.
En réalité, certains peuples belges étaient originaires des régions germaniques à l’est du Rhin, mais furent vraisemblablement soumis à de fortes influences celtiques, alors que d’autres peuples étaient d’origine celte.
Parmi les nombreuses tribus du territoire de la «Gaule belge» qui résistèrent à l’occupation romaine.
La Belgique doit cependant rendre à César ce qui lui appartient, et en premier lieu son nom. C'est en effet le général romain qui parle le premier de "Belgae" les Belges en écrivant cette phrase laudatrice pour le peuple vaincu : "De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves !"
Dans l'introduction de son livre De Bello Gallico "La guerre des Gaules", César parle des Belges en ces mots: «Horum omnium fortissimi sunt Belgae.»
Autrement dit : «De tous, les Belges sont les plus valeureux.»
Cependant, ce qui nous paraît être un qualificatif désignant un trait de caractère positif, n'a pas le sens que nous entendons et le mot "brave" doit être replacé dans le contexte. En réalité, pour César, fortissimi signifiait les guerriers les plus «violents» ou les plus «sauvages», et ce, parce qu'Ils aimaient la bagarre et qu'ils étaient les plus éloignés de Rome, centre de la civilisation.
C'est d'ailleurs en Belgique, donc en Gaule belge, que César essuya sa plus sanglante défaite.
Ambiorix, le chef des Éburons, avait surpris les Romains dans la vallée du Geer et avait exterminé entièrement deux légions , c'est à dire 6000 soldats.
Arrivé trop tard en renfort avec le reste de son armée pour éviter le massacre de ses légions, César poursuivit Ambiorix qui se réfugia dans la forêt ardennaise où il ne parviendra jamais à le surprendre.
Cela dit, certains historiens laissent croire que les peuples belges s’étaient déjà formés dès le IVe siècle avant notre ère, alors que d’autres situent cette mixité plutôt vers le IIe siècle.
À l’époque de la conquête des Gaules, en 57 avant notre ère, la Gaule belge s’étendait entre la mer du Nord, la Seine et la Marne, et comptait quelque 500 000 habitants répartis en une quinzaine de tribus.
Les Belgae parlaient des idiomes germaniques, fortement influencés par les parlers celtiques, mais d’autres historiens considèrent qu’il s’agissait d’idiomes celtiques fortement influencés par des apports germaniques.
Au temps dire, comme je le signale plus haut, que la confusion, la difficulté à séparer les deux cultures n'est pas récente, et même qu'elle remonte à l'époque romaine.
Établi dans la région de Tournai, le peuple franc fonde un premier grand État sur les ruines de l'empire romain, le «Regnum francorum» ou Royaume des Francs.
La France et l'Allemagne en sont issus.
Au Moyen Âge, la Belgique, qui n'est encore qu'un concept géographique et non national, est divisée entre d'innombrables seigneuries plutôt prospères et dynamiques, plus ou moins indépendantes : comté de Flandre, duchés de Brabant et de Hainaut, évêché de Liège...
Portion du royaume franc où s'élabore la puissance des Carolingiens dès le VIIe siècle, le centre de leurs domaines familiaux était situé dans la région liégeoise, la Belgique est divisée par Charlemagne de 768 à 814 en comtés, origine des circonscriptions féodales du Moyen Âge.
Le territoire belge divisé par le traité de VerdunAu lendemain du traité, le territoire est partagé entre la Francie et la Lotharingie. C’est ainsi que la Flandre, au nord, revient à Charles le Chauve, tandis que la Wallonie s’intègre aux territoires de Lothaire Ier. Ces derniers seront toutefois attribués au Saint Empire romain germanique quelques années plus tard.Après le partage de l’empire carolingien par le traité de Verdun en 843, la Belgique est divisée de part et d’autre de l’Escaut entre le futur royaume de France, auquel est rattaché le comté de Flandre et la Basse-Lotharingie, landgraviat de Brabant, comté de Hainaut, rattachée bientôt à la Germanie, cœur du Saint Empire romain germanique ; mais ces liens restent assez lâches comme en témoigne, notamment, la résistance des Flamands à l’annexion par Philippe le Bel voir la bataille des Éperons d’or en 1302.
Donc, le pays est déjà divisé en deux quand conformément au traité de Verdun en 843, les comtés de Flandre, de Boulogne et d'Artois, à l'ouest, font allégeance aux rois capétiens, mais avec réticence car ils tiennent à commercer librement avec les Anglais, ennemis traditionnels des Capétiens. Le comte de Flandre figure au premier rang des ennemis de Philippe Auguste à la bataille de Bouvines en 1214.
En Mars 1240 Les pères de l'Abbaye de Leffe rachètent une Brasserie voisine
L’Abbaye de Leffe rachète une brasserie située de l’autre côté de la Meuse toute proche. Les pères peuvent alors commencer le brassage de la bière qui compense une eau à la qualité peu certaine. La méthode utilisée est alors celle de la haute fermentation, procédé qui est toujours en vigueur chez la célèbre marque.
Le 18 Mai 1302 Les "Mâtines de Bruges"Les Flamands se révoltent contre l'occupant français et massacrent les soldats de la garnison à Bruges. Cette journée est nommée "Mâtines de Bruges" par comparaison aux "Vêpres siciliennes" qui chassèrent 20 ans plus tôt les Français de Sicile. Philippe le Bel, furieux, enverra sa meilleure armée en Flandres. Mais celle-ci sera vaincue près de Coutrai le 11 juillet. C'est la fin du rêve des rois Capétiens d'annexer les Flandres.
- À l'est de l'Escaut, on quitte le domaine capétien pour entrer dans le duché de Basse-Lorraine. Il fait partie du Saint Empire romain germanique et s'étend jusqu'au Rhin.
En 1339, profitant de la guerre entre France et Angleterre, la Flandre, le Hainaut et le Brabant-Limbourg
se lient par un pacte pour consolider leur indépendance. Ainsi s'efface la frontière de l'Escaut.
En 1384 La Flandre devient bourguignonne
Le dernier comte de Flandre trouve la mort. Son gendre, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne obtient le territoire flamand. C’est ainsi que naissent les Pays-Bas bourguignons. Par la suite, Philippe le Bon annexera au territoire le comté de Namur, le duché de Brabant-Limbourg, les comtés de Hainaut, Zellande, Hollande et Frise. Il y ajoutera encore le duché de Luxembourg et la principauté de Liège.
Avec la bataille de Courtrai, le roi Philippe IV le Bel tente de remettre les Flamands dans le droit chemin mais il doit y renoncer... Il faudra attendre Louis XIV et le traité d'Aix-la-Chapelle de 1668 pour que la Flandre méridionale, autour de Lille, Boulogne et Arras, entre dans le giron français !
Le 20 septembre 1460 meurt Gilles Binchois. Le plus célèbre représentant de l’école franco-flamande, Gilles Binchois, laisse au monde une œuvre profane et audacieuse. Influencé par l’Ars Nova mais aussi par la musique plus sobre de John Dunstable, le musicien belge vivant au service de Philippe le Bon à la cour de Bourgogne a composé de nombreuses chansons dont « Je ne vis oncques la pareille ». Mais il a aussi laissé des œuvres de musique sacrée.
En 1611 Rubens peint l'Érection de la Croix
L’exécution du triptyque "l’Erection de la croix" donne à Rubens le statut de véritable maître de la peinture flamande de son époque. Rubens a en effet atteint une maturité dans sa création qui se traduit par l’harmonie des couleurs, le travail sur la lumière et le mouvement. Peignant jusqu’à sa mort sans que son talent ne décline, Rubens sera le principal représentant du Baroque flamand.
le 29 Octobre 1702 Marlborough s'en va t'en guerre
Le général anglais John Marlborough s'empare de la ville de Liège qui appartenait aux espagnols. C'est le début de la guerre de succession en Espagne : l'Angleterre, l'Autriche et la Hollande soutiennent Charles d'Autriche, le prétendant au trône. Une chanson populaire française rendit le nom du général anglais légendaire.
Essor des villes et du commerce
Si l'histoire politique des principautés belges, qu'elles soient fief français ou terres d'Empire, se confond avec celle des Pays-Bas, eux aussi terre d'empire, à partir du XIIIe siècle, une société urbaine et marchande s'épanouit en territoire flamand ou brabançon, notamment autour de cités comme Gand, Louvain,Bruges ou Anvers qui deviennent de grandes places commerciales.
L'État bourguignon
L'œuvre d'unification des Pays-Bas, tentée par les ducs de Bourgogne, surtout Philippe le Bon, dans le cadre des États bourguignons, dont seule reste exclue la principauté ecclésiastique de Liège, est poursuivie par les Habsbourg. Ceux-ci héritent de ces territoires à la suite du mariage de Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, avec le futur empereur germanique Maximilien d'Autriche (1477).
En 1493, leur fils, Philippe le Beau, devient maître des Pays-Bas, en passe de devenir État indépendant. Il épouse Jeanne la Folle, fille des Rois catholiques, souverains d'Aragon et de Castille. Le sort des Pays-Bas est désormais lié à celui de la maison d'Espagne.
Après la mort de Philippe le Beau, son fils Charles, dit Charles Quint, reçoit les Pays-Bas en 1515, en attendant d'hériter des Espagnes en 1516 et d'être élu à la tête du Saint Empire romain germanique en 1519.
Les Pays-Bas constituent dès lors un véritable État dont la puissance démographique, évaluée à 3 millions d'habitants en 1557 renforce la puissance économique.
Les Pays-Bas au temps de Charles Quint
Si Charles Quint, respectueux des libertés locales, gouverne les Belges avec fermeté, mais prudence, il n'en est pas de même de son fils Philippe II, qui monte sur le trône d'Espagne en 1556, héritant également des Pays-Bas.
Le soulèvement contre la domination espagnole
Les atteintes portées par Philippe II, devenu prince des Pays-Bas, aux libertés des provinces, provoquent une explosion du sentiment national, incarné par les comtes d'Egmont et de Hornes, qui sont exécutés à Bruxelles (1568).
La lutte pour les libertés politiques va de pair avec celle des calvinistes pour la tolérance religieuse alors que le souverain espagnol, soucieux avant toute chose de maintenir l’unité religieuse de l’Empire, entend appliquer les dispositions de la Contre Réforme en s'appuyant sur le concile de Trente.
Cependant, la résistance des catholiques wallons à l'emprise des protestants les amène à former la Confédération d'Arras en 1579 et à se rapprocher du gouverneur espagnol Alexandre Farnèse, qui reconquiert ensuite la Flandre et le Brabant entre 1581-1585.
Les rebelles intransigeants ont de leur côté conclu l'Union d'Utrecht en 1579, acte de naissance des Provinces-Unies qui marque la rupture de l'unité des Pays-Bas.
Des Habsbourg à l'indépendance
Les provinces du Sud, maintenues dans le giron du catholicisme, connaîtront la domination des Habsbourg d'Espagne jusqu'au début du XVIIIe siècle.
Véritable boulevard militaire des Provinces-Unies d'une part, les Pays-Bas méridionaux se trouvent d'autre part entraînés dans les guerres auxquelles participe l'Espagne.
Le cadre territorial de la future Belgique se précise ainsi au XVIIe siècle :
cession aux Provinces-Unies du Brabant septentrional et de la Flandre zélandaise, afin de contrôler les bouches de l'Escaut en vue d'empêcher le développement d'Anvers : par le traité de Münster en 1648 ;
-abandon à la France de l'Artois avec le traité des Pyrénées, en 1659, de la Flandre et du Hainaut français , voir les traités d'Aix-la-Chapelle en 1668 et de celui de Nimègue en 1678.
Sous la tutelle autrichienne 1713-1795
En 1713, le traité d'Utrecht remet les Pays-Bas méridionaux à l'Autriche.
Les souverains autrichiens ont le souci de promouvoir la prospérité des Pays-Bas méridionaux. Le réseau routier se modernise, la mortalité recule.
Le pays est l'un des plus peuplés d'Europe avec 100 habitants au kilomètre carré au Brabant et en Flandre.
La population est essentiellement rurale, Bruxelles et Liège restent des villes modestes et n'ont respectivement que 75 000 et 55 000 habitants ; La population bénéficie des nouvelles techniques agricoles encouragées par les physiocrates c'est à dire les économistes prônant le respect des « lois naturelles » et donnant la prépondérance à l'agriculture.
l'industrialisation qui règne dans toute l'Europe, draine dans son mouvement l'industrie wallonne qui connaît alors un est grand essor : charbonnages, métallurgie, verrerie, textile même, révolutionné par le machinisme naissant.
Mais comme toujours le niveau de vie qui s'améliore entraîne une augmentation rapide de la population et le prolétariat enfle, avec la disparition progressive des famines et des épidémies.
Cependant le progrès ne bénéficie pas à tous de façon unitaire et à la fin du XVIIIe siècle, si brillant pour la bourgeoisie et les privilégiés, la misère est malgré toujours grande dans les campagnes belges.
Au nom du despotisme éclairé, l'empereur germanique Charles VI puis sa fille Marie-Thérèse d'Autriche réduisent les prérogatives du clergé belge, limitent le développement des couvents, on verra les Jésuites chassés en 1773, et l'empereur taxe les biens ecclésiastiques.
1789/1795 Révoltes et révolutions
À la fin du XVIII e siècle, Alors que la France en révolution est à feu et à sang, la Belgique en réaction contre des réformes conçues par Joseph II sans tenir compte des particularismes locaux, on voit le fait national belge devenir réalité :
La révolution brabançonne en 1789 chasse les Autrichiens, réunit à Bruxelles les états généraux, qui n'ont pas siégé depuis 1632, et qui proclament, le 11 janvier 1790, "l'indépendance des États belges unis".
Bataille de Jemmapes
Mais les Belges se divisent, et les Autrichiens réoccupent leur pays en décembre 1790 ;
En effet ceux -ci ont en sont chassés par les Français, voir la bataille de Jemmapes en novembre 1792.
Les Autrichiens l'occupent à nouveau du 18 mars 1793 avec la victoire de Neerwinden. Le 26 juin 1794 c'est la bataille de Fleurus.
La France, finalement victorieuse, l'annexe le 1er octobre 1795, y compris le pays de Liège, et l'Autriche reconnaît le fait accompli au traité de Campoformio le 17 octobre 1797 et la cession des Pays-Bas méridionaux à la France.
La Belgique française de 1795-1815
Le régime français de 1795-1815, unifie administrativement la Belgique, dont la division en départements, cadre des futures provinces belges de 1830, achève de détruire les autonomies provinciales et le régime féodal.
Les principes révolutionnaires qui agitent la France, liberté individuelle, égalité de tous devant la loi et le Code civil napoléonien y sont introduits. Napoléon rétablit la paix civile et religieuse compromise par les persécutions de la Convention et du Directoire ; le pays retrouve une prospérité économique, mais la conscription rend le gouvernement impopulaire.
Le royaume des Pays-Bas de 1815-1830
Lors de l'effondrement de l'Empire en 1814 , les Alliés et surtout l'Angleterre reviennent à la vieille idée de barrière destinée à contenir la France, l'hégémonie de l'empire Napoléonien incite, l'Angleterre en premier lieu, à créer une zone tampon et ils décident le 21 juillet 1814 le principe d'une union des Provinces-Unies, des anciens Pays-Bas autrichiens et de l'évêché de Liège en un royaume uni des Pays-Bas, créé au profit du prince d'Orange, devenu le roi Guillaume Ier le 16 mars 1815.
La Hollande et Belgique auraient pu former une monarchie puissante ; économiquement, la Hollande, commerçante et coloniale, offre un débouché à la Belgique, déjà fortement industrialisée.
Finalement l'hostilité des catholiques aux Néerlandais calvinistes et celle de la bourgeoisie francisée à l'usage du néerlandais comme langue officielle rendent l'union impossible.
Le 25 août 1830, exalté par la réussite de la révolution parisienne de juillet des trois journées de juillet 1830, Bruxelles s'insurge ; le 27 septembre, les troupes néerlandaises l'évacuent et, en octobre, elles abandonnent toute la Belgique, à l'exception de la citadelle d'Anvers.
L'indépendance en 1830.
Les états généraux proclament la séparation du Nord et du Sud le 29 septembre 1830 et, le 4 octobre, l'indépendance de la Belgique.
Le roi Léopold Ier
Le 3 novembre, le Congrès national est élu au scrutin direct et censitaire ; le 4, s'ouvre à Londres une conférence qui, le 20 janvier 1831, reconnaît l'indépendance de la Belgique et garantit l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire, limité au nord par l'ancienne frontière de 1790.
Le Congrès élabore la Constitution qui sera promulguée le 11 février 1831 ; dès le 3, il offre la couronne au duc de Nemours, fils de Louis-Philippe, roi des Français, qui, redoutant l'hostilité de l'Angleterre, n'ose l'accepter pour son fils ; elle est alors proposée au prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, qui devient Léopold Ier, roi des Belges : il prête serment à la Constitution le 21 juillet 1831.
Cependant le 2 août 1831, les Néerlandais envahissent la Belgique, qui fait appel aux Français.
Ceux-ci délivrent le territoire belge, mais ils ne peuvent s'emparer d'Anvers qu'en décembre 1832.
Par ailleurs, le traité des Vingt-Quatre-Articles, par lequel l'Europe reconnaît l'indépendance de la Belgique, enlève à celle-ci, au profit des Pays-Bas, Maastricht, le Limbourg néerlandais et le Luxembourg de langue allemande le 14 octobre 1831 et lui impose la neutralité.
Et ce n'est qu'en 1839 que le roi des Pays-Bas reconnaît l'indépendance belge.
Le royaume de Belgique jusqu'à la « question royale » entre 1830- et 1951
Léopold II
La Constitution de 1831 fait de la Belgique une monarchie constitutionnelle. Léopold Ier de 1831-1865à , qui a épousé Louise-Marie d'Orléans, fille de Louis-Philippe, tente de maintenir l'union nationale, mais libéraux et catholiques, une fois l'indépendance assurée, accentuent leurs divisions.
Ils constitueront des partis séparés rivaux, les premiers en 1846, les seconds en 1868.
Sous Léopold II (1865-1909), la vie politique belge est d'abord dominée par le problème scolaire.
Les libéraux, bourgeois anticléricaux, exercent le pouvoir de 1847 à 1870 avec une interruption de 1855 à 1857 et de 1878 à 1884, les catholiques dans l'intervalle et de 1884 à 1914.
Le ministre libéral Frère-Orban, 1878-1884 fait voter une loi en 1879 réglant la question scolaire dans le sens de la laïcité.
Son successeur, le catholique Jules Malou en 1884, permet aux communes de remplacer leurs écoles neutres par des écoles confessionnelles, mais, face à une violente opposition des libéraux, il doit céder la place à Beernaert, catholique plus modéré de 1884 à 1894.
Le 16 Janvier 1875 Verlaine sort de prison
Condamné à deux ans d'emprisonnement, le 27 août 1873, le poète bénéficie d'une remise de peine pour bonne conduite et sort de la prison de Mons. Paul Verlaine avait été condamné pour avoir tiré deux coups de revolver alors qu'il était saoul sur son amant Arthur Rimbaud. Peu après sa sortie, il partira rejoindre Rimbaud à Stuttgart où ce dernier travaille en tant que précepteur.
Le 1 Avril 1875, découverte des iguanodons de Bernissart
A Bernissart en Belgique, des mineurs font la découverte de 29 squelettes d'iguanodons à 322 mètres de profondeur. Les reptiles dinosauriens sont en parfait état et mesurent près de 10 mètres de long. Ils seront exposés à l'Institut royal de sciences naturelles de Bruxelles
L'essor économique
Les atouts de la Belgique
Après 1860, la vie économique de la Belgique, qui compte alors 5 millions d'habitants, se développe rapidement sous l'impulsion du libre-échange.
Les activités sur lesquelles s'appuie son essor sont : une agriculture riche, aux procédés hardis, aux rendements les plus élevés d'Europe ; des sources d'énergie abondantes pour 17 millions de tonnes de houille en 1880, 24 en 1908 ; une production métallurgique et textile considérable ; un commerce extérieur dont le volume quadruple entre 1850 et 1890.
L'expansion économique est en outre bien desservie par d'excellents moyens de communication notamment le réseau ferroviaire le plus dense du monde, huit fois plus long en 1908 qu'en 1845, bien doublé par des canaux fluviaux ou maritimes.
L'orientation coloniale
Les capitaux belges s'investissent à l'étranger : compagnies de tramways en Europe, usines du Donets, dans le Donbass en Ukraine, du Brésil, de la Chine du Sud et de l'Afrique australe.
Surtout, orientant les Belges dans la voie de la colonisation, Léopold II, homme d'affaires avisé, fonde l'Association internationale africaine en 1876 et fait explorer par Stanley, le Congo – dont la propriété personnelle lui est reconnue par l'acte de Berlin, le 26 février 1885 et qui est érigé en État indépendant sous sa souveraineté.
Il en tire de gros bénéfices, mais est violemment critiqué pour ses méthodes d'exploitation qui pressurent les indigènes. Aussi Léopold II lègue-t-il finalement le Congo à la Belgique en 1908.
Le problème social et la représentation politique
Ce remarquable essor économique et colonial modifie la vie sociale et politique de la Belgique. Dans ce pays de bas salaires et de longues journées de travail – « paradis du capitalisme » selon les termes de Karl Marx, qui y avait vécu en exil –, une lutte va se développer sur deux terrains : le suffrage électoral et la législation sociale.
Le parti ouvrier belge
Un parti socialiste, le parti ouvrier belge (POB) est fondé en 1885 ; il recrute ses premiers adhérents surtout dans les régions industrielles dans les vallées de la Sambre et de la Meuse, agglomérations de Bruxelles, d'Anvers et de Gand ; ses chefs ne sont pas seulement des intellectuels, comme Émile Vandervelde et Destrée, mais aussi des ouvriers, tels le marbrier L. Bertrand et le tisserand E. Anseele.
Peu férus de théorie, ils créent coopératives, mutualités et syndicats.
Sur le plan politique, opposés au système électoral censitaire, ils forcent l'adoption, sous la pression de grèves, du principe du suffrage universel en 1892, mais l'Assemblée constituante le tempère par le vote plural qui accorde une ou deux voix supplémentaires aux électeurs pères de famille, jouissant d'une certaine aisance ou titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire, la loi Nyssens.
Le parti libéral et le parti catholique
En même temps qu'il donne une représentation parlementaire aux socialistes, ce système aboutit, aux élections de 1894, à éliminer pratiquement le parti libéral.
Libéraux et socialistes réclament une nouvelle réforme électorale, et le ministre Paul de Smet de Naeyer fait adopter le scrutin de liste par province, avec représentation proportionnelle en 1899, ce qui permet au parti libéral de se reconstituer.
Le parti catholique conserve cependant la majorité absolue et gardera le pouvoir jusqu'à la Première Guerre mondiale il est représenté par Auguste Beernaert, 1884-1894 ; Paul de Smet de Naeyer, 1896-1907 ; Franz Schollaert, 1908-1911.
Il s'adapte à l'entrée des masses dans la vie politique par la constitution d'une aile démocratique, la Jeune-Droite, animée par Henry Carton de Wiart et attentive aux applications sociales de l'encyclique Rerum novarum en 1891.
Le règne d'Albert Ier 1909-1934
Albert Ier
Au début du règne d'Albert Ier, l'agitation contre la majorité catholique se développe : les socialistes recourent en vain à la grève générale d'avril 1913 avec 800 000 participants pour l'abolition du vote plural.
Le cabinet Charles de Broqueville de 1911-1918 fait adopter en 1913 le service militaire obligatoire et général.
La Première Guerre mondiale surprend donc la Belgique à l'apogée de sa puissance économique, mais en pleine réorganisation militaire.
Pendant la Première Guerre mondiale
Quand, le 2 août 1914, l'ultimatum allemand viole la neutralité belge, les luttes intérieures cessent aussitôt et, dès le 4 août, les deux chefs de l'opposition, le libéral Paul Hymans et le socialiste Émile Vandervelde, sont nommés ministres d'État.
L'invasion allemande submerge la Belgique, malgré la résistance du roi Albert autour de Liège et de Namur.
Le gouvernement doit se retirer à Anvers, puis à Furnes et finalement au Havre, tandis que l'armée belge, défendant avec héroïsme, derrière l'Yser par la bataille de l'Yser, les dernières parcelles du territoire national non occupées, s'intègre à l'aile gauche du dispositif allié.
Cependant le 17 Octobre 1914, les écluses stoppent l'avancée allemande sur le front de l'Yser
Afin de barrer la route de la mer aux Allemands, l’armée belge réfugiée derrière le fleuve côtier Yser ouvre les écluses pour immerger la plaine. Malgré leur infériorité numérique, et après des victoires dans la Marne, cette inondation artificielle permet aux Belges de stopper la progression ennemie et d’établir un barrage effectif tout au long de la guerre.
L'Allemagne tente alors d'exploiter, mais en vain, l'opposition entre la Flandre et la Wallonie, en décrétant la séparation administrative des deux régions en 1917.
La Belgique occupée ne cessa de témoigner, sous la domination des gouverneurs allemands, d'une dignité parfaite, soutenue par le cardinal Mercier, archevêque de Malines, et le bourgmestre de Bruxelles, Adolphe Max.
Le traité de Versailles en 1919 lui attribue Eupen et Malmédy et un mandat de la Société des Nations, SDN ancètre de l'ONU sur le Ruanda-Urundi, mais il n'est plus question de neutralité.
Société et faits divers
Durant la guerre, en 1915, le 12 Octobre Edith Cavell est assassinée. L'infirmière anglaise Edith Louisa Cavell est exécutée en Belgique par des soldats allemands. Elle est accusée d'avoir aidé des alliés à se rendre en Hollande pour reprendre le combat. L'infirmière-major d'une grande clinique bruxelloise travaillait en Belgique occupée. Grâce à son action, 170 hommes ont pu rejoindre les Pays-Bas en quelques mois. Au moment de son arrestation elle ne cherchera pas à nier, au contraire elle avouera tout à l'Allemagne.
Et le 11 Septembre 1917, Guynemer meurt, le pilote de chasse français est abattu aux commandes de son Spad près de Ypres en Belgique. Le corps de "l'as des as" qui compte 53 victoires à son actif et qui avait déjà été "descendu" sept fois auparavant ne sera jamais retrouvé.
Le 24 Avril 1920 à l'occasion des jeux olympiques d'Anvers, c'est la première apparition, du drapeau et du serment olympique. Après l’annulation des Jeux de 1916 pour cause de Première Guerre mondiale, Anvers est choisie pour accueillir ceux de 1920 en hommage aux souffrances endurées par le pays. Et pour la première fois, le drapeau aux cinq anneaux dessiné par Coubertin flotte sur le stade tandis que Victor Boin est le premier athlète à prononcer le serment olympique. Le serment, engageant l’esprit sportif et sa gloire, subira par la suite quelques évolutions. En 1972, il sera complété par un serment des arbitres.
EN 1929 le 10 janvier paraissent les premières aventures de Tintin
L'illustrateur Georges Rémi alias Hergé, publie dans le supplément du quotidien bruxellois "Le vingtième siècle", sa nouvelle bande dessinée: "Tintin au pays des soviets".
Suivie l'année suivante, le 23 Janvier 1930 , de la première de "Quick et Flupke"
Georges Rémy, alias Hergé, publie pour la première fois les aventures de "Quick et Flupke" dans le journal belge "le Petit vingtième", tout comme il l'avait fait pour "Tintin" un an auparavant. Les deux garnements bruxellois resteront pourtant dans l'ombre écrasante du jeune reporter.
Puis le 21 Avril 1938, c'est la naissance du Journal de Spirou
Créé sur l’initiative de l’éditeur Jean Dupuis, le Journal de Spirou paraît pour la première fois, en même temps que le personnage du même nom créé par Rob-Vel. Spirou signifie « écureuil » en wallon, référence que l’on retrouve par la présence de Spip au côté du célèbre groom. Contrairement à de nombreux magasines consacrés à la bande dessinée, l’hebdomadaire est publié sans interruption depuis cette date tandis que des albums de Spirou sont toujours publiés.
En politique on voit le 3 février 1958 la création du Bénélux
Le traité du Benelux signé entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas assure aux trois pays une unité économique et leur permet d'adopter une politique commune sur les plans social et financier. Le siège de cette nouvelle union est installé à Bruxelles. Le mot Benelux est une contraction de Belgique, Nederland et Luxembourg.
Le 22 Janvier 1972 Elargissement de la CEE
A Bruxelles, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège signent un traité d'adhésion au marché commun européen. Dès le 1er janvier 1973, les Britanniques, les Danois et les Irlandais intègreront la CEE. En revanche, les Norvégiens, soumis à un référendum, refuseront d'entrer dans la Communauté européenne.
Le 25 Octobre 1972 est Eddy Merckx recordman de l'heure
Le cycliste belge bat le record du monde de l'heure sur le vélodrome de Mexico en parcourant 49,432 kilomètres. Il faudra attendre 29 ans pour que sa performance soit améliorée, le 27 octobre 2001, par Chris Boardman à Manchester. Le coureur anglais fera 49,441 km en une heure sur un vélo classique.
Le 23 janvier 1978, le Baron Empain est enlevé
Le baron belge Edouard-Jean Empain, 41 ans, PDG du groupe Empain-Schneider, est enlevé à 11 heures du matin en sortant de son domicile parisien, avenue Foch. Ses ravisseurs demanderont une rançon de 100 millions de francs puis de 40 millions. Pour faire pression sur la famille Empain, ils n'hésiteront pas à amputer leur otage de l'auriculaire. Au terme de deux mois de séquestration, le Baron Empain sera libéré le 26 mars après que l'un de ses preneurs d'otage se soit fait arrêter par la police.
Le 10 Juin 1979 ont lieu les premières élections du Parlement européen
Depuis le 7 juin, les citoyens des neuf états membres de la Communauté européenne élisent pour la première fois les députés du Parlement européen au suffrage universel direct. La plus forte participation est celle de la Belgique avec 91% et la plus faible celle de la Grande-Bretagne, avec 31%. En France, elle s'élève à 60%. Le Parlement, dont le siège est à Strasbourg a un rôle consultatif. Mais il est également compétent pour légiférer aux côtés du Conseil des ministres et exerce un contrôle sur la Commission.
Le 29 Mai 1985, le drame au stade du Heysel
Lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, retransmise en direct dans toute l'Europe, les tribunes du stade de Heysel (Bruxelles) se transforment en champs de bataille mortel. Les affrontements entre les supporters de Liverpool et ceux de la Juventus de Turin feront 39 morts. Dans la bousculade, des corps sont piétinés et écrasés contre les grilles. Le match a quand même lieu : la Juventus l'emporte grâce à un penalty de Michel Platini, qui ignore la gravité du drame. Il refusera de revenir sur la pelouse du Heysel.
Le 29 Mars 1990 l'avortement est dépénalisé en Belgique
La Chambre des députés belges approuve la loi sur la dépénalisation de l'avortement à 126 voix contre 69 et 12 abstentions. Fervent catholique, le roi des Belges, Baudouin, affirme que sa conscience ne lui permet pas de signer le texte sur l'IVG. Il abdique pour une durée de 36 heures, en accord avec l'article 82 de la Constitution qui invoque "l'impossibilité de régner".
Le 30 Aout 1992 Michael Schumacher remporte sa première victoire à Spa
Un an après ses débuts dans le championnat, l’Allemand Michael Schumacher gagne son premier grand prix. Profitant des erreurs tactiques de ses concurrents, et notamment de Senna, quant aux choix des pneumatiques, il hisse sa Benetton sur le haut du podium. S’il n’obtient qu’une victoire lors de la saison 1992, il cumule assez de points et de podiums pour terminer à la troisième place du championnat, derrière les deux Williams de Mansell et Patrese, mais devant la McLaren du Brésilien.
Le 20 Octobre 1996 le peuple organise une "Marche blanche" contre l'affaire Dutroux
Une marche est organisée en Belgique pour protester contre les dysfonctionnements judiciaires et policiers liés à l’affaire Dutroux. Elle réunit plus de 300 000 personnes. Marc Dutroux, accusé de viols et meurtre sur plusieurs enfants et adolescentes, a été arrêté peu de temps auparavant. Il ne sera jugé pour ses crimes qu’en 2004 et sera condamné à perpétuité. Cette affaire bouleversera le système politique du pays. Quelques réformes judiciaires seront appliquées et une commission d’enquête - dont le rapport s’avèrera alarmant – sera mise en place.
En Juin 1999 La crise de la dioxine affaiblit la Belgique
De la dioxine est découverte dans les graisses animales destinées à l’alimentation de bêtes d’élevage. Ces produits d’origine belge ont été envoyés en France et ont nourri les volailles belges. Les produits seront retirés du marché aussi bien en Belgique qu’en Europe. La crise affectera fortement l’économie du pays et aboutira à la démission des ministres de la santé et de l’agriculture.
Le 23 Septembre 2002 La Belgique autorise l’euthanasie
Sous le gouvernement du Premier ministre Guy Verhofstadt, qui allia en 1999 six partis libéraux, socialistes et écologistes, une loi autorisant l’euthanasie est adoptée. La Belgique est ainsi le second pays, après les Pays-Bas, à appliquer cette réforme. Cette pratique reste tout de même contrôlée : les patients doivent être affligés d’une souffrance physique ou psychique insupportable et leur situation doit être sans issue.
Le 30 Janvier 2003 Le mariage homosexuel est autorisé en Belgique
Le gouvernement adopte une loi autorisant les couples de même sexe à s’unir par les liens du mariage. Toutefois, ils n’ont pas la possibilité d’adopter et la filiation leur est interdite. Il faudra attendre 2005 pour qu’un projet modifiant ces interdictions soit mis en place.
Le 28 Aout 2007 La Belgique s’enfonce dans la crise
Yves Leterme, chargé de former un gouvernement après les élections fédérales, démissionne faute de parvenir à un accord entre Flamands et Wallons. Depuis le 10 juin, la Belgique est privée de gouvernement à cause des divergences concernant le degré d’autonomie à attribuer aux territoires néerlandophones. Face à la montée en puissance des indépendantistes flamands auxquels Leterme est allié, la Belgique risque l’implosion. Rappelé quelques semaines plus tard, Yves Leterme jettera à nouveau l’éponge le 1er décembre suivant.
Le poison de la langue.
La question de la langue
L'« École de Liège », qui réclame l'intervention de l'État et de la législation dans le règlement de la question sociale, est représentée par Godefroid Kurth, l'abbé Antoine Pottier, Monseigneur Victor Doutreloux. Le syndicalisme chrétien belge s'avère très vigoureux.
La démocratisation pousse aussi le parti catholique à s'intéresser aux revendications flamandes, jusque là, la langue flamand était défavorisée au profit du Français. La majeure partie des voix qu'il recueille lui venant des régions agricoles flamandes. Dès les premières années de l'indépendance, la langue néerlandaise avait connu un renouveau littéraire, qui avait provoqué la naissance d'un mouvement politique flamingant, réclamant pour le néerlandais l'égalité de droits avec le français. Plusieurs lois lui donnent, entre 1873 et 1898, de larges satisfactions.
Quant à la question scolaire, l'enseignement religieux est rendu obligatoire 1895
La langue de l'enseignement dans les classes primaires sections préparatoires annexées aux écoles moyennes est le flamand dans la région flamandes du pays, le français dans la région wallonne et l'allemand dans les communes d'expression allemande.
Le français, langue de l'aristocratie
En 1830, date de son indépendance, la Belgique se divise alors en deux entités géographiques et culturelles distinctes. Pour la partie wallonne au sud, l'indépendance est l'occasion d'une séparation avec les Flandres, au nord. A la création du nouvel Etat, le français, alors langue des élites et de l'aristocratie, devient langue officielle et entraîne la vexation progressive d'élus flamands préoccupés de l'avenir de leur langue, ce n'est d'ailleurs qu'en 1930 que la première université en langue flamande est construite.
Un "mouvement flamand" se construit alors en réaction à cette situation. Un antagonisme latent se creuse au long du XIXe siècle entre les deux communautés principales du pays.
Une séparation linguistique et économique
Cette séparation devient autant linguistique qu'économique. Le commerce international qui se développe à la fin du XIXe siècle profite aux Flandres et à ses ports de Zeebruge par exemple alors que la Wallonie, dont l'économie était avant tout bâtie sur les industries lourdes et l'exploitation du charbon, est durement touchée par les conséquences de la crise de 1929.
D'autre part, entre les deux guerres mondiales, des épisodes isolés accroissent le fossé entre les deux communautés. A partir de 1930, le gouvernement central décide ainsi d'instaurer l'emploi exclusif du néerlandais en Flandres et du français en Wallonie dans l'administration et les écoles.
Par ailleurs, alors que la loi du 14 juillet 1932 prescrivait le néerlandais comme langue officielle de la Flandre et le français comme langue officielle de la Wallonie, elle autorisait l'enseignement de l'allemand dans la région d'Eupen et de Saint-Vith dans la région germanophone.
La loi de 1932 eut pour effet de poursuivre la francisation de Bruxelles, alors que la Flandre se néerlandisait. Quant aux établissements d'enseignement libres, ils échappaient au régime en vigueur de sorte qu'un enseignement primaire francophone pouvait toujours être dispensé en Flandre. On aura intérêt à lire deux affiches publiées en 1932 par la Ligue contre la flamandisation de Bruxelles.
Les langues en matière de justice
Plus tard, la Loi du 15 juin1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire garantit l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment aux néerlandophones afin qu'ils puissent se défendre dans leur langue :
Article 1er
Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, toute la procédure en matière contentieuse est faite en français. [L. 23 septembre 1985, art. 1er (vig. voy. L. 23 septembre 1985, art. 59 s., infra)].
Article 2
Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toute la procédure est faite en néerlandais. [L. 23 septembre 1985, art. 2 (vig. voy. L. 23 septembre 1985, art. 59 s., infra)].
Article 2bis
Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et le tribunal du travail dont le siège est établi dans l'arrondissement d'Eupen, toute la procédure en matière contentieuse est faite en allemand. [L. 23 septembre 1985, art. 3 (vig. voy. L. 23 septembre 1985, art. 59 s., infra)].
Malheureusement, toutes ces nouvelles mesures déclenchèrent de vivres polémiques, surtout parce que, les traductions des avis communaux n'étant pas interdites, elles ne s'appliquaient qu'en Flandre.
Les Flamands exigèrent donc la suppression de ces traductions. Le gouvernement dut constamment interpeller les communes durant plus d'une décennie afin de faire respecter l'unilinguisme régional, ce qui démontrait que la loi était peu respectée, surtout en Wallonie.
Ces diverses lois linguistiques finirent par donner satisfaction aux Flamands, mais les francophones de Flandre et les Flamands de Wallonie furent tous laissés-pour-compte.
Si la loi n’était pas respectée dans beaucoup de communes, c’était le plus souvent dans le sens d’une ouverture à l’autre communauté, rarement pour écraser une minorité. Ce non-respect atténuait en quelque sorte la rigueur de la loi, mais exaspérait les flamingants qui devinrent plus virulents.
La seconde Flamenpolitik seconde guerre mondiale de1939-1945.
En mai 1940, les troupes allemandes nazies envahirent la Belgique.
Les Allemands favorisèrent les Flamands au détriment des Wallons francophones; ils considérèrent les Flamands comme un «peuple frère» germanique, à peine inférieur à la «race allemande».
Le 14 juillet 1940, Adolf Hitler ordonna de «favoriser autant que possible les Flamands, mais de n'accorder aucune faveur aux Wallons».
C'était encore une Flamenpolitik déjà pratiquée lors de la Première Guerre mondiale.
Le Vlaams Nationaal Verbond (VNV), le Rassemblement national flamand, fut chargé de faire régner l'ordre nouveau en Flandre. Les prisonniers de guerre flamands purent regagner leur foyer, mais les 65 000 prisonniers wallons, associés aux francophones, demeurèrent dans les stalags, les camps de prisonniers de guerre.
Adolf Hitler accorda une attention particulière aux revendications flamandes et octroya au flamand la protection la plus étendue. Les Wallons développèrent un ressentiment non seulement envers les Allemands, mais aussi envers les Flamands.
Ils accusèrent tous les Flamands de collaboration dans la mesure où la politique allemande correspondait aux aspirations nationalistes flamands.
Il est vrai que le VNV, devenu fasciste, travailla activement aux côtés des nazis, mais certains Wallons ont aussi collaboré avec l'occupant nazi. Ce n'était pas là un problème flamand, mais un problème «belge» général. La plupart des Flamands réagirent avec une certaine froideur et une certaine méfiance devant les nazis; ils conservèrent leur caractère «klein katholiek».
En réalité, la bourgeoisie francophone se servit du prétexte de la guerre pour tenter de se débarrasser définitivement du mouvement flamand.
La Seconde Guerre mondiale mit les réformes linguistiques sous le tapis et offrit aux partisans du français l'occasion de développer une grande contre-offensive. C'est pourquoi les conséquences de la collaboration furent catastrophiques pour le mouvement flamand.
La répression allait s'abattre durement.
L'après-guerre
Les élections de 1919 inaugurent le régime du suffrage universel sans voix supplémentaires.
Désormais, socialistes et catholiques se disputent la première place pour obtenir la majorité absolue ; les libéraux, moins nombreux, apportent le plus souvent aux catholiques leur appoint pour constituer des cabinets de coalition. La poussée du nationalisme flamand complique encore la lutte des partis.
La législation sociale se complète, mais la grande dépression de 1929 entraîne un chômage important.
Léopold III 1934-1951
Après la mort accidentelle d'Albert Ier en février 1934, Léopold III, dans une Europe en fièvre, ramène la Belgique à une neutralité volontaire, qui n'empêche pas son territoire d'être, une fois de plus, violé.
Attaquée le 10 mai 1940, en même temps que les Pays-Bas et le Luxembourg, la Belgique est occupée à nouveau par les Allemands.
Pendant la Seconde Guerre mondiale
Le 28 mai, le roi des Belges, comme chef suprême de l'armée, capitule, et regagne le château de Laeken, tandis que des membres de son gouvernement, présidé par le catholique Hubert Pierlot, 1939-1945, partent pour Londres, d'où ils dirigeront la résistance belge.
Se déclarant prisonnier de guerre, le roi se tient, pendant quatre ans, à l'écart des affaires publiques.
Mais, bien que s'abstenant de toute collaboration avec l'Allemagne, il rencontre discrètement Hitler, au cours d'une entrevue à Berchtesgaden en novembre 1940.
Par ailleurs, veuf de la princesse Astrid de Suède, qui jouit d'une grande popularité auprès des Belges, il épouse en 1941 Liliane Baels, qui devient princesse de Réthy.
Ce remariage avec une femme considérée par certains comme une intrigante et l'attitude ambiguë du monarque vis-à-vis de l'Allemagne et du gouvernement en exil lui sont vivement reprochés, contribuant, après la libération du territoire belge, à la naissance de la « question royale ».
En attendant le règlement de cette dernière, le Parlement confère à son frère, le prince Charles, la régence le 20 septembre 1944, alors que le souverain et ses proches ont été emmenés en Allemagne.
Libéré en 1945, Léopold se retire en Suisse.
La reprise économique de l'après-guerre
Le gouvernement, qui entreprend le redressement économique du pays, bénéficie de conditions exceptionnelles : les destructions sont relativement faibles, tandis que l'utilisation du port d'Anvers par les Américains a procuré des réserves considérables de dollars.
À la fin du conflit, la Belgique est le seul pays créancier des États-Unis.
D'autre part, le marché intérieur est rapidement assaini par l'opération de résorption de la masse monétaire, doublée d'un blocage des avoirs, réalisée par le ministre des Finances Camille Gutt en octobre 1944.
L'abdication en faveur de Baudouin
De 1945 à 1950, huit gouvernements se succèdent, les personnalités dominantes étant les socialistes Achille Van Acker et surtout Paul Henri Spaak, qui dirige la politique étrangère de la Belgique durant dix ans et se fait l'apôtre de l'idée européenne.
En 1950, bien que rappelé par les Chambres et le gouvernement social-chrétien, conformément au référendum du 12 mars, Léopold III doit, devant l'opposition de la gauche, remettre ses pouvoirs à son fils, le prince Baudouin 1er août, en faveur duquel il abdique un an après 16 juillet 1951.
La fin des colonies belges
En 1960, prenaient fin les clonies belges, soit le Congo belge dont faisaient partie le Rwanda et le Burundi. Le 30 juin 1960, le Congo belge accédait à l'indépendance. Aussitôt, les Européens fuirent forcés de quitter l'Afrique. Des milliers de colons et de soldats belges revinrent en Belgique et durent être reclassés. Ce sont les conséquences du retour des Belges au pays qui eurent des répercussions par la suite.
En effet, afin de redresser les finances de l'État, le premier ministre Gaston Eyskens fit adopter la loi du 14 février 1961, dite Loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, ou plus simplement par dérision la «Loi unique», une loi proposant un programme d'austérité suite à un endettement public important et à la perte du Congo belge. Cette loi suscita des remous dans les rangs libéraux et sociaux chrétiens; elle fut à l'origine de la grève générale de l'hiver 1960-1961, laquelle dura quatre mois. La grève fut totale en Wallonie, alors qu'elle fut peu suivie en Flandre. C'était là une autre scission entre francophones et néerlandophones!
À la suite de cette période troublée, de nombreux Wallons commencèrent à être favorables à un fédéralisme qui accorderait à la Wallonie une pleine autonomie aux plans économique et social. Cette tendance au fédéralisme se transmit aussi en Flandre. Cependant, alors que les revendications de la Wallonie reposaient sur des motivations socio-économiques, celles de la Flandre portait alors essentiellement sur des raisons culturelles.
La fameuse frontière linguistique
À partir des années 1960, la vie politique fut dominée par le réveil des querelles communautaires entre Flamands et Wallons, ou entre Flamands et francophones bruxellois. Le compromis de la frontière linguistique évoluant au rythme des consultations populaires décennales ne convenait plus aux Flamands qui voyaient les francophones «agrandir» leur territoire de quelques kilomètres tous les dix ans. De là, est venu leur objectif d’établir une frontière linguistique définitive. Certains bourgmestres flamands, 278, soit près du quart avaient refusé de distribuer les formulaires qui comprenaient des questions d'ordre linguistique, car un tel formulaire avait révélé treize ans plus tôt la progression de la «tache d’huile» francophone à partir de Bruxelles.
Devant le mouvement de contestation flamande, la loi du 24 juillet 1961 (litt.: «Loi du 24 juillet 1961 prescrivant l'exécution en 1961 des recensements généraux de la population, de l'industrie et du commerce») entérina le «refus flamand» et prescrivit de faire les recensements sans poser de question relativement à l'emploi des langues.
Le pays connut ensuite une autre période de revendications flamandes jusqu'à ce qu’une loi traçât définitivement la frontière linguistique en consacrant l'unilinguisme de la Flandre et celui de la Wallonie, de même que le bilinguisme de la région de Bruxelles-Capitale.
La loi du 8 novembre 1962, qui entrait en vigueur le 1er septembre 1963, fixait définitivement la frontière linguistique entre la Flandre et la Wallonie, mais elle prévoyait aussi des «accommodements» pour les Flamands et les Wallons résidant dans les communes mixtes appelées «communes à facilités».
En raison des problèmes reliés à la mauvaise crédibilité des recensements, ce ne sont pas ceux de 1930 et de 1947, sans valeur scientifique parce qu’ils généraient des conséquences administratives, ce qui faussait le jeu, mais les recensements précédents ne l’étaient guère plus qui ont déterminé les communes à facilités, mais les études menées sur le terrain par le Centre Harmel: selon que la majorité s’était déclarée de langue néerlandaise ou française, la commune faisait partie de la Flandre ou de la Wallonie. En réalité, la fameuse «frontière linguistique» fut fixée en deux temps: une première fois en 1962 pour la Flandre et la Wallonie, une seconde fois en 1963 pour délimiter la région bilingue de Bruxelles, placée comme un «îlot» en Flandre, car seulement 3,5 km séparent Bruxelles de la Wallonie en passant par la commune de Rhode-Saint-Genèse.
À la suite du rapport Harmel, 24 communes flamandes, 23 250 habitants ont été détachées de leur province wallonne et rattachées à une province flamande ou à un arrondissement flamand dans la province du Brabant.
De plus, 25 communes wallonnes soit 87 450 habitants qui faisaient partie d’une province flamande ont été transférées à une province wallonne ou à un arrondissement wallon dans la province du Brabant.
Le cas des Fourons, environ 5000 habitants suscita des débats houleux au Parlement belge.
Consultés par le Conseil provincial de Liège, les habitant se déclarèrent majoritairement en faveur de leur maintien dans la région de langue française avec des facilités pour les néerlandophones.
Pendant que 15 000 Wallons manifestaient à Liège, plus de 50 000 Flamands défilaient à Bruxelles.
Le Parlement trancha avec une majorité de 130 voix, mais seulement 20 Wallons et 13 Bruxellois s'étaient prononcés pour le transfert à la province flamande du Limbourg.
Ces décisions parurent contestables pour les francophones qui remirent en question la valeur scientifique des études, notamment dans les six communes des Fourons.
Évidemment, par la suite, il y eut des tractations et des manœuvre politiques.
Pour les Flamands, l'établissement de la frontière linguistique de 1962 constituait une avancée importante: l'agglomération bruxelloise était clairement définie et limitée à 19 communes.
Mais, pour les Flamands, la frontière linguistique consolidait les «conquêtes» francophones, notamment dans l'agglomération bruxelloise.
En bout de ligne, la Belgique se trouvait dotée de deux zones officiellement unilingues: la Flandre néerlandaise au nord et la Wallonie francophone au sud. Et à ce sujet, les Flamands et les Wallons étaient d'accord!
Les communes «à facilités» de 1962
Soulignons que les textes juridiques belges qualifient toujours de communes à régime linguistique spécial, ce que les citoyens ordinaires appellent généralement des communes à facilités.
Ces communes dites «à facilités» — juridiquement non reconnues en tant que communes bilingues — auraient été prévues pour faciliter l’intégration des francophones en Flandre et des Flamands en Wallonie.
La loi du 8 novembre 1962 prévoyait cinq catégories de communes qui pourraient déroger à la règle de l’unilinguisme territorial, avec un minimum de 30 % de minorités sans acquérir pour autant le statut de communes bilingues, sauf à Bruxelles.
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de communes avant la fusion de 1978:
Évidemment, cette sorte d'accommodement suscita un conflit idéologique entre la conception des francophones et celle des néerlandophones en ce qui concerne la notion des mots «nation» et «peuple».
Pour les néerlandophones, la nation est délimitée par le territoire où est parlée une langue donnée.
Par exemple, en France, c'est le français; en Allemagne, c'est l'allemand; en Italie; c'est l'italien, etc.
Pour les francophones de Belgique, la langue du citoyen est celle que doivent utiliser les administrations, peu importe où ils résident sur le territoire.
Autrement dit, les néerlandophones privilégient les droits territoriaux, les francophones les droits personnels.
Or, les droits territoriaux sont plus sécurisants pour une minorité, alors que les droits personnels sont moins contraignants pour une majorité. Il était donc normal que les droits territoriaux prévalent en Flandre et que les droits personnels soient préférés par les francophones.
Au plan géographique, il est possible de résumer les communes à facilités en trois types:
1) Les six communes de la périphérie bruxelloise:
Kraainem/Crainhem; Drogenbos; Linkebeek; Sint-Genesius-Rode / Rhode-Saint-Genèse; Wemmel; Wezembeek-Oppem.
2) Les dix communes de la «frontière linguistique» dont six en Flandre avec facilités en français :
Mesen / Messines; Spiere-Helkijn / Espierres-Helchin; Ronse / Renaix; Bever / Biévène; Herstappe; Voeren / Fourons et quatre en Wallonie avec facilités en néerlandais : Comines / Komen; Mouscron / Moeskroen; Flobecq / Vloesberg; Enghien / Edingen).
Les communes malmédiennes avec facilités limitées en allemand.
- La rapport Harmel de 1958
Un rapport élaboré par le Centre Harmel fut déposé le 25 avril 1958 au Parlement belge; le Centre était formé de se compose de 23 membres néerlandophones et de 22 membres francophones.
Le rapport allait servir de base pour les négociations sur les lois linguistiques de 1962-1963, ainsi que pour la révision de la Constitution de 1970.
Le rapport de Pierre Harmel était bilingue: à droite le texte français, à gauche le texte néerlandais, les deux versions ayant la même valeur juridique. Les conclusions de la «section politique» le Centre était divisé en trois sections qui traitaient des problèmes spécifiques: une «section politique», une «section culturelle» et une «section économique» furent les suivantes :
1) Il existe au sein de la nation belge deux communautés culturelles et linguistiques: la communauté wallonne et la communauté flamande;
2) Ces deux communautés sont homogènes et ce caractère doit être respecté. Les Flamands qui s’établissent en Wallonie, et les Wallons qui s’établissent en Flandre doivent s’adapter au milieu;
3) Par voie de conséquence, tout organisme public ou institutionnel privé remplissant une mission d’intérêt public, doit être, en principe, français en Wallonie, et néerlandais en Flandre;
4) L’agglomération bruxelloise doit être le bien commun de la communauté wallonne et de la communauté flamande. Wallons et Flamands doivent y jouir de droits culturels égaux. Leur individualité doit y être respectée et les moyens doivent leur être donnés de la maintenir et de la développer. (Chapitre III, F – c, § I, p. 266).
Les conclusions de la «section culturelle» (Chapitre I, p. 309) sont les suivantes:
1) Les principes ont fait l’objet d’un accord unanime de ses membres et peuvent se résumer comme suit:
2) Il existe en Belgique deux communautés culturelles : la communauté wallonne et la communauté flamande;
3) La première est de langue française, la seconde de langue néerlandaise;
4) Les deux communautés doivent être homogènes : en aucun cas, l’État ne saurait encourager la constitution ou le maintien de minorités linguistiques dans l’une ou l’autre communauté;
5) Il n’existe pas de communauté culturelle bruxelloise;
6) Il existe cependant une entité bruxelloise, bien commun des deux communautés culturelles, dans laquelle Wallons et Flamands doivent pouvoir conserver leurs caractères propres.
Il était clair que les deux grandes régions linguistiques devaient demeurer homogènes, sans le maintien de «minorités linguistiques». Ces principes sont repris à la page suivante (p. 310) :
1) La communauté wallonne et la communauté flamande doivent être homogènes. Les Flamands qui s’établissent en Wallonie et les Wallons qui s’établissent en Flandre doivent être résorbés par le milieu. L’élément personnel et ainsi sacrifié au profit de l’élément territorial;
2) Par voie de conséquence, tout l’appareil culturel doit être français en Wallonie et néerlandais en Flandre;
3) La communauté wallonne et la communauté flamande doivent conserver les enfants nés respectivement en Wallonie et en Flandre et émigrés à Bruxelles, de même que ceux qui sont nés à Bruxelles de parents originaires de Wallonie et de Flandre. Dans la capitale, l’élément personnel doit l’emporter sur l’élément territorial.
Les auteurs du rapport Harmel espéraient probablement que les minorités s’assimileraient et que les problèmes se résoudraient d’eux-mêmes après plusieurs années, mais les faits allaient démontrer que ce n'était guère le cas.
Les conclusions du rapport ne furent pas reprises intégralement dans les lois de 1962 et de 1963.
Pendant que les néerlandophones restaient convaincus que les «communes à facilités» étaient temporaires et destinées à disparaître progressivement en raison de l'assimilation des minorités, les francophones, pour leur part, croyaient que ces «facilités» étaient définitives et qu'elles leur accordaient des droits linguistiques permanents et immuables.
Cette interprétation divergente allait constituer plus tard une source de nouveaux conflits, notamment dans la région de Bruxelles-Capitale.
Lire la suite --> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=2828#forumpost2828
.
Posté le : 21/07/2013 01:07
|
|
|
|
|
Fète nationale Belge Abdication du roi 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
- L'Université catholique de Louvain
En 1963, l'endiguement de la langue française, tant souhaité par les Flamands, semblait acquis, mais le conflit linguistique a rebondi en 1968 à propos de l'Université catholique de Louvain, demeurée bilingue et non encore néerlandisée.
De violentes manifestations exigèrent le départ des francophones aux cris de Walen buiten («Wallons dehors») et de Leuven Vlaams «Louvain aux Flamands».
Dans les années 1970, les Québécois, eux, criaient «le Québec aux Québécois». Rappelons qu’au cours de ces années tumultueuses des étudiants francophones invitaient à Louvain un ancien premier ministre en 1950, le Wallon Jean Duvieusart 1900-1977, qui défendait dans ses discours le statut bilingue de Louvain et osait déclarer: «Un Wallon qui apprend le flamand est un Wallon dénaturé.»
Ces mêmes étudiants chantaient «la Marseillaise» sur le balcon de l’hôtel de ville de Louvain; des professeurs francophones demandaient la fondation des écoles secondaires en français à Louvain.
Pour les Flamands, il s’agissait là de véritables provocations, et ce, très peu de temps après la fixation de la frontière linguistique.
Finalement, l’Université de Louvain fut coupée en deux et sa composante française déménagea dans la province du Brabant wallon: ce fut la création de l'Université de Louvain-la-Neuve.
Cette séparation fut très durement ressentie par les francophones et cet épisode marqua le début de la fin des partis nationaux. La bière Stella Artois qui se brassait auparavant à Louvain est aujourd'hui brassée à Leuven.
Fermeture des écoles francophones en Flandre
La loi du 2 août 1962 sur l’enseignement fit fermer les écoles francophones qui existaient encore dans la région de langue néerlandaise; la loi énonçait aussi que, dorénavant, seuls les enfants dont les parents étaient domiciliés dans les «communes à facilités» pouvaient s'inscrire dans les écoles francophones de ces communes.
Insatisfaits de cette loi estimée discriminatoire ainsi que des fermetures d’écoles, des parents francophones de Flandre introduisirent un recours contre cette loi devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.
Dans son arrêt du 23 juillet 1968, la Cour débouta les plaignants, car il n’y avait pas eu de violation des droits de l’homme du seul fait que la loi obligeait une école francophone à fermer ses portes en région flamande unilingue.
Le clivage entre les deux communautés gagna ensuite les formations politiques traditionnelles qui éclatèrent.
Devant tant de haine linguistique, certains se demandent ce que signifie en définitive l’expression pourtant répandue dans le monde de «compromis à la belge».
Cette expression signifie simplement que, dans les zones de conflits ethniques, linguistiques ou religieux, il est toujours possible de rechercher des solutions parfois très compliquées, voire difficilement applicables, mais qui évitent les bains de sang. En fait, s'il a coulé du sang dans les Fourons, jamais la Belgique n’a eu à déplorer un seul mort à cause des querelles linguistiques.
La partition territoriale des langues de 1970
Sous la pression tant des Flamands que des Wallons, l'idée s'imposa qu'il fallait modifier de façon fondamentale les structures politiques de la Belgique.
Toutefois, il a fallu attendre les réformes constitutionnelles de 1970-1971 et celles de 1980 pour transformer la Belgique en un État communautaire et régionalisé, puis celles du 1er janvier 1989 et du 15 février 1994 pour en faire un État fédéral.
Au cours de cette période, les Flamands durent batailler ferme pour obtenir la communautarisation du pays. De leur côté, les Wallons durent batailler ferme pour obtenir la régionalisation économique et les Bruxellois durent batailler de leur côté pour être reconnus par la Flandre comme une «Région» à part entière.
Dans l’ensemble des partis politiques, les partisans du maintien d’un État unitaire firent face à ceux qui voulaient plus de pouvoir pour les entités communautaires et régionales.
En 1970, le Parlement fédéral marquait son accord sur le texte de la Constitution révisée. On établit d’abord les quatre régions linguistiques voir Titre I, article 3bis, ensuite les trois communautés culturelles (Titre III) et, pour finir, les trois régions (chapitre IIIter). La Constitution révisée déterminait aussi les compétences des Communautés linguistiques (section III, article 59, § 2 et 3).
La Belgique a donc été partagée en trois communautés :
française, flamande et allemande et trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.
L’année 1980 a vu la définition des compétences régionales, aménagement du territoire, logement, politique économique, etc.). En 1988-1989, l'enseignement a été communautarisé.
En 1993-1994, on a élargi les compétences, agriculture, commerce extérieur, programmes sociaux, etc. et accru les moyens financiers des gouvernements et parlements, communautaires et régionaux; et les conseillers régionaux ont été élus au suffrage universel.
Depuis les accords de Lambermont, votés le 7 juin 2001, les moyens financiers des Régions et Communautés ont été élargis une fois de plus, surtout les Communautés ont été les principaux bénéficiaires; l’État fédéral a transféré encore quelques-unes de ses compétences, notamment les compétences résiduelles relatives à l’agriculture, l’organisation et le contrôle sur les communes et provinces et le commerce extérieur. De plus, les Régions peuvent désormais disposer de certains moyens financiers d’une façon plus libre, en vertu de l’«autonomie fiscale».
Donc, avec la législation de 2000-2001, la Belgique a connu la cinquième phase de la réforme de l’État. Il est probable que dans l’avenir l’État belge connaîtra d’autres réformes.
Déjà, dans certains milieux wallons, on aimerait bien que la Communauté française disparaisse au profit de la Wallonie; certains membres du gouvernement wallon considèrent comme anormal le fait de financer à 80 % des projets de la Communauté française et d'être constamment ignorés de la part de ce même gouvernement communautaire.
Après 25 ans de réformes constitutionnelles, on peut affirmer que la Belgique a davantage changé qu’aucun autre pays occidental, démocratique et industriel.
Le principe de la séparation territoriale des langues est maintenant scellé par la partition du pays en quatre zones ou régions linguistiques.
La Belgique compte aujourd’hui trois langues officielles: le néerlandais, le français, l'allemand.
Le pays comprend également, rappelons-le, trois communautés, la Communauté française, la Communauté néerlandaise et la Communauté germanophone et trois régions, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour enrayer le mouvement, qui menaçait d'extinction la minorité bruxelloise néerlandophone et conduisait à une fusion géographique du Grand-Bruxelles avec la Wallonie, les Flamands ont obtenu, d’une part, que l'agglomération bruxelloise, limitée à 19 communes, reste officiellement bilingue, d’autre part, que les communes ceinturant l'agglomération demeurent flamandes, dans six d'entre elles, la population de langue française dispose de «facilités».
Or, les nationalistes flamands voudraient bien que Bruxelles revienne à la Flandre, mais beaucoup de Bruxellois francophones s'y opposent farouchement; même la plupart des Bruxellois flamands s’y opposent.
Dans les années quatre-vingt, le président du FDF, le Front démocratique des francophones, parti francophone bruxellois, André Lagasse, développa l’idée d’un «corridor francophone», Kraainem, Wezembeek-Oppem et Rhode-Saint-Genèse qui devrait fusionner l’agglomération bruxelloise avec la Wallonie.
Depuis lors, l’idée a commencé à se répandre, mais on devine les conflits en perspective! Mais les ténors de la politique belge considèrent cette idée comme farfelue.
Cela dit, il convient de distinguer deux types de «régions»:
-les quatre régions linguistiques (la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande), qui correspondent à des frontières linguistiques;
-les trois gouvernements régionaux s'occupant d'affaires régionales: la Région flamande, la Région bruxelloise et la Région wallonne.
Quant aux provinces et aux communes, elles ne disposent d'aucune juridiction en matière de langues, si ce n'est par les écoles. Cependant, les autorités provinciales doivent appliquer les lois linguistiques prescrites par la législation belge, ainsi que les décrets de leur communauté et région respectives. Au plan juridique, une commune peut faire tout ce qui ne lui est pas interdit, mais elle est contrôlée par les autorités de tutelle, telles que la Communauté, la Région et la province.
Entre la Constitution de 1831 et celle de 1993, le statut des langues s'est vu radicalement modifier en Belgique.
La liberté linguistique individuelle a fait place à une obligation collective! D'un État unitaire, la Belgique est devenue un État fédéral.
La question minoritaire et le Conseil de l'Europe
Pour le Conseil de l'Europe, la Belgique constitue un cas insoluble en ce qui a trait à la protection des minorités. Le modèle belge apparaît comme un cas presque unique où les deux grandes langues officielles de l'État sont en pratique interdites dans près de la moitié du territoire national. La Belgique demeure l'un des rates États européens à ne pas avoir ratifié ni la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ni la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Compte tenu de la complexité des structures fédérales de la Belgique, ce n'est pas demain que ce pays va adopter l'un de ces deux traités européens sur la protection des minorités nationales. En effet, pour adopter ces traités sur les minorités, il faudrait qu'ils soient ratifiés par les sept assemblées législatives compétentes avant de pouvoir entrer en vigueur, ce qui implique la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil flamand, le Conseil de la Communauté française, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour adopter un tel traité, il faudrait aussi que les deux grandes communautés s'entendent. Or, la majorité flamande ne veut reconnaître qu'une seule minorité nationale «belge»: les germanophones. Pour les Flamands, les francophones constituent une majorité dans leur territoire. Quant aux francophones, ils insistent pour que les francophones de Flandre bénéficient de ce même statut de «minorité nationale», quitte à accorder ce statut aux néerlandophones de Wallonie. Mais les politiciens flamands craignent que des francophones de Flandre, notamment dans la périphérie bruxelloise, utilisent ces traités européens pour poursuivre les autorités flamandes pour non-respect des droits des minorités.
En conséquence, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe attire l'attention sur une improbable ratification par le Royaume de Belgique et par ses assemblées législatives compétentes, puisque toute ratification d'un traité supposerait une protection tant au niveau national l'État fédéral que régional la Flandre et la Wallonie.
À la demande de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, la Commission européenne pour la démocratie par le droit «Commission de Venise» a étudié la question de savoir à quels groupes la Convention-cadre, par exemple, pourrait s'appliquer en Belgique. La Commission est arrivée à la conclusion suivante :
Au niveau régional, eu égard à la répartition des compétences entre les diverses régions et communautés et à la division territoriale du pays, la Commission considère que les francophones de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande peuvent être considérés comme une minorité au sens de la Convention-cadre de même, d’ailleurs, que les néerlandophones et les germanophones de la région de langue française.
Les wallons
Le terme Wallon vient de Walh , très vieux mot germanique utilisé par les Germains pour désigner les populations celtophones ou romanes.
Selon les régions, Walh s'est transformé, notamment par des emprunts à d'autres langues, et son sens a été réduit. C'est le cas de Wallon qui fut créé dans le roman avec d'autres termes apparentés mais les a très vite supplantés.
Sa plus ancienne trace écrite remonte à 1465 dans les Mémoires de Jean, sire de Haynin et de Louvignies , où Jean de Haynin désigne les populations romanes des Pays-Bas bourguignons.
La portée sémantique se réduira encore un peu plus avec les régimes français, hollandais puis l'indépendance belge pour ne plus désigner que les Belges de langue romane .
Le clivage linguistique dans la politique belge et l'apparition du mouvement wallon ajouteront un contenu conceptuel et affectif8 au mot Wallon , qui désigne à présent les habitants de la Wallonie - terre unilingue francophone - en opposition directe au mot Flamand .
À la suite de la fédéralisation de la Belgique, des entités fédérées ont été créées, à la fois des Communautés et des Régions. L'une d'elles s'appelle la Région wallonne et ses habitants sont appelés des Wallons.
Au 1er janvier 2007, il y avait 3 435 879 Wallons en Région wallonne. La majorité d'entre eux sont des Belges francophones mais la population comprend également des Belges germanophones dans l'Est du pays, des Belges néerlandophones principalement dans les communes à facilités le long de la frontière linguistique ainsi que des ressortissants de différents pays européens et des immigrés de diverses origines, notamment une importante communauté italienne.
L'UNION FAIT LA FORCE, Devise de la Belgique
La phrase « l’Union fait la Force » est prononcée par le régent Érasme-Louis Surlet de Chokier lors de sa prestation de serment le 25 février 1831. Il ne s'agit pas alors de l'union entre les communautés linguistiques du pays, comme on interprète souvent aujourd'hui cette devise, mais de l'union des tendances catholiques et libérales de la bourgeoisie majoritairement francophone au nord comme au sud, l'unionisme, au pouvoir après la révolution4. Cette devise, qui sera gravée au centre du parlement, exprime la nécessité de s'unir dans un État encore fragile et menacé par les armées de Guillaume Ier des Pays-Bas.
**************************************
Le 21 Juillet 2013 à l'occasion de la fête nationale
LE ROI ABDIQUE EN FAVEUR DE SON FILS,
article de " l'express"
Le roi des Belges Albert II, âgé de 79 ans, a annoncé son abdication ce mercredi soir, après 20 ans de règne, en invoquant son âge et sa santé. Son fils Philippe est-il prêt à prendre la relève? Les liens pour mieux comprendre.
Le roi Albert II de Belgique a officiellement annoncé son abdication.
REUTERS/Sebastien Pirlet
"C'est avec sérénité et confiance que je vous fais part de mon intention d'abdiquer ce 21 juillet 2013, jour de notre fête nationale en faveur de mon prince héritier, Philippe"
Comme prévu, le roi Albert II de Belgique a annoncé son abdication en faveur de son fils sur les quatre grandes chaînes de télévision du pays. Ce qu'il faut savoir.
Discours sur les chaînes nationales
Après presque 20 ans de règne, le roi Albert II de Belgique abdique, lors d'un discours diffusé sur les quatre grandes chaînes nationales. Les rumeurs ont fini par se faire de plus en plus pressantes tout au long de la journée. Ce matin, le Conseil des ministres, initialement prévu à 9h, a une première fois été reporté à 13h15. Une décision officiellement justifiée par le fait que les documents sur le budget n'étaient pas prêts. La réunion s'est finalement tenue au Palais Royal, en présence d'Albert II et des principaux membres du gouvernement. Une procédure rarissime, qui dissimulait une annonce sans précédent. En effet, jamais un roi n'avait abdiqué en Belgique.
"Ce fut pour moi un honneur et une chance d'avoir pu consacrer une large partie de ma vie au service de notre pays et de sa population. Nous n'oublierons jamais tant de liens chaleureux tissés avec la population. La fin de mon règne ne signifie pas que nos chemins se séparent, bien au contraire" a déclaré solennellement le roi des Belges.
Quelles sont les raisons de cette abdication?
"J'estime que le temps est venu de passer la main. (...) Mon âge et ma santé ne me permettent plus d'exercer mes fonctions comme je le voudrais", a expliqué le "Roi", âgé de 79 ans. Pour lui, il s'agit là d'une "question de respect envers les institutions" et envers les Belges. Ces derniers mois, des rumeurs persistantes faisaient état d'inquiétudes quant à de possibles problèmes cardiaques. Des informations relayées notamment par Het Laatste Nieuws et het Nieuwsblad,
Comment se passera la succession?
Comme annoncé par les médias belges et les informations relayées sur les réseaux sociaux, la passation de pouvoir aura lieu le 21 juillet juillet prochain, jour de fête nationale et date à laquelle le roi Albert II devait célébrer ses 20 ans de règne. "Je m'adresserai encore à vous le 21 juillet prochain. Je participerai avec la reine et le souverain aux festivités", a-t-il confirmé.
Pour respecter la tradition, le gouvernement devra alors présenter sa démission au nouveau souverain, "en marque de déférence". Une démission qui devrait alors être refusée.
Philippe est-il prêt à régner?
C'est son fils Philippe, 53 ans, qui prendra sa succession. Le 10 juin dernier, alors que les rumeurs d'un départ de son père circulaient en Belgique, Philippe avait annoncé qu'il se "préparait à la succession de son père avec enthousiasme". Tout en confessant ne pas être certain d'avoir les qualités d'un leader.
Pour Albert II, il ne fait aucun doute que son fils a les épaules suffisamment larges pour endosser le costume. "Le prince Philippe est bien préparé. Il jouit avec la princesse Mathilde de toute ma confiance. Au fil des années, le prince a montré combien ses engagements envers notre pays lui tiennent à coeur"
Pour autant, l'homme ne fait pas vraiment l'unanimité autour de lui. Le 28 septembre dernier, Le Soir organisait un débat sur le sujet. Pour Martin Bruxant, journaliste au Morgen, le prince Philippe n'est tout simplement "pas prêt". Se basant sur des témoignages d'une quarantaine de responsables diplomatiques, le journaliste faisait alors état des pires craintes quant à ses capacités à gérer la "bérézina" politique qui s'annonce pour 2014.
Il évoque également "une timidité maladive". Et d'ajouter: "si j'étais impliqué d'une quelconque manière dans les intérêts de la famille royale, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Je m'arrangerai pour qu'Albert reste le plus longtemps sur son trône même si j'ai lu qu'il avait déjà pris douze fois des vacances depuis janvier. Et ensuite, je changerais les règles lors de la transition."
Un avis contraire à celui de Thomas de Bergeyck, journaliste chez RTL. Pour lui, le prince Philippe ferait au contraire "un bon roi". "Je suis convaincu que la fonction royale fera l'homme ! Philippe va changer le jour où il sera roi, il aura davantage confiance en lui. Il pourra enfin habiter la fonction. Il aura plus de recul par rapport à cette obligation de rendre des comptes en permanence", expliquait-il. Les mois à venir devraient donner le ton.
Le compromis de Val-Duchesse
En fait, le «compromis de Val-Duchesse» château où eurent lieu les négociations entre Flamands et francophones sur les facilités allait jeter les bases d'une réforme de l'État belge à deux et à trois composantes. Du côté des Flamands, il fallait se résigner à ce que les francophones de la périphérie bruxelloise puissent demeurer officiellement des francophones ayant le droit de ne pas parler le néerlandais.
Chez les francophones, il leur fallait vivre avec les conséquences d'un compromis qui les rabaissait au statut de minorité en territoire flamand. Le compromis signifiait pour les Flamands que les francophones de Flandre obtenaient un statut officiel (temporaire); pour les francophones, le compromis entraînait la néerlandisation totale de la Flandre et au carcan du bilinguisme imposé à Bruxelles. Au final, néerlandophones et francophones n'ont jamais véritablement accepté de vivre avec les conséquences du compromis. De fait, Il est encore possible aujourd'hui pour des francophones de vivre dans des communes néerlandaises à facilités, sans jamais apprendre le néerlandais.
Les flamingants de Jacques Brel (pamphlet)
Les f…
by Jacques Brel
Télécharge la sonnerie de "Les f…" pour ton portable
Les Flamingants, chanson comique!
Messieurs les Flamingants, j´ai deux mots à vous rire
Il y a trop longtemps que vous me faites frire
A vous souffler dans l’cul, pour dev’nir autobus
Vous voilà acrobates mais vraiment rien de plus
Nazis durant les guerres et catholiques, entre elles
Vous oscillez sans cesse du fusil au missel
Vos regards sont lointains, votre humour est exsangue
Bien qu´il y ait des rues à Gand qui pissent dans les deux langues
Tu vois, quand j’pense à vous, j´aime que rien ne se perde
Messieurs les Flamingants, je vous emmerde
Vous salissez la Flandre, mais la Flandre vous juge
Voyez la mer du Nord, elle s´est enfuie de Bruges
Cessez de me gonfler mes vieilles roubignoles
Avec votre art flamand italo-espagnol
Vous êtes tellement, tellement beaucoup trop lourds
Que quand les soirs d´orage, des Chinois cultivés
Me demandent d´où je suis, je réponds fatigué
Et les larmes aux dents : "Ik ben van Luxembourg"
Et si, aux jeunes femmes, on ose un chant flamand
Elles s´envolent en rêvant aux oiseaux roses et blancs
Et je vous interdis d´espérer que jamais
A Londres, sous la pluie, on puisse vous croire anglais
Et je vous interdis, à New York ou Milan
D´éructer, messeigneurs, autrement qu´en flamand
Vous n´aurez pas l´air con, vraiment pas con du tout
Et moi, je m´interdis de dire que je m´en fous
Et je vous interdis d´obliger nos enfants
Qui ne vous ont rien fait, à aboyer flamand
Et si mes frères se taisent et bien tant pis pour elles
Je chante, persiste et signe, je m´appelle :
Jacques Brel
En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/actualite/mond ... .html#3l46l29Y7iiHrgeH.99
Liens
http://youtu.be/AUUydHFtv1k La Brabançonne Helmut Lotti
http://youtu.be/ABTR2Xe_sGw Letherm
http://youtu.be/0xHALEbyujgChant de étudiants wallons
http://youtu.be/6_ljwB819Xo visite de Bruxelles
http://youtu.be/zvyYMp7QeWQ histoire de la Belgique
http://youtu.be/WPTM2_54-xc La Belgique petit pays si grand dans l'histoire
http://youtu.be/qomWwet4NG0 Histoire des drapeaux Belges
http://youtu.be/kkt-Im6hhLU manifestation de flamingants
http://www.dailymotion.com/video/xndk ... ingants_news#.Ueu7n7Qxq0w Les flamingants Jacques brel
http://youtu.be/dcA5cwXG5eM Les flamandes de Brel
http://youtu.be/2KOt4Owaoxc Bruxelles Brel
http://youtu.be/Cd5725HpKK0 Bruxelles ma belle Dick Annegarn
 [img width=600]http://static.euronews.com/articles/232674/606x341_232674_das-leben-des-koenigs-albert-ii-vo.jpg?1374255003[/img]  [img width=600]http://s.tf1.fr/mmdia/i/67/3/belgique-le-roi-albert-ii-et-son-fils-philippe-la-veille-de-la-passation-10955673joeas_1713.jpg?v=1[/img]    
Posté le : 21/07/2013 01:03
Edité par Loriane sur 21-07-2013 12:58:52
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
94 Personne(s) en ligne ( 54 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 94
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages