|
|
Le Général De Gaulle 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Bibliographie
Charles de Gaulle, qui commence a écrire à l'âge de quinze ans, est considéré comme un écrivain de talent. Dans les années 1920, Pétain, qui souhaitait entrer à l'Académie française, fit appel à lui pour la rédaction d'un ouvrage, Histoire du soldat français, qui devait être publié sous le nom du maréchal. Pétain n'en écrivit que la partie sur la Première Guerre mondiale La Guerre mondiale 1914-1918. Suite à des dissensions entre les deux hommes, le livre ne fut jamais publié et De Gaulle reprendra ses écrits pour la rédaction de la La France et son Armée, sorti en 1938.
En 1963, il fait partie des lauréats potentiels du Prix Nobel de littérature et ses Mémoires de guerre lui valent d'entrer dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade en 2000. Le tome 3 de ses Mémoires de guerre, Le Salut, 1944-1946, est inscrit au programme du baccalauréat littéraire en 2011-2013.
Œuvres de Charles de Gaulle
Une mauvaise rencontre, Imp. de Montligeon, 1906 écrit à 15 ans
La Congrégation, Hors de France, Revue du collège d'Antoing no 6 1908
Carnet de campagne d'un officier français, Revue de Paris no 6 1920
La Discorde chez l'ennemi, Berger-Levrault 1924
Le Flambeau 1re et 2e parties Revue militaire, no 69 et 70 1927
La Défaite, question morale, 1927-1928
Philosophie du recrutement, Revue de l'Infanterie no 439 1929
La Condition des cadres dans l'armée, 1930-1931
Histoire des troupes du Levant, Imp. nationale 1931 en collaboration avec le cdt Yvon, le col de Mierry collaborant à la préparation du texte final
Le Fil de l'épée, éd. Berger-Levrault, 1932
Combats du Temps de paix, Revue de l'Infanterie no 476 1932
Pour une politique de défense nationale, Revue Bleue no 3 1933
Le soldat de l'Antiquité, Revue de l'Infanterie 1933
Forgeons une armée de métiers, Revue des Vivants 1934
Vers l'armée de métier, Berger-Levrault 1934
Le problème belge, Revue Défense Nationale 1936
La France et son Armée, Plon 1938
Discours de guerre, Paris ; Fribourg : LUF Librairie universelle de France Egloff, 1944-1945, 3 vol.Collection Le Cri de la France. Série 2 ; 1 ; 2 ; 3), imprimés à Genève.
Trois études, Berger-Levrault 1945, Rôle historique des places fortes ; Mobilisation économique à l'étranger ; Comment faire une armée de métier suivi par le Mémorandum du 26 janvier 1940.
Mémoires de guerre
Volume I - L'Appel, 1940-1942 Plon 1954
Volume II - L'Unité, 1942-1944 Plon 1956
Volume III - Le Salut, 1944-1946 Plon 1959
Mémoires d'espoir
Volume I - Le Renouveau, 1958-1962 Plon 1970
Volume II - L'effort, 1962… Plon 1971
Discours et Messages
Volume I - Pendant la Guerre, 1940-1946 Plon 1970
Volume II - Dans l'attente, 1946-1958 Plon 1970
Volume III - Avec le Renouveau, 1958-1962 Plon 1970
Volume IV - Pour l'Effort, 1962-1965 Plon 1970
Volume V - Vers le Terme, 1966-1969 Plon 1970
Lettres, Notes et Carnets
Tome 1 - 1905-1918 Plon 1980
Tome 2 - 1919-juin 1940 Plon 1980
Tome 3 - juin 1940-juillet 1941 Plon 1981
Tome 4 - juillet 1941-mai 1943 Plon 1982
Tome 5 - juin 1943-mai 1945 Plon 1983
Tome 6 - mai 1945-juin 1951 Plon 1984
Tome 7 - juin 1951-mai 1958 Plon 1985
Tome 8 - juin 1958-décembre 1960 Plon 1985
Tome 9 - janvier 1961-décembre 1963 Plon 1986
Tome 10 - janvier 1964-juin 1966 Plon 1986
Tome 11 - juillet 1966-avril 1969 Plon 1987
Tome 12 - mai 1969-novembre 1970 Plon 1988
Tome 13 - Compléments de 1924 à 1970 Plon 1997
Textes, allocutions déclarations et notes. La Documentation française no 216 25 septembre 1967
Voyage en Pologne du général de Gaulle, président de la République 6 - 11 septembre 1967
Œuvres consacrées à Charles de Gaulle L'homme
Marc Alloueteau, Charles de Gaulle, 1890-1970, album souvenir, Histoire pour tous, 194 p., 1980,
Yves Amiot, La Capture - De Gaulle à Douaumont 2 mars 1916, Éditions Ulysse, 1997
Claire Andrieu, Philippe Braud, Guillaume Piketty, Dictionnaire de Gaulle, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2006
Pierre Louis Blanc, Charles de Gaulle au soir de sa vie, Fayard, 1990 Prix Pierre Lafue
Pierre Louis Blanc, Valise Diplomatique, Éditions du Rocher, 2004 Grand prix de l'Académie Française
Pierre Louis Blanc, Retour à Colombey, Éditions Pierre Guillaume de Roux, 2011
Jacques Boissay, De Gaulle en campagne, textes de Jean-Louis Lemarchand, préface de Jean Mauriac, Le Cherche Midi éditeur, 192
Alain de Boissieu : Pour combattre avec de Gaulle ; Souvenirs 1940-1946, Omnibus, 1999 et Pour servir le Général ; 1946-1970, Plon, 1990
Christine Clerc, « Tout est fichu ! ». Les coup de blues du général, Albin Michel, 2014, 218 p.
Paul-Marie Coûteaux, Le génie de la France. Tome I : De Gaulle philosophe, Paris, Jean-Claude Lattès. 323 p., 2002
Alexandre Duval-Stalla, André Malraux - Charles de Gaulle : une histoire, deux légendes, Gallimard, 2008
Christian Fouchet, Au service du général de Gaulle Plon, 1971 et Les Lauriers sont coupés Plon, 1973
Guy Forzy, Ça aussi, c’était de Gaulle, Dualpha, 2004
Max Gallo, De Gaulle 4 tomes : L’Appel du Destin 1890-1940, La Solitude du Combattant 1940-1946, Le Premier des Français 1946-1962 et La Statue du Commandeur 1962-1970, Éditions Robert Laffont et Pocket, 1998
Max Gallo (avec la participation d’Yves Guéna, De Gaulle, les images d’un Destin, Éditions du Soleil, Fondation Charles de Gaulle
Philippe de Gaulle – Michel Tauriac, Mon père en images, Michel Lafon, 2006 ouvrage de photos inédites
Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon Père. Entretiens avec Michel Tauriac, Paris, Plon, 2000
Henri-Christian Giraud dir., Réplique à l’amiral de Gaulle, Monaco, éd. du Rocher, col. Documents, 2004
Yves Guéna, De Gaulle, Gründ, collection Histoire sur le vif, 2007, 64 pages illustrations couleurs, plus de 60 fac-similés
Henri Guillemin, Le Général clair obscur, Paris, Le Seuil
Riccardo Brizzi et Michele Marchi, Charles de Gaulle, Bologna, Il Mulino, 2008
Julian Jackson, De Gaulle. Au-delà de la légende, Alvik, 2004
Jean Lacouture, De Gaulle, Paris, Éditions du Seuil 3 volumes : 1 — Le Rebelle 1890-1944, 1984, 2 — Le Politique 1944-1959, 1985, 3 — Le Souverain 1959-1970, 1986
Paul-Marie de La Gorce, De Gaulle, Éditions Perrin, 2000
Alain Larcan, De Gaulle : le soldat écrivain, Paris : Textuel, col. Passion, 2005, 191 p., 29 cm
Jacques Laurent, Mauriac sous de Gaulle, La Table Ronde, 1964
Adrien Le Bihan, De Gaulle écrivain, Fayard/Pluriel, 2010
Adrien Le Bihan, Le Général et son double. De Gaulle écrivain, Paris, Flammarion, 1996.
Corinne Maier, Le Général de Gaulle à la lumière de Jacques Lacan, L’Harmattan, 2001
Charles Morazé, Le Général de Gaulle et la République, Flammarion, 1993, col. Vieux Fonds Fic,
Jean-François Revel, Le Style du Général, éd. Complexe, 1988
Anne et Pierre Rouanet, Les Trois Derniers Chagrins du général de Gaulle, Paris, Grasset, 1980
Éric Roussel, De Gaulle, Éditions Gallimard, 2002 ; rééd. Perrin, coll. Tempus, 2 tomes : 1890-1945 et 1946-1970, 2007 ; coll. Folio biographies, un tome, 2008 (la biographie de référence)
Odile Rudelle, De Gaulle pour mémoire, Éditions Gallimard, 1991
Dominique Venner, De Gaulle, la grandeur et le néant, Monaco, éditions du Rocher, 2004, 300 p.
Henri De Wailly, De Gaulle sous le casque, Abbeville 1940, Librairie académique Perrin, 1990
La politique, Ouvrages généraux
Maurice Agulhon, De Gaulle : histoire, symbole, mythe, Paris, Plon, 2000, 163 p
Serge Berstein, Histoire du gaullisme, Paris, Rémi Perrin, 2001, 568 p.
Gérard Dalmaz, De Gaulle à la une, Paris, Hoëbeke, 2000, 124 p.
Max Lagarrigue, La France sous l'Occupation, Montpellier, SCÉRÉN-CRDP Académie de Montpellier (no 46), 2007, 239 p.
René Rémond, Les droites en France, Paris, Aubier Montaigne, coll. historique , 1982, 544 p.
Henry Rousso, Le syndrome de Vichy : 1944-198--, Paris, Seuil, 1987, 378 p.
Études thématiques
François Audigier, Histoire du S.A.C. : la part d'ombre du gaullisme, Paris, Stock, 2003, 521 p.
Philippe Bedouret, L'influence du monde germanique sur Charles de Gaulle : Une clé décisive pour comprendre la pensée, l'action et la production littéraire de Charles de Gaulle, Sarrebruck, Editions universitaires europeennes, 25 octobre 2011
François Broche, Une histoire des antigaullismes : des origines à nos jours, Paris, Bartillat, 2007, 627 p.
Alexandre Gerbi, Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine : imposture, refoulements et névroses, Paris, Éditions L'Harmattan, coll.Études africaines,
Vincent Jauvert, L’Amérique contre de Gaulle, Paris, Éditions du Seuil, 2000
Guy Penaud, De Gaulle-Pétain : l'affrontement du printemps 1940, Paris, L'Harmattan, coll. Historiques, 2012, 338 p.
Pierre Quatrepoint, L'aveuglement : De Gaulle face à l'Indochine : essai, Paris, R. Perrin, 2003, 165 p.
Thierry J. Laurent, Camus et de Gaulle, Paris, L'Harmattan, 2012, 100 p.
La Résistance
Fondation et Institut Charles de Gaulle, Avec de Gaulle : témoignages, t. 1 : La Guerre et la Reconstruction, Paris, Nouveau Monde éditions, 2003
Robert Belot, La Résistance sans de Gaulle : politique et gaullisme de guerre, Paris, Fayard, 2006, 668 p.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France libre: de l'appel du 18 juin à la Libération, Paris, Gallimard, 1996, 969 p.
Yves Maxime Danan, La vie politique à Alger de 1940 à 1944, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1963
Patrick Girard, De Gaulle, le mystère de Dakar, Paris, Calmann-Lévy, 2010, 366 p.
François Kersaudy, De Gaulle et Churchill: la mésentente cordiale, Paris, Perrin, 2001, 496 p.
François Kersaudy, De Gaulle et Roosevelt: le duel au sommet, Paris, Éditions Rémi Perrin, 2004, 522 p.
Elisabeth de Miribel préf. Pierre Emmanuel., La liberté souffre violence, Paris, Plon, 1981, 259 p
Philippe Ratte, Charles de Gaulle, Paris, Nouveau monde éd, coll. Les petits illustrés no 1, 2005
De Gaulle, opposant à la IVe République
Fondation Charles de Gaulle et Centre aquitain de recherches en histoire contemporaine, De Gaulle et le rassemblement du peuple français, 1947-1955 : actes du colloque, Bordeaux, 12-14 novembre 1997, Paris, A. Colin, 1998, 864 p.
Jean Charlot (préf. Georgette Elgey), Le gaullisme d'opposition, 1946-1958 : histoire politique du gaullisme, Paris, Fayard, 1983, 436 p.
Frédéric Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l'Indochine : 1940-1956, Paris, Les Indes savantes, 2005, 666 p.
Le retour au pouvoir en 1958
Christophe Nick, Résurrection : naissance de la Ve République : un coup d'Etat démocratique, Paris, Fayard, 1998, 835 p.
Michel Winock, L’agonie de la IVe République. 13 mai 1958, Paris, Éditions Gallimard, coll. Les journées qui ont fait la France , 2006
Dimitri Kitsikis, L'attitude des États-Unis à l'égard de la France, de 1958 à 1960, vol. 16 : no 4, Revue française de science politique, 1966, p. 685-716
La guerre d’Algérie
Pierre Abramovici et Gabriel Periès, La Grande Manipulation, Hachette, 2006
Jacques Baumel, Un tragique malentendu - De Gaulle et l'Algérie, Plon, 2006.
Georges-Marc Benamou, Un mensonge français, Robert Laffont, 2003
Jean-Paul Brunet, Charonne. Lumières sur une tragédie, Flammarion, 2003
Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Gallimard, col. Folio-histoire, 2006
Mohamed Harbi et Benjamin Stora dir., La Guerre d’Algérie, Éditions Robert Laffont, 2004, rééd. Hachette, Pluriel-histoire, 2005
Benjamin Stora, Le Mystère de Gaulle, son choix pour l’Algérie, Éditions Robert Laffont, 2009
Irwin M. Wall, Les États-Unis et la guerre d’Algérie, Éditions Soleb, 2006
La présidence
Serge Berstein, La France de l’expansion, t.1 La République gaullienne 1958-1969, Seuil, col. Points Histoire, 1989
Jean-Paul Bled dir., Le général de Gaulle et le monde arabe, Beyrouth, Éditions Dar An-Nahar, 2009
Jean Charlot, Le Phénomène gaulliste, Fayard, 1970
Jean Clémentin, L’Affaire Fomasi, Grasset, 1969
Jean Cosson, Les Industriels de la fraude fiscale, Jean de Bonnot, 1986
François Mitterrand, Le Coup d'État permanent, Plon, 1964, rééd. Julliard, 1984, et 10/18, 1993
Pierre Péan, Affaires africaines, Paris, éd. Fayard, 1983 ; L’Homme de l’ombre. Éléments d’enquête sur Jacques Foccart, l’homme le plus mystérieux et le plus puissant de la Ve République, Fayard, 1990
Pierre Viansson-Ponté, Histoire de la République gaullienne, Hachette, Pluriel, deux volumes, 1994, 1re édition, 1970
Bernard Krouck, De Gaulle et la Chine : la politique française à l'égard de la République populaire de Chine 1958-1969, Éditions Les Indes savantes, Paris, 2012
Maurice Vaisse, La Grandeur, politique étrangère du général de Gaulle 1958-1969, Fayard, Paris, 1998.
Témoignages et souvenirs
André Malraux, Les Chênes qu'on abat..., Gallimard, 1971,
Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, 3 tomes, Fayard, 1994-2000
Fondation Charles de Gaulle, Avec de Gaulle : témoignages. Tome 2, Le temps du rassemblement, 1946-1958, Paris, Nouveau Monde, 2005, 502 p., 23 cm
Lucien Bitterlin, Nous étions tous des terroristes, Paris, éd. Témoignage chrétien, 1983
François Flohic, De Gaulle intime. Un aide de camp raconte, Archipel, 2010
Jacques Foccart, Journal de l’Élysée, Paris, éd. Fayard/Jeune Afrique, tomes 1 Tous les soirs avec de Gaulle. 1965-1967, 1997 et 2 Le Général en mai. 1967-1968, 1998
Claude Guy, En écoutant de Gaulle. Journal. 1946-1949, Paris, Grasset, 1996
Constantin Melnik, Mille jours à Matignon. Raisons d’État sous de Gaulle. Guerre d’Algérie, 1959-1962, Grasset, 1988 ; La mort était leur mission Paris, Plon, 1996 ; Politiquement incorrect, Plon, 1999
Jules Moch, Rencontres avec Charles de Gaulle, Plon, 1971
Jean Pierre-Bloch, De Gaulle ou le temps des méprises, Paris, La Table Ronde, 1969
Michel Tauriac, Vivre avec de Gaulle, Plon, 2008
Divers
Jean-Yves Ferri, De Gaulle à la plage bande dessinée humoristique, Dargaud, coll. Poisson Pilote, 2007
Guy Lehideux, Jean-Marie Cuzin, Yves Guéna, De Gaulle, un destin pour la France bande dessinée historique, éd. du Signe, 2010
Filmographie
Laurent Herbier, Adieu de Gaulle, adieu inspiré du roman La Fuite à Baden d’Hervé Bentégeat, téléfilm diffusé sur Canal+ en avril 2009 et prix 2009 au Festival du film de télévision de Luchon
Serge Moati, Je vous ai compris : De Gaulle, 1958-1962, France Télévision, diffusé le 2 novembre 2010
Bernard Stora, Le Grand Charles, France Télévision, 2006, ASIN B000E5OARA
Félix Olivier, Ce jour-là, tout a changé - L'appel du 18 juin, France Télévision, série en 3 épisodes, diffusée le 8 juin 2010
Discographie
Charles de Gaulle, Discours historiques 1940-1969 disque 33 t
Liens
http://youtu.be/tjPeo1IY05o Appel du 18 juin 1940
http://www.ina.fr/video/CPD10001911/n ... l-22-juin-1940-video.html
http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fich ... -liberation-de-paris.html Libération de Paris
http://www.ina.fr/video/I00012416 Paris libérée
http://youtu.be/pj6v3mSWkwA Biographie
http://youtu.be/uNKlgmpW1hU Le dernier des géants
http://youtu.be/wwC_OflXeTw Le grand Charles (film ) 1
http://youtu.be/et3rYFqZCn8 Le grand Charles 2
http://youtu.be/1K-24CQ_Qhg Véritable histoire du général de Gaulle
http://youtu.be/MNHakPLJiVg Interview
http://youtu.be/ZprDRpof3UQ Conférence de presse
http://www.ina.fr/video/I06188302/le- ... atre-de-france-video.html Avec Mme de gaulle
http://youtu.be/o8uRawU7B2E Petite phrase "une idée de la France"
http://www.ina.fr/video/I00012914/cha ... s-!-en-avant-!-video.html Français en avant !
http://youtu.be/_Uv5XGq4Iyo Vive le Quebec libre
http://youtu.be/ZymAKKM1QMg Obsèque du général de Gaulle
http://www.ina.fr/video/I00012416
               
Posté le : 08/11/2014 19:09
|
|
|
|
|
Marie-Antoinette |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 2 novembre 1755 à Vienne naît Marie-Antoinette Josèphe Jeanne de
Habsbourg-Lorraine,
en allemand, Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, archiduchesse d’Autriche, de la maison de Habsbourg-Lorraine, princesse impériale, princesse royale de Hongrie et de Bohême, morte guillotinée à 37 ans, place de la révolution à Paris, le 16 octobre 1793 à Paris, fut la dernière reine consort des Français du 4 septembre 1791 au 10 août 1792 soit 11 mois et 6 jours, puis Reine consort de France et de Navarre du 10 mai 1774 au 4 septembre 1791 soit 17 ans, 3 mois et 25 jours 1774–1792, elle reçut pour surnom L’Autrichienne, Madame Déficit, puis plus tard, Madame Véto. Elle est inhumée à la nécropole de Saint-Denis, épouse de Louis XVI de France avec qui elle eut 4 enfants, Marie-Thérèse de France,
Louis-Joseph de France, Louis-Charles de France et Sophie-Béatrice de France
Fille de l'empereur François Ier du Saint-Empire, et de Marie-Thérèse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, elle était par son père, arrière-petite-fille de Philippe, duc d’Orléans, frère de Louis XIV, donc une lointaine descendante des rois de France Henri IV et Louis XIII.
En bref
Fille de Marie-Thérèse d'Autriche et de François de Lorraine, celle que les siens nommaient Antonia est destinée tout enfant à sceller la réconciliation de la monarchie française avec celle des Habsbourg. Elle n'a pas encore quinze ans lorsque, au printemps de 1770, elle épouse le dauphin Louis, petit-fils de Louis XV. Les fêtes données à cette occasion sont magnifiques, impayables selon le mot du contrôleur général Terray ; à Paris, le feu d'artifice est l'occasion d'une bousculade monstre qui fait cent trente-deux morts ; c'est le premier contact entre la future reine et sa capitale. La petite archiduchesse est aussitôt la coqueluche de la cour ; elle est délicieuse selon ses contemporains, toute menue, blonde, blanche et rose avec déjà cette grâce et ce port de tête qui faisait dire à son page que, comme on offrait une chaise aux autres femmes, on avait envie de lui avancer un trône. Mais c'est une tête légère qui se laisse vite entraîner dans les coteries et les intrigues et d'autant plus facilement que son nouvel époux ne semble guère s'intéresser à elle. Elle doit attendre huit ans, dans l'inquiétude d'être reconnue stérile, la naissance de sa fille, la petite Madame Royale. En attendant, elle s'étourdit : fêtes et bals, tables de jeu où elle perd des sommes énormes, escapades avec ses compagnons favoris qui font d'autant plus jaser que l'on connaît ses problèmes conjugaux. Mercy d'Argenteau, ambassadeur de Vienne, fait régulièrement des rapports à Marie-Thérèse qui à son tour écrit à sa fille pour lui prodiguer ses conseils : moins de folles dépenses, plus de considération pour le roi, pour les duchesses à tabouret, pour l'étiquette pesante mais inséparable du trône. En 1775, Marie-Thérèse écrit à Mercy : Ma fille court à grands pas vers sa ruine.
Marie-Antoinette est devenue reine l'année précédente ; Louis et elle n'ont pas trente-huit ans à eux deux et la balourdise, l'apathie du jeune roi font penser à beaucoup que c'est elle qui va gouverner. Elle se mêle en effet de politique : pour faire avoir des places à ceux de sa coterie, pour faire chasser ceux qui lui ont déplu. Marie-Thérèse ne pourra plus bientôt prodiguer ses conseils ; elle meurt en 1780. En 1784, Marie-Antoinette soutient les intérêts de son frère Joseph II dans sa querelle avec les Pays-Bas à propos d'Anvers ; Vergennes, appuyé par Louis XVI, refuse de prendre le parti de l'Autriche ; les manœuvres de la reine ayant abouti à un accord désavantageux pour la France, le peuple lui donne son surnom : l'Autrichienne. En 1785 éclate l'affaire du Collier, préface de la Révolution selon Goethe. Dans cette affaire, la reine est victime à la fois d'une audacieuse escroquerie montée par une aventurière qui se fait appeler La Motte-Valois, de la sottise d'un grand seigneur, le cardinal de Rohan, et des rancunes de tous ceux qu'elle a méprisés, égratignés de son esprit ; mais, surtout, elle est prise au piège de sa légèreté, de ses imprudences qui ont donné prise à toutes les calomnies. Pénétrée de son innocence, elle exige l'arrestation de Rohan et un procès public devant le Parlement qui condamne la fausse comtesse de La Motte, mais innocente le cardinal et éclabousse le trône d'un scandale aux dimensions européennes. Malgré les quatre enfants qu'elle a donnés à la France, la reine est maintenant détestée. La misère engendrée par les mauvaises récoltes successives, c'est elle ; la faillite du Trésor, révélée en 1787, c'est elle. Elle pleure et se réfugie dans son amour pour Axel de Fersen, le bel officier suédois qui lui a été présenté en 1774, amour partagé et révélé par la correspondance échangée entre les amants et qui ne cessera qu'à la mort de la reine. Dès le début de la Révolution, elle refuse tout compromis avec les députés de l'Assemblée, cet amas de fous. Ses lettres à Fersen, à Joseph II montrent que, jusqu'à la chute du trône, elle demeure murée dans un orgueil intransigeant, qu'elle ne comprend pas l'idée, si nouvelle d'ailleurs, de nation. Elle repousse successivement l'appui de La Fayette, de Mirabeau, de Barnave qui est tombé amoureux d'elle lors du retour de Varennes et avec lequel elle entretient quelque temps une correspondance secrète ; ce n'est qu'une feinte de sa part pour temporiser, attendre le secours de son frère. En 1792 encore, elle refuse le secours de Dumouriez. Elle pousse à la guerre, persuadée que c'est de là que viendra le salut, la délivrance. Depuis les terribles journées d'octobre 1789, elle est quasi captive de la nation avec sa famille ; les épreuves ont fait d'elle une mère admirable, une épouse exemplaire qui, à défaut d'amour, a de l'estime et de l'affection pour l'homme maladroit mais bon que le sort lui a donné. Elle fait face avec courage et dignité aux grandes journées révolutionnaires, c'est sur elle que se cristallisent les haines populaires ; elle n'est plus que l'infâme, la bête féroce dont il faut arracher le cœur. Le 13 août 1792, elle se retrouve enfermée avec les siens dans le vieux donjon du Temple. Tous ses amis lui sont arrachés, emprisonnés, exécutés, massacrés : les restes sanglants de la princesse de Lamballe sont présentés sous ses fenêtres. Après l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, on lui arrache son fils âgé de huit ans qu'elle entend bientôt jurer avec ses geôliers dans la cour de la prison.
En octobre c'est la dernière étape : la Conciergerie, le procès. Mêlant dans son réquisitoire les arguments les plus fondés sur les dépenses de la reine et son action politique avec des récits fantaisistes sur les orgies de la cour, Fouquier-Tinville y joint, à l'instigation d'Hébert, d'infâmes accusations sur des pratiques sexuelles auxquelles elle aurait initié son fils. Elle répond à tout avec une grande dignité. Marie-Antoinette ne sait pas que sa mort est déjà décidée et garde jusqu'au bout l'espoir, un espoir entretenu par les nombreux dévouements qu'elle inspire jusqu'à la fin. Ses deux avocats Chauveau-Lagarde et Tronson du Coudray épuisent en vain leur éloquence et sont arrêtés en pleine audience. Condamnée à quatre heures du matin, elle est conduite à l'échafaud quelques heures plus tard. Âgée de trente-huit ans, elle en paraissait alors soixante : depuis le retour de Varennes, ses cheveux étaient devenus blancs.
Sa vie
Marie-Antoinette est la quinzième et avant-dernière enfant de l’empereur germanique François Ier de Lorraine et de l’archiduchesse d’Autriche, reine de Hongrie et de Bohême Marie-Thérèse dite la Grande, au milieu de leurs cinq fils, Joseph l’héritier du trône, Léopold, Charles, Ferdinand et Maximilien et de leurs huit filles, Marie-Anne, Marie-Christine, Marie-Élisabeth, Marie-Amélie, Marie-Jeanne, Jeanne-Gabrielle, Marie-Josèphe, Marie-Caroline.
Elle naît le 2 novembre 1755, au palais de la Hofburg, à Vienne. Ses parrain et marraine sont le roi Joseph Ier de Portugal et son épouse la reine Marie Anne Victoire d'Espagne. On apprend quelques jours plus tard qu'un tremblement de terre a ravagé Lisbonne la veille de la naissance de l'archiduchesse, jour de la Toussaint. D'aucuns y verront — surtout après coup — un mauvais présage.
L'archiduchesse est baptisée sous les prénoms de Maria Antonia Josepha Joanna . Elle est aussitôt confiée aux ayas, les gouvernantes de la famille royale comme Mme de Brandeis et partage son enfance entre le palais de la Hofburg à Vienne et le château de Schönbrunn. Son enfance est ponctuée de belles rencontres, comme celle avec le tout jeune enfant prodige Mozart dans le Salon des Glaces du palais de Schönbrunn le 13 octobre 1762, ce dernier l’ayant ingénument demandée en mariage à cette occasion.
Marie-Antoinette reçoit une éducation où le maintien, la danse, la musique et le paraître occupent l’essentiel de son temps et ne bénéficie d’aucune instruction politique. Cependant, à l'âge de dix ans, elle a encore du mal à lire ainsi qu’à écrire en allemand, parle peu et difficilement le français, et très peu l’italien – trois langues qui étaient alors parlées couramment dans la famille impériale, sans compter son apprentissage des rudiments de latin. Mme de Brandeis, rendue responsable par l'impératrice du retard de la jeune princesse, est congédiée et est remplacée par Mme de Lerchenfeld, plus sévère. Maria Antonia est à cette époque une enfant débordante de vie, espiègle, étourdie, volontiers moqueuse
À cette époque, la cour d’Autriche possède une étiquette beaucoup moins stricte que celle de Versailles : les danses y sont moins complexes, le luxe y est moindre et la foule moins nombreuse. La jeune Maria Antonia Josepha est très proche de sa plus jeune sœur aînée, Marie-Caroline, qui deviendra reine consort de Naples en épousant Ferdinand Ier des Deux-Siciles.
Promise au roi de France
Sa mère Marie-Thérèse, comme tous les souverains de l’époque, met le mariage de ses enfants au service de sa politique diplomatique, qui vise à réconcilier, après des décennies de guerres fratricides, les Habsbourg et les Bourbons, contexte du renversement des alliances et de la fin de la guerre de Sept Ans, et faire ainsi face aux ambitions de la Prusse et de la Grande-Bretagne.
Ainsi, parmi les sœurs aînées de Marie-Antoinette, seule Marie-Christine, l’enfant préféré de l’impératrice, peut épouser en 1766 - après la mort de leur père qui y était opposé - le prince Albert de Saxe, fils cadet du roi Auguste III de Pologne et frère de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe, mère du futur Louis XVI de France. Le prince cadet Saxon est même créé duc de Teschen par Marie-Thérèse. Marie-Christine et Albert seront nommés avec lui régents des Pays-Bas en 1780.
En revanche, Marie-Amélie épouse contre son gré, en 1769, Ferdinand Ier, duc de Parme, et Marie-Caroline épouse en 1768 Ferdinand IV, le roi de Naples et des Deux-Siciles, après que deux sœurs successivement promises au jeune monarque soient mortes prématurément.
Désormais veuve depuis le décès de François Ier, extrêmement douloureux pour Marie-Antoinette, Marie-Thérèse prend en mains la vie de ses filles et le mariage entre le dauphin – futur Louis XVI – et Marie-Antoinette qui doit concrétiser la réconciliation des deux Maisons les plus prestigieuses d'Europe semble poindre. Louis XV ne voit pas d'inconvénient au mariage de la princesse avec son petit-fils à condition que celle-ci soit capable de parler convenablement français. Cela semble perdu d'avance. C'est pourquoi Mathieu-Jacques de Vermond est envoyé à la Cour pour s'occuper de la future dauphine. Celle-ci semble bien progresser. Elle est alors prise en charge par de grands professionnels français afin d'améliorer entre autres sa dentition, alors très mauvaise, et sa coiffure.
Le 7 février 1770 au soir, Marie-Antoinette est réglée, prête à être donnée en mariage. Cela ne tarde pas, le 17 avril 1770, Marie-Antoinette renonce officiellement à ses droits sur les couronnes dépendant de la Maison d’Autriche. Le 19 avril 1770, on célèbre son mariage par procuration, à cinq heures du soir, dans l'église des Augustins. Seul le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne un siècle auparavant avait eu un semblable retentissement. Par ailleurs, on n'avait pas vu une archiduchesse d'Autriche sur le trône de France depuis Élisabeth d'Autriche, épouse de Charles IX en 1570.
Deux jours plus tard, au petit matin, elle quitte Vienne pour ne jamais y revenir. Elle a quatorze ans. Sa mère lui laisse alors un grand nombre de recommandations. De douloureux pressentiments entourent alors son départ de Vienne. Weber dira, dans ses mémoires : On a peine à se défendre de la superstition des pressentiments quand on a vu les adieux de Marie-Antoinette à sa famille, à ses serviteurs et à son pays, en 1770. Hommes et femmes se livrèrent aux mêmes expressions de la douleur. Les avenues, comme les rues de Vienne en retentirent. On ne rentrait chez soi qu'après avoir perdu de vue le dernier courrier qui la suivait, et l'on y rentrait que pour gémir en famille d'une perte commune. L'impératrice sa mère semble aussi touchée par le phénomène. Une anecdote raconte que Joseph Gassner, ecclésiastique venu chercher l'asile à Vienne, se croyant inspiré par Dieu, à une question de Marie-Thérèse lui demandant comment allait sa fille, ne répondit pas, pâlit, et finit par articuler : Madame, il est des croix pour toutes les épaules.
En chemin pour la France, Marie-Antoinette croise le cortège de sa tante paternelle Anne Charlotte de Lorraine, qui, comme toute sa famille, est résolument opposée à l'alliance avec la France qui a dépossédé ses ancêtres des duchés sur lesquels ils avaient régné près de 700 ans. Marie-Thérèse demanda à Charlotte et Louise de Hesse-Darmstadt, amie de Marie Antoinette d'accompagner cette dernière en France.
L'arrivée en France
Après près de trois semaines de voyage, le 7 mai 1770, la jeune Marie-Antoinette arrive à Kehl où elle doit participer au rite de remise de l'épouse, tradition de l'Ancien Régimea 13. Au moment de quitter le Saint-Empire, tous les biens venant de son pays d’origine, même ses vêtements, lui sont retirés dans un bâtiment construit, en bois, à cet effet sur l'île aux Épis, au milieu du Rhin, entre les villes de Kehl et de Strasbourg, formant ainsi une sorte de rite de passage de sa vie de jeune fille à sa vie de femme.Le choix de cette île, entre l'Allemagne et la France représente également une sorte de zone neutre. Les deux entrées de ce bâtiment sont disposées de telle manière qu’elle y entre du côté autrichien et en ressort en France. C'est alors qu'elle fait la connaissance de sa première femme d'honneur, Mme de Noailles qui lui présente alors la duchesse de Villars, sa femme d'atour ainsi que les comtesses de Mailly, de Tavannes, la duchesse de Picquigny et la marquise de Duras, ses secondes femmes d'honneur.
Une fois le rituel achevé, elle sort du bâtiment par la porte côté français, sous une pluie battante. Arrivée à Strasbourg, le temps redevenu clément, elle est complimentée de toutes parts et à M. d'Autigny, maire de la ville, qui s'adresse à elle en allemand, elle répond : Non ! Ne parlez point allemand, s'il vous plaît. À dater d'aujourd'hui je n'entends plus d'autre langue que le français. Parvenue à l'Évêché, elle fait la connaissance du vieux cardinal de Rohan qui l'attend et reçoit trente-six jeunes femmes de la noblesse d'Alsace. Puis elle se rend le soir-même à la comédie où l'on donne alors Dupuis et Desronnais ainsi que la Servante maîtresse. Le lendemain, remerciant M. d'Autigny du bel accueil qui lui avait été réservé, elle quitte Strasbourg pour cinq jours de voyage, au bout duquel elle rencontrera enfin le dauphin à qui elle est promise.
À Saverne, sa première escale, elle voit pour la première fois une résidence princière française, le château des princes évêques de Strasbourg, alors récemment embelli. Le 9 mai 1770, elle s'arrête à Nancy. La ville, ancienne-capitale du Duché de Lorraine c'est là le lieu de naissance de son père et la capitale ancestrale de sa famille, n'est devenue française que quatre années auparavant. Elle se recueille en l'église des cordeliers, devant les tombeaux de ses ancêtres paternels, les ducs de Lorraine et de Bar. Le 10, elle passe à Bar-le-Duc, le 11 à Châlons-sur-Marne,aujourd'hui Châlons-en-Champagne où elle assiste à la représentation de La Partie de chasse de Henri IV, le 12 à Soissons où elle séjourne quarante-huit heures. Weber écrit aussi, à propos de ce voyage : Sur la route, tous les habitants des campagnes abandonnent leurs travaux pour venir la saluer. Les chemins sont jonchés de fleurs ; les jeunes filles, dans leurs plus belles parures, présentent leurs bouquets à la dauphine, qui sourit à la naïveté des unes, daigne répondre aux compliments des autres, et les accueille toutes avec bonté. À vingt lieues de Strasbourg, les habitants des villages voisins se sont rassemblés. On entendait de toutes parts retentir les cris de : Vive la dauphine ! Vive le dauphin ! Le chemin était obstrué par la foule. Les stores de sa voiture étaient levés et tous les spectateurs pouvaient contempler à loisir sa beauté, son sourire enchanteur, sa douce physionomie. De jeunes paysans se disaient l'un à l'autre : Qu'elle est jolie, notre dauphine!. Le 14 mai enfin, à deux pas de Compiègne, la jeune dauphine rencontre le premier ministre, le duc de Choiseul, venu au devant d'elle.
La jeune princesse va ensuite attendre la cérémonie de son mariage près de Paris au château de la Muette, dont le dauphin avait pris possession en 1764.
Elle fut surnommée l’Autrichienne dès son arrivée à Versailles, puis Madame Déficit et, plus tard, Madame Veto.
Mariage
Le 16 mai 1770, Marie-Antoinette épouse le dauphin à Versailles.
Le jour même des noces, un scandale d’étiquette a lieu : tout comme l'avaient fait leurs ancêtres en 1698 lors du mariage d'Élisabeth-Charlotte d'Orléans, nièce de Louis XIV avec le duc Léopold Ier de Lorraine, grand-père de Marie-Antoinette, les princesses de Lorraine, arguant de leur, lointaine parenté avec la nouvelle dauphine, ont obtenu de danser avant les duchesses, au grand dam du reste de la noblesse qui, suivant l'exemple des filles de Louis XV, murmure déjà contre l’Autrichienne .
Le soir du 30 mai 1770, où l'on fête place Louis XV, à Paris, le mariage princier, est tiré un magnifique feu d'artifice dont une fusée tombe sur les pièces d'artifice destinées au bouquet final, créant un incendie, puis une véritable panique, conduisant à la mort de plusieurs centaines de victimes,131 selon les chiffres officiels, mais en réalité vraisemblablement autour de 400. Bouleversés, le dauphin et la dauphine - qui n'ont que 15 ans - financeront sur leur cassette personnelle une importante aide aux victimes et à leurs familles.
La jeune fille, au physique agréable, est assez petite et ne possède pas encore la gorge si appréciée en France. Elle est blonde, d'un blond assez soutenu tirant sur le roux, qui, sous la poudre, prend des reflets rosés. Ses yeux bleu pâle sont un peu trop saillants. Son visage, au vaste front bombé, considéré comme trop haut, offre un ovale très allongé. Le nez, qui promet d'être légèrement aquilin, offre peu de finesse. La jeune dauphine a néanmoins beaucoup de grâce et une légèreté presque dansante dans sa façon de se mouvoir. Archiduchesse d’Autriche, arrière-petite nièce de Louis XIV, par sa grand-mère paternelle Élisabeth-Charlotte d'Orléans duchesse de Lorraine et de Bar, objet vivant du renversement des alliances du roi Louis XV, elle attire dès son arrivée l’inimitié d’une partie de la cour. De plus, la jeune dauphine a du mal à s’habituer à sa nouvelle vie, son esprit se plie mal à la complexité et à la rouerie de la vieille cour, au libertinage du roi Louis XV et de sa maîtresse la comtesse du Barry. Son mari l’aime mais l’évite, partant très tôt chasser ; elle peine à s’habituer au cérémonial français, au manque d’intimité et subit péniblement l’étiquette, rigide mode d’emploi de la cour.
Elle est manipulée par Mesdames Tantes, les filles du roi Louis XV, qui lui enseignent l’aversion pour la comtesse du Barry, ce qui agace Louis XV. Par ailleurs, Marie-Antoinette s’en fera bientôt une ennemie : pendant les premiers temps, elle refuse de lui parler mais, forcée par Louis XV, et poussée par Marie-Thérèse sa mère, et Mercy-Argenteau, elle finit par adresser la parole à la comtesse avec ces quelques mots il y a bien du monde à Versailles aujourd'hui. Marie-Antoinette ressortira humiliée de cet incident, surtout que Mesdames tantes verront en son acte une haute trahison. En outre, Vienne tente de la manipuler par le biais de la volumineuse correspondance qu’entretient sa mère avec le comte de Mercy-Argenteau, ambassadeur d’Autriche à Paris. Ce dernier est le seul sur lequel elle puisse compter, car le duc de Choiseul, celui qui avait permis le rapprochement de la France avec l’Autriche, est tombé en disgrâce moins d’un an après le mariage, victime d’une cabale montée par Mme du Barry. Cette fameuse correspondance secrète de Mercy-Argenteau est une large source d’information sur les détails de la vie de Marie-Antoinette depuis son mariage en 1770 jusqu’au décès de Marie-Thérèse Ire en 1780. Selon l’auteur du livre regroupant cette correspondance : Ces documents originaux ne se contentent pas de nous introduire dans son intimité, ils nous révèlent aussi comment Marie-Antoinette, dépourvue d’expérience et dénuée de culture politique, fut manipulée par sa famille autrichienne à laquelle elle demeura toujours attachée.
Elle se fait une amie en la personne de Rosalie de Beauchamp, présentée à la cour par Honoré III, prince de Monaco et le comte d'Angiviller. Mademoiselle de Beauchamp devint la lectrice de la future reine.
Une tradition fait de Marie-Antoinette d'Autriche celle qui aurait officiellement introduit et popularisé en France le croissant à partir de 1770, d'où le nom de viennoiserie.
Reine de France
Le roi Louis XV meurt le 10 mai 1774 et Marie-Antoinette devient reine de France et de Navarre à 18 ans. Toujours sans héritier à offrir à la France et toujours considérée comme une étrangère même par la famille royale qu'elle n'aime pas, en fait le mariage entre elle et Louis XVI met sept ans à être consommé, la reine devient, dès l’été 1777, la cible de premières chansons hostiles qui circulent de Paris jusqu’à Versailles.
Une véritable coterie se monte contre elle dès son accession au trône, des pamphlets circulent, d'abord de courts textes pornographiques puis des libelles orduriers. Ses déboires conjugaux étant publics, on l’accuse d’avoir des amants le comte d’Artois son beau-frère, le comte suédois Hans Axel de Fersen ou même des maîtresses, la duchesse de Polignac, la princesse de Lamballe, de dilapider l’argent public en frivolités, robes de Rose Bertin, parfums de Jean-Louis Fargeon ou pour ses favoris, de faire le jeu de l’Autriche, désormais dirigée par son frère Joseph II. Elle y est clouée au pilori comme une nymphomane perverse et insatiable et bien vite la certitude de son insatiable érotisme se répand. Elle est décrite comme une prostituée babylonienne, une infâme tribade ayant l'habitude, à Trianon, d'épuiser quotidiennement plusieurs hommes et plusieurs femmes pour satisfaire sa diabolique lubricité. De plus, le couple royal n'arrive pas à procréer, ce qui alimente les rumeurs sur l'impuissance de Louis XVI ou la stérilité de Marie-Antoinette. Le premier se révèle en fait inexpérimenté et intimidé par sa femme avec qui il ne s'entend pas. Cette dernière, peu attirée par son époux, se montre réticente à accomplir le devoir conjugal. Sa mère Marie-Thérèse, craignant pour la survie de l'Alliance franco-autrichienne et que sa fille puisse être répudiée, envoie son fils aîné Joseph le 19 avril 1777 à la Cour de France afin d’analyser au mieux la situation du couple. Un an plus tard, le couple donne naissance à leur première fille, Marie-Thérèse-Charlotte mais cette naissance tant attendue apparaît suspecte et fait naître la rumeur de bâtardise de l'enfant, la paternité de la princesse étant attribuée au Comte d'Artois ou au duc de Coigny.
Son portrait
Sa beauté n'est pas régulière. …. D'aucuns lui reprochent aussi la mâchoire trop forte des Habsbourg et une poitrine trop abondante. …. Elle est grande, admirablement faite avec des bras superbes Mme Vigée-Lebrun. …. Sa peau, dit encore sa portraitiste, était si transparente qu'elle ne prenait point d'ombre. …. C'était la femme de France qui marchait le mieux Vigée-Lebrun …. On n'a jamais fait la révérence avec tant de grâce s'émerveille Tilly. Elle salue dix personnes en se ployant une seule fois. De la tête et du regard elle donne à chacun ce qui lui revient. …. L'intelligence n'est pas moins vive. La correspondance le montre.
Son caractère
Marie-Antoinette ne peut souffrir les personnages ennuyeux. On dit d'elle qu'elle a un bon caractère mais qu'elle est en même temps partiale. Le trait déplaisant de son caractère est la partialité. …. Beaucoup accusent Marie-Antoinette de légèreté. À commencer par sa propre mère. …. Elle aime seulement à se divertir, ….
Ses goûts
Marie-Antoinette aime le théâtre, la comédie, le jeu, pharaon, tric-trac, billard, .... Elle aime la danse On dit qu'elle ne danse pas en mesure, écrit Horace Walpole, mais alors c'est la mesure qui a tort et la musique. Elle chasse également. Le duc de Croÿ rapporte qu'elle monte supérieurement. Elle aime les toilettes, les voyages dans les différents châteaux de la Cour autour de Paris, l'aménagement intérieur et la décoration. Elle lit même si la lecture n'est pas son passe-temps préféré.
On lui passe difficilement ses bals et ses soirées dansantes chez ses amies ou ses beaux-frères. On ne lui pardonne pas les bals masqués de l'Opéra, inconvenants, juge-t-on, pour une reine de France. Malheureusement elle en raffole, et s'y fait conduire plusieurs fois pendant le carnaval. …. On lui reproche aussi sa passion du jeu. Tous les soirs, elle joue au Pharaon jusqu'à deux ou trois heures du matin. …. L'opinion publique lui fait grief de ses goûts dispendieux en matière de toilettes et de réceptions. Elle aime les toilettes, c'est vrai, mais ses fournisseurs en profitent abusivement. …. Pour les réceptions et les voyages, Marie-Antoinette manifeste parfois des exigences coûteuses. …. La reine agit de même pour les aménagements et décorations de ses appartements. Tout doit être fait tout de suite, et sans avoir égard au coût de l'opération. …. En décoration son goût n'est pas toujours le meilleur, mais il est parfait en musique. Musicienne elle-même - elle chante et joue de la harpe et de la flûte -, elle exerce dans cet art un intelligent mécénat. Elle protège Gluck, son ancien professeur de musique, et surtout elle réalise fort bien le caractère novateur de son art.
Sa piété
Souvent même, elle paraît plus proche de la philosophie nouvelle que de la religion. Sa piété est jugée tiède.
Son rôle politique
Elle tente d’influencer la politique du roi, de faire et défaire les ministres, toujours sur les conseils intéressés de ses amis. Mais, contrairement à la rumeur, son rôle politique s’avère extrêmement limité. Le baron Pichler, secrétaire de Marie-Thérèse Ire, résume poliment l’opinion générale en écrivant : Elle ne veut être ni gouvernée ni dirigée, ni même guidée par qui que ce soit. C’est le point sur lequel toutes ses réflexions paraissent jusqu’à présent s’être concentrées. Hors de là, elle ne réfléchit encore guère, et l’usage qu’elle a fait jusqu’ici de son indépendance le prouve assez, puisqu’il n’a porté que sur des objets d’amusement et de frivolité.
Sa vie à la Cour de France
S’entourant d’une petite cour d’amis vite qualifiés de favoris, la princesse de Lamballe, le duc de Lauzun, le baron de Besenval, le duc de Coigny puis la comtesse de Polignac plus enjouée et spirituelle que la princesse de Lamballe qu'elle juge trop pieuse et timorée, elle suscite les jalousies des autres courtisans surtout après avoir évincé dans sa cour les vieux aristocrates11. Ses toilettes et les fêtes coûteuses qu’elle organise profitent au rayonnement de la France, notamment pour la mode et le commerce du textile, mais sont critiquées, bien qu’elles soient une goutte d’eau dans les dépenses générales de la cour, des administrations, ou comparées au niveau de vie de certains princes de sang ou seigneurs menant grand train. Au total, les dépenses de la cour ne représentent que 7 % du budget du royaume, soit guère plus que les règnes précédents.
Elle tient grand couvert et reçoit trois fois par semaine à Versailles.
Pour retrouver à Versailles ce qu’elle a connu à Vienne – une vie plus détendue en famille avec ses amis –, elle va souvent avec quelques privilégiés au Petit Trianon construit par Louis XV sous l'impulsion de sa maîtresse, Madame de Pompadour, qui décèdera avant que celui-ci ne soit terminé, puis que Louis XVI offrit à Marie-Antoinette. Elle fait construire un village modèle, le Hameau de la Reine, où elle installe des fermiers. Dans son petit théâtre, elle joue notamment Le Barbier de Séville de Beaumarchais et tient souvent des rôles de servante devant un Louis XVI amusé. Par son désir de plaisirs simples et d’amitiés exclusives, Marie-Antoinette va vite se faire de plus en plus d’ennemis, même à la cour de Versailles.
Les escapades de Marie-Antoinette sont aussi fréquentes. Si Marly est délaissé - le cérémonial paraissant encore plus gênant qu'à Versailles - le petit Trianon a toute la faveur de la reine. … Enthousiaste, la baronne d'Oberkirch ne s'étonne pas que la reine y reste "la plus grande partie de la belle saison". Les usages ne sont pas ici ceux de la Cour, ils imitent plutôt la simplicité de vie de la gentilhommerie. La reine "entrait dans son salon sans que le piano-forte ou les métiers de tapisserie fussent quittés par les dames, et les hommes ne suspendaient ni leur partie de billard ni celle de trictrac". Trianon offre peu de logements. Aussi les invités dînent-ils avec la reine, passent l'après-midi, soupent puis reviennent coucher à Versailles. Le roi et les princes sauf Madame Élisabeth viennent en galopins. Dames d'honneur et du palais n'y sont pas davantage établies, mais, par grâce royale, peuvent y venir souper les mercredis et samedis, nommés ainsi "jours du palais". Vivre en particulier loin de la pompe monarchique, échapper à la tyrannie de l'étiquette, abandonner les fastueux mais encombrants habits de Cour pour "une robe de percale blanche, un fichu de gaze, un chapeau de paille", fait le bonheur de Marie-Antoinette. Au hameau - auquel on a donné "à grands frais l'aspect d'un lieu bien pauvre" - la reine joue à la fermière, regarde pêcher dans le lac ou assiste à la traite des vaches.
Après la mort de la Marquise de Pompadour 1764, l'arrivée en France de l'archiduchesse Marie-Antoinette en 1770 ranime la vie musicale à Versailles. La dauphine cultive le chant, touche le clavecin et la harpe. …. Plus que son talent de harpiste, la protection qu'elle accorde aux musiciens "constitue son vrai mérite musical". Négligeant peintres et écrivains, la reine met son influence au service des musiciens, attire à la Cour Gluck 1773, Piccini - le maître le plus célèbre d'Italie 1776 -, Sacchini 1781, favorise la carrière de Grétry. Très attachée à l'auteur de Richard Cœur de Lion, elle le nomme directeur de sa musique particulière 1787, lui obtient dons et pensions, accepte d'être la marraine d'une de ses filles, favorise la création de ses opéras-comiques à Versailles, Fontainebleau ou Trianon. Dès son arrivée à la Cour, le chevalier Gluck, son ancien professeur à Vienne, est comblé d'honneurs. Six mille livres de pension et autant pour chaque opéra qu'il fera jouer doivent le retenir à Versailles.
Marie-Antoinette suit son exemple de Madame de Pompadour. Dauphine, elle courait avec son mari les salles parisiennes. Reine, elle ne change pas ses habitudes. "Sa Majesté, écrit Mercy-Argenteau en 1777, est venue aux spectacles de Paris deux ou trois fois chaque semaine." Avec ses belles-sœurs elle anime agréablement sa société intime : elle apprend à jouer et possède son théâtre à Trianon. Au printemps 1780, elle devient actrice, avec une prédilection pour les comédies à ariettes.
Vrai et gai. La cour de France lui doit pour une bonne part le charme riant de ses derniers feux. Se plaisant à la vie de famille et aux simples réunions amicales, elle fait aménager pour sa vie intime à Versailles, Fontainebleau, Compiègne et Saint-Cloud, des petits appartements tapissés de toiles peintes à motifs de fleurs et d'oiseaux, ornés de lambris blancs et de glaces. Ennemie du cérémonial et de l'étiquette, elle invente un nouveau style de vie et de divertissement. À Marly, par exemple, en 1788, elle établit une espèce de café, où les seigneurs et les dames vont prendre leur petit déjeuner le matin. On se met à une petite table, et chacun se fait servir ce qu'il veut.
Descendance
Huit ans et demi après son mariage, Marie-Antoinette accouche de son premier enfant, le seul qui parviendra à l'âge adulte. Trois autres suivront.
Marie-Thérèse-Charlotte 1778-1851, dite Madame Royale ;
Louis Joseph Xavier François 1781 -1789, Dauphin ;
Louis-Charles 1785-1795, duc de Normandie 1785 puis Dauphin 1789 puis Prince Royal 1790-1792 puis roi sous le nom de Louis XVII 1793-1795 ;
Sophie-Béatrice 1786-1787, morte à 11 mois.
Dans une entreprise de calomnie sciemment orchestrée, les libelles ne manquent cependant pas d'affirmer que ses enfants, en particulier ses fils, ne sont pas de Louis XVI.
Après le scandale de l'affaire du collier, Marie-Antoinette se tourne davantage vers sa famille et s'emploie à montrer d'elle l'image d'une mère de famille comme les autres. Enceinte, elle se fait peindre par Madame Vigée-Lebrun entourée de ses enfants, mais perd sa fille Sophie-Béatrice au berceau en 1787 âgée de 11 mois.
Marie-Antoinette vivra très douloureusement cette perte. À l'origine, se trouvait peinte dans le berceau, sa fille Sophie Béatrice. La reine a souhaité laisser le berceau vide comme un symbole de deuil et de douleur. Constante source de chagrin pour la reine qui ne pouvait retenir ses larmes à la vue de l'œuvre, le tableau sera expédié à Vienne, Louis XVI l'offrant à son beau-frère Joseph II du Saint-Empire.
Elle perdra ensuite un deuxième enfant, Louis Joseph Xavier, âgé de presque 8 ans, en juin 1789, en pleine session des États-Généraux.
La Maison de la Reine Maison ecclésiastique Grand Aumônier de la Reine
1774 - Mgr François de Fontanges, archevêque de Toulouse
1774 - 1780 - Le cardinal André Hercule de Fleury, évêque de Chartres
1780 - 1789 - Mgr Louis Hector Honoré Maxime de Sabran, évêque de Laon
Premier Aumônier de la Reine
1774 - 1780 - Mgr de Sabran
1780 - 1789 - Mgr Camille de Polignac, évêque de Meaux
Aumônier ordinaire
Roch-Étienne de Vichy, vicaire général d'Évreux
Aumôniers de quartier
Chapelain ordinaire
Chapelains de quartier
Clerc ordinaire
Clerc de quartier
Sommiers
Confesseurs de la Reine
1770 - 1789 - l'abbé Mathieu-Jacques de Vermond, professeur de français, lecteur et confident, secrétaire de cabinet.
1792, l'abbé Poupart
1793, l'abbé Magnin et l'abbé Cholet, prêtre vendéen, qui lui donna les sacrements la veille de sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire.
Affaire du collier de la reine.
En juillet 1785, éclate l’affaire du Collier : les joailliers Boehmer et Bassange réclament à la reine 1,6 million de livres pour l’achat d’un collier de diamants dont le cardinal de Rohan a mené les tractations, au nom de la reine. La reine ignore tout de cette histoire et, quand le scandale éclate, le roi exige que le nom de sa femme soit lavé de l’affront. Le cardinal est arrêté en pleine journée dans la Galerie des Glaces, sous les yeux des nombreux courtisans. Le roi confie l’affaire au Parlement, l’affaire est jugée par Étienne François d'Aligre, qui conclut à la culpabilité du couple d’aventuriers à l’origine de l’affaire, les prétendus comte et comtesse de la Motte et disculpe le cardinal de Rohan et le comte de Cagliostro, abusés mais innocents.
Le cardinal de Rohan, aussi innocent que la Reine dans cette affaire, s’est laissé manipuler par Madame de La Motte. Le Cardinal, frivole et volubile, est ignoré par la Reine depuis qu'il a mécontenté sa mère, Marie-Thérèse, alors qu'il était ambassadeur de France à la Cour d'Autriche, des années plus tôt. Lorsque Madame de la Motte, qui se dit amie et cousine de Marie-Antoinette, lui confie les tractations avec le bijoutier, le Cardinal demande des preuves et Madame de La Motte va jusqu’à lui présenter une fausse Marie-Antoinette en réalité une prostituée Nicole Leguey qui ressemblait à s’y méprendre à la reine un soir dans le parc de Versailles et inventer une fausse correspondance ; le naïf mais ambitieux Cardinal accepte donc sa mission avec zèle, clamant à qui voulait l'entendre qu'il était enfin devenu intime de Sa Majesté.
La reine, bien qu’innocente, sort de l’affaire du collier déconsidérée auprès du peuple. Non seulement l'affront ne fut pas lavé, mais il généra une réelle campagne de désinformation étendue à tout le royaume. C'est à la même époque qu'est diffusée une littérature diffamante à propos des amours de la reine et du roi. Parmi ces représentations, l'une fut très populaire : Les Amours de Charlot et Toinette, caricatures du couple royal 1789, un succès de librairie.
Marie-Antoinette se rend enfin compte de son impopularité et tente de réduire ses dépenses, notamment en réformant sa maison, ce qui déclenche plutôt de nouveaux éclats quand ses favoris se voient privés de leurs charges. Rien n’y fait, les critiques continuent, la reine gagne le surnom de « Madame Déficit et on l’accuse de tous les maux, notamment d’être à l’origine de la politique anti-parlementaire de Louis XVI.
La Révolution française 1789
Le 5 mai 1789 s’ouvrent les États généraux. Lors de la messe d’ouverture, Mgr de La Fare, qui est à la chaire, attaque Marie-Antoinette à mots à peine couverts, dénonçant le luxe effréné de la cour et ceux qui, blasés par ce luxe, cherchent le plaisir dans une imitation puérile de la nature, rapporté par Adrien Duquesnoy, Journal sur l’Assemblée constituante, allusion évidente au Petit Trianon.
Le dauphin qui mourut à 7 ans pendant les États Généraux
Le 4 juin, le petit dauphin meurt. Pour éviter la dépense, on sacrifie le cérémonial de Saint-Denis. L’actualité politique ne permet pas à la famille royale de faire son deuil convenablement. Bouleversée par cet événement et désorientée par le tour que prennent les États généraux, Marie-Antoinette se laisse convaincre par l’idée d’une contre-révolution. En juillet, Necker démissionne. Le peuple interprète cette démission comme un renvoi de la part du roi. La reine brûle ses papiers et rassemble ses diamants, elle veut convaincre le roi de quitter Versailles pour une place-forte sûre, loin de Paris. Il faut dire que, depuis le 14 juillet, un livre de proscription circule dans Paris. Les favoris de la reine y sont en bonne place et la tête de la reine elle-même est mise à prix. On l’accuse de vouloir faire sauter l’Assemblée avec une mine et de vouloir faire donner la troupe sur Paris, ce qui est faux. Il est néanmoins vrai que la reine prônera l’autorité et restera toujours ancrée dans la conviction de la légitimité du pouvoir royal.
Le 1er octobre, un nouveau scandale éclate : lors d’un banquet donné par les gardes du corps de la Maison militaire, au régiment de Flandre qui vient d’arriver à Paris, la reine est acclamée, des cocardes blanches sont arborées, et selon la presse révolutionnaire des cocardes tricolores auraient été foulées. Paris est outré par ces manifestations contre-révolutionnaires, et par la tenue d’un banquet alors que le pain manque à Paris. Il en résulte les journées révolutionnaires d'octobre, dont l'historiographie tel le récit romancé de Jules Michelet a retenu la marche des femmes sur Versailles, disant aller chercher le boulanger, le roi, la boulangère, la reine et le petit mitron le dauphin.
Journées des 5 et 6 octobre 1789
Bien des gens attribuent faussement à Marie-Antoinette une boutade cynique : S’ils n’ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche !. On lui a attribué cette phrase en 1789 alors qu’elle figure dans le Livre vi des Confessions de Jean-Jacques Rousseau publiées en 1782. Aucune personne n'attribua la boutade à Marie-Antoinette à l'époque, les partisans de la Révolution compris.
La monarchie constitutionnelle
Louis XVI et Marie-Antoinette auraient pu se résoudre à demander de l’aide aux souverains étrangers, le roi d’Espagne Charles IV et Joseph II, frère de la reine. Mais le roi d’Espagne répond évasivement et, le 20 février 1790, Joseph II meurt. Des doutes et des controverses entre historiens subsistent sur ce possible appel à l’étranger. La Fayette suggère froidement à la reine le divorce. D’autres parlent à mots à peine couverts d’un procès en adultère, et de prendre la reine en flagrant délit avec le comte de Fersen.
Il est à noter que durant cette période, la famille royale est assignée à résidence et ne peut quitter son palais : il lui a notamment été interdit de quitter les Tuileries pour aller fêter Pâques à Saint- Cloud.
Breteuil propose alors, fin 1790, un plan d’évasion. L’idée est de quitter les Tuileries et de gagner la place-forte de Montmédy, proche de la frontière. La reine est de plus en plus seule, surtout depuis qu’en octobre 1790 Mercy-Argenteau a quitté la France pour sa nouvelle ambassade aux Pays-Bas et que Léopold II, le nouvel empereur, un autre de ses frères, élude ses demandes d’aide, car, monarque philosophe, il pousse au contraire sa sœur à jouer le jeu de la nouvelle Constitution. Le 7 mars, une lettre de Mercy-Argenteau à la reine est interceptée et portée devant la Commune. C’est le scandale, une preuve, pense-t-on, du comité autrichien, des tractations de la reine pour vendre la patrie à l’Autriche.
Le 20 juin 1791 débute la tentative d’évasion, stoppée le lendemain par l’arrestation à Varennes-en-Argonne.
Fuite de Louis XVI et arretation Après Varennes
Interrogé à Paris par une délégation de l’Assemblée constituante, Louis XVI répond évasivement. Ces réponses, rendues publiques, suscitent le scandale, et certains révolutionnaires réclament la déchéance du roi. Marie-Antoinette, elle, correspond secrètement avec Barnave, Duport et Lameth qui veulent convaincre le roi d’accepter son rôle de monarque constitutionnel. Mais elle joue là un double jeu car elle espère seulement les endormir et ... leur donner confiance ... pour les mieux déjouer après, lettre de la Reine à Mercy. Elle écrit même à Fersen ces mots : Quel bonheur si je puis un jour redevenir assez puissante pour prouver à tous ces gueux que je n’étais pas leur dupe. Le 13 septembre, Louis XVI accepte la Constitution. Le 30, l’Assemblée constituante se dissout et est remplacée par l’Assemblée législative, cependant que des bruits de guerre avec les monarchies alentour, au premier rang desquelles l’Autriche, se font plus pressants. Le peuple est alors monté contre Marie-Antoinette, toujours appelée l’Autrichienne. Les pamphlets et journaux révolutionnaires la traitent de monstre femelle ou encore de Madame Veto, et on l’accuse de vouloir faire baigner la capitale dans le sang. Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche et elle subit dans un premier temps de sérieux revers. Le 3 août 1792, le manifeste de Brunswick, largement inspiré par Fersen, achève d’enflammer une partie de la population.
Le 10 août, c’est l’insurrection. Les Tuileries sont prises d’assaut, les gardes massacrés, le roi et sa famille doivent se réfugier à l’Assemblée, qui vote sa suspension provisoire et leur internement au couvent des Feuillants. Le lendemain, la famille royale est finalement transférée à la prison du Temple. Pendant les massacres de septembre, la princesse de Lamballe, proche amie de la reine et victime symbolique, est sauvagement assassinée, démembrée, mutilée, déchiquetée et sa tête est brandie au bout d’une pique devant les fenêtres de Marie-Antoinette pendant que divers morceaux de son corps sont brandis en trophée dans Paris. Les auteurs du meurtre veulent "monter dans la tour et obliger la reine à embrasser la tête de sa grue". Ils veulent lui montrer la tête et le corps nu et profané de la princesse sur lequel, ils en sont convaincus, la reine se serait si longtemps livrée à ses penchants saphiques. Peu après, la Convention déclare la famille royale otage. Début décembre, a lieu la découverte officielle de l’armoire de fer dans laquelle Louis XVI cachait ses papiers secrets et dont l’existence est aujourd’hui sujette à débats. Le procès est désormais inévitable. Le 11 décembre, Louis XVI est séparé de sa famille pour être emmené dans un autre logement de la prison du Temple.
Le 26 décembre, la Convention vote la mort avec une majorité étroite, en partie à cause du duc d'Orléans, cousin du roi, connu alors sous le nom de Philippe Égalité. Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. Le 27 mars, Robespierre évoque le sort de la reine pour la première fois devant la Convention. Le 13 juillet, le dauphin est enlevé à sa mère et confié au savetier Simon. Le 2 août, c’est Marie-Antoinette qui est séparée des princesses, sa fille Madame Royale et sa belle-sœur madame Élisabeth et est conduite à la Conciergerie. Durant son séjour dans sa prison, Marie-Antoinette aurait développé un cancer de l'utérus, un cancer cervical, un fibrome ou aurait été affectée d'une ménopause précoce : Robespierre inquiet la fait suivre par son propre médecin Joseph Souberbielle qui rapporte à L'Incorruptible des métrorragies récurrentes, aussi Robespierre fait accélérer la procédure judiciaire. Lors du transfert, alors qu’elle s’est violemment cogné la tête, elle répond à ses geôliers qui s’en inquiètent son fameux Rien à présent ne peut plus me faire de mal. Son interrogatoire commence le lendemain.
Le Procès de Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine.
Le 3 octobre 1793, Marie-Antoinette comparaît devant le Tribunal révolutionnaire, mené par l’accusateur public Fouquier-Tinville. Si le procès de Louis XVI avait conservé quelques formes de procès équitable, ce n’est pas le cas de celui de la reine. Le dossier est monté très rapidement, il est incomplet, Fouquier-Tinville n’ayant pas réussi à retrouver toutes les pièces de celui de Louis XVI. Pour charger l’accusation, il parle de faire témoigner le dauphin contre sa mère qui est alors accusée d’inceste par Jacques-René Hébert. Il déclare que la reine et Mme Élisabeth ont eu des attouchements sur le jeune Louis XVII. Marie-Antoinette ne répond rien et un juré en fait la remarque. Marie-Antoinette se lève et répond. Si je n’ai pas répondu c’est que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation faite à une mère. J’en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici !. Pour la dernière fois, la foule, et surtout les femmes applaudit la reine. Une fois la séance terminée, celle-ci demande à son avocat. N’ai je pas mis trop de dignité dans ma réponse ? Selon Gaspard Louis Lafont d'Aussonne dans ses mémoires publiés en 1824, des personnes dans la foule dirent le matin du jugement Marie-Antoinette s'en retirera : elle a répondu comme un ange, on ne fera que la déporter.
On l’accuse également d’entente avec les puissances étrangères. Comme la reine nie, Herman, président du Tribunal, l’accuse d’être l’instigatrice principale de la trahison de Louis Capet : c’est donc bien un procès pour haute trahison. Le préambule de l’acte d’accusation déclare également : Examen fait de toutes les pièces transmises par l’accusateur public, il en résulte qu’à l’instar des Messaline, Frédégonde et Médicis, que l’on qualifiait autrefois de reines de France et dont les noms à jamais odieux ne s’effaceront pas des fastes de l’histoire, Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, a été, depuis son séjour en France, le fléau et la sangsue des Français. Il ajoute la cause des troubles qui agitent depuis quatre ans la nation et ont fait tant de malheureuses victimes.
Les dépositions des témoins à charge s’avèrent bien peu convaincantes. Marie-Antoinette répond qu’elle n’était que la femme de Louis XVI, et qu’il fallait bien qu’elle se conformât à ses volontés. Fouquier-Tinville réclame la mort et fait de l’accusée l’ennemie déclarée de la nation française. Les deux avocats de Marie-Antoinette, Tronçon-Ducoudray et Chauveau-Lagarde, jeunes, inexpérimentés et n’ayant pas eu connaissance du dossier, ne peuvent que lire à haute voix les quelques notes qu’ils ont eu le temps de prendre.
Quatre questions sont posées au jury :
Marie-Antoinette devant le Tribunal révolutionnaire.
1. Est-il constant qu’il ait existé des manœuvres et des intelligences avec les puissances étrangères et autres ennemis extérieurs de la République, lesdites manœuvres et des intelligences tendant à leur fournir des secours en argent, à leur donner l’entrée du territoire français et à leur faciliter le progrès de leurs armes ?
2. Marie-Antoinette d’Autriche … est-elle convaincue d’avoir coopéré à ces manœuvres et d’avoir entretenu ces intelligences ?
3. Est-il constant qu’il ait existé un complot et une conspiration tendant à allumer la guerre civile à l’intérieur de la République ?
4. Marie-Antoinette est-elle convaincue d’avoir participé à ce complot et à cette conspiration ?
Aux quatre questions, le jury répond oui. Lorsque le jury rend son verdict, il n’existe aucune preuve de l’accusation de haute trahison que l’on impute à la reine. Le dossier est vide de toute pièce.
Techniquement, au vu des pièces du procès, la condamnation n’est pas basée sur des faits avérés. On apprit plus tard que la reine entretenait une correspondance avec le comte Hans Axel de Fersen où il apparaît que l'Autriche et les monarchies d'Europe se préparaient à la guerre contre la France, ainsi lit-on dans une lettre du 19 avril 1792 adressée au comte que la reine écrivait : ... "Les ministres et les jacobins font déclarer demain au roi la guerre à la maison d'Autriche, sous prétexte que par ses traités de l'année dernière elle a manqué à celui d'alliance de cinquante-six, et qu'elle n'a pas répondu catégoriquement à la dernière dépêche. Les ministres espèrent que cette démarche fera peur et qu'on négociera dans trois semaines. Dieu veuille que cela ne soit point et qu'enfin on se venge de tous les outrages qu'on reçoit dans ce pays-ci! ...". La reine, captive, n'était pour autant personnellement pas en mesure d'organiser ou d'ordonner directement quelque directive militaire que ce soit. Sa correspondance avec le comte de Fersen indique néanmoins qu'elle y incite par divers courriers.
En réalité, il fallait condamner la veuve Capet. Robespierre a donc intégré au jury le médecin qui soignait la reine à la Conciergerie, lequel a indiqué aux autres jurés que de toute façon Marie-Antoinette était médicalement condamnée à brève échéance car elle avait de forts épanchements sanguins.
La condamnation à mort, pour haute trahison, est prononcée le 16 octobre 1793 vers 4 heures du matin.
La dernière lettre de Marie-Antoinette
À l'annonce de la sentence, Marie-Antoinette rédige une dernière lettre à l'attention de Madame Élisabeth, sœur de feu le roi Louis XVI.
Cette lettre, qui n'est jamais parvenue à sa destinataire, a été conservée par Robespierre, puis récupérée par le conventionnel Courtois, avant d'être saisie par Louis XVIII. Elle est aujourd'hui conservée dans "l'armoire de fer" des Archives nationales cote AE/II/1384 et un fac-similé est exposé au Musée des Archives nationales.
Cette lettre, à usage privé, ne contient aucun message d'ordre politique. Marie-Antoinette l'a rédigée dans son cachot de la Conciergerie juste après l'annonce de sa condamnation. L'en-tête porte la mention :
Ce 16 octobre, 4 heures 1/2 du matin.
Elle n'est pas signée et ne mentionne aucun nom propre même pas celui de sa destinataire la sœur de Louis XVI, qui partage la captivité des enfants royaux au Temple :
C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois ; je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien ; j'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants ; vous savez que je n'existais que pour eux, et vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse ! J'ai appris par le plaidoyer même du procès que ma fille était séparée de vous. Hélas ! la pauvre enfant, je n'ose pas lui écrire, elle ne recevrait pas ma lettre, je ne sais même pas si celle-ci vous parviendra, recevez pour eux deux ici ma bénédiction. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous, et jouir en entier de vos tendres soins.
Malgré son exécution très proche et son isolement, Marie-Antoinette récuse d'avance toute assistance d'un prêtre assermenté qui aurait prêté le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé condamnée par Rome :
Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle où j'ai été élevée, et que j'ai toujours professée, n'ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant pas s'il existe encore ici des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop s'ils y entraient une fois. Adieu, adieu ! Je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre dans mes actions, on m'amènera peut-être un prêtre, mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot,et que je le traiterai comme un être absolument étranger.
Celle qui vient de vivre seule une captivité de deux mois et demi, sans pouvoir communiquer avec ses enfants, tente de leur faire passer ses dernières recommandations. La femme autrefois décrite comme autoritaire et superficielle s'exprime à ce dernier instant en toute humilité. Sa préoccupation essentielle concerne l'état d'esprit dans lequel ses enfants assumeront la mort de leurs parents, dans leur vie à venir dont elle ne veut pas douter, alors que le dauphin mourra en captivité. Sans un mot de plainte ni de regret, Marie-Antoinette ne songe plus qu'à laisser un héritage spirituel à ses enfants :
Qu'ils pensent tout deux à ce que je n'ai cessé de leur inspirer : que les principes et l'exécution de leurs devoirs sont la première base de la vie ; que leur amitié et leur confiance mutuelle en feront le bonheur ; qu'ils sentent enfin tous deux que, dans quelque position où ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union, qu'ils prennent exemple de nous : combien dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolations, et dans le bonheur on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami ; et où en trouver de plus tendre, de plus cher que dans sa propre famille.
Le dernier conseil n'est pas celui de l'Autrichienne perverse que le Tribunal s'efforcera de montrer pour justifier la condamnation à mort :
Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément : qu'il ne cherche jamais à venger notre nom.
et plus loin
Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et mots rayés et à tous mes frères et sœurs.
Resteront sans doute de cette lettre retrouvée en 1816 ces mots touchants :
Mon Dieu ayez pitié de moi ! Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous mes pauvres enfants. Adieu, Adieu !
Exécution de Marie-Antoinette d'Autriche.
Marie-Antoinette est exécutée après un procès injuste le même jour à midi et quart. Le matin du 16 octobre, Marie-Antoinette est menée, mains entravées et sur une charrette – alors que Louis XVI avait eu droit à un carrosse –, de la Conciergerie, jusqu'à la place de la Révolution ancienne place Louis-XV, actuelle place de la Concorde. D'après certains historiens, elle subit avec dignité les sarcasmes et les insultes lancés par la foule massée sur son passage, elle mettra une heure pour traverser la place et monter à l'échafaud. Le peintre et révolutionnaire Jacques-Louis David, observant le cortège depuis la rue Saint-Honoré, en dessine un croquis resté légendaire. Selon ces mêmes historiens, c'est avec courage qu'elle monte à l'échafaud. En marchant sur le pied du bourreau Sanson, elle lui aurait demandé pardon. Ce seront ses dernières paroles.
Selon une légende, ses cheveux auraient entièrement blanchi, phénomène connu sous le nom de syndrome de Marie-Antoinette les jours suivant son retour de Varennes.
Le jour de son exécution, la reine aurait trébuché et perdu un escarpin, récupéré par un fidèle et conservé actuellement au musée des Beaux-Arts de Caen. Cette chaussure a fait l'objet d'une exposition en 1989.
L'inhumation
Tout comme pour Louis XVI, il a été ordonné que les bières des membres de la monarchie soient recouvertes de chaux. Marie-Antoinette est inhumée avec la tête entre les jambes dans la fosse commune de la Madeleine, rue d’Anjou-Saint-Honoré, Louis XVIII fera élever à cet endroit la chapelle expiatoire située de nos jours sur le square Louis-XVI, seul endroit de Paris portant le nom du roi. Ses restes et ceux de Louis XVI furent exhumés le 18 janvier 1815 et transportés le 21 en la basilique de Saint-Denis.
Le premier crime de la Révolution fut la mort du Roi, mais le plus affreux fut la mort de la Reine dit Chateaubriand.
Napoléon prononça ces mots : La mort de la reine fut un crime pire que le régicide.
Acte de décès de Marie Antoinette dans l'état-civil de Paris
L'acte de décès de Marie Antoinette est rédigé le 24 octobre 1793. L'original de l'acte a disparu lors de la destruction des archives de Paris en 1871 mais il avait été recopié par des archivistes et des historiens. Voici ce que dit le texte, on remarquera que de nombreuses informations n'avaient alors pas été indiquées par les officiers publics de l'état civil :
Du trois du second mois de l'an Second de la République française 24 octobre 1793.
Acte de décès de Marie Antoinette Lorraine d'Autriche du vingt-cinq du mois dernier 16 octobre 1793, âgée de trente-huit ans, native de..., domiciliée à..., veuve de Louis Capet.
Sur la déclaration faite à la commune par..., âgé de... ans, profession..., domicilié à..., ledit déclarant a dit être..., et par..., âgé de..., profession..., domicilié à..., ledit déclarant a dit être...
Vu l'extrait du jugement du tribunal criminel révolutionnaire et du procès-verbal d'exécution, en date du 25 du mois dernier.
Signé : Wolff, commis-greffier ;
Vu le certificat d... ;
Claude-Antoine Deltroit, officier public.
Signé : Deltroit
Le mythe
Marie-Antoinette est une femme célèbre et controversée de l'histoire de France. Après sa mort sur l'échafaud, les royalistes ont composé la légende de la reine martyre. Alors que de son vivant, la reine eut à subir des paroles ou des écrits malveillants, bien des souvenirs furent oubliés plus ou moins volontairement et camouflés après sa mort. L'un des principaux doutes qui subsistèrent concerne la nature de sa liaison avec Hans Axel de Fersen. Ce roman d'amour a tourmenté plusieurs générations de fidèles inconditionnels, qui considéraient que la soupçonner de quelque faiblesse amoureuse revenait tout simplement à commettre un crime contre la monarchie même. Pour les républicains, la dernière reine de l'Ancien Régime ne figure plus parmi les grandes criminelles de l'Histoire mais apparaît plutôt comme une princesse sotte, égoïste, et inconséquente, dont on minimise le rôle politique. Cependant, Marie-Antoinette suscite généralement intérêt et compassion jusqu'à nos jours. Marie-Antoinette est la dernière souveraine à avoir porté le titre de reine de France. Marie-Amélie de Bourbon-Siciles 1782-1866, épouse de Louis-Philippe Ier, régna de 1830 à 1848 sous le titre de reine des Français.
Tous les 16 octobre, jour anniversaire de sa mort, de nombreuses personnes se rendent en pèlerinage au château de Versailles afin d'y déposer des fleurs dans ses jardins.
Liens
http://youtu.be/DUGGD5Q5cu4 L'histoire de Marie-Antoinette
http://youtu.be/TrVC_FIW7oQ L'ombre d'un doute, Fallait-il condamner Marie-Antoinette ?
http://youtu.be/VSE5PoxgRdo Le meurtre d'une femme, d'une mère
http://youtu.be/PbDNHha3WwY L'éxécution de Marie-Antoinette
http://youtu.be/qmCsy0f1B9E Marie-Antoinette par H. Cuillemin
http://youtu.be/0A2Mdf7Ewnc Marie-Antoinette Les dernières heures 1
http://youtu.be/bUgL1LkEhrI Marie Antoinette Les dernières heures 2
http://youtu.be/0A2Mdf7Ewnc?list=PLD87628DFF7CAE7EF 11 vidéos Marie-Antoinette
         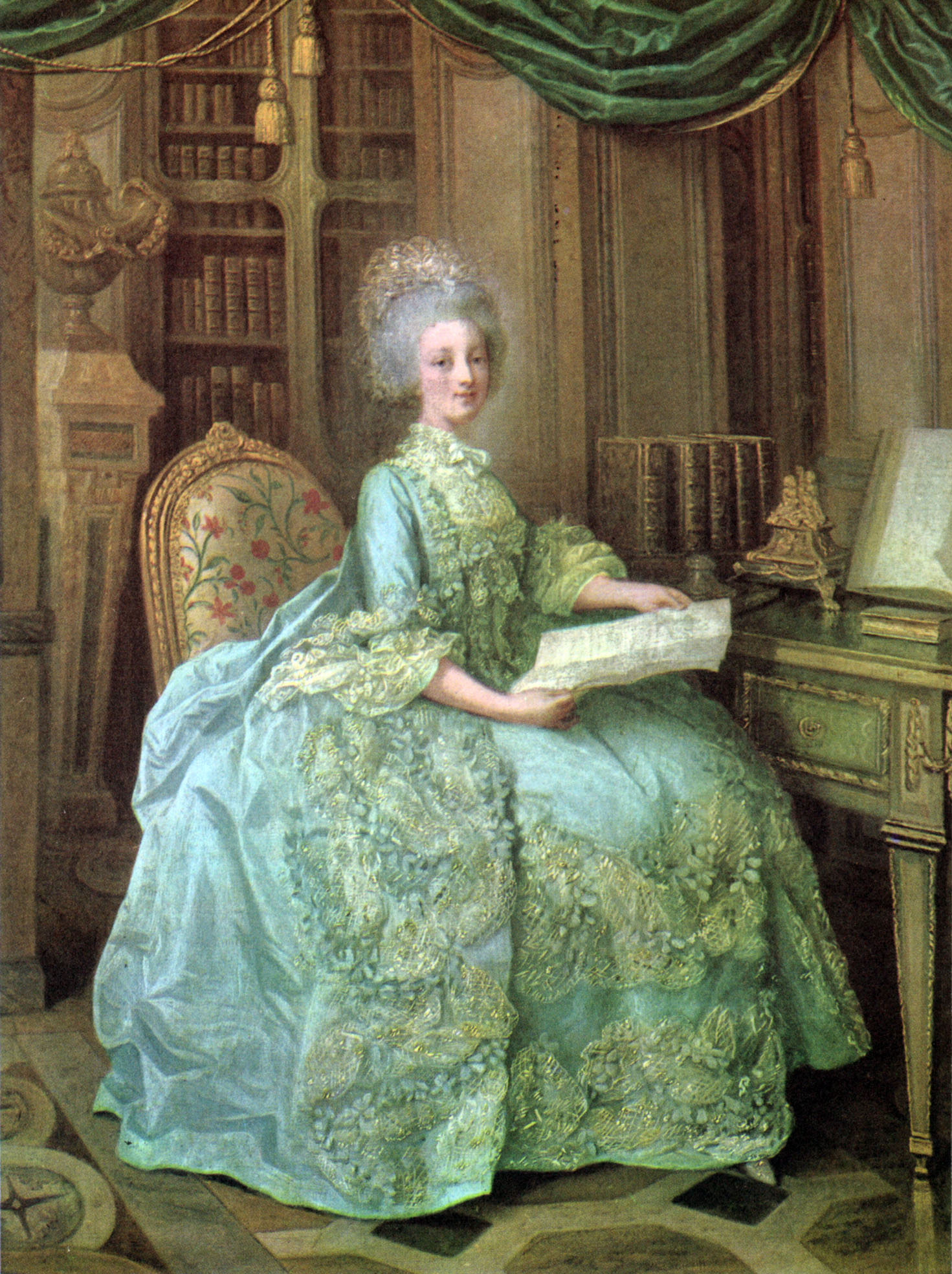   
Posté le : 01/11/2014 17:50
Edité par Loriane sur 02-11-2014 18:26:01
|
|
|
|
|
Gille de Rais / de Retz 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 26 octobre 1440 à 35 ans, à Nantes est exécuté Gilles de Rais ou Retz,
de son véritable nom Montmorency-Laal, Gilles de Rais ou, selon la graphie contemporaine, Gilles de Retz en référence à son titre de baron de Retz, né au château de Champtocé-sur-Loire à une date inconnue, vraisemblablement durant l'année 1405 peut-être vers le 1er septembre 1405, chevalier et seigneur de Bretagne, d'Anjou, du Poitou et du Maine.
Origine Duché d'Anjou, il fait allégeance au Royaume de France, Duché de Bretagne, il est Maréchal de France de 1420 à 1436 pendant la guerre de cent ans, ses Faits d'armes son le siège d'Orléans, bataille de Jargeau, la bataille de Patay, il est baron de Retz, seigneur de Machecoul, seigneur de La Bénate en Corcoué-sur-Logne, seigneur du Coutumier en Bois-de-Céné, seigneur de Bourgneuf-en-Retz, seigneur de l'île de Bouin, seigneur de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, seigneur de Pornic, seigneur de Princé en Chéméré, seigneur de Vue, seigneur de Tiffauges, seigneur de Pouzauges, seigneur de Champtocé-sur-Loire, seigneur d'Ingrandes,il appartient à la maison de Montmorency-Laval, Maison de Laval, la maison de Montmorency
Durant la guerre de Cent Ans, il se range dans le camp du roi Charles VII de France et du grand chambellan Georges Ier de La Trémoille, son propre cousin et allié. Gilles de Rais est ainsi amené à combattre les Anglais aux côtés de Jeanne d'Arc, campagnes militaires au cours desquelles il est promu maréchal de France le jour du sacre royal de Reims 17 juillet 1429.
Après la mort de son grand-père Jean de Craon en 1432 et la disgrâce de son cousin Georges de La Trémoille en 1433, le maréchal de Rais se retire de la vie militaire. Il se voit accusé par sa famille, et notamment par son frère cadet René de La Suze, de dilapider son patrimoine en aliénant ses terres au plus offrant afin de pallier ses fastueuses dépenses.
En octobre 1440, Gilles de Rais est condamné dans le duché de Bretagne par un tribunal ecclésiastique pour hérésie, sodomie et meurtres de cent quarante enfants, ou plus tandis qu'une cour séculière le condamne à la pendaison et au bûcher pour s'être emparé indûment du château de Saint-Étienne-de-Mer-Morte ainsi que pour des crimes commis sur plusieurs petits enfants sans précision de leur nombre.
Postérieurement à sa mort, suivant une tradition orale attestée dès le XIXe siècle, un fréquent amalgame entre la figure historique du baron de Rais et le personnage mythique de Barbe Bleue survient dans certaines traditions folkloriques locales, des ballades, des complaintes et des contes, avant d'être exploité dans des œuvres littéraires.
Depuis la progressive reconnaissance scientifique du phénomène des tueurs en série à partir de la fin du XIXe siècle, Gilles de Rais est parfois comparé à ce type de criminel ou qualifié lui-même en ces termes.
En bref
Ancien compagnon de Jeanne d'Arc, retiré dans ses terres vers 1435 et immensément riche, il se consacra à l'alchimie et à la magie noire, qui le mena aux pires scélératesses. Accusé d'assassin d'enfants, de 140 à 300, selon les évaluations, il fut exécuté.
Arrière-petit-neveu de Du Guesclin, fils de Marie de Craon et de Guy de Laval de Blaison, Gilles de Rais appartient à l'une des plus hautes et des plus influentes familles du début du XVe siècle. Orphelin à onze ans, il est élevé par son grand-père Jean de Craon, qui ne réfrène aucune des passions de l'enfant et lui enseigne au contraire la désobéissance à l'égard de l'autorité, tant religieuse que royale. L'enfant, qui avait appris le latin jusqu'à la mort de ses parents, n'est initié ensuite qu'aux jeux de la guerre et de la chasse. Pour des raisons d'intérêt, il est fiancé deux fois, à treize et à quinze ans, mais c'est à seize ans qu'il sera uni secrètement à Catherine de Thouars, le mariage officiel avec autorisation de Rome n'ayant lieu que deux ans plus tard. En 1424, Gilles décide d'administrer tous ses biens et, à l'instigation de son cousin La Trémoille, entreprend une carrière militaire, ajoutant à sa fortune une compétence guerrière et un courage dont témoignent ses nombreuses victoires sur les Anglais. À Chinon, quand Charles VII reçoit Jeanne d'Arc, il se voit confier les troupes et part avec la Pucelle pour Orléans. Au combat décisif des Tourelles, il est près d'elle quand elle est blessée et entre dans la ville. Après d'autres victoires comme celle de Patay, c'est Gilles qui est chargé de porter à Reims le saint chrême du sacre ; ce même jour de juillet 1429, il est fait maréchal de France. Trois mois plus tard, lorsqu'elle est blessée sous les murs de Paris, c'est le sire de Rais que Jeanne veut près d'elle, mais la Pucelle doit abandonner, cependant que le roi accorde à Gilles, privilège qu'il partage seul avec Jeanne, d'ajouter à ses armes un semis de fleurs de lys.
Jusqu'en 1433, Gilles guerroie, dilapide sa fortune. À partir de la mort de son grand-père, il apparaît cependant sous cet autre jour, qui lui vaudra d'être le vrai Barbe-Bleue de la légende sans qu'on sache s'il est bien à l'origine du personnage ou s'il représente sa concrétisation dans l'esprit populaire. Désormais, et jusqu'à son arrestation, avec la complicité de serviteurs qui partagent ses passions et enlèvent les enfants, Gilles de Rais se rend coupable de très nombreux meurtres officiellement cent quarante, commis surtout sur des jeunes garçons au cours de scènes d'orgie. Entièrement adonné à sa débauche, Gilles ne néglige pas pour autant les fondations pieuses : il crée à Machecoul, pour le bien et le salut de son âme, la fondation des Saints-Innocents, dépense une fortune pour monter à Orléans, en 1435, une grande machine théâtrale en mémoire de Jeanne d'Arc. Il mène grand train et s'attache surtout à sa maison ecclésiastique, digne des plus grands. Mais, en 1437, deux squelettes ayant été découverts dans son château, une rumeur naît que les petits n'osent amplifier et que les grands écoutent peu : sans être inquiété, Gilles installe près de lui François Prelati et commence à Tiffauges, en Vendée, des évocations de Satan... qui ne lui répond d'ailleurs jamais, même quand il lui offre dans un verre le cœur et le sang d'un enfant. Toujours homme d'armes, Gilles confie une partie de ses hommes à Jeanne d'Arc ressuscitée, la dame des Armoises, mais ce n'est qu'un intermède dans sa vie partagée entre le meurtre, l'appel de Satan et le désir d'aller pleurer en Terre sainte pour la rémission de ses péchés. En mars 1440, il se confesse, communie au milieu des paysans, mais les crimes continuent.
Cependant, l'évêque de Nantes ayant secrètement mené une enquête, Gilles est arrêté le 15 septembre 1440 ; il est accusé de crime et de sodomie sur des enfants, d'évocation des démons, de violation de l'immunité ecclésiastique. Après un temps de silence, et pour éviter la torture à moins que ce ne fût aussi chez ce monstre qui se voulut jusqu'à sa mort bon chrétien et dévot la preuve d'un remords sincère, d'un souci du salut de son âme, Gilles passe aux aveux : il reconnaît tous les méfaits qui lui sont reprochés, donnant, avec ses complices, les plus horribles détails sur ses pratiques, implorant le pardon de ses juges et exhortant le peuple à vénérer notre Sainte Mère l'Église.
Le 23 octobre, ses complices Henriet et Poitou sont condamnés à mort ; le 25, la cour ecclésiastique excommunie Gilles pour apostasie hérétique ... évocation des démons ... crime et vice contre nature avec des enfants de l'un et de l'autre sexe selon la pratique sodomite. À genoux, avec des soupirs et des gémissements, Gilles demande à être réincorporé dans l'Église et se confesse. Il est ensuite remis à la cour séculière, qui le condamne à verser une amende de 50 000 écus d'or, puis à être pendu et brûlé, le lendemain même. Après la procession demandée par Gilles et suivie par une foule immense qui prie pour son âme, il est pendu, livré aux flammes, mais son corps est retiré du brasier à temps pour qu'il puisse reposer en terre chrétienne. Sa dépouille est portée et ensevelie par quatre ou cinq dames ou demoiselles de grand état dans l'église de Notre-Dame-du-Carmel de Nantes. Trois siècles plus tard, lors du pillage de l'église par les révolutionnaires, le corps de Barbe-Bleue disparaîtra. Au reste, Gilles de Rais dut sa gloire durable à l'excès de ses crimes.
Sa vie
Ascendance de Gilles de Rais
En 1371, la maison de Rais s'éteint à la mort de Girard V Chabot. Sa sœur Jeanne Chabot la Sage † 1407 recueille son héritage, convoité par le duc Jean IV de Bretagne. Le roi Charles V confie alors la garde du pays de la dame de Rays à un proche parent de Jeanne, Guy Brumor de Montmorency-Laval † après 1375. Nonobstant, le duc de Bretagne exige de Jeanne Chabot qu'elle lui cède ses biens puis, devant le refus de celle-ci, la séquestre et fait occuper militairement les places fortes de la baronnie de Rais, notamment le château de Machecoul. Ces violences occasionnent de longues procédures judiciaires jusqu'au décès de Jean IV le 1er novembre 1399.
Le 29 septembre 1401, Jeanne Chabot, restée sans enfant et désireuse de régler sa succession, désigne comme son héritier le fils de Guy Brumor, Guy II de Montmorency-Laval † 1415, à la condition que ce dernier relève le nom et les armes de Rais.
Jean de Craon vers 1355 - 25 novembre 1432, seigneur de La Suze-sur-Sarthe et de Champtocé, sieur des Jamonières s'oppose judiciairement à cette dévolution mais les deux parties parviennent finalement à un compromis, scellant leur entente par un projet de mariage entre Guy de Laval et la fille de Jean de Craon, Marie † avant octobre 1415. Deux actes datés des 5 et 17 février 1404 précisent notamment les conditions du mariage, subordonnant celui-ci à l'approbation préalable de l'accord par le parlement de Paris. Les 24 et 25 avril 1404, Jean de Craon et Guy de Laval constituent à cet effet des procureurs chargés de soumettre leur convention à la cour souveraine, qui homologue l'accord le 2 mai 1404. Enfin, Jeanne Chabot la Sage cède quatre seigneuries à Guy de Laval, moyennant une rente viagère, le 24 juillet 1404. Guy de Laval et Marie de Craon s'unissent vraisemblablement à une date postérieure.
Guy de Laval devient conséquemment le nouveau baron de Retz, prenant le nom de Guy II de Laval-Rais, doyen des barons de Bretagne, titre dont héritera son fils aîné Gilles. Guy II de Montmorency-Laval hérite des seigneuries de Machecoul, de La Bénate, du Coutumier, de Bourgneuf, de Bouin, de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, de Pornic, de Princé, de Vue, etc., qui forment la baronnie de Rais, correspondant peu ou prou à l'actuel Pays de Retz.
Gilles de Rais est aussi un arrière-petit-neveu du connétable de France Bertrand Du Guesclin 1320-1380, héros breton de la Guerre de Cent Ans.
Ascendance de Gilles de Rais
Descendant des maisons de Montmorency-Laval, Craon et Retz, Gilles de Rais naît en une chambre appelée la Tour Noire au château de Champtocé, à une date inconnue. Sa naissance a été située de manière variable entre 1396 et 1406, et plus fréquemment vers la fin de l'année 1404. Toutefois, le futur baron voit vraisemblablement le jour au plus tôt en 1405 en raison des délais occasionnés par les procédures juridiques qui conditionnèrent le mariage de ses parents.
Gilles a un frère cadet : René de Montmorency-Laval, dit René de La Suze vers 1407 - 30 octobre 1473, qui succèdera à son frère comme baron de Retz sous le nom de René de Rais .
À la suite de la mort de leur mère Marie de Craon à une date inconnue puis de leur père Guy II de Laval-Rais fin octobre 1415 à Machecoul, le jeune Gilles et son frère cadet René sont élevés par leur grand-père maternel, Jean de Craon, seigneur de La Suze et de Champtocé. Dans son testament, Guy II de Laval-Rais désignait pourtant son beau-frère, Jean II Tournemine de la Hunaudaye, comme gardien, tuteur, protecteur, défenseur et administrateur légitime de ses deux fils.
Projets matrimoniaux
Le 14 janvier 1417, Jean de Craon fiance son petit-fils Gilles, 12 ans, à une riche héritière de Normandie, Jeanne Paynel, fille de Foulques IV Paynel, seigneur de Hambye et de Bricquebec. Toutefois, le Parlement de Paris interdit le mariage jusqu'à ce que Jeanne Paynel ait atteint sa majorité. Ce projet matrimonial n'aboutit pas.
Le 28 novembre 1419, le seigneur de La Suze fiance le jeune baron à Béatrice de Rohan, fille d'Alain IX de Rohan et de Marguerite de Bretagne, et nièce du duc Jean V de Bretagne. Le contrat, daté de Vannes, n'a pas de suite pour une raison indéterminée.
Gilles de Rais finit par se fiancer avec sa cousine Catherine de Thouars, fille de Miles II de Thouars et de Béatrice de Montjean. Outre l'obstacle posé par la consanguinité de Gilles et Catherine, des litiges opposent alors la maison de Craon à Miles II de Thouars, seigneur de Pouzauges et de Tiffauges. Négligeant ces contraintes et sans attendre de dispense ecclésiastique, Gilles enlève Catherinenote 12 puis l'épouse dans une chapelle sise en dehors de son église paroissiale, sans publier de bans. En dépit d'un contrat de mariage établi le 30 novembre 1420, les deux jeunes gens voient leur union annulée et déclarée incestueuse par l'Église.
À la suite du décès de Miles II de Thouars, des alliances matrimoniales finissent par rapprocher les maisons de Craon et de Thouars, contribuant ainsi à régulariser la situation de Gilles de Rais et Catherine de Thouars. Le 24 avril 1422, le légat pontifical s'adresse à Hardouin de Bueil, évêque d'Angers, afin que ce dernier prononce une sentence de séparation à l'encontre de Gilles et Catherine, leur impose une pénitence avant de les absoudre du crime d'inceste et de permettre leur mariage en bonne et due forme. Après avoir diligenté une enquête, Hardouin de Bueil marie en grande pompe Gilles et Catherine le 26 juin 1422 au château de Chalonnes-sur-Loire.
Catherine donne à Gilles de Rais une fille unique, Marie de Rais 1429-1457, qui se mariera à l'amiral Prigent de Coëtivy puis au maréchal André de Lohéac, et qui succèdera à son père en tant que baronne de Retz.
Conflits familiaux
Conformément aux clauses du contrat de mariage de sa fille Catherine de Thouars, Béatrice de Montjean conserve en douaire un certain nombre de possessions de feu Miles II de Thouars, dont les châteaux de Tiffauges et Pouzauges. Jean de Craon et Gilles de Rais escomptent récupérer ultérieurement l'héritage constitué par l'ensemble des châteaux poitevins de Béatrice.
Cependant, Béatrice de Montjean se remarie avec Jacques Meschin de la Roche-Aireault, chambellan du roi Charles VII, ce qui compromet les projets du seigneur de La Suze et de son petit-fils. Les deux compères chargent alors leur acolyte Jean de la Noe ou la Noue, capitaine de Tiffauges, d'enlever Béatrice. Jean de la Noe profite de l'occasion pour s'emparer également de la sœur cadette de Jacques Meschin.
Béatrice de Montjean est emprisonnée au Loroux-Bottereau, puis à Champtocé. Son beau-fils Gilles de Rais et Jean de Craon menacent de la coudre dans un sac avant de la jeter dans une rivière si elle ne renonce pas à son douaire.
Afin de libérer sa femme et sa sœur, le chambellan Jacques Meschin de la Roche-Aireault fait assigner Jean de Craon et Gilles de Rais à plusieurs reprises devant le parlement de Paris, en pure perte. Jacques Meschin dépêche un huissier à Champtocé avant d'y déléguer son propre frère, Gilles Meschin, placé à la tête de ses envoyés. Jean de Craon jette en prison tous les porteurs de l'assignation, Gilles Meschin inclus, puis consent à relâcher Béatrice de Montjean. Les otages finissent par être libérés moyennant rançon mais Gilles Meschin meurt quelques jours plus tard, probablement éprouvé par les conditions de sa détention champtocéenne. La sœur cadette de Jacques Meschin, envoyée en Bretagne, est contrainte d'épouser Girard de la Noe, le fils du capitaine de Tiffauge.
Poursuivis judiciairement devant le parlement de Paris par le chambellan, Jean de Craon et Gilles de Rais n'en parviennent pas moins à lui extorquer tour à tour Tiffauges et Pouzauges, molestant au passage Adam de Cambrai, le premier président du parlement lui-même. Les multiples condamnations qui frappent les deux complices ne sont pas suivies d'effets.
Titres et patrimoine
Armorial des Montmorency. Armes des Montmorency-Laval Blasonnement :
D'or, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'argent, et cantonnée de seize alérions d'azur ; au franc-canton d'argent au lion de gueules.
Commentaires : Il s'agit des armes de la branche des seigneurs de Challouyau de famille de Montmorency-Laval, dont faisait partie Guy II de Laval-Rais, le père de Gilles de Rais.
Armes de Retz Blasonnement :
D'or à la croix de sable. Armes de la baronnie de Retz, que Guy II de Laval-Rais a repris lorsqu'il est devenu baron de Retz.
Armes personnelles de Gilles de Rais à partir de septembre 1429 Blasonnement :
D'or à la croix de sable qui est de Retz, à la bordure d'azur semé de fleurs de lis d'or qui est de France.
En septembre 1429, Charles VII honore Gilles de Rais pour services rendus lors de la guerre de Cent Ans, en lui octroyant le privilège d'ajouter une bordure de France au blason de la baronnie de Retz.
Carrière militaire Premières armes
Le 13 février 1420, le duc Jean V de Bretagne est enfermé à Champtoceaux par les Penthièvre, ses ennemis. Jean de Craon prend le parti du duc dans le cadre des querelles résiduelles de la guerre de succession de Bretagne entre les Montfort et les Penthièvre. Les bandes de ces derniers assaillent les fiefs du seigneur de La Suze et de son petit-fils Gilles de Rais.
Une fois le parti des Penthièvre vaincu, Jean V de Bretagne est libéré. Rentré triomphalement à Nantes, le duc dédommage de leurs pertes et récompense Jean de Craon ainsi que son fils de Rays. Celui-ci accomplit sans doute ses premiers faits d'armes en prenant une part active dans cette guerre féodale.
En mai 1420, le roi Henri V d'Angleterre devient l'héritier du roi Charles VI de France par le traité de Troyes. Jean V de Bretagne reconnaît Henri V, avant de louvoyer entre les couronnes de France et d'Angleterre afin de préserver l'indépendance de son duché.
En tant que vassaux du duc Louis III d'Anjou, Jean de Craon et Gilles de Rais prennent peut-être part à la bataille de la Gravelle le 26 septembre 1423, puis à la bataille de Verneuil le 17 août 1424.
Rapprochement avec le roi Charles VII
À partir de 1423, Yolande d'Aragon, dirigeante de la maison d'Anjou et belle-mère du roi Charles VII, œuvre de concert avec son conseiller Jean de Craon au rapprochement de la France et de la Bretagne. En mars 1425, cette politique promeut Arthur de Richemont, frère cadet du duc Jean V de Bretagne, à la dignité de connétable de France.
Courant juillet 1425, Charles VII envoie Jean de Craon et d'autres ambassadeurs auprès du duc de Bretagne afin de l'informer officiellement du renvoi des conseillers royaux impliqués dans le complot des Penthièvre. Après avoir consulté ses États, Jean V accepte de rencontrer son suzerain sur la rivière de Loire, entre Angers et Tours. En septembre 1425, accompagné par de nombreux seigneurs dont Gilles de Rais, le duc se rend à Saumur. Flanqué du connétable de Richemont, Charles VII parvient à son tour dans cette ville afin d'y signer un traité d'alliance avec Jean V, le 7 octobre 1425, en présence de la duchesse douairière d'Anjou.
Selon certains auteurs, Gilles de Rais rencontre le roi de France pour la première fois à l'occasion des fêtes et conciliabules saumurois. Cependant, le jeune baron est gratifié d'un don royal de 200 livres dès le 16 janvier 1425. Il paraît donc probablement à la cour de Charles VII avant la signature du traité de Saumur.
Campagne en pays manceau contre les Anglais
Le 19 juin 1427, Yolande d'Aragon établit Jean de Craon lieutenant général en Anjou et dans le Maine. Cette dignité permet probablement au seigneur de La Suze de favoriser l'ascendant à la cour royale de Georges Ier de La Trémoille, cousin de Gilles de Rais par la branche des Craon.
Le lieutenant général dote alors son petit-fils d'un mentor militaire en la personne de Guillaume de la Jumellière, seigneur de Martigné-Briant, également conseiller de Yolande d'Aragon à la cour ducale d'Anjou. L'influence curiale de sa famille engage Gilles dans la lutte contre les Anglais, entraînant la nomination du jeune baron comme capitaine de la place de Sablé au nom du duc d'Anjou.
Menant campagne dans le comté du Maine en compagnie de son parent Jacques de Dinan, seigneur de Beaumanoir et du chevalier Ambroise de Loré, Gilles de Rais reprend aux Anglais la forteresse de Rennefort, anciennement Rainefort, Ramefort, Ramessort et le château de Malicorne-sur-Sarthe. Les capitaines respectent leur promesse d'épargner les garnisons anglaises qui ont rendu ces places fortes, mais font pendre les hommes de la langue française qu'ils y trouvent, possible manifestation d'un fort sentiment national à l'encontre des combattants considérés comme des Français reniés.
Par la suite, les seigneurs de Rais, de Loré et de Beaumanoir emportent d'assaut le château du Lude. Le commandant de la garnison, un capitaine anglais dénommé Blackburn, est tué ou fait prisonnier.
En juin 1427, le grand chambellan La Trémoïlle domine le conseil royal, et en éloigne le connétable Arthur de Richemont, tombé en disgrâce suite à ses revers militaires face aux Anglais.
Peu de temps après, le duc Jean V de Bretagne, lui-même en butte aux assauts anglais, procède à un nouveau revirement d'alliance en reconnaissant le traité de Troyes le 8 septembre 1427 et en ordonnant à ses vassaux de cesser la lutte contre les troupes du duc de Bedford. Gilles de Rais est l'un des plus notables seigneurs bretons à désobéir à son suzerain en demeurant fidèle au roi de France. Il participe en 1428 à la rançon fournie par libérer André de Lohéac avec plusieurs membres de la famille de Laval.
Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc
Le 6 mars 1429, Gilles de Rais est présent à la cour de Chinon lorsque Jeanne d'Arc arrive de Vaucouleurs. Un mois plus tard, par lettre datée du 8 avril 1429, signée de sa main et munie de son sceau, le jeune baron noue une alliance avec son cousin Georges de La Trémoille, s'engageant à le servir de toute sa puissance jusques à mort et à vie, envers tous et contre tous seigneurs et autres, sans nul excepté..., dans la bonne grâce et amour du roi.
Gilles est un des principaux capitaines qui aident Jeanne d'Arc à faire entrer des vivres dans Orléans et contribuent à la levée du siège de la ville par les Anglais65. Conjointement à d'autres chevaliers, écuyers et gens de guerre, il accompagne la Pucelle lorsque celle-ci rend compte au roi de la levée du siège.
Le sacre de Charles VII à Reims.
Le baron participe ensuite avec Jeanne à la campagne de la Loire, qui vise la reconquête des villes occupées par les Anglais dans la région. Il est ainsi présent à la prise de Jargeau le 12 juin 1429 puis à la victoire de Patay le 18 juin 1429.
Durant le trajet menant le gentil dauphin à Reims afin qu'il y soit sacré roi de France, l'armée - commandée à l'avant-garde par Gilles de Rais et Jean de Brosse, maréchal de Broussac - réduit à l'obéissance Troyes ainsi que d'autres villes et de nombreux châteaux. Le 17 juillet 1429, lors du sacre royal, Gilles est chargé avec trois autres seigneurs d'apporter la sainte ampoule de la basilique Saint-Remi de Reims à l'église métropolitaine. Ce même jour, le jeune baron de Rais est élevé à la dignité de maréchal de France.
Le lundi 15 août 1429, les troupes royales et anglo-bourguignonnes se font face à Montépilloy. Charles VII confie les ailes de son armée à ses deux maréchaux, Jean de Boussac et Gilles de Rais.
Le 8 septembre 1429, lors du siège de Paris, Jeanne d'Arc souhaite avoir le maréchal de Rais et Raoul de Gaucourt à ses côtés lors de l'assaut donné à la porte Saint-Honoré. Gilles se tient toute la journée auprès de la Pucelle, parmi de nombreux gens d'armes, tentant en vain d'atteindre et de franchir l'enceinte parisienne depuis un arrière-fossé. À la tombée du jour, Jeanne est blessée à la jambe par un vireton d'arbalète. Le siège de Paris est rapidement levé, l'armée royale - dite armée du sacre - se replie vers la Loire avant d'être licenciée à Gien le 21 septembre 1429.
En septembre 1429, le roi honore derechef Gilles pour ses recommandables services en lui octroyant le privilège d'ajouter à son blason une bordure aux armes de France, fleurs de liz d'or semées sur champ d'azur.
Campagnes post-johanniques
Gilles de Rais se signale, en 1430, à la prise de Melun et à la bataille d'Anthon le 11 juin. L'année suivante, il contribue à la levée du siège de Lagny-sur-Marne par les Anglais.
En 1434, il commande avec le maréchal Pierre de Rieux l'avant-garde de l'armée française, sous les ordres du connétable de Richemont. Cette armée étant arrivée devant Sillé-le-Guillaume dans le Maine en présence des Anglais, les deux partis se séparent sans combattre.
Dilapidation du patrimoine
Gilles de Rais a une garde de deux cents hommes à cheval, dépense que les plus grands princes peuvent à peine soutenir dans ce temps-là, et il traîne en outre à sa suite plus de cinquante individus, chapelains, enfants de chœur, musiciens, pages et serviteurs. Sa chapelle est tapissée de drap d'or et de soie. Les ornements, les vases sacrés sont d'or et enrichis de pierreries. Il a aussi un jeu d'orgues qu'il fait toujours porter devant lui. Ses chapelains, habillés d'écarlate doublé de menu vair et de petit gris, portent les titres de doyen, de chantre, d'archidiacre, et même d'évêque, et il a de plus député au pape pour obtenir la permission de se faire précéder par un porte-croix. Il donne à grands frais des représentations de mystères.
Mais tout cela occasionne des frais énormes qui l'obligent, en 1434, à vendre au duc Jean V de Bretagne les places de Mauléon, de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, du Loroux-Bottereau, de Pornic et de Champtocé-sur-Loire.
Pour se livrer à ses profusions, Gilles de Rais aliène une partie de ses terres. Parmi les acheteurs, on compte les bourgeois d'Angers et les manieurs d'argent de la cour bretonne, l'évêque-chancelier Jean de Malestroit et Geoffroy Le Ferron, futur trésorier général.
Les difficultés financières du baron de Retz prennent un tour dramatique. Face à cela, sa famille, son frère cadet René de La Suze en tête lui intente un procès afin d'interdire à quiconque d'acheter des terres lui appartenant81. Elle obtient un arrêt du parlement de Paris qui défend au maréchal d'aliéner ses domaines. Le roi ne voulant pas approuver les ventes déjà faites, le duc Jean V de Bretagne s'oppose à la publication de ces défenses et refuse d'en donner de semblables dans ses États.
René de La Suze, frère de Gilles, et ses cousins André de Lohéac et Guy XIV de Laval, irrités de ce refus, s'efforcent de conserver ces places dans leur famille et résistent au duc Jean V ; mais ce dernier les reprend et enlève à son gendre Guy XIV de Laval, cousin de Gilles, la lieutenance générale de Bretagne pour la confier à Gilles de Rais lui-même, avec lequel il consomme tous ses marchés en 1437.
Crimes Coup de force de Saint-Étienne-de-Mer-Morte
En 1434, Gilles de Rais confie la châtellenie de Saint-Étienne-de-Mer-Morte à son frère René de la Suze. Se ravisant, le maréchal récupère le château par un coup de force puis s'accorde avec son cadet à Nantes le 15 janvier 1439 afin de conserver son bien.
Gilles aliène de nouveau cette terre à la suite d'une transaction avec Geoffroy Le Ferron, trésorier et homme de confiance du duc Jean V de Bretagne. L'officier ducal confie l'administration de la châtellenie à son frère Jean Le Ferron, clerc tonsuré. Le baron tente derechef de se réapproprier le château afin de le revendre à son cousin, le sire de Vieillevigne, mais Jean Le Ferron s'y oppose.
En représailles, le jour de la Pentecôte ou au lendemain de cette fête religieuse, le 15 ou le 16 mai 1440, Gilles de Rais place en embuscade une troupe de cinquante à soixante hommes dans un bois voisin de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Le maréchal pénètre en armes dans l'église paroissiale et interrompt la grand-messe de l'officiant Jean Le Ferron, injuriant ce dernier et menaçant de le tuer avec une guisarme s'il ne sort pas du sanctuaire. Effrayé, le clerc tonsuré s'exécute en emboîtant le pas du marquis Lenano de Ceva, capitaine piémontais au service de Gilles. Après avoir ouvert les portes du château de Saint-Étienne-de-Mer-Morte à ses agresseurs, Jean Le Ferron y est incarcéré avec un receveur et Jean Rousseau, sergent général du duché de Bretagne.
De la sorte, Gilles de Rais porte simultanément atteinte aux majestés ducale et divine. En violant les immunités ecclésiastiques, il commet un sacrilège et encourt l'excommunication88. Qui plus est, l'église de Saint-Étienne-de-Mer-Morte se situe dans le diocèse de l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, chancelier du duc Jean V de Bretagne.
Le duc breton condamne son vassal à rendre la place forte à Jean Le Ferron sous peine d'avoir à payer une amende de 50.000 écus d'or89. Gilles de Rais fait alors conduire son prisonnier à Tiffauges, en Poitou, hors de la juridiction bretonne.
En juillet 1440, le baron de Rais se rend à Josselin afin d'y rencontrer son suzerain Jean V de Bretagne mais la teneur de leurs propos demeure inconnue.
Enquêtes ecclésiastique et séculière
Probablement peu de temps après l'attentat de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, une enquête secrète est lancée sur les rumeurs qui courent à l'encontre de Gilles de Rais. Le 29 juillet 1440, les résultats de l'enquête ecclésiastique sont publiés sous forme de lettres patentes par l'évêque Jean de Malestroit : Rais est accusé par la rumeur publique de viols et meurtres commis sur de nombreux enfants ainsi que d'évocations et pactes démoniaques. Parallèlement, l'enquête de la justice séculière procède à l'audition des mêmes témoins.
Le 24 août 1440, le duc Jean V de Bretagne s'entretient à Vannes avec son frère, le connétable de France Arthur de Richemont. Compromis dans la Praguerie contre le roi Charles VII au printemps 1440, Jean V souhaite obtenir de Richemont, grand officier royal, une promesse d'assistance mutuelle. Pour ce faire, le duc octroie notamment au connétable la terre de Bourgneuf-en-Retz, bien de Gilles de Rais. Richemont retourne ensuite dans le domaine royal et s'empare de Tiffauges, libérant l'otage Jean Le Ferron.
Le 13 septembre 1440, Gilles de Rais est cité à comparaître devant le tribunal ecclésiastique de Nantes, sous les accusations de meurtres d'enfants, de sodomie, d'évocations de démons, d'offense à la Majesté divine et d'hérésie .
Le 15 septembre 1440, le baron est arrêté en son château de Machecoul par Jean Labbé, capitaine d'armes au service du duc de Bretagne. Deux des gens de Gilles de Rais sont également arrêtés, Henriet et Étienne Corillaut dit Poitou ou Pontou. Certains de ses complices, dont Gilles de Sillé et Roger de Briqueville, ont déjà pris la fuite.
S'ouvre alors l'instruction du procès civil qui va être l'instrument de sa chute. Le maréchal est emprisonné dans le château de Nantes tandis que le duc de Bretagne charge son commissaire, Jean de Toucherond, de commencer une enquête.
Procès Premières audiences
Suite à son arrestation le 15 septembre 1440, Gilles de Rais comparaît à une date inconnue devant la cour séculière de Nantes, présidée par Pierre de l'Hôpital, président et juge universel de Bretagne, grand officier du duc Jean V. Le baron doit répondre des chefs d'accusation relatifs aux assassinats d'enfants et à l'attentat de l'église de Saint-Étienne-de-Mer-Morte suivi de l'occupation du château du même lieu. Cependant, la relation officieuse de cette première audience ne mentionne que la réponse de Gilles aux juges civils à propos de l'affaire de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, sans aucune référence aux meurtres96. Le 18 septembre, le clerc Jean de Touscheronde, commis par le duc, commence à recueillir les témoignages des parents des enfants disparus.
Le 19 septembre 1440, dans la grande salle supérieure du château de la Tour Neuve, Gilles de Rais comparaît pour la première fois devant la cour ecclésiastique présidée par Jean de Malestroit, tout à la fois évêque de Nantes, président de la Chambre des comptes de Bretagne et chancelier du duc Jean V. Cette dernière charge fait de Malestroit le supérieur hiérarchique de toute l'administration judiciaire, y compris celui de Pierre de L'Hôpital, président et juge universel.
Le promoteur procureur aux causes de la foi Guillaume Chapeillon accuse le baron d'avoir commis l' hérésie doctrinale et l'assigne donc à comparaître le 28 du mois devant le représentant de l'Inquisition pour la ville et le diocèse de Nantes : le dominicain Jean Blouyn, vicaire de l'inquisiteur du royaume de France Guillaume Merici.
Gilles de Rais consent à comparaître devant ses deux juges, l'évêque-chancelier et le vice-inquisiteur, à la date convenue par le tribunal de l'Église. À l'instar de la cour séculière, la cour ecclésiastique n'évoque apparemment pas les chefs d'accusation relatifs aux meurtres d'enfants au cours de cette première audience.
Témoignages des parents
La cour ecclésiastique consacre finalement la séance du 28 septembre 1440 à l'audition de dix plaignants hors de la présence de Gilles de Rais, la comparution du baron étant ajournée au 8 octobre. Parallèlement, du 27 septembre au 8 octobre, Jean de Touscheronde entend de nombreux parents d'enfants disparus dans le cadre de l'enquête civile.
Accumulation des charges
Le samedi 8 octobre 1440, dans la salle basse du château de la Tour Neuve, les dix plaignants de la séance du 28 septembre sont entendus derechef par la cour ecclésiastique.
Le même jour, dans une grande salle supérieure du château, le seigneur de Tiffauges comparaît de nouveau devant cette même cour, composée cette fois de l'évêque Malestroit et de l'inquisiteur dominicain Jean Blouyn, assistés de notaires publics et de scribes. Le président de Bretagne Pierre de l'Hôpital, responsable de la cour séculière, est également présent.
Le promoteur aux causes de la foi Guillaume Chapeillon expose oralement les articles de l'accusation, dévoilant l'ensemble des délits et crimes reprochés à Gilles de Rais. Ce dernier en appelle alors de ses juges mais Jean de Malestroit et le frère Blouyn rejettent aussitôt l'appel, considéré comme frivole. Le baron nie la vérité desdits articles et conteste qu'il y ait matière à procès, tout en s'affirmant comme vrai chrétien. Le promoteur jure de dire la vérité puis il prie Gilles de prêter le même serment, en vain. Malestroit et Blouyn somment Gilles de jurer, le menaçant d'excommunication, mais l'accusé persiste dans son refus et ses dénégations. En réaction, l'évêque de Nantes et le vicaire de l'inquisiteur assignent le promoteur Guillaume Chapeillon et le maréchal de Rais à comparaître le mardi 11 octobre.
Gilles de Rais s'emporte et se révolte, ce qui entraîne en réaction son excommunication par l'évêque qui préside le procès. Cette excommunication l'effraie, et il se résout alors à faire des aveux en échange de la levée de cette sanction, ce qui lui est accordé. Certains auteurs y voient une preuve de sa foi en l'Église et dans le jugement de Dieu.
Sa première confession, dite confession hors jugement est prononcée volontairement, librement et douloureusement le 21 octobre 1440 dans la chambre haute du château nantais de la Tour Neuve, où il est emprisonné L'accusé répète, en l'assortissant de nouvelles précisions, cette confession à l'audience du 22 octobre.
Alchimie et évocations diaboliques
Afin de pallier ses dépenses, Gilles de Rais s'adonne à l'alchimie en vue de trouver la pierre philosophale. Il envoie quérir dans le royaume de France et à l'étranger des maistres qui se entremetoient de l'art d'arquemie .
En 1438, Eustache Blanchet, prêtre au service de Gilles de Rais, recrute ainsi à Florence le clerc toscan Francesco François Prelati, originaire de Montecatini Terme près de Pistoia108. Outre les expériences alchimiques, Prelati déclare avoir tenté d'invoquer les démons à Tiffauges en présence de Gilles de Rais.
Jugement et exécution de la peine
Le jugement est prononcé le 25 octobre au château du Bouffay par le tribunal présidé par le juge universel de Bretagne, Pierre de l'Hôpital. Gilles de Rais a été excommunié pour apostasie hérétique ... évocation des démons ... crime et vice contre nature avec des enfants de l'un et de l'autre sexe selon la pratique sodomite. La sentence de la cour ecclésiastique reproche à Gilles de Rais cent quarante meurtres ou plus tandis que la sentence de la cour séculière n'arrête pas de chiffre exact. Gilles de Rais et ses deux valets sont condamnés à être pendus, puis brûlés. À sa demande, le tribunal lui accorde trois faveurs : le jour de l'exécution, les familles des victimes pourront organiser une procession, il sera exécuté avant ses complices et son corps ne sera pas entièrement brûlé pour être inhumé.
Le lendemain matin, le mercredi 26 octobre 1440, après une messe à la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, l'exécution est accomplie en prairie de Biesse. Tandis que ses valets, Poitou et Henriet, sont laissés sur le bûcher, le corps de Gilles de Rais en est retiré, avant d'être trop abîmé par les flammes.
Conformément à la requête qu'il avait formulée et qu'on lui avait accordée avant son exécution, son corps est enseveli dans l'église du couvent des Carmes, à Nantes. Ce couvent et le monument funéraire dédié à sa mémoire seront détruits durant la Révolution française, et son corps sans doute jeté dans la Loire.
Construit sur le lieu du supplice afin d'en commémorer le souvenir, un monument expiatoire - croix de pierre ou calvaire - devient un lieu de pèlerinage pour femmes enceintes. Les vestiges de ce petit monument dit de Notre-Dame-de-Crée-Lait sont actuellement conservés au musée archéologique de Nantes.
Sort des acolytes Francesco Prelati et Eustache Blanchet
Condamné à la prison perpétuelle, Francesco Prelati réussit probablement à s'évader puis trouve refuge à la cour du duc René d'Anjou, hors de la juridiction du duc de Bretagne. Par des tours de prestidigitateur, le jeune clerc parvient à valoriser ses soi-disant talents d'alchimiste auprès du bon roi de Sicile, qui le nomme capitaine du château de La Roche-sur-Yon. Adoptant désormais l'identité de François de Montcatin, d'après le nom francisé de sa commune natale, l'aventurier toscan profite de sa nouvelle position pour assouvir sa vengeance sur Geoffroy Le Ferron, devenu entretemps trésorier de France.
Ce dernier, se rendant à Taillebourg auprès de l'amiral Prigent de Coëtivy, est de passage à La Roche-sur-Yon le 7 décembre 1444. Invité au château par le capitaine-alchimiste, Le Ferron y est injurié par le prêtre Eustache Blanchet avant d'être emprisonné arbitrairement sur ordre de Prelati, qui lui reproche sa propre incarcération nantaise du temps du procès de Gilles de Rais. Afin d'extorquer une énorme rançon au trésorier, les deux anciens serviteurs du maréchal lui font subir de mauvais traitements durant deux mois et demi. Entre autres tortures morales et physiques, Francesco Prelati et Eustache Blanchet tentent d'effrayer Le Ferron en feignant de découvrir parmi ses papiers une lettre factice qui le compromet dans une trahison imaginaire de Prigent de Coëtivy.
Informés de la situation, des officiers de René d'Anjou demandent à Prelati d'amener Le Ferron devant le conseil ducal. Le capitaine fait mine d'obtempérer avant de reconduire le trésorier de France dans son cachot. Douze jours plus tard, le chevalier Guy d'Aussigny, seigneur de Trèves et lieutenant du roi ès pays de Poitou, Saintonge, gouvernement de La Rochelle et Angoumois, se présente avec une compagnie de cinquante hommes de guerre devant la forteresse yonnaise. Refusant de délivrer Geoffroy Le Ferron, Francesco Prelati s'oppose à la reddition de la place et effectue une sortie avec sa propre troupe, accrochage qui provoque la mort d'un soldat de Guy d'Aussigny.
Peu après, deux officiers de René d'Anjou essayent derechef d'obtenir de Francesco Prelati qu'il leur livre Geoffroy Le Ferron. Le capitaine italien finit par y consentir après versement de la rançon du trésorier de France. Ce dernier est transféré à Angers, où il dépose vainement une plainte auprès de la chambre des comptes d'Anjou. Le Ferron parvient à être conduit sous escorte auprès du roi René d'Anjou à Nancy mais il demeure un temps en détention dans cette ville, où séjourne alors le roi de France. Charles VII a finalement vent de l'affaire ; le parlement de Paris est saisi puis le conseil royal rend un arrêt condamnant à mort Francesco Prelati et Jacques Chabot, son principal complice. Vers la fin de mars 1446 ou au début du mois suivant, l'ex-évocateur de démons subit le supplice du feu pour ses crimes.
Renvoyé devant la cour du parlement avec plusieurs autres comparses de Prelati, Eustache Blanchet fait constamment défaut de janvier 1448 à mars 1451. Le 18 mai 1453, le parlement rend son arrêt définitif, condamnant le prêtre et ses acolytes à restituer les biens de Geoffroy Le Ferron, à faire amende honorable au roi et au trésorier de France, au paiement d'une amende ainsi qu'au bannissement perpétuel et à la confiscation de leurs biens.
Roger de Briqueville.
Descendance et postérité
De son épouse Catherine de Thouars 1405-02/12/1462, Gilles de Rais ne laisse qu'une fille dont la paternité serait par ailleurs contestée : Marie de Montmorency-Laval dite Marie de Rais 1429-01/11/1457, qui lui succédera à la tête de la baronnie de Retz.
Sa veuve Catherine de Thouars se remariera le 14 janvier 1441 avec Jean II de Vendôme, vidame de Chartres, et aura deux autres enfants : Jean de Vendôme né vers 1443 et Jacqueline de Vendôme.
Marie de Rais se mariera deux fois : le 5 juillet 1444 avec Prigent VII de Coëtivy 1399-20/07/1450, amiral de France, gouverneur de La Rochelle, puis en 1451 avec André de Montfort-Laval dit André de Lohéac 1408-29/12/1486, seigneur de Lohéac et de Montjean, amiral de France puis maréchal de France et cousin de Gilles de Rais. De ses deux unions, Marie de Rais n'aura aucun enfant..
C'est ensuite son oncle René de La Suze 1407/30/10/1473, frère cadet de Gilles de Rais, qui hérita de la baronnie de Retz, René de Rais. Marié à Anne de Champagne-au-Maine, il en aura une fille : Jeanne de Montmorency-Laval dite Jeanne de Rais, qui lui succèdera. Elle sera mariée le 13 avril 1457 à François de Chauvigny 1430-15/03/1491, vicomte de Brosse.
Par la suite, le baronnie de Retz quittera alors la famille de Montmorency-Laval pour passer à la famille de Chauvigny, André de Chauvigny, fils de François de Chauvigny et de Jeanne de Rais, puis aux familles de Tournemine, d'Annebault, de Clermont-Tonnerre, de Gondi, de Blanchefort-Créquy, de Neufville-Villeroy et de Brie-Serrant, jusqu'à la Révolution française.
Historiographie Georges Bataille
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Dans son livre Le Procès de Gilles de Rais, paru en 1959, Georges Bataille voit en Gilles de Rais la figure exemplaire d'une époque de la féodalité où la raison balbutiante n'avait pas encore muselé la fête archaïque de la violence : Sa noblesse a le sens d'une violence ne regardant rien et devant laquelle il n'est rien qui ne cède.
Matei Cazacu
La pratique de l'alchimie et de messes noires est avérée chez Gilles de Rais, on peut, selon l'historien et archiviste paléographe Matei Cazacu, relever le viol — et peut-être de l'assassinat — de huit enfants dont on connaît le nom exact de leurs parents, leurs parents témoignant lors de son procès de leur disparition.
Physionomie
Il n'existe ni description, ni portrait de Gilles de Rais réalisé de son vivant qui soit parvenu jusqu'à nous. On ignore donc à quoi il ressemblait physiquement.
Selon la traduction par Georges Bataille et Pierre Klossowski de la confession en jugement incluse dans les minutes en latin du procès, le seigneur de Tiffauges déclare qu'il a toujours été de nature délicate durant sa jeunesse. L'écrivain Michel Hérubel entend ces propos au sens de complexion physique, mais l'historien Matei Cazacu signale que la traduction de Bataille et Klossowski est quelque peu hâtive, l'adjectif delicatus pouvant également signifier mignon, recherché, luxueux, efféminé, galant, licencieux.
Descriptions littéraires
La première description du sire de Tiffauges, homme de bon entendement, belle personne et de bonne façon, apparaît tardivement dans l'Histoire de Bretaigne 1582 du juriste breton Bertrand d'Argentré. Dans le tome V de son Histoire de France 1841, Jules Michelet cite intégralement ce signalement apocryphe sans mentionner nominalement d'Argentré comme source, popularisant ainsi l'image d'un seigneur aux traits séduisants. Dans le tome II de son Histoire de Charles VII, roi de France, et de son époque, 1403-1461 1863, Auguste Vallet de Viriville modernise et enrichit de nouveaux détails imaginaires la description de Gilles de Rais selon d'Argentré : C'était un beau jeune homme, gracieux, pétulant, d'un esprit vif et enjoué, mais faible et frivole.
Dans ses récits romancés intitulés Curiosités de l'histoire de France 1858, le polygraphe Paul Lacroix alias le bibliophile Jacob affuble fictivement Gilles d'une chevelure blonde détonnant avec une barbe noire aux reflets presque bleuâtres, qui avaient fait donner au sire de Rays le surnom de Barbe Bleue, surnom populaire en Bretagne, où son histoire s'est métamorphosée en conte fantastique. Entre autres détails inventés par le bibliophile Jacob et promis à une belle fortune littéraire, cette pilosité faciale particulière et ce sobriquet prêtés au seigneur de Tiffauges assimilent ce dernier au personnage de Charles Perrault.
Iconographie
Toutes les effigies de Gilles de Rais sont posthumes et imaginaires, à l'exception probable d'une gravure publiée dans Les monumens de la monarchie françoise, qui comprennent l'histoire de France, avec les figures de chaque règne que l'injure des tems a épargnées 1731 de Dom Bernard de Montfaucon. Cette représentation équestre de Gilles de Laval Seigneur de Rais Maréchal de France pourrait reproduire un document plus ancien, remontant peut-être au xve siècle. Les traits du visage de Gilles sont dissimulés par le casque au plumet de son armure tandis que les armoiries de Laval figurent de manière visible sur son écu et le caparaçon de son cheval. Ces caractéristiques semblent rapprocher la gravure d'une représentation d'ordre héraldique plutôt que d'un portrait physique.
Par ailleurs, Gilles de Rais est représenté imberbe et les cheveux mi-longs dans deux miniatures qui dépeignent respectivement son procès et son exécution. Sur les deux miniatures figurent les armes de la famille Bouhier, d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent, et en pointe d'une tête de bœuf d'or. Le juriste et historien Jean Bouhier 1673-1746, président à mortier au parlement de Dijon, conservait des recueils de manuscrits de son grand-père, selon la pratique des collectionneurs érudits qui rassemblaient, aux XVIIe et XVIIIe siècles, des copies de procès relatifs aux crimes de lèse-majesté. Sa copie du procès civil de Gilles de Rais est ornée de la miniature représentant l'exécution du maréchal ; cette peinture, ou plutôt le recueil qui la comporte, daterait du XVIe siècle. L'autre miniature, représentant Gilles de Rais durant son procès, date du XVIIe siècle ; elle orne une copie du procès canonique, à savoir le manuscrit latin 17663 également conservé à la Bibliothèque nationale de France.
La plus célèbre vue d'artiste demeure l'huile sur toile 1835 d'Éloi Firmin Féron, commandée au peintre le 29 décembre 1834 par le gouvernement du roi Louis-Philippe Ier afin de légitimer la monarchie de Juillet en récupérant et instrumentalisant les représentations historiques de l'ancienne France. Campé sur des moellons délabrés, s'appuyant sur une hache et se détachant d'un arrière-plan encombré de chevaliers, Gilles de Rais en armure damasquinée prend place, en tant que figure militaire de la Guerre de Cent ans, dans le cortège des maréchaux de France des galeries historiques du château de Versailles. Le versant criminel du personnage y est occulté.
Par la suite, de nombreuses représentations s'inspireront de l'œuvre picturale de Féron, portraiturant le plus souvent un baron de Retz barbu, aux cheveux mi-longs bruns ou noirs. La toile de Féron ou les différentes œuvres gravées d'après celle-ci sont fréquemment reproduites en première de couverture ou hors-texte des ouvrages consacrées à Gilles de Rais.
Le neuvième art a également puisé dans les traditions littéraire et picturale relatives au sire de Rais. Par exemple, le baron correspond physiquement à la description romanesque de Paul Lacroix, amalgame entre les figures historique et mythique du personnage, dans la série de bande dessinée Jhen écrite par Jacques Martin. Le dessinateur Jean Pleyers y représente l'ogre de Tiffauges avec une barbe noire qui contraste avec des cheveux roux en conformité avec la symbolique médiévale évocatrice du Malin.
Conjectures à propos de Gilles de Rais et de Jeanne d'Arc
Le fait qu'un criminel de cette ampleur ait côtoyé Jeanne d'Arc a fasciné de nombreux auteurs, qui ont retracé les destinées à la fois parallèles et radicalement opposées » d'une sainte et d'un damné supposément proches. Pourtant, les sources d'époque ne permettent pas d'établir une quelconque relation privilégiée entre les deux compagnons d'armes.
Gilles de Rais était allié à Georges Ier de La Trémoille, traditionnellement dépeint comme un adversaire méfiant et jaloux du prestige de la Pucelle. Ainsi, le grand chambellan semble être à l'origine de l'abandon du siège de Paris le 9 septembre 1429, début du reflux de l'épopée johannique. Toutefois, certains historiens ont relevé des sources prouvant le soutien de La Trémoïlle à Jeanne d'Arc, du moins jusqu'au sacre de Charles VII1.
La présence attestée de Gilles de Rais le 26 décembre 1430 à Louviers, ville sise à sept lieues (environ 28 kilomètres) de Rouen où Jeanne d'Arc était alors détenue prisonnière, a parfois été interprétée comme une velléité de libérer la Pucelle155. Il ne s'agit que d'une hypothèse ; de surcroît, une telle tentative ne semble pas avoir eu lieu.
Le Mystère du siège d'Orléans a été régulièrement associé à Gilles de Rais par plusieurs auteurs, qui ont qualifié le baron de mécène, inspirateur ou coauteur de cette œuvre théâtrale. Le personnage du « mareschal de Rais », également dénommé « le sire de Rais ou simplement Rais, y est dépeint constamment comme un fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, à l'instar des autres capitaines entourant l'héroïne. Cependant, Rais n'y tient pas un rôle prépondérant, ses interventions représentant quantitativement assez peu dans les 20 538 vers que compte le mystère. En outre, le Mystère du siège d'Orléans ne semble ni être antérieur à 1450, ni avoir été joué sur scène.
L'épisode des relations de Gilles de Rais avec Jeanne des Armoises en 1439 demeure difficile à interpréter. Gilles confie des troupes à la fausse Jeanne mais il est impossible d'en conclure une quelconque dévotion vis-à-vis de la Pucelle, ou de prouver que le seigneur de Machecoul ait reconnu ou non l'imposture.
Faute de sources, il s'avère donc ardu de spéculer sur les relations entre Gilles et Jeanne. Les sentiments de la Pucelle vis-à-vis de son compagnon d'armes demeurent inconnus.
Barbe-Bleue
Gilles de Rais va devenir au fil des siècles un personnage légendaire, entouré de fantasmes. Il deviendra l'inspiration du personnage de Barbe Bleue, l'ogre du conte La Barbe bleue 1697 de Charles Perrault, bien que sa vie et ses actions soient loin de celles du personnage
Prosper Mérimée et Stendhal s'étaient préalablement contentés d'interpréter Barbe Bleue comme un souvenir mythisé de Gilles de Rais.
Aujourd'hui encore, au Pays de Retz, on désigne toujours Gilles de Rais par l'appellation de Barbe Bleue : le château de Machecoul, où Gilles commit ses crimes et où il fut arrêté, est communément appelé château de Barbe Bleue.
Doutes et tentatives de réhabilitation Siècle des Lumières
Dans son Essai sur les mœurs en 1756, Voltaire évoque laconiquement Gilles de Rais comme un supplicié ayant été accusé de magie, et d'avoir égorgé des enfants pour faire avec leur sang de prétendus enchantements. Sur la base de ce passage succinct, le philosophe a été présenté par certains partisans de l'innocence de Gilles comme leur plus fameux précurseur. Bien qu'il émette des réserves quant à la culpabilité du seigneur de Tiffauges, Voltaire évite toutefois de se prononcer définitivement sur la question. Sa brève mention du procès d'octobre 1440, parmi d'autres procès médiévaux d'hérésie et de sorcellerie, lui permet principalement de vilipender le fanatisme composé de superstition et d'ignorance, travers qu'il juge de tous temps mais caractérisant particulièrement sa conception d'un Moyen Âge obscurantiste en contraste avec les Lumières.
Dans un court passage de leur ouvrage L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur… 1784, des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur semblent rejoindre l'opinion du philosophe en proposant également la superstition comme cause plausible du supplice de Gilles de Rais. Les érudits religieux assurent dans un premier temps que le maréchal se déshonorait en Bretagne par des actions infâmes qui excitaient le cri du public contre lui. Mais, abandonnant ensuite le ton affirmatif, ils emploient des termes similaires à la prose voltairienne lorsqu'ils évoquent le cortège de prétendus devins et magiciens possiblement à l'origine des horreurs imputées au seigneur de Tiffauges, horreurs dont il n'était peut-être point coupable. À l'instar de l'Essai sur les mœurs, L'art de vérifier les dates… amalgame ici les évocations diaboliques et les meurtres d'enfants, contrairement aux aveux de Gilles qui dissociaient en pratique les deux accusations. Distinguées des horreurs, les actions infâmes alléguées de manière évasive au début du passage ne concerneraient donc pas les crimes eux-mêmes mais peut-être les pratiques sodomites. Les bénédictins laissent finalement planer le doute sur la réalité des horreurs , sans conclure à l'innocence.
XIXe siècle
À deux exceptions près, les actes des procès ne mentionnent pas clairement de découvertes macabres dans les demeures et lieux de passage du maréchal, bien que l'exhumation d'importants restes humains soit évoquée erronément par certains historiens durant le XIXe siècle.
Ainsi, Pierre-Hyacinthe Audiffret, dans l'article RETZ, Gilles de LAVAL, seigneur de de la Biographie universelle ancienne et moderne 1824 affirme que Pour éliminer les traces de ses forfaits, Gilles de Rais faisait précipiter les cadavres dans les fosses d'aisances quand il était en voyage ; mais dans ses châteaux, il les brûlait et en jetait les cendres au vent. Malgré ces précautions, on en trouva quarante-six à Champtocé et quatre-vingts à Machecoul.
Prenant la suite de la Biographie Universelle, Jules Michelet désigne également par un pronom indéfini les auteurs de l'exhumation présumée des cendres compromettantes : On trouva dans la tour de Chantocé une pleine tonne d'ossements calcinés, des os d'enfants en tel nombre qu'on présuma qu'il pouvait y en avoir une quarantaine. On en trouva également dans les latrines du château de la Suze, dans d'autres lieux, partout où il avait passé.. Le célèbre professeur du Collège de France s'appuie sur les dépositions des chambriers Henriet Griart et Étienne Corillaut pour alléguer cette macabre découverte champtocéenne, entre autres lieux, mais sa formulation ambiguë semble évoquer le résultat de fouilles entreprises par la justice ducale ou ecclésiastique.
Beaucoup d'auteurs et d'historien jusqu'au Grand dictionnaire universel du XIXe siècle emboiteront le pas à Jules Michelet, souvent par le biais d'une longue citation de son Histoire de France, reproduisant ainsi à l'envi cette légende issue d'une mauvaise lecture des documents . Autre réminiscence micheletiste, le récit romancé de Pitre-Chevalier dans La Bretagne ancienne et moderne en vient même à évoquer la libération de jeunes filles prisonnières du sire de Rais, version fantaisiste réfutée notamment par l'abbé Eugène Bossard.
Dans la première monographie consacrée au châtelain de Tiffauges, Gilles de Rais, maréchal de France, dit Barbe-Bleue, 1404-1440 en1885, l'abbé Bossard ne doute pas de la réalité des crimes mais il relève que le récit micheletiste n'est qu'une extrapolation due à une lecture approximative des sources primaires, voire la réminiscence de l'œuvre d'un historien mal informé. De fait, selon les actes des procès, il apparaît des propos des chambriers Henriet Griart et Étienne Corillaut que les restes des victimes ont été exhumés par les propres familiers et serviteurs de Gilles de Rais : Gilles de Sillé, Hicquet de Brémont, Robin Romulart ainsi que les chambriers eux-mêmes. Ces deux derniers attestent aux procès d'octobre 1440 que leur maître leur avait enjoint de retirer d'une tour près du château fort de Machecoul les ossements desséchés d'une quarantaine de victimes afin de les faire disparaître avant que René de La Suze et le sire de Lohéac ne s'emparent de cette forteresse bretonne
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7024#forumpost7024
Posté le : 25/10/2014 19:40
|
|
|
|
|
Gilles de Rais 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
XXe siècle Salomon Reinach
Salomon Reinach utilise la presse pour faire connaître ses vues au grand public. Dans Le Signal du 2 octobre 1902, il fait paraître une Lettre sur Gilles de Rais, innocent, qu'il signe Un amateur d'histoire vraie. Dans L'Éclair du 16 janvier 1905, il publie un Exposé de la question Gilles de Rais.
Gilbert Prouteau
Le poète et écrivain Gilbert Prouteau prête à l'avocat Maurice Garçon des doutes concernant la culpabilité de Gilles de Rais ainsi que la velléité de rédiger un ouvrage plaidant la thèse de l'innocence. Le livre projeté n'a pas vu le jour.
Postérieurement au décès de Maurice Garçon, l'écrivain affirme avoir été sollicité à Nieul-sur-l'Autise par un dignitaire de la Région dans le cadre de la préparation de la route Gilles de Rais, un circuit touristique consacré aux châteaux du maréchal. L'ouvrage de commande doit étayer la démarche des promoteurs en remettant en cause la légende et en éclairant les zones d'ombre du procès .
À l'en croire, le romancier laisse dormir son manuscrit pendant un an par crainte du refus d'un éditeur. Il finit par présenter son texte à l'avocat Jean-Yves Goëau-Brissonnière. Celui-ci accepte de devenir le défenseur de Gilles de Rais et de réunir une cour arbitrale, collège composé de personnalitésnote 50 chargées de se livrer à une révision du procès tenu en 1440. Le texte romancé de Prouteau aurait servi d'inspiration au plaidoyer attribué à Goëau-Brissonnière, que l'avocat prononce dans l'amphithéâtre de l'UNESCO en mai 1992 puis au Palais du Luxembourg, siège du Sénat, en novembre 1992. Cette cour arbitrale n'inclue aucun historien médiéviste et ne sollicite jamais l'avis d'experts de cette discipline historique.
Le roman et la plaidoirie sont reproduits dans l'ouvrage Gilles de Rais ou la Gueule du loup, mai 1992, juxtaposition de textes narratifs, d'extraits de minutes, de lettres romancées et d'un journal fictif tenu par un Gilles de Rais présenté comme un féru d'alchimie, esthète alcoolique et pédophile éloquent, sinon meurtrier. Négligeant les analyses des études historiques, Gilbert Prouteau reprend à son compte la thèse de Salomon Reinach et Fernand Fleuret en faveur de l'innocence de Gilles de Rais, à savoir une machination judiciaire orchestrée par l'évêque-chancelier Jean de Malestroit. Les contradicteurs de Reinach et Fleuret sont traités de cuistres et de trissotins de l'histoire tandis que les romanciers Jean-Marie Parent et Roger Facon sont qualifiés d historiens de grand talent en raison de leur œuvre littéraire développant également la théorie du complot judiciaire ourdi à l'encontre du maréchal.
La Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public dont son vice-président Jean Kerhervé réagit en faisant part de ses objections méthodologiques devant cette histoire-spectacle. Les historiens Jean Kerhervé et Olivier Bouzy publient des comptes rendus critiques, respectivement dans le journal Le Peuple breton en novembre 1992 et dans le bulletin Connaissance de Jeanne d'Arc en 1993 ; Philippe Reliquet effectue une mise au point dans un courrier publié par Le Monde le 5 septembre 1992.
Ainsi, Jean Kerhervé remarque qu'en dépit des considérations de Prouteau relatives aux sources soi disant manipulées ou mal interprétées par les précédents chercheurs, l'écrivain lui-même ne paraît ni avoir étudié les sources primaires originales rédigées en moyen français et essentiellement en latin ni maîtriser les compétences paléographiques nécessaires au déchiffrement de la cursive gothique du XVe siècle. Prouteau est régulièrement pris en défaut sur ses connaissances en histoire de la religion, du droit et des institutions médiévales, notamment dans le cadre du duché de Bretagne. En raison de ses erreurs, approximations ou inventions forgées délibérément pour les besoins de la réhabilitation, il est reproché à Gilles de Rais ou la Gueule du loup de créer la confusion la plus totale entre les éléments historiques et l'imaginaire de l'auteur.
De surcroît, la couverture médiatique du procès de révision est blâmée pour son manque de recul critique. Des journalistes reproduisent parfois, sans vérification préalable, certains propos entendus à la séance publique du 9 novembre 1992 ou imprimés dans Gilles de Rais ou la Gueule du loup, erreurs et manipulations comprises. Le jeudi 18 juin 1992, une dépêche de l'AFP évoque ainsi un seigneur de Rais plus grande fortune du royaume de France, en sus de faire état de ses prétendus aveux concernant 800 meurtres, chiffre inventé par Fernand Fleuret puis repris par Gilbert Prouteau et Goëau-Brissonnière.
La révision du procès aboutit à l'acquittement du seigneur de Tiffauges199 mais ce jugement ne peut prétendre à une valeur légale car aucune juridiction constituée n'est compétente pour réviser un procès du XVe siècle ; sa portée est d'ordre moral, symbolique… et médiatique.
Auteur de canulars littéraires avec Simenon ou Robert Desnos, le poète Gilbert Prouteau a parfois été qualifié de facétieux et de provocateur. Le procès de révision tenu en 1992 aurait ainsi été une farce monumentale ... mont[ée] avec des comparses de haute volée, mystification dont Prouteau se serait amusé encore plusieurs années après les faits.
Paru la même année que le procès de révision, Plaidoyer pour Gilles de Rais octobre 1992 est un ouvrage de Jean-Pierre Bayard, auteur spécialisé dans l'ésotérisme, le rosicrucianisme, les sociétés secrètes et la Franc-maçonnerie. Présentant le seigneur de Tiffauges comme une victime de l'Inquisition, l'écrivain dédie son livre à Jean-Yves Goëau-Brissonnière en témoignage de notre communion d'esprit et, en conclusion, remercie ce dernier et Gilbert Prouteau pour leur heureuse et courageuse campagne. La quatrième de couverture précise que ce Plaidoyer… va dans le sens spirituel du Comité de réhabilitation du Maréchal Gilles de Rais. En 2007, Goëau-Brissonnière préface la réédition chez Dualpha de l'ouvrage de son frère maçon de la Grande Loge de France.
Liens
http://youtu.be/udSJHxAPUGg Gille de Rais de Matei Cazacu,
http://youtu.be/9f3_10kSz-M?list=PLB1654B0EA3F06C5F Secrets d'histoire Gille de Rais
http://youtu.be/MGBjsfW44Fc Les procès de l'histoire
http://www.ina.fr/video/RXC00001212/u ... gilles-de-rais-video.html Le chateau de Gilles de Rais
http://www.ina.fr/video/CPC11003472/barbe-bleue-blanchi-video.html Barbe bleu blanchi
Fiction
http://youtu.be/-3l8SdCSr54 Monstrum
   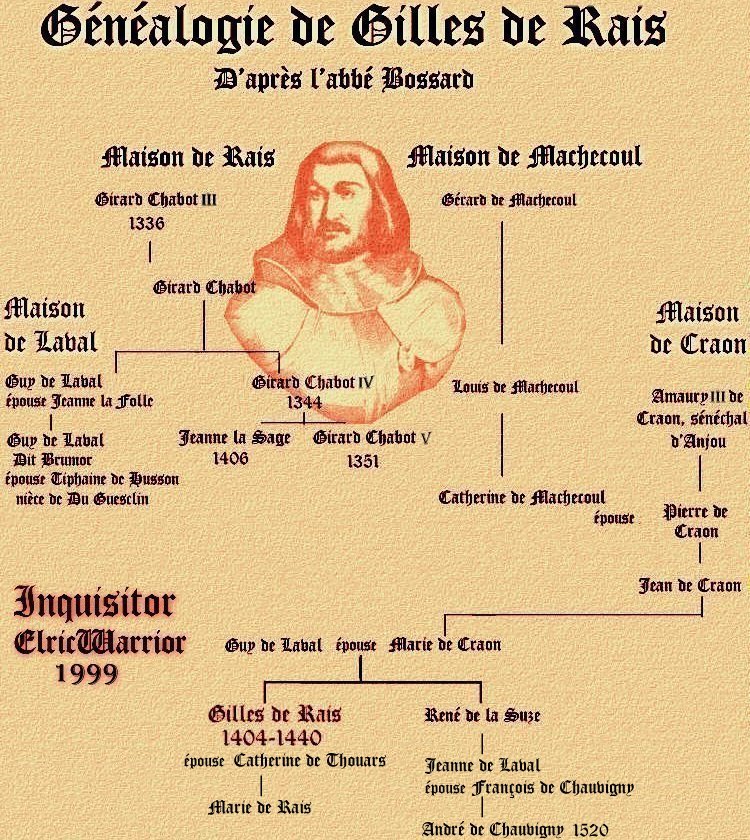      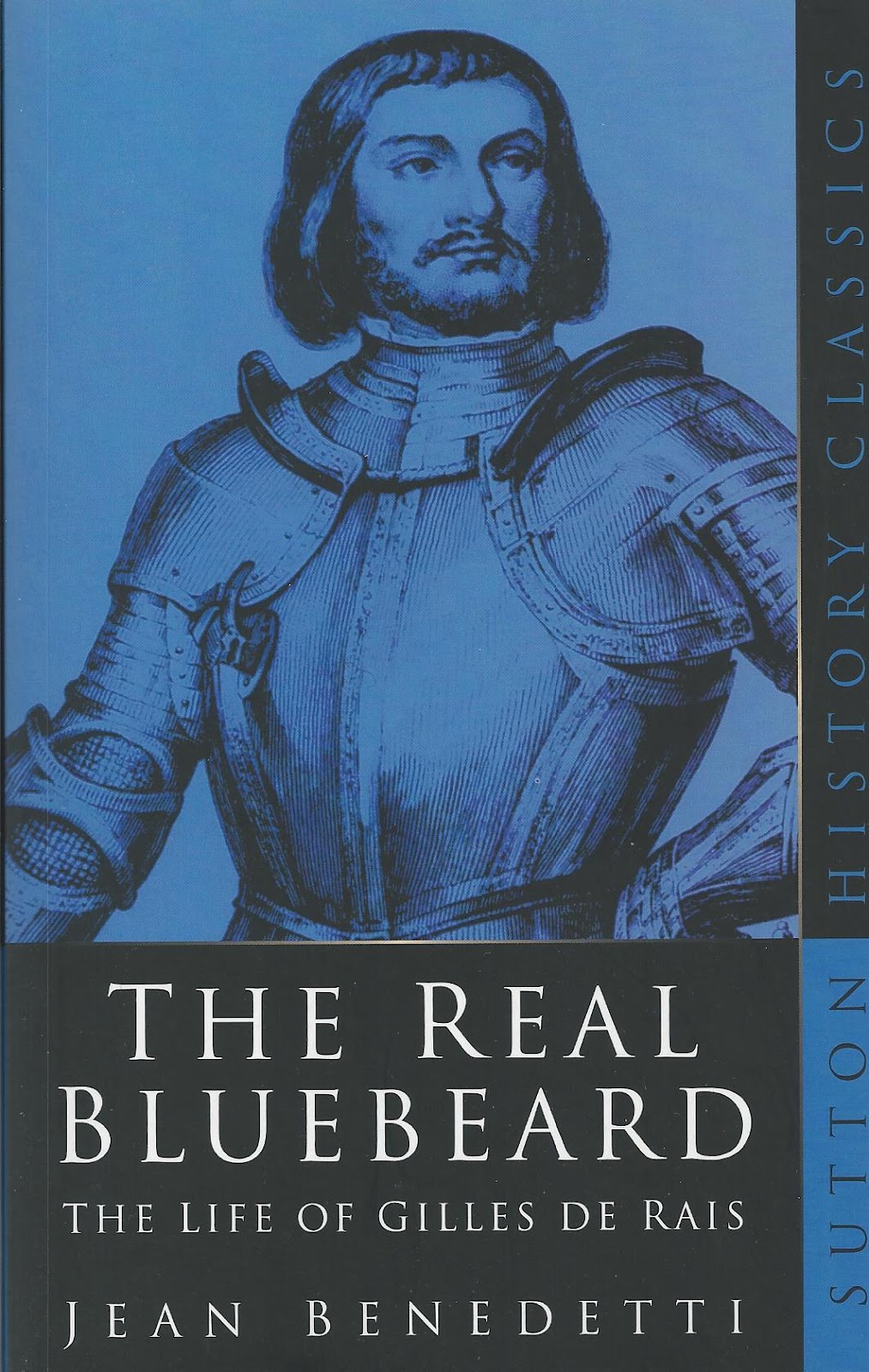  
Posté le : 25/10/2014 19:38
|
|
|
|
|
Shah Mohammad Reza Pahlavi shah d'Iran |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 26 octobre 1919 à Téhéran naît Mohammad Reza Chah Pahlavi
ou Muhammad Rizā Shāh Pahlevi, en persan : محمد رضا شاه پهلوی), mort, à 60 ans, le 27 juillet 1980 au Caire, Il était le deuxième et dernier monarque de la dynastie des Pahlavi Homayouni de la monarchie iranienne et le dernier chah d'Iran qui régna du 16 septembre 1941 au 11 février 1979, événement dit du 22 Bahman 1357. Contraint à l'exil le 16 janvier 1979, il fut remplacé par un conseil royal et renversé par la Révolution iranienne. Mohammad Reza Pahlavi n'a jamais abdiqué officiellement.
Chah d'Iran du 16 septembre 1941 au 11 février 1979 soit dirant 37 ans, 4 mois et 26 jours, il esty ouronné le 26 octobre 1967 son premier ministre sont Mohammad Ali, Foroughi, Ali Soheili, Ahmad Ghavam, Ali Soheili, Mohammad Saed Maraghei, Morteza Gholi Bayat, Ebrahim Hakimi, Mohsen Sadr, Ebrahim Hakimi, Ahmad Ghavam, Reza Hekmat, Ebrahim Hakimi, Abdolhossein Hajir, Mohammad Saed Maraghei, Ali Mansur, Ali Razmara, Hossein Ala', Mohammad Mossadegh, Ahmad Ghavam, Mohammad Mossadegh, Fazlollah Zahedi
Hossein Ala', Manouchehr Eghbal, Jafar Sharif-Emami, Ali Amini, Asadollah Alam, Hassan Ali Mansur, Amir Abbas Hoveida, Jamshid Amouzegar, Jafar Sharif-Emami, Gholam Reza Azhari, Shapour Bakhtiar, son prédessesseur est Reza Chah, son Successeur Abolhassan Bani Sadr pemier président de la République islamique d'Iran, Rouhollah Khomeini le guide de la révolution.
Son père est Reza Chah, sa mère Tadj ol-Molouk, ses épouses successives sont Fawzia bint Fuad 1938-1949, Sorayah Esfandiari Bakhtiari,1951-1958 puis Farah Diba 1959-1980
Ses enfants du premier mariage : Princesse Chahnaz Pahlavi, il n'a pas d'enfants avec Soraya ce qui sera répudiée, il a en troisième mariage : le prince Reza Pahlavi, prince impérial, la princesse Farahnaz Pahlavi, le prince Ali-Reza Pahlavi, la princesse Leila Pahlavi Son héritier est Ali-Reza Pahlavi 1922-1954 1941-1954, Ali Patrick Pahlavi 1954-1960, Reza prince impérial depuis 1960
Mohammad Reza succéda à son père, Reza Chah, lorsque ce dernier fut contraint d’abdiquer en septembre 1941, peu après l'invasion anglo-soviétique. À la tête d'un empire occupé, soumis au bon vouloir de Churchill et Staline, le jeune chah fut également confronté aux tentatives sécessionnistes dans les provinces du nord-est et aux rébellions tribales dans le sud du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, Mohammad Reza Pahlavi se rapprocha progressivement des États-Unis et entretint des liens très étroits avec la Maison-Blanche, en particulier avec les présidents Dwight Eisenhower et Richard Nixon.
L’essor de la production pétrolière au Moyen-Orient entraîna sous son règne une crise internationale qui allait opposer le Premier ministre nationaliste Mossadegh et la Grande-Bretagne. Appuyé par l’armée et les services secrets anglo-américains qui renversèrent Mossadegh, Mohammad Reza Pahlavi fut restauré sur le trône après un bref exil en Italie. Évoluant ensuite vers une conception plus nationale, réformiste et autoritaire de la politique intérieure, le chah d’Iran entreprit, par référendum, un vaste programme de progrès social et de développement économique, la Révolution blanche associé à une répression des mouvements d’opposition incarnée par la Savak. À l’extérieur, tout en demeurant un allié de premier plan pour les Américains et les chancelleries occidentales, Mohammad Reza Pahlavi se rapprocha progressivement de l’Union soviétique puis de la Chine, traduisant ainsi un désir d’émancipation et de neutralisme.
Si la politique volontariste du chah améliora considérablement le niveau de vie des Iraniens et permit au pays une modernisation rapide dans les années 1960 et 1970, elle contribua à élargir le fossé économique, social et culturel entre une élite fortement occidentalisée et une classe populaire sensible au conservatisme religieux. En 1978, de plus en plus critiqué, le chah dut faire face à un soulèvement populaire la Révolution iranienne qui s'accentua au fil des mois et d'où émergèrent les fondamentalistes chiites inspirés par l'ayatollah Khomeini. En janvier 1979, après avoir perdu progressivement ses soutiens traditionnels et l'appui occidental, Mohammad Reza Pahlavi nomma en dernier recours l'opposant social-démocrate Shapour Bakhtiar au poste de Premier ministre et quitta ensuite l'Iran. Le renversement du gouvernement Bakhtiar et la déclaration de neutralité de l'armée, quelques semaines plus tard, précipitèrent sa chute et contribuèrent à l'avènement de Khomeini. Contraint à l'exil et atteint d'un cancer, Mohammad Reza Chah Pahlavi décéda en Égypte l'année suivante.
En bref
Muḥammad Reza Rīza est le fils aîné de Reza shāh. Élevé à l'École des cadets, il reçoit une éducation française et poursuit ses études en Suisse de 1931 à 1936. À son retour en Iran, son père l'initie à la vie politique et, tout en fréquentant le collège militaire de Téhéran, il se prépare au rôle d'héritier du trône. Son père ayant abdiqué en 1941, Muḥammad Reza prête serment et devient shāh le 17 septembre de la même année. Il annonce aussitôt la redistribution des terres de la Couronne, décrète l'amnistie générale de tous les prisonniers politiques et se ménage le soutien de l'armée. La réaction ne tarde pas à se manifester, notamment de la part des forces religieuses hostiles aux réformes. Le shāh reçoit Roosevelt, Churchill et Staline à Téhéran en novembre 1943 et obtient d'eux que soit respectée l'intégrité de l'Iran. La guerre finie, il se tourne vers les États-Unis pour contrebalancer la politique des Britanniques et surtout celle des Soviétiques dont il redoute une intervention. Ayant échappé à plusieurs attentats, notamment en 1949, le shāh est convaincu qu'il est placé sous protection divine et qu'il a une mission à accomplir pour son pays. Il fait alors interdire le Parti communiste iranien Tudeh et accomplit son premier voyage aux États-Unis. De ces derniers il sollicite une aide économique et surtout le renforcement des forces armées de l'Iran aviation, armes blindées. Militaire de formation et fidèle aux idées de son père, il estime indispensable, pour gouverner, le soutien de l'armée et s'en assure le contrôle. Aussi lorsqu'en 1952 le Premier ministre Mossadegh s'attribue le portefeuille de la Défense nationale et place à la tête de l'armée des officiers peu favorables au shāh, il se donne les moyens de préparer l'avènement de la république. Le shāh le laisse agir et, lorsque la situation est devenue critique, il le fait arrêter et rentre triomphalement à Téhéran accompagné de son épouse Soraya. Il ne laisse plus alors à son cabinet qu'un rôle de conseiller. Se voulant despote éclairé, il intervient directement dans l'établissement des programmes de développement économique et des projets de réformes sociales, tenant ses ministres pour responsables devant lui. Il choisit délibérément de se ranger aux côtés des puissances occidentales et se fait le défenseur d'un nationalisme positif opposé à celui de Mossadegh, en ce qu'il n'est pas neutralité passive mais défense des intérêts du pays. Toute atteinte au prestige de la nation trahison, subversion, démagogie est vigoureusement réprimée. Le progrès économique facilité par les revenus pétroliers et la justice sociale figurent parmi ses objectifs principaux.
En 1957, il crée l'Organisation de sécurité nationale iranienne et fonde deux partis politiques. Le Parti nationaliste Melliyun a pour mission, en tant que parti majoritaire à l'Assemblée Majlis, de soutenir le gouvernement. Le Parti du peuple Mardom figure l'opposition et doit se borner aux critiques touchant les affaires intérieures, la politique extérieure ne pouvant être mise en question par qui que ce soit. En 1958, le shāh crée la fondation Pahlavi, qui permet aux ressources de la Couronne d'être affectées notamment à l'amélioration de la santé publique et à l'alphabétisation.Il s'emploie parallèlement à lutter contre la corruption et à appliquer la réforme agraire.
Bien que la naissance du prince héritier tant attendu que lui donne sa troisième épouse Farah Diba, en 1960, l'encourage dans sa mission, le shāh se heurte à ses propres alliés politiques et ne parvient pas à mettre ses projets en œuvre. Or, responsable aux yeux du peuple de tout acte politique, il lui faut agir rapidement, sous peine d'être renversé.
Aussi déclenche-t-il, en 1962, la révolution blanche en procédant par le haut aux réformes qu'il fait approuver, le 27 janvier 1963, par référendum : réforme agraire, nationalisation des forêts, intéressement des ouvriers à la production, création de l'armée du savoir, etc. Ainsi le shāh a-t-il le sentiment de travailler efficacement pour son peuple et la nation. S'étant fait de lui-même l'image d'un héros national, il se consacre shāhinshāh, c'est-à-dire roi des rois, en 1967, à la manière des princes achéménides ou sassanides. Disposant d'une armée puissante et moderne grâce à l'aide américaine, il peut se donner le rôle de protecteur du golfe Persique. S'il n'a certes pas renoncé à une politique d'équilibre afin de se ménager le concours de toutes les puissances, capitalistes et socialistes, le shāh entretient des rapports privilégiés avec les États-Unis. Sa défiance reste en éveil à l'égard des Soviétiques, lesquels ont marqué quelque irritation lors du rapprochement de l'Iran avec la Chine. Au cours du printemps de 1974, le shāh a rééquilibré sa diplomatie en mettant fin au gel de ses relations avec l'Inde. Ce rapprochement a été facilité par le fait que l'Inde n'est pas devenue un satellite de Moscou et que le shāh a offert à Indira Gandhi de faciliter l'approvisionnement de son pays en pétrole.
L'essor économique remarquable de l'Iran a favorisé l'apparition de nouvelles couches sociales et d'une bourgeoisie d'affaires avec laquelle le shāh doit compter lorsqu'elle revendique certaines libertés politiques, parallèlement aux milieux intellectuels. Ayant éliminé les partis d'opposition, le shāh réagit par des mesures de répression impitoyable, notamment après la découverte, en automne de 1972, d'un complot qui le visait en même temps que la famille royale. Il conserve le soutien de l'armée et des puissances occidentales, bénéficiant de leurs relations économiques avec l'Iran, en même temps qu'elles favorisent son développement. Mais petit à petit le régime doit affronter une double opposition : celle des mouvements religieux shī‘ites et celle des milieux politiques progressistes. Dès lors, la répression croissante exercée par la redoutable Savak police politique alterne avec de timides tentatives de libéralisation sans toutefois que l'agitation sociale diminue. Dans cette lutte contre le régime du shāh l'opposition religieuse l'emporte sur l'opposition politique dès 1978 et c'est depuis la France où il s'est réfugié à Neauphle-le-Château que l'ayatollah Khomeyni dirige la révolution en marche.
En fait, pendant le dernier trimestre de 1978, c'est l'ensemble de l'activité économique de l'Iran qui est paralysée — notamment le secteur du pétrole — par une vague de grèves sans précédent, tandis que dans tout le pays des manifestations quasi quotidiennes réclament le retour de l'ayatollah Khomeyni. Nommé chef du gouvernement en décembre 1978, Chahpour Bakhtiyar ne parvient pas à freiner le mouvement en cours, le régime ayant perdu tout soutien à l'intérieur — à l'exception de celui de l'armée — comme à l'extérieur où même les États-Unis se désolidarisent du monarque Pahlavi. Dès le 16 janvier 1979, le shāh et sa famille doivent quitter l'Iran.
Sa vie
De 1919 à 1941, les jeunes années Du fils d'officier au prince héritier
Mohammad Reza Pahlavi vit le jour le dimanche 26 octobre 1919 à l'hôpital Ahâmadiyeh, dans les quartiers sud de Téhéran. Fils aîné de Reza Khan, officier cosaque au seuil d'une irrésistible ascension, il était le second enfant porté par Nimtaj Khanum, future reine-mère Tadj ol-Molouk 1896-1982, et le frère jumeau de la princesse Ashraf Pahlavi. Ses jeunes années sans histoire se confondaient avec la fin de règne d'Ahmad Chah. Au bord du gouffre financier et de l'effondrement institutionnel, la Perse des Qadjar se trouvait en effet dans un "état de sous-développement abyssal. Ce fut dans ce contexte particulier de déclin dynastique et de confusion nationale qu'émergea le père de Mohammad Reza Pahlavi. Devenu dès 1921 le nouvel homme fort du pays, le général Reza Khan allait occuper successivement les postes de chef de l’armée et de gouvernement, avant de ceindre la couronne impériale sous le nom de règne de Reza Chah Pahlavi en 1925. Le jeune Mohammad Reza devint dès lors le nouveau prince héritier.
Une grande fratrie
Troisième enfant d’une fratrie composée de sept garçons et quatre filles, Mohammad Reza Pahlavi est le frère cadet de la princesse Chams 1917-1996 et le demi-frère de la princesse Fatimah, dite Hamdan Saltaneh 1912-1992, née d’une précédente union. La princesse Ashraf née en 1919 et le prince Ali-Reza 1922-1954 sont respectivement sa sœur jumelle et son seul frère de mère non qadjare. Ses demi-frères et demi-sœur d’ascendance qadjare donc non dynastes sont les princes Gholam-Reza, né en 1923 — mais l’intéressé a déclaré que sa mère était simplement apparentée aux Qadjars, Abdol-Reza 1924-2004, Ahmad-Reza 1925-1981, Mahmoud-Reza 1926-2001, la princesse Fatimah 1928-1987 et l’ex-prince Hamid-Reza 1932-1992, déchu par son frère et devenu Hamid Islami sous la République islamique.
Du collège suisse à l'école militaire
En 1925, bénéficiant d'une éducation stricte à la fois militaire et occidentale, Mohammad Reza Pahlavi gagna le prytanée Nezam, deux jours après qu'une loi lui eut conféré le titre de prince héritier. Une fois son certificat d'étude obtenu, à la fin de l'été 1931, Mohammad Reza Pahlavi quitta l'Iran afin de poursuivre son instruction en Suisse, dans le canton de Vaud. En 1936, au terme des cinq années passées au collège du Rosey, Institut Le Rosey, à Rolle, le jeune prince revint au pays et acheva son apprentissage à l'École des officiers de Danechkadéyé-Afsari. Il reçut le diplôme des mains de son père le 28 septembre 1938, avec le grade de sous-lieutenant. Arrivé au terme de sa formation, il fut aussitôt fiancé à la princesse Fawzia d'Égypte, la sœur du roi Farouk Ier qu'il n'avait jamais vue auparavant. Moins d'un an plus tard, le 15 mars 1939, les cours d'Iran et d'Égypte étaient unies.
De 1941 à 1949, un roi sans expérience et sous dépendance
Mohammad Reza Pahlavi jeune Accession au trône Invasion anglo-soviétique de l'Iran.
Suite à l'abdication de son père, écarté du pouvoir par les Anglais et les Soviétiques au début de la Seconde Guerre mondiale, Mohammad Reza devient Chah d'Iran le 16 septembre 1941. Le jeune homme inexpérimenté, qui se trouve propulsé sur le trône du Paon à l'aube de ses vingt-deux ans, débute son règne avec un pouvoir purement nominal et protocolaire, sévèrement limité par les Britanniques. Exaspérés par les libertés prises par Reza Chah, ces derniers avaient caressé l'idée de réhabiliter la dynastie Kadjar. Aussi, jetèrent-ils leur dévolu sur Soltan Hamid Mirza qui était le fils de l'ancien régent Mohammad Hassan Mirza et le neveu d'Ahmad Chah Qajar. Toutefois la probabilité de voir ce prétendant monter sur le trône paraissait bien faible tant son profil révélait des failles non négligeables : Soltan Hamid Mirza ne parlait pas le persan et connaissait bien mieux Londres et la Riviera italienne que sa terre natale quittée à l'âge de quatre ans.
L’occupation anglo-soviétique crise irano-soviétique.
Mohammad Reza Pahlavi succède à son père en septembre 1941 dans un contexte difficile, l'Iran étant en partie occupé par les armées anglo-soviétiques. Sous l'impulsion du Premier ministre Mohammad Ali Foroughi, le jeune chah laisse s'instaurer un régime plus démocratique et octroie aux forces alliées le droit de transiter du golfe Persique vers l’URSS: en échange, un traité janvier 1942 garantit l'intégrité territoriale et le départ des armées d'occupation six mois après la fin de la guerre. En 1945-1946, alors que le conflit mondial est arrivé à son terme, Mohammad Reza Pahlavi et le Premier ministre Ghavam os-Saltaneh sont confrontés à diverses menées séparatistes, notamment en Azerbaïdjan iranien et au Kordestan, ainsi qu'au refus soviétique d'évacuer les provinces du nord sans négociations préalables. C'est à l'issue de l'intervention militaire dans les provinces rebelles et d'une offensive diplomatique orchestrée par Ghavam os-Saltaneh que le jeune monarque, naguère peu estimé par les grandes puissances, gagne en prestige et devient le symbole de l'unité nationale retrouvée.
L'attentat de l'université de Téhéran
Mohammad Reza Pahlavi à l'hôpital après l'attentat du 4 février 1949
Le 4 février 1949, soit quelques mois à peine après avoir échappé à la mort dans un accident d'avion, lors d'une visite d'inspection au barrage de Zayandeh rud, le chah devait faire l'objet d'une tentative d'assassinat durant les célébrations du dixième anniversaire de l'Université de Téhéran. Arrivé par la porte principale du bâtiment, Mohammad Reza Pahlavi devait recevoir deux balles d'un pistolet de petit calibre, un 6,35 mm. La première balle atteignit la joue droite, passant entre la gencive et la lèvre, pour sortir sous le nez. La seconde effleura le dos, arrachant des chairs de l'omoplate. Bien que les blessures eussent été jugées graves, elles étaient plus impressionnantes que mortelles ; aucun organe vital n'ayant été touché, le chah n'eut à subir que des points de suture et sortit de l'hôpital militaire no 1 quelques heures après. De retour au palais impérial, Mohammad Reza Pahlavi s'adressa à la nation dans un communiqué radiodiffusé et poursuivit ses activités comme à l'accoutumée.
La cause exacte de l'attentat devait demeurer une énigme, car l'agresseur fut tué durant sa fuite par des gardes qui étaient peu au fait des règles du Code pénal. Tout au plus, l'enquête révéla que l'auteur de l'attentat s'appelait Nasser Fakhr-Araï, qu'une carte de presse lui avait permis de déjouer la surveillance et qu'il était membre du Tudeh. Les investigations policières révélèrent en outre des complicités dans les rangs islamistes. En effet, il apparut que Nasser Fakhr-Araï était employé par le quotidien Parchamé Eslam la Bannière de l'islam, un organe de presse proche des Fedayin de l'islam de Navvab Safavi, et avait obtenu sa carte de presse grâce à une intervention de l'ayatollah Kachani, figure influente du courant conservateur chiite et mentor de Ruhollah Khomeiny. Selon toute vraisemblance, le militant communiste n'était pas un tireur professionnel puisqu'il éprouva de grandes difficultés à toucher sa cible malgré la courte distance deux mètres qui le séparait du chah. Sur les six balles contenues dans le pistolet, trois s'étaient logées dans le képi du souverain et une resta bloquée dans le barillet. Pris de panique, Nasser Fakhr-Araï jetta son arme, détala et fut abattu aussitôt après, en pleine course.
L'iranologue Yann Richard souligne le caractère ambigu de cet attentat qui fit l'objet d'une exploitation médiatique. De fait, le chah bénéficia d'un regain de popularité et fut dès lors placé dans un contexte plus favorable pour justifier certaines initiatives visant à neutraliser l'opposition et à renforcer les prérogatives royales. Ceci expliquerait en conséquence, selon l'iranologue français, l'interdiction du parti Tudeh le jour même de l'attentat et les mesures coercitives prises à l'encontre des dirigeants des Fedâ'iyân-e eslâm, qui ne tardèrent pas à être arrêtés ou exilés. Parmi ceux-ci figurait l'ayatollah Abou al-Qassem Kachani qui fut expulsé au Liban. Parallèlement à ces mesures, Yann Richard soutient la thèse selon laquelle le chah aurait mis à profit cet attentat en obtenant plus de pouvoirs au détriment du jeu parlementaire alors en vigueur. La loi fondamentale iranienne fut en effet révisée en mai 1949, soit deux mois à peine après la tentative d'assassinat. Toutefois, Yann Richard ne fournit aucune preuve pour étayer cette théorie.
Une autre théorie du complot gouvernemental a été par ailleurs avancée par l'ancien ministre et parlementaire Ezzatolah Sahabi. Cité par la revue Pajouhesh en juin 2008, ce proche du courant réformateur accuse Mohammad Saed et Haj Ali Razmara, d'avoir été à l'origine de la conspiration. Selon lui, le Premier ministre et le chef d'état-major de l'époque auraient en outre ordonné l'élimination de Fakhr-Araï afin de "brouiller les pistes". Néanmoins, tout comme la thèse défendue par Yann Richard, la théorie du complot d'Ezzatolah Sahabi ne repose sur aucune preuve connue.
De 1949 à 1953, les années Mossadegh La lutte de pouvoir
À l’aube des années 1950, l’enjeu énergétique et la Guerre froide vont placer l’Iran au centre des préoccupations géostratégiques de la Grande-Bretagne, de l’Union soviétique et des États-Unis. En effet, Londres tient absolument à conserver sa maîtrise du Golfe Persique et sa mainmise sur les champs pétrolifères, par le biais de l’AIOC. De son côté, Moscou convoite les ressources naturelles de la Mer Caspienne et s’appuie sur le parti Tudeh pour influencer le cours des événements. Quant à la Washington, sous l’impulsion de la CIA et du cartel des Sept Sœurs, elle n’entend plus se laisser damer le pion par les puissances coloniales traditionnelles : il importe désormais d’ancrer durablement le modèle américain, tant d’un point de vue économique, politique qu’idéologique, au cœur du Moyen-Orient.
La nationalisation du pétrole Coup d'État et restauration
Aidé par la CIA et le MI6 britannique au cours de l'opération Ajax, le chah remonte rapidement sur le trône. L'ancien Premier ministre Mossadegh est condamné à 3 ans d'emprisonnement.
De 1953 à 1971, apogée du règne Renforcement du pouvoir personnel
Le chah devient dès la fin des années 1950 un des dirigeants les plus importants du Moyen-Orient, grâce notamment au pétrole, à une armée puissante et à l'appui des États-Unis, Opération Ajax. Après avoir régné en souverain constitutionnel jusqu'à la chute du gouvernement de Mossadegh, il évolue vers une conception plus autoritaire et autocratique du pouvoir, supprimant le multipartisme et s'appuyant sur une police politique : la SAVAK.
Avec la Révolution blanche, Mohammad Reza Pahlavi modernise progressivement l'Iran pour en faire un pays occidentalisé. Son père Reza Chah avait lancé la construction d'un Iran laïc et à l'image de ce que Mustafa Kemal Atatürk a fait pour la Turquie : une révolution industrielle et culturelle.
La Révolution blanche concerne une série de mesures destinées à moderniser le pays, comme une réforme agraire, la constitution du corps de Sepah-e Danech, l'armée du savoir pour alphabétiser les populations, la relève du suffrage universel, y compris pour les femmes, la mise en place d'un examen professionnel pour les aspirants théologiens islamiques les mollahs et ce en rupture avec les vieilles traditions religieuses.
Couronnement
C’est à l’automne 1967, le 26 octobre, qu’eurent lieu les cérémonies du sacre de Mohammad Reza Pahlavi. Durant les vingt-six années qui s’étaient écoulées depuis sa prestation de serment, en septembre 1941, le chah n’avait pas envisagé de ceindre la couronne impériale. Tant qu’il ne sentait pas l’Iran suffisamment engagé dans la voie du développement économique et social, il ne voulait pas être le roi d’un pays pauvre et n’éprouvait aucune fierté à être couronné devant un peuple encore pauvre et en partie illettré.
Célébrations des 2500 ans de la monarchie iranienne
Le chah a organisé du 12 au 16 octobre 1971 une fête spectaculaire, pour les deux mille cinq cents ans de l'Empire perse, sur le site de Persépolis, siège des rois d'Iran depuis des siècles. Monarques et présidents de monde entier ont fait le déplacement pour assister à cette folie destinée à célébrer la prodigieuse modernisation de l'Iran ainsi que son glorieux passé. Les Iraniens sont censés prendre conscience du prestige de leur pays dans le monde. Mais ce qu'ils virent, c'est que le chah a dépensé trois cents millions de dollars en tentes de soie équipées de toilettes en marbre, et en mets et vins pour vingt-cinq mille personnes, venus en avion depuis Paris.
L'Ayatollah Khomeiny condamna ces excès depuis Nadjaf, évoquant les millions d'Iraniens pauvres qui, selon lui, réclamaient l'aide du clergé pour la construction de bains publics: "Les crimes des rois d'Iran ont noirci les pages de l'histoire... Que sont devenues ces belles promesses, ces allégations prétentieuses selon lesquelles le peuple serait prospère et heureux?"
La chute
Sa politique a donné lieu à une croissance économique très forte durant les années 1960 et 1970. Cependant, en 1978, devant la brutalité des méthodes de la SAVAK, le faste ostentatoire des plus riches et de la famille impériale et une sclérose démocratique, le président américain Jimmy Carter demande au chah de libéraliser son pays.
Le chah fait appel à ses opposants les plus libéraux, comme Chapour Baktiar, pour tenter de sauver le régime impérial perçu comme trop autoritaire et trop occidentalisé en particulier par les conservateurs religieux. Le nouveau Premier ministre, pour pouvoir rétablir la situation, demande au chah de quitter l'Iran pour une durée indéterminée le chah lui-même voulait absolument quitter le pays. Par mesure de sécurité, l'armée boucle tous les accès au quartier nord, la banlieue cossue où se situe la résidence des souverains. Le chah et l'impératrice Farah quittent en hélicoptère le palais de Niavaran pour l'aéroport de Mehrabad. Le 16 janvier 1979, l'avion transportant le couple impérial et quelques collaborateurs décolle : c'est le début de l'exil du chah.
L'exil Le départ 16 janvier 1979
Le chah et l'impératrice Farah peu avant leur départ en exil.
"Chah raft - le roi s'en va " - Une du journal Ettela'at du 16 janvier 1979
Le 16 janvier 1979, le chah se lève à l’aube et s’isole dans son bureau durant quelques heures. Il rejoint la chahbanou en fin de matinée. Suivant l’usage persan avant un long voyage, Mohammad Reza Pahlavi et l’impératrice Farah passent sous le Coran, après avoir distribué des objets précieux, des bijoux personnels et de l’argent. Ils saluent une dernière fois les militaires, dont le général Abdollah Badreï, et le personnel de la maison impériale avant de prendre place dans un des deux hélicoptères affrétés pour rejoindre l’aéroport de Mehrabad. Accueilli par des officiers et quelques civils, le couple impérial fait une brève déclaration à la presse iranienne et attend l’arrivée de Shapour Bakhtiar qui devait être préalablement investi par le Majles en tant que nouveau chef de l'exécutif. Ce dernier, accompagné par Djavad Saïd, le président du parlement, est aussitôt transporté par hélicoptère pour se joindre aux officiers, aux pilotes, aux personnalités de la Cour et aux membres de la Garde impériale rassemblés sur le tarmac de l’aéroport. Après avoir échangé quelques mots avec son Premier ministre, le chah salue les personnes présentes et monte dans un Boeing 707 bleu et blanc. Il est suivi par l’impératrice Farah et par quelques proches et collaborateurs. Aussitôt à bord, le chah prend les commandes de l’appareil baptisé Châhine qu'il va piloter jusqu’à la sortie de l’espace aérien national. Tandis que l’avion vole à destination de l’Égypte, où les souverains iraniens sont attendus par le couple Sadate, le quotidien national Ettela'at titre en première page Chah raft le roi s'en va. De son côté, la population iranienne est partagée entre liesse, désolation et incertitude.
Première étape égyptienne 16 au 22 janvier 1979
Accueillis dans un premier temps par le président Sadate, devenu au fil des années un allié et un ami fidèle, le chah et l'impératrice Farah séjournent à Assouan durant une semaine. Persuadé que la résistance serait mieux organisée à partir du territoire égyptien, le Raïs insiste pour que le couple impérial reste sur place. Le chah ne veut pas l'encombrer et sur l'invitation du roi Hassan II, un autre allié de longue date, il reprend l'avion à destination de Marrakech le 22 janvier 1979. Deux jours plus tôt, durant une conférence de presse, le président Jimmy Carter avait fait savoir que sa présence n'était plus souhaitée aux États-Unis : divisée au sein même de son administration et après avoir tenu des discours contradictoires des mois durant, la Maison-Blanche décide clairement d'abandonner son allié de naguère. Contrairement à ce qui avait été annoncé par les médias au début du mois de janvier, la famille impériale ne va donc pas s'installer à Palm Springs, en Californie, sur l'initiative de Nelson et David Rockefeller.
Étape marocaine 22 janvier au 30 mars 1979
C'est durant son séjour au Maroc que le souverain empêché apprend la nouvelle du retour d'exil de Khomeiny et la fin du gouvernement de Shapour Bakhtiar, renversé par les révolutionnaires et privé du soutien de l'armée qui s'est déclarée neutre. Le régime islamique s'impose et va organiser une purge, la plupart des anciens ministres et officiers de l'ancien régime, encore présents en Iran, sont jugés et exécutés. Des menaces sont proférées contre les pays qui accepteraient d'accueillir le chah, dont le retour est exigé : les chefs religieux veulent le traduire en justice. Malgré les conseils et l'assurance du soutien du roi Hassan II, l'exil marocain n'excède pas trois semaines : arrivé en urgence de Paris, Alexandre de Marenches tire la sonnette d'alarme. Reçu en audience au palais de Rabat, le chef des services secrets français informe que les religieux iraniens ont l'intention d'enlever ou d'attenter à la vie des membres de la famille royale marocaine si celle-ci s'obstine à soutenir le chah. Hassan II refuse de céder au chantage, mais Mohammad Reza Pahlavi préfère éviter ce scénario : il décide donc de quitter le sol marocain.
Étape des Bahamas 30 mars au 10 juin 1979
Roberto Armao, le responsable des relations publiques de la famille Rockefeller, est dépêché pour trouver une autre terre d'accueil. Devant faire face au refus ou aux tergiversations des alliés d'autrefois, l'émissaire reçoit finalement une réponse favorable de l'archipel des Bahamas. La solution demeure néanmoins provisoire puisque les souverains déchus n'obtiennent qu'un visa de trois mois et sont confinés dans une petite maison en bord de mer. Installés depuis le 30 mars 1979 à Paradise Island, aux Bahamas, les souverains iraniens sont cette fois acceptés par le Mexique, sur l'insistance conjointe de Roberto Armao et d'Henry Kissinger.
Étape mexicaine 10 juin au 22 octobre 1979
La Villa de las Rosas, située dans une impasse de Cuernavaca, devient le nouveau havre de paix. Alors que tout laisse présager que le Mexique sera le point final de l'exil, la maladie dont souffre le chah depuis 1974 se rappelle à son souvenir : les ganglions du cou sont fortement enflés. Le professeur Flandrin, l'assistant du professeur Jean Bernard, est appelé de Paris en consultation. Pour la première fois le mot cancer est évoqué en présence du chah. Atteint de la maladie de Waldenström, Mohammad Reza Pahlavi doit subir une intervention chirurgicale dans les plus brefs délais : la chimiothérapie, à base de Chlorambucil, prescrite par les hématologues français, a atteint ses limites et il devient impératif de procéder à une splénectomie. Sceptique, l'administration Carter envoie ses propres médecins pour l'informer de l'état de santé du chah.
Première étape américaine 22 octobre au 1er décembre 1979
L'admission du souverain au New York Hospital du Centre médical Cornell sera à l'origine de la crise iranienne des otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Le chah est opéré mais seule la vésicule biliaire est extraite, tandis qu'un calcul reste dans le canal biliaire et que la rate, dont les proportions ont été jugées inquiétantes par les professeurs Flandrin et Coleman, est laissée en l'état. La situation devenant intenable, Mohamed Reza Pahlavi est à présent transféré au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center où il doit suivre une cure de radiothérapie avant de pouvoir retourner à Cuernavaca. Mais la pression diplomatique contraint le président José López Portillo à renoncer à ses engagements, refusant désormais la présence du couple impérial sur le sol mexicain.
Seconde étape américaine 1 au 15 décembre 1979
L'administration Carter prend la décision de transférer le chah et l'impératrice Farah sur la base militaire de Lackland, proche de San Antonio, au Texas, dans l'attente d'un départ vers une autre terre d'exil. Le couple impérial quitte New-York le 1er décembre 1979. À la Maison-Blanche, l'anxiété et les craintes dues à l'affaire des otages exigent un départ rapide du territoire américain. Après avoir sondé différents pays susceptibles d'accueillir les souverains iraniens, Jimmy Carter reçoit finalement un avis positif du président panaméen Omar Torrijos. Dépêché sur la base de Lackland, Hamilton Jordan, le chef de cabinet de Carter, fait part de la proposition au chah qui accepte de partir pour le Panama où les Américains, alors gardiens du canal, peuvent assurer une protection militaire et fournir des soins médicaux adaptés.
Étape panaméenne 15 décembre 1979 au 24 mars 1980
Mohammad Reza Pahlavi s'installe dans une maison moderne sur l’île de Contadora, dans l’archipel des Perles, le 15 décembre 1979. Mais le répit n'est que de courte durée : les mollahs et Sadegh Ghotbzadeh, le ministre iranien des affaires étrangères, tentent d'obtenir son extradition avec l'aide des avocats franco-argentin Christian Bourguet et Hector Villalon. Le gouvernement panaméen, d'abord disposé à accueillir les souverains déchus, change de position : il ne verrait pas d'objection à négocier une extradition. Anouar el-Sadate, qui avait toujours demandé que les Pahlavi demeurent en Égypte, réitère son invitation. C'est donc le retour à la première destination d'exil, mais avant cela l'avion va être bloqué plusieurs heures dans l'archipel des Açores : des avocats, chargés par le régime islamique, tentent par ce moyen d'arrêter le Chah. L'avion décolle le 24 mars 1980 avant que les autorités locales ne reçoivent officiellement la demande.
Seconde étape égyptienne 24 mars au 27 juillet 1980
Mohammad Reza Pahlavi, extrêmement diminué par la maladie, est installé au palais Koubeh avec les membres de sa famille. Transféré d'urgence à l'hôpital Ma'adi le 25 mars 1980, il doit subir une splénectomie : le professeur Michael E. DeBakey enlève la rate, mais laisse le foie infecté et ne dispose pas de drain sur le pancréas qui a été touché au cours de l'intervention chirurgicale. La dégradation de l'état de santé du chah nécessite une nouvelle opération qui n'est désormais plus assurée par le professeur DeBakey, mais par une équipe médicale française. Le 30 juin 1980, le docteur Pierre-Louis Fagniez procède au pompage d'un litre et demi de pus et à l'extraction des débris du pancréas. Suivra une agonie de plusieurs semaines qui prendra fin le dimanche 27 juillet 1980 vers 5 h du matin.
Funérailles
Les obsèques de Mohammad Reza Chah Pahlavi, dernier empereur d'Iran, eurent lieu deux jours plus tard, le 29 juillet 1980. Pour les circonstances, Anouar el Sadate offre des funérailles nationales grandioses à celui qu'il considère comme un ami et un allié : trois millions de Cairotes s'étaient rassemblés tout le long du parcours reliant le palais d'Abedin à la mosquée al-Rifai. Des centaines d'étudiants de l'Académie militaire conduisaient en musique la procession, vêtus d'uniformes blanc, jaune et noir, selon leur rang. Derrière les cadets marchaient des soldats arborant des couronnes de roses et d'iris, flanqués d'officiers à cheval et suivis directement par un escadron d'hommes qui portaient les décorations militaires du chah sur des coussins de velours noir. Le cercueil, drapé dans les couleurs de l'Iran impérial, reposait sur un affût de canon tiré par huit chevaux arabes. Il précédait le cortège à la tête duquel marchaient la chahbanou, les enfants du couple impérial et les frères du chah. Aux côtés des Pahlavi se tenaient le couple Sadate et l'ancien président américain Richard Nixon. Ce dernier, venu à titre privé, dénonça l'indignité de l'administration américaine et des principaux alliés occidentaux à l'égard du monarque déchu. Si la plupart des chefs d'État et de gouvernement en fonction n'assistèrent pas à la cérémonie, certains pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Australie et Israël dépêchèrent néanmoins leurs ambassadeurs. Représenté par un de ses proches, Moulay Hafid Alaoui, le roi Hassan II avait offert une pièce de tissu brodé de prières qui avait recouvert la Kaaba: le présent du souverain marocain devait être déposé sur le linceul du chah avant son inhumation. Parmi les autres personnalités qui avaient fait le déplacement au Caire figuraient l'ex-roi Constantin II de Grèce et son épouse, Anne-Marie de Danemark, ainsi que le prince Vittorio Emanuele di Savoia. À la mosquée al-Rifai, la dépouille du chah fut descendue, en sous-sol dans un caveau particulier, en présence de ses deux fils.
L'impératrice Farah Diba et l'héritier du trône, son fils Reza Pahlavi, sont très impliqués aujourd’hui dans les mouvements d’opposition au régime iranien au niveau international.
Mariages et descendance
Mohammad Reza Pahlavi s’est marié trois fois et a eu cinq enfants.
La reine Fuzeye, Fawzia, la reine Soraya et la reine Farah.Fawzia d’Égypte
La reine Fawzia, Mohammad Reza Chah Pahlavi et leur fille Chahnaz en 1941
Reza Chah, après avoir rétabli la grandeur de l'Iran, avait voulu la rendre manifeste en mariant le prince héritier à une princesse musulmane de haute lignée. La nouvelle constitution stipulant qu'aucun descendant de la dynastie Qadjar, par les hommes ou par les femmes, ne pouvait monter sur le trône iranien, le vieux monarque porta son choix sur une jeune étrangère de sang royal : Fawzia bint Fuad, la sœur du roi d'Égypte.
Le 26 mai 1938, le palais impérial annonce qu'une délégation conduite par le Premier ministre Mahmoud Djam va se rendre au Caire pour convenir du mariage entre le prince héritier et Fawzia d’Égypte, fille du roi Fuad Ier et sœur du jeune Farouk Ier, intronisé deux ans auparavant. Les fiancés ne se sont jamais vus, ne parlent pas la même langue, et il importe surtout à Reza Chah que la toute jeune dynastie Pahlavi gagne en légitimité aux yeux du monde. Moins d'un an plus tard, le 16 mars 1939, Mohammad Reza Pahlavi épouse la princesse Fawzia au palais d'Abedin, au Caire, selon le rite chiite. Une seconde cérémonie, de rite sunnite, se déroule à Téhéran, au Palais impérial du Golestan, le 25 avril 1939.
Si d'un point de vue politique ce mariage apporte le prestige et la reconnaissance à la dynastie Pahlavi, il ne tarde pas à révéler ses failles. Éloignée des salons chics d'Alexandrie et du Caire, Fawzia, devenue reine d'Iran Malika Fawzia Pahlavi à l'avènement de Mohammad Reza, ne s'adapte pas à la cour de Téhéran. Hormis la naissance d'une fille, la princesse Chahnaz, le 27 octobre 1940, l'union est vécue comme un échec relationnel. Rentrée dans son pays, la reine Fawzia se voit accorder le divorce par le gouvernement égyptien dès 1945. Ce n'est que trois ans plus tard que les autorités iraniennes confirment cette décision. Le divorce officiel est donc accordé le 17 novembre 1948, à la condition que la princesse Chahnaz reste sous la responsabilité de son père.
Sorayah Esfandiari Bakhtiari
Trois ans après son divorce, le chah épouse en secondes noces Sorayah Esfandiari Bakhtiari 22 juin 1932- 26 octobre 2001, fille de Khalil Esfandiari, l'ambassadeur d'Iran à Bonn, et d'Eva Karl, une Allemande. Fiancés le 11 octobre 1950, Mohammad Reza Pahlavi et la jeune femme issue de la tribu des Bakhtiaris se marient le 12 février 1951. En l'absence d'héritier après sept années d'union, le couple royal divorce en mars 1958.
Farah Diba
C'est durant un voyage officiel en France que Mohammad Reza Pahlavi rencontre pour la première fois celle qui sera son épouse pendant vingt ans et sept mois: Farah Diba. Parti pour un mois en Europe, du 3 mai au 4 juin 1959, le chah doit se rendre en Suisse, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France. Arrivé à Paris le mardi 26 mai, il est reçu au Palais de l'Élysée par le général de Gaulle, avec qui il entretient des relations excellentes. Trois jours plus tard, le 29 mai 1959, une réception à laquelle sont conviés des étudiants iraniens est organisée dans leur ambassade: c'est à cette occasion que Farah Diba, étudiante en architecture, est présentée au souverain.
Bilan de règne Les chefs d'accusation
Les révolutionnaires et dirigeants de la République islamique d'Iran ont accusé le chah d'avoir :
renié les valeurs islamiques et abandonné les traditions culturelles iraniennes, au profit des valeurs occidentales et étrangères à l'Iran, et de leur « modernisme sans âme ;
sacrifié les intérêts du peuple et du pays au profit des impérialistes notamment américains et d'une minorité d'Iraniens, industriels et financiers, donc créé une société injuste ;
favorisé ou laissé se développer la corruption ;
créé une bureaucratie dévorante et un régime policier ;
utilisé la terreur (emprisonnements massifs, tortures, assassinats et massacres lors de manifestations ;
ignoré la réalité du pays et de ses besoins et possibilités, en essayant de brûler les étapes du développement économique ;
constitué une armée dispendieuse dépendant de l'aide américaine 10 % du PNB et plus de 50 % des dépenses courantes du budget consacrées aux forces armées ;
dépensé 10 milliards de dollars de matériel aéronautique acheté aux Américains de 1972 à 1976 ;
appuyé son régime sur l'armée 500 000 hommes bien équipés, la gendarmerie 75 000 hommes, la police 60 000 hommes et la SAVAK 500 000 agents et informateurs supposés.
La défense
Le chah voulait faire de l'Iran une grande puissance mondiale et le sortir rapidement du sous-développement :
Il entreprit la modernisation de la production et la diversification des infrastructures ;
Il développa les transports autoroutes, routes secondaires, chemins de fer, installations portuaires et aéroportuaires ;
Il investit dans les équipements sanitaires hôpitaux, l'accès aux soins de santé et les campagnes de vaccination ;
Il lutta contre l'analphabétisme 10 millions d'écoliers, 200 000 étudiants, 20 universités et 136 instituts créés ;
Il éleva le niveau de vie de la population au-dessus de celui de la plupart des pays du Moyen-Orient et du Tiers monde ;
Il engagea des réformes en profondeur réforme agraire, participation des ouvriers aux bénéfices des grosses entreprises, droit de vote des femmes et amélioration de la condition féminine....
Deux autres arguments à décharge peuvent être mis en exergue :
Le chah fut victime de son entourage familial, politique, écran entre lui et son peuple, qui commit des excès ;
Son renversement est l'échec d'une politique d'industrialisation et de modernisation trop ambitieuse, imposée à une société traditionnelle qui n'y était pas préparée
.
Titulature
26 octobre 1919-15 décembre 1925 : Mohammad Reza Pahlavi naissance
15 décembre 1925-16 septembre 1941 : Son Altesse impériale le prince impérial
16 septembre 1941-11 février 1979 : Sa Majesté impériale l'empereur d'Iran
Durant son règne, le dernier empereur d'Iran a porté préférentiellement les prédicats énoncés comme suit : Alaa-Hazrat Homayoun, Chahanchah Aryamehr, Chahanchah-e Iran en français Sa Majesté impériale, Sa Grandeur, Roi des Rois, Lumière des Aryens, l'empereur d'Iran
Si le titre simplifié de chah d'Iran a été le plus souvent utilisé et relayé par les médias étrangers pour désigner Mohammad Reza Pahlavi, son nom pouvait être substitué par d'autres titres officialisés par le majles et le sénat iranien:
Chahanchah ou shahinshah persan شاهنشاه, en français Roi des Rois
Aryamehr persan آریامهر, en français Lumière des Aryens
Bozorg Arteshtārān (persan بزرگ ارتشتاران, en français Chef des guerriers
Distinctions et décorations Décorations iraniennes
Grand collier de l’Ordre des Pahlavi 1932
Grand cordon de l’ordre de Zulfiqar 1949
Décorations étrangères Pays Décoration
Année date
Afghanistan Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Suprême 1965
Allemagne fédérale Grand Cordon, classe spéciale de la Bundesverdienstkreuz 1955 25-02
Arabie saoudite Décoration 1re classe de l’ordre du Roi Abdul Aziz Al-Saoud 1955 09-08 / 1957 12-03
Arabie saoudite Chaîne de Badr 1965
Argentine Grand Cordon de l’ordre du Libérateur San Martin 1965
Autriche Grande Étoile de la Décoration d'Honneur pour Mérite 1958 15-03
Bahreïn Collier de l’ordre d'al-Khalifa 1966
Belgique Grand Cordon de l’ordre de Léopold du Royaume de Belgique 1960 11-05
Brésil Grand Collier de l’ordre de la Croix du Sud 1965 03-05
Danemark Chevalier de l’ordre de l’Éléphant 1959 14-05
Égypte Collier de l’ordre de Méhémet Ali du Royaume d’Égypte 1939
République arabe unie Égypte Grand Cordon de l’ordre du Nil de la République arabe unie d'Égypte 1965
Espagne régime franquiste Grand Collier de l’ordre du Joug et des Flèches 1957
Espagne transition démocratique Grand Collier de l’ordre de Charles III 1975
États-Unis Commandeur en chef de la Légion du Mérite Legion of Merit des États-Unis 1947 septembre
Empire d'Éthiopie Chevalier avec Grand Collier et Chaîne de l’ordre de Salomon de l’Empire d'Éthiopie 1964
Finlande Commandeur Grand Croix avec collier de l’ordre du Lion de Finlande 1970
France Grand-croix de la Légion d’honneur 1939 15 juin
France Croix de Guerre avec palme de la République française 1945
Grèce Grand Croix de l’ordre du Sauveur du Royaume de Grèce 1960
Irak Chevalier du Grand Ordre des Hachémites du Royaume d'Irak 1957 18-10
Italie Chevalier Grand Croix avec collier de l’ordre du Mérite de la République italienne 1957 26-08
Japon Collier du Grand Ordre de la Décoration du Chrysanthème 1958 13-05
Jordanie Collier de l’ordre d’Hussein ibn Ali du Royaume hachémite de Jordanie 1949 28-02
Jordanie Grand Collier, classe spéciale, de la Renaissance de Jordanie 1949 28-02
Liban Grand Cordon, classe spéciale, de l’ordre du Mérite du Liban 1956 17-1
Libye Collier d’Idris Ier de Libye 1958
Koweït Collier de l’ordre de Mubarak le Grand du Koweït 1966
Malaisie Porteur du Darjah Utama Seri Mahkota Negara DMN, le Très Exalté Ordre Royal de la Couronne de Malaisie 1968 février
Maroc Grand Cordon de l’ordre d'El Mohammedi du Royaume chérifien du Maroc 1966 11-06
Mexique Grand Collier de l’ordre de l’Aigle aztèque du Mexique 1975
Népal Étoile du Très Glorieux Ordre de Ojaswi Rajanya du Royaume du Népal 1960 03-07
Norvège Grand Croix avec Collier de l’ordre de Saint-Olaf du Royaume de Norvège 1961 17-05
Oman Ordre militaire 1re classe du Sultanat d’Oman 1973
Pakistan Nishan-i-Pakistan 1re classe 1959 09-11
Pays-Bas Grand Collier de l’ordre du Lion néerlandais 1959 19-05
Qatar Collier d'Indépendance de l'État du Qatar 1966
Royaume-Uni Chevalier Grand Croix GCB du très honorable ordre du Bain 1942
Royaume-Uni Chaîne Royale Victorienne RVC d’Édouard VII du Royaume-Uni 1948
Soudan Collier de l’ordre de la Chaîne d'honneur du Soudan 1966
Suède Chevalier 1960 de l’ordre du Séraphin de Suède, avec collier 1967 1960 29-04 / 1967 04-09
Taïwan (République nationaliste de Chine Grand Collier, grade spécial, de l’ordre des Nuages propices de la République nationaliste de Chine (Taïwan)1946 (03-06)
Tchécoslovaquie Grand Croix 1re classe de l’ordre du Lion blanc 1943 décembre
Thaïlande Chevalier de l’ordre de Maha Chakri du Royaume de Thaïlande 1968 22-01
Tunisie Grand Cordon avec collier de l’ordre de l'Indépendance de la République de Tunisie 1965 15-03
Vatican Chevalier de l’ordre de l’Éperon d’or du Saint-Siège 1948 20-08
Yougoslavie Grand Cordon de l’ordre de la Grande Étoile de la République socialiste fédérale de Yougoslavie O6.03.1966
Liens
http://youtu.be/1-_fCpWzxKc interview avec Kouchner
http://www.ina.fr/video/CPD11001871/1 ... n-a-persepolis-video.html Iran 1971
http://youtu.be/UISbeKdhTnI Couronnement du Shah et de la shabanou
http://www.ina.fr/video/CAF94085273/v ... ran-a-l-elysee-video.html Visite du shah en France
http://www.ina.fr/video/CAF94075792/d ... d-iran-a-paris-video.html 2eme visite du Shah à l'Elysée
http://www.ina.fr/video/I09223050/val ... ollah-khomeiny-video.html V? G? D'Estaing
http://www.ina.fr/video/CAA7900571001 ... manifestations-video.html manifestations à Téhéran
http://youtu.be/l047n4WSRlo Khomeini en France
http://youtu.be/Piq0f98txAw révolution islamique 1
http://youtu.be/9hZKNMbZfnI révolution Islamique 2
http://www.ina.fr/video/CAA8001546201 ... du-shah-d-iran-video.html Décès du Shah
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7019#forumpost7019
      [img width=600]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQh2CD4ekja5c9BofNpehMKCdTXHgqu8_-JUrk4kCLlRTGNy3mmtawIQf1QtQ[/img]     
Posté le : 25/10/2014 18:29
|
|
|
|
|
Iran 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Iran Histoire et politique
L'histoire moderne de l'Iran, vieil empire multiethnique, devenu au fil du XXe siècle (sous la dynastie pahlavi puis sous la République islamique) un État-nation centralisé, présente quelques constantes remarquables.
Les relations de domination puis de rejet des puissances étrangères ont rythmé les étapes de l'évolution de ce pays, fier de sa singularité et de son indépendance et qui n'a jamais été colonisé. La domination de la Grande-Bretagne et de la Russie, dès la seconde moitié du XIXe siècle, a entraîné des mouvements de protestation puis, au début du XXe siècle, une révolution constitutionnelle (1905-1911) originale. C'est encore contre la Grande-Bretagne et sa mainmise sur les richesses pétrolières que la population se révolta sous l'égide de Mossadegh, alors Premier ministre, au début des années 1950 ; les Américains ayant pris le relais des Britanniques, ils devinrent la cible de ces protestations qui atteignirent leur paroxysme lors de la révolution de 1979.
Une seconde constante de l'histoire politique de l'Iran est la place singulière qu'y tient le clergé shi’ite, force traditionnelle de cristallisation des mécontentements et volontiers contestataire des pouvoirs établis, pour des raisons doctrinales propres à ce courant de l'islam. La revendication de la gestion directe des affaires politiques, sous la forme du velāyat-e faghih (« la souveraineté du docte »), est cependant une innovation de la République islamique et de son promoteur, l'ayatollah Khomeyni, innovation qui a profondément bouleversé le paysage politique régional et international.
Une troisième constante, depuis plus d'un siècle, est le balancement entre soubresauts démocratiques et autoritarisme brutal, que traduit, dans le langage quotidien, l'opposition entre mellat (le peuple et ses aspirations) et dowlat (le gouvernement et ses pratiques). À de courts moments de liberté d'opinion et d'expression (révolution constitutionnelle, mossadeghisme, premiers mois de la révolution de 1978-1979) ont régulièrement succédé coups d'État ou répression.
Encerclé, au début du XXIe siècle, par deux pays occupés et en guerre (l'Irak et l'Afghanistan), l'Iran demeure la grande puissance de la région, assurée de la stabilité de ses frontières, exerçant une forte influence sur les pays d'Asie centrale qui faisaient autrefois partie de son empire et sur un « croissant shi’ite » qui s'étend du golfe au Liban en passant par l'Irak. Mais, depuis les événements révolutionnaires, l'Iran tend aussi à s'ériger en référence centrale pour le monde musulman, voire en puissance mondiale, orchestrant un front du refus, position affirmée avec plus ou moins de véhémence selon les conjonctures électorales et internationales.
La monarchie iranienne
La situation géographique de l'Iran entre le Proche-Orient et l'Inde d'une part, entre l'océan Indien et la Russie d'autre part a valu à ce pays, à partir de la fin du XVIIIe siècle – qui voit l'avènement de la dynastie des Qadjar (1794-1925) et l'établissement de la capitale à Téhéran – d'être l'un des théâtres de la rivalité anglo-russe ; les Russes souhaitaient, à travers l'Iran, atteindre le golfe Persique et l'océan Indien et tourner l'Empire ottoman, les Anglais entendaient protéger la route des Indes et interdire la réalisation des visées de l'empire tsariste. En outre, depuis 1795, des problèmes frontaliers opposaient la Russie à l'Iran : la Géorgie en était l'enjeu ; en 1813, les Russes finirent par obtenir cette province ainsi que le Daghestan et, en 1828, par le traité de Torkamantchaï, les Iraniens durent aussi céder les districts arméniens d'Erevan et de Nakhitchevan. Par la suite, les Russes soutinrent à plusieurs reprises les Iraniens contre les Anglais, notamment à propos des affaires d'Afghanistan qui trouvèrent leur conclusion avec le traité anglo-iranien de 1857.
La rivalité et l'influence des deux grandes puissances ne firent dès lors que s'amplifier ; à tour de rôle, Anglais et Russes obtinrent des concessions extraordinaires qui mirent pratiquement entre leurs mains toutes les ressources de l'Iran ; la plus spectaculaire fut le contrôle par les Anglais de la recherche et de l'exploitation des pétroles en Iran du Sud (1901) et la création de l'Anglo-Persian Oil Company (1909) ; à l'Imperial Bank of Persia (anglaise) s'opposait la Banque d'escompte de la Perse (russe) ; à cela s'ajoutaient la domination politique des Anglais sur le sud du pays, celle des Russes sur le Nord.
Après avoir paru favorable à des réformes, Naser od-din shah (1848-1896) se montra de plus en plus indifférent aux problèmes de ses sujets, accentua le caractère absolutiste de son pouvoir et laissa les puissances étrangères mettre la main sur l'économie du pays, attitude qui fut encore plus celle de son successeur, Mouzaffar od-din shah (1896-1907). Cette politique provoqua le mécontentement des tenants des traditions religieuses et sociales, dont les oulémas étaient les chefs, et des partisans de réformes profondes, qui ne constituaient cependant qu'une minorité. La conjonction des mécontents aboutit à la révolution de 1906, dont le résultat fut l'instauration d'un régime parlementaire (oct. 1906) et la promulgation d'une Constitution (oct. 1907) ; mais le nouveau shah, Mohammad Ali, rétablit le régime absolutiste (juin 1908) : des révoltes éclatèrent alors en de nombreux points du pays, particulièrement à Ispahan où le chef de l'importante tribu des Bakhtiyaris conduisait le mouvement : le 13 juillet 1909 le shah fut déposé et remplacé par son fils, Ahmad, âgé de douze ans, qui devait être le dernier souverain de la dynastie qadjari (1909-1925). Profitant de la situation politique trouble, Anglais, Russes et Allemands travaillèrent à accroître leur influence, notamment les Allemands, apparus à la fin du XIXe siècle et qui, avec les Turcs, essayèrent de s'imposer durant la Première Guerre mondiale ; leur défaite en Occident entraîna leur échec en Iran, et le changement de régime en Russie laissa les mains libres aux Anglais.
Le règne de Reza shah
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la situation de l'Iran était proche de l'anarchie : dans le sud du pays, les Anglais avaient étendu leur contrôle et pensaient pouvoir imposer leur autorité au gouvernement de Téhéran grâce au traité du 9 août 1919 qui visait à instituer leur protectorat sur l'ensemble de l'Iran, en profitant du retrait des troupes soviétiques. Mais cette action anglaise se heurta à l'opposition des Persans, des Américains et des Français ; les provinces d'Azerbaïdjan et du Ghilan se révoltèrent, et cette dernière se proclama même, en mai 1920, république soviétique du Ghilan. Finalement, le traité ne fut pas ratifié.
Cependant les Anglais obtinrent que les officiers russes de la division « cosaque » cèdent la place à des officiers persans ; il est probable qu'alors la diplomatie anglaise cherchait à instaurer en Perse un nouveau gouvernement, appuyé sur l'armée, et dont elle contrôlerait l'action, directement ou indirectement. De fait, de nombreux incidents éclatèrent dans la région de Téhéran au cours de l'automne et de l'hiver 1920-1921 ; des tentatives de complots eurent lieu, mais sans résultat, jusqu'à ce que l'une d'elles, dirigée par Seyyed Ziya ed-Din et soutenue par le colonel Reza khan, de la division « cosaque », réussisse à s'imposer à Téhéran le 20 février 1921 et prenne en main le pouvoir. Le shah nomma aussitôt Seyyed Ziya ed-Din Tabatabaï Premier ministre tandis que Reza khan devenait ministre de la Guerre.
Seyyed Ziya ed-Din obtint le 26 février 1921 la conclusion d'un traité soviéto-persan, par lequel les Soviétiques renonçaient aux avantages acquis autrefois par les gouvernements tsaristes, mais en échange se voyaient accorder un droit d'intervention armée en Perse, au cas où leur sécurité serait menacée par une intervention étrangère dans ce pays, et l'interdiction pour les Persans de concéder à des étrangers autres que soviétiques des concessions pétrolières dans les cinq provinces du nord. D'autre part, Seyyed Ziya ed-Din élimina du pouvoir un certain nombre de personnages importants et chercha aussitôt à restaurer l'autorité du gouvernement central. Mais sa politique heurtait trop d'intérêts en place et ne plaisait guère aux Britanniques. Trois mois après sa nomination, Seyyed Ziya ed-Din dut donner sa démission et même quitter le pays. Le shah confia alors la direction du gouvernement à Qaram os-Saltane, ancien gouverneur du Khorasan, qui revint à une politique appuyée sur les groupes traditionnels et abandonna les projets de réforme de son prédécesseur. Cependant Reza khan demeurait à la tête de l'armée et, dans la tâche primordiale de restauration de l'autorité gouvernementale, il joua un rôle prééminent. Des troupes furent envoyées pour éliminer les mouvements rebelles, les insurrections et les troubles en Azerbaïdjan, au Gilan, au Khorasan, et soumettre les Lours, les Qashqays, les Arabes du Sud. Les succès obtenus valurent à Reza khan un grand prestige et une influence croissante, qui n'était pas sans faire penser à l'action de Mustafa Kemal dans la Turquie voisine : le 28 octobre 1923, Reza khan fut nommé Premier ministre et le shah quittait alors le pays pour voyager en Europe.
Reza khan est né en 1878 dans un petit village de montagne proche de la mer Caspienne ; sa famille était de condition modeste et l'on ne sait rien sur sa jeunesse. Il entra dans la division « cosaque » vers 1900, servit à Téhéran, Hamadhan, Kermanshah, et participa aux combats de Téhéran en 1908 et 1911. En 1921, il avait le grade de colonel ; il était réputé pour la fermeté de son caractère, son courage et son esprit de détermination. On a parfois prétendu qu'il avait été assez tôt « protégé » par les Anglais, le général Ironside d'abord, sir Percy Loraine ensuite ; on n'a pas de preuves formelles de cette assertion.
Comme l'avait fait Mustafa Kemal en Turquie, Reza khan envisagea de proclamer la république en Perse en 1924 ; mais il se heurta à l'opposition des milieux traditionnels et conservateurs, en particulier des milieux religieux. Pour manifester son mécontentement et affirmer son prestige, Reza khan résigna son pouvoir au début de 1925 : il fut aussitôt rappelé par des démonstrations populaires, les démarches des militaires et d'un certain nombre de députés ; en février 1925 il regagna Téhéran et obtint du Madjlis (Parlement) des pouvoirs quasi dictatoriaux par 93 voix contre 7. L'obstacle majeur au pouvoir suprême était la dynastie des Qadjar : la monarchie était depuis longtemps le régime de la Perse et Reza khan craignait un changement brutal de système de gouvernement. Le shah ayant annoncé son retour en Iran et ses partisans s'agitant, Reza khan prit les devants et obtint la déposition d'Ahmad shah, son exil et celui des membres de la dynastie des Qadjar. Il fut nommé président du gouvernement provisoire le 31 octobre 1925 et se fit décerner la couronne royale le 12 décembre 1925 ; ainsi fut fondée la nouvelle dynastie des Pahlavi.
Sous le règne de Reza shah (12 déc. 1925-16 sept. 1941), l'Iran a subi des transformations profondes dans les domaines économique, administratif et culturel, mais en même temps le pays a été soumis à un étroit contrôle policier : bien que le régime parlementaire n'ait pas été supprimé, le Parlement n'eut pratiquement plus aucun rôle et, dans son désir d'affirmer l'autorité du gouvernement central, le shah fut conduit à supprimer les libertés individuelles ; il agit en fait comme un véritable dictateur, éliminant les opposants à sa politique, soit en les exilant, soit en les emprisonnant ou même en les faisant exécuter. Les chefs de tribu qui tentèrent de se dresser contre son pouvoir furent éliminés et remplacés par des officiers, souvent sans culture et sans pitié. La constitution d'une armée forte, aux cadres privilégiés, visait à contrôler les provinces, à assurer la fermeté du régime et à décourager toute attaque venant de l'extérieur. Les dépenses militaires, la création d'une infrastructure de communications nécessaire à l'armée, routes, voies ferrées, télégraphe, furent couvertes par les revenus tirés du pétrole. En même temps fut institué le service militaire obligatoire et l'obligation de l'usage de noms de famille, indispensables pour la conscription. C'est dans la même optique que furent développés les services médicaux et hospitaliers, l'instruction publique, par besoin d'hommes qualifiés, de techniciens, et fut mis sur pied un programme d'industrialisation. Mais il n'y eut pas de véritable programme national, pas de plan de mise en valeur du pays. Au contraire même, certains projets se révélèrent irréalisables par les seuls moyens iraniens et furent alors confiés à des Occidentaux qui trouvèrent là une possibilité de profits, sans aucune considération pour le développement économique de l'Iran. Cependant on ne peut nier que ces mesures aient contribué à déclencher un processus de modernisation du pays, qui s'est traduit par la création d'écoles et d'une université (1935), des efforts en vue de la libération de la femme (interdiction du port du voile, décrétée en 1935), la lutte contre les milieux religieux fanatiques, l'amélioration de la production agricole.
Mais ces mesures entraînèrent des oppositions : des milieux religieux, des grands propriétaires fonciers, dont les impôts avaient été accrus (mais qui avaient répercuté ces augmentations sur les paysans), et qui avaient perdu leur rôle politique au bénéfice de l'armée, des paysans eux-mêmes qui se méfiaient de la conscription et voyaient d'un mauvais œil la mise en circulation de papier-monnaie à la place des monnaies d'or et d'argent (1932). Cependant Reza shah conservait un grand prestige auprès des paysans. C'est le 31 décembre 1934 qu'un décret du shah donna officiellement au pays le nom d'Iran à la place de celui de Perse, considéré comme symbole détestable du passé. Dès 1928 Reza shah avait abrogé toutes les conventions accordant des privilèges et des capitulations aux puissances étrangères et avait récupéré certains revenus perçus jusqu'alors par des États ou des sociétés non iraniens. Pour améliorer les finances de l'Iran, il annonça en 1932 le retrait de toutes les concessions de l'Anglo-Persian Oil Company et, devant les menaces britanniques, porta l'affaire devant la Société des nations : finalement un accord fut conclu en 1933, par lequel les royalties versées au gouvernement iranien étaient accrues, tandis qu'était réduit le périmètre d'exploitation de l'A.P.O.C. (devenue plus tard l'A.I.O.C., Anglo-Iranian Oil Company) ; toutefois la compagnie voyait renouveler sa concession pour soixante ans. Vers la même époque, Reza shah eut de nouvelles difficultés avec les Britanniques à propos de leur protectorat sur l'île de Bahrein dont il revendiquait la souveraineté : il n'obtint aucun succès.
Avec l'Union soviétique, les relations furent relativement calmes : un traité de neutralité et de garanties réciproques fut signé le 1er octobre 1927 et une compagnie mixte irano-soviétique créée pour l'exploitation des pêcheries sur la côte méridionale de la mer Caspienne. Cependant le Parti communiste iranien, fondé en 1920, fut interdit en 1931 et, par la suite, des dirigeants communistes iraniens furent arrêtés et jugés, notamment au cours des procès de 1937.
Cette attitude anticommuniste est à mettre en parallèle avec le rapprochement avec l'Allemagne hitlérienne, qui tint alors le premier rang dans les échanges extérieurs de l'Iran et envoya dans le pays de nombreux techniciens : en août 1941, on en comptait plus de 2 000. Les États-Unis n'avaient alors qu'une influence réduite ; ils obtinrent néanmoins une concession d'exploitation pétrolière dans le nord-est de l'Iran.
Avec ses voisins du Proche-Orient, Reza shah entretint des relations amicales, concrétisées par la signature, en juillet 1937, du pacte de Saadabad avec l'Afghanistan, l'Irak et la Turquie, par lequel les quatre États se garantissaient mutuellement leurs frontières et s'engageaient à se défendre solidairement contre toute attaque dirigée contre l'un d'eux, et par la conclusion en 1939 du mariage du prince héritier Mohammad Reza avec la princesse Fawzia d'Égypte.
Le règne de Mohammad Reza
Lorsque se déclencha la Seconde Guerre mondiale, l'Iran se déclara neutre et le demeura jusqu'à la fin du mois d'août 1941. L'attaque allemande contre l'Union soviétique, le 22 juin 1941, fit de l'Iran le lieu de jonction des Britanniques et des Soviétiques, pour une fois alliés dans ce pays contre un ennemi commun. En effet l'Iran était la voie la plus pratique pour faire parvenir des armes aux Soviétiques, et d'autre part les Britanniques tenaient à protéger les pétroles de l'A.I.O.C. et la route de l'Inde, menacés par l'avance allemande vers le Caucase.
Dès juillet 1941, Britanniques et Soviétiques envoyèrent à Reza shah une note diplomatique demandant l'expulsion des ressortissants allemands : devant le refus du shah, les deux puissances alliées, avec l'appui des États-Unis, se déclarèrent alors contraintes d'intervenir militairement en Iran, sans pour autant vouloir porter atteinte à la souveraineté du shah ni à l'intégrité territoriale du pays. Le 25 août 1941, les armées britanniques pénétraient dans le sud et l'ouest de l'Iran et s'installaient au Khouzistan et au Kurdistan, tandis que les armées soviétiques occupaient le Nord, notamment les provinces d'Azerbaïdjan et du Khorasan ; le gouvernement iranien s'inclina devant le fait accompli, mais les alliés voulaient davantage : l'abdication du shah dont ils n'appréciaient ni la politique présente ni la politique passée. Finalement, le 16 septembre 1941, Reza shah abdiqua en faveur de son fils Mohammad Reza ; il fut exilé à l'île Maurice, puis en Afrique du Sud où il mourut, à Johannesburg, le 16 juillet 1944.
Mohammad Reza accéda au trône iranien sans difficultés, aucune opposition n'ayant eu le temps de se manifester. Le nouveau souverain, né le 27 octobre 1919, avait fait des études en Suisse, et suivi les cours de l'École militaire de Téhéran, mais sans recevoir la moindre formation politique. Cependant, dès son arrivée au pouvoir, il distribua au peuple tous les biens fonciers hérités de son père, déclara vouloir l'amélioration du sort des paysans et des ouvriers ; il fit arrêter les policiers agents du régime précédent, libéra et amnistia les condamnés politiques ; la Constitution fut remise en vigueur, le Parlement se réunit et la presse, à nouveau libre, attaqua avec violence l'ancien shah et dénonça ses excès. Toutefois cela n'empêchait pas la situation politique de l'Iran d'être soumise aux influences étrangères et les problèmes pétroliers de prendre une acuité nouvelle.
Le 29 janvier 1942, malgré l'opposition de plusieurs députés, un traité d'alliance fut signé entre l'Iran, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique ; ces deux dernières puissances s'engageaient notamment à défendre l'Iran contre toute agression, à sauvegarder et à respecter son intégrité territoriale et son indépendance politique, à évacuer leurs troupes du pays au plus tard six mois après la suspension des hostilités. C'est à Téhéran que se réunirent pour la première fois Roosevelt, Churchill et Staline, à la fin de novembre 1943.
La guerre a pesé sur l'Iran : par le renchérissement du coût de la vie, par l'importance énorme acquise par l'A.I.O.C., par les difficultés nées de l'occupation britannique et soviétique, chacune des deux puissances s'efforçant d'accroître son influence, sans grand succès pour les Britanniques qui, appliquant le traité de 1942, retirèrent leurs troupes d'Iran avant le 2 mars 1946. En revanche, dans leur zone d'occupation, les Soviétiques avaient facilité la création de partis politiques favorables à leur cause, le parti Tudeh (« la masse »), le Mouvement démocratique d' Azerbaïdjan et le Mouvement pour l'autonomie kurde, par l'intermédiaire desquels ils dirigeaient les provinces azéries et kurdes, interdisant toute intervention des autorités politiques et militaires iraniennes. À la fin de 1943 la compagnie Royal Dutch Shell et, en 1944, les compagnies américaines Socony Vacuum Oil et Sinclair Oil demandèrent au gouvernement iranien des concessions pétrolières : les négociations avançaient favorablement lorsque, à leur tour, les Soviétiques réclamèrent des concessions. Le gouvernement iranien décida alors de reporter à la fin des hostilités toute attribution de concession, ce qui déchaîna la fureur du gouvernement et de la presse soviétiques. Cela n'empêcha pas le Madjlis de voter, sur la proposition du Dr Mossadegh, une loi interdisant aux ministres de mener avec des États ou des compagnies étrangers des négociations sur l'octroi de concessions pétrolières : seules étaient permises des négociations sur l'exploitation et la vente du pétrole.
À la fin de la guerre, les Soviétiques favorisèrent la formation de gouvernements autonomes en Azerbaïdjan et en Kurdistan iraniens (nov. 1945), empêchant toute intervention iranienne et refusant d'évacuer leurs troupes. L'Iran présenta un recours devant le Conseil de sécurité en janvier 1946 et entama des négociations avec l'U.R.S.S. ; un accord fut conclu en avril : contre l'évacuation des troupes russes, l'Iran octroyait une concession pétrolière aux Soviétiques dans le nord du pays. Si les Soviétiques retirèrent bien leurs troupes en mai 1946, ils n'en continuèrent pas moins à exercer une pression politique et ce n'est qu'en décembre 1946 que les autorités iraniennes purent pénétrer en Azerbaïdjan.
En octobre 1947, le Madjlis rejeta l'accord sur les pétroles conclu avec l'U.R.S.S. Quant aux Américains, de plus en plus présents en Iran, ils participèrent alors au développement des forces militaires et techniques, prenant ainsi la place des Allemands.
La question du pétrole
Le Premier ministre Qavam os-Saltane, qui avait réussi à manœuvrer les Soviétiques, envisagea alors de réviser l'accord conclu en 1933 avec l' Anglo-Iranian ; mais son ministère tomba et ses successeurs firent traîner les négociations, puis conclurent en juin 1949 un nouvel accord avec l'A.I.O.C. Bien que l'Iran dût en tirer des profits accrus, cet accord rencontra au Parlement une violente opposition menée par le Dr Mossadegh. Le gouvernement du général Razmara entama des négociations secrètes avec l'A.I.O.C., mais le 7 mars 1951 il fut assassiné par un membre du groupe des Fedayān-e Eslām (« les Combattants de l'islam »). En avril 1951 le Parlement vota à l'unanimité la nationalisation de l'industrie pétrolière, et le 29 avril le Dr Mossadegh, chef du Front national et leader de la campagne pour la nationalisation, devint Premier ministre.
Son programme portait sur l'exécution de la loi de nationalisation des pétroles et sur le remaniement des lois sur les élections législatives et municipales. L'A.I.O.C. ayant fait arrêter l'exploitation des puits, le gouvernement iranien voulut intervenir à Abadan, ce qui provoqua une plainte de l'A.I.O.C. et du gouvernement britannique devant la Cour internationale de La Haye (juin 1951). Le gouvernement iranien refusa de reconnaître la juridiction mais celle-ci, finalement, se déclara incompétente (juill. 1952). À la création de la Compagnie nationale des pétroles iraniens (oct.-nov. 1951) les Britanniques répondirent par le blocus du pétrole d'Iran. Tandis que l'affaire s'enlisait, au Madjlis l'opposition au Dr Mossadegh grandissait et la situation économique se dégradait ; des désordres éclatèrent, et contre Mossadegh s'unirent les anticommunistes, les militaires, les grands propriétaires et les clients ou les partisans des Anglo-Saxons ; à la suite de l'échec d'une tentative de la Garde impériale pour arrêter Mossadegh (16 août 1953), le shah quitta l'Iran après avoir confié au général Zahedi le soin de diriger le gouvernement ; le 19 août, Mossadegh et plusieurs de ses ministres furent arrêtés, la répression se déchaîna à Téhéran et en province : traduit devant la Cour martiale, le Dr Mossadegh fut condamné et emprisonné ; le Dr Fatemi, ministre des Affaires étrangères, fut condamné à mort et fusillé, de même qu'une trentaine d'autres accusés.
Le général Zahedi institua un gouvernement dictatorial et finalement conclut avec un consortium international un accord pour vingt-cinq ans sur l'exploitation des pétroles iraniens (sept. 1954) et reçut des États-Unis un don exceptionnel de 45 millions de dollars. La tentative iranienne de contrôler son pétrole se soldait par un échec relatif ; mais cet échec devait aussi servir de leçon. Par ailleurs, si la Grande-Bretagne conservait la majorité au sein du consortium, les Américains avaient désormais pénétré en force en Iran où ils prirent la relève des Britanniques. Jusqu'en 1965, le consortium domina à 95 p. 100 la production pétrolière de l'Iran ; cependant le gouvernement, surtout à partir de 1958, octroya des concessions de recherche et d'exportation à d'autres sociétés étrangères, en coopération avec la C.N.P.I. En décembre 1966, il conclut avec le consortium un nouvel accord par lequel la C.N.P.I. récupérait un quart des territoires concédés et commercialisait elle-même une partie de la production du consortium. D'autres accords conclus en 1967 et 1969 accrurent les bénéfices du gouvernement iranien.
La politique intérieure
Le gouvernement du général Zahedi était un gouvernement de répression, qui exerça son action contre les membres du Front national et du parti Tudeh : des complots vrais ou faux permirent de sévir notamment contre ce dernier, qui fut interdit, et de confier les principaux postes de l'administration à des militaires dont la brutalité entraîna le mécontentement du peuple et même certains soulèvements, au point qu'en avril 1955 le shah se sépara de Zahedi et désigna Hoseyn Ala comme Premier ministre : lui-même prit une part plus active au gouvernement. Peu après, l'Iran adhéra au pacte de Bagdad (oct. 1955) dont faisaient également partie la Turquie, l'Irak, le Pakistan et la Grande-Bretagne (ce pacte est devenu le Cento : Central Treaty Organization en 1959, après le retrait de l'Irak ; les États-Unis participaient aux commissions militaires et économiques du pacte, et conclurent avec les États membres des accords bilatéraux de coopération militaire et économique en mars 1959).
Quoique les relations avec l'U.R.S.S. aient été peu cordiales depuis la chute du Dr Mossadegh, un accord fut cependant signé en décembre 1954, portant sur le règlement des dettes de guerre de l'U.R.S.S. envers l'Iran et sur la délimitation des frontières. Le shah effectua un voyage officiel en U.R.S.S. en 1956.
Le ministère Ala n'apporta pas beaucoup d'améliorations à la situation politique et économique, en dépit d'une aide financière considérable des États-Unis ; le régime policier de répression était toujours en vigueur et le Premier ministre fut même victime d'un attentat en novembre 1955. Finalement, en avril 1957, Hoseyn Ala fut remplacé par Manoutshehr Eghbal qui instaura une politique plus souple : suppression de la loi martiale, mise sur pied d'un régime à caractère démocratique. C'est alors qu'apparurent des partis politiques dont les principaux étaient le Mardom (« le peuple ») fondé en 1957, et le Melliun (Parti national) fondé en février 1958 ; par la suite, en 1963, a été créé le Iran Novin (Parti de l'Iran nouveau) ; les uns et les autres ne représentaient que les milieux des conservateurs, des bourgeois, des fonctionnaires et donnaient l'illusion d'un système bi-partisan ; la corruption et le truquage des élections continuaient comme auparavant. En fait ces partis n'apparaissaient qu'en période d'élections pour donner une apparence de jeu démocratique entre le gouvernement et une prétendue opposition ; en dehors de ces périodes, leur rôle au Parlement – comme d'ailleurs le rôle du Parlement lui-même – était réduit au minimum. Selon la Constitution de l'Iran, le pouvoir exécutif était aux mains du shah, qui désignait le Premier ministre : celui-ci devait recevoir l'approbation du Parlement. Le Premier ministre constituait un cabinet dont les ministres étaient responsables devant le Parlement, qui pouvait être dissous par le shah. Le pouvoir législatif appartenait au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le Sénat, constitué pour la première fois en 1950, comprenait soixante sénateurs dont trente nommés par le shah, et trente élus (15 pour Téhéran et 15 pour les provinces).
L'Assemblée nationale (Madjlis, ou Parlement) comprenait deux cents députés élus pour quatre ans au suffrage universel (les femmes ont reçu le droit de vote et ont pu être élues à partir de 1963). L'Iran est divisé en quatorze provinces (ostān) administrées chacune par un gouverneur général directement responsable devant le gouvernement central : le rôle des gouverneurs généraux est extrêmement important, car ils sont chargés de faire appliquer la politique du gouvernement et d'assurer l'ordre dans leur province.
Les élections de juillet-août 1960 pour un Parlement de transition (deux ans) donnèrent lieu à des irrégularités telles que le shah annula les élections ; Eghbal démissionna et fut remplacé par Djafar Sharif Emami, chef du parti Melliun ; aux élections de janvier 1961, ce parti obtint une large majorité, mais Emami eut à faire face à une opposition non parlementaire, qui contestait la régularité des élections, demandait une réforme de la loi électorale et réclamait la liberté d'expression pour tous. En mai 1961, les élections furent annulées et Ali Amini, chef de l'opposition parlementaire, devint Premier ministre avec les pleins pouvoirs. Il se lança dans la lutte contre la corruption, procéda à l'arrestation d'officiers compromis dans des actions de répression brutale, ouvrit une enquête sur les ressources de la presse (et en profita pour éliminer les journaux de l'opposition), annonça un programme de réforme agraire ; mais en même temps il fit arrêter et déporter dans le Sud des membres du Front national et maintint le Dr Mossadegh – qui aurait dû être libéré – en résidence surveillée.
Des tentatives de réforme
Le lancement de la « révolution blanche » en janvier 1962 avait été pour le shah et son gouvernement un acte de modernisation destiné à améliorer le sort de la population rurale qui constituait la grande majorité des Iraniens ; des lois promulguées par la suite visèrent à mettre en place des organismes d'aide aux paysans et l'on pouvait alors penser que l'Iran s'engageait dans la voie d'un progrès économique et social dont les premiers bénéficiaires seraient les paysans. Toutefois la réforme agraire avait fait aussi des mécontents parmi les grands propriétaires fonciers, laïcs et religieux. Surtout, les belles intentions n'avaient pas été suivies d'applications pratiques suffisantes, faute d'un personnel qualifié et d'une volonté de persévérance. Pourtant en 1964 le Premier ministre Hasan Ali Mansour fit voter une loi limitant les grands domaines, mais en janvier 1965 il fut tué au cours d'un attentat commis par les Fedayān-e Eslām ; un attentat manqué contre le shah, en avril 1965, entraîna de sévères répressions contre les milieux de gauche et d'extrême gauche, mais elles s'exercèrent aussi contre les réactionnaires et contre les religieux, notamment contre l'ayatollah Khomeyni ; celui-ci était connu comme l'un des principaux chefs de la communauté shī‘ite depuis 1944, date à laquelle il avait critiqué la tendance à la laïcisation du régime et ses orientations économiques ; ses critiques étant devenues de plus en plus dures, et, son audience s'accroissant, il fut arrêté plusieurs fois puis condamné à l'exil ; installé en Irak en 1965, il conduisit depuis ce pays sa lutte contre le régime du shah.
Le gouvernement iranien mena aussi une politique extérieure dynamique. La guerre israélo-arabe de 1967 avait mis en lumière les répercussions en Occident des événements du Proche-Orient, notamment en matière d'approvisionnement en pétrole ; dans ces conditions, le shah pensa pouvoir jouer un rôle déterminant dans la vie économique et politique du Proche-Orient et du monde occidental.
Le IVe plan quinquennal présenté en 1968 par le Premier ministre Amir Abbas Hoveyda prévoyait l'augmentation de la production intérieure (57 p. 100 en cinq ans), la création de deux millions d'emplois, le développement de l'industrie lourde, des industries alimentaires, des voies de communication ; l'éducation et la santé devaient être l'objet d'attributions de crédits substantielles, mais, en raison du contexte politique oriental, c'est l'armée qui reçut la meilleure part, son budget étant porté à 500 millions de dollars. L'essentiel des ressources financières devait être fourni par une augmentation constante de la production pétrolière : de fait, de 129 millions de tonnes en 1967, elle passa à 250 millions en 1972 et à 290 millions en 1973, les revenus correspondants passant de 750 millions de dollars en 1967 à 3 885 millions en 1973. De son côté, l'Union soviétique apporta une contribution importante à la construction de la voie ferrée Téhéran-Caspienne, signa un accord pétrolier et participa à la construction d'une vaste aciérie à Ispahan ; d'autres complexes sidérurgiques furent construits, notamment à Ahwaz. Les bons rapports avec l'Union soviétique furent aussi concrétisés par la construction du gazoduc transiranien qui permit la livraison aux Soviétiques de 17 millions de mètres cubes de gaz dès 1970.
La volonté de puissance montrée par le shah se manifesta sur le plan militaire par la constitution, avec l'aide des États-Unis, d'une armée sur-équipée qui devint rapidement l'une des premières du monde ; elle lui permit d'affirmer les prétentions iraniennes dans la région du Golfe, vitale pour l'exportation du pétrole iranien ; en même temps il établit des relations plus étroites avec l'Arabie Saoudite et le Koweït, un peu plus tard avec l'Égypte, tandis que les rapports avec l'Irak se détérioraient de façon sensible à cause du différend frontalier du Chatt al-Arab et du droit d'asile accordé par le gouvernement irakien à des opposants politiques iraniens ; c'est seulement en mars 1975 que fut réglé le différend frontalier ( accord d'Alger) et à cette occasion les deux gouvernements s'engagèrent à ne plus accorder de soutien à leurs opposants respectifs. L'Iran apporta son concours militaire au sultan d'Oman, aux prises avec une rébellion militaire dans le Dhofar.
Le rapprochement avec les pays arabes parut un moment menacé lorsque les troupes iraniennes, le 30 novembre 1971, occupèrent trois îlots du golfe Persique (Abou Moussa, Grande Tomb et Petite Tomb), au large des côtes des Émirats arabes dont la GrandeBretagne s'était retirée peu auparavant ; cette occupation fut l'un des épisodes de la politique pétrolière de l'Iran, marquée par la construction de plusieurs raffineries (en particulier celle d'Abadan, l'une des plus importantes du monde), par la mise en service en novembre 1972 de l'énorme terminal pétrolier de l' île de Kharg et par de nouveaux accords avec le consortium pétrolier international qui donnèrent à l'Iran un plus large contrôle de la production et de l'exploitation du pétrole. En mai 1973, toutes les installations du consortium devinrent la propriété de la Société nationale iranienne des pétroles (S.N.I.P., en anglais N.I.O.C.) ; l'exploitation de ces installations fut partagée entre la S.N.I.P. (51 p. 100) et le consortium (49 p. 100) ; la production devait être portée à 400 millions de tonnes en 1975 (elle n'atteindra en fait que 294 millions de tonnes) sur lesquelles la part de la S.N.I.P. devait être de 75 millions de tonnes.
Planification erronée et démesure
Cependant la situation politique intérieure ne donne pas les mêmes satisfactions au gouvernement iranien ; la contestation est vive parmi les intellectuels et les étudiants : une sévère répression s'abat sur eux et, à plusieurs reprises, l'université de Téhéran est fermée ; des opposants sont arrêtés, passent en jugement de façon expéditive, voire illégale ; la police politique (Savak) manifeste une activité grandissante : aux arrestations, procès et exécutions répond en avril 1971 l'assassinat du chef de la justice militaire ; mais cette opposition n'est le fait que d'une fraction limitée de la population et la toute-puissance gouvernementale apparaît dans les résultats des élections aux assemblées départementales où le parti officiel, Iran Novin, remporte 97,5 p. 100 des sièges (sept. 1970), puis aux élections législatives où il gagne 239 sièges sur 280 (juill. 1971). Ces élections confortables permettent au shah de célébrer avec un faste démesuré le 2500e anniversaire de la monarchie persane à Persépolis (oct. 1971), à l'occasion duquel l'ayatollah Khomeyni lance un appel à la désobéissance civile, appel qui reste alors sans grand écho. À cette époque, l'opposition est peu organisée, n'a pas de chef d'envergure, et sa lutte, très fragmentaire, n'est pas encore ressentie en profondeur par la population.
L'année 1973 marque pour l'Iran le début d'une nouvelle politique pétrolière, mise davantage en valeur à la suite de la guerre israélo-égyptienne d'octobre 1973 et de l'utilisation par les pays arabes de l'« arme du pétrole », ce dont bénéficient les pays producteurs groupés au sein de l' O.P.E.P. qui, réunie à Téhéran à la fin de décembre 1973, fixe le prix du baril à 11,651 dollars, soit près de quatre fois son prix du mois d'octobre. À cette occasion, le shah d'Iran déclare entretenir des relations réalistes avec l'Occident, notamment avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.).
L'augmentation considérable des revenus attendue du relèvement du prix du pétrole doit permettre de lancer en Iran des projets d'investissements dont l'Occident peut tirer des bénéfices certains. Simultanément, la mise en route du Ve plan quinquennal, revu en hausse, vise à favoriser l'agriculture, les investissements à caractère social, la lutte contre les épidémies, et à assurer une croissance démographique raisonnable. Mais le gouvernement iranien lance aussi de vastes projets d'industrialisation dans le domaine pétrochimique, dans celui de l'énergie nucléaire et dans la construction de nouvelles raffineries de pétrole ; sont également prévues la construction d'usines de montage d'automobiles et d'un métro à Téhéran, l'extension des voies ferrées et du réseau routier. Des contrats fabuleux sont passés, en 1974 et 1975, avec les États industrialisés, cependant que des millions de dollars sont consacrés à l'équipement de l'armée iranienne dont le shah et les États-Unis veulent faire le « gendarme de l'Orient ». L'abondance des pétrodollars donne au gouvernement iranien la possibilité d'acquérir 25 p. 100 du capital des usines Krupp (juill. 1974), une participation dans Eurodif et dans des sociétés industrielles diverses du monde occidental (janv.-avr. 1975).
Dans l'euphorie de la richesse, le shah et le gouvernement ne connaissent plus de bornes à la démesure ; le succès économique fait passer au second plan les problèmes politiques internes, considérés comme mineurs : le développement du pays ne doit pas être mis en cause par une quelconque opposition, même parlementaire ; aussi, en mars 1975, est institué le système du parti unique, le Rastākhiz (« Parti du renouveau »), placé sous le contrôle étroit du shah et du gouvernement. Les élections de juin 1975 ne sont qu'une formalité : le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement, toutes les décisions émanant du shah ou de son entourage et de quelques personnalités, parfois extérieures au gouvernement.
Les dirigeants de l'Iran, obnubilés par leurs projets grandioses, négligent de plus en plus les problèmes immédiats, surtout les problèmes sociaux et humains ; la nouvelle fortune de l'Iran profite à une minorité : chefs d'entreprise, banquiers, intermédiaires et gens bien placés auprès des responsables de l'économie iranienne. En même temps, une vague d'occidentalisation déferle sur le pays, une occidentalisation qui ne vise qu'à satisfaire des appétits matériels et nullement des besoins primordiaux et plus profonds ; l'accaparement de la fortune par quelques privilégiés, malgré une augmentation incontestable du revenu moyen des Iraniens, la dilapidation des richesses dans des investissements trop nombreux, trop souvent mal adaptés, le renchérissement du coût de la vie, tout cela entraîne un mécontentement grandissant ; il s'y ajoute l'exode de nombreux paysans vers les villes où ils espèrent trouver emploi et meilleures conditions d'existence, ce qui n'est pas toujours le cas : le résultat le plus tangible est un accroissement énorme de la population urbaine et le développement de formes d'habitat précaire, en particulier autour de Téhéran.
La contestation s'affermit
Le shah et le gouvernement considérant comme inadmissible toute opposition à leur politique, il s'ensuit une activité grandissante de la Savak et une répression qui ne fait qu'accentuer la réaction des mouvements et des groupes contestant cette politique, tels les Moudjahidin-e Khalq, d'obédience islamo-progressiste, et les Fedā'iyān-e Khalq, de tendance marxiste ; les mouvements religieux opposés au shah n'apparaissent pas encore au grand jour. Ces groupes se manifestent par des attentats contre les personnalités du régime, des attaques contre des banques, des tentatives de manifestation politique ; la Savak les poursuit avec acharnement, et la plupart des procès engagés contre les « terroristes » se terminent par des condamnations à mort et des exécutions ; la répression est dure, mais ne décourage nullement les opposants, qui recrutent leurs adhérents dans les milieux intellectuels et les milieux ouvriers. Les dirigeants d'anciens partis politiques (tel le Front national, de Mossadegh), Karim Sandjabi, Mehdi Bazargan, Chapour Bakhtiyar, Ahmad Sadr, Darius Forouhar, ont aussi à subir les rigueurs du régime et sont à plus d'une reprise mis en prison : ils contribuent à donner une plus grande audience à l'opposition, d'autant qu'ils participent à la création d'un comité pour la défense des libertés et des droits de l'homme.
En août 1977, le remplacement, comme Premier ministre, d'Amir Abbas Hoveyda par Djamchid Amouzegar, spécialiste des problèmes du pétrole, témoigne de la volonté du shah de renforcer encore davantage sa politique par l'accroissement des revenus pétroliers, et de son désir de confier la direction des affaires à un homme sûr, qui a été successivement ministre des Finances et ministre de l'Intérieur avant de devenir le chef du parti unique Rastakhiz. L'Iran commence à connaître des difficultés économiques et techniques : les vastes projets d'équipement requièrent un potentiel énergétique et des spécialistes que le pays est loin de posséder ; aussi le shah envisage-t-il de combler progressivement les lacunes énergétiques par la construction de centrales nucléaires commandées aux États-Unis, à la république fédérale d'Allemagne et à la France, cependant que le grand barrage sur le Karoun voit son achèvement retardé, mais c'est à des spécialistes étrangers qu'il est fait appel : les millions de dollars nécessaires seront fournis par les ventes de pétrole ; cette politique se fait au détriment des équipements sociaux et de l'amélioration des conditions de vie, car l'augmentation du prix du pétrole se répercute sur les produits importés : on estime qu'en 1977 l'Iran a connu un taux d'inflation de 25 p. 100, ce dont souffrent les catégories les plus humbles de la population, alors que la corruption règne dans les milieux de la cour et des affaires.
Cette situation favorise l'action des opposants au régime qui dénoncent les scandales financiers, la prévarication, la démesure des achats d'équipements militaires, l'échec de la politique économique et l'action répressive de la police politique. Les manifestations contestataires se multiplient de plus en plus ouvertement, certaines allant jusqu'à demander le départ du shah et le changement de régime, d'autres exigeant surtout le rétablissement des libertés, l'abolition de la censure et la suppression de la Savak. Ces manifestations se déroulent dans toutes les principales villes et réunissent des participants appartenant à tous les milieux sociaux et culturels ; à la répression sanglante par la police répondent des grèves et, pour la première fois, les commerçants du grand bazar de Téhéran (les bazaris, représentants de la moyenne et de la petite bourgeoisie, musulmans convaincus) s'y joignent pour protester à la fois contre la situation économique, les actions policières et la dégradation de la moralité : cet apparent amalgame est en fait la marque du poids grandissant des milieux religieux qui protestent contre la modernisation et l'occidentalisation effrénées du pays, contre la corruption, contre la part trop belle faite aux intérêts étrangers dans l'économie nationale ; pour beaucoup d'opposants, le recours à l'islam shī‘ite – qui, originellement et théoriquement, lutte pour la justice et contre l'autoritarisme du pouvoir – est un moyen d'attirer les masses et de donner une base plus large à la révolte contre le shah, désigné de plus en plus comme le vrai responsable de la situation du pays.
La fin du régime impérial
Durant le premier semestre de 1978, de violentes émeutes éclatent dans diverses villes notamment à Tabriz, à Qom, à Mechhed, à Téhéran ; elles reçoivent le soutien des autorités religieuses shi'ites (les ayatollahs, littéralement « signes de Dieu ») et surtout du plus célèbre et du plus populaire, l'ayatollah Khomeyni qui, de Nadjaf, en Irak, lance de virulentes attaques contre le shah, appelant la population à se révolter contre celui-ci, à le renverser et à établir en Iran un nouveau pouvoir dont les principes fondamentaux de l'islam constitueront la base. Bien que les chefs religieux shi'ites et les dirigeants des partis (illégaux) réformistes libéraux, progressistes ou marxistes ne conçoivent pas l'avenir de l'Iran de la même façon, ils unissent leurs forces pour renverser le régime impérial. De timides tentatives de libéralisation mises en œuvre par le gouvernement sont annulées par le drame d'Abadan (19 août 1978) où 377 personnes périssent dans l'incendie d'un cinéma, incendie peut-être d'origine criminelle et politique. Sur le plan extérieur, le shah reçoit l'appui, outre celui des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et de la Chine (Hua Guofeng se rend en visite à Téhéran en août 1978). À l'intérieur, le gouvernement est désormais dirigé par Djafar Charif-Emami, musulman pratiquant et technocrate tout dévoué au shah ; mais le nouveau ministère n'a pas de politique déterminée et répond aux manifestations par la loi martiale ; l'opposition religieuse, le Front national et le parti Tudeh (communiste) déclenchent des grèves et de vastes mouvements de masses ; la population, à l'appel de l'ayatollah Khomeyni, rend hommage aux centaines de victimes de la répression policière par des journées de deuil national ; Khomeyni quitte l'Irak pour la France le 8 octobre 1978 ; de cette date jusqu'à son retour en Iran, le 1er février 1979, la petite ville de Neauphle-le-Château devient le quartier général de la lutte contre le régime impérial. Malgré la tentative de Chapour Bakhtiar, nommé Premier ministre à la fin de décembre, de promouvoir un régime à tendance social-démocrate et d'enrayer le processus de renversement du shah, celui-ci perd les uns après les autres ses appuis intérieurs, à l'exception de l'armée, et ses appuis extérieurs, les États-Unis lui retirant leur caution. La situation du pays, qui ne cesse de se dégrader, évolue inexorablement, vers l'issue attendue : le 16 janvier 1979, le shah, sa famille et quelques-uns de ses proches quittent l'Iran. Ce départ, accueilli avec enthousiasme par l'immense majorité de la population, crée un sérieux malaise politique, l'armée apportant son soutien au gouvernement Bakhtiar et cherchant à empêcher la constitution d'un gouvernement « islamique », au besoin par la force. L'arrivée de l'ayatollah Khomeyni à Téhéran, le 1er février 1979, déclenche le processus ultime : investi spontanément de l'autorité sur le pays, le 5 février il désigne Mehdi Bazargan comme Premier ministre ; en dépit d'une dernière tentative de résistance de Chapour Bakhtiar et de l'armée, en quelques jours la victoire de l'ayatollah et de ses alliés est totale. Très vite, des comités de « khomeynistes » contrôlent étroitement la vie politique, tandis que des « tribunaux islamiques » commencent à juger et à faire exécuter de façon expéditive des personnalités civiles et militaires de l'ancien régime ; l'ancien Premier ministre, Amir Abbas Hoveyda, est exécuté le 7 avril après un simulacre de procès.
La République islamique Une phase d'adaptation
Le 31 mars 1979, un référendum approuve à 98 p. 100 des votants l'institution de la République islamique, mais les abstentions ont été nombreuses parmi les Kurdes, les Turkmènes, les milieux de gauche et les classes moyennes. Le gouvernement de Mehdi Bazargan doit faire face à de graves problèmes politiques : ralliement de l'armée, durement éprouvée par les exécutions, limitation des excès des tribunaux islamiques, dissensions parmi les triomphateurs car les partis de gauche, écartés du pouvoir, se méfient de l'intégrisme des milieux shi'ites, mouvements autonomistes en Azerbaïdjan, au Kurdistan, en pays turkmène et dans les régions arabes du Sud ou du Khouzistan. Les problèmes économiques ne sont pas moindres : remise en route des diverses activités, discussions serrées avec les ouvriers d'Abadan, fortement politisés, reconsidération des plans d'investissement et d'équipement. De nombreux contrats sont annulés, en particulier, ceux qui concernent l'énergie nucléaire. Les rapports avec les États-Unis sont tendus, les relations diplomatiques avec Israël rompues ; en revanche, l'Organisation de libération de la Palestine est reconnue et Yasser Arafat reçoit à Téhéran un accueil enthousiaste. Le gouvernement iranien met fin à l'activité du consortium pétrolier international et entend gérer lui-même l'exploitation et l'exportation de son pétrole ; en juin 1979 sont nationalisées les banques, les compagnies d'assurances et les principales sociétés industrielles.
Cependant les milieux laïques s'inquiètent des excès des partisans du renouveau de l'islam qui imposent des mesures restrictives touchant certaines catégories d'individus, les femmes par exemple, ou certaines activités, notamment en cherchant à contrôler les principaux journaux. Au sein même des milieux religieux un clivage apparaît entre éléments intégristes, partisans de l'ayatollah Khomeyni, rassemblés dans le Parti de la République islamique dirigé par l'ayatollah Behechtī, et éléments progressistes qui suivent l'ayatollah Taleghani et sont proches des groupes de gauche tels les Moudjahidin-e Khalq et le Front national démocratique animé par le fils du Dr Mossadegh. Des attentats visant des religieux intégristes créent un climat tendu, aggravé par les revendications des ouvriers, conscients du rôle qu'ils ont joué dans la révolution, conscients aussi de la place qu'ils tiennent dans la vie économique du pays.
En attendant qu'une nouvelle constitution soit élaborée, l'imam Khomeyni s'attache à détruire les structures du régime impérial pour construire une république totalement islamique en s'appuyant sur la grande majorité des chefs religieux shi'ites, sur les « gardiens de la révolution » (pāsdārān, ou milice armée) et sur une grande partie de la population proprement iranienne, soit que celle-ci ait souffert du régime précédent, soit qu'elle ait participé à la lutte et aspiré à un nouvel ordre social et moral, soit encore qu'elle ne connaisse que les mots d'ordre des ayatollahs. Les partis modérés laïques ou religieux et les partisans de gauche pencheraient pour un régime démocratique, parlementaire et laïque, mais ils ne peuvent s'exprimer ou se taisent volontairement. Le gouvernement Bazargan navigue à vue entre un pouvoir islamique inconditionnel et un réformisme prudent qui n'ose pas dire son nom, mais surtout il manque d'autorité face à l'imam Khomeyni, au Conseil de la révolution installé à Qom et à quelques groupes de pression comme les « étudiants islamiques », qui en fait décident de la politique générale et de ses applications pratiques, y compris les excès dans la répression. La mort soudaine de l'ayatollah Taleghani (sept. 1979) enlève aux modérés le leader qui pouvait tenter d'infléchir le régime ; celui-ci a été conforté par les élections à l'Assemblée constituante où les représentants religieux favorables au Parti républicain islamique de Khomeyni emportent 75 p. 100 des sièges ; il est vrai que les modérés, les partis de gauche et les dirigeants des minorités ethniques avaient appelé au boycottage de ces élections.
La perspective d'une Constitution autoritaire et centralisatrice conduit les Kurdes à se rebeller : le pouvoir engage à fond l'armée contre eux (août-sept.) et se lance dans une violente campagne antiaméricaine, accentuée par le fait que le shah se rend aux États-Unis pour se soigner (22 oct.), et dont l'aboutissement est, le 4 novembre, l'occupation de l'ambassade des États-Unis à Téhéran et la séquestration de soixante otages américains par des « étudiants islamiques », ces derniers demandant, en échange de la libération des otages, l'extradition et le procès du shah. À Bazargan démissionnaire, le Conseil de la révolution ne donne pas de successeur, cependant que le ministre des Affaires Étrangères, Bani Sadr, en désaccord avec les étudiants islamiques détenteurs des otages, doit céder la place à Sayyed Ghotbzadeh, qui, plus proche de Khomeyni, sera pourtant désavoué à plusieurs reprises. Au début de décembre, un référendum – auquel ne participent que la moitié des électeurs – approuve une constitution qui donne pratiquement les pleins pouvoirs à l'imam Khomeyni et ne fait aucune allusion à l'autonomie des régions allogènes, dont les populations ont d'ailleurs boycotté le référendum.
Un voyage de Kurt Waldheim, secrétaire général de l'O.N.U., à Téhéran au début de janvier 1980 en vue de négocier la libération des otages n'aboutit à aucun résultat. Par ailleurs, le refus de toute discussion sur l'autonomie des régions provoque un soulèvement à Tabriz, capitale de l'Azerbaïdjan iranien, dont le leader, l'ayatollah Chariat Madari, prône une politique plus modérée et plus souple.
Durcissement du régime et problèmes extérieurs
La politique iranienne, suivie à ses débuts avec une certaine sympathie par les pays musulmans, surtout les plus progressistes, suscite ensuite, par ses excès et son intransigeance, des réserves quasi unanimes ; par ailleurs, la situation économique, assez profondément bouleversée, pose des problèmes que le gouvernement ne peut ou ne veut pas résoudre, au nom d'un idéal religieux rejetant les contingences matérielles du monde moderne.
En janvier 1980, Bani Sadr est élu président de la République par 75 p. 100 des votants, mais la réalité du pouvoir demeure entre les mains de l'imam Khomeyni ; rapidement, Bani Sadr, qui est partisan de la séparation de la religion et de la politique, se trouve isolé ; ses efforts pour résoudre le problème des otages américains, sa tendance au réformisme le marginalisent de plus en plus et le font classer parmi les « contre-révolutionnaires pro-occidentaux », alors qu'en revanche s'affirme l'importance politique de l'ayatollah Behechti, président de la Cour suprême, qui place ses fidèles aux postes clés du pouvoir. La situation économique s'aggrave tout comme la situation politique, en raison des jugements et des exécutions sommaires et de la guerre au Kurdistan où les peshmerga kurdes s'affrontent à l'armée régulière et aux pasdarans. L'échec de la tentative américaine en vue de libérer les otages (Tabas, 24-25 avr. 1980) renforce la position des intransigeants qui, aux élections législatives d'avril 1980, remportent une victoire écrasante. Cependant, la mort du shah, à la fin du mois de juillet, relance les négociations indirectes avec les États-Unis, mais sans résultat immédiat.
Estimant la situation favorable, le président irakien, Saddam Hussein, rompt le 17 septembre 1980 l'accord de 1975 et lance ses troupes à l'attaque de l'Iran (le 17 septembre) en vue de reconquérir les territoires cédés en 1975 et surtout de provoquer la chute du régime iranien dont la propagande antibaassiste en direction de la population shī‘ite d'Irak (40 p. 100 de la population) peut constituer une menace. Cette propagande indispose également les États du Golfe et même l'Arabie Saoudite qui vont dès lors apporter leur soutien à l'Irak. L'avance des troupes irakiennes est rapide au début, mais est bientôt bloquée dans le Khouzistan : les pertes en hommes et les destructions sont considérables. La guerre a comme conséquence le rassemblement des Iraniens autour du régime de Khomeyni qui repousse toute tentative de médiation. En revanche, par l'intermédiaire des Algériens, les otages américains sont libérés le 20 janvier 1981.
N'ayant pratiquement plus ni pouvoirs ni autorité, Bani Sadr, qui a essayé de redresser son image de marque et sa popularité en s'intéressant de près à la guerre irako-iranienne, est finalement destitué le 21 juin 1981 : il réussit à échapper à ses adversaires et finit par trouver refuge en France en juillet, en compagnie de Masoud Radjavi, chef des Moudjahidin-e Khalq. À Téhéran, des attentats coûtent la vie à l'ayatollah Behechti (28 juin), au nouveau président de la République Mohammad Ali Radjai et au Premier ministre Mohammad Javad Bahonar (30 août) ainsi qu'à l'ayatollah Madani (11 sept.). Ces attentats entraînent de nouvelles vagues d'exécutions, notamment parmi les Moudjahidin-e Khalq. L'hodjatoleslam Ali Khamenei est élu président de la République (2 oct.) et Mir Hossein Moussavi devient Premier ministre.
L'année 1982 est marquée, sur le plan intérieur, par plusieurs faits : la répression s'accentue contre la communauté bahā'i, contre les Moudjahidin-e Khalq, considérés comme les opposants les plus dangereux ; Seyyed Ghotbzadeh est arrêté, sous prétexte de complot contre l'imam Khomeyni, condamné à mort et exécuté (15 sept.) ; ce prétendu complot permet aussi d'écarter l'ayatollah Chariat Madari, chef spirituel des Azéris, de tendance modérée ; cette action manifeste la radicalisation du régime qui par ailleurs poursuit ses attentats contre les autonomistes kurdes.
Sur le plan extérieur, l'armée iranienne prend l'offensive contre les Irakiens, qui se voient contraints d'abandonner les parties du territoire d'Iran qu'ils avaient occupées. La propagande antibaassiste des Iraniens ne reçoit pas d'écho en Irak où la population, y compris les shi'ites, se regroupe autour de Saddam Hussein. Cette propagande prend également un aspect anti-arabe et antisunnite par des manifestations de pèlerins iraniens à La Mecque et par des menaces lancées contre les émirats du Golfe.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7018#forumpost7018
Posté le : 25/10/2014 18:12
|
|
|
|
|
Iran 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Poursuite de la guerre et rivalités internes
La guerre avec l'Irak conduit le gouvernement iranien à accentuer sa politique de répression à l'intérieur et à créer des rapports souvent tendus avec les pays qui soutiennent l'Irak et lui fournissent des armements : au premier rang figurent l'Union soviétique et la France. En Iran, le Parti communiste ( Tudeh) fait l'objet de mesures draconiennes : mise hors la loi, arrestation et exécution de nombre de ses dirigeants, son secrétaire général, Noureddine Kianouri, doit faire des « aveux » sur un prétendu complot tendant à renverser le régime. Celui-ci est épaulé par les pasdarans (membres des comités islamiques) qui se renforcent et quadrillent le pays, exerçant sur celui-ci une pression policière qui souvent dégénère en terreur ; on estime que, depuis le début de la République islamique, près de 5 000 personnes ont été exécutées, dont plus de la moitié après l'éviction de Bani Sadr.
Les offensives iraniennes dans le secteur du Chatt al-Arab ne donnant pas les résultats escomptés, les Iraniens ouvrent un nouveau front dans le Kurdistan, à la frontière nord-est de l'Irak, spéculant sur un appui des Kurdes hostiles au gouvernement de Bagdad et sur la réussite d'une percée en direction de Kirkouk, centre de l'exploitation pétrolière d'Irak (oct. 1983). Simultanément, le gouvernement de Téhéran lance des avertissements à propos de la navigation dans le détroit d'Ormuz aux États arabes du Golfe, coupables de soutenir l'Irak, et Bagdad inaugure ce que l'on appellera « la guerre des villes », c'est-à-dire le bombardement aérien de villes à l'intérieur de l'Iran, y compris Téhéran et Ispahan, à quoi les Iraniens répondent en bombardant Bagdad et Bassorah. Par ailleurs, la livraison d'avions Super-Étendard par la France aux Irakiens entraîne une très vive tension entre Paris et Téhéran, qui se traduit par des expulsions réciproques de diplomates.
Au début de l'année 1984, les Iraniens lancent de nouvelles offensives sur trois fronts : le Kurdistan, la région Amarah-Kurna et le secteur sud du Chatt al-Arab dans lequel les îles Madjnoun sont occupées et où Bassorah est directement menacée. Les élections législatives d'avril 1984 donnent d'autant plus la majorité au parti au pouvoir que l'opposition modérée, à la tête de laquelle se trouve alors Mehdi Bazargan, boycotte ces élections ; en fait, l'opposition, dans toutes ses composantes, est divisée et impuissante face aux structures du Parti de la République islamique, solidement installé dans le pays, mais qui connaît des rivalités internes marquées par des incidents divers : refus par le Madjlis de la confiance à plusieurs ministres (même si le Premier ministre, Mir Hoseyn Moussavi, est facilement reconduit dans ses fonctions), arrestations, répression contre ceux qui sont soupçonnés de ne pas respecter les règles islamiques. L'imam Khomeyni témoigne de son appui aux « radicaux » dans la conduite de la politique en donnant une délégation de pouvoir à l'ayatollah Hoseyn Ali Montazeri, l'un de leurs chefs. À la fin de l'année 1985, Montazeri est officiellement confirmé comme successeur de Khomeyni, mais cela ne met pas fin à la lutte pour le pouvoir. En août 1985, Ali Khamenei est réélu président de la République par 85 p. 100 des votants (au lieu de 95 p. 100 en 1981) et le taux de participation n'est que de 60 p. 100, alors qu'il était de 80 p. 100 en 1981.
La guerre avec l'Irak se poursuit avec tous les moyens possibles : attaques terrestres iraniennes dans le Kurdistan et dans le Chatt al-Arab, bombardements réciproques des grandes villes par avions et par missiles, attaques aériennes des Irakiens contre le terminal pétrolier de l' île de Kharg – ce qui entraîne une diminution sensible des exportations de pétrole iranien – et surtout utilisation d' armes chimiques par les Irakiens pour stopper les offensives iraniennes au nord et au sud. Une mission de l'O.N.U. recherchant un compromis pouvant mener à la paix aboutit à un échec complet.
Décidé à porter au régime de Saddam Hussein des coups décisifs, le gouvernement iranien lance une attaque dans le Chatt al-Arab qui lui permet de s'emparer du port de Fao et une autre dans le Kurdistan irakien ; lorsqu'en août 1986 Saddam Hussein propose l'ouverture de négociations, celles-ci sont totalement rejetées par les Iraniens, forts de leurs succès militaires, forts aussi des changements survenus dans leurs rapports avec certains États occidentaux : ainsi, les relations entre Paris et Téhéran s'améliorent, des négociations s'engagent sur le règlement du contentieux financier (remboursement par la France des fonds versés par le shah pour la construction de la centrale nucléaire Eurodif) et surtout, en échange de l'expulsion de France de l'opposant iranien Masoud Radjavi, le 7 juin 1986, deux otages français du Liban sont libérés le 20 juin.
En Iran, l'ayatollah Montazeri ne peut parvenir à imposer son autorité et tombe, ainsi que ses proches, dans une disgrâce qui profite à l'hojjatol-eslām Rafsandjani, président du Madjlis. Bien que l'imam Khomeyni ait à nouveau condamné tout rapprochement avec les États-Unis, on apprend, à la fin du mois de novembre, que des ventes secrètes d'armes américaines ont eu lieu, ce qui provoque aux États-Unis l'éclatement du scandale appelé « Irangate », et en Iran des critiques sévères contre Rafsandjani, accusé d'avoir cherché une amélioration des relations avec les Américains. À la suite du rejet par les Iraniens de l'appel à la paix lancé par le sommet des États islamiques, et en dépit de difficultés économiques croissantes, de nouvelles offensives ont lieu dans le Chatt al-Arab et le Kurdistan ; la menace iranienne dans le Golfe se précisant, les grandes puissances y envoient des navires de guerre afin de protéger les pétroliers. Les tensions avec le monde arabe s'accentuent : à la suite de la découverte d'un « complot » islamiste en Tunisie, ce pays rompt les relations diplomatiques avec l'Iran (mars 1987) et, en juillet, des incidents provoqués à La Mecque par des pèlerins iraniens aboutissent à une répression sanglante où des centaines d'Iraniens trouvent la mort ; l'attitude du gouvernement de Téhéran se durcit : attaques de pétroliers dans le Golfe, refus total de tout cessez-le-feu malgré les appels de l'O.N.U. en faveur de la paix ; au sommet arabe de Amman, l'Iran est condamné. La seule amélioration notable apparaît dans les relations avec la France : à la fin de novembre 1987, deux otages français du Liban sont libérés en échange du libre départ pour l'Iran de Wahid Gordji, tenu par les Français pour un des acteurs, direct ou indirect, des attentats meurtriers de septembre 1986 à Paris. Au contraire, les relations s'enveniment avec les Britanniques et avec les Américains, et de graves incidents se produisent dans le Golfe.
À Téhéran, les clans s'affrontent de plus en plus nettement : c'est la lutte pour le pouvoir entre « radicaux » de Montazeri et « modérés » de Rafsandjani. Les premiers veulent la poursuite de la guerre jusqu'à la défaite totale de Saddam Hussein qui représente à la fois le laïcisme, le nationalisme arabe et la compromission avec des gouvernements étrangers ; les seconds, sans être ouvertement pour la paix, constatent la situation catastrophique de l'économie du pays et de la condition des habitants, notamment dans les villes où sévissent chômage et marché noir. En juin, le Parti de la république islamique, fondé en 1979, est dissous en raison des factions internes qui le déchirent ; un peu plus tard, les proches de Montazeri font l'objet de poursuites, d'arrestations, et l'un des plus notables, Mehdi Hachemi, est même exécuté. Il semble alors que Rafsandjani l'emporte sur ses adversaires et qu'une certaine ouverture se fasse jour car des discussions sont engagées sur l'éventuelle participation aux élections du Mouvement de libération nationale de Mehdi Bazargan. Mais le Conseil de surveillance de la Constitution, créé en 1980 et composé de personnalités hostiles à toute libéralisation du régime, représente un obstacle aux tentatives de réformes ; pourtant, Khomeyni paraît soutenir les réformateurs lorsque, en février 1988, il institue au-dessus de ce Conseil un petit comité, le « Conseil de discernement », destiné, théoriquement, à limiter les pouvoirs de celui-ci : en fait, il s'agit du renforcement des pouvoirs personnels de l'imam car, parmi les membres de ce comité, figurent son propre fils et le chef de son secrétariat personnel ; cette attitude n'échappe pas à Mehdi Bazargan qui critique sévèrement cette accentuation de l'absolutisme et réclame l'arrêt de la guerre : le résultat en est l'arrestation de nombre de ses partisans.
Le règlement du conflit
Alors que les opérations militaires menées au début de l'année 1988 dans le Kurdistan sont favorables aux Iraniens avec la prise des villes de Halabja et de Khurmal, en revanche, dans le Sud, la contre-offensive irakienne aboutit en avril à la reconquête de Fao, en mai et juin à celle de Chalamcheh puis des îles Madjnoun. Rafsandjani, qui a été réélu président du Madjlis, est alors nommé commandant en chef des forces armées, mais celles-ci sont maintenant partout sur la défensive et doivent même abandonner le Kurdistan irakien.
Finalement, le 18 juillet 1988, l'Iran accepte sans condition la résolution 598 du Conseil de sécurité de juillet 1987 exigeant l'arrêt des combats. Le 20 août, le cessez-le-feu entre en vigueur et des négociations doivent commencer peu après sous l'égide de l'O.N.U. ; mais les problèmes demeurent : demande instante de Téhéran de voir l'Irak désigné comme l'agresseur, fixation de la frontière dans le Chatt al-Arab, échange des prisonniers. En novembre, les pourparlers sont interrompus.
Les relations avec l'extérieur
Pendant ce temps, à Téhéran, la démission du Premier ministre Mir Hossein Moussavi est refusée, mais certains ministres de son cabinet sont très contestés par le Madjlis. Les rivalités internes sont fatales aux partisans de Montazeri, dont onze sont exécutés en novembre, ouvrant la voie à toute une vague d'exécutions politiques. À la fin de l'année, l'imam Khomeyni décrète la limitation des pouvoirs du Conseil de discernement qui, en certaines occasions, s'est permis de légiférer à la place du Parlement. Après la reprise des relations diplomatiques avec la France, les relations économiques paraissent être relancées, mais le ministre iranien des Affaires étrangères réclame la libération d'Anis Nakkache, compromis dans la tentative d'assassinat à Paris de l'ancien Premier ministre iranien Chapour Bakhtiyar, et cette demande est mal reçue par le gouvernement français. Éprouvé par la guerre, mais paradoxalement peu endetté et disposant de revenus potentiels considérables avec le pétrole, l'Iran envisage un redémarrage rapide de son économie, en utilisant au besoin, directement ou indirectement, les techniques et les compétences de l'Occident dont certains États sont tout prêts à apporter leur concours très intéressé.
Mais, le 15 février 1989, l'imam Khomeyni décrète un arrêt de mort à l'encontre de l'écrivain britannique Salman Rushdie, auteur d'un livre jugé blasphématoire à l'égard de la religion musulmane et du Prophète. Cet appel à l'assassinat, étendu à tous les éditeurs du livre, soulève l'indignation dans les pays occidentaux et entraîne le rappel des ambassadeurs des pays de la Communauté européenne à Téhéran, tandis que les Iraniens répondent par le rappel de leurs propres ambassadeurs. Cet événement illustre la volonté de l'imam d'apparaître comme le défenseur intransigeant de la religion, face aux dévoiements dus aux compromissions avec les pays occidentaux : défenseur unique, puisque les autres chefs musulmans n'ont pas du tout, ou guère, réagi à la publication du livre ; défenseur motivé, puisque adepte du shi'isme, seule véritable expression de la religion musulmane ; il s'agit pour l'imam, convaincu de détenir la vérité, non seulement d'être le combattant de l'islam, mais aussi de se faire reconnaître comme tel par tous, de rassembler les musulmans dans la lutte contre les perversions qui le menacent, qu'elles proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur : impérialisme occidental, communisme soviétique, laïcisme, nationalisme arabe ; et, dans cette lutte, le shi'isme doit être le fer de lance de l'islam, et plus spécialement le shi'isme iranien dont lui-même est l'imam, le guide.
Cette attitude explique la rigueur nouvelle qui s'exerce vis-à-vis des opposants : Moudjahidin-e Khalq, membres du parti Tudeh, éléments dits « de gauche », dont on estime que plus de 2 500 ont été exécutés depuis la fin de la guerre, en dépit des appels à la modération de Montazeri, cependant que les partis, et spécialement le Mouvement de libération de l'Iran de Mehdi Bazargan, sont étroitement surveillés, et que les mesures de libéralisation du régime annoncées sont reportées à des jours meilleurs, l'affaire Rushdie servant de prétexte à ce report. La même affaire est évoquée par les Iraniens à la Conférence islamique de Riyād en mars 1989, mais les pays arabes ne vont pas au-delà de la condamnation du livre.
La dégradation, connue, de la santé de l'imam entraîne la rivalité de plus en plus manifeste des clans et des individus en prévision de l'élection à la présidence de la République islamique d'août 1989 : aux « radicaux », partisans de la ligne dure conduits par Moussavi Khoeiniha, procureur général, Mir Hoseyn Moussavi, Premier ministre, et surtout par Ahmad Khomeyni, fils de l'imam, s'opposent les « pragmatistes » ou modérés menés par Ali Akbar Hachemi Rafsandjani, président du Parlement, et Ali Khamenei, président de la République (qui ne peut être réélu à ce poste). Rafsandjani est finalement désigné comme candidat par l'Association des religieux combattants, parti majoritaire au Madjlis. Presque simultanément est annoncée la destitution de l'ayatollah Montazeri de ses fonctions de successeur désigné de l'imam, car il est jugé trop libéral et trop critique de la conduite des affaires du pays (28 mars), et une épuration est menée parmi les proches de Rafsandjani. À la fin du mois d'avril est nommée une commission chargée de modifier la Constitution dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du président de la République et du Premier ministre, et de la réforme du Conseil de surveillance et du Conseil de discernement.
Mais cette commission voit ses travaux interrompus par la mort de l'imam Khomeyni, le 3 juin 1989, des suites d'une opération. Le président de la République, Ali Khamenei est désigné, à titre provisoire, pour succéder à Khomeyni comme imam et guide, ce qui peut apparaître comme un compromis entre les tendances « dure » et « modérée ». Le 5 juin, le testament de l'imam est rendu public : il y affirme la primauté du shi'isme dans le monde musulman et demande aux Iraniens de lutter pour le triomphe de leur religion, sans concessions ni aux musulmans des autres doctrines religieuses, ni aux « athées » des pays d'Islam, ni enfin aux dirigeants non musulmans des pays de l'Ouest comme de l'Est. Les obsèques de Khomeyni se déroulent le 6 juin au milieu du délire d'une marée humaine.
La mort de l'imam ne résout rien : non seulement l'Iran se trouve dans une situation économique difficile (il dispose pourtant de ressources – dont le pétrole – et de potentialités considérables auxquelles les grandes puissances ne sont pas indifférentes) et les conditions de vie sont pénibles pour une grande partie de la population, mais surtout aucun système politique défini n'a été mis en place;
L'ère Rafsandjani
L'élection triomphale d'Ali Akbar Hachemi Rafsandjani à la présidence de la République, le 28 juillet 1989, avec 94,5 p. 100 des voix, marque un changement dans le processus révolutionnaire, voire une rupture que l'on a qualifiée, sans doute abusivement, de « Thermidor à l'iranienne », de perestroïka ou encore d'« instauration d'une IIe République ».
La réforme de la Constitution, approuvée par référendum le même jour que l'élection, institue un régime présidentiel. Le poste de Premier ministre est supprimé ; le président est assisté d'un premier vice-président et d'une pléiade de vice-présidents en charge d'un domaine particulier et doublant, de fait, la plupart des ministères. Le magistère du guide de la République est redéfini, en fonction même du profil d'Ali Khamenei, hojjat ol-eslām (clerc de niveau intermédiaire) qui ne possède pas l'aura et les qualifications religieuses de son prestigieux prédécesseur. Le guide est cantonné et confirmé dans ses fonctions politiques (qui demeurent considérables) mais ne peut désormais prétendre à la direction théologique de l'ensemble des shi'ites (cette confusion des rôles était, depuis le début de la révolution, une pomme de discorde avec nombre de grands ayatollahs, soucieux de leurs prérogatives). Sous ces nouvelles conditions, Ali Khamenei est définitivement élu guide par l'Assemblée des experts, le 9 août 1989.
Rafsandjani évince les personnalités « radicales » les plus marquantes (tels l'ancien Premier ministre Mir Hossein Moussavi et l'ancien ministre de l'Intérieur Ali Akbar Mohtashemi) et forme un gouvernement de technocrates, pour promouvoir une nouvelle politique économique, rompant avec l'étatisme révolutionnaire et dont les mots d'ordre sont « reconstruction, libéralisation, privatisation ». « On ne construit pas un barrage avec des slogans », déclare-t-il lors de sa prestation de serment. Parallèlement, Rafsandjani, soucieux d'attirer les investissements étrangers, prône une politique internationale moins agressive, dont le leitmotiv n'est plus l'exportation de la Révolution islamique. De façon symptomatique, le terrorisme, stimulé par des groupes radicaux proches du pouvoir, se « désinternationalise » et ne vise « plus » désormais « que » des opposants résidant en Iran ou à l'étranger (assassinats de Chapour Bakhtiar, dernier Premier ministre du shah, à Paris en 1991, du leader kurde Sadegh Sharafkandi à Berlin en 1992...). Dans ce contexte de dégel relatif, l'Union européenne engage, contre l'avis des États-Unis, un « dialogue critique » avec l'Iran, en 1992. La même année, les élections législatives confirment une certaine « décléricalisation » du pouvoir (le nombre de religieux élus baisse de plus de la moitié) et l'ascendant des partisans du libéralisme économique ; ceux-ci prônent cependant un rigoureux conservatisme moral, dans un climat d'atténuation sensible de la répression. Indice de ce virage vers une droite pragmatique et traditionaliste, l'élection du très intégriste hojjat ol-eslām Ali Akbar Nategh Nouri à la présidence du Parlement.
Les espoirs mis dans la nouvelle politique inaugurée par Rafsandjani s'estompent progressivement à l'épreuve des faits ; celui-ci est réélu président en 1993, mais avec seulement 63,5 p. 100 des voix. Quant aux élections législatives de 1996, elles consacrent la victoire des conservateurs intégristes, revendiquant plus de libéralisme économique et de sévérité morale, alors que se développent la contestation et les aspirations au pluralisme, dont témoigne la floraison des journaux.
À l'évidence, la reconstruction dont Rafsandjani avait fait son mot d'ordre n'a pas porté les fruits attendus. Le programme de privatisation des entreprises nationalisées a été abandonné en 1995, faute d'acquéreurs, les détenteurs de capitaux préférant la spéculation sur le cours des devises (favorisée par l'existence de plusieurs taux de change) aux placements productifs. Les sociétés étrangères hésitent à investir dans un pays mal organisé, dont la dette extérieure augmente depuis 1988 (paradoxalement, l'Iran ne s'était pas endetté pendant la longue guerre contre l'Irak, alors que, en 1996, ses arriérés de paiement représentent quelque 12 milliards de dollars). Sur le chemin souhaité, par les dirigeants pragmatiques, d'une « évolution à la chinoise », l'embargo total contre l'Iran décrété par les États-Unis en 1995, puis la loi D'Amato-Kennedy, votée par le Sénat américain en 1996, ont été d'autres obstacles : pour punir l'« État terroriste », mais non sans arrière-pensées sur les intérêts économiques futurs des États-Unis, cette loi menace de sanctions toute société qui investirait en un an plus de 40 millions ou plus de 20 millions de dollars (selon les cas) dans le secteur pétrolier en Iran (les firmes italiennes et françaises – notamment le groupe Total – ont cependant passé outre). La libéralisation quasi générale des importations de 1989 à 1993 a, par ailleurs, contribué à l'augmentation de l'inflation (22 p. 100 en moyenne par an) et à la dépréciation de la monnaie (1 dollar s'échangeait contre 70 rials en 1980, contre 7 730 en mars 2000 !). Sans doute la croissance a-t-elle repris sous les présidences de Rafsandjani, mais à un rythme très insuffisant (0,7 p. 100 par an) pour répondre à la forte augmentation démographique du pays (environ 2 p. 100 par an). On estime alors que le niveau de vie moyen de la population a diminué de moitié depuis 1977. Cette paupérisation, à peine atténuée par le subventionnement des denrées de base (pain, pétrole, essence, etc.), a entraîné des émeutes, durement réprimées, dans les grandes villes (à Mechhed, au printemps de 1992, à Ghazvin en août 1994) et dans les banlieues et cités satellites de Téhéran. Cependant, des efforts importants ont été faits dans les domaines de la santé et de l'éducation (le taux d'alphabétisation avoisine les 85 p. 100). La réalisation de quelques grands équipements (des centrales électriques notamment, mettant un terme aux coupures quotidiennes dans les villes, de la centrale nucléaire de Bouchir, dont la construction a fait l'objet d'un accord de coopération avec la Russie en 1995) tranche aussi dans un contexte global de stagnation. Mais, faute d'aide technologique étrangère suffisante, l'Iran n'a pu se doter des infrastructures qui lui seraient nécessaires : la première ligne du métro de Téhéran, dont la construction était prévue pour 1980, n'a été ouverte qu'en 2000, alors que la capitale et sa banlieue regroupent environ 10 millions d'habitants. En revanche, des équipements de moindre envergure (tels que l'électrification des villages, l'aménagement de voies secondaires, etc.) ont été réalisés à un bon rythme sous l'impulsion de la guerre sainte puis du ministère de la Reconstruction.
L'ère Rafsandjani a été marquée par un assouplissement relatif mais sensible des contrôles et de la répression qui pèsent sur la vie quotidienne et politique en Iran. Revues, journaux, cercles de pensée indépendants, étouffés pendant les dix premières années de la révolution, firent, de nouveau, une timide apparition ; cependant, plusieurs intellectuels furent jetés en prison pour leurs initiatives, les conservateurs et le guide s'opposant à toute critique et expression nouvelle, aussitôt stigmatisées comme des produits de l'« invasion », voire de l'« agression culturelle de l'Occident ».
La gesticulation et les invectives anti-impérialistes baissèrent également d'un cran pendant les deux mandats de Rafsandjani, mais les ouvertures diplomatiques vers l'Ouest demeurèrent limitées. La présidence de l'hojjat ol-eslām s'acheva par des manifestations contre l'Allemagne (un des partenaires économiques les plus actifs, avec le Japon, de la République islamique) puis par le rappel des ambassadeurs européens dans leurs pays respectifs (avril 1997), à la suite de la mise en évidence, par la justice allemande, de la responsabilité du gouvernement iranien dans l'assassinat de leaders kurdes en 1992 à Berlin. Pendant ces deux mandats, l'Iran a cependant noué des relations politiques et économiques fécondes avec les républiques proches – géographiquement et culturellement – d'Asie centrale, issues de la dislocation de l'U.R.S.S.
Au total, les conflits permanents entre tendances, instances et leaders grevèrent lourdement les projets pragmatiques de Rafsandjani. Les querelles entre un Parlement et un guide « conservateurs », d'une part, et un gouvernement d'inspiration plus « libérale », de l'autre, bloquèrent les initiatives et contribuèrent à enliser l'Iran dans un processus de tiers-mondisation politique et économique.
La présidence Khatami, un nouveau printemps iranien ?
Le mécontentement, les aspirations au déverrouillage de la société iranienne aboutirent, le 23 mai 1997, à l'élection à la présidence de la République de l'hojjat ol-eslām réformateur Mohamad Khatami, qui avait été évincé du ministère de la Culture et de l'orientation islamique pour excès de libéralisme en 1992. Khatami reçut le soutien de mouvements et de courants très disparates (déçus de l'islamisme révolutionnaire, intellectuels laïques, partisans du libéralisme économique et politique, radicaux étatistes) mais fut surtout porté au pouvoir par une majorité de jeunes (65 p. 100 des Iraniens et un tiers des électeurs ont alors moins de vingt-cinq ans) et de femmes qui participèrent massivement au scrutin, ainsi que par les minorités marginalisées (Kurdes, Baloutche...) de l'ouest et de l'est du pays. Sa victoire écrasante (il fut élu à près de 70 p. 100 des voix) fut d'autant plus remarquable et inattendue que son principal adversaire, Ali Akbar Nategh Nouri, le très conservateur président du Parlement, bénéficiait de l'appui du guide et de la plupart des appareils de pouvoir et de propagande. C'était aussi la preuve que, si cadenassées fussent-elles par le Conseil des gardiens de la Constitution, qui décide de l'éligibilité des candidats en fonction de leur conformité aux normes islamiques, des élections au résultat incertain pouvaient avoir lieu en Iran (ce qui est un cas de figure profondément original dans cette région du monde).
Attaché à la formule de la République islamique, Khatami plaide pour de profondes réformes : la reconnaissance des libertés publiques, des droits de la personne (en particulier des femmes) et de la société civile (jāme'e-ye madani, une expression qui fait florès en Iran), du pluralisme politique par la légalisation des partis qui font allégeance à la Constitution ; il se fait aussi le chantre du dialogue des civilisations, respectueux de l'authenticité culturelle (esālat-e farhangi) des unes et des autres, et de l'ouverture internationale. Il nomme à des postes clés de son gouvernement des personnalités connues pour leur rejet de l'islamisme politique et favorables à la séparation des pouvoirs politique et religieux : Kamal Kharrazi aux Affaires étrangères, Abdollah Nouri au ministère de l'Intérieur, Atollah Mohajarani à celui de la Culture et de l'Orientation islamique. Pour la première fois, une femme occupe un poste de vice-président.
Un net assouplissement se manifeste dans le domaine de la politique étrangère. La tenue à Téhéran, en décembre 1997, du sommet de la Conférence de l'organisation islamique est un succès pour l'Iran, qui la préside ; s'y esquisse un rapprochement avec l'Arabie Saoudite, pays honni depuis le début de la révolution, où le nouveau président se rend en voyage officiel en mai 1999. En janvier 1998, Khatami accorde à la chaîne américaine de télévision C.N.N. une interview, au cours de laquelle il affiche son souci d'ouverture vis-à-vis des États-Unis et sa volonté de rétablir un État de droit. En juillet de la même année, l'Italien Romano Prodi est le premier chef de gouvernement d'un pays de l'Union européenne à se rendre en Iran depuis la Révolution islamique. En mars 1999, Khatami est reçu en Italie et au Vatican, effectuant la première visite en Europe d'un chef d'État iranien depuis 1979. Sa visite prévue à Paris en avril 1999 est différée pour des raisons protocolaires (l'Iran exige qu'il n'y ait pas de vin à table lors des repas officiels) ; un compromis sera trouvé lors de sa visite en octobre. Certes, ces voyages sont troublés par des manifestations d'opposants en exil (Moudjahidin du peuple, intellectuels laïques) ou encore assombris par l'arrestation de treize Juifs de Chiraz, soupçonnés d'espionnage, mais l'engagement pris par Téhéran, en 1998, de renoncer à faire exécuter la fatwa de Khomeyni condamnant à mort Salman Rushdie, contribue fortement au réchauffement des relations internationales de l'Iran (cette décision, quoique toujours contestée par les conservateurs, a permis la normalisation des relations avec le Royaume-Uni).
Cohabitation tendue et désillusion
Sous la première présidence de Khatami, la vie politique se caractérise par une cohabitation tendue entre les réformateurs et pragmatiques qui occupent la plupart des postes gouvernementaux et les radicaux qui, derrière le guide ayant la haute main sur l'armée, la police, la justice, la télévision, contrôlent les autres rouages du pouvoir (le Parlement, le Conseil des gardiens, le Conseil de discernement de l'intérêt public – créé pour régler les litiges entre les deux précédentes instances –, l'Assemblée des experts – chargée de la désignation du guide –, etc.). Les oppositions entre ces deux tendances, elles-mêmes hétéroclites, se cristallisent tout particulièrement sur le statut des libertés publiques et des intellectuels. Dans un climat où la parole s'est libérée et où les Iraniens sont avides de publications critiques, de très nombreux journaux et revues voient le jour (on en compte environ 900, dont plusieurs titres féminins) ; certaines de ces publications n'hésitent pas à stigmatiser ouvertement les tenants de l'ordre, voire à remettre en cause les attributions du guide. Interdites par le Parlement ou par les autorités judiciaires qui font emprisonner leurs directeurs, elles renaissent quelque temps après sous d'autres noms. Les penseurs et les personnalités politiques revendiquant la séparation du pouvoir et du religieux et davantage de liberté sont aussi les cibles privilégiées des milieux conservateurs et islamistes. Plusieurs intellectuels, dont Dariush Forouhar, qui avaient été emprisonnés sous le régime du shah, sont assassinés durant l'automne de 1998. Des universitaires, clercs ou anciens ministres de Khatami, sont harcelés, jugés, mis en prison pour avoir osé discuter de la légitimité du velāyat-e faghih (la souveraineté du juriste théologien) ; les conférences d'Abdolkarim Soroush, un des promoteurs de la « révolution culturelle » dans les premières années de la République islamique, mais récusant désormais le mélange des genres (politique et religieux), sont interdites ou troublées par les hezbollāhi. Pour les mêmes raisons doctrinales, Mohsen Kadivar, un clerc de haut niveau, a été condamné au printemps de 1999 à dix-huit mois de prison et Abdollah Nouri, le populaire ancien ministre de l'Intérieur de Khatami, à cinq ans de prison, en novembre 1999. En mai de la même année, la condamnation à deux ans de prison, pour détournement de fonds publics, du maire réformateur et libéral de Téhéran, Gholam-Hoseyn Karbastchi, s'est inscrite dans le même contexte de règlements de comptes qui caractérise la vie politique iranienne. Face au harcèlement multiforme, continu et haineux des conservateurs, le président de la République, bien que conforté par les résultats des premières élections locales et municipales en février 1999, ne dispose que de pouvoirs limités et fait preuve d'hyperlégalisme. Sans doute a-t-il changé les gouverneurs de province, contribué à la libéralisation de la presse, de la vie culturelle et à l'ouverture internationale du pays. Mais son attitude en juillet 1999, lors de la révolte des étudiants de Téhéran, qui s'élevaient contre une loi visant à bâillonner la presse et contre l'interdiction d'un quotidien réformateur, ne laisse pas d'être ambiguë. Les manifestants, dont plusieurs seront tués et quelque mille quatre cents arrêtés, se réclament pourtant de la « ligne » de Khatami, qui ne fait rien pour empêcher la répression de ce mouvement. La crainte des provocations, d'être déchu par le guide (celui-ci en a le pouvoir), le souci de préserver la République islamique, l'esprit de corps clérical... expliquent sans doute cette prudence. Les réformateurs savent aussi que l'objectif prioritaire demeure les élections législatives de février et avril 2000.
Celles-ci suscitent une participation sans précédent (83 p. 100 des électeurs se rendent aux urnes) et confirment le désaveu des conservateurs, tout comme celui de l'ex-président Rafsandjani dont la candidature in extremis, à la tête d'une coalition au programme ambigu, pouvait être une menace pour les réformateurs. Dès le premier tour, les partisans de Khatami remportent 170 des 290 sièges que compte le Parlement. Des personnalités emblématiques arrivent en tête du scrutin : le frère du président, Mohamad Reza Khatami, celui de l'ancien ministre Nouri, Ali Reza, ou encore l'épouse du théologien Kadivar. Ce succès, qui traduit une profonde volonté de changement, ne doit pas masquer l'hétérogénéité de la coalition de mécontents réunie autour de Khatami. Cette nébuleuse regroupe des formations aussi diverses que le Front islamique pour la participation (le parti du président) et l'Association du clergé combattant (gauche islamique et étatiste).
La volonté de changement qui anime la société iranienne est confirmée par la réélection de Khatami à la présidence de la République en juin 2001. Opposé à neuf candidats conservateurs ou radicaux, celui-ci obtient 77 p. 100 des suffrages. Mais le tassement de la participation électorale (67 p. 100 contre 80 p. 100 en 1997) est un premier symptôme du reflux des réformateurs. Celui-ci est dû à l'incapacité de Khatami à imposer des modifications structurelles (telle une révision de la Constitution qui conférerait plus de pouvoir au président), à une situation économique (plus de 20 p. 100 d'inflation annuelle) aggravant la précarité des plus pauvres, au désengagement désenchanté de la sphère politique des forces vives (les jeunes, les femmes, les intellectuels) qui avaient constitué le principal soutien des réformateurs. Ses initiatives étant bloquées par le guide et par le Conseil des gardiens, Khatami, dont l'action – favorisant la création de journaux, d'associations, etc. – contribua cependant à l'installation durable du débat dans la société iranienne, se cantonna, au fil des mois, dans un rôle essentiellement décoratif, se faisant le chantre du « dialogue des civilisations », un programme qui n'apportait pas de solutions concrètes aux problèmes sociaux du pays.
La présidence Ahmadinejad
L'ascension d'Ahmadinejad et le retour des radicaux
Les élections locales de 2003 traduisent ce désenchantement et ce revirement de l'opinion. Le taux de participation est très faible (49 p. 100 dans l'ensemble du pays, 12 p. 100 à Téhéran), un indice récurrent de la démobilisation des électeurs réformateurs, et les conservateurs remportent la plupart des municipalités. À Téhéran, ils conquièrent la totalité des sièges sous l'impulsion du parti des Abādgarān (« Bâtisseurs »), fondé par Mahmoud Ahmadinejad, qui est élu maire. Celui-ci, qui entame alors une ascension décisive, est un fils de forgeron, ancien chef d'état-major des Gardiens de la révolution, devenu par la suite gouverneur de la province d'Ardabil. Cette poussée des conservateurs se confirme à l'occasion des élections législatives de février 2004 (ceux-ci obtiennent 195 sièges sur 290) ; elle bénéficie de la révocation par le Conseil des gardiens d'un grand nombre de candidats (3 544 sur 8 144), d'un fort taux d'abstention (50,6 p. 100) et de la désunion des « libéraux » (rafsandjanistes, réformateurs). Les analystes prévoient cependant la victoire d'Hashemi Rafsandjani, candidat expérimenté et pragmatique, à l'élection présidentielle de juin 2005. Mais c'est le radical Mahmoud Ahmadinejad qui l'emporte au second tour, en obtenant 62 p. 100 des voix contre 35 p. 100 à son rival. Ce succès inattendu tient à plusieurs facteurs : la lassitude, voire l'exaspération, des mostaz'afin (« déshérités ») qui subissent durement la dégradation de la situation économique, la mauvaise réputation de Rafsandjani, accusé d'enrichissement illicite et de corruption, le soutien apporté à ce fils du peuple et de la révolution par le guide Ali Khamenei, par les bassidji (« volontaires »), par l'électorat conservateur des villes et des campagnes du centre du pays, rétif à l'évolution des mœurs. Avec ses vêtements simples, son habitation modeste et son langage direct et démagogique, Ahmadinejad est la figure même du leader populiste ; il propose de « balayer les rues de la nation », de « mettre sur les nappes des familles l'argent du pétrole » et, lors de ses nombreuses tournées en province, flatte l'orgueil régional et national. Pour asseoir sa politique conservatrice, il démet de leurs fonctions la plupart des cadres du pays (préfets, présidents d'université, dirigeants de banques et d'entreprises d'État, négociateurs du dossier nucléaire...) et installe ses partisans. Il octroie des sommes considérables aux entreprises possédées par les pāsdārān qui l'ont soutenu et occupent de nombreux sièges au Parlement et dans son gouvernement.
D'emblée, Ahmadinejad se signale, sur la scène internationale, par ses prises de position provocatrices. Proclamant que « l'énergie nucléaire est notre droit inaliénable », il remet en cause l'engagement qu'avait pris l'Iran, en octobre 2003, de suspendre ses activités d'enrichissement de l'uranium, activités sensibles pouvant déboucher sur la fabrication d'armes atomiques, qui avaient été dissimulées à l'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) et découvertes en 2002. Malgré de longues négociations menées sous l'égide de l'Union européenne, l'Iran reprend ses activités sensibles de conversion et d'enrichissement de l'uranium en août 2005 (sur son site d'Ispahan) puis en janvier 2006 (sur celui de Natanz), tout en se défendant de poursuivre un programme à visée militaire. Face au refus réitéré des autorités de suspendre ces programmes, le Conseil de sécurité de l'O.N.U. adopte, le 23 décembre 2006, la résolution 1737 condamnant l'Iran et promulguant « un embargo sur les matériaux et technologies pouvant aider à poursuivre des activités nucléaires sensibles ». D'autres sanctions sont prévues si l'Iran n'obtempère pas au terme de soixante jours. Elles sont, en définitive, prises par le Conseil de sécurité le 24 mars 2007 dans sa résolution 1747.
La politique étrangère d'Ahmadinejad renoue avec les projets et déclarations extrémistes des débuts de la période révolutionnaire. Entendant « rayer Israël de la carte », le gouvernement iranien apporte un soutien redoublé (logistique et financier) au Hamas palestinien et au Hezbollah libanais qu'il parraine avec la Syrie. On a pu apprécier l'importance de l'aide militaire et matérielle de l'Iran à ce mouvement shi’ite et à son armée lors la guerre qui l'opposa à Israël en juillet-août 2006. Hassan Nasrallah, son leader, a fait une partie de ses études théologiques à Qom et se reconnaît pour guide l'ayatollah Khamenei. Par ailleurs, en « réponse » aux caricatures du prophète, publiées dans un journal danois en septembre 2005 et qui suscitèrent une vive émotion dans le monde musulman, l'Iran organisa un concours de caricatures sur l'Holocauste qui furent exposées à Téhéran en août 2006 (la plupart dressait un parallèle entre Israël et le régime hitlérien). Prolongeant cette initiative, un colloque international, réunissant de nombreux négationnistes remettant en cause la réalité de la Shoah, se tint dans une officine du ministère des Affaires étrangères, les 11 et 12 décembre 2006. Cette rencontre, qui suscita peu d'intérêt en Iran, contribua à noircir encore l'image du pays dans le monde occidental. L'aide apportée au Hezbollah libanais et aux mouvements shi’ites en Irak (en particulier à celui, radical, de Moqtada al-Sadr avec qui Ahmadinejad entretient des relations privilégiées) étend l'influence de l'Iran vers la Méditerranée orientale et l'éloigne de son aire historique de rayonnement, à savoir l'Asie centrale. Un « arc » ou un « croissant » shi’ite semble ainsi se substituer au « grand Iran » (Irān-e bozorg) englobant, outre l'Afghanistan, plusieurs anciennes républiques soviétiques. Un anti-impérialisme vigoureusement proclamé rapproche, par ailleurs, l'Iran d'Ahmadinejad du Venezuela d'Hugo Chávez. Visites et accords, à la portée surtout symbolique, scellent ce front anti-George Bush.
D'abord séduite par ces bravades nationalistes et populistes, assorties de quelques mesures sociales (en matière d'aide au logement, de crédit à la consommation...), l'opinion se lasse au fil des mois de ces gesticulations qui isolent l'Iran, l'associent au monde arabe, objet d'une forte aversion héritée de l'histoire, et n'apportent aucune solution concrète aux problèmes économiques du pays. Les élections municipales et pour le renouvellement de l'Assemblée des experts, qui se déroulent simultanément le 15 décembre 2006, sont un revers pour Ahmadinejad et son équipe. À Téhéran, la liste de ses partisans, regroupés sous l'étiquette du « Doux parfum de servir », ne remporte que deux sièges sur quinze, alors que celle du maire, issu de la frange « moderniste » des pāsdārān, en obtient huit, et que rafsandjanistes et réformateurs, alliés dans ce scrutin, en enlèvent quatre. Quant aux élections à l'Assemblée des experts, elles portent Rafsandjani au premier rang et relèguent dans une position subalterne l'ayatollah ultra-conservateur Mezbah Yazdi, principale référence religieuse d'Ahmadinejad.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7017#forumpost7017
Posté le : 25/10/2014 18:10
|
|
|
|
|
Iran 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Réélection contestée et durcissement du régime
Dans un tel contexte général de mécontentement, la réélection d'Ahmadinejad à la présidence de la République en juin 2009 semble incertaine. Face à lui se présentent trois candidats : Mohsen Rezai, ancien chef des Gardiens de la révolution, Mehdi Karoubi, un clerc réformateur, ex-président du Parlement, déjà candidat en 2005 et Mir Hossein Moussavi, ancien Premier ministre pendant la guerre Irak-Iran (1980-1988), soutenu par les réformateurs et les conservateurs modérés. Il apparaît comme le candidat capable de répondre aux aspirations de la société civile et d'engager de sensibles transformations, sans toutefois remettre en cause les fondements du régime. Les élections se déroulent le 12 juin dans une grande confusion. Alors que, lors des précédentes consultations, l'abstention était considérable, cette fois-ci la participation est très forte (85 p. 100) ; dès avant la clôture du scrutin, Ahmadinejad et Moussavi se déclarent chacun vainqueur. Pour couper court à cette incertitude, le ministère de l'Intérieur publie précipitamment des résultats donnant Ahmadinejad élu au premier tour avec une large avance : 62,6 p. 100 des voix contre 33,7 p. 100 à Moussavi, 1,7 p. 100 à Rezai et 0,85 p. 100 à Karoubi. À l'annonce de ces résultats, les opposants à Ahmadinejad, ainsi que de nombreux observateurs, dénoncent une fraude massive. Dès le lendemain et pendant les semaines qui suivent, d'immenses manifestations ont lieu à Téhéran puis dans les grandes villes du pays pour protester contre le « trucage » des élections (« Où est mon vote ? » clament les manifestants) et demander un nouveau scrutin. On n'a pas vu de mouvements de foule aussi importants en Iran depuis la révolution de 1979. Les manifestants se parent d'un ruban vert, cette couleur symbolisant le mouvement de protestation et, plus généralement, d'aspiration au changement. La répression, assurée par des bassidji en civil, armés de gourdins et se déplaçant en moto, s'accroît à partir du 19 juin, après qu'Ali Khamenei a apporté son soutien au président et exigé l'arrêt des manifestations, fomentées selon lui par les puissances hostiles à l'Iran. Lors de la manifestation du 20 juin, une jeune femme défilant pacifiquement, Neda Agha Soltan, est tuée par balle par un bassidji. Les images de cette mort tragique, filmées à l'aide d'un téléphone portable, sont diffusées sur le Web à travers le monde et font de Neda l'icône de ce mouvement de protestation. Le Conseil des gardiens confirme le résultat des élections le 29 juin, Ahmadinejad reçoit l'investiture du guide le 3 août, puis celle du Parlement deux jours après, mais plusieurs députés, dignitaires et diplomates boycottent cette cérémonie. Les opposants saisissent l'occasion des célébrations officielles ou religieuses pour manifester. Les slogans sont de plus en plus hostiles au régime (Khamenei est comparé à Yazid, le calife responsable du meurtre de Hossein, le troisième imam, comme l'était le shah en 1979) ou sont modifiés pour stigmatiser les « usurpateurs » (devant l'ambassade des États-Unis les manifestants scandent, au lieu des habituels « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël », « Mort au dictateur ») et la répression est de plus en plus violente, y compris à l'égard des anciens dignitaires du régime et de leurs familles. On estime que, six mois après les élections, 4 000 personnes au total ont été arrêtées et plusieurs dizaines tuées ; 65 journalistes seraient emprisonnés, alors que la quasi-totalité des journaux réformateurs sont interdits. Parmi les détenus, figurent plusieurs personnalités proches de Moussavi et de Khatami. Les conditions d'emprisonnement sont souvent épouvantables : on signale des tortures, des viols et on découvre l'existence du centre de détention de Kahrizak, au sud de Téhéran, où les prisonniers sont soumis à des traitements inhumains. La répression prend aussi la forme de grands procès collectifs, tel celui qui s'ouvre le 1er août pour « juger » une centaine de manifestants. Parmi eux, une jeune Française, Clotilde Reiss, lectrice à l'université d'Ispahan, accusée d'avoir participé aux manifestations et d'espionnage au profit d'une puissance étrangère ; après un mois et demi de détention dans la prison d'Evin, elle est placée en résidence surveillée à l'ambassade de France, puis libérée le 15 mai 2010, sa peine ayant été commuée, « par mesure de clémence », en une amende de 230 000 euros. Tout est mis en œuvre pour intimider les opposants. Les manifestants interpellés sont désormais qualifiés de mohareb (« ennemis de Dieu ») ; le 11 février 2010, jour anniversaire de la Révolution, le gouvernement et les pāsdārān font une démonstration de force, coupant court aux velléités de manifestations contestataires. Des proches des leaders (Moussavi, Rafsandjani...) sont arrêtés, la maison et la voiture de Karoubi sont attaquées par des nervis. Intellectuels et artistes ne sont pas épargnés : le cinéaste Jafar Panahi est arrêté avec sa femme et sa fille le 1er mars. Il est, en définitive, condamné à six ans d'emprisonnement et à vingt ans d'interdiction de réalisation de films et de sortie du territoire.
Quelles leçons tirer de ces évènements post-électoraux ? Alors qu'une large partie de la population était démobilisée politiquement, ces élections contestées ont suscité une remobilisation, une mise en cause, chez beaucoup, du velâyat-e faqih, de l'association du religieux et du politique. On mesure aussi, à la faveur de ces évènements, la modernité de la société iranienne : pour préparer une manifestation, ou en rendre compte, les opposants communiquent par Internet (un tiers de la population est connectée) ou par téléphone mobile. Informations et réflexions circulent sur les blogs. Des sites sont verrouillés ou surveillés par le pouvoir, mais les internautes s'ingénient à contourner ces obstacles et interdits. Cependant, pour réussir, il manque au mouvement vert une cohérence programmatique, une organisation opérationnelle et un leader charismatique. En face, les forces qui soutiennent Ahmadinejad et le guide sont, sinon plus nombreuses, du moins beaucoup plus structurées : les bassidji, ces volontaires qui contrôlent la rue, surveillent institutions et entreprises ; l'armée des Gardiens de la révolution, qui forme un puissant État dans l'État, a ses propres services de renseignement, sa propre prison et contrôle notamment le Parlement ; les différentes institutions étatiques enfin (ministères, Conseil des gardiens, etc.). S'il dispose de la force, le pouvoir est cependant tiraillé entre différentes tendances et contesté, y compris au sein du clergé : de grands ayatollahs souhaitent limiter le velāyat-e faghih à un simple magistère moral et religieux ; Ahmadinejad serait, lui, partisan d'un islam milicien sans mollahs (il n'y a plus que deux religieux dans son gouvernement).
Au fil des mois, la politique iranienne se durcit à l'égard des jeunes, des femmes, des minorités, des grandes puissances... Alors que les défenseurs des droits de l'homme sont emprisonnés ou, calomniés et menacés, contraints de demeurer hors d'Iran, l'enseignement supérieur est mis au pas : refonte des programmes de sciences humaines et sociales, jugés trop occidentaux, contrôle des universités « libres », c'est-à-dire privées, jusque-là sous la coupe des conservateurs « modérés », etc. La tenue des femmes mais aussi les coupes de cheveux des hommes font l'objet d'une vigilance et d'un contrôle accrus ; des sanctions cruelles (coups de fouet, plus exceptionnellement amputation de la main pour vol, lapidation pour adultère) sont appliquées à ceux qui s'écartent du droit chemin tracé par la charia ; le cas de Sakineh Mohammadi Ashtiani, condamnée en 2006 à la peine de mort par pendaison pour participation au meurtre de son mari et à la lapidation pour adultère, suscite une vive émotion en Occident. Ses aveux télévisés (août 2010), sa dénonciation des médias étrangers qui ternissent l'image de l'Iran (janvier 2011) participent d'une mise en scène de « confessions » forcées qu'affectionnent les régimes totalitaires. Pour s'opposer aux lois discriminatoires à l'égard des femmes, une campagne internationale « Un million de signatures » a été lancée, dès 2006, par plusieurs personnalités iraniennes (dont Chirine Ebadi). Outre le mécontentement d'une large partie de la population, le gouvernement doit aussi affronter les mouvements de revendication religieuse et régionale, aussitôt dénoncés comme des complots fomentés de l'extérieur. Les régions périphériques (l'Azerbaïdjan, le Baloutchistan, le Kurdistan, le pays turkmène), et en particulier celles où sont localisées les minorités sunnites, demandent plus de reconnaissance. Ces revendications se traduisent par un fort activisme culturel mais aussi, au Baloutchistan et, dans une moindre mesure, au Kurdistan, par des actions violentes qui donnent lieu à de spectaculaires représailles (arrestations, pendaisons).
À la faveur de sa réélection, Mahmoud Ahmadinejad, en accord sur ce point avec le guide Ali Khamenei, accentue son soutien militaire et financier à ses alliés proche-orientaux (mouvement sadriste en Irak, Hezbollah libanais, Hamas palestinien). Contrepartie de ce soutien, Ahmadinejad est accueilli triomphalement au Liban par les supporters du Hezbollah en octobre 2010. Il entretient également ses relations avec les présidents populistes d'Amérique du Sud (Hugo Chávez, Evo Morales). À ce cercle de pays amis d'Amérique du Sud s'adjoint le Brésil, qui accueille Ahmadinejad en novembre 2009, tandis que le président Lula se rend à Téhéran en mai 2010.
Malgré la politique de la « main tendue » lancée par le président Obama après son élection, les relations se durcissent avec les puissances occidentales et le groupe de négociateurs (groupe dit 5+1, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'O.N.U. plus l'Allemagne) du dossier nucléaire. Ce refroidissement général tient à la découverte, en septembre 2009, d'un site nucléaire près de Qom dont l'existence a été cachée aux inspecteurs de l'A.I.E.A., institution qui, en février 2010, rédige un rapport faisant état de « travaux visant à fabriquer une charge nucléaire pour un missile », alors même que l'Iran proclame qu'il réservera sa production nucléaire à des usages civils. Dans ce contexte, en septembre 2009, le groupe 5+1 propose que la Russie et la France enrichissent 1 200 kilogrammes d'uranium produit en Iran et destiné ensuite à des fins de recherche médicale à Téhéran, cette procédure garantissant que l'uranium ne servira pas à terme à des usages militaires. D'abord acceptée, cette proposition est finalement rejetée par l'Iran. En mai 2010, la même offre est faite par la Turquie et donne lieu à un accord avec la médiation du Brésil. Mais les négociateurs ne voient là qu'une nouvelle manœuvre dilatoire et un quatrième train de sanctions est voté par l'O.N.U. en juin 2010.
Ces sanctions, désormais plus précises, commencent à peser sur la vie quotidienne du pays dont l'économie se dégrade : le taux de chômage dépasse 20 p. 100 ; l'inflation annuelle, officiellement de 9,9 p. 100, est, en fait, de 16 p. 100. Les prix de l'immobilier connaissent une très forte hausse. Ahmadinejad a par ailleurs lancé, à la fin de l'année 2010, un plan de suppression des subventions aux produits de première nécessité (essence, pain, etc.), y substituant des aides directes aux familles, ce qui risque d'entraîner une inflation redoublée. Les capacités de transformation des ressources naturelles demeurent insuffisantes : l'Iran doit importer du gaz du Turkménistan et 40 p. 100 de l'essence consommée, car le pays ne dispose pas des installations de raffinage suffisantes. Les grandes compagnies pétrolières et gazières (Total, Shell, Repsol, B.P...) s'étant retirées, la mise en exploitation des réserves d'accès difficile est désormais problématique. Les pāsdārān se sont emparé de secteurs clés de l'économie (énergie, travaux publics, transports, télécommunications...), mais les compétences techniques font souvent défaut pour assurer un rendement optimal dans ces différents domaines.
Isolement renforcé et dégradation de la situation intérieure
Le vent de contestation qui souffle sur le Maghreb et le Proche-Orient à partir de décembre 2010 donne un nouvel élan au mouvement vert. D'amples manifestations ont lieu à Téhéran et dans diverses villes du pays en février 2011. Les répliques du pouvoir (répression redoublée, organisation d'une journée « de la haine et de la colère » contre les leaders du mouvement vert, dont les adversaires les plus acharnés exigent l'exécution...) attisent l'exaspération des opposants, qui réclament désormais un changement de régime.
Les événements qui ponctuent les deux dernières années de la présidence d’Ahmadinejad ne font qu’accentuer l’isolement international de l’Iran et la dégradation des conditions de vie des Iraniens. Un rapport de l’A.I.E.A de novembre 2011 fait part « de sérieuses préoccupations concernant les possibles dimensions militaires » du programme nucléaire iranien. En réaction à ce rapport, Ahmadinejad traite Yukiya Amano, le directeur de l’Agence, de « marionnette occidentale ». Dans un tel contexte de tension, une tentative de visite des sites nucléaires par l’A.I.E.A. échoue en février 2012, et les discussions entre le groupe 5+1 et les négociateurs iraniens, reprises (à Istanbul, Bagdad, Moscou) après quinze mois d’interruption, n’aboutissent à rien. Le groupe demande à l’Iran de cesser la production d’uranium enrichi à 20 p. 100 (qui peut avoir des applications militaires) et le démantèlement du site enterré de Fordow (à proximité de Qom), mais il se heurte au refus des négociateurs. Suspendues pendant huit mois, ces discussions reprendront en mars 2013, sans donner plus de résultats. Experts et diplomates considèrent alors que l’Iran disposerait de 167 kilogrammes d’uranium enrichi sur les 250 kilogrammes nécessaires à la production d’une arme nucléaire ou serait « un pays du seuil », c’est-à-dire qui possède tous les éléments pour fabriquer une arme atomique, mais ne le fait pas.
Devant l’intransigeance iranienne, un nouveau train de sanctions est adopté en 2011 (mai et novembre), non pas par l’O.N.U., où la Chine et la Russie s’y opposent, mais par les États-Unis et l’Union européenne. Ces sanctions visent le socle de l’économie iranienne (le pétrole) et les institutions financières (en particulier la Banque centrale) permettant au pays de commercer avec l’Occident. L’embargo européen sur le pétrole iranien prend effet en janvier 2012 pour les nouveaux contrats et en juillet de la même année pour l’annulation des contrats existants (parmi les États européens, l’Italie et la Grèce dépendaient principalement de l’Iran pour leur approvisionnement). Les États-Unis renchérissent en juillet 2013, avec le Nuclear Iran Prevention Act qui prévoit de sanctionner tout client des secteurs pétrolier, minier et industriel iraniens. Ces mesures visent à asphyxier l’économie du pays. La chute des exportations pétrolières est estimée à 40 p. 100 en 2012, mais, coupé des pays occidentaux, l’Iran continue d’approvisionner la Turquie, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud…
Aux sanctions s’ajoutent menaces, opérations clandestines et réponses symétriques de l’Iran. Israël menace de bombarder les sites nucléaires iraniens, la détention de l’arme atomique par la République islamique étant considérée par le Premier ministre Nétanyahou comme une « menace existentielle » pour son pays. À la suite de l’annonce des sanctions, l’ambassade britannique à Téhéran est attaquée (novembre 2011) et Ali Khamenei menace en janvier 2012 de fermer le détroit d’Ormuz. Des cyberattaques sont lancées contre les équipements nucléaires iraniens, auxquelles répondent des cyberattaques contre des banques, mais aussi contre les systèmes de gestion informatique d’infrastructures gazières et pétrolières américaines. Des scientifiques iraniens font l’objet d’attentats en Iran même ; ceux-ci sont attribués par le gouvernement aux « agents de l’oppression » (États-Unis, Israël). De même, en réaction, des attentats visent des diplomates israéliens en Inde, en Géorgie.
Sur le plan intérieur, la situation économique et politique se dégrade. L’inflation passe de 27,4 p. 100 en 2012 à 45 p. 100 en juillet 2013 ; de 2011 à 2013, la monnaie iranienne a perdu plus du double de sa valeur. Ce fiasco n’est pas seulement dû à la chute des exportations pétrolières à la suite des sanctions, mais aussi à une gestion privilégiant une redistribution inconsidérée de la rente pétrolière plutôt que des investissements productifs créateurs d’emplois. Ces difficultés, qui ont entraîné des troubles (entre autres, dans le bazar de Téhéran en octobre 2012), se sont ajoutées à une crise politique. Les dissensions entre le Guide et le président de la République, unis lors des élections de 2009 et de la répression qui suivit, se multiplient à partir de 2011. À l’origine de ces tensions, les prérogatives de l’un et de l’autre, et la place du clergé dans l’appareil gouvernemental. Mahmoud Ahmadinejad souhaite mettre la main sur les secteurs du pétrole et des renseignements, domaines réservés du Guide et, avec son ex-vice-président et beau-frère Esfandiar Rahim Mashaie, il promeut un Iran nationaliste et islamique, mais moins subordonné au clergé. Pour manifester son opposition et sa domination, Ali Khamenei nomme un de ses fidèles, Saïd Jalili, comme principal négociateur du dossier nucléaire, ce qui constitue un camouflet pour le président, et fait arrêter des proches de celui-ci. Ces dissensions et le médiocre bilan d’Ahmadinejad ont des conséquences électorales. Lors des élections législatives de mars 2012, les partisans du Guide, au premier rang desquels Ali Larijani, le président du Parlement, remportent les trois quarts des sièges, ceux du président de la République n’en conservant qu’une petite minorité. Celui-ci est convoqué et auditionné par le Parlement ce même mois, une première dans l’histoire de la République islamique.
Ce qui ne change pas cependant, au fil de ces événements, c’est la politique répressive. Mir Hossein Moussavi et Mehdi Karoubi, les leaders du mouvement vert de 2009, sont placés en résidence surveillée en février 2011 ; l’été suivant des journaux sont interdits, des cinéastes sont arrêtés ; au début de 2013, des cafés sont fermés. On évalue alors le nombre de prisonniers politiques à huit cents.
Sur le plan de la politique internationale, les cibles demeurent les mêmes, les États-Unis et Israël au premier chef. Dans ses discours, Khamenei qualifie l’État hébreu de « tumeur cancéreuse », d’« excroissance artificielle » devant disparaître du paysage. Fait majeur, le leadership de l’Iran au sein de l’« arc chiite » se renforce à l’occasion du « printemps arabe », aussi bien par des manifestations de soutien à la population chiite de Bahreïn en révolte contre la dynastie sunnite régnante, que par une aide au pouvoir alaouite (envoi d’armes et de conseillers pāsdārān plutôt que de soldats) en Syrie pour mater l’importante rébellion qui s’est déclenchée en mars 2011 et est soutenue, entre autres, par certains régimes sunnites du Moyen-Orient. Le conflit syrien est certes un combat contre une dictature, mais il s’agit aussi d’une lutte pour l’hégémonie dans cette région du monde, laquelle oppose chiites (Iran et Hezbollah libanais, soutenus par la Russie) et sunnites (Arabie Saoudite et Qatar, eux-mêmes rivaux, soutenus par les Occidentaux).
L’élection de Hassan Rohani, changement de cap ou de style ?
C’est dans ce contexte intérieur et extérieur tendu que se prépare l’élection présidentielle du 14 juin 2013. Sur les quelque six cents postulants à la candidature, le Conseil des gardiens de la Constitution n’en retient que huit et, fait marquant, disqualifie Rahim Mashaie, poulain d’Ahmadinejad qui, lui, ne peut pas se représenter au terme de ses deux mandats, et Ali Akbar Hachemi Rafsandjani, qui a fait acte de candidature in extremis. On prévoit la victoire d’un conservateur proche du Guide (Saïd Jalili, le maire de Téhéran Mohammad Bagher Ghalibaf, l’ancien ministre des Affaires étrangères Ali Velayati), mais, contre toute attente, c’est Hassan Rohani qui, ayant bénéficié du retrait du réformateur Mohammad Reza Aref, remporte l’élection, dès le premier tour, avec 50,68 p. 100 des voix. Les scores de ses principaux concurrents sont très faibles. Une importante partie de l’électorat, tentée jusqu’à la veille du scrutin par l’abstention, a en définitive préféré voter pour le candidat le moins éloigné de ses aspirations. Le taux de participation a été de 72 p. 100. L’élection de Rohani donne lieu à des manifestations de joie dans les grandes villes du pays, et en particulier à Téhéran. Le nouveau président apparaît, en fait, comme un candidat de compromis. Il a été soutenu, pendant sa campagne, par les anciens présidents Rafsandjani et Khatami (donc par les conservateurs modérés et les réformateurs), et il a promis la libération des prisonniers politiques ; c’est lui, alors qu’il était le principal négociateur du dossier nucléaire, qui a été l’artisan de la suspension de l’enrichissement de l’uranium en 2003 (ce qui lui valut d’être traité de « traître » et d’être écarté par Ahmadinejad lors de son arrivée au pouvoir en 2005) ; c’est un pragmatique et un diplomate, rétif aux éclats de voix et aux provocations. Mais c’est aussi un proche du Guide, avec lequel il entretient d’excellentes relations ; son passé témoigne de sa fidélité aux principaux idéaux de la République islamique. Compagnon de Khomeyni, il a été chargé, après la révolution, de superviser l’islamisation des programmes télévisés, puis a été nommé au Conseil suprême de la Défense comme représentant de Khamenei jusqu’en 2005. Ses premières déclarations et la composition de son gouvernement témoignent de la continuité, mais aussi du changement de style de la politique iranienne, changement qui laisse espérer un apaisement des tensions à l’intérieur et à l’extérieur. Signe le plus spectaculaire de cette possibilité d’ouverture, l’entretien téléphonique entre les présidents Obama et Rohani le 27 septembre 2013, à l’occasion de la soixante-huitième session de l’assemblée générale de l’O.N.U. Ce contact au plus haut niveau est une première depuis la révolution islamique.
Posté le : 25/10/2014 18:08
|
|
|
|
|
Danton 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 26 octobre 1759 naît à Arcis-sur-Aube Georges Jacques Danton
guillotiné à 34 ans le 5 avril 1794 16 germinal an II à Paris, avocat au Conseil du Roi et un homme politique français.Président de la Convention nationale du 25 juillet 1793 au 8 août 1793 dans le groupe politique la "Montagne", membre du Comité de salut public du 6 avril 1793 au 10 juillet 1793, puis député de la Seine du 6 septembre 1792 au 8 août 1793 à l'assemblée nationale législative, Convention nationale puis ministre de la Justice du 10 août 1792 au 9 octobre 1792, il épouse en première noce Antoinette Gabrielle Charpentier 1760-1793, ensuite Louise Sébastienne Gély 1777-1856 il 4 enfants François Danton 1788-1789, Antoine Danton 1790-1858, François Georges Danton 1792-1848, N Danton 1793, enfant mort-né
Danton est une des figures emblématiques de la Révolution française, tout comme Mirabeau, avec qui il partage un prodigieux talent oratoire et un tempérament impétueux, avide de jouissances,les ennemis de la Révolution l'appellent le Mirabeau du ruisseau, ou comme Robespierre, à qui tout l’oppose, le style, le tempérament et le type de talent. Il incarne la Patrie en danger dans les heures tragiques de l’invasion d’août 1792, quand il s'efforce de fédérer contre l'ennemi toutes les énergies de la nation et d'user de tous les expédients : pour vaincre, dit-il, il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France sera sauvée !, et il n'hésite pas, par pragmatisme, à entamer des négociations secrètes avec les monarques coalisés pour négocier une paix rapide.
En bref
Comme pour Robespierre, il s’est vite constitué autour de sa personne une légende. Et s’est déchaînée entre historiens robespierristes et dantonistes une polémique idéologique et politique qui a culminé sous la IIIe République. Pour les premiers, Danton est un politicien sans scrupules, vénal, capable de trahir la Révolution ; pour les seconds, il est un ardent démocrate, un patriote indéfectible, un homme d’État généreux.
Tribun populaire, Danton est une des figures majeures de la Révolution française. Ministre de la Justice au moment de la chute de la royauté, il a été ensuite le premier président du Comité de salut public, avant d’être éliminé par Robespierre, en raison de son opposition au régime de la Terreur. Sa personnalité est complexe et il faut dissocier deux questions trop souvent emmêlées : celle de la vénalité de Danton, celle de la portée et du sens de son action politique. Sur sa vénalité, le débat semble tranché. Bon vivant, jouisseur et truculent, Danton n'appartient pas à la race des révolutionnaires puritains, vertueux jusqu'au scrupule ; il n'a rien de l'incorruptible et, par là, ne cesse de séduire ou d'indigner ceux qui s'inquiètent des rapports de l'éthos révolutionnaire avec la morale. Mais, si Danton ne refusait guère les cadeaux, il est difficile de prouver qu'il en ait jamais tenu compte pour déterminer sa politique : toujours acheté, jamais vendu ! Un homme comme moi est impayable, disait-il.
Dans ces quarante jours qui créèrent la République, de la prise des Tuileries à Valmy et la réunion de la Convention, Danton va mériter toutes les admirations qui s'égareraient sur les autres moments de sa carrière. Seul, dans un conseil des ministres dominé par Roland et les Girondins, il impose la résistance à l'offensive prussienne et le refus d'abandonner Paris ; seul, devant une Assemblée pusillanime et toujours royaliste en secret, il défend les initiatives de la Commune insurrectionnelle de Paris ; il seconde cette dernière dans les mesures de surveillance et de défense de la capitale ; il envoie des commissaires dans les départements pour impulser partout les mesures civiques et les préparatifs militaires. Pas plus que les autres dirigeants, il ne fait rien pour empêcher les massacres de septembre, mais il intervient pour empêcher l'arrestation de personnalités compromises. La postérité a surtout conservé un grand souvenir de ses harangues galvanisatrices De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace !; c'est pourtant par des actes plus que par des phrases que, dans ces jours critiques, Danton a bien mérité de la patrie en danger. Audace, bien sûr, mais aussi sang-froid et habileté manœuvrière : c'est grâce à ses agents doubles qu'il entrave le déclenchement d'une première rébellion vendéenne, et avec ses émissaires qu'il achève de démoraliser le haut état-major prussien après Valmy.
Lui fallait-il le stimulant de cette crise décisive pour donner le plus efficace de lui-même ? Quittant son ministère pour exercer à la Convention son mandat de député de Paris, attaqué comme l'un des triumvirs de la Montagne, avec Robespierre et Marat par la Gironde, mis en demeure de présenter les comptes de sa gestion ministérielle, Danton se défend malaisément ; il échoue dans sa tentative de regrouper au sein d'un club de la Réunion un tiers parti centriste ; rejeté vers la Montagne par la haine du couple Roland, il prend part de loin aux débats sur le procès de Louis XVI, stipendié par l'ambassadeur d'Espagne – pour s'opposer au régicide, il empoche – et vote quand même la mort. Il est surtout occupé par ses missions auprès de Dumouriez, dans la Belgique conquise après Jemmapes ; il louvoie entre la constitution d'un proconsulat base stratégique d'une opération plus vaste et l'annexion pure et simple ; il résiste mal à la tentation de mettre cette belle proie en coupe réglée pour lui et ses amis les plus affairistes ; il ne renonce pas à utiliser le duc de Chartres, futur Louis-Philippe, alors lieutenant de Dumouriez, en vue d'une éventuelle monarchie constitutionnelle orléaniste. Aussi, en mars 1793, quand Dumouriez se fait battre et trahit en passant à l'ennemi avec le duc de Chartres, Danton, suspecté de toute part, manque-t-il d'être dénoncé comme complice.
Robespierre, d'abord ébranlé, semble prêt à s'unir à Danton, puis se reprend. Démasqué, Fabre est arrêté. Desmoulins est exclu des Jacobins. Philippeaux est débouté de ses accusations. Un dernier espoir pour les Indulgents : la répression qui s'abat en ventôse sur leurs ennemis jurés, les Cordeliers et Hébert. C'est mal se rendre compte que Robespierre, après avoir décapité sa gauche, ne peut éviter de frapper sa droite. Pourtant l'Incorruptible hésite encore ; il a plusieurs entretiens secrets, qui tournent mal, avec Danton chez des amis communs ; il se décide enfin, sous la pression de Billaud-Varenne, qui n'a consenti à avaliser la condamnation des Cordeliers qu'en exigeant en contrepartie celle des Indulgents. Prévenu, Danton avait refusé d'émigrer On n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers ; il se savait trop compromis par ses amis, et en même temps trop coupé des masses, pour garder une illusion ; il se sentait las sauf en de rares occasions, ce colosse était d'une extrême indolence. Arrêté le 10 germinal au soir 30 mars 1794, traduit devant le Tribunal révolutionnaire, il se défend avec des éclats de voix si éloquents qu'il faut extorquer à la Convention un décret, assez immonde, pour clore les débats hors de sa présence. Il est guillotiné le 16 germinal 5 avril. Son dernier mot sera pour dire au bourreau : Tu montreras ma tête au peuple ; elle en vaut la peine.
S'intéresser à Danton aujourd'hui, c'est parcourir un champ de bataille ; le champ d'une des batailles les plus acharnées de l'historiographie révolutionnaire, mais dont l'intérêt stratégique actuel apparaît de plus en plus minime et où l'on ne gaspille plus guère de cartouches. Les jugements de ses contemporains sur lui sont presque tous sévères. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que Danton devient, malgré ses détracteurs robespierristes, Louis Blanc, Ernest Hamel, Jean Jaurès, le héros de la bourgeoisie libérale puis radicale : Jules Michelet, puis le positiviste Jean-François Eugène Robinet, puis surtout Alphonse Aulard l'exaltent toujours davantage. La contre-attaque décisive sera menée par Albert Mathiez qui, procureur passionné s'appuyant sur un dossier bien fourni, renverse de son socle la statue de l'idole pourrie. Georges Lefebvre admettra la plupart des accusations de Mathiez, mais les assortira de plus d'estime et d'une curieuse sympathie. Aujourd'hui, qui songerait encore à ranimer le duel Robespierre-Danton, à voir l'essentiel de l'histoire révolutionnaire à la lumière des cultes contradictoires de ces deux personnalités ?
Sa vie
période avant la Révolution
Les parents de Danton sont Jacques Danton 1722-1762, huissier royal à Arcis-sur-Aube, et sa seconde épouse, Jeanne-Madeleine Camut, fille d'un entrepreneur en charpenterie, commissionné pour l'entretien des ponts et chaussées1, sa première épouse étant morte en couches en donnant naissance à son cinquième enfant. Marié en 1754, le couple a quatre enfants. Son père Jacques Danton vient de Plancy 10, gros village situé à quatre lieues d’Arcis, où son grand-père prénommé lui-aussi Jacques 1690-1733 cultive encore la terre en 1760.
Georges Jacques Danton est né le 26 octobre 1759 à Arcis-sur-Aube, dans la province de Champagne, et il est baptisé le même jour en l'église Saint-Étienne d'Arcis-sur-Aube : son parrain est Georges Camus, charpentier, et sa marraine est Marie Papillion, fille du chirurgien Charles Papillion.
Le jeune Danton a un an lorsqu’un taureau, se jetant sur une vache qui l’allaite selon la coutume répandue dans les campagnes champenoises, le blesse d’un coup de corne, lui laissant une difformité à la lèvre supérieure gauche. À sept ans, comme il est doué d'une grande force, il veut se mesurer à un taureau qui lui écrase le nez d’un coup de sabot. Enfin, renversé par un troupeau de cochons, il manque de se noyer et contracte dans sa jeunesse la petite vérole, dont il conserve des traces sur son visage grêlé. Ainsi se forment et se transmettent les légendes.
Son père meurt en 1762 à l'âge de 40 ans en laissant deux enfants vivants, lui et sa soeur aînée Anne-Marguerite, mariée en 1784 avec Pierre Menuel, marchand. Sa mère se remarie en 1770 à un marchand de grain, Jean Recordain. Danton est mis au petit séminaire de Troyes, puis au collège des Oratoriens, plus libéral, où il reste jusqu'à la classe de rhétorique.
En 1780, il part pour Paris, où il se fait engager comme clerc chez un procureur, équivalent de l'époque de l'avoué, Me Vinot, qui l'emploie de 1780 à 1787. En 1784, il se rend à la faculté de droit de Reims pour obtenir une licence en droit grâce au système de la dispense, puis regagne Paris comme avocat stagiaire.
Au café du Parnasse, qu’il fréquente, un des établissements de limonadier les plus considérés de Paris, presque en face du Palais, au coin de la place de l’École et du quai, il rencontre sa future femme, Antoinette Gabrielle Charpentier, fille du propriétaire, jeune, jolie et de manières douces, son portrait peint par David est au musée des beaux-arts de Troyes. Avec la dot de 20 000 livres qu’elle lui apporte et des prêts cautionnés par sa famille d’Arcis, il peut acheter en 1787 la charge d'avocat de Me Huet de Paisy pour la somme de 78 000 livres, somme qu'il payera en plusieurs fois, la dernière échéance le 3 décembre 1789 grâce notamment à l’argent du roi Louis XV1 ou celui de son cousin le duc d'Orléans, sans que l'on puisse conclure que sa vénalité s'est traduite par des services rendus à ces hauts personnages.
Il se marie le 14 juin 1787 en l'église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris avec Antoinette Gabrielle Charpentier, fille de François-Jérôme, riche marchand cabaretier, tenancier du café de l'École, receveur des fermes du roi, et s’installe cour du Commerce. L’État actuel de Paris de 1788 indique au no 1 de cette cour : Cabinet de M. d'Anton, avocat ès conseils. Il est vraisemblable que le couple ait habité par la suite rue des Cordeliers comme l'indique un état des scellés apposés par les juges de paix sur les biens d'Antoinette Gabrielle Charpentier, décédée le 12 février 1793, épouse du citoyen Georges-Jacques Danton, ex-ministre, député à la Convention nationale, rue des Cordeliers.
La Révolution
Avocat modeste et inconnu à la veille de la Révolution, Danton va faire ses classes révolutionnaires à la tête des assemblées de son quartier et en particulier du club des Cordeliers, dont il devient un orateur réputé. C’est la chute de la monarchie, journée du 10 août 1792 qui le hisse à des responsabilités gouvernementales et en fait un des chefs de la Révolution.
Un agitateur de quartier 1789-10 août 1792
À l’emplacement de la maison de Danton12, la Ville de Paris a inauguré le 14 juillet 1891, en hommage à l’âme de la défense nationale, une statue, œuvre du sculpteur Auguste Paris, qui représente le tribun debout en redingote, entouré de deux volontaires, en train de haranguer la foule. Sur le socle, une citation : Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple.
En 1789, Danton habite le district des Cordeliers, devenu en mai 1790 la section du Théâtre-Français dans le quartier du Luxembourg, quartier de libraires, de journalistes et d’imprimeurs. Il demeure au no 1 de la cour du Commerce-Saint-André, passage bordé de boutiques reliant la rue Saint-André-des-Arts à la rue de l'École-de-Médecine, qui connait son heure de gloire sous la Révolution : Marat y a son imprimerie au no 8, Camille Desmoulins y séjourne, la guillotine est expérimentée sur des moutons en 1790 dans la cour du no 918.
Appartenant à la moyenne bourgeoisie, titulaire d’un office, il participe aux élections du tiers état aux États Généraux de 1789, 412 votants dans le district des Cordeliers; 11 706 pour Paris qui compte environ 650 000 habitants et doit élire 40 députés et s'enrôle dans la garde bourgeoise de son district.
Il acquiert sa renommée dans les assemblées de son quartier : assemblée de district dont il est élu et réélu président, puis assemblée de section qu’il domine comme il domine le club des Cordeliers qui se réunit au café Procope, crée en avril 1790 dans l’ancien couvent des Cordeliers avant de s’inscrire au club des Jacobins.
Car Danton, comme Mirabeau, est une gueule, un personnage théâtral, figure repoussante et atroce, avec un air de grande jovialité selon Mme Roland qui le hait. Orateur d’instinct, ses harangues improvisées, il n'écrit jamais ses discours enflamment ses auditeurs. Les contemporains disent que ses formes athlétiques effrayaient, que sa figure devenait féroce à la tribune. La voix aussi était terrible. "Cette voix de Stentor, dit Levasseur, retentissait au milieu de l'Assemblée, comme le canon d'alarme qui appelle les soldats sur la brèche." Un autre témoin oculaire, Thibaudeau, le décrit aux Cordeliers :
Je fus frappé de sa haute stature, de ses formes athlétiques, de l’irrégularité de ses traits labourés de petite vérole, de sa parole âpre, brusque, retentissante, de son geste dramatique, de la mobilité de sa physionomie, de son regard assuré et pénétrant, de l’énergie et de l’audace dont son attitude et tous ses mouvements étaient empreints… Il présidait la séance avec la décision, la prestesse et l’autorité d’un homme qui sent sa puissance
.
L’historien Georges Lefebvre en trace le portrait suivant :
Il était nonchalant et paresseux ; c’était un colosse débordant de vie, mais dont le souci profond et spontané était de jouir de l’existence, sans se mettre en peine de lui assigner une fin idéologique ou morale, en se tenant le plus près possible de la nature, sans souci du lendemain surtout. On le comprend encore mieux quand on le voit fier de sa force, de l’abus qu’il en faisait et de ses prouesses amoureuses ; si solide qu’il fût, il avait des moments de dépression qui aggravaient sa paresse, et dégénéraient en atonie. Et enfin, il me parait vraiment qu’il fut magnanime comme le dit Royer-Collard. S’il ignorait les scrupules, il ne connaissait pas non plus la haine, la rancune, la soif de vengeance qui ont tant contribué à déformer la Terreur et à l’ensanglanter.
… Avec son goût très vif, mais sain, pour les plaisirs de la vie, le cœur sur la main, et la dépense facile, insouciant et indulgent, d’une verve intarissable et primesautière, qui n’épargnait pas les propos salés, Danton plaisait naturellement à beaucoup de gens. … Aimant l’existence, il était optimiste ; débordant de sève, il respirait ordinairement l’énergie ; ainsi devait-il s’imposer aisément comme un chef : c’était un entraineur d’hommes.
On sait aujourd'hui sans contestation possible que Danton a touché de l’argent de la Cour selon le plan de corruption, proposé à Louis XVI par Mirabeau, qui visait notamment les journalistes et les orateurs de club. On sait qu’avec cet argent il a remboursé les emprunts faits pour acquérir son office d’avocat et acheté des biens nationaux à Arcis-sur-Aube. Mais on ne sait rien de précis sur les services qu’il a pu rendre à ceux qui le payaient. Ils sont imperceptibles dit Mona Ozouf. Sur ce que la Cour obtint de lui, nous ne savons rien » écrit Georges Lefebvre.
Sa renommée grandit vite. Le district qu’il préside s’illustre dans la lutte contre Bailly, le maire de Paris et contre La Fayette. Il s’insurge en janvier 90 pour soustraire Marat aux poursuites judiciaires. Si Danton ne participe pas directement aux grandes journées révolutionnaires – 14 juillet, 6 octobre, 20 juin, 10 août – il les arrange, les prépare. Le 13 juillet, il harangue les troupes cordelières. Début octobre, il rédige l’affiche des Cordeliers qui appelle les Parisiens aux armes. Le 16 juillet 1791 dans l’après-midi, la veille de la fusillade du Champ-de-Mars, il va lire la pétition des Jacobins au Champ-de-Mars sur l’autel de la patrie. Mais le 17, il est absent lorsque la garde nationale commandée par La Fayette tire sur les pétitionnaires, faisant une cinquantaine de victimes. Une série de mesures répressives contre les chefs des sociétés populaires suit cette journée dramatique, l’obligeant à se réfugier à Arcis-sur-Aube, puis en Angleterre.
Après l'amnistie votée à l'Assemblée le 13 septembre, il revient à Paris. Il tente de se faire élire à l'Assemblée législative mais l'opposition des modérés à l'assemblée électorale de Paris l'en empêche. En décembre 1791, lors du renouvellement partiel de la municipalité, marqué par une forte abstention la défaite de La Fayette à la mairie au poste de Bailly démissionnaire marque le déclin du parti constitutionnel qui a jusque-là dominé l'Hôtel de Ville, il est élu second substitut adjoint du procureur de la Commune Manuel.
Dans le débat sur la guerre aux Jacobins qui commence au début de décembre 1791 et voit naître l'opposition entre Montagne et Gironde, il hésite sur la nécessité de la guerre, penchant plutôt du côté de Robespierre que de Brissot mais ne s'engageant pas activement.
À la veille de la chute de la monarchie journée du 10 août 1792, Danton est un des hommes en vue des clubs parisiens Cordeliers, Jacobins.
Premier passage au gouvernement août/sept 1792 - Ministre de la Justice
Le nouveau conseil général de la Commune 88 membres se réunit en permanence comme une assemblée nationale. Un homme se détache : Robespierre.
Le comité de surveillance de la Commune est chargé de la police politique et de la coordination des comités de surveillance des sections. Dix membres y siègent, dont Marat.
Danton est un des grands bénéficiaires de cette journée à laquelle il n’a pas participé personnellement. Il s’est targué au Tribunal révolutionnaire d’avoir fait le 10 août. Sa section, le Théâtre-français, a joué un rôle actif dans l'insurrection mais on ne sait rien de précis sur le sien, les témoignages étant rares et contestés.
Face à la Commune insurrectionnelle qui s’appuie sur les sections insurgées et qui tient Paris, l’Assemblée législative n’a d’autres choix que de suspendre Louis XVI et de lui substituer un Conseil exécutif provisoire de six membres composé des anciens ministres girondins, Roland à l’Intérieur, Servan à la Guerre, Clavière aux Finances avec Monge à la Marine et Lebrun aux Affaires étrangères. Les Girondins, hostiles au Paris révolutionnaire, ont besoin d’un homme populaire et engagé avec les insurgés pour faire la liaison avec la Commune insurrectionnelle. Ils font nommer Danton au ministère de la Justice.
Condorcet, qui bien qu’adversaire malheureux de Danton aux élections de substitut et dans le débat sur la guerre, soutient sa candidature, explique son vote :
Il fallait dans le ministère un homme qui eût la confiance de ce peuple dont les agitations venaient de renverser le trône … qui par son ascendant pût contenir les instruments très méprisables d’une révolution utile, glorieuse et nécessaire … qui par son talent pour la parole, par son esprit, par son caractère, n’avilît point le ministère. Danton seul avait ces qualités.
Et Condorcet ajoute cette considération significative :
D’ailleurs Danton a cette qualité si précieuse que n’ont jamais les hommes ordinaires : il ne hait ou ne craint ni les lumières, ni les talents, ni la vertu.
Danton s’installe place Vendôme, devenue place des Piques, et fait aussitôt entrer ses amis au ministère : Desmoulins est nommé secrétaire du Sceau, Fabre d'Églantine secrétaire général de la Justice jusqu'alors un seul fonctionnaire occupait les deux postes, Robert chef des secrétaires particuliers
Dans un climat de violence et de peur où s’opposent des autorités rivales, il va devenir, par sa personnalité et son autorité naturelle, le vrai chef du Conseil exécutif.
La Commune insurrectionnelle force l’Assemblée à faire emprisonner Louis XVI au Temple, à convoquer une Convention nationale élue au suffrage universel chargée d’élaborer une Constitution et met en place le dispositif de ce que l’on a appelé la première Terreur qui préfigure celle de 1793 : suppression des journaux d’opposition, perquisitions, visites domiciliaires, arrestations de prêtres réfractaires, des notables aristocrates, des anciens ministres feuillants, premier Tribunal révolutionnaire, qui ne fera guillotiner que trois conspirateurs. Là où commence l’action des agents de la nation doit cesser la vengeance populaire dit Danton.
Paris vit à l’heure des préparatifs militaires, de la patrie en danger, des volontaires. Le 21 août, on apprend la première insurrection vendéenne. À la fin du mois, les frontières sont franchies. Le duc de Brunswick avec une armée de 80 000 austro-prussiens s’avance vers Paris. Les soldats de la Révolution reculent.
Le 28 août, Roland, soutenu par Servan et Clavière, propose d’abandonner Paris et de se retirer au-delà de la Loire avec l’Assemblée et le roi. Seul des ministres Danton s’y oppose avec tant d’indignation et de menaces que les autres y renoncent. Le même jour, devant l’Assemblée, il félicite la Commune pour les mesures déjà prises, puis fait décider l’envoi dans les départements de commissaires c’est lui qui les choisira, presque tous parmi les membres de la Commune qui procéderont aux levées de volontaires, 30 000 hommes à Paris et dans les départements voisins et à la réquisition des denrées nécessaires au ravitaillement des armées. Il fait enfin autoriser les visites domiciliaires de suspects, décidées par la Commune.
Le 2 septembre, Paris apprend que le duc de Brunswick a occupé Verdun, que ses troupes sont à deux jours de la capitale. Danton, en costume rouge, monte à la tribune de l’Assemblée et prononce son célèbre discours, salué par une ovation assourdissante :
Il est bien satisfaisant, messieurs, pour les ministres d’un peuple libre, d’avoir à lui annoncer que la patrie va être sauvée. Tout s’émeut, tout s’ébranle, tout brûle de combattre ! … Le tocsin qu’on va sonner n’est point un signal d’alarme, c’est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France sera sauvée !
Grâce à lui, grâce aux décrets qu’il fait voter à l’Assemblée, une impulsion nouvelle sera donnée à la poursuite de la guerre. L’armée sent que le gouvernement, désormais, est résolu à lutter. Jusqu’à Valmy, c’est lui qui va incarner le mieux cette volonté de vaincre et cette passion de l’union révolutionnaire, mieux que la Commune et les Girondins, obsédés par leur haine réciproque.
À Paris, du 2 au 6 septembre, dans un climat de panique et de peur lié à l’invasion du territoire et aux appels au meurtre des journaux de Marat et d’Hébert, des sans-culottes massacrent entre 1 100 et 1 400 personnes détenues dans les prisons. Les contemporains et certains historiens ont attribué à Danton un rôle dans ces événements, mais rien ne prouve que les massacres aient été organisés par lui, ni par aucun autre. On sait seulement que, ministre de la Justice, il n’a rien fait pour les arrêter. L’attitude des autorités est, sur le moment, embarrassée écrit François Furet. Toutes se sentent débordées et intimidées. Ni la Commune, ni son Comité de surveillance, n’ont préparé les massacres : ils les ont laissé faire en cherchant à en limiter la portée. Ministre de la Justice, Danton s’est abstenu de toute intervention. L’opinion révolutionnaire a, dans son ensemble, non pas approuvé mais justifié l’événement.
Le 4 septembre, pendant les massacres, le Comité de surveillance de la Commune où siège Marat lance des mandats d’arrestation contre Roland et Brissot. Cette fois Danton intervient et, s’opposant à Marat en une altercation caractéristique des deux hommes, fait révoquer les mandats ; de même, il réussit habilement à faire échapper Adrien Duport, Talleyrand et Charles de Lameth.
Le 20 septembre, Valmy sauve la France de l’invasion et donne le signal de la détente. Le même jour, la Convention se réunit, première assemblée élue au suffrage universel à deux degrés, mais seuls les militants révolutionnaires ont osé paraître aux assemblées primaires. À Paris, Robespierre est élu le premier, puis c’est le tour de Danton qui obtient le plus grand nombre de voix : 638 sur 700 présents. Ses amis, Camille Desmoulins, Legendre et Fabre d’Eglantine sont élus avec lui. Il opte pour la députation, quittant le Conseil exécutif.
La Convention nationale
Élus par moins de 10 % de la population, les 749 Conventionnels sont tous issus du mouvement révolutionnaire. Deux factions rivales, les Montagnards et les Girondins entrent aussitôt en lutte pour le contrôle de la Convention. La majorité des députés, la Plaine ou le Marais, qui ne sont pas des modérés, suivent les Montagnards ou les Girondins selon qu’ils estiment que les uns ou les autres incarnent le mieux les espoirs collectifs. Danton siège à gauche avec la Montagne. Malgré les attaques des Girondins, il sera longtemps le défenseur de l’union entre les factions.
À la Convention, le 4 octobre, Danton propose de déclarer que la patrie n’est plus en danger. Il ne demande qu’à renoncer aux mesures extrêmes. Surtout, il mesure les risques que font courir à la Révolution les querelles fratricides entre républicains. Il prêche la conciliation et appelle plusieurs fois l'assemblée à la sainte harmonie. C'est en vain que l'on se plaignait à Danton de la faction girondine, écrira Robespierre, il soutenait qu'il n'y avait point là de faction et que tout était le résultat de la vanité et des animosités personnelles. Mais les attaques des Girondins se concentrent sur lui, Marat et Robespierre — les triumvirs — accusés d’aspirer à la dictature. Danton défend Robespierre. Tous ceux qui parlent de la faction Robespierre sont, à mes yeux, ou des hommes prévenus ou de mauvais citoyens mais se désolidarise de Marat Je n’aime pas l’individu Marat. Je dis avec franchise que j’ai fait l’expérience de son tempérament : il est volcanique, acariâtre et insociable. Les Girondins l’attaquent sur sa gestion des fonds secrets du ministère de la Justice. Roland, ministre de l’Intérieur donne scrupuleusement ses comptes. Danton en est incapable. Harcelé par Brissot, il n’échappe que par la lassitude de la Convention et longtemps les Girondins crieront Et les comptes ? pour l’interrompre à la tribune. Son influence est en baisse, au profit de Robespierre qui devient le vrai chef de la Montagne.
Peut-être écœuré par ces attaques et par l’échec de ses tentatives de conciliation, Danton se fait envoyer fin novembre par la Convention en Belgique avec trois autres commissaires, pour enquêter sur les besoins de l'armée du nord. Le général Dumouriez se plaignait du directoire d’achats, mis en place par la Convention en remplacement de son fournisseur aux armées, et ami de Danton l’abbé d’Espagnac, et accusait le directoire de laisser l’armée dans le dénuement. Il part le 30 novembre alors que débute le procès de Louis XVI.
Danton aurait souhaité sauver Louis XVI. Il aurait cru que c’était une des conditions de la paix. Robespierre écrira en mars 1794 : Il voulait qu’on se contentât de le bannir. La force de l’opinion détermina la sienne. Théodore de Lameth, venu de Londres pour tenter de sauver le roi, raconte dans ses Mémoires que Danton lui a promis de l’aider : Je ferai avec prudence mais hardiesse tout ce que je pourrai. Je m’exposerai si je vois une chance de succès, mais si je perds toute espérance, je vous le déclare, ne voulant pas faire tomber ma tête avec la sienne, je serai parmi ceux qui le condamneront. Ajoutant cependant sans illusion : Peut-on sauver un roi mis en jugement ? Il est mort quand il paraît devant ses juges. Pour sauver le roi, il faut des fonds. Talon, interrogé en 1803 par la police de Bonaparte, déclare avoir proposé, de la part de Danton, à William Pitt et au roi de Prusse de faire sauver, par un décret de déportation, la totalité de la famille royale et ajoute : Il me fut démontré, n'ayant pu avoir aucune réponse, que les puissances étrangères se refusaient aux sacrifices pécuniaires demandés par Danton. On sait cependant que le banquier Le Couteulx versa deux millions à Ocariz, qui représentait l’Espagne à Paris pour acheter des voix durant le procès du roi. Dans ses mémoires l'ancien montagnard René Choudieu admit mais sans donner de nom l'existence d'une telle corruption. Georges Lefebvre conclut J’admets qu’on laisse en suspens la question de savoir si Danton entendait ou non garder pour lui une portion des millions qu’il demandait, mais qu’il les ait sollicités, je ne parviens pas à en douter. De retour à Paris, les 16 et 18 janvier, double jeu ou pas, il vota la mort et rejeta le sursis.
D’ordre économique, sa mission en Belgique déborde vite sur le terrain politique et militaire. La Belgique doit-elle s’ériger en république indépendante ou être réunie à la France ? Qui doit faire les frais de la guerre ? Si la République doit payer, dit Cambon, le contrôleur général des finances de la Convention, il est impossible de continuer la guerre. Danton se décide pour l’annexion. Il prépare à Bruxelles, contre l’avis de Dumouriez soucieux de ménager les Belges, le célèbre décret sur l'administration révolutionnaire française des pays conquis. Ce décret qui, selon la formule de Georges Lefebvre, entreprend, sous la protection des baïonnettes françaises, de rendre les peuples heureux sans les consulter, et à leurs frais, présenté à la Convention par Cambon le 15 décembre et adopté par acclamation, proclame la souveraineté du peuple dans les pays occupés, l’abolition de la noblesse et des privilèges, la confiscation des biens du clergé et de la noblesse pour servir de gage aux assignats émis et la création d’une administration provisoire. C'est aussi la période où il est décidé de réglementer la spéculation.
Le 31 janvier, Danton vient demander à la Convention la réunion de la Belgique. Il développe dans un fameux discours la théorie des frontières naturelles qui va orienter pendant deux décennies la politique de la France :
Ses limites sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes, des quatre coins de l’horizon : du côté du Rhin, du côté de l’océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République et nulle puissance ne pourra nous empêcher de les atteindre.
Danton est renvoyé en Belgique avec Camus et Delacroix. Dans cette seconde mission, les commissaires, presque occupés que de leurs plaisirs dit leur collègue Merlin de Douai, vont faire appliquer le décret par la force. Aux contributions et réquisitions va s'ajouter le pillage individuel. Danton et Delacroix vont acquérir une réputation de violence et de débauche sinon de déprédation.
Sa femme, âgée de 28 ans meurt en son absence le 10 février 1793 peu après avoir mis au monde son troisième enfant. De retour en France le 16 février, désespéré, il fait exhumer le corps et mouler le buste par le sculpteur Deseine. Il reçoit une lettre de condoléance de Robespierre : Si, dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme comme la tienne, la certitude d’avoir un ami tendre et dévoué peut t’offrir quelque consolation, je te la présente. Je t’aime plus que jamais, et jusqu’à la mort. Dès ce moment, je suis toi-même. Embrasse ton ami. On ne le voit pas, du 17 février au 8 mars, reparaître à la Convention. Il se remarie six mois plus tard le 12 juin 1793 avec une jeune fille de 16 ans, Sébastienne-Louise Gély 1776-1856, fille d'un huissier audiencier au Parlement de Paris. Il demandera sa démission du Comité de Salut Public le 10 juillet suivant.
Jacobin, ministre des Affaires étrangères dans le ministère girondin de mars 1792, général en chef de l’armée du Nord en août 1792, vainqueur à Valmy, Dumouriez occupe la Belgique après la victoire de Jemmapes. Après la défaite de Neerwinden, il échoue dans une marche sur Paris pour rétablir la monarchie au profit du futur Louis-Philippe, lieutenant général dans son armée, et passe à l’ennemi début avril 1793. Très lié avec lui dans les premiers mois de 1793, Danton le soutiendra jusqu’au bout et sera accusé, sans aucune preuve, de complicité.
Reparti en Belgique le 5 mars à l’appel de Delacroix, il trouve une situation désastreuse. Alors que Dumouriez vient d'entrer en Hollande, les Autrichiens battent le général Miranda qui doit abandonner Liège. Les habitants se révoltent contre l’armée française. Le 7, les commissaires, réunis à Bruxelles, décident de dépêcher à Paris Danton et Delacroix pour hâter les grandes mesures .
Outre les revers militaires en Belgique la situation de la République est grave : soulèvements dans les campagnes après la décision le 23 février de lever 300 000 hommes, insurrection de la Vendée, difficultés économiques entraînant à Paris une vague d’agitation orchestrée par les Enragés qui réclament le maximum des prix et des changements sociaux. Face à cette situation, il n’y a pas de direction homogène et efficace. Le gouvernement est tiraillé entre les généraux, les ministres du Conseil exécutif, qui depuis la Constituante ne peuvent être députés et la Convention, toujours plus divisée entre Girondins et Montagnards et soumise à la pression des sans-culottes parisiens.
Le printemps 1793 fournit à Danton, qui a maintes fois proposé avec la Plaine, par la voix de Barère, un gouvernement d’union nationale, l’occasion de mettre son énergie et son éloquence au service de la Révolution. Les onze discours qu’il prononce du 8 mars au 1er avril sont empreints d’une sorte de frénésie. Sitôt arrivé à Paris le 8 mars, il monte à la tribune :
Nous avons, dit-il, fait plusieurs fois l’expérience que tel est le caractère français qu’il faut des dangers pour retrouver toute son énergie. Eh bien, ce moment est arrivé ! Oui, il faut le dire à la France entière ; si vous ne volez pas au secours de vos frères de la Belgique, si Dumouriez est enveloppé, si son armée était obligée de mettre bas les armes, qui peut calculer les malheurs incalculables d’un pareil évènement. La fortune publique anéantie, la mort de 600 000 français pourrait en être la suite. Citoyens, vous n’avez pas une minute à perdre !
Il fait voter l’envoi de commissaires dans les sections pour engager les citoyens à voler au secours de la Belgique et provoquer une nouvelle expression de patriotisme.
Le 9 mars, il appelle avec succès à la libération des prisonniers pour dettes ; proposition transformée en loi d'interdiction absolue de ce type d'emprisonnements, sur l'initiative de Jeanbon Saint-André. Le 10, Danton prononce deux discours ; le matin, un appel à l’énergie et à l’union :
Vos dissensions sont nuisibles. Vos discussions sont misérables. Battons l’ennemi et ensuite nous disputerons. Eh ! Que m’importe, pourvu que la France soit libre, que mon nom soit flétri ! J’ai consenti à passer pour un buveur de sang ! Buvons le sang des ennemis de l’humanité, mais enfin que l’Europe soit libre ! Remplissez vos destinées, point de passions, point de querelles, suivons la vague de la Liberté !
Le discours s’achève dans une ovation « universelle » dit le compte rendu. Le soir, les commissaires envoyés dans les sections évoquent la création d’un Tribunal révolutionnaire, celui institué le 17 août 1792 avait été supprimé le 29 novembre), tribunal extraordinaire jugeant sans appel et dont les jugements sont applicables sous 24 heures. La majorité de l’assemblée effarouchée est hésitante. Il est 6 heures. Pour en sortir, le président déclare la séance levée.
Soudain Danton s’élance à la tribune en rugissant : Je somme tous les bons citoyens de ne pas quitter leur poste !. Les députés, éberlués, regagnent leur place.
Danton :
Quoi, citoyens, au moment où, Miranda battu, Dumouriez enveloppé va être obligé de mettre bas les armes, vous pourriez vous séparer sans prendre les grandes mesures qu’exige le salut de la chose publique ? Je sais à quel point il est important de prendre des mesures qui punissent les contre-révolutionnaires…
Une voix dans la salle : Septembre !
Le salut du peuple exige de grands moyens et des mesures terribles. Puisqu’on a osé dans cette assemblée rappeler les journées sanglantes sur lesquelles tout bon citoyen a gémi je dirai, moi, que si un tribunal révolutionnaire eût existé le peuple auquel on a si souvent, si cruellement reproché ces journées ne les aurait pas ensanglantées. Faisons ce que n’a pas fait l’Assemblée législative, soyons terribles pour éviter au peuple de l’être et organisons un tribunal non pas bien, c’est impossible, mais le moins mal qui se pourra, afin que le peuple sache que le glaive de la liberté pèse sur la tête de tous ses ennemis. Je demande que, séance tenante, le tribunal révolutionnaire soit organisé, et que le pouvoir exécutif reçoive les moyens d’action et d’énergie qui lui sont nécessaires.
Une voix dans la salle : Tu agis comme un roi !
Danton : Et toi comme un lâche !
Après une intervention de Robespierre visant à empêcher qu'il ne puisse toucher les patriotes, la loi instituant le Tribunal révolutionnaire - devant lequel, après la reine et les Girondins, il devait lui-même comparaître un an après - est votée
C'est dans la salle du Manège des Tuileries que se réunit la Convention jusqu’au 9 mai 1793.
Le 15 mars, la Convention reçoit une lettre menaçante de Dumouriez, la rendant responsable de ses défaites. Malgré l’indignation générale, Danton s’oppose à un décret d’accusation contre lui et se fait envoyer en Belgique pour le raisonner. Il le rejoint le 20 ; dans l’intervalle, Dumouriez s’est fait écraser à Neerwinden le 18. Danton n’obtient qu’un vague billet de soumission J’ai épuisé tous les moyens de ramener cet homme aux bons principes. dira-t-il ; il rentre à Paris, mais au lieu de venir rendre compte de sa mission, disparaît plusieurs jours. Parti de Bruxelles le 21, il ne réapparait au Comité de défense général que le 26, ce qui a intrigué contemporains et historiens. Lorsque la Convention apprend la défaite de Neerwinden et les tractations de Dumouriez avec les Autrichiens, elle renouvelle le 25 mars, dans un élan d’union, son Comité de défense générale en y élisant des Girondins, des hommes de la Plaine et des Montagnards, Danton, Desmoulins, Dubois-Crancé et Robespierre. À la première séance, le 26, Danton, enfin réapparu, prend encore la défense de Dumouriez, reconnaît que le général a des torts, mais se porte garant de son désintéressement. Robespierre s’étonne de l’attitude de Danton et demande la destitution immédiate du général en chef. Les Girondins font bloc avec Danton pour la faire refuser. Le lendemain 27, à la Convention, Robespierre fait de nouveau le procès de Dumouriez. C’est seulement le 30 mars qu’elle se décide à envoyer des commissaires pour le citer à comparaître. Dumouriez les fait arrêter le 1er avril et les livre aux Autrichiens. Il tente ensuite d’entrainer son armée contre Paris mais se heurte à ses propres troupes et passe à l’ennemi accompagné de quelques généraux, dont Égalité fils, le duc de Chartres, futur Louis-Philippe, fils du duc d’Orléans, Philippe-Égalité, qui va être arrêté à Paris par les comités.
Jusqu'au dernier moment, Danton a cherché à établir l’union entre les républicains, contrairement à Robespierre et aux Montagnards qui jugeaient l’union avec les Girondins impossible Quoique assis au sommet de la Montagne, écrit le robespierriste Levasseur, il avait été jusque-là, sinon l’homme de la Droite, du moins en quelque sorte le chef du Marais. La trahison de Dumouriez va provoquer la rupture de Danton avec la Gironde. Le 1er avril, à la Convention, les Girondins l’accusent de complicité. Danton, soutenu par la Montagne qui comprit, dit Levasseur, que son impétueuse éloquence allait rompre toutes les digues répond en attaquant à son tour. Se tournant vers la Montagne, il s’écrie :
Je dois commencer par vous rendre hommage, citoyens qui êtes placés à cette Montagne : vous avez mieux jugé que moi. J’ai cru longtemps que, quel que fût l’impétuosité de mon caractère, je devais tempérer les moyens que la nature m’a départis, je devais employer, dans les circonstances difficiles où m’a placé ma mission, la modération que m’ont paru commander les évènements. Vous m’accusiez de faiblesse ; vous aviez raison, je le reconnais devant la France entière… Eh bien ! je crois qu’il n’est plus de trêve entre la Montagne, entre les patriotes qui ont voulu la mort du tyran et les lâches qui, en voulant le sauver, nous ont calomniés dans toute la France.
Au cours d’une séance dramatique, la Gironde et lui se renvoient l’accusation d’avoir trempé dans le complot monarchique du général en chef. Seul résultat immédiat de cette mêlée : les Girondins font décréter que les députés suspects de complicité avec l’ennemi ne seront plus protégés par l’inviolabilité parlementaire. Le soir, aux Jacobins, Robespierre prend la défense de Danton et demande la mise en accusation des Girondins.
La Plaine ne songe pas à suivre Robespierre, mais les circonstances l’inclinent vers Danton. Le 6 avril, la Convention crée enfin le Comité de Salut public, réclamé par Danton et Robespierre dès le 10 mars et y place des hommes qui ne sont pas trop impliqués dans le conflit entre Gironde et Montagne et qui souhaitent l’unité: sept députés de la Plaine, Barère en tête, la Montagne n’est représentée que par Danton et son ami Delacroix.
Second passage au gouvernement avril/ Juil 1793 – Comité de salut public
Le Comité de salut public, chargé de surveiller et d’animer le Conseil exécutif des ministres devient très vite le véritable pouvoir exécutif de la Convention. Composé de neuf membres rééligibles tous les mois par la Convention, il se réunit au deuxième étage du pavillon de Flore, devenu le pavillon de l’Égalité et ses délibérations demeurent secrètes. Dominé par Danton, il va être réélu intégralement le 10 mai et le 10 juin, il s’agrandit à cette date de 4 adjoints, 3 robespierristes, Saint-Just, Couthon, Jean Bon Saint-André, et un ami de Danton, Hérault de Séchelles.
Danton, le plus modéré des Montagnards, se refuse aux mesures révolutionnaires réclamées par les sections et les clubs parisiens économie dirigée, levée en masse, loi des suspects face à une situation extérieure et intérieure de plus en plus menaçante invasion étrangère, contre-révolution intérieure. La Terreur ne sera mise à l’ordre du jour qu’après son départ. Chargé au Comité de salut public des Affaires étrangères, il rêve d’un compromis avec l’Europe et essaie de négocier en secret pour fissurer le bloc de la coalition, prêt à offrir la libération de la reine. Le 13 avril, il détermine la Convention à désavouer la guerre de propagande et à déclarer qu’elle ne s’immiscerait en aucune manière dans le gouvernement des autres puissances. Mais ses tentatives n’aboutissent pas et se heurtent à une situation militaire défavorable. La Belgique et la rive gauche du Rhin reprises par les coalisés, la France ne disposait plus de monnaie d'échange. Que pouvait offrir Danton ? se demande Georges Lefebvre L’abandon des conquêtes de la République ? Les coalisés les avaient reprises et comptaient démembrer la France ; ils se moquaient des propositions dérisoires d’un régicide aux abois. Cette diplomatie, souvent louée depuis, supposait la victoire ou la capitulation déguisée en compromis.
Cette politique de ménagements mécontente les sans-culottes exaspérés par la cherté des denrées de première nécessité ainsi que Robespierre et ses amis qui aspirent à le remplacer. Tes formes robustes, dira Saint-Just dans son réquisitoire, semblaient déguiser la faiblesse de tes conseils … Tous tes exordes à la tribune commençaient comme le tonnerre et tu finissais par faire transiger la vérité et le mensonge.
À la Convention, la lutte entre la Gironde et la Montagne s’exacerbe. Pour écraser les Girondins, les Montagnards vont s’allier aux sans-culottes, en acceptant certaines de leurs revendications sociales. Le 13 avril, malgré Danton qui tente de s’y opposer, N’entamez pas la Convention ! s’écrie-t-il, les Girondins font voter la mise en accusation de Marat, mais le jury du Tribunal révolutionnaire l’acquitte et il est ramené en triomphe par la foule à l’assemblée. Le 18 mai, la Convention élit une commission de douze membres, tous girondins, pour enquêter sur les agissements de la Commune. Le 24, cette commission arrête Hebert et Varlet. Le 25, Isnard répond par des menaces à une délégation de la Commune venue demander leur libération. Le 26, Robespierre lance aux Jacobins un appel à une insurrection des députés « patriotes contre leurs collègues accusés de trahisons. Danton tente de désamorcer la journée qui se prépare en faisant voter le 27 à minuit la cassation de la Commission des Douze ; en vain car elle est rétablie le lendemain. Le 31 mai, la Convention est encerclée par les sans-culottes qui réclament l’arrestation des Girondins et des mesures sociales. L’assemblée se contente de supprimer de nouveau la Commission et renvoie les pétitions au Comité de salut public. Le lendemain 2 juin, une foule de 80 000 hommes armés de 150 canons investit la Convention. Après une tentative de sortie en cortège qui se heurte aux canons de Hanriot, l’assemblée doit se résigner à décréter l’arrestation de 29 de ses membres. Danton a laissé faire. Les Cordeliers l’accuseront d’avoir voulu empêcher sinon modérer l’action des sans-culottes.
Danton va essayer de ne pas achever d’anéantir la droite. Les députés girondins consignés chez eux sont gardés si mollement qu’une partie s’échappe. Encouragés par l’attitude du Comité de salut public, 73 députés signent une protestation contre le 2 juin. Le 6, Barère et Danton proposent la suppression de tous les comités révolutionnaires de sections, la destitution d’Hanriot et l’envoi d’otages aux départements dont on avait arrêté les députés (preuve que Danton ne voulait pas la mort des Girondins mais Robespierre fait repousser ces mesures. Danton n’insiste pas.
Le 16 juin, Danton se remarie. Il épouse Louise Gély, jeune fille qui s’occupe de ses enfants, amie de sa première femme. Elle est charmante, jeune 16 ans et pieuse. Pour l’épouser, il consent se marier devant un prêtre insermenté échappé aux massacres de septembre. La dot de 40 000 livres apportée par la jeune fille est en réalité payée par lui et le régime est celui, rare à l’époque, de la séparation des biens.
Plus occupé par son bonheur privé que par les soucis d’État, il ne vient plus aux Jacobins. Ses absences à la Convention sont remarquées. Il néglige même le Comité. Les clubs et la Commune l’accusent d’inertie. Le 23 juin Vadier dénonce les endormeurs du Comité. Marat attaque le Comité de la perte publique. Même son ami Chabot lui reproche aux Jacobins d’avoir perdu son énergie .
Danton semble las, usé par les défaites de l’été. Attaqué vivement le 8 à la Convention, il ne se défend pas. Le 10 juillet, lors du renouvellement du Comité de salut public, il demande à la Convention de l’écarter, par fatigue ou par calcul, ou les deux à la fois.
Peut-être, écrit François Furet, fait-il un calcul politique qui va se révéler redoutable : puisque le pouvoir l’a compromis, que les autres se compromettent à leur tour et le laissent se refaire une virginité ! Le 10 juillet, à sa demande, la Convention l’écarte du Comité qu’elle renouvelle. Élu malgré lui le 5 septembre, il refuse encore sa participation au pouvoir. Jaurès a bien vu quel danger cette attitude faisait planer sur la majorité et sur lui-même : un ministrable puissant qui refuse le pouvoir risque d’être demain le pôle autour duquel se cristallisera l’opposition.
Les robespierristes entrent au Comité. Robespierre lui-même s’y fait porter deux semaines plus tard. Jamais substitution d’une équipe à l’autre ne se fit plus simplement écrit Louis Madelin.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7013#forumpost7013
Posté le : 25/10/2014 17:06
|
|
|
|
|
Danton 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le chef des Indulgents
Camille Desmoulins 1760-1794, l’homme du 14 juillet, l’ami de Danton et de Robespierre. À la fin de 1793, il veut, avec Danton et ceux qui le soutiennent, les Indulgents, arrêter la Terreur et négocier la paix. Il écrit dans son journal Vieux Cordelier, no 4 : Ouvrez les prisons à 200 000 citoyens que vous appelez suspects, car, dans la Déclaration des Droits, il n’y a point de maisons de suspicion… Vous voulez exterminer tous vos ennemis par la guillotine ! Mais y eut-il jamais plus grande folie ! … Croyez-moi, la liberté serait consolidée et l’Europe vaincue si vous aviez un Comité de Clémence ! Portrait posthume par Jean-Sébastien Rouillard.
Le nouveau Comité de Salut public à peine installé, les événements désastreux se multiplient pendant l’été 1793 : soulèvements dans les provinces après l’élimination des Girondins Lyon, Bordeaux, Marseille, victoire des vendéens à Vihiers, 17 juillet, aux frontières capitulation de Valenciennes, 28 juillet et Mayence, Toulon livrée aux Anglais 29 août. La République n’est plus, dit Barère le 23 août dans son discours sur la levée en masse, qu’une grande ville assiégée. À Paris, où la crise économique s’accentue, les luttes pour le pouvoir entre les factions révolutionnaires s’exacerbent. Les revers militaires résultent surtout de la confusion et des désaccords sur le plan de la direction politique et du commandement militaire.
Hébert 1757-1794, rédacteur du Père Duchesne, le journal des sans-culottes, se veut le successeur de Marat. Les Hébertistes veulent renforcer l'économie dirigée et radicaliser la terreur. Ils dirigent le mouvement sans-culotte et contrôlent le club des Cordeliers, le ministère de la Guerre dont le secrétaire général est Vincent et l’armée révolutionnaire parisienne, dont le chef est Ronsin. Autre appui : la Commune dont le maire Pache, le procureur Chaumette et le commandant de la garde nationale Hanriot leur sont favorables.
Danton, de retour aux Jacobins dès le 12 juillet où il se fait applaudir, participe à ces luttes en essayant de déborder le Comité avec tous ceux que mécontente Robespierre et va faire pendant l’été de la surenchère révolutionnaire. Avec Delacroix, le 11 août 1793, il va demander la dissolution de la Convention et l'application immédiate de la nouvelle Constitution de l'an I, ce que leur reprochera Robespierre en mars 1794; votée le 24 juin 1793, son exécution fut repoussée par le reste de la Montagne pour la fin de la guerre. Le 25, il est élu président de la Convention. Mais les Hébertistes, qui sont aussi candidats à la succession du pouvoir avec l’appui des sans-culottes, l’accusent de modérantisme : Cet homme peut en imposer par de grands mots, cet homme sans cesse nous vante son patriotisme, mais nous ne serons jamais dupes… dit Vincent aux Cordeliers, le vieux club de Danton. Le 2 septembre, à la nouvelle que Toulon s’est livrée aux Anglais, les sans-culottes, soutenus par la Commune, préparent une nouvelle journée. Les Jacobins s’y rallient pour canaliser le mouvement. Le 5, la Convention, cernée par les manifestants, me la Terreur à l’ordre du jour. La pression sans-culotte accélère les mesures révolutionnaires et fait entrer Billaud-Varennes et Collot d’Herbois au Comité, mais elle ne parvient pas à le remettre en cause. Désormais ce qu’on est convenu d’appeler le Grand Comité, dominé par Robespierre, va reprendre la situation en main et exercer une dictature de fait jusqu’en juillet 1794.
Le 5 et le 6 septembre, Danton prononce des discours révolutionnaires très applaudis à la Convention qui décrète qu’il soit adjoint au Comité. Après deux jours de réflexion, il refuse. Je ne serai d’aucun Comité, s’écrie-t-il le 13 septembre, mais l’éperon de tous.
Et puis, subitement, du 13 septembre au 22 novembre 1793, il va disparaître. Le 13 octobre, le président communique à la Convention la lettre suivante :
Délivré d’une maladie grave, j’ai besoin, pour abréger le temps de ma convalescence, d’aller respirer l’air natal ; je prie en conséquence la Convention de m’autoriser à me rendre à Arcis-sur-Aube. Il est inutile que je proteste que je reviendrai avec empressement à mon poste aussitôt que mes forces me permettront de prendre part à ses travaux.
Garat raconte : Il ne pouvait plus parler que de la campagne… Il avait besoin de fuir les hommes pour respirer. Telle attitude indique que la neurasthénie l’assaillait et déjà le terrassait, dit son biographe Louis Madelin. J'ai trop servi. La vie m'est à charge. dira-t-il à son procès.
En son absence, ses amis continuent leurs attaques à la Convention contre le Comité. Le 25 Thuriot met en cause sa politique économique et sociale. L’assemblée applaudit et élit au Comité Briez, qui était en mission à Valenciennes lors de la capitulation. Robespierre doit menacer de quitter le Comité pour faire repousser la décision : celui qui était à Valenciennes lorsque l’ennemi y est entré n’est pas fait pour être membre du Comité de Salut public. Ce membre ne répondra jamais à la question : pourquoi n’êtes-vous pas mort ? Il faut, exige-t-il, proclamer que vous conservez toute votre confiance au Comité. La Convention, se dressant alors en fait le serment. Fin octobre, vingt-deux Girondins comparaissent devant le Tribunal révolutionnaire. Je ne pourrai les sauver dit Danton à Garat, les larmes dans les yeux. Le 1er novembre, ils sont guillotinés en chantant encore la Marseillaise au pied de l’échafaud. Suivent Mme Roland, Bailly, Barnave, Houchard, Biron, 177 condamnations à mort dans les trois derniers mois de 1793.
Danton rentre le 20 novembre pour venir au secours de ses amis, députés montagnards compromis dans l'affaire de la falsification du décret de suppression de la Compagnie des Indes, voir l’article : Chabot et Bazire, ont été arrêtés le 19 novembre par le Comité de Salut public. Fabre d'Églantine, lié politiquement à Danton, reste libre bien que le Comité soit au courant de sa signature de complaisance. Car Robespierre a besoin de Danton et des modérés pour combattre la déchristianisation dans laquelle il voit une manœuvre politique de débordement par les Hébertistes.
L’offensive des Indulgents décembre 1793 - janvier 1794
Pendant plus d’un mois, de décembre au milieu de janvier, il se forme comme un axe Robespierre-Danton sur la base d’une vigoureuse offensive contre la déchristianisation et les ultra-révolutionnaires. Les amis de Danton attaquent les leaders hébertistes avec l’approbation tacite de Robespierre. Camille Desmoulins lance un nouveau journal, Le Vieux Cordelier, dont les premiers numéros qui s’attaquent aux Hébertistes et à tout le courant déchristianisateur, obtiennent un énorme succès. En même temps, on apprend les premières victoires révolutionnaires. Les menaces militaires s’atténuent sans disparaître : la première guerre de Vendée est gagnée, Lyon révoltée capitule en octobre, l’insurrection de Toulon est battue en décembre, l’armée repousse les coalisés sur les frontières.
Danton incarne alors un courant plus modéré de la Montagne qui pense qu’avec le redressement de la situation militaire il convient de mettre fin à la Terreur et de faire la paix : Je demande qu’on épargne le sang des hommes, s’écrie-t-il le 2 décembre à la Convention. Il semble qu’il ait espéré détacher Robespierre des membres du Comité liés aux Hébertistes, Billaud-Varennes et Collot et partager avec lui les responsabilités gouvernementales.
Le 12 décembre, Danton prononce un discours sur l'instruction publique à la Convention, dans lequel il déclare :
Il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître : que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Personne plus que moi ne respecte la nature. Mais l'intérêt social exige que là seulement doivent se réunir les affections.
Le 12 décembre, Bourdon demande à la Convention le renouvellement du Comité de Salut public dont les pouvoirs expirent le lendemain et Merlin de Thionville propose de le renouveler tous les mois par tiers. La majorité ne les suit pas. Le 15, le no 3 du Vieux Cordelier a un grand retentissement dans l’opinion. Il ne se borne plus à attaquer les Hébertistes mais s'en prend au système de la Terreur et au Gouvernement révolutionnaire lui-même. Le 17, Fabre, Bourdon et Philippeaux font décréter d’arrestation par la Convention deux chefs hébertistes Ronsin et Vincent, sans même en référer aux Comités. Le 20, des femmes viennent supplier la Convention de délivrer les patriotes injustement incarcérés et Robespierre lui-même fait nommer un comité de clémence chargé de réviser les arrestations. Le 24, le no 4 du Vieux Cordelier réclame pratiquement la libération des suspects.
Mais le revirement a eu lieu le 21 décembre. Collot d’Herbois, de retour de Lyon et se voyant directement menacé, défend ses amis Ronsin et Vincent aux Jacobins et obtient que le club proteste contre leur arrestation. Billaud-Varennes fait révoquer par la Convention le comité de clémence. Robespierre met fin le 25 décembre aux espoirs d’alliance de Danton en impliquant les deux factions adverses dans un même complot : Le Gouvernement révolutionnaire doit voguer entre deux écueils, la faiblesse et la témérité, le modérantisme et l’excès ; le modérantisme qui est à la modération ce que l’impuissance est à la chasteté ; et l’excès qui ressemble à l’énergie comme l’hydropisie à la santé. Le 7 janvier, le 5e numéro du Vieux Cordelier est attaqué aux Jacobins. Robespierre affecte d’abord de traiter Camille en bon enfant gâté qui a d’heureuses dispositions et qui est égaré par de mauvaises compagnies ; mais celui-ci, l’entendant demander que son journal soit brûlé, riposte par une citation de Rousseau : Brûler n’est pas répondre. Robespierre éclate alors : L’homme qui tient aussi fortement à des écrits perfides est peut-être plus qu’égaré . Pour isoler Danton de Robespierre, Billaud et Collot font manœuvrer le Comité de sûreté générale qui découvre le faux décret de liquidation de la Compagnie des Indes signé par Fabre d’Eglantine, dont le gouvernement connaît l’existence depuis un mois. Fabre est arrêté le 12 janvier. Le lendemain, Danton prend sa défense mais il est isolé. Malheur à celui qui a siégé aux côtés de Fabre, s’écrie Billaud-Varenne, et qui est encore sa dupe. C’est l’échec de l’offensive des Indulgents.
La contre-offensive des Hébertistes février 1794
Provisoirement, les divers courants de la Montagne tombent d'accord à la Convention pour voter le 4 février l’abolition de l'esclavage dans les colonies sur proposition de Levasseur après un rapport d’un des trois députés de Saint-Domingue arrivés à Paris. Danton intervient presque seul avec son ami, Delacroix, dans un célèbre discours où il proclame : Lançons la liberté dans les colonies, liant le fait de libérer les esclaves à la volonté de ruiner l’Angleterre c’est aujourd’hui que l’Anglais est mort. Mais il se félicite également de l'entrée, la veille 3 février 1794, des deux nouveaux députés de couleur à la Convention, et place l'abolition sous le signe philosophique du "compas des principes" et du "flambeau de la raison". L’abolition sera fêtée au Temple de la Raison, Notre-Dame par la Commune en présence de Chaumette, d’Hébert et des nouveaux députés de Saint-Domingue le 18 février. Trois ans plus tôt, le 10 juin 1791, dans l'affaire des hommes de couleur libres, Danton avait enclenché au club des Jacobins une politique d'expulsion des députés des colonies, défenseurs de l'aristocratie de la peau.
Mais la crise des subsistances, aggravée par la loi du maximum général, taxation des denrées et des salaires et la libération de Ronsin et de Vincent 2 février vont marquer une reprise de l’agitation des sans-culottes : attroupements devant les boutiques, pillages, violences. Le club des Cordeliers, dirigé par Vincent, mène l’attaque. Le 12 février, Hébert dénonce la clique qui a inventé le mot ultra-révolutionnaire ; le 22, il réclame des solutions à la crise des subsistances. Le Comité répond par les décrets de ventôse : nouveau maximum général Barère, confiscation des biens des suspects au profit des patriotes indigents Saint-Just. Mais, le 2 mars, Ronsin parle d’insurrection. Le 4, Hébert affirme que Robespierre est d’accord avec les Indulgents ; les Cordeliers voilent, en signe de deuil, la Déclaration des droits de l’homme affichée derrière le président dans la salle des débats. Carrier réclame une sainte insurrection ; Hébert s’y rallie. Mais, mal préparée, non suivie par la Commune, elle échoue.
La liquidation des factions mars - avril 1794
Isolés, les dirigeants cordeliers sont arrêtés dans la nuit du 13 au 14 mars. Le procès se tient du 21 au 24 mars. La technique de l’amalgame permet de mêler à Hébert, Ronsin, Vincent et Momoro des réfugiés étrangers Cloots, Proli, Pereira, afin de les présenter comme des complices du complot de l’étranger. Tous sont exécutés le 24 mars sans que les sans-culottes bougent.
Le lendemain de l’arrestation des Hébertistes, Danton et ses amis qui ont gardé le silence pendant ces évènements, reprennent l’offensive. Le numéro 7 du Vieux Cordelier, qui ne paraîtra pas, réclame le renouvellement du Comité et une paix aussi rapide que possible, en même temps qu'il attaque pour la première fois Robespierre accusé par Camille Desmoulins de tenir le langage belliciste de Brissot justement combattu autrefois. Mais Robespierre est décidé à frapper les chefs des Indulgents. Toutes les factions doivent périr du même coup dit-il à la Convention le 15 mars. Il semble néanmoins qu'il ait hésité à mettre Danton sur la liste en considération du passé commun et des services rendus à la République. Il a accepté de le rencontrer. On ne sait pas ce qui s’est dit entre les deux hommes mais on sait que Robespierre est sorti de l’entretien avec une froideur que tous les témoins ont notée. D’après les confidences de Barère, Robespierre aurait voulu sauver Camille, son ancien camarade de collège, celui qui l’avait choisi comme témoin de son mariage. Mais les pressions de Collot d’Herbois, Billaud-Varennes, Barère et surtout Saint-Just ont emporté la décision.
On a l’impression que ces quelques lignes raturées et surchargées ont été écrites au cours d’une discussion dans un certain désarroi. Barère aurait tenu la plume. Billaud-Varenne signe fermement le premier. Carnot aurait dit en mettant sa signature : Songez-y bien, une tête comme celle de Danton en entraîne beaucoup d’autres. Robespierre signe tout en bas un des derniers. Du Comité de Salut public, seul Lindet refuse de signer.
Danton n'écoute pas ceux qui lui conseillent de fuir : On n'emporte pas sa patrie sous la semelle de ses souliers. Le 30 mars, le Comité ordonne son arrestation et celle de Delacroix, Desmoulins et Philippeaux. C’est Saint-Just qui est chargé du rapport devant la Convention. Soutenu par Robespierre, il veut que les accusés soient présents à la lecture du rapport et qu’on les arrête en fin de séance. La majorité du Comité s’y oppose par crainte d’un débat dangereux. Si nous ne le faisons pas guillotiner, nous le serons. De rage, Saint-Just aurait jeté son chapeau au feu.
Le lendemain, à la Convention consternée, Legendre demande que les accusés puissent venir se défendre. Une partie de l’assemblée est prête à le suivre. C’est Robespierre qui intervient : Legendre a parlé de Danton, parce qu’il croit sans doute qu’à ce nom est attaché un privilège. Non, nous ne voulons point de privilèges ! Nous ne voulons pas d’idoles ! Nous verrons dans ce jour si la Convention saura briser une prétendue idole pourrie depuis longtemps, ou si dans sa chute elle écrasera la Convention et le peuple français !. Et fixant Legendre : Quiconque tremble est coupable. Après son intervention et celle de Barère, Saint-Just présente son rapport rédigé à partir des notes de Robespierre, ces notes ont été publiées en 1841; Comme pour les Hébertistes, on associe aux accusés politiques, les prévaricateurs, Fabre, Chabot, Basire, Delauney et des affairistes comme l’abbé d’Espagnac, les banquiers autrichiens Frey et le financier espagnol Guzman, étrangers de surcroit pour rattacher les accusés à la conspiration de l’étranger.
Le procès, ouvert le 2 avril, est un procès politique, jugé d’avance. Au bout de deux séances, l’accusateur Fouquier-Tinville et le président Herman doivent réclamer l’aide du Comité : Un orage horrible gronde… Les accusés en appellent au peuple entier… Malgré la fermeté du tribunal, il est instant que vous vouliez bien nous indiquer notre règle de conduite, et le seul moyen serait un décret, à ce que nous prévoyons. Un projet de complot en vue d’arracher les accusés de leur prison, Lucile Desmoulins aurait proposé de l’argent « pour assassiner les patriotes et le Tribunal permet à Saint-Just de faire voter par la Convention un décret mettant les accusés hors des débats. La défense de Danton est étranglée comme avait été étouffée celle des Girondins. Le procès-verbal du Tribunal révolutionnaire a été très "arrangé" et son grand discours purement supprimé. Certaines de ses réponses ont été conservées : Moi vendu ! Moi ! Un homme de ma trempe est impayable !, interrogé sur ses nom, prénoms, domicile : Bientôt dans le néant, et mon nom au Panthéon.
Danton est guillotiné le 5 avril à trente-quatre ans. Passant en charrette devant la maison de Robespierre guillotiné le 28 juillet, il s'écrie : Robespierre, tu me suis ! Ta maison sera rasée ! On y sèmera du sel ! .
Il existe un récit de son exécution par Arnault :
L’exécution commençait quand, après avoir traversé les Tuileries, j’arrivai à la grille qui ouvre sur la place Louis XV. De là, je vis les condamnés, non pas monter mais paraître tour à tour sur le fatal théâtre, pour disparaître aussitôt par l’effet du mouvement que leur imprimait la planche ou le lit sur lequel allait commencer pour eux l’éternel repos … Danton parut le dernier sur ce théâtre, inondé du sang de tous ses amis. Le jour tombait. Je vis se dresser ce tribun, à demi éclairé par le soleil mourant. Rien de plus audacieux comme la contenance de l’athlète de la Révolution ; rien de plus formidable comme l’attitude de ce profil qui défiait la hache, comme l’expression de cette tête qui, prête à tomber, paraissait encore dicter des lois. Effroyable pantomime ! Le temps ne saurait l’effacer de ma mémoire. J’y trouve toute l’expression du sentiment qui inspirait à Danton ses dernières paroles, paroles terribles que je ne pus entendre, mais qu’on répétait en frémissant d’horreur et d’admiration : N’oublie pas surtout, n’oublie pas de montrer ma tête au peuple : elle est bonne à voir.
Son acte de décès est dressé le 7 floréal an II 26 avril 1794 par l'état civil de Paris.
Le 13 avril, une dernière fournée envoie à la guillotine Lucile Desmoulins, la femme de Camille, Chaumette et la veuve d’Hébert.
Ayant obligé la Convention à livrer Danton, le Comité se croyait sûr de sa majorité. Il se trompait, écrit Georges Lefebvre, elle ne lui pardonnait pas ces sacrifices. Tant de places vides répandaient une terreur secrète qui, aisément, tournerait en rébellion, car c’était sa position de médiateur entre l’assemblée et les sans-culottes qui avaient fait la force du Comité; en rompant avec ces derniers, il libérait l’assemblée et, pour achever de se perdre, il ne lui restait plus qu’à se diviser.
Historiographie
Au XIXe siècle, la tradition républicaine a vite réhabilité Danton. Michelet, qui va se consacrer pendant dix ans aux sept volumes de son histoire de la Révolution française, parus entre 1847 et 1853, fait de Danton l’incarnation de la Révolution, le vrai génie pratique, la force et la substance qui la caractérise fondamentalement. Son génie ? L’action, comme dit un ancien. Quoi encore ? L’action. Et l’action comme troisième élément. Edgar Quinet, dans sa Révolution de 1865 voit dans le triple appel de Danton à l’audace la devise de tout un peuple. Pour Auguste Comte et les positivistes, la philosophie encyclopédiste a produit au moins deux héros : l’un théorique – c’est Condorcet, l’autre pratique – c’est Danton.
Le véritable promoteur du culte de Danton est le docteur Robinet, un disciple de Comte, qui consacre 25 ans de sa vie à militer pour Danton. Son premier livre Danton. Mémoire sur sa vie privée date de 1865 ; son dernier, Danton, homme d’État, de 1889.
Les républicains fondateurs de la IIIe République qui veulent une incarnation républicaine de la Révolution, ce qui exclut Mirabeau non compromise dans la Terreur, ce qui exclut Robespierre, font de Danton le héros par excellence de la Révolution française. Danton a alors des voies publiques ou des établissements scolaires portant son nom, des statues et un cuirassé. Son nom est évoqué dans de nombreuses cérémonies officielles.
Le début du XXe siècle va être marqué par une célèbre polémique entre deux grands historiens universitaires de gauche, Aulard et Mathiez, le premier est radical, le second socialiste au sujet de Danton et Robespierre. Alphonse Aulard, le premier à occuper la chaire d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne, créée en 1886, est un admirateur de Danton qui incarne pour lui la synthèse de la Révolution française et en qui il voit un précurseur de Gambetta, Danton était avant tout un homme d'État… C'est aussi et surtout un esprit français. Il y a de la gaieté, de la verve, un bon sens endiablé et une bonhomie fine dans le discours. La réaction a lieu en 1908 avec Albert Mathiez, ancien collaborateur d’Aulard qui a été son directeur de thèse. C’est lui qui va établir de façon quasi irréfutable, en épluchant minutieusement ses comptes et en faisant un inventaire systématique de ses amis douteux, la corruption de Danton. Il fonde sa propre revue destinée à exalter l’œuvre de Robespierre et va reprendre, en l’étayant de documents, le réquisitoire de Robespierre et de Saint-Just contre Danton. Pour lui et pendant longtemps pour les historiens de la Société des études robespierristes qui se réclament de lui, Danton est un vendu et un débauché qui a mené une politique de double-jeu, Mathiez résumant sa pensée en écrivant Danton était un démagogue affamé de jouissances, qui s'était vendu à tous ceux qui avaient bien voulu l'acheter, à la Cour comme aux Lameth, aux fournisseurs comme aux contre-révolutionnaires, un mauvais Français qui doutait de la victoire et préparait dans l'ombre une paix honteuse avec l'ennemi, un révolutionnaire hypocrite qui était devenu le suprême espoir du parti royaliste .
En 1932, Louis Barthou, homme politique de la IIIe République, conteste dans son Danton les arguments de Mathiez et refait l'apologie du grand révolutionnaire au service de la patrie.
Georges Lefebvre, qui occupe à son tour en 1937 la chaire d’histoire de la Révolution à la Sorbonne et sera jusqu’à sa mort en 1959 le spécialiste incontesté du domaine, adopte en 1934 une position moins partisane et plus équilibrée : admettant la vénalité, il n’en tire pas toutes les conséquences qu’en déduit Mathiez sur la politique de Danton.
La position de Lefebvre a été adoptée par les historiens contemporains François Furet et Mona Ozouf qui s’intéressèrent surtout aux contradictions et à la complexité du personnage. François Furet reconnait que les documents mis au jour par Mathiez permettent d'établir, ou au moins de rendre très vraisemblable, la corruption de Danton. Mais il lui reproche de tirer de ces preuves plus qu'elles ne peuvent offrir et de mélanger politique révolutionnaire et vertu privée : Danton n'est ni chaste, ni vertueux, ni convaincu comme l'est Robespierre, le héros de Mathiez. Pour François Furet, Danton est un homme politique opportuniste, intermittent, peu délicat sur les moyens, en même temps qu'un orateur un peu génial dans l'improvisation, et un vrai tempérament politique dans les grandes occasions : la Patrie en danger, la levée en masse, le Salut public, son procès enfin.
Gérard Walter écrit dans son introduction au procès de Danton Actes du Tribunal révolutionnaire, Mercure de France, 1986 :
Que demandons-nous à Danton? Est-ce de savoir combien d’argent il a gagné au cours de sa carrière politique, et comment ? Ou quels sont les services qu’il a rendus à la Révolution ? Si l’on entend le juger sous ce dernier rapport, ce n’est pas le bilan de sa fortune qu’il y a lieu de dresser, mais celui de ses actes. Si celui-ci, en fin de compte, est en mesure d’établir que l’activité de Danton a contribué effectivement au triomphe de la Révolution, peu importe s’il a reçu de la Cour ou ailleurs, 30 000 livres, ou 300 000, ou même 3 millions. Par contre, s’il avait été démontré qu’il n’eût jamais touché un sol de personne, mais qu’il ne fut pas le sauveur de la France révolutionnaire à l’époque où les Allemands et les émigrés marchaient sur Paris, on aurait bien le devoir de le proclamer grand honnête homme, mais aussi celui de le rayer définitivement du nombre des grands révolutionnaires.
À propos de notes rédigées par Robespierre à la veille du procès de Danton
Ces notes, une vingtaine de pages étaient destinées à Saint-Just pour son rapport d'accusation à la Convention :
Le mot de vertu faisait rire Danton ; il n'y avait pas de vertu plus solide, disait-il plaisamment, que celle qu'il déployait toutes les nuits avec sa femme.
Quand je montrais à Danton le système de calomnie des brissotins développé dans les papiers publics, il me répondait : "Que m'importe ! L'opinion publique est une putain, la postérité une sottise !.
C'est en vain que l'on se plaignait à Danton de la faction girondine : il soutenait qu'il n'y avait point là de faction et que tout était le résultat de la vanité et des animosités personnelles.
Une autre maxime de Danton était qu'il fallait se servir des fripons. Aussi était-il entouré des intrigants les plus impurs. Il professait pour le vice une tolérance qui devait lui donner autant de partisans qu'il y a d'hommes corrompus dans le monde. C'était sans doute le secret de sa politique.
Il ne faut pas oublier les thés de Robert, ou d'Orléans faisait lui-même le punch, ou Fabre, Danton et Wimpffen assistaient. C'était là qu'on cherchait à attirer le plus grand nombre de députés de la Montagne pour les séduire ou pour les compromettre.
Il ne voulait pas la mort du tyran; il voulait qu'on se contentât de le bannir, comme Dumouriez.
Il a vu avec horreur la révolution du 31 mai ; il a cherché à la faire avorter ou à la tourner contre la liberté, en demandant la tête du général Hanriot, sous prétexte qu'il avait gêné la liberté des membres de la Convention.
Danton voulait une amnistie pour tous les coupables; il s'en est expliqué ouvertement; il voulait donc la contre-révolution. Il voulait la dissolution de la Convention, ensuite la destruction du gouvernement : il voulait donc la contre-révolution.
Il y avait un trait de Danton qui prouve une âme ingrate et noire : il avait hautement préconisé les dernières productions de Desmoulins : il avait osé, aux Jacobins, réclamer en leur faveur la liberté de la presse, lorsque je proposai pour elles les honneurs de la brûlure. Dans la dernière visite dont je parle, il me parla de Desmoulins avec mépris : il attribua ses écarts à un vice privé et honteux, mais absolument étranger à la Révolution.
Danton et le procès de Louis XVI
Le 6 novembre 1792, Danton, le tout premier, demande la publication intégrale du rapport Valazé, premier acte énonciatif des crimes de Louis Capet qui venait être lu, en même temps qu'il rejette l'inviolabilité de Louis XVI et appelle à la condamnation en cas de reconnaissance de sa culpabilité. Le 15 novembre, il exprime le souhait d'un rapport sur le décret du 13, présenté par Pétion sur le thème "Louis est-il jugeable ?" en précisant la nécessité de se prononcer sur l'inviolabilité, le mode de jugement et la peine. Dans cette logique le 30 novembre, avant de partir en mission il appelle à l'accélération des procédures de jugement afin d'obtenir au plus vite la condamnation à mort de Louis Capet. Il aurait même dit en privé : "il ne faut pas juger le roi mais simplement le tuer". De ce fait, en février 1793 il avait la confiance pleine et entière des régicides ou pro-régicides qu'on n'a jamais dans cette affaire soupçonnés de corruption : de René Choudieu à l'abbé Grégoire et Hérault de Séchelles. Si on s'en tient aux faits, par ses propres votes il a ignoré les menaces de révélations de cette corruption politique par Bertrand dans une lettre du 11 décembre 1792 qu'il a découverte à son retour de mission, c'est-à-dire au moment de choisir. Les tentatives vénales de sauvetage du roi ont existé mais en réalité selon René Choudieu, elles concernaient majoritairement ceux qui n'avaient pas voté la mort du roi ou dans quelques cas contraires qui avaient assorti la peine capitale de l'appel au peuple et du sursis. Ce qui n'était évidemment pas le cas de Danton ; ni d'ailleurs des "Dantonistes" montrés du doigt dans cette affaire Lacroix, Chabot, Bazire, Fabre d'Eglantine, Robert, Thuriot. Le 16 janvier alors que des girondins tels que Lanjuinais et Lehardy désireux de sauver le roi réclamaient le vote de la mort une majorité des 2/3 Danton fit front avec plusieurs Montagnards et réclama avec succès le vote de la mort à la majorité simple.
"... Je demande si vous n'avez pas voté à la majorité absolue seulement la république, la guerre ; et je demande si le sang qui coule au milieu des combats ne coule pas définitivement ? Les complices de Louis n'ont-ils pas subi immédiatement la peine sans aucun recours au peuple et en vertu de l'arrêt d'un tribunal extraordinaire ? Celui qui a été l'âme de ces complots mérite-t-il une exception ?"...
Toujours le 16 janvier, à propos d'une discussion futile sur une pièce de théâtre, il s'exclame : "Je vous l’avouerai citoyens, je croyais qu’il s’agissait d‘une tragédie que vous devez donner en spectacle à toute l’Europe. Je croyais qu’aujourd’hui vous deviez faire tomber la tête du tyran et c’est d’une misérable comédie dont vous vous occupez."
Il se trouve que l'Espagne qui aurait tenté de l'acheter envoya une lettre au Président de la Convention. Danton protesta fermement les risques d'une négociation visiblement destinée à faire traîner le procès voire à l'annuler.
"Cependant qu'on entende si on le veut cet ambassadeur, mais que le président lui fasse une réponse digne du peuple dont il sera l'organe et qu'il lui dise que les vainqueurs de Jemmapes ne démentiront pas la gloire qu'ils ont acquise, et qu'ils retrouveront, pour exterminer tous les rois de l'Europe conjurés contre nous, les forces qui déjà les ont fait vaincre... Rejetez, rejetez, citoyens, toute proposition honteuse..."
Par ailleurs contrairement à ce qu'affirme Bertrand de Molleville, Danton motiva son vote. Toujours, le 16 janvier, il s'écrie
- "Je ne suis point de cette foule d'hommes d'État qui ignorent qu'on ne compose pas avec les tyrans, qui ignorent qu'on ne frappe les rois qu'à la tête, qui ignorent qu'on ne doit rien attendre de ceux de l'Europe que par la force de nos armes ! Je vote la mort du tyran" !
Le lendemain 17 en fin d'après-midi, le vote terminé avec une très courte majorité favorable à la mort inconditionnelle, on préfère décider du sursis. Tallien, montagnard comme lui, demande qu'il soit ouvert sur le champ. Danton s'y oppose :
"Il ne faut pas décréter, en sommeillant, les plus chers intérêts de la patrie. Je déclare que ce ne sera ni par la lassitude, ni par la terreur qu'on parviendra à entraîner la Convention nationale à statuer, dans la précipitation d'une délibération irréfléchie, sur une question à laquelle la vie d'un homme et le salut public sont également attachés... Je demande donc la question préalable sur la proposition de Tallien ; et que, si cette proposition était mise aux voix, elle ne pût l'être que par l'appel nominal."
Il est difficile de ne pas prendre en compte les remarques de Louis Barthou quand il écrivait :
"Quand il parlait à la tribune, Danton avait toute la Convention pour témoin et pour juge des responsabilités qu'il assumait : il accomplissait un acte. Qui fut le témoin de ses entrevues avec Lameth ?"
Dans la fiction
1983 : dans le film Danton, son rôle est joué par Gérard Depardieu.
1989 : dans le film La Révolution française, son rôle est joué par Klaus Maria Brandauer.
2013 : dans le téléfilm Une femme dans la Révolution, son rôle est joué par Grégory Gadebois.
Liens
http://youtu.be/BuNETgEW3t0 par henrui Guillemin
http://youtu.be/UVf8rrbZYEI secrets d'histoire Danton
http://youtu.be/xzsf3edIWoo Secrets d'histoire
http://youtu.be/hkGDZX2ADTc Danton film bande annonce
http://youtu.be/rHbJI_fiLD8 Danton le procès par Depardieu     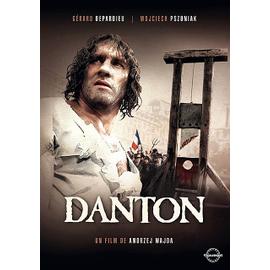        
Posté le : 25/10/2014 17:04
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
113 Personne(s) en ligne ( 69 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 113
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages