|
|
Alan Stewart Patton |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 11 janvier 1903 naît Alan Stewart Paton
dans la province du Natal en Afrique du sud, il meurt le 12 avril 1988, écrivain et un homme politique sud-africain, fondateur du parti libéral.Descendant de colon Anglais, il lutte contre l'aparteid et fonde le parti libéral.
En bref
Célèbre pour un roman pathétique, Pleure, ô pays bien-aimé (1948), il évoque la dure réalité politique et humaine de l'Afrique du Sud dans une série de récits : Quand l'oiseau disparut (1953), le Bal des débutants (1961), Instruments de ta paix (1968). Président du parti libéral (1956-1958 ; 1961-1969), il a également écrit une biographie de l'ancien ministre libéral Hofmeyr et réuni ses essais et articles dans la revue Contact de 1958 à 1966. Après avoir évoqué sa femme disparue en 1967, il revient sur sa propre vie (Vers la montagne, une autobiographie, 1980) et fait un retour au roman avec Ah, mais ta terre est belle (1982).
Sa vie
Il est né dans la province du Natal, aujourd'hui appelée KwaZulu-Natal. Sa famille descendait des colons anglais en Afrique du Sud. Ses parents appartenaient à la communauté religieuse protestante des christadelphians. Alan Paton obtint à l'université du Natal une licence de sciences ainsi qu'un diplôme d'enseignement.
Il devint enseignant en lycée, puis, de 1935 à 1948, proviseur d'un centre de rééducation pour mineurs délinquants. Il y introduisit des réformes progressistes en assouplissant les conditions de vie et en proposant toutes sortes de permissions en cas de bonne conduite : dortoirs plus ouverts, autorisation de travail hors du centre. Il autorisa aussi l'hébergement dans des familles d'accueil avec contrôle par l'institution.
Alan Paton voulut s'engager lors de la Seconde Guerre mondiale mais fut réformé. Il décida alors de voyager, à ses propres frais, pour découvrir les systèmes éducatifs étrangers et tout particulièrement leurs centres de rééducation. Il visita ainsi une partie de l'Europe et les États-Unis. Lors de son passage en Norvège, il commença à écrire son premier roman, Pleure, ô pays bien-aimé. Il en finit l'écriture fin 1946 à San Francisco, où il rencontra également son éditeur.
Rentré au pays en 1947, il fonda en 1953 le parti libéral sud-africain qui militait pacifiquement contre l'apartheid fraîchement instauré. Il en resta président jusqu'à sa dissolution en 1968, la loi interdisant alors les partis multiraciaux.
En 1971, dans un texte publié dans Knocking on the Door 1975, Alan Paton — né au Natal — revient, avec une pointe d'humour attendri, sur sa jeunesse : « Pinky [« Socialo naquit dans une maison qui n'avait pas de fenêtres... Et puis un jour, avec stupéfaction, Pinky découvrit que le monde extérieur existait. » Si l'on tient compte du contexte sud-africain, on comprend mieux pourquoi cet homme a pu passer sa vie à prôner le risque de l'ouverture et de la découverte des autres, armé de sa seule foi, et du culte qu'il voue à saint François d'Assise. Il fait sienne sa prière, qu'il cite dans Instrument of Thy Peace 1968 : C'est en donnant que nous recevons, c'est en pardonnant que nous sommes pardonnés. Paton ne cesse de frapper aux portes de l'indifférence.
Son ardeur et sa ferveur l'amènent à se partager en de multiples activités : membre de la communauté anglaise, il tente de comprendre le monde fermé des Afrikaners, tout en se consacrant, de 1935 à 1948, à de jeunes délinquants noirs, à Diepkloof ; il devient secrétaire, puis président du Parti libéral de 1956 à 1968, date de dissolution de cette espérance en l'avenir du pays. Il se heurte, ici comme ailleurs, aux foudres du pouvoir. Il s'intéresse au journalisme, Contact, 1958-1968, au théâtre, à la prière, à la poésie, et plus particulièrement à l'élégie, Kentakion for You Departed, dédié à sa femme Dorrie décédée en 1967, à la biographie historique Hofmeyr, 1964. En 1946, il parcourt le monde pour dénoncer un système pénal qui réprime au lieu d'assister. Mais il revient souvent au roman, qui est sans doute le plus apte à porter son message.
La réconciliation demeure le thème essentiel de Cry, the Beloved Country : Pleure, ô pays bien-aimé, 1948, dont le récit dépouillé a le rythme d'une tragédie grecque. Les deux premiers temps sont constitués par la quête des pères, l'un noir et l'autre blanc, partis chercher leurs enfants dans une ville qui demeure le lieu de la perdition. Le troisième temps est celui de la rédemption et du retour à la terre : le fils du Blanc mettra ses compétences au service du Noir.
Dans Too Late the Phalarope en 1953, Paton l'anglophone nous brosse le portrait poignant d'un policier afrikaner déchiré entre son éducation puritaine et ses amours impossibles pour une femme de couleur. L'œuvre frappe par sa force et sa pudeur.
En 1961, il se tourne vers la nouvelle, qu'il maîtrise admirablement, Debbie Go Home. L'expérience cruciale de Diepkloof s'extériorise dans la nouvelle intitulée Sponono, dont Paton titre une pièce en 1963 ; l'éducateur se voit interpellé par sa propre charité : du donneur et du receveur, qui donc demande le plus à être reconnu par l'autre ; La structure d'un roman comme Ah, But Your Land is Beautiful 1981 annonce de grandes ambitions : l'édifice romanesque s'organise autour de trames qui s'enchevêtrent et accueillent les faits divers ainsi que les lettres d'un corbeau.
L'appel à la réconciliation est aussi fort que dans The Quarry, nouvelle parue au Cap en 1967, où l'on voit un jeune Noir voler au secours d'un jeune Blanc, en dépit des interdits, sur la muraille abrupte d'une carrière.
Le héros est acclamé par la foule qui s'est agglutinée au pied de la paroi et où toutes les races se côtoient, comme si les personnages étaient tout à coup touchés par le « Christmas Spirit » cher à Dickens : une foule semblable à celle qui s'était recueillie sous les voûtes d'une église, lors des obsèques d'Edith Jones, une militante blanche, ce qui fit dire à Paton : J'eus là une vision qui ne devait jamais plus me quitter.
Dès la parution de Pleure, ô pays bien-aimé, des écrivains noirs comme L. Nkosi et B. Modisane avaient dénoncé ce roman comme une version sud-africaine de l'Oncle Tom. Une ferveur toute franciscaine et la foi opiniâtre du charbonnier peuvent-elles être assez fortes pour renverser l'ordre des privilèges établis ; Mais Paton ne se fait pas trop d'illusions. Ce qu'il affirme, en tant qu'écrivain, c'est le devoir d'Antigone, le droit à protester. Ce qu'il maintient, c'est qu'une société n'a plus rien de chrétien lorsqu'elle pense « consolider son avance en la refusant aux autres ».
Il prit sa retraite à Botha's Hill, dans sa province natale, où il mourut le 12 avril 1988.
Ouvrages
Pleure, ô pays bien-aimé Cry, The Beloved Country, 1948 édition française en 1950, Albin Michel, traduction Denise Van Moppès
Lost in the Stars 1950
Quand l'oiseau disparut Too Late the Phalarope, 1953 édition française en 1970
The Land and People of South Africa, 1955
South Africa in Transition, 1956
Debbie Go Home, 1960
Tales from a Troubled Land, 1961
Hofmeyr, 1964
South African Tragedy, 1965
Spono, 1965
The Long View, 1967
Instrument of Thy Peace, 1968
Kontakio For You Departed, 1969
Case History of a Pinky, 1972
Apartheid and the Archbishop: the Life and Times of Geoffrey Clayton, Archbishop of Cape Town, 1973
Knocking on the Door, 1975
Towards the Mountain, 1980
Ah, but Your Land is Beautiful, 1981
Journey Continued: An Autobiography, 1988
Save the Beloved Country, 1989   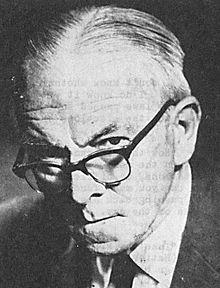 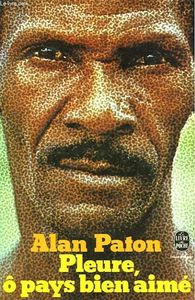     
Posté le : 11/01/2015 15:20
|
|
|
|
|
Le nouvel an : dates traditions, coutumes |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
La date du nouvel an Bonne Année!
Ces deux mots qu’on souhaite sans y penser ont une très longue histoire derrière eux et n’ont pas toujours été souhaités à la date du 1er janvier.
L’Histoire du Nouvel an
La célébration du Nouvel An est la plus vieille célébration au monde. La toute première daterait de plus de 4000 ans et était célébrée à Babylone. La nouvelle année commençait alors avec la première Nouvelle Lune qui suivait le solstice de printemps.
Le début du printemps est en effet un moment logique pour commencer la nouvelle année. Car après tout c’est la saison de la renaissance, le moment où l’on plante la nouvelle récolte et où les plantes refleurissent. Les célébrations babyloniennes du Nouvel An duraient onze jours. On y célébrait le dieu Mardouk qui protégeait les récoltes. Chaque jour avait sa propre célébration, et il est certain que nos festivités modernes de la Saint-Sylvestre sont bien pâles en comparaison.
Pourquoi l'année commence-t-elle le 1er janvier ?
Le nouvel an tombe le 1er janvier : l'affirmation semble évidente, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ce jour a-t-il été choisi ? Quelles ont été les autres premiers jours de l'an ? Remontez le temps et découvrez les tribulations de la nouvelle année.
Le 1er mars, premier jour du calendrier julien fondé par Jules César
En 46 Av. J-C, Jules César, établi le Calendrier Julien, le 1er janvier représente alors le jour du Nouvel An et pour synchroniser le calendrier avec le soleil, César a dû créer une année de 445 jours. Les Romains dédiaient ce jour à Janus, Dieu des portes et des commencements.
A la chute de l’empire romain, cette tradition tend à disparaître pour reprendre au Moyen Âge. Mais les dates sont différentes selon les pays, pour les Anglais le nouvel an avait lieu en mars, pour les Français le dimanche de Pâques et pour les Italiens à Noël.
Il faut attendre l'instauration du calendrier grégorien par le pape Grégoire XIII en 1582 pour que l'année commence le 1er janvier sans avoir à jouer avec les dates.
Jules César décide donc de remplacer le calendrier lunaire jusque-là en vigueur par un calendrier solaire, dit "julien" du nom de l'empereur. Tout comme notre calendrier actuel, il est divisé en 12 mois et 365 jours, une journée supplémentaire étant ajoutée tous les quatre ans année bissextile. Seule différence : le premier jour de l'année est fixé au 1er mars, mois très important à Rome car associé au dieu de la guerre. Cette répartition a laissé des traces aujourd'hui : nos derniers mois de l'année actuels s'appellent ainsi octobre, de "octo", le huitième, novembre, de "novo" le neuvième et décembre, de "decem" le dixième alors qu'ils sont désormais les dixième, onzième et douzième mois de l'année.
Le nouvel an, une spécificité régionale
En 532, l'Église décide de faire commencer l'année au 1er janvier, mois qui suit immédiatement la naissance du Christ fixée au 25 décembre 753 de l'an de Rome, la fondation de la ville éternelle servant de point de départ au calendrier romain par le Pape Libère. Pour autant, le 1er janvier n'est pas le premier jour de l'année pour tous. Dans certaines régions de France, c'est Pâques, date anniversaire de la résurrection du Christ, qui fait office de nouvel an. Mais cela pose quelques problèmes : Pâques est une date mobile qui correspond au premier dimanche après la pleine lune de printemps 21 mars. On peut donc se retrouver aussi bien avec des années de longueur variable… ce qui s'avère bien compliqué à l'usage. Dans d'autres pays ou régions, c'est Noël qui est choisi comme début de l'année : ainsi, à Lyon, dans le Poitou, en Normandie ou en Anjou...
De l'Edit de Roussillon au calendrier grégorien
L'Edit de Roussillon impose le 1er janvier comme début de chaque année.
Le 9 août 1564, par l'Edit de Roussillon, le roi Charles IX impose le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année. La mesure prend effet au 1er janvier 1567. En 1582, un nouveau calendrier naît : le calendrier dit grégorien, du nom du pape Grégoire XIII (pape de 1572 à 1582). La structure du calendrier grégorien est analogue à celle du calendrier julien. Le calendrier grégorien donne un temps moyen de l'an de 365,2425 jours. Pour assurer un nombre entier de jours par année et pour correspondre à la réalité solaire, on y ajoute régulièrement (tous les 4 ans en principe) un jour bissextile, le 29 février. Quand les catholiques européens se réveillent le lendemain du jeudi 4 octobre, ils sont en réalité le vendredi 15 octobre selon le nouveau calendrier. L'année 1582 compte dix jours de moins pour rattraper le décalage avec le soleil. Le calendrier julien n'était en effet pas en accord avec l'année solaire, il avançait d'environ 11 minutes. C'est pour rétablir ce décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur.
En revanche, pas de modification de la date du nouvel an. C'est ce calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui.
Le 22 septembre, nouvel an révolutionnaire
Personnification de Pluviose
Le 22 septembre 1792, la Convention proclame la République. Symbolisant une rupture avec l'ordre ancien, l'élaboration du calendrier républicain demande plus d'un an de débats auxquels participent notamment David, Chénier et Fabre d'Eglantine. Le projet définitif est adopté le 24 octobre 1793 : le début de la nouvelle ère est fixé au 22 septembre 1792 qui devient ainsi le 1er vendémiaire an I. Chaque année commence le jour de l'équinoxe d'automne, moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, ce qui, selon les années, peut correspondre au 22, 23 ou 24 septembre, date qui est fixée par décret. L'année est divisée en douze mois de trente jours, eux-mêmes divisés en trois "décadi " de dix jours, pour supprimer toute référence biblique à la semaine de sept jours, suivis de cinq jours "complémentaires" appelés aussi "sans-culottides". L'année bissextile est appelée "franciade" et le jour rajouté tous les quatre ans, jour de la Révolution.
Retour au 1er janvier
En 1805, un retour à l'ancien système devient nécessaire : la France doit avoir le même calendrier que le reste de l'Europe. Le 1er janvier 1806 11 nivôse an XIV marque ainsi l'abandon du calendrier révolutionnaire pour le calendrier grégorien. Depuis lors, le 1er janvier est resté premier jour de l'année.
Les Traditions autour du nouvel an
-Les bonnes résolutions :
C’est l’une des plus importantes traditions de cette période. Là aussi cette coutume date des Babyloniens. Si nos résolutions modernes les plus populaires sont celles d’arrêter du fumer ou de faire du sport, sous Babylone, la résolution la plus populaire était celle de rendre l'équipement agricole emprunté.
-L’échange de présents :

Dans la Rome antique on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. Ces présents étaient des échanges de bons présages pour l'année à venir et des gages d'amitié entre romains.
Les cartes de vœux :
C’est au Moyen âge que la carte de vœux fait son apparition. On envoyait alors un petit présent à sa famille en l'accompagnant d'une lettre de vœux peinte à la main. Cette tradition a complètement disparu au XVI ème siècle pour revenir en force XVIII ème siècle.
La première carte de vœux moderne est anglaise. Elle date de 1843 et a été dessinée par John Calcott. Dès 1860 l'envoi des cartes de vœux remporte un franc succès et se généralise partout.
-S’embrasser sous le gui :
Ce geste est lui aussi un héritage des traditions et croyances anciennes. Le feuillage vert et persistant du gui lui conférait des pouvoirs surnaturels, car son feuillage « ne mourrait jamais ». Pour les druides le gui portait bonheur. Il avait aussi d’autres pouvoirs qui permettaient aux femmes d’avoir des enfants, qui garantissaient de bonnes récoltes et protégeait du mauvais sort. Aujourd’hui, nous avons gardé l'habitude de nous embrasser sous le gui, le soir du réveillon de la nouvelle année, afin de connaître le bonheur sentimental et le mariage pour les célibataires.
-Manger certains produits :
Beaucoup de cultures pensent que manger quelque chose en forme d'anneau apporterait la chance. En effet le cercle symbolise l’achèvement du cycle d'une année. Ainsi, les hollandais mangent des beignets ronds (les donuts) le jour de l’an afin d’avoir de la chance durant toute l’année.
-En Espagne :
A chaque coup des 12 coups de minuit, on mange un grain raisin.

-En Italie :
On mange des plats spéciaux, censés apporter richesse et abondance. Ces sont en général des brioches, des plats de lentilles ou des gâteaux enrobés de miel.
-En Russie :
Pendant les 12 coups de minuit, on boit du champagne. Ensuite, à la fin des 12 coups, on ouvre la porte ou la fenêtre afin que le nouvel an entre dans la maison.
-Les Nouvels Ans du bout du monde
-En Chine :
Le nouvel an est fêté entre le 21 janvier et le 20 février. Comme le calendrier chinois est un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An chinois varie d'une année sur l'autre.
-Au Cambodge :
Le Nouvel An est fêté du 13 au 15 avril.
-Le nouvel an persan :
Norouz, est célébré depuis au moins 3000 ans et découle de rituels et de traditions du Zoroastrisme. Aujourd'hui, cette fête est célébrée dans les pays qui ont été soit conquis soit influencés par l'Empire Perse.
On trouve bien sûr l'Iran, mais aussi l'Irak, l'Afghanistan, certaines parties du Moyen-Orient ainsi qu’au Tadjikistan, en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, et au Kyrgyzstan. Cette fête est aussi célébrée par les Parsis zoroastriens d’Inde et de Turquie. Certaines communautés la célèbre le 21 mars, d'autres le jour de l'équinoxe vernal, qui a lieu le 20, 21 ou 22 mars.
Les étrennes
En parlant des étrennes, on ne peut se dispenser de remonter, non pas aux Grecs, mais du moins aux Romains, inventeurs de cet usage. Le premier endroit de l’histoire romaine nous apprenant cette coutume est de Symmachus, auteur ancien, qui nous rapporte qu’elle fut introduite sous l’autorité du roi Tatius Sabinus, qui reçut le premier la verbène (verveine) du bois sacré de la déesse Strénia, pour le bon augure de la nouvelle année.
Soit que les Romains imaginassent quelque chose de divin dans la verbène, soit qu’ils faisaient allusion au nom de cette déesse Strénia, dans le bois de laquelle ils prenaient la verbène, avec le mot de strenuus, qui signifie vaillant et généreux : aussi le mot strena, qui signifie étrenne, se trouve quelquefois écrit strenua chez les Anciens, pour témoigner que c’était proprement aux personnes de valeur et de mérite qu’était destiné ce présent, et à ceux dont l’esprit tout divin promettait plus par la vigilance que par l’instinct d’un heureux augure.

Après ce temps-là, l’on vint à faire des présents de figues, de dattes et de miel, comme pour souhaiter aux amis qu’il n’arrivât rien que d’agréable et de doux pendant le reste de l’année. Ensuite les Romains, quittant leur première simplicité, et changeant leurs dieux de bois en des dieux d’or et d’argent, commencèrent à être aussi plus magnifiques en leurs présents, et à s’en envoyer ce jour-là de différentes sortes, et plus considérables ; mais ils s’envoyaient particulièrement des monnaies et médailles d’argent, trouvant qu’ils avaient été bien simples, dans les siècles précédents, de croire que le miel fût plus doux que l’argent, comme Ovide le fait agréablement dire à Janus.
Avec les présents, ils se souhaitaient mutuellement toute sorte de bonheur et de prospérité pour le reste de l’année, et se donnaient des témoignages réciproques d’amitié : et comme ils prenaient autant d’empire dans la religion que dans l’Etat, ils ne manquèrent pas d’établir des lois qui la concernaient, et firent de ce jour-là un jour de fête, qu’ils dédièrent et consacrèrent particulièrement au dieu Janus, qu’on représentait à deux visages, l’un devant et l’autre derrière, comme regardant l’année passée et la prochaine. On lui faisait ce jour des sacrifices, et le peuple allait en foule au mont Tarpée, où Janus avait quelqu’autel, tous habillés de robes neuves.
Néanmoins, quoique ce fût une fête, et même une fête solennelle, puisqu’elle était encore dédiée à Junon, qui avait tous les premiers jours de mois sous sa protection, le peuple ne demeurait pas sans rien faire ; chacun commençait à travailler à quelque chose de sa profession, afin de n’être pas paresseux le reste de l’année.
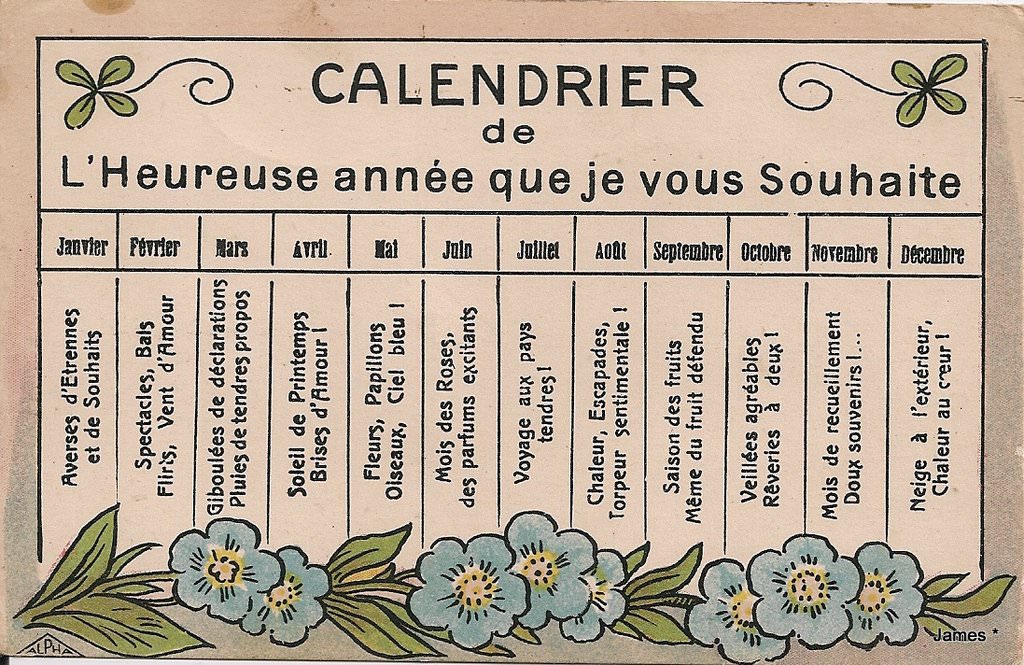
Enfin, l’usage des étrennes devint peu à peu si fréquent sous les empereurs, que tout le peuple allait souhaiter la bonne année à l’empereur, et chacun lui portait son présent d’argent, selon son pouvoir. Auguste en recevait en si grande quantité, qu’il avait accoutumé d’en acheter et dédier des idoles d’or et d’argent, comme étant généreux, et ne veillant pas appliquer à son profit particulier les libéralités de ses sujets.
Tibère, son successeur, qui était d’une humeur plus sombre et n’aimait pas les grandes compagnies, s’absentait exprès les premiers jours de l’année, pour éviter l’incommodité des visites du peuple, qui serait accouru en foule pour lui souhaiter la bonne année. Ces cérémonies occupaient même si fort le peuple, les six ou sept premiers jours de l’année, qu’il fut obligé de faire un édit par lequel il défendait les étrennes, passé le premier jour. Caligula, qui posséda l’empire immédiatement après Tibère, fit savoir au peuple, par un édit, qu’il recevrait les étrennes le jour des calendes de janvier, qui avaient été refusées par son prédécesseur ; et pour cet effet il se tint tout le jour dans le vestibule de son palais, où il recevait à pleines mains tout l’argent et les présents qui lui étaient offerts par le peuple.
Claude, qui lui succéda, abolit ce que son prédécesseur avait voulu rétablir, et défendit, par arrêt, qu’on n’eût point à lui venir présenter des étrennes, comme on avait fait sous Auguste et Caligula. Depuis ce temps, cette coutume demeura encore parmi le peuple. Les Romains pensaient qu’il y avait quelque chose de divin dans les commencements.
Plus tard, le concile d’Auxerre, tenu en 587, défendit de faire, le premier jour de l’an, des sacrifices de génisses ou de biches et d’aller faire des vœux devant les arbres consacrés aux faux dieux. Les étrennes, jointes à des sacrifices, étaient véritablement diaboliques.
Lorsqu’en France l’année débutait encore à Pâques, continuait-on de donner des étrennes le premier jour de janvier ? Il semble que oui. Dans les lettres du roi Jean, en date de juillet 1362 et contenant des statuts pour la confrérie des drapiers, il est dit « que ladite confrérie doit seoir le premier dimanche après les estraines, si celle de Notre-Dame n’y eschoit. » Le dimanche dont il est question ici est le premier dimanche de janvier, si l’on s’appuie sur le témoignage de Du Cange qui, dans son Glossaire, prouve, par différents passages, que lorsque l’année ne commençait qu’à Pâques, on ne laissait pas de regarder le premier jour de janvier comme le premier jour de l’année.
Jour des étrennes. 1er janvier 1564
L’ancienne chronique de Louis, duc de Bourbon, comte de Clermont, grand-chambrier de France conforte ce témoignage. On y lit au chapitre second : « De Clermont partit ledit duc Loys, s’en vint à son duché de Bourbonnois à Souvigny, où il arriva deux jours avant Noël, l’an de grâce 1363 ; et là vindrent par devers luis ses chevaliers et écuyers, et le quart jour des fêtes, dit aux chevaliers, le duc en riant : Je ne vous veux point mercier des biens que vous m’avez faicts, car si maintenant je vous en merciois, vous vous en voudriez aller, et ce me seroit une des grandes déplaisances que je pusse avoir... ; et je vous prie à tous que vous veuillez estre en compagnie le jour de l’an en ma ville de Molins, et là je vous veux étrenner de mon cœur et de ma bonne volonté que je veux avoir avec vous. »
Et au troisième chapitre : « L’an qui courait 1363, comme dit est, advint que la veille du jour de l’an fut le duc Loys en sa ville de Molins, et sa chevalerie après lui... ; et le jour de l’an, bien matin, se leva le gentil duc pour recueillir ses chevaliers et nobles hommes pour aller à l’église de Notre-Dame de Molins ; et avant que le duc partist de sa chambre, les vint étrenner d’une belle ordre qu’il avait faicte, qui s’appeloit l’écu d’or. » Au chapitre cinq on lit enfin : « Si les commanda le duc à Dieu, et eux pris congé de lui se partirent... Les gens partis de cour, vint le jour des Rois, où le duc de Bourbon fit grande feste et lye-chère. »
Rappelons que si sous les Mérovingiens, l’année commençait le 1er mars dans plusieurs de nos provinces, elle débuta à Noël sous Charlemagne, dans tous les territoires soumis à sa juridiction. Sous les Capétiens, le jour de l’an coïncidait avec la fête de Pâques, usage presque général au Moyen Age. En certains lieux, l’année changeait le 25 mars, fête de l’Annonciation. Le concile de Reims, tenu en 1235, mentionne cette date comme « l’usage de France ». C’est le roi Charles IX qui rendit obligatoire, en 1564, la date du 1er janvier comme origine de l’année.
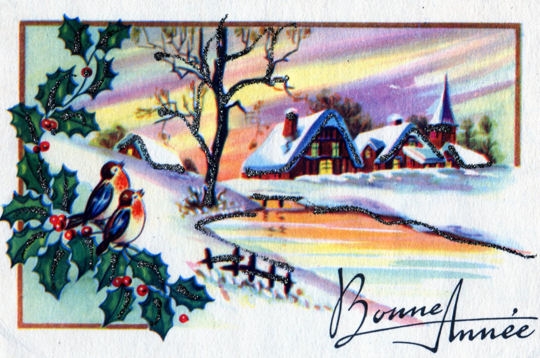
A la fin du XIXe siècle, avec l’apparition du Père Noël dans la publicité des grands magasins, la coutume d’offrir des cadeaux le 1er janvier disparut, le jour des étrennes se confondant dès lors avec celui de Noël : on offrit les cadeaux le 25 décembre.[/font]
Posté le : 27/12/2014 23:29
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:04:58
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:10:06
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:13:00
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:16:16
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:19:04
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:25:14
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:28:51
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:30:50
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:33:30
Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:36:21
|
|
|
|
|
Benjamin Disraeli 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 21 décembre 1804, à Londres, naît Benjamin Disraeli

mort le 19 avril 1881, à 79 ans, homme politique et auteur britannique, nommé deux fois premier ministre du Royaume-Uni. Il joue un rôle central dans la création du parti conservateur moderne dont il formalise la doctrine. Par sa grande influence sur la politique étrangère, il a associé les conservateurs à la gloire et à la puissance de l'Empire britannique. Il est marié à Mary Anne Disraeli, et a pour religion le Judaïsme puis se convertit à l'église d'Anglicanne. Il est Chef de l'opposition sous la reine Victoria du 27 février 1852 au 17 décembre 1852, puis du 26 février 1858 au 11 juin 1859, 6 juillet 1866 – 29 février 1868, et du 1er décembre 1868 au 17 février 1874. Il occupe la fonction 40e et 42e premier ministre du Royaume-Uni, il occupera ce poste du 27 février 1868 au 1er décembre 1868 sous le règne de la reine Victoria son prédécesseur est Lord Derby, son successeur William Ewart Gladstone, puis du 20 février 1874 au 21 avril 1880, toujours sous le règne de la reine Victoria
Né à Londres dans une famille juive, Benjamin Disraeli est élevé dans la foi anglicane car son père est en conflit avec sa synagogue. Il entame une carrière d'avocat mais se tourne vers la politique dans les années 1830 et est élu à la chambre des Communes comme député de Maidstone en 1837. Lorsque les conservateurs prennent le pouvoir en 1841, Disraeli n'intégre pas le gouvernement du premier ministre Robert Peel. Cinq ans plus tard, Peel divise le parti en demandant l'abrogation des Corn Laws qui limitaient les importations de céréales : il est violemment attaqué par Disraeli. Peu de notables conservateurs rompent avec Peel, et Disraeli devient alors une figure importante du parti même si beaucoup se méfient de lui. Il est trois fois chancelier de l'Échiquier et leader de la chambre des Communes au sein des cabinets de Lord Derby dans les années 1850 et 1860. Il développe à cette période une forte rivalité avec le libéral William Ewart Gladstone.
Lorsque Derby démissionne pour des raisons de santé en février 1868, Disraeli devient premier ministre mais perd les élections à la fin de l'année. Il représente alors l'Opposition avant de mener son parti à la victoire en 1874. Il développe une forte amitié avec la reine Victoria qui le fait comte de Beaconsfield en 1876. Le second mandat de Disraeli est dominé par la Question d'Orient, désignant le déclin de l'Empire ottoman et les actions des autres pays européens, notamment la Russie, pour en profiter. Il pousse ainsi les intérêts britanniques à prendre des parts dans la compagnie du canal de Suez en Égypte ottomane. En 1878, devant les victoires russes contre les Ottomans, Disraeli mène la délégation britannique au congrès de Berlin et négocie des termes favorables au Royaume-Uni.
Même si Disraeli est félicité pour ses actions à Berlin, d'autres événements affectent le soutien à son gouvernement : les guerres en Afghanistan et en Afrique du Sud sont critiquées, et il irrite les agriculteurs britanniques en refusant de rétablir les Corn Laws. Gladstone mène une campagne efficace et le parti libéral remporte les élections de 1880.
Auteur de plusieurs romans depuis 1826, Benjamin Disraeli publie sa dernière œuvre, Endymion, peu avant sa mort à l'âge de 76 ans.
En bref
Fils du critique et historien de la littérature Isaac Disraeli 1766-1848, il donna des récits où le romantisme sentimental s'allie à la satire Vivian Grey, 1826 ; Contarini Fleming, 1832, avant de plaider dans sa trilogie Jeune Angleterre pour la démocratie tory Coningsby, 1844 ; Sybil, 1845 ; Tancred, 1847. Déjà les Voyages du capitaine Popanilla 1828 attestaient l'acuité de son regard sur le snobisme et l'ambition : la suite de son œuvre critique et romanesque Endymion, 1880 prouve la consanguinité de l'écrivain et du politique
Homme d'État britannique. Fils d'un père juif converti à l'anglicanisme, Benjamin Disraeli se fait d'abord connaître par ses talents d'écrivain. Après plusieurs œuvres mineures, dont Vivian Grey en 1827, il publie en 1844, 1845 et 1847 ses trois grands romans : Coningsby ; Sybil, or The Two Nations et Tancred, or The New Crusade. Le premier pose le problème de la société de son temps ; il dénonce dans le deuxième les maux de la vie ouvrière à Manchester et y déplore l'existence dans un même pays de deux nations ; dans le troisième s'exprime le rêve d'une nouvelle révélation divine et l'espérance d'un spiritualisme régénérateur qui viendrait d'Asie. Il traduit ainsi les aspirations d'un groupe de jeunes tories dits sociaux. C'est qu'entre-temps il s'est tourné vers l'action politique. Tenté au départ par le radicalisme, il a rompu à partir de 1836 avec le parti libéral pour adopter les couleurs des conservateurs et pour se faire élire sous leur égide, en 1837, aux Communes. Son éloquence extraordinaire, sa mise, sa réputation d'extravagance contribuent à son succès, et il est récompensé, après 1846, de sa fidélité à un parti déchiré par la « trahison » de Robert Peel et des libre-échangistes. Ami personnel de lord Derby, il devient son chancelier de l'Échiquier en 1852 et servira encore sous sa direction en 1858 et en 1867, avant de devenir Premier ministre lui-même en 1868. Vaincu aux élections de décembre 1868, il revient au pouvoir de février 1874 à avril 1880. Nourri de la nostalgie de la vieille alliance de la couronne et du peuple, il a eu l'intuition des nécessités du monde contemporain et, comme Gladstone, son grand rival, il s'est fait l'apôtre de la démocratisation progressive du régime. On lui doit l'inspiration de la réforme de 1867, considérée alors comme un « saut dans l'inconnu » parce qu'elle accordait le droit de vote à l'aristocratie ouvrière. Convaincu que l'« élite naturelle » s'imposerait aux suffrages de la masse, il lui demande de consentir aux réformes sociales qui scelleront ce destin. Ses années de gouvernement ont été marquées par le vote de lois importantes dont le fameux Employer and Workman Act de 1875, abolissant les différences entre patrons et ouvriers sur le plan du témoignage judiciaire, ou encore la nouvelle loi syndicale votée la même année et qui rendait légal le piquet de grève, ainsi que d'autres textes législatifs sur le logement ou la santé publique. Dans son discours célèbre de Crystal Palace en 1872, Disraeli avait tenté de définir les voies d'un conservatisme moderne, attaché à la tradition, mais ouvert à l'évolution. La nouvelle organisation du parti, définie à la même époque, essaie d'allier le militantisme de sections locales plus vigoureuses et l'autoritarisme d'un comité directeur tout-puissant dans la détermination de la politique générale et dans le choix des candidats à la députation. Disraeli est l'apôtre d'une plus Grande-Bretagne et l'un des pères de l'impérialisme britannique. La reine Victoria lui doit d'être devenue, en 1876, impératrice des Indes. L'Angleterre se fait, sous son égide, plus entreprenante et plus audacieuse dans l'œuvre coloniale, plus interventionniste dans les affaires extérieures : une politique « au bord du gouffre » permettra à Disraeli, en 1878, de contenir les ambitions méditerranéennes de la Russie et d'obtenir de la Turquie la concession de l'île de Chypre. Ainsi est mieux assuré le contrôle de la route des Indes, déjà amélioré par l'acquisition, trois ans plus tôt, d'un gros paquet d'actions du canal de Suez. Très liée à son Premier ministre, Victoria l'anoblit dès août 1876. Elle déplore son échec électoral de 1880, suivi, en avril 1881, d'une mort soudaine. Une plaque apposée à Westminster sur le vœu du Parlement célèbre le souvenir du fondateur véritable de l'esprit conservateur britannique d'aujourd'hui.
Sa vie
Benjamin Disraeli est né le 21 décembre 1804 dans le quartier londonien de Bloomsbury. Il était le second enfant et le premier fils d'Isaac D'Israeli, un historien et critique littéraire, et de Maria, Miriam née Basevi. La famille descendait de marchands italiens séfarades et tous les grands-parents et arrière-grands-parents de Benjamin étaient nés en Italie ; le père d'Isaac, également prénommé Benjamin, quitta Venise en 1748 pour s'installer en Angleterre. Disraeli romança par la suite ses origines en avançant que la famille de son père était issue de l'aristocratie espagnole ou vénitienne ; en réalité, il n'y avait aucun noble dans la famille d'Isaac mais du côté de sa mère, auquel il ne s'intéressa pas, il possédait plusieurs illustres aïeuls. Les historiens sont partagés sur les motivations de Disraeli pour récrire son histoire familiale ; Bernard Glassman avance que cela était destiné lui donner un statut comparable celui de l'élite dominante anglaise tandis que Sarah Bradford suppose que son aversion de l'ordinaire ne lui permettait pas d'accepter le fait que sa naissance soit aussi banale qu'elle était en réalité.
Benjamin Disraeli avait une sœur aînée Sarah 1802-1859 et trois frères cadets Naphtali né et mort en 1807, Raphael 1809-1898 et Jacobus 1813-1868. Il était proche de sa sœur et plus distant avec ses frères. On sait peu de choses sur son éducation. À l'âge de six ans, il fut scolarisé dans une dame school à Islington que l'un de ses biographes décrivit comme un excellent établissement pour l'époque. Environ deux ans plus tard, il fut envoyé à l'école du révérend John Potticary à Blackheath. C'est à cette époque que son père renonça au judaïsme et ses quatre enfants furent baptisés dans la foi anglicane en juillet et août 1817.
Isaac D'Israeli n'avait jamais accordé un grand intérêt à la religion mais il était resté membre de la synagogue de Bevis Marks. Son père en était un membre influent et c'est probablement par respect pour lui qu'Isaac ne la quitta pas lorsqu'il se disputa avec les autorités du lieu en 1813. Après la mort de son père en 1816, Isaac décida de quitter la congrégation après une nouvelle dispute. Son ami et avocat, Sharon Turner, le convainquit que s'il lui était possible de n'être rattaché à aucune religion, cela serait préjudiciable à ses enfants s'ils faisaient de même. Turner fut ainsi le parrain de Benjamin lors de son baptême à l'âge de 12 ans le 31 juillet 1817.
Sa conversion au christianisme permit à Disraeli d'envisager une carrière en politique. La société britannique du début du xixe siècle n'était pas particulièrement antisémite et plusieurs juifs avaient été députés depuis Sampson Eardley en 1770. Cependant, jusqu'en 1858, les députés devaient prêter un serment d'allégeance à la véritable foi chrétienne ce qui imposait au minimum une conversion de forme. On ne sait pas si Disraeli avait déjà des ambitions politiques au moment de son baptême mais il est certain qu'il regretta amèrement la décision de ses parents de ne pas l'envoyer au Winchester College. Il s'agissait de l'une des plus prestigieuses public schools d'Angleterre qui formait une partie de l'élite politique. Ses deux frères cadets y furent scolarisés et on ignore précisément pourquoi Isaac décida d'envoyer son fils aîné dans une institution bien moins cotée. Il intégra ainsi une école de Walthamstow à l'automne 1817.
Années 1820
En novembre 1821, peu avant son 17e anniversaire, Disraeli fut embauché comme apprenti dans un cabinet d'avocat de la cité de Londres. L'un de ses directeurs, T. F. Maples était non seulement son premier employeur et un ami de son père mais il faillit également devenir son beau-père. Une amitié se développa entre Benjamin et la fille de Maples mais cela n'alla pas plus loin. Les affaires du cabinet étaient fructueuses et le biographe R. W. Davis note que le travail était le type de fonction stable et respectable dont beaucoup de pères rêvaient pour leurs enfants. Même si ses biographes comme Robert Blake et Sarah Bradford avancent que ce poste était incompatible avec la nature ambitieuse et romantique de Disraeli, il donna satisfaction à ses employeurs et indiqua par la suite qu'il avait beaucoup appris en travaillant dans le cabinet.
Environ un an après avoir rejoint le cabinet de Maples, Benjamin changea son nom de D'Israeli à Disraeli. Ses raisons sont inconnues mais son biographe Bernard Glassman suggère que cela était destiné à éviter toute confusion avec son père. Les frères et sœurs de Disraeli adoptèrent cette nouvelle version tandis que leurs parents conservèrent l'ancienne.
Disraeli visita la Belgique et la vallée du Rhin avec son père à l'été 1824 ; il écrivit plus tard que ce fut le long du Rhin qu'il décida de démissionner. À son retour en Angleterre, il quitta le cabinet pour, sur les conseils de Maples, devenir barrister. Il s'inscrivit au Lincoln's Inn et rejoignit le cabinet de son oncle, Nathaniel Basevy, puis celui de Benjamin Austen, qui persuada Isaac que Disraeli ne réussirait pas dans cette voie et qu'il devrait être autorisé à mener une carrière littéraire. Il avait en effet déjà soumis un manuscrit à un ami de son père, l'éditeur John Murray, mais l'avait retiré avant que ce dernier n'ait décidé de le publier ou non. Après avoir quitté le droit, Disraeli écrivit quelques textes pour Murray mais se concentra sur des activités de spéculation à la bourse.
En raison de la fin de la domination espagnole en Amérique du Sud, les compagnies minières étaient en pleine expansion et émettaient de nombreuses actions. Sans fonds propres, Disraeli emprunta de l'argent pour investir. Il se rapprocha du financier John Diston Powles qui était l'un de ceux encourageant le boom minier. Durant l'année 1824, Disraeli rédigea trois pamphlets anonymes faisant la promotion des sociétés minières pour le compte de Powles. Les articles furent publiés par John Murray qui avait beaucoup investi dans le secteur.
Murray avait un temps envisager de créer un nouveau journal du matin pour rivaliser avec The Times et en 1825, Disraeli le convainquit de se lancer. La nouvelle publication, The Representative, fit la promotion des compagnies minières et des hommes politiques qui les soutenaient comme George Canning. Disraeli impressionna Murray par son enthousiasme et son engagement dans le projet mais il ne parvint pas à convaincre l'influent écrivain John Gibson Lockhart d'éditer son journal. Après cela, l'influence de Disraeli sur Murray diminua et il fut, à son grand regret, écarté de la rédaction du périodique. La publication du journal ne dura que six mois en partie du fait de l'éclatement de la bulle spéculative à la fin de l'année 1825 et parce que, selon Blake, il était atrocement édité et aurait échoué tôt ou tard.
L'éclatement de la bulle ruina Disraeli et en juin 1825, ses associés et lui avaient perdu 7 000 £ environ 574 000 £ de 2011 ; Disraeli ne remboursa complètement sa dette qu'en 1849. Il revint alors à l'écriture pour essayer d'obtenir de l'argent et pour prendre sa revanche sur Murray et ceux qui, selon lui, l'avaient abandonné. À cette époque, le genre littéraire en vogue était la silver-fork fiction fiction de la cuillère en argent mettant en scène la vie de l'aristocratie dans des romans généralement rédigés anonymement et destinés aux classes moyennes. En 1826 et 1827, Disraeli publia anonymement les quatre volumes de son premier roman Vivian Grey qui se basait largement sur l'échec du Representative. Les ventes furent satisfaisantes mais l'œuvre fit scandale dans les cercles littéraires quand l'identité de son auteur fut découverte. Les nombreux solécismes démontraient que Disraeli, alors âgé de seulement 23 ans, n'évoluait pas dans la haute-société et les critiques furent sévères. De plus, Murray et Lockhart, qui disposaient d'une grande influence dans les cercles littéraires, estimèrent qu'ils avaient été caricaturés et trompés ; ces accusations furent rejetées par l'auteur mais reprises par beaucoup de ses biographes. Dans les éditions ultérieures, Disraeli apporta de nombreuses modifications au texte pour adoucir la satire mais sa réputation en fut longuement ternie.
Le biographe Jonathan Parry avance que l'échec financier et les critiques à son encontre affectèrent fortement Disraeli et il souffrit d'une grave crise nerveuse pendant près de quatre ans : Il avait toujours été lunatique, sensible et solitaire par nature, mais il devint alors profondément déprimé et léthargique. Il vivait encore avec ses parents à Londres mais les médecins lui recommandèrent de changer d'air et il occupa plusieurs maisons à la campagne et sur la côte.
Années 1830
Avec le fiancé de sa sœur, William Meredith, Disraeli voyagea en Méditerranée en 1830 et 1831. Le voyage fut en partie financé par un autre de ses romans, The Young Duke, écrit en 1829 et 1830. L'expédition fut écourtée car Meredith mourut de la variole au Caire en juillet 1831. Malgré cette tragédie, Disraeli sortit enrichi de cette expérience. Il devint, selon Parry, conscient des valeurs qui semblaient échapper à ses concitoyens en métropole. Le voyage développa sa conscience de lui-même, son relativisme moral et son intérêt pour les opinions religieuses et raciales de l'Orient. Blake considère l'expédition comme l'une des expériences les plus formatrices de toute sa carrière : L'influence qu'elle eut sur lui fut durable. Elle conditionna son attitude envers les problèmes les plus importants qu'il affronta dans ses dernières années, en particulier la Question d'Orient ; elle colora également nombre de ses romans.
Disraeli rédigea deux romans à son retour. Contarini Fleming publié en 1832 était un autoportrait revendiqué. Sous-titré une autobiographie psychologique, il illustre les éléments contradictoires du caractère de son héros : la dualité de son ascendance nordique et méditerranéenne, l'artiste rêvé et l'homme d'action courageux. The Wondrous Tale of Alroy l'année suivante dépeint les problèmes d'un juif important du Moyen Âge devant décider entre un petit État exclusivement juif et un grand empire multireligieux.
Après la publication des deux romans, Disraeli déclara qu'il n'écrirait plus rien sur lui-même. Il avait commencé à s'intéresser à la politique en 1832 durant la crise de la Reform Bill. Il avait participé à un pamphlet anti-whig édité par John Wilson Croker et publié par Murray intitulé England and France: or a cure for Ministerial Gallomania. Le choix d'une publication tory fut jugé étrange par les amis et les proches de Disraeli qui considérait qu'il était plus proche des radicaux. Au moment de la publication de l'article, Disraeli faisait en effet campagne à High Wycombe pour la cause radicale.
À cette époque, les politiques nationales étaient dominées par des membres de l'aristocratie. Les whigs descendaient de la coalition de nobles qui avaient imposés l'adoption de la charte des droits et libertés en 1689. Les tories étaient plus en faveur du roi et de l'Église et étaient opposés à tout changement politique. Un petit nombre de radicaux, généralement issus des conscriptions du Nord de l'Angleterre, étaient les plus farouches partisans de réformes politiques et sociales. Au début des années 1830, les tories et les intérêts qu'ils défendaient semblaient perdus. Les whigs, qui formaient l'autre grand parti, étaient détestés par Disraeli : Le torysme est à bout de souffle et je ne peux m'abaisser à être un whig. Lors des deux élections générales de 1832, Disraeli tenta sans succès d'être élu à High Wycombe sous l'étiquette radicale.
Disraeli partageait certaines idées politiques des radicaux comme le besoin de réformes du système électoral et d'autres défendues par les tories comme le protectionnisme. Il commença à se rapprocher de ces derniers et en 1834, il fut présenté à l'ancien Lord Chancelier John Copley par Henrietta Sykes, l'épouse de Francis Sykes. Elle entretenait une relation amoureuse avec Copley et en entama une autre avec Disraeli. Disraeli et Copley développèrent immédiatement une forte amitié. Ce dernier propageait imprudemment les commérages et aimait les intrigues ce qui plut fortement à Disraeli qui devint son adjoint et intermédiaire. En 1835, Disraeli se présenta pour la dernière fois comme un radical mais échoua à nouveau à être élu à High Wycombe.
En avril 1835, Disraeli participa à une élection partielle à Taunton comme tory. Le député irlandais Daniel O'Connell, induit en erreur par des dépêches de presse incorrectes, pensa que Disraeli l'avait calomnié durant sa campagne et il lança une violente attaque faisant référence à Disraeli comme à :
« un reptile... tout juste bon maintenant, après avoir été deux fois rejeté par le peuple, à devenir un conservateur. Il possède tous les prérequis nécessaires en perfidie, en égoïsme, en dépravation, en corruption, etc. pour pouvoir prétendre à ce changement. Son nom montre qu'il est d'origine juive. Je n'utilise pas ce terme comme un reproche ; il y a nombreux juifs respectables. Mais il y en a, comme dans tout autre peuple, du plus bas et du plus méprisable niveau de turpitude morale ; et de ceux-ci, je considère M. Disraeli comme le pire.
Les échanges publics entre les deux hommes furent largement reproduits dans The Times58 dont une demande en duel avec le fils de O'Connell, pour laquelle Disraeli fut temporairement incarcéré par les autorités, une référence à la haine inépuisable avec laquelle il Disraeli poursuivra son existence et l'accusation selon laquelle les partisans de O'Connell avaient un revenu princier extirpé d'un race affamée d'esclaves fanatisé. Disraeli fut grandement satisfait par la dispute qui le propulsa sur le devant de la scène nationale pour la première fois. Il ne remporta pas l'élection face au whig sortant Henry Labouchère mais la circonscription de Taunton était jugée impossible à gagner par les tories. Disraeli fit néanmoins un bon score et cela en faisait un candidat potentiel pour une circonscription plus facile lors des prochaines élections.
Avec le soutien de Copley, Disraeli se mit à écrire des pamphlets pour son nouveau parti. Son Vindication of the English Constitution, fut publié en décembre 1835 sous la forme d'une lettre ouverte à Copley et, selon Bradford, présentait la philosophie à laquelle il adhéra jusqu'à sa mort. Il y défendait les vertus d'un gouvernement aristocratique bienveillant, le mépris des dogmes politiques et la modernisation des politiques tories. L'année suivante, il rédigea une série de satires sur les politiciens de l'époque qui furent publiées dans The Times sous le pseudonyme Runnymede. Il s'attaqua ainsi aux whigs, aux nationalistes irlandais et à la corruption de la classe politique. Disraeli se trouvait à présent fermement ancré dans le camp tory et il fut élu au Carlton Club, un club exclusivement tory, en 1836. En juin 1837, le roi Guillaume IV mourut et sa nièce Victoria monta sur le trône. Le Parlement fut dissous et, sur recommandation du Carlton Club, Disraeli fut choisi pour être candidat à l'élection générale.
Parlement Simple député
Lors de l'élection générale de juillet 1837, Disraeli fut élu à la chambre des Communes comme l'un de deux députés tories de la circonscription de Maidstone. L'autre était Wyndham Lewis, qui participa au financement de la campagne électorale de Disraeli et mourut l'année suivante68. La même année, Disraeli publia le roman Henrietta Temple, une histoire d'amour et une comédie sociale basée sur son aventure avec Henrietta Sykes. Il avait rompu sa relation avec elle à la fin de l'année 1837, déçu qu'elle eut pris un nouvel amant. Il rédigea une autre romance dans Venetia en se basant sur Percy Bysshe Shelley et George Gordon Byron pour obtenir rapidement de l'argent.
Disraeli réalisa son premier discours devant le Parlement le 7 décembre 1837. O'Connell le précéda et il critiqua son « discours long, décousu et embrouillé. Les partisans de O'Connell le firent taire en criant plus fort que lui et Blake rapporte que ses derniers mots furent Je vais à présent m'asseoir mais le jour viendra où vous m'entendrez. Après ce début peu prometteur, Disraeli fit profil bas durant toute sa mandature. Il fut un partisan loyal du chef de parti Robert Peel et de ses politiques même s'il fit part de sa sympathie personnelle pour le mouvement chartiste que de nombreux tories ne partageaient pas.
En 1839, Disraeli épousa Mary Anne Lewis, la veuve de Wyndham Lewis. De douze ans son aînée, Mary Lewis disposait d'un revenu annuel confortable de 5 000 £ environ 516 000 £ de 2011. Ses biographes considèrent que cette union était intéressée mais les deux devinrent très proches jusqu'à la mort de Mary trois décennies plus tard. Elle déclara plus tard : Dizzy m'a épousé pour mon argent mais s'il en avait à nouveau la possibilité, il m'épouserait par amour.
Estimant que les exigences financières de son siège de député étaient trop élevées, Disraeli obtint la nomination tory pour Shrewsbury et fut élu en 1841 malgré une forte opposition. Le scrutin fut une grave défaite pour les whigs et Peel devint premier ministre. Disraeli s'attendait de manière irréaliste à être nommé au sein du Cabinet. Même s'il était déçu de n'être qu'un simple député, il continua à soutenir Peel en 1842 et 1843 et chercha à s'établir comme un expert en politique et commerce international.
Bien qu'il soit un tory, ou un conservateur comme certains membres du parti se désignaient, Disraeli était favorable au chartisme et défendait une alliance de l'aristocratie foncière et de la classe ouvrière contre le pouvoir grandissant des marchands et des industriels de la classe moyenne. Il fut unanimement salué en mars 1842 après avoir remporté un débat contre le grand orateur Lord Palmerston et fut rejoint par plusieurs nouveaux députés tories avec lesquels il forma le groupe Young England Jeune Angleterre pour promouvoir l'idée selon laquelle les intérêts fonciers devraient utiliser leur pouvoir pour protéger les pauvres de l'exploitation par les hommes d'affaires de la classe moyenne.
En obtenant l'abrogation des Corn Laws, le premier ministre conservateur Robert Peel entraîna la scission de son parti.
Disraeli devint progressivement un critique virulent du gouvernement de Peel et prenait souvent délibérément des positions opposées à celles de son chef de parti. Ses oppositions les plus connues portèrent en 1845 sur la Maynooth Grant désignant la subvention gouvernementale à un séminaire catholique irlandais et en 1846 sur l'abrogation des Corn Laws. Ces dernières imposaient des taxes douanières sur les importations de céréales pour protéger les agriculteurs britanniques mais elles accroissaient le prix du pain. Peel espérait que leur abrogation et la baisse des coûts qui en résulterait améliorerait les conditions de vie des pauvres et en particulier de ceux souffrant de la famine en Irlande causée par les mauvaises récoltes de pommes de terre. Les premiers mois de l'année 1846 au Parlement furent ainsi dominés par l'affrontement entre les libre-échangistes et les protectionnistes avec ces derniers menés par Disraeli et George Bentinck. Une alliance des conservateurs libre-échangistes, les peelites , des radicaux et des whigs parvint à obtenir l'abrogation de la législation85 et le parti conservateur se divisa : les peelites se rapprochèrent des whigs tandis qu'un nouveau parti conservateur se forma autour des protectionnistes menés par Disraeli, Bentinck, et Lord Stanley.
La scission du parti conservateur eut de profondes implications sur la carrière politique de Disraeli : presque tous les tories avec une expérience gouvernementale suivirent Peel laissant la base privée de direction. Dans les mots de Blake, Disraeli se retrouva le seul personnage de son camp capable de mettre en œuvre les talents d'orateur essentiels à un responsable parlementaire. Depuis la chambre des Lords, George Campbell écrivit que Disraeli était comme un officier subalterne dans une grande bataille où tous les officiers supérieurs étaient morts ou blessés. Si le parti conservateur pouvait rassembler le soutien électoral nécessaire à la formation d'un gouvernement, Disraeli semblait à présent certain d'y obtenir une fonction importante. Il serait néanmoins contraint de gouverner avec un groupe d'hommes ne disposant d'aucune ou de peu d'expérience et qui lui restaient hostiles sur le plan personnel. Finalement, ce problème ne se posa pas car le parti tory divisé perdit rapidement le pouvoir et ne le reprit qu'en 1852. Le parti conservateur ne disposa pas d'une majorité à la chambre des Communes avant 1874.
Direction du parti
Peel fit adopter l'abrogation des Corn Laws par le Parlement mais fut battu par une alliance de tous ses adversaires sur la question du rétablissement de l'ordre en Irlande ; il démissionna en juin 1846. Les tories restèrent divisés et la reine fit appel au chef des whigs, John Russell. Durant l'élection générale de 1844, Disraeli fut élu député du Buckinghamshire. La nouvelle chambre des Communes comptait plus de conservateurs que de whigs mais la scission du parti tory permit à Russel de rester au pouvoir. Les conservateurs étaient menés par Bentinck à la chambre des Communes et par Stanley à la chambre des Lords.
Le manoir Hughenden acheté par Disraeli en 1848 et dans lequel il résida jusqu'à sa mort.
En 1847, une crise politique mineure souligna les différences de Disraeli avec son propre parti. Durant l'élection générale, Lionel de Rothschild avait été élu député de la cité de Londres. En tant que juif pratiquant, il ne pouvait prêter serment sous la forme chrétienne imposée et ne pouvait donc pas siéger au Parlement. Le premier ministre John Russell, qui comme Rothschild avait été député de la cité de Londres, proposa à la chambre des Communes que le serment d'allégeance soit amendé pour permettre aux juifs d'entrer au Parlement.
Disraeli défendit la mesure en avançant que le christianisme était le judaïsme achevé et demanda à la chambre des Communes : Où est votre chrétienté si vous ne croyez pas en leur judaïsme. Russell et son futur rival, William Ewart Gladstone, le félicitèrent pour cet acte courageux car son discours fut mal reçu par son propre parti. L'establishment conservateur et anglican était hostile à la loi et l'évêque d'Oxford Samuel Wilberforce insinua que Russell récompensait les juifs pour l'aider à être élu. Le texte fut adopté à la chambre des Communes mais rejeté par la chambre des Lords.
À la suite du débat, Bentinck quitta la direction des conservateurs et fut remplacé par Charles Manners ; Disraeli, dont le discours avait été jugé blasphématoire par beaucoup au sein de son parti, fut écarté. Durant cette crise, Disraeli échangea avec la famille Bentinck pour obtenir les fonds nécessaires à l'acquisition du manoir Hughenden dans le Buckinghamshire. Disposer d'une maison de campagne et être député étaient considérés comme essentiels à un tory pour pouvoir briguer la direction du parti. Disraeli et son épouse alternèrent entre Hughenden et plusieurs résidences londoniennes pendant le reste de leur mariage. Les négociations furent compliquées par la mort soudaine de Bentinck le 21 septembre 1848 mais Disraeli obtint un prêt de 25 000 £, environ 2,8 millions de livres de 2011 de la part de ses frères Henry et William.
Moins d'un mois après sa nomination, Charles Manners, qui ne se sentait pas à la hauteur de la tâche, démissionna de la direction des conservateurs à la chambre des Communes ; le parti fonctionna sans chef jusqu'à la fin de la session parlementaire. Au début de la mandature suivante, les affaires furent gérées par un triumvirat formé de Manners, de Disraeli et de John Charles Herries; cette direction compliquée témoignait des tensions entre Disraeli et le reste du parti qui avait besoin de ses talents mais se méfiait de lui.
Mandats gouvernementaux Premier gouvernement Derby
Lord Derby fut premier ministre en 1852, 1858-1859 et 1866-1868
En mars 1851, le premier gouvernement de John Russell chuta à l'occasion d'une motion de censure essentiellement du fait des divisions au sein de son parti. Il démissionna et la reine fit appel à Lord Stanley ; ce dernier considérait cependant qu'un gouvernement minoritaire ne pourrait pas durer très longtemps et Russell resta premier ministre. Disraeli regretta cette décision car il espérait profiter de cette opportunité, aussi brève qu'elle soit, pour démontrer ses capacités. À l'inverse, Lord Stanley avança l'inexpérience de ses soutiens comme raison pour ne pas devenir premier ministre : Ce ne sont pas des noms que je peux présenter à la reine.
À la fin du mois de juin 1851, le père de Lord Stanley mourut et son fils devint comte de Derby. Le parti whig était également traversé par des divisions internes durant la seconde moitié de l'année 1851 et Russell limogea Lord Palmerston. Le 4 février 1852, ce dernier et les tories de Disraeli s'allièrent pour renverser le gouvernement et Russell démissionna. Lord Derby accepta de devenir premier ministre. Il proposa à Lord Palmerston de devenir chancelier de l'Échiquier mais ce dernier déclina toute proposition pour intégrer le gouvernement ; Disraeli était son second choix et il accepta le poste tout en reconnaissant qu'il n'était pas particulièrement expérimenté dans le domaine économique103. Il est possible que Disraeli ait été attiré par le salaire annuel de 5 000 £ qui pouvait lui permettre de rembourser ses dettes. Peu de membres du nouveau cabinet avaient été ministres ; quand Lord Derby informa Arthur Wellesley de la composition du gouvernement, le duc de Wellington octogénaire et malentendant donna sans le vouloir son surnom au nouveau gouvernement en répétant Who ? Who ?, Qui ? Qui ? à chacun des noms.
Au cours des semaines qui suivirent, Disraeli siégea comme chancelier de l'Échiquier et leader de la chambre des Communes. Il rédigea régulièrement des rapports sur le déroulement des échanges à la chambre pour la reine qui les décrivit comme très curieux et semblables au style des livres. Le Parlement fut ajourné le 1er juillet 1852 car les tories en minorité ne pouvaient plus gouverner. Disraeli espérait qu'ils pourraient obtenir une majorité d'environ 40 voix mais l'élection fit peu évoluer les lignes partisanes et le gouvernement Derby resta au pouvoir jusqu'à la reprise de la session parlementaire.
William Ewart Gladstone fut l'un des plus virulents opposants à Disraeli
En tant que chancelier de l'Échiquier, Disraeli devait établir un budget permettant de satisfaire les protectionnistes soutenant les tories tout en évitant l'opposition des libre-échangistes. Sa proposition, présentée à la chambre des Communes le 3 décembre, réduisait les taxes sur le malt et le thé et comprenait des provisions destinées à apaiser la classe ouvrière. Pour équilibrer le budget et obtenir les fonds nécessaires à la construction de défenses contre les Français, il doubla l'impôt foncier et poursuivit la collecte de l'impôt sur le revenu. L'objectif général de Disraeli était de mettre en place des politiques qui bénéficieraient à la classe ouvrière afin de rendre son parti plus attractif à cette frange de la population. Même si le budget ne comprenait pas d'éléments protectionnistes, l'opposition était résolue à s'y opposer en partie pour se venger des actions de Disraeli contre Peel en 1846 ; le député Sidney Herbert avança que le budget serait rejeté car les juifs ne font pas de convertis.
Disraeli présenta le budget le 3 décembre 1852109 et les débats se poursuivirent jusqu'au 16 décembre. Il était de coutume pour le chancelier d'avoir le dernier mot et alors qu'une grave défaite était annoncée, Disraeli attaqua individuellement ses opposants ; son discours de trois heures fut rapidement considéré comme un chef-d'œuvre. Alors que les députés de l'opposition semblaient hésiter, Glasdtone se leva et se lança dans un discours furieux malgré les députés tories tentant de le faire taire en criant plus fort que lui. Les interruptions diminuèrent alors que Gladstone prenait le contrôle de la chambre et durant deux heures présenta Disraeli comme frivole et son budget comme subversif. Le texte fut rejeté avec une majorité de 19 voix et Lord Derby démissionna quatre jours plus tard. Il fut remplacé par le peelite Lord Aberdeen et Gladston devint chancelier de l'Échiquier. Du fait l'impopularité de Disraeli auprès des peelites, aucune réconciliation n'était possible et il resta le chef des tories à la chambre des Communes.
Opposition
Après la chute du gouvernement Derby, Disraeli et les conservateurs retournèrent sur les bancs de l'opposition ; Disraeli passa les trois-quarts de sa carrière parlementaire dans l'opposition. Lord Derby ne souhaitait pas renverser la nouvelle administration pour éviter une répétition du gouvernement Who ? Who ? et car il savait que malgré les forces de ses soutiens, la coalition au pouvoir s'était en partie formée pour contrer Disraeli. Ce dernier, à l'inverse, était impatient de revenir au sein du cabinet et en tant que chef des conservateurs à la chambre des Communes, s'opposa au gouvernement sur toutes les principales législations.
En juin 1853, Disraeli reçut un diplôme honoraire de l'université d'Oxford ; il avait été recommandé par Lord Derby, le chancelier de l'institution. Le début de la guerre de Crimée en 1854 entraîna une accalmie dans les luttes politiques et Disraeli fit des discours patriotiques en sa faveur. Les revers et l'incompétence du haut-commandement britannique poussèrent le Parlement à envisager la mise en place d'une commission sur la conduite de la guerre. Le gouvernement de Lord Aberdeen choisit d'en faire une motion de confiance ; Disraeli mena l'opposition et le texte fut rejeté par 305 voix contre. Lord Aberdeen démissionna et la reine fit appel à Lord Derby qui refusa le poste. Lord Palmerston était jugé essentiel à tout gouvernement whig et il refuserait d'y participer s'il ne le présidait pas. La reine lui demanda alors avec réticence de former un gouvernement. Le déroulement de la guerre s'améliora avec l'arrivée de la nouvelle administration et le conflit s'acheva par le traité de Paris en mars 1856. Disraeli avait été l'un des premiers à demander la paix mais il eut peu d'influence sur le cours des événements.
Lorsqu'une révolte éclata en Inde en 1857, Disraeli s'y intéressa de près car il avait fait partie en 1852 d'une commission chargé de définir la manière de gouverner au mieux le sous-continent. Après le retour du calme en 1858, Lord Palmerston présenta une législation pour un contrôle direct de l'Inde par la Couronne et la fin du pouvoir de la compagnie anglaise des Indes orientales. Disraeli s'y opposa mais de nombreux conservateurs refusèrent de le suivre et le texte fut facilement adopté.
Le gouvernement Palmerston fut affaibli par sa réaction à l'affaire Orsini du nom d'un révolutionnaire italien qui avait tenté d'assassiner l'empereur français Napoléon III avec une bombe fabriquée à Birmingham. À la demande de l'ambassadeur français, Lord Palmerston présenta des amendements à la définition du conspiracy to murder pour que la fabrication d'une machine infernale soit un crime et non un délit. La proposition fut rejetée avec l'appui de nombreux libéraux. Il démissionna immédiatement et fut remplacé par Lord Derby.
Second gouvernement Derby
Lord Derby prit ses fonctions à la tête d'une administration purement conservatrice et non au sein d'une coalition. Il offrit à nouveau un poste à Gladstone mais ce dernier refusa. Disraeli redevint chancelier de l'Échiquier. Comme en 1852, Lord Derby mena un gouvernement minoritaire dépendant pour sa survie, de la division de ses opposants. En tant que leader de la chambre des Communes, Disraeli reprit ses compte-rendus réguliers à la reine Victoria qui avait demandé qu'il inclut ce qu'elle ne pouvait pas rencontrer dans les journaux.
Durant sa brève existence, le gouvernement Derby fut modérément progressiste. Le Government of India Act de 1858 mit fin à l'administration de la compagnie anglaise des Indes orientales dans le sous-continent. Disraeli avait soutenu les tentatives visant à autoriser les juifs à siéger au Parlement. Il présenta des lois permettant aux deux chambres du Parlement de définir la rédaction des serments d'allégeance. Le texte fut adopté avec réticence par la chambre des Lords et en 1858, Lionel de Rothschild devint le premier député juif.
À la suite de la démission d'Edward Law de la présidence de l'Indian Board chargé de l'administration de l'Inde, Disraeli et Derby tentèrent à nouveau de convaincre Gladstone, toujours nominalement un député conservateur, d'entrer au gouvernement. Disraeli lui écrivit personnellement une lettre pour lui demander de placer le bien du parti au-dessus des animosités personnelles. Dans sa réponse, Disraeli nia que des différends personnels aient joué un rôle dans ses décisions pour accepter maintenant et auparavant un poste tout en reconnaissant qu'il existait des oppositions entre Derby et lui plus profondes que vous pouviez supposer.
En 1859, les tories présentèrent une loi visant une extension mineure du droit de vote. Les tensions entre les partisans de Russell et ceux de Palmerston au sein du parti libéral furent apaisées et à la fin du mois de mars 1859, le gouvernement fut renversé. Lord Derby dissolut le Parlement et l'élection de 1859 fut une victoire conservatrice qui fut néanmoins insuffisante pour prendre le contrôle de la chambre des Communes. Lors de la reprise de la session parlementaire, le gouvernement Derby fut battu par 13 voix sur un amendement au discours du Trône. Il démissionna et la reine fit à nouveau appel avec réticence à Lord Palmerston.
Opposition et troisième gouvernement Derby
Après la chute de Lord Derby, Disraeli fut attaqué par les membres de son parti qui le rendaient responsable de la défaite et l'ancien premier ministre l'avertit que certains députés cherchaient à l'écarter de la direction du parti. Parmi les conspirateurs figurait Robert Cecil, un jeune député conservateur qui devint un quart de siècle plus tard premier ministre en tant que Lord Salisbury ; il écrivit qu'avoir Disraeli comme chef à la chambre des Communes réduisait les chances des conservateurs de prendre le pouvoir. Quand son père témoigna son désaccord, Cecil répondit : Je ne fais qu'imprimer ce que tous les gentlemen du pays disent en privé
Disraeli mena une opposition incapable de renverser Lord Palmerston car Lord Derby avait décidé de ne pas chercher la défaite du gouvernement. Lorsque la guerre de Sécession éclata en 1861, Disraeli fit peu de déclarations publiques mais, comme la plupart des Britanniques, il s'attendait à une victoire du Sud. Lord Palmerston, Gladstone à nouveau chancelier et Russell furent moins réticents et leurs déclarations en faveur du Sud contribuèrent à créer quelques années d'une vive animosité avec les États-Unis. En 1862, Disraeli rencontra le responsable prussien Otto von Bismarck pour la première fois et dit de lui : Faisons attention à cet homme, il sait ce qu'il veut.
La trêve politique cessa en 1864 car les tories furent outrés par la gestion de Lord Palmerston du différend frontalier entre la confédération germanique et le Danemark au sujet du Schleswig-Holstein. Disraeli reçut peu de soutien de la part de Lord Derby, qui était malade, mais il rassembla suffisamment le parti pour pouvoir réduire la majorité gouvernementale. Malgré les rumeurs concernant la santé de Lord Palmerston alors âgé de 80 ans, il restait populaire et les libéraux accrurent leur majorité lors de l'élection de 1865. Du fait des mauvais résultats des conservateurs, Lord Derby dit à Disraeli qu'aucun d'eux ne reviendrait jamais au pouvoir.
Le cabinet Derby de 1867. Ce dernier est debout à droite et Disraeli est à droite tenant un journal.
Les tactiques politiques furent bousculées par la mort de Palmerston le 18 octobre 1865. Russell redevint premier ministre avec Gladstone à la tête du parti libéral et Disraeli, leader de la chambre des Communes, comme son principal opposant. L'un des premiers actes de Russell fut de présenter une réforme du suffrage mais le texte divisa le parti. Les conservateurs et les dissidents libéraux attaquèrent la législation et le gouvernement tomba finalement en juin. Les dissidents ne souhaitaient pas servir sous Disraeli à la chambre des Communes et Lord Derby forma un troisième gouvernement minoritaire avec Disraeli à nouveau au poste de chancelier de l'Échiquier. En 1867, les conservateurs présentèrent une réforme électorale. Sans majorité à la chambre des Communes, les conservateurs furent contraints d'accepter des amendements qui modifièrent considérablement la législation mais Disraeli refusa d'accepter toutes les modifications proposées par Gladstone.
Le Reform Act adopté en août accrut considérablement le nombre d'hommes pouvant voter, élimina les bourgs pourris de moins de 10 000 habitants et augmenta la représentativité des grandes villes comme Liverpool et Manchester. La loi était impopulaire au sein de l'aile droite des conservateurs dont Robert Cecil qui démissionna du gouvernement et se prononça contre le texte en accusant Disraeli d'avoir commis « une trahison politique sans équivalent dans nos annales parlementaires. Cecil fut cependant incapable de mener une opposition efficace à Disraeli et Lord Derby. Disraeli fut célébré et devint un héros de son parti pour les merveilleux talents parlementaires avec lesquels il obtint le passage de la réforme à la chambre des Communes.
Lord Derby souffrait depuis longtemps de la goutte et avait de moins en moins d'influence sur la politique. Alors que l'ouverture de la nouvelle session du Parlement en février 1868 approchait, il était cloué au lit dans sa résidence de Knowsley Hall près de Liverpool. Il ne souhaitait cependant pas démissionner en avançant qu'il n'avait que 68 ans et était donc bien plus jeune que Palmerston ou Russell à la fin de leurs mandats. Il savait néanmoins que sa santé l'obligerait un jour ou l'autre à renoncer à ses responsabilités. À la fin du mois de février, Lord Derby, toujours absent, écrivit à Disraeli pour lui demander de confirmer qu'il ne se déroberait pas face à ces nouvelles importantes responsabilités. Rassuré, il présenta sa démission à la reine et recommanda Disraeli comme le seul à pouvoir recevoir le soutien de ses collègues. Ce dernier se rendit à Osborne House sur l'île de Wight où la reine lui demanda de former un gouvernement. Elle écrivit à sa fille, Victoria de Prusse, M. Disraeli est premier ministre ! Un noble accomplissement pour un homme issu du peuple !. Le nouveau premier ministre déclara à ceux venus le féliciter Je suis arrivé au sommet du mât de cocagne.
Premier gouvernement Disraeli 1868
Les conservateurs restèrent en minorité à la chambre des Communes mais aucun des deux camps ne souhaitait d'élection avant l'actualisation des registres électoraux. Le mandat de premier ministre de Disraeli qui commença en février serait donc bref à moins que les conservateurs ne remportent l'élection générale à l'automne. Il réalisa deux changements majeurs au sein de son cabinet en remplaçant le Lord chancelier Lord Chelmsford par Lord Cairns et en nommant George Ward Hunt pour lui succéder au poste de chancelier de l'Échiquier. Lord Derby avait prévu de remplacer Chelmsford dès qu'une vacance dans une sinécure convenable apparaîtrait mais Disraeli ne voulait pas attendre pour nommer Cairns qu'il jugeait bien plus efficace.
Le premier mandat de Disraeli fut dominé par les débats concernant l'Église d'Irlande. Même si l'île était très majoritairement catholique, l'Église protestante restait l'église officielle et la perception de la dîme était très mal acceptée par la population. Des tentatives de Disraeli pour négocier la création d'une université catholique à Dublin avec l'archevêque Henry Edward Manning échouèrent en mars quand Gladstone présenta une législation visant à supprimer l'Église officielle d'Irlande. La proposition rassembla le parti libéral sous la direction de Gladstone et divisa les conservateurs. Lors des élections générales avec les nouveaux registres électoraux, les libéraux reprirent le pouvoir avec une majorité renforcée.
Malgré sa brève existence, le premier gouvernement Disraeli parvint à faire adopter plusieurs législations relativement consensuelles. Il mit fin aux exécutions publiques et le Corrupt Practices Act permit de réduire sensiblement la corruption politique. Il lança une version primitive de nationalisation en faisant racheter les compagnies télégraphiques par le General Post Office via le Telegraph Act de 1869 et fit adopter des amendements aux lois sur l'éducation et au système judiciaire écossais. Disraeli ordonna également l'expédition de Robert Napier contre Téwodros II d'Éthiopie visant à libérer des captifs britanniques.
Chef de l'opposition
Face à la majorité libérale à la chambre des Communes, Disraeli ne pouvait que protester contre les législations présentées par le gouvernement. En conséquence, il décida d'attendre et de profiter des erreurs des libéraux. Ayant plus de temps libre, il écrivit un nouveau roman intitulé Lothair qui fut publié en 1870. Il s'agissait de la première œuvre de fiction rédigée par un ancien premier ministre et le livre devint un best-seller.
En 1872, l'incapacité à s'opposer à Gladstone entraîna des tensions au sein du parti conservateurs. Disraeli prit des mesures pour asseoir son autorité et les dissensions s'apaisèrent alors que les divisions éclataient au sein du parti libéral. Le soutien populaire à Disraeli fut démontré lors d'une réception destinée à souhaiter un prompt rétablissement au prince de Galles ; Disraeli fut acclamé lors de son discours tandis que celui de Gladstone ne rencontra que le silence. Encouragé par Disraeli, John Eldon Gorst réorganisa l'administration du parti conservateur pour la moderniser.
Lors de son départ du 10 Downing Street en 1868, Disraeli avait convaincu la reine Victoria d'anoblir son épouse et Mary Anne devint vicomtesse de Beaconsfield. Après avoir souffert d'un cancer de l'estomac durant toute l'année 1872, la comtesse octogénaire mourut le 15 décembre. Après sa mort, Gladstone, qui avait toujours apprécié Mary Anne, envoya une lettre de condoléances à son veuf.
En 1873, Gladstone présenta une législation pour fonder une université catholique à Dublin. Cela divisa les libéraux et le 12 mars, les conservateurs et les catholiques irlandais renversèrent le gouvernement avec une majorité de trois voix. Gladstone démissionna et la reine fit appel à Disraeli qui refusa la proposition car le gouvernement conservateur serait en minorité au Parlement. Disraeli estima qu'il aurait plus à gagner en laissant les libéraux rester temporairement au pouvoir. L'administration Gladstone partiellement remaniée resta donc en place malgré de nouveaux scandales.
En janvier 1874, Gladstone demanda la tenue d'une élection générale considérant que plus il attendrait et plus son score serait mauvais. Le scrutin fut étalé sur deux semaines à partir du 1er février. Dès les premiers résultats, il devint clair que les conservateurs allaient disposer d'une majorité pour la première fois depuis 1841. Finalement, ils remportèrent 350 sièges contre 242 pour les libéraux et 60 pour la Home Rule League irlandaise. La reine fit appel à Disraeli qui devint premier ministre pour la deuxième fois.
Second gouvernement Disraeli 1874-1880
Le cabinet de Disraeli composé de six pairs et de six roturiers était le plus réduit depuis le Reform Act de 1832. Sur les six pairs, cinq avaient été membres du précédent gouvernement conservateur ; le sixième, Lord Salisbury, s'était réconcilié avec Disraeli et il fut nommé secrétaire d'État à l'Inde. Lord Stanley devenu Lord Derby à la mort de son père, l'ancien premier ministre, en 1869 et Stafford Northcote furent respectivement nommés aux Affaires étrangères et aux Finances.
En août 1876, Disraeli fut anobli comte de Beaconsfield et vicomte Hughenden. La reine lui avait proposé cet anoblissement dès 1868 mais il avait refusé et le fit à nouveau alors qu'il était malade en 1874 ; il ne souhaitait en effet pas quitter la chambre des Communes pour la chambre des Lords dans laquelle il n'avait aucune expérience. Les problèmes de santé persistants durant son second mandat de premier ministre lui firent envisager une démission mais Lord Derby y était réticent car il ne se sentait pas capable d'obtenir le soutien de la reine. Pour Disraeli, la chambre des Lords, où les débats étaient moins intenses, était une alternative à la démission. Cinq jours avant la fin de la session parlementaire le 11 août 1874, Disraeli quitta la chambre des Communes visiblement à regret. Les journaux annoncèrent son anoblissement le lendemain matin. Concernant cette élévation, Disraeli écrivit à Lady Bradford le 8 août : Je suis assez las de ce lieu la chambre des Communes mais quand un ami lui demanda s'il aimait la chambre des Lords, il répondit : Je suis mort ; mort mais aux Champs Élysées.
Politique intérieure
Sous la direction du secrétaire d'État à l'Intérieur Richard Assheton Cross, le nouveau gouvernement lança de nombreuses réformes dont l'Artisan's and Labourers' Dwellings Improvement Act qui encourageait les administrations locales à construire des logements pour la classe ouvrière grâce en facilitant l'accès au crédit, le Public Health Act visant à moderniser la santé publique, le Sale of Food and Drugs Act destiné à protéger les consommateurs et l'Education Act pour développer la scolarisation. Pour protéger les ouvriers, le gouvernement fit adopter le Factory Act limitant le temps de travail et le travail des enfants, le Conspiracy and Protection of Property Act autorisant les piquets de grève pacifiques et l'Employers and Workmen Act permettant aux ouvriers de poursuivre en justice leurs employeurs en cas de violation des contrats de travail. À la suite de ces réformes sociales, le travailliste-libéral Alexander Macdonald déclara à ses électeurs en 1879 : Le parti conservateur a plus fait pour les classes ouvrières en cinq ans que les libéraux en cinquante.
En 1870, Gladstone avait émis un ordre en Conseil introduisant un concours d'entrée dans la fonction publique pour réduire la corruption lors de l'embauche de fonctionnaires. Disraeli y était opposé et s'il ne chercha pas à revenir sur cette décision, ses actions trahirent fréquemment son opinion. Il réalisa ainsi plusieurs nominations politiques à des fonctions auparavant accordées à des fonctionnaires de carrière. Il était en cela soutenu par son parti dont les membres étaient impatients de pouvoir profiter des avantages associés aux fonctions officielles après près de 30 ans de brefs passages au gouvernement. Disraeli accorda des postes à des notables conservateurs dont un disposant d'un salaire annuel de 2 000 £ environ 190 000 £ de 2011, ce qui ulcéra Gladstone. Disraeli ne créa cependant que 22 pairs contre 37 pour son prédécesseur.
De même que dans l'administration, Disraeli récompensa ses soutiens par des fonctions dans le clergé165. Il favorisa la Basse Église en écartant les autres tendances anglicanes pour des raisons politiques ; il s'opposa en cela à la reine qui, par loyauté à son époux défunt Albert, préférait la Large Église. Une nomination controversée eut lieu peu avant l'élection de 1868. Lorsque l'archevêque de Cantorbéry Charles Thomas Longley mourut, Disraeli accepta de nommer le candidat de la reine, l'évêque de Londres Archibald Campbell Tait. Pour remplacer Tait, Disraeli fut pressé de nommer Samuel Wilberforce, l'ancien évêque de Winchester et figure importante de la société londonienne. Disraeli ne l'appréciait cependant pas et il choisit plutôt l'évêque de Lincoln John Jackson. Blake suggère que ces nominations coûtèrent plus de voix à Disraeli qu'elles ne lui en rapportèrent.
Politique étrangère
Disraeli considérait les affaires étrangères comme l'élément le plus important et le plus intéressant de son travail de premier ministre. Son biographe Robert Blake doute néanmoins qu'il ait développé de véritable doctrine dans le domaine avant sa prise de fonction en 1874. Il s'était rarement rendu à l'étranger ; depuis son voyage au Proche-Orient en 1830-1831, il n'avait quitté la Grande-Bretagne que pour sa lune de miel et trois visites à Paris dont la dernière datait de 1856.
Canal de Suez
Le canal de Suez inauguré en 1869 permettait aux navires d'éviter le contournement de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et réduisait de plusieurs semaines, la durée de la traversée entre la Grande-Bretagne et l'Inde ; en 1875, environ 80% des navires empruntant le canal étaient britanniques. Dans le cas d'une nouvelle révolte en Inde ou d'une invasion russe, le temps gagné à Suez serait crucial. Comme ils avaient financé sa construction, la plupart des actions de la compagnie du canal de Suez appartenaient à des intérêts français ; le khédive Ismaïl Pacha, qui gouvernait l'Égypte au nom de l'Empire ottoman et était connu pour ses dépenses excessives, avait également des parts dans la société. Comme en Crimée, le canal de Suez relança la Question d'Orient sur les actions entourant le déclin de l'Empire gouverné depuis Constantinople. Comme une grande partie du commerce et des communications britanniques avec l'Inde passait par l'Empire ottoman avant la construction du canal, le Royaume-Uni avait fait de son mieux pour soutenir ce dernier contre la menace des Russes qui, s'ils prenaient Constantinople, pourraient disposer d'un accès maritime illimité à la Méditerranée. Les Français s'inquiétaient également de cette possibilité en raison de leurs intérêts en Syrie. Le Royaume-Uni avait eu la possibilité de prendre des parts dans le canal, mais n'avait finalement pas pris d'initiatives en ce sens.
Disraeli était passé près de Suez lors de son voyage au Proche-Orient dans sa jeunesse et lors de son accession au pouvoir, il réalisa l'importance des intérêts britanniques dans la zone. Il dépêcha donc le député libéral Nathan Rothschild à Paris pour essayer de racheter les actions de son constructeur Ferdinand de Lesseps169. Le 14 novembre 1875, l'éditeur du Pall Mall Gazette, Frederick Greenwood, apprit du banquier londonien Henry Oppenheim que le khédive cherchait à vendre ses parts dans la compagnie du canal à une société française. Greenwood en informa immédiatement le secrétaire d'État aux affaires étrangères Lord Derby qui transmit la nouvelle à Disraeli. Ce dernier agit rapidement pour obtenir leur achat et le 23 novembre, le khédive offrit de vendre ses actions pour 4 millions de livres, 400 millions de livres de 2011. Comme le Parlement n'était pas en session, Disraeli ne pouvait obtenir un financement gouvernemental pour cette acquisition et il fit appel à Lionel de Rothschild pour avancer les fonds. Ce dernier accepta et cette décision fut vivement critiquée en particulier par Gladstone qui accusa Disraeli de saper le système constitutionnel britannique. La cession des actions fut signée au Caire le 25 novembre.
Disraeli dit à la reine : C'est réglé ; vous l'avez, madame ! L'opinion publique vit l'opération comme une démonstration audacieuse de la suprématie maritime britannique. Dans les décennies qui suivirent, la sécurité du canal de Suez en tant que passage stratégique vers l'Inde, devint un des principaux centres d'attention de la politique étrangère britannique. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères Lord Curzon décrivit en 1909 le canal comme le facteur déterminant de toute action britannique à l'Est et au Sud de la Méditerranée.
Relations avec Victoria
Caricature publiée dans le magazine Puck intitulée Nouvelles Couronnes pour les Anciennes représentant Disraeli en colporteur offrant à Victoria une couronne impériale en échange de sa couronne royale.
Initialement intrigué par Disraeli lorsqu'il entra au Parlement en 1837, Victoria se mit à le détester en raison de ses actions contre Peel. Son opinion devint plus favorable en particulier car Disraeli fit tout pour lui plaire. Il dit ainsi à l'écrivain Matthew Arnold : tout le monde aime la flatterie et, quand il s'agit de princes, il faut l'étendre avec une truelle. L'un de ses biographes, Adam Kirsch, suggère que l'obséquiosité de ses relations avec la reine était à la fois de la flatterie, le sentiment que cela était la façon dont un loyal sujet s'adresse à sa souveraine et l'émerveillement qu'un bourgeois d'origine juive soit le compagnon d'un monarque. Au début de son second mandat de premier ministre, Disraeli avait établi une solide relation avec Victoria, sans doute plus étroite qu'avec tout autre premier ministre en dehors de son premier, Lord Melbourne. Lors de sa prise de fonctions en 1874 réalisa littéralement la cérémonie du baisemain avec la reine en mettant un genou à terre et selon le biographe Richard Aldous, pendant les six années qui suivirent, Victoria et Disraeli exploitèrent mutuellement leur proximité à leur avantage.
Victoria souhaitait depuis longtemps posséder un titre impérial reflétant le territoire en expansion du Royaume-Uni. Elle était irritée que l'empereur Alexandre II de Russie ait un titre plus élevé que le sien et outrée que sa fille la dépasse quand son époux deviendrait empereur allemand. Le titre d'impératrice des Indes était utilisé de manière informelle depuis quelque temps et elle souhaitait le rendre officiel. La reine demanda donc à Disraeli de présenter une loi sur les titres royaux et lui indiqua sa volonté d'ouvrir le Parlement en personne, ce qu'elle ne faisait alors que lorsqu'elle avait besoin d'obtenir quelque chose de la part des législateurs. Disraeli s'inquiétait d'une possible réaction négative des députés et refusa d'évoquer une telle possibilité dans le discours du Trône.
Une fois la loi préparée, sa gestion par Disraeli fut maladroite. Il n'en informa ni le prince de Galles ni l'opposition et fut accueilli avec agacement par le prince et la colère des libéraux qui dénoncèrent une manœuvre despotique. Craignant de perdre, Disraeli hésita à présenter le texte à la chambre des Communes mais la législation fut finalement adoptée avec une majorité de 75 voix en 1876. Selon Aldous, l'impopulaire Royal Titles Act démolit néanmoins l'autorité de Disraeli à la chambre des Communes.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7521#forumpost7521
Posté le : 21/12/2014 15:42
|
|
|
|
|
Benjamin Bisraeli 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Balkans et Bulgarie
En juillet 1875, les populations chrétiennes de Bosnie, alors province de l'Empire ottoman, se soulevèrent pour protester contre les persécutions religieuses et les défaillances de l'administration provinciale. En janvier, le sultan Abdulaziz accepta les réformes proposées par l'homme d'État hongrois Gyula Andrássy mais les rebelles, sentant qu'ils pourraient gagner leur liberté, refusèrent de négocier et furent rejoints par des insurgés serbes et bulgares. La répression ottomane en Bulgarie fit des dizaines de milliers de morts et lorsque les rapports de ces exactions arrivèrent en Grande-Bretagne, Disraeli et Derby déclarèrent au Parlement qu'ils ne les croyaient pas. Disraeli qualifia les compte-rendus de ragots de comptoir et rejeta les allégations de torture par les Ottomans en avançant que les Orientaux abrègent généralement leurs relations avec les coupables d'une manière plus expéditive.
Gladstone, qui avait quitté la direction du parti libéral et s'était retiré de la vie publique, fut horrifié par les rapports sur les atrocités en Bulgarie et en août 1876, rédigea un pamphlet hâtivement écrit affirmant que les Ottomans devraient être privés de la Bulgarie en punition de leurs actes. Il envoya une copie à Disraeli qui la qualifia de vindicative et mal-écrite... de toutes les horreurs bulgares, peut-être la pire. Le pamphlet connut néanmoins un immense succès et poussa les libéraux à exiger que l'Empire ottoman ne soit plus un allié du Royaume-Uni. Disraeli écrivit le 3 septembre à Lord Salisbury : S'il n'y avait pas eu ces malheureuses atrocités, nous aurions négocié une paix très honorable pour l'Angleterre et satisfaisante pour l'Europe. Nous sommes à présent obligés de prendre un nouveau point de départ et contraindre la Turquie qui a renoncé à toute compassion. Malgré cela, la politique de Disraeli était de protéger Constantinople et l'intégrité de son empire.
Disraeli et le cabinet envoyèrent Salisbury pour mener la délégation britannique à la conférence de Constantinople organisée de décembre 1876 à janvier 1877. Durant les préparatifs de la conférence, Disraeli demanda à Salisbury d'obtenir l'occupation militaire de la Bulgarie et de la Bosnie par le Royaume-Uni et le contrôle britannique de l'armée ottomane. Salisbury ignora ces consignes que son biographe Andrew Roberts qualifie d'absurdes. La conférence fut finalement un échec car l'Empire ottoman et les puissances européennes ne parvinrent pas à un accord.
La session parlementaire reprit en février 1877 avec Disraeli à la chambre des Lords en tant que comte de Beaconsfield. Il ne fit qu'un seul discours durant cette législature et déclara le 20 février que les Balkans avaient besoin de stabilité et que forcer à Turquie à faire des concessions territoriales ne ferait rien pour faciliter cette évolution. Le premier ministre voulait un accord avec les Ottomans selon lequel les Britanniques occuperaient temporairement des positions stratégiques pour dissuader les Russes d'entrer en guerre le temps de négocier une sortie de crise mais il était isolé au sein de son cabinet qui préférait démanteler l'Empire ottoman. Alors que Disraeli, de plus en plus malade, continuait d'affronter son cabinet, la Russie envahit l'Empire ottoman le 21 avril.
Congrès de Berlin.
Carte de la Bulgarie d'après le traité de San Stefano. Le traité de Berlin la divisa entre une partie autonome en vert et une province ottomane en rouge.
Les Russes progressèrent rapidement dans les Balkans et s'emparèrent de la ville bulgare de Pleven en décembre 1877 ; la chute de Constantinople semblait alors inévitable. La guerre divisait l'opinion publique britannique mais les succès russes poussèrent certains à demander une intervention du côté ottoman. Le siège de Plevna fit la une des journaux pendant des semaines et les déclarations de Disraeli avertissant de la menace posée aux intérêts britanniques par les Russes semblèrent de plus en plus prophétiques. L'attitude jingoïstique de nombreux Britanniques renforça la position politique de Disraeli ; la reine agit également en sa faveur en lui rendant visite à Hughenden ; il s'agissait de sa première visite dans la résidence de son premier ministre depuis Lord Melbourne. À la fin du mois de janvier 1878, le sultan ottoman fit appel au Royaume-Uni pour sauver Constantinople. Au milieu de la fièvre belliciste, le gouvernement britannique demanda au Parlement d'octroyer 6 millions de livres, 631 millions de livres de 2011 à la préparation de l'armée et de la marine. Gladstone, qui était revenu en politique, s'opposa à la mesure mais ne fut suivi que par la moitié des députés de son parti. L'opinion publique était du côté de Disraeli même si certains lui reprochaient de ne pas immédiatement déclarer la guerre à la Russie.
Avec les Russes aux portes de Constantinople, les Ottomans acceptèrent un armistice et, par le traité de San Stefano signé en mars 1878, cédèrent de larges territoires à un nouvel État appelé Bulgarie qui devenait de fait un vassal de la Russie. Les autres possessions ottomanes en Europe reçurent leur indépendance et des territoires furent cédés directement à la Russie. Cela était inacceptable pour les Britanniques qui protestèrent en espérant convaincre les Russes d'accepter une conférence internationale que le chancelier allemand Bismarck proposait d'organiser à Berlin. Le cabinet discuta de la proposition de Disraeli de stationner des troupes indiennes à Malte avant un possible déploiement dans les Balkans et émit ses réserves. Derby démissionna en signe de protestation et Disraeli le remplaça par Salisbury. Alors que les préparatifs militaires britanniques se poursuivaient, les Russes et les Ottomans acceptèrent de négocier à Berlin.
En préparation de la conférence, des échanges secrets eurent lieu entre le Royaume-Uni et la Russie en avril et mai 1878. Les Russes étaient disposés à accepter une réduction du territoire bulgare mais refusèrent d'abandonner leurs conquêtes en Bessarabie et sur la côte orientale de la Mer Noire. En échange, les Britanniques demandèrent une possession en Méditerranée orientale pour baser des navires et des troupes et négocièrent la cession de Chypre avec les Ottomans. Une fois parvenu à ces accords secrets, Disraeli était prêt à accepter les gains russes.
La reine Victoria nomme Disraeli à l'ordre de la Jarretière en 1878
Disraeli laissa le détail des négociations à Salisbury et concentra ses efforts sur la manière d'empêcher la création d'une Grande Bulgarie. Il parvint à obtenir que la Bulgarie reste en partie inféodée à l'Empire ottoman mais échoua à empêcher la démilitarisation de Batum que les Russes fortifièrent en 1886. La convention de Chypre cédant l'île au Royaume-Uni fut également annoncée durant le Congrès. Disraeli négocia que l'Empire ottoman conserve suffisamment de territoires en Europe pour protéger les Dardanelles. Selon un compte-rendu, il demanda à son secrétaire de préparer un train spécial pour qu'il puisse rentrer en Grande-Bretagne préparer la guerre si les Russes restaient intransigeants. La Russie finit par céder et accepter les conclusions du Congrès mais Alexandre II décrivit plus tard la conférence comme une coalition européenne contre la Russie menée par Bismarck.
Le traité de Berlin fut signé le 13 juillet 1878 au palais Radziwill à Berlin. Disraeli et Salisbury furent accueillis en héros à leur retour en Grande-Bretagne. Au seuil du 10 Downing Street, il reçut des fleurs envoyées par la reine198 et déclara à la foule rassemblée : Lord Salisbury et moi-même vous avons ramené la paix mais une paix, je l'espère, avec honneur. Il déclina la proposition royale de le faire duc mais accepta d'intégrer l'ordre de la Jarretière à condition que Salisbury ait aussi droit à cet honneur. À Berlin, Bismarck déclara admiratif à propos de Disraeli : Der alte Jude, das ist der Mann! Ce vieux Juif, c'est l'homme de la situation!
Seconde guerre anglo-afghane et Guerre anglo-zouloue.
Dans les semaines qui suivirent le congrès de Berlin, Disraeli et le cabinet envisagèrent d'organiser une élection générale pour profiter de la satisfaction de l'opinion publique. Les législatures duraient alors au maximum sept ans et la tradition voulait que l'on n'organise pas d'élection avant la sixième année à moins d'y être contraint par les événements. Le précédent scrutin avait eu lieu quatre ans et demi plus tôt et rien ne laissait présager une défaite conservatrice s'ils attendaient. Cette décision de ne pas chercher une conformation de son pouvoir a souvent été citée comme la plus grande erreur de Disraeli. Blake nuance néanmoins cette affirmation en avançant que les résultats des conservateurs lors des élections locales n'avaient pas été particulièrement brillants et doute que Disraeli ait manqué une grande opportunité en attendant.
Comme l'Afghanistan avait souvent été la porte d'entrée des conquérants de l'Inde, les Britanniques surveillaient la région et y intervenaient depuis les années 1830 pour essayer de maintenir les Russes à distance. L'émir Sher Ali Khan s'efforçait de conserver la neutralité de son pays entre ses deux puissants voisins mais malgré son opposition, une délégation russe arriva à Kaboul en juillet 1878. Les Britanniques demandèrent alors qu'une de leurs délégations soit également reçue dans la capitale afghane. Le vice-roi Lord Lytton, n'informa pas Disraeli de son ultimatum et il ignora ce dernier quand il lui demanda de ne pas agir. Lorsque l'entrée de la délégation britannique en Afghanistan fut refusée, Lord Roberts passa à l'offensive et battit facilement les forces afghanes. Le conflit se termina par la signature du traité de Gandomak par lequel l'Afghanistan renonçait à sa souveraineté externe et acceptait une garnison britannique à Kaboul. Le 8 septembre 1879, Louis Cavagnari responsable de la garnison fut tué par des soldats afghans qui s'étaient mutinés. Roberts entreprit alors une expédition punitive qui se termina par la bataille de Kandahar un an plus tard. Les Britanniques abandonnèrent l'idée de stationner des troupes dans le pays mais leurs objectifs de stabilisation de la frontière nord-ouest de l'Inde avaient été remplis.
La politique britannique en Afrique du Sud était d'encourager le rapprochement des colonies britanniques du Cap et du Natal et des républiques boers du Transvaal annexée par le Royaume-Uni en 1877 et de l'Orange. Le gouverneur de la colonie du Cap, Bartle Frere, considérait que la formation d'une fédération serait impossible tant que les tribus indigènes locales refuseraient la domination britannique. Il envoya donc une série de demandes au roi zoulou Cetshwayo en sachant pertinemment qu'elles étaient inacceptables. Frere n'informa pas le cabinet de ses actes jusqu'à ce que l'ultimatum soit presque expiré. Disraeli et le gouvernement le soutinrent à contre-cœur et acceptèrent d'envoyer des renforts en janvier 1879. Le 22 janvier, un impi ou armée zouloue attaqua par surprise un campement britannique à Isandhlwana et près de 1 300 soldats furent tués. La nouvelle de la défaite n'arriva à Londres que le 12 février206 et Disraeli écrivit le lendemain : Le terrible désastre m'a atteint au plus profond. Il réprimanda Frere mais le laissa responsable de la situation, ce qui fut très critiqué. Disraeli plaça le général Garnet Joseph Wolseley à la tête de l'armée et les Zoulous furent écrasés à la bataille d'Ulundi le 4 juillet 1879 ; la guerre se termina par l'annexion du territoire zoulou.
Élection de 1880
Lors de l'élection de 1874, Gladstone avait été élu un des deux députés de Greenwich mais il était arrivé derrière le candidat conservateur, ce qu'il qualifia de défaite plutôt que de victoire. En décembre 1878, il reçut la nomination libérale pour Edinburghshire, une circonscription populairement appelée Midlothian. La petite scène politique écossaise était dominée par le conservateur Lord Buccleuch et le libéral Lord Rosebery. Ce dernier, un ami de Disraeli et de Gladstone qui succéda à ce dernier au poste de premier ministre, s'était rendu aux États-Unis pour étudier les pratiques politiques locales et revint convaincu que certains aspects pouvaient être appliqués en Grande-Bretagne. Sur ses conseils, Gladstone réalisa une campagne dite de Midlothian, non pas uniquement dans sa circonscription, mais dans tout le Royaume-Uni au cours de laquelle il donna des discours enflammés attaquant Disraeli en particulier sur sa politique étrangère.
Les perspectives conservatrices furent affectées par le mauvais temps et ses conséquences sur l'agriculture. Quatre étés humides avaient entraîné des récoltes médiocres et si dans le passé, les agriculteurs pouvaient facilement augmenter leurs prix, les importations de céréales depuis les États-Unis maintenaient à présent les cours à un niveau bas. D'autres pays européens, affrontant les mêmes difficultés, avaient opté pour le protectionnisme et Disraeli était pressé de réinstaurer les Corn Laws pour réduire les importations et faire remonter le prix de vente des produits agricoles. Il refusa en déclarant que cette question était réglée. Le protectionnisme aurait été très impopulaire auprès des nouvelles classes moyennes urbaines car il aurait renchéri le coût de la vie. Au milieu d'un marasme économique général, les conservateurs perdirent l'appui de nombreux agriculteurs.
La santé de Disraeli continua de se détériorer tout au long de l'année 1879. Du fait de son infirmité, il arriva avec un retard de trois-quart d'heure à un banquet organisé par le Lord-maire de Londres à Guildhall en novembre au cours duquel il est de coutume que le premier ministre fasse un discours. Même si beaucoup le complimentèrent sur son apparente bonne santé, il lui avait fallu de grands efforts pour apparaître ainsi et lorsqu'il déclara à l'audience qu'il espérait reparler à cette réception l'année suivante, beaucoup rirent. Malgré son assurance en public, Disraeli s'attendait à une défaite de son parti lors de la prochaine élection.
En dépit de ce pessimisme, les conservateurs reprirent espoir au début de l'année 1880 avec des succès dans des élections partielles que les libéraux semblaient assurés de remporter. Le cabinet avait décidé d'attendre avant de dissoudre le Parlement mais au début de mois de mars, il décida d'organiser un scrutin le plus tôt possible. Le Parlement fut dissous le 24 mars et les premières circonscriptions votèrent une semaine plus tard.
Disraeli ne participa pas à la campagne car il estimait déplacé qu'un Lord face des discours pour influencer une élection à la chambre des Communes. Cette règle s'appliqua également aux principaux membres du parti conservateur comme Salisbury. Les estimations annonçaient un résultat serré mais après les premiers retours, il devint clair que les conservateurs avaient subi une cuisante défaite. Les libéraux disposaient d'une majorité absolue avec environ 50 voix d'avance.
Mort
Après sa défaite, Disraeli écrivit à Lady Bradford que dissoudre un gouvernement demandait autant de travail qu'un former un, le plaisir en moins. De retour à Hughenden, Disraeli rumina sa défaite mais reprit son roman Endymion dont il avait commencé la rédaction en 1872 avant de l'arrêter après l'élection de 1874. L'œuvre fut rapidement achevée et publiée en novembre 1880. Il maintint une correspondance épistolaire avec Victoria qui avait été attristée par son départ. Lorsque le Parlement se réunit en janvier 1881, il devint leader conservateur à la chambre des Lords et s'efforça de modérer les législations de Gladstone.
Souffrant d'asthme et de goutte, Disraeli sortait aussi peu que possible. En mars, il développa une bronchite et ne quitta son lit que pour une réunion avec Salisbury et d'autres dirigeants conservateurs le 26. Lorsqu'il devint clair qu'il ne guérirait pas de cette maladie, ses amis et opposants se rendirent à son chevet. Il refusa une visite de la reine en indiquant qu'elle me demanderait uniquement de porter un message à Albert.
Malgré la gravité de l'état de santé de Disraeli, les médecins rédigeaient des bulletins optimistes à destination du public. Le premier ministre Gladstone, s'enquit à plusieurs reprises de l'état de son rival et écrivit dans son journal : Puisse le Tout-Puissant être près de son oreiller. Disraeli communiait habituellement à Pâques et le 17 avril, ses amis et ses proches discutèrent de lui offrir la possibilité de le faire ; ceux qui craignaient de lui faire perdre espoir furent finalement plus nombreux. Le matin du lundi de Pâques, il fut pris de démence et tomba dans le coma. Les derniers mots connus de Disraeli furent j'aurais préféré vivre mais je n'ai pas peur de mourir le 19 avril même si des rumeurs avancent qu'il aurait prononcé la Chema Israël de la religion juive. La maison où il mourut, à Curzon Street dans le quartier de Mayfair, a une plaque à son nom.
Ses exécuteurs testamentaires se prononcèrent contre des funérailles publiques car ils voulaient éviter que de trop grandes foules ne veuillent lui rendre un dernier hommage. La cérémonie funèbre fut menée par son frère Raphael et son neveu Coningsby qui hérita du manoir Hughenden. La reine endeuillée envisagea d'anoblir Raphael ou Coningsby en mémoire de Disraeli comme il n'avait pas d'enfants, ses titres disparurent avec lui mais elle se ravisa car leurs possessions étaient trop faibles pour une pairie. Le protocole lui interdisait d'assister aux funérailles mais elle envoya une gerbe de primevères, ses fleurs préférées et se rendit sur sa tombe quatre jours plus tard ; le protocole ne changea pas jusqu'en 1965 quand Élisabeth II assista à l'enterrement de l'ancien premier ministre Winston Churchill.
Disraeli fut inhumé avec son épouse dans un caveau sous l'église St Michael and All Angels se trouvant dans le domaine du manoir Hughenden. La reine Victoria fit également ériger un mémorial dans le chancel de l'église. Le caveau Disraeli renferme également le corps de Sarah Brydges Willyams, une riche veuve avec qui Disraeli maintint une longue correspondance à partir des années 1830. À sa mort en 1865, elle lui légua un large héritage qui l'aida à rembourser ses dettes. Disraeli laissa une fortune de près de 84 000 £ environ 9 millions de livres de 2011 au moment de sa mort.
Disraeli possède un mémorial à l'abbaye de Westminster qui fut érigé à l'instigation de Gladstone qui le recommanda dans son eulogie devant la chambre des Communes. Son discours était très attendu du fait de son opposition bien connue au défunt. Finalement, l'allocution fut un modèle du genre et il évita de commenter les politiques de Disraeli tout en soulignant ses qualités.
Héritage Littérature
Blake suggère que Disraeli « a produit un poème épique incroyablement mauvais et une tragédie en vers blancs de cinq actes, peut-être encore pire. Il écrivit également sur la science politique et une biographie, la Life of Lord George Bentinck qui est excellente... remarquablement équilibrée et juste. Disraeli a néanmoins plus été jugé sur ses romans et les critiques ont dès le départ été partagés. L'écrivain R. W. Stewart note qu'il y a toujours deux critères pour juger l'œuvre de Disraeli, un politique et l'autre artistique. Le critique littéraire Robert O'Kell est de cet avis et écrit : Il est après tout, même si vous êtes un conservateur jusqu'au bout des ongles, impossible de considérer Disraeli comme un romancier de premier plan. Et il est tout aussi impossible, peu importe que vous regrettiez les extravagances et les inconvenances de ses livres, d'en faire un auteur insignifiant.
Ses premiers romans silver fork comme Vivian Grey 1826 et The Young Duke 1831 mettaient en scène de manière romancée la vie aristocratique dont il ne connaissait rien avec des personnages basés sur des figures publiques bien connues. Son roman le plus autobiographique fut Contarini Fleming 1832, une œuvre au sérieux revendiqué qui ne rencontra pas le succès. Le critique William Kuhn suggère que l'œuvre de Disraeli peut être prise comme les mémoires qu'il n'écrivit jamais et révèlent la vie personnelle d'un homme politique pour qui les normes de l'époque victorienne semblaient être un carcan social.
Sur ses autres romans du début des années 1830, Alroy est décrit par Blake comme lucratif mais illisible tandis que The Rise of Iskander 1833, The Infernal Marriage et Ixion in Heaven 1834 eurent peu d'impact. Henrietta Temple 1837 fut le second succès de Disraeli. Le livre s'appuie sur son aventure avec Henrietta Sykes pour relater l'histoire d'un jeune homme criblé de dettes déchiré entre un mariage intéressé mais sans amour et une passion coup de foudre pour l'héroïne éponyme. Venetia 1837 fut une œuvre mineure écrite pour obtenir rapidement de l'argent.
Dans les années 1840, Disraeli rédigea une trilogie sur des thèmes politiques. Avec Coningsby; or, The New Generation 1844, Disraeli, selon Blake, insuffla dans le monde littéraire un vent de sensibilité politique épousant la croyance que le futur de l'Angleterre comme puissance mondiale dépendait non pas de la vielle garde suffisante mais des jeunes politiciens idéalistes Coningsby fut suivi par Sybil; or, The Two Nations 1845, un autre roman politique mais moins idéaliste et plus clairvoyant que le précédent ; le two nations du sous-titre fait référence à l'écart économique et social séparant quelques privilégiés et les classes ouvrières défavorisées. Le dernier ouvrage de la trilogie politique fut Tancred; or, The New Crusade 1847, qui défendait le rôle de l'Église d'Angleterre dans le renouveau spirituel britannique.
Les derniers romans de Disraeli furent Lothair 1870 et Endymion 1880. Le premier fut décrit par Daniel R. Schwarz comme son Voyage du pèlerin dans lequel il analyse les rôles des églises anglicane et catholique en politique. Même si le héros d'Endymion est un whig, Disraeli y expose pour la dernière fois ses croyances politiques et économiques. Jusqu'au bout, il attaqua ses adversaires dans des caricatures à peine déguisées : le personnage de St Barbe dans Endymion est largement considéré comme une moquerie de l'écrivain William Makepeace Thackeray qui avait offensé Disraeli plus de trente ans plus tôt en le ridiculisant dans le magazine Punch. Disraeli laissa un roman inachevé dont le personnage central, Falconet, est indiscutablement une caricature de Gladstone.
Politique
Dans les années qui suivirent la mort de Disraeli, le parti conservateur, mené par Salisbury, reprit son idéologie de démocratie tory selon laquelle les conservateurs devaient soutenir et améliorer le sort des classes ouvrières. Cet aspect de ses politiques ont été réévaluées par les historiens des XX et XXIe siècles. En 1972, B. H. Abbott avança que l'expression de démocratie toryfut inventée par Randolph Churchill mais que ce fut Disraeli qui en fit une composante essentielle de la philosophie conservatrice. En 2007, Parry écrivit que le mythe de la démocratie tory n'a pas résisté à l'examen attentif des historiens des années 1960 qui démontrèrent que Disraeli s'était très peu intéressé aux législations sociales et qu'il avait été très flexible dans les négociations sur la réforme parlementaire de 1867. Malgré cela, Parry considère Disraeli et non Peel, comme le fondateur du parti conservateur moderne. L'écrivain et homme politique conservateur Douglas Hurd écrivit en 2013 : Disraeli ne fut pas un démocrate tory ; et ce ne fut pas parce qu'il n'utilisa jamais l'expression. Il rejetait le concept dans son ensemble.
Les actions de Disraeli en politique internationale ont également été vues comme ayant attiré les électeurs des classes ouvrières. Avant sa direction du parti conservateur, l'impérialisme était associé au parti libéral et en particulier à Palmerston tandis que les conservateurs murmuraient leur opposition. Disraeli fit de son parti le principal défenseur de l'Empire britannique et soutien d'actions militaires pour asseoir sa domination. Cette évolution provenait en partie des propres vues de Disraeli, en partie car il y voyait un avantage pour les conservateurs et en partie en opposition à Gladstone qui appréciait peu l'expansion de l'Empire. Blake avança que l'impérialisme de Disraeli orienta le parti conservateur pour de nombreuses années et que la tradition qu'il initia fut probablement son meilleur atout pour remporter les voix des classes ouvrières durant le dernier quart de siècle. Certains historiens ont mentionné une impulsion romantique derrière l'approche de Disraeli envers l'Empire et les affaires étrangères ; Abbot écrivit ainsi : Aux concepts conservateurs mythiques de la Couronne, de l'Église, de l'Aristocratie et du Peuple, Disraeli ajouta l'Empire. D'autres y ont vu un certain pragmatisme. Le biographe de Gladstone, Philip Magnus, opposa la gestion de Disraeli des affaires étrangères avec celle de Gladstone qui ne comprit jamais que les grands principes moraux, dans leur application à la politique étrangère, sont plus souvent destructeurs de la stabilité politique que motivations pour l'intérêt national.
Tout au long de sa vie, les opposants et parfois les amis et les alliés de Disraeli se demandèrent s'il croyait sincèrement dans les idées qu'il défendait ou s'il les considérait simplement comme des outils qu'il promouvait sans conviction. En 1843, au moment du groupe Young England, John Manners écrivit : Si je pouvais me convaincre que D'Israeli croyait tout ce qu'il a dit, je serais ravi : ses vues historiques sont proches des miennes, mais les croient-ils En 1966, Blake suggère qu'il n'est pas plus possible de répondre à cette question aujourd'hui qu'à l'époque256. Paul Smith avance néanmoins dans son article sur les politiques de Disraeli que ses idées furent articulées de manière cohérente sur une carrière de près d'un-demi siècle et qu'il est impossible de les écarter comme un vulgaire attirail de cambrioleur visant à entrer par effraction dans le panthéon politique britannique.
Frances Walsh résuma ainsi la vie de Disraeli :
Le débat sur sa place dans le panthéon conservateur a perduré depuis sa mort. Disraeli a fasciné et divisé les opinions de ses contemporains ; il était vu par beaucoup, y compris au sein de son propre parti, comme un aventurier et un charlatan et par les autres comme un homme d'État patriote et clairvoyant. En tant qu'acteur sur la scène politique, il joua de nombreux rôles : héros byronien, homme de lettres, critique social, virtuose parlementaire, monsieur Hughenden, compagnon royal, homme d'État européen. Sa personnalité singulière et complexe a offert aux historiens et aux biographes un défi particulièrement ardu. [img width=-00]http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/5/14/1305390365594/Benjamin-Disraeli-c1878-007.jpg[/img]  [img width=-00]http://www.universitystory.gla.ac.uk/images/UGSP00401_m.jpg[/img] [img width=-00]http://www.victorianweb.org/graphics/portraits/disraeli1.jpg[/img]  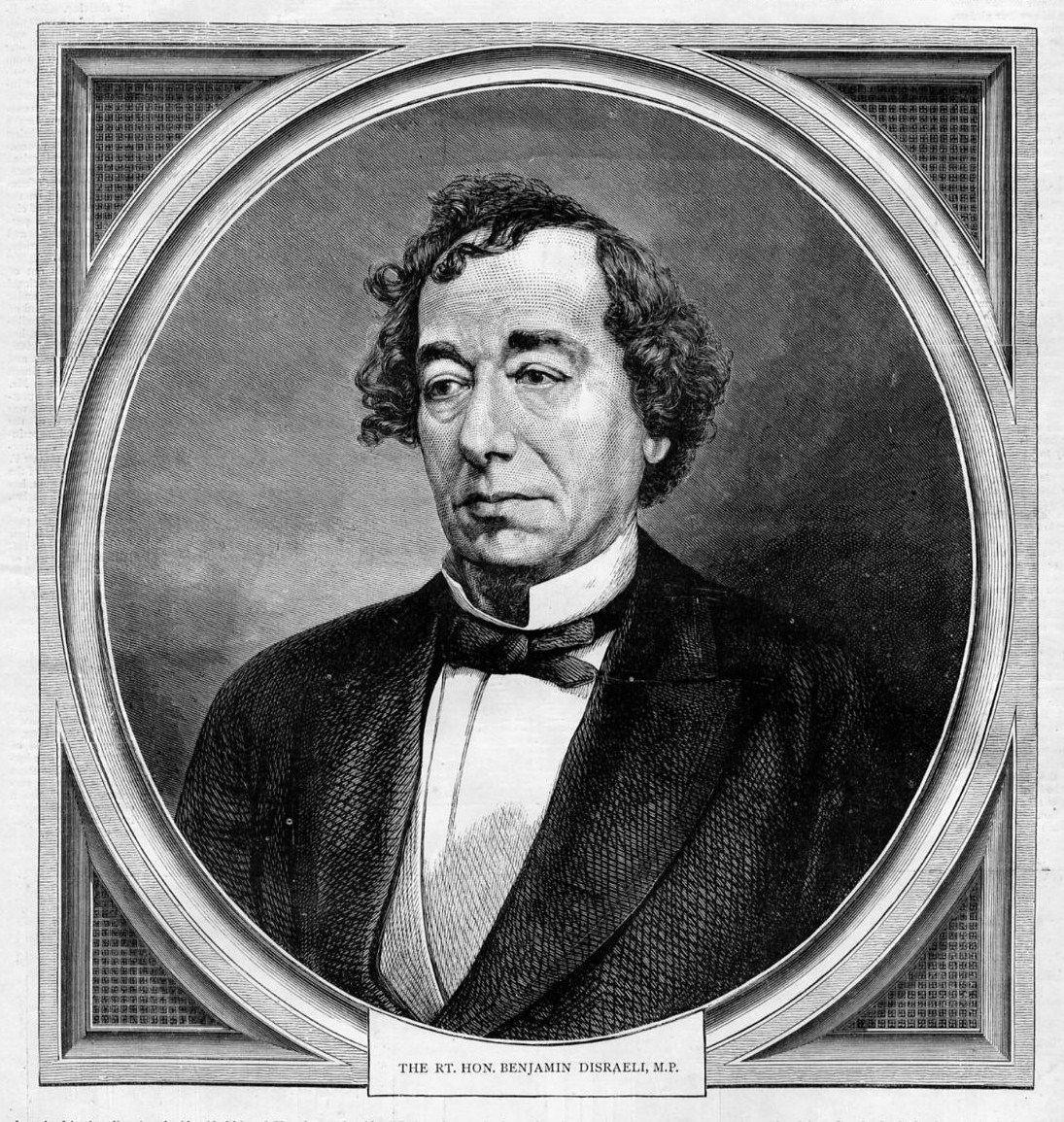      
Posté le : 21/12/2014 15:39
|
|
|
|
|
Nicolas Fouquet |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 21 décembre 1664 Nicolas Fouquet est reconnu coupable de péculat

c'est à dire, détournement de fonds publics par un comptable public, peine qui lui fait encourir la peine d emort. Nicolas Fouquet, marquis de Belle-Île, vicomte de Melun et Vaux, né en janvier 1615 à Paris, mort le 23 mars 1680 à 65 ans, à Pignerol, homme d'État français de haut rang, surintendant des finances à l'époque de Mazarin, procureur général au parlement de Paris. Il est licencie en droit à la Faculté de décret de l'Université de Paris, son activité principale est celle de surintendant des finances de Louis XIV 1653 -1661, il est également procureur général du Parlement de Paris
Il est le fils de François IV Fouquet, saon épouse est Marie-Madeleine de Castille.Il eut un pouvoir et une fortune considérables. Promoteur des arts au sens le plus noble du terme, Nicolas Fouquet sut s'attirer les services des plus brillants artistes de son temps. De nos jours, il est possible de mesurer la grandeur qui fut la sienne au château de Vaux-le-Vicomte. Destitué et arrêté sur l'ordre de Louis XIV en 1661 pour malversations, condamné à la confiscation de ses biens et au bannissement hors du royaume, il vit sa peine élargie par le roi, en vertu de ses pouvoirs de justice, à l'emprisonnement à vie. Personnage candidat au masque de fer, Nicolas Fouquet connut, bien longtemps après sa disgrâce, une réhabilitation posthume de son destin tragique, par les nombreux romans et films qui lui furent consacrés, et dont l'exemple le plus fameux fut le récit d'Alexandre Dumas, Le vicomte de Bragelonne.
En bref
Marquis de Belle-Isle, vicomte de Melun, vice-roi d'Amérique, procureur du roi au parlement de Paris et surintendant des Finances, Fouquet, mécène fastueux qui a construit Vaux, le premier Versailles du Grand Siècle, pensionné La Fontaine, découvert et fait travailler Molière, Lebrun, Le Nôtre, est le type accompli du grand seigneur en ce premier XVIIe siècle, le siècle de Louis XIII, lequel s'est achevé en 1661 avec la carrière du surintendant. Pourtant Fouquet est issu de la grande bourgeoisie, de cette bourgeoisie anoblie par les charges et le service du roi ; ses armes parlantes : un foucquet écureuil avec cette devise : Quo non ascendo. Son ascension est en effet exceptionnelle. C'est Richelieu qui épaule ce jeune homme doué : conseiller au parlement de Metz à seize ans, maître des requêtes à vingt, il passe, à la mort du grand cardinal, au service de Mazarin. À trente-cinq ans, il achète la charge de procureur du roi au parlement de Paris. En 1653 enfin, la double protection d'Anne d'Autriche et de Mazarin lui vaut la charge de surintendant des Finances ordinaires et extraordinaires ; il est alors l'homme le plus puissant de France après le cardinal. Il est vrai que jusqu'en 1659 il a un collègue, Servien ; mais, après la mort de ce dernier, Fouquet ne doit plus de comptes qu'au roi ; et, si le roi mineur règne, c'est Mazarin qui gouverne.
Le royaume étant partiellement ruiné par la guerre étrangère, suite de la guerre de Trente Ans, guerre contre l'Espagne et par la guerre civile, la Fronde, le Trésor était généralement vide, et les dépenses de l'État étaient acquittées avec des billets sur des espérances de rentrée d'argent ; ces billets étaient assignés par un trésorier de France à l'un des fonds de l'État, par exemple une ferme. Si ce fonds s'avérait insolvable, le billet recevait une autre assignation et le créancier était forcé de se promener de bureau en bureau jusqu'à ce que son assignation se dévalue et qu'il se trouve trop heureux de la revendre bien au-dessous de sa valeur réelle. L'acquéreur du billet n'avait plus qu'à le faire signer par le surintendant qui l'assignait sur un bon fonds ; il était intégralement payé, ce qui permettait de réaliser jusqu'à 90 p. 100 de bénéfice. Bien entendu, ces services étaient reconnus par des dessous-de-table qui accroissaient prodigieusement la fortune de Fouquet et encore plus celle de Mazarin. Fouquet prêtait aussi à l'État à des taux réputés usuraires, mais ces sommes permettaient parfois de gagner une bataille. En réalité, ses finances et celles de l'État se confondaient, et le crédit de l'État, c'était le sien, la confiance en sa signature toujours honorée. Toujours à la frontière d'une légalité qu'il connaissait fort bien, Fouquet aimait ces jeux d'argent comme il aimait les livres rares, les meubles précieux, les jardins enchantés, les demeures fastueuses, les jolies femmes. Ce goût d'un faste vraiment royal le perdit dans l'esprit d'un roi de vingt ans qui n'avait guère connu que la pauvreté. Mazarin meurt au début de l'année 1661, léguant au roi Colbert son fidèle commis. Mazarin n'aimait pas Fouquet, mais en avait besoin ; Colbert le haïssait et voulait sa place. Il n'était guère difficile de perdre Fouquet dans l'esprit du roi. Depuis des années, Colbert accumulait notes et mémoires qui accablaient le surintendant. Et celui-ci accumulait les imprudences : il offrait de l'argent à La Vallière, qui le repoussait avec indignation ; il donnait à Vaux une fête trop royale en l'honneur du roi ; il vendait enfin sa charge de procureur contre de fallacieuses promesses, perdant ainsi le privilège d'être jugé par le Parlement. Sa perte était résolue. C'est en Bretagne, dans son fief, que Fouquet est arrêté par d'Artagnan le 5 septembre 1661. Usant de son droit de justice retenue, le roi nomme une chambre spéciale composée surtout d'ennemis de Fouquet. L'opinion est d'ailleurs satisfaite ; le bonheur, la richesse de Fouquet, sa puissance lui ont suscité beaucoup d'envieux. Il passe pour être l'affameur du peuple. Le procès va durer près de trois ans, malgré les efforts de Colbert et du roi. Contre Fouquet, tous les moyens sont bons : corruption de juges, falsification de pièces, isolement total du prisonnier, à qui on refuse tout moyen de défense ; ses plus fidèles collaborateurs sont emprisonnés. Pourtant, sa mère, sa femme, ses amis assaillent le roi de suppliques ; Fouquet se défend, conteste ses juges, fait paraître des mémoires justificatifs. Devant l'acharnement du pouvoir, l'opinion se retourne, et l'accusé devient martyr de l'absolutisme ; certains juges, tels Lamoignon, d'Ormesson, refusent d'obéir. Corneille, La Fontaine, Mme de Sévigné mettent leur plume au service de Fouquet. Le 20 décembre 1664, après des réquisitoires qui soulèvent l'indignation par leur ton haineux, l'accusé est condamné au bannissement perpétuel. Le roi voulait la mort. Fait inouï, il commue la peine en prison à vie. Le rideau tombe sur la vie de Nicolas Fouquet, coupable d'avoir fait ce que tant d'autres avaient fait avant lui et de n'avoir pas compris que le temps en était révolu et que, dans le ciel de France, il n'y avait place désormais que pour un seul astre. Enfermé dans la forteresse de Pignerol, Fouquet survivra vingt ans. Cet homme qui avait eu tout n'aura plus rien, broyé par la raison d'État et peut-être par la possession d'un secret qu'il ne révélera jamais, ce qui l'a fait identifier par certains historiens au masque de fer de l'île Sainte-Marguerite, où il n'a probablement jamais été transféré ; il serait mort au moment où il venait enfin de voir s'ouvrir les portes de la prison.
Sa vie
Nicolas est le second fils de François IV Fouquet, conseiller au parlement de Paris, maître des requêtes de l'hôtel du roi puis conseiller d'État, et associé de la Compagnie des îles d'Amérique, et de Marie de Maupéou, issue d'une grande famille de la robe. La famille Fouquet a fait fortune dans le commerce du drap avant de se convertir dans la magistrature. Contrairement aux prétentions de l'époque du clan Fouquet, la famille n'est pas d'origine noble : son trisaïeul, François Foucquet, était marchand, et fils de marchand de drap à Angers. Son père, était devenu un riche armateur breton, remarqué par Richelieu qui l'avait fait entrer au Conseil de la Marine et du Commerce, et qui devint conseiller d'État ordinaire et maître des requêtes à Paris. Il avait accepté de siéger dans la Chambre composée en août 1626 par Richelieu pour juger le comte de Chalais.
Le blason des Fouquet porte D'argent à l'écureuil rampant de gueules, avec la devise « Quo non ascendet ?, Jusqu'où ne montera-t-il pas ?. Un foucquet est en effet, en gallo, un écureuil.
Comme les Maupéou, les Fouquet sont devenus une famille exemplaire de la Contre-Réforme, d'une spiritualité très proche de François de Sales et de Jeanne de Chantal. Sur les douze enfants survivants du couple, les six filles deviennent religieuses, quatre garçons sont tonsurés dont un, Basile Fouquet, est abbé, seuls Nicolas et son frère puîné Gilles étant laïcs et deux d'entre eux sont évêques.
Dans un même esprit, c'est aux Jésuites du collège de Clermont que ses parents confient l'éducation de Nicolas. Tout en étudiant, il aide sa mère, Marie de Maupéou, dans la préparation de médicaments pour les pauvres. Son goût pour la chimie et la pharmacie persistera tout au long de sa vie. Son frère aîné étant destiné à rejoindre la robe, comme son père, le jeune Nicolas est d'abord orienté vers l'état ecclésiastique. En conséquence, il reçoit la tonsure en janvier 1635. Il devient trésorier de l'abbaye Saint-Martin de Tours et reçoit le bénéfice du prieuré de Saint-Julien de Doüy. Malgré tout, sa famille hésite encore sur l'orientation à donner à sa carrière. C'est finalement le droit qui l'emporte — selon le jurisconsulte Christophe Balthazar, sur conseil de Richelieu en personne : Nicolas passe sa licence de droit à la Faculté de décret de l'Université de Paris et se fait inscrire au tableau des avocats.
Carrière politique Magistrat
En mars 1633, son père demande au cardinal une charge de conseiller au Parlement de Paris pour Nicolas. Sa demande est refusée : le frère aîné, François V, possède déjà une charge identique. Néanmoins, il obtient l'année suivante une charge de conseiller au parlement de Metz, nouvellement créé par Richelieu. Cela témoigne de la faveur de François et la confiance du cardinal en Nicolas, qui obtient une dispense d'âge. Nicolas reçoit une mission du cardinal : inventorier les papiers du Trésor de la chancellerie de Vic, où sont conservés tous les titres du temporel de l'évêché de Metz et de l'abbaye de Gorze. Il s'agit de vérifier si le duc Charles IV de Lorraine n'empiète pas sur les droits du roi de France, ce qui est toujours le cas quand il s'agit de territoires enclavés à l'étranger et rattachés depuis peu à la France ; c'est le casus belli couramment utilisé. Il s'agit en effet de justifier l'entrée des troupes françaises dans ses États qui occupent le duché avant les conclusions de Nicolas. Le jeune homme s'acquitte de sa tâche avec brio.
En 1635, le frère aîné de Nicolas entre dans les ordres. Désormais, Nicolas porte les espoirs d'ascension sociale de son père, qui lui achète une charge de maître des requêtes de l'Hôtel. Là encore, Nicolas bénéficie d'une dispense d'âge. En 1638, il est détaché de la cour de Metz pour participer au Conseil souverain imposé par la France à Nancy. Il y mène grand train, prenant part aux séances à la comédie, aux bals et aux festins. La même année, son père, pour l'associer à ses affaires, lui cède une part dans la Compagnie des îles d'Amérique.
François Fouquet, se sentant proche de la mort, pousse son fils au mariage. Nicolas jette son dévolu sur Louise Fourché, dame de Quéhillac, petite-fille de Jean Fourché, maire de Nantes en 1597-1598. Le contrat est signé le 10 janvier 1640 à Nantes entre les parents, la cérémonie a lieu le 24 à Notre-Dame de Nantes. C'est un riche mariage : Louise apporte en dot 160 000 livres en argent et rentes sur particuliers plus la terre de Quéhillac. Nicolas reçoit de ses parents la propriété de sa charge de maître des requêtes estimée à 150 000 livres, plus une rente de 4 000 livres au denier, ce qui représente environ 20 000 livres de capital. De plus, Louise comme Nicolas ont de forts liens de parenté en Bretagne : Louise par ses parents, son père est conseiller au parlement de Bretagne et Nicolas par ses cousins Chalain et par les liens de son père avec les compagnies de commerce de l'Atlantique. François Fouquet meurt peu de temps après, suivi au début de l'année 1641 par le grand-père maternel de Nicolas, Gilles de Maupéou. La même année, six mois après avoir donné naissance à une fille, Marie, sa femme meurt. À 26 ans, Nicolas Fouquet se retrouve donc veuf.
Le Cardinal Mazarin, protecteur de Fouquet.
Durant cette période, il reprend les activités de son père au sein des différentes compagnies maritimes dans lesquelles la famille détient des parts : Compagnie des îles d'Amérique, du Sénégal ou encore de la Nouvelle-France. En 1640, il fait partie des premiers actionnaires de la Société du Cap-Nord et en 1642, il entre dans celle des Indes orientales.
Il fait aussi l'acquisition de la terre noble de Vaux avec la dot de son épouse16, dans le bailliage de Melun, et se fait appeler « vicomte de Vaux ». En 1642, la mort de Richelieu, protecteur de longue date de la famille Fouquet, vient mettre fin à ses rêves coloniaux et maritimes. Fouquet choisit alors définitivement le service de l'État. Heureusement pour lui, l'équipe ministérielle est maintenue en place par Louis XIII puis, à la mort de celui-ci, par la régente Anne d'Autriche : le cardinal Mazarin prend la succession de Richelieu et devient le nouveau patron de Fouquet.
En 1644, il est nommé intendant de justice, police et finances à Grenoble dans le Dauphiné, sans doute sur décision personnelle de la régente. C'est un poste difficile pour un jeune homme peu expérimenté, qui plus est dans une province qu'il ne connaît pas. Au cours de l'été, alors qu'il s'est absenté sans autorisation pour assister à l'intronisation de son frère aîné François, nommé évêque d'Agde, une émeute de paysans a éclaté contre les levées d'impôts. Il est révoqué aussitôt par Mazarin, sur l'initiative du chancelier Séguier.
Heureusement, un second incident lui permet d'écourter sa disgrâce : sur le chemin du retour, de nouvelles émeutes se déclenchent à Valence. Grâce à son sang-froid, à ses talents oratoires et à son courage personnel, Fouquet parvient à calmer ce soulèvement. En récompense, il réintègre dès 1646 le corps des maîtres des requêtes. Mazarin lui confie une mission d'observation lors du siège de Lérida, en Espagne. Ayant donné toute satisfaction, Fouquet est nommé l'année suivante intendant à l'armée de Picardie, sur décision personnelle d'Anne d'Autriche.
Sous la Fronde
En 1648, il devient intendant de la généralité de Paris. La Fronde donne à son poste une importance inespérée. Il se range immédiatement du côté d'Anne d'Autriche et de Mazarin, se gagnant ainsi la faveur indéfectible de la reine. Après l'arrêt d'Union, il envoie à la reine une lettre conseillant de négocier et de diviser ses ennemis, attitude qu'il conserve tout au long de la Fronde. Pendant le siège de Paris, il se voit chargé du service des subsistances et gagne beaucoup d'argent.
En novembre 1650, il peut franchir un pas important en achetant pour 450 000 livres la charge de procureur général du parlement de Paris. Il entre ainsi dans l'élite de la robe. Il en profite pour contracter un second mariage, conclu en février 1651. La nouvelle madame Fouquet, née Marie-Madeleine de Castille-Villemereuil, appartient, elle aussi, par son père à une famille de marchands passés à la finance, puis anoblis. Elle n'a que 15 ans, lui en a 36. Sa dot est inférieure à celle de Marie Fourché, mais elle apporte en compensation le vaste cercle de relations de la famille de sa mère dans la haute robe parisienne. Au même moment, le Parlement vote l'expulsion de Mazarin. Celui-ci a pris les devants en s'exilant en Allemagne. Officiellement, Fouquet, procureur général, instruit contre Mazarin. En sous-main, il tient Mazarin informé jusqu'à son retour en grâce, par le truchement de son frère Basile, dit l'abbé Fouquet, chef de la police secrète du cardinal. Le 31 juillet, un arrêt royal transfère le Parlement à Pontoise, Fouquet supervise l'opération, sous les quolibets de la foule.
Il tient sa revanche à la fin de la Fronde : lors du lit de justice du 22 octobre 1652, après la lecture de l'acte d'amnistie, il prononce un grand discours louant la clémence du roi et fustigeant ses collègues restés fronder à Paris. Par la suite, il se montrera impitoyable envers les partisans de Condé.
Surintendant des finances
En février 1653, le duc de La Vieuville, surintendant des finances, meurt subitement. Fouquet, soutenu par des amis financiers, se porte aussitôt candidat à sa succession. Mazarin, répugnant à trancher et sachant que diviser c'est régner, opte pour deux charges de surintendant des finances. L'une revient au diplomate Abel Servien. L'autre est emportée par Fouquet le 7 février sur des candidats de première importance comme Le Tellier, Mathieu Molé, l'ancien surintendant de Maisons ou encore les maréchaux de Villeroi et de l'Hospital. Il doit sa nomination à sa bonne conduite durant la Fronde, mais aussi à l'influence de son frère Basile. À la surintendance est assorti un brevet de ministre, qui permet à Fouquet de siéger au Conseil d'En-Haut, la plus puissante instance monarchique. Fouquet est ainsi le plus jeune responsable des Finances de l'Ancien Régime. Pour ce qui est de sa compétence, les opinions varient selon qu'on considère l'homme d'affaires ou l'homme d'État. L'historien Daniel Dessert souligne ses compétences financières et commerciales, qu'il est préparé à affronter la redoutable tâche des Finances royales et il connaît de l'intérieur le fonctionnement de la finance . En revanche, l'un de ses biographes, Jean-Christian Petitfils, précise qu il connaissait mal les arcanes de la finance publique et qu'il était étranger au milieu des publicains.
Les finances royales sont alors dans un état désastreux. Alors que les besoins d'argent de la couronne sont immenses, à la fois pour financer la guerre et pour les dépenses personnelles de Louis XIV, le Trésor est en banqueroute, la conjoncture fiscale est calamiteuse les tailles ne rentrent plus et le stock de métaux précieux disponible, insuffisant. Pour faire face, Fouquet ne s'appuie pas sur une théorie économique précise. Cependant, il sait d'expérience que le principal problème de l'État français est son manque de crédit : les traitants, fermiers et autres bailleurs de fonds ne lui font pas confiance. Il s'emploie donc à restaurer le crédit en respectant les contrats passés entre ces traitants et le Trésor et en leur consentant des taux avantageux. Ainsi, il assigne sur de nouveaux fonds de vieux billets de l'Épargne, compensant ainsi une partie de la banqueroute de 1648. Il met l'accent sur les affaires extraordinaires : création et vente de charges, création de droits nouveaux, émissions de rentes et prêts, le tout dans des conditions très avantageuses pour les traitants. Au contraire des manipulations monétaires passées, il impose en juillet 1653 une réévaluation de la livre tournois : la pistole d'or passe de 12 à 10 livres. Le crédit se fait plus abondant et la situation s'améliore.
Loin d'inciter à la sagesse, cette embellie provoque de nouvelles dépenses inconsidérées. Dès 1654, la crise revient. Fouquet doit s'engager de manière importante sur sa fortune personnelle et même celle de ses proches. En novembre 1657, il doit ainsi prendre à sa charge un tiers d'un contrat global de 11,8 millions de livres. Son crédit personnel lui permet de couvrir l'engagement, mais au prix d'un intérêt de 20 %27.Parallèlement aux difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa charge, il doit compter avec la faveur changeante de Mazarin et les critiques de Colbert, intendant de ce dernier. Exaspéré par ces tensions, il offre même sa démission, qui est refusée. Il ne s'entend guère non plus avec son collègue Servien : dès décembre 1654, il avait dû réclamer au roi un règlement pour délimiter les fonctions de chacun. Le 24, les tâches sont redéfinies : Servien a en charge les dépenses, Fouquet les recettes.
La politique de Fouquet lui permet de se constituer une large clientèle parmi les manieurs d'argent du royaume. En outre, les flux financiers considérables qui passent par les mains du surintendant ainsi qu'un réseau d'espions et d'informateurs permettent à Fouquet de consolider sa position. Les plus grands seigneurs deviennent ses amis et/ou ses obligés. Enfin, ses cousins Maupéou ainsi que son remariage lui garantissent une bonne mainmise sur la robe. Fouquet consacre son ascension sociale en mariant sa fille Marie avec Armand de Béthune, marquis de Charost, petit-neveu de Sully. Il dote sa fille princièrement : elle apporte 600 000 livres à son époux en louis d'or et d'argent.
À la mort de Servien en 1659, Fouquet est confirmé seul dans sa charge, qu'il conserve jusqu'à la suppression de cette dernière en 1661. Il repousse avec succès une intrigue de Colbert pour le relever de la surintendance, s'emploie à convaincre Mazarin de la nécessité de réduire les dépenses de l'État et simultanément, travaille à un vaste plan de redressement financier fondé sur l'amélioration de la perception des impôts indirects centralisation des fermes générales, l'allègement des tailles remise sur les arrérages de tailles impayées, l'assainissement des finances municipales, vérification des dettes des villes et, toujours, l'amélioration des relations avec les manieurs d'argent. Malgré la fin de la guerre, pourtant, la situation des finances royales reste très dégradée. Les manieurs d'argent préfèrent prêter à la Cour qu'au roi, et Fouquet doit une nouvelle fois engager sa signature personnelle, consentir à des taux d'intérêt considérables, accorder des remises et recourir aux affaires extraordinaires.
Le bilan de sa surintendance ne fait pas l'unanimité. L'historiographie classique reproche à Fouquet son absence de principes économiques clairs, sa timidité à réduire les affaires extraordinaires et à éteindre les emprunts royaux, mais surtout sa collusion avec le milieu des manieurs d'argent, son clientélisme et son enrichissement personnel. Daniel Dessert juge ce bilan largement marqué par les critiques de Colbert et préfère souligner l'amorce de redressement financier obtenu par Fouquet, par des moyens somme toute similaires à ceux de Colbert :
En réalité, il n'existe pas de politique financière profondément différente entre Fouquet et son rival Colbert. Ce qui les différencie, c'est leur style : tout en nuances, en touches subtiles chez le premier ; en coups de boutoir chez le second.
On a objecté à cette thèse que si Fouquet avait bien une politique cohérente, il n'a pas comme Colbert été l'auteur d'un système administratif cohérent.
Toujours est-il, que l'État se retrouve complètement ruiné par les intérêts des emprunts qu'il lui a fait contracter auprès de ses amis traitant ou de compagnies dans lesquelles il est intéressé, tandis que lui-même se retrouve à la tête d'une fortune fabuleuse lui permettant d'entretenir une cour et de donner des fêtes somptueuses. Ce contraste entre la prospérité de ses affaires et la ruine corrélative de son maître ne tardera pas à provoquer sa chute.
Aventures coloniales et maritimes
Actionnaire, à la suite de son père, de compagnies d'exploitation coloniales, Fouquet a conscience des problèmes inhérents à ces sociétés qui hésitent souvent entre but religieux et but commercial, possèdent des moyens insuffisants et pâtissent de la concurrence des Anglais et des Néerlandais. Rapidement, il décide donc d'intervenir dans les colonies de manière plus directe, en se faisant armateur. Dès les années 1640, sa famille achète ou fait bâtir plusieurs navires, dont des bâtiments de guerre. Certains semblent être utilisés pour la course, sous commission de la France comme du Portugal ; une partie sera vendue à la couronne de France en 1656. Des membres de la parenté sont également placés à des fonctions stratégiques : en 1646, son cousin le président de Chalain devient gouverneur du port breton de Concarneau.
Fouquet veut aller plus loin et se créer en Bretagne une puissance domaniale pouvant servir de base à de vastes entreprises coloniales et commerciales. C'est dans cette optique qu'il se lie à l'illustre maison bretonne de Rieux, à qui il rachète plusieurs terres aux alentours du golfe du Morbihan, comme la forteresse de Largoët. En 1658, par l'intermédiaire de Jeanne-Pélagie de Rieux, propriétaire de l'île d'Yeu, il fait fortifier l'île où il amène des vaisseaux armés. La même année, il achète Belle-Île pour 2,6 millions de livres, dont il restaure les murailles, et où il fait bâtir un port, des magasins et des entrepôts à grands fraits. Il semble bien que l'île soit également destinée à être une place de sûreté, un refuge en cas de procès. Simultanément, il constitue par l'intermédiaire d'un prête-nom une société de commerce à destination de l'Espagne et des Indes, dont les bateaux utilisent Belle-Île comme port d'attache et entrepôt. À la tête d'une dizaine de navires, utilisés pour le cabotage ou le commerce au long cours, Fouquet se classe parmi les premiers armateurs du royaume. Selon le surintendant et ses amis, l'ambition était que Belle-île remplace le port d'Amsterdam dans son rôle d'entrepôt de l'Europe septentrionale.
Afin de se prévaloir d'une autorité légitime, Fouquet achète en 1660 au duc de Damville la charge de vice-roi d'Amérique, qu'il confie à un homme de paille : les lettres de provision accordent au titulaire l'autorisation d'exempter d'impôts les marchandises et munitions destinées aux places existant ou à créer en Amérique. L'objectif du surintendant est alors de prendre le contrôle du commerce des peaux et fourrures d'Acadie, ainsi que de la pêche à la morue. Toutefois, il ne peut concrétiser ses projets en raison de l'opposition de la Compagnie de la Nouvelle-France. Ses projets en Terre-Neuve et aux Antilles connaissent pareillement l'échec, sans doute en raison de la dispersion des efforts de Fouquet.
Protecteur des arts et des lettres
Fouquet a de nombreuses demeures. Jeune homme, il réside dans la maison familiale de la rue de Jouy, à Paris. Il acquiert ensuite une demeure près de la rue de Matignon, avant de déménager dans l'hôtel de Castille, apporté en dot par sa seconde épouse. Il possède ensuite l'hôtel de Narbonne et celui d'Émery, jouxtant celui de Mazarin. Il achète également une grande propriété à Saint-Mandé. Il la fait rebâtir et embellir. Il y constitue une grande collection de livres 27 000 volumes, surpassée seulement par celle de Mazarin 50 000. Son goût des jardins s'y développe : il les réaménage, les décorant de statues, de serres et d'orangeries. Il y donne de nombreuses réceptions et y joue gros jeu. En 1656, il reçoit successivement la Cour, Gaston d'Orléans et la reine Christine de Suède.
Fortune
Nicolas Fouquet s'est bâti entre 1651 et 1661, une colossale fortune qui a fait de lui à la mort de Mazarin en 1661, l'homme le plus riche de France. À la mort de son père, Nicolas Fouquet hérite d'une fortune de 800 000 livres. En 1653, ses actifs étaient de 2 millions de livres et en 1661, ils sont de 19,5 millions de livres avec un passif de 16 millions de livres. Son revenu annuel de surintendant est de 150 000 livres.
Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne
À partir de 1653, il fait bâtir le magnifique Château à Vaux-le-Vicomte actuelle commune de Maincy. Le domaine, acheté avant son accession à la surintendance, n'est que friches au milieu desquelles est construit un vieux château. Fouquet commence par racheter méthodiquement les terres alentour : l'ensemble du domaine représente, à terme, plus de 200 contrats, certains achats ne portant que sur quelques arpents de terre. Il fait raser le village de Vaux, quelques autres hameaux et bois, détourner une rivière et arracher des vignes. En outre, des travaux d'adduction d'eau sont réalisés. Le cout total des travaux de Vaux-le-Vicomte est évalué à plus de 4 millions de livres.
Il y fait travailler Le Vau, Le Brun, Le Nôtre et Villedo. Il s'entoure d'une petite cour d'écrivains comme Molière, La Fontaine, Madame de Sévigné ou Mademoiselle de Scudéry.
Le roi y vient pour la première fois en juillet 1659. Le 17 juillet 1660, Fouquet l'y reçoit de nouveau, accompagné par l'infante Marie-Thérèse que le roi vient d'épouser, alors qu'ils reviennent de Saint-Jean-de-Luz.
Le 11 juillet 1661, il reçoit une nouvelle fois la Cour. Louis XIV n'ayant pu assister à la fête, une autre est donnée le 17 août pour le monarque accompagné de ses 600 courtisans. Elle est somptueuse, avec jets d'eaux, feux d'artifice, ambigu, buffet donné pour plus de mille couverts et supervisé par François Vatel et création de la pièce de Molière Les Fâcheux. Louis XIV est furieux de voir tant de splendeur alors que ses propres demeures sont vides. L'origine de tant d'argent lui paraît suspecte. L'offre de Fouquet de lui donner Vaux ne fait que l'irriter davantage. Selon l'abbé de Choisy, Louis XIV aurait déclaré dans le carrosse qui le ramène à Paris à Anne d'Autriche : Ah, madame, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à tous ces gens-là ?
Le mécène
Fouquet fonde un salon à Saint-Mandé dès la fin de la Fronde. Il y attire Paul Pellisson, Charles Perrault, Quinault, Ménage, La Fontaine et Madame de Sévigné. Il fréquente aussi des scientifiques comme le médecin Samuel Sorbière ou le philosophe La Mothe Le Vayer. Dès 1660, il s'intéresse à Molière. Il protège le peintre Nicolas Poussin. À Vaux, son salon réunit plutôt des Précieux. Fouquet lui-même écrit poèmes, chansons, énigmes et bouts-rimés, suivant la mode de l'époque. Il pensionne de nombreux poètes, comme Corneille 2 000 livres par an, Scarron 1 600 livres ou encore Gombauld 1 000 livres, et protège les sculpteurs François Anguier, son disciple François Girardon, Thibaut Poissant et Pierre Puget.
Sa générosité à l'égard des artistes en fait l'un des mécènes les plus puissants de France, bien devant le cardinal Mazarin et même le roi. En remerciement, Corneille dédie son Œdipe 1659 au surintendant, pas moins celui des belles-lettres que des finances, et Madeleine de Scudéry le place dans sa Clélie, histoire romaine au même rang que Richelieu en tant que protecteur des arts et des lettres.
Le procès Les raisons de la chute
Lorsque Mazarin meurt en mars 1661, la faveur de Fouquet semble à son comble : il contrôle le Conseil privé du souverain, qui le charge de créer un Conseil du commerce et lui confie plusieurs missions de diplomatie secrète. Cependant, les critiques de Colbert et l'avertissement de Mazarin, sur son lit de mort, à propos de Fouquet jouent en sa défaveur : Louis XIV se méfie de plus en plus d'un ministre jugé trop ambitieux. Contrairement à une idée reçue, la fête extravagante de Vaux n'est pas la cause de l'arrestation de Fouquet : la décision du renvoi, de l'aveu même du roi, fut prise auparavant, le 4 mai.
Elle s'explique principalement par la crainte du feu cardinal et de Colbert qui voient, en ses places fortes qu'il fait bâtir sur les côtes, une menace : il a fait débarquer des hommes et de nombreux canons sur l'île d'Yeu. Aussi, Fouquet qui est populaire possède un immense réseau de clientèle dans le royaume et est un fervent soutien des partis dévots que Colbert suspecte d'avoir attenté à la vie du roi le 29 juin 1658 à Calais par empoisonnement. Le parti dévot est absolument contre l'alliance qui s'est faite entre l'Angleterre, jugée hérétique, et le royaume de France. Le roi, probablement empoisonné, entouré de ses médecins, réussit à vomir et survit alors que l'après Louis XIV était évoqué. Colbert aussi avait prévenu le cardinal dès 1658 d'une possible tentative d'empoisonnement à l'encontre du roi. C'est ce même réseau de clientèle, fidèle à Fouquet, qui est impliqué dans l'affaire des poisons qui éclabousse jusqu'à Madame de Montespan. Mais joue aussi le fait que Louis XIV a l'impression d'être joué par Fouquet : après lui avoir promis de revenir à une gestion plus saine de ses finances, le surintendant est retombé dans ses anciennes pratiques. La résolution du roi se durcit quand Colbert lui remet les rapports de son cousin, Colbert de Terron, sur les fortifications et l'armement de Belle-Île. Mais il faut noter pour la défense de Fouquet que la distinction des finances royales et privées était peu envisagée jusqu'à l'arrivée de Colbert au poste de contrôleur des finances.
Deux éléments font obstacle à la chute du surintendant : de par sa charge de procureur général, Fouquet n'est justiciable que devant le Parlement, qu'il contrôle. Ensuite, le surintendant jouit de la faveur d'Anne d'Autriche. Colbert y pare méthodiquement : d'abord, il s'arrange pour que Fouquet propose spontanément au roi de vendre sa charge pour lui en remettre le produit. Ensuite, il gagne à la cause anti-Fouquet la duchesse de Chevreuse, vieille amie de la reine-mère. Si Fouquet est informé de ces menées, il n'en comprend pas le danger et, au contraire, accumule les maladresses.
L’arrestation de Nicolas Fouquet.
Alors que la cour est à Nantes pour les États de Bretagne, le 5 septembre 1661, Louis XIV ordonne à d'Artagnan d'arrêter le surintendant pour malversations. Visiblement surpris, Fouquet offre de faire remettre Belle-Île au roi et parvient à faire prévenir ses proches, qui n'utiliseront pas ce répit pour détruire ses documents les plus compromettants.
Hugues de Lionne, son ami, demande au roi de partager la disgrâce du surintendant, mais Louis XIV refuse. Belle-Île se rend sans résistance aux troupes royales.
Les scellés sont posés sur toutes les résidences de Fouquet, et celles de ses clients. Mme Fouquet est exilée à Limoges, ses frères Louis et François confinés dans leurs diocèses. Gilles est déchu de sa charge de premier écuyer, et même Basile doit s'exiler en Guyenne.
Certains de ses amis les plus proches, comme Pellisson, sont emprisonnés, les autres assignés à résidence.
L'instruction
Le 7 septembre, Fouquet est transféré au château d'Angers. Les perquisitions commencent, en présence de Colbert, pourtant simple particulier sans rôle dans l'instruction. Tout au long des recherches, il fait porter au roi, en toute irrégularité, les pièces inventoriées, dont certaines sont conservées et certaines rendues après quelques jours. Colbert fait également analyser tous les comptes et tous les registres financiers saisis, afin d'y chercher des éléments de preuve contre Fouquet. Derrière un miroir, à Saint-Mandé, on découvre le plan de défense de Fouquet : il s'agit d'instructions en cas de crise, rédigées par Fouquet lui-même en 1657, à une époque où il croit que Mazarin a juré sa perte. Le mémoire prévoit qu'en cas d'emprisonnement et de mise au secret de Fouquet, les gouverneurs qui comptent parmi ses amis s'enferment dans leur citadelle et menacent d'entrer en dissidence pour obtenir sa libération — projets de révolte qui eussent mérité la mort si le ridicule n'en avait adouci le crime, note l'abbé de Choisy. Indiscutablement factieux, ce plan est effectivement inachevé, lacunaire et tout à fait irréaliste. On relève également un engagement pris par les adjudicataires des gabelles de verser une pension annuelle de 120 000 livres à un bénéficiaire dont le nom est laissé en blanc : il s'agit clairement d'un pot-de-vin.
Par la suite, Fouquet accusera Colbert d'avoir fait placer chez lui un document issu des papiers de Mazarin : de fait, le papier n'est pas mentionné dans un premier procès-verbal établi avant la visite de Colbert, et n'est trouvé qu'après une visite minutieuse des lieux par ce dernier.
Le 12 septembre, Louis XIV supprime la surintendance, la remplaçant par un Conseil royal des finances. Colbert prend le poste de Fouquet au Conseil d'En Haut, avec rang de ministre. Relevant d'une forme parfaitement légale de justice retenue du roi, ce dernier a institué une juridiction d'exception par édit royal de novembre 1661 portant création et établissement d’une chambre de justice, pour la recherche des abus et malversations commises dans les finances de Sa Majesté depuis l’année 1635, chambre de justice constituée le 15 et présidée par le chancelier Séguier avaec pour adjoint Guillaume de Lamoignon. Elle est composée de magistrats de la Cour des aides et de la Chambre des comptes. Son objet est la recherche des abus et malversations commises dans les finances depuis 1635. Le 1er décembre, Fouquet est transféré au château d'Amboise ; la population l'injurie sur son passage.
L'instruction du procès de Fouquet est ouverte le 3 mars 1662. Dès lors, la procédure s'embourbe. Les interrogatoires débutent le 4 mars, alors que Fouquet n'a pas connaissance des pièces saisies et qu'aucun acte de procédure ne lui a été notifié56. En mai, il est inculpé. Le 6 juillet, un arrêt du Conseil d'En Haut lui interdit de se pourvoir devant le Parlement, malgré sa qualité d'ancien procureur général. Il n'est pas confronté aux témoins avant le 18 juillet, et on ne lui accorde un conseil que le 7 septembre. Le 18 octobre marque une étape importante du procès : la cour rend un arrêt d'appointement, qui impose que la procédure se déroule désormais par écrit.
À partir de novembre 1662 commence une procédure écrite qui dure deux ans. Le président désigne une liste de rapporteurs. Mme de Maupéou, qui agit pour le compte de son fils, en récuse deux, comme elle en a le droit. Louis XIV réplique qu'il avait choisi précisément ces deux magistrats, et refuse toute modification. Le 10 décembre, Colbert fait remplacer Lamoignon, jugé trop favorable à l'accusé, et lui substitue Pierre Séguier, dont la haine pour l'ancien surintendant est notoire.
Enfin, le 3 mars 1663, la cour accepte de communiquer à Fouquet les pièces de son choix, et consent à n'utiliser que celles qu'il aurait étudiées. Pendant ce temps, plusieurs des complices de Fouquet ont été jugés et condamnés. Ainsi, Jean Hérault de Gourville est condamné à mort par contumace pour péculat et lèse-majesté. La marquise du Plessis-Bellière, probablement la meilleure amie de Fouquet, est emprisonnée.
Pendant ce temps, plusieurs amis du prisonnier publient des libelles en sa faveur. Pellisson, embastillé, publie en cachette un Discours au roi par un de ses fidèles sujets sur le procès de M. Fouquet dont Louis XIV prend connaissance. La Fontaine écrit et fait circuler, sans nom d'auteur, une Élégie aux Nymphes de Vaux, poème dédié à M. F. faisant appel à la clémence du roi, ce qui lui vaut la suppression de sa pension par Colbert. Colbert fait pourchasser les auteurs et les colporteurs de gazettes.
Le 14 novembre 1664, Fouquet est amené à la chambre de justice dans l'Arsenal, pour être interrogé sur la sellette. Il se défend avec acharnement au cours de cette procédure orale.
Les crimes reprochés
Les deux crimes reprochés sont le péculat, détournement de fonds publics par un comptable public et la lèse-majesté, passibles tous deux de la peine de mort.
Le péculat
Les chefs d'accusation peuvent être regroupés comme suit :
réception de pensions sur les fermes mises en adjudication ;
acquisition de droits sur le roi par l'utilisation de divers prête-noms ;
réassignation de vieux billets surannés ;
octroi d'avances à l'État en cumul avec une fonction d'ordonnateur des fonds, afin d'en tirer bénéfice.
L'accusation appuie son argumentation sur deux types de preuves : d'abord, l'opulence de Fouquet et ses nombreuses acquisitions, ensuite, le témoignage de plusieurs manieurs d'argent ainsi que les papiers trouvés durant les perquisitions.
Sur le premier point, l'accusation soutient la pauvreté de Fouquet avant d'entrer dans les affaires : à preuve, il a dû emprunter les 450 000 livres de sa charge de procureur général. Elle met également en avant les dépenses importantes engagées pour Vaux. Elle met ensuite en avant son immense fortune actuelle, sur la base des 38 comptes découverts chez son commis : entre février 1653 et la fin 1656, Fouquet a reçu 23 millions de livres. Sur ce montant, 3,3 millions proviennent de ses gages et appointements, le reste étant constitué de billets de l'Épargne, d'ordonnances de comptant et de sommes reçues des gens d'affaires60. Pour l'accusation, cela prouve que Fouquet confond les recettes destinées à l'État et ses revenus personnels.
De manière surprenante, et malgré les demandes de Fouquet, les magistrats ne dressent aucun état des biens de l'accusé, qui aurait permis de trancher la question. En effet, Fouquet de son côté nie sa prétendue pauvreté au moment d'entrer en charge comme sa richesse actuelle. Tout au long de la procédure, il se défend habilement, profitant d'une insuffisante culture financière du chancelier Séguier. Il se montre évasif sur les questions les plus épineuses pour lui, comme celle des droits d'octroi, et exploite les faiblesses de l'accusation comme la complexité du dossier.
Sur le fond, Daniel Dessert donne raison au surintendant. Il juge que les différents chiffres produits à charge sont divers, contradictoires, en un mot discutables et devant être maniés avec précaution. Pour lui, ils témoignent davantage de la circulation des effets et de l'argent entre les mains de Fouquet et de ses collaborateurs que de l'ampleur de la fortune de ce dernier, et donc des détournements qu'il aurait commis. Sur la base des actes notariés existants, des papiers du procès et des pièces relatives au règlement de la succession, il estime la fortune de Fouquet lors de son arrestation à 15,4 millions de livres d'actif et 15,5 millions de passif, soit un solde négatif de 89 000 livres. Fouquet n'aurait donc pas gagné à être surintendant. De plus, Fouquet n'aurait pas volé son argent au roi : toutes ses acquisitions seraient payées ou en cours de paiement avec l'argent de son couple. Il conclut que l'ensemble du dossier, pièces à conviction et interrogatoires, ne permet pas de prouver un quelconque manquement de Fouquet.
Jean-Christian Petitfils se montre plus réservé. Sa propre estimation de l'état des biens de Fouquet fait ressortir un actif de 18 millions de livres et un passif de 16,2 millions, soit un solde positif de 1,8 million. Il met également l'accent sur le compte de résultat et notamment l'importance des dépenses, ainsi que sur le désordre de la comptabilité de Fouquet. Si rien ne démontre qu'il ait puisé directement dans les caisses du Trésor … il est difficile d'admettre qu'au milieu de cette orgie de faux et de concussion, Fouquet soit resté blanc comme neige.Comme beaucoup de ses contemporains, Fouquet se serait donc bel et bien enrichi en se comportant comme banquier, financier et traitant vis-à-vis de l'État, alors même qu'il était en même temps ordonnateur des fonds.
La lèse-majesté
L'accusation, assez ténue, se fonde essentiellement sur le plan de défense de Saint-Mandé, lequel n'était pas connu au moment de l'arrestation : on reproche à Fouquet d'avoir fomenté un plan de rébellion en bonne et due forme en corrompant des gouverneurs de place et des officiers, en fortifiant certaines de ses terres, en constituant une flotte de vaisseaux armés en guerre et en tentant d'enrôler dans son parti la Compagnie de Jésus.
Au pied du mur, Fouquet invoque un mouvement de folie et dénie tout caractère sérieux au contenu du plan. Pour lui, son seul crime est de ne pas avoir brûlé ce papier aussitôt rédigé. Pourtant le plan de Saint Mandé est modifié par Fouquet plusieurs fois après sa rédaction initiale en 1657, 1658 et 1659. Ce qui rend peu crédible sa défense basée sur une folie due à la fièvre. Il conclut en retournant la politesse à son accusateur, Séguier, dont le comportement pendant la Fronde n'avait pas été exempt de tout reproche, et surtout dont le gendre, le duc de Sully, avait ouvert aux Espagnols les portes de Mantes dont il avait le gouvernement.
Si le plan de Saint Mandé n'est pas connu lors de l'arrestation, de fortes présomptions pèsent sur lui depuis la fortification de ses places fortes, en plus des liens qui l'unissent aux milieux dévots, plus proches des Rois Catholiques et de la maison des Habsbourg que des rois Très Chrétiens qui eux sont proches des pays protestants et du Grand Turc. Le procès est surtout un procès politique mené en sous main par les ministres de Louis XIV, notamment Colbert et Le Tellier.
Le jugement
Après trois ans d'audience pendant lesquels les avocats de Fouquet ont produit plus de dix volumes in-folio de mémoires en défense, la Chambre de justice reconnaît le 21 décembre 1664 Nicolas Fouquet coupable de péculat, crime pour lequel les ordonnances prévoient la mort. Mais sur les vingt-deux magistrats, seuls neuf opinèrent pour la mort, et Fouquet est condamné à la peine de confiscation de tous ses biens et de bannissement hors du royaume. Cette indulgence, toute relative, est peut-être une déception pour Colbert qui a consacré trois ans d'efforts à cette affaire. Le marquis de Sourches note dans ses Mémoires que la nouvelle est reçue avec une joie extrême même par les plus petites gens des boutiques.
Pour la plupart des contemporains, le verdict et la liesse populaire sont dues à un procès inique. L'abbé de Choisy note ainsi : la manière dont on s’y prit pour le perdre ramena les cœurs dans son parti. Il était coupable ; mais, à force de le poursuivre contre les formes, on irrita les juges en sa faveur, et son innocence prétendue fut un effet de la colère aveugle et précipitée de ses ennemis. De même, Voltaire, tout en reconnaissant que Fouquet a dissipé les finances de l'État et … en a usé comme des siennes propres, explique cette sentence clémente par l'irrégularité des procédures faites contre Fouquet, la longueur de son procès, l'acharnement odieux du chancelier Séguier contre lui, le temps qui éteint l'envie publique, et qui inspire la compassion pour les malheureux, enfin les sollicitations toujours plus vives en faveur d'un infortuné que les manœuvres pour le perdre ne sont pressantes.
Louis XIV change, en usant de son droit de grâce, la sentence en détention perpétuelle à Pignerol, place forte royale située dans les Alpes, le roi ne pouvant pas prendre le risque de laisser Fouquet, qui garde toute son influence, se réfugier dans une cour ennemie. Il disgracie également les juges, dont Olivier Le Fèvre d'Ormesson et Pierre de Roquesante, qui n'ont pas appliqué ses volontés dans cette affaire. Les riches amis financiers de Fouquet sont poursuivis par la même chambre de justice, qui siège jusqu'en 1669. Les nobles ne sont pas inquiétés.
La fin
Fouquet est emprisonné dans deux pièces du donjon de la forteresse de Pignerol commandée par Bénigne Dauvergne de Saint-Mars. On lui adjoint deux valets, Champagne et la Rivière, puis on les lui retire. Louis XIV libéralise ses conditions de détention à partir de 1677, il peut désormais se promener dans l'enceinte du donjon, recevoir la visite de sa famille ou de ses amis. Le roi envisage de libérer le vieil homme malade et usé lorsque Fouquet meurt officiellement à la forteresse le 23 mars 168074, peu après l'affaire des poisons qui touche une partie des amis de l'ancien surintendant dont par exemple la veuve du marquis d'Assérac. Il meurt sous les yeux de son fils, le comte de Vaux, qui se trouve là en visite. La mort est due à une crise d'apoplexie et fait suite à une longue maladie. Aucun acte de décès n'est établi, mais une ordonnance énumère les frais entraînés par la maladie puis les funérailles de Fouquet. Au reste, la famille ne conteste pas les circonstances du décès ; aucune autopsie n'est donc pratiquée. Le corps de Fouquet est déposé dans l'église Sainte-Claire de Pignerol, comme c'est la coutume pour les défunts anciens prisonniers de la forteresse, avant d'être transféré dans la chapelle Fouquet du couvent de la Visitation-Sainte-Marie, à Paris, actuel temple du Marais, rue Saint-Antoine.
Cependant, plusieurs sources jettent le trouble sur ce récit des événements. Gourville affirme dans ses Mémoires que Fouquet a été libéré peu de temps avant de mourir, thèse confirmée, d'après Voltaire dans son Siècle de Louis XIV, par la comtesse de Vaux, sa belle-fille. Il faut noter cependant que le premier écrit des années après les événements et que la seconde a épousé le comte de Vaux en 1687, après la mort de Fouquet.
Robert Challes rapporte dans ses Mémoires une théorie que lui aurait confiée le premier commis de Colbert : relâché à la suite de l'intercession de la dauphine, Fouquet serait mort à Chalon-sur-Saône, possiblement d'une indigestion. Il est le premier à mentionner un éventuel empoisonnement. Malgré son niveau de détail, la théorie telle que rapportée par Challes est peu vraisemblable.
Enfin, il faut mentionner un ajout autographe de Louvois à la fin d'une lettre adressée à Saint-Mars, geôlier de Fouquet : Mandez-moi comment il est possible que le nommé Eustache ait fait ce que vous m'avez envoyé, et où il a pris les drogues nécessaires pour le faire, ne pouvant croire que vous les lui ayez fournies. Le dénommé Eustache est Eustache Dauger, un autre prisonnier de Pignerol, autrement plus célèbre que Fouquet puisque c'est le nom que donne Louvois au masque de fer dans sa correspondance avec Saint-Mars.
Le texte sibyllin de Louvois laisse penser à un empoisonnement mais, si Dauger a bien eu la possibilité matérielle de le faire, on ne lui reconnaît aucun mobile. Petitfils suppose que les drogues dont il est question ont servi à élaborer de l'encre sympathique et conclut que Fouquet est mort de mort naturelle. Dessert, tout en jugeant plausible l'empoisonnement, souligne également l'absence de mobile, et écarte comme matériellement impossible l'idée que Colbert puisse en être à l'origine.
Sa haute position sociale au moment de son arrestation, et donc les nombreux secrets qu'il était censé connaître, l'acharnement du roi, qui brisa la sentence des juges, font que certains auteurs, comme Paul Lacroix, ont mêlé le sort de Fouquet à celui de l'Homme au masque de fer, thèse sans fondements historiques. Il reste que dans ses mémoires, l'abbé Dubois, confident du Régent, fait état d'un entretien de ce dernier avec Louis XIV, peu avant sa mort, qui lui aurait dit que le Masque de fer était Fouquet, laissant entendre qu'il aurait soupçonné la reine Anne d'Autriche ou Marie-Thérèse ? d'avoir eu une liaison avec lui.
Généalogie
De son premier mariage, avec Louise Fourché de Quéhillac, Nicolas Fouquet eut une fille, Marie, qu'il maria avec Armand de Béthune, marquis de Charost, moyennant un apport dotal de 600 000 livres de la part de l'épouse. Ce mariage à la fin des années 1650 confirme l'ascension sociale de la famille.
Le second mariage permit d'assurer une descendance masculine. Nicolas Fouquet eut 5 enfants de Marie-Madeleine de Castille :
François 1652-1656 qui mourut très jeune ;
Louis Nicolas, comte de Vaux mort en 170 qui se maria avec Jeanne-Marie Guyon, fille de parlementaire, sans descendance ;
Marie-Madeleine 1656-1720 qui épousa Emmanuel Balaguier de Crussol d'Uzès, marquis de Montsales ;
Charles Armand 1657-1734, est entré à l'Oratoire ;
Louis, marquis de Belle-Isle 1661-1738 qui épousa Catherine-Agnès de Lévis, fille du marquis de Charlus.
Seul le marquis de Belle-Isle eut une descendance. Le mariage de sentiments qu'il obtint avec la fille du marquis de Charlus contre le gré de la famille apparaît comme une véritable chance étant donnée la réputation des Fouquet après la condamnation de Nicolas. Les Lévis sont en effet une famille de noblesse de race fort ancienne.
De ce mariage naquit notamment Charles Louis Auguste Fouquet 1684-1761 et Louis Charles Armand 1693-1747. Ces deux fils, par leur carrière dans les armes, nouveauté chez les Fouquet ! permirent de redorer le blason du lignage, et d'acquérir les plus grands honneurs jamais reçus : Charles Louis Auguste devint entre autres Gouverneur des Trois-Evêchés, places fortes de première importance aux confins du Saint-Empire et fut nommé duc et pair sous Louis XV, en récompense de ses loyaux services.
naissance de la branche des Fouquet-Bouchefollière
Nicolas Fouquet dans les œuvres de fiction
Alexandre Dumas fait de Nicolas Fouquet un personnage central de son roman Le Vicomte de Bragelonne. Dumas dépeint Fouquet avec sympathie et défend la thèse de son innocence. C'est en partie pour sauver son ami Fouquet mais surtout pour s'assurer la maîtrise du royaume qu'Aramis fait enlever et emprisonner Louis XIV et le remplace par son jumeau caché. Fouquet refuse cependant de participer au complot et délivre le véritable roi ; le jumeau est renvoyé en prison, et devient le masque de fer. Louis XIV se montre cependant ingrat : toujours dressé contre son surintendant, et ne lui pardonnant pas de l'avoir vu emprisonné et humilié, il ordonne tout de même l'arrestation de Fouquet.
En 1910, le premier film qui lui est consacré s'intitule Fouquet, l'homme au masque de fer. Le film muet réalisé par Camille de Morlhon a pour sujet la thématique du Masque de fer, laquelle reviendra de façon constante et récurrente dans sa filmographie tout le long du xxe siècle83. Cette thématique n'est pas étrangère aux lignes écrites par Alexandre Dumas.
En 1939, L'Homme au masque de fer, film américain de James Whale, avec Joseph Schildkraut dans le rôle du surintendant, est une adaptation très libre du Vicomte de Bragelonne.
En 1977, Patrick McGoohan, acteur de la série-culte Le Prisonnier, tient le rôle de Nicolas Fouquet dans la série télévisée britannique : L'homme au masque de fer The Man in the Iron Mask .
Publié en 2002, Imprimatur, de Rita Monaldi et Francesco Sorti, propose une autre alternative de fiction, avec l'évasion de Nicolas Fouquet de Pignerol et la fin de sa vie à Rome, base de l'intrigue du livre.
Publié en 2010, Le ministère des ombres de Pierre Lepère, évoque la vie à Vaux-Le-Vicomte - Colbert se meurt d'amour pour l'épouse de Fouquet - autour du personnage le plus puissant du royaume, la fatidique date du 17 août 1661... jusqu'à son emprisonnement.
Publié la même année, Althéa ou la colère d'un roi de Karin Hann. Althéa est la filleule du surintendant. Le récit est fidèle aux faits historiques. Par contre, l'auteur prend le parti de romancer l'épisode du Masque de Fer, imaginant que Fouquet avait eu connaissance de ce secret d'État, ce qui incita Louis XIV à se débarrasser du surintendant.
Le téléfilm en deux parties Le Roi, l'Écureuil et la Couleuvre de Laurent Heynemann diffusé en mars 2011 est centré sur la rivalité entre Fouquet l'écureuil Lorànt Deutsch et Colbert la couleuvre Thierry Frémont pour obtenir la faveur de Louis XIV Davy Sardou. S'il penche du côté du gentil Fouquet jalousé par un Colbert haineux et revanchard jusqu'au bout, il n'est pas exempt d'erreurs historiques plus ou moins légères le second mariage n'est pas évoqué, les précédentes visites royales à Vaux-le-Vicomte avant la grande soirée non plus et d'anachronismes comme la référence au mythe de Don Juan dans les années 1650 alors que la pièce de Molière qui popularisera le personnage n'est créée qu'en 1665.
Liens
http://youtu.be/CDfjWhOAL84 Louis XIV et Nicolas Fouquet 1
http://youtu.be/5dWZKk2aiss Louis XIV et Nicolas Fouquet 2
   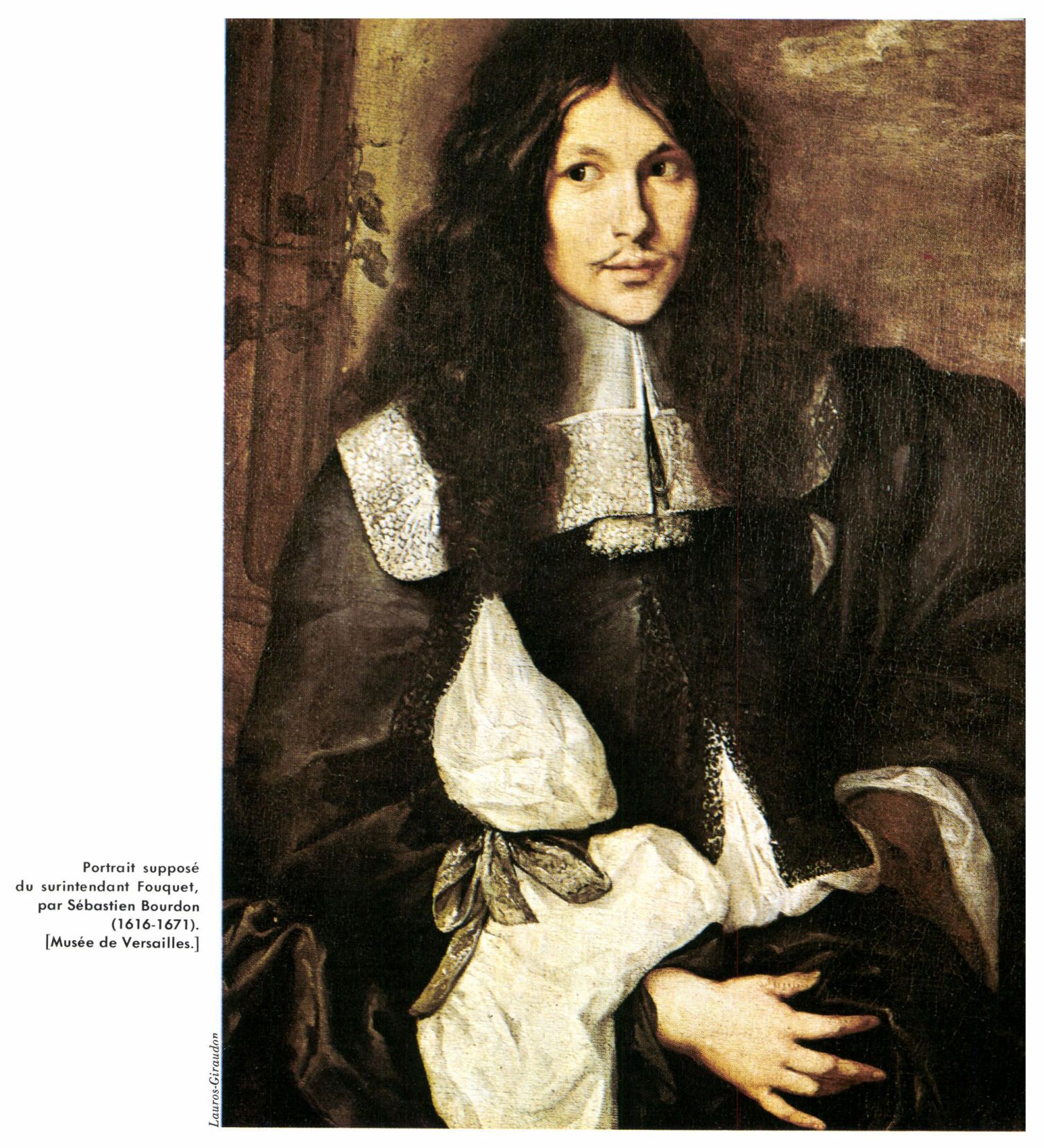         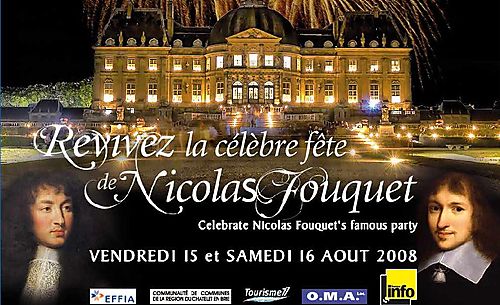 
Posté le : 20/12/2014 22:21
Edité par Loriane sur 21-12-2014 23:49:10
|
|
|
|
|
Joseph Staline 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 21 décembre 1879 naît à Gori Joseph Staline
Iossif Vissarionovitch Djougachvili, en russe : Иосиф Виссарионович Джугашвилиprononciation ; en géorgien : იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი, Iosseb Bessarionis dze Djoughachvili, connu sous le nom de Joseph Staline Иосиф Сталин, également surnommé Le Vojd ou Le Petit père des peuples, né à Gori le 18 décembre 1878 — officiellement le 21 décembre 18791 — et mort à 74 ans, à Moscou le 5 mars 1953, est un révolutionnaire communiste et homme d'État soviétique d'origine géorgienne. Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Russie bolchévik du 3 avril 1922 – décembre 1925, puis Secrétaire général du Comité central du Parti communiste pansoviétique, bolchévik de décembre 1925 – 16 octobre 1952. Président de la présidence collective 1922-1938
Président du Conseil de Vladimir Ilitch Lénine 1922-1924 avecAlexeï Rykov 1924-1930 et Viatcheslav Molotov, 1930-1941suivi par Nikita Khrouchtchev en septembre 1953
Président du Conseil des commissaires du Peuple d'URSS du 6 mai 1941 – 15 mars 1946 soit pendant 4 ans, 10 mois et 9 jours, son prédécesseur est Viatcheslav Molotov
Président du Conseil des ministres d'URSS, son surnom est Le Vojd : Le Petit père des peuples. il est de nationalité Géorgienne de 1878-1917, il sera Russe de 1917-1922, Soviétique de 1922-1953. Il appartient au parti politique POSDR de 1898-1903, POSDRb de 1903-1918, PCR de 1918-1925, PCP dez 1925-1952, PCUS de 1952-1953
Son père était Vissarion Djougachvili, sa mère Ekaterina Gueladzé, il épouse en première noce Ekaterina Svanidze 1906-1907, puis en seconde noces Nadejda Allilouïeva 1919-1932. Il a 3 enfants : Iakov Djougachvili, Vassili Djougachvili ety Svetlana Allilouïeva. Diplômé du Séminaire de Tiflis, il est malgré tout athée. Il gardera sa résidence au Kremlin
En Bref
De tous les grands hommes politiques du XXe siècle, Staline est sans doute celui qui a pesé le plus longtemps sur les affaires mondiales et transformé le plus en profondeur son pays. Churchill et Lénine n'ont exercé une influence majeure que cinq ans durant, Roosevelt et Hitler douze ans, tandis que Staline a, pendant un quart de siècle, influé directement sur le destin non seulement de près de deux cents millions de Soviétiques, mais aussi sur celui d'un nombre presque équivalent d'Européens de la partie centrale et orientale du continent. Rarement homme politique a suscité autant de haine et d'adoration. Dès les années 1930, Staline était devenu un symbole honni pour tous ceux qui combattaient le communisme, qu'ils fussent ses concurrents les plus proches – les fascistes et les nazis – ou, au contraire, qu'ils aient perçu dans l'homme d'acier l'incarnation d'un nouvel antihumanisme. Mais Staline fit aussi l'objet d'un formidable culte, d'une passion à la fois révolutionnaire et messianique. Si l'adoration était réservée aux « croyants » communistes, l'admiration pour le « maréchal Staline » était largement répandue parmi les non-communistes ; elle reposait sur la reconnaissance au vainqueur de Stalingrad, qui avait largement contribué à la victoire des Alliés sur la barbarie nazie.
Remarquable stratège et tacticien de la politique, Staline sut parfaitement mettre en adéquation ses moyens avec ses objectifs : s'imposer, dans les cinq ans qui suivirent la disparition de Lénine, comme le khoziain, patron tout-puissant du Parti communiste ; faire entrer la société soviétique, au prix de terribles sacrifices, dans l'ère industrielle ; construire ce qu'il considérait être le socialisme ; accroître la puissance industrielle et militaire de l'U.R.S.S. ; étendre la sphère d'influence soviétique à la moitié de l'Europe. Pour transformer le pays, le faire sortir de son « arriération séculaire », Staline n'hésita pas à mobiliser en permanence la société soviétique contre les « ennemis intérieurs, à engager une véritable guerre contre le monde paysan, profondément réfractaire à la collectivisation des campagnes, et à lancer de vastes opérations meurtrières d'ingénierie sociale visant à éradiquer ceux qu'il qualifiait d'éléments étrangers et socialement nuisibles : koulaks, gens du passé, ce terme désignait toutes les élites, administratives, économiques et politiques de l'ancien régime, membres du clergé, marginaux et autres asociaux furent déportés, envoyés en camp de travail ou exécutés en masse. La société soviétique paya un tribut particulièrement lourd au modèle stalinien de transformation du pays : entre 1930 et 1953, plus d'un million de Soviétiques furent condamnés à mort comme contre-révolutionnaires par une juridiction d'exception ; sept millions de Soviétiques furent déportés, plus de quinze millions firent l'expérience des camps de travail du Goulag, six ou sept millions moururent de faim au cours de deux grandes famines 1932-1933 ; 1946-1947.
Comme l'ont confirmé les archives, déclassifiées depuis 1991, le dictateur joua un rôle décisif dans l'élaboration et la mise en œuvre des grandes options politiques, tant sur le plan intérieur collectivisation forcée des campagnes, industrialisation accélérée, opérations de purges et de terreur) que sur le plan international virage antifasciste et soutien aux Fronts populaires dans les pays de démocratie parlementaire à partir de 1934-1935 ; pacte germano-soviétique en août 1939 ; définition de zones d'influence en Europe en 1944-1945. Les documents aujourd'hui accessibles permettent de mieux identifier la marque personnelle du dictateur dans la gestion de l'U.R.S.S. et d'analyser la manière dont il exerça le pouvoir.
Secrétaire général du Parti communiste soviétique à partir de 1922, il dirige l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) à partir de la fin des années 1920 jusqu'à sa mort. Il établit un régime de dictature personnelle : les historiens lui attribuent, à des degrés divers, la responsabilité de la mort de trois à plus de vingt millions de personnes.
Surnommé Sosso diminutif de Iossef ou de Iosseb pendant son enfance, il se fait ensuite appeler Koba d'après un héros populaire géorgien dans ses premières années de militantisme clandestin et par ses amis proches. Il utilise ensuite le pseudonyme de Staline, formé sur le mot russe сталь (stal), qui signifie acier.
Par un jeu patient d'intrigues souterraines et d'alliances successives avec les diverses factions du parti unique bolchevik, et en s'appuyant sur la toute-puissante police politique et sur la bureaucratisation croissante du régime, il impose progressivement un pouvoir personnel absolu et transforme l'URSS en un régime de type totalitaire dont le culte obligatoire rendu à sa propre personne est un des traits les plus marquants. Il fait nationaliser intégralement les terres, et industrialise l'Union soviétique à marche forcée par des plans quinquennaux, au prix d'un lourd coût humain et social. Son long règne est marqué par un régime de terreur et de délation paroxystique et par la mise à mort ou l'envoi aux camps de travail du Goulag de millions de personnes, notamment au cours de la collectivisation des campagnes et des Grandes Purges de 1937. Il pratique aussi bien des déplacements de population massifs, dont la déportation intégrale d'une quinzaine de minorités nationales, que la sédentarisation forcée non moins désastreuse de nomades d'Asie centrale. Il nie aussi l'existence des famines meurtrières de 1932-1933, Holodomor et de 1946-1947 après les avoir en partie provoquées par sa politique brutale. Le secret et la propagande systématiquement entretenus autour de ses actes font du travestissement de la réalité et de la réécriture du passé une caractéristique permanente de son pouvoir absolu.
Son souvenir est aussi associé à la victoire militaire des Alliés sur l'Allemagne nazie dont l'Union soviétique est un des principaux artisans, après la rupture en juin 1941 du pacte de non-agression mutuelle conclu entre les deux dictatures, pacte dont la signature en août 1939 a été le prélude au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit, après avoir mis l'URSS au bord du gouffre, apporte ensuite à Staline un très grand prestige dans le monde entier, et permet au successeur de Lénine d'affirmer son emprise sur un empire s'étendant de la frontière occidentale de la RDA à l'océan Pacifique.
Joseph Staline est également l'auteur de textes exposant ses conceptions du marxisme et du léninisme, qui contribuent à fixer pour des décennies, au sein du mouvement communiste, l'orthodoxie marxiste-léniniste. Sa pratique politique et ses conceptions idéologiques sont désignées sous le terme de stalinisme.
Après la mort de Staline, ces pratiques sont dénoncées par Nikita Khrouchtchev au cours du XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique de 1956 : la déstalinisation et la relative détente qui s'ensuivent n'entraînent cependant pas une démocratisation en profondeur du bloc de l'Est. Ce n'est qu'à l'époque de la perestroïka mise en place par Mikhaïl Gorbatchev que les crimes de Staline peuvent être dénoncés en URSS dans toute leur ampleur.
Jeunesse et formation
Iossif Vissarionovitch Djougachvili est né dans la ville géorgienne de Gori, alors dans le gouvernement de Tiflis (Empire russe), le 18 décembre 1878 — officiellement le 21 décembre 1879 —, troisième enfant et seul survivant de sa fratrie.
Le père de Staline, Vissarion Djougachvili, était un cordonnier gagnant bien sa vie, mais qui devint rapidement alcoolique. Il était originaire d'un village du nord de la Géorgie, Djougha (d'où son nom) ; on dit qu'il avait des origines ossètes. Sa mère, Ekaterina Gavrilovna Gueladzé, était une couturière d'Ossétie. Fervente orthodoxe, abandonnée par son mari, elle pousse son fils vers la prêtrise et finance difficilement ses études.
Après avoir brillamment réussi ses examens, Iossif entre en 1894 au séminaire de Tiflis et y reste jusqu'à vingt ans. Il y suit un enseignement secondaire général avec une forte connotation religieuse. Surnommée le « Sac de pierre », l'école a sinistre réputation8. Rapidement, le jeune Djougachvili devient athée et commence à se montrer rebelle à l'autorité du séminaire. Il reçoit de nombreuses punitions pour lecture de livres interdits, entre autres, Les Travailleurs de la Mer de Victor Hugo et en août 1898 s'inscrit à la branche locale du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR). Malgré les faveurs que lui accorde le recteur du séminaire, il en est expulsé en mai 1899, officiellement pour absence à l'examen de lectures bibliques. « Je fus renvoyé pour propagande marxiste », se vanta ensuite l'ex-séminariste.
Révolution et clandestinité
Iossif Djougachvili commence alors sa carrière de révolutionnaire sous le surnom de Koba. Il se fait arrêter à de nombreuses reprises. En 1907, il est impliqué dans des braquages de banques sanglants servant à financer le Parti, comme le hold-up commis à Tbilissi, en juin, qui rapporte 250 000 ou 350 000 roubles.
Il est déporté plusieurs fois en Sibérie et s'évade à chaque fois. Il s'évade notamment en 1904 et adhère alors à la fraction bolchevique du P.O.S.D.R.. C'est à cette époque qu'il rencontre pour la première fois Lénine. Il fait un récit élogieux de cette rencontre en 1924, une semaine après la mort de ce dernier :
Alexandre Martynov à Stockholm :
Lorsque je le comparais aux autres dirigeants de notre Parti, il me semble toujours que les compagnons de lutte de Lénine – Plekhanov, Martov, Axelrod et d’autres encore – étaient moins grands que lui d’une tête ; que Lénine comparé à eux, n’était pas simplement un des dirigeants, mais un dirigeant de type supérieur, un aigle des montagnes, sans peur dans la lutte et menant hardiment le Parti en avant, dans les chemins inexplorés du mouvement révolutionnaire russe …
En 1911, Lénine parle de lui comme du « merveilleux Géorgien », mais en 1915, dans une lettre à Maxime Gorki, il a oublié son nom.
L'accès au pouvoir suprême (1917-1929)
Staline en exil, 1915 Le communisme de guerre (1917-1922)
Après la chute du tsarisme et l'abdication de Nicolas II lors de la Révolution de février 1917, Staline, à peine de retour d'une longue déportation en Sibérie, prend en main la direction du Parti à Pétrograd. Il prône alors la politique du « soutien critique » au gouvernement provisoire réformiste bourgeois d'Alexandre Kerensky. Néanmoins, dès le retour d'exil de Lénine, il se range très rapidement aux Thèses d'avril. Celles-ci avancent l'idée que la tâche des bolcheviks est de préparer la révolution socialiste, seule à même, selon Lénine, de donner le pouvoir au peuple et d'arrêter la guerre. À l'été 1917, il est membre fondateur du Politburo.
Exécutant dévoué, Staline ne joue aucun rôle de premier plan dans la Révolution d'Octobre mais il a l'habileté, comme toujours depuis qu'il est membre du Parti, de s'aligner systématiquement sur les positions de Lénine. Cela lui permettra bien plus tard de reprocher comme des crimes à ses camarades la moindre divergence antérieure avec le défunt Lénine.
Staline, commissaire bolchevique à Tsaritsyne à l’été 1918, au début de la guerre civile russe.
Staline, d'origine géorgienne, est nommé commissaire aux Nationalités dans le Conseil des commissaires du Peuple issu de la révolution.
Pendant la guerre civile russe, il est commissaire bolchevique à Tsaritsyne (future Stalingrad). Il s'y fait remarquer par sa propension à attribuer à des « saboteurs » tous les problèmes rencontrés, par sa méfiance viscérale des « experts » et autres « spécialistes bourgeois » recyclés par le nouveau régime, méfiance qui ne le quittera jamais, et par son absence complète de sentiment lorsqu'il prend des mesures radicales et ordonne des exécutions en nombre. Il s'y heurte déjà à Léon Trotski, chef suprême de l'Armée rouge.
C'est aussi à Tsaritsyne qu'il se forge un clan de fidèles qui l'aideront vers la marche au pouvoir : les chefs de la cavalerie rouge Kliment Vorochilov et Semion Boudienny en premier lieu, bientôt rejoints par des compatriotes du Caucase (Grigory Ordjonikidze) puis des hommes unis par la détestation de Trotski. C'est aussi pendant la guerre civile que Staline noue des relations étroites avec la police politique, la redoutable Tcheka, et son fondateur et chef suprême Félix Dzerjinski. Cette alliance avec la police, qui sera la clé du futur régime stalinien, ira en se renforçant d'année en année, au point que Staline confiera aux tchékistes la gestion et l'éducation de sa propre famille.
En 1920, une désobéissance de Staline aux ordres du général Toukhatchevski est une des causes importantes de l'échec de la bataille de Varsovie et de la défaite dans la guerre russo-polonaise.
Bureaucrate laborieux et discret, Staline gravit silencieusement les échelons et devient Secrétaire général du parti le 3 avril 1922, fonction qu'il transforme rapidement en poste le plus important du pays.
La même année, avec son compatriote Grigory Ordjonikidze, Staline planifie l'invasion de leur pays d'origine, la Géorgie, dont le gouvernement menchevik était régulièrement élu et l'indépendance internationalement reconnue, y compris par Moscou. Les violences qui accompagnent ce rattachement forcé à l'Union soviétique provoquent la colère impuissante de Lénine, déjà malade.
Mort de Lénine et éviction de Trotski
Pour parvenir au pouvoir suprême, Staline s'appuie sur la bureaucratie naissante, sur la police, sur son clan de fidèles et sur un jeu habile d'alliances successives avec les diverses factions au sein du Parti. Pendant la guerre civile, Lénine apprécie Staline comme un exécutant efficace et discipliné, qui lui a assuré que « sa main ne tremblerait pas », mais leurs relations politiques et personnelles se dégradent sensiblement en 1922-1923.
Avant la mort de Lénine en janvier 1924, Staline exerce déjà une autorité considérable. Sa fonction, apparemment technique, de Secrétaire général du Comité central, sa qualité de membre du Politburo et de l'Orgburo, lui permettent de maîtriser un nombre croissant de leviers de pouvoirs, et notamment celui de nomination des cadres du Parti : il peut ainsi placer ses fidèles aux postes-clé de l'appareil. Personnage en apparence terne et peu porté aux discours théoriques brillants, c'est un génie de l'intrigue souterraine. Il joue pendant des années au modéré, et laisse aux divers groupes le soin de s'invectiver et de se discréditer les uns les autres, tout en tissant sa toile. Maints vétérans du Parti, mais plus encore les nouveaux bureaucrates d'origine plébéienne qu'il promeut en nombre se reconnaissent facilement en ce personnage d'apparence bonhomme, bon vulgarisateur, qui se tait à la plupart des réunions et fume tranquillement sa pipe entre deux paroles apaisantes. Il leur convient mieux qu'un Trotski solitaire et trop brillant, qui les critique âprement, et qui n'a pas su se tisser de réseaux dans un Parti qu'il n'a rejoint qu'en 1917. Cependant, Lénine redoute le clivage entre Staline et Trotski, qui pourrait mettre à mal le Parti. Après la mort de Lénine, Staline empêchera la publication du « testament de Lénine », dans le post-scriptum celui-ci affirmait son hostilité à son égard :
« Staline est trop brutal, et ce défaut parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, communistes, ne l’est pas dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d’étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place une autre personne qui n’aurait en toutes choses sur le camarade Staline qu’un seul avantage, celui d’être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d’humeur moins capricieuse, etc… »
En 1924-1925, allié de Kamenev et de Zinoviev, Staline évince Trotski du gouvernement.
Éviction des derniers opposants
En 1926, allié à la droite de Boukharine, il fait écarter du Politburo et du Komintern Trotski, Zinoviev et Kamenev, réconciliés entre-temps.
Ayant battu l'Opposition de gauche, il se retourne en 1928-1929 contre l'opposition de droite de Boukharine et Rykov, chassés respectivement de la tête du Komintern et du gouvernement. En 1929, Staline fait exiler Trotski d'URSS et achève d'installer ses hommes à tous les postes-clés. La célébration en grande pompe de ses 50 ans, le 21 décembre 1929, marque aussi les débuts du culte autour de sa personnalité.
La prise de pouvoir et le Grand Tournant
Staline ayant pris la succession de Lénine, il abandonne peu à peu la direction collégiale pour progressivement imposer, en s'appuyant sur la bureaucratie née lors de la guerre civile, un régime totalitaire. Le pouvoir oligarchique absolu est mis en place progressivement23, processus achevé à la fin des années 1930.
Peu porté à l'internationalisme inhérent au communisme, Staline désigne sa politique sous le nom de « marxisme-léninisme » et de « socialisme dans un seul pays ». Presque jamais sorti de Russie, méprisant envers le Komintern, la boutique, il ne croit pas à une révolution mondiale qui n'en finit pas de se faire attendre et veut compter sur les seules forces de l'Union Soviétique. Il ne croit plus non plus à une NEP qui n'en finit pas d'agacer les planificateurs, tant à cause de ses externalités (la « crise des ciseaux ») que de son caractère non orthodoxe au regard de l'idéologie marxiste. Hanté comme tous les bolcheviks par la possibilité d'une prochaine confrontation avec les pays capitalistes, il veut accélérer à tout prix la modernisation industrielle pour s'y préparer. C'est le sens de son fameux discours au XVIe congrès du Parti (juin 1930) où il martèle que « chaque fois que la Russie a été en retard, nous avons été battus ». D'où, à partir de fin 1928, la priorité absolue que Staline accorde à l'accumulation du capital par pressurisation de la paysannerie (jusque-là ménagée par la NEP), au développement « à toute vapeur » des moyens de production et de l'industrie lourde.
De 1929 à 1933, Staline met en place la « collectivisation » des terres. Il livre en fait ce qui est peut être considéré comme la dernière guerre paysanne de l'histoire européenne. En 1934, l'objectif est atteint, mais à un prix exorbitant : la moitié du cheptel abattu sur place par les paysans, les riches terres à blé d'Ukraine et d'autres régions ravagées par la famine de 1932-1933 entre quatre et dix millions de morts selon les estimations que Staline n'a rien fait pour empêcher même en admettant qu'il ne l'a pas délibérément provoquée, d'innombrables violences, morts ou destructions, fuite anarchique de 25 millions de campagnards vers des villes vite surpeuplées, plus de deux millions de prétendus koulaks (paysans supposés « riches ») déportés par familles entières en Sibérie et abandonnés sur place à leur sort... Le système des kolkhozes et des sovkhozes permet à l'État d'acheter à vil prix les récoltes et de financer l'industrialisation. Mais devant la résistance passive des paysans (sous-productivité systématique), Staline leur concède un lopin privé de terre en 1935 : à la fin de la décennie, ces derniers produisent 25 % des récoltes sur 3 % des terres, la majorité des fruits et légumes d'URSS ainsi que 72 % du lait et de la viande. La Russie, premier exportateur de céréales du monde sous les tsars, devient définitivement pays importateur. À Winston Churchill, Staline dira que la collectivisation représenta pour lui une épreuve « pire que la guerre ». Selon Anne Applebaum, si Staline a brisé la continuité de l'histoire russe, c'est bien dans les campagnes.
À partir de 1929, l'importance du GOSPLAN (Государственный плановый комитет, créé par Lénine — décret du Conseil des Commissaires du Peuple en date du 21 février 1921) s’accroît en raison de l'organisation de la planification économique sur une base désormais quinquennale. Cet organisme d'État rigide est chargé de la mise en place et de l'exécution de cette planification impérative et très ambitieuse. Le premier plan quinquennal (1929-1933) fait de l'URSS de Staline un pays productiviste vivant dans l'obsession d'accomplir et de dépasser des normes de production toujours rehaussées. Staline rétablit le salaire aux pièces et le livret ouvrier, allonge la journée de travail, encourage la naissance d'une nouvelle aristocratie ouvrière en patronnant le mouvement stakhanoviste (1935) et fait punir d'envoi au Goulag tout retard répété de plus de 10 minutes. En quelques années, le pays change radicalement d'aspect et se couvre de grands travaux en partie réalisés par la main-d'œuvre servile du Goulag : métro de Moscou, villes nouvelles, canaux, barrages, énormes usines… Mais le prix est tout autant démesuré : gouffre financier, inflation, gaspillages, travaux bâclés à l'origine du « mal-développement » dont l'URSS périra en 1991. Le sacrifice délibéré des industries de consommation et la pression exercée sur la classe ouvrière font que sous le Premier Plan, le niveau de vie des ouvriers soviétiques baisse de 40 %30.
À partir de 1934, un tournant réactionnaire est également effectué dans le domaine des mœurs : culte de la « famille socialiste », retour de l'interdiction de l'avortement et de la répression de l'homosexualité (alors que la Révolution avait apporté dans ces domaines une libéralisation tant par rapport à la situation antérieure que par rapport aux pays occidentaux. Staline restaure aussi le titre de maréchal, revient au nationalisme grand-russe, à l'académisme dans l'art, à la libre consommation de la vodka. Enfin, en 1935, Staline ramène l'âge limite pour la condamnation à mort à 12 ans.
Certains marxistes se réclamant de Lénine s'opposent alors au « marxisme-léninisme » de Staline : les trotskistes dénoncent la dictature à l'intérieur du Parti, les bordiguistes dénoncent la politique économique de Staline comme une forme de capitalisme d'État (analyse partagée par les « décistes » du groupe Sapronov). Des organisations communistes anti-staliniennes se créent à partir des années 1920. L’Opposition communiste internationale est créée en 1930.
Au XVIIe Congrès du PCUS, dit Congrès des Vainqueurs (février 1934), les pires difficultés du Grand Tournant semblent passées. Le nom de Staline est acclamé et cité plusieurs dizaines de fois dans chaque discours. Lui-même multiplie les signes d'apaisement envers les anciens opposants et de libéralisation pour la société soviétique. Mais il mesure aussi la persistance sourde des critiques à son encontre : il n'est réélu au Comité Central qu'en dernier de la liste, son nom étant rayé plus d'une centaine de fois. Le but des Grandes Purges sera notamment d'anéantir les dernières potentialités de résistance au sein du Parti et de la population. De 1936 à 1938, les Procès de Moscou sont montés pour éliminer les vieux bolcheviks opposants ou s’étant opposés à Staline. Trostski sera par ailleurs assassiné par Ramon Mercader en 1940 au Mexique.
Les Grandes Purges, refondation définitive du pouvoir de Staline
En décembre 1934, Sergueï Kirov, chef du Parti à Léningrad, est assassiné. Or Kirov était alors le plus populaire des dirigeants soviétiques et, élu avec le plus grand nombre de voix au Comité central, constituait dès lors une alternative potentielle au poste de Secrétaire général occupé par Staline (le plus mal élu de tous les candidats). Par cette élimination, ce dernier faisait d'une pierre deux coups: il éliminait son concurrent le plus plausible et pouvait se servir de la réprobation publique pour monter une campagne de purges dans le Parti et à l'extérieur dans les années suivantes. La grande terreur stalinienne commence le soir même alors qu'il fait promulguer un décret suspendant toutes les garanties de droit et rendant sans appel les sentences de mort prononcées par les juridictions spéciales du NKVD. Il débarque en personne à Leningrad et en fait déporter des milliers d'habitants.
En août 1936, le premier des trois procès de Moscou engage la liquidation physique de la vieille garde bolchevique. Staline se débarrasse définitivement de ses anciens rivaux des années 1920, déjà vaincus politiquement depuis longtemps.
Au-delà, il entreprend de remplacer ceux qui l'ont soutenu et aidé dans les années 1920-1930 par une nouvelle génération de cadres. Les jeunes promus de la « génération de 1937 » (Khrouchtchev, Beria, Malenkov, Jdanov, Brejnev, etc.) n'ont connu que Staline et lui doivent tout. Ils lui vouent un culte sans réserve, là où la précédente génération voyait davantage en Staline son patron ou un primus inter pares qu'un dieu vivant, et n'hésitait pas à le critiquer parfois avec loyauté mais franchise. Entre 1937 et 1939, Staline planifie l'élimination de la moitié du Politburo, des trois quarts des membres du Parti ayant adhéré entre 1920 et 1935, etc. La Terreur n'épargne aucun organisme : des coupes claires frappent les divers ministères, Gosplan, Komintern, Armée rouge et même à terme l'encadrement du Goulag et les policiers du NKVD.
Nikolaï Iejov, chef suprême du NKVD est tué en 1940. Il est alors effacé des archives par la censure.
Les Grandes Purges permettent également à Staline d'éliminer radicalement tous les éléments socialement suspects et tous les mécontents suscités par sa politique. Alors que les tensions diplomatiques s'accumulent en Europe depuis l'avènement d'Adolf Hitler, et que le déclenchement de la guerre d'Espagne en juillet 1936 fait craindre l'irruption d'un nouveau conflit général, Staline entend éliminer tout ce qui pourrait constituer une « cinquième colonne » de l'ennemi en cas d'invasion. Une série d'opérations frappe par centaines de milliers les dékoulakisés appauvris par la collectivisation, les vagabonds et marginaux engendrés par cette dernière, les anciens membres des classes dirigeantes et leurs enfants, tous les individus entretenant ou ayant entretenu des relations avec l'étranger (corps diplomatique, anciens combattants d'Espagne, agents du Komintern, et, ainsi que le montre Robert Conquest, jusqu'aux espérantistes, aux philatélistes et aux astronutes.
À plus court terme, Staline fournit aussi à la population des boucs émissaires aux difficultés du quotidien, en rejetant tout le mal sur une pléthore de « saboteurs ». Il règle ses comptes avec les techniciens et les spécialistes compétents, qui ont souvent osé contredire ses directives et ses objectifs irréalistes et dont il se méfie depuis toujours en raison de leur faible présence au Parti ; il les remplace par une génération de nouveaux spécialistes issus des couches populaires et qui, formés sous le Ier Plan, n'ont connu que la révolution et son régime. Il brise aussi les réseaux clientélistes et les fiefs géographiques ou ministériels que se sont constitués les membres du gouvernement et du Politburo, ou bien, à tous les échelons, les responsables du Parti et les chefs de Goulag. Il entretient plus largement une atmosphère de suspicion généralisée qui brise les solidarités amicales, familiales ou professionnelles.
Pareillement, Staline considère que les minorités nationales frontalières sont par définition suspectes : aussi ordonne-t-il la déportation de centaines de milliers de Polonais et de Baltes, ou le transfert en Asie centrale de 170 000 Coréens. Mais c'est aussi la sédentarisation forcée des populations nomades, notamment au Kazakhstan, qui se solde par un désastre démographique et la perte de nombreuses traditions culturelles.
Le principe totalitaire de la responsabilité collective défendu par Staline fait que la « faute » d'un individu s'étend à son conjoint, à ses enfants, à sa famille entière, à tout son réseau d'amis et de relations. Par exemple, le 5 juillet 1937, le Politburo ordonne au NKVD d'interner toutes les épouses de « traîtres » en camp pour 5 à 8 ans, et de placer leurs enfants de moins de 15 ans « sous protection de l’État ». Ordre qui conduit à arrêter 18 000 épouses et 25 000 enfants, et à placer près d'un million d’enfants de moins de 3 ans dans des orphelinats.
Par ailleurs, les familles des plus proches hommes de confiance de Staline (Molotov, Kaganovitch, Kalinine, etc.) sont elles-mêmes frappées par les purges. Le meilleur ami de Staline, Grigory Ordjonikidze, qui s'est montré hostile devant lui à la purge des cadres de l'industrie, voit son frère fusillé et se suicide en signe de protestation (février 1937). La famille même de Staline n'est pas épargnée par la Terreur, avec la disparition et l'exécution de ses proches parents Maria Svanidze, Pavel Allilouiev, Stanislas Redens...
En 1939, à l'arrêt des Grandes Purges — autrement appelée la Grande Terreur d'autant que, selon les calculs de Nicolas Werth, elles ont frappé à 94 % des non-communistes — Staline a éliminé les dernières sphères d'autonomie dans le parti et la société, et imposé définitivement son culte et son pouvoir absolu. Il a pris ce faisant le risque de désorganiser gravement son armée et son pays, alors même que la guerre approche.
Politique extérieure Molotov et Staline
Dans les années 1930, la politique extérieure de Staline est à géométrie variable.
Tout d’abord, lors du VIIe congrès du Komintern en août 1928, il impose la politique « classe contre classe » aux partis communistes. La social-démocratie, qu'il a qualifiée d'« aile modérée du fascisme », est considérée comme l'ennemi prioritaire, et toute entente même tactique avec elle est prohibée. Cette politique conduit le Parti communiste français à son pire isolement de l'Entre-deux-guerres et à une chute électorale notable. Elle facilite surtout l'accès au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. En mars 1933, alors que la destruction de la République de Weimar est presque achevée et que les communistes allemands prennent en nombre le chemin des camps de concentration, le KPD clandestin et le Komintern répètent inlassablement que les événements démontrent la justesse des attaques contre la social-démocratie et la nécessité de les poursuivre sans changement.
Staline pensait d'abord que l'expérience Hitler ne durerait pas : « Après lui, ce sera nous ». Mais le régime nazi se consolide, et une menace militaire réelle plane désormais sur l'URSS. Dès lors, à partir de juin 1934, Staline se ravise et lance une politique d’alliance des partis communistes avec des « partis bourgeois » pour tenter de faire reculer le fascisme et le nationalisme. Il rapproche parallèlement l'Union soviétique des États occidentaux, ce qui a pour conséquence l’entrée tardive de l’URSS dans la SDN (1934) ou la conclusion du pacte d'assistance franco-soviétique lors de l'entrevue Laval-Staline (mai 1935). C’est ainsi que le Front populaire peut se constituer en France et en Espagne et qu’en Chine, le 22 septembre 1937, Tchang Kaï-chek s’accorde avec Mao Zedong contre l'impérialisme du Japon et signe un pacte de non-agression avec l’URSS. Au niveau intérieur, Staline s'efforce de se montrer plus libéral en faisant promulguer la « constitution stalinienne » de 1936, annoncée comme « la plus démocratique du monde », en signe d'ouverture envers l'Occident.
Pendant la guerre d'Espagne Staline est à partir de fin octobre 1936 le seul chef d'État à intervenir officiellement aux côtés de la République espagnole, menacée par Franco aidé de Hitler et Mussolini. Mais s'il envoie des chars, des avions et des conseillers, il en profite aussi pour faire main basse sur l'or de la banque d'Espagne, freiner sur place le mouvement révolutionnaire tout en satellisant le gouvernement espagnol, et faire liquider physiquement de nombreux anarchistes, trotskistes et marxistes dissidents du POUM.
Des documents du Komintern montrent cependant que même dans ces années où il fait figure d'allié des démocraties, Staline n'a pas renoncé à l'espoir secret d'un pacte avec Hitler, qui mettrait à l'abri l'URSS et lui garantirait en outre des bénéfices territoriaux. Il fait régulièrement modérer les attaques de la presse contre le régime nazi, ou tente quelques sondages secrets à Berlin41. Les procès de Moscou et les purges qui meurtrissent l'Armée rouge troublent les démocraties occidentales, où l'anticommunisme reste très fort, et les font douter des capacités militaires soviétiques.
En 1938, Staline est furieux que son pays n'ait pas été convié à la conférence qui décide des accords de Munich (30 septembre) et craint une entente des Occidentaux avec Hitler contre l'URSS. Staline fait clairement savoir à Berlin, début 1939, que Moscou se liera au plus offrant. Mais persuadé que la guerre avec les nazis est inévitable, il décide le transfert des usines d'armement vers l'est au delà de Moscou et arrête la stratégie de l'Armée rouge pour cette confrontation. Ce sera une posture défensive, copie de celle de Mikhaïl Koutouzov devant Napoléon en 1812 et qui prend en compte la possibilité d'une invasion en profondeur. La prise des capitales, Moscou et Léningrad, qui seront protégées par des troupes d'élites, est, cette fois, exclue. Staline table sur l'usure des troupes d'élite allemandes qu'Hitler devra engager dès le début de l'attaque, scénario qui se vérifiera complètement devant Moscou et partiellement devant Léningrad.
Le 12 août 1939, les plénipotentiaires de la France et du Royaume-Uni sont en visite en URSS afin de tenter – bien tardivement et sans conviction – de refonder l’alliance de 1914, après avoir refusé à de nombreuses reprises des propositions similaires faites auparavant par Staline. Staline dénonce une absence de réelle volonté des démocraties occidentales de combattre Hitler et signe, le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique. Un protocole secret prévoit le partage de l'Europe centrale en zones d'influences et les relations économiques entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie sont très fortement accrues permettant à Berlin d'accumuler des stocks vitaux de matières premières. Il gagne alors de l'espace et du temps, mais moins que prévu du fait de la rapide défaite de la France à l'Ouest, qu'il interprète comme l'intégration de celle-ci à la puissance nazie.
La Seconde Guerre mondiale
Avant le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, l'URSS gagne deux batailles de frontières contre le Japon : la bataille du lac Khassan en 1938, puis la bataille de Halhin Gol en Mongolie en 1939. Le 17 septembre 1939, les troupes de Staline entrent en Pologne — jusqu'à sa frontière Est actuelle — et prennent à revers l'armée de ce pays qui se défend face à l’invasion nazie sur sa frontière occidentale, en cours depuis deux semaines. Le 30 novembre, l'armée soviétique attaque la Finlande et, après des échecs spectaculaires et inquiétants, parvient à la faire plier en mars 1940, sous le nombre des assaillants.
Le 5 mars 1940, Staline fait contresigner par le Politburo son ordre d'exécuter sommairement plus de 20 000 officiers et notables polonais capturés, qui seront en particulier enterrés près de Katyń.
En juin 1940, Staline annexe les États baltes, puis en août la Bessarabie roumaine, érigée en République socialiste soviétique de Moldavie. La terreur et la soviétisation accélérée s'abattent aussitôt sur ces territoires. Elles se traduisent par la déportation de plusieurs centaines de milliers d'habitants et le meurtre d'une partie des élites locales.
Staline respecte scrupuleusement le Pacte germano-soviétique. Jusqu'à la nuit du 21 au 22 juin 1941, il livre ponctuellement et à crédit les céréales et des matières premières dont le Reich a besoin. Il livre aussi à la Gestapo plusieurs dizaines de communistes allemands réfugiés à Moscou.
Le pacte prend fin le 22 juin 1941 avec l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht.
Contrairement à la légende longtemps répandue, Staline ne s'est pas effondré psychologiquement au constat de la trahison d'Hitler, ni n'est resté plusieurs jours prostré et incapable de réagir. Les archives et les témoignages concordent aujourd'hui pour prouver qu'il reste à son poste nuit et jour pendant la première semaine d'invasion, et qu'il prend aussitôt des mesures radicales, avec un bonheur très inégal. Ce n'est que le 28 juin, après cinq jours et cinq nuits presque sans repos, et un heurt mémorable avec le général Joukov, que Staline part brusquement se retirer dans sa datcha pour préparer son discours qui sera radiodiffusé le 3 juillet.
Néanmoins, avant l’invasion nazie, Staline a refusé jusqu'au dernier moment de réagir aux rapports — de Trepper, Sorge et même Churchill — qui le prévenaient depuis de longs mois de l'imminence d'une invasion, allant même jusqu'à menacer de liquider ceux qui s'en faisaient écho avec trop d'insistance. Il semble s'être laissé paralyser par la hantise d'une provocation allemande, jugeant qu'une réaction préventive serait politiquement contre-productive : il se raccrochait désespérément à l'idée que l'année était trop avancée pour que Hitler commette la même erreur que Napoléon. De ce fait, les troupes soviétiques n'ont été mises en alerte que très tard — le 22 juin à 0 h, à la suite de l'ultime désertion d'un soldat allemand — et incomplètement, permettant par exemple que l'aviation allemande détruise partiellement l'aviation soviétique restée au sol. Le matin même du 22 juin, une partie de l'Armée rouge n'ose toujours pas ouvrir le feu, alors qu'une autre — à Brest-Litovsk — résiste âprement et parvient à tenir près de six semaines.
Les purges de l'avant-guerre, en particulier celle de 1937, ont profondément affaibli l'Armée rouge, puisque la quasi-totalité des généraux modernisateurs et compétents a disparu : environ 90 % des cadres supérieurs de l'armée ont été éliminés, tandis que 11 000 officiers sur 70 000 ont été fusillés et 20 000 autres sont internés dans les camps du Goulag. De même, sur cinq maréchaux, seuls ont survécu les deux tenants inconditionnels de la cavalerie, amis de toujours de Staline, mais ennemis jurés de l'arme blindée. L'effort de modernisation tenté in extremis avant l'invasion, de même que la réintégration de milliers d'officiers purgés sortis en loques du Goulag — comme le futur maréchal Rokossovki — ne peuvent empêcher les désastres initiaux.
Dans les premiers mois, Staline perd des milliers de chars et d'avions, et laisse encercler d'immenses armées. Ainsi, l'URSS perd un million de km² et plusieurs millions de soldats qui se retrouvent prisonniers : en outre, les nazis les laissent mourir de faim et d’épuisement lors d’interminables marches.
Cependant, en raison d’une invasion commencée trop tard, la Wehrmacht n'atteint pas la totalité de ses objectifs, même si elle avance très loin et avec des pertes limitées. De l'avis de ses historiens même les plus critiques, Staline démontre son sang-froid et son génie politique en s'adressant, dès le 3 juillet 1941 à ses « frères-et-sœurs » soviétiques, pour proclamer l'union sacrée de la nation dans la « Grande Guerre patriotique » et, surtout, en décidant de ne pas quitter Moscou menacée, à la surprise de ses proches. Sa présence galvanise les énergies et enraye un début de panique.
D'autre part, l'armée japonaise a abandonné toute velléité d'attaquer la Russie après ses défaites de 1939 : l'URSS en a eu confirmation par Richard Sorge. Ne craignant plus l'ouverture d'un second front en Extrême-Orient, les troupes sibériennes deviennent ainsi disponibles face aux allemands au moment crucial de l'hiver 1941. Le 6 décembre 1941, l'Armée rouge stoppe des Allemands à bout de souffle parvenus à seulement 22 km de la capitale ; puis au cours de l'hiver, elle les repousse à plus de 200 km à l'ouest.
Après cet échec, l'armée nazie change d'objectif principal pour sa campagne de 1942 : elle souhaite prendre le contrôle du pétrole du Caucase, voire, ensuite, de celui du Moyen-Orient. Après un court succès, la Wehrmacht sort vaincue de la bataille de Stalingrad. La ville, au nom symbolique, devient l'objet de l'attention universelle. Entièrement détruite sous les bombes et par les combats de rue, 300 000 Allemands y périssent ou y sont faits prisonniers. La VIe Armée, encerclée, capitule début février 1943.
C'est le début du recul allemand. À la bataille de Koursk en été 1943, au cours de la plus grande confrontation de blindés de l'histoire, 500 000 hommes et 1 500 chars sont mis hors de combat.
Après ses erreurs dramatiques de 1941, Staline a su faire progressivement un réel apprentissage militaire, et surtout accepter de laisser une plus grande autonomie à ses généraux : il ne se rend jamais en personne au front. Par ailleurs, vis-à-vis de la société soviétique, il desserre l'emprise du gouvernement, noue une trêve avec les Églises, met l'accent sur la défense de la patrie plutôt que sur la Révolution. Cependant, son pouvoir absolu reste intact et même renforcé : chef du gouvernement depuis mai 1941, Staline se fait nommer commissaire à la Défense en août, « commandant en chef suprême » en juillet 1942, maréchal en 1943, généralissime en 1945. L'Internationale cesse d'être l'hymne soviétique pour être remplacée par un chant patriotique qui mentionne son nom. C'est aussi la nature totalitaire du gouvernement qui lui permet d'imposer une stratégie d'offensive à tout prix et d'attaque frontale de l'ennemi, très coûteuse en hommes, où les pertes humaines se dénombrent par millions : ce type de stratégie n’a plus cours en Occident depuis la fin de la Grande Guerre.
Pour obtenir « l'adhésion » totale de ses troupes, des équipes spéciales du NKVD sont chargées de mitrailler les soldats qui refluent vers l'arrière : cette technique a par exemple été expérimentée devant Moscou et à Stalingrad[réf. souhaitée]. De même, les prisonniers et leurs familles sont officiellement reniés et considérés comme des traîtres, tandis que des généraux et officiers de tout rang sont fusillés dès les premiers jours, boucs émissaires des erreurs du chef suprême qui avait déjà gravement purgé les chefs de son armée à la fin des années 3045. En pleine offensive allemande de 1941, Staline détourne aussi des forces importantes du front pour faire déporter intégralement les Allemands de la Volga, descendants de colons installés au XVIIIe siècle. En 1944, il fait déporter en totalité une dizaine de peuples — soldats décorés et militants communistes compris — sous la fausse accusation de collaboration avec les Allemands. Ainsi, en mars 1944, 600 000 Tchétchènes, hommes, femmes, enfants et vieillards sont déportés en six jours seulement, un record historique jamais égalé.
Les trois Grands Winston Churchill, Roosevelt et Staline à la Conférence de Yalta
En 1944, Staline reconquiert le territoire national. Arrivé devant Varsovie, il laisse les Allemands, regroupés autour de la capitale polonaise après l'offensive soviétique, écraser l'insurrection de la capitale polonaise, entre le 1er août et le 2 octobre 1944. S'il est vrai que l'offensive soviétique est à bout de souffle et que Staline n'a plus les moyens de franchir la Vistule, il refuse toutefois de parachuter des armes ou bien de laisser les avions occidentaux atterrir sur les aérodromes contrôlés par l'Armée rouge à proximité de la capitale polonaise. Ainsi, des centaines d'aviateurs alliés tentent désespérément de parachuter des armes aux insurgés et périssent lors d'allers-retours longs et dangereux entre l'Italie et la Pologne. De cette manière, Staline exprime sa volonté de laisser écraser une insurrection nationaliste qu'il ne contrôle pas et qui pourrait contrarier l'installation d'un gouvernement communiste allié de Moscou après la guerre.
Alors que les Alliés débarquent en Normandie et s'approchent des frontières occidentales de l'Allemagne, les Soviétiques qui affrontent dix fois plus de divisions nazies à l'Est[réf. nécessaire] continuent leur progression vers le centre du Reich. Au total, la guerre à l'Est aura permis de mettre hors de combat 80 % des effectifs de la Wehrmacht : sur 783 divisions allemandes disséminées sur tous les fronts, 607 sont anéanties sous les feux soviétiques.
Goebbels avait énoncé l'un des objectifs idéologiques de la guerre à l'Est : « La lutte contre le bolchevisme mondial est le but principal de la politique allemande ». Il faut ajouter à cela la volonté des Allemands de reconquérir ce qu'ils considèrent comme leur « espace vital » — le Lebensraum — et celle de réduire en esclavage les peuples slaves considérés comme des « sous-hommes » : des Untermenschen. En pratiquant une politique d'extermination contre les populations slaves et surtout juives, les nazis se sont eux-mêmes privés de la possibilité de bénéficier d’un soutien de la population soviétique parmi laquelle les mécontents de la dictature stalinienne étaient pourtant nombreux. Ils parviendront néanmoins à recruter un certain nombre de partisans, par exemple l'armée Vlassov, une division SS ukrainienne ; ainsi, des maquis anti-communistes subsisteront en Ukraine jusqu'à l'été 1946 et d’anciens SS ukrainiens rejoindront l'Armée insurrectionnelle ukrainienne — l'UPA — en lutte contre l'Armée rouge jusqu'en 1948, et dans une moindre mesure jusqu'en 1954 pour ses derniers éléments.
La victoire se paye au prix de millions de morts : environ 21 000 000 morts — 13 millions de civils et 8 millions de militaires — ; le total de 27 millions sera même annoncé à l'époque de la Perestroïka. Et ces millions de morts doivent être ajoutés aux autres millions tombés au cours des catastrophes humaines qui ont précédé depuis le début du xxe siècle : pertes de la Première Guerre mondiale, guerre civile, élimination des opposants, déportations dans des régions inhospitalières et famines, soit un total de l'ordre de 20 % de la population soviétique, et 12 % pour le seul second conflit mondial.
En comparaison, sur la seule Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne perdent que 0,2 % de leur population, et la France 1,5 % de la sienne.
En outre, les destructions matérielles en URSS sont gigantesques, les pires subies par un belligérant dans ce conflit.
L'après-guerre
La conférence de Potsdam en juillet 1945
Tous les témoignages concourent à montrer que lors de la victoire de 1945, la population espère conserver les espaces de liberté concédés pendant la guerre et ne pas revenir au système d'avant 1941. Mais au cours de l'été, Staline prend la décision de rétablir ce dernier à l'identique.
Les pays d'Europe de l'Est traversés sont placés sous le contrôle de l'URSS et y restent après la conférence de Yalta. Staline leur impose le modèle soviétique, notamment par le coup de Prague en 1948 et par la mise en place de gouvernements pro-soviétiques. En Tchécoslovaquie, le seul pays de la sphère soviétique dotée d'une tradition démocratique, le parti communiste prend le pouvoir avec la bénédiction de Staline. Il crée en 1947 le Kominform, un rassemblement de partis communistes européens à l'image de l'Internationale et dirigée par le PCUS. Impuissant à empêcher la rupture soviéto-yougoslave (1948), Staline développe une campagne intense contre Tito, qu'il avait épargné au moment des Grandes Purges, et multiplie les procès truqués de communistes disgraciés en Europe de l’Est, notamment à Prague où la plupart des accusés sont choisis parmi des Juifs (procès de Prague contre Rudolf Slánský et d'autres hauts dignitaires du parti communiste tchécoslovaque, 1952). En 1949, il fait accéder son pays à l'arme atomique, en partie grâce à ses réseaux d'espionnage aux États-Unis et aux prisonniers du Goulag et des charachka. En Asie, la politique stalinienne de l'après-guerre suit un cours sinueux : soutien au sionisme entre 1946 et 1950, suivi d'un net revirement anti-israélien et même antisémite51, accueil très réservé fait à la révolution chinoise, politique prudente en Corée.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7496#forumpost7496
Posté le : 20/12/2014 18:39
Edité par Loriane sur 21-12-2014 23:53:22
|
|
|
|
|
Joseph Staline 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
L'Antisémitisme de Joseph Staline.
À l'intérieur, le culte de la personnalité du Vojd (« Guide ») atteint son ampleur maximale, culminant à son 70e anniversaire en 1949. Des dizaines de villes, des milliers de rues, de fermes, d'usines, etc. portent le nom de Staline, qui refuse la proposition de renommer la capitale Moscou « Stalinodar ». Le point culminant de l'URSS reçoit le nom de « pic Staline ». Des « prix Staline » décernés depuis 1941 deviennent les équivalents soviétiques des prix Nobel.
Le système se reproduit dans certains partis communistes des pays frères, dont les dirigeants sont qualifiés de « meilleurs staliniens » de France, d'Italie, etc. (Maurice Thorez, Palmiro Togliatti, Georgi Dimitrov…). Probablement repris de l'appellation d'Abraham, le titre de Père des peuples (Отец народов) ou encore de « Grand guide des peuples » (Великий вождь народов) signale que Staline a réussi à s'identifier non seulement à la nation soviétique mais aussi à d'autres nations du monde grâce à sa victoire sur le nazisme qui lui confère un réel prestige dans le monde bien au-delà des seuls cercles communistes.
Le second stalinisme se caractérise aussi par un retour encore plus affirmé au nationalisme et au chauvinisme, un renforcement de la russification et de la répression des minorités, une campagne antisémite contre le cosmopolitisme.
L'emprise de Staline sur le champ culturel et scientifique s'alourdit aussi considérablement. Il fit réécrire en permanence l'histoire, notamment pour apparaître comme le coauteur de la Révolution russe, pour gommer le rôle de ses opposants et victimes, ou pour attribuer à des Russes la paternité de toutes les grandes inventions contemporaines. Il accentua son soutien aux théories charlatanesques du biologiste Trofim Lyssenko, et ravagea ainsi la génétique soviétique. Il se mêla même d'intervenir dans les débats linguistiques (Le Marxisme dans les questions linguistiques, 1951) et prétendit que la manipulation du langage permettrait l'avènement de « l'homme nouveau », prétention qui inspira à George Orwell la satire du novlangue. Quant aux écrivains, musiciens et artistes, leur création fut soumise étroitement au réalisme socialiste, et Staline chargea son protégé Andreï Jdanov de les remettre au pas par une violente campagne doctrinaire (Jdanovtchina).
Accentuant une tendance autocratique déjà nette avant la guerre, Staline ne réunit pratiquement plus le Politburo et espace à l'extrême les congrès du Parti : cinq seulement de 1927 à 1953, dont aucun entre 1939 et 1952, alors qu'il s'en tenait un par an même en pleine guerre civile russe. S'il ne pratique plus de grandes purges comme avant-guerre, il terrorise son propre entourage, humiliant souvent en public ses plus fidèles serviteurs, les frappant à travers leurs épouses, leurs frères, etc. et leur faisant miroiter à toute occasion la possibilité d'une disgrâce fatale. Il s'apprête notamment à éliminer le chef de la police Lavrenti Beria lorsque la mort le saisit.
Mort et Funérailles de Joseph Staline.
Souffrant depuis plusieurs années d'athérosclérose, il avait déjà subi plusieurs attaques cardiaques qui l'avaient amené à arrêter de fumer et boire moins d'alcool au profit du thé.
Le soir du 28 février 1953, après avoir réuni au Kremlin un Præsidium de 25 membres au sujet du complot des blouses blanches, Staline emprunte vers 23 heures une des trois limousines ZIS 110 devant le mener à sa datcha de Kountsevo, ancienne résidence d'été des princes d'Orlov, près de Moscou, les deux autres étant des leurres : chaque voiture prend un itinéraire différent chaque soir. Il prend son dîner dans le salon de la datcha en compagnie de Beria, Malenkov, Boulganine et Krouchtchev puis monte se coucher dans une de ses sept chambres, toutes fermées par une porte blindée.
Staline ne se manifeste pas pendant toute la journée du 1er mars et ne commande aucun de ses repas, contrairement à son habitude. L'arrivée du courrier du comité central du Kremlin donne le prétexte de déranger Staline malgré ses consignes. Selon le garde du corps de Staline Alexandre Rybine, c'est l'officier de sécurité Piotr Lozgatchev qui force la porte et trouve Staline tout habillé son pantalon de pyjama trempé d'urine, allongé sur le tapis, inconscient, frappé par une attaque cérébrale, vraisemblablement peu de temps après le départ de ses collaborateurs. Les Mémoires de Khrouchtchev mentionnent que c'est la vieille gouvernante de Staline Matrena Boutouzova qui le découvre ainsi. Les gardes déplacent Staline sur le canapé du salon avant de décider ce qu'il convient de faire. Son plus proche collaborateur Gueorgui Malenkov, averti de la situation, téléphone à Beria seul habilité à autoriser un médecin à s’approcher de Staline (il soupçonnait ses médecins de vouloir le tuer) mais le chef de la police politique est introuvable. Dans la nuit du 1er au 2 mars, le chef de la garde convoque les principaux collaborateurs de Staline à la datcha, dont Khrouchtchev, Boulganine, Béria, Malenkov, qui découvrent alors Staline inconscient mais pas encore mort. Ayant peur de son courroux s'ils lui faisaient mal, ils attendent plusieurs heures avant d'appeler un médecin, alors que Staline avait déjà été frappé par cette attaque depuis plus de 24 heures. Selon certains témoignages, Béria s'opposa à la convocation de médecins, sachant que Staline préparait une purge qui le concernait ; il avait donc tout intérêt à ce que Staline meure. Lorsque le médecin arrive, il est trop tard, Staline est déclaré mort le 5 mars à 6h du matin. Selon le témoignage de sa fille Svetlana, Staline au cours de sa longue agonie aurait manifesté des moments de conscience avant de mourir. Selon un memorandum de Beria publié conformément à ses souhaits après sa mort, le décès de Staline est attribué à un empoisonnement par l'un de ses rivaux, Viatcheslav Molotov, pour achever Staline : victime d'une attaque lors de la discussion houleuse du Præsidium du 28 février, il fut ramené dans sa datcha et Molotov aurait versé de la warfarine dans son cognac.
L'aura de Staline est telle que la Pravda passe sous silence, pendant près d'une semaine, la mort du compositeur Sergueï Prokofiev, survenue le même jour, 50 minutes avant celle du « petit père des peuples ».
Les funérailles de Joseph Staline se tiennent le 9 mars 1953 à Moscou. Elles sont marquées par une terrible bousculade qui fait des centaines de victimes. Dans le monde socialiste, dans le mouvement communiste international et chez les anciens Alliés de la Seconde Guerre mondiale, le chagrin et la déférence semblent alors les sentiments dominants, au moins en public, ainsi que la peur devant un avenir désormais incertain.
Exposé aux côtés de Lénine dans le mausolée de la place Rouge, il en est déplacé en 1961 à la suite du XXIIe Congrès du PCUS. Selon Hélène Carrère d'Encausse, à la suite de propos tenus par une vieille militante bolchévique, Lazourkina, qui aurait rêvé de Lénine lui disant qu'il lui était pénible de reposer aux côtés de Staline, le Congrès vote l'expulsion du corps de Staline du Mausolée. On l'enterre entre le mausolée et le mur du Kremlin, dans ce qui deviendra un petit cimetière des hauts personnages de l'URSS.
« Legs politique »
Le décès de Staline marque la confirmation de la « coexistence pacifique » sur le plan international, tout comme elle entraîne vite une vague d'événements en URSS et dans le bloc soviétique. En Union Soviétique, une direction collégiale se met en place, dominée un temps par Lavrenti Beria qui contrôle toujours l'appareil policier et certains ministères stratégiques. Beria se transforme paradoxalement en champion de la libéralisation : il relâche les accusés du « complot des blouses blanches » en reconnaissant que leurs « aveux » ont été extorqués par la torture, et amnistie dès le mois de mars près d'un million de condamnés de droit commun qui sortent alors du Goulag. Le stalinisme n'est pas pour autant renié encore officiellement.
Dans le bloc de l'Est, la mort de Staline entraîne un soulèvement contre le régime à Berlin-Est et en RDA à partir du 16 juin, donnant l'espoir d'une réunification allemande rapide, mais le mouvement est sévèrement réprimé.
Après une longue période de flottement, qui se solde entre autres par l'exécution du chef du KGB Lavrenti Beria, Nikita Khrouchtchev arrive à la tête du pays. En 1956, l'URSS rompt officiellement avec le stalinisme au cours du XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. En 1961, le corps embaumé de Staline est retiré du mausolée de Lénine et Stalingrad devient Volgograd. Les rescapés du régime stalinien sont libérés du Goulag et la réhabilitation globale des victimes de Staline, initiée par Khrouchtchev, stoppée sous Brejnev, est relancée sous Gorbatchev et achevée après la dislocation de l'URSS. Hélène Carrère d'Encausse a qualifié la déstalinisation enclenchée en 1956 à la lecture du « rapport secret » de Khrouchtchev de « deuxième mort de Staline ».
En revanche, les successeurs de Staline ne réforment pas le système économique et social hérité de son règne, malgré ses défauts de plus en plus évidents (bureaucratisme, pénuries chroniques, sous-productivité, absence d'initiative personnelle, coût écologique, déséquilibre des branches au profit d'une industrie lourde de moins en moins adaptée à l'évolution historique, etc.). L'effondrement des régimes d'Europe de l’Est (1989) et la désintégration de l'URSS (1991) achèveront l'agonie de la structure du système économique soviétique près de 35 ans plus tard.
Mao Zedong et Staline, en 1949.
Après 1961, seules la République populaire de Chine de Mao Zedong, la Corée du Nord de Kim Il-sung et l'Albanie de Enver Hodja continuent à se réclamer ouvertement de Staline, et ce jusqu'à la mort de Mao Zedong en 1976. Même aujourd'hui, la critique de Staline n'est pas à l'ordre du jour en Chine populaire et encore moins en Corée du Nord, souvent considérée comme « le dernier régime stalinien de la planète ».
À l'heure actuelle, sur le plan international, plusieurs partis communistes de faible importance (PC de Grèce (KKE), Parti communiste bolchevik de Nina Andreeva, Russie laborieuse de Viktor Anpilov, Parti communiste ouvrier de Russie de Viktor Tioulkine, Union des PC russe/biélorusse de Chénine, Parti du travail de Belgique, entre autres) ont annoncé avoir réévalué positivement l'œuvre et les mérites de Staline. D'autres groupes parfois maoïstes continuent à se réclamer plus ou moins directement de Staline : Parti communiste du Népal, Sentier lumineux au Pérou, ou en France un groupuscule comme l'Union des révolutionnaires-communistes de France. Ces organisations affirment incarner le « marxisme-léninisme véritable ». Quelques rares auteurs staliniens très controversés développent également une vision encore très favorable de Staline et de son action, dont ils passent sous silence ou minimisent les nombreuses zones d'ombre : ainsi le Belge Ludo Martens ou l'historienne française Annie Lacroix-Riz, qui s'appuient surtout sur l'ouverture des archives soviétiques et européennes pour relativiser la critique antistalinienne, encore dominante, déclenchée par le rapport Kroutchev de 1956.
En Russie, le culte de Staline n'est pas exclusivement le fait de nostalgiques du régime. Il est également propagé par des milieux ultra-nationalistes qui considèrent que le mérite essentiel de Staline a été de créer un État fort incarnant le destin de la nation russe. Ce culte est généralement associé à l'antisémitisme. La plupart des staliniens considèrent que ce sont des Juifs qui ont incarné les tendances les plus internationalistes du marxisme (Trotsky, Rosa Luxemburg, Zinoviev, Kamenev, etc.) — Karl Marx étant lui-même d'origine juive.
Controverses
De nombreuses interprétations contradictoires ont été suscitées par l'ampleur des crimes de Staline, mais aussi par celle des mutations qu'il a fait connaître à la Russie. Selon le mot de Churchill, « Staline a hérité d'une Russie à la charrue, et l'a laissée avec l'arme atomique ».
Pendant les Grandes Purges, de nombreux Soviétiques, dans les villes surtout, étaient sincèrement convaincus que Staline ignorait ce qui se passait dans le pays et qu'on lui cachait la vérité. C'était là la reprise du très vieux thème du bon tsar victime de ses mauvais ministres.
De même, de très nombreux communistes, envoyés brusquement en prison ou au Goulag sans pouvoir comprendre ce qu'on pouvait bien leur reprocher, persistaient de toutes leurs forces à défendre Staline et à lui faire appel, croyant avoir en lui leur recours. Jusqu'au seuil de leur exécution, des condamnés à mort protestaient de leur amour pour lui et de leur dévouement total à sa personne et au Parti, écrivant et déclarant qu'ils mourraient avec le nom de Staline sur les lèvres. En réalité, Staline était parfaitement au courant et pilotait en personne toutes les opérations de la Grande Terreur. Les archives de Moscou ont levé les derniers doutes, et mis au jour 383 listes de condamnations à mort signées de la main de Staline — soit 44 000 exécutions — ou les injures qu'il griffonnait parfois sur les lettres de dévouement ultimes de ses victimes.
Du vivant même de Staline, on glosa sans fin à l'étranger et jusqu'au sein du Parti sur ses origines caucasiennes, et on fut tenté d'expliquer ses crimes comme une manifestation de « barbarie asiatique ». Ossip Mandelstam fut déporté sans retour pour avoir stigmatisé dans une pièce de vers « le montagnard du Kremlin », « l'homme au large poitrail d'Ossète ».
Armés de leurs préjugés racistes, les nazis et leurs collaborateurs poussèrent ad nauseam l'assimilation de Staline, russe ou caucasien, à l'Asiatique dégénéré et cruel — bien qu'Hitler n'ait jamais caché en privé son admiration pour Staline, seul homme à ses yeux à avoir su faire marcher au pas les « sous-hommes » slaves, et dont il enviait sa capacité de faire fusiller ses généraux contestataires. Les parentés, mais aussi les différences tout aussi notables des deux dictateurs totalitaires, restent un sujet de discussion inépuisable, notamment depuis les travaux de Hannah Arendt (Les Origines du totalitarisme, 1951) et la double biographie pionnière d'Alan Bullock (Hitler et Staline : vies parallèles, Paris, Albin Michel, 1993).
D'autres voient Staline avant tout comme un chef d'État russe, continuateur des tsars et incarnation des ambitions nationales de l'ancienne Russie. Il n'aurait conservé que pour la forme un vernis de discours révolutionnaire. C'était en gros la vision du général de Gaulle, ou celle des nationaux-bolcheviks allemands. Staline a lui-même invité à interroger sa place dans la continuité de l'histoire russe, en se comparant volontiers aux despotes modernisateurs Ivan le Terrible et Pierre le Grand. Néanmoins, il reste difficile de concevoir, par exemple, pourquoi Staline aurait tant tenu à aligner les pays de l'Est, déjà sous sa coupe, sur le modèle soviétique, si ses ambitions impériales avaient été étrangères à toute adhésion profonde au projet révolutionnaire hérité du parti bolchevique.
Le rapport de Staline à la Révolution russe est pareillement controversé. Pour Nikita Khrouchtchev en 1956, la dérive de Staline n'aurait commencé qu'en 1934, ce qui permettait de ne pas remettre en cause la collectivisation désastreuse ni les choix d'industrialisation forcenée, encore moins l'œuvre de Lénine. Les communistes furent à ses yeux les principales victimes de Staline, et les Grandes Purges, tombées sur un Parti présenté comme innocent, ne seraient dues qu'à sa « paranoïa » personnelle — explication intenable aujourd'hui, et au demeurant fort peu marxiste. Pour Trotski et les trotskistes, Staline est d'abord le représentant de la bureaucratie, qui a « trahi la révolution » en la privant de sa dimension internationale au profit du « socialisme dans un seul pays », et qui a liquidé l'héritage de Lénine ainsi que la vieille garde. Aux yeux de Trotski, Staline représentait le « Thermidor » de la révolution russe (bien qu'au contraire du Thermidor français, celui-ci ait relancé la transformation sociale et la terreur à un degré que nul n'aurait osé prévoir).
Pour de nombreux anarchistes ou sociaux-démocrates, ainsi que pour la plupart des historiens actuels, il n'y a pas au contraire de discontinuité entre Lénine et Staline.
Nul n'avance certes que Lénine aurait été du genre à promouvoir la bureaucratie, le nationalisme, l'antisémitisme, l'académisme, les théories de Lyssenko ou un culte de sa personnalité. Mais dans la lignée de la biographie pionnière et toujours utilisable de Boris Souvarine, les historiens soulignent qu'il a laissé à Staline la dictature du parti-guide infaillible, le centralisme démocratique interdisant les tendances, le culte du secret, l'apologie de la violence « nécessaire » et de l'absence de scrupules moraux au nom de la révolution, ainsi qu'un État policier déjà tout-puissant ayant liquidé toutes les oppositions et employant un certain nombre de pratiques perfectionnées ultérieurement par Staline (responsabilité collective des familles, stigmatisation-discrimination collective de groupes sociaux, procès truqués, censure, persécutions religieuses, massacres, premiers camps de travail, etc.).
En tout état de cause, Staline lui-même était militant bolchevique depuis trop longtemps pour qu'on puisse exonérer raisonnablement le Parti de toute responsabilité dans la formation de sa personnalité et de ses méthodes. La récente biographie de Simon Sebag Montefiore, par exemple, met fréquemment en parallèle les comportements et la sociabilité du Staline des années 1930-1950 (et de ses amis) avec ceux hérités de la guerre civile. De très nombreux bolcheviks entrés au Parti dès l'adolescence, souvent bien avant la révolution, ont d’ailleurs servi la politique (et les crimes) de Staline sans état d'âme (Molotov, Kliment Vorochilov, Boudienny, Grigory Ordjonikidze, Kirov, Iagoda, Iejov, etc.).
Par ailleurs, s'il est certain aujourd'hui que Staline est responsable de la mort de plus de communistes qu'aucun dictateur anticommuniste au monde (même Hitler a, comparativement, tué moins de dirigeants du KPD), la thématique faisant des communistes les « premières victimes de Staline » est relativisée fortement. Nicolas Werth montre ainsi que 94 % des victimes des Grandes Purges de 1937-1939 n'étaient pas communistes.
Enfin, aujourd'hui, le jugement du peuple russe, pourtant parmi les premiers à avoir souffert des méfaits de Staline, est loin d'être unanime. Ainsi, un sondage69 réalisé par l'institut Youri Levada en mai 2006 révèle que les avis favorables et défavorables des Russes envers la personnalité de dirigeant de Joseph Staline s'équilibrent à peu près (différence des pourcentages favorables moins défavorables égale à -2). Si l'on compare au même jugement porté par exemple sur Mikhaïl Gorbatchev (-24), on constate une forte inversion par rapport au jugement généralement porté par l'Occident. L'écrivain Alexandre Zinoviev est passé d'une critique sans concession du stalinisme à une critique non moins mordante de l'antistalinisme.
Bilan des assassinats de masse et déportations commis sous Staline
La déportation continue de centaines de milliers d'opposants réels ou supposés, les emprisonnements arbitraires, et l'interdiction de toute contestation de la personne de Staline sont emblématiques de la période 1922-1953. L'historienne Anne Applebaum estime que 18 millions de Soviétiques ont connu le Goulag sous Staline et six autres millions l'exil forcé au-delà de l'Oural ; un à deux millions de personnes y décédèrent. En tout, un Soviétique adulte sur cinq connut le Goulag de par la politique stalinienne. Des gens disparurent pour avoir mal orthographié le nom de Staline ou pour avoir enveloppé un pot de fleurs avec une page de journal comprenant sa photo. On distingue cependant plusieurs épisodes marquants :
1930-1932 : « déportation-abandon » (Nicolas Werth) de deux millions de koulaks au-delà de l'Oural, où ils sont laissés à eux-mêmes sans les moindres structures ni habitations pour les accueillir. Beaucoup périrent de faim et de dénuement.
1932-1933 : résultante notamment de la collectivisation forcée des terres, la famine ravage les riches terres à blé ukrainiennes, et fait entre 6 et 8 millions de morts, dont 2,6 à 6 en Ukraine, où elle est appelée holodomor (littéralement : meurtre par la faim). Si l'holodomor n'est pas le génocide que certains ont voulu voir (les Ukrainiens sont même surreprésentés au Parti et dans l'entourage de Staline), Staline a refusé d'écouter les avertissements nombreux qui lui parvenaient, et qui démontraient que la poursuite des collectes forcées conduirait au désastre. Il a nié l'existence même de la famine. Cependant, selon certains chercheurs (notamment Mark Tauger ou Stephen Wheatcroft), les exportations soviétiques en 1932 et 1933 étaient inférieures à deux millions de tonnes, soit moins que la moyenne des années précédentes et suivantes. Pour eux, la famine est également due à une très mauvaise récolte en 1932 et à l’abandon partiel des populations par le régime. La famine était probablement évitable, mais Staline semble l'avoir laissé se produire plus qu'il ne l'a délibérément organisée.
1937-1938 : les Grandes Purges conduisent à l'exécution de 681 000 personnes et à l'envoi au Goulag d'à peu près un million, aux dires du chef du KGB sous Gorbatchev, Krjuckov en 1989. De nombreuses minorités frontalières sont aussi déplacées de force, comme les 170 000 Coréens qui se retrouvent en Asie centrale, ou de très nombreux Baltes et Polonais. À l'été 1937, Staline lève personnellement l'interdiction de la torture dans les prisons, et ne la rétablit que fin 1938. Il a personnellement signé 383 listes de condamnations à mort collectives représentant un total de 44 000 individus. Rayant tout au plus un nom de temps à autres, quelques mots en marge voire un simple signe d'approbation lui suffisait pour mettre fin en bloc et sans appel à plusieurs centaines d'existences. Dans la soirée du 25 novembre 1938, il signe ainsi avec Molotov l'arrêt de mort de 3 173 personnes, un record.
De septembre 1939 à juin 1941, dans la partie orientale de la Pologne (revenue à l'URSS à la suite du pacte germano-soviétique), deux millions de personnes sont déportées par trains entiers. Des centaines de milliers de ces déportés périrent soit dans les trains, soit dans les camps de Russie septentrionale, de Sibérie ou du Kazakhstan, où beaucoup succombèrent au froid ou à la faim. En mars 1940 y a lieu le massacre de Katyń : 14 736 officiers et fonctionnaires polonais ainsi que 10 685 de leurs concitoyens déjà détenus par le NKVD sont exécutés dans la forêt de Katyń, près de Smolensk, sur ordre de Staline et en raison de leur statut social dans la société polonaise. Katyń ne fut d'ailleurs pas un lieu d'exécution spécifiquement réservé aux Polonais. Des estimations plus récentes ont sensiblement réduit à la baisse les chiffres de cette répression : « Entre septembre 1939 et juin 1941, les Soviétiques assassinèrent ou déportèrent plus de 440000 Polonais ».
En 1944, en six jours, l'ensemble du peuple tchétchène est déporté, soit 600 000 personnes, en Sibérie orientale, ainsi que d'autres peuples Allemands de la Volga (en 1941), Tatars de Crimée, Kalmouks, Coréens de Vladivostok (avant 1944) ; ou en partie : Ukrainiens, Estoniens, Lettons, Lituaniens).
Les archives soviétiques ouvertes après la dislocation de l'Union soviétique, montrent qu'environ 800 000 prisonniers sont morts sous Staline mais en 32 ans 1921-1953) pour des raisons politiques ou criminelles, qu'environ 1,7 million de personnes sont mortes dans les goulags et environ 390 000 dans les transferts de population pour un total d'environ 3 millions de morts officiellement recensés.
Les historiens qui ont travaillé après la dislocation de l'Union soviétique estiment quant à eux que le nombre des victimes du régime en dehors des famines se situe entre 4 et 10 millions. Vadim Erlikman, donne les estimations suivantes :
Nombre de victimes
Exécutions 1,5 million
Goulag 5 millions
Morts en déportations 1,7 million
Prisonniers de guerre
et civils allemands 1 million
Total 9 millions
En incluant les victimes de la famine on arrive à des chiffres de plus de 20 millions.
D'autres relèvent 963 766 décès - « ennemis du peuple » et droits communs confondus - dans les camps entre le 1er janvier 1934, jour officiel de la création de l'administration pénale pénitentiaire, et le 31 décembre 1947. « Ce dernier chiffre, ainsi que celui des personnes décédées lors de la déportation des koulaks peut être ajouté au "terrible prix" qui a été payé ».
Famille
La mère de Staline meurt en 1937. Staline ne vint pas aux funérailles, mais envoya une couronne.
Il a eu deux épouses : Ekaterina Svanidze et Nadejda Alliloueva-Staline. On lui a aussi parfois prêté une maîtresse ou épouse nommée Rosa Kaganovitch, présentée comme sœur de Lazare Kaganovitch. Néanmoins, une telle relation a été niée par Svetlana Allilouïeva. La famille Kaganovitch a également démenti l’existence de cette Rosa.
La première femme de Staline, Ekaterina Svanidze, dite Kato, meurt du typhus en 1907, quatre ans seulement après leur mariage. À ses funérailles, Staline aurait confié à un ami que tout sentiment chaleureux qu'il avait eu pour le peuple était mort avec elle, car elle seule pouvait soigner son cœur. Pendant les Grandes Purges, la belle-famille de Staline, après avoir partagé des années son quotidien au Kremlin, est arrêtée puis exécutée avec son accord : Aliocha Svanidze et sa femme Maria Svanidze seront fusillés en 1941.
Kato avait eu un fils, Iakov Djougachvili, que Staline ne vit pas avant son adolescence. L'attitude de Iakov était insupportable aux yeux de Staline, qui n'éprouvait que du mépris et de la colère envers lui90. Iakov tenta même de se suicider avec une arme à feu à cause de l'incroyable dureté de son père envers lui, mais il survécut. Après cet épisode, Staline se contenta de déclarer : « Il ne peut même pas tirer droit ». Iakov servit dans l'Armée rouge et fut capturé par les Allemands en juillet 1941. En vertu de ses dispositions répressives contre les prisonniers, considérés comme des traîtres et qui exposaient leurs familles à des représailles, Staline fit arrêter quelque temps la jeune femme de son fils. En 1943, Staline refusa de l'échanger contre le Maréchal Friedrich Paulus, capturé par l'Armée rouge lors de la bataille de Stalingrad : « un lieutenant ne vaut pas un général », aurait-il dit ; selon d'autres sources, il aurait répondu à cette offre « je n'ai pas de fils ». Le rapport officiel indique que Iakov s'est suicidé en se jetant contre une barrière électrique du camp de concentration de Sachsenhausen. Si les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été toutes élucidées, la thèse du suicide n'est cependant guère controversée.
La seconde femme de Staline, Nadejda Alliloueva-Staline, meurt le 9 novembre 1932. Elle se suicida au moyen d'une arme à feu (une balle dans le cœur) après une querelle avec Staline, laissant une lettre qui selon sa fille était « en partie personnelle, en partie politique ». Officiellement, elle mourut de maladie. Le dossier médical de Nadia, disponible aujourd'hui, révèle qu'elle souffrait de dépression et de solitude, son mari n'ayant plus guère de temps libre à lui consacrer. Militante bolchévique fervente, et bien que des amis fréquentés à l'université l'aient mise au courant des horreurs de la dékoulakisation et de la famine sévissant en Ukraine, il n'est plus certain aujourd'hui qu'une opposition à la politique de son mari ait été la raison principale de son suicide, comme on le supposait traditionnellement.
Le couple avait deux enfants : un fils, Vassili, et une fille, Svetlana Allilouieva.
Choqué par le suicide de sa mère (il avait 13 ans), et marqué par son enfance très particulière dans un foyer familial que gardaient les agents du NKVD, Vassili fut un adolescent dissolu et fugueur, travaillant mal à l'école, puis s'adonnant vite à l'alcoolisme. Il s'éleva dans les rangs de l'armée de l'air soviétique où son père l'avait poussé à s'engager, bien que Vassili n'avait pas de réel intérêt à intégrer les forces aériennes de l'armée rouge. Il se battit — plutôt bien — pendant la guerre et grâce à son père obtint d'importantes promotions. À la mort de son père, Vassili fut interné quelque temps par Beria. Il mourut officiellement d'alcoolisme en 1962 ; ce point est cependant parfois débattu.
Svetlana eut une relation privilégiée avec son père, celui-ci étant très attentionné vis-à-vis d'elle pendant son enfance, au contraire des sentiments qu'il manifestait envers ses fils. Les amis qu'eut Svetlana en grandissant étant pour certains d'origine juive, ce qui put confirmer Staline dans son idée d'infiltration de son entourage par les milieux sionistes. En 1943, il l'oblige à rompre sa relation avec un cinéaste juif, Alexis Kapler, de 24 ans plus âgé qu'elle, et envoie celui-ci au goulag. Conséquence de la dégradation croissante de leurs relations personnelles, Svetlana critiquera durement la politique de l'État et donc de son propre père après la fin de l'ère stalinienne.
Une descendance de Staline subsiste aujourd'hui. En mars 2001, la chaîne russe privée NTV découvrit un petit-fils auparavant inconnu vivant à Novokouznetsk. Iouri Davydov raconta à la NTV que son père l'avait informé de son lignage, mais, parce que la campagne contre le culte de la personnalité de Staline était à son apogée, lui avait dit de se taire. L'écrivain dissident Alexandre Soljenitsyne avait effectivement mentionné l'existence d'un fils de Staline né en 1918 durant l'exil de Staline en Sibérie du nord.
Vie privée et personnalité
« Tout petit, cauteleux, peu sûr de lui, cruel, nocturne et d'une méfiance perpétuelle, Staline paraît tout droit sortir de la Vie des douze Césars de Suétone, plutôt qu'appartenir à la vie politique moderne. » C'est ainsi que l'historien Eric Hobsbawm présente Staline dans son livre consacré à l'histoire du « court vingtième siècle ».
Staline n'a quitté la Russie qu'exceptionnellement et ne connaissait que le géorgien et le russe Après 1929, il vit cloîtré au Kremlin, dirigeant invisible qu'on ne voit en public qu'à de rares occasions. Son temps s'écoule entre son bureau et sa datcha de Kountsevo près de la capitale, avec l'été des vacances à Sotchi au bord de la mer Noire.
Staline vit en décalage temporel, utilisant la soirée et la nuit pour travailler — puis festoyer avec ses courtisans — se couchant à l'aube et se levant l'après-midi. Il impose dès lors son rythme d'existence à ses proches collaborateurs, et de là à d'innombrables fonctionnaires de Moscou et d'URSS, à tous les échelons.
Soucieux de tout contrôler dans les moindres détails, il pratique l'intervention directe dans des affaires de tout degré d'importance. Le moindre général au front, le moindre directeur d'usine ou de kolkhoze, le moindre écrivain pouvait un jour entendre son téléphone sonner avec Staline en personne au bout du fil. La moindre lettre de citoyen soviétique, la moindre demande d'aide — ou la moindre dénonciation — pouvait obtenir une réponse manuscrite de Staline en personne, ce qui contribuait à renforcer l'image d'un dirigeant omnipotent et proche des gens, mais aussi à tenir en inquiétude les responsables de tout ordre.
Bourreau de travail, Staline avait conservé de son passé de conspirateur une mémoire prodigieuse et travaillait fréquemment jusqu'à 16 heures par jour. Dévoré de la passion du pouvoir, il mène un train de vie spartiate et n'a jamais semblé intéressé par le luxe et l'argent que ce pouvoir absolu pouvait lui offrir. S'il saoule fréquemment son entourage au cours de nuits festives parfois quasi-orgiaques, lui-même reste en réalité fort sobre et se sert de ces banquets comme moyen de contrôle politique, l'alcool déliant les langues. Ainsi, en 1935, le diplomate français Alexis Léger, secrétaire général du Quai d'Orsay, alors présent à Moscou avec Pierre Laval, le président du Conseil français, constate que Staline se fait verser de la vodka depuis un carafon personnel qui, en réalité, contient de l'eau.
Des travaux récents ont contesté la représentation traditionnelle d'un Staline grossier et inculte, terrorisant ses proches à coup de colères menaçantes. La synthèse récente de Simon Sebag Montefiore, la « plus éminente médiocrité du Parti » (dixit Trotski) décrit Staline comme étant, en réalité, un autodidacte passionné et un dévoreur de livres. Sa bibliothèque comportait 20 000 volumes dont beaucoup soigneusement annotés et fichés. Il possédait tous les ouvrages de référence du marxisme, mais aussi toutes les œuvres de ses ennemis tels Trotski ou Souvarine. Il connaissait tous les grands classiques géorgiens, russes et européens, appréciait le ballet et la musique, allant revoir une vingtaine de fois incognito Le Lac des Cygnes. Tel jadis le tsar Nicolas Ier censurant en personne Alexandre Pouchkine, il lisait lui-même de nombreux manuscrits de poètes et romanciers, et visionnait pratiquement tous les films (il raffolait des westerns et des films policiers américains et était un admirateur de Spencer Tracy et Clark Gable ) qui sortaient en URSS. S'il fit éliminer sans états d'âme tous les écrivains qui avaient un jour pu le critiquer (Boris Pilniak, Ossip Mandelstam, Isaac Babel, etc.) il laissa vivre Mikhaïl Boulgakov, ou Boris Pasternak qu'il jugeait un « doux rêveur » inoffensif, et se limita à brimer Anna Akhmatova.
L'ouvrage de Montefiore, appuyé sur une masse de nouveaux documents et témoignages, souligne également la part d'humanité troublante que l'un des pires despotes du xxe siècle pouvait conserver. Comme le décrit l'historien britannique, le même homme qui détruisit froidement des millions d'existences savait aussi être un très bon mari sincèrement accablé par l'énigmatique suicide de sa femme, un père attentionné et un ami chaleureux. Surtout jusqu'aux Grandes Purges de 1937, il règne sur son entourage plus par ses capacités de charme que par ses colères ou la terreur qu'il inspirera surtout sur la fin. Pour Montefiore, ni fou ni paranoïaque, Staline suit toujours une réelle rationalité politique même dans ses plans répressifs ou son appui aux théories les plus démentes (lyssenkisme, réalisme socialiste dans l'art) pour peu qu'ils puissent renforcer son pouvoir.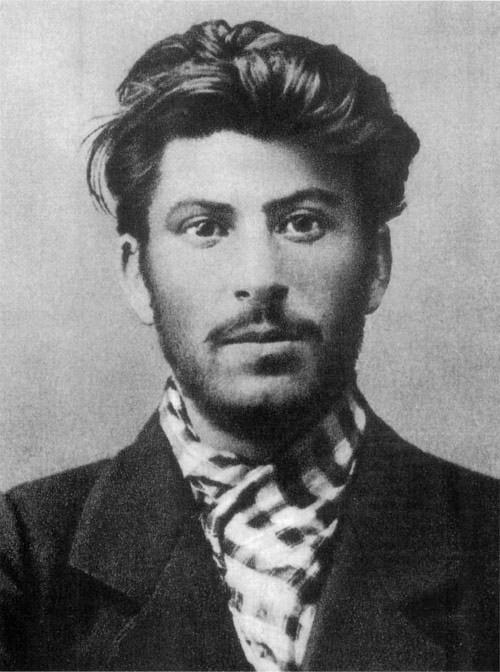  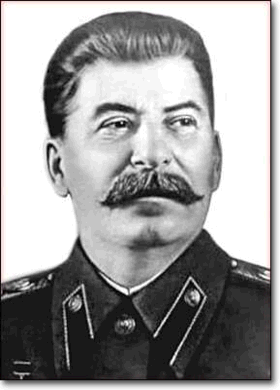       [img width=600]http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7300&g2_serialNumber=3[/img]  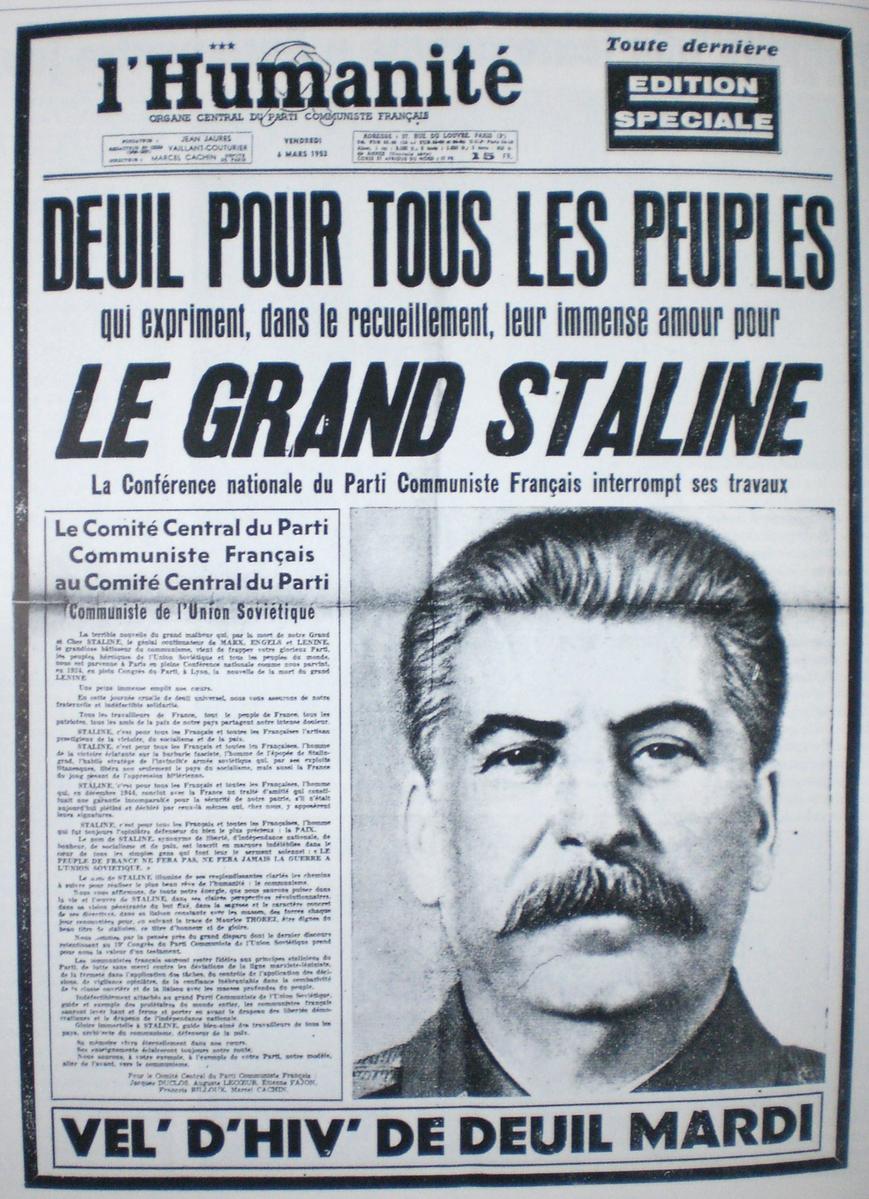 
Posté le : 20/12/2014 18:37
|
|
|
|
|
Roald Amundsen |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 décembre 1911, Roald Amundsen atteint le pôle Sud.
à quinze heures, Scott en est encore distant de 572 km, il mettra encore plus de trente-trois jours à parcourir. Roald Engelbregt Gravning Amundsen est un marin et explorateur polaire norvégien naît le 16 Juillet 1872 à Borge dans le comté d'Østfold, il décède le 18 juin 1928 à 55 ans vers l'île aux Ours en Norvège
En bref
Explorateur norvégien. Fils d'un petit armateur, Roald Amundsen se destine d'abord à la médecine avant d'être saisi d'une vocation irrésistible pour l'exploration polaire. En 1893, il s'engage comme simple matelot sur un phoquier et, de 1897 à 1899, il participe à l'expédition antarctique d'Adrien de Gerlache en qualité de second du Belgica. Sa carrière d'explorateur s'ordonne autour de trois grandes réalisations : le forcement du passage du Nord-Ouest, la conquête du pôle Sud et la première liaison aérienne Europe-Amérique par le pôle.
Nordenskjöld avait ouvert le passage du Nord-Est 1878-1879, Amundsen se consacre à celui du Nord-Ouest. Il achète le Gjöa, un vieux mais solide phoquier de vingt-deux mètres de long, monté par six hommes d'équipage et transportant pour cinq ans de vivres. Le 17 juin 1903, il part de Christiania l'actuelle Oslo et s'insinue le long de la côte canadienne jusqu'au rivage sud de l'île du Roi-Guillaume, où il hiverne pendant deux ans 9 sept. 1903-12 août 1905, profitant de ce long arrêt pour étudier le pôle magnétique Nord. Poursuivant sa route vers l'ouest, il hiverne de nouveau à King Point, près de l'embouchure du Mackensie 1905-1906. Enfin, le 30 août 1906, il pénètre dans le port de Nome Alaska, sa mission accomplie.
Il pense alors à s'attaquer au pôle Nord, mais le succès de Peary en 1909 l'oblige à changer d'objectif. Il obtient de Nansen qu'il lui confie le Fram et commence les préparatifs minutieux d'une expédition vers le pôle Sud, sur laquelle il garde un secret absolu qui ne sera levé qu'à l'escale de Madère. Parti de Norvège le 9 août 1910, il jette l'ancre dans la baie des Baleines mer de Ross, où il installe son camp de base qu'il baptise Framheim en janvier 1911. La majeure partie de l'année se passe en travaux d'aménagement, reconnaissances et installation de dépôts de vivres. Le 19 octobre, Amundsen se lance à l'assaut du pôle avec quatre hommes, cinquante-deux chiens et quatre traîneaux, engageant une dramatique course de vitesse avec le commandant Scott. Il touche au but le 14 décembre 1911, battant son concurrent britannique qui n'atteindra le pôle que le 17 janvier 1912, avant de périr sur le chemin du retour.
Après la Première Guerre mondiale, aidé financièrement par le milliardaire américain Ellsworth, il s'intéresse au survol du pôle Nord par l'avion et le dirigeable. Une première tentative, réalisée avec deux hydravions, échoue en 1925. Il recommence l'année suivante à bord du dirigeable Norge, piloté par l'Italien Nobile : s'il est devancé au pôle par l'avion de Byrd 9 mai pour l'un, 12 mai pour l'autre, il réalise la première liaison sans escale entre le Spitzberg et l'Alaska 10-13 mai 1926, ouvrant ainsi la voie à la navigation aérienne transpolaire.
En juin 1928, à l'annonce de la catastrophe du dirigeable Italia, Amundsen part à la recherche de Nobile et de ses compagnons à bord de l'hydravion Latham-47 du capitaine de corvette français Guilbaud, qui se perd corps et biens au-dessus de la mer de Barents le 18 juin 1928.
En 1898, il participe à l'expédition polaire belge d'Adrien de Gerlache de Gomery qui réalisa le premier hivernage en Antarctique. Il s'y lie avec le médecin du bord, le docteur Frederick Cook qui lui révèle le parti que l'on peut tirer des chiens Huskies dans les expéditions polaires. En 1905, il est le premier à franchir le passage du Nord-Ouest qui relie l'océan Atlantique au Pacifique dans le Grand Nord Canadien. Il commande plus tard l'expédition qui, la première, atteint le pôle Sud, le 14 décembre 1911, après être arrivé dans la baie des Baleines le 14 janvier de la même année. Préparée avec méticulosité, cette entreprise hardie était aussi le fruit du hasard. Deux ans auparavant, Amundsen avait échafaudé des plans pour étendre son exploration de l'océan Arctique et se laisser dériver jusqu'au pôle Nord. Mais il avait reçu la nouvelle que Robert Peary avait annoncé l'avoir déjà atteint ce qui fut ensuite contesté. À cet instant, racontera plus tard Amundsen, je décidai de modifier mon objectif, de changer du tout au tout, et d'aller vers le Sud . Amundsen escomptait que la conquête du pôle Sud lui assurerait la gloire aussi bien que le financement des explorations suivantes. Faisant semblant de se préparer pour le Nord, il organisa secrètement son départ pour le Sud. Mais parvenir le premier au pôle Sud n'allait pas de soi. Commandée par le capitaine Robert Falcon Scott et entourée d'une abondante publicité, une expédition britannique s'y destinait également. Amundsen n'ignorait rien des ambitions de son rival. La note du 12 septembre dans son journal de bord en témoigne : tenaillé par l'idée que Scott pourrait le prendre de vitesse, il se mit en route avant l'arrivée du printemps polaire, malgré une météo défavorable et fut le premier à atteindre le pôle sud. En 1926, après avoir survolé le pôle Nord en dirigeable, Amundsen devient le premier à avoir atteint les deux pôles. Il disparaît en juin 1928 en participant à une mission de recherche et sauvetage de l'ingénieur aéronautique et explorateur italien Umberto Nobile.
Il est, avec Douglas Mawson, Robert Falcon Scott et Ernest Shackleton, l'un des chefs de file de l'exploration polaire de l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique entre 1900 et 1912.
Sa vie
Né le 16 juillet 1872 à Borge, près d'Oslo appelé alors Christiania, entre les villes de Fredrikstad et Sarpsborg, il est le quatrième fils d'un capitaine de marine devenu armateur, Jens Amundsen. Sa mère fait pression sur lui pour l'éloigner de l'activité maritime et souhaite qu'il devienne médecin. Lors du retour triomphal de Fridtjof Nansen après sa traversée du Groenland en ski en 1889, Amundsen, alors âgé de 18 ans, décide de devenir explorateur polaire mais cache ce rêve à ses parents. En 1890, il entame cependant des études de médecine pour sa mère. Après le décès de celle-ci, en 1893, et des examens ratés, il quitte l'université pour une vie de marin. Il est alors âgé de 21 ans et s'engage pour une campagne de six mois sur le phoquier Magdalena2. Il poursuit ensuite son apprentissage de marin à bord des navires de la flotte de son père.
Ses expéditions polaires L'expédition de la Belgica, 1897-1899
En 1896 un Belge, le commandant Adrien de Gerlache de Gomery, qui prépare une expédition d'exploration scientifique en Antarctique, achète un phoquier en Norvège qu'il rebaptise Belgica. Il compose un équipage international et intègre comme second lieutenant Roald Amundsen.
La Belgica appareille en octobre 1897 et atteint la Terre de Graham en janvier 1898. Là, Amundsen participe à plusieurs raids à l'intérieur des terres équipés de ses skis ; il est le premier à en utiliser en Antarctique. En mars, le navire est pris dans la banquise de la mer de Bellingshausen au large de la Terre Alexandre, à l'ouest de la péninsule Antarctique, à 70°30'S et hiverne pendant six mois avant de rentrer en Belgique. C'est le premier hivernage en Antarctique.
Lors de cette première expédition majeure, Roald Amundsen noue une solide amitié avec le médecin du bord, l'Américain Frederick Cook, qui joue un rôle prépondérant dans la réussite de l'hivernage. Selon Amundsen, Cook a sauvé l'équipage des ravages du scorbut en lui donnant à manger de la viande de manchot. Cook, qui venait de parcourir avec Robert Peary le nord du Groenland, lui fournit de nombreuses informations sur les Inuits, leurs techniques de protection au froid ainsi que sur leurs déplacements avec des chiens d'attelage. Amundsen restera fidèle à cette amitié même au plus fort de la polémique qui opposera Peary à Cook pour la revendication de la conquête du pôle Nord.
Le passage du Nord-Ouest, Expédition Gjøa.
Après son retour en Norvège et l'obtention de son brevet de capitaine, Amundsen prépare sa première expédition personnelle. L'ouverture du passage du Nord-Ouest passage, fermé par les glaces, qui relie l'Atlantique au Pacifique par le grand nord canadien jusqu'au détroit de Béring, découvert par voie terrestre en 1822. Il n'avait jamais encore été ouvert par voie maritime. Nombreux sont les explorateurs qui ont tenté de forcer ce passage maritime : Jean Cabot, Jacques Cartier ou encore Henry Hudson, sans oublier la tragique expédition de John Franklin au milieu du XIXe siècle.
Pour son expédition, Amundsen rencontre, en décembre 1900, l'explorateur Fridtjof Nansen, qui encourage et appuie le projet. Il le complète même par une recherche plus scientifique : le pôle Nord magnétique.
Amundsen vend ses parts de l'entreprise familiale et prend le large avec six compagnons sur un navire de pêche de 47 tonnes, le Gjøa, qu'il munit d'un petit moteur. Il appareille le 16 juin 1903, criblé de dettes. Ils naviguent par la mer de Baffin, les détroits de Lancaster et de Peel, puis les détroits de Ross et de Rae.
Au lieu d'aller à l'ouest de l'île du Roi-Guillaume comme l'avait fait John Franklin, il décide de longer sa côte est. Le 9 septembre, il ancre le Gjøa sur la côte sud de l'île du Roi-Guillaume et hiverne deux ans dans une baie qu'il nomme Gjoa Haven, aujourd'hui au Nunavut, Canada.
Pendant cette longue période, occupée par des mesures magnétiques, il se rapproche du campement des Inuits Netsilik et continue patiemment à apprendre les techniques des Inuit auxquelles Frederick Cook l'avait initié, ainsi que leur langue. Il apprend à mener les chiens d'attelage et à porter des vêtements en fourrures du Grand Nord à la place des lourdes parkas en laine. Après son troisième hiver dans les glaces, il arrive à se frayer un passage dans la mer de Beaufort, et arrive au détroit de Béring. Il devient ainsi celui qui ouvre le passage du Nord-Ouest1. Continuant au sud de l'île Victoria, il quitte l'archipel arctique canadien, le 17 août 1905, et s'arrête pour l'hivernage avant de rebrousser chemin jusqu'à Nome, sur la côte pacifique de l'Alaska. Le poste de télégraphe le plus proche étant à Eagle City, à 800 km, Amundsen fait un aller-retour par la terre pour annoncer au monde par message le succès son expédition. Message envoyé PCV le 5 décembre 1905. Il arrive à Nome en 1906. Il n'aurait jamais pu accomplir son exploit sur un navire plus grand car il y avait des bas-fonds. Il a mesuré parfois un seul mètre de profondeur.
En Alaska Roald Amundsen apprend que la Norvège est devenue indépendante de la Suède et a son roi. Il envoie à Haakon VII un message lui disant que c'est un grand exploit pour la Norvège. Il lui dit qu'il espérait faire davantage pour son pays et signe Votre sujet loyal, Roald Amundsen.
Le passage du Nord-Ouest est franchi mais il est rapidement délaissé en raison des difficultés de navigation. Il faudra attendre 1977 pour qu'un voilier, le Williwaw, et son skipper Willy de Roos renouvellent l'exploit d'Amundsen.
Les pôles
La gloire permet à Amundsen de faire de fructueuses tournées de conférences à travers le monde. Il va désormais pouvoir s'attaquer au pôle arctique, dont il prévoit la conquête en utilisant la lente dérive des glaces polaires vers le nord. Pour cet exploit, Nansen lui confie son beau navire, le Fram. Mais une grande déception attend les Scandinaves : c'est à l'Américain Robert E. Peary que revient l'honneur de planter, le 6 avril 1909, la bannière de son pays au pôle... Amundsen ne renonce pas, officiellement, à son projet de dérive, et le Fram part le 6 juin 1910 pour tenter l'expérience à partir des passages du détroit de Béring. En fait, l'objectif secret du Norvégien, c'est le pôle Sud : cette fois, il va l'emporter sur un autre Anglo-Saxon, Robert Falcon Scott.
À la conquête du pôle Sud
Il est temps maintenant pour Amundsen de s'attaquer au rêve de toute sa vie : être le premier homme à atteindre le pôle Nord. Nansen lui prête le Fram et Amundsen se prépare pour une répétition de la dérive de ce dernier à travers l'océan Arctique, un projet prévu pour durer entre quatre et cinq ans. À cette époque les expéditions polaires sont en plein essor et dans un esprit de compétition entre les nations et entre les hommes, aussi bien pour le Nord Peary, Cook, Amundsen, que pour le Sud Scott, Shackleton. Cette rivalité va faire basculer le destin d'Amundsen : le 1er septembre 1909, Frederick Cook annonce qu'il a atteint le pôle Nord le 21 avril. Six jours plus tard, Peary annonce qu'il a atteint le pôle Nord, lui, le 6 avril. La grande controverse du pôle Nord commence.
Parti soi-disant pour effectuer une dérive dans l'Arctique, à partir du détroit de Béring, Amundsen annonce, à son passage à Madère, le but réel de son expédition : le sud ; il n'a pas l'intention, après la victoire de Peary au nord, de se laisser souffler par Scott un exploit aussi glorieux que la conquête du pôle Antarctique. Son navire, le Fram, un baleinier rendu célèbre par l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen qui, en 1895, s'était laissé dériver vers le pôle, à la plus haute latitude septentrionale jamais atteinte 86° 13', double le cap Horn, longe la terre du Roi-Édouard-VII et va mouiller, le 13 janvier 1911, dans une large ouverture de la plate-forme de Ross, la baie des Baleines. Son expédition dans l'Antarctique devient alors une course au pôle Sud, le capitaine britannique Robert Falcon Scott ayant conçu le même projet.
À 4 km du rivage de glace, Ramundsen monte sa maison, où il va hiverner avec sept compagnons, et établit ses magasins, pendant que Scott se prépare lui aussi à affronter l'hiver, au cap Evans. Le 14 janvier 1911, il installe son camp de base, qu'il nomme Framheim, dans la baie des Baleines à l'est de la barrière de Ross dans l'Antarctique. Lorsque le Terra Nova, le navire de Scott, pénètre dans la baie des Baleines où l'équipage découvre le Fram, les Britanniques sont frappés par la qualité de l'expédition norvégienne, l'expérience des hommes et surtout par le nombre de chiens, 130. C'est sur cette impression forte que Scott établira son camp à 700 km à l'ouest du camp d'Amundsen au Cap Evans.
Robert Falcon Scott prépare une expédition, l'expédition Terra Nova, d'après les notes et les cartes d'une route ouverte en fin 1908-début 1909 par Ernest Shackleton, son ex-lieutenant de sa précédente expédition Discovery 1901-1904, devenu à son tour chef d'expédition, l'expédition Nimrod, et contraint de faire demi-tour le 9 janvier 1909 à 180 km du pôle sud. Scott donc, hâte ses préparatifs. Amundsen apprenant en peu de temps les nouvelles du Nord comme celles du Sud, de cette année 1909 chargée, prend immédiatement la décision de changer ses plans et de mettre cap au Grand Sud pour tourner la page de la conquête du pôle sud. Il tient cette nouvelle rigoureusement secrète y compris vis-à-vis de son équipage seuls son frère et son second seront au courant du changement de destination.
Le 3 juin 1910, il appareille officiellement de Christiania — aujourd'hui Oslo. Une fois à Madère, Amundsen informe son équipage du changement de destination et envoie un télégramme à Scott BEG TO INFORM YOU FRAM PROCEEDING ANTARCTIC--AMUNDSEN Prends liberté vous informer Fram fait route vers l'Antarctique. Tous les membres de l'équipage décident de rester avec leur capitaine.
Utilisant des skis et des chiens d'attelage, Amundsen et son équipage créent des dépôts de ravitaillement aux 80°, 81° et 82° degrés Sud en ligne droite vers le pôle. Après une tentative avortée le 8 septembre 1911, le 19 octobre Amundsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel et Oscar Wisting prennent le départ. Ils prennent quatre traîneaux et 52 chiens il prévoyait de tuer quelques chiens au retour pour se nourrir ainsi que ses hommes et les chiens restants. Ouvrant une voie jusqu'alors inconnue, sur le glacier Axel Heiberg ils arrivent sur le plateau polaire le 21 novembre après une ascension de quatre jours.
Amundsen part pour le pôle le 20 octobre 1911, avec quatre compagnons et quatre traîneaux tirés chacun par treize chiens, et assez de vivres pour quatre mois. La traversée de l'immense champ de glace peu accidenté que limite la barrière de Ross s'effectue sans grandes difficultés : plus de 1 700 km sont parcourus en moins d'un mois. Le temps est favorable, et le voyage se déroule sans encombre. Mais le voyage devient plus difficile à travers un massif montagneux qu'Amundsen appelle la chaîne de la Reine-Maud, qui limite le haut plateau antarctique. L'expédition s'insinue à travers elle par le grand glacier Axel Heiberg. D'autres obstacles sont contournés. Au pied de la chaîne des monts Dominion, c'est un terrible glacier, labouré d'innombrables crevasses et baptisé par Amundsen la Salle de bal du Diable. Il faudra seize étapes pour franchir les 320 km de la région montagneuse. Enfin, le 6 décembre, le point culminant du parcours est franchi, quand l'équipe escalade un sommet de 3 276
mètres. Peu après, les plus grandes difficultés surmontées, le plateau est abordé.
Le 14 décembre 1911, à trois heures de l'après-midi, des observations du ciel confirment qu'ils ont atteint le pôle Sud. Le drapeau norvégien est planté. Rendant hommage à ses compagnons, Amundsen les décrit ainsi : Après avoir été à la peine, ils devaient être aujourd'hui à l'honneur. Saisissant tous les cinq la hampe, nous élevâmes le pavillon et, d'un seul coup, l'enfonçâmes dans la glace. L'équipe demeure sur place jusqu'au 17 décembre, effectuant des relevés et des observations, et font des raids dans toutes les directions pour couper court à toutes contestations possibles quant à leur localisation du pôle : l'un d'eux, de toute façon, aura foulé la latitude 90°. Amundsen nomme leur camp du pôle Sud Polheim, maison au pôle. Il renomme le plateau Antarctique le plateau Haakon VII. Lui et son équipe laissent une petite tente et une lettre adressée au roi Haakon où il raconte leur exploit au cas où ils périraient au cours de leur retour à Framheim. Le retour, par le même itinéraire qu'à l'aller, s'effectue vite et sans grandes difficultés. Ils survivent et rentrent le 25 janvier 1912 avec 11 chiens d'attelage après avoir parcouru 2 824 km en 97 jours 56 à l'aller, 38 au retour soit une moyenne de 30 km par jour.. Les dépôts de vivres sont retrouvés. Le 30 janvier, le Fram quittait la baie des Baleines, et, le 8 mars, Amundsen pouvait télégraphier à son roi et au Daily Chronicle la nouvelle de son exploit. Entre-temps, Scott et quelques membres de son groupe ont atteint le pôle le 17 janvier, après un périple épuisant. Ils y trouvent le drapeau d'Amundsen et les messages qu'il a laissés. Scott et tous ses compagnons périssent sur le chemin du retour.
Le succès de l'expédition d'Amundsen tient à une préparation soignée, des équipements de qualité, des vêtements appropriés en peau animale, des tâches matérielles simples Amundsen ne fait pas de relevés pendant le voyage au pôle et ne prend que deux photos, une bonne connaissance des chiens d'attelage, et l'usage des skis. En contraste avec l'expédition de Scott, celle d'Amundsen est sans surprise et bien planifiée.
Dernières explorations
Le Fram devenant vieux, Amundsen équipe un nouveau navire, la Maud. En 1918, à bord de ce dernier, il franchit le passage du Nord-Est ouvert en 1879 par le suédois Nils Gustaf Nordenskiöld, devenant le premier homme à franchir les deux passages mythiques de l'Arctique. Il veut figer la Maud dans la glace de la banquise pour dériver avec comme Nansen avait fait avec le Fram, mais il ne réussit pas. Toutefois, les études scientifiques menées à bord, principalement par Harald Sverdrup, sont d'une grande valeur.
L'aviation attire Amundsen. Il obtient son brevet de pilote en 1918. En 1923, il projette de tenter un vol au-dessus du pôle Nord mais son avion s'écrase quelques jours avant le départ. Un millionnaire américain, Lincoln Ellsworth lui propose alors de financer le projet à condition d'en faire partie. En mai 1925, Amundsen, Ellsworth et le pilote Hjalmar Riiser-Larsen ainsi que trois autres membres d’équipage décollent du Spitzberg à bord de deux hydravions, le N-24 et le N-25, et réalisent un vol avant de se poser en catastrophe à 87°44' de latitude Nord. Les avions se posent sur la glace à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre, mais les équipages arrivent à se réunir. Le N-24 étant trop endommagé, ils travaillent trois semaines pour créer une piste de décollage. L'accueil est triomphal, le public pensant qu'ils étaient perdus à jamais.
L'année suivante, en 1926, Amundsen, Ellsworth, Riiser-Larsen, Wisting et l'ingénieur en aéronautique Umberto Nobile décident une tentative en dirigeable, l'Italie propose un navire à la condition que Nobile fasse partie de l'équipage. Le Norge, conçu par Nobile, quitte le Svalbard le 11 mai 1926, survole le pôle Nord à 1 h 30 et arrive à Teller en Alaska deux jours plus tard.
Les trois revendications du premier voyage au pôle Nord, Cook en 1908, Peary en 1909, et Byrd en 1926 — ce dernier quelques jours avant le Norge, étant disputées, soit par inexactitude géographique ou accusations de mensonge, le voyage du Norge est considéré par certains comme le premier à avoir réellement survolé le point mythique 90° N. Ainsi, Amundsen et Wisting seraient les premières personnes à avoir atteint les deux pôles.
Disparition
Amundsen annonce sa retraite après le voyage du Norge. Malgré son énorme gloire, particulièrement dans son pays natal, il est toujours profondément endetté. Ses relations avec Umberto Nobile se sont dégradées. Il accepte toutefois de prendre part à une mission de recherche et sauvetage de Nobile et son équipage du dirigeable Italia, écrasé au nord du Spitzberg en revenant du pôle Nord. Il s'envole le 18 juin 1928 à bord d'un hydravion Latham 47 de la marine nationale française avec son compatriote, le pilote Leif Dietrichson. L'équipage est composé du capitaine de corvette René Guilbaud, du lieutenant de vaisseau Albert Cavelier de Cuverville, du maître mécanicien Gilbert Brazzi et du second maître radiotélégraphiste Emile Valette. Aucun d'entre eux ne reviendra. Seul un flotteur et un réservoir de l'hydravion ainsi qu'un radeau de fortune sont retrouvés près de la côte de Tromsø. Il est probable que l'hydravion se soit écrasé, désorienté dans un brouillard, quelque part dans la mer de Barents, et qu'Amundsen soit mort lors de l'accident ou peu après. Son corps n’a jamais été retrouvé. Le gouvernement norvégien n’a stoppé les opérations de recherche d’Amundsen qu'en septembre de la même année. Plus récemment, en 2003 on supposait que l'hydravion s'était écrasé au nord-ouest de l'île aux Ours.
Le 24 février 2009, la marine norvégienne annonce une expédition pour le mois d'août 2009 afin de rechercher les restes de l'épave. À l'aide d'un sous-marin automatisé, baptisé Hugin, l'exploration d'une centaine de km2 au nord-ouest de l'île aux Ours pourrait retrouver les débris du Latham 47 disparu quelque 81 ans auparavant8. En 2010, le documentaire Roald Amundsen, sur les traces du grand explorateur polaire de l'Allemand Rudolph Herzog, relate notamment les dernières recherches d'août 2009. Ces recherches sont restées infructueuses.
Postérité
Aujourd'hui plusieurs lieux polaires sont nommés en honneur d'Amundsen, dont la base Amundsen-Scott au pôle Sud, la mer d'Amundsen et le glacier Amundsen en Antarctique, et le golfe d'Amundsen dans l'océan Arctique. Il existe également le cratère Amundsen, près du pôle Sud de la Lune. L'écrivain Roald Dahl a reçu son prénom en l'honneur d'Amundsen. Un navire de recherche de la Garde côtière canadienne a également été nommé en son honneur, le NGCC Amundsen
Publications
En avion vers le pôle nord de Roald Amundsen, aux éditions Albin Michel   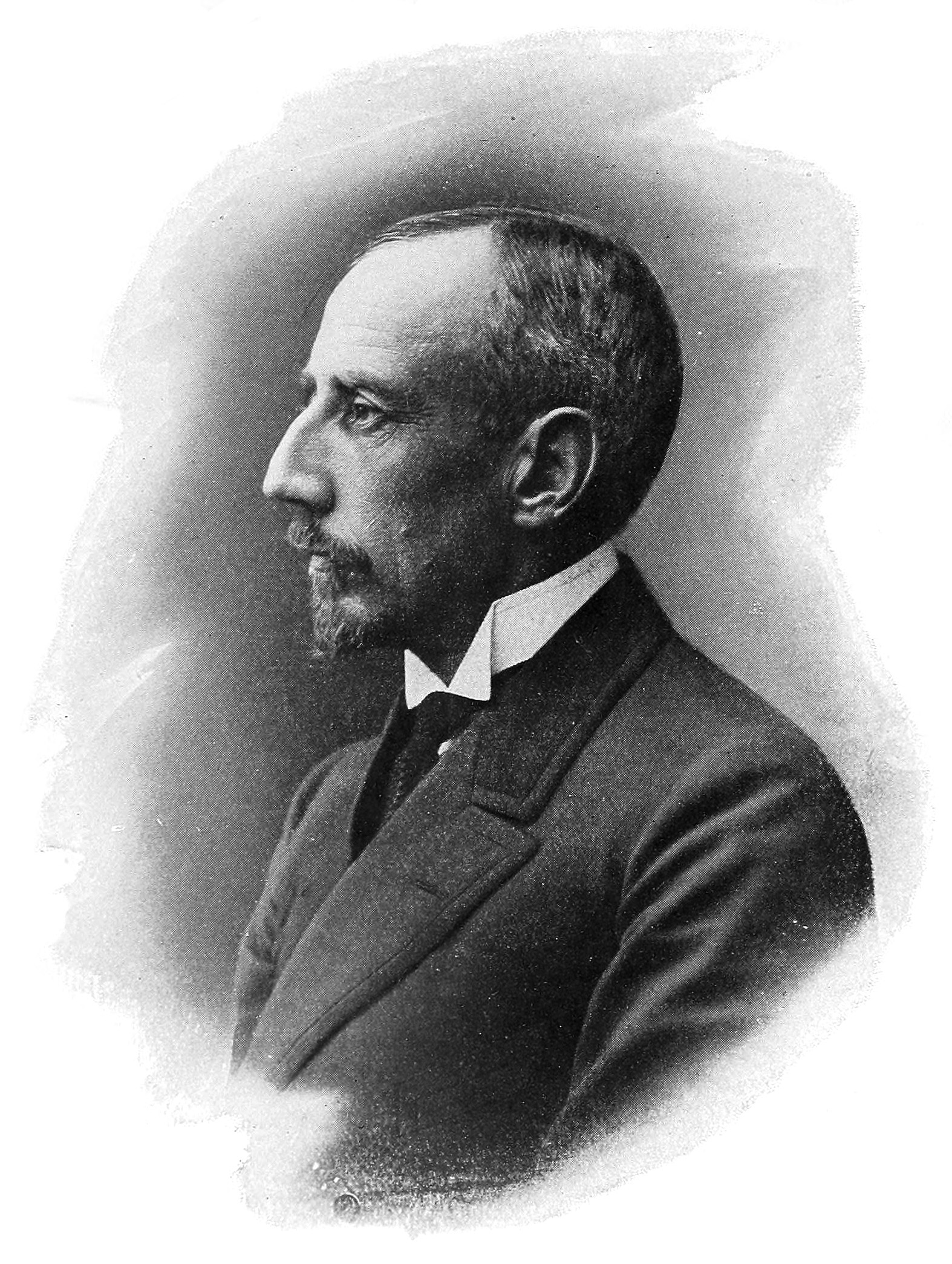   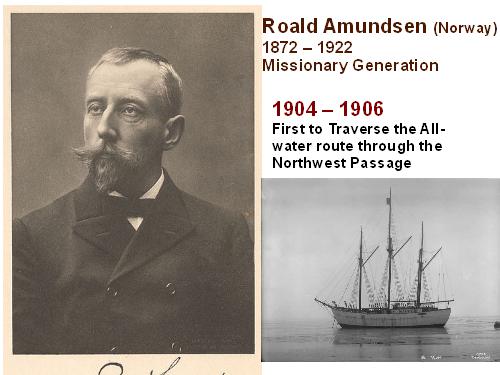  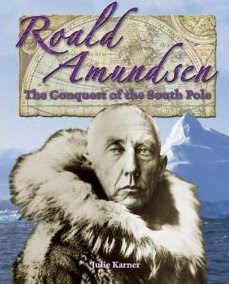    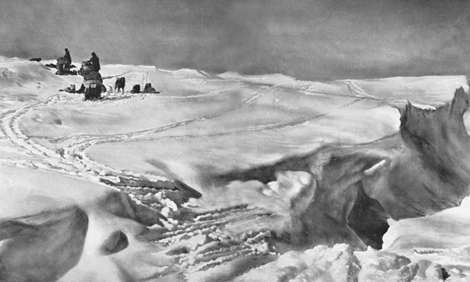 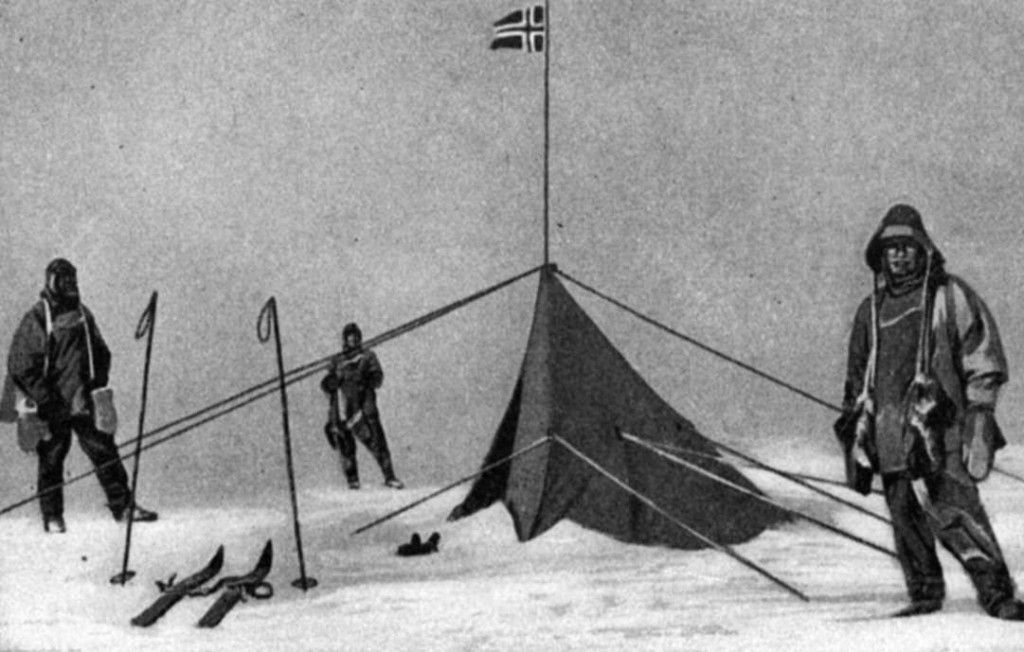
Posté le : 13/12/2014 16:35
Edité par Loriane sur 14-12-2014 13:10:27
Edité par Loriane sur 14-12-2014 13:11:08
|
|
|
|
|
Albert de Saxe-Cobourg |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 14 décembre 1861 meurt le prince François Auguste Charles Albert
Emmanuel de Saxe-Cobourg et Gotha,

Franz August Karl Albert Emanuel von Sachsen Coburg und Gotha, au château de Windsor, né le 26 août 1819 au château de Rosenau près de Cobourg, il fut un membre de la famille royale britannique. Il était l'époux et le prince consort de la reine Victoria, avec laquelle il vécut jusqu'à sa mort, à 42 ans, consécutive à une fièvre typhoïde. Il est prince consort du Royaume-Uni du 10 février 1840 au 14 décembre 1861, soit durant 21 ans, 10 mois et 4 jours, il appartient à la dynastie de la Maison de Saxe-Cobourg-Gotha, il repose au Château de Windsor mBerkshire, Royaume-Uni, il à pour sépulture un mausolée royal de Frogmore, son père est Ernest Ier de Saxe-Cobourg-Gotha, sa mère est Louise de Saxe-Gotha-Altenbourg
Conjoint de Victoria du Royaume-Uni, ils auront ensemble 9 enfants : Victoria, princesse royale, Édouard VII , Alice du Royaume-Uni, Alfred , Helena du Royaume-Uni, Louise du Royaume-Uni, Arthur duc de Connaught et Strathearn, Leopold,duc d'Albany et Béatrice du Royaume-Uni
En Bref
François-Auguste-Charles-Albert-Emmanuel de Saxe-Cobourg et Gotha naquit le 26 Août 1819 au château de Rosenau, résidence d'été de la famille Saxe-Cobourg en Allemagne. Il est le second fils du Duc Ernest III de Saxe-Cobourg-Saalfeld, frère de futur roi des belges Léopold Ier et de la duchesse Louise de Saxe Altenbourg. Il eut comme parrains et marraines l'Empereur d'Autriche, le Duc de Gotha, le Duc Albert de Saxe-Teschen, le Comte de Mensdorff et la Duchesse de Cobourg. Son baptême se déroula le 19 Septembre 1819. À la mort de l'oncle d'Albert Frédéric Iv de Saxe-Cobourg-Gotha Altenbourg, on fera du tri dans les duchés c'est pourquoi le père d'Albert aura pour titre duc de Saxe-Cobourg-Gotha.
Il eut une enfance heureuse et chaleureuse mais un drame le secoua ainsi que toute sa famille. Ses parents divorcèrent plus précisément sa mère fut chassée en 1824 par son père pour cause d'adultère. Elle se remariera avec Alexander Von Hanstein, comte de polzig et Beiersdorf, son amant. Elle ne reverra plus ses enfants, elle décèdera à l'âge de 30 ans en 1831. Quant à son père, il se maria avec sa propre nièce Marie-Antoinette de Wurtemberg. Ce sera un mariage pas très heureux (car les époux n'étaient pas proches...
Lui et son frère Ernest reçurent une éducation privée qui se déroula au sein de leur château par Christoph Florschütz mais également à Bruxelles. Par la suite, il continuera son éducation à l'université de Bonn où il sera diplômé.
Il étudiera le droit, l'histoire de l'art, la philosophie, l'économie, la politique..... Il fut également un très bon musicien et un sportif tels que l'escrime et l'équitation. C'est cette éducation qui voudra transmettre à ses propres enfants.
En 1839, par exemple, le prince Albert, revenant d'Italie, trouva à Cobourg, dans sa chambre à coucher, un portrait de Victoria devenue reine, placé là par son ordre et à l'insu du prince. Plus tard, voulant lui témoigner qu'elle l'avait choisi pour époux, elle lui donna tout simplement, au milieu d'un bal et pendant un quadrille, le bouquet qu'elle avait porté. Le prince Albert plaça romanesquement le bouquet sur son cœur, après avoir déchiré son habit.
Le fait que la reine Victoria veuille se marier avec un allemand dérangea beaucoup de personnes tels certains parlementaires et membres de la famille royale (oncles de victoria. Le fait qu'albert soit le mari de la reine d'angleterre ne lui donna pas tous droits par exemple il n'aura le titre de roi, il sera nommé « prince consort » par l'insistance de victoria. Ce titre qui lui conférera le 25 juin 1857, lui permettra en cas de mort prématurée de la reine d'être régent mais ne pourra pas jamais régner. les parlementaires lui accordera une rente 30 000 £ sterling. Il n'aura aucun rôle politique mais influencera son épouse en tout points.
Ses titres
- du 26 août 1819 au 12 novembre 1826 : Son Altesse Sérénissime le prince Albert de Saxe-Cobourg-Saalfeld, Duc de Saxe
- du 12 novembre 1826 au 6 février 1840 : Son Altesse Sérénissime le prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, Duc de Saxe
- du 6 février 1840 au 25 juin 1857 : Son Altesse royale le Prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha , Duc de Saxe
- du 25 juin 1857 au 14 décembre 1861 : Son Altesse royale le Prince Consort
Sa vie
Il est né dans une fratrie de quatre enfants dont il était le deuxième. Son père, le duc Ernest Ier de Saxe-Cobourg, d'abord duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld, puis duc de Saxe-Cobourg et Gotha, était le frère aîné du roi Léopold Ier de Belgique ainsi que de la mère de la reine Victoria.
Alors que Victoria n'était qu'une enfant, le roi Leopold de Belgique, le duc Ernest de Saxe-Cobourg et la duchesse douairière de Saxe-Cobourg avait planifié qu'elle épouserait son cousin le prince Albert de Saxe-Cobourg Gotha. Le prince Albert était né le 26 aoüt 1819, 3 mois après Victoria au château de Roseanu près de Coburg.
Il était le deuxième fils du duc Ernest de Saxe-Cobourg, le frère aîné de la duchesse de Kent et de la princesse Louise, héritière des états de Saxe-Gotha.
Le frère aîné d'Albert s'appelait Ernest comme son père. La mère d'Albert, Louise, le duc Ernest âgé de 32 ans alors qu'elle n'avait que 16 ans. Le duc Ernest a toujours été un homme dissolu et il continua à se vautrer dans la débâuche, négligeant indûment sa pauvre épouse.
Après la naissance d'Albert, la princesse Louise chercha consolation auprès d'un autre homme. Le duc Ernest demanda le divorce en 1826 et Louise se vit interdire tout contact futur avec ses fils. Il lui arrivait parfois de les surveiller de loin sur la place du marché de Cobourg.
Louise se remaria mais, elle mourut d'un cancer de l'utérus en 1831. Le duc Ernest aussi contracta une nouvelle union, cette fois avec sa nièce, Marie de Wurtemberg, la fille de sa soeur Antoinette, ce mariage fut stérile. Malgré l'absence de sa mère, l'enfance du prince Albert se déroula de manière heureuse et libre.
Il était très attaché à son frère Ernest. En grandissant, il devint studieux et brilla par son intelligence; c'était un luthérien dévot, il aimait la musique et contrairement à son père et à son frère, il montrait des principes très rigides quant aux questions morales.
Les deux frères visitèrent l'Angleterre pour la première fois en 1836 quand Victoria n'était pas encore reine. Il semblerait qu'Albert ne fit pas cette fois grande impression sur sa royale cousine. Albert et Ernest visitèrent de nouveau l'Angleterre en octobre 1839. Victoria était maintenant reine et, quand elle s'aperçut son cousin Albert, elle sut immédiatement qu'elle en était amoureuse. Elle écrivit dans son journal: 'C'est avec émotion que j'ai fait la connaissance d'Albert qui est si beau... de si beaux yeux bleus, un nez exquis et une si jolie bouche surmontée de délicates moustaches; un bel homme, large d'épaules avec la taille fine'.
Victoria et Albert célébrèrent leur mariage le 10 février 1840.
Prince consort Un rôle à inventer
La vie était difficile pour Albert en Angleterre; il agissait en tant que secrétaire personnel de son épouse mais, à cause de ses origines allemandes, il n'était pas populaire et on le tint éloigné des affaires politiques ce qui lui déplût car il était très intéressé par le sujet.
De plus, la préséance de sa femme sur lui n'était pas facile à assimiler et certaines difficultés commencèrent à ébranler leur couple. De fait, la reine affirma: 'Albert vit dans ma maison, pas moi dans la sienne'.
En 1854, la reine Victoria menace d'abdiquer devant la virulence des attaques dont son mari très aimé est l'objet. En effet, au moment où menace la guerre contre la Russie, le prince Albert est ouvertement accusé de sympathies avec l'empire des tsars.
Quoiqu'il en soit, Victoria l'aimait énormément et, il commença à prendre la place de Lord Melbourne dans la vie de la reine. Victoria et Albert eurent 9 enfants durant leur mariage: Victoria Vicky, Albert Edward Bertie, Alice, Alfred Alfie, Héléna Lenchen, Louise, Arthur, Leopold et Beatrice. Vicky était la favorite d'Albert alors qu'Arthur était l'enfant chéri de Victoria. Bertie, le prince de Galles était constamment repoussé par ses parents à cause de son caractère rebelle et de sa paresse. La famille avait l'habitude de passer beaucoup de temps dans leurs maisons de campagne, Balmoral en Écosse et Osborne sur l'Isle de Wight, cette dernière demeure dessinée par Albert lui-même.
C'est justement au moment de la guerre de Crimée, que le prince participa à la réorganisation de l'armée, puis se révéla un excellent conseiller pour la reine qui le mit discrètement à contribution, écoutant ses avis avec beaucoup d'attention.
Rôle dans le gouvernement
Si les premières années, il n'assistait pas aux entretiens de la reine avec les ministres, il fut par la suite toujours présent, au courant de tout et accomplissant, avec passion et compétence, un travail important pour alléger la tâche de sa femme. C'est d'ailleurs en reconnaissance de ce travail que la reine Victoria créa le titre de prince consort. En 1841, Lord Melbourne perdit de nouveau ses élections et sir Robert Peel reprit le poste de Premier Ministre. Victoria se désolait car elle n'aimait pas du tout sir Robert. Un an après avoir perdu son poste, Lord Melbourne souffrit d'une attaque de paralysie; il continua d'entretenir une correspondance avec la reine mais, c'était maintenant un vieil homme solitaire et mélancolique.
Il mourut en 1848. Après l'accession de sir Robert, le prince Albert commença à participer activement aux affaires d'état. Il ressemblait à Peel sur plusieurs points, tous deux étaient intelligents, ils avaient une façon de penser similaire et une morale très stricte. Peel invita Albert à présider la Comission Royale pour la promotion des Arts; le prince organisa aussi et réforma la Maison Royale de la reine. L'attitude de Victoria envers Peel se modifia dès qu'elle s'aperçut dans quelle estime le Premier Ministre tenait le Prince Albert. Le prince devint graduellement l'axe principal du gouvernement de Peel. À la fin de son mandat, c'était pratiquement Albert qui dirigeait le royaume.
En 1861, il intervint de façon discrète et efficace auprès du Premier ministre Lord Palmerston pour empêcher une guerre avec les Etats-Unis lors de l'affaire du Trent : en effet, la marine américaine avait intercepté un navire anglais qui transportait des ambassadeurs de la Confédération en Europe. Le prince Albert retouche et adoucit le ton de la lettre rédigée par le ministre des affaires étrangères à l'intention de son homologue américain.
Il était doué dans un grand nombre de matières ; bon organiste et bon compositeur, il avait un goût sûr en peinture et s'occupa des collections royales et prit aussi des décisions en architecture. Dans les fermes de Windsor, il fit expérimenter de nouvelles techniques de production agricole, et avait des compétences en apiculture et en botanique. Sportif, il affectionnait les longues marches à pied, pratiquait la chasse à courre, le tir et le patin à glace.
Conseiller de la reine, chancelier de l'université de Cambridge, président de la commission des Beaux-Arts, président de la société pour l'amélioration de la condition des classes laborieuses, il eut une vie très active au service du Royaume-Uni.
Exposition universelle
Mais son œuvre maîtresse officielle et le point culminant de sa carrière de prince consort, fut l'organisation et la direction de la première grande exposition universelle, celle de 1851 dans Hyde park. Chaque pays y exposait des exemples de ses apports en matière de machinerie, technologie, inventions mécaniques, production ainsi que des oeuvres d'arts plastique et appliqués. Le Prince Albert avait passé beaucoup de temps à planifier et préparer cette exposition. Albert détermina quel édifice allait la recevoir, son choix se porta sur celui déssiné par Joseph Paxton: le Crystal Palace, une immense structure de cristal et de fer de 550 m de long, 120 m de large et 30 m de haut, sur le site de Hyde Park. Après plusieurs mois de préparation, la reine inaugura la Grande Exposition en mai 1851. Chaque pays y exposait des exemples de ses apports en matière de machinerie, technologie, inventions mécaniques, production ainsi que des oeuvres d'arts plastique et appliqués. Le Prince Albert avait passé beaucoup de temps à planifier et préparer cette exposition. Ce fut un grand succès pour le prince Albert. Les bénéfices qu'on en retire furent énormes et les revenus qu'elle généra servirent à bâtir le Royal Albert Hall, le Royal College of Music, le Imperial College of Science and Technology ainsi que les musées de South Kensington. Elle regroupa 14 000 exposants, dont 6 500 venus de l'étranger, et marqua le triomphe du Royaume-Uni industriel et de l'âge mécanique. Elle fut visitée par six millions de visiteurs du monde entier, la reine elle-même y viendra une quarantaine de fois. De plus elle fut un grand succès financier et le prestige du prince fut considérablement accru ce qui renforça son influence politique, discrète mais réelle.
Une Reine amoureuse
Sous son règne, l'Empire britannique représentait le cinquième des terres émergées, l'apogée du régime. La reine Victoria Ier n'a pas seulement connu le faste du pouvoir, elle a aussi vécu une grande histoire d'amour. La jeune Victoria rencontre à seize ans le Prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, son cousin germain et futur mari. En 1838, Victoria monte sur le trône, et épouse Albert, deux ans plus tard, à l'âge de 20 ans. Le Prince, d'origine allemande, a connu deux précédentes unions. Celle avec Victoria sera la plus longue et la plus heureuse, selon de nombreux historiens. Ensemble, ils auront neuf enfants et assumeront les diverses tâches officielles, Albert devenant un conseiller politique très écouté de la Reine. Mais le 14 décembre 1861, le Prince Consort succombe à la fièvre typhoïde. Dévastée, Victoria ne s'habille plus qu'en noir et limite ses apparitions publiques pendant une dizaine d'années. Après soixante-trois ans de règne, elle meurt le 22 janvier 1901 à l'âge de 82 ans.
Le deuil d’une reine –
Le 14 décembre 1861 le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, époux de la reine Victoria, meurt au château de Windsor. Il a quarante-deux ans.
La reine tombe en désespoir et Windsor devient le palais de la mort. Le temps y est suspendu, toutes choses immobilisées. Dans l’antichambre, les gants et le chapeau de chasse du prince restent là où il les a jetés pour la dernière fois. Dans le parc, une pierre marque l’endroit où il a tiré son dernier coup de fusil. La chambre bleue où il a rendu l’âme se fige dans un rituel immuable ; chaque matin, le valet de chambre dispose sur le divan l’habit du prince, son gilet, ses chaussettes, ses chaussures. Dans le cabinet de toilette il remplit le pot d’eau chaude comme si son maître allait se raser. Chaque soir, pour le dîner, il lui prépare une chemise propre. Victoria a fait prendre des photos d’Albert sur son lit de mort ; dans tous les châteaux royaux, elle en accroche une au montant de son lit, à sa droite, la place que le défunt occupait la nuit auprès d’elle. Elle fait sculpter des bustes d’Albert, elle les dispose dans toutes les pièces où elle se tient, elle ne se fait jamais photographier sans l’un d’eux. Quant à son papier à lettres, il est bordé d’une bande noire si large qu’elle peut à peine y tracer quelques mots.
La chambre bleue après la mort d'Albert
Le chagrin de la reine est sincère. Mais elle l’exprime selon les usages, et rien dans son comportement ne semble extraordinaire à une Angleterre qui s’associe au deuil. La Cour et le Parlement se sont mis au noir. Dans Oxford street, à Londres, les boutiques ne vendent plus que des plumes d’autruche noires pour les chapeaux des dames, des brassards de crèpe, des manteaux violets et des plumets noirs pour les chevaux. Le mariage de la princesse Alice, en juillet, ne détonne pas : le trousseau de la marié est noir, les hommes portent le deuil, les femmes sont en mauve, l’autel nuptial se dresse sous un grand portrait d’Albert ; le doigt levé, le prince semble bénir les mariés.
Mais au bout d’un an les usages veulent que la reine, symbole de la nation, sorte du deuil et se montre. Elle n’en fait rien, pour elle Albert règne toujours. Elle refuse de rentrer à Buckingham, elle continue à inonder de larmes les manteaux d’Albert, ses chapeaux, ses kilts et toutes les reliques dont elle s’est fait un rempart contre le monde. Alors l’opinion s’impatiente et l’on voit même apparaître, my goodness, un parti républicain. Victoria sera tiré d’affaire par John Brown, son fidèle et broussailleux serviteur écossais, qui l’appelle « femme » et lui donne des ordres. Mais c’est une autre histoire.
La famille royale
Descendance de la reine Victoria du Royaume-Uni.
On peut aussi mettre au bilan du prince l'apport, à la cour du Royaume-Uni, de la coutume allemande de l'arbre de Noël
Armes du prince Albert en tant que prince consort
Le prince Albert est à sa naissance un prince allemand membre de la maison de Saxe-Cobourg-Saalfeld qui deviendra Saxe-Cobourg-Gotha lorsque son père prendra la tête du duché du même nom. Après son mariage avec la reine Victoria, il est titré prince consort en reconnaissance du soutien qu'il apporte à Victoria dans sa charge de souveraine. Il est le seul consort britannique à avoir été titré officiellement prince consort prince consort est ici un titre de la pairie du Royaume-Uni et non un titre de courtoisie.
Il porta successivement les titres de:
Son altesse sérénissime le prince Albert de Saxe-Cobourg-Saalfeld, duc de Saxe 1819-1826
Son altesse sérénissime le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Saxe 1826-1840
Son altesse royale le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Saxe 1840-1857
Son altesse royale le prince consort 1857-1861
Postérité
Le prince consort a laissé son nom :
à l'Albert Memorial
au Royal Albert Hall de Londres
au Victoria and Albert Museum
à la ville de Prince Albert en Afrique du Sud
à la ville de Prince Albert au Canada province de la Saskatchewan
             
Posté le : 13/12/2014 15:56
|
|
|
|
|
Marie Walewska |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 7 décembre 1786 naît Marie Walewska ou Waleska
à l'origine Maria Łączyńskà Brodno, à Brodno en Pologne, morte, à 31 ans, à Paris le 11 décembre 1817 à Paris, est connue pour avoir été l'une des maîtresses de Napoléon Ier, épouse de Anastazy Walewski dont elle a un fils Antoine walewski, puis de Philippe Antoine d'Ornano avec qui elle aura un fils Rudolf-August d'Ornano ; elle est également désignée comme la femme polonaise de Napoléon, Napoléon 1 avec qui elle aura Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski. La jeune Marie appartient à une famille ancienne de la noblesse polonaise. Très respectée, elle s'est distinguée à travers les âges au service de la Pologne. À la fin du xvie siècle, Jérôme Hieronym Łączyński est connu comme juriste. Au XVIIIe siècle, la branche cadette de la famille s'établit en Pologne orientale et la branche aînée, la plus ancienne, en Pologne centrale.
Durant le règne de Stanislas-Auguste, le père de Marie, Mathieu Maciej Łączyński reprend le domaine familial lorsque son frère aîné décide d'entrer dans les ordres.
En 1792, la Pologne subit le second partage et perd une bonne part de son territoire. En 1794, Mathieu participe à l'insurrection de Kosciuszko, qui ne parvient pas à éviter le troisième partage 1795 ; cela met fin au royaume de Pologne. Les terres de la famille font partie du territoire incorporé à la Prusse. Mathieu, blessé durant une des batailles, meurt en mai 17953.
En bref
Marie Laczynska est née le 7 décembre 1789 à Varsovie.
En 1804 elle épouse le comte Athénase Walewski, beaucoup plus âgé qu'elle il a 70 ans. Un petit Antoine naît de leur union en 1805.
Elle a 18 ans quand elle rencontre Napoléon, le 1r janvier 1807, au relais de Blonie. Elle voudrait le convaincre de donner l'indépendance à la Pologne. Ses amis la poussent à accepter les avances de l'Empereur, geste qu'ils qualifient de "patriotique".
Le "sacrifice" se transforme en amour et le 4 mai 1810 ils ont un fils: Alexandre Walewski.
Marie est discrète et fidèle. Son désir est de suivre Napoléon et d'être à ses côtés dans les moments difficiles. Elle tente en vain de le voir à Fontainebleau. Début septembre 1814, elle passe 3 jours à l'île d'Elbe. Elle voit l'Empereur pour la dernière fois à Malmaison, après Waterloo. Il refuse qu'elle le suive à Sainte-Hélène.
Etant veuve, elle épouse le comte Philippe-Antoine d'Ornano, un cousin éloigné, en septembre 1816. Elle meurt le 11 décembre 1817, à 31 ans, des suites d'un accouchement.
Son coeur est placé dans la crypte de la famille d'Ornano au cimetière du Père Lachaise, à Paris, et son corps est ramené en Pologne.
Elle était blonde, elle avait les yeux bleus et la peau d'une blancheur éblouissante; elle n'était pas grande, mais parfaitement bien faite et d'une tournure charmante. Une teinte légère de mélancolie, répandue sur toute sa personne, la rendait plus séduisante encore.
Sa vie
Marie naît le 7 décembre 1786 à Brodno, village proche de Kiernozia en pologne. La première enfance de Marie fut heureuse, bien que souvent solitaire. Après la mort de son père, son enfance est marquée par le précepteur engagé par sa mère, Eva ; c'est un Français venu en Pologne sept ans plus tôt, Nicolas Chopin, le père de Frédéric. De 1795 à 1802, il éduque Théodore et Marie, puis les deux autres filles, Antonine et Honorée, avant d'entrer au service d'une famille amie des Laczynski, la famille Skarbek.
À cette époque, de nombreux jeunes gens quittent le pays pour s'engager dans l'armée de Bonaparte, en particulier les Légions polonaises formées à Mantoue sous le commandement du général Jean-Henri Dombrowski. C'est d'ailleurs le cas du frère aîné de Marie, Benoît Benedykt, qui deviendra général en 1804 Théodore, deviendra colonel de l'armée française.
Un peu avant son quatorzième anniversaire, Marie part pour le couvent Notre-Dame de l'Assomption à Varsovie, où les jeunes filles de bonne famille étaient envoyées pour y compléter leur éducation. Marie fut heureuse dans cette vie nouvelle. Marie est intelligente et studieuse, avec une douceur de caractère qui l'a fait aimer par tous ici écrivait la supérieure à sa mère, Ewa Laczynska, à la fin de la scolarité de la jeune fille. Marie était aussi devenue d'une grande beauté. Il n'y avait qu'une voie qui pouvait apporter à une fille fortune et honneur : un riche mariage avec un homme bien né.
Mariage
Elle est mariée en 1804 - à 17 ans - au comte et chambellan Anastazy Walewski, un grand noble polonais presque septuagénaire. La jeune femme rêve d'une Pologne libre, et nourrit une haine virile du Russe qui occupe la Mozavie, ce lambeau de Pologne où elle est née, à quelques lieues de Varsovie, mais aussi du Prussien et de l'Autrichien qui se sont partagés le reste du pays. C'est en Pologne, en 1805, qu'elle donne naissance à son premier fils, Antoine6.
Napoléon
À l'automne 1806, Napoléon Ier occupe le territoire polonais. Les Polonais l'attendaient comme le Messie. Le champion de la liberté, se devait de libérer la Pologne. Les Walewski Walewscy, eux aussi voient en lui un libérateur, et s'installent à Varsovie pour mieux s'intégrer à l'enthousiasme ambiant. Marie s'abandonna à une fiévreuse agitation, travaillant avec les dames de Varsovie à organiser des hôpitaux, des ambulances, des stations de premier secours. Elle est également introduite dans la haute société, mais la vie mondaine l'intéresse peu.
C'est le 1er janvier 1807, lors du passage de l'empereur au relais de Blonie, que Marie Walewska aurait rencontré Napoléon pour la première fois. Un bal fut organisé par Talleyrand, ministre français des relations extérieures, devait marquer à Varsovie l'ouverture du carnaval et la plus brillante réception que la capitale dévastée eût vue depuis Stanislas-Auguste. Un bref paragraphe apparut dans le journal officiel, la gazette de Varsovie : Sa majesté l'Empereur a assisté à un bal chez le ministre des relations extérieures, le Prince de Bénévent, au cours duquel il a invité à une contredanse la femme du chambellan Anastase Walewski. À midi, le lendemain, une voiture s'arrêta devant l'hôtel des Walewski. Duroc, le grand maréchal du palais, en descendit, portant un gigantesque bouquet de fleurs et une lettre sur un épais parchemin, fermée du sceau vert impérial.
" Je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne désire que vous. … N "
Marie fit répondre à Duroc qu'il n'y aurait pas de réponse. D'autres lettres enflammées suivirent… Les allées et venues de Duroc allaient attirer l'attention, et nombre de gens venaient donner des conseils à Marie. Elle avait été distinguée par le destin. Elle avait été choisie pour sauver la Pologne. Le chef de famille Laczynski - soldat modèle de l'empereur - lui donnait sa bénédiction.
Elle finit par accepter, avec l'accord de son mari de devenir sa maîtresse. Ils poursuivent leur liaison au château de Finckenstein en Prusse-Occidentale. L'idylle printanière du couple d'avril à juin dans le lointain château de Finckenstein est un moment unique et entièrement inattendu dans la vie de Napoléon, une période qui le vit déployer ce qu'un historien de cette période de sa vie appela une énergie miraculeuse. Pour Marie, la décision de rejoindre l'Empereur à Finckenstein était un acte de suprême courage et le risque couru énorme. Les deux amants sont très épris l'un de l'autre et l'empereur va dès lors organiser sa vie de façon à consacrer du temps à ses amours, chose qu'il n'avait pas faite depuis Joséphine de Beauharnais.
Dans l'intimité Marie, avec son doux entêtement polonais, ramène la conversation sur son idée fixe : la résurrection de la Pologne. Patiemment Napoléon discute avec elle sans toutefois s'engager. Ses arguments sont toujours les mêmes : que les Polonais fassent preuve de cohésion, de maturité, qu'ils soutiennent militairement sa lutte contre la Russie, et ils seront récompensés selon leurs mérites. Son obstination finira par aboutir : Napoléon crée le Duché de Varsovie 1807-1815, qui disparaîtra peu après la défaite de la campagne de Russie en 1812-1813. C'était en fait un compromis pour ne pas déplaire au tsar, mais une réponse terriblement faible à l'attente de milliers de soldats polonais morts pour l'empereur.
Naissance d'Alexandre
Le 4 mai 1810, à 4 heures de l'après-midi, Alexandre, comte Walewski, un bel enfant robuste, ouvrit les yeux sur un monde dans lequel il allait connaître une carrière brillante et tumultueuse. Je suis né au château Walewice en Pologne, écrira 35 années plus tard dans ses mémoires le futur ministre des affaires étrangères de Napoléon III. Mgr Anastazy Walewscy, Anastase de Walewski - âgé de 73 ans - déclara qu'il était issu de son mariage avec Marie née Łączyńska - âgée de 23 ans. Napoléon apprend la naissance de son fils au cours d'un voyage triomphal en Belgique avec sa jeune épouse, Marie-Louise d'Autriche. Il fait parvenir des dentelles de Bruxelles et 20 000 francs en or pour Alexandre. Le 5 mai 1812 , à Saint-Cloud, en présence de Marie, Napoléon signa un long document juridique garantissant l'avenir du jeune Alexandre. La dotation consistait en 60 fermes aux environs de Naples, d'un revenu annuel de 169 516 francs 60 centimes. Les armoiries conférées par les lettres patentes en même temps que le titre de comte de l'Empire étaient un mélange des blasons Walewski et Laczynski.
Séparation et divorce
D'après les règles de la communauté de biens de son mariage, les revenus de la dotation du jeune Alexandre, pendant sa minorité, couraient le risque d'être engloutis dans l'avalanche de dettes du vieux chambellan. Le 16 juillet 1812 le couple passa un acte dans lequel Marie déclarait son intention de se séparer légalement de son mari et se chargeait d'assumer la responsabilité financière de ses deux fils (Antoine et Alexandre). La Comtesse Walewska bénéficiait des dispositions récemment introduites par le Code Napoléon qui facilitait le divorce. Le 24 août le mariage était dissous — un temps étonnamment court pour qu'un tribunal rendît une décision. Si Marie était légalement libre, son éducation catholique comme la tradition la contraignirent, aussi longtemps que vécut le chambellan (2 ans et demi), à le considérer comme son mari.
Vie en France
L'année 1813 trouva Marie de retour à Paris, installée rue de la Houssaye avec ses deux fils, son frère Théodore et sa sœur Antonia. Grâce à la généreuse dotation de Napoléon, la comtesse Walewska était maintenant une femme riche.
Marie et son fils Alexandre rendirent visite à Napoléon en exil à l'île d'Elbe du 1er au 3 septembre 1814 en compagnie d'Emilia et de Teodor Émilie et Théodore, sœur et frère de Marie.
Second mariage
Veuve en 1814 de son premier mari, elle consent à épouser le 7 septembre à Sainte-Gudule Bruxelles 1816 le comte Philippe Antoine d'Ornano, cousin éloigné de Napoléon et général d'empire. En janvier 1817, Marie qui attendait un enfant décida de se rendre en Pologne pour consulter son vieil ami, éminent gynécologue, le Dr Ciekierski. Il diagnostiqua une maladie des reins : toxémie aiguë aggravée par la grossesse. La fin de sa vie semble proche. Au cours de l'été, étendue sur une chaise longue dans le jardin de sa maison à Liège, la comtesse d'Ornano dicta à son secrétaire, ce qui est supposé être ses Mémoires. Sa liaison avec l'empereur y est décrite comme un sacrifice fait à son pays.
Décès
À 7 heures du soir, le 11 décembre 1817, le cœur de Marie Walewska cessa de battre. Elle avait 31 ans et 4 jours. Toute la maison était plongée dans un vrai désespoir, racontera Alexandre Walewski des années plus tard. … Ma mère était l'une des femmes les plus remarquables qui eût existé.
Testament
Dans son testament, Marie exprima le désir que son cœur reste en France mais que son corps soit transporté en Pologne dans le caveau familial de Kiernozia. Conformément à ce vœu, une urne contenant son cœur repose aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise dans le caveau des d'Ornano 67e division, portant la simple inscription : Marie Laczynska, comtesse d'Ornano … et le corps fut emmené en Pologne 4 mois plus tard.
Regards des contemporains
Sous la plume de Madame de Kielmannsegge :
" J'eus peu de rapports avec Mme Walewska … Elle n'était pas précisément grande, mais elle avait la taille bien prise, les cheveux blonds, le teint clair, la figure pleine, un sourire extrêmement agréable et un timbre de voix qui la rendait sympathique aussitôt qu'elle parlait ; modeste et sans prétention, très réservée dans ses gestes et toujours très simple dans sa toilette, elle avait comme femme tout ce qu'il faut pour plaire et être aimée.
Napoléon évoquant Marie Walewska :
"Une femme charmante, un ange ! C'est bien d'elle qu'on peut dire que son âme est aussi belle que sa figure !… "
Lettre de Napoléon Ier à Marie Colonna Walewska, à Varsovie, le mercredi 28 janvier 1807 :
"Madame, vous étiez triste lundi au cercle, cela m'a peiné... Je vous ai écrit deux fois mais tout le monde est parti, et mes lettres ne vous sont pas arrivées... Je désire, Marie, vous voir ce soir à huit heures. Allez chez votre amie, celle dont vous m'avez parlé. Une voiture viendra vous y prendre... J'espère et j'ai besoin de vous dire ce soir tout ce que vous m'inspirez et toutes les contrariétés que j'ai éprouvées ... Mille baisers sur les lèvres de ma Marie.
ce mercredi 28
à 11 heures du matin."
Marie se montre rétive mais Napoléon n'est pourtant pas un homme qu'on décourage :
"Je veux, entends-tu bien ce mot, s'écrie-t-il avec violence, je veux te forcer à m'aimer ! J'ai fait revivre le nom de ta patrie : sa souche existe encore, grâce à moi. Je ferai plus encore. Mais songe que, comme cette montre que je tiens à la main et que je brise à tes yeux, c'est ainsi que son nom périra, et toutes tes espérances, si tu me pousses à bout en repoussant mon coeur et me refusant le tien."
Sa forte voix résonne, durcie par l'accent qui revient dans tous ses moments d'émotion. Marie demeure immobile et muette, mais quand il jette sa montre sur le parquet et l'écrase du talon, ses nerfs s'affaissent, elle s'évanouit.
Lorsqu'elle retrouve ses sens, au visage anxieux de Napoléon, aux mots qu'il murmure, elle comprend qu'il a abusé de sa défaillance sic.
Cette vilenie, il l'a accomplie comme poussé par un instinct sauvage. Maintenant il la regrette et, devant ces yeux désespérés, il a peur.
Elle le repousse avec horreur et sanglote longuement. Heure lourde et triste où l'homme reste décontenancé, muet devant sa captive."
Hommages
En 1937, Greta Garbo interprète le rôle de Marie Walewska dans le film Marie Walewska, Conquest, en anglais qui retrace sa vie.
Chanson : Serge Lama, Marie La Polonaise
Marie Walewska vient en visite à l'île d'Elbe avec son fils Alexandre. Ils débarquent sur l'île le 1r septembre 1814 et passent les journées des 2 et 3 à la Madona des Monte en compagnie de l'Empereur.
Extraits de NAPOLÉON empereur de l'île d'Elbe - Souvenirs & Anecdotes de Pons de l'Hérault, Les Éditeurs Libres 2005
La visite de Marie Walewska Récit 1
En réalité Marie Walewska débarqua à San Giovanni face à la rade de Portoferraio le 01-09-1814 dans la soirée. Elle quitta la Madonna Del Monte à Marciana le 3 septembre dans la soirée, en pleine tempête.
L'embarquement prévu initialement à Marciana Marina ne put avoir lieu vu cette tempête et finalement c'est dans l'anse de Mola Porto Longone devenu en 1947 Porto Azzuro qu'elle reprit la mer malgré les craintes de son entourage, mais c'était "un ordre de l'Empereur"!
Les avis divergent quant au fait que Napoléon tenta de la rejoindre en chevauchant dans la nuit. Il semble plutôt que ce soit l'officier d'ordonnance Carlo PERES qui fut chargé de cette mission, qu'il ne remplit point...
Les Elbois croyaient qu'il s'agissait de l'Impératrice et s'agitaient quelque peu: on leur cachait quelque chose, car ils avaient bien vite repéré ce navire qui état venu mouiller dans l'anse de San Giovanni et les commentaires allaient bon train.
Bien que Marie s'offrit même à rester à l'île d'Elbe discrètement, il ne voulut pas. Il semble qu'il craignait les rumeurs: alors qu'il n'omettait jamais de dire dans son entourage que son épouse et son fils lui manquaient, tout le monde allait savoir qu'il s'agissait de sa maîtresse polonaise... ce que les espions n'allaient pas manquer de rapporter à qui de droit. A ce moment là, en septembre 1814, je crois qu'il espère encore l'arrivée de Marie-Louise et de l'Aiglon.
Donc, pour le départ rapide, comme je l'ai écrit: c'était un ordre de l'Empereur!
On peut découvrir à l'île d'Elbe l'être humain avec ses craintes, ses hésitations, ses remords et ses doutes. Il n'osa pas rentrer directement à Porto Ferraio la peur d'être interpellé.
et résida quelques temps à Porto Longone.
Il ne revint plus à la Madonna Del Monte, le charme était rompu. Il ne fut jamais aussi Humain que dans cette île.
L'endroit de l'arrivée:
"A 09.30 heures, comme la nuit tombait, le bateau jeta l'ancre dans le petit port de San Giovanni, une baie écartée de l'autre côté de Portoferraio"
Marie Walewska, le Grand Amour de Napoléon.
"...à un tournant du chemin, exactement à Proccio, les voyageurs qu'escortaient les palefreniers porteurs de torches, aperçurent une lanterne et derrière elle un cavalier...
Le bateau a jeté l'ancre dans la baie, hors du port. Marie admire du pont la blanche ville de Portoferraio..."
Marie Walewska l'épouse polonaise de Napoléon, Comte d'Ornano
"Tout à coup, la population matinale s’écria : « L’Impératrice et le Roi de Rome sont arrivés » et aussitôt la population entière fut debout. On m’envoya un exprès pour m’instruire de ce grand évènement, j’accourus à Porto-Ferrajo. Les officiers de la Garde avaient la tête à l’envers ; ils voulaient que l’Impératrice et le Roi de Rome restassent à l’île d’Elbe.
Le commandant Malet me priait de rédiger une adresse raisonnée pour signifier cela à l’Empereur. Les Porto-Ferrajais voulurent en faire autant ; l’intendant me demanda s’il devait consentir à cette démarche. Le général Drouot évitait de se montrer en public.
Le vrai était que Mme la comtesse Walewska et son fils avaient débarqué à Marciana, que Mme la comtesse Walewska avait à peu près l’âge de l’Impératrice, autant de noblesse que l’Impératrice, que l’enfant avait aussi à peu près l’âge du Roi de Rome, qu’il était mis comme le Roi de Rome. l’erreur était facile ; elle fut complète. Mme la comtesse Walewska se plut à la laisser exister, même elle la sanctionna, car elle faisait répéter à son fils les paroles que la renommée attribuait au Roi de Rome. C’était le rapport des marins dans le bâtiment desquels Mme la comtesse Walewska était venue à l’île d’Elbe avec son fils.
Aussitôt que Mme la comtesse Walewska fut arrivée à la tente de l’Empereur, l’Empereur ne reçut plus personne, pas même Madame Mère, et l’on peut dire qu’il se mit en grande quarantaine. Son isolement fut complet. …
Mme la comtesse Walewska et son fils restèrent environ cinquante heures auprès de l’Empereur."
Le 1er septembre 1814, la comtesse Walewska, sa soeur, Émilie Laczinska et Alexandre, fils de l’empereur débarquèrent à l’île d’Elbe. Louis Marchand précise que le frère de la comtesse, le colonel Teodor Laczinski, accompagnait ces dames et l’enfant. Il ajoute que dans l’île, on crut que c’était l’impératrice et le Roi de Rome, les têtes s’en montèrent .
«Mme Walewska avait dû être, dans son jeune âge, une fort belle personne. Bien qu’ayant, lors de son voyage à l’île d’Elbe, la trentaine, elle était née en 1786 et s’éteignit en 1817, après avoir épousé en secondes noces le général d’Ornano et peut-être quelque chose de plus, elle était encore fort bien. Ce qui la déparait un peu, c’était quelques petites places sanguines, ou rougeurs, qu’elle avait dans la figure. Du reste elle était très blanche et d’un coloris qui annonçait une belle santé. Elle était de belle taille, avait un embonpoint raisonnable. Elle avait une fort belle bouche, de beaux yeux, les cheveux châtain clair ; elle avait l’air fort douce et paraissait être une excellente personne. … Le jeune Walewski était gentil garçon, déjà grandelet, la figure un peu pâle ; il avait quelque chose des traits de l’empereur. Il en avait le sérieux. Né en 1810, il a alors quatre ans. Il décèdera en 1868, après une carrière publique bien remplie, ambassadeur et ministre des Affaires étrangères sous le Second Empire
La visite de Marie Walewski à l'ile d'Elbe Récit 2
...Une visite inopinée va troubler cette quiétude. exceptionnelle dans l'existence de Napoléon. Au cours de la nuit du 1er septembre, un navire entre en rade de Porto Ferrajo mais, au lieu de gagner le port, mouille dans une crique au fond du golfe. Bertrand prévenu accourt, salue profondément la jeune femme et l'enfant qui débarquent, fait atteler une calèche et seller les chevaux. Les voyageurs disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont venus. En ville le bruit se répand de l'arrivée de l'Impératrice et du Roi de Rome.
Quelques heures plus tôt, au crépuscule, Napoléon avait suivi à la lunette l'approche du bâtiment. Dès qu'une estafette de Bertrand lui apprend l'accostage, il la renvoie avec ses ordres et saute lui-même à cheval. Précédé de quatre porteurs de torches, il descend de son nid d'aigle. La rencontre des deux groupes se fera au milieu de la nuit, le long de la mer, près de Marciana Marina. Napoléon prend la place de Bertrand dans la calèche et, tout en jouant avec les boucles blondes de l'enfant, s'enquiert affectueusement du voyage. Avant l'aube, tout le monde atteint enfin l'Ermitage, Napoléon a cédé sa chambre et fait dresser une tente devant la maison. Mais Ali, son valet de chambre, le voit furtivement la quitter aussitôt : Marie Walewska passe avec lui une dernière nuit...
Certes, les temps de l'idylle polonaise sont révolus. L'amour de l'Empereur est mort, celui de Marie subsiste-t-il ? Pendant les quatre années du règne de Marie-Louise il l'a rarement revue. A Fontainebleau, après l'abdication, elle a vainement attendu une nuit devant sa porte, il ne l'a pas reçue. A l'île d'Elbe, elle lui a écrit plusieurs fois, gagnant par petites étapes la côte toscane, sollicitant la permission de venir. Il la lui accorde enfin et elle accourt, peut-être avec l'espoir de rester auprès de lui.
C'est mal le connaître. Informé quelques heures plus tard de la rumeur publique, il en conçoit un vif mécontentement. Ainsi, malgré les précautions prises, les Elbois sont déjà persuadés que sa femme et son fils l'ont rejoint. Il désire éviter que le Cabinet autrichien ne tire parti de cette visite pour inciter Marie-Louise à ajourner encore sa venue. Il ne veut surtout pas, lui si strict pour les autres, que sa conduite soit un objet de scandale quand la vérité éclatera.
Marie Walewska sera donc une fois de plus sacrifiée au devoir conjugal et aux obligations d'Etat. Il ne le lui dit pas tout de suite. Le matin, il l'emmène jusqu'à son rocher ; au déjeuner, il s'esquive pour sa visite quotidienne à Madame Mère - la famille avant tout. Le soir, il dîne sous la tente avec la jeune femme et les officiers polonais de la Garde. On improvise des danses, les chants slaves s'élèvent de la terre latine. Marie espère, Marie est heureuse. Le lendemain, informée par le trésorier Peyrusse de la détresse financière de l'Empereur, elle veut restituer le collier de perles qu'il lui offrit jadis à la naissance d'Alexandre, mais il refuse avec émotion et la prie doucement de partir le soir même. Puis il disparaît toute la journée et ne la reverra que pour les adieux.
Rien ne manque à cet épisode, ni le cadre exceptionnel où il se déroula, ni son dénouement romantique. Avec la nuit la tempête s'est levée, la pluie tombe en rafales. Marie, transie, serrant son enfant contre elle, tente de s'embarquer à Marciana. Le risque est trop grand. Son navire ira l'attendre à Porto Longone, à l'autre extrémité de l'île. De longues heures elle peine sur les mauvais chemins transformés en torrents. dans la nuit traversée d'éclairs. Lorsqu'elle atteint son but, on veut encore la dissuader. Trop fière elle s'obstine, saute dans une barque et, courant mille périls. gagne l'échelle de coupée. Le vaisseau s'éloigne, elle ne reverra Napoléon que furtivement à l'Elysée et à Malmaison. quelques mois plus tard. Lui, pendant ce temps, saisi de remords et d'angoisse, dépêche un officier d'ordonnance pour ajourner l'embarquement, puis de plus en plus inquiet, saute à cheval et galope jusqu'à Longone, où il arrivera trop tard. Au matin, accablé, frissonnant, il regagne l'Ermitage, mais le charme est rompu. Deux jours plus tard, il le quittera à son tour pour n'y plus revenir."
Le départ de Marie Walewska
Une espèce d’ouragan bouleversait le ciel et la terre. On craignait pour les bâtiments qui se trouvaient affalés sur la côte de Toscane. Néanmoins, ce fut en ce moment que Mme la comtesse Walewska quitta l’Empereur pour retourner sur le continent. Une barque attendait Mme la comtesse à Longone. Toutefois, à peine avait-elle quitté Marciana, que l’Empereur, justement effrayé de la fureur toujours croissante du vent, fit monter à cheval l’officier d’ordonnance Pérez, et lui ordonna d’aller l'empêcher de partir sous quelque prétexte que ce pût être. Mais ce Pérez, tout officier d’ordonnance que l’Empereur l’avait fait, était le sot des sots : sans cœur, sans âme, et incapable de s’inquiéter du danger qui menaçait Mme la comtesse Walewska, il ne songea qu’à s’abriter lui-même. Mme la comtesse Walewska était en pleine mer lorsque ce franc malotru arriva à Longone.
Les autorités et les marins de Longone avaient fait tout ce qu’il leur était possible de faire pour que Mme la comtesse Walewska ne mît pas à la voile. Mais, résolue, elle repoussa tous les conseils et elle affronta la destinée.
L'Empereur eut des heures d’angoisse. Il lui fut impossible d’attendre le retour de son officier d’ordonnance. Il se rendit de sa personne au lieu où Mme la comtesse Walewska devait s’embarquer. Il était trop tard. Ses alarmes durèrent jusqu’au moment où Mme la comtesse Walewska lui eut appris elle-même que le péril était passé.
Merci au général Bertrand
Lien
http://www.ina.fr/video/CPF86618423/marie-walewska-video.html Decaux et castelot
         
Posté le : 06/12/2014 18:16
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
119 Personne(s) en ligne ( 72 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 119
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages