|
|
Les académies 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
LES ACADÉMIES
L'académie telle qu'elle se développe à partir du Quattrocento italien, dans le grand mouvement de retour à l'Antiquité qui caractérise la Renaissance, est inspirée du modèle grec de l'akademia, le jardin où enseignait Platon. Elle s'épanouit dans toute l'Europe à l'âge classique, pour décliner ensuite à l'époque romantique jusqu'à revêtir une connotation plus souvent péjorative qu'emphatique : académicien peut être encore un titre envié par certains, et si même des arts récents, tel le cinéma, se dotent à leur tour de leurs propres académies, l'adjectif académique n'en est pas moins devenu, dans les milieux artistiques éclairés, une forme d'invective.
L académisme est, on le sait, un phénomène particulier aux activités culturelles, celles-ci pouvant s'entendre, en l'occurrence, de diverses façons : au sens large (celui de l'anthropologie, qui assimile plus ou moins « culture » et « civilisation »), l'académie est un instrument parmi d'autres de ce processus de « civilisation des mœurs » décrit par l'historien Norbert Elias, et qui touche aussi bien l'élite intellectuelle que l'aristocratie – dont les enfants allaient apprendre le maniement de l'épée, les règles de l'équitation et l'art de la danse dans ce qu'on appelait, justement, des « académies ». Au sens étroit de la familiarité avec les arts tel que l'entend la sociologie, la « culture » des académies fut avant tout celle des arts libéraux, enseignés par ailleurs à l'université et non soumis à rétribution directe (activités littéraires et poétiques, musicales et mathématiques essentiellement) ; elle ne s'étendra que progressivement à certains des arts dits mécaniques, en particulier la peinture qui, paradoxalement, finira par symboliser le lieu par excellence de l'académisme.
Ainsi, en tant qu'elle opère un regroupement plus ou moins formalisé – ne serait-ce que par son titre – de certaines catégories d'activités, l'académie se définit par opposition à d'autres formations collectives : le cercle d'amis ou le salon, dont elle constitue un avatar plus formel ou moins mondain ; l'Université, contre laquelle elle s'est parfois explicitement constituée ; ou encore l'atelier ou la boutique, la corporation ou la manufacture, par rapport auxquels elle affirme sa rupture avec l'univers du « métier » (artisanal ou industrialisé mais, en tout cas, ressortissant du negotium) pour revendiquer l'accès à la « profession », intellectuelle et libérale, autrement dit désintéressée (telle que la pratique ceux qui vivent dans l'oisiveté, l'otium).
On conçoit ainsi l'importance du mouvement académique dans la culture des Temps modernes même si, comme le fait remarquer l'historien Daniel Roche, il ne concerne guère qu'une élite très limitée (de l'ordre de 1 à 5 p. 100 tout au plus de l'ensemble de la population au siècle des Lumières). Il est en tout cas partie prenante de l'histoire de ces lieux universitaires que les Américains désignent encore, justement, du terme academic.
L'expansion européenne de la Renaissance
Avant de se trouver officialisées par une protection princière ou royale, les académies de la Renaissance ne furent à l'origine que des cercles privés ou, selon l'expression de N. Pevsner, des « regroupements informels d'humanistes ». La première à avoir été ainsi recensée fut l'Accademia platonica de Marsile Ficin et Pic de la Mirandole, fondée à Florence en 1462 sous le règne de Laurent le Magnifique. Sur ce même modèle d'une culture à la fois encyclopédique et humanistes, par opposition à la scolastique, se développèrent dans l'Italie du XVIe siècle un grand nombre d'académies ; on en compte environ 500 vers 1530, dont 70 à Bologne, 56 à Rome, 43 à Venise, ainsi qu'à Naples, à Vérone, etc., et, bien sûr, à Florence, où l'Accademia degli Umidi devint en 1540 l'Accademia fiorentina, sous l'égide de Cosme de Médicis qui présida également la fondation par Vasari en 1563 de l'Accademia del disegno, première académie pour la peinture et la sculpture. C'est à Florence également que fut créée, puis officialisée en 1584, l'Accademia della Crusca, autre académie importante.
Mais avec le succès, dont témoigne cette multiplication, la formule évolua très vite. D'une part, en se spécialisant : à l'encyclopédisme humaniste des premiers temps se substituèrent des spécificités (ainsi furent créées des académies exclusivement consacrées au théâtre ou à la musique, à l'italien ou aux langues classiques, à la théologie ou au droit, à la médecine ou aux sciences, etc.) ; et, d'autre part, en s'institutionnalisant, notamment grâce à la protection d'un prince ou d'un prélat, par le choix d'un nom, d'une devise, d'un emblème allégorique, ou par l'instauration de réunions régulières et, parfois, d'un enseignement. Or une telle évolution ne pouvait que ré-activer, par rapport aux institutions concurrentes (en particulier l'Université ou, dans certains cas, les corporations), une rivalité qui n'était plus seulement intellectuelle, mais aussi structurelle, et qui pouvait aboutir, selon les cas, soit à un rapprochement (comme lorsque le consul de l'Accademia fiorentina devint recteur de l'Université), soit au contraire à une « autonomisation » plus radicale encore : c'est ainsi que, grâce aux efforts des académiciens concernés (et de Vasari au premier chef), peintres et sculpteurs florentins furent, par un décret de 1571, libérés de l'obligation de s'affilier aux corporations. Il en fut de même un peu plus tard à Rome, où fut créée en 1593 l'Accademia di San Luca, sous la protection du cardinal Borromée et sous la direction du peintre Federico Zuccari, qui s'efforça de donner à la peinture ses lettres de noblesse intellectuelle grâce à une production théorique importante. Ce même processus d'académisation affecta ultérieurement d'autres villes italiennes : Bologne, Venise, Milan, etc.
Mais le XVIIe siècle fut, en Italie, le grand siècle des académies scientifiques : à la suite de l'Accademia dei Segreti, apparue à Naples en 1560, fut créée à Rome en 1603 la célèbre (et toujours active) Accademia dei Lincei, puis, en 1657, l'Accademia del Cimento, qui rompait d'une certaine façon avec la tradition humaniste en privilégiant un travail d'expérimentation au sens moderne.
Au même moment, et dans la même perspective, apparut en Angleterre la Royal Society, créée sous forme privée en 1645 puis officialisée par Charles II en 1662. En revanche, les arts n'y furent pas « académisés » avant 1720. On constate le même décalage en Allemagne, où les académies littéraires et scientifiques furent les premières à émerger (avec, notamment, le Collegium Naturae Curiosum de Rostock en 1652), alors que les académies d'art ne s'y formèrent qu'entre 1650 et 1750 (à Nuremberg, Augsbourg, Dresde, Berlin, Vienne). De même, la Hollande ne connut sa première académie de peinture que dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
C'est à cette époque également que la France connut le plus grand essor du mouvement académique à l'échelle européenne, sous sa forme la plus officielle et la plus institutionnalisée. Il avait été précédé, dès le XVIe siècle, d'une floraison d'académies privées, à Paris et en province. On a pu compter au total plus de 70 académies au XVIIe siècle : par exemple celle de saint François de Sales à Annecy ou encore celle des frères Dupuy ou le cercle du père Mersenne à Paris, etc. La fondation de l'Académie française sous Richelieu, en 1635, marque dans le domaine littéraire le départ d'une série d'académies royales créées sur ce même modèle dans les dix premières années du siècle de Louis XIV : l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée sous Mazarin en 1648 mais officiellement protégée et pensionnée à partir de 1661 ; l'Académie de danse (1661 également) ; la Petite Académie (future Académie des inscriptions et belles-lettres) en 1663 ; l'Académie des sciences (1666) ; l'Académie de musique (1669) ; L'Académie d'architecture (1671) ; on mentionnera également l'Académie de France à Rome (sorte de filiale italienne de l'Académie de peinture) en 1666, ainsi qu'une Académie royale des spectacles, projetée en 1673 mais qui ne vit jamais le jour.
Cette floraison du mouvement académique parisien, spectaculaire tant par son caractère systématique que par son haut degré d'officialisation par la royauté, fit du cas français le paradigme, pour ainsi dire, des académies telles qu'elles se multiplièrent ensuite dans le courant du XVIIIe siècle : soit en province, où elles furent autorisées par Colbert en 1676 (pour les seules peinture et sculpture, près d'une quarantaine d'académies de ce type y furent créées jusqu'à la Révolution, surtout à partir de 1740) ; soit à l'étranger, où on peut citer notamment les académies de Berlin en 1697 et 1700, de Vienne en 1705 et 1726, de Madrid en 1713, de Lisbonne en 1720, de Saint-Pétersbourg en 1726, de Stockholm en 1739, et jusqu'en Amérique (Philadelphie en 1744), etc.
L'institutionnalisation de l'âge classique
Les académies royales créées avant ou pendant le règne de Louis XIV avaient en commun le nom et la structure, ainsi qu'une fonction de sociabilité, d'information et de reconnaissance mutuelle, venant d'ajouter au prestige conféré à leurs membres à l'extérieur des académies. Mais, par-delà ces similitudes formelles, d'importantes différences les opposaient dans leur rôle et leur fonctionnement, selon le statut antérieur des disciplines concernées. Un statut « libéral », autrement dit affilié aux arts libéraux (littéraires, avec le Trivium, ou scientifique, avec le Quadrivium), impliquait un exercice peu ou pas professionnalisé (service du roi, salons, cercles privés), auquel l'académisation apportait essentiellement une légitimation des pratiques extra-universitaires et, par là même, extrascolastiques : par exemple, la défense de la langue vulgaire ou, dans le cas de la science, le recours à l'expérimentation et à une certaine spécialisation. En revanche, lorsque le statut antérieur était – comme dans le cas de la peinture et de la sculpture et, dans une moindre mesure, de l'architecture – du ressort des arts mécaniques, donc des corporations, l'académie représentait avant tout un instrument d'intellectualisation et de « libéralisation », donc de promotion sociale, de ces arts et de leurs représentants. On va le voir avec les trois cas les plus significatifs à cet égard : celui de l'Académie française, de l'Académie des sciences et de l'Académie de peinture et de sculpture.
Première non seulement par sa date de fondation, mais aussi par son impact, l'Académie française fut créée en 1635 avec la protection de Richelieu, comme une compagnie de personnes libres et détachées de l'obligation d'instruire le public, qui voulussent joindre ensemble leur étude et leur travail, selon la définition de l'abbé d'Aubignac en 1663. Instrument, donc, d'autonomisation par rapport à l'Université et, dans une certaine mesure, à l'égard des mécènes, elle constituait également un moyen de distinction vis-à-vis des doctes et de toutes sortes d'esprits qui ne sont pas propres à cet exercice comme les gens du peuple, les gens de robe, les gens d'Église ou les gens de Cour qui défigurent la langue, de sorte que les académiciens doivent la nettoyer des ordures qu'elle a contractées, Projet de l'Académie pour servir de préface à ses statuts de Nicolas Faret en 1635. Cette fonction d'expertise se concrétisera par le projet, longtemps retardé, d'établissement d'un dictionnaire. L'Académie française aura également en propre l'instauration immédiate d'un numerus clausus, ainsi qu'un haut degré de ritualisation port de l'uniforme, rituels d'intronisation.
Fondée en 1666, l'Académie des sciences eut, pour sa part, deux origines distinctes : la première, issue du pouvoir politique Colbert et son conseiller Charles Perrault, consistait en un projet éclectique d'« académie générale » rassemblant toutes les disciplines, et où l'on aurait également pu traiter de droit, de politique, de théologie ; la seconde, issue du milieu savant et, notamment, de l'académie de Montmort, préconisait une « compagnie » spécialisée dans les matières spécifiquement scientifiques – l'astrologie et l'alchimie en étant explicitement exclues. Cette seconde formule s'imposa très vite, non pas tant d'ailleurs sous la pression des savants qu'en raison de l'hostilité des institutions concurrentes, la Sorbonne et l'Académie française ainsi que la toute récente « Petite Académie » qui en était issue, chargée notamment de l'établissement des devises royales.
Les trente premières années d'existence de l'Académie des sciences furent relativement informelles, l'activité consistant exclusivement en assemblées bi-hebdomadaires sans public, sans règlement écrit, sans bulletin le Journal des savants », fondé en 1665, ne proposait que des notes critiques mais aucun compte rendu suivi des séances, au contraire de la Royal Society qui publiait régulièrement ses Transactions). Si les mathématiciens et, en particulier, les géomètres y étaient en position dominante, numériquement et hiérarchiquement, par rapport aux physiciens, chimistes, botanistes et anatomistes, la spécialisation y était encore embryonnaire – les académiciens étant par exemple censés assister à toutes les séances. À cette structure hiérarchique, en grande partie héritée du découpage médiéval entre les « arts » (libéraux et mécaniques), une atténuation va être apportée en 1699 avec l'instauration de règlements très formalisés et l'introduction d'académiciens « honoraires » (amateurs) et « associés » (étrangers), mais avec, en contrepartie, un renforcement de la hiérarchie interne.
Par rapport à l'activité scientifique telle qu'elle s'exerçait à la Renaissance, l'« académisation » va donc engendrer, directement ou indirectement, des transformations structurelles fondamentales : concentration de l'activité et de l'information (qui auparavant tendait à circuler par les voyages et les correspondances), fixation des hiérarchies entre disciplines et spécialisation. C'est là la base d'un processus de professionnalisation qui, sur le plan proprement scientifique, va prendre une triple forme : d'une part, l'extension du rôle accordé à la pratique et, notamment, à l'expérimentation, par opposition aux discussions scolastiques ; d'autre part, la systématisation et l'organisation des publications, sous l'égide de l'Académie, qui gère collectivement les travaux individuels ; enfin, l'instauration de plus en plus fréquente et régulière d'une rémunération qui, de pension irrégulière et arbitraire qu'elle était du temps où elle était négociée directement entre les représentants de l'État et l'individu, prendra peu à peu la forme d'un traitement automatiquement attribué par le biais de l'appartenance à l'Académie.
Si donc, dans le cas des sciences, la structure académique tend à une professionnalisation proche du fonctionnariat – auquel on est effectivement parvenu aujourd'hui, alors que l'Académie française consistait essentiellement en un instrument de regroupement des pairs et d'accumulation du prestige –, à l'opposé, l'Académie royale de peinture et de sculpture détache ses membres des structures de métier dont ils dépendaient jusqu'alors. L'affiliation traditionnelle à l'artisanat, à une époque où la catégorie « mécanique » renvoyait aux plus bas degrés de l'échelle sociale, était en effet une entrave suffisamment puissante aux velléités d'ascension sociale des peintres et des sculpteurs, pour que ceux-ci – dont les plus privilégiés pouvaient fréquenter l'univers des courtisans – tentassent par tous les moyens d'échapper à une corporation qui s'ingéniait en outre, par toutes sortes de pressions juridiques, à restreindre les possibilités d'accès au métier (notamment avec les « privilèges » ou brevets octroyés par le roi ou la famille royale et qui permettaient d'échapper au contrôle corporatif). Et ce furent, justement, des peintres et sculpteurs du roi, avec à leur tête Charles Le Brun, qui décidèrent en 1648 de fonder une académie de peinture et de sculpture, à l'encontre de la tradition académique qui réservait cette faveur aux arts libéraux, mais avec, cependant, l'exemple du précédent italien et, notamment, de l'académie de Saint-Luc à Rome dont revenaient, entre autres, Le Brun, ainsi que le diplomate Martin de Charmois. C'est ce dernier qui se chargea de présenter à Mazarin et à la reine (le roi n'étant alors qu'un enfant) une requête en faveur de ces « excellents artisans », auxquels se joignirent très vite une douzaine d'autres confrères – requête vraisemblablement inspirée du Trattato della nobiltà della pittura composé en 1585 par Romano Alberti pour la fondation de l'Académie romaine, qui s'appuyait lui-même en grande partie sur le livre XXXV de l'Histoire naturelle de Pline. Explicitement dirigée contre la maîtrise, qu'elle attaque violemment au nom de la liberté des peintres et des intérêts de la royauté, cette requête défend, avec un luxe d'arguments lettrés, la nécessité du rétablissement de la peinture et de la sculpture. Celles-ci doivent échapper à la « troupe abjecte » des « artisans les plus mécaniques », en vertu de leurs qualités éthiques (noblesse, honneur, vertu, étude) et aussi de leur nécessaire utilisation des règles de la rhétorique, de la musique, de la géométrie, de l'arithmétique, de l'astronomie – autrement dit des arts libéraux, parmi lesquels il convient non seulement de compter la peinture et la sculpture, mais encore de leur y rendre le « premier rang ». On observe ainsi que cette requête ne touche guère à des questions de « liberté », mais bien plutôt de « libéralité », autrement dit de légitimité du statut ou – selon un euphémisme qui n'en était pas un à l'époque – de « dignité » : revendiquer la libertas (Libertas artibus restituta sera la devise de l'Académie), ce n'était pas tant exiger plus de liberté, juridique ou morale, que réclamer plus de considération. Il ne s'agissait pas de récuser la distinction entre le « mécanique » et le « libéral » mais, simplement de déplacer au profit des peintres et sculpteurs la frontière entre les deux : de sorte que le mépris affiché par les aspirants-académiciens et leur porte-parole envers les artisans n'est qu'une arme supplémentaire pour faire de ces derniers les marchepieds de leur ascension – ascension dont leur déclaration d'allégeance au roi est destinée à garantir l'efficacité politique et symbolique, et dont la fondation de l'académie représente, au sens fort du terme, l'institution.
Mais prendre le parti du roi, contre la corporation soutenue par le Parlement, n'était pas, en ces temps troublés par la Fronde, un pari gagné d'avance. De contre-attaques juridiques en tentatives de conciliation, d'alliances éphémères en créations d'institutions concurrentes (la corporation fonda peu après sa propre « académie de Saint-Luc », qui connut une existence durable mais confidentielle malgré la nomination à sa tête de l'illustre Simon Vouet), de coups de force politiques en astuces juridiques, le sort des académiciens suivit peu ou prou les aléas du parti du Mazarin durant la Fronde, jusqu'à la première normalisation en 1656 suivie – à l'avènement de Louis XIV, puis à la nomination de Colbert à la surintendance des Bâtiments – d'une protection officielle, définitive et concrète (nouveaux statuts, pension, logement, etc.).
La réussite de l'académie est donc désormais assurée, et sur tous les plans : institutionnellement, le soutien royal se renforce par la création en 1666 de l'Académie de France à Rome, dont l'une des fonctions essentielles était, explicitement, l'importation des antiques, au moins par les nombreuses copies que les élèves, sélectionnés parmi les meilleurs éléments de l'académie parisienne, étaient incessamment invités à réaliser. Sur le plan géographique, l'ancienne domination de l'Italie tend à se renverser au profit de Paris (ainsi les peintres français seront beaucoup moins nombreux à faire le voyage à Rome dans la seconde moitié du XVIIe siècle). Sur le plan fonctionnel, on organise tant bien que mal un enseignement (exclusivement consacré au dessin, à la perspective et à l'anatomie, le reste de la formation demeurant du ressort des ateliers) et, plus tard, des conférences, destinées à parfaire l'intellectualisation des arts du dessin. Sur le plan matériel, l'académie attire les commandes d'État les plus prestigieuses. Sur le plan honorifique, enfin, le statut d'arts libéraux ne tardera pas à être accordé à la peinture et à la sculpture, comme en témoignent en particulier les dictionnaires de la fin du siècle, tel le Dictionnaire de l'Académie française (1694) qui, à l'article « Académie », propose : « Lieu où s'assemblent des gens de lettres ou d'autres personnes qui font profession de quelqu'un des arts libéraux, comme la peinture, la sculpture, etc. »
Triomphe et déclin
Cette incontestable réussite ne fut pas éphémère, et marqua profondément toute la peinture française du XVIIIe siècle, époque ou l'Académie exerça quasiment un monopole non seulement sur la « grande » peinture – dont on établit les règles au cours des conférences et dans les nombreux écrits qui se mirent à paraître sur le sujet – mais également sur des genres plus marginaux, représentés notamment par Watteau ou Chardin qui, formés ailleurs, ne tardèrent pas à s'y faire admettre. Il faut dire que, en l'absence de tout numerus clausus, l'appartenance à l'académie n'exigeait guère que la fourniture d'un morceau de réception, pas forcément représentatif de la manière habituelle du peintre ; elle permettait, en contre-partie, une carrière fonctionnalisée, organisée de poste en poste (professeur et, pour les peintres d'histoire exclusivement, « officier »), ainsi qu'une position avantageuse sur le marché des commandes d'État ainsi que des amateurs privés. Ceux-ci en effet se multipliaient, qu'ils fussent collectionneurs, commanditaires ou simples connaisseurs. Ces derniers apparurent avec les salons, organisés régulièrement à partir du début du XVIIIe siècle, et qui avaient notamment pour fonction de compenser l'interdiction d'exposer en boutiques, que les artistes s'étaient imposés dans les premiers statuts de l'académie afin de marquer la rupture avec l'univers artisanal et commercial. Ces salons, longtemps réservés aux seuls académiciens, entraînèrent l'apparition d'une forme particulière de littérature artistique : la critique d'art, dont Lafont de Saint-Yenne fut le premier représentant et Diderot, le plus illustre.
Ce grand règne de l'académie n'alla pourtant pas sans conflits. Ainsi, le développement du marché privé des amateurs entraîna une vogue des genres considérés comme mineurs (le paysage, la scène de genre, la nature morte, et, particulièrement prisé, le portrait), qui engendra à son tour une réaction des défenseurs de la peinture d'histoire, directement subordonnée au marché prestigieux mais fragile des commandes d'État. Or cette domination de la peinture d'histoire, inséparable de l'esthétique académique, n'était elle-même qu'une séquence de la subordination aux références littéraires (les tableaux d'« histoire » ayant en commun de s'appuyer sur un texte), qui dans la première génération académique ne tardèrent pas à supplanter – autre conflit – les références mathématiques et, plus généralement, scientifiques (observance des règles anatomiques et, surtout, perspectives). Cette prégnance du littéraire n'est sans doute pas non plus étrangère à la lutte qui opposa, vers la fin du XVIIe siècle, les partisans du dessin (représenté par Poussin) aux partisans de la couleur (représentée par Rubens) qui prônaient des critères de perception et d'évaluation plus spécifiquement plastiques.
L'académie, quoi qu'il en soit, cumulait les instruments de prestige qui en faisaient une institution d'État et d'élite tout à la fois. C'est sans doute ce qui lui valut sa suppression par la Convention, tout comme sa reconstitution quasi immédiate, en 1795, sous une forme quelque peu différente, celle de l'« institut », dont peinture et sculpture occupèrent, avec les belles-lettres, la troisième classe, jusqu'en 1803, date où les beaux-arts conquirent leur autonomie dans une classe séparée. Mais ces transformations nominales s'accompagnèrent d'une réforme structurelle importante : l'instauration, comme à l'Académie française, d'un numerus clausus, entraînant une forte sélection des membres et une élévation de leur âge. Ce durcissement des frontières à l'entrée, qui imposa notamment l'instauration d'un jury pour les salons, ne fut sans doute pas pour rien dans les attaques et les contestations répétées qui, s'ajoutant à des transformations numériques (augmentation du nombre des peintres) et sociologiques (élévation de leur origine sociale), ébranlèrent peu à peu la légitimité de l'institution. Les grands fondements de l'esthétique académique furent ainsi, de génération en génération, battus en brèche : la domination du dessin sur la couleur, contestée par Delacroix dans les années 1830 ; la domination de la peinture d'histoire sur tous les autres genres (encore qu'un grand prix ait été créé en 1817 pour le paysage), domination malmenée par Courbet et le courant réaliste dans les années 1840-1850 ; la domination du « fini » sur l'esquisse, transgressée par Manet puis par les impressionnistes à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. L'organisation en 1863 (année où, sur 5 000 œuvres présentées au Salon officiel, plus de 3 000 avaient été refusées) du premier Salon des refusés marque le début de la fin du grand règne académique, de plus en plus marginalisé à l'intérieur d'un nouveau système, hautement complexe, où les courants dominants se renouvellent à un rythme accéléré, selon le jeu des intérêts convergents ou contradictoires des groupes d'artistes, des critiques, des marchands, des conservateurs, des collectionneurs. Ce n'est plus, quoi qu'il en soit, la reproduction plus ou moins fidèle des règles enseignées par l'académie qui fonde la légitimité des modernes mais, au contraire, la capacité à inventer de nouveaux sujets, de nouvelles formes, de nouvelles matières, de nouvelles manières d'occuper la position d'artiste.
L'effet académique
Cet impératif d'innovation apparaîtra-t-il à la postérité comme une autre forme d'académisme ? Il est trop tôt pour en juger, mais il est certain que le phénomène académique au sens strict qu'il revêtait du temps de son triomphe, et non pas sous la forme négative, péjorative, qui tend à lui être assignée depuis lors renvoie à un ensemble de caractéristiques tout à fait spécifique.
Il s'agit, tout d'abord, d'un effet d'institution, à travers une formalisation à plusieurs niveaux : formalisation juridique confirmation par lettres patentes ; privilèges tels que l'exemption du service militaire ou de certaines taxes ; tenue de registres, comptes rendus, procès verbaux ; formalisation politique, à travers la signature du roi et l'engagement de l'État, attestant la reconnaissance de l'utilité publique de l'académie, ainsi distinguée d'une académie privée ; formalisation, enfin, au niveau de la pratique, par la fixation d'un mode de fonctionnement le règlement, d'un lieu et de dates régulières de réunion.
Un autre effet spécifique du phénomène académique est l' effet de corps : le regroupement des pairs, par un processus de dé-singularisation, autorise la formation d'une identité collective fondée sur l'exercice d'une activité donnée et sur l'universalisation des intérêts. Cette identité collective dont la première concrétisation est le choix du nom de l'académie se soutient d'un double processus d'identification ou d'assimilation entre semblables, et de distinction ou de différenciation vis-à-vis des profanes.
Autant dire que toute académie est, foncièrement, un processus élitaire, un instrument de sélection et de regroupement des meilleurs, selon les critères en vigueur. Ainsi, on ne s'étonnera pas d'y trouver à l'œuvre divers principes de sélection, tel le sexe : les femmes étant soit exclues, comme ce fut le cas durant trois siècles et demi de l'Académie française, soit admises en nombre très limité par un numerus clausus elles se comptaient sur les doigts d'une main dans l'Académie de peinture au XVIIIe siècle, et encore presque uniquement dans les genres réputés mineurs tels que la nature morte. Mais il convient de remarquer, avant tout, que le principe de sélection était, pour la première fois dans l'histoire, proprement culturel. En effet, mis à part le cas de quelque honoraires admis pour leur nom ou leurs bonnes œuvres au moins autant que pour la qualité de leurs ouvrages, l'académie a ceci de particulier qu'elle ne sélectionne et ne rassemble ni des noms, privilège de la noblesse, ni des fortunes, privilèges de certaines couches de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, ni même des diplômesl'Université y pourvoit – mais cette qualité, purement individuelle et relativement impondérable en l'absence des critères formalisés et universellement reconnus, qu'on appelle le talent, qu'il soit fondé sur le travail et l'étude, comme on tendra à le supposer à l'âge classique, ou sur un don inné, comme on voudra le croire à partir de l'époque romantique. Toujours est-il que l'effet de distinction ou, si l'on préfère, de prestige, propre à l'académie, opère dans un univers à la fois intellectualisé et désintéressé, les académiciens ne sont pas directement rémunérés, si l'on excepte les « jetons de présence » distribués à certaines époques dans les séances de l'Académie française pour assurer un minimum de présence, nécessaire à l'avancement du dictionnaire qui est celui des professions qu'on appelle aujourd'hui culturelles.
Deux remarques s'imposent pour finir. La première tient à ce qu'on pourrait appeler les perversions propres au phénomène académique : perversion de l'effet d'institution, par la routine qui s'installe dans les pratiques, facteur d'immobilité ; perversion de l'effet de corps, par la fermeture aux éléments extérieurs, facteur de conformisme. Ce sont bien ces effets pervers que l'on a aujourd'hui en tête lorsqu'on parle d'académisme, sans bien voir peut-être à quel point ils sont indissociables du principe même de toute académie, de sorte qu'il paraît tout à fait vain de rêver d'une académie qui ne devienne pas, tôt ou tard, académique, quels que soient la forme et le nom qu'elle se donne.
La seconde remarque tient au rôle de l'État, qu'une certaine tendance de l'analyse historique, modernisée à peu de frais, se plaît à hypertrophier, faisant de l'« État » (toutes nuances confondues) le grand responsable et le grand bénéficiaire du processus académique. Or, responsable, il ne l'est que dans une faible mesure, étant en général appelé pour légitimer une entreprise pré-existante, comme on le voit bien par exemple avec l'Académie de peinture et de sculpture qui mit quinze ans à se voir, après force manœuvres, officialisée et protégée par le roi (seules en fait la « Petite Académie » et l'Académie de France à Rome peuvent apparaître comme des émanations directes de la politique colbertiste). L'État tire certes un certain prestige de l'académie (notamment vis-à-vis de l'étranger) et l'assurance de services sans doute plus sûrs, plus réguliers ou plus homogènes que ne lui en assuraient des commandes individuelles (encore qu'il ne s'agisse ni plus ni moins que d'une systématisation des rapports d'échange traditionnels entre demandeurs et producteurs, les pressions esthétiques ne pouvant d'ailleurs guère s'exercer que sur les sujets des travaux) ; mais on ne peut en aucune manière parler de « mainmise du pouvoir » : l'académie, loin de se réduire à un simple instrument politique aux mains des fractions qui se disputent le pouvoir, est bien la première responsable, et la première bénéficiaire, de l'allégeance à l'État et à ses mandataires instrument essentiel de sa légitimité.
Ainsi, par-delà les différences de professionnalisation des activités concernées par le mouvement académique, celui-ci a pour principe un double effet d'élitisme – institutionnel (par les carrières) et culturel (par les œuvres) – propre à assurer l'existence et la reconnaissance d'une nouvelle catégorie, constituée grâce à des critères d'excellence spécifiques : à la fois dématérialisés (par le désintéressement et l'intellectualisation) et individualisés. Cette nouvelle élite se trouve ainsi dotée d'un double facteur de distinction : temporel, par la notoriété que confère l'appartenance à une institution au prestige en principe illimité (les « Immortels ») ; et social, par l'obtention d'une sorte de titre de noblesse culturelle, propre à assurer, à défaut d'un véritable anoblissement, une forme inédite, et spécifiquement culturelle, d'ennoblissement.Nathalie Heinich
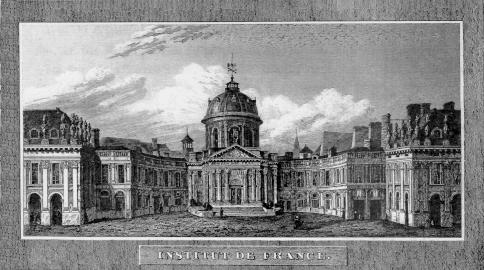          
Posté le : 21/02/2015 16:17
|
|
|
|
|
Charles VII |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 22 février 1403 naît Charles VII, en l'hôtel St Pol à Paris
on le nomme aussi Charles le victorieux ou Charles le Bien Servi, mort, à 58 ans, au château de Mehun-sur-Yèvre, résidence royale située à Mehun-sur-Yèvre, entre Bourges et Vierzon, le 22 juillet 1461, fut roi de France de 1422 à 1461 soit 38 ans et 9 mois et 1 jour, couronné le 17 Juillet 1429 en la cathédrale de Reims, son prédessesseur est Anne de Luxembourg et son successeur Louis XI. Il est le cinquième roi de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne. Son père est Charles VI, sa mère est Isabeau de Bavière, son conjoint Marie d'Anjou, il réside au château de Bourges, son héritier est Louis de France.
Roi indissociable de l'épopée de Jeanne d'Arc, il réussit à renverser une situation compromise :
-en échappant en 1418, à l'âge de quinze ans, à l'invasion de Paris par les Bourguignons qui tentaient de le capturer et en se réfugiant à Bourges où il se proclame lui-même régent du Royaume de France, eu égard à l'indisponibilité de son père resté à Paris, atteint de folie et tombé au pouvoir du duc de Bourgogne, Jean sans Peur.
-en se proclamant lui-même roi de France, depuis Bourges, en 1422, à l'âge de 19 ans, à la mort de son père, en dépit du traité de Troyes de 1420 qui le déshéritait du royaume de France depuis l'âge de 17 ans, au profit de la dynastie anglaise des Plantagenêt.
-en se faisant sacrer à Reims le 17 juillet 1429.
-en combattant les Bourguignons, alliés des Anglais, et en ratifiant le traité d'Arras de 1435, qui met fin à la guerre civile engagée depuis l'année 1407 entre Armagnacs et Bourguignons.
-en combattant les Anglais et en obtenant la victoire finale de Castillon-la-Bataille, dans l'actuel département de la Gironde, en 1453, qui met fin à la guerre de Cent Ans.
Contesté, Charles VII est devenu roi en 1422 en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, compliquée d'une intervention militaire anglaise victorieuse depuis la bataille d'Azincourt 1415. Chef de fait du parti Armagnac, il est déshérité par son père au traité de Troyes 1420 au profit du roi Henri V d'Angleterre puis du fils de ce dernier, Henri VI. Replié au sud de la Loire, le roi de Bourges, comme on le surnomme par dérision, voit sa légitimité et sa situation militaire s'arranger nettement grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. Celle-ci délivre Orléans et conduit Charles VII à la cérémonie du sacre à Reims.
Souvent critiqué par la postérité pour avoir ralenti la reconquête de la France commencée par Jeanne d'Arc et pour l'avoir abandonnée à son sort après la victoire, Charles la fait néanmoins réhabiliter solennellement en 1456 et laver de toute accusation d'hérésie. Achevant de chasser les Anglais du royaume, il s'emploie également à rétablir l'économie grâce à Jacques Cœur, le gallicanisme et l'autorité royale.
En bref
Fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, le futur Charles VII était comte de Ponthieu et devint dauphin de Viennois à la mort de son frère Jean en 1417. Il apparut donc tardivement aux côtés de Bernard d'Armagnac, comme le chef du parti hostile à la politique réformatrice et souvent démagogique du duc de Bourgogne, parti lui-même discrédité par la violence de la réaction anticabochienne des années 1413-1418. Éloigné de Paris par la domination bourguignonne en 1418, puis déshérité par son père et déclaré bâtard par sa mère traité de Troyes, 1420, il prit cependant le titre de roi à la mort de Charles VI 21 octobre 1422, mais il ne fut vraiment reconnu comme tel qu'après le sacre. Jusque-là, l'usage courant de la Cour ne lui accordait que le titre de dauphin.
Établi en Berry et en Touraine notamment à Loches et à Chinon, Charles VII était fort de la fidélité des provinces du Centre et du Languedoc, d'où il tira l'essentiel de ses ressources. Pour gouverner, au contraire, il dut improviser avec un personnel généralement nouveau et peu au fait des affaires. Le Parlement qu'il organisa à Poitiers et la Chambre des comptes qui fut établie à Bourges furent, pour l'essentiel, peuplés d'officiers naguère éliminés à Paris par les Bourguignons, de telle sorte que l'administration fut plus facilement efficace que le gouvernement. La défection d'officiers demeurés à Paris et tardivement ralliés à Charles VII renforça, surtout à partir de 1430, les structures administratives de la monarchie.
L'intervention de Jeanne d'Arc et l'énergie de quelques capitaines, parmi lesquels le bâtard de Louis d'Orléans, Dunois, sauva Charles VII de la catastrophe qu'eût été la prise d'Orléans par les Anglais, symbole de la résistance à l'étranger. Le sacre de Reims 17 juill. 1429, terme d'une randonnée où purent se manifester la fidélité des populations il n'y eut de réticences qu'à Troyes et parfois leur enthousiasme, apparut surtout comme le jugement de Dieu, reconnaissant la légitimité de l'héritier, auquel l'opinion publique fut d'autant plus sensible que le prétendant anglais Henri VI dut se contenter, deux ans plus tard, d'un sacre parisien, faute de pouvoir gagner Reims en toute sécurité.
La reconquête des régions au nord de la Loire fut entreprise dès le temps de Jeanne d'Arc. La réconciliation de Charles VII et du duc de Bourgogne, rendue possible par la modération des deux princes et par l'obstination des Anglais traité d'Arras, 1435, facilita la reprise des villes où l'adhésion au parti bourguignon ne soutenait plus la résistance militaire de garnisons anglaises souvent insuffisantes. Paris fut livré par les Parisiens aux troupes de Richemont 1436. La chute de Pontoise, en 1441, permet le rétablissement des relations avec le nord du royaume. Le pays de Caux et la région de Vire se soulevèrent. Les Anglais négocièrent une trêve Tours, 1444, que le roi de France mit à profit pour renforcer sa puissance. Il réorganisa en particulier son armée et resserra l'alliance bretonne, précieuse pour la reconquête de la Normandie. Au cours de la dernière phase de la guerre 1449-1453 furent successivement occupées la Normandie Formigny, 1450 et la Guyenne Castillon, 1453, où le roi eut l'habileté de confirmer les privilèges et d'empêcher toute réaction contre les anciens fidèles du Lancastre. Rares furent ceux qui jugèrent opportun de fuir en Angleterre.
Le règne de Charles VII n'est pas seulement un difficile parcours de l'humiliation à la victoire. C'est aussi le temps de l'organisation définitive d'institutions essentielles au gouvernement monarchique. Ayant obtenu des assemblées locales et des états généraux ou provinciaux les impôts nécessaires au financement de la guerre, Charles VII sut, avec l'aide de Jacques Cœur, son grand argentier, habituer ses sujets à la permanence de l'impôt et put, dès le milieu du siècle, éviter de convoquer les états généraux et se passer du consentement qui semblait indispensable pour la levée de toute ressource extraordinaire. L'impôt permanent, c'était la reconnaissance d'un droit monarchique étranger au droit coutumier selon lequel le roi devait vivre de son revenu domanial, comme une personne privée. C'était aussi le moyen d'une puissance assurée par une force militaire permanente. Dès 1445, Charles VII dotait son armée de structures adaptées au maintien d'une force armée en tout temps : les compagnies de l'ordonnance étaient soldées régulièrement, cependant que les autres compagnies étaient dissoutes, la guerre finie ; les unes assuraient la soumission des autres. L'efficacité des grandes institutions judiciaires et financières fut accrue, de même que satisfaction fut donnée au particularisme des provinces, par une multiplication des ressorts qui décentralisa partiellement la fonction administrative.
La crise du Grand Schisme d'Occident avait été favorable au renforcement de l'autorité royale sur le clergé français. La publication en France des canons du Concile de Bâle fournit l'occasion d'assurer cette autorité : le roi fit examiner ces canons par l'assemblée réunie à Bourges en 1438 et il les publia, amendés, en une pragmatique sanction qui fonda en droit la position du roi comme « première personne ecclésiastique du royaume ». Ce fut surtout, pour trois quarts de siècle, la base de négociations avec la papauté.
Charles VII se méfiait de Paris, où il avait vécu des jours difficiles dans son enfance. Il fit passer la prévôté des marchands aux mains d'officiers de justice ou de finance qui assurèrent la tutelle de la capitale. Pour sa résidence, le roi continua de préférer les petites villes du Val de Loire et ses châteaux de Touraine et de Berry. Capitale administrative, Paris cessa d'être la résidence principale du roi, de la cour et de l'aristocratie.
La personnalité de Charles a sensiblement évolué en quarante ans de règne. Médiocrement énergique, très affecté par la maladie de son père et par le reniement de sa mère, le roi de Bourges apparaît parfois comme un velléitaire qui laisse condamner Jeanne d'Arc, peut-être afin de ménager ses adversaires avec lesquels il espère traiter. Plus puissant que ses ancêtres et maître d'un royaume où, passée la tentative féodale dite de la Praguerie 1440, la monarchie l'emporte sur tout système de partage de la puissance publique, il apparaît encore comme très influençable, souvent dominé par des favoris Richemont, La Trémoille, Brézé et même par sa maîtresse Agnès Sorel, du moins de 1444 à 1450. Mais la seule faiblesse sérieuse de la fin du règne est l'insoumission du dauphin Louis, flagrante dès 1447 et sans cesse aggravée ; à la mort de Charles VII, le dauphin, futur Louis XI, était en révolte ouverte et réfugié à la cour de Bourgogne.
Sa vie
Jean Fouquet a représenté le roi Charles VII en roi mage. Il s'agit de l'un des très rares portraits du roi. D'après certaines sources[Lesquelles ?], les deux autres rois mages sont le dauphin Louis, futur Louis XI, et son frère.
L'héritier du trône de France
Charles est le onzième et avant-dernier enfant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Il est le troisième à porter le prénom de Charles, les deux Charles précédents étant morts, l'un au berceau, l'autre à l'âge de neuf ans. Il reçoit le titre de comte de Ponthieu et, en tant que cadet de famille, ne présente aucune perspective de succéder à ses deux frères aînés, Louis et Jean, comme dauphin de France : son seul destin est de recevoir un apanage dont il rendrait hommage au roi de France. Il est élevé à Paris, dans l'hôtel Saint-Pol, alors résidence royale. Ses fiançailles avec Marie d'Anjou sont décidées. Elles sont célébrées au Louvre en décembre 1413 : les enfants, n'ont respectivement que dix et neuf ans.
La mère de Marie, Yolande d'Aragon, duchesse consort d'Anjou, ne souhaitait pas, depuis la sanglante Révolte des Cabochiens survenue au printemps 1413 à Paris, laisser les jeunes fiancés dans la capitale, les hôtes royaux de l'hôtel Saint-Pol étant notamment menacés par les Bourguignons. Elle réussit à emmener sa fille et son futur gendre en Anjou le 5 février 1414. Puis, au début de l'année 1415, sa belle-famille emmène Charles en Provence au château de Tarascon. Il revient en Anjou à la fin de l'année. Aussi, le prince peut-il passer, avec sa fiancée, quelques heureuses et paisibles années, jusqu'en 1417. Pendant son séjour, le dauphin Charles est instruit par les meilleurs maîtres et il leur doit d'être le prince le plus cultivé de son époque, comme son grand-père, Charles V.
Dauphin de France
Ses frères aînés sont morts prématurément à l'âge de 19 ans, les dauphins Louis, duc de Guyenne en 1415 et Jean, duc de Touraine en 1417. Charles, comte de Ponthieu, dernier héritier vivant de la couronne de France, devient dauphin de France, sous la dénomination traditionnelle de dauphin de Viennois, à l'âge de 14 ans, à partir du 5 avril 1417. À l'initiative de Yolande d'Aragon, il était rentré à Paris au début de l'année 1417 en compagnie de son mentor, Jean Louvet, président de Provence, pour assister au Conseil de Régence. À l'hôtel Saint-Pol, il est placé sous la tutelle de son père, Charles VI, dont l'état de démence s'est aggravé. Sa mère, Isabeau de Bavière, prétend assumer seule la direction de la régence, sous l'influence du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Pour s'en débarrasser, son fils l'envoie sous bonne garde à Tours, en résidence surveillée par les Armagnacs : elle ne pardonnera jamais au dauphin cette mésaventure !
Le dauphin prend part à la régence du royaume avec ses conseillers Armagnacs. Il est fait duc de Touraine, duc de Berry et comte de Poitiers, sous le nom de Charles II de Poitiers. En mai 1417, il est nommé lieutenant-général du royaume, chargé de suppléer son père en cas d'empêchement. Il bénéficie de la garde rapprochée de quelques officiers de la couronne affiliés au parti d'Armagnac.
Cependant, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, dévoré d'ambition, vient de libérer la reine Isabeau de sa prison tourangelle. Il l'installe à Troyes le 23 décembre 1417, après l'avoir ralliée à sa cause contre le dauphin. Il publie un manifeste pour réclamer les pleins pouvoirs, eu égard à la maladie du roi et à la jeunesse du dauphin.
Il décide de prendre le contrôle de la situation à Paris en enlevant le dauphin Charles et en éliminant les Armagnacs, afin d'assumer seul la régence du royaume.
Le roi de Bourges
1418- Devant les menaces qui se précisent contre sa personne, en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l’héritier du trône de France, sous la protection d'officiers de la couronne, doit quitter Paris envahi par les Bourguignons, dans la nuit du 29 mai 1418. Il échappe ainsi à l'influence du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, dont les gens aux ordres du redoutable tueur Capeluche procèdent au massacre du chancelier Henri de Marle, du connétable de France, le comte d'Armagnac et de leurs partisans Armagnacs.
Le dauphin se réfugie à Bourges, capitale de son duché de Berry6, entouré des fidèles officiers de la couronne affiliés au parti d'Armagnac, qui deviendront ses premiers conseillers, ce qui lui vaut, de la part des chroniqueurs bourguignons, le sobriquet péjoratif de roi de Bourges, tandis que ses conseillers sont traités d' aventuriers sans scrupules, avides de pouvoir et accusés de cupidité. Les mêmes chroniqueurs répandent le bruit que le jeune dauphin, âgé de 15 ans, est totalement livré à l'influence de ses conseillers et qu'il manque singulièrement de caractère: le parcours de Charles VII prouvera au contraire sa conduite avisée.
Il apparaît comme l'héritier légitime du royaume de France dont il porte toujours le titre de lieutenant-général, conféré par son père, Charles VI. Il est allié des Armagnacs et hostile à la politique du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, secrètement allié des Anglais. C'est dans cette ville de Bourges qu'il se proclame régent du royaume de France, au grand dam de Jean sans Peur. Ce dernier fait promulguer à Paris un édit par le roi Charles VI - toujours en état de démence - pour révoquer les pouvoirs du lieutenant-général et pour stigmatiser les méfaits de ses conseillers.
Le dauphin Charles établit le Parlement à Poitiers et la Cour des Comptes à Bourges. Il prend les armes pour reconquérir son royaume. Entouré de grands féodaux et de chefs de guerre, il soumet plusieurs villes telles que Tours, Melun, Meaux, Compiègne et Montereau.
Montereau
1419- Jean sans Peur est soucieux de faire rapatrier le dauphin à Paris sous la tutelle de son père, pour mieux le contrôler, comme il l'avait déjà fait avec les dauphins précédents. En vain, car Charles est déjà en campagne pour recouvrer son royaume. En outre, l'union entre les Bourguignons et les Anglais se délite devant les ambitions du roi Henri V d'Angleterre. Jean sans Peur décide alors de négocier avec le dauphin et avec ses conseillers un traité d'alliance contre les Anglais. Une première rencontre a lieu le 8 juillet 1419 à Pouilly-le-Fort. Elle se solde par un traité provisoire signé le 11 juillet 1419, connu sous le nom de paix du Ponceau, qui devra être confirmé ultérieurement. La seconde rencontre a lieu le 10 septembre 1419, à Montereau, résidence royale où s'est transporté le dauphin, entouré de sa garde. On dresse un enclos au milieu du pont : le dauphin et Jean sans Peur s'y retrouvent avec chacun 10 hommes armés, le gros de chaque troupe attendant sur l'une et l'autre rive. La discussion est orageuse : le dauphin reprocherait à son cousin de maintenir secrètement son alliance avec les Anglais en dépit du traité provisoire de Pouilly. Ce dernier répliquerait qu'il avait fait ce qu'il avait à faire ! Les entourages sont nerveux et, alors que le ton monte, les hommes d'armes brandissent leur épée. Tanguy du Châtel, qui avait sauvé le jeune prince lors de l'entrée des Bourguignons à Paris en 1418, écarte le dauphin de la mêlée. Jean sans Peur est tué. Les Bourguignons vont accuser le dauphin d'assassinat prémédité. Celui-ci s'en défendra et devra affronter longtemps la vengeance de Philippe le Bon, fils de Jean sans Peur.
Le traité de Troyes
Dès la mort de son père, Philippe le Bon s'est allié avec les Anglais pour combattre le dauphin.
Les chroniqueurs bourguignons répandent le bruit que le dauphin Charles est le fils naturel de feu son oncle Louis de Valois, duc d'Orléans, frère cadet de Charles VI, qui fut assassiné en 1407 sur l'ordre du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, et dont il aurait voulu venger le meurtre. Ils désignent Charles sous le sobriquet de soi-disant dauphin. Selon la rumeur, c'est parce qu'il est bâtard qu'un décret le bannit du royaume le 17 janvier 1420. Cette théorie n'est pas démontrée.
La véritable cause du déshéritement est la complicité dans le meurtre de Jean sans Peur dont on accuse le dauphin Charles. À ce titre, il est considéré comme indigne de prétendre désormais à la succession du royaume de France, du fait de ses crimes abominables.
En réalité, la dynastie anglaise des Plantagenêts revendique le trône de France et obtient l'élimination du dauphin et la disparition programmée de la dynastie directe de Valois, avec la complicité du duc Philippe le Bon de Bourgogne qui entend ainsi venger la mort de son père.
Le 21 mai 1420, en pleine crise de folie, le roi de France Charles VI est représenté par Isabeau de Bavière. Elle confirme la destitution de son propre fils qui s'exercera au profit du roi d'Angleterre, en signant avec le duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon, et Henri V d'Angleterre, le traité de Troyes. Ce traité tripartite stipule que la couronne de France sera cédée à Henri V d'Angleterre, à la mort du roi Charles VI, à condition qu'il épouse une de ses filles. Le dimanche de la Trinité, en l'église Saint-Jean de Troyes, son mariage est donc célébré avec Catherine de Valois, dont il aura un fils, le futur Henri VI.
Pour parvenir à ce subterfuge historique, le traité de Troyes abroge en tant que de besoin la Loi salique, qui interdit, dans le royaume de France, la succession monarchique en ligne féminine : le petit roi de Bourges, descendant de Saint Louis, dernier représentant de la dynastie directe de Valois, est virtuellement écarté du trône de son royaume de France.
À Troyes, le roi Henri V d'Angleterre, héritier du trône de France, avait répété que le dauphin est le seul chef et la seule cause de la guerre civile et que, par le meurtre du duc Jean, il avait bien montré son mauvais naturel et ses dispositions cruelles. Il avait ordonné aux seigneurs, conformément à leur devoir, leur consentement de venir avec lui et de l'aider à réduire ce fils obstiné et déloyal sous l'obéissance du roi son père.
1429
Territoires contrôlés par Henri V
Territoires contrôlés par le duc de Bourgogne
Territoires contrôlés par le dauphin Charles
Principales batailles
Raid Anglais de 1415
Itinéraire de Jeanne d'Arc vers Reims en 1429
Le dauphin Charles, en évoquant à juste raison l’incapacité mentale de son père, refuse les termes du traité qui devait, selon les protagonistes, abréger la guerre de Cent Ans. L'avenir démontrera que les savantes manœuvres diplomatiques concoctées par les Anglais et les Bourguignons, ont échoué. Les droits des Plantagenêts sur le trône de France sont définitivement révoqués en 1453.
Le roi de France
Rappelons que le traité de Troyes organise la future succession du roi Charles VI au profit du roi d'Angleterre, Henri V. Or, ce scénario n'aura pas lieu, car Henri V meurt le 31 août 1422 au château de Vincennes, avant Charles VI qui trépasse à l'hôtel Saint-Pol de Paris à moins de deux mois de distance, le 21 octobre 1422.
Il s'ensuit que le jeune Henri VI d'Angleterre, bébé de neuf mois, succède à son père comme roi d'Angleterre le 1er septembre 1422 et qu'il double la mise le 22 octobre 1422 en devenant également roi de France, sous la régence de son oncle le duc de Bedford qui va gouverner à Paris.
Bien entendu, cette double couronne, programmée avec la complicité des Bourguignons, n'est pas admise à la cour du petit roi de Bourges : le dauphin se proclame roi de France sous le nom de Charles VII le 30 octobre 1422. Il siège pour la première fois en majesté en la cathédrale Saint-Étienne de Bourges.
Après une chevauchée en territoire contrôlé en partie par l'ennemi, Charles VII est sacré roi de France en la cathédrale Notre-Dame de Reims le 17 juillet 1429 en présence de Jeanne d'Arc.
De son côté, Henri VI d'Angleterre est sacré, à son tour, roi de France à l'âge de neuf ans en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 16 décembre 1431, par le cardinal de Winchester, entouré du duc de Bedford et de nombreux lords anglais.
Le roi Charles VII doit affronter les Anglais et les Bourguignons dans de durs combats pour recouvrer l'intégralité du royaume de France dont il est le légitime héritier.
La nef sans gouvernail
De 1422 à 1425, le roi Charles VII consolide ses positions. Il contrôle le Berry, la Touraine, le Poitou, l'Aunis, et la Saintonge, une part de l'Auvergne et du Limousin, Lyon, le Dauphiné, le Languedoc, l'Agenais, le Rouergue et le Quercy. L'Anjou, le Maine, le Bourbonnais, l'Orléanais et le Vendômois sont également placés sous son contrôle. En 1425 Charles VII place son armée sous les ordres du comte de Richemont, frère du duc de Bretagne, à qui il remet l'épée de connétable de France. L'alliance avec le duché de Bretagne va renforcer les armes de France, nonobstant quelques atermoiements relevés de part et d'autre au fil des années. Cette même année 1425 voit l'éviction du pouvoir des premiers conseillers de Charles VII, à l'instigation de Philippe le Bon, beau-frère du comte de Richemont, qui est intervenu pour éliminer ceux qu'il considère comme les auteurs du meurtre de son père sur le pont de Montereau en 1419. De 1425 à 1429, les troupes royales confrontées aux Anglais et aux Bourguignons, subissent des revers entrecoupés de quelques victoires... Le sort du royaume de France semble indécis. L'historiographe de Charles VII, Alain Chartier déclare : Nous allons comme la nef sans gouvernail. Les Anglais reviennent en force et le 4 septembre 1428 envahissent le Gâtinais. Ils investissent Beaugency, Notre-Dame de Cléry et d'autres places : leur objectif est de prendre Orléans, ville-clef de la défense française sur la Loire.
Le 1er octobre 1428, pour faire face au péril, Charles VII réunit les États généraux à Chinon, afin d'obtenir les ressources nécessaires pour résister à l'ennemi. Il obtient à la fois des subsides et des renforts qui serviront utilement à la défense de la ville d'Orléans.
Jeanne d'Arc à Chinon
Le duc de Bedford, régent des royaumes de France et d'Angleterre, met le siège devant Orléans, et veut poursuivre jusqu'à Bourges pour s'emparer du roi Charles VII. Mais celui-ci s'était d'ores et déjà réfugié à Chinon. C'est dans le château de Chinon que le 25 février 1429, une jeune fille vient le trouver et lui demande audience. Elle lui dit : Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France.
Cette jeune fille de seize ans lui affirme qu'elle a eu des visions qui lui ont intimé l'ordre de sauver Orléans et de le faire couronner roi de France. Charles VII la fait examiner par des ecclésiastiques, qui se montrent convaincus de sa sincérité et de sa catholicité. Cette jeune fille, qui dit venir de Lorraine et s’appeler Jeanne d'Arc, pousse Charles à se faire sacrer roi et à lever son armée pour bouter les Anglais hors de France.
Le siège d'Orléans
Commencé en juillet 1428, le siège d'Orléans s'est poursuivi pendant près de dix mois, entrecoupé de revers et de succès. Les Français, aux ordres de Jean de Dunois et leurs alliés écossais, conduits par John Stuart de Darnley, se font tailler des croupières lors de la journée des Harengs, du 12 février 1429. Mais les forces fidèles à Charles VII vont réagir et le siège d'Orléans s'est achevé le 8 mai 1429 par une éclatante victoire française. Les historiens considèrent que cette victoire est due à Jeanne d'Arc et à son compagnon d'armes Dunois.
Les ultimes combats de Jeanne d'Arc
Depuis la levée du siège d'Orléans, Jeanne d'Arc participe sans interruption à des combats victorieux contre les Anglais au cours du mois de juin 1429 :
– le 10 juin à la bataille de Jargeau ;
– le 14 juin à la bataille de Meung-sur-Loire ;
– le 15 juin à la bataille de Beaugency ;
– le 18 juin à la bataille de Patay.
Puis, en traversant des régions occupées en partie par les Anglais et les Bourguignons, elle s'engage dans la marche triomphale de Charles VII jusqu'à Reims où il est sacré le 17 juillet 1429, en recevant l'onction sacrée de la Sainte Ampoule, par Mgr Renault de Chartres, archevêque de Reims et ancien chancelier de France. En la cathédrale, lors de la cérémonie, Jeanne d'Arc est à ses côtés, en armure et munie de son étendard: les prédictions de Domrémy étaient heureusement avérées.
Enfin, après une période de négociations et de trèves entre les Armagnacs et les Bourguignons, ces derniers rouvrent les hostilités. Le 10 mai 1430, Jean de Luxembourg entame le siège de Compiègne. Alertée par ses habitants, Jeanne d'Arc vient à leur secours à la tête de 400 lances. Mais, tombée dans une embuscade, elle devient prisonnière des Bourguignons. Elle est vendue aux Anglais, jugée à Rouen par le tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque de Beauvais, Pierre Cauchon. Elle est condamnée à mort comme hérétique et relapse, et meurt en martyre, brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans.
Le roi Charles VII, après avoir libéré Rouen en 1449, fait ouvrir une enquête sur les circonstances de son procès et de son supplice. Il obtient pour celle qui l'avait si fidèlement servi, une solennelle réhabilitation le 17 juillet 1456. Sa fête, devenue fête nationale française, est fixée au dimanche suivant le 8 mai, jour anniversaire de la délivrance d'Orléans.
Depuis le xve siècle, les historiens ont cherché à définir le rôle exact de celle que les Français ont adoptée comme leur sainte patronne. Sur le plan militaire, elle n'est pas considérée comme chef de guerre, mais plutôt comme l'auxiliaire de la victoire, par ses encouragements et ses incitations à se battre résolument contre les Anglais et leurs alliés bourguignons. Sur le plan politique, elle sert admirablement les desseins du roi Charles VII, au moment où il était atteint de découragement devant les progrès de l'ennemi et la faiblesse de son camp : cette jeune fille inspirée religieusement, énergique et enthousiaste, entraîne le roi à un total changement de cap. Elle est surtout à l'origine de sa légitimation en le faisant sacrer à Reims. Enfin, elle incarne le symbole de la résistance du peuple de France contre l'occupant étranger.
La paix d'Arras
Le 1er juillet 1435, sous la présidence des légats du pape et en présence de nombreux princes français et étrangers, le congrès de la paix entre Bourguignons et Armagnacs s'ouvre en la ville d'Arras. Le roi Charles VII est représenté par le duc de Bourbon, le comte de Vendôme et le connétable de Richemont. Philippe le Bon est accompagné de son fils, le futur duc de Bourgogne Charles le Téméraire et assisté du chancelier Rolin.
Le 21 septembre 1435, dans la liesse populaire, la paix d'Arras est proclamée en l'église Saint-Waast, mettant fin à la guerre civile déclenchée en 1407 entre les Armagnacs et les Bourguignons, à la suite de l'assassinat du duc Louis d'Orléans par les sbires du duc de Bourgogne, Jean sans Peur.
La Pragmatique Sanction de Bourges
En 1438, le roi Charles VII, soucieux d'affirmer son autorité sur l'Église de France, décide de convoquer une assemblée composée d'évêques, de religieux et de théologiens, ainsi que des représentants du pape Eugène IV, en la Sainte-Chapelle de Bourges, afin de bien définir et de renforcer les pouvoirs du roi de France face aux prérogatives du souverain pontife. La Pragmatique Sanction de Bourges, promulguée le 7 juillet 1438, lui permet ainsi de s'imposer comme le chef naturel de l'Église de France. Il détient désormais le pouvoir de désigner les principaux représentants du clergé français dans les abbayes et les différents sièges épiscopaux français, avec l'approbation des conciles et de celle du souverain pontife. En outre, il a un droit de regard et d'intervention sur les modalités de redistributions des redevances vers le Saint-Siège. C'est le premier pas vers une institution bien française connue sous le nom de gallicanisme.
L'ordonnance d'Orléans
En 1439, les États généraux de langue d'oïl, réunis sous la présidence du roi Charles VII à Orléans, émettent le vœu qu'une réforme intervienne pour mettre fin aux désordres provoqués par les routiers et les écorcheurs. Ces supplétifs des troupes combattantes de l'armée royale, le plus souvent aux ordres des grands féodaux, se signalaient en effet par leurs nombreuses exactions. Entre deux combats, leurs groupes armés pillaient et rançonnaient la population, en échappant à tout contrôle des autorités constituées.
Par l'ordonnance d'Orléans, donnée le 2 novembre 1439 par le roi Charles VII, deux réformes sont décidées :
Le roi se réserve désormais le droit exclusif de lever les compagnies de gens d'armes, les compagnies libres étant désormais interdites. Seuls les paysans restent autorisés à se rassembler et à s'armer pour détruire les bandes de pillards.
L'armée royale est tenue de respecter un règlement disciplinaire rigoureux.
Le roi décrète l'unité de l'impôt, au détriment des tailles seigneuriales, pour financer l'armée permanente du royaume de France.
La Praguerie
L'ordonnance d'Orléans provoque la réaction des féodaux du royaume qui refusent toute atteinte de leurs prérogatives médiévales au profit du pouvoir royal centralisateur.
En 1440, les grands vassaux s'engagent dans une révolte armée contre le roi Charles VII. Cette conspiration est connue sous le nom de Praguerie, par allusion à la Révolte des Hussites à Prague au début du xve siècle. Parmi les comploteurs se retrouvent Jean II d'Alençon, Jean IV d'Armagnac, Charles Ier de Bourbon et jusqu'au dauphin Louis, futur Louis XI, pressé de prendre le pouvoir en éliminant son père.
Les conjurés prennent les armes, mais ils essuient le refus des seigneurs qui restent fidèles au roi Charles VII. Après de nombreux combats, les troupes royales, dirigées en personne par le roi Charles VII, finissent par venir à bout des révoltés le 19 juillet 1440. Ces derniers demandent grâce et l'obtiennent de la part du roi. Son fils Louis est éloigné jusqu'en Dauphiné dont il va assumer le gouvernement.
Les compagnies d'ordonnance
Profitant d'une accalmie dans la guerre de Cent Ans, le roi Charles VII crée, par l'ordonnance de 1445, les premières unités militaires permanentes à disposition du roi de France, appelées compagnies d'ordonnance.
Elles visent à la fois à une plus grande efficacité au combat de l’armée royale, et à une diminution des dégâts causés par l’armée en déplacement. Elles joueront un grand rôle dans la victoire de la France à la fin de la guerre de Cent Ans en 1453.
La bataille de Normandie
Le 31 juillet 1449, le conseil du roi approuve la décision de Charles VII d'ouvrit les hostilités afin de libérer définitivement cette province.
Trois corps d'armée dirigés par le comte de Saint-Pol, par Jean de Dunois et Pierre de Brézé et par le duc François Ier de Bretagne, investissent les Places-Fortes du Cotentin, de Basse et Haute Normandie. Les troupes anglaises rendent les armes sous la pression des forces de l'intérieur et de l'armée royale.
Le 21 octobre 1449, la ville de Rouen est libérée. Dans la liesse populaire, le roi Charles VII prend part en majesté au grand défilé de la Libération le 10 novembre 1449.
Après de nombreux combats auxquels le roi prend part directement, les troupes royales libèrent Caen, le 6 juillet 1450, puis Cherbourg capitule le 12 août 1450 après un siège meurtrier.
La Normandie est ainsi libérée définitivement de l'occupation anglaise après un an de combat.
La bataille de Guyenne
La libération de la Guyenne devait se révéler plus longue et plus difficile que celle de Normandie. Car, en effet, les Bordelais considéraient les Anglais comme des amis et surtout des clients privilégiés dans le commerce du vin.
Le roi envoie en septembre 1450 un détachement sous les ordres de Jean de Blois, comte de Périgord. Les royaux investissent Bergerac, Jonzac et plusieurs Places-Fortes aux environs de Bordeaux.
En mai 1451, une armée forte de 20 000 hommes, aux ordres de Jean de Dunois, procède au siège de Bordeaux. La capitale de la Guyenne est libérée le 24 juin 1451 et occupée par les royaux qui administrent la cité. Mais les Bordelais se révoltent et le 22 octobre 1452, ouvrent les portes aux forces anglaises commandées par John Talbot. Les Français sont faits prisonniers et la ville est à nouveau occupée et défendue par les Anglais.
Ce n'est que le 2 juin 1453 que le roi parvient à envoyer des renforts, après avoir défendu les côtes normandes d'une nouvelle et menaçante invasion anglaise. Ils battent les troupes de Talbot le 17 juillet 1453 lors de la bataille de Castillon et reprennent le siège de Bordeaux, avec l'appui de l'artillerie des frères Bureau. Les assiégés résistent vaillamment, tous Bordelais et Anglais confondus, mais ils finissent par capituler le 5 octobre 1453 auprès de l'amiral de Bueil.
Le roi Charles VII, fait grâce aux rebelles bordelais, cependant que les Anglais rembarquent définitivement le 19 octobre 1453.
Ainsi s'achève la libération de la France, à l'exception de Calais qui ne sera libéré qu'en 1558. La prédiction de Jeanne d'Arc est réalisée, les Anglais sont définitivement boutés hors de France .
Les personnalités de la cour Agnès Sorel
C'est en 1443, à l'âge de quarante ans, que Charles VII fait connaissance d'Agnès Sorel, demoiselle d'honneur d'Isabelle Ire de Lorraine, épouse du duc René d'Anjou. Elle fut admise à la cour royale et devint la favorite du roi. Elle lui donna trois filles, les princesses Marie de Valois, Charlotte de Valois et Jehanne de Valois, qui furent officiellement légitimées et mariées à de grands seigneurs de la cour.
Agnès Sorel rayonnait par sa grâce et sa beauté. Le peintre Jean Fouquet nous en a laissé un portrait éloquent. Elle avait reçu en présent du roi le château de Beauté et elle fut surnommée la dame de Beauté.
Agnès Sorel est morte prématurément avant d'avoir atteint l'âge de trente ans, le 9 février 1450, peu de temps après avoir mis au monde une quatrième fille qui n'a pas survécu, au grand désespoir du roi. Le Tombeau d'Agnès Sorel est érigé en l'église abbatiale jouxtant le château de Loches. Un deuxième tombeau contenant une partie de ses cendres est érigé en l'abbaye de Jumièges.
Jacques Cœur
Né vers 1395 à Bourges, Jacques Cœur est le fils de Pierre Cœur, riche marchand pelletier, fournisseur de la cour du duc Jean Ier de Berry.
Jacques Cœur prend la suite de son père et devient en 1427 fournisseur attitré de la cour du roi Charles VII, qui a fait de Bourges sa capitale. Il s'engage dans le commerce international et dirige une flotte de 12 navires marchands.
En 1435, il obtient la charge de maître de la monnaie de Bourges, puis de celle de Paris. Le 2 février 1439, il est nommé grand argentier de France, chargé de recevoir les redevances des trésoriers généraux au nom du roi. Il crée des impôts nouveaux ou les remet en vigueur : la taille, le fouage, les aides et la gabelle.
Toujours chargé de son commerce international, Jacques Cœur est anobli en 1441. Il est nommé conseiller du roi en 1442. Il devient son confident et reçoit de nombreuses missions diplomatiques. Il intervient aussi pour assainir les finances du royaume. Devenu richissime, Jacques Cœur est sollicité pour financer la bataille de Normandie contre les Anglais en 1447.
Il avait fait construire en 1443 un somptueux palais à Bourges, aujourd'hui connu sous le nom de palais Jacques-Cœur, qui dépassait en magnificence le palais royal de Bourges et celui des archevêques. Il suscita de nombreuses jalousies et fut la victime, notamment de ceux qui lui avaient emprunté de l'argent. Ils témoignèrent contre lui lorsqu’un procès pour concussion lui fut intenté en 1451. Condamné à la confiscation de ses biens et au bannissement en 1453, il s'évade du château de Poitiers et se réfugie à Rome. Le pape Calixte III lui confie en 1456 le commandement de l'expédition sur l'île génoise de Chios contre les Ottomans. Il meurt au cours de l'expédition le 25 novembre 1456.
Georges de La Trémoille
Né en 1384, le comte Georges Ier de La Trémoille, après avoir servi les ducs de Bourgogne, rejoint les rangs du roi Charles VII à Bourges en 1422, tout en conservant des intelligences dans le camp des Bourguignons.
Il entre au conseil du roi et devient son confident. Il s'oppose au connétable de Richemont et trempe dans de nombreuses intrigues pour finalement subir une tentative d'attentat le 3 juin 1433 dont il ressort blessé et captif du connétable.
En 1440, il complote avec les grands féodaux dans la conspiration de La Praguerie, mais défait, il se retire dans son château de Sully-sur-Loire où il meurt le 6 mai 1446.
Les autres personnages de la cour
Les premiers conseillers du dauphin de 1418 à 1425 : Notamment, Robert Le Maçon, Jean Louvet, Tanneguy III du Chastel, Arnault Guilhem de Barbazan et Pierre Frotier. Ils adhèrent au Parti d'Armagnac et protègent le jeune dauphin de France, lors de l'invasion de Paris par les Bourguignons en 1418. Repliés à Bourges avec l'héritier du trône, ils l'assistent fidèlement lors de ses négociations avec les Bourguignons. Ils constituent sa garde rapprochée dans ses combats contre les Anglais et les Bourguignons. Ils sont partie prenante à l'entrevue de Montereau en 1419, accusés du meurtre de Jean sans Peur. Ils sont poursuivis par la vindicte du duc Philippe le Bon de Bourgogne qui entend venger la mort de son père .Ils sont jugés par contumace dans la cour de Justice de Paris en 1420 et passibles de la peine de mort pour crime de lèse-majesté. Le procès traine en longueur et n'aboutira jamais.
Ils sont évincés du pouvoir en 1425, par le comte de Richemont, nouveau connétable de France, à l'instigation de son beau-frère, Philippe le Bon. Puis, ils seront menacés dans leur vie et dans leurs biens lors de la signature du traité d'Arras en 1435 mettant fin à la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. En dépit des clauses du traité imposées par les Bourguignons, le roi Charles VII reste fidèle à ceux qui l'ont si bien servi à ses débuts et il les maintient ou les rétablit dans de nouvelles fonctions dès l'année 1444.
Les chefs de guerre : Le roi Charles VII a combattu les Anglais et les Bourguignons à la pointe de son épée, appuyé par d'excellents capitaines et chefs de guerre, parmi lesquels se sont distingués Jean II d'Alençon, Charles II d'Albret, Jean d'Aulon, Guillaume d'Avaugour, Arnault Guilhem de Barbazan, Raoul du Bouchet, Charles Ier de Bourbon, Pierre de Brézé, Jean de Brosse, Jean V de Bueil, Gaspard Bureau, Jean Bureau, Jacques Ier de Chabannes de La Palice, Antoine de Chabannes, Tanneguy III du Chastel, Prégent de Coëtivy, Louis de Culant, Philippe de Culant, Jean de Dunois, Joachim de Gamaches, Raoul de Gaucourt, Louis Giribaut, Jean VIII d'Harcourt, Tugdual de Kermoysan, La Hire, Guy XIV de Laval, André de Lohéac, Ambroise de Loré, Guillaume II de Narbonne, Gilles de Rais, le connétable de Richemont, Pierre de Rieux, les Écossais, John Stuart de Buchan et John Stuart de Darnley, Jean de Xaintrailles,
Fin de règne
Les dernières années de Charles VII sont troublées par l'ambition de son fils, le futur Louis XI, qui s'était déjà manifesté dans le passé en participant activement à la Praguerie en 1440.
En 1451, Jacques Cœur, grand argentier du roi, est arrêté sans doute à cause de ses créanciers et débiteurs jaloux de sa réussite personnelle. Il est banni en 1453.
L'année 1453 marque la fin de la guerre de Cent Ans et le triomphe de Charles VII, le Victorieux. Le roi Henri VI d'Angleterre sombre dans la démence comme son grand-père maternel, le roi de France Charles VI. Pendant ce temps, Charles VII est vainqueur des Anglais à la bataille de Castillon où périt le chef militaire anglais John Talbot. Puis, pour achever son règne si combattu par les Bourguignons et les Anglais, il triomphe des forces ennemies en reprenant Bordeaux le 15 octobre 1453.
Le 19 octobre 1453 les Anglais capitulent à Bordeaux : c'est la fin de la guerre de Cent Ans. Le roi Charles VII recouvre la souveraineté de la Guyenne et de l'ensemble du royaume de France, à la seule exception de la ville de Calais qui restera aux mains des Anglais.
Le roi Charles VII meurt le 22 juillet 1461 à Mehun-sur-Yèvre. Son tombeau est érigé en la basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France. Son fils lui succède sous le nom de Louis XI.
Le dauphin, futur roi Charles VII, échappe de justesse en 1418, à l'âge de quinze ans, grâce aux officiers fidèles à la couronne de France, à l'invasion bourguignonne de Paris commandée par le duc Jean sans Peur, en pleine guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignon. Protégé par ses conseillers, il se réfugie à Bourges et se proclame régent de France.
À la mort de son père, Charles VI, il se proclame roi de France en 1422, en dépit des clauses du traité de Troyes instituant la primauté de la dynastie anglaise des Plantagenêt sur le trône de France, et il n'aura de cesse que de chasser les forces armées anglaises du royaume de France.
Par la voie diplomatique, il obtient le rapprochement du royaume de France et du duché de Bourgogne grâce au traité d'Arras du 20 septembre 1435, mettant ainsi fin à la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons.
Il combat, l'épée à la main, en chevalier, pour recouvrer le trône de France et la totalité de son royaume, confisqués par la dynastie anglaise des Plantagenêt. Il a bénéficié de l'aide rapprochée de nombreux fidèles, dont Jeanne d'Arc est la plus belle illustration, pour obtenir la libération définitive de la France de ses occupants anglais en 1453, par la capitulation de Bordeaux.
Charles VII restaure le pouvoir royal : il soumet notamment le clergé par la pragmatique sanction de Bourges en 1438 et brise la révolte des grands féodaux, lors de la Praguerie de 1440.
Le roi Charles VII laisse un royaume pacifié à son fils Louis XI en 1461.
Sépulture
Il fut inhumé en l'église abbatiale de Saint-Denis, où il reposa avec son épouse jusqu'à la Révolution, dans la chapelle caroline de Saint-Jean-Baptiste. Les travaux de construction du tombeau débutèrent avant même le décès de la reine et furent achevés entre 1464 et 1465. Le socle de marbre noir n'était pas entouré de pleurants ni de statuettes princières, à la différence des tombeaux de Charles V et de Charles VI. Deux colonnes de marbre blanc sculpté bordaient les gisants sur la dalle. On retrouvait dais, coussins et chiens traditionnels. Une inscription funéraire était gravée au dos du dais de Marie d'Anjou. La réalisation des gisants est attribuée à Michel Colombe 1430-1513. Le grand sculpteur, célèbre pour la réalisation du tombeau de François II de Bretagne, n’a guère séjourné en Île-de-France mais il a suivi les rois dans leur déplacement de Bourges à Tours.
Le document de la collection Gaignières, aujourd'hui à Oxford, à la Bodleian Library montre qu'au XVIIe siècle, le tombeau n'était plus intact. Les bras des souverains avaient été cassés et les couronnes amputées. On ne sait à quelle période eurent lieu ces dégradations marginales.
Cependant, le monument était relativement bien préservé comme le prouve l'état du décor gothique entourant les deux gisants, tout au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle car si le dessin de Gaignières reproduit les deux colonnettes horizontales gothiques sur les côtés de la dalle, le plan de dom Félibien de 1706 ne les montre plus. Ce plan, très détaillé, les maintient pour les tombeaux de Charles V et Charles VI, ce qui peut laisser penser qu'il y eut des travaux inachevés au début du XVIIIe siècle qui motivèrent un retrait temporaire de cette décoration.
Le tombeau fut détruit du 5 au 8 août 1793. À la différence des gisants de Charles V, de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, ceux de Charles VII et de Marie d’Anjou furent brisés à coup de masse. Alexandre Lenoir put sauver les bustes des gisants qu’il fit détacher des parties supérieures amputées et s’émiettant. Aussi fit-il découper horizontalement à la scie ce qui restait de récupérable pour le transporter dans les réserves du musée des monuments français.
Au XIXe siècle, les deux vestiges ne retournèrent pas à Saint-Denis mais subirent une restauration nouveaux nez, nouvelles couronnes, peut-être à l’initiative de Viollet-le-Duc. Ils furent ensuite envoyés aux Archives nationales puis au Louvre et enfin retournèrent à la fin des années 1990 dans la basilique Saint-Denis, juste à côté du tombeau de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, sur des colonnes se faisant face.
Généalogie
Arbre généalogique des Valois.
Ascendance de Charles VII de France
Enfants légitimes de Charles VI et d'Isabeau de Bavière
Cette section doit être recyclée. Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Discutez des points à améliorer en page de discussion.
Ce paragraphe indique la fratrie de Charles VII et la destinée de chacun de ses frères et sœurs.
Nous observons que le futur roi Charles VII est le 11e enfant et qu'il est placé en 4e position dans la succession monarchique, en tant que quatrième et dernier dauphin vivant de sa génération, après la mort de ses frères no 5/Charles, no 8/Louis et no 9/Jean : À l'époque où le roi Charles VI est atteint de folie, la prétention au trône de France de la dynastie des Plantagenêt d'Angleterre, alliée aux ducs de Bourgogne, menace la succession de la dynastie de Valois. On n'aurait pas donné cher de l'accession du comte de Ponthieu au trône de France... En 1415, son frère, le deuxième dauphin Louis, duc de Guyenne, est mort, au grand dam de son beau-père, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Ce dernier, après avoir assassiné le frère du roi Charles VI, Louis Ier d'Orléans, dont il redoutait la concurrence, voyait s'effondrer ses rêves d'hégémonie du royaume de France. Après la mort du troisième dauphin Jean, duc de Touraine, en 1417 et après l'accession du quatrième dauphin Charles, comte de Ponthieu, au delphinat, - Le futur Charles VII est connu historiquement sous le nom de comte de Ponthieu-, les troupes bourguignonnes envahissent Paris et tentent en vain de le capturer en 1418. Il ira, sous la protection des officiers de la couronne18 se réfugier à Bourges, à l'abri des convoitises et des menaces de son oncle Jean sans Peur et ainsi commence l'épopée du roi Charles VII, à la reconquête du royaume de France dont il est l'héritier légitime.
Nous observons aussi que le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, cousin apanagé du roi Charles VI, dévoré d'ambition, marie sa fille Marguerite aux deux premiers dauphins, Charles et Louis. Leur mort prématurée fait obstacle à ses convoitises hégémoniques dans la régence du royaume de France, au temps de la folie du roi Charles VI.
Nous observons enfin que Catherine, qui précède immédiatement le dauphin Charles, est mariée en 1420 au roi d'Angleterre, Henri V, conformément au traité de Troyes : à la suite de la mort brutale de Jean sans Peur survenue sur le pont de Montereau, dont on accuse le futur Charles VII, ce dernier est purement et simplement déshérité par son père Charles VI au profit du roi d'Angleterre, Henri V et de ses héritiers, avec la complicité du nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui veut ainsi venger la mort de son père. La dynastie de Plantagenêt d'Angleterre doit hériter le royaume de France à la mort du roi Charles VI... Le dauphin contestera la validité de ce traité en alléguant l'état de démence de Charles VI et se proclamera roi de France en 1422, à la mort de son père.
Frères et sœurs de Charles VII
no 1/Charles1°, 25 septembre 1386 - 28 décembre 1386.
no 2/Jeanne(1°, 18 juin 1388 - 1390.
no 3/Isabelle, 9 novembre 1389 - 13 septembre 1409. Mariée le 1er novembre 1396, à l'âge de sept ans, au roi Richard II d'Angleterre. Ce dernier est mort le 14 février 1400, alors qu'elle n'avait que onze ans. Elle épouse en deuxième noce, le 6 juin 1407 son cousin Charles d'Orléans.
no 4/Jeanne 2°, 24 janvier 1391 - 27 septembre 1433. Mariée le 30 juillet 1397 à Jean de Montfort, futur duc de Bretagne.
no 5/Charles 2°, 6 février 1392 - 13 janvier 1401. Duc de Guyenne, premier dauphin de Viennois. Marié au berceau à Marguerite de Bourgogne, fille de Jean sans Peur. Mort en 1401 à l'âge de neuf ans.
no 6/Marie, 22 août 1393 - 19 août 1438. Destinée au couvent dès sa naissance. Religieuse dominicaine, elle deviendra supérieure du prieuré Saint-Louis de Poissy. Elle meurt de la peste en 1438.
no 7/Michelle, 12 janvier 1395 - 1422. Mariée le 5 mai 1403 au futur duc de Bourgogne, Philippe le Bon, mariage consommé en juin 1409.
no 8/Louis, 22 janvier 1397 - 18 décembre 1415. Duc de Guyenne, deuxième dauphin de Viennois en 1401, à la mort de son frère Charles.Marié le 30 août 1404 à Marguerite de Bourgogne, fille de Jean sans Peur, veuve de son frère Charles2 Mariage consommé en juillet 1409. Mort en 1415 à l'âge de 19 ans.
no 9/Jean, 31 août 1398 - 5 mai 1417. Duc de Touraine et de Berry, comte de Poitou, troisième dauphin de Viennois en 1415, à la mort de son frère Louis. Marié le 29 juin 1406 à Jacqueline de Bavière. Mort en 1417 à l'âge de 19 ans.
no 10/Catherine, 27 octobre 1401 - 1438. Mariée le 2 juin 1420 au roi d'Angleterre Henri V. Conformément au traité de Troyes, elle lui apporte en dot l'héritage du royaume de France, ainsi que l'Aquitaine et la Normandie. Elle lui donne un fils unique, Henri VI qui deviendra à la fois, roi d'Angleterre, à la mort de son père Henry V, et roi de France, à la mort de son grand-père Charles VI, en 1422, avant l'âge de un an, cependant que le dauphin Charles, depuis son refuge de Bourges, se proclame de son côté roi de France, sous le nom de Charles VII.
no 11/Charles3° futur roi Charles VII, 22 février 1403 - 22 juillet 1461. Comte de Ponthieu, quatrième dauphin de Viennois en 1417 à la mort de son frère Jean. Fiancé le 18 décembre 1413 à Marie d'Anjou marié en 1422. Roi de France, sous le nom de Charles VII, à la mort de son père, Charles VI en 1422.
no 12/Philippe, né et mort en l'hôtel Barbette à Paris, le 10 novembre 1407. C'est en revenant de sa visite à l'hôtel Barbette que son oncle Louis Ier d'Orléans, frère du roi Charles VI, est assassiné dans la rue Vieille-du-Temple, le 23 novembre 1407 par les sbires de Jean sans Peur.
Enfants légitimes de Charles VII et de Marie d'Anjou
Il n'a pas vingt ans lorsqu'il épouse le 22 avril 1422 à Bourges, dans la cathédrale Saint-Étienne, Marie d'Anjou. Ils eurent quatorze enfants :
Louis de France 3 juillet 1423 - 30 août 1483, qui lui succède sous le nom de Louis XI ;
Jean de France né et mort le 19 septembre 1426 ;
Radegonde de France Chinon, août 142819 - 1445 ;
Catherine de France 1428 - 13 septembre 1446, qui épouse en 1440 le futur duc de Bourgogne Charles le Téméraire ;
Jacques de France 1432 - 1437
Yolande de France 23 septembre 1434 - 29 août 1478, qui épouse le futur duc Amédée IX de Savoie en 1452, et qui, à la mort de ce dernier, devient régente de Savoie ;
Jeanne de France 1435 - 1482, qui épouse en 1452 le futur duc Jean II de Bourbon ;
Philippe de France 1436 - 1436
Marguerite de France 1437 - 1438
Jeanne de France 7 septembre 1438 - 26 décembre 1446 ;
Marie de France 7 septembre 1438 - 14 février 1439, sœur jumelle de Jeanne de France ;
Marie de France 1441-morte jeune
Madeleine de France 1er décembre 1443 - 24 janvier 1495), qui en 1462 épouse Gaston de Foix, prince de Viane ;
Charles de France 1446 - 1472.
Descendance naturelle
Charles VII eut de sa liaison avec Agnès Sorel :
Marie de France 1444-1473, qui épouse Olivier de Coëtivy, sénéchal de Guyenne ;
Charlotte de Valois ca. 1446-1477, qui épouse Jacques de Brézé, sénéchal de Normandie, dont le fils Louis de Brézé épousa Diane de Poitiers ; elle mourut assassinée par son époux qui la transperça d'un coup d'épée après l'avoir découverte dans les bras de l'un de ses écuyers ;
Jeanne de Valois 1448-après 1467 qui épousa Antoine de Bueil, chancelier du roi.
Une fille née le 3 février 1450 au manoir du Mesnil près de l'abbaye de Jumièges en Normandie et morte à l'âge de six mois.
A lire
Journal d'un bourgeois de Paris, Paris, Livre de poche, coll. Lettres gothiques, 1990
Thomas Basin, Histoire de Charles VII, Charles Samaran, Paris, Belles lettres, 2 vol
Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France
Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France
Gaston Du Fresne de Beaucourt, Extrait du catalogue des actes de Charles VII, du siège d'Orléans au sacre de Reims.
Personnalités du règne de Charles VII
La famille :
Marie d'Anjou, reine de France
Le dauphin Louis
La maison d'Orléans :
Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois
Charles, duc d'Orléans
La maison d'Anjou :
Yolande d'Aragon
René, duc d'Anjou
Charles, comte du Maine
La maison de Bretagne :
Jean V, duc de Bretagne
François Ier, duc de Bretagne
Pierre II, duc de Bretagne
Les conseillers :
Robert Le Maçon
Jean Louvet
Tanneguy III du Chastel
Arnault Guilhem de Barbazan
Pierre Frotier
Pierre de Giac
Georges Ier de La Trémoille, grand chambellan
Renault de Chartres, archevêque de Reims, chancelier
Guillaume Jouvenel des Ursins, chancelier
Les hommes de guerre :
Arthur, comte de Richemont, connétable
Jean II d'Alençon
Charles II d'Albret
Jean d'Aulon
Guillaume d'Avaugour
Arnault Guilhem de Barbazan
Raoul du Bouchet
Charles Ier de Bourbon
Pierre de Brézé
Jean de Brosse
Jean V de Bueil
Gaspard Bureau
Jean Bureau, Grand maître de l'artillerie
Jacques Ier de Chabannes de La Palice
Antoine de Chabannes
Prégent de Coëtivy
Louis de Culant
Philippe de Culant
Joachim de Gamaches
Raoul de Gaucourt
Louis Giribaut
Jean VIII d'Harcourt
Tugdual de Kermoysan
Étienne de Vignolles, dit La Hire
Guy XIV de Laval, André de Lohéac
Ambroise de Loré
Guillaume II de Narbonne
Gilles de Rais
Pierre de Rieux
John Stuart de Buchan
John Stuart de Darnley
Jean de Xaintrailles
Les financiers :
Jacques Cœur
Les hommes des arts et des lettres :
Jean Fouquet, peintre
Jean Chartier, historiographe
Les adversaires bourguignons :
Philippe le Bon, duc de Bourgogne
Les adversaires anglais :
Jean de Lancastre, duc de Bedford, régent du royaume de France
Henri Beaufort, cardinal de Winchester
Henri VI, roi d'Angleterre
John Talbot
John Fastolf
Thomas Montaigu, comte de Salisbury
William de la Pole, duc de Suffolk
Richard de Beauchamp, comte de Warwick
Maison capétienne de Valois
Charles V
Charles VI
Louis XI
Guerre de Cent Ans
Liste des traités de paix de la guerre de Cent Ans
Guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons
Traité d'Arras 1435
Formation territoriale de la France métropolitaine        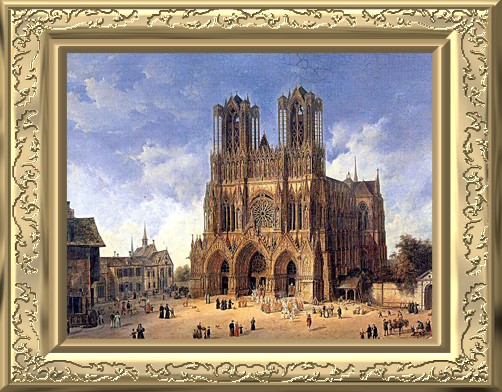 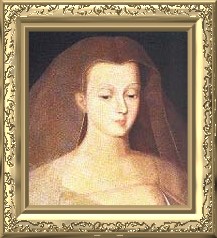 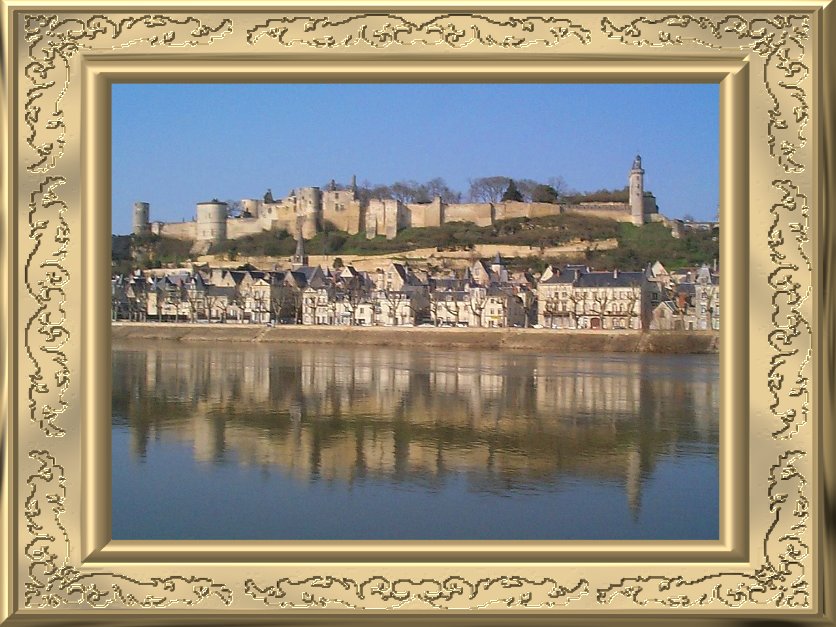 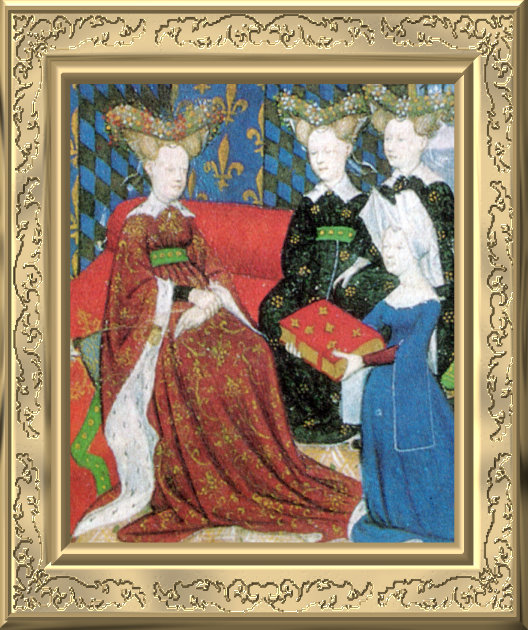 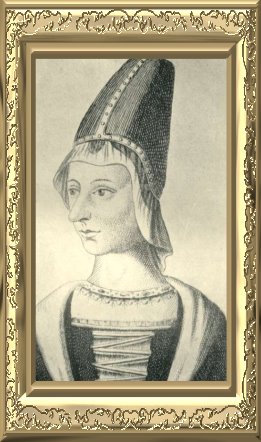 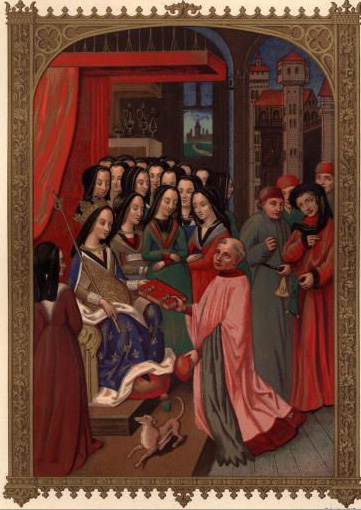 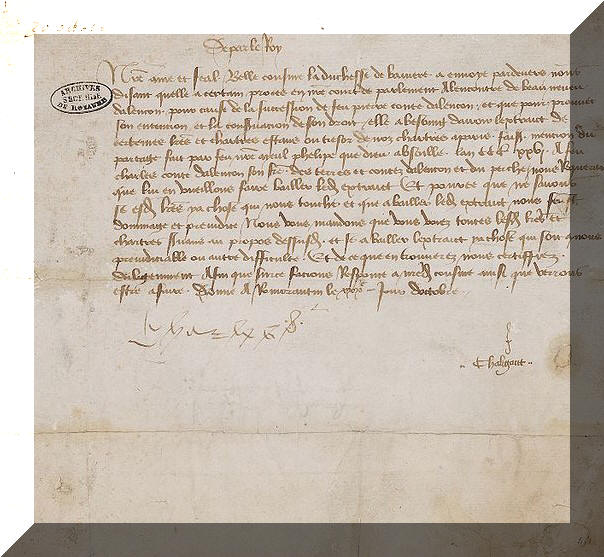
Posté le : 21/02/2015 16:06
|
|
|
|
|
Louis XV 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 15 février 1710 naît Louis XV dit le Bien-Aimé
au château de Versailles, mort, à 64 ans le 10 mai 1774 dans le même château, il est inhumé dans la nécropole de St Denisroi de France et de Navarre. Membre de la dynastie de la Maison de Bourbon, il a pour nom de naissance Louis de France, duc d'Anjou, il règne sur le royaume de France du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774.Il a pour père Louis de France, dauphin de france et pour mère Marie-Adélaïde de Savoie, sa conjointe est Marie Leszczynska et pour enfants Enfants Élisabeth de France, Henriette de France, Marie-Louise de France, Louis de France, Philippe de France, Adélaïde de France, Victoire de France, Sophie de France, Thérèse de France, Louise de France. Héritier des trônes de France et de Navarre du 8 mars 1712 au 1er septembre 1715, pendant 3 ans, 5 mois et 24 jours sous le règne du monarque Louis XIV, son prédécesseur est Louis, dauphin de France, son successeur Philippe, duc d'Orléans. Il a pour régent Philippe d'Orléans de 1715 à 1723, le premier ministre sont le Cardinal Dubois, Duc de Bourbon, Cardinal de Fleury, le prédécesseur Louis XIV, son successeur Louis XVI. Puis il est fait roi de France et de Navarre du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774, pendant 58 ans, 8 mois et 9 jours, il est couronné le 25 octobre 1722 en la cathédrale de Reims.
Orphelin à l'âge de 2 ans, duc d'Anjou puis dauphin de France du 8 mars 1712 au 1er septembre 1715, il succède à son arrière-grand-père Louis XIV à l'âge de cinq ans ; son pouvoir est alors délégué à son cousin, le duc d'Orléans, proclamé régent du Royaume le 2 septembre 1715, jusqu'au 15 février 1723, date de l'entrée du jeune roi dans sa treizième année, où il prend officiellement la direction du gouvernement.
Les premières années de son règne se déroulent dans un calme relatif, sous la direction prudente de plusieurs précepteurs, qui lui prodiguent une vaste culture. À sa majorité, il confie successivement le gouvernement à des proches parents, le duc d'Orléans, ex-régent, puis le duc de Bourbon, puis à l'un de ses anciens précepteurs, le cardinal de Fleury.
À la différence de Louis XIV, Louis XV n'a pas été en contact direct avec la vie politique du pays. Il ne voyait que rarement ses ministres et agissait souvent à l'encontre de leurs attentes faute de pouvoir leur donner des directives fermes et précises, d'après les informations émanant d'un réseau secret de diplomates et d'espions qu'il avait constitué. Son désintérêt pour la politique et la succession de ministres aux tendances différentes aboutissent à un affaiblissement de l'influence de la France en Europe.
Seul survivant de la famille royale stricto sensu, il bénéficie au début de son règne d'un grand soutien populaire, ce qui lui vaut le surnom de Bien-Aimé en 1744 après une maladie qui faillit l'emporter à Metz. Au fil des années cependant, son manque de fermeté, le dénigrement de son action par les parlementaires et une partie de la noblesse de cour, les intrigues incessantes impliquant sa maîtresse, la marquise de Pompadour, et son inconduite dans sa vie privée amènent la disparition de sa popularité, à tel point que sa mort - de la petite vérole - provoque des festivités dans Paris, comme suite à celle de Louis XIV.
Sous son règne, toutefois, la France connaît de grands succès militaires sur le continent européen et acquiert le duché de Lorraine et le duché de Bar, ainsi que la Corse. En revanche, elle perd le contrôle d'une grande partie de son empire au profit de la domination coloniale britannique : spécialement la Nouvelle-France, en Amérique, comme la prépondérance aux Indes.
En bref
Louis XV, qui sera plus tard surnommé Louis le Bien-Aimé par ses sujets apparaît un peu, à la mort de Louis XIV, son arrière-grand-père, comme l'enfant miraculeux qui va sauver la dynastie. Mais il finira son long règne 59 ans dans la disgrâce, en raison du manque de fermeté et d'esprit de décision qu'il a manifesté, même si le royaume a connu, à cette époque, la prospérité et l'ouverture à une certaine modernité.
Le Grand Dauphin, fils du Roi-Soleil, est mort en 1711 ; en 1712, c'est le tour de son petit-fils, le duc de Bourgogne, de la femme de celui-ci, Marie-Adélaïde, et de leur fils aîné, le duc de Bretagne, âgé de cinq ans, tous trois enlevés par la rougeole pourprée et par les pratiques des médecins de la cour : la purge et la saignée. Le jeune Louis est sauvé de leurs mains par son rang infime dans la succession ; sa gouvernante, Mme de Ventadour, se borna à le tenir au chaud jusqu'à sa guérison. Héritier du trône à cinq ans, le jeune Louis commence dès lors à subir les contraintes de la vie publique et d'une étiquette minutieuse voulues par son aïeul ; mais ce qui convenait à un homme fait pétri d'orgueil et de volonté ne réussit pas à l'enfant émotif et secret. Dans une lettre destinée à Mme de Maintenon, sa gouvernante raconte que Louis aime jouer « à ne plus faire le roi ». À sept ans, il est séparé de sa gouvernante et confié à son gouverneur, le maréchal de Villeroi, un vieux courtisan vaniteux qui adore faire admirer la grâce et les talents de son élève. Celui-ci, au cours d'interminables cérémonies publiques, doit apprendre à dissimuler ses besoins comme ses sentiments, à cacher sa timidité naturelle. Il acquiert alors cet air de froideur et de majesté qu'il montrera toute sa vie en public et le goût des petits appartements, des cercles intimes, d'une vie presque bourgeoise. De Fleury, son précepteur, il reçoit une excellente instruction, un penchant pour les sciences et les techniques fortement encouragées sous son règne, et il concevra pour cet homme ambitieux, secret lui aussi mais d'abord aimable, une admiration qui va marquer fortement sa vie. À onze ans, Louis voit arriver sa fiancée, une infante de trois ans qui ne lui inspire que de l'ennui. Déjà des pamphlets circulent contre le roi ; en 1722, l'avocat Barbier note dans son journal : Il a un bon et beau visage, bon air, et n'a point la physionomie de ce qu'on dit de lui, morne, indifférente et bête. L'année suivante voit la proclamation de la majorité royale et, quelques mois après, la mort du régent Philippe d'Orléans. Louis-Henri de Bourbon-Condé, dit Monsieur le Duc, prend la tête du gouvernement et, très vite, s'inquiète de la santé du roi ; non par attachement à la dynastie, mais pour empêcher l'accession au pouvoir des Orléans qu'il considère comme ses ennemis. Or le roi est de constitution fragile, et manifeste des troubles qui font craindre pour sa vie. Monsieur le Duc décide de marier le roi au plus vite, renvoie la trop jeune infante en Espagne et, entre tous les partis d'Europe, choisit une princesse pauvre et vertueuse, mais non sans charme, qui a vingt et un ans, l'âge de procréer. Le 5 septembre 1725 fut célébrée l'union de Louis XV et de Marie Leszczyńska, fille du roi détrôné de Pologne.
En 1726, le roi, qui vient d'atteindre seize ans et à qui le mariage a donné une autorité que chacun remarque à la cour, disgracie Monsieur le Duc devenu très impopulaire et appelle à la direction du ministère son cher Fleury, qui demeurera à ce poste jusqu'à sa mort en 1743. Ce sera la période la plus calme et la plus prospère du règne, en dépit de l'agitation parlementaire et janséniste. Il est difficile de déterminer quelle part Louis XV prend aux décisions, mais on sait qu'il soutient constamment son ministre contre les cabales de cour et les intrigues ministérielles. Malheureusement, lorsque la querelle européenne autour de la succession d'Autriche éclate, le vieux Fleury n'a plus assez d'énergie pour s'opposer à la guerre et le roi cède aux pressions du parti anti-autrichien. À la mort de son ancien précepteur, Louis a trente-trois ans ; il a connu quelques années de bonheur auprès d'une épouse qui lui voue presque autant de dévotion qu'à Dieu. Presque chaque année un enfant est né, des filles surtout, mais aussi un dauphin qui donnera le jour à Louis XVI. Mais Marie s'est lassée d'éternelles grossesses, et son époux d'une adoration sans conditions. Pour la première fois en 1734, Marie se plaint à son père des infidélités de Louis. Le roi a découvert l'amour avec Mme de Mailly, puis avec Mme de Châteauroux, la sœur de cette dernière, tandis que la reine se réfugiait dans la religion et les œuvres charitables. Ces amours n'ont pas fait oublier au souverain les devoirs de sa charge qu'il remplit scrupuleusement, mais il manque du feu sacré de son aïeul et il a pris l'habitude de se reposer sur Fleury des tâches d'exécution, de s'appuyer sur ses conseils pour les décisions. Pendant les dix-sept ans de ce long ministère, il a formé son jugement mais n'a pu forger sa volonté. C'est un an après la mort du ministre que se déroule le drame de Metz (1744) qui va laisser des cicatrices profondes dans l'âme du roi et dans la vie politique de la France. Parti aux armées, Louis XV tombe gravement malade à Metz. On le croit alors perdu. Mme de Châteauroux, qui avait suivi le roi, doit partir sous les huées tandis que Marie est accourue de Paris. Poussé par le parti dévôt, Mgr de Fitz-James, premier aumônier du roi, exige pour lui donner l'absolution une confession publique de ses fautes dans laquelle il déclare être indigne du nom de Roi Très Chrétien ; répandue à travers le royaume par les soins du clergé, cette confession stupéfie le peuple ; le scandale éclabousse la monarchie ; réchappé de la mort, le monarque est rejeté vers ses penchants les plus détestables. Rencontrée en 1746, Mme de Pompadour est une maîtresse plus qu'honorable ; belle, cultivée, intelligente et sincèrement attachée au roi, elle a pourtant un défaut qui la rend impopulaire aux yeux de la cour et du peuple : celui d'être une bourgeoise qui, de plus, se mêle de politique. Mais peu sensuelle et de santé fragile, la maîtresse n'est plus qu'une amie dès 1750 et Louis s'enlise dans les amours éphémères et peu reluisantes qu'il cache dans sa petite maison du Parc-aux-Cerfs, amours que la légende a démesurément grossies et dont l'objet le plus célèbre fut Louise O'Murphy.
" Après moi, le déluge "
Depuis 1743, le roi n'a plus de Premier ministre ; il a lu et relu les instructions de son aïeul : « Écoutez, consultez votre Conseil, mais décidez. » Mais, sans doute plus intelligent et plus cultivé que lui, Louis XV manque de confiance en soi ; sa correspondance politique montre sa connaissance des affaires, la justesse de ses vues ; mais il hésite à trancher, pensant que son interlocuteur peut avoir raison contre lui, et ce n'est que poussé à bout, souvent lorsqu'il est trop tard, qu'il se décide à l'action avec une brutalité qui étonne. Sa disgrâce tombe comme la foudre sur le ministre estimé coupable ; ainsi en est-il pour Maurepas, pour d'Argenson, pour Choiseul. Seul Machault qui conserve toute son estime sera remercié avec les honneurs. Cet homme si sensible à l'opinion n'ose entreprendre les réformes indispensables par crainte de perdre sa popularité ; en décembre 1756, le roi a obligé le Parlement à enregistrer des édits le privant de ses moyens d'action, il est décidé à mettre fin à la rébellion des magistrats. Le coup de couteau de Damiens, le 5 janvier suivant, le persuade qu'il fait fausse route puisque son peuple le désavoue. La réforme de Machault ne sera réalisée qu'avec Maupeou en 1771.
De ses déboires politiques, Louis ne se console pas seulement avec ses maîtresses ; il aime tendrement ses enfants qui le lui rendent bien ; l'une de ses filles, Louise, prendra le voile en expiation des péchés de son père. La mort du Dauphin, en 1765, le plonge dans une douleur d'autant plus grande qu'il ne reste pour lui succéder qu'un enfant de onze ans. Peu auparavant, il écrivait à Choiseul : « Au moins avec mon fils, je suis sûr d'un successeur fait et ferme. Et c'est tout vis-à-vis de la multitude républicaine. Louis XV était lucide sur l'état dans lequel il laisserait la France ; de ses mots : tout cela durera bien autant que moi », les manuels d'histoire ont fait le célèbre : Après moi le déluge. Sa révolution royale, il ne la réalise que trois ans avant sa mort. Depuis 1768, il a auprès de lui une nouvelle favorite, Jeanne du Barry née Bécu, encore plus détestée que la Pompadour. Il sait qu'il n'est plus le Bien-Aimé. La petite vérole l'emporte à l'âge de soixante-quatre ans au milieu de l'indifférence générale. Louis XV demeure l'une des figures les plus attachantes de sa lignée : fin, généreux, sensible, il partagera largement les goûts de son temps ; il lui manqua sans doute l'essentiel pour un souverain : l'esprit de décision, une volonté ferme et constante. Pendant les cinquante-quatre ans que dura son règne, Louis XIV avait habitué la France à obéir, et incarné l'État. Sa grande ombre devait éclipser son successeur en proie à trop de faiblesses humaines. Le Siècle de Louis XIV n'a-t-il pas été conçu par Voltaire pour démontrer cette écrasante supériorité ?
Sa vie
Louis XIV et ses descendants : le dauphin, le duc de Bourgogne et le duc de Bretagne à la naissance du futur Louis XV, Largillière, 1710
Louis XV est né le 15 février 1710 dans le château de Versailles. Il est le troisième fils de Louis de France, duc de Bourgogne, surnommé le Petit Dauphin, et de Marie-Adélaïde de Savoie. Il est ainsi l'arrière-petit-fils de Louis XIV. De ses deux frères aînés, également prénommés Louis, le premier, titré duc de Bretagne mourut en 1705 à l'âge d'un an, le second, reprenant le titre de duc de Bretagne, né en 1707, ne vécut que cinq ans.
À sa naissance, en pleine guerre de Succession d'Espagne, le futur Louis XV, titré duc d'Anjou — titre porté précédemment par son oncle, Philippe de France, prétendant français au trône d'Espagne et futur roi Philippe V 1700-1746 — est immédiatement confié à sa gouvernante, la duchesse de Ventadour, secondée par Madame de La Lande, sous-gouvernante. Il n'est alors pas destiné à régner, se plaçant au quatrième rang dans l'ordre de succession dynastique. Avant lui, doivent logiquement régner le fils de Louis XIV, le Grand Dauphin, puis son père le Petit Dauphin, et enfin son frère aîné, le duc de Bretagne. Mais entre 1710 et 1715, une série de morts dans la famille royale met brusquement le jeune prince en première ligne dans la succession de Louis XIV : le Grand Dauphin meurt de la variole le 14 avril 1711. L'année suivante, une rougeole maligne emporte le Petit Dauphin et son épouse les 18 et 12 février 1712.
Les deux fils aînés du duc de Bourgogne, les ducs de Bretagne et d'Anjou, contractent également la maladie. L'aîné, Bretagne, meurt le 8 mars 1712. Le jeune duc d'Anjou, âgé alors d'à peine deux ans, devient alors l'héritier du trône de France avec le titre de dauphin de Viennois, abrégé en dauphin. Malade, sa santé est scrutée avec attention par Louis XIV, roi vieillissant et suffisamment affecté par les pertes familiales récentes pour se laisser aller à pleurer devant ses ministres. On craint longtemps pour la santé du jeune prince, mais, petit à petit, il se remet, soigné par sa gouvernante et protégé par elle des abus de saignées qui ont vraisemblablement causé la mort de son frère.
En 1714, Louis est confié à un précepteur, l'abbé Perot. Celui-ci lui apprend à lire et à écrire, et lui enseigne des rudiments d'histoire et de géographie et, bien sûr, lui donne l'enseignement religieux nécessaire au futur roi très chrétien. En 1715, le jeune dauphin reçoit également un maître à danser, puis un maître à écrire. Son confesseur est le père Le Tellier.
Le jeune roi
Le futur Louis XV commence sa vie publique peu de temps avant la mort de son bisaïeul Louis XIV. Le 19 février 1715, Louis XIV reçoit en effet en grande pompe dans la galerie des Glaces de Versailles l'ambassadeur de Perse. Il associe son successeur, qui vient d'avoir cinq ans, à la cérémonie, le plaçant à sa droite. En avril 1715, l'enfant participe avec le vieux roi à la cérémonie de la Cène du Jeudi saint et participe au Lavement des pieds. Il est toujours accompagné de sa gouvernante, Madame de Ventadour. Dans les derniers temps de la vie de Louis XIV, le futur roi participe à plusieurs défilés militaires et cérémonies visant à lui donner l'habitude de la vie publique.
Le 26 août, sentant la mort venir, Louis XIV fait entrer le jeune Louis dans sa chambre, l'embrasse et lui parle avec gravité de sa future tâche de roi, dans des mots qui sont par la suite passés à la postérité, qui y a vu une sorte de testament politique du grand roi et des remords concernant sa propre action :
Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre : c'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela ; j'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l'ai soutenue par vanité. Ne m'imitez pas, mais soyez un prince pacifique, et que votre principale application soit de soulager vos sujets.
Louis XIV meurt six jours plus tard, le 1er septembre 1715.
Les 3 et 4 septembre 1715, Louis XV accomplit ses premiers actes de roi, d'abord en se rendant à la messe de requiem célébrée pour le feu roi à la chapelle de Versailles, ensuite en recevant l'assemblée du clergé venue célébrer son propre avènement. Le 12, il enchaîne sur un lit de justice, l'une des cérémonies les plus solennelles de la monarchie, le 14, sur les harangues du Grand Conseil, de l'Université de Paris et de l'Académie française, les jours suivants, sur les réceptions d'ambassadeurs venus présenter leurs condoléances, etc. Malgré son jeune âge, il doit se plier à la mécanique du gouvernement et de la cour et jouer son rôle de représentation.
Au jour anniversaire de ses sept ans le 15 février 1717, ayant atteint l'âge de raison, son éducation passe aux hommes : elle est désormais confiée à un gouverneur, le duc François de Villeroy, un ami d'enfance de Louis XIV et fils de Nicolas V de Villeroy, gouverneur de Louis XIV qui lui impose tous les rituels de la Cour de Versailles mis en place par Louis XIV. Il y a également un précepteur, André Hercule de Fleury, évêque de Fréjus. On lui apprend désormais le latin, les mathématiques, l'histoire et la géographie, la cartographie, le dessin et les rudiments d'astronomie, mais aussi la chasse. L'éducation manuelle n'est pas non plus négligée : en 1717, il apprend un peu de typographie, et en 1721, il s'initie à tourner le bois. Depuis 1719, il avait des maîtres de musique. Contrairement à Louis XIV, il n'avait que peu d'affinités pour la musique mais était attiré par l'architecture.
Régence du duc d’Orléans
La monarchie française a, depuis le Moyen Âge, fixé de manière stricte les règles de succession. Elle a cependant peu de règles concernant les régences. Ces périodes sont redoutées comme propices aux troubles à cause de la faiblesse alors présentée par le pouvoir royal. Louis XIV, voyant ses descendants mourir avant lui, a donc réglé les problèmes de régence qui allaient se poser après sa mort. Il songeait également que, le petit Louis XV étant seul de sa lignée et fragile, il fallait assurer une succession au trône. Cela entraîna donc, à la fin du règne de Louis XIV, plusieurs modifications des coutumes, et notamment le fait que les enfants bâtards de Louis XIV aient été déclarés successibles.
Mais le régent fait casser le testament de Louis XIV et devient le successeur potentiel de Louis XV. Le principal danger dynastique vient, pour lui, de l'Espagne, dotée d'un roi Bourbon qui, normalement, avait, par le traité d'Utrecht renoncé à tout droit au trône, mais qui aurait bien pu évoquer l’indisponibilité de la couronne pour faire valoir ses droits en cas de décès de Louis XV sans enfant.
Le Régent, Philippe d'Orléans, à qui Louis XIV a confié le jeune roi, est donc conduit à prendre quelques libertés avec les instructions de l'ancien roi, ce afin de protéger Louis XV et de commencer à assurer son autorité.
La première mesure prise par le Régent est de ramener Louis XV et la Cour à Paris. C'est aller contre les volontés de Louis XIV, mais se rapprocher du peuple. Le souvenir de la Fronde est encore vif, et le Régent souhaite construire un lien fort entre le peuple de Paris et le jeune roi, afin d'éviter tout trouble. Après un passage par Vincennes de septembre à décembre 1715, Louis XV s'installe au palais des Tuileries tandis que le Régent gouverne le royaume depuis le Palais-Royal. Le peuple parisien se prend alors d'affection pour ce jeune roi alors que le noblesse, désormais dispersée dans les hôtels de la capitale, jouit sans contrainte ni mesure de sa liberté.
Un des premiers actes politiques de Philippe d'Orléans est également sa volonté de donner des garanties au Parlement pour compenser le retour à Paris de la Cour et la liberté prise par le Régent avec les instructions de Louis XIV. Il lui redonne notamment le droit de remontrance, que Louis XIV avait fortement réduit en le cantonnant à des remontrances postérieures à la prise de décision royale. En ces temps de faiblesse du pouvoir, les parlements, et principalement le Parlement de Paris se présentent comme des représentants du peuple, malgré la vénalité de leurs charges et leur composition quasi exclusivement issue de la noblesse de robe. Cela leur donne le pouvoir de s'opposer au Régent, notamment par des grèves, appelées cessations d'activité ». Le premier conflit apparaît en 1717-1718, à propos des soucis financiers dus à la banqueroute de Law. Par ailleurs, entre 1715 et 1718, le gouvernement central est réorganisé: les secrétaires d'État sont supprimés et remplacés par des conseils qui redonnent un rôle politique à la haute noblesse: c'est la polysynodie. Ce système est abandonné en raison de sa lourdeur.
D'autres conflits apparaissent régulièrement, liés notamment au problème janséniste et à l'application de la Bulle Unigenitus. En rompant avec la mainmise de Louis XIV sur les droits des parlements, le Régent ouvre la porte à une ère de contestation, que Louis XV aura bien du mal ensuite à contrer.
Louis XV et sa fiancée Marie Anne Victoire d'Espagne, fille de Philippe V d'Espagne par François de Troy.
La Régence marque aussi un changement d'alliances pour la France. Alors qu'elle avait auparavant noué une solide alliance avec l'Espagne des Bourbons, voisine géographique et alliée catholique, le Régent opte au contraire pour un éloignement d'avec l'Espagne et un rapprochement avec les puissances du nord de l'Europe, revenant à la politique du siècle précédent alors que le risque d'encerclement des Habsbourg n'existe plus. C'est ainsi qu'il renoue des contacts avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, pourtant protestants. En 1717 est formalisée la Triple alliance de La Haye, liant France, Pays-Bas et Angleterre. Ce retournement d'alliance du régent est même complété en 1718, par une alliance innovante avec l'Autriche des Habsbourg quadruple alliance. Tout cela inquiète le roi Philippe V d'Espagne à tel point qu'il tente de faire renverser le régent par le duc du Maine et que cela entraîne une courte guerre entre la France et l'Espagne en 1719. La victoire des puissances européennes contraint l'Espagne à rejoindre leur alliance et à organiser des fiançailles ou des mariages franco-espagnols. Le roi est un temps fiancé à Marie-Anne-Victoire d'Espagne, renvoyée en Espagne par le duc de Bourbon.
Sur le plan économique, la Régence est une période de vitalité et d'expérimentations. Mais l'échec du système de Law et les réticences qui suivent concernant le crédit et l'investissement ralentissent, à terme, la modernisation de l'économie.
Las des critiques des Parlementaires qui commencent à agiter en sous-main les Parisiens et de l'hostilité de la foule qui lance injures et projectiles sur son carrosse, le Régent, sans l'annoncer officiellement, décide de faire revenir la Cour au château de Versailles. Le 15 juin 1722, Versailles redevient résidence royale et symbolise le retour à la politique louis-quatorzienne.
La Régence laisse ainsi au jeune roi Louis XV, lorsqu'il prend effectivement les rênes du pouvoir en 1723 un royaume à la fois héritier de la monarchie absolutiste de Louis XIV et des ouvertures parfois fragilisantes du Régent. Cela influence considérablement le règne de Louis XV.
Règne Début du règne personnel
Le jeune Louis XV est sacré et couronné à Reims le 25 octobre 1722. Il atteint sa majorité 13 ans l'année suivante, et est déclaré majeur lors du lit de justice du 22 février 1723. Cependant, encore trop jeune pour régner par lui-même, il laisse l'exercice effectif du pouvoir tout d'abord au duc d'Orléans et au cardinal Dubois. Les deux meurent à quelques mois d'intervalle, à la fin de l'année 1723. En 1724, le Roi, probablement sous influence, signe une révision du Code noir. Destiné à la Louisiane, il s'agit d'un durcissement de la version précédente édictée par son arrière grand-père. Notamment, les mariages entre Noirs et Blancs sont interdits.
C'est le duc de Bourbon, prince du sang, qui devient alors le principal conseil du roi. Pendant que celui-ci termine son éducation et s'adonne à de nouveaux plaisirs, comme ceux de la chasse, le duc de Bourbon cherche à trouver une épouse pour le roi. La première pressentie, Marie-Anne-Victoire de Bourbon, avait été fiancée en 1721 à Louis XV, alors qu'elle n'avait que trois ans. Mais le duc de Bourbon, craignant que le jeune roi, de santé fragile, ne décède sans enfant mâle s'il fallait attendre que sa fiancée soit en âge d'avoir des enfants, et craignant alors de perdre sa place privilégiée en cas de transmission de la couronne à la branche d'Orléans, rompt les fiançailles en 1725.
La recherche d'une autre fiancée parmi les princesses d'Europe est dictée par la santé fragile du roi, qui nécessite une rapide descendance. Après avoir dressé une liste des cent princesses d'Europe à marier, le choix se porte sur Marie Leszczyńska, princesse catholique et fille du roi détrôné de Pologne Stanislas Leszczynski. Le mariage n'est d'abord pas très bien vu en France, la jeune reine étant perçue comme de trop faible extraction pour un roi de France. Mais les époux se plaisent, malgré les sept ans qui les séparent, Marie Leszczyńska ayant 22 ans et Louis XV seulement et la reine est rapidement appréciée du peuple pour sa charité. Après un mariage par procuration le 15 août dans la cathédrale de Strasbourg afin de valoriser la province d'Alsace récemment annexée, la cérémonie du mariage est célébrée à Fontainebleau le 5 septembre 1725.
À la suite de ce mariage, et malgré l'insistance de la reine qui le considérait comme son mentor, Louis XV écarte le duc de Bourbon du pouvoir et l'exile dans ses terres à Chantilly. Avec cet exil, Louis XV décide également de supprimer la charge de premier ministre. Il appelle auprès de lui le cardinal de Fleury, son ancien précepteur. Celui-ci commence alors auprès du roi une longue carrière à la tête du royaume, de 1726 à 174313.
Ministère du cardinal de Fleury
Le renvoi du duc de Bourbon marque le début du règne personnel du roi adolescent. En fait, se réfugiant derrière l'ombre tutélaire du feu Louis XIV, le jeune roi, orphelin trop tôt, abandonnera la totalité du pouvoir au cardinal de Fleury, le précepteur fidèle qui avait su capter son affection. Ainsi, bien qu'instruit et désireux d'accomplir au mieux sa charge, il commence son règne le 16 juin 1726 en fixant les cadres de son gouvernement, annonçant à son "Conseil d'En Haut", outre la fin de la charge de premier ministre, sa fidélité à la politique de Louis XIV, son arrière-grand-père :
"Mon intention est que tout ce qui regarde les fonctions des charges auprès de ma personne soient sur le même pied qu'elles étaient sous le feu Roi mon bisaïeul. ... Enfin, je veux suivre en tout l'exemple du feu Roi mon bisaïeul. " "Je leur, aux conseillers fixerai des heures pour un travail particulier, auquel l'ancien évêque de Fréjus le cardinal de Fleury assistera toujours."
De 1726 jusqu'à sa mort en 1743, le cardinal dirige donc la France aux côtés du roi. La situation est alors inédite. C'est la première fois qu'un ancien précepteur de roi devient de facto Premier ministre. Louis XV, désireux de garder auprès de lui son mentor auquel il était profondément attaché, qui avait déjà des charges importantes et en qui il avait totale confiance, donne au cardinal de Fleury pourtant septuagénaire un pouvoir extrêmement étendu. Les près de dix-sept ans où Fleury administre au jour le jour le royaume, pour l'historien Michel Antoine, délimitent dans le règne une période caractéristique et importante, tant pour l'extension du royaume et son rayonnement dans le monde et pour les affaires intérieures, que pour l'administration, la législation et l'économie .
Nouvelle équipe
Si le cardinal de Fleury est un homme âgé en 1726, il a soixante-treize ans, le reste des ministres et très proches conseillers du roi se renouvelle et est composé d'hommes plus jeunes qu'auparavant. Les changements sont nombreux, mais ensuite la période du ministère Fleury est marquée par une grande stabilité. Fleury fait revenir le chancelier d'Aguesseau, renvoyé en 1722. Il ne retrouve cependant pas toutes ses prérogatives, puisque les sceaux et les Affaires étrangères sont confiées à Germain Louis Chauvelin, président à mortier du Parlement de Paris. Le comte de Maurepas devient secrétaire d'État à la Marine, à vingt-cinq ans. C'est la période la plus pacifique et prospère du règne de Louis XV, malgré d'importants troubles avec le parlement de Paris et les jansénistes. Après les pertes humaines et financières subies à la fin du règne de Louis XIV, puis lors de l'établissement de nouveaux systèmes financiers français, le gouvernement de Fleury a souvent été qualifié de réparateur . Il est difficile de déterminer avec exactitude le degré d'intervention du roi dans les décisions de Fleury, mais il est certain que Louis XV a soutenu sans relâche son mentor et qu'il n'est jamais allé véritablement contre ses volontés. Pour Michel Antoine, Louis XV, extrêmement timide, resta pratiquement en tutelle jusqu'à l'âge de trente-deux ans.
Avec l'aide des contrôleurs généraux des finances Michel Robert Le Peletier des Forts, 1726-1730 et surtout Philibert Orry, 1730-1745, "Monsieur le Cardinal" parvint à stabiliser la monnaie française 1726, en nettoyant le système financier de Law, et finit par équilibrer le budget du royaume en 1738. L'expansion économique était au cœur des préoccupations du gouvernement. Les voies de communications furent améliorées, avec l'achèvement en 1738 du canal de Saint-Quentin, reliant l'Oise à la Somme, étendu ultérieurement vers l'Escaut et les Pays-Bas, et principalement la construction systématique d'un réseau routier sur l'ensemble du territoire national. Le corps des Ingénieurs des ponts et chaussées construisit un ensemble de routes modernes, partant de Paris selon le schéma en étoile qui forme encore l'ossature des routes nationales actuelles. Au milieu du XVIIIe siècle, la France s'était dotée de l'infrastructure routière la plus moderne et la plus étendue du monde. Le commerce fut également stimulé par le Bureau et le Conseil du Commerce. Le commerce maritime extérieur de la France grimpa de 80 à 308 millions de livres entre 1716 et 1748. Cependant, les lois rigides édictées auparavant par Colbert ne permirent pas à l'industrie de profiter pleinement de ce progrès économique.
Le pouvoir de la monarchie absolue s'exerça lors de la répression des oppositions jansénistes et gallicanes. L'agitation causée par les illuminés du cimetière Saint-Médard à Paris les Convulsionnaires, un groupe de jansénistes qui prétendait que des miracles survenaient dans le cimetière cessa en 1732. Sur un autre front, après l'exil de 139 parlementaires en province, le parlement de Paris dut enregistrer la bulle papale Unigenitus et fut dorénavant interdit de s'occuper des affaires religieuses.
Acquisition de la Lorraine et du Barrois
En ce qui concerne les affaires étrangères, Fleury a recherché la paix à tout prix en pratiquant une politique d'alliance avec la Grande-Bretagne, tout en se réconciliant avec l'Espagne. En septembre 1729, après sa troisième grossesse, la reine donna enfin naissance à un garçon, Louis Ferdinand, qui devint aussitôt dauphin. L'arrivée d'un héritier mâle, qui assurait la pérennité de la dynastie, fut accueillie avec une immense joie et célébrée dans toutes les sphères de la société française et également dans la plupart des cours européennes. Le couple royal était à l'époque très uni, se manifestait un amour réciproque et le jeune roi était extrêmement populaire. La naissance d'un garçon écartait également le risque d'une crise de succession et le probable affrontement avec l'Espagne qui en aurait résulté.
En 1733, malgré la politique pacifiste de Fleury, le roi, convaincu par son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Germain Louis Chauvelin 1727-1737, intervint mollement pour tenter de remettre sur le trône de Pologne Stanislas Leszczyński, son beau-père qu'il hébergeait à Chambord. Ce fut la guerre de Succession de Pologne. Si l'intervention sans conviction de la France contre l'Autriche ne permit pas de renverser le cours de la guerre ni de rendre le trône à Stanislas, en revanche, l'habileté du cardinal de Fleury réussit à programmer le rattachement des duchés de Lorraine et de Bar au Royaume, stratégiquement situés entre Paris et le Rhin.
Ces duchés furent, en effet, le principal enjeu de la guerre: ils étaient possession du jeune duc François III, fils du duc Léopold Ier et d'Élisabeth-Charlotte d'Orléans, sœur du feu régent, qui en assurait la régence. François III, en effet, vivait à Vienne où il avait été appelé par son proche parent, empereur du Saint-Empire Charles VI, qui l'avait nommé vice-roi de Hongrie en 1731, prémices d'une carrière plus prometteuse, puisqu'il le pressentait pour épouser sa fille aînée et héritière Marie-Thérèse. Une telle union aurait considérablement renforcé la puissance autrichienne qui possédait déjà aux frontières de la France, les Provinces belges et le Luxembourg. L'empire aurait protégé ainsi la route du Rhin et se rapprochait dangereusement de Paris.
Lors de la guerre, les troupes françaises occupèrent rapidement le Barrois et la Lorraine. La paix fut signée dès 1735. Fleury trouva un habile arrangement : par le traité de Vienne novembre 1738, le beau-père de Louis XV obtint à titre viager les duchés de Lorraine et de Bar en compensation de la seconde perte de son trône polonais, avec l'objectif que le duché soit intégré au royaume de France à sa mort par le biais de sa fille, tandis que le duc François III devenait héritier du grand duché de Toscane avant d'épouser la jeune Marie-Thérèse et de pouvoir prétendre à la couronne impériale, en Toscane le dernier des Médicis n'avait pas d'héritier. Par le traité secret de Meudon, Stanislas abandonnait la réalité du pouvoir à un intendant nommé par la France qui préparerait sans ménagement la réunion des duchés au royaume. Cette guerre, peu coûteuse comparativement aux ponctions humaines et financières exorbitantes des campagnes de Louis XIV, était un succès pour la diplomatie française. L'annexion de la Lorraine et du Barrois, effective en 1766 à la mort de Stanislas, constitue la dernière expansion territoriale du royaume de France sur le continent avant la Révolution.
Peu après ce résultat, la médiation française dans le conflit entre le Saint-Empire et l'Empire ottoman aboutit au traité de Belgrade, septembre 1739, qui mit fin à la guerre avec un avantage pour les Ottomans, alliés traditionnels des Français contre les Habsbourg depuis le début du XVIe siècle. En conséquence, l'Empire ottoman renouvela les capitulations françaises, qui affirmèrent la suprématie commerciale du royaume au Moyen-Orient. Après tous ces succès, le prestige de Louis XV, arbitre de l'Europe, atteignit son sommet.
Guerre de Succession d'Autriche
En 1740, la mort de l'empereur Charles VI et l'avènement de sa fille Marie-Thérèse déclencha la guerre de Succession d'Autriche. Le vieux cardinal de Fleury n'avait plus la force de s'y opposer et le roi succomba à la pression du parti anti-autrichien de la cour : il entra en guerre en 1741 en s'alliant à la Prusse contre les Autrichiens, les Britanniques et les Hollandais. Ce conflit devait durer sept longues années. La France était de nouveau entrée dans un cycle guerrier typique du règne de Louis XIV. Fleury mourut avant la fin de la guerre, en janvier 1743. Le roi, suivant finalement l'exemple de son prédécesseur, décida alors de gouverner sans Premier ministre. La première partie du conflit fut marquée par de cuisants échecs : la Bavière, soutenue par la France, fut envahie par les troupes autrichiennes et les troupes des Habsbourg se trouvaient sur le Rhin. Seule l'intervention de la Prusse les obligea à renoncer à l'Alsace.
Par contraste, la dernière partie de la guerre fut marquée par une série de victoires françaises aux Pays-Bas : bataille de Fontenoy 1745, bataille de Rocourt 1746, bataille de Lauffeld 1747. En particulier, la bataille de Fontenoy, remportée par le maréchal de Saxe et le roi en personne, est considérée comme une des plus éclatantes victoires des Français contre les Britanniques. À la suite de ces victoires, la France occupait tout le territoire de l'actuelle Belgique et se trouvait en position d'envahir la Hollande avec la chute de la forteresse de Berg-op-Zoom. Louis XV n'était pas loin de réaliser le vieux rêve français d'établir la frontière septentrionale du pays le long du Rhin. La bataille de Plaisance, perdue en 1746 par le marquis de Maillebois, força toutefois les Français à repasser les Alpes, mais sans grandes conséquences politiques car le front essentiel se situait aux Pays-Bas.
Sur mer, la marine royale, qui combattait pourtant à un contre deux contre la Royal Navy fit mieux que de se défendre puisqu'elle réussit, entre 1744 et 1746, à maintenir ouvertes les lignes de communication vers les colonies et à protéger les convois commerciaux. La bataille du cap Sicié permettait de lever le blocus de Toulon. Deux tentatives de débarquement en Angleterre échouaient en 1744 et 1746, de même qu'une attaque anglaise débarquement contre Lorient en 1746. En Amérique du Nord, l'Angleterre s'empara en 1745 de Louisbourg qui défendait l'entrée du fleuve Saint-Laurent, mais sans pouvoir envahir le Canada français. Aux Indes, les Français tinrent en échec la flotte anglaise et mirent la main en 1746 sur Madras, le principal poste anglais dans la région. Ils repoussèrent ensuite une flotte anglaise venue reconquérir la place et attaquer Pondichéry. La marine anglaise, qui changea de stratégie en 1746 en imposant un blocus près des côtes, fit subir à la marine française en 1747 deux lourdes défaites dans l'Atlantique, au cap Ortégal, en mai et au cap Finisterre, en octobre, mais sans conséquences sur la prospérité coloniale de la France car la paix était signée peu après.
Au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, la France et l'Angleterre se resituaient leurs conquêtes respectives, Louisbourg contre Madras ce qui créait, pour quelques années, un équilibre naval entre les deux pays. Le roi rendit cependant toutes ses conquêtes à l'Autriche, à l'indignation du peuple, la consternation de ses généraux et à la surprise des puissances européennes. Louis XV, qui n'avait pas le tempérament belliqueux de son prédécesseur, avait aussi compris que jamais l'Angleterre ne laisserait les ports belges devenir français et que le temps était venu de contrecarrer les nouvelles puissances émergentes protestantes, Angleterre, Prusse pour sauvegarder l'ordre ancien représenté par la France et l'Autriche catholiques. Alors que Lois XIV avait eu l'ambition de remettre la France partout où jadis fut la Gaule, son successeur se satisfaisait d'un royaume hexagonal, qu'il nommait son pré carré. Il préférait cultiver ce pré carré que de chercher à l'étendre. Les seuls changements notables en Europe furent l'annexion par la Prusse de la Silésie, riche région minière austro-bohême, et le retour du minuscule duché de Parme à la dernière des Farnèse, la reine douairière d'Espagne; le duché fut attribuée au fils cadet de celle-ci, l'infant Philippe, gendre depuis 1739 de Louis XV. Louis déclara qu'il avait conclu la paix en roi et non en marchand. Sa générosité fut saluée en Europe dont il devint l'arbitre.
Portrait adulte
Physiquement, Louis XV est beau, grand, 1,77 m selon ses médecins, d'une constitution athlétique, la taille cambrée et le maintien droit ; il émane de sa personne une autorité naturelle qui impressionne fortement ceux qui le voient pour la première fois Qui ?. Passionné de chasse, il s'y rend chaque jour, sauf les dimanches et fêtes. Il connaît parfaitement tous les chiens de sa meute, à laquelle il prodigue des soins attentifs, au point de faire aménager dans ses appartements du château de Versailles le cabinet des chiens. Il aime l'exercice physique, la vitesse, et mener ses chevaux au grand galop. Pour faciliter ses courses, il fait réaménager les forêts d'Île-de-France avec les pattes d'oie qui subsistent actuellement. D'esprit vif, il a un jugement prompt et sûr. Sa mémoire est grande, et il se rappelle avec précision une foule de détails sur les Cours étrangères, qui étonnent les ambassadeurs. Il aime lire, et les résidences royales sont équipées de bibliothèques : Versailles mais aussi Choisy-le-Roi, comme Fontainebleau et Compiègne. Malgré sa clairvoyance et sa lucidité, il doute en permanence de ses capacités, et préfère suivre l'avis d'un conseiller en dépit de son opinion : c'est ainsi que, contre son opinion, il engage la France dans la guerre de Sept Ans.
Méfiant voire méprisant pour les gens de lettres, sa curiosité le porte vers les connaissances scientifiques et techniques. Il observe avec les astronomes les plus réputés les éclipses des planètes. Ses connaissances en médecine lui permettent d'avoir des conversations suivies avec les grands médecins de son temps sur les découvertes récentes. Il fait aménager au Trianon un jardin botanique qui, avec 4 000 espèces, sera le plus important d'Europe. Enfin, passionné de géographie, il encourage le travail des géographes, et est à l'origine de la réalisation de la carte de Cassini. Il possède, en outre, une grande connaissance de l'histoire du royaume, et étonne ses interlocuteurs par la précision de ses connaissances liturgiques. Capable de beaucoup de bienveillance, il peut aussi se montrer cassant. Il est sujet à des accès de neurasthénie, où il s'enferme dans un mutisme complet. Son entourage est très attentif à l'humeur du roi quand il faut traiter d'affaires importantes. Il est d'une timidité quasi maladive, ce qui le fait paraître froid et distant. Sa voix mal posée et rauque l'encombre, et, lors des cérémonies officielles, il demande souvent que son discours soit lu par un de ses ministres.
Louis le Bien-Aimé
À la mort du cardinal de Fleury en 1743, le roi avait 33 ans. Il avait connu des années heureuses avec la reine qui l'adulait et lui était entièrement dévouée. Un enfant naissait presque chaque année. Cependant, la reine finit par se fatiguer de ces grossesses à répétition, autant que le roi se lassait de l'amour inconditionnel de son épouse. De plus, la plupart de leurs enfants étaient de sexe féminin, ce qui finit par indisposer le roi. Sur leurs dix enfants, ils n'eurent que deux garçons et un seul survécut, le dauphin.
En 1734, pour la première fois, la reine se plaignit à son père des infidélités du roi. Le roi tomba amoureux de la comtesse de Mailly, puis de sa jeune sœur, la comtesse de Vintimille, puis à sa mort d'une autre de leurs sœurs, la marquise de Tournelle qu'il fit duchesse de Châteauroux. Il rencontrait généralement ces dames dans l'entourage de la reine qui se réfugia alors dans la religion, les œuvres de charité et la vie familiale. Pour des raisons d'économie, le cardinal de Fleury avait confié l'éducation des plus jeunes filles du couple royal aux religieuses toutes nobles de l'abbaye de Fontevraud. Une des princesses, Madame Sixième, y mourut à l'âge de 8 ans, les autres princesses revinrent à la cour entre 1748 et 1750. Les enfants royaux prirent le parti de leur mère.
Épisode de Metz
Un an après la mort de Fleury, se produisit un événement qui allait marquer la personnalité du roi et la suite de la vie politique française : L'épisode de Metz. Louis XV était parti diriger ses armées engagées sur le front de l'est dans la guerre de succession autrichienne. Le 4 août 1744, à Metz, il tomba gravement malade d'une fièvre subite et inexpliquée, une "fièvre maligne" d'après les médecins de l'époque. En hâte, les médecins parisiens sont amenés auprès de Louis XV, dont l'état est préoccupant : le chirurgien royal, François de La Peyronie, pratique des saignées, et François Chicoyneau, médecin à la Cour, multiplie les médications. Mais le patient continue de voir son état empirer d'heure en heure, et le 12, le chirurgien déclara que le roi n'en avait que pour deux jours. Le 15 août, Louis XV reçoit l'extrême-onction.
Les prières se multiplièrent à travers le pays pour son salut. Sa maîtresse, Madame de Châteauroux, qui l'avait accompagné, dut le quitter tandis que la reine arrivait en hâte. C'est à cette période que le roi fait le vœu de faire construire une église dédiée à Sainte Geneviève, dans le cas où il guérirait.
Sous la pression du parti dévot, Monseigneur de Fitz-James, premier aumônier du roi, refusa de lui donner l'absolution sans une confession publique de ses péchés dans laquelle le roi apparaissait comme une personne immorale, indigne de porter le titre de Roi Très Chrétien. Colportée dans tout le pays par le clergé, la confession royale ternit le prestige de la monarchie. Pendant ce temps, les dévots, fort maladroitement, plaçaient ostensiblement un second oreiller dans le lit de la reine et poussaient celle-ci, pourtant quadragénaire, à s'habiller comme une adolescente, abusant du rouge et des parfums, ce qui seyait peu à une femme de son âge.
En désespoir de cause, on fit appel à un médecin juif, Isaïe Cervus Ullmann qui sauva le roi de sa dysenterie. D'après Tribout de Morembert, le médecin Esaias Cervus Ulman eut l'honneur de remettre sur pied Louis XV lors de sa grave maladie, mais comme il était impensable que le roi Très Chrétien ait été guéri par un juif, on découvrit un vieux médecin pensionné du régiment d'Alsace, Alexandre de Montcharvaux, à qui on fit endosser la guérison. D'après Chaffanjon, Cervus Isaie Ulmann, alias Isaye Cerf, est le médecin qui donna des soins à Louis XV ; celui-ci le dispensa en retour du paiement de l’impôt et de loger chez lui des officiers de la garnison.
Le roi échappa ainsi à la mort et, à la suite de la messe d'action de grâce célébrée en l'église Notre-Dame de Metz en présence de la famille royale, le pays tout entier reprit les qualificatifs du célébrant et appela le roi Louis le Bien-Aimé. Louis XV donne ses indications pour faire construire l'église qu'il avait promise en cas de guérison ; elle deviendra le Panthéon.
Cependant Louis XV, en tant que roi, avait ressenti douloureusement l'humiliation que lui avait infligée le parti dévot. De retour à Versailles, il démit Monseigneur de Fitz-James de ses fonctions d'aumônier, l'exila dans son diocèse et rappela Madame de Châteauroux, mais celle-ci mourut avant sa rentrée en grâce officielle. Le roi, bien que sa vie sexuelle déréglée le fît souffrir d'un profond sentiment de culpabilité, ne renoua pas avec la reine.
Marquise de Pompadour
Jeanne Le Normant d'Étiolles, née Poisson, rencontrée en 1745 lors du bal masqué donné à l'occasion du mariage du dauphin Louis-Ferdinand, devint la favorite la plus célèbre du règne. Le roi, pour lui permettre d'être présentée à la cour et de devenir dame d'honneur de la reine, lui attribua une terre limousine tombée en déshérence : le marquisat de Pompadour. Fille d'un financier, elle était plutôt belle, cultivée, intelligente et sincèrement attachée au roi, mais avait contre elle d'appartenir au Tiers état, étant une bourgeoise proche des milieux financiers, ce que la cour et le peuple ne pardonnèrent pas : les maîtresses officielles de Louis XIV, et celles de Louis XV jusqu'à présent, choisies dans les hautes sphères de l'aristocratie, avaient été d'autant plus tolérées qu'elles n'exerçaient aucune influence sur le gouvernement à l'exception de Madame de Maintenon.
Le fait que le roi se commette avec une roturière provoqua un scandale orchestré par l'aristocratie, qui se sentait humiliée de l'influence grandissante de la bourgeoisie dans la société, et reprise par le peuple qui haïssait le monde de la finance qui l'exploitait... Parurent bientôt des chansons et des pamphlets injurieux appelés Poissonades, par allusion aux mazarinades du siècle précédent, le nom de jeune fille de la marquise étant Poisson, qui la brocardaient comme dans l'exemple suivant :
"Fille de sangsue et sangsue elle-même
Poisson d'une arrogance extrême
Étale en ce château sans crainte et sans effroi
La substance du peuple et la honte du Roi"
Malgré ces critiques, la marquise de Pompadour eut une influence indéniable sur l'épanouissement des Arts durant le règne de Louis XV. Véritable mécène, la Marquise amassa une imposante collection de meubles et d'objets d'art dans ses diverses propriétés. Elle fut responsable du développement de la manufacture de porcelaine de Sèvres, et ses commandes assurèrent leur subsistance à de nombreux artistes et artisans. Elle joua également un rôle important en architecture, étant à l'origine de la construction de la place Louis XV aujourd'hui place de la Concorde, et de l'École militaire de Paris, réalisées par Ange-Jacques Gabriel, un de ses protégés. La Marquise défendit également le projet de l'Encyclopédie contre les attaques de l'Église. À sa manière, elle fut représentative de l'évolution des mentalités lors de ce siècle des Lumières, bien qu'elle ne parvienne pas complètement à convertir le roi à ses vues. L'étalage de tout ce luxe dans ses propriétés lui valut bien des reproches, bien que sa famille, très riche, fournît également une aide financière au gouvernement et sauvât la monarchie de la banqueroute.
La marquise de Pompadour était officiellement logée au troisième niveau du château de Versailles, au-dessus des appartements du roi. Elle y organisait des soupers intimes avec des invités choisis, où le roi oubliait les obligations de la cour qui l'ennuyaient. De santé fragile, et supposée frigide, la marquise devint dès 1750 une simple mais véritable amie et confidente, après avoir été amante, et elle parvint à conserver ses relations privilégiées avec le roi, jusqu'à sa mort, ce qui est exceptionnel dans les annales des maîtresses royales. Ne pouvant satisfaire la sensualité du roi et pour éviter d'être évincée par une rivale potentielle, ce qui fut sa hantise jusqu'à la fin de sa vie, elle se chargea de fournir discrètement au roi, avec l'accord de leur famille, bien rémunérée, des jeunes filles peu farouches, de petite vertu et de peu d'intelligence qui, occupant les sens du roi, n'occupaient en revanche ni son cœur ni son esprit. Ainsi la marquise conservait son influence sur le roi... Les rencontres se faisaient après le passage des jeunes filles dans un lieu dont le nom seul offrait au fantasme et aux ragots : le parc-aux-cerfs.
Après 1750 donc, Louis XV, qui venait d'avoir 40 ans, s'engagea dans une série d'histoires sentimentales et sexuelles de courte durée, la plus connue étant celle avec Marie-Louise O'Murphy. Le pavillon du parc-aux-cerfs servit à abriter ces amours éphémères : les jeunes filles y étaient examinées par un médecin avant d'être menées discrètement dans la chambre du roi. La légende a exagéré les événements qui s'y sont passés, contribuant à assombrir la réputation du souverain. Cette image de roi vieillissant et libidineux accaparé par ses conquêtes féminines ne le quittera plus et entachera sa mémoire, bien qu'il n'ait été guère différent de François Ier ou de Henri IV de ce point de vue.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7937#forumpost7937
Posté le : 14/02/2015 14:19
|
|
|
|
|
Louis XV 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Impopularité et attentat de Damiens
La popularité du roi pâtit largement des suites de la guerre de Succession d'Autriche. Les Français avaient pardonné à Louis XIV ses impôts, ses maîtresses et ses dépenses fastueuses, celui-ci ayant toujours su donner à ses fins de guerres des allures de victoires. De la même façon, pour Louis XV, les scènes de Metz 1744 comptaient peu aux yeux de la population en regard des victoires de la guerre de succession autrichienne. Mais la nouvelle de l'abandon des Pays-Bas à l'Autriche — en opposition avec les intérêts français tels que les avaient définis Richelieu puis Louis XIV — fut accueillie avec incrédulité et amertume. Les Parisiens utilisèrent l'expression bête comme la paix. On avait "travaillé pour le roi de Prusse". Tant d'efforts et de vies humaines pour donner une couronne — minuscule — à la fille du roi, alors que la couronne impériale était conservée par les Habsbourg puisque l'ex-duc de Lorraine, époux de la reine de Hongrie avait été élu empereur en 1745. La montagne avait accouché d'une souris.
On peut à ce titre considérer que 1748 fut marquée par la première manifestation d'une opinion publique française, portée par un nationalisme émergeant que le monarque n'avait pas compris. La présence aux côtés du roi de la marquise de Pompadour, fortement décriée par l'aristocratie curiale qui n'hésitait pas à faire courir les bruits les plus ignobles qui, sortant du palais, atteignaient le peuple, donnait du roi l'image d'un jouisseur égoïste uniquement préoccupé de ses plaisirs. Le mécontentement s'amplifiait, alimenté par le train de vie de la Cour et ce qui était perçu comme une incompétence du roi à gouverner. En se replaçant dans une perspective historique, il apparaît que Louis XV n'était pas incompétent, bien qu'il manquât certainement de volonté. D'autre part, les dépenses de la cour n'étaient pas spécialement élevées, comparées à celles des précédents monarques français, ou encore d'autres cours européennes, comme celle de Russie qui dépensait des sommes astronomiques pour construire les palais de Saint-Pétersbourg. Pourtant, telle était la perception qu'en avait le peuple de France, également influencé par la campagne violente à l'encontre de la marquise de Pompadour.
Peut-être est-ce ce contexte qui poussa Robert-François Damiens — domestique chez plusieurs conseillers du Parlement — à essayer de tuer le roi. Le 5 janvier 1757, Damiens loua épée et chapeau dans une boutique sur la place d'armes devant le château pour se faire passer pour noble, entra au palais de Versailles, parmi les milliers de personnes qui essayaient d'obtenir des audiences royales. Vers 18 heures, le roi revenait de visiter sa fille qui était souffrante et s'apprêtait à entrer dans son carrosse pour retourner à Trianon, quand Damiens franchit la haie de gardes et le frappa avec une lame de 8,1 cm. Louis XV portait d'épais vêtements d'hiver et la lame ne pénétra que d'un centimètre, entre les 4e et 5e côtes. Cependant, on craignait un éventuel empoisonnement. On tortura à plusieurs reprises Damiens, pour savoir s'il avait des complices, mais il apparaît que cet homme, serviteur de membres du parlement de Paris, était un déséquilibré qui avait surtout entendu beaucoup de discours critiques à l'encontre du roi. Louis XV était plutôt enclin à pardonner, mais il s'agissait de la première tentative de meurtre sur un monarque français depuis l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac en 1610, et il dut accepter un procès pour régicide. Jugé par le parlement de Paris, Damiens fut exécuté le 28 mars 1757 sur la place de Grève, dans des conditions effroyables. La main qui avait tenu le couteau fut brûlée avec du soufre, on lui entailla ensuite les membres et la poitrine avant d'y introduire du plomb fondu, ses quatre membres furent arrachés par des chevaux écartèlement et son tronc finalement jeté aux flammes. Une foule immense assista à ce spectacle, les balcons des maisons de la place de Grève furent loués jusqu'à 100 livres la paye d'un ouvrier pour 10 mois de travail.
Le roi était déjà si impopulaire que l'élan de sympathie provoqué par cette tentative de meurtre disparut rapidement avec l'exécution de Damiens, dont l'inhumanité pourtant laissa le parti philosophique de marbre. Louis XV lui-même n'y était pas pour grand-chose, les détails de cette horrible mise à mort ayant été élaborés par le parlement de Paris, peut-être avec le souci de se réconcilier avec le monarque. Mais plus que tout, le peuple ne pardonnait pas au roi de ne pas s'être séparé de la Pompadour. L'ambassadeur d'Autriche écrivait à Vienne : le mécontentement public est général. Toutes les conversations tournent autour du poison et de la mort. Le long de la galerie des Glaces apparaissent des affiches menaçant la vie du roi. Louis XV, qui avait conservé un calme royal le jour de la tentative d'assassinat, parut profondément affecté et déprimé dans les semaines qui suivirent. Toutes les tentatives de réformes furent abandonnées. Sur la proposition de la marquise de Pompadour, il renvoya deux de ses ministres les plus décriés, le comte d'Argenson, secrétaire d'État à la Guerre et Machault d'Arnouville, Garde des Sceaux et précédemment contrôleur général des finances, et introduisit Choiseul dans le gouvernement. Du roi Bien-aimé, Louis XV s'affligeait et reconnaissait qu'il était désormais devenu le Bien-haï.
Inauguré en 1763 sur la place Louis XV actuelle place de la Concorde un monument comportant la statue du roi à cheval fut commandé à Edmé Bouchardon et achevé par Jean-Baptiste Pigalle. Son piédestal était soutenu par les statues des quatre Vertus. Peu de temps après l'inauguration, on trouva sur le piédestal un distique, tracé d'une main inconnue, qui témoigne de l’impopularité du roi : Grotesque monument / Infâme piédestal / Les vertus sont à pied / Le vice est à cheval. Autre version : Ah ! la belle statue, ah ! le beau piédestal, / Les vertus sont à pied et le vice à cheval...
Résistances intérieures et déboires de la politique extérieure
Affaire du Vingtième
Toutes ces histoires amoureuses n'empêchaient pas Louis XV de travailler, mais il lui manquait l'inépuisable énergie de son arrière-grand-père. Pendant les dix-sept années du gouvernement de Fleury, il avait formé son jugement mais n'avait pu forger sa volonté. Décidé à diriger seul le royaume, il s'évertuait à suivre les instructions de son aïeul : Écoutez, consultez votre Conseil, mais décidez. Cependant, il n'avait pas assez confiance en lui pour appliquer efficacement ce précepte. Sa correspondance politique révèle sa profonde connaissance des affaires publiques et la justesse de son raisonnement. Il éprouvait en revanche des difficultés à décider, et quand il y était obligé, se montrait comme tous les timides, brutal.
Amical et compréhensif avec ses ministres, du moins en apparence, sa disgrâce tombait soudainement, sans prévenir, sur ceux qu'il estimait l'avoir desservi. Sa direction était souple, les ministres ayant une grande indépendance, mais il leur était difficile de savoir si leurs actions convenaient au souverain. La plupart du travail gouvernemental s'effectuait dans des comités auxquels le roi ne participait pas, ce dernier siégeant dans le Conseil d'en haut, créé par Louis XIV, chargé des secrets d'État concernant la religion, la diplomatie et la guerre. Divers partis s'affrontaient, celui des dévots, dirigé par le comte d'Argenson, secrétaire d'État à la Guerre, opposé à celui du parti philosophique emmené par Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville, contrôleur général des finances, et soutenu par la marquise de Pompadour, qui agissait comme un ministre sans portefeuille. Appuyée par de puissants financiers, les frères Pâris Duverney et Pâris de Montmartel…, elle obtint du roi la nomination de certains ministres, Bernis, secrétaire d'État des Affaires étrangères en 1757 autant que leur révocation, Orry, contrôleur général des finances en 1745 malgré ses quinze ans de loyaux services et efficaces ; Maurepas, secrétaire d'État de la Marine en 1749. Sur son conseil, le roi approuva la politique de justice fiscale de Machault d'Arnouville. Afin de combler le déficit du royaume, qui s'élevait à 100 millions de livres en 1745, Machault d'Arnouville créa un impôt prélevant un vingtième des revenus, qui concernait également les privilégiés, édit de Marly, 1749.
Cette brèche dans le statut privilégié du clergé et de la noblesse, traditionnellement dispensés, les premiers effectuant un don gratuit au trésor et s'occupant des pauvres et de l'enseignement, les seconds payant l'impôt du sang sur les champs de bataille, était une première dans l'histoire de France, bien qu'elle ait été déjà envisagée par des esprits visionnaires comme Vauban au temps de Louis XIV.
Cette nouvelle taxe fut accueillie avec hostilité par les états provinciaux qui avaient encore le pouvoir de décider de leur politique fiscale. Le clergé et le parlement s'opposèrent également violemment au nouvel impôt. Pressé par son entourage et par la cour, Louis XV abandonna la partie et en exempta le clergé en 1751. Finalement, le « vingtième » finit par se fondre dans une augmentation de la taille, qui ne touchait pas les classes privilégiées. Ce fut la première défaite de la guerre de l'impôt engagée contre les privilégiés.
À la suite de cette tentative de réforme, le parlement de Paris, s'emparant du prétexte de la querelle entre le clergé et les jansénistes, adressa des remontrances au roi avril 1753. Le parlement, constitué d'aristocrates privilégiés et de roturiers anoblis, s'y proclamait le défenseur naturel des lois fondamentales du royaume contre l'arbitraire de la monarchie et présentait le roi comme un tyran.
Bannissement des Jésuites
L'opposition aux Jésuites était menée par une curieuse alliance contre nature des jansénistes avec les gallicans, les philosophes et les encyclopédistes. Après la faillite commerciale de l'établissement dirigé par le père Antoine Lavalette, qui finançait les missions jésuites aux Caraïbes, la Martinique, le parlement, saisi par les créanciers, confirma en appel le 8 mai 1761 un jugement ordonnant le paiement de ses dettes par les Jésuites de France, sous peine de saisie de leurs biens.
Il s'ensuivit toute une série d'actions qui allaient aboutir à leur bannissement. Sous la direction de l'abbé de Chauvelin, le 17 avril 1762, le texte des Constitutions de l'Ordre fut épluché par le parlement. On mit en exergue des écrits de théologiens jésuites, afin de les accuser d'enseigner toutes sortes d'erreurs et de considérations immorales. Le 6 août, un arrêt ordonnait la dissolution de l'ordre, mais un délai de huit mois leur fut accordé par Louis XV. Après que le pape eut refusé un compromis permettant de rendre les constitutions de l'ordre compatibles avec les lois du royaume, les parlements votèrent les uns après les autres la suppression de l'ordre dans leur ressort respectif. Seuls les parlements de Besançon et de Douai s'y refusèrent. Les collèges furent fermés d'autorité le 1er avril 1763. À la fin novembre 1764, Louis XV signa un acte de bannissement complet de l'ordre dans tout le royaume afin de protéger les Jésuites en tant qu'individus des poursuites judiciaires que les parlements entendaient entreprendre contre eux. Seuls les prêtres qui acceptaient de se placer sous l'autorité d'un évêque étaient autorisés à rester sur le sol français. La plupart choisirent de partir en exil.
Renversement des alliances
De plus, en 1756, le roi opéra un renversement d'alliance impromptu en rupture avec l'alliance franco-prussienne traditionnelle. Un nouveau conflit européen était en préparation, la paix d'Aix-la-Chapelle ne constituant qu'une sorte de trêve. Les Britanniques et les Français se battaient déjà en Amérique du Nord, sans déclaration de guerre. En 1755, les Britanniques s'emparèrent de 300 navires marchands français violant plusieurs traités internationaux. Quelques mois plus tard, le 16 janvier 1756, le Royaume-Uni et la Prusse signèrent un traité de neutralité. À Paris et Versailles, le parti philosophique et la marquise de Pompadour furent déçus de cette trahison du roi Frédéric II de Prusse, qui était auparavant considéré comme un souverain éclairé, ami des philosophes. Frédéric II avait même accueilli Voltaire à Potsdam quand ce dernier s'était retrouvé en disgrâce à la suite des manœuvres du parti dévot. Mais Frédéric II était surtout animé par des motifs politiques dans le but de consolider la puissance prussienne. Il avait déjà abandonné ses alliés français en signant des traités séparés avec l'Autriche en 1742 et 1745. La marquise de Pompadour n'appréciait pas Frédéric II, snob et misogyne, qui la tenait dans le plus grand mépris, allant jusqu'à appeler un de ses chiens Pompadour. Pendant la même période, les responsables français commencèrent à percevoir le déclin relatif de l'Empire autrichien, qui ne représentait plus le même danger qu'au début de la dynastie Habsbourg, aux XVIe et XVIIe siècles, alors qu'ils contrôlaient l'Espagne et la plus grande partie de l'Europe. La Prusse apparaissait maintenant comme la puissance émergente la plus menaçante. C'est dans ce contexte que la marquise de Pompadour et le parti philosophique convainquirent le roi de l'intérêt de ce retournement d'alliances. Par le traité de Versailles signé le 1er avril 1756, le roi, contre l'avis de ses ministres, s'allia avec l'Autriche en mettant fin à deux siècles de conflit avec les Habsbourg.
À la fin du mois d'août 1756, Frédéric II envahit la Saxe sans déclaration de guerre et vainquit facilement les armées saxonnes et autrichiennes, mal préparées. Le sort réservé à la famille électrice de Saxe fut particulièrement brutal, l'électrice Marie-Josèphe succombant à ces mauvais traitements. Ces exactions choquèrent l'Europe et particulièrement la France. La femme du dauphin, sœur du prince François-Xavier de Saxe, fille de l'électeur et de l'électrice de Saxe, fit une fausse couche en apprenant la nouvelle. Louis XV se trouva contraint d'entrer en guerre. Entre-temps, la Grande-Bretagne avait déjà déclaré la guerre à la France le 18 mai 1756. Ce sera la guerre de Sept Ans 1756-1763, qui aura des conséquences importantes en Grande-Bretagne et en France.
Traité de Paris et la perte de la Nouvelle-France
L'ascension de Choiseul, sous l'influence de la marquise de Pompadour, marque une certaine victoire du parti philosophique. Fait pair de France, le nouvel homme fort du gouvernement autorise la publication de l'Encyclopédie et contribue à la dissolution des Jésuites. Il réforme la structure de la marine et de l'armée et essaye d'étendre les colonies françaises dans les Antilles.
Avec le désastre de Rossbach, les nombreuses défaites dans les colonies et la perte des îles du littoral, Belle-Île, etc., Choiseul, successivement à la tête de la diplomatie et du ministère de la Guerre et de la Marine, cherche à arrêter rapidement la guerre. Le traité de Paris 1763 reconnaît une importante défaite française avec la perte de la Nouvelle-France et de l'Inde au profit des Britanniques. Cependant, la France récupère ses comptoirs et les îles des Antilles, indispensables à la vitalité de son commerce.
La marine française pendant la Guerre de Sept Ans.Expédition de Corse
Celle-ci est l'aboutissement de quarante années de révolte dans l'île (1729-1769) et de près de trente ans de présence française dans l'île (1738-1768) à des fins de pacification pour la république de Gênes. Avec la convention de Versailles, en 1738, la France obtient le droit d'intervenir en Corse. Avec le traité de Versailles, en 1768, la France a la garantie de conserver l'île si elle parvient à la conquérir. La campagne dure moins d'un an. Les Français tiennent, dans un premier temps, les seuls présides places fortes du littoral et ont pour objectif de défaire et d'anéantir l'État national.
Militairement, la campagne est marquée par deux combats majeurs. Tout d'abord, à la bataille de Borgo, en 1768, Clément Paoli défait les Français, en tue 600 et en capture 600 autres dont le colonel de Ludre, le propre neveu de Choiseul. À la suite de cet échec, un corps expéditionnaire de près de 20 000 hommes débarque à Saint-Florent et est commandé par l'un des plus grands militaires de la monarchie, le comte Noël Jourda de Vaux. Les nationaux sont finalement vaincus à la bataille de Ponte Novu, le 8 mai 1769. Peu après, Pascal Paoli, général en chef de la nation corse, part en exil en Angleterre et la Corse se soumet au roi. Le comte de Vaux obtient le bâton de maréchal.
Deuils et sentiment de culpabilité
Les années 1760 furent marquées par des deuils : en 1752, le roi avait déjà perdu sa fille préférée Henriette. En 1759, mourut son aînée, la duchesse de Parme. En 1761, la mort du duc de Bourgogne, âgé de dix ans, fils aîné du dauphin, enfant précoce et prometteur, fut vivement ressentie. En 1763 mourut à Schönbrunn l'intelligente et romanesque petite-fille du roi, épouse de l'archiduc héritier d'Autriche, Marie-Isabelle de Bourbon-Parme. En avril 1764 mourut sa maîtresse la Marquise de Pompadour. En 1765, le roi perdit successivement son fils, dauphin, dont la vie morale irréprochable l'édifiait et son gendre le duc de Parme. En février 1766, le vieux roi Stanislas mourait presque nonagénaire à Lunéville. L'année suivante, ce fut le tour de la dauphine, veuve inconsolable qui avait contracté la maladie de son mari en le soignant. Enfin, en juin 1768, mourut la reine.
Toujours culpabilisé par sa vie intime, le roi ne vit pas sans tristesse la plus jeune de ses filles entrer en 1770 au Carmel, pensant par là obtenir de Dieu le pardon des fautes de son père. Pour éviter que la sensualité du roi veuf ne le pousse à des excès, le parti dévot soutenu par les filles du roi, et notamment sa fille carmélite, proposa alors de remarier le souverain, à la beauté intacte malgré ses 58 ans, avec l'archiduchesse Marie-Élisabeth d'Autriche, sœur de Marie-Antoinette, mais celle-ci vit sa grande beauté compromise par une attaque de petite vérole et le projet de mariage fit long feu. Entre-temps, le duc de Richelieu, grand seigneur libertin, s'était entremis pour donner à Louis XV une nouvelle maîtresse.
Fin du règne
La fin du règne fut en effet marquée par l'arrivée dans la vie du roi de la superbe comtesse du Barry, officiellement présentée à la cour en 1769. Le ministre Choiseul montra ouvertement son hostilité pour la maîtresse royale et engagea dans son parti la jeune dauphine Marie-Antoinette d'Autriche qui venait d'arriver à la cour. Celle-ci agissait également sous l'influence de ses tantes, les filles du roi. Pour affermir son pouvoir, le ministre souhaitait donner pour maîtresse au roi sa propre sœur la duchesse de Grammont. Exaspéré par ces querelles de cour et convaincu de l'incapacité de Choiseul à faire face à la fronde du Parlement, Louis XV finit par renvoyer son ministre en 1770 peu après le mariage du dauphin qui scellait l'alliance avec l'Autriche.
Désormais le conseil est dominé par René Nicolas de Maupeou, Chancelier de France depuis 1768, par l'abbé Terray et par le duc d'Aiguillon, nommé ministre des Affaires étrangères en juin 1771. Maupeou s'appliqua à restaurer l'autorité royale et à surmonter la fronde des parlements. Les membres du Parlement s'étant mis en grève, Maupeou fit exiler tous ceux qui refusaient de reprendre le service. Leurs charges furent rachetées. Ils furent remplacés par d'autres magistrats. Maupeou entreprit alors une réforme structurelle fondamentale. La justice, jusqu'alors administrée par des magistrats dont la charge était héréditaire, devint une institution publique, gratuite. Tout en restant inamovibles, et donc indépendants, les magistrats étaient payés par l'État. Le droit de remontrances demeure intact. À plusieurs reprises, en 1766, lors de la séance de la Flagellation, en 1770 et en 1771, le roi avait réaffirmé son attachement à ce droit à condition qu'il ne fût pas un instrument de contre-pouvoir mais qu'il demeurât un devoir de conseil.
Les magistrats du Parlement Maupeou se servirent à plusieurs reprises de ce droit de remontrances, dans un esprit de conseil. L'harmonie institutionnelle était restaurée. Ayant surmonté l'opposition des parlements, Louis XV et l'abbé Terray purent alors apporter des réformes à la fiscalité du royaume, améliorant le rendement du vingtième, et rétablissant ainsi, dès 1772, l'équilibre des recettes et des dépenses.
Mort
Le 26 avril 1774, se déclarèrent les symptômes de la petite vérole, alors que Louis XV était au Petit Trianon.
Le parlement de Paris envoya, le dimanche 1er mai 1774, Nicolas Félix Van Dievoet dit Vandive, conseiller notaire secrétaire Maison et Couronne de France, greffier au Grand Conseil, pour s'enquérir de la santé du roi, comme nous l'apprend en son journal le libraire parisien Siméon-Prosper Hardy :
« La nouvelle cour du Parlement n'avait pas manqué, suivant l'usage ordinaire, de députer le nommé Vandive, l'un des premiers principaux commis au greffe de la Grand Chambre et de ses notaires secrétaires, pour aller à Versailles savoir des nouvelles de la santé du Roi. Mais ce secrétaire ne pouvoit rendre compte de sa mission à l'inamovible compagnie que le mardi suivant, attendue la vacance accoutumée du lundi 2 mai.
Les filles survivantes du roi, le comte de Lusace, oncle maternel du dauphin, furent aussi présents lors de l'agonie du roi. Durant la nuit, une bougie fut allumée au balcon de la chambre, puis fut éteinte à la mort du souverain, qui survint le 10 mai 1774, à 15 heures 30, au château de Versailles, des suites de la maladie septicémie aggravée de complications pulmonaires, ceci dans l'indifférence du peuple et la réjouissance d'une partie de la cour. Variolique, il ne fut pas embaumé : il est le seul roi de France à ne pas avoir reçu cet hommage post-mortem. Il laissa le trône à son petit-fils, le futur Louis XVI.
L'effondrement de la popularité de Louis XV dit pourtant le Bien-Aimé était telle que sa mort fut accueillie dans les rues de Paris par des festivités joyeuses, comme l'avait été celle de Louis XIV. Pour éviter les insultes du peuple sur son passage, le cortège funèbre réduit contourna Paris de nuit, par l'ouest, avant d'arriver à la basilique Saint-Denis. Les obsèques eurent lieu le 12 mai dans cette basilique. La décomposition du corps fut si rapide que la partition du corps, dilaceratio corporis, division du corps en cœur, entrailles et ossements avec des sépultures multiples ne put être réalisée. Si les Parisiens manifestèrent leur indifférence ou leur hostilité, de nombreux témoignages attestent la profonde tristesse des Français de province, qui suivirent en grand nombre au cours de la fin du printemps 1774 les offices organisés dans toutes les villes et gros bourgs de France et de Navarre pour le repos de l'âme du Roi.
Dix-neuf ans plus tard, le 16 octobre 1793, durant la profanation des tombes de la basilique Saint-Denis, après avoir ouvert les cercueils de Louis XIII et de Louis XIV relativement bien conservés les révolutionnaires ouvrirent celui de Louis XV et découvrirent le cadavre nageant dans une eau abondante, perte d'eau du corps qui avait été en fait enduit de sel marin, le roi dévoré par la petite vérole pendant presque 20 années n'ayant pas été embaumé comme ses prédécesseurs. Le corps tombant rapidement en putréfaction car désormais à l'air libre, les révolutionnaires brûlèrent de la poudre pour purifier l'air qui dégageait une odeur infecte puis jetèrent le corps du Roi, à l'instar des autres, dans une fosse commune sur de la chaux vive.
Le 21 janvier 1817, Louis XVIII fit rechercher les restes de ses ancêtres dans les fosses communes, dont Louis XV pour remettre leurs ossements dans la nécropole des Rois, aucun corps n'a cependant pu être identifié.
Une légende populaire veut que Louis XV se soit exprimé au sujet de sa mort Après moi le déluge, cette expression prophétique, son successeur Louis XVI étant guillotiné lors de la Révolution française qui n'apparaît qu'en 1789 est apocryphe et a été également attribuée à Madame de Pompadour en 1757, alors que la favorite cherchait à consoler le roi très affecté par la déroute de Rossbach avec ces mots Il ne faut point s'affliger : vous tomberiez malade. Après nous le déluge !.
Ascendance de Louis XV de France
Postérité Enfants légitimes
La reine Marie et le dauphin Louis, par Alexis Simon Belle.
Marie Leszczyńska donna à Louis XV dix enfants, dont trois moururent en bas-âge :
Louise-Élisabeth 14 août 1727-1759 dite Madame en tant que fille aînée du roi ou Madame Première puis, après son mariage, Madame Infante ;
Anne-Henriette 14 août 1727-1752, sœur jumelle de la précédente, dite Madame Seconde puis « Madame Henriette ;
Marie-Louise 28 juillet 1728-19 février 1733 dite Madame Troisième puis Madame Louise ;
Louis-Ferdinand 4 septembre 1729-20 décembre 1765, dauphin. Père de Louis XVI, Louis XVIII, et Charles X ;
Philippe-Louis 30 août 1730-7 avril 1733, duc d'Anjou ;
Marie-Adélaïde 23 mars 1732-27 février 1800 dite Madame Quatrième, puis Madame Troisième, Madame Adélaïde et enfin Madame ;
Victoire-Louise-Marie-Thérèse 11 mai 1733-7 juin 1799, dite Madame Quatrième puis Madame Victoire ;
Sophie-Philippe-Élisabeth-Justine 27 juillet 1734-3 mars 1782 dite Madame Cinquième puis Madame Sophie ;
fausse couche, garcon 1735
Thérèse-Félicité 16 mai 1736-28 septembre 1744, dite Madame Sixième puis Madame Thérèse ;
Louise-Marie 15 juillet 1737-23 décembre 1787, dite Madame Septième puis Madame Louise, en religion sœur Marie-Thérèse de Saint-Augustin.
fausse couche, 1738, garcon
Favorites, maîtresses et enfants adultérins
Louis XV, comme Louis XIV, eut également un certain nombre d'enfants adultérins de nombreuses maîtresses à partir de 1733. Suite à une nouvelle fausse couche de la reine en 1738, cette dernière, lassée par les maternités répétitives, lui ferma la porte de sa chambre, ce qui facilita l'officialisation de la première favorite royale, la comtesse de Mailly. Ses quatre premières maîtresses furent les quatre sœurs de Nesle, quatre des cinq filles de Louis III de Mailly, marquis de Nesle et de Mailly, prince d'Orange. Tous ses enfants adultérins, autres que Charles de Vintimille, naquirent de jeunes filles non mariées, appelées les petites maîtresses. Hanté par les mauvais souvenirs liés aux bâtards de son arrière-grand-père, Louis XV se refusa toujours à les légitimer. Il subvint à leur éducation et s'arrangea pour leur donner une place honorable dans la société, mais ne les rencontra jamais à la cour. Seuls furent légitimés Charles de Vintimille et l'abbé de Bourbon.
Ses maîtresses et favorites furent :
Louise Julie de Mailly-Nesle, comtesse de Mailly 1710-1751, épouse en 1726 son cousin Louis-Alexandre, comte de Mailly. Elle devient maîtresse en 1733, favorite en 1738, et est supplantée en 1739 par sa sœur Pauline. Elle rentre en grâce en 1741, mais est renvoyée de la cour en 1742 à la demande de sa sœur Marie-Anne ;
Pauline Félicité de Mailly-Nesle, comtesse de Vintimille 1712-1741, maîtresse de Louis XV elle épouse en 1739 Jean-Baptiste, comte de Vintimille 1720-1777. Elle est mère de :
Charles de Vintimille 1741-1814 dit le Demi-Louis car il ressemblait beaucoup à Louis XV. Marquis du Luc, Madame de Pompadour tenait tellement pour assuré qu'il était de naissance royale que, souffrant de n'avoir pas d'enfants avec le roi et désireuse de porter des petits-enfants en commun, elle nourrit en 1751 de le marier à sa fille Alexandrine; il épousera 1764 Adélaïde de Castellane 1747-1770, dont postérité ;
Diane Adélaïde de Mailly-Nesle, duchesse de Lauraguais 1713-1760;
Marie-Anne de Mailly-Nesle, marquise de La Tournelle, duchesse de Châteauroux 1717-1744.
Hortense de Mailly-Nesle, marquise de Flavacourt, fut aussi pendant un temps soupçonnée de liaison intime avec le roi, mais cette hypothèse fut rapidement écartée au profit de ses quatre sœurs.
La marquise de Pompadour de son vrai nom Jeanne Antoinette Poisson, 1721-1764, fille d'un financier véreux exilé en 1725. Elle épouse en 1741 Charles-Guillaume Le Normant d'Étiolles et a deux enfants dont Alexandrine Le Normant d'Étiolles 1744-1754 qui est élevée en princesse et anoblie Mlle de Crécy. Elle devient de 1745 à 1751 la maîtresse du roi, et est honorée en 1752 du tabouret et des prérogatives de duchesse. Elle est dame du palais de la reine en 1756, mais doit quitter Versailles quelque temps en 1757 à la suite d'une cabale ;
La comtesse du Barry Jeanne Bécu, 1743 - guillotinée en 1793 : fille naturelle d'Anne Bécu, couturière, et de Jean-Baptiste Gomard de Vaubernier. Après avoir reçu une bonne éducation, elle travaille comme modiste à Paris. Elle devient en 1768 la maîtresse du roi auquel Jean, comte Dubarry dont elle a été la maîtresse l'a présentée. Louis XV lui fait épouser la même année Guillaume Dubarry frère de Jean, puis la présente à la cour en 1769. Elle avait dit un jour devant Louis XV : La France, ton café fout le camp ! - car tel était le surnom qu'elle donnait à son valet. Elle se retire de la cour à la mort du roi, puis émigre en Grande-Bretagne en 1792 pour y cacher ses diamants : elle est arrêtée au retour et condamnée à mort pour avoir dissipé les trésors de l'État, conspiré contre la République et porté le deuil de Louis XVI. Avant d'être guillotinée à Paris, elle supplia : Encore un moment, messieurs les bourreaux. ;
Marie-Louise O'Murphy
Marie-Louise O'Murphy 1737-1814 dite Mlle de Morphise, fille de Daniel O'Murphy, d'origine irlandaise. Elle épouse : 1°Jacques Pelet de Beaufranchet en 1755, 2° François Nicolas Le Normant de Flaghac en 1759, et 3° Louis-Philippe Dumont en 1798, député du Calvados à la Convention, dont elle divorcera la même année. Elle est la mère de :
Agathe Louise de Saint-Antoine de Saint-André Paris, 20 juin 1754-1774 qui épousera en 1773 René-Jean-Mans de La Tour du Pin, marquis de la Charce 1750-1781.
Marguerite Victoire Le Normant de Flaghac Riom, 5 janvier 1768 qui épousera en 1786 Jean-Didier Mesnard, comte de Chousy 1758-1794, dont postérité, puis en 1794 Constant Le Normant de Tournehem 1767-1814.
Françoise de Chalus, duchesse de Narbonne-Lara 1734-1821, duchesse de Narbonne-Lara, fille de Gabriel de Chalus, seigneur de Sansac, elle épousera en 1749 Jean-François, duc de Narbonne-Lara. Elle est la mère de :
Philippe, duc de Narbonne-Lara 1750-1834 qui épouse en 1771 Antoinette Françoise Claudine de La Roche-Aymon, et de
Louis-Marie, comte de Narbonne-Lara 1755-1813 qui épousera en 1782 Marie Adélaïde de Montholon, dont postérité.
Marguerite-Catherine Haynault 1736-1823, fille de Jean-Baptiste Haynault, entrepreneur de tabac. Elle épouse en 1766 Blaise d'Arod, marquis de Montmelas. Elle est la mère de :
Agnès-Louise de Montreuil 1760-1837, qui épousera en 1788 Gaspar d'Arod 1747-1815, comte de Montmelas, dont postérité, et de
Anne-Louise de La Réale 1763-1831 qui épousera en 1780 le comte de Geslin 1753-1796.
Lucie Madeleine d'Estaing 1743-1826, sœur naturelle de l'amiral d'Estaing, elle épousera en 1768 François, comte de Boysseulh. Elle est la mère de :
Agnès-Lucie-Auguste 1761-1822 qui épousera en 1777 Charles, vicomte de Boysseulh 1753-1808 et de
Aphrodite-Lucie-Auguste 1763-1819 qui épousera en 1784 Louis-Jules, comte de Boysseulh 1758-1792.
Anne Couppier de Romans, baronne de Meilly-Coulonge 1737-1808 baronne de Meilly-Coulonge, elle est la fille d'un bourgeois, Jean-Joseph Roman Coppier. Elle entretient une liaison avec le roi de 1760 à 1765, et épousera en 1772 Gabriel Guillaume de Siran, marquis de Cavanac. Elle est la mère de :
Louis-Aimé de Bourbon 1762-1787, dit l'abbé de Bourbon le seul enfant bâtard que Louis XV reconnaîtra en 1762.
Louise-Jeanne Tiercelin de La Colleterie 1746-1779 dite Mme de Bonneval. Elle est la mère de :
Benoît-Louis Le Duc 1764-1837 abbé.
Irène du Buisson de Longpré38 décédée en 1767, fille de Jacques du Buisson, seigneur de Longpré, elle épousera en 1747 CharlesFrançois Filleul, conseiller du roi. Elle est la mère de :
Julie Filleul 1751-1822, qui épousera 1° Abel François Poisson en 1767, marquis de Vandières, de Marigny, de Menars, etc., frère de Madame de Pompadour ; 2° François de La Cropte, marquis de Bourzac en 1783 dont elle divorcera en 1793.
Catherine Éléonore Bénard 1740-1769, fille de Pierre Bénard, écuyer de la bouche du roi. Elle épouse en 1768 Joseph Starot de Saint-Germain, fermier général qui sera guillotiné en 1794. Elle est la mère de :
Adélaïde de Saint-Germain, comtesse de Montalivet 1769-1850 qui épousera en 1797 Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet 1766-1823, dont postérité.
Marie Thérèse Françoise Boisselet 1731-1800, qui épouse en 1771 Louis-Claude Cadet de Gassicourt. Elle est la mère de :
Charles Louis Cadet de Gassicourt 1769-1821, qui épouse en 1789 Madeleine-Félicité Baudet 1775-1830, dont postérité.
Louis XV fut donc le père de quatorze enfants adultérins. La naissance royale n'est certaine que pour 8 enfants 3 garçons et 5 filles. Madame de Pompadour fit toujours des fausses couches, et la seule naissance d'un enfant naturel avérée après la mort de celle-ci, est celle de Marie Victoire Le Normand de Flaghac en 1768. Ajoutons une possible relation avec Françoise de Chalus, dame d'honneur de sa fille, Marie-Adelaïde. De cette union serait né en 1755 le comte Louis-Marie de Narbonne-Lara.
Guerres
Trois grandes guerres vont se succéder et ternir l'image du roi et de son règne : la Guerre de Succession de Pologne 1733-1738, la guerre de Succession d'Autriche 1744–1748 et la Guerre de Sept Ans 1756-1763.
Guerre de Succession de Pologne
À la mort d’Auguste II en 1733, son fils, Auguste III, et Stanislas Ier, ancien roi de Pologne déchu en 1709, beau-père de Louis XV, se disputent le trône. Alors que les querelles des partisans d'Auguste II et ceux de Stanislas divisent le pays, la mort d’Auguste II en 1733, vient déchaîner les passions. Son fils, Auguste III, et Stanislas Ier se disputent le trône. La crise se transforme en guerre de succession.
Guerre de Succession d'Autriche
La guerre de Succession d'Autriche 1744–1748, traité d'Aix-la-Chapelle est un conflit européen né de la Pragmatique Sanction, par laquelle l'empereur Charles VI du Saint-Empire lègue à sa fille Marie-Thérèse d'Autriche les États héréditaires de la Maison des Habsbourg.
Guerre de Sept Ans
La Guerre de Sept Ans opposa principalement la France à la Grande-Bretagne d'une part, l'Autriche à la Prusse d'autre part. Cependant, par le jeu des alliances et des opportunismes, la plupart des pays européens et leurs colonies se sont retrouvés en guerre. Le début de la guerre est généralement daté au 29 août 1756 attaque de la Saxe par Frédéric II bien que l'affrontement ait débuté plus tôt dans les colonies d'Amérique du Nord avant de dégénérer en guerre ouverte en Europe. La France en ressort meurtri avec la perte de la quasi-totalité de ses colonies en Amérique.
Titres
1710-1712 : S.A.R. Monseigneur le duc d'Anjou
1712-1715 : S.A.R. Monseigneur le Dauphin
1715-1774 : S.M. le Roi de France et de Navarre
          
Posté le : 14/02/2015 14:17
|
|
|
|
|
Galilée 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 15 février 1564, à Pise naît Galilée en italien : Galileo Galilei
mort à 77 ans, à Arcetri, près de Florence, le 8 janvier 1642, mathématicien, géomètre, physicien et astronome Florentin, du XVIIe siècle.Diplomé de l'université de Pise, de Padoue, il est universellement vconnu pour ses travaux en astronomie, cinématique, dynamique, héliocentrisme, lunette astronomique, mécanique
Parmi ses réalisations techniques, il a inventé, plus exactement perfectionné la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. Cet homme de sciences s'est ainsi posé en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'Univers, proposant d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements satellitaires, et ses observations et généralisations se sont alors heurtées aux critiques des philosophes partisans d'Aristote, proposant un géocentrisme stable, une classification des corps et des êtres, un ordre immuable des éléments et une évolution réglée des substances, ainsi qu'aux théologiens jésuites de l'Église catholique romaine, soucieux alors de préserver les fondements de la transsubstantiation. Galilée, qui ne disposait pas de preuves directes du mouvement terrestre, a parfois oublié la prudence de ses protecteurs religieux.
Dans le domaine des mathématiques, ce langage décrivant la nature qu'il appelait de ses vœux pour l'écriture mathématique du livre de l'Univers en 1623 dans son opus sur les comètes, s'il n'a pas contribué à faire progresser l'algèbre, a produit des travaux inédits et remarquables sur les suites, sur certaines courbes géométriques, sur la prise en compte des infiniment petits…
Par ses études et ses nombreuses expériences, parfois uniquement de pensée, sur l'équilibre et le mouvement des corps solides, notamment leur chute, leur translation rectiligne, leur inertie, ainsi que par la généralisation des mesures, en particulier du temps par l'isochronisme du pendule, et la résistance des matériaux, ce chercheur toscan a posé les bases de la mécanique avec la cinématique et la dynamique. Il est considéré depuis 1680 comme le fondateur de la physique, qui s'est imposée comme la première des sciences exactes modernes.
En bref
Le nom de Galilée est plus que célèbre. Il fut – il est encore – signe de contradiction, et l'homme auquel il appartient s'estompe derrière les symboles. Symbole du martyr qui a souffert pour les droits de la raison et de l'expérience face aux dogmatismes philosophiques et qui a ouvert l'ère de la science positive. Pour quelques-uns aussi, symbole du somnambule ou de l'apprenti sorcier qui, dans une demi-conscience, a précipité pour l'humanité une évolution aux fruits amers.
Il est vrai que, condamné par le Saint-Office, en 1633, pour avoir pris parti en faveur de la réalité du mouvement de la Terre, Galilée a fini ses jours en reclus, dans les souffrances physiques et morales, tandis que ses écrits et son exemple devenaient, à la confusion de ses juges, le ferment de l'Europe savante. Il est vrai encore que la seule preuve formelle qu'il proposait du mouvement de la Terre, à savoir le flux et le reflux de la mer, ne valait absolument rien, et qu'il a brillé davantage par les formules audacieuses, suggestives et bien frappées, que par le contenu qu'il était réellement en mesure de leur donner. Mais la vérité de Galilée défie les schématisations simplistes.
Il n'a pas inventé la lunette, mais il a considérablement amélioré cet instrument par voie empirique, et croyant, malgré l'absence de théorie de l'appareil, à la réalité de ce que l'on voit à travers, il n'a pas hésité à le tourner vers les cieux. Ce qu'il a vu demeure encore aujourd'hui un modèle d'observation critique et méritait de bouleverser les conceptions de son temps. Il a fait confiance aux suggestions de l'observation pour conjuguer l'analyse et les contrôles expérimentaux rudimentaires en ce qui concerne l'oscillation du pendule, la chute des corps, la trajectoire des projectiles, et, s'il n'a rien laissé de définitif pour la nouvelle science de la mécanique qui devait devenir le prototype de toutes les autres, il a suffisamment mis en valeur des thèmes, porté l'attention sur les phénomènes fondamentaux, ébauché des lois, pour que les principales œuvres scientifiques de la fin de son siècle soient impensables sans référence à lui. Lui qui avait lancé l'idée que la langue mathématique permet de lire le grand livre de la nature, il n'a pas participé au perfectionnement de cette langue qui, par l'algèbre, s'accomplissait en son temps, mais il a écrit sur les suites et sur les sommes infinies, sur les infiniment petits, des pages magistrales où une mathématique entièrement nouvelle se dessinait.
Galilée s'applique dès l'automne de 1609 à construire des lunettes et à les utiliser à des fins astronomiques. Celle du haut, constituée d'un tube en bois recouvert de papier, est munie d'un oculaire plan-convexe et d'un objectif biconvexe de 26 millimètres d'ouverture et de 1,33 mètre de distance f…
Démonstration géométrique de l'accord entre la loi des espaces de la chute des corps et la proportionnalité de la vitesse au temps écoulé. L' agrégat des vitesses pour la durée 1 petit triangle hachuré est contenu 4 fois dans l'agrégat pour la durée 2.
Par un curieux retour des choses, la conception de la théorie physique moderne est plus proche de la prudence des amis que Galilée avait parmi les princes de l'Église, et qui l'ont abandonné au moment crucial du fameux procès, que du réalisme, à nos yeux un peu naïf, qui fait le fond de la philosophie galiléenne. Mais la prudence des uns ne saurait être, à l'opposé de l'audace de l'autre, considérée comme effet de la conscience des difficultés que trois siècles et demi d'histoire scientifique nous ont enseignées. En fait, si cette histoire a été possible, c'est grâce à l'homme qui a su faire valoir ses talents, promouvoir une révolution de la pensée et obtenir à titre posthume, pour la recherche rationnelle, la relative indépendance qui ne peut plus lui être contestée. Contre ses juges du Saint-Office, Galilée a incarné l'optimisme catholique concernant l'usage des facultés rationnelles, tel que le reconnaîtra le concile Vatican I 1869-1870 et, le 31 octobre 1992, le pape Jean-Paul II, en le réhabilitant. S'il convient aujourd'hui de nuancer, on doit de pouvoir le faire aux conquêtes que permit, dans le monde de la science, la diffusion de l'esprit galiléen.
Galileo Galilei est né à Pise dans une famille modeste issue d'une ancienne noblesse florentine dont les ressources avaient subi de sérieux revers. Ses parents lui léguèrent une vigoureuse constitution, que souligne l'aspect carré de son corps tel que l'ont saisi ses portraitistes et ses proches biographes.
Il fit ses premières études auprès de son père, qui était un musicologue averti, et manifesta de bonne heure, outre son goût pour la musique et le dessin, une habileté manuelle remarquable dans la construction d'instruments. Sa famille s'étant établie à Florence en 1574, il fit ses classes au monastère de Santa Maria de Vallombrosa où il faillit rester comme novice. Son père le reprit en 1579, à cause des soins que nécessitait une grave ophtalmie, et le dirigea vers la profession médicale. Entré avec cette intention à l'université de Pise en 1581, il supporta fort mal l'enseignement médiocre, à base de discussions livresques, qui y était proposé et se tourna résolument vers les mathématiques, sous l'influence d'un maître sans grand savoir, mais bon pédagogue.
Les voies qu'il avait suivies n'avaient rien de régulier. Il quitta Pise en 1585 sans aucun diplôme, mais riche d'une culture répondant à l'idéal humaniste. Il s'était nourri des dialogues de Platon et avait médité sur l'isochronisme des oscillations du pendule.
À Florence, où il était revenu, Galilée poursuivit des recherches sur le centre de gravité de certains solides, ainsi que sur la balance hydrostatique d'Archimède, et se fit connaître par des exercices littéraires et des conférences publiques, notamment sur Dante, le Tasse et l'Arioste. La poésie burlesque qu'il écrivit contre le port de la toge révèle dès cette époque le caractère militant de son aversion pour les structures conservatrices qui nuisent à l'indépendance de l'esprit.
C'est à l'absence de structures universitaires précises dans l'enseignement des mathématiques qu'il dut de pouvoir poser sa candidature de professeur dans diverses universités et d'obtenir en définitive une chaire à Pise, en 1589, sur la recommandation du mathématicien et mécanicien Guidobaldo del Monte.
Son dernier séjour dans sa ville natale ne dura que trois ans, car les conflits avec le milieu fermé de l'Université ne tardèrent pas à l'obliger à partir ; c'est alors qu'il commença à faire œuvre originale, rédigeant un premier traité de mécanique où, malgré la permanence de conceptions traditionnelles, sont introduites des idées nouvelles et fondamentales pour la science future. Notamment l'absence de nécessité d'imaginer un repos intermédiaire entre deux mouvements d'un même mobile qui se succèdent dans des sens contraires ou différents. La légende a beaucoup brodé par la suite et les données sûres concernant ces premiers travaux scientifiques à Pise sont insuffisantes. Si Galilée n'a pas fait du haut de la célèbre tour penchée les expériences qu'on lui a prêtées, il est certain qu'il s'est intéressé spécialement, à cette époque, au problème de la chute des corps et qu'il a cherché à lui appliquer la méthode expérimentale. Il semble bien aussi que l'idée de suivre par la pensée le mouvement d'un point d'une circonférence qui roule sur une droite et d'enrichir la géométrie d'une courbe nouvelle, la cycloïde, date du même moment.
La nécessité de subvenir aux besoins des siens, après la mort de son père en 1591, ajouta aux difficultés du jeune maître contesté et mal payé. C'est avec joie qu'il obtint du Sénat de Venise, en 1592, sa nomination de professeur de mathématiques à l'université de Padoue.
Sa vie
Galileo Galilei Galilée, fils de Vincenzo Galilei et de Giulia Ammannati, est l'aîné de leurs sept enfants. La famille florentine appartient à la petite noblesse et gagne sa vie dans le commerce à Pise. Vincenzo Galilei, son père, est luthiste, musicien, chanteur, et auteur en 1581 d'un Dialogue de la musique moderne. Il participe à des controverses sur la théorie musicale.
Galilée fait preuve très tôt d'une grande habileté manuelle : Enfant, il s'amuse à réaliser les maquettes de machines qu'il a aperçues.
Il est éduqué chez ses parents jusqu'à l'âge de 10 ans. Ceux-ci déménagent alors à Florence et le confient à un prêtre du voisinage, Jacopo Borghini, pendant deux ans. Par la suite, Galilée entre au couvent de Santa Maria de Vallombrosa et y reçoit une éducation religieuse. Poussé au noviciat par ses maîtres, il ne poursuit pas sa carrière ecclésiastique très longtemps : son père, profitant d'une maladie des yeux de son fils, le ramène à Florence en 1579.
Deux ans plus tard, Vincenzo Galilei l'inscrit à l'université de Pise où il suit des cours de médecine, sur les traces d'un de ses glorieux ancêtres, le magister maître Galilaeus de Galilaeis, 1370 - ~1450, mais sans y porter de l'intérêt. Il revient à Florence en 1585 sans avoir fini ses études ni obtenu son diplôme.
La découverte de sa vocation
Dès 1583, Galilée est initié aux mathématiques par Ostilio Ricci, un ami de la famille, élève de Tartaglia. Bien que Ricci soit un savant peu renommé, il a l'habitude, rare à l'époque, de lier la théorie à la pratique par l'expérience. Il a également été influencé par Giovanni Battista Benedetti, autre élève de Tartaglia.
À l'âge de dix-neuf ans, il découvre, en chronométrant à l'aide de son pouls, la régularité des oscillations des lustres de la cathédrale de Pise. De retour chez lui, il compare les oscillations de deux pendules et travaille à la loi de l'isochronisme des pendules, dont le néerlandais Christian Huygens découvre la vraie loi de l'isochronisme rigoureux, nécessitant l'invention d'un autre mouvement isochrone : le pendule cycloïdal alors que le pendule simple de Galilée n'est pas parfaitement isochrone en décembre 1659, étape de la découverte d'une nouvelle science : la mécanique galiléenne.
Galilée observe la régularité du mouvement du pendule simple et le décrit en 1638. Il affirme que la période d'un pendule ne dépend pas de sa masse mais de sa longueur et il énonce la loi sur les périodes : les carrés des périodes d’oscillations sont proportionnels aux longueurs des pendules. La formule s'énonce de nos jours sous la forme suivante, l étant la longueur du pendule, g la gravité et T la période, la première formule de la physique :
Galilée entame d'abord des études de médecine, mais n'ayant aucun goût pour la médecine et la philosophie aristotélicienne, il abandonne. Grâce à Euclide, qui l'éblouit, Galilée réoriente ses études vers les mathématiques. Dès lors, il se réclame de Pythagore, de Platon et d'Archimède et contre le géocentrisme aristotélicien. Dans le courant humaniste, il rédige aussi un pamphlet féroce sur le professorat de son temps. Deux ans plus tard, il est de retour à Florence sans diplôme, mais avec de grandes connaissances et une grande curiosité scientifique.
De Florence à Pise 1585-1592
Galilée commence par démontrer plusieurs théorèmes sur le centre de gravité de certains solides dans son Theoremata circa centrum gravitatis solidum, et entreprend en 1586 de reconstituer la balance hydrostatique d'Archimède ou Bilancetta. En même temps, il poursuit ses études sur les oscillations du pendule pesant et invente le pulsomètre. Cet appareil permettait d'aider à la mesure du pouls et fournissait un étalon de temps, qui n'existait pas à l'époque. Il débute aussi ses études sur la chute des corps.
Depuis son retour de Pise, l'ancien étudiant fréquente à Florence les cercles d'amateurs de musique, chers à son père, excellent théoricien de la musique. Il y donne des conférences érudites sur l'art et la littérature. Le fils Galilée est ainsi remarqué par le cénacle du cardinal del Monte, qui, en politique péninsulaire, soutient le parti français. En 1588, il est invité par l'Accademia Fiorentina, Académie florentine à présenter deux leçons sur la forme, le lieu et la dimension de l'Enfer de Dante.
Parallèlement à ses activités diversifiées, il cherche vainement un emploi de professeur de géomètrie ou de mathématique dans une université. La mort de son père tombé gravement malade en 1589 rend cette quête cruciale car il doit désormais subvenir seul au besoin de sa famille. Il cherche alors à rencontrer, entre autres grands personnages avec lesquels il correspond déjà, le père jésuite Christophorus Clavius, sommité des mathématiques au Collège pontifical. Il obtient aussi l'aide du mathématicien Guidobaldo del Monte. Ce dernier recommande Galilée au grand-duc Ferdinand Ier de Toscane, qui le nomme à la chaire de mathématique de l'Université de Pise pour 60 écus d'or par an, une misère. Sa leçon inaugurale a lieu le 12 novembre 1589.
En 1590 et 1591, il découvre la cycloïde et s'en sert pour dessiner des arches de ponts.
Il expérimente également sur la chute des corps et rédige son premier ouvrage de mécanique, le De motu Le mouvement. La réalité même de ces expériences est aujourd'hui largement mise en doute et serait une invention de son premier biographe, Vincenzo Viviani. Ce volume contient des idées nouvelles pour l'époque, mais il expose encore, bien évidemment pour s'adapter aux contraintes de l'enseignement officiel, les principes de l'école aristotélicienne et le système de Ptolémée. Galilée les enseigne d'ailleurs longtemps après avoir été convaincu de la justesse du système copernicien, faute de preuves tangibles.
L'université de Padoue 1592-1610
En 1592, Galilée part enseigner à l'université de Padoue où il reste 18 ans. Le départ de Pise, après seulement trois ans, s'expliquerait par un différend l'opposant à un fils du grand-duc Ferdinand Ier de Toscane. Ce poste lui a été proposé par l'entremise du cardinal Del Monte. Sensiblement mieux rémunéré, et accompagné de la jouissance d'une maison qu'il n'hésitera pas à louer en partie à ses étudiants étrangers, quitte à cohabiter avec eux pendant les cours, il offre de grandes facilités de recherche.
Padoue, qui possède des artisans des métaux et du bois, experts en fonderie et en menuiserie, appartenait à la puissante République de Venise, ce qui garantissait à Galilée une grande liberté intellectuelle, l'Inquisition y étant très peu puissante. Même si Giordano Bruno avait été livré à l'Inquisition par les patriciens de la République, Galilée pouvait effectuer ses recherches sans trop de soucis. Venise est alors très réputée pour son arsenal, ce qui offre à Galilée de grandes possibilités. Détail qui a son importance, la grande cité républicaine est également célèbre pour la qualité de son industrie verrière protégée dans les îlots de Murano. Il logera modestement dans la ville, la Sérénissime, avec sa compagne et ses enfants.
Il enseigne la mécanique appliquée, les mathématiques, l'astronomie et l'architecture militaire. Il installe une fructueuse coopération avec les ateliers de fondeurs et de menuisiers, ce qui lui permet de mettre au point avec ses étudiants des expériences sur le mouvement des solides. Il professait alors publiquement le système de Ptolémée, n'osant pas encore s'insurger contre les idées admises, bien qu'ayant déjà adopté personnellement le système de Copernic. Ses leçons de mécanique eurent un succès considérable, et le Père Mersenne publiera en France en 1634 les Méchaniques de Galilée.
Depuis la mort de son père en 1591, Galilée doit subvenir aux besoins de la famille : il se porte notamment caution pour la dot — dix fois supérieure à son salaire — d'une de ses sœurs et devra jusqu'à la fin de sa vie aider financièrement son frère Michelagnolo Galilei ou supporter l'instabilité croissante de sa mère, ²endetté, il savait qu'en rentrant à Florence il serait mis en prison. Il est accaparé par ses tâches dans l'enseignement : il donne de nombreux cours particuliers à de riches étudiants qu'il héberge chez lui. Mais il est piètre gestionnaire et seule la vente d'instruments scientifiques, thermomètre de Galilée, balance hydrostatique et surtout l'aide financière de ses protecteurs et amis lui permettent d'équilibrer ses comptes.
En 1593, il rédige le Trattato di Forticazioni, traité des fortifications et le Trattato di Meccaniche, traité de mécanique à l'intention de ses étudiants de cours particuliers. Les travaux de Galilée permettent une meilleure efficacité de l'artillerie lourde, ils établissent qu'un canon doit être pointé à 45° pour avoir sa portée maximale et ne font l'objet d'aucune contestation.
En 1597, il améliore et fabrique un compas de proportion, le compas géométrique et militaire, ancêtre de la règle à calcul, qui connaît un grand succès commercial. Il n'en rédige le mode d'emploi que neuf ans plus tard.
En 1599, Galilée participe à la fondation de l’Accademia dei Ricovrati avec l’abbé Federico Cornaro. La même année, il fait venir le mécanicien Marc'Antonio Mazzolenidans l'atelier au rez-de-chaussée de son logis pour y fabriquer, d'après ses plans, et vendre des instruments scientifiques.
La même année, Galilée rencontre Marina Gamba, une jeune Vénitienne issue de famille modeste, avec laquelle il entretient une liaison jusqu'en 1610, ils ne sont pas mariés et ne vivent pas sous le même toit. En 1600, naît Virginia, sa première fille, suivie par sa sœur Livia en 1601, puis un fils, Vincenzo, en 1606. Après la séparation, non conflictuelle du couple, Galilée se charge des enfants. Il place plus tard ses filles au couvent à Arcetri, Virginie deviendra sœur Marie Céleste car fille d'un homme fasciné par les étoiles.
Selon Guillaume Libri, Galilée expérimente vers 1602-1603, un appareil destiné à observer les variations de température ou thermoscope et en montre les effets à Castelli. Mais la primauté de la découverte ne peut être attestée.
L'année 1604
1604 est annus mirabilis pour Galilée qui a 40 ans :
En juillet, il teste sa pompe à eau dans un jardin de Padoue.
En octobre, il découvre la loi du mouvement uniformément accéléré, qu'il associe à une loi des vitesses erronées.
En décembre, il débute son observation d'une nova connue depuis le 10 octobre au moins. Il consacre 5 leçons sur le sujet le mois suivant, et en février 1605 il copublie Dialogo de Cecco di Ronchitti in Perpuosito de la Stella Nova avec Girolamo Spinelli. Bien que l'apparition d'une nouvelle étoile, et sa disparition soudaine, entre en totale contradiction avec la théorie établie de l'inaltérabilité des cieux, Galilée reste encore aristotélicien en public, mais il est déjà fermement copernicien en privé. Il attend la preuve irréfutable sur laquelle s'appuyer pour dénoncer l'aristotélisme.
Reprenant ses études sur le mouvement, Galilée montre que les projectiles suivent, dans le vide, des trajectoires paraboliques.
De 1606 à 1609
En 1606, Galilée et deux de ses amis tombent malades le même jour d'une même maladie infectieuse. Seul Galilée survit, mais il restera perclus de rhumatismes pour le restant de ses jours.
Dans les deux années qui suivent, le savant étudie les armatures d'aimants. On peut encore voir ses travaux au musée d'Histoire de la Science, Istituto e Museo di Storia della Scienza de Florence.
Perfectionnement de la lunette
En mai 1609, Galilée, ou plutôt Paolo Sarpi ? reçoit de Paris une lettre du Français Jacques Badovere, l'un de ses anciens étudiants, qui lui confirme une rumeur insistante : l'existence d'une longue-vue conçue par l'opticien hollandais Hans Lippershey en 1608 permettant de voir les objets éloignés. Fabriquée communément en Hollande et en France, la lunette est d'abord un jouet commun qui grossit les objets observés environ sept fois, non sans d'énormes aberrations latérales. Selon les indications françaises qui envisage un usage de multiplicateur du sens de la vision, Galilée, qui ne donne plus de cours à Cosme II de Médicis, construit sa première lunette. Il l'améliore en appliquant des principes élémentaires d'optique et la transforme en lunette astronomique, envisageant d'observer les étoiles invisibles à l'œil nu. Son instrument déforme toujours sensiblement les objets, mais les grossit surtout de manière linéaire jusqu'à trente fois. Il est aussi le seul à l'époque à réussir à obtenir une image droite grâce à l'utilisation d'une lentille divergente en oculaire. Cette invention marque un tournant dans la vie de Galilée car il croit d'emblée, sans construire une théorie prudente de l'instrument d'optique fabriquée, qu'il observe bien la réalité. Il se précipite vers l'observation des corps célestes et extrapole déjà leurs mouvements.
Le 21 août 1609, il termine sa deuxième lunette assez proche de la longue-vue hollandaise et conçue pour l'observation maritime ou nocturne. Elle grossit huit ou neuf fois. Il la présente au sénat de Venise. La démonstration a lieu au sommet du Campanile de la place Saint-Marc. Les spectateurs sont enthousiasmés : sous leurs yeux, Murano, située à 2,5 km, semble être à environ 300 m seulement.
Galilée offre son instrument et en lègue les droits à la République de Venise, très intéressée par les applications militaires de l'objet. En récompense, Galilée est confirmé à vie à son poste de Padoue et ses gages sont doublés. Il est enfin libéré des difficultés financières.
Il faut cependant signaler que Galilée ne maîtrisait pas la théorie optique et que les instruments fabriqués sont de qualité très variable. Certaines lunettes sont pratiquement inutilisables, en tout cas en observation astronomique. En avril 1610, à Bologne, par exemple, la démonstration de la lunette est désastreuse, ainsi que le rapporte Martin Horky dans une lettre à Kepler.
Galilée lui-même reconnaissait, en mars 1610, que, sur plus de 60 lunettes qu'il avait construites, quelques-unes seulement étaient adéquates. De nombreux témoignages, y compris celui de Kepler, confirment la médiocrité des premiers instruments.
Montées sur de simple tubes en bois ou de carton, les lentilles conçues par Galilée permirent pour la première fois à l'œil humain d'étudier de près la Lune, les taches solaires et les planètes et leurs satellites.
Plusieurs des lunettes astronomiques construites par Galilée sont exposées au Musée Galilée à Florence.
L'observation de la Lune
Pendant l'automne, Galilée continue à développer sa lunette. En novembre, il fabrique un instrument qui grandit une vingtaine de fois. Il prend le temps de tourner sa lunette vers le ciel. Très vite, en observant les phases de la Lune, il découvre, quelques mois après Thomas Harriot, que cet astre n'est pas parfait comme le voulait la théorie aristotélicienne.
La physique aristotélicienne, qui faisait autorité à l'époque, distinguait deux mondes :
le monde sublunaire : comprenant la Terre et tout ce qui se trouve entre la Terre et la Lune ; dans ce monde tout est imparfait et changeant ;
le monde supralunaire : qui part de la Lune et s'étend au-delà. Dans cette zone, il n'existe plus que des formes géométriques parfaites, des sphères et des mouvements réguliers immuables, circulaires.
Galilée, quant à lui, observa une zone transitoire entre l'ombre et la lumière, le terminateur, qui n'était en rien régulière, ce qui par conséquent invalidait la théorie aristotélicienne. Galilée en déduit l'existence de montagnes sur la Lune et estime même leur hauteur à 7 000 mètres, davantage que la plus haute montagne connue à l'époque. Il faut dire que les moyens techniques de l'époque ne permettaient pas de connaître l'altitude des montagnes terrestres sans fantaisie. Quand Galilée publie son Sidereus Nuncius, Messager Céleste, il pense que les montagnes lunaires sont plus élevées que celles de la Terre, bien qu'en réalité elles soient équivalentes.
La tête dans les étoiles
En quelques semaines, il découvre la nature de la Voie lactée, dénombre les étoiles de la constellation d'Orion et constate que certaines étoiles visibles à l'œil nu sont en fait des amas d'étoiles. Il étudie également les taches solaires.
Le 7 janvier 1610, Galilée fait une découverte capitale : il remarque trois petites étoiles à côté de Jupiter. Après quelques nuits d'observation, il découvre qu'il y en a une quatrième et qu'elles accompagnent la planète. Ce sont les satellites visibles de Jupiter, qu'il nommera plus tard les étoiles Médicées ou astres médicéens, en l'honneur de ses protecteurs, la Famille des Médicis, Grands Ducs de Toscane. Les satellites de Jupiter, aujourd'hui appelés lunes galiléennes seront baptisés Callisto, Europe, Ganymède et Io par Simon Marius, qui en revendiquera également la découverte plusieurs années après. Pour Galilée, qui est alors le seul à expliquer leurs mouvements relatifs, Jupiter et ses satellites sont un modèle du système solaire. Grâce à eux, il pense pouvoir démontrer que les orbes de cristal d’Aristote n'existent pas et que tous les corps célestes ne tournent pas autour de la Terre. C'est un coup très rude porté aux aristotéliciens. Il corrige aussi certains coperniciens qui prétendent que tous les corps célestes tournent autour du Soleil, sauf la Lune.
Le 12 mars 1610, Galilée publie à Venise les résultats de ses premières observations stellaires dans l'ouvrage Sidereus Nuncius, Le Messager céleste, dont les 500 exemplaires seront épuisés en quelques jours. Le professeur d'université de Padoue, qui affiche son origine florentine, accède à la célébrité en quelques semaines. Les cours italiennes ne parlent que de ses observations astronomiques et veulent rencontrer le noble homme de science florentin.
Désireux de retourner avec tous les honneurs dans sa Toscane natale et à Florence, Galilée rebaptise les satellites de Jupiter qui sont pour quelque temps les «astres médicéens», en l'honneur de Cosme II de Médicis, son ancien élève et grand-duc de Toscane qui vient de lui octroyer une généreuse pension à vie et lui proposer un poste officiel de géomètre du duché de Florence. Galilée a hésité entre Cosmica sidera et Medicea sidera. Le jeu de mots, Cosmica = Cosme est évidemment volontaire et c'est seulement après la première impression qu'il retient la deuxième dénomination. La petite famille de Galilée - il a une femme et trois enfants vivant à Venise - est désormais protégée du besoin.
Le 10 avril, il fait observer ces astres à la cour de Toscane. C'est le triomphe. Le même mois, il donne trois cours sur le sujet à Padoue. Toujours en avril, Johannes Kepler offre son soutien à Galilée. L'astronome allemand ne confirme pas vraiment cette découverte puisqu'il n'a pas encore eu accès à la lunette, il offre seulement une dissertation-discussion, enthousiaste pour son aspect copernicien sur la pertinence du petit ouvrage de Galilée. C'est la Dissertatio cum Nuncio Sidereo21 où même la question de l'impact sur les fondements de l'astrologie est abordée, ces nouvelles planètes invalident-elles l'astrologie de la tradition ? Question remise au goût du jour depuis 2006 avec l'actualité des planétoïdes plutoniens et le déclassement de Pluton. En septembre 1610, Kepler publie sa Narratio, un compte-rendu court et précis de l'observation des compagnons de Jupiter : c'est là qu'il crée le néologisme "satellite" garde du corps en latin. En effet, si l'on ajoutait des "planètes" au système solaire, son système des 5 solides, 1596, Mysterium Cosmographicum serait invalidé…
À noter que Galilée ne lui fit jamais parvenir une seule lunette, et ce malgré son soutien officiel en tant qu'Astronome Impérial. L'observation des satellites de Jupiter n'a pu avoir lieu que par l'emprunt d'une lunette, qu'il eut à disposition une ou deux nuits seulement. Galilée, en effet, s'est toujours méfié des écrits képlériens faisant une part belle à l'astrologie, à l'Écriture Sainte, Kepler est protestant et théologien de formation ou, à partir de 1609, à des ellipses et des forces dans le système solaire. Galilée qualifiera même de puérile l'idée d'une attraction mutuelle entre les eaux des mers et la Lune… rappelant trop la symbolique astrologique.
Observations à Florence, présentation à Rome
Le 10 juillet 1610, Galilée quitte Venise pour Florence.
Malgré l'avis de ses amis Fra Paolo Sarpi et Sagredo, qui craignent que sa liberté ne soit bridée, il a, en effet, accepté le poste de Premier Mathématicien de l'Université de Pise, sans charge de cours, ni obligation de résidence et celui de Premier Mathématicien et Premier Philosophe du grand-duc de Toscane.
Le 25 juillet 1610, Galilée tourne sa lunette astronomique vers Saturne et découvre ses anneaux. C'est seulement 50 ans plus tard et avec des instruments plus puissants que Christian Huygens en comprendra la nature.
Le cardinal Barberini
Le mois suivant, Galilée trouve une astuce pour observer le Soleil à la lunette et découvre les taches solaires. Il en donne une explication satisfaisante.
En septembre 1610, poursuivant ses observations, il découvre les phases de Vénus. Pour lui, c'est une nouvelle preuve de la vérité du système copernicien, car s'il est facile d'interpréter ce phénomène grâce à l'hypothèse héliocentrique, il est beaucoup plus difficile de le faire à l'aide de l'hypothèse géocentrique.
Il est invité le 29 mars 1611 par le cardinal Maffeo Barberini, futur Urbain VIII à présenter ses découvertes au Collège pontifical de Rome et à la jeune Académie des Lyncéens. Galilée reste dans la capitale pontificale un mois complet, durant lequel il reçoit tous les honneurs. L'Académie des Lyncéens notamment, lui réserve un accueil enthousiaste et l'admet en tant que 6e membre. Dorénavant, le lynx de l'Académie ornera le frontispice de toutes les publications de Galilée.
Le 24 avril 1611, des professeurs de sciences du Collège romain, dirigé par les jésuites répondent à la demande d'information de Bellarmin. Cette réponse, signée par Christophorus Clavius, un éminent mathématicien, confirme au cardinal Bellarmin que les observations de Galilée sont exactes. Se limitant à leur domaine et aux questions posées les savants se gardent bien de confirmer ou d'infirmer les conclusions que le Florentin en a tirées. Galilée s'empresse de faire connaitre cette opinion. Il retourne à Florence le 4 juin.
Le Messager céleste
Informé, en juin 1609, par le Français Jacques Baudouère, des propriétés d'un instrument d'optique récemment apparu aux Pays-Bas, Galilée s'appliqua aussitôt à le construire à partir des données sommaires qui lui étaient communiquées : association de deux lentilles, l'une convergente, l'autre divergente. Il ne tarda pas à obtenir un résultat supérieur à celui des artisans hollandais, avec un grossissement linéaire de 30. Dès le 21 août, il fit de sa longue-vue une présentation spectaculaire à quelques patriciens de Venise, bien qu'il ignorât le fonctionnement exact de l'instrument et les aberrations diverses qui l'affectent avec l'augmentation du grossissement. À l'automne, tandis que Kepler venait de publier les deux premières de ses célèbres lois cinématiques du mouvement des planètes, il entreprit d'utiliser l'appareil pour explorer le ciel.
C'est avec une rapidité surprenante qu'il réunit en quelques mois la matière d'un petit ouvrage appelé à un immense retentissement. Publié le 12 mars 1610, le Sidereus Nuncius Le Messager céleste apporte, en une centaine de pages, de quoi révolutionner l'astronomie commune.
Pour situer cette affirmation et dégager de la structure du livre la leçon qu'elle comporte par rapport à l'auteur, quelques détails s'imposent.
Après la présentation de la lunette, promue au rang d'instrument astronomique, de longs développements sont accordés au résultat de l'observation de la Lune, et le lecteur moderne peut s'étonner non seulement de cette longueur, mais aussi de la prudence qui préside aux conclusions proposées. Celles-ci concernent essentiellement, par l'interprétation des variations des ombres, l'existence d'un relief important à la surface de la Lune, relief qui apparente l'astre à la Terre et, par les variations de luminosité de la face obscure de la Lune, l'existence d'une réflexion par la Terre de la lumière solaire. Si Galilée se borne à assurer ainsi, avec beaucoup de soin et de précautions, les ressemblances entre la Terre et la Lune et les relations réciproques des échanges lumineux qui les rapprochent l'une de l'autre dans une même situation d'ensemble, lointaine, par rapport au Soleil, c'est que la pièce maîtresse des conceptions reçues, à savoir l'association paradoxale pour la Terre du privilège d'être le centre du Monde et de la propriété d'être le royaume de la corruption et de la mort, constituait, sur la voie d'une solution raisonnable, un obstacle majeur. L'affirmation de l'homogénéité des astres, y compris la Terre, avait eu sa part dans la condamnation au bûcher de Giordano Bruno, en 1600.
De la Lune, le Sidereus Nuncius passe à ce que la lunette a révélé le plus immédiatement, à savoir que la Voie lactée et les nébuleuses sont des amas d'étoiles et que, d'une manière générale, le peuplement des cieux décourage le dénombrement que l'héritage antique avait cru fixer. Quant aux observations comparées des grandeurs apparentes, elles imposent pour les espaces célestes une profondeur vertigineuse.
Mais il y a mieux encore. L'ouvrage se termine sur le rapport d'une découverte sensationnelle. Le 7 janvier 1610, une heure après minuit, Galilée a vu près de Jupiter trois étoiles nouvelles, et, après deux mois d'observations précises, il peut livrer une démonstration incontestable : dans son mouvement à travers les cieux, la grande planète entraîne avec elle quatre satellites qui ne cessent de tourner autour d'elle. Dès lors, la difficulté que la Lune présentait à ceux qui, en suivant Copernic, avaient transféré au Soleil le privilège exclusif d'être centre de mouvement, est résolue. Que la Lune tourne autour de la Terre n'empêche pas qu'elle soit entraînée par elle dans sa translation annuelle et l'exemple de Jupiter révèle que, sans préjudice pour le rôle du Soleil dans le système planétaire, chaque planète peut être elle-même centre de mouvement relatif.
Tel est le Message auquel Pascal, cinquante ans plus tard, apportera dans ses Pensées la puissance de sa plume incomparable, en joignant seulement à l'émerveillement l'effroi du silence éternel des espaces infinis, c'est-à-dire en ajoutant la note que le recul du temps a permise à une sensibilité mystique et philosophique particulière. Galilée, quels que soient ses sentiments intimes au cours de cet hiver mémorable, ne prend pas le loisir de méditer ; il se hâte de publier, sans polir ni arranger, ce qui devient ainsi un document positif impérissable.
Et cette hâte même, comme sa rapidité à mettre en œuvre l'instrument nouveau, révèle combien Galilée était l'homme d'un moment décisif.
Galilée attaqué et condamné par les autorités L'opposition s'organise
Les partisans de la théorie géocentrique sont devenus les ennemis acharnés de Galilée et les attaques contre lui ont commencé dès la parution du Sidereus Nuncius. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre la face et ne veulent pas voir leur science remise en question.
De plus, les méthodes de Galilée, basées sur l'observation et l'expérience plutôt que sur l'autorité des partisans des théories géocentriques, qui s'appuyaient sur le prestige d'Aristote, sont en opposition complète avec les leurs, à tel point que Galilée refuse d'être comparé à eux.
D'abord, ce ne sont que des escarmouches. Mais Sagredo écrit tout de même à Galilée, fraîchement arrivé à Florence :
La puissance et la générosité de votre prince, le grand-duc de Toscane permettent d'espérer qu'il saura reconnaître votre dévouement et votre mérite ; mais dans les mers agitées des cours, qui peut éviter d'être, je ne dirai pas coulé, mais au moins durement secoué par les rafales furieuses de la jalousie ?
La première flèche vient de Martin Horky, disciple du professeur Giovanni Antonio Magini et ennemi de Galilée. Cet assistant publie en juin 1610, sans consulter son maître, un pamphlet contre le Sidereus Nuncius. Hormis les attaques personnelles, son argument principal est le suivant :
Les astrologues ont fait leurs thèmes astrologiques en tenant compte de tout ce qui bougeait dans les cieux. Donc les astres médicéens ne servent à rien et, Dieu ne créant pas de choses inutiles, ces astres ne peuvent pas exister.
Il est ridiculisé par les partisans de Galilée, qui répondent que ces astres servent à une chose : faire enrager Horky. Devenu la risée de toute l'université, Horky est finalement chassé par son maître : Giovanni Antonio Magini ne tolère pas un échec aussi cuisant. Au mois d'août, un certain Sizzi tente le même genre d'attaque avec le même genre d'arguments, sans plus de succès.
Une fois les observations de Galilée confirmées par le Collège romain, les attaques changent de nature. Ludovico Delle Combe attaque sur le plan religieux en demandant si Galilée compte interpréter la Bible pour la faire s'accorder à ses théories. À cette époque en effet, et avant les travaux exégétiques du xixe siècle, le psaume 93 92 laissait entendre une cosmologie géocentrique dans la ligne : Tu as fixé la Terre ferme et immobile.
Les attaques se font plus violentes
Galilée, de retour à Florence, est inattaquable sur le plan astronomique. Ses adversaires vont donc critiquer sa théorie des corps flottants. Galilée prétend que la glace flotte parce qu'elle est plus légère que l'eau, alors que les aristotéliciens pensent que c'est dans sa nature de flotter. Physique quantitative et mathématique de Galilée contre physique qualitative d'Aristote. L'attaque aura lieu durant un repas à la table du grand-duc Cosme II de Toscane au mois de septembre 1611.
Galilée est opposé aux professeurs de Pise et notamment à Delle Combe lui-même, durant ce qu'on appelle la bataille des corps flottants. Galilée réalise l'expérience et sort victorieux de l'échange. Quelques mois plus tard, il en tirera un opuscule où il présente sa théorie.
En dehors de ces démêlés, Galilée continue ses recherches. Son système de détermination des longitudes par l'observation de la position des satellites de Jupiter est proposé à l'Espagne par l'ambassadeur de Toscane.
En 1612, il entreprend une discussion avec Apelles latens post tabulam pseudonyme du jésuite Christoph Scheiner, un astronome allemand, au sujet des taches solaires. Apelles défend l'incorruptibilité du Soleil en arguant que les taches sont en réalité des amas d'étoiles entre le Soleil et la Terre. Galilée démontre que les taches sont soit à la surface même du Soleil, soit si proches qu'on ne peut mesurer leur altitude. L'Académie des Lyncéens publiera cette correspondance le 22 mars 1613 sous le titre d'Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti. Scheiner finira par adhérer à la thèse galiléenne.
Le 2 novembre 1612, la querelle reprend. Le dominicain Niccolo Lorini, professeur d'histoire ecclésiastique à Florence, prononce un sermon résolument opposé à la théorie de la rotation de la Terre. Sermon sans conséquence particulière, mais qui marque les débuts des attaques religieuses. Les opposants utilisent le passage biblique, Josué 10, 12-14 dans lequel, à la prière de Josué, Dieu arrête la course du Soleil et de la lune, comme arme théologique contre Galilée.
En décembre 1613, le professeur Benedetto Castelli, ancien élève de Galilée et un de ses collègues à Pise, est sommé par la grande-duchesse douairière Christine de Lorraine de prouver l'orthodoxie de la doctrine copernicienne. Galilée viendra en aide à son disciple en lui écrivant une lettre le 21 décembre 1613 sur le rapport entre science et religion, affirmant que dans le domaine des phénomènes physiques, l'Écriture Sainte n'a pas de juridiction. La grande-duchesse est rassurée, mais la controverse ne faiblit pas.
Galilée cependant, continue ses travaux. Du 12 au 15 novembre, il reçoit Jean Tarde, à qui il présente son microscope et ses travaux d'astronomie. En 1614, il fait la connaissance de Jean-Baptiste Baliani, physicien génois, qui sera son ami et correspondant pendant de longues années.
La censure de la thèse copernicienne 1616
Le 20 décembre, le dominicain Tommaso Caccini attaque très violemment Galilée à l'église Santa Maria Novella. Le 6 janvier 1615, un copernicien, le carme Paolo Foscarini, publie une lettre traitant positivement de l'opinion des pythagoriciens et de Copernic sur la mobilité de la Terre. Il envisage le système copernicien en tant que réalité physique. La controverse prend une telle ampleur que le cardinal Bellarmin, pourtant favorable à Galilée, est obligé d'intervenir le 12 avril. Il écrit une lettre à Foscarini où, en l'absence de réfutation concluante du système géocentrique, il condamne sans équivoque la thèse héliocentrique. Tout en reconnaissant l'intérêt pratique, pour le calcul astronomique, du système de Copernic, il déclarait formellement imprudent de l'ériger en vérité physique.
En réaction, vers avril 1615, Galilée écrit à Christine de Lorraine une longue lettre dans laquelle il développe admirablement ses arguments en faveur de l'orthodoxie du système copernicien. Galilée y explique que l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au Ciel, et non comment va le ciel, principe qu'il attribue au cardinal Cesare Baronio. On y voit par ailleurs les passages des Écritures qui posaient problème d'un point de vue cosmologique. Cette lettre est, elle aussi, largement diffusée. Pour Galilée, c'était accepter le déplacement du débat du terrain scientifique au terrain de la Foi.
Galilée se rend à Rome pour se défendre contre les calomnies et surtout essayer d'éviter une interdiction de la doctrine copernicienne. Mais il lui manque la preuve irréfutable de la rotation de la Terre pour appuyer ses plaidoiries. Son intervention arrive trop tard : Lorini, par lettre de dénonciation, avait déjà prévenu Rome de l'arrivée de Galilée et le Saint-office avait déjà commencé l'instruction de l'affaire.
Cherchant toujours une preuve du mouvement de la Terre et pour répondre aux objections du cardinal Bellarmin, Galilée pense la trouver dans le phénomène des marées. Le 8 février 1616, il envoie sa théorie des marées, Discorso del Flusso e Reflusso au cardinal Orsini. Cette théorie rappelle la relation entre les marées et la position apparente de la lune, qui tourne moins vite autour de la Terre, 29,57 jours que la Terre n'est supposée tourner sur elle-même, 1 jour. Malheureusement, Galilée ne peut expliquer ainsi qu'une marée par jour alors qu'il en est couramment observé deux, parfois avec un peu de décalage sur l'heure astronomique, qui ne sera expliqué que plus tard par la Dynamique des fluides. Elle reste en revanche compatible avec le principe d'inertie admis par Galilée. L'influence de la lune sur les marées avait déjà été soulignée par Kepler, mais Galilée n'en avait pas alors tenu compte.
Il faudra attendre l'année 1728 et les observations de Bradley sur l'aberration de la lumière pour avoir une première preuve directe du mouvement de la Terre par rapport aux étoiles.
L'intransigeance de Galilée, qui refuse l'équivalence des hypothèses copernicienne et ptoléméenne, a sans doute précipité les événements. De fait, sur la question de la translation de la Terre et de sa rotation sur elle-même, les arguments décisifs n'ont été acquis qu'au début du XIXe siècle. L'équivalence des hypothèses était la conclusion rationnelle justifiée pour l'époque ; et non l'affirmation d'une réalité physique telle que soutenue par Galilée.
L'historien Maurice Clavelin a cherché à justifier le refus de l'équivalence des hypothèses de Galilée. Bellarmin, qui demande à Galilée, de présenter l'héliocentrisme comme une hypothèse, le fait sur la base d'un géocentrisme admis et considéré comme vrai. Quand Galilée refuse ce compromis, il refuse que l'astronomie conserve un rôle de subordonné par rapport à la philosophie naturelle traditionnelle, d'Aristote, alors partie intégrante de la théologie catholique. Galilée revendique le statut de philosophe et considère que, non seulement Dieu a donné aux hommes les sens et la raison pour découvrir la vraie constitution du monde, mais que ses observations minent l'astronomie de Ptolémée et justifie son adhésion à l'astronomie copernicienne.
Malgré deux mois passés en de nombreuses tractations, Galilée est convoqué le 16 février 1616 par le Saint-office pour l'examen des propositions de censure. Les 25 février et 26 février 1616, la censure est ratifiée par l'Inquisition et par le pape Paul V. Galilée n'est pas inquiété personnellement mais est prié d'enseigner sa thèse en la présentant comme une hypothèse. Cet arrêté s'étend à tous les pays catholiques. Des rumeurs circulent que Galilée a abjuré et reçu une sévère pénitence. À sa demande Bellarmin lui donne un certificat, 26 mai 1616 clarifiant que rien de tel n'eut lieu. Il lui a été simplement notifié que l'héliocentrisme, étant contraire aux Saintes Ecritures, ne peut à ce stade être défendu ou enseigné.
Progrès des thèses de Galilée
Cette affaire a beaucoup éprouvé Galilée. Ses maladies reviennent le tourmenter pendant les deux années suivantes et son activité scientifique se réduit. Il reprend seulement son étude de la détermination des longitudes en mer. Ses deux filles entrent dans les ordres.
En 1618, on observe le passage de trois comètes, phénomène qui relance la polémique sur l'incorruptibilité des cieux.
En 1619, le père jésuite Orazio Grassi publie De tribus cometis anni 1618 disputatio astronomica. Il y défend le point de vue de Tycho Brahe sur les trajectoires elliptiques des comètes. Galilée riposte d'abord par l'intermédiaire de son élève Mario Guidicci qui publie en juin 1619 Discorso delle comete où il développe une théorie farfelue sur les comètes, allant jusqu'à en faire des phénomènes météorologiques d'illusions d'optique.
En octobre, Orazio Grassi attaque Galilée dans un pamphlet plus sournois : aux considérations scientifiques se mêlent des insinuations religieuses malveillantes et dangereuses au temps de la Contre-Réforme.
Cependant, Galilée, encouragé par son ami le cardinal Barberini, futur pape Urbain VIII et soutenu par l’Académie des Lyncéens, y répondra avec ironie dans Il Saggiatore, ou L'Essayeur; ouvrage qui est considéré comme un chef-d’œuvre de l'art polémique. Grassi, l’un des plus grands savants jésuites, est ridiculisé et envoie une lettre anonyme à l’Inquisition, mais un théologien de l'Inquisition conclut à un non-lieu.
Lorsque Peiresc, ami et ancien élève de Galilée, apprend qu'il est inquiété, il envoie une lettre au cardinal Barberini.
Entre-temps, Galilée a repris son étude des satellites de Jupiter. Malheureusement des difficultés techniques l'obligent à abandonner le calcul de leurs éphémérides. Nonobstant, Galilée se voit couvert d'honneurs en 1620 et 1622.
Le 28 août 1620, le cardinal Maffeo Barberini adresse à son ami le poème Adulatio Perniciosa qu'il a composé à son honneur. Le 20 janvier 1621, Galilée devient consul de l'Accademia fiorentina. Le 28 février, Cosme II, le protecteur de Galilée, meurt subitement. En 1622, à Francfort, paraît une Apologie de Galilée rédigée par Tommaso Campanella en 1616. Un défenseur bien encombrant, car Campanella est déjà convaincu d'hérésie.
Le 6 août 1623, l'ami de Galilée, le cardinal Maffeo Barberini est élu Pape sous le nom de Urbain VIII. Le 3 février 1623 Galilée reçoit l'autorisation de publier son Saggiatore qu'il dédie au nouveau Pape. L'ouvrage paraît le 20 octobre 1623. Ce sont d'abord les qualités polémiques, et littéraires de l'ouvrage qui assureront son succès à l'époque. Il n'en demeure pas moins qu'en quelques mois et dans une atmosphère de grande effervescence culturelle, Galilée devient en quelque sorte le porte-drapeau des cercles intellectuels romains en rébellion contre le conformisme intellectuel et scientifique imposé par les Jésuites. Dans cet ouvrage, il énonce la mathématisation de la physique :
« La philosophie est écrite dans ce vaste livre constamment ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont le triangle et le cercle et autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot.
Les années suivantes sont assez calmes pour Galilée malgré les attaques des aristotéliciens. Il en profite pour perfectionner son microscope composé, septembre 1624.
En 1626, Galilée poursuit ses recherches sur l'armature de l'aimant. Il reçoit aussi la visite d'Élie Dodati, qui apportera les copies de ses manuscrits à Paris. En 1628, Galilée, âgé de 64 ans, tombe gravement malade et manque de mourir en mars.
L'année suivante, ses adversaires tentent de le priver de l'allocation qu'il reçoit de l'Université de Pise, mais la manœuvre échoue.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7935#forumpost7935
Posté le : 14/02/2015 14:13
|
|
|
|
|
Galilée 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le Dialogue et la condamnation de 1633
Dans les années 1620, après la censure de ses thèses, Galilée passe un mois à Rome où il est reçu plusieurs fois par le pape Urbain VIII qui a pour lui une grande amitié. Il lui expose le plan de l'étude commanditée par celui-ci Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, ouvrage devant présenter de façon neutre les avantages comme les inconvénients du système de Ptolémée et du système de Copernic. En effet, le pape qui apprécie Galilée ne veut pas qu'il fasse figurer des arguments si peu convaincants notamment à propos de sa théorie sur les marées, conseil dont Galilée ne tiendra pas compte.
Jusqu'en 1631 Galilée consacre son temps à l'écriture du Dialogo qui sera le triomphe de ses idées et à tenter de les faire admettre par la censure. L'ouvrage est achevé d'imprimer en février 1632. Les yeux de Galilée commencent à le trahir en mars et avril.
Le 21 février 1632, Galilée, protégé par le pape Urbain VIII et le grand-duc de Toscane Ferdinand II de Médicis, petit-fils de Christine de Lorraine, fait paraître à Florence son dialogue des Massimi sistemi, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, où il raille sensiblement le géocentrisme de Ptolémée comme il l'avait fait avec son expérience de pensée concernant les affirmations erronées d'Aristote sur la chute des corps.
Galilée, qui veut écraser ses adversaires, publie son ouvrage en demandant l'imprimatur, c'est-à-dire l'approbation de l'Église. Il piège Mgr Riccardi, maître du Sacré Palais, qui avait la mission d'inspecter le dialogue. En effet, lors de l'inspection, Mgr Riccardi n'a connaissance que de la préface et de la conclusion dans lesquelles Galilée ne dévoile pas ses vraies intentions.
Le style du Dialogue cause à la fois révolution et scandale. Le Dialogue se déroule à Venise sur quatre journées entre trois interlocuteurs : Filippo Salviati, Florentin partisan de Copernic, Giovan Francesco Sagredo, Vénitien éclairé mais sans a priori, et Simplicio, piètre défenseur de la physique aristotélicienne, personnage caricatural qui ne pose que des questions idiotes, en lequel les clercs de l'Université, voire Urbain VIII lui-même, se seraient peut-être sentis visés. Toutefois, lorsqu'on lui reprocha le caractère ostensiblement péjoratif du nom, Galilée répondit qu'il s'inspirait de Simplicius de Cilicie.
L'Église se sent obligée de réagir d'autant plus qu'elle considère qu'on lui a, en quelque sorte, volé son imprimatur puisque le texte imprimé ne correspond pas au texte présenté à Mgr Riccardi. De plus, Galilée écrit son livre en italien et non en latin, langue scientifique. Il souhaite ainsi toucher un large public.
Le pape lui-même ne peut qu'avaliser le reproche des adversaires de Galilée à qui il avait demandé une présentation neutre des deux théories, pas un plaidoyer en faveur du seul Copernic. Le Pape trahi ne lui en veut pas pour avoir tourné en dérision ses propres paroles, mais pour le manque de preuves de sa théorie. D'autant qu'à cette époque les systèmes se déduisent par simple transformation mathématique l'un de l'autre : seul le pendule de Foucault apportera, bien plus tard, une preuve de la rotation de la Terre sur elle-même, sa rotondité étant acquise depuis Aristote sur lequel l'Église comme l'Université s'alignaient alors, Terre sphérique et immobile au centre de l'univers et par l'expédition de Magellan bien avant la naissance de Galilée.
Le pape se sent alors doublement trahi, ce qui le pousse à prendre une décision stricte. Il doit de même agir vite car avec le succès du livre, Galilée devient un personnage très médiatisé, déchaînant la colère de ses opposants. Malgré cela, le Pape Urbain VIII veut éviter à Galilée de comparaître devant les juges mais la Commission refuse.
Galilée est donc à nouveau convoqué par le Saint-office, le 1er octobre 1632. Ce qui lui est reproché n'est pas sa thèse elle-même, mais le détournement d'une mission commanditée, ce qui justifie des sanctions pénales. Son livre est en outre ouvertement pro-copernicien, bafouant l'interdit de 1616 la mise à l'index de ces thèses ne sera levée qu'en 1757. Malade, il ne peut se rendre à Rome qu'en février 1633. Les interrogatoires se poursuivent jusqu'au 21 juin où une menace de torture est même évoquée sur ordre du pape ; Galilée cède.
Le 22 juin 1633, sentence rendue au couvent dominicain de Santa-Maria :
Il est paru à Florence un livre intitulé Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic dans lequel tu défends l'opinion de Copernic. Par sentence, nous déclarons que toi, Galilée, t'es rendu fort suspect d'hérésie, pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la Terre et repos du Soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l’Église. Et afin que ta grande faute ne demeure impunie, nous ordonnons que ce Dialogue soit interdit par édit public, et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-office.
Il prononce également la formule d'abjuration que le Saint-office avait préparée :
Moi, Galiléo, fils de feu Vincenzio Galilei de Florence, âgé de soixante dix ans, ici traduit pour y être jugé, agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté, ayant devant les yeux et touchant de ma main les Saints Évangiles, jure que j'ai toujours tenu pour vrai, et tiens encore pour vrai, et avec l'aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur, tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j'avais été condamné par injonction du Saint-office d'abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n'est pas au centre du monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée de quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit; et après avoir été averti que cette doctrine n'est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures, j'ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants, sans la réfuter en aucune manière; ce pour quoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie, pour avoir professé et cru que le Soleil est le centre du monde, et est sans mouvement, et que la Terre n'est pas le centre, et se meut. J'abjure et maudis d'un cœur sincère et d'une foi non feinte mes erreurs. …
Le fameux aparté attribué à Galilée E pur si muove! ou Eppur si muove - Et pourtant elle tourne est probablement apocryphe : cette rétractation l'aurait en effet immédiatement fait passer pour relaps aux yeux de l'Église, et aurait pu lui faire risquer le bûcher, ou même perdre tout espoir de commutation de sa peine.
Le texte de la sentence est diffusé largement : à Rome le 2 juillet, le 12 août à Florence. La nouvelle arrive en Allemagne fin août, aux Pays-Bas Espagnols en septembre. Les décrets du Saint-office ne seront jamais publiés en France, mais, prudemment et pour éviter la controverse, René Descartes renonce à faire paraître son traité du monde et de la lumière.
Beaucoup y compris René Descartes qui diffère puis annule par crainte la publication de son traité de science, à l'époque, pensèrent que Galilée était la victime d'une cabale des Jésuites qui se vengeaient ainsi de l'affront subi par Orazio Grassi dans le Saggiatore.
Les positions du théologien liégeois Libert Froidmont de l'Université de Louvain s'efforcent d'éclairer en détail l'équivoque de la condamnation de Galilée.
La condamnation de Galilée est immédiatement commuée par le Pape en résidence surveillée. Le scientifique n'est donc jamais allé en prison et continua même à percevoir les revenus de deux bénéfices ecclésiastiques que le souverain pontife lui avait octroyés. La deuxième sanction : la récitation des psaumes de la pénitence une fois par semaine pendant un an, sera effectuée par sa fille religieuse carmélite.
La fin
D'abord assigné à résidence chez l'archevêque Piccolomini à Sienne, il obtient finalement d'être relégué chez lui, à Florence dans sa villa d'Arcetri, la Villa le Gioiello Villa le petit joyau, non loin de ses filles au couvent.
Au début, personne n'est autorisé à se rendre chez le prisonnier d'Arcetri mais cette interdiction s'assouplit ensuite, ce qui lui permet de recevoir quelques visites et lui fournit l'occasion de faire passer la frontière à quelques ouvrages en cours de rédaction. Ces livres paraissent à Strasbourg et à Paris en traduction latine.
En 1636, Louis Elzevier reçoit une ébauche des Discours sur deux sciences nouvelles de la part du maître florentin. C'est le dernier livre qu'écrira Galilée, ouvrage où le scientifique a consigné les découvertes d'où est née la dynamique moderne ; il y établit les fondements de la mécanique en tant que science et marque ainsi la fin de la physique aristotélicienne. Il tente aussi de poser les bases de la résistance des matériaux, avec moins de succès. Il finira ce livre de justesse, car le 4 juillet 1637, il perd l'usage de son œil droit.
Le 2 janvier 1638, Galilée perd définitivement la vue. Par chance, Dino Peri a reçu l'autorisation de vivre chez Galilée pour l'assister avec le père Ambrogetti qui prendra note de la sixième et dernière partie des Discours. Cette partie ne paraîtra qu'en 1718. L'ouvrage complet paraît en juillet 1638 à Leyde Pays-Bas et à Paris. Il est lu par les grands esprits de l'époque. Descartes par exemple enverra ses observations à Mersenne, l'éditeur parisien.
Il restera à Arcetri jusqu'à sa mort, entouré de ses disciples, Viviani, Torricelli, Vincenzo Reinieri, Dino Peri, etc., travaillant à l'astronomie et autres sciences. Fin 1641, Galilée envisage d'appliquer l'oscillation du pendule aux mécanismes d'horloge.
Quelques jours plus tard, le 8 janvier 1642, Galilée s'éteint à Arcetri, une petite colline au sud de Florence, à l'âge de 77 ans. Sur l'ordre du grand-duc de Toscane, son corps est inhumé religieusement à Florence le 9 janvier dans le caveau familial de la Basilique Santa Croce de Florence. L’Église refusant que lui soit édifié un monument funéraire, un mausolée sera érigé en son honneur le 13 mars 1736.
Postérité : de l'incompréhension des scientifiques au réexamen de l'affaire Galilée par l'Église
Le procès de Galilée, spécialement pour son ouvrage Dialogue sur les deux grands systèmes du monde 1633, a eu des retombées considérables sur la méthode scientifique, tant la méthode expérimentale que théorique, mais aussi indirectement sur la philosophie et d'autres domaines de la pensée. En philosophie, on vit ainsi apparaître des courants de pensée rationalistes Descartes, et empiriques voir Francis Bacon, mais aussi Robert Boyle.
Révolution copernicienne.XVIIe siècle : réactions des scientifiques
La théorie de l'héliocentrisme, souleva d'abord des questions sur l'aristotélisme Terre fixe au centre de l'univers, et sur la métaphysique, qui entraînèrent des réactions des scientifiques :
Descartes se lança dans un projet philosophique cogito, et dans les Méditations sur la philosophie première 1641, dénonça la philosophie d'Aristote et la scolastique Thomas Hobbes ne le suivit pas sur ce point
Blaise Pascal rejoignit le courant janséniste, et participa avec une équipe de Port-Royal à une traduction de la Bible sous la direction de Lemaître de Sacy, qui fut la seule traduction de la Bible en français au XVIIe siècle.
XVIIIe siècle : la confirmation scientifique et la levée de l'interdit par le pape Benoît XIV
En 1728, James Bradley fut le premier à prouver scientifiquement, par l'explication qu'il donna à l'aberration de la lumière, la rotation de la Terre autour du Soleil.
Le pape Benoît XIV autorisa les ouvrages sur l'héliocentrisme dans la première moitié du xviiie siècle, et ceci en deux temps :
En 1741, devant la preuve optique de l'orbitation de la Terre faite par Bradley en 1728, il fit donner par le Saint-office l'imprimatur à la première édition des œuvres complètes de Galilée, avec cependant l'ajout du fait que le mouvement de la Terre est supposé. Ce geste constitua une révision implicite des sentences de 1616 et 1633, même si celles-ci ne furent pas abrogées.
En 1757, les ouvrages favorables à l'héliocentrisme furent à nouveau autorisés, par un décret de la Congrégation de l'Index, qui retira ces ouvrages du catalogue des livres interdits.
Dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, d'Alembert critique sévèrement l'Inquisition pour la condamnation de Galilée :
Un tribunal devenu puissant dans le midi de l'Europe, dans les Indes, dans le Nouveau Monde, mais que la foi n'ordonne point de croire, ni la charité d'approuver, ou plutôt que la religion réprouve, quoique occupé par ses ministres, et dont la France n'a pu s'accoutumer encore à prononcer le nom sans effroi, condamna un célèbre astronome pour avoir soutenu le mouvement de la terre, et le déclara hérétique …. C'est ainsi que l'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence ; et peu s'en fallut qu'on ne défendit au genre humain de penser.
Dans l'article Astronomie, l'Encyclopédie indique :
Les opinions de Galilée lui attirèrent les censures de l'inquisition de Rome : mais ces censures n'ont pas empêché qu'on ne l'ait regardé comme un des plus grands génies qui ait paru depuis longtemps.
XIXe siècle : les travaux d'exégèse s'intensifient
Les protestants travaillèrent sur l'Ancien Testament, tandis que les catholiques s'attelèrent au Nouveau Testament. Dix-neuf traductions de la Bible en français parurent au xixe siècle et à la fin du siècle, le pape Léon XIII indiqua les règles à adopter pour les études bibliques, encyclique Providentissimus Deus de 1893.
Avant cela, en 1820, l'Europe se relevant à peine du choc causé par la Révolution française et l'Empire Napoléonien, le chanoine Settele s'apprête à publier ses éléments d'optique et d'astronomie, et se voit opposer un refus d'imprimer. C'est la dernière manifestation de l'interdiction des écrits coperniciens. L'auteur injustement censuré s'adresse au pape Pie VII, dont il reçoit dès 1822 une sentence favorable.
L'affaire Galilée est devenue au XIXe siècle un cheval de bataille du positivisme et plus encore d'un anticléricalisme à peine masqué qui a créé l'image d'un Galilée persécuté et jeté en prison par l'Église obscurantiste alors qu'il n'a pas passé une heure en cachot indigne et que sa peine est relativement bénigne par rapport à celle de Giordano Bruno. Cette bataille oublie aussi que Galilée, pourtant adepte de la méthode scientifique, avance parfois avec intransigeance des assertions scientifiques gratuites. Provocateur et orgueilleux, il traite ses adversaires de pygmées mentaux, idiots stupides, à peine dignes du nom d'êtres humains et s'aliène progressivement les jésuites qui ont pourtant, dès 1611, confirmé ses découvertes scientifiques.
XXe siècle : l'Église reconnaît ses erreurs repentance de l'Église.
L'Église catholique a reconnu lors du Concile Vatican II que les interventions de certains chrétiens dans l'Histoire dans le domaine scientifique étaient indues, en mentionnant Galilée. Les papes modernes ont rendu hommage au grand savant qu'était Galilée.
De nouvelles traductions de la Bible sont apparues dans la deuxième moitié du xxe siècle, tenant compte des études bibliques exégèse et herméneutique lancées par les papes Léon XIII et Pie XII qui ne s'est pas offusqué de la théorie du Big Bang, voir Pie XII et le Big Bang.
En 1979 et en 1981, le pape Jean-Paul II, récemment élu, chargea une commission d'étudier la controverse ptoléméo-copernicienne des XVI et XVIIe siècle. Jean-Paul II considéra qu'il ne s'agissait pas d'une réhabilitation, le tribunal qui a condamné Galilée n'existant plus. Celle-ci est d'ailleurs implicite après les autorisations données par Benoît XIV en 1741 et en 1757.
Le 31 octobre 1992, Jean-Paul II a reconnu clairement, lors de son discours aux participants à la session plénière de l'Académie pontificale des sciences, les erreurs de certains théologiens du xviie siècle dans l'affaire :
" Ainsi la science nouvelle, avec ses méthodes et la liberté de recherche qu'elle suppose, obligeait les théologiens à s'interroger sur leurs propres critères d'interprétation de l'Écriture. La plupart n'ont pas su le faire. "
" Paradoxalement, Galilée, croyant sincère, s'est montré plus perspicace sur ce point que ses adversaires théologiens. “Si l'écriture ne peut errer, écrit-il à Benedetto Castelli, certains de ses interprètes et commentateurs le peuvent, et de plusieurs façons”. On connaît aussi sa lettre à Christine de Lorraine 1615 qui est comme un petit traité d'herméneutique biblique.
Jean-Paul II a souligné que le grand savant avait eu une " intuition de physicien de génie " en comprenant pourquoi seul le soleil pouvait avoir fonction de centre du monde, tel qu'il était alors connu, c'est-à-dire comme système planétaire.
XXIe siècle
En octobre 2005, le livre du cardinal Paul Poupard sur l'affaire Galilée est publié.
En janvier 2008, 6746 professeurs de l'Université de Rome La Sapienza, soutenus par des étudiants, s'en prennent au pape Benoît XVI, au point que ce dernier doit renoncer à participer à la cérémonie d'inauguration de l'année universitaire à laquelle il avait été convié. Ces professeurs reprochent au pape sa position sur l'affaire Galilée telle qu'elle était apparue dans un discours prononcé par lui à Parme en 1990, dans lequel il s'appuie sur l'interprétation du philosophe des sciences Paul Feyerabend jugeant la position de l'Église d'alors plus rationnelle que celle de Galilée. Une manifestation en soutien du pape réunit 100 000 fidèles sur la place Saint-Pierre le 20 janvier 2008
Le 15 février 2009, soit 445 ans jour pour jour après la naissance de Galilée, le président du Conseil pontifical pour la culture célèbre une messe en l'honneur de Galilée en la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs.
L'année 2009 a été déclarée Année Mondiale de l'Astronomie AMA09 ou IYA09 en anglais par l'UNESCO, l'organisme des Nations Unies pour l'Éducation, les Sciences et la Culture. Elle coïncide avec le 400e anniversaire des premières observations faites avec une lunette astronomique, par Galilée 1564-1642, et ses premières découvertes sur les montagnes lunaires, les taches solaires, les phases de Vénus, les satellites de Jupiter 1609.
Les sentiers de la gloire
Que Galilée ait parfaitement compris l'importance considérable de sa découverte des satellites de Jupiter, rien ne le montre davantage que le nom d'astres médicéens qu'il leur impose juste à temps pour figurer sur le frontispice du Sidereus Nuncius. L'auteur et sa découverte avaient certainement besoin de protecteurs, mais, en choisissant de flatter le nouveau grand-duc de Toscane, Cosme II de Médicis, Galilée caressait de vastes desseins. Il avait la nostalgie de sa province natale et, comme il le dit lui-même dans la lettre qu'il adressa au prince de Florence, ses cartons étaient pleins de merveilleux plans et projets. Des projets techniques, des projets de publication sur le système du monde et sur une science entièrement nouvelle du mouvement.
Malgré les efforts faits à Venise pour le retenir, malgré les avis de quelques amis soucieux de sa liberté intellectuelle, Galilée suivit la voie ouverte par sa propre diplomatie et s'installa à Florence, en septembre 1610, avec le titre de premier mathématicien et philosophe du grand-duc.
Son activité ne fut d'abord entravée que par la maladie qui le cloua périodiquement au lit durant plusieurs années, et il poursuivit les recherches qui l'avaient amené, à Padoue, au printemps de 1610, à observer les taches du Soleil. Il découvrit en décembre les phases de la planète Vénus, et au printemps de 1611 reçut à Rome l'accueil flatteur de l'Accademia dei Lincei et du Collège romain, la puissante institution jésuite. Mais le Discours sur les corps flottants qu'il publia en 1612 après d'âpres discussions avec les professeurs aristotéliciens de Pise manifesta l'étendue des difficultés dans lesquelles il était engagé en fait par rapport à la science traditionnelle. Ce fut le conflit.
En vain Galilée réussit-il à faire nommer à Pise, dans la chaire de mathématiques, son disciple le père Benedetto Castelli. Celui-ci reçut du recteur l'ordre de s'abstenir de toute allusion à la théorie copernicienne et de la grande-duchesse douairière de Toscane, Christine de Lorraine, des avertissements inspirés par le souci de l'orthodoxie. Galilée fut obligé d'intervenir. Il le fit dans une lettre à son disciple où il aborda de manière directe les rapports de la science et de la religion, affirmant que, dans le domaine des phénomènes physiques, l'Écriture sainte n'a pas de juridiction. La diffusion de cette lettre provoqua l'extension de la polémique. Des prédicateurs stigmatisèrent en chaire les idées nouvelles. Au début de 1615, un autre religieux du parti copernicien, le père Foscarini, crut bien faire en publiant une brochure pour montrer qu'en fait les passages de l'Écriture qui servaient d'arguments contre la théorie héliocentrique pouvaient être interprétés dans son cadre. Mais l'initiative suivait une plainte contre Galilée déposée au Saint-Office. Le cardinal Bellarmin, personnage important de la Curie romaine, favorable à Galilée, essaya d'enrayer le développement de l'affaire en écrivant au père Foscarini une lettre quasi publique où, tout en reconnaissant l'intérêt pratique, pour le calcul astronomique, du système de Copernic, il déclarait formellement imprudent de l'ériger en vérité physique. Poussé par quelques amis, dont Mgr Dini, Galilée diffusa à son tour une lettre à la grande-duchesse Christine où il développait magistralement que l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel, et non comment va le ciel.
C'était là parler juste et respecter profondément la spécificité de la Révélation. Mais c'était aussi accepter le déplacement du débat, que la polémique avait obscurci. Au cardinal Bellarmin, dont toute l'attitude semble inspirée par le désir de maintenir la paix en retardant une discussion délicate, il eût mieux valu concéder l'inexistence d'une preuve absolue de la réalité du mouvement de la Terre et de l'immobilité du Soleil, et réclamer le droit à professer les contradictions entraînées par le maintien du système géocentrique ptoléméen et de la physique aristotélicienne en face des faits récemment rassemblés dans divers domaines.
Tout en exprimant, sur le terrain où il s'était laissé entraîner, une position religieuse bien supérieure à celle de ses adversaires, Galilée n'a pas adopté au point de vue scientifique la position rigoureuse qui eût été inattaquable.
À la fin de 1615, il se rendit à Rome pour essayer de conjurer une décision fâcheuse, il y parla ouvertement en faveur des arguments convergents que permettaient ses observations, mais, malgré son talent, il n'obtint pas la conviction ferme d'un nombre suffisant de personnes influentes. Le 3 mars 1616, l'œuvre de Copernic fut mise à l'Index. Son prestige et ses relations avaient évité que Galilée fût mentionné dans les attendus du décret, mais on l'informa officiellement de la nécessité de s'abstenir désormais de toute discussion concernant le système du monde.
De retour à Florence, il tint compte de l'événement et aborda d'autres sujets de recherche, notamment le problème de la détermination des longitudes en mer, tandis que, l'une après l'autre, ses deux filles entraient en religio
Le drame final et le couronnement de l'œuvre
L'apparition de trois comètes, en 1618, vint réveiller les controverses entre astronomes. Galilée, qui n'avait pas cessé ses observations, avait évidemment son mot à dire. Mais il ne prépara son intervention que sur les encouragements du cardinal Barberini, qui devint pape sous le nom d'Urbain VIII, en 1623. Comment Galilée aurait-il pu ne pas nourrir l'espoir de faire abroger le décret de 1616 ! L'ouvrage de circonstance qui lui avait été suggéré, et auquel il donna le titre adéquat de Il Saggiatore L'Essayeur, est un chef-d'œuvre de l'art polémique. Au-delà de la controverse suscitée par le jésuite Horatio Grassi à propos des comètes, il invite le lecteur à la réflexion sur la méthode de la science. Et c'est là que se trouve le passage prophétique concernant l'écriture mathématique du livre de l'univers. Le nouveau pape accueillit avec faveur le résultat de l'effort qu'il avait lui-même suscité et qui lui était d'ailleurs dédié.
L'année suivante, en 1624, Galilée se rendit à Rome pour exposer à Urbain VIII l'intérêt qu'il y aurait à publier un ouvrage où les thèses relatives au système du monde seraient présentées contradictoirement. Le projet ne déplut pas. Il fut seulement précisé à l'auteur qu'il devait être objectif, c'est-à-dire n'avantager aucune des théories en présence.
C'est ainsi que le drame, dont les motifs, déjà noués en 1615, n'avaient pas changé, se traduisit dans les faits. Au fur et à mesure de la réalisation de son dessein, Galilée eut à mener des négociations difficiles, mais le quiproquo provenant de ce qu'il ne comprenait pas l'objectivité de la même manière que les autorités romaines se poursuivit jusqu'à la publication, en février 1632, de son célèbre Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano.
Écrit en langue vulgaire, et dans un style alerte, souvent ironique et mordant, qui fait rendre à son genre littéraire tous ses effets, l'ouvrage prenait parti, et, bien que certaines de ses assertions, notamment l'interprétation du phénomène des marées comme preuve positive du mouvement de la Terre, soient erronées, il avait dans l'ensemble une vigueur démonstrative considérable. Urbain VIII pouvait s'y reconnaître sous les traits de Simplicio, l'aristotélicien trop soucieux de défendre la tradition, et Galilée perdit les puissants appuis dont il avait bénéficié jusque-là.
Nous n'entrerons pas ici dans plus de détails à propos du fameux procès, dont certains aspects sont peu honorables pour les juges du Saint-Office. Il importe davantage d'en fixer nettement la leçon. Si Galilée se trouvait livré à des adversaires sans scrupules, incapables de saisir le problème délicat qui formait le fond réel du débat, il avait tout fait pour qu'il en fût ainsi.
Sans doute avait-il agi en raison de sa conviction profonde qu'en matière de recherche physique il n'y a pas équivalence entre les hypothèses, mais il n'avait pas compris qu'entre la convergence des arguments en faveur d'une hypothèse et l'affirmation d'une réalité physique, il y a un pas que l'on peut hésiter à franchir.
Sans doute, les hésitations à franchir ce pas, telles qu'elle apparaissaient chez un Bellarmin, étaient loin d'avoir les fondements épistémologiques qu'on peut leur donner aujourd'hui et se teintaient de politique théologique ; mais, sur la question préalable de la comparaison des hypothèses, les arguments décisifs en faveur de la translation de la Terre et de sa rotation sur elle-même par rapport au Soleil n'ont été acquis qu'au début du XIXe siècle.
S'il y a lieu, en définitive, de s'étonner, en cette affaire où l'autorité de l'Église s'est tout de même compromise hors de sa juridiction stricte, c'est de ce que le scandale, encore qu'il fût différent suivant le point de vue de chaque antagoniste, n'ait pas empêché le débat de porter ses fruits. Pour la science, comme pour la mentalité religieuse. Nul doute que, dans ce fait remarquable, les dernières années de Galilée n'aient joué un très grand rôle.
Condamné le 22 juin 1633, Galilée ne connaîtra jusqu'à sa mort que des résidences surveillées, mais, d'une part, il fera l'admiration d'un nombre toujours croissant d'esprits à travers l'Europe, par la dignité et la noblesse de son attitude, d'autre part, la surveillance n'ira jamais jusqu'à interdire son travail. C'est la recrudescence de ses maux physiques, accompagnée à la fin de 1637 de la perte complète de la vue, qui fut pour lui le principal obstacle.
Grâce au gallicanisme, le décret du Saint-Office ne fut pas enregistré en France où, sous le couvert des franchises des parlements, les ouvrages de Galilée passèrent assez librement. Ils y trouvèrent de puissants protecteurs, tel le célèbre religieux minime Mersenne, qui surent avec précaution assurer la diffusion de leur message scientifique.
Lorsqu'en 1638 Galilée couronne son œuvre en publiant à Leyde ses Discorsi (Discours et démonstrations mathématiques concernant deux nouvelles sciences touchant la mécanique et les mouvements locaux), c'est par Paris que passe son manuscrit, en y laissant une influence profonde.
Dans cet ouvrage, somme de toute sa vie scientifique, se trouve en particulier la correction de l'erreur concernant le comment de la loi des espaces dans la chute des corps, que Galilée avait d'abord cru découvrir dans une augmentation de la vitesse en proportion directe de la hauteur de chute. En démontrant que la loi des espaces ne s'accorde qu'avec l'accélération rapportée au temps écoulé, Galilée a non seulement fait date dans l'histoire de la mathématique, légué à ses successeurs de quoi fonder la mécanique nouvelle et la gravitation universelle, mais il a encore scellé le testament de sa grandeur. Le vrai savant est celui qui, jusqu'au bout, remet sur le métier.
Hommages et références
Astronomie et astronautique :
L'astéroïde 697 Galilea a été nommé en son honneur, à l'occasion du 300e anniversaire de la découverte des lunes galiléennes.
Galileo est le nom d'une sonde de la NASA envoyée vers Jupiter et ses satellites.
Galileo est aussi le futur système de positionnement européen.
Galilaei est un cratère lunaire.
Galilaei est un cratère martien.
Enseignement :
Le Liceo Classico Galileo est un lycée dans le centre historique de Florence.
L'institut Galilée près de Paris en France, est un pôle scientifique constitué de huit laboratoires de recherche, six formations d'ingénieurs et une école doctorale.
La Haute École Galilée51 est un établissement d'enseignement supérieur bruxellois dans le domaine de la communication master journalisme, publicité…, des soins infirmiers (bachelier en soins infirmiers, de l'enseignement (bachelier régent de l'enseignement secondaire inférieur… et du secteur économique bachelier en secrétariat de direction et bachelier en tourisme.
Galilée a été choisi comme nom de baptême par la promotion 2008-2009 de l'Institut national des études territoriales INET.
Culture :
La Vie de Galilée est une pièce de théâtre de Bertolt Brecht.
La vie de Galilée fait l'objet d'un album du groupe de metal allemand Haggard avec l'opus « Eppur Si Muove » qui lui est entièrement consacré.
En 2005, un téléfilm français, Galilée ou l'Amour de Dieu, réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe, avec Claude Rich dans le rôle de Galilée, retrace son procès devant le tribunal de l'Inquisition.
Galilée, opéra en 12 scènes de Michael Jarrell livret du compositeur d'après La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, est créé à Genève en janvier 2006.
Messager des étoiles, fresque musicale de Jean-Claude Amiot d'après La Vie de Galilée créée à Dijon en 1994, version nouvelle en 2009.
Citation :
L'université de Padoue de « la Bô » conserve à l'académie l'épine dorsale de Galilée ; ce qui fait écrire à André Suarès, dans son Voyage du Condottière :
Peuple à reliques : ils ont aussi l'épine dorsale de Galilée, à l'Académie, en rien différente d'une autre épine, un os à moelle pour le pot-au-feu du dimanche. Il faudrait mettre le tout dans un tronc à la Sainte Science ou à Saint Antoine.
Œuvres
Principaux ouvrages scientifiques
1590 : De motu
1606 : Le Operazioni del compasso geometrico et militare di Galileo-Galilei, nobil Fiorentino
1610 : Discorso intorno alle cose che stanno in su l'acqua et che in quella si muovono
12 mars 1610 : Sidereus Nuncius, magna longeque admirabilia spectacula prodens, etc.
1613 : Storia e dimonstrazioni intorno alle macchie solari et loro accidenti
1623 : Il Saggiatore nel quale con bilancia esquisita et giusta si ponderano le cose contenute nella libra astronomica et filosofica di Lotario Sarsi, etc.
1632 : Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
1638 : Discorsi e Dimonstrazioni matematiche intorno a due scienze attenanti alla mecanica ed i movimenti locali
Traductions en français
Lettre à Christine de Lorraine et autres écrits coperniciens, traduction par Philippe Hamou et Martha Spranzi. Paris, Librairie générale française, 2004
L'Essayeur, traduction par Christine Chauviré. Paris, les Belles Lettres, 1979. Annales littéraires de l'Université de Besançon ; 234
Le Messager des étoiles, traduction annotée par Fernand Hallyn. Paris, Seuil, 1992 Sources du savoir
Sidereus nuncius. Le messager céleste, texte et traduction par Isabelle Pantin. Paris, les Belles Lettres, 1992. Science et humanisme
Histoire et démonstration sur les taches solaires…, 1613.
Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, publié en 1632, traduction par René Fréreux et François de Gandt. Paris, Seuil, Points Sciences, 2000
Discours concernant deux sciences nouvelles, traduction par Maurice Clavelin. Paris, PUF 1995. repris de A. Colin 1970. Les quatre premières journées seulement. La sixième journée a été publiée par S. Moscovici dans la revue Isis
Galilée : Dialogues et Lettres choisies trad. Paul-Henri Michel, préf. Giorgio di Santillana, Hermann, 1966, 430 p
Musées
Musée Galilée, Florence. Ouvert en 2010, il remplace le Musée de la Storia della Scienza (Histoire des Sciences) de Florence. On peut voir des vitrines consacrées à de nombreux instruments de Galilée, également la relique momifiée de l'index de Galilée, celui-là même ayant désigné les astres qu'il voyait avec sa lunette.
Biblio-filmographie
Galilée, de Ludovico Geymonat Turin 1957, traduction française coll. Sciences, Seuil 1992, biographie
Galilée de Georges Minois. Paris, PUF, 2000. Que sais-je ? no 3574.
Le Mythe Galilée, Fabien Chareix, PUF, 2002
Galilée, de Claude Allègre, éditions Plon, 2002
Galilée, un savant résolument moderne, BT2 no 91, Pemf, Mouans-Sartoux France, septembre 2006, 64 pages.
Enrico Bellone, Galilée, le découvreur du monde, Les génies de la science, Belin/Pour la Science, 2003, 160 pages.
Pierre Costabel et Michel Pierre Lermer, Les nouvelles pensées de Galilée, Vrin, 1973.
Paul Couderc, Galilée et la pensée contemporaine, Société Astronomique de France, 1966.
S. Drake, Galilée, Actes Sud, 1987. Traduction de l'ouvrage anglais Galileo, Oxford, 1980.
Collectif, Galilée, aspect de sa vie et de son œuvre, Centre international de Synthèse, Presse Universitaire de France, 1966.
Sur l'affaire Galilée
L'Affaire Galilée, Émile Namer commentaires de sa correspondance, collection archives no 58, Gallimard/Julliard, 1975
Galilée hérétique de Pietro Redondi. Paris, Gallimard, 1985. Bibliothèque des Histoires.
Isabelle Stengers, Les affaires Galilée, dans Michel Serres dir., Éléments d'histoire des sciences, Paris, Bordas, 1997, p. 223-273
Galilée en procès, Galilée réhabilité ?, sous la direction de Francesco Beretta. Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 2005
L'Affaire Galilée, cardinal Poupard, éditions de France, octobre 2005
Exorciser le spectre de Galilée, par Philippe Marcille, Éditions du Sel, 2006
La Vérité sur l'affaire Galilée, Aimé Richardt, François-Xavier de Guibert, 2007
La Preuve selon Galilée, Pierre Gillis, La matière et l'esprit, 5, p. 27-42, 2006 Mons, Belgique
   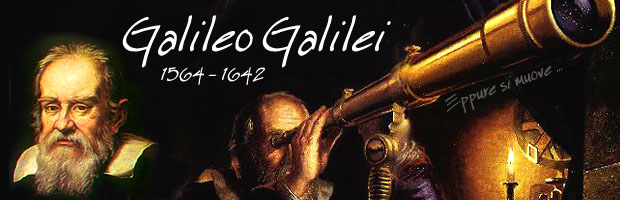        
Posté le : 14/02/2015 14:11
|
|
|
|
|
Création du drapeau français 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 15 février 1794 pour la première fois, adoption d'un pavillon national
par la Convention. Le drapeau français Tricolore de bandes verticales bleue, blanche et rouge de largeur respectivement 30:33:37 bleu:blanc:rouge bleu blanc rouge est né. Deuxième adoption en 1812 et dernièrement confirmation le 5 mars 1848.
La cocarde tricolore
Le drapeau de la France, drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, également appelé "drapeau ou pavillon tricolore", est l’emblème national de la République française. Il est mentionné dans l’article 2 de la Constitution française de 1958. Ce drapeau de proportions 2:3 est composé de trois bandes verticales de largeur égale.
Il date de 1794 — dessiné par Jacques-Louis David qui vécut de 1748 à 1825 à la demande de la Convention — mais ses origines sont plus anciennes et remontent aux trois couleurs de la liberté défini le 14 juillet 1789, le bleu et le rouge pour les couleurs de Paris qui entourent le blanc de la royauté, identiques aux trois couleurs utilisées par les différents pavillons français d'Ancien Régime. Le drapeau tricolore est le pavillon officiel de la France depuis 1794 et le drapeau officiel des armées depuis 1812, à l’exception des périodes de Restauration 1814-1815 et 1815-1830.
En bref
Le nombre des couleurs franches et héraldiques étant fort limité, la combinaison du bleu, du blanc et du rouge fut assez fréquente en France à travers les siècles. Des manuscrits à peintures ont utilisé la bande tricolore depuis Philippe V le Long 1316-1322 et surtout sous Charles V 1364-1380, mais ils ne sont pas tous d'origine royale. Par contre, le dauphin futur Charles VII 1419, Charles IX 1566-1570, Henri III et Henri IV 1591 ont eu la livrée aux couleurs vermeil, ou rouge, ou incarnat, blanc et bleu, ce dernier roi abandonnant sa propre livrée, de couleur tannée, laissée aux cadets princes de Condé comme ventre de biche ou feuille morte, le drapeau du régiment d'infanterie dit de Navarre fut à cette couleur. Louis XIII et les autres rois Bourbons gardèrent cette triade jusqu'en 1830. Le jésuite Ménestrier explique ainsi ces couleurs : La livrée des rois de France, branche de Bourbon, est tricolore : blanc, incarnat et bleu, le bleu à cause du fond des armes de France, ancienne couleur des rois, l'incarnat à cause du champ de gueules des armes de Navarre et le blanc parce qu'il est de temps immémorial la couleur propre de la nation autour de 1670. Le bleu dérive effectivement du champ d'azur des armes de France, provenant du manteau cosmique du sacre. Le rouge était en réalité la couleur de l'oriflamme, du drapeau rouge à croix blanche servant depuis le XVe siècle, du pavillon des galères, des brisures des princes cadets sur l'écu royal. Henri IV, déjà roi de Navarre ayant ainsi des chaînes d'or sur champ de gueules, unit tout cela sur sa cornette des couleurs et livrées, deux fois rayée horizontalement de tricolore, sa devise brochant. Le blanc était le champ de l'écu à croix rouge des Français sous les croisades, symbole pris par la suite en Angleterre ; on sait que les bandes de Du Guesclin allant en Castille venger la mort de la reine Blanche de Bourbon s'ornaient de croix blanches, d'où le surnom de compagnie blanche 1366. Vers la fin de la guerre de Cent Ans, le blanc devint officiellement la couleur de la croix des Français, de l'étendard fleurdelisé d'or du Roi du Ciel porté par sainte Jeanne d'Arc. La France est représentée comme une femme en robe blanche fleurdelisée d'or dans Les Vigilles de Charles Septiesme de Martial de Paris 1484. Au XVIe siècle, le blanc devint couleur de commandement pour celui qui agissait au nom du roi. Il est par ailleurs certain que la livrée de celui-ci se voyait partout à la cour, que de nombreux uniformes, dont celui des gardes-françaises, étaient tricolores, que des musiques régimentaires portaient, elles aussi, cette livrée, etc.
Le pouvoir municipal révolutionnaire de Paris créa, le 13 juillet 1789, une nouvelle milice parisienne à cocarde bleu et rouge, antiques couleurs de Paris, dès 1358, l'écu de la ville montrait un bateau d'argent sur champ de gueules sous un chef d'azur fleurdelisé d'or. Nul ne sait cependant qui fabriqua des dizaines de milliers de cocardes où le blanc du roi et de la nation fut ajouté dès le 15 juillet suivant. Venu le 17 à Paris, Louis XVI reçut des mains du maire Bailly une cocarde qu'il plaça à son chapeau : elle était certainement tricolore, et il se peut que La Fayette ait inventé ce symbole en devenant, le 15, commandant général de la milice parisienne, dont le règlement du 27 suivant ratifia la cocarde.
Emblème du tiers état ou, mieux, couleurs de la liberté, la cocarde se répandit immédiatement dans une France en proie au désordre, et ne pas la porter pouvait être signe de mise à mort immédiate. Louis XVI la rendit obligatoire à tous 1790 et abolissait ainsi les cocardes blanches ou noires de l'armée. Il est certain qu'à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, on vit des drapeaux rayés horizontalement blanc en haut, rouge et bleu, mais on trouva par la suite que le blanc devait séparer les deux autres couleurs, ce qui se vit dès 1791 sur les nouveaux drapeaux d'infanterie, où le canton, angle de l'écu supérieur près de la hampe eut ses bandes horizontales bleu en haut, blanc et rouge. On vit à terre, durant une bonne partie de la Révolution, des drapeaux tricolores aux bandes horizontales. Cependant, l'Assemblée nationale constituante voulut, en 1790, que la marine eût un pavillon blanc agrémenté dans le coin supérieur proche de la hampe d'un rectangle tricolore aux bandes verticales, rouge près de la hampe, lequel rectangle servait, seul, comme pavillon de beaupré. La verticalité des bandes fut une véritable révolution due au fait qu'on ne voulait pas qu'il y ait confusion à la mer avec le pavillon des Provinces-Unies des Pays-Bas, tricolore aux bandes horizontales.
En 1794, les marins réclamèrent un nouveau pavillon où il n'y eut que les trois bandes et la Convention nationale décréta le 15 février, 27 pluviôse an II que le bleu serait à la hampe ; ce nouveau pavillon devait être arboré le 20 mai, 1er prairial. Ainsi naquit l'actuel drapeau national, bien que rien n'ait été décidé pour le pavois à terre. Les armées de la Révolution, du Consulat puis de l'Empire accommodèrent de diverses manières les trois couleurs, et il fallut attendre 1812 pour que les drapeaux, étendards et guidons aient les trois bandes verticales, à l'image du drapeau qui flottait au-dessus du pavillon central des Tuileries quand Napoléon Ier y résidait, c'est vers 1793 que l'on mit un drapeau tricolore en cet endroit, car la Convention siégeait à côté.
Mouchoirs, drapeaux et cocardes de couleur blanche apparurent à Paris dès le 31 mars 1814 ; le 9 avril, le gouvernement provisoire décida que la garde nationale prendrait la cocarde blanche alors que le drapeau blanc fleurissait partout en une France occupée et passant aux Bourbons. Apparus le 27 juillet 1830 à Paris, la cocarde et le drapeau tricolores furent légalisés les 1er et 6 août par le lieutenant général duc d'Orléans et inscrits dans la charte du 14 suivant, art. 67. Le drapeau tricolore, contesté par des révolutionnaires de 1848 et par la Commune parisienne de 1871 ne variera plus jusqu'à nos jours. Toutefois la marine nationale utilise depuis le milieu du XIXe siècle un pavillon aux bandes de largeurs inégales, le vent pliant l'étoffe et l'usure diminuant le rouge : pour un battant, longueur du rectangle de 100, il y a donc 30 pour le bleu, 33 pour le blanc et 37 pour le rouge. La Constitution de 1946, art. 2, fut la première à évoquer le drapeau tricolore, les bandes verticales étant d'égales dimensions, mais celle de 1958, art. 2, élimina cette précision.
Utilisation des trois couleurs sous la Royauté
Les emblèmes utilisés reflétaient les trois ordres traditionnels de la société, avec :
une bannière religieuse qui fut d'abord l'oriflamme de saint Denis puis la bannière de Jeanne d'Arc ou de saint Michel ;
un étendard royal ou seigneurial, en l'occurrence les fleurs de lys sur fond bleu puis la cornette blanche également adoptée par la flotte ;
un signe de reconnaissance pour les fantassins qui fut d'abord la croix rouge sur fond blanc puis la croix blanche sur fond souvent bleu, comme pour le pavillon de la marine marchande.
Rouge
Oriflamme, L'oriflamme d'Hugues Capet
La couleur rouge est la couleur de la bannière de l'abbaye de Saint-Denis élaborée en 1124 par Suger, père de la patrie. Ce rouge symbolise le martyre de saint Denis, premier évêque de Paris. Les comtes du Vexin la portaient à la guerre en tant qu'avoués de cette abbaye royale fondée par Dagobert Ier. Quand, en 1077, Philippe Ier réunit le Vexin français au domaine royal, le roi hérite de cette charge de porte drapeau et de défenseur militaire de l'abbaye. Le gonfalon rouge, porté par le dapifer, figurera désormais au côté de la propre bannière de France. Usurpé par les prétendants anglais au trône de France, le port de la bannière de saint Denis est abandonné par Charles VII au profit de l'étendard de saint Michel.
La bannière de saint Denis est appelée dès les alentours de 1170 oriflamme, du nom de l'étendard que la Chanson de Roland attribue à Charlemagne. Plus qu'une légitimité à succéder aux carolingiens, l'oriflamme devient le signe de la mission divine du roi capétien. Une oraison funèbre écrite en 1350, reprise par une Chronique universelle du début du xve siècle, mentionne la légende que Clovis l'a reçue de Dieu.
La Vraie Croix portée par Saint Georges
Les Français arboreront une croix rouge sur fond blanc pendant les croisades. Le drapeau sera confisqué en 1283 aux Gallois et arborée par les Anglais ensuite.
Le 13 janvier 1188, lors d'une entrevue à Gisors, l'archevêque latin de Tyr exhorte le roi de France Philippe II, le roi d'Angleterre Henri II et le comte de Flandre Philippe Ier à secourir la Terre sainte. Une nouvelle croisade est organisée. Il est convenu que les Français arboreront une croix rouge sur fond blanc, les Anglais une croix blanche sur fond rouge, et les Flamands une croix verte sur fond blanc.
Denier de Gènes émis à partir de 1139. L'avers, comme sur le genovino, montre l'insignia cruxata comunis Janue, qui figure à partir de 1218 en rouge sur le champ blanc du drapeau de la ville.
Cependant, aucune de ces bannières ne véhiculent alors de signification nationale. La croix rouge est un insigne du Christ et d'une mission que la tradition attache au souvenir du pape Gélase armant les cités contre l'envahisseur ostrogoth, l'arien Théodoric. La porter est un honneur auquel chaque militaire peut prétendre en formant un vœu. Identifiée à saint Georges combattant le dragon, elle avait déjà été brandie en juin 1063 pour encourager les troupes de Roger de Hauteville à la bataille de Cerami face aux Sarrazins de Sicile. La bannière de Saint Georges apparait de nouveau en décembre 1096 à la bataille d'Alcoraz contre les Maures d'Al Andalus puis deux ans plus tard au siège d'Antioche.
Elle est adoptée par plusieurs des communes qui se développent dans la plaine cisalpine8 comme signe de la légitimité de leur franchise face à l'Empereur. Milan en fait une de ses bannières, son Vexillum publicum, arboré au carroccio de 1160. Quand à Gisors le pape la transmet au roi Philippe, l'intention du premier est donc clairement d'inscrire le second dans ce qui deviendra le parti guelfe. Être pour la croisade, c'est aussi être pour le pape. Les navires génois, qui transportent les croisés, arborent la croix de Saint Georges. En 1218, l'insignia cruxata comunis Janue, enseigne à la croix de la Commune de Gênes, est pavoisée dans la cité de Vintimille conquise et devient l'emblème de la République maritime.
C'est donc à quelle puissance reviendra l'honneur de porter l'étendard de Saint Georges. Après avoir capturé le 22 juin 1283 dans les tourbières du mont Bera, le dernier prince des Galles indépendantes, David ab Gruvuz en fuite depuis la défaite du pont sur l'Irvon, puis l'avoir exécuté hanged, drawn and quartered à Shrewsbury le 3 octobre, le roi d'Angleterre Edouard organise pour lui et sa famille à Londres un triomphe qui se déroule en mai 1285. Au cours des cérémonies, est exposée à Westminster, parmi les autres regalia du défunt roi gallois Léolin l'Ultime que l'abbé de Cymer de Huw ab Izhel avait remises deux ans plus tôt au vainqueur, la couronne du roi Arthur et la croix de Nuz, réputée être du bois de la Vraie Croix. C'est alors que la croix rouge, symbole de la Vraie Croix toute entière, est choisie par l'Angleterre à son tour. L'Ordre de la Jarretière11, créé vers 1348, la diffuse comme l'emblème de sa puissance étendue sur le Pays de Galles et l'Écosse, assujettie en 1296 à la suite de la bataille de Dunbar et le transfert à Westminster de la Pierre du destin.
Or ces deux pays vont devenir des pièces dans le jeu politique de la France en lutte contre son ennemi héréditaire. En 1326, le roi de France Charles le Bel, qui avait pourtant participé deux ans plus tôt à une expédition contre l'Écosse, conclut avec elle le traité de Corbeil qui renouvelle l'Auld Alliance. En 1335, son successeur Philippe de Valois envoie à son alliée une armée commandée par Raoul de Brienne. En vertu du traité de 1213 signé entre Philippe Auguste et Léolin le Grand, le roi de France Charles le Sage soutient de 1363 à 1372 les prétentions d'Yvain Main Rouge sur le royaume de Galles. Dès le début de la guerre de Cent Ans, les villes gasconnes se ralliant au Prince Noir arborent la croix de Saint Georges. Quand quatre-vingt-deux ans plus tard, le 1er décembre 1420, les Anglais s'emparent de Paris, de Saint-Denis et de son oriflamme, le rouge de la croix de Saint Georges, que portaient les français deux siècles et demi plus tôt, est fixé définitivement comme la couleur de l'ennemi des fidèles au Dauphin. Repliés à Bourges, ceux-ci choisissent alors d'arborer une croix blanche et de se donner pour patron Saint Michel.
Les galères
Le rouge fleurdelysé d'or a été choisi comme étendard des galères royales alors que les vaisseaux royaux arboraient le blanc ou parfois le blanc fleurdelysé d'or.
Bleu
La même recouvrant les fidèles de son manteau désormais bleu. La tunique est traditionnellement rouge. Memmi, Orvieto, mi xive. Le pallium chrétien
Dès l'Antiquité, le rejet de la toge pour le pallium a togo ad pallium signe le vœu de se retirer du monde. Tertullien instaure cette coutume dans la tradition chrétienne. À partir du XIIe siècle, apparaissent de nouveaux pigments, le pastel pour les vêtements, l'outremer véritable pour la peinture, dont l'emploi est un signe de richesse tant sa fabrication est coûteuse. Ce n'est qu'alors que le bleu cosmique est associé au manteau des saints, peut être par opposition à la pourpre de la toge impériale. L'azur devient un symbole de grandeur spirituelle.
C'est la couleur du manteau de la Vierge, qui abandonne ses vêtements de deuil sombres1 peints jusqu'alors en noir ou gris foncé. C'est également celle qui est désormais attribuée à la chape de Saint Martin.
À l'époque carolingienne, la tradition est déjà établie que cette relique, dont aucune source directe antérieure au xiie siècle ne précise la teinte, est utilisée comme palladium par Clovis. Si elle a été portée par les rois mérovingiens dans la guerre quasiment comme un artifice magique15, elle le sera par les capétiens au moment du sacre. C'est la raison pour laquelle ils portent un manteau à fond bleu au cours de cette cérémonie.
Armorial capétien des rois de France avant 1376 et des rois de France après 1376
Le bleu de France
C'est donc au début du règne des capétiens que la chape de Saint Martin se colore en bleu. Le bleu est ainsi intimement associé aux rois de France et figure très tôt dans leurs armoiries fleurdelisées, dont l'usage militaire apparait au xiie siècle. Revêtir la chape de Saint Martin est le symbole de la légitimité que confère l'Église au roi, en particulier au moment du sacre, et réciproquement de la politique de la France capétienne, fille aînée de l’Église, s'appuyant sur les évêques et le pape.
La couleur d'azur est en particulier celle des armes des branches cadettes de la famille royale, par exemple celles de Raoul Ier de Vermandois, échiqueté d'or et d'azur, entre 1135 et 1145.
Blanc
Croix blanche de Saint Michel, opposée à la croix rouge des Anglais, sur fond bleu, couleur de la chape de Saint Martin et des capétiens. La guerre de Cent Ans l'érige en drapeau militaire de la France et Croix de Saint Michel
Les croisades instaurent la coutume de se distinguer au combat par des croix de couleurs différentes, croix qui pour des raisons pratiques se réduisent bien souvent à des doubles sautoirs. À la croix guerrière, est associée la figure de Saint Michel capitaine des armées célestes. Invoquer pour son camp l'archange combattant Satan est une manière d'insulter son ennemi sinon de l'envoyer symboliquement au diable. À partir de 1300, au cours des campagnes de Flandre, les armées royales prennent l'habitude d'arborer sous l'invocation de Saint Michel une croix blanche, d'abord en bande ou en croix latine. À la bataille de Mons-en-Pévèle en 1304, la tactique prévaut sur le symbole, la couleur sur la forme, et les chevaliers français se ceignent avant de partir au combat d’écharpes blanches de rencontre pour servir de signe de ralliement juste avant la charge.
La guerre de Cent Ans est l'occasion d'exalter le symbole de la croix blanche, opposée à la croix rouge d'Angleterre. En 1355, Jean Ier d'Armagnac, exige de ses soldats de porter une croix blanche sur la frontière de Guyenne. Durant l'été 1417, devant la menace des troupes anglaises d'Henri V qui combattent avec l'emblème de la croix rouge, les habitants d'Orléans en état de prendre les armes reçoivent l'ordre de porter notamment une heuque bleue marquée sur la poitrine d'une croix blanche.
En 1418, le dernier fils de Charles VI, devenu le dauphin l'année précédente, adopte sur ses étendards l'image de saint Michel armé terrassant le dragon et fait de l'archange le protecteur de la France. L'emblème des combattants français est dès lors appelé la croix blanche de saint Michel, symbole de lumière opposé au rouge sang et, réciproquement, l'archange fut représenté avec cette croix. Cette opposition entre croix rouge anglaise et croix blanche française s'insinue dans les conflit annexes, comme celui entre Armagnacs et Bourguignons : les seconds, alliés des anglais, portent le sautoir écoté rouge sur fond blanc, tandis que les premiers, farouchement opposés aux Anglais, reprennent la croix blanche et l'écharpe assortie. En 1449, Mauléon est prise aux partisans des Plantagenêt et ses défenseurs doivent pour leur soumission troquer leurs croix rouges avec des croix blanches. En 1451, le croix blanche de Saint Michel apparait dans le ciel de Bayonne conquise, le 20 août26, lendemain de bataille, et convainc les vaincus de changer leurs couleurs et rallier le parti Valois.
Symbole de sainteté
Dès la naissance de l'héraldique, à la fin du Moyen Âge central, le métal argent se confond avec l'acier de l'écu, c'est-à-dire une absence de couleur. Lancelot, parce qu'il est de père inconnu, est le chevalier aux blanches armes. Cette naissance le place hors des querelles familiales que tranche le combat ordalique et en fait un candidat au titre de champion de Dieu, finalement remporté par Perceval. Le jugement de Dieu ne peut que lui donner la victoire, qu'il remporte à tous coups tant qu'il n'agit pas par passion pour un intérêt terrestre.
L'étendard de la Pucelle au sacre du gentil dauphin. Il avoit esté a la peine, c'estoit bien raison qu'il fust a l'honneur.
Cette expression de l'élévation au-dessus de la condition humaine se retrouve dans la fourrure d'hermine, réservée au clergé. Elle s'affiche sur le blason du Royaume de Jérusalem et depuis 1808 celui du pape. Tous deux transgressent les règles ordinaires par l'enquerre d'un motif d'or sur l'argent.
C'est le choix que fait en 1429 Jeanne d'Arc pour sa bannière. Sur ordre de voix qu'elle attribue à Sainte Marguerite et Sainte Catherine, elle fait faire par un peintre de Tours un étendard blanc sur lequel figure au milieu Dieu tenant l'orbe entouré de deux anges, l'étendard du Roy du ciel. Sur le conseil de clercs, la devise franciscaine Jésus Marie y est inscrite sur le côté. Comme Dieu soutient le parti français, il est fleurdelysé d'or.
Signe du commandement royal
Sur les tuniques et les étendards, la croix blanche de Saint Michel devient le symbole de l'armée française et le reste jusqu'à la Révolution.
Le 1er octobre 1544, François Ier, tirant les leçons de la bataille de Cérisoles, procède à une réforme de l'infanterie en créant la charge de colonel général sous le commandement unique duquel sont placées toutes les compagnies franches, qui étaient, aux côtés des Cent-Suisses et des troupes de garnison, les seules unités de fantassins, la Garde écossaise et les compagnies d'ordonnance sont montées. Elles étaient composées de conscrits enrôlés par les milices municipales et mises à disposition du roi en échange d'une exemption de taille pour ses soldats. À ce titre, ces bandes portaient des étendards propres.
Coligny ajoute à sa fonction de colonel général, que le roi Henri II lui confie le 29 avril 1547, celle de nommer les capitaines de compagnies. Il crée alors deux compagnies colonelles, qui sont entièrement recrutées et dirigées par ses lieutenants. En 1552, Andelot succède à son aîné nommé Amiral et procède à une réorganisation qui aboutit en 1558, à travers un intérim exercé par Montluc, à la création des régiments. Ceux-ci sont des réservoirs administratifs rassemblant derrière une compagnie colonelle commandée par un lieutenant-colonel un nombre de bandes variable selon le moment, dont l'ordre de bataille est adapté selon les circonstances. Les bandes conservent leurs enseignes à l'origine des drapeaux d'ordonnance des régiments et les compagnies colonelles, ou premières compagnies, arborent réglementairement un drapeau blanc, le drapeau colonel.
À la différence des régiments de cavalerie, qui adopteront le plus souvent sous Louis XIV un motif de soleil d'or, les régiments de troupes de ligne adoptent tous la croix blanche, qui est, avec le drapeau entièrement blanc de leurs colonels, leur seul point commun.
Panache blanc
Le blanc est la couleur traditionnellement associée à la monarchie française, à tel point qu'après la Révolution, elle incarnera le monarchisme traditionnel. Cette association ne date que de la fin du XVIe siècle, même si elle continue une série de traditions plus anciennes. Elle provient de l'adoption par Henri IV de l'écharpe blanche le fameux panache blanc comme signe distinctif des armées royales par opposition à celles, rouges ou vertes, des Espagnols et des Lorrains. Il faisait en fait de la couleur du parti huguenot, auquel il avait appartenu avant son accession au trône, celle de la France. Ses successeurs prendront soin de taire cette origine protestante pour insister au contraire sur son caractère catholique.
Après les guerres de Religion et la décision d'Henri IV d'adopter le blanc huguenot comme couleur de ralliement, l'écharpe puis le drapeau blanc devinrent les symboles du royaume de France. Le blanc était plus spécifiquement la couleur du commandement militaire, les officiers ayant des écharpes plus voyantes afin d'être repérables par leurs hommes. Les colonels des régiments avaient des drapeaux blancs à croix blanche, adaptation des drapeaux d'ordonnance de leur unité où les quartiers de couleur étaient remplacés par des quartiers blancs. Commandant suprême des armées, le roi était accompagné d'un drapeau blanc sur les champs de bataille. Le blanc a ainsi été d'Henri IV à 1790 la couleur du drapeau royal Les successeurs d'Henri IV, luttant contre le particularisme religieux des protestants, turent cette origine pour donner au blanc une nouvelle signification. La couleur humble et pure des huguenots était ainsi remplacée par celle de la vierge Marie, sous la protection de laquelle Louis XIII plaça le royaume.
Pavillon de marine moderne
Couleur militaire, le blanc fut réservé à partir de 1638 aux vaisseaux de guerre de la marine royale. Les galères utilisaient des pavillons rouges. Les navires marchands devaient se contenter des drapeaux bleus à la croix blanche surnommés alors ancien pavillon de France. C'est un de ces anciens pavillons, arboré par le bateau de Samuel de Champlain qui donna naissance au drapeau du Québec.
Naissance du drapeau : l'association des trois couleurs
Les couleurs de Paris
Au milieu du XIVe siècle, Étienne Marcel, riche drapier devenu prévôt des marchands de Paris adopta comme couleurs le bleu et le rouge, qui devinrent alors la marque de ses partisans et de l'Échevinage. Maître de la capitale, il profita de la captivité du roi Jean le Bon pour tenter d'imposer des réformes au dauphin Charles de manière unilatérale. Le 22 février 1358, il prit d'assaut le palais royal de l'île de la Cité avec ses hommes, qui massacrèrent deux maréchaux du dauphin sous les yeux de celui-ci ; Marcel mit alors son chaperon bleu et rouge sur la tête du jeune régent devenu son otage. Après la mort du prévôt, le bleu et le rouge se confondirent avec les couleurs du blason parisien modifié par le roi, le chef fleurdelysé placé définitivement au-dessus de la nef d'argent à partir du sceau de 1426.
Sacre de Philippe-Auguste, des Grandes Chroniques de France de Charles V, XIVe siècle, qui retracent l'histoire des rois de France. Les enluminures ont une bordure tricolore.
Une caractéristique des productions de l'Île-de-France du XIVe siècle
De nombreux manuscrits comportent des miniatures avec un encadrement tricolore, caractéristique des productions de l'Île-de-France du XIVe siècle. Les trois couleurs associées sont par ailleurs les couleurs du roi de France depuis le Moyen Âge.
Le parchemin Les Décades de Tite-Live, traduit par Pierre Bersuire et illustré par l'atelier du Maître des boqueteaux au milieu du xive siècle raconte l'histoire de Rome. Il s'agit de la traduction de Tite-Live que Jean le Bon confia à Bersuire, prieur de Saint-Eloi de Paris, et qu'il exécuta de 1352 à 1359. Le manuscrit comporte 109 miniatures dont l'encadrement tricolore caractérise les productions de l'Île-de-France du XIVe siècle. Elles se raccordent plus ou moins bien au texte et représentent en fait un tableau de la société française de cette époque. En effet, les types de vêtements et d'armures sont caractéristiques du règne de Charles V 1364-1380.
Les armoiries du Royaume de France utilisées jusqu'à la Révolution. Le blason de Navarre y figure depuis qu'Henri, roi de Navarre, était devenu roi de France sous le nom d'Henri IV.
Les couleurs du roi de France depuis le Moyen Âge
Plusieurs rois de France ont utilisé le bleu, le blanc et le rouge associés dans leur livrée. C'est par exemple le cas de Charles V ou de Charles IX. D'autres, comme Charles VII utilisaient des combinaisons proches de celle-ci où le vert remplace le bleu. À partir d'Henri IV 1589-1610, le personnel domestique placé sous l'autorité du roi de France fut habillé d'une livrée blanche ornée de bleu et de rouge. Les Gardes-Françaises, créés pour assurer la sécurité du roi, avaient en effet adopté les trois couleurs sur leur uniforme et l'emblème de leur régiment. Elles les conservent après la Révolution, en devenant la Garde nationale.
Henri IV avait même recommandé les trois couleurs bleu, blanc, rouge aux ambassadeurs des Provinces-Unies, indépendantes de fraîche date, qui en ont fait leur drapeau. Le rouge fut toutefois initialement remplacé par l'orangé, couleur de la Maison d'Orange, avant de réapparaître parmi les couleurs néerlandaises.
À partir d'Henri IV, chaque souverain de la dynastie des Bourbons se titrait roi de France et de Navarre et utilisait un écu mi-parti bleu et rouge aux armes des deux royaumes.
Les couleurs d'Outre-Mer
À la fin du XVIIIe siècle, les soldats britanniques et les miliciens américains portaient une cocarde noire, notamment contre les défenseurs français du Canada durant la guerre de Sept Ans. Avec la Déclaration d'Indépendance des États-Unis, les insurgés gardèrent la même cocarde, mais à l'arrivée en 1780 des troupes de Rochambeau utilisant la cocarde blanche, il fut convenu avec Washington que les troupes alliées porteraient une union cockade noire et blanche.
Selon Michel Pastoureau, jusqu'en 1789, le bleu et rouge ne représentait que marginalement la ville de Paris, pour laquelle on utilisait beaucoup plus le rouge et tanné rouge-marron. La combinaison du bleu du blanc et du rouge avait connu un regain de faveur depuis que la France avait aidé les États-Unis à obtenir leur indépendance (les couleurs de la nouvelle nation reprenant celles de la Grande-Bretagne. À partir des années 1770 en France et en Europe, tous les sympathisants de la cause des libertés arborèrent du tricolore, tout comme à la cour.
Un siècle plus tard, les insignes des avions britanniques sont copiés sur les cocardes françaises, en inversant les couleurs, tandis que les drapeaux de New York et de certains États s'inspireront du tricolore de l'Hexagone.
Pour autant, la naissance du drapeau français reste un sujet mal étudié et controversé.
Monarchie constitutionnelle, République, Ier Empire
Les cocardes révolutionnaires Cocarde tricolore.
Le dimanche 12 juillet 1789, dans les jardins du Palais-Royal, Camille Desmoulins prit une feuille verte et la plaça à son chapeau. Il incita la foule à en faire autant : ce geste signifiait une mobilisation générale. Rapidement, on s'aperçut que le vert était la couleur du très impopulaire comte d'Artois futur Charles X et on s'empressa de remplacer les cocardes vertes par des cocardes de différentes couleurs, souvent blanches ou rouges. Après la prise de la Bastille, les cocardes bleu et rouge devinrent populaires parce qu'elles étaient celles de la garde municipale parisienne. On a dit aussi que deux Gardes-Françaises avaient été portés en triomphe dans tout Paris pour avoir été les premiers à pénétrer dans la Bastille : leur uniforme était tricolore.
Durant la Révolution, les combattants de Paris arboraient donc une cocarde bleu et rouge, couleurs de la ville. Quelques jours après la prise de la Bastille, La Fayette eut l'idée d'intégrer le blanc symbole à l'époque du royaume de France dans cette cocarde qui remporta tout de suite un vif succès. Il est possible que La Fayette, qui venait de combattre aux côtés des insurgés américains, vit dans les trois couleurs une réminiscence de la cocarde américaine avec laquelle il avait combattu. Le vendredi 17 juillet 1789, Louis XVI se rendit à l’hôtel de ville de Paris où il reçut la cocarde tricolore au milieu de la Révolution en armes. Il est possible que l'association du bleu-rouge et du blanc signifiait, en ce jour, la reconnaissance par le roi de la garde municipale parisienne comme unité officiellement reconnue des forces armées de la France.
Les couleurs bleu, blanc, rouge étaient depuis longtemps employées ensemble ou séparément comme symbole de l'autorité de l'État en France. Mais une cocarde n'était qu'un signe d'appartenance à une unité militaire : ce n'était pas encore un emblème national.
Dans les textes de 1789, le blanc n'est pas désigné comme couleur du roi mais comme couleur de la France ou du royaume. Ce n’est que plus tard que cette couleur a été désignée comme couleurs du roi, la couleur du royaume étant celle du roi. Le blanc était considéré comme la couleur française et non pas celle du roi, la preuve en est que la République, en 1792, ne songea même pas à supprimer le blanc des trois couleurs.
L’Assemblée nationale dans son décret du 20 mars 1790 décida que lorsque les officiers municipaux seront en fonction, ils porteront pour marque distinctive une écharpe aux trois couleurs de la nation : bleu, rouge et blanc.
Les bannières tricolores
La cocarde donna spontanément naissance à des drapeaux tricolores, le plus souvent à bandes horizontales, comme ceux blanc-rouge-bleu installés au-dessus de la tribune de la Fête de la Fédération le 14 juillet 1790.
En 1765, les armateurs civils avaient obtenu officiellement le droit de faire flotter sur leurs bateaux le pavillon blanc du roi (celui des vaisseaux de guerre) au lieu de leurs nombreux drapeaux bleu et blanc ; ainsi pour la première fois dans l'histoire, tous les bâtiments d'un même pays — qu'ils soient marchands ou militaires — purent arborer un même pavillon national.
En octobre 1790, l'assemblée constituante se pencha sur la nécessité ou non de créer un nouveau pavillon national. Les traditionalistes voulaient conserver le pavillon blanc ancré dans l'histoire de la marine et refusaient de copier le drapeau néerlandais. Le baron Jacques-Francois de Menou, futur général Abdallah Menou défendit lui l'idée d'adopter un nouveau pavillon tricolore, et le marquis de Mirabeau appuya par principe le choix de ce qui était considéré comme les nouvelles couleurs nationales et celles de la liberté.
Le drapeau tricolore apparut aux armées à l'initiative du comte Henri de Virieu, représentant de la noblesse du Dauphiné aux États généraux. Il proposé à l'Assemblée nationale, le 20 octobre 1790, de charger le pavillon maritime d'un carton bleu, blanc, rouge afin qu'à la couleur qui fut celle du panache d'Henri IV se joignît celle de la liberté reconquise; dans son sillage, le duc de Choiseul-Praslin proposa qu'une cravate analogue fût accrochée aux drapeaux de l'armée de terre.
Le 21 octobre, l'Assemblée décida que le pavillon national serait blanc avec un quartier tricolore, les détails furent renvoyés au comité de marine. L'ordonnance du 24 octobre 1790 créait : 1° un pavillon de beaupré, pour les cérémonies officielles, à l'avant des navires de guerre à trois bandes verticales rouge blanche et bleue, 2° un pavillon ordinaire de poupe ; ce dernier était blanc, couleur de la France, et il portait un canton à trois bandes verticales rouge, blanche et bleue. Le canton rectangulaire était entouré d'un liseré blanc à l'intérieur et bordé à l'extérieur d'un liseré bleu à la hampe et rouge vers la partie flottante; ce second liseré était destiné à séparer les deux parties blanches du pavillon. C'est le premier emblème national tricolore.
C'est pour un second pavillon national tricolore adopté le 15 février 1794 décret du 27 pluviôse an II que la disposition actuelle « bleu au mât, blanc au centre, et rouge flottant a été imaginée. L'idée est due au peintre Jacques-Louis David. Ce changement de pavillon, qui devint effectif sur les vaisseaux à partir du 20 mai 1794 1er prairial an II, avait été effectué à la demande des marins de la flotte de guerre. Ils menaçaient en effet de se révolter parce que le pavillon national de 1790 accordait trop de place à l'uniforme de leurs officiers le blanc et trop peu au leur, la tenue bleue à ceinture rouge.
Deuxième pavillon national adopté par la Convention, le 15 février 1794
Le pavillon de marine fut ensuite adopté comme drapeau national ; il était installé au palais des Tuileries quand le premier consul Bonaparte y prit résidence le 19 février 1800.
Les drapeaux de l'armée de terre dès 1791, comme ceux de la garde nationale à partir de 1789, offerts par les quartiers de Paris, portent les trois couleurs, mais de diverses façons fantaisistes selon l'usage de l'époque. Ainsi, à la bataille du Pont d'Arcole, Napoléon Bonaparte brandit un étendard blanc ayant un faisceau du licteur doré au centre, et quatre losanges bleus et rouges dans les angles. Cette variété est conforme à la tradition des drapeaux. Elle est visible dès les origines, une cocarde, dont les couleurs étaient diversement superposées et non accolées dans un ordre uniforme.
Sous Napoléon Ier, les drapeaux des régiments avaient souvent une croix blanche cantonnée de rouge, de bleu ou de vert. Les dessins variaient d'un régiment à l'autre.
Une première uniformisation des drapeaux régimentaires date de 1804 : carré blanc sur la pointe au centre et triangles alternés bleus et rouges dans les coins, inscriptions dorées au centre. Ils portait le nom d'aigles, par référence à celles imitées de l'Empire romain qui couronnaient la hampe.
Le dessin à bandes verticales des pavillons est adopté pour les drapeaux de l'armée de terre en 1812, avec inscriptions dorées sur le blanc.
Comment s'est imposée la bannière tricolore :
La Restauration rétablit en 1814 le drapeau blanc.
En 1793, les couleurs dites nationales, bleu foncé, blanc et rouge remplacent l'habit de l'infanterie de ligne. Voulant rompre avec les souvenirs napoléoniens, Louis XVIII, le 15 juillet 1815 supprime les régiments, crée des légions départementales qu'il habille en blanc et abolit la conscription. L'ordonnance du 23 octobre 1820 transforme les légions en 60 régiments de ligne et 20 légers et rend au fantassin l'habit bleu. Avec un pantalon bleu, l'infanterie combat en Espagne et en Morée. En 1829, est adopté le pantalon rouge pour débarquer à Alger en 1830.
Louis-Philippe, qui a combattu à Valmy et à Jemmapes, restaure en 1830 sous la Monarchie de Juillet le drapeau tricolore, ainsi que la cocarde. La hampe s'orne d'un coq.
La Révolution de 1848 pencha un moment pour le drapeau rouge, en référence au drapeau rouge arboré par la garde nationale en cas d’instauration de la loi martiale, invention de la Révolution française. Le drapeau rouge signe de la loi martiale fut utilisé le 17 juillet 1791 quand la Garde nationale ouvrit le feu sur une manifestation au Champ de Mars. Le drapeau symbole de la répression du peuple insurgé est repris par celui-ci comme emblème. Cette inversion de sens du drapeau rouge relève d’un processus classique de la création et de l’appropriation des symboles. Le groupe ou la population en question prend comme emblème le symbole même de sa répression. Le drapeau rouge a par la suite été choisi par les résistants au coup d’État de 1851, puis par la Commune de Paris en 1871 et par les bolchéviques lors de la révolution de 1917.
Cependant, le poète Lamartine, né le jour de l'adoption du nouveau pavillon impose le drapeau tricolore comme drapeau de la Seconde République issue de la Révolution de 1848. Dans une harangue à la foule en 1848, le poète défendit le drapeau bleu-blanc-rouge, arguant qu'il a fait le tour du monde avec la République et l'Empire, alors que le drapeau rouge n'a fait que le tour du Champ-de-Mars dans le sang du peuple. Le coq ornant la hampe est abandonné pour le fer de lance, toujours repris depuis.
En 1873, le retour à la royauté échoua à cause du refus intransigeant du prétendant légitimiste au trône de France, Henri d'Artois, comte de Chambord, d’accepter le drapeau tricolore. Il exigeait au contraire le retour au drapeau blanc de l’Ancien Régime. Par le manifeste du drapeau blanc du 5 juillet 1871 réitéré par lettre le 23 octobre 1873, il refuse d'abandonner le drapeau blanc pour le drapeau tricolore, héritage de la Révolution, ruinant les espoirs d'une restauration monarchique rapide Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d'Henri IV. Charles Maurras écrira plus tard : il a été prêtre et pape de la royauté plutôt que roi.
En Vendée, pays de tradition royaliste, légitimiste, il fallut attendre 1916 pour que le drapeau tricolore fût admis dans l'enceinte des églises, voir Union sacrée et Claire Ferchaud.
Évolution du drapeau dates
*Monarchie : XIIe siècle-XVIIe siècle, rien n'est fixé ; les rois, princes et capitaines utilisent chacun leurs propres enseignes et en changent souvent. La bannière fleurdelisée est ce qui se rapproche le plus d'un drapeau national stable.
*indifférent : XVIIe siècle-179O, rien n'est fixé, mais des patrons généraux s'imposent dans la pratique autour du drapeau blanc. Les colonels des régiments utilisent des drapeaux blancs à croix blanche et la marine de guerre utilise le pavillon blanc.
*Monarchie constitutionnelle : 1790 - 10 août 1792 Il n'y a pas de drapeau national Premier pavillon national :
*Pavillon de beaupré: Décret des 21-23 octobre 1790 : Le pavillon de France portera les trois couleurs nationales, suivant les dispositions et la forme que l'Assemblée nationale charge son comité de la marine de lui proposer.
*Décret de l'Assemblée constituante des 24-31 octobre 1790 : est fixée la disposition des couleurs dans les différents pavillons des vaisseaux de guerre et des bâtiments de commerce : le rouge tenant au bâton, le blanc au milieu et le bleu à l'extrémité.
*Décret du 5 juillet 1792 : l'art. 16 prescrit à tout homme résidant ou voyageant en France de porter la cocarde nationale ; toute autre cocarde est considérée comme un *signe de rébellion, et tout individu qui s'est revêtu à dessein d'un signe de rébellion est puni de mort.
*Première République 22 septembre 1792-18 mai 1804 Il n'y a pas de drapeau national Décret du 27 pluviôse an II 15 février 1794 : le pavillon national sera formé des trois couleurs nationales, disposées en bandes verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs.
*Premier Empire 18 mai 1804-1812 Le premier drapeau national arbore un grand carré blanc posé sur une pointe et cantonné de bleu et de rouge. Le pavillon national reste identique au modèle de 1794
*Aigle 1804, Ordonnance impériale uniformisant les drapeaux de tous les régiments.
*Premier Empire 1812-6 avril 1814 Aigle 1812 Ordonnance impériale adoptant, pour les drapeaux des régiments, le modèle du pavillon national de 1794.
*Première Restauration 6 avril 1814 - 1er mars 1815 Lys Acte du Gouvernement provisoire du 13 avril 1814 : Le Gouvernement provisoire, ouï le rapport du commissaire *provisoire du département de la marine, arrête, le pavillon blanc et la cocarde blanche seront arborés sur les bâtiments de guerre et sur les navires du commerce.
*Cent-Jours 1er mars 1815 - 18 juin 1815 Aigle Décret du 9 mars 1815 : rétablissement du pavillon tricolore.
Décret du 13-21 mars 1815 : abolition de la cocarde blanche, de la décoration du Lis, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Ordonne d'arborer *la cocarde nationale et le drapeau tricolore.
Décret des 9-12 mai 1815 : toute personne convaincue d'avoir enlevé le drapeau tricolore placé sur un monument public est punie conformément à l'art. 257 c. pén. art. 4,et les communes qui ne se sont point opposées à cet enlèvement seront poursuivies en exécution de la loi du 10 vend.an 4, relatif à la responsabilité des communes art. 5.
*Seconde Restauration monarchie constitutionnelle 8 juillet 1815 - 2 août 1830 Lys Loi du 9 novembre 1815 : déclare séditieux l'enlèvement du drapeau blanc et le port de cocardes non autorisées par le roi.
*Monarchie de Juillet monarchie parlementaire 9 août 1830 - 24 février 1848 Coq gauloisOrdonnance du 1er août 1830 : rétablissement des couleurs nationales.
Article 67 de la Charte constitutionnelle du 14 août 1830. -La France reprend ses couleurs. À l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.
*Deuxième République République 24 février 1848 - 5 mars 1848 Fer de lance Décret du 26 février 1848 : le drapeau tricolore est le drapeau national et les couleurs en seront rétablies dans l'ordre qu'avait adopté la République française.
Arrêté du 28 février 1848, signé du délégué de la République au Département de la Police, Marc Caussidière : Le drapeau bleu-rouge-blanc doit être arboré sans délai sur les monuments et établissements publics ». Cet ordre des couleurs est celui de la fête de la Fédération et des cocardes de l'Empire.
*Deuxième République 5 mars 1848 - 2 décembre 1852 Fer de lance Décret du 5 mars 1848 : Le pavillon, ainsi que le drapeau national, sont rétablis tels qu'ils ont été fixés par le décret de la Convention nationale du 27 pluviôse an II… En conséquence, les trois couleurs nationales, disposées en trois bandes égales, seront, à l'avenir, rangées dans l'ordre suivant: le bleu attaché à la hampe, le blanc au milieu et le rouge flottant à l'extrémité .
*Second Empire 2 décembre 1852 - 1er mars 1871 Aigle
*Troisième République République 4 septembre 1870 - 10 juillet 1940 Fer de lance
*Régime de Vichy 10 juillet 1940 - 20 août 1944 Fer de lance
*Gouvernement provisoire de la République française République 2 juin 1944 - 13 octobre 1946 fer de lance
*Quatrième République République 13 octobre 1946 - 27 septembre 1958 Fer de lance Article 2 de la Constitution. - L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions.
*Cinquième République République Depuis le 28 septembre 1958 Fer de lanceArticle 2 de la Constitution. - L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
Réglementation et usages Dimensions et couleurs
Pendant longtemps, les trois bandes n'avaient pas la même largeur, en effet les bandes du drapeau de Paris n'étaient pas de même largeur et cela s'est conservé sur le drapeau révolutionnaire, et parfois le mât était du côté rouge, parfois du côté bleu. C'est sur une décision de Napoléon Bonaparte, sur conseil du peintre Jacques-Louis David, que la réglementation actuelle a été établie : les trois bandes doivent avoir la même largeur et le mât est toujours placé du côté de la bande bleue.
Comparaison du changement de teinte
Bien que toutes les lois définissent les couleurs du drapeau, elles ne précisent pas la nuance ; des habitudes ont été prises et instituées pour les drapeaux officiels. Le bleu drapeau plus sombre est ainsi parfois remplacé par un bleu plus vif que d'aucuns trouvent moins martial, et par un rouge plus clair, depuis Valéry Giscard d'Estaing juin 1976, notamment pour les interventions télévisées du chef de l'État ou des membres du gouvernement. Les mairies, casernes et bâtiments publics sont en revanche souvent ornés de pavillons bleu sombre. L'Album des pavillons nationaux et des marques distinctives, édition du Service hydrographique et océanographique de la marine, indique que les couleurs officielles du drapeau français sont le bleu sombre et le rouge vif.
Pour les unités et organismes du ministère de la Défense, les couleurs du symbole national sont fixées dans le document Couleurs de la Défense GAM-C Édition 2006, page 79 C : bleu-violet sombre A503 ; blanc A665 ; rouge orangé vif A805. Ces couleurs font référence à la norme NF X 08-000.
Actuellement, le drapeau doit être 50 % plus long battant que haut guindant en proportion 3:2, et les bandes des trois couleurs sont de largeur égale. Les drapeaux de cérémonie sont carrés, les bandes des trois couleurs étant également de même largeur.
Le battant et le guindant des pavillons de marine sont également dans la proportion 3:2, mais les bandes des couleurs ont des largeurs respectives de 30:33:37 % du battant conformément aux dessins initiaux du peintre David, ce qui permet de les percevoir comme d'égales dimensions lorsque le pavillon flotte au vent.
Le drapeau qui flotte sous l'Arc de triomphe, à Paris, est le plus grand, il est de taille 1. Un drapeau de taille 2 est deux fois plus petit, un drapeau de taille 13, treize fois plus petit, c'est la taille la plus courante utilisée dans les administrations et armées.
Seize tailles de pavillons nationaux sont nomenclaturés dans la marine.
Drapeau souvent utilisé pour les interventions télévisées
On remarque parfois en France, à la télévision, que la bande blanche du drapeau placée derrière un locuteur est nettement plus étroite que les bandes colorées43 pendant les allocutions du président de la République par exemple. Cela est fait pour compenser un cadrage resserré qui ne laisserait autrement voir que du blanc à l'écran.
Il y a souvent confusion entre drapeau et pavillon. Le pavillon, terme de marine, est toujours frappé sur une drisse et les trois couleurs ne sont pas de même largeur alors que le drapeau peut être fixée à demeure sur une hampe ou être aussi frappé sur une drisse et les trois couleurs sont de même largeur.
Cadre légal Textes législatifs anciens Évolution du drapeau,
Textes législatifs en vigueur
Les constitutions de 1946 et de 1958 article 2 officialisent le drapeau tricolore comme emblème national de la République.
Article 2 de la Constitution de la Cinquième République française.
L'article L322-17 du Code de justice militaire incrimine l'outrage au drapeau ou à l'armée ; mais il ne concerne que les militaires.
En 2003, la Loi pour la sécurité intérieure créait, dans son article 113, un délit d'outrage public à l'hymne national ou au drapeau tricolore, punissable de 7 500 € d'amende, et 6 mois d'emprisonnement si le délit est commis en réunion. Le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés et 60 sénateurs, a émis une réserve d'interprétation à cette disposition, considérant que sont exclus du champ d'application de l'article critiqué les œuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle privé, ainsi que les actes accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités publiques ou non réglementés par elles, afin de concilier cette incrimination, jugée suffisamment claire et précise, avec la garantie des libertés constitutionnellement protégées. Ce délit ne trouverait donc à s'appliquer que dans le cas « des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent. De plus, la peine d'amende ne revêt, pour le juge constitutionnel français, aucun caractère manifestement disproportionné. Dans le cadre d'une manifestation indépendantiste, ce délit peut être considéré comme une atteinte à la défense national Commis par un militaire, il est réprimé par le Code de justice militaire, 5 ans d'emprisonnement, destitution ou perte du grade pour les officiers.
La loi est aujourd'hui en vigueur, et ce délit se trouve à l'article 433-5-1 du Code pénal français.
La loi protège les œuvres de l'esprit. Mais à la suite d'un fait divers révélé le 21 avril 2010, l'appareil législatif est remis en question. Une photographie montrant un homme en train de s'essuyer le postérieur avec le drapeau français a été réalisée – et primée – dans le cadre d'un concours sur le thème de Politiquement incorrect , organisé par la Fnac de Nice du 6 au 18 mars 2010. Le cliché a été publié dans le journal Métro le 19 mars qui a relaté cet événement local sans en être partenaire. Des associations d'anciens combattants ayant exprimé leur indignation, la garde des Sceaux Michèle Alliot-Marie a demandé que des poursuites pénales soient engagées contre cet acte inadmissible, a déclaré Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la Justice. On peut penser qu'il y a déjà en l'état actuel du droit des moyens juridiques pour sanctionner un acte aussi intolérable contre le drapeau français, a-t-il ajouté. Mais le droit actuel se révèle être lacunaire sur ce point. La ministre de la Justice envisage de prendre un décret visant à sanctionner les outrages aux symboles de la Nation, quels qu'ils soient, réfléchit à la création par décret d'une contravention de 5e classe qui permettrait, tout en respectant les exigences du Conseil constitutionnel, de faire évoluer rapidement notre droit pour sanctionner ce type de comportement. La question qui est posée est celle de savoir quelle est la limite de l'art, de la provocation, de la liberté d'expression, a déclaré Frédéric Vézard, directeur de la rédaction de Metro France.
Quelques mois plus tard est publié le décret no 2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l’incrimination de l’outrage au drapeau tricolore, qui punit d’une contravention de 5e classe jusqu'à 1 500 € d’amende, le double en cas de récidive le fait, lorsqu’il est commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau tricolore :
De détruire celui-ci, le détériorer ou l’utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
Pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives à leur commission.
La France rejoint ainsi la liste des pays pour lesquels l'outrage au drapeau fait l'objet d'une incrimination spécifique.
Le 25 juillet 2010, la Ligue des droits de l'Homme s'inquiète dans les colonnes du Monde des limites que pose ce décret à la liberté d'expression et de création et décide le 27 septembre 2010 de saisir le Conseil d'État pour faire juger l’anticonstitutionnalité de ce décret.
Protocole et étiquette
Ces règles sont communément admises au niveau international. Le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. Traditionnellement sur les façades des grandes mairies françaises, il flotte auprès du drapeau européen et régional. Les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial très précis. Lorsque le président de la République s'exprime publiquement, le drapeau français est souvent placé derrière lui. En fonction des circonstances, on trouve aussi le drapeau européen ou le drapeau d'un autre pays.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7931#forumpost7931
Posté le : 14/02/2015 14:07
|
|
|
|
|
Création du drapeau français 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Déploiement lors des cérémonies officielles
Le drapeau est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires, lors des commémorations nationales. La soprano américaine Jessye Norman, fréquemment appelée à se produire lors d'événements publics ou de cérémonies, a célébré en juillet 1989 le bicentenaire de la Révolution française sur la place de la Concorde à Paris, en chantant La Marseillaise, drapée dans une robe aux couleurs du drapeau français imaginée par le styliste d'avant-garde Jean-Paul Goude.
Honneurs funèbres Drapeaux en berne
Le drapeau est hissé jusqu'en haut du mât, puis abaissé de l'équivalent de la hauteur du drapeau, comme si le drapeau invisible du défunt était fixé au-dessus du drapeau, quand on abaisse le drapeau on fait de même, c'est-à-dire que l'on remonte le drapeau jusqu'en haut avant de le descendre. À l'intérieur, avec une hampe trop courte pour permettre la mise en berne, ou si drapeau est porté, on met une boucle de crêpe noir - une cravate - fixée au sommet de la hampe, et dont les volants tombent vers le sol.
Selon l'article 47 du décret no 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires : Lors du décès du président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.
Drap mortuaire
Le côté que l'on fixe à la drisse, le guindant se trouve à la tête du cercueil et le canton d'honneur au-dessus de l'épaule gauche du défunt.
Par les circulaires no 338 du 17 septembre 1965, no 423 du 10 octobre 1957, et no 77530 du 3 août 1977 du ministère de l’intérieur, le privilège de recouvrir un cercueil d'un drap tricolore en lieu et place du drap noir, si la famille en exprime le désir, a été accordé et réservé aux militaires titulaires de la carte du combattant ou de la carte du combattant volontaire de la Résistance. En juin 1999, un accord a été donné par le ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, pour l'extension de ce privilège aux titulaires de la médaille de la Reconnaissance de la Nation ex. TRN. Par ailleurs, il a été décidé de conférer le même honneur aux anciens réfractaires au STO, Service du travail obligatoire.
La famille du défunt doit le signaler à l'entreprise de pompes funèbres qui se chargera, de fournir et poser le drapeau tricolore sur le cercueil et éventuellement le coussin pour les décorations. Elle doit aussi contacter l'association, dont le défunt était adhérent, afin qu'elle envoie une délégation et le porte-drapeau.
Disposition
Entrée vers le palais des Nations à Genève, le siège européen de l'ONU.
Le drapeau de la France doit toujours être mis tête en haut. Le faire tenir à l'envers est un signe de détresse en mer par exemple ou est considéré comme une marque d'irrespect..
Trois drapeaux : la place d'honneur est au centre.
Plus de trois drapeaux : ils sont disposés en file indienne sur des mâts distincts et d'égale hauteur. La place d'honneur est au bout de la file, à la gauche de l'observateur, puis les autres drapeaux se présentant dans l'ordre alphabétique de leur nom s'ils sont de même rang, voir infra l'ordre de préséance. Si les mâts sont disposés de telle façon que celui du centre est plus haut, le drapeau d'honneur y sera hissé. Il en va de même sur une façade, sur un toit, etc.
Deux drapeaux ne sont jamais arborés sur un même mât, l'un au-dessus de l'autre. Ce serait une marque de domination pour le drapeau en position supérieure et d'infériorité voire d'irrespect pour le drapeau en position inférieure.
Ordre de préséance
Le drapeau national tricolore a la préséance sur tous les autres sur le territoire de la République française Drapeau de la France > Drapeau européen.
Les grands ensembles n'ont pas forcément préséance : les drapeaux de même rang ont droit aux mêmes marques d'honneur. Ils doivent être de dimensions identiques et être hissés à la même hauteur.
Les drapeaux actuels ont toujours préséance sur les drapeaux historiques, y compris dans un lieu historique précis.
Selon le lieu
Dans une salle ou lors d'une réunion : à l'intérieur ou à l'extérieur, le drapeau doit être fixé au mur à une hauteur convenable, soit à l'arrière ou au-dessus du président, du conférencier, soit à l'endroit le plus honorifique. Le côté que l'on fixe à la drisse se place à la gauche de l'observateur ou au-dessus ; le canton d'honneur est à la gauche de l'observateur, que le drapeau soit déployé horizontalement ou verticalement.
Attaché à une hampe : à l'intérieur, le drapeau est le plus souvent attaché à une hampe posée sur un piédestal, à une hauteur suffisante pour l'empêcher de toucher le sol. Cela s'applique aussi pour le déploiement dans les défilés.
En travers d'une rue ou d'une salle : au-dessus d'une rue, le drapeau est suspendu au centre. Le côté que l'on fixe à la drisse se trouve en haut, le canton d'honneur orienté vers le nord dans les rues allant de l'est à l'ouest, et vers l'est dans les rues allant du nord au sud. Au-dessus d'un trottoir, le canton d'honneur doit être orienté vers la rue.
Sur les véhicules : le drapeau doit être placé à droite du véhicule.
Sur les fuselages : c'est le revers qui doit apparaître sur côté tribord, et l'avers sur le côté bâbord, comme si c'était l'arête de la dérive qui faisait office de hampe.
Sur les habits : si le drapeau est cousu sur les manches, c'est le revers qui doit apparaître sur la manche droite, et l'avers sur la manche gauche comme si c'était l'avant du corps qui faisait office de hampe.
Les porte-drapeau
Les porte-drapeau des anciens combattants et associations patriotiques à Strasbourg lors d’une cérémonie commémorant la victoire sur les Nazis du 8 mai 1945.
Il existe un diplôme d'honneur de porte-drapeau régit par un arrêté du 30 janvier 2003.
Le drapeau ne peut être incliné, mis à l'horizontal par le porte-drapeau que lors de la Sonnerie aux morts, devant le Président de la République et, pendant une messe catholique, devant le Saint-Sacrement en particulier pendant l'élévation.
Événements et incidents liés au drapeau
Le 6 octobre 2001, lors d'un match France-Algérie au stade de France, La Marseillaise a été sifflée, en présence du Premier ministre Lionel Jospin. À la suite de cet incident, le délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national a été introduit à l'article 433-5-1 du Code pénal par une loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure.
À Toulouse, après la victoire de l'Algérie face à l'Égypte dans un match joué au Soudan pour les qualifications du Mondial 2010, le drapeau tricolore de la mairie a été arraché et remplacé par le drapeau algérien.
En mars 2010, le quotidien Métro a diffusé une photographie montrant un jeune s'essuyant les fesses avec le drapeau tricolore. Le gouvernement a alors décidé de compléter les textes réprimant l'outrage au drapeau français : cela a abouti au décret du 21 juillet 2010 punissant même les actes privés si leur auteur leur donne une diffusion publique.
Variations du drapeau tricolore : cas particuliers Les marques des présidents de la République
Pavillons en mer
Le pavillon particulier apparaît pour la première fois avec le décret du 20 mai 1885 qui précise : Le bâtiment monté par le président de la République arbore au grand mât le pavillon carré aux couleurs nationales, au centre duquel ses lettres initiales sont brodées en or. Toute autre marque distinctive est alors rentrée. L’embarcation montée par le président de la République porte le même pavillon à l’avant et le pavillon national à la poupe.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Philippe Pétain fait ainsi frapper le blanc de son pavillon personnel de son bâton de maréchal, orné d’une Francisque et surmontant ses sept étoiles de maréchal58. Mais le drapeau de la France pendant le régime de Vichy est le drapeau tricolore sans marque distinctive particulière.
Le général de Gaulle choisit de prendre comme symbole de la France libre le drapeau français orné d’une croix de Lorraine. Ce drapeau est le symbole de la Résistance française et de la Libération. Il est plus tard utilisé comme fanion de voiture par Charles de Gaulle, en tant que président de la République.
Le drapeau de l'Armée française
Les documents officiels suivants définissent certains usages relatifs aux drapeaux dans l'Armée française :
la circulaire 808 EMM/CAB du 5 décembre 1985, définit, par référence aux textes interarmées, les unités qui peuvent se voir attribuer un drapeau ;
la décision no 12350/SGA/DPMA/SHD/DAT du 14 septembre 2007 est relative aux inscriptions de noms de batailles sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
un arrêté du 19 novembre 2004 est relatif à l'attribution de l'inscription AFN 1952-1962 sur les drapeaux et étendards des formations des armées et services.
Armée de terre
Le drapeau de 90 cm de côté est l'insigne de tous les régiments français de traditions ou unités, infanterie, génie, transmissions, écoles militaires. Il existe aussi un étendard de 64 cm de côté en vigueur dans les armes à cheval, arme blindée, cavalerie, artillerie, train et matériel ainsi que dans l'aviation légère de l'armée de terre. Seul le corps des chasseurs ne possède par tradition qu'un seul drapeau pour l'ensemble de ses unités celles-ci ayant chacune un fanion rectangulaire de 50 cm de largeur et 40 cm de hauteur . La garde de ce drapeau unique est confiée alternativement à chaque unité de chasseurs pour une durée d'un an.
Le drapeau est composé d'un tablier en soie de 90 cm de côté divisé en 3 bandes tricolores, il est bordé d'une frange dorée de 5 cm sur trois côtés, le quatrième bord étant rattaché à une hampe en bois de 2,11 m et 32 mm de diamètre. Au sommet un cartouche portant les lettres RF est surmonté d'un fer de lance en bronze doré de 38 cm. Le drapeau porte, inscrit en doré, sur l'avers, République française et le nom du régiment et sur le revers, la devise Honneur et patrie. Aux angles supérieurs et inférieurs le numéro du régiment est entouré d'une couronne de feuilles de chêne. Au sommet de la hampe deux bandes tricolores de 90 cm de long sur 24 cm, bordé d'une frange dorée de 8 cm reprenant la couronne et le numéro du régiment forment ce que l'on appelle la cravate. C'est sur celle-ci que sont accrochées les décorations et les fourragères que le drapeau reçoit au nom de l'ensemble du régiment pour l'action de ses hommes. En fonction du nombre reçu, le personnel peut se voir ensuite attribuer la ou les fourragères à la couleur du ruban de la ou des médailles, par exemple la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918. Les décorations étrangères ne sont pas portées sur la cravate mais sur le coussin. Sur le revers, sous de la devise Honneur et Patrie, le drapeau de la Légion étrangère est le seul à porter l'inscription Honneur et Fidélité, le drapeau, initialement vierge, voit s'inscrire l'histoire du régiment au fil des grandes batailles auxquelles celui-ci a pris part. Ce rappel du rôle que le régiment a joué au front impose aux soldats le respect.
Le régiment ayant le plus d'inscriptions sur son drapeau est celui du 2e régiment d'infanterie de marine. Il porte 15 noms de batailles dans ses plis ainsi que l'inscription A.F.N. .
Le seul drapeau décoré de la médaille des Évadés est celui du 2e régiment de dragons.
Le drapeau du régiment d'infanterie-chars de marine régiment étranger d'infanterie 3e REI avec 16 citations à l'ordre de l'armée.
Marine nationale Pavillons et marques de la marine nationale.
Pavillon de la Marine nationale. Dimensions 30/33/37 - Ratio 2:3.
En mer, depuis le Second Empire, les bateaux français, civils ou militaires, arborent un pavillon national un peu différent du drapeau. Les proportions des couleurs nationales du pavillon français sont alors : 30/33/37. La bande bleue est légèrement plus étroite que la bande blanche et la blanche légèrement plus étroite que la bande rouge. Ainsi, en flottant, les trois bandes paraissent égales. Ce type de dessin, corrigeant un effet d'optique dû au mouvement du drapeau ou du pavillon, se retrouve en Scandinavie, en Finlande croix décalée, au Japon anciens drapeaux et drapeau de la marine de guerre, au Portugal, au Bangladesh, à Palau et au Groenland.
Cérémonie des couleurs
À la mer, le pavillon national est hissé en permanence soit au mât de pavillon à la poupe, soit dans la mature à la corne la plus à l'arrière.
Au mouillage sur rade foraine ou à quai, le pavillon national est hissé au mât de pavillon à la poupe. À l'étrave la proue, un pavillon plus petit ou une marque distinctive est hissé au mât de beaupré.
Les couleurs sont battantes du lever du soleil au lieu où l'on se trouve et au plus tôt à 8 heures, jusqu'à l'heure du coucher du soleil et au plus tard à 20 heures. Les couleurs sont envoyées le matin à l' assemblée en présence de tout l'équipage qui se découvre, contrairement aux autres armées où l'on salue. Le soir, elles sont rentrées en présence du personnel de service qui se découvre.
Drapeaux de la Marine nationale
Pavillon des Forces navales françaises libres.
Comme l'armée de terre, la marine nationale possède aussi ses drapeaux, au nombre de neuf :
1er régiment blindé de fusiliers marins noyau permanent pour les honneurs à Paris
Demi-brigade de fusiliers marins école des fusiliers marins
Canonniers marins centre d'instruction naval de Saint-Mandrier
École navale
École militaire de la flotte
Centre d'instruction naval de Brest
École des mousses
École des apprentis mécaniciens de la flotte centre d'instruction naval de Saint-Mandrier
Bataillon de marins pompiers de Marseille
Oriflamme
La partie basse de l'oriflamme peut être droite ou en forme de queue de pie
Évocations du drapeau tricolore
Dans d'autres symboles officiels de la République française Blason Armoiries de la France
La France n'a pas d'armoiries officielles car elles ont été considérées comme liées à la royauté. Aux fenêtres et balcons des édifices publics comme les mairies ou les préfectures, les drapeaux sont souvent tenus à l'arrière d'un porte-drapeau pas clair, généralement orné d'un écusson tricolore avec le sigle RF et des palmes.
Cocarde tricolore
Elle est composée des trois couleurs du drapeau de la France, avec le bleu au centre, le blanc ensuite et le rouge à l'extérieur. Les cocardes des aéronefs britanniques ont été dessinées en utilisant les couleurs françaises mises à l'envers : rouge-blanc-bleu.
Les insurgés de 1789 arboraient des cocardes tricolores, les FFI de 1944 portaient des brassards bleu-blanc-rouge.
Écharpe tricolore
Un élu de la République française, Nicolas Perruchot, portant son écharpe tricolore pour remettre la médaille de l'Assemblée nationale au chef Raoni.
En France, l’écharpe tricolore est un symbole des élus députés, sénateurs, maires et dans certains cas, adjoints et conseillers municipaux. Le port et l'usage de l'écharpe tricolore est régi par le décret no 2000-1250 du 18 décembre 2000, Journal officiel du 23 décembre 2000.
Brièvement, le port de l’écharpe par tous les élus s’effectue sur l’épaule droite au côté gauche. Pour les parlementaires, le bord rouge doit être près du col formant ainsi, lues de gauche à droite, les couleurs bleu-blanc-rouge. À l’inverse, les élus communaux les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux portent l’écharpe avec le bord bleu près du col.
Cette différenciation présente l’avantage de distinguer d’un simple coup d'œil un parlementaire d’un maire, étant bien entendu qu'en cas de cumul de mandat (député-maire, sénateur-maire c’est le mandat national qui prévaut.
Deux autres catégories portent à l’occasion de l'exercice de certaines de leurs prérogatives, une écharpe tricolore, les commissaires de police en leur qualité de magistrats civils et les officiers de police judiciaire notamment en matière de maintien de l’ordre.
Ruban tricolore
Lors d'inaugurations de bâtiments publics, il est d'usage qu'un élu coupe avec des ciseaux un ruban aux couleurs tricolores.
Logotype Logo de la République française.
Le gouvernement français s'est doté en septembre 1999, sous le gouvernement Jospin, d'un logotype rappelant le drapeau du pays sous la forme d'un rectangle allongé où la partie blanche prend la forme d'une effigie de Marianne vue de profil et contournée, c'est-à-dire regardant vers la droite. Sous le rectangle figure la devise de la République Liberté • Égalité • Fraternité et sous une deuxième ligne la mention République française.
Décorations
Les couleurs bleu blanc rouge sont fréquemment utilisées pour les rubans des décorations françaises, par exemple la Médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.
Dans le domaine de la communication d'État Logotypes d'institutions publiques
Les institutions publiques et les forces armées de la France ont des logos qui reprennent naturellement les couleurs du drapeau français :
le Sénat ;
l'Assemblée nationale ;
le Conseil constitutionnel ;
la Marine nationale ;
l'armée de terre ;
la police nationale ;
la gendarmerie nationale ;
la marque France.
Dans d'autres drapeaux à l'étranger Drapeaux nationaux
Pays ayant adopté le modèle tricolore vertical
De nombreuses nations, d'anciennes colonies africaines par exemple admiratrices de la liberté, de l'égalité et de la fraternité à la française ont adopté le modèle tricolore vertical la norme auparavant était le drapeau horizontal.
La péninsule italienne connaît un drapeau tricolore italien dès 1796, lorsque la République transpadane est proclamée, qu'elle conserve jusqu'en 1802. C'est Napoléon Bonaparte qui le lui impose, en préférant le vert au bleu, car le vert est la couleur complémentaire au rouge en peinture et devient la couleur impériale. Il devient drapeau officiel du royaume d'Italie en 1861.
En 1831, la Belgique indépendante des Pays-Bas adopte la disposition en bandes verticales en référence aux couleurs du Duché de Brabant. La mythologie patriotique belge veut que ce drapeau tricolore, repris en 1830, ait déjà été celui de la révolution brabançonne de 1787-1790. De 1830 à 1831, les couleurs étaient horizontales. Les couleurs horizontales ont été d'usage jusqu'en 1832.
L'État libre d'Irlande fait un usage officiel du modèle tricolore à partir de sa création en 1922. Il est confirmé comme drapeau officiel dans la constitution de décembre 1937. L'usage des trois couleurs est attesté depuis 1830[réf. souhaitée], quand des patriotes irlandais fêtent le retour au drapeau tricolore en France après les Trois Glorieuses. Le drapeau dans sa disposition actuelle est déployé pour la première fois de manière certaine en 1848 par le mouvement Jeune Irlande ; il est possible qu'il ait été utilisé quelques années plus tôt. Il flotte sur la Poste centrale de Dublin et sur les positions tenues par les troupes républicaines lors de l'insurrection de Pâques 1916 quand est proclamée la République irlandaise. Il reste le drapeau officiel quand l'Irlande devient une république en 1949. Il a été longtemps interdit dans les Six Comtés du Nord, sous souveraineté britannique.
Les trois couleurs, bleu, jaune et rouge du drapeau d'Andorre adopté en 1866, rappellent celles des drapeaux de la Catalogne et de la France.
Les drapeaux de la Roumanie et de la Moldavie reprennent les couleurs historiques des anciennes principautés, attestées bien avant la révolution française mais dans une disposition verticale adoptée en 1848/1866 et peut-être influencée par le modèle français.
Drapeau de la Moldavie.Tricolores africains
La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali se sont inspirés du drapeau tricolore français pour leurs drapeaux.
Les couleurs du drapeau du Tchad ont été choisies par le dernier gouverneur français, sur le modèle du drapeau français.
Pays ayant adopté les couleurs de la France
Le drapeau de la République centrafricaine, barré de rouge en son centre, mélange les couleurs du drapeau français, en souvenir de l'ancienne puissance coloniale, et les couleurs typiques de l'Afrique rouge, jaune et vert.
Le drapeau de la Thaïlande, adopté en 1917 par le roi thaïlandais Rama VI, est influencé par le graphisme moderne des drapeaux européens qui étaient presque tous composés de bandes horizontales ou verticales. Le drapeau comporte des bandes rouges, blanches et bleue symbolisant respectivement la nation, la religion et la monarchie, le bleu était la couleur du roi Rama VI. On dit que les bandes colorées du drapeau sont un hommage aux Forces alliées : Français, Britanniques, Américains et Russes qui possèdent tous les quatre ces couleurs sur leurs drapeaux respectifs.
La couleur bleue de la croix ajoutée au Dannebrog danois a été choisie par les Norvégiens notamment pour faire référence aux couleurs françaises et américaines, symbole de liberté à l'époque.
Drapeaux de provinces, d'États fédérés, de villes
La province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador possède également un tricolore non officiel rose, blanc, et vert qui a historiquement été utilisé par les nationalistes opposés à la confédération canadienne ou mécontents du gouvernement fédéral. Il existe actuellement un mouvement populaire pour en faire le drapeau officiel de la province.
Toujours au Canada, le drapeau acadien est un tricolore bleu-blanc-rouge orné d'une étoile jaune en son coin supérieur à la hampe, en l'honneur de la Vierge Marie, protectrice des marins. À la fin du xixe siècle, le drapeau tricolore français était en effet devenu la marque de ralliement d'une grande partie des Canadiens-français de toutes les régions, et il a été adopté officiellement comme drapeau de l'Acadie en 1884, un 15 août tandis que le Québec a fini par s'orienter vers le drapeau fleurdelisé.
L'Iowa, État du centre des États-Unis, possède un drapeau tricolore. Les Filles de la Révolution américaine sont à l'origine de ce drapeau où l'on voit un pygargue à tête blanche tenant dans son bec une banderole portant la devise de l'État. Le bleu et le rouge furent ajoutés à la ratification du drapeau en 1921, de sorte que les couleurs de ce dernier devinrent celles du drapeau tricolore français, pour commémorer le passé de l'Iowa dans l'Amérique du Nord française.
Drapeaux de départements et territoires français d'outre-mer
À l'exception de celui de la Polynésie française et de La Réunion qui utilise le drapeau français, les drapeaux des DOM-TOM sont tous non officiels, étant supplantés par le drapeau national. La Nouvelle-Calédonie utilise le drapeau français et le drapeau kanak, bien que cet usage n'ait pas été acté par une loi de pays. Le drapeau des îles Wallis-et-Futuna, archipel de l'océan Pacifique, ne dispose pas encore de statut officiel. Le drapeau tricolore, placé dans le haut à gauche et séparé du reste du drapeau par une fine ligne blanche, fut ajouté en 1959, lorsque les îles optèrent pour le statut de Territoire d'outre-mer. Le carré, formé par quatre triangles isocèles congrus, représente les rois des trois principales îles — Uvea Wallis, Futuna et Alofi — et la France.
Drapeaux historiques
Anciens drapeaux nationaux arborant le drapeau tricolore français
Dans le domaine du sport Tenues des équipes françaises
Les couleurs de la tenue des équipes nationales françaises de différents sports font référence à celle du drapeau. C'est en raison de la couleur de leur maillot que les sportifs des équipes de France sont surnommés les Bleus.
Pour exemple, voici le jeu de maillot de l'Équipe de France de football à la Coupe du monde 2010 : Couleurs Bleu, blanc et rouge
Domicile Extérieur
C'est logiquement de cette manière que sont habillées les mascottes Jules en 1994 et Footix en 1998.
Logos des fédérations françaises de sport
Le drapeau est régulièrement utilisé à des fins de communication ou de publicité, soit en entier, soit de manière partielle, ou comme une simple évocation par l'intermédiaire de ses couleurs. Nombre de fédérations françaises de sport ont ainsi un logo comportant une référence au drapeau, par exemple la FFE (Fédération française d'équitation.
Couleurs des équipes hors de France
Suwon Samsung Bluewings Football Club
Dans le domaine de la communication d'entreprise
Comme pour les fédérations françaises de sport, nombre de compagnies commerciales françaises ont des logos comportant une référence au drapeau :
Air France : le logo, basé sur les couleurs nationales, reproduit sur l'empennage et le fuselage des avions, souligne "non seulement l'identité française, mais également les valeurs et l'histoire de la Compagnie qui fête ses 75 ans : le bleu marine, prédominant depuis la naissance d'Air France, évoque le capital historique de la marque et l'efficacité de la Compagnie ; le blanc, couleur de l'exigence, suggère le bien-être et l'art du voyage à la française ; l'accent rouge vif, ponctue et dynamise la marque, soulignant à la fois le chic français et l'attention portée aux clients d'Air France par le personnel de la Compagnie, en aéroport et en vol. (Extrait du communiqué Air France, du mercredi 11 février 2009
TF1, première chaîne de télévision généraliste française privée. Le logo adopté depuis 1990 représente le sigle TF1 inscrit en blanc dans un rectangle partagé en deux couleurs : le bleu et le rouge.
Française des jeux, entreprise publique française détenue à 72 % par l'État qui lui a confié le monopole des jeux de loterie et de paris sportifs sur tout le territoire national. Le logo représente un trèfle blanc à quatre feuilles sur fond bleu. L'une des feuilles possède un carré rouge.
FRAM, voyagiste français indépendant fondé en 1949. Leur logo, composé de trois cocotiers, a été abandonné en 2006.
ECF École de conduite française
Crédit immobilier de France : spécialiste du crédit à l'habitat indépendant. Son logo représente une clé sur un fond bleu de forme carrée. En ce qui concerne la clé : l'anneau et la tige sont blanches, le panneton est rouge.
Carrefour
Associations
Drapeau de la Société française de vexillologie
En ce qui concerne les associations françaises certaines reconnues d'utilité publique, on peut donner en exemple :
le Secours populaire français : le logo créé par Grapus représente une main blanche avec une aile rouge et une aile bleue ;
l'Association des maires de France : le logotype représente une écharpe tricolore formant un hexagone l'une des locutions désignant la France, avec cette particularité de respecter l'ordre du drapeau national, donc d'être une écharpe de parlementaire ;
l'Union des Français de l'étranger UFE : la plus ancienne association française d'expatriés ;
le Souvenir français ;
la Fédération du Scoutisme français dispose d'un logo basé sur les couleurs du drapeau tricolore. La plupart des équipes nationales des associations membres portent un foulard scout déclinant les couleurs du drapeau français ;
la Société française de vexillologie, association des passionnés de drapeaux, représentante de la France au sein de la Fédération internationale des associations vexillologiques possède un drapeau créée par son fondateur, le baron Pinoteau, conçu sur le modèle des drapeaux militaires d'ancien régime et associant ainsi les trois couleurs dans une disposition historique, Croix blanche délimitée par un filet alternativement rouge et bleu. Ces filets sont séparés des cantons écartelés bleus et rouges par un filet blanc. Proportions 9-1-1-5-1-1-9.
Dans le domaine de la communication politique
Certains partis politiques nationaux français - principalement de droite - reprennent aussi ce symbole dans leurs logos :
le Rassemblement pour la République RPR ;
l'Union pour un mouvement populaire UMP. Son logo représente un arbre de la liberté blanc inscrit au milieu d'un rectangle partagé en deux par deux couleurs : le bleu et le rouge ;
le Mouvement pour la France MPF de Philippe de Villiers ;
le Front national FN. Son logo représente une flamme composée de trois flammèches de couleurs différentes : le bleu, le blanc et le rouge. Le FN organise également la Fête des Bleu-blanc-rouge en référence au drapeau national.
Debout la République DLR : parti politique de tendance gaulliste et républicaine, créé en 1993 et présidé par Nicolas Dupont-Aignan. Le logo reprend la silhouette du tableau d'Eugène Delacroix : La Liberté guidant le peuple ;
Le Parti radical, parti le plus ancien de France fondé en 1901. Son logo représente Marianne en bleu et blanc sur un fond rouge de forme hexagonale en référence à la France.
Le Forum des républicains sociaux, FRS, parti politique fondé en mars 2001 par Christine Boutin qui fait actuellement partie du Parti chrétien-démocrate.
Dans la société Honneurs au niveau national
l'écharpe de Miss France arbore une cocarde tricolore.
la médaille du meilleur ouvrier de France décernée par la Société des meilleurs ouvriers de France est composée d'un ruban tricolore. L'ouvrier a le droit de porter une veste blanche au col tricolore. L'ouvrier récompensé conserve son titre à vie avec l'indication de sa promotion l'année d'obtention.
Pascal Caffet, chef pâtissier et chocolatier français, en tenue de meilleur ouvrier de France
Expressions L'expression Bleu Blanc Rouge
La formule bleu-blanc-rouge, tout comme les mots tricolore ou hexagonal, est souvent utilisée comme synonyme de l'adjectif français.
Elle a aussi été utilisée pour favoriser, dans certaines listes d'embauche, les candidats 100 % Français par rapport à ceux qui présenteraient une peau foncée et des traits de type non européen. Cette pratique discriminatoire illégale a été sévèrement réprimée65,66. Il a été fait usage d'un autre code de discrimination : 00167.
L'expression Black Blanc Beur
Lors de la Coupe du monde de football de 1998 est apparue l'expression Black Blanc Beur, qui joue sur la symétrie avec le bleu blanc rouge du drapeau ; elle souligne le métissage et le multiculturalisme de la France nés de l'immigration Black et Beur faisant respectivement référence aux populations noires et maghrébines. Le succès de l'équipe de France qui comportait des joueurs de diverses origines a fait passer dans le langage courant cette expression connue sous le sigle BBB. L'expression offre un assemblage rare : celui de trois mots d'origine distincte. Black anglais, Blanc français, Beur, issu du langage des cités - Beur est le verlan, prononciation inversée d'Arabe.
Œuvres littéraires, artistiques et prouesses techniques La Patrouille de France
La Patrouille de France est la patrouille acrobatique officielle de l'Armée de l'Air française. Elle réalise des figures avec des fumigènes bleu blanc et rouge.
Eugène Delacroix : La Liberté guidant le peuple 1830
Henri Félix Emmanuel Philippoteaux, Épisode de la Révolution de 1848 : Lamartine repoussant le drapeau rouge à l’hôtel de ville, le 25 février 1848, v. 1848. Huile sur toile, 63 × 27,5 cm. Musée Carnavalet, Paris.
Henri Félix Emmanuel Philippoteaux, Lamartine faisant acclamer le drapeau tricolore sur le perron de l'Hôtel de ville de Paris.
E. Charpentier. Alphonse de Lamartine présentant le drapeau tricolore, à l'hôtel de ville de Paris, 1848. Lithographie.
Jacques-Louis David, Serment de l'Armée fait à l'Empereur après la Distribution des Aigles au Champ de Mars, 1810.
Monnaie
Tricolore, le drapeau est très rarement représenté sur les pièces de monnaie, unicolores par définition, ou bicolores gris-jaune depuis 1988. Il figure cependant en bonne place sur la face nationale des pièces de 1071,72, 2073,74 et 5075 76 centimes d'euros ainsi que sur la pièce de 10 euros à l'Hercule77 gravée par Joaquin Jimenez en argent, émise en 2012, elle a cours légal en France. Comme en héraldique, les couleurs sont représentées par des hachures conventionnelles ; tout l'arrière-plan, derrière les personnages, représente les trois couleurs : des hachures horizontales pour le bleu sur le tiers gauche, un fond uni pour le blanc sur le tiers médian, des hachures verticales pour le rouge sur le tiers droit.
Citations
Alphonse de Lamartine dans son discours du 25 février 1848 a déclaré : Le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie !
Dans L'Aiglon, Edmond Rostand évoque le drapeau tricolore :
...Plein de sang dans le bas et de ciel dans le haut,
Puisque le bas trempa dans une horreur féconde,
Et que le haut baigna dans les espoirs du monde...
        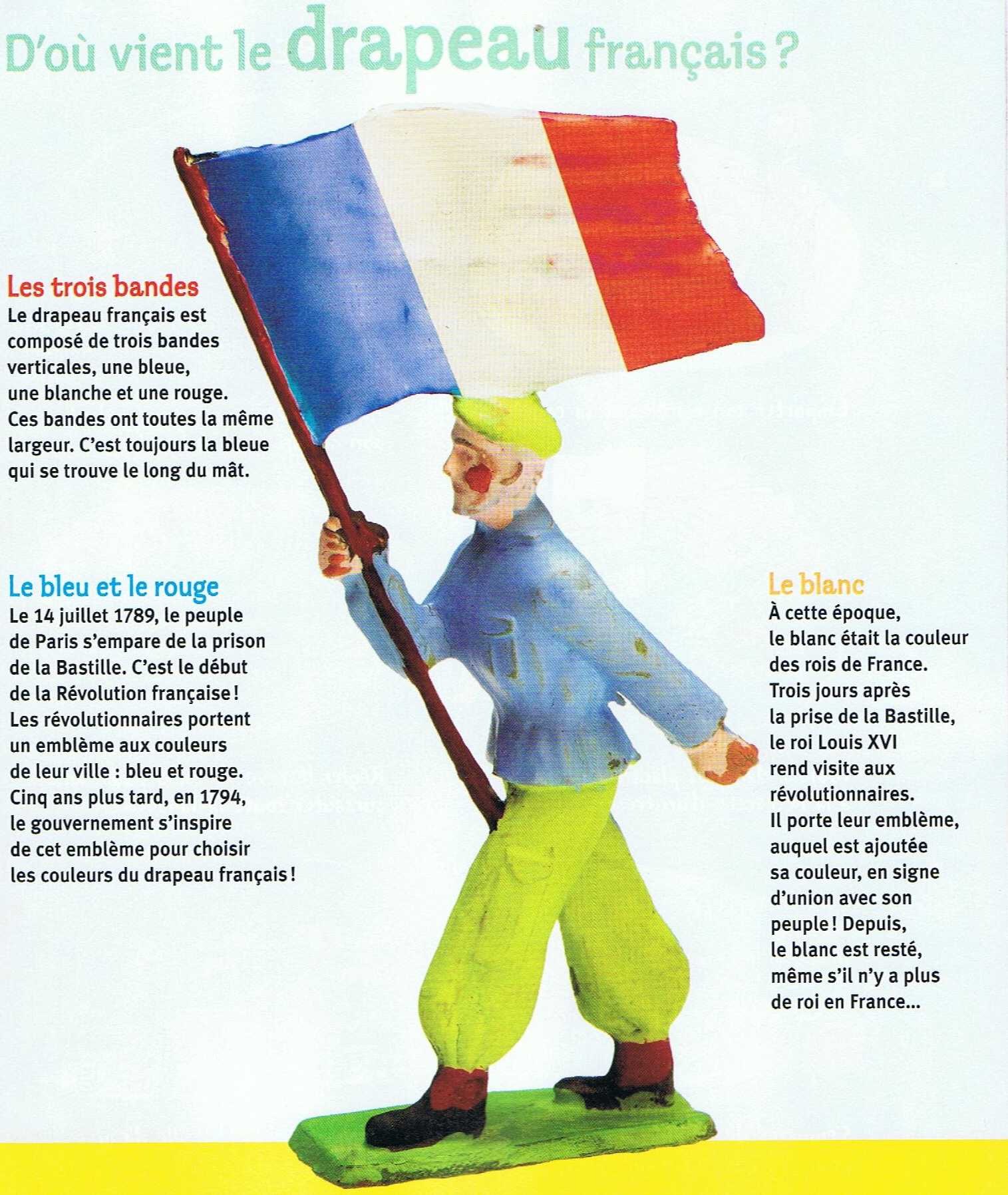  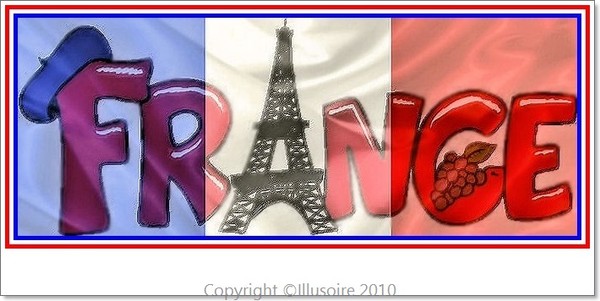   
Posté le : 14/02/2015 14:05
|
|
|
|
|
Charles IV le bel dernier Capétien |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 1er février 1328 à Vincennes, à 33 ans meurt Charles IV de France
dit Charles le Bel né le 15 juin 1294 dans le comté de Clermont dans l'Oise, fut comte de la Marche puis, de 1322 à 1328, roi de France, le quinzième et dernier de la dynastie dite des Capétiens directs, et roi de Navarre sous le nom de Charles Ier.
Roi de France et de Navarre du 3 janvier 1322 au 1er février 1328 soit 6 ans, 0 mois et 29 jours, il est Couronné le 21 février 1322, en la cathédrale de Reims
son prédécesseur est Philippe V son successeur Philippe VI de France et Jeanne II de Navarre, il appartient à la Dynastie des Capétiens.
Père est Philippe IV de France, et sa Mère Jeanne Ire de Navarre, sa Conjointe Blanche de Bourgogne, 1308-1322, Marie de Luxembourg 1322-1324, puis Jeanne d'Évreux
1325-1328.
Ses sphères d'influence et principaux axes commerciaux au royaume de France en 1330 : Possessions de Jeanne de Navarre, États pontificaux, Territoires contrôlés par Édouard III, Zone d'influence économique anglaise, Zone d'influence culturelle française
En Bref
Roi de France et de Navarre Charles Ier 1322-1328, troisièmes fils de Philippe IV le Bel et de Jeanne Ire, reine de Navarre.D'abord comte de la Marche, il succède à son frère Philippe V, qui ne laisse que des filles, et continue la politique de celui-ci contre la noblesse.
Ce plus jeune des fils de Philippe le Bel, Charles de la Marche, prend la succession de son frère Philippe V, mort sans héritier mâle, selon le précédent créé en 1317. Le scandale de la tour de Nesle après lequel il obtient l'annulation de son mariage avec Blanche de Bourgogne n'atteint pas le prestige du nouveau roi. Son voyage en Languedoc en 1324 est une suite de fêtes royales qui contribuent à sa popularité. Pour gouverner, il doit, comme ses frères, consentir aux exigences de réformes soutenues par la noblesse et le clergé. Les réformateurs généraux pour l'ensemble du royaume et surtout ceux de la ville et vicomté de Paris poursuivent leur tâche. Les charges financières et judiciaires accordées gratuitement sont restituées. Les officiers de la Chambre des comptes, du Parlement, des Requêtes de l'hôtel, de la Chancellerie et du Châtelet sont surveillés ; leur office réformé. Mais l'action des réformateurs ne freine ni la bureaucratisation, ni l'intrusion des bourgeois parisiens et auvergnats et, surtout, des compagnies italiennes dans les mouvements de fonds royaux. La recherche de moyens financiers reste un problème majeur. Mutations monétaires, impôts sur les marchandises, dîme levée avec l'accord du pape en prétendant partir à la croisade 1323, confiscation des biens des financiers italiens, octroi de chartes de communes sont autant d'expédients. Mais, à la mort de Charles IV, d'autres problèmes restent en suspens. Après avoir prononcé la confiscation de la Guyenne 1324, faute d'avoir reçu l'hommage du roi anglais Édouard II, guerres et négociations se succèdent dans le Sud-Ouest. En 1327, profitant de la faiblesse de la royauté anglaise, Charles IV impose un accord draconien : 50 000 marcs d'indemnité de guerre, 60 000 livres de relief ; les terres sont occupées en attendant le paiement de la somme. La mort de Charles IV risque de compromettre ce succès, d'autant qu'Édouard III, son neveu, est candidat à la couronne de France puisque le roi ne garde que des filles de ses deux mariages, avec Marie de Luxembourg 1322 et Jeanne d'Évreux 1324.
Il tente de faire restituer à la Couronne les domaines aliénés, retire les charges accordées à titre gratuit et les met en vente. Pour faire face aux dépenses, payer une administration qui prend de l'ampleur et entretenir le prestige royal, il pratique une politique impopulaire de taxation et d'économies. Il séquestre la Guyenne anglaise 1324, que son oncle Charles de Valois conquiert en partie, et consent à la paix avec l'Angleterre 1327, mais en conservant l'Agenais et le Bazadais. Il meurt l'année suivante sans laisser d'héritier mâle. Avec lui s'éteint la dynastie des Capétiens directs.
Sa vie
Troisième fils du roi de France et de Navarre Philippe IV le Bel et de la reine Jeanne Ire de Navarre, Charles n'est pas destiné à régner. Très peu de choses sont connues sur son enfance, qu'il passe entièrement au palais de la Cité. En 1307, Philippe le Bel rachète le comté de Bigorre, qu'il offre peu après en apanage à Charles.
En 1307 ou 1308, Charles épouse Blanche de Bourgogne, fille d'Othon IV de Bourgogne et de Mahaut d'Artois. En 1310 ils sont déclarés nubiles et autorisés à vivre ensemble en un appartement de la tour de Nesle.
Blanche est condamnée pour adultère au début de l'année 1314 avec sa belle-sœur Marguerite de Bourgogne, dans ce que l'on a appelé l'affaire de la tour de Nesle. Blanche étant enfermée dans la forteresse de Château-Gaillard, le mariage n'est pas rompu et Charles ne peut se remarier.
Sous le règne de son père, du fait de son jeune âge, Charles joue un rôle très secondaire dans la conduite des affaires du royaume. Ce n'est que dans les dernières années du règne qu'il apparaît au Conseil royal.
En août 1314, Charles de Bigorre participe à la très courte campagne de Flandre, et le 20 août débloque facilement Tournai assiégée par les troupes du comte de Flandre.
Sans doute déçu de son piètre apanage, il doit attendre les derniers jours de la vie de son père, en novembre 1314, pour que celui-ci mourant lui accorde le comté de La Marche. Encore peut-il se sentir frustré, car il n'obtient pas le comté d'Angoulême, qui avec la Marche faisait pourtant partie de l'héritage de Hugues XIII de Lusignan récupéré par la couronne en 13083.
Succession de 1316
Charles de France, comte de La Marche, ne joue aucun rôle notable sous le court règne de son frère aîné Louis X le Hutin. Mais la mort de ce dernier le 5 juin 1316 lui permet d'intervenir dans la crise de succession qui s'annonce. En effet, la France se retrouve à cette date sans monarque, la reine veuve Clémence de Hongrie étant enceinte d'un enfant posthume du feu roi. Dans le cas où naîtrait une fille, de nombreux barons du royaume, et en particulier le duc Eudes IV de Bourgogne, souhaiteraient voir accéder au trône la petite Jeanne de Navarre, fille aînée de Louis X mais soupçonnée de bâtardise après l'Affaire de la tour de Nesle, mais sans droits.
À l'été 1316, la question la plus urgente à régler est celle de la régence du royaume. Philippe, comte de Poitiers, frère de Louis X et de Charles, la réclame en tant que plus proche parent du feu roi. Ceci n'est pas sans contrarier Charles de Valois, frère cadet de Philippe le Bel qui, en plus d'être l'aîné de la famille royale, a exercé la réalité du pouvoir sous le règne de son neveu Louis le Hutin. Charles de France penche nettement pour ce dernier. Selon une chronique, les comtes de Valois et Charles de France auraient fait occuper le Palais de la Cité par leurs hommes d'armes, ce qui aurait obligé le connétable Gaucher de Châtillon à employer la manière forte pour permettre au comte de Poitiers d'entrer dans la place et de prendre le pouvoir.
Quoi qu'il en soit Charles qui est prince de France mais sans terre ni titre ni responsabilités, se rallie de très mauvaise grâce au gouvernement de son frère aîné. Le 15 novembre 1316, la reine Clémence met au monde le petit roi Jean Ier qui décède au bout de cinq jours. Rejetant les prétentions de Jeanne de Navarre, le comte de Poitiers se proclame roi sous le nom de Philippe V. Plus que jamais opposé à son frère et partisan des droits de sa nièce, le prince Charles n'hésite pas à répandre alors des bruits médisants selon lesquels Philippe aurait, avec la complicité de sa belle-mère Mahaut d'Artois, fait empoisonner le petit roi.
En janvier 1317, Charles fait scandale en quittant précipitamment la ville de Reims pour ne pas assister au sacre de son frère. De toutes les oppositions contre Philippe V, il s'allie à Eudes de Bourgogne qui souhaite voir Jeanne de Navarre sur le trône de France.
Le roi, sur les conseils du pape Jean XXII, rallie son cadet en le dotant du comté de la Marche. Ainsi le 17 mars 1317 le comte de La Marche soutient-il les droits au trône du fils qui naîtrait de Philippe V.
Dans l'attente du trône
Après une dernière brouille en juin 1317, le comte de La Marche cesse toute attaque contre son frère, Phillipe V. Avec son oncle Charles de Valois, dont il reste très proche, il est toutefois tenu à l'écart de la réalité du pouvoir, sans pour autant être en disgrâce.
La mort en 1317 de Louis, le jeune fils de Philippe V, fait de lui l'héritier présomptif de la couronne de France, ce qui le pousse à la modération. Fin 1321, la maladie de son frère aîné lui fait espérer un avènement très proche.
Le règne / Avènement
Le comte de La Marche monte sur le trône sous le nom de Charles IV à la mort de son frère Philippe V le Long le 3 janvier 1322. Cette fois-ci, il ne tient aucun compte d'éventuels droits de ses nièces, Jeanne de Navarre et les filles de Philippe V. Contrairement à ce qui s'était passé en 1316, cette prise du pouvoir s'effectue sans aucune contestation.
Charles IV est sacré à Reims le 21 février 1322 par l'archevêque Robert de Courtenay. En tant qu'héritier de sa mère Jeanne de Navarre, il ajoute au titre de roi de France celui de roi de Navarre.
Trouvant le trésor royal épuisé par les abus du règne précédent, Charles IV punit sévèrement et dépouille les financiers lombards. Il traite avec la même rigueur les mauvais juges et les seigneurs qui avaient accaparé les biens des particuliers. Il fait même arrêter Girard de la Guette, ex-surintendant des finances de Philippe le Long, lequel est accusé d'avoir détourné un million deux cent mille livres. Il le remplace par son trésorier Pierre de Rémi, qui sera lui-même pendu sous le règne suivant pour le même motif de concussion. À la chancellerie, Charles IV nomme son ancien chancelier du comté de La Marche Pierre Rodier.
Sa montée sur le trône permet aussi à son oncle et parrain Charles de Valois de retrouver un pouvoir qu’il n'avait pas eu sous le règne précédent. L’oncle du roi fait ainsi entrer au gouvernement des hommes à lui, comme le trésorier Jean Billouart ou le chancelier Jean de Cherchemont, qui remplace Pierre Rodier en 1323. Parmi les autres conseillers du nouveau souverain, on peut citer d’anciens légistes de Philippe le Bel tels que Guillaume de la Brosse et Raoul de Presles, ou encore Guillaume Flote, appelé à jouer un rôle encore plus grand sous Philippe de Valois.
Le roi
On sait très peu de choses sur la personnalité de Charles le Bel. Les chroniqueurs ont jugé sévèrement ce roi qui « régna grand temps sans rien faire et qui tenait plus du philosophe que du roi. Charles le Bel semble toutefois avoir été soucieux de faire respecter la justice, comme le prouve sa fermeté dans l'affaire Jourdain de l'Isle.
En 1324, le roi effectue un long voyage en Languedoc, ce qui le rend populaire auprès du peuple. Cette popularité s'érode cependant avec les pratiques financières douteuses de la couronne.
Deuxième et troisième mariages
A l'intervention de Philippe V, le pape Jean XXII annule le mariage pour cause de consanguinité voir l'affaire de la tour de Nesle, Mahaut d'Artois, la mère de son épouse, étant également sa marraine
Le 21 septembre 1322 à Provins, il prend pour seconde épouse Marie de Luxembourg, qui lui donnera une fille mais qui ne survivra pas. Le 21 mars 1324, au cours d'un voyage à Issoudun en Berry, la voiture de Marie de Luxembourg se renverse, provoquant la mort de la reine et de l'enfant qu'elle portait.
Le 13 juillet 1325, le roi, toujours sans héritier, épouse en troisièmes noces sa cousine Jeanne d'Évreux. Cette dernière accouche d'une première fille prénommée Jeanne en 1326, et d'une seconde fille, Marie, l'année suivante. Elle est de nouveau enceinte lorsque le roi meurt en février 1328. Il faut attendre la naissance de l'enfant pour savoir si les Capétiens vont conserver le Trône. C'est de nouveau une fille, Blanche, qui naît le 1er avril 1328. Cette dernière fille épousera en 1345 Philippe 1336-1375, duc d'Orléans, fils de Philippe VI de Valois.
Finances
Le règne de Charles IV le Bel voit la poursuite de la bureaucratisation de l'administration royale, déjà accélérée sous le règne de son père et de ses frères aînés. Des réformes sont aussi effectuées, touchant les offices de la Chambre des Comptes, du Parlement, la Chancellerie, etc. ceci afin d'effectuer des économies budgétaires et de prévenir les fraudes.
Comme sous les règnes précédents, l'État royal fait face à des difficultés financières. Pour y remédier, le gouvernement de Charles le Bel utilise les expédients habituels : mutations monétaires, taxes sur les marchandises, confiscations des biens des marchands italiens. La dîme levée avec l'accord du pape dans le but officiel de préparer la Croisade est aussi un habile moyen de renflouer les caisses royales.
Politique extérieure, Flandres et Révolte des Karls.
La question du Saint-Empire. Lorsque Charles le Bel arrive au pouvoir, deux princes revendiquent le titre d'empereur romain germanique : Louis de Bavière, élu mais non reconnu par le pape Jean XXII, et Frédéric le Bel, duc d'Autriche.
En 1322, Louis de Bavière bat et capture son rival à la bataille de Mühldorf. Cependant, Jean XXII refuse toujours de le reconnaître comme empereur. Le conflit entre Louis et le souverain pontife ne cesse de s'envenimer jusqu'à l'excommunication de Louis prononcée en 1324, point de départ d'une lutte de près de vingt-cinq ans entre l'Empire et la papauté.
À ce moment-là, les partisans de Frédéric d'Autriche songent à faire du roi de France leur nouveau champion. L'épouse de ce dernier, Marie de Luxembourg, est en effet la fille de l'ancien empereur Henri VII. Cette union offre à Charles IV de puissants soutiens, en plus de celui du pape, dans le cas d'une éventuelle élection à l'Empire.
Mais Marie meurt prématurément le 26 mars 1324, ce qui met un terme aux ambitions impériales de Charles IV.
Charles et les projets de croisade
L'idée d'une nouvelle croisade était réapparue sous les règnes de Philippe IV et Philippe V. En 1323, le roi charge le comte de Valois de négocier avec Jean XXII l'organisation d'une nouvelle expédition en Terre sainte et l'obtention d'un subside. Toutefois, les conciliabules entre le pape et Valois sont un échec, le pape soupçonnant Charles IV de vouloir utiliser cet argent à ses fins personnelles, et nullement pour prendre la Croix.
En 1326, Charles le Bel s'intéresse de nouveau aux questions d'Orient et envisage de mener une expédition contre l'Empire byzantin. Il prend pour cela officiellement la Croix et nomme le vicomte de Narbonne à la tête d'une flotte expéditionnaire. L'année suivante, il reçoit à Paris des envoyés de l'empereur Andronic II Paléologue qui proposent, en plus de la paix, de rétablir l'union de la chrétienté. La chute d'Andronic, renversé par son fils Andronic III, et la mort de Charles mettent un terme aux négociations.
La guerre de Guyenne (1324) dite de "Saint-Sardos"
Les relations de Charles IV avec l'Angleterre sont d'abord cordiales. Le roi envoie en effet outre-Manche une ambassade au roi Édouard II, afin de conclure un mariage entre Marie, une des filles de Charles de Valois, et le prince Édouard, futur Édouard III. Les ambassadeurs français acceptent même de participer à une guerre contre l'Écosse, au cours de laquelle ils sont d'ailleurs fait prisonniers. Néanmoins la Gascogne reste le point sensible des relations entre les deux royaumes. Édouard II, qui est également duc de Guyenne, souhaite mettre un terme aux luttes d'influence qui opposent dans cette région ses partisans et ceux du roi de France.
En 1323, l'évasion de Roger Mortimer aggrave les relations franco-anglaises. Mortimer avait participé quelques années plus tôt à une rébellion contre le roi et son favori Hugues le Despenser. Vaincu et emprisonné à la tour de Londres, il est parvenu à s'évader et a trouvé refuge en France.
En juillet 1323, Édouard II envoie une ambassade en France pour obtenir la livraison de Mortimer. Charles IV refuse et, prétextant un trop haut degré de parenté entre les futurs époux, met un terme au projet de mariage entre le prince Édouard et Marie de Valois. De plus, le roi de France réclame d'Édouard II l'hommage pour le duché de Guyenne, formalité que le souverain anglais n'a toujours pas remplie depuis le sacre de Reims.
À l'automne 1323 intervient l'incident de Saint-Sardos qui met le feu aux poudres. Le village de Saint-Sardos, dans l'Agenais, se trouve à l'époque dans une situation complexe. Bien que situé sur les terres du duché de Guyenne, donc du roi d'Angleterre, il appartient au Prieur de Sarlas, dépendant du roi de France. Lorsque le sire de Montpezat, seigneur gascon donc vassal du roi d'Angleterre, construit sur le site une bastide, le Parlement de Paris proclame que celle-ci se trouve sur les terres du Royaume de France. Les Gascons, conduits par Montpezat, répliquent en chassant les Français qui s'étaient installés dans la place. Les officiers du roi de France qui ont eu le malheur de se trouver là sont pendus.
Charles IV réagit en exigeant réparation et somme Édouard II de lui rendre hommage. Édouard désavoue Montpezat et accepte de négocier mais ne prend aucune résolution. Devant sa mauvaise volonté, Charles fait prononcer par le Parlement la saisie du duché de Guyenne le 1er juillet 1324, ce qui déclenche le conflit armé.
Les principales opérations militaires se déroulent évidemment en Guyenne. Le roi y envoie une puissante expédition commandée par l'inévitable Charles de Valois. Édouard II envoie quant à lui son demi-frère Edmond de Kent. La campagne est très facile pour les Français qui rencontrent peu de résistance jusqu'à ce qu'ils mettent le siège devant La Réole, occupée par Kent. Incapable de résister, celui-ci se rend au bout d'un mois, le 22 septembre 1324 et signe une trêve.
Afin de négocier la paix, Édouard II envoie en 1325 son épouse Isabelle auprès de son frère Charles le Bel.
Chute d'Édouard II et règlement du conflit gascon
Par l'intermédiaire de la papauté et de la reine Isabelle, Français et Anglais parviennent à un accord en mai 1325: la Guyenne est restituée à Édouard II, mais les officiers du duché seront désormais nommés par le roi de France. De plus Édouard doit venir rendre hommage à Charles IV. Le roi d'Angleterre refuse de se déplacer à Paris, et envoie à sa place son fils le prince Édouard, qu'il titre duc d'Aquitaine.
Charles profite alors de l'absence de son rival pour imposer de nouvelles conditions à son jeune fils. Le prince Édouard récupèrera bien la Guyenne, mais amputée de l'Agenais. Furieux, Édouard II désavoue son fils et dénonce le traité modifié. Charles le Bel riposte en confisquant une nouvelle fois le duché.
En parallèle à ces négociations, le voyage d'Isabelle sur le continent prend un tour scandaleux. Celle-ci en effet affiche ostensiblement une relation avec Roger Mortimer, l'ennemi juré du roi d'Angleterre et ses favoris les Despenser. Très vite, la louve de France et son amant s'allient dans le but de renverser ces derniers puis de prendre le pouvoir. Charles IV se retrouve alors dans une situation difficile en étant assailli par les réclamations d'Édouard II, qui exige le retour de son épouse.
Il est finalement contraint de demander le départ des deux amants. Ceux-ci, réfugiés en Hainaut, montent une expédition et débarquent en Angleterre en septembre 1326. Aidés par une révolte des barons du royaume, Isabelle et Mortimer éliminent les Despenser et déposent Édouard II, qui sera assassiné quelques mois plus tard. Le 25 janvier 1327, le duc d'Aquitaine est proclamé roi sous le nom d'Édouard III.
Reste à régler l'affaire de Guyenne. Isabelle signe le 31 mars 1327 le traité de Paris très défavorable à l'Angleterre. En effet, si Édouard III recouvre le duché de Guyenne moins l'Agenais, c'est au prix d'une énorme indemnité de guerre. Mais la mort de Charles le Bel moins d'un an plus tard complique l'application du traité.
Mort et Succession
Testament de Charles IV le Bel et son codicille. Le testament est rédigé en 1324. Le codicille est rédigé en 1328. Archives nationales.
Article détaillé : Succession de Charles IV de France.
Malade, Charles IV est alité à partir du 25 décembre 1327. Selon le chroniqueur Jean Lebel, mais il est le seul à rapporter ce fait, le roi mourant aurait souhaité que le comte Philippe de Valois devînt régent si la reine Jeanne, alors enceinte, donnait naissance à un fils. Si une fille venait à naître, alors Philippe de Valois pourrait monter directement sur le trône. Mais la volonté du roi ne semble pas avoir été suivie immédiatement d'effet, puisque la question de sa succession n'est tranchée qu'après sa mort.
Charles IV meurt finalement le 1er février 1328. En l'absence de descendant mâle survivant, se pose la question de savoir qui va alors régner.
Avant sa redécouverte en 1358, on ignorait qu'il y eût une loi salique ; tous les rois avaient eu des fils, et du fait de la primogéniture masculine positionnant un frère cadet avant sa sœur ainée, les souverains avaient toujours été des hommes. Ainsi Philippe V en 1316 puis Charles IV en 1322 avaient succédé à leur frère Louis X au détriment de sa fille, Jeanne, puis de leur sœur Isabelle, après que Jean Ier avait lui-même prévalu sur Jeanne sa sœur aînée. À la mort de Charles IV en 1328, les quatre prétendants, dont trois qui se font connaître, sont donc dans l'ordre de succession :
Philippe III d'Evreux, par les droits de son épouse Jeanne de Navarre née en 1311, fille contestée de Louis X le Hutin, puis en principe à compter de 1332 au nom de leur fils Charles le Mauvais ;
Jeanne de France née en 1308, duchesse de Bourgogne, fille de Philippe V le long et de Jeanne II de Bourgogne non directement compromise dans l'affaire de la tour de Nesle 1311-1314, au nom de son fils Philippe de Bourgogne. En 1330, s'intercale, en principe, dans l'ordre de succession Marguerite de France née en 1309, duchesse de Bourgogne, sœur cadette de la précédente, au nom de son fils Louis II de Flandre, tandis que les dernières filles de Phillippe V le long, Isabelle de France †1348 et Blanche de France †1358 n'auront pas de descendance, au même titre que celles de Charles IV, Marie de France †1342 et Blanche de France †1393 ;
Édouard III d'Angleterre, par les droits de sa mère Isabelle de France, fille de Philippe IV le bel ;
Philippe VI de Valois, par les droits du plus proche héritier mâle, neveu de Philippe IV le bel.
Tous les candidats qui devaient leur prétention successorale à une princesse de France furent écartés pour le motif qu'une femme qui n'a pas le droit de monter sur le trône ne peut pas transmettre ce droit. Cette succession contestée par le roi d'Angleterre fut une des raisons principales de la guerre de Cent Ans, alors que même en mettant en doute la légitimité de Jeanne II de Navarre, dans le cas d'une transmission directe de la couronne d'une princesse de France à son fils, Philippe de Bourgogne précédait Édouard III dans la ligne de succession à la date de la mort de Charles IV. Une telle règle aurait également été une source de conflit, dans le cas où le fils d'une fille cadette ayant accèdé au trône, son ainée aurait ultérieurement donnée naissance à un fils, auquel le roi aurait dû de son vivant restituer la couronne, ce qui aurait justement pu se produire avec la naissance de Charles le Mauvais quatre ans plus tard en 1332, lequel s'engagera d'ailleurs dans une vaine lutte avec le futur Charles V jusqu'à sa défaite à Cocherel en 1364.
Philippe de Valois, cousin germain de Charles IV, devint ainsi roi de France par primogéniture masculine sous le nom de Philippe VI. Il restitua la Navarre à laquelle il ne pouvait prétendre à son héritière légitime, Jeanne II, qui avait épousé en 1317 son cousin Philippe d'Evreux, roi de Navarre sous le nom de Philippe III de Navarre.
À la condition d'exclure Charles le Mauvais, qui abandonna en 1365 ses droits pour lui et ses successeurs, à la mort de Louis II de Flandre en 1384, c'est son petit fils Jean sans Peur né en 1371 qui, par l'intermédiaire de sa mère Marguerite de Male comtesse de Flandre, revendiqua à son tour la couronne de France concurremment avec le roi d'Angleterre. En effet, Philippe de Bourgogne n'avait plus d'héritier mâle à cette date, suite à la mort prématurée de son fils sans descendance, en 1361. Devenu duc de Bourgogne en 1404, Jean sans Peur déclenchera la Guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons en faisant assassiner en 1407 Louis Ier d'Orléans, frère du roi Charles VI.
Ascendance de Charles IV de France 1294-1328
Père de Thomas de La Marche
Charles le Bel est parfois considéré comme le père de Thomas de La Marche 1318-1361, capitaine, né de Béatrice La Berruère. Il est plus vraisemblablement le fils naturel de Philippe VI de Valois-         
Posté le : 31/01/2015 18:42
|
|
|
|
|
Anne de Bretagne |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 25 janvier 1477 à Nantes naît Anne de Bretagne

de la maison de Montfort, morte le 9 janvier 1514 à 36 ans à Blois, duchesse de Bretagne et comtesse de Montfort 1488-1514 et d'Étampes 1512-1514 et, par ses mariages, archiduchesse consort d'Autriche, reine consort de Germanie 1490-1491, puis de France 1491-1498, puis de nouveau reine consort de France 1499-1514 et de Naples 1501-1503 et duchesse consort de Milan 1499-1500 et 1500-1512.
Elle était la fille de François II de Bretagne 1435-1488, duc de Bretagne, et de sa seconde épouse Marguerite de Foix v. 1449-1486, princesse de Navarre.
Elle a pour conjoint Maximilien de Habsbourg en 1490, mariage annulé, puis Charles VIII de France mariage de 1491 à 1498, puis Louis XII de France de 1499 à 1514
Ses enfants sont Charles-Orland de France,dauphin de France, claude de France, Renée de France.
Elle fut duchesse de Bretagne, comtesse de Montfort du 9 septembre 1488 au 9 janvier 1514, soit durant 25 ans, 4 mois, Couronnement le 10 février 1489, son prédécesseur est François II, son successeur est Claude de France. Elle est archiduchesse consort d'Autriche et reine consort de Germanie du 19 décembre 1490 au 6 décembre 1491, pendant 11 mois et 17 jours sous Maximilien Ier d'Autriche, son prédécesseur à ce rang est Catherine de Saxe et son successeur est Blanche-Marie Sforza. Elle est ensuite reine consort de France du 6 décembre 1491 au 7 avril 1498 soit pendant 6 ans, 4 mois et 1 jour, le monarque qui la précède à cette distinction est Charles VIII, son prédécesseur est Charlotte de Savoie, son successeur est Jeanne de France, du 8 janvier 1499 au 9 janvier 1514 pendant 15 ans et 1 jour, le monarque est Louis XII
son prédécesseur est Jeanne de France, son successeur Marie d'Angleterre. Elle est duchesse consort de Milan du 6 septembre 1499 au 5 février 1500 pendant donc 4 mois et 30 jours, du 17 avril 1500 – 16 juin 1512 donc 12 ans, 1 mois et 30 jours, prédécesseur, Béatrice d'Este, successeur Claude de France. Elle est reine consort de Naples du 1er août 1501 au 29 décembre 1503 sur une période donc de 2 ans, 4 mois et 28 jours, prédécedée par Isabelle des Baux, son successeur est Isabelle Ire de Castille. Elle est Comtesse d'Étampes du 11 avril 1512 au 9 janvier 1514, pendant 1 an, 8 mois et 29 jours, son prédécesseur est Gaston de Foix-Nemours, son successeur est Claude de France.
Elle est un enjeu central dans les luttes d’influence qui aboutiront après sa mort à l’union de la Bretagne à la France. Elle a également été élevée dans la mémoire bretonne en un personnage soucieux de défendre le duché face à l'appétit de ses voisins.
En bref
Fille de François II, duc de Bretagne, et de Marguerite de Foix, Anne devint duchesse de Bretagne à la mort de son père conformément à une décision prise par les états convoqués à cette fin en 1486. Par le traité du Verger 19 août 1488, le roi Charles VIII avait donné son accord et François II avait promis de soumettre au consentement royal le futur mariage d'Anne. Celle-ci avait été fiancée, à l'âge de trois ans, à un prince anglais. Mais c'est avec Maximilien de Habsbourg qu'elle se maria, par procuration, en 1490. Charles VIII rappela les clauses du traité du Verger et envahit la Bretagne. Il obtint alors la main d'Anne pour lui-même et négocia avec le pape l'annulation de ses propres fiançailles avec une fille de Maximilien et celle du mariage d'Anne avec le même Maximilien. Le mariage du roi de France et de la duchesse fut célébré le 6 décembre 1491.
Le contrat prévoyait que la duchesse, si elle survivait à son mari, épouserait son successeur. Roi en 1498, Louis XII se hâta de faire annuler son mariage — passablement contraint — avec la boiteuse Jeanne de France, fille de Louis XI. Puis il épousa la duchesse-reine Anne (1499). Parce qu'elle était déjà reine douairière, celle-ci put alors poser ses conditions : elle conserva le gouvernement de la Bretagne et se réserva de transmettre le duché à ses propres héritiers collatéraux si elle ne laissait pas d'enfants de son royal mari.
Politique habile et courageuse, Anne de Bretagne administra le duché avec sagesse et fermeté. À la cour de France, elle protégea les poètes et les artistes, qui contribuèrent à assurer sa renommée. Il est inexact de dire qu'Anne réalisa l'union de la Bretagne à la France. À sa mort en 1514, le duché fut immédiatement cédé par Louis XII à François d'Angoulême (le futur François Ier), qui avait épousé la fille de Louis XII et d'Anne, Claude de France. C'est celle-ci qui fit don du duché à son mari en 1515, mais ce n'est qu'en 1532 que les états de Vannes acceptèrent définitivement l'union du duché à la couronne.
Sa vie
Anne de Bretagne naît le 25 janvier 1477 ou le 15 janvier 1477 ancien style au château des ducs de Bretagne à Nantes.
De l'éducation d'Anne de Bretagne, on conserve peu de traces. D'intelligence moyenne, il est probable qu’elle reçoit l’éducation d’une jeune noble de son temps : elle apprend à lire et à écrire en français, peut-être un peu de latin. Contrairement à ce que l’on retrouve parfois, il est peu probable qu’elle ait appris le grec ou l’hébreu et n'a jamais parlé ni compris le breton, langue à laquelle les milieux nantais où elle évolue sont étrangers. Elle est élevée par une gouvernante : Françoise de Dinan, comtesse consort de Laval. Elle a plusieurs précepteurs, tel son maître d'hôtel, le poète de cour Jean Meschinot, de 1488 à la mort de celui-ci en 1491, qui, lors des loisirs d'Anne, va chasser au faucon avec elle. On lui aurait peut-être enseigné la danse, le chant et la musique.
Héritière de Bretagne
En cette période, la loi successorale est imprécise, établie principalement par le premier traité de Guérande en 1365 par Jean IV. Celle-ci prévoyait la succession de mâle en mâle dans la famille des Montfort en priorité ; puis dans celle de Penthièvre. En effet, côté Montfort, il ne reste qu'Anne puis Isabeau et côté Blois-Penthièvre, Nicole de Penthièvre. Or en 1480, Louis XI achète les droits de la famille de Penthièvre pour 50 000 écus. Anne de Beaujeu confirme cette vente en 1485 à la mort de Jean de Brosse, mari de Nicole de Penthièvre.
Pour la succession du duc François II, le manque d’un héritier mâle menaçait de replonger la Bretagne dans une crise dynastique voire de faire passer le duché directement dans le domaine royal. François II étant en résistance contre les prétentions du roi de France il décide de faire reconnaître héritière sa fille par les États de Bretagne malgré le traité de Guérande. Ceci a lieu en 1486 et accroit les oppositions au duc dans le Duché, la concurrence des prétendants au mariage avec Anne de Bretagne et mécontente l'entourage du roi de France.
Fiançailles
En mariant sa fille, François II comptait renforcer sa position contre le roi de France. La perspective de joindre le duché à leur domaine a ainsi permis successivement d'obtenir l'alliance de plusieurs princes d'Europe :
elle fut d'abord fiancée officiellement en 1481 au prince de Galles Édouard, fils du roi Édouard IV d'Angleterre. À la mort de son père, il fut brièvement roi en titre sous le nom d’Édouard V et disparut peu après mort probablement en 1483.
Henri VII d'Angleterre, 1457-1485-1509, alors détenu en Bretagne, mais ce mariage ne l'intéressait pas.
Maximilien Ier d'Autriche, roi de Germanie et archiduc d'Autriche, futur empereur romain germanique 1449-1508-1519, veuf de Marie de Bourgogne, héritière de Charles le Téméraire.
Alain d'Albret, fils de Catherine de Rohan et de Jean Ier d'Albret, époux de Françoise de Châtillon donc héritier possible, cousin et allié de François II, que Anne refusera toujours d'épouser en raison du dégoût qu'il lui inspire.
Louis, duc d'Orléans, cousin germain du roi Charles VIII et futur roi Louis XII 1462-1498-1515, mais il était déjà marié à Jeanne de France.
Jean de Chalon, prince d'Orange 1443-1502, neveu de François II petit-fils de Richard d'Étampes et héritier présomptif du duché après Anne et Isabeau.
Edward Stafford, duc de Buckingham 1478-1521, Henri VII envisage son mariage avec Anne.
Le vicomte Jean II de Rohan, autre héritier présomptif, proposa avec le soutien du maréchal de Rieux le double mariage de ses fils François et Jean avec Anne et sa sœur Isabeau, mais François II s'y opposa.
Mariages
En 1488, la défaite des armées de François II à Saint-Aubin-du-Cormier qui conclut la guerre folle le contraint à accepter le traité du Verger dont une clause stipule que François II ne pourra marier ses filles sans le consentement du roi de France.
À la mort de François II quelques jours plus tard, s’ouvre une nouvelle période de crise qui mène à une dernière guerre franco-bretonne, le duc, sur son lit de mort, ayant fait promettre à sa fille de ne jamais consentir à l'assujettissement au royaume de France. Avant de mourir, François II a nommé le maréchal de Rieux tuteur de sa fille, avec pour mission de la marier. Dans la cathédrale de Rennes le 19 décembre 1490, Anne, devenue duchesse, épouse en premières noces et par procuration le futur Maximilien Ier devenu par la suite empereur romain germanique, veuf et qui était alors titré roi des Romains. Ce faisant, elle devient reine, conformément à la politique de son père. Cependant, ce mariage est une grave provocation à l'égard du camp français qui considère qu'il viole le traité du Verger, il réintroduit un ennemi du roi de France en Bretagne, ce que leur politique a toujours tenté d’éviter aux XIV et XVe siècles. De plus, il est conclu au mauvais moment : les alliés de la Bretagne sont occupés sur un autre front siège de Grenade pour le roi de Castille, succession de Hongrie pour Maximilien d’Autriche qui rend la procuration inopérante pendant neuf mois.
En dépit de renforts anglais et castillans venus soutenir les troupes ducales, le printemps 1491 voit de nouveaux succès de La Trémoille déjà vainqueur à Saint-Aubin-du-Cormier, et, se posant en héritier, Charles VIII vient mettre le siège devant Rennes où se trouve Anne, afin qu’elle renonce à ce mariage avec l’ennemi du royaume de France.
Après deux mois de siège, sans assistance et n'ayant plus aucun espoir de résister, la ville se rend et Charles VIII y fait son entrée le 15 novembre, les deux parties signant le traité de Rennes, mettant fin à la quatrième campagne militaire des troupes royales en Bretagne. Anne ayant refusé toutes les propositions de mariage avec des princes français, les fiançailles avec Charles VIII sont célébrées à la chapelle des Jacobins de Rennes le 17 novembre 1491. Puis Anne de Bretagne se rend, escortée de son armée et donc libre, ce qui était important pour la légitimité du mariage et du rattachement de la Bretagne jusqu'à Langeais pour les noces des deux fiancés. L'Autriche combat désormais sur le terrain diplomatique notamment devant le Saint-Siège, soutenant que la duchesse vaincue a été enlevée par le roi de France et que leur descendance est donc illégitime.
Le 6 décembre 1491 à l'aube, Anne épouse officiellement dans la grande salle du château de Langeais le roi de France Charles VIII. Ce mariage discret est conclu en urgence car il n'est validé qu'après coup par le pape Innocent VIII qui se décide, en échange de concessions appréciables, à adresser à la cour de France le 15 février 1492 l’acte d’annulation antidaté du mariage par procuration d'Anne avec Maximilien et la dispense concernant la parenté au quatrième degré d'Anne et de Charles par la bulle du 15 février 1492. Le contrat de mariage comprend une clause de donation mutuelle au dernier vivant de leurs droits sur le duché de Bretagne. En cas d'absence d'héritier mâle, il est convenu qu’elle ne pourra épouser que le successeur de Charles VIII. De cette union naissent six enfants, tous morts en bas âge.
Reine consort de France Épouse de Charles VIII
Par le mariage de 1491, Anne de Bretagne est reine consort de France. Son contrat de mariage précise qu’il est conclu pour assurer la paix entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Il fait de Charles VIII son procureur perpétuel. Le 8 février 1492, Anne est sacrée et couronnée reine de France à Saint-Denis. Elle est la première reine couronnée dans cette basilique et sacrée, oincte, chef et poitrine, par André d'Espinay, archevêque de Bordeaux. Son époux lui interdit de porter le titre de duchesse de Bretagne. Gabriel Miron sera chancelier de la reine et premier médecin. Il a signé le contrat de la reine, le 1er janvier 1499, avec le roi Louis XII
Elle passe beaucoup de temps en grossesses avec un enfant tous les quatorze mois en moyenne. Lors des guerres d’Italie, la régence est attribuée à Anne de Beaujeu, qui a déjà tenu ce rôle de 1483 à 1491. Anne de Bretagne est encore jeune, et sa belle-sœur la suspecte. Elle n'a qu’un rôle réduit en France comme en Bretagne et doit parfois accepter d'être séparée de ses enfants en bas-âge. Anne vit essentiellement dans les châteaux royaux d'Amboise, de Loches et du Plessis ou dans les villes de Lyon, Grenoble ou Moulins lorsque le roi est en Italie. À Amboise, Charles VIII fait faire des travaux, tandis qu'elle réside à côté, au Clos Lucé, futur logis de Léonard de Vinci. Elle y a sa chapelle.
Elle devient reine consort de Naples et de Jérusalem lors de la conquête de Naples par Charles VIII.
Duchesse de Bretagne, épouse de Louis XII
Dès la mort de Charles VIII, héritière des droits des rois de France sur la Bretagne, elle reprend la tête de l'administration du duché de Bretagne. Elle restaure notamment la chancellerie de Bretagne au profit du fidèle Philippe de Montauban, nomme lieutenant général de Bretagne son héritier Jean de Chalon, convoque les États de Bretagne, émet un monnayage à son nom une monnaie d'or à son effigie. Elle nomme aussi responsable du château de Brest son écuyer Gilles de Texue.
Parmi ses poètes de cour, il faut rappeler l'humaniste Fauste Andrelin de Forlì, le chroniqueur Jean Lemaire de Belges et le rhétoriqueur français Jean Marot. Elle y prend également à son service les musiciens les plus célèbres de son temps, Johannes Ockeghem, Antoine de Févin, Loyset Compère, Jean Mouton. Anne de Bretagne est sans aucun doute la première reine de France à apparaître comme une mécène recherchée par les artistes et auteurs de son époque.
Trois jours après la mort de son époux, le principe du mariage avec Louis XII est acquis, à la condition que Louis obtienne l'annulation de son mariage avant un an. Elle retourne pour la première fois en Bretagne en octobre 1498, après avoir échangé une promesse de mariage avec Louis XII à Étampes le 19 août, quelques jours après le début du procès en annulation de l’union entre Louis XII et Jeanne de France.
Le contrat de son troisième mariage, en 1499 est conclu dans des conditions radicalement différentes du second. À l'enfant vaincue a succédé une jeune reine douairière et duchesse souveraine désormais incontestée, en face de qui l'époux est un ancien allié, ami et prétendant. Contrairement aux dispositions du contrat de mariage avec Charles VIII, le nouveau lui reconnaît l'intégralité des droits sur la Bretagne comme seule héritière du duché et le titre de duchesse de Bretagne. Le contrat affirme aussi clairement que le duché de Bretagne reviendra au deuxième enfant, mâle ou femelle et s'il avenoit que d'eux deux en ledit mariage n'issist ou vinst qu'un seul enfant masle, que cy-après issent ou vinssent deux ou plusieurs enfans masles ou filles, audit cas, ils succéderont pareillement audit duché, comme dit est. Une clause qui ne sera pas respectée par la suite. Renée sera déshéritée au profit de son ainée, Claude de France, et surtout de son mari : François Ier. Pour le moment, le pouvoir régalien en Bretagne est exercé par Louis XII, qui prend alors le titre de duc consort, quoique les décisions soient prises au nom de la duchesse. Anne vit à Blois où la présence de la duchesse de Bretagne est partout signée. Elle fait édifier le tombeau de ses parents en la cathédrale de Nantes où son cœur reviendra également selon ses dernières volontés avec les symboles des 4 vertus : prudence, force, tempérance, justice, qu'elle aura toujours essayé de porter. Tous les arts italiens seront appréciés par cette reine de plus en plus cultivée. Durant la maladie de Louis XII elle fait un tour de la Bretagne mais pas le Tro Breizh, contrairement à ce qui est souvent raconté et les Bretons peuvent lui savoir gré d'avoir aussi longtemps que possible, maintenu les impôts seulement sur les états, les octrois sur les pays et les jugements également sur les pays.
Leur fille Claude de France, héritière du duché, est fiancée à Charles de Luxembourg en 1501, pour faciliter la conduite de la 3e guerre d’Italie en renforçant ainsi l’alliance espagnole, et pour convenir au dessein d'Anne de lui faire épouser le petit-fils de son premier mari Maximilien d'Autriche. Ce contrat de mariage est signé le 10 août 1501 à Lyon par François de Busleyden, archevêque de Besançon, Guillaume de Croÿ, Nicolas de Rutter et Pierre Lesseman, les ambassadeurs du roi Philippe Ier de Castille le Beau, père de Charles de Luxembourg. Les fiançailles sont annulées quand le risque d'encerclement plus complet du royaume peut être évité par l’absence d’un dauphin, à qui le contrat de mariage de Louis et Anne aurait interdit d'hériter de la Bretagne. C’est désormais au futur François Ier que sa fille est fiancée. Anne refusera jusqu'au bout ce mariage, qui aura lieu quatre mois après sa mort, et tentera de revenir à l'alliance matrimoniale avec le futur Charles Quint. C'est à ce moment qu'elle commence son tour de Bretagne, visitant bien des lieux qu’elle n’avait jamais pu fréquenter enfant. Officiellement il s'agit d'un pèlerinage aux sanctuaires bretons mais en réalité il correspond à un voyage politique et un acte d'indépendance qui vise à affirmer sa souveraineté sur ce duché. De juin à septembre 1505, ses vassaux la reçoivent fastueusement. Elle en profite pour s'assurer de la bonne collecte des impôts et se faire connaître du peuple à l'occasion de festivités, de pèlerinages et d'entrées triomphales dans les villes du duché.
Mort et sépulture
Écrin en or la tache sombre étant due au transfert du fer et du plomb des boîtes métalliques qui le contenaient du cœur d’Anne, musée Dobrée, Nantes.
Usée par les nombreuses maternités et les fausses couches, atteinte de la gravelle, elle meurt le 9 janvier 1514 vers six heures du matin au château de Blois, après avoir dicté par testament la partition de son corps dilaceratio corporis, division du corps en cœur, entrailles et ossements avec des sépultures multiples, privilège de la dynastie capétienne. Elle permet ainsi la multiplication des cérémonies, funérailles du corps, la plus importante et funérailles du cœur et des lieux tombeau de corps et de cœur.
La reine Anne de Bretagne est inhumée dans la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Ses funérailles sont d’une ampleur exceptionnelle : elles durent quarante jours, et inspirent toutes les funérailles royales jusqu’au xviiie siècle. À cette occasion, le héraut d'armes de Bretagne Pierre Choque prononce pour la première fois le cri funèbre : La reine est morte ! la reine est morte ! la reine est morte !.
Selon sa volonté, son cœur a été placé dans un écrin ou reliquaire en or rehaussé d’émail cette boîte en or étant enfermée dans une autre boîte en plomb puis une autre en fer puis transporté à Nantes en grande pompe pour être déposé, le 19 mars 1514, en la chapelle des Carmes, dans un coffre à la tête du tombeau de François II de Bretagne qu’elle a fait réaliser pour ses parents et transféré plus tard à la cathédrale Saint-Pierre de Nantes.
Le mausolée à double étage de Louis XII et d’Anne de Bretagne, sculpté en marbre de Carrare, est installé dans la basilique de Saint-Denis en 1830. Le dais à arcades, les bas-reliefs du socle sarcophage illustrant les victoires de Louis XII bataille d'Agnadel, entrée triomphale à Milan, les statues des douze apôtres et des quatre vertus cardinales sont l'œuvre des frères Juste, sculpteurs italiens qui en ont reçu la commande en 1515. Les transis dont le réalisme a poussé à faire figurer sur leur abdomen l'ouverture recousue pratiquée lors de leur éviscération et les orants devant un prie-Dieu couronnant la plate-forme sont attribués à Guillaume Regnault. Ce tombeau est profané pendant la Révolution, le 18 octobre 1793, leurs corps étant jetés dans une fosse commune. Alexandre Lenoir sauve en grande partie le monument qui est restauré et conservé dans le Musée des monuments français en 1795 avant d'être restitué à la basilique royale sous la Seconde Restauration, où se trouve l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne
Généalogie
Ascendance
Jean IV
1339-1345-1399
Jeanne de Navarre
1370-1437
Richard 1395-1438
Comte d'Étampes
Marguerite d'Orléans et Gaston IV de Foix-Béarn
Éléonore de Navarre
Marguerite de Bretagne
1443-1469
François II
1433-1458-1488
Marguerite de Foix
-1486
Jean de Chalon
1443-1502 Anne de Bretagne
1477-1514 Isabeau de Bretagne
Claude de France
Descendance
De son mariage avec Charles VIII elle eut de nombreuses fausses couches et six enfants, tous morts en bas âge:
Charles-Orland de France 1492 - 1495, mort de la rougeole à 3 ans.
François Courcelles, août 1493 - idem, né à deux mois de son terme, inhumé en l'église Notre-Dame de Cléry
N, fille mort-née printemps 1495
Charles de France 1496
François de France 1497 - 1498
Anne 20 mars 1498
Des quatre enfants issus de son mariage avec Louis XII, seules survécurent :
Claude de France 1499-1524, duchesse de Bretagne et reine consort de France 1515-1524 par son mariage en 1514 avec François Ier, roi de France ;
Renée de France 1510-1575, dame de Montargis, duchesse de Chartres 1528-? - Mariée en 1528 avec Hercule II d'Este 1508-1559, duc de Ferrare, de Modène et de Reggio.
Chaque fausse-couche ou mort d'un enfant mâle de la reine ravit l'ambitieuse Louise de Savoie, dont le fils François futur roi François Ier est l'héritier présomptif de la couronne en vertu de la loi salique. Aussi l'inconscient public entoure Louise d'une aura de sorcière capable d'avoir tué les nourrissons mâles d'Anne de Bretagne.
Par Claude de France, dont la fille aînée Marguerite a épousé le duc de Savoie, Anne de Bretagne est l'ancêtre de Victor-Emmanuel de Savoie, actuel prétendant au trône d'Italie. Par son petit-fils Henri II de France, Anne est aussi l'ancêtre de Charles de Habsbourg-Lorraine, actuel prétendant au trône d'Autriche-Hongrie.
Par Anne d'Este, fille aînée de Renée de France, Anne de Bretagne eut également descendance, notamment dans la Maison de Guise et celle de Savoie-Nemours.
Généalogie simplifiée
Ses emblèmes et devises
Blason d'Anne de Bretagne, les armes de son époux royal fleurs de lys à dextre, celles de son père queues d'hermine à senestre.
Anne avait hérité de ses prédécesseurs les emblèmes dynastiques bretons : hermine passante de Jean IV, d'hermine plain de Jean III, cordelière de François II. Veuve de Charles VIII, elle s'inspire de cette figure paternelle pour créer en 1498 l'Ordre de la Cordelière.
Lettres couronnées L A de Louis XII et d'Anne avec leurs armes d'alliance entourées du collier de Saint-Michel et de la cordelière.
Elle fit usage aussi de son chiffre, la lettre A couronnée, de la devise Non mudera je ne changerai pas, et d'une forme particulière de la cordelière paternelle, nouée en 8. Ses emblèmes furent joints dans la décoration de ses châteaux et manuscrits avec ceux de ses maris : l'épée enflammée pour Charles VIII et le porc-épic pour Louis XII. Elle avait également comme devise Potius Mori Quam Foedari : "Plutôt mourir que déshonorer", ou "Plutôt la mort que la souillure" en breton : "Kentoc'h mervel eget bezañ saotret".
On retrouve son blason dans de nombreux lieux où elle est passée ou liés à ses fonctions principalement de duchesse ou de reine :
le revêtement mural de la mise au tombeau à l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes, par Michel Colombe, 1496 ;
vitrail de l’église de Ervy-le-Châtel, 1515;
vitrail de l’hôtel de ville d’Étampes, 1853.
Sa bibliothèque
La reine possédait sa propre bibliothèque contenant une cinquantaine d’ouvrages sur la religion, la morale, l’histoire, etc.. On y trouve notamment des livres d'heures les Grandes Heures, les Petites Heures, les Très Petites Heures, les Heures, inachevées, la Vie de sainte Anne, les Vies des femmes célèbres de son confesseur Antoine Dufour, la Dialogue de vertu militaire et de jeunesse française. Le Livre d’heures d’Anne de Bretagne, illuminé par Jean Poyer, est commandé par Anne pour Charles-Orland, etc.
Une partie venait de ses parents. Elle en a commandé elle-même plusieurs et quelques-uns lui ont été offerts. Enfin, ses deux maris possédaient aussi des nombreux ouvrages environ un millier sont ramenés à la suite de la première guerre d’Italie.
Elle a elle-même écrit de nombreuses lettres.
Ses Grandes Heures
Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne est un livre de prières commandité par Anne de Bretagne à l'enlumineur Jean Bourdichon.
Postérité
Dernière duchesse de Bretagne et deux fois reine de France, Anne de Bretagne est avec saint Yves un des personnages historiques les plus populaires de Bretagne.
En 2014, pour le 500e anniversaire de sa mort, plus d’une quarantaine d’événements sont organisés dans les cinq départements bretons39.
Représentations
Statue d’Anne de Bretagne dans la série Reines de France et Femmes illustres du jardin du Luxembourg à Paris XIXe siècle.
Représentations d'Anne de Bretagne.
De son vivant, les propagandes royales de Charles VIII puis de Louis XII ont présenté Anne de Bretagne en reine parfaite, symbole de l’union et de la paix entre le royaume de France et le duché de Bretagne tradition populaire de la bonne duchesse. L’Autriche de Maximilien, évincée du mariage, a porté un autre regard sur ces événements. Au cours des siècles, les historiens et l’imaginaire populaire ont présenté une Anne de Bretagne parfois différente, lui attribuant des actes ou des caractéristiques physiques et psychologiques qui ne sont pas nécessairement attestés par des éléments historiques.
Après sa mort, elle tombe progressivement dans l'oubli jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les régionalistes bretons cherchent, dès la fondation en 1843 de l’Association bretonne, un personnage capable d’incarner leur idéal de renouveau agraire et régional, tout en manifestant leur attachement à la nation française. Leur choix se porte sur Anne de Bretagne, qui est progressivement dotée, dans les histoires de Bretagne, du costume breton d'où la légende de la duchesse en sabots.
Plusieurs mythes entourent désormais Anne de Bretagne, celui d'une femme contrainte à un mariage forcé avec Charles VIII, celui d'une duchesse bretonne attachée à l’indépendance et au bonheur de son duché ou au contraire d'une reine symbole de l'union et de la paix entre la Bretagne et la France. Elle est ainsi devenue un enjeu entre des historiens bretons qui poursuivent une mythification de leur passé et une historiographie nationale voulant forger le mythe d'une nation française une et indivisible.
Cette figure hautement symbolique explique la parution d'une cinquantaine de livres à son sujet depuis 200 ans qui n'ont pas fini d'en donner une vision contrastée, entre un Georges Minois qui la présente comme une personne bornée, mesquine et vindicative et un Philippe Tourault qui en fait une personnalité tout à fait riche et positive, ardemment attachée à son pays et à son peuple .
Ouvrages
Anne de Bretagne, reine de France. Tragédie par le sieur Ferrier, par Louis Ferrier de La Martinière, édité chez Jean Ribou, 1679
Le prince de Longueville et Anne de Bretagne, nouvelles historiques, Pierre de Lesconvel, édition J. Guignard, 1697
Télévision
Borgia série TV, interprétée par Héléna Soubeyrand saison 2, épisodes 7 et 8.
Isabel série TV, interprétée par Marta Belmonte
Théâtre
Je ne t'oublierai jamais, comédie romanesque sur la rencontre de Anne de Bretagne et Hervé de Portzmoguer, dit Le Primauguet, Pièce de Bruno Tanguy.
Musique
Requiem d'Anne de Bretagne, messe composé par Antoine de Févin.
Gilles Servat évoque sa vie dans la chanson Koc'h ki gwenn ha koc'h ki du.
Anne de Bretagne, un opéra breton avec en rôle-titre Agnès Bove.
Si mort a mors, poème anonyme datant de ses funérailles, et repris par Tri Yann. D'autres chansons du répertoire du groupe font référence à la Duchesse notamment l'instrumental Anne de Bretagne de l'album Portraits en 1995.
Anne de Bretagne, opéra folk rock de l'auteur-compositeur nantais Alan Simon, dont les deux premières représentations ont eu lieu les 29 et 30 juin 2009 au château des ducs de Bretagne, à Nantes. Cécile Corbel y interprète le rôle d'Anne de Bretagne44.
Soldat Louis dans la chanson C'est un pays évoque une duchesse encore enfant qui s'est fait mettre d'une manière royale.
Le groupe Stetrice l'évoque en chantant « Mais ici honte à qui délaisse la volonté de la Duchesse dans sa chanson Naoned e Breizh, de l'album éponyme en 2011.
Bâtiments Sites historiques
Le château des ducs de Bretagne, à Nantes est conçu comme une forteresse dans le contexte de la lutte pour l'indépendance du duché de Bretagne. Le système défensif du château est composé de sept tours reliées par des courtines et un chemin de ronde. Depuis le début des années 1990, la ville de Nantes a mis en œuvre un programme de restauration et d'aménagement de grande envergure pour mettre en valeur ce site patrimonial en plein centre-ville, emblématique de l'histoire de Nantes et de la Bretagne. L'édifice restauré accueille le musée d'histoire de Nantes installé dans 32 salles.
La tour Anne-de-Bretagne à Montfort-l'Amaury.
Le manoir de la vicomté, dit Le Bailliage à Montreuil-l'Argillé Eure datant du xve siècle est, depuis 1949 inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Le manoir aurait été un pavillon de chasse, propriété d'Anne de Bretagne et de Louis XII.
L'église Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury. Construite à la demande d'Anne de Bretagne
La tour Anne-de-Bretagne, tour du xve siècle, construite à Montfort-l'Amaury Yvelines, classée monument historique en 1862. La duchesse Anne de Bretagne séjourna cinq ans à Montfort-Lamaury
L'église Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury Yvelines : Église des xve et xvie siècles, d’une taille impressionnante et rare pour une petite cité, construite par la volonté d'Anne de Bretagne en lieu et place d’une église médiévale du XIe siècle.
Les Bains de la Reine dénommés aussi pavillon d'Anne de Bretagne, à Blois, classé aux monuments historiques.
Autres sites
Nombre de noms de rues, lieux et bâtiments portent son nom :
Rues Anne-de-Bretagne ou duchesse-Anne un peu partout en Bretagne, mais aussi à Langeais. Boulevard de la Duchesse-Anne à Rennes.
Place Duchesse-Anne à Nantes, ainsi qu'à Quiberon.
Les maisons d'Anne de Bretagne, à Guingamp, Morlaix, Saint-Malo et quelques autres villes, sont supposées avoir accueilli la duchesse lors de son tour de Bretagne et non le Tro Breizh, ce pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne étant confondu avec celui du Folgoët qu'elle réalise le 29 août 1505 en exécution d'un vœu si le roi guérissait, pèlerinage prolongé par le tour de la Bretagne pendant trois mois.
Lycée Anne-de-Bretagne à Locminé.
Collège Anne-de-Bretagne à Rennes, à Saint-Herblain.
Écoles :
École publique de la Duchesse Anne à Rennes.
École publique Anne de Bretagne, à Locronan
Pont Anne-de-Bretagne à Nantes.
Hôtels :
de la Duchesse-Anne à Nantes, Dinan et Ouessant.
Anne de Bretagne à Saint-Malo, Rennes, La Plaine-sur-Mer et Vannes.
Festival Anne de Bretagne à Blain.
Maison, rue et centre commercial Anne-de-Bretagne à Lesneven, où elle séjourna quelques jours lors de son pèlerinage au Folgoët.
Hors de Bretagne :
à Blois :
Hôtel Anne de Bretagne.
Hôtel de la Duchesse Anne à Langeais, Lourdes, à Mount Tremper (près de Woodstock, État de New York, États-Unis).
Chocolaterie La Duchesse Anne à Saumur.
Objets Liés à la vie d'Anne
En 1505, la reine Anne fit cadeau de trois couronnes de mariage :
une couronne d'or à la collégiale de Guérande
une couronne d'argent à la paroisse de Saillé commune de Guérande
une couronne de bronze doré à la paroisse de Trescallan ancienne paroisse de Guérande aujourd'hui sur la commune de La Turballe. Cette dernière est classée au titre des monuments historiques.
On attribue à Anne de Bretagne le don du grand calice présent dans le trésor de Saint-Jean-du-Doigt.
Créés ou nommés en hommage à Anne
Le Duchesse Anne est un voilier trois-mâts amarré en tant que bateau musée dans le musée portuaire de Dunkerque.
Un timbre à son effigie est édité par La Poste début 2014 pour marquer le 500e anniversaire de sa mort50 .
Nourriture et boissons
Duchesse Anne, nom d'une bière produite en Bretagne par la brasserie Lancelot.
Étiquette de camembert dans les années 1930
Cuvée de vin par l’Ordre des Chevaliers BretvinsNote 10 créée en 2014
Croyances populaires
Contrairement à une croyance populaire, la gratuité des routes en Bretagne n'est pas due à Anne de Bretagne, mais au Comité d'étude et de liaison des intérêts bretons Celib, créé en 1949. Le plan routier breton proposé par le Celib dans le cadre du deuxième plan français d'aménagement du territoire est mis en place par le comité interministériel d'aménagement du territoire du 9 octobre 1968, qui valide la création d'un réseau à quatre-voies moderne, sans péages, destiné à compenser la géographie péninsulaire bretonne.
          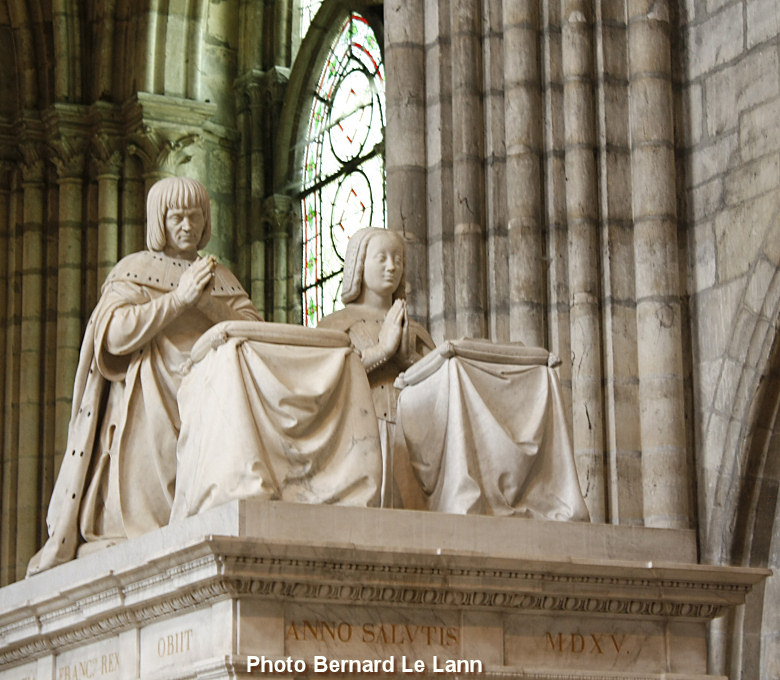 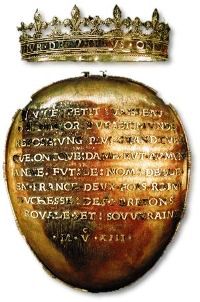
Posté le : 24/01/2015 16:59
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
131 Personne(s) en ligne ( 79 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 131
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages