|
|
Pierre Minuit |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 24 Mai 1625 Pierre Minuit, Achète l'île de Manhattan
dite Manna Hata, aux indiens Algonquins pour la somme de 60 florins soit environ 30 dollars. Il conclut cet achat pour la compagnie des indes occidentales, Il fondera la colonie de La Nouvelle-Amsterdam. Les Anglais s'empareront ensuite de ce territoire en 1664 et la rebaptiseront New York en l'honneur du duc d'York, le futur roi Jacques II.
L'île fut découverte lors de l'expédition de Henry Hudson le 11 septembre 1609.
Son nom a pour origine la langue des indiens Algonquins qui y résidait et l'appelait Manna Hata l'île aux collines. Dès 1625 des colons des pays bas, belges et français s'installent... Peu après l'île est rachetée par Pierre Minuit aux indiens - On estime le montant de cet achat à 60 florins Soit moins de 30$.
La vente de l'île fut négocier sous un tulipier qui se trouvait sur l'île de Manhattan
La En février 1653, la ville naissante fut baptisée New York en l'honneur du Duc de York. New York fut également le théâtre de la guerre d'Indépendance entre Les Etats Unis d'Amérique et l'Angleterre. D'abord prise par les anglais en 1776 la ville fût ensuite restituée en 1783 après la signature du traité de Versailles proclamant la victoire des Insurgés. Plus de détails : Guerre d'Indépendance des Etats Unis d'Amérique.
Au XIXe siècle, poussée par un incroyable dynamisme économique et une immigration massive, l'île de Manhattan connut une croissance fulgurante - La population passa en effet de 60.000 âmes en 1800 à plus de 2.000.000 en 1900 ! Les premiers gratte-ciels font alors leur apparition. La première moitié du XXème siècle est marqué par la terrible Grande Dépression de 1930 qui plonge de nombreux habitants dans la misère. New York City devient après la seconde guerre mondiale la capitale culturelle des Etats Unis et la principale place financière. En savoir plus : Histoire de New York
Pierre Minuit
Peter Minuit ou Pieter Minnewit, né à Wesel vers 1580, mort à Saint-Christophe le 5 août 1638, est le 3e gouverneur de la colonie de la Nouvelle-Néerlande.
Les parents de Pierre Minuit, calvinistes wallons originaires de Tournai, s’étaient installés en Rhénanie pour fuir les persécutions religieuses alors que la ville faisait partie des Pays-Bas espagnols. Leur fils Pierre naquit alors dans le duché de Clèves car la ville de Wesel était devenue un refuge pour les protestants dès 1540.
De nombreux noms de famille sont néerlandisés à l’époque, dont Rapalje pour Rapaille ou Minnewit pour Minuit. Un autre usage courant était de donner aux gens comme patronyme le nom de la ville dont ils étaient originaires dans les Provinces-Unies des Pays-Bas.
La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales fait remplacer Willem Verhulst, gouverneur impopulaire de la Nouvelle-Amsterdam, par Minuit qui débarque sur l’île de Manhattan le 4 mai 1626. Selon la légende, Pierre Minuit se rend célèbre en achetant, le 24 mai 1626, l’île de Manhattan aux Amérindiens Manhattes, en échange de verroterie et autres colifichets, pour l’équivalent de 60 florins néerlandais, équivalant à 24/30 dollars US du XIXe siècle.
Soucieux de défendre les intérêts des colons, il se distingue par son attention à préserver aussi les intérêts des Indiens, en vertu du principe qu’une intégration harmonieuse de deux cultures vaut mieux que le rejet de la moins civilisée, qui amène, le plus souvent, des conflits.
Afin de garantir un monopole aux importations en provenance des Provinces-Unies des Pays-Bas, la compagnie des Indes occidentales interdit aux colons le tissage de la laine ou de la toile, ainsi que la fabrication de drap ou de tout autre tissu sous peine d’être bannis ou punis comme parjures.
En 1631, la compagnie néerlandaise des Indes occidentales a suspendu Minuit de son poste. L’année suivante, il est rappelé aux Provinces-Unies pour expliquer ses actions, suite aux démêlés qui l’avaient opposé au ministre de la colonie, ainsi qu’à la convoitise et aux intrigues d’un directeur de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales voulant imposer son neveu en tant que gouverneur. En août, il est licencié et remplacé comme directeur-général par Wouter van Twiller.
Son ami Willem Usselincx, également déçu par la compagnie des Indes, a attiré l’attention de Minuit sur les efforts entrepris par les Suédois en vue de fonder une colonie sur le fleuve Delaware au sud de la Nouvelle-Hollande. En 1636 ou 1637, Minuit conclut des arrangements avec en:Samuel Blommaert et la couronne suédoise pour créer la première colonie suédoise dans le Nouveau Monde et en devenir le premier gouverneur. Située sur le cours inférieur du fleuve Delaware, dans le territoire auparavant revendiqué par les Hollandais, elle reçut le nom de Nouvelle-Suède. Au printemps 1638, Minuit et sa compagnie arrivent à bord du Fogel Grip et du Kalmar Nyckel à Swedes’ Landing, Débarquement des Suédois, aujourd’hui Wilmington, Delaware. Ayant été directeur de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, et le prédécesseur du gouverneur d’alors, William Kieft, Minuit connaissait le statut des terres bordant le Delaware. Il savait que les Néerlandais avaient établi des actes pour les terres à l’est du fleuve New Jersey, mais pas pour les terres à l’ouest, le Maryland, le Delaware et la Pennsylvanie. Ils se sont donc principalement installés au Delaware où Minuit construit Fort Christina cette année.
Le Kalmar Nyckel était l'un des navires sous le commandement de Pierre Minuit lorsque la Suède était une puissance coloniale. Photo de la réplique construite en 1997, basée à Wilmington, Delaware.
En choisissant la rive ouest du fleuve, Minuit s’affranchit des contraintes territoriales imposées par les Néerlandais et il rassembla les sachems des tribus Delawares locales. Les sachems des Susquehannocks étaient aussi présents. Ils tinrent un conclave dans sa cabine sur le Kalmar Nyckel, et il persuada les sachems de signer quelques actes qu’il avait préparés afin de résoudre d’éventuels problèmes avec les Néerlandais. Ces actes ne survécurent pas. En effet, les Suédois déclarèrent que le segment de terre acquis incluait les terres à l’ouest du fleuve Sud et en dessous le fleuve Schuylkill ; en d’autres termes, l’actuelle Philadelphie, le sud-est de la Pennsylvanie, le Delaware, et le Maryland. Le sachem Delaware Mattahorn, qui était un des participants de la transaction, soutenait au contraire que la taille des terres achetées était égale à celle qu’il faut pour planter six arbres, et que le reste des terres occupées par les Suédois était volé.
Le directeur Kieft s’opposa à l’accostage des Suédois, mais Minuit ignora sa missive car il savait que les Néerlandais étaient militairement impuissants à ce moment. Minuit termina Fort Christina en 1638, puis repartit pour Stockholm pour embarquer un deuxième groupe de colons. C’est alors qu’il fit un détour par les Caraïbes à embarquer une cargaison de tabac à revendre en Europe pour rentabiliser le voyage. Un ouragan survenu à Saint-Christophe lui fut fatal. Les fonctions officielles du gouvernorat furent reprises par le lieutenant Måns Nilsson Kling, dont le grade fut élevé à celui de capitaine pendant les deux ans nécessaires au gouvernement pour nommer et envoyer le nouveau gouverneur en Amérique. Les Suédois eurent le temps de réaliser neuf expéditions à la colonie jusqu’en 1655, date à laquelle les Hollandais capturèrent la colonie.
Patrimoine
Plaque commémorative sur la cathédrale Saint-Willebrord de Wesel, en Allemagne, dont Pierre Minuit fut Diacre
Aujourd’hui, une place située à proximité de Battery Park, sur la pointe sud de Manhattan porte le nom de Pierre Minuit.
Une pierre et une plaque commémorative, "Shorakkopoch Rock", ont été élevées, à Inwood Hill Park à New York, à l'endroit où s'élevait un tulipier sous lequel, selon la légende, la vente de l'île de Manhattan a été négociée
Un peu d'histoire New York
L'histoire de New York est un résumé des grandes dates de l'histoire des États-Unis.
New York précolombien
et premiers peuplements européens
À l'origine, les Indiens occupent la place. L'endroit s'appelait Mannahatta ou l'île aux Collines. Les premiers habitants sont probablement les Lenape, une tribu de langue algonquienne.
Si Christophe Colomb découvre officiellement l'Amérique en 1492, la tranquillité des peuples algonquiens ne sera pas troublée pendant encore un siècle.
Quelques décennies après Colomb, en 1524, François Ier missionne le Florentin Verrazano pour explorer les côtes, dans le but de trouver un passage vers l'Ouest.
Durant son périple, Verrazano ne découvre pas la route vers l'Ouest, mais recense clairement la baie de New York qu'il baptise Nouvelle Angoulême. Toutefois, il ne débarquera pas.
C'est l'Anglais Henry Hudson, pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui débarque le premier dans la baie qui, désormais, porte son nom.
De La Nouvelle-Amsterdam à La Nouvelle-York
Les premiers colons affluent, et le comptoir se transforme en un village qu'ils baptisent La Nouvelle-Amsterdam. La naissance de New York se fait pacifiquement : en 1626, Peter Minuit, gouverneur de la colonie, achète l'île de Manhattan aux Indiens. Les premières relations avec les Indiens du coin sont commerciales.
Très vite, ils vont demander plus aux colons, et ceux-ci vont devoir les payer avec de l'alcool et des armes à feu en quantité.
En 1643, de premiers affrontements éclatent. Ceux-ci deviennent ensuite si fréquents qu'en 1653, Peter Stuyvesant est obligé de faire construire une palissade Wall protectrice sur ce qui correspond aujourd'hui à Wall Street.
La palissade sert aussi de protection contre les Anglais, dont la continuité territoriale des colonies est entravée par la petite colonie néerlandaise.
Les Anglais font le forcing et, en septembre 1664, ils s'emparent de la ville. La Nouvelle-Amsterdam devient La Nouvelle-York, en anglais « New York ».
La prospérité économique
et les années sombres de l'esclavage
La croissance démographique se fait raisonnablement : à la fin du XVIIe siècle, la ville de New York compte près de 20 000 personnes.
Les 11 premiers esclaves africains débarquent d'un navire hollandais en 1626 pour satisfaire le besoin de main-d'œuvre dans les plantations. En 1740, la population de New York se compose de près de 21 % d'esclaves.
En 1817, la ville et l'État de New York abolissent l'esclavage. Mais malgré cette abolition, le commerce persiste jusqu’en 1865 aux États-Unis. De plus, même libres, ces nouveaux citoyens, pour la plupart noirs ou métis, n'avaient pas la vie facile : ils sont souvent victimes de préjugés raciaux sur le marché du travail. Le 13 juillet 1863, la tension raciale se traduit par les draft riots, des émeutes anticonscription qui sont détournées en émeutes raciales contre les populations noires de la ville.
La guerre d'indépendance des États-Unis
Après la Déclaration d'indépendance et durant la guerre qui suivit, New York fut au centre de toutes les convoitises, en raison d'intérêts stratégiques et commerciaux. Les combats firent de nombreuses victimes.
De 1784 à 1790, New York assure provisoirement le rôle de capitale des jeunes États-Unis.
L'urbanisation : du port à la ville
La ville continua son extension. En 1811, le Common Council, l'équivalent de notre conseil municipal, décide d'un plan en damier. On oriente les rues d'est en ouest et les avenues du nord au sud. Seul Broadway, fait exception à la règle.
Ce n'est qu'après la construction du canal Érié en 1825 que l'intérieur de l'État commença à se développer économiquement. C'est grâce à cette croissance industrielle et agricole que les capitalistes de Wall Street firent fortune.
Le 1er janvier 1898, 40 municipalités se sont jointes à Manhattan et au Bronx pour devenir la première ville mégalopole : New York City. New York devient la ville la plus peuplée des États-Unis et la deuxième du monde après Londres.
Les premiers parcs urbains apparaissent dès 1860 : Central Park, puis Riverside Park dans Manhattan et Prospect Park à Brooklyn. Après de terribles incendies en 1835 et 1845, la ville se dote d'un corps de sapeurs-pompiers professionnels et une loi est instaurée qui oblige les propriétaires d’immeubles à construire des fire escapes, ces fameux escaliers métalliques à l’extérieur des buildings.
La ville des superlatifs
Au XIXe siècle, New York devient la ville de tous les superlatifs : la plus active, la plus riche de toutes, etc. ; son port est le plus grand du monde de 1820 à 1960. Il périclitera ensuite, victime de l’invention du conteneur, qui entraînera la délocalisation des installations portuaires dans le New Jersey. Et ruinera Brooklyn pour quelques décennies.
À la fin du XIXe siècle, tout l'argent de cette prospérité est investi. De grands projets immobiliers voient le jour. Le premier d'entre eux est la construction du pont de Brooklyn.
Les immigrants
Les tout premiers immigrants arrivent en 1624. Fuyant la misère, la famine, les persécutions politiques, raciales ou religieuses, ils sont 12 millions en un peu plus de 30 ans, de 1892 à 1924, à faire le voyage jusqu’au pied de la statue de la Liberté. Irlandais, Allemands, Italiens, juifs d’Europe centrale, tous viennent chercher en Amérique une vie meilleure.
Depuis la fin de la guerre froide, beaucoup de Russes vivent à New York.
À la fin du XIXe siècle, New York compte à elle seule 146 journaux quotidiens en une demi-douzaine de langues différentes.
La loi sèche
Après la Première Guerre mondiale, une nouvelle bataille ronge l'Amérique : celle de la lutte contre l'alcool. En 1919, la prohibition, votée par le Congrès, interdit de consommer de l'alcool sur le territoire américain. New York devient la tête de pont d'un gigantesque réseau de contrebande.
La crise de 1929
Durant l'été 1929, l'indice de référence de la Bourse monte de 110 points. Tout le monde achète, sûr de revendre plus cher rapidement. Mais, le 24 octobre 1929, le tristement célèbre Jeudi noir, les cours s'écroulent. Une vraie panique. Les ventes se succèdent à un rythme hallucinant durant 22 jours. Le krach est total.
De boursière, la crise devient économique puis sociale. Une telle crise ne pouvait manquer de favoriser la corruption.
En 1933, les New-Yorkais en ont assez et ils élisent un maire bien décidé à nettoyer tout cela. Fiorello La Guardia fait un grand ménage. Pour contrer la crise, il lance un vaste programme de construction duquel naquirent l’Empire State Building (de 1929 à 1931) et le Rockefeller Center dont l’édification débute en 1932.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, New York devient la capitale intellectuelle du monde occidental.
Une ville en pleine banqueroute
L’après-guerre est prospère du point de vue économique, comme c’est souvent le cas, mais c’est là le seul point positif. Car New York est rongée par les problèmes de logement et d’insalubrité. La ville est très sale, et des millions de rats hantent les égouts. La dégradation rapide des logements favorise la spéculation immobilière sous toutes ses formes. Peu à peu, les classes aisées désertent le centre-ville, entraînant la fermeture de nombreux commerces. L’insécurité augmente et de graves émeutes noires éclatent à Harlem durant les années 1960.
Résultat : en octobre 1975, New York échappe de peu à la faillite.
En 1989, Edward Koch fut remplacé par David Dinkins, le premier maire black. Rien d’étonnant dans une ville où les Noirs et les Hispaniques représentent la moitié de la population.
En novembre 1993, après 30 ans d’absence, les conservateurs reprennent la mairie. Rudolph Giuliani est élu maire. Il le restera jusqu’en 2001.
La renaissance de New York
Comme il l'avait promis dans sa campagne électorale, Rudolph Giuliani « nettoye » littéralement New York. Il fait tomber le parrain des Latin King et celui de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne.
Mais Giuliani ne s’attaque pas qu’aux gros poissons. Rue par rue, il reconquiert la ville en appliquant la « tolérance zéro » en matière de vandalisme. Aux antipodes de la tolérance chère aux New-Yorkais, cette politique entraîne de nombreuses bavures, mais connaît un succès indéniable, faisant de New York l’un des endroits les plus difficiles pour obtenir un permis de port d’arme et aujourd’hui la ville la plus sûre des États-Unis. Les crimes en tout genre diminuent de moitié, le nombre de meurtres chute de 60 %, les rues deviennent plus propres et près de 320 000 emplois sont créés.
Enfin, durant son premier mandat, Giuliani remet les caisses de la mairie à flot.
11 septembre 2001
Le 11 septembre 2001 marque d'une pierre noire l'entrée dans le XXIe siècle. Ce matin-là, quatre avions commerciaux américains sont détournés par des terroristes kamikazes et transformés en bombes volantes. Trois appareils atteignent leur cible : deux avions s’écrasent sur les Twin Towers, symboles de Manhattan et de la puissance économique américaine, et le troisième sur le Pentagone à Washington, symbole de sa puissance militaire. C'est la plus grosse attaque terroriste jamais commise contre un État. Le bilan est tragique et les pertes humaines sont les plus lourdes pour les États-Unis depuis la guerre du Vietnam : près de 3 000 morts et autant de blessés.
Ce qui frappe dans ces attentats, c’est la démesure de la violence et l’atteinte mondiale : 80 nationalités furent recensées parmi les victimes du World Trade Center, un des lieux les plus cosmopolites de la planète.
Les conséquences économiques de ces événements sont sévères. La zone proche des attaques est paralysée pendant de nombreuses semaines, et les cours immobiliers chutent. Les assurances enregistrent les plus grosses pertes de leur histoire, les compagnies aériennes vivent une crise financière sans précédent, sans parler du coût de la reconstruction.
L’impact psychologique est au moins aussi important : les attaques ont porté le coup de grâce à une croissance déjà moribonde en entamant la confiance de tous les agents économiques : investissements et consommation en berne, licenciements à la pelle.
L'après-11 Septembre : New York veut rebondir
Pourtant, plus que jamais, la Grosse Pomme veut croquer la vie à pleines dents, bien décidée à ne pas vivre dans le spectre du 11 Septembre. Puisant dans son exceptionnel réservoir d’énergie, la ville réagit aux incroyables défis qui se présentent à elle.
Si, sur le site du World Trade Center, un nouveau projet architectural sort de terre, la reconstruction est d’abord économique. Le 11 septembre 2001 précipite une récession déjà en embuscade. À l’arrivée à la tête de la ville de Michael Bloomberg, homme d’affaires élu grâce au parrainage de Giuliani mais surtout grâce à sa fortune, les finances municipales sont en état de crise aiguë. C’est sans compter sur le dynamisme de la ville des villes. Faisant mentir ceux qui annonçaient son déclin après September 11th, New York garde la tête haute et balaie la crise.
2011 : le come-back de New York
La nouvelle de la mort de Ben Laden en mai 2011, provoque une explosion de joie dans tous les États-Unis, et particulièrement à New York.
New York a retrouvé toute sa vitalité et son énergie créatrice. Les signes de reprise se multiplient, et la crise financière appartient désormais au passé.
Une vague écolo, encouragée par Michael Bloomberg, déferle sur la ville. La Big Apple se mue en Green Apple, une ville plus zen où l'on prend le temps de vivre, de respirer. New York renaît de ses cendres jusque dans ses boroughs, Brooklyn en tête, mais aussi le Bronx et Queens. Quant à Harlem, il devient une destination culturelle et gastronomique privilégiée.
Cependant, si New York se porte mieux, la jeunesse prend la crise de plein fouet. Le 17 septembre 2011, un millier de personnes occupent le parc Zuccotti près de Wall Street pour dénoncer les abus du capitalisme financier et le scandale des inégalités sociales. C'est le début du mouvement Occupy Wall Street, qui s'étend à l'ensemble du pays, sur le modèle des Indignés espagnols et du Printemps arabe.
L'ouragan Sandy
Fin octobre 2012, une semaine avant l’élection présidentielle, un redoutable ouragan baptisé Sandy est annoncé sur la côte est des États-Unis. New York est en ligne de mire. 500 000 New-Yorkais sont évacués, les autres, barricadés chez eux, vivent dans un calme olympien une nuit de cauchemar.
D’une violence « historique », Sandy touche de plein fouet le sud de Manhattan et certains quartiers de Brooklyn, mais épargne le nord. Une quarantaine de morts seront recensés dans la seule ville de New York et les dégâts se chiffrent en milliards de dollars. Toute la moitié sud de Manhattan se retrouve privée d’électricité plusieurs jours durant, et les transports publics, inondés, sont paralysés. Une pénurie d’essence fait rage. Même le célèbre marathon doit finalement être annulé. Quant au symbole de New York, la statue de la Liberté, elle restera fermée 8 mois…
Le retour des démocrates
Fin 2013, après trois mandats à la tête de la ville, Michael Bloomberg passe la main. De tous ses prédécesseurs, il est celui qui aura le plus marqué New York. Certes, les mauvaises langues estiment qu’il a surtout embourgeoisé la ville et accru les inégalités, mais le multimilliardaire s’est battu sur tous les fronts pour redonner à la Big Apple sa vitalité perdue après le 11 Septembre.
Il n’empêche, c’est un démocrate, quasi inconnu jusque-là, qui emporte la mairie, en prenant l’exact contre-pied de son prédécesseur. Dénonçant une ville à deux vitesses, Bill de Blasio, 52 ans, promet de s’attaquer aux inégalités sociales, de rouvrir des hôpitaux publics, de construire 200 000 logements sociaux, de taxer plus lourdement les plus riches afin de financer l’école maternelle pour tous dès 4 ans.
Dans une ville plus que jamais multiethnique, il fait de sa famille atypique un argument de campagne. Sa femme, poétesse et ancienne lesbienne, est afro-américaine, ses enfants, deux ados, sont évidemment métis. Son fils tourne même un spot de campagne pour dénoncer la pratique policière du « stop and frisk » que son père entend réformer, une arrestation arbitraire de passants avec fouille superficielle qui touche en priorité les minorités (Noirs et Hispaniques).
Bill de Blasio est élu largement, avec 73 % des voix. Un score à relativiser, seul un quart des New-Yorkais étant allé voter.           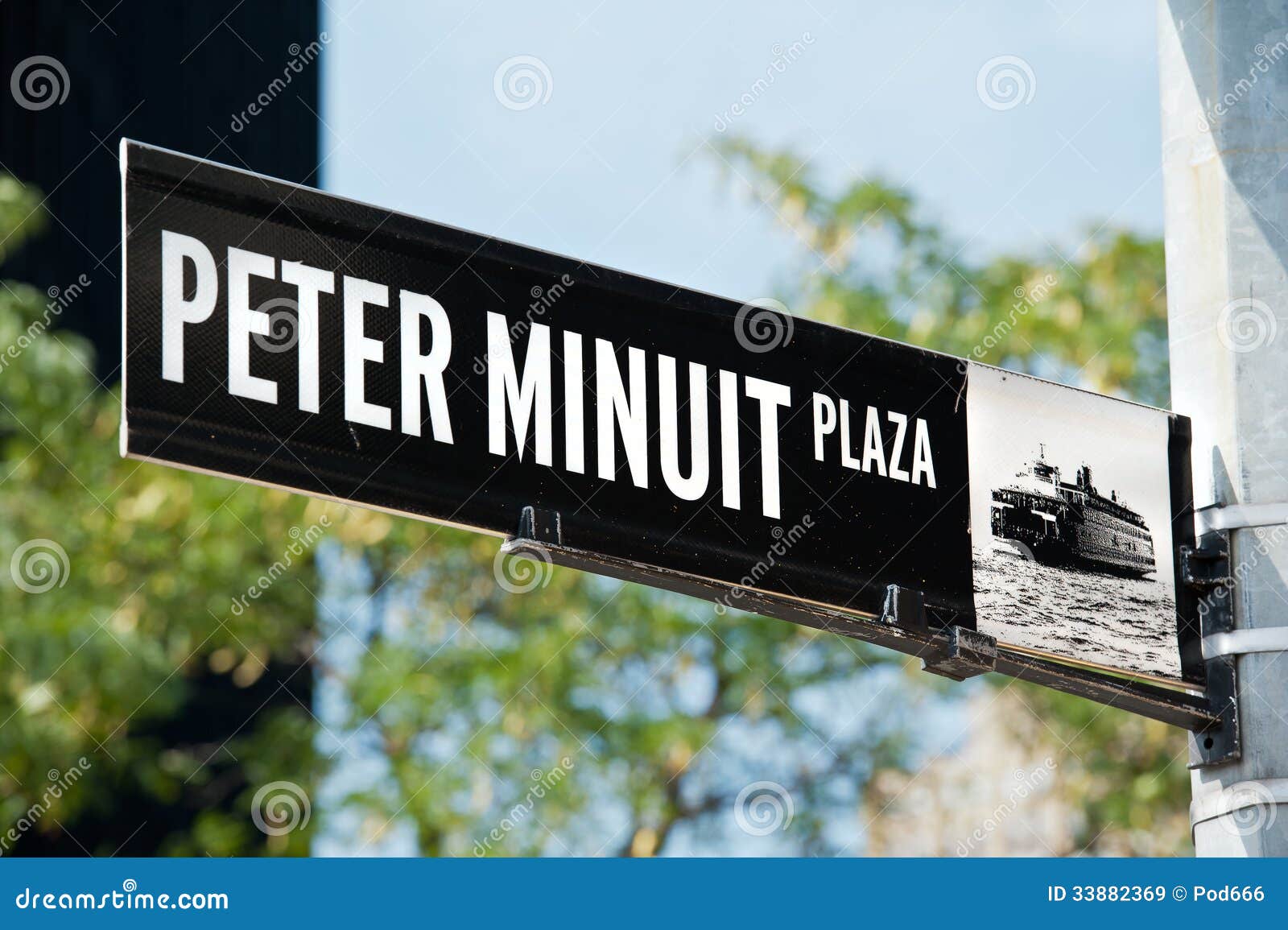  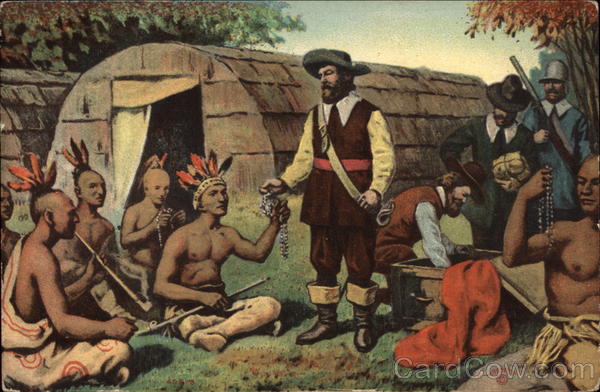
Posté le : 16/05/2015 10:58
|
|
|
|
|
Bartholomew Roberts |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 17 mai 1682 naît Bartholomew Roberts
à Casnewydd-Bach, mort le 10 février 1722,près du Cap Lopez, au Gabon, boucanier britannique de son vrai nom John Roberts, dit Le Baronnet Noir, est un des pirates les plus célèbres de son époque.
Né à Casnewydd-Bach, près de Haverfordwest dans le Pembrokeshire au Pays de Galles, on raconte qu’il a mené la carrière de pirate la plus réussie de toute l’histoire, en capturant plusieurs centaines de navires jusqu’à 22 navires en une seule prise en seulement deux ans. Le prénom qu'il a choisi pourrait être un hommage au pirate Bartholomew Sharp.
Ses premiers pas
Il est supposé avoir pris la mer à l'âge de 13 ans en 1695, mais il n'y a aucune trace de lui jusqu'en 1718, lorsqu’il est le second d'un sloop de la Barbade. En 1719, à l’âge de 37 ans, il embarque en tant que second à bord du navire Princess, destiné au transport d’esclaves, qui sera capturé en juin 1719 par le pirate Howel Davis à Anomabu près de la Côte-d'Or devenue le Ghana aujourd’hui. Six semaines après sa capture, certains parlent plutôt de quatre semaines, la flottille de Howel Davis est prise en embuscade par le gouverneur de l’île de Príncipe, Île du Prince. Au cours de la bataille, Howel Davis est lui-même tué. Bartholomew Roberts, décrit comme un homme grand et noir, a eu le temps, en quelques semaines, de montrer son talent et sa supériorité au combat ; il est alors élu capitaine du bateau pirate Royal Rover par son équipage. À cette occasion, Bartholomew Roberts aurait dit à ses hommes :
" Il vaut mieux être un commandant qu’un homme normal, puisque j’ai plongé mes mains dans l’eau boueuse et dois être un pirate."
Plus tard, il dirigera successivement le Fortune, le Royal Fortune, et le Good Fortune. Il subsiste cependant de nombreuses imprécisions sur le nombre de navires qui portèrent ces noms, on pense qu’il y aurait eu un seul Fortune, deux Royal Fortune et un seul Good Fortune.
L’âge d’or des pirates des Caraïbes Bartholomew Robert
Quittant l’île de Príncipe Île du Prince, aujourd’hui faisant partie de Sao Tomé-et-Principe, Bartholomew Roberts fait route avec le Royal Rover vers le Brésil. Au cours de ce trajet, il capture un navire hollandais et coule un navire britannique transportant des esclaves. En septembre 1720, le Royal Rover croise la route d’un convoi de 42 navires marchands portugais, escortés par deux navires de combat chacun équipé de 70 canons. Bartholomew Roberts décide d’attaquer ce convoi et capture, entre autres, un navire plus gros que le Royal Rover, à bord duquel se trouve une quantité importante de pièces d’or, d’une valeur de plus de 30 000 livres sterling. Pendant que Bartholomew Roberts se trouve à bord d’un des autres navires capturés, Walter Kennedy pirate, qui était aux commandes en l’absence de son capitaine, s’enfuit avec ce navire chargé d’or et le Royal Rover. Bartholomew Roberts donne alors au sloop sur lequel il se trouve le nom de Fortune, pille quatre autres navires et doit s’enfuir avec ce qui restait de son équipage pour échapper à un navire britannique lancé à leur poursuite.
En juin 1720, Bartholomew Roberts écume les côtes du Nouveau Monde, capturant 26 sloops et 150 bateaux de pêche et détruisant de nombreuses constructions et machines. Il capture également une galère possédant 18 canons et l’échange contre un navire français possédant 28 canons, qu’il aurait renommé Royal Fortune. Bartholomew Roberts continue ensuite sa route vers le sud et pille au moins une douzaine de navires marchands britanniques.
En septembre 1720, Bartholomew Roberts atteint les Antilles où il attaque le port de Saint Kitts. Il y capture un navire et en coule deux autres. Il quitte le port et tente d’y retourner le lendemain, mais des tirs de canon endommagent le Royal Fortune et plusieurs autres navires, les forçant à se rendre à Saint-Barthélemy afin d’y être réparés. En octobre 1720, il repart à l’attaque de Saint Kitts, où il pillera 15 navires britanniques et français.
À l’assaut de la Martinique
En janvier 1721, Bartholomew Roberts ajoute à sa flotte un navire hollandais destiné au transport d’esclaves. Il l’utilise pour tromper les habitants de la Martinique : il passe sans encombre à proximité des ports martiniquais, signalant aux Français son intention d’aller à Sainte-Lucie pour y faire du commerce d’esclaves. Installé incognito à Sainte-Lucie, Bartholomew Roberts n’a plus qu’à attendre ses proies : il capture et détruit ainsi 14 navires français. Les prisonniers sont férocement torturés, certains sont tués. L’un des navires, un brigantin, devient alors le navire amiral de la flottille, Bartholomew Roberts le baptise Good Fortune. Il capture ensuite un bâtiment de guerre français, armé de 52 canons, à bord duquel se trouve le gouverneur de la Martinique. Après avoir pendu le gouverneur, Bartholomew Roberts décide de garder son navire et le renomme Royal Fortune. Il conserve alors trois navires dans sa flotte : le Fortune, le Royal Fortune, et le Good Fortune. C’est à ce moment qu’il arrêta brutalement d’écumer la côte de la Nouvelle-Espagne, après avoir passé plus d’un an dans les Caraïbes infestées par la Royal Navy. Il traverse l’Atlantique afin de vendre ses marchandises de contrebande et piller la côte africaine.
Le pillage des côtes africaines
En avril 1721, Bartholomew Roberts devient plus tyrannique envers son équipage. Durant son trajet vers l’Afrique, le Good Fortune est volé par Thomas Anstis, qui le dirigeait alors. En juin 1721, Bartholomew Roberts atteint l’Afrique où il capture quatre navires, il n’en gardera qu’un seul, qu’il nommera le Ranger. Il met le cap vers le Liberia où il capture le Onslow, navire de la Compagnie royale d'Afrique. Ce navire avait à bord une cargaison d’une valeur de 9 000 livres sterling, Bartholomew Roberts décide de l’utiliser à la place du Royal Fortune.
Il prend ensuite pour cible la Côte d'Ivoire, où il capture au moins six navires et leur cargaison. Le 11 juin 1721, Bartholomew Roberts capture onze navires transportant des esclaves, il demandera une rançon de huit livres de poudre d’or par navire. Le capitaine de l’un des navires refuse de payer le tribut, Bartholomew Roberts coule son navire et tout ce qu’il transporte à bord, équipage et esclaves inclus. Il ajoute alors un nouveau navire à sa flotte : un bâtiment de guerre français, armé de 32 canons, qu’il renomme le Great Ranger. Il devient alors une menace pour les compagnies de commerce britanniques, qui lancent plusieurs chasseurs de pirates à sa poursuite, dont l’Hirondelle, un navire de guerre envoyé en Afrique occidentale par la couronne britannique à la poursuite des pirates, commandé par Chaloner Ogle.
La dernière bataille
Sa carrière de capitaine pirate s’arrête brutalement en février 1722 près du Cap Lopez, au Gabon. Le 5 février 1722, un bâtiment de guerre britannique, l’Hirondelle attaque la flotte de Bartholomew Roberts. À ce moment, les avis sur la fin de l’aventure divergent. Certains pensent que Bartholomew Roberts aurait confondu l’Hirondelle avec un navire marchand portugais et décide de l’attaquer. D’autres racontent que Chaloner Ogle aurait trouvé la flotte de Bartholomew Roberts ancrée sur la côte, la plupart des hommes saouls après avoir fêté une victoire de la veille ; Bartholomew Roberts aurait alors foncé avec le Royal Fortune en direction de l’Hirondelle, tentant ainsi de le prendre de vitesse avec l’aide du vent. Dans un cas comme dans l’autre, la fin de l’histoire est la même. Arrivé à portée de tir, les canons du Swallow tirent une salve, le Royal Fortune riposte. Bartholomew Roberts est tué dès la première et dernière salve : une volée de chaînes tirée d’un canon lui brise les os du cou.
Avant qu’il n’ait pu être emporté par Chaloner Ogle, le corps de Bartholomew Roberts est jeté par-dessus bord, conformément à son souhait de reposer dans la mer à tout jamais. Son équipage tente désespérément de prendre la fuite mais sera vite rattrapé et fait prisonnier. Les navires ne peuvent plus naviguer tellement les mâts et les voiles sont endommagés. Les membres d'équipage seront jugés à Cape Coast, au Ghana. 74 hommes sont acquittés, 70 pirates noirs retournent à l’esclavage, 54 pirates sont pendus et 37 sont condamnés à des peines plus légères. Peu de temps après ces événements, ce fut la fin de l’âge d'or de la piraterie.
Personnalité
Bartholomew Roberts ne correspondait pas au stéréotype du pirate. Voici certaines informations à son sujet, rapportées par certains écrits:
Il était toujours bien habillé.
Il avait d’excellentes manières.
Il ne partageait pas sa cabine avec n’importe qui et violait « uniquement » les filles de plus de 15 ans.
Il ne buvait pas d’alcool.
Il avait une excellente écriture manuscrite.
Il était toujours rasé de près.
Il aimait la musique classique et avait des musiciens à bord de son navire.
Il avait intimé l’ordre à ses hommes de jeter son corps à la mer s’il mourait dans la bataille.
Ce fut lui qui fit entrer dans l'histoire une bonne partie du fameux Code des Pirates.
Le code des pirates
I. Chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d'importance et aura un pouvoir de se servir quand il voudra des provisions et des liqueurs fortes nouvellement prises, à moins que la disette n'oblige le public d'en disposer autrement, la décision étant prise par vote.
II. Les pirates iront tour à tour, suivant la liste qui en sera faite, à bord des prises et recevront pour récompense, outre leur portion ordinaire de butin : une chemise de toile. Mais, s'ils cherchent à dérober à la compagnie de l'argenterie, des bijoux ou de l'argent d'une valeur d'un dollar, ils seront abandonnés sur une île déserte. Si un homme en vole un autre, on lui coupera le nez et les oreilles et on le déposera à terre en quelque endroit inhabité et désert.
III. Il est interdit de jouer de l'argent aux dés ou aux cartes
IV. Les lumières et les chandelles doivent être éteintes à huit heures du soir. Ceux qui veulent boire, passé cette heure, doivent rester sur le pont sans lumière
V. Les hommes doivent avoir leur fusil, leur sabre et leurs pistolets toujours propres et en état de fonction.
VI. La présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite. Celui que l'on trouvera en train de séduire une personne de l'autre sexe et de la faire naviguer déguisée sera puni de mort.
VlI. Quiconque déserterait le navire ou son poste d'équipage pendant un combat serait puni de mort ou abandonné sur une île déserte.
VIII. Personne ne doit frapper quelqu'un d'autre à bord du navire ; les querelles seront vidées à terre de la manière qui suit, à l'épée ou au pistolet. Les hommes étant préalablement placés dos à dos feront volte-face au commandement du quartier-maître et feront feu aussitôt. Si l'un d'eux ne tire pas, le quartier-maître fera tomber son arme. Si tous deux manquent leur cible, ils prendront leur sabre et celui qui fait couler le sang le premier sera déclaré vainqueur.
IX. Nul ne parlera de changer de vie avant que la part de chacun ait atteint 1000 livres. Celui qui devient infirme ou perd un membre en service recevra 800 pièces de huit sur la caisse commune et, en cas de blessure moins grave, touchera une somme proportionnelle.
X. Le capitaine et le quartier-maître recevront chacun deux parts de butin, le canonnier et le maître d'équipage, une part et demie, les autres officiers une part et un quart, les flibustiers une part chacun.
XI. Les musiciens auront le droit de se reposer le jour du sabbat. Les autres jours de repos ne leur seront accordés que par faveur.
Réutilisation
Dans le manga One Piece, l'auteur Eiichiro Oda se sert de lui pour créer Bartholomew Kuma, un des sept Capitaines Corsaires. Dans ce même manga, Mihawk alias Œil-de-faucon, un autre Corsaire, est aussi comparé à Roberts.
Dans Peter Pan, le capitaine James Crochet, créé par le dramaturge James Barrie, partage beaucoup de similarités avec le Baronnet Noir : l’élégance vestimentaire, les goûts raffinés, ainsi que les bonnes manières. On peut pousser la comparaison au fait que les deux pirates semblent suivre un certain code d'honneur, Batholomew étant à l'origine d'une bonne partie du Code des pirates, et Crochet suivant sa philosophie de la bonne et due forme ou du savoir-vivre, selon les traductions.
Il apparaît dans le jeu Assassin's Creed IV: Black Flag 2013. Il est considéré dans le jeu comme étant un Sage, c'est-à-dire une réincarnation d'Aita, un des êtres de la Première Civilisation. Il trahit le protagoniste principal pour finalement mettre la main sur un artéfact lui permettant d'assurer sa domination sur ses adversaires. Certaines de ses caractéristiques le rapprochent de sa version historique, de par le fait qu'il ne buvait pas d'alcool ou qu'il souhaitait être jeté à la mer après sa mort.
         
Posté le : 16/05/2015 09:26
|
|
|
|
|
Henri Barbusse |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 17 mai 1873, naît Adrien Gustave Henri Barbusse
à Asnières-sur-Seine, mort, à 62 ans à Moscou le 30 août 1935, écrivain français. Il reçoit le prix Goncourt en 1916
il appartient au mouvement prolétarien.
En bref
Journaliste dès l'âge de seize ans, Henri Barbusse fut d'abord influencé par le Parnasse et par le symbolisme. Ses premiers poèmes, réunis en recueil en 1894 sous le titre Le Mystère d'Adam, furent salués par Mallarmé et par Barrès. Puis cet ami de Heredia évolue vers le naturalisme, et son roman L'Enfer 1908 est une fresque sociale à la manière de Zola. La guerre vient accentuer son engagement : dès qu'elle est déclarée, ce pacifiste convaincu s'engage en première ligne, et c'est sur un lit d'hôpital qu'il écrira Le Feu 1916. Il s'agit donc du livre de guerre d'un combattant, et son sous-titre, Journal d'une escouade, indique que Barbusse souhaite donner à son témoignage la dimension collective de l'épopée. Les scènes quotidiennes des tranchées, la pluie, la faim, l'absurdité des combats et des morts sont décrits avec un réalisme dépouillé qui conquiert l'émotion. Barbusse s'intéresse uniquement aux combattants de base, cette énorme masse ignorante et méprisée par ses chefs : les soldats ne savent rien, ni ce qui les attend au combat ni même pourquoi ils combattent, pour la défense de quels intérêts. Barbusse ne mêle aucune grandiloquence à sa condamnation de la guerre, à son exaltation de la fraternité entre les hommes ; si dans ces combats se forge un idéal, ce n'est pas un idéal humaniste mais un idéal révolutionnaire qui le conduit au communisme. Chez beaucoup des combattants de la guerre resta l'espoir qu'elle serait la dernière, mais peu firent suivre cette prise de conscience d'un engagement politique et du procès de la société qui avait conduit au combat. Barbusse adhère en 1923 au Parti communiste français. Ses deux romans, Clartés 1919 et La Lueur de l'aube 1921, sont empreints de conviction révolutionnaire. En 1935, Barbusse meurt à Moscou au cours d'un voyage. Antoine Compagnon
Prix Goncourt 1916 avec le Feu, description non conventionnelle de la vie du simple soldat, il tenta, après la guerre, dans l'Humanité et dans la revue Monde, de fixer les critères d'une littérature prolétarienne .
Sa vie
Il est issu d'une famille protestante d'origine cévenole attestée au XVIIe siècle dans un hameau d'Anduze, près d'Alès. Né à la fin du siècle, il partage le pessimisme de son temps : on le voit à la mélancolie de son recueil les Pleureuses 1895, dans son roman noir l'Enfer 1908, dans ses recueils de nouvelles désenchantées datant d'avant 1914, Nous autres 1914, l'Illusion 1919, l'Étrangère 1922, Quelques coins du cœur 1921. Engagé volontaire dès le 2 août 1914, il participe longtemps à la terrible réalité de la guerre, et son livre le Feu – à la fois reportage sur une guerre concrète et atroce, création littéraire et romanesque, épopée réaliste du peuple en guerre, message pacifiste et révolutionnaire – obtient le prix Goncourt en 1916.
Dès lors, l'écrivain devient combattant social : il fonde en 1917 l'Association républicaine des anciens combattants et, en 1919, le mouvement international d'intellectuels Clarté. Il écrit trois essais politiques, la Lueur dans l'abîme, Paroles d'un combattant, le Couteau entre les dents, où il défend les idées du communisme. Mais il reste un écrivain, en publiant son roman Clarté 1919 – où dominent, dans un style expressionniste, les thèmes individuels du sexe et de la mort comme ceux de l'oppression idéologique et sociale –, sa vaste fresque historique des Enchaînements 1925 et sa trilogie religieuse sur Jésus 1926-1927, passionnante aventure poétique, mythique et épique.
Le milieu littéraire le reconnaît très jeune comme l'un des siens à la suite de sa participation remarquée au concours de poésie de L'Écho de Paris de Catulle Mendès. Son premier recueil de poèmes, Pleureuses, est publié en 1895 réédité en 1920. Il s'exerce alors professionnellement dans la presse, se tourne vers la prose et publie un premier roman, empreint de décadence et de naturalisme à la fois : L'Enfer, en 1908. En 1914, âgé de 41 ans et malgré des problèmes pulmonaires, il s'engage volontairement dans l'infanterie malgré ses positions pacifiques d'avant-guerre et réussit à rejoindre les troupes combattantes en décembre 1914 au 231e régiment d'infanterie avec lequel il participe aux combats en premières lignes jusqu'en 1916.
Par ailleurs, sa conception de l'écrivain homme public lui fait déployer une vaste activité contre l'oppression, le fascisme et la guerre, et pour le communisme, avec une foi aveugle en l'U.R.S.S. : s'enchaîneront ainsi les Bourreaux la terreur blanche dans les Balkans, 1926, le Comité Amsterdam-Pleyel contre la guerre 1933, Connais-tu Thachmann ? 1934, Russie 1930 et Staline, Un monde nouveau vu à travers un homme 1935.
La postérité se souviendra surtout du roman qu'il écrivit sur cette expérience Le Feu, prix Goncourt 1916, récit sur la Première Guerre mondiale dont le réalisme souleva les protestations du public de l'arrière autant que l'enthousiasme de ses camarades de combat. En 1917, il sera cofondateur et premier président de l'Association républicaine des anciens combattants ARAC. Il adhère au Parti communiste français en 1923 et se lie d'amitié avec Lénine et Gorki. En 1928 il fonde la revue Monde, publiée jusqu'en 1935 avec des collaborations mondiales prestigieuses.
Admirateur de la Révolution russe Le Couteau entre les dents, 1921; Voici ce qu'on a fait de la Géorgie, 1929, il anima le mouvement et la revue Clarté et chercha à définir une littérature prolétarienne.
Il fonde Monde 1928-1935, revue indépendante de tout parti, qui se heurte à divers sectarismes. Bienveillant mais prudent à l'égard de la littérature prolétarienne, il préfère laisser à chaque créateur ses responsabilités artistiques. Cela ne l'empêche pas d'avoir ses conceptions personnelles, dans le sens d'un réalisme qui dépasserait celui de Zola 1932.
Il fut l'un des instigateurs du mouvement pacifiste Amsterdam-Pleyel, dont il devient le président avec Romain Rolland et auquel adhéra notamment Albert Camus, dès la prise du pouvoir d'Hitler en Allemagne. Il fit plusieurs voyages en URSS et écrivit une biographie de Staline 1935. C'est à l'occasion d'un de ces voyages qu'il décède à Moscou le 30 août 1935. Selon Arkadi Vaksberg, il serait mort empoisonné, sur l'ordre de Staline. Lors de ses funérailles à Paris, la population parisienne lui rendit un dernier hommage particulièrement important.
Durant les dix dernières années de sa vie, il diversifie dans ce sens sa production : Force Trois films 1926 tente de fonder un renouveau d'écriture à la fois sur l'art cinématographique et sur le récit idéologique, Faits divers 1928 est sans fiction,
Élévation 1930 mêle l'homme-point et l'homme-monde. On ne peut manquer de trouver de l'intérêt à cet ensemble de préoccupations idéologiques et esthétiques. Barbusse est un écrivain qui a poussé le plus loin qu'il a pu la convergence entre questions artistiques et sollicitations politiques.
Il a été marié à Hélyonne, fille de Augusta Holmès et Catulle Mendès.
Henri Barbusse est enterré au cimetière du Père-Lachaise division 97, près du mur des Fédérés.
Un musée lui est dédié à Aumont-en-Halatte Oise.
Soutien de l'espéranto
Barbusse n’était pas espérantiste, simplement sympathisant. En 1922 paraît la brochure de SAT For la Neŭtralismon ! A bas le Neutralisme, écrite par Eugène Lanti - le fondateur de SAT- pour justifier l’existence du mouvement espérantiste des travailleurs, séparé du mouvement neutre. Sur la page de titre de cette brochure se trouve la citation suivante de Barbusse : les espérantistes bourgeois et mondains seront de plus en plus étonnés et terrorisés par tout ce qui peut sortir de ce talisman : un instrument permettant à tous les êtres humains de se comprendre.
Barbusse fut également Président d'honneur du premier congrès de Sennacieca Asocio Tutmonda qui se tint à Prague en 1921.
Œuvres
Pleureuses 1895, réédité en 1920
Les Suppliants 1903
L'Enfer 1908
Nous autres 1914
Le Feu Journal d'une escouade 1916, prix Goncourt
Carnets de guerre
Paroles d'un combattant. Articles et discours 1917-1920 1917
Clarté 1919
L'Illusion 1919
La Lueur dans l'abïme 1920
Quelques coins du cœur 1921
Le Couteau entre les dents 1921
Les Enchaînements 1925
Envoi de Barbusse à Abel Hermant
Les Bourreaux 1926
Force Trois films 1926
Jésus 1927
Les Judas de Jésus 1927
Manifeste aux Intellectuels 1927
Faits divers 1928
Voici ce que l'on a fait de la Géorgie 1929
Élévation 1930
Ce qui fut sera 1930
Russie 1930
Zola 1932
Staline. Un monde nouveau vu à travers un homme 1935
Lénine et sa famille 1936
Lettres de Henri Barbusse à sa femme 1914 - 1917 1937
Ouvrages sur Barbusse
Jean Relinger, Henri Barbusse écrivain combattant, Presses universitaires de France, 1994, 289 pages.
Philippe Baudorre : Barbusse, Le Pourfendeur de la Grande Guerre, Paris, Flammarion, Grandes Biographies, 1995.
Jean Sanitas, Paul Markides, Pascal Rabate, Barbusse La passion d'une vie, Valmont, 1996 Müller, Horst F.: Henri Barbusse: 1873-1935; Bio-Bibliographie. Die Werke von und über Barbusse mit besonderer Berücksichtigung der Rezeption in Deutschland. - Weimar, VDG, 2003
Liens
Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale de la Diète • Bibliothèque nationale d'Espagne • WorldCat
Œuvres numérisées sous format image sur Internet Archive
Œuvres numérisées sous format image sur Internet Archive
Œuvres numérisées sous format image sur Internet Archive
Courte biographie de Henri Barbusse
Pierre Michel, Octave Mirbeau, Henri Barbusse et l’enfer
Un site consacré à Henri Barbusse, créé par l'association des Amis d'Henri Barbusse AHB
Allocution de Pierre Gamarra pour le centenaire d'Henri Barbusse, site des Cahiers Henri Barbusse.
  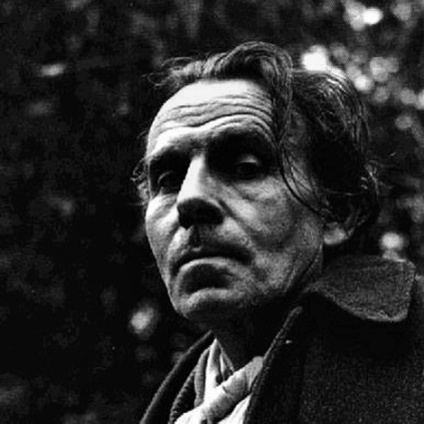 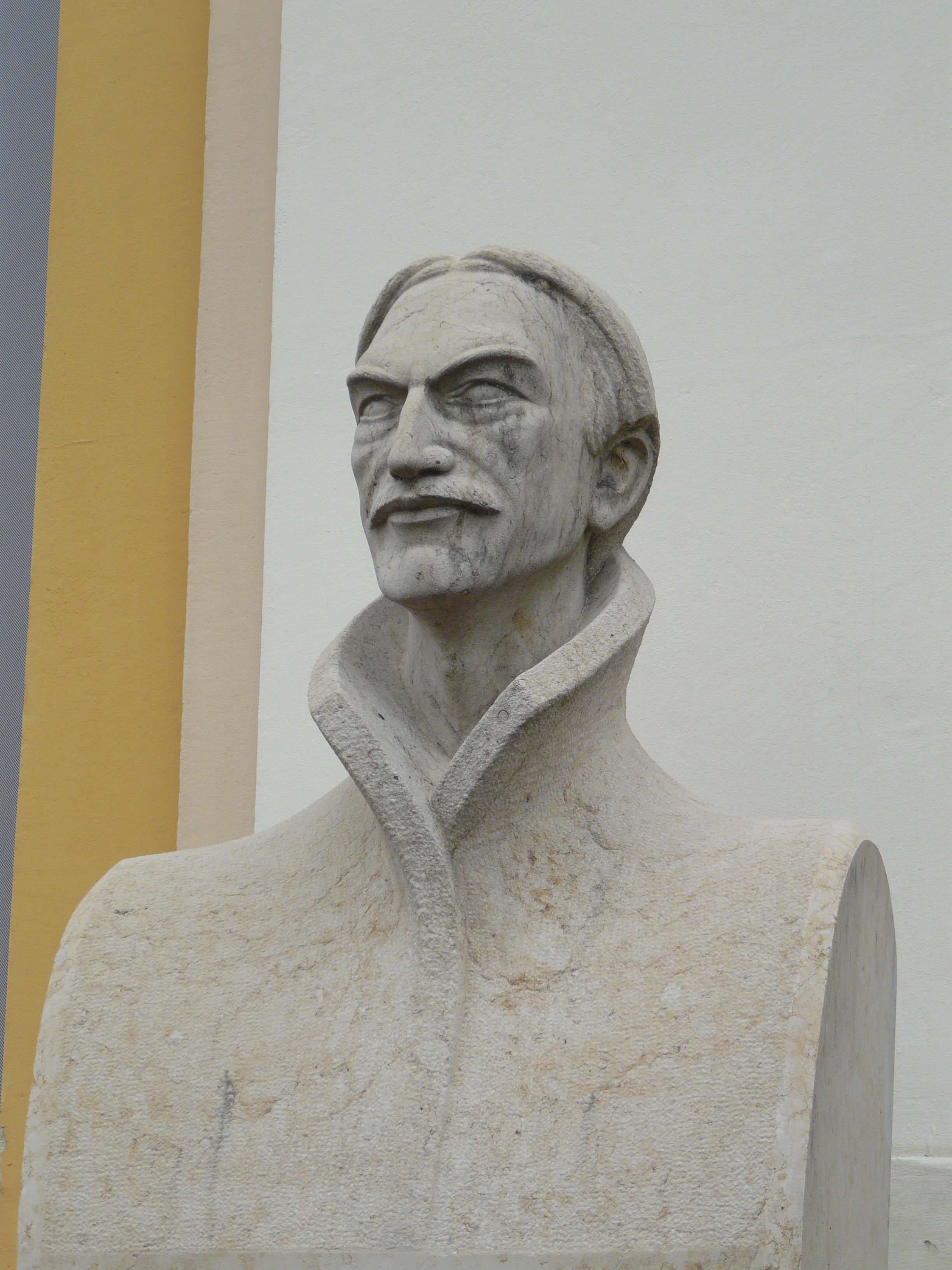  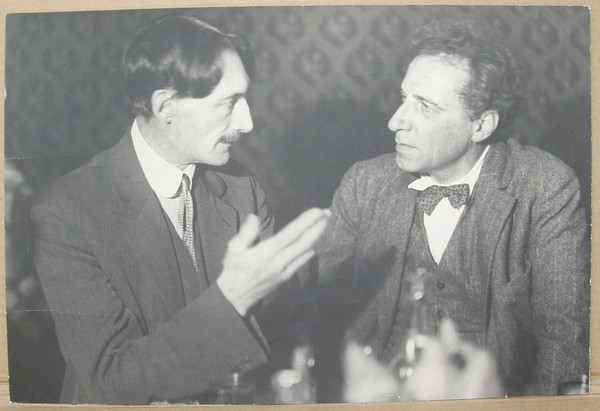 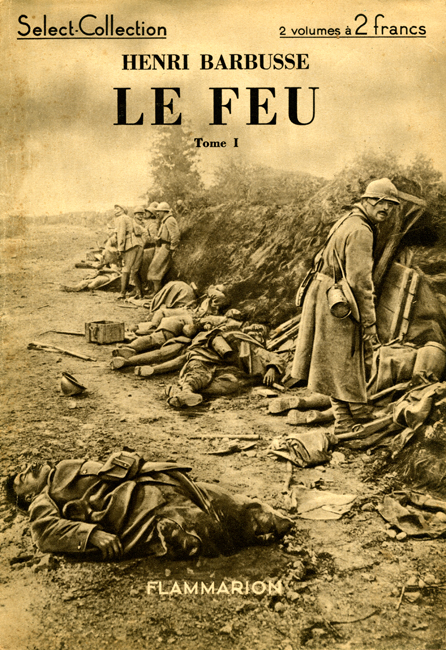 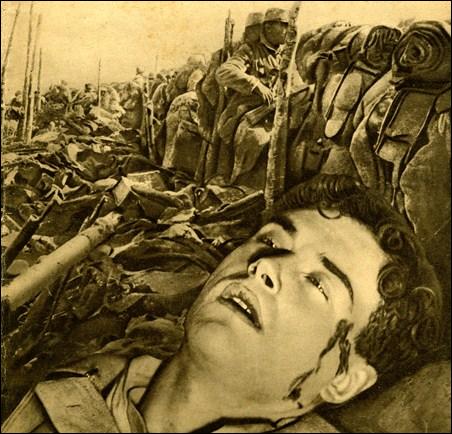 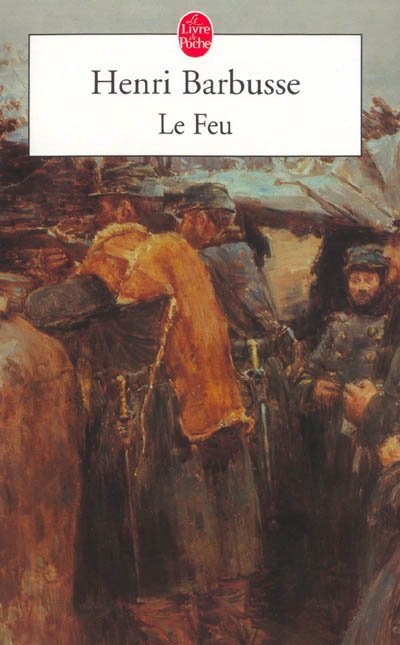 
Posté le : 16/05/2015 09:23
Edité par Loriane sur 17-05-2015 16:39:14
|
|
|
|
|
René Caillé |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 17 mai 1838, à 38 ans meurt René Caillié
à La Gripperie-Saint-Symphorien dans les Charente-Maritime, né le 19 novembre 1799 à Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres, est un explorateur français, connu comme le premier Occidental à revenir de la ville de Tombouctou, au Mali. Son exploit tient au fait que cette ville était considérée comme sacrée, tabou et donc interdite aux étrangers et plus encore aux occidentaux.
En bref
Après une enfance passée à Rochefort, où son père est détenu au bagne pour vol, René Caillié, apprenti cordonnier attiré par l'aventure, s'embarque en 1816 pour le Sénégal comme domestique ; il quitte ensuite Saint-Louis pour la Guadeloupe, où il reste six mois, avant de revenir en France. À la fin de 1818, il est de nouveau à Saint-Louis et, l'année suivante, il fait partie de la caravane qui porte secours au major Gray, à Boundou. Ramené malade à Saint-Louis, il rentre en France. Entre 1820 et 1823, il voyage entre Bordeaux et les Antilles pour le compte d'un négociant en vins. De retour au Sénégal, en 1824, il obtient l'appui du gouverneur Roger pour pénétrer chez les Maures, de l'autre côté du fleuve Sénégal. Il part le 3 août et se fait passer pour un Égyptien captif des Français et désireux de rejoindre son pays. Il vit misérablement au milieu des Maures, apprend leurs coutumes et leur langue. En 1825, il revient à Saint-Louis, puis se rend à Freetown, capitale de la Sierra Leone, en 1826. Le gouverneur anglais refuse de financer son projet d'exploration vers Tombouctou, mais l'engage pour diriger une fabrique d'indigo. Ayant épargné quelque argent 2 000 francs, Caillié quitte la Sierra Leone, achète de la pacotille, se rend au Río Núñez vêtu comme un musulman, traverse avec une caravane le Fouta Djalon et parvient le 11 juin 1827, sur le haut Niger, à Kouroussa. Il se dirige ensuite vers Djenné, mais il est obligé de s'arrêter, atteint de scorbut, et échappe de peu à la mort. Il ne peut reprendre sa route que le 1er janvier 1828. Il arrive à Djenné deux mois plus tard, s'embarque sur une pirogue et atteint, le 20 avril, Tombouctou. Il séjourne très peu de temps dans Tombouctou, ville en pleine décadence, et la quitte dès le 4 mai pour aller toucher le prix de 10 000 francs offert par la Société de géographie de Paris au premier Européen qui atteindrait ce centre. Il fait partie d'une caravane qui se rend au Maroc. Le 12 août, il est à Fès, le 27 septembre à Tanger, d'où il s'embarque pour la France. Reçu triomphalement à Paris, il se voit attribuer le titre honorifique de résident à Bamako, ainsi qu'un traitement de 6 000 francs. Ayant obtenu gloire et fortune, René Caillié se consacre à la rédaction du Journal d'un voyage à Tombouctou et à Djenné dans l'Afrique centrale Paris, 1830 ; mais, miné par la tuberculose, il meurt le 15 mai 1838. Alfred Fierro
Sa vie
René Caillié est né dans les Deux-Sèvres le 19 novembre 1799 à Mauzé-sur-le-Mignon. Il est un homme du peuple, fils d'un ouvrier-boulanger, son père est condamné au bagne pour un petit vol l'année de sa naissance. Certains biographes, défenseurs de l'explorateur, clamèrent l'innocence de ce père, ce qui n'a pas été avéré. En revanche, la plupart des biographes posent la volonté de redorer le blason familial comme l'un des motifs du voyage de Caillié. Il ne connaît pourtant pas son père qui meurt au bagne de Rochefort en 1808. À onze ans, il devient orphelin car sa mère meurt en 1811. Fasciné par la lecture de Robinson Crusoé de Daniel Defoe5, il quitte Mauzé à l'âge de dix-sept ans, à pied, pour Rochefort.
Pauvre et orphelin, attiré dès son enfance par les voyages, il part pour le Sénégal en 1816. Il se joint en 1819 à l'expédition du major Gray au Boundou et, de Bakel, revient à Saint-Louis. En 1824-1825, il séjourne chez les Maures braknas, sous prétexte de se convertir à l'islam, puis se rend en Sierra Leone. Le grand départ pour le Soudan a lieu du rio Nuñez le 19 avril 1827, Caillié se faisant passer pour un Égyptien musulman regagnant son pays. Il traverse la Guinée par le Fouta-Djalon, puis le Ouassoulou et est immobilisé par le scorbut à Timé, non loin de Tengrela, d'août 1827 à janvier 1828. Par le nord de la Côte-d'Ivoire, il gagne la région de Sikasso, le Minianka et Djenné, où il séjourne un mois avant de descendre en pirogue le Bani, puis le Niger. Il arrive ainsi à Kabara et entre dans Tombouctou le 20 avril ; il en part le 4 mai pour Araouan avec une caravane. Après la traversée du Sahara, il parvient à Fès, Rabat et Tanger, où il embarque le 27 septembre sur une goélette française. À Paris, il reçoit la médaille d'or promise par la Société de géographie au premier voyageur qui rapporterait le récit de sa visite à Tombouctou. Jomard, secrétaire général de la Société, l'aide à rédiger son Journal d'un voyage à Tombouctou et à Jenné publié en 1830, qui sera un grand succès, quoique les Anglais l'aient accusé d'imposture. Si Caillié n'était pas un savant comme Barth, son esprit d'observation s'est révélé remarquable, et son témoignage reste fondamental. Il se retira en Saintonge et mourut oublié.
Son périple
Désirant parcourir des terres inconnues, il quitte la France le 17 juin 1816 à bord de La Loire un navire de l'escadre de La Méduse qui échappe au naufrage et atteint le Sénégal, mais ne réalise son rêve que onze ans plus tard. Il connaît d'abord deux échecs, doit revenir en France. Enfin, il se rend chez les Maures braknas, dans l'actuelle Mauritanie, d'août 1824 à mai 1825, pour apprendre la langue arabe et la religion musulmane. Comme l'a fait Jean Louis Burckhardt avant lui au Levant, il s'invente une nouvelle identité de musulman, qu'il endossera durant son voyage pour éviter de se faire tuer. Après avoir appris l'existence du prix offert par la Société de géographie au premier Européen qui pénètrerait dans la ville de Tombouctou rendue mythique par les récits des voyageurs arabes du Moyen Âge et interdite aux chrétiens, il décide de partir seul, par ses propres moyens, sans aide financière, sans escorte militaire, se faisant passer pour un humble lettré musulman. Parti de Boké en Guinée, le 19 avril 1827, il est ensuite retenu cinq mois — gravement atteint du scorbut — à Tiémé dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Enfin, il atteint le 20 avril 1828, Tombouctou, il est déçu de trouver une cité tombant quelque peu en ruines, c'est finalement Fès qu'il qualifie de la ville la plus belle qu'il ait vue en Afrique . Toutefois on sait aujourd'hui que René Caillé ne fut pas le premier Européen à entrer dans Tombouctou. Avant lui, Paul Imbert, poitevin comme lui, y pénétra en tant qu'esclave du pacha Ammar el Feta, à l'époque du sultanat de Zaidan el-Nasir.
Tombouctou
Tombouctou, ville mythique, symbole du désert, des caravanes de sel, des empires lointains ?
Tombouctou ? On la voit ocre, mystérieuse, on la devine labyrinthe de ruelles incertaines, de maisons aux volets clos renfermant des pans d'histoire sagement gardés à l'abri des importuns.
Tombouctou, autrefois interdite aux étrangers, a assuré la gloire des explorateurs britannique, français et allemand qui, voici plus de cent ans, ont forcé son intimité. Les Gordon Laing, René Caillié et Heinrich Barth l'ont immortalisée.
La ville de 30.000 habitants, posée sur le sable, est de toute beauté. De vastes maisons en banco d'un étage, le toit en terrasse, s'ouvrent sur le désert ou serpentent d'une venelle à l'autre, à l'ombre des mosquées, dont Djinguereber, la plus ancienne, date du 14e siècle.
"Tombouctou ? J'y suis allé", dira-t-on avec fierté. A tel point que des Américains ont créé un club très fermé des "visiteurs de Tombouctou". Il faut montrer son "visa" tamponné à Tombouctou même pour pouvoir en être membre.
Les touristes européens y cherchent les maisons où vécurent Laing, Caillié et Barth.
Bien que le mot "Tombouctou" soit utilisé comme désignant un endroit "fort fort lointain", Tombouctou est bien réelle. Elle est une ville du Mali qui fut jadis le centre intellectuel et spirituel de l'Afrique. La ville de Tombouctou est située au sommet de la boucle du Niger et on y parle principalement Sonrhaï et Tamasheq. Les débuts de la ville remontent aux premiers siècles de l'histoire écrite. Des nomades berbères ou touaregs s'y sont établis au Xe siècle. L'Empereur du Mandé, Mansa Moussa, y fit construire une prestigieuse mosquée au XIVe siècle.
Tombouctou, autrefois
Tombouctou fut une plaque tournante du commerce entre le Maghreb et le Sahel africain assuré par les caravanes du moment. Elle connut son apogée au XVIe siècle. A cette époque, la ville était peuplée d'environ 100 000 habitants dont pas moins de 25000 étudiants fréquentant l'Université Sankoré. Elle compte maintenant un peu plus de 32 000 habitants.
Tombouctou, maintenant
La ville abrite la célèbre Université Sankoré, qui résulta de la construction de la mosquée Sankoré au XVe siècle, une université islamique connue sous le nom "d'Oxford de l'Afrique Occidentale", plusieurs médersas des écoles qui ont intégré l'enseignement du coran dans leurs programmes) et 2 mosquées historiques datant du moment de son apogée au XVIe siècle : Djingareyber et Sidi Yahya.
La ville aux rues pavées d'or
Tombouctou fut célèbre quand le roi Mansa Moussa fit un voyage à la Mecque en transportant une remarquable quantité d'or. Son passage en Égypte valut à celle-ci la dévalorisation de sa monnaie. C'est alors que le mythe de la ville aux rues pavées d'or fut créé. Le succès de Tombouctou venait du fait qu'elle était le terminus de la route transsaharienne du commerce de l'or et du sel. Les experts estiment qu'au moins une centaine de milliers de manuscrits inestimables largement rédigés en arabe et en peulh et remontant au XIIe siècle seraient détenus par des familles à Tombouctou comme propriétés privées sacrées. Ces documents traiteraient de sujets sur l'astronomie, la botanique, la musique, le droit, les sciences, l'histoire, la religion, ou le commerce. La ville de Tombouctou a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Elle est aujourdhui le centre administratif de la région du même nom au Mali.
Son retour en Europe
Son retour en France en 1830, à travers le désert du Sahara puis le Maroc, est un véritable calvaire. Il reçoit de la Société de géographie un prix de 10 000 francs, ainsi que le Grand Prix des explorations et voyages de découvertes, partagé symboliquement avec le major Alexander Gordon Laing. Il publie en 1830 son Journal d'un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l'Afrique centrale, précédé d'observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 Paris, Imprimerie Royale, 1830, avec le concours d'Edme François Jomard, qui lui assurera une grande renommée. Les Anglais ont contesté la véracité de ses écrits et de son voyage. Les attaques de ses détracteurs lui sont très pénibles, il clôt ainsi son journal : Quoi qu'il en soit, j'avouerai que ces injustes attaques me furent plus sensibles que les maux, les fatigues et les privations que j'avais éprouvés dans l'intérieur de l'Afrique Mais ses écrits sur Tombouctou seront confirmés par le voyageur allemand Heinrich Barth en 1858, encore que ce dernier soit très critique vis-à-vis de la qualité des observations de Caillié.
Il écrit à son arrivée en France : Ceux qui ont été longtemps absents de leur pays, et qui ont pu craindre de ne jamais y rentrer, ceux-là peuvent se faire une idée de ce que j'éprouvai en revoyant cette chère patrie !. Le public l'oublie vite et il semble s'ennuyer sur son domaine de La Baderre devenu l'Abadaire sur la commune de La Gripperie-Saint-Symphorien alors qu'il est devenu maire de Champagne. Il rêve de partir une nouvelle fois en Afrique. Il meurt sur ses terres le 17 mai 1838, usé par son périple, des suites d'une maladie contractée en Afrique et est enterré dans la commune voisine de Pont-l'Abbé-d'Arnoult.
Legs
Le voyage de René Caillié a été interprété de différentes façons. Jules Verne le qualifie du plus intrépide voyageur des temps modernes Il est admiré comme ouvreur de l'empire colonial français africain à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ; ainsi, en 1885, ses biographes E. Goepp et E. Cordier écrivent ceci :
René Caillié a été le précurseur des grandes choses qui, plus de cinquante ans après lui, s'accomplissent sous nos yeux. Il n'a pas créé de mer, ni percé d'isthme ; mais il a tracé une route, et cette route que durant de longs mois il a cheminée douloureusement aux prix de fatigues inouïes, voilà que déjà nous pouvons prévoir le jour, où sillonnée par des machines à vapeur, elle nous livrera toutes les richesses de l'Afrique centrale.
Il a été plus récemment considéré comme le premier africaniste : respectueux des hommes et civilisations qu'il a rencontrés, il dénonce l'esclavage et la condition des femmes.
Son récit de voyage, constitue une peinture minutieuse des paysages naturel et culturel rencontrés : de la géographie des pays traversés, de leur faune et de leur flore, des mœurs de leurs populations, etc.
Sa ville natale, Mauzé-sur-le-Mignon, organise chaque année la Fête à Caillié et le Festival de l'Aventure individuelle où est décerné le prix René Caillié des écrits de voyages ainsi qu'une bourse de l'aventure. Quoiqu'il ne soit plus très connu en France ailleurs que dans sa région natale, l'explorateur reste connu et étudié dans trois des pays qu'il a traversés : la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali.
Citations
Les intérêts de la science ne sont ni Anglais, ni Français, ni Chinois : les découvertes utiles appartiennent au Monde En effet, la découverte de l'intérieur des terres en Afrique fit l'objet d'une concurrence et de querelles entre la France et l'Angleterre.
C'est un rêve, n'est-ce pas, mes aventures ?
René Caillié
Journal d'un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l'Afrique centrale, précédé d'observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 : par René Caillié. Avec une carte itinéraire, et des remarques géographiques, par M. Jomard, membre de l'institut. Imprimé à Paris en mars 1830, par l'imprimerie royale. Tome 1, Tome 2, Tome 3, Tome 4, Tome 5 annexes, Atlas
Une réédition en fac-similé a été réalisée par les éditions Anthropos en 1965.
édition actuelle : Voyage à Tombouctou deux volumes, La Découverte, 1996
À propos de René Caillié
Notice historique sur la vie et les voyages de René Caillié par E. F. Jomard, 1839
Un Ouvrier voyageur: René Caillié par Jules Duval, 1867
Edouard Goepp et E. Cordier, René Caillié, 1885
Voyage d'un faux musulman à travers l'Afrique : Tombouctou, le Niger, Jenné et le désert 1885
THOMAS P.-Félix Vie de René Caillié par P.-Félix Thomas, 1884
André Lamandé et Jacques Nanteuil, La vie de René Caillié, vainqueur de Tombouctou, Plon, 1928.
Oswald Durand, René Caillié à Tombouctou, Mame, 1938.
Henriette Célarié, La prodigieuse Aventure d'un enfant du peuple René Caillé 1799-1838, Librairie Gedalge, Collection Les Loisirs de la Jeunesse, 1938
Alain Kerjean, La piste interdite de Tombouctou, Flammarion, 1984.
Roger Frison-Roche, L'esclave de Dieu, Flammarion, 1985.
Numa Broc et al., Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle. Afrique, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1988-2003
Yves Baron et Alain Quella-Villéger, René Caillié. Un Voyageur controversé. in Aventures scientifiques. Savants en Poitou-Charentes du xvie au xxe siècle J. Dhombres, dir., Les éditions de l’Actualité Poitou-Charentes Poitiers : 44-57, 1995
Alain Quella-Villéger, René Caillié, une vie pour Tombouctou, préface de Théodore Monod, Atlantique, 1999.
Henry Viaux, Sur les traces des grands marcheurs de tous les temps, Éditions Ouest-France, 2001
Georges Page, De Mauzé à Tombouctou, Éditions PG, 2004.
Christophe Dabitch (scénario) et Jean-Denis Pendanx dessin, 2006, Abdallahi, Futuropolis. Deux tomes albums de bande-dessinée
L'Afrique Noire à l'Époque Charnière 1783, Elisabeth Noël Le Coutour, L'Harmattan, avril 2006
Jean-Marc Pineau, Mon voyage à Tombouctou, sur les pas de René Caillié, Presses de la Renaissance, 2007.
Jean-Marc Pineau, Mon voyage au Maroc, sur les pas de René Caillié, Editions Les 2 Encres, 2010.
Alain Quella-Villéger, René Caillié, l'Africain : une vie d'explorateur 1799-1838, Aubéron, 2012.
        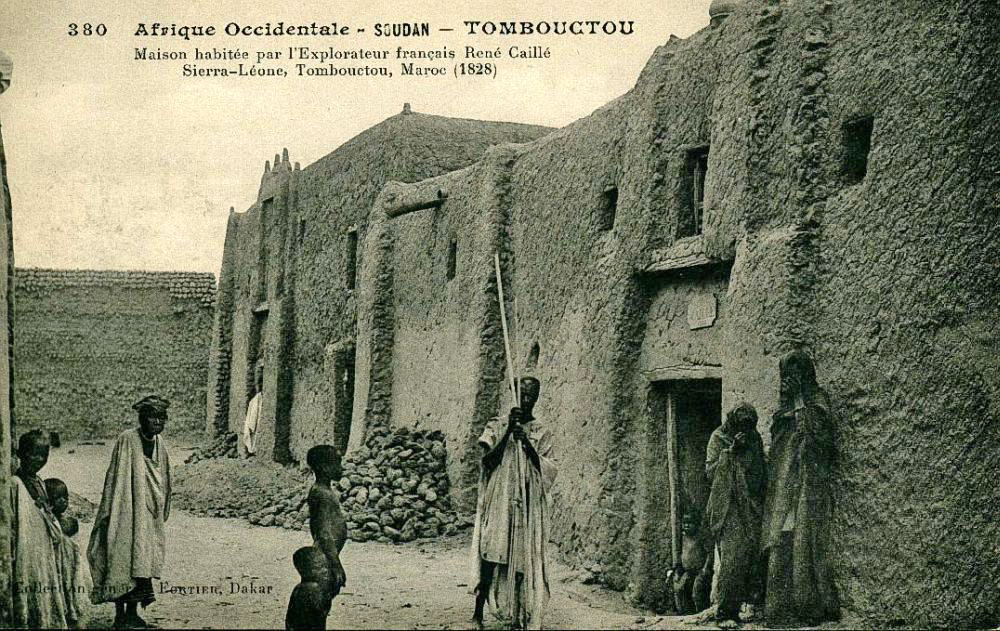 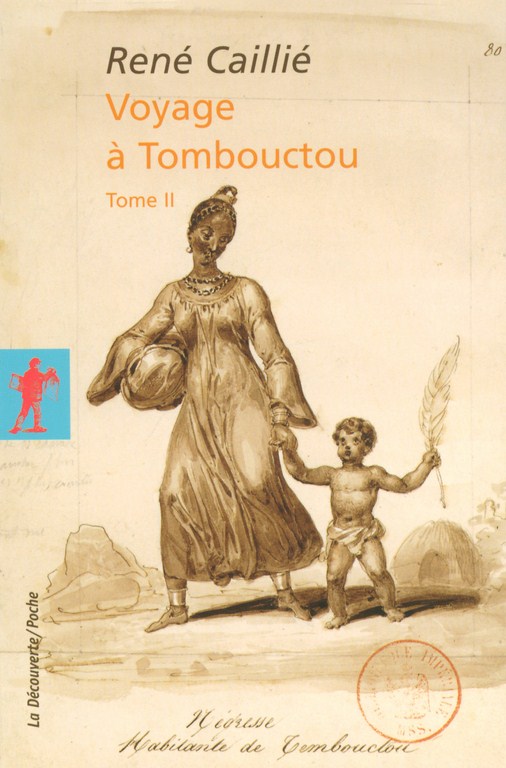  
Posté le : 16/05/2015 09:10
|
|
|
|
|
Georges Vancouver |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 10 mai 1798 à Petersham Surrey meurt George Vancouver
à 40 ans, né le 22 juin 1757 à King's Lynn dans le comté de Norfolk, navigateur britannique, officier de marine de la Royal Navy, qui est plus particulièrement renommé pour son exploration de la côte Pacifique le long de ce qui est aujourd'hui la province canadienne de la Colombie-Britannique et des États américains de l'Oregon, de Washington et de l'Alaska. Il explore également l'archipel d'Hawaï et la côte sud de l'Australie.
La ville de Vancouver et l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique Canada, ainsi que la ville de Vancouver État de Washington et le Mount Vancouver à la frontière entre le Yukon et l'Alaska ont été nommés en son honneur.
Sa vie
Origines et début de sa carrière
George Vancouver est le sixième enfant de John Gasper van Couverden et Bridget Bernes. Le nom qu'il portera est donc une contraction du nom d'origine néerlandaise van Couverden d'après la ville de Coevorden aux Pays-Bas.
Il entre dans la Royal Navy à treize ans1. En 1772, à quinze ans, il s'embarque comme à midshipman à bord du HMS Resolution lors du deuxième voyage 1772-1775 du captain James Cook à la recherche de la Terra Australis. Il accompagne également Cook lors de son troisième voyage 1776-1780, cette fois à bord du sister-ship du Resolution', le HMS Discovery et participe à la première reconnaissance et exploration, par des Européens de l'archipel d'Hawaï.
À son retour en Grande-Bretagne en 1779, il est nommé au grade britannique de lieutenant, équivalent à lieutenant de vaisseau dans la marine royale française de l'époque. Il est nommé à bord du sloop HMS Martin, chargé de surveiller les côtes anglaises.
À la fin des années 1780, l'empire espagnol envoie une expédition dans le Nord-Ouest Pacifique. Cependant, la Controverse de Nootka intervient en 1789. L'Espagne et la Grande-Bretagne sont prêtes à se déclarer la guerre à propos de la souveraineté sur la baie de Nootka sur l'actuelle île de Vancouver et, plus important encore, à propos du droit de coloniser et de s'établir sur la côte Nord-Ouest du Pacifique. Henry Roberts et Vancouver rejoignent les vaisseaux de guerre que la Grande-Bretagne arme en vue du conflit. Vancouver est sous les ordres de Joseph Whidbey sur le HMS Courageux. Lorsque la première Convention de Nootka met fin à la crise en 1790, Vancouver reçoit le commandement du HMS Discovery pour prendre possession de la baie de Nootka et pour en cartographier les côtes.
Voyage d'exploration de 1791-1795 Expédition Vancouver.
Puis, George Vancouver passe une dizaine d'années sur des navires de guerre avant d'être chargé d'une expédition de cartographie des côtes américaines de 1791 à 1794. À l'époque les spéculations sur l'existence d'un passage maritime qui relierait les océans Atlantique et Pacifique à travers l'Amérique du Nord, le fameux passage du nord-ouest, reprennent de la vigueur. Au cours de ce voyage, il rencontre le commerçant américain Robert Gray de Boston en avril 1792. Gray faisait lui-même des explorations dans la région avec son navire le Columbia, pour des raisons liées au commerce de fourrures de loutres de mer. Gray informa Vancouver qu'il avait découvert l'embouchure d'un grand fleuve qu'il avait nommé la Columbia d'après son vaisseau, mais Vancouver décida de ne pas pousser ses investigations sur ce fleuve, n'ayant pas suffisamment de confiance dans les rapports de Gray.
Vancouver passa l'été en naviguant autour de la grande île au nord du détroit de Juan de Fuca qui porte aujourd'hui son nom. Il baptisa plusieurs éléments géographiques pour les hommes de ses vaisseaux, tels que Puget Sound, Mount Baker et Burrard Inlet. Cependant, comme les navigateurs espagnols s'engageaient aussi à l'exploration de cette région, Vancouver respecta plusieurs noms déjà conférés par les espagnols, tels que l'île Galiano. Ayant achevé le voyage autour de l'île, et afin de rencontrer le navigateur et homme militaire espagnol Juan Francisco de la Bodega y Quadra, Vancouver se dirigea en l'automne de 1792 à Friendly Cove, à Nootka Sound une anse sur la côte Pacifique de l'île de Vancouver, où les espagnols maintenaient un poste depuis plusieurs années. Les gouvernements de l'Espagne et de la Grande-Bretagne avaient arrangé cette rencontre pour permettre la discussion des prétentions de ces deux pays au territoire de la côte Pacifique de l'Amérique du Nord. Les relations entre Vancouver et Quadra étaient si amicales que Vancouver proposa nommer la grande île où ils se trouvaient Quadra's and Vancouver's Island. Quadra avait des instructions d'offrir à Vancouver que la frontière entre les territoires britanniques et espagnols soit le détroit de Juan de Fuca, qui rendrait nécessaire la retraite des espagnols de Friendly Cove. Vancouver, sans instructions de Londres et ne voulant pas compromettre la position de son pays, déclina cet offre et les deux hommes décidèrent remettre la question à leurs gouvernements respectifs.
Le rencontre historique entre Vancouver et Quadra eut lieu dans le territoire traditionnel des Nuu-chah-nulth, un peuple amérindien appelés alors les Nootka. Le grand chef Maquinna des Nuu-chah-nulth jouait le rôle d'hôte, ce qui augmentait sa fortune ainsi que son prestige parmi les autres peuples indigènes de la région.
En revenant de Nootka Sound, après la rencontre avec Bodega y Quadra, Vancouver décida d'envoyer le lieutenant Broughton dans le Chatham pour explorer le fleuve Columbia que Vancouver avait négligé à la suite de sa première rencontre avec Robert Gray. Broughton poussa dans le fleuve une centaine de milles et en prit possession pour la Grande-Bretagne. Vancouver le croyait le premier européen à naviguer sur le fleuve Columbia, étant ignorant des explorations plus poussées de Gray après leur rencontre.
Rentré en Grande-Bretagne en septembre 1795, il prend sa retraite à Petersham, aujourd'hui dans le borough londonien de Richmond upon Thames, où il se consacre à la rédaction du récit de son voyage d'exploration, mais meurt en mai 1798, à l'âge de quarante ans, le laissant inachevé. Une querelle avec Thomas Pitt, un jeune aristocrate d'une famille politique puissante qui avait accompagné Vancouver pendant le voyage en Amérique et qu'il avait renvoyé à Londres, aurait pu contribuer à la réception tiède dont Vancouver souffre à son retour.
Les villes de Vancouver, West Vancouver, et North Vancouver en Colombie-Britannique et une autre ville du même nom dans l'État de Washington, ainsi que l'île de Vancouver portent aujourd'hui leurs noms en l'honneur de George Vancouver.
Publication
George Vancouver, Voyage de découvertes à l'océan Pacifique du nord et autour du monde, complété par son frère John et publié en 1798
Édition originale en anglais : Voyage Of Discovery To The North Pacific Ocean, And Round The World In The Years 1791–95,
Réédité en 1984 par W. Kaye Lamb sous le nom The Voyage of George Vancouver 1791–1795, publié par la Hakluyt Society de Londres.
Posté le : 09/05/2015 17:39
|
|
|
|
|
Anne Robert Jaccques Turgot |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 10 mai 1727 à Paris naît Anne Robert Jacques Turgot
baron de l'Aulne, souvent appelé Turgot, mort, à 53 ans, le 18 mars 1781, est un homme politique et économiste français. Partisan des théories libérales de Quesnay et de Gournay, il est nommé Secrétaire d’État à la Marine, puis contrôleur général des finances du roi Louis XVI. Il fait parti des hommes illustres du louvre. Néanmoins, ses mesures pour tenter de réduire la dette nationale et d'améliorer la vie du peuple échouèrent ou furent révoquées par son successeur, le baron Jean Clugny de Nuits. Il est le fils de Michel-Étienne Turgot, prévôt des marchands de Paris, et de Madeleine Françoise Martineau de Brétignolles.
En bref
Fils du prévôt des marchands de Paris, Turgot fait des études à Louis-le-Grand, puis au collège de Plessis. Destiné à l'état ecclésiastique, il entre au séminaire de Saint-Sulpice, où il révèle un esprit distingué capable de traduire des textes en hébreu, en grec, en latin, en allemand et en anglais. Élu prieur à la Sorbonne en 1749, il prononce, en 1750, le discours Des progrès successifs de l'esprit humain et celui des Avantages que le christianisme a procurés au genre humain. Il discute les théories de Maupertuis sur le langage et il écrit une géographie politique. À la mort de son père, il renonce à l'état ecclésiastique, collabore à l'Encyclopédie, s'oriente vers la magistrature, devenant conseiller puis maître des requêtes au parlement de Paris. Il unit un certain stoïcisme à la philanthropie de son siècle ; Malesherbes devine en lui le cœur de L'Hôpital et la tête de Bacon. Turgot prend part aux discussions religieuses, écrit les Lettres sur la tolérance en 1753, Lettre à un magistrat en 1754 ; il y préconise la tolérance et même la séparation de l'Église et de l'État. Intéressé par les questions économiques, il partage les idées des physiocrates et accompagne Gournay dans ses tournées d'intendant de commerce en 1755-1756, puis il voyage en Suisse et en Alsace.
Nommé intendant de Limoges par Bertin en 1761, il essaie d'appliquer ses théories dans ce pays pauvre, réalise une répartition plus juste de la taille, supprime la corvée, allège les charges du paysan. Il encourage les cultures nouvelles pomme de terre, autorise la libre circulation des grains ; il construit des routes, embellit Limoges. Il écrit des Lettres sur la liberté de commerce des grains, un essai intituléRéflexions sur la formation et la distribution des richesses 1766 qui devance le célèbre traité d'Adam Smith, un Mémoire légitimant le prêt à intérêt 1770. À l'avènement de Louis XVI, il est nommé secrétaire d'État à la Marine, puis contrôleur général des Finances. Décidé à repousser la banqueroute, ainsi que toute augmentation d'impôt et tout emprunt, il veut réduire les dépenses au-dessous des recettes et généralise les réformes tentées en Limousin. Il envisage l'abolition de la dîme et de la plupart des droits féodaux. Il veut libérer l'industrie et le commerce de leurs entraves. Il désire instruire le peuple pour obtenir plus d'efficacité dans le travail et une participation à l'élection d'une hiérarchie d'assemblées représentatives.
Selon Mme du Deffand, le nouveau Sully réalise quelques économies. Reprenant les idées de Bertin et de Laverdy, il proclame la liberté de circulation des grains et de leur importation en 1774. Il supprime les corporations et la corvée royale, il institue une subvention territoriale sans privilèges pour l'entretien du réseau routier. Il crée une Caisse d'escompte.
Le temps a manqué à Turgot pour parachever ses réformes et peut-être sauver la monarchie. Il se fait des ennemis par ses innovations et son manque d'aménité. La première phase de son ministère, dominée par les problèmes techniques, déclenche l'incompréhension populaire et la guerre des farines. La seconde phase, dominée par les problèmes politiques, suscite l'incompréhension parlementaire. Tous se liguent contre Turgot. La cabale, conduite par la reine et le comte de Provence, persuade Louis XVI de se détacher de ce ministre. Le roi est blessé par la mise en garde de Turgot : N'oubliez pas, sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur un billot. Il lui intime l'ordre de quitter Versailles, sans reparaître à la Cour. Turgot meurt cinq ans plus tard.
Sa vie
Il est le plus jeune fils de Michel-Étienne Turgot, prévôt des marchands de Paris, et de Madeleine Françoise Martineau de Brétignolles, issue d’une ancienne famille normande. Il est éduqué par l’Église, et à la Sorbonne, où il est admis en 1749. Il s’appelle alors l’abbé de Brucourt. Il remet deux dissertations latines remarquées, Les avantages que la religion chrétienne a apportés à l’espèce humaine, et sur L'Histoire du progrès dans l’esprit humain. Le premier signe de son intérêt pour l’économie est une lettre de 1749 sur le billet de banque, écrit à son camarade l’abbé de Cicé, et réfutant la défense par l’abbé Terrasson du système de Law. Il se passionne pour la poésie et tente d’introduire dans la poétique française les règles de la prosodie latine. Sa traduction du quatrième livre de l'Énéide est accueillie par Voltaire comme la seule traduction en prose où il ait trouvé le moindre enthousiasme.
En 1750, il décide de ne pas entrer dans les ordres et s’en justifie, selon Pierre Samuel Dupont de Nemours, en disant qu’il ne peut porter un masque toute sa vie. En 1752, il devient substitut, et plus tard conseiller au Parlement de Paris, et, en 1753, maître des requêtes. En 1754, il fait partie de la chambre royale qui siège pendant un exil du Parlement. En 1755 et 1756, il accompagne Gournay, alors intendant de commerce, dans ses tournées d’inspection dans les provinces, et en 1760, pendant qu’il voyage dans l’est de la France et en Suisse, il rend visite à Voltaire, avec qui il se lie d’amitié. À Paris, il fréquente les salons, en particulier ceux de Françoise de Graffigny – dont on suppose qu’il a voulu épouser la nièce, Anne-Catherine de Ligniville Minette, plus tard épouse du philosophe Helvétius et son amie à vie – Marie-Thérèse Geoffrin, Marie du Deffand, Julie de Lespinasse et la duchesse d’Envilie. C’est pendant cette période qu’il rencontre les théoriciens physiocrates, Quesnay et Gournay, et avec eux Dupont de Nemours, l’abbé Morellet et d’autres économistes.
Parallèlement, il étudie les diverses branches de la science, et des langues à la fois anciennes et modernes. En 1753, il traduit les Questions sur le commerce de l’anglais Josiah Tucker, et rédige ses Lettres sur la tolérance, et un pamphlet, Le Conciliateur, en défense de la tolérance religieuse. Entre 1755 et 1756, il compose divers articles pour l'Encyclopédie, et entre 1757 et 1760, un article sur les Valeurs des monnaies, probablement pour le Dictionnaire du commerce de l’abbé Morellet. En 1759, paraît son Éloge de Gournay.
Intendant
En août 1761, Turgot est nommé intendant de la généralité de Limoges, laquelle inclut certaines des régions les plus pauvres et les plus surtaxées de France. Il y resta 13 ans. Il est déjà profondément marqué par les théories de Quesnay et Gournay, et s’emploie à les appliquer autant que possible dans sa province. Sa première idée est de continuer le travail, déjà commencé par son prédécesseur Tourny, de faire un relevé du territoire cadastre, afin d’arriver à une estimation plus exacte pour la taille. Il obtient également une large réduction dans la contribution de la province. Il publie un Avis sur l’assiette et la répartition de la taille 1762–1770, et comme président de la Société d’agriculture de Limoges, offre des prix pour des expérimentations sur le principe de taxation. Quesnay et Mirabeau ont eux proposé une taxe proportionnelle impôt de quotité, mais c’est une taxe distributive impôt de répartition que propose Turgot. Une autre idée est la substitution en ce qui concerne les corvées d’une taxe en monnaie levée sur la province entière, la construction de routes étant donnée à des contracteurs, ceci afin d’établir un réseau solide tout en distribuant plus justement les dépenses de sa construction.
En 1769, il écrit son Mémoire sur les prêts à intérêt, à l’occasion de la crise provoquée par un scandale financier à Angoulême. Pour lui, il s'agit que la question du prêt soit traitée scientifiquement, et non plus seulement d’un point de vue dépendant des recommandations d'une morale du religieux, issue en partie de la scholastique et réprouvant le profit1. Parmi les autres travaux écrits pendant l’intendance de Turgot figurent le Mémoire sur les mines et carrières et le Mémoire sur la marque des fers, dans lesquels il proteste contre les normes étatiques et l’intervention de l’État, et défend la libre concurrence. En même temps, il fait beaucoup pour encourager l’agriculture et les industries locales, entre autres les manufactures de porcelaine. Pendant la famine de 1770–1771, il applique aux propriétaires terriens cependant l’obligation d’aider les pauvres et particulièrement leurs métayers, et organise dans tous les ateliers de la province des bureaux de charité pour fournir une activité à ceux capables de travailler, et un secours aux infirmes. Parallèlement, il condamne la charité non discriminatoire. Turgot fait des curés, quand il peut, les agents de ses charités et de ses réformes. C’est en 1770 qu’il écrit ses fameuses Lettres sur la liberté du commerce des grains adressées au contrôleur général des finances, l’abbé Terray. Trois de ces lettres ont disparu, ayant été envoyées à Louis XVI par Turgot plus tard et jamais récupérées, mais celles qui restent démontrent que le commerce libre est de l’intérêt du propriétaire foncier, du fermier et aussi du consommateur, et demandent énergiquement un retrait des restrictions.
L’un des travaux les plus connus de Turgot, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, est écrit au début de son intendance, au bénéfice de deux étudiants chinois. En 1766, il rédige les Éphémérides du citoyen, qui paraissent en 1769–1770 dans le journal de Dupont de Nemours, et sont publiés séparément en 1776. Dupont, cependant, a altéré le texte pour le mettre plus en accord avec la doctrine de Quesnay, ce qui refroidit ses relations avec Turgot.
Après avoir tracé l’origine du commerce, Turgot développe la théorie de Quesnay selon laquelle le sol est la seule source de richesse, et divise la société en trois classes, les cultivateurs, les salariés ou les artisans, et les propriétaires. Après avoir discuté de l’évolution des différents systèmes de culture, de la nature des échanges et des négociations, de la monnaie, et de la fonction du capital, il choisit la théorie de l'mpôt unique, selon laquelle seul le produit net du sol doit être taxé. En conséquence, il demande encore une fois la liberté totale du commerce et de l’industrie.
Ministre
Turgot est nommé ministre de Maurepas, le mentor du Roi, auquel il a été chaudement recommandé par l’abbé de Véry, un ami commun. Sa nomination comme ministre de la Marine en juillet 1774 est bien accueillie, notamment par les philosophes. Un mois plus tard, il est nommé contrôleur général des finances. Son premier acte est de soumettre au roi une déclaration de principe : pas de banqueroute, pas d’augmentation de la taxation, pas d’emprunt. La politique de Turgot, face à une situation financière désespérée, est de contraindre à de strictes économies dans tous les ministères. Toutes les dépenses doivent désormais être soumises pour approbation au contrôleur. Un certain nombre de sinécures sont supprimées, et leurs titulaires sont dédommagés. Les abus des acquis au comptant sont combattus, cependant que Turgot fait appel personnellement au roi contre le don généreux d’emplois et de pensions.
Il envisage également une grande réforme de la ferme générale, mais se contente, au début, d’imposer ses conditions lors du renouvellement des baux : employés plus efficaces, suppression des abus des croupes nom donné à une classe de pensions – réforme que l'abbé Terray avait esquivée, ayant noté combien de personnes bien placées y étaient intéressées. Turgot annule également certains fermages, comme ceux pour la fabrication de la poudre à canon et l’administration des messageries, auparavant confiée à une société dont Antoine Lavoisier est conseiller. Plus tard, il modernise le service de diligences en remplaçant celles-ci par d’autres plus confortables qui sont surnommées turgotines. Il prépare un budget ordinaire.
Les mesures de Turgot réussissent à réduire considérablement le déficit, et améliorent tant le crédit national qu’en 1776, juste avant sa chute, il lui est possible de négocier un prêt à 4 % avec des banquiers, mais le déficit est encore si important qu’il l’empêche d’essayer immédiatement la mise en place de son idée favorite, le remplacement des impôts indirects par une taxe sur l’immobilier. Il supprime cependant bon nombre d’octrois et de taxes mineures, et s’oppose sur la base des finances du pays à la participation de la France à la guerre d'indépendance des États-Unis, sans succès.
Turgot dès sa nomination aux finances s'était mis au travail pour établir le libre-échange dans le domaine des grains suppression du droit de hallage, mais son décret, signé le 13 septembre 1774, rencontre une forte opposition dans le Conseil même du roi. Le préambule de ce décret, exposant les doctrines sur lesquelles il est fondé, lui gagne l’éloge des philosophes mais aussi les railleries des beaux esprits, aussi Turgot le réécrit-il trois fois pour le rendre si purifié que n’importe quel juge de village pourrait l’expliquer aux paysans. Turgot devient la cible de tous ceux qui ont pris intérêt aux spéculations sur le grain sous le régime de l’abbé Terray, ce qui inclut des princes de sang. De plus, le commerce des blés a été un sujet favori des salons et le spirituel Galiani, l’adversaire des physiocrates, a de nombreux partisans. L’opposition de l’époque est le fait de Linguet et Necker, qui en 1775 a publié son Essai sur la législation et le commerce des grains.
Pourtant, le pire ennemi de Turgot s’avère être la médiocre moisson de 1774, qui mène à la hausse du prix du pain pendant l’hiver 1774 et le printemps 1775. En avril, les perturbations surgissent à Dijon, et, au début de mai, ont lieu les grandes émeutes frumentaires connues comme la guerre des farines, qui peut être considérée comme le signe avant-coureur de la Révolution française. Turgot fait preuve d’une grande fermeté et d’un grand esprit de décision dans la répression des émeutes, et bénéficie du soutien de Louis XVI. Sa position est affermie par l’entrée de Malesherbes parmi les ministres en juillet 1775.
Pour ce qui est de ses relations avec Adam Smith, Turgot écrit : Je me suis flatté, même de son amitié et estime, je n’avais jamais celui de sa correspondance, mais il n’y a aucun doute qu'Adam Smith a rencontré Turgot à Paris et il est généralement admis que Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations doit beaucoup à Turgot.
Enfin, Turgot présente au Conseil du roi en janvier 1776 les fameux Six Décrets de Turgot. Sur les six, quatre sont d’importance secondaire. Les deux qui ont rencontré une opposition violente sont le décret supprimant la corvée royale et la suppression des jurandes et maîtrises, corporations. Dans le préambule, Turgot annonce courageusement son objectif d’abolir les privilèges et de soumettre les trois ordres à taxation — le clergé en a ensuite été exempté, notamment à la demande de Maurepas. Dans le préambule au décret sur les jurandes, il fixe comme principe le droit de chaque homme pour travailler, sans restriction.
Il obtient l’enregistrement des décrets par le lit de justice du 12 mars, mais, à ce moment-là, presque tout le monde est contre lui. Ses attaques contre les privilèges lui ont gagné la haine de la noblesse et du Parlement ; sa réforme de la Maison du roi, celle de la Cour ; sa législation de libre-échange, celle des financiers ; ses avis sur la tolérance et sa campagne contre les serments du sacre vis-à-vis des protestants, celui du clergé ; enfin, son décret sur les jurandes, celui de la bourgeoisie riche de Paris et d’autres, comme le Prince de Conti, dont les intérêts sont engagés. La reine Marie-Antoinette ne l’aime guère depuis qu’il s’est opposé à l’octroi de faveurs à ses favoris, comme la duchesse de Polignac.
Tout pouvait encore aller bien si Turgot conservait la confiance du roi, mais le roi ne manque pas de voir que Turgot n’a pas l’appui des autres ministres. Même son ami Malesherbes pense qu’il est trop impétueux. L’impopularité de Maurepas va également croissante. Que ce soit par jalousie de l’ascendant que Turgot a acquis sur le roi, ou par l’incompatibilité naturelle de leurs personnages, Maurepas bascule contre Turgot et se réconcilie avec la reine. C’est vers cette époque qu’apparaît une brochure, Songe de M. Maurepas, généralement attribué au comte de Provence, futur Louis XVIII, contenant une caricature acide de Turgot.
Avec les physiocrates, Turgot croit en l’aspect éclairé de l’absolutisme politique et compte sur le roi pour mener à bien toutes les réformes. Quant aux Parlements, il s’est opposé à toute intervention de leur part dans la législation, considérant qu’ils n’avaient aucune compétence hors la sphère de la justice. Il reconnaît le danger des vieux Parlements, mais se révèle incapable de s’y opposer efficacement depuis qu’il a été associé au renvoi de Maupeou et de l’abbé Terray et semble avoir sous-estimé leur pouvoir. Il s’oppose à la convocation des États généraux préconisée par Malesherbes le 6 mai 1775, probablement en raison de l’important pouvoir qu’y ont les deux ordres privilégiés. Son plan personnel se trouve dans son Mémoire sur les municipalités qui a été soumis d’une façon informelle au roi. Dans le système proposé par Turgot, les propriétaires seuls doivent former l’électorat, aucune distinction n'étant faite entre les trois ordres. Les habitants des villes doivent élire des représentants par zone municipale, qui à leur tour élisent les municipalités provinciales, et ces dernières une grande municipalité, qui n’a aucun pouvoir législatif, mais doit être consultée pour l’établissement des taxes. Il faut y combiner un système complet d’éducation, et de charité visant à soulager les pauvres.
Louis XVI recule devant l’ampleur du plan de Turgot. Il reste à Turgot à choisir entre une réforme superficielle du système existant et une réforme totale des privilèges — mais il aurait fallu pour cela un ministre populaire et un roi fort.
Avec l'aide de son conseiller, le banquier suisse Isaac Panchaud, il prépare à la fin de son mandat la création de la Caisse d'Escompte, ancêtre de la banque de France, qui a pour mission de permettre une baisse des taux d'intérêt des emprunts commerciaux, puis publics.
Chute
La cause immédiate de la chute de Turgot est incertaine. Certains parlent d’un complot, de lettres fabriquées de toutes pièces, et attribuées à Turgot, contenant des attaques sur la reine Marie-Antoinette, d’une série de notes sur le budget de Turgot préparée, dit-on, par Necker et montrée au roi pour prouver son incapacité. D’autres l’attribuent à la reine et il n’y a aucun doute sur sa haine de Turgot depuis qu’il a soutenu Vergennes dans l’affaire du comte de Guines.
D’autres l’attribuent à une intrigue de Maurepas. En effet, après la démission de Malesherbes en avril 1776, Turgot tente de placer l’un de ses candidats. Très mécontent, Maurepas propose au roi comme son successeur un nommé Amelot. Turgot, l’apprenant, écrit une lettre indignée au roi, et lui montre en termes énergiques les dangers d’un ministère faible, se plaint amèrement de l’indécision de Maurepas et de la soumission de ce dernier aux intrigues de cour. Bien que Turgot ait demandé à Louis XVI de garder la lettre confidentielle, le roi la montre à Maurepas.
Avec tous ces ennemis, la chute de Turgot est certaine, mais il tente de rester à son poste assez longtemps pour finir son projet de la réforme de la Maison du roi, avant de démissionner. Cela ne lui est même pas accordé : le 12 mai, on lui ordonne d’envoyer sa démission. Il se retire dès le 13 mai 1776, partant pour La Roche-Guyon au château de la duchesse d’Enville, puis retourne à Paris, où il consacre le reste de sa vie aux études scientifiques et littéraires. En 1777, il est fait vice-président de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
Son tombeau se trouve auprès de celui de son père Michel-Étienne Turgot, dans la chapelle de l’ancien hôpital Laennec, à Paris 7e.
Personnalité
Les commentateurs décrivent Turgot comme un homme simple, honorable et droit, passionné de justice et de vérité : un idéaliste, ou un doctrinaire ; les termes « des droits naturels, la loi naturelle, se trouvent fréquemment sous sa plume. Ses amis parlent de son charme et de sa gaieté dans les relations intimes, tandis qu'entouré d’étrangers, silencieux et maladroit, il donne une impression de réserve et de dédain. Ainsi ses amis comme ses ennemis s’accordent sur un point : sa brusquerie et son manque de tact dans les relations humaines ; August Oncken5 relève et souligne le ton de maître d’école de sa correspondance, même avec le roi.
Les jugements sont partagés à propos de ses qualités d’homme d’État, mais on considère généralement qu’il est à l’origine d’un grand nombre des réformes et des idées de la Révolution française. Souvent ce ne sont pas ses idées propres, mais on lui doit de les rendre publiques. Concernant ses qualités d’économiste, les avis sont aussi partagés. Oncken, pour prendre le plus négatif des avis, le voit comme un mauvais physiocrate et un penseur confus, tandis que Léon Say considère qu’il est le fondateur de l’économie politique moderne et que « bien qu’il ait échoué au XVIIIe siècle, il a triomphé au XIXe siècle. Jugement partagé par Murray Rothbard, lequel y voit le plus grand économiste du XVIIIe siècle avec Cantillon et estime que, sur certains points, la théorie économique a perdu plusieurs dizaines d’années en ne s’inspirant pas de ses conceptions :
c’était un génie unique, ce qu’il est quand même difficile de dire des Physiocrates. Sa compréhension de la théorie économique était incommensurablement supérieure à la leur, et la manière dont il traita le capital et l’intérêt est quasiment inégalée encore aujourd’hui.
Pour Schumpeter, sa théorie de la formation des prix était :
presque irréprochable et, mis à part une formulation explicite du principe marginaliste, se trouve à une distance palpable de celle de Böhm-Bawerk.
La théorie de l’épargne, de l’investissement et du capital était « la première analyse sérieuse de ces questions et a tenu remarquablement longtemps. Il est douteux qu’Alfred Marshall soit parvenu à la dépasser, et certain que J.S. Mill ne l’a pas fait. Böhm-Bawerk y a sans doute ajouté une nouvelle branche mais, pour l’essentiel, il avait repris les propositions de Turgot.
La théorie de l’intérêt de Turgot est non seulement le plus grand exploit … du XVIIIe siècle, mais elle préfigurait nettement une bonne partie des meilleures réflexions des dernières décennies du XIXe siècle.
En somme,
il n’y a pratiquement aucune erreur discernable dans ce tout premier traité de la valeur et de la distribution, traité dont la mode allait tellement se développer dans les dernières décennies du xixe siècle. Ce n’est pas exagérer que de dire que l’analyse économique a pris un siècle pour se retrouver où elle aurait pu en être vingt ans après la publication du Traité de Turgot si son contenu avait été correctement compris et assimilé par une profession plus éveillée.
Œuvres
Cet article ou cette section contient des liens externes. Selon les recommandations sur l'usage des liens externes, il ne devrait pas y avoir de liens externes dans le corps de l'article. Il est souhaitable, si cela présente un intérêt, de citer ces liens comme source et de les enlever du corps de l'article.
Lettre à M. l’abbé de Cicé, depuis évêque d’Auxerre, sur le papier supplée à la monnaie, 1749
Les avantages que la religion chrétienne a procurés au genre humain, Discours prononcé en latin, dans les écoles de la Sorbonne, 1750.
Tableau philosophique des progrès successifs de l’ésprit humain, Discours prononcé en latin, dans les écoles de la Sorbonne, 1750.
Plan de deux discours sur l’histoire universelle, 1751
Plan d’un ouvrage sur la géographie politique, 1751.
Fragmens et pensées détachées pour servir à l’ouvrage sur la geographie politique, 1751
Lettres sur la tolérance, 1753-4
Étymologie, Existence Expansibilité, Foires et Marchés, Fondation, Langues 1757, articles dans l’Encyclopédie de Diderot et D'Alembert.
Éloge de Vincent de Gournay, Mercure, 1759
Le commerce des grains: Projet de lettre au contrôleur général Bertin sur un projet d’édit, 1763
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, 1766
Circulaire aux officiers de police des villes, 1766
Observations sur les mémoires de Graslin et Saint-Péravy, 1767
Attribué Lettres sur les émeutes populaires que cause la cherté des bleds et sur les précautions du moment, 1768
L’impôt indirect: Observations sur les mémoires récompensés par la Société d’Agriculture de Limoges, 1768
Lettres à Hume, 1768
Valeurs et Monnaies: Projet d’article, 1769
Lettres à Dupont de Nemours, 1766-70
Mémoire sur les prêts d’argent, 1770
Lettres au contrôleur général l’abbé Terray sur le commerce de grains, 1770
Extension de la liberté du commerce des colonies, 1772
Lettre au contrôleur général toujours l’abbé Terray]sur la marque des fers, 1773
Arrêt du Conseil établissant la liberté du commerce des grains et des farines à l’intérieur du royaume et la liberté de l’importation, 1774
Mémoire sur les moyens de procurer, par une augmentation de travail, des ressources au peuple de Paris, dans le cas d’une augmentation dans le prix des denrées, 1er mai 1775, 1775
Des administrations provinciales : mémoire présenté au Roi, 1788
Mémoires sur le prêt à intérêt et sur le commerce des fers, 1789
Œuvres de Turgot. T. 1, T. 2, ed. Dupont de Nemours, 1844
Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei
Posté le : 09/05/2015 17:32
|
|
|
|
|
Rouget de l'Isle |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 10 mai 1760 naît, Claude Joseph Rouget dit de Lisle
à Lons-le-Saulnier, souvent appelé Rouget de l'Isle, mort à 76 ans le 26 Juin 1834 à Choisy le roi, officier français, capitaine du Génie, poète et auteur dramatique. Il est l'auteur de La Marseillaise et d'autres hymnes moins connus tels que l'Hymne Dithyrambique sur la conjuration de Robespierre et la Révolution du 9 Thermidor 1794 et Vive le Roi ! 1814. Œuvres réputées, : La Marseillaise, Vive le Roi
Révolutionnaire modéré, il est sauvé de la Terreur grâce au succès de son chant. Auteur de quelques romances et opéras, il vit dans l'ombre sous l'Empire et la Restauration jusqu'à son décès à Choisy-le-Roi en 1836.
En bref
Officier et compositeur français né à Lons-le-Saunier, mort à Choisy-le-Roi, Rouget de Lisle est en 1791 capitaine en garnison à Strasbourg. En avril de l'année suivante, il y écrit les vers et compose très probablement la mélodie d'un Chant de guerre de l'armée du Rhin, qui prendra le nom de Marseillaise après avoir été chanté par les volontaires de Marseille lors de leur entrée à Paris en juillet 1792. En 1795, un décret de la Convention en fait un chant national. Après avoir connu une éclipse sous l'Empire et la Restauration, il reparaît lors des révolutions de 1830 et de 1848, et il est déclaré hymne national en 1879. Rouget de Lisle écrit encore l'Hymne dithyrambique sur la conjuration de Robespierre 1794, le Chant des vengeances 1798, le Chant du combat 1800 pour l'armée d'Égypte, ainsi que des livrets d'opéra ; on lui doit aussi un Premier Recueil de vingt-quatre hymnes, chansons ou romances avec violon obligé vers 1796 et Cinquante Chants français 1825.
La paternité de la musique La Marseillaise a souvent été contestée à Rouget de Lisle, qui semble pourtant devoir en être plus probablement l'auteur que tous les autres concurrents qu'on a voulu lui susciter (un certain Grisons, ou même Ignace Pleyel. Le thème mélodique, assez courant pour l'époque, s'apparente à des thèmes divers d'opéras sans s'y ramener absolument. Plus complexe est l'histoire des nombreuses variantes, et surtout des harmonisations orchestrales que divers musiciens adapteront à l'hymne : la moins somptueuse n'est pas celle de Berlioz. Une chose demeure certaine : La Marseillaise que nous entendons aujourd'hui dans les cérémonies officielles n'est plus exactement le chant qu'improvisa le jeune capitaine de l'armée du Rhin en avril 1792 à Strasbourg, dans la maison du maire Dietrich, ni celui qui frappa tant Goethe lorsqu'il l'entendit chanter dans l'été de 1793 par les Mayençais de Kléber. Marc Vignal
Sa vie
Né le 10 mai 1760 à Lons-le-Saunier, sous les arcades de la rue du commerce où sa mère était descendue de Montaigu au marché. Une plaque a été placée sous les arcades à l'endroit précis. Claude Joseph Rouget de Lisle est le fils aîné1 de Claude Ignace Rouget2 et de Jeanne Madeleine Gaillande. Son père était avocat au bailliage de Lons-le-Saunier. Avec son frère Claude Pierre, il y passe sa jeunesse, y fait ses études jusqu'au collège.
Sorti de l'École royale du génie de Mézières, il est nommé dans différentes garnisons, dont Mont-Dauphin, où il exerce ses talents de Don Juan4. En garnison à Strasbourg à partir du 1er mai 1791, au début de la Révolution, il fait la connaissance de Philippe-Frédéric de Dietrich, maire de Strasbourg, dans une loge maçonnique. À la demande de celui-ci, il compose plusieurs chants patriotiques, dont : l'Hymne à la Liberté pour la fête de la Constitution célébrée à Strasbourg le 25 septembre 1791, dont la musique vient de Ignace Joseph Pleyel et que de Dietrich fait chanter par la foule sur la place d'Armes à Strasbourg. Plus tard, il compose Le Chant de guerre pour l'armée du Rhin, le 25 avril 1792, chanté par Philippe-Frédéric de Dietrich lui-même et non pas par Rouget de Lisle pour la première fois en public dans son salon, dès le lendemain 26 avril.
Face à l'invasion des armées coalisées, l'Assemblée déclare la patrie en danger, et les fédérés des provinces gagnent Paris pour participer à la défense de la Patrie. Des fédérés marseillais entonnent et répandent sur leur chemin le chant de Rouget de Lisle, qui était déjà parvenu chez eux. C'est ainsi que Le Chant de guerre pour l'armée du Rhin devient la Marche des Marseillois, puis La Marseillaise.
Rouget de Lisle quitte Strasbourg le 13 juin 1792 pour diriger la forteresse de Huningue.
Le 10 août 1792, Rouget de Lisle est destitué de ses fonctions de capitaine par Lazare Carnot pour avoir protesté contre l'internement de Louis XVI à la suite de la prise des Tuileries. Proche des Monarchiens, il est emprisonné sous la Terreur mais il échappe à la guillotine. En 1795, il est envoyé à l'armée des côtes de Brest sous les ordres du général Hoche, il affronte les Chouans et les Émigrés lors de l'expédition de Quiberon. Il démissionne en 1796 et vit difficilement à Lons-le-Saunier.
Il se montre tout à fait hostile à l'instauration du Premier Empire en 1804 ; il ose même alors écrire à Bonaparte : "Bonaparte, vous vous perdez, et ce qu'il y a de pire, vous perdez la France avec vous !"
Sous le Ier Empire, il dirige une entreprise de fournitures de vivres auprès des armées.
Rouget de Lisle compose d'autres chants semblables à la Marseillaise et en 1825 il publie Chants français. Il n'arrive pas à percer dans sa carrière littéraire préfaces, traductions d'ouvrages anglais, mémoires. Il écrit sous la Restauration un hymne royaliste. Mais celui-ci, baptisé Vive le Roi !, ne parvint pas à séduire Louis XVIII, qui n'agréa pas la chanson. Il finira sa vie dans une situation précaire, devant même vendre l'héritage de son père. On connait une lettre que Pierre Jean de Béranger lui adresse le 21 juin 1826 à la prison de Sainte-Pélagie où il est emprisonné pour dettes. Sous la Monarchie de Juillet, Louis-Philippe Ier lui accordera une pension viagère. Peu de temps après, il s'éteint à Choisy-le-Roi le 26 juin 1836 à l'âge de 76 ans. Ses cendres furent solennellement transférées aux Invalides le 14 juillet 19158. On peut cependant encore voir sa tombe au cimetière de Choisy-le-Roi.
Les papiers personnels de Claude-Joseph Rouget de Lisle sont conservés aux Archives nationales sous la cote 75AP9.
La Marseillaise
Le chant de guerre pour l'armée du Rhin a été composé en avril 1792 à Strasbourg, deviendra la Marseillaise, qui sera adopté comme hymne national de la France en 1879.
Les paroles de La Marseillaise sont marquées par les slogans patriotiques, et le style du temps, qu'on retrouve dans les affiches de conscription, ou autres chants : Aux armes, citoyens !, l'étendard sanglant est levé... Marchons... Il faut combattre, vaincre ou mourir... ou des images littéraires, comme chez Nicolas Boileau : ...Et leurs corps pourris, dans nos plaines, n'ont fait qu'engraisser nos sillons, ode sur un bruit qui courut, en 1656, que Cromwell et les anglais allaient faire la guerre à la France, comme d'autres chansons, alliant l'idée de patrie à celle de terre nourricière, de défense des plus faibles devant l'envahisseur l'Europe coalisée contre la France, stigmatisant les féroces étrangers qui ravissent d'entre nos bras nos femmes et nos enfants.
La Marseillaise a été traduite dans pratiquement toutes les langues du monde, comme chant révolutionnaire et de résistance, notamment dans les camps de concentration.
Hommages
La ville de Lons-le-Saunier a rendu de nombreux hommages à Rouget de Lisle. Le premier en 1882 en lui élevant une statue, commandée à Bartholdi à qui l'on doit la statue de la Liberté de New York. Puis en célébrant les anniversaires de sa naissance, de son décès ou encore de la composition de La Marseillaise en 1992. Chaque heure, le carillon du théâtre égrène les premières notes de La Marseillaise pour rappeler aux Lédoniens que son auteur est un enfant du pays. Enfin, en 1996, la ville a inauguré un musée dans son appartement natal.
La rue Rouget-de-L'Isle dans le 1er arrondissement de Paris est nommée en 1879 en son souvenir.
Éric Heidsieck, Hommage à Rouget de Lisle : paraphrase sur La Marseillaise : en vingt-trois variations à la manière de la dernière pour piano à quatre mains. Lyon : Symétrie, 2002 p.
Le train corail reliant Strasbourg à Nice était surnommé « Le Rouget de Lisle."
Une statue commémorative est située, en son honneur, à Choisy-le-Roi. Ce monument a été commandé par souscription nationale le 23 juillet 1882 et inauguré le 6 juillet 1902 par Justin Germain Casimir de Selves. La place le portant porte son nom. Elle est très fréquentée et est un carrefour routier important du Val de Marne. Une gare routière est située à cet endroit.
Une plaque a été déposée sur sa maison de Choisy-le-Roi, dans laquelle il est décédé au 6 rue Rouget-de-Lisle.
Philatélie
1936 centenaire de la mort de Claude Rouget de Lisle
En 1936, un timbre de 20 centimes vert est émis. Il représente sa statue à Lons-Le-Saunier. Il est le premier à avoir fait l'objet d'une vente anticipée le 27 juin 1936, à Lons-Le-Saunier. Il porte le n° YT 314.
En 2006, c'est un timbre de 0,53 euro multicolore qui est émis. Il représente "Rouget de Lisle chantant la Marseillaise" d'après le tableau d'Isidore Pils avec à gauche le village de Montaigu et à droite la ville de Lons-le-Saunier. Il a bénéficié de deux cachets 1er jour, un à Paris le 13 juillet et un second à Lons-Le Saunier le 14 juillet. Il porte le n° YT 393910.
Autres signatures
Forme retenue dans les catalogues des bibliothèques : Rouget de Lisle, Claude Joseph
Formes rejetées :
Lisle, Claude-Joseph Rouget de
Rouget Delisle, Joseph
Delisle, Joseph Rouget
Rouget de L'Isle, Claude-Joseph
L'Isle, Claude-Joseph Rouget de
R.D.L.
Rouget de Lisle au cinéma et à la télévision
Plusieurs films reprennent le personnage de Rouget de Lisle :
Harry Krimer a incarné le personnage dans le célèbre Napoléon d'Abel Gance en 1927, ainsi que dans la version sonorisée et modifiée en 1935
Rouget de Lisle apparaît en train de composer La Marseillaise dans le film Cadet Rousselle en 1954, où le rôle est incarné par Pierre Destailles.
Michel Valmer est Rouget de Lisle dans Quand flambait le bocage, un téléfilm de Claude-Jean Bonnardot de 1978
Darry Cowl joue le rôle de Rouget de Lisle dans la comédie Liberté, égalité, choucroute en 1985.
La Marseillaise
En 1792, à la suite de la déclaration de guerre du Roi à l'Autriche, un officier français en poste à Strasbourg, Rouget de Lisle compose, dans la nuit du 25 au 26 avril, chez Dietrich, le maire de la ville, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin".
Ce chant est repris par les fédérés de Marseille participant à l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792. Son succès est tel qu'il est déclaré chant national le 14 juillet 1795.
Interdite sous l'Empire et la Restauration, la Marseillaise est remise à l'honneur lors de la Révolution de 1830 et Berlioz en élabore une orchestration qu'il dédie à Rouget de Lisle.
La IIIème République 1879 en fait un hymne national et,en 1887, une "version officielle" est adoptée par le ministère de la guerre après avis d'une commission. C'est également sous la IIIème République, le 14 juillet 1915, que les cendres de Rouget de Lisle sont transférées aux Invalides.
En septembre 1944, une circulaire du ministère de l'Education nationale préconise de faire chanter la Marseillaise dans les écoles pour "célébrer notre libération et nos martyrs". Le caractère d'hymne national est à nouveau affirmé dans les constitutions de 1946 et de 1958 article 2.
La partition
En quelques semaines, l' "Hymne des Marseillais" est diffusé en Alsace, sous une forme manuscrite ou imprimée, puis il est repris par de nombreux éditeurs parisiens. Le caractère anonyme des premières éditions a pu faire douter que Rouget de Lisle, compositeur par ailleurs plutôt médiocre, en ait été réellement l'auteur.
Il n'existe pas de version unique de la Marseillaise qui, dès le début, a été mise en musique sous diverses formes, avec ou sans chant. Ainsi, en 1879, la Marseillaise est déclarée hymne officiel sans que l'on précise la version, et un grand désordre musical pouvait se produire lorsque des formations différentes étaient réunies.
La commission de 1887, composée de musiciens professionnels, a déterminé une version officielle après avoir remanié le texte mélodique et l'harmonie.
Le Président Valéry Giscard d'Estaing a souhaité que l'on revienne à une exécution plus proche des origines de l'oeuvre et en a fait ralentir le rythme. C'est aujourd'hui une adaptation de la version de 1887 qui est jouée dans les cérémonies officielles. Parallèlement, la Marseillaise a été adaptée par des musiciens de variété ou de jazz.
La guerre modifie radicalement l'équilibre politique, car une mobilisation d'une ampleur surprenante répond à ces menaces ; partout en France, des volontaires vite appelés les fédérés s'engagent dans l'armée et partent renforcer les frontières. Mais sur leur passage, s'intronisant défenseurs de la Révolution, ils entreprennent des opérations punitives à l'encontre des adversaires, et notamment des prêtres réfractaires. Les Marseillais se distinguent particulièrement, marchant sur Paris au son du Chant de guerre de l'armée du Rhin, qui prendra le nom de Marseillaise. La nouvelle pression populaire se traduit, à Paris, par une journée révolutionnaire : le 20 juin, les sans-culottes et les fédérés, sous la conduite des Cordeliers, envahissent les Tuileries pour obliger le roi à légaliser la répression ; il refuse, ce qui lui vaut des messages de soutien de la part d'une partie de l'opinion restée favorable à la monarchie et qui n'arrive plus à se faire entendre dans la vie politique.
Les six premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle en 1792 pour l'Armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. Dans ce contexte originel, la Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère.
Pendant la période du régime de Vichy, bien qu'elle soit toujours l'hymne national, elle est souvent accompagnée par le chant Maréchal, nous voilà !. En zone occupée, le commandement militaire allemand interdit de la jouer et de la chanter à partir du 17 juillet 19413.
Son caractère d’hymne national est à nouveau affirmé dans l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 par la IVe République, et en 1958 — par l’article 2 de la Constitution de la Cinquième République française.
Paroles en Français de la Marseillaise
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
Que veut cette horde d'esclaves
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés?
Français, pour nous, ah! quel outrage
Quels transports il doit exciter?
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage!
Quoi ces cohortes étrangères!
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fils guerriers!
Grand Dieu! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres des destinées.
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix!
Tout est soldat pour vous combattre
S'ils tombent, nos jeunes héros
La France en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre.
Français, en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups!
Épargnez ces tristes victimes
À regret s'armant contre nous
Mais ces despotes sanguinaires
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié
Déchirent le sein de leur mère!
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre!
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs!
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!
Complète :
I.
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras,
Égorger vos fils, vos compagnes !
Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !
II.
Que veut cette horde d’esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage !
Quels transports il doit exciter !
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !
(Refrain)
III.
Quoi ! des cohortes étrangères,
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !
(Refrain)
IV.
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre !
(Refrain)
V.
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
(Refrain)
VI. (Couplet souvent seul retenu aujourd’hui après le premier)
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
(Refrain)
VII. (Couplet des enfants)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !
(Refrain)
VIII. (Couplet supprimé par Servan, Ministre de la Guerre en 1792)
Dieu de clémence et de justice
Vois nos tyrans, juge nos cœurs
Que ta bonté nous soit propice
Défends-nous de ces oppresseurs (bis)
Tu règnes au ciel et sur terre
Et devant Toi, tout doit fléchir
De ton bras, viens nous soutenir
Toi, grand Dieu, maître du tonnerre.
(Refrain)
Couplets supplémentaires
IX.
Peuple français, connais ta gloire ;
Couronné par l’Égalité,
Quel triomphe, quelle victoire,
D’avoir conquis la Liberté ! (bis)
Le Dieu qui lance le tonnerre
Et qui commande aux éléments,
Pour exterminer les tyrans,
Se sert de ton bras sur la terre.
(Refrain)
X.
Nous avons de la tyrannie
Repoussé les derniers efforts ;
De nos climats, elle est bannie ;
Chez les Français les rois sont morts. (bis)
Vive à jamais la République !
Anathème à la royauté !
Que ce refrain, partout porté,
Brave des rois la politique.
(Refrain)
XI.
La France que l’Europe admire
A reconquis la Liberté
Et chaque citoyen respire
Sous les lois de l’Égalité ; (bis)
Un jour son image chérie
S’étendra sur tout l’univers.
Peuples, vous briserez vos fers
Et vous aurez une Patrie !
(Refrain)
XII.
Foulant aux pieds les droits de l’Homme,
Les soldatesques légions
Des premiers habitants de Rome
Asservirent les nations. (bis)
Un projet plus grand et plus sage
Nous engage dans les combats
Et le Français n’arme son bras
Que pour détruire l’esclavage.
(Refrain)
XIII.
Oui ! déjà d’insolents despotes
Et la bande des émigrés
Faisant la guerre aux Sans-Culottes
Par nos armes sont altérés ; (bis)
Vainement leur espoir se fonde
Sur le fanatisme irrité,
Le signe de la Liberté
Fera bientôt le tour du monde.
(Refrain)
XIV.
Ô vous ! que la gloire environne,
Citoyens, illustres guerriers,
Craignez, dans les champs de Bellone,
Craignez de flétrir vos lauriers ! (bis)
Aux noirs soupçons inaccessibles
Envers vos chefs, vos généraux,
Ne quittez jamais vos drapeaux,
Et vous resterez invincibles.
(Refrain)
XV.
Enfants, que l’Honneur, la Patrie
Fassent l’objet de tous nos vœux !
Ayons toujours l’âme nourrie
Des feux qu’ils inspirent tous deux. (bis)
Soyons unis ! Tout est possible ;
Nos vils ennemis tomberont,
Alors les Français cesseront
De chanter ce refrain terrible.
(Refrain)
Explication utile :
"qu'un sang impur abreuve nos sillons"
La traduction qui en est faite depuis la fin du XXe siècle serait risible si elle ne s'était pas autant généralisée. Rappelons dans un premier temps qu'en histoire il n'y a que deux crimes : l'anachronisme et jouer à l'"histoire-fiction". En l’occurrence, nos contemporains considèrent que cette phrase est proche de l'idéologie nazie. On considère le sang impur comme celui de l'étranger, les sillons devenant les tranchées des batailles.
Il est triste de devoir faire un rappel historique basique. Avant la Révolution, la société est divisée selon l'origine familiale. Vous êtes nobles, car vous avez du sang noble, votre supériorité vis-à-vis du reste du peuple ne vient que de là. Un noble est supérieur à un paysan par son sang. Quand les soldats français s'époumonaient "qu'un sang impur abreuve nos sillons", ils ne parlaient pas des étrangers.
Le sang impur ce n'était que le leur, les sillons n'étaient par ailleurs que des sillons, n'oublions pas que la France d'alors est agricole. Il s'agit d'une phrase symbolisant le sacrifice, les républicains d'alors étaient fiers de verser leur sale sang sur le champ d'honneur. Ils ne considéraient qu'une chose, mieux vaut tapisser tout le territoire national de sang plutôt que de se rendre.
S'indigner de cette phrase est grave. Quitte à nous bombarder d'identité nationale et d'autres expressions grandiloquentes qu'on commence d'abord à enseigner la Marseillaise aux écoliers. Mais enseigner ne veut pas dire apprendre par cœur un chant, enseigner veut dire faire comprendre ce chant, ce qu'il représente.
La chose la plus cocasse dans ce petit billet est que son auteur qui a l'air si franchouillard dans ses propos est un autonomiste corse. Aimer sa petite île ne veut pas dire qu'on a la haine pour la France. L'amour est un sentiment qui n'a pas besoin d'avoir une opposition pour exister, c'est pour cela qu'il est si fort.
Posté le : 09/05/2015 16:12
|
|
|
|
|
Louis XV ( 1 ) |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 10 Mai 1774, meurt, à 64 ans, Louis XV
naît le 15 Février 1710 au château de Versailles, royaume de France, son nom de naissance est Louis de France, duc d'Anjou, appartenant à la maison de Bourbon. Il est inhumé à la nécropole de St Denis. Son père est Louis de France, dauphin de France, sa mère est Marie-Adélaïde de Savoie, il est marié à Marie Marie Leszczyńska, ses enfants sont Élisabeth de France, Henriette de France, Marie-Louise de France, Louis de France, Philippe de France, Adélaïde de France, Victoire de France, Sophie de France, Thérèse de France, Louise de France.
Il est héritier des trônes de France et de Navarre du 8 mars 1712 au 1er septembre 1715 soit 3 ans, 5 mois et 24 jours sous le règne du monarque Louis XIV, le prédécesseur est Louis, dauphin de France, le successeur est Philippe, duc d'Orléans
Roi de France et de Navarre du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774 soit 58 ans, 8 mois et 9 jours, il est couronné le 25 octobre 1722, en la cathédrale de Reims, il a pour régent Philippe d'Orléans, 1715-1723. Le premier ministre est alors le Cardinal Dubois, Duc de Bourbon, puis le Cardinal de Fleury. son prédécesseur est son arrière grand-père Louis XIV, son successeur est Louis XVI
Louis XV dit le Bien-Aimé, né à Versailles le 15 février 1710 et mort le 10 mai 1774 dans la même ville, est un roi de France et de Navarre. Membre de la Maison de Bourbon, il règne sur le royaume de France du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774.
Orphelin à l'âge de 2 ans, duc d'Anjou puis dauphin de France du 8 mars 1712 au 1er septembre 1715, il succède à son arrière-grand-père Louis XIV à l'âge de cinq ans ; son pouvoir est alors délégué à son cousin, le duc d'Orléans, proclamé régent du Royaume le 2 septembre 1715, jusqu'au 15 février 1723, date de l'entrée du jeune roi dans sa treizième année, où il prend officiellement la direction du gouvernement.
Les premières années de son règne se déroulent dans un calme relatif, sous la direction prudente de plusieurs précepteurs, qui lui prodiguent une vaste culture. À sa majorité, il confie successivement le gouvernement à des proches parents, le duc d'Orléans, ex-régent, puis le duc de Bourbon, puis à l'un de ses anciens précepteurs, le cardinal de Fleury.
À la différence de Louis XIV, Louis XV n'a pas été en contact direct avec la vie politique du pays. Il ne voyait que rarement ses ministres et agissait souvent à l'encontre de leurs attentes faute de pouvoir leur donner des directives fermes et précises, d'après les informations émanant d'un réseau secret de diplomates et d'espions qu'il avait constitué. Son désintérêt pour la politique et la succession de ministres aux tendances différentes aboutissent à un affaiblissement de l'influence de la France en Europe.
Seul survivant de la famille royale stricto sensu, il bénéficie au début de son règne d'un grand soutien populaire, ce qui lui vaut le surnom de Bien-Aimé en 1744 après une maladie qui faillit l'emporter à Metz. Au fil des années cependant, son manque de fermeté, le dénigrement de son action par les parlementaires et une partie de la noblesse de cour, les intrigues incessantes impliquant sa maîtresse, la marquise de Pompadour, et son inconduite dans sa vie privée amènent la disparition de sa popularité, à tel point que sa mort - de la petite vérole - provoque des festivités dans Paris, comme suite à celle de Louis XIV.
Sous son règne, toutefois, la France connaît de grands succès militaires sur le continent européen et acquiert le duché de Lorraine et le duché de Bar, ainsi que la Corse. En revanche, elle perd le contrôle d'une grande partie de son empire au profit de la domination coloniale britannique : spécialement la Nouvelle-France, en Amérique, comme la prépondérance aux Indes.
En bref
Louis XV, qui sera plus tard surnommé Louis le Bien-Aimé par ses sujets apparaît un peu, à la mort de Louis XIV, son arrière-grand-père, comme l'enfant miraculeux qui va sauver la dynastie. Mais il finira son long règne (59 ans) dans la disgrâce, en raison du manque de fermeté et d'esprit de décision qu'il a manifesté, même si le royaume a connu, à cette époque, la prospérité et l'ouverture à une certaine modernité.
Le Grand Dauphin, fils du Roi-Soleil, est mort en 1711 ; en 1712, c'est le tour de son petit-fils, le duc de Bourgogne, de la femme de celui-ci, Marie-Adélaïde, et de leur fils aîné, le duc de Bretagne, âgé de cinq ans, tous trois enlevés par la rougeole pourprée et par les pratiques des médecins de la cour : la purge et la saignée. Le jeune Louis est sauvé de leurs mains par son rang infime dans la succession ; sa gouvernante, Mme de Ventadour, se borna à le tenir au chaud jusqu'à sa guérison. Héritier du trône à cinq ans, le jeune Louis commence dès lors à subir les contraintes de la vie publique et d'une étiquette minutieuse voulues par son aïeul ; mais ce qui convenait à un homme fait pétri d'orgueil et de volonté ne réussit pas à l'enfant émotif et secret. Dans une lettre destinée à Mme de Maintenon, sa gouvernante raconte que Louis aime jouer « à ne plus faire le roi ». À sept ans, il est séparé de sa gouvernante et confié à son gouverneur, le maréchal de Villeroi, un vieux courtisan vaniteux qui adore faire admirer la grâce et les talents de son élève. Celui-ci, au cours d'interminables cérémonies publiques, doit apprendre à dissimuler ses besoins comme ses sentiments, à cacher sa timidité naturelle. Il acquiert alors cet air de froideur et de majesté qu'il montrera toute sa vie en public et le goût des petits appartements, des cercles intimes, d'une vie presque bourgeoise. De Fleury, son précepteur, il reçoit une excellente instruction, un penchant pour les sciences et les techniques, fortement encouragées sous son règne, et il concevra pour cet homme ambitieux, secret lui aussi mais d'abord aimable, une admiration qui va marquer fortement sa vie. À onze ans, Louis voit arriver sa fiancée, une infante de trois ans qui ne lui inspire que de l'ennui. Déjà des pamphlets circulent contre le roi ; en 1722, l'avocat Barbier note dans son journal : Il a un bon et beau visage, bon air, et n'a point la physionomie de ce qu'on dit de lui, morne, indifférente et bête. » L'année suivante voit la proclamation de la majorité royale et, quelques mois après, la mort du régent Philippe d'Orléans. Louis-Henri de Bourbon-Condé, dit Monsieur le Duc, prend la tête du gouvernement et, très vite, s'inquiète de la santé du roi ; non par attachement à la dynastie, mais pour empêcher l'accession au pouvoir des Orléans qu'il considère comme ses ennemis. Or le roi est de constitution fragile, et manifeste des troubles qui font craindre pour sa vie. Monsieur le Duc décide de marier le roi au plus vite, renvoie la trop jeune infante en Espagne et, entre tous les partis d'Europe, choisit une princesse pauvre et vertueuse, mais non sans charme, qui a vingt et un ans, l'âge de procréer. Le 5 septembre 1725 fut célébrée l'union de Louis XV et de Marie Leszczyńska, fille du roi détrôné de Pologne.
En 1726, le roi, qui vient d'atteindre seize ans et à qui le mariage a donné une autorité que chacun remarque à la cour, disgracie Monsieur le Duc devenu très impopulaire et appelle à la direction du ministère son cher Fleury, qui demeurera à ce poste jusqu'à sa mort en 1743. Ce sera la période la plus calme et la plus prospère du règne, en dépit de l'agitation parlementaire et janséniste. Il est difficile de déterminer quelle part Louis XV prend aux décisions, mais on sait qu'il soutient constamment son ministre contre les cabales de cour et les intrigues ministérielles. Malheureusement, lorsque la querelle européenne autour de la succession d'Autriche éclate, le vieux Fleury n'a plus assez d'énergie pour s'opposer à la guerre et le roi cède aux pressions du parti anti-autrichien. À la mort de son ancien précepteur, Louis a trente-trois ans ; il a connu quelques années de bonheur auprès d'une épouse qui lui voue presque autant de dévotion qu'à Dieu. Presque chaque année un enfant est né, des filles surtout, mais aussi un dauphin qui donnera le jour à Louis XVI. Mais Marie s'est lassée d'éternelles grossesses, et son époux d'une adoration sans conditions. Pour la première fois en 1734, Marie se plaint à son père des infidélités de Louis. Le roi a découvert l'amour avec Mme de Mailly, puis avec Mme de Châteauroux, la sœur de cette dernière, tandis que la reine se réfugiait dans la religion et les œuvres charitables. Ces amours n'ont pas fait oublier au souverain les devoirs de sa charge qu'il remplit scrupuleusement, mais il manque du feu sacré de son aïeul et il a pris l'habitude de se reposer sur Fleury des tâches d'exécution, de s'appuyer sur ses conseils pour les décisions. Pendant les dix-sept ans de ce long ministère, il a formé son jugement mais n'a pu forger sa volonté. C'est un an après la mort du ministre que se déroule le drame de Metz 1744 qui va laisser des cicatrices profondes dans l'âme du roi et dans la vie politique de la France. Parti aux armées, Louis XV tombe gravement malade à Metz. On le croit alors perdu. Mme de Châteauroux, qui avait suivi le roi, doit partir sous les huées tandis que Marie est accourue de Paris. Poussé par le parti dévôt, Mgr de Fitz-James, premier aumônier du roi, exige pour lui donner l'absolution une confession publique de ses fautes dans laquelle il déclare être indigne du nom de Roi Très Chrétien ; répandue à travers le royaume par les soins du clergé, cette confession stupéfie le peuple ; le scandale éclabousse la monarchie ; réchappé de la mort, le monarque est rejeté vers ses penchants les plus détestables. Rencontrée en 1746, Mme de Pompadour est une maîtresse plus qu'honorable ; belle, cultivée, intelligente et sincèrement attachée au roi, elle a pourtant un défaut qui la rend impopulaire aux yeux de la cour et du peuple : celui d'être une bourgeoise qui, de plus, se mêle de politique. Mais peu sensuelle et de santé fragile, la maîtresse n'est plus qu'une amie dès 1750 et Louis s'enlise dans les amours éphémères et peu reluisantes qu'il cache dans sa petite maison du Parc-aux-Cerfs, amours que la légende a démesurément grossies et dont l'objet le plus célèbre fut Louise O'Murphy
Depuis 1743, le roi n'a plus de Premier ministre ; il a lu et relu les instructions de son aïeul : « Écoutez, consultez votre Conseil, mais décidez. » Mais, sans doute plus intelligent et plus cultivé que lui, Louis XV manque de confiance en soi ; sa correspondance politique montre sa connaissance des affaires, la justesse de ses vues ; mais il hésite à trancher, pensant que son interlocuteur peut avoir raison contre lui, et ce n'est que poussé à bout, souvent lorsqu'il est trop tard, qu'il se décide à l'action avec une brutalité qui étonne. Sa disgrâce tombe comme la foudre sur le ministre estimé coupable ; ainsi en est-il pour Maurepas, pour d'Argenson, pour Choiseul. Seul Machault qui conserve toute son estime sera remercié avec les honneurs. Cet homme si sensible à l'opinion n'ose entreprendre les réformes indispensables par crainte de perdre sa popularité ; en décembre 1756, le roi a obligé le Parlement à enregistrer des édits le privant de ses moyens d'action, il est décidé à mettre fin à la rébellion des magistrats. Le coup de couteau de Damiens, le 5 janvier suivant, le persuade qu'il fait fausse route puisque son peuple le désavoue. La réforme de Machault ne sera réalisée qu'avec Maupeou en 1771.
De ses déboires politiques, Louis ne se console pas seulement avec ses maîtresses ; il aime tendrement ses enfants qui le lui rendent bien ; l'une de ses filles, Louise, prendra le voile en expiation des péchés de son père. La mort du Dauphin, en 1765, le plonge dans une douleur d'autant plus grande qu'il ne reste pour lui succéder qu'un enfant de onze ans. Peu auparavant, il écrivait à Choiseul : Au moins avec mon fils, je suis sûr d'un successeur fait et ferme. Et c'est tout vis-à-vis de la multitude républicaine. Louis XV était lucide sur l'état dans lequel il laisserait la France ; de ses mots : tout cela durera bien autant que moi, les manuels d'histoire ont fait le célèbre : Après moi le déluge. Sa révolution royale, il ne la réalise que trois ans avant sa mort. Depuis 1768, il a auprès de lui une nouvelle favorite, Jeanne du Barry née Bécu, encore plus détestée que la Pompadour. Il sait qu'il n'est plus le Bien-Aimé. La petite vérole l'emporte à l'âge de soixante-quatre ans au milieu de l'indifférence générale. Louis XV demeure l'une des figures les plus attachantes de sa lignée : fin, généreux, sensible, il partagera largement les goûts de son temps ; il lui manqua sans doute l'essentiel pour un souverain : l'esprit de décision, une volonté ferme et constante. Pendant les cinquante-quatre ans que dura son règne, Louis XIV avait habitué la France à obéir, et incarné l'État. Sa grande ombre devait éclipser son successeur en proie à trop de faiblesses humaines. Le Siècle de Louis XIV n'a-t-il pas été conçu par Voltaire pour démontrer cette écrasante supériorité ? Solange Marin
Sa vie
Louis XV est né dans le château de Versailles est le troisième fils de Louis de France, duc de Bourgogne, surnommé le Petit Dauphin, et de Marie-Adélaïde de Savoie. Il est ainsi l'arrière-petit-fils de Louis XIV. De ses deux frères aînés, également prénommés Louis, le premier titré duc de Bretagne mourut en 1705 à l'âge d'un an, le second reprenant le titre de duc de Bretagne, né en 1707, ne vécut que cinq ans.
À sa naissance, en pleine guerre de Succession d'Espagne, le futur Louis XV, titré duc d'Anjou — titre porté précédemment par son oncle, Philippe de France, prétendant français au trône d'Espagne et futur roi Philippe V 1700-1746 — est immédiatement confié à sa gouvernante, la duchesse de Ventadour, secondée par Madame de La Lande, sous-gouvernante. Il n'est alors pas destiné à régner, se plaçant au quatrième rang dans l'ordre de succession dynastique. Avant lui, doivent logiquement régner le fils de Louis XIV, le Grand Dauphin, puis son père le Petit Dauphin, et enfin son frère aîné, le duc de Bretagne. Mais entre 1710 et 1715, une série de morts dans la famille royale met brusquement le jeune prince en première ligne dans la succession de Louis XIV : le Grand Dauphin meurt de la variole le 14 avril 1711. L'année suivante, une rougeole maligne emporte le Petit Dauphin et son épouse les 18 et 12 février 1712.
Demi-Louis dit de Noailles sous Louis XV le Bien-Aimé.
Les deux fils aînés du duc de Bourgogne, les ducs de Bretagne et d'Anjou, contractent également la maladie. L'aîné, Bretagne, meurt le 8 mars 1712. Le jeune duc d'Anjou, âgé alors d'à peine deux ans, devient alors l'héritier du trône de France avec le titre de dauphin de Viennois, abrégé en dauphin. Malade, sa santé est scrutée avec attention par Louis XIV, roi vieillissant et suffisamment affecté par les pertes familiales récentes pour se laisser aller à pleurer devant ses ministres. On craint longtemps pour la santé du jeune prince, mais, petit à petit, il se remet, soigné par sa gouvernante et protégé par elle des abus de saignées qui ont vraisemblablement causé la mort de son frère
En 1714, Louis est confié à un précepteur, l'abbé Perot. Celui-ci lui apprend à lire et à écrire, et lui enseigne des rudiments d'histoire et de géographie et, bien sûr, lui donne l'enseignement religieux nécessaire au futur roi très chrétien. En 1715, le jeune dauphin reçoit également un maître à danser, puis un maître à écrire. Son confesseur est le père Le Tellier.
Le jeune roi
Le futur Louis XV commence sa vie publique peu de temps avant la mort de son bisaïeul Louis XIV. Le 19 février 1715, Louis XIV reçoit en effet en grande pompe dans la galerie des Glaces de Versailles l'ambassadeur de Perse. Il associe son successeur, qui vient d'avoir cinq ans, à la cérémonie, le plaçant à sa droite. En avril 1715, l'enfant participe avec le vieux roi à la cérémonie de la Cène du Jeudi saint et participe au Lavement des pieds. Il est toujours accompagné de sa gouvernante, Madame de Ventadour. Dans les derniers temps de la vie de Louis XIV, le futur roi participe à plusieurs défilés militaires et cérémonies visant à lui donner l'habitude de la vie publique.
Le 26 août, sentant la mort venir, Louis XIV fait entrer le jeune Louis dans sa chambre, l'embrasse et lui parle avec gravité de sa future tâche de roi, dans des mots qui sont par la suite passés à la postérité, qui y a vu une sorte de testament politique du grand roi et des remords concernant sa propre action :
Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre : c'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela ; j'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l'ai soutenue par vanité. Ne m'imitez pas, mais soyez un prince pacifique, et que votre principale application soit de soulager vos sujets.
Louis XIV meurt six jours plus tard, le 1er septembre 1715.
Les 3 et 4 septembre 1715, Louis XV accomplit ses premiers actes de roi, d'abord en se rendant à la messe de requiem célébrée pour le feu roi à la chapelle de Versailles, ensuite en recevant l'assemblée du clergé venue célébrer son propre avènement. Le 12, il enchaîne sur un lit de justice, l'une des cérémonies les plus solennelles de la monarchie, le 14, sur les harangues du Grand Conseil, de l'Université de Paris et de l'Académie française, les jours suivants, sur les réceptions d'ambassadeurs venus présenter leurs condoléances, etc. Malgré son jeune âge, il doit se plier à la mécanique du gouvernement et de la cour et jouer son rôle de représentation.
Au jour anniversaire de ses sept ans le 15 février 1717, ayant atteint l'âge de raison, son éducation passe aux hommes : elle est désormais confiée à un gouverneur, le duc François de Villeroy un ami d'enfance de Louis XIV et fils de Nicolas V de Villeroy, gouverneur de Louis XIV qui lui impose tous les rituels de la Cour de Versailles mis en place par Louis XIV. Il y a également un précepteur, André Hercule de Fleury, évêque de Fréjus. On lui apprend désormais le latin, les mathématiques, l'histoire et la géographie, la cartographie, le dessin et les rudiments d'astronomie, mais aussi la chasse. L'éducation manuelle n'est pas non plus négligée : en 1717, il apprend un peu de typographie, et en 1721, il s'initie à tourner le bois. Depuis 1719, il avait des maîtres de musique. Contrairement à Louis XIV, il n'avait que peu d'affinités pour la musique mais était attiré par l'architecture.
Régence du duc d’Orléans
La monarchie française a, depuis le Moyen Âge, fixé de manière stricte les règles de succession. Elle a cependant peu de règles concernant les régences. Ces périodes sont redoutées comme propices aux troubles à cause de la faiblesse alors présentée par le pouvoir royal. Louis XIV, voyant ses descendants mourir avant lui, a donc réglé les problèmes de régence qui allaient se poser après sa mort. Il songeait également que, le petit Louis XV étant seul de sa lignée et fragile, il fallait assurer une succession au trône. Cela entraîna donc, à la fin du règne de Louis XIV, plusieurs modifications des coutumes, et notamment le fait que les enfants bâtards de Louis XIV aient été déclarés successibles.
Mais le régent fait casser le testament de Louis XIV et devient le successeur potentiel de Louis XV. Le principal danger dynastique vient, pour lui, de l'Espagne, dotée d'un roi Bourbon qui, normalement, avait par le traité d'Utrecht renoncé à tout droit au trône, mais qui aurait bien pu évoquer l’indisponibilité de la couronne pour faire valoir ses droits en cas de décès de Louis XV sans enfant.
Le Régent, Philippe d'Orléans, à qui Louis XIV a confié le jeune roi, est donc conduit à prendre quelques libertés avec les instructions de l'ancien roi, ce afin de protéger Louis XV et de commencer à assurer son autorité.
La première mesure prise par le Régent est de ramener Louis XV et la Cour à Paris. C'est aller contre les volontés de Louis XIV, mais se rapprocher du peuple. Le souvenir de la Fronde est encore vif, et le Régent souhaite construire un lien fort entre le peuple de Paris et le jeune roi, afin d'éviter tout trouble. Après un passage par Vincennes de septembre à décembre 1715, Louis XV s'installe au palais des Tuileries tandis que le Régent gouverne le royaume depuis le Palais-Royal. Le peuple parisien se prend alors d'affection pour ce jeune roi alors que le noblesse, désormais dispersée dans les hôtels de la capitale, jouit sans contrainte ni mesure de sa liberté.
Un des premiers actes politiques de Philippe d'Orléans est également sa volonté de donner des garanties au Parlement pour compenser le retour à Paris de la Cour et la liberté prise par le Régent avec les instructions de Louis XIV. Il lui redonne notamment le droit de remontrance, que Louis XIV avait fortement réduit en le cantonnant à des remontrances postérieures à la prise de décision royale. En ces temps de faiblesse du pouvoir, les parlements et principalement le Parlement de Paris se présentent comme des représentants du peuple, malgré la vénalité de leurs charges et leur composition quasi exclusivement issue de la noblesse de robe. Cela leur donne le pouvoir de s'opposer au Régent, notamment par des grèves, appelées cessations d'activité. Le premier conflit apparaît en 1717-1718, à propos des soucis financiers dus à la banqueroute de Law. Par ailleurs, entre 1715 et 1718, le gouvernement central est réorganisé: les secrétaires d'État sont supprimés et remplacés par des conseils qui redonnent un rôle politique à la haute noblesse: c'est la polysynodie. Ce système est abandonné en raison de sa lourdeur.
D'autres conflits apparaissent régulièrement, liés notamment au problème janséniste et à l'application de la Bulle Unigenitus. En rompant avec la mainmise de Louis XIV sur les droits des parlements, le Régent ouvre la porte à une ère de contestation, que Louis XV aura bien du mal ensuite à contrer.
La Régence marque aussi un changement d'alliances pour la France. Alors qu'elle avait auparavant noué une solide alliance avec l'Espagne des Bourbons, voisine géographique et alliée catholique, le Régent opte au contraire pour un éloignement d'avec l'Espagne et un rapprochement avec les puissances du nord de l'Europe, revenant à la politique du siècle précédent alors que le risque d'encerclement des Habsbourg n'existe plus. C'est ainsi qu'il renoue des contacts avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, pourtant protestants. En 1717 est formalisée la Triple alliance de La Haye, liant France, Pays-Bas et Angleterre. Ce retournement d'alliance du régent est même complété en 1718, par une alliance innovante avec l'Autriche des Habsbourg quadruple alliance. Tout cela inquiète le roi Philippe V d'Espagne à tel point qu'il tente de faire renverser le régent par le duc du Maine et que cela entraîne une courte guerre entre la France et l'Espagne en 1719. La victoire des puissances européennes contraint l'Espagne à rejoindre leur alliance et à organiser des fiançailles ou des mariages franco-espagnols. Le roi est un temps fiancé à Marie-Anne-Victoire d'Espagne, renvoyée en Espagne par le duc de Bourbon.
Sur le plan économique, la Régence est une période de vitalité et d'expérimentations. Mais l'échec du système de Law et les réticences qui suivent concernant le crédit et l'investissement ralentissent, à terme, la modernisation de l'économie.
Las des critiques des Parlementaires qui commencent à agiter en sous-main les Parisiens et de l'hostilité de la foule qui lance injures et projectiles sur son carrosse, le Régent, sans l'annoncer officiellement, décide de faire revenir la Cour au château de Versailles. Le 15 juin 1722, Versailles redevient résidence royale et symbolise le retour à la politique louis-quatorzienne.
La Régence laisse ainsi au jeune roi Louis XV, lorsqu'il prend effectivement les rênes du pouvoir en 1723 un royaume à la fois héritier de la monarchie absolutiste de Louis XIV et des ouvertures parfois fragilisantes du Régent. Cela influence considérablement le règne de Louis XV.
Début du règne personnel
Le jeune Louis XV est sacré et couronné à Reims le 25 octobre 1722. Il atteint sa majorité 13 ans l'année suivante, et est déclaré majeur lors du lit de justice du 22 février 1723. Cependant, encore trop jeune pour régner par lui-même, il laisse l'exercice effectif du pouvoir tout d'abord au duc d'Orléans et au cardinal Dubois. Les deux meurent à quelques mois d'intervalle, à la fin de l'année 1723. En 1724, le Roi, probablement sous influence, signe une révision du Code noir. Destiné à la Louisiane, il s'agit d'un durcissement de la version précédente édictée par son arrière grand-père. Notamment, les mariages entre Noirs et Blancs sont interdits.
C'est le duc de Bourbon, prince du sang, qui devient alors le principal conseil du roi. Pendant que celui-ci termine son éducation et s'adonne à de nouveaux plaisirs, comme ceux de la chasse, le duc de Bourbon cherche à trouver une épouse pour le roi. La première pressentie, Marie-Anne-Victoire de Bourbon, avait été fiancée en 1721 à Louis XV, alors qu'elle n'avait que trois ans. Mais le duc de Bourbon, craignant que le jeune roi, de santé fragile, ne décède sans enfant mâle s'il fallait attendre que sa fiancée soit en âge d'avoir des enfants, et craignant alors de perdre sa place privilégiée en cas de transmission de la couronne à la branche d'Orléans, rompt les fiançailles en 1725.
La recherche d'une autre fiancée parmi les princesses d'Europe est dictée par la santé fragile du roi, qui nécessite une rapide descendance. Après avoir dressé une liste des cent princesses d'Europe à marier, le choix se porte sur Marie Leszczyńska, princesse catholique et fille du roi détrôné de Pologne Stanislas Leszczynski. Le mariage n'est d'abord pas très bien vu en France, la jeune reine étant perçue comme de trop faible extraction pour un roi de France. Mais les époux se plaisent (malgré les sept ans qui les séparent, Marie Leszczyńska ayant 22 ans et Louis XV seulement et la reine est rapidement appréciée du peuple pour sa charité. Après un mariage par procuration le 15 août dans la cathédrale de Strasbourg afin de valoriser la province d'Alsace récemment annexée, la cérémonie du mariage est célébrée à Fontainebleau le 5 septembre 1725.
À la suite de ce mariage, et malgré l'insistance de la reine qui le considérait comme son mentor, Louis XV écarte le duc de Bourbon du pouvoir et l'exile dans ses terres à Chantilly. Avec cet exil, Louis XV décide également de supprimer la charge de premier ministre. Il appelle auprès de lui le cardinal de Fleury, son ancien précepteur. Celui-ci commence alors auprès du roi une longue carrière à la tête du royaume, de 1726 à 1743.
Ministère du cardinal de Fleury
Le renvoi du duc de Bourbon marque le début du règne personnel du roi adolescent. En fait, se réfugiant derrière l'ombre tutélaire du feu Louis XIV, le jeune roi, orphelin trop tôt, abandonnera la totalité du pouvoir au cardinal de Fleury, le précepteur fidèle qui avait su capter son affection. Ainsi, bien qu'instruit et désireux d'accomplir au mieux sa charge, il commence son règne le 16 juin 1726 en fixant les cadres de son gouvernement, annonçant à son "Conseil d'En Haut", outre la fin de la charge de premier ministre, sa fidélité à la politique de Louis XIV, son arrière-grand-père :
Mon intention est que tout ce qui regarde les fonctions des charges auprès de ma personne soient sur le même pied qu'elles étaient sous le feu Roi mon bisaïeul. ... Enfin, je veux suivre en tout l'exemple du feu Roi mon bisaïeul. Je leur,aux conseillers fixerai des heures pour un travail particulier, auquel l'ancien évêque de Fréjus le cardinal de Fleury assistera toujours.
De 1726 jusqu'à sa mort en 1743, le cardinal dirige donc la France aux côtés du roi. La situation est alors inédite. C'est la première fois qu'un ancien précepteur de roi devient de facto Premier ministre. Louis XV, désireux de garder auprès de lui son mentor auquel il était profondément attaché, qui avait déjà des charges importantes et en qui il avait totale confiance, donne au cardinal de Fleury pourtant septuagénaire un pouvoir extrêmement étendu. Les près de dix-sept ans où Fleury administre au jour le jour le royaume, pour l'historien Michel Antoine, délimitent dans le règne une période caractéristique et importante, tant pour l'extension du royaume et son rayonnement dans le monde et pour les affaires intérieures, que pour l'administration, la législation et l'économie.
Nouvelle équipe
Si le cardinal de Fleury est un homme âgé en 1726 il a soixante-treize ans, le reste des ministres et très proches conseillers du roi se renouvelle et est composé d'hommes plus jeunes qu'auparavant. Les changements sont nombreux, mais ensuite la période du ministère Fleury est marquée par une grande stabilité. Fleury fait revenir le chancelier d'Aguesseau, renvoyé en 1722. Il ne retrouve cependant pas toutes ses prérogatives, puisque les sceaux et les Affaires étrangères sont confiées à Germain Louis Chauvelin, président à mortier du Parlement de Paris. Le comte de Maurepas devient secrétaire d'État à la Marine, à vingt-cinq ans. C'est la période la plus pacifique et prospère du règne de Louis XV, malgré d'importants troubles avec le parlement de Paris et les jansénistes. Après les pertes humaines et financières subies à la fin du règne de Louis XIV, puis lors de l'établissement de nouveaux systèmes financiers français, le gouvernement de Fleury a souvent été qualifié de réparateur ». Il est difficile de déterminer avec exactitude le degré d'intervention du roi dans les décisions de Fleury, mais il est certain que Louis XV a soutenu sans relâche son mentor et qu'il n'est jamais allé véritablement contre ses volontés. Pour Michel Antoine, Louis XV, extrêmement timide, resta pratiquement en tutelle jusqu'à l'âge de trente-deux ans.
Avec l'aide des contrôleurs généraux des finances Michel Robert Le Peletier des Forts 1726-1730 et surtout Philibert Orry 1730-1745, "Monsieur le Cardinal" parvint à stabiliser la monnaie française 1726, en nettoyant le système financier de Law, et finit par équilibrer le budget du royaume en 1738. L'expansion économique était au cœur des préoccupations du gouvernement. Les voies de communications furent améliorées, avec l'achèvement en 1738 du canal de Saint-Quentin, reliant l'Oise à la Somme, étendu ultérieurement vers l'Escaut et les Pays-Bas, et principalement la construction systématique d'un réseau routier sur l'ensemble du territoire national. Le corps des Ingénieurs des ponts et chaussées construisit un ensemble de routes modernes, partant de Paris selon le schéma en étoile qui forme encore l'ossature des routes nationales actuelles. Au milieu du XVIIIe siècle, la France s'était dotée de l'infrastructure routière la plus moderne et la plus étendue du monde. Le commerce fut également stimulé par le Bureau et le Conseil du Commerce. Le commerce maritime extérieur de la France grimpa de 80 à 308 millions de livres entre 1716 et 1748. Cependant, les lois rigides édictées auparavant par Colbert ne permirent pas à l'industrie de profiter pleinement de ce progrès économique.
Le pouvoir de la monarchie absolue s'exerça lors de la répression des oppositions jansénistes et gallicanes. L'agitation causée par les illuminés du cimetière Saint-Médard à Paris les Convulsionnaires, un groupe de jansénistes qui prétendait que des miracles survenaient dans le cimetière cessa en 1732. Sur un autre front, après l'exil de 139 parlementaires en province, le parlement de Paris dut enregistrer la bulle papale Unigenitus et fut dorénavant interdit de s'occuper des affaires religieuses.
Acquisition de la Lorraine et du Barrois
En ce qui concerne les affaires étrangères, Fleury a recherché la paix à tout prix en pratiquant une politique d'alliance avec la Grande-Bretagne, tout en se réconciliant avec l'Espagne. En septembre 1729, après sa troisième grossesse, la reine donna enfin naissance à un garçon, Louis Ferdinand, qui devint aussitôt dauphin. L'arrivée d'un héritier mâle, qui assurait la pérennité de la dynastie, fut accueillie avec une immense joie et célébrée dans toutes les sphères de la société française et également dans la plupart des cours européennes. Le couple royal était à l'époque très uni, se manifestait un amour réciproque et le jeune roi était extrêmement populaire. La naissance d'un garçon écartait également le risque d'une crise de succession et le probable affrontement avec l'Espagne qui en aurait résulté.
En 1733, malgré la politique pacifiste de Fleury, le roi, convaincu par son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Germain Louis Chauvelin 1727-1737, intervint mollement pour tenter de remettre sur le trône de Pologne Stanislas Leszczyński, son beau-père qu'il hébergeait à Chambord. Ce fut la guerre de Succession de Pologne. Si l'intervention sans conviction de la France contre l'Autriche ne permit pas de renverser le cours de la guerre ni de rendre le trône à Stanislas, en revanche, l'habileté du cardinal de Fleury réussit à programmer le rattachement des duchés de Lorraine et de Bar au Royaume, stratégiquement situés entre Paris et le Rhin.
Ces duchés furent, en effet, le principal enjeu de la guerre: ils étaient possession du jeune duc François III, fils du duc Léopold Ier et d'Élisabeth-Charlotte d'Orléans, sœur du feu régent, qui en assurait la régence. François III, en effet, vivait à Vienne où il avait été appelé par son proche parent, empereur du Saint-Empire Charles VI, qui l'avait nommé vice-roi de Hongrie en 1731, prémices d'une carrière plus prometteuse, puisqu'il le pressentait pour épouser sa fille aînée et héritière Marie-Thérèse. Une telle union aurait considérablement renforcé la puissance autrichienne qui possédait déjà aux frontières de la France, les Provinces belges et le Luxembourg. L'empire aurait protégé ainsi la route du Rhin et se rapprochait dangereusement de Paris.
Lors de la guerre, les troupes françaises occupèrent rapidement le Barrois et la Lorraine. La paix fut signée dès 1735. Fleury trouva un habile arrangement : par le traité de Vienne novembre 1738, le beau-père de Louis XV obtint à titre viager les duchés de Lorraine et de Bar en compensation de la seconde perte de son trône polonais avec l'objectif que le duché soit intégré au royaume de France à sa mort par le biais de sa fille, tandis que le duc François III devenait héritier du grand duché de Toscane avant d'épouser la jeune Marie-Thérèse et de pouvoir prétendre à la couronne impériale, en Toscane le dernier des Médicis n'avait pas d'héritier). Par le traité secret de Meudon, Stanislas abandonnait la réalité du pouvoir à un intendant nommé par la France qui préparerait sans ménagement la réunion des duchés au royaume. Cette guerre, peu coûteuse comparativement aux ponctions humaines et financières exorbitantes des campagnes de Louis XIV, était un succès pour la diplomatie française. L'annexion de la Lorraine et du Barrois, effective en 1766 à la mort de Stanislas, constitue la dernière expansion territoriale du royaume de France sur le continent avant la Révolution.
Peu après ce résultat, la médiation française dans le conflit entre le Saint-Empire et l'Empire ottoman aboutit au traité de Belgrade septembre 1739, qui mit fin à la guerre avec un avantage pour les Ottomans, alliés traditionnels des Français contre les Habsbourg depuis le début du XVIe siècle. En conséquence, l'Empire ottoman renouvela les capitulations françaises, qui affirmèrent la suprématie commerciale du royaume au Moyen-Orient. Après tous ces succès, le prestige de Louis XV, arbitre de l'Europe, atteignit son sommet.
Guerre de Succession d'Autriche
En 1740, la mort de l'empereur Charles VI et l'avènement de sa fille Marie-Thérèse déclencha la guerre de Succession d'Autriche. Le vieux cardinal de Fleury n'avait plus la force de s'y opposer et le roi succomba à la pression du parti anti-autrichien de la cour : il entra en guerre en 1741 en s'alliant à la Prusse contre les Autrichiens, les Britanniques et les Hollandais. Ce conflit devait durer sept longues années. La France était de nouveau entrée dans un cycle guerrier typique du règne de Louis XIV. Fleury mourut avant la fin de la guerre, en janvier 1743. Le roi, suivant finalement l'exemple de son prédécesseur, décida alors de gouverner sans Premier ministre. La première partie du conflit fut marquée par de cuisants échecs : la Bavière, soutenue par la France, fut envahie par les troupes autrichiennes et les troupes des Habsbourg se trouvaient sur le Rhin. Seule l'intervention de la Prusse les obligea à renoncer à l'Alsace.
Par contraste, la dernière partie de la guerre fut marquée par une série de victoires françaises aux Pays-Bas : bataille de Fontenoy 1745, bataille de Rocourt 1746, bataille de Lauffeld en 747. En particulier, la bataille de Fontenoy, remportée par le maréchal de Saxe et le roi en personne, est considérée comme une des plus éclatantes victoires des Français contre les Britanniques. À la suite de ces victoires, la France occupait tout le territoire de l'actuelle Belgique et se trouvait en position d'envahir la Hollande avec la chute de la forteresse de Berg-op-Zoom. Louis XV n'était pas loin de réaliser le vieux rêve français d'établir la frontière septentrionale du pays le long du Rhin. La bataille de Plaisance, perdue en 1746 par le marquis de Maillebois, força toutefois les Français à repasser les Alpes, mais sans grandes conséquences politiques car le front essentiel se situait aux Pays-Bas.
Sur mer, la marine royale, qui combattait pourtant à un contre deux17 contre la Royal Navy fit mieux que de se défendre puisqu'elle réussit, entre 1744 et 1746, à maintenir ouvertes les lignes de communication vers les colonies et à protéger les convois commerciaux. La bataille du cap Sicié permettait de lever le blocus de Toulon. Deux tentatives de débarquement en Angleterre échouaient en 1744 et 1746, de même qu'une attaque anglaise débarquement contre Lorient en 1746. En Amérique du Nord, l'Angleterre s'empara en 1745 de Louisbourg qui défendait l'entrée du fleuve Saint-Laurent, mais sans pouvoir envahir le Canada français. Aux Indes, les Français tinrent en échec la flotte anglaise et mirent la main en 1746 sur Madras, le principal poste anglais dans la région. Ils repoussèrent ensuite une flotte anglaise venue reconquérir la place et attaquer Pondichéry. La marine anglaise, qui changea de stratégie en 1746 en imposant un blocus près des côtes, fit subir à la marine française en 1747 deux lourdes défaites dans l'Atlantique au cap Ortégal, en mai et au cap Finisterre, en octobre, mais sans conséquences sur la prospérité coloniale de la France car la paix était signée peu après.
Au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, la France et l'Angleterre se resituaient leurs conquêtes respectives Louisbourg contre Madras ce qui créait, pour quelques années, un équilibre naval entre les deux pays. Le roi rendit cependant toutes ses conquêtes à l'Autriche, à l'indignation du peuple, la consternation de ses généraux et à la surprise des puissances européennes. Louis XV, qui n'avait pas le tempérament belliqueux de son prédécesseur, avait aussi compris que jamais l'Angleterre ne laisserait les ports belges devenir français et que le temps était venu de contrecarrer les nouvelles puissances émergentes protestantes Angleterre, Prusse pour sauvegarder l'ordre ancien représenté par la France et l'Autriche catholiques. Alors que Lois XIV avait eu l'ambition de « remettre la France partout où jadis fut la Gaule »[réf. nécessaire], son successeur se satisfaisait d'un royaume hexagonal, qu'il nommait son pré carré. Il préférait cultiver ce pré carré que de chercher à l'étendre. Les seuls changements notables en Europe furent l'annexion par la Prusse de la Silésie, riche région minière austro-bohême, et le retour du minuscule duché de Parme à la dernière des Farnèse, la reine douairière d'Espagne; le duché fut attribuée au fils cadet de celle-ci, l'infant Philippe, gendre depuis 1739 de Louis XV. Louis déclara qu'il avait conclu la paix en roi et non en marchand. Sa générosité fut saluée en Europe dont il devint l'arbitre.
Louis XV
Physiquement, Louis XV est beau, grand 1,77 m selon ses médecins, d'une constitution athlétique, la taille cambrée et le maintien droit ; il émane de sa personne une autorité naturelle qui impressionne fortement ceux qui le voient pour la première fois. Passionné de chasse, il s'y rend chaque jour, sauf les dimanches et fêtes. Il connaît parfaitement tous les chiens de sa meute, à laquelle il prodigue des soins attentifs, au point de faire aménager dans ses appartements du château de Versailles le cabinet des chiens. Il aime l'exercice physique, la vitesse, et mener ses chevaux au grand galop. Pour faciliter ses courses, il fait réaménager les forêts d'Île-de-France avec les pattes d'oie qui subsistent actuellement. D'esprit vif, il a un jugement prompt et sûr. Sa mémoire est grande, et il se rappelle avec précision une foule de détails sur les Cours étrangères, qui étonnent les ambassadeurs. Il aime lire, et les résidences royales sont équipées de bibliothèques : Versailles mais aussi Choisy-le-Roi, comme Fontainebleau et Compiègne. Malgré sa clairvoyance et sa lucidité, il doute en permanence de ses capacités, et préfère suivre l'avis d'un conseiller en dépit de son opinion : c'est ainsi que, contre son opinion, il engage la France dans la guerre de Sept Ans.
Méfiant voire méprisant pour les gens de lettres, sa curiosité le porte vers les connaissances scientifiques et techniques. Il observe avec les astronomes les plus réputés les éclipses des planètes. Ses connaissances en médecine lui permettent d'avoir des conversations suivies avec les grands médecins de son temps sur les découvertes récentes. Il fait aménager au Trianon un jardin botanique qui, avec 4 000 espèces, sera le plus important d'Europe. Enfin, passionné de géographie, il encourage le travail des géographes, et est à l'origine de la réalisation de la carte de Cassini. Il possède, en outre, une grande connaissance de l'histoire du royaume, et étonne ses interlocuteurs par la précision de ses connaissances liturgiques. Capable de beaucoup de bienveillance, il peut aussi se montrer cassant. Il est sujet à des accès de neurasthénie, où il s'enferme dans un mutisme complet. Son entourage est très attentif à l'humeur du roi quand il faut traiter d'affaires importantes. Il est d'une timidité quasi maladive, ce qui le fait paraître froid et distant. Sa voix mal posée et rauque l'encombre, et, lors des cérémonies officielles, il demande souvent que son discours soit lu par un de ses ministres.
Louis le Bien-Aimé
À la mort du cardinal de Fleury en 1743, le roi avait 33 ans. Il avait connu des années heureuses avec la reine qui l'adulait et lui était entièrement dévouée. Un enfant naissait presque chaque année. Cependant, la reine finit par se fatiguer de ces grossesses à répétition, autant que le roi se lassait de l'amour inconditionnel de son épouse. De plus, la plupart de leurs enfants étaient de sexe féminin, ce qui finit par indisposer le roi. Sur leurs dix enfants, ils n'eurent que deux garçons et un seul survécut, le dauphin.
En 1734, pour la première fois, la reine se plaignit à son père des infidélités du roi. Le roi tomba amoureux de la comtesse de Mailly, puis de sa jeune sœur, la comtesse de Vintimille, puis à sa mort d'une autre de leurs sœurs, la marquise de Tournelle qu'il fit duchesse de Châteauroux. Il rencontrait généralement ces dames dans l'entourage de la reine qui se réfugia alors dans la religion, les œuvres de charité et la vie familiale. Pour des raisons d'économie, le cardinal de Fleury avait confié l'éducation des plus jeunes filles du couple royal aux religieuses toutes nobles de l'abbaye de Fontevraud. Une des princesses, Madame Sixième, y mourut à l'âge de 8 ans, les autres princesses revinrent à la cour entre 1748 et 1750. Les enfants royaux prirent le parti de leur mère.
Épisode de Metz
Un an après la mort de Fleury, se produisit un événement qui allait marquer la personnalité du roi et la suite de la vie politique française : « L'épisode de Metz ». Louis XV était parti diriger ses armées engagées sur le front de l'est dans la guerre de succession autrichienne. Le 4 août 1744, à Metz, il tomba gravement malade d'une fièvre subite et inexpliquée, une "fièvre maligne" d'après les médecins de l'époque. En hâte, les médecins parisiens sont amenés auprès de Louis XV, dont l'état est préoccupant : le chirurgien royal, François de La Peyronie, pratique des saignées, et François Chicoyneau, médecin à la Cour, multiplie les médications. Mais le patient continue de voir son état empirer d'heure en heure, et le 12, le chirurgien déclara que le roi n'en avait que pour deux jours. Le 15 août, Louis XV reçoit l'extrême-onction.
Les prières se multiplièrent à travers le pays pour son salut. Sa maîtresse, Madame de Châteauroux, qui l'avait accompagné, dut le quitter tandis que la reine arrivait en hâte. C'est à cette période que le roi fait le vœu de faire construire une église dédiée à Sainte Geneviève, dans le cas où il guérirait.
Sous la pression du parti dévot, Monseigneur de Fitz-James, premier aumônier du roi, refusa de lui donner l'absolution sans une confession publique de ses péchés dans laquelle le roi apparaissait comme une personne immorale, indigne de porter le titre de Roi Très Chrétien. Colportée dans tout le pays par le clergé, la confession royale ternit le prestige de la monarchie. Pendant ce temps, les dévots, fort maladroitement, plaçaient ostensiblement un second oreiller dans le lit de la reine et poussaient celle-ci, pourtant quadragénaire, à s'habiller comme une adolescente, abusant du rouge et des parfums, ce qui seyait peu à une femme de son âge.
En désespoir de cause, on fit appel à un médecin juif, Isaïe Cervus Ullmann qui sauva le roi de sa dysenterie. D'après Tribout de Morembert, le médecin Esaias Cervus Ulman eut l'honneur de remettre sur pied Louis XV lors de sa grave maladie, mais comme il était impensable que le roi Très Chrétien ait été guéri par un juif, on découvrit un vieux médecin pensionné du régiment d'Alsace, Alexandre de Montcharvaux, à qui on fit endosser la guérison. D'après Chaffanjon, Cervus Isaie Ulmann, alias Isaye Cerf, est le médecin qui donna des soins à Louis XV ; celui-ci le dispensa en retour du paiement de l’impôt et de loger chez lui des officiers de la garnison.
Le roi échappa ainsi à la mort et, à la suite de la messe d'action de grâce célébrée en l'église Notre-Dame de Metz en présence de la famille royale, le pays tout entier reprit les qualificatifs du célébrant et appela le roi Louis le Bien-Aimé. Louis XV donne ses indications pour faire construire l'église qu'il avait promise en cas de guérison ; elle deviendra le Panthéon.
Cependant Louis XV, en tant que roi, avait ressenti douloureusement l'humiliation que lui avait infligée le parti dévot. De retour à Versailles, il démit Monseigneur de Fitz-James de ses fonctions d'aumônier, l'exila dans son diocèse et rappela Madame de Châteauroux, mais celle-ci mourut avant sa rentrée en grâce officielle. Le roi, bien que sa vie sexuelle déréglée le fît souffrir d'un profond sentiment de culpabilité, ne renoua pas avec la reine.
Marquise de Pompadour, Madame de Pompadour.
Jeanne Le Normant d'Étiolles, née Poisson, rencontrée en 1745 lors du bal masqué donné à l'occasion du mariage du dauphin Louis-Ferdinand, devint la favorite la plus célèbre du règne. Le roi, pour lui permettre d'être présentée à la cour et de devenir dame d'honneur de la reine, lui attribua une terre limousine tombée en déshérence : le marquisat de Pompadour. Fille d'un financier, elle était plutôt belle, cultivée, intelligente et sincèrement attachée au roi, mais avait contre elle d'appartenir au Tiers état, étant une bourgeoise proche des milieux financiers, ce que la cour et le peuple ne pardonnèrent pas : les maîtresses officielles de Louis XIV, et celles de Louis XV jusqu'à présent, choisies dans les hautes sphères de l'aristocratie, avaient été d'autant plus tolérées qu'elles n'exerçaient aucune influence sur le gouvernement à l'exception de Madame de Maintenon.
Le fait que le roi se commette avec une roturière provoqua un scandale orchestré par l'aristocratie, qui se sentait humiliée de l'influence grandissante de la bourgeoisie dans la société, et reprise par le peuple qui haïssait le monde de la finance qui l'exploitait... Parurent bientôt des chansons et des pamphlets injurieux appelés Poissonades par allusion aux mazarinades du siècle précédent, le nom de jeune fille de la marquise étant Poisson, qui la brocardaient comme dans l'exemple suivant :
Fille de sangsue et sangsue elle-même
Poisson d'une arrogance extrême
Étale en ce château sans crainte et sans effroi
La substance du peuple et la honte du Roi
Malgré ces critiques, la marquise de Pompadour eut une influence indéniable sur l'épanouissement des Arts durant le règne de Louis XV. Véritable mécène, la Marquise amassa une imposante collection de meubles et d'objets d'art dans ses diverses propriétés. Elle fut responsable du développement de la manufacture de porcelaine de Sèvres, et ses commandes assurèrent leur subsistance à de nombreux artistes et artisans. Elle joua également un rôle important en architecture, étant à l'origine de la construction de la place Louis XV aujourd'hui place de la Concorde, et de l'École militaire de Paris, réalisées par Ange-Jacques Gabriel, un de ses protégés. La Marquise défendit également le projet de l'Encyclopédie contre les attaques de l'Église. À sa manière, elle fut représentative de l'évolution des mentalités lors de ce siècle des Lumières, bien qu'elle ne parvienne pas complètement à convertir le roi à ses vues. L'étalage de tout ce luxe dans ses propriétés lui valut bien des reproches, bien que sa famille, très riche, fournît également une aide financière au gouvernement et sauvât la monarchie de la banqueroute.
La marquise de Pompadour était officiellement logée au troisième niveau du château de Versailles, au-dessus des appartements du roi. Elle y organisait des soupers intimes avec des invités choisis, où le roi oubliait les obligations de la cour qui l'ennuyaient. De santé fragile, et supposée frigide, la marquise devint dès 1750 une simple mais véritable amie et confidente, après avoir été amante, et elle parvint à conserver ses relations privilégiées avec le roi, jusqu'à sa mort, ce qui est exceptionnel dans les annales des maîtresses royales. Ne pouvant satisfaire la sensualité du roi et pour éviter d'être évincée par une rivale potentielle ce qui fut sa hantise jusqu'à la fin de sa vie, elle se chargea de « fournir » discrètement au roi, avec l'accord de leur famille bien rémunérée, des jeunes filles peu farouches, de petite vertu et de peu d'intelligence qui, occupant les sens du roi, n'occupaient en revanche ni son cœur ni son esprit. Ainsi la marquise conservait son influence sur le roi... Les rencontres se faisaient après le passage des jeunes filles dans un lieu dont le nom seul offrait au fantasme et aux ragots : le parc-aux-cerfs.
Après 1750 donc, Louis XV, qui venait d'avoir 40 ans, s'engagea dans une série d'histoires sentimentales et sexuelles de courte durée, la plus connue étant celle avec Marie-Louise O'Murphy. Le pavillon du parc-aux-cerfs servit à abriter ces amours éphémères : les jeunes filles y étaient examinées par un médecin avant d'être menées discrètement dans la chambre du roi. La légende a exagéré les événements qui s'y sont passés, contribuant à assombrir la réputation du souverain. Cette image de roi vieillissant et libidineux accaparé par ses conquêtes féminines ne le quittera plus et entachera sa mémoire, bien qu'il n'ait été guère différent de François Ier ou de Henri IV de ce point de vue.
Impopularité et attentat de Damiens
La popularité du roi pâtit largement des suites de la guerre de Succession d'Autriche. Les Français avaient pardonné à Louis XIV ses impôts, ses maîtresses et ses dépenses fastueuses, celui-ci ayant toujours su donner à ses fins de guerres des allures de victoires. De la même façon, pour Louis XV, les scènes de Metz 1744 comptaient peu aux yeux de la population en regard des victoires de la guerre de succession autrichienne. Mais la nouvelle de l'abandon des Pays-Bas à l'Autriche — en opposition avec les intérêts français tels que les avaient définis Richelieu puis Louis XIV — fut accueillie avec incrédulité et amertume. Les Parisiens utilisèrent l'expression bête comme la paix. On avait "travaillé pour le roi de Prusse". Tant d'efforts et de vies humaines pour donner une couronne — minuscule — à la fille du roi, alors que la couronne impériale était conservée par les Habsbourg puisque l'ex-duc de Lorraine, époux de la reine de Hongrie avait été élu empereur en 1745. La montagne avait accouché d'une souris.
On peut à ce titre considérer que 1748 fut marquée par la première manifestation d'une opinion publique française, portée par un nationalisme émergeant que le monarque n'avait pas compris. La présence aux côtés du roi de la marquise de Pompadour, fortement décriée par l'aristocratie curiale qui n'hésitait pas à faire courir les bruits les plus ignobles qui, sortant du palais, atteignaient le peuple, donnait du roi l'image d'un jouisseur égoïste uniquement préoccupé de ses plaisirs. Le mécontentement s'amplifiait, alimenté par le train de vie de la Cour et ce qui était perçu comme une incompétence du roi à gouverner. En se replaçant dans une perspective historique, il apparaît que Louis XV n'était pas incompétent, bien qu'il manquât certainement de volonté. D'autre part, les dépenses de la cour n'étaient pas spécialement élevées, comparées à celles des précédents monarques français, ou encore d'autres cours européennes, comme celle de Russie qui dépensait des sommes astronomiques pour construire les palais de Saint-Pétersbourg. Pourtant, telle était la perception qu'en avait le peuple de France, également influencé par la campagne violente à l'encontre de la marquise de Pompadour.
Peut-être est-ce ce contexte qui poussa Robert-François Damiens — domestique chez plusieurs conseillers du Parlement — à essayer de tuer le roi. Le 5 janvier 1757, Damiens loua épée et chapeau dans une boutique sur la place d'armes devant le château pour se faire passer pour noble, entra au palais de Versailles, parmi les milliers de personnes qui essayaient d'obtenir des audiences royales. Vers 18 heures, le roi revenait de visiter sa fille qui était souffrante et s'apprêtait à entrer dans son carrosse pour retourner à Trianon, quand Damiens franchit la haie de gardes et le frappa avec une lame de 8,1 cm. Louis XV portait d'épais vêtements d'hiver et la lame ne pénétra que d'un centimètre, entre les 4e et 5e côtes. Cependant, on craignait un éventuel empoisonnement. On tortura à plusieurs reprises Damiens, pour savoir s'il avait des complices, mais il apparaît que cet homme, serviteur de membres du parlement de Paris, était un déséquilibré qui avait surtout entendu beaucoup de discours critiques à l'encontre du roi. Louis XV était plutôt enclin à pardonner, mais il s'agissait de la première tentative de meurtre sur un monarque français depuis l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac en 1610, et il dut accepter un procès pour régicide. Jugé par le parlement de Paris, Damiens fut exécuté le 28 mars 1757 sur la place de Grève, dans des conditions effroyables. La main qui avait tenu le couteau fut brûlée avec du soufre, on lui entailla ensuite les membres et la poitrine avant d'y introduire du plomb fondu, ses quatre membres furent arrachés par des chevaux écartèlement et son tronc finalement jeté aux flammes. Une foule immense assista à ce spectacle, les balcons des maisons de la place de Grève furent loués jusqu'à 100 livres la paye d'un ouvrier pour 10 mois de travail.
Le roi était déjà si impopulaire que l'élan de sympathie provoqué par cette tentative de meurtre disparut rapidement avec l'exécution de Damiens, dont l'inhumanité pourtant laissa le parti philosophique de marbre. Louis XV lui-même n'y était pas pour grand-chose, les détails de cette horrible mise à mort ayant été élaborés par le parlement de Paris, peut-être avec le souci de se réconcilier avec le monarque. Mais plus que tout, le peuple ne pardonnait pas au roi de ne pas s'être séparé de la Pompadour. L'ambassadeur d'Autriche écrivait à Vienne : le mécontentement public est général. Toutes les conversations tournent autour du poison et de la mort. Le long de la galerie des Glaces apparaissent des affiches menaçant la vie du roi. Louis XV, qui avait conservé un calme royal le jour de la tentative d'assassinat, parut profondément affecté et déprimé dans les semaines qui suivirent. Toutes les tentatives de réformes furent abandonnées. Sur la proposition de la marquise de Pompadour, il renvoya deux de ses ministres les plus décriés, le comte d'Argenson secrétaire d'État à la Guerre et Machault d'Arnouville Garde des Sceaux et précédemment contrôleur général des finances, et introduisit Choiseul dans le gouvernement. Du roi Bien-aimé, Louis XV s'affligeait et reconnaissait qu'il était désormais devenu le Bien-haï.
Inauguré en 1763 sur la place Louis XV actuelle place de la Concorde, un monument comportant la statue du roi à cheval fut commandé à Edmé Bouchardon et achevé par Jean-Baptiste Pigalle. Son piédestal était soutenu par les statues des quatre Vertus. Peu de temps après l'inauguration, on trouva sur le piédestal un distique, tracé d'une main inconnue, qui témoigne de l’impopularité du roi : Grotesque monument / Infâme piédestal / Les vertus sont à pied / Le vice est à cheval. Autre version : Ah ! la belle statue, ah ! le beau piédestal, / Les vertus sont à pied et le vice à cheval...
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=8697#forumpost8697
Posté le : 09/05/2015 15:45
|
|
|
|
|
Louis XV (2) |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Résistances intérieures et déboires de la politique extérieure
Affaire du Vingtième
Toutes ces histoires amoureuses n'empêchaient pas Louis XV de travailler, mais il lui manquait l'inépuisable énergie de son arrière-grand-père. Pendant les dix-sept années du gouvernement de Fleury, il avait formé son jugement mais n'avait pu forger sa volonté. Décidé à diriger seul le royaume, il s'évertuait à suivre les instructions de son aïeul : Écoutez, consultez votre Conseil, mais décidez. Cependant, il n'avait pas assez confiance en lui pour appliquer efficacement ce précepte. Sa correspondance politique révèle sa profonde connaissance des affaires publiques et la justesse de son raisonnement. Il éprouvait en revanche des difficultés à décider, et quand il y était obligé, se montrait comme tous les timides, brutal.
Amical et compréhensif avec ses ministres, du moins en apparence, sa disgrâce tombait soudainement, sans prévenir, sur ceux qu'il estimait l'avoir desservi. Sa direction était souple, les ministres ayant une grande indépendance, mais il leur était difficile de savoir si leurs actions convenaient au souverain. La plupart du travail gouvernemental s'effectuait dans des comités auxquels le roi ne participait pas, ce dernier siégeant dans le Conseil d'en haut, créé par Louis XIV, chargé des secrets d'État concernant la religion, la diplomatie et la guerre. Divers partis s'affrontaient, celui des dévots, dirigé par le comte d'Argenson, secrétaire d'État à la Guerre, opposé à celui du parti philosophique emmené par Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville, contrôleur général des finances, et soutenu par la marquise de Pompadour, qui agissait comme un ministre sans portefeuille. Appuyée par de puissants financiers les frères Pâris Duverney et Pâris de Montmartel…, elle obtint du roi la nomination de certains ministres Bernis, secrétaire d'État des Affaires étrangères en 1757 autant que leur révocation Orry, contrôleur général des finances en 1745 malgré ses quinze ans de loyaux services et efficaces ; Maurepas, secrétaire d'État de la Marine en 1749. Sur son conseil, le roi approuva la politique de justice fiscale de Machault d'Arnouville. Afin de combler le déficit du royaume, qui s'élevait à 100 millions de livres en 1745, Machault d'Arnouville créa un impôt prélevant un vingtième des revenus, qui concernait également les privilégiés édit de Marly, 1749. Cette brèche dans le statut privilégié du clergé et de la noblesse, traditionnellement dispensés, les premiers effectuant un don gratuit au trésor et s'occupant des pauvres et de l'enseignement, les seconds payant l'impôt du sang sur les champs de bataille, était une première dans l'histoire de France, bien qu'elle ait été déjà envisagée par des esprits visionnaires comme Vauban au temps de Louis XIV.
Cette nouvelle taxe fut accueillie avec hostilité par les états provinciaux qui avaient encore le pouvoir de décider de leur politique fiscale. Le clergé et le parlement s'opposèrent également violemment au nouvel impôt. Pressé par son entourage et par la cour, Louis XV abandonna la partie et en exempta le clergé en 1751. Finalement, le vingtième finit par se fondre dans une augmentation de la taille, qui ne touchait pas les classes privilégiées. Ce fut la première défaite de la guerre de l'impôt engagée contre les privilégiés.
À la suite de cette tentative de réforme, le parlement de Paris, s'emparant du prétexte de la querelle entre le clergé et les jansénistes, adressa des remontrances au roi avril 1753. Le parlement, constitué d'aristocrates privilégiés et de roturiers anoblis, s'y proclamait le défenseur naturel des lois fondamentales du royaume contre l'arbitraire de la monarchie et présentait le roi comme un tyran.
Bannissement des Jésuites
L'opposition aux Jésuites était menée par une curieuse alliance contre nature des jansénistes avec les gallicans, les philosophes et les encyclopédistes. Après la faillite commerciale de l'établissement dirigé par le père Antoine Lavalette, qui finançait les missions jésuites aux Caraïbes la Martinique, le parlement, saisi par les créanciers, confirma en appel le 8 mai 1761 un jugement ordonnant le paiement de ses dettes par les Jésuites de France, sous peine de saisie de leurs biens.
Il s'ensuivit toute une série d'actions qui allaient aboutir à leur bannissement. Sous la direction de l'abbé de Chauvelin, le 17 avril 1762, le texte des Constitutions de l'Ordre fut épluché par le parlement. On mit en exergue des écrits de théologiens jésuites, afin de les accuser d'enseigner toutes sortes d'erreurs et de considérations immorales. Le 6 août, un arrêt ordonnait la dissolution de l'ordre, mais un délai de huit mois leur fut accordé par Louis XV. Après que le pape eut refusé un compromis permettant de rendre les constitutions de l'ordre compatibles avec les lois du royaume, les parlements votèrent les uns après les autres la suppression de l'ordre dans leur ressort respectif. Seuls les parlements de Besançon et de Douai s'y refusèrent. Les collèges furent fermés d'autorité le 1er avril 1763. À la fin novembre 1764, Louis XV signa un acte de bannissement complet de l'ordre dans tout le royaume afin de protéger les Jésuites en tant qu'individus des poursuites judiciaires que les parlements entendaient entreprendre contre eux. Seuls les prêtres qui acceptaient de se placer sous l'autorité d'un évêque étaient autorisés à rester sur le sol français. La plupart choisirent de partir en exil.
Renversement des alliances
De plus, en 1756, le roi opéra un renversement d'alliance impromptu en rupture avec l'alliance franco-prussienne traditionnelle. Un nouveau conflit européen était en préparation, la paix d'Aix-la-Chapelle ne constituant qu'une sorte de trêve. Les Britanniques et les Français se battaient déjà en Amérique du Nord, sans déclaration de guerre. En 1755, les Britanniques s'emparèrent de 300 navires marchands français violant plusieurs traités internationaux. Quelques mois plus tard, le 16 janvier 1756, le Royaume-Uni et la Prusse signèrent un traité de neutralité. À Paris et Versailles, le parti philosophique et la marquise de Pompadour furent déçus de cette trahison du roi Frédéric II de Prusse, qui était auparavant considéré comme un souverain éclairé, ami des philosophes. Frédéric II avait même accueilli Voltaire à Potsdam quand ce dernier s'était retrouvé en disgrâce à la suite des manœuvres du parti dévot. Mais Frédéric II était surtout animé par des motifs politiques dans le but de consolider la puissance prussienne. Il avait déjà abandonné ses alliés français en signant des traités séparés avec l'Autriche en 1742 et 1745. La marquise de Pompadour n'appréciait pas Frédéric II, snob et misogyne, qui la tenait dans le plus grand mépris, allant jusqu'à appeler un de ses chiens Pompadour. Pendant la même période, les responsables français commencèrent à percevoir le déclin relatif de l'Empire autrichien, qui ne représentait plus le même danger qu'au début de la dynastie Habsbourg, aux XVIe et XVIIe siècles, alors qu'ils contrôlaient l'Espagne et la plus grande partie de l'Europe. La Prusse apparaissait maintenant comme la puissance émergente la plus menaçante. C'est dans ce contexte que la marquise de Pompadour et le parti philosophique convainquirent le roi de l'intérêt de ce retournement d'alliances. Par le traité de Versailles signé le 1er avril 1756, le roi, contre l'avis de ses ministres, s'allia avec l'Autriche en mettant fin à deux siècles de conflit avec les Habsbourg.
À la fin du mois d'août 1756, Frédéric II envahit la Saxe sans déclaration de guerre et vainquit facilement les armées saxonnes et autrichiennes, mal préparées. Le sort réservé à la famille électrice de Saxe fut particulièrement brutal, l'électrice Marie-Josèphe succombant à ces mauvais traitements. Ces exactions choquèrent l'Europe et particulièrement la France. La femme du dauphin, sœur du prince François-Xavier de Saxe, fille de l'électeur et de l'électrice de Saxe, fit une fausse couche en apprenant la nouvelle. Louis XV se trouva contraint d'entrer en guerre. Entre-temps, la Grande-Bretagne avait déjà déclaré la guerre à la France le 18 mai 1756. Ce sera la guerre de Sept Ans 1756-1763, qui aura des conséquences importantes en Grande-Bretagne et en France.
Traité de Paris et la perte de la Nouvelle-France
L'ascension de Choiseul, sous l'influence de la marquise de Pompadour, marque une certaine victoire du parti philosophique. Fait pair de France, le nouvel homme fort du gouvernement autorise la publication de l'Encyclopédie et contribue à la dissolution des Jésuites. Il réforme la structure de la marine et de l'armée et essaye d'étendre les colonies françaises dans les Antilles.
Avec le désastre de Rossbach, les nombreuses défaites dans les colonies et la perte des îles du littoral Belle-Île, etc., Choiseul, successivement à la tête de la diplomatie et du ministère de la Guerre et de la Marine, cherche à arrêter rapidement la guerre. Le traité de Paris 1763 reconnaît une importante défaite française avec la perte de la Nouvelle-France et de l'Inde au profit des Britanniques. Cependant, la France récupère ses comptoirs et les îles des Antilles, indispensables à la vitalité de son commerce.
La marine française pendant la Guerre de Sept Ans.
Expédition de Corse Histoire de la Corse.
Celle-ci est l'aboutissement de quarante années de révolte dans l'île 1729-1769 et de près de trente ans de présence française dans l'île 1738-1768 à des fins de pacification pour la république de Gênes. Avec la convention de Versailles, en 1738, la France obtient le droit d'intervenir en Corse. Avec le traité de Versailles, en 1768, la France a la garantie de conserver l'île si elle parvient à la conquérir. La campagne dure moins d'un an. Les Français tiennent, dans un premier temps, les seuls présides places fortes du littoral et ont pour objectif de défaire et d'anéantir l'État national.
Militairement, la campagne est marquée par deux combats majeurs. Tout d'abord, à la bataille de Borgo, en 1768, Clément Paoli défait les Français, en tue 600 et en capture 600 autres dont le colonel de Ludre, le propre neveu de Choiseul. À la suite de cet échec, un corps expéditionnaire de près de 20 000 hommes débarque à Saint-Florent et est commandé par l'un des plus grands militaires de la monarchie, le comte Noël Jourda de Vaux. Les nationaux sont finalement vaincus à la bataille de Ponte Novu, le 8 mai 1769. Peu après, Pascal Paoli, général en chef de la nation corse, part en exil en Angleterre et la Corse se soumet au roi. Le comte de Vaux obtient le bâton de maréchal.
Deuils et sentiment de culpabilité
Les années 1760 furent marquées par des deuils : en 1752, le roi avait déjà perdu sa fille préférée Henriette. En 1759, mourut son aînée, la duchesse de Parme. En 1761, la mort du duc de Bourgogne, âgé de dix ans, fils aîné du dauphin, enfant précoce et prometteur, fut vivement ressentie. En 1763 mourut à Schönbrunn l'intelligente et romanesque petite-fille du roi, épouse de l'archiduc héritier d'Autriche, Marie-Isabelle de Bourbon-Parme. En avril 1764 mourut sa maîtresse la Marquise de Pompadour. En 1765, le roi perdit successivement son fils, dauphin, dont la vie morale irréprochable l'édifiait et son gendre le duc de Parme. En février 1766, le vieux roi Stanislas mourait presque nonagénaire à Lunéville. L'année suivante, ce fut le tour de la dauphine, veuve inconsolable qui avait contracté la maladie de son mari en le soignant. Enfin, en juin 1768, mourut la reine.
Toujours culpabilisé par sa vie intime, le roi ne vit pas sans tristesse la plus jeune de ses filles entrer en 1770 au Carmel, pensant par là obtenir de Dieu le pardon des fautes de son père. Pour éviter que la sensualité du roi veuf ne le pousse à des excès, le parti dévot soutenu par les filles du roi, et notamment sa fille carmélite, proposa alors de remarier le souverain, à la beauté intacte malgré ses 58 ans, avec l'archiduchesse Marie-Élisabeth d'Autriche, sœur de Marie-Antoinette, mais celle-ci vit sa grande beauté compromise par une attaque de petite vérole et le projet de mariage fit long feu. Entre-temps, le duc de Richelieu, grand seigneur libertin, s'était entremis pour donner à Louis XV une nouvelle maîtresse.
Fin du règne
La fin du règne fut en effet marquée par l'arrivée dans la vie du roi de la superbe comtesse du Barry, officiellement présentée à la cour en 1769. Le ministre Choiseul montra ouvertement son hostilité pour la maîtresse royale et engagea dans son parti la jeune dauphine Marie-Antoinette d'Autriche qui venait d'arriver à la cour. Celle-ci agissait également sous l'influence de ses tantes, les filles du roi. Pour affermir son pouvoir, le ministre souhaitait donner pour maîtresse au roi sa propre sœur la duchesse de Grammont. Exaspéré par ces querelles de cour et convaincu de l'incapacité de Choiseul à faire face à la fronde du Parlement, Louis XV finit par renvoyer son ministre en 1770 peu après le mariage du dauphin qui scellait l'alliance avec l'Autriche.
Désormais le conseil est dominé par René Nicolas de Maupeou, Chancelier de France depuis 1768, par l'abbé Terray et par le duc d'Aiguillon, nommé ministre des Affaires étrangères en juin 1771. Maupeou s'appliqua à restaurer l'autorité royale et à surmonter la fronde des parlements. Les membres du Parlement s'étant mis en grève, Maupeou fit exiler tous ceux qui refusaient de reprendre le service. Leurs charges furent rachetées. Ils furent remplacés par d'autres magistrats. Maupeou entreprit alors une réforme structurelle fondamentale. La justice, jusqu'alors administrée par des magistrats dont la charge était héréditaire, devint une institution publique, gratuite. Tout en restant inamovibles, et donc indépendants, les magistrats étaient payés par l'État. Le droit de remontrances demeure intact. À plusieurs reprises, en 1766, lors de la séance de la Flagellation, en 1770 et en 1771, le roi avait réaffirmé son attachement à ce droit à condition qu'il ne fût pas un instrument de contre-pouvoir mais qu'il demeurât un devoir de conseil.
Les magistrats du Parlement Maupeou se servirent à plusieurs reprises de ce droit de remontrances, dans un esprit de conseil. L'harmonie institutionnelle était restaurée. Ayant surmonté l'opposition des parlements, Louis XV et l'abbé Terray purent alors apporter des réformes à la fiscalité du royaume, améliorant le rendement du vingtième, et rétablissant ainsi, dès 1772, l'équilibre des recettes et des dépenses.
Mort
Le 26 avril 1774, se déclarèrent les symptômes de la petite vérole, alors que Louis XV était au Petit Trianon.
Le parlement de Paris envoya, le dimanche 1er mai 1774, Nicolas Félix Van Dievoet dit Vandive, conseiller notaire secrétaire Maison et Couronne de France, greffier au Grand Conseil, pour s'enquérir de la santé du roi, comme nous l'apprend en son journal le libraire parisien Siméon-Prosper Hardy :
La nouvelle cour du Parlement n'avait pas manqué, suivant l'usage ordinaire, de députer le nommé Vandive, l'un des premiers principaux commis au greffe de la Grand Chambre et de ses notaires secrétaires, pour aller à Versailles savoir des nouvelles de la santé du Roi. Mais ce secrétaire ne pouvoit rendre compte de sa mission à l'inamovible compagnie que le mardi suivant, attendue la vacance accoutumée du lundi 2 mai.
Les filles survivantes du roi, le comte de Lusace, oncle maternel du dauphin, furent aussi présents lors de l'agonie du roi. Durant la nuit, une bougie fut allumée au balcon de la chambre, puis fut éteinte à la mort du souverain, qui survint le 10 mai 1774, à 15 heures 30, au château de Versailles, des suites de la maladie septicémie aggravée de complications pulmonaires, ceci dans l'indifférence du peuple et la réjouissance d'une partie de la cour. Variolique, il ne fut pas embaumé : il est le seul roi de France à ne pas avoir reçu cet hommage post-mortem. Il laissa le trône à son petit-fils, le futur Louis XVI.
L'effondrement de la popularité de Louis XV dit pourtant le Bien-Aimé était telle que sa mort fut accueillie dans les rues de Paris par des festivités joyeuses, comme l'avait été celle de Louis XIV. Pour éviter les insultes du peuple sur son passage, le cortège funèbre réduit contourna Paris de nuit, par l'ouest, avant d'arriver à la basilique Saint-Denis. Les obsèques eurent lieu le 12 mai dans cette basilique. La décomposition du corps fut si rapide que la partition du corps dilaceratio corporis, division du corps en cœur, entrailles et ossements avec des sépultures multiples ne put être réalisée. Si les Parisiens manifestèrent leur indifférence ou leur hostilité, de nombreux témoignages attestent la profonde tristesse des Français de province, qui suivirent en grand nombre au cours de la fin du printemps 1774 les offices organisés dans toutes les villes et gros bourgs de France et de Navarre pour le repos de l'âme du Roi.
Dix-neuf ans plus tard, le 16 octobre 1793, durant la profanation des tombes de la basilique Saint-Denis, après avoir ouvert les cercueils de Louis XIII et de Louis XIV relativement bien conservés les révolutionnaires ouvrirent celui de Louis XV et découvrirent le cadavre nageant dans une eau abondante perte d'eau du corps qui avait été en fait enduit de sel marin, le roi dévoré par la petite vérole pendant presque 20 années n'ayant pas été embaumé comme ses prédécesseurs. Le corps tombant rapidement en putréfaction car désormais à l'air libre, les révolutionnaires brûlèrent de la poudre pour purifier l'air qui dégageait une odeur infecte puis jetèrent le corps du Roi, à l'instar des autres, dans une fosse commune sur de la chaux vive.
Le 21 janvier 1817, Louis XVIII fit rechercher les restes de ses ancêtres dans les fosses communes dont Louis XV pour remettre leurs ossements dans la nécropole des Rois (aucun corps n'a cependant pu être identifié.
Une légende populaire veut que Louis XV se soit exprimé au sujet de sa mort Après moi le déluge, cette expression prophétique son successeur Louis XVI étant guillotiné lors de la Révolution française qui n'apparaît qu'en 1789 est apocryphe et a été également attribuée à Madame de Pompadour en 1757, alors que la favorite cherchait à consoler le roi très affecté par la déroute de Rossbach avec ces mots Il ne faut point s'affliger : vous tomberiez malade. Après nous le déluge !.
Ascendance
Ascendance de Louis XV de France
Postérité Enfants légitimes
La reine Marie et le dauphin Louis, par Alexis Simon Belle.
Marie Leszczyńska donna à Louis XV dix enfants, dont trois moururent en bas-âge :
Louise-Élisabeth 14 août 1727-1759 dite Madame en tant que fille aînée du roi ou Madame Première puis, après son mariage, Madame Infante ;
Anne-Henriette 14 août 1727-1752, sœur jumelle de la précédente, dite Madame Seconde puis Madame Henriette ;
Marie-Louise 28 juillet 1728-19 février 1733 dite Madame Troisième puis Madame Louise;
Louis-Ferdinand 4 septembre 1729-20 décembre 1765, dauphin. Père de Louis XVI, Louis XVIII, et Charles X ;
Philippe-Louis 30 août 1730-7 avril 1733, duc d'Anjou ;
Marie-Adélaïde 23 mars 1732-27 février 1800 dite Madame Quatrième, puis Madame Troisième, Madame Adélaïde et enfin Madame;
Victoire-Louise-Marie-Thérèse 11 mai 1733-7 juin 1799, dite Madame Quatrième puis Madame Victoire;
Sophie-Philippe-Élisabeth-Justine 27 juillet 1734-3 mars 1782, dite Madame Cinquième puis Madame Sophie ;
fausse couche, garcon 1735
Thérèse-Félicité 16 mai 1736-28 septembre 1744, dite Madame Sixième puis Madame Thérèse » ;
Louise-Marie 15 juillet 1737-23 décembre 1787, dite Madame Septième puis Madame Louise en religion sœur Marie-Thérèse de Saint-Augustin.
fausse couche, 1738, garcon
Favorites, maîtresses et enfants adultérins
Liste des maîtresses des rois de France.
Louis XV, comme Louis XIV, eut également un certain nombre d'enfants adultérins de nombreuses maîtresses à partir de 1733. Suite à une nouvelle fausse couche de la reine en 1738, cette dernière, lassée par les maternités répétitives, lui ferma la porte de sa chambre, ce qui facilita l'officialisation de la première favorite royale, la comtesse de Mailly. Ses quatre premières maîtresses furent les quatre sœurs de Nesle, quatre des cinq filles de Louis III de Mailly, marquis de Nesle et de Mailly, prince d'Orange. Tous ses enfants adultérins, autres que Charles de Vintimille, naquirent de jeunes filles non mariées, appelées les petites maîtresses. Hanté par les mauvais souvenirs liés aux bâtards de son arrière-grand-père, Louis XV se refusa toujours à les légitimer. Il subvint à leur éducation et s'arrangea pour leur donner une place honorable dans la société, mais ne les rencontra jamais à la cour. Seuls furent légitimés Charles de Vintimille et l'abbé de Bourbon.
Ses maîtresses et favorites furent :
Louise Julie de Mailly-Nesle, comtesse de Mailly 1710-1751, épouse en 1726 son cousin Louis-Alexandre, comte de Mailly. Elle devient maîtresse en 1733, favorite en 1738, et est supplantée en 1739 par sa sœur Pauline. Elle rentre en grâce en 1741, mais est renvoyée de la cour en 1742 à la demande de sa sœur Marie-Anne ;
Pauline Félicité de Mailly-Nesle, comtesse de Vintimille 1712-1741, maîtresse de Louis XV elle épouse en 1739 Jean-Baptiste, comte de Vintimille 1720-1777. Elle est mère de :
Charles de Vintimille (1741-1814) dit le Demi-Louis car il ressemblait beaucoup à Louis XV. Marquis du Luc, Madame de Pompadour tenait tellement pour assuré qu'il était de naissance royale que, souffrant de n'avoir pas d'enfants avec le roi et désireuse de porter des petits-enfants en commun, elle nourrit en 1751 de le marier à sa fille Alexandrine; il épousera (1764) Adélaïde de Castellane 1747-1770, dont postérité ;
Diane Adélaïde de Mailly-Nesle, duchesse de Lauraguais 1713-1760 ;
Marie-Anne de Mailly-Nesle, marquise de La Tournelle, duchesse de Châteauroux 1717-1744.
Hortense de Mailly-Nesle, marquise de Flavacourt, fut aussi pendant un temps soupçonnée de liaison intime avec le roi, mais cette hypothèse fut rapidement écartée au profit de ses quatre sœurs.
La marquise de Pompadour de son vrai nom Jeanne Antoinette Poisson, 1721-1764, fille d'un financier véreux exilé en 1725. Elle épouse en 1741 Charles-Guillaume Le Normant d'Étiolles et a deux enfants dont Alexandrine Le Normant d'Étiolles 1744-1754 qui est élevée en princesse et anoblie Mlle de Crécy. Elle devient de 1745 à 1751 la maîtresse du roi, et est honorée en 1752 du tabouret et des prérogatives de duchesse. Elle est dame du palais de la reine en 1756, mais doit quitter Versailles quelque temps en 1757 à la suite d'une cabale ;
La comtesse du Barry Jeanne Bécu, 1743 - guillotinée en 1793 : fille naturelle d'Anne Bécu, couturière, et de Jean-Baptiste Gomard de Vaubernier. Après avoir reçu une bonne éducation, elle travaille comme modiste à Paris. Elle devient en 1768 la maîtresse du roi auquel Jean, comte Dubarry dont elle a été la maîtresse l'a présentée. Louis XV lui fait épouser la même année Guillaume Dubarry frère de Jean, puis la présente à la cour en 1769. Elle avait dit un jour devant Louis XV : La France, ton café fout le camp ! - car tel était le surnom qu'elle donnait à son valet. Elle se retire de la cour à la mort du roi, puis émigre en Grande-Bretagne en 1792 pour y cacher ses diamants : elle est arrêtée au retour et condamnée à mort pour avoir dissipé les trésors de l'État, conspiré contre la République et porté le deuil de Louis XVI. Avant d'être guillotinée à Paris, elle supplia : Encore un moment, messieurs les bourreaux ;
Marie-Louise O'Murphy 1737-1814 dite Mlle de Morphise, fille de Daniel O'Murphy, d'origine irlandaise. Elle épouse : 1° Jacques Pelet de Beaufranchet en 1755, 2° François Nicolas Le Normant de Flaghac en 1759, et 3° Louis-Philippe Dumont en 1798, député du Calvados à la Convention, dont elle divorcera la même année. Elle est la mère de :
Agathe Louise de Saint-Antoine de Saint-André Paris, 20 juin 1754-1774 qui épousera en 1773 René-Jean-Mans de La Tour du Pin, marquis de la Charce 1750-1781.
Marguerite Victoire Le Normant de Flaghac36 Riom, 5 janvier 1768 qui épousera en 1786 Jean-Didier Mesnard, comte de Chousy 1758-1794, dont postérité, puis en 1794 Constant Le Normant de Tournehem 1767-1814.
Françoise de Chalus, duchesse de Narbonne-Lara 1734-1821, duchesse de Narbonne-Lara, fille de Gabriel de Chalus, seigneur de Sansac, elle épousera en 1749 Jean-François, duc de Narbonne-Lara. Elle est la mère de :
Philippe, duc de Narbonne-Lara 1750-1834 qui épouse en 1771 Antoinette Françoise Claudine de La Roche-Aymon, et de
Louis-Marie, comte de Narbonne-Lara 1755-1813 qui épousera en 1782 Marie Adélaïde de Montholon, dont postérité.
Marguerite-Catherine Haynault 1736-1823, fille de Jean-Baptiste Haynault, entrepreneur de tabac. Elle épouse en 1766 Blaise d'Arod, marquis de Montmelas. Elle est la mère de :
Agnès-Louise de Montreuil 1760-1837, qui épousera en 1788 Gaspar d'Arod 1747-1815, comte de Montmelas, dont postérité, et de
Anne-Louise de La Réale 1763-1831 qui épousera en 1780 le comte de Geslin 1753-1796.
Lucie Madeleine d'Estaing 1743-1826, sœur naturelle de l'amiral d'Estaing, elle épousera en 1768 François, comte de Boysseulh. Elle est la mère de :
Agnès-Lucie-Auguste 1761-1822 qui épousera en 1777 Charles, vicomte de Boysseulh 1753-1808, et de
Aphrodite-Lucie-Auguste 1763-1819 qui épousera en 1784 Louis-Jules, comte de Boysseulh 1758-1792.
Anne Couppier de Romans, baronne de Meilly-Coulonge 1737-1808, baronne de Meilly-Coulonge, elle est la fille d'un bourgeois, Jean-Joseph Roman Coppier. Elle entretient une liaison avec le roi de 1760 à 1765, et épousera en 1772 Gabriel Guillaume de Siran, marquis de Cavanac. Elle est la mère de :
Louis-Aimé de Bourbon 1762-1787, dit l'abbé de Bourbon le seul enfant bâtard que Louis XV reconnaîtra en 1762.
Louise-Jeanne Tiercelin de La Colleterie 1746-1779 dite Mme de Bonneval. Elle est la mère de :
Benoît-Louis Le Duc 1764-1837, abbé.
Irène du Buisson de Longpré38 décédée en 1767, fille de Jacques du Buisson, seigneur de Longpré, elle épousera en 1747 CharlesFrançois Filleul, conseiller du roi. Elle est la mère de :
Julie Filleul 1751-1822, qui épousera 1° Abel François Poisson en 1767, marquis de Vandières, de Marigny, de Menars, etc., frère de Madame de Pompadour ; 2° François de La Cropte, marquis de Bourzac en 1783 dont elle divorcera en 1793.
Catherine Éléonore Bénard 1740-1769, fille de Pierre Bénard, écuyer de la bouche du roi. Elle épouse en 1768 Joseph Starot de Saint-Germain, fermier général qui sera guillotiné en 1794. Elle est la mère de :
Adélaïde de Saint-Germain, comtesse de Montalivet 1769-1850 qui épousera en 1797 Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet 1766-1823, dont postérité.
Marie Thérèse Françoise Boisselet 1731-1800, qui épouse en 1771 Louis-Claude Cadet de Gassicourt. Elle est la mère de :
Charles Louis Cadet de Gassicourt 1769-1821, qui épouse en 1789 Madeleine-Félicité Baudet 1775-1830, dont postérité.
Louis XV fut donc le père de quatorze enfants adultérins. La naissance royale n'est certaine que pour 8 enfants 3 garçons et 5 filles. Madame de Pompadour fit toujours des fausses couches, et la seule naissance d'un enfant naturel avérée après la mort de celle-ci, est celle de Marie Victoire Le Normand de Flaghac en 1768. Ajoutons une possible relation avec Françoise de Chalus, dame d'honneur de sa fille, Marie-Adelaïde. De cette union serait né en 1755 le comte Louis-Marie de Narbonne-Lara.
Guerres
Trois grandes guerres vont se succéder et ternir l'image du roi et de son règne : la Guerre de Succession de Pologne (1733-1738), la guerre de Succession d'Autriche 1744–1748 et la Guerre de Sept Ans 1756-1763.
Guerre de Succession de Pologne
Article détaillé : Guerre de Succession de Pologne.
À la mort d’Auguste II en 1733, son fils, Auguste III, et Stanislas Ier, ancien roi de Pologne déchu en 1709, beau-père de Louis XV, se disputent le trône. Alors que les querelles des partisans d'Auguste II et ceux de Stanislas divisent le pays, la mort d’Auguste II en 1733, vient déchaîner les passions. Son fils, Auguste III, et Stanislas Ier se disputent le trône. La crise se transforme en guerre de succession.
Guerre de Succession d'Autriche
La guerre de Succession d'Autriche 1744–1748, traité d'Aix-la-Chapelle est un conflit européen né de la Pragmatique Sanction, par laquelle l'empereur Charles VI du Saint-Empire lègue à sa fille Marie-Thérèse d'Autriche les États héréditaires de la Maison des Habsbourg.
Guerre de Sept Ans
La Guerre de Sept Ans opposa principalement la France à la Grande-Bretagne d'une part, l'Autriche à la Prusse d'autre part. Cependant, par le jeu des alliances et des opportunismes, la plupart des pays européens et leurs colonies se sont retrouvés en guerre. Le début de la guerre est généralement daté au 29 août 1756 attaque de la Saxe par Frédéric II bien que l'affrontement ait débuté plus tôt dans les colonies d'Amérique du Nord avant de dégénérer en guerre ouverte en Europe. La France en ressort meurtri avec la perte de la quasi-totalité de ses colonies en Amérique.
Posté le : 09/05/2015 15:41
|
|
|
|
|
Autodafé d'Hitler le 10 Mai 1933 (1) |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 10 mai 1933, Adolf Hitler lance un grand autodafé.
Peu de temps après l'arrivée au pouvoir du NSDAP, en 1933, le chancelier Adolf Hitler lance une action contre l'esprit non allemand dans le cadre de laquelle se développent des persécutions organisées et systématiques visant les écrivains juifs, marxistes ou pacifistes. Il s'agit en fait d'une initiative organisée et mise en œuvre par des étudiants allemands sous la direction de la NSDStB, association allemande des étudiants nationaux socialistes.
Le mouvement atteint son point culminant, au cours d'une cérémonie savamment mise en scène devant l'opéra de Berlin et dans 21 autres villes allemandes : des dizaines de milliers de livres sont publiquement jetés au bûcher par des étudiants, des enseignants et des membres des instances du parti nazi. Ils constituent les autodafés allemands de 1933.
La campagne contre l'esprit non allemand
Sous la République de Weimar, les universités allemandes témoignaient déjà clairement d'un esprit réactionnaire, chauviniste et nationaliste1. La corporation des étudiants Allemands DSt était passée dès l'été 1931 sous la direction d'un représentant de l'association des étudiants allemands nationaux-socialistes NSDStB qui avait été élu avec 44,4 % des voix. Après l'accession des nazis au pouvoir, la corporation des étudiants allemands se retrouva en concurrence avec celle des étudiants nationaux-socialistes. Afin de renforcer la corporation des étudiants allemands, trois mois après l'accession d'Hitler et dans la foulée de la création du ministère du Reich à l'Éducation du peuple et à la Propagande, le pouvoir dota ses instances dirigeantes de leurs propres organes de presse et de propagande.
Au début du mois d'avril 1933, la fédération étudiante d'Allemagne demanda à ses membres de participer, sous la houlette de Hans Karl Leistritz, à une action qui devait se dérouler sur quatre semaines, entre le 12 avril et le 10 mai, avec pour thème la lutte contre l'esprit non allemand. L'action faisait référence à un autodafé de livres qui s'était déroulé au cours de la première fête de la Wartbourg en 1811, et se présentait comme une « action commune menée contre le négativisme juif. L'esprit juif, tel qu'il se manifeste dans toute son absence de retenue dans l'agitation de la scène internationale, et tel qu'il a déjà laissé ses marques dans la littérature allemande, doit en être extirpé. Dans le domaine de la politique académique, l'action contre l'esprit non allemand constituait le départ d'une conquête des universités par les corporations étudiantes qui se présentaient comme des « sections d'assaut intellectuelles.
Les préparatifs
Dans un premier temps, ordre est donné de former dans les facultés des comités contre l'esprit non allemand formés de deux étudiants, un professeur, un représentant de la ligue contre l'esprit non allemand d'Alfred Rosenberg et un écrivain. La direction revient à un dirigeant de la corporation étudiante en exercice.
Le travail de propagande est l'élément fondamental du combat politique mené par les étudiants. Le 2 avril 1933, au lendemain du boycott des magasins juifs, une feuille de route est élaborée; le 6 avril, les différentes organisations étudiantes reçoivent une circulaire qui les avertit de l'action à venir.
En réaction aux menées honteuses de la communauté juive à l'étranger, la corporation des étudiants allemands a prévu des actions coordonnées sur quatre semaines pour lutter contre le nihilisme juif et défendre la pensée et le sentiment national dans la littérature allemande. Cette campagne commencera le 12 avril par l'affichage de 14 thèses, Contre l'esprit non allemand, et se terminera le 10 mai par une conférence publique dans toutes les facultés allemandes. La campagne, qui connaîtra une intensité croissante jusqu'au 10 mai, fera appel à tous les moyens de propagande, tels que la radio, les journaux, les panneaux d'affichage, les tracts et des articles spéciaux publiés dans la correspondance académique de la DSt.
— Actes de la corporation des étudiants allemands, in Archive de la direction des étudiants du IIIe Reich, conservée à la bibliothèque universitaire de l'université de Würzburg.
La direction de la Dst misait beaucoup sur cette initiative, qui devait démontrer son zèle et sa capacité à mobiliser les étudiants dans le combat national-socialiste ; en effet, sa rivale la NSDStB Association national-socialiste des étudiants allemands avait, après les législatives de mars 1933, revendiqué un monopole sur l'éducation politique des étudiants. Les préparatifs voient se développer une rivalité croissante entre les deux organisations et leurs leaders respectifs, Gerard Krüger DSt et Oskar Stäbel NSDStB. La veille même du début de la campagne, Stäbel donne l'ordre de ne pas soutenir l'action de la Dst, mais d'en prendre les commandes.
12 propositions contre l'esprit non allemand
Les 12 propositions contre l'esprit non allemand, synthèse des positions et des objectifs de la campagne, constituent le préambule de la campagne contre les idées du judaïsme, de la social-démocratie, du libéralisme et contre leurs représentants. Imprimées en lettres gothiques rouges, elles sont affichées dans les universités allemandes et publiées dans de nombreux journaux.
La langue et la littérature tirent leurs racines du peuple. Le peuple allemand a le devoir de s'assurer que la langue allemande et la littérature soient l'expression non corrompue de son identité nationale.
Un fossé s'est actuellement ouvert entre la littérature et l'identité allemande. Ce fossé est intolérable.
Pureté de la langue et de la littérature dépendent de toi ! C'est à toi que le peuple a confié la tâche de préserver fidèlement sa langue.
Notre ennemi principal est le juif et celui qui l'écoute.
Le juif ne peut penser que comme juif. S'il écrit en allemand, il ment. L'Allemand qui écrit en allemand mais qui publie des idées contraires à l'esprit allemand est un traître. L'étudiant qui produit des pensées et des écrits contraires à l'esprit allemand fait preuve de légèreté et trahit son devoir.
Nous voulons éradiquer le mensonge, nous voulons marquer la trahison au fer rouge, Nous voulons que les étudiants se trouvent non pas dans un état d'ignorance, mais de culture et de conscience politique.
Nous voulons considérer le juif comme un étranger et prendre au sérieux l'identité nationale. Nous demandons donc à la censure que les écrits juifs soient publiés en hébreu. S'ils sont publiés en allemand, il doit être clairement indiqué qu'il s'agit de traductions. La censure doit intervenir contre l'emploi abusif de la langue écrite. L'allemand écrit ne doit servir qu'aux allemands. Ce qui est contraire à l'esprit allemand sera extirpé de la littérature.
Nous exigeons que les étudiants allemands fassent preuve de la volonté et de la capacité à apprendre et à faire des choix de façon autonome.
Nous exigeons que les étudiants allemands fassent preuve de la volonté et de la capacité à maintenir la pureté de la langue allemande.
Nous exigeons que les étudiants allemands fassent preuve de la volonté et de la capacité à triompher de l'intellectualisme juif et de ses chimères libérales sur la scène intellectuelle allemande.
Nous exigeons que les étudiants et les professeurs soient sélectionnés en fonction des garanties qu'ils présentent de ne pas mettre en danger l'esprit allemand.
Nous exigeons que les facultés soient le sanctuaire de l'identité allemande et le lieu d'où partira l'offensive de l'esprit allemand dans toute sa puissance.
À la tête des comités de combat contre l'esprit non allemand actifs dans l'ensemble du Reich, on trouve Paul Karl Schmidt. Les comités locaux doivent servir de fer de lance de la communauté étudiante contre l'intellectualisme juif. Schmidt est responsable de l'affichage des 12 propositions. Son rôle au sein des comités le prépare à celui qu'il jouera plus tard dans la propagande de guerre anti-juive en tant que responsable de presse au ministère des affaires étrangères et plus tard encore après 1945 en tant que journaliste.
Service de presse
Parallèlement à la campagne d'affichage, les responsables organisent un prétendu « service de presse » qui doit en fait diffuser des déclarations de soutien de la part de responsables de la culture et d'écrivains engagés dans le courant nationaliste ; l'objectif est de sensibiliser l'opinion publique à la campagne. 66 écrivains, qui se sont illustrés par leur engagement pour la littérature allemande, se voient priés de soumettre un article ; parmi ces écrivains figurent Werner Bergengruen, Richard Billinger, Paul Ernst, Max Halbe, Karl Jaspers, et Julius Streicher. Le succès de l'initiative est très mitigé. La majorité des personnalités sollicitées ne donne pas suite, même Alfred Rosenberg qui avait reçu un courrier personnel lui demandant d'écrire un texte introductif pour la campagne. Certains allèguent un délai trop court et proposent des textes déjà publiés, comme Erwin Guido Kolbenheyer, de Munich5. En fin de compte le service de presse ne diffusera que quatre contributions, signées notamment Herbert Böhme, Will Vesper, Alfred Bäumler et Kurt Herwarth Ball cf. Zeitungsberichte.
Boycott des enseignants
Le 19 avril voit la direction de la DSt lancer un appel à continuer la lutte en s'engageant « contre les professeurs indignes de nos facultés allemandes. La conclusion du manifeste affirme : L'État a été conquis, mais pas l'université ! Les troupes d'assaut intellectuelles entrent en action, levez vos étendards ! Les étudiants sont encouragés à dénoncer les professeurs qui, après la promulgation de la Loi allemande sur la restauration de la fonction publique du 7 avril 1933 avaient été contraints à la démission ; les étudiants doivent faire des déclarations sous serment ou fournir des preuves incriminantes telles que des citations de cours ou des extraits de publications. La campagne vise non seulement les juifs et les membres du parti communiste ou de la Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bannière impériale Noire-Rouge-Or, mais, selon les explications de la direction du syndicat, les personnes qui ont vilipendé les leaders nationaux, le mouvement de redressement national ou les soldats du front anciens combattants de 1914-18 ; les responsables du syndicat étudiant visent également les professeurs dont les méthodes scientifiques trahissent leurs positions libérales voire pacifistes.
Même les professeurs dont le comportement politique est irréprochable doivent être signalés à la direction du syndicat dans la mesure où ils témoignent de « capacités au-dessus de la moyenne. Presque toutes les universités participent à la campagne, avec le soutien du corps enseignant, des doyens et des recteurs. Des maîtres de conférence juifs, des membres de l'administration et des étudiants sont victimes de violences organisées, des cours sont chahutés ou boycottés, des professeurs juifs se voient empêcher l'accès à leur lieu de travail.
La chasse aux sorcières va encore plus loin dans certaines universités, notamment à Rostock, Königsberg, Erlangen, Münster et Dresde, où se dressent des poteaux de deux mètres affichant la liste des professeurs incriminés, et où des œuvres littéraires sont mises au pilori :
Dans toutes les facultés se dressera un poteau. Un tronc d'arbre noueux de la taille d'un homme environ, dans l'enceinte de l'université. Sur ce poteau seront mis au pilori les œuvres de ceux qui ne partageront pas nos opinions. Et ces poteaux resteront tout le temps qu'il faudra, tant que leur présence sera nécessaire. Aujourd'hui pour les écrivains, demain pour les professeurs. Ils serviront indifféremment pour ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne veulent pas comprendre. Ces poteaux devront être mis en place dans les universités à partir du 3 mai.
Les étudiants de Rostock rapportent que le jour du 5 mai a lieu une grande fête avec l'érection d'un poteau sur lequel sont mises au pilori huit des œuvres littéraires désignées comme les pires, celles de Magnus Hirschfeld, Tucholsky, Stephan Zweig, Lion Feuchtwanger, Baum, Remarque, Emil Ludwig ainsi que l'hebdomadaire die Weltbühne.
Collecte de livres
Le seconde phase de la campagne de propagande débute le 26 avril 1933 par la collecte des écrits à détruire. Les étudiants doivent commencer par nettoyer leur bibliothèque et celles de leurs proches en éliminant les ouvrages nuisibles, puis passer au crible les bibliothèques universitaires et celles des instituts. Les bibliothèques publiques et les librairies doivent également se soumettre à des perquisitions permettant d'isoler les ouvrages méritant d'être brûlés.
Les bibliothèques municipales et publiques sont sommées de faire elles-mêmes le tri et de se dessaisir spontanément des ouvrages incriminés. Les étudiants reçoivent le soutien de leurs professeurs et des recteurs qui ne se contentent pas d'attendre de venir assister aux auto-da-fé mais collaborent activement au sein des commissions à dresser la liste des ouvrages destinés au bûcher. Les critères de sélection vont permettre de constituer la liste noire du bibliothécaire Wolfgang Herrmann, âgé alors de 29 ans.
L'action des étudiants reçoit un soutien sans réserves de la part des librairies et des bibliothèques. La revue spécialisée de l'union des bibliothécaires allemands et une gazette des professionnels du livre allemand, la Börsenblatt des deutschen Buchhandels, diffusent la liste des ouvrages mis à l'index en la commentant ; la revue des bibliothécaires insiste sur le fait que le corpus à détruire comporte en majorité des ouvrages juifs. Les professionnels lésés par les mesures de saisie ne protestent pas, les responsables des bibliothèques de prêts étant même priés de signer cette déclaration :
Je m'engage par la présente à retirer de ma bibliothèque tous les ouvrages inscrits sur la liste noire et à ne plus les prêter. J'ai été averti que le prêt de ces ouvrages est désormais punissable par la loi.
Le 6 mai, le pays est le théâtre d'un pillage général des bibliothèques de prêt et des librairies, avant-dernier acte de la campagne contre l'esprit non allemand. Les troupes d'assaut estudiantines se chargent de la collecte et du transport des ouvrages incriminés. À Berlin, les étudiants de la faculté des sports et de l'école vétérinaire prennent d'assaut l'institut de sexologie de Magnus Hirschfeld, situé dans le quartier du jardin zoologique, et pillent une bibliothèque riche de plus de dix mille ouvrages. Hirschfeld, quant à lui, assistera à la destruction de l'œuvre de sa vie en regardant les actualités de la semaine dans un cinéma parisien.
Déclarations devant le bûcher
Après les actions de propagande et la chasse aux ouvrages interdits, la troisième phase sera la mise à mort proprement dite de l'esprit non allemand ainsi que l'agence centrale de propagande des étudiants allemands l'a prévu : Le 10 mai 1933, dans toutes les universités, la littérature à détruire sera confiée aux flammes. L'auto-da-fé est pour les étudiant un geste symbolique : dans le passé on attribuait au feu un pouvoir purificateur et thérapeutique, de même le recours au bûcher exprimera l'idée qu'« en Allemagne la nation s'est purifiée intérieurement et extérieurement. Joseph Goebbels dans son discours de la place de l'opéra de Berlin, le 10 mai 1933.
À cette fin, chaque université reçoit une circulaire destinée au corps étudiant, contenant une série de déclarations du bûcher » qui permettront d'uniformiser le déroulement symbolique des auto-da-fé du lendemain. Les mêmes phrases seront prononcées dans tout le pays au moment où les représentants des étudiants jetteront dans le brasier les ouvrages qui représentent la littérature « honteuse et ordurière. Le procédé permet d'insister sur la nature symbolique de l'auto-da-fé en lui conférant le caractère d'un rituel. Les signataires de la circulaire sont Gerhard Krüger permanent du parti National-socialiste, la DSt, et Hans-Karl Leitstritz, chef de l'administration :
Comme base du déroulement symbolique de la mise au bûcher on utilisera la sélection fournie ci-dessous et le représentant des étudiants restera aussi proche que possible de sa formulation en composant son allocution. Étant donné que pour des raisons pratiques il ne sera pas toujours possible de brûler tous les livres, il conviendra de se limiter aux ouvrages donnés dans la sélection pour choisir ceux qui seront nommément jetés dans les flammes. Cela n'empêchera pas qu'un grand nombre d'ouvrages finisse sur le bûcher. Chaque organisateur a toute liberté de faire là-dessus comme bon lui semble.
1er récitant : Contre la guerre des classes et le matérialisme, pour la communauté nationale et un idéal de vie !
Je jette dans les flammes les écrits de Marx et de Kautsky.
2e récitant : Contre la décadence et la corruption morale, pour l'éducation et la tradition au sein de la famille et de l'État !
Je jette aux flammes les écrits de Heinrich Mann, Ernst Glaeser et Erich Kästner.
3e récitant : Contre les coups bas idéologiques et la trahison politique, pour le don de soi au peuple et à l'État !
je donne aux flammes les écrits de Friedrich Wilhelm Foerster.
4e récitant : Contre la valorisation excessive de la vie pulsionnelle qui dégrade l'âme, pour la noblesse de l'âme humaine !
«Je jette aux flammes les écrits de Sigmund Freud.
5e récitant : Contre la falsification de notre histoire et la dévalorisation de ses grandes figures, pour le respect de notre passé,
je jette aux flammes les écrits d'Emil Ludwig et de Werner Hegemann
«6e récitant : Contre le journalisme étranger au peuple et marqué par la judéo-démocratie, pour une participation consciente et responsables à l'œuvre de construction nationale !
«je jette aux flammes les écrits de Theodor Wolff et Georg Bernhard.
7e récitant : Contre la trahison littéraire visant les combattants de la première guerre mondiale, pour l'éducation du peuple dans un esprit qui lui permette de prendre les armes pour sa défense
Je jette aux flammes les écrits d'Erich Maria Remarque.
8e récitant : Contre la dénaturation barbare de la langue allemande, pour la protection du bien le plus précieux de notre peuple !
Je jette aux flammes les écrits d'Alfred Kerr.
9e récitant : Contre l'impudence et l'affectation, pour le respect et la vénération de l'immortel esprit du peuple allemand !
Dévorez aussi, Ô flammes, les écrits de Tucholsky et de Ossietzky !
Dans le reportage radiophonique enregistré sur la place de l'opéra de Berlin, on note de légères variantes par rapport à la circulaire. On entend par exemple le mot feu au lieu de flamme dans la dernière invocation, l'utilisation du prénom de Karl Marx ou les mots l'école de Sigmund Freud au lieu de Sigmund Freud ; Emil Ludwig, pour la plus grande joie des spectateurs, est appelé Emile Ludwig Cohen.
Les autodafés
Le 10 mai 1933 doit être le point culminant de la campagne contre l'esprit non allemand. L'action devant se dérouler avec une précision toute militaire, une feuille de route détaillée est distribuée aux divers responsables locaux. Entre 20h30 et 22h, la cérémonie doit s'ouvrir sur une communication du syndicat étudiant qui aura lieu dans le grand amphithéâtre de l'université concernée. À la tombée de la nuit, une marche aux flambeaux transportera les ouvrages vers le bûcher et les festivités se termineront sur un feu de joie. Les comités étudiants sont sommés de respecter au plus près ces instructions et de les exécuter de façon aussi élaborée que possible, car entre 23h et minuit l'événement fera l'objet d'un reportage sur les ondes de la radio nationale.
La récitation scrupuleuse des textes de la circulaire est également obligatoire. Dans toutes les villes, les volontaires se mettent au travail dès le matin pour construire les bûchers devant lesquels les spectateurs attendent une conférence publique, dont se chargeront dans la plupart des cas les professeurs de l'université. À Berlin, Joseph Goebbels prend également la parole, ce qui donne à l'événement un caractère officiel.
Le 10 mai 1933 à Berlin
La marche aux flambeaux berlinoise se forme sur la place Hegel derrière l'université Humboldt avant de s'avancer le long de l'île aux Musées jusqu'à la maison des étudiants dans la rue Oranienburg. Là stationnent des camions qui sont chargés de plus de 25 000 ouvrages. Fritz Hippler, dirigeant des étudiants du Brandebourg et futur producteur du film de propagande Der ewige Jude Le Juif éternel se lance alors dans une diatribe qui dure jusqu'à ce que le cortège se mette en marche en direction du Reichstag, sous une pluie battante, au son d'une fanfare des SA. La tête d'un buste fracassé de Magnus Hirschfeld est promenée au bout d'un bâton. Une foule avide assiste au défilé des associations étudiantes, des corporations arborant le Wichs le costume de leur affiliation, de professeurs en toge, de membres des SA, des SS et de la jeunesse hitlérienne escortés par la police montée ; ils franchissent la porte de Brandebourg, empruntent l'avenue Unter den Linden Sous les tilleuls jusqu'au forum fredericianum qui deviendra plus tard la place Bebel avant de s'arrêter devant l'opéra national. Des orchestres SA ou SS jouent des airs patriotiques et des marches tandis que la place est éclairée par les projecteurs des équipes venues filmer les actualités.
Comme la pluie diluvienne interdit d'allumer le bûcher, les pompiers prêtent main forte aux étudiants en arrosant les livres d'essence. Après l’allocution du dirigeant syndical étudiant Herbet Gutjahr, qui conclut par ces mots : Nous avons dirigé notre offensive contre l'esprit non allemand. Je jette au bûcher tout ce qui ne respecte pas l'esprit allemand !, neuf représentants choisis des associations étudiantes s'avancent les premiers et jettent sur le brasier les livres qui correspondent aux textes de la circulaire. Puis, aux acclamations assourdissantes des étudiants et des spectateurs, c'est le tour des ouvrages transportés dans les camions qui sont jetés en vrac dans les flammes, après être passés de main en main le long d'une chaîne humaine. À la fin de la soirée, les livres de 94 auteurs, dont Karl Marx, Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Erich Kästner et Sigmund Freud, sont réduits en cendres.
Près de 70 000 personnes participent à l'événement. Vers minuit paraît le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, docteur en études germanistes, qui prononce un discours à la fin duquel il ne reste plus rien de la pile de livres qu'un tas de cendres encore fumantes. Les festivités se terminent avec l'exécution chorale du Horst-Wessel-Lied.
Les villes universitaires
Parallèlement aux événements de Berlin, des bûchers sont allumés le 10 mai 1933 dans 21 villes universitaires allemandes : Bonn, Brême, Breslau, Brunswick, Dortmund, Dresde, Francfort-sur-le-Main, Göttingen, Greifswald, Hanovre, Hannoversch Münden, Kiel, Königsberg, Landau, Marbourg, Munich, Nuremberg, Rostock, Worms et Wurtzbourg. En raison des fortes pluies, l'événement doit être repoussé dans certaines villes, ce qui fait qu'entre le 10 et le 19 mai on signale encore huit autodafés : le 12 à Erlangen, et Halle, le 15 à Hambourg, le 17 à Heidelberg, le 19 à Mannheim et Cassel avec 30 000 participants. L'événement prévu le 19 mai à Fribourg est annulé sine die en raison de la pluie. Le dernier bûcher s'embrase le 23 juin à Mayence alors que le premier avait eu lieu le 8 mai à Giessen.
En ce qui concerne les universités de Stuttgart, Tübingen et Singen, et pour des raisons de rivalité à l'intérieur du mouvement national-socialiste, le commissaire aux associations étudiantes, l'écrivain Gerhard Schumann, interdit toute participation à l'événement et maintient son refus en dépit des protestations que certains groupes d'étudiants font parvenir à Berlin8. L'association des étudiants de Darmstadt fait savoir qu'en raison de la situation particulière de la ville, dont la municipalité est dominée par le Front populaire, il ne sera pas possible d'organiser une manifestation publique.
Munich est le théâtre d'un double autodafé : le premier est organisé par la Jeunesse hitlérienne, le 6 mai, car la direction du mouvement a demandé aux sections de brûler en tous lieux … les livres et les écrits marxistes et pacifistes; le second, qui date du 10 mai, est à l'initiative de l'association des étudiants allemands et rassemble plus de 50 000 spectateurs sur la place Royale. Plusieurs radios bavaroises se font l'écho de l'événement.
Les autodafés eux-mêmes sont exécutés par l'association des étudiants allemands Dst, association qui chapeaute les commissions générales étudiantes AStA, et par la ligue des étudiants nationaux-socialistes NSDStB avec l'accord tacite de l'administration locale, et même la participation active de la police et des pompiers. De très nombreux professeurs prennent part à l'événement et arborent la robe universitaire devant les brasiers ou pour prononcer une allocution, par exemple le philosophe Alfred Baeumler à Berlin, le germaniste Hans Naumann à Bonn et les germanistes Friedrich Neumann et Gerhard Fricke à Göttingen. À Dresde, c'est Will Vesper qui se charge du discours. À Greifswald, le bûcher est organisé par la section locale de la ligue des étudiants nationaux-socialistes et s'inscrit dans une campagne contre l'esprit non allemand qui se déroule sur plusieurs semaines. Encadrés professionnellement par les professeurs Wolfgang Stammler et Hans Wilhelm Hagen, des étudiants postdoctoraux profitent des événements pour publier dans les journaux poméraniens des essais comparatifs sur la littérature allemande et les œuvres non allemandes destinées au bûcher.
À Francfort, 15 000 personnes environ se rassemblent sur le Römerberg, notamment de nombreux étudiants en uniforme de SA, mais aussi des professeurs en robe et bonnet carré. Les livres sont acheminés vers le bûcher dans un char à bœufs. Un croc à fumier signale qu'il s'agit du transport des ordures. C'est l'aumônier universitaire Otto Fricke qui prend la parole devant le bûcher.
Dans d'autres endroits, les étudiants ne se contentent pas de jeter des livres au bûcher. Ils brûlent aussi des drapeaux, notamment celui du Roter Frontkämpferbund la branche paramilitaire du Parti communiste allemand à Hambourg, et à Mannheim et Königsberg le drapeau noir-or-rouge de la République de Weimar.
[size=X-large]En Autriche[/size]
Après l'Anschluss , c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, la ligue des enseignants nationaux-socialistes organise un autodafé de livres Place de la Résidence à Salzbourg sous le patronage de Karl Springendschmid, le Goebbels salzbourgeois. 1 200 ouvrages d'auteurs religieux et juifs y sont brûlés, notamment les œuvres du Salzbourgeois d'adoption Stefan Zweig et la monographie sur Max Reinhard de Siegfried Jacobson. On entend proclamer : Que le feu fasse aussi disparaître l'affront et la honte qui ont rejailli sur notre ville. Que libre et allemande se dresse la ville de Mozart!
Actions en dehors des universités
Ces autodafés de livres ne sont pas les premiers qu'ait connus l’Allemagne nazie. Plusieurs cas étaient intervenus dans le sillage de la vague de terreur menée par les nazis lors des élections législatives de mars 1933 ; organisés par les SA et les SS, ils avaient touché de nombreuses villes, ainsi Dresde 8 mars, Brunswick 9 ma, Wurzbourg 10 mars, Heidelberg 12 mars, Kaiserslautern 26 mars, Münster 31 mars, Wuppertal 1er avril, Leipzig 1er avril et 2 mai, Düsseldorf 11 avril et Cobourg 7 mai. Il s'agissait alors de s'attaquer au noyau de l'opposition qui résistait encore, notamment les presses des partis politiques, des syndicats ou de la social-démocratie qui furent envahies et pillées, mais on en profita également pour brûler certaines œuvres comme À l'Ouest rien de nouveau d'Erich Maria Remarque. L'assaut de la Maison du peuple social-démocrate de Brunswick fit une victime. Ces actions donnèrent probablement une impulsion au mouvement étudiant qui allait suivre avec la Campagne contre l'esprit non allemand.
L'exemple du 10 mai 1933 déchaîne une vague de répliques en dehors des universités ; elle touche Neustrelitz 13 mai, Neustadt an der Weinstraße 14 mai, Offenbach-sur-le-Main 22 mai, Hambourg une nouvelle fois le 30 mai, à l'initiative de la Jeunesse hitlérienne et de la ligue des jeunes filles allemandes le Bund Deutscher Mädel ou BDM, Neubrandenburg le 31 mai, Heidelberg, Karlsruhe, Offenburg et Pforzheim le 17 juin, Essen, Darmstadt et Weimar le 21 juin et Mayence le 23. Le dernier événement de ce type est signalé le 26 août à Iéna. Il est impossible de donner un chiffre exact tant les petites répliques locales sont nombreuses, mais les archives font état de plus de 70 actions dans l'ensemble du pays au cours de l'année 1933.
En mars 1938, la branche mexicaine du parti national socialiste organise à Mexico une fête pour célébrer l'annexion définitive de l'Autriche, qui là aussi est suivie d'un petit autodafé de livres. La même année on voit encore brûler les livres de la communauté juive dans de nombreuses villes et villages, notamment dans des localités de Franconie telles que Hegenbach, Karlstadt et Steinach. En 1941, plusieurs autodafés ont encore lieu en Alsace, dans le cadre d'une action d'épuration contre les juifs du Sud .
Lieu et date des autodafés
Avant les autodafés étudiants du 10 mai 1933
Par ordre alphabétique :
Berlin 15 mars 1933
Brunswick 9 mars 1933 devant la Maison du Peuple social-démocrate
Cobourg 7 mai 1933 place du Château, le jour de la fête de la Jeunesse allemande
Dresde 7 mars 1933 rue Neue Meißner devant la librairie
Dresde 8 mars 1933 place Wettiner
Düsseldorf 11 avril 1933 planétarium aujourd'hui salle de concerts
Heidelberg 12 mars 1933 devant la maison des syndicats
Leipzig 1er avril 1933
Munich 6 mai 1933 organisé par les Jeunesses hitlériennes
Münster 31 mars 1933
Rosenheim 7 mai 1933 place Max-Josefs, organisé par les Jeunesses hitlériennes, la ligue des jeunes filles allemandes, et les jeunesses populaires
Schleswig 23 avril 1933 Stadtfeld
Wurtzbourg 10 mars 1933
Wuppertal 1er avril 1933 parvis de la mairie de Barmen et Brausenwerth à Elberfeld organisé par les lycéens encadrés par le corps enseignant
Autodafés à l'initiative de la campagne contre l'esprit non allemand.
Berlin 10 mai 1933 place de l'Opéra
Bonn 10 mai 1933 place du Marché
Brême 10 mai 1933 rue du Nord
Brunswick 10 mai 1933 place du Château
Breslau 10 mai 1933 place du Château
Darmstadt 21 juin 1933 place Merck
Dortmund 10 mai 1933 place de la Hanse
Dresde 10 mai 1933 contre la colonne Bismarck
Düsseldorf 11 mai 1933 place du marché
Erlangen 12 mai 1933 place du Château
Francfort-sur-le-Main 10 mai 1933 place de l'Hôtel de ville ou Römerberg
Fribourg-en-Brisgau stade universitaire, annulé en raison des pluies
Giessen 8 mai 1933 bassin de la Fontaine
Göttingen 10 mai 1933 place Adolf-Hitler aujourd'hui place Albani
Greifswald 10 mai 1933 place du Marché, organisé en parallèle avec une action pour l'esprit allemand menée par le syndicat local national-socialiste étudiant
Halle 12 mai 1933 place de l'Université
Hambourg 15 mai 1933 Rive de l'Empereur Frédéric
Hanovre 10 mai 1933 près de la colonne Bismarck
Hann. Münden 10 mai 1933 place du Marché
Heidelberg 17 mai 1933 place de l'Université
Cassel 19 mai 1933 place Frédéric
Kiel 10 mai 1933 place Guillaume
Königsberg 10 mai 1933 place du Tambour
Landau 10 mai 1933 place de la Parade, aujourd'hui place de l'Hôtel-de-Ville
Mannheim 19. Mai 1933 Messplatz, caserne des pompiers
Marbourg 10 mai 1933 Champ de Mars
Munich 10 mai 1933 place Royale
Münster 10 mai 1933 place Hindenburg
Nuremberg 10 mai 1933 place du Grand Marché, anciennement place Adolf-Hitler
Rostock 10 mai 1933 place Blücher
Stuttgart et Tübingen : le dirigeant régional du NSDStB du Württemberg s'opposa à un autodafé de livres, mais ne put empêcher quelques actions isolées menées par des groupes d'étudiants.
Worms 10 mai 1933 parvis du palais de justice
Wurtzbourg 10 mai 1933 place de la Résidence
Autodafés spontanés
Bad Kreuznach 10 mai 1933 Marché au blé
Bamberg 1er juillet 1933 terrain de jeu principal du Jardin public
Bautzen 9 août1933 Carrière de la rue Löbauer
Quartier de Bergedorf à Hambourg 24 juin 1933 dans le cadre des fêtes du solstice d'été
Clève 19 mai 1933 cour du lycée public de la Rue de Rome
Cologne 17 mai 1933 monument aux morts de l'Université
Düsseldorf 11 mai 1933 place du Marché
Eutin 24 juin 1933
Essen 21 juin 1933 place Gerling
Flensbourg 30 mai 1933
Hambourg 30 mai 1933 place de la Porte de Lübeck, à l'initiative des jeunesses hitlériennes
Heidelberg 17 juin 1933 place du Jubilé
Heidelberg 16 juin 1933 place de l'Université
Helgoland 18 mai 1933 place de l'École
Iéna 26 août 1933 place du Marché
Karlsruhe 17 juin 1933 place du marché
Leipzig 2 mai 1933 Maison du Peuple et plus tard sur la petite Messplatz
Lübeck 26 mai Cour Buniam
Mayence 23 juin 1933 place Adolf-Hitler
Neubrandenbourg 31 mai 1933 place du Marché
Neustadt an der Weinstraße 14 mai 1933 place du Marché
Neustrelitz 13 mai 1933 place du champ de Mars
Offenbach-sur-le-Main 22 mai 1933 devant le château d'Isenbourg
Offenbourg 17 juin 1933 place du Marché
Pforzheim 17 juin 1933 place du Marché
Ratisbonne 12 mai Neupfarrplatz
Rendsburg 9 octobre place de la Parade
Schleswig 23 juin 1933
Spire 6 mai 1933
Weimar 21 juin 1933 à Niedergrunstedt lors de la fête du solstice de la ligue nationale allemande des employés de commerce
Wilsdruff 23 septembre 1933 à Steinbruch Blankenstein, après la consécration des couleurs des cadets de la Jeunesse hitlérienne de Wilsdruff
Les auteurs mis à l'index
Magazine Die Weltbühne du 12 mars 1929, avec la participation de Kurt Tucholsky sous la direction de Carl von Ossietzky
Article détaillé : Liste des auteurs interdits pendant la période du national-socialisme.
La liste noire ne comportait pas seulement des auteurs de langue allemande, mais également des français, notamment André Gide, Marcel Proust, Romain Rolland et Henri Barbusse ; les américains Ernest Hemingway, Upton Sinclair, Jack London et John Dos Passos ainsi que de nombreux écrivains soviétiques tels que Maxime Gorki, Isaac Babel, Lénine, Trotski, Vladimir Maïakovski, Ilya Ehrenbourg.
Les persécutions dont furent victimes les écrivains dont les prises de positions orales ou écrite entraient en contradiction avec les idées du national socialisme et qui s'étaient refusés à participer au processus de préparation à la résistance spirituelle comme on le leur demandait ne commencèrent pas avec ces autodafés qui en représentèrent en fait le point culminant. De nombreux auteurs mais aussi des artistes et des scientifiques se virent par la suite frappés d'interdiction de publier ou de travailler, leurs œuvres disparurent les bibliothèques et des programmes scolaires ; certains furent exécutés comme Carl von Ossietzky, Erich Mühsam, Gertrud Kolmar, Jakob van Hoddis, Paul Kornfeld, Arno Nadel, Georg Hermann, Theodor Wolff, Adam Kuck et Rudolf Hilferding d'autres perdirent leur nationalité Ernst Toller et Kurt Tucholsky et furent réduits à l'exil Walter Mehring et Arnold Zweig ou forcés à une forme de résistance passive, qui prendra plus tard le nom d'émigration intérieure et qu'Erich Kästner décrira en ces termes : on est un cadavre vivant. Beaucoup d'entre eux connurent le désespoir et se suicidèrent, tels Walter Hasenclever, Ernst Weiß, Carl Einstein, Walter Benjamin, Ernst Toller ou Stefan Zweig.
Pour les auteurs qui se coulaient dans le moule national-socialiste, la mise à l'index d'un collègue était une aubaine professionnelle. On les voit sortir en rampant de tous les trous, ces petites putes provinciales de la littérature, écrivait Kurt Tucholsky en 1933, Enfin, enfin la concurrence juive a disparu… Mais maintenant ! … Voici les biographies des nouveaux héros, l'ivresse des cimes et les edelweiss, le tapis vert des prairies et le sillon des champs, … Vous ne pouvez pas imaginer la nullité totale.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=8695#forumpost8695
Posté le : 09/05/2015 15:26
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
121 Personne(s) en ligne ( 75 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 121
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages