|
|
Georges II de Grèce 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 19 juillet 1890 naît au palais de Tatoï Georges II de Grèce
en grec moderne : Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας / Geórgios II tis Elládas, roi des Hellènes et prince de Danemark, en Grèce, décédé, à 56 ans, le 1er avril 1947 au palais royal d’Athènes. Il est roi des Hellènes de 1922 à 1923 puis de 1935 à 1941/1944 et enfin de 1946 à 1947.Sa mère est Sophie de Prusse, son père Constantin 1er de Grèce, il est mariée à Elisabeth de Roumanie. Il appartient à la maison de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg. Il succede à Paul du 18 mars 1913 au 10 juin 1917, soit pendant 4 ans 2 mois et 23 jours, sous le règne de Constantin 1er; Il est diadoque de Grèce du 19 décembre 1920 au 27 septembre 1922, soit 1 an 9 mois et 8 jours, Il est chef de l'État grec du 27 septembre 1922 au 25 mars 1924 soit 1 an 5 mois et 27 jours, premiers ministres : Dimitrios Gounaris, Nikolaos Stratos, Petros Protopapadakis, Nikólaos Triantaphyllákos, Anastasios Charalabis, Sotírios Krokidás, Stylianós Gonatás. Il est régent de Grèce du 3 novembre 1935 au 23 mai 1941, soit 5 ans 6 mois et 20 jours, le premier ministre est Geórgios Kondýlis, Konstantínos Demertzís Ioánnis Metaxás, Alexandros Korizis, Emmanouil Tsouderos prédécesseur, Geórgios Kondýlis régent de Grèce, successeur Lui-même, roi de la Grèce libre et Georgios Tsolakoglou. il est Roi des Hellènes du 1er septembre 1946 au 1er avril 1947 durant 7 mois, le premier ministre est Konstantinos Tsaldaris, Dimitrios Maximos, son prédécesseur Damaskinos d'Athènes. Il est régent de Grèce après Paul Ier de Grèce duu 23 mai 1941 au 31 décembre 1944 pendant 3 ans 7 mois et 8 jours, le premier ministre est Emmanouil Tsouderos, Sophoklís Venizélos, Geórgios Papandréou
L’enfance et la jeunesse de Georges II sont marquées par l’effervescence nationaliste que connaît le royaume hellène au tournant des XIXe et XXe siècles. Après la défaite de la Grèce face à l’Empire ottoman en 1897, la famille royale est en effet accusée d’être responsable de l’échec de la Grande Idée et l’opposition républicaine augmente dans le pays jusqu’au coup de Goudi de 1909. Les victoires militaires grecques durant les Guerres balkaniques 1912-1913 rapprochent quelque temps la famille royale de son peuple mais l’éclatement de la Première Guerre mondiale renverse la situation. Après l'implication indirecte du pays dans le conflit en 1915, Georges, qui n’est alors que diadoque, assiste au Schisme national, autrement dit à la rupture violente entre son père, le roi Constantin Ier, et le Premier ministre Elefthérios Venizélos.
Acculé par la montée en puissance de l’Entente et des vénizélistes, Constantin Ier doit quitter le pouvoir et partir en exil en 1917. Jugé tout aussi germanophile que son père parce qu’il a été formé militairement en Allemagne, le prince Georges doit lui aussi quitter la Grèce tandis que son frère cadet, le jeune Alexandre Ier, monte sur le trône. Exilé avec sa famille en Suisse, Georges mène dès lors une existence relativement simple et morne. En octobre 1920, il se fiance cependant à l’une de ses cousines éloignées, la princesse Élisabeth de Roumanie, avec laquelle il est en contact depuis plusieurs années. Peu de temps après, son frère meurt à Athènes et une nouvelle crise politique secoue la Grèce, permettant à Constantin Ier de reprendre le pouvoir. La restauration de l’ancien souverain est toutefois éphémère puisque la défaite de la Grèce face aux nationalistes turcs commandés par Mustafa Kemal, l’oblige à abdiquer en faveur de son fils aîné en 1922.
Bien que reconnu roi des Hellènes, Georges II est écarté de la direction des affaires et il doit composer avec une classe politique de plus en plus radicale. Après la victoire électorale des républicains en décembre 1923, le souverain et sa famille partent une nouvelle fois en exil. D’abord réfugié dans la patrie de sa femme, Georges choisit de s’installer au Royaume-Uni en 1932. Vers la même époque, son couple se désagrège et son épouse obtient le divorce en 1935. Les malheurs conjugaux du souverain sont toutefois compensés par le retour en force des monarchistes en Grèce et par la tenue d’un référendum demandant son retour à la tête du pays le 3 novembre. De nouveau roi des Hellènes, Georges II tente de normaliser la situation politique de son pays mais la montée en force des communistes l'incite finalement à soutenir le coup d’État du général Ioannis Metaxas et la mise en place du Régime du 4-Août 1936.
Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale est une nouvelle épreuve pour la Grèce. Après un important succès contre les forces italiennes en 1940-1941, le pays est envahi par les armées de l’Axe en avril-mai 1941. De nouveau exilé, Georges II prend la tête des forces grecques libres. Cependant, ses liens avec la dictature de Metaxas affaiblissent son image auprès de la résistance grecque, très marquée à gauche. Devant l’opposition qu’il soulève, Georges II doit accepter de ne pas rentrer en Grèce dès la Libération et de remettre le pouvoir à une régence en 1944. Les portes de son pays lui étant à nouveau fermées, le souverain envisage de s’installer définitivement au Royaume-Uni mais le succès des monarchistes au référendum institutionnel du 27 septembre 1946 l’en dissuade finalement.
De retour en Grèce, Georges II trouve un pays ravagé par l’occupation et la guerre civile qui l'a suivie. Il reprend alors les affaires du pays mais trouve la mort seulement sept mois après la restauration de la monarchie.
En bref
Georges II est le fils aîné du roi Constantin Ier de Grèce 1868-1923 et de son épouse la princesse Sophie de Prusse 1870-1932, elle-même fille de l’empereur Frédéric III d'Allemagne 1831-1888 et de sa femme la princesse royale Victoria du Royaume-Uni 1840-1901.
Georges II a donc la particularité généalogique d'être à la fois l'arrière-petit-fils du roi Christian IX de Danemark 1818-1906, surnommé le beau-père de l'Europe , et de la reine Victoria Ire du Royaume-Uni 1819-1901, surnommée la grand-mère de l'Europe .
Le 27 février 1921, Georges épouse, à Bucarest, la princesse Élisabeth de Roumanie 1894-1956, fille du roi Ferdinand Ier de Roumanie 1865-1927 et de son épouse la princesse anglo-allemande Marie de Saxe-Cobourg-Gotha 1875-1938, surnommée la Belle-mère des Balkans. Par sa mère, Élisabeth est donc la petite-fille du duc Alfred Ier de Saxe-Cobourg-Gotha 1844-1900, que les Grecs avaient élus par plébiscite à la tête de leur royaume en 1862.
De l'union de Georges II et d'Élisabeth ne naît aucun enfant et le couple divorce le 6 juillet 1935. Après cette séparation, le souverain entretient une relation suivie avec une divorcée, sans jamais se remarier. Le roi n'ayant pas d'héritier direct, c'est donc le plus jeune de ses frères qui lui succède sous le nom de Paul Ier en 1947.
Sa vie
Un petit prince conscient de sa position
Fils du diadoque Constantin et de la princesse Sophie de Prusse, le futur Georges II voit le jour un peu moins de neuf mois après le mariage de ses parents, le 19 juillet 1890, au palais de Tatoï. Légèrement prématuré, l'enfant vient au monde de façon très rapide, mais néanmoins difficile. De fait, pendant l'accouchement, son cordon ombilical se place autour de son cou et il faut tout le savoir-faire de la sage-femme allemande que lui a envoyée sa grand-mère, l'impératrice douairière Victoria, pour que la naissance se déroule sans problème. Baptisé le 18 août suivant, le prince Georges compte, parmi ses multiples parrains et marraines, son arrière-grand-mère maternelle, la reine Victoria du Royaume-Uni.
Bientôt entouré de nombreux frères et sœurs Alexandre, Hélène, Paul, Irène et Catherine viennent agrandir la famille entre 1893 et 1913, le prince passe son enfance à Athènes, dans une villa de l'avenue Kifissias et dans le palais du diadoque, actuelle demeure du président grec, ainsi qu'à Tatoï, résidence secondaire de ses grands-parents paternels. L'enfant effectue par ailleurs de nombreux séjours à l'étranger puisque, chaque année, le diadoque et sa famille se rendent plusieurs semaines en Angleterre, où ils fréquentent les plages de Seaford et d'Eastbourne. L'été se passe à Friedrichshof, chez la mère de Sophie, mais aussi à Corfou et à Venise, où la famille royale se rend à bord du yacht Amphitrite.
Décrit comme le plus introverti, froid et même distant de sa fratrie, le prince Georges semble avoir pris conscience très jeune de son rôle d'héritier présomptif. L'historien John Van der Kiste le présente ainsi comme un enfant pas toujours très sage, surtout lors de ses visites chez sa grand-mère maternelle mais nettement moins turbulent que son frère cadet, l'espiègle Alexandre, jamais à court de bêtises, ou que sa sœur, la sportive Hélène, qui passe pour un garçon manqué.
Le coup de Goudi et ses conséquences Coup de Goudi.
En tant qu'héritier présomptif, le prince Georges reçoit une éducation à la tonalité fortement militaire. Formé à Athènes, à l'École des Évelpides, le jeune homme rejoint l'infanterie hellénique avec le grade de sous-lieutenant le 27 mai 1909. Or, cette promotion arrive à un très mauvais moment. Le 15 août 1909, un groupe d’officiers, réunis dans la Ligue militaire en grec : Στρατιωκικός Σύνδεσμος / Stratiotikos Syndesmos, organise en effet un coup d’État contre le gouvernement de Georges Ier : c’est le coup de Goudi. Bien que se déclarant monarchistes, les membres de la Ligue, dirigée par Nikólaos Zorbás, demandent au roi de démettre les princes de l’armée. Officiellement, il s'agit de protéger la famille du souverain des jalousies que pourraient faire naître ses amitiés avec certains militaires. Dans les faits, la réalité est bien différente : les officiers accusent le diadoque Constantin d'être responsable de la défaite de la Grèce face à l'Empire ottoman en 1897 et considèrent que la famille royale monopolise indûment les plus hauts postes de l'armée.
Dans le pays, la situation est si tendue que certains envisagent déjà de renverser le souverain et de le remplacer par l'aîné de ses petits-enfants autrement dit le prince Georges lui-même ou par un autre candidat un fils naturel d'Othon Ier, le duc des Abruzzes, le duc de Teck, voire un Hohenzollern. Moins impopulaire que son père Constantin, déjà majeur et ne nécessitant donc pas de régence, mais jeune et politiquement inexpérimenté, le prince Georges semble plus facilement contrôlable. L'option qu'il représente reste donc ouverte pour les insurgés jusqu'en février 1910.
Dans ce contexte tendu, les membres de la famille royale sont obligés de démissionner de leurs postes militaires afin d’épargner au souverain la honte de devoir les renvoyer. Le diadoque et son épouse doivent par ailleurs quitter précipitamment la Grèce avec leurs enfants et la famille s'installe, pour plusieurs mois, en Allemagne. Pour sauver les apparences, les jeunes officiers ont demandé un congé d'instruction de trois ans. Ainsi, le prince Georges poursuit sa formation militaire et intègre, pendant deux ans, le prestigieux 1er régiment d'infanterie de la garde prussienne. Ce départ à l'étranger lui évite, de surcroît, d'apparaître comme une alternative potentielle à son grand-père et à son père pour le trône.
De la garde prussienne à la Première Guerre balkanique Grèce dans les guerres balkaniques.
Après bien des tensions, la situation politique finit par s'apaiser en Grèce et le diadoque Constantin est autorisé à rentrer dans son pays avant d'être restauré dans ses fonctions militaires par le Premier ministre Elefthérios Venizélos, en 1911. En dépit d'un séjour de quelques mois dans son pays natal à la fin de l'année 1910, Georges retourne poursuivre sa formation militaire à Berlin, dans le 1er régiment d'infanterie de la garde prussienne.
C'est seulement avec le déclenchement de la Première Guerre balkanique, qui oppose les nations chrétiennes des Balkans à leur ancien suzerain ottoman, que le jeune homme regagne définitivement le royaume de Grèce en octobre 1912. Avec son frère cadet, le prince Alexandre, il sert alors comme officier dans l'État-major de son père27,28. Au grand dam de certains Grecs qui craignent pour la vie de l'héritier présomptif, Georges prend part à différentes batailles et est à plusieurs reprises exposé au feu ennemi. Il participe ainsi à la prise de la ville de Thessalonique, le 8 novembre 1912, qui constitue l'un des moments phares du conflit.
Diadoque de Grèce
De l’assassinat de Georges Ier à la Première Guerre mondiale.
Le 18 mars 1913, le roi Georges Ier est assassiné par un anarchiste grec près de la Tour blanche de Thessalonique pendant qu'il y effectue sa promenade quotidienne. Son fils, qui est alors au faîte de sa popularité grâce au succès du premier conflit balkanique, lui succède à la tête du pays sous le nom de Constantin Ier. Âgé de vingt-trois ans, le prince Georges devient, quant à lui, héritier du trône et prend les titres de diadoque de Grèce et de duc de Sparte.
Dans les jours qui suivent, Constantin Ier et sa famille déménagent dans le nouveau palais royal ex-palais du diadoque, tandis que le prince Georges prend pleinement possession de leur ancienne résidence de l'avenue Kifissias. Il y mène une vie simple et reçoit fréquemment son oncle, le prince Christophe de Grèce, qui n'a que deux ans de plus que lui et avec lequel il entretient une relation amicale très étroite.
Le 30 juin 1913, éclate la Deuxième Guerre balkanique qui oppose, cette fois, la Grèce et ses alliés à la Bulgarie et qui aboutit à une nouvelle victoire pour le royaume hellène. Dans les Balkans, un nouvel ordre géopolitique se dessine, marqué notamment par le rapprochement du royaume hellène et de la Roumanie. C'est apparemment vers cette époque que s'esquisse le projet d'union matrimoniale entre le diadoque et sa future épouse, la princesse Élisabeth de Roumanie.
La paix revenue, Georges effectue plusieurs séjours à l'étranger avec sa famille. À l'automne, il accompagne ainsi le roi dans un voyage diplomatique à Berlin, durant lequel son oncle, le Kaiser Guillaume II, lui confère l'ordre de l'Aigle rouge avec des épées. L'été suivant, le diadoque se rend au Royaume-Uni avec le prince Christophe et il se trouve à Londres lorsque se produit l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et de son épouse, le 28 juin 1914.
La Première Guerre mondiale Grèce dans la Première Guerre mondiale.
Pendant la Première Guerre mondiale, le roi Constantin Ier cherche à maintenir la Grèce dans une position de neutralité. Il considère en effet que son pays n'est pas prêt à participer à un nouveau conflit après les Guerres balkaniques. Mais, formé en Allemagne et lié au Kaiser Guillaume II dont il est le beau-frère, Constantin est rapidement accusé de soutenir la Triple-Alliance et de souhaiter la défaite des Alliés. Bientôt, le souverain rompt avec son Premier ministre, Elefthérios Venizélos, qui est quant à lui convaincu de la nécessité de soutenir les pays de la Triple-Entente pour rattacher les minorités grecques de l'Empire ottoman et des Balkans au royaume hellène. Protégé par les pays de l'Entente, et par la République française en particulier, l'homme politique forme, en octobre 1916, un gouvernement parallèle à celui du monarque à Thessalonique. Le centre de la Grèce est alors occupé par les forces alliées et le pays est en passe de sombrer dans la guerre civile : c'est le Schisme national.
En dépit de ces difficultés, Constantin Ier refuse de modifier sa politique et doit faire face à l'opposition toujours plus nette de l'Entente et des vénizélistes. Ainsi, le 14 juillet 1916, un incendie criminel, dont on accuse des agents de la France, ravage le domaine de Tatoï et manque de tuer une bonne partie des membres de la famille royale. Le diadoque Georges n'est pas touché mais sa mère sauve sa plus jeune sœur de justesse en la portant dans les bois sur plus de deux kilomètres. Parmi le personnel du palais et les pompiers venus éteindre le feu, seize à dix-huit personnes selon les sources trouvent par ailleurs la mort.
Finalement, le 10 juin 1917, Charles Jonnart, le Haut-Commissaire de l'Entente en Grèce, ordonne au roi de quitter le pouvoir. Sous la menace d'un débarquement de l'Entente au Pirée, le souverain accepte de partir en exil, sans toutefois abdiquer officiellement. Les Alliés ne souhaitant pas instaurer la république en Grèce, l’un des membres de sa famille doit lui succéder. Or, le diadoque Georges est jugé tout aussi germanophile que son père parce qu'il a lui-aussi été formé en Allemagne. Il est par ailleurs considéré comme peu malléable, alors que c'est un souverain fantoche que les ennemis de Constantin veulent mettre sur le trône. C’est donc d’abord à l’un des frères du monarque déposé un autre Georges, marié à une princesse française que les Alliés pensent pour le remplacer. Cependant, celui-ci refuse catégoriquement de monter sur le trône par loyauté envers le souverain45. C’est donc finalement le frère cadet du diadoque, Alexandre, que Venizélos et l’Entente choisissent comme nouveau roi des Hellènes.
Le prince Alexandre succède à Constantin Alexandre Ier de Grèce.
La cérémonie par laquelle Alexandre Ier monte sur le trône, le 10 juin 1917, est entourée de tristesse. Hormis l’archevêque-primat Théoclète Ier d’Athènes, qui reçoit le serment du nouveau souverain, seuls y assistent le diadoque Georges, l'ex-roi Constantin et le Premier ministre Alexandros Zaimis. Aucune festivité ni aucune pompe n’entourent l’événement, qui demeure d’ailleurs secret. Alexandre, qui a alors vingt-trois ans, a la voix cassée et les larmes aux yeux lorsqu’il prête serment de fidélité sur la constitution grecque. Il sait qu’il s’apprête à jouer un rôle difficile dans la mesure où l’Entente et les vénizélistes sont opposés à la famille royale et ne sont pas prêts à lui obéir. Surtout, il est conscient que son règne est de toute façon entaché d'illégitimité. De fait, ni son père ni son frère aîné n’ont renoncé à leurs droits à la couronne et, avant la cérémonie, Constantin a longuement expliqué à son fils qu’il est désormais l’occupant du trône mais pas le véritable monarque.
Le soir même de la cérémonie de prestation de serment, la famille royale décide de quitter le palais d’Athènes pour se rendre à Tatoï. Cependant, une partie des habitants de la capitale refuse de voir leurs souverains partir en exil et des foules se forment autour du palais pour empêcher Constantin et les siens d’en sortir. Le 11 juin, l'ex-roi et sa famille parviennent toutefois à s’enfuir en cachette de leur résidence. Dès le lendemain, Constantin, Sophie et tous leurs enfants hormis leur deuxième fils gagnent le petit port d’Oropos et prennent le chemin de l’exil. C’est la dernière fois que Georges et sa famille sont en contact avec Alexandre Ier, désormais considéré comme prisonnier des vénizélistes.
Du premier exil au second règne de Constantin Ier
De la Suisse à la Roumanie
Après avoir traversé la mer Ionienne et l’Italie, le prince Georges et sa famille s'installent en Suisse alémanique, d’abord à Saint-Moritz, puis à Zurich. Dans leur exil, ils sont bientôt rejoints par la quasi-totalité des membres de la dynastie hellénique, qui quitte la Grèce avec le retour d'Elefthérios Venizélos à la tête du cabinet et l’entrée en guerre d'Athènes aux côtés de l’Entente. Or, la situation financière de la famille royale n’est pas des plus brillantes et l'ex-roi Constantin, déjà très affaibli, ne tarde pas à tomber malade. En 1918, il contracte ainsi la grippe espagnole et manque de trouver la mort.
Avec la fin de la Première Guerre mondiale et la signature des traités de Neuilly et de Sèvres, le royaume hellène réalise d'importantes acquisitions territoriales en Thrace et en Anatolie. Pourtant, la Grèce est loin d'avoir retrouvé sa stabilité avec le départ des anciens souverains et la guerre contre la Turquie reprend dès 1919. En outre, les tensions entre Venizélos et les Oldenbourg se poursuivent. La décision d'Alexandre Ier d'épouser Aspasía Mános, une jeune aristocrate d'ascendance phanariote, plutôt qu'une princesse européenne déclenche en effet la colère du chef du gouvernement. L'homme politique crétois voit dans cette mésalliance une occasion perdue de se rapprocher de la Grande-Bretagne et de son gouvernement.
Plus conventionnel que son frère cadet, le prince Georges se fiance, quelques mois plus tard, en octobre 1920, à la princesse Élisabeth de Roumanie. Le couple est en relations depuis 1911 et Georges a déjà demandé la main de la jeune fille en 1914. Mais, conseillée par sa grand-tante, la fameuse Carmen Sylva, la princesse a d’abord décliné la proposition du diadoque, le jugeant trop petit et trop anglais dans ses manières. Dédaigneuse, la future reine des Hellènes aurait même déclaré à cette occasion que Dieu avait commencé le prince mais avait oublié de le terminer. Ses sentiments n’ont d’ailleurs pas vraiment évolué lorsqu’elle retrouve le jeune homme lors d'un voyage en Suisse. Mais, peut-être davantage consciente de ses propres imperfections sa mère, la reine Marie de Roumanie, la décrit comme grosse et peu intelligente, Élisabeth finit par accepter le mariage lorsque Georges se tourne une nouvelle fois vers elle.
À cette époque, l’avenir du prince est pour le moins incertain : exilé, désargenté et sans aucune situation, il n’a guère à offrir à sa fiancée qu'un hypothétique droit de succession sur la couronne de Grèce. Pourtant, la combinaison matrimoniale satisfait tout autant les parents du jeune homme que sa future belle-famille et la reine Marie de Roumanie ne tarde pas à inviter le prince à se rendre, avec deux de ses sœurs Hélène et Irène, à Bucarest afin d'y annoncer publiquement les fiançailles. C'est d'ailleurs dans cette ville que se trouve Georges lorsqu'il apprend le décès de son frère Alexandre.
La Restauration de Constantin et les mariages gréco-roumains
À Athènes, la disparition d’Alexandre Ier, le 25 octobre 1920, donne lieu à une grave crise institutionnelle. Tandis que le Parlement hellénique réitère l'exclusion de l'ex-roi Constantin et du diadoque Georges de la succession au trône, le gouvernement d'Elefthérios Venizélos offre la couronne hellénique au prince Paul, troisième fils du souverain déposé. Cependant, celui-ci refuse de monter sur le trône avant son père et son frère aîné à moins qu’un référendum ne l’appelle à la tête de l’État. Le trône restant vacant et la guerre gréco-turque faisant toujours rage, les nouvelles élections législatives donnent lieu à un conflit ouvert entre venizélistes et monarchistes. Le 14 novembre 1920, les partisans de l'ex-roi l'emportent et Dimitrios Rallis est nommé Premier ministre. Vaincu, Venizélos part en exil à Constantinople. Avant son départ, il demande cependant à la reine douairière Olga d’accepter la régence en attendant la restauration de son fils.
Le 5 décembre 1920, un référendum au résultat contesté appelle la famille royale à rentrer en Grèce. Constantin Ier, la reine Sophie et le diadoque Georges regagnent donc Athènes le 19 décembre suivant. Leur retour s’accompagne d’importantes manifestations de liesse populaire. Un peu partout, des portraits de Venizélos sont arrachés et remplacés par ceux de la famille royale. Surtout, une foule immense entoure les souverains et l'héritier du trône dans les rues de la capitale et, une fois rentrés au palais royal, ceux-ci doivent apparaître à de nombreuses reprises au balcon pour saluer le peuple qui les acclame.
D'autres réjouissances touchant la famille royale se déroulent dans les semaines qui suivent. Deux mariages unissant les Oldenbourg de Grèce aux Hohenzollern de Roumanie sont en effet célébrés en quelques jours d'intervalle. Le 27 février 1921, le diadoque Georges épouse ainsi, à Bucarest, la princesse Élisabeth de Roumanie tandis que le frère de celle-ci, le prince royal Carol se marie, à Athènes, à la princesse Hélène de Grèce, le 10 mars.
Pourtant, le retour de la famille royale de Grèce dans son pays n'amène pas la paix escomptée par la population. Bien plus encore, elle empêche la nation de recevoir l’appui des grandes puissances dans la guerre qui l’oppose à la Turquie de Mustafa Kemal depuis 1919. De fait, les anciens alliés de la Première Guerre mondiale n’ont pas pardonné aux Oldenbourg leur attitude durant le conflit et ils ne sont pas prêts à leur apporter leur soutien. La haine des grandes puissances pour les souverains apparaît d’ailleurs clairement à l’occasion des noces princières de 1921. Invités au mariage d'Hélène et de Carol, l’ambassadeur de Grande-Bretagne et son épouse refusent ostensiblement de saluer le roi et la reine des Hellènes alors qu’ils montrent publiquement leurs respects à la reine Marie de Roumanie, venue assister aux épousailles de son fils aîné.
La guerre gréco-turque et la fausse-couche d’Élisabeth
Le front anatolien en 1921-1922. Guerre gréco-turque 1919-1922 et Occupation de Smyrne par la Grèce.
Peu de temps après le retour de la famille royale en Grèce, Constantin Ier endosse la charge de commandant suprême de l’armée hellénique et séjourne en Asie mineure de mai à septembre 1921 afin d’y soutenir l’effort de guerre contre la résistance turque menée par Mustafa Kemal. Le diadoque Georges ayant intégré l’État-major de son père, il accompagne le souverain à Smyrne et sur le front anatolien, où il visite champs de bataille et hôpitaux de campagne. Or, après une série de victoires qui mènent l’armée grecque aux portes d’Ankara, les forces helléniques connaissent une importante défaite à la bataille de la Sakarya d’août-septembre 1921.
Déjà affaiblie par le conflit toujours latent avec les vénizélistes, la famille royale est touchée de plein fouet par le désastre militaire. Le prince André l'un des oncles du diadoque a en effet quitté le front peu de temps avant la défaite de la Sakarya et il est donc accusé de désertion par l'opposition.
Les mois suivants la bataille, la situation militaire ne cesse de se dégrader et l'armée grecque bat peu à peu en retraite en direction de Smyrne. Tandis que le diadoque effectue de nouveaux séjours auprès de l'armée en Ionie, son épouse, la princesse Élisabeth, intègre la Croix-Rouge et s'implique dans le secours aux soldats blessés et aux réfugiés chrétiens qui fuient devant les forces turques. Cependant, l'éloignement de son mari pèse à la princesse royale, qui éprouve beaucoup de difficulté à s'intégrer à son nouveau pays et à sa belle-famille. De plus en plus incertaine face à l'avenir de la dynastie grecque, Élisabeth jalouse le sort de sa sœur, la reine Marie de Yougoslavie, et de sa belle-sœur, la princesse Hélène, qui ne connaissent pas ses difficultés financières et sa solitude.
Déjà tendues par la guerre, les relations du diadoque et de sa femme sont assombries par leur incapacité à donner un héritier au royaume de Grèce. Élisabeth tombe en effet enceinte quelques mois après son mariage mais elle perd l'enfant qu'elle porte lors d'un voyage officiel dans la ville de Smyrne. Gravement affectée par sa fausse couche, la princesse royale tombe malade. Atteinte d'une typhoïde bientôt suivie de pleurésie aggravée de dépression, elle trouve alors refuge auprès de sa famille à Bucarest. Mais, malgré les efforts de sa mère et de son époux, ni la santé de la princesse ni son mariage ne se remettent complètement de la perte de son enfant.
Dans les mêmes moments, la contre-offensive turque s'intensifie en Anatolie et les forces de Mustafa Kemal organisent la reconquête de Smyrne, qui tombe le 9 septembre 1922. Durant plusieurs jours, la ville est mise à sac et incendiée. Des milliers de Grecs et d'Arméniens sont assassinés tandis que d'autres fuient vers les îles de l'Égée et le Péloponnèse. Dans ce contexte difficile, la propagande vénizéliste et républicaine trouve de nouveaux échos en Grèce. Le 11 septembre, une partie de l’armée, conduite par les colonels Nikolaos Plastiras et Stylianós Gonatás, se soulève et demande l’abdication de Constantin Ier ainsi que la dissolution du parlement hellénique.
Un premier règne sous surveillance
Entre accession au trône et Grande catastrophe Nikolaos Plastiras
Désireux d'éviter des troubles supplémentaires, le roi Constantin Ier finit par abdiquer le 27 septembre 1922 et part en exil avec son épouse et ses filles en Italie. Le diadoque quitte alors Bucarest, où il s'était rendu pour retrouver sa femme, afin de succéder à son père à la tête de la Grèce. Le nouveau souverain, qui prend le nom de Georges II, arrive au pouvoir dans un contexte difficile. Il hérite en effet d’un pays en proie à d’énormes tensions politiques depuis la révolution du 11 septembre et soumis à un afflux massif de réfugiés victimes de la Grande catastrophe qui se déroule en Asie mineure.
Comme son frère le roi Alexandre Ier avant lui, Georges II devient en réalité un souverain fantoche soumis au bon vouloir des vénizélistes. Sans réel pouvoir, il vit sous la menace constante du comité révolutionnaire dirigé par Nikolaos Plastiras et Stylianós Gonatás. Reclus au palais de Tatoi avec son épouse, qui l’a rejoint une fois guérie, le roi est étroitement surveillé. Très inquiet des événements qui secouent son pays et de la façon dont sont traités les membres de sa famille, il ne bénéficie même pas de soutien à l’étranger puisque les Alliés refusent de le reconnaître, comme ils avaient refusé de reconnaître son père lors de sa restauration.
Le Procès des Six
Parmi tous les événements qui contribuent au profond malaise de Georges II, le procès des Six, autrement dit les poursuites judiciaires menées par le comité révolutionnaire contre les hommes politiques et les généraux monarchistes qu’il tient pour responsables de la défaite face à la Turquie, a une place particulière. De fait, en dépit des protestations internationales, les anciens Premiers ministres Dimitrios Gounaris, Petros Protopapadakis et Nikolaos Stratos ainsi que trois autres personnalités de premier ordre Georgios Baltatzis, Nikolaos Theotokis et Geórgios Hatzanéstis sont fusillés le 28 novembre 1922, après seulement deux semaines de procès. Le roi est d'autant plus atterré par les événements qu'il a été privé de son droit de grâce et qu'il ne peut intervenir en faveur de ces hommes qui se sont toujours montrés loyaux envers sa famille.
Or, les Six ne sont pas les seules victimes des révolutionnaires et un climat de chasse aux sorcières, qui n'épargne pas la dynastie, se développe dans le pays. Le prince André est ainsi arrêté dans son palais de Mon Repos le 26 octobre, conduit à Athènes sur un navire de la marine nationale, emprisonné puis jugé à son tour pour son rôle dans le désastre militaire à partir du 2 décembre. Afin d'éviter que le scénario du 28 novembre se reproduise, les membres de la famille royale exilés à l'étranger utilisent alors tous leurs contacts pour que des pressions diplomatiques fortes soient exercées sur le gouvernement athénien. Finalement, André de Grèce est déclaré coupable par le tribunal révolutionnaire qui ne le condamne toutefois qu'au bannissement perpétuel dans le but d'éviter au pays les sanctions internationales. Évacué par un navire britannique, l'oncle de Georges II quitte alors le royaume hellène avec son épouse et leurs cinq enfants le 5 décembre.
Du coup d’État royaliste au deuxième exil
Coup d'État grec d'octobre 1923.
Très choqué par les procès mis en place par le comité révolutionnaire et par le refus de celui-ci d'organiser des funérailles officielles pour son père, l'ex-roi Constantin Ier mort en exil à Palerme le 11 janvier 1923, Georges II envisage d'abdiquer et de quitter la Grèce avec son épouse. Sur les conseils du général monarchiste Ioannis Metaxas, le souverain choisit toutefois de rester à la tête du pays, dans l'espoir que la situation politique se renverse.
Alors que les relations du roi avec le gouvernement révolutionnaire, présidé par le Premier ministre républicain Stylianós Gonatás, sont de plus en plus tendues, une tentative de coup d'État est organisée par des militaires royalistes peut-être appuyés par Metaxas en octobre 1923. Après quelques succès, les contre-révolutionnaires sont défaits et leur échec rejaillit sur la couronne. Bien qu'étranger au complot, Georges II est en effet accusé d'avoir initié le soulèvement. Plus que jamais, le souverain et la dynastie sont les cibles de violentes critiques et des militaires comme Nikolaos Plastiras ou Theodoros Pangalos réclament ouvertement l'abolition de la monarchie et le bannissement des Oldenbourg.
Après la victoire des venizélistes aux élections législatives du 16 décembre 1923, le Premier ministre Gonatás demande à Georges II de quitter le pays pendant que la nouvelle Assemblée nationale délibère sur la forme future du régime politique de la Grèce. Placé dans une situation similaire à celle de son père en 1922, le roi se soumet à la pression des politiques mais refuse d’abdiquer. Il prend alors prétexte d'une visite officielle dans le pays de sa belle-famille, en Roumanie, pour partir en exil avec son épouse, la reine Élisabeth et son jeune frère, le prince Paul, le 19 décembre 1923.
Exil et séparation
En Roumanie Deuxième République hellénique.
Sans surprise, la Deuxième République hellénique est proclamée par le parlement le 25 mars 1924, avant d'être confirmée par un référendum deux semaines et demie plus tard. Officiellement déposés et bannis, Georges et Élisabeth sont par ailleurs déchus de leur nationalité grecque et voient leurs biens confisqués par le gouvernement. Désormais apatrides comme tous les membres de la famille royale, ils reçoivent cependant du chef des Oldenbourg, leur cousin le roi Christian X de Danemark, un nouveau passeport.
Exilés en Roumanie depuis décembre 1923, les anciens souverains grecs s'installent à Bucarest, où le roi Ferdinand Ier et la reine Marie de Roumanie leur mettent quelque temps à disposition une aile du palais Cotroceni. Après plusieurs semaines cependant, le couple déménage et établit sa résidence dans une villa plus modeste de la Calea Victoriei. Hôtes réguliers des souverains roumains, Georges et Élisabeth participent alors aux cérémonies qui ponctuent la vie des Hohenzollern-Sigmaringen. Mais, malgré la bonté avec laquelle le traite sa belle-mère dont il dit plus tard qu'elle a été la seule à rendre sa vie supportable à cette époque, l'ex-roi des Hellènes se sent désœuvré à Bucarest et peine à cacher l'ennui que lui procurent les fastes de la Cour roumaine.
Éprouvées par les humiliations de l'exil, les difficultés financières et l'absence de descendance, les relations de Georges et d'Élisabeth se dégradent. Après avoir d'abord trompé sa lassitude dans la nourriture trop riche et les jeux d'argent, l'ex-reine des Hellènes entretient des relations extra-conjugales avec différents hommes mariés. Elle profite ainsi d'une visite à sa sœur malade, à Belgrade, pour flirter avec son propre beau-frère, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Plus tard, elle noue une liaison avec le banquier de son mari, un Grec du nom d'Alexandros Scavani, dont elle fait son chambellan pour étouffer le scandale. Il reste qu'Élisabeth n'est pas la seule responsable de l'échec de son mariage. Au fil des années, Georges passe en effet de moins en moins de temps auprès de son épouse et transporte progressivement sa résidence au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni
Au début de sa vie d'exilé, Georges séjourne la moitié de l'année en Roumanie avec Élisabeth. Seul ou en compagnie de son épouse, il partage les six mois restant entre la Toscane, où il réside chez sa mère, à la Villa Bobolina, et la Grande-Bretagne, où il a de nombreux amis. Après la mort de la reine douairière Sophie, en 1932, Georges choisit cependant de quitter définitivement Bucarest et sa femme pour établir sa résidence à Londres. Accompagné de son écuyer, le major Dimitrios Levidis, et d'un fidèle serviteur, Mitso Panteleos, l'ex-souverain loue une petite suite de deux pièces au Brown's hotel de Mayfair.
Toujours aussi désargenté, Georges mène une vie relativement simple et éloignée du protocole. Pas toujours bien reçu par les membres de la haute société britannique, qui lui reprochent volontiers sa parenté avec le Kaiser Guillaume II, il n'en a pas moins de nombreux amis, qui l'invitent régulièrement à leurs fêtes et à leurs parties de chasse, en Écosse ou ailleurs. Proche de la famille royale britannique, qui l'accueille à plusieurs reprises dans ses palais, il fréquente également les pubs et les antiquaires, devenant ainsi expert en vieux meubles et en argenterie anglaise.
Toujours soucieux de ne pas représenter une gêne pour ses hôtes, Georges s'abstient de toute déclaration ou action à caractère politique. Mais s'il se contente de répondre aux Grecs qui lui demandent de rentrer à Athènes qu'il ne peut le faire que si la nation l'appelle librement, il continue à se considérer comme un membre à part entière du peuple hellène. C'est ainsi en uniforme de l'armée grecque qu'il assiste au mariage de sa cousine la princesse Marina avec le duc de Kent en 1934.
Amour et divorce
Peu après l'union de sa cousine, Georges part pour un voyage de plusieurs mois dans les Indes britanniques. Hôte du vice-roi Freeman-Thomas, il est reçu dans la colonie en souverain étranger et y rencontre de nombreux officiels. Invité régulier des maharajas, il se montre avide de découvrir leur culture et participe avec enthousiasme aux chasses que ces derniers organisent en son honneur.
Durant ce séjour, l'ex-roi des Hellènes fait par ailleurs la connaissance d'une jeune femme mariée dont il ne tarde pas à tomber amoureux. D'origine roturière, Joyce Wallach est l'épouse malheureuse de John Britten-Jones ou Brittain-Jones, l'aide de camp du gouverneur des Indes, et la mère d'une petite fille. Séduite par Georges, elle ne tarde pas à demander le divorce et à quitter le joyau de la couronne britannique » pour suivre son amant, après son retour à Londres. C'est le début d'une liaison discrète et heureuse, qui dure jusqu'à la mort de Georges, en 1947.
Quelques mois après avoir regagné le Royaume-Uni, l'ex-souverain grec apprend par un journal, le 6 juillet 1935, la nouvelle de son propre divorce. Accusé de désertion du foyer familial » par Élisabeth de Roumanie, il voit son mariage dissout par un tribunal de Bucarest sans avoir été même invité à s'exprimer sur la question.
Un deuxième règne sous le signe de la dictature
Une restauration inattendue
Entre 1924 année où la Deuxième République hellénique est proclamée et 1935 date à laquelle cette dernière est abolie, la Grèce connaît une forte instabilité politique et financière. En un peu plus de dix ans, vingt-trois gouvernements, une dictature et treize coups d'État se succèdent. En moyenne, chaque cabinet reste en place durant six mois tandis qu'une tentative de putsch est organisée toutes les quarante-deux semaines. Incapables de rétablir l'ordre dans le pays et décrédibilisés par leur implication dans les différents coups d'État, les républicains perdent progressivement du terrain face aux monarchistes et des voix de plus en plus nombreuses réclament le retour sur le trône de Georges II ou d'un autre membre de sa famille comme le duc de Kent.
Finalement, le 10 octobre 1935, les forces armées grecques destituent le Premier ministre Panagis Tsaldaris et le président de la République Aléxandros Zaïmis, avant de les remplacer par le ministre de la guerre Geórgios Kondýlis. Ancien vénizéliste, Kondylis est un militaire déçu de la république, qu'il juge coupable d'avoir amené l'anarchie en Grèce. Sous son impulsion, l'Assemblée hellénique proclame la restauration de la monarchie et nomme l'homme politique régent en attendant le retour de Georges II au pouvoir. Or, en Angleterre, le roi des Hellènes fait savoir au nouveau gouvernement que seule la tenue d'un référendum peut le conduire à remonter sur le trône.
Kondylis organise alors une consultation nationale truquée visant à légitimer son entreprise et à pousser le roi à rentrer à Athènes. Officiellement, plus de 95 % des électeurs grecs réclament le retour de la monarchie, le 3 novembre 1935. La consultation populaire se déroule dans des conditions plus que contestables : le vote n’est pas secret et la participation est obligatoire. Time magazine décrit ainsi l’événement : un électeur a le choix entre placer dans l’urne un bulletin bleu en faveur de Georges II et de plaire ainsi au général Georges Kondylis … ou d’y mettre un bulletin rouge pour la République et de risquer les problèmes.
En fait, la fraude électorale est si manifeste qu'elle finit par indisposer le gouvernement, qui craint de voir la tricherie dénoncée. Le soir même du référendum, le ministre de l'Intérieur grec détruit ainsi une grande quantité de bulletins de vote en faveur de la restauration tout en s'écriant : Non ! Non ! je ne voulais pas qu'ils aillent aussi loin ! Il reste qu'après décompte des résultats, seuls 32 454 des 1 527 714 suffrages exprimés demandent le maintien de la république alors que 1 491 992 soutiennent le retour de la monarchie et que 3 268 autres sont déclarés invalides.
Vers la réconciliation nationale ?
Une fois le résultat du référendum annoncé, une délégation hellène rencontre officiellement Georges II et son frère Paul à l'ambassade de Grèce, à Londres, pour leur demander de rentrer à Athènes et le 5 novembre 1935, le roi accepte officiellement de remonter sur le trône. Après avoir réglé leurs affaires, le souverain et son héritier quittent la capitale britannique le 14 novembre et gagnent Paris. Là, ils sont reçus par le président de la République française Albert Lebrun et ont une entrevue avec leur oncle, le prince André. Les deux frères se rendent ensuite en Italie, où ils retrouvent leurs sœurs toutes trois installées à la Villa Sparta et d'autres membres de leur parentèle, comme le prince Christophe. À Florence, ils se recueillent par ailleurs sur les tombes de leurs parents, provisoirement ensevelis à l'église russe de la ville. Après un bref passage à Rome, où le roi Victor-Emmanuel III leur confère l’ordre de l’Annonciade, les deux frères partent ensuite pour Brindisi, où le croiseur grec Elli les attend pour les ramener à Athènes. Finalement, le souverain et son héritier retrouvent le sol de leur patrie le 25 novembre et sont accueillis à Phalère par une foule en liesse.
Une fois le roi rentré en Grèce, Geórgios Kondýlis perd son statut de régent mais le souverain le nomme Premier ministre et le fait Grand-croix de l'ordre de Georges Ier pour le remercier de son rôle dans la restauration monarchique. Pourtant, les relations entre les deux hommes se tendent rapidement. Georges II désire en effet faire table rase du passé et déclarer l'amnistie générale pour les opposants politiques. De son côté, Kondylis ne peut accepter que les leaders de la tentative de coup d’État qu’il a lui-même écrasée en mars 1935 soient pardonnés par le roi. Face à l’entêtement du souverain, Kondylis présente sa démission le 30 novembre et Georges II nomme à sa place le professeur de droit Konstantínos Demertzís.
L'Assemblée hellénique est dissoute et de nouvelles élections législatives sont convoquées le 26 janvier 1936. Cependant, l'arrivée de nombreux réfugiés issus d'Asie mineure après 1922 a renforcé le poids de la gauche dans le pays et les gains électoraux du Parti communiste, qui obtient quinze élus, lui permettent de jouer le rôle d'arbitre au moment où les deux principales organisations politiques le Parti libéral d'Elefthérios Venizélos et le Parti populaire de Panagis Tsaldaris obtiennent sensiblement le même nombre de députés. Une série de morts naturelles inattendues au sein de la classe politique hellène dont celles de Venizélos, de Kondylis, de Tsaldaris et de Demertzís ainsi qu’une situation politique de plus en plus incertaine conduisent à la nomination du général monarchiste Ioannis Metaxas comme Premier ministre le 13 avril.
Bientôt autorisé par le Parlement à gouverner par décrets, Metaxas doit faire face à l’opposition des communistes qui cherchent, par tous les moyens, à contrecarrer sa politique. L’incapacité des partis traditionnels à s’entendre a rendu la machine parlementaire presque totalement inefficace et les a définitivement déconsidérés. La répression sanglante de la grève des ouvriers du tabac de Thessalonique en mai 1936, plus le contexte de la guerre d’Espagne et de la guerre en Éthiopie poussent les syndicats communiste Syndicat unitaire communiste et conservateur Syndicat général des ouvriers grecs à appeler à une grève générale prévue le 5 août .
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=9275#forumpost9275
Posté le : 18/07/2015 18:37
|
|
|
|
|
Georges II de Grèce 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
La dictature de Metaxas
Ioannis Metaxas et Régime du 4-Août.
La veille de la grève générale, Metaxas convoque les membres de son cabinet et les informe de son intention de demander à Georges II de dissoudre l’Assemblée hellénique sans convoquer de nouvelles élections. Le Premier ministre souhaite également suspendre certains articles de la constitution pour établir sa dictature. Trois des ministres donnent alors leur démission mais Metaxas les fait arrêter au moment où ils s’apprêtent à quitter le siège du gouvernement.
Confronté à l’instabilité politique et à la montée du communisme, le roi se range rapidement derrière le Premier ministre et l’autorise à proclamer la loi martiale : c’est le début du Régime du 4-Août, qui dure jusqu’à la mort de Metaxas, en 1941. Tandis que la Troisième Civilisation Hellénique est proclamée, les partis politiques sont interdits et les opposants arrêtés. Une stricte censure est imposée et un Index de livres interdits, incluant les œuvres de Platon, de Thucydide et de Xénophon, est mis en place. En fait, s’il n’est pas à proprement parler fasciste, le nouveau régime qui apparaît alors en Grèce copie bien des aspects des dictatures fondées par Mussolini en Italie et Hitler en Allemagne.
Dans le système qui se met en place, Georges II perd l’essentiel de ses prérogatives et n’est plus qu’un souverain nominal. Certes, Metaxas est un monarchiste fervent et son comportement avec le roi est loin de rappeler celui de Venizélos avec Alexandre Ier. Pourtant, le monarque se méfie du dictateur, qui jouit du soutien de l’armée et qui pourrait facilement le renverser. En fait, Georges II se sent si isolé dans son pays qu’il en vient à douter de tous ceux qui l’entourent, déclarant un jour à sa cousine, la duchesse de Brunswick, qu’en Grèce il ne peut avoir confiance en personne.
Il reste qu’une fois le régime de Metaxas établi, le souverain ne se meut pas en opposant à la dictature. Au contraire, il déclare, en 1938, à l’ambassadeur du Royaume-Uni, qu’il soutient la politique de son Premier ministre. Bien plus encore, il ajoute, méprisant : les Grecs sont des Orientaux, ils considèrent la modération dans l’exercice du pouvoir comme de la faiblesse. Ils sont le peuple le plus démocrate du monde, mais une fois qu’ils prennent le pouvoir, ils deviennent automatiquement tyranniques. Tous le savent et l’acceptent.
Un souverain soucieux de sa famille
Entre réinstallation et nostalgie de l’Angleterre
Depuis son retour en Grèce, en 1935, Georges II vit dans des conditions relativement modestes, pour un monarque. Durant la période républicaine, la plupart des biens du roi et de sa famille ont été confisqués. Le palais royal d'Athènes a, par exemple, été presque entièrement vidé de ses meubles pour en faire un lieu de réceptions. Une fois la monarchie restaurée, ni le souverain ni sa parentèle ne demandent cependant à être dédommagés pour les pertes subies. Malgré tout, des travaux doivent être engagés dans les résidences royales et, l'argent manquant, Georges II décide de prendre lui-même en charge leur redécoration. Seul ou avec son frère Paul, qui vit à ses côtés jusqu'à son mariage en 1938, le roi visite ainsi les salles des ventes et les marchés afin d'y trouver les tentures et autres objets nécessaires à l'aménagement de ses appartements.
Divorcé depuis 1935, le souverain poursuit sa relation amoureuse avec Joyce Wallach mais, conscient qu'il ne peut épouser une roturière divorcée et déjà mère sans causer de grave scandale dans son pays, il ne cherche pas à rendre officielle sa liaison. La fonction royale nécessitant toutefois la présence d'une femme pour jouer, à ses côtés, le rôle de première dame, Georges II appelle auprès de lui ses sœurs Irène et Catherine, encore célibataires.
Toujours aussi anglophile, Georges II effectue des séjours réguliers au Royaume-Uni. Il se rend ainsi chaque fin d'année à Londres afin d'y retrouver ses amis et la vie qu'il menait avant la restauration. Mais s'il profite de ses voyages pour se reposer et oublier un peu la dictature de Metaxas, le roi n'en garde pas moins en mémoire ses obligations. Ses séjours à l'étranger sont en effet l'occasion de rencontres diplomatiques avec le gouvernement anglais. Ils sont également le prétexte de négociations destinées à l'acquisition, par la Grèce, d'armes et d'équipements militaires.
Le retour des dépouilles royales
Soucieux d'effacer le souvenir de l'exil et des humiliations subies par sa famille durant les années 1920-1930, Georges II décide de faire rapatrier les dépouilles de ses parents enterrées à l'étranger. En novembre 1936, il envoie ainsi le prince Paul à Florence pour y récupérer les cendres du roi Constantin et des reines Olga et Sophie, qui reposaient jusque-là dans l'église russe de la ville. Transférés en Grèce sur le navire Averoff et escortés par des evzones, les catafalques des anciens souverains sont ensuite exposés durant six jours à la cathédrale d'Athènes. Enfin, le 23 novembre, une cérémonie solennelle qui réunit tous les membres de la famille royale et d'autres membres du gotha européen est organisée pour accompagner le retour des dépouilles royales dans le mausolée de Tatoi.
Quatre ans plus tard, en 1940, Georges II obtient du gouvernement soviétique qu'il lui rende les restes de sa tante, la princesse Alexandra, morte en Russie en 1891. De cette manière, le souverain réalise la promesse faite à sa grand-mère paternelle, profondément choquée par la révolution russe et le massacre des Romanov.
Mariages princiers
Georges II n'ayant pas d'enfant et son remariage étant de moins en moins probable, c'est son frère Paul qui assume la fonction d'héritier du trône. Or, le prince a fêté ses 34 ans un mois après la restauration de la monarchie et il est toujours célibataire. La Grèce appliquant une succession semi-salique, ce serait à l'un de ses oncles Nicolas, Georges, André ou Christophe ou à l'un de ses rares cousins Pierre ou Philippe de monter sur le trône s'il décédait sans descendance. Cependant, les oncles de Georges II sont déjà âgés et ils ne jouissent pas d'une très bonne réputation dans leur pays : la figure de Nicolas reste ainsi associée à celle de son frère, Constantin Ier, et aux événements malheureux de la Première Guerre mondiale141 ; Georges a été déconsidéré par son échec en tant que gouverneur de la Crète autonome, en 1898-1906 ; l'honneur d'André a été durablement entaché par la défaite de la Grèce contre la Turquie, en 1919-1922, et par le procès des Six ; seul Christophe, l'oncle préféré du souverain, échappe à ce rejet généralisé, mais il n'est nullement intéressé par la politique et l'idée de devenir roi. Quant aux cousins de Georges II, ils connaissent très mal la Grèce, dont ils ont longtemps été éloignés par l'exil. Il est donc capital que le prince Paul contracte une union dynastique et donne le jour à un fils pour affermir le trône et assurer la continuité de la dynastie.
Après avoir vaincu les réticences de ses cousins, le duc et la duchesse de Brunswick, l'héritier du trône épouse finalement leur fille, la princesse Frederika de Hanovre, le 9 janvier 1938. La cérémonie du mariage réunit, à Athènes, une bonne partie du gotha européen mais ne soulève guère d'enthousiasme du côté de la population. Les Grecs craignent en effet l'arrivée d'une nouvelle Allemande qui plus est descendante du Kaiser Guillaume II au sein de la famille royale. Ils sont par ailleurs choqués par les dépenses occasionnées pour l'événement à un moment où l'économie nationale n'est guère florissante. Du côté des chancelleries, les épousailles princières créent également un certain malaise. Tandis que les Occidentaux s'interrogent sur l'influence que peut avoir Frederika sur l'héritier du trône et la dynastie, Adolf Hitler tente, sans succès, de profiter de la cérémonie matrimoniale pour imposer la présence de l'hymne et du drapeau nazis dans la capitale hellénique.
Mais si Georges II parvient à éviter la présence de symboles fascistes au mariage de son frère et héritier, il ne peut faire de même lors des épousailles de sa sœur Irène. Le 1er juillet 1939, la jeune femme épouse en effet le prince Aymon de Savoie-Aoste, duc de Spolète et cousin du roi Victor-Emmanuel III d'Italie. La cérémonie, qui se déroule à Florence, ne bénéficie pas du soutien du dictateur Benito Mussolini et donne lieu à des tensions entre les patries des fiancés. Désireux d’humilier la Grèce, dont il revendique une partie du territoire, le Duce interdit en effet que soit hissé le drapeau hellène dans son pays. Choqué par ce qu’il considère comme un affront, Georges II menace de boycotter la cérémonie nuptiale. Depuis Athènes, cependant, Ioannis Metaxas conseille au souverain de participer aux festivités afin d’éviter de donner une excuse à Mussolini de transformer l’affaire en incident diplomatique.
La Grèce dans la Seconde Guerre mondiale.
La guerre contre l’Italie Guerre italo-grecque.
Le 2 juin 1940, la princesse Frederika donne le jour au futur Constantin II, procurant ainsi une grande joie au souverain et à sa famille. Les festivités qui accompagnent la naissance de l'héritier du trône sont toutefois de courte durée. Au même moment, les troupes allemandes s'emparent progressivement de l'Europe et la France s'effondre sous les coups de la Blitzkrieg. Devant les succès hitlériens, l'Italie fasciste entre à son tour dans le conflit, le 10 juin. Immédiatement, Mussolini lance une violente campagne de propagande contre la Grèce, accusant le gouvernement de Georges II d'abriter des navires britanniques dans ses eaux territoriales et de violer ainsi sa propre neutralité. Quelques semaines plus tard, le 15 août, un sous-marin italien coule le croiseur grec Elli alors qu'il escorte un navire rempli de pèlerins, au large de Tinos, dans la mer Égée.
L'Épire, théâtre des opérations de la guerre italo-grecque.
Dans ce contexte difficile, la diplomatie allemande s'empresse d'intervenir auprès du gouvernement hellène pour lui proposer sa médiation avec le royaume d'Italie. En échange de l'abdication de Georges II, jugé beaucoup trop anglophile, le Troisième Reich propose non seulement à Athènes d'empêcher Rome de l'attaquer mais encore de lui octroyer les territoires qu'elle revendique depuis longtemps dans les Balkans. Averti de cette proposition, le souverain éclate dans une violente colère et fait répondre aux nazis qu' ils feraient mieux de ne pas mettre leur nez dans les affaires de son pays s'ils savent ce qui est bon pour eux ! .
Quelques mois plus tard, le 28 octobre, Mussolini transmet à Metaxas un ultimatum lui demandant d’accepter, dans les trois heures, le stationnement de troupes italiennes sur le sol hellène et l'occupation de certaines bases stratégiques. Sans surprise, le dictateur hellène refuse, déclenchant ainsi la guerre italo-grecque. Face au danger imminent, l’opposition en exil, incarnée par le général républicain Nikolaos Plastiras, proclame son soutien au gouvernement de Georges II.
Dans le même temps, à Athènes, le souverain prend la tête des forces armées. En contact permanent avec les alliés, il préside quotidiennement le conseil de guerre à l’Hôtel Grande-Bretagne, sur la place Syntagma, et visite à plusieurs reprises le théâtre des opérations, dans le nord-ouest du pays. Contrairement aux attentes de Mussolini, la Grèce se défend avec succès et parvient même à occuper le Sud de l'Albanie, pays sous domination italienne depuis 1939.
L’invasion de la Grèce par les puissances de l’Axe
L'invasion de la Grèce continentale par les forces de l'Axe, en avril 1941.
Campagne des Balkans, Bataille de Grèce et Bataille de Crète.
Alors que la guerre avec l’Italie fait rage en Épire, le général Ioannis Metaxas s’éteint le 29 janvier 1941. Pourtant, Georges II refuse de mettre en place un gouvernement d’unité nationale et nomme comme nouveau Premier ministre le gouverneur de la Banque nationale, Alexandros Korizis. L’attitude équivoque du souverain, qui maintient ainsi la dictature mise en place en 1936, contribue à ternir davantage son image et lui vaut de nombreuses critiques, tant en Grèce que du côté des Alliés.
Or, après une série de victoires grecques en Albanie, la situation militaire se dégrade avec l’invasion des Balkans par l’armée allemande. Le 6 avril 1941, la Luftwaffe déclenche en effet l’opération Châtiment qui vise à punir le gouvernement de Belgrade pour avoir renversé le régent Paul et dénoncé le pacte tripartite. C’est le début d’une campagne militaire qui aboutit au dépeçage du royaume de Yougoslavie et à l’arrivée des soldats allemands aux portes de la Grèce. Rapidement, l’armée hellénique et le corps expéditionnaire envoyé en soutien par Londres sont dépassés et Thessalonique est occupée par les Allemands le 9 avril. Le même jour, la ligne Metaxas, sorte de ligne Maginot grecque, est franchie et la IIe armée capitule face aux assauts de l’ennemi.
Dans ces conditions, les forces helléniques et alliées n’ont d’autre choix que de se retirer plus au sud. Durant sa retraite, la Ire armée grecque est prise à revers et doit offrir sa reddition aux Allemands le 20 avril. En fait, dès la mi-avril, la situation est devenue si alarmante que le Premier ministre Korizis a demandé à Georges II d’accepter la capitulation. Mais le souverain a alors éclaté dans une terrible colère et s’est opposé catégoriquement à toute forme de compromission avec l’ennemi. Ne pouvant supporter la situation, Korizis s’est suicidé à son domicile athénien le 18 avril, laissant le cabinet vacant jusqu’à la nomination d’Emmanouil Tsouderos comme chef du gouvernement, le 21 avril.
Conscient que l’arrestation de la famille royale constitue un objectif majeur pour la Wehrmacht, le souverain et son gouvernement envisagent, dès le 9 avril, de quitter la Grèce continentale pour trouver refuge en Crète. Mais l’île étant également vulnérable aux attaques allemandes, Georges II demande officiellement au gouvernement britannique l’autorisation de s’installer à Chypre avec son cabinet et 50 000 recrues grecques. De là, une contre-offensive pourrait en effet être facilement organisée en direction du Dodécanèse italien. Dans un premier temps, la Grande-Bretagne semble acquiescer. Cependant, le Colonial Office ne tarde pas à s’opposer à ce qui lui apparaît comme une tentative déguisée de réaliser l’énosis, autrement dit l’annexion de l’île par la Grèce et c’est donc la Crète qui est choisie comme situation de repli par le gouvernement.
Le 22 avril, la majeure partie de la famille royale est évacuée en Crète mais le roi et le diadoque Paul restent à Athènes jusqu’au lendemain. Georges II établit alors son quartier-général à La Canée, où il fait de son cousin, le prince Pierre, son aide de camp personnel. Après le début de l’attaque aérienne allemande sur la Crète, le 20 mai, le souverain et son gouvernement doivent tout de même se résoudre à évacuer l’île. Gratifié du titre d’ennemi numéro 1 du Reich en Grèce par Hitler, le roi échappe de peu aux parachutistes allemands et parvient à rejoindre un navire britannique à Chóra Sfakíon. Avec son cousin et son fidèle écuyer, le major Dimitrios Levidis, il gagne alors Alexandrie, où il retrouve le reste de la famille royale, réfugiée en Égypte depuis la fin avril. Le courage dont le souverain fait preuve durant ces événements lui vaut tout de même d’être le seul monarque de l’histoire à être décoré de l’ordre du Service distingué.
L’occupation de la Grèce et l’exil
L'occupation tripartite de la Grèce par les troupes de l'Axe entre 1941 et 1944. On peut voir sur cette carte les régions occupées par l'Allemagne en rouge, par la Bulgarie en vert et par l'Italie en bleu. Le Dodécanèse, italien depuis 1911, apparaît quant à lui en bleu foncé.
Occupation de la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, État grec 1941-1944, Gouvernement grec en exil et Résistance grecque.
Tandis qu'à Athènes un gouvernement grec collaborateur est mis en place par les occupants, en Égypte, la présence des Oldenbourg indispose fortement Farouk Ier et ses ministres pro-Italiens. La famille royale grecque doit donc chercher un autre lieu de refuge pour passer la guerre et poursuivre sa lutte contre les forces de l'Axe. Le souverain britannique s'opposant à la présence de la princesse Frederika et de ses enfants dans son pays, il est finalement décidé que Georges II et son frère Paul pourraient s'installer à Londres mais que le reste de la famille royale devrait s'établir en Afrique du Sud jusqu'à la fin du conflit.
Après un bref séjour au Cap, Georges II s'installe avec son gouvernement dans la capitale anglaise. Accompagné de sa maîtresse et du major Dimitrios Levidis, le souverain établit sa résidence à l'hôtel Claridge's de Mayfair. En contact permanent avec Winston Churchill et le cabinet britannique, Georges II organise, avec Tsouderos, la lutte des armées grecques libres au Moyen-Orient mais cherche également à épurer les forces helléniques de leurs éléments vénizélistes et communistes. Or, en agissant de cette manière, le souverain provoque la colère des groupes républicains, qui organisent plusieurs mutineries au sein des forces terrestres et navales grecques, manquant ainsi d'affaiblir l'effort de guerre allié en Afrique du Nord et au Levant.
Sous la pression des Britanniques et de l’opposition républicaine, le roi et son cabinet émettent, le 22 octobre 1941, un décret qui jette les bases d'un nouveau régime parlementaire. Cependant, ce n’est que le 4 février 1942 que la dictature établie par Metaxas en 1936 est totalement abolie. Un mois plus tard, en mars, Georges II et Tsouderos retournent en Égypte afin d’y rencontrer les forces armées et de normaliser leurs relations avec les combattants hellènes. Les deux hommes restent dans le pays jusqu’en juin mais leur voyage rencontre un succès mitigé. Après un bref séjour aux États-Unis, où il rencontre le président Franklin Delano Roosevelt, le souverain retourne à Londres puis au Caire, où son gouvernement s’installe finalement à partir de mars 1943.
Pendant ce temps, dans la Grèce occupée, la résistance s’organise. Tandis que la gauche, et surtout les communistes, offre son soutien au Front de libération nationale EAM et à son Armée populaire de libération nationale ELAS, les vénizélistes et les libéraux intègrent plutôt la Ligue nationale démocratique grecque EDES. Or, malgré leurs tendances clairement républicaines, ces deux mouvements reçoivent le soutien du gouvernement britannique et de ses services secrets, ce qui n’est pas sans causer la fureur de Georges II.
Un roi mis à l’écart
ADamaskinos d'Athènes, Geórgios Papandréou et Nikolaos Plastiras.
La Libération approchant, la perspective de retour de Georges II en Grèce provoque de plus en plus de dissensions au sein des résistants de l’intérieur comme de l’étranger. Bien que le souverain ait officiellement promis, lors d’une émission de radio, le 4 juillet 1943, de restaurer la constitution de 1911 et d'organiser des élections libres dans les six mois suivant sa restauration, de nombreux Grecs ne lui font plus confiance et s'opposent à son retour. Or, avec la reddition des forces italiennes le 8 septembre 1943, les communistes grecs s'emparent des armes de l'occupant, gagnant ainsi en importance dans le camp allié.
Les mois passant, de plus en plus de voix demandent au souverain de conditionner son retour à la tenue d'un référendum et de nommer un régent pour assurer la transition, une fois le pays libéré. Bientôt, le nom de l'archevêque-primat de l'Église grecque s'impose, tant du côté des Alliés que de la résistance nationale. Or, monseigneur Damaskinos est bien connu pour ses opinions républicaines et Georges II s'oppose avec force à sa nomination à la tête de l'État. Devant l'entêtement du souverain, un gouvernement rival mené par les communistes, le Comité politique de libération nationale ou PEEA, est mis en place dans la Grèce occupée en mars 1944. Peu de temps après, une mutinerie pro-EAM éclate parmi les forces grecques libres afin de renverser le roi et son gouvernement.
Afin d'apaiser les esprits, Georges II n'a alors d'autre choix que d'accepter la démission de Tsouderos, le 8 avril 1944, et de le remplacer par le libéral Sophoklis Venizélos. Une fois la mutinerie réprimée et ses responsables arrêtés, le nouveau Premier ministre est cependant remplacé par un autre libéral, Georges Papandréou, qui nomme à ses côtés plusieurs ministres républicains. Quelques semaines plus tard, en mai 1944, une conférence de trois jours est organisée au Liban afin d'y discuter du sort de la Grèce une fois les forces de l'Axe chassées. À la suite de cette conférence, Papandréou demande à Georges II d'attendre la tenue d'un référendum pour rentrer à Athènes. N'ayant pas d'autre alternative, le souverain accepte.
En novembre 1944, le territoire national est totalement libéré et les exilés grecs regagnent leur foyer, sans que ni Georges II ni la famille royale ne puissent faire de même. Le monarque doit par ailleurs accepter, sous la pression de Churchill et d'Eden, de nommer régent monseigneur Damaskinos le 29 décembre 1944. Or, l'archevêque-primat forme immédiatement un gouvernement à majorité républicaine et place le général Nikolaos Plastiras à la tête du cabinet. Humilié, malade et sans plus aucun pouvoir, Georges II envisage d'abdiquer en faveur de son frère mais décide finalement de n'en rien faire. Persuadé que les portes de la Grèce lui sont à jamais fermées, il achète une maison à Chester Square, à Londres, et s’y retire avec sa maîtresse anglaise, Joyce Wallach.
Un difficile retour en Grèce Entre restauration et guerre civile
Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, la situation politique reste très tendue en Grèce, où des violences opposent communistes, modérés et forces britanniques commandées par le général Ronald Scobie. Après plusieurs mois d'instabilité, des élections finissent tout de même par être organisées, le 3 mars 1946, sous l'égide d'observateurs britanniques, français et américains. Le Parti populaire royaliste obtient alors une nette majorité au parlement et un référendum sur la monarchie est programmé par le nouveau gouvernement de Konstantinos Tsaldaris. Entre-temps, les registres électoraux sont contrôlés sous la supervision des Alliés.
Finalement, lorsque le référendum est organisé, le 1er septembre suivant, les résultats officiels indiquent que 90 % des électeurs ont voté et que, parmi ceux-ci, 69 % ont exprimé leur désir de voir le roi revenir à la tête de l'État. L'interprétation la plus souvent proposée est que le retour du roi est, aux yeux de la population, la moins mauvaise des solutions, dans un contexte de découragement politique généralisé. Quatre jours plus tard, Tsaldaris se rend à Londres afin d'y inviter Georges II à revenir en Grèce. Une fois ses affaires réglées, le souverain quitte le Royaume-Uni à bord d'un avion, le 27 septembre, et arrive le jour même près d'Éleusis, où il retrouve le diadoque Paul et son épouse Frederika. De là, le monarque et sa parentèle gagnent Phalère puis Athènes, où ils sont reçus par une foule en liesse et par un Te Deum célébré par monseigneur Damaskinos.
Malgré tout, le retour des Oldenbourg dans leur patrie d'origine ne suffit pas à faire oublier les souffrances de la population grecque. Le pays est totalement dévasté, les résidences royales ont été pillées et saccagées et une violente guerre civile, opposant communistes et monarchistes, frappe le nord du pays depuis la proclamation de la restauration de la monarchie.
L’annexion du Dodécanèse
Carte du Dodécanèse italien.
Le palais royal d'Athènes ayant été très endommagé par la guerre, Georges II s'installe dans la résidence construite pour son père à l'occasion de son mariage. Il y retrouve bientôt la plus jeune de ses sœurs, la princesse Catherine, qui reprend, auprès de lui, le rôle d'hôtesse de la monarchie qu'elle avait déjà tenu dans les années 1930. Dans un pays toujours frappé par le rationnement, la famille royale mène un train de vie modeste et le souverain passe la majeure partie de ses journées à travailler dans son bureau, ouvrant consciencieusement tous les courriers qui lui sont adressés.
Tandis que la guerre civile frappe toujours le nord du pays, le traité de Paris du 10 février 1947 permet à la Grèce d'annexer les îles du Dodécanèse, possession de Rome depuis la Guerre italo-turque de 1911-1912. Georges II nomme alors comme premier gouverneur de l'archipel l'amiral Periklís Ioannídis, deuxième époux de sa tante, la princesse Marie de Grèce. Malgré le vote, en 1944, d'une résolution du sénat américain en ce sens, le royaume hellène n'obtient par contre pas la cession de l'Épire du Nord, qui reste sous l'administration de l'Albanie.
Une disparition inattendue
Alors que la famille royale s'apprête à célébrer le mariage de la princesse Catherine de Grèce avec le major britannique Richard Brandram, la santé de Georges II décline, sans que ses médecins s'en inquiètent. Le 31 mars 1947, le roi assiste à une représentation d’Henry V, à l'ambassade britannique, à l'occasion d'un gala de charité. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, il déclare à un domestique qu'il se sent fatigué et est retrouvé inconscient quelques minutes plus tard dans son bureau. À quatre heures, la radio grecque annonce que le monarque vient de décéder d’artériosclérose. La nouvelle est si soudaine que certains croient d’abord à un poisson d'avril, avant de se rendre à l’évidence.
Georges II est enterré quatre jours plus tard dans le mausolée royal du palais de Tatoï. Son frère cadet lui succède à la tête du pays sous le nom de Paul Ier.
Bilan du règne
Le règne de Georges II a été assombri par une série de graves crises politiques, sociales et militaires qui ont fait dire un jour au souverain que « le seul instrument nécessaire à un roi de Grèce est une valise »91,186. De fait, si l’on considère que Georges II n’a jamais abdiqué et qu’il a été de jure roi des Hellènes de 1922 à 1947, alors on constate qu’il n’a réellement gouverné la Grèce que durant sept de ses vingt-cinq années de règne théorique. Le pouvoir du souverain a en outre été étroitement limité par la dictature instituée par Ioannis Metaxas à partir de 1936 et qui a duré au moins jusqu’en 1941. Pourtant, l’acceptation tacite du régime du 4-Août par le monarque a fortement contribué à affaiblir sa réputation et celle de la famille royale à un moment où le communisme se développait en Grèce.
Ordres et décorations Créations de Georges II
En janvier 1936, le roi Georges II fonde les ordres des Saints-Georges-et-Constantin et des Saintes-Olga-et-Sophie. Il s'agit là d'ordres dynastiques créés en l'honneur de ses parents Constantin Ier et Sophie de Prusse)et de ses grands-parents Georges Ier et Olga de Russie.
Décorations reçues par Georges II
En 1909, il est fait chevalier grand-croix de l’ordre royal de Victoria GCVO par le roi Édouard VII.
En 1913, le Kaiser Guillaume II d’Allemagne, lui confère l’ordre de l’Aigle rouge avec des épées.
En 1935, le roi Victor-Emmanuel III d'Italie confère l’ordre de l’Annonciade au souverain à l’occasion de sa restauration sur le trône hellénique.
En 1941, Georges II est décoré par le gouvernement britannique de l’Ordre du Service distingué pour le courage qu’il a montré sous le feu de l’ennemi. Il est le premier et le seul souverain à avoir jamais reçu cette décoration.
En 1942, le roi reçoit également de son cousin Haakon VII la Croix de Guerre norvégienne.
Georges II dans la culture populaire Dans la propagande de guerre
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés utilisent la figure de Georges II comme instrument de propagande afin de renforcer le sentiment patriotique grec. Plusieurs courts-métrages centrés sur le souverain et son gouvernement sont ainsi tournés, comme Heroic Greece! de l'Américain Frank Norton 1941.
À la télévision
La relation amoureuse du roi Georges II et de sa maîtresse, surnommée Mrs Brown, est évoquée brièvement dans le troisième épisode The New King de la mini-série britannique Edward and Mrs. Simpson, qui met en scène la croisière du roi Édouard VIII du Royaume-Uni et de Wallis Simpson dans les îles grecques, en 1936190.
En musique
À l’occasion de la restauration de Georges II, en 1935, le chanteur de rebetiko Markos Vamvakaris a écrit la chanson Nous te souhaitons la bienvenue, Roi en grec : Καλώς μας ήρθες Βασιληά.
En philatélie
Différents timbres à l'effigie de Georges II ont été émis par la Poste grecque durant son règne. Une série de quatre timbres représentant le souverain a ainsi été éditée, peu de temps après sa restauration sur le trône, le 1er novembre 1937, avec des valeurs faciales de 1, 3, 8 et 100 drachmes192.
En numismatique Pièces de monnaie grecques.
Différentes pièces de monnaie à l'effigie de Georges II ont été émises par la banque nationale de Grèce. Parmi celles-ci, on trouve :
une série de pièces commémoratives frappées en 1940 afin de célébrer le cinquième anniversaire de la restauration du roi pièces de 20 et de 100 drachmes de cuivre, d'argent et d'or mentionnant la date du 25 novembre 1935 ;
une pièce de 30 drachmes d'argent mise en circulation en 1963 à l'occasion du centenaire de la monarchie grecque et montrant les portraits des rois Georges Ier, Constantin Ier, Alexandre Ier et Georges II et Paul Ier.
Arbres généalogiques
Georges II et les monarchies balkaniques
Quartiers du souverain
Quartiers de Georges II
Bibliographie Sur Georges II
Ricardo Mateos Sainz de Medrano, Jorge II: una vida de contratiempos, dans La Familia de la Reina Sofίa, La Dinastίa griega, la Casa de Hannover y los reales primos de Europa, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, p. 182-193
Panayótis Pipinélis, Γεώργιος Β’, Athènes, Στέγη του Βιβλίου, 1951
Dwight Wales Beach, The Question of the Return of King George II of Greece 1941-1946, Cincinnati, University of Cincinnati, 1974
Sur la famille royale de Grèce en général
Panagiotis Dimitrakis, Greece and the English, British Diplomacy and the Kings of Greece, Londres, Tauris Academic Studies, 2009
Michael of Greece, Arturo B. Eéche et Helen Hemis-Markesinis, The Royal Hellenic dynasty, Eurohistory, 2007
Alan Palmer et Michael of Greece, The Royal House of Greece, Weidenfeld Nicolson Illustrated,
Ricardo Mateos Sainz de Medrano, La Familia de la Reina Sofίa, La Dinastίa griega, la Casa de Hannover y los reales primos de Europa, Madrid, La Esfera de los Libros, 2
John Van der Kiste, Kings of the Hellenes: The Greek Kings, 1863-1974, Sutton Publishing, 1994
Sur les membres de la famille royale de Grèce
Célia Bertin, Marie Bonaparte, Paris, Perrin, 1982
Julia Gelardi, Born to Rule: Granddaughters of Victoria, Queens of Europe, Headline Review, 2006
Hugo Vickers, Alice, Princess Andrew of Greece, Londres, Hamish Hamilton, 2000
Sur la famille royale de Roumanie
Hannah Pakula, The Last Romantic: A Biography of Queen Marie of Roumania, Weidenfeld & Nicolson History, 1996
Regina Maria a Romaniei, Însemnari zilnice, vol. 3, Editura Historia, 2006
John Wimbles, Elisabeta of the Hellenes: passionate woman, reluctant queen (série d'articles en 4 parties, Royalty Digest, vol. 12#5, 12#6, 12#7 et 13#1, no 137,138, 139 et 145, 2002 et 200
Sur l'histoire de la Grèce
Anthony Beevor, Crete : The Battle and the Resistance, Athènes, Govostis Publications, 2003
Christopher Buckley, Greece and Crete 1941, Londres, P. Efstathiadis & Sons S.A., 1984
D. J. Cassavetti, Hellas and the Balkan Wars, Londres, Fisher Unwin, 1914
Richard Clogg, A Short History of Modern Greece, Cambridge, University Press, 1992
Georges Contogeorgis, Histoire de la Grèce, Hatier, 1992
Édouard Driault et Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, t. V, PUF, 1926
S. Victor Papacosma, The Military in Greek Politics : The 1909 Coup d'Etat, Kent (Ohio), Kent State University Press, 1977, 254 p.
Apostolos Vacalopoulos, Histoire de la Grèce moderne, Horvath, 1975
Panayiotis J. Vatikiotis, Popular Autocracy in Greece, 1936-41 : A Political Biography of General Ioannis Metaxas, Frank Cass Publishers, 1998
Autres ouvrages
A. Karamitsos, Hellas stamp catalogue, vol. 1, 2008
Milica Zarkovic Bookman, The demographic struggle for power: the political economy of demographic engineering in the modern world, Routledge, 1997             
Posté le : 18/07/2015 18:35
|
|
|
|
|
La constitution civile du clergé |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 12 juillet et 24 août 1790 vote de La Constitution civile du clergé.
est un décret adopté en France par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790. Sanctionnée par Louis XVI le 24 août 1790, elle devient la loi des 12 juillet et 24 août 1790. Elle réorganise le clergé séculier français, et provoque la division de celui-ci en clergé constitutionnel et clergé réfractaire. La Constitution civile du clergé est une série de décrets sur la Constitution civile du clergé dans le royaume de France. L' adoption par l'Assemblée nationale constituante prise le 12 juillet 1790 et sanctionnée par Louis XVI le 24 août 1790.
Elle sera condamnée par le pape Pie VI et abrogée par le Concordat de 1801.
Le clergé constitutionnel en bref.
Au sens strict, les constitutionnels ne comprennent que les fonctionnaires publics ecclésiastiques : évêques, curés et vicaires décret du 27 nov. 1790 ; prédicateurs 27 mars 1791 ; chapelains et aumôniers d'hôpitaux et de prisons 15-17 avr.. Les assermentés englobent les religieux non astreints au serment de 1790 et les ralliés tardifs, y compris les jureurs de Liberté-Égalité 14 août 1792. C'est ce dernier serment qui a valeur d'adhésion à l'Église constitutionnelle aux colonies et dans certains pays conquis par exemple, le Mont-Terrible. En France, des soumissionnaires de 1792 refusent l'assimilation : ainsi, Monsieur Émery, supérieur général de Saint-Sulpice. Les promesses de fidélité à l'État, après Thermidor, ne préjugent de rien, sauf pour des laïcs ordonnés prêtres par des évêques constitutionnels après 1796.
La Constitution civile du clergé avait deux objectifs principaux : un remaniement de la carte des diocèses ultérieurement des paroisses, qu'on estimait devoir réduire de 41 000 à 35 000 et le règlement de la procédure électorale concernant les évêques et curés fonctionnaires. Partout on simplifie : 1 diocèse par département et, pour les 83 diocèses dont on remodèle les territoires, 10 métropoles au lieu de 18 en 1789. Les sièges métropolitains sont désignés par le nom de leur arrondissement jusqu'en 1797. Aux 83 diocèses de 1790 viendront s'ajouter en 1793 ceux d'Annecy, pour le département du Mont-Blanc, et d'Avignon pour celui de Vaucluse. La procédure électorale est définie par le titre II de la Constitution, le plus controversé par les milieux romains. À l'instar des fonctionnaires laïcs décret du 22 déc. 1789, les évêques sont élus sur le mode des assemblées départementales, les curés sur celui des districts : présentation de deux candidats ; majorité absolue des suffrages au premier tour, majorité relative aux tours suivants ; élection du plus âgé en cas d'égalité. Des conditions canoniques sont exigées des candidats : 10 ans de service paroissial pour les futurs évêques, 5 pour les curés. L'investiture canonique est soumise au métropolitain archevêque, qui ne peut la refuser qu'après en avoir délibéré avec tout le clergé de son Église art. 16 ; de même l'évêque doit-il en référer à son Conseil pour l'investiture des curés élus par scrutins séparés pour chaque cure vacante art. 28. En aucun cas, il ne pourra y avoir de recours que de l'évêque au synode diocésain et du métropolitain au synode de la métropole titre I, art. 5.
Dans la pratique, la prestation des serments commence en janvier 1791, le plus souvent à l'issue de la messe paroissiale et en présence des autorités civiles, cependant que les premières consécrations épiscopales ont lieu, le 24 février, en l'église de l'Oratoire : ainsi sont sacrés Expilly, évêque du Finistère, et Marole, évêque de l'Aisne ; le prélat consécrateur est Talleyrand ; le rituel est parfaitement observé et tous les actes seront notariés. La mise en place de la nouvelle Église se heurte à deux obstacles : d'une part, les lenteurs de l'administration départementale à voter les crédits nécessaires, spécialement pour les séminaires diocésains ; de l'autre, la confusion jetée dans les rangs des jureurs par la réaction romaine. Après huit mois de silence, le pape condamne sans appel la Constitution civile, par les brefs Quod aliquantum et Charitas 10 mars-13 avr. 1791. Il s'ensuit, au cours de l'été, un reflux d'assermentés : les uns se rétractent purement et simplement, les autres, semi-constitutionnels, déclarent refuser tout contact, pour les matières spirituelles, avec le nouvel évêque jugé intrus. Il est donc hasardeux, en l'absence de pointages précis, de dresser une carte des serments pour l'ensemble de la France ; tout au plus voit-on des majorités de constitutionnels se dessiner dans le Bassin parisien, le couloir rhodanien, une partie du Sud-Ouest et quelques régions du Massif central et des Pyrénées. Nombre de paroisses restant sans candidat, il faudra enfreindre les textes pour les pourvoir : abrogation des stages préalables, recours aux religieux, nomination de desservants au lieu de l'élection, acceptation de prêtres venant d'un autre département.
La vague terroriste de l'an II opère une première décantation : sous de multiples pressions, les prêtres abdiquent leur état et quelques-uns se marient ou font semblant. Les jeunes résistent souvent mieux que leurs aînés et le pourcentage des mariages demeure faible de l'ordre de 5 à 6 p. 100, semble-t-il. Il n'empêche qu'une foule de prêtres, en situation irrégulière, demandent leur réconciliation, dès 1795. C'est l'époque d'une décisive réorganisation de l'Église constitutionnelle sous l'égide d'un comité des évêques réunis. Ceux-ci se montreront plus sévères que les réfractaires dans les réconciliations, qui dureront jusque sous l'Empire : le cardinal Caprara dispensera 3 224 absolutions, d'après les dossiers présentés, mais jamais en faveur d'un prêtre marié. De 1795 à 1801, l'Église constitutionnelle se dote de nouvelles structures, grâce aux synodes, et procède à une profonde mise à jour » de la discipline, de la morale et de la liturgie catholique en réunissant deux conciles nationaux 1797 et 1801. On compte, au moment du Concordat, environ 15 000 constitutionnels qui desservent plus de 30 000 paroisses. Bernard Plongeron
Histoire de la loi.
Le Comité ecclésiastique de l'Assemblée constituante
Article détaillé : Comité ecclésiastique.
À la suite de la Nuit du 4 août 1789, l'ordre du clergé, premier ordre en dignité de la société d'Ancien Régime, disparaît en tant que corps politique.
À l'automne 1789 commencent à la Constituante les débats sur la nouvelle organisation de l'Église de France. Le comité ecclésiastique, présidé par Treilhard, est chargé d'élaborer un projet. Trois membres du comité, avocats de tendance janséniste, sont plus spécialement concernés par son élaboration : Louis-Simon Martineau comme rapporteur, Camus et Lanjuinais comme défenseurs. Ils sont persuadés de leur droit à réformer l'Église. Dans la lignée des libertés gallicanes, ils veulent œuvrer indépendamment du pape. Enfin, ils ont l'ambition de réformer le clergé pour revenir à la pureté de l'Église primitive en s'inspirant du richérisme, doctrine ecclésiologique très implantée dans le bas-clergé, qui prône le gouvernement démocratique des communautés paroissiales et diocésaines.
Le rapport de Martineau, légèrement amendé, est voté le 12 juillet 1790 : il devient la Constitution civile du clergé. Louis XVI promulgue le décret le 24 août 1790.
Le nouveau règlement
Le texte comporte quatre titres :
Des offices ecclésiastiques ;
Nomination aux bénéfices ;
Traitements et pensions ;
De la résidence.
Les offices ecclésiastiques
Les diocèses et paroisses sont profondément remaniés, sur la base d'un diocèse par département : de cent trente, leur nombre est réduit à quatre-vingt-trois, et une restructuration des paroisses est projetée. Les diocèses sont regroupés, au lieu des quatorze provinces, en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges sont à Paris, Rouen, Reims, Besançon, Lyon, Aix, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Bourges.
Nombre des anciens offices ecclésiastiques sont supprimés, comme les chanoines, prébendiers ou chapelains, sans charge d'âme. Les évêques s'entourent de vicaires épiscopaux qui, avec les directeurs et supérieurs du séminaire diocésain, forment le conseil qui doit donner son accord pour les actes de juridiction en rapport avec le gouvernement du diocèse.
La nomination aux bénéfices
Les évêques sont élus par l'assemblée des électeurs du département4 et les curés par celle des électeurs du district, que les électeurs professent la religion catholique ou non. L'amendement proposé par l'abbé Grégoire, stipulant que les catholiques soient seuls électeurs, sera repoussée.
Le texte conserve la distinction entre la nomination, c'est-à-dire la désignation du titulaire, et l'institution canonique, laquelle confère la juridiction. Cependant, si l'évêque conserve l'institution des curés, il est lui-même institué non plus par le pape, mais par le métropolitain ou le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain. Le pape n'est plus qu'un chef visible de l'Église universelle, auquel il peut écrire en gage d'unité de foi et de communion dans le sein de l'Église catholique.
Avant leur sacre, les évêques doivent prêter le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse …, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée Nationale et acceptée par le roi. Les curés devront faire de même, un dimanche, avant la grand-messe.
Des officiers civils
Les ecclésiastiques – évêques et curés – perçoivent un traitement de l'État. Le traitement de l'archevêque de Paris est de 50 000 livres, celui des autres évêques de 20 000 livres. Les vicaires épiscopaux reçoivent entre 8 000 et 2 000 livres. Les curés entre 6 000, pour les cures de Paris, et 1 200 livres, pour les cures les moins peuplées.
Tous les religieux – évêques, prêtres, moines, moniales – ont des droits civiques qui les autorisent à quitter leurs postes ou leurs communautés monastiques.
Un ecclésiastique ne peut être maire, officier municipal ou conseiller général. Il est cependant électeur et éligible à l'Assemblée nationale.
Avant cette loi, les membres du clergé étaient soumis à la juridiction interne de l'Église, qui les astreignait au célibat, les empêchait de léguer leurs biens à leur famille et d'habiter où bon leur semblait, et les soumettait à des tribunaux ecclésiastiques, appelés officialités.
En français moderne, la loi aurait pu être appelée loi de réorganisation de l'Église et donnant statut de citoyen-fonctionnaire-élu aux membres du clergé. Compromis entre les tendances gallicanes, jansénistes et richéristes, la Constitution civile du clergé, tout en souhaitant établir l'indépendance, sauf en matière doctrinale, de l'Église de France à l'égard de la papauté, la soumet à l'État. Pour Pierre de la Gorce : Peu d'actes ont aussi mal résisté au temps. Vu à distance, celui-ci ne répond à aucune conception nette.
La controverse
Le 29 mars 1790, le pape Pie VI tient un consistoire secret, au cours duquel il dénonce particulièrement la sécularisation des biens ecclésiastiques et la suppression des vœux de religion. Le cardinal de Bernis, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, obtient que cette allocution ne soit pas publiée. Il s'en félicite dans ses dépêches à Montmorin tout en précisant : Si on continue à traiter si durement l'Église de France, je ne saurais répondre à la longue de la patience du chef de l'Église catholique.
Dans les mois qui suivent, la préparation de la Constitution civile du clergé est suivie avec anxiété aussi bien à Rome que par Louis XVI. Ce dernier sollicite les avis de deux de ses ministres : Lefranc de Pompignan, ancien archevêque de Vienne, et Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux. Se faisant les porte-parole de leurs confrères, dont la plupart siègent à l'Assemblée nationale, ils conseillent au roi de ne pas s'opposer à l'Assemblée et de rechercher un compromis avec Pie VI. Cependant, le pape écrit le 9 juillet 1790 à Louis XVI : Nous devons vous dire avec fermeté et amour paternel que, si vous approuvez les décrets concernant le Clergé, vous induirez en erreur votre Nation entière, vous précipiterez votre Royaume dans le schisme et peut-être dans une guerre civile de religion. Le 10 juillet, des brefs de Pie VI demandent au roi de refuser la Constitution. Ceux-ci sont remis à Louis XVI le 23 juillet. Or, la veille, celui-ci a annoncé qu'il accepterait les décrets. Croyant le Pape mal informé des affaires de France - celui-ci est en effet conseillé par le cardinal de bernis, fort prévenu contre le nouvel ordre des choses - et persuadé de l'urgence, Louis XVI sanctionne et promulgue les décrets le 24 août 1790.
Dès le mois d'août, Mgr Asseline, évêque de Boulogne, publie une réfutation de la Constitution civile, à laquelle adhèrent quarante évêques. En octobre, Boisgelin, archevêque d'Aix, publie ses Observations sur le serment prescrit aux ecclésiastiques et sur le décret qui l'ordonne. Tous les évêques de France adhèrent à ce texte, qui est envoyé au pape. Un très grand nombre de publications s'attachent à défendre ou à combattre la Constitution civile. Pour les uns, elle est une œuvre indispensable pour mettre fin aux abus : elle permet un retour à la pureté et à la simplicité de l'Église primitive, et elle correspond aux vœux de la Nation souveraine. Pour les autres, l'assemblée a commis un abus de pouvoir en remodelant les circonscriptions ecclésiastiques. Celles-ci n'établissent pas un pouvoir sur un territoire mais sur des âmes. Or, ce pouvoir sur les âmes ne peut être conféré que par l'Ėglise. Le concordat de Bologne avait été établi par deux parties : le roi et le pape. Mais ce dernier n'a pas été consulté. Enfin, la Constitution est schismatique : le sacre ne donne pas à l'évêque une mission et un pouvoir de juridiction, laquelle ne peut lui être conférée que par l'Institution canonique. Cependant, en réduisant celle-ci à une formalité, puisque c'est le président de l'assemblée électorale qui proclame l'élu évêque titre II, art. 14 et non les autorités légitimes, le lien avec le pape et l'Église est rompu. Ce qui fait écrire à Boisgelin : Nous ne pouvons pas transporter le schisme dans nos principes.
Le serment à la Constitution civil Le serment obligatoire
Le 26 novembre, Voidel, député de la Moselle, dénonce la formation d'une ligue contre la Constitution civile. Il propose le serment, le besoin indispensable de régénérer l'église de France. Le décret est voté. Le Roi doit le sanctionner le 26 décembre 1790, ayant vainement espéré des concessions de la part du Pape, ce dernier ayant accepté, dix ans plus tôt, la réforme de l'Église d'Autriche opérée de façon autoritaire et unilatérale par l'empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette.
Par décret de l'Assemblée nationale, et conformément à la constitution civile du clergé en date du 24 août 1790, tous les ecclésiastiques prêteront le serment exigé un jour de dimanche après la messe, en présence du conseil général de la commune et des fidèles. Ceux qui ne le prêteront pas seront réputés avoir renoncé à leur office et il sera pourvu à leur remplacement.
Le serment était le suivant :
Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse ou du diocèse qui m'est confiée, d'être fidèle à la Nation, à la Loi, au Roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi.
Le serment oblige prêtres et évêques à maintenir la nouvelle organisation du clergé. Pour les deux cent cinquante officiers ecclésiastiques membres de l'assemblée, le serment doit être prêté dans les huit jours, soit le 4 janvier 1791 au plus tard. À la suite de l'abbé Grégoire, cent cinq députés prêtent serment à la barre. Enfin, le 4 janvier 1791, malgré la pression des tribunes, quatre seulement jurent. En tenant compte des rétractations, ce sont quatre-vingt-dix-neuf députés ecclésiastiques qui prêtent le serment.
Le 7 janvier commencent les prestations de serment dans les provinces. Elles sont échelonnées tous les dimanches, de janvier et février 1791, à des dates différentes selon les diocèses. La quasi-totalité des évêques, sauf quatre, et la moitié des curés, refusent alors de prêter serment.
Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution. Plat commémoratif de la Constitution civile du clergé 1790. Musée Carnavalet.
Réponse officielle du pape Pie VI
Le pape Pie VI, qui ne répond pas durant des mois aux demandes pressantes de l'ambassadeur de France, fait connaître sa réponse officielle par les brefs Quod aliquantum, du 10 mars 1791, et Caritas, du 13 avril 1791. Il demande aux membres du clergé n'ayant pas encore prêté serment de ne pas le faire, et à ceux qui ont déjà prêté serment de se rétracter dans l'espace de quarante jours. Les élections épiscopales et paroissiales sont déclarées nulles et les consécrations d'évêques sacrilèges. La publication des brefs est interdite, mais ceux-ci circulent clandestinement et sont largement connus.
Malgré les nombreuses rétractations de prêtres assermentés au sein de l'Église de France, une situation de schisme divise le clergé en prêtres constitutionnels, désignés comme intrus, et prêtres insermentés, désignés comme réfractaires. La rupture entre la Révolution et l'Église catholique semble inévitable.
Par souci d'apaisement, et en application de la liberté religieuse affirmée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur proposition de Talleyrand et Sieyès, l'Assemblée constituante vote le 7 mai 1791 un décret qui donne le droit aux prêtres insermentés de célébrer la messe dans les églises constitutionnelles. Les catholiques qui refusent la nouvelle église ont la possibilité de louer des édifices pour le culte.
Assermentés et insermenté
On appelle insermentés les prêtres qui refusent de prêter serment à la Constitution civile du clergé. La quasi-totalité des évêques sauf cinq et une grosse moitié des curés seront des prêtres réfractaires.
On appelle assermentés – ou jureurs ou intrus – les prêtres qui prêtent serment à la Constitution civile du clergé. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Henri Grégoire, Yves Marie Audrein sont les premiers à appartenir au clergé constitutionnel. Le premier évêque constitutionnel est Louis-Alexandre Expilly de La Poipe, recteur curé de Saint-Martin-des-Champs près de Morlaix, élu député du clergé en août 1788, et qui préside ensuite à l'Assemblée constituante la commission qui rédige la Constitution civile du clergé. Il est sacré évêque de Quimper à Paris par Talleyrand, lui-même évêque, en 1790, avant d'être guillotiné le 22 mai 1794.
Typologies des prestations de serment
Avec l'historien Jean de Viguerie, on peut distinguer six manières de prêter le serment :
le serment prêté purement et simplement ;
le serment d'abord refusé puis prêté ;
le serment prêté avec restriction ou avec rétractation partielle – ainsi Bernard Bellegarrigue, curé de Born dans la Haute-Garonne, jure le 13 mars 1791 en précisant D'après l'instruction de l'Assemblée Nationale qu'elle n'entend porter aucune atteinte à la religion catholique, apostolique et romaine.
le serment prêté puis entièrement rétracté ;
le refus avec explication, souvent fondé sur l'argument de l'impossibilité en conscience ;
le refus pur et simple.
En fonction de la position hiérarchique
L'historien américain Timothy Tackett note que la proportion de réfractaires était, dans le haut clergé évêques, très supérieure à celle observée dans le bas clergé prêtres et vicaires. Il note par ailleurs que les vicaires étaient statistiquement davantage réfractaires que les curés.
En fonction de la géographie
En général, les régions périphériques seront davantage réfractaires. Cela pourrait être lié aux différences culturelles, soulignées par l'usage encore très répandu de langues régionales : par exemple, en Bretagne, avec 20 % de jureurs ou en Alsace, avec seulement 8 % de jureurs dans le Bas-Rhin. Dans ce contexte, on peut aussi citer le Nord, la Lorraine, le Languedoc et l'Auvergne. Cela pourrait peut-être aussi s'expliquer du fait d'une certaine méfiance vis-à-vis des décisions de la capitale.
La diffusion des idées des Lumières est sans doute également l'un des facteurs de motivation pour prêter ou non serment. La présence d'un nombreux clergé gallican et/ou janséniste dans le Bassin parisien est, pour certains historiens, l'une des raisons pour lesquelles le serment y a rencontré beaucoup de succès, 90 % de jureurs dans le Loiret. Les autres régions à majorité de jureurs sont la Bourgogne, la Provence, 96 % de jureurs dans le Var et les régions littorales du Sud-Ouest.
Au total, au niveau national, en tenant compte des rétractations intervenues après les brefs pontificaux, on atteindrait une proportion de 47 à 48 % de jureurs.
Élection du nouveau clergé
Pour remplacer les prêtres réfractaires, il faudra élire de nouveaux prêtres : quatre-vingts évêques sont alors élus et environ vingt mille prêtres sont remplacés. L'abbé Grégoire, curé et député, qui avait participé à la rédaction du projet de Constitution civile du clergé, sera élu évêque constitutionnel de Loir-et-Cher, et deviendra, de fait, le chef de l'Église constitutionnelle de France. Il faut souligner que ces élections sont ouvertes aux non-catholiques, ce qui ne pouvait qu'irriter les fidèles et la Papauté.
Conséquences de la Constitution civile du clergé et du serment
La plupart des prêtres réfractaires prennent le parti de la contre-révolution et les patriotes suspectent les ecclésiastiques, ce qui engendre des haines passionnées. De très nombreux catholiques, paysans, artisans ou bourgeois, qui avaient soutenu le Tiers état, rejoignent ainsi l'opposition. Dans l'ouest de la France, alors que des régions comme la Bretagne ou la Vendée avaient soutenu les débuts de la Révolution, celles-ci deviennent des foyers de troubles et de guerres liés à la contre-révolution.
Décret de l'Assemblée national qui supprime les ordres religieux et religieuses. Le mardi 16 février 1790. Caricature anonyme de 1790. Que ce jour est heureux, mes sœurs. Oui, les doux noms de mère et d'épouse est bien préférable à celui de nonne, il vous rend tous les droits de la nature ainsi qu'à nous.
Les débats agitent en profondeur la société française pendant les six premiers mois de 1791, et commencent à couper le pays en deux. Ils divisent des familles, rompent des amitiés anciennes. Charrier de la Roche, défenseur de la Révolution, constate en octobre 1791 : On accrédite des préjugés incendiaires dont les mieux intentionnés n'ont aucun moyen de se garantir, on sème, on entretient l'aigreur et l'animosité contre les sectateurs les plus paisibles du parti que l'on n'a pas adopté.
Conséquences religieuses
Les conséquences religieuses furent d'une extrême gravité. Désireux de donner au nouveau statut de l'Église la consécration canonique, le roi et les évêques tentèrent de négocier l'assentiment du pape, mais l'Assemblée, impatientée par les résistances qui se manifestaient dans le clergé, décida, le 27 novembre 1790, que les ecclésiastiques en fonctions devraient prêter le serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, ce qui impliquait l'acceptation de la Constitution civile. Presque tousles évêques et la moitié du clergé paroissial refusèrent le serment. L'Église de France se trouva coupée en deux : prêtres assermentés ou constitutionnels, prêtres insermentés ou réfractaires. Lorsque le pape Pie VI eut, le 10 mars 1791, condamné la Constitution civile, le schisme fut consommé. L'unité de l'Église de France ne fut rétablie que par le Concordat de 1801.
Conséquences politiques
Les conséquences politiques ne furent pas moins graves. Louis XVI se rallia au projet d'évasion depuis longtemps formé par son entourage. La résistance du clergé réfractaire et les persécutions dont il fut l'objet dressèrent contre la Révolution des fractions de la population, qui ne lui étaient point hostiles jusqu'alors ; elles expliquent en partie les insurrections de l'Ouest, chouannerie.
Pour en savoir plus, voir les articles abbé Grégoire, Église constitutionnelle, Révolution française.
Le 29 novembre 1791, un décret donne aux administrateurs locaux la possibilité de déporter les prêtres de leur domicile en cas de trouble.
Les suites
Des mesures de déchristianisation se poursuivent en France en 1793 et 1794, avec le développement du culte de la Raison et de l'Être suprême, et la fermeture des églises au culte du 31 mai 1793 jusque vers novembre 1794.
Les lois de 1790 – hors Constitution civile du clergé, réservée au culte catholique – permettent des mesures de tolérance par rapport aux protestants et aux juifs, accordant à ces derniers la citoyenneté.
Les prêtres réfractaires sont l'objet d'une sévère répression, notamment sous la Terreur, et sont confondus à cette période avec les autres, les prêtres constitutionnels ou assermentés, ou jureurs.
Dans la Rhénanie occupée par les forces françaises 1793, le mouvement de sécularisation chasse l'archevêque de Mayence de ses terres. La désacralisation des symboles et des édifices religieux et aristocratiques favorise l'émergence du pouvoir bourgeois dans le Saint Empire.
La fin : la première séparation de l’Église et de l’État 1794
La séparation de l'Église et de l'État avait été instaurée en fait par le décret du 2 sansculotides an II 18 septembre 1794 : par raison d'économie, Cambon fit supprimer ce jour-là le budget de l'Église assermentée ; la Constitution civile du clergé était ainsi implicitement rapportée et l'État complètement laïcisé.
Cinq mois plus tard, la Convention thermidorienne confirme cette séparation en votant, le 21 février 1795 3 ventôse an III, le Décret sur la liberté des cultes :
Art. I - Conformément à l'article VII de la Déclaration des Droits de l'homme et à l'article 122 de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé.
Art. II - La République n'en salarie aucun.
Art. III.- Elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice des cultes, ni pour le logement des ministres.
Art. IV.- Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.
Art. V - La loi ne reconnaît aucun ministre du culte, nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Art. VI - Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.
Art. VII - Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.
Art. VIII - Les communes ou sections de commune en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes...
Enfin, la paix religieuse est totalement retrouvée avec Bonaparte, alors Premier Consul, qui signe le Concordat avec le Pape en 1801. Pie VII entérine une mise sous tutelle de l'Église de France, tutelle que son prédecesseur pie VI avait refusé à l'Assemblé nationale.      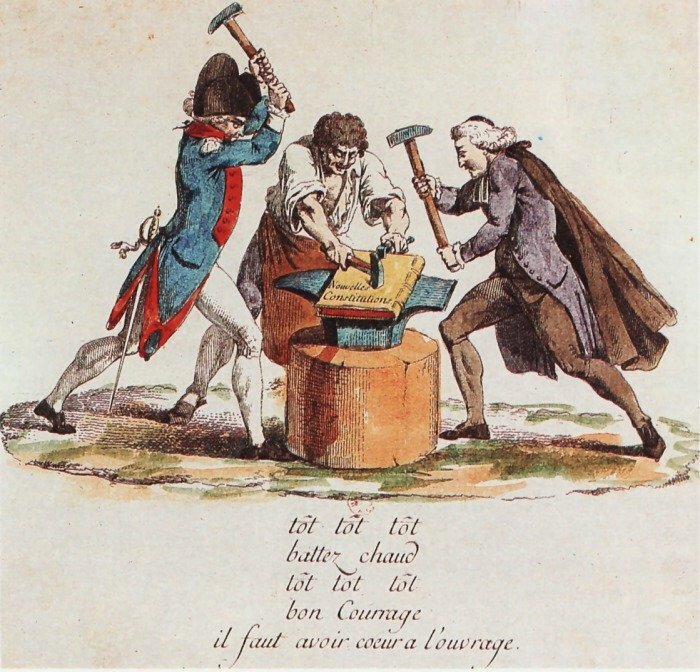   
Posté le : 11/07/2015 18:52
|
|
|
|
|
Henry VIII D'Angleterre 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 juin 1491 naît Henri VIII, né Henry Tudor
au Palais de Placentia Greenwich, Angleterre, mort à 55 ans le 28 janvier 1547 au Palais de Whitehall à Londres, Angleterre, il fut roi d'Angleterre et d'Irlande du 24 Avril 1509 où il fut couronné à l'abbaye de Westminster jusqu'à sa mort soit durant 37 ans, 9 mois et 4 jours, son prédécesseur est henri Vii et son successeur est son fils Edouard VI. Son père est Henri Vii roi d'Angleterre et sa mère Elisabeth d'York
La controverse juridique et théologique relative à la validité de son premier mariage avec Catherine d'Aragon et à son annulation fut l'une des principales causes du schisme de l'Église d'Angleterre avec Rome et de la Réforme anglaise. Henri VIII supervisa cette séparation avec notamment la dissolution des monastères et fut pour cela excommunié ; il resta néanmoins un fervent défenseur des fondamentaux de la théologie catholique. Henri VIII se remaria à cinq reprises et il fit exécuter deux de ses épouses.Il fut marié à Catherine d'Aragon 1509-1533, Anne Boleyn 1533-1536, Jeanne Seymour 1536-1537, Anne de Clèves 1540, Catherine Howard 1540-1542, Catherine Parr 1543-1547. Ses enfants sont Marie première, Élisabeth première, Édouard VI, Henry FitzRoy, fils illégitime. Religion Catholique, puis fondateur de l' Anglicanisme à partir de 1534. En politique étrangère, Henri VIII participa notamment aux guerres d'Italie contre la France de François Ier en s'alliant fréquemment à Charles Quint. Ses succès sur le continent furent cependant limités. Dans les îles britanniques, il s'opposa à plusieurs reprises à l'Écosse alors alliée à la France tandis que son règne marqua le début d'une plus grande influence anglaise en Irlande. Ces guerres et les dépenses fastueuses du roi affectèrent profondément les finances du Royaume et les mesures prises pour équilibrer le budget ne firent qu'aggraver la situation économique de l'Angleterre.
Henri VIII était un homme de la Renaissance athlétique et éduqué qui s'exerçait à l'écriture et à la musique. Néanmoins, un accident de joute et l'usure du temps affectèrent la santé physique et mentale du roi qui devint obèse et était à la fin de sa vie considéré comme un tyran égoïste. Au fil de ses mariages, il avait écarté de sa succession ses deux filles Marie et Élisabeth au profit de son fils Édouard. Tous ses enfants légitimes montèrent néanmoins sur le trône mais en l'absence de descendance, ils furent les derniers de la dynastie Tudor.
En bref
Né à Greenwich en juin 1491, fils d'Henri VII qui fut le premier souverain Tudor, Henri VIII d'Angleterre monte sur le trône en 1509 à l'âge de dix-huit ans et son règne ne s'achève qu'en janvier 1547. Contemporain de François Ier et de Charles Quint, il a été, comme eux, un roi à la fois humaniste et chevalier, dont les décisions en matière de gouvernement, de vie religieuse, d'économie, surtout dans le domaine commercial, et les relations extérieures ont durablement marqué l'histoire de son pays. Il serait aussi injuste que ridicule de ne retenir de lui que l'image du grand amateur de femmes et d'épouses, qui ne connut pas moins de six reines à son côté, Catherine d'Aragon de 1509 à 1533, dont il divorça, Anne Boleyn, les trois années suivantes, qu'il fit exécuter, Jane Seymour, en 1536-1537, qui mourut douze jours après avoir accouché du futur Édouard VI, Anne de Clèves qu'il répudia, à peine épousée, en janvier 1540, Catherine Howard, qui fut exécutée en février 1542 après moins de vingt mois de vie commune, et Catherine Parr, sa veuve en 1547 après une union de trois ans et demi.
En montant sur le trône, Henri VIII a découvert un héritage aux facettes variées. Le royaume, encore borné au nord de l'Écosse indépendante, compte environ trois millions de sujets, héritiers des survivants de l'hécatombe des pestes du XIVe siècle, dont 85 p. 100 étaient des villageois et presque autant des agriculteurs ; le reste de la population est constitué par de maigres cités, Londres compte alors quelque 50 000 à 60 000 habitants, qui, parfois dotées du statut de bourgs, gèrent elles-mêmes, par l'intermédiaire des élus des bourgeoisies, leurs affaires municipales. L'aristocratie soumise d'une main de fer par Henri VII, mais affaiblie surtout par les effets des morts et des renouvellements de la longue guerre civile des Roses, achevée en 1485, est tentée parfois de redresser la tête en s'appuyant sur de vastes clientèles, des châteaux, des armées privées ; le système religieux est fondé sur le monopole de l'Église catholique en Angleterre, riche d'un tiers des terres du royaume, réparties entre ordres monastiques et clergé séculier, défendue contre l'hérésie, celle des Lollards en particulier, par de terribles lois pénales. La puissance extérieure est encore fort limitée, surtout depuis l'avortement définitif des grands rêves de domination sur la France voisine mais la prudence financière, la possession de ressources non négligeables, la position géographique autorisent d'utiles et fructueux marchandages diplomatiques et une influence parfois démesurée. La faiblesse du système politique réside dans la jeunesse même de la dynastie des Tudors, conquérante du trône en 1485 et toujours, de ce fait, exposée à faire face à d'autres ambitions, dans un régime qui allie un Parlement fort de deux siècles d'existence dans ses structures bicamérales, et dans la prétention de l'autorité d'un exécutif toujours doté de l'investiture divine. Les possessions sont plus assurées au pays de Galles qu'en Irlande ; et l'action est en général entravée dès lors qu'il s'agit de compter sur une administration squelettique et nécessairement recrutée, au sommet, parmi des notables qui ne se veulent pas seulement des serviteurs ; de même, lorsqu'il faut constituer une armée, une flotte de guerre en trouvant les ressources, les hommes et les navires dans un royaume surtout terrestre.
Les atouts du jeune roi ne sont pas négligeables. Il bénéficie de l'expérience et des réalisations de son père et prédécesseur, de la popularité que lui a gagnée son intelligente politique économique d'encouragement du grand commerce maritime et qu'a renforcée la paix intérieure et extérieure ; il peut jouer de la soumission du Parlement, que Henri VII n'avait réuni que sept fois en vingt-cinq ans, préférant légiférer en Conseil. Il a été formé à son métier, bien que seule la mort de son frère aîné Arthur, en 1502, lui eût valu la promesse de la Couronne : il est un excellent cavalier, apte à tous les combats, il a goûté, dans les temps de l'humanisme naissant, aux joies de l'esprit, ami de Thomas More, d'Érasme, qu'il rencontre ou avec lequel il entretient une active correspondance ; il se pique de connaissances variées et étendues, son intelligence est indéniable. Son entourage lui est d'autant plus dévoué qu'il puise ses exemples dans une Antiquité grecque et romaine dont on retient surtout les ardeurs patriotiques ; il élève aux plus hautes fonctions son ancien chapelain, Thomas Wolsey ; celui-ci, rapidement porté à l'épiscopat, devenu archevêque d'York et, en 1515, cardinal, est promu en décembre de la même année chancelier du royaume : très ambitieux, ayant à deux reprises rêvé d'une élection au pontificat, il garantit à son maître les conseils les meilleurs pour renforcer son autorité et cela jusqu'à sa disgrâce de 1529.
L'histoire du règne doit être divisée en deux périodes que sépare la grande querelle avec Rome, avec son aboutissement : le schisme et la constitution d'une Église nationale. Ce n'est pas privilégier le religieux que de marquer d'entrée cette césure : elle a préfiguré un immense changement dans l'ordre des choses politiques, dans la vie sociale, dans le reclassement international des puissances européennes.
Avant 1529, Henri VIII est davantage un continuateur qu'un innovateur. À l'heure des déchirements religieux sur le continent, après que Luther, en 1517, eut levé l'étendard d'une révolte contre Rome, le roi se veut le défenseur de l'orthodoxie. Il n'empêche pas les humanistes de conduire leur quête, permet sans difficulté à Thomas More de publier, en 1516, son Utopie, demeure l'ami de John Colet, doyen de Saint-Paul, mort en 1519 après avoir créé une école de grande valeur et qui est un lecteur critique des Écritures et le pourfendeur des abus du clergé ; il approuve Wolsey de chercher à réprimer certains de ces abus et de créer de bons collèges à Oxford et Ipswich. Mais il gagne en 1521, sur décision de Léon X, le titre de défenseur de la foi, désormais partie intégrante de la titulature royale anglaise, pour avoir publié une Assertio septem sacramentorum dirigée contre Luther. On brûle des livres, mais aussi des hérétiques accusés de lollardisme ; Thomas More lui-même est chargé en 1529 de réfuter les écrits de William Tyndale, disciple de Luther et premier traducteur du Nouveau Testament en anglais 1525. Il s'agit de ne faire porter la réforme que sur des matières de discipline et de rites.
Maintenant le calme religieux dans le royaume, le souverain est d'autant plus libre de poursuivre une politique autoritaire. C'est lépoque de la création de section qu'on essaye vainement de réduire à une vingtaine de personnes en 1526, du développement de la section judiciaire du Conseil dans sa Chambre étoilée Star Chamber, de la réduction au minimum de l'intervention du Parlement qui n'est réuni qu'à cinq reprises et dont on se passe financièrement au prix de quelques exactions fiscales illégales, dont la difficile levée, en 1525, d'une taxe étrangement qualifiée d'amicale amicable grant. Soucieux de ne pas heurter les grands intérêts et conscient de ses propres besoins, Henri VIII encourage l'essor maritime, mais se garde bien de chercher à appliquer avec rigueur les lois contre les enclosures, qui, permettant le développement de l'élevage du mouton à laine, « dépeuplent » certains cantons du royaume en chassant les fermiers et journaliers de terres jusqu'alors vouées à la céréaliculture. Tout au plus une grande enquête mise en œuvre en 1517 contribue à ralentir le mouvement.
À l'extérieur, la politique est résolument empirique. La guerre n'est jamais exclue comme moyen : en 1512, elle prend l'aspect d'une vaine tentative de reconquête de la Guyenne ; en 1514, elle comporte l'acquisition de Tournai aux dépens de Louis XII de France, que son fils rachète en 1518 ; en 1513-1514, c'est sur les confins écossais qu'il faut se battre. La diplomatie est habile : le grand affrontement des Valois et des Habsbourg permet à Henri de se vendre au plus offrant, dans la mesure où ses intérêts propres ne sont pas menacés ; en juin 1520, il demeure insensible aux fastes du camp du Drap d'or et préfère appuyer Charles Quint plutôt que François Ier. Les malheurs du roi de France poussent, en 1525, à une paix entre l'Angleterre et la France, fort généreusement payée par celle-ci, puis, l'année suivante, à un renversement d'alliances. Cependant, il apparaît souvent de bon ton de reprendre à son compte la vieille idée d'une réconciliation de la chrétienté sous la bannière d'une croisade contre les Turcs pour délivrer les Lieux saints !
Symbole de la continuité avec le passé : à partir de 1525, et pour la première fois, le souverain anglais se fait désigner, dans sa titulature, avec le numéro d'ordre qui est le sien dans l'emploi de son prénom.
En 1529, les nuages se sont accumulés. Henri n'a qu'une héritière, Marie, née en 1516. Il se persuade d'autant plus aisément que sa dynastie serait en péril en cas de succession par une femme parfaitement légitime pourtant, qu'il est, depuis 1527, tombé follement amoureux d' Anne Boleyn : un remariage pourrait lui valoir l'héritier jugé nécessaire. Pour divorcer, le roi invoque le tardif scrupule de conscience d'avoir épousé la veuve de son frère Arthur : ce mariage, intervenu en 1501, une année avant la mort du prince, n'a sans doute jamais été consommé, mais le procès de divorce a été marqué par l'appel à de douteux et répugnants témoignages contraires. Sollicitée auprès du pape Clément VII, une décision favorable aurait sans doute pu être obtenue si, après le sac de Rome par les troupes de Charles Quint en 1527, celui-ci, devenu le plus puissant souverain de la Chrétienté et le plus influent en Italie, n'avait pas été le neveu de Catherine.
Les tergiversations pontificales et l'échec, à Londres, de la procédure entamée devant le tribunal des légats, Wolsey et Campeggio, entraînent la chute du cardinal Wolsey et donnent le signal des grandes mutations.
La prospérité économique est réelle parce que le règne du roi coïncide avec le début d'un beau XVIe siècle : l'essor de la population, même relatif, un climat plus favorable, mais aussi une politique habile y contribuent. Henri VIII est un artisan du mercantilisme alors en honneur. Cela se traduit par le renouvellement des Actes de navigation de son père, en particulier en 1540, pour favoriser l'essor d'une flotte de commerce dotée d'équipages anglais. Par ailleurs, il soutient les entreprises commerciales, en particulier les voyages répétés de William Hawkins sur les côtes de Guinée et du Brésil, malgré les protestations portugaises. En 1537, une loi sur les guildes tend à faciliter l'accession de compagnons à la maîtrise, dans le dessein de réduire le malthusianisme des corporations et de permettre la croissance des productions. Un souci identique a justifié les ventes et les distributions de terres, mais aussi la poursuite des efforts pour prévenir les excès des enclosures : une loi de 1536 réserve à la culture les terres d'origine monastique pour une durée minimale de vingt ans.
Autant par souci de l'ordre que par préoccupation chrétienne, le roi n'a pas été insensible à la misère : sur la longue route qui mène à la fameuse loi des pauvres d'Élisabeth en 1601, Henri a planté d'importants jalons en confiant, en 1531 et en 1536, des responsabilités de contrôle aux juges de paix et, surtout, en réservant, pour la première fois à cette dernière date, aux paroisses la mission de secourir les indigents.
Il est vrai aussi que le roi, par ses manipulations monétaires des années 1540, destinées à lui procurer des ressources et à alléger ses dettes en faisant varier le titre des pièces et la définition – or ou argent de la livre –, a largement aussi contribué à une hausse erratique des prix et à une baisse des salaires réels. On a estimé à quelque 39 p. 100 la hausse des prix alimentaires de 1541 à 1550, d'où une difficile course entre prix et rémunérations.
La politique extérieure, par contre, n'a guère varié dans sa pratique du jeu de basculement entre Valois et Habsbourg. Pendant plusieurs années, on vit une paix précaire et un rapprochement avec la France que symbolisent un traité d'amitié en 1532, suivi d'un pacte pour s'opposer en commun à l'expansion ottomane. Mais la lutte d'influence des deux monarchies amène de vifs affrontements à propos de l' Écosse : Jacques V, époux d'une princesse française, ravage les zones frontières en 1542 et sa mort n'empêche pas l'action d'un puissant parti français. En 1542, Henri est ainsi poussé à une alliance avec Charles Quint contre François Ier. Ses troupes occupent Boulogne deux ans plus tard. Une paix séparée entre l'empereur et son éternel rival français met l'Angleterre en fâcheuse posture, mais, en 1546, le traité d'Ardres rétablit la paix en laissant Boulogne à l'Angleterre pour une période de huit ans. Henri VIII reçoit d'autre part la promesse d'une forte indemnité.
Dans ce contexte d'événements contradictoires, la santé et la vigueur de Henri VIII entrent dans un lent déclin. Il assiste, au cours des dernières années de sa vie, à l'affrontement à la cour de partis opposés, chacun soucieux de prendre le meilleur en cas d'accession au trône d'un roi mineur Édouard à neuf ans à la mort de son père. L'exécution du comte de Surrey et l'emprisonnement de son père, le duc de Norfolk, traduisent les suspicions ultimes du roi à l'encontre du parti le plus décidé à renouer avec Rome. Cependant qu'Edward Seymour, comte de Hertford, favorable à une réforme plus radicale, semble alors renforcer sa position.
Henri VIII meurt le 28 janvier 1547. Les difficultés traversées par le royaume sous le court règne d'Édouard VI, jusqu'en 1553, puis de Marie la Sanglante de 1553 à 1558, contribuent, dès le XVIe siècle, à rehausser les mérites du père de la grande Élisabeth.Roland MARX
Sa vie
Né au palais de Placentia le 28 juin 1491, Henri Tudor était le troisième enfant et le second fils du roi Henri VII et d'Élisabeth d'York. Sur les six frères et sœurs d'Henri, seuls trois Arthur de Galles, Marguerite et Marie atteignirent l'âge adulte. Il fut baptisé par l'évêque d'Exeter Richard Fox dans une église franciscaine non loin du palais. En 1493, à l'âge de deux ans, il fut fait connétable du château de Douvres et gouverneur des Cinq-Ports. L'année suivante, il devint comte maréchal d'Angleterre, lord lieutenant d'Irlande, duc d'York, gardien des Marches et il intégra l'Ordre du Bain. En mai 1495, il fut nommé à Ordre de la Jarretière. Henri reçut une éducation de très haut niveau et il parlait couramment l'anglais, le latin et le français et avait quelques bases en italien. On ne sait que peu de choses de son enfance car n'étant pas prince de Galles, il n'était pas destiné à devenir roi. En novembre 1501, il joua un rôle important dans les cérémonies entourant le mariage de son frère Arthur à Catherine d'Aragon, la plus jeune fille du roi Ferdinand II d'Aragon et de la reine Isabelle Ire de Castille.
Arthur mourut soudainement, peut-être de la suette, à l'âge de 15 ans en avril 1502 après 20 semaines de mariage avec Catherine. Toutes ses prérogatives et titres furent ainsi transmis à Henri, âgé de dix ans, qui devint duc de Cornouailles en octobre et prince de Galles et comte de Chester en février 1503. Henri VII ne délégua que quelques missions à son nouvel héritier. Les actes du jeune Henri furent également étroitement encadrés et il accéda au trône sans entraînement à l'art exigeant de la royauté.
Henri VII poursuivit ses tentatives pour sceller une alliance entre l'Angleterre et l'Espagne en proposant de marier Henri à Catherine. L'idée avait germé immédiatement après la mort d'Arthur et un accord en vue d'un mariage fut signé 23 juin 1503. Les lois religieuses interdisaient le mariage entre membres de la même famille et une dispense papale fut demandée par Henri VII et l'ambassadeur espagnol. Celle-ci n'était nécessaire que si l'union avait été consommée, ce qui n'était pas arrivé selon Catherine et sa chaperonne, mais le pape Jules II accorda néanmoins la dispense. Le jeune âge d'Henri empêchait toute cohabitation tandis que la mort d'Isabelle Ire en 1504 et la crise de succession qui suivit compliqua la question. Son père préférait qu'elle reste en Angleterre, mais les relations de Henri VII avec Ferdinand II s'étaient détériorées et la perspective d'un mariage semblait s'éloigner. Catherine vécut donc relativement recluse et elle fut nommée ambassadrice par son père pour lui permettre de rester indéfiniment en Angleterre.
Début de règne
Henri VII mourut de la tuberculose le 22 avril 1509 et le jeune Henri lui succéda sous le nom d'Henri VIII. Peu après l'enterrement de son père le 10 mai, Henri VIII déclara qu'il épouserait Catherine même si les questions entourant la dispense papale restaient irrésolues. La cérémonie de mariage fut sobre et organisée à l'église franciscaine de Greenwich. Le 23 juin 1509, Henri VIII mena Catherine de la Tour de Londres à l'abbaye de Westminster pour leur couronnement qui eut lieu le lendemain. Le trajet du couple royal fut décoré de tapisseries15 et la cérémonie fut suivie par un luxueux banquet dans la grande salle du palais de Westminster.
Deux jours après son couronnement, Henri VIII fit arrêter deux des ministres les plus impopulaires de son père : Richard Empson et Edmund Dudley. Ils furent condamnés pour haute trahison et exécutés en 1510. L'historien Ian Crofton considère que de telles exécutions furent largement utilisées par Henri VIII pour éliminer ceux qui s'opposaient à son autorité. À l'inverse, il fut beaucoup plus modéré que son père envers la maison d'York qui avait des revendications sur la Couronne d'Angleterre. Plusieurs nobles qui avaient été emprisonnés par Henri VII comme Thomas Grey furent amnistiés mais certains furent exécutés ; Edmond de la Pole fut ainsi décapité en 1513 après que son frère Richard eut rejoint les adversaires de l'Angleterre durant la guerre de la Ligue de Cambrai.
Catherine tomba enceinte peu après le mariage mais elle accoucha d'une fille morte-née le 31 janvier 1510. Elle fut à nouveau enceinte peu après et elle donna naissance à un fils appelé Henri le 1er janvier 1511. Après le chagrin causé par la perte de leur premier enfant, le couple se réjouit de cette naissance et de nombreuses célébrations, dont un tournoi de joute, furent organisées; l'enfant mourut cependant au bout de sept semaines. Il fut révélé en 1510 qu'Henri VIII avait une liaison extra-conjugale avec l'une des sœurs d'Edward Stafford, Anne ou Elizabeth. Catherine fit une nouvelle fausse couche en 1514 puis accoucha d'une fille, Marie, en février 1516. Les relations au sein du couple royal s'améliorèrent après cette naissance et rien n'indique que le mariage ait été autre chose qu' exceptionnellement bon pour la période.
Elizabeth Blount fut la principale maîtresse d'Henri VIII pendant trois ans à partir de 1516. Elle est l'une des deux seules femmes dont le statut de maîtresse est incontesté, ce qui est peu pour un jeune roi de l'époque. Leur nombre exact fait l'objet de débats : David Loades estime qu'Henri VIII n'en avait qu'un nombre très limité tandis qu'Alison Weir considère qu'elles furent nombreuses. Catherine ne protesta pas et elle accoucha d'une fille morte-née en 1518. En juin 1519, Blount donna naissance à un fils illégitime appelé Henry FitzRoy. Le garçon fut fait duc de Richmond en juin 1525 dans ce que certains estimèrent être un premier pas vers une éventuelle légitimation. En 1533, FitzRoy fut marié à Marie Howard mais il mourut trois ans plus tard. Au moment de sa mort, le Parlement avait adopté le Second Succession Act qui lui aurait permis de devenir roi si Henri VIII mourait sans héritiers légitimes.
France et Habsbourg
En 1510, la France avait formé une alliance fragile avec le Saint-Empire Romain Germanique au sein de la Ligue de Cambrai contre Venise. Henri VIII maintint les bonnes relations de son père avec le roi Louis XII de France, mais cette question divisait ses conseillers et, peu après, il signa un pacte contradictoire avec Ferdinand II d'Aragon contre la France. Le problème fut résolu par la formation en octobre 1511 de la Ligue catholique dirigée contre la France par le pape Jules II. Henri VIII rejoignit cette coalition peu après et prépara une attaque anglo-espagnole en Aquitaine, visant à reprendre les territoires perdus durant la guerre de Cent Ans. L'offensive fut un désastre qui détériora les relations entre les deux pays, mais le retrait français d'Italie apaisa les tensions. Henri VIII remporta ensuite un grand succès diplomatique en convaincant l'empereur Maximilien Ier de rejoindre la coalition. Il obtint également que le pape le couronne roi de France si Louis XII était vaincu.
Le 30 juin 1513, Henri VIII et ses troupes battirent une armée française à Guinegatte dans le Pas-de-Calais et s'emparèrent de Tournai. Le roi avait mené personnellement ses forces et son absence poussa son beau-frère Jacques IV d'Écosse à envahir l'Angleterre pour soutenir Louis XII. Les Écossais furent néanmoins écrasés lors de la bataille de Flodden Field le 9 septembre 1513 et la mort du roi entraîna la fin de la brève participation de l'Écosse au conflit. Henri VIII avait grandement apprécié son expérience militaire, mais il décida de ne pas mener une nouvelle campagne en 1514. Il avait soutenu financièrement Ferdinand II et Maximilien Ier mais avait peu obtenu en retour et les coffres anglais étaient à présent vides. Le nouveau pape Léon X étant favorable à une paix avec la France, Henri VIII négocia son propre traité avec Louis XII : sa sœur Marie épouserait le roi de France et une trêve fut signée pour huit ans, une durée particulièrement longue pour l'époque.
François Ier succéda à son cousin Louis XII en 1515 tandis qu'après la mort respective de ses grand-pères Ferdinand II et Maximilien Ier en 1516 et 1519, Charles d'Autriche devint roi d'Espagne et empereur germanique. La diplomatie prudente du lord chancelier, le cardinal Thomas Wolsey, permit la signature du traité de Londres de 1518 qui visait à créer une paix permanente en Europe occidentale et à se prémunir contre la menace grandissante de l'Empire ottoman. Le 7 juin 1520, Henri VIII et François Ier se rencontrèrent au camp du Drap d'Or près de Calais pour deux semaines de somptueuses festivités. Les deux hommes espéraient mettre en place des relations amicales après les affrontements de la décennie passée, mais les tensions restèrent élevées et un nouveau conflit inévitable. Le roi anglais se sentait plus proche de Charles Quint qu'il avait rencontré avant François Ier. Une nouvelle guerre éclata entre l'Empire et la France en 1521 et Henri VIII proposa sans grands succès sa médiation. Toujours désireux de reprendre les anciens territoires anglais en France, il se rapprocha de la Bourgogne et apporta son soutien à Charles Quint. Une armée anglaise mena une offensive dans le Nord de la France à partir de 1522 avec des résultats mitigés. Le tournant du conflit fut la capture du roi de France à Pavie en février 1525 par les forces de Charles Quint qui pouvait à présent dicter ses conditions de paix et estimait qu'il ne devait rien à Henri VIII. Ce dernier décida donc de négocier une paix séparée qui fut signée le 30 août 1525 et ramenait quasiment les belligérants à la situation d'avant-guerre.
Divorce d'avec Catherine d'Aragon
Au début des années 1520, Henri VIII entretenait une relation avec Mary Boleyn, la dame de compagnie de Catherine d'Aragon. Il a été avancé qu'il était le père de ses deux enfants, Catherine et Henry, mais cela n'a jamais été prouvé et le roi ne les a pas reconnus comme il l'avait fait pour Henry FitzRoy. Alors qu'Henri VIII se désespérait de l'incapacité de Catherine à lui donner l'héritier mâle qu'il désirait, il se rapprocha de la sœur de Mary, Anne Boleyn, une jeune femme charismatique de l'entourage de la reine. Elle résista néanmoins à ses avances et refusa de devenir sa maîtresse comme l'était sa sœur. C'est dans ce contexte qu'Henri VIII évalua ses trois options pour obtenir un héritier et ainsi résoudre ce que la cour qualifia de grand dilemme du roi. Il pouvait légitimer Henry FitzRoy, ce qui nécessiterait l'intervention du pape et pourrait être contesté ; fiancer sa fille Marie le plus vite possible et espérer un petit-fils qui pourrait hériter directement - mais elle n'avait qu'une dizaine d'années et pouvait ne produire un héritier qu'après sa mort ; ou se séparer d'une façon ou d'une autre de Catherine et épouser une femme capable de lui donner un fils. Cette dernière possibilité et la perspective d'épouser Anne semblait la plus désirable pour Henri VIII et sa volonté d'obtenir l'annulation de son mariage devint rapidement évidente.
Les motivations et les intentions précises d'Henri VIII dans les années qui suivirent ne font pas l'unanimité. Du moins dans la première partie de son règne, Henri VIII fut un catholique pieux et instruit dont le traité théologique qu'il rédigea en 1521 contre les attaques de Martin Luther lui valut de recevoir le titre de défenseur de la Foi par le pape Léon X. Vers 1527, il devint persuadé qu'en épousant Catherine, l'épouse de son frère, il avait violé la loi divine Lévitique et que même une dispense papale ne pouvait rendre cette union valide. Catherine fut invitée à se retirer discrètement dans un couvent mais elle refusa en déclarant qu'elle était la seule et véritable épouse du roi. Henri VIII dépêcha donc des émissaires auprès du Saint-Siège pour demander l'annulation du mariage, mais le pape refusa car il ne voulait pas désavouer son prédécesseur et irriter Charles Quint, le neveu de Catherine, dont les troupes se trouvaient à proximité du Vatican et avaient pillé Rome en mai 1527.
Il fut alors décidé d'organiser en octobre 1528 un tribunal ecclésiastique chargé de se prononcer sur la validité du mariage en Angleterre en présence d'un représentant du pape. Même si Clément VII approuva la constitution d'une telle cour, il n'avait pas l'intention de déléguer à son émissaire Lorenzo Campeggio l'autorité pour accepter la demande d'Henri VIII. Après deux mois de discussions, Clément VII demanda en juillet 1529 que l'affaire soit jugée à Rome, où il était certain que la validité du mariage serait confirmée. Cette incapacité à obtenir le divorce désiré entraîna la chute soudaine et totale de Thomas Wolsey qui fut accusé de trahison en octobre et mourut ruiné l'année suivante. Thomas More le remplaça au poste de lord chancelier et de principal conseiller du roi. Intelligent et capable mais également catholique fervent et opposant au divorce, More soutint initialement le roi devant le Parlement.
En 1531, Catherine fut expulsée de la cour et ses appartements furent transmis à Anne. Cette dernière était une femme particulièrement intelligente et éduquée pour l'époque et elle s'intéressa grandement aux idées des réformateurs protestants, même si son degré d'adhésion au protestantisme reste débattu. Lorsque l'archevêque de Cantorbéry William Warham mourut en 1532, l'influence d'Anne et le besoin de trouver un ecclésiastique favorable au divorce entraînèrent la nomination de Thomas Cranmer. Ce choix fut approuvé par le pape, qui ignorait les plans du roi d'Angleterre.
Mariage avec Anne Boleyn
Durant l'hiver 1532, Henri VIII rencontra François Ier à Calais et obtint le soutien du roi de France pour son remariage. Immédiatement après son retour à Douvres, Henri VIII et Anne se marièrent en secret. Elle tomba rapidement enceinte et une deuxième cérémonie fut organisée à Londres le 25 janvier 1533. Le 23 mai 1533, Cranmer présida un tribunal spécial et annula le mariage d'Henri VIII et de Catherine ; cinq jours plus tard, il officialisa le mariage d'Henri VIII et d'Anne. Catherine perdit formellement son titre de reine et devint princesse douairière en tant que veuve d'Arthur. Anne fut ainsi couronnée reine consort le 1er juin 1533. Elle accoucha le 7 septembre et la fille fut appelée Élisabeth en l'honneur de la mère du roi, Élisabeth d'York.
À la suite du mariage, plusieurs législations furent adoptées pour régler les problèmes causés par cette union65. Les changements au droit canon furent supervisés par Cranmer tandis que les réformes présentées au Parlement furent soutenues par Thomas Cromwell, Thomas Audley et Thomas Howard ainsi que par Henri VIII. Mécontent de cette évolution, Thomas More démissionna et Cromwell devint le principal conseiller du roi. Le First Succession Act de 1533 excluait Marie de la succession au trône, légitimait le mariage d'Henri VIII avec Anne tandis que les enfants qu'il aurait avec elle deviendraient ses héritiers. L'acte de suprématie et la loi sur la restriction de l'appel faisait d'Henri VIII le chef suprême de l'Église en Angleterre. Ces décisions poussèrent Clément VII à excommunier le roi et l'archevêque de Cantorbéry même si cela ne fut rendu public que plus tard.
Le roi et la reine n'étaient pas satisfaits de leur vie de couple, notamment parce qu'Anne refusait de jouer le rôle de femme soumise qui était attendu d'elle. La vivacité d'esprit qui l'avait rendu si attirante la rendait trop indépendante pour le rôle largement cérémoniel d'une reine, et cela lui valut de nombreuses inimités. De son côté, Henri VIII appréciait peu l'irritabilité d'Anne et, après une grossesse nerveuse ou une fausse couche en 1534, il vit son incapacité à lui donner un fils comme une trahison. Dès Noël 1534, Henri VIII discuta avec Cranmer et Cromwell de la possibilité de quitter Anne sans avoir à revenir auprès de Catherine. L'année suivante, il entama une relation avec Margaret Shelton.
L'opposition aux politiques religieuses d'Henri VIII fut rapidement réprimée en Angleterre. De nombreux moines furent exécutés et beaucoup d'autres furent cloués au pilori. Les plus importants opposants étaient l'évêque de Rochester, John Fisher, et Thomas More qui refusaient de prêter allégeance au roi. Henri VIII et Cromwell ne souhaitaient pas leur mort et ils espéraient qu'ils changent d'avis. Cela ne fut pas le cas et les deux hommes furent condamnés pour haute trahison et exécutés à l'été 153574. Cette répression associée à la dissolution des monastères de 1536 accrut le mécontentement populaire et un large soulèvement appelé Pèlerinage de Grâce comprenant entre 20 000 et 40 000 rebelles menés par Robert Aske éclata dans le Nord de l'Angleterre en octobre. Henri VIII promit de prendre en compte leurs revendications et décréta une amnistie ; confiant dans la parole du roi, le meneur renvoya ses disciples; le monarque considérait néanmoins les rebelles comme des traîtres et environ 200 d'entre-eux, dont Aske, furent exécutés.
Exécution d'Anne Boleyn
Le 8 janvier, le couple royal apprit la mort de Catherine d'Aragon et Henri VIII demanda l'organisation de festivités pour célébrer cette nouvelle. La reine était à nouveau enceinte et elle était consciente des conséquences si elle ne donnait pas naissance à un fils. Plus tard dans le mois, le roi fut désarçonné et gravement blessé lors d'une joute et il sembla temporairement que sa vie était en danger. Choquée par la nouvelle, la reine accoucha d'un garçon mort-né d'une quinzaine de semaines le jour des funérailles de Catherine le 29 janvier. Pour la plupart des commentateurs, cette tragédie personnelle marqua le début de la fin du mariage royal. Étant donné le fort désir du roi pour un fils, la série de grossesses d'Anne attira largement l'attention. L'historien Mike Ashley avance qu'Anne avait fait deux fausses couches entre la naissance d'Élisabeth et l'accouchement du fils mort-né en 1536. La plupart des sources parlent de la naissance d'Élisabeth en septembre 1533, d'une possible fausse couche à l'été 1534 et de la fausse couche d'un garçon d'environ quatre mois en janvier 1536.
Même si la famille de Boleyn occupait encore d'importantes positions au sein du conseil privé, Anne s'était fait de nombreux ennemis, dont le général Charles Brandon. Les Boleyn privilégiaient une alliance avec la France tandis que le roi, sous l'influence de Cromwell, était plus favorable à un rapprochement avec le Saint-Empire et cela affecta l'influence de la famille. Les opposants à Anne étaient également les partisans d'une réconciliation avec la princesse Marie, devenue majeure, et les anciens soutiens de Catherine. Un second divorce était devenu une réelle possibilité mais il était largement considéré que Cromwell cherchait un moyen de se débarrasser physiquement de la reine.
La chute d'Anne eut lieu peu après qu'elle eut récupéré de sa dernière fausse couche. Les premiers signes de cette disgrâce furent l'octroi de logements prestigieux à la nouvelle maîtresse du roi, Jeanne Seymour, et le refus de l'Ordre de la Jarretière au frère d'Anne, George Boleyn ; le titre fut à la place accordé au frère de Jeanne qui devint marquis d'Hertford.
Entre le 30 avril et le 2 mai, cinq hommes dont le frère d'Anne et elle-même furent arrêtés pour adultère et inceste. Même si les preuves étaient peu convaincantes, les accusés furent reconnus coupables et condamnés à mort. George Boleyn, accusé d'être l'amant de sa propre sœur, et les autres hommes furent exécutés le 17 mai 1536 et le 19 mai à 8 h, Anne fut décapitée dans l'enceinte de la Tour de Londres.
Mariage avec Jeanne Seymour
Le lendemain de l'exécution d'Anne Boleyn, Henri VIII se fiança à Jeanne Seymour, qui avait été l'une des dames de compagnie de la reine, et ils se marièrent dix jours plus tard. Le 12 octobre 1537, Jeanne donna naissance à un fils, Édouard, mais l'accouchement fut difficile et elle mourut le 24 octobre d'une infection.L'euphorie qui avait entouré la naissance d'Édouard laissa place à la tristesse et si Henri VIII sembla rapidement surmonter sa mort, il semble que ce fut d'elle qu'il garda les souvenirs les plus tendres et il demanda à être inhumé avec elle. La recherche d'une nouvelle épouse reprit immédiatement même si le roi porta le deuil pendant trois mois.
Comme Charles Quint était occupé par les tensions politiques et religieuses au sein de ses nombreux royaumes et qu'Henri VIII et François Ier étaient en bons termes, le roi d'Angleterre délaissa la politique étrangère au début des années 1530 pour se concentrer sur les questions intérieures. En 1536, il approuva l'acte d'union qui unifiait formellement le Pays de Galles à l'Angleterre. La même année, le Second Succession Act écartait Marie et Élisabeth de la succession au trône et mettait Édouard à la première place ; la législation autorisait également le souverain à préciser l'ordre de succession dans son testament. Cependant lorsque Charles Quint et François Ier firent la paix en 1538, Henri VIII devint de plus en plus inquiet. Enrichi par la dissolution des monastères, il fit construire des défenses côtières et se prépara financièrement à une attaque franco-germanique.
La réforme religieuse
Henri VIII fait appel, sur l'avis de son nouveau conseiller, le théologien Thomas Cranmer, au jugement des principales universités d'Europe. Il en retire bien des satisfactions, mais l'intransigeance du pape leur donne une valeur surtout intellectuelle. Un jeu dangereux s'engage de part et d'autre : certains conseillers de Henri, dont Thomas Cromwell, estiment opportun d'associer leurs ambitions et leurs idées à l'affirmation farouche d'un « anglicanisme » voisin du gallicanisme en France ; Cranmer, progressivement gagné au luthéranisme, et promu archevêque de Canterbury en mars 1533, incite à des évolutions doctrinales ; la stratégie d'intimidation du Saint-Siège conduit à des gestes dont l'échec constitue autant d'étapes vers une rupture : en février 1531, Henri est reconnu par le clergé comme chef suprême de l'Église anglaise « autant que la loi du Christ le permet ; en mai 1532, la soumission du clergé comporte l'acceptation d'un contrôle royal sur toutes ses décisions ; le 23 mai 1533, on espère encore placer Rome devant le fait accompli en faisant prononcer par une cour présidée par Cranmer le divorce du roi. Mais la riposte de Rome est l'excommunication du souverain et, en 1534, l'évêque de Rome, privé de toute autorité, l' Acte de suprématie établit Henri comme chef de l'Église en Angleterre, il est complété par l'exigence d'un serment à la personne royale de tout adulte et l'assimilation à un acte de trahison de toute résistance. Épouvantés par l'exécution, en 1535, de l'évêque Fisher et de Thomas More, chancelier du royaume de 1529 à 1532, les voix des protestataires se taisent rapidement. Un régime religieux curieux est ensuite peu à peu défini. On est partagé entre la volonté, qui est celle du roi, de ne procéder qu'à des réformes limitées et de respecter l'essentiel des articles de la foi romaine, et la crainte d'ébranler un système ancestral. Henri VIII se laisse facilement convaincre de supprimer les petits monastères en 1536, puis les autres en 1539 ; il est, ce faisant, à l'écoute des critiques courantes des humanistes contre l'inutilité et les scandales de la vie monastique, mais il est surtout intéressé par la confiscation des biens considérables des monastères ; parmi ceux-ci, les uns sont réservés au domaine royal, d'autres vendus, distribués ou convertis en fondations d'écoles et de collèges, voire de nouveaux diocèses, garantissant la fidélité de leurs heureux bénéficiaires. Mais il paye cette initiative de la plus grave révolte de son règne, le pèlerinage de la Grâce d'octobre à novembre 1536, qui rassemble, contre les mauvais conseillers du roi, 20 000 pèlerins du Lincolnshire, du Yorkshire, du Cumberland et du Northumberland : la victoire royale est acquise moins par les armes que par la duplicité et, après un armistice en décembre, des insurrections sporadiques sont matées en février 1537 et suivies de l'exécution des principaux meneurs. La révolte a pourtant convaincu Henri de réduire au minimum les atteintes à la foi. Alors qu'en 1536 Thomas Cromwell a été autorisé à promulguer les Dix Articles qui prévoyaient en particulier la diffusion de la Bible en anglais, en mai 1539, l'Acte des Six Articles est dirigé contre les excès de zèle réformateurs et proclame la préservation de presque toutes les traditions catholiques. Ce que confirme à nouveau expressément le Livre du roi de 1543, rédigé sur l'initiative de Cranmer et personnellement approuvé par le souverain. La vraie réforme protestante est encore à venir. Quant aux résultats obtenus par les attaques contre les abus, s'ils ne sont pas entièrement négligeables, on ne peut les juger décisifs.
Les changements dans l'État
L'évolution politique est des plus importantes. Elle est en partie déterminée par le souci de faire approuver par le peuple les perturbations du statut religieux et les modifications d'un ordre dynastique troublé par les mariages successifs du souverain, la naissance en 1533 d'Élisabeth, fille d'Anne Boleyn, suivie, en 1537, de celle d'Édouard, fils de Jane Seymour. D'où un retour en grâce de l'institution parlementaire et la recherche de ce qui a constitué à partir de là le chef-d'œuvre de l'action des Tudors : un compromis entre le goût, intact, d'une autorité indiscutable et le respect de l'apparence des libertés et du Parlement.
Henri VIII ne renonce pas à affirmer ses préférences absolutistes. Il suit les conseils de Thomas Cromwell et fait du conseil privé un instrument efficace de gouvernement en le distinguant du Grand Conseil, en lui fixant un nombre restreint de membres, dix-neuf en 1536, recrutés parmi des officiers compétents et parfaitement soumis à la volonté royale ; jusqu'à la chute du favori, en 1540, le Conseil apparaît trop comme l'outil de Cromwell, mais il peut ensuite faire pleinement ses preuves. En 1537, le Conseil du Nord est profondément remanié, doté d'une compétence administrative et judiciaire sans limite, défini comme itinérant avant de se fixer, plus tard, à York et, grâce à son président, de 1538 à 1550, Robert Holgate, fait archevêque d'York en 1544, il garantit la sécurité de la frontière avec l'Écosse comme l'obéissance des sujets. Pour le pays de Galles, l'Acte d'union de 1536 substitue le système anglais des comtés à des structures féodales et fait du conseil des Marches un puissant organisme de contrôle et de gouvernement. En 1541, Henri se proclame d'autre part roi, et non plus seigneur de l' Irlande. La Chambre étoilée, toujours, considérée comme une section judiciaire du Conseil, gagne en initiative, même si il lui est interdit de prononcer des peines capitales. Le pouvoir exécutif est confié à un nombre restreint de personnes : de 1533 à 1540, Thomas Cromwell, fait comte d'Essex peu avant sa disgrâce de 1540, devient, avec le titre de secrétaire d'État, un véritable Premier ministre ; Henri ne prolonge pas l'expérience par la suite, mais confie à deux secrétaires d'État des tâches majeures. Les divers rouages exigent des finances sûres : outre le revenu d'un domaine considérablement élargi par les confiscations de biens monastiques, Henri, par une mesure des plus illégales, s'arroge à partir de 1534 le droit de modifier à sa guise les taxes douanières. Le Parlement ne pâtit pas de ces efforts. En particulier parce que le Reformation Parliament qui a siégé de 1529 à 1536 a parfaitement secondé le souverain dans son œuvre religieuse et l'a ainsi convaincu de son utilité. Privée de ses lords-abbés, la Chambre haute connaît une stagnation du nombre de ses membres, alors que les Communes sont passées de 296 à 341 députés au cours du règne : la création de nouveaux sièges autorise parfois la constitution de clientèles, d'autant que Cromwell utilise avec fermeté un véritable mode de candidature officielle et innove en faisant admettre dans l'enceinte des réunions des représentants de la Couronne, qui expliquent les mesures sollicitées, mais aussi contribuent à les faire adopter. Signe des temps nouveaux, entre 1530 et 1547, le Parlement a siégé pendant près de onze ans au total contre environ quatre au cours des vingt et une premières années du règne.
Si beaucoup de députés sont en même temps des juges de paix, commissaires royaux dans les comtés, on ne peut pas en inférer qu'ils ont été des serviteurs dociles : recrutés parmi les notables locaux, ils ont pu manifester des qualités et un esprit d'autonomie remarquables. Leur dévouement tient en partie à la crainte, tant l'immunité parlementaire est loin d'être acquise, mais aussi plus positivement à leur approbation fondamentale de la politique économique et extérieure du souverain.
Les encouragements à l'économie
La prospérité économique est réelle parce que le règne du roi coïncide avec le début d'un « beau XVIe siècle » : l'essor de la population, même relatif, un climat plus favorable, mais aussi une politique habile y contribuent. Henri VIII est un artisan du mercantilisme alors en honneur. Cela se traduit par le renouvellement des Actes de navigation de son père, en particulier en 1540, pour favoriser l'essor d'une flotte de commerce dotée d'équipages anglais. Par ailleurs, il soutient les entreprises commerciales, en particulier les voyages répétés de William Hawkins sur les côtes de Guinée et du Brésil, malgré les protestations portugaises. En 1537, une loi sur les guildes tend à faciliter l'accession de compagnons à la maîtrise, dans le dessein de réduire le malthusianisme des corporations et de permettre la croissance des productions. Un souci identique a justifié les ventes et les distributions de terres, mais aussi la poursuite des efforts pour prévenir les excès des enclosures : une loi de 1536 réserve à la culture les terres d'origine monastique pour une durée minimale de vingt ans.
Autant par souci de l'ordre que par préoccupation chrétienne, le roi n'a pas été insensible à la misère : sur la longue route qui mène à la fameuse loi des pauvres d'Élisabeth en 1601, Henri a planté d'importants jalons en confiant, en 1531 et en 1536, des responsabilités de contrôle aux juges de paix et, surtout, en réservant, pour la première fois à cette dernière date, aux paroisses la mission de secourir les indigents.
Il est vrai aussi que le roi, par ses manipulations monétaires des années 1540, destinées à lui procurer des ressources et à alléger ses dettes en faisant varier le titre des pièces et la définition – or ou argent de la livre –, a largement aussi contribué à une hausse erratique des prix et à une baisse des salaires réels. On a estimé à quelque 39 p. 100 la hausse des prix alimentaires de 1541 à 1550, d'où une difficile course entre prix et rémunérations.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=9094#forumpost9094
Posté le : 27/06/2015 20:27
|
|
|
|
|
Henry VIII d'Angleterre 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Mariage avec Anne de Clèves
À la fin des années 1530, Henri VIII voulut à nouveau se marier pour assurer sa succession. Cromwell, devenu comte d'Essex suggéra le choix d'Anne de Clèves, la sœur du duc de Clèves, qui était considéré comme un allié important dans le cas d'une attaque catholique contre l'Angleterre car il disputait le contrôle du duché de Gueldre à Charles Quint. Hans Holbein le Jeune fut envoyé à Clèves pour réaliser un portrait d'Anne destiné au roi. Même s'il fut avancé qu'Holbein enjoliva son œuvre, il est plus probable que le portrait était exact ; Holbein resta d'ailleurs en faveur à la cour. Après avoir vu le tableau et entendu ses courtisans réaliser des descriptions flatteuses de la princesse, le roi accepta d'épouser Anne. Henri VIII fut néanmoins déçu de son apparence lors de leur première rencontre le 3 janvier 1540 mais le mariage fut néanmoins organisé trois jours plus tard. Il fut rapidement décidé d'annuler cette union et Anne ne s'y opposa pas; peut-être en récompense de sa docilité, elle reçut le titre de sœur aimée du roi ainsi qu'une résidence et une généreuse pension. La nièce de Thomas Howard, Catherine, était l'une des dames de compagnie d'Anne et elle attira rapidement l'attention du roi ; cela inquiéta Cromwell car Howard était l'un de ses principaux opposants.
Peu après, les réformateurs et protégés de Cromwell, Robert Barnes et Thomas Garret, furent brûlés comme hérétiques. Dans le même temps, Cromwell perdit les faveurs d'Henri VIII pour des raisons qui restent incertaines ; ses idées en politique intérieure et étrangère différaient peu de celles du roi et malgré son rôle dans l'affaire, il ne fut pas officiellement tenu pour responsable de l'échec du mariage avec Anne de Clèves. Il était néanmoins isolé à la cour tandis que Howard pouvait s'appuyer sur la position de sa nièce. Cromwell fut accusé de trahison, d'hérésie et de corruption et fut exécuté le 28 juillet 1540.
Mariage avec Catherine Howard
Le 28 juillet 1540, le jour de l'exécution de Cromwell, Henri VIII épousa la jeune Catherine Howard de 30 ans sa cadette. Il fut ravi de sa nouvelle reine et lui accorda les propriétés de Cromwell et de nombreux joyaux. Peu après le mariage, Catherine eut néanmoins une aventure avec le courtisan Thomas Culpeper et elle employa comme secrétaire personnel, Francis Dereham, avec qui elle avait été informellement fiancée avant son union avec le roi. Les rumeurs devinrent pressantes en 1541 et Henri VIII, qui ne se trouvait pas à la cour, chargea Thomas Cranmer d'enquêter. Le souverain refusa de croire ces allégations malgré les preuves fournies par l'archevêque et les aveux de Catherine ; lorsqu'il réalisa, Henri VIII éclata de rage et blâma le conseil privé avant de se consoler en allant chasser. La reine aurait pu avoir mentionné l'existence de fiançailles informelles avec Dereham, ce qui aurait invalidé son mariage avec le roi mais elle avança que Dereham l'avait contrainte à l'adultère. De son côté, ce dernier révéla la relation de la reine avec Culpeper qui fut condamné pour trahison. Il fut décapité le 10 décembre 1541 tandis que Dereham fut pendu, éviscéré et démembré le même jour. Catherine connut un sort identique à Culpeper le 13 février 1542.
La paix entre Charles Quint et François Ier fut brève et les hostilités reprirent dès 1542. Irrité par l'influence française en Écosse, Henri VIII se rapprocha de l'empereur même si ce dernier lui reprochait son éloignement du catholicisme. Une invasion de la France fut planifiée pour 1543 et Henri VIII décida au préalable d'éliminer la potentielle menace écossaise. Cela lui permettrait également d'imposer la Réforme protestante dans une région encore largement catholique et d'unifier les deux Couronnes en mariant son fils Édouard à Marie, la fille du roi d'Écosse Jacques V. Cette campagne, qui se poursuivit sous le règne d'Édouard VI, fut surnommée le Rough Wooing rude séduction. Les Écossais furent battus lors de la bataille de Solway Moss le 24 novembre 1542 et Jacques V mourut le 15 décembre. Le régent James Hamilton signa le traité de Greenwich prévoyant le mariage mais l'accord fut rejeté par le Parlement écossais en décembre 1543 qui renouvela de plus son alliance avec la France. Henri VIII organisa une nouvelle offensive et ses troupes incendièrent Édimbourg en mai 1544 avant d'être battues à Ancrum Moor en février 1545. Les hostilités se prolongèrent après la mort d'Henri VIII jusqu'en 1551.
Malgré ses succès en Écosse, Henri VIII hésita à attaquer la France avant d'ordonner une double invasion en juin 1544. La première menée par Thomas Howard attaqua sans succès Montreuil tandis que la seconde commandée par Charles assiégea Boulogne-sur-Mer. Henri VIII prit personnellement le contrôle de ses troupes et Boulogne tomba le 18 septembre. La campagne de Charles Quint était cependant dans l'impasse et il décida unilatéralement de signer une trêve avec François Ier le jour de la chute de Boulogne à la colère d'Henri VIII. L'Angleterre étant à présent seule contre la France, les gains anglais furent rapidement repris mais une tentative d'invasion française fut repoussée à l'été 1545. L'épuisement des deux belligérants entraîna la signature du traité d'Ardres le 7 juin 1546.
Mariage avec Catherine Parr
Henri épousa sa sixième et dernière épouse, la riche veuve Catherine Parr, en juillet 1543. Réformatrice convaincue, elle échangea beaucoup avec le roi au sujet de la religion mais ce dernier resta fidèle à une idiosyncrasie catholique et protestante. Parr contribua à réconcilier Henri VIII avec ses filles et le Third Succession Act de 1543 ramena Marie et Élisabeth dans l'ordre de succession même si elles se trouvaient après Édouard. Elles restaient néanmoins juridiquement illégitimes et le texte contenait plusieurs provisions comme une interdiction de se marier sans l'accord du conseil privé.
Mort et succession
À la fin de sa vie, Henri VIII était devenu obèse avec un tour de taille de 53 pouces 135 cm et un poids de 28 stones 178 kg. Il souffrait probablement de la goutte et présentait de nombreux furoncles douloureux. Son obésité et ses autres problèmes médicaux étaient certainement liés à la blessure à la jambe qu'il avait subi lors du tournoi de joute de 1536. L'incident aggrava un ancien traumatisme et ses médecins furent incapables de traiter la blessure qui suppura et s'ulcéra jusqu'à sa mort. En plus de l'empêcher de maintenir son niveau d'activité antérieur, on considère que cet accident est à la cause de ses sautes d'humeur qui eurent une profonde influence sur sa personnalité.
La théorie selon laquelle il souffrait de syphilis est rejetée par la plupart des historiens. Une étude plus récente suggère que ses symptômes étaient caractéristiques d'un diabète de type 2 non traité ou du scorbut, deux maladies pouvant être causées par la consommation de grandes quantités de viande sans fruits ou légumes frais. Certains ont avancé que les fausses couches de ses épouses et la détérioration de son état mental pouvaient laisser penser qu'il souffrait du syndrome de McLeod. Selon une autre étude, l'évolution morphologique d'Henri VIII fut causée par un traumatisme crânien reçu lors de l'accident de joute de 1536 qui affecta son système endocrinien. Une déficience en hormone de croissance est peut-être la cause de sa prise de poids et de ses changements de comportement dans ses dernières années dont ses multiples mariages.
L'obésité d'Henri VIII s'aggrava avant sa mort le 28 janvier 1547 à l'âge de 55 ans au palais de Whitehall. Ses derniers mots auraient été Monks! Monks! Monks! Moines ! Moines ! Moines ! peut-être en référence aux ecclésiastiques expulsés lors de la dissolution de leurs monastères. Il fut enterré dans le chœur de la chapelle Saint-George du château de Windsor dans le caveau où reposait Jeanne Seymour. Plus d'un siècle plus tard, Charles Ier fut inhumé dans le même caveau.
Après sa mort, son seul fils légitime, Édouard devint roi sous le nom d'Édouard VI. Comme il n'avait que neuf ans, il ne pouvait pas gouverner et le testament d'Henri VIII désignait seize exécuteurs testamentaires pour former un conseil de régence jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Les exécuteurs choisirent Edward Seymour, le frère aîné de Jeanne Seymour, pour devenir lord protecteur du Royaume. Édouard VI mourut sans enfants en 1553 à l'âge de 15 ans et sa demi-sœur Marie devint reine sous le nom de Marie Ire après une brève crise de succession. Elle n'eut pas non plus de descendance et à sa mort en 1558, la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn devint Élisabeth Ire. Le testament prévoyait que si la lignée de cette dernière s'éteignait, la Couronne serait transmise aux descendants de la sœur d'Henri VIII, Marie Tudor, tandis que ceux de son autre sœur, Marguerite Tudor, étaient exclus de la succession. Cette dernière disposition ne fut pas respectée quand son arrière-petit-fils Jacques VI d'Écosse devint Jacques Ier d'Angleterre à la mort d'Élisabeth Ire en 1603. La dynastie Tudor disparut donc au profit de la dynastie Stuart et l'union des Couronnes rapprocha les deux pays qui fusionnèrent en 1707 pour former le Royaume de Grande-Bretagne.
Image publique
Henri VIII cultivait l'image d'un homme de la renaissance et sa cour aiguillait de nombreux artistes et intellectuels. Il appréciait particulièrement la musique et il soutint des compositeurs comme Richard Sampson et Ambrose Lupo. Il possédait une grande collection d'instruments et jouait du luth, de l'orgue et du virginal. Il pouvait lire à vue la musique et chantait bien. Il était un musicien, un auteur et un poète accompli ; son œuvre la plus connue est Pastime with Good Company tandis que Greensleeves lui est, à tort, populairement attribué. Il était un parieur invétéré, adorait les jeux de dés et excellait à la joute, à la chasse et au jeu de paume. Il participa à la construction et au développement de nombreux bâtiments importantes dont le palais de Sans-Pareil, la King's College Chapel et l'abbaye de Westminster. Beaucoup de travaux furent réalisés dans les propriétés confisquées à Wolsey telles que le Trinity College, le Christ Church, le château de Hampton Court et le palais de Whitehall.
Il était le premier roi d'Angleterre à avoir eu une éducation humaniste, maîtrisait le français, l'anglais et le latin et possédait une vaste bibliothèque dont il annota beaucoup d'ouvrages. Pour promouvoir la réforme de l'Église auprès du peuple, Henri VIII commanda de nombreux pamphlets comme l'Oratorio 1534 de Richard Sampson qui défendait une obéissance absolue envers la monarchie et affirmait que l'Église anglaise avait toujours été indépendante de Rome. Des troupes de théâtre et des ménestrels voyageaient de ville en ville pour faire connaître les nouvelles pratiques religieuses ; le pape et les prêtres catholiques étaient ridiculisés tandis que le roi était présenté comme un défenseur héroïque de la vraie foi.
Henri VIII était un homme fort et de grande taille, plus de 6 pieds 183 cm qui excellait à la chasse et à la joute. Plus que de simples passe-temps, ces activités étaient des outils politiques lui permettant de renforcer son image royale, d'impressionner les diplomates et les dirigeants étrangers et de démontrer sa capacité à écraser toute opposition. Il organisa ainsi un tournoi de joute à Greenwich en 1517 au cours duquel il porta une armure dorée avec une tunique en velours et satin ornée de perles et de joyaux. Cela impressionna les ambassadeurs présents et l'un d'eux rapporta que la richesse et la civilisation du monde sont ici et ceux qui qualifient les Anglais de barbares me semblent en fait en être. Henri VIII abandonna la joute en 1536 après une chute qui le laissa inconscient pendant deux heures mais il continua de soutenir deux fastueux tournois chaque année. Cette baisse d'activité physique causa sa prise de poids et la disparition du personnage athlétique qui l'avait rendu si élégant, et tranche avec l'image donnée par les portraits d'Holbein : Henri VIII, immonde tâche de graisse et de sang sur l'histoire d'Angleterre, incapable, à la fin de sa vie, de franchir certaines portes de Whitehall tant il était obèse, est-ce vraiment lui cette idole impassible offerte à la vénération de ses sujets ? .
Administration Gouvernement
L'autorité des souverains Tudor, dont Henri VIII, était entière car ils revendiquaient un pouvoir de droit divin. La Couronne disposait de prérogatives royales regroupant des privilèges comme la diplomatie, les déclarations de guerre, la gestion de la monnaie, le droit d'amnistie et le pouvoir de convoquer et de dissoudre à volonté le Parlement. Le pouvoir d'Henri VIII n'était cependant pas absolu et le roi devait respecter des limites légales et financières qui l'obligeaient à travailler étroitement avec la noblesse et le Parlement. En pratique, le souverain utilisait le patronage pour établir une cour royale comprenant des institutions officielles comme le conseil privé et des groupes plus ou moins formels. L'ascension et la chute des nobles à la cour pouvait être rapide. Le chiffre de 72 000 exécutions durant son règne est fréquemment avancé mais est exagéré; Henri VIII fit néanmoins exécuter deux de ses épouses, vingt nobles, quatre haut-fonctionnaires, six proches conseillers, un cardinal John Fisher et de nombreux ecclésiastiques. Parmi les personnalités en faveur auprès du roi figurait généralement son chef ministre même si l'un des plus importants débats historiographique sur son règne est de savoir dans quelle mesure ces conseillers contrôlaient Henri VIII ou vice-versa. L'historien Geoffrey R. Elton estime ainsi que l'un de ces ministres, Thomas Cromwell, mena une révolution du gouvernement Tudor de manière relativement indépendante du roi qu'Elton qualifie d'opportuniste qui comptait sur d'autres pour faire la plus grande part du travail. Il estime également que lorsqu'Henri VIII participait à la gouvernance du pays, cela n'était généralement pas à son avantage. L'importance des luttes entre factions politiques à la cour est également discutée débattue dans le contexte des différents mariages du roi dont notamment la chute d'Anne Boleyn.
De 1514 à 1529, le cardinal Thomas Wolsey supervisa la politique étrangère et intérieure du royaume pour le compte du jeune Henri VIII en tant que lord chancelier141. Il aida à combler le vide créé par la faible participation du roi au gouvernement, notamment en comparaison de son père, mais il le fit essentiellement en prenant la place du souverain. Wolsey centralisa l'administration et élargit la juridiction des cours de justice dont la chambre étoilée qu'il utilisa à son profit pour écarter ses adversaires. Son large enrichissement personnel et son pouvoir irritèrent les nobles tandis que son incapacité à obtenir le divorce du roi avec Catherine d'Aragon déçut profondément Henri VIII. Après seize années au sommet, il fut limogé en 1529 avant d'être arrêté pour trahison l'année suivante et de mourir en détention. Sa chute fut un avertissement pour le pape et le clergé s'ils refusaient de satisfaire les demandes du roi. Henri VIII intervint plus fréquemment en politique mais les nombreuses factions à la cour continuèrent de se livrer une lutte acharnée pour le pouvoir.
Thomas Cromwell joua également un rôle considérable durant le règne d'Henri VIII lorsqu'il devint son principal conseiller en 1531. Poussé en partie par ses croyances religieuses, il tenta de réformer l'administration via la négociation sans essayer d'imposer de changements trop brusques. Ses principales mesures visaient à retirer une partie des prérogatives royales mais cette évolution ne fut pas complète car il devait conserver le soutien du roi et de ses pairs. Cromwell optimisa la collecte des impôts décidés par Henri VII et délégua leur gestion à des structures largement indépendantes. L'autorité du conseil royal fut transféré à un conseil privé réformé plus réduit et plus efficace que ses prédécesseurs. L'économie anglaise profita de ses réformes mais sa chute affecta fortement la bureaucratie qui nécessitait son intervention pour éviter les dépenses trop importantes détériorant les relations autant que les finances. L'influence de Cromwell dans le mariage à Anne de Clèves, bien que non fatale en elle-même, l'affaiblit alors que ses opposants gagnaient en pouvoir. Henri VIII épousa ensuite Catherine Howard, la nièce de Thomas Howard, et ce fut ce dernier qui organisa sa chute. Cromwell fut décapité le 28 juillet 1540.
Finances
Financièrement, le règne d'Henri VIII fut un désastre. Il hérita d'une économie prospère et le trésor royal fut alimenté par les biens confisqués à l'Église mais sa mauvaise gestion et ses dépenses considérables affectèrent l'économie. Il possédait ainsi près de 2 000 tapisseries dans ses palais contre seulement 200 pour le roi Jacques V d'Écosse et il était très fier de sa collection d'armes composée d'environ 9 000 pièces.
Henri VIII hérita d'une large fortune de son père qui, à sa différence, avait été économe et prudent avec l'argent. Cette somme était estimée à 1,25 millions de livres soit 328 milliards de livres de 2012. Une grande partie de cette richesse fut utilisée pour l'entretien de la cour et de ses résidences dont beaucoup furent agrandies. Les souverains Tudor devaient financer toutes les dépenses gouvernementales avec leurs propres revenus tirés des terres de la Couronne et des droits de douanes accordés par le Parlement. Durant son règne, les revenus de la couronne restèrent constants autour de 100 000 £ par an, environ 17,3 milliards de livres de 2012 mais furent érodés par l'inflation causée par les guerres. Ce furent ainsi les interventions européennes d'Henri VIII qui épuisèrent le surplus laissé par son père dès le milieu des années 1520. Alors qu'Henri VII avait peu fait appel au Parlement, son fils fut contraint de le solliciter pour accroître ses revenus et le financement de ses conflits. La dissolution des monastères permit de renflouer les caisses de l'État et la valeur des terres confisquées représentait 120 000 £ environ 22,6 milliards de livres de 2012. En 1526, la Couronne dévalua légèrement la monnaie puis de manière plus importante sous l'administration de Cromwell. La livre anglaise perdit la moitié de sa valeur par rapport à la livre flamande entre 1540 et 1551. Cela permit d'accroire les revenus de la Couronne mais affecta fortement l'économie et cela contribua à une période de très forte inflation après 1544.
Réforme anglaise.
Henri VIII est généralement crédité pour le développement de la Réforme anglaise qui fit passer l'Angleterre de la sphère catholique à la sphère protestante. En 1527, le roi, jusque-là un catholique fervent, fit appel au pape pour lui demander l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Le refus papal, en partie attribué aux pressions de Charles Quint, a été traditionnellement considéré comme le déclencheur du rejet de la suprématie pontificale par Henri VIII alors qu'il avait auparavant défendu cette doctrine. L'historien Albert Pollard estime néanmoins que même s'il n'avait pas eu besoin d'un divorce, le roi aurait certainement rejeté l'influence papale sur l'Angleterre pour des raisons purement politiques.
Quelles qu'en soient les raisons, Henri VIII introduisit plusieurs législations entre 1532 et 1537 pour structurer l'Église d'Angleterre naissante et affaiblir l'influence du pape. La loi sur la restriction de l'appel de 1533 permettaient d'accuser de trahison et de condamner à mort ceux qui défendaient les bulles pontificales en Angleterre. D'autres lois renforçaient le pouvoir royal sur l'Église dont le Suffragan Bishops Act de 1534 qui obligeait le clergé à élire des évêques nommés par le souverain. La même année, l'acte de suprématie faisait du roi l' unique chef suprême de l'Église d'Angleterre du Terre et refuser le serment de suprématie reconnaissant cela était passible de mort d'après le Treasons Act. De même, tous les sujets du Royaume devaient accepter par serment l'invalidité du mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon et la validité de celui avec Anne; ceux qui refusaient pouvaient être emprisonnés à vie et tout éditeur ou imprimeur de documents avançant que le mariage avec Anne était invalide pouvaient être exécutés. Enfin, après l'excommunication du roi, l'Ecclesiastical Licences Act supprimait le denier de Saint-Pierre et affirmait que la couronne impériale d'Henri VIII avait été affaiblie par les usurpations et les exactions déraisonnables et peu charitables du pape.
Malgré l'opposition de Cromwell, Henri VIII insista pour utiliser le temps parlementaire afin de discuter de questions religieuses et cette initiative fut ensuite défendue par Howard. Cela entraîna l'adoption des Six Articles qui réaffirmait la doctrine catholique traditionnelle sur plusieurs points fondamentaux comme la transsubstantiation et limitait l'expansion de la Réforme en Angleterre. Cela fut suivi par le développement d'une liturgie réformée et du livre de la prière commune sous l'influence de Cranmer mais ce processus ne fut pas achevé avant 1549. Le reste du règne d'Henri VIII vit un lent éloignement de l'orthodoxie religieuse et cette évolution fut aidé par la mort des principaux dignitaires religieux d'avant le schisme avec Rome dont notamment les exécutions de Thomas More et de John Fisher qui avaient refusé de renoncer à l'autorité papale. Henri VIII établit une nouvelle théologie politique de l'obéissance à la Couronne qui reflétait la nouvelle interprétation par Martin Luther du quatrième commandement Honore ton père et ta mère introduite en Angleterre par William Tyndale. Les protestants furent néanmoins persécutés sous son règne en particulier du fait de leur refus de reconnaître l'annulation de son mariage et beaucoup quittèrent le Royaume.
Lorsque les taxes auparavant payées à Rome furent transférées à la Couronne, Cromwell réalisa le besoin d'évaluer la valeur des importantes possessions de l'Église et cela donna naissance au compendium Valor Ecclesiasticus, Valeur de l'Église. En septembre 1535, il exigea une inspection plus complète des institutions religieuses et la vie des moines fut rendue plus difficile par les prêches les accusant d'être des parasites improductifs. Les informations accumulées entraînèrent en janvier 1536 le début de la dissolution de tous les monastères par laquelle toutes les institutions aux revenus annuels inférieurs à 200 £ environ 96 000 £ de 2012 furent saisies par la Couronne. Les autres couvents furent progressivement transférés à la Couronne et à de nouveaux propriétaires. En janvier 1540, près de 800 monastères avaient été dissous ; le processus avait été efficace et n'avait rencontré que peu d'opposition. Les actions de Cromwell permirent le transfert d'environ 20% de la richesse foncière anglaise dans de nouvelles mains et créèrent une aristocratie terrienne redevable à la Couronne.
Les réponses à la Réforme furent variées. Les monastères étaient les seuls soutiens des plus pauvres et leur dissolution fut une des causes du soulèvement du Pèlerinage de Grâce de 1536-1537. Ailleurs, les changements furent acceptés et ceux qui conservèrent les rites catholiques entrèrent dans la clandestinité. Ils réémergèrent lors du règne de Marie Ire entre 1553 et 1558.
Militaire
En dehors des garnisons de Berwick, de Calais et de Carlisle, l'armée professionnelle anglaise ne comptait que quelques centaines d'hommes et sa taille ne fut que légèrement accrue par Henri VIII. Lors de l'invasion de la France en 1513, l'armée était composée de 30 000 vougiers et archers à une époque où les autres nations européennes commençaient à adopter les piques et les arquebuses. L'influence de ces armes n'était pas encore décisive et les Anglais furent capables de combattre à égalité avec leurs adversaires.
Henri VIII est traditionnellement présenté comme l'un des fondateurs de la Royal Navy grâce à sa création de ports permanents pour la flotte. Il semble qu'il ait également supervisé la conception de certains navires comme des galères. L'artillerie navale se développa sous son règne et des canons de plus en plus grands furent installés à bord des navires, ce qui contribua à l'abandon de la tactique de l'abordage. La taille de la flotte passa à cinquante navires dont certains très modernes comme la Mary Rose et Henri VIII établit un conseil pour gérer l'entretien et le déploiement de la Marine qui devint par la suite l'Amirauté.
La rupture d'Henri VIII avec Rome accrut la menace d'une invasion française ou espagnole. Pour se prémunir contre cette éventualité, il ordonna à partir de 1538 la construction d'une série de fortifications coûteuses et modernes telles que le château de Deal le long des côtes méridionales du Kent à la Cornouailles. Wolsey avait auparavant organisé un recensement de la population afin de réformer la milice mais aucune réforme ne fut lancée avant le règne de Marie Ire.
Irlande Reconquête de l'Irlande par les Tudors.
La division de l'Irlande en 1450
Au début du règne d'Henri VIII, l'Irlande était de fait divisée en trois zones : le Pale où la domination anglaise était sans opposition ; le Leinster et le Munster surnommés les terres obéissantes contrôlés par les nobles anglo-irlandais et le Connacht et l'Ulster où le contrôle anglais était limité. Jusqu'en 1513, Henri VIII poursuivit la politique de son père qui consistait à autoriser les nobles irlandais, et notamment la famille FitzGerald, à gouverner au nom du roi afin de limiter les coûts de la colonie et de protéger le Pale. Cet équilibre fut déstabilisé par la mort du lord deputy Gerald FitzGerald en 1513 et la politique plus ambitieuse du nouveau roi. Son successeur et fils, également nommé Gerald FitzGerald, lutta énergiquement contre les seigneurs irlandais qui s'opposaient à l'influence anglaise mais son autonomie déplaisait à Henri VIII qui le renvoya en 1520. Il fut néanmoins contraint de le rappeler en 1524 car il était le seul à pouvoir maintenir un semblant d'ordre sur l'île. Lorsqu'en 1534, Gerald Fitzgerald fut convoqué à Londres et accusé de trahison, son fils Thomas organisa un soulèvement et mena une croisade catholique contre le roi. L'insurrection, qui menaçait de se transformer en guerre civile, fut réprimée par l'intervention de l'armée anglaise et Thomas Fitzgerald fut exécuté.
Même si la révolte fut suivie par la volonté d'un plus grand contrôle de l'Irlande, Henri VIII souhaitait éviter un conflit avec les seigneurs locaux et une commission royale recommanda une politique de diplomatie pour les assurer que leurs terres ne seraient pas menacées par l'expansion anglaise. Anthony St Leger fut ainsi nommé lord deputy et le resta jusqu'à la fin du règne d'Henri VIII. Il appliqua une politique de renonciation et restitution qui transforma l'organisation du pouvoir en Irlande, traditionnellement basée sur les clans et les liens familiaux, en un système semi-féodal. Les propriétaires fonciers renonçaient à leurs terres et les cédaient au roi. En jurant fidélité au roi, leurs terres leur étaient restituées avec un titre de noblesse et ils pouvaient siéger à la Chambre des Lords irlandaise. En pratique, les seigneurs acceptèrent leurs nouveaux privilèges mais continuèrent à se comporter comme avant.
Héritage
La complexité et l'importance de l'héritage d'Henri VIII contribua à ce que, dans les mots des historiens Betteridge et Freeman, tout au long des siècles depuis sa mort, Henri VIII a été loué et vilipendé mais jamais il ne fut ignoré. L'un des débats de l'historiographie moderne est de savoir dans quelle mesure les événements de la vie d'Henri VIII dont ses mariages et sa politique étrangère et domestique furent le résultat de ses actions, et si cela fut le cas, si elles étaient volontaires ou opportunistes138. Dans son évaluation du règne d'Henri VIII publiée en 1902, Albert Pollard le loua comme le roi et le chef d'État qui, quels que soient ses défauts, mena l'Angleterre sur la route de la démocratie parlementaire et de l'Empire. L'interprétation de Pollard resta la plus influente jusqu'à la publication de la thèse de doctorat de Geoffrey R. Elton en 1953. Cette dernière intitulée The Tudor Revolution in Government reprit l'interprétation positive de Pollard de la période mais en présentant Henri VIII comme un suiveur plutôt que comme un meneur. Pour Elton, ce fut Cromwell et non Henri VIII qui entreprit la réforme du gouvernement. Il ne fut donc, en d'autres mots, rien de plus qu'une monstruosité égocentrique dont le règne « dut ses réussites aux meilleurs et aux plus grands hommes ; la plupart de ses horreurs et échecs émanant plus directement du roi.
Même si les principaux arguments de la thèse d'Elton ont aujourd'hui presque tous été abandonnés, elle a contribué à la réalisation de nouveaux travaux de recherches comme ceux de son étudiant, Jack Scarisbrick. Ce dernier conserva son évaluation positive de Cromwell mais estima qu'Henri VIII avait eu le dernier mot dans la création et l'application des politiques gouvernementales. Scarisbrick considérait cependant que cette capacité avait été néfaste car son règne fut marqué par les troubles et les destructions et que ceux au pouvoir méritaient plus les blâmes que les louanges. Même dans les biographies plus récentes, comme celles de David Loades, David Starkey et de John Guy, l'étendue de la responsabilité d'Henri VIII dans les changements de son règne continue de faire débat.
Ce manque de certitude sur le contrôle d'Henri VIII sur les événements a contribué à la variété de traits de personnalité qui lui ont été attribués. Une approche traditionnelle, développée entre autres par Starkey, est de diviser en deux le règne d'Henri VIII : une première positive avec un roi pieux, athlétique et érudit qui présida à une période de stabilité et la seconde avec un tyran imposant qui régna lors d'une époque de changements profonds et parfois fantasques.
Henri VIII a été joué à l'écran par:
Tefft Johnson dans le film Cardinal Wolsey 1912
Emil Jannings dans le film Anne Boleyn 1920
Lyn Harding dans les films When Knighthood Was in Flower 1922 et Les Perles de la Couronne 1937
Charles Laughton dans les films La Vie privée d'Henry VIII 1933 et La Reine vierge 1953
Montagu Love dans le film Le Prince et le Pauvre 1937
Ralph Forbes dans le film La Tour de Londres 1939
James Robertson Justice dans le film La Rose et l'Épée 1953
Robert Shaw dans le film Un homme pour l'éternité 1966
Richard Burton dans le film Anne des mille jours 1969
Keith Michell dans le film Les Six Femmes d'Henry VIII 1972
Charlton Heston dans le film Le Prince et le Pauvre 1978
Jared Harris dans le film The Other Boleyn Girl 2003
Ray Winstone dans le film Henry VIII 2003
Eric Bana dans le film Deux sœurs pour un roi 2008
Jonathan Rhys Meyers dans la série Les Tudors 2008-2010
Damian Lewis dans la mini-série Wolf Hall 2015
Henri VIII a également fait l'objet d'une pièce de théâtre de William Shakespeare en 1623 et d'un opéra de Camille Saint-Saëns en 1883.
Titre et armoiries
Armoiries d'Henri VIII durant son règne
Le titre d'Henri VIII connut plusieurs évolutions durant son règne. Il utilisait initialement le titre : Henri VIII, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, de France et seigneur d'Irlande ». Les revendications sur le trône de France n'étaient que symboliques et étaient invoquées par tous les rois d'Angleterre depuis Édouard III, peu importe la quantité de territoires français contrôlés. En 1521, le pape Léon X lui accorda le titre de défenseur de la foi mais il lui fut retiré par Paul III à la suite de son excommunication ; le Parlement adopta néanmoins une loi pour confirmer sa validité et il reste encore utilisé de nos jours. La devise d'Henri VIII était Cœur Royal » et son emblème était la rose Tudor. Durant son règne, ses armoiries étaient les mêmes que celles de ses prédécesseurs depuis Henri IV : Écartelé, trois fleurs de lys or sur fond azur qui est France et trois lions en pal or qui est Angleterre.
En 1535, Henri VIII ajouta le titre de chef suprême de l'Église d'Angleterre : Henri VIII, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, de France, défenseur de la foi, seigneur d'Irlande et de l'Église d'Angleterre sur Terre, chef suprême. L'année suivante, la partie de l'Église d'Angleterre devint de l'Église d'Angleterre et aussi d'Irlande. En 1541, le Parlement d'Irlande adopta le Crown of Ireland Act qui créait le titre de roi d'Irlande en lieu et place de celui de seigneur d'Irlande. Cette évolution avait été voulue par Henri VIII quand on l'avait informé que de nombreux Irlandais considéraient le pape comme le véritable chef de leur pays tandis que le seigneur n'était qu'un simple représentant. De fait, la suzeraineté de l'île avait été accordé au roi Henri II d'Angleterre par le pape Adrien IV au xiie siècle. Le titre de Henri VIII, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, de France et d'Irlande, défenseur de la foi et de l'Église d'Angleterre et aussi d'Irlande sur Terre, chef suprême resta en vigueur jusqu'à la fin de son règne.           
Posté le : 27/06/2015 20:16
|
|
|
|
|
Découverte de la Guadeloupe |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 28 juin 1635 à la Pointe Allègre à Nogent en Guadeloupe
des français débarquent dans l'actuelle ville de Sainte-Rose, accompagnés de 4 dominicains et de 150 hommes dont de nombreux Bretons ou Normands engagés par contrat, pour trois ans, dans le but de faire fortune.
L'histoire de la Guadeloupe, à la fois région d'outre-mer et département d'outre-mer numéro 971 français, fut marquée comme l'histoire de la Martinique et l'histoire de la Jamaïque par la déportation massive, à partir des années 1670, d'esclaves noirs africains, ancêtres de l'immense majorité de la population actuelle, phénomène qui a marqué également dès 1640 l'histoire de la Barbade puis vers 1700 l'histoire de Saint-Domingue.
Ce petit territoire des Antilles mer des Caraïbes situé à environ 600 km au nord des côtes de l'Amérique du Sud, à 600 km à l'est de la République dominicaine et à 950 km au sud-est des États-Unis fut plusieurs fois investi par les Anglais et connut la Révolution française plus longtemps que la Martinique.
Les Amérindiens en Guadeloupe
Selon les données archéologiques, les premiers signes d'occupation de la Guadeloupe datent d'environ 300 avant J.-C. Ces peuples d'Arawaks y développèrent essentiellement l'agriculture, et auraient été exterminés par des peuples plus belliqueux : les Caraïbes. Ces derniers nommèrent l'île Caloucaera Karukera, mot voulant dire l'île aux belles eaux. Ces communautés sont celles qu'ont rencontrées les premiers Européens débarqués sur l'île.
Arrivée des premiers Européens en Guadeloupe
Les cinq îles de la Guadeloupe clairement identifiées et nommées Isla de Guadalupe, Isla Deserada, Marígalante et Todos Santos sur le planisphère de Cantino datant de 1502.
21 jours après avoir quitté les îles Canaries, au cours de son deuxième voyage, Christophe Colomb aperçoit une première terre : La Désirade, qu'il baptise ainsi Desirada, tant la vue d'une terre fut désirée par l'équipage. Le dimanche 3 novembre 1493, une autre île est en vue, que Colomb nomme Maria Galanda Marie-Galante, du nom du navire amiral. Après un passage d'une nuit à la Dominique, ils reprennent la mer vers une île plus grande dont ils avaient aperçu au loin les montagnes. Colomb décide alors de jeter l'ancre devant cette île afin d'accorder quelques jours de repos à ses hommes.
Le 4 novembre 1493, il débarque sur l'île principale nommée par les Caraïbes Karukera ou Caloucaera. Il baptise cette île Guadalupe du nom du monastère royal de Santa Maria de Guadalupe en Espagne. Lors d'un pèlerinage, Colomb aurait fait la promesse aux religieux de donner le nom de leur monastère à une île ou alors, il s'était fait cette promesse à lui-même lors des tempêtes de son retour en Europe en 1492. Il semblerait également que Colomb ait été inspiré par les chutes du Carbet, lui rappelant les cascades présentes dans la région d'Estremadure Espagne où se situe le monastère.
Les débuts de la colonisation
Les Espagnols se préoccupent peu de l'île au long du XVIe siècle. En effet, cette île est relativement inhospitalière, et ne possède aucune mine d'or. Elle servira alors daiguade : point de ravitaillement en eau douce et en bois, pour les navires en route vers l'Eldorado.
Au début, les Caraïbes tolèrent ces marins de passage, et parfois même fraternisent avec eux, mais petit à petit les hostilités grandissent entre les indigènes et les Espagnols.
Les Caraïbes, aguerris au combat, résistent à la présence grandissante des Européens, jusqu'à ce qu'une cédule royale datant d'octobre 1503, autorise aux Espagnols la capture d'Indiens habitant les îles sans or. Plusieurs expéditions et raids au cours du xvie siècle ont lieu dans le but de capturer des Caraïbes et de les faire travailler, de pacifier puis de coloniser ces îles.
En 1515, Juan Ponce de León, conquérant de Porto Rico et Antonio Serrano décident de pacifier la Guadeloupe et d'y installer définitivement des colons ibériques sur l'île, avec trois navires et trois cents hommes de guerre. Cachés en embuscade, les Caraïbes foncent sur ceux qui débarquent, les tuent et en font des prisonniers.
Lassés, les Espagnols, qui préfèrent les terres plus riches de l'Amérique centrale, abandonnent progressivement les Petites Antilles aux expéditeurs et flibustiers anglais, français et hollandais. Ceux-ci font escale régulièrement à partir de 1550 pour faire du commerce avec les Amérindiens.
Les Français arrivés en 1635, et les amérindiens
Les Français, menés par Jean du Plessis d'Ossonville et Charles Liènard de l'Olive débarquent le 28 juin 1635 à la Pointe Allègre à Nogent, dans l'actuelle ville de Sainte-Rose Guadeloupe, accompagnés de 4 dominicains et de 150 hommes dont de nombreux Bretons ou Normands engagés par contrat, pour trois ans, dans le but de faire fortune.
Du Plessis et De L'Olive sont mandatés par la Compagnie des îles d'Amérique pour évangéliser les indigènes. Les premiers mois sont difficiles maladies, manque de nourriture : nombre de colons périssent. Les survivants s'installent au sud, près de l'actuel Vieux-Fort. Ils reçoivent l'aide des Caraïbes. Contre l'avis de Du Plessis, Charles Liènard de l'Olive leur déclare la guerre pour prendre vivres et femmes. Les Français vont alors pratiquement exterminer les amérindiens.
1640 : signature d'un traité de paix avec les Caraïbes. Les Français vont ensuite importer des esclaves par centaines à partir de 1641 et 1645.
1643 : la ville de Basse-Terre est fondée dans le sud de la Guadeloupe.
1649 : première révolution anglaise, le roi Charles Ier décapité, les monarchistes anglais fuient à la Barbade, poursuivis par les troupes du parlement de Cromwell. L'économie sucrière doit se développer ailleurs qu'à la Barbade. Charles Houël acquiert la Guadeloupe, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes, après avoir laissé la Compagnie des îles d'Amérique, leur propriétaire, tomber en faillite.
1654 : temps fort de l'histoire du Pernambouc au Brésil. Les jésuites portugais gagnent la reconquête contre les Hollandais, qui doivent fuir avec 300 de leurs esclaves. Contre l'avis des jésuites français, Charles Houël leur donne 16 hectares de bonnes terres au lieu-dit Sainte-Marie, à Capesterre de Guadeloupe. La Martinique, partagée entre de nombreux propriétaires, encore peu défrichée et à moitié occupée par les caraïbes, doit leur dire non.
1656 : la Guadeloupe compte 3 000 esclaves noirs, deux fois plus qu'en Martinique
1658 : Guerre de 1658 contre les indiens caraïbes en Martinique.
1664 : Colbert augmente la taxe sur les sucres étrangers importés des Antilles via la marine hollandaise, asphyxiant les planteurs, qui ont peu de navires et sont par ailleurs privés d'approvisionnement en esclaves. La crise sucrière s'installe.
1664 : la Compagnie française des Indes Occidentales prend possession de la Guadeloupe en expropriant Houël et sa famille.
1666 : les Anglais attaquent les Saintes et se dirigent vers la Guadeloupe, mais un cyclone détruit complètement la flotte anglaise le 22 août.
1667 : fin de la Deuxième Guerre anglo-néerlandaise. Le Traité de Breda est signé entre les Français, Danois et Hollandais d'un côté, et les Anglais de l'autre.
1671 : la Guadeloupe a 4 267 esclaves noirs. Il n’y en a que 2 400 en Martinique où les chefs de la guerre contre les caraïbes, dont Pierre Dubuc de Rivery, reçoivent des terres nouvelles.
1674 : La Compagnie des indes occidentales fait faillite. La Guadeloupe devient propriété de Louis XIV. Les planteurs de tabac de Martinique et de Saint-Domingue sont chassés par la création de la ferme du tabac.
1679 : Charles François d'Angennes gouverneur de Marie-Galante, signe avec la Compagnie du Sénégal un contrat pour se faire livrer 1 600 esclaves sur ses plantations du Precheur, en Martinique. En 1682, il obtient le monopole du commerce avec l'empire espagnol.
1680 : la Martinique compte déjà 4 900 esclaves et rattrape ainsi la Guadeloupe en nombre d'esclaves. Elle en compte 15 000 dès 1700, trois ans après l'arrivée de Jean-Jacques Mithon de Senneville
1690 : le prix du sucre, miné par la concurrence, affiche une baisse de 65 % par rapport à son niveau de 1655..
Mise en place de la traite négrière et de l'esclavage
Le Père Labat décrit dans ses ouvrages la société esclavagiste. Les pratiques religieuses européennes, couplées à de longues pratiques militaires, étaient jugées plus ritualisées et ordonnancées que celle des amérindiens. Des engagés de 36 mois sont utilisés pour la fortification de l'île. Une fois affranchis, ils obtiennent des lopins de terre. Les plus riches planteurs de café, de canne à sucre et de coton recherchent alors une nouvelle main d'œuvre meilleur marché, en s'inspirant du succès des planteurs de sucre de la Barbade.
Dès 1641, les colons signent avec les indiens caraïbes un traité pour les expédier sur l'île de la Dominique, ouvrant la voie aux défrichements. En 1656, lorsque des Hollandais arrivent du Brésil et s'installent dans la baie des flammands, les esclaves étaient déjà 3 000 en Guadeloupe, mais minoritaires face aux 12 000 blancs.
En 1671, l'île est encore habitée par de nombreux petits colons blancs qui cultivent du tabac, sur des plantations nécessitant peu de capitaux, dans le cadre de la Compagnie des Indes occidentales. Mais son monopole est aboli en 1671: la traite négrière est ouverte à tous les ports français, dans le but que cette concurrence la rende plus efficace. C'est l'époque où Louis XIV rencontre la veuve Scarron, Marquise de Maintenon, grandie en Martinique, et prête l'oreille à son ministre de la Défense: Louvois dirige la guerre contre les Pays-Bas (1672-1678), jusqu'alors détenteurs de l'asiento, le monopole d'importations des esclaves vers le Nouveau-Monde, organisé par le Traité de Tordesillas, qui interdit aux espagnols de s'aventurer en Afrique, zone réservée par la papauté aux Portugais.
L'augmentation rapide de la population d'esclaves correspond aussi à la création en 1673 par Louis XIV de la Compagnie du Sénégal, ancêtre de la Compagnie de Guinée, dans le sillage de la Compagnie Royale d'Afrique, fondée en 1672 par le duc d'York Jacques Stuart, cousin et allié de Louis XIV, qui deviendra roi d'Angleterre en 1685.
L'investissement rapide et massif des Français et des Anglais dans le commerce triangulaire fait flamber le prix des esclaves sur les côtes d'Afrique, alimentant de nouvelles filières et la construction d'une multitude de forts, mais abaisse le coût de leur transport, au profit des planteurs de sucre. Ceux-ci rachètent alors des terres en Guadeloupe et en Martinique. Le nombre de petits planteurs blancs diminue d'autant plus rapidement que la création de la ferme du tabac en 1674 par Louis XIV entraîne la ruine rapide du tabac français. Moins taxé, moins cher, le tabac produit en Virginie par les grands planteurs jacobite installés par Jacques II profite de la contrebande et prend son essor.
Dès 1674, la Compagnie des Indes occidentales est en faillite, puis dissoute. La Guadeloupe et la Martinique passent sous l'autorité directe du roi de France Louis XIV, qui pousse la culture de la canne à sucre, plus gourmande en capitaux mais beaucoup plus rentable, en donnant des terres à des officiers supérieurs pour les encourager à y importer toujours plus d'esclaves. Le sucre est une culture violente, qui nécessite de grandes propriétés et consomme des esclaves jeunes, rapidement épuisés au travail de coupe et de transport des cannes, qu'il faut régulièrement remplacer par de nouvelles recrues.
La population d'esclaves avait reculé en Guadeloupe entre 1664 et 1671 passant de 6 323 à 4 627 personnes, faute de livraisons suffisantes par une Compagnie des Indes occidentales jugée trop dispersée, car elle s'investit aussi au Canada. Mais après sa dissolution en 1674, le nombre d'esclaves en Guadeloupe remonte rapidement pour atteindre 6 076 personnes dès 1700. L'essor de l'esclavage, au même moment, est encore plus rapide à la Martinique, où la population noire double entre 1673 et 1680. La traite négrière réserve à la Martinique les esclaves les plus résistants, car Louis XIV y a installé plus de nobles de rang élevé et d'anciens officiers, comme le chevallier Charles François d'Angennes.
Cette différence entre les deux îles explique aussi qu'un siècle plus tard, en 1794, Victor Hugues ait pu se rendre maître de la Guadeloupe pour le compte de la Révolution française alors que la Martinique est restée sous la domination des grands planteurs de sucre alliés aux anglais dans le cadre du Traité de Whitehall.
Le choix des noirs comme esclaves est lié à des critères géographiques, comme le climat, mais surtout théologiques, avec l’accord de la papauté. Pour perdurer, l'ère de prospérité des colons nécessitait l'institutionnalisation de l'esclavage codification. La très rentable culture du sucre, que se disputent anglais et français, rapportait beaucoup d'impôts aux Métropoles, générant des travaux de fortification, menés d'une main de maître par Louis XIV, Vauban et relayées par les anglais.
Une société opulente, très hiérarchisée, s'organise, tirant ses principes de fonctionnement des ordres à la fois militaires et religieux.
Les esclaves noirs, d'origines diverses, subirent eux des problèmes de langues et de coutumes ancestrales qui aboutirent à la création de la langue créole et de la culture du même nom.
Révolution et époque napoléonienne
Le préfet colonial François-Marie Perichou de Kerversau, est un général de brigade de l'armée française sous Napoléon Bonaparte, l'un des dragons de Saint-Domingue de l'expédition de Saint-Domingue. Avec le général Jean-Louis Ferrand, il occupe la direction de la partie orientale de Saint-Domingue, de décembre 1803 jusqu'à la bataille de Bataille de Palo Hincado, qui permet aux révolutionnaires espagnols de s'en emparer et de chasser les Français.
Le 24 décembre 1854, à bord de l'Aurélie, les premiers indiens arrivent en Guadeloupe. Ils viennent de la Côte de Coromandel, Pondichéry, de Madras, de la côte de Malabar ou de Calcutta. En 1925, Raymond Poincaré décide d'octroyer définitevement la nationalité française aux ressortissants indiens ainsi que le droit de vote11.
La Guadeloupe contemporaine
Avec 22,7 % de chômeurs12, la Guadeloupe voit ses tensions sociales s'aggraver.
Le 1er décembre 1999 : Lucette Michaux-Chevry, présidente du conseil régional de la Guadeloupe, Alfred Marie-Jeanne, président du conseil régional de la Martinique et Antoine Karam, président du conseil régional de la Guyane, signent à Basse-Terre, chef-lieu du département de la Guadeloupe, la « déclaration de Basse-Terre ». Ils proposeront au président de la République et au gouvernement, une modification législative voire constitutionnelle, visant à créer un statut nouveau de région d'outre-mer autonome doté d'un régime fiscal et social spécial pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, dans le cadre de la République française et de l'Union européenne (article 299-2 du traité d'Amsterdam).
Le 18 janvier 2000 : les conseillers régionaux réunis en séance plénière approuvent la déclaration de Basse-Terre 27 voix pour et 10 voix contre et décident par une délibération d'unir leurs efforts afin de bâtir un projet de développement économique, social et culturel impliquant la prise en compte des identités propres à chaque région et basé sur l'évidence que « la dignité procède du travail et non de l'assistanat ».
Le 10 mai 2001 : le gouvernement a adopté le texte signifiant la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Le 7 décembre 2003 : 72,98 % des électeurs guadeloupéens ont dit non à la réforme institutionnelle soumise par référendum.
Le 23 mai 2004 : Victorin Lurel est élu président de la région.
La Guadeloupe
La Guadeloupe est un archipel des Petites Antilles, situé à 610 de latitude ouest et 160 de latitude nord. Elle couvre une superficie de 1 703 kilomètres carrés et compte une population de 404 000 habitants 2009. Autrefois colonie française, la Guadeloupe est devenue, en 1946, un département de plein exercice, en 1982, une région administrative région mono-départementale et, en 2003, un département et région d’outre-mer D.R.O.M.. L'archipel offre une grande diversité de paysages et possède quelques-uns des milieux naturels les plus attrayants des Antilles. Au niveau de la population guadeloupéenne, la force des particularismes exprime la variété et les nuances des composantes culturelles antillaises.
Un archipel au cœur des Petites Antilles
Les deux îles principales qui composent le territoire de la Guadeloupe sont séparées par un étroit bras de mer appelé Rivière Salée et par une zone de mangroves au niveau du Grand Cul-de-Sac Marin. À l'ouest se situe l'île de la Guadeloupe proprement dite, également appelée Basse Terre, en référence à sa position par rapport à la navigation d'autrefois. C'est une île montagneuse dont la partie sud est constituée de plusieurs édifices volcaniques s'élevant au-dessus de 900 mètres d'altitude. Le plus important d'entre eux est le massif de la Soufrière dont le dôme, signalé par un cratère et des fumerolles, atteint 1 467 mètres. Ce volcan actif est équipé d'un observatoire scientifique permanent, en raison de risques sérieux. Ces massifs forment une barrière aux vents alizés, de sorte que la pluviométrie y est élevée (plus de 4 mètres de précipitations et une nébulosité constante). Sur le versant ouest s'étend une plaine littorale étroite. Le parc national de la Guadeloupe, créé en 1989, qui couvre une superficie de 173 kilomètres carrés est constitué essentiellement des forêts domaniales de l'intérieur de l'île forêt tropicale dense.
À l'inverse, la Grande Terre, située à l'est, est une plate-forme calcaire peu élevée 137 mètres au maximum, disséquée par l'érosion karstique dans la région des Grands Fonds. Au nord de cette île, la table calcaire se brise en de hautes falaises dans la région d'Anse-Bertrand. Sur les côtes est et sud se lovent de belles plages de sable, en forme d'anses, ainsi que quelques mangroves. La plate-forme se prolonge dans le domaine océanique par d'autres îles, aux abords de la Grande Terre : la Désirade et Marie Galante principalement. Plusieurs récifs coralliens bordent ces îles et forment un admirable champ d'observation sous-marin et un abri important pour les poissons et les crustacés.
La petite île de la Désirade est la plus avancée à l'est dans l'océan Atlantique ; elle est peu arrosée par les vents alizés qui la survolent ; l'hydrographie de surface y est si peu abondante que l'eau doit être acheminée par une canalisation à partir de la Grande Terre. La végétation comporte beaucoup de plantes xérophiles.
L'île de Marie Galante, de forme pratiquement circulaire, couvre 158 kilomètres carrés. La table calcaire possède un relief faiblement accidenté et est ourlée de très belles plages. Les sols conviennent à la culture de la canne à sucre et à celle des légumes tropicaux ; la pluviométrie est satisfaisante (1 370 mm à Grand-Bourg).
Les îles des Saintes se situent dans l'axe de l'arc volcanique interne des Petites Antilles et sont alignées sur les massifs de la Basse Terre et de l'île proche de la Dominique Dominica. Deux îles principales ont un modelé bosselé de volcans éteints : la Terre de Haut et la Terre de Bas. Une canalisation sous-marine, qui descend jusqu'à 320 mètres de profondeur, leur apporte l'eau, indispensable, depuis la Basse Terre.
Les deux dernières îles, Saint-Barthélemy et la partie française de Saint-Martin – l'autre partie relève du royaume des Pays-Bas –, rattachées administrativement au département de la Guadeloupe jusqu'en 2007, se situent dans un cadre géographique sensiblement différent. Alignées vers 180 de latitude nord, dans le quart nord-ouest de l'île de la Guadeloupe (Basse Terre), elles en sont séparées par plusieurs autres petites îles « Sous-le-Vent », Montserrat, Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Eustache... qui ne relèvent pas de la souveraineté française.
Saint-Barthélemy appelée souvent Saint-Barth par un raccourci familier est une petite île sèche, peu élevée sommet à 286 mètres au Morne de Vitet, qui possède un grand nombre de belles plages. L'île a été une colonie de la Suède de 1785 à 1878. La partie française de l'île de Saint-Martin fait face à l'île d'Anguilla (un territoire d'outre-mer britannique, très proche. Elle culmine à 424 mètres au Pic du Paradis et est également assez sèche (elle abritait des salines. L'ensoleillement exceptionnel de ces deux îles leur procure un grand avantage pour le tourisme balnéaire et la pratique de nombreux sports. Leur économie a connu une transformation rapide depuis les années 1970, avec un boom de la construction d'hôtels, de résidences à temps partagé et de villas cossues. Une très forte immigration antillaise Haïti et république Dominicaine a suivi. La tradition propre à ces îles Sous-le-Vent, liée aux exemptions douanières et à la contrebande – ce sont des ports francs depuis plusieurs siècles –, le dynamisme du tourisme et de la construction ont amené les collectivités locales à revendiquer davantage d'autonomie vis-à-vis du cadre préfectoral et départemental les rattachant à la Guadeloupe.
Les paysages de l'archipel dévoilent la diversité, la beauté, la violence parfois, des milieux insulaires et marins, qui ont inspiré des poètes comme Saint-John Perse et Daniel Maximin. Mais les formations naturelles, écosystèmes forestiers et savanes, milieux littoraux fragiles sont en danger face aux nouveaux usages plus intensifs, plus polluants et à la négligence des acteurs décharges sauvages. Bon nombre des mangroves ont été détruites pour permettre le creusement de chenaux et pour faire place à des ports de plaisance marinas. Quant aux récifs coralliens frangeants, qui se déploient sur une étendue de 200 kilomètres, ils sont également menacés de surexploitation par les pêcheurs et les touristes. Le Grand Cul-de-Sac Marin a été déclaré réserve de la biosphère par l'U.N.E.S.C.O. en 1992, mais beaucoup d'efforts doivent encore être réalisés pour sensibiliser la population et les acteurs économiques à la protection de cet environnement magnifique.
Un climat tropical à deux saisons
Le climat est caractérisé par une période sèche durant les premiers mois de l'année, appelée temps de carême, suivie de la saison des alizés vents océaniques de l'est qui apportent les pluies, dite aussi saison de l'hivernage – les mois de juillet à novembre recevant le plus de précipitations. Celles-ci atteignent un total de 1 780 mm/an au Raizet aéroport international de Pointe-à-Pitre et 2 460 mm/an à Gourbeyre, au nord-ouest des Trois-Rivières, sur la Basse Terre, ce qui est idéal pour les cultures tropicales. À l'inverse, dans les îles voisines, plus petites et dans les îles du nord, la pluviométrie est souvent insuffisante pour la culture des fruits, des légumes et de la canne à sucre sauf à Marie Galante. Il en va de même pour l'élevage, marginal ou de caractère extensif, car le fourrage fait défaut.
Les données climatiques favorisent le tourisme balnéaire et les activités de plein air nautisme, sports, randonnées une bonne partie de l'année, d'autant que la sensation de chaleur est atténuée par l'action des vents alizés. Cependant, l'archipel se trouve sur le parcours des ouragans ou cyclones qui peuvent causer des dommages très importants et perturber les activités économiques les cyclones David et Frédéric en 1979, et le cyclone Hugo en 1989 qui provoqua la mort d'une vingtaine de personnes.
De la conquête coloniale à la départementalisation
Le peuplement amérindien des îles est attesté depuis au moins 2 500 ans avant J.-C. Les premiers habitants, les Arawaks, sont arrivés du continent sud-américain (bassin du fleuve Orénoque en naviguant le long de la chaîne des îles. La plupart des migrations ultérieures ont suivi cette même voie. Des sites de roches gravées particulièrement importants signalent des lieux cérémoniels anciens Baillif et Trois-Rivières sur la Basse Terre. Christophe Colomb, qui débarque en 1493 dans l'île et la baptise Guadalupe en l'honneur d'un sanctuaire espagnol consacré à la Vierge, rencontre une population essentiellement composée de Karibs, dispersés en de nombreux villages, et métissés aux populations arawaks originelles. Les Espagnols ne colonisent pas ces îles face à la résistance farouche que leur opposent les Karibs. Prenant prétexte des pratiques anthropophagiques des Indiens, l'administration espagnole autorise des razzias pour les capturer et les réduire en esclavage. Ce sont des expéditions britanniques et françaises qui, à partir de 1625, marquent le début de la colonisation européenne à Saint-Christophe tout d'abord (aujourd'hui Saint Kitts), puis à la Guadeloupe et à la Martinique et enfin dans les îles voisines.
La colonisation française se fit sous le patronage du cardinal de Richelieu et de la Compagnie des îles d'Amérique. En 1635, des Français, sous le commandement de Liénart de l'Olive et de Jean Du Plessis, prennent pied à la Guadeloupe. Les premières années de la colonie sont très agitées en raison des guerres avec les Indiens et aussi des rivalités entre chefs et gouverneurs recevant des lettres de commandement tantôt de la Compagnie (qui périclite après la mort de Richelieu en 1642), tantôt directement du roi. En 1643, le Normand Charles Houël réussit à s'imposer comme gouverneur et obtient l'appui des propriétaires fonciers de la région de Basse-Terre et de Capesterre. Le sort politique de la colonie reste fragile pendant plusieurs décennies, alors que l'économie du tabac devient très prospère. Les Indiens vont se réfugier sur l'île voisine de la Dominique et sont remplacés par les premiers contingents de main-d'œuvre africaine, réduite en esclavage souvent achetée aux Hollandais à Saint-Eustache et à Curaçao, pour travailler sur les plantations de canne à sucre qui se développent rapidement. En 1674, par décision de Colbert, ministre de Louis XIV, l'administration des îles d'Amérique revient directement au pouvoir royal.
Les attaques britanniques, à la fin du XVIIe et durant le XVIIIe siècle, occasionnent de grandes pertes économiques et humaines. Les Britanniques occupent les îles de 1759 à 1763 et renforcent le site commercial de Pointe-à-Pitre. À la bataille navale des Saintes 1782, la flotte française est défaite. La marine britannique possède désormais un avantage stratégique sur les Français dans les Petites Antilles. Pendant la Révolution, les Britanniques s'emparent à nouveau de la Guadeloupe mais le commissaire de la Convention, Victor Hugues, proclame l'abolition de l'esclavage dans l'île et réussit à les chasser 1794. Il fait procéder à des exécutions massives de royalistes qui avaient pris le parti des Britanniques. Puis Napoléon Bonaparte, influencé par les milieux des planteurs, envoie des forces importantes pour rétablir l'esclavage arrêté du 22 mai 1802. Plusieurs centaines de Noirs et de Mulâtres révoltés sont férocement réprimés à Baimbridge près de Pointe-à-Pitre et à Matouba près de Basse-Terre mai 1802.
C'est finalement sous la IIe République que l'esclavage est définitivement aboli à la Guadeloupe décret du 27 avril 1848, qui avait été précédé dans l'île de manifestations ayant conduit à la libération de fait des esclaves). Dès 1848, la Guadeloupe élit des députés à l'Assemblée nationale et, au cours de la IIIe République, la vie politique locale est très animée. La colonie se rallie au Comité français de libération nationale en juillet 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, sur proposition des députés d'outre-mer, la Guadeloupe et les autres « vieilles colonies » deviennent, en mars 1946, des départements français d'outre-mer D.O.M.. Mais sous la IVe et la Ve République, l'avenir des D.O.M. suscite de nombreuses interrogations, tandis que s'installe un certain malaise politique, notamment en Guadeloupe où des revendications autonomistes et indépendantistes se font jour manifestation violente à Pointe-à-Pitre en 1967, attentats dans les années 1970 et 1980. Les consultations politiques, caractérisées par des taux d'abstention élevés surtout à l'occasion de certaines consultations nationales ou européennes, l'implantation de fortes personnalités politiques, comme Henri Bangou, Lucette Michaux-Chevry, Victorin Lurel, témoignent des spécificités insulaires et, selon le politologue Justin Daniel, de l'autonomisation croissante de ces espaces politiques. Lors du référendum de 2003 sur la question de la fusion de la collectivité départementale et de la collectivité régionale, la Guadeloupe a massivement rejeté ce projet 73 p. 100 des suffrages. Pourtant, une évolution institutionnelle amorcée lors de cette consultation se concrétise, en 2007, lorsque Saint-Barthélemy et Saint-Martin deviennent des collectivités d'outre-mer C.O.M. et élisent, pour la première fois, leur propre Assemblée territoriale.
Des déséquilibres économiques et sociaux persistants
Les problèmes de la Guadeloupe sont perceptibles à travers les données de population et les indicateurs socio-économiques qui montrent un net décalage par rapport à la France métropolitaine. La Guadeloupe a une population jeune : 31,6 p. 100 de la population a moins de vingt ans France métropolitaine : 24,9 p. 100 mais en cours de vieillissement. Le solde naturel reste élevé parce que le comportement démographique n'a pas atteint la phase dite de transition. Par ailleurs, le solde migratoire est positif du fait de l'immigration importante venue de la Caraïbe et de l'installation de métropolitains ou d'Antillais qui prennent leur retraite dans les îles.
Le chômage, traditionnellement élevé, est considéré comme une donnée structurelle à la Guadeloupe 23,5 p. 100 de la population active en 2009, car le déclin des activités agricoles sucre, bananes n'est pas compensé par la création de nouveaux emplois dans les services en particulier dans le tourisme. La fonction publique à elle seule représente pratiquement la moitié de l'ensemble des emplois. L'analyse économique montre que le département vit des transferts de la métropole, des subventions européennes et aussi des remises des Guadeloupéens qui vivent en France métropolitaine. Le P.I.B. par tête n'est que de 17 900 euros 2009, contre 24 000 euros en métropole. Le nombre de foyers bénéficiaires du R.S.A. revenu de solidarité active est également beaucoup plus important qu'en métropole et les inégalités de revenus sont patentes. Certaines formes de marginalité sociale liées à la consommation et au trafic de stupéfiants constituent des motifs d'inquiétude.
L'État a tenté, à maintes reprises, de relancer l'activité économique par des aides et une politique de défiscalisation systématique zones franches. Grâce aux fonds d'investissement français et européens, les îles sont dotées d'infrastructures de bonne qualité routes, ports, aéroports, télécommunications... et d'équipements sanitaires et éducatifs corrects ; elles bénéficient de la continuité territoriale grâce à des transports maritimes et aériens nombreux vers la métropole en partie subventionnés. En revanche, l'insertion économique dans le cadre régional caraïbe, et plus largement nord-américain, est notoirement faible.
Sur le plan du développement des territoires, la concentration croissante de la population et des activités dans l'agglomération de Pointe-à-Pitre qui compte 172 000 habitants 2005 et concentre près de 41 p. 100 de la population totale, et dans les îles du Nord Saint-Barthélemy et Saint-Martin, aux dépens des zones rurales et des bourgs de la Basse Terre et des îles voisines demeure le principal facteur de déséquilibre. Christian Girault
Cette situation de déséquilibres et d’inégalités explose en janvier 2009, quand une grève générale est déclenchée à l’appel d’un collectif de syndicats, associations et partis de Guadeloupe. Celui-ci réclame notamment la baisse des taxes sur les produits de première nécessité et les carburants, ainsi que le relèvement des bas salaires et des minima sociaux. Les négociations entre le collectif, les représentants de l’État et le patronat aboutissent à un accord le 4 mars 2009, après quarante-quatre jours de grève.
Les autochtones des caraïbes : Arawaks et Karibs
Arawaks et Karibs n'ont cessé d'alimenter en stéréotypes, depuis le XVIe siècle, une vision occidentale, extérieure, ethnologique et anthropologique de l'espace des Caraïbes. Ces aborigènes signalés par Christophe Colomb dès son premier voyage ont fourni à la littérature, au cinéma, à la presse et à l'historiographie coloniale le thème obsédant du cannibalisme. Au service du roi de France, le capitaine florentin Giovanni da Verrazzano aurait fait escale en juillet 1528 en Guadeloupe. À peine aurait-il débarqué avec quelques marins qu'aurait surgi un groupe d'indigènes qui les auraient criblés de flèches et se seraient saisi d'eux. Les équipages de trois vaisseaux auraient assisté horrifiés au festin des cannibales qui dévorèrent leurs amis.
Le mythe
Après Christophe Colomb, le franciscain André Thevet, avec Nicolas de Villegagnon en 1555-1556 et le Hessois Hans Staden, prisonnier des Tupinamba en 1557 au Brésil, laissèrent des témoignages. Les illustrations de Théodore de Bry du récit du voyage en Floride de Jacques Le Moyne popularisèrent les scènes de cannibalisme dans l'opinion publique européenne.
L'opposition Karibs/Arawaks, la supériorité des Arawaks sur les Karibs, leurs dissemblances, comme leur cannibalisme supposé, posent des questions aux historiens. Car, au-delà des anecdotes, des scénarios de films d'horreur et des images stéréotypées, la recherche historique exige une enquête et des réponses claires. Une question se pose au préalable : qu'en est-il exactement de ces Karibs et Arawaks ?
Une première réponse peut être fournie par un examen minutieux des documents archéologiques et par la critique des données anthropologiques. Ces premiers et principaux acteurs de l'histoire des Caraïbes se dérobent. Ils n'ont pas laissé de témoignage écrit de leurs activités. L'historien est donc renvoyé à la consultation des sources disponibles qui ont déjà suscité maintes controverses. L'importance de la critique des documents espagnols, en particulier des relations de ceux qui rencontrèrent les premiers ces indigènes, n'a pas été suffisamment soulignée. Les sources doivent être replacées dans leur contexte historique. Christophe Colomb, qui souhaitait accréditer l'idée qu'il s'était rendu en Asie auprès des souverains catholiques espagnols, dut recréer le monde mythique popularisé par Marco Polo. Dans cet univers légendaire d'îles, de monstres, de magie, héritage de la géographie arabo-musulmane, s'ébauchèrent les premières visions de la dualité Karibs/Arawaks.
Des îles Karibs, dominées par les hommes, des guerriers belliqueux, se distinguèrent des îles Arawaks, habitées par des femmes, des Amazones ou des monstres femelles... Les deux communautés, karib et arawak, sortirent progressivement des limbes de la géographie médiévale et devinrent réalité.
Les monarques espagnols permirent par décret en 1503 aux colons de réduire les indigènes en esclavage pourvu qu'ils fussent des Karibs. Aussi ce fameux décret eut-il une profonde répercussion sur l'évolution du mythe. Toutes les populations qui résistèrent à la conquête espagnole entrèrent dans la catégorie des Karibs, les autres devenant Arawaks, ces « mangeurs de farine » dont on glorifia le pacifisme.
Arawaks et Karibs se laissent mieux cerner et livrent quelques-uns de leurs mystères quand on les étudie sous l'éclairage multiple de l'archéologie, de l'histoire, de l'anthropologie et de la linguistique.
Les apports de l'archéologie
L'établissement des Arawaks et des Karibs fut le résultat d'intenses mouvements de population entre les domaines continental et insulaire de l'aire des Caraïbes. Les îles de l'archipel oriental des Caraïbes furent utilisées dans le processus des migrations entre les grandes unités, de la Floride à la Terre-Ferme, des isthmes au Venezuela. L'implantation dans les milieux insulaires commença dans de grandes îles, Ayti (nom karib de Haïti) et Cuba, à la suite de la montée des eaux qui empêcha la circulation sur les passerelles reliant préalablement les îles. Des relations commerciales s'établirent entre insulaires et continentaux.
La poterie aurait été introduite dans les îles par la culture saladoïde. Des cultivateurs de manioc auraient laissé des vestiges de poteries semblables à ceux du domaine insulaire à Saladero, sur le moyen Orénoque, vers 1000 avant J.-C. Des traces de culture saladoïde remonteraient à 300 avant J.-C. sur la côte orientale du Venezuela, à Trinidad et dans l'île de Grenade. La culture barrancoïde aurait succédé au saladoïde, selon le même trajet côtier et insulaire, entre 350 et 650, puis la culture ostionoïde apparut à Porto Rico et dans les îles Vierges vers 700. Au cours de cette dernière période se seraient produites les premières migrations des Karibs, entre 650 et 950, dans les îles orientales. Les chroniqueurs du XVIe siècle ont mentionné des noms de peuplades qui auraient alors appartenu à l'ensemble insulaire : Igneris des îles orientales, Tainos et Ciguayo des grandes îles, Lucayo des Bahamas... Selon les mêmes interprétations, les Karibs seraient presque parvenus à chasser les Arawaks des îles orientales à la fin du XVe siècle. Ils pratiquaient la culture sur brûlis, l'irrigation, ainsi que la pêche. Les Karibs avaient acquis, au cours de leurs migrations, une grande pratique de la navigation en haute mer. Ils avaient élaboré une astronomie qui leur permettait de se repérer et dont les fonctions furent mises en évidence dans leurs pratiques religieuses. La poterie de ces guerriers flecheros considérée comme grossière par les archéologues, par comparaison avec celle des Arawaks sédentarisés, témoigne de leur perpétuel mouvement de migration. Le Dr Alvarez Chanca, qui accompagnait Christophe Colomb lors de son deuxième voyage vers les Amériques en 1493, décrivit le premier les Karibs de la Guadeloupe et les indigènes des îles orientales.
Ses descriptions de crânes humains – ceux des ancêtres – conservés par les habitants qu'il observa, ainsi que des têtes – celles de manati lamantins vraisemblablement – qu'il vit en cours de cuisson pour l'alimentation, déclenchèrent le processus mythique de la thèse du cannibalisme des Karibs.
L'île d'Ayti comptait, selon les travaux de l'école de Berkeley une population estimée à 8 millions d'habitants – des Arawaks Tainos – à l'arrivée des Européens. À l'époque de la conquête, Ayti était divisée en cinq caciquats ou provinces, Caizcimu, Hubaho, Cayabo, Bainoa et Guacayarima. Parmi les dirigeants les plus notoires, l'histoire a retenu les noms des caciques Behechio, Guacanagari, le Karib Caonabo, Guarionex, Mayobanex et une femme, Higuonama. Une catégorie de nobles, les nitaynos, dominait une classe de serviteurs, les naborias, employés aux travaux agricoles essentiellement. Tous les observateurs signalèrent le grand nombre des villages en Ayti, l'étendue des terres mises en valeur, le perfectionnement des techniques utilisées et la qualité des produits récoltés, manioc, arachide, maïs, patate douce, haricot, piment et fruits. Christophe Colomb chargea Fray Ramón Pane, hiéronymite, d'une enquête sur les Tainos et leur religion, pour mieux les connaître et les combattre.
Pétroglyphes, terrains de jeu de balle, pierres à trois pointes, lourds colliers de pierre sont des éléments archéologiques communs à la Terre-Ferme et aux sites insulaires. Malheureusement, dans tous les pays des Caraïbes un pillage systématique des sites archéologiques alimente un marché privé d'art précolombien particulièrement prospère.
Bartolomé de Las Casas connaissait Pane, ce missionnaire catalan qu'il qualifia de « personne simple d'esprit », parlant mal le castillan et ne comprenant quasiment rien à la langue des indigènes. Quant à ses investigations effectuées sur le terrain, de 1494 à 1496, et à son rapport que Christophe Colomb rapporta en Espagne en 1500,Las Casas ne cacha pas qu'il les considérait comme des choses confuses et de peu de substance, Apologetica Historia de las Indias, Madrid, 1909. Ramón Pane s'était contenté de transcrire ce qu'il saisissait mal des légendes sur les croyances et l'idolâtrie des Indiens, sur leur origine mythique, sur les Cimi, ces représentations divines si propres aux insulaires. En conclusion de son rapport, le moine catalan demandait que les populations de l'île d'Ayti soient soumises, évangélisées par les Espagnols et que toute résistance soit brisée par la force et le châtiment. On sait qu'il fut écouté sur ce dernier point, bien au-delà de ses espérances.
Les Karibs pratiquaient le rite de perforation de la langue, comme les Mayas. Ce rite était exécuté par le chaman, lors de l'initiation des jeunes. Leur légende évoque des arbres mythiques animés par un esprit divin, Hyruca ou Hunrakan en Guyane. Les Zemis ou Cimi des insulaires symbolisaient des dieux et renvoient indubitablement aux Kimi des Mayas, associés par eux à la mort.
Plusieurs documents permettent de connaître avec une relative précision les instruments de musique utilisés par les Amérindiens. Ils témoignent d'une réelle homogénéité de l'orchestre des indigènes dans une vaste zone allant du Guatemala à la Colombie, au Venezuela et jusqu'à l'Amazonie. La musique était associée à toutes les cérémonies religieuses et politiques. L'areyto ou mitote mêlait danses et chants selon un ordre rigoureux. Des chroniqueurs décrivirent ainsi les cérémonies auxquelles ils assistèrent en Ayti ou sur le continent. Fray Juan de Torquemada évoqua dans Veinte i un libros rituales i monarchia indiana, chronique parue en 1723, le spectacle de l'areyto donné sur la place publique d'un village : Lorsqu'ils veulent commencer la danse, trois ou quatre Indiens font retentir des sifflets très aigus, puis les tambours sont battus sourdement, la sonorité s'élevant peu à peu. La troupe des danseurs, en entendant le prélude des tambours, comprend quels sont le chant et la danse à interpréter, et elle les commence aussitôt. Les danses du début s'exécutent sur un ton grave [...] et lentement, le premier étant en conformité avec la fête ; deux coryphées l'entonnent, puis tout le chœur le poursuit, chantant et dansant à la fois.
Les données de l'anthropologie
Tous les groupements arawaks et karibs subsistent sur le continent mais ils furent détruits dans le domaine insulaire, sauf en Dominique où une réserve, Carib Reserve fut créée en 1903. Dirigés par un chef ubutu, les Karibs de la Dominique subsistent grâce à un artisanat objets de fil, de corde, fabrication des paniers caraïbes et de petite vannerie en général. Des Black Karibs, réfugiés dans l'île de Saint-Vincent au XVIIIe siècle, furent déportés à la fin de ce siècle par les Britanniques dans le golfe du Honduras, sur l'île de Roatan, d'où ils s'implantèrent sur les côtes du Honduras, du Nicaragua et de Belize, communauté des Garifunas.
Les anthropologues distinguent quatre grands groupes culturels en Amérique moyenne et en Amérique du Sud : les Tupi-Guarani, les Arawaks, les Karibs et les Gê. La grande famille des Arawaks est connue sous des noms divers : Aruak, Aroaqui, Arauaca, Aroaco, Araguaco, Arauac, Araguac, Nu-Aruak, Arowak, appelés aussi Maipure. Tous ces noms semblent provenir d'un groupe du Venezuela que les Espagnols appelaient Araguacos et qui se nommaient eux-mêmes Lukkunu. Les Arawaks occupent une zone d'habitat très étendue, qui se déploie depuis la Floride, les îles, jusqu'au Venezuela et au nord du Brésil.
Ils s'y seraient installés après un premier grand mouvement migratoire parti du berceau vénézuélien d'où auraient peu à peu essaimé tous les Arawaks. Selon certains anthropologues, ils descendraient non pas d'un noyau originel situé au Venezuela, mais d'Amazonie péruvienne, près du Marañon. On rencontre dans la forêt amazonienne des groupes méridionaux comme les Matsiguenga, les Campa-ashaninca, les Piro et les Mashco, qui constituent un groupe proto-arawak qui aurait été séparé du groupement principal et aurait donné naissance aux parlers arawaks du littoral caraïbe et de l' Amazonie. Seule l'archéologie pourrait aider à trancher cette origine controversée et à élucider le problème des migrations. On pense qu'ils atteignirent vers l'ouest les côtes du Pacifique et qu'ils essaimèrent au nord, vers les territoires isthmiques et insulaires.
Les Arawaks possèdent une grande diversité de types physiques. Ils ont en moyenne 1,60 m mais certains groupes de l'Altiplano bolivien, comme les Moxo et les Bauré, peuvent atteindre 1,70 m. Les conquérants ont très tôt associé les Arawaks à des activités agricoles et empruntèrent à leur langue des noms de plantes, d'ustensiles, d'objets de transport, maïs, tabac, piment, canoë, hamac, etc. Ils cultivaient le manioc et fabriquaient une belle céramique. Leur habitation a la forme caractéristique d'un cône tronqué, une grande case commune de forme conique couverte de feuilles de palmier autour de laquelle sont disposées des huttes en cercle.
Toutes les populations arawaks vivent de l'agriculture, cultivant surtout le manioc, le tabac, le maïs et diverses racines. Les Arawaks pratiquent la pêche, la chasse à l'arc. Ils possèdent des instruments de musique : l'ocarina ou tsinhali des Paressi, une grande trompette (hezô-hezô), une flûte, ualalocê, et le tiriaman pour accompagner les danses.
On a parlé d'une mythologie lunaire des Arawaks, sur le plan spirituel, qui renvoie aux jumeaux de la tradition du Popol-Vuh, Hunahpu et Ixbalamqué. Ces jumeaux sont des divinités mythiques qui se situent au fondement de la genèse de la population Maya-Quiché. Les anthropologues soulignent par ailleurs la base matrilinéaire de la société arawak.
La grande famille des Karibs a elle aussi des noms divers : Caribe, Cariba, Caribi, Caryba, Cariva, Caraibe. L'origine de leur nom dériverait de Calina ou de Caripuna, selon Christophe Colomb. Or, Kalina, Karina, Kallinago signifie pour les Karibs « brave » ou « compagnon ». De Karib, on sait que naquit le mot cannibale que les Espagnols appliquèrent à ces indigènes en raison, disaient-ils, de leurs tendances anthropophagiques. Leur territoire s'étend sur un vaste espace, limité au nord par les îles, au sud par le rio Xingu à hauteur du 13e parallèle de latitude sud. On distingue les groupements du sud de l'Amazonie, Apalai, Pianacoto, Pauxi, Uaieué, Voiavai, Boanari, Iauaperi et Crixana, les groupements du Venezuela et des Guyanes. Les Karibs insulaires reçurent le nom de Callinago, Calliponau, Caripura. Ils appartiennent au groupe Galibi du continent. Sur la Terre-Ferme de la côte vénézuélienne, les Cumanagoto ont subi l'influence des missions catholiques et ont vu fondre leur population. Ils regroupaient les Tamanaco, les Chaima, les Chacopata, les Piritué, les Palenque, les Pariagoto, les Cuneguava, les Guaiqueri. L'embouchure de l'Orénoque était habitée par les Tamanaque, qui ont disparu. On y trouve encore les Cariniaco, les Taparito, les Panare, les Mapoio et les Iabarana. Entre le rio Ventuari, le rio Branco et le rio Negro au Brésil, s'étend la région des Mankitari. Dans les Guyanes se côtoient d'importants groupements qui vont jusqu'au Brésil : les Acauoio, les Arecuna, les Camarocoto, les Purucoto, les Guaiamara et les Sapara. C'est sur le littoral des Guyanes que subsiste une trace des Karibs stricto sensu Caribe, Caribi, Galibi, Calina) qui vivent dans une région qui s'étend de l'Oyapock à l'Orénoque. De là ils essaimèrent vers le nord jusqu'aux îles et vers l'intérieur en remontant le cours des rivières. On a identifié dans la région du rio Repunuri, un affluent du rio Negro, des groupes connus sous le nom de Cariba, Caribi, Caribana, Carabana et Cariana. Dans la région de l'Essequibo vivent les Partamona, les Trio occupaient la vallée du Tapanahoni au XVIIIe siècle. En Guyane française, les Oyana, ou Roucouyenne, voisinent avec les Aracuiana du Brésil.
Les données de la linguistique
Au moment de la conquête, on parlait plusieurs langues dans les îles et sur le continent. Dans le domaine insulaire, le premier atteint, on distingue quatre grandes familles linguistiques : warao, arawak, karib insulaire et karib. Les parlers warao étaient ceux des indigènes de Trinidad et des habitants de l'embouchure de l'Orénoque. Plusieurs variétés de cette langue sont encore parlées aujourd'hui par 15 000 Amérindiens de l'Orénoque. Plusieurs langues appartenaient à la grande famille arawak, comme le taino, Bahamas, Ayti, Cuba, le caquetio, Curaçao et Aruba, le ciguayo Ayti, le macorixe Cuba. Le karib insulaire est une langue arawak. La famille karib comprenait les groupes karina, galibi ou carinaco, carinepagoto, parlés à Tobago, en Grenade, dans les autres îles de l'arc oriental, dans les Guyanes, de l'Orénoque à l'Amazone. On ne connaît que le nom de certaines langues qui ont disparu à l'époque de la conquête : nepuyo, Trinidad, Guyanes, shebayo ou salvaio Trinidad, yao, Trinidad et la région côtière des Guyanes, de l'Orénoque au Matacare, le guaiqueri ou waikeri, Margarita et, bien sûr, le taino, englobant le lucayo des grandes îles et des Bahamas. Ainsi, trois langues anciennes des îles sont encore parlées sur le continent : arawak, karib et karib insulaire ou igneri, parlé encore à Belize, dans le voisinage du golfe du Honduras et dans les communautés garifunas.
Dans les îles Dominique et Saint-Vincent, le créole remplaça progressivement la langue vernaculaire des Karibs au XIXe siècle. Le père de Lettre mentionna vers 1853 la présence à la Dominique de 125 indigènes Karibs qui ont peu à peu oublié leur ancienne langue, dont ils ne se servent entre eux que comme en cachette des autres personnes... Ils parlent le créole comme les autres naturels du pays. En 1879, un ornithologue nord-américain, Frederick Ober, ne comptait plus que quelques vieux et vieilles qui parlent encore l'ancienne langue karib. Pourtant, en 1898, un médecin a pu recueillir des textes de cette ancienne langue. Les derniers locuteurs moururent en 1910-1920 dans l'île, et un témoin, Douglas Taylor, signala en 1930 qu'il n'y avait plus que cinq ou six personnes ayant pu entendre dans leur enfance une langue maternelle disparue à jamais. Oruno D.Lara
        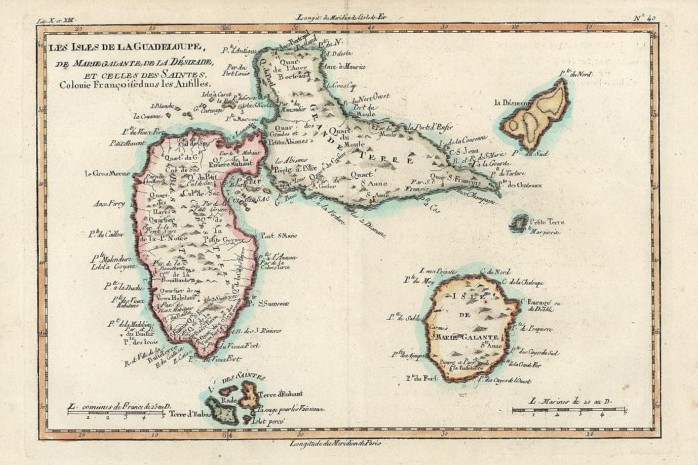        
Posté le : 27/06/2015 19:44
|
|
|
|
|
Benazir Bhutto |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 21 juin 1953 naît Mohtarma Benazir Bhutto
en ourdou : بینظیر بھٹو ; en sindhi : بينظير ڀٽو ; /beːnəziːr bɦʊʈːoː/ à Karachi, morte assassinée à Rawalpindi le 27 décembre 2007, femme politique pakistanaise. Elle a été dirigeante du Parti du peuple pakistanais de 1984 à 2007 et a été deux fois Première ministre du Pakistan. Elle est ainsi la première femme élue démocratiquement à la tête d'un pays à majorité musulmane. Elle est dirigeante du Parti du peuple pakistanais du 10 janvier 1984 au 27 décembre 2007, son prédécesseurest Nusrat Bhutto, son successeur Asif Ali Zardari et Bilawal Bhutto Zardari. Elle est ministre de la Défense du Pakistan du 4 décembre 1988 au 6 août 1990 sous le président Ghulam Ishaq Khan, puis elle est ministre des Finances du Pakistan du 26 janvier 1994 au 10 octobre 1996 sous le président Farooq Leghari
du 4 décembre 1988 au 6 décembre 1990 sous le président Ghulam Ishaq Khan. Elle est le 11e Premier ministre du Pakistan du 2 décembre 1988 au 6 août 1990 sous le président Ghulam Ishaq Khan son prédécesseur est Muhammad Khan Junejo son successeur sera Ghulam Mustafa Jatoi, elle est le 13e Premier ministre du Pakistan du 19 octobre 1993 au 5 novembre 1996 sous le président Wasim Sajjad Farooq Leghari, le prédécesseur Moeenuddin Ahmad Qureshi en intérim Nawaz Sharif, le successeur Miraj Khalid en intérim, Nawaz Sharif. Son conjoint est Asif Ali Zardari 1987-2007, leurs enfants sont Bilawal Bhutto Zardari, Bakhtawar Bhutto Zardari, Asifa Bhutto Zardari
Elle est diplômée de Radcliffe College, Université Harvard, du Lady Margaret Hall, Université d'Oxford et du St Catherine's College Université Harvard
Elle est aussi une figure marquante du Pakistan, et a été l'une des principales opposantes au pouvoir des présidents Muhammad Zia-ul-Haq et Pervez Musharraf. Son père, Zulfikar Alî Bhutto a fondé le PPP et a été à la tête du Pakistan de 1971 à 1977. En 1987, elle s'est mariée avec l'homme d'affaires Asif Ali Zardari, qui devient président en 2008.
Elle exerce son premier mandat de Première ministre à la tête du Pakistan à partir de 1988, à la suite des élections législatives, remportées par son parti et où elle a mené campagne en son nom. Elle est destituée de ses fonctions par le président Ghulam Ishaq Khan en 1990, et elle perd les élections législatives de la même année. Elle retrouve son poste de Première ministre en 1993 à la suite de nouvelles élections législatives. Son second mandat se termine en 1996 par un ordre de destitution du président Farooq Leghari, sur la base d'accusations de corruption. Afin d'échapper à la justice, elle s'exile à Dubaï puis à Londres en 1998.
Ayant obtenu du président Pervez Musharraf une amnistie et un accord de partage du pouvoir après les élections législatives prévues pour janvier 2008, elle rentre au pays le 18 octobre 2007. Chef de l'opposition, elle est alors pressentie pour redevenir Première ministre, et s'associe avec Nawaz Sharif. Le 27 décembre suivant, deux semaines avant les élections, elle est en campagne pour le Parti du peuple pakistanais, lorsqu'elle meurt, victime d'un attentat-suicide à l'issue d'un meeting à Rawalpindi. Sa mort provoque d'importants troubles, trois jours de deuil national et le report des élections, qui sont finalement remportées par son parti. Elle a obtenu le Prix des droits de l'homme des Nations unies à titre posthume en 2008.
En bref
Deux fois Premier ministre du Pakistan, de 1988 à 1990, puis de 1993 à 1996, Benazir Bhutto restera comme la première femme de l'époque moderne à avoir dirigé un pays musulman.
Socialement et politiquement, son parcours est celui d'une héritière. Elle naît à Karachi, le 21 juin 1953, dans une famille de grands propriétaires fonciers du Sind, la province du Sud. Son père, le brillant Zulfikar Ali Bhutto, lui-même fils d'un ministre du gouvernement impérial, sera président puis Premier ministre du Pakistan de 1971 à 1977, jusqu'au coup d'État du général Zia ul Haq. Ses frères, Murtaza et Shahnawaz, qui auraient pu jouer un rôle politique de premier plan, trouveront la mort dans des circonstances mal définies. Benazir Bhutto étudie à Harvard puis à Oxford, dont elle est diplômée, bachelor of arts, en 1973 et 1977, respectivement. Deux ans plus tard, l'exécution de son père fait d'elle la dirigeante du parti qu'il avait créé, le Pakistan People's Party, P.P.P.. Le régime, qui a imposé la loi martiale, est alors des plus autoritaires. Fréquemment emprisonnée de 1979 à 1984, en exil de 1984 à 1986, Benazir Bhutto ne peut faire campagne lors des élections législatives qui sont organisées, mais elle devient à son retour la figure de proue de l'opposition au régime, à travers des manifestations de masse qui caractériseront son action politique. En août 1988, le général Zia disparaît dans un mystérieux accident d'avion. Le vide politique qui en résulte et les élections qui s'ensuivent amènent la victoire du P.P.P., porté par le charisme et le prestige de Benazir Bhutto. Le 1er décembre 1988, celle-ci prend la tête d'un gouvernement de coalition. Elle est alors l'une des femmes les plus célèbres dans le monde. Elle conservera jusqu'à sa mort, dans les médias occidentaux, une image flatteuse, en dépit d'un bilan politique décevant.
Les succès, en effet, ne suivent guère. La concurrence exercée par la Ligue musulmane de Nawaz Sharif, ses mauvaises relations avec l'armée et avec le président de la République s'ajoutent à ses propres erreurs. En août 1990, accusée de corruption, elle est démise de ses fonctions par le président Ghulam Ishaq Khan. Après la défaite du P.P.P. aux élections d'octobre, Nawaz Sharif lui succède. Le scénario semble se rejouer en 1993, quand celui-ci connaît à son tour le même sort : victorieuse en octobre, Benazir Bhutto forme de nouveau un gouvernement de coalition qui, lui aussi, prendra fin, en novembre 1996, en raison d'accusations de corruption et de mauvaise gouvernance dirigées contre le Premier ministre et contre son époux, Asif Ali Zardari.
Entretenues par le nouveau gouvernement de Nawaz Sharif, large vainqueur des élections de 1997, ces accusations vont désormais conditionner la marge de manœuvre politique de Benazir Bhutto. Asif Ali Zardari est emprisonné de 1996 à 2004. En 1999, l'ex-Premier ministre, qui choisit alors de vivre à Dubaï et à Londres, est déclarée coupable par un tribunal de Lahore. Le jugement sera cassé en 2001 par la Cour suprême, mais Benazir Bhutto demeure sous le coup des mandats d'arrêt lancés contre elle au Pakistan. Son retour suppose un accord préalable avec le nouvel homme fort du pays, le général Pervez Moucharraf, qui a renversé le gouvernement Sharif le 12 octobre 1999.
L'exil durera huit années, pendant lesquelles Benazir Bhutto, qui par ailleurs fait face à une accusation de blanchiment devant la justice suisse, se tient à l'écart de la vie politique pakistanaise, même si le P.P.P. fait bonne figure aux élections générales de 2002. C'est seulement en 2007, peu avant l'élection présidentielle qui le reconduit pour un nouveau mandat, que le général Moucharraf, sans doute pressé par Washington, signe le décret d'amnistie portant l'abandon de toutes les charges dirigées contre l'ex-Premier ministre – une décision critiquée par la Cour suprême. Le 18 octobre, accueillie à Karachi par une foule impressionnante, Benazir Bhutto retrouve un Pakistan où, depuis plusieurs mois, se sont intensifiés la contestation du régime et l'affrontement de ce dernier avec les islamistes radicaux. Ce jour-là, un attentat-suicide contre le cortège fait plus de cent quarante morts. Benazir Bhutto, que l'on dit avoir mené des négociations avec Pervez Moucharraf pour un éventuel partage du pouvoir, apparaît à la fois comme une alliée objective de ce dernier contre les extrémistes religieux et une solution politique dans la perspective d'une victoire de l'opposition aux prochaines élections législatives. Le 27 décembre 2007, à la sortie d'un meeting électoral à Rawalpindi, près d'Islamabad, elle est victime d'un attentat.
Sa vie
Benazir Bhutto est née à Karachi le 21 juin 1953 dans une grande famille de politiciens et propriétaires terriens du Sind où la famille Bhutto possède de vastes terres. Elle est la fille aînée de l'ancien président, puis Premier ministre Zulfikar Alî Bhutto, pakistanais d'origine sindhi, et de la Bégum Nusrat Ispahani Bhutto, iranienne d'origine kurde ainsi que la sœur de Murtaza Bhutto.
Son éducation commence dans des pensionnats d'anciennes missions catholiques. Elle fréquente les écoles de la Congrégation de Jésus et Marie à Karachi puis à Murree Pendjab et de nouveau à Karachi où elle obtient son O-level à l'âge de 15 ans. Elle passe ensuite son A-level à la Karachi Grammar School.
En 1969, à 16 ans, après ses études secondaires, elle part pour les États-Unis où elle étudie à Radcliffe College, un collège de l'université Harvard. Elle obtient un Bachelor of Arts en gouvernement comparé en 1973 avec la mention cum laude. Elle est membre de la sororité Phi Beta Kappa. Elle poursuit son cursus au Royaume-Uni, au collège Lady Margaret Hall Oxford, où elle étudie la philosophie, la politique et l'économie en parallèle avec le droit international et la diplomatie. En décembre 1976, elle devient la première femme originaire d'Asie à être élue présidente de l'Oxford Union.
Famille
En 1977, une fois diplômée, elle rentre au Pakistan pour entamer une carrière diplomatique. Quelques jours après son retour, son père Zulfikar Alî Bhutto, qui est alors Premier ministre, est démis de ses fonctions après un coup d'État militaire, dirigé par l'ancien chef militaire, le général Muhammad Zia-ul-Haq, qui impose la loi martiale, mais promet de tenir des élections générales dans les trois mois. Mais au lieu de tenir sa promesse, le général Zia fait passer en cour martiale l'ancien Premier ministre pour conspiration dans l'assassinat d'Ahmed Raza Kasuri et celle-ci le condamne à mort. En dépit d'un motif considéré comme douteux et malgré de nombreux appels à la clémence de dirigeants étrangers, Bhutto est pendu le 4 avril 1979. Benazir Bhutto et sa mère sont détenues dans un camp jusqu'en mai 1979. Le 10 janvier 1984, Benazir Bhutto s'exile au Royaume-Uni pour raison médicale.
En 1985, son frère Shahnawaz Bhutto meurt dans des circonstances suspectes en France.
Le 18 décembre 1987, elle épouse à Karachi, Asif Ali Zardari avec lequel elle aura trois enfants Bilawal, né en 1988, Bakhtawar et Aseefa, nées en 1990 et 1993.
L'assassinat d'un autre de ses frères, Murtaza Bhutto, en 1996, a contribué à déstabiliser son deuxième mandat de Première ministre. De nombreux proches de Murtaza accusent Benazir d'avoir commandité son assassinat, les deux étant en concurrence et Murtaza voyant sa popularité augmenter.
Régime du général Zia 1977-1988
Ayant achevé ses études, elle rentre au Pakistan en 1977, l'année du coup d'État du général Zia. Elle est emprisonnée puis assignée à résidence surveillée en 1979 et elle s'exile finalement au Royaume-Uni en janvier 1984.
Elle devient chef du Parti du peuple pakistanais qu'avait fondé son père et dont sa mère avait repris la direction. Soutenue par cette dernière qui reste coprésidente, Bénazir Bhutto exercera de façon autoritaire jusqu'à sa mort une fonction de présidente à vie du PPP, au sein duquel aucune élection ne sera organisée.
Elle revient au pays en 1986 et y est accueillie triomphalement. De nouveau emprisonnée quelques jours après une manifestation interdite contre le général Zia, elle échappe à un attentat en janvier 1987.
Ascension au pouvoir Élections législatives de 1988
Le 17 août 1988, Zia ul-Haq meurt dans un accident d'avion aux causes non élucidées, en rentrant dans la base de Bahawâlpur. Comme le prévoit alors la Constitution, le président du Sénat, Ghulam Ishaq Khan devient Président du Pakistan par intérim. Durant la campagne électorale pour les élections législatives de 1988, le premier enfant de Benazir, Bilawal Bhutto Zardari naît le 21 septembre 1988. Le 29 septembre, des attaques simultanées à Karachi et Hyderabad font 240 morts, paralysant ainsi la campagne électorale. Le 5 octobre, après que Benazir Bhutto a déposé un recours en inconstitutionnalité, la Cour suprême annule le décret prit par Zia qui excluait les partis politiques des futures élections. En septembre 1988, le parti au pouvoir, la Ligue Musulmane du Pakistan, se scinde en deux partis : l'un pro-Zia et l'autre anti-Zia, dirigée par Muhammad Khan Junejo. Cependant, ces deux derniers partis s'unissent avec sept autres partis politiques et forment une coalition, l'Alliance démocratique islamique IDA. Dans le même temps, la loi électorale est modifiée, imposant aux électeurs de présenter une carte d'identité. Auparavant l'inscription dans les listes électorales étaient suffisante. Benazir Bhutto voit cette loi comme un moyen de réduire ses électeurs étant donné que selon elle, seuls 5 % des femmes et 30 % des hommes habitants en dehors des villes disposent d'une carte d'identité. Bhutto introduit alors un recours d'inconstitutionnalité, qui n'aboutit pas. Elle mène campagne durant un mois, en remontant le pays de Karachi à Rawalpindi par le train.
Le 16 novembre 1988, dans le premier scrutin ouvert depuis plus d'une décennie, son parti, le Parti du peuple pakistanais gagne largement les élections législatives de 1988, remportant 114 sièges contre contre 60 pour l'Alliance démocratique islamique à l'Assemblée nationale. Le PPP frôle ainsi la majorité absolue de 119 sièges. Le 16 novembre, Benazir Bhutto est allé voter dans sa circonscription de Larkana et est ensuite allé se recueillir sur la tombe de son père. Elle sera élue dans les trois circonscriptions où elle s'est présentée, c'est-à-dire à Larkana, Lahore et Karachi. Sa mère, Nusrat Bhutto est également élue dans les deux circonscriptions dans lesquelles elle s'est présentée, à Larkana et Chitral. Le 19 novembre, le PPP remporte également les élections aux assemblées provinciales, raflant 184 sièges contre 145 pour l'IDA. Le PPP forme finalement une alliance de coalition avec le Muttahida Qaumi Movement, permettant ainsi d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Premier mandat de Première ministre 1988-1990
Malgré sa majorité à l'Assemblée nationale, le président par intérim Ghulam Ishaq Khan ne demande pas à Benazir Bhutto de former un gouvernement, et les deux personnes rentrent en conflit. Finalement, ils trouvent un compromis : Ghulam Ishaq Khan nomme Benazir Bhutto au poste de Premier ministre, et le PPP donnera ses voix à Ishaq Khan pour sa candidature au poste de Président.
Elle prête serment en tant que Première ministre d'un gouvernement de coalition, le 2 décembre 1988B 8, à l'âge de 35 ans et devient la plus jeune personne et la première femme élue démocratiquement à la tête d'un pays à majorité musulmane1. Durant le même mois, le président par intérim Ghulam Ishaq Khan, est élu par l'Assemblée nationale, le Sénat, et les quatre assemblées provinciales formant un collège électoral. Il obtient 608 des 700 voix du collège. Le président Ishaq Khan bénéficie alors des réformes constitutionnelles et des amendements votés par le général Zia et qui donnaient un pouvoir important au président.
Son mandat marque une période de transition dans la région, avec le retrait les troupes soviétiques d'Afghanistan. Jusqu'ici le gouvernement du général Zia, ainsi que l'ISI, avaient reçu l'aide et le soutien du gouvernement américain dans leur lutte contre l'armée rouge. En juin 1989, Benazir Bhutto rencontre le président américain George H. W. Bush à Washington, photo à droite. Dans son autobiographie, Benazir Bhutto dénonce l'absence de soutien de la part des puissances occidentales à partir de 1989. Elle reçoit le Prix pour la liberté de l'Internationale libérale durant cette même année, un prix destiné à récompenser toutes personnes ou organisation ayant fait des efforts pour favoriser les libertés et la démocratie. Cependant, son mandat marque aussi la recrudescence des partis et des mouvements radicaux, qui réaliseront des scores importants aux élections législatives de 1990.
L'année 1989 correspond également au retour du Pakistan au sein du Commonwealth. En décembre 1988, Rajiv Gandhi et Benazir Bhutto se rencontrent à Islamabad.
Le gouvernement Bhutto mena également un politique de privatisation des grandes entreprises nationales. La réforme commença dès avril 1989 mais fut un semi échec, les investissements privés n'ont pas été suffisants et les fonctionnaires se sont opposés à la réforme. Ainsi, les objectifs de privatisations, qui concernaient en partie l'industrie et les services publics, et notamment la Pakistan International Airlines, la compagnie aérienne nationale, ne purent être totalement atteints. Selon certains analystes cet échec est dû au manque d'une politique plus globale en matière de privatisation, ainsi que d'un manque de volonté de réformer profondément les entreprises concernées pour les rendre plus attractives pour les grands investisseurs. Le gouvernement de Nawaz Sharif qui lui succéda en 1990 entamera une réforme de privatisation plus large, dont les objectifs seront mieux atteints.
Les conflits entre le Président et la Première ministre atteignent leur paroxysme en 1990. Ils concernaient notamment la nomination du chef militaire et du Président de la Cour suprême. Le 6 août 1990, après vingt mois de fonction, le président Ghulam Ishaq Khan dissout l'Assemblée nationale et démet de ses fonctions Benazir Bhutto, provoquant ainsi de nouvelles élections législatives. Les assemblées provinciales sont également dissoutes par la suite.
Officiellement, elle est démise sous l'accusation de corruption et d'abus de pouvoir en août 1990, elle comparaît devant des tribunaux spéciaux de septembre 1990 à mai 1991 pour abus de pouvoir, malversations et détournement de fonds public, accusations dont elle sera innocentée en 1994. Son époux, Asif Ali Zardari, est maintenu en détention de 1990 à 1993, puis est acquitté.
Élections législatives de 1990.
Le président Ghulam Ishaq Khan ayant dissout l'Assemblée nationale, de nouvelles élections législatives se sont tenues le 24 octobre 1990. Le Parti du peuple pakistanais forme alors une coalition avec deux autres petits partis. Face à eux, l'opposition de l'Alliance démocratique islamique s'unit autour de Nawaz Sharif, le nouveau leader de la coalition. Les opposants de Bhutto l'accusent de corruption, et surtout de favoritisme, ce qui poussera certains journalistes à parler du clan Bhutto », qui inclurait notamment son mari Zardari. Le PPP pâti également d'une augmentation de la criminalité et de l'insécurité, et d'une stagnation de la lutte contre la corruption. L'IDA fera campagne notamment autour de ce dernier sujet. Benazir Bhutto va pourtant contester l'équité de la campagne électorale, arguant que son parti disposait d'un moindre accès aux médias. Les observateurs américains signalent quant à eux, signaleront des fraudes préalables au scrutin.
Le 24 octobre 1990, l'IDA obtient 37,4 % des voix et 7,9 millions de votes, contre 36,8 % et 7,8 millions pour le PP. Toutefois, l'IDA remportant la majorité dans un plus grand nombre de circonscriptions, elle emporte une large majorité à l'Assemblée avec 106 sièges contre 44 pour le PP.
Malgré ce résultat, le PPP garde sa majorité à l'Assemblée provinciale du Sind ainsi qu'un fort soutien dans ses fiefs, à Karachi, Larkana et Sukkur. De plus, à la veille du scrutin, Bhutto réunit plusieurs centaines de milliers de supporters à Lahore, soit nettement moins que Nawaz Sharif. Ceci permettra notamment aux sympathisants du PPP de contester la régularité du scrutin, et Benazir Bhutto a accusé ses opposants de bourrages d'urnes.
Chef de l'opposition Élections législatives de 1993
Le 18 avril 1993, le président Ghulam Ishaq Khan dissout l'Assemblée nationale et démet de ses fonctions le Premier ministre Nawaz Sharif en raison d'accusations de corruption contre lui. Cependant, la Cour suprême annule cette décision, la jugeant inconstitutionnelle. Finalement, le 18 juillet 1993, la rivalité entre les deux hommes ne trouvant pas de solution, le président et le Premier ministre démissionnent conjointement.
Les élections législatives qui s'ensuivent ont lieu le 6 octobre 1993. Sur les 207 sièges élus directement par le peuple, 86 sièges sont remportés par le Parti du peuple pakistanais et 73 par la Ligue musulmane du Pakistan, la faction de la Ligue musulmane du Pakistan mené par Nawaz Sharif, qui s'était divisée d'avec celle de Muhammad Khan Junejo, qui obtient six sièges. Les deux principaux partis se lancent alors dans une lutte pour convaincre les petits partis, essentiels pour acquérir une majorité afin de former un gouvernement. Le PPP est ensuite conforté par les élections des assemblées provinciales le 9 octobre. Cependant, il pâtit de la décision du Muttahida Qaumi Movement, traditionnellement son allié, de boycotter les élections. Ces derniers dénoncent des pressions de l'armée. Toutefois, l'élection est reconnue par les observateurs internationaux.
Second mandat de Première ministre 1993-1996
Hillary Clinton rencontre Nawaz Sharif lors d'une visite au Pakistan en 2009.
Le 20 octobre 1993, l'Assemblée nationale élit Benazir Bhutto Première ministre, avec 121 voix contre 72 à Nawaz Sharif. Bhutto obtient donc deux voix de plus que la majorité absolue, de 119 voix. Elle est alors investie à la tête d'une fragile coalition composée essentiellement de petits partis, le plus important d'entre eux étant la Ligue musulmane de Muhammad Khan Junejo qui détient six sièges. Après que Benazir Bhutto a été investie par l'Assemblée nationale le 20 octobre 1993, l'élection du Président a lieu, le 13 novembre suivant. Elle oppose le président par intérim Wasim Sajjad à Farooq Leghari, membre du Parti du peuple pakistanais. Ce dernier remporte le scrutin par 274 voix contre 168 à Sajjad.
À partir de 1993, redevenue Première ministre, elle agit en politicienne plus chevronnée, fait des alliances, y compris avec des militaires, ce qui lui permet de traiter certains des problèmes de façon plus efficace que lors de son premier mandat. Elle doit néanmoins faire face à la montée du fondamentalisme musulman. En 1994, elle s'allie pourtant aux islamistes du Jamiat Ulema-e-lslami JUI, qui dirige la plupart des madrassas où seront formés les futurs talibans.
Durant son second mandant, Benazir Bhutto tente aussi de raffermir les liens avec les puissance occidentales, notamment les États-Unis. En mars 1995, elle reçoit Hillary Clinton, femme du président américain Bill Clinton et sa fille Chelsea Clinton à Islamabad. Cette visite, fortement médiatisée, permet de montrer à l'occident un visage différent du Pakistan. En novembre 1994, elle est en voyage officiel en France, accompagnée de généraux de l'armée et de son mari Zardari, où elle rencontre le président François Mitterrand36. Elle s'exprime devant les députés de la commission des affaires étrangères :
Nous et le Monde, qu'il soit musulman ou non musulman, nous ne devons pas permettre que les voies stridentes de quelques extrémistes déforment, pour leurs buts politiques personnels, la voie et l'esprit du message de Dieu. .... Les démocraties devront toujours rester vigilantes à ce sujet.
Lors de son arrivée au pouvoir en 1993, elle confie la politique afghane à son ministre de l'intérieur, le général Nasrullah Babar. En novembre 1994, les talibans libèrent un convoi pakistanais qui traversait l'Afghanistan pour se rendre au Turkménistan, révélant l'existence d'une alliance stratégique entre les talibans et le Pakistan, ce dernier souhaitant avoir à sa frontière un Afghanistan stable pour pouvoir développer ses relations avec les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Les talibans prennent Kaboul en septembre 1996. Des documents déclassifiés datés du 22 octobre 1996 ont montré que les services secrets des États-Unis disposaient d'informations sur des fournitures pakistanaises de nourriture, de carburant et de munitions destinées aux Talibans.
En 1996, alors que des divergences apparaissent entre la Première ministre et le président, le frère de Benazir, Murtaza Bhutto est tué dans une fusillade avec la police à Karachi. Sa mort provoque de forts soupçons autour de Benazir d'autant plus qu'une rivalité était apparue entre les deux personnes. Certains proches de Murtaza accusent Benazir d'avoir commandité son assassinat, les deux étant en concurrence et Murtaza voyant sa popularité augmenter. Cependant, aucune de ses accusations ne sera jamais démontrée. Le président Farooq Leghari accuse Benazir Bhutto d'être impliquée dans sa mort, puis cette dernière renvoie ces accusations contre le président. Le 5 novembre 1996, le président Farooq Leghari démet de ses fonctions la Première ministre et son gouvernement au milieu d'allégations de dysfonctionnements, et d'accusation de corruption, puis il dissout l'Assemblée nationale puis les assemblées provinciales.
Élections législatives de 1997 Élections législatives de 1997.
Les élections législatives de 1997 ont lieu le 3 février 1997 dans un contexte de polémique suite aux accusations de corruption formulées contre Benazir Bhutto et son gouvernement. Le Parti du peuple pakistanais subit la pire défaite de son histoire, remportant seulement 18 sièges à l'Assemblée nationale, contre 137 pour la Ligue musulmane du Pakistan. Dans le même temps, l'abstention atteint un niveau record, avec 35 % de participation, montrant ainsi la désillusion des Pakistanais envers leurs hommes politiques. La corruption a été le premier thème de campagne, mais la violence islamiste a été abordée plus que durant les autres élections, dans un contexte de talibanisation de l'Afghanistan.
Benazir Bhutto conteste l'impartialité de ces élections, et les observateurs internationaux refusent de parler d'élections démocratiques, mais ne dénoncent pas pour autant des fraudes massives. Les sondages préélectoraux prédisaient néanmoins une telle déroute pour le parti de Benazir Bhutto, estimant les voix de la Ligue musulmane du Pakistan N à 40 % contre 20 % pour le PPP.
Nawaz Sharif décrit ce résultat comme la volonté des Pakistanais de mettre fin au chaos. Benazir Bhutto refuse d'appeler à des manifestations, arguant qu'elle ne veut pas menacer la stabilité du Pakistan, alors que l'insurrection talibane prend de l'ampleur.
Accusations de corruption Exil à l'étranger
Afin d'échapper à la justice, elle s'est exilée à Dubaï en 1998. Les poursuites judiciaires restent pour l'essentiel en suspens le temps de son exil et jusqu'à l'amnistie décrétée par Musharraf en octobre 2007.
En 1999, Bhutto et Zardari sont condamnés pour corruption ; Bhutto, en exil en Angleterre et aux Émirats arabes unis, conteste ce jugement. En 2002, ne s'étant pas présentée au procès en appel, elle est condamnée à ne plus pouvoir pénétrer sur le territoire pakistanais. De plus, le président pakistanais Pervez Musharraf fait voter cette même année un amendement à la constitution interdisant de faire plus de deux mandats de Premier ministre. Cette décision empêche ainsi un retour au pouvoir aux anciens Premiers ministres Bhutto et Nawaz Sharif.
Le 5 août 2003, elle devient membre du Minhaj ul Quran International, une organisation d'obédience soufie fondée par le professeur Muhammad Tahir-ul-Qadri.
Elle voyage beaucoup et participe à de nombreuses conférences dans plusieurs pays.
Le 27 janvier 2007, elle est invitée par les États-Unis à prendre la parole devant le président George W. Bush, le Congrès et les responsables du Département d'État.
Retour d'exil et préparation des élections Retour au Pakistan
Benazir Bhutto s'exprimant devant ses sympathisants.
Durant l'été 2007, de longues transactions ont eu lieu avec le président Musharraf, pour un partage du pouvoir. Le 5 octobre 2007, Musharraf signe l'ordonnance sur la réconciliation nationale, en accordant l'amnistie à Bhutto et Zardari dans toutes les affaires judiciaires à leur encontre, y compris toutes les charges de corruption. D'autres dirigeants politiques, comme l'ancien premier ministre en exil Nawaz Sharif sont exclus de cette amnistie. En retour, Bhutto et son parti, conviennent de ne pas boycotter l'élection présidentielle. Bhutto est alors fortement critiquée par sa famille politique et certains membres du parti pour avoir signé un accord avec le chef de la junte. Le 6 octobre 2007, Pervez Musharraf remporte l'élection présidentielle, toutefois, la Cour suprême statue que le vainqueur ne peut être officiellement proclamé jusqu'à la décision de savoir s'il peut être président tout en restant général de l'armée.
Après huit années d'exil à Londres, Benazir Bhutto est de retour à Karachi le 18 octobre 2007, afin de préparer les élections législatives de 2008. En larmes, elle est accueillie par de nombreux sympathisants dès sa descente d'avion à l'aéroport international Jinnah, elle déclare alors :
Les gens que vous voyez derrière moi donnent la vraie image du Pakistan. Ce sont les représentants des classes moyennes et des classes ouvrières qui travaillent dur et qui veulent avoir le pouvoir de construire une nation moderne et modérée, ou tous sont égaux, c'est le vrai Pakistan, et si nous avons la démocratie, c'est vraiment le visage du Pakistan que le monde veut voir, pas celui des extrémistes qui ont proliféré sous la dictature.
— Benazir Bhutto, le 18 octobre 2007, à Karachi.
En route pour un rassemblement dans la capitale, deux explosions se produisent. Elle est la cible d'un attentat-suicide, dont elle sort indemne mais 136 personnes sont tuées dont au moins 50 des gardes de sécurité de son parti et six policiers, qui formaient une chaîne humaine autour de son camion pour la protéger d'éventuelles attaques et de nombreux sympathisants.
Protestations contre l'état d'urgence
Le 3 novembre, alors qu'elle est à Dubaï depuis le 1er pour voir ses enfants, elle rentre après que le président Musharraf a décrété l'état d'urgence pour lutter contre l'augmentation des attentats-suicides et l'ingérence de la justice dans le domaine politique. Il annonce également le report des élections législatives prévues pour la mi-janvier. Le 7 novembre, Benazir Bhutto appelle à manifester en masse contre l'état d'urgence. Plus tard, 400 de ses partisans seront arrêtés. Le 8 novembre, Pervez Musharraf annonce la tenue des élections législatives avant le 15 février 2008 et promet de démissionner de son poste de chef des armées avant de prêter serment pour son deuxième mandat en tant que chef de l'État. Le 9 novembre, Bhutto est assignée à résidence pour lui éviter de participer au meeting de son parti interdit par l'état d'urgence et par crainte d'attentats. Malgré l'interdiction, elle réussit à passer deux barrages de police avant d'être stoppée. Dans la nuit son assignation est levée, le lendemain, elle participe à une manifestation organisée par des journalistes. Dans une déclaration, elle lance un appel à une longue marche le 13 novembre entre Lahore et la capitale Islamabad pour exiger du pouvoir la fin de l'état d'urgence et le maintien des législatives à la mi-janvier. Alors qu'elle souhaite rencontrer l'ancien président de la Cour suprême et leader de l'opposition à Musharraf, le juge Muhammad Chaudhry assigné à résidence, elle est bloquée par la police. Le 10 novembre, elle part pour Lahore, d'où elle compte mener une longue marche de protestation vers la capitale.
Campagne pour les législatives de 2008 Élections législatives de 2008.
Le 11 novembre, Pervez Musharraf annonce la dissolution du Parlement pour le 15 novembre et la tenue d'élections législatives avant le 9 janvier 2008. Il annonce également l'abandon de son uniforme de général si sa réélection est validée par la Cour suprême.
Le 12 novembre, elle annonce que les négociations pour un éventuel partage du pouvoir avec Musharraf sont rompues. Elle menace le président de boycotter les législatives s'il ne met pas fin à l'état d'urgence. Elle est à nouveau assignée à résidence dans la nuit du 12 au 13 novembre pour une période de 7 jours dans le but notamment de l'empêcher de participer à une manifestation interdite prévue le 12 novembre et contre son opposition au président. 20 000 policiers sont déployés à Lahore, dont 4 000 aux abords de la maison où elle séjourne. Le 13 novembre, dans une interview, elle demande à la communauté internationale de cesser de soutenir le président Musharraf et réclame sa démission. Elle exclut également de devenir première ministre tant qu'il sera au pouvoir. Elle propose à son ancien rival et ancien Premier ministre en exil Nawaz Sharif de former ensemble une alliance. Celui-ci s'est dit favorable à cette proposition. 1 500 de ses sympathisants ont été arrêtés alors qu'ils essayaient de mener la longue marche prévue.
Le 16 novembre, son assignation est levée quelques heures avant la visite du numéro deux américain des Affaires étrangères John Negroponte. Elle tient une conférence de presse dans laquelle elle affirme que le gouvernement de transition mis en place aujourd'hui avec à sa tête le président du Sénat Mohammedmian Soomro, nouveau Premier ministre et qui est chargé d'organiser, sous l'état d'urgence, les élections législatives et provinciales qui doivent se tenir avant le 9 janvier 2008, n'est pas acceptable.
Le 25 novembre, elle annonce sa candidature dans la circonscription sud de Karachi pour les élections législatives du 8 janvier. Alors qu'elle essaye de fédérer l'ensemble de l'opposition face à Musharraf et contrairement à certains partis qui ont appelé au boycott du scrutin, elle n'a pas encore décidé si elle le boycotterait.
Le 28 novembre, elle accueille favorablement la démission du président Musharraf de la tête de l'armée mais s'est dite peu pressée de le reconnaitre comme un président civil légitime. Le lendemain, Musharraf prête serment pour un second mandat et annonce la levée de l'état d'urgence pour le 16 décembre. Le même jour, Bhutto annonce que son parti participera aux élections législatives et provinciales du 8 janvier mais se réserve le droit de décider plus tard de les boycotter. Le président Musharraf lève l'état d'urgence le 15 décembre, et annonce que les élections prévues le 8 janvier 2008 seront équitables et transparentes.
Assassinat Les faits
Le 27 décembre 2007, Benazir Bhutto se rend à une réunion du Parti du peuple pakistanais dans un parc public de Rawalpindi, dans la banlieue sud d'Islamabad. En quittant les lieux, elle salue la foule à travers le toit ouvrant de son véhicule blindé lorsqu'un homme présent à moins de deux mètres tire trois coups de feu dans sa direction puis déclenche la ceinture d'explosifs qu'il porte sur lui, tuant 20 personnes et en blessant plusieurs dizaines d'autres. Grièvement blessée à la tête et ayant perdu beaucoup de sang, Benazir Bhutto est transportée au Rawalpindi General Hospital à 17 h 35. Après une demi-heure de massage cardiaque et respiration artificielle, les médecins prononcent son décès à 18 h 16.
Transféré dans la nuit à Larkana, le cercueil de Benazir Bhutto est transporté jusque dans sa ville natale de Garhi Khuda Bakhsh, accompagné de centaines de milliers de personnes. Sa dépouille est enterrée aux côtés de son père, dans le mausolée familial. Le nombre de personnes présentes lors de l'enterrement le 28 décembre est estimé jusqu'à 600 000.
Les causes exactes de la mort de Benazir Bhutto font dans les jours qui suivent l'objet d'une controverse. Le gouvernement affirme qu'elle est morte à la suite d'un choc à la tête contre le levier du toit ouvrant de sa voiture alors qu'elle tentait d'éviter les balles tirées par le kamikaze, mais le porte-parole de Benazir Bhutto affirme que l'ancienne Première ministre a été touchée par une balle et déclare : J'ai vu qu'elle avait une blessure par balle à l'arrière de la tête et une autre, causée par la sortie de la balle, de l'autre côté de la tête. Javed Cheema, porte-parole du ministère de l'Intérieur, s'est déclaré prêt à exhumer le corps de Benazir Bhutto pour enquête si son parti le souhaite mais son mari a refusé d'exhumer le corps afin d'effectuer une autopsie. En février 2008 Scotland Yard a attribué les graves blessures que Benazir Bhutto portait au crâne à une explosion.
Réactions Nationales
Une rue de Karachi après les émeutes qui ont suivi l'annonce de la mort de Bhutto.
Sa mort donne lieu à plusieurs manifestations et à des émeutes dans tout le pays ayant fait au moins 32 morts. Le président décrète trois jours de deuil national.
Le chef des opérations d'al-Qaïda en Afghanistan, Mustafa Abu Al-Yazid, a revendiqué l'attentat et déclaré de Benazir Bhutto qu'elle était une fidèle de l'Amérique et promettait d'écraser les moudjahidines, et elle a été liquidée mais, le même jour, le chef supposé d'al-Qaida au Pakistan, Baïtullah Mehsud, dément l'avoir fait tuer.
Internationales
L'attentat est condamné par la communauté internationale.
Enquête L'enquête des Nations unies
Après la victoire du parti de Bhutto, le PPP, aux élections législatives de février 2008, le nouveau gouvernement pakistanais a mandaté l'ONU, en juillet 2008, d'une mission sur les faits et les circonstances de la mort de Bhutto. La commission est présidée par Heraldo Munoz, ambassadeur du Chili auprès des Nations unies. Le rapport aurait initialement dû être rendu public le 31 mars 2010, mais le gouvernement fédéral a demandé que le rapport soit communiqué plus tard afin qu'il soit étayé par des faits, selon le ministre de l'intérieur Rehman Malik.
Le rapport est rendu public le 15 avril 2010, et il remet en cause le gouvernement pakistanais, à l'époque celui du président Pervez Musharraf, en l'accusant de ne pas avoir assuré la sécurité de Benazir Bhutto de façon convenable compte tenu des menaces qui pesaient sur elle. Le rapport accuse aussi la police locale d'avoir sciemment fait échouer l'enquête, en relevant que l'enquête pakistanaise a manqué d'instructions, était inefficace et manquait d'implication pour identifier les criminels et les traduire en justice. Le rapport relève également que des responsables, craignant notamment l'implication des services de renseignement, ne savaient pas vraiment jusqu'où ils pouvaient aller dans l'enquête, même s'ils savaient pertinemment, en tant que professionnels, que certaines mesures auraient dû être prises. Le rapport accuse également les autorités locales de la province du Pendjab, et de la ville de Rawalpindi, de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient. Il relève également un traitement discriminatoire, en argumentant que deux autres anciens Premiers ministres, soutenant Musharraf, avaient bénéficié de meilleurs services de sécurité.
Les cadres du PPP et les proches de Bhutto réagissent en indiquant que les conclusions correspondent exactement à ce qu'ils pensaient depuis le début. Les autorités pakistanaises indiquent qu'elle étudieront les preuves et mèneront une enquête concernant l'implication éventuelle d'officiers ou de responsables de sécurité. Le Premier ministre promet que les coupables seront arrêtés. Cependant Pervez Musharraf, ainsi que de nombreux membres de son parti politique, battu durant les élections législatives de février 2008, remettent en doute le rapport.
L'enquête des autorités pakistanaises
C'est en revanche le gouvernement pakistanais qui se charge de l'enquête sur les coupables, et le 1er mars 2008, la justice pakistanaise a inculpé le chef du TTP, Baitullah Mehsud. Dès le 28 décembre, ce dernier dément l'avoir fait tuer tout en se réjouissant de sa mort, considérant que Benazir Bhutto est une alliée des États-Unis. Mehsud est tué en août 2009 dans l'une des nombreuses frappes aériennes américaines ayant lieu dans le Waziristan.
Après la remise par l'ONU du rapport aux autorités pakistanaises le 15 avril 2010, le gouvernement pakistanais met en place une commission d'enquête le 24 avril. Le 19 avril, huit hauts officiers cités dans le rapport des Nations unies, sont suspendus de leur fonction, dont notamment Saud Aziz, chef de la police de Rawalpindi et qui était responsable de la sécurité de Benazir Bhutto durant sa réunion électorale à Rawalpindi.
Finalement, sept personnes sont inculpées par la Cour anti-terroriste de Rawalpindi, dont cinq présumés talibans pour leur implication directe dans l'assassinat, et deux officiels de la police dont Saud Aziz pour ne pas avoir assuré correctement la sécurité de Benazir et pour avoir détruit des preuves, selon la Cour.
Postérité
Benazir Bhutto est enterrée dans le village de Garhi Khuda Bakhsh près de Larkana, dans le mausolée familial dans lequel repose également son père. Sa mort est commémorée tous les 27 décembre. La première commémoration réunit 150 000 personnes autour de sa tombe, dans une cérémonie présidée par Asif Ali Zardari et Bilawal Bhutto.
L'aéroport international Benazir Bhutto, desservant Islamabad, a été renommé ainsi le 21 juin 2008 par un décret du Premier ministre Youssouf Raza Gilani. Un nouvel aéroport, devant le supplanter, est actuellement en cours de construction. Il deviendrait le plus important aéroport du Pakistan et pourrait également s'appeler Benazir Bhutto.
Nawabshah 24e plus grande ville du pays avec 270 000 habitants a été officiellement renommée Benazirabad en septembre 2008, et son district Shaheed Benazirabad .     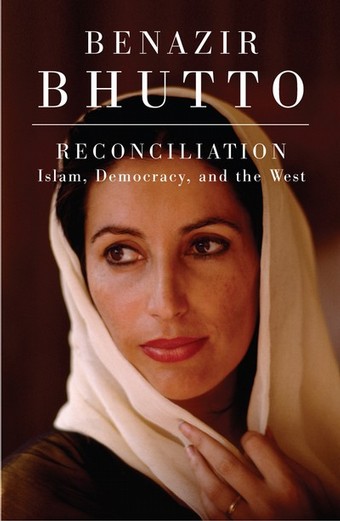  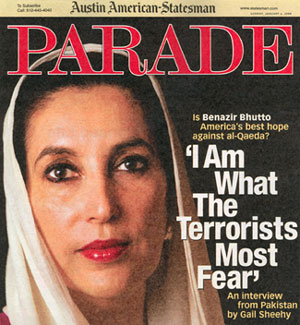    
Posté le : 19/06/2015 18:31
|
|
|
|
|
La fuite à Varennes |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 21 juin 1791 échec de la fuite de Louis XVI et sa famille
et arrestation à Varennes. La fuite manquée des 20 et 21 juin 1791 — plus connue sous le nom de Fuite de Varennes — est un épisode important de la Révolution française, au cours duquel le roi de France Louis XVI, sa femme Marie-Antoinette, et leur famille immédiate tentèrent de rejoindre le bastion royaliste de Montmédy, à partir duquel le roi espérait lancer une contre-révolution. En accréditant la thèse de la trahison du roi, cet événement déterminant dans le cours de la Révolution française a largement contribué à rendre crédible l’idée d’instaurer une république en France.
En bref
Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin 1791, Louis XVI parvient à s'enfuir des Tuileries avec sa famille. Se considérant comme prisonnier du peuple de Paris depuis le 6 octobre 1789, date à laquelle il a dû quitter Versailles, heurté dans ses convictions religieuses par la Constitution civile du clergé, soumis à l'influence du clan absolutiste, Marie-Antoinette, Breteuil, Saint-Priest, Fersen qui lui conseille la force, le roi s'est finalement décidé à rejoindre l'armée du marquis de Bouillé, concentrée à Montmédy et à Metz. Parvenu sans encombre à Sainte-Menehould, il y est reconnu par Drouet et arrêté à Varennes, un petit bourg de l'Argonne. Mal préparée, n'ayant pas assez prévu la réaction hostile de la population, la tentative a échoué. Ramené à Paris, Louis XVI, devenu suspect aux yeux des patriotes, est dès lors tenu sous bonne garde aux Tuileries. Sa fuite a pour effet d'éveiller des sentiments républicains dans une opinion restée jusqu'alors monarchiste. Le gouvernement n'a-t-il pas continué de fonctionner sans problème en l'absence du roi ? Le 17 juillet 1791, une pétition invitant la Constituante à prévoir le remplacement de Louis XVI et l'organisation d'un nouveau pouvoir exécutif est déposée par le club des Cordeliers sur l'autel de la Patrie au Champ-de-Mars. La manifestation est dispersée par la garde nationale : il y a plusieurs morts. La fusillade du Champ-de-Mars contre les républicains le 17 juillet 1791 renforce la Constituante dans l'idée que le gouvernement monarchique est indispensable à la France. On avance la thèse de « l'enlèvement du roi » pour absoudre Louis XVI. Celui-ci, le 14 septembre, prête serment à la Constitution. Moins d'un an après, il est renversé.
Contexte historique de l'évènement.
Le départ de la famille royale de Paris est un projet récurrent depuis le 5 octobre 1789, date à laquelle il a été pour la première fois abordé en conseil, mais cette fois, la situation décide le roi Louis XVI à autoriser son entourage et celui de Marie-Antoinette d'Autriche, avec au premier rang Axel de Fersen, à lui soumettre un plan d'évasion minutieusement organisé du palais des Tuileries. Le roi n'est plus tout à fait libre de ses mouvements et se trouve même de fait avec sa famille quasi prisonnier de Paris, placé qu'il est avec les siens sous la surveillance étroite de La Fayette et de la garde nationale. C'est en effet La Fayette, en tant que général commandant de la garde nationale, qui est chargé de la protection de l'exécutif mais également de sa surveillance assidue. D'ailleurs, premier responsable mis au courant de ce départ, il prend immédiatement et seul l'ordre d'envoyer des hommes dans toutes les destinations envisageables, qui conduira ainsi à la reprise du roi. La Fayette élabore et défend une communication publique d'un prétendu enlèvement du roi en refusant de diffuser la déclaration à tous les Français, rédigée par Louis XVI afin d'expliquer ce départ de Paris, le testament politique de Louis XVI, infra. La Fayette sera immédiatement suivi, dans son acte de censure, par l'Assemblée qui censurera à son tour la diffusion de ce texte du roi, adressé à l'ensemble de la Nation. Louis XVI voulait en effet s'adresser directement au peuple par cette déclaration à tous les Français, afin de les faire juges de la situation politique où en était arrivé le pays.
L'objectif consiste à rallier discrètement la place forte de Montmédy, pour y rejoindre le marquis de Bouillé, général en chef des troupes de la Meuse, Sarre et Moselle, coorganisateur du plan d’évasion. Une série de mauvaises applications de ce plan transformera cette tentative de reprise en main de la Révolution par le roi en échec, qui sera particulièrement bien exploité par les partisans de l'instauration d'une république.
Cela fait de nombreux mois que Louis XVI songe à quitter Paris. Le plan d'évasion était déjà validé mais la crainte d'une guerre civile le retenait. Deux événements vont décider Louis XVI à vouloir reprendre la main par la force :
La mort de Mirabeau le 2 avril 1791 : l'orateur du peuple qui s'est tant battu pour la liberté, pour restreindre les prérogatives royales au profit de l'Assemblée, a toujours prôné une voie moyenne entre la révolution et la monarchie, or il sent, depuis les journées des 5 et 6 octobre 1789, que les choses lui échappent. Il appartient à la catégorie des hommes publics qui tentent de freiner le cours comme les autres membres de la Société des amis de la convention, comme son ami Talleyrand et son rival La Fayette ; c'est de ce club que sera prise la décision de faire passer la fuite de Varennes pour un enlèvement. C'est la fuite de Varennes qui sera à l'origine de la scission entre le club des feuillants opposé au renversement du roi et le club des jacobins républicains, associés désormais à Robespierre. Cependant Mirabeau avait, depuis son installation définitive à Paris, installé des relations secrètes avec la cour. C'est une grande perte, écrira Fersen, car il travaillait pour eux, la famille royale.
Les Pâques inconstitutionnelles, 18 avril 1791 : Le roi n'a jamais accepté la signature imposée du décret relatif au serment des prêtres à la constitution civile du clergé. Son testament rappelle d'ailleurs qu'il a eu ce regret toute sa vie. Aussi, durant la messe du dimanche des Rameaux célébrée par le cardinal assermenté Montmorency, il s'abstient de communier. Cette réticence fait l'objet d'une communication assez large. Toujours est-il que lorsque le lendemain, lundi 18 avril, Louis et sa famille s’apprêtent à quitter les Tuileries, comme l’année précédente, pour rejoindre Saint-Cloud afin d’y passer la semaine sainte, il en est empêché. Une foule informée de ces intentions, spontanément rassemblée place du carrousel, a immobilisé le carrosse royal. Or la deuxième division de la garde nationale s'est jointe aux manifestants. Pendant deux heures la famille royale sera bloquée tandis que La Fayette, arrivé entre temps avec Bailly, ne parvenait pas à frayer un passage au roi. C'est à pied que Louis XVI est finalement retourné au palais des Tuileries. À la suite de cet épisode, La Fayette démissionna le 21 avril avant de se rétracter aussitôt devant l'insistance de ses officiers et une majorité des sections.
Plan d’évasion
Les premières traces de préparation de cette évasion datent de septembre 1790. Il semble que le plan initial ait été apporté par l'évêque de Pamiers, Joseph-Mathieu d'Agoult : Sortir de sa prison des Tuileries et se retirer dans une place frontière dépendant du commandement de M. de Bouillé. Là, le roi réunirait des troupes ainsi que ceux de ses sujets qui lui étaient restés fidèles et chercherait à ramener le reste de son peuple égaré par des factieux. Seulement si ce plan échouait, le recours aux alliés, c'est-à-dire l'empereur d'Autriche, était envisagé.
Les protagonistes
Le roi, qui reste le cerveau de son voyage à Montmédy comme il nomme lui-même cette opération, a chargé de l'organisation les personnages suivants:
Monseigneur Joseph-Mathieu d'Agoult, "l'initiateur du plan d'évasion"
Hans Axel de Fersen, l'intendant;
Joseph Duruey et Jean-Baptiste Tourteau de Septeuil, "les banquiers" ;
le lieutenant général marquis de Bouillé, le militaire ;
le baron de Breteuil, le diplomate;
le comte de Mercy-Argenteau, l'intermédiaire avec l'empereur.
Pierre-Jean de Bourcet, chevalier de l'Ordre royal de Saint-Louis, ancien valet de chambre du premier Dauphin de France.
Nicolas de Malbec de Montjoc, marquis de Briges, 1715-1795 cocher de la voiture au départ des Tuileries.
Dès septembre, l'évêque de Pamiers s'était rendu à Metz rencontrer Bouillé, commandant des troupes de l'Est. Ce dernier eut même l'idée de demander à l'empereur allié du roi de faire avancer quelques troupes sur la frontière et ainsi demander du renfort des meilleurs régiments. Un courrier de Marie-Antoinette à Mercy-Argenteau montre cette demande de mouvement des troupes alliées vers la frontière française.
Pour davantage illustrer dans quelle discrétion ce plan a été mis au point, il suffit de lire les mémoires du comte de Provence5. Il y dit qu'il a été mis au courant de la destination finale de Louis XVI Montmédy le 19 juin. Il a lui aussi quitté Paris dans la nuit du 20 juin il demeurait au Petit Luxembourg. Déguisé, muni d'un passe-port anglais, il rejoint ainsi les Pays-Bas, via Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge.
Au mois de juin 1791 lors du départ du roi et de la famille royale pour Montmédy, M. de Bourcet partit pour Mons, où il devait trouver des ordres6, mais il fut arrêté à Valenciennes. M. de Bourcet prit le nom, le brevet, les lettres de services, le passeport et l'uniforme de son cousin M. de Polastre. Il put sortir de Paris mais reconnu pour ne pas être cet officier fut arrêté. Il allait être livré à un conseil de guerre, lorsque la nouvelle de l'arrestation de la famille royale parvint à Valenciennes. M. de Bourcet s'échappa et revint à Paris. Il était près du roi au château des Tuileries, le 20 juin 1792.
Les modalités de l'évasion
Le principe consistait à se faire passer pour l'équipage de la baronne de Korff, veuve d'un colonel russe qui se rend à Francfort avec deux enfants, une femme, un valet de chambre et trois domestiques. Une berline fut spécifiquement commandée infra.
Le trajet, choisi par Louis XVI pour se rendre à Montmédy, empruntait la route de Châlons-sur-Marne. À Pont-de-Somme-Vesle un premier détachement de 40 hussards de Lauzun, aux ordres du duc de Choiseul suivrait l'équipée jusqu'à Sainte-Menehould où un détachement du régiment Royal Dragons escorterait directement la berline : à Clermont-en-Argonne, un escadron du régiment des Dragons de Monsieur aux ordres du comte Damas rejoindrait la berline. À la sortie de Varennes, un escadron de hussards de Lauzun bloquerait durant vingt-heures les éventuels poursuivants : le poste de Dun-sur-Meuse serait gardé par un escadron des hussards de Lauzun et le régiment de Royal Allemand cantonnerait à Stenay. Le roi pourrait gagner ainsi la place forte de Montmédy où l'attendrait le marquis de Bouillé.
En réalité, rien ne va se passer ainsi. Selon de nombreux passionnés de cet événement, comme Napoléon Bonaparte dont un courrier sur le sujet a été exhumé des archives par l'historien André Castelot, le grand responsable de cet échec est le duc de Choiseul. Ce dernier n'a pas, d'une part, respecté les directives de Bouillé, mais il s'est même permis de désorganiser le plan initial. Ainsi, il a autorisé des officiers, qui attendaient un trésor à escorter à quitter leur poste, en raison du retard du cortège royal. Pour ce faire, il a confié ces instructions au coiffeur de la reine, Léonard, qui les appliqua avec trop de zèle. Sans cela, toujours selon le mot de Napoléon, la face du monde aurait été changée.
À la suite de cette désorganisation et des nombreux retards, les hommes de La Fayette, à la poursuite du convoi, n'auraient pas rencontré Jean-Baptiste Drouet, maître de poste de Sainte-Menehould. Ce dernier s'est souvenu avoir vu, une heure avant, une berline correspondant à la description. Il s'est souvenu qu'elle se dirigeait vers Varennes. Aussitôt, il prit l'initiative de s'y rendre afin d'arrêter le convoi, avec l'aide des autorités locales qu'il avait convaincues de faire contrôler scrupuleusement les passeports. Bloqué une partie de la nuit, le roi refusa que la force fût employée, des hussards et une partie de la population étaient prêts à couvrir son départ. Louis XVI attendait, en vain, le renfort de Bouillé, qui aurait dû arriver. Pendant ce temps, les habitants de Varennes et de nombreuses personnes, venues des environs, alertés par le tocsin, se sont massés à Varennes pour voir le roi.
Grâce à cette situation tendue, l'aide de camp de La Fayette, Romeuf, autre homme clef de cette arrestation eut le temps d'arriver, muni d'un décret de l'Assemblée ordonnant l'arrestation de la famille royale. Possédant la légitimité de la garde nationale et de l'Assemblée, il prit l'ascendant. Seulement, voyant qu'il jouait la montre avec Louis XVI, au lieu d'organiser sans tarder le retour du roi à Paris, son adjoint patriote, quelques autorités locales ont alors forcé la volonté de Louis XVI. À ce moment, environ 10 000 personnes s'étaient agglutinées à Varennes. Certains scandèrent À Paris ! À Paris ! Vive la nation !, ce qui exacerba les tensions. Romeuf sera arrêté le 23 juin suivant pour qu'il s'explique sur son rôle. Il sera relâché et deviendra général et baron d'Empire. Son nom est gravé sur l'Arc de triomphe de l'Étoile.
Leurs passeports
Fersen, au nom de Mme de Korff, sollicita du ministre Montmorin un laissez-passer qu'il signa en ne soupçonnant rien. La signature du roi fut moins difficile à obtenir. Voici les identités d’emprunt des membres de l'équipée :
Louis XVI : M. Durand intendant de la baronne de Korff.
Marie-Antoinette d’Autriche : Mme Rochet gouvernante des enfants de Mme de Korff.
Marie-Thérèse de France : une des filles de Mme de Korff.
Le Dauphin : autre fille de Mme de Korff il est vêtu en fille.
La marquise Louise-Elisabeth de Croÿ de Tourzel, gouvernante des enfants de France : la baronne de Korff.
Madame Elisabeth sœur de Louis XVI : Rosalie, dame de compagnie de la baronne.
Les trois domestiques étaient messieurs de Moustier, de Valory et de Malden, gentilshommes anciens gardes du corps licenciés en 1789. Le roi leur avait demandé de se couvrir de livrée de courrier afin de devancer les changements de chevaux dans les relais. Or le choix de leur couleur, jaune, ne fut pas des plus judicieux, puisqu'elle était celle de la maison du prince de Condé parti à l’étranger au début de la Révolution et ne pouvait qu’éveiller les soupçons dans l'Argonne où elle était fort connue.
La voiture
Le 22 décembre 1790, une voiture susceptible de tenir six personnes, robuste et confortable est commandée au carrossier Jean Louis, implanté quai des Quatre-Nations quai Malaquais, aujourd'hui hôtel Parabère. La caisse et les moulures de cette berline seront peintes en vert et le train et les roues en jaune citron. Elle comportera un attelage de six chevaux. Cette demande de fourniture émane de la baronne Anna de Korff et c'est Fersen qui joue les intermédiaires. Durant tout l'hiver, il le fera presser son travail. La berline est terminée le 12 mars 1791, mais personne ne vient la chercher avant le 2 juin.
Il convient à cet égard d’écarter cette idée encore très présente dans l’imagerie populaire : la berline de la famille royale n’était en aucun cas un abrégé du château de Versailles, mais un véhicule de voyage tout à fait conforme à l’usage pour effectuer un long trajet, cette berline servit d’ailleurs de diligence, assurant le Paris-Dijon, jusqu’en 1795, date à laquelle elle fut détruite dans un incendie. L'historienne spécialiste de Louis XVI, Pierrette Girault de Coursac ose la comparaison suivante : on peut la qualifier de belle Mercédès mais certainement pas de Rolls-Royce. Trois gardes du corps accompagnent la famille royale : Malden, Vallory et Moutier. Ils seront cochers ou chevaucheront devant ou à côté de la berline pour préparer les relais. Michelet voit ici une des raisons de l'échec de la fuite : la reine avait choisi elle-même ses gardes du corps, privilégiant le dévouement à la compétence. Il en va de même pour le choix de Fersen et Choiseul 22 ans à peine comme organisateurs du plan de fuite. Bien que très loyaux, il n'en sont pas moins incompétents et très inexpérimentés pour une mission de cette nature.
La sortie des Tuileries
C'est à Fersen que revenait l'organisation de la sortie des Tuileries. L'historien André Castelot souligne la difficulté de quitter secrètement un palais qu'il qualifie de caravansérail où dormaient, sur des couches à même le sol, le nombreux personnel. Les hommes de La Fayette, qui s'était engagé sur sa tête à ce que le roi ne tente pas de s'échapper, étaient vigilants.
Pour quitter les Tuileries afin de rejoindre une citadine petite voiture garée rue des Échelles, il faut donc, après avoir procédé à la cérémonie du coucher réduite mais toujours en vigueur en 1791, connaître les mouvements des sentinelles. Vite déguisés, le roi, la reine, la gouvernante accompagnée du dauphin et de madame royale, la marquise et madame Élisabeth quittent le palais en direction de la citadine dont le cocher est le marquis de Briges. Ce dernier et Fersen les emmènent ensuite, via la rue du Faubourg-Saint-Martin, à la barrière de la Villette. Il est 1h20. Celle-ci est passée sans problème, étant donné que les responsables de la barrière fêtent le mariage de l'un d'eux. Une fois sorti de la capitale, tout le monde descend pour s'installer dans la berline qui les attend avec les trois valets en livrée … du prince de Condé ! Fersen peut alors faire ses adieux.
Départ de Paris - 20 juin 1791
Déclaration autographe de Louis XVI adressée aux Français à sa sortie de Paris le 20 juin 1791.Archives Nationales - AE-II-1218
22 heures 30
Deux femmes de chambre de Marie-Antoinette, madame Brunier et madame Neuville, les premières dames de Madame et du Dauphin, quittent les Tuileries pour Claye-Souilly où elles doivent rejoindre la berline royale.
Dans le même temps, dans l'Argonne et dans la Marne, 180 dragons sous le commandement du colonel de Damas, cantonnent à Clermont-en-Argonne et au village voisin d'Auzéville-en-Argonne. 40 hussards de Lauzun, commandés par le sous-lieutenant Boudet cantonnent à Sainte-Ménéhould. Ils doivent rejoindre le lendemain Pont-de-Somme-Vesle, premier relais après Châlons-en-Champagne.
22 heures 50
Axel de Fersen emmène des Tuileries le dauphin, futur Louis XVII de France, sa sœur, Marie-Thérèse de France et leur gouvernante, Louise-Élisabeth de Croÿ de Tourzel. Il fait un tour du Louvre par les quais et revient se positionner rue de l'Échelle à côté du Louvre en attendant le roi, la reine et Élisabeth.
23 heures 30
Louis XVI et Marie-Antoinette font semblant de se coucher selon le cérémonial habituel. La Fayette et Romeuf sont venus faire la visite de courtoisie habituelle retardant ainsi la fin de la cérémonie du coucher.
Fuite de la famille royale : 21 juin 1791
Minuit dix
Louis XVI, déguisé en valet de chambre, monte dans une citadine voiture de ville stationnée près des Tuileries, rue de l’Échelle. Il y trouve sa sœur, Élisabeth de France, et Marie-Antoinette qui le rejoint à 0 heure 35. Marie-Antoinette s’était perdue dans les méandres des rues entourant le Louvre. Selon Michelet, Choiseul avait réservé la dernière place pour un de ses hommes de main. Louise-Élisabeth de Croÿ de Tourzel, fait valoir qu'en sa qualité de gouvernante elle a fait serment de ne pas quitter les enfants et qu'il doit lui céder sa place. Louis XVI intercédera à sa demande et le soldat sera forcé de descendre de la voiture. Pour Michelet, qui voit là l'une des raisons de l'échec de la fuite, l’expédition perd un homme compétent et connaissant le pays, au profit d'une femme inutile.
1 heure 50
La famille royale atteint la berline avec une heure et demie de retard sur l’horaire prévu.
2 heures 30
Premier relais à Bondy : Axel de Fersen qui avait accompagné la famille royale la quitte.
4 heures
Un cabriolet avec les deux femmes de chambre rejoint la berline royale à Claye-Souilly.
7 heures
Testament politique de Louis XVI : Déclaration de Louis XVI à tous les Français, à sa sortie de Paris, sur Wikisource
Le valet de chambre s’aperçoit que Louis XVI n’est pas dans la chambre aux Tuileries et à la place du roi il trouve, laissé par ses soins, le texte : Déclaration de Louis XVI à tous les Français à sa sortie de Paris, document manuscrit de 16 pages rédigé de la main du roi dans les jours précédents son départ, considéré comme « le testament politique de Louis XVI. Ce texte sera censuré sur le moment par La Fayette, puis par l'Assemblée qui ne le diffuseront pas. Il ne fut jamais connu des Français ni diffusé dans son intégralité à l'époque révolutionnaire. D'une part, Louis XVI y stigmatise les Jacobins et leur emprise croissante sur la société française. D'autre part, il y explique sa volonté : une monarchie constitutionnelle avec un exécutif puissant et autonome vis-à-vis de l'Assemblée. Ce document historique majeur, traditionnellement appelé le testament politique de Louis XVI a été redécouvert en mai 2009. Il est au Musée des lettres et manuscrits à Paris. Le roi commente son sentiment sur la Révolution, en critique certaines conséquences sans pour autant rejeter les réformes importantes comme l'abolition des ordres et l'égalité civile.
Le comte de Provence, futur Louis XVIII de France quitte quant à lui Paris au petit matin avec son ami d’Avaray et arrive sans la moindre difficulté par Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe, à Mons, en Belgique. De là il gagne Marche-les-Dames où il apprendra plus tard l’arrestation de son frère Louis XVI.
8 heures
La nouvelle du départ de Louis XVI se répand dans Paris. L’Assemblée constituante, après avoir hésité entre la fuite ou l’enlèvement, déclare qu’il a été enlevé.
10 heures
60 hussards du régiment de Lauzun aux ordres du sous-lieutenant Röhrig cantonnent au Couvent des Cordeliers à Varennes-en-Argonne : ils y sont présents depuis le 8 juin, avec un détachement principal le 19 juin. Un détachement de 100 hussards aux ordres du chef d'escadron Deslon tient le poste de Dun-sur-Meuse à 24 km de Varennes : un détachement de 40 hussards est confié au sous-lieutenant Boudet, sous les ordres du duc de Choiseul pour accueillir la famille royale à Pont-de-Somme-Vesle, à la sortie de Châlons-en-Champagne. La Berline arrive à Viels-Maisons, l'aubergiste François Picard reconnait le roi. Les Postillons et palefreniers sont mis au courant.
11 heures
Les voitures royales s’arrêtent à Montmirail. Elles ont trois heures de retard sur l’horaire prévu. À Paris, La Fayette envoie des courriers dans toutes les directions pour arrêter la famille royale. À Sainte-Menehould et Clermont-en-Argonne, la population s’inquiète de l’arrivée des cavaliers; la garde nationale prend les armes.
14 heures 30
Passage à Chaintrix, où le roi est reconnu par le maitre de Poste. À la sortie de Chaintrix, les chevaux s'affalent deux fois. Vers 16h00, arrive à Chaintrix, de Briges, un hussard qui veut rejoindre le roi dès qu'il a appris son départ. Vers 17h00 arrive Bayon, courrier envoyé par La Fayette qui interroge et retient de Briges, il repartira à 19h45 mais aura pris le soin d'envoyer un courrier le fils de la Poste de Lagny celui-ci relaiera jusqu'à Châlons venant ainsi conforter le passage du roi et le message de La Fayette. Le Courrier de l'Assemblée Nationale Romeuf, porteur de l'ordre d'arrestation du roi, passe à 17h00.
16 heures
La berline royale arrive à Châlons-en-Champagne par l'avenue de Paris, ils traversent la Marne et prennent la rue de Marne. Avec quatre heures de retard, ils relaient chez le maître de poste Viet au 94 rue Saint-Jacques, actuellement rue Léon Bourgeois. Puis reprennent la direction de Sainte-Menehould. Les hussards du régiment de Lauzun détachés à Pont-de-Somme-Vesle, las d’attendre le passage des voitures royales et menacés par les paysans, reçoivent l’ordre de leur jeune chef, le duc de Choiseul, de se replier à travers champs et de gagner Varennes en Argonne en évitant les routes.
19 heures 55
Jean-Baptiste Drouet.
Louis XVI écu constitutionel
Le cabriolet, suivi de la berline royale, s’arrête devant le relais de Sainte-Menehould.
Le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, qui a séjourné à Versailles, reconnaît le roi mais ne réagit pas.
Dans son témoignage devant l'Assemblée constituante, le 24 juin 1791, il affirme :
Je crus reconnoître la reine ; et apercevant un homme dans le fond de la voiture à gauche, je fus frappé de la ressemblance de sa physionomie avec l'effigie d'un assignat de 50 livres.
Il ne se lance à la poursuite de la berline royale que lorsque la municipalité le mandate après délibération.
20 heures 10
Les deux voitures quittent le relais en direction de Clermont-en-Argonne où les attend un détachement de dragons commandé par le colonel Damas. Ceux-ci, pactisant avec la population, refusent les ordres et laisseront passer la berline. En fait Damas ayant parlé avec le roi, celui-ci souhaite rester incognito et relayer sans autre formalité, Damas se propose de le suivre à distance. Damas ne pourra prendre la route qu'avec quelques soldats.
21 heures
Constatant qu'après avoir demandé des chevaux pour Verdun, ces voitures prenoient la route de Varennes, Jean-Baptiste Drouet et son ami Jean-Chrisosthome Guillaume10 montent à cheval. Ils se dirigent par la forêt d’Argonne vers le village des Islettes pour rejoindre Varennes-en-Argonne, où ils pensent que se dirigent les voitures royales. À Sainte-Menehould, les dragons sont désarmés sans résistance par la population.
22 heures 50
Voûte de l’église Saint-Gégoult
La berline royale s’arrête à l’entrée de Varennes pendant qu’un postillon cherche le relais.
Les voyageurs sont étonnés de ne trouver aucun des cavaliers qui devaient les escorter.
Ils frappent à la maison de Monsieur de Préfontaines qui dit tout ignorer d’un relais.
En effet, ne voyant rien venir, le relais a été déplacé dans la ville basse, de l’autre côté du pont enjambant la rivière l’Aire.
22 heures 55
Jean-Baptiste Drouet et Jean-Chrisosthome Guillaume arrivent à Varennes, passent devant la berline arrêtée et avertissent le procureur-syndic, l’épicier Jean-Baptiste Sauce, que les voitures de la famille royale en fuite sont arrêtées en haut de la ville. Ils décident de barricader le pont de l’Aire, par lequel doit passer la berline royale. La garde nationale de Varennes se mobilise et son commandant, le futur général Radet, fait mettre deux canons en batterie près du pont.
23 heures 10
Tour Louis XVI
Les deux voitures de la famille royale sont immobilisées bien avant la barricade, avant la voûte de l’église Saint-Gégoult qui enjambe la rue.
Jean-Baptiste Sauce, sous la pression des patriotes qui se trouvaient à l’estaminet du Bras d’or, oblige les voyageurs à descendre et les fait entrer dans sa maison qui est à quelques pas.
Le tocsin sonne, la garde nationale est mise en alerte. Bayon et Romeuf, qui depuis Paris portent l'ordre d'arrêter la famille royale, arrivent peu de temps après, ainsi que les hussards errants de Choiseul et Goguelat.
La Nuit à Varennes
Minuit et demi - 22 juin 1791
Le juge Destez qui a vécu assez longtemps à Versailles, et que Jean-Baptiste Sauce est allé chercher, reconnaît formellement le roi. Les hussards de Lauzun, cantonnés au Couvent des Cordeliers, n'ayant pas été rassemblés par leurs officiers, dont le lieutenant Bouillé, fils du marquis de Bouillé, pactisent avec la foule. Le chirurgien Mangin monte à cheval pour porter la nouvelle à Paris.
Le détachement des hussards de Lauzun aux ordres du duc de Choiseul de retour de Pont-de-Somme-Vesle, rentre à Varennes et se place en garde devant la Maison Sauce : à la demande du duc de Choiseul, le sous-lieutenant Röhrig part pour Stenay, prévenir le marquis de Bouillé, le chevalier de Bouillé, incapable d'initiative était déjà parti rejoindre son père à Stenay.
Le tocsin sonne et de plus en plus de paysans et de gardes nationaux arrivent à Varennes.
5 heures 30
Le chef d'escadron Deslon, responsable du poste de Dun-sur-Meuse, ayant vu passer le chevalier de Bouillé vers 3 heures du matin, puis le sous-lieutenant Röhrig, comprend ce qui se passe à Varennes, fait monter son escadron de hussards et arrive à Varennes vers 05 h 30, mais ne peut entrer dans le village mis en alerte avec sa troupe : il peut néanmoins rencontrer le roi et sa famille et propose une sortie en force sous la protection des hussards de Lauzun encore fidèles. Le roi refuse et souhaite attendre l'arrivée des troupes du marquis de Bouillé.
7 heures 45
Les patriotes de Varennes, avec les envoyés de l’Assemblée législative, Bayon et Romeuf, officiers de la Garde Nationale de Paris, arrivés vers 7 heures, décident de renvoyer la famille royale à Paris. Alertée par le tocsin qui sonne partout une foule énorme vient border la route suivie par le cortège des prisonniers, encadré par la Garde Nationale varennoise et les dragons ralliés aux patriotes : il est 8h, la berline royale reprend la route de Paris.
Le duc de Choiseul et le comte de Damas sont arrêtés par la foule. Le chef d'escadron Deslon essaye en vain de combiner une opération de la dernière chance avec les hussards présents à Varenne et son détachement bloqué devant le village, mais sans carte, il ne trouve pas un gué pour passer la rivière l'Aire avec son escadron. Le régiment Royal Allemand n'arrive à Varennes qu'à 9 heures. Il ne restait plus que l'émigration pour les officiers compromis dans cette aventure.
Retour de la famille royale à Paris
22 juin 1791 - 22 heures
À Paris, l’Assemblée constituante prévenue par Mangin de l’arrestation de la famille royale nomme trois commissaires, Antoine Barnave, Jérôme Pétion de Villeneuve et Charles César de Fay de La Tour-Maubourg, pour ramener la famille royale à Paris. Pétion et Barnave monteront dans la voiture de la famille royale. Aux abords de Paris, selon Michelet, Pétion très populaire alors se placera entre le Roi et la Reine afin de décourager un éventuel tir de mousquet dans leur direction.
23 heures
La famille arrive à Châlons-en-Champagne, par la porte Sainte-Croix, qui avait été dédiée à la Dauphine lors de son arrivée en France le 11 mai 1770, où elle passe la nuit à l'Hôtel de l'Intendance.
23 juin 1791 - 12 heures
Le cortège royal quitte Châlons-en-Champagne, après avoir reçu une délégation du directoire de la ville conduit par Louis Joseph Charlier à 10 heures et assisté à la messe qui sera interrompue.
16 heures
Le cortège arrive à Épernay, où la famille royale dîne.
17 heures 30
Plaque commémorative de la rencontre du 23 juin 1791 à Boursault
Les trois députés de l’Assemblée constituante, accompagnés du colonel Mathieu Dumas rejoignent la famille royale à Boursault, entre Épernay et Dormans. Ils couchent à Dormans. À Paris, le club des Cordeliers demande l’établissement de la République.
24 juin 1791 - 6 heures
Le cortège part pour Paris et s’arrête pour la nuit à Meaux. À Paris, une pétition, signée de 30 000 noms, réclame la République.
25 juin 1791 - 7 heures
La famille royale quitte Meaux. À Paris, dès l’aube, une foule immense prend la direction de Meaux. La ville est inondée de pamphlets violents, injurieux pour le roi et la reine.
14 heures
Les premiers Parisiens rencontrent la famille à Villeparisis. L’Assemblée nationale décrète la suspension de Louis XVI.
18 heures
Le retour du Roi passant à la Barrière des Ternes le 25 juin 1791 Duplessi-Bertaux d’après un dessin de J-L Prieur.
Le cortège royal arrive sur les nouveaux boulevards actuels boulevards de La Chapelle, Rochechouart, Clichy, etc.. Pour éviter de trop violentes manifestations, la municipalité a décidé que les fugitifs feraient le tour de Paris et rentreraient aux Tuileries par les Champs-Élysées et la place de la Concorde. La Garde nationale forme la haie, mais la crosse en l’air, comme pour un enterrement. Le silence a été ordonné : Quiconque applaudira le roi sera bâtonné, quiconque l’insultera sera pendu. Il est 22 heures.
19 heures
Au passage de la berline royale et de sa double haie de gardes nationaux précédés par La Fayette, on se montrait sur les sièges les trois gardes du corps du Roi Malden, Moustier et Valory qui arrivaient les mains liées derrière le dos. La foule était immense, mais silencieuse, ou presque : on entendait quelques cris de Vive Drouet ! Vive la Nation ! Vive la brave garde nationale ! En effet, La Fayette avait interdit toute manifestation de soutien ou de haine.
22 heures
Lorsque la voiture royale arriva aux Tuileries, la fureur de la foule éclata. Il s’en fallut de peu que Marie-Antoinette ne fut écharpée. Le duc d’Aiguillon et Louis-Marie de Noailles la sauvèrent de justesse.
Le retour aux Tuileries allait, dans les faits, sceller le destin tragique de la famille royale. Le ralliement de Louis XVI à la Constitution, et son serment de fidélité le 14 septembre, auront peu de poids face à de supposées trahisons, dont la tentative de fuite constituait un symbole éclatant.
Conséquences
Au-delà même des erreurs d’organisation de cette équipée, l’arrestation du roi marque véritablement un tournant dans la Révolution. L'idée d'une république commence à faire son chemin. Les partisans de l'abolition de la Monarchie vont utiliser cet évènement pour poser Louis XVI en ennemi de la Révolution. Ce départ, pourtant justifié par Louis XVI cf ci-dessous, le testament politique, est alors assimilé à une fuite.
Cette fuite constituera un des chefs d’accusation développés par la Convention en décembre 1792
D'autre part, la fuite de Louis XVI fut dans tous les esprits lors des débats à l'Assemblée nationale, en 1792, sur le rétablissement des passeports et l'alourdissement des contrôles requis.
Le testament politique de Louis XVI
Testament politique de Louis XVI : Déclaration de Louis XVI à tous les Français, à sa sortie de Paris
Le matin du 21 juin 1791, le valet de chambre de Louis XVI découvre sur le lit, en lieu et place du corps du roi, un texte de 16 pages écrit de la main de Louis, intitulé Déclaration à tous les Français, justifiant ce départ de Paris. Ce texte sera censuré sur le moment par La Fayette, puis par l'Assemblée qui ne le diffuseront pas. Il ne fut jamais connu des Français ni diffusé dans son intégralité à l'époque révolutionnaire.
Traditionnellement appelé le testament politique de Louis XVI, ce document a été redécouvert en mai 2009. Il est au Musée des lettres et manuscrits à Paris.
Ce document historique majeur explique la volonté du roi : une monarchie constitutionnelle avec un exécutif puissant et autonome vis-à-vis de l'Assemblée.
Par ailleurs, il commente son sentiment sur la révolution, en critique certaines conséquences sans pour autant rejeter les réformes importantes comme l'abolition des ordres et l'égalité civile.
Conclusion du manuscrit : Français, et vous surtout Parisiens, vous habitants d'une ville que les ancêtres de Sa Majesté se plaisaient à appeler la bonne ville de Paris, méfiez-vous des suggestions et des mensonges de vos faux amis, revenez à votre roi, il sera toujours votre père, votre meilleur ami. Quel plaisir n'aura-t-il pas d'oublier toutes ces injures personnelles, et de se revoir au milieu de vous lorsqu'une Constitution qu'il aura acceptée librement fera que notre sainte religion sera respectée, que le gouvernement sera établi sur un pied stable et utile par son action, que les biens et l'état de chacun ne seront plus troublés, que les lois ne seront plus enfreintes impunément, et qu'enfin la liberté sera posée sur des bases fermes et inébranlables. A Paris, le 20 juin 1791, Louis.
Sa rédaction a initialement été confiée au comte de Provence, mais Louis XVI, trouvant les propos trop agressifs à l'égard de l'Assemblée, le réécrit dans sa quasi-totalité, nous apprennent Les mémoires du comte de Provence. Le manuscrit préparatoire de huit pages du comte de Provence est également au Musée des lettres et manuscrits à Paris.
Les sources
Plusieurs participants directs ou indirects ont écrit leurs mémoires. On peut citer celles de François Claude de Bouillé, du marquis de Choiseul, qui aidèrent à la fuite et celles du comte de Moustier, Valory ainsi que celle de la marquise de Tourzel qui participèrent à la fuite les premiers en tant que garde du corps et Mme de Tourzel en tant que baronne de Korff.
Plusieurs historiens, contemporains ou de peu, de l’évènement, ont également relaté ce dernier dont les plus connus restent Charles de Lacretelle et Jules Michelet.
Alexandre Dumas s’est intéressé à la fuite de Varennes lors de l’écriture de son roman La Comtesse de Charny. Il s’est alors abondamment documenté sur le sujet et a refait lui-même le trajet, plus d’un demi-siècle plus tard, reconstituant les lieux, recherchant des témoins visuels et pointant ainsi les imprécisions des historiens. Il relate sa quête dans La Route de Varenne, publié en 1860.
Controverses
Pour certain, l'épisode de Varennes constitue un élément de preuve de la duplicité du roi, qui n'aurait accepté officiellement la révolution française que pour sauver son titre royal et n'aurait attendu qu'une occasion pour rejoindre les princes étrangers. Pour d'autres, c'était l'occasion de reprendre la main à partir d'une constitution équilibrant les pouvoirs. Michelet de son coté ne doute pas que l'objectif du roi était de revenir à la tête d'une armée d'émigrés dans le but de mener une contre-révolution par la force.
En 2009, à propos d'un téléfilm sur le sujet, Ce jour-là, tout a changé : l'évasion de Louis XVI, l'historien Jean-Christian Petitfils a émis une thèse différente : Le scénario qui m'avait été présenté aborde deux thèmes essentiels et pourtant peu connus, ou en tout cas que les historiens en général n'ont pas pris en compte : Louis XVI est prêt à s’entendre avec les révolutionnaires, il accepte le principe d’une monarchie limitée. Néanmoins, il souhaite conserver une autorité dans certains domaines politiques. Mais cette volonté est rejetée par une grande majorité de députés de l’assemblée. ...
Un collectif d'historiens a fortement critiqué la thèse de Petitfils. Ils citent notamment l’historien Edgar Quinet qui a évoqué le plan de Mirabeau, devenu conseiller de la Cour jusqu’à sa mort le 2 avril 1791 : le roi devait se réfugier dans une place forte au milieu des régiments fidèles, dissoudre l’Assemblée, et reprendre Paris aux révolutionnaires. Ils citent l'historien Alphonse Aulard : Dès le mois d’octobre le projet était arrêté de partir secrètement pour Montmédy. L’empereur ferait sur nos frontières une démonstration militaire qui effraierait les patriotes. Louis XVI marcherait sur Paris avec l’armée de Bouillé. Ils invoquent l'historien François Bluche pour qui Louis XVI prisonnier de Paris depuis le 18 avril, ulcéré d’avoir dû accorder sa sanction à la Constitution civile du clergé votée le 12 juillet 1790 et condamnée par le pape le 10 mars 1791, est décidé à ne plus jouer le rôle que les circonstances lui imposaient depuis presque deux ans. Il est résolu à fuir la capitale, à se réfugier en province à Montmédy afin de retrouver au moins la plénitude de ses attributions constitutionnelles.
Cette dernière version, de François Bluche, correspond d'ailleurs à la thèse du téléfilm et de Jean-Christian Petitfils.
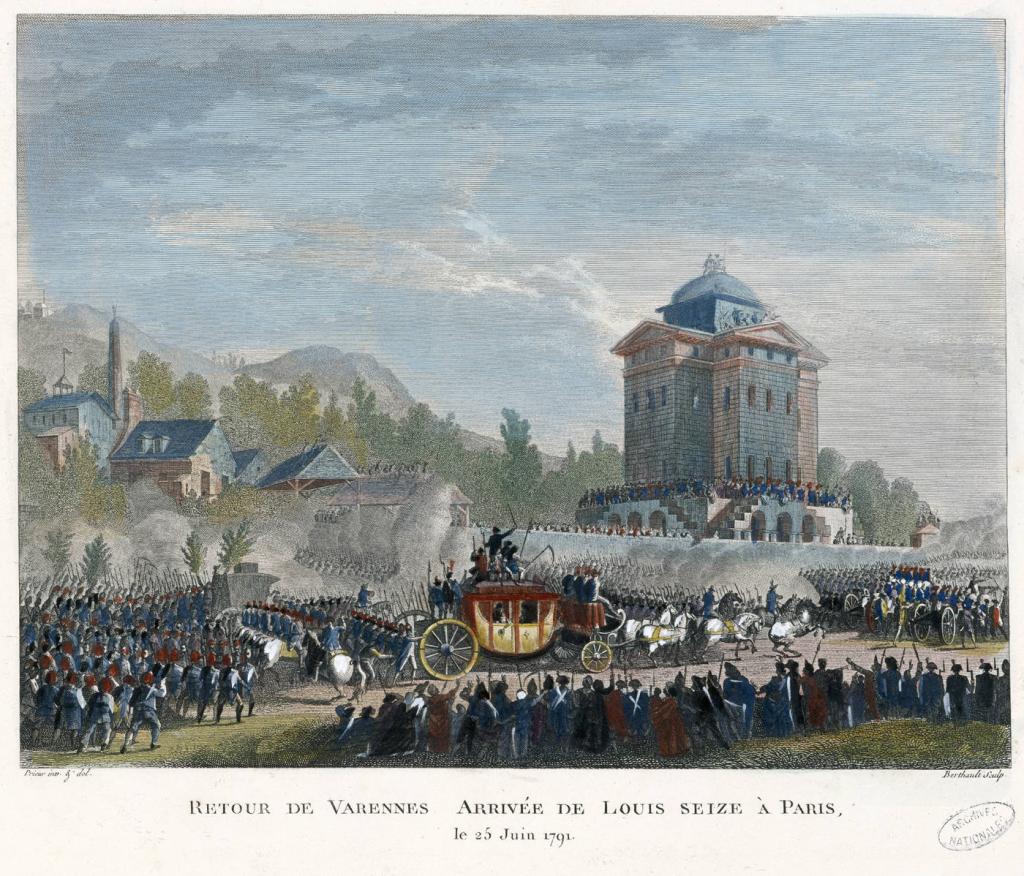   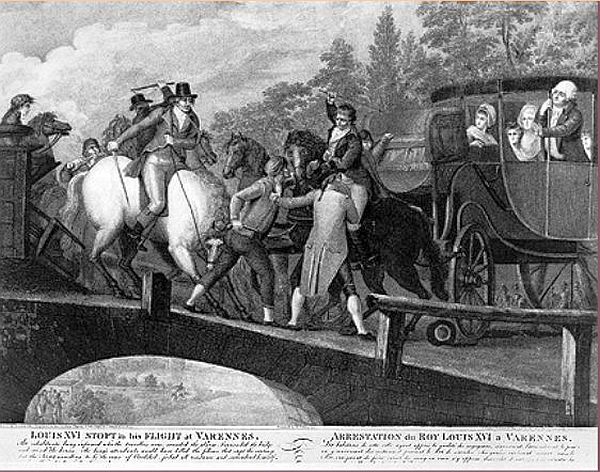    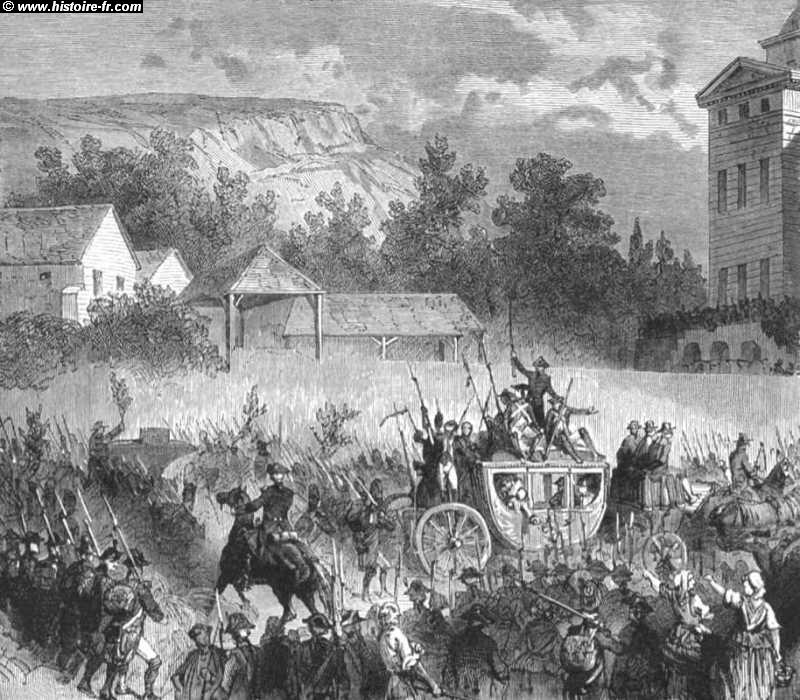   
Posté le : 19/06/2015 17:43
|
|
|
|
|
La guerre de trente ans 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 21 juin 1621; en Bohême exécution de 27 leaders protestants
tchèques à Prague au cours de la guerre de trente ans, ces condamnés à mort sont les responsables de la révolte, la Lettre de majesté de Rodolphe II est révoquée, une intense campagne de restauration du catholicisme et de germanisation est entreprise. La couronne élective devient héréditaire au profit des Habsbourg et le siège de la Cour est transféré à Vienne : l'exécution marque symboliquement la fin du soulèvement des nobles de Bohême et de la période bohémienne de la Guerre de trente ans.
La guerre de Trente Ans est une série de conflits armés qui a déchiré l’Europe de 1618 à 1648. Les causes en sont multiples mais son déclencheur est la révolte des sujets tchèques protestants de la maison de Habsbourg, la répression qui suivit et le désir de ces derniers d’accroître leur hégémonie et celle de la religion catholique dans le Saint-Empire.
Bataille de la Montagne Blanche De 1618 à 1648 en Europe, Issue Traités de Westphalie
Guerre franco-espagnole de 1635 à 1659, belligérants : Royaume de Suède, Royaume de Bohême, Danemark-Norvège 1625-1629, Provinces-Unies, Royaume de France, Électorat de Saxe, Palatinat du Rhin, Brandebourg-Prusse, Royaume de Hongrie, Principauté de Transylvanie, Zaporogue, Union protestante 1618-1621, Saint-Empire, Monarchie espagnole, Royaume de Portugal, Archiduché d'Autriche, Électorat de Bavière, Ligue catholique, Royaume de Hongrie, Croatie, Danemark-Norvège 1643-1645.
Les commandants sont Gustave II Adolphe de Suède †, Johan Banér, Lennart Torstenson, Carl Gustaf Wrangel, Charles X Gustave de Suède, Frédéric V du Palatinat, Christian IV de Danemark, Maurice de Nassau, Piet Hein, Cardinal de Richelieu, Louis II de Bourbon-Condé, Vicomte de Turenne, Bernard de Saxe-Weimar, Jean-Georges Ier de Saxe, Duc de Buckingham, Gabriel Bethlen, Ernst von Mansfeld †, Comte de Tilly †, Albrecht von Wallenstein, Franz von Mercy †, Jean de Werth, Ferdinand II, Ferdinand III
Comte d'Olivares, Maximilien Ier de Bavière, Ambrogio Spinola, Ferdinand d'Autriche, Comte de Bucquoy †.
Les forces en présence sont constituées de 661 000 hommes dont : 150 000 Suédois, 150 000 Français, 100 à 150 000 Allemands, 75 000 Néerlandais, 50 000 Danois et Norvégiens, 20 à 30 000 rebelles Hongrois, 6 000 Transylvains, 450 000 hommes dont : 300 000 Espagnols, 100 à 200 000 Allemands, 20 000 cavaliers Hongrois et Croates
Les pertes représentent 1 à 2 millions de morts 3 à 5 millions de morts
Les batailles de la guerre de Trente Ans :
Pilsen 09-1618 · Sablat 06-1619 · Montagne Blanche 11-1620 · Cap Saint-Vincent 08-1621 · Mingolsheim 04-1622 · Wimpfen 05-1622 · Höchst 06-1622 · Fleurus 08-1622 · Stadtlohn 08-1623 · Dessau 04-1626 · Lutter 08-1626 · Wolgast 09-1628 · Magdebourg 05-1631 · Werben 07-1631 · Abrolhos 09-1631 · Breitenfeld 09-1631 · Rain am Lech 04-1632 · Alte Veste 09-1632 · Lützen 11-1632 · Oldendorf 07-1633 · La Mothe 06-1634 · Nördlingen 09-1634 · Les Avins 05-1635 · Louvain 06-1635 · Tornavento 06-1636 · Corbie 08-1636 · Wittstock 10-1636 · Îles de Lérins 05-1637 · Rheinfelden 02-1638 · Guetaria 08-1638 · Cabañas 08-1638 · Fontarrabie 09-1638 · Thionville 09-1639 · Downs 10-1639 · Ille-sur-Têt 09-1640 · Montjuïc 01-1641 · Marfée 06-1641 · Saint-Vincent 11-1641 · Perpignan 11-1641 · Honnecourt 05-1642 · Barcelone 06-1642 · 1er Lérida 10-1642 · Leipzig 10-1642 · Rocroi 05-1643 · Carthagène 09-1643 · Tuttlinghem 11-1643 · Fribourg 08-1644 · Jüterbog 11-1644 · Jankau 03-1645 · Alerheim 08-1645 · Orbetello 06-1646 · Mardyck 08-1646 · Dunkerque 09-1646 · 2e Lérida 11-1646 · 3e Lérida 05-1647 · Cavite 06-1647 · Zusmarshausen 05-1648 · Lens 08-1648
Ces conflits ont opposé le camp des Habsbourg d’Espagne et du Saint-Empire germanique, soutenus par l’Église catholique romaine, aux États allemands protestants du Saint-Empire, auxquels étaient alliées les puissances européennes voisines à majorité protestante, Provinces-Unies et pays scandinaves, ainsi que la France qui, bien que catholique et luttant contre les protestants chez elle, entendait réduire la puissance de la maison de Habsbourg sur le continent européen.
Cette guerre a impliqué l'ensemble des puissances européennes selon qu'elles étaient pour ou contre le parti de l'Empereur, à l'exception de l'Angleterre et de la Russie – qui ont néanmoins indirectement œuvré contre le parti des Habsbourg. L'emploi de mercenaires était la règle. Les combats se déroulèrent surtout dans les territoires d’Europe centrale dépendant du Saint-Empire, puis se portèrent sur la plaine de Flandre, le nord de l'Italie ou encore dans la péninsule Ibérique. Les batailles, les famines, les massacres ont provoqué plusieurs millions de morts. Cette guerre civile européenne a lourdement pesé sur la démographie et l'économie des États allemands et du royaume d'Espagne, et assis l'hégémonie de la France, qui s'épanouira davantage encore sous Louis XIV.
La guerre de Trente Ans a été marquée sur le plan religieux par l'affrontement entre protestantisme et catholicisme et sur le plan politique par l'affrontement entre féodalité et absolutisme. Avec la paix de Westphalie, le problème politique se solde par la victoire du modèle absolutiste, qui du même coup résout celui des guerres de religion : puisque c'est au nom de conceptions rivales du bien que l'on s'est fait la guerre, on cesse de vouloir fonder la société sur une conception du bien admise par tous et on assied la paix civile en recourant à ce que les hommes ont en commun : la peur de la mort violente. Sous la forme de l'absolutisme, théorisé par Bodin et Hobbes, naît ainsi l’État moderne, une entité exerçant dans ses frontières le monopole de la violence légitime et se défendant à l'extérieur par une armée nationale.
De cette manière, la paix de Westphalie jette les bases du jus publicum europaeum : un système nouveau et stable de relations internationales, fondé sur un équilibre entre des États chacun titulaire de la souveraineté ; les guerres sont désormais conçues comme des conflits sécularisés d’État souverain à État souverain.
En bref
Les nouveaux conquérants : Hollande, Angleterre, France, Russie. Guerre de Trente Ans. Louis XIV. La prépondérance de l'Espagne et du Portugal s'achève au cours du XVIIe siècle devant les appétits commerciaux des autres grandes puissances européennes. Les Provinces-Unies calvinistes, don…
L'occasion du conflit fut fournie par la question religieuse, et la guerre de Trente Ans a bien été, à son origine et dans son essence profonde, une guerre de religion entre une aristocratie protestante attachée à ses privilèges et une dynastie catholique résolue à soutenir la Contre-Réforme et à obtenir la conversion des sujets à la doctrine romaine, définie par le Concile. En Bohême, terre d'Empire, dont le roi était généralement élu empereur, les seigneurs protestants utraquistes communiant sous les deux espèces) avaient obtenu de Rodolphe II en 1609 un statut la Lettre de majesté qui garantissait l'existence de leurs Églises et, par l'enseignement de l'Université, la diffusion de la Réforme. Sur cette vieille terre de tradition hussite et antipapiste, l'aristocratie de langue tchèque défendait sa civilisation originale. En 1617, la Diète de Bohême n'en avait pas moins reconnu pour son futur roi l'archiduc Ferdinand de Styrie, catholique ardent et convertisseur déclaré. Les protestants allemands s'inquiétèrent d'une promotion qui semblait désigner ce prince à l'Empire. Aussi attisèrent-ils les querelles de Bohême entre les utraquistes et un groupe de seigneurs tchèques catholiques tel le chancelier de Lobkowicz qui cherchait à la fois à consolider l'autorité royale et à étendre les positions romaines. Pendant une absence prolongée de l'empereur-roi Mathias et du chancelier, une assemblée protestante se réunit à Prague et, le 23 mai 1618, condamna à la défenestration, selon l'antique usage, deux seigneurs tchèques, membres du Conseil de lieutenance. Une guerre civile était ainsi commencée par une révolte aristocratique, qui n'avait rien d'exceptionnel pour le temps, et où la question de nationalité Allemands contre Tchèques n'avait joué aucun rôle. Les choses prirent bientôt une tournure plus grave, au cours de l'année 1619, après la mort de Mathias, dont les Bohêmes n'avaient point prononcé la déposition. La Diète prépara une nouvelle constitution, annula l'élection de 1617 et choisit pour roi un protestant, l'Électeur palatin Frédéric V. Pourtant, dans les mêmes jours, Ferdinand de Styrie fut élu empereur à Francfort. L'Empereur entreprit la reconquête de la Bohême, dont il s'estimait le roi légitime. Son armée l'emporta le 8 novembre 1620, à la bataille de la Montagne-Blanche, grâce à l'appui de la Ligue catholique du duc de Bavière. Frédéric V le roi d'un hiver s'enfuit ; bientôt, l'Empereur le mit au ban de l'Empire, et une réunion des Électeurs prononça la confiscation de ses États personnels, qui furent occupés par des troupes espagnoles Bas-Palatinat et bavaroises Haut-Palatinat. La Bohême fut sévèrement châtiée de sa rébellion : condamnations à mort, confiscations de biens, choix entre l'exil et la conversion au catholicisme. De nombreux nobles tchèques rejoignirent Frédéric V et les armées protestantes levées pour sa cause. En 1621, à l'expiration de la trêve de Douze Ans, la guerre reprit entre l'Espagne et les Provinces-Unies. Les Espagnols recrutaient des troupes en Italie, où ils étaient maîtres du Napolitain et de Milan, et ils empruntaient la voie des Alpes et la vallée du Rhin pour les conduire aux Pays-Bas. Les Hollandais contrôlaient le commerce sur mer dans la Manche, la mer du Nord et la Baltique et, hors d'Europe, l'immense empire espagnol d'Amérique, et les richesses des compagnies de navigation hollandaises allaient fournir des ressources à la lutte des deux États. La guerre religieuse et civile d'Allemagne trouvait ainsi un arrière-plan européen et même mondial. Les États européens, France, Angleterre, Danemark, Suède, voire Pologne et Russie, et la Turquie en suivaient les péripéties avec d'autant plus d'intérêt que le statut religieux et politique de l'Europe pouvait être bouleversé par la victoire des protestants ou par celle de la maison d'Autriche Espagne et Empereur dont, selon le mot d'un ministre français, le titre de religion recouvrait aussi des desseins temporels. Au premier caractère de religion, s'ajoutait celui d'un conflit de puissances.
Les armées de la guerre de Trente Ans :
Trente ans de guerre, dont le principal théâtre d'opérations allait être le Saint Empire. Les armées en présence étaient, avant tout, des armées de mercenaires, levées par des chefs de guerre qui assuraient l'enrôlement, l'armement et le ravitaillement des troupes. Au début, les effectifs ne dépassaient pas une vingtaine de milliers d'hommes, mais ils s'enflèrent considérablement au cours du conflit. L'équipement de l'infanterie et de la cavalerie était traditionnel : piques, mousquets, casques et cuirasses ; l'artillerie était encore peu importante, utilisée pour semer le désordre chez l'adversaire pendant le combat et tenter le siège des villes, mal fortifiées. Tout dépendait de la solde : si celle-ci n'était pas fournie à temps, les soldats se débandaient et pillaient la campagne. Plus les armées étaient nombreuses, plus il fallait d'argent. Les souverains ne pouvaient le fournir qu'en augmentant les impôts, mais, pour obtenir immédiatement des espèces, ils recouraient aux avances de négociants et de banquiers. Pour détourner les armées de leurs territoires, les grandes villes marchandes d'Allemagne consentaient à verser de lourdes contributions, mais elles n'évitaient pas toujours le saccage, cas de l'incendie de Magdebourg par l'armée catholique de Tilly, en 1631. Dans la campagne, les châteaux et les monastères étaient livrés au pillage. Le long des routes suivant les grands fleuves, les paysans subissaient sans défense les exactions de tout genre : enlèvement des récoltes et des bestiaux, violences contre les personnes avec des raffinements de méchanceté, pendaisons, viols. La discipline n'existait que pendant le combat et encore !, et le soldat de la guerre de Trente Ans, quel que fût son parti, et dont la figure est bien évoquée dans le roman de Hans Jakob von Grimmelshausen, Les Aventures de Simplicius Simplicissimus, a laissé un durable souvenir de terreur. Au début de son intervention 1631 l'armée du roi de Suède Gustave Adolphe 13 000 hommes présentait un autre caractère. Elle était recrutée dans le pays même par la conscription, animée d'un idéal religieux, soumise à une discipline sévère, avec interdiction de vol et de blasphème. La Suède, pays producteur de cuivre et de fer, était en mesure de fournir des armes. Bon stratège et tacticien, Gustave Adolphe modifia l'armement, supprima la cuirasse de l'infanterie, introduisit l'usage de la cartouche, du canon de bataillon, rendit l'action plus efficace par la tactique de l'ordre mince. Il forma de très bons élèves : J. G. Baner, L. Torstensson, C. G. Wrangel, ce qui explique que les armées suédoises, de 1631 à 1648, aient tenu un rôle essentiel jusqu'à la fin du conflit. Mais les effectifs atteignaient parfois 170 000 hommes, et ils étaient recrutés aussi par enrôlement, parmi les Allemands surtout. Il n'était plus question de la discipline du début. Les généraux suédois, comme les autres, s'enrichissaient de contributions et de pillages. Il serait trop sommaire de présenter tous les chefs de la guerre de Trente Ans comme des reîtres et des condottieri, en quête de butin. Plusieurs d'entre eux ne manquèrent pas d'esprit politique, mais assurément l'ambition personnelle fut le premier de leurs mobiles. Le cas le plus prestigieux reste celui d'Albert de Wallenstein 1583-1634. Jeune seigneur catholique de Bohême, il avait commencé sa fortune en acquérant des biens confisqués et en participant à une opération de refonte monétaire, au service de l'Empereur, en 1622 ; il leva une première armée qui lui permit, dans la guerre avec le Danemark, d'occuper au nom de l'Empereur la Basse-Saxe et le Mecklembourg, puis il fut brutalement disgracié. Lors de l'entrée en guerre de la Suède, il accepta de reprendre un commandement. Sa nouvelle armée, plus nombreuse, comportait des officiers étrangers. Avec elle, il affronta Gustave Adolphe à Lutzen 1632 et essuya une défaite, compensée par la mort du roi de Suède sur le champ de bataille. Il reconstitua son armée en Bohême, mais il ne s'en servit guère en 1633, tandis qu'il entrait en négociations avec les Suédois et les Français. Richelieu lui-même crut que Wallenstein allait abandonner la cause impériale et, avec l'espoir de devenir pour son propre compte roi de Bohême, se retourner contre Ferdinand II. Celui-ci, n'ayant plus confiance dans son généralissime, le destitua. Wallenstein périt dans un guet-apens misérable. Mais ses véritables desseins demeurent impénétrables : des historiens croient qu'il voulait chasser les étrangers Suédois, Français, Espagnols d'Allemagne et rétablir la paix dans l'Empire. Sa réussite avait été prodigieuse : duc de Friedland et plusieurs fois prince d'Empire, bâtisseur et collectionneur, il laissait une fortune personnelle immense. Ses héritiers en sauvèrent une partie, mais elle fut aussi partagée entre ses lieutenants étrangers, dont l'un, au moins, l'avait dénoncé. Le cas cependant n'était pas exceptionnel : le lieutenant de Gustave Adolphe, Bernard de Saxe-Weimar, essaya de s'assurer un duché personnel en Franconie et en Alsace.
Comme il n'avait pas été réglé par la victoire de l'Empereur sur la révolte de Bohême, le conflit n'a cessé de rebondir à mesure que des intérêts nouveaux – et plus généraux – s'y sont trouvés engagés. Il est certain que les princes protestants redoutaient que l'Empereur n'établît son autorité sur toute l'Allemagne, n'y augmentât son autorité personnelle et n'y imposât le catholicisme. C'est cette considération qui détermina, à partir de 1624, le roi de Danemark Christian IV à intervenir : en effet, déjà maître de la Norvège et des régions méridionales de la Suède, détenteur du détroit du Sund qui donnait accès à la Baltique et prince protestant convoitant des évêchés d'Empire, la victoire impériale eût mis en péril sa puissance. Il essaya donc de chasser de la Basse-Saxe l'armée catholique de Tilly, mais il fut vaincu par l'armée de Wallenstein, avec lequel il dut conclure la paix de Lübeck qui sauvegardait ses États personnels.
La France, où Richelieu était devenu ministre en 1624, ne pouvait que redouter un succès définitif de la maison d'Autriche dans l'Empire, succès qui eût facilité la victoire des Espagnols sur les Provinces-Unies. Il lui fallait donc entretenir la guerre par des alliances avec les adversaires des Habsbourg : les Provinces-Unies et, à partir de 1631, la Suède. Ces alliances protestantes faisaient scandale auprès des catholiques de France, mais elles paraissaient à Richelieu un moindre mal. Il essayait en même temps d'une alliance avec la Bavière catholique. En 1630, à l'assemblée de Ratisbonne, le Père Joseph, conseiller de Richelieu, encouragea la Bavière à demander le licenciement de l'armée de Wallenstein et à refuser l'élection immédiate d'un roi des Romains empereur désigné, que Ferdinand II espérait pour son fils. Mais l'Empereur avait commis l'erreur de promulguer l' édit de Restitution qui contraignait les protestants à rendre aux catholiques les biens d'Église confisqués depuis la paix d'Augsbourg. Le roi de Suède répondit à l'appel des protestants alarmés. Il obligea les Électeurs de Brandebourg et de Saxe à entrer dans son alliance ; il vainquit Tilly à Breitenfeld 1631. L'essai d'arbitrage de la France avait échoué : les protestants étaient tous regroupés derrière le roi de Suède, les catholiques derrière l'Empereur. C'est alors que celui-ci rappela Wallenstein. Les victoires suédoises, favorisées par les subsides français, inquiétaient Richelieu par l'ampleur des résultats, car la France catholique ne souhaitait pas que l'Allemagne devînt un empire protestant. Les forces françaises, qui occupaient déjà la Lorraine, prirent sous leur protection plusieurs villes d' Alsace, pour que la région ne tombât pas entièrement aux mains des Suédois. En revanche, après la mort de Gustave Adolphe 1632, il était indispensable d'empêcher la débandade des protestants et de maintenir en guerre contre l'Empereur le chancelier Oxenstierna, régent de Suède, et les princes protestants de l'Ouest ligue d'Heilbronn. Pendant quelques mois, en 1633, Wallenstein, son armée à pied d'œuvre, fut peut-être l'arbitre de la situation. Mais, après lui, son armée, reprise en main par le roi de Hongrie futur empereur Ferdinand III, remporta la victoire de Nordlingen sur les Suédois. Aussitôt, les Électeurs se réconcilièrent avec l'Empereur à la paix de Prague 1635, et, contre l'abandon de l'édit de Restitution, lui promirent leur concours pour chasser d'Allemagne les armées étrangères. On assistait à un incontestable réveil d'un patriotisme d'Empire. La France avait intérêt à lui opposer la liberté germanique, à maintenir dans leur résistance les princes protestants non encore réconciliés et la Suède. Au printemps de 1635, elle déclara la guerre au roi d'Espagne. À la mort de Richelieu 1642, elle avait obtenu de sérieux avantages. En Allemagne, les armées françaises et suédoises combinaient leurs actions pour atteindre les capitales de l'Empereur : Prague et Vienne. Cependant le pape, inquiet de la lutte entre les grandes puissances catholiques, pressait la réunion d'un congrès, et le successeur de Richelieu, Mazarin, diplomate consommé, renforçait dans toute l'Europe la position morale de la France.
Le Congrès et la paix de Westphalie
Réuni dès 1643 en Westphalie, à Osnabrück pour les protestants, à Münster pour les catholiques, le Congrès parvint lentement à rétablir la paix et à instaurer un statut nouveau de l'Allemagne, qui fut garanti par toutes les puissances contractantes 24 oct. 1648. Trois confessions étaient reconnues dans l'Empire : catholique, luthérienne et calviniste. Les princes allemands pouvaient avoir leur armée, conclure alliance entre eux ou avec des étrangers, mais jamais contre l'Empereur et l'Empire. C'était la Landeshoheit. Les princes allemands les plus puissants agrandirent leurs États : la Saxe de la Lusace, le Brandebourg de la Poméranie et de plusieurs évêchés, le fils de Frédéric V retrouva l'électorat et les territoires de son père, cependant que la Bavière conservait la dignité électorale. La maison d'Autriche ne disposerait donc plus de l'Allemagne, mais elle y conservait une forte influence et elle était consolidée dans ses États héréditaires : Bohême et Autriche. La Diète, réunie à Ratisbonne en 1641, ne se séparerait pas avant d'avoir réglé les derniers litiges. Elle allait, en fait, devenir perpétuelle. Des satisfactions territoriales furent accordées à la France et à la Suède. La France reçut Pignerol, conquête de Richelieu, qui assurait l'entrée en Italie, et Brisach, qui avait le même caractère en Allemagne ; elle obtint, de plus, les droits de la maison d'Autriche sur l'Alsace, ce qui devait lui permettre, en quelques années de reconstruction, de faire de l'Alsace une province française. La Suède gagna la Poméranie occidentale, des ports de la Baltique et les évêchés de Brême et de Verden. L'Espagne avait signé, en janvier, une paix séparée avec les Provinces-Unies, dont l'indépendance fut ainsi consacrée. Mais la lutte entre la France et l'Espagne devait durer encore onze ans, jusqu'en 1659. Si douloureusement établie, cette pacification de l'Empire pouvait contribuer à la naissance de l'Europe moderne. Épuisée par trente ans de combats dans certaines régions la perte de population était de 66 à 70 p. 100, et bien que les ports de la Baltique eussent été préservés, voire enrichis par les fournitures aux armées, l'Allemagne devait mettre longtemps à réparer les ruines en hommes et en biens.
Développement. Les origines du conflit
Ses origines sont multiples, même si la première est l’opposition religieuse et politique entre catholiques et protestants luthériens ou calvinistes. D’autres ressortent : tentations hégémoniques ou d’indépendance, rivalités commerciales, ambitions personnelles, jalousies familiales y trouvent leur exutoire.
La défenestration de Prague, épisode relativement anodin, est la cause immédiate du conflit, mais la disproportion est grande entre l’étincelle initiale et la gravité et la durée du conflit – celles-ci ne peuvent se comprendre que par l'existence de causes profondes qui atteignent leur paroxysme pendant la même période.
La guerre de Trente Ans 1618-1648 a été longtemps considérée, mais trop étroitement, comme une guerre d' Allemagne, sur laquelle s'est greffée, à partir de 1635, une nouvelle phase de la lutte traditionnelle entre l' Espagne et la France. Commencée en Bohême par la défenestration de Prague 23 mai 1618 et terminée par la signature des traités de Westphalie, à Münster et à Osnabrück, le 24 octobre 1648, elle s'est déroulée sur le territoire du Saint Empire. À partir de l'intervention du roi de Suède, Gustave II Adolphe, des armées étrangères ont pénétré en Allemagne et pris part à la lutte. Les faits de guerre ont laissé des ruines tragiques, moins les batailles que les pillages, les incendies du plat pays, la propagation des épidémies, entraînant des pertes de vies humaines et des dévastations matérielles. Le conflit était né de l'opposition entre protestants et catholiques dans l'Empire, il s'est élargi à la mesure européenne, dans un affrontement entre les maisons d'Autriche et de France, la première cherchant à asseoir sa prépondérance en Europe, la seconde défendant sa propre liberté et prenant dans sa clientèle les petits États d'Allemagne et d'Italie. La paix a consacré un nouvel ordre dans le Saint Empire : ordre politique, où l'Empereur ne pouvait plus prétendre à la souveraineté absolue, ordre religieux, par la reconnaissance des trois confessions chrétiennes, catholique, luthérienne, calviniste. La France et la Suède étaient garantes de la nouvelle Constitution de l'Empire : Constitutio Westphalica, avec les autres signataires du traité. L'historiographie contemporaine prend une vue encore plus large de l'événement ; la guerre de Trente Ans, par sa durée, son intensité, ses résultats, représente la période la plus aiguë d'une large crise qui la déborde : crise idéologique de la chrétienté, qui avait suscité deux réformes rivales, celle du pur Évangile, celle du concile de Trente ; crise économique avec la montée des prix au XVIe siècle, les transformations des marchés, les problèmes monétaires, le déclin relatif de la Méditerranée au profit des routes atlantiques ; crise politique et sociale, avec la constitution en Europe d'États monarchiques de plus en plus centralisés France, Espagne et l'apparition de nouvelles sociétés la bourgeoisie marchande des Provinces-Unies.
Catholiques contre protestants Martin Luther
À la suite de la prédication de Martin Luther 1483-1546, la Réforme se répand rapidement. De nombreuses principautés allemandes adoptent le protestantisme, ce qui divise l'Empire en deux camps opposés. La Contre-Réforme, dirigée par la maison de Habsbourg, a pour ambition de faire regagner au catholicisme le terrain perdu.
La paix d'Augsbourg 1555 confirme les conclusions de la première diète de Spire et met fin aux combats entre catholiques et luthériens dans les États allemands. Elle stipule que :
les princes allemands pour environ 360 d'entre eux sont libres de choisir la confession catholique ou luthérienne de leurs territoires, selon leur conviction ou leurs intérêts, leurs sujets n’ayant qu'à se soumettre Cujus regio, ejus religio;
les luthériens qui habitent dans des principautés ecclésiastiques dépendant d'un évêque)peuvent conserver leur foi ;
les luthériens peuvent conserver les territoires conquis sur les catholiques depuis la paix de Passau en 1552 ;
les dignitaires de l'Église catholique évêques et archevêques qui se sont convertis au luthéranisme doivent abandonner leurs domaines évêchés et archevêchés.
Les tensions politiques et économiques s'accroissent entre les puissances européennes au début du XVIIe siècle. L'Espagne s'intéresse aux affaires allemandes car Philippe III d'Espagne est un Habsbourg et possède des territoires bordant à l'ouest certains États allemands. Les deux branches de la famille des Habsbourg restent si étroitement liées que leur politique extérieure est commune. Le roi d'Espagne en est le chef véritable.
La France s'intéresse aussi aux affaires allemandes, car elle surveille avec méfiance son encerclement par les territoires soumis aux Habsbourg. Son action est ambiguë et louvoyante, car le cardinal de Richelieu n'hésite pas à s'allier aux princes protestants pour contrer la maison d'Autriche, championne du catholicisme et de la chrétienté contre les Turcs, alors qu'il combat les protestants en France. La Suède et le Danemark s'intéressent aussi aux duchés de Poméranie et de Mecklembourg, dont les rivages bordent la mer Baltique, pour des raisons plutôt économiques mais non dénuées d'arrière-pensées politiques.
Les tensions religieuses se sont également accrues pendant la seconde moitié du XVIe siècle. La paix d'Augsbourg est mise à mal pendant cette période car des évêques convertis n'ont pas renoncé à leurs évêchés. Par ailleurs, le calvinisme se propage en Allemagne, ce qui ajoute une nouvelle confession. Les catholiques d'Europe orientale Polonais, Autrichiens souhaitent restaurer la primauté de la confession catholique.
Pour les Habsbourg : conserver l’hégémonie
L'empereur Rodolphe II L'empereur Mathias
Les empereurs Rodolphe II puis Matthias Ier veulent avant tout accroître leur hégémonie ; ils sont donc parfois prêts à coopérer avec les protestants, ce qui est mal compris par leurs partisans. La lutte entre la maison d’Autriche et la monarchie française pour la suprématie en Europe dure depuis cent ans : le terrain est propice pour qu’elle s’y déploie sans ménagement.
Les Habsbourg sont en outre très tolérants, ce qui favorise l’expansion des nouvelles religions, contribuant ainsi à multiplier les causes de querelles. La Suède et le Danemark, qui veulent contrôler l’Allemagne du Nord, sont dans le camp des luthériens.
Tout ceci dégénère en violence ouverte en 1606 dans la petite ville allemande de Donauwörth. La majorité luthérienne empêche la communauté catholique de faire une procession, ce qui déclenche une rixe. À la demande des catholiques, le duc Maximilien Ier de Bavière intervient et impose le retour de la ville au catholicisme. Après ces combats, les calvinistes, encore peu nombreux en Allemagne, se sentent les plus menacés, et fondent la Ligue de l’Union Évangélique sous la direction de l’électeur Frédéric V du Palatinat, époux d’Elizabeth Stuart, fille de Jacques Ier d’Angleterre. Sa possession du Palatinat rhénan est précisément l’un des territoires de la vallée du Rhin que convoite l’Espagne, pour pouvoir y faire passer librement ses troupes du Milanais vers les Pays-Bas. En réaction, les catholiques s’unissent en 1609, sous la direction de Maximilien de Bavière et sous la bannière de la Sainte Ligue catholique.
Un conflit indépendant, la guerre de Quatre-Vingts Ans entre l’Espagne et les Provinces-Unies, contribue à faire converger vers les pays allemands les armées espagnoles, alliées de l’Empire. En effet, l’Espagne ne dispose plus, depuis la déroute de l’Invincible Armada, de la suprématie sur les mers. Le passage des troupes par la voie maritime océan Atlantique, Manche, mer du Nord étant trop risqué, le moyen le plus sûr pour faire passer les troupes espagnoles de la péninsule Ibérique vers le lieu des affrontements aux Pays-Bas est une route passant par la Méditerranée, Gênes, le Milanais, les cols alpins de la Valteline et la vallée du Rhin. Le jeu des alliances focalise sur ces différentes contrées l’affrontement entre les puissances rivales.
L’empereur Matthias Ier, également roi de Bohême, est sans descendance : se pose donc le problème de sa succession et de la conservation du titre impérial par les Habsbourg. Matthias souhaite que celui-ci revienne à son cousin germain Ferdinand de Styrie. Or, le roi de Bohême titre électif en droit, mais habituellement dévolu à un Habsbourg est un des sept princes-électeurs : Matthias abandonne le titre de roi de Bohême en 1617 et Ferdinand de Habsbourg lui succède, avec la perspective de pouvoir ainsi accéder à la dignité impériale à la mort de Matthias. Les Tchèques ont obtenu de Rodolphe II, par une lettre de majesté de 1609, des prérogatives leur assurant une certaine autonomie et des garanties concernant la liberté religieuse.
Or, Ferdinand II, catholique zélé qui a été éduqué chez les Jésuites, veut voir revenir la Bohême dans le giron de l’Église catholique. Des incidents survenus entre l’archevêque de Prague et les luthériens amènent le Conseil des Défenseurs de la Foi à convoquer une diète. Le roi s’y oppose par une lettre.
La Défenestration de Prague 1618.
Le 23 mai 1618 au palais de Hradschin à Prague, les Défenseurs de la Foi rencontrent deux émissaires de Ferdinand II, Martinitz et Slawata : ceux-ci sont passés par la fenêtre sans être sérieusement blessés car ils tombent sur un tas d’ordures. Cet événement mineur, appelé : la défenestration de Prague, marque le début de la guerre de Trente Ans. La révolte de la Bohême est soutenue et accompagnée avec plus ou moins de conviction par les États voisins de Moravie, Silésie et Lusace.
Le 20 mars 1619, l’empereur Matthias meurt. Mécontents de leur nouveau roi, les Tchèques déposent Ferdinand II le 19 août et élisent à sa place l’électeur palatin et ardent calviniste Frédéric V, le 26 août, alors que l’élection impériale se tient à Francfort le 28 août. Un roi protestant à la tête de la Bohême signifie une majorité d’électeurs du Saint-Empire acquis au protestantisme, Brandebourg, Saxe, Palatinat et Bohême contre les trois princes-évêques de Cologne, Mayence et Trèves, ce qui serait un bouleversement considérable.
Les nouvelles de Bohême ne sont pas parvenues à Francfort et Ferdinand II est élu Empereur : s’appuyant sur la Sainte Ligue et sur son cousin Philippe III d'Espagne, Ferdinand II se met en devoir de mater la révolte tchèque et d’éliminer son rival Frédéric V. De fait, ce dernier va très vite mécontenter ses sujets du fait de sa méconnaissance du pays et de son calvinisme intransigeant. Le décor est en place pour la conflagration.
Une guerre familiale
Ces souverains régnants qui s’affrontent si longuement ont d'étroites parentés :
Maximilien Ier de Bavière est cousin de Frédéric V du Palatinat, oncle et beau-frère de l'empereur Ferdinand III ;
Charles Ier d’Angleterre est beau-frère de Frédéric V et de Louis XIII de France ;
Louis XIII, beau-frère de Charles Ier d'Angleterre, est également beau-frère de Ferdinand III, de Victor-Amédée Ier de Savoie et de deux façons de Philippe IV d'Espagne, lui-même cousin puis gendre de l’empereur Ferdinand III ;
etc
.
Financement de la guerre
Les dégâts causés par les combats et la circulation incessante des troupes armées en campagne ou en débandade sont considérables, parfois inouïs. Les armées comprennent une majorité de mercenaires dont la paye n’est pas régulièrement assurée sur les budgets des États qui les emploient. Ainsi les soldats, mal payés, payés avec retard ou pas payés du tout, sont amenés à se rémunérer par eux-mêmes en fondant sur les populations civiles, qu’elles soient ennemies ou de leur propre bord. D’ailleurs Wallenstein développe au plus haut point s’il ne l'inventa pas le principe selon lequel la guerre doit financer la guerre c’est-à-dire que l’exploitation économique des pays conquis doit être la ressource principale de l’armée en campagne, quitte à demander à des financiers des avances sur le tribut à percevoir. Des fortunes colossales sont ainsi amassées sur le malheur des populations par des hommes sans scrupules tels que Wallenstein lui-même, Liechtenstein ou Hans de Witte.
Les exactions sont nombreuses : tortures, massacres en masse d’innocents, viols, assassinats, etc. Des épisodes comme ceux du sac de Magdebourg, les atrocités commises au Palatinat ou en Franche-Comté par exemple, marquent les esprits pour des décennies et restent dans la mémoire collective pendant plus d’un siècle, alimentant en chaîne le cycle infernal des représailles et de la vengeance. Certaines régions de l’Allemagne ou de la France actuelles comme la Lorraine sortent de cet interminable conflit ruinées, dévastées, dépeuplées pour de longues années.
Les traités qui suivent la guerre de Trente Ans redessinent la carte de l’Europe en instaurant un nouvel équilibre des forces, consacrant le déclin de l’Espagne, l’affaiblissement durable de la Maison d’Autriche, l’affirmation de la puissance de la Suède et de la France qui progresse en territoire germanique reconnaissance de l'annexion des Trois-Évêchés par l'empire, acquisition d'une partie de l'Alsace, l’extrême morcellement politique de l’Allemagne en 439 principautés indépendantes, la reconnaissance de nouvelles nations Pays-Bas, Suisse.
Les quatre périodes de la guerre
On analyse traditionnellement la guerre de Trente Ans en quatre périodes successives correspondant chacune à un élargissement de l'ensemble des protagonistes. Chacune des trois premières périodes se termine en effet par un succès du camp impérial et catholique qui détermine un nouvel acteur à entrer en lice pour voler au secours du camp protestant.
Ces périodes sont :
la période bohémienne et palatine, de 1618 à 1625 ;
la période danoise de 1625 à 1629 ;
la période suédoise de 1630 à 1635 ;
la période française ou franco-suédoise de 1635 à 1648.
La période bohémienne et palatine 1618-1625
Maximilien Ier, Électeur et duc de Bavière et sa seconde épouse, Marie-Anne d’Autriche.
Les Habsbourg allemands ont pour alliés la papauté, leur cousin Philippe III d'Espagne, Maximilien Ier de Bavière et sa Ligue catholique dont les armées sont commandées par Jean t' Serclaes, comte de Tilly. Les Électeurs ecclésiastiques, princes-archevêques de Mayence, de Cologne et de Trèves, chefs temporels autant sinon plus que spirituels font partie de la Ligue catholique l’archevêque de Cologne est même le propre frère de Maximilien. Pourtant, l’archevêque de Trèves va plus tard, par ses intrigues et sa politique francophile, provoquer l’entrée en guerre de la France.
Le prince-électeur Jean-Georges Ier de Saxe est dans un premier temps du côté de l’Empereur, bien que protestant : il espère des gains territoriaux et, de toute façon, voit d’un mauvais œil l’accroissement de puissance d’un de ses collègues Électeurs — car, élu roi de Bohême, l’Électeur Palatin dispose de deux voix sur les sept du collège électoral institué par la Bulle d'Or. Ce prince est par la suite un allié plus que versatile.
Bautzen, 1620
Le Palatin compte sur l’appui au camp protestant du prince protestant de Transylvanie Gabriel Bethlen et sur l’aide financière des Provinces-Unies celles-ci sont liées par la trêve de douze ans conclue avec l'Espagne en 1609, qui va bientôt se terminer. Mais il ne peut bénéficier de celui de son beau-père, Jacques Ier d’Angleterre dont la politique incohérente cherche à ce moment l’alliance avec l’Espagne. De fait, Frédéric V, prince jeune, manquant d’expérience et de la stature politique qu'exige sa situation, va bien vite éprouver le défaut de motivation, de constance et/ou de courage de tous ceux qui pourraient lui apporter leur appui.
Le duc de Bavière catholique et l’Électeur palatin calviniste sont tous deux de la famille des Wittelsbach, le premier issu de la branche aînée et le second issu d'une branche cadette qui a reçu la dignité électorale au XIVe siècle : l’opposition religieuse se double d’une longue jalousie familiale. En fait, Maximilien, qui aurait pu à un moment postuler à l’Empire, a obtenu de Ferdinand II, pour prix de son soutien, entre autres promesses, celle de reprendre la dignité électorale.
Les premiers combats ont lieu dès le mois de septembre 1618 avec le siège de Pilsen par les protestants allemands commandés par le comte Ernst von Mansfeld. Puis, en août 1619, les Bohémiens conduits par le comte de Thurn battent une armée impériale et menacent Vienne ; mais cet avantage est momentané. Le 26 août 1619, Ferdinand II succède à Mathias mort le 19 à la dignité impériale, mais il est écarté du royaume de Bohème par la Diète de Prague qui offre la couronne à Frédéric V.
En Valteline nord de l'Italie, les catholiques se révoltent contre la tutelle des Grisons protestants et conduisent, dans toute la région, le massacre des protestants en juillet 1620 : c'est le Sacro Macello ou boucherie sacrée.
Louis XIII de France souhaite aider l’Empereur. Malgré la rivalité des deux familles, ils ont en commun l’idéal monarchique, le désir de conforter le catholicisme contre les protestants et les Turcs, toujours menaçants à l’est. La France offre sa médiation, concrétisée à Ulm en juillet 1620 par une trêve entre catholiques et luthériens : la Bohême calviniste n’est donc pas concernée, et les armées catholiques peuvent l’attaquer librement : Tilly et Bucquoy écrasent les révoltés de Bohême à la bataille de la Montagne Blanche Bila Hora près de Prague le 8 novembre 1620. Leur déroute est complète et la reprise en main de la Bohême très énergique.
Frédéric V est vaincu, 1 an et 4 jours après le début de son règne : il reste pour la postérité le Roi d’un hiver. Il est mis au ban de l’Empire, ses territoires sont confisqués et il doit s'exiler en Hollande. Il est plus tard déchu de son titre d’Électeur au profit de Maximilien de Bavière. Celui-ci reçoit en outre une partie du Palatinat.
En Bohême, les responsables de la révolte sont condamnés à mort exécution de 27 leaders protestants tchèques à Prague le 21 juin 1621, la Lettre de majesté de Rodolphe II est révoquée, une intense campagne de restauration du catholicisme et de germanisation est entreprise. La couronne élective devient héréditaire au profit des Habsbourg et le siège de la Cour est transféré à Vienne : l'exécution marque symboliquement la fin du soulèvement des nobles de Bohême et de la période bohémienne de la Guerre de trente ans.
Campagnes de Tilly et principales batailles 1619-1623.
Les Espagnols commandés par Spinola occupent le Palatinat qui leur servira d'étape stratégique importante entre leurs domaines du Milanais où stationnent leurs troupes et les Provinces-Unies. À la mort de Philippe III en 1621, son fils Philippe IV, qui n’a que seize ans prend pour conseiller le comte-duc d’Olivares, catholique très zélé ; celui-ci, véritable responsable des affaires, est partisan convaincu d’une collaboration étroite avec les Habsbourg d’Autriche.
De nombreux princes protestants estiment que l’empereur a outrepassé ses droits ; c’est une cause majeure de la poursuite et de l’extension du conflit. Trois princes, à la tête de troupes de mercenaires, restent en armes : le comte Ernst von Mansfeld, le plus redoutable, retourne vers les rives du Rhin avec 20 000 hommes ; les deux autres, Christian de Brunswick et Georg Friedrich de Bade-Durlach ont chacun 15 000 hommes. Ces troupes d’aventuriers sont autant, sinon plus, motivées par l’appât du gain et les perspectives de pillage que par leur conviction religieuse. Tilly se porte vers les régions rhénanes pendant les années 1621-1622, et les affronte ensemble ou tour à tour au cours de plusieurs batailles à Wiesloch, victoire protestante, à Wimpfen, à Höchst — victoires de la Ligue alliée aux Espagnols de Spinola sans résultat définitif. Toutefois, lors de la bataille décisive de Stadtlohn le 6 août 1623, Tilly met en déroute complète l’armée de Christian de Brunswick : les forces catholiques contrôlent le sud et l’ouest de l’Allemagne mais ces combats sont accompagnés de destructions, de pillages et d’exactions très importants par les armées en campagne. La France voit avec dépit le déséquilibre qui s’instaure au profit du parti des Habsbourg.
La période danoise 1625-1629
Christian IV
En 1625, Christian IV de Danemark se décide à intervenir dans le conflit. Ce monarque luthérien, également duc de Holstein et comme tel vassal de l’empereur, veut à la fois défendre le luthéranisme et, si possible, étendre ses possessions en Allemagne du Nord. La France, sollicitée mais en proie à des difficultés intérieures, se limite à accorder une aide financière. Les troupes danoises sont commandées par Ernst von Mansfeld. Elles trouvent sur leur route non seulement les armées de la Sainte Ligue dirigées par Tilly, mais aussi une armée impériale nouvellement levée et placée sous le commandement d’Albrecht von Wallenstein, le plus grand condottiere de son temps, homme d’intrigue autant — sinon plus — que militaire de talent.
Les Danois et leurs alliés allemands sont défaits tour à tour par Wallenstein le 25 avril 1626 à Dessau pour les Allemands et par Tilly le 27 août à Lutter pour les Danois. Wallenstein livre bataille et vainc Gabriel Bethlen à Neuhäusel en Hongrie. Puis les armées catholiques, à nouveau réunies, traversent le Holstein, pénètrent au Jutland : pour sauver son royaume, Christian IV est contraint de signer la paix de Lübeck le 12 mai 1629, par laquelle le Danemark s’engage à ne plus intervenir dans les affaires de l’Empire. C’en est fini de ce pays en tant que grande puissance européenne. Les forces catholiques dominent l’Allemagne du Nord, malgré l’échec de Wallenstein devant la ville hanséatique de Stralsund, les princes catholiques, inquiets de la domination de Wallenstein, s’opposent à ce que Tilly le rejoigne. Wallenstein s’est lui-même toujours abstenu de trop aider Tilly lorsqu’il en a eu la possibilité : alors que ce dernier est toujours motivé par sa fidélité à ses convictions et à son camp, Wallenstein est principalement mû par l’ambition personnelle.
Débarrassé du danger danois, l’Empereur peut envoyer ses troupes en Italie du Nord pour appuyer les Espagnols qui combattent les troupes françaises envoyées par Richelieu dans la guerre de Succession de Mantoue et du Montferrat.
Albrecht von Wallenstein
L’empereur récompense richement Wallenstein en ajoutant à ses possessions en Bohême de nouveaux territoires en Silésie et dans le Mecklembourg et en le nommant amiral de la Baltique41 : véritable maître de l’Allemagne du Nord, il devient un presque souverain, d'où la jalousie des princes de la Ligue catholique. Par ailleurs, la France agit en sous-main pour les convaincre qu’ils ont intérêt à limiter les pouvoirs de l’empereur. À la diète de Ratisbonne en août 1630, ils imposent à Ferdinand II de relever Wallenstein de son commandement. Celui-ci se retire dans ses domaines de Bohême et Tilly le remplace à la tête des troupes impériales. Les effectifs des armées catholiques sont diminués.
Par ailleurs, l’édit de restitution du 6 mars 1629 pris par Ferdinand II exige le retour à l’Église catholique de tous les biens perdus par elle depuis 1552 et Tilly est chargé de son application. Il y gagne auprès des protestants une réputation détestable, largement outrancière car lui-même fait ce qu’il peut pour limiter les exactions de ses troupes.
La période suédoise 1630-1635
La diplomatie de la France s’exerce aussi auprès du roi luthérien de Suède Gustave II. La Suède, puissance montante de la Baltique qui vient de vaincre la Pologne, a des vues sur la Poméranie et voit défavorablement la puissance catholique s’installer en Allemagne du Nord. Par le traité de Bärwald le 23 janvier 1631, Gustave Adolphe s’engage à intervenir en Allemagne et la France à lui verser 400 000 écus par an. Les Suédois doivent respecter le culte catholique et l’indépendance de la Bavière. Dès la fin du mois, ils mettent pied en Poméranie et au Mecklembourg. Un traité secret est par ailleurs conclu entre la France et la Bavière pour se garantir mutuellement leurs possessions sur le Rhin.
Gustave-Adolphe débarque en Allemagne
Gustave Adolphe est un génie militaire. Il commence par éviter le combat contre l’armée de Tilly, afin de lui ôter l’initiative. Celui-ci, probablement pour forcer son adversaire au combat, investit la ville protestante de Magdebourg où se tient une garnison suédoise. Ravagée par l’incendie et mise à sac voir sac de Magdebourg sans que les circonstances en soient complètement éclaircies, la ville est réduite en ruines. Tilly se retire vers la Thuringe, ravage la Saxe qui se rallie alors aux Suédois et affronte Gustave Adolphe le 17 septembre à Breitenfeld. L’armée impériale est écrasée. Gustave Adolphe poursuit son avancée vers le sud, combattant à plusieurs reprises l’armée impériale reconstituée. Les pays sillonnés sont dévastés, les Suédois atteignant la Franconie, l’Alsace, la Lorraine et en particulier les Trois-Évêchés, les pays rhénans avec la ville de Mayence l'Aurea Moguntia et se dirigent vers Munich.
Ferdinand II ne peut que rappeler Wallenstein. Celui-ci accepte de recruter et diriger une nouvelle armée mais à des conditions exorbitantes qui le font discuter à égalité avec l’empereur. Les armées catholiques ne font pas leur jonction : pendant que Wallenstein chasse les Saxons de Bohême, Tilly affronte une nouvelle fois les Suédois à Rain am Lech le 15 avril 1632 : il y est grièvement blessé et ses troupes sont vaincues. Lui-même, après avoir organisé la défense de Ratisbonne et d’Ingolstadt, meurt dans cette dernière ville.
Wallenstein s'installe dans le camp fortifié de Zirndorf non loin de la ville de Nuremberg occupée par les Suédois. Ceux-ci assiégés tentent vainement de le déloger et subissent leur première défaite majeure du conflit en attaquant vainement ses positions d'Alte Veste le 3 septembre 1632. Ils sont contraints d'abandonner Nuremberg tandis que Wallenstein prend l'offensive, s'empare de Leipzig et menace les liaisons des Suédois avec la Baltique. Les adversaires se rencontrent à la bataille de Lützen le 16 novembre 1632. Gustave Adolphe est tué au cours de l’affrontement, mais les Suédois remportent néanmoins la victoire sous le commandement repris par Bernard de Saxe-Weimar. La mort de Gustave Adolphe désorganise quelque peu le commandement de l’armée suédoise.
L’assassinat de Wallenstein
L'héritière du royaume, Christine de Suède, âgée de six ans, laisse gouverner le régent Axel Oxenstierna qui poursuit la politique allemande de Gustave Adolphe.
De son côté, Wallenstein n’exploite pas l’avantage qu’il aurait pu tirer de la nouvelle situation et commence à travailler pour son propre compte, négociant avec les ennemis de l’empereur Suède, France, électeurs de Saxe et de Brandebourg dans le but de se constituer son propre royaume. Ferdinand II, convaincu de sa trahison, le relève secrètement de ses fonctions et le fait assassiner le 25 février 1634 avec l’aide de certains de ses officiers, notamment Gallas et Piccolomini.
Les catholiques peuvent alors reprendre l’avantage, menés par l'archiduc Ferdinand, futur Ferdinand III avec les généraux de Wallenstein Ottavio Piccolomini et Matthias Gallas ralliés à l’empereur ; ils battent les protestants à Ratisbonne le 26 juillet puis, avec l’aide des Espagnols sous le commandement de l’autre Ferdinand fils de Philippe III d'Espagne, cousin du précédent, le Cardinal-Infant en route vers les Pays-Bas, à Nördlingen le 6 septembre 1634.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=9022#forumpost9022
Posté le : 19/06/2015 17:29
|
|
|
|
|
La guerre de Trente ans 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
La période française 1635-1648
Depuis le début de la guerre, la France s’était toujours soigneusement tenue à l’écart des combats tout en appuyant les opposants à l’Empereur et au roi d’Espagne par sa diplomatie et ses subsides. Ses seules implications directes se sont exercées dans des zones périphériques :
Valteline occupée en 1624-1625 pour couper les communications entre le Milanais espagnol et l’Autriche;
Saugeais occupé et détruit en partie par ses armées ; on dut par la suite reconstruire l’abbaye de Montbenoît.
Duché de Mantoue et Montferrat, à l'occasion de la guerre de Succession de Mantoue 1628-1631 ;
Lorraine occupée en 1633 car son duc, Charles IV, a une position hostile à la France. C’est le temps du premier siège de La Mothe.
Cette politique n’est pas sans contradictions car Richelieu, cardinal de l’Église catholique et adversaire impitoyable des forces protestantes à l’intérieur du royaume, est l’allié des protestants étrangers contre les Habsbourg, champions du catholicisme. Les considérations religieuses s'opposent donc aux considérations politiques et à la volonté de contenir la puissance des Habsbourg. Or ceux-ci finissent par l’emporter sur leurs divers adversaires. Pour maintenir l’équilibre désiré, la France n’a plus d’autre solution que de s’engager directement dans le conflit. Cet engagement est précédé d’une intense activité diplomatique et de la négociation de multiples traités avec les ennemis de l’Empereur et du roi d’Espagne ce dernier est d’ailleurs, plus que l’Empereur, le principal adversaire. Avec les Hollandais est notamment prévu le partage des Pays-Bas espagnols grosso modo l'actuelle Belgique, la Flandre française, le Hainaut français, le Cambrésis et l'Artois.
Les Suédois ont subi un revers mais, contrairement aux Danois quelques années plus tôt, ils ne sont pas anéantis et ils continueront à intervenir en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre, avec des généraux de valeur tels que Johan Banér ou Lennart Torstenson. Les Impériaux ne seront par conséquent jamais libres de se retourner complètement contre la France. Souvent les armées française et suédoise se coordonneront ou tenteront de se rejoindre pour forcer l’ennemi commun.
Intervention française 1635
Par précaution, les Espagnols occupent Philippsbourg, Spire, Landau et enfin Trèves dont l’archevêque Philipp Christoph von Sötern, l’un des Princes-Électeurs, s’est mis sous la protection de la France61 : Richelieu prend ce prétexte pour déclarer, le 19 mai 1635, la guerre à l’Espagne, adversaire le plus direct des intérêts français. Les armées françaises, fortes de 120 000 hommes, vont intervenir dans quatre secteurs dont trois principaux :
vers le nord, où les Pays-Bas espagnols se trouvent pris en tenaille entre la France et les Provinces-Unies ; le commandement est aux maréchaux de Châtillon et de Brézé ;
vers l’est, duché de Lorraine, Alsace et pays rhénans, Franche-Comté – alors possession de l’Empire ; le commandement est au cardinal de La Valette et à Bernard de Saxe-Weimar qui escompte acquérir une principauté en Alsace ;
en Italie du nord, dans le Piémont sous le maréchal de Créquy et dans la Valteline sous le duc de Rohan ;
dans le secteur des Pyrénées ne se trouve qu’un corps d’observation.
Les combats se portent vers les Pays-Bas où Châtillon et Brézé vainquent les Espagnols à la bataille d'Avein65 le 20 mai 1635 avant de se joindre au prince d’Orange Frédéric-Henri. Mais des atermoiements franco-hollandais permettent aux Espagnols de recevoir des renforts et de sauver leurs possessions. C’est à ce même moment qu'est négociée la Paix de Prague entre l’Empereur et plusieurs princes protestants dont l’Électeur de Saxe : les armées impériales commandées par Piccolomini peuvent alors se retourner vers les Pays-Bas. Sur le Rhin, les impériaux commandés par Matthias Gallas, alliés aux troupes de Charles de Lorraine, font équilibre aux troupes de la France et de Bernard de Saxe-Weimar. En Italie, l’invasion du Milanais ne peut se faire du fait de l’alliance peu fiable du duc de Savoie et malgré les succès des troupes stationnées en Valteline.
Avantage aux Impériaux 1636
La campagne de 1636 est très difficile pour la France. Les opérations en Italie piétinent, de même que celles d’Alsace ; une opération menée en Franche-Comté contre Dole se solde par un échec et Gallas envahit la Bourgogne avant d'échouer au siège de Saint-Jean-de-Losne et de devoir repasser le Rhin à l'arrivée de renforts ; dans le nord, les Espagnols et leurs alliés, sous le commandement d’Ottavio Piccolomini, de Jean de Werth et du Cardinal-Infant, gagnent du terrain, prenant finalement Corbie sur la Somme le 15 août. Paris est donc directement menacé, mais Louis XIII parvient à reprendre Corbie le 14 novembre. Pourtant au Sud, l'Espagne s'est emparée de Saint-Jean-de-Luz et menace le Sud-Ouest.
Le 4 octobre, le général suédois Johan Banér défait les Impériaux à Wittstock, ce qui contribue à alléger les difficultés françaises en relançant le camp protestant. Ferdinand II va bientôt mourir. Son fils et successeur Ferdinand III appelle les troupes de Gallas qui rejettent les Suédois en Poméranie. C’est la fin de la supériorité suédoise incontestée en Allemagne.
Confusion et statu quo 1637-1638
Les hostilités en 1637 et 1638 sont marquées par la confusion et un relatif statu quo. Les faits les plus marquants sont en 1637 la mort des ducs de Mantoue et de Savoie, et le début de régence difficile de la duchesse de Savoie, Christine, la sœur de Louis XIII, en butte aux intrigues de ses beaux-frères, Thomas et Maurice, alliés aux Espagnols. En 1638, ce sont la défaite française à Fontarrabie au Pays basque le 7 septembre et la destruction d’une flotte espagnole le 22 août ainsi que la prise de Brisach, clef de l’Alsace et de la Souabe par Bernard de Saxe-Weimar le 19 décembre. À cette même époque, Mazarin devient l’homme de confiance de Richelieu qui vient de perdre son éminence grise, le père Joseph.
Côté français, sur le front nord, la stratégie consiste à capitaliser sur la victoire de Corbie en repoussant toujours plus au nord la ligne de front tout en la cloisonnant. Ainsi, la reconquête du château de Bohain, et les prises de Landrecies le 26 juillet 1636, de Maubeuge et de La Capelle respectivement les 5 août 1636 et 28 septembre 1636 sécurisent Thiérache et Vermandois des coups de force de détachements de cavalerie croate impériale qui sévissent en Picardie, à partir de 1636, depuis les collines d'Artois et le Hainaut.
Les impériaux sur la défensive 1640-1642
Sur ordre du roi, au début du printemps 1638, l'armée française regroupe ses forces à Saint-Quentin. L'objectif de la campagne est alors de parvenir à placer la Picardie occidentale à couvert après la protection réussie de son flanc oriental en 1637. Le maréchal de Châtillon prévoit de s'introduire en territoire ennemi avec pour objectif de s'emparer de la place de Saint-Omer tandis que le maréchal de La Force et sa troupe font diversion en feignant de marcher sur Cambrai via Le Catelet.
Châtillon arrive le 26 mai 1638 devant Saint-Omer qui, renforcée, lui oppose une résistance farouche. Louis XIII ordonne alors à La Force de lever le camp de devant le Catelet et d'aller appuyer sur le champ le maréchal de Châtillon afin d'assurer la logistique de son armée au cas où les Espagnols décideraient de marcher sur Saint-Omer. Tel est effectivement le cas et après plusieurs manœuvres successives de part et d'autre, le prince Thomas de Savoie-Carignan, ayant renforcé la garnison du château de Ruminghem, contre-attaque et prend l'armée du marquis de La Meilleraye de vitesse. Il s'empare d'une redoute stratégique positionnée à proximité de Ardres. Le 8 juillet, l'armée du comte Piccolomini et la cavalerie du comte de Nassau arrivent pour soutenir le prince Thomas. De La Force engage la bataille à Zouafques pour profiter de l'effet de surprise et du terrain. Son armée repousse les forces espagnoles dans des marécages. Le lieutenant-général Colloredo est tué ainsi que deux mille cavaliers. Mais, la contre-attaque du prince Thomas sur des positions françaises assiégeant Saint-Omer prive La Force de victoire. Ce dernier doit se retirer pour assister Châtillon devant la ville et l'aider à lever, le 15 juillet 1638, un siège désormais mal engagé. Les garnisons françaises prennent quartier à Nielles à partir du 17 juillet afin de protéger, comme prévu, le flanc occidental de la Picardie.
Après un début d'année 1639 sans importance sur le plan des opérations militaires — si ce n’est la mort de Bernard de Saxe-Weimar dont l’armée passe sous les ordres du comte de Guébriant —, l'armée française, plus puissamment armée, après son échec devant Saint-Omer, repasse à l'offensive sur le front nord et prend successivement Hesdin le 29 juin 163982 et Arras siège d'Arras, le 9 août 1640. Le 18 septembre 1640, dans la foulée de cette importante victoire, Mazarin, commandité par Richelieu, retourne le prince Thomas de Savoie en lui proposant par traité de se placer sous la protection de la France. Durant le printemps 1641 et jusqu'en septembre 1641, d'autres place fortes espagnoles, telles que Aire-sur-la-Lys, Lens, Bapaume et La Bassée, tombent. Le royaume de France contrôle désormais de nouveau l'Artois.
Sur le front oriental les hostilités sont moins intenses. Banér et de Guébriant lancent en 1640 une nouvelle attaque contre les Impériaux rapidement mise en échec par Piccolomini. Banér meurt l’année suivante. Cette même année, le sort des armées en Italie du Nord fait rentrer les États de Savoie dans la dépendance de la France84. De plus, deux couronnes dépendant de la Maison d'Autriche secouent le joug : le Portugal appelle au trône Jean de Bragance, de la maison d’Aviz, et la Catalogne reconnaît Louis XIII comme comte de Barcelone et de Roussillon le 23 janvier 1641. La France envoie une armée, commandée par Lamothe pour prendre possession de la nouvelle province. Plusieurs places sont prises et le siège est mis devant Tarragone que bloque aussi la flotte française commandée par l’archevêque de Sourdis. Les Espagnols la battent et les Français doivent lever le siège.
Des tractations commencent dès 1641 pour ouvrir des négociations de paix, que tous les belligérants commencent à appeler de leurs vœux. Cet espoir ne doit se concrétiser que plusieurs années après, alors que les combats continuent toujours, malgré la lassitude générale.
La France renoue avec le succès en Italie victoire d’Ivrée, prise de Coni et en Allemagne où le comte de Guébriant bat Piccolomini à Wolfenbüttel le 25 juin 1641 et Lamboy et Mercy à Kempen le 17 janvier 1642 et où le général suédois Lennart Torstenson remporte sur les Impériaux la bataille de Leipzig, aussi connue comme la seconde bataille de Breitenfeld, le 23 octobre 1642. Cette même année, le maréchal de Lamothe est forcé d'évacuer la Catalogne malgré son succès du 7 octobre sur les Espagnols de Leganez à la bataille de Lérida.
Progrès français 1642-1643
Richelieu veut forcer l’Espagne en la menaçant directement. Au printemps, Louis XIII et lui-même, bien que tous deux malades, partent avec une armée pour conquérir le Roussillon. Richelieu doit s’arrêter mais le roi engage le siège de Perpignan, qui est prise le 9 septembre. Au mois de juin une armée française a battu les deux beaux-frères de Christine de Savoie. Le 4 décembre 1642 meurt Richelieu ; Louis XIII le suit dans la tombe le 14 mai 1643, laissant la régence à une épouse peu aimée, Anne d’Autriche qui est flanquée d’un conseil de régence composé entre autres de Mazarin et de Pierre Séguier
Turenne
Profitant de ces circonstances, les Espagnols s’avancent en Champagne. Ils y sont sévèrement défaits à la célèbre bataille de Rocroi le 18 mai 1643, par un général de 22 ans, Louis de Bourbon, duc d'Enghien, surnommé plus tard le grand Condé. Celui-ci s’empare plus tard de Thionville. D’autres succès français se font en Italie, en Espagne, y compris sur mer, où la flotte française est maîtresse de la Méditerranée et s'illustre lors de la bataille navale de Carthagène. Ces succès sont contrebalancés par des revers en Allemagne Rantzau battu à la bataille de Tuttlingen, à la faveur desquels le commandement du comte de Guébriant passe au maréchal de Turenne. Opposé aux impériaux de Mercy, qui a pris Fribourg le 29 juillet 1644, Turenne commandant l'Armée de l'Allemagne est rejoint par le duc d’Enghien et son Armée de France. Entre le 3 et le 5 août 1644, une bataille meurtrière entre les Français et les troupes impériales fait rage sur les collines de l’alentour de Fribourg. À la fin, Fribourg reste impériale mais les Français se rendent maîtres de la vallée du Rhin.
Histoire de la marine française.
Paroxysme et fin de la guerre 1645-1648
Les principaux événements de 1645 se déroulent en Allemagne. Torstenson continue ses campagnes victorieuses Bohême, Silésie, Moravie, s’approchant de Vienne. Turenne veut le rejoindre, dans des conditions difficiles en raison de l'indiscipline de ses soldats, et Mercy en profite pour lui infliger la défaite de Mergentheim. Rejoint par le duc d’Enghien, il rencontre les Impériaux à la seconde bataille de Nördlingen, le 3 août, où Mercy est tué. Mais Torstenson ne peut forcer Vienne, doit se retirer en Bohême pendant que les Français évacuent leurs éphémères conquêtes, en les dévastant systématiquement.
Les campagnes de 1646 et 1647 voient à nouveau des opérations tour à tour favorables à chacun des camps, en Italie du nord et dans les Pays-Bas. Les Français commandés par le duc d’Enghien s’emparent de plusieurs villes de Flandres, mais après la prise de Dunkerque, les Hollandais font une trêve avec les Espagnols laquelle trêve se termine par une paix définitive et ces derniers peuvent reprendre pied. En juillet 1647, le frère de l'empereur, l'archiduc Léopold, gouverneur général des Pays-Bas espagnols, reprend la place forte de Landrecies conquise onze années auparavant.
Bataille de Lens
Les choses se passent mal pour les Français en Catalogne : le comte d'Harcourt doit abandonner le siège de Lérida en 1646. Afin d'éloigner le vainqueur de Dunkerque dont les ambitions deviennent gênantes, Mazarin nomme le duc d’Enghien, par ailleurs devenu prince de Condé depuis la mort de son père, vice-roi de Catalogne avec la charge de reprendre le siège de Lérida. Il échoue dans cette tâche et la Catalogne est perdue pour la France, définitivement.
Bien que les champs de bataille d’Allemagne soient considérés par la France comme théâtre d’opérations d’importance secondaire, c’est là que Turenne lui offre les plus grandes victoires des derniers temps de la guerre. Il reprend son projet de rejoindre les Suédois pour se diriger vers Vienne, impose un traité à Maximilien de Bavière mais reçoit l’ordre de revenir sur le Rhin. Le duc de Bavière rompt le traité. L’année suivante, Turenne revient en Souabe puis en Bavière, rejoint le Suédois Wrangel, inflige aux impériaux la défaite de Zusmarshausen 17 mai 1648 et chasse Maximilien de Bavière de Munich avant de devoir se retirer.
La dernière grande bataille de la guerre est celle de Lens 19 août 1648 : Condé y défait si sévèrement les Espagnols que cette bataille oblige Ferdinand III à accepter les formalités de paix dont les négociations durent depuis cinq ans.
Les traités de Westphalie
Banquet de la garde civique d'Amsterdam à l'occasion de la paix de Münster par Bartholomeus van der Helst, peint en 1648
Les traités de Westphalie concluent la guerre de Trente Ans et, simultanément, la guerre de Quatre-Vingts Ans le 24 octobre 1648. Négociés pendant plusieurs années, ils sont signés en deux lieux distincts, pour des raisons de préséance et d’incompatibilité religieuse :
à Osnabrück entre le Saint-Empire, la Suède et les puissances protestantes ;
à Münster entre l’Empire, la France et les autres puissances catholiques.
La guerre entre la France et l’Espagne n’est pas incluse dans leurs dispositions.
Les traités de Westphalie énoncent et initient la nécessité d'un équilibre politique « opérant par et dans la pluralité des États. En ce sens, ces accords révèlent la fin d'un ordre et l'établissement progressif puis la domination d'un nouveau. Ce nouvel ordre met fin à l'idée d'une paix terrestre perpétuelle administrée par un Empire européen des derniers jours renvoyant à l'idée d'une autorité pastorale. Désormais, les principes d'administration des hommes se baseront de plus en plus sur le primat de la raison d'État. Ces traités apparaissent donc comme un pivot temporel, seuil de passage d'un ordre autoritaire de type pastoral vers celui de l'établissement progressif d'une gouvernementalité fondée sur une rationalité politique privilégiant l'économie politique de l'État souverain, ce dernier lui-même fondement du droit international moderne et contemporain.
Autres traités
Traité de Vic Vic-sur-Seille signé le 6 janvier 1632 entre le duc de Lorraine Charles IV et Louis XIII.
Traité de Liverdun : 26 juin 1632. Nancy - capitale du duché de Lorraine - étant menacée directement par les Français, le duc de Lorraine doit signer de nouveau un traité avec Louis XIII de France. Ce dernier rend les principales places occupées mais le duc doit céder au roi, pour quatre ans, les villes de Stenay, Dun-sur-Meuse, Jametz et Clermont - cette ville sera donnée définitivement à la France en échange d'une indemnité. D'autre part, Charles IV de Lorraine promet de rendre hommage au roi pour le duché de Bar d'ici à un an.
Traité de Charmes : il est signé le 19 septembre 1633, entre Richelieu et Charles IV dans la maison du Chaldron, dite maison des Loups, propriété du duc de Lorraine ; l'armée ducale cède la ville de Nancy à l’armée française cinq jours après. Le 25 septembre, le roi lui-même s'installe dans la ville ducale, nommant un gouverneur : le baron de Brassac Jean de Galard de Béarn, né en 1580, comte de Brassac, baron de Saint-Maurice et de la Rochebeaucourt. Celui-ci s'établit au palais du gouverneur le 1er octobre 1633.
Traité des Pyrénées entre l'Espagne et la France, 7 novembre 1659.
Traité de Vincennes entre la France et la Lorraine, 1661.
Trêve d'Andrusovo entre la Pologne et la Russie en 1667
Les conséquences du conflit
La chapelle de Moncourt, seul vestige d'un village détruit.
La guerre de Trente Ans a ravagé pour de longues années toutes les régions, principalement en Allemagne, qu'ont traversées en tous sens les armées venues de toutes parts. Les populations sont décimées par les armes, les exactions de la soldatesque, les dégâts innombrables, les disettes qui s'ensuivent, les épidémies.
Certaines provinces se dépeuplent de manière dramatique par suite de la mort ou de la fuite des habitants vers des contrées moins exposées. Des historiens estiment que certaines régions perdent jusqu'à la moitié de leur population Saxe, Hesse, Alsace, Franche-Comté, Lorraine ou même les deux tiers tel le Palatinat. Les traités de paix sont signés dans un pays en ruine et qui mettra des dizaines d'années à se relever. Les autres belligérants Suède, France, Espagne sont financièrement exsangues.
Cette guerre modifie de plus profondément l'équilibre des forces politiques européennes :
le Danemark perd définitivement son statut de grande puissance ;
la Suède devient maîtresse de la Baltique et assure sa suprématie en Europe du Nord : elle gagne la Poméranie occidentale, les villes de Wismar et Stettin, le Mecklembourg, les évêchés de Brême et Verden qui lui assurent le contrôle des embouchures de l'Elbe et de la Weser ;
le Brandebourg acquiert la Poméranie orientale et les archevêchés de Magdebourg et Halberstadt : la future puissance prussienne est en germe dans la montée en puissance de cet État du Nord de l'Allemagne.
la Saxe conserve la Lusace ;
la Bohême demeure domaine héréditaire des Habsbourg ;
la Bavière conserve le Haut-Palatinat et la dignité électorale ;
le Bas-Palatinat est restitué à Charles Louis, le fils de Frédéric V, et un 8e siège électoral est créé en sa faveur ;
la Haute-Autriche revient aux Habsbourg ;
l'Empire est éclaté en une multitude de petits États pratiquement indépendants : son titulaire ne dispose plus que d'une autorité très réduite pendant que les Turcs menacent ses frontières orientales. En outre, son affaiblissement ouvre la porte à l'avènement d'états modernes, préludes aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc à l'avènement des démocraties modernes ;
les Pays-Bas et la Suisse gagnent leur indépendance de droit ;
la France est la grande gagnante : son hégémonie pourra bientôt s’affirmer sous Louis XIV. Elle bénéficie de plusieurs gains territoriaux sur ses frontières : les Trois-Évêchés, officiellement rattachés, ainsi que Brisach et Philippsburg, la Franche-Comté Traité de Nimègue, 1678, l’Alsace et Strasbourg en 1681, la forteresse de Pignerol, l’Artois et le Roussillon.
l’Espagne entame un déclin prolongé qu’accroîtront les difficultés dynastiques.
Des pays qui sont restés à l’écart et se sont économisés pourront aussi entrer bientôt en lice : l’Angleterre et la Russie.
Bilans du conflit Sur le plan culturel
Sébastien Vrancx Musée des beaux-arts de Göteborg.
Les horreurs de la guerre entraînent à travers l'Europe un fort renouveau de la pratique religieuse, où les populations catholiques et protestantes cherchent le réconfort.
Sur le plan des idées, la guerre amène à un progrès parmi les élites de l'idée de fait national, avec la langue comme facteur d'unification, préfigurant la naissance des conceptions modernes de l'État.
Sur le plan artistique, la guerre de Trente Ans a inspiré des œuvres à des créateurs qui ont vécu cette époque :
Les Grandes Misères de la guerre, gravures de Jacques Callot ;
Le roman picaresque anonyme intitulé La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, publié en 1646;
Simplicius Simplicissimus, roman de Grimmelshausen ;
les portraits de Tilly, Wallenstein, etc., en chefs de guerre par Antoine van Dyck ;
la poésie d'Andreas Gryphius : Les Larmes de la patrie, datant de 1636 ;
des gravures de Hans Ulrich Franck.
et d'autres artistes de l'époque contemporaine :
l'écrivain allemand Günter Grass a placé en 1647, pendant les pourparlers de la paix de Westphalie, l'intrigue de son roman Une rencontre en Westphalie Das Treffen in Telgte, publié en 1979.
l'écrivain allemand Bertolt Brecht situe l'action de sa pièce de théâtre Mère Courage et ses enfants entre 1624 et 1648, sur les champs de bataille de la guerre de Trente ans. La pièce, écrite à l'aube de la Seconde Guerre mondiale 1939, décrit l'horreur et l'absurdité de la guerre, à travers les tentatives de Mère Courage de tirer un bénéfice commercial du conflit, tentatives qui n'aboutiront finalement qu'à lui faire perdre ses enfants l'un après l'autre.
Hermann Löns 1866-1914 y consacre son roman le plus célèbre Le Loup-Garou Der Wehrwolf. Eine Bauernchronik, 1910 : les paysans de la lande de Lunebourg chassent les soldats errants et les pillards.
Alfred Döblin a écrit le roman historique Wallenstein 1920.
Sur le plan démographique
Pillage d'un village par des soldats, Sébastien Vrancx
La population de l'Allemagne et de l'Europe centrale souffre énormément de la guerre, morts aux combats, massacres, famines et déplacements de populations entraînant de véritables saignées démographiques : l'Allemagne du Nord est particulièrement dépeuplée ; en Poméranie, la population diminue de 65 % entre 1618 et 1648. Les États patrimoniaux des Habsbourg connaissent également des pertes importantes : la Silésie perd le quart de sa population. Bien que certaines régions aient pu être épargnées, notamment les villes hanséatiques qui achetaient à prix d'or leur sauvegarde, l'Europe centrale perd environ 60 % de sa population.
Ces chiffres, issus de l'historiographie du XIXe siècle, basée sur les écrits de témoins horrifiés, n'ont pas été confirmés par des enquêtes de démographie historique. Ils ont été l'objet de débats importants. On s'accorde aujourd'hui sur le chiffre de 3 ou 4 millions de décès en trente ans pour une population initiale de 17 millions d'habitants, chiffre énorme.
Sur le plan économique
La guerre saigne à blanc l'économie de la plupart des États allemands, combats et pénurie alimentaire jetant sur les routes un nombre important de vagabonds et de mendiants. L'Espagne, initialement soutenue par l'or des Amériques, sort financièrement et politiquement très affaiblie du conflit.
Sur le plan militaire
Les États européens prennent progressivement conscience des désavantages de l'emploi de mercenaires, qui a été la règle quasi générale durant la guerre de Trente ans. L'Europe se dirige vers un système d'armée de métier : les effectifs de l'armée permanente augmentent, en France, de manière exponentielle. En Allemagne, la Marche de Brandebourg compte parmi les États qui commencent à constituer une armée nationale. La guerre de Trente Ans contribue à la naissance du concept d'armée moderne.
Liste des principaux acteurs
Matthias Gallas
Johan Banér
Lennart Torstenson
Le Saint-Empire romain germanique
Ferdinand II 1578-1637
Ferdinand III 1608-1657
Charles-Bonaventure de Longueval, comte de Bucquoy 1571-1621
Albrecht von Wallenstein 1583-1634
Matthias Gallas 1584-1647
Gottfried Heinrich von Pappenheim 1594-1632
Ottavio Piccolomini 1599-1656
Peter Melander 1585-1648
Jean de Werth 1595-1652
Raimondo Montecuccoli 1609-1680
La Ligue catholique
Maximilien Ier de Bavière 1573-1651
Jean t'Serclaes, comte de Tilly 1559-1632
Franz von Mercy 1590-1645
L’Union évangélique
Frédéric V du Palatinat 1596-1632
Christian Ier d’Anhalt-Bernburg 1568-1630
Heinrich Matthias von Thurn 1567-1640
Ernst von Mansfeld vers 1580-1629
Georg Friedrich de Bade-Durlach (573-1638
Christian de Brunswick 1599-1626
Bernard de Saxe-Weimar 1604-1639
L'Espagne
Philippe III 1578-1621
Philippe IV 1605-1665
Ferdinand d’Autriche, dit le Cardinal-Infant 1609/1610-1641
Gaspar de Guzmán, comte-duc d'Olivares 1587-1645
Ambrogio Spinola 1569-1630
Le Danemark
Christian IV de Danemark 1577-1648
La Suède
Gustave II Adolphe de Suède 1594-1632
Axel Oxenstierna 1583-1654
Johan Banér 1596-1641
Gustaf Horn 1592-1657
Lennart Torstenson 1603-1651
Carl Gustaf Wrangel 1613-1676
La France
Louis XIII 1601-1643
Richelieu 1585-1642
Condé 1621-1686
Turenne 1611-1675
Luxembourg 1628-1695
La Transylvanie
Gabriel Bethlen 1580-1622
Pour le parti de l'Empereur : engagement direct en rouge ; engagement indirect en rose
Contre le parti de l'Empereur : engagement direct en bleu ; engagement indirect en bleu clair
         
Posté le : 19/06/2015 17:27
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
163 Personne(s) en ligne ( 95 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 163
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages