|
|
César Borgia |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 septembre 1475 naît à Rome César Borgia
en valencien et en Catalan, César de Borja Llançol, dit le Valentinois Il Valentino, est un seigneur italien de la Renaissance, mort, à 31 ans, le 12 mars 1507 à Viana, en Navarre, Espagne. Il succède à son frère Giovanni Borgia Juan Borgia en tant que Duc de Gandie.
Il fait allégeance aux États pontificaux sous le Grade de Capitaine général de l'Église, Commandement de l'armée papale, il fut Pair de France, Chevalier de l'ordre de Saint-Michel, Prince de Romagne, d'Andria et de Venafro, Duc de Gandie, de Romagne et de Valentinois, Comte de Diois, Seigneur d'Issoudun, de Piombino, Camerino et Urbino, Gonfalonier de la Sainte Eglise, Capitaine général de L'Eglise universelle, condottière et cardinal.
Cardinal de l’Église catholique Créé cardinal en 1493 par le pape Alexandre VI sous le titre cardinalice Cardinal-prêtre de S. Marcello, Évêque et cardinal général de l’Église catholique romaine. Fonctions épiscopales Évêque de Pampelune, Archevêque de Valence
Il doit sa notoriété en grande partie à Machiavel qui le cite fréquemment dans Le Prince.
En bref
Fils naturel du futur pape Alexandre VI, né vers 1476, probablement à Rome, mort le 12 mai 1507, près de Viana Espagne, César Borgia a élargi le pouvoir politique de la papauté et a tenté d'établir sa propre principauté dans le centre de l'Italie. Sa politique inspira le Prince de Machiavel.
César Borgia est le fils du cardinal Rodrigo Borgia, alors vice-chancelier de l'Église, et de Vannozza Catanei. Éduqué pour faire carrière dans les ordres, il est nommé protonotaire apostolique et chanoine de la cathédrale de Valence dès l'âge de sept ans, les Borgia sont originaires d'Espagne.
Les premiers précepteurs de César Borgia reconnaissent en lui un élève exceptionnellement brillant. En 1489, il entre à l'université de Pérouse pour étudier le droit. Il suit ensuite les cours du juriste Filippo Decio à l'université de Pise, où il obtient un diplôme de droit canon et civil. Nommé évêque de Pampelune en 1491, il est fait archevêque de Valence en 1492 après l'élection de son père au Saint-Siège. Cet événement change la destinée de César Borgia, qui obtient en outre le titre de cardinal en 1493. S'il est désormais l'un des principaux conseillers de son père, il est clair qu'il n'a pas de réelle vocation religieuse. Il est en effet plus réputé à la cour pontificale pour sa vie de débauche que pour la stricte observance de ses charges ecclésiastiques.
À la mort de son frère aîné Pier Luigi en 1488, le titre de duc de Gandie échappe à César Borgia et revient à son cadet Giovanni. C'est ce dernier qui est chargé de commander l'armée pontificale en 1496 pour les premières campagnes d'Alexandre contre la rébellion des Orsini. Lorsque Giovanni est mystérieusement assassiné en 1497, César est suspecté de complicité. Son caractère guerrier et son engagement politique répondent alors parfaitement au profil de lieutenant séculier que cherche son père. César renonce ainsi à la dignité de cardinal en 1498. Il épouse alors Charlotte d'Albret, sœur du roi de Navarre. Parallèlement, il reçoit de Louis XII, roi de France, le titre de duc de Valentinois.
Grâce à ce mariage, César et son père obtiennent l'aide des Français dans leur projet de reprendre le contrôle des États pontificaux et de fonder un royaume permanent en Italie pour César. Fort de cet appui, César, capitaine général de l'Église, se lance en 1499 dans une occupation systématique des villes de Romagne et des Marches aux mains de feudataires du Saint-Siège. La campagne de 1499 est marquée par la conquête d'Imola et de Forli. Celle de 1500-1501 ramène dans le giron de César les villes de Rimini, Pesaro et Faenza. Urbino, Camerino et Senigallia tombent en 1502. C'est lors de cette dernière campagne que Machiavel, ambassadeur florentin auprès de César Borgia, observe directement les méthodes de l'homme qui inspirera son œuvre.
Les activités d'Alexandre et de César, bien que peu différentes de celles des papes précédents du XVe siècle, suscitent l'opposition des États pontificaux et d'autres États italiens. La guerre de propagande acharnée menée contre les Borgia a des répercussions durables. César est décrit comme un monstre de luxure et de cruauté qui exerce une influence surnaturelle sur son père après avoir assassiné son frère Giovanni, le favori du pape. Il semble néanmoins que père et fils travaillent de concert : Alexandre est un fin politicien, tandis que César est un homme d'action impitoyable. Ambitieux et arrogant, ce dernier est déterminé à devenir prince avant que la mort de son père le prive du soutien politique et financier de la papauté.
La troisième campagne de Romagne 1502-1503 illustre au mieux les méthodes de César. Il lance une marche éclair sur Urbino qui, surprise, se rend sans un seul coup de feu. Il se lance alors vers Camerino, qui tombe aussi rapidement. Ses capitaines, craignant son pouvoir, se retournent alors contre lui, à Magione. César, privé de l'essentiel de ses troupes, est forcé de battre en retraite en Romagne. Utilisant les fonds du Saint-Siège, il reconstitue cependant son armée tout en luttant sur le front diplomatique pour briser la conspiration. Une fois cet objectif atteint, il convie, au motif de réconciliation, certains conspirateurs à Senigallia et les fait exécuter décembre 1502.
Doté d'une armée puissante et dévouée, César semble alors à l'apogée de sa carrière. Il prévoit probablement d'attaquer la Toscane, pour fonder l'État indépendant dont il rêve, lorsque son père meurt le 18 août 1503. Son farouche ennemi, Giuliano della Rovere, est alors élu pape Jules II. Il lui retire son titre de duc de Romagne et de capitaine général de l'Église et lui demande de libérer les villes de Romagne. César est arrêté. Il répond favorablement à la proposition pontificale pour gagner du temps et s'enfuit à Naples, où il est rattrapé par Gonzalve de Cordoue, vice-roi d'Espagne. Ce dernier refuse de se liguer avec lui contre le pape. César est alors emprisonné en Espagne, dans le château de Chinchilla près de Valence, puis à Medina del Campo, dont il s'échappe en 1506. Dans l'impossibilité de rentrer en Italie, il se met au service de son beau-frère, le roi de Navarre, et est tué en 1507 dans une échauffourée avec des rebelles navarrais près de Viana. Michael Edward Mallett
Sa vie
César est le fils de Roderic Llançol i de Borja, issu d'une famille espagnole et futur cardinal Rodrigo Borgia puis pape Alexandre VI, et de sa maîtresse Vannozza Cattanei. Il est aussi le frère de Giovanni Borgia 1474-1497, duc de Gandie, de Lucrèce Borgia, de Gioffre Jofré, prince de Squillace, et le demi-frère de Pedro Luis de Borja Pere Lluis de Borja et de Girolama de Borja, nés de mères inconnues.
La famille Borgia Borja en Catalan est originaire du royaume de Valence et voit son influence augmenter au XVe siècle, quand le grand-oncle paternel de Cesare devient pape sous le nom de Calixte III en 1455, puis Roderic Rodrigo en espagnol sous le nom d'Alexandre VI en 1492.
Bien que les précédents papes aient eu parfois des maîtresses, son père est le premier à reconnaître publiquement ses enfants, ce qui vaudra à César d'être souvent appelé « le neveu du pape », par pudeur, tout comme ses frères et sœurs.
Comme pratiquement tous les aspects de sa vie, la date de naissance de César Borgia est sujette à débat. En général on admet qu'il est né à Rome en 1475.
Jeunesse
Décrit comme un enfant gracieux, il grandit vite et devient un homme beau et ambitieux, comme son père. Ce dernier, dans sa volonté de développer l'influence de sa famille en Italie, a de grandes ambitions pour ses fils. Alors que les affaires temporelles reviennent à son frère Giovanni, nommé capitaine général de l'Église et fait duc de Gandie, César suit une carrière dans l'Église afin de succéder à son père. Sacré protonotaire de la papauté à 7 ans, il est fait évêque de Pampelune à 15 ans, et nommé par son père, fraîchement élu pape, cardinal de Valence en Espagne à 17 ans, même si ses goûts le portent plutôt vers la corrida, les chevaux et l'exercice des armes. À cette époque, il étudie le droit à Pérouse et à Pise.
En 1497, on retrouve le corps poignardé de son frère Giovanni dans le Tibre. César est soupçonné du crime, qu'il aurait commis soit pour des raisons politiques, soit par jalousie : Sancha d'Aragon, fille du roi de Naples et épouse de Gioffre, aurait été la maîtresse de César comme de Giovanni. Rien n'est alors prouvé, mais César a désormais la voie libre : le 17 août 1498, il devient le premier cardinal de l'histoire à abandonner sa fonction.
À cette époque, Louis XII, roi de France cherche à faire annuler son mariage afin d'épouser Anne de Bretagne et ainsi annexer son duché au royaume de France. Alexandre VI annule le mariage, en échange de quoi César devient duc de Valentinois, ce qui lui vaudra son surnom Il Valentino. Il se voit aussi accorder la main de Charlotte d'Albret, dame de Châlus et sœur de Jean III, roi de Navarre. Leur mariage a lieu le 12 mai 1499.
Ascension
Alexandre VI s'allie avec Louis XII qui poursuit les guerres d'Italie, espérant en tirer profit, notamment obtenir le trône de Naples4. En 1498, il est honoré par Louis XII du titre de gouverneur du Lyonnais.
En 1499, le roi entre en Italie, et après que Gian Giacomo Trivulzio a chassé le duc de Milan Ludovico Sforza, César chevauche à ses côtés à son entrée dans la ville.
Les Borgia, père et fils, passent alors à l'action : ils débarrassent les États pontificaux de leurs dirigeants censés être sous l'autorité du pape mais qui en réalité se considéraient indépendants depuis plusieurs générations. Ainsi en Romagne et dans les Marches.
César est nommé gonfalonier de l'armée papale dite « Armée des clefs », du nom de l'emblème héraldique de la papauté qui comprend des mercenaires italiens, et des régiments suisses envoyés par le roi de France environ 4 000 fantassins et 300 cavaliers. La seule qui parvient à lui tenir tête dans sa campagne est Caterina Sforza, mais le 9 mars 1499 elle est vaincue, ce qui permet à César d'ajouter Imola et Forlì à ses possessions.
En 1500, Alexandre VI nomme douze nouveaux cardinaux, ce qui lui donne assez d'argent pour permettre à César d'engager les condottieri Vitellozzo Vitelli, Gian Paolo Baglioni, les frères Orsini Giulio et Paolo et Oliverotto da Fermo qui poursuivent sa campagne en Romagne. Giovanni Sforza, premier mari de sa sœur Lucrèce, perd Pesaro et Pandolfaccio Malatesta perd Rimini la même année.
En 1501, Faenza se rend, son jeune seigneur Astorre III Manfredi est envoyé au Château Saint-Ange, à Rome. On retrouve son corps dans le Tibre, peu de temps après. En mai de cette année César prend le titre de duc de Romagne, et ajoute Castel Bolognese à son domaine. Alors que ses condottieri assiègent Piombino, qui tombe en 1502, César se bat à Naples et à Capoue avec les Français. Le 24 juin 1501, la ville, défendue par Prospero et Fabrizio Colonna, tombe, entraînant le début du conflit du roi de France avec Ferdinand II d'Aragon pour le contrôle de Naples.
En juin 1502, il retourne dans les Marches et capture Urbino et Camerino. Florence, craignant sa puissance, lui envoie deux émissaires : Machiavel et le cardinal Soderini pour connaître ses intentions, mais c'est surtout Louis XII qui va s’opposer à ses velléités d’attaquer la ville. Son ambition se porte alors sur Bologne. Mais ses condottieri complotent contre lui Congiura di Magione : avec leur aide, Guidobaldo da Montefeltro et Giovanni Maria da Varano poussent Camerino et Fossombrone à la révolte. César l'apprend et organise une réconciliation au château de Sinigaglia le 31 décembre 1502. Vitellozzo Vitelli, les frères Orsini et Oliverotto da Fermo viennent sans leurs troupes. Au milieu du banquet, César les fait arrêter puis étrangler. Paolo Giovio qualifie cet acte de « merveilleuse tromperie ». Après cela César Borgia est au sommet de sa puissance :
« Certains voudraient faire de César le roi de l'Italie, d'autres le voudraient faire empereur, parce qu'il réussit de telle façon que nul n'aurait le courage de lui refuser quoi que ce soit », écrira le Vénitien Priuli.
César Borgia fut mécène de Léonard de Vinci durant dix mois. Durant cette période, celui-ci réalisa des travaux de cartographie, en particulier de la ville d'Imola.
Chute
Bien que général et homme d'État de talent, son empire s'effondre très rapidement. Le 10 août 1503, César et son père assistent à un banquet chez Adriano Castelli, cardinal tout juste nommé. De nombreux invités ressentent de violentes douleurs, Alexandre VI meurt huit jours plus tard. Avant que sa mort ne soit révélée publiquement, César, malade lui aussi, envoie Don Michelotto piller les caisses papales, prévoyant de conquérir la Toscane mais sa mauvaise condition l'empêche de faire pression sur le Conclave pour désigner un pape à sa solde.
Le nouveau pape est Pie III, considéré comme neutre entre le parti des Borgia César étant resté à Rome pour influer sur l'élection et celui du cardinal Giuliano della Rovere, ennemi farouche de ces derniers. Mais il meurt à peine un mois après son élection et, cette fois, della Rovere est élu. Il prend le nom de Jules II, et fait tout pour affaiblir César. Alors que celui-ci se rend en Romagne pour mater une révolte, il est capturé par Gian Paolo Baglioni, près de Pérouse, et emprisonné. Jules II va alors démembrer son domaine, soit en le rattachant aux États pontificaux Imola, soit en rétablissant dans leurs droits ceux que César a chassés du pouvoir Rimini et Faenza.
En 1504, César est livré au roi d'Espagne, contre qui il a lutté avec Louis XII, et est emprisonné à la forteresse de Medina del Campo. Il parvient à s'évader et entre au service de son beau-frère Jean III de Navarre. Il meurt au cours du siège de Viana le 10 mars 1507, tombant dans une embuscade à l'âge de 31 ans.
Sa devise est restée célèbre :
« Aut Caesar aut nihil » « Ou César, ou rien »,
qui joue sur l'ambiguïté de son prénom et du titre porté par les empereurs romains.
Mariages et descendance
Le 12 mai 1499 César Borgia épouse Charlotte d'Albret 1480-1514, dame de Châlus et sœur de Jean III de Navarre. De cette union nait une fille, Louise Borgia, dite Louise de Valentinois 1500-1553, qui épouse, le 7 avril 1517, Louis II de la Trémoille mort en 1524, en secondes noces, le 3 février 1530, Philippe de Bourbon 1499-1557, baron de Busset.
Outre Louise, César Borgia eut au moins onze enfants, tous illégitimes, dont Girolamo Borgia, qui épouse Isabella, comtesse de Carpi et Camilla Borgia 1502-1573, abbesse de San Bernardino de Ferrare5.
César Borgia et Machiavel
Sa vie d'aventurier sans scrupule, d'habile diplomate, d'excellent administrateur de la Romagne, a inspiré Machiavel dans son portrait du « Prince »
On considère généralement que César Borgia servit de modèle au Prince de Machiavel. Il le présente comme le modèle du tyran : outre ses crimes politiques, dont il se fait un jeu, on l'accuse d'avoir fait assassiner son frère aîné, Giovanni Borgia 1474-1497, dont il est jaloux, et d'entretenir un commerce incestueux avec sa sœur, Lucrèce.
Machiavel reste auprès de César d'octobre 1502 à janvier 1503, en tant que secrétaire de la seconde chancellerie envoyé par Florence, période pendant laquelle il écrit souvent à ses supérieurs, correspondance qui a survécu jusqu'à nos jours.
Le chapitre VII « Des principautés nouvelles qui s'acquièrent par les forces et la fortune d'autrui » revient en effet sur sa conquête de la Romagne et le piège de Sinigaglia. César y est présenté comme un modèle pour tout homme d'État :
« je ne saurais proposer à un prince nouveau de meilleurs préceptes que l'exemple de ses actions », sa chute n'étant pas de sa responsabilité mais due « seulement à une extraordinaire malignité de la fortune ».
Cet éloge est sujet à controverse. En effet, certains universitaires voient dans le Borgia de Machiavel le précurseur des crimes commis au XXe siècle au nom de l'État. D'autres, dont Macaulay et lord Acton expliquent que l'admiration pour la violence et le manque de parole ne sont qu'un effet de la criminalité et de la corruption généralisées à cette époque8.
Sources bibliographiques
Marcel Brion, Les Borgia, Tallandier, Paris, 2011,
Ivan Cloulas,
Les Borgia, Fayard, 1987
César Borgia : Fils de pape, prince et aventurier, Tallandier, Paris, 2005. 287 p., [8] p. de pl.
Marion Johnson, Les Borgia
Nicolas Machiavel, Le Prince
Rafael Sabatini, La Vie de César Borgia
Antonio Spinosa, La Saga des Borgia, Mondadori, 1999
Paul Rival, César Borgia, Grasset, Paris, 1931
César Borgia vu par…La littérature
Alexandre Dumas, Les Borgia, roman appartenant aux volumes III et IV des Crimes célèbres, 1839
Le sang doré des Borgia, Françoise Sagan, Jacques Quoirez, 1977
Le sang des Borgia, the Family par Mario Puzo l'auteur du Parrain, 2001
Manuel Vázquez Montalbán, Ou César ou rien, une biographie largement romancée de César Borgia
Les Borgia, le roman d'une famille, par Klabund, Max Milo Editions, 2011
Assassin's Creed, Brotherhood d'Oliver Bowden, 2011
Les séries TV
The Borgias est un feuilleton télévisé canadien créé par Neil Jordan avec François Arnaud dans le rôle de César Borgia, Holliday Grainger dans celui de sa sœur Lucrèce Borgia et Jeremy Irons dans celui de son père Rodrigo Borgia.
Les Borgia ou le sang doré est un feuilleton télévisé français de 1977 avec Jean-Claude Bouillon dans le rôle de Cesar Borgia, Maureen Kerwin dans celui de sa sœur Lucrèce Borgia et Julien Guiomar dans celui du pape Alexandre VI.
Borgia, série télévisée produite par Atlantique Productions et Lagardère Entertainment, a été diffusée sur Canal + en octobre 2011. César Borgia est interprété par Mark Ryder.
Les mangas et la BD
César Borgia est le personnage principal du manga Cantarella, de You Higuri (2001). Ce manga retrace l'histoire de César et de la famille Borgia, bien que, malgré son côté historique et précis, l'auteur a pris plusieurs libertés dans son adaptation. Dans le manga, César n'est pas totalement humain : il aurait été vendu aux démons par son père, ce dernier espérant devenir Pape grâce à cela. Mais, paradoxalement, dans cette œuvre César apparaît comme un personnage attachant, malgré son côté froid et calculateur.
Un autre manga centré sur César Borgia intitulé Cesare de Fuyumi Soryo se veut quant à lui plus fidèle historiquement. L'auteur a même fait appel à un spécialiste de la Renaissance Italienne9.
Borgia, Jodorowsky, Manara
Dans Kakan no madonna de Chio Saito, Césare Borgia y tient le rôle du principal méchant, amoureux de sa sœur puis de la protagoniste.
Les jeux vidéo
César Borgia est présent dans le jeu vidéo Assassin's Creed: Brotherhood, dont il est le principal antagoniste. L'image du personnage est proche de celle dépeinte par Machiavel également présent dans le jeu : tyrannique, hautain, jaloux des aventures de sa sœur, Lucrèce Borgia, avec qui il entretient des rapports proches de l'inceste. Il y serait également responsable de la mort de son père, à qui il aurait fait avaler de force une pomme empoisonnée après l'avoir lui-même croquée. Le héros du jeu tuera César en 1507 à Viana, sur les murailles de la ville assiégée.
        
Posté le : 13/09/2015 16:52
|
|
|
|
|
Colbert |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 6 septembre 1683 meurt Jean-Baptiste Colbert
à 64 ans, à Paris, né le 29 août 1619 à Reims, un des principaux ministres de Louis XIV. Contrôleur général des finances de 1665 à 1683, secrétaire d'État de la maison du roi et secrétaire d'État de la Marine de 1669 à 1683.
Contrôleur général des finances 1665-1683, il est également Secrétaire d'État de la Maison du roi, Secrétaire d'État à la Marine. Il est marié à Marie Charron ilq ont trois fils, ses descendants sont Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Jacques Nicolas Colbert, Jean-Jules-Armand Colbert
Il entre au service du roi à la mort de son protecteur Mazarin, incite Louis XIV à disgracier son rival Nicolas Fouquet. Inspirateur et promoteur d'une politique économique interventionniste et mercantiliste ultérieurement désignée sous le vocable de colbertisme il favorise le développement du commerce et de l'industrie en France par la création de fabriques étatiques. Il passe pour s'être inspiré des idées de Barthélemy de Laffemas, économiste et conseiller d'Henri IV1 ; Laffemas avait en particulier développé le commerce colonial et l'industrie textile, les deux secteurs auxquels Colbert s'est particulièrement consacré pour devenir à son tour l'éminence grise du royaume.
En bref
Une légende tenace faisait de Colbert le fils d'un marchand drapier de Reims. Les historiens ont eu raison de ce mythe en montrant que le grand ministre était issu d'une dynastie de grands marchands internationaux, banquiers et financiers. Laboureurs à la fin de la guerre de Cent Ans, entre Reims et les Ardennes, ils firent du transport de pierres pour reconstruire les villes détruites et devinrent maçons. Marchands grossistes à Reims au XVIe siècle, ils donnent des échevins à la ville et appartiennent à la bourgeoisie riche de la cité. Très liés à la fin du siècle aux milieux bancaires italo-lyonnais, proches du pouvoir sous Henri IV et sous Louis XIII, ils atteignent leur apogée sous Louis XIV. Colbert n'est pas en effet devenu ministre par un coup de baguette magique, en sortant de la boutique du Long-Vêtu. Il fut poussé dans les allées du pouvoir par un groupe où se mêlaient des ministres comme Le Tellier (père de Louvois), des gens d'affaires comme Particelli d'Émery, Lumagne, Camus, rapprochés par un ensemble d'intérêts et des alliances matrimoniales. L'enfance et la jeunesse de Jean-Baptiste Colbert sont mal connues. On suppose qu'il fit ses études chez les Jésuites. Dès 1634, il fait son apprentissage chez Mascranny, banquier à Lyon, puis il travaille à Paris dans une étude de notaire, chez un procureur au Châtelet, avec un ancien munitionnaire devenu officier de finance ; il reçoit en somme une éducation de marchand et d'officier de finance, avec des notions juridiques acquises par la pratique. En 1640, il devient commissaire des guerres, charge lucrative s'il en fût, commis du secrétaire d'État à la Guerre, François Sublet de Noyers. Ces fonctions l'obligent à voyager dans le royaume pour connaître troupes et garnisons : expérience précieuse pour un futur ministre. En 1645, il entre comme commis au service de Michel Le Tellier, secrétaire d'État à la Guerre, qui lui fera obtenir un brevet de conseiller d'État. En 1648, son mariage avec la fille d'un intendant des turcies et levées de France lui apportera 100 000 livres de dot.
Colbert passa du service de Le Tellier à celui de Mazarin, dont il géra les immenses biens et auquel il servit d'intermédiaire avec la reine pendant son exil. Le cardinal le recommanda à Louis XIV comme étant fort fidèle. Sa valeur personnelle fit le reste. Il travailla à la disgrâce de Fouquet, réussit à influencer le roi, dut subir les assauts de la compagnie du Saint-Sacrement qui soutenait le surintendant, entra au conseil d'En-Haut et cumula peu à peu les responsabilités : bâtiments et manufactures, contrôle général des Finances, Maison du roi et Marine. Seules les Affaires étrangères et la Guerre lui échappèrent, quoiqu'il parvînt très vite à installer son frère Croissy au poste de ministre des Affaires étrangères. Pour venir à bout de tant de tâches, il fallait un homme exceptionnel. Michelet le compare à un bœuf de labour, mettant ainsi en évidence sa qualité fondamentale : l'archarnement au travail. Esprit méthodique, il sait rédiger pour le roi — à qui il voue une inébranlable fidélité — des rapports très clairs. Il esquisse tout un système de réformes afin de rétablir l'ordre dans le royaume, après les lourdes épreuves de la guerre. Ses idées ont souvent servi de modèle pour décrire le mercantilisme qu'il incarne.
Citadin, homme du commerce international, Colbert a le souci d'exporter pour accumuler à l'intérieur des frontières le maximum d'or et d'argent, et d'importer le moins possible pour éviter d'en perdre. À cette fin, les manufactures fourniront l'essentiel de l'effort, le grand commerce sera relancé et les paysans soulagés par la diminution de leurs impôts. Colbert n'est pas le père de ces idées, élaborées avant lui, mais il les a mises en application avec une rare énergie. Il est de bon ton d'en critiquer le bilan, qui n'est pourtant pas mince : les bourgeois, qui préféraient certes l'achat des offices et des biens fonciers, n'ont pas dédaigné d'investir dans l'industrie et le commerce, ce qui est significatif ; de plus, l'expansion économique du XVIIIe siècle trouve son origine à cette époque. Malgré les structures archaïques du temps, Colbert a réussi à modifier l'état des esprits et à entraîner derrière lui beaucoup d'imitateurs ; il a fait fonctionner un embryon d'administration, utilisé au mieux clientèles et membres du lignage ; il s'est conduit en chef de clan : ses frères sont devenus, l'un évêque de Luçon puis d'Auxerre, l'autre, Croissy, ministre des Affaires étrangères, le troisième, enfin, lieutenant général des armées du roi. Son fils, Seignelay, lui succéda à la Marine mais n'eut jamais les honneurs du conseil. Colbert eut en quelque sorte la chance de mourir en 1683, avant le temps des guerres difficiles et des catastrophes. Il a laissé une image de réformateur, de grand initiateur besogneux, luttant de toutes ses forces pour le progrès. Voltaire a fait l'éloge de Colbert, le XIXe siècle a reconnu en lui l'un des siens, un bourgeois conquérant, homme d'ordre et d'économie, glorificateur du travail, peu aimé de la Cour : Mme de Sévigné le nommait le Nord et Saint-Simon vilipendait en lui le règne de vile bourgeoisie. Jean-Marie Constant
Sa vie
Jean-Baptiste Colbert appartient à une famille de riches marchands et banquiers, parfois spéculateurs et souvent usuriers de la cité de Reims. Cette famille - de petite noblesse - se prétendait descendante d'une illustre et antique noblesse écossaise ce qui est plus que douteux. En réalité l'aïeul à la 6e génération, Édouard III Colbert, était déjà, au XVe siècle, seigneur de plusieurs terres Magneux et Crèvecoeur.
Jean-Baptiste Colbert est le fils de Nicolas Colbert, seigneur de Vandières et de son épouse Mariane Pussort, fille du seigneur de Cernay. Contrairement à une tenace légende son père ne fut jamais marchand de drap mais receveur général et payeur des rentes de la ville de Paris et négociant. Colbert se trouve être le neveu du conseiller d'État Henri Pussort, qui l'aidera dans sa carrière.
La jeunesse de Colbert, en revanche, est mal connue : après des études dans un collège jésuite, en 1634, il est employé chez un banquier de Saint-Étienne, Mascranny, puis chez un notaire parisien, père de Jean Chapelain.
Une ascension due à ses relations 1640-1651
Jean-Baptiste Colbert entre au service de son cousin Jean-Baptiste Colbert de Saint-Pouange, premier commis du département de la guerre sous Louis XIII.
En 1640, alors qu'il est âgé de 21 ans, son père utilise ses relations et sa fortune pour lui acheter la charge de commissaire ordinaire des guerres, commis du Secrétaire d'État à la guerre, François Sublet de Noyers. Cette fonction l’oblige à inspecter les troupes et lui donne une certaine notoriété auprès des officiers, tous issus de la noblesse.
En 1645, Saint-Pouange le recommande à Michel Le Tellier père du marquis de Louvois, son beau-frère, alors secrétaire d'État à la Guerre. Celui-ci l'engage comme secrétaire privé puis le fait nommer conseiller du roi en 1649.
En 1651, Le Tellier le présente au cardinal Mazarin qui lui confie la gestion de sa fortune, l'une des plus importantes du royaume.
La disgrâce de Fouquet 1659-1665
Chargé de veiller à la gestion des Finances de l'État, Colbert rédige dès octobre 1659 un mémoire sur de prétendues malversations du surintendant des finances Nicolas Fouquet, pointant que moins de 50 % des impôts collectés arriveraient jusqu’au roi.
Réputé cassant et peu disert, il n’est guère aimé de la Cour. Madame de Sévigné le surnomme Le Nord.
Le cardinal Mazarin, peu avant sa mort le 9 mars 1661, recommande à Louis XIV de prendre Colbert à son service par la phrase célèbre : Sire, je dois tout à votre Majesté, mais je m'acquitte de ma dette en lui présentant Colbert. Celui-ci devient intendant des finances le 8 mars 1661.
Le 5 septembre 1661, le surintendant Fouquet tombé en disgrâce est arrêté à Nantes par d'Artagnan. À la suite de cette arrestation, Louis XIV supprime la charge de surintendant des Finances et décide de l'exercer lui-même avec l'aide d'un Conseil créé le 15 septembre à l'instigation de Colbert : le Conseil royal des finances.
A partir de 1663, il est la main du roi dans la mise au pas des provinces et notamment pour juguler la puissance des nobles et mettre fin à une certaine impunité nobiliaire. Ainsi, les Grands Jours d'Auvergne de septembre 1665 à janvier 1666, qui veulent purger la montagne d'une infinité de désordres statuent sur 1.360 affaires concernant des officiers corrompus et des nobles auteurs d'exactions. Les condamnations de 87 nobles, 26 officiers et 4 ecclésiastiques sont accompagnées d'annonces aux carrefours et durant les prônes vantant les mérites du roi protecteur et justicier. La réformation de la noblesse étendue à l'ensemble du royaume à partir de 1666-1668 s'efforce de dresser un catalogue de l'ordre nobiliaire pour mieux le contrôler.
Éminence grise du royaume
Colbert est l'un des trois conseillers qui forment ce conseil et le chef effectif de l'administration des Finances. Le 12 décembre 1665 il reste seul contrôleur général des finances et est désormais désigné le plus souvent par ce titre.
Mémoire sur les travaux de Versailles, adressé à Louis XIV en 1665 par Jean Baptiste Colbert, contrôleur général, où celui-ci exprime son hostilité à tout projet de quelque ampleur. Archives nationales
Le 16 février 1669, il renforce son pouvoir en devenant secrétaire d'État de la Maison du Roi et secrétaire d'État de la Marine. Ses diverses charges lui permettent d'exercer une grande influence dans plusieurs secteurs d'intervention de l'État : finances, industrie, commerce, marine, police, justice, administration, travaux publics, postes, agriculture, aménagement du territoire, culture. Seules lui échappent la guerre et les affaires étrangères, confiées à Hugues de Lionne et à Michel Le Tellier, puis à son fils François Michel Le Tellier de Louvois.
Colbert et le colbertisme
Portrait de Colbert en tenue de l'ordre du Saint-Esprit, par Claude Lefèbvre 1666, musée du château de Versailles
Article principal : Colbert, l'économie et la marine française.
Sous le contrôle de Louis XIV, il n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France. Colbert souhaitait réduire l'attrait des rentes constituées et de la préférence française pour la rente, en incitant à investir dans les manufactures et les Compagnies coloniales françaises.
Pour Colbert, la puissance d'un royaume se définit par la richesse de son souverain. Pour ce faire, il faut disposer d'une balance commerciale excédentaire et accroître le produit des impôts.
Pour enrichir la France, il met en place un système économique : le mercantilisme. Il veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher.
Dans ce but il convient de :
– créer une puissante marine qui importera les matières premières et exportera les produits finis ;
– réglementer la production de corporations ;
– créer une manufacture avec monopole qui fabriquera les produits de qualité à partir des matières premières.
À partir de 1661 Colbert dirige officieusement la Marine. En 1663, il est nommé Intendant de la Marine. Louis XIV dissout la Compagnie des Cent-Associés et fait de la Nouvelle-France une province royale sous juridiction de la Marine de Colbert.
En 1663, il fonde l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
En 1664, nommé surintendant des Bâtiments et manufactures :
– il fonde la Compagnie des Indes Occidentales française, dissoute en 1674:
– il décide de copier les productions des États voisins pour rendre la France indépendante de leurs fournitures ;
– il n'hésite pas à débaucher des ouvriers étrangers pour former les ouvriers des manufactures françaises ;
– il utilise fréquemment l'octroi de monopoles, rétablit les anciennes manufactures, en crée de nouvelles. Il favorise ainsi la production de glaces Manufacture royale de glaces de miroirs, composante de la future compagnie de Saint-Gobain et de tapisseries Les Gobelins.
Carte de la Nouvelle-France dédiée à Colbert XVIIe siècle.
En 1664, il met en place le premier tarif des douanes modernes, le tarif Colbert. Cette mesure protectionniste fut revue sévèrement à la hausse en 1667 par Louis XIV envers les Anglais et les Hollandais en particulier, créant une guerre économique qui fut suivie d'un conflit militaire.
Il protège les sciences, les lettres et les arts et est élu à l'Académie française en 1667. Il favorise également la recherche en créant l'Académie des sciences 1666, l'Observatoire de Paris 1667 où Huygens et Cassini sont appelés, l'Académie d'architecture 1671.
Le 16 février 1669, nommé secrétaire d'État de la Maison du Roi, il agrège la Marine à ce département le 7 mars suivant et passe commande de 276 navires de guerre triplant ainsi les capacités de la France N 1. Il lance une grande réformation des forêts royales pour la construction navale, afin que les navires du royaume aient des mâts en l'an deux mille Colbert s’inquiète beaucoup que la France puisse un jour périr faute de bois. Il fait aménager les forêts avec l'obligation de conserver une partie de chaque forêt en haute futaie le quart en réserve et fait limiter le pâturage en forêt.
La grande réformation des forêts royales est aussi un choix stratégique pour réparer le patrimoine forestier français à une époque ou le bois est non seulement le premier matériau de construction mais également la première source d'énergie. Avec le défrichage, la surexploitation, la contrebande et le relâchement de l’administration des forêts, celles-ci sont décimées quantitativement et qualitativement : c'est un danger sur le long terme pour la France qui doit même importer du bois de chêne de Scandinavie pour sa marine. La grande réformation est un succès et permet de ressusciter la marine royale : dès 1670, on n’utilise plus que des bois français. La grande réformation des forêts inspirera par-delà la Révolution le code forestier moderne de 1827.
En 1673, il ordonne la création de la Caisse des emprunts pour permettre de financer les dépenses extraordinaires de l’État.
L’édit du 21 mars 16736, dit de Colbert, institue la législation sur les hypothèques, applicable dans l’ensemble du royaume. Destiné à protéger les créanciers par la publicité effective des hypothèques, l’édit souleva une vive opposition tant de la noblesse, qui préférait le secret à la sécurité afin de ne pas révéler au grand jour son endettement hypothécaire, que du notariat, qui craignait une mise en cause de ses prérogatives. L’édit fut temporairement suspendu dès l’année suivante, en avril 1674. Mais, pour la première fois dans l'histoire de la publicité foncière, Colbert met au premier plan la nécessaire sécurité juridique des transactions immobilières et du crédit Il faut rétablir la bonne foi qui est perduë, & assurer la fortune de ceux qui prêtent leur argent. Il faut aussi rétablir le crédit des particuliers qui est perdu sans ressources …Il faut faire voire clair à ceux qui vous secoureroient s'ils y trouvaient leur seureté. Il faut aussi ôter le moien à ceux qui veulent tromper les autres, de le pouvoir faire ….
Pour favoriser le commerce, Colbert développe encore les infrastructures : il fait améliorer les grandes routes royales et en ouvre plusieurs ; il fait relier la Méditerranée à l'Océan par le canal des Deux-Mers.
Il fait paver et éclairer Paris, embellit la ville de quais, de places publiques, de portes triomphales Portes St-Denis et St-Martin. On lui doit aussi la colonnade du Louvre et le jardin des Tuileries.
Avec son fils, Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, il fait venir des villes hanséatiques des artisans, constructeurs, cordiers, pour installer des chantiers ou arsenaux de construction navale dans les principaux ports du royaume. Pour assurer le recrutement des équipages, il n'a pas recours, comme l'Angleterre, à la presse, ou enrôlement forcé des matelots de la marine marchande, mais à un nouveau procédé, appelé l'inscription maritime. En revanche, il demande aux juges de privilégier la condamnation aux galères, y compris pour le délit de vagabondage.
Il institue des compagnies commerciales : Compagnie des Indes Orientales Océan indien, Compagnie des Indes Occidentales Amériques, et Compagnie du Levant Méditerranée et Empire ottoman. Il est aussi à l'origine de la création de comptoirs : Pondichéry 1670 et de ce qui fut le début du peuplement en Nouvelle-France Amérique du Nord et encore l'île Bourbon.
Il pensait s'emparer des comptoirs hollandais du golfe de Guinée, particulièrement sur la Côte de l'Or Ghana aujourd'hui, mais ne mit jamais ce projet à exécution8.
Il s'oppose au secrétaire d'État de la Guerre, Louvois, jugé trop prodigue des fonds publics. Celui-ci intrigue contre lui auprès de Louis XIV à tel point que Colbert se trouve dans une position difficile quand il meurt le 6 septembre 1683, rue des Petits-Champs, laissant Claude Le Peletier lui succéder au poste de contrôleur général des finances.
Colbert donne un cadre juridique à l'exercice de l'esclavage dans les Antilles. Il élabore la première version du Code noir, promulgué par Louis XIV en 1685.
Tout en gérant les affaires de l'État, Colbert amasse une fortune personnelle considérable s'élevant à environ 4,5 millions de livres. C'est pourquoi le peuple, croyant voir dans cette fortune un signe de prévarication, insulte son cercueil. Il est enterré à Saint-Eustache, où sont conservées ses jambes tandis que le reste de sa dépouille est transféré dans les catacombes de Paris en 1787.
Ayant refusé de recevoir Louis XIV sur son lit de mort, officiellement parce que son état ne le lui permettait pas, il disait, selon ses proches : J'ai tout donné de moi au roi ; qu'il me laisse au moins ma mort et si j'avais fait pour Dieu tout ce que j'ai fait pour cet homme, je serais sauvé dix fois !.
Postérité de Colbert
Statue de Colbert par Gayrard fils, cour Napoléon du palais du Louvre.
Hommes illustres Louvre.
Il laisse l'image d'un excellent gestionnaire, même si les résultats économiques du règne peuvent paraître très discutables en raison des fortes ponctions causées par les dépenses militaires, les constructions et les largesses du roi. Il ne faut pas oublier que Louis XIV a encore régné 32 ans après la mort de Colbert : tant que le ministre fut aux affaires, les budgets ont été à peu près maîtrisés ; les déficits ne cessent de s'accumuler après lui.
Le terme de colbertisme souligne la part plus importante de l'intervention de l'État dans l'économie en comparaison des autres pays occidentaux.
Les manuels d'histoire du XXe siècle Mallet et Isaac ont forgé l'image populaire d'un homme entièrement dévoué à sa tâche et se frottant les mains de plaisir lorsqu'il était surchargé de travail.
Le clan Colbert Famille Colbert.
Le 13 décembre 1648, Jean-Baptiste Colbert épouse Marie Charron, fille d’un membre du conseil royal, sœur de Jean-Jacques Charron de Menars et cousine par alliance avec Alexandre Bontemps. Sa dot fut de 100 000 livres. Ensemble, ils eurent neuf enfants :
Jeanne-Marie 1650-1732 mariée à Charles-Honoré d'Albert de Luynes ;
Jean-Baptiste 1651-1690, marquis de Seignelay ;
Jacques-Nicolas 1654-1707, archevêque de Rouen ;
Antoine-Martin 1659-1689 ;
Henriette-Louise 1657-1733 mariée à Paul de Beauvilliers, marquis de Saint-Aignan ;
Jean-Jules-Armand 1664-1704, marquis de Blainville ;
Marie-Anne 1665-1750 mariée à Louis de Rochechouart, duc de Mortemart (neveu de Madame de Montespan), avec postérité dont notamment Talleyrand ;
Louis 1667-1745, comte de Linières, garde de la Bibliothèque du roi et militaire ;
Charles-Édouard 1670-1690, comte de Sceaux.
Après avoir débuté au sein du clan Le Tellier, Colbert devient lui aussi adepte du népotisme et décide de créer son propre clan en plaçant tous ses proches à des postes clés tel ses frères Charles et Nicolas ou son cousin germain, Charles Colbert de Terron. De fait, il devient un rival du clan Le Tellier et particulièrement du secrétaire d'État à la guerre, Louvois.
En 1657, il achète la baronnie de Seignelay dans l'Yonne, puis en 1670, la baronnie de Sceaux dans le sud de Paris. Il fait du domaine de Sceaux l'un des plus beaux de France grâce à André Le Nôtre qui dessine les jardins et à Charles Le Brun qui est chargé de toute la décoration tant des bâtiments que du parc.
Armoiries et devise
Blasonnement :
Coupé : D'or à une couleuvre ondoyante, en pal d'azur.
Commentaires : Blason de la famille Colbert. Armes parlantes en latin, couleuvre se dit coluber.
Devise : Pro rege, saepe, pro patria semper, en français : Pour le roi souvent, pour la patrie toujours.
Généalogie
Ascendance de Jean-Baptiste Colbert
Fonctions
Buste de Colbert par Antoine Coysevox.
de 1661 à 1665 Intendant des Finances
de 1661 à 1683 Surintendant des Postes
de 1661 à 1683 Surintendant des Bâtiments, arts et manufactures
de 1665 à 1683 Contrôleur général des Finances
de 1669 à 1683 Secrétaire d'État de la Maison du Roi
de 1669 à 1683 Secrétaire d'État de la Marine
de 1670 à 1683 Grand Maître des Mines et Minières de France
de 1671 à 1683 Surintendant des Eaux et Forêts
Ouvrages anciens
Courtilz de Sandras La Vie de Jean-Baptiste Colbert Ministre d'état sous Louys XIV Roy de France, Cologne, 1695
Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang, Jean-Baptiste Colbert dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878
Ouvrages récents
Sur la France à l'époque de Louis XIV
Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, Fayard, .
Thierry Sarmant et Mathieu Stoll, Régner et gouverner : Louis XIV et ses ministres, Paris : Perrin, 2010.
Sur la famille Colbert
Jean-Louis Bourgeon, Les Colbert avant Colbert, Presses Universitaires de France, Paris, 2002 2e édition.
François de Colbert, Histoire des Colbert du xve au xxe siècle, Grenoble, 2000 'Histoire des Colbert du xve au xxe siècle', prix Hugo 2002 de l'Institut de France.
Luc-Normand Tellier, Face aux Colbert : les Le Tellier, Vauban, Turgot... et l'avènement du libéralisme, Presses de l'Université du Québec, 1987, 816 pages.Etexte
Sur Colbert
Daniel Dessert, Le Royaume de Monsieur Colbert 1661-1683, Paris, Perrin, 2007.
Olivier Pastré, La Méthode Colbert ou le patriotisme économique efficace, Paris, Perrin, 2006.
Philippe Minard, La Fortune du colbertisme, État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 1998.
Jean Villain La Fortune de Colbert, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1994,
Jean Meyer, Colbert, Paris, Hachette, 1981.
Inès Murat, Colbert, Paris, Fayard, 1980.
François d'Aubert, Colbert, la vertu usurpée, Paris, Perrin, 2010.
Jacob Soll, The Information Master : Jean-Baptiste Colbert’s State Intelligence System, The University of Michigan Press, 2011.
Sur le département de la Marine
Jean-Philippe Zanco, Dictionnaire des Ministres de la Marine 1689-1958, Paris, S.P.M. Kronos, 2011.        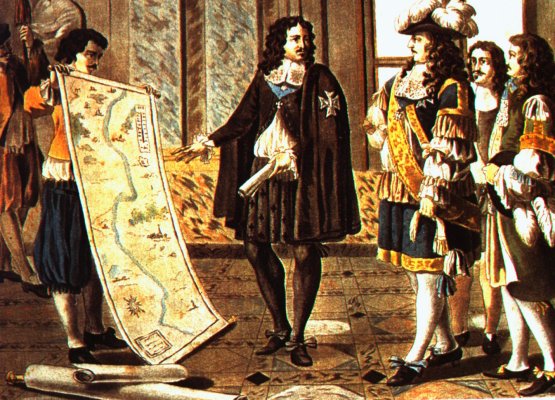
Posté le : 04/09/2015 17:23
|
|
|
|
|
La Fayette 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 6 septembre 1757 naît Gilbert du Motier, marquis de La Fayette
dit La Fayette, au château de Chavaniac, paroisse de Saint-Georges-d'Aurac dans la province d'Auvergne, actuellement Chavaniac-Lafayette dans la Haute-Loire et mort à 76 ans, le 20 mai 1834 à Paris, ancien 1er arrondissement aristocrate d'orientation libérale, officier et homme politique français, qui a joué un rôle décisif aux côtés des Américains dans leur Guerre d'indépendance contre le pouvoir colonial britannique, ainsi que dans l'émergence en France d'un pouvoir royal moderne, avant de devenir une personnalité de la Révolution française jusqu'à son émigration, son arrestation et sa mise en prison pour cinq ans en 1792, puis un acteur politique majeur des débuts de la monarchie de Juillet. Surnommé le héros des deux mondes, il est l'un des huit citoyens d'honneur des États-Unis d'Amérique. Homme politique et militaire de la famille Motier de La Fayette, Il fait allégeance au Royaume de France et aux États-Unis. Son arme est la Cavalerie, la Garde nationale, son Grade est Major-général, Lieutenant général, Général de division de 1775 – 1830. Il participe aux Conflits, de la Guerre d'indépendance des États-Unis, des Guerres de la Révolution. Il assure le commandement des Troupes de la américaines, dont la division des Virginiens, Dragons du roi, puis brigade d'infanterie, Garde nationale, de l'armée du Nord, de la garde nationale en 1831. Ces faits d'armes sont : Bataille de Brandywine Bataille de Barren Hill, Bataille de Gloucester, Bataille de Monmouth, Bataille de Rhode Island, Bataille de Yorktown
Il reçoit les distinctions suivantes : Ordre de Cincinnatus , Chevalier de Saint-Louis. Hommages Citoyen d'honneur de plusieurs états après 1781, Citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique, son nom est gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile 3e colonne
Après la révolution de 1789, La Fayette décide de signer tous ses courriers d'un Lafayette en un seul mot, en réaction contre le système nobiliaire. C'est aussi la graphie utilisée par ses contemporains jusqu'à sa mort.
En bref
Héros de trois révolutions : celle d'Amérique, celle de 1789, celle de 1830, La Fayette est issu d'une vieille famille noble d'Auvergne, et participe à la guerre d'Indépendance de l'Amérique. À son retour en 1779, héros du jour, il s'efforce d'allier la grâce aimable d'un grand seigneur d'Ancien Régime à une simplicité toute républicaine rapportée d'Amérique. À l'Assemblée des notables en 1787, il conseille l'adoption de l'édit sur les protestants. Un des principaux animateurs de la Société des Trente, il est élu député de la noblesse d'Auvergne aux États généraux et nommé, le 15 juillet 1789, commandant général de la milice parisienne, à laquelle il donne le nom de garde nationale et la cocarde tricolore, dont il est l'inventeur. Partisan du veto suspensif pour le roi et du bicamérisme, il devient après les journées d'octobre 1789 le personnage le plus considérable de France, le maire du palais, dira Mirabeau. La fête de la Fédération le 14 juillet 1790 marque l'apothéose de sa carrière révolutionnaire. Mais son esprit manque de profondeur et son caractère, de décision : il subit plus les événements qu'il ne les dirige, veut défendre la Révolution à la fois contre les aristocrates et contre les sans-culottes, qui, eux, souhaiteraient des décisions plus radicales, et anime avec Bailly et Condorcet la très modérée Société de 1789. Pour assurer le maintien de l'ordre, il fait voter la loi martiale et il s'imagine que le roi et la cour accepteront l'œuvre de la Constituante. Après la fuite à Varennes en 1791, il fait admettre, avec Barnave, Duport et les Lameth, la fiction de l'enlèvement, puis tire sur le peuple lors de la manifestation républicaine du Champ-de-Mars le 17 juillet 1791, ce qui lui enlève toute popularité. À la déclaration de guerre le 20 avril 1792, il reçoit le commandement de l'armée du Centre, mais il entre en négociation avec les Autrichiens et, après le 20 juin 1792, il menace de faire marcher son armée sur Paris si de nouvelles atteintes sont portées à la majesté royale. Décrété d'accusation le 19 août 1792, il passe dans le camp autrichien, mais il est gardé prisonnier jusqu'en 1797. N'ayant joué aucun rôle pendant la période napoléonienne, il se rallie aux Bourbons en 1814. Lors des Cent-Jours, il refuse la pairie, mais se fait élire député de Seine-et-Marne, devient vice-président de la Chambre, puis participe, avec Fouché, à la déchéance de l'Empereur. Élément actif de l'opposition libérale sous la seconde Restauration, il entre dans la conspiration groupant des bonapartistes et les républicains de la société des Amis de la vérité qui voulaient s'emparer du pouvoir par un coup de force prévu pour le 19 août 1820 ; il participe également au premier complot de la charbonnerie en décembre 1820 et proteste contre l'expédition d'Espagne en 1822-1823. En juillet 1830, il retrouve sa popularité de 1789-1790. Les révolutionnaires lui eussent, volontiers, offert la présidence de la République, mais il se rallie à la solution orléaniste, intronise Louis-Philippe au balcon de l'Hôtel de Ville, reçoit de nouveau le commandement de la garde nationale, mais se laisse jouer par Louis-Philippe, qui, pour se débarrasser de mylord protecteur, l'amène à démissionner de son commandement à la fin de décembre 1830. Il ne cessera, dès lors, jusqu'à sa mort, de condamner l'évolution rétrograde du régime de Juillet. Roger Dufraisse.
Sa vie
Issu d'une ancienne famille militaire d'Auvergne dont les origines connues remonteraient au XIe siècle, un de ses illustres ancêtres, Gilbert Motier de La Fayette, est maréchal de France au XVe siècle, Gilbert du Motier naît au château de Chavaniac le 6 septembre 1757. Le nom de la famille trouve son origine à La Fayette, actuelle commune d'Aix-la-Fayette Puy-de-Dôme, site d'une motte castrale documentée. Le nom complet, Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, est rarement utilisé : il est généralement désigné comme marquis de La Fayette ou Lafayette. Son biographe Louis R. Gottschalk précise que Gilbert orthographie son nom aussi bien en Lafayette qu'en La Fayette.
Son père, Michel Louis Christophe du Motier, marquis de La Fayette 13 août 1733 – 1er août 1759, colonel aux Grenadiers de France, est tué en Westphalie à l'âge de vingt-six ans par un boulet lors de la bataille de Minden, le 1er août 1759, dans les bras du duc de Broglie. Sa mère, Marie Louise Jolie de La Rivière, riche aristocrate de Saint-Brieuc, née en 1737, se retire à Paris au Palais du Luxembourg ; elle meurt le 3 avril 1770. Élevé, en son absence, par ses tantes et sa grand-mère, il passe à Chavaniac une enfance libre et protégée et rêve, à neuf ans, de chasser la bête du Gévaudan.
À l'âge de 12 ans, le marquis de La Fayette se trouve orphelin et seul héritier potentiel de la fortune de son grand-père maternel, le marquis de La Rivière, qui meurt à son tour le 24 avril 1770 et lui laisse une rente de 25 000 livres. À la même époque un autre oncle meurt et lui laisse un revenu annuel de 120 000 livres, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de France. C'est son arrière-grand-père, le comte de La Rivière, ancien lieutenant général des Armées du Roi, qui le fait venir à Paris pour son éducation.
Il étudie jusqu'en 1771 au collège du Plessis actuel lycée Louis-le-Grand et suit parallèlement une formation d'élève-officier à la compagnie des mousquetaires noirs du roi. L'armée deviendra pour lui une deuxième famille. Il suit également les cours de l'Académie militaire de Versailles.
Le 11 avril 1774, à 17 ans, il épouse Marie Adrienne Françoise de Noailles 1759-1807 fille du duc d'Ayen, dotée de 200 000 livres. C'est un mariage arrangé, qui peu à peu se muera toutefois en une belle histoire d'amour même si Gilbert trompera régulièrement sa femme. Sa belle-famille, une des plus anciennes de la Cour de France et apparentée à Madame de Maintenon, permet à La Fayette d’être présenté à la Cour au printemps 1774. De ce mariage naîtront quatre enfants, un fils et trois filles :
Henriette 1776-1778
Anastasie 1777-1863, qui épouse Juste-Charles de Latour-Maubourg 1774-1824 le 23 février 1798. Par elle, le marquis est l'aïeul de Paola Ruffo di Calabria, l'ancienne Reine des Belges, épouse du Roi Albert II.
Georges Washington de La Fayette 1779-1849, qui épouse Émilie d'Estutt de Tracy.
Virginie 1782-1849, qui épouse le 20 avril 1803 Louis de Lasteyrie du Saillant 1781-1826.
À la cour de Louis XVI, il n'obtient aucun succès. Attaché à ses libertés et dépourvu d'esprit courtisan, il fait avorter les tentatives de son beau-père visant à lui faire obtenir une situation intéressante.
Après son mariage, il quitte volontiers la Cour dont il maîtrise mal les codes et rejoint le régiment de Noailles de son beau-père avec d'abord un grade de sous-lieutenant avant d'être progressivement promu au rang de capitaine des dragons. Son chef est le duc de Broglie, ancien ami de son défunt père. À l'exemple de ce dernier, il choisit alors de suivre une carrière militaire et entre dans la Maison militaire du roi.
La guerre d'indépendance américaine
La participation de La Fayette à la Guerre d'indépendance des États-Unis 1775-1783 lui a valu une immense célébrité et une place symbolique pour avoir été le trait d'union entre les Américains et la France, lui valant d'être surnommé le héros des deux mondes. Et ce qui fait de La Fayette le symbole du soutien français aux insurgés d'Amérique, comme ce qui en fait la figure du héros romantique qu'on en conserve, c'est son jeune âge 19 ans et les circonstances de son départ de France sans l'autorisation officielle du roi encore favorable à la paix, finançant le voyage de ses propres deniers. Cependant, bien qu'il ait eu un rôle notable sur le plan militaire, celui-ci est moindre par rapport au bilan politique qu'il suscsité.
L'arrivée de La Fayette en Amérique
Histoire de la marine française sous Louis XV et Louis XVI.
En août 1775, le capitaine Gilbert de La Fayette est envoyé par son beau-père, le duc d'Ayen, en garnison à Metz pour y parfaire sa formation militaire. Il raconte dans ses Mémoires qu'il participe le 8 août à un dîner offert par le comte de Broglie au duc de Gloucester, frère du roi d'Angleterre, qui y évoque le soulèvement des Insurgents. C’est le jour même de ce fameux dîner de Metz que le jeune officier prend la décision de partir combattre pour l'indépendance de l'Amérique.
De retour à Paris à l’automne, La Fayette participe à des sociétés de pensée qui débattent de l'engagement de la France dans la Révolution américaine. Lors de ces réunions, un conférencier, l'abbé Raynal, insiste sur les Droits de l'homme et la fin des colonies, critique le clergé comme la noblesse. Censuré, il exprime dès lors secrètement ses vues auprès de loges maçonniques, entre autres celle dont La Fayette est membre.
Le jeune capitaine se fait réformer de l'armée le 11 juin 1776 puis, grâce au soutien du comte de Broglie et à ses futurs protecteurs le baron de Kalb et Silas Deane, diplomate et commissaire des Insurgents, signe à Paris le 7 décembre 1776 son engagement dans l'armée américaine comme major général. Le comte de Broglie, chef du cabinet secret » de Louis XV qui souhaite aider discrètement les Insurgents contre la Couronne britannique, lui fait financer secrètement l'achat de La Victoire, un navire de 200 tonneaux, avec seulement 2 canons, trente hommes d’équipage et comme cargaison 5 à 6 000 fusils.
Après un voyage en Angleterre destiné à tromper espions anglais et opposants français à son entreprise, il s'échappe et gagne Bordeaux. Là, il embarque ouvertement pour l'Espagne et le port basque de Pasajes de San Juan Le Passage près de Saint-Sébastien, drôle de destination pour qui veut partir pour les Amériques. Revenu rapidement à Bordeaux, il y apprend qu'il serait sous le coup d'un ordre d'arrestation à l'origine duquel se trouve son beau-père qui réclamerait à son encontre une lettre de cachet auprès du roi qui lui avait déjà interdit officiellement de quitter le pays après que des espions britanniques eurent découvert son plan.
Obéissant à un ordre lui enjoignant de partir pour Marseille, il feint d'en prendre la route en chaise de poste mais après quelques lieues, la voiture change de direction et file sur Bayonne. Arrivé à Pasajes de San Juan le 17 avril 1777, il embarque sur la Victoire avec quelques fidèles et, le 26 avril, appareille pour l'Amérique. Suivant une route passant bien au large des Antilles où les flottes anglaises et françaises pouvaient lui faire barrage et après une traversée longue de sept semaines, il touche terre le 13 juin à South Inlet, près de Georgetown où les fusils sont vendus pour armer la milice de Géorgie.
Il fait prêter à ses compagnons le serment de vaincre ou de périr, puis rencontre le major Benjamin Huger ; il est adopté par George Washington qu'il rencontre le 1er août 1777 il est affecté à son état-major comme aide de camp avec le titre de major général et, malgré un accueil au début mitigé des membres d'un Congrès à Philadelphie, il participe aux combats dès l’été. Il reçoit une balle à la jambe à la bataille de Brandywine, le 11 septembre 1777.
Mission de propagande en France
Par sa motivation, son désintéressement, et sa constante présence à la tête du régiment de Virginie, même pendant l'hiver rigoureux qu'ils passèrent à Valleyforge, il finira par convaincre les chefs de la Révolution américaine qu'il pouvait leur être utile. Le 6 février 1778, une alliance officielle est enfin instaurée entre la France et le nouveau pays. Une flotte d'une douzaine de bateaux, commandée par l'amiral d'Estaing est envoyée. Le mois suivant, il établira également des alliances avec plusieurs tribus indiennes.
En février 1779, de retour en France, La Fayette sait très habilement rendre populaire la cause des Insurgents et son expédition américaine auprès de l'opinion publique en France21. La sanction qu'il reçoit pour avoir désobéi et quitté la France n'est que symbolique, puisqu'elle n'est limitée qu'à une dizaine de jours d'arrêts, qu'il passe chez lui auprès de sa femme, Adrienne.
La Fayette en Virginie ; Yorktown
Préparation du corps expéditionnaire français de 1780 aux États-Unis, Bataille du cap Henry, Défense de la Virginie par La Fayette, Bataille de la baie de Chesapeake et Bataille de Yorktown.
De retour aux États-Unis en 1780 à bord de L'Hermione, il reçoit de George Washington le commandement des troupes de Virginie. Chargé d'opérer en Virginie contre des forces quatre fois supérieures en nombre, il sacrifie encore une partie de sa fortune pour maintenir ses soldats sous ses ordres et arrive, par des marches forcées et des retours subits, à tellement fatiguer Cornwallis et harceler ses troupes que le général britannique est forcé de le considérer comme un adversaire redoutable.
La Fayette fait sa jonction avec les troupes de George Washington et du comte de Rochambeau, commandant le corps expéditionnaire français de 6 000 hommes dont Axel de Fersen, pour se concentrer sur l'encerclement de Cornwallis à Yorktown. Les troupes anglaises sont bientôt coincées sur la rive ouest de la baie de Chesapeake, dans l'impossibilité de recevoir des secours ou d'évacuer par mer du fait du blocus effectué par l'amiral de Grasse, qui, le 5 septembre 1781, a repoussé victorieusement la Royal Navy à la bataille de la Chesapeake. Ce verrouillage permet aux alliés franco-américains de remporter, le 17 octobre 1781, la victoire décisive de Yorktown.
La Fayette est fait citoyen du Maryland par l'Assemblée générale de cet État le 28 décembre 1784 ce qui lui confère de fait la nationalité américaine. Il rentre en France en 1782 et est promu maréchal de camp.
La fin de l'Ancien Régime 1789 Paris
La Fayette rentre en France vers la fin de 1781. Sa participation aux opérations militaires sur le sol américain est sa première tentative pour appliquer les théories d'indépendance américaine à la société française. L'intention de La Fayette est de brusquer les réformes qu'il méditait. Mais Washington, avec qui il ne cesse de correspondre, le ramène à plus de mesure : C'est une partie de l'art militaire de connaître le terrain avant de s'y engager. On a souvent plus fait par les approches en règle que par une attaque à force ouverte. Cette observation ralentit un peu la fougue du jeune réformateur, et il renonce à emporter de haute lutte ce que Louis XVI opèrera de lui-même sans secousse, peu de temps après.
En mai 1784, La Fayette écrit une lettre enthousiaste à propos des travaux du médecin allemand Franz Anton Mesmer à George Washington, moins convaincu, et influencé par Benjamin Franklin fortement dubitatif : Un docteur allemand nommé Mesmer, ayant fait la plus grande découverte sur le magnétisme animal, a formé des élèves, parmi lesquels votre humble serviteur est appelé l'un des plus enthousiastes. Cette lettre est suivie d'une lettre de Mesmer lui-même le 16 juin à laquelle Washington répond cinq mois plus tard en confirmant qu'il a bien rencontré La Fayette. Ce dernier a entre-temps donné une ou deux leçons de magnétisme animal et rencontré une communauté de Shakers ayant vu une similarité entre les pratiques de transe de ces derniers et les crises mesmériennes. Lafayette participa également à des rituels nord-amérindiens, persuadé que le magnétisme animal était la redécouverte d'une pratique ancienne et primitive.
La Fayette repart pour l'Amérique le 1er juillet 1784. C'est un voyage privé, sur invitation de Washington. Le 4 août 1784, il est acclamé à New York par la foule qui l’accueille. Après trois jours de réceptions, il part faire un grand tour des provinces, partout accueilli avec la même chaleur. De grands banquets lui sont offerts à Philadelphie, Baltimore et Boston. Après un séjour à Mount-Vernon, chez Washington, La Fayette passe par New York, avant de remonter l’Hudson et de signer un traité de paix avec des Hurons et des Iroquois. La Fayette continue son voyage par Boston, Chesapeake, Yorktown et Richmond, avant de quitter le pays à New York le 21 décembre 1784.
La Fayette vient à Paris dans les derniers jours de 1785. Son retour excite un enthousiasme considérable. La reine Marie-Antoinette, qui assistait alors à une fête à l'hôtel de ville, veut conduire madame de La Fayette dans sa propre voiture à l'hôtel de Noailles, où vient de descendre son époux. Le lendemain, il est reçu à la cour, et ne cesse d'être, pendant plusieurs jours, l'objet des hommages et de la curiosité publics. Accueilli en héros à Paris, il peut jeter son dévolu avec succès sur l'une des plus célèbres beautés de l'époque, Aglaë de Barbentane, comtesse d'Hunolstein puis la comtesse de Simiane dont le mari, le comte de Simiane, se tue en 1787 en apprenant que sa femme est la maîtresse de La Fayette.
La Guyane
L'émancipation graduelle des esclaves est une de ses utopies favorites. Désireux d'appeler à son secours un commencement d'expérience, il achète une plantation considérable dans la Guyane française, et s'y livre à divers essais encore aujourd'hui méconnus et qu'interrompent les événements de la Révolution française. Il provoque, en 1787, la formation d'un comité chargé de discuter l'abolition du monopole des tabacs, et il y plaide avec chaleur la cause du commerce américain, que ce monopole frappait d'un préjudice de près de trente millions.
Les efforts plus heureux qu'il déploie en faveur de la nation américaine, lors de la négociation du traité que la France conclut avec elle, provoquent de sa part de nouveaux témoignages de reconnaissance, en resserrant les liens d'amitié qui l'unissent à George Washington, son glorieux libérateur. La correspondance établie entre ces deux hommes si unis d'intentions, si différents de caractère, ne prend fin qu'à la mort de Washington, qui survient le 14 décembre 1799.
L'assemblée des notables 1787
La Fayette participe à la première assemblée des notables, réunie à Versailles au mois de février 1787, et appartient au bureau présidé par le comte d'Artois. Il saisit avidement cette occasion de produire quelques-unes des réformes qu'il a méditées, fait voter la suppression de la gabelle et la mise en liberté des personnes détenues à l'occasion de cet impôt, réclame l'abolition des lettres de cachet et des prisons d'État, et la révision des lois criminelles. Il est de ceux qui obtiennent le renvoi du ministre Calonne en 1787. Il formule même le vœu d'une convocation des États généraux, comme le seul remède efficace aux maux de la situation ; mais ce vœu demeure sans écho. Il fait la motion expresse mot prononcé pour la première fois de la convocation de la nation représentée par ses mandataires.
L'année 1789
Porte-parole de l'aristocratie libérale, député de la noblesse d'Auvergne aux États généraux et chef de la Garde Nationale, il est membre de la société des amis des Noirs. Comme de nombreux militaires à cette époque, il a été initié comme franc-maçon dès 1775.
Les États-Généraux de 1789
D'abord favorable à des réformes, La Fayette fait partie des États généraux comme député de la noblesse d'Auvergne. Il ne remplit aucun rôle dans ces premiers engagements, où domine presque seule la figure de Mirabeau. II appuie la motion de Mirabeau sur l'éloignement de la menace des troupes qui encerclent la capitale, et présente un projet de Déclaration des Droits de l'homme à l'Assemblée constituante, fait décréter la responsabilité des ministres, et, ce qui est peut-être le plus marquant de son action, l'établissement d'une garde civique, dont il sera élu commandant.
Projet de Déclaration des droits de l'Homme juillet
Cent jours après le rapport de Jean-Joseph Mounier sur la constitution française, le 11 juillet 1789, il inaugure sa carrière parlementaire par la présentation d'un des projets de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que l'Assemblée ne retient pas. Ce projet, emprunté à la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, est le premier monument direct de cet esprit d'assimilation entre deux peuples si divers d'origine, de situation et de caractère. La Déclaration des droits qu'il proposait constituait un véritable corps de jurisprudence révolutionnaire qui considérait que le peuple français était abusivement soumis au roi de France, comme celui de l'Amérique l'était à la couronne de Grande-Bretagne, et qu'il convenait qu'il prît son indépendance et se gouvernât lui-même.
Commandant de la Garde nationale fin juillet
La Garde nationale est née sous la pression des troubles qui ensanglantent Paris dans les journées des 12 et 15 juillet, et composée de quarante-huit mille citoyens, enregistrés en un jour. L’assemblée élit La Fayette à la tête de la Garde nationale, au moment où, comme vice-président de l'assemblée, il vient de féliciter les électeurs de Paris, réunis à l'hôtel de ville, de la conquête de la Bastille. Le vicomte de Noailles, son beau-frère, lui est adjoint en qualité de major général, et Bailly est élevé au poste de maire de la capitale.
Son acte suivant comme commandant de la garde nationale est de faire démolir la Bastille 16 juillet. Le 26 juillet, il présente aux électeurs de Paris les nouvelles couleurs nationales, la cocarde tricolore.
Par sa fermeté, La Fayette sauve la vie à un grand nombre de personnes que menacent les fureurs populaires, et contient la faction d'Orléans, qui aspire à réorganiser les anciennes gardes françaises. Mais il ne peut empêcher le massacre de Foulon et de Berthier de Sauvigny, et ce témoignage de son impuissance le porte à se démettre du commandement dont il est revêtu ; des acclamations unanimes viennent de le rappeler à ses fonctions, lorsque surviennent les évènements des 5 et 6 octobre.
Les journées des 5 et 6 octobre Journées des 5 et 6 octobre 1789.
Lors de la Journées des 5 et 6 octobre 1789, où des Parisiens montent à Versailles pour demander du pain à Louis XVI, la Garde nationale est en retard, laissant dans un premier temps le roi face au peuple. Chargé de la sécurité du château, il se montre incapable d'empêcher son invasion. Le 6, il sauve à Versailles la famille royale, et la ramène à Paris où vient s'établir aussi l'Assemblée constituante. Il demande le jury britannique, les droits civils des hommes de couleur, la suppression des ordres monastiques, l'abolition de la noblesse héréditaire, l'égalité des citoyens.
1790 L'insurrection est le plus saint des devoirs
Les premiers jours de 1790 sont marqués par l'arrestation et le supplice du marquis de Favras, accusé d'un complot contre-révolutionnaire avec la participation de Monsieur, frère du roi. Le discours que ce prince prononce à l'Hôtel de ville, pour désavouer son loyal et infortuné mandataire, excite l'indignation de La Fayette, qui s'est fort exagéré l'importance de cette affaire, et devient entre ces deux personnages la source d'une inimitié jamais démentie.
C’est dans ce contexte que l'assemblée a à discuter la loi sur les attroupements, et dans cette discussion, La Fayette fait entendre à la tribune une phrase devenue célèbre : Pour la révolution, il a fallu des désordres, car l'ordre ancien, n'était que servitude, et, dans ce cas, l'insurrection est le plus saint des devoirs ; mais pour la constitution, il faut que l'ordre nouveau s'affermisse, et que les lois soient respectées. Il faut reconnaître que La Fayette, fidèle, du moins à cette époque, aux conditions du principe qu'il avait posé, ne cesse de se montrer le plus ferme adversaire du chaos. Sa fermeté déconcerte plusieurs séditions qui pouvaient devenir fatales à la sécurité publique. Le 11 février 1790, il fait arrêter 234 émeutiers.
Le club des Feuillants
Il s'entend avec Bailly pour fonder le club des Feuillants, société destinée à contrebalancer l'influence du club des Jacobins. Lorsque l'assemblée promulgue la constitution du clergé, La Fayette, plein des idées américaines sur l'égalité pratique des religions, protège, dans l'intérêt même de la liberté, le culte non assermenté, et ce culte est constamment en usage dans sa propre famille. Enfin, il propose au roi le rappel de ses gardes du corps, licenciés après les évènements d'octobre ; mais la reine s'y oppose de peur de mettre en péril la vie de ces fidèles militaires.
La fête de la Fédération 14 juillet
Il prend en charge l'organisation de la fête de la Fédération 14 juillet 1790 qui symbolise la réconciliation du roi avec la révolution. Le général paraît avec éclat à la fête de la Fédération, à la tête d'une députation de dix-huit mille gardes nationaux, entouré d'un nombreux état-major et monté sur le cheval blanc qui lui sert ordinairement dans ces solennités, il favorise avec beaucoup de zèle les acclamations adressées au roi, et dont la chaleur ranime chez tous les amis de l'ordre et du trône des espérances qui devaient trop promptement s'évanouir.
Le retour du duc d'Orléans devient le signal des premières hostilités du parti jacobin contre les constitutionnels et contre La Fayette, que les clubs et les groupes populaires commencent à désigner du nom de traître. L'énergie avec laquelle il se prononce pour la répression des désordres occasionnés par l'affaire de Nancy, la révolte de trois régiments de ligne qui avaient chassé leurs officiers, fortifie ces dispositions. Sa popularité décline visiblement. Un nouvel épisode révolutionnaire vient constater cette défaveur.
1791 Les troubles du début de 1791
Le 28 février 1791, La Fayette est informé qu'un attroupement conduit par Santerre s'est porté sur le donjon de Vincennes, pour faire éprouver sans doute à ce château le même sort qu'à la Bastille. Aidé de quelques cavaliers, il attaque les factieux, qui se replient sur le faubourg Saint-Antoine, dont ils disputent avec acharnement l'accès au corps demeuré fidèle. La Fayette triomphe de leur résistance et rentre dans Paris aux acclamations de tous les amis de l'ordre public.
Au même instant, une scène d'une autre nature se passe au château des Tuileries. Les périls de la famille royale, évidemment menacée par ce mouvement séditieux, y ont attiré un certain nombre de royalistes en armes. L'accueil empressé que leur font la reine et Madame Elisabeth excite l'ombrage et les murmures de la garde nationale, et Louis XVI, informé de ces rumeurs, ordonne à ces gentilshommes de déposer leurs armes entre ses mains. Ils obéissent avec résignation, lorsque La Fayette arrive au château. Il prend avec ardeur le parti de la garde qu'il commande ; il souffre que ce petit nombre de chevaliers fidèles soit chargé de menaces et d'outrages, et expulsé, sous ses yeux, du palais qu'ils sont venus défendre. Le lendemain, dans un ordre du jour, le commandant général flétrit le zèle très justement suspect qui a porté quelques hommes à oser se placer entre la garde nationale et le roi et ajoute que le roi de la constitution ne devait et ne voulait être entouré que des soldats de la liberté.
Les problèmes politiques
Ces timides ménagements sont désormais impuissants à sauver la royauté. Chaque jour aggrave les périls qui la menacent. L'émigration, commencée dès le 15 juillet 1789, se propage avec une effrayante activité. Quelques esprits songent à appeler l'intervention étrangère dans les débats intérieurs français ; Louis XVI a secrètement adressé, dès le 3 décembre 1790, un mémoire aux cabinets européens pour solliciter l'établissement d'un congrès continental destiné à en imposer, par sa seule existence, aux factieux qui conjuraient la ruine du trône. Ces démarches sont activement secondées par le comte d'Artois et par les nombreux émigrés qui ont fui d'imminentes persécutions.
La Fayette sert l'ordre sans zèle pour le roi. La mort de Mirabeau porte le dernier coup à la cause royale.
Le 18 avril, Louis XVI, qui a annoncé hautement l'intention d'aller remplir à Saint-Cloud ses devoirs religieux, en est empêché par une multitude ameutée sur le bruit que ce départ n'est qu'un commencement d'évasion. La Fayette ordonne vainement à la garde nationale de rendre la circulation libre : il n’est point obéi ; et le roi, forcé de rentrer dans ses appartements, se plaint, sans plus d'effet, à l'assemblée, de la violence qui lui a été faite.
Du 11 au 15 mai, après l'annonce de la mort du mulâtre de Saint-Domingue, Vincent Ogé, se déroule à la Salle du Manège le débat sur les droits des hommes de couleur discriminés par les assemblées coloniales dominées par les Blancs. Conformément à ses opinions de membre de la Société des amis des Noirs, La Fayette défend la cause des Noirs. À la suite du premier vote parlementaire du 12 mai, son nom figure dans une liste de colons hostiles de 276 députés qui ont voté pour l'Angleterre dans l'affaire des colonies.
La fuite et l'arrestation du roi juin
Le général conçoit alors et exécute le projet de se démettre du commandement qu'il exerce. Mais sa résolution fléchit une seconde fois devant les instances et les protestations de la milice citoyenne, et il a le malheur de se trouver à sa tête, lorsque la fuite et l'arrestation du roi 20 juin aggravent la responsabilité de ce commandement.
Lors de la fuite du Roi et de sa famille jusqu'à Varennes 20 juin 1791, il répand le bruit que l'on a enlevé la famille royale. Cette tentative du roi n'a été en aucune façon prise au sérieux par La Fayette, depuis la mort de Mirabeau, tête pensante du projet, en avril, et que rassurent, indépendamment de précautions minutieuses, les affirmations précises du roi.
Fuite de Louis XVI et arrestation à Varennes.
L'exaspération populaire est très vive contre La Fayette, qu'on accuse hautement de connivence avec la cour ; il calme par degrés ces dispositions menaçantes en s'avançant seul et sans escorte au-devant de la multitude, répandue sur la place de Grève. Mandé à l'assemblée, il se borne à confirmer les explications qu'a fournies son adjoint Gouvion, à qui la garde du château était spécialement confiée. Cependant il demande secrètement au président Beauharnais et au maire de Paris si, dans leur opinion, l'arrestation du roi importe au salut de l'État ; et, sur leur réponse affirmative, il dépêche un aide de camp sur la route de Montmédy, présumant que ce prince chercherait à s'y réunir au corps commandé par Bouillé.
Lorsque Louis XVI fut descendu aux Tuileries, La Fayette se présente à lui avec attendrissement et respectN 20. L'effet de cette infructueuse tentative rend plus étroite la surveillance à laquelle est soumise la famille royale, et La Fayette se trouve, par ses fonctions, l'instrument naturel de ces sévérités.
Au milieu de ces rigueurs, La Fayette ne dément point un reste de sentiments monarchiques. Il appuie la motion de Barnave tendant à maintenir l'autorité royale à Louis XVI, et il ajoute à cette occasion que ce prince est le meilleur de sa famille et le meilleur des souverains de l'Europe. Inculpé de tyrannie envers le roi par le marquis Louis de Bouillé, son cousin, dans une lettre menaçante à l'assemblée, il se borne à répondre qu'il est prêt à verser son sang pour le gouvernement établi.
Le 13 juillet, Muguet de Nanthou, rapporteur de l'enquête ouverte sur l'évènement de Varennes, conclut que ce voyage n'avait rien de coupable, et que d'ailleurs le roi était protégé par son inviolabilité constitutionnelle. Cette conclusion pacifique est accueillie par un décret de l'assemblée qui arrache de vives clameurs au parti jacobin, et il est décidé qu'une pétition ayant pour objet le report de ce décret sera portée le dimanche au Champ de Mars, où chaque citoyen pourra la signer sur l'autel de la patrie.
L'épisode du Champ de Mars 17 juillet
La Fayette se joint à Bailly pour empêcher la réunion des patriotes au Champ de Mars le 17 juillet 1791 pour signer la pétition relative au pouvoir royal ; mais il ne peut réussir.
Une foule considérable se réunit au lieu et au jour indiqués. La Fayette s'y présente bientôt, à la tête d'un détachement de la garde nationale ; il renverse quelques barricades et essuie un coup de feu qui ne l'atteint pas. Deux invalides, qu'une imprudente curiosité avait attirés sous l'autel, sont saisis, entraînés au comité du Quartier du Gros-Caillou et égorgés par le peuple.
Invité par l'assemblée nationale à pourvoir à la répression de ces désordres, Bailly se rend au Champ de Mars, accompagné de plusieurs officiers municipaux et d'une nombreuse escorte de la Garde nationale. Il fait déployer le drapeau rouge et adresse les sommations légales aux factieux, qui ne répondent que par une grêle de pierres ; un groupe armé tire sur le maire de Paris et/ou sur La Fayette. Le général fait tirer quelques coups en l'air ; mais cette démonstration ne faisant qu'enhardir les perturbateurs, la Garde nationale ouvre le feu sur l'ordre de Bailly. Une centaine de ces forcenés tombent morts ou blessés. Quelques officiers veulent employer l'artillerie ; La Fayette s'y oppose avec force et pousse même résolument son cheval devant la bouche des canons. Cet épisode est connu sous le nom de Fusillade du Champ-de-Mars.
La loi martiale est proclamée, le sang coule, et cette journée vaut à Bailly l'échafaud à quelque temps de là, et à La Fayette, la perte de sa popularité. Il est haï de la Cour, et les révolutionnaires doutent de sa sincérité patriotique. Marat se lance dans une grande campagne de presse contre lui. Il l'appelle l'infâme Motier.
La nouvelle constitution septembre Constitution de 1791.
La constitution, achevée à la hâte, est sanctionnée par le roi le 13 septembre. Cette solution cause une joie universelle : la révolution semble terminée. La Fayette appuie et fait décréter la proposition d'une amnistie générale. C’est son dernier vote à l'assemblée constituante. Privé de la plupart des qualités oratoires, il n'a guère exercé sur cette assemblée que l'espèce d'ascendant qui dérive de l'estime personnelle et d'une constance inébranlable dans des opinions conçues avec ardeur et courageusement défendues. Son commandement militaire lui paraît terminé par l'acceptation de l'acte constitutionnel et par l'installation de l'assemblée législative, et il fait supprimer l'emploi de colonel général de la garde nationale. Mais Jacques Pierre Brissot, un des fondateurs de la Société des amis des Noirs en 1788, lui reproche d'avoir le 24 septembre, trahi les mulâtres en s'abstenant prudemment de venir à l'assemblée constituante, lorsque son nouvel ami feuillant, Barnave a fait révoquer leurs droits obtenus le 15 mai 1791.
La démission octobre
Le 8 octobre, il adresse à la milice citoyenne une lettre d'adieu noblement formulée, et résigne ses pouvoirs entre les mains du conseil général de la commune. Quelques hommages remarquables honorent sa retraite.
II se retire aussitôt à Chavaniac-Lafayette, d'où un grand nombre d'électeurs songeront plus tard à le rappeler, en remplacement de Bailly, dans le poste difficile et périlleux de maire de Paris. Mais Pétion est nommé à une forte majorité, et ce choix avance rapidement la défaite du parti constitutionnel.
Général à Metz décembre
Cependant la guerre est imminente sur les frontières du Nord et de l'Est. En décembre 1791, trois armées sont constituées sur le front pour repousser les Autrichiens, et La Fayette est placé à la tête de l'armée du Centre, puis de l'armée du Nord. Trois corps d'armée, formant environ cent cinquante mille hommes, y sont réunis sous le commandement de Luckner, de Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau et de La Fayette.
La Fayette, qui a été promu quelques mois auparavant 30 juin au grade de lieutenant général, est chargé du commandement de l'une des trois armées lors de la Première Coalition. Il part le 25 décembre pour Metz, où il établit son quartier général. Il introduit dans le service des améliorations utiles, il rétablit la discipline, imagine le système des tirailleurs, organise l'artillerie légère, crée le corps des artilleurs à pied, et organise celui des artilleurs à cheval.
Lire La suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=9653#forumpost9653
Posté le : 04/09/2015 17:18
|
|
|
|
|
La Fayette 2 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
1792 L'armée du Nord
La guerre ayant été déclarée dans les premiers jours d'avril, il entre immédiatement en campagne et se porte, avec vingt-cinq mille hommes de très belles troupes, sur la rive droite de la Meuse, près de Givet, ayant son avant-garde à quatre lieues de là, dans les bois au-delà de Philippeville. Cette dernière position est mal choisie. Les Autrichiens, qui occupent Mons avec des forces supérieures, tombent un matin à l'improviste sur ce corps de troupes, composé d'environ trois mille hommes, et le dispersent avant que le général ait eu le temps d'être informé de cet engagement.
Quelques jours après, La Fayette va prendre une autre position dans le camp retranché de Maubeuge, ayant encore son avant-garde très loin de lui, dans les bois de Malplaquet et de la Glisuelle. Cette avant-garde est encore surprise par le même corps autrichien, parti de Mons à la faveur de la nuit. Le bataillon des volontaires de la Côte-d'Or a beaucoup à souffrir dans cette rencontre, qui coûte la vie au général Gouvion, aide de camp et ami dévoué de La Fayette. Le général survient, rétablit le combat et force l'ennemi à se replier en désordre sur la route de Mons. Mais ce faible avantage n'est guère propre à balancer l'influence fâcheuse que ces deux échecs, quoique peu considérables en eux-mêmes, peuvent exercer sur le moral de l'armée au début d'une campagne.
Mieux avisé, La Fayette se retranche à Tesnières, sous Bavay, dans l'intention d'y tenir en échec le général autrichien Clairfayt, lequel manœuvre pour se réunir à l'armée ennemie, qui campe sous Tournai. Mais il est aussitôt appelé au commandement de l'armée du Nord, en remplacement de Rochambeau, et porte son quartier général à Cerfontaine, à Longwy, puis à Sedan. Il bat l'ennemi à la bataille de Florennes. Voulant se porter de Metz sur Namur, il apprend à Dinant la défaite des deux corps de Dillon et de Biron, et se hâte d'opérer sa retraite.
La crise de la monarchie constitutionnelle
Cependant, les événements de plus en plus graves de l'intérieur de la France attirent toute l'attention de La Fayette. Élevé au prix de tant de sang et de sacrifices, l'édifice constitutionnel s'écroulait rapidement sous les coups redoublés des Jacobins et des Girondins. La Fayette présume d'un reste de popularité pour espérer que l'exposition de ses idées sur cette alarmante situation pourra produire un effet utile. Voyant que la vie du couple royal est, chaque jour, de plus en plus menacée, il s'oppose au Club des Jacobins, avec l'intention d'utiliser son armée pour rétablir une monarchie constitutionnelle.
La lettre du 16 juin 1792
Le 16 juin, il écrit, de son camp de Maubeuge, une longue lettre à l'assemblée législative, où il dénonce avec énergie la faction jacobine comme l'instigatrice évidente de tous les désordres dont souffre le pays. Il s'applique ensuite à prévenir toute inculpation personnelle en parlant noblement, de lui-même, de son intervention dans la Guerre de l'Indépendance, de son zèle à défendre la liberté et la souveraineté des peuples et rappelle la Déclaration des droits, dont il a été le promoteur. Il adjure enfin l'assemblée de rétablir l'égalité civile et la liberté religieuse sur leurs véritables bases, de faire respecter l'intégrité du pouvoir royal, et d'anéantir le régime des organisateurs des clubs et des sociétés secrètes. La lecture de cette lettre, dont La Fayette a adressé une copie au roi, provoque dans l'assemblée de vives réactions.
La droite seule l'approuve et en fait décréter l'impression. Les Girondins, par l'organe de Vergniaud et de Guadet, s'efforcent d'alarmer leurs collègues sur les dangers que font courir à la liberté de pareilles remontrances, adressées à une assemblée délibérante par un chef militaire, et affectent des doutes hypocrites sur l'authenticité de sa signature ; ils demandent que la lettre soit renvoyée à un comité, afin que l'assemblée puisse venger le général du lâche qui a osé se couvrir de son nom. Cette proposition est adoptée, et quelques voix réclament sans succès l'envoi de ce manifeste aux départements. Mais, peu de jours après, soixante-quinze administrations départementales adhèrent formellement aux considérations développées par le général.
Cette lettre est mal reçue de la majorité. La Fayette en apprend le mauvais effet en même temps que la journée du 20 juin. Il ne peut marcher sur Paris, son armée stationnée à Pont-sur-Sambre refuse de le suivre, notamment par l’opposition de Gobert.
La journée du 20 juin 1792
Lors de cette journée du 20 juin 1792, autre Journée révolutionnaire, au Louvre, la Garde nationale est absente, laissant le peuple aborder le roi en tête-à-têteN 24.
Plusieurs amis de La Fayette, et notamment Dupont de Nemours, lui mandent que cette journée a produit dans le public un sentiment de réaction assez vif pour que sa présence à Paris puisse lui imprimer une impulsion décisive. La Fayette n'hésite pas.
La Fayette devant l'Assemblée fin juin
Malgré les avis timorés de Luckner, La Fayette quitte aussitôt son armée, et le 28 il est à la barre de l'Assemblée. Il avoue hautement la lettre qui a été lue en son nom, et déclare qu'il a été chargé, par tous les corps de son armée, d'improuver les insultes faites au roi et de demander la destruction de cette secte qui envahissait la souveraineté, et dont les projets étaient connus.
L'allocution de La Fayette est accueillie avec enthousiasme par la droite, et par un morne silence à gauche.
En quittant l'assemblée, La Fayette se rend chez le roi, qui l'accueille avec bienveillance, mais avec réserve. Madame Elisabeth, présente à cette entrevue, conseille à son frère de s'en remettre à lui ; mais la reine s'est déjà prononcée contre toute tentative d'évasion à laquelle le général pourrait prendre part ; elle déclare qu'elle aime mieux mourir que de lui devoir sa délivrance. L'indécision de Louis XVI et la répugnance de la reine font avorter ce projet. La Fayette quitte ensuite Paris pour rejoindre son armée et il est brûlé en effigie dans les rues de Paris. C’est la fin de sa popularité qui a pris naissance sur les ruines de la Bastille, pour s'éteindre dans les journées du 20 juin et du 10 août. Sa démarche n'a rendu au pouvoir exécutif qu'une vigueur passagère ; le maire et le procureur de la commune sont suspendus pour leur conduite au 20 juin ; mais l'assemblée annule bientôt cette décision.
À son retour à l'armée, La Fayette veut tenter un dernier effort ; il pense qu'une victoire pourrait changer l'état des esprits, et fait proposer à Luckner, par le colonel Bureau de Pusy, son ancien collègue et son ami, d'attaquer les Autrichiens à Jemappes ; mais le maréchal s'y refuse formellement.
Les accusations des Jacobins
Tandis que les jacobins lui suscitent à l'armée mille tracasseries de détail, lui refusent les renforts dont il a besoin, interceptent ou dénaturent ses dépêches, circonscrivent son commandement, et appellent Luckner, exclusivement à lui, à la fédération du 14 juillet, ses ennemis, d'un autre côté, ne demeurent point inactifs. Il s'écoule peu de jours avant qu'il ne soit dénoncé à la barre de l'assemblée par quelque section de la capitale, comme un citoyen rebelle, comme un autre Cromwell, qui aspire à substituer le despotisme militaire au régime légal et à renverser la constitution par la constitution elle-même. Ces dénonciations rencontrent d'imposants appuis chez les députés Vergniaud et Delaunay, qui prononcent l'un et l'autre de longs discours sur les dangers de la patrie.
Ces vagues inculpations se compliquent d'un incident qui, plus adroitement combiné, aurait pu devenir fatal à La Fayette. Gobet, évêque constitutionnel de Paris, reçoit Luckner à dîner chez lui, et extorque à ce vieillard, au milieu d'une orgie, en présence de six députés jacobins, l'aveu que La Fayette lui a fait proposer par Jean-Xavier Bureau de Pusy, de marcher avec leurs corps d'armée, non contre l'ennemi, mais contre l'assemblée nationale. Cette intrigue échoue devant les dénégations écrites de Luckner, et surtout devant un démenti formel de Bureau de Pusy, qui s'explique à la barre de l'assemblée avec beaucoup de précision et d'énergie. Cependant, dans la séance du 6 août, Debry, organe de la commission à laquelle a été déféré l'examen de la conduite du général, conclut à sa mise en accusation ; mais cette proposition, soutenue par Jacques Pierre Brissot, et combattue avec chaleur par Vienot-Vaublanc et de Quatremère de Quincy, est repoussée à la majorité de 406 voix contre 224. Cette décision manque de peu de coûter cher aux députés qui l'ont provoquée. Au sortir de la séance ils sont assaillis, frappés, menacés de mort, et ne doivent leur salut qu'à la protection de la garde nationale. Hippolyte Taine commente cet épisode en ces termes : Quant au principal défenseur de La Fayette, M. de Vaublanc, assailli trois fois, il eut la précaution de ne pas rentrer chez lui ; mais des furieux investissent sa maison en criant que quatre-vingt citoyens doivent périr de leur main, et lui le premier ; douze hommes montent à son appartement, y fouillent partout, recommencent la perquisition dans les maisons voisines, et, ne pouvant l'empoigner lui-même, cherchent sa famille ; on l'avertit que s'il rentre à son domicile, il sera massacré.
Galiot Mandat de Grancey le remplace à la tête de la Garde nationale. Mais, le 10 août, il est massacré et La Fayette, destitué et décrété d'accusation. À la nouvelle du 10 août 1792, le premier soin de La Fayette est de se rendre au directoire du département des Ardennes, le corps constitué le plus rapproché de lui ; il lui déclare son refus de reconnaître le nouveau gouvernement, et une assemblée évidemment opprimée par la faction qui domine à Paris.
Il adresse ensuite aux troupes une proclamation énergique, et tente d'organiser, entre plusieurs départements de l'Est, une fédération dans le but de résister aux jacobins ; mais le duc de Brunswick ayant alors commencé son invasion en France, cette entreprise ne peut avoir aucune suite. La Fayette se borne à faire arrêter trois commissaires envoyés à son armée par l'assemblée. Cette levée de boucliers aurait pu déterminer une impulsion salutaire, si ses compagnons d'armes l'avaient secondé : mais Rochambeau se démet de son commandement, Luckner mollit ; le général Biron, ami du duc d'Orléans, soutient les jacobins, et Dillon traite avec Dumouriez, au lieu de punir sa désobéissance aux ordres de Luckner, qui lui a demandé de venir le joindre. Ces défections successives rendent la situation de La Fayette fort critique.
La Fayette déclaré traître à la nation août
Le 19 août 1792, il est déclaré traître à la nation. L'assemblée, dans sa séance du 19 août, l'a décrété d'accusation, et le directoire de Sedan a ordonné son arrestation. Il a un moment la pensée d'aller se présenter en personne à ses accusateurs ; mais cette démarche lui paraît aussi stérile que dangereuse. Réduit par l'infériorité et l'abandon de ses troupes à l'impuissance d'attaquer l'ennemi avec avantage, il songe à chercher un asile en pays étranger.
Après quelques précautions destinées à assurer le salut de son armée, il part secrètement de Sedan, dans la nuit du 19 août, avec César de Latour-Maubourg, Alexandre de Lameth, Bureau de Pusy et quelques autres officiers, et se dirige vers la forêt des Ardennes, sous prétexte de faire une reconnaissance. Il veut alors passer en pays neutre, obligé de se réfugier à Liège.
La captivité et l'exil capture par les Autrichiens
Bureau de Pusy est envoyé à Rochefort actuellement en Belgique, mais dans les Pays-Bas autrichiens à l'époque pour demander le passage en faveur d'officiers forcés de quitter l'armée française, ce qui est accordé. Mais, à son entrée à Rochefort, La Fayette est reconnu et contraint de se nommer. Informé de cette capture inespérée, le feld-maréchal autrichien Johann von Moitelle, qui commandait à Namur, y fait amener les fugitifs sous bonne escorte, et l'on prévient La Fayette que le prince Charles de Lorraine va venir de Bruxelles pour le consulter sur l'état intérieur de la France. Le général, Lameth, Latour-Maubourg et Bureau de Pusy sont conduits au château de Luxembourg. Avant son départ, La Fayette dicte à Romeuf, son aide de camp, une déclaration destinée à être rendue publique dans le cas où il succomberait dans sa captivité et où il avertit en conclusion : L'aristocratie et le despotisme sont frappés à mort, et mon sang, criant vengeance, donnera à la liberté de nouveaux défenseurs. Le duc de Saxe-Teschen, oncle de l'empereur, à qui La Fayette avait fait demander un passeport, répondit que puisque le chef de l'insurrection française était tombé entre les mains des princes alliés, on le garderait jusqu'à ce que son souverain, dans sa clémence ou dans sa justice, eût décidé de son sort.
La captivité en Prusse
Peu de jours après, les prisonniers sont remis par l'Autriche à la Prusse, et transférés dans la citadelle de Wesel en dépit des interventions des États-Unis et de la femme de La Fayette. Il est accueilli à la citadelle par le colonel prussien Friedrich August Albrecht von Tschirschky qui remplaçait au commandement de la forteresse de Wesel le général Romberg qui venait de mourir. Quand on amena Lafayette, von Tschirschky lui fit voir la caserne entourée de palissades, et, ne sachant pas un mot de français, lui dit : Bastille ! Bastille !. La Fayette tombe dangereusement malade. Il est transféré à Magdebourg, où il passe un an dans un appartement souterrain et humide, en butte à la surveillance la plus inhumaine, et réduit à recourir à un cure-dent trempé dans de la suie délayée pour correspondre secrètement avec quelques amis.
Transféré à Neisse, en Silésie, il y est traité un peu moins rigoureusement. Enfin, au mois de mai 1795, par suite du traité de paix conclu entre la France et la Prusse, La Fayette, Bureau de Pusy et Latour-Maubourg sont rendus aux Autrichiens et conduits dans la forteresse d'Olomouc en Moravie, où ils sont séparés et privés de toute communication avec le dehors ; il y subit toutes les tortures pendant cinq ans.
Tandis que La Fayette essuie ainsi toutes les angoisses de la plus dure captivité, la faction qui domine alors en France n'omet aucune persécution propre à se venger d'une retraite qui a dérobé sa tête à l'échafaud.
La Terreur en France
Madame de La Fayette, arrêtée dans sa terre au mois de septembre 1792, est relâchée par l'ordre de Brissot, à qui elle s'est plainte de cet acte de rigueur, mais consignée dans son château de Chavaniac, puis incarcérée de nouveau en 1794 dans un premier temps à Brioude et transférée à Paris ordre du 27 mai 1794 ; elle ne recouvre définitivement la liberté que le 21 janvier 1795, après avoir vu périr sur l'échafaud révolutionnaire la maréchale de Noailles, sa grand-mère, la duchesse d'Ayen, sa mère, et la vicomtesse de Noailles, sa sœur. Cette femme réussit, après mille difficultés, à aller jusqu'à Vienne, où elle obtient de partager, avec ses deux filles, la captivité de son mari, dans la forteresse d'Olmutz. Elle y reste jusqu'à la libération de son mari malgré de très graves ennuis de santé.
Tentative d'évasion octobre 1794
La présence de Mme de La Fayette est le premier adoucissement que le sort du général ait encore éprouvé. Mais il aggrave bientôt le poids de sa détention par une tentative infructueuse d'évasion entreprise au mois d'octobre 1794, de concert avec le docteur Bollemann, et un jeune Américain nommé Huger, qui se sont dévoués à ses intérêts. La faculté de se promener autour de la citadelle lui fut retirée, ainsi qu'aux deux autres prisonniers. Le caractère de La Fayette ne se dément point devant ces longues et pénibles épreuves. Une seule préoccupation domine dans tous les rapports qu'il peut entretenir au-dehors, celle du tort que pourront faire à la cause de la liberté les persécutions qu'il a souffertes au sein de sa patrie. Il s'applique dans ce but, avec une pieuse sollicitude, à atténuer ses propres griefs ; il ne veut pas que l'offense d'un obscur citoyen nuise au succès de tout un principe. Il conserve, sans ostentation, sans amertume, sous les verrous d'Olmutz, l'intrépidité de sa foi politique et de son dévouement aux intérêts de la liberté. Une circonstance douloureuse a troublé cependant cette foi si bien affermie.
La délivrance septembre 1797
Cependant l'heure de la délivrance approche. La campagne de 1796 vient de s'accomplir, et le Traité de Leoben s'en est suivi : Napoléon Bonaparte et Clarke, s'arrogeant le droit de traiter au nom de la République française, ont insisté pour la mise en liberté des trois captifs comme une des conditions de la paix du traité de Campo-Formio 19 septembre 1797, à la condition qu'ils ne pourraient rentrer, immédiatement, sur le territoire français. Le Directoire lui interdit de rentrer en France. Après cinq mois de pourparlers, La Fayette et ses deux compagnons de captivité sont libres, sous leur simple promesse de quitter dans douze jours les États de l'empereur. Arrivés à Hambourg, leur premier soin est de remercier le général Bonaparte du miracle de leur résurrection.
Les contacts avec Bonaparte
La Fayette passe ensuite dans les Provinces-Unies, où il est bien accueilli, et se fixe quelque temps à Utrecht, épiant avec impatience l'occasion de rentrer en France, où un parti puissant, ayant à sa tête l'ancien constituant Sieyès, s'agite en sa faveur. C’est là qu'il apprend le débarquement de Napoléon Bonaparte, au port de Fréjus, d'où sa marche vers Paris n'a été qu'une course triomphale. La Fayette écrit à Bonaparte pour le complimenter sur son retour ; mais cette démarche, probablement intéressée, n'amène aucun résultat. Ses relations avec Napoléon sont complexes. Ainsi il lui exprime par écrit sa gratitude pour sa libération et il le félicite aussi lors de son retour d'Égypte. Mais Napoléon, sans l'avoir rencontré, lui est hostile et lui interdit de s'installer à Paris.
La période napoléonienne Le retour en France 1800
Enfin, en 1800, las du rôle de proscrit, le général fait savoir au Premier Consul que la prolongation de son exil ne convient ni au gouvernement, ni à lui-même, et qu'il arrive à Paris. Ce retour imprévu cause au chef de l'État une humeur qu'il ne peut dissimuler. Chacun remarque l'affectation avec laquelle, dans l'éloge de Washington que Fontanes prononce à cette époque par son ordre, l'orateur omet jusqu'au nom de son brillant auxiliaire.
Cependant La Fayette se retire dans son château de La Grange Blesneau entre Rozay-en-Brie et Courpalay, Seine-et-Marne, dans une propriété de sa femme qu'il avait héritée de sa belle-mère, et cet acte de prudence calme graduellement les dispositions ombrageuses du Premier Consul. La Fayette se lie d'amitié avec Joseph Bonaparte et dans un premier temps se voit accorder quelques faveurs. Il est rayé de la liste des émigrés, reçoit une retraite de 6 000 francs tandis que son fils, Georges Washington de La Fayette, devient officier dans un régiment de hussards. Il obtient pour son fils un grade dans l'armée et pour lui le titre de membre du conseil général de la Haute-Loire, avec le maximum de la pension de retraite de son grade.
Rencontre avec Bonaparte
Finalement Napoléon et La Fayette se rencontrent, par l'intermédiaire de Lebrun, peu après la bataille de Marengo. La Fayette refuse la dignité de sénateur qui lui est offerte par Talleyrand et par Cabanis, en ajoutant que le lendemain de sa promotion il se verrait obligé de dénoncer le Premier Consul et son administration. Il refuse aussi la légation des États-Unis, se regardant, dit-il, comme trop Américain pour y jouer le rôle d'étranger.
Bien qu'un peu blessé de ces refus successifs, le vainqueur de Marengo montre à La Fayette de l'ouverture et de la simplicité. Lors de la votation du consulat à vie, La Fayette déclare qu'il ne l'approuvera pas tant que la liberté publique ne sera point garantie, et il développe cette opinion dans une lettre dont la franchise ne paraît pas trop déplaire au maître de la France ; cependant, c’est alors que les relations de ces deux hommes cessent entièrement. La rupture intervient en 1802 car La Fayette s'oppose au titre de consul à vie de Napoléon dans une lettre écrite le 20 mai.
La Fayette s'élève avec énergie contre l'exécution du duc d'Enghien. Il refuse, à plusieurs reprises, d'entrer au Sénat et ne cache pas son hostilité au régime.
L'Empire
L'avènement du Premier Consul à l'Empire est pour l'austère démocrate le sujet d'une vie encore plus retirée. Il s'abstient de toute participation, même indirecte, aux affaires publiques. En 1804, il vote contre le titre d'Empereur. À partir de cet instant, La Fayette se tient à l'écart de la vie publique et s'adonne à l'agriculture et l'élevage dans son domaine briard.
À l'époque de l'institution de la Légion d'honneur, l'empereur lui fait proposer, par le comte de Ségur, son parent, d'être un des dignitaires de l'ordre ; mais La Fayette refuse ce cordon comme un ridicule, et par la suite, l'on n'y revint plus. Son isolement finit par indisposer Napoléon, qui supporte difficilement toute position en dehors de son gouvernement ; et, lorsque, après la campagne d'Ulm, Georges de La Fayette, fils unique du général, qui sert comme lieutenant de hussards, est proposé pour un grade supérieur, l'empereur lui-même repousse cette promotion avec persévérance.
Les splendeurs croissantes de l'Empire achèvent de condamner La Fayette à une obscurité absolue. Ses ennemis supposent qu'il endure cette situation avec peine ; aussi, une chute grave qu'il fait sur la glace, à cette époque, ayant excité quelque intérêt, on prétend que le héros des deux mondes n'a trouvé que ce moyen de faire parler de lui. On le sollicite vivement alors de visiter l'Amérique, ce théâtre de ses premiers exploits ; mais il s'en défend par la crainte que le gouvernement impérial ne mette obstacle à son retour. Cette appréhension n'est pas sans fondement. Napoléon, qui ne le perdait pas de vue, disait un jour au conseil d'État : Tout le monde en France est corrigé, excepté La Fayette : vous le voyez tranquille, eh bien ! je vous dis, moi, qu'il est prêt à recommencer.
Le ralliement aux Bourbons 1814
Il se rallie aux Bourbons en 1814. Avec Fouché, il participe à la déchéance de l'Empereur. Le général nous apprend lui-même, dans ses Mémoires, qu'il revit avec plaisir le régime pacificateur de la Restauration, dont les princes, ses contemporains, avaient été ses compagnons d'enfance ou de jeunesse. Cédant à l'entraînement universel, il paraît aux Tuileries avec l'uniforme d'officier général et la cocarde blanche, et il y est bien accueilli. Cette visite, toutefois, est la seule qu'il ait rendue aux frères de Louis XVI ; l'esprit général du gouvernement, des attaques semi-officielles dirigées contre lui, ne tardent pas à réveiller ses anciens ressentiments, et il s'abstient de reparaître au château. À cette époque, La Fayette a plusieurs conférences avec l'empereur de Russie, et ce souverain libéral d'un État despotique se plaint ouvertement à lui du peu de libéralisme de cette dynastie que la mauvaise foi, bien plus que l'erreur, lui a si souvent reproché d'avoir imposée à la France.
Les Cent Jours 1815
Malgré la défaveur personnelle que la famille royale inspire à La Fayette, il voit avec effroi, au mois de mars 1815, le retour de Napoléon, qui remet en question cette paix européenne achetée au prix de tant de sacrifices. Quelques royalistes étant venus lui demander si le gouvernement des Bourbons pouvait, dans la ligne de ses opinions, compter sur son dévouement, il répond oui sans hésiter : ne doutant pas, dit-il, qu'à la faveur d'une opposition bien dirigée, on ne puisse tirer meilleur parti de Louis XVIII que de celui qu'il regarde depuis longtemps comme le plus redoutable ennemi de la liberté.
Dans une réunion à laquelle il est appelé, chez Laine, pour débattre le parti le plus convenable aux circonstances, il propose sérieusement de mettre le duc d'Orléans à la tête des troupes, et de réunir tous les membres survivants des assemblées nationales depuis 1789, afin d'opposer une grande force morale à la puissance matérielle de Bonaparte. Cette opinion, comme on pense, demeure sans écho.
La Fayette demeure trois jours à Paris, comme pour faire parade de sécurité personnelle, puis il va s'ensevelir, dans son château de La Grange. Napoléon est rentré aux Tuileries sans coup férir. Un républicain moins austère et moins désintéressé que La Fayette, Benjamin Constant, qui s'est récemment signalé par l'ardeur de son hostilité contre le régime impérial, vient d'accepter le titre de conseiller d'État.
Cependant il promet de concourir à repousser les étrangers et les Bourbons, en mettant à ses services la même condition qu'il a imposée aux Bourbons eux-mêmes, à savoir : la réunion d'une chambre de représentants librement convoquée et largement élue.
Appelé à la présidence du collège électoral de Seine-et-Marne, puis à la députation de ce département lors des Cent-Jours, il est incité à revenir sur le devant de la scène politique. Il voit se rouvrir pour lui, après vingt-trois ans d'interruption, la carrière parlementaire, dans les conjonctures les plus favorables à ses théories d'opposition et de démocratie.
Un concours imposant de suffrages l'élève à la vice-présidence de la chambre des représentants, et il fait partie, en cette qualité, de la députation chargée de recevoir Napoléon au palais de la chambre, lorsqu'il vient en personne ouvrir sa courte session. La Fayette ne prend pour ainsi dire aucune part aux débats de la chambre des Cent-Jours : il semble se réserver tout entier pour de plus hautes circonstances. La bataille de Waterloo éclate comme un coup de foudre sur la capitale et sur la France entière.
Napoléon reparaît, et mille bruits de dissolution et de dictature militaire agitent les esprits. C’est alors que La Fayette monte à la tribune lors de la séance du 21 juin. Pour la première fois depuis bien des années, j'élève une voix que les vrais amis de la liberté reconnaîtront » commence-t-il. Appelé à « parler des dangers de la patrie à sauver, il juge le temps venu de se rallier autour du vieil étendard tricolore, celui de 89, celui de la liberté, de l'égalité et de l'ordre public ; C'est celui-là seul que nous avons à défendre contre les prétentions étrangères et contre les tentatives intérieures. Vétéran de cette cause sacrée, qui fut toujours étranger à l'esprit de faction, M. de La Fayette soumet à la chambre, sous des applaudissements, une résolution de 5 articles dont 4 sont adoptés :
Déclaration que l'indépendance nationale est menacée art. 1 ;
Constitution en permanence de la chambre, qui regardera toute tentative de dissolution comme un acte de haute trahison art. 2 ;
Proclamation du mérite de la patrie en faveur des armées de ligne et des gardes nationales au combat art. 3 ;
Plein pouvoir au ministre de l'intérieur sur l'État-major et la garde nationale parisienne, pour défendre la capitale d'éventuelles exactions propres aux situations de crise art. 4 - écarté pendant les débats ;
Mandatement des ministres à la barre pour y rendre compte de la situation de la France art. 5.
Cette énergique motion n'est pas moins intempestive qu'inconstitutionnelle. La Fayette n'est, en cette occasion, que l'instrument d'une intrigue habilement ourdie par Joseph Fouché qui l'a rencontré la veille. En outre, juste après la présentation de la proposition de M. de La Fayette, une motion identique et jointe à celle du héros des deux mondes par le président de la séance a été soutenue par Jean de Lacoste. Or Lacoste était proche de Fouché. D'après le célèbre biographe de Fouché, Louis Madelin, le ministre de l'intérieur risquait à la fois Vincennes avec le retour de Napoléon, et la fin de sa carrière avec le retour des Bourbons. Il n'a pas de mal à convaincre La Fayette qu'il est l'homme de la situation. La Fayette a peu de considération pour Fouché mais pense dominer la situation. Personne ne pouvait penser qu'une substitution de Napoléon par La Fayette était viable. En réalité, Fouché, désespérant du succès de ses vœux secrets en faveur du duc d'Orléans, accepte la branche aînée des Bourbons comme un pis-aller.
Napoléon consent avec peine à laisser aller ses ministres à la chambre, et leur adjoint Lucien Bonaparte, qui défend avec beaucoup de véhémence les intérêts de son frère. Cet orateur ayant, dans la chaleur de l'improvisation, parlé de la légèreté des Français, La Fayette répond que cette imputation est calomnieuse, et que si la nation n'avait pas suivi Napoléon dans les sables d'Égypte, dans les déserts de la Russie, et sur cinquante champs de bataille, le pays n'aurait pas trois millions de Français à regretter. Le lendemain matin, il fait prévenir l'empereur que, s'il ne se décide pas à abdiquer, lui-même va proposer sa déchéance. Napoléon abdique, les chambres proclament Napoléon II, et la commission de gouvernement, sur la proposition de Fouché qui la préside, députe aux souverains alliés des plénipotentiaires chargés d'arrêter leur marche sur Paris, et de traiter de la paix au nom de la France.
La Fayette et Voyer d'Argenson font partie de cette députation dont l'objet apparent est de détourner les puissances étrangères du projet de rétablir les Bourbons sur le trône de France. Mais cette frivole ambassade n'a pas d'autre but, en réalité, que d'amuser l'impatience du parti révolutionnaire, et d'éloigner un agitateur propre à contrarier les projets de restauration auxquels Fouché s'était dévoué. Les plénipotentiaires se dirigent sur Mannheim, puis sur Haguenau ; mais ils ne peuvent être admis auprès de l'empereur Alexandre de Russie, dont La Fayette sollicite vainement une audience, et leurs négociations se bornent à quelques conférences sans résultats avec des commissaires désignés par ce prince et par les autres souverains coalisés. C’est dans l'un de ces pourparlers que le commissaire britannique fait entendre que la France n'obtiendra la paix qu'en livrant Napoléon aux puissances coalisées. Napoléon, abattu, inspire à cette grande âme la sympathie que La Fayette avait refusée constamment à sa haute fortune. Il fait offrir à son ancien libérateur les moyens d'assurer son passage aux États-Unis ; mais l'ex-empereur, qui garde jusqu'au tombeau le souvenir de sa dernière agression, préfère se confier à la générosité britannique.
La Restauration 1815-1830
Le retour des Bourbons ne peut être vu avec faveur par celui qui vient de les repousser. La mission d'Haguenau a brisé sans retour les faibles rapports qui s'étaient établis durant la première Restauration entre la cour et La Fayette. Il est trop compromis pour être réconciliable. Le général passe dans une retraite absolue les trois premières années de la restauration de 1815, période d'incriminations et de violences, où la ferveur outrée de la réaction royaliste eût difficilement permis une position politique à l'ancien promoteur de la Déclaration des droits.
Au mois de novembre 1818, le collège électoral de la Sarthe l'envoie à la chambre, et il vient prendre, à l'extrême gauche, la place qu'il ne cessera plus d'occuper jusqu'à la révolution de 1830.
Député
Il vote contre la proposition Barthélémy, qui tendait à modifier la loi électorale de 1817, et se montre, dès le début, pénétré des mêmes doctrines qu'il a professées toute sa vie. Plein de l'idée que le gouvernement des Bourbons marche, tantôt ouvertement, tantôt par des voies détournées, à la destruction des libertés dont leur retour avait doté la France, on le voit toujours au premier rang des adversaires du pouvoir, harcelant les ministres de ses énergiques provocations, luttant sans cesse contre le fantôme insaisissable de la contre-révolution, encourageant sans relâche, du haut de la tribune, les peuples voisins à la résistance contre les prétendus oppresseurs de leurs droits.
Ses principaux discours sont ceux qu'il prononce, en 1819 sur la pétition pour le rappel des bannis et sur le budget de cette année, et en 1820, pour solliciter la réorganisation de la garde nationale, sur le maintien de la loi d'élection, sur les projets de loi relatifs à la liberté individuelle, à la censure et aux élections. Les révolutions espagnole et napolitaine, auxquelles ses encouragements n'avaient eu que trop de part, viennent d'échouer par suite des mesures prises de concert entre les souverains alliés. Cette impuissance jointe au ressentiment de plus en plus vif du général contre les hommes et le système de la Restauration, explique la résolution qui le précipite dans les complots. Lui-même, dans un sentiment de droiture, a pris soin de déclarer à la tribune qu'il se regardait comme délié de ses serments par les violations qu'avait, selon lui, éprouvées la charte constitutionnelle.
La voie de la conspiration
Chez lui, la foi monarchique est essentiellement subordonnée au respect du gouvernement pour les droits du peuple, entendus dans leur acception la plus illimitée. Tout acte en dehors de ce cercle redoutable lui semblait une espèce de sacrilège auquel il ne se faisait aucun scrupule de répondre par l'insurrection. Le temps n'a soulevé que lentement le voile qui couvrait ces associations mystérieuses, et La Fayette lui-même s'est montré fort discret, dans ses Mémoires, sur la mesure exacte de sa participation.
La première conspiration dans laquelle son nom se trouve mêlé d'une manière sérieuse est le complot militaire d'août 1820, où plusieurs déclarations le désignent comme un des chefs du mouvement. Ces révélations paraissent insuffisantes, toutefois, pour autoriser une action légale. Dans le procès intenté au mois de mars à Goyet et à Sauquaire-Souligné, prévenus d'attentat contre la sûreté de l'État, La Fayette paraît comme témoin, et le ministère public n'hésite point à attribuer aux encouragements consignés dans ses lettres, qui sont produites à l'audience, le dangereux entraînement qui a placé les prévenus sous la main de la justice. L'une de ces lettres, adressée aux jeunes gens du Mans, offre alors les caractères d'une provocation à la révolte. Vertement interpelé à cette occasion par le président de la cour d'assises, La Fayette répond fièrement qu'il persiste dans des opinions dont il n'est responsable qu'à la chambre des députés.
L'échec de ces premiers complots contre la Restauration inspire bientôt à l'esprit de faction l'établissement de sociétés secrètes permanentes, destinées à stimuler et à régulariser ces tentatives, à les lier entre elles, et à marquer les temps et les lieux où les conjurés pourraient agir efficacement. La Fayette entre dans la plus importante de ces associations et en devient bientôt le membre le plus influent par l'illustration attachée à son passé politique, par la facilité de son accès, par sa docilité à répondre à toutes les propositions insurrectionnelles et à encourager tous les complots.
Prodigue en effet d'encouragements et d'espérances, le vétéran de l'insurrection ne s'engage dans aucune entreprise avant d'en avoir calculé avec soin les ressources et les moyens d'action49,50, et il n'y participe qu'après avoir pris toutes les précautions propres, en cas d'échec, à garantir sa sécurité personnelle. Il abandonne aux conspirateurs subalternes le lot de l'agression et du péril, ne s'exposant qu'avec une extrême prudence aux atteintes d'un gouvernement dénué de vigueur et d'initiative, et dont la politique ménage secrètement dans La Fayette un principe de résistance et de contrepoids aux ardeurs des ultra-royalistes.
La Charbonnerie
C’est sous les auspices de la charbonnerie à laquelle il adhère en 1821 que se forme, dans la ville de Belfort, un vaste complot dont les conjurés fixent l'exécution aux premiers jours de 1822. Le général devait quitter Paris pour se mettre à leur tête. Des circonstances particulières le portent à différer son départ de vingt-quatre heures. C'est à ce retard qu'il doit de n'être pas surpris en flagrant délit de conspiration. Avertis de l'avortement du complot par Saint-Amand Bazard, à peu de distance de la ville de Lure, le général et son fils peuvent changer immédiatement de route, descendre la vallée de la Saône et se rendre à Gray, d'où ils regagnent précipitamment Paris. Leur voiture, qui pouvait servir de témoignage de leur présence, est enlevée par les soins de MM. Kœchlin, qui la font transporter au-delà du Rhin, où on la réduit en cendres.
Demeuré disponible pour d'autres complots, La Fayette est bientôt signalé par des déclarations précises comme l'un des instigateurs du mouvement séditieux entrepris sur Saumur par le général Breton dans le mois de février 1822, et qui a échoué par la trahison du sous-officier Woelfel. Un magistrat ardent, mais probe, le procureur général Mangin, touché de la concordance de ces témoignages, ne craint pas de les reproduire dans son acte d'accusation. Il présente comme établis les rapports de La Fayette avec les principaux conjurés, et enveloppe dans la même inculpation plusieurs députés de l'opposition, entre autres le général Foy, Voyer d'Argenson et Benjamin Constant. Cet énergique manifeste soulève le 1er août une tempête violente au sein de la chambre.
Le général Foy désavoue, avec une chaleur probablement sincère, la complicité qui lui est attribuée, et soutient que « de telles infamies sont l'œuvre du ministère ». La Fayette monte à la tribune au milieu du tumulte, et fait entendre quelques paroles qu'on peut considérer comme la provocation la plus audacieuse peut-être dont ait jamais retenti une assemblée délibérante. On a généralement supposé que cette provocation s'adressait à Louis XVIII lui-même, et qu'elle avait trait à quelque particularité peu connue de la conduite de ce prince envers le marquis de Favras. Quoi qu'il en soit, pour trancher cet éclatant défi, il fallait à La Fayette une conscience bien profonde de la puissance de ses révélations ou de la faiblesse du gouvernement qu'il accablait ainsi du sentiment de son impunité.
Rien n'est plus véritable, en effet, que la complicité du général avec les conjurés de Saumur. C'est dans l'hôtel même de La Fayette, et en sa présence, que deux d'entre eux, Grandmesnil et Baudrillet, ont formé le plan et concerté les principales dispositions du complot. Ces circonstances ont été révélées à la justice par Baudrillet ; mais une inqualifiable omission en a fait évanouir l'importance. On se figure aisément les proportions qu'un tel évènement eût données aux débats et les révélations dont il fût devenu la source. La préoccupation de la chambre lui a dérobé cet incident, qui n'a été divulgué que bien des années plus tard.
Lorsqu'un mois après, les débats du procès de Breton ont lieu devant la cour d'assises de Poitiers, M. Mangin soutient avec force ses premières affirmations, et fait entendre des paroles qui ne caractérisent que trop fidèlement les rapports de La Fayette avec les conjurés: le complot de Breton est le dernier auquel se trouva mêlé le nom de La Fayette, et les ventes du carbonarisme prirent fin elles-mêmes en 1823.
La guerre d'Espagne de 1823
Lors de l'expulsion de Manuel, il est du nombre des soixante-quatre députés qui protestent contre cet acte de violence parlementaire. Dans une réunion de députés de l'opposition qui a lieu à cette époque, il va jusqu'à proposer de déclarer nettement par une proclamation au peuple, que l'impôt a cessé d'être obligatoire depuis cette violation de la charte ; mais cet avis extrême est unanimement repoussé. L'issue favorable de la guerre d'Espagne de 1823 a imprimé aux esprits une forte impulsion monarchique, et cette disposition générale, secondée par les efforts actifs du ministère, écarte de la chambre des députés la plupart des chefs de l'opposition. Réélu député en novembre 1822, à Meaux, La Fayette n’est pas réélu et est battu aux élections de 1824.
Lire la suite ->http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=9652#forumpost9652
Posté le : 04/09/2015 17:17
|
|
|
|
|
La Fayette 3 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le voyage en Amérique 1824
Il profite de cette inaction forcée pour accomplir un vœu qui lui tient à cœur : celui de revoir l'Amérique, théâtre de sa première gloire, et de visiter ce peuple qu'il a soutenu dans la conquête de son indépendance. Cette entreprise, contrariée dix-huit ans auparavant, est un hommage implicite à la tolérance du régime dont La Fayette n'a cessé de conspirer le renversement. Informé de son désir, le congrès américain l'invite avec empressement à le réaliser, et met à sa disposition un vaisseau de l'État. Il retourne en Amérique pour une tournée triomphale dans 182 villes de juillet 1824 à septembre 1825.
Le général part du Havre en juin 1824, accompagné de son fils et d'un secrétaire, sur un simple bâtiment de commerce. Il débarque le 16 août dans la baie de New York, où il est accueilli avec un enthousiasme considérable par les deux tiers des habitants de la ville. Une escadre de neuf vaisseaux à vapeur, pavoisés et montés par plus de six mille citoyens de tous âges, de tout sexe et de toute condition, est en station dans le port. Le vice-président des États-Unis et l'ancien gouverneur du New Jersey viennent le recevoir à son bord. La Fayette se rend au milieu d'un cortège imposant, au bruit des salves d'artillerie et des acclamations, à l'hôtel de ville, où il est complimenté par tous les ordres de l'État.
Les portes de l'édifice sont ouvertes, et le général est livré pendant plus de deux heures à l'adoration d'une foule en délire. Un banquet nombreux, les toasts les plus flatteurs, de brillantes illuminations, terminent cette première journée triomphale. La Fayette visite successivement les États de New-York, du Massachusetts, de New Hampshire, de Pennsylvanie, de Baltimore, de Virginie, du Maryland, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud, de la Géorgie, d'Alabama, s'arrête à Boston, à Portsmouth, à Newburgh, à Hudson, à Albany, à Philadelphie, à Baltimore ; et partout il est accueilli avec les mêmes transports d'enthousiasme. Les populations rurales, dit M. Levasseur, historien de ce voyage, accouraient de plus de vingt milles à la ronde au-devant de lui. À Washington, siège du Congrès, La Fayette est reçu par le président Monroe, qui donne en son honneur un dîner splendide, auquel assistent tous les ministres étrangers, excepté ceux de France, du Royaume-Uni et de Russie.
Il visite à Mount Vernon le tombeau de Washington, ainsi que sa maison et son jardin, descend le Potomac, et s'arrêt à Yorktown, théâtre d'une des actions les plus mémorables de la guerre d'Indépendance. Le colonel Lewis, qui l'accueille à son débarquement dans cette ville, l'engage à s'installer en Amérique Le général fait une courte excursion parmi les tribus indiennes d'Uchee-Cruk et de Line-Cruk, qui l'accueillent avec cordialité.
Il est présenté le 10 décembre aux deux chambres du Congrès par leurs présidents. Enfin, le 20 décembre, le Congrès adopte à l'unanimité un bill par lequel il reçoit du peuple américain 200 000 dollars et 12 000 hectares en Floride, en récompense de ses services et en indemnité des dépenses qu'il a faites dans la guerre de l'Indépendance. L'université de Princeton lui décerne à cette occasion un doctorat honoris causa, attribué en 1790.
La Fayette visite Fayetteville, Charlestown, Savannah, où il pose la première pierre d'un monument à la mémoire du général Greene ; puis, remontant le Mississippi, il parcourt La Nouvelle-Orléans, dont l'ancienne population française lui témoigne un vif empressement.
Son séjour en Amérique se prolonge pendant quatorze mois, qui ne sont qu'une marche à peine interrompue dans les vingt-quatre États de l'Union, et une succession continuelle d'honneurs.
Chargé par la famille de Washington d'envoyer le portrait de son illustre chef à Bolivar, il y joint une lettre flatteuse pour le libérateur de la Colombie, qui répond que le Washington donné par La Fayette est la plus sublime des récompenses que puisse ambitionner un homme. En remontant l'Ohio, à la suite d'une tournée dans les provinces du sud-ouest, le bateau à vapeur qui porte le général heurte un écueil et coule, à cent vingt-cinq milles environ de Louisville, où il se rendait ; mais cet accident n'a aucun effet sérieux, et le général avec sa suite est immédiatement reçu à bord d'un autre bâtiment, sur lequel il achève sa traversée par Cincinnati, Pittsburgh, Utica, Boston et New-York.
À Boston, le 17 juin 1825, a lieu un immense cérémonie d'anniversaire de la bataille de Bunker Hill. Lors de ce grand rassemblement, 200 000 personnes sont présentes. Selon le rituel maçonnique, La Fayette est chargé de poser la première pierre du bâtiment à la mémoire de cette bataille. La fête se termine par un grand banquet de 4 000 couverts.
Après avoir séjourné de nouveau pendant quelques semaines à Washington, chez le nouveau président, John Quincy Adams, La Fayette se met en devoir de retourner en France. Le 7 septembre 1825, il reçoit les adieux des ministres, de tous les chefs civils et militaires de l'État, et d'une foule de citoyens réunis dans l'hôtel du président de la république. Celui-ci, dans un discours étendu, récapitule la vie de La Fayette, rappelle son dévouement à la cause américaine, et la fermeté avec laquelle, pendant quarante ans, il a soutenu la cause de la liberté. Le général répond par une glorification de l'Amérique républicaine et exhorte les États à la concorde et à l'union. Il quitte ensuite le pays sur la frégate la Brandywine et parvient au Havre le 5 octobre 1825. L'aspect politique de la France s'est favorablement modifié pendant son absence.
La Fayette, avec d'autres philhellènes, profite aussi de son séjour pour plaider la cause de la Grèce insurgée contre l'Empire ottoman.
Le règne de Charles X 1825-1830
L'avènement de Charles X avait paru éteindre ou affaiblir les discordes des partis. L'apparition du fameux mémoire de M. de Montlosier met brusquement fin à la courte trêve qu'ils s'étaient tacitement accordée. La dissolution de la garde nationale de Paris augmente le mécontentement en désarmant l'autorité royale des forces nécessaires pour en réprimer les effets, et les troubles de la rue Saint-Denis révèlent tout le succès que le génie de la sédition peut se promettre encore d'un appel aux passions populaires.
C'est dans ces circonstances que les électeurs de Meaux députent La Fayette à la chambre, au mois de juin 1827, en remplacement de M. Pinteville-Cernon. De nouvelles élections ramènent sur les bancs de l'opposition la plupart des anciens membres que le ministère avait fait écarter de la chambre septennale, et La Fayette est encore appelé par l'arrondissement de Meaux à prendre part à cette dernière lutte contre la Restauration.
Dans un discours prononcé le 23 juin, sur le budget de 1828, La Fayette reproche au gouvernement ses tendances rétrogrades et bat impitoyablement en brèche les abus qu'il avait signalés à diverses reprises. L'année suivante, dans un discours sur les crédits supplémentaires, il dénonce la Sainte-Alliance comme une vaste et puissante ligue dont le but est d'asservir et d'abrutir le genre humain, et relève par une allusion les expressions inconsidérées par lesquelles Louis XVIII, en 1814, avait remercié le prince régent de son concours.
C’est, comme il arrive souvent, par une mesure extrême que Charles X espère franchir les difficultés de sa situation.
La Fayette, absent de Paris depuis la fin de la session, est allé passer quelques jours, après quatorze ans de séparation, à Chavaniac, lieu de sa naissance. C’est à son passage au Puy qu'il apprend l'avènement du ministère Polignac. Un banquet lui est aussitôt offert par les chefs de l'opposition libérale. Là retentissent, sous la forme d'énergiques toasts, les premières protestations populaires contre les nouveaux conseillers de Charles X.
Le voyage du général prend dès lors un caractère exclusivement politique ; le choix des villes qu'il affecte de traverser et les démonstrations extraordinaires dont il y est l'objet révèlent le but réel de cette tournée, évidemment destinée à en imposer au gouvernement, par une parade menaçante des forces populaires. La Fayette visite successivement Grenoble, VizilleN 46, Voiron, La Tour-du-Pin, Bourgoin, Vienne, et le 5 septembre il se met en route pour Lyon, où le délire révolutionnaire a préparé une réception presque royale au patriarche de la démocratie française.
La Fayette fait son entrée à Lyon en présence d'un concours innombrable de spectateurs et y reçoit des députations des villes de Chalon et de Saint-Étienne. De toutes parts, on se prépare à la résistance contre les tentatives liberticides du ministère ; des associations se forment pour le refus de l'impôt, et de nouvelles sociétés secrètes, organisées à la manière des carbonari de 1822, s'établissent au sein de la capitale.
La Fayette les encourage hautement, exprime même l'avis que les chambres doivent refuser le budget jusqu'à ce que la France ait reçu une organisation démocratique, et se met en rapport direct avec la plus séditieuse de ces associations, connue sous le nom de Conspiration La Fayette qui a pour organe La Tribune des départements. La fameuse adresse des 221, par laquelle la chambre dénie son concours à un ministère dont le système lui est encore inconnu, ne stimule que trop ces dispositions perturbatrices.
La Fayette ne prend aucune part ostensible aux débats qui la précèdent. Les meneurs de l'opposition sont trop habiles pour ne pas comprendre à quel point l'influence de son nom et de ses doctrines aurait compromis le succès d'une lutte aussi décisive. La situation, cependant, est loin d'être désespérée. Le parti le plus logique et le plus sage était de dissoudre à la fois la chambre et le ministère, et d'en appeler aux électeurs. Mais ce parti ne prévaut point. Un sentiment exagéré de la prérogative monarchique, une certaine impatience, et, disons-le, certaine dignité propre au caractère de Charles X, l'emportent, et l'imprévoyant monarque se plaît à resserrer, par un renvoi pur et simple de la chambre des 221, l'étroite impasse dans laquelle le pouvoir royal se trouve engagé. Les élections, faites sous l'influence de l'irritation populaire, ramènent une opposition plus nombreuse et plus animée. De cette situation violente sortent les ordonnances du 28 juillet, moyen fatal et désespéré de dégager la royauté imprudemment acculée dans ses derniers retranchements, mais qui prend facilement la couleur d'un odieux parjure aux yeux d'une population hostile et prévenue.
La Révolution de 1830 Les Trois Glorieuses
La Révolution de Juillet, révolution française à la faveur de laquelle un nouveau régime, la monarchie de Juillet, succède à la Seconde Restauration, se déroule sur trois journées, les 27, 28 et 29 juillet 1830, dites les Trois Glorieuses.
Après une longue période d’agitation ministérielle puis parlementaire, le roi Charles X tente un coup de force constitutionnel par ses ordonnances de Saint-Cloud du 25 juillet 1830. En réaction, un mouvement de foule se transforme rapidement en révolution républicaine. Le peuple parisien se soulève, dresse des barricades dans les rues, et affronte les forces armées, commandées par le maréchal Marmont, au cours de combats qui font quelque 200 tués chez les soldats et près de 800 chez les insurgés.
Charles X et la famille royale fuient Paris. Les députés libéraux, majoritairement monarchistes, prennent en main la révolution populaire et, au terme de l’hésitation de 1830 , conservent une monarchie constitutionnelle, au prix d’un changement de dynastie. La maison d’Orléans, branche cadette de la maison de Bourbon, succède à la branche aînée ; Louis-Philippe Ier est proclamé « roi des Français » et non plus roi de France.
La chute de Charles X
La première impression qu'excite la fuite de Charles X est la stupeur ; l'absence de forces militaires respectables encourage la résistance, et une suite de dispositions mal conçues, mollement exécutées, font bientôt prendre à l'émeute le caractère d'une vaste insurrection.
Lors de la révolution dite des Trois Glorieuses, en 1830, retrouvant sa popularité de l'année 1789, La Fayette a ses propres partisans qui le poussent à jouer un rôle de premier plan. Absent lors de la promulgation des ordonnances, il se met en route dans la soirée du 26 et accourt de Lagrange à Paris au milieu de la nuit, sans que le gouvernement, dans son incurie ou dans son respect mal entendu pour la liberté individuelle, ait songé à contrarier cette dangereuse assistance ; il est adopté comme un drapeau par les chefs de l'insurrection. Le général paraît le lendemain à la réunion des députés assemblés chez Audry de Puyraveau et à celles qui la suivent ; mais, son attitude répond mal à l'attente des meneurs qui commencent à le diriger. Il ne cesse d'exhorter au calme et à l'inaction la jeunesse turbulente qui vient à plusieurs reprises solliciter sa coopération.
Lorsque l'assemblée décide l'envoi d'une députation au duc de Raguse, dans le but de suspendre les hostilités, La Fayette insiste pour qu'elle tienne au maréchal un langage sévère, et qu'on mette sous sa responsabilité tout le sang qui serait répandu.
À la réunion du 28 au soir, lorsque la révolution a pris tout son développement, le général, frappé du nombre croissant des victimes, s'écrie avec la plupart de ses collègues, qu'il faut diriger les efforts du peuple, adopter son étendard, et se déclare prêt à occuper le poste qu'on voudrait lui assigner. La Fayette passe une partie de la nuit à stimuler et à diriger l'activité populaire : il visite plusieurs des barricades qui s’élèvent sur les différents points de la capitale, et sa présence est saluée de vives acclamations. L'abandon inopiné du Louvre procure, dans la matinée du 29 la victoire au peuple. Une foule immense et enthousiaste remplit les rues. La Commission municipale provisoire, dont le général a refusé de faire partie, lui défère le commandement de toutes les gardes nationales du royaume. Dès lors il se trouve investi de la plus haute influence peut-être que jamais citoyen ait exercée en aucun pays.
C’est dans ces circonstances que, le 29 au soir, Huguet de Sémonville, grand-référendaire de la Chambre des pairs, et le comte d'Argout, se présentent, au nom du roi Charles X, à la commission municipale, et font part à ses membres réunis de la révocation des ordonnances du 28 et l'appel d'un nouveau ministère sous la présidence du duc de Mortemart. La Fayette, mandé dans le sein de la commission, écoute sans rien objecter la communication du grand référendaire, et se borne à lui demander si la conquête du drapeau tricolore ne serait pas du moins le prix de la victoire du peuple parisien. M. de Sémonville répond évasivement, et l'on se sépare.
Dans la matinée du 30, La Fayette, quittant une attitude d'observation qui n'est guère dans son caractère, fait adresser aux corps de troupes réunis autour de Saint-Cloud l'audacieuse sommation de déposer les armes. Le duc de Mortemart, par des raisons particulières, n'ayant pu présenter lui-même à la réunion des députés les ordonnances de révocation, cette mission est remplie par Jean-Baptiste Henry Collin de Sussy, qui est écouté sans faveur. II comprend que le gouvernement de fait qui siège à l'hôtel de ville est le seul tribunal où la cause de Charles X et de sa dynastie puisse à cette heure s'agiter encore avec utilité. Collin de Sussy est admis avec peine auprès de La Fayette, qu'environne un cortège menaçant de délégués des sociétés populaires, de gardes nationaux et d'ouvriers. C'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie, lui dit le général avec enthousiasme ; vous me voyez entouré d'amis qui étaient las comme moi du despotisme des quinze dernières années. Permettez que nous prenions tous ensemble connaissance de votre message. M. de Sussy ayant témoigné le désir d'être présenté à la commission municipale, La Fayette lui-même le met en rapport avec MM. de Lobau, Mauguin et Audry de Puyraveau. Mais à peine a-t-il commencé la communication dont il s'est chargé qu'il est interrompu par les exclamations répétées : II est trop tard ! il est trop tard ! Charles X a cessé de régner ; le peuple a acquis par son sang le droit de se choisir un autre souverain ! Malgré cette réponse si péremptoire de la commission, le général, dont la mesure et la politesse ne se sont pas un instant démenties, croit devoir rendre hommage à son principe favori en faisant connaître la mission de M. de Sussy au peuple qui se presse dans l'intérieur de l'hôtel de ville. Il passe à cet effet dans la grande salle, et, après avoir réclamé le silence, il se met en devoir de donner lecture des dernières ordonnances de Charles X. Mais à ce nom seul, un cri de réprobation se fait entendre sur tous les points de la salle. La lecture des ordonnances excite de nouvelles vociférations. C’est au milieu de cet ouragan populaire que La Fayette fait entendre à travers un sourire ces simples paroles, qui devaient être un arrêt fatal : Vous le voyez, il faut vous résigner ; c'est fini des Bourbons ! . En prenant congé du général, Collin de Sussy tente vainement de l'écarter de l'hôtel de ville, sous prétexte d'une conférence au Luxembourg avec le duc de Mortemart ; il répond que le délégué du peuple ne peut avoir rien de commun avec l'envoyé de la monarchie déchue, et l'entretien est terminé.
La Fayette rejette hautement l'offre qui lui est faite d'être le régent du comte de Chambord, Henri d'Artois, et le général Talon, l'un des chefs de la garde royale, l'ayant engagé à s'expliquer sur l'effet des ordonnances du 29, il répond le 31 par un billet autographe qui se termine ainsi : Toute réconciliation est impossible, et la famille royale a cessé de régner.
Le parti bonapartiste, de tout temps antipathique à La Fayette, s'était agité sans aucune chance de succès. Restait à opter entre deux autres combinaisons gouvernementales, la république et la monarchie du duc d'Orléans. L'appel de ce prince à la lieutenance générale du royaume, dans la journée du 30 juillet, est un grand pas dans la voie de cette solution ; mais il importe de décider La Fayette, qui ne voit dans cette résolution précipitée qu'une mesure purement provisoire. Fils de l'ennemi personnel du général, ce prince ne se recommande à son suffrage par aucune prédilection particulière ; mais ses partisans se mettent activement à l'œuvre. Ils font valoir l'origine révolutionnaire du prince, ses antécédents patriotiques, alors assez mal connus, ses vertus de famille, son opposition permanente au système de la Restauration. Ces considérations, habilement présentées, surmontent les instigations des sociétés établies à l'hôtel de ville, et font pencher définitivement la balance en sa faveur. Une circonstance fortuite ou préparée achève de fixer l'indécision du général : William Cabell Rives, ministre américain à Paris, étant venu le visiter à l'hôtel de ville : Que vont dire nos amis des États-Unis, s'écria La Fayette en s'avançant vers lui avec empressement, s'ils apprennent que nous avons proclamé la république en France ? - Ils diront, répondit froidement M. Rives, que quarante ans d'expérience ont été perdus pour les Français. La Fayette, qui a refusé avec désintéressement la présidence de la république, renonce, momentanément du moins, à son utopie favorite.
L'avènement du duc d'Orléans
Le 31, il reçoit une lettre de Charles X qui lui fait les plus séduisantes propositions. Par défiance ou par conviction, et aussi peut-être du fait de ses 73 ans, il refuse, et répond : II n'est plus temps. Le même jour, il reçoit à l'hôtel de ville de Paris le duc d'Orléans, Louis-Philippe Ier, qui vient demander son investiture à l'arbitre naturel du dénouement de la révolution.
Il traverse les salles de l'hôtel de ville, et ces dispositions ne prennent un autre cours que lorsque le prince et le général s'unissent sur le balcon de l'hôtel par une accolade qui paraît proclamer ou consommer l'adoption populaire. Le lendemain, 1er août, La Fayette, déférant au vœu exprimé par plusieurs membres de la commission municipale, se rend au Palais-Royal dans l'intention plus ou moins avouée de pressentir le futur roi des Français sur son système de gouvernement. Il débute par un éloge de la constitution américaine, que le prince n'adopte pas sans réserve, et que le général modifie lui-même en se bornant à demander un trône populaire entouré d'institutions républicaines.
Le duc d'Orléans paraît accepter avec empressement ce programme, si célèbre depuis sous le nom de Programme de l'hôtel de ville, et qui défraie pendant plusieurs mois les illusions du patron de la nouvelle monarchie. Tandis que le prince, par une politique habile, s'approprie ainsi les fruits d'une lutte à laquelle il n'a point concouru, Charles X lui défère de son côté le titre de lieutenant général et abdique la couronne en faveur de son petit-fils.
Ces actes demeurant sans effet, la cour paraît se disposer à une lutte que le nombre et le dévouement des troupes qui l'entourent la mettent en état de soutenir avec avantage. Des commissaires sont dépêchés à Rambouillet pour exhorter le roi à s'éloigner. Leurs instances étant vaines, on obtient du duc d'Orléans la permission de provoquer cet éloignement par une manifestation décisive. La Fayette, qui paraît prendre sur lui toute cette démonstration, fait battre le rappel dans Paris, et réunit cinq cents hommes dans chaque légion de la garde nationale pour marcher sur Rambouillet. En un instant, toute la capitale est en rumeur. Il se forme aux Champs-Élysées un corps d'à peu près dix mille hommes, dont le général Pajol prend le commandement. Il choisit pour aide de camp Georges de Lafayette, fils du général, et cette troupe, qui se grossit en route de cinq à six mille volontaires, arrive dans la nuit aux environs de Rambouillet.
Le départ de la famille royale, déterminé par des rapports sur l'importance de cette expédition populaire, prévient un engagement qui, selon toute apparence, eût été fatal aux agresseurs. La Fayette annonce au peuple de la capitale, dans un ordre du jour, cette victoire sans combat. La chambre élue sous Charles X ouvre, dans les premiers jours d'août, la discussion qui abandonne le principe de la légitimité. Le parti républicain, profondément irrité de l'issue des événements, menace de la troubler par des désordres que les exhortations de La Fayette réussissent à prévenir. Lui-même n'y prend part que pour combattre l'hérédité de la pairie et pour lancer contre l'aristocratie nobiliaire quelques-uns de ces anathèmes qui lui sont familiers. Le 7 août, les deux chambres portent au duc d'Orléans la résolution qui lui défère la couronne. Ce prince, cédant aux acclamations populaires, se montre sur le balcon du Palais-Royal, accompagné de La Fayette, qu'il embrasse avec effusion. Le général paraît profondément ému : Voilà, dit-il au peuple en lui montrant son nouveau roi, voilà le prince qu'il nous fallait ; voilà ce que nous avons pu faire de plus républicain!
Il s'agit de savoir quel nom prendrait le nouveau roi. Quelques-uns de ses conseillers avaient imaginé de l'appeler Louis XIX ou Philippe VII, afin de le rattacher d'une manière continue à la chaîne des souverains de la troisième race. La Fayette combat cette idée si logique comme impliquant une pensée dangereuse de légitimité, et fait prévaloir son avis.
La Monarchie de Juillet Nouveaux honneurs
Au mois d'août 1830, La Fayette fait l'objet de nombreux honneurs, parmi lesquels on peut compter les innombrables publications, ainsi que les créations artistiques et poétiques. De plus, la population parisienne lui témoigne son attachement en lui offrant le 3 août deux petits canons, que La Fayette fait ramener dans son château de Lagrange. De plus, le 15 août le ville de Paris offre un grand banquet de 350 couverts en l'honneur du Général, où sont présents les ministres, des membres de la chambre des pairs, ainsi que des députés, des militaires, les maires de Paris et autres agents royaux. Le chanteur Nourrit y récite Lafayette en Amérique de Béranger, ainsi que La Parisienne : Marche nationale, de Delavigne. La Fayette y prononce un discours politique faisant le lien entre la révolution de 1830 et celle de 1789 :
Lorsque la population parisienne s’est levée spontanément pour repousser l’agression et reconquérir ses droits, nos droits à tous, les imprescriptibles droits du genre humain, elle a daigné se souvenir d’un vieux serviteur de la cause des peuples : en me proclamant son chef, en associant mon nom à ses triomphes, elle a récompensé les vicissitudes d’une vie entière. En 1789 naquit le funeste système de division et d’anarchie dont vous connaissez les déplorables suites. … Mais le sens exquis de la population actuelle nous préservera de ce malheur. … Vous êtes les élèves de la révolution et votre conduite dans les grandes journées de gloire et de liberté vient d’en montrer la différence.
Commandant de la Garde nationale Garde nationale 1831.
La Fayette retrouve le commandement de la Garde nationale pour quelques mois. Durant les premiers mois du règne de Louis-Philippe, le général paraît s'effacer en quelque sorte de la scène politique pour se concentrer uniquement dans la réorganisation de la garde nationale du royaume. Il retrouve pour cette opération favorite le zèle et l'activité de ses jeunes années. Dix-sept cent mille gardes nationaux, pourvus d'artillerie, reçoivent par ses soins une institution régulière, il se montre fidèle à ses principes en rendant à cette milice citoyenne l'élection de ses principaux officiers. Journellement occupé à recevoir et à haranguer des députations départementales, La Fayette n'aspire à aucune influence immédiate sur la direction des affaires d'État, ni sur les modifications ministérielles qui, dans cette première phase du nouveau gouvernement, se succèdent avec rapidité.
Le procès des ministres de Charles X
La garde joue un rôle décisif pour maintenir le calme dans Paris en décembre 1830, à l'occasion du procès des ministres de Charles X. Il appuie la proposition de son ami, Victor Destutt de Tracy, pour l'abolition de la peine de mort, proposition qui emprunte au prochain jugement des ministres de Charles X une généreuse opportunité. Il dénonce avec énergie le mouvement homicide qui, dans le courant d'octobre, a conduit une troupe de perturbateurs autour du donjon de Vincennes, où ils étaient détenus, mouvement auquel le gouverneur Daumesnil a opposé une énergique résistance.
La décision de ce procès est pour l'établissement du 7 août, un moment de crise redoutable. Sous le cri de : Mort aux ministres ! les agitateurs déguisent à peine le dessein de renverser le gouvernement qui s'est rendu le bénéficiaire de la révolution de juillet. Les exhortations répétées de La Fayette n'ont inspiré à la garde nationale qu'une vigueur incertaine. L'effusion d'une goutte de sang peut livrer Paris et la France entière à d'incalculables désordres.
La Fayette s'applique sans relâche à prévenir cette collision redoutée ; il multiplie les précautions et les ordres du jour, et fait circuler de nombreuses patrouilles. Cependant le palais du Luxembourg est plusieurs fois sur le point d'être forcé par la multitude ameutée. Le 21 décembre, jour de la clôture des débats, on donne l'ordre de reconduire les prisonniers à Vincennes, sage disposition destinée à les soustraire à l'exaspération populaire, dans le cas prévu d'absence d'une condamnation capitale. Cet ordre est exécuté par les soins du comte de Montalivet, ministre de l'intérieur, qui escorte les accusés au péril de sa vie. Leur enlèvement produit un mécontentement dont l'explosion menace pendant plusieurs heures le Palais-Royal.
Enfin La Fayette contribue, par la fermeté de ses dispositions et par son influence personnelle, à pacifier ce formidable conflit, et le roi lui écrit à cette occasion une lettre pleine des témoignages de l'admiration que sa conduite lui a inspirée. Affectées ou sincères, ces démonstrations touchent à leur terme.
La loi sur la Garde nationale
Une fois ce cap passé, Louis-Philippe réalise le risque qu'il y a à conserver un tel instrument dans les mains de La Fayette, qu'il juge peu fiable. Le 24 décembre, à son instigation, la Chambre des députés adopte une loi qui supprime le titre de commandant de toutes les gardes nationales de la France, jugé contraire à la Charte de 1830. La chambre, dans la discussion du projet de loi sur la garde nationale, adopte, avec le concours du ministère, un amendement qui interdit à toute personne de commander les gardes nationales d'un département entier. Cette résolution implique nécessairement la déchéance de La Fayette. Quelques députés s'efforcent vainement de la faire modifier : leurs propositions sont repoussées. Le roi, proteste de son ignorance personnelle, de la bonne volonté de ses ministres, et se flatte de faire revenir le général sur sa démission.
La démission
Le roi n'épargne aucune séduction propre à désarmer son interlocuteur : il lui propose le titre de commandant honoraire, que La Fayette a précédemment refusé comme une décoration insignifiante. Un peu piqué de cette insistance : Votre Majesté lui dit le général se contenterait-elle d'être un roi honoraire ? Le président du Conseil, Jacques Laffitte, et le ministre de l'Intérieur, Camille de Montalivet, lui-même colonel de la garde nationale, cherchent à trouver un compromis, mais La Fayette pose des conditions extravagantes : il veut la formation d'un nouveau ministère où n'entreraient que ses amis, la dissolution de la Chambre des députés et l'abolition de l'hérédité de la pairie.
Louis-Philippe demande vingt-quatre heures pour réfléchir ; mais ce délai n'ayant amené aucun changement dans les négociations, La Fayette croit devoir se dépouiller définitivement du pouvoir exorbitant dont il était revêtu. La Fayette donne sa démission dès le lendemain, non sans avoir rendu visite à Louis-Philippe, qu'il menace de se retirer dans son château de La Grange-Bléneau : une explication a lieu entre le monarque et La Fayette, dans laquelle celui-ci, donnant cours aux sentiments qu'il concentrait depuis longtemps, déclare au roi que la dissidence de leurs doctrines politiques et l'ombrage qu'inspirait son autorité ne lui permettent pas d'en prolonger l'exercice.
– Et que ferez-vous sans l'appui de ma popularité ? demande La Fayette.
– Si vous retourniez à La Grange ? Eh bien, je vous y laisserais!
Il rend sa démission publique par un ordre du jour du 27 décembre, et développe le même jour à la tribune de la chambre les motifs de sa détermination, en déclarant que si sa conscience d'ordre public est satisfaite, il n'en est pas de même de sa conscience de liberté. Le 26, il maintient sa démission. Louis-Philippe en prend aussitôt acte dans une brève et sèche lettre de regret. L'essentiel, constatera plus tard La Fayette, était de passer sans encombre la grande crise du procès des ministres. On m'aimait tant pendant ce temps-là ! Mais vous voyez qu'ensuite, on n'a pas perdu un jour.
Tout porte à croire que le sacrifice de La Fayette était depuis longtemps arrêté dans l'esprit du roi. Mais Louis-Philippe commençait à subir les conséquences du mode accidentel de son élévation ; il ne pouvait se séparer impunément des hommes qui y avaient concouru par leurs démarches. L'éloignement de La Fayette, suivi bientôt de celui de Dupont de l'Eure et de Laffitte, lui est reproché comme un acte éclatant d'ingratitude, et cette triple séparation consomme sa rupture avec le parti démocratique, dont les derniers événements ont naturellement accru les forces et les exigences.
L'opposition parlementaire
Rendu à une existence purement parlementaire, La Fayette reprend à l'extrême gauche de la Chambre la place qu'il avait occupée durant la Restauration, et il ne tarde pas à redevenir le principal chef de l'opposition. Peu à peu il subit, ainsi que ses amis politiques, la loi qui veut que tout ce qui procède de la violence n'ait pas de durée. Cet homme, qui a défait un roi et en a fait un autre, se retrouve membre toujours mécontent de l'extrême opposition à la Chambre des députés.
Le système agressif de La Fayette présente pour caractère essentiel son application à la politique extérieure du gouvernement. Le parti démocratique, qui aspirait généralement à l'annulation des onéreux traités de 1814 et de 1815, est divisé sur les moyens d'y parvenir. Une fraction notable, excluant toute agression décidée, se prononce pour un système qui garantisse aux peuples le libre développement de leurs forces, C'est le système de la non-intervention entendue dans son acception la plus absolue. Cette opinion est celle de La Fayette, et, bientôt avec lui celle du ministère installé le 3 novembre sous la présidence de Laffitte.
La politique européenne
Mais les événements postérieurs ont fait voir combien, d'accord sur le principe, ils différaient sur l'application. La révolution belge, qui éclate à la fin d'août, est le premier contrecoup de la révolution française. La Fayette refuse dignement la royauté de ce peuple et l'exhorte à porter son choix sur un de ses citoyens.
Son désir secret est que la Belgique se constitue en république fédérative, de manière à former une Suisse septentrionale dans l'alliance intime et sous la garantie immédiate de la France. L'insurrection polonaise, qui suit de près, excite ses vives sympathies. Par des documents dont le cabinet essaie vainement d'infirmer la valeur, il établit que l'effet de ce mouvement a été de retenir sur les bords de la Vistule les armées russes prêtes à envahir le territoire français. On sait que ses efforts n'aboutirent qu'au vœu stérile du maintien de la nationalité polonaise, formulé depuis 1831 dans toutes les communications des chambres avec le roi.
La Fayette obtient du ministère la reconnaissance des nouveaux États de l'Amérique ; mais sa politique est moins heureuse à l'égard des insurgés espagnols, avec lesquels il entretenait également des rapports depuis la junte insurrectionnelle de 1823. Ferdinand VII s'étant, dans le principe, obstinément refusé à reconnaître la royauté de Louis-Philippe, le cabinet français prête d'abord une oreille complaisante aux instigations propagandistes du patriarche de la démocratie européenne ; des fonds sont distribués aux insurgés ; mais le gouvernement espagnol ayant menacé d'encourager, de son côté, des rassemblements d'émigrés royalistes sur les frontières méridionales françaises, ces rebelles, livrés à eux-mêmes, échouent dans deux tentatives désespérées. Enfin, le peu de succès des insurrections de Modène et de Bologne, auxquelles La Fayette a procuré les encouragements et l'appui du ministère, lui apporte bientôt des déceptions encore plus cuisantes.
Politique intérieure
La défection dont le cabinet se rend coupable en cette occasion est un des textes sur lesquels l'hostilité parlementaire de La Fayette s'exerce avec le plus d'avantage et de fondement. Il ne néglige d'ailleurs aucune occasion de censurer en même temps le système de politique intérieure adopté par le gouvernement. L'imprudente démonstration du 14 février, dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'amène à exposer ouvertement à la tribune l'esprit démocratique dans lequel il suppose que la révolution de juillet s'est accomplie, et la marche qu'elle lui semble devoir suivre. Mais il blâme vivement les profanateurs de ce temple et les démolisseurs de l'archevêché, et fait offrir au prélat fugitif un asile dans son propre hôtel. Il s'indigne aussi de l'acte de condescendance du roi, qui a fait disparaître ses armes des édifices de la capitale. C’est dans ces circonstances que Casimir Perier saisit les rênes du pouvoir, et son premier soin est la dissolution de la chambre.
La Fayette croit devoir adresser à ses électeurs un compte détaillé de ses travaux parlementaires. Il y rend un hommage à la dernière révolution, mais il y décrie avec amertume la direction suivie par le régime qui en est issu, et invoque, pour en affirmer la violation, ce prétendu programme de l'hôtel de ville auquel ses illusions seules ont prêté quelque consistance. Ce manifeste agressif cause à la cour un profond mécontentement et consomme la scission personnelle du général avec le roi. Nous sommes, dit La Fayette, comme deux gentlemen qui se sont donné un démenti mutuel : les circonstances ne nous permettent pas d'aller au bois de Boulogne, mais elles nous empêchent de nous faire des visites. La compression momentanée du parti démagogique et l'attitude plus décidée de l'administration ne découragent point ses efforts. Lors de la seconde insurrection des Romagnols, en 1832, il flétrit avec énergie l'épithète de factieux qui leur a été donnée dans une note diplomatique.
La Fayette combat hautement l’hérédité de la pairie, et fait rayer du Code pénal l'article qui punit l'usurpation des titres nobiliaires. C’est lui qui, après la session de 1832, fait adopter aux députés de l'opposition l'idée d'exprimer, sous la forme d'un compte-rendu, leurs idées sur la politique intérieure et extérieure. Trois jours avant la publication de cette pièce, le chef du ministère, Casimir Perier, est mort sans avoir assisté au rétablissement de l'ordre, auquel il avait immolé son repos et prodigué l'énergie de son caractère.
Les funérailles du général Lamarque, qui ont lieu peu de jours après, deviennent le signal des troubles les plus sérieux qui, depuis les journées de juillet, ont ensanglanté la capitale. La Fayette assiste à ces obsèques, et il vient de prononcer une allocution sur la tombe du général, lorsque l'apparition subite d'un bonnet rouge au milieu de l'innombrable cortège met toute la population en rumeur. Des cris séditieux sont proférés. Quelques hommes suspects s'approchent du général et l'exhortent à se rendre à l'hôtel de ville en lui offrant ce symbole : mais il le repousse avec dédain, monte en voiture et se fait conduire à son hôtel sous l'escorte d'une populace menaçante. L'insurrection prend des proportions formidables. Un grand nombre de députés de l'opposition se réunit le soir chez Laffitte, et l'on délibère sur les moyens propres à arrêter l'effusion du sang. La Fayette combat sans succès l'idée d'une députation au roi et refuse d'en faire partie. Il accompagne ce refus de quelques mémorables paroles de douleur sur les infructueux efforts qu'il a faits, aux deux plus grandes époques de sa vie, pour résoudre le problème d'une monarchie assise sur les bases de la souveraineté nationale.
Informé qu'on l'inculpe d'avoir reçu le bonnet rouge et qu'on parle de l'arrêter, La Fayette demeure quelques jours à Paris, pour regarder en face, dit-il, le gouvernement de l'état de siège ; puis il regagne sa terre de La Grange, un peu étonné que ce retour au plus complet arbitraire n'ait pas excité plus d'émotion dans les esprits. Il se démet aussitôt de ses fonctions de maire et de conseiller municipal, ne voulant pas, dit-il, conserver aucun rapport avec la contre-révolution de 1830.
Lors du premier attentat sur la personne de Louis-Philippe, le 19 novembre 1832, il refuse de se joindre à ceux de ses collègues qui se rendent aux Tuileries, objectant que depuis le démenti donné par le roi au programme de l'hôtel de ville, sa place ne lui paraît plus là. Dans la session de 1833, il parle sur la loi d'organisation départementale, et appuie la demande d'une pension au profit des vainqueurs de la Bastille. La police ayant arrêté dans sa terre même de La Grange, et presque sous ses yeux, le réfugié polonais Joachim Lelewel, auquel il donnait asile, il se plaint vivement de ce procédé inouï, dit-il, sous la Restauration elle-même, et contraint le ministre de l'Intérieur à désavouer cet acte de brutalité.
La mort de La Fayette
La discussion de l'adresse au Trône, en janvier 1834, est le dernier débat parlementaire auquel La Fayette prend part. Une maladie de vessie, dont il avait recueilli le germe aux obsèques de Dulong, s'aggrave rapidement et finit par l'emporter. La Fayette meurt le 20 mai 1834, dans sa 77e année, au 6 rue d'Anjou-Saint-Honoré (ancien 1er arrondissement, actuellement 8 rue d'Anjou dans le 8e arrondissement de Paris.
Son cercueil est accompagné à l'église de l'Assomption par un nombreux cortège, qui se compose de l'élite des deux chambres, des académies, de l'administration civile et militaire, de la garde nationale et des étrangers alors à Paris. Étroitement surveillées par l'armée, malgré les protestations de la gauche, ses obsèques ne donnent lieu à aucune manifestation républicaine, le parti républicain venant d'être décapité à la suite de la seconde révolte des Canuts à Lyon en avril.
Des représentants choisis dans chacun de ces corps et dans la légation des États-Unis portent les coins du drap mortuaire. Après la célébration du service religieux, le convoi, suivi d'une foule immense, se dirige vers le cimetière de Picpus, à Paris le 22 mai, où, suivant son désir, le général est inhumé à côté de sa femme. La terre utilisée pour l'enterrer provient partiellement d'Amérique, ramenée par lui-même dix ans auparavant lors de son dernier voyage et destinée spécialement à cet usage.
Les deux chambres du congrès américain lui décernent les mêmes honneurs funèbres qu'au président George Washington. Jusqu'à la fin de la session, les salles des séances sont tendues de noir, et John Quincy Adams, Edward Everett, J. Upham et le général Tailmadge prononcent son éloge en présence de tous les corps de l'État.
Postérité Jugements de contemporains
Les talents de La Fayette ont été diversement appréciés. Exalté tour à tour comme l'émule de Washington et comme le glorieux promoteur de la régénération française, c'était selon Napoléon un niais ... sans talents civils ni militaires, un esprit borné, un caractère dissimulé.
Mirabeau, son principal adversaire au sein du parti patriote , l'avait surnommé Gilles César, en référence au dictateur romain. Antoine de Rivarol reprit le mot sous la forme César Gille.
Chateaubriand voyait en lui une espèce de monomane, à qui l'aveuglement tenait lieu de génie car il n'avait qu'une seule idée, et heureusement pour lui elle était celle du siècle ; la fixité de cette idée a fait son empire. Il en retient que ses actions furent souvent en contradiction avec ses pensées : Royaliste, il renversa en 1789 une royauté de huit siècles ; républicain, il créa en 1830 la royauté des barricades : il s'en est allé donnant à Philippe la couronne qu'il avait enlevée à Louis XVI … Dans le Nouveau Monde, M. de La Fayette a contribué à la formation d'une société nouvelle ; dans le monde ancien, à la destruction d'une vieille société : la liberté l'invoque à Washington, l'anarchie à Paris.
Madame de Staël disait : Qui l'avait observé pouvait savoir d'avance avec certitude ce qu'il ferait dans toute occasion.
Dans ses Souvenirs, la duchesse légitimiste de Maillé commente ainsi la mort de La Fayette : M. de La Fayette vient de mourir. Le héros des deux mondes est allé dans le troisième. Sa mort n'a fait aucun effet politique. Il était devenu incommode et inutile à son parti, il était odieux aux autres, son rôle était fini.
Odilon Barrot porte un jugement davantage élogieux dans ses Mémoires : C’est le 20 mai 1834 que s’éteignit ce grand citoyen. J’ai peut-être été trop son ami pour en parler avec une entière impartialité. … Je n’ai rencontré dans aucun homme plus de grandeur d’âme, unie à plus de bonté et de simplicité.… Si même on peut adresser un reproche à cette noble nature, c’est l’exagération de ses qualités. Soupçonnant difficilement dans autrui le mal, qui n’était pas en lui, le général Lafayette accordait trop facilement sa confiance et on en a souvent abusé. Emporté par le besoin de se dévouer, il était trop disposé à préférer les tentatives, où il exposait sa vie aux efforts patients et persévérants de la lutte légale
Hommages Aux États-Unis
Aux États-Unis, plus de 600 lieux s'appellent La Fayette. Une montagne, sept comtés et quarante localités portent notamment son nom.
Auguste Bartholdi sculpte une statue de La Fayette à la fin du XIXe siècle pour la ville de New York. Inaugurée en 1876, elle se trouve aujourd'hui dans Union Square Park.
Le rôle du marquis de La Fayette dans l'histoire de l'indépendance américaine est consacré de longue date dans la ville de Washington, par un square à son nom devant la Maison-Blanche avec sa statue à l'une des quatre extrémités. Lafayette Square est également le nom d'un parc de la ville de Los Angeles et de Saint-Louis.
Tous les ans, le 4 juillet, jour de la Saint-Florent et anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, en signe de reconnaissance, l'ambassade des États-Unis en France dépose une gerbe de fleurs sur sa tombe, au cimetière de Picpus, à Paris.
Le 8 août 2002, il est élevé à titre posthume au rang de citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique, privilège rare qui n'a été accordé auparavant qu'à cinq reprises.
Au mois de juin 2007, la frégate furtive La Fayette F710 de la Marine Nationale s'est rendue aux États-Unis dans le cadre de la commémoration du 250e anniversaire de la naissance du marquis. Le 5 juin le La Fayette faisait escale à La Nouvelle-Orléans. Accompagnée du consul général de France à La Nouvelle-Orléans, une délégation d'une quarantaine de membres de l'équipage, conduite par son commandant, s'est rendue dans la ville de Lafayette. Ils y ont été reçus par le maire de la ville entouré d'officiels au centre culturel Jean-Lafitte où sont exposés documents et objets sur le marquis et son époque, ainsi qu'une maquette de son navire L'Hermione à bord duquel il est arrivé aux États-Unis avec ses volontaires le 10 mars 1780.
En France
Lors de leur débarquement en France en 1917, le général Pershing, général en chef des armées américaines, se serait exclamé : La Fayette nous voilà !. Cette formule fut prononcée, en réalité, par l'aide de camp du général américain, le colonel Charles Stanton78, lors d'une cérémonie organisée le 4 juillet 1917, devant la tombe du Français, au cimetière de Picpus, avant d'y déposer une couronne. La première unité composée de volontaires américains avait été l'escadrille aérienne La Fayette, avant même l'entrée en guerre officielle des États-Unis.
À Paris, une rue porte le nom de La Fayette. La ville de Lyon lui a consacré un pont et une longue rue, le cours Lafayette.
Au Puy-en-Velay, dans son département natal, la Haute-Loire, la Statue Lafayette, dans le square éponyme, du sculpteur Ernest-Eugène Hiolle, est érigée en son honneur en 1883, sur le boulevard Saint-Louis. Elle est inscrite Monument Historique en 2005 : C'est le seul monument commémoratif notable de la reconnaissance de la Haute-Loire à son enfant le plus connu. En décembre 2013, elle est commémorée pour les 70 ans de son enlèvement de son socle par les résistants : en décembre 1943, par crainte que le régime allemand ne récupère son métal en la faisant fondre, elle sera cachée durant deux années dans une bergerie, et retrouvera son socle en décembre 1945. Pour cette commémoration de 2013 : Le square La Fayette arbore depuis cette année un éclairage tricolore qui illumine la statue à la nuit tombée, pour garder en mémoire cet acte héroïque qui nous a permis de préserver un monument local et national.
À Clermont-Ferrand, un lycée technologique porte de nom de lycée La Fayette.
À Dangé-Saint-Romain, une ancienne cité américaine porte depuis la fin des années 1950 le nom de Résidence La Fayette.
À Metz, d'où il décida de partir pour les Amériques, une statue équestre en bronze, réalisée en 2004 par Claude Goutin, est installée dans le jardin de Boufflers derrière le palais de justice de Metz.
À Pauillac-Médoc, une esplanade porte son nom, en bordure des quais d'où il est parti en 1777. Une stèle commémorant son départ y est installée.
Le 7 novembre 2007, le président français Nicolas Sarkozy évoque plusieurs fois La Fayette dans son discours au Congrès américain. Comme le ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner, interpellé l'été précédent par Gonzague Saint Bris dans le cadre de la célébration du 250e anniversaire du marquis à Chavaniac, a lâché Le Panthéon, ce n’est pas une mauvaise idée et ajouté qu’il porterait cette idée au sommet de l’État, cette insistance déclenche une polémique sur l'éventuel transfert au Panthéon des cendres de La Fayette. Nicolas Sarkozy y est favorable. Jean-Noël Jeanneney s'y oppose, car il n'imagine pas voir reposer aux côtés de soldats tombés pour la Révolution un général en chef qui n'a jamais été républicain et qui a abandonné son armée en pleine guerre pour passer chez l'ennemi. Mais comme Jeanneney s'appuie sur le témoignage de Napoléon, P. Bercis répond que celui-ci a, par exemple, rétabli l'esclavage alors que La Fayette est resté un militant constant de son abolition et de la démocratie. G. Saint Bris réplique à son tour que les hommes d’exception ont toujours servi l’intérêt de la France plus que celui d’un régime, que ce soit au temps de la monarchie ou de la république. Un lecteur du Monde a entretemps fait remarquer que la question La Fayette au Panthéon ? est tranchée : il y est déjà, parmi les personnages représentés sur son fronton par David d'Angers.
Le nom de La Fayette est perpétué sur la mer par des bâtiments de la Marine nationale :
Le 21 juin 1951, le porte-avion léger américain USS Langley CVL-27 construit en 1942 en pleine guerre du Pacifique, passe sous pavillon français à titre de prêt sous le nom de PA La Fayette. Il y servira jusqu'en 1963. Ce bâtiment est le navire-jumeau de l'USS Belleau Wood CVL-24 ainsi nommé en mémoire de l'exploit des Marines américains de la 2e division d'infanterie US à la bataille du bois Belleau pendant la Première Guerre mondiale : La Fayette nous voilà…. Le Belleau Wood devient le PA Bois Belleau sous pavillon français de 1953 à 1960 dans les mêmes conditions que le PA La Fayette.
En mai 1957, le Bois Belleau se trouve à Hampton Roads avec le croiseur De Grasse portant la marque de l'amiral Jozan entouré de deux escorteurs d'escadre et de deux escorteurs rapides, au milieu des représentants des flottes de trente Nations, à la revue navale célébrant le bicentenaire de la Marine des États-Unis.
Le 13 juin 1992, la frégate furtive FLF La Fayette F710 est lancée à Lorient. Basée à Toulon, elle est la tête d'une série de cinq, conçues principalement pour faire respecter les intérêts maritimes de l'État dans les espaces d'outre-mer, mais pouvant aussi assurer d'autres missions telles que l'intégration à une force d'intervention, la protection du trafic maritime, l'accompagnement d'un groupe aéronaval, la réalisation de missions spéciales ou humanitaires.
La Fayette dans l'audiovisuel
1961 : La Fayette de Jean Dréville, avec Michel Le Royer dans le rôle-titre. Ce film raconte l'épisode américain de sa vie.
1989 : La Révolution française de Robert Enrico, avec Sam Neill voix française de Pierre Arditi
2012 : La Fayette est un des personnages centraux du jeu vidéo Assassin's Creed III Ubisoft se déroulant en Amérique pendant la Révolution américaine.
2012 : diffusion le 6 novembre sur France 2 de Secrets d’Histoire - La Fayette, il était une fois l’Amérique.
2013 : diffusion le 27 mars sur Arte de La Fayette, un héros méconnu, traduction d'un documentaire américain de 2009.
2015 : La Fayette est l'un des personnages principaux du jeu The Order: 1886 Ready at Dawn.
Armoiries
Figure Blasonnement
Armes des Motier de La Fayette :
De gueules à la bande d’or et à la bordure de vair.90
Voir aussi articles connexes
Le marquis de La Fayette
Révolution américaine
Hermione 1779
Visite du marquis de La Fayette aux États-Unis
         
Posté le : 04/09/2015 17:15
|
|
|
|
|
Rodolphe III de Bourgogne |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 6 septembre 1032 meurt Rodolphe III de Bourgogne
dit Le Pieux ou Le Fainéant, né vers 970; il est le dernier roi de Bourgogne.
En bref
Un premier royaume de Provence-Viennois fut formé en 879 sous l'autorité de Boson, beau-frère de Charles le Chauve. Sa couronne réunissait la Provence, le Bugey, la Bresse, une partie de la Bourgogne cisjurane, une partie du Languedoc et le Dauphiné. Boson dut lutter continuellement contre l'hégémonie des Carolingiens, mais put léguer son patrimoine à son fils. Cependant, à la mort de Charles le Gros naquirent les royaumes de Bourgogne et de Provence. Le Welf Rodolphe, duc de Transjurane, prenait en 888 la couronne à Agaune et à Toul ; mais l'occupation de la Lorraine par Arnoul de Carinthie le cantonna dans la Bourgogne jurane, partie méridionale du royaume de Lothaire II (Sion, Lausanne, Besançon, Genève, peut-être Aoste). Louis l'Aveugle, fils de Boson, releva en 890 le titre royal que son père avait pris à Mantaille en 879 et s'assura du Lyonnais, du Viennois et de la Provence, qui avaient formé de 855 à 863 le royaume de Charles de Provence. Il échoua dans sa tentative d'occuper aussi le trône d'Italie (905). Aveuglé, il régna sous la tutelle de son cousin Hugues et mourut en 928, ne laissant à son bâtard Charles-Constantin que le comté de Vienne. Hugues, proclamé roi d'Italie en 926, céda ses droits sur la Provence, le Viennois et le Lyonnais à Rodolphe II en 932 ; il mourut à Arles après avoir été chassé d'Italie.
Sa vie
Rodolphe III est le fils du roi de Bourgogne Conrad III dit le Pacifique 925-993 et de Mathilde de France 943-980, fille du roi de France Louis IV dit d'Outremer.
En 993, Rodolphe III succède à son père. Il est présenté par les historiens comme un homme faible, manquant de courage. Son demi-frère Burchard II, archevêque de Lyon depuis 979, sillonne le royaume pour garantir les pouvoirs royaux. Sous son règne, la tutelle de la royauté germanique se fait encore plus pesante et finit par étouffer son autorité.
Les souverains ottoniens commencent en effet à intervenir directement dans le royaume bourguignon. En 999, Rodolphe doit mater une révolte des grands seigneurs du royaume. L’impératrice Adélaïde vient ainsi dans le royaume de Bourgogne, où elle arbitre souverainement les différends qui opposent Rodolphe III à son aristocratie.
Après l’an mil, le roi perd l’habitude de réunir en conciles les évêques bourguignons. Désormais, les prélats rhodaniens prennent le chemin de la Germanie, comme le font les archevêques de Lyon et les évêques de Tarentaise, de Genève et de Lausanne en 1007, lorsqu’ils vont assister au concile de Francfort. Profitant de l’affaiblissement de la royauté, les évêques peuvent ainsi gérer leurs diocèses en toute indépendance.
Acte de donation du roi de Bourgogne Rodolphe III à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune 15 février 1018
Par la suite, pour se concilier l'appui du clergé contre les nobles, il fait plusieurs donations importantes aux évêques de Bâle, de Sion et de Lausanne. À ce dernier, il cède en 1011 le comté de Vaud, c'est-à-dire la charge de comte et les droits régaliens, droits publics exercés à l'origine par le roi sur les routes, les péages, les forêts, la monnaie, les marchés, les mesures, les eaux, les criminels, dans le territoire du comté. Le 15 février 1018, à la demande de ses familiers, Rodolphe III, donne ou plutôt rend à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune les fiscs de Sciex ?, de Lully, de Commugny, la moitié de Pully, Oron, la pauté de Vuadens, Bouloz, le plaid de Vevey, Lutry, Vouvry, Ollon, Villy, Naters, quelques droits à Saint-Maurice et l'ensemble des alpages du Chablais.
En 1011, Rodolphe III épouse Hermengarde, une parente si proche du futur comte de Savoie Humbert Ier aux Blanches Mains 980-1048, qu’il est vraisemblable qu’elle en est la sœur, selon une hypothèse souvent défendue par les historiens italiens. Rodolphe III donne à son épouse un douaire considérable, qui s’étend en particulier autour d’Aix-les-Bains et de la combe de Savoie. Bien vite, ces terres royales passent aux mains du comte Humbert aux Blanches Mains. Le roi aime résider et prendre les eaux à Aix-les-Bains et il s'y fait construire un vaste palais. À l'époque un temple romain dédié à Mercure est encore debout à côté du palais.
La région qu'il donne à Hermengarde remonte jusqu'au pied du Jura avec la ville de Neuchâtel.
À Strasbourg, en 1016, Rodolphe prête un hommage de main à son neveu l’empereur germanique Henri II, le reconnaîssant comme protecteur et héritier. Le roi de Bourgogne promet à l’empereur de gouverner selon ses conseils et de lui laisser sa succession s’il devait mourir sans laisser un fils légitime. Mais cette soumission n'est pas acceptée par les grands du royaume, et sous l’impulsion du comte Otte-Guillaume, toutes les villes du comté de Bourgogne ferment leurs portes à l’empereur.
En 1018, Rodolphe renouvelle et complète les engagements qu’il avait pris à Strasbourg, et se comporte dès lors en véritable vassal de l’empereur en lui remettant en libre disposition les fiefs tenus par le comte de Besançon, Otte-Guillaume, et en se faisant investir par lui de sa couronne et de son sceptre. La royauté bourguignonne est désormais totalement soumise au pouvoir impérial.
Hugues, fils illégitime de Rodolphe est promu à l’évêque de Lausanne en 1019.
Rodolphe III concède le comté de Vienne à l’archevêque de Vienne en 1023.
À la mort d'Henri II, en 1024, Rodolphe III est contraint par les nobles de Bourgogne, de révoquer sa donation faite huit ans auparavant.
Toutefois, en 1025, il se voit contraint de renouveler son engagement initial, vis-à-vis du nouveau roi de Germanie Conrad II le Salique, le mari de sa nièce Gisèle, fille de sa sœur Gerberge, et qui occupe Bâle pour faire pression sur lui.
En 1027, Conrad II est couronné empereur germanique, Rodolphe assiste à la cérémonie et confirme la succession.
En juin 1032, Burchard, archevêque de Lyon désavoue la succession sur le royaume et fait partie des révoltés. En septembre, à la mort de Rodolphe III, la lutte s’engage entre l’empereur Conrad II et l’autre neveu du roi défunt, le comte de Blois et de Troyes Eudes II, l’héritier le plus direct de Rodolphe.
La donation faite à son épouse
Le 24 avril 1011, Rodolphe III fait une donation en faveur de son épouse Ermengarde dont les Archives départementales de l'Isère ont conservé le diplôme original sur parchemin. Voici le texte de ce document :
" Au nom de la très Sainte et Indivise Trinité, Rodolfe, Roi par la Clémence de Dieu ; qu'il soit connu de tous les hommes, nés ou à naître, que, poussé par amour conjugal et conseillé par les grands de mon royaume, je donne à ma très chère épouse Irmengarde, la résidence royale d'Aix avec les colons de ce domaine en notre propriété, pour qu'ils l'habitent et en cultivent les terres. Et je lui donne mon fisc d'Annecy, avec ses dépendances, ses esclaves et ses servantes ; et je lui donne la totalité de l' abbaye de St Pierre de Montjoux et je lui donne mon fisc de Rue avec ses dépendances, ses esclaves et ses servantes, et je lui donne le château de Font avec ses dépendances, et la part de la villa d' Yvonand qu'Henri possédait, avec ses esclaves, ses servantes et toutes ses dépendances ; je lui donne la résidence royale de Neuchâtel, avec ses esclaves, servantes et toutes ses dépendances ; je lui donne Auvernier (11) avec toutes ses dépendances, esclaves et servantes ; je lui donne Arinis Saint-Blaise, avec toutes ses dépendances, esclaves et servantes. Qu'elle ait le droit de posséder, de donner, de vendre, en somme de faire tout ce qu'elle voudra de ces biens. Pour que nos successeurs tiennent pour vrai et ne cassent pas ce que j'ai fait, nous avons authentifié de notre main et ordonné qu'il soit scellé de notre sceau. Signé du seigneur Rodolfe.
Padolfe chancelier, j'ai reconnu.
Daté du 8e jour des calendes de mai, 17e lune, indiction…., l'an de l'Incarnation du Seigneur 1011, sous la 19e année du règne de Rodolfe, fait à Aix "
Au dos du texte : " Moi Hermengarde, reine, je donne à Dieu et à St Maurice de l'Église de Vienne, tout ce qui m'a été donné" .
Succession de Bourgogne 1032-1034.
Mort sans postérité, le 6 septembre 1032, Rodolphe III avait institué comme son héritier, l'empereur germanique Conrad le Salique, mais son neveu Eudes II de Blois, fils de sa sœur aînée, suscite contre l'empereur, la révolte des féodaux et des prélats du royaume de Bourgogne, dont le comte Gérold de Genève, l'archevêque de Vienne, l'évêque de Maurienne et Burchard, archevêque de Lyon. Eudes II envahit le royaume. La guerre entre les deux cousins dura deux ans et Eudes doit abandonner la partie devant une coalition formée par le nouvel empereur Conrad II et le roi de France Henri Ier.
[img width=600]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Donation_du_roi_de_Bourgogne_Rodolphe_III_%C3%A0_l'abbaye_Saint-Maurice_(15_f%C3%A9vrier_1018).jpg/400px-Donation_du_roi_de_Bourgogne_Rodolphe_III_%C3%A0_l'abbaye_Saint-Maurice_(15_f%C3%A9vrier_1018).jpg[/img]          
Posté le : 04/09/2015 16:56
|
|
|
|
|
le téléphone rouge |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 30 août 1963 est établi le téléphone rouge
ligne de communication directe établie entre les États-Unis et l’Union soviétique après que la crise des missiles a mené le monde au bord de la guerre mondiale en 1962.
Cette dénomination est un raccourci lexical repris et popularisé par les médias, la ligne étant au départ une ligne de téléscripteur, sa supposée couleur rouge symbolisant simplement le fait qu’il s’agissait d’une ligne d’urgence. Ce téléphone rouge reliant la Maison-Blanche au Kremlin a permis, par la suite, de désamorcer des situations conflictuelles mettant aux prises les deux blocs qu'étaient l'ex-URSS Devenue en 1992 la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique.
Le 5 novembre 2007, la Chine et les États-Unis ont décidé l’installation annoncée d’un téléphone rouge, à l’occasion de la visite en Chine du secrétaire à la Défense Robert Gates.
En bref
Le téléphone rouge est entré en service le 30 août 1963 entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Ce mode de communication directe entre les États-Unis et l'U.R.S.S. doit permettre d'éviter les risques d'une guerre nucléaire déclenchée accidentellement. En effet, un an après la crise de Cuba, qui avait failli provoquer une guerre de ce type dû aux missiles soviétiques installés à Cuba, la peur d'un accident de ce genre est encore présente.
L'acceptation du téléphone rouge par l'U.R.S.S. le 5 avril 1963, a fait preuve de satisfaction par le département d'État, qui a tout de même dit qu'il aimerait établir un télétype, les messages écrits réduisant les confusions de traduction
La ligne directe entre les Etats-Unis et la Russie a été mise en place le 30 août 1963 après la crise des missiles de Cuba. Mais la téléphone rouge n'était ni rouge, ni même un téléphone.
Les relations entre Washington et Moscou ne sont pas au beau fixe: les deux puissances s'affrontent sur la position à adopter face à la crise en Syrie. Hasard du calendrier, il y a 50 ans jour pour jour, le téléphone rouge était mis en service.
Le téléphone rouge, kézako? Une ligne de communication directe entre le Pentagone et le Kremlin, mise en service après l'épisode de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, paroxysme de la Guerre froide: les Etats-Unis et la Russie se sont opposés après que Moscou a pointé des missiles vers l'Oncle Sam depuis l'île de Cuba. Le téléphone rouge représente donc, symboliquement, l'espoir qu'une telle crise diplomatique ne se reproduise plus.
Le 30 août 1963, Khrouchtchev et Kennedy se sont-ils parlé de vive voix avec des combinés rouges? Non. Bien loin des communications d'aujourd'hui, le téléphone rouge était en fait une ligne télégraphique, plus proche du fax que du téléphone. Le comble, c'est qu'il n'était même pas rouge, comme nous le laisse croire le Docteur Folamour de Stanley Kubrick: cette couleur lui a été donnée car il devait répondre à des situations d'urgence. D'ailleurs, aux Etats-Unis, on l'appelle plutôt "hot line", ligne chaude.
Alors, que se sont dit Washington et Moscou? Pour commencer ces toutes nouvelles relations, le premier message envoyé par les Américains a été: "Le rapide renard brun a sauté par dessus le chien parresseux". En anglais, cette phrase permet d'utiliser tous les caractères de l'alphabet latin. A l'image du téléphone rouge, utile et propice à l'imaginaire.
Sécurité des communications
On pense que la ligne était chiffrée grâce au principe du masque jetable, avec des clés transportées par valise diplomatique. La clé était changée à chaque communication et détruite lorsque celle-ci était terminée. Ces informations n’ont jamais été confirmées mais l’utilisation du masque jetable est très probable pour plusieurs raisons.
C’est le seul chiffrement qui est théoriquement inviolable, si plusieurs conditions sont respectées et les valises diplomatiques étaient une solution pratique pour un échange sécurisé des clés aléatoires. De plus, le principe de masque jetable était souvent utilisé par l’URSS et ses agents. Le masque jetable, système très simple et connu depuis 1917, évitait d’avoir à divulguer le fonctionnement d’un algorithme secret de chiffrement à une tierce partie. Les États ont toujours jalousement gardé secrets les rouages de leurs algorithmes même si cette pratique est potentiellement risquée, principe de Kerckhoffs.
Réalisation de la liaison Première génération
La première génération ne transmettait pas la voix, car on estimait que les communications verbales spontanées pouvaient mener à de mauvaises interprétations. Il s'agissait d'une ligne télégraphique duplex. La ligne suivait le trajet Washington - Londres - Copenhague - Stockholm - Helsinki - Moscou. Au départ, la liaison Washington - Londres transitait par le câble TAT‑1, le premier câble téléphonique transatlantique. Il existait une liaison radio secondaire, Washington - Tanger - Moscou.
Les chefs d'État formulaient leurs messages dans leur propre langue ; les messages étaient traduits par le destinataire.
Seconde génération
En 1971, les deux camps décidèrent d'améliorer le système, car de nouvelles technologies étaient désormais disponibles. Un téléphone fut installé, et la première ligne télégraphique fut complétée par deux liaisons radio par satellite, l'une composée de deux satellites américains Intelsat, et l'autre de deux satellites soviétiques Molniya II. La mise à niveau du système dura de 1971 à 1978, et à l'occasion la liaison radio Washington - Tanger - Moscou fut éliminée.
Troisième génération.
La dernière modernisation eut lieu en 1986. L’Union soviétique utilisa des satellites géostationnaires du type Gorizont de la flotte Statsionar pour remplacer les satellites Molniya II. Des fonctionnalités de fax à haute vitesse furent ajoutées. Ceci permet aux chefs d'États des deux pays d'échanger rapidement des documents et d'autres informations en plus des messages textuels et des communications téléphoniques.
Liaison New Delhi - Islamabad
L'Inde et le Pakistan ont repris en 2004 le principe du téléphone rouge et cela en vue d'éviter un conflit. Ces deux pays, dotés chacun de la puissance nucléaire, sont en état de tension sur le Cachemire depuis les années 19401.
Dans la culture populaire
Un téléphone rouge sans cadran exposé dans le Jimmy Carter Library and Museum. Ce téléphone est en fait un accessoire, représentant à tort la ligne directe entre Washington et Moscou.
L'histoire
50 ans après, l'histoire du téléphone rouge qui n'était ni téléphone, ni rouge
Le 30 août 1963, Washington envoie son premier message crypté à Moscou, via le téléphone rouge. Cinquante ans plus tard, retour sur l'histoire de ce téléphone célèbre... qui n'en était pas un.
29 AOÛT 2013
Par Bénédicte Weiss
S'il s'agissait d'un conte, l'histoire du téléphone rouge pourrait commencer ainsi : "il était une fois deux superpuissances, américaine et soviétique, qui ne s'entendaient pas. Arrivées au bord d'un conflit nucléaire, elles décidèrent de se parler, pour éviter la fin du monde." En fait, pour le professeur émérite à la Sorbonne André Kaspi, "le téléphone rouge servait de lien entre Washington et Moscou pour prévenir les crises et éviter qu'elles ne deviennent des conflits." Ce à quoi ajoute l'historien Pierre Melandri, professeur émérite à Sciences-Po : "il s'agissait d'assurer des communications à la fois sûres, précises et rapides entre les deux grands, surtout dans le contexte de l'après-crise des missiles de Cuba."
Symbole nucléaire
Voici donc le décor de l'histoire. La Guerre froide entre les Etats-Unis et l'Union soviétique poussée à son paroxysme. En octobre 1962, les Américains détectent la présence de missiles soviétiques sur l'île de Cuba, située 160 Km au sud de la Floride. Les flottes des deux puissances se mettent en place, un bras de fer s'engage. Des deux côtés du monde, les dirigeants craignent un conflit nucléaire. "Ce qui a beaucoup marqué les responsables de cette époque, commente André Kaspi, c'est que la crise de Cuba aurait très bien pu dégénérer en une guerre mondiale, qui aurait été une guerre atomique, et qui aurait abouti en fin de compte à la destruction de la planète. Donc on a frôlé le pire."
Tout doucement, pour prévenir le retour à une telle situation, l'idée de mettre en place un canal de discussion entre les deux grands fait surface. Andreï Kozovoï, maître de conférences à l'université de Lille et auteur de plusieurs ouvrages sur la Guerre froide, relate : "L'initiative est américaine. Il faut souligner qu'une proposition en ce sens est faite dès avril 1962, six mois avant la crise. Mais c'est la crise de Cuba qui pousse les Soviétiques à accepter la proposition américaine, qui fait d'abord partie d'un "package" sur le désarmement (voir encadré ci-contre)." Pour Pierre Melandri, la position du président Kennedy à l'issue de la crise lui donne l'avantage : "Une fois que la crise des missiles de Cuba lui a donné l'impression d'être en position de force, d'avoir remporté la victoire dans la crise, ce qui est toutefois disputé sur le plan des réalités, il est prêt à faire des ouvertures à Moscou."
Andreï Kozovoï rappelle que cette création "téléphonique" ne revêt pas que des aspects diplomatiques. La stratégie militaire est elle aussi touchée : "Du côté américain, il y a alors l'émergence de la doctrine MAD, comprendre "destruction mutuelle assurée", selon laquelle pour prévenir un conflit nucléaire, il faut mener des discussions bilatérales. D'une certaine manière, la création d'une ligne anti-crise répond aussi à une demande de l'opinion publique américaine. Elle a vécu intensément la crise, à la différence du public soviétique, qui n'en connaît que la version officielle, mensongère et partielle, diffusée par la propagande."
Téléphone sans fil
Pourtant, Nikita Khrouchtchev et John Fitzgerald Kennedy ne s'appellent pas tous les soirs, assis au coin du feu une couverture à carreaux sur les genoux. Non, le "téléphone rouge" n'a pas de combiné, ni de cadran à chiffres. "C'était un télétype, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une sorte de télégraphe !" décrit André Kaspi. Pour Andreï Kozovoï, "le cinéma a popularisé l'image d'un téléphone rouge entre la maison blanche et le Kremlin, par exemple dans le film "Docteur Folamour" de Stanley Kubrick." En lieu et place du téléphone imaginaire, on trouve "seulement" l'ancêtre du fax. Pour couronner le tout, le récepteur américain du Molink - abréviation pour Moscow link - est installé au Pentagone. En face, le récepteur soviétique est tenu au secret. Le dirigeant de l'URSS n'a pas la main dessus. "Les messages n'arrivaient sur le bureau des dirigeants qu'une fois reçus, décodés, et traduits", précise le chercheur à Lille.
Pour arriver à Moscou en partant de Washington, les bulletins rédigés par les responsables américains voyagent. Ils suivent le TAT-1 (lien en anglais), un câble transatlantique installé en 1956. Londres, Copenhague, Stockholm et Helsinki sont sur leur route.
Le système a deux avantages : la vitesse et la clarté. "A notre période d'Internet on a du mal à le comprendre, mais pendant la crise, il faut souvent une douzaine d'heures pour qu'un message arrive de Moscou à la Maison Blanche, note Pierre Melandri. Il n'y a pas de ligne de téléphone directe entre l'ambassade de l'Union soviétique à Washington et Moscou. Les échanges se font entre l'ambassade et Moscou par des télégrammes codés envoyés par la Western Union. Alors on envoie des petits coursiers à bicyclette déposer les messages, ensuite transmis à Moscou. Bref, alors que les choses peuvent prendre un tour terriblement urgent, les communications sont d'une lenteur tout à fait inquiétante."
Alors que techniquement, une ligne téléphonique pourrait être mise en place et serait encore plus rapide et directe qu'un télégramme, cette hypothèse n'est pas retenue. "Par peur de malentendus", rapporte Andreï Kozovoï. Ecrits en toutes lettres et à la rédaction posée, ils permettent d'éviter les compréhensions hasardeuses et les quiproquos.
Par la suite, le système sera amélioré à deux reprises, explique le chercheur : "en 1971, des liaisons satellite et radio sont ajoutées, et en 1986, il est complété par un fax permettant la transmission de documents iconographiques et de schémas."
A toutes fins utiles
En somme, ce téléphone qui n'en est pas un, permet aux dirigeants soviétique et américain de se tenir au courant de leurs faits et gestes et d'éviter toute nouvelle crise. Selon André Kaspi, "le but de ce téléphone, au fond, c'est d'ouvrir la voie à la coexistence pacifique entre deux superpuissances, et d'établir d'une manière plus sure ce que l'on appelé l'équilibre de la terreur." Le chercheur poursuit : "Ce qui est important, c'est que dans la crise de Cuba de 1962, ça n'est pas par puissances interposées, ou par Etats interposés, que l'Union soviétique et les Etats-Unis s'opposent. C'est directement : la flotte soviétique est à quelques centaines de kilomètres des côtes de Cuba. En face d'elle, il y a la marine américaine. Donc le moindre faux pas de l'une ou de l'autre peut dégénérer. Tandis que dans les guerres successives il y a un troisième, un quatrième ou un cinquième partenaire. C'est tout à fait différent. C'est pour cela que ce téléphone rouge a moins d'importance à mesure que les années passent, sans compter bien sûr les transformations technologiques."
Mais quatre ans après sa mise en place, le téléphone est décroché. Nous sommes en pleine Guerre des six jours, entre Israël et pays arabes. Le premier est soutenu par les Etats-Unis, les seconds par l'URSS. Pour Andreï Kozovoï, la communication entre les deux grands "a peut-être permis d'éviter que les deux superpuissances n'utilisent leurs forces pour soutenir leurs alliés. Mais d'un autre côté, la ligne n'a pas empêché une guerre bien chaude d'avoir lieu, au Vietnam, et une grave crise de se produire en septembre 1983, lorsque les soviétiques abattent par erreur un avion de ligne coréen avec 269 passagers a bord. L'OTAN procède à un exercice de manœuvre perçu par le secrétaire général de l'époque, Iouri Andropov, comme le prélude d'une attaque américaine."
Le téléphone est encore utilisé lors du conflit indo-pakistanais de 1971, de la guerre du Kippour de 1973, ou de la crise polonaise sous la présidence de Ronald Reagan. Mais "la ligne n'a plus été utilisée en "mode crise" depuis 1982", souligne Andreï Kozovoï.
Symboles
Aux Etats-Unis et en Union soviétique, on parle généralement de hotline, ou "ligne chaude", à propos du téléphone rouge. Si elle permet de parer aux situations urgentes, elle ne fait pas reculer les a priori de part et d'autre de l'Atlantique. "Aucun téléphone ne peut abattre les stéréotypes négatifs, commente Andreï Kozovoï. Les objectifs idéologiques des uns et des autres dans la Guerre froide font qu'il existe trop d'arrière-pensées pour que le contact soit sincère : les Américains et les Soviétiques cherchent d'abord et avant tout à diffuser leur modèle. Peut-être que l'image du téléphone rouge, fortement symbolique, a joué un rôle positif en entretenant l'idée d'un dialogue au sommet. Mais elle a aussi maintenu l'idée d'un condominium americano-soviétique par une entente sur le dos des populations et aux dépens d'autres nations. Elle a perpétué l'image d'une division du monde en deux camps. En réalité, les deux puissances avaient des canaux bien plus confidentiels à leur disposition que celui du téléphone rouge. A en croire des témoins de l'époque, il était très loin d'être un modèle de rapidité et d'efficacité côté soviétique, reflétant les obsessions bureaucratiques du régime."
Reste que pour André Kaspi, "cette mesure prise en 1963 est symbolique, elle manifeste en somme le désir des uns et des autres de ne pas se retrouver dans la situation extrêmement dangereuse d'octobre 1962."
Le renard et le chien
Le premier message du "téléphone rouge" a été envoyé le 30 août 1963. Sa signification, étrange, avait en fait un sens purement technique. Il s'agissait d'utiliser toute la chaîne de caractères latins, de l'émetteur américain.
Deux hérissons faisant l'amour
"Au moment de la crise de Cuba, relate André Kaspi, professeur émérite à la Sorbonne. Il y avait, dans le bureau de ceux qui conseillaient le président Kennedy, une affiche. Elle représentait deux hérissons… en train de faire l'amour. La légende était : "comment les hérissons font-ils l'amour ?" Et la réponse : "avec prudence". Ce qui voulait dire que, si l'on compare les deux superpuissances aux hérissons, elles peuvent s'aimer ou en tout cas s'accepter l'une l'autre, à condition bien sûr que tout soit réuni pour éviter que cela dégénère en conflit."
Qu'est-ce que la crise de Cuba ?
Andreï Kozovoï, maître de conférence à l'université de Lille, explique : "du 14 au 28 octobre 1962, le monde s'est retrouvé au bord d'une guerre thermonucléaire, au cours de la crise de Cuba. Le premier secrétaire soviétique, Nikita Khrouchtchev, avait décidé d'installer dans le plus grand secret des missiles sur l'île pour être capable de menacer les Etats-Unis d'une frappe nucléaire et globalement, pour soutenir les mouvements révolutionnaires d'obédience communiste dans la périphérie des Etats-Unis. Il faut dire qu'à l'époque, on imaginait, des deux côtés, et surtout côté soviétique, qu'une guerre nucléaire pouvait être gagnée. Le président Kennedy avait été mis au courant de l'opération et avait décidé d'organiser un blocus de l'île. À plusieurs reprises, les deux dirigeants avaient échangé des messages. Pour les Américains, le temps de recevoir et traduire correctement les messages soviétiques était jugé démesurément long, par rapport à la gravité de la crise. La terreur engendrée par la crise de Cuba a fait prendre conscience les dirigeants du fait qu'un tel conflit serait fatal aux deux pays, et qu'il n'y aurait pas de vainqueur. Cela pousse les USA et l'URSS, en octobre 1963, à signer le traité sur l'interdiction partielle des essais nucléaires, dont le mémorandum sur la mise en place d'une ligne "directe" entre Moscou et Washington, pour les situations d'urgence, signé en juin, apparaît a l'origine comme un corollaire."
Le 27 octobre, jour le plus long
"Ce jour-là, on a vraiment frôlé la guerre nucléaire, raconte Pierre Melandri, historien et professeur émérite à Sciences-Po. Un avion américain a été abattu par un missile anti-aérien soviétique tiré de Cuba, et un sous-marin soviétique a failli tirer une torpille atomique contre un navire américain qui l'a forcé à faire surface dans la mer des Caraïbes. Le soir, lorsqu'il est rentré chez lui, le secrétaire à la Défense des Etats-Unis, Robert McNamara, a dit qu'il n'était pas sûr d'être en vie encore le lendemain ! Le 28 au matin, lors s'une réunion du présidium suprême en URSS, Nikita Khrouchtchev a dit que l'on était au bord de la guerre atomique, qu'il était confronté à la perspective éventuelle d'une destruction de l'humanité. Et il a ajouté : pour sauver le monde nous devons reculer."
Stocks d'armes nucléaires entre 1945 et 2005
Et aujourd'hui ?
Depuis la fin de la guerre froide, Washington et Moscou continuent de communiquer. "Un système par fibre optique est devenu opérationnel le 1er janvier 2008", annonce Pierre Melandri. "En 2012, on a discuté de la possibilité d'ajouter la cyber criminalité à la liste des sujets de conversation pouvant être abordés sur cette ligne, ajoute Andreï Kozovoï. On ignore cependant le détail des discussions récentes."
D'autres "téléphones rouges" ont par ailleurs été installés. "En 1969, une ligne directe fut installée entre Moscou et Pékin dans le contexte de la grave crise entre les deux pays. Après la Chine, L'Inde et le Pakistan en ont ouverte une en 2004. En 2008, une ligne fut ouverte entre les Etats-Unis et la Chine. Mais encore une fois, la charge symbolique est au moins aussi importante que la fonction réelle de communication", décrit le maître de conférence. Une dénomination qu'André Kaspi relativise : "il y a quand même un dialogue qui existe entre Pékin et Washington, le danger n'est pas le même. Pour le moment, on peut pas dire que Chinois et Américains s'affrontent face à face dans une sorte de duel qui pourrait se terminer par une guerre nucléaire ! La Chine a beau détenir des armements nucléaires, elle n'a pas la même puissance de feu que pouvait avoir l'Union soviétique en 1963."
Film sur le téléphone rouge
Gathering of Eagles
Drame de Delbert Mann, avec Rock Hudson, Mary Peach, Rod Taylor.
Pays : États-Unis
Date de sortie : 1962
Son : couleurs
Durée : 1 h 55
Résumé
Un colonel est nommé à la tête d'une base du Strategic Air Command qui assure la défense nucléaire aérienne des États-Unis. Il multiplie les exercices d'alerte et se rend impopulaire. Mais il finira par gagner l'estime de ses hommes.
    [img width=600]http://cine.ch/photo/film/le-telephone-rouge--128740_1.jpg?w=250&h=335[/img]  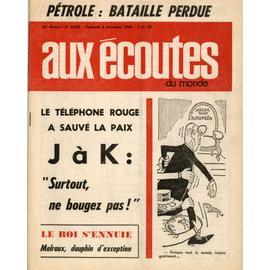  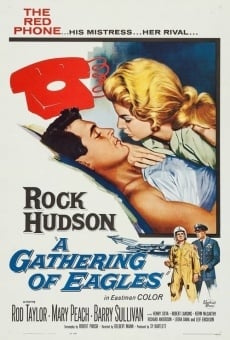
Posté le : 29/08/2015 22:05
|
|
|
|
|
Georges Cuvier |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 23 août 1769 naît Georges Cuvier
de son nom complet Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier à Montbéliard il porte aussi les prénoms de Dagobert et de Chrétien selon les sources, mort le 13 mai 1832 à Paris, à 62 ans, est un anatomiste, zoologiste, français, promoteur de l'anatomie comparée et de la paléontologie au XIXe siècle. Champs Anatomie, paléontologie, il reçoit les distinctions : Membre de la Royal Society, Académie des sciences, son nom est sur la liste des soixante-douze noms de savants inscrits sur la tour Eiffel.
Toute science étant le fruit d'une longue gestation, on ne peut dire que Cuvier soit l'unique fondateur de l'anatomie comparée et de la paléontologie des Vertébrés. C'est pourtant à partir de ses travaux que ces deux domaines de l'histoire naturelle se sont affirmés comme des disciplines véritablement scientifiques.
L'apport de Cuvier présente encore un autre aspect, souvent passé sous silence : dans ses leçons sur l'histoire des sciences, il met, selon sa propre expression, « l'esprit humain en expérience.
En bref
Georges Cuvier, né en 1769 à Montbéliard, est un des grands naturalistes du début du XIXe siècle. Il commence ses travaux au Muséum national d'histoire naturelle de Paris en 1795. Sa carrière scientifique se double d'une carrière administrative qui lui fait occuper de hautes positions sou…
Ainsi le génie novateur de Cuvier a-t-il puissamment contribué au développement des sciences de la vie depuis le début du XIXe siècle.
Georges Cuvier est né en 1769 à Montbéliard, ville alors rattachée au duché de Wurtemberg, d'une famille originaire d'un village du Jura qui était venue s'y établir au moment de la Réforme.
La lecture d'un ouvrage de Buffon, trouvé par hasard dans la bibliothèque d'un de ses parents, éveille en lui le goût de l'histoire naturelle.
Georges Cuvier 1769-1832 a mené l'essentiel de sa carrière scientifique au Muséum d'histoire naturelle. Après avoir établi les fondements de la paléontologie des vertébrés, en appliquant les principes de l'anatomie comparée, il démontre l'existence d'extinctions d'espèces au cours du temps, qu'il explique par de grandes catastrophes à l'échelle du globe.
Crédits: Courtesy of the Musée National d'Histoire Naturelle, Paris Consulter
Après de brillantes études à l'Académie de Stuttgart, il quitta cette ville en 1788 et devint précepteur dans une famille de Normandie. Il passa ainsi les années de la Révolution dans la campagne du pays de Caux, en contact direct avec la nature, à peu près sans livres. On peut penser avec Flourens qu'au cours de cette période commencèrent à germer dans son esprit les deux projets qui allaient marquer toute son œuvre : comparer les espèces fossiles aux espèces vivantes et refondre la classification du règne animal, ce dont il eut l'idée en récoltant des Térébratules et en disséquant des Mollusques et autres animaux marins.
À cette époque, il entre en relation avec Tessier, médecin-chef de l'hôpital militaire de Fécamp, qui, frappé de l'étendue du savoir de Cuvier, en fait part à ses amis du jardin des Plantes. En 1795, Cuvier est nommé suppléant de Mertrud, alors chargé de l'enseignement de l'anatomie comparée ; en 1799, il succède à Daubenton à la chaire d'histoire naturelle du Collège de France ; enfin, en 1802, à la mort de Mertrud, il devient professeur au jardin des Plantes. Les honneurs et les charges n'allaient cesser d'arriver : en 1803, il était promu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences pour les sciences physiques et naturelles ; en 1808, il entrait au conseil de l'Université ; en 1813, il devenait maître des requêtes. La Restauration lui octroya des distinctions nouvelles ; il fut conseiller d'État, chancelier de l'Instruction publique et, en 1831, pair de France. Fait sans doute unique, il appartenait à trois académies de l'Institut de France : l'Académie française, celle des sciences et celle des inscriptions, et il était membre de toutes les académies savantes du monde.
En dépit de ces tâches multiples, Cuvier put mener à bien une œuvre scientifique qui est un des monuments de l'histoire naturelle.
Jusqu'à Cuvier, l'anatomie comparée n'était qu'un recueil de faits particuliers concernant la structure des animaux. Cuvier en fit la science des lois de l'organisation animale. Certains organes ont sur l'ensemble du fonctionnement une influence prépondérante, d'où la loi de subordination : les organes d'un animal ne sont pas simplement juxtaposés, mais agissent les uns sur les autres et coopèrent à une action commune par une réaction réciproque. Autrement dit, certains traits d'organisation s'appellent nécessairement les uns les autres, tandis qu'il en est d'autres qui s'excluent par incompatibilité physiologique, d'où la loi des corrélations organiques. En se fondant sur leur organisation interne, Cuvier allait tenter d'établir les rapports des êtres vivants entre eux, et il publiera ainsi en 1817 Le Règne animal distribué d'après son organisation.
La loi de subordination des caractères permet d'établir une classification naturelle. Le système nerveux, qui est au fond tout l'animal, donne les embranchements ; les organes de la respiration et de la circulation donnent les classes ; des organes de plus en plus subordonnés donneront successivement les ordres, les familles, les tribus, les genres, les espèces. Cuvier devait développer surtout cette méthode dans son grand ouvrage sur l'Histoire naturelle des Poissons 1828-1831.
Sa vie
Né d'une modeste famille luthérienne de Montbéliard, il est le fils de Jean-Georges Cuvier 1715-1795 et de Clémentine Chatel 1736-1792 et le frère ainé de Frédéric Cuvier. Il épouse le 2 février 1804 Anne Marie Sophie Loquet du Trazail 1768-1849, veuve de l'ancien fermier général Duvaucel guillotiné en 1793, dont elle a eu une fille, Sophie Duvaucel 1789-1867, femme de lettres. Du mariage de Georges Cuvier et de Anne Marie Sophie Coquet du Trazail sont nés 4 enfants : trois enfants sont morts en bas âge et la quatrième, Clémentine Cuvier 1809-1827 est morte à l'âge de 18 ans.
À la naissance de Cuvier, le territoire de Montbéliard est rattaché au duché de Wurtemberg où l’école est obligatoire. C'est la lecture de Buffon lors de ses brillantes études qui orientera la vie de Georges Cuvier. Après avoir étudié au collège de Montbéliard, il s'inscrit en 1784 à l'Académie Caroline de Stuttgart en Allemagne qui forme les cadres pour le duché de Wurtemberg et où il est l'élève du botaniste Johann Simon von Kerner. C'est là qu'il acquiert la connaissance de la langue et de la littérature allemandes, reçoit des cours de sciences qui le passionnent mais aussi d'économie, de droit administratif ou de gestion forestière qui l'aideront dans ses fonctions futures d'administrateur.
Les premières activités scientifiques
En 1788, il reprend le poste de précepteur d'un coreligionnaire auprès de la famille du comte d'Héricy, famille noble protestante de Caen en Normandie tenant salon5. Sa fonction lui laissant du temps libre, il découvre les sciences naturelles en disséquant le chat ou le perroquet de la comtesse, les poissons et mollusques, en récoltant des fossiles et comparant des espèces vivantes. Il constitue à cette époque un important herbier. Il passe les années troubles de la Révolution française dans le pays de Caux en Normandie à Fiquainville où la famille d'Héricy s'est installée, ce qui ne l'empêche pas de devenir le secrétaire greffier de la commune révolutionnaire, où il continue de consacrer ses loisirs à l'étude de l'histoire naturelle. De ces travaux solitaires, il déduira par la suite la loi de corrélation des formes permettant la reconstitution d’un squelette à partir de quelques fragments. Très tôt, il a l’intuition de la nécessité d’une nouvelle classification du règne animal. Il soumet ses notes au curé Tessier qui les communique à Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, professeur du nouveau Muséum national d'histoire naturelle à Paris, qui remarque les qualités du jeune homme.
La carrière universitaire
Ses talents ayant été appréciés par Henri Alexandre Tessier, agronome, il est appelé à Paris en 1795 et se fait bientôt remarquer, soit par ses cours, soit par ses écrits notamment ses Mémoires sur les espèces d'éléphants vivants et fossiles. Son savoir d’autodidacte et l’originalité de ses méthodes le font admettre au Jardin des Plantes de Paris, où Jean-Claude Mertrud, puis Louis Jean-Marie Daubenton, recherchent sa collaboration et l’introduisent à l’Académie des sciences.
Il est nommé successivement professeur d'histoire naturelle aux écoles centrales du Panthéon à cette occasion, il publie ses cours sous forme du Traité élémentaire des animaux qui revoit l'ensemble de la classification des animaux et qui assure sa notoriété, suppléant de la chaire d'anatomie comparée au Muséum, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences où il est secrétaire perpétuel pour les sciences physiques en 1803. La même année, il se marie avec la veuve de l’ancien fermier général Duvaucel, guillotiné en l'an I. Aucun de leurs quatre enfants ne survécut, et leur mort lui fut très douloureuse. Il devient membre étranger de la Royal Society le 17 avril 1806.
Il devient inspecteur des études, co-conseiller et chancelier de l'Université 1808, et remplit plusieurs fois les fonctions de grand maître : il profite de cette position pour favoriser l'enseignement de l'histoire et des sciences. Nommé en 1814 conseiller d'État, puis président du comité de l'intérieur, il se signale dans cette nouvelle carrière par une haute capacité, mais il se montre trop complaisant envers le pouvoir et consent à se charger de soutenir à la tribune des mesures impopulaires. Critiqué car ambitieux, se faisant de nombreux adversaires car il n'hésite pas à remettre en cause les thèses de savants renommés comme Buffon ou Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, il n'hésite pas à aider financièrement des collègues dans le besoin.
Sous la Seconde Restauration, Georges Cuvier reçut le titre héréditaire de baron par lettres patentes du roi Charles X du 29 décembre 1829.
Il disparait le 13 mai 1832 des suites de paralysie à l’âge de soixante-deux ans à Paris et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise division 8.
L'anatomie comparée et la paléontologie
Cuvier est parmi les fondateurs de l'anatomie comparée moderne. Il énonce le principe de subordination des organes et de corrélation des formes. Ainsi proposera-t-il une classification du règne animal en quatre embranchements, articulés, vertébrés, mollusques, radiaires et cela, en structurant l'étude de l'anatomie comparée des animaux et en remettant en cause la chaîne des êtres. Le système nerveux, respiratoire et les organes, de plus en plus subordonnés indiquent successivement l'ordre, la famille, le genre et enfin l'espèce.
À la faveur de cette loi, il a pu créer pour ainsi dire un monde nouveau : ayant établi par de nombreuses observations qu'il a dû exister à la surface du globe des animaux et des végétaux qui ont disparu aujourd'hui, il est parvenu à reconstruire ces êtres dont il reste à peine quelques débris informes et à les classer méthodiquement.
Enfin, il a donné à la géologie de nouvelles bases, en fournissant les moyens de déterminer l'ancienneté des couches terrestres par la nature des débris qu'elles renferment. C'est lui, notamment, qui baptisa la période du jurassique de l'ère secondaire ou mésozoïque en référence aux couches sédimentaires dans le massif du Jura, qu'il connaissait bien.
Il pratique l’Actualisme ou l’Uniformitarisme terme employé par William Whewell en 1832 : Les chocs actuels sont les mêmes que ceux du passé, et il est en accord avec les idées fixistes se référant notamment à la Création divine et catastrophistes. Il n'évoque pas des extinctions de masse mais des extinctions majeures qu'il appelle révolutions du globe par des catastrophes de type inondations ou séismes, la terre étant ensuite repeuplée par une nouvelle création ou des migrations après ces catastrophes. Par prudence vis-à-vis des autorités religieuses, il exclut l'homme de cette histoire géologique.
Dans son ouvrage Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes 1812, qui en 1825 avait vu son discours préliminaire démembré et publié sous le titre Discours sur les révolutions de la surface du Globe, Cuvier défend l'idée que la disparition et l'apparition de plusieurs espèces en même temps sont le résultat de crises locales.
Cuvier est considéré comme le fondateur du premier paradigme dans la discipline scientifique de la paléontologie. Certains voient aussi en lui le fondateur d'un paradigme nouveau en sciences sociales, conduisant en droite ligne au positivisme d'Auguste Comte et à la sociologie classique[réf. nécessaire]. Alcide Dessalines d'Orbigny et Pierre-Joseph van Beneden furent de ses élèves.
L'opposition au transformisme
Partisan de la fixité des espèces, il s'opposa violemment au transformisme de Lamarck13. Chef de file du courant opposé au transformisme, il utilisa tous les pouvoirs que lui octroyait sa position de professeur au Muséum d'histoire naturelle et de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences pour entraver la diffusion des idées transformistes. Il bloqua l'accès de leurs partisans vers les carrières académiques, interdit l'accès aux collections du Muséum et aux colonnes des revues scientifiques dont il avait le contrôle.
Ces mesures ne suffirent pas à décourager les naturalistes opposés à Cuvier. Tout en restant des amateurs- c'est-à-dire non reconnus par une institution officielle - ils poursuivirent avec succès leurs travaux, enrichirent leurs collections et publièrent leurs ouvrages. Ils possédaient leurs propres revues qui, hors du cercle parisien étaient bien connues. L'acharnement de Cuvier contre les théories transformistes est aussi attesté par la tentative d'entraver la publication des Annales des sciences de l'observation. François-Vincent Raspail témoigne des méthodes employées à cette occasion:
Cuvier et plus d'un de ses illustres collègues prirent part aux secrètes machinations, dans lesquelles l'éditeur fut forcé de tomber, afin de récupérer sa liberté menacée par une condamnation politique.
À la mort de Lamarck, Cuvier composa un éloge funèbre où il ne se priva pas de tourner en ridicule et de déformer les idées transformistes de Lamarck. Cet éloge, qualifié d'éreintement académique ne fut lu à l'Académie des sciences que le 26 novembre 1832. Il fut également traduit en anglais et il constitue fort probablement l'origine de l'idée erronée selon laquelle Lamarck attribuait la transformation des animaux à leur volonté et à leur désir.
Sur son lit de mort, Cuvier prit soin de désigner Pierre Flourens comme successeur au poste de secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences. Jusqu'à sa démission en 1864, ce dernier y fut le défenseur le plus acharné de la doctrine de Cuvier dans le domaine des sciences zoologiques.
Les ossements fossiles
Mais l'application la plus originale, celle qui frappa davantage les esprits et qui constitue le plus grand titre de gloire de Cuvier, a trait aux ossements fossiles. Le 1er pluviôse an IV, il lut devant l'Institut national son mémoire sur les espèces d'Éléphants fossiles comparées aux espèces vivantes. En 1812, paraissait la première édition des Recherches sur les ossements fossiles où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces, ouvrage qui n'était guère que la réunion des travaux antérieurs de l'auteur. Une deuxième édition, enrichie de faits nouveaux, était publiée de 1821 à 1824 ; une troisième, datant de 1825, ne différait de la précédente que par quelques développements ajoutés au célèbre discours préliminaire, souvent imprimé à part sous le titre : Discours sur les révolutions de la surface du globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal. Il précisait ainsi le but qu'il se proposait d'atteindre : N'y aurait-il pas quelque gloire pour l'homme à savoir franchir les limites du temps et à retrouver, au moyen de quelques observations, l'histoire de ce monde et une succession d'événements qui ont précédé la naissance du genre humain ?
Crânes de bovidés figurés par Georges Cuvier dans ses Recherches sur les ossements fossiles 1812, permettant des comparaisons anatomiques entre diverses espèces actuelles ou disparues.
Ptérodactyle
Squelette de ptérodactyle provenant des calcaires lithographiques du Jurassique de Bavière, figuré par Cuvier dans ses Recherches sur les ossements fossiles (1812). Ce naturaliste fut le premier, en 1801, à reconnaître en cet animal un reptile volant disparu.
Découverte dans le Miocène du sud de l'Allemagne, la salamandre géante est identifiée comme telle par Georges Cuvier.
Crédits: Coll. Eric Buffetaut Consulter
Dès son premier mémoire sur les Éléphants fossiles, il émet l'idée d'une création d'animaux antérieurs à la création actuelle, création entièrement détruite et perdue. Cette hypothèse servira de point de départ à de brillantes recherches qui se poursuivront pendant trente années, malgré les plus grandes difficultés. Dans le cas des Mammifères, auxquels s'intéressait particulièrement Cuvier, il est infiniment rare de trouver un squelette fossile à peu près complet : « Des os isolés et jetés pêle-mêle, presque toujours brisés et réduits à des fragments, voilà tout ce que nos couches nous fournissent, et la seule ressource des naturalistes. »
Il fallait donc être capable de déterminer ou de reconstituer, à partir d'un fragment d'os, l'animal auquel il avait appartenu, art presque inconnu au moment où Cuvier commença ses recherches. L'anatomie comparée lui fournissait le principe nécessaire à cette détermination : le principe de corrélation des organes, selon lequel chaque partie d'un animal peut être donnée par chaque autre, et toutes par une seule. De la forme des dents, par exemple, on pourra conclure la forme des pieds, celle des mâchoires, celle des intestins. Cette déduction rigoureuse, sinon infaillible, a souvent permis à Cuvier de reconnaître un animal à partir d'un fragment d'os ou d'une dent. On connaît l'anecdote qu'il a lui-même rapportée à propos de la découverte d'un Didelphe dans le gypse de Montmartre ; l'examen des dents lui ayant montré la parfaite analogie de ce fossile avec les Sarigues, il ne doute point, avant d'avoir vu le bassin, que celui-ci portait des os marsupiaux. En présence de quelques amis, il fit creuser la pierre et mit au jour le bassin ; les os marsupiaux s'y pouvaient voir.
La sarigue de Montmartre, marsupial provenant du gypse éocène de Montmartre et identifié par Georges Cuvier.
La paléontologie
Un des buts essentiels d'une telle recherche fut, pour Cuvier, d'établir les rapports des espèces fossiles avec les différentes couches du globe. Se limitant aux Vertébrés quadrupèdes, il constate que les ovipares sont apparus bien avant les vivipares, et qu'ils étaient plus forts, plus variés dans les terrains anciens qu'à la surface actuelle du globe. Quatre populations différentes ont successivement recouvert la portion de la Terre qui nous est accessible. La première renfermait des Poissons et des Reptiles monstrueux ; il ne s'y trouvait que quelques petits Mammifères. La deuxième était surtout caractérisée par les Palaeotherium et les Anoplotherium, dont le gypse de Paris a livré les premiers restes ; les Mammifères terrestres commencent à dominer. La troisième comprenait les Mastodontes, les Mammouths, les Hippopotames, les Rhinocéros
Le Palaeotherium est un mammifère fossile, proche des ancêtres du cheval, dont Georges Cuvier parvint à reconstituer le squelette, puis l'aspect à l'état vivant, à partir d'ossements trouvés dans le gypse de Montmartre.
Mais on n'a point encore trouvé de restes humains fossiles. Cuvier passe en revue tous les ossements alors considérés comme tels et n'a aucune peine à établir son affirmation. Tout porte donc à croire que l'espèce humaine n'existait point dans les pays où se découvrent les os fossiles à l'époque des révolutions qui les ont enfouis. On peut ainsi définir une quatrième et dernière époque, qui est l'âge de l'homme et des espèces domestiques.
L'échelle des êtres et l'unité de plan du règne animal
Ses recherches sur les ossements fossiles devaient inévitablement amener Cuvier à prendre position sur le grand problème des rapports que les vivants soutiennent entre eux et sur les questions, fort discutées en son temps, de l'échelle des êtres et de l'unité de plan du règne animal.
La conception de l'échelle des êtres, c'est-à-dire la conception selon laquelle les êtres se rangent sur une ligne unique n'offrant ni interruptions ni hiatus, était encore très répandue au début du XIXe siècle. Cuvier souligne que la série animale ne forme pas une seule ligne, mais se résout en une multitude de lignes. En effet, les organes ne suivent pas tous le même ordre de modifications : tel est à son plus haut degré de perfectionnement dans une espèce et rudimentaire dans une autre. De sorte que, si l'on établit une série à partir des organes des sens, une autre en considérant la circulation, ou la respiration, aucune ne sera semblable.
La forme extrême donnée par É. Geoffroy Saint-Hilaire à la notion d'unité de plan du règne animal a été rejetée par Cuvier. Le plan correspond à la position relative des organes. Pour qu'il y ait unité de plan, il suffit que ceux-ci conservent, les uns par rapport aux autres, les mêmes positions. « Mais peut-on dire que le Vertébré, dont le système nerveux est placé sur le canal digestif, soit fait sur le même plan que le Mollusque, dont le canal digestif est placé sur le système nerveux ? » La position relative des organes est donc différente. En réalité, le plan, défini par cette position relative des organes, est toujours le même chez les Vertébrés, le même chez les Mollusques, le même chez les Articulés... Mais il se modifie quand on passe de l'un de ces groupes à l'autre.
Cuvier a été enfin amené, par ses recherches paléontologiques, à aborder le problème de la mutabilité des espèces. Il en a ainsi posé les données : Pourquoi les races actuelles ne seraient-elles pas des modifications de ces races anciennes que l'on trouve parmi les fossiles, modifications qui auraient été produites par les circonstances locales et le changement de climat, et portées à cette extrême différence par la longue succession des années ? » À quoi on peut répondre, déclarait-il, que, si les espèces avaient changé par degrés, on devrait trouver des traces de ces changements. Entre la faune à Palaeotherium et la faune à Mastodontes, entre la faune à Mastodontes et la faune actuelle, on devrait trouver des intermédiaires, « et jusqu'à présent cela n'est point arrivé. Et même si les espèces anciennes n'avaient pas été fixes, les révolutions nombreuses dont notre globe a été le théâtre ne leur auraient pas laissé le temps de se livrer à leurs variations.
Il n'en demeure pas moins que la vie a présenté, au cours des âges géologiques, des aspects différents et que des faunes variées se sont succédé à la surface du globe. Sur ce point, d'ailleurs, la pensée de Cuvier reste vague et obscure. Il n'admet point, contrairement à ce que l'on dit généralement, des créations nouvelles. Cette succession des faunes, qu'il a si bien mise en évidence, serait limitée à certains continents qui, à la suite des grandes révolutions du globe, auraient été repeuplés par migrations à partir d'une source d'emplacement inconnu, où auraient coexisté les espèces que nous appelons fossiles et les espèces encore vivantes. La faune actuelle ne serait qu'un résidu appauvri des faunes du passé.Jean Piveteau
Le racisme
Cuvier représentait la pensée scientifique dominante en France, en accord avec les préjugés racistes de l'époque, et son influence était grande.
Dans ce contexte, il a fait des recherches sur les Noirs africains qu'il tenait pour la plus dégradée des races humaines, dont les formes s'approchent le plus de la brute, et dont l'intelligence ne s'est élevée nulle part au point d'arriver à un gouvernement régulier. Peu après la mort de Saartjie Baartman, il entreprit de la disséquer19 au nom du progrès des connaissances humaines. Il réalisa un moulage complet du corps et préleva le squelette ainsi que le cerveau et les organes génitaux qui furent placés dans des bocaux de formol et exposés au Musée de l'Homme. En 1817, il exposa le résultat de son travail devant l'Académie de médecine. La publication de ses Observations sur le cadavre d'une femme connue à Paris et à Londres sous le nom de Vénus hottentote témoigne des théories racistes des scientifiques de l'époque21. Il fait notamment allusion à la classification des races humaines par le squelette de la tête, et à une loi cruelle qui semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimé et comprimé. Saartjie Baartman est plus décrite par des traits simiesques que par son appartenance à la race noire : Notre Boschimane a le museau plus saillant encore que le nègre, la face plus élargie que le calmouque, et les os du nez plus plats que l'un et que l'autre. À ce dernier égard, surtout, je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable aux singes que la sienne.
Stendhal
Stendhal fréquente le salon des Cuvier lors de sa relation avec Sophie Duvancel, belle-fille de Cuvier, qu'il surnomme Melle Mamouth
Honoré de Balzac
Balzac, qui tout d'abord admirait Cuvier, s'est pourtant moqué de lui en le surnommant baron cerceau dans le conte satirique Guide-âne à l'usage des animaux qui veulent parvenir aux honneurs et en le traitant d'habile faiseur de nomenclatures Puis dans la querelle qui opposa Cuvier à Étienne Geoffroy Saint-Hilaire à partir de 1830 sur le sujet de l’unité de composition organique, il prit parti pour Saint-Hilaire. Ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui, dans ces derniers temps, s'est émue entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, reposait sur une innovation scientifique ... La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d'ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera l'éternel honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et dont le triomphe a été salué par le dernier article qu'écrivit le grand Goethe
Malgré cela, en 1844, Balzac placera Cuvier au rang des hommes qui ont eu « une vie immense, au même titre que Napoléon et lui-même
Œuvres et publications
Buste de Georges Cuvier au Musée Cuvier de Montbéliard
Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux 1797-1798
Leçons d'anatomie comparée 5 volumes, 1800-1805, ouvrage capital qui obtint en 1810 un des prix décennaux. Textes en ligne.
Essais sur la géographie minéralogique des environs de Paris, avec une carte géognostique et des coupes de terrain, avec Alexandre Brongniart 1811
Le Règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée 4 volumes, 1817. Textes en ligne.
Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes, où l'on rétablit les caractères de plusieurs espèces d'animaux que les révolutions du globe paraissent avoir détruites 4 volumes, 1812. Textes en ligne : volume 1, volume 2 disponible sur Gallica, volume 3 disponible sur Gallica, volume 4 disponible sur Gallica.
Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des mollusques
Éloges historiques des membres de l'Académie royale des sciences, lus dans les séances de l'Institut royal de France par M. Cuvier 3 volumes, 1819-1827. Textes en ligne : Vol. 1, Vol. 2 et Vol. 3.
Théorie de la terre 1821.
Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal. G. Dufour et éd. d'Ocagne Paris, 1825 [troisième édition française ; l'édition de 1840 est disponible sur Gallica ; réédition : Christian Bourgois Paris
Histoire des progrès des sciences naturelles depuis 1789 jusqu'à ce jour 5 volumes, 1826-1836
Histoire naturelle des poissons 11 volumes, 1828-1848, continuée par Achille Valenciennes.
Histoire des sciences naturelles depuis leur origine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples connus, professée au Collège de France 5 volumes, 1841-1845, rédigée, annotée et publiée par Magdeleine de Saint-Agy. : Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4, et Vol. 5.
Discours sur les révolutions du globe avec des notes et un appendice d'après les travaux récents de MM. de Humboldt, Flourens, Lyell, Lindley, etc. rédigés par le Dr Hoefer, Firmin-Didot et Cie Paris, 1858. Texte en ligne disponible sur IRIS. Edition de 1879 disponible sur IRIS aussi.
L'histoire des sciences naturelles de Cuvier : vingt-quatre leçons de l'Antiquité à la Renaissance nouvelle édition de Theodore W. Pietsch, préface de Philippe Taquet], Paris: Publications scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, 2012, 734 p. coll. Archives; 16.
Georges Cuvier a également collaboré au Dictionnaire des sciences naturelles 61 volumes, 1816-1845 et à la Biographie universelle 45 volumes, 1811-18??.
Distinctions et hommages
Une succession d’honneurs le conduisent de l’Académie française en 1818, à la pairie de France en 1831, en passant par le Conseil d'État et la chancellerie de l’Instruction publique, sans parler des distinctions académiques venant du monde entier.
Grand Officier de la Legion d'honneur le 9 septembre 1826.
Musée Cuvier de Montbéliard.
Fontaine Cuvier face au Jardin des Plantes de Paris.
Un collège devenu aujourd'hui un lycée porte son nom à Montbéliard.
Son nom est inscrit sur la Tour Eiffel liste des soixante-douze noms de savants inscrits sur la tour Eiffel.
Rue Cuvier dans le 5e arrondissement de Paris par décret royal le 8 novembre 1838, rue du Jardin des plantes de Paris, du Muséum national d'histoire naturelle, de la Ménagerie du Jardin des plantes, de l'Université Paris VI ou Université Pierre-et-Marie-Curie et de la Fontaine Cuvier.
En 1935, l'union astronomique internationale a donné le nom de Cuvier à un cratère lunaire.
       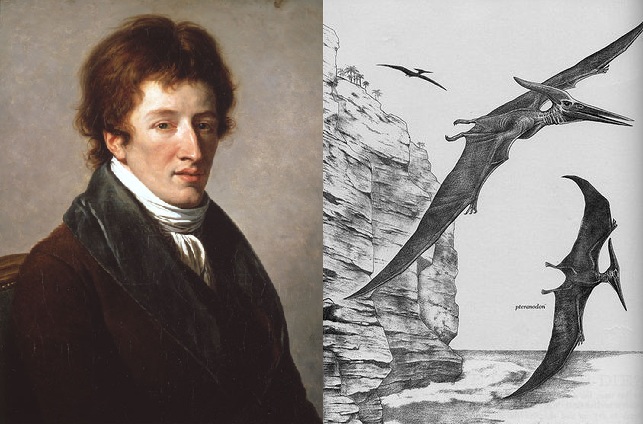 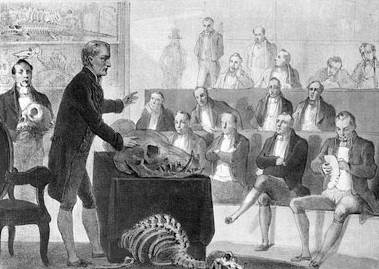  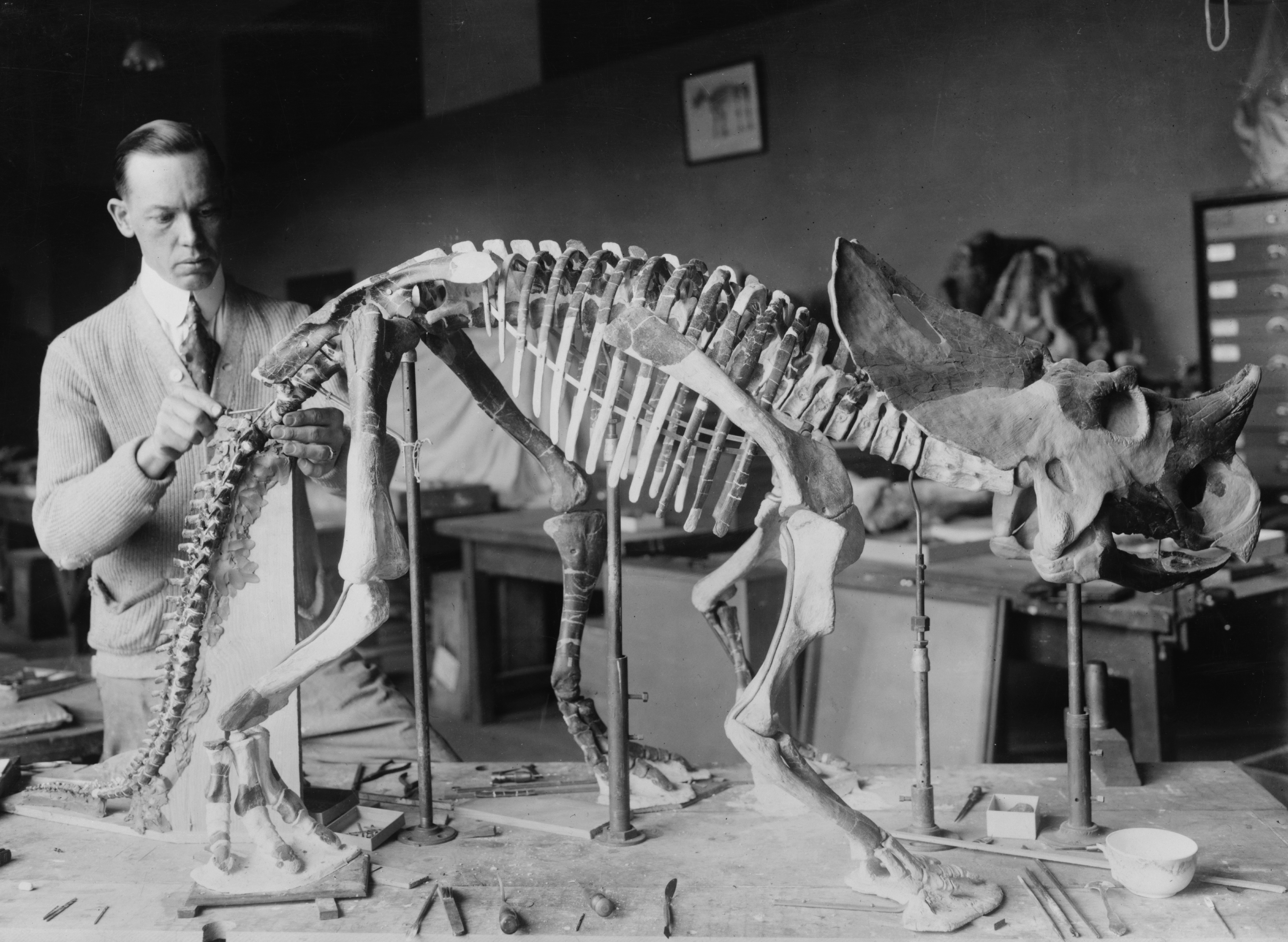 
Posté le : 21/08/2015 18:35
Edité par Loriane sur 22-08-2015 14:37:06
Edité par Loriane sur 22-08-2015 14:39:24
|
|
|
|
|
William Wallace |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 23 août 1305 à Londres meurt Sir William Wallace
à 35 ans chevalier écossais né en 1270 à Ellerslie, il est surnommé William Braveheart Wallace, Gardien de l'Écosse, il reste un héros pour tout le peuple écossais. Il mena son peuple contre l'occupation des Anglais sous le roi Édouard Ier d'Angleterre. Son rôle pendant les guerres d'indépendance de l'Écosse fut tellement décisif pour le sort de son pays que sa vie prit une dimension légendaire.
En retour
Héros de l'indépendance écossaise. En 1297, il prit la tête de la résistance aux Anglais et remporta la bataille de Stirling septembre. Nommé régent d'Écosse, il fut écrasé à Falkirk 1298 par le roi Édouard Ier d'Angleterre. Il fut capturé en 1305 et exécuté.
Second fils d'un chevalier écossais, William Wallace n'apparaît dans l'histoire qu'en mai 1297, après la déposition de John de Balliol et la confiscation de la monarchie écossaise par Édouard Ier d'Angleterre. Les attaques de Wallace contre l'occupant sont le signal d'un soulèvement populaire. Il prend la tête du mouvement et, avec l'aide d'Andrew de Moray, libère l'Écosse malgré l'abandon de Robert Bruce et de nombreux nobles un moment ralliés. Ayant écrasé l'armée envoyée par Édouard Ier au pont de Stirling en septembre 1297, il pénètre en Angleterre et ravage le nord du pays. Il est alors proclamé gardien du royaume d'Écosse, fonction qu'il exerce au nom de John de Balliol, retenu prisonnier à Londres. Mais une trêve étant intervenue entre la France et l'Angleterre, Édouard Ier tourne ses forces contre l'Écosse, où il entre à la tête de son armée ; Wallace, mal soutenu par l'aristocratie, est écrasé à Falkirk en juillet 1298 ; sa réputation militaire ruinée, il abandonne son titre de gardien. À partir de cette époque, on ne sait que peu de chose de sa vie. Il se rend en France, puis retourne en Écosse pour continuer la guérilla ; il est le seul des chefs écossais à qui le roi d'Angleterre n'ait jamais fait de proposition de reddition. Pris en 1305, il est exécuté à Londres ; ses membres sont envoyés en Écosse pour y être exposés à la foule. La vie de ce héros très populaire de l'indépendance nationale sera, au XVe siècle, le sujet du roman historique d'Henri le Ménestrel, The Actif and Deidis of the Illustere and Vailyeand Campioun Schir William Wallace Knicht of Ellerslie.
John de Balliol ou Bailleul 1250 env.-1314, roi d'Écosse, abdique en faveur d'Édouard Ier d'Angleterre, en 1296. Ce dernier était entré en Écosse avec son armée après que Balliol eut dénoncé l'hommage qu'il lui devait. Paul Benoît
Sa vie
Aux yeux du plus grand nombre, William Wallace semblait être une personne du peuple, contrastant avec son compagnon, Robert le Bruce Robert Ier d'Écosse, qui provenait de la haute noblesse, en fait, la famille de Wallace était de petite noblesse, descendante de Richard Wallace Richard le Gallois, un propriétaire terrien vassal d'un des premiers membres de la famille Stewart (qui plus tard deviendra la lignée royale des Stuart.
William Wallace est né à Ellerslie Ayrshire ou Elderslie Renfrewshire aux alentours de 1270, ce qui faisait de lui encore un jeune homme dans ses années de gloire en 1297 et 1305. Des documents contemporains suggèrent que Wallace était originaire de l'Ayrshire. Son père était de Riccarton, Ayrshire et sa mère de Loudoun, Ayrshire. De plus ses premières batailles se dérouleront en Ayrshire. Quelques sources d'information contemporaines à propos de la première partie de la vie de Wallace existent, et les historiens se reposent souvent sur les notes de Blind Harry, écrites aux alentours de 1470, environ deux siècles après la naissance de Wallace. Il est presque sûr qu'il soit né en Ayrshire, qu'il fut le fils de Sir Alan1 Wallace de Riccarton, et qu'il ait eu deux frères, Malcolm et John. Mais on ne dispose que de très vagues bribes d'informations sur William Wallace et son enfance, le plus souvent transmises de bouche à oreille, parfois écrites.
William Wallace reçut son éducation de son oncle Argheim, et de ce fait devint bien instruit selon les standards de l'époque, parlant le latin et le français. Blind Harry ne fait pas mention du fait que Wallace ait quitté le pays, ou qu'il ait eu une quelconque expérience militaire avant 1297. Un rapport fait état, en 1296, d'un voleur, un William le Waleys à Perth. Encore selon les documents de Blind Harry ; William Wallace serait tombé amoureux et se serait même marié à une certaine Marion Braidfute dont aucun document ne prouve qu'elle a réellement existé. Des historiens pensent qu'elle a été inventée et ajoutée à une nouvelle édition du texte de Blind Harry en 1570, mais d'autres historiens affirment que le manuscrit de Ramsay qui retranscrit les histoires de Blind Harry date de 1488 et contient bien le personnage de Marion Braidfute.
L'Écosse du temps de William Wallace
Au temps de la naissance de William Wallace, le roi Alexandre III d'Écosse régnait depuis 20 ans sur l'Écosse. Son règne avait été une période de paix et de stabilité économique, et il avait repoussé avec succès les demandes incessantes de suzeraineté du roi d'Angleterre. En 1286, Alexandre III meurt d'une chute de cheval; aucun de ses enfants ne lui avait survécu. Les lords écossais déclarèrent sa petite fille Margaret alors âgée de 3 ans, reine. À cause de son âge, ils mirent en place une régence, les Gardiens de l'Écosse, pour assurer l'administration de l'Écosse jusqu'à ce qu'elle soit en âge de gouverner. Le roi Édouard Ier mit à profit l'instabilité potentielle pour signer avec les lords le traité de Birgham, promettant de marier son fils Édouard à Margaret, sous réserve que l'Écosse demeure une nation indépendante. Mais Margaret tombe malade et meurt en 1290, à 8 ans sur le chemin de sa Norvège natale vers l'Écosse. Pas moins de treize prétendants au trône se manifestèrent presque immédiatement ce qui mène à la crise de succession écossaise.
John Balliol avait des droits certains sur le trône. Cependant, les Écossais voulaient un arbitre extérieur pour décider de la question, de façon à éviter les accusations de partialité. De façon tout à fait déraisonnable, ils en appelèrent au roi Édouard Ier pour décider. Au lieu d'arriver comme un arbitre indépendant, il vint à la frontière anglo-écossaise avec une grande armée, et annonça qu'il était venu en seigneur pour régler une dispute dans un État vassal, forçant tous les rois potentiels à lui rendre hommage. Après avoir entendu chaque serment, Édouard choisit Balliol en 1292 pour régner sur l'État vassal d'Écosse. En mars 1296, Balliol renie son serment et s'allie avec le royaume de France. Rapidement vaincu, le 7 juillet, il renonce au traité avec la France et le 8 juillet 1296 à Montrose il résigne son royaume au profit du roi d'Angleterre.
L'épopée de William Wallace 1297-1298
Statue de Wallace au château d'Edimbourg.
William Wallace apparaît dans l'histoire en assassinant le shérif anglais de Lanark pour venger la mort de sa bien aimée nommée Marion Braidfute selon la tradition. En raison de ce crime, il est mis hors la loi et se réfugie dans les bois où il est bientôt rejoint par une trentaine de compagnons avec lesquels il massacre la garnison anglaise de Lanark en mai 1297. C'est le signal de la rébellion. De grands seigneurs ne tardent pas à se joindre à lui, William Douglas, qui devient son lieutenant, Robert Wishart, évêque de Glasgow qui parvient à rallier James Stewart le Grand Sénéchal à la cause et bientôt Robert Bruce le Jeune rompant par là la réputation d'anglophilie de la famille Bruce. Et c'est avec une armée que Wallace met le siège devant Dundee au mois d'août 1297. Le comte de Surrey et Hugh Cressingham, trésorier, réagissent et placent leur troupe à Stirling coupant ainsi Wallace de ses arrières.
William Wallace rompt alors le siège et se dirige vers Stirling. Mais lorsqu'il arrive, les Anglais sont déjà solidement positionnés et plus nombreux – 6 350 fantassins et 350 cavaliers contre 6 000 fantassins dotés de lances et 180 cavaliers écossais. La situation semble désespérée pour les Écossais qui parviennent cependant à profiter de la maladresse d'un chevalier anglais qui souhaitait engager le combat prématurément. Suite à ce renversement de situation, les Anglais perdent 3 000 hommes dont plus de 100 chevaliers. La victoire écossaise est éclatante.
Quelques villes ne tardent pas à ouvrir leurs portes dont : Aberdeen, Dundee, Perth, Stirling, Édimbourg, Roxburgh, Berwick. Wallace dirige en octobre-novembre 1297 des campagnes qui le mènent jusque dans le Cumberland et le Northumberland, tout en faisant régner l'ordre dans les territoires sous son pouvoir. Il est proclamé avant mars 1298 « gardien du royaume d'Écosse. Édouard Ier doit intervenir en personne, abandonnant un temps le continent - où il appuyait les Flamands contre la France - pour reprendre le contrôle de l'Écosse. Il reprend Berwick en juillet 1298, puis Roxburgh. Il parvient à couper le chemin de Wallace à Falkirk. L'armée écossaise y est écrasée le 22 juillet 1298 - 2 000 morts. C'est la fin de l'épopée de Wallace.
Fin de vie
William Wallace doit abandonner son titre de gardien du royaume entre juillet et décembre 1298. Il passe quelque temps en France avec d'autres chevaliers écossais à l'automne 1299 ; en novembre 1300, le roi de France Philippe IV envoie même pour lui une lettre de recommandation au pape. William Wallace réapparaît en Écosse aux alentours de 1303-1304 où il reprend sa vie de hors-la-loi. Sa dernière action militaire est une escarmouche en septembre 1304 à l'extrémité des Ochil Hills entre Abernethy et Lindores. Il est capturé près de Glasgow le 3 août 1305 par les hommes de sir John Menteith, le gardien du château de Dumbarton qui, comme la plupart des nobles écossais, avait fait sa soumission au roi d'Angleterre.
William Wallace est transféré à Londres le 22 août 1305 et condamné à mort pour haute trahison envers son souverain, crimes et sacrilège. Le lundi 23 août 1305 il est emmené en procession sur un cheval jusqu'à Westminster Hall et exécuté Hanged, drawn and quartered à l'âge de 33 ans. William Wallace est mis à mort dans les conditions atroces réservées aux traîtres : traîné par des chevaux par les pieds sur plusieurs kilomètres de Westminster à la Tour de Londres et de là à Aldgate moitié pendu, éventré et le feu mis à ses entrailles. Il est finalement décapité, puis découpé en morceaux. Pour donner un exemple, Edouard Ier fait exposer les différentes parties du corps de William Wallace aux quatre coins du royaume d'Angleterre. Sa tête est placée sur le pont de Londres et les parties de son corps réparties entre Newcastle-upon-Tyne, Berwick-upon-Tweed, Stirling et Perth.
Mais au lieu de détruire l’esprit de liberté chez les Écossais, cette exécution va vivifier le sentiment nationaliste écossais, et d’autres hommes se sont dressés contre l’Angleterre, en particulier Robert Bruce. En 1314, les Écossais, sous le commandement de Robert Bruce, qui s'était rallié les nobles et proclamé roi d'Écosse, défait l'armée anglaise à la bataille de Bannockburn, et assurent, à la fin de la guerre, l'indépendance de l'Écosse en 1328.
Dans la culture populaire
Une tour en son honneur, nommée Monument William Wallace, a été construite en 1869 près de Stirling.
Cinéma
La vie de William Wallace a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1995 sous le nom de Braveheart et avec Mel Gibson. Même s'il ne respecte pas la réalité historique, il retrace bien la violence des combats ainsi que l'obstination écossaise. Le film fut un grand succès et remporta 5 Oscars. En effet, il relate et reprend la majorité des lieux et les principales figures historiques.
Jeux vidéo
La campagne-tutoriel de Age of Empires II reprend en partie l'épopée de William Wallace. A noter que la dernière mission de cette campagne est uchronique : une victoire du joueur signifie alors que les Ecossais l'emportent à Falkirk et que l'odyssée de William Wallace continue mentionné dans le résumé final de la campagne.
Le jeu de stratégie Medieval Total War' SEGA British Island Conquest met en scène le héros écossais, permettant de retracer sa campagne et celle de ses armées. Le second opus, Medieval 2: Total War, offre également dans son extension "Britannia" la possibilité de contrôler William Wallace en jouant la faction écossaise.
Est également sorti le jeu vidéo éponyme tiré du film en juillet 1999.
Musique
Le groupe de heavy metal Iron Maiden parle de William Wallace et de ses désirs de liberté dans la chanson The Clansman, parue en 1998 dans l'album Virtual XI. Un autre groupe de heavy metal, Grave Digger, lui a également rendu hommage sur un morceau simplement intitulé William Wallace, sorti en 1996 dans l'album Tunes of War. Le groupe de folk metal Skiltron y fait également référence dans l'album de 2006 The Clans Have United, et particulièrement avec le titre Stirling Bridge. Enfin, le groupe de Oi! breton, Killer Boots, lui dédicace une chanson éponyme, ainsi que Fraction Hexagone, dans leur titre ' Vivre libre, ou mourir'.
         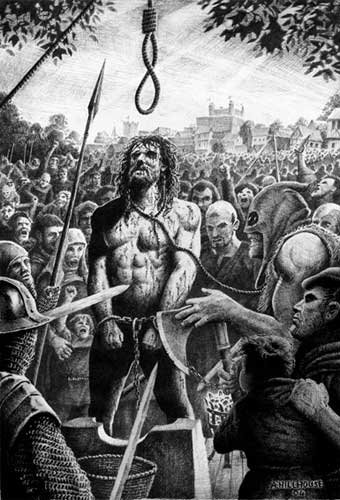    
Posté le : 21/08/2015 17:25
Edité par Loriane sur 22-08-2015 14:17:06
Edité par Loriane sur 22-08-2015 14:18:14
|
|
|
|
|
La Pérouse |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 23 août 1741 naît Jean François de Galaup, comte de La Pérouse
au château du Gô dans la paroisse de Saint-Julien à deux lieues d'Albi, il a disparu en 1788, à 47 ans à Vanikoro, né au château du Gô, officier de marine et un explorateur français. Il est chef d'escadre des armées navales dans la marine royale française, entre 1756 et 1788, il participe aux conflits de la Guerre de Sept Ans, de la Guerre d'indépendance des États-Unis, il est commandement de L'Amazone, de L'Astrée, de la La Boussole. Ses faits d'armes est la bataille des Cardinaux, il Combat le 21 juillet 1781, il fait l'expédition de la baie d'Hudson, l'expédition de La Pérouse,
Il reçoit les distinctions de Chevalier de Saint-Louis, de l'Ordre de Cincinnatus. Il est Fait comte par Louis XVI. Parmi les Hommagesqui lui sont rendus il ya son nom donné à divers liex : Le détroit de La Pérouse, Une baie de l'île de Pâques, La Perouse, une banlieue de Sydney, Le piton de La Pérouse au centre de l'atoll de la Frégate française, Le lycée Lapérouse à Albi et Nouméa, Plusieurs stèles, statues et mémoriaux, Cinq navires de la Marine nationale française, Plusieurs timbres commémoratifs. Ses armes représentent " De gueules, à l'épervier essorant d'argent, tenant entre ses serres un rameau d'olivier d'or"
Navigateur français, manoir du Gô, près d'Albi, 1741-île de Vanikoro, dans le Pacifique, 1788.
Embarqué à quinze ans c'est lors de son entrée dans les Gardes de la marine qu'il ajoute à son nom celui de Lapérouse, Lapérouse est blessé, à dix-huit ans, dans un combat près de Belle-Île 1759. Il est emmené prisonnier en Grande-Bretagne. La paix revenue, il est promu enseigne de vaisseau en 1764. En 1782, il est chargé de ravager les établissements anglais de la baie d'Hudson.
Une importante expédition scientifiqe au lendemain du traité de Versailles 1783, Louis XVI rédige lui-même les instructions pour une entreprise qui doit parachever l'œuvre de James Cook : Lapérouse dirigera une expédition chargée de reconnaître les parties septentrionales des rivages américain et asiatique. Des astronomes et naturalistes, ainsi que des artistes peintres seront du voyage. Le 1er août 1785, les deux frégates de Lapérouse, la Boussole et l'Astrolabe, quittent la rade de Brest. Le cap Horn est franchi en février 1786.
En bref
Navigateur et chef d'escadre français. Entré dans la marine en 1756, Lapérouse prend part à la guerre de Sept Ans, puis à celle de l'Indépendance américaine au cours de laquelle il s'illustre notamment en 1782 quand il attaque par surprise et détruit les établissements anglais de la baie d'Hudson. La paix rétablie, il propose d'organiser un grand voyage dans le Pacifique, prolongeant ceux de Bougainville et de Cook. Louis XVI participe en personne à la mise au point des instructions lui donnant pour mission de reconnaître les atterrages du nord du Pacifique, de poursuivre l'exploration de l'Océanie et d'étudier les possibilités d'ouvrir la Chine et le Japon au commerce des pelleteries. Au terme de préparatifs minutieux, il dispose de deux bâtiments neufs, la Boussole et l'Astrolabe, aménagés spécialement pour recevoir un important état-major scientifique avec ses livres, collections et instruments. Le corps des officiers se recommande par son haut niveau de connaissances, à l'exemple de Fleuriot de Langle, le savant directeur de l'Académie de marine, qui reçoit le commandement de l'Astrolabe. En cette fin du siècle des Lumières, la navigation cesse d'être une estime pour devenir une science.
Lapérouse quitte Brest le 1er août 1785, explore les côtes nord-ouest de l'Amérique entre l'Alaska et la Californie, fait escale à Macao pour se renseigner sur les possibilités commerciales du marché chinois, puis mène une remarquable campagne hydrographique le long des côtes du Japon, de la Corée et de Sakhaline avant de relâcher à Petropavlovsk où il débarque l'interprète Jean-Baptiste de Lesseps, porteur de son compte rendu de mission. Mettant le cap au sud, il traverse la Micronésie, atteint les îles Samoa où de Langle est massacré par les indigènes 11 déc. 1787 et mouille à Botany Bay en même temps que l'escadre britannique transportant le premier contingent de convicts destinés à peupler l'Australie. Il repart en mars 1788 et disparaît. Plusieurs expéditions partent en vain à sa recherche Marchand, d'Entrecasteaux, Dupetit-Thouars. Ce n'est qu'en 1827 que le capitaine anglais Peter Dillon retrouvera les traces du double naufrage sur les récifs de l'île de Vanikoro Nouvelles-Hébrides, renseignements confirmés et complétés, l'année suivante, par Dumont d'Urville. À la fin du XVIIIe siècle parut une relation de l'expédition, Voyage autour du monde, d'après le journal de bord de Lapérouse. Jean-Marcel Champion.
L'île de Pâques est atteinte le 9 avril, puis, après une longue traversée vers le nord, Lapérouse fait de la découverte à l'envers : il s'agit surtout, en effet, de détruire certains mythes cartographiques hérités des anciens navigateurs espagnols ; plusieurs terres, qui figuraient sur les cartes vers le tropique du Cancer entre les Sandwich Hawaii et la côte américaine, sont rayées des cartes. Après des trocs fructueux aux îles Sandwich, c'est le départ pour la côte de l'Alaska, que l'on aperçoit vers le mont Saint-Élie. Les travaux de Lapérouse permettent de comprendre la complexité du littoral, bordé d'archipels montagneux. Depuis la Californie, une nouvelle traversée de l'océan est entreprise le 24 septembre. La position des Mariannes est rectifiée en décembre. Après des escales à Macao et aux Philippines, la partie la plus profitable de l'expédition commence, entre la Corée et le Japon ; ces régions ont bien été décrites par les jésuites, mais leur cartographie est celle de terriens : tout est à faire pour l'hydrographie marine, ce à quoi s'emploie Lapérouse d'avril à août 1787. Il franchit le détroit auquel son nom est donné, entre Sakhaline et Hokkaido, puis gagne le Kamtchatka. L'expédition repart en octobre pour le sud. Les dernières nouvelles des voyageurs seront envoyées d'Australie : en février 1788, Lapérouse annonce qu'il se propose de gagner, pendant l'été, les îles Tonga, puis les parages de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Guinée.
Une mystérieuse disparition peu à peu élucidée
Le mystère entourant la disparition de Lapérouse et de ses compagnons 220 hommes est vivement ressenti par l'opinion. L'expédition de Bruni d'Entrecasteaux 1791-1793 ne trouve rien. Peu à peu, cependant, vont s'accumuler les indices d'un naufrage, auquel ont survécu des membres de l'expédition qui ont réussi à gagner la terre. En 1827, le navigateur britannique Peter Dillon localise avec certitude le lieu du naufrage de l'un des bateaux, au large de l'île de Vanikoro, dépendance des îles Salomon, dans le Pacifique Sud, et rapporte en France les premiers objets récupérés de l'expédition. Le 26 février 1828, Dumont d'Urville repère à son tour l'une des épaves qui sera identifiée plus tard comme étant celle del'Astrolabe, dans une fausse passe de la barrière corallienne, et collecte quelques vestiges, mais doit écourter sa mission en raison de l'état sanitaire désastreux d'une grande partie de son équipage. Il faudra attendre ensuite plus d'un siècle pour que d'autres expéditions, réalisées par la Marine nationale ou par des particuliers, permettent de recueillir de nouveaux vestiges dans les fonds sous-marins, tout en poursuivant les recherches à terre. De 1962 à 1964, les recherches menées notamment par le Néo-Zélandais Reece Discombe et l'amiral Brossard aboutissent à la localisation de la seconde épave, celle de la Boussole, sur le site de La Faille. De 1981 à 2008, l'association néo-calédonienne Salomon, créée et présidée par Alain Conan, réalise huit expéditions de plus en plus importantes à Vanikoro. Entre autres résultats, celle de 1999 permet la découverte, à terre, des vestiges du camp où vécurent les membres rescapés de l'expédition de Lapérouse ; celle de 2003, la découverte du squelette presque complet d'un individu européen non identifié, âgé d'environ 32 ans, ayant participé à l'expédition ; enfin, celle de 2005, l'identification formelle de l'épave de la Boussole, grâce à la découverte dans celle-ci d'un sextant répertorié dans l'inventaire du matériel embarqué à bord du navire.
Sa vie
Né dans une famille noble originaire d'Albi, La Pérouse s'engage dans la Marine royale au début de la Guerre de Sept Ans. Il connaît son baptême du feu pendant ce conflit en Amérique du Nord et aux Antilles, sous les ordres du chevalier de Ternay, son mentor. Il est présent au siège de Louisbourg en 1758 et à la bataille des Cardinaux l'année suivante. Blessé au cours de ce combat, il est fait prisonnier en Angleterre avant d'être échangé. À la signature de la paix de Paris, il est affecté à différentes missions d'escortes, notamment à destination de l'Isle de France où il passe cinq ans et rencontre sa future femme.
Rentré en France avant le début de la guerre d'indépendance des États-Unis, il est promu lieutenant de vaisseau et décoré de la croix de Saint-Louis. Lors de la reprise des hostilités, il participe aux combats contre les Britanniques aux Antilles - il est à la prise de la Grenade et aux combats de Saint-Christophe et des Saintes - et il est chargé de conduire une expédition contre les établissements britanniques en baie d'Hudson, où il démontre sa valeur maritime et militaire en capturant deux forts britanniques.
Capitaine de vaisseau à la fin de la guerre, il est choisi par le marquis de Castries, ministre de la Marine et par Louis XVI pour diriger une expédition autour du monde visant à compléter les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique. Cette expédition maritime autour du monde, qu'il commandait, disparaît corps et biens à Vanikoro îles Santa Cruz en 1788, trois ans après son départ de Brest.
Une expédition de secours commandée par le vice-amiral d'Entrecasteaux est envoyée dans les années qui suivent le naufrage 1791-1794, sans succès. Le mystère de la disparition de La Pérouse n'est percé qu’en 1826 par Peter Dillon et par Jules-Sébastien-César Dumont d’Urville en 1828, qui retrouvèrent l’épave de L’Astrolabe. Enfin, Reece Discombe identifie celle de La Boussole en 1964.
Jean-François de Galaup naît le 22 ou le 23 août 1741 en Albigeois au manoir du Gô, à deux lieues d'Albi, et il est baptisé le 3 octobre 1741 dans la paroisse de Saint-Julien.
Il est issu d'une famille albigeoise dont la noblesse remonte à 1558. La famille de Galaup s'enrichit et est anoblie à la période faste de la culture et de la commercialisation du pastel. Les de Galaup, à l’origine seigneurs de Brens et d’Orban, non loin d’Albi, vont exercer des charges juridiques et administratives et occuper souvent les fonctions de consuls de la ville d'Albi. La famille possédait un manoir sur les terres du Gô, dans un méandre du Tarn en amont d'Albi, acquis en 1613 par Claude de Galaup, ainsi qu'une terre sur le territoire de l’actuelle commune de Puygouzon : la ferme de Lapeyrouse, La pierreuse.
Naissance
Son père, Victor-Joseph de Galaup 1709-1784 est député aux États particuliers d'Albigeois. Il est le fils de Jean-Antoine de Galaup né en 1677 et de Claire de Metgé. La famille de Galaup est alliée au Taffanel de la Jonquière.
Sa mère est Marguerite de Rességuier, née en 1717 à Sauveterre-de-Rouergue et morte à Albi, le 14 juin 1788, est la fille de Jean-Jacques Rességuier, seigneur du Pouget 1662-1725, ancien commandant du second bataillon de Condé, et de Françoise de Moly 1677-1764. La famille de Rességuier est alliée aux famille de Dalmas, Izarn, Guigard de Motarnal, Genton, Azémar, Flottes et Garrigues de Lagarde.
Le couple se marie le 4 octobre 1740, à Sauveterre-de-Rouergue. Jean-François est l'aîné de onze enfants. L'un de ses frères, Jacques Antoine Victor de Galaup 1749 - Quiberon, 16 juillet 1795, émigré, participe à l'expédition de Quiberon où il trouve la mort lors des premiers combats. Ne survivront à l’âge adulte que le fils aîné Jean-François, sa sœur Jacquette née un an après lui, et une sœur, Victoire, de 18 ans plus jeune.
La Pérouse navigua sur de nombreux vaisseaux en tant qu’enseigne avant d’être attaché, en 1757, au service du chevalier Charles-Henri-Louis d’Arsac de Ternay sous les ordres duquel il participa, à bord du Zéphir, à deux campagnes au Canada au cours de la guerre de Sept Ans. Le chevalier de Ternay éprouva rapidement de l’amitié pour cet enseigne et le prit sous sa protection. Aussi, lorsqu’il fut nommé gouverneur de l’île de France, actuellement l’île Maurice en 1772, La Pérouse, alors âgé de trente et un ans, l’y accompagna. C’est ainsi qu’il séjourna cinq années à l’Ile Maurice ancienne Ile de France de 1772 à 1777. Le futur illustre navigateur avait acheté, avec son ami le lieutenant de vaisseau Charles Mengaud de La Hague, une propriété de 156 arpents à Eau Coulée, donnant sur la Rivière du Mesnil, non loin de l’actuelle ville de Curepipe sur les hauts plateaux de l’île. C’est au cours de ce long séjour à l'île Maurice qu’il fit la connaissance de la famille Broudou qui, elle, habitait Rivière-la-Chaux près de l’actuelle ville de Mahébourg dans le sud. La Pérouse rencontra et fréquenta assidûment Éléonore Broudou 1755-1807, une des filles d’Abraham Broudou et de Françoise Cailliard et en tomba éperdument amoureux. Mais sa famille envisageait pour lui un autre mariage avec mademoiselle de Vésian, issue de la vieille noblesse d’Albi. Malgré ses trente-six ans, La Pérouse se plia aux exigences de son père et c’est la mort dans l’âme qu’il quitta l’Ile de France en 1777. Éléonore rejoignit sa mère à Nantes deux semaines plus tard et, au désespoir, s’attendait à prendre le voile tandis que La Pérouse s’engageait dans la guerre d’Indépendance américaine aux côtés du vice-amiral Charles Henri d’Estaing et rejoignait son escadre aux Antilles. Mais l’amour triompha. Les deux amoureux finirent par se marier à Paris, en 1783, en l’église Sainte-Marguerite. La Pérouse était alors âgé de quarante-deux ans et Éléonore en avait vingt-huit. Le couple ignorait alors que leur bonheur ne durerait que deux ans. On raconte que le ministre de la Marine, Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries, avait finalement donné son accord à cette union à la condition que La Pérouse accepte de prendre la direction d’une expédition scientifique d’envergure autour du monde.
Jean-François de La Pérouse épouse donc en 1783 Louise Éléonore Broudou 1755-1807, sœur de Frédéric Broudou qui prend part également à l'expédition funeste. Le couple n'a pas de postérité.
Jeunesse
La Pérouse passe sa jeunesse entre Albi et le Gô, avec probablement quelques séjours chez sa grand-mère à Sauveterre-de-Rouergue. Il parle occitan et français. Ses études secondaires au collège des Jésuites d'Albi, jusqu'à l’âge de 15 ans, sont dispensées en latin. Il y fait la rencontre d'autres nobles de la ville, futurs officiers de la Marine, tels que le marquis de Rochegude, né la même année que lui, et Charles Jean-Baptiste Mengaud de la Hage 1741-1779, dont les parents, originaires du Gers, habitaient Toulouse. Mengaud de la Hage deviendra l'un des meilleurs amis de La Pérouse. Il meurt noyé en mars 1779, alors que son navire La Charmante heurte un écueil et coule au large de la Chaussée de Sein.
Guerre de Sept Ans 1756-1763
Il entre dans la compagnie des Gardes de la Marine de Brest à quinze ans, le 19 novembre 1756, ayant ajouté au sien le nom de La Pérouse, celui d'une terre reçue de son père. Il est encouragé par l'un de ses parents, le marquis Clément de Taffanel de La Jonquière. Pendant ses études à Brest, il est engagé dès l'âge de 17 ans dans les conflits maritimes de la guerre de Sept Ans avec la Grande-Bretagne au large de l'Amérique du Nord, notamment à Terre-Neuve et sur le Saint-Laurent avec son cousin Clément puis avec le chevalier de Ternay, qui deviendra son véritable tuteur, ainsi qu'aux Antilles.
Jean-François de Galaup embarque en mars 1757 sur Le Célèbre dans l’escadre commandée par le comte Dubois de La Motte et envoyée au secours de Louisbourg, sur l'île Royale. Il échappe à l’effroyable épidémie qui ravage les vaisseaux et la ville de Brest où il revient le 12 novembre 1757. Le 22 février 1758, il embarque sur la frégate La Zéphyr dans l’escadre envoyée à Louisbourg aux ordres du comte Du Chaffault de Besné. Le 15 août, La Pérouse passe sur Le Cerf puis, le 16 mai 1759, sur le vaisseau Le Formidable dans l’escadre que le comte de Conflans prépare péniblement à Brest pour protéger un éventuel débarquement en Angleterre. Le 20 novembre, cette escadre de vingt-et-un vaisseaux se heurte, à l’entrée de la baie de Quiberon, aux vingt-trois bâtiments britanniques commandés par l'amiral Hawke. Le Formidable, dans l’arrière-garde, doit supporter tout le poids de l’attaque ennemie et offre une belle résistance ; La Pérouse reçoit deux blessures et, fait prisonnier, il est presque aussitôt échangé.
En mai 1762, La Pérouse embarque sur Le Robuste, dans la division commandée par le chevalier de Ternay, qui alla détruire les pêcheries britanniques de Terre-Neuve. En septembre 1763, Bidé de Chézac prend avec lui quelques Gardes de la Marine, dont La Pérouse, pour conduire de Lorient à Brest le vaisseau neuf Les Six Corps9.
Retour à la paix et missions dans l'océan Indien 1764-1778
La Pérouse est promu enseigne de vaisseau le 1er octobre 1764 et, de 1765 à 1769, il est affecté au transport maritime en France. En 1771, il fait campagne à Saint-Domingue actuelle île d’Haïti à bord de la frégate La Belle-Poule.
Au début de l’année suivante, il part pour l’Isle de France en compagnie de son protecteur Arsac de Ternay qui venait d’en être nommé commandant général. De là, il entreprend, en avril 1773, une longue expédition dans les mers de l'Inde. Il retourne à l’Isle de France en mars 1774 et regagne la France en mai 1777 après cinq ans d'éloignement. Promu lieutenant de vaisseau le 4 avril 1777, il est créé chevalier de Saint-Louis le mois suivant pour avoir sauvé Mahé des Indiens. Il est initié à la franc-maçonnerie dans la loge de Brest « l'Heureuse rencontre.
Chargé de deux voyages aux Indes orientales comme commandant de La Seine, il rencontre à l'Isle de France sa future épouse, Éléonore Broudou, fille d'un armateur nantais, devenu administrateur de la marine.
Les quatorze ans de paix de 1764 à 1778 lui permettent de consolider son expérience de la navigation en Atlantique et dans l'océan Indien, en qualité d'abord de simple officier, puis de commandant de plusieurs bâtiments du roi.
La guerre d'indépendance américaine 1778-1783
Lors de la reprise des hostilités en 1778, La Pérouse reçoit le commandement de la frégate L’Amazone qui, incorporée dans la division de La Motte-Piquet, part le 1er mai 1779 pour les Indes Orientales, escortant un convoi vers la Martinique. Ralliant le pavillon du vice-amiral, le comte d'Estaing, La Pérouse participe à la prise de la Grenade et au violent combat contre l’escadre de John Byron les 4, 5 et 6 juillet. Par la suite, à bord de L’Amazone, il est placé en surveillance devant Charleston en Caroline du Sud.
Combats dans les Antilles et en Amérique du Nord
La bataille des Saintes, 12 avril 1782. Promu capitaine de vaisseau le 4 avril 1780, La Pérouse reçoit le 18 décembre suivant le commandement de la frégate L'Astrée. Dès cette époque, une expédition est prévue contre les établissements britanniques de la baie d’Hudson mais divers contretemps provoquent son ajournement. Patrouillant dans les parages de l’île du Cap-Breton, sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, avec L’Astrée et L’Hermione, commandée par Latouche-Tréville. La Pérouse livre, le 21 juillet 1781, un brillant combat à un convoi britannique composé d'une frégate et de cinq petits bâtiments. Il s’empare de la frégate HMS Ariel et d'un bâtiment, les autres parvenant à fuir.
Combat du 21 juillet 1781.
Il escorte ensuite un convoi vers les Antilles décembre 1781, participa à l’attaque de Saint-Christophe février 1782, aux combats des 9 et 12 avril au large des îles des Saintes contre l’escadre de l’amiral Rodney.
L'expédition de la Baie d'Hudson 1782
La flotte française est vaincue, mais La Pérouse parvient sans encombre au Cap-Français Cap-Haïtien, Haïti où, le 14 mai, il prend le commandement du vaisseau Le Sceptre et appareille, le 31 du même mois, avec les frégates L'Astrée et L'Engageante pour la baie d'Hudson. Il emmène avec lui 250 soldats, 40 artilleurs, quatre pièces de canon et deux mortiers. Malgré une navigation extrêmement difficile, il parvint, à la mi-juillet, dans le détroit d’Hudson et, le 8 août, en vue de l’entrée de la rivière Churchill Manitoba. Le lendemain, il débarque ses troupes et somme l’agent principal Samuel Hearne de se rendre, ce que ce dernier fait aussitôt. Le Fort Prince of Wales est détruit partiellement, les cartes et plans de la Marine britannique, les stocks de vivres et de fourrures sont saisis. Le 24 août, il attaque avec succès York Factory Manitoba. Pressé par le mauvais temps, La Pérouse repart aussitôt après avoir exécuté fidèlement sa mission, sans perdre un homme et tout en traitant ses prisonniers avec la plus grande humanité. Il permet notamment à Samuel Hearne de retourner en Angleterre en échange de la libération de prisonniers français et de la publication de la cartographie britannique qu'il lui a redonnée. Cette expédition lui valut une pension de 800 livres.
Cette expédition resta assez obscure à l'époque, mais elle développa les talents de La Pérouse, et le fait connaître comme un officier capable de diriger une campagne de découvertes. Il venait de parcourir des parages peu connus, et il avait eu à surmonter, dans un espace très restreint, la plupart des dangers que la navigation peut offrir dans toute l'étendue du globe. Cette renommée lui vaudrait le commandement de l'expédition de 1786 autour du monde.
Nommé capitaine de vaisseau à 39 ans pour sa brillante conduite pendant la guerre, il épouse Éléonore Broudou en 1783, malgré quelques objections paternelles, et l'installe à Albi dans une maison achetée rue de l'École Mage13. À cette occasion, La Pérouse est forcé de demander à son père son émancipation par manumission, comme au Moyen Âge, car le droit d'Ancien Régime en fait toujours un mineur incapable de se marier et d'acheter des biens immobiliers14, malgré son âge mûr et sa situation.
L’Expédition autour du monde 1785
Après le traité de Paris, il est choisi par Charles Pierre Claret de Fleurieu alors directeur des ports et arsenaux, chargé de l'organisation de l'expédition, et confirmé par le marquis de Castries, ministre de la Marine et par Louis XVI, en raison de sa grande expérience et de ses qualités humaines, pour diriger une expédition autour du monde visant à compléter les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique15. En juillet 1785, peu avant son départ, La Pérouse est promu brigadier des armées navales.
La Boussole et L'Astrolabe, les deux frégates de l’expédition préparée principalement par Charles Pierre Claret de Fleurieu avec le concours de l’Académie des sciences, partent de Brest le 1er août 1785, franchissent facilement le cap Horn et arrivent à la baie de Concepción Chili le 23 février 1786. Le 9 avril, La Pérouse fait escale à l’île de Pâques, et, en mai, aux îles Sandwich Hawaii où il découvre l’île Maui négligée par James Cook. Le 23 juin, les frégates arrivent en vue du mont Saint-Élie sur la frontière de l’Alaska et du Canada. La Pérouse descend ensuite le long de la côte ouest de l’Amérique en multipliant les reconnaissances hydrographiques. Le 14 septembre, il arrive à Monterey Californie où Esteban José Martínez lui vient en aide pour diriger les deux frégates dans le port. Traversant le Pacifique d’est en ouest, il entre à Macao, Chine, le 3 janvier 1787, puis, le 26 février, dans la baie de Manille avant de remonter vers le nord. Premier navigateur européen à pénétrer dans les parages situés entre la Chine et le Japon, La Pérouse découvre le détroit entre Yeso ancien nom de l'île d'Hokkaidō, au Japon et Sakhaline Russie qui porte son nom, avant de faire escale, le 7 septembre, dans la baie d’Avacha Tar’ya sur la côte de la péninsule Kamtchatka. C'est là qu'il reçoit une commission de chef d'escadre, arrivée de France. L’interprète Jean-Baptiste-Barthélemy de Lesseps débarque, avec les rapports et les cartes établis par son chef, pour regagner la France par la Sibérie.
Trajet de La Pérouse en 1787 le long des côtes asiatiques
La Pérouse se dirige alors vers le Pacifique central, débarque le 9 décembre à Maouna Tutuila, îles Samoa, continue sa route vers les îles des Amis îles Tonga, puis arrive le 26 janvier 1788 à Botany Bay, en Australie. Il en repart vers le 15 mars en direction du nord-est. Prises dans un cyclone, les frégates se brisent aux alentours de l’archipel des Îles Santa Cruz au milieu de juin 1788.
Trajet emprunté par l'expédition de La Pérouse jusqu'à Botany Bay
Recherche des traces de l'expédition
L'Expédition d'Entrecasteaux 1791-1794 et rumeurs à la fin du XVIIIe siècle
La Recherche et L'Espérance, par François Roux. Les deux navires de l'expédition envoyée à la recherche de La Pérouse
Une expédition part à sa recherche en septembre 1791. Dirigée par l'amiral d'Entrecasteaux, elle part de Brest le 28 septembre avec deux frégates La Recherche et L'Espérance. Elle atteint l'île des Pins le 16 juin 1792 ; puis le 19 mai 1793, l'expédition découvrit une île nouvelle que d'Entrecasteaux baptisa l'île de La Recherche. Or c'est sur cette île également appelée Vanikoro que les survivants de l'expédition La Pérouse et peut-être La Pérouse lui-même avaient trouvé refuge. L'expédition poursuit sa route vers Surabaya sans jamais l'atteindre.
Plusieurs rumeurs couraient à l'époque. Une des déclarations les plus retentissantes est celle du Britannique George Bowen, capitaine du navire Albemarle, devant les autorités de Morlaix, en 1793. Cet officier prétend avoir vu, dans la nuit du 30 décembre 1791, sur la côte de la Nouvelle-Géorgie, des débris de vaisseau, des filets de main-d'œuvre européenne. Les contradictions de cette déclaration ne permettent pas d'en faire la base d'une tentative sérieuse. Toutefois, malgré le peu de succès des recherches, on avait toujours gardé l'espoir de retrouver une partie de son équipage, ou au moins un indice de leur destin. Divers bruits de cette nature se succédèrent presque d'année en année, mais ils parurent trop peu fondés pour mériter de fixer l'attention.
XIXe siècle
l'expédition Dumont d'Urville et découverte Peter Dillon
Enfin, vers la fin de 1825, un officier britannique affirme savoir d'un capitaine américain, que celui-ci, après avoir découvert un groupe d'îles bien peuplées et entourées de récifs, en avait rencontré les habitants, et vu entre leurs mains une croix de Saint-Louis et des médailles comme celles que la Pérouse avait emmenées. Ces indices pouvaient faire croire que les bâtiments de la Pérouse avaient péri sur ces îles. Mais la position de ces îles restait inconnue. Quoique l'espoir de le retrouver fût presque évanoui, et que le rapport du capitaine américain omît ce renseignement capital, on voulut lancer une nouvelle expédition.
Dumont d'Urville, alors capitaine de frégate, en est vivement frappé. Il prend la tête d'une nouvelle entreprise de circumnavigation qui part de Toulon le 25 avril. Quatre mois après, le 15 août, un vaisseau de la compagnie anglaise des Indes orientales, expédié spécialement à la recherche des traces de La Pérouse, mouille dans la rade de Tonga-Tabou.
En 1828, Dumont d'Urville reconnaît après l'explorateur britannique Peter Dillon, dans l'île de Vanikoro le lieu probable du naufrage et de la mort de Jean-François de La Pérouse. Il retire du corail des ancres, des pierriers ayant appartenu à L'Astrolabe mais toujours pas de trace de La Boussole.
Peter Dillon.
Entre temps, le capitaine marchand Peter Dillon découvre en 1826-1827 les restes du naufrage à Vanikoro, Îles Santa Cruz Îles Salomon, au nord du Vanuatu. Ce dernier découvre la cloche de L'Astrolabe et des pierriers de bronze qui avaient été conservés par les habitants. Quant à La Boussole pas la moindre trace. Il apprend sur l'île de Vanikoro comment deux grands navires s'étaient échoués par une nuit de grande tempête : l'un aurait coulé, l'autre se serait échoué et les survivants auraient pu s'installer sur un point de Vanikoro, nommé Paiou. Cinq ou six mois après, une partie des survivants seraient repartis à bord d'un petit bateau fabriqué avec les débris du grand. L'autre partie resta à Vanikoro, se mêla aux affrontements des indigènes. Le dernier des survivants serait mort peu avant la venue de Peter Dillon.
Dans les années qui suivirent, deux autres explorateurs français passent par Vanikoro : Legoarant de Tromelin retrouve les ancres et les canons qui sont déposés, depuis 1884, au pied du monument dressé en l'honneur de La Pérouse par la ville d'Albi.
Années 1960-2000 : exploration des épaves
En juin 1962, un plongeur néo-zélandais fixé à Port Vila accompagne Pierre Anthonioz dans son expédition. Reece Discombe prospecte le récif de part et d'autre du gisement de L'Astrolabe et repère rapidement, par 15 mètres de fond, des formes d'ancres et de canons pris dans le corail. Il remonte un plomb de sonde qu'il pense être de La Boussole.
En février 1964, Reece Discombe revient sur les lieux et il remonte des pierriers, une poulie de bronze. En mars, avec l'amiral de Brossard de la Marine Nationale, il retrouve beaucoup d'objets dont une partie est exposée au musée d'Albi, dont une cloche attribuée à La Boussole.
Depuis le début des années 1980, des plongeurs de l'association Salomon organisent des campagnes de fouilles et d'archéologie sous-marine sur les lieux du naufrage, permettant de remonter un grand nombre d'objets ayant appartenu aux membres de l'Expédition de La Pérouse.
Jugement par ses contemporains et les historiens
Extrait des Mémoires d'outre-tombe. François-René de Chateaubriand doit être reçu par le comte d'Hector en préalable à son entrée aux gardes de la marine.
Lorsque le comte de Boisteilleul me conduisait chez M. Hector, j'entendais les jeunes et les vieux marins raconter leurs campagnes, et causer des pays qu'ils avaient parcourus : l'un arrivait de l'Inde, l'autre de l'Amérique ; celui-là devait appareiller pour faire le tour du monde, celui-ci allait rejoindre la station de la Méditerranée, visiter les côtes de la Grèce. Mon oncle me montra La Pérouse dans la foule, nouveau Cook dont la mort est le secret des tempêtes. J'écoutais tout, je regardais tout, sans dire une parole ; mais la nuit suivante, plus de sommeil : je la passais à livrer en imagination des combats, ou à découvrir des terres inconnues… »
L'historien et spécialiste de la Marine Étienne Taillemite dit de lui :
Lapérouse représente le type le plus accompli du marin du XVIIIe siècle. Excellent navigateur, brillant combattant, chef très humain, esprit ouvert à toutes les sciences de son temps, il sut toujours habilement combiner prudence et audace, expérience et théorie. Aussi habile qu’infatigable, aussi aimable que ferme, il savait se faire aimer de tous.
Honneurs et postérité Citation
Les dernières paroles de Louis XVI avant de quitter sa prison le jour de son exécution auraient été, selon certains chroniqueurs :
A-t-on des nouvelles de monsieur de La Pérouse ?
Lieux nommés d'après La Pérouse
Jean-François Galaup de La Pérouse a laissé son nom :
au détroit entre les îles de Hokkaido et de Sakhaline,
à une baie de l'île de Pâques,
à une localité de la banlieue de Sydney près de l'endroit où il aborda en 1788 voir La Perouse,
à un îlot nommé piton de La Pérouse au centre de l'atoll de la Frégate française French Frigate Shoals dans l'archipel d'Hawaï,
à la pointe du sud de l'île de Maui archipel d'Hawaï appelée La Pérouse Bay.
à des lycées à Albi lycée Lapérouse, Nouméa et San Francisco.
à un cratère lunaire, La Pérouse, attribué par l'Union astronomique internationale en 1935.
à une rue du 16e arrondissement de Paris : la rue La Pérouse.
à une rue de Nantes : rue La Pérouse.
à une rue de Reims dans le quartier des Chatillons ; la Rue La Pérouse.
à une place de Bompas Pyrénées orientales.
à une rue de Rochefort en Charente-maritime berceau de l'Hermione: rue La Pérouse.
à un lycée de Brest renommé Lapérouse-Kerichen en 2014
Une école maternelle La Pérouse à Reims
Statues, stèles, mémoriaux
En 1825 à l'initiative de Hyacinthe de Bougainville, commandant La Thétis, une colonne a été élevée à Botany Bay (Australie).
En 1843 un monument a été érigé, à l'initiative de la France, après autorisation du Tsar, à Petropavlosk (Russie). Détruit en 1854, il a été restauré en 1882 aux frais du savant polonais Dybowski.
En 1853, la ville d'Albi, patrie du navigateur, lui a élevé une statue de bronze œuvre du sculpteur Raggi.
En 1887 aux Samoa un mémorial a été élevé par la Marine Nationale à la mémoire du capitaine de vaisseau de Langle tué en septembre 1787.
En 1947 une plaque a été apposée près de l'église de San Carlos de Borromeo à Carmel USA.
En 1952 une plaque du souvenir faisant mention de la prise du fort Prince of Wales Canada a été apposée par Historical Sites and Monuments Board of Canada.
En 1985 dépôt d'une plaque du souvenir sur l'île du Cénotaphe à Lituya Bay Alaska-USA. Disparue depuis.
En 1997 un monument est érigé à Ternei Russie à l'initiative des autorités de la ville qui porte le nom emprunté à un toponyme donné par Lapérouse quand il aborda sur les côtes de la Manche de Tartarie : Ternay.
Le 30 mai 1994, une plaque commémorative est inaugurée par The friends of La Pérouse, en souvenir de l'arrivée le 30 mai 1786 de l'Amiral Jean-François Galaup, comte de La Pérouse, au lieu-dit Keone'O'Iu, ou La Pérouse Bay, à Maui archipel des Îles Hawaï.
Le 5 mai 2006 était inauguré à Tomari-Penzenskoi Ile Sakhaline-Russie une stèle à Lapérouse grâce à l'action de Jacques Bodin et des autorités locales.
Le 27 octobre 2007 a été érigé au cap Soya Hokkaïdo-Japon un monument commémorant le passage de Lapérouse dans le détroit qui porte son nom. Ce monument a été élevé grâce aux initiatives de MM. Jacques Bodin et Shunzo Tagami avec les aides de la municipalité de Wakkanaï et de l'association Lapérouse d'Albi.
Le 29 juin 2011 est inaugurée une stèle sous laquelle repose l'inconnu de Vanikoro à la mémoire de l'expédition La Pérouse. Elle est située dans la cour d'honneur de la préfecture maritime de Brest18.
En 2013 un monument est érigé grâce aux autorités locales en Baie de Kastri Russie en un lieu nommé par Lapérouse en l'honneur du ministre de la Marine de Castries les Russes ignoraient que l'on prononce "Castres".
Navires
Cinq navires de la Marine nationale française ont aussi porté son nom.
La Pérouse : croiseur de 1re classe, mis sur cale à Brest en 1875, lancé en 1877. Il fait naufrage à Madagascar le 31 juillet 1898.
Un bâtiment hydrographique, mis sur cale à Penhoët en 1938, saisi sur cale par les Allemands en juin 1940 qui le rebaptisèrent SG4 Merkur. Il est récupéré en 1945 à Saint-Nazaire. En 1946, il prend le nom de La Pérouse. Désigné comme aviso de 1re classe F 750, il est cependant principalement déployé en océan Indien, basé à Diego Suarez, et effectua des missions hydrographiques aux Terres australes et antarctiques françaises TAAF
Un bâtiment hydrographique du type éponyme.
Un navire porte-conteneur de 13800 EVP, le CMA CGM Laperouse, de la compagnie française CMA CGM
À Anvers en Belgique, un bateau restaurant porte son nom.
Philatélie
De nombreux timbres commémoratifs ont été dessinés en mémoire de l'expédition de La Pérouse, certains ayant été diffusé en 1988 à l'occasion du bicentenaire de la disparition du navigateur et de son équipage.
Centenaire de la mort de La Pérouse
Le centenaire de la mort de La Pérouse est célébré le 20 avril 1888 en séance solennelle dans le grand amphithéâtre à La Sorbonne, par la société de géographie, sous la présidence de Ferdinand de Lesseps, de l'Institut ; le contre-amiral vicomte Fleuriot de Langle et Norbert de Barthès de Lapérouse, commissaire de la Marine en retraite et petit-neveu de l'illustre navigateur, étaient membres du Comité d'organisation. Ce dernier avait réuni pour l'occasion une importante collection d'objets lettres, portraits, ouvrages, etc. en tout 173 articles dont plus de cent provenaient de sa collection personnelle.
Expositions
Deux expositions lui ont été consacrées au Musée national de la Marine à Paris. La première intitulée La généreuse et tragique expédition de La Pérouse a eu lieu du 13 juin 1985 au 23 septembre 1985. La seconde Le mystère Lapérouse, enquête dans le Pacifique sud a eu lieu quant à elle du 19 mars 2008 au 20 octobre 2008.
Œuvres sur de La Pérouse
Jean-François de La Pérouse, Voyage autour du monde sur l’Astrolabe et la Boussole, Paris, La Découverte, 2005, poche Voyage Round the World; Performed in the Years 1785, 1786, 1787, and 1788, by the Boussole and Astrolabe chapitres VI à XII - Volume 2 chapitre XVI
Carte D'Une Partie Du Grand Océan à l'E et S.E. de la Nouvelle Guinée pour l'intelligence du Voyage de la Frégate Espagnole la Princesa commandée par D. Francisco Antonio Maurelle en 1781 Paris 1789
Carte du Grand Océan ou Mer du Sud dressée pour la relation du voyage de decouvertes faites par les frégates françaises la Boussole et l'Astrolabe dans les années 1785, 86, 87 et 88
Iconographie Sources et bibliographie
Des journaux de navigation de Jean-François de La Pérouse sont conservés aux Archives nationales sous la cote 489AP. Ils sont consultables sous forme de microfilms.
Jean-François de La Pérouse, dans Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et littérateurs français ou étrangers, 2e édition, 1843-1865 détail de l’édition
Bruno de Dinechin, Duhamel du Monceau : un savant exemplaire au siècle des Lumières, Luxembourg, Connaissance et mémoires européennes, 1999, 442 p.
Œuvres anciennes sur La Pérouse
Jean-Baptiste de Lesseps oncle de Ferdinand de Lesseps, qui avait fait une partie de la campagne de La Pérouse, s'en était séparé au Kamtchatka et était revenu en France par terre, avec tous les journaux et cartes qui ont été publiés. Son récit de voyage entre le port de St-Pierre et St-Paul et Okhotsk puis Saint-Pétersbourg est imprimé en 1790.
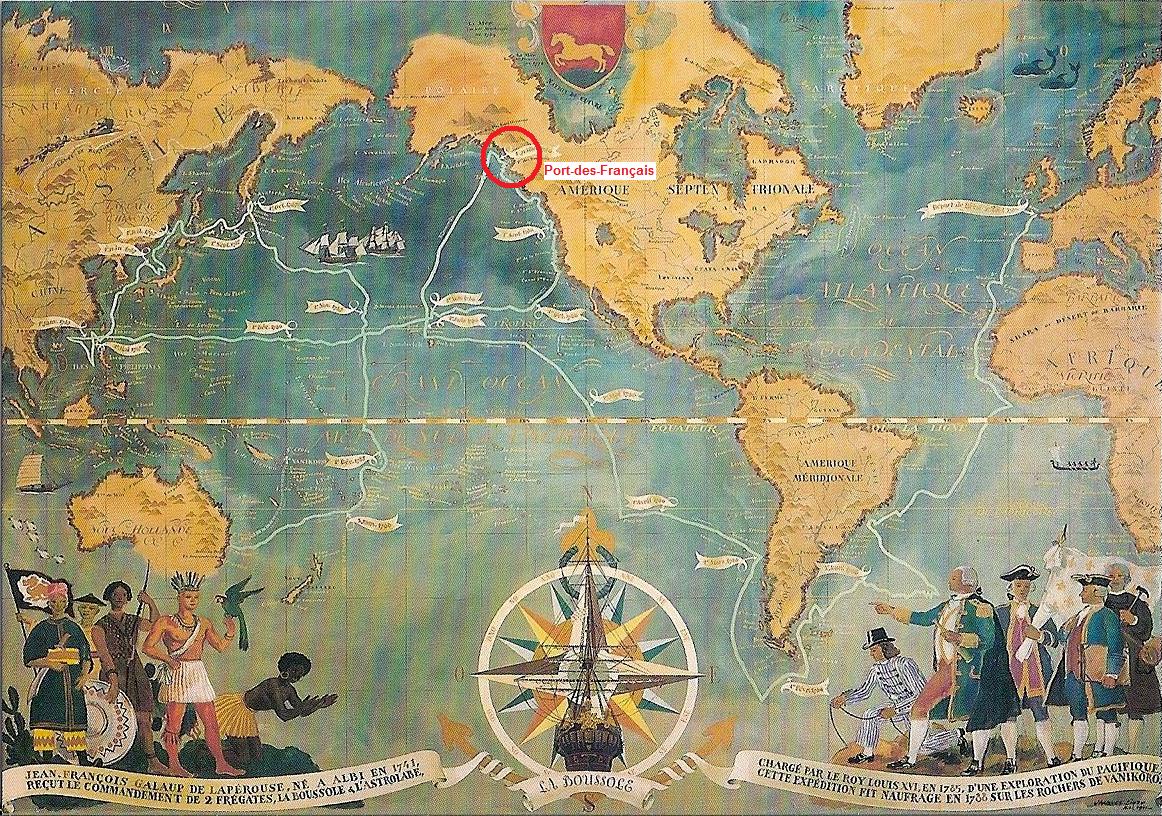          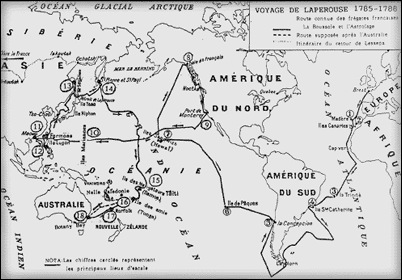  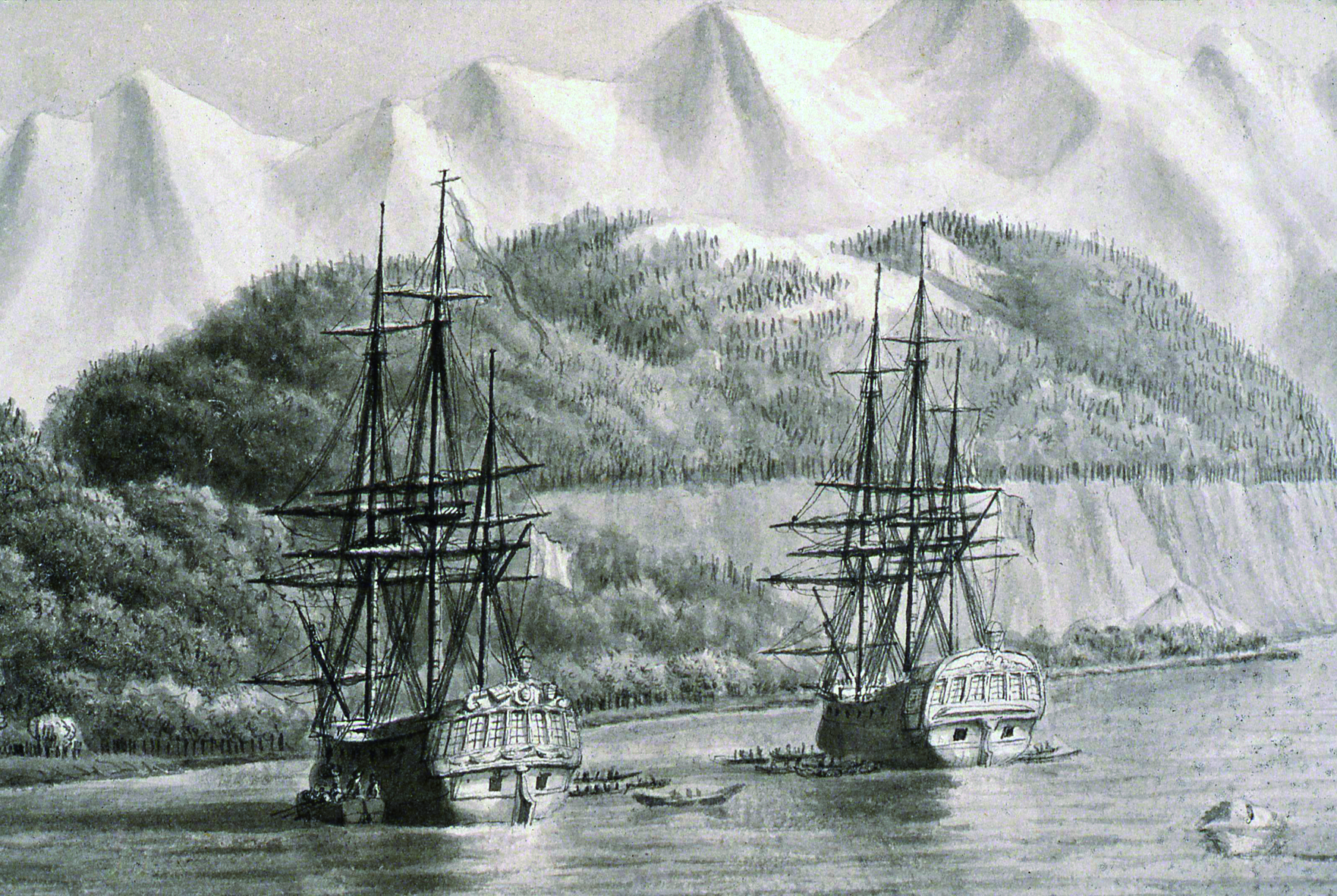 
Posté le : 21/08/2015 17:22
Edité par Loriane sur 22-08-2015 14:02:43
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
100 Personne(s) en ligne ( 65 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 100
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages