|
|
Re: Le prince youssoupov |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Oui, ces gens ont connu une période bien troublée et dont les conséquences sont encore présentes dans la politique de nos jours, même si certains pensent que prendre le contre-pied des voies choisies par nos ancêtres est une solution, ce qui n'est pas bien sûr.
La naissance du communisme fut un tremblement ethnologique qui a mis beaucoup de monde sur les routes.
Ils ont traversé des épreuves bien cruelles.
Ioussoupov croyait bien naïvement que tuer Raspoutine ramènerait le calme du passé, et ... ! en définitive, non !
Quand l'histoire est en marche, elle est en marche et il semble que rien ne puisse l'arrêter
Merci de ton passage.
Posté le : 04/10/2015 22:13
|
|
|
|
|
Re: Le prince youssoupov |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Chère Loriane,
J'ai lu avec grand intérêt la vie du prince Youssoupov et de sa femme Irène que je ne connaissais pas réellement.
Quelle histoire que celle des femmes et des hommes qui ont connu l'exil!
Je te souhaite un bon week end.
Amitiés de Dijon.
Jacques
Posté le : 03/10/2015 18:25
|
|
|
|
|
Louis X le hutin |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 4 octobre 1289 à Paris naît Louis X de France
dit le Hutin c'est-à-dire l'entêté, mort à 26 ans, le 5 juin 1316 à Vincennes, est roi de Navarre de 1305 à 1316 sous le nom de Louis Ier et roi de France de 1314 à 1316 sous le nom de Louis X, douzième de la dynastie dite des Capétiens directs.
Fils du roi de France, Philippe IV le Bel, et de la reine de Navarre, Jeanne Ire, Louis X ne laisse pas de descendance au trône de France ; son seul fils, Jean Ier le Posthume, né après sa mort, ne vit que quelques jours. Il est roi de France du 29 novembre 1314 au 5 juin 1316 soit 1 an 6 mois et 7 jours, il est couronné le 24 août 1315, en la cathédrale de Reims, sont prédécesseur est son père Philippe IV le Bel, sont successeur naturel est Jean Ier le Posthume qui ne vit que quelques jours. Il est roi de Navarre sous le nom de Louis Ier du 4 avril 1305 au 5 juin 1316 soit durant 11 ans 2 mois et 1 jour, il est précédé par Jeanne Ire et Philippe IV le Bel
Son successeurest là encore Jean Ier le Posthume son fils décèdé jeune. Sa sépulture se trouve dans la basilique de Saint-Denis près de Paris. Il est l'époux de
Marguerite de Bourgogne 1305-1315 avec qui il a une fille Jeanne II, puis de Clémence de Hongrie 1315-1316, avec qui il a un fils Jean 1er le postume
En bref
La Cour, sous l'influence de son oncle, Charles de Valois, s'en prend à l'entourage de l'ancien monarque, dont la plupart des officiers sont destitués.
Sans mettre en cause le principe monarchique et l'autorité du gouvernement, les nobles demandent au roi de leur confirmer les chartes qui, dans chaque province, précisent leurs droits et coutumes. Le « mouvement des chartes » aboutit à la concession par le roi de diverses chartes aux Languedociens, aux Bourguignons, aux Picards, aux Champenois, aux Auvergnats, aux Berrichons, aux Nivernais, aux seigneurs des basses Marches, etc. 1315.
Louis X réussit cependant à limiter la portée de ces privilèges et parvient à obtenir le concours des barons pour mener campagne contre la Flandre, sans résultat d'ailleurs.
Il meurt alors que la reine, Clémence de Hongrie, attendait un enfant : ce sera le roi Jean Ier qui mourra aussitôt. De ce fait, la couronne passe au frère de Louis X, Philippe V le Long. Louis X avait épousé, en premières noces, Marguerite de Bourgogne, qui fut condamnée pour adultère.
Fils aîné de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre, Louis X hérite d'un domaine agrandi la Champagne et le royaume de Navarre, d'une souveraineté renforcée, mais aussi des problèmes qui ont freiné l'action de son père à la fin de son règne.
Sa première femme, Marguerite, fille de Robert II duc de Bourgogne, épousée en 1305, est mêlée au scandale de la tour de Nesle. Elle meurt, étouffée dans des conditions mystérieuses, à Château-Gaillard. Louis X, aux yeux de l'opinion largement informée, apparaît plutôt comme un roi fragile et malchanceux.
Son avènement favorise une recrudescence de l'agitation. En fait, face à une situation économique et politique difficile, l'apparente résignation du roi le sert.
L'expansion de la société féodale XIe-XIIIe s. atteint alors ses limites. La crise de subsistance de 1315-1317 marque le retournement de la conjoncture. Des milliers de personnes meurent de faim dans le nord du royaume. La hausse des prix, encore accélérée par la crise, provoque un mécontentement général. Les revendications sont surtout politiques. La petite noblesse en est le moteur. Des ligues, constituées dès 1314, pays par pays, présentent leurs doléances dans de longs rouleaux.
Les nobles ruinés par la hausse des prix, n'admettent pas que l'administration royale locale empiète sur leurs pouvoirs et réduise leurs finances. Plutôt que de briser la résistance, Louis X choisit de négocier.
Avec habileté, il met les abus sur le compte des officiers royaux et joue sur les particularismes locaux. Il octroie ainsi une série de chartes provinciales dans lesquelles il prend soin de réserver ses droits de roi. Le mouvement, peu cohérent, est vite désamorcé.
Mais, quand Louis X disparaît de façon prématurée, deux graves problèmes ne sont pas résolus. Les grands, hostiles aux méthodes de gouvernement de Philippe le Bel, et en particulier à l'entrée des légistes au Conseil, obtiennent, en 1315, l'exécution de l'impopulaire Enguerrand de Marigny. Le roi le sacrifie à la vindicte de tous. Cependant, les grands, menés par l'oncle du roi, Charles de Valois, ne désarment pas. Ils veulent à nouveau dominer le Conseil et diriger à leur profit les affaires du royaume. Mais, surtout, Louis X est le premier Capétien à ne pas laisser d'héritier mâle.
De son premier mariage, il a eu une fille, Jeanne. Le sort de la monarchie est suspendu à l'héritier qu'attend sa seconde femme, épousée en 1315, Clémence de Hongrie. Celui-ci, un garçon, Jean Ier Posthume, ne vit que quelques jours.
Le problème de la succession reste ouvert. Période de réaction violente sur un arrière-plan de crise, le règne de Louis X marque le pas dans les progrès de la monarchie. Le dialogue du roi et de la nation est devenu nécessaire. Claude Gauvard
Sa vie
Roi de Navarre
En 1305 Louis X hérite de la couronne de Navarre au décès de sa mère, Jeanne de Champagne, reine de Navarre. Le royaume est administré localement par un gouverneur nommé par les souverains français. Philippe IV le Bel qui maintient ses fils sous sa dépendance et son strict contrôle selon les habitudes héritées de Philippe Auguste, ne l'autorise à se rendre en Navarre qu'en 1307 pour s'y faire couronner par l'assemblée des nobles, les Corte. Louis X se rend en Navarre avec son épouse Marguerite de Bourgogne et une forte délégation de nobles français. Ils sont couronnés à Pampelune, le 1er octobre 1307, roi et reine de Navarre.
Roi de France
Bien que Louis X n'ait régné que deux courtes années, on peut tout de même noter certains éléments de sa politique. Succédant à Philippe le Bel, de 1314 à 1316, il doit faire face aux révoltes suscitées par la politique de son prédécesseur et menées par les barons qu'il calme par des concessions.
Isolé dans un conseil étroit, Louis X doit rechercher l'appui de ses frères Philippe de Poitiers et Charles de la Marche. Les trois frères, dont la descendance est douteuse depuis l'affaire de la tour de Nesle, n'ont pas d'héritier mâle. Leurs épouses sont en prison. Le comte de Valois est tout puissant et il a trois fils dont l'aîné est le futur Philippe VI ; il est un de ceux qui mènent la révolte des seigneurs.
Louis X s'allie à son frère Philippe de Poitiers en échange de l'héritage du comté de Bourgogne. Philippe IV a acheté les droits de la Comté Franche à Othon IV de Bourgogne en échange d'une alliance matrimoniale. Les deux filles d'Othon IV de Bourgogne épousent respectivement Philippe de Poitiers et Charles de la Marche. En acceptant de perdre ses droits de succession sur le comté de Bourgogne, l'ainée d'Othon, Jeanne II de Bourgogne, en conserve la jouissance et le titre, tandis que sa cadette Blanche de Bourgogne reçoit en dot 20 000 marcs d'argent. Selon le testament de Philippe IV le comté doit revenir à la couronne si Philippe de Poitiers et Jeanne de Bourgogne n'ont pas de fils. Philippe de Poitiers monnaye son appui en exigeant que son épouse Jeanne puisse léguer la Franche-Comté à sa fille ainée, en plus de l'Artois qui lui vient de sa mère Mahaut d'Artois. Cet accord, par lequel Louis X paye la stabilité de son début de règne, doit amener sous le règne de Louis XI la difficile succession de la Bourgogne et de l'Artois, réunies entre les mains des Habsbourg par mariage, et sous Louis XIV la guerre de Dévolution de l'Artois et de la Franche-Comté.
Ne pouvant briser la résistance des nobles, Louis X choisit de négocier. Avec habileté, il met les abus sur le compte des officiers royaux et joue sur les particularismes locaux. Il octroie ainsi une série de chartes provinciales durant l'année 1315 qui ont pour fonction de répondre aux attentes de la population. Les baillis et sergents royaux intervenant dans tout le comté d'Amiens ainsi que celui de Vermandois, au mépris des droits du comte, ont interdiction sur ordonnance de Louis X d'exercer leurs prises, ajournements et autres faits de justice. Il répond donc aux attentes des ligues nobiliaires en garantissant leurs privilèges, leurs droits de haute justice et y compris celui de port d’armes à travers ces chartes provinciales destinées à satisfaire les différentes requêtes nobiliaires dans les différentes provinces du royaume. D’autres chartes régionales de ce type ont été certainement concédées dans les mêmes conditions. Ces ordonnances qui redonnent un certain pouvoir aux nobles et à l'aristocratie ainsi que les droits et prérogatives qu'ils ont perdu sous Philippe IV le Bel contribuent à affaiblir le pouvoir royal au détriment de l'idée d'unité souveraine qu'ont menée ses prédécesseurs.
La fronde menée par les nobles est soutenue par le peuple oppressé par les taxes et impôts et par les ligues nobiliaires. Elle fait de nombreuses victimes, notamment Enguerrand de Marigny qui est pendu, Pierre de Latilly ou encore Raoul de Presles qui sont torturés. Louis X renonçe à les défendre, tant la parole du roi est devenue inaudible. La monarchie subit un véritable recul pendant ces deux années de règne, surtout dans le domaine fiscal. Le roi ne peut plus lever d'impôts indirects puisque la noblesse veut battre sa monnaie. Les provinces restent fidèles à la couronne, mais rebelles à de nouveaux impôts.
Louis X doit faire face à un conflit avec les Flamands, pour lequel il promulgue l'édit du 3 juillet 1315 qui tourne au fiasco. L'expédition, montée grâce au rappel des Lombards, s'enlise dans la Lys en crue. Louis X doit rebrousser chemin piteusement. C'est au retour qu'il épouse Clémence de Hongrie à Troyes le 19 août 1315.
Décès
Louis X est pris de malaise après une partie de jeu de paume à Vincennes. Il a bu un vin glacé alors qu'il était échauffé. Pris de remords de n'être pas intervenu, il fait dédommager les enfants d'Enguerrand de Marigny qu'il n'a pas pu sauver et fait rendre à Raoul de Presles les biens dont il a été spolié.
Mariages et descendance
Louis X a deux enfants.
En 1305, il épouse en premières noces Marguerite de Bourgogne, capétienne comme lui, fille de Robert II, duc de Bourgogne et d'Agnès de France. Convaincue d'adultère avec la complicité de ses belles-sœurs scandale de la Tour de Nesle, Marguerite est condamnée à l'enfermement à Château-Gaillard et la rumeur voudrait qu'elle y ait été étouffée ou étranglée à l'instigation de son royal époux. De cette union est issue la future Jeanne II, reine de Navarre de 1328 à 1349.
Le 19 août 1315, Louis X épouse en secondes noces Clémence de Hongrie, elle aussi capétienne, fille de Charles d'Anjou, dit Charles-Martel de Hongrie, roi titulaire de Hongrie et de Clémence de Habsbourg. De cette union est issu un unique enfant, posthume de plusieurs mois, qui ne vit que quelques jours, Jean Ier le Posthume, roi de France et de Navarre.
Une succession disputée
La question d'une éventuelle illégitimité de la princesse Jeanne, issue de la première union, à la succession au trône de France se pose à la noblesse française. En effet, l'absence d'héritier mâle direct ne s'est encore jamais produite. C'est ce que l'on a appelé le miracle capétien. La succession à la couronne française, préalablement élective, s'était faite peu à peu par l'usage. La noblesse française préfére selon le principe de la masculinité qui régissait les fiefs offrir le trône au frère de Louis X, Philippe V le Long, qui est déjà régent depuis la mort de Louis X. Cet épisode de l'histoire de France a donné lieu à une interprétation romancée, Les Rois maudits, de Maurice Druon.
   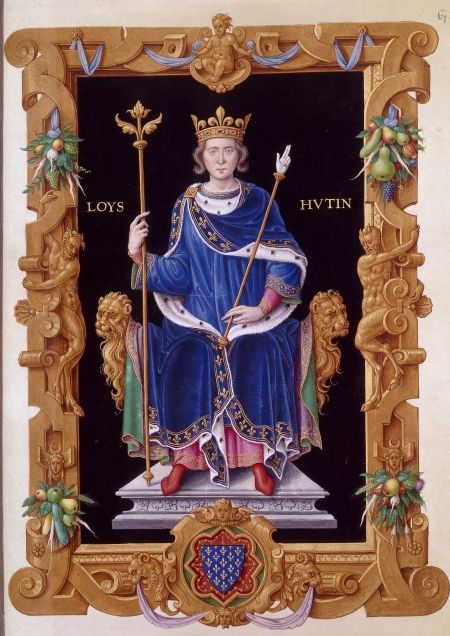     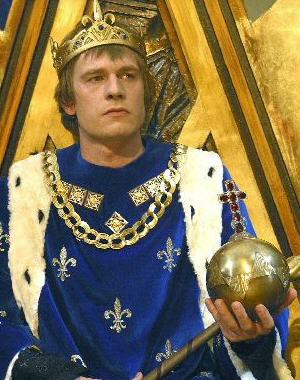 
Posté le : 03/10/2015 17:27
|
|
|
|
|
Le prince youssoupov |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 27 septembre 1967 à Paris meurt Félix Ioussoupov
prince Russe, de son nom complet Félix Felixovitch Ioussoupov, translittération récente ou Félix Youssoupoff orthographe traditionnelle en français ou Youssoupov orthographe moderne en russe Феликс Феликсович Юсупов, prince Ioussoupov et comte Soumakorov-Elston russe : Князь Юсупов и Граф Сумакоров-Эльстон, né le 11 mars 1887 à Saint-Pétersbourg, prince russe, au prédicat d’altesse sérénissime.
Il est particulièrement célèbre comme maître d’œuvre de la conjuration qui conduisit à l’assassinat de Raspoutine, le favori du couple impérial, le 16 décembre 1916, peu de temps avant la Révolution de Février. Le prince et la princesse Félix Youssoupov. Epoux d'Irina de Russie, nièce du tsar Nicolas II, Félix Youssoupov est devenu une figure de légende par le rôle qu'il joua dans l'élimination de Raspoutine. Les premiers temps de l'émigration se passent dans une relative aisance grâce à la vente de bijoux et de deux toiles de Rembrandt que Félix avait réussi à emporter, enroulées autour de la taille. Créant tour à tour une organisation de secours aux réfugiés, participant à l'ouverture d'un restaurant et d'un cabaret russes, lançant une maison de couture et de parfum qui connût une certaine notoriété, à la prospérité du moment se succèdent des fins de mois difficiles. Adepte de l'adage propre à certains aristocrates ruinés par les circonstances de la vie - ne pas avoir d'argent est déjà fort désagréable, mais si en plus il faut se priver - pratiquant une vie mondaine très cosmopolite, tenant maison et table ouverte à la russe, jamais le prince Youssoupov ne refusera d'aider ceux qui venaient lui demander du secours.
En bref
Félix Felixovitch Youssoupoff ou Félix Ioussoupoff ou encore Félix Youssoupov, prince Youssoupoff et comte Soumakoroff-Elston, né en 1887 et mort en 1967, était un prince russe, au prédicat d'Altesse Sérénissime admis comme l'équivalent du russe сиятельство.
Il est particulièrement célèbre comme maître-d'oeuvre de la conjuration qui conduisit à l'assassinat de Grigori Raspoutine, le favori du couple impérial, le 30 décembre 1916, peu de temps avant la révolution russe de février.
Plus riche que le tsar. Fils cadet de la princesse Zénaïde Youssoupoff et du comte Félix Soumarokoff-Elston, il reçoit en 1894, par oukase spéciale du Tsar Alexandre III le droit de prendre les noms, titres et armes de la prestigieuse famille Youssoupoff dont sa mère était la dernière descendante.
La famille Youssoupoff, d'origine arabe et tartare descendait en ligne directe de ‘Ali et des Khans Nogai et fut russifiée au XVIIème siècle. Par son père, Félix Soumarokoff-Elston, Prince Youssoupoff, il est l'arrière-petit-fils du roi Fréderic-Guillaume IV de Prusse. La mort de son frère aîné, Nicolas, lors d'un duel en 1908 fait de lui l'héritier de la plus grosse fortune de Russie et l'homme le plus riche d'Europe.
Sa mère, la princesse Zénaïde, était en effet réputée être plus riche que le tsar lui-même. En 1917, sa fortune était estimée à 600 millions de dollars de l'époque près de 100 milliards de dollars actuels!et était composée de plusieurs millions d'hectares de terres – une des propriétés Youssoupoff, sur la Caspienne, s'étendait sur près de 250 kilomètres de long – de participations dans plus de 3000 sociétés, de quartiers entiers de Moscou et Saint-Pétersbourg et d'une superbe collection d'œuvres d'art.
La famille résidait le plus souvent dans son palais du 94, quai de la Moïka à Saint-Pétersbourg mais également dans son domaine moscovite d'Arkhangelskoye, ou aux villas de Koreiz et de Kokoze en Crimée ainsi que dans l'immense domaine de Rakitnoïe, en Ukraine.
Cette fortune provenait des terres des Khans Nogai, conservées par leurs descendants mais également des dons reçus des Tsars en récompense des services rendus par les Youssoupoff. Le grand-père de Félix, le prince Nicolas Borisovitch Youssoupoff sera également, au milieu du XIXe siecle, un des premiers membres de la haute noblesse russe à investir une partie importante de sa fortune dans l'industrialisation de la Russie. Certaines propriétés Youssoupoff, comme Rakitnoïe, devinrent ainsi de véritables centres industriels, employant plusieurs dizaines de milliers de personnes
Une personnalité complexe. Après une jeunesse dorée, Félix Youssoupoff épousa la grande-duchesse Irina Alexandrovna, nièce de Nicolas II. De cette union naquit la princesse Irina Felixovna Youssoupova dite Baby, morte en 1983, épouse du comte Nicolas Cheremeteff. Le couple Youssoupoff, a priori si dissemblable, résistera à toutes les épreuves. Doté d'une grande intelligence et de goûts artistiques très sûrs, le prince Félix Youssoupoff causait scandale durant sa jeunesse par sa vie dissolue. Sa beauté et son aspect androgyne lui donnent la possibilité de se travestir en femme. Lors d'une soirée pétersbourgeoise, grimé en chanteuse légère, il sera reconnu grâce aux fastueux bijoux empruntés à l'écrin de sa mère… Il s'amusera également à errer dans Saint-Pétersbourg déguisé en mendiant.
Bisexuel assumé, il sera d'ailleurs lié avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin germain de Nicolas II.
Il multipliera également les liaisons féminines. Ces comportements ne l'empêchent pas d'être un proche de la grande duchesse Elisabeth, sœur de la tsarine et veuve du grand duc Serge. Cette dernière, devenue religieuse après l'assassinat de son mari en 1905, sera la directrice spirituelle et la confidente du jeune Félix, passablement bouleversé par la mort de son frère. En 1909, il part continuer ses études en Angleterre. Le prince Félix Youssoupoff est en 1913 diplômé d'Oxford où il fonda le cercle des étudiants russes. Raspoutine et Félix Youssoupoff : De retour en Russie, l'ascendance qu'exerce Raspoutine sur la famille impériale le fait souffrir et le plonge dans une profonde tristesse. Le staretz envoûte la tsarine et met en péril le trône de Russie.
Une autre hypothèse, évoquée notamment par Vladimir Volkoff, expliquerait le résolution du jeune Félix par son appartenance aux services secrets anglais. Ceux-ci, effrayés par l'influence du très germanophile Raspoutine, poussèrent le prince Youssoupoff à le supprimer en s'appuyant sur ses relations et sa quasi immunité juridique.
En tuant Raspoutine, Félix Youssoupoff exercera sans doute une vengeance. Son père, le général Youssoupoff, gouverneur-général de Moscou, avait été spectaculairement limogé en 1915 pour avoir critiqué le régime impérial. Sa mère, la princesse Zenaïde, avait également été déclarée indésirable à la Cour après avoir demandé à la Tsarine de renvoyer Raspoutine.
L'organisation du complot. En 1916, il entendit une conversation concernant "Grichka" diminutif de Gregori Raspoutine. Cette conversation eut lieu entre des monarchistes russes parmi lesquels se trouvait Vladimir Pourichkevitch. Sa décision fut prise : il faut, par tous les moyens, empêcher le staretz de nuire à la sainte Russie. Pour cela, Félix commence, malgré sa répulsion pour Raspoutine, à se lier avec lui prétextant une quelconque maladie qui nécessite des séances d'hypnotisme. Puis il cherche des complices qui pourront lui venir en aide pour mener à bien son entreprise. Dans le même temps, il imagine un plan pour attirer Raspoutine chez lui au palais de la Moïka à Saint-Pétersbourg, afin de l'assassiner.
Félix Youssoupoff informe certaines personnes sur ses intentions à l'égard du staretz. Un groupe d'hommes excédés par la vie scandaleuse et le danger que fait courir "Grichka" au trône de Russie se rapproche du prince. Il s'agit du député de droite Vladimir Pourichkevitch, du grand-duc Dimitri Pavlovitch, du chevalier garde Soukhotine et du docteur de Lazovert qui fournira le cyanure.
L'assassinat accompli, le prince Youssoupoff et ses complices seront incapables de garder le silence. La Tsarine réclamera l'exécution immédiate de Youssoupoff et de Dimitri Pavlovitch. Mais les autorités pétersbourgeoises refusèrent d'arrêter les responsables d'un acte soutenu par la population. Félix sera finalement assigné à résidence dans son domaine de Rakitnoïe oblast de Koursk par Nicolas II de Russie après avoir été entendu par le président du Conseil.
"En exil". En 1919, Il fut contraint de quitter la Russie à bord d'un dreadnough de la marine de guerre britannique envoyé à Yalta (Crimée) par le roi d'Angleterre pour sauver ses cousins russes, membres de la famille impériale. Sa présence d'esprit et son sens de la négociation lui permettront de sauver une partie de sa belle-famille.
Installé dans un premier temps à Londres, le prince Youssoupoff fut une des chevilles ouvrières de la Croix-Rouge russe.
En 1920, il s'établit avec sa femme à Paris où il crée en 1924 la maison de couture Irfé, installée rue Duphot. Son épouse lui sert de mannequin pour présenter les différents modèles de ses collections. Ami de Kessel, Cocteau ou du comte Boniface de Castellane, il resta, jusqu'à sa mort et malgré son refus de tout engagement politique, une des grandes figures de l'émigration russe et de la société mondaine parisienne.
La fortune colossale des Youssoupoff avait été confisquée par les Soviets dès 1917. Les avoirs placés à l'étranger avaient été rapatriés dès 1914 pour des motifs patriotiques. Mais les Youssoupoff réussirent à sauver nombre d'objets précieux au premier rang desquels on trouve deux Rembrandt, vendus au début des années-20 et la perle Pelegrina, vendue en 1953. Leurs ventes leur assureront de solides moyens de subsistances.
Le prince Youssoupoff intenta par ailleurs un procès au département du Finistère et entra, en 1956, en possession du château de Kériolet, ancienne propriété de son arrière grand-mère, la princesse Zénaïde Narichkine-Youssoupoff. La charité du prince Youssoupoff, bien que discrète était importante. Ainsi, il se rendait au chevet des malades dépourvus de famille et il aida financièrement le grand-duc Théodore Alexandrovitch qui vivait dans la pauvreté. Anti-communiste viscéral et résolument anti-nazi, il donna également d'importantes sommes d'argent à des mouvements de résistance.
Le prince Félix Youssoupoff est l'auteur de plusieurs ouvrages.
Famille Ioussoupov.
La famille Ioussoupov était d'origine tatare. Elle descendait du khan de la horde Nogaï Youssouf-Mourza, mort en 1556.
Le comte Félix Felixovitch Soumarokov-Elston et la princesse Zénaïde
Le prince Félix Felixovitch Ioussoupov est le fils du comte Felix Felixovitch Soumarokov-Elston 1856-1928 et de la princesse Zénaïde Nikolaïevna Ioussoupova 1861-1939.
Ainsi par sa mère, le prince Félix Ioussoupov descend du khan de la Horde Nogaï Youssouf-Mourza, du prince Potemkine et des comtes Louvradoux de Ribeaupierre et, par son père, le prince Félix Ioussoupov descend de deux des plus anciennes familles de la noblesse russe, les Soumarokov et les Tiesenhausen, et serait l'arrière-petit-fils du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV.
La fortune des Ioussoupov : plus riches que le tsar
La mère du prince Félix Felixovitch, la princesse Zénaïde, était réputée être plus riche que le tsar lui-même. En 1917, sa fortune était estimée à 600 millions de dollars de l’époque, près de 11 milliards de dollars actuels et était composée de plusieurs millions d’hectares de terres — une des propriétés Ioussoupov, sur la Caspienne, s’étendait sur près de 250 kilomètres de long, de participations dans plus de 3 000 sociétés, de quartiers entiers de Moscou et Saint-Pétersbourg et d’une superbe collection d’œuvres d'art. La famille résidait le plus souvent dans son palais du 94 quai de la Moïka à Saint-Pétersbourg mais également dans son domaine moscovite d’Arkhangelskoïe, ses villas de Koreiz et de Kokoze en Crimée, ou encore dans l’immense domaine de Rakitnoïe, en Ukraine. En outre, au cours des siècles, la famille amassa des mines de charbon et de fer, des industries diverses, des gisements pétrolifères, des moulins à farine…
Cette fortune provenait des terres des khans de la horde Nogaï, conservées par leurs descendants mais également des dons reçus des tsars en récompense des services rendus par les Ioussoupov. L'arrière-grand-père de Félix, le prince Nicolas Borisovitch Ioussoupov, était également, au milieu du XIXe siècle, un des premiers membres de la haute noblesse russe à investir une partie importante de sa fortune dans l’industrialisation de la Russie. Certaines propriétés Ioussoupov, comme Rakitnoïe, devinrent ainsi de véritables centres industriels, employant plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Jeunesse et études
Le prince Félix Felixovitch Ioussoupov était le fils cadet de la princesse Ioussoupova et du comte Felix Felixovitch Soumarokov-Elston.
La princesse Zénaïde Nikolaïevna Ioussoupov apporta à ses deux fils toute son affection maternelle, les gâtant outre mesure. Les liens unissant la princesse Zénaïde Nikolaïevna Ioussoupova à son fils Félix furent très forts. Entre la mère et le fils existait une similitude de caractère, de goût et une ressemblance physique. La beauté de la princesse subjugua le prince Félix : Ma mère était charmante. Avec une taille svelte et mince, élégante, avec des cheveux très foncé, un teint basané et ses yeux bleus qui brillaient comme des étoiles, elle n'était pas seulement intelligente, elle était instruite, artiste, pleine de charme, d'une grande bonté de cœur, rien ne peut résister à ses charmes.
Quant au comte Félix Felixovitch Soumarokov-Elston, il fut un père distant. En cette fin du XIXe siècle, les familles de l'aristocratie russe tentaient d'éloigner leurs enfants du luxe et de la magnificence des palais. En revanche, les deux enfants de la princesse Ioussoupov vécurent dans la splendeur et le luxe des palais de la famille, leur mère craignant de se séparer d'eux. Nikolaï et Félix devinrent des enfants capricieux à qui l'on ne pouvait rien refuser. Cette éducation laxiste donna de mauvais résultats, les deux jeunes garçons manquant de discipline et de maintien. Seul leur père, souvent absent, possédait un ascendant sur eux. Les jeunes garçons livrés à eux-mêmes dans ces immenses palais imposaient leurs lois aux domestiques, précepteurs, professeurs. Connaissant à l'avance la réaction de la princesse, aucun n'osait contredire les jeunes garçons. Malgré leur jeune âge, les deux enfants comprirent très vite l'ascendant que leur permettait leur position et devinrent tyranniques avec le personnel.
Le prince Nikolaï Felixovitch, frère aîné de Félix, fut un jeune homme suffisant à l'orgueil incommensurable. Dès son plus jeune âge, il vécut une vie dissolue. En 1908, le prince Nikolaï Felixovitch Ioussoupov s'éprit de Maria Manteuffel, une femme mariée. Six mois avant son 26e anniversaire, le jeune prince fut tué en duel par le comte Arvid Manteuffel, le mari jaloux 1908. Cette mort prématurée fit écho à la malédiction qui planait sur la maison princière des Ioussoupov : le fils aîné de cette richissime famille ne devait pas atteindre ses 26 ans. Selon la croyance, cette punition infligée aux Ioussoupov avait pour origine la conversion de leurs ascendants musulmans à l'orthodoxie russe. La mort de son frère aîné fait de Félix l’héritier de la plus grosse fortune de Russie et l’homme le plus riche d’Europe.
Après des études à l'école secondaire Gourevitch à Moscou dont il sortit diplômé, de 1909 à 1912, le prince Félix Felixovitch effectua de nombreux voyages en Europe. Dans le même temps 1910, il dirigea l'Automobile Club installé dans le bâtiment de la Compagnie d'assurances russe et étudia à l'University College d'Oxford où il fonda l'Oxford University Russian Society et dont il sortit diplômé. De 1915 à 1916, afin de se préparer aux examens d'officier, il entra au corps spécial des pages.
Une personnalité complexe
En Russie, on disait du prince Félix Felixovitch Ioussoupov qu'il était le plus bel homme de tout l'Empire. Ces paroles, tenues par l'aristocratie saint-pétersbourgeoise, n'étaient pas des paroles exagérées. Comme sa mère, la princesse Zinaïda, le prince était d'une grande beauté, son visage aux traits fins de type asiatique, ses yeux d'un bleu foncé attirait les compliments des membres de la famille et ravissait sa mère.
Ce prince élégant, raffiné, doté d’une grande intelligence, amateur d'art, au goût très sûr, vouant un véritable culte à la beauté, mena une double vie. Cette personnalité angoissée et émotive éprouva pour Oscar Wilde une véritable fascination : comme le célèbre écrivain, il afficha son homosexualité. Félix éprouva également une attirance pour les sciences occultes.
Le jeune Félix Felixovitch Ioussoupov mena une vie extravagante, scandalisant son entourage par sa vie dissolue. Dans son autobiographie, il expliqua avoir passé beaucoup de temps avec les tziganes. Sa beauté et son aspect androgyne, sa taille souple lui donnent la possibilité de se travestir en femme. Il aimait revêtir les robes et les bijoux de sa mère ; ainsi paré, il se rendait dans différents restaurants et autres célèbres endroits de Saint-Pétersbourg captant l'intérêt des officiers de la garde impériale, ces derniers se méprenant sur sa véritable identité lui faisaient une cour empressée. Il semblerait que son frère aîné et sa jeune maîtresse Polia l'avaient incité à se travestir. Selon d'autres sources, la princesse Zénaïde espérait une fille, mais ce fut un garçon, elle lui donna le prénom de Félix mais l'habilla en fille jusqu'à l'âge de cinq ans, ce qui, pour certains expliquerait les tendances du jeune homme pour les travestissements. Il s’amuse également à errer dans Saint-Pétersbourg déguisé en mendiant. Il consomme volontiers de l'opium. Après son union avec la grande-duchesse Irina Alexandrovna de Russie, il continue à avoir des aventures homosexuelles12. Il a une préférence pour les hommes virils.
Un soir, le jeune prince revêtit l'une des plus belles robes de sa mère, se para de bijoux et de précieuses fourrures pour se rendre dans l'un des endroits les plus en vue de Saint-Pétersbourg. Au cours de la soirée, le collier de perles se rompit, celles-ci se répandirent sur le sol. Sans attendre, les amis du prince se mirent à leur recherche, beaucoup furent retrouvées mais d'autres échappèrent aux regards des convives ; elles furent ramassées par le propriétaire des lieux. Ce dernier connaissant le prince travesti les rapporta à ses parents. Son attirance pour le travestissement fut découverte. Son père entra dans une grande colère et lui ordonna d'abandonner ses déguisements féminins et de se conduire en homme. Pendant quelque temps, le prince abandonna ses habitudes de travesti, mais très vite il retourna à ses penchants.
Plus tard, le grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie, l'un des complices dans l'assassinat de Raspoutine, fut vraisemblablement l’amant du prince Félix Ioussoupov.
Ces comportements ne l’empêchèrent pas d’être un proche de la grande-duchesse Élisabeth, sœur de la tsarine et veuve du grand duc-Serge. La grande-duchesse, devenue religieuse après l’assassinat de son mari en 1905, sera la directrice spirituelle et la confidente du jeune Félix, passablement bouleversé par la mort de son frère. Il rendit également visite à l'impératrice Alexandra dans son boudoir mauve, cette dernière l'avait pris sous sa protection. Incorrigible, en l'absence de l'impératrice, le prince critiqua les tenues vestimentaires et le goût d'Alexandra Fiodorovna pour la décoration de ses appartements.
Son mariage avec Irène
Après une jeunesse dorée, Félix Youssoupoff se fiance à la villa Youssoupoff, près de Yalta avec la nièce de Nicolas II, la princesse Irène, jeune fille d'une rare beauté. Le 22 février 1914, le mariage est célébré avec le consentement de l'empereur à l'église du palais Anitchkov. Des mains du tsar, le couple reçoit en cadeau de mariage un sac contenant vingt-neuf diamants. De cette union naît la princesse Irène Félixovna, future épouse du comte Nicolas Dmitrievitch Cheremetiev, et décédée en 1983. Le couple Youssoupov était d'une grande beauté. Pourtant si dissemblable de caractère, le ménage résista à toutes les épreuves. Uni à une des plus belles princesses de l'Empire, ce prince si futile resta jusqu'au terme de sa vie un époux respectueux, éprouvant des sentiments très forts pour son épouse.
Le complot contre Raspoutine son assassinat.
Dépliant anti-monarchiste représentant Raspoutine, Nicolas II de Russie et son épouse Alexandra Fiodorovna, avant 1916 - avant l'assassinat du starets
De retour en Russie, Félix Ioussoupov souffre de l’ascendant qu’exerce Raspoutine sur la famille impériale et plonge dans une profonde tristesse. Le starets envoûte la tsarine et met en péril le trône de Russie.
En tuant Raspoutine, Félix Felixovitch Ioussoupov exerça sans doute une vengeance. Son père, le général Ioussoupov, gouverneur-général de Moscou, avait été spectaculairement limogé en 1915 pour avoir critiqué le régime impérial. Sa mère, la princesse Zenaïde, avait également été déclarée indésirable à la cour après avoir demandé à la tsarine de renvoyer Raspoutine.
Auparavant, ce prince émotif et superficiel montra un total désintérêt pour la politique ou l'Empire. Selon certaines thèses, Raspoutine menaçait de révéler à l'impératrice certains scandales impliquant le prince et son ami, le grand-duc Dmitri Pavlovitch de Russie. Dans ses Mémoires, le prince révéla ses sentiments profonds pour le cousin de Nicolas II, mais à aucun moment il ne révéla avec exactitude la nature de ses sentiments pour le grand-duc. Selon certains témoignages, la nature de ces sentiments furent volontairement dissimulés.
Avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch, le député Vladimir Pourichkevitch, le lieutenant Sergueï Soukhotine et le Docteur Stanislas Lazovert le prince Ioussoupov organisa et perpétra l’assassinat de Raspoutine dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916.
Sanctions
L’assassinat accompli, le prince Ioussoupov et ses complices furent incapables de garder le silence. L'enquête sur l'assassinat de Raspoutine fut dirigée par le major-général Popel. Le docteur Stanislas Lazovert et le jeune officier du régiment Preobrajenski, Sergueï Mikhaïlovitch Soukhotine, avaient déjà quitté Saint-Pétersbourg, le prince Ioussoupov fut arrêté dans la gare alors qu'il allait prendre le train pour s'enfuir en Crimée. Seuls le prince Félix Felixovitch Ioussoupov, le grand-duc Dmitri Pavlovitch de Russie et Vladimir Mitrofanovitch Pourichkevitch subirent un interrogatoire. L’impératrice réclama l'exécution immédiate du prince et du grand-duc Dimitri, mais les autorités pétersbourgeoises refusèrent d’arrêter les responsables d’un acte soutenu par la population. Nicolas II ordonna l'exil pour les trois hommes16. Au cours de l'interrogatoire mené par le Président du Conseil, Alexandre Fiodorovitch Trepov, le prince nia toute implication dans le complot. Félix Felixovitch fut finalement assigné à résidence dans son domaine de Rakitnoïe, oblast de Koursk par Nicolas II10. Quant au grand-duc Dmitri Pavlovitch, de par sa haute naissance, il dépendait de la justice de l'empereur qui l'envoya sur le front en Perse où il servit à l'état-major des armées impériales18. En raison de sa fonction de député de la Douma mais surtout grâce à sa place de leader du parti de la droite monarchiste, Vladimir Mitrofanovitch Pourichkevitch bénéficiait d'un tel prestige que l'empereur n'osa pas le sanctionner et qu'il ne fut pas inquiété. Sur ordre du tsar, il quitta la capitale de l'Empire russe.
Une relation ambiguë
Dans son journal, le grand-duc Nikolaï Mikhaïlovitch de Russie évoqua une vraisemblable non neutre relation intime avec Raspoutine.
" Félix Ioussoupov me narra toute l'histoire, son affection, sa relation homosexuelle avec Raspoutine. Le starets se prit d'affection pour lui. Peu après, le prince lui fit entièrement confiance. Ils se sont vus presque chaque jour et parlèrent de tout. Raspoutine l'initia à ses projets. Une chose incroyable se produisit, Raspoutine était épris et avait une passion charnelle pour Félix. Je suis convaincu qu'il y avait des manifestations physiques de cette amitié sous forme de baisers, d'attouchements de part et d'autre et peut-être quelque chose de plus cynique. Le sadisme de Raspoutine laisse un doute. Je comprenais peu les perversités sexuelles de Félix. Bien avant son mariage, des rumeurs circulèrent sur sa lascivité."
La Révolution russe
Assigné à résidence dans son domaine de Rakitnoïe, le prince trouva la vie monotone ; sa principale occupation fut les promenades en traîneau. Mais de la capitale, des signes alarmants vinrent troubler la quiétude du prince et de la princesse Ioussoupov. Les mauvaises nouvelles se succédèrent, Georgi Ievgenievitch Lvov devint le chef du gouvernement provisoire, puis le 3 mars 1917, Nicolas II abdiqua.
La Révolution russe resta pour le prince un souvenir douloureux.
En mars 1917, lors de son séjour au palais de la Moïka à Saint-Pétersbourg, des personnalités illustres rendirent visite au prince, des officiers, des politiciens, des popes. L'amiral Alexandre Koltchak, le grand-duc Nikolaï Mikhaïlovitch de Russie, ce dernier lui tint ces propos : Le trône de la Russie n'est ni héréditaire, ni électif : il est usurpateur. Profitez de la situation ; vous détenez tous les atouts, la Russie ne peut pas continuer sans un monarque, et les Romanov sont discrédités, les gens ne veulent pas les voir revenir. Ces propos laissèrent le prince dans un grand état d'abattement : lui, l'un des assassins de Raspoutine, il était sollicité pour s'approprier indûment du trône de la Russie impériale.
Au printemps 1917, le prince Félix Felixovitch Ioussoupov, accompagné de son épouse et de sa fille, quittèrent Saint-Pétersbourg pour la Crimée.
En mai 1917, désireux de visiter son hôpital installé dans sa maison rue de Litenaïa et passer dans son palais de la Moïka, le prince, accompagné du grand-duc Fiodor Alexandrovitch de Russie, se rendit à Saint-Pétersbourg.
En quittant le palais de la Moïka, le prince Ioussoupov décrocha deux tableaux de Rembrandt, aujourd'hui exposés au National Gallery of Art à Washington et un de Floris Claesz van Dijck après les avoir ôtés de leur cadres, il les enroula, ils récupéra également des bijoux, les produits de leur vente contribuèrent au soutien financier de la famille en exil. À Saint-Pétersbourg, le couple princier et le grand-duc Fiodor Alexandrovitch de Russie prirent le train en partance pour la Crimée. Ce fut un voyage éprouvant. Le prince écrivit dans ses Mémoires : Une foule de soldats, déserteurs, ont assiégé le train. Rempli les couloirs, montèrent sur le toit. Tous étaient ivres et beaucoup tombèrent du train en chemin. Après ce voyage fastidieux, le prince et le grand-duc arrivèrent à Aï-Todor, près de Yalta.
Lors du séjour du prince Ioussoupov à Saint-Pétersbourg, un matin, des bolcheviks surgirent dans la villa Aï-Todor, les différents membres de la famille Romanov, le prince et son épouse furent retenus prisonniers par 25 soldats armés. En août 1917, le prince fut informé du transfert de Nicolas II de Russie et de sa famille dans la ville de Tobolsk en Sibérie occidentale.
À l'automne de la même année, afin de cacher les biens les plus précieux de la famille Ioussoupov, le prince se rendit à Saint-Pétersbourg. Les serviteurs restés fidèles au prince l'aidèrent dans cette tâche. Sur la demande de Maria Fiodorovna, Félix Felixovitch se rendit au palais Anitchkov afin de prendre un portrait d'Alexandre III, un bien précieux pour la veuve de l'empereur, mais les bijoux de l'impératrice douairière avaient déjà été saisis par le gouvernement provisoire et transférés à Moscou. Puis, le prince ramassa tous les bijoux de la famille, et, aidé de Grigori, l'un des serviteurs de Félix Felixovitch, les deux hommes prirent la route de Moscou. Arrivés à destination, tout en ordonnant au serviteur de ne jamais révéler la cachette aux Bolcheviks, même sous la torture, les deux hommes dissimulèrent les joyaux sous un escalier. Malheureusement, huit ans plus tard, au cours de travaux de rénovation, les ouvriers découvrirent les bijoux.
Un jour, un détachement de soldats est venu occuper ma maison. Je la leur ai montrée et j'ai essayé de leur faire comprendre qu'elle était plus appropriée à être un musée qu'une caserne. Ils partirent sans insister, mais évidemment avec la volonté de revenir. Quelques jours plus tard, en quittant ma chambre je suis tombé sur les corps de certains soldats endormis, complètement armés, et sur le sol de marbre. Un officier est venu vers moi et m'a dit qu'il avait été commandé pour garder ma maison. Je n'ai pas du tout aimé cela ; cela signifiait que les bolcheviks me considéraient comme un sympathisant, ce qui était un compliment que je n'appréciais pas le moins du monde, j'ai décidé de partir immédiatement pour la Crimée…
La veille de son départ pour Aï-Todor, il rencontra la grande-duchesse Elizaveta Fiodorovna. Le lendemain, 7 novembre 1917, les Bolcheviks prirent le pouvoir. À Saint-Pétersbourg, le prince Félix Felixovitch Ioussoupov fut le témoin de crimes commis par les Bolcheviks. Le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk fut signé, le prince, son épouse et les membres de la famille impériale présents dans la Villa Aï-Todor furent libérés par les Allemands.
L'exil Le départ
Le 11 avril 1919, Il est contraint de quitter la Russie à bord d’un cuirassé de la Royal Navy, le HMS Marlborough envoyé à Yalta Crimée par le roi d’Angleterre pour sauver ses cousins russes, membres de la famille impériale. Sa présence d’esprit et son sens de la négociation lui permettent de sauver une partie de sa belle-famille. Debout sur le pont, le prince voit disparaître à jamais sa terre natale. À bord du navire, tous pensent au jour de leur retour en Russie.
Passant le Bosphore, le cuirassé croisa d'autres navires transportant des émigrés russes ayant également embarqué en Crimée. La présence de l'impératrice Dagmar de Danemark à bord du HMS Malborough était connue de tous, les émigrés russes entonnèrent l'hymne Dieu sauve le tsar.
Lors de leur escale à Constantinople, le prince et son épouse visitèrent la cathédrale Sainte-Sophie. Sur l'îles des Princes, le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch de Russie et les membres de sa famille quittèrent le cuirassé pour embarquer sur le Lord Nelson et prirent la direction de Malte puis Gênes. Quant au prince et sa famille, ils débarquèrent à Malte.
Après un bref séjour dans la villa d'été du gouverneur à San Antonio, le 9 mai 1919, le prince, son épouse et sa fille embarquèrent à bord d'un ferry à Syracuse ; quelques plus jours plus tard, le couple arriva à Rome.
En Italie, faute de visas pour la famille, le prince soudoya des fonctionnaires avec un collier de diamants appartenant à la grande-duchesse Irina. Ils séjournèrent quelques jours à l'hôtel de Vendôme à Paris, puis la famille Ioussoupov s'installa à l'hôtel Ritz à Londres.
L'exil en Angleterre puis en France
Installé dans un premier temps à Londres, le prince Ioussoupov est une des chevilles ouvrières de la Croix-Rouge russe. En 1920, il s’établit avec sa femme à Paris où il crée en 1924 la maison de couture Irfé, Ir pour Irina - Fé pour Félix installée rue Duphot. Son épouse lui sert de mannequin pour présenter les différents modèles de ses collections. Ami de Kessel, Cocteau ou du comte Boniface de Castellane, il reste, jusqu’à sa mort et malgré son refus de tout engagement politique, une des grandes figures de l’émigration russe et de la société mondaine parisienne. Il aimait passer ses vacances à Biarritz.
La fortune colossale des Ioussoupov est confisquée par les Soviets dès 1917. Les avoirs placés à l’étranger ont été rapatriés dès 1914 pour des motifs patriotiques. Mais les Ioussoupov réussissent à sauver nombre d’objets précieux au premier rang desquels on trouve deux Rembrandt, vendus au début des années 1920 et la perle Pelegrina, vendue en 1953. Leurs ventes leur assurent de solides moyens de subsistance. Le prince Ioussoupov, avide, intente par ailleurs un procès au département du Finistère et entre en 1956 en possession du château de Kériolet, ancienne propriété de son arrière-grand-mère, la princesse Zénaïde Narichkine-Ioussoupov, expertisée à 400 millions de francs de l’époque, anciens francs. Aussitôt, ce château néogothique est fermé à la visite du public, c’était auparavant un musée, selon les volontés de la princesse Narichkine, ses collections disparates dispersées et le château vendu au plus offrant. La charité du prince Ioussoupov, bien que discrète, est importante. Ainsi, il se rend au chevet des malades dépourvus de famille et il aide financièrement le grand-duc Théodore Alexandrovitch qui vit dans la pauvreté. Anti-communiste viscéral et résolument anti-nazi, il donne également d'importantes sommes d'argent à des mouvements de résistance.
Le prince Félix Felixovitch Ioussoupov est l’auteur de plusieurs ouvrages. En 1927, il publie un opuscule intitulé La Fin de Raspoutine, éclaircissant les circonstances du meurtre du gourou de la tsarine. Cet ouvrage lui vaut un procès de la part de Maria Raspoutine, fille de la victime. Dans les années 1950, le prince publie ses mémoires, en deux volumes, sous les titres Avant l’exil 1887-1919 et Après l’exil 1919-. Ces différents ouvrages rencontrent un succès certain et sont encore régulièrement réédités.
L’assassinat de Raspoutine hante le prince Ioussoupov jusqu’à sa mort : il est en proie à des cauchemars tenaces et peint des tableaux inquiétants représentant des monstres mi-homme, mi-animal. Ne pouvant plus supporter ces tableaux représentant des figures hideuses, sa fille les vendra à la mort de ses parents.
Le prince et la princesse Ioussoupov ont vécu en exil en France de 1920 à leur mort en 1967 et 1970. Leurs adresses à Paris et en région parisienne étaient les suivantes :
1920-1939 : 37, rue Gutenberg puis 19, rue de La Tourelle à Boulogne-sur-Seine.
1939-1940 : ils louèrent une maison à Sarcelles, rue Victor-Hugo.
1940-1943 : ils habitèrent successivement rue Agar et 65, rue La Fontaine, 16e arrondissement de Paris, quartier d'Auteuil.
de 1943 jusqu'à leurs morts : 38, rue Pierre-Guérin, 16e arrondissement de Paris, quartier d'Auteuil, dans une maison achetée à Madame Bottin, propriétaire du dictionnaire du même nom.
Décès du prince Félix Felixovitch Ioussoupov
Le prince mourut le 27 septembre 1967 à Paris, quelques mois après son interview par l'historien Alain Decaux.
Il est inhumé au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, à Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne, Île-de-France, où il repose en compagnie de son épouse la princesse Irina Alexandrovna, de sa mère et du comte et de la comtesse Cheremetiev. À noter la simplicité de la tombe du prince, une simple croix orthodoxe surmonte un carré de terre orné de quelques fleurs entouré d'un carré de ciment.
Le rapatriement des dépouilles des Ioussoupov au mausolée d’Arkhangelskoïe est régulièrement évoqué.
Les Ioussoupov aujourd’hui
En 2004, Xenia Sfiris, petite-fille et unique héritière de Félix Felixovitch Ioussoupov, a demandé à la Fédération de Russie de lui restituer une partie de la fortune familiale, arguant du fait que la propriété était maintenant un droit constitutionnel en Russie et que les bases juridiques des nationalisations de 1917 étaient inexistantes. Elle conclut sa lettre au président Poutine en faisant part de son incompréhension du fait que lors de ses visites à Saint-Pétersbourg, elle soit contrainte de descendre à l’hôtel au lieu de résider dans l’un des palais familiaux. Ces démarches n’ont abouti qu’à un refus des autorités russes.
Xenia Sfiris reste néanmoins très liée à la Russie. Un Ukase spécial de Vladimir Poutine lui a rendu la nationalité russe en 2000. L’héritière des Ioussoupov préside par ailleurs l’association française des amis du théâtre Mariinsky.
En 2008, grâce à Olga Sorokina directrice et styliste, aidée par la princesse Ksenia Nikolaïevna Cheremeteva, née Sfiris, la maison de couture IRFE connaît une nouvelle vie. Le 25 mars 2009, cette maison de couture créée en 1924 par son grand-père et sa grand-mère présenta sa première collection au palais de Tokyo, de nombreux journalistes assistèrent au défilé de mode. La confection de ces vêtements rappelle un autre temps les collections lancées par le prince et la princesse Ioussoupov entre 1924 et 1929. Jusqu'à nos jours, la princesse garda précieusement la composition des parfums héritée de la famille Ioussoupov. Ksenia Nikolaïevna Cheremeteva profita de cet évènement pour annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de parfums. Après avoir ouvert un magasin à Paris, IRFE projette également d'ouvrir des maisons de couture à Moscou en 2010 ensuite à Milan puis dans d'autres villes dans le monde. La Maison de couture IRFE projette également de lancer une ligne de bijoux et de montres copiés sur les bijoux détenus par la famille Ioussoupov, Cheremetev et sur les prestigieux joyaux de la Maison Romanov.
Depuis la mort de Félix Felixovitch Ioussoupov, personne n'a été autorisé à relever le titre de prince Ioussoupov, même si sa petite-fille s’intitule souvent ainsi.
Le palais de la Moïka aujourd'hui
De nos jours, le palais de la Moïka est ouvert au public. Dans la pièce du sous-sol où fut perpétré l'assassinat de Raspoutine, la scène est reproduite à l'aide de mannequins de cire, dont un représente le prince Ioussoupov offrant des gâteaux à la crème rose au starets. Dans une autre pièce, une scène représente les complices du prince.
Depuis la mort de Félix Félixovitch, personne n'a été autorisé à relever le titre de prince Youssoupoff même si sa petite-fille s’intitule souvent comme tel.
1920 à leurs morts en 1967 et 1970. Leurs adresses à Paris et en région parisienne étaient les suivantes: Raspoutine hantera le prince Youssoupoff jusqu'à sa mort ; il était en proie à des cauchemars tenaces et peignait des tableaux inquiétants représentants des monstres mi-homme, mi-animal. Ne pouvant plus supporter ces tableaux représentant des figures hideuses, sa fille les vendra à la mort de ses parents.1927, il publie un opuscule intitulé "J'ai tué Raspoutine" éclaircissant les circonstances du meurtre du gourou de la Tsarine. Cet ouvrage lui vaudra un procès de la part de Maria Raspoutine, fille de la victime. Dans les années 1950, le prince publiera ses mémoires, en deux volumes, sous les titres "Avant l'exil" 1887-1919 et "Après l'exil" 1919-. Ces différents ouvrages rencontrèrent un succès certain et sont encore régulièrement réédités.
L'héritage du prince Félix Felixovitch Ioussoupov
Les différents objets papiers personnels, sculptures, peintures et photos de famille ayant appartenu au prince Félix Felixovitch Ioussoupov sont aujourd'hui la propriété de Victor Contreras, un sculpteur mexicain, qui fut dans les années 1960 étudiant en art et vécut pendant cinq ans auprès de la famille Ioussoupov. Victor Contreras, aujourd'hui propriétaire d'une maison située au sud de Mexico, désire faire un musée où il exposera les objets ayant appartenu au prince.
Publications
Félix Youssoupov, La Fin de Raspoutine, Plon
Félix Youssoupov, Mémoires, 1953 ; édition révisée par Félix Bonafé, 1990, Paris, V & O éditions
www.rummuseum.ru
Voir sur yusupov.ucoz.net
www.spartacus.schoolnet.co.uk
Filmographie
1967 : J'ai tué Raspoutine de Robert Hossein et Alain Decaux, récit de la vie de Raspoutine et du complot. Le rôle du prince Ioussoupov est interprété par Peter McEnery.
1996 : Raspoutine de Uli Edel, met l'accent sur la relation entre Raspoutine et la tsarine Alexandre. Le prince Ioussoupov est joué par James Frain.
2011 : Raspoutine de Josée Dayan, couvre d'une façon assez fidèles les évènements survenus dans la vie de Raspoutine. Le prince Ioussoupov tient un rôle majeur dans la seconde partie du film et est interprété par Filipp Yankovsky.
Le Film
J'ai tué Raspoutine
Film historique de Robert Hossein, avec Gert Fröbe, Peter Mac Enery, Geraldine Chaplin, Robert Hossein.
Pays : France
Date de sortie : 1967
Son : couleurs
Durée : 1 h 30
Résumé
Les souvenirs du prince Félix Youssoupov, en exil à Paris après avoir échappé à la révolution d'Octobre. C'est lui qui fut l'instigateur et le principal exécutant du meurtre du fameux Raspoutine.
Raspoutine GIrigori Efimovitch Novykh 1872-1916
Paysan sibérien, surnommé Raspoutine le Dépravé à cause de sa vie dissolue, il n'était ni moine, ni pratiquant de l'Église orthodoxe, mais appartenait très probablement à l'une des sectes chrétiennes fort nombreuses en Russie. Il fut recommandé à l'impératrice parce qu'il avait le pouvoir d'arrêter les hémorragies et pouvait soulager le grand-duc héritier, atteint d'hémophilie ; il ne put cependant jamais le guérir. Il mène une vie débauchée et s'entoure de gens sans aveu et d'aventuriers qui désirent profiter de son crédit.
Dès 1912, toute la Russie bien pensante est dressée contre Raspoutine, mais celui-ci, usant de chantage à l'amour maternel, impose sa volonté à l'impératrice et, par elle, à l'empereur.
Le rôle politique de Raspoutine a été beaucoup exagéré, mais certaines nominations de hauts fonctionnaires sont dues à son influence. Quand, au mois de décembre 1916, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin du tsar, le prince Youssoupov et le député d'extrême droite Pourichkevitch organisent l'assassinat de Raspoutine, cet acte et surtout la manière dont il est perpétré desservent la dynastie. Raspoutine est empoisonné pendant un dîner avec les conjurés et, comme il n'arrive pas à mourir, il est achevé à coups de revolver.
Raspoutine ne manquait pas de clairvoyance et répétait souvent qu'une guerre mènerait la Russie vers une révolution, d'où peut-être les rumeurs l'accusant d'être à la solde de l'Allemagne. Pierre Kovalewsky
       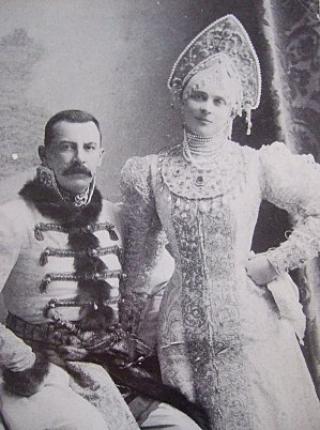   
Posté le : 25/09/2015 21:09
|
|
|
|
|
Louis XIII |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 27 septembre 1601 au château de Fontainebleau naît Louis XIII
Roi de France et de Navarre. Louis XIII, surnommé Louis le Juste, décédé à 52 ans, le 14 mai 1643 au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, inhumé à la basilique de Saint-Denis, est roi de France et de Navarre entre 1610 et 1643. Couronné dans la cathédrale de Reims le 17 octobre 1610, il succède à son père Henri IV et précède son fils louis XIV Il est le fils de Henri IV et de Marie de Médicis, qui sera régente de 1610 à 1614. Il est dauphin de France du 27 Septembre 1601 au 14 Mai 1610, soit pendant 8 ans 7 mois et 17 jours. Il réside au Château neuf de Saint-Germain-en-Laye, puis Palais du Louvre.
Son règne est marqué par l’affaiblissement des grands et des protestants, la lutte contre la maison de Habsbourg et l'affirmation de la domination militaire française en Europe pendant la guerre de Trente Ans. L’image de ce roi est inséparable de celle de son principal ministre, le cardinal de Richelieu.
Il est le père du roi Louis XIV et de Philippe, fondateur de la maison Orléans dont est issu le roi Louis-Philippe Ier.
En bref
Fils de Henri IV et de Marie de Médicis, Louis XIII est l'une des figures les plus énigmatiques de la royauté française. Son personnage, cette singulière et si efficace alliance politique qu'il a constituée avec Richelieu ont donné lieu aux interprétations les plus diverses. Du tableau, à la fois critique et ambigu, de Tallemant des Réaux à l'admiration inconditionnelle de Saint-Simon, de la quasi-victime romantique d'Alexandre Dumas aux portraits contrastés de l'historiographie contemporaine, autant de points de vue divers, mais qui tendent, tous, à privilégier Richelieu. Le roi timide, secret, pudique ne manque ni de dons naturels, artistiques en particulier, ni de bon sens. Quasi abandonné par sa mère, veule et peu intelligente, il a, peut-être, souffert du mystère qui planait sur la mort de son père. Il a probablement détesté sa mère et peu aimé sa femme. Roi dès l'âge de neuf ans, mais roi à l'éducation négligée, il laisse éclater sa rancœur et son orgueil bafoué en faisant assassiner Concini, favori de sa mère, en 1617. Cet événement démontre que la raison d'État et le peu de scrupules quant au choix des moyens ne sont pas des créations exclusives du cardinal de Richelieu. Non que la politique de Luynes de 1617 à 1621 eût été très différente de celle de Concini : catholique, pro-espagnole, elle ne s'en différencie que par l'éloignement de la régente Marie de Médicis. Il faut attendre 1624 et l'entrée de Richelieu au gouvernement pour que, très progressivement, après maintes expériences, se dégage une nouvelle politique dont le mérite revient à ce dernier. L'important est de voir ce que signifie le ministériat. Sa courte durée de 1624 à 1661, avec Richelieu puis avec Mazarin, l'importance de l'hostilité qu'a suscitée cette forme de gouvernement, la grandeur des deux personnages qui s'y sont succédé posent des problèmes. On a l'habitude de mettre la série de complots contre les cardinaux Premiers ministres sur le compte de la politique extérieure. C'est oublier qu'ils visent d'abord le système inauguré en 1624, autant et plus que les hommes qui l'incarnent. Richelieu, comme Mazarin, ont fait la fortune de leur famille et de leur clientèle. Et il existe, de ce fait, une certaine rivalité entre clientèle royale et clientèle ministérielle, comme l'a bien entrevu Alexandre Dumas. Au vrai, la question ne se serait pas posée avec une telle acuité si les nécessités de la guerre de Trente Ans n'avaient, dans la décennie 1630-1640, formidablement augmenté, par l'accroissement de l'armée et de la pression fiscale, la puissance réelle du pouvoir monarchique. L'installation des intendants dans les provinces, la centralisation administrative qui joue au bénéfice de la ville de Paris et se traduit, entre autres, par l'essor, définitif, de l'atelier de frappe monétaire parisien au détriment des ateliers provinciaux, tout prouve combien le poids de l'État s'appesantit sur l'ensemble de la société française. Ces novelletés », justement attribuées au ministériat, font de lui le point de mire non seulement des tenants d'une politique extérieure plus pacifique, mais aussi des partisans d'une structure d'État moins pesante. Or Louis XIII ne s'est guère éloigné de la ligne tracée par Richelieu et a souvent renchéri sur les rigueurs du cardinal. En vérité, le seul vrai ministériat a été celui de Mazarin, maître exclusif, et par moments désinvolte, d'Anne d'Autriche. Richelieu doit d'abord convaincre le roi, et l'on connaît sa célèbre phrase sur la difficulté à conquérir et à garder les quelques pieds carrés du cabinet royal. Louis XIII a tenu à rester le maître de ses décisions et il a eu à maintes reprises, comme lors de la journée des Dupes, à trancher entre son ministre et les clans adverses. Henri IV devait encore équilibrer les diverses tendances politiques dans son entourage. Louis XIII a pu se permettre de donner son appui à un homme dont la politique ne représentait probablement pas la tendance majeure de l'opinion de la cour et de la ville. Ce qui paraît démontrer le rôle prééminent du cardinal souligne, paradoxalement, la profondeur du renforcement de l'absolutisme royal, et explique aussi la violence des tentatives de réaction ultérieures. N'exagérons cependant pas l'opposition entre le rationalisme déjà classique du couple politique roi-Premier ministre et la réaction féodale de cette première moitié du XVIIIe siècle français étonnamment baroque. Chez le roi comme chez le cardinal, on rencontre aussi quelques-uns des désirs politiques fondamentaux de l'époque : souhait de voir réaliser l'unité religieuse, à tout le moins de briser l'État dans l'État qu'avait formé, sous la régence, l'appareil politique protestant groupé autour des Rohan ; volonté de rénovation religieuse et d'épuration des mœurs. Mécène à sa manière, doué pour la musique, quelque peu sculpteur, Louis XIII se révèle peut-être le mieux dans ses goûts. Il a fait, entre autres, de Georges de La Tour un peintre royal et, ce qui est plus significatif, il a collectionné les œuvres de celui-ci : éclairage oblique, mais combien typique, de l'homme. Ambigu, secret, jaloux de son autorité et pénétré de ses devoirs, Louis XIII a eu, à défaut de génie propre, celui de voir et d'utiliser celui du cardinal. Y a-t-il tant d'hommes, surtout dans le monde politique, qui ont possédé ce genre de clairvoyance et, plus encore, qui sont capables de supporter sans ombrage un esprit qui les dépasse ? Jean Meyer
Le fils de Henri IV et de Marie de Médicis
Louis XIII, premier fils du roi Henri IV et de la reine Marie de Médicis, naît au château de Fontainebleau. L'enfance du dauphin Louis nous est assez bien connue grâce au journal qu'a laissé son médecin, Jean Héroard. Tous les détails de son alimentation, sa santé et de sa vie intime y sont notés. Le futur roi est installé dès le mois de novembre au château de Saint-Germain-en-Laye, où il retrouve les enfants illégitimes de son père, puis plus tard ses frères et sœurs le rejoignent au château1. Il est baptisé le 14 septembre 1606 à Fontainebleau, son parrain est, comme il est d'usage, le pape Paul V, représenté par le cardinal de Joyeuse, sa marraine est sa tante, Éléonore de Médicis, duchesse de Mantoue, sœur de la reine Marie. Du château de Saint-Germain, le jeune Louis XIII sort peu, sa mère Marie n'aime pas beaucoup que son fils entre en contact avec les habitants. Le dauphin est rapidement attiré par la musique et reçoit souvent des musiciens dans ses appartements. Il joue lui aussi de certains instruments et chante. La danse, la peinture et le dessin seront aussi parmi les distractions du futur souverain, mais ce qu'il préfère, ce sont les armes et ce qui touche au militaire.
Très tôt, il se découvre une passion pour les armées et les chevaux et parle souvent de guerre. Il s'exerce très jeune à l'arc et à l'arquebuse4 et aime faire appliquer les obligations cérémoniales à ses gardes. Il reçoit sa première leçon à l'âge de sept ans de la part de son précepteur le poète Nicolas Vauquelin des Yveteaux ; il ne montre pas un grand intérêt pour les lettres, que ce soit en français ou en latin, pour la géométrie, les mathématiques. Seule l'histoire semble le passionner un peu, en dehors des activités artistiques et militaires. Jugé insuffisant, des Yveteaux est remplacé en 1611 par le philosophe Nicolas Le Fèvre, qui meurt en novembre 1612, remplacé par M. de Fleurence. Il a pour gouverneur le militaire Gilles de Courtenvaux de Souvré.
Le futur Louis XIII a une profonde adoration pour son père, malgré le fait que ce dernier n'hésite pas à le fouetter dès son plus jeune âge et à l'humilier moralement selon un ancien usage qui veut que le dauphin soit dressé pour servir le Roi et la Reine8. Son père montre toutefois des signes d'affection en demandant à ses enfants de l'appeler papa et non Monsieur comme le veut l'usage. Ses relations avec sa mère sont tout autres. Cette dernière cache rarement sa préférence pour son cadet Gaston d'Orléans. Il n'est jamais ravi de la voir et refuse plusieurs fois de la servir, contrairement à son père, avec lequel il n'hésite pas à jouer le rôle de valet de chambre.
Louis, l'orphelin de père
À la mort d'Henri IV en 1610, Louis XIII monte sur le trône. Il n'a que 8 ans. Le pouvoir est alors assuré par sa mère Marie de Médicis, qui gouverne le royaume comme régente. La majorité du roi est proclamée en 1614, mais Marie déclare que Louis est trop faible de corps et d'esprit pour assumer les devoirs de sa charge ; elle l'écarte du Conseil et laisse gouverner ses favoris Concino Concini et Léonora Galigaï qui accaparent les plus hautes charges de l'État.
Traumatisé par la mort brutale d'un père qu'il chérissait, le petit roi n'a pas une enfance joyeuse. Tout d'abord, il ne trouve aucun substitut à l'amour paternel auprès de sa mère Marie de Médicis, qui le considère comme quantité négligeable. Louis se renferme assez vite sur lui-même, il a des troubles d'élocution, voire de bégaiement et souffre d'un manque d'affection.
Louis face à la régence de sa mère
Par ailleurs, le mépris des favoris italiens à son égard accroît son mal-être. En grandissant, Louis XIII devient taciturne et ombrageux. Il y a pourtant en lui, en regard de ces défauts, une forte volonté d'être digne de son père Henri IV. Il s'indigne de voir Concini, un étranger incapable selon lui, d'usurper le gouvernement de son État, tandis qu'on le relègue, lui, jeune roi, dans un coin du Louvre.
Or la régence de Marie de Médicis est très difficile : la gestion des affaires par son gouvernement est mauvaise, et les forces du royaume, hostiles à la centralisation du pouvoir qu'avait initiée Henri IV, en profitent. De graves troubles éclatent dans le royaume religieux, nobiliaires, sociaux, ce qui provoque des États Généraux inutiles et une instabilité politique. La politique pro-italienne et pro-espagnole de la Reine fait naître chez le petit roi un très lourd sentiment d'amertume. Alors que Henri IV avait songé à marier son héritier avec la princesse Nicole de Lorraine héritière des duchés de Lorraine et de Bar, ce qui aurait porté pacifiquement la frontière française jusqu'aux Vosges, le 21 novembre 1615 à Bordeaux, Marie de Médicis marie le jeune roi à Anne d'Autriche, infante d'Espagne. Pour Louis, c'est une humiliation de plus, car, conformément à la mémoire des choix de son père, il ne voit en Anne qu'une Espagnole et par conséquent une ennemie. Louis XIII, qui n'a que quatorze ans, pour éviter toute demande de divorce par l'Espagne, est obligé de consommer le mariage comme en témoigne son médecin dans ses notes personnelles, prises heure par heure et qui relatent avec précision la vie du jeune Louis XIII. Le roi est traumatisé par ce rapport obligatoire, au point qu'il attendra quatre ans avant de regagner, poussé par le duc de Luynes, le lit de la reine, son épouse.
Assassinat de Concini dans la cour du Louvre 24 avril 1617
À la mort de son père 1610, il n'a que 9 ans. Sa mère, qui exerce la régence, le marie à Anne d'Autriche en 1615. La politique catholique et pro-espagnole suivie par Marie de Médicis et la faveur dont jouit Concini, véritable chef du gouvernement, provoquent une opposition gallicane au parlement et le mécontentement des protestants et des grands, qui se livrent à des prises d'armes et exigent de la régente la réunion des états généraux 1614-1615.
Tenu à l'écart du gouvernement par sa mère malgré sa majorité déclarée le 2 octobre 1614, Louis XIII, pénétré du sentiment de la grandeur royale, souffre de cette humiliation. Sur les conseils de Luynes, il fait assassiner Concini 24 avril 1617, puis disgracie les ministres de sa mère, qu'il exile à Blois.
Un souverain qui affirme son autorité.
Après la régence mouvementée et pro espagnole de sa mère, Louis XIII rétablit progressivement l'autorité royale en brisant les privilèges des protestants, ceux des Grands, et l'encerclement des Habsbourg par une politique conflictuelle conduite par son ministre Richelieu.
Sortir de la régence de la reine-mère
C'est par un coup de force, le 24 avril 1617, que Louis XIII accède au pouvoir. Poussé par son favori Luynes il ordonne l'assassinat du favori de sa mère, Concino Concini et fait exécuter la Galigai sa femme, dame de compagnie de sa mère. Il exile Marie de Médicis à Blois et prend enfin sa place de roi. Louis XIII remplace Concini par son propre favori, Charles d'Albert, duc de Luynes. Très rapidement, Luynes accumule les titres et les fortunes. Son avancement crée des mécontentements, d'autant que le favori du roi est un très mauvais homme d'État.
En 1619, la reine-mère s'échappe du château de Blois et lève une armée contre son fils qui choisit de se réconcilier avec elle, lors du Traité d'Angoulême le 30 avril 1619, lui cède les villes d'Angers et de Chinon, mais lui interdit de revenir au Conseil. En 1620, Marie de Médicis déclenche une guerre civile qui se conclut par sa défaite totale à la bataille des Ponts-de-Cé le 7 avril 1620, où le roi commande personnellement. Par crainte de voir sa mère poursuivre des complots, le roi accepte son retour à la cour de France, et se réconcilie avec elle sous l’influence de Richelieu.
Contre les protestants
Le roi se rend à Pau en Béarn, dont il est le souverain, pour y rétablir la religion catholique comme religion officielle. Dès lors, il entend mettre fin aux privilèges politiques et militaires dont bénéficient les protestants depuis l'Édit de Nantes et imposer le catholicisme d'État à tous ses sujets. De 1620 à 1628 siège de La Rochelle, il combat et massacre les protestants, pille et détruit les fortifications de leurs places-fortes.
Il mène une première campagne contre les protestants en 1621 et permet la prise de Saint-Jean-d'Angély, mais il échoue devant Montauban défendue par le duc de Rohan en grande partie du fait de l'incompétence de Luynes. Celui-ci meurt de la scarlatine durant le siège de Monheurt, alors qu'il était déjà tombé en disgrâce.
Les hostilités reprennent en 1622. Le 16 avril, par une habile manœuvre, le roi écrase le duc de Soubise réfugié dans l'île de Riez. Puis il attaque son frère le duc de Rohan retranché dans Montpellier. Finalement un accord est conclu entre les deux parties, le 19 octobre 1622 au bout de deux mois de siège. Louis XIII signe l'Édit de Montpellier confirmant l'Édit de Nantes : extension de la liberté d'exercice de culte des protestants et limitation à deux du nombre de leur places de sûreté La Rochelle et Montauban.
Le duc de Luynes
Mais le roi ne prend pas effectivement le pouvoir : il laisse gouverner Charles d'Albert de Luynes, qui poursuit la politique catholique de la régente. Aussi l'opposition des grands, qui intriguent avec Marie de Médicis, se reconstitue-t-elle, ainsi que celle des protestants. Après avoir dispersé l'armée des princes et de sa mère aux Ponts-de-Cé 7 août 1620, Louis XIII mène une expédition contre les protestants qui se sont soulevés dans le Midi, sous la direction de Rohan, après le rétablissement du culte catholique en Béarn et Basse-Navarre et la réunion à la Couronne de ces provinces 1620. L'armée royale ayant échoué devant Montauban 1621, puis Montpellier 1622, le roi confirme l'édit de Nantes paix de Montpellier, 18 octobre 1622.
Avec Richelieu, souverain confident
Après la mort de Luynes décembre 1621, Louis XIII, conscient de ses propres limites et de la nécessité d'une ferme direction des affaires du royaume, décèle chez Richelieu le ministre d'envergure qui lui manque. Bien qu'il se défie du cardinal, qui est un protégé de sa mère, il l'appelle au Conseil le 29 avril 1624. Devenu principal ministre quatre mois plus tard, Richelieu le demeurera jusqu'à sa mort 1642.
Ainsi s'établit dans la France d'Ancien Régime une nouvelle forme de gouvernement, le ministériat, système fondé sur l'étroite association du roi et de son ministre, leur collaboration et mutuelle confiance. Richelieu souverain confident suggère au roi les décisions qui s'imposent, mais Louis XIII est seul à décider ; la puissance du ministre lui vient de ce que la confiance royale lui délègue l'autorité. Le système qui ne fonctionne réellement qu'à partir de 1630 restera précaire en raison de la nature très complexe de Louis XIII, dont Richelieu redoutera toujours les crises d'instabilité. Une santé médiocre, une enfance privée d'affection expliquent en partie le caractère timide, secret et ombrageux du roi, ainsi que ses amitiés passionnées qui le lient notamment à Marie de Hautefort, à Mlle de La Fayette, à Luynes et à Cinq-Mars.
Profondément pieux, Louis XIII vouera son royaume à la Vierge 10 février 1638. Jaloux de son autorité et imbu de ses droits et de ses devoirs de roi, il est passionné pour les choses de la guerre mais a peu de goût pour la politique. Avec Richelieu, homme d'État plus qu'administrateur, il va s'efforcer, pendant huit ans, de restaurer l'autorité royale et de rétablir en Europe la puissance de la monarchie française.
La mise au pas des huguenots et l'édit de grâce d'Alès
En 1624, le royaume est en proie à l'anarchie : les huguenots partageaient l'État avec le roi, les grands se conduisaient comme s'ils n'eussent pas été ses sujets et les plus puissants gouverneurs des provinces comme s'ils eussent été souverains en leurs charges ...; la dignité de la majesté royale était tel qu'il était presque impossible de la reconnaître Richelieu. Dès 1629, le parti huguenot est brisé : vaincus à La Rochelle 1628 et en Languedoc 1629, les protestants sont privés de leurs privilèges politiques assemblées et militaires places de sûreté par l'édit d'Alès 28 juin 1629. Mais cet édit, qui maintient les dispositions religieuses de l'édit de Nantes, indigne le parti dévot, hostile à la tolérance.
Le choix de Richelieu
Le Cardinal de Richelieu, premier ministre du Roi, 1633 par Philippe de Champaigne
Louis XIII, décidé à participer davantage aux affaires de l’État et de se lier à un seul ministre, gouverne avec Brûlart de Sillery et son fils, le marquis de Puisieux, ainsi qu’avec La Vieuville qui sont vite disgraciés pour incompétence.
En 1624, Marie de Médicis parvient à faire entrer le cardinal de Richelieu au conseil du roi, prélat qui a été le représentant du clergé aux États généraux de 1614 et ministre du gouvernement Concini. La plupart des historiens mettent en évidence l'étroitesse des relations entre Louis XIII et Richelieu qui écrit : Je soumets cette pensée comme toutes les autres à votre majesté pour signifier au roi qu'il ne tentera jamais de gouverner à sa place. La relation du Roi avec Richelieu est assez complexe et a sans doute évolué avec le temps vers une affection réelle. Il est l'auteur de cet éloge sur le cardinal : Le cardinal de Richelieu est le plus grand serviteur que la France ait eu.
Les deux hommes partagent une même conception de la grandeur de la France et des priorités qui s’imposent dans le domaine politique. Mais le Cardinal, beaucoup plus posé et responsable, semble respecter beaucoup plus la fonction que l'homme. Le programme politique de Richelieu se décline de plusieurs manières : l'abaissement des grands féodaux, la rationalisation du système administratif et la lutte contre la maison de Habsbourg à l'extérieur Guerre d'Italie 1624-1625, Guerre franco-espagnole, Guerre de Trente Ans.
Richelieu combat les protestants moins d'une façon planifiée que pour assurer l'autorité de l'État. Toutes les guerres contre les huguenots sont déclenchées par le soulèvement d'un de leurs chefs duc de Rohan, Benjamin de Rohan, duc de Soubise. Même le siège de La Rochelle n'est sans doute pas souhaité jusqu’à ce que Rohan déclenche les hostilités. La reddition de cette dernière ville, après un très long siège qui s'achève en 1628, est suivie de la promulgation de l’édit de grâce d’Alès 28 juin 1629, interdisant les assemblées politiques et supprimant les places de sûreté protestantes, mais maintenant la liberté de culte dans tout le royaume sauf à Paris.
Le choix décisif
Appuyé sur la très grande majorité des Français sensibles à la renaissance catholique, ce parti réprouve les alliances protestantes et la guerre contre les Habsbourg, champions de la Contre-Réforme, que préconisent Richelieu et le parti des bons Français : il réclame la paix pour réformer l'administration du royaume plein de séditions Michel de Marillac et soulager le peuple misérable et accablé d'impôts. Le parti des bons Français estime, au contraire, que le salut de l'État exige que l'on abatte la maison d'Autriche, qui prétend à la monarchie universelle, et que le roi doit séculariser sa politique pour défendre l'indépendance de la Couronne de France. Désavouant les dévots lors de la journée des Dupes 10 novembre 1630, Louis XIII choisit la politique de guerre et de grandeur suggérée par Richelieu, abandonnant toute pensée de repos, d'épargne et de règlement du dedans du royaume. Toute la politique intérieure va être subordonnée aux exigences de la lutte contre les Habsbourg.
Politique conduite par Richelieu contre les Grands et l'Espagne
Affaiblir les Grands
Louis XIII doit faire face à l’hostilité d’une partie de la famille royale à l'égard de Richelieu et de sa politique anti-espagnole.
Il se brouille avec sa femme. Après 11 ans de mariage, le couple, qui s'entend mal, n'a toujours pas donné d'héritier à la couronne. En 1626, la reine, poussée par la duchesse de Chevreuse, participe au complot du comte de Chalais, ayant pour but d'assassiner le roi et mettre son frère et héritier, le joyeux Gaston de France, sur le trône. À partir de cette date, le couple vit séparé.
Dès le début de l'implication de la France dans la guerre de Trente Ans 1635, Anne d'Autriche tente de renseigner secrètement l'Espagne sur les dispositions militaires et politiques françaises bien qu'elle soit tenue à l'écart de toutes les décisions du roi. La trahison est découverte mais l'affaire est finalement étouffée par le roi lui-même, qui est trop pieux pour penser sérieusement à un divorce de répudiation, qui provoquerait en outre des difficultés avec le Saint-Siège.
Il écarte également définitivement sa mère lors de la journée des Dupes 10 novembre 1630, pendant laquelle la cour croit le cardinal congédié, à la suite d’une violente altercation entre le roi et la reine-mère. Cette journée se termine par l'exil de la reine-mère à Moulins le roi ne la revit plus jamais, l'emprisonnement du chancelier Michel de Marillac et l'exécution du frère de celui-ci, le maréchal de Marillac, pour des motifs fallacieux, le procès étant dirigé par des hommes du cardinal.
Louis XIII doit mater plusieurs révoltes organisées par son frère et héritier, Gaston d'Orléans, et faire enfermer nombre de ses demi-frères comme le duc de Vendôme. Conscient des dilemmes qui agitent le roi, Pierre Corneille lui dédie plusieurs répliques du Cid.
Le roi veut aussi rabaisser l'orgueil des Grands du royaume et se montre inflexible à plusieurs reprises, ordonnant l'exécution du comte de Montmorency-Bouteville pour avoir violé l'interdiction des duels et celle du duc de Montmorency pour révolte. La légende qui fait de Louis XIII un fantoche soumis à Richelieu a pour origine le refus de nombre de contemporains de donner au roi le crédit des nombreuses exécutions qui eurent lieu sous son règne.
Louis XIII veut que les enfants de la noblesse, trop souvent rebelles, soient réunis non loin de Paris et crée en 1638 le Collège de Juilly pour leur inculquer l'amour de leur roi dans un lieu où il pourra leur rendre visite régulièrement.
Briser l'encerclement espagnol
Depuis François Ier, le Royaume de France est encerclé par les possessions des Habsbourg (Espagne, Saint-Empire, Pays-Bas, influence en Italie, colonies.... Plusieurs guerres ou complots ont opposé les Habsbourg aux Valois, en particulier au moment des guerres de religion. Henri IV au moment de son assassinat en 1610 était sur le point de faire alliance avec les protestants pour relancer la guerre contre la très catholique Espagne. Pendant la régence, à cause de la peur d'une nouvelle guerre, sa veuve Marie de Médicis se rapproche du parti pro-espagnol et conclut deux alliances matrimoniales avec les enfants de Philippe III 1612. En 1615, Louis XIII épouse Anne d'Autriche, et Élisabeth le dauphin Philippe, prince des Asturies.
Mais la France redoute toujours la politique impérialiste des Habsbourg, notamment en Allemagne, et se fait défenseur des « libertés germaniques. Sur les conseils de Richelieu, Louis XIII attend l'occasion favorable pour desserrer la domination diplomatique et reprendre le projet de son père, la guerre contre l'Espagne plusieurs fois reportée. Or, les Habsbourg sont en difficulté dans l'Empire face aux protestants lors de la guerre de Trente Ans. De plus, le redressement de la France par Richelieu amène l'accroissement des tensions franco-espagnoles.
À partir de 1631, la diplomatie française se rapproche des ennemis de l'Espagne, et particulièrement des puissances protestantes qu'elle finance. D'abord, les deux pays se contentent d'une guerre froide passage du pas de Suse et Guerre de Succession de Mantoue. L'année 1635 marque un véritable tournant : la France déclare la guerre ouverte à l'Espagne. Le roi est dans une position délicate, d'un point de vue politique comme religieux, puisqu'il se retrouve en conflit avec deux rois catholiques Habsbourg : Ferdinand III du Saint-Empire et Philippe IV d'Espagne. Son allié est le protestant Gustave II Adolphe de Suède. Militairement, jusqu’à la fin du règne, le roi est engagé dans une terrible guerre durant laquelle il commande plusieurs fois personnellement siège de Corbie. Il occupe ainsi la Catalogne révoltée dans la guerre des faucheurs 1641. Après ces quelques années difficiles, l'armée française vient peu à peu à bout de l'armée espagnole.
Un régime de guerre L'effort de guerre
L'effort de guerre se traduit par une aggravation du fardeau fiscal et un renforcement de l'absolutisme monarchique et de l'appareil étatique. Pour faire face à ses besoins financiers sans cesse croissants, la monarchie en guerre recourt à toutes sortes d'expédients : elle procède à des emprunts aux traitants et financiers et à des mutations monétaires création du louis d'or, 1640 ; elle multiplie les ventes d'offices nouveaux dévaluant ainsi les anciens et accroît le don gratuit du clergé ; surtout, elle augmente la taille et la gabelle et crée des taxes nouvelles de consommation. Mais le déficit sera constant.
Le relèvement de l'État
Afin d'assurer l'autorité royale dans tout le royaume et la tranquillité publique, Richelieu utilise les institutions existantes mais en les rendant plus efficaces et en les peuplant d'hommes de confiance tels les surintendants Bouthillier et Bullion, le chancelier Séguier, le Père Joseph. Le parlement voit ses droits et ses devoirs fixés dit du 21 février 1641. En province, les gouverneurs sont surveillés, doublés ou remplacés par des lieutenants généraux ; l'emploi des commissaires et des intendants devient intensif, quasi systématique : chargés de maintenir l'ordre et de contrôler tous les corps provinciaux dotés de privilèges, les intendants dépossèdent pratiquement de leurs fonctions les officiers de finances trésoriers, élus règlement d'août 1642. De plus, pour tenir l'opinion publique et défendre leur politique, Louis XIII et Richelieu entretiennent des pamphlétaires et utilisent la Gazette 1631 de Théophraste Renaudot. La fondation de l'Académie française 1635 relève, en partie, du même souci de propagande monarchique.
Le choix de la fermeté
Contre la noblesse séditieuse…
Ce régime et ces finances de guerre imposés à un pays attaché à ses privilèges et à ses libertés, et au moment d'un fléchissement de toute l'économie renversement de la conjoncture européenne, de hausse en baisse, vers 1630-1640, et crises de subsistances en 1629-1630 et 1636-1639, provoquent de multiples résistances. Supplantée par la noblesse de robe, qui est omniprésente dans l'appareil étatique, la noblesse d'épée ourdit de nombreux complots qui sont d'autant plus redoutables que des membres de la famille royale y sont impliqués en particulier Gaston d'Orléans, héritier du trône jusqu'en 1638, et que les princes du sang et les grands seigneurs, dotés de larges clientèles nobiliaires, négocient parfois avec des souverains étrangers et même avec une puissance ennemie Espagne.
Louis XIII frappe impitoyablement les conjurés exécutions du comte de Chalais 1626, du duc de Montmorency 1632, de Cinq-Mars 1642. Il prend des mesures sévères contre les duels, fait démanteler les châteaux forts et attache davantage les nobles au service de ses armées. Malgré ces mesures, l'esprit de sédition nobiliaire subsistera : la noblesse turbulente, qui obéit encore à une morale féodale et cultive la notion romanesque du héros, restera étrangère à la notion de raison d'État chère à Richelieu.
… les révoltes populaires
Les révoltes populaires rurales et urbaines qui éclatent chaque année sont dues à la pression fiscale qui s'accroît considérablement à partir de 1635 avec l'ouverture des hostilités. Les plus fortes effervescences se situent en 1630 et de 1635 à 1643 révoltes des croquants 1636-1637, des va-nu-pieds 1639-1640, etc.. Encadrées parfois par des nobles qui craignent que leurs paysans pressurés par le roi ne puissent plus leur payer rentes, droits ou fermages, ces émotions sont encouragées par la passivité complice des parlements, des municipalités et des officiers locaux, menacés dans leurs privilèges par les progrès de l'administration monarchique. Sans cohésion, ni programme, ces révoltes populaires seront brisées impitoyablement.
Pour le premier rang en Europe
Contrecarrer l'hégémonisme des Habsbourg
La guerre est destinée à contrecarrer les visées hégémoniques des Habsbourg de Vienne et de Madrid, et à enrayer leur expansion, mais aussi à améliorer la sécurité des frontières du royaume et à donner à la France une place prépondérante en Europe.
Dans l'Empire, où se déroule un conflit entre l'empereur et les princes protestants guerre de Trente Ans, la France s'efforcera de garantir les princes contre l'oppression de la maison d'Autriche. Mais son but essentiel sera d'écarter la menace d'encerclement que les possessions espagnoles font peser sur le royaume : pour ce faire, écrit Richelieu au roi le 13 janvier 1629, il convient d'ouvrir des portes dans tous les États voisins pour mieux intervenir contre l'éventuelle menace espagnole.
Le 6 mars 1629, Louis XIII force le pas de Suse, puis s'empare de Pignerol 1630, faisant ainsi échec à l'Espagne en Italie, traité de Cherasco. En 1634, la France étend sa zone de couverture vers l'est en occupant la Lorraine.
La guerre couverte
Pratiquant la guerre couverte 1630-1635, Louis XIII soutient les adversaires de l'empereur Ferdinand II princes protestants allemands, Gustave II Adolphe, Maximilien de Bavière et de Philippe IV d'Espagne Provinces-Unies.
Assurer la continuité et la succession du roi
L'absence d'héritier favorise les complots
Le souci majeur de Louis XIII, durant son règne, est d'être de nombreuses années sans héritier mâle. D'une santé médiocre, secoué par de violentes maladies, le roi manque à maintes reprises de mourir subitement sans héritier : cela entretient chez les prétendants au trône de grandes espérances Gaston d'Orléans, le comte de Soissons, le comte de Moret…. La très difficile relation qu'entretient le roi avec la reine augmente les espoirs de ces princes, qui toujours mêlés à des complots (notamment la conspiration de Chalais, espèrent bien que le roi n'ait jamais d'héritier.
La naissance du dauphin, futur Louis XIV, en 1638 après 23 ans de mariage, alors que le roi et la reine ont 36 ans, le font surnommer l'enfant du miracle. Les mémorialistes diffèrent sur l'attitude du roi à l'égard de son héritier : Tallemant des Réaux dit que le roi considéra son fils d'un œil froid, puis se retira. Tous les autres mémorialistes, dont l'ambassadeur de Venise Contarini qui était présent, disent que le roi tomba à genoux devant son fils et l'embrassa. Louis XIII et Anne d'Autriche ont en 1640 un second fils, Philippe, le futur duc d'Orléans. Ces deux naissances limitent les complots à ceux qui veulent prendre la place du Cardinal, malade conspiration de Cinq-Mars.
Le décès de Richelieu, la montée de Mazarin et la mort du Roi
Louis XIII le Juste, écu d’argent, 1er poinçon de Warin 1642, Paris.
Après la mort du cardinal, en décembre 1642, le roi décide de se réconcilier avec certains des anciens conspirateurs comme son demi-frère, César de Vendôme et ses fils, le duc de Mercœur et le duc de Beaufort. Toutefois, il poursuit la même politique. Il fait entrer au conseil d'État un des proches collaborateurs de Richelieu, le Cardinal Mazarin qui devient vite premier ministre de fait, le Roi n'a pas nommé de premier ministre, mais au bout de quelques mois, lorsque le secrétaire d'État à la guerre, Sublet de Noyers démissionne, le roi nomme pour le remplacer un des protégés de Mazarin, Michel Le Tellier.
Après six semaines de terribles coliques et vomissements, Louis XIII meurt le 14 mai 1643, soit 33 ans jour pour jour après son père Henri IV assassiné le 14 mai 1610, à 41 ans, des conséquences d'un mal aujourd'hui identifié comme la maladie de Crohn. Il est toutefois probable que cette maladie chronique n'ait fait que l'affaiblir et que le coup de grâce lui ait été donné par son médecin, Bouvard, qui laisse le bilan de trente-quatre saignées, mille deux cents lavements et deux cent cinquante purges pratiqués sur le roi dans les deux dernières années de sa vie14. Son corps est porté à la basilique Saint-Denis sans aucune cérémonie, selon son propre désir pour ne pas accabler son peuple d'une dépense excessive et inutile. Juste avant de mourir, Louis XIII rédige un testament visant à limiter les prérogatives de sa femme, la nouvelle Régente. Anne d'Autriche n'en tient pas compte et le fait casser dès qu'elle en a connaissance.
Personnalité et bilan : un roi fragile qui rétablit l'autorité royale
Louis le Juste : un roi religieux
Louis XIII est très pieux, profondément catholique. S'il est tolérant envers les protestants, c'est par respect de la réconciliation accomplie par son père. Marie de Médicis a tout de même veillé à ce que son fils reçoive une éducation catholique sévère. Louis XIII a horreur du péché. C'est pour lui une obsession. Le roi répugne aux superfluités de la vie. Les difficultés qu'il rencontre en 1638, ainsi que son tempérament très pieux l'amènent à placer la France sous la protection de la Vierge Marie. Il rédige aussi, avec son confesseur, le père Nicolas Caussin, un livre de prières. Sa politique religieuse active rallie le clergé ce qui limite les contestations catholiques à sa diplomatie d'alliance avec les puissances protestantes contre les Habsbourg.
Le roi contrôle par son gouvernement centralisateur les autorités locales dans le souci du bien-être des peuples et du salut de ses États. Il est à l'origine de l'édit qui fait obligation aux évêques d'octroyer une rémunération aux officiers du culte. Il permet le retour de l'école des Jésuites de Clermont à Paris et ouvre celle-ci aux fils de la bourgeoisie. Il aide également Vincent de Paul - qui sera canonisé par Clément XII le 16 juin 1737 - à fonder une congrégation religieuse dont le but est de venir en aide aux plus pauvres. Le corps des Intendants remplace les baillis et sénéchaux dans l'administration du territoire. Sous son règne est frappé le premier Louis d'or. Il achève la construction du pont Neuf, fait creuser le canal de Briare et crée le premier office de recensement des chômeurs et invalides. Toutefois, le poids des conflits pèse lourd en fiscalité.
Un roi guerrier qui agrandit son royaume
Louis XIII est un roi-soldat comme son père. Depuis toujours, il est passionné par les chevaux et par les armes. Excellent cavalier, il se trouve fréquemment sur les champs de bataille, où il montre un grand courage. En temps de paix, la chasse est son passe-temps favori. Il ne craint pas de dormir sur la paille, quand ses chevauchées l'emmènent loin de la ville. Il écrit des articles militaires pour la Gazette de Théophraste Renaudot. Quoique passionné par le dessin et la danse, Louis XIII, n'est pas un roi mécène. La seule statue à son effigie fut fondue à la Révolution. Il a cependant protégé le peintre Georges de La Tour, voulu faire rester Poussin en France et promulgué plusieurs édits en faveur des troupes de théâtre.
Il affirme nettement l'unité du Royaume, contre les protestants, les grands et l'Espagne, en général par l'usage de la force. Le Béarn et la Navarre sont rattachés à la couronne tandis que les protestants cessent de former un État dans l'État. Perpignan, le Roussillon, et la Catalogne en révolte contre l'Espagne sont annexés à la France, de même que l'ensemble de la Savoie et du Piémont, ainsi que la ville de Casale Monferrat. Au nord, une grande partie du Hainaut est conquise avec la prise d'Arras. À l'est, la Lorraine est intégralement occupée par les troupes françaises. Enfin, le roi subventionne les expéditions de Champlain au Canada et favorise le développement de la Nouvelle-France. Louis XIII laisse faire Richelieu qui cherche à doter la monarchie française d'une marine de guerre. Cette jeune marine, qui compte une soixantaine de vaisseaux et un peu plus de vingt galères en 1642, intervient efficacement contre la flotte espagnole en Méditerranée et sur les côtes atlantiques.
Il autorise aussi, pour la France, la traite négrière en 1642. Tous les ports français y participeront, en premier lieu ceux de Nantes et de Bordeaux mais aussi le Havre, Marseille, Brest, Lorient, La Rochelle ou St-Tropez. La traite suscite néanmoins de violentes protestations.
Sur le plan économique, Louis XIII crée en 1640 le louis d'or, un nouveau système monétaire français qui tiendra jusqu'à la Révolution française.
La déclaration de guerre
Puis, le 19 mai 1635, il ouvre le conflit avec l'Espagne, entrant ainsi dans la guerre de Trente Ans. Après des revers prise de Corbie, 1636 ; désastre de Fontarabie, 1638), la France et ses alliés remportent des succès : l'occupation de Brisach 1638 ouvre les portes de l'Allemagne; la prise d'Arras 1640 garantit solidement la frontière du Nord ; en 1642, le Roussillon est conquis capitulation de Perpignan, 9 septembre.
Ces succès et le soutien accordé par Richelieu aux révoltes du Portugal et de la Catalogne 1640 Louis XIII est proclamé comte de Barcelone en 1641 amorcent le déclin de la puissance de l'Espagne. Louis XIII et Richelieu meurent peu avant la victoire de Rocroi 19 mai 1643 sur les Espagnols.
La guerre qu'ils ont entamée en 1630 malgré l'opinion catholique, et qu'ils ont menée au moyen d'une séparation des intérêts politiques et religieux, aboutira aux traités de Westphalie 1648 et des Pyrénées 1659, qui consacreront l'échec des ambitions des Habsbourg et la prépondérance française en Europe.
Avant de mourir 14 mai 1643, Louis XIII organise la régence de son fils, le futur Louis XIV, en créant un conseil de régence comprenant Anne d'Autriche et Mazarin.
La sexualité du Roi
La sexualité du Roi a été sujette à une attention particulière, eu égard à ses relations hétérosexuelles et aux relations qu'il entretient avec certains hommes de son entourage, comme le raconte Gédéon Tallemant des Réaux dans ses Historiettes.
Si le roi ne trouve pas le bonheur dans son mariage avec Anne d'Autriche l'union n'est consommée qu'en 1619, il lui donne deux enfants18, la reine accouchant du futur Louis XIV après plusieurs fausses couches. Le Roi avait, selon les termes de Pierre Chevallier, incontestablement des tendances homosexuelles. Il est lié amoureusement à plusieurs autres personnes : aux femmes Louise Angélique de La Fayette et Marie de Hautefort, et aux hommes le Duc de Luynes, François de Barradat, Claude de Saint-Simon et le marquis de Cinq-Mars ; il n'existe cependant pas de preuve qu'il se soit engagé dans des relations charnelles avec ses favoris masculins. Le sexologue Fritz Klein, spécialiste de l'étude de la bisexualité, voit ainsi le roi Louis XIII comme bisexuel.
Un souverain austère
Son rejet des vanités entraîne chez lui une grande méfiance vis à vis des courtisans et de sa femme. Il vise ainsi une réputation d'austérité.
Anne d'Autriche, son épouse, est délaissée après la nuit de noces ; le jeune Louis XIII a de la honte et une haute crainte selon les mots d'Héroard à aller voir la reine, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs. Son jeune âge 14 ans peut justifier ses appréhensions. Il la néglige ensuite assez souvent. Toutefois, la plupart des historiens et des romanciers qui soutiennent la thèse d'une non consommation du mariage de Louis XIII et Anne d'Autriche avant la naissance de Louis XIV oublient que la reine fit trois fausses couches, dont l'une consécutive à une chute accidentelle dans un escalier. Des études génétiques récentes prouvent que Louis XIV descendait bien d'Henri IV, garantissant ainsi qu'un fils de Henri IV est bien le père de Louis XIV.
Sa santé fragile et sa religiosité peuvent expliquer pour partie cette distance vis-à-vis d'une épouse imposée par sa mère. Sa méfiance politique justifiée joue un rôle au moins aussi important. Autre raison ; le souvenir de la mésentente politique et conjugale entre ses parents : outre sa position anti-espagnole, Marie de Médicis reprochait à Henri IV ses infidélités ouvertes Louis avait été élevé avec ses demi-frères.
Toutefois, on connaît du roi deux liaisons féminines, toutes deux platoniques il est vrai : l'une avec Marie de Hautefort, future duchesse d'Halluin, l'autre avec Louise de La Fayette, avec laquelle il voulut se retirer à Versailles.
Les favoris
Durant son règne, Louis XIII entretient des relations émotionnelles fortes avec quelques hommes de son entourage. Les deux plus célèbres de ses favoris furent le duc de Luynes et le marquis de Cinq-Mars, que le roi combla de bienfaits.
La nature exacte de ces relations est l'objet de réflexion de la part de certains contemporains et des historiens comme Chevallier et Petitfils. Sans avoir de preuves que ces relations aient été charnelles, la familiarité du roi avec ses favoris les a conduits à s'interroger sur une possible homosexualité ou bisexualité du roi.
Pierre Chevallier, qui a par ailleurs douté de l'homosexualité d'Henri III, a mis en avant les tendances homosexuelles de Louis XIII ; il évoque le témoignage en octobre 1624, du Vénitien Morosini, qui définit le rôle du maréchal de Toiras, l'un des favoris de Louis XIII : Non pour les affaires de l’État mais pour la chasse et les inclinations particulières du roi. Jean-Christian Petitfils a repris ces conclusions, tout en mettant en avant, sans le prouver toutefois, les convictions catholiques du monarque pour inférer l'hypothèse de la non-consommation de ses désirs.
Parmi les contemporains, la source la plus importante à cet égard est Gédéon Tallemant des Réaux, chroniqueur assez hostile à Richelieu et qui ne se cache pas d'utiliser des témoignages de seconde, voire de troisième main. Parmi les autres sources, on citera Héroard, Ménage et Saint-Simon.
Parmi, les autres favoris, on peut citer Blainville, Vendôme, le commandeur de Souvray, Montpuillan-la-Force, le marquis de Grimault, François de Baradas et le duc de Saint-Simon.
Le compositeur et joueur de luth
En 1635, Louis XIII aurait créé la musique, le livret et les costumes du Ballet de la Merlaison ou Ballet de la chasse au merle, dansé par le roi lui-même la même année à Chantilly et à Royaumont le 17 mars. Louis XIII jouait également du luth dès l'âge de 3 ans. Surnommé le roi des Instruments, il l’impose à sa Cour et lui consacre des cycles de concerts privés devant une assemblée choisie d’amateurs et de praticiens comme lui.
Ascendance de Louis XIII de France
Descendance
Louis Dieudonné 1638-1715, roi de France et de Navarre 1643-1715, épouse en 1660 sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne 1638-1683, d'où six enfants naissent, puis secrètement Françoise d'Aubigné, Veuve Scarron, marquise de Maintenon 1635-1719
Philippe de France 1640-1701 duc d'Anjou, puis duc d'Orléans, Monsieur, épouse en 1661 sa cousine Henriette d'Angleterre 1644-1670 d'où six enfants naissent, puis en 1671 Élisabeth-Charlotte de Bavière 1652-1722 d'où trois enfants naissent.
Naissance de Louis XIV
Louis XIII avait fait le vœu de placer le royaume de France sous la protection de la Vierge Marie s'il obtenait un fils.
Au bout de vingt-trois années de mariage, ce vœu fut enfin réalisé : le dauphin Louis Dieudonné, futur Louis XIV, naquit en 1638.
Mais la mort du roi devait empêcher celui-ci d'exécuter entièrement sa promesse : élever un nouveau maître-autel à Notre-Dame de Paris et offrir au chœur un groupe sculpté représentant la Vierge et le Christ après la Crucifixion.
Le style Louis XIII
De la fin du XVIe s. à l'avènement de Louis XIV, les modèles hispano-flamands et italiens se partagent les faveurs des décorateurs et de leurs commanditaires, princes, nobles et grands bourgeois.
Les murs se couvrent de larges cartouches peints encadrés de stucs dorés, ou se tendent de tapisseries ou de cuirs gaufrés, peints et dorés. La chambre demeure la pièce principale de l'appartement, qu'occupe le lit « en housse », drapé de courtines (remplacé vers 1645 par l'alcôve fermée d'une balustrade), accompagné de sièges (fauteuils, chaises, « ployants », tabourets) garnis de tissu, à pieds tournés en chapelet ou en spirale. Le grand meuble d'ébénisterie est le cabinet d'ébène, souvent d'importation flamande ou allemande, aux vantaux sculptés en léger relief, porté par des cariatides, des consoles ou des balustres, tandis qu'apparaît, venue d'Italie, la table bureau.
Le bilan d'un règne
Son règne a associé la grandeur de l'État et la misère du peuple, la puissance extérieure et la fragilité intérieure, avec la détresse financière, la précarité économique et les troubles sociaux. Son action, conjuguée à celle de Richelieu, a été décisive : elle a porté la France au premier rang en Europe, transformé l'absolutisme doctrinal en absolutisme pratique et renforcé l'unité du royaume. Mais l'effort de soumission fiscale que le roi a exigé d'un peuple récalcitrant a suscité une masse de mécontentements qui gronde dans des révoltes durant tout son règne et explosera lors de la Fronde.
La rigueur de cette époque tourmentée et tumultueuse n'a nullement enrayé les progrès de la civilisation. Le règne de Louis XIII occupe les trente-trois années centrales du premier xviie siècle 1600-1660, ce demi-siècle dit baroque qui est marqué par un réveil éclatant du catholicisme et par une floraison de talents littéraires et artistiques : c'est l'époque de saint François de Sales, de saint Vincent de Paul, de Bérulle et de Saint-Cyran ; celle d'Honoré d'Urfé, de la marquise de Rambouillet, de Scarron, de Théophile de Viau, de Corneille, de Descartes, de Pascal, de Simon Vouet, de Philippe de Champaigne, de Le Sueur, etc.
La musique du roi de France 1601-1643.
Grand amateur de musique dès son enfance, il succéda en 1610 à son père Henri IV, mais, malgré sa position, n'eut pas d'influence sur la vie musicale en France à cette époque. Son attitude fut plutôt celle d'un dilettante passionné, entouré de musiciens, et n'hésitant pas à prendre part, lui-même, aux ensemble vocaux, voire à diriger le chœur royal lors de l'absence de son chef. Il reste fort peu de ses œuvres, bien que la tradition veuille faire de lui un compositeur de musique sacrée motets, harmonisations de psaumes, De profundis. En fait, seul un psaume, Seigneur à qui seul je veux plaire, peut lui être attribué de source sûre. Il est, en revanche, l'auteur d'une chanson à 4 parties, Tu crois, ô beau soleil publiée par Mersenne et surtout de la partition intégrale (paroles et musique du Ballet de la Merlaison, exécuté le 15 mars 1635 à Chantilly par le roi et des membres de la cour.
Culture Inspirations littéraires
Alexandre Dumas
Robert Merle, Fortune de France les tomes 7 à 13 du cycle retracent la vie de Louis III
Arts
Une statue équestre de Louis XIII est située, place des Vosges à Paris dans le square portant son nom. Ce monument a été élevé le 4 novembre 1829 en remplacement de l’ancienne statue de bronze érigée en 1639.
Le Vœu de Louis XIII.
Cinéma et télévision
Le personnage de ce roi apparaît dans de nombreux films, essentiellement grâce aux diverses adaptations du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires qui a été adapté une trentaine de fois. Le roi y apparaît souvent comme un personnage triste et infortuné. Certaines adaptations de Dumas, comme celles de George Sidney ou de Richard Lester, font de Louis XIII un personnage comique, en le dépeignant comme un benêt ou un maladroit. Le règne de Louis XIII donne au cinéma de cape et d'épée, notamment dans les années cinquante et soixante, ses heures de gloire.
Les Trois Mousquetaires 1948, de George Sidney, avec Frank Morgan dans le rôle du roi. Louis XIII y est dépeint comme un imbécile, dénué de toute autorité et ouvertement méprisé par Richelieu.
Les Trois Mousquetaires 1953 d'André Hunebelle avec Louis Arbessier dans le rôle du roi.
Si Versailles m'était conté... 1954 de Sacha Guitry avec Louis Arbessier dans le rôle du roi.
Le Capitan 1960 d'André Hunebelle : le film relate le conflit entre Concini et le jeune Louis XIII, joué par Christian Fourcade.
Les Trois Mousquetaires 1961 de Bernard Borderie avec Guy Tréjan dans le rôle du roi.
Cyrano et d'Artagnan 1964 d'Abel Gance avec Philippe Noiret dans le rôle du roi.
Les Diables 1971 de Ken Russell : le film relate l'affaire des démons de Loudun ; le roi, joué par Graham Armitage, y fait deux courtes apparitions. Dans cette représentation assez fantaisiste, Louis XIII est dépeint comme un homosexuel efféminé qui se divertit en tuant dans son jardin, à coups de pistolet, des protestants habillés en oiseaux.
Les Trois Mousquetaires 1973 et On l'appelait Milady 1974 de Richard Lester avec Jean-Pierre Cassel dans le rôle du roi. Louis XIII est à nouveau représenté comme un personnage ridicule et incompétent.
D'Artagnan amoureux, mini-série de 1977 réalisée par Yannick Andréi avec Gabriel Cattand dans le rôle du roi.
Richelieu ou la Journée des dupes, téléfilm de 1983 réalisé par Jean-Dominique de La Rochefoucauld avec Patrick Raynal dans le rôle du roi.
Les Trois Mousquetaires 1993 de Stephen Herek avec Hugh O'Conor dans le rôle du roi.
Les Trois Mousquetaires 2011 de Paul W. S. Anderson en 3D avec Freddie Fox dans le rôle du roi.
Richelieu, la Pourpre et le Sang 2014 de Henri Helman avec Stéphan Guérin-Tillié dans le rôle du roi ; téléfilm français qui traite de la conspiration de Cinq-Mars
The Musketeers 2014 de Adrian Hodges avec Ryan Gage dans le rôle du roi ; série télévisée britannique
Sources imprimées
Pierre Boitel, sire de Gaubertin, Histoire des choses les plus mémorables de ce qui s'est passé en France depuis la mort de Henri le Grand jusqu’à l'assemblée des notables en 1617 et 1618
Armand Jean du Plessis de Richelieu, Mémoires du cardinal de Richelieu sur le règne de Louis XIII
Antoine Girard & Jacques Dinet, jésuites : La Mort du roi Louis le Treizième, mis en forme par Girard à la demande de la reine mère pour servir de modèle à Louis XIV en 1643.
Jean Héroard, Journal : publié sous la direction de Madeleine Foisil, Centre de recherches sur la civilisation de l'Europe moderne séminaire de Pierre Chaunu, vol. 1 et 2, Paris, Fayard, 1989, 3123 p.
Bibliographie
Pierre Chevallier, Louis XIII, roi cornélien, Paris, Fayard, 1979, 680 p.
Paul Cunisset-Carnot, Un Mouvement séparatiste sous Louis XIII. L'émeute des Lanturelus à Dijon en 1630 1897
Madeleine Foisil, « La première éducation du prince d'après le Journal de Jean Héroard, Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, t. 99-1, 1987, p. 303-335 .
Madeleine Foisil, L'enfant Louis XIII : l'éducation d'un roi, 1601-1617, Paris, Perrin, 1996, 263 p.
Hubert Méthivier et Pierre Thibault, Le Siècle de Louis XIII, 9e édition corrigée, Collection : Que sais-je ? ; n° 1138, 1994,
(en) Lloyd Moote, Louis XIII, the Just, 1989
Jean-Christian Petitfils, Louis XIII, Perrin, 2008
Marius Topin, Louis XIII et Richelieu : étude historique, 1876
         
Posté le : 25/09/2015 20:52
Edité par Loriane sur 02-10-2015 19:30:13
|
|
|
|
|
Cosme de Médicis |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 27 septembre 1389 naît Cosme de Médicis Côme en français
à Florence, ou en italien Cosimo de Medici, mort le 1er août 1464 à Careggi, banquier, diplomate, et homme d'État italien, est le fondateur de la dynastie politique des Médicis, dirigeants effectifs de Florence durant une bonne partie de la Renaissance italienne. Son père est Jean de Médicis, sa mère est Piccarda de Bueri; il est mériée à Contessina de Bardi avec qui il a des enfants : deux enfants : Pierre Ier de Médicis, Jean de Médicis, et un fils hors mariage, Charles de Médicis. Il est aussi connu sous le nom de Cosme l'Ancien Cosimo il Vecchio ou Cosimo Pater Patriae, Cosme Père de la patrie.
En bref
Homme d'État italien, né le 27 septembre 1389 à Florence, mort le 1er août 1464 à Careggi, près de Florence, Côme de Médicis, dit Côme l'Ancien, premier d'une lignée des Médicis qui gouverna Florence de 1434 à 1537.
Fils de Giovanni di Bicci 1360-1429, qui a fait fortune, Côme est chargé de représenter la banque des Médicis. Il gère ensuite les finances de la papauté et, en 1462, remplit largement ses coffres en obtenant de Pie II le monopole des mines d'alun de Tolfa, indispensables à l'industrie textile de Florence. Il est alors probablement l'homme le plus riche de son temps. Sa puissance et sa démagogie le rendent insupportable à l'oligarchie. Les Albizzi, autre grande famille florentine, tentent de le renverser. En 1431, Côme de Médicis séjourne à Cafaggiolo lorsqu'il est accusé d'un crime capital : « avoir cherché à s'élever plus haut que les autres ». Il se laisse emprisonner au Palazzo Vecchio. Les Albizzi ne tardent pas à découvrir qu'il est difficile d'assassiner un homme aussi riche. Le geôlier goûte sa nourriture et Côme a payé le gonfalonier pour qu'il commue sa peine de mort en bannissement. Il se retire alors à Padoue et à Venise, où il est reçu comme un souverain. Tout juste un an plus tard, les Médicis remportent frauduleusement la seigneurie de Florence. Côme rentre triomphant dans la cité en 1434, tandis que ses ennemis partent définitivement en exil.
Côme de Médicis est souvent accusé d'avoir supprimé les libertés florentines, mais celles-ci ont déjà disparu sous le gouvernement des Albizzi. Côme maintient l'illusion d'un régime constitutionnel, mais change radicalement l'esprit de la loi. Alors que les fonctions officielles étaient auparavant tirées au sort, il s'arrange pour que seuls apparaissent les noms des personnes dignes de sa confiance. Il neutralise l'indépendance des deux assemblées municipales en donnant un caractère normal à une procédure exceptionnelle : Il obtient ainsi pour une durée limitée des pouvoirs dictatoriaux qui seront sans cesse renouvelés. Côme s'allie également aux Sforza de Milan, qui lui fournissent des troupes. il écrase ainsi l'opposition grandissante par un coup d'État en août 1458 et crée un sénat composé de 100 partisans loyaux.
Côme de Médicis a les moyens d'assouvir sa passion pour l'architecture. Brunelleschi, qui a déjà terminé le dôme de la cathédrale de Florence, travaille à l'église San Lorenzo et à sa Sagrestia Vecchia, ainsi qu'à la rotonde de l'église Santa Maria degli Angeli et Michelozzo crée le palais Medici-Riccardi, le couvent de Saint-Marc, la chapelle Médicis de l'église Santa Croce, une chapelle de l'église San Miniato. Côme réunit aussi autour de lui les sculpteurs Lorenzo Ghiberti et Donatello ainsi que les peintres Andrea del Castagno, Fra Angelico et Benozzo Gozzoli.
Côme de Médicis se lance à la recherche de manuscrits anciens dans la Chrétienté et même, avec l'accord du sultan Mehmet II, en Orient. Il constitue ainsi une bibliothèque sans pareille, ouverte au public, appelée bibliothèque Laurenziana d'après son petit-fils. Il s'entoure d'humanistes comme le Pogge et Marsile Ficin, dont il fait diffuser les œuvres avec l'aide de moines copistes. Côme lui-même se prend d'admiration pour la philosophie grecque et Platon, et fonde une Académie platonicienne dans sa villa de Careggi, dont il confie la direction à Marsile Ficin.
En 1439, Côme parvient à faire transférer de Ferrare à Florence le concile œcuménique, qui pensera avoir résolu le schisme régnant au sein de l'Église d'Orient. Ce sera le plus grand succès de Côme de Médicis en matière de politique étrangère.
Après avoir perdu son frère, 1440 et son fils Giovanni, 1463, laissant la succession à Piero, né en 1416, Côme de Médicis meurt en 1464 et est enseveli dans l'église San Lorenzo. L'année suivante, le peuple lui décernera le titre latin de Pater patriae Père de la patrie.
Sa vie
Il est le fils de Giovanni di Bicci De' Medici et Piccarda de Bueri.
Il reçoit une éducation humaniste et apprend le latin et le grec, mais également le français et l'allemand. À 13 ans, il dirige l'un des ateliers de laine de son père et parcourt l'Europe en inspectant les filiales de la banque familiale. En 1414, il voyage pendant deux ans en Allemagne, en France et dans les Flandres, puis passe trois ans à Rome.
Après la mort de son père en 1429, il s'opposa au régime oligarchique alors en place à Florence, dans lequel prévalait la famille rivale des Albizzi. L'influence de Cosme de Médicis, doué d'un sens politique remarquable, grandit encore du fait que le chef de l'oligarchie, Rinaldo degli Albizzi, le fit arrêter le 7 septembre 1433, en l'accusant de concussion. Il fut emprisonné dans le Palais de la Seigneurie mais réussit grâce à différents pots de vin à transformer sa condamnation à mort en exil pour dix ans1. Cosme partit avec sa famille le 3 octobre 1433 et s'installa à Venise, tout en gardant un contact étroit avec ses partisans à Florence qui exigèrent des débiteurs des Médicis le remboursement immédiat de leurs emprunts, paralysant progressivement l'économie de Florence. Il disposa également de l'appui du pape Eugène IV.
Prise de pouvoir
Mais Albizzi eut affaire à forte partie ; ni son prestige, ni son argent n'intimidèrent ses adversaires. Le 5 octobre 1434, Cosme est de retour à Florence, triomphant et acclamé par le peuple. À son tour, il bannit son rival. Comme son père autrefois, il est nommé gonfalonier de Florence en 1434, et peut mettre en œuvre son dessein politique visant à faire de sa famille l'arbitre de l'État florentin. Il inspirait la politique extérieure et exerçait une grande influence sur celle de toute l'Italie. Il utilisa à cette fin et dans plusieurs directions son exceptionnelle fortune, reposant sur la banque que lui avait léguée son père, qui possédait des filiales dans divers États italiens et même à l'étranger. Pour museler ses opposants, il utilisa deux techniques : le bannissement, très courant dans la République de Florence), mais aussi les redressements fiscaux, qui consistaient à ruiner la victime en augmentant les taxes que celle-ci devait payer.
Le mécénat
Le mécénat des Médicis commença avec lui. Il fit peindre les fresques du couvent San Marco par Fra Angelico. Marsile Ficin écrit que c'est après avoir entendu en 1438 les leçons du philosophe platonicien Gemiste Pléthon, que Cosme conçut l'idée de faire revivre une sorte d'Académie : l'Académie platonicienne de Florence, fondée en 1459. Il prenait un intérêt très vif à l'art et à la science, au service desquels il mit sa fortune avec la libéralité d'un grand seigneur ; tout Florence suivit son exemple. Collectionneur, il se fit conseiller par Donatello, qui devint son ami et qu'il encouragea dans ses recherches artistiques.
Descendance
Cosme de Médicis épousa vers 1414 Contessina de Bardi, fille aînée de l'associé de son père, et eut deux enfants :
Pierre Ier de Médicis 1416-1469
Jean de Médicis 1421-1463
Avec une esclave circassienne, il eut aussi un fils illégitime – Carlo 1428/1430 à c. 1492 qui devint prélat.
À la mort de Cosme, dévoré par la goutte, son fils Pierre lui succède.
Citations
"Il nous est ordonné de pardonner à nos ennemis, mais il n'est écrit nulle part que nous devons pardonner à nos amis ". (Cosme de Médicis)
Les Médicis en italien Medici
Famille italienne de banquiers toscans remontant au XIIIe siècle et qui domina Florence avant d'y régner, du XVIe au XVIIIe siècle.
Les origines
C'est dès le XVIIIe siècle que l'on trouve mention de cette famille, originaire du Mugello à 30 km de Florence. Le premier Médicis à apparaître dans le gouvernement de Florence est Sylvestre, Salvestro [Florence 1331-Florence 1388, gonfalonnier, qui déclenche en 1378 l'insurrection des Ciompi contre les Albizzi, ce qui lui vaut d'être exilé.
C'est Jean d'Averardo Giovanni di Bicci 1360-1429, gonfalonnier également en 1421 et représentant d'une autre branche de la famille, qui fonde la puissance des Médicis en développant la banque familiale avec des filiales à Rome,Venise et Naples et regroupant autour de lui un véritable parti. Ses deux fils, Cosme l'Ancien, Cosimo il Vecchio Florence 1389-Careggi 1464 et Laurent, Lorenzo le Magnifique, Florence 1449-Careggi 1492 sont à l'origine des deux branches appelées à régner sur Florence.
Les défenseurs du peuple
Cosme ou Cosme l'Ancien
Cosme hérite de la direction de l'entreprise Médicis en 1429. il consolide, grâce à une gestion habile, l'affaire familiale, qui devient banque, maison de commerce et centre de fabrication. Exilé en 1433 par le chef de l'oligarchie Rinaldo degli Albizzi, il fait un retour triomphal en 1434. Il prête également aux grands : ainsi il est au service du Saint-Siège, des rois de France et d'Angleterre, des ducs de Bourgogne. Une part importante de ses profits est placée dans le Monte dei dotti, qui se charge des emprunts de la cité florentine, ou encore dans le mécénat, faisant de ce marchand un amateur éclairé en matière d'art.
Cosme fonde l'Académie platonicienne et fait de Florence la capitale de l'humanisme, protégeant notamment des artistes comme le sculpteur Donatello, les peintres Fra Angelico, Filippo Lippi et des architectes comme Michelozzo. Ainsi sont achevés pour Cosme le palais-forteresse de la via Larga et la bibliothèque de San Marco, l'église St-Laurent.
Il domine le monde politique en se contentant de fausser avec l'aide de Luca Pitti les institutions traditionnelles et en confiant les magistratures à exercer à des obligés. À sa mort, il reçoit le titre de Pater Patriae, père de la patrie. L'autorité morale des Médicis est si grande que le fils de Cosme, Pierre le Goutteux Florence vers 1414-Florence 1469, peut diriger Florence de 1464 à 1469, sans quitter sa demeure, secondé par son fils Laurent qui lui succède bientôt avec son jeune frère Julien Giuliano Florence 1453-Florence 1478.
Laurent le Magnifique
Laurent le Magnifique réalise pendant son principat à Florence 1469-1492 l'idéal de la Renaissance italienne. Il est poète, animant les milieux littéraires et écrivant des stances et sonnets, comme le Triomphe de Bacchus et Ariane, philosophe, mécène et diplomate. Collectionneur, il fonde la bibliothèque Laurentienne, protège les artistes et les savants tels Verrocchio à Venise, Botticelli, Andrea Sansovino et Léonard de Vinci. Sa cour est celle d'un prince où se déroulent fêtes et réceptions, mais il est aussi contraint à une intense activité diplomatique et militaire. Il se heurte à l'opposition du patriciat, soutenu par le pape Sixte IV, qui laisse organiser la conjuration des Pazzi, banquiers florentins : ils tentent d'assassiner les Médicis 1478 dans la cathédrale ; Julien est tué, mais Laurent échappe aux meurtriers. Le pape déclenche contre lui une guerre avec le soutien du roi de Naples Ferdinand Ier. Laurent va alors trouver le roi en 1480 et réussit à le gagner à sa cause. Le pouvoir des Médicis sort renforcé, mais, accaparé par les affaires politiques, Laurent laisse péricliter l'affaire familiale, dont les filiales de Londres, Bruges et Lyon font faillite. En puisant dans le capital familial pour ses dépenses culturelles et politiques, il provoque la banqueroute de Monte dei dotti.
Léon X
Laurent laisse trois enfants : Pierre II Florence 1472-Cassino 1503 et Julien, qui règnent après lui sur Florence, et Jean, Florence 1475-Rome 1521, qui accède au cardinalat à 14 ans et devient pape → Léon X de 1513 à 1521, marquant ainsi le sommet de l'ascension sociale des Médicis. Rompant avec la tradition familiale, ils ne s'appuient plus sur le peuple, mais sur les grandes familles.
Les exils, la tutelle pontificale
Pierre II, Florence 1472-Cassino 1503, fils aîné et successeur de Laurent, s'allie avec le roi de France Charles VIII, provoquant de ce fait la colère des Florentins, qui, excités par la prédiction de Savonarole, le chassent novembre 1494.
Julien de Médicis
À sa mort, la direction de la famille passe à son frère cadet Julien Giuliano Florence 1478-Rome 1516, fait duc de Nemours par François Ier en épousant Philiberte de Savoie tante de François Ier. Il retrouve le pouvoir grâce à l'appui du pape Jules II et des troupes espagnoles 1512, mais meurt prématurément. Pierre II et Julien ont été immortalisés par Michel-Ange à San Lorenzo et par la dédicace du Prince de Machiavel.
Laurent Florence 1492-Florence 1519, fils de Pierre II, gouverne en fait par l'autorité du pape Léon X, son oncle, qui lui donne le titre de capitaine général de l'Église et le duché d'Urbino 1515. Marié à Madeleine de La Tour d'Auvergne 1518, il n'aura qu'une fille, Catherine, future reine de France, Catherine de Médicis.
Florence est gouvernée par le cardinal Jules Giulio Florence 1478-Rome 1534, bâtard de Julien le frère de Laurent le Magnifique, qui s'appuie sur son cousin de la branche cadette, le condottiere Jean des Bandes noires Giovanni dalle Bande Nere Forli 1498-Mantoue 1526. Le cardinal Jules, devenu le pape Clément VII 1523-1534, confie Florence à des cardinaux, qui l'administrent au nom de deux bâtards : Hippolyte, Urbino 1511-Itri 1535, fils du duc de Nemours, et Alexandre 1512-1537, dont la filiation est incertaine. Clément VII rallie les ennemis de Charles Quint, qui lance contre lui les bandes protestantes : Florence chasse les Médicis et proclame la république de 1527 à 1530.
La domination espagnole
Le pouvoir est rendu aux Médicis par Charles Quint lui-même, réconcilié avec le pape. Il impose la domination d'Alexandre, fait duc de Florence 1532-1537 et fiancé à sa fille naturelle Marguerite 1531. Le nouveau souverain, par ses débauches, s'attire la haine des Florentins. Il meurt assassiné, en 1537, par son cousin Lorenzino, Florence 1513-Venise 1548, de la branche cadette le Lorenzaccio de Musset, qui lui-même mourra assassiné sur les ordres de Cosme Ier. Avec lui s'éteint la branche aînée des Médicis.
Les Florentins choisissent le fils de Jean des Bandes noires, Cosme I er Cosimo, Florence 1519-Villa di Castello 1574], duc de Florence de 1537 à 1569. Mais Charles Quint lui impose des garnisons espagnoles ; il réprime la révolte républicaine des Strozzi en 1538, conquiert Sienne et Lucques et transforme les structures de la seigneurie en créant un Conseil de 200 membres et un Sénat de 48 membres, coiffés par un comité restreint, dirigé par le prince lui-même. Il centralise entre ses mains le pouvoir politique et économique. Collectionneur, il fonde l'Académie en 1561, fait construire le palais des Offices et fait entourer le palais Pitti des jardins de Boboli. Le pape Pie V le fait grand-duc de Toscane en 1569 et il devient le fondateur d'une dynastie qui va durer environ 200 ans.
Son fils François Francesco, Florence 1541-Florence 1587, grand-duc de Toscane, continue la politique de son père et cherche un allié ; il se tourne vers les Habsbourg d'Espagne et se proclame leur vassal. De sa première femme, il eut une fille qui devint la reine de France, Marie de Médicis. Le trône passe à son frère Ferdinand, Florence 1549-Florence 1609 qui abandonne la pourpre cardinalice et devient grand-duc de Toscane 1587-1609. Bon administrateur, il encourage le commerce en créant le port de Livourne, développe l'agriculture et se révèle également un grand mécène, protégeant Jules Romain et Galilée. Désireux de pratiquer une politique indépendante, il cherche un allié dans la France : Henri IV épouse sa nièce Marie de Médicis en 1600.
Après Ferdinand Ier la décadence s'affirme : son fils et successeur Cosme II, Florence 1590-Florence 1621, grand-duc de Toscane de 1609 à 1621, ferme la banque Médicis. Le fils de Cosme, Ferdinand II, Ferdinando, Florence 1610-Florence 1670, dominé par les prêtres et les moines, est incapable de protéger efficacement Galilée, qu'il admire.
Les derniers Médicis
Après Ferdinand II, son fils aîné Cosme III Cosimo Florence 1639-Florence 1723 est grand-duc de Toscane de 1670 à 1723. Le dernier de la lignée est son fils Jean-Gaston Florence 1671-Florence 1737, qui devient grand-duc de Toscane de 1723 à 1737, mais déjà toute l'Europe se dispute sa succession, qui ira au duc de Lorraine. La sœur de Jean-Gaston, la princesse Palatine, Anne-Marie-Louise 1667-Florence 1743, la dernière des Médicis, lègue le trésor des collections familiales à l'État toscan.
         
Posté le : 25/09/2015 19:01
|
|
|
|
|
Jean-Fraçois Paul de Gondi cardinal de Retz |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 20 septembre 1613 naît J.-François Paul de Gondi, cardinal de Retz
ʁɛ à Montmirail en royaume de France, mort à ,65 ans le 24 août 1679 à Paris, homme d'État et mémorialiste français, Son ordination sacerdotale a lieu en novembre 1643. Il est archevêque de Paris, puis il occupe de 1644 à 1654 des fonctions épiscopales il est archevêque coadjuteur de Paris, Il est fait cardinal de l’Église catholique le 19 février 1652 par le pape Innocent Xpar ordination sacerdotale en novembre 1643, nommé
Cardinal-prêtre de S. Maria sopra Minerva . Il reçoit en 1627 un canonicat à Notre-Dame de Paris, mène une vie de plaisirs et élabore des projets ambitieux, qu'il évoque dans la Conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque écrite vers 1632. Rendu suspect par ce livre et par ses relations avec le comte de Soissons, il n'est nommé coadjuteur de l'archevêque de Paris qu'en 1643. Rival malheureux de Mazarin, il se lance dans la Fronde, durant laquelle il sert successivement toutes les factions. Louis XIV le fait nommer cardinal en 1652, puis le fait incarcérer à cause de ses intrigues. Il devient archevêque de Paris 1654, perd ce titre, s'évade de prison, s'enfuit à Rome, récupère son évêché, se fait chasser de Rome par le pape Alexandre VII 1656, et ne revient en France qu'en 1661, après avoir renoncé à l'archevêché de Paris. Il s'est mis lui-même en scène dans ses Mémoires rédigés à partir de 1665 et publiés en 1717.
En bref
Longtemps, Paul de Gondi a été un prêtre franchement scandaleux, factieux, opportuniste et maladroit. Mais il fut aussi – encore que plus rarement – coadjuteur, familier du pavé de Paris, champion de la romanité, élève de M. Vincent, proscrit et pénitent de dom Hennezon. Peu à peu, il quitte ce personnage douteux pour devenir ce qu'il est : un des grands écrivains de son temps ; sa vie entière se confond avec ses écrits. Non pas seulement parce que sa plume lui fut une arme, mais parce qu'il écrit comme il a rêvé, comme il a tenté de vivre.
Dans le parterre Il a commencé sa vie à Montmirail ; très tôt attaché à l'Église, il mène de front, dès 1632, galanteries, duels, études. En 1639, il entre en littérature avec une nouvelle historique, La Conjuration de Fiesque, épisode de l'histoire de Gênes au XVIe siècle : il s'y inspire de l'Italien Mascardi et, peut-être, de la traduction de Bouchard, libertin érudit, auteur établi à Rome de polissonnes Confessions. Ce récit, connu très vite par des copies manuscrites – plus subversives que le texte imprimé 1665, et découvertes il y a peu –, inquiète Richelieu. Décrivant la conduite de Fiesque, Gondi prouve qu'il connaît la leçon de Machiavel, et il en démontre l'efficacité : Les scrupules et la grandeur ont été de tout temps incompatibles. Le rapprochement de cette adaptation avec ses modèles permet de saisir quelle part personnelle entre dans l'interprétation du sujet : sous les prétextes spécieux de l'histoire affleurent sans cesse les tumultes de la conspiration et son apologie. Qu'importe le succès funeste de Fiesque ! Gondi conclut 1639 : Son procédé haut et élevé et les grandes vertus dont il a toujours fait profession nous justifieront que la couronne et le sceptre étaient moins l'objet de son ambition que l'honneur. Œuvre étonnante, prémonitoire programme de vie, où, à chaque ligne, l'autobiographie du mémorialiste perce sous l'héroïsation d'un factieux. La Conjuration, au début d'une vie, porte autant de rêves que La Vie du cardinal de Rais à sa fin : l'impatience, simplement, y préfigure le souvenir.
1648 : la Fronde éclate. C'est que la Constitution est en cours de transformation : selon le statut coutumier du royaume, fils de France et princes du sang avaient alors le droit de conseiller le roi, de participer au gouvernement. Dès Henri IV et, a fortiori, sous les régences, le roi – ou la régente – gouverne avec des hommes de son choix, sans considérer les droits héréditaires des anciennes familles ; les membres de celles-ci se jugent lésés, tentent de s'imposer par un plus grand dévouement au roi ou par la révolte. Le Parlement s'émeut, et tous les ordres : officiers de justice et de finances contre intendants, petit peuple à la vie précaire. Gondi, très emporté et très séditieux contre Mazarin, élit la rébellion, s'avoue l'auteur de féroces pamphlets parmi les milliers que génère la Fronde, Ces écrits de circonstance font entendre Gondi, justifient l'engouement du public pour son prêche, témoignent de sa tessiture, du burlesque Manifeste du duc de Beaufort à la solennelle Remontrance au roi ; désormais cardinal de Retz, il est néanmoins arrêté 1652, incarcéré. Noblesse et Parlement ont perdu pouvoirs et illusions ; la mode des cardinaux-ministres est passée.
Après la liberté recouvrée 1654, ce sont les années d'exil : Retz aborde au rivage italien, participe à son premier conclave 1655 ; pressé de quitter Rome 1656, il mène alors une vie errante, puis s'établit à Commercy 1661 ; considéré comme papabile, il assiste à un deuxième conclave 1667, puis à un troisième 1669. Retiré à Saint-Mihiel 1675, il écrit ses Mémoires, dédiés à Mme de Sévigné, et se rend à un dernier conclave 1676.
Il meurt, est inhumé à Saint-Denis : son tombeau s'y voit toujours, inviolé.
Quelque quarante ans après, les Mémoires du cardinal de Retz sont imprimés à Nancy 1717. Œuvre impure : le littéraire fuit les pages historico-politiques ; l'historien suspecte le livre de – trop – belle invention. D'où cet éternel exil où, malheureusement, Retz est, aujourd'hui encore, resserré.
Sa vie
Issu d'une famille florentine, dont la fortune avait été faite par Catherine de Médicis qui appréciait les petits chiens élevés par la grand-mère du futur cardinal, ce surdoué de la rhétorique, de la politique et de la galanterie finit par décevoir tout le monde – sauf les lecteurs de ses Mémoires. Parus en 1717, ceux-ci posèrent d'ailleurs aussitôt un problème d'authenticité. Étaient-ils bien du cardinal ? Mais le cardinal était-il bien un politique ?
Le cardinal de Retz a fait son autoportrait en cynique. Peinture irritante que stigmatisent Saint-Simon, Chateaubriand qui incrimine une lecture viciée de Plutarque : une mauvaise interprétation des Vies parallèles génère non des héros bénéfiques mais des chefs de parti, Tocqueville Retz avoue son projet d'assassinat de Richelieu, ses dévotions et ses charités hypocrites, de peur de ne pas passer pour un habile conspirateur : ce n'est pas l'amour de la vérité qui le mène, ce sont les travers de l'esprit qui trahissent involontairement les vices du cœur .
Retz avait cependant été à bonne école. Son père, Philippe Emmanuel de Gondi, général des galères, et sa mère, Marguerite de Silly, avaient donné comme précepteur à leur fils aîné Vincent de Paul : Mme de Gondi avait joué un rôle déterminant dans la mise en route des entreprises charitables du futur saint et son mari, devenu veuf, se retira à l'Oratoire. Le jeune Paul de Gondi, avec l'âme la moins ecclésiastique qui fût, voyait « l'archevêché de Paris dans sa maison, deux Gondi, dont son oncle, avait occupé le siège. Très jeune, il fut pourvu de bénéfices qu'il semblait mériter : tonsuré à dix ans, il fit preuve devant le jésuite chargé d'examiner ses connaissances d'une étonnante capacité en grec et en latin. Élève du collège de Clermont, brillant étudiant en Sorbonne, il se signala aussitôt à Richelieu par ses qualités d'orateur il emporta la première place à la licence de théologie contre le candidat du cardinal-ministre, la dissipation de ses mœurs, Je ne pouvais me passer de galanterie et son dangereux esprit. À dix-huit ans, il avait écrit en effet une Conjuration de Fiesque, qui préfigure toute sa carrière – avoir le pouvoir, l'applaudissement du public, se placer au-delà de la morale – et son échec : Retz ne sera qu'un perpétuel opposant, sa démagogie se retournera contre lui, ses mobiles seront percés à jour. Et sa conversion finale sera interprétée comme une pirouette de plus Le cardinal s'en va en Paradis par chez Mme de Bracciano ; Il s'était fait le familier de Dieu, comme en sa jeunesse il avait serré la main des quarteniers de Paris.
Il reçoit Une formation à la carrière ecclésiastique Il est le neveu de Jean-François de Gondi, premier archevêque de Paris, il naît dans une famille de petite noblesse florentine, qui a suivi Catherine de Médicis lors de sa venue en France. Son père Philippe-Emmanuel de Gondi a été le protecteur de Vincent de Paul, qui demeure chez lui de 1613 à 1617. Son frère aîné est Pierre de Gondi, duc de Retz. Très jeune, il est destiné à l'état ecclésiastique, bien qu'il n'en ait ni le goût — il rêve de se couvrir de gloire sur les champs de bataille — ni les dispositions — il se sent incapable de respecter le vœu de chasteté. D'un esprit curieux, il fait de solides études, lisant en particulier Salluste et Plutarque. Son inclination pour les conspirations le pousse à écrire, à l'âge de vingt-cinq ans, un récit historique intitulé La Conjuration du comte de Fiesque 1639.
En 1643, à la mort de Louis XIII, il est ordonné prêtre novembre puis nommé coadjuteur de son oncle. Peu après, le 31 janvier 1644, il est consacré évêque et reçoit l'évêché in partibus de Corinthe. Très vite, il se rend populaire par l'éloquence de ses sermons, sa générosité en matière d'aumônes, ses amitiés avec les Grands, comme les Rohan, et ses accointances avec le parti dévot.
Le coadjuteur, frondeur
Par ambition, par désir d'obtenir le chapeau de cardinal, par goût naturel pour l'intrigue et par opposition politique au ministériat et à la monarchie absolue, il se lance dans la Fronde dès son début. Il tente au départ de s'imposer comme médiateur entre la reine et les parlementaires rassemblés en chambre Saint-Louis. Anne d'Autriche le congédie sans ménagement, et jette ainsi le coadjuteur dans le camp des Frondeurs. Après l'échec de la paix de Rueil et celui de la paix de Saint-Germain, il tente d'organiser la révolte en lui donnant un chef. Le Grand Condé refuse ce rôle. Gondi doit se rabattre sur son frère cadet, le prince de Conti, qu'il juge pourtant «un zéro qui ne multipliait que parce qu'il était prince du sang;
Quand les régiments de l'armée d'Allemagne désertent en mars 1649, bien que leur chef Turenne reste avec la Fronde, Gondi sent le vent tourner. Il négocie en hâte avec la reine un codicille, réservant honneurs et places à lui-même et à ses amis. Cependant, Mathieu Molé, président du Parlement de Paris, divulgue le contenu du codicille, faisant ainsi brusquement chuter la popularité du coadjuteur.
Quand, après la Fronde parlementaire, Condé est trouvé trop puissant, la régente ne peut que se tourner vers Gondi et sa puissante coterie. Grâce à sa maîtresse, Charlotte de Lorraine, fille de la duchesse de Chevreuse, le coadjuteur s'est retrouvé conseiller intime de Gaston de France, oncle du roi. La reine le rencontre au cloître Saint-Honoré. Gondi accepte de faire défection, en échange du chapeau de cardinal tant convoité. Les princes sont arrêtés le 18 janvier 1650.
Le 25 novembre, néanmoins, après avoir transféré les princes au Havre, hors de portée de Gondi, Mazarin lui refuse la barrette. De nouveau, Gondi se retourne, entraînant Gaston de France avec lui. Après avoir réclamé le renvoi de Mazarin, il est informé que la reine va emmener le roi à Saint-Germain, où a fui le cardinal. Il ameute la foule, qui va au Palais-Royal vérifier que le roi est bien dans son lit. Deux meneurs surveillent le sommeil royal. Louis XIV ne pardonna jamais cette humiliation au coadjuteur. Gondi devient en 1651, abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame de la Chaume de Machecoul, à la suite de son oncle Jean-François de Gondi.
Du théâtre du monde au théâtre de la conscience
Ce siècle capital, où la France passe de la féodalité au monde moderne, est le décor de Retz. Il distingue trois parties dans les Mémoires, correspondant aux trois temps de sa vie. La première : Je n'ai été jusques ici que dans le parterre ..., je vas monter sur le théâtre » ; la seconde : Je vas travailler au reste du compte que je vous dois de ma vie : et qui en contiendra la troisième et dernière partie : ce qu'il a vu ; ce qu'il a fait ; ce qu'il a été.
Retz est historiographe et autobiographe : il s'agit pour lui de « donner l'histoire de [sa] vie ». Le titre, Vie du cardinal de Rais, est écrit bellement, de sa main, dans le manuscrit. Et, ô paradoxe ! Narcisse se mirant a besoin du poids de l'histoire : d'où le point de perspective personnel, le gauchissement des faits, les silences. Car cet énorme livre recèle des lacunes : l'information semble abondante, elle est incomplète : sans archives, Retz puise dans ses souvenirs fatalement pâlis, et ne fait rien pour pallier les blancs. Sa source, unique, est le Journal du Parlement 1648-1652, qui lui fournit matériaux bruts et stimulus nécessaires.
L'intérêt historique de Retz réside dans ce don de restituer le climat particulier à la Fronde, les motivations des acteurs : par amour de la gloire, par orgueil de la grandeur, tous luttent contre le pouvoir, rêvent de l'incarner, de monter le plus haut possible dans la hiérarchie des conseils. On mesure la puissance, et le péril pour le pouvoir royal, que représentent ces attitudes aristocratiques : chaque grand a ses fidèles, qui lui assurent leurs propres alliés, formant ainsi une chaîne, une armée de suivants voués corps et âme au maître dont ils sont les créatures. Les Mémoires demeurent essentiels pour explorer la face cachée de la Fronde, dénuder les mécanismes cruels du destin et du cœur.
Retz a compté sur son action pour ériger sa statue : pour son malheur et pour sa gloire, il voit son avenir politique limité aux murs d'un donjon ; or la figure de l'écrivain va se dresser sur le piédestal du factieux, que ses conclaves même n'eussent suffi à sauver de l'oubli : tout écrit autobiographique fait méditer sur le sens d'une vie, sa dérision.
L'autre intérêt des Mémoires est celui-ci : son alchimie qui fait qu'en un or pur le plomb vil est changé. Au moment où le jour bascule dans la nuit, Retz se retire, proche de l'abbaye de Saint-Mihiel, et se livre à une passionnée quête du moi : Je trouve une satisfaction sensible à me développer ..., à vous rendre compte des mouvements les plus cachés et les plus intérieurs de mon âme. Car son désir d'agir pour le bien d'autrui n'a jamais été grand ; ce prince des égotistes s'intéresse au bonheur d'un seul être : lui-même. Écrivant dans un présent éthique ou hors du temps, Cressot, il prolonge les mirages qui l'ont tant ébloui ; il se fait le spectateur de soi et recompose en destin le cours de sa vie pour échapper aux déceptions du bilan : s'il n'a pas cru toujours, souvent il a été dupe ; ses martingales infaillibles n'ont jamais piégé le réel ; il idéalise, mais il a sous-estimé.
Vingt ans après son évasion, il revit l'élan jubilatoire : Saragosse, Majorque, Tusculum lui sont alluvions de grande mémoire ; la beauté des sites le fascine encore, si vive est sa sensualité, si fondamental son optimisme. Au souvenir, Retz mêle le rêve : son récit est gonflé d'espoirs, comme si l'écrivain s'était installé sur une île u-topique, dérivant entre réel et imaginaire. Sa vie, écrite selon ses rêves, prend forme. Le dessein délibéré d'une composition tripartite du livre atteste le besoin nostalgique de trouver un ordre à son existence. Ainsi, l'échec de la vie, généralement considéré comme une déroute, devient expérience singulière et victoire.
Le manuscrit original, emporté aux Amériques au XIXe siècle, puis rapporté on ne sait rien de cette odyssée, est désormais à la Bibliothèque nationale : c'est un document exceptionnel, rédigé d'une forte écriture, élégante, jaillissante, triomphalement ascendante, mais aussi présentant des ratés. Document émouvant, car le trait, en rapport avec le rythme vital, est immobilisé à jamais, semblable à un électroencéphalogramme, et aussi aisé à lire. Et voilà que le manuscrit de Retz se met à ressembler à la vie de Retz : il est, à son image, double, troublant, envoûtant.
Le cardinal de Retz aura lutté, vainement, pour s'imposer, conquérir, mais il n'a perdu pied dans la réalité que pour laisser sa trace fascinante, manquée, triomphale ; proscrit, failli, vieilli, troquant contre une plume l'épée des Gondi et le poignard du coadjuteur, il retrouve l'ordre de ses origines, sécrétant une prose altière de si peu d'art, une prose aristocratique. Marie-Thérèse Hipp
Le cardinal et la chute
Le 19 février 1652, Gondi, grand adversaire de Mazarin, obtient enfin le chapeau de cardinal des mains d’Innocent X. Quand le roi rentre à Paris en octobre 1652, l'un des premiers gestes de Mazarin est de faire jeter en prison le tout nouveau cardinal de Retz 16 décembre : celui-ci est mené à Vincennes.
Le 21 mars 1654, son oncle, l'archevêque de Paris, meurt. Retz est toujours en prison, malgré l'intercession de ses amis et même du pape. Retz signe une renonciation suffisamment vague pour être dénoncée aussitôt après. Placé en résidence surveillée au château de Nantes, il s'en échappe grâce à une corde dissimulée sous sa simarre. Furieux, Mazarin déclare vacant l'archevêché, et Retz gagne l'Espagne, puis Rome. Il nomme des vicaires qui parviennent à administrer le diocèse pour lui. En 1655, Alexandre VII succède à Innocent X. Mazarin le dépeint au pape comme un janséniste endurci. Alexandre VII, élu en partie grâce à l'appui de Retz, nie le tout vivement.
Pendant ses années d'exil, Gondi, après sa fuite du château de Nantes, vient se réfugier à Belle-Île-en-Mer dont il a hérité de son grand-oncle, Albert de Gondi. En difficulté, il consent à vendre Belle-Île au surintendant Nicolas Fouquet pour environ quatorze cent mille livres. Fouquet achève ce que son prédécesseur a commencé, à savoir l'agrandissement de la citadelle à Palais.
Le cardinal de Retz se réfugie par la suite dans son château de Commercy, centre de la principauté dont il avait hérité de sa mère en 1640.
Retz voyage alors en Europe, s'intéressant à la politique locale. Il prend ainsi parti en faveur des Stuarts. Quand Mazarin meurt en 1661, Retz espère rentrer en grâce, sous-estimant la rancune de Louis XIV. En 1662, Retz se résigne à renoncer à son siège. En échange, il obtient l'abbaye de Saint-Denis, un bénéfice considérable. Il peut regagner Paris en 1668. Il continue à se mêler de politique, mais uniquement de celle entre Paris et Rome. Il empêche Alexandre VII d'excommunier le parlement de Paris, qui a rejoint la Sorbonne dans son combat contre l'infaillibilité pontificale. Il prend part aux conclaves de Clément IX et Clément X, et attire quelques suffrages sur sa tête en 1676.
Retz meurt le 24 août 1679, après s'être retiré dans son abbaye de Saint-Denis. Il y est inhumé, mais Louis XIV interdit qu'on y dresse un monument.
Retz, mémorialiste
Édition des Mémoires datée de 1731 parue chez J-F Bernard à Amsterdam.
Le cardinal de Retz reste connu pour ses Mémoires, rédigés entre 1675 et 1677 et publiés seulement en 1717. Retz y raconte, d'une plume spirituelle et sous forme romancée, son implication dans la Fronde.
Œuvres
Œuvres complètes, publiées par Jacques Delon aux éditions Honoré Champion :
t. I. Œuvres oratoires, politiques et religieuses, 2005.
t. II. Discours philosophiques. Controverses avec Desgabets sur le cartésianisme, 2005.
t. III. Correspondance. Affaire du cardinalat, 2005.
t. IV. Correspondance. Lettres épiscopales, 2005.
t. V. Correspondance. Affaires d’Angleterre et Affaires de Rome, 2007.
t. VI. Correspondance. Affaires privées. Textes établis, avec introduction, notes, bibliographie, reproduction de manuscrits, illustrations, index des noms de personnes, index des noms de lieux, 2009.
Armoiries
Armes Blasonnement
D'or, à deux masses d'armes de sable, passées en sautoir et liées de gueules.
Généalogie
Il est le fils de Philippe-Emmanuel de Gondi, comte de Joigny, marquis de Belle-Île, baron de Montmirel, seigneur de Dampierre et de Villepreux, général des Galères de France, et de Françoise Marguerite de Silly5 1584-1625, dame de Commercy.
Ascendance de Jean-François Paul de Gondi
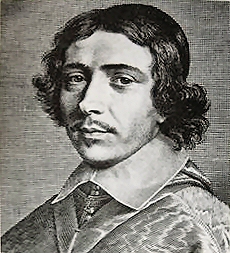       
Posté le : 19/09/2015 19:15
|
|
|
|
|
Re: Rodolphe III de Bourgogne |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Et oui la Bourgogne fut un "pays puissant " et sa culture reste encore inscrite dans notre histoire.
Vive les bourguignons !
Mille mercis pour penser à me laisser un mot.
Loriane
Posté le : 17/09/2015 21:16
|
|
|
|
|
Re: Rodolphe III de Bourgogne |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Chère Loriane,
Je lis la plupart de tes écrits mais je ne pense pas à te faire un petit mot.
Alors je le fais ici avec d'autant plus de plaisir que tu écris sur la région de mon coeur: la Bourgogne.
Eh oui, nous avons eu une grande Bourgogne qui allait bien au delà de ses frontières étriquées actuelles.
En lisant ton texte, j'ai repensé aussi au destin désastreux de notre Charles Le Téméraire qui désirait tant reconstitué le royaume de Bourgogne.
Faisons un peu d'histoire fiction. Tiens, je ferai un texte à ce sujet. Charles Le Téméraire n'est pas mort à Nancy. Il a survécu et il est devenu Roi de Bourgogne. A la bataille de Molois en Bourgogne, il vainquit les armées de Louis XI. Et ....
Merci pour tous les textes que tu nous proposes et qui font de ce site un site de grande valeur intellectuel mais aussi de partage.
Je m'y sens bien.
Amitiés de Bourgogne, bien sûr.
Jacques
Posté le : 13/09/2015 20:45
|
|
|
|
|
Bataille de Marignan |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 13 et 14 septembre 1515 eut lieu la bataille de Marignan
à 16 km au sud-est de Milan en Italie, l'issue fut la victoire franco-vénitienne décisive, les belligérants, étaient le royaume de France, la république de Venise, la Confédération suisse et le Duché de Milan. Les commandants étaient François Ier, Jacques de Trivulce, Bartolomeo d'Alviano, Louis II de la Trémoille, Charles III de Bourbon Matthieu Schiner, Maximilien Sforza, Marx Röist.Les forces en présence se composaient de 2 500 cavaliers, 35 000 fantassins, 200 cavaliers, 22 000 fantassins. Les pertes s'élèverent à 5 000 à 8 000 morts, 9 000 à 10 000 mortsLa bataille de Marignan, ou Marignano en Italie, aujourd’hui Melegnano, ville à 16 km au sud-est de Milan eut lieu les 13 et 14 septembre 1515 et opposa le roi de France François Ier et ses alliés vénitiens aux mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan.
La bataille de Marignan est l’un des épisodes des guerres d'Italie commencées par Charles VIII en 1494 afin de contrôler le duché de Milan.
Première victoire du jeune roi François Ier, acquise dès la première année de son règne, elle fit environ 16 000 morts en seize heures de combat. Elle donnera lieu à une intense propagande développée par le pouvoir royal afin de justifier cette expédition.
L'histoire en bref
Dans sa conquête du Milanais, le roi François Ier affronte les Confédérés suisses, alliés du duc de Milan, Maximilien de Sforza, du pape Léon X, de l'empereur Maximilien de Habsbourg et du cardinal de Sion. Une fois les Alpes franchies au col de l'Argentière, l'armée française, combinant chevalerie, artillerie et infanterie, soit plus de 30 000 hommes, se heurte à 20 000 Suisses, organisés en véritables phalanges, les 13 et 14 septembre 1515, dans la plaine de Marignan, entrecoupée de rivières, de canaux et de fossés. Le rôle de l'artillerie française du sénéchal d'Armagnac y est décisif, tout comme celui de la cavalerie. La bataille s'interrompt à la tombée de la nuit dans une totale confusion et reprend dès l'aube du jour suivant. L'avantage revient peu à peu aux Français grâce à l'intervention de leurs alliés vénitiens conduits par Barthélemy d'Alviano. La défaite est cuisante pour les Suisses qui laissent 14 000 fantassins dans la plaine, taillés en pièces par la chevalerie française. Marignan marque le début de l'époque militaire moderne, où l'artillerie joue un rôle déterminant. Pascal LE Pau
13 septembre 1515 François 1er bat les Suisses à Marignan
Le 13 septembre 1515, le lendemain de ses 21 ans, le roi François 1er écrase les Suisses dans la plaine du Pô, à Marignan... comme ne l'ignore aucun écolier ou ancien écolier de France.
François 1er, dès son avènement, veut reprendre la conquête de l'Italie, entamée par ses prédécesseurs Charles VIII et Louis XII, à commencer par le duché de Milan, qu'il revendique comme étant l'héritage de son arrière-grand-mère Valentine Visconti.
À défaut d'un projet politique cohérent, le nouveau roi a le soutien de la noblesse française, jeune et fougueuse, avide de combats et de gloire, avec des chefs aussi prestigieux que le connétable de Bourbon, La Trémoille, La Palice (qui donnera naissance, bien malgré lui, aux lapalissades) et bien sûr le chevalier Bayard.
Vingt mille Suisses, alliés des Milanais, barrent aux Français l'accès de l'Italie. Ils tiennent les principaux cols alpins, à Suse et Pignerol. Ces milices paysannes sont la terreur des armées féodales. Elles ont coutume d'attaquer en masses compactes au son lugubre des trompes de berger.
François 1er et son armée remontent la vallée de la Durance. Ils «passent les monts» au mois d'août 1515, par le difficile col de L'Argentière (ou Larche), au sud des Alpes, et déboulent hardiment dans la plaine du Pô.
À Villafranca, Bayard surprend en plein déjeuner Prosper Colonna, bras droit du duc, et le capture. Là-dessus, les Français établissent leur camp à Marignan, à quelques kilomètres au sud de Milan, sur la route de Pavie.
Leur armée, la plus nombreuse, comporte une cavalerie commandée par des nobles volontaires et une infanterie de mercenaires gascons et basques. L'artillerie, à la pointe de la technique, prend de plus en plus d'importance. Les Vénitiens, alliés des Français, campent à proximité, à Lodi, sous le commandement de Bartolomeo d'Alviano. Face à eux 35.000 mercenaires suisses à Milan et Monza.
Une délégation suisse entame des négociations avec les Français et signe un projet de traité le 8 septembre. Mais avant que celui-ci ne soit signé, les soldats suisses de la garnison de Milan, sous la conduite du cardinal de Sion, Matthaüs Schiner, se précipitent au-devant des Français pour les attaques.
Le combat commence l'après-midi du 13 septembre. Dans un premier temps, un carré de 7.000 Suisses disperse la cavalerie et tente de s'emparer de l'artillerie française. Voyant cela, François 1er n'hésite pas à les charger à la tête de 200 hommes. Épuisés, les combattants luttent jusqu'à la nuit tombée et s'endorment sur place.
Le lendemain, l'arrivée inespérée des alliés vénitiens, appelés d'urgence, prend les Suisses à revers et les oblige à se réfugier à Milan. Elle transforme la bataille en un succès total... Mais 14.000 Suisses restent sur le carreau. En une vingtaine d'heures, la bataille de Marignan fait un total d'au moins 16.000 morts *. C'est encore plus qu'à Azincourt, un siècle plus tôt... Du jamais vu en Occident depuis la fin de l'Antiquité !
On peut voir dans la bataille de Marignan la préfiguration des hécatombes de l'ère moderne.
François 1er peut savourer une victoire chèrement acquise. Il s'est montré à la hauteur des enjeux, plongeant dans la mêlée, écoutant également les avis de ses capitaines les plus aguerris, Pierre Terrail, seigneur de Bayard, ou encore Jacques de Chabannes, seigneur
À la fin de la bataille, selon une légende postérieure, le jeune roi se fait sacrer chevalier par le glorieux seigneur Pierre Terrail de Bayard. Le rituel d' adoubement est désuet mais il plaît à ces jeunes gens qui cultivent le souvenir romanesque de leurs aïeux des temps féodaux.
Le retentissement de la bataille est immense dans l'opinion, en Italie et dans le reste de la chrétienté.
Il conduit le pape à signer la paix dès le 13 octobre 1515 et à reconnaître en François 1er le légitime duc de Milan, de Parme et de Plaisance ! Les deux signataires mettent en chantier un projet de concordat. Il sera conclu à Bologne le 18 août 1516.
Par le traité de Noyon, le même mois, Charles d'Espagne, petit-fils de l'empereur Maximilien de Habsbourg, obtient de conserver le royaume de Naples en échange d'un tribut à la France.
Le 29 novembre 1516, à Fribourg, les cantons suisses et la France concluent une «paix perpétuelle». Ces derniers se mettent même au service des rois de France jusqu'à la Révolution française. Enfin, par le traité de Cambrai, le 11 mars 1517, la France et les Habsbourg concluent une alliance défensive contre les Turcs.
Dix ans plus tard, la situation est complètement renversée. Après une défaite à Pavie, les Français doivent définitivement renoncer à l'Italie. Repliés sur leur pays, les jeunes nobles ne tardent pas à se déchirer dans les guerres de religion.
Les guerres d’Italie
Les guerres d’Italie sont une suite de conflits menés par les souverains français en Italie au cours du xvie siècle pour faire valoir leurs droits héréditaires sur le royaume de Naples, puis sur le duché de Milan. En effet, le royaume de Naples jusqu’en 1442 est aux mains de la maison d’Anjou, maison cadette des Capétiens. À cette date, l’Aragon avec le roi Alphonse V en prend le contrôle. La maison d’Anjou essaie alors sans relâche d’en reprendre possession. Son dernier représentant, René d’Anjou, meurt en 1480 : ses droits sur le royaume de Naples passent alors au royaume de France, sur lequel règne Louis XI, puis, à partir de 1483, Charles VIII. En 1486, certains barons du royaume de Naples, restés fidèles aux Angevins, se révoltent. Vaincus, ils se réfugient en France. Les monarques français vont alors essayer de faire valoir leurs droits pendant près de soixante ans.
Au tournant du XVIe siècle, les Suisses opèrent militairement à leur propre compte ou dans le service mercenaire dans une Italie du nord affaiblie et morcelée. En 1495, ils permirent au roi Charles VIII de triompher des Milanais et des Vénitiens à Fornoue. En 1499, les Suisses passèrent une alliance de dix ans avec le roi de France en vertu de laquelle celui-ci pourrait prendre 5 000 mercenaires à son service. Grâce à ces mercenaires, Louis XII conquit le duché de Milan et en expulsa son maître, Lodovico Sforza, dit le Maire.
Toutefois, comme le Roi de France ne s’acquittait pas de la solde promise, les Suisses mécontents changèrent de camp et les Français s’en allèrent, sans même livrer bataille, permettant le retour de Sforza. Louis XII revint avec 15 000 mercenaires suisses engagés au prix fort contre la volonté de la Diète de Zurich. Ainsi, des mercenaires suisses firent face à d’autres mercenaires suisses. Suite à une intervention de la Diète et des tractations entre les camps, le combat fratricide fut empêché, et Louis XII récupéra les territoires perdus.
Suite à un nouveau différend entre Louis XII et les cantons d’Uri, Schwyz et Unterwald portant sur Bellinzone que ces derniers revendiquaient, 14 000 Suisses marchèrent sur Arona où le roi de France renonça formellement à ses exigences par le traité de 1503.
Les territoires du Milanais aux mains du roi de France continuaient à susciter les convoitises. Lorsque l'alliance de dix ans entre le roi de France et les Suisses arriva à son terme 1509 et que celui-là montra son désintérêt vis-à-vis de ses anciens alliés, le pape Jules II par l'intermédiaire de l’évêque de Sion, Matthieu Schiner, convainquit les Suisses de rallier sa cause contre une forte solde et des pensions annuelles 1510. Fort de cette alliance, le pape ouvrit les hostilités contre le roi. En 1511, les Suisses marchèrent sur Milan que les Français abandonnèrent sans livrer bataille. En 1512, 24 000 Suisses sous les ordres du commandant en chef Ulrich von Hohensax, qui s'était particulièrement distingué lors de la guerre de Souabe, se rallièrent aux Vénitiens en Lombardie, également alliés au pape, et prirent une ville après l'autre aux Français qui tombaient entre leurs mains sans résistance, à l'exception de Pavie qui nécessita un siège de courte durée avant de capituler. Il ne fallut que quelques semaines pour chasser les Français d'Italie.
Avec l'appui des Suisses, Maximilien Sforza se fit remettre Milan 29 décembre 1512. En contrepartie, les Suisses obtinrent la vallée de la Maggia, de Locarno, Lugano, Mendrisio, Bormio, la Valteline, Chiavenna et Neuchâtel.
Dès le printemps 1513, Louis XII tenta de récupérer le Milanais. Une première tentative dirigée par La Trémoille se solda par un échec. Les troupes françaises manquèrent de prendre Novare défendue par les Suisses. Après une bataille qui coûta la vie à 1 500 Suisses et 6 000 Français, les troupes françaises prirent la fuite.
Alors que les campagnes d'Italie conféraient un énorme prestige à la Suisse, des tensions internes apparaissaient entre certaines grandes familles suisses qui continuaient à percevoir des rentes du roi de France pour le service étranger et le peuple qui n'en tirait que peu d'avantages.
Suite à une fausse nouvelle de défaite des Suisses à Novare, la Suisse envoya 30 000 hommes faire le Siège de Dijon, défendue par La Trémoille, qui fut forcé de négocier leur départ. Par le traité de Dijon du 14 septembre 1513, il promit une indemnité de guerre de 400 000 couronnes et 20 000 écus. Cependant, Louis XII refusa de reconnaître la dette, empêchant une conclusion de paix entre les deux pays.
Le lancement de la cinquième guerre d'Italie L'avènement de François Ier
Louis XII mourut le 1er janvier 1515 alors qu'il préparait une nouvelle campagne. Son successeur, François Ier, affirme ses prétentions sur le Milanais dès le début de son règne, en faisant valoir les droits de sa femme Claude, héritière des Orléans, et donc de Louis XII. Afin d'y parvenir, il obtient le soutien de Venise mais manque d'obtenir celui des Suisses, exigeant toujours les indemnités promises lors de la prise de Dijon avant toute régularisation des relations. Dans une ultime tentative de conciliation, le jeune roi français se déclara disposé à honorer la dette de Dijon à condition de récupérer le Milanais. Sous l'influence de Schiner et la prédominance des cantons anti-français, la proposition fut repoussée par les Suisses.
Devant l'échec de la diplomatie, François Ier rassemble une armée de 50 000 hommes. Pour financer ses dépenses militaires, le roi augmente l'impôt et fait des emprunts, car il lui faut acheter la neutralité d'Henri VIII d'Angleterre mais aussi celle de Charles de Gand, futur Charles Quint. Quatre cents kilos d'or 150 000 écus vont à la garnison suisse. En l'absence du roi, sa mère, Louise de Savoie assure la régence.
Les forces en présence
L'armée de François Ier est placée sous le haut commandement du Connétable Charles III de Bourbon, de la Trémoille, Jacques de Trivulce, Lautrec, Bayard et Robert III de La Marck de Bouillon7. Composée de nobles français, arquebusiers et arbalétriers gascons et navarrais, lansquenets allemands, et mercenaires des Pays-Bas la bande noire, l'armée française comprenait plus de 22 000 lansquenets allemands ; 2 500 cavaliers lourdement armés ; vingt compagnies de Navarrais, Basques et Gascons 10 000 hommes, aux ordres du général basco-navarrais Pedro Navarro ; 8 000 fantassins français et 3 200 sapeurs ou charpentiers ; une artillerie de 72 grosses pièces ; un important train des équipages, sous le commandement de Galiot de Genouillac, sénéchal d'Armagnac.
De mai à août, 32 000 Suisses avaient fait mouvement vers Suse, Pignerol et Saluces pour empêcher le passage des Alpes par les Français. Les Suisses étaient conduits par leurs meilleurs généraux Werner Steiner de Zug, Hugues de Hallwyl et l'avoyer de Watteville de Berne. Le commandant en chef des troupes suisses, Ulrich von Hohensax, qui les avait conduits à la victoire lors des précédentes campagnes d'Italie était retenu par la maladie.
Le franchissement des Alpes
Au printemps 1515, François Ier ordonne la concentration des troupes à Grenoble, sous la supervision de Bayard, lieutenant général du Dauphiné. En mai 1515, les troupes françaises firent mouvement sur Gênes et occupèrent la ville. Alarmée par les évènements, la Diète suisse commença par envoyer 8 500 hommes vers Novare rejoindre Schiner, devenu cardinal, et fit occuper les cols des Alpes du Piémont où l'armée française était attendue.
Solidement établis à Suse, les Suisses tiennent la route habituelle du Mont-Cenis. L’armée française d'environ 63 000 personnes, y compris les chevaux et l’artillerie 60 canons de bronze avec l’aide technique de l’officier et ingénieur militaire Pedro Navarro qui utilise pour l'une des premières fois des explosifs pour élargir les chemins de montagne, franchit les Alpes par une route secondaire, contournant les troupes suisses au sud par le col de l'Argentière Colle della Maddalena en italien, un sentier à peine praticable par des chevriers ; trois mille sapeurs y ouvrirent à la fin juillet 1515 un chemin carrossable, où, du 4 au 9 août 1515, en cinq jours, passèrent environ 30 000 fantassins, 9 000 cavaliers, 72 gros canons et 300 pièces de petits calibres. Les Suisses se replièrent alors sur Milan. Après quelques combats d'arrière-garde en août 1515 à Villafranca Piemonte, Chivasso et sur la Doire Baltée ainsi que l'envoi d'un contingent de 15 000 hommes supplémentaires, les Suisses comptaient 45 000 hommes répartis entre Varèse, Monza et Domodossola, plus la garnison de Milan. Dans la plaine du Piémont, une partie de l’armée suisse prend peur et propose, le 8 septembre à Gallarate, de passer au service de la France.
Les négociations de Gallarate
[/size]
Une campagne efficace de propagande française, visant à dissuader les cantons suisses de poursuivre les hostilités, entraîne le mécontentement parmi les troupes suisses et les différends parmi les chefs, permettant en même temps une poussée sur toute la partie occidentale du Milanais par les Français. Une série de pourparlers furent engagés en septembre 1515 pourparlers de Gallarate, lors desquels François Ier offrit encore davantage de concessions aux Suisses pour qu'ils renoncent à leurs prétentions, aboutissant même au traité de Gallarate 9 septembre qui finalement ne fit que consacrer la dissension entre les Confédérés souffrant de l'absence d’un chef unique.
Les Français se mirent à négocier directement avec le pape derrière le dos des Confédérés. Le duc de Milan tardait à verser la solde et les vivres venaient à manquer. Après la signature de ce traité qui divisa encore un peu plus les Confédérés, les Bernois, Fribourgeois, Valaisans et Soleurois, peu enclins à se battre pour un commanditaire qui tardait à assumer ses obligations, rentrèrent en Suisse, ce qui représentait le départ de 10 000 Confédérés.
La bataille
Devant l'échec des négociations et la division des troupes suisses, François Ier fit mouvement en direction de Milan et établit son camp près de Marignan. Les Zurichois et les Lucernois, se sentant liés par le traité de Gallarate, reçurent l'ordre de leurs gouvernements respectifs d'accepter une paix honorable. Uri, Schwyz, Unterwald et Glaris refusèrent de battre en retraite. Ceux parmi les Suisses qui étaient restés à Milan se laissèrent entraîner au combat sur l'insistance du cardinal Schiner. Quelque 20 000 Suisses jusqu'à 30 000 selon P. de Vallière disposant de 8 canons et 1 000 arquebusiers devaient faire face à plus de 30 000 Français équipés de la plus belle artillerie de siège de l'époque. La plaine maraichère irriguée était ensoleillée.
L'affrontement du 13 septembre
Craignant le départ des dernières troupes des Confédérés sans livrer bataille contre les Français, le cardinal Schiner choisit de provoquer la bataille par la ruse devant Milan. Il envoya avec la complicité secrète de certains capitaines suisses dont Winkelried à ne pas confondre avec Arnold Winkelried, qui se sacrifia héroïquement, du moins selon certaines sources, lors de la bataille de Sempach en 1386, la garde ducale et des cavaliers pontificaux provoquer la cavalerie française. Le jeudi 13 septembre 1515, aussitôt le combat engagé, les cavaliers du pape revinrent appeler les troupes suisses à l'aide. Celles-ci, avec Schiner à leur tête, se mirent immédiatement en route et sortirent de la ville de Milan pour affronter l'ennemi. Une fois hors de la ville et constatant la tromperie, La Trémoille et de Fleuranges s'étant repliés après la légère escarmouche, de Winkelried soi-disant en grand danger se reposant en toute quiétude, après un moment de confusion, on décida néanmoins de poursuivre. Les hommes se jetèrent à genoux pour prier le Seigneur suivant l'usage de leurs pères et se mirent en marche.
Le combat s'engagea. Les Confédérés durent faire face au feu de l'artillerie française ainsi qu'aux cavaliers commandés par Bourbon, Guise et Gaillards qui les attaquaient par le flanc. Le premier choc avait complètement enfoncé la première ligne de l'armée française qui se reforme soutenue par la cavalerie, elle-même confrontée aux difficultés du terrain et aux piques suisses. François Ier, en personne à la tête de la cavalerie et des lansquenets allemands, ordonna une attaque généralisée contre les Suisses. Un combat furieux s'engagea pendant lequel tomba Jacques, fils aîné de Jean IV d'Amboise, François du Bourbon, le fils du général Trivulcese se fit capturer, et le chevalier sans peur Bayard évita de justesse la mort. Ce dernier se battit avec grande bravoure mais fut finalement contraint de ramper le long des fossés pour sortir du champ de bataille. Le corps à corps sanglant entre belligérants se poursuivit jusqu'en soirée et dans l'obscurité croissante. À la disparition de la lune vers 23 heures, la nuit noire ne permettant plus de distinguer amis et ennemis, tambours et trompettes sonnèrent le ralliement après six heures de luttes ininterrompues. Après quelques instants d'hésitations, contre l'avis de Schiner, les Confédérés décidèrent de tenir leur position, légèrement en leur faveur, plutôt que de retourner sur Milan, malgré le froid et la faim. Ainsi s'acheva la première journée de la bataille. Dans l'obscurité, la confusion sur le terrain était grande. On raconta que le roi de France avait passé la nuit appuyé contre une pièce de canon à 50 toises d'un bataillon suisse20(environ 90 mètres.
La victoire franco-vénitienne du 14 septembre
Au petit matin du 14, le combat reprit. L’artillerie française commandée par le sénéchal d’Armagnac fit des ravages, mais fut incapable de ne serait-ce que ralentir les Suisses, tandis que l’aile gauche de l’armée commandée par le duc d'Alençon fléchit face au gros de l'ennemi, les lansquenets encore faiblissent aussi. La victoire fut proche pour les Suisses mais soudain un cri à 8 heures du matin retentit : Marco ! Marco !. Ce furent les Vénitiens, menés par Bartolomeo d'Alviano, qui arrivèrent sur l’aile avec 3 000 cavaliers à la tête des fantassins et estradiots cavaliers légers originaires de Grèce ou d'Albanie, voire de Croatie et de Bosnie actuelles. Ils écrasèrent le gros des Suisses tandis que les lansquenets repartirent à l’assaut avec vigueur. À 11 heures, les Suisses, qui avaient subi des pertes énormes, battirent en retraite vers Milan.
Le soir, entre 9 000 et 10 000 Suisses gisent sans vie sur le champ de bataille, près de la moitié des contingents engagés. Tandis que le camp franco-vénitien compte 5 000 à 8 000 morts.
Plusieurs auteurs évoquent l'adoubement du roi par Bayard sur le champ de bataille de Marignan le 15 septembre 1515, soit Symphorien Champier 1525, le Loyal Serviteur 1527, mais peut-être 1524 et Aymar du Rivail v. 1530, ainsi que le maréchal de Florange v. 1526: Symphorien Champier, Les gestes ensemble la vie du preulx chevalier Bayard…, Lyon, novembre 1525 ; éd. Denis Crouzet, Paris, 1992, p. 195-196. La très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayart…, Paris, septembre 1527 ; éd. Joseph Roman, Paris, 1878, p. 385-386. Aymar du Rivail, De Allobrogibus Libri IX, éd. Alfred de Terrebasse, Vienne, 1844, p. 561-562. Mémoires du maréchal de Florange, dit le Jeune Adventureux, éd. Robert Goubaux et Paul-André Lemoisne, Paris, 1913-1924, 2 vol., t. I, p. 190. Quelques auteurs ont considéré cette histoire comme un mythe, qui aurait été monté par demande royale, afin notamment de faire oublier que celui qui adouba François Ier lors de son sacre c'est-à-dire le connétable de Bourbon, artisan de la victoire de Marignan) se rangea en 1523 du côté de Charles Quint. Pire, le connétable aurait été l'organisateur de la future défaite de Pavie, et donc de l'emprisonnement de François Ier. La légende fut donc inventée pour faire oublier les liens "filiaux" qui liaient le roi et son traitreux sujet, tandis qu'elle aurait renforcée un lien inexistant au départ entre le souverain et le symbole du courage et de la vaillance, qui mourra en 1524. Le roi, toutefois, a fait ses premières armes avec Bayard lors de la campagne malheureuse de Navarre automne 1512, et il a tenu à le récompenser de sa bravoure dès janvier 1525 avec le don de la lieutenance générale du Dauphiné, charge fort prestigieuse. L'invention pourrait également être liée à la volonté du roi de France de se montrer le parfait exemple, chevaleresque entre tous, alors qu'il était prisonnier. Mais, le roi étant prisonnier à Madrid, il était incapable de monter une quelconque opération de propagande. Le maréchal de Florange qui rédige ses mémoires en captivité et totalement coupé du monde extérieur n'aurait pas été en mesure d'ailleurs de recevoir un tel message de la cour de France. Il n'en reste pas moins que l'épisode est étrange et, s'il n'a pas été inventé par les panégyristes de Bayard, relève probablement d'un "jeu chevaleresque" comme le roi les aimait tant.
Les conséquences
Cette victoire apporte renommée au roi de France dès le début de son règne. Les conséquences diplomatiques sont nombreuses :
François Ier prend rapidement le contrôle de la Lombardie, qu'il conservera jusqu'au désastre de Pavie, en 1525. Le 13 octobre, il signe avec le pape Léon X, le traité de Viterbe. Le pape s'y engage à reconnaître l'autorité du roi de France sur le duché de Milan, et lui offre Parme et Plaisance, en échange de son soutien à Florence, contre Venise ;
il signe la paix perpétuelle de Fribourg le 29 novembre 1516 avec les cantons suisses qui restera en vigueur jusqu’à la fin de la monarchie en France en 1792 et l'invasion française de la Confédération. En échange de cet engagement de paix de la part des suisses, le roi de France octroya aux cantons suisses 700 000 écus d'or de dédommagements, une pension annuelle de 2000 francs pour chacun d'eux ainsi que divers privilèges commerciaux. De plus, les suisses purent garder une grande partie de leurs acquisitions territoriales de 1512. Seuls Luino et Domodossola échappèrent à la Confédération.
Les Suisses mettent leurs mercenaires au service du roi de France, par le traité de Genève le 7 novembre 1515 ;
le 13 août 1516, François Ier et le jeune roi des Espagnes Charles Ier, futur Charles Quint, signent le traité de Noyon qui confirme à François Ier la possession du Milanais, qui restitue la Navarre à Henri d’Albret et qui promet à Charles la main de la fille aînée du roi de France, Louise, alors âgée d’un an mais qui ne survivra pas à son troisième anniversaire. Dans la dot de la future mariée sont inclus les droits sur le royaume de Naples ;
les relations entre le roi de France, roi Très-Chrétien, et le pape, sont à redéfinir. L'accord du pape est indispensable pour l'acquisition durable des conquêtes, et la perception des décimes sur le clergé. En décembre 1515, la rencontre de Bologne permet d'engager les négociations. Antoine Duprat signe en son nom le concordat de Bologne le 18 août 1516. Ce concordat régira les relations entre le royaume de France et la Papauté jusqu’à la Révolution française. Désormais, le roi nomme les évêques, archevêques, qui sont par la suite confirmés par le pape.
Une bataille célèbre
La gloire du roi François
À l'aube du règne de François Ier, la bataille de Marignan, qui a duré deux jours, fait inhabituel pour cette époque, est devenue un symbole de la gloire du roi : dès la victoire, le récit de la bataille est publié et raconté sur la place publique ou lors des prêches à l'église. Elle sert aussi à justifier une croisade imaginée par Léon X et que devait conduire François Ier lors de leur entrevue en décembre 1515, le roi français abandonne la Pragmatique Sanction de Bourges, en échange le pape lui propose de mener une croisade héroïque. Dans le cadre de la préparation de cette croisade, est réécrit la geste de François Ier unique vainqueur à Marignan le jour symbolique de la Sainte-Croix, les alliés vénitiens disparaissant complètement du récit. Cette image du roi chevalier se renouvelle en 1519 lorsque François Ier prétend à l'élection impériale. Après la défaite française de Pavie en 1525, des textes de propagande soulignent que la bataille de Pavie est insignifiante par rapport à celle de Marignan Tout est perdu, fors l'honneur. À la fin de son règne, François Ier malade ne participe plus aux combats mais la propagande rappelle que sur les théâtres de bataille, François Ier est présent symboliquement tel le chef de guerre qu'il a été à Marignan.
La défaite des Suisses est un événement, car ceux-ci ont acquis, par leur discipline, une réputation d'invincibilité. Elle évoque un autre grand chef de l'Antiquité, Jules César.
Marignan et l'histoire militaire
Elle s'inscrit dans le début de la Renaissance. L'artillerie y a été utilisée de manière décisive.
Marignan et les Arts
Elle devient le thème de nombreuses compositions poétiques et de chansons, comme celles écrites par Clément Janequin, La Guerre La Bataille de Marignan, publiée à Paris en 1528.
Les artistes italiens, dont Léonard de Vinci, vont alors se diriger vers la France et contribuer à la diffusion de la Renaissance. Léonard de Vinci organisa d'ailleurs en mai 1518 un simulacre de la bataille de Marignan. De cette fête témoigne l'ambassadeur de Mantoue qui décrit une reconstitution spectaculaire où participèrent des milliers de figurants, autour d'un château de bois et de tissu attaqué par des canons chargés à blanc.
Beaucoup plus tard, en 1939, Jean Daetwyler, compositeur suisse d'origine bâloise mais Valaisan d'adoption, écrit une marche militaire pour orchestre à vent. Au départ, l'œuvre qui était une commande devait s'intituler : Marche du cinquantenaire de la Fédération des musiques du Valais central. Jean Daetwyler, trouvant ce titre peu engageant et surtout trop long, intitula finalement la marche : Marignan, en mémoire de l'engagement des Valaisans dans cette bataille aux côtés des Confédérés.
 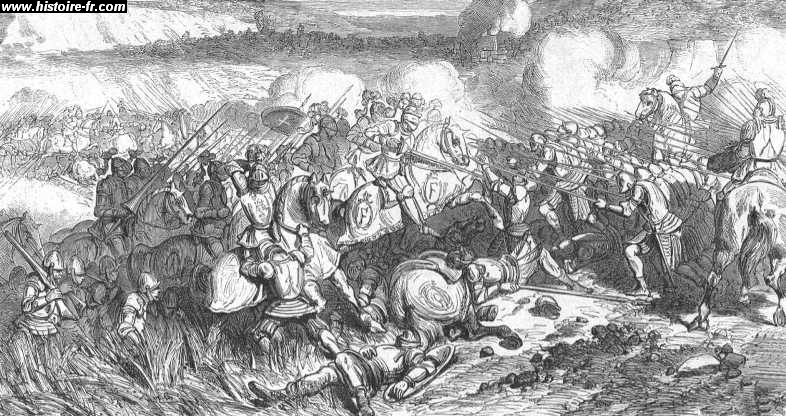       
Posté le : 13/09/2015 18:43
Edité par Loriane sur 18-09-2015 21:47:47
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
136 Personne(s) en ligne ( 86 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 136
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages