|
|
Re: Bataille d'Azincourt |
|
Administrateur  
Inscrit:
30/05/2013 12:47
Niveau : 34; EXP : 7
HP : 0 / 826
MP : 540 / 26786
|
Ma chère Loriane, n'étant pas, hélas, un féru histoire, je me demandais, en écoutant la chanson de Cabrel , le pourquoi de des paroles et de cette chanson!!
J'ai la réponse à mon interrogation, et désormais j'écouterai les paroles de cette dernière avec une autre oreille!!!
''Chevaliers de la cour finis à bout portant
Et leurs chevaux trop lourds dans la boue jusqu'au flanc
Sous le vol des vautours et le dard des frelons
Tournoyant tout autour partout des papillons. ''
Merci loriane de me donner l'occasion de charger mon cerveau, sachant que la place vide ne fait pas défaut!!!!
Bisous
Serge.
Posté le : 27/10/2015 18:05
|
|
_________________
Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …
Titi
|
|
|
Re: Bataille d'Azincourt |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Jacques,
Tu as raison, toute proportion gardée cela rappelle la légende de David et Goliath qui a force d'allégorie et dont la symbolique est claire : le poids et la lourdeur sont perdant devant la mobilité et la légèreté. A Azincourt ce sont les archers anglais qui ont décimé la lourde armée française. C'est le triomphe de la piétaille, des simples piétons sur la la très noble chevalerie, embourbée.
Merci de ton passage.
Posté le : 26/10/2015 08:41
Edité par Loriane sur 27-10-2015 22:02:17
|
|
|
|
|
Re: Dagobert |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Oui, les guerres, guerres de territoire et de pouvoir ne finissaient pas.
C'est qui tout à fait curieux, c'est le hasard des dates, sur cette même date, ils étaient trois cette semaine, et trois de la même période : Clotaire II, Jean sans terre et Dagobert.
Curieux hasard.
Merci de ton passage.
Posté le : 25/10/2015 21:46
|
|
|
|
|
Re: Bataille d'Azincourt |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Chère Loriane,
C'est avec plaisir que j'ai lu la triste histoire de la bataille d'Azincourt, l'une de nos plus funestes défaites militaires.
Elle nous invite à l'humilité : une troupe plus modeste a eu raison d'une armée plus puisante, simplement à cause d'un orgueil mal placé et d'un manque patent de préparation.
Merci vraiment.
Amitiés de Dijon.
Jacques
Posté le : 25/10/2015 21:44
|
|
|
|
|
Re: Dagobert |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
18/02/2015 13:39
De Dijon
Niveau : 39; EXP : 1
HP : 190 / 950
MP : 767 / 25999
|
Chère Loriane,
J'ai eu très envie de chanter la chanson "le bon roi Dagobert" même si elle n'est vraiment pas historique.
Un grand merci à toi de me faire revisiter cette périoide de l'histoire de notre pays, très riche.
Cela étant, à cette époque, les conflits étaient nombreux et les paix étaient très éphémères.
Amitiés de Dijon.
Jacques
Posté le : 24/10/2015 17:18
|
|
|
|
|
Bataille d'Azincourt |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 25 octobre 1415 se déroule la bataille d'Azincourt
en Artois, Battle of Agincourt en anglais pendant la guerre de Cent Ans.
Elle se déroule dans une clairière entre le bois d'Azincourt et celui de Tramecourt et se termine par une victoire anglaise décisive. Les Belligérants sont le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Commandé par Charles Ier d'Albret, et Jean II Le Meingre, Henri V d'Angleterre et Thomas Erpingham. Les forces en présence
sont composées de 12 000 à 35 000 hommes, approx. 9 000 hommes : 1 000 chevaliers, 6 000 archers, 2 000 fantassins. Les pertes sont de 6 000 morts, 2 200 prisonniers 600 morts, dont 13 chevaliers. Elle se déroule pendant la guerre de Cent Ans.
Les batailles :
-première phase 1337-1360, Arnemuiden 1338 · L'Écluse 1340 · Saint-Omer 1340 · Chevauchée de 1346 · Caen 1346 · Crécy 1346 · Calais 1346 · Neville's Cross 1346 · Winchelsea 1350 · Chevauchée de 1356 · Poitiers 1356 · Grande Jacquerie 1358 · Meaux 1358.
-Guerre de Succession de Bretagne : Champtoceaux 1341 · Hennebont 1342 · Morlaix 1342 · Vannes 1342 · Cadoret 1345 · La Roche-Derrien 1347 · Combat des Trente 1351· Mauron 1352 · Montmuran 1354 · Rennes 1356-1357 · Auray 1364
-La deuxième phase 1369-1389 : Cocherel 1364 · Pontvallain 1370 · La Rochelle 1372 · Révolte des Tuchins 1381-1384 · Révolte paysanne anglaise 1381 · Roosebeke 1382
Guerre civile de Castille : Nájera 1367 · Montiel 1369
-Armagnacs et Bourguignons, Révolte des Cabochiens 1413· Anthon 1430
-Troisième phase 1415-1428 : Harfleur 1415 · Azincourt 1415 · Rouen 1418 · Baugé 1421 · Meaux 1421 · Cravant 1423 · Brossinière 1423 · Verneuil 1424
-Quatrième phase 1429-1453 :Orléans 1428-1429 · Journée des Harengs 1429 · Jargeau 1429 · Meung-sur-Loire 1429 · Beaugency 1429 · Patay 1429 · Chevauchée vers Reims 1429· Montépilloy 1429 · Paris 1429 · Laval 1429 · Compiègne 1430 · Gerberoy 1435 · Campagne Bretagne et Normandie 1448-1449 · Fougères 1449 · Verneuil 1449 · Formigny 1450 · Castillon 1453
En bref
Bataille de la guerre de Cent Ans à Azincourt, le 25 octobre 1415, près d'Hesdin, aujourd'hui dans le Pas-de-Calais.
L'armée féodale du roi de France Charles VI, peu disciplinée, y fut écrasée par les Anglais, moins nombreux, mais mieux commandés, sous les ordres de leur roi Henri V. Cette bataille décima la noblesse française et permit aux Anglais de conquérir une grande partie de la France, au moment où la querelle des Armagnacs et des Bourguignons divisait les Français guerre de Cent Ans.
La bataille d'Azincourt est une défaite cuisante des Français face aux Anglais, durant la guerre de Cent Ans. Revendiquant le trône de France, Henri V d'Angleterre débarque en Normandie en août 1415, à la tête d'une armée d'environ 11 000 hommes. Il s'empare de Harfleur en septembre, mais ses forces sont réduites alors de moitié, à la suite des combats et en raison des maladies. Henri prend la décision de se porter vers le nord-est pour rejoindre Calais, possession anglaise, d'où il espère pouvoir regagner l'Angleterre. Mais une imposante armée française, sous les ordres du connétable Charles d'Albret, cherche à lui bloquer sa retraite.
Cette armée compte de 20 000 à 30 000 hommes et réunit la fine fleur de la chevalerie française. Elle rattrape l'armée anglaise exténuée à Agincourt aujourd'hui Azincourt, dans le département du Pas-de-Calais. Persuadés de remporter une victoire facile, les Français ont imprudemment choisi pour champ de bataille une étroite clairière, d'environ 900 mètres, encadrée par deux bois. L'exiguïté du terrain rendant les manœuvres quasi impossibles, l'avantage de leur écrasante supériorité numérique se voit réduit à néant. À l'aube du 25 octobre 1415, les deux armées se préparent au combat. Du côté français, trois formations en bataille, les deux premières à pied, sont contraintes de s'aligner les unes derrière les autres. Henri ne dispose que d'environ 5 000 archers et 900 hommes d'armes, qu'il déploie en une seule ligne. Les hommes d'armes ont mis pied à terre et sont répartis en trois groupes centraux reliés par des groupes d'archers qui forment des angles en saillie, flanqués sur les ailes droite et gauche par deux masses d'archers supplémentaires.
Les archers anglais s'avancent pour avoir leur ennemi à portée de flèches. Le tir nourri des long bows pousse alors les Français à attaquer. Des charges isolées de chevaliers français se brisent sur la ligne de pieux acérés dressée par les Anglais. Vient alors le principal assaut, à pied, des chevaliers français, en lourde armure de plaques, sur un sol détrempé par la pluie. Sous le choc, la ligne anglaise cède d'abord du terrain, mais se ressaisit rapidement. Les chevaliers français sont engagés en rangs si serrés que certains d'entre eux parviennent à peine à lever le bras pour porter leurs coups. C'est à ce moment déterminant que Henri donne l'ordre à ses archers, équipés légèrement et plus mobiles, d'attaquer à l'épée et à la hache. Les Anglais taillent alors en pièces les Français empêtrés dans une effroyable cohue. Des centaines de nobles sont faits prisonniers pour être rançonnés, mais lorsque la crainte d'une nouvelle attaque française survient à l'approche des milices communales, ils sont tous massacrés sur les ordres d'Henri.
Cette bataille est un désastre pour les Français. Le connétable et douze autres membres de la haute noblesse, quelque 1 500 chevaliers et environ 4 500 hommes d'armes sont tombés, tandis que les pertes des Anglais s'élèvent à moins de 450 hommes. Les Anglais furent certes vaillamment dirigés par leur roi, mais la tactique absurde des Français a au moins autant contribué à leur défaite.
La bataille
Les troupes françaises, fortes de quelque 18 000 hommes, tentent de barrer la route à l'armée du roi d'Angleterre Henri V, forte d'environ 6 000 hommes et qui tente de regagner Calais, devenue anglaise depuis 1347, et donc par là même l'Angleterre.
Débarquée dès le 13 août au lieu-dit Chef-de-Caux, près de la ville d'Harfleur, l'armée anglaise parvient au bout d'un mois et demi de siège 17 août-7 octobre 1415 à prendre cette dernière, s'assurant ainsi d'une tête de pont en Normandie. Jugeant la saison trop avancée, Henri V se refuse à marcher sur Paris, et comme son aïeul Edouard III en 1346, il se dirige alors avec son armée vers le Nord de la France en vue de rembarquer vers l'Angleterre. L'ost du roi de France, Charles VI absent car atteint alors d'une maladie mentale, parvient à rattraper les Anglais le 24 octobre. La bataille qui s'ensuit se solde par une défaite importante pour le camp français : la cavalerie lourde, rendue moins efficace par un terrain boueux et les retranchements anglais, est transpercée par les archers en majorité gallois, équipés de grands arcs à très longue portée.
Cette bataille, où la chevalerie française est mise en déroute par des soldats anglais inférieurs en nombre, est souvent considérée comme la fin de l'ère de la chevalerie et le début de la suprématie des armes à distance sur la mêlée, suprématie qui ne fait que se renforcer par la suite avec l'invention des armes à feu. Elle est, en réaction, une cause majeure de l'épopée de Jeanne d'Arc, puis de l'investissement dans l'artillerie qui deviendra une spécialité française.
Pour les Anglais, cette bataille reste l'une des victoires les plus célébrées, notamment par William Shakespeare dans une pièce de théâtre, Henri V.
Configuration du terrain et conditions météorologiques
La bataille a lieu dans la clairière entre les bois d'Azincourt et de Tramecourt, dans l'actuel Pas-de-Calais près du village d'Azincourt. Le champ de bataille a été un élément déterminant à l'issue de l'affrontement. Au nord, au pied de la colline et dans des champs fraîchement labourés, se trouve l'armée commandée par Charles Ier d'Albret, connétable de France, qui s'y est placé, après une longue poursuite de onze jours, pour interdire le passage vers Calais aux forces anglaises qui ont mené une campagne sur la Somme.
La nuit du jeudi 24 octobre se passe sur le terrain pour les deux camps. Une lourde pluie tombe toute la nuit sur les deux armées peu abritées. Le champ de bataille, tout en longueur, est fortement détrempé, particulièrement côté français, placés dans le bas de la colline où coule un ruisseau devenu torrent durant la nuit. Le terrain boueux désavantageait l'armée française composée de nombreux chevaliers en armures dont certains se sont noyés sous leur poids. Le religieux de Saint-Denis dira dans sa chronique que les troupes françaises marchaient dans la boue qui s'enfonçait jusqu'aux genoux. Ils étaient déjà vaincus par la fatigue avant même de rencontrer l'ennemi.
Disposition des armées
Position troupes lors de la bataille d'Azincourt
Troupes françaises :
L'avant-garde est composée de bacinets, chevaliers ou écuyers, d'archers m d'arbalétriers n et d'hommes d'armes à pied C et Cr que le connétable C conduit.
L'aile droite du comte de Vendôme est composé d'hommes d'armes
L'aile gauche était composée de l'élite des hommes d'armes à cheval .
L'arrière garde était le surplus des gens d'armes.
Troupes anglaises :
Les archers sur le devant avec les gens d'armes derrière. les 2 autres ailes sont disposées de la même manière.
Au point du jour, le vendredi 25 la Saint-Crépin, Henri V dispose sa petite armée environ 6 000 combattants, dont 5 000 archers et 1 000 hommes d'armes. Il est probable que les trois forces habituelles aient été placées sur une ligne, chacune avec ses archers sur les flancs et les hommes d'armes démontés occupant le centre ; les archers étant placés en avant dans des avancées en forme de coin, presque exactement comme à la bataille de Crécy. Henry V se met en bon chef de guerre à la tête de ses hommes, entouré de sa garde personnelle, dans le corps de bataille principal, formé d'une ligne ininterrompue de combattants sur quatre rangs. Le duc d'York commande l'aile droite, tandis que le sire de Camoys est à la tête de l'aile gauche. Les archers sont menés par le duc d'Erpyngham, dont une grande majorité se trouve sur les flancs, ainsi que 200 autres archers dans le bois de Tramecourt afin d'empêcher un encerclement par les Français. Enfin, les archers se sont protégés par des rangées de pieux, destinés à briser la charge française.
Un grand nombre de seigneurs français sont présents au point que des bannières durent être repliées car elles gênaient la vue du corps de bataille principal. Les Français, en revanche, sont groupés sur trois lignes et en masse. Ils sont significativement plus nombreux que les Anglais, mais à Azincourt, ils ne peuvent utiliser la puissance de leur charge. Le terrain boueux fait glisser les chevaux lourdement chargés. Les quatre vagues d'attaque successives s'empêtrent les unes dans les autres.
L'avant-garde française est composée de 3 000 chevaliers, commandée par les grands seigneurs tels que le maréchal Boucicaut, le connétable Charles d'Albret, le duc d'Orléans, le duc de Bourbon, David de Rambures, grand maître des arbalétriers, le seigneur de Dampierre amiral de France, Guichard Dauphin, et autres officiers du roy d'après Monstrelet. Le plus puissant d'entre eux, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, est absent; il désirait participer à la bataille et avait même mobilisé des troupes. Le gouvernement armagnac alors en place avait en effet commandé au duc de Bourgogne l'envoi de 500 hommes d'armes et de 300 archers. Cependant, sa présence n'était pas souhaitée à cause notamment de la rivalité entre les partis bourguignon et armagnac. De ce fait, Jean sans Peur ne donna pas à ses vassaux l'ordre de se rendre à la bataille, ordre qui ne fut bien entendu pas écouté puisque nombre de chevaliers français tués à Azincourt étaient sujets du duc de Bourgogne, dont ses propres frères Antoine de Brabant et Philippe de Nevers.
Le corps de bataille principal, 150 mètres derrière l'avant-garde, était fort de 4 000 hommes commandés par les comtes d'Aumale, de Dammartin et de Fauquembergues. Ces deux premières batailles étaient constituées d'hommes en armure qui avaient mis pied à terre. L'arrière-garde se composait de combattants de petite noblesse et de combattants de basse naissance soldats et hommes de traits soit au total 4 100 combattants. Ils s'étaient fait ainsi reléguer à l'arrière à cause de l'organisation traditionnelle des batailles, qui veut que les grands soient à l'avant. De plus, selon les chroniqueurs, l'ost royal refusa l'aide de 4000 arbalétriers génois car il s'estimait bien assez nombreux. Sur les flancs, deux contingents de cavalerie lourde, soit 2400 cavaliers. Son but était de briser les rangs d'archers anglais et de faciliter de cette manière l'attaque des batailles principales. Les commentateurs français estiment que les chevaliers ont peu à craindre car, s'ils sont capturés, une rançon sera versée pour les libérer. Ce n'est pas le cas de la piétaille, composée de simples soldats. Ceux-ci ont intérêt à défendre chèrement leur peau et à bien se battre.
Des débats courent sur le nombre de Français présents, amenant ainsi un rapport de 1 contre 2 à 1 contre 12, soit environ 72 000 hommes d'armes français. Le nombre le plus raisonnable est celui du Dr. Anne Curry: 13 500 Français. Le royaume de France ne pouvait mobiliser davantage, d'autant plus qu'une partie de l'ost était à Rouen chargée de la protection du roi.
Déroulement de la bataille
et massacre des prisonniers et blessés français
L'échec des négociations
Pendant les trois premières heures après le lever du soleil, il n'y a aucun combat.
Des négociations s'engagent. Les Français demandent la renonciation du roi d'Angleterre à la couronne de France. Les Anglais de leur côté demandent l'accès libre à Calais et sont même prêts à rendre les forteresses qu'ils tiennent dans le Nord du royaume de France, Harfleur, qu'ils viennent de prendre après un long siège d'un mois, entre autres. Elles échouent. La bataille aura lieu.
La bataille
Il est dix heures. L'armée anglaise met genoux en terre et baise le sol. Le roi d'Angleterre, en manque de vivres avec une armée malade et fatiguée, ne peut repousser la bataille. Henri V d'Angleterre fait alors avancer ses hommes de 600 mètres vers les lignes françaises, d'une part pour les provoquer et les faire attaquer, d'autre part pour occuper la partie la plus étroite de la plaine, entre deux forêts. De plus, en se plaçant aussi près, il met les Français à portée des flèches des arcs anglais. Les archers se réfugient derrière des pieux qu'ils ont taillés le soir ou la veille, apportés et plantés dans le sol pour parer les charges de cavalerie. Ils décochent une première volée.
Oubliant les leçons des batailles de Crécy et de Poitiers, les chevaliers français, 1 200 hommes de cavalerie lourde sur chaque aile, chargent les rangs anglais. Mais seuls 900 cavaliers sont à leur poste. Le premier obstacle est le terrain, détrempé par la pluie qui s'est abattue toute la nuit et fraîchement labouré nous sommes fin octobre, le second obstacle se trouve dans les archers anglais et leurs redoutables capacités. Criblés, cavaliers et montures n'atteignent pas les rangs ennemis. Ceux qui ont réussi sont empalés sur les pieux des archers ou capturés, voire tués.
Sur ce, les chevaux blessés cherchent à s'enfuir et se heurtent à l'avant-garde française à pied, qui devant ce massacre, décide de charger. Le connétable lui-même dirige la ligne principale d'hommes d'armes démontés. Et fut l'avant-garde toute fendue en plusieurs lieux d'après la chronique de Ruisseauville. Alors commencèrent à cheoir hommes d'armes sans nombre, d'après Le Fèvre. Les archers anglais déversent leurs flèches et en noircissent le ciel. Du côté français, les hommes de traits sont bloqués derrière l'arrière-garde. Les Français utilisent des canons et serpentines, Le Fèvre.
Sous le poids de leurs armures, les hommes d'armes de l'avant-garde s'enfoncent profondément dans la boue à chaque pas. Ils atteignent cependant les lignes anglaises et engagent le combat avec les hommes d'armes anglais. Pendant un court moment, le combat est intense. L'armée anglaise se voit contrainte de reculer. Henri V est presque mis à terre, la couronne de son heaume voit l'un de ses ornements fendu par le connétable qui a réussi à fendre la garde rapprochée du roi, il est rapidement désarmé. Les archers anglais répondent par d'autres salves. Piégés dans un entonnoir, les Français, embourbés, obligés de baisser la tête face aux flèches, incapables de lever leurs armes dans cette mêlée trop serrée, sont immobilisés. Les Anglais en profitent et pénètrent les rangs français. Les archers délaissent leurs arcs pour des armes de corps-à-corps épées, haches, maillets, becs de faucons, ... et entrent dans la mêlée. L'avant-garde française est taillée en pièces en une demi-heure.
Cette première ligne ruinée bat en retraite mais se heurte à la deuxième ligne de bataille française qui entre dans la mêlée, ce qui engendre une confusion monstre. Les cadavres des chevaux et des hommes barrent toute progression et tout assaut. Les Anglais comprennent que la bataille est presque gagnée et cherchent à faire des prisonniers. Contrairement aux ordres d'Henri V, les hommes d'armes anglais profitent de la victoire qui se fait jour et font de nombreux prisonniers espérant en tirer rançon comme c'est alors l'usage, estimant en outre qu'il serait peu chrétien de les tuer. Certains Français, selon les chroniqueurs, s'enfuient alors.
Les Français reçoivent alors quelques renforts. D'abord, le duc de Brabant, frère de Jean sans Peur duc de Bourgogne, arrive avec onze de ses chevaliers. Il n'attend pas son armure qui doit arriver par convoi, endosse le tabard de son chambellan et fonce dans la mêlée.
Le massacre des prisonniers et blessés français
Puis, dans le dos des Anglais, des cris retentissent. C'est Ysembart, seigneur d'Azincourt, Rifflart de Palmasse et Robinet de Bournonville, avec 600 paysans. Ils s'en prennent aux bagages royaux et s'emparent de l'épée royale, d'une couronne, des sceaux royaux et d'une partie du trésor royal. Pris de la peur d'être attaqué à revers, Henry V donne ordre de massacrer les prisonniers "sinon les seigneurs" selon Georges Chastellain. Mais les archers refusent non pour des raisons morales mais parce qu'un tel acte supprime toute possibilité de demander rançon des prisonniers. Henry V menace de pendre quiconque refusera d'obéir à ses ordres et charge un écuyer et 20 archers de tuer les prisonniers. Il craint que la charge d'Ysembart d'Azincourt n'amène les prisonniers français à se soulever contre leurs gardiens. Chaque homme tue son prisonnier. Ils sont égorgés, ils ont le crâne fracassé à la masse d'arme ou à la hache, ou bien enfermés dans des granges auxquelles on met le feu, rapportés par Gilbert de Lannoy qui échappe de peu aux flammes. Le duc de Brabant est lui aussi égorgé. Il n'a pas été reconnu par les Anglais en tant que membre de la maison de Bourgogne.
Henry V peut alors se tourner vers le combat principal. C'est alors que la troisième ligne française, bien que sans chef, charge et se brise sur les Anglais et s'enfuit à son tour. Ysembart d'Azincourt et ses hommes battent eux aussi en retraite. Il est dix-sept heures. La bataille est terminée.
Revenant le lendemain matin sur le champ de bataille, Henry V fait massacrer les blessés français qui ont survécu.
Facteurs de l'issue de la bataille
En plus de leur indiscipline et de leur conviction de remporter la victoire grâce à leur supériorité numérique, les Français se créèrent eux-mêmes certaines difficultés.
Il avait plu toute la nuit précédant la bataille.
Arbalètes : les cordes d'arbalètes françaises étaient trop humides et donc souvent hors fonctionnement. De plus, les arbalétriers étaient mal placés pour tirer.
Jean II le Meingre dit Boucicaut, commandant les troupes françaises, avait établi un plan de bataille quelques jours avant la bataille avec les grands nobles présents. Cependant, il ne put être appliqué car il ne prenait pas en compte la nature du terrain, qui allait devenir celui d'Azincourt. Il fallut se rendre à l'évidence que l'ost du roi de France était trop nombreux pour manœuvrer dans une plaine aussi étroite rendant alors obsolète le plan de Boucicaut. En conséquence, on en revient à un plan plus simple et traditionnel, en rejetant la piétaille et les gens de trait à l'arrière, privant les hommes d'armes de leurs soutiens.
Placement en hauteur des Anglais. Les Français ont chargé, de plus à pied, sur une pente boueuse...
Tactique de placement des lignes anglaises occupant la place entre les deux bois : plus moyen de les attaquer de côté. En outre, Henry V avait placé des hommes dans les bois pour éviter toute approche française par ceux-ci. Les Anglais étaient placés en entonnoir, les Français ont eu le réflexe chevaleresque de charger tout droit, les plaçant ainsi sous les flèches anglaises en tir croisé.
Tous les attaquants français étaient à découvert de même que les Anglais d'ailleurs, et les archers anglais n'avaient qu'à tirer sans cesse devant eux puisque sur les côtés se trouvaient les deux bois qui restreignaient leur cible.
Armes de jet : le long bow, un des arcs les plus puissants pouvant transpercer une armure jusqu'à 100 mètres, bien que les arbalètes soient encore plus puissantes. Cependant, les tirs étaient, à longue distance, des tirs de sape, et non des tirs efficaces, pour blesser les troupes dont l'équipement défensif était léger et les flèches avaient perdu leur puissance contre les chevaliers lourdement armés. Il faut attendre une centaine de mètres pour que le long bow anglais, d'une puissance allant de 100 à 180 livres, puisse se montrer efficace.
Cadence de tir des archers anglais : de 12 à 14 flèches par minute les arbalètes ne pouvant tirer que 2 carreaux par minute. De plus, les archers anglais étant positionnés en entonnoir, le tir croisé s'est révélé meurtrier.
Le nombre des cavaliers français à la charge en rangs serrés. Lorsqu'un cheval tombait pendant la charge, le suivant écrasait ou trébuchait fréquemment sur le précédent. Les archers anglais, qui composaient les deux ailes, avaient planté des pieux dans le sol, afin de se prémunir des charges de cavalerie.
Bilan
Les pertes totales des Anglais sont de 13 chevaliers dont le duc d'York, petit-fils d'Édouard III, tué par le duc d'Alençon et une centaine de simples soldats. Les Français perdent 6 000 chevaliers dont le connétable, et de nombreux grands seigneurs dont quatre princes du sang, plusieurs ducs, Jean Ier d'Alençon, Édouard III de Bar, Charles d'Orléans est lui fait prisonnier ; 5 comtes dont Philippe de Bourgogne et le comte Robert de Marle, 90 barons et un millier d'autres chevaliers furent faits prisonniers. Baudoin d'Ailly, dit Beaugeois, seigneur de Picquigny, vidame d'Amiens, grand seigneur de l'Amiénois, conseiller et chambellan du roi de France Charles VI, meurt trois semaines après la bataille, des suites de ses blessures. À signaler également la mort du duc de Brabant et de Limbourg Antoine de Bourgogne, venu participer à la bataille côté français malgré la neutralité affichée de son frère et suzerain Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
Les seuls à survivre seront ceux qui auront préféré ne pas participer : À ce combat, le duc de Bretagne, Jean, bien qu'il eût été appelé, n'assista pas. Étant venu à Amiens avec un grand nombre de ses Bretons, communément estimés à dix mille hommes, il aima mieux attendre là l'issue de la guerre, plutôt que de s'exposer de trop près aux dangers. La bataille terminée, il reprit le chemin de son duché, sans même avoir vu les ennemis, mais non sans quelque dommage pour les localités où il passait.
La paix de Troyes, désastreuse pour la France
sera signée cinq ans plus tard.
La débâcle de la chevalerie française d'Azincourt, qui fait suite à celles de Crécy, de Poitiers et de Nicopolis, prive momentanément la France de cadres administratifs et militaires en grand nombre du fait des nombreux tués chez les baillis et les sénéchaux du roi. Elle met également en évidence la conception dépassée que se font de la guerre les armées françaises en particulier une partie de la chevalerie, alors qu'Anglais et Ottomans ont déjà organisé des armées unies et disciplinées : les Français, supérieurs en nombre, mais incapables d'obéir à un chef unique et placés dans l'impossibilité de faire manœuvrer les chevaux, comme à la bataille de Poitiers, soixante ans auparavant, auraient eu intérêt à négocier avec Henri V, qui avait abandonné son rêve de revendiquer la couronne de France.
Cette bataille marqua un tournant dans l'art de la guerre en Europe : des armées plus maniables et plus articulées, comme l'était déjà celle d'Édouard III, dont la composition et le comportement permettaient de préfigurer le déroulement des batailles intervenant dès la fin du XIVe siècle défont des masses hétéroclites pleines d'inutile bravoure.          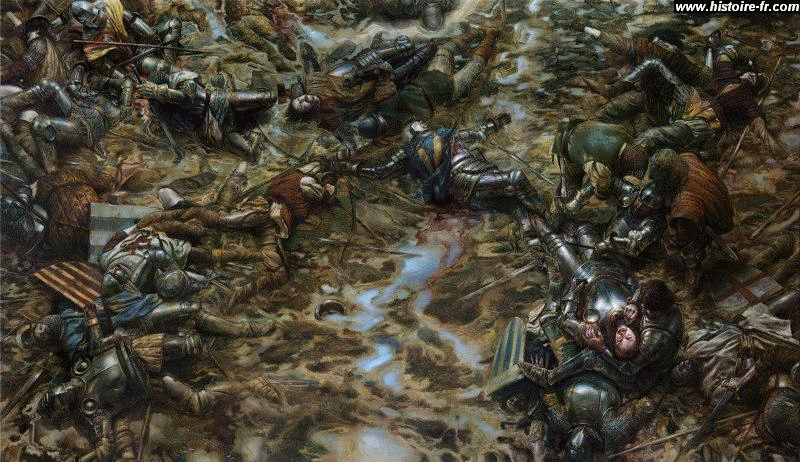
Posté le : 23/10/2015 19:38
|
|
|
|
|
Louis VII le jeune |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 25 octobre 1131 est couronné Louis VII
dit Louis le Jeune, né en 1120, mort à 60 ans, le 18 Septembre 1180 à Paris, roi des Francs de 1137 à 1180. Il est le fils de Louis VI, dit Louis le Gros, roi des Francs, et d’Adélaïde de Savoie v. 1092-1154. Roi des Francs de la dynastie des Capétiens, du 1er août 1137 au 18 septembre 1180 soit pendant 43 ans 1 mois et 17 jours. Le couronnement à lieu le 25 octobre 1131, en la cathédrale de Reims. Le 25 décembre 1137, en la Cathédrale Saint-Étienne de Bourges roi unique
Son prédécesseur est Louis VI son successeur seraPhilippe II. Il est le Duc d'Aquitaine du 8 août 1137 au 21 mars 1152 soit 14 ans 7 mois et 10 jours Couronnement le 8 août 1137, à Poitiers, son prédécesseur est Aliénor d'Aquitaine, son successeur est Henri II Plantagenêt. Marié à Aliénor d'Aquitaine de 1137 à 1157, à Constance de Castille de 1154 à 1160, à Adèle de Champagne de 1160 à 1180. Ses enfants sont Marie de France, Alix de France
Marguerite de France, Adèle de France, Philippe II, Agnès de France, son héritier est Philippe de France. Il réside au Château de Fontainebleau, Château de Vincennes, Palais de la Cité
1137 Louis VII le Jeune succède à Louis VI le Gros à la tête du royaume de France et épouse Aliénor d'Aquitaine.
1146 Bernard de Clairvaux prêche la deuxième croisade.
1147 L'empereur germanique Conrad III et le roi de France Louis VII participent à la deuxième croisade.
1147-1149 Organisée pour reprendre Édesse, la deuxième croisade échoue devant Damas ; le roi de France Louis VII et l'empereur germanique
En bref
Fils de Louis VI et d'Adélaïde de Savoie, Louis VII le Jeune a épousé, juste avant son accession au trône, l'héritière d'Aquitaine, Aliénor. Il a alors seize ans. Il commence par écarter sa mère de la cour et gouverne avec l'excellent conseiller de son père, l'abbé de Saint-Denis, Suger. Résidant le plus souvent à Paris, il poursuit la politique paternelle de soumission et de mise en valeur du domaine royal : il multiplie les concessions de privilèges aux communautés rurales, encourage les défrichements et favorise l'émancipation des serfs ; il prend appui sur les villes en accordant des chartes de bourgeoisie Étampes, Bourges. Hors du domaine, il soutient le mouvement communal Reims, Sens, Compiègne, Auxerre et surtout il soutient l'élection d'évêques dévoués au pouvoir royal.
C'est autour d'affaires d'élections épiscopales qu'éclatent les premières crises du règne : en 1138, le roi accorde son investiture pour l'évêché de Langres à un moine de Cluny et non au candidat de Bernard de Clairvaux et, surtout, en 1141, il veut imposer au siège de Bourges son propre candidat contre Pierre de La Châtre, élu du chapitre de la cité, soutenu par le pape Innocent II qui excommunie Louis VII. Pierre de La Châtre s'étant réfugié en Champagne, le roi envahit le comté et brûle Vitry 1142. Mais il doit finalement accepter l'élection de Pierre de La Châtre pour faire lever l'interdit qui pèse sur le royaume. Il se croise peu après Noël 1145 pour répondre à l'appel de Bernard de Clairvaux et, confiant son royaume à Suger, il gagne Antioche, échoue devant Damas et rentre en France 1147-1149. C'est pendant cette expédition que serait née la brouille entre le roi et son épouse, qui devait aboutir à un divorce aux funestes conséquences pour le royaume.
Aliénor se remarie aussitôt avec Henri II Plantagenêt, comte d'Anjou et duc de Normandie, qui s'empare ainsi de l'Aquitaine, avant de devenir roi d'Angleterre en 1154. Dès lors, malgré une réconciliation passagère, les affrontements sont permanents. Ne pouvant affaiblir son adversaire, Louis VII soutient l'archevêque de Canterbury Thomas Beckett et les fils révoltés de Henri II, Henri et Richard 1173. Il faudra l'autorité du pape pour imposer à Henri II la conclusion du traité d'Ivry en 1177.
Outre l'appui des papes qu'il a soutenus contre l'empereur, Louis VII a trouvé contre le Plantagenêt l'alliance du comte de Flandre et du comte de Champagne, dont il épouse la fille, Adèle, mère de Philippe Auguste, en troisièmes noces 1160. Il meurt après quarante-trois ans de règne, ayant, comme ses prédécesseurs, associé son fils à la monarchie pour assurer la continuité dynastique. Michel Sot
Sa vie
Sixième souverain de la dynastie des Capétiens directs. Il épouse successivement Aliénor d'Aquitaine, Constance de Castille, et Adèle de Champagne. Son fils Philippe Auguste lui succéde
Il est sacré roi et couronné, à Reims, dès le 25 octobre 1131, par le pape Innocent II, après la mort accidentelle de son frère aîné Philippe de France 1116-1131 à ne pas confondre avec Philippe, son frère cadet du même prénom, à la suite d'une chute de cheval provoquée par un cochon errant, le 14 octobre 1131. Louis étant le second fils de Louis VI le gros, il n'était pas prédestiné à une carrière royale et son père lui réservait une carrière ecclésiastique, voire une carrière monastique comme son frère cadet Henri, d'où sa piété austère et rigoureuse. Son inexpérience et sa faible préparation à l'exercice du pouvoir expliquent probablement sa désastreuse politique malgré les réticences de Suger.
Après le décès de son père Louis VI le Gros, d'une dysenterie probablement consécutive à un excès de bonne chère, il est à nouveau couronné à Bourges, le 25 décembre 1137.
Avant de mourir, son père avait organisé son mariage avec Aliénor d'Aquitaine 1122-1204, fille de Guillaume X d'Aquitaine, duc d’Aquitaine et d’Aénor de Châtellerault. Le mariage eut lieu à Bordeaux, le 25 juillet 1137. Il est lui-même couronné duc d'Aquitaine, à Poitiers le 8 août 1137. Ce mariage fabuleux permit au domaine royal de presque tripler, car la jeune mariée apporte dans sa dot la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Limousin, l’Angoumois, la Saintonge et le Périgord, c’est-à-dire une partie du Midi et de l’Ouest de la France, l’équivalent de 19 départements actuels. Le caractère du roi, dévot, ascétique il aurait voulu être moine, naïf et maladroit, mou dans ses décisions, s’accorde mal avec le caractère d'Aliénor, fort et sensuel. Cependant les dix premières années semblent se passer sans réelle mésentente.
Louis VII écarte sa mère de la cour, mais garde les conseillers de son père dont l’abbé de Saint-Denis, Suger. Il poursuit également la politique de son père et continue de mettre en valeur le domaine royal ainsi que la rénovation et la transformation de la basilique Saint-Denis. Il fait de multiples concessions aux communautés rurales, encourage les défrichements et favorise l’émancipation des serfs. Il prend appui sur les villes en accordant des chartes de bourgeoisie Étampes, Bourges et en les encourageant hors de son domaine Reims, Sens, Compiègne, Auxerre. Il soutient enfin l’élection d’évêques dévoués au pouvoir royal.
En 1138, Louis VII s’oppose au comte Thibaud II de Champagne et au pape Innocent II au sujet de l’investiture pour l’évêché de Langres, pour lequel il avait imposé Guillaume de Sabran, un moine de Cluny au lieu d'un candidat de Bernard de Clairvaux5. Il s’oppose à nouveau au pape en tentant d’imposer son candidat au siège de Bourges en 1141 contre Pierre de La Châtre, soutenu par le pape Innocent II. Celui-ci finit par excommunier Louis VII et Pierre de La Châtre trouve refuge en Champagne. Innocent II lève ensuite cette excommunication. En décembre 1142, le roi envahit le comté et lors de son avancée incendie en janvier 1143 Vitry-en-Perthois et son église dans laquelle s’étaient réfugiés les habitants du village, qui y trouvèrent une mort affreuse.
En vue d'apaisement, il signe le traité de Vitry avec le comte Thibaud II à l’automne 1143, acceptant l’élection de Pierre de La Châtre pour faire lever l'interdit qui pèse sur le royaume. Le 22 avril 1144, il participe à la conférence de Saint-Denis pour régler définitivement le conflit entre le Saint-Siège et lui.
En conflit avec l'Église
Son règne débute par un grave conflit avec le Saint-Siège et avec le comte de Champagne, Thibaud IV. Le roi veut, en effet, imposer au siège archiépiscopal de Bourges un clerc de son entourage. Mais le chapitre de Bourges élit Pierre de La Châtre, à qui Louis VII refuse l'entrée de la ville 1141. Le pape Innocent II jette l'interdit sur les terres du roi, et Pierre se réfugie auprès du comte de Champagne. Le roi envahit la Champagne et brûle Vitry 1142. Il devra finalement l'évacuer et accepter la promotion de Pierre de La Châtre.
En 1147, Louis VII, laissant le gouvernement de son royaume à Suger, prend la tête de la deuxième croisade → les croisades, mais l'expédition échoue et le roi rentre en France en 1149.
La paix du roi
Dans l'administration de son domaine, il multiplie les communautés rurales sur le modèle de celle de Lorris en Gâtinais et s'efforce de se faire reconnaître comme le protecteur naturel du clergé. Il renforce son autorité, créant de nouvelles prévôtés, combattant la tendance à l'hérédité des offices royaux et achevant l'œuvre paternelle de soumission des seigneurs de l'Île-de-France.
Il intervient dans maintes affaires du royaume, particulièrement en Auvergne, en Bourgogne et en Languedoc, et fait peu à peu prévaloir l'idée d'une paix du roi ordonnance de 1155 redevenue plus efficace que la paix de Dieu et de l'Église.
De même, il entretient de bonnes relations avec le Saint-Siège et accueille Eugène III, puis Alexandre III, lorsqu'ils se réfugient en France. Il est, en outre, l'un des fermes soutiens du second contre Frédéric Barberousse.
La menace anglaise
La principale menace vient d'Henri II Plantagenêt, comte d'Anjou et duc de Normandie, qui, en 1152, met la main sur l'Aquitaine en épousant la duchesse Aliénor, que Louis VII vient de répudier pour Constance de Castille. En 1154, Henri II et devient roi d'Angleterre : dès lors, le conflit sera permanent entre les deux monarques.
Le Capétien ne réussit pas à affaiblir son adversaire, mais il parvient, en soutenant Thomas Becket, puis en apportant son aide aux fils révoltés de son rival, à ne pas subir de graves échecs. Il trouve même contre le Plantagenêt l'alliance du comte de Flandre, Philippe d'Alsace, et du comte de Champagne, Henri, dont il épouse, en troisièmes noces, la sœur Adèle. Son action avait assuré le triomphe de l'idée de suzeraineté royale.
Pour en savoir plus, voir l'article Capétiens.
La deuxième croisade
Pour sceller le règlement du conflit, il accepte de prendre part à la deuxième croisade prêchée par saint Bernard de Clairvaux, et aux environs de Noël 1145, Louis VII annonce sa décision de partir pour porter secours aux États chrétiens de Palestine, menacés par les Turcs qui viennent d’envahir le comté d'Édesse où de nombreux chrétiens sont massacrés. Le pape Eugène III approuve cette croisade et autorise le Roi de France à prélever le décime, c'est-à-dire d'imposer les biens ecclésiastiques, normalement exclus de tout impôt, pour financer son expédition. Vers Pâques 1146, le roi prend la croix en même temps que de nombreux barons lors de l’assemblée de Vézelay.
Le 11 juin 1147, le roi Louis VII et Aliénor partent pour la deuxième croisade, à la tête de 300 chevaliers et d’une nombreuse armée, suivie peu à peu par des dizaines de milliers de pèlerins. Se mettant en marche à partir de Metz, ville impériale, ils passent par la vallée du Danube, où ils sont rejoints par l’armée de l’empereur Conrad III et prévoient de passer en Asie Mineure par Constantinople, où ils arrivent le 4 octobre 1147.
L’expédition est marquée par la discorde entre les clans français et allemand, l’inexpérience de Louis VII qui se montre velléitaire, et le soutien douteux des Byzantins qui nuisent plus aux chrétiens qu’ils ne les aident. Trompé par ceux-ci, Louis VII est battu par les Turcs en Asie Mineure et connaît plusieurs revers en Syrie. Il rejoint à grand peine Antioche en mars 1148, alors aux mains de Raymond de Poitiers, oncle d’Aliénor, qui reçoit les Croisés avec beaucoup d’égards.
Raymond espère que Louis VII va l’aider à combattre l’ennemi qui l’avait dépouillé de certains de ses territoires, mais le roi ne pense qu’à aller à Jérusalem. Aliénor tente en vain de convaincre son mari d’aider son oncle Raymond de Poitiers. Le roi préfère prendre conseil auprès du Templier eunuque Thierry de Galeran. Après coup, les chroniqueurs de l’époque se déchaînent et accusent la reine d’adultère : Guillaume de Tyr l’accuse même d’un inceste avec son propre oncle.
Forçant Aliénor à le suivre, Louis VII quitte Antioche et gagne Jérusalem où il accomplit le pèlerinage qu’il s’était imposé. En juin 1148, il tente de prendre Damas, devant laquelle son armée est repoussée. Le couple royal séjourne encore une année en Terre sainte avant de revenir séparément vers la France, par mer. Le roi fait d'abord escale en Calabre où il débarque le 29 juillet 1149. Il séjourne dans le royaume de Sicile où il attend trois semaines l'arrivée de la reine venant de Palerme6. À Potenza et durant trois jours, Louis VII fut l'hôte du roi normand Roger II de Sicile. Sur le chemin du retour, il eut à Tivoli une entrevue avec le pape Eugène III 9-10 octobre 1149.
Le roi Louis VII part en croisade.
En définitive, la participation de Louis VII à cette deuxième croisade fut lourdement préjudiciable à l’avenir du royaume, car l’expédition se solda par un très lourd échec sur tous les plans. D'abord sur le plan financier, car cette expédition appauvrit considérablement le trésor royal ; sur le plan politique, car le roi ne s’est pas occupé directement du royaume pendant ses deux années d’absence, et par conséquent, a relâché son emprise sur les grands féodaux ; sur le plan militaire, car la croisade est une succession d’échecs militaires ; de plus, une partie de sa chevalerie et une grande armée ont été sacrifiées ; et sur les plans dynastiques, patrimoniaux, territoriaux et stratégiques car cette croisade provoque la rupture du roi avec Aliénor, lors de la séparation, Aliénor récupère les fiefs qu’elle avait apportés dans sa dot. Cette dernière va alors épouser le futur roi d’Angleterre, Henri Plantagenêt. Ce mariage apporte d’immenses territoires à la couronne d’Angleterre, permettant ainsi la présence sur le continent d’un redoutable concurrent au roi de France. Par ce mariage, le roi Henri II d'Angleterre règne sur un territoire qui s’étend de l’Écosse aux Pyrénées, comprenant l’Angleterre, l’Anjou, le Maine, la Normandie, l’Aquitaine et la Bretagne. Les successeurs de Louis batailleront sans relâche contre l'Angleterre pendant à peu près cent ans pour finalement récupérer une bonne partie des territoires perdus par Louis VII et faire la paix avec l'Angleterre pour un bon moment en 1259 lors du traité de Paris.
La séparation d'avec Aliénor
Dès le voyage de retour en France, en novembre 1149, Louis VII pense à se séparer d’Aliénor. Mais le pape Eugène III, lors d’un arrêt au Mont-Cassin, puis l’abbé Suger réussissent à les réconcilier, et en 1151, Alix de France 1150-1195, seconde fille du couple royal, vient au monde.
Cependant, après le décès de Suger, en 1151, le roi désirant toujours la séparation, le Second concile de Beaugency trouve finalement une faille, au motif que l’arrière-grand-mère d’Aliénor, Audéarde de Bourgogne, était la petite-fille de Robert le Pieux, arrière-arrière-grand-père de Louis VI cousinage au 9e degré civil, mais au 5e degré canonique, et de ce fait prononce l’annulation du mariage le 21 mars 1152. Aliénor reprend sa dot, et le 18 mai 1152, elle épouse en secondes noces le comte d’Anjou Henri II Plantagenêt, qui devient roi d’Angleterre en 1154. Il a 19 ans et elle, 30 ans.
Cette faute politique s'ajoute en tant qu'élément déclencheur dans la rivalité entre les rois de France et les rois d’Angleterre, qui a débuté sous le règne de Henri Ier de France, pour se terminer au milieu du xiiie siècle. Beaucoup d'historiens médiévistes considèrent que cette séparation est à l'origine d'une Première Guerre de Cent-Ans.
L'ascension des Plantagenêts
Geoffroy d'Anjou est alors un des principaux vassaux du Roi de France. Fin stratège, il se marie avec Mathilde, petite-fille de Guillaume le Conquérant ce qui lui permet, en plus de l'Anjou, de revendiquer la Normandie mais aussi le trône d'Angleterre si jamais Étienne venait à mourir sans descendance. Geoffroy, qui conquiert progressivement la Normandie, meurt finalement en 1151, laissant derrière lui trois fils. L'aîné, Henri, a l'intelligence de se marier avec Aliénor d'Aquitaine à la suite de son divorce avec le Roi de France, en 1152. Henri possède alors un domaine plus grand que celui du Roi de France, domaine qui s'agrandit avec la mort d'Étienne, qui le désigne comme son successeur à la couronne d'Angleterre en 1153 avec le traité de Wallingford. Henri est finalement couronné Roi d'Angleterre en 1154.
Louis VII va alors tout faire pour affaiblir son puissant vassal. Reprenant une stratégie qui avait fait merveille lors du règne de son grand-père Philippe Ier, il soutient les révoltes de Bretagne et du Poitou contre l’Angleterre, et celle des fils d’Henri II contre leur père. Il est aidé en cela :
par les manœuvres d’Henri II Plantagenêt qui pousse à la révolte ses grands vassaux,
par le soutien du clergé au roi de France, en raison de la piété de Louis VII et des liens historiques étroits entre l’épiscopat et la royauté capétienne,
et par la révolte des fils d’Henri II qui exigent des apanages et trouvent refuge et protection auprès de Louis VII, et qui sont appuyés par leur mère, Aliénor d'Aquitaine.
Principaux évènements de son règne
En 1158, Louis VII et Henri II Plantagenêt se réconcilient et se font la promesse d’un mariage entre Marguerite de France et Henri le Jeune. Apaisement de courte durée, dès mars 1159, Henri II s’en prend au comté de Toulouse, et durant l’été, Louis VII contraint le roi d’Angleterre à lever le siège de la ville de Toulouse. Lors de l'année 1163, Henri II rend hommage à Louis VII pour la Normandie au nom de son fils Henri le Jeune. Louis VII fait alliance avec les comtes de Flandre et de Champagne tandis que l'on pose la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est le pape Alexandre III qui a cet honneur. Louis VII offre la somme de deux cents livres pour la construction dirigée par Maurice de Sully, évêque de Paris.
Il y a un affrontement entre Henri II Plantagenêt et Thomas Becket l’archevêque de Cantorbéry, soutenu par Louis VII. Finalement quatre chevaliers fidèles d’Henri II tuent l’archevêque.
Louis VII fait, entre temps, bâtir les fortifications de Villa franca devenue Villa nova regis Villeneuve-sur-Yonne qui devait servir de bastion avancé à plusieurs provinces, et devint une des huit résidences royales, à qui il donne les privilèges de Lorris pour qu'elle s'accroisse rapidement.
Le 21 août 1165, naît Philippe Auguste, unique héritier mâle de Louis VII. Le 30 septembre 1174, le traité de mariage d’Adèle avec Richard Cœur de Lion est signé.
En 1172 et 1173, Louis VII pousse Henri et Richard, les enfants d’Henri II Plantagenêt, à entrer en conflit avec leur père. Fin 1173, Louis VII et Henri II concluent à Caen une trêve provisoire et réaffirment vers le printemps 1174 l’intention de marier leurs enfants Adèle et Richard.
En 1177, le pape impose à Henri II la conclusion du traité d'Ivry, signé le 21 septembre, et par lequel les deux rois se jurent amitié ; traité suivi, le 22 juin 1180, par la signature d’un pacte de non-agression. Le traité de Gisors du 28 juin 1180 marqua la fin de cette série de guerres continuelles entre la France et l’Angleterre.
Le 1er novembre 1179, il fit sacrer son fils Philippe Auguste, et épuisé par la maladie, il lui abandonna le pouvoir l’année d’après.
En 1180 se conclut le mariage d’Agnès et d’Alexis II Comnène. Louis VII meurt finalement le 18 septembre 1180, d'une cachexie paralytique dans son palais royal de la Cité à Paris. Le lendemain, il est inhumé à l’abbaye royale Saint-Port de Barbeau qu’il a fondée près de Fontaine-le-Port, en bord de Seine entre Melun et Fontainebleau. Son fils Philippe Auguste lui succède. Ce dernier exerçait en fait le pouvoir depuis le 28 juin 1180, jour où son père lui abandonna le pouvoir.
À la suite de l'abandon de l'abbaye de Barbeau, Louis XVIII fait transporter le 30 juin 1817, les cendres de Louis VII à la basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France.
Bilan du règne
Bien qu’éduqué pour être clerc ou moine plutôt que roi, Louis VII a joué un rôle important dans l’histoire de France :
Il consolide le pouvoir royal dans les provinces qui étaient sous son influence et combat le pouvoir féodal.
Il s’entoure de conseillers de grande qualité et promulgue des ordonnances importantes pour la gestion du royaume comme celle de paix de 1155 :
« Moi, Louis, par la grâce de Dieu roi de France. Afin de réprimer la fièvre des méchants et d'arrêter les mains violentes des pillards, à la demande du clergé et avec l'accord du baronnage, nous décrétons la paix dans tout le royaume. Pour cette raison, l'année du Verbe incarné 1155, le 4 des ides de juin, nous avons réuni un concile à Soissons. Y furent présents les archevêques de Reims et de Sens ainsi que leurs suffragants, tout comme les barons, les comtes de Flandre, de Troyes et de Nevers, et d'autres très nombreux, et le duc de Bourgogne. Par leur volonté, nous prescrivons qu'à partir de la prochaine fête de Pâques, et pour dix ans, toutes les églises du royaume et l'ensemble de leurs possessions, tous les paysans, le gros et le petit bétail également, et, pour ce qui est de la sécurité des chemins, tous les marchands où qu'ils se trouvent et tous les hommes quels qu'ils soient — tant qu'ils seront prêts à venir en justice devant ceux qui doivent leur rendre justice —, aient absolument tous la paix et pleine sécurité. Nous avons dit en plein concile et devant tous, par le verbe royal, que nous observerions cette paix sans la briser et que, s'il s'en trouvait pour violer la paix prescrite, nous ferions justice d'eux selon notre pouvoir. Ont juré cette paix le duc de Bourgogne, le comte de Flandre, le comte Henri de Troyes, le comte de Nevers, le comte de Soissons et le reste du baronnage présent. Le clergé également, les archevêques et les évêques, les abbés ont promis, devant les reliques sacrées et au vu de tout le concile, d'observer cette paix, de leur côté, de toutes leurs forces ; et pour que justice soit faire des violences, ils ont promis de nous aider selon leur pouvoir et ils ont proclamé dans la stabilité de la parole consacrée. Pour que la chose soit entendue plus largement et qu'on n'en perde pas le souvenir, j'ai confié à la mémoire des lettres la stipulation de la chose faire et la teneur de la paix, et nous avons ordonné de les fortifier de l'autorité de notre sceau.
Le royaume de France s’enrichit sous son règne, l’agriculture se transforme et gagne en productivité, la population augmente, le commerce et l’industrie se développent, une véritable renaissance intellectuelle apparaît, et le territoire se couvre de châteaux forts construits en pierre.
Cependant, la deuxième croisade fut calamiteuse, et la séparation d’avec Aliénor d’Aquitaine est une erreur lourde, qui fournit à un vassal mineur le moyen de s’imposer, en plaçant le roi de France en infériorité territoriale pendant près d’un demi-siècle. Il fallut l’action de trois grands rois, Philippe Auguste, Louis VIII le Lion et Louis IX, pour redresser la situation et arriver à réduire les conséquences de cette lourde décision.
La monarchie, jusque-là itinérante, s’est fixée à Paris car la présence du roi dans tout son domaine n’est plus nécessaire. Un embryon d’administration centrale et locale s’est formé. Autour de lui, des familiers lui ont donné des conseils politiques, et vont former le Conseil du roi, les services centraux de la monarchie regroupent les chefs des services domestiques du palais. En province, des prévôts ont été chargés par le roi de collecter les revenus, de lever des contingents militaires et de rendre la justice. Comme son père, le roi va soutenir le mouvement d’émancipation des communes, va accorder des privilèges aux communautés rurales et émanciper des serfs.
Unions et descendance
Avec Aliénor d'Aquitaine :
Marie de France 1145 - 11 mars 1198, épouse en 1164 Henri Ier de Champagne, comte de Troyes, dit Le Libéral. Régente du Comté de Champagne de 1190 à 1197.
Alix de France, 1150 - 1195, elle épouse Thibaut V de Blois dit Le Bon 1129 - 1191, comte de Blois 1152 - 1191.
Avec Constance de Castille, v.1138 - 1160 fille de Alphonse VII de Castille.
Marguerite de France 1158 - 1197, épouse en 1172 le prince d’Angleterre Henri, duc de Normandie mort en 1183, et en 1185/1186, le roi de Hongrie Bela III.
Adèle de France 1160-1221 ou Alix, comtesse de Vexin 1160 - 1218 ou 1221, épouse en 1195, Guillaume III de Ponthieu ou de Montgomery.
Avec Adèle de Champagne ou Adèle de Blois :
Philippe Auguste 1165 - 1223, roi de France.
Agnès ou Anne de France 1171 - 1240, impératrice byzantine par son mariage avec Alexis II Comnène en 1180, empereur de Constantinople 1169-1183. Puis par un autre mariage en 1183 avec Andronic Ier Comnène, empereur de Constantinople 1183-1185. Vers 1204 elle épouse Théodore Branas, seigneur d’Andrinople.
D'une maîtresse au nom resté inconnu, il est le père de Philippe de France mort en 1161.
Cinéma
1964 : Becket
      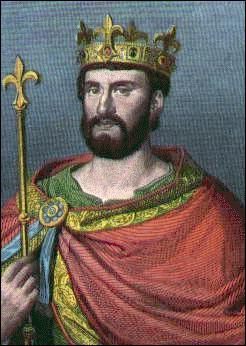    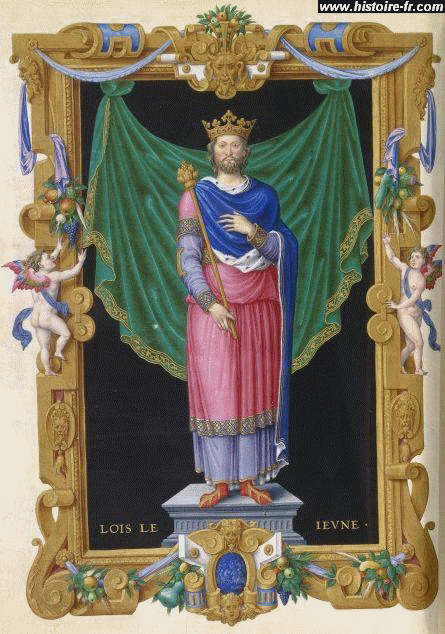 
Posté le : 23/10/2015 17:37
|
|
|
|
|
Marguerite Tudor |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 18 octobre 1541 meurt Marguerite Tudor
à 51 ans au château de Methven, Perthshire, née le 28 novembre 1489 au palais de Westminster à Londres, était l'aînée des deux filles survivantes de Henri VII d'Angleterre et d'Élisabeth d'York, et la sœur aînée de Henri VIII. En 1503, elle fut mariée en première noce à Jacques IV, roi d'Écosse, ce qui devait faire d'elle la mère de Jacques V et la grand-mère de Marie Stuart. Et surtout, ce mariage fut indirectement à l'origine de l'Union des deux royaumes. C'est le destin, a-t-on dit, qui avait prédestiné Marguerite à devenir reine d'Écosse, puisque née le 29 novembre 1489, elle fut baptisée le 30, jour de saint André, le patron de l'Écosse — dans l'église de Sainte-Marguerite à Westminster, dédiée au seul personnage royal d'Écosse à avoir été canonisé. En tout Marguerite devait être mariée trois fois et on pourrait tracer un parallèle entre son histoire et celle de sa petite-fille, Marie Stuart, avec leur mélange haut en couleur de tragédie, d'intrigue, de duplicité… et de simple comédie. Reine consort d'Écosse du 24 janvier 1502 au 9 septembre 1513 soit 11 ans 7 mois et 16 jours, son prédécesseur est Marguerite de Danemark, son Successeur Madeleine de France. Elle appartient à la dynastie de la Maison Tudor. elle fut mariée à Archibald Douglas, puis de Henry Stewart, Lord Methven. Ses enfants sont James, duc de Rothesay, Arthur, duc de Rothesay, Jacques V d'Écosse, Alexander Stewart, duc de Ross et Margaret Douglas
En bref
Marguerite Tudor, reine d'Écosse 1503-1541, née le 29 novembre 1489, morte le 18 octobre 1541. Fille aînée de Henri VII et d'Élisabeth d'York, elle épousa en 1503 Jacques IV, roi d'Écosse, se remaria après sa mort avec Archibald Douglas, comte d'Angus 1514, divorça en 1527 pour épouser Henri Stewart Stuart, lord de Methyen. Du premier mariage naquit Jacques V. C'est d'elle que les Stuarts d'Ecosse tinrent leurs droits à la couronne d'Angleterre
Margaret était la soeur ainée d'Henry VIII et elle a passé la majeure partie de sa vie embrouillée dans les rapports politiques compliqués entre l'Angleterre et l'Ecosse. Elle était mariée à James IV d'Ecosse, qui est mort à la bataille de Flodden, sur quoi elle est devenue régente car son fils, James V devenu plus tard le père de Mary Stuart, reine d'Ecosse, était encore enfant. Cependant, quand elle s'est embarquée dans son deuxième mariage, à Archibald Douglas, 6ème comte d'Angus, la régence lui a été retirée et elle s'est enfuite en Angleterre. Dans quelques années elle s'est éloignée de son mari et elle a divorcée. Peu après elle s'est mariée avec Henry Stuart devenu plus tard Lord Methven. Elle a essayé d'organiser une réunion entre son fils James V et son frère Henry VIII mais ceci n'a fait que mener James à l'accuser de trahison ; il a également refusé de la laisser divorcer de Methven. Elle est morte d'une attaque en 1541
Marguerite Tudor, reine d'Écosse 1503-1541, née le 29 novembre 1489, morte le 18 octobre 1541. Fille aînée de Henri VII et d'Élisabeth d'York, elle épousa en 1503 Jacques IV, roi d'Écosse, se remaria après sa mort avec Archibald Douglas, comte d'Angus 1514, divorça en 1527 pour épouser Henri Stewart Stuart, lord de Methyen. Du premier mariage naquit Jacques V. C'est d'elle que les Stuarts d'Ecosse tinrent leurs droits à la couronne d'Angleterre
Sa vie
Le Chardon et la Rose
Pour les rois, les filles peuvent avoir été moins désirées que les garçons ; elles n'en étaient pas moins des éléments politiques importants dans un monde où diplomatie et mariages étaient souvent étroitement liés. Avant même qu'elle eût six ans, Henri VII avait eu l'idée d'un mariage entre elle et Jacques IV d'Écosse, pour empêcher ce dernier de soutenir Perkin Warbeck, prétendant yorkiste au trône d'Angleterre. Sans être tout de suite acceptée, la proposition une fois faite ne fut pas retirée. En septembre 1497, Jacques conclut avec Henri une très longue trêve et le mariage fut une fois encore envisagé comme une possibilité sérieuse. On assure que certains, au conseil royal d'Angleterre, soulevèrent des objections à cette union, en représentant qu'il placerait les Stuarts dans la ligne directe de succession, mais Henri, fin renard, leur répondit qu'en pareil cas le royaume n'en souffrirait aucun dommage, car ce ne serait pas l'Écosse qui s'agrandirait de l'Angleterre, mais l'Angleterre qui s'agrandirait de l'Écosse.
Le 24 janvier 1502, l'Écosse et l'Angleterre conclurent le Traité de Paix perpétuelle, le premier accord de ce genre entre les deux royaumes depuis plus de 170 ans. Le même jour, un traité de mariage fut aussi conclu : c'était le signe le plus manifeste de la nouvelle paix et sa garantie. Le mariage ayant été totalement réalisé par procuration, Marguerite fut désormais considérée comme la reine d'Écosse ; certains historiens rapportent que son frère Henri, qui était alors un enfant et encore simple duc d'York, entra dans une crise de rage, quand il se rendit compte qu'à la cour sa sœur avait maintenant préséance sur lui.
En 1503, Marguerite arriva enfin en Écosse après un grand voyage dans le nord. Dans la ville d'York, il existe encore aujourd'hui une plaque qui rappelle l'endroit précis où la reine d'Écosse en a passé les portes. Dès son arrivée Marguerite éprouva un grand choc, quand un feu d'écurie tua quelques-uns de ses chevaux préférés, et c'est son nouvel époux qui vint la consoler. Elle et Jacques furent mariés le 8 août 1503 à l'abbaye d'Holyrood à Édimbourg, union célébrée par le poète William Dunbar dans Le Chardon et la Rose :
Douce dame au visage charmant,
Fille chère d'un roi très puissant,
Et d'une princesse sereine,
Bienvenue ici, notre Reine...
La reine régente
Le traité de 1502, loin d'être perpétuel, survécut à peine à la mort d'Henri VII en 1509. Son successeur, Henri VIII d'Angleterre, jeune et agressif, avait peu de goût pour la diplomatie prudente de son père, et il prépara bientôt une guerre contre la France, la vieille alliée de l'Écosse. En 1513 Jacques IV envahit l'Angleterre pour honorer son engagement de la Auld Alliance, mais ce ne fut que pour trouver la défaite et la mort à la Bataille de Flodden Field le 9 septembre. Marguerite, enceinte à la mort de son mari, donna naissance à Alexandre, quatrième enfant du couple, en avril 1514. Elle s'était opposée à cette guerre, mais le testament royal la nommait régente pour son fils, Jacques, encore tout jeune, aussi longtemps qu'elle resterait veuve.
Le Parlement se réunit à Stirling peu après Flodden, et confirma Marguerite en tant que régente. Il était rare qu'une femme fût bien acceptée dans une position de pouvoir suprême, et Marguerite était la sœur d'un roi ennemi, ce qui ne pouvait qu'aggraver ses problèmes. En très peu de temps, un parti pro-français prit forme au sein de la noblesse, pressant qu'on remplaçât la reine par John Stewart, 2e duc d'Albany, le plus proche parent mâle des petits princes et maintenant le troisième dans la ligne de succession au trône. Albany, qui était né en France et y avait été élevé, était le représentant vivant de la Auld Alliance, en contraste avec Marguerite pro-anglaise.
La pauvre Marguerite se trouvait dans une situation presque impossible avec une opposition à la régence qui ne cessait de grandir au sein du conseil royal lui-même. Elle sut agir cependant avec calme et non sans adresse politique. Pour juillet 1514, elle avait réussi à réconcilier les partis opposés, et l'Écosse — en même temps que la France — conclut la paix avec l'Angleterre ce même mois. Cependant, dans sa recherche d'alliés politiques parmi la noblesse écossaise frondeuse, elle commit une erreur fatale, en soumettant sa raison et sa prudence à la passion et à la séduction
En recherchant des appuis, Marguerite se tourna de plus en plus vers la puissante famille des Douglas, et elle se sentit particulièrement attirée par Archibald Douglas, 6e comte d'Angus, que même son oncle Gavin Douglas, ecclésiastique et poète, appelait un « jeune imbécile sans cervelle ». Sans mesurer les conséquences d'une pareille union, Marguerite et Douglas se marièrent secrètement le 6 août dans l'église paroissiale de Kinnoull, près de Perth. Non seulement cela mécontenta les autres familles nobles, mais la fraction minoritaire pro-française au conseil en fut immédiatement renforcée ; on trouvait à sa tête James Beaton, l'archevêque de Glasgow. Selon les dispositions établies par le feu roi, s'étant remariée, elle avait renoncé à sa régence. Avant que le mois fût écoulé, elle fut obligée de céder la place à Albany. En septembre, le Conseil privé décida qu'elle avait perdu également ses droits sur l'éducation de ses fils ; sur quoi, se méfiant, elle et ses alliés emmenèrent les princes au Château de Stirling.
Albany arriva en Écosse en mai 1515 et fut finalement installé comme régent en juillet. Sa première tâche fut de recevoir la garde de Jacques et d'Alexandre, ce qui était politiquement essentiel pour l'autorité de la régence. Marguerite, après avoir d'abord résisté, se soumit à Stirling en août. Avec les princes entre les mains de leur oncle, la reine douairière, à présent enceinte d'Angus, se retira à Édimbourg. Pendant quelque temps, son frère lui avait conseillé de fuir en Angleterre avec ses fils; mais elle avait toujours refusé de le faire, craignant qu'un tel geste pût coûter son trône à Jacques.
Ne présentant plus d'intérêt dans cette affaire, elle obtint la permission d'aller à Linlithgow, d'où elle s'enfuit en passant la frontière. Elle fut reçue par Lord Dacre, à qui Henri avait confié les marches et emmenée au Château de Harbottle où, au début d'octobre, elle donna naissance à Marguerite Douglas, future comtesse de Lennox et mère de Henry Stuart Lord Darnley, qui devait être le deuxième époux de Marie Stuart. Alors qu'elle était toujours dans le nord de l'Angleterre, elle apprit la mort d'Alexandre. Dacre lui fit comprendre qu'Albany — nouveau Richard III — en était responsable. Mais Marguerite, malgré sa pauvre situation, refusa d'accepter une telle idée, disant que, si le régent avait vraiment souhaité s'attribuer le trône, la mort de Jacques lui aurait mieux convenu. C'est aussi à cette époque qu'elle commença enfin à se rendre compte de ce qu'Angus valait vraiment, puisque ce dernier, ne considérant que ses propres intérêts, était revenu en Écosse pour faire la paix avec le régent, ce qui donna à Marguerite beaucoup à réfléchir. Quand Henri apprit qu'Angus n'accompagnerait pas sa sœur à Londres, il déclara : Il a agi comme un Écossais. Il ne faudrait pas, cependant, juger trop durement Angus. C'est que tout son pouvoir, toute sa richesse et toute son influence étaient en Écosse ; abandonner le pays pouvait lui valoir une déchéance pour trahison. À cet égard il avait bien connu l'exemple d'un parent, James Douglas, 9e comte de Douglas, qui avait fui en Angleterre au siècle précédent, et qui avait été toute sa vie un mercenaire déshérité.
Mariage et politique
Marguerite fut bien reçue par Henri et, pour confirmer son statut, fut logée à Scotland Yard, l'ancien palais des rois d'Écosse. En 1517, après une année passée en Angleterre, elle retourna dans le Nord, après qu'un traité de réconciliation eut été négocié entre Albany, Henri et le cardinal Wolsey. Provisoirement Albany était absent en France — où une nouvelle fois il renouvelait la Auld Alliance et prenait des dispositions pour le futur mariage de Jacques V — mais la reine douairière fut reçue à la frontière par son représentant, le Sieur de la Bastie, en même temps que par son mari. La paix pouvait bien être arrivée, il était cependant parfaitement clair qu'on se méfiait toujours de Marguerite et qu'on ne la laissait approcher son fils que de façon très limitée.
Bien que Marguerite et Angus se fussent provisoirement réconciliés, il fallut peu de temps pour que leurs rapports commençassent à se détériorer définitivement. Elle découvrit que, pendant qu'elle était en Angleterre, son mari avait vécu avec Lady Jane Stewart, une ancienne maîtresse, ce qui était déjà mauvais, mais pire encore qu'il avait vécu avec l'argent de sa femme. En octobre 1518 elle écrivit à son frère, en faisant des allusions à un divorce;
Je suis douloureusement troublée au sujet de Lord d'Angus depuis mon dernier retour en Écosse, et chaque jour de plus en plus, si bien que nous ne nous sommes pas trouvés ensemble cette moitié de l'année … j'en suis au point, si la loi de Dieu et mon honneur m'y autorisent, de me séparer de lui, car je comprends bien qu'il ne m'aime pas, comme il me le montre tous les jours.
C'était un problème difficile pour Henri ; de conviction conservatrice et orthodoxe, il s'opposait au divorce par principe — ce qui laisse rêveur, si l'on considère ce qu'il devait faire par la suite. Tout aussi important était le fait qu'Angus était un allié utile, un contrepoids efficace contre Albany et la faction pro-française. Outrée par son attitude, Marguerite se rapprocha du parti d'Albany et se joignit à d'autres pour l'appeler à revenir de France. Albany, nullement pressé apparemment de revenir dans ce turbulent royaume du Nord, suggéra qu'elle reprît elle-même la régence. La querelle entre les époux devait dominer la politique écossaise pendant les trois années suivantes, compliquée encore par une violente rivalité entre Angus et James Hamilton, 1er comte d'Arran ; avec une rapidité surprenante, Marguerite passa du camp de l'un à celui de l'autre.
Albany revint finalement en Écosse en novembre 1521 et fut chaleureusement reçu par Marguerite. On chuchota bientôt que leurs relations cordiales dépassaient le domaine politique. Angus partit pour l'exil, tandis que le Régent — avec l'appui total de la reine douairière — s'attachait à remettre en ordre un pays déchiré par trois ans de conflits entre factions. Albany était utile pour Marguerite : on savait qu'il avait de l'influence à Rome, ce qui aiderait à faciliter sa demande de divorce. Angus et ses partisans faisaient courir la rumeur que tous les deux étaient amants, au point que même Lord Dacre, qui avait l'esprit rassis, écrivit à Wolsey, en prédisant que Jacques serait assassiné et qu'Albany deviendrait roi et se marierait avec Marguerite. Mais leurs rapports ne dépassèrent pas le simple calcul d'intérêt personnel, comme les événements devaient bientôt le prouver.
Le coup d'État de Marguerite
Au fond d'elle-même Marguerite restait une Anglaise dans son attitude et dans sa façon de voir, et ce qu'elle désirait le plus sincèrement, c'était une meilleure entente entre son pays natal et sa dynastie d'adoption. Mais elle comprit vite combien la politique écossaise pouvait être périlleuse et que survivre dépendait de la capacité à maintenir un équilibre entre les intérêts opposés. La situation pressante exigeait une alliance avec Albany et la faction pro-française, surtout après les désastreuses guerres frontalières avec l'Angleterre au début des années 1520. Mais Albany ne se fut pas plus tôt éloigné qu'elle entreprit de se créer un parti qui lui serait propre. En 1524 le Régent fut finalement écarté du pouvoir grâce à un coup d'État simple mais efficace. Comme il se trouvait une nouvelle fois en France, Marguerite, avec l'aide d'Arran et des Hamilton, ramena Jacques, âgé maintenant de douze ans, de Stirling à Édimbourg. C'était un geste audacieux mais bien vu du peuple. En août le Parlement mit fin à la régence, et confia à Jacques tous les pouvoirs d'un roi. En pratique, il continua à être gouverné par d'autres, surtout par sa mère. Quand Beaton s'opposa à ces nouvelles dispositions, Marguerite le fit arrêter et jeter en prison. En novembre, le Parlement reconnut officiellement Marguerite comme principale conseillère du roi.
L'alliance de Marguerite avec Arran ne pouvait que lui aliéner les autres familles nobles. Sa situation ne s'améliora pas quand son frère permit à Angus de revenir en Écosse. Ces deux facteurs jusqu'à un certain point lui échappaient. Mais ce n'était pas là le plus dangereux pour elle. Elle s'attacha une nouvelle fois, cette fois à Henry Stewart, frère cadet de Lord Avondale. Stewart fut nommé au conseil supérieur, ce qui déchaîna, entre autres, la colère du comte de Lennox, qui conclut rapidement une alliance avec son mari dont elle était séparée. Ce même mois de novembre où le Parlement avait confirmé le rôle politique de Marguerite, sa guerre avec Angus tourna à la farce meurtrière. Quand il arriva à Édimbourg à la tête d'un grand nombre d'hommes en armes, réclamant son droit d'assister au Parlement, elle ordonna aux canons de tirer sur lui, aussi bien depuis le Château d'Édimbourg que du Palais de Holyrood. Quand les deux ambassadeurs anglais présents à la cour lui objectèrent qu'elle ne devait pas attaquer son légitime époux, elle leur répondit avec colère de rentrer chez eux et de ne pas se mêler des affaires d'Écosse. Angus se retira pour le moment, mais, sous des pressions venant de différents côtés, la Reine finit par l'admettre au conseil de régence en février 1525. C'était tout ce dont il avait besoin. S'étant emparé de la garde de Jacques, il refusa de renoncer à lui, et exerça sous son nom le pouvoir suprême pendant une période de trois ans. L'expérience que Jacques retira de ce moment-là fut une haine définitive tant de la maison de Douglas que du parti pro-anglais.
Divorce, mariage et mort
Marguerite tenta de résister, mais fut forcée de se plier aux nouvelles réalités politiques. En outre, à ce moment-là, son envie de divorcer avait tourné à l'obsession, passant avant toutes les autres affaires. Elle était disposée à se servir de tous les arguments, y compris le mythe largement répandu que Jacques IV n'avait pas été tué à Flodden. Malgré son coup d'État de 1524, elle correspondait chaleureusement avec Albany, qui poursuivait pour elle ses efforts à Rome. En mars 1527, le pape Clément VII fit droit à sa requête. En raison de la situation politique en Europe à cette époque, ce ne fut pas avant décembre qu'elle apprit la bonne nouvelle. Sans perdre un moment, elle épousa Henry Stuart, passant outre aux pieux avertissements de son frère, lui disant que le mariage était d'institution divine, et à ses protestations contre la honteuse décision venue de Rome. À peine quelques années plus tard, Henri rompait les relations avec Rome précisément parce qu'il n'avait pas pu recevoir pour lui la même honteuse décision.
En juin 1528, Jacques finit par se libérer de la tutelle d'Angus — une fois de plus contraint à fuir en exil — et commença à régner lui-même. Marguerite fut une des premières bénéficiaires du coup d'État royal, elle et son mari devenant maintenant les principaux conseillers du roi. Jacques créa Stuart Lord Methven en raison du grand amour qu'il portait à la plus chère des mères. On a prétendu — faussement — que la Reine aurait souhaité un mariage entre son fils et sa nièce, la princesse Marie, mais elle contribua à l'accord de paix anglo-écossais de mai 1534.
Le but central de la vie politique de Marguerite — outre d'assurer sa propre survie — était d'amener une meilleure entente entre l'Angleterre et l'Écosse, objectif qu'elle a maintenu à travers des époques difficiles. Jacques se méfiait de Henri, surtout parce que ce dernier continuait à soutenir Angus, un homme que lui-même détestait passionnément. Malgré tout, au début de 1536, sa mère le persuada de rencontrer son oncle. Ce fut son moment de triomphe, et elle écrivit à Henri et à Thomas Cromwell, à présent le conseiller le plus écouté de ce dernier, en disant que c'était grâce à notre conseil et à personne d'autre au monde. Elle espérait une grande manifestation dans le style du Camp du Drap d'Or et dépensa une somme énorme pour la préparer. Finalement cela n'aboutit à rien parce trop de voix s'étaient élevées contre et parce que Jacques ne voulait pas être dirigé par sa mère ni par personne d'autre. Dans un entretien privé avec l'ambassadeur d'Angleterre, elle laissa voir sa déception — Je suis lasse de l'Écosse, avoua-t-elle. Sa lassitude allait jusqu'à lui faire trahir des secrets d'État au profit de Henri.
Elle était peut-être lasse de l'Écosse : à présent elle l'était encore plus de Lord Methven, qui se montrait encore pire qu'Angus dans son désir de courir les femmes tout en profitant de l'argent de son épouse. Elle aurait voulu une nouvelle fois divorcer, mais cette fois-ci elle se heurta à l'opposition de Jacques, qu'elle crut soudoyé par son mari. Une nouvelle fois, comme ce fut si souvent le cas dans la vie de Marguerite, la tragédie et le malheur alternaient avec l'intrigue et la farce. À un moment elle s'enfuit vers la frontière, mais ce ne fut que pour être rattrapée et reconduite à Édimbourg. À plusieurs reprises, elle écrivit à Henri pour se plaindre de sa pauvreté et lui demander argent et protection — elle souhaitait l'aisance et le confort plutôt que d'être obligée « de suivre son fils partout comme une dame d'honneur sans le sou .
En juin 1538 Marguerite accueillit en Écosse Marie de Guise, la jeune épouse française de Jacques. Les deux femmes, parmi les plus importantes de l'histoire de l'Écosse, s'entendirent bien, même si Marguerite, d'une vanité maladive, se voyait soumise à l'humiliation de n'être plus considérée que comme la Vieille Reine. Marie s'assura que sa belle-mère, réconciliée maintenant avec Methven, faisait des apparitions régulières à la cour, et on rapporta à Henri que la jeune reine était toute papiste et la vieille reine guère moins.
Marguerite mourut d'une attaque au château de Methven, dans le Perthshiren, le 18 octobre 1541 et fut enterrée au Prieuré des Chartreux de Saint-Jean à Perth démoli en 1559 au moment de la Réforme. La dynastie de son frère se termina avec Élisabeth Ire, morte sans enfants, et le trône d'Angleterre revint aux héritiers de Marguerite. Son arrière-petit-fils, Jacques VI d'Écosse, devint Jacques Ier d'Angleterre, unissant ainsi les couronnes des deux pays, et conférant à Marguerite une sorte de triomphe posthume.
Mariage et enfants
Elle épouse en 1503 Jacques IV d'Écosse dont :
Jacques, duc de Rothesay 21 février 1507, au Palais de Holyrood - le 27 février 1508, au Château de Stirling.
Une fille mort-née 15 juillet 1508, au Palais de Holyrood.
Arthur, duc de Rothesay 20 octobre 1509, au Palais de Holyrood - 14 juillet 1510, au Château d'Édimbourg.
Le roi Jacques V 10 avril 1512, au Palais de Linlithgow - 14 décembre 1542, au Palais de Falkland.
Une fille mort-née novembre 1512, au Palais de Holyrood.
Alexandre Stewart, duc de Ross 30 avril 1514, au Château de Stirling - 18 décembre 1515, au Château de Stirling.
elle épouse en 1514 Archibald Douglas dont :
Margaret Douglas 1515-1577, épouse Matthew Stewart 4e comte de Lennox, régent d'Écosse de 1570 à 1571.
elle épouse en 1528 Henry Stewart dont
Marguerite dans l'histoire
Marguerite perpétuait l'énergie des Tudor, elle partageait avec son frère l'aptitude à rebondir et l'obstination. Mais finalement elle est passée à côté de la vraie grandeur. Sa vanité et son inconstance l'emportaient souvent sur le bon sens et, lorsque ses propres intérêts étaient en jeu, elle était parfaitement capable de trahir tour à tour son pays d'adoption, son fils et son frère, et sans guère de problèmes de conscience. Elle étalait de façon indécente ses querelles privées sur la place publique et l'histoire de ses mariages oscilla entre le tragique et le pathétique. Malgré tout, pour une femme à cette époque, qu'elle soit arrivée à se débrouiller dans le labyrinthe dangereux de la politique écossaise et à rester au pouvoir pendant une grande partie de sa carrière, voilà qui force dans une certaine mesure l'admiration et le respect. Contre toute attente, Marguerite est restée au pouvoir, sous une forme ou sous une autre, pendant presque trente ans, alors que Marie Stuart, sa petite-fille, devait y rester à peine six ans.
Source
Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé Margaret Tudor
Références
Chapman, Hester W. 1969. The Thistle and the Rose: The Sisters of Henry VIII. Coward, McCann & Geoghegan Inc. LCC
Jansen, Sharon L. 2002. The Monstrous Regiment of Women: Female Rulers in Early Modern Europe.
Mackie, J. D. 1994. The Earlier Tudors: 1485 - 1558.
Perry, Maria. The Sisters of Henry VIII: The Tumultuous Lives of Margaret of Scotland and Mary of France
Routh, C. R. 2001. Who's Who in Tudor England.
Ashley, Mike 2002. British Kings & Queens. Carroll & Graf.
Arbella Stuart
Liens externes
Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • WorldCat
Un rapide portrait de Marguerite au milieu d'autres femmes de son temps ayant exercé de l'influence
Margaret Tudor Gallery
Généalogie de Margaret Tudor
Reines et princes consorts écossais jusqu’en 1707
Dunkeld Gruoch 1040-1057 · Ingibiorg Finnsdottir 1058-1069 · Marguerite de Wessex 1070-1093 · Ethelreda de Dunbar 1094 · Sibylle de Normandie 1107-1122 · Maud de Huntingdon 1124-1130 · Ermengarde de Beaumont 1186-1214 · Jeanne d'Angleterre 1221-1238 · Marie de Coucy 1239-1249· Marguerite d'Angleterre 1251-1275 · Yolande de Dreux 1285-1286
Bruce Élisabeth de Burgh 1306-1327· Jeanne d'Angleterre 1329-1362 · Marguerite Drummond 1364-1369
Stuart Euphémie de Ross 1371-1386· Annabella Drummond 1390-1401 · Jeanne Beaufort 1424-1437 · Marie d'Egmont 1449-1460 · Marguerite de Danemark 1469-1486 · Marguerite Tudor 1502-1513 · Madeleine de France 1537 · Marie de Guise 1538-1542 · François II de France 1558-1560 · Henry Stuart, Lord Darnley 1565-1567 · James Hepburn, comte de Bothwell 1567 · Anne de Danemark 1589-1619 · Henriette Marie de France 1625-1649 · Catherine de Bragance 1662-1685 · Marie de Modène 1685-1688 · Georges de Danemark 1702-1707
En 1707, Georges de Danemark devient le premier prince consort britannique.
Portail du Royaume-Uni Portail de l’Écosse Portail de l’histoire          
Posté le : 16/10/2015 22:20
Edité par Loriane sur 17-10-2015 18:11:52
|
|
|
|
|
Clotaire II |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 18 octobre 629 meurt Clotaire II dit le Jeune
né en mai 584, roi de Neustrie de 584 à 613 et roi des Francs de 613 à 629, après la conquête du royaume d'Austrasie et du royaume de Bourgogne. Sa victoire de 613 sur la reine Brunehilde Brunehaut met fin à la longue période de guerres entre rois francs, commencée en 570, et dont deux protagonistes ont été les parents de Clotaire, Chilpéric Ier et Frédégonde.
Il est roi des Francs du 10 octobre 613 au 18 octobre 629, son prédécesseur est Sigebert II, Réunion de tous les royaumes francs, son successeur est Dagobert Ier: Roi des Francs. Caribert II: fut roi d'Aquitaine, roi des Francs de Neustrie de 584 à 613 dont le prédécesseur est Chilpéric Ier
Successeur lui-même depuis la réunion de tous les royaumes francs, roi des Francs de Paris de 595 à 613, son prédécesseur Childebert II, son successeur lui-même depuis la réunion de tous les royaumes francs, roi d'Austrasie et des Burgondes, roi de Paris 595-61. Il appartient à la dynastie des Mérovingiens. Son père est Chilpéric Ier
sa mère est Frédégonde, ses conjointes sont Haldetrude, Bertrude, Sichilde. Ses enfants sont : Mérovée, Emma, Dagobert Ier, Caribert II, sa résidence se trouve à Clichy
En bref
Clotaire né en584, mort en 629, roi de Neustrie de 584 à 629, d'Austrasie et de Bourgogne 613-629, fils de Chilpéric Ier à qui il succéda sous la tutelle de sa mère Frédégonde. Il est âgé de quatre mois lorsqu'il succède à son père, sous la tutelle de sa mère qui, profitant de la mort de Gontran 592 et de Childebert II 595, occupe Paris et remporte sur les Austrasiens la victoire de Latofao.Ceux-ci prennent leur revanche à la mort de Frédégonde 597, et, par les victoires de Dormelles 600 et d'Étampes 604, contraignent Clotaire à l'onéreuse paix de Compiègne. La mort de Thierry II, survenue en 613, est suivie de la trahison des grands d'Austrasie, qui lui livrent Brunehaut. Après le meurtre de celle-ci, Clotaire devient seul maître du royaume franc, mais doit faire des concessions aux nobles par l'édit de 614, et reconnaître l'hérédité des maires du palais. Il proclame son fils Dagobert roi d'Austrasie.
Clotaire n'est qu'un nourrisson à la mort de son père Chilpéric Ier, assassiné en 584. Ce sont sa mère, Frédégonde, et son oncle, Gontran, roi de Bourgogne et d'Orléans, qui ont veillé sur sa succession. Après avoir repoussé une attaque de son cousin Childebert II d'Austrasie en 592, Clotaire s'empare des territoires des jeunes successeurs de Childebert, Théodebert II et Thierry II, en 596. Mais il reperd une grande partie de son royaume face à eux en 600. Cependant, en 613, alors que Théodebert et Thierry sont tous deux morts, et que l'Austrasie est très hostile à Brunehaut, arrière-grand-mère du jeune fils de Thierry, Sigebert II, Clotaire en profite pour faire exécuter Sigebert et Brunehaut, et pour mettre la main sur l'Austrasie et la Bourgogne, réunissant ainsi les terres franques.
Clotaire assainit les relations entre l'Église et la couronne par un édit rendu lors du concile de Paris en 614, qui a pour objectif d'apaiser les tensions nées des longues années d'agitation politique. Il rencontre par ailleurs le missionnaire irlandais saint Colomban, dont il soutient le monastère, à Luxeuil. À l'exception de quelques troubles en Bourgogne, la période d'après 613 est relativement calme. S'il a réuni le royaume des Francs, Clotaire n'ira pas jusqu'à unifier l'autorité royale : il maintient le système des maires du palais qui le représentent dans ses trois territoires. En 623, il couronne son fils Dagobert Ier roi d'Austrasie, et fait de Pépin Ier de Landen, dit l'Ancien, le maire du palais.
Sa vie
Contexte historique : les territoires francs au VIe siècle
Le règne de Clotaire II se situe dans le cadre territorial et politique issu du partage du royaume franc effectué en 561 à la mort de Clotaire, fils de Clovis et grand-père de Clotaire II.
À la mort de Clovis, en 511, quatre royaumes avaient été créés avec pour capitales : Reims, Soissons, Paris et Orléans, l'Aquitaine étant répartie séparément. Dans les années 550, Clotaire, dernier survivant des quatre frères reconstitue l'unité du royaume franc, augmenté du territoire burgonde Burgundia, Burgondie, Bourgogne conquis entre temps.
En 561, les quatre fils de Clotaire effectuent un partage analogue à celui de 511 : Sigebert à Reims, Chilpéric à Soissons, Caribert Ier à Paris, Gontran à Orléans, ce dernier royaume incluant maintenant le territoire burgonde. Ils se répartissent de nouveau l'Aquitaine séparément.
Très vite, Sigebert déplace sa capitale de Reims à Metz ; Gontran déplace la sienne d'Orléans à Chalon.
À la mort de Caribert en 567, sa part est partagée entre les trois survivants : en particulier, Sigebert Metz reçoit Paris et Chilpéric Soissons Rouen.
C'est à cette époque, vers la fin du vie siècle, qu'apparaissent les deux nouvelles dénominations d'Austrasie pour le royaume de Metz et de Neustrie pour le royaume de Soissons et ses dépendances.
Contexte historique : la faide royale, ambitions de Frédégonde
Dans les années 560, Sigebert et Chilpéric épousent deux sœurs, filles du roi wisigoth d'Espagne Athanagild : les princesses Brunehilde Brunehaut et Galswinthe. Mais Chilpéric est attaché à une concubine, Frédégonde, et assez rapidement, Galswinthe réclame d'être renvoyée à Tolède. Vers 570, elle est assassinée et les soupçons se portent sur Chilpéric, qui aurait volontiers répudié Galswinthe, mais ne voulait pas qu'elle emporte sa dot. Puis il fait officiellement de Frédégonde une reine des Francs.
En l'absence de père, mort depuis quelques années, c'est Brunehilde qui devient responsable des représailles contre Chilpéric. Celui-ci accepte d'abord de payer une composition wergeld, puis se lance dans une série d'opérations militaires contre Sigebert. C'est le début de ce qu'on appelle la "faide royale", qui ne prendra donc fin qu'en 613.
Les principaux épisodes sont, jusqu'à l'assassinat de Chilpéric en 584 : l'assassinat de Sigebert 575 ; l'emprisonnement de Brunehilde, puis son mariage avec un fils de Chilpéric ; le retour de Brunehilde auprès de son fils Childebert II, successeur de Sigebert.
Par ailleurs, Frédégonde s'efforce d'assurer sa position, assez fragile, étant donnée qu'elle est d'origine servile, en éliminant les fils que Chilpéric a eu de sa précédent épouse Audovère : Mérovée et Clovis. Ses propres enfants, cependant, meurent très jeunes dans des conditions qu'elle juge suspectes.
Lorsque Frédégonde a un fils au printemps 584, il est le futur successeur de Chilpéric, à condition de vivre assez longtemps.
Les sources
Les principales sources d'époque sont la chronique de Grégoire de Tours et celle de Frédégaire.
Mais il faut savoir que leurs auteurs sont de parti pris, Grégoire, évêque de Tours, est même un acteur des conflits de l'époque.
L'Histoire des Francs de Grégoire de Tours de la fin du vie siècle, s'arrête vers 572. Elle est favorable à la reine Brunehilde et à Sigebert et extrêmement hostile à Chilpéric et à Frédégonde.
La chronique de Frédégaire, du viie siècle, commence en 584, est en revanche hostile à Brunehilde.
Clotaire II
Naissance de Clotaire mai 584
Le nouveau-né ne reçoit pas de nom à sa naissance ; ceci dans le but de ne pas propager d'inquiétude liée à la symbolique du nom mérovingien. Voulant choisir un parrain en fonction de l'évolution des troubles qui agitent le royaume des Francs, son père ne le fait pas baptiser immédiatement.
Chilpéric et Frédégonde ont aussi le souci de protéger leur enfant, étant donné que ses prédécesseurs morts jeunes ont peut-être été victimes d'assassinats.
Il est élevé en secret dans la villa royale de Vitry, en Artois.
Mort de Chilpéric en septembre 584 et conséquences
En septembre 584, Chilpéric Ier est assassiné près de sa villa de Chelles, peut-être sur ordre de la reine Brunehilde4, après une partie de chasse. Cet événement produit un désordre général.
Désordres dans le royaume
Les Grands de Neustrie pillent les trésors de Chilpéric, notamment son missorium d'or et s'emparent de tous les documents importants, pour se réfugier en Austrasie.
La princesse Rigonde, en chemin vers l'Espagne en vue d'épouser le prince Recarède, est attaquée à Toulouse par le duc Didier, lié à la conspiration de Gondovald, qui lui vole tout ce qui reste de sa dot, de sorte qu'elle est obligée de renoncer à son mariage.
Des guerres éclatent entre des cités rivales, ainsi Orléans et Blois se dressent contre Chartres et Châteaudun.
Rapprochement de Frédégonde avec Gontran
La reine Frédégonde réussit à conserver ses trésors personnels et quelques officiers, comme Ansoald et Audon, alors que d'autres l'abandonnent, comme le chambrier Eberulf. Elle fait emmener son fils de Vitry à Paris et envoie un message à Gontran, roi de Bourgogne, pour qu'il accepte d'adopter l'enfant et d'exercer la régence jusqu'à sa majorité.
Childebert II, qui se trouvait vers Meaux au moment du meurtre de Chilpéric, se déplace à Melun[réf. nécessaire], envisageant de prendre Paris, mais Gontran le devance. Des pourparlers s'engagent entre Childebert II et Brunehilde d'une part, Gontran d'autre part : mais Gontran refuse qu'ils entrent dans la ville. Il refuse également de leur livrer Frédégonde, que Brunehilde réclame en invoquant le régicide de Sigebert Ier, des princes Mérovée et Clovis et même de Chilpéric Ier.
Assemblée de Neustrie, reconnaissance de Clotaire
Gontran convoque ensuite une assemblée des Grands de Neustrie, au cours de laquelle l'enfant de Frédégonde est reconnu comme fils de Chilpéric Ier, bien que des doutes sur sa paternité aient été évoqués. Ils décident de lui donner le nom de Clotaire11, nom du grand-père du nouveau-né. Celui-ci est alors adopté par Gontran.
Le gouvernement de Gontran 584-58713
Reprise en main du royaume de Neustrie
L'officier Ansoald est chargé de reprendre le contrôle des villes neustriennes délaissées depuis la mort du roi. Elles font alors serment de fidélité à Gontran et à Clotaire. Gontran tente de remettre de l'ordre dans les affaires de Neustrie : contre l'avis de Frédégonde et peut-être pour montrer son autorité, il redonne son siège épiscopal de Rouen à Prétextat et démet de ses fonctions Melaine qui le remplaçait.
L'évêque Promotus de Châteaudun, dont le diocèse avait été rétrogradé en paroisse à la suite du concile de Paris en 573 pour avoir été nommé à ce poste au mépris des lois canoniques, réclame sa restitution après avoir été exilé à la mort de Sigebert Ier. Il ne récupère que ses biens personnels.
Réapparaît la menace austrasienne.
Deux envoyés de Brunehilde, le duc Gararic et le chambrier Eberon, réussissent à faire passer Limoges, Tours et Poitiers sous influence austrasienne, avec l'aide des évêques Grégoire de Tours et Venance Fortunat. Gontran envoie des troupes récupérer les cités perdues qui sont toutes reprises et retournent dans ses états.
Frédégonde est envoyée dans la villa de Vaudreuil, dans le diocèse de Rouen, où elle est sous la surveillance de l'évêque Prétextat.
Le baptême de Clotaire
Durant l'été 585, Gontran revient à Paris pour être le parrain de Clotaire ; il fait jurer à Frédégonde, trois évêques et trois cents aristocrates de Neustrie, que Clotaire II est bien fils de Chilpéric Ier. Mais le baptême est annulé. Il est prévu de réunir un concile à Troyes, mais les Austrasiens refusent d'y participer si Gontran ne déshérite pas Clotaire. Le concile est donc déplacé à Mâcon en Bourgogne et a lieu le 23 octobre 585.
Rétablissement de Frédégonde, conflit avec Gontran 587-592
Alors que Gontran tente de s'emparer de la Septimanie wisigothique, Frédégonde tente de d'échapper à la surveillance de l'évêque Prétextat pour fuir Rouen. Durant une messe dominicale, Prétextat est poignardé. Comme il ne meurt pas tout de suite, Frédégonde va se recueillir auprès de lui et lui demande s'il a besoin de ses médecins. L'évêque l'accuse ouvertement d'être à l'origine de ce meurtre et de celui des autres rois et il jette une malédiction sur elle. Il meurt peu après.
La reine utilise alors sa liberté pour rallier à son fils et à elle le plus possible de nobles et d'évêques. Elle réinstalle Melaine à Rouen malgré l'interdiction de Gontran.
Gontran s'efforce alors d'affaiblir Frédégonde en débauchant une partie de l'aristocratie, afin d'au moins conserver les terres neustriennes qu'il a accaparées entre Loire et Seine grâce au ralliement du duc Beppolène. En 587, il réussit à reprendre les villes d'Angers, Saintes et Nantes.
Frédégonde propose alors de négocier la paix et envoie à Gontran des ambassadeurs, en réalité chargés de le tuer. Mais ils sont arrêtés et Gontran rompt ses relations avec la Neustrie, se rapprochant alors de Brunehilde et de Childebert II, avec lesquels il conclut le pacte d'Andelot : à la mort d'un des deux rois, l'autre héritera de son royaume. C'est effectivement ce qui survient en 592 : Gontran meurt et Childebert devient roi d'Austrasie et de Bourgogne.
Les relations avec l'Austrasie et la Bourgogne 592-613
L'union Austrasie-Bourgogne ne dure que jusqu'en 595 ; à la mort de Childebert II, l'Austrasie est attribuée à son fils Thibert ou Théodebert et la Bourgogne à Thierry ou Théodoric ; Brunehilde est toujours présente, mais son pouvoir et son rôle de régente ne sont pas toujours acceptés, et les deux frères sont loin d'être toujours en accord
Avec Frédégonde 592-597
En 593, même s'il ne s'agit que d'une présence symbolique car il n'a que neuf ans, Clotaire II apparaît à la tête de ses armées qui mettent en déroute le duc austrasien Wintrio qui cherche à envahir la Neustrie. En 596, il ravage les environs de Paris.
La reine Frédégonde meurt en 597, laissant Clotaire gouverner désormais seul.
La défaite de Dormelles 600 et ses conséquences
Vers 600, Thierry II et Thibert II s'allient contre lui et le battent à la bataille de Dormelles, près de Montereau ; il doit alors signer un traité qui réduit son royaume aux régions de Beauvais, Amiens et Rouen, le reste étant réparti entre les deux frères.
En 604, une première tentative de reconquête de son royaume se solde par un échec. Son fils Mérovée âgé de 4 ans, qu'il a eu de sa première épouse, est fait prisonnier par Thierry II à la bataille d’Étampes28 et est assassiné sur ordre de Brunehilde. Clotaire change alors de stratégie et se rapproche de Thierry ; en 607, il devient le parrain d'un des fils de ce dernier, qui reçoit le nom de Mérovée.
Vers la même époque, Thierry, repoussant après l'avoir sollicitée la princesse wisigothe Ermenberge, fille du roi Wittéric, se brouille avec ce dernier. Wittéric entre alors en relations avec Clotaire II en vue d'une alliance, ainsi qu'avec Thibert II et Agilulf, roi des Lombards. Cette coalition contre Thierry II ne paraît pas avoir été suivie d'effets importants.
La guerre entre Austrasie et Bourgogne 610-612
En 610, commence une véritable guerre entre Thibert et Thierry. Thibert est d'abord vainqueur en 610 ; c'est alors Thierry II qui se rapproche de Clotaire, promettant de lui rendre le nord de la Neustrie qu'avait reçu Thibert en 600. Le nouveau roi wisigoth Gundomar se joint à la coalition contre Thierry. Thibert est écrasé en 612, lors des batailles de Toul, puis de Tolbiac près de Cologne. Il le fait exécuter ainsi que ses enfants, réunissant de nouveau l'Austrasie à la Bourgogne.
La guerre entre Clotaire et l'union Austrasie-Bourgogne 613
Comme convenu, Thierry rend à Clotaire le nord de la Neustrie[réf. nécessaire]29, puis organise une invasion de la Neustrie. Mais il meurt de dysenterie à Metz en 613. Ses troupes se dispersent immédiatement, et Brunehilde place sur le trône d'Austrasie son arrière-petit-fils Sigebert II.
Supplice de la reine Brunehaut.
N'acceptant pas la tutelle de Brunehilde, les nobles austrasiens font appel à Clotaire II, qui envahit l'Austrasie ; Brunehilde et les fils de Thierry lui sont livrés. Les enfants sont exécutés à l'exception de Mérovée, son filleul, et peut-être de Childebert qui aurait pris la fuite.
Brunehilde accusée d'avoir fait assassiner dix rois est jugée et reconnue coupable. Elle subit un châtiment extrêmement dur : suppliciée trois jours puis exécutée en étant attachée à l'arrière d'un cheval indompté.
Clotaire seul roi des Francs 613-629
Clotaire établit sa résidence à Paris et dans les villas des alentours.
Les mairies du palais
Un aspect important de la nouvelle configuration est le maintien dans chacun des trois royaumes d'une administration spécifique avec à sa tête un maire du palais. Le maire du palais est à l'origine le majordomus, serviteur du roi chargé de la vie matérielle du palais. Durant la période de la faide royale, la fonction a pris de l'importance et leurs titulaires, membres de la haute aristocratie, ont joué un rôle politique important. C'est en particulier le cas de Warnachaire, maire du palais de Bourgogne en 613, un des responsables de la livraison de Brunehilde, qui occupe le poste jusqu'à sa mort en 626. L'épouse de Warnachaire, Berthe, est d'ailleurs peut-être une fille de Clotaire.
L'édit de 614
En 614, Clotaire II réunit une assemblée des évêques et des grands dont les résultats apparaissent dans un édit daté du 18 octobre 614. L'article 11 indique qu'il s'agit de rétablir "la paix et la discipline dans notre royaume" et de "réprimer les révoltes et insolences des méchants ; L'édit concerne l'ensemble des trois royaumes et pas seulement celui de Neustrie. Il vise les abus de pouvoir commis par certains fonctionnaires, en particulier le non-respect de certaines immunités accordées par Chilpéric. L'article 12 est considéré comme notable : il établit que les fonctionnaires ne peuvent pas être nommés hors de leur région d'origine.
Dagobert, roi d'Austrasie 623
En 623, Dagobert est "associé au royaume" et établi "roi sur les Austrasiens". Il est alors envoyé à Metz, où les deux personnalités sont l'évêque Arnoul et le maire du palais nouvellement nommé Pépin de Landen. En même temps, Clotaire opère un changement territorial en attribuant la région de Reims à la Neustrie. Mais Dagobert, devenu un véritable Austrasien, obtiendra en 626 le retour de Reims à son royaume.
Le comportement de Clotaire II entre barbarie et christianisme
Clotaire II ne constitue pas une exception dans la lignée des Mérovingiens par ses mœurs barbares et sa pratique de la vendetta familiale. Toutefois, il fut un des rares mérovingiens à ne pas être polygame. Il resta fidèle à Bertrude jusqu'à son décès en 618 puis se remaria à Sichilde. Respectueux de l'Église et ses représentants qu'il préférait avoir pour alliés, il est probable qu'il s'efforçait de se composer une image de roi pieux, inspiré par la sainteté de son oncle Gontran qui l'avait protégé et lui avait permis l'accession au trône et dont il faut remarquer qu'en ces temps troublés il soit mort non pas assassiné mais de vieillesse.
En 617, il reconduit le traité d'amitié qui liait les rois Francs aux rois Lombards.
Mort de Clotaire et avènement de Dagobert
Clotaire meurt le 18 octobre 629 à l'âge de 45 ans, et est inhumé, comme son père, dans la basilique Saint-Vincent de Paris, intégrée par la suite à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés.
L'aristocratie neustrienne choisit pour roi Caribert, demi-frère de Dagobert. Mais celui-ci, appuyé par les Austrasiens, s'impose assez facilement en Bourgogne, puis en Neustrie. Caribert est doté d'un royaume constitué de territoires aquitains.
Mariages et descendance
Il épouse en premières noces Haldetrude, qui donne naissance à :
Mérovée, qui est envoyé avec Landéric, maire de palais de Neustrie, pour combattre l'Austrasien Berthoald à Arele en 604, mais les deux sont tués au cours de la bataille.
Emma, mariée en 618 à Eadbald † 640, roi de Kent.
En secondes noces, il épouse Bertrude, citée en 613 et en 618, fille probable de Richomer, patrice des Burgondes, et de Gertrude d'Hamage. Elle a au moins :
Dagobert Ier vers 605-639, roi des Francs
et peut-être :
un fils mort jeune vers 617.
Berthe, épouse de Warnachaire † 626, maire du palais de Bourgogne.
En 618, il se marie avec Sichilde, sœur de Gomatrude, qui épousera Dagobert Ier, roi des Francs, et probablement de Brodulfe ou Brunulfe, qui soutiendra Caribert II. Sichilde était auparavant sa concubine et avait déjà donné naissance à :
Caribert II † 632, roi d'Aquitaine.
  *    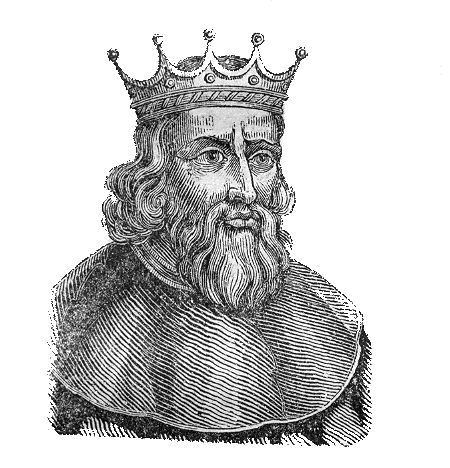        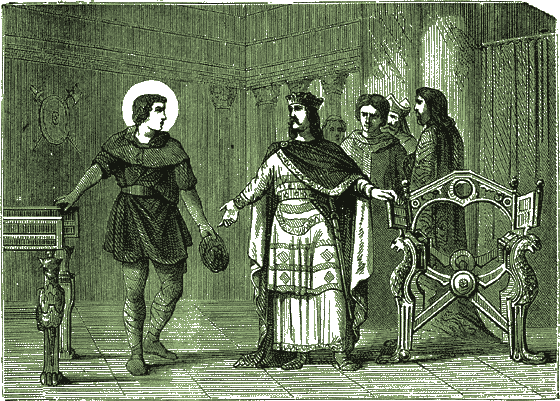
Posté le : 16/10/2015 22:17
Edité par Loriane sur 17-10-2015 17:18:02
Edité par Loriane sur 17-10-2015 17:19:24
|
|
|
|
|
Jean Sans terre 1 |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57675
|
Le 18/19 octobre 1216 meurt Jean sans terre
à 48 ou 49 ans au Chateau de Newak en Angleterre sa sépulture se trouve dans la cathédrale de Worcester, né le 24 décembre 1166 ou 1167 au palais Beaumont à Oxford en Angleterre, il fut roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine de 1199 à sa mort.
Roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine du 6 avril 1199 au 19 octobre 1216 soit durant 17 ans 6 mois et 13 jours. Il est couronné le 27 mai 1199
Son prédécesseur est Richard Ier, son successeur Henri III. Il appartient à la dynastie des Plantagenêt. Son nom de naissance est John. Il est marié à Isabelle de Gloucester 1189-1199, puis à Isabelle d'Angoulême 1200-1219. leurs enfants sont Henri III, Richard, Jeanne, Isabelle et Aliénor
Cinquième et dernier fils du roi Henri II d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine, Jean n'était pas destiné à monter sur le trône ou à recevoir un quelconque territoire en héritage ; il fut donc surnommé Jean sans Terre n 1 par son père. Cela changea après la révolte ratée de ses frères aînés entre 1173 et 1174 et il devint le fils préféré d'Henri II qui le fit seigneur d'Irlande en 1177 et lui accorda des terres sur le continent. La mort de trois de ses frères Guillaume, Henri et Geoffroy et l'accession au trône de Richard Ier en 1189 en fit l'héritier apparent. Jean tenta sans succès de prendre le pouvoir alors que son frère participait à la Troisième croisade mais il devint finalement roi en 1199.
Le nouveau monarque fut immédiatement confronté à la menace posée par le roi Philippe II de France sur ses territoires continentaux formant l'Empire Plantagenêt. Il perdit ainsi la Normandie en 1204 notamment en raison du manque de ressources militaires et de son traitement méprisant des nobles poitevins et angevins. Il consacra la plus grande partie de son règne à tenter de reconquérir ces territoires en formant des alliances contre la France, en accroissant les revenus de la Couronne et en réformant l'armée. Malgré ses efforts, une nouvelle offensive en 1214 se solda par la défaite de ses alliés à Bouvines et il fut contraint de rentrer en Angleterre.
Irrités par le comportement jugé tyrannique du souverain et par la forte hausse des impôts et des taxes destinés à financer sa politique continentale, les barons anglais se révoltèrent à son retour. La dispute entraîna la signature en 1215 de la Magna Carta garantissant les droits des hommes libres du royaume mais ni Jean, ni les nobles ne respectèrent ses dispositions. La première guerre des barons éclata peu après et le roi dut affronter les rebelles soutenus par le prince Louis VIII de France. La situation fut rapidement bloquée et Jean mourut de la dysenterie en 1216 alors qu'il faisait campagne dans l'Est de l'Angleterre. Sa mort apaisa les tensions, ce qui permit à son fils et successeur Henri III de prendre définitivement l'ascendant sur les rebelles l'année suivante.
Les évaluations historiques du règne de Jean ont fait l'objet de nombreux débats et ont considérablement varié selon les époques. Considéré comme un héros proto-protestant par les historiens Tudor en raison de son opposition au pape Innocent III qui lui valut l'excommunication, il a également été présenté comme un tyran par ses contemporains et les historiens de l'époque victorienne. Le consensus actuel est qu'il fut un administrateur appliqué et un général compétent affligé d'une personnalité méprisante et cruelle. Ces aspects négatifs ont servi de base à de nombreuses œuvres de fiction depuis Shakespeare et Jean reste un personnage influent de la culture populaire notamment via les aventures de Robin
En bref
Fils cadet de Henri II Plantagenêt, Jean attend longtemps en vain de recevoir une part des domaines paternels, en Irlande ou en France ; son mariage seul lui vaudra le comté de Gloucester. Opposé à son père, envieux du sort de son frère Richard Cœur de Lion, il lutte d'abord avec celui-ci contre la domination paternelle. À partir de l'accession au trône de Richard, en 1189, et, pendant les dix ans de son règne, il se signale surtout par des tentatives répétées et avortées pour s'emparer du pouvoir en l'absence du roi parti pour la croisade ou dans la France du Sud. Devenu enfin roi en 1199, il réussit, en dix-sept ans, à ruiner l'œuvre autoritaire de ses prédécesseurs et à gagner une rare impopularité. Les plus cuisants de ses échecs sont la perte de la Normandie, confisquée en 1204 par Philippe Auguste, et de l'Anjou révolté contre lui. Après Bouvines, il aura perdu tous ses fiefs en terre de France. Sa politique ecclésiastique de contrôle des bénéfices et de lutte contre les ingérences pontificales ne connaît guère plus de succès : l'interdit jeté sur son royaume par Innocent III en 1207, les vacances d'évêchés, la menace d'une intervention armée du roi de France pour exécuter les condamnations pontificales 1211 l'amènent à se soumettre, à garantir la liberté des élections épiscopales et à se constituer le vassal du pape 1213. Ses échecs, ses exactions fiscales, l'humiliation devant Innocent III lui valent une croissante opposition des barons et, en 1215, il est contraint de reconnaître, sans sincérité d'ailleurs, la nécessité de consulter un parlement avant de lever toute aide extraordinaire, d'abjurer tous ses abus et d'accepter l'idée d'un véritable droit à l'insurrection : ces concessions sont inscrites dans la Grande Charte. Décidé à les remettre en question, en s'appuyant en particulier sur la papauté, Jean sans Terre meurt au moment où une nouvelle révolte des barons, assistés par le roi de France, met son trône en grand danger. Roland MARX
Sa vie
Jean est né le 24 décembre 1166 ou 1167 au palais Beaumont d'Oxford. Il était le cinquième et dernier fils du roi Henri II d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine. En plus de l'Angleterre, Henri II avait hérité de vastes possessions dans l'ouest de la France dont l'Anjou, la Normandie et avait conquis la Bretagne. Par ailleurs, il avait épousé la puissante Aliénor qui régnait sur le duché d'Aquitaine et avait une revendication sur le Languedoc et l'Auvergne en plus d'être l'ancienne femme du roi Louis VII de France. Henri II régnait ainsi sur ce qui fut appelé l'Empire Plantagenêt d'après le nom de sa dynastie. Cette entité était cependant structurellement fragile car si tous les territoires rendaient hommage à Henri II, ils avaient chacun leurs propres traditions, histoires et formes de gouvernement. L'autorité du roi anglais était très limitée en Aquitaine et les liens traditionnels entre la Normandie et l'Angleterre se dissolvaient lentement. Le destin de l'Empire à la mort d'Henri II était inconnu et même si la pratique de la primogéniture selon laquelle le fils aîné hérite de toutes les possessions de son père se répandait en Europe, elle était peu populaire chez les rois normands d'Angleterre. Beaucoup d'observateurs pensaient que le souverain allait diviser son Empire entre ses fils en espérant qu'ils continueraient à se comporter en alliés après sa mort. Pour compliquer les choses, une grande partie des provinces françaises de l'Empire étaient contrôlées par Henri II en tant que vassal du roi de France qui appartenait à la dynastie rivale des Capétiens. Les relations étaient encore tendues par le fait que le roi anglais s'était souvent allié avec l'empereur contre la France.
Peu après sa naissance, Jean fut confié à une nourrice selon la pratique traditionnelle des familles aristocratiques médiévales. Aliénor se rendit à Poitiers, la capitale de l'Aquitaine, tandis que Jean et sa sœur Jeanne furent envoyé à l'abbaye de Fontevrault. Cela était peut-être destiné à orienter son fils cadet vers une carrière ecclésiastique étant donné qu'il avait peu de chance d'accéder au trône. Aliénor passa les années suivantes à comploter contre son époux et aucun de ses parents ne participa à l'enfance de Jean. Comme ses frères, il fut confié à un magister chargé de son éducation et de la gestion de son foyer. Jean passa quelque temps dans le foyer de son frère aîné Henri le Jeune où il reçut probablement une éducation militaire.
Selon ses contemporains, Jean mesurait 168 cm, était relativement trapu avec un corps puissant et des cheveux roux sombres. Il adorait la lecture et se fit construire une bibliothèque mobile, une chose inhabituelle pour l'époque. Il était un parieur avide, notamment au backgammon, ainsi qu'un chasseur enthousiaste. Il se fit connaître comme un connaisseur de joyaux » et devint célèbre pour son opulence vestimentaire et, selon les chroniqueurs français, son goût du mauvais vin. La personnalité de Jean était assez complexe et il était connu pour être génial, plein d'esprit, généreux et aimable mais pouvait également être jaloux, susceptible et prompt à des accès de rage où il se mordait et rongeait les doigts de colère.
Jeunesse
Durant la jeunesse de Jean, Henri II tenta de résoudre la question de sa succession. Henri le Jeune avait été couronné roi d'Angleterre en 1170 mais ne reçut aucun pouvoir. Il était prévu qu'il hérite de la Normandie et de l'Anjou en plus de l'Angleterre tandis que ses frères Richard et Geoffroy II devaient respectivement obtenir l'Aquitaine et la Bretagne. À ce moment, il était peu probable que Jean obtienne un quelconque territoire et il fut pour plaisanter surnommé Lackland sans Terre par son père.
Henri II voulait sécuriser les frontières orientales de l'Aquitaine et il décida de fiancer son plus jeune fils à Alix, la fille et héritière du comte Humbert III de Savoie. D'après les termes du contrat de mariage, Jean devait hériter de la Savoie, du Piémont, de la Maurienne et des autres possessions de son futur beau-père. De son côté, le roi anglais céda la possession des châteaux poitevins de Chinon, de Loudun et de Mirebeau à Jean même s'il continuait à les contrôler étant donné que son fils n'avait que cinq ans. Cette décision fut peu appréciée d'Henri le Jeune qui considérait qu'il s'agissait de son futur héritage. Alix traversa les Alpes pour rejoindre la cour d'Henri II mais elle mourut avant d'épouser Jean qui redevint sans Terre.
De plus en plus mécontent des décisions de son père, Henri le Jeune se rendit à Paris et s'allia au roi Louis VII de France. Irritée par les nombreuses interférences de son époux en Aquitaine, Aliénor encouragea Richard et Geoffroy à rejoindre leur frère à Paris. Henri II triompha rapidement de la révolte de ses fils mais fut généreux dans l'accord de paix signé à Montlouis. Henri le Jeune fut autorisé à voyager librement en Europe avec sa suite de chevalier, Richard récupéra l'Aquitaine et Geoffroy fut autorisé à rentrer en Bretagne, seule Aliénor fut emprisonnée pour son rôle dans le soulèvement.
Jean avait accompagné son père durant le conflit et reçut de nombreux territoires par le traité de Montlouis ; à partir de ce moment, beaucoup d'observateurs le considéraient comme le fils préféré du roi même s'il était le plus éloigné dans l'ordre de succession. Henri II continua à acquérir de nouvelles terres pour son fils, essentiellement aux dépens de la noblesse. En 1175, il s'appropria les possessions du feu comte Réginald de Dunstanville et l'année suivante, il déshérita les sœurs d'Isabelle de Gloucester, un acte contraire à la coutume, et fiança Jean à cette dernière. En 1177, le roi limogea William FitzAldelm de ses fonctions de seigneur d'Irlande et le remplaça par Jean alors âgé de dix ans.
Henri le Jeune affronta brièvement son frère Richard en 1183 sur la question du statut de l'Angleterre, de la Normandie et de l'Aquitaine. Henri II appuya Richard, et Henri le Jeune mourut de la dysenterie à la fin de la campagne. Le prince héritier étant mort, le roi modifia ses plans pour sa succession. Richard devait devenir roi d'Angleterre même s'il n'aurait aucun pouvoir avant la mort de son père ; Geoffroy conserverait la Bretagne et Jean deviendrait duc d'Aquitaine à la place de Richard. Ce dernier refusa d'abandonner l'Aquitaine et Henri II, furieux, ordonna à ses deux autres fils de marcher vers le sud pour reprendre le duché par la force. Les deux frères assiégèrent Poitiers et Richard répondit en attaquant la Bretagne. La guerre se termina par un retour au statu quo et une difficile réconciliation familiale à la fin de l'année 1184.
En 1185, Jean se rendit pour la première fois en Irlande avec 300 chevaliers et un groupe d'administrateurs mais son séjour fut calamiteux. Henri II essaya de proclamer officiellement Jean roi d'Irlande mais le pape Lucius III s'y opposa28. L'île avait récemment été conquise par les forces anglo-normandes et les tensions étaient fortes entre les colons et les habitants traditionnels. En plus d'offenser les souverains locaux en se moquant de leurs longues barbes, Jean ne parvint pas à se faire des alliés chez les colons anglo-normands et fut bousculé par les attaques irlandaises. Il retourna en Angleterre à la fin de l'année 1185 et blâma le vice-roi Hugues de Lacy pour le fiasco.
Alors que les relations au sein de la famille royale continuaient à se détériorer, Geoffroy mourut lors d'un tournoi en 1186. Le duché de Bretagne fut transmis à son fils Arthur et non à Jean mais la mort de Geoffroy rapprochait ce dernier du trône d'Angleterre. La succession d'Henri II était toujours aussi incertaine car Richard désirait rejoindre les croisades et il n'était pas exclu qu'en son absence, le roi nomme Jean comme son successeur.
Richard entama des négociations en vue d'une potentielle alliance avec le roi Philippe II de France en 1187 et l'année suivante, il promit de rendre hommage au roi de France en échange de son soutien lors d'une guerre avec son père. Au terme de ce conflit en 1189, Richard fut confirmé en tant que futur roi d'Angleterre. Jean était initialement resté loyal à son père mais il changea de camp lorsqu'il devint clair que Richard allait gagner. Henri II mourut peu après.
Règne de Richard Ier 1189-1199
Lorsque le frère aîné de Jean devint roi sous le nom de Richard Ier en septembre 1189, il avait déjà annoncé son intention de participer à la troisième croisade. Il rassembla les fonds nécessaires à cette expédition en vendant des terres, des titres et des offices et tenta de s'assurer qu'il n'y aurait pas de révolte en son absence. Jean fut fait comte de Mortain, épousa la riche Isabelle de Gloucester et reçut des terres dans le Lancastre, les Cornouailles, le Devon, le Dorset et le Somerset afin d'obtenir sa loyauté. Richard Ier conserva néanmoins le contrôle des principaux châteaux de ces comtés pour l'empêcher d'acquérir trop de pouvoir et il désigna Arthur de Bretagne alors âgé de quatre ans comme son héritier au trône. En retour, Jean promit de ne pas se rendre en Angleterre pendant les trois années suivantes, ce qui devait permettre à Richard de mener une croisade victorieuse et de rentrer du Levant sans craindre une prise de pouvoir par son frère. Il confia l'autorité politique en Angleterre, le poste de justiciar, à l'évêque de Durham Hughes du Puiset et Guillaume de Mandeville et nomma chancelier l'évêque d'Ely, William Longchamp. Mandeville mourut rapidement et Longchamp partagea la fonction de justiciar avec de Puiset38. Dans le même temps, Aliénor convainquit Richard de laisser son frère se rendre en Angleterre en son absence.
La situation politique en Angleterre se détériora rapidement car Longchamp refusa de travailler avec de Puiset et s'attira les foudres de la noblesse et du clergé. Jean profita de cette impopularité pour se présenter comme une alternative et était ravi de se voir présenter comme un potentiel régent voire comme le futur roi. Un affrontement ouvert opposa les deux hommes mais il tourna rapidement à l'avantage de Jean qui parvint à isoler Lonchamps dans la Tour de Londres en octobre 1191. Au même moment, l'archevêque de Rouen Gautier de Coutances arriva en Angleterre après avoir été envoyé par Richard pour ramener l'ordre. Lonchamps fut condamné pour son comportement autocratique et exilé en France mais la position de Jean fut affaiblie par la relative popularité de l'archevêque et l'annonce du mariage de Richard Ier avec Bérangère de Navarre sur l'île de Chypre qui annonçait la possibilité que le roi aurait des héritiers.
Le désordre politique persistant, Jean chercha à se rapprocher du roi Philippe II de France qui venait tout juste de revenir de la croisade ; il espérait ainsi récupérer la Normandie, l'Anjou et les territoires français de son frère mais il fut persuadé par sa mère ne pas chercher une alliance contre Richard Ier. Comme ce dernier n'était toujours pas revenu de la croisade, Jean commença à affirmer que son frère était mort ou avait disparu. Il avait en réalité été fait prisonnier en octobre 1192 par le duc Léopold V d'Autriche qui l'avait remis à l'empereur Henri VI et ce dernier exigea le paiement d'une rançon. Jean saisit l'opportunité et se rendit à Paris pour s'allier à Philippe II. Il accepta de quitter Isabelle de Gloucester et d'épouser Adèle, la sœur du roi de France, en échange de son soutien. Des combats éclatèrent rapidement en Angleterre entre les partisans de Jean et ceux restés loyaux à Richard Ier. Sa position militaire était délicate et il accepta une trêve ; au début de l'année 1194, le roi rentra finalement en Angleterre et les dernières forces de Jean se rendirent. Il se replia en Normandie mais fut rattrapé par son frère à la fin de l'année. Le souverain déclara que Jean, malgré ses 27 ans, n'était qu'un enfant qui avait eu des conseillers malveillants et il le pardonna ; il le priva néanmoins de toutes ses terres à l'exception de l'Irlande.
Jusqu'à la fin du règne de Richard Ier, Jean le soutint, apparemment loyalement, sur le continent48. Le souverain chercha à reconquérir les forteresses que Philippe II avait conquises alors qu'il était en croisade et il s'allia avec les nobles de Flandres et de l'Empire pour combattre les Français sur deux fronts49. En 1195, Jean commanda un siège victorieux contre le château d'Évreux et défendit par la suite la Normandie contre les attaques de Philippe II. L'année suivante, il s'empara de Gamaches et mena une chevauchée vers Paris qui permit la capture de l'évêque de Beauvais. En récompense de ses services, Richard Ier abandonna sa malevontia; rancœur contre Jean et lui rendit ses titres de comte de Gloucester et de Mortain.
Début de règne 1199-1204 Accession au trône
Après la mort de Richard Ier le 6 avril 1199, il y avait deux potentiels successeurs au trône Plantagenêt : Jean, dont les revendications étaient liées au fait d'être le dernier fils en vie d'Henri II et Arthur de Bretagne en tant que fils de Geoffroy, le frère aîné de Jean. Le défunt roi semblait avoir commencé à considérer Jean comme son héritier légitime peu avant sa mort mais cela n'était pas sans équivoques et la loi médiévale ne permettait pas de résoudre le problème. La situation dégénéra rapidement car Jean était soutenu par la noblesse anglaise et normande et fut couronné à Westminster avec l'appui de sa mère Aliénor tandis qu'Arthur avait le soutien des barons bretons, angevins et de Philippe II. L'armée d'Arthur remontant le val de Loire vers Angers et celles de Philippe II le descendant vers Tours, l'empire continental de Jean risquait d'être coupé en deux.
La Normandie comptait peu de défenses naturelles mais elles étaient solidement renforcées par de puissantes fortifications comme le Château Gaillard. Il était difficile pour un assaillant d'avancer loin en territoire ennemi sans avoir pris le contrôle de ces places-fortes situées en des points stratégiques le long des voies de communication et de ravitaillement. Les armées de l'époque étaient composées de troupes féodales ou de mercenaires. Les premières pouvaient être levées pour une période donnée avant d'être libérées, ce qui causait la fin de la campagne ; les secondes, parfois appelés brabançons d'après le duché de Brabant mais issues de toute l'Europe, pouvaient opérer toute l'année mais leur professionnalisme était compensé par leur coût supérieur aux levées féodales. En conséquence, les commandants de la période s'appuyaient de plus en plus sur les troupes de mercenaires.
Après son couronnement, Jean se rendit en France et adopta une stratégie défensive le long des frontières normandes5 mais les deux camps négocièrent avant la reprise des combats. La position de Jean était alors plus forte car les comtes Baudouin VI de Flandre et Renaud de Boulogne avaient renouvelé leurs alliances anti-françaises. Le puissant baron angevin Guillaume des Roches fut persuadé de changer d'alliance en faveur de Jean et la situation semblait basculer en défaveur d'Arthur et de Philippe II. Personne ne souhaitait cependant poursuivre les combats et les deux souverains se rencontrèrent en janvier 1200 pour négocier une trêve. Du point de vue de Jean, cela représentait une opportunité pour stabiliser ses possessions continentales et créer une paix durable avec la France. Par le traité du Goulet de mai 1200, Philippe II reconnaissait Jean comme l'héritier légitime de Richard Ier pour ses possessions françaises et ce dernier abandonnait sa stratégie d'endiguement de la France via des alliances avec la Flandre et Boulogne et acceptait le roi français comme son suzerain pour ses territoires continentaux. La politique de Jean lui valut le surnom de Jean l'Épée molle de la part de certains chroniqueurs en contraste avec celle plus agressive de Richard Ier.
Paix du Goulet
La nouvelle paix ne dura que deux ans et les combats reprirent en raison de la décision de Jean d'épouser Isabelle d'Angoulême en août 1200. Pour se remarier, il devait d'abord abandonner Isabelle de Gloucester ; pour cela, il avança que leur union était nulle car elle était sa cousine et il n'avait pas obtenu de dispense papale pour l'épouser. Les raisons pour lesquelles Jean voulut épouser Isabelle d'Angoulême sont peu claires. Les chroniqueurs contemporains ont avancé qu'il en était tombé fou amoureux mais il est vrai que les terres de sa future épouse étaient stratégiques ; en contrôlant la région d'Angoulême, Jean obtenait une voie terrestre entre le Poitou et la Gascogne et renforçait son emprise sur l'Aquitaine
Isabelle était cependant déjà fiancée à Hugues IX de Lusignan, un membre influent d'une puissante famille du Poitou et frère du comte Raoul d'Eu qui possédait des terres le long de la frontière sensible entre la Normandie et la France. Si l'union était à l'avantage de Jean, elle menaçait les intérêts des Lusignan qui contrôlaient les routes commerciales et militaires en Aquitaine. Plutôt que de négocier une forme d'indemnisation, Jean traita Hugues X avec mépris ; cela entraîna un soulèvement des Lusignan qui fut rapidement écrasé par Jean qui intervint également contre Raoul en Normandie.
Même si Jean était comte de Poitou et donc le suzerain des Lusignan, ces derniers pouvaient se plaindre de ses actions à son propre suzerain, Philippe II. Hugues X fit exactement cela en 1201 et le roi de France convoqua Jean à Paris en 1202 en citant le traité du Goulet pour appuyer sa demande. Le roi d'Angleterre ne souhaitait pas affaiblir son autorité dans l'Ouest de la France en acceptant et il répondit qu'il ne pouvait accepter en raison de son statut de duc de Normandie que la tradition féodale exemptait de devoir se présenter à la cour de France. Philippe II avança qu'il le convoquait non pas en tant que duc de Normandie mais comme comte de Poitou et à la suite d'un nouveau refus, il déclara que Jean ne respectait pas ses responsabilités de vassal ; il attribua toutes ses possessions françaises à Arthur de Bretagne à l'exception de la Normandie qu'il prit pour lui et se lança dans une nouvelle guerre.
Perte de la Normandie
Jean adopta initialement une stratégie défensive similaire à celle de 1199 en évitant les batailles rangées et en défendant ses forteresses. Philippe II fit néanmoins des progrès à l'est tandis que Jean apprit en juillet que les forces d'Arthur menaçait sa mère Aliénor qui se trouvait au château de Mirebeau. Accompagné de Guillaume des Roches, son sénéchal en Anjou, il envoya ses mercenaires pour la secourir. Ses forces prirent Arthur par surprise et ce dernier ainsi que de nombreux commandants rebelles furent faits prisonniers. Son flanc sud affaibli, Philippe II fut contraint de se retirer et de se redéployer dans le val de Loire.
La victoire de Mirebeau renforça grandement la position de Jean en France mais il la gaspilla par son traitement des prisonniers et de Guillaume des Roches. Ce dernier était un puissant noble angevin mais le roi anglais ignorait fréquemment ses avis tandis que les chefs rebelles capturés furent détenus dans des conditions telles que 22 moururent. À une époque où les nobles d'une même région entretenaient d'étroites relations familiales, ce traitement de leurs proches était inacceptable; Guillaume des Roches et plusieurs alliés de Jean en France rallièrent Philippe II tandis que la Bretagne se souleva69. Cela fit basculer l'équilibre des forces car le roi de France disposait à présent d'un avantage considérable en termes de soldats et de ressources..
D'autres défections dans le camp de Jean en 1203 réduisirent à nouveau sa capacité à combattre et il demanda sans succès au pape Innocent III d'intervenir. Il semble qu'il ait alors décidé de faire assassiner Arthur pour éliminer un potentiel rival et saper l'insurrection bretonne. Arthur avait initialement été détenu à Falaise avant d'être emmené à Rouen. Son destin après cela est inconnu mais les historiens modernes considèrent qu'il fut tué par Jean. Les annales de l'abbaye Margan indiquent que Jean avait capturé Arthur et l'avait gardé en prison pendant quelque temps dans le château de Rouen... Alors que Jean était ivre, il a occis Arthur de ses propres mains et a accroché une lourde pierre à son corps avant de le jeter dans la Seine. Les rumeurs sur les circonstances de la mort d'Arthur affaiblirent encore le soutien dont disposait Jean dans la région.
La perte de Château Gaillard porta un coup dévastateur à la position militaire de Jean en France.
À la fin de l'année 1203, Jean tenta de secourir Château Gaillard assiégé par Philippe II via une opération impliquant des forces terrestres et navales ; les historiens considèrent qu'il s'agissait d'une manœuvre innovante mais trop complexe pour les possibilités de l'époque. Les forces françaises repoussèrent l'assaut et Jean se tourna vers la Bretagne pour tenter de réduire la pression à l'est de la Normandie. Il ravagea le territoire mais cela n'eut pas d'effet sur le déroulement de la campagne. Les historiens sont en désaccord sur les qualités militaires démontrées par Jean durant la campagne mais les études les plus récentes tendent à les considérer comme médiocres.
La situation de Jean commença à se détériorer rapidement. Philippe II contrôlait de plus en plus de territoires dans l'est de la Normandie tandis que les défenses anglaises en Anjou avait été affaiblies par la cession par Richard Ier de forteresses stratégiques. Le soutien des nobles locaux fut encore réduit par le déploiement de troupes de mercenaires qui se livrèrent à de nombreux pillages dans la région. Jean retraversa la Manche en décembre après avoir ordonné l'établissement d'une nouvelle ligne défensive à l'ouest de Château Gaillard. En mars 1204, la forteresse tomba et la mère de Jean mourut le mois suivant. Cela ne fut pas seulement une tragédie personnelle pour Jean car cela menaçait de ruiner le fragile réseau d'alliance établies dans le sud de la France. Philippe II contourna la nouvelle ligne défensive par le sud et envahit le cœur du duché de Normandie avant de se tourner vers l'Anjou et le Poitou où il ne rencontra qu'une faible résistance. En août, Jean ne contrôlait plus en France que le duché d'Aquitaine.
Politique intérieure Gouvernance
Exemplaire d'un pipe roll datant de 1194. Ces documents fiscaux royaux furent l'une des conséquences de la croissance de la bureaucratie au début du XIIIe siècle
La forme de gouvernance en vigueur dans l'Empire Plantagenêt est mal connue. Les prédécesseurs de Jean avaient gouverné selon le principe vis et voluntas force et volonté, en prenant des décisions, parfois arbitraires, qui étaient souvent justifiées par le fait que le roi était au-dessus des lois. Henri II et Richard Ier avaient tous deux avancé que les rois étaient de droit divin et Jean continua sur cette voie. Cette idée n'était pas partagée par tous les contemporains et beaucoup d'auteurs estimaient que le roi devait gouverner en accord avec les lois et les coutumes et devait respecter les avis des principaux nobles du royaume. Rien n'était cependant prévu si le roi refusait de faire ainsi. Même s'il revendiquait être la seule autorité en Angleterre, Jean chercha parfois à justifier ses actions en avançant qu'il avait pris conseil auprès des barons. Les historiens modernes restent divisés sur la question de savoir si Jean souffrait d'une sorte de schizophrénie royale dans sa gouvernance ou si ses actions reflétaient la nature complexe de la monarchie Plantagenêt du début du XIIIe siècle.
Jean hérita en Angleterre d'une administration complexe composée de plusieurs offices : la Chancellerie conservait les documents écrits et les correspondances ; le Trésor et l'Échiquier étaient respectivement chargés de la gestion des recettes et des dépenses du royaume tandis que des juges rendaient la justice dans tout le pays86. Sous l'impulsion d'hommes comme Hubert Walter, cette évolution vers la conservation des documents royaux se renforça durant son règne. Comme ses prédécesseurs, Jean gouvernait une cour itinérante et s'occupait des questions locales et nationales durant ses déplacements dans le Royaume. Jean était très actif dans la gouvernance de l'Angleterre et en ce sens, il suivait la tradition d'Henri Ier et d'Henri II. Cependant, la croissance de la bureaucratie au XIIIe siècle rendit très difficile ce type de gestion car le souverain n'était plus capable de suivre tout ce que faisait son administration. Jean resta en Angleterre pendant de plus longues périodes que ses prédécesseurs et il s'impliqua donc plus dans la gestion de régions auparavant ignorées comme le Nord de l'Angleterre.
Jean s'intéressa particulièrement aux questions judiciaires. Henri II avait introduit de nouvelles procédures comme les assizes de novel disseisin et de mort d'ancestor qui élargissaient et renforçaient le rôle des tribunaux royaux dans les affaires locales qui étaient auparavant traitées uniquement par les cours ou les seigneurs locaux. Jean accrut le professionnalisme des juges et s'efforça de garantir le bon fonctionnement du système en intervenant parfois lui-même dans les affaires judiciaires. L'historien Lewis Warren estime que Jean exerça son devoir royal de rendre la justice... avec un zèle et un acharnement pour lesquels la loi anglaise est grandement redevable. D'autres spécialistes ont néanmoins avancé que le souverain était plus motivé par la perspective d'obtenir de l'argent via les amendes plutôt que par le désir de rendre la justice ; le système judiciaire s'appliquait également uniquement aux hommes libres et non pas à l'ensemble de la population notamment les serfs. Ces évolutions étaient néanmoins populaires chez les paysans aisés qui pouvaient faire appel à un système judiciaire plus fiable mais elles mécontentaient les barons qui n'avaient plus la possibilité d'influer sur les affaires locales et restaient soumis à l'arbitraire de la justice royale.
Économie
L'un des principaux défis de Jean était de trouver les ressources nécessaires pour financer les expéditions destinées à reconquérir la Normandie. Les souverains Plantagenêt disposaient de trois sources de revenus : ceux issus de leurs domaines fonciers ou demesne, les tributs venant de leurs vassaux et les recettes issues des taxes et impôts. Les revenus des domaines royaux étaient relativement figés car dépendant de la productivité des terres et avaient lentement diminué depuis la conquête normande au XIe siècle. La situation fut compliquée par la vente de nombreuses possessions royales par Richard Ier en 1189 tandis que les taxes et impôts ne représentaient qu'une faible part dans les revenus du Trésor. Les rois anglais disposaient de nombreux droits féodaux qu'ils pouvaient utiliser pour accroître leurs revenus comme l'écuage qui permettaient aux nobles de ne pas participer aux campagnes militaires de leur suzerain en échange du paiement d'une indemnité. Par ailleurs, le roi pouvait tirer des revenus des amendes, de pénalités diverses ou de la vente de chartes et d'autres privilèges. Jean s'efforça d'accroître toutes ses sources de revenus au point qu'il fut décrit comme avare, pingre, radin et obsédé par l'argent. Il utilisa également ce besoin d'argent à des fins politiques pour renforcer son contrôle sur les barons. Les dettes que ces derniers avaient contractées auprès de la Couronne pouvaient être annulées s'ils le soutenaient tandis que les demandes de remboursement pouvaient être fermement exigées dans le cas de ses opposants.
Les efforts du souverain pour accroître ses revenus débouchèrent sur une série de réformes innovantes mais très impopulaires. Jean leva onze fois l'écuage durant ses 17 ans de règne, autant que ses trois prédécesseurs rassemblés. Dans de nombreux cas, cela avait été réalisé en l'absence de toute campagne militaire, ce qui dénaturait l'idée originelle selon laquelle l'écuage était une alternative au service militaire. Il poussa également à l'extrême son droit de demander des droits de succession à la mort d'un noble, en exigeant des sommes exorbitantes, bien au-delà des capacités de paiement des barons. Jean réitéra la fructueuse vente des fonctions de shérif de 1194 mais les nouveaux officiers remboursèrent leur investissement en augmentant les amendes et les pénalités, notamment dans les régions forestières. Une autre innovation de Richard Ier, une taxe sur les veuves voulant rester célibataires, fut accrue par Jean et il continua à vendre des chartes pour la création de nouvelles villes comme Liverpool ou de nouveaux marchés en Gascogne. Le roi introduisit de nouvelles taxes et en augmenta d'autres. Les juifs étaient déjà lourdement taxés en échange de la protection royale contre les persécutions mais leur imposition fut encore accrue ; la communauté dut payer 44 000 livres pour la taille de 1210 dont la plus grande partie alla entre les mains des débiteurs chrétiens des préteurs juifs. Jean instaura en 1207 une taxe sur le revenu similaire à l'impôt sur le revenu moderne qui rapporta 60 000 livres dans les coffres de la Couronne ainsi que de nouveaux droits de douane. En plus de rapporter des sommes colossales, ces taxations avaient également l'avantage de permettre à Jean de confisquer les terres des barons qui ne pouvaient ou refusaient de payer.
Au début du règne de Jean, l'économie anglaise fut frappée par une série de mauvaises récoltes qui fit augmenter le prix des céréales et des animaux. Cela entraîna une inflation qui perdura jusqu'à la fin du XIIIe siècle et eut des conséquences à long-terme sur le Royaume. La situation économique fut par ailleurs déstabilisée par des vagues déflationnistes provoquées par les campagnes militaires du roi. Il était en effet de coutume à l'époque que le roi collecte les taxes et les impôts en argent qui était ensuite frappé sous forme de nouvelles pièces ; ces dernières étaient alors stockées en tonneaux avant d'être envoyées dans les châteaux dans tout le pays pour payer les mercenaires et les coûts annexes. En prévision des campagnes en Normandie, Jean accumula d'immenses quantités d'argent qui n'étaient plus disponibles pour l'économie pendant des mois.
Relations avec la noblesse
Jean était entouré par plusieurs groupes de courtisans. L'un d'eux était le familiares regis, composé de ses amis et des nobles qui l'accompagnaient dans ses déplacements dans son royaume. Ils jouaient également un rôle important dans l'organisation de ses campagnes militaires. Un autre groupe était la curia regis regroupant les principaux membres de l'administration royale. Intégrer ce proche entourage permettait d'obtenir les faveurs du roi, d'épouser une riche héritière, d'obtenir gain de cause devant la justice ou de voir ses dettes effacées. À partir du règne d'Henri II, ces fonctions furent de plus en plus accordées à des nouveaux hommes n'appartenant pas à la haute noblesse. Cela s'intensifia durant le règne de Jean avec l'intégration de nombreux membres de la basse noblesse ou de la gentry souvent originaires du continent ; beaucoup étaient des chefs mercenaires du Poitou comme Falkes de Breauté, Geard d'Athies, Engelard de Cigongé et Philip Marc qui se firent tristement connaître en Angleterre pour leur conduite. De nombreux barons percevaient cette cour royale comme, selon l'historien Ralph Turner, une clique profitant des faveurs royales aux dépens des barons et composée de membres sans envergure.
Ce mécontentement des barons fut exacerbé par la personnalité de Jean et la tradition Plantagenêt du ira et malevolentia colère et rancœur. Sous Henri II, cette expression commença à être utilisée pour décrire le droit du roi à exprimer son mécontentent envers certains nobles ou ecclésiastiques qui perdaient ainsi le soutien de la Couronne. L'une des victimes les plus célèbres de cette pratique fut Thomas Becket qui fut assassiné par des partisans du roi Henri II durant une dispute avec le souverain concernant les constitutions de Clarendon. Associé à ses pouvoirs judiciaires et économiques, la menace de la colère royale renforçait encore la capacité de Jean à affaiblir ses vassaux.
Jean se méfiait fortement des barons, notamment les plus puissants qui pouvaient potentiellement menacer son autorité. Plusieurs d'entre-eux furent la cible de sa malevolentia y compris Guillaume le Maréchal, un célèbre chevalier souvent présenté comme un modèle de loyauté. Il obligea notamment le puissant seigneur des Marches William de Braose à payer 40 000 marcs environ 26 666 livres de l'époque et quand ce dernier refusa, il fit emprisonner son épouse et l'un de ses fils. Ces derniers moururent en détention tandis que de Braose périt en exil en 1211 et ses petits-fils ne furent libérés qu'en 1218. En raison de cette sévérité et de la méfiance de Jean, même ses plus fervents partisans entretenaient des relations difficiles avec le roi.
Vie privée
La vie privée de Jean impacta largement son règne. Les chroniqueurs contemporains ont avancé qu'il était outrageusement débauché et impie. Il était habituel pour les rois et les nobles de l'époque d'avoir des maîtresses mais les chroniqueurs se lamentaient que celles de Jean étaient des femmes mariées, ce qui était jugé inacceptable. Il eut au moins cinq enfants avec des maîtresses durant son premier mariage avec Isabelle de Gloucester, et deux d'entre-elles appartenaient à la noblesse. Son comportement après l'annulation de son premier mariage est moins connu. Aucun enfant illégitime ne lui a été attribué et aucune preuve n'indique un possible adultère même si Jean eut certainement des relations avec les femmes de sa cour. Les historiens estiment que les accusations spécifiques lancées durant les révoltes des barons ont généralement été inventées pour justifier les soulèvements mais la plupart de ses contemporains semblaient déplorer le comportement sexuel du souverain.
La nature de la relation de Jean avec sa seconde épouse Isabelle d'Angoulême est mal connue. Cette dernière était relativement jeune et si sa date de naissance exacte est inconnue, les historiens estiment qu'elle avait au maximum 15 ans et plus probablement 9 ans au moment de leur mariage en 1200. Même selon les normes de l'époque, cela était très jeune. Jean n'accorda pas beaucoup d'argent à la suite d'Isabelle au point que l'historien Nicholas Vincent l'a décrit comme franchement malveillant »129. Vincent conclut que leur mariage ne fut pas particulièrement heureuxmais d'autres aspects suggèrent une relation plus proche et positive. Les chroniqueurs écrivirent que Jean était complètement fou d'Isabelle et ils eurent cinq enfants. L'historien William Chester Jordan estime qu'ils formèrent un couple amical et que leur mariage fut une réussite selon les normes de l'époque.
Le manque de dévotion religieuse de Jean avait été noté par ses contemporains et certains historiens ont avancé qu'il était impie voire athée, ce qui était extrêmement mal accepté à l'époque. Ses habitudes anti-religieuses furent largement documentées par les chroniqueurs comme son refus de faire la communion, ses remarques blasphématoires et ses plaisanteries sur la doctrine de l'Église notamment sur l'improbabilité de la Résurrection. Ses contemporains notèrent également la faiblesse de ses donations aux œuvres caritatives de l'Église. L'historien Frank McLynn avance que la jeunesse de Jean à l'abbaye de Fontevraud et son haut niveau d'éducation sont peut-être à la source de son hostilité à la religion. D'autres historiens sont néanmoins plus prudents avec les documents de l'époque et notent que les chroniqueurs rapportèrent également son intérêt personnel pour la vie de Wulfstan de Worcester et son amitié avec plusieurs ecclésiastiques dont notamment Hugues d'Avalon qui fut par la suite canonisé. Les documents sur les dépenses de la cour indiquent qu'elles suivaient normalement les fêtes religieuses même s'il est également fait mention des donations royales aux pauvres pour expier la conduite peu orthodoxe de Jean.
Fin de règne 1204-1214 Politique continentale
Jusqu'à la fin de son règne, Jean essaya de récupérer la Normandie mais il dut affronter de nombreuses difficultés. L'Angleterre devait être protégée contre une possible invasion française, les voies maritimes vers l'Aquitaine devaient être sécurisées à la suite de la perte des routes terrestres et le contrôle de la Gascogne devait être assuré malgré la mort d'Aliénor en 1204. Jean prévoyait d'utiliser le Poitou comme base d'opérations pour soutenir une offensive le long de la Loire et menacer Paris, ce qui immobiliserait les forces françaises et permettrait à une seconde force de débarquer en Normandie. Jean espérait par ailleurs obtenir l'entrée en guerre à ses côtés des voisins orientaux de la France comme la Flandre, ravivant ainsi la stratégie d'encerclement de Richard Ier. Tout cela allait cependant nécessiter beaucoup de soldats et d'argent.
Jean consacra une grande partie de l'année 1205 à protéger l'Angleterre d'une éventuelle attaque française. Sa première mesure fut de recréer les Assizes de 1181 d'Henri II par lesquelles chaque comté devait mobiliser des levées locales. Lorsque la menace d'invasion s'éloigna, Jean rassembla en Angleterre une grande armée devant être déployée dans le Poitou ainsi qu'une grande flotte sous son commandement pour attaquer la Normandie. Pour parvenir à ses fins, il réforma le système féodal de contribution militaire pour le rendre plus flexible ; seul un chevalier sur dix serait mobilisé mais il serait soutenu financièrement par les neuf autres et pourrait ainsi combattre indéfiniment. Jean développa également un corps professionnel d'arbalétriers et renforça les capacités de ses troupes à mener des sièges. Au niveau du commandement, le roi était épaulé par les barons les plus expérimentés tels que Guillaume de Longue-Épée, Guillaume le Maréchal, Roger de Lacy et, jusqu'à ce qu'il perde les faveurs du roi, William de Braose.
Jean avait déjà commencé à améliorer ses forces navales avant la perte de la Normandie et la construction de nouveaux vaisseaux s'accéléra par la suite. Les navires étaient stationnés dans les Cinq-Ports dans le Kent mais le port de Portsmouth fut également agrandi. À la fin de l'année 1204, il disposait d'environ 50 grandes galères et une cinquantaine d'autres furent construites entre 1209 et 1212. William de Wrotham fut nommé gardien des galères, faisant de lui le principal amiral du roi.
L'agitation des barons anglais empêcha le départ de l'expédition de 1205 et seule une faible force commandée par Guillaume de Longue-Épée fut déployée dans le Poitou. En 1206, Jean se rendit lui-même dans la région mais dut se rendre vers le sud pour repousser une attaque d'Alphonse VIII de Castille contre la Gascogne. Une fois ce dernier vaincu, il retourna vers le nord et s'empara de la ville d'Angers. Les contre-attaques de Philippe II furent peu fructueuses et les deux camps acceptèrent une trêve de deux ans à la fin de l'année.
Durant la trêve de 1206-1208, Jean chercha à améliorer sa position financière et militaire en vue d'une nouvelle tentative pour reprendre la Normandie. Il utilisa une partie de son argent pour financer de nouvelles alliances auprès des voisins orientaux de la France qui s'inquiétaient de la montée en puissance du pouvoir capétien. En 1212, une alliance fut signée avec Renaud de Dammartin qui contrôlait Boulogne, Ferrand de Flandre ainsi qu'Otton IV, un des candidats potentiels au titre d'empereur qui était également le neveu du roi anglais. Les plans d'invasion de 1212 furent repoussés en raison du mécontentement des barons anglais qui ne voulaient pas combattre dans le Poitou. Philippe II prit l'initiative l'année suivante en envoyant son fils Louis envahir les Flandres pour préparer une invasion de l'Angleterre. Jean fut contraint d'annuler son débarquement pour contrer cette menace et il envoya sa flotte pour attaquer les Français dans le port de Damme. Cela fut un succès et la destruction des navires de Philippe II éloigna la perspective d'une invasion du moins sur le court terme. Jean chercha à profiter de cette victoire en lançant la reconquête de la Normandie à la fin de la 1213 mais l'agitation de la noblesse le contraignit une fois de plus à repousser l'attaque à l'année suivante.
Écosse, Irlande et Pays de Galles
À la fin du XIIe siècle et au début du xiiie siècle, le tracé de la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse provoquait des frictions entre les deux royaumes car les rois écossais revendiquaient des territoires dans ce qui est aujourd'hui le Nord de l'Angleterre. Henri II avait obligé Guillaume Ier à le reconnaître comme suzerain par le traité de Falaise de 1174. Le texte avait été abrogé en 1189 par Richard Ier en échange d'une compensation financière mais les relations restèrent difficiles. Dès le début de son règne, Jean chercha à réaffirmer sa souveraineté sur les territoires disputés et il refusa les demandes de Guillaume Ier sur le comté de Northumbrie. En revanche, il n'intervint pas dans les affaires intérieures écossaises et se concentra sur ses problèmes en France. Les relations entre les deux rois étaient initialement amicales et ils se rencontrèrent en 1206 et 1207 mais cela changea en 1209 quand des rumeurs indiquèrent que Guillaume Ier voulait s'allier avec Philippe II. Jean envahit l'Écosse et contraignit son roi à signer le traité de Norham par lequel il payait un tribut de 10 000 livres. Cela affaiblit considérablement l'autorité de Guillaume Ier dans son royaume et Jean dut intervenir militairement en 1212 pour le soutenir contre ses rivaux. Il ne fit cependant rien pour réaffirmer le traité de Falaise ; Guillaume Ier et son successeur Alexandre II ne considéraient ainsi pas Jean comme leur suzerain même s'il les soutenait comme tels.
Jean profita de son statut de seigneur d'Irlande pour obtenir les ressources nécessaires à sa guerre sur le continent. L'opposition entre les colons anglo-normands et les habitants historiques de l'île persista tout au long de son règne et il manipula les deux groupes pour accroître son pouvoir. En 1210, le roi écrasa une révolte des barons anglo-normands et il imposa une nouvelle charte exigeant le respect des lois anglaises en Irlande. Jean n'obligea pas les royaumes irlandais locaux à appliquer cette charte mais l'historien David Carpenter avance qu'il l'aurait fait si la révolte des barons n'avait pas eu lieu. Malgré cela, les tensions restèrent fortes entre les chefs locaux et le pouvoir central.
La situation politique au Pays de Galles était assez complexe car le territoire était divisé entre les seigneurs des Marches le long de la frontière, les possessions royales dans le Pembrokeshire et les nobles gallois relativement indépendants en Galles du Nord. Jean s'intéressa particulièrement à la région et il s'y rendit chaque année entre 1204 et 1211 ; il maria également sa fille illégitime Jeanne au prince gallois Llywelyn en 1204. Le roi renforça sa position dans la région par la force en contraignant les seigneurs des Marches et les nobles gallois à reconnaître son autorité. Ces actions étaient mal acceptées et en 1211, Llywelyn tenta d'exploiter l'instabilité provoquée par la chute de William de Braose pour organiser un soulèvement qui fut cependant rapidement écrasé par Jean. Llywelyn fut contraint de céder des terres au roi d'Angleterre mais il s'était imposé comme le principal meneur de la noblesse galloise.
Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10007#forumpost10007
Posté le : 16/10/2015 22:14
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
37 Personne(s) en ligne ( 23 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 37
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages