|
|
21 Juillet F.H.Thiéfaine, fête Nationale Belge, Isaak Stern, 1er pas sur la Lune, R. Burns, Hémingwa |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57662
|
Posté le : 28/07/2013 15:55
|
|
|
|
|
Le bon mot de la semaine 31 |
|
Plume d'Or  
Inscrit:
22/01/2012 16:15
De Alsace
Niveau : 16; EXP : 64
HP : 0 / 391
MP : 105 / 14211
|
J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé...
De Voltaire.
Posté le : 28/07/2013 14:55
|
|
|
|
|
Re: Les expressions |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57662
|
« Clés en main »
Complètement terminé, prêt à être utilisé
Il suffit d'imaginer le garagiste qui remet à l'acheteur la clé de sa voiture flambant neuve fraîchement livrée et préparée pour comprendre le sens de l'expression : la voiture est prête à être utilisée et l'heureux acheteur peut partir avec, après avoir toutefois été délesté de quelques milliers d'euros mais, théoriquement, sans rien avoir à dépenser de plus (à part pour un peu d'essence, si jamais il tient vraiment à rouler avec).
Cette expression nous vient du XVIIIe siècle où, semble-t-il, sous la forme les clés à la main, elle a d'abord été utilisée dans le monde du bâtiment pour désigner une construction complètement terminée à un prix forfaitaire.
La chose semblait être difficile à obtenir à l'époque ; non pas la construction terminée, mais le prix forfaitaire, car, en l'absence d'un maître d'œuvre, chaque artisan y allait de son devis personnel, évoluant au fil de l'avancement du bâtiment et des difficultés rencontrées.
D'ailleurs, en 1863, Charles Nisard, dans son Curiosités de l'étymologie française, évoque un dialogue entre un individu et un architecte où le premier se plaint des devis du second qui sont toujours largement dépassés ; ce dernier se défend en invoquant ceux des artisans qui ne sont pas stables ; l'individu évoque alors un concurrent qui est prêt à lui bâtir une maison pour un montant fixe, la clé à la main ; l'architecte, craignant de voir le marché lui échapper, propose alors de lui bâtir sa maison pour un montant un peu inférieur, mais également la clé à la main.
Il ne fait donc aucun doute que l'expression indique à la fois une maison finie prête à être habitée et pour un montant forfaitaire, sans surprise.
Avec le temps, on a définitivement droit à plusieurs clés et cette locution peut maintenant être employée partout où il est question de mettre à disposition de quelqu'un quelque chose de terminé, directement utilisable et pour un montant fixé, même s'il n'y a pas réellement besoin de clé pour en profiter.
Posté le : 28/07/2013 12:37
|
|
|
|
|
Re: présentation de monlokiana |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57662
|
Bonjour Monlokania, bonne idée, invente, invente, tu nous réjouiras.
Bienvenue parmi nous et j'espère que tu te sentiras bien sur L'ORée.
A bientôt de te lire
Posté le : 28/07/2013 00:50
|
|
|
|
|
présentation de monlokiana |
|
Débutant  
Inscrit:
23/07/2013 22:48
De saint-louis, sénégal
Niveau : 1; EXP : 0
HP : 0 / 0
MP : 0 / 0
|
alors, j'ai 20 ans je suis sénégalaise, j'adore écrire même si j'ai pas eu le temps de beaucoup le faire à cause de la fac...
J'aimerais beaucoup reprendre mes stylos et inventer, inventer...
Posté le : 27/07/2013 23:37
|
|
|
|
|
Karl Popper |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57662
|
Le 28 Juillet 1902 naît Karl Popper
Sir Karl Raimund Popper 28 juillet 1902 à Vienne, Autriche - 17 septembre 1994 à Londres, Croydon, Royaume-Uni, est un philosophe des sciences du XXe siècle.
Philosophe et épistémologue britannique d'origine autrichienne.
Influencé par Socrate, Xénophane, Carnéade, Kant, Bolzano, Frege, Russell, Einstein, Carnap, Hayek, Tarski, Lorenz, Brouwer, Darwin
Il a influencé Hayek, Lakatos, Feyerabend, Soros, Gombrich, Schmidt, Lorenz, Medawar, Albert.
Ces principaux intérêts : Philosophie des sciences, épistémologie, logique, mathématiques, physique, théorie de l'évolution, philosophie politique
ces idées remarquables : Réfutabilité, société ouverte, épistémologie évolutionniste
En repensant les questions de méthode et de théorie dans une perspective critique, Karl Popper redéfinit les critères de différenciation entre science et métaphysique.
Il fut au XXe s. le dernier philosophe capable d’embrasser dans une ample réflexion la culture dans toute la diversité des sciences expérimentales, humaines et sociales.
Il critique la théorie vérificationniste de la signification et invente la réfutabilité comme critère de démarcation entre science et pseudo-science.
Rejetant d'abord la métaphysique comme système irréfutable et invérifiable, il admet par la suite la nécessité de fonder les recherches scientifiques sur des programmes de recherche métaphysique et inscrit son propre travail dans le cadre de l'épistémologie évolutionniste.
Dans son Autobiography, il se présente comme ayant une vie humainement riche et équilibrée et un grand bonheur privé, mais aussi une vive sensibilité aux menaces politiques.
Son style offre souvent une verdeur et une vivacité très stimulantes pour le lecteur ; parfois, il se fait presque sommaire à force de radicalité, ou bien il s'alourdit par excès de scrupule et par surcroît d'information. Sa formation s'est effectuée à partir de Frege et de Tarski, puis dans un dialogue avec Quine et avec Carnap, à qui revient, en l'occurrence, le rôle laborieux et constructif du proposant.
Popper ne veut être ni un philosophe du langage ni un philosophe de la croyance : plus que les significations lui importent les vérités. Dans le domaine des sciences exactes comme dans celui des sciences humaines, cet épistémologue, qui est l'un des grands de notre temps, n'a cessé de nous avertir que le roi est nu .
Dans la logique de la découverte scientifique, comment distinguer, plus précisément comment démarquer la science véritable des pseudo-sciences : mythologies, gnoses, idéologies, métaphysiques ?
Telle est l'une des questions initiales auxquelles Popper se trouva très jeune confronté, lorsqu'il rencontra la psychanalyse, puis le marxisme, enfin – rencontre décisive – les théories d'Einstein. En premier lieu, Popper rejette la thèse classique selon laquelle les sciences se caractériseraient par leur méthode inductive. Il fait une critique radicale de cette dernière et résout de manière drastique le fameux problème de Hume : il n'existe ni méthode ni logique inductives.
Ce n'est pas par un quelconque procédé inductif que l'on parvient aux théories scientifiques. La formation d'une hypothèse est un exercice actif et créateur, non un enregistrement passif de régularités données. Et même si l'induction elle-même permettait d'arriver aux hypothèses, ce n'est certes pas elle qui les justifierait. Une telle critique vise, après Hume, les néo-positivistes du Cercle de Vienne. Ceux-ci, en effet, s'efforçaient de distinguer énoncés pourvus de sens et énoncés dépourvus de sens, la vérifiabilité empirique fournissant la condition nécessaire, et donc le critère, pour qu'un énoncé soit pourvu de sens et puisse bénéficier d'un statut scientifique.
Popper substitue à cette thèse une idée moins ambitieuse, qui lui avait été suggérée par Einstein et selon laquelle ce qu'il appellera du terme désormais classique de testabilité constitue la marque de la scientificité des énoncés comme des théories.
Ce qui m'a impressionné le plus, note Popper à propos d'Einstein, est qu'il considérait sa théorie comme insoutenable si elle ne résistait pas à l'épreuve de certains tests.
L'attitude scientifique est ainsi l'attitude critique qui ne cherche pas des vérifications mais des tests cruciaux, des tests qui peuvent réfuter la théorie, mais ne parviennent jamais à l'établir définitivement.
L'une des conséquences de l'adoption d'un tel critère de démarcation est le statut à jamais hypothétique des théories scientifiques. Une hypothèse qui résiste aux épreuves n'est jamais confirmée de manière concluante.
Elle survit , elle est corroborée, dans la mesure même où elle était réfutable. La science n'est pas un système d'énoncés certains ou bien établis ; notre science n'est pas savoir "épistémè", elle ne peut jamais prétendre avoir atteint la vérité .
Nous ne savons pas, nous pouvons seulement conjecturer.
La démarche de la science se présente ainsi comme une méthode de conjectures audacieuses et de tentatives ingénieuses et sévères pour réfuter celles-ci .
C'est à partir de l'élaboration effective de la science que Popper peut récuser toute prétention de type dogmatique et scientiste, sans pour autant verser dans le scepticisme qui suit les exigences déçues : que toutes nos théories restent des suppositions, des conjectures, des hypothèses , c'est là tout le solide et la meilleure part de la connaissance humaine.
La position de Popper entraîne une autre conséquence qui concerne les discours de type gnostique, totalisant, dialectique : elle souligne qu'ils sont capables de tout expliquer et de tout absorber, qu'ils trouvent partout des vérifications et des confirmations de leur bien-fondé. On imaginerait difficilement quel type de fait ou d'expérience aurait pour eux valeur de réfutation, voire de simple objection.
Biographie
Karl Popper est né de parents juifs convertis au protestantisme. Il commence sa vie active comme apprenti ébéniste.
Puis il étudie à l'Université de Vienne.
Il adhère un temps au Parti social-démocrate d'Autriche à l'époque marxiste.
Il devient enseignant au Lycée en mathématiques et physique. Il côtoie le Cercle de Vienne néopositiviste, qui le fit connaître, mais sans jamais y entrer.
Sa pensée fut influencée par ses lectures de Frege, Tarski et Carnap.
En 1936, il donna des conférences en Grande-Bretagne, où il rencontra ses compatriotes Hayek et Gombrich.
En 1937, il accepta une proposition de conférencier lecturer à Christchurch en Nouvelle-Zélande, où il resta le temps de la Seconde Guerre mondiale.
Début 1946, il revint s'installer à Londres. Sur une proposition de Hayek, il devint professeur à la London School of Economics.
Il y fonda en 1946 le département de logique et de méthodologie des sciences.
Il participa également à de nombreux séminaires et conférences dans d'autres universités, notamment américaines.
Il était membre de la British Academy.
Il prit sa retraite d'enseignant en 1969 et mourut le 17 septembre 1994, sans avoir eu le temps de rédiger la préface de son dernier recueil de conférences Toute vie est résolution de problèmes.
Sa pensée
Philosophie des sciences
Le problème de la démarcation
Dans "Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance" K. Popper. Ed. Hermann que sont pour Popper le problème de l'induction ou "problème de Hume", et le problème de la démarcation ou "problème de Kant", l'auteur précise que puisqu'aucune théorie universelle stricte n'est justifiable à partir d'un principe d'induction sans que cette justification ne sombre dans la régression à l'infini, ceci implique, notamment, qu'aucun énoncé de ce genre ne peut être vérifié sur la base d'un dénombrement d'énoncés particuliers.
Il s'ensuit qu'il faut donc considérer l'induction comme un mythe dans l'élaboration de toute connaissance objective, et que le passage à un autre mode d'évaluation des théories, devient, par cette voie, logiquement nécessaire : si l'on ne peut évaluer le contenu empirique des énoncés universels stricts de la Science, sur la base de leur sous-classe d'énoncés particuliers permis par eux, il est par contre possible de les évaluer à partir de tests permettant de confirmer ou d'infirmer l'occurrence d'un seul de leurs énoncés interdits, ou, comme l'écrit Popper dans La logique de la découverte scientifique, les falsificateurs potentiels des énoncés universels stricts.
Pour Popper, le problème fondamental en philosophie des sciences est donc celui de la démarcation : c'est la question de la distinction entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la métaphysique, sachant que pour Popper, son critère de démarcation est avant tout un critère permettant de distinguer deux types d'énoncés : scientifiques et métaphysiques.
D'où, par exemple, son opposition aux thèses du Cercle de Vienne, lesquelles proposaient d'éliminer complètement la métaphysique, à tous les stades de l'élaboration de la science, alors que Popper défendait l'idée que toute science nécessite, à ses débuts, dans ses engagements ontologiques, des énoncés métaphysiques, lesquels doivent être, soit éliminés progressivement , soit transformés en énoncés testables.
Pour comprendre ce problème, il s'interroge d'abord sur la place de l'induction dans la découverte scientifique : toutes les sciences sont basées sur l'observation du monde. Comme cette observation est par nature partielle, la seule approche possible consiste à tirer des lois générales de ces observations remarquons que c'est l'approche générale et fondamentale de tout organisme vivant qui apprend de son milieu.
Si cette démarche permet d'avancer, elle ne garantit en aucun cas la justesse des conclusions.
Pour Popper, il faut donc prendre au sérieux l'analyse de Hume qui montre l'invalidité fréquente de l'induction.
Par exemple, une collection d'observations.
Je vois passer des cygnes blancs, ne permet jamais d'induire logiquement une proposition générale, Tous les cygnes sont blancs, car la présente observation ne dit rien des observations à venir.
Il reste toujours possible qu'une seule observation contraire, J'ai vu passer un cygne noir, invalide la proposition générale.
Cette critique de l'induction conduit Popper à remettre en cause l'idée que l'on attribue un peu rapidement à tous les positivistes de vérification. Plutôt que de parler de vérification d'une hypothèse, Popper parlera de corroboration, c’est-à-dire d'un test ou d'une séries de tests indépendants mais inscrits dans une tradition de recherche, et qu'une théorie testée aurait passée avec succès. Même par un grand nombre de tests, la corroboration ne permet pas de conclure à la « vérité » d'une hypothèse générale supposée vérifiée pour toutes les observations jusqu'à la fin des temps. La corroboration, pour Popper, demeure donc une sorte de vérité relative aux tests, et n'est jamais identifiable à une vérité absolue, ou un déterminisme absolu.
Une proposition scientifique n'est donc pas une proposition vérifiée avec certitude - ni même vérifiable par l'expérience c'est-à-dire par l'intermédiaire de tests scientifiques-, mais une proposition réfutable ou falsifiable dont on ne peut affirmer qu'elle ne sera jamais réfutée. La proposition « Dieu existe » est pour Popper dotée de sens, mais elle n'est pas scientifique, car elle n'est pas réfutable. La proposition Tous les cygnes sont blancs est une conjecture scientifique.
Si j'observe un cygne noir, cette proposition sera réfutée. C'est donc la démarche de conjectures et de réfutations qui permet de faire croître les connaissances scientifiques.
Il est par ailleurs important de souligner que pour Popper, aucune corroboration, ni même aucune réfutation ne peut être certaine.Cf. K. Popper, in "Le réalisme et la science". Ed. Hermann, ce qui l'écarte de toute accusation de « falsificationnisme naïf. La certitude d'une réfutation est impossible parce que les conditions initiales permettant d'échafauder les tests, dépendent, elles aussi, d'énoncés universels, et il est toujours possible de sauver une théorie d'une réfutation, grâce à des stratagèmes ad hoc. Mais ceci, loin d'être un défaut du critère de démarcation de Popper, représente au contraire une possibilité pour continuer la voie de la recherche, en imaginant des tests toujours plus sévères. Ce sont donc toujours en dernier ressort, des « décisions méthodologiques » reconnue par une communauté de chercheurs, qui permettent d'accepter ou de rejeter les résultats d'une corroboration ou d'une réfutation scientifique. Ceci est la raison pour laquelle, Popper précise que son critère de démarcation doit être compris comme étant un « critère méthodologique » de démarcation. Cf. K. Popper. in "Le réalisme et la science", Ed. Hermann.
Dans cette démarche, la théorie doit donc précéder l'observation.
Il rejette cette méthode de l'induction et formule ainsi une critique méthodologique, indépendante de notre capacité à modéliser les raisonnements inductifs, l'induction étant un type de raisonnement courant d'un point de vue cognitif voir à ce propos le théorème de Cox-Jaynes.
Il va lui substituer le principe de la réfutabilité empirique anglais : falsifiability. C'est ce principe qui va devenir le critère de démarcation entre science et non-science proposé par Popper.
Il peut être ainsi formulé : Si on entend par énoncé de base un rapport d'observation, une théorie est dite scientifique si elle permet de diviser en deux sous-classes les énoncés de base :
la classe des énoncés qui la contredisent, appelés falsifieurs potentiels si ces énoncés sont vrais, la théorie est fausse, la classe des énoncés avec lesquels elle s'accorde si ces énoncés sont vrais, ils la corroborent.
Le critère de falsificabilité de Popper peut être apparenté dans son principe à un test de falsificabilité bayésien, hormis le fait qu'il travaille uniquement en logique discrète vrai/faux tandis que les bayésiens font varier les valeurs de vérité sur une plage continue de l'intervalle.
Le principe de réfutabilité de Popper a été critiqué notamment par Imre Lakatos 1922-1974 et Paul Feyerabend (1924-1994).
Réfuter ou falsifier, une question de vocabulaire
L'accès à l'œuvre épistémologique de Karl Popper est compliqué par l'utilisation du mot falsifier et ses dérivés pour traduire l'anglais falsify et ses dérivés. Comme le signale Catherine Bastyns dans sa Note et remerciements de la traductrice de la version partielle de La connaissance objective publiée en 1978 par les Éditions Complexe : « (Le terme falsifier) construit sur un des termes de l'opposition vrai-faux, (…) avait l'avantage de marquer par son étymologie qu'il s'agissait de démontrer la fausseté, et le désavantage de n'être pas recensé au dictionnaire avec cette signification.
Karl Popper lui a signalé son souhait que « le terme alors en usage falsifier soit remplacé par réfuter et ses dérivés. En effet, ... si en anglais et en allemand, les termes concernés signifient à la fois réfuter et adultérer, en français par contre le terme falsifier n'a que ce dernier sens. Un point intéressant est que, même en anglais, « to falsify » est pour lui le synonyme de to refute.
En pratique, cette recommandation de Popper permet d'éviter une phrase comme La psychanalyse n'est pas une science car elle est infalsifiable pour s'en tenir au plus compréhensible La psychanalyse n'est pas une science car elle est irréfutable.
Les limites du champ d'application
C'est principalement en prenant appui sur des exemples tirés des sciences dites "dures" physique, chimie, etc., que Popper démontre le caractère applicable de son critère. Cf. K. Popper, in Le réalisme et la science". En outre, puisque tout projet scientifique consiste, in fine, à établir par des tests des explications des phénomènes étudiés, lesquelles sont exprimables sous la forme d'énoncés universels au sens strict, Popper en vient à proposer l'indiscutable unité de la méthode scientifique. Pour lui, toute vraie science nécessite des énoncés généraux, mais des énoncés réfutables, et par conséquent un certain type de test qui ne peut obéir, logiquement, qu'à des procédures visant à corroborer ou réfuter les théories.
On considère souvent qu'un domaine est une science si le corpus des théories qui y sont généralement admises respecte les critères de Popper.
En outre, ce caractère scientifique ou non, n'est en rien un indicateur de la vérité scientifique (puisqu'une théorie n'est considérée comme "possiblement" vraie ou proche du vrai que jusqu'à sa réfutation), ni de l'intérêt scientifique : l'histoire des sciences enseigne que beaucoup de théories scientifiques sont nées sur un terreau qui ne respectait pas les critères actuels pour une science.
Le caractère non scientifique d'une théorie est souvent considéré comme synonyme de « sans intérêt scientifique », ce qui sous-entendrait que la science ne se préoccupe que de ce qui est scientifique, alors que la science tente de codifier, justement, ce qui ne l'est pas, par exemple, voir histoire des sciences.
Ceci finit par desservir l'épistémologie et provoquer le rejet de cette théorie par les défenseurs des domaines attaqués. Pour Popper en revanche, la science est "fille de la métaphysique" et celle-ci peut avoir eu de grands mérites heuristiques.
Selon ce critère, l'astrologie, la métaphysique, l'épistémologie, la plupart des sciences humaines ou encore la psychanalyse ne relèvent pas de la science, puisqu'on ne peut en tirer aucun énoncé prédictif testable et qu'en conséquence, aucune expérience ne permet d'en établir ou non la réfutation - et donc une confirmation non plus. En pratique cependant, il n'est pas toujours facile de réfuter une théorie qui échoue à expliquer un fait expérimental, en particulier si on ne dispose pas d'une meilleure théorie.
Dans certains cas, deux théories contradictoires peuvent cohabiter, car l'une et l'autre sont soutenues par certains faits et contredites par d'autres, faute d'une meilleure théorie capable d'unifier ces théories contradictoires.
La physique, qui est pourtant l'exemple type d'une science gouvernée par l'épistémologie de la réfutabilité, nous donne un bon exemple, avec l'énigme de la précession de Mercure que la mécanique newtonienne ne parvenait pas à expliquer, et qui a été résolue par la théorie de la relativité générale, elle-même entrant ensuite en conflit avec certaines des expériences qui soutiennent la mécanique quantique. Différents auteurs ont défendu qu'une démarche scientifique devait reposer sur l'induction, hors les mathématiques et la logique.
Le cas des sciences humaines
Les critères de scientificité de Popper posent problème dans les sciences humaines, où ils sont difficiles voire impossibles à appliquer. En effet :
l'expérimentation contrôlée y est la plupart du temps impossible, notamment dans les sciences sociales ; mais c'est le cas aussi en astronomie, paradigme de la science.
la comparaison de situations observées n'est pas probante car il est impossible d’être sûr que toutes les conditions sont les mêmes ; mais il faut procéder à des analyses situationnelles , lesquelles intègrent des généralités de tout ordre.
il est difficile de séparer les effets des différentes causes qui interviennent dans les situations observées. Mais ce problème est tout à fait général.
Il en résulte que le critère de réfutabilité n’est opératoire que dans les sciences expérimentales ou d’observation, comme l'astronomie ou l'histoire observation critique des documents de tous ordres.
Cette position est celle du dualisme méthodologique, selon lequel les méthodes applicables aux sciences de la nature d'une part, et celles applicables aux sciences humaines d'autre part, sont différentes.
Elle est l'un des fondements de l'École autrichienne d'économie.
Popper quant à lui soutient à la fois l'unité méthodologique de toutes les sciences, et la spécificité des sciences humaines, où un « principe de rationalité est souvent à l'œuvre.
Popper a donc défendu l'unicité du modèle scientifique. Dans une controverse fameuse avec Theodor Adorno, il défend même l'idée que la sociologie comme science sociale, peut se soumettre à la falsifiabilité.
L'ensemble de ce débat est résumé dans un ouvrage : De Vienne à Francfort.
La querelle allemande des sciences sociales, 1979 voir à l'intérieur de cet ouvrage la conférence de Popper : La logique des sciences sociales , et la réponse d'Adorno Sur la logique des sciences sociales.
À l'extrême et à des degrés divers, ce problème donne lieu à des controverses autour de domaines tels que la psychanalyse.
Si ce domaine n'offre aujourd'hui ni preuves expérimentales fiables, ni critères de réfutabilité, il ne peut être totalement exclu que l'évolution technique ou des développements scientifiques futurs changent cet état des choses, non neutre, ce qui est la règle selon Popper.,
Le statut non-scientifique conduit une partie plus ou moins importante selon le domaine incriminé de la communauté scientifique à rejeter ces domaines comme des charlatanismes, surtout si, comme c'est le cas pour l'astrologie, les données disponibles contredisent les thèses des tenants de l'astrologie cf. le fameux effet mars qui n'a jamais été démontré de façon probante.
Mais Popper met en garde aussi contre l'exclusion trop rapide des charlatans , car il y a des idées fécondes parfois apparemment absurdes.
La critique de l'historicisme : pour une vision indéterministe du monde
Les deux ouvrages ouvertement politiques de Popper sont Misère de l'historicisme et La Société ouverte et ses ennemis, écrits tous les deux au titre d'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont pour point focal la critique de l'historicisme et des théories politiques qui en découlent.
Dans la préface à l'édition française chez Plon, 1955 de Misère de l'historicisme, Karl Popper explique :
Qu'il me suffise de dire que j'entends par historicisme une théorie, touchant toutes les sciences sociales, qui fait de la prédiction historique leur principal but, et qui enseigne que ce but peut être atteint si l'on découvre les rythmes ou les motifs patterns, les lois , ou les tendances générales qui sous-tendent les développements historiques.
Le nœud de son argumentation est la preuve strictement logique qu'il est impossible de déterminer le futur, Popper s'étant attaché à défendre l'indéterminisme.
Partant du fait que toutes les théories s'appuyant sur une prophétie ou sur un prétendu cours de l'histoire sont invalides, il critique ainsi particulièrement le marxisme qui ramène toute l'histoire connue à la lutte des classes, ce qui n'est qu'une interprétation féconde parmi d'autres, et surtout prétend prédire la chute du capitalisme et la venue nécessaire du communisme via la dictature du prolétariat.
L'ouvrage est dédié À la mémoire des innombrables hommes, femmes et enfants de toutes les convictions, nations ou races, qui furent victimes de la foi communiste ou fasciste en des Lois Inexorables du Destin de l’Histoire.
Ce qui devait initialement constituer des notes de Misère de l'historicisme prend petit à petit de la consistance et devient La Société ouverte et ses ennemis. Dans cet ouvrage, Karl Popper tente de montrer comment ce qu'il appelle l'historicisme a conduit aux totalitarismes.
Plus particulièrement, il s'attache à critiquer trois philosophes reconnus : Platon, Hegel et Karl Marx.
Il leur reproche l'erreur fondamentale de mettre en place des systèmes philosophiques historicistes, centrés sur une loi "naturelle" d'évolution du monde : la décadence des choses réelles chez Platon, le développement de l'Esprit chez Hegel et la lutte des classes conduisant à la société sans classes chez Marx.
Au système historiciste, Popper oppose une philosophie essentiellement fondée sur l'indéterminisme.
Cette conception suit celle de son épistémologie, selon laquelle la connaissance progresse par essai/erreur, trial and error ce qui se traduit en français par méthode par essais et erreurs : pour résoudre un problème donné le problème est toujours premier, on propose plusieurs hypothèses/solutions qu'il s'agit de tester et on élimine celles qui aboutissent à une erreur.
Popper tire de cette conception une position politique et idéologique : comme il est impossible de prédire le cours de l'histoire, il faut progresser petit à petit par essai/erreur, d'où une conception fragmentaire des sciences sociales piecemeal social engineering dans laquelle rien n'est joué d'avance.
Au lieu de prévoir un plan d'ensemble pour réorganiser la société, il s'agit, au contraire, de procéder par petites touches, afin de pouvoir comprendre l'effet de telle ou telle mesure, et d'en corriger les inévitables conséquences inattendues.
Popper reste toutefois ambigu sur ce point car il reste "progressiste" au sens où il témoigne d'une foi dans le progrès des sciences.
Il pense que les théories successives progressent vers une approximation de plus en plus fine du réel, ce qui a pu provoquer l'accusation absurde de positivisme à son encontre.
Philosophie politique
L'œuvre de Popper ne se limite pas à l'épistémologie.
Même s'il s'est toujours refusé à se présenter comme un philosophe politique, il n'en reste pas moins qu'il s'est beaucoup attardé sur la politique et notamment sur le fonctionnement de la démocratie.
Une vision politique libérale
Les idées politiques de Popper sont donc fondamentalement libérales, comme en témoigne sa participation à la fondation de la Société du Mont Pèlerin au côté de libéraux très engagés comme Ludwig von Mises, Milton Friedman et Friedrich Hayek. Popper propose en effet une vision du monde dans laquelle la liberté de l'homme est fondamentale et doit être protégée.
En particulier, dans sa critique du marxisme et de l'historicisme hégélien, il combat une conception du monde dans laquelle l'homme serait impuissant face à la marche de l'histoire.
Popper soutient au contraire que les idées influencent le monde et l'histoire, et que l'homme, en particulier les philosophes, ont une importante responsabilité.
Le libéralisme de Popper n'exclut pas l'intervention de l'État, y compris dans le domaine économique.
Au contraire, il en fait une condition de l'exercice des libertés des individus, en raison du paradoxe de la liberté :
La liberté, si elle est illimitée, conduit à son contraire ; car si elle n’est pas protégée et restreinte par la loi, la liberté conduit nécessairement à la tyrannie du plus fort sur le plus faible.
Aussi l'État a le devoir de limiter la liberté de telle sorte qu'aucun individu ne doit être amené à être aliéné à un autre :
C'est pourquoi nous exigeons que l'État limite la liberté dans une certaine mesure, de telle sorte que la liberté de chacun soit protégée par la loi.
Personne ne doit être à la merci d'autres, mais tous doivent avoir le droit d'être protégé par l'État.
Je crois que ces considérations, visant initialement le domaine de la force brute et de l'intimidation physique, doivent aussi être appliquées au domaine écrit.
Nous devons construire des institutions sociales, imposées par l’État, pour protéger les économiquement faibles des économiquement forts.
Théorie de la démocratie
Popper ne distingue que deux types de régimes politiques : la démocratie et la tyrannie.
Comme à son habitude, Popper n'attribue pas plus d'importance qu'il n'en faut aux mots ; on ne doit comprendre, par ces deux termes, que des repères terminologiques.
Ainsi, ce n'est pas par l'étymologie que Popper va définir la démocratie, qui serait alors le gouvernement du peuple.
La question classique depuis Platon Qui doit gouverner ? est rejetée par Popper comme étant essentialiste, terme qu'il a inventé, pour celui de réalisme des universaux .
À ce problème, il propose d'en substituer un plus réaliste : Existe-t-il des formes de gouvernement qu'il nous faille rejeter pour des raisons morales ?
Et inversement : existe-t-il des formes de gouvernement qui nous permettent de nous débarrasser d'un gouvernement sans violence ? .
Sera ainsi qualifié de démocratique, un régime dans lequel les dirigeants peuvent être destitués par les dirigés sans effusion de sang.
Tout autre gouvernement dans lequel la destitution des dirigeants ne peut passer que par la violence pourra être qualifié de tyrannique.
Le problème auquel s'attachera Popper sera alors de penser l'organisation de la démocratie de telle sorte que celle-ci permette au mieux la destitution des dirigeants.
C'est pourquoi Popper rejette sans appel la démocratie directe et plus tard le scrutin proportionnel.
En effet, avec la démocratie directe, le peuple est responsable devant lui-même, ce qui est une contradiction : le peuple ne peut se destituer lui-même.
Avec le scrutin proportionnel, la plupart des partis sont nécessairement représentés dans les assemblées dans une plus ou moins grande proportion, quoi qu'il arrive lors des élections, et les partis majoritaires sont alors souvent forcés de devoir gouverner avec eux en créant des coalitions, ce qui signifie en clair que certains partis pourraient toujours participer au pouvoir et ne jamais être destitués.
C'est pourquoi la préférence de Popper va à la démocratie représentative avec scrutin majoritaire, et ce en raison de ce qu’il pense être les faiblesses de la démocratie directe et du scrutin proportionnel.
De plus, il semble marquer une nette préférence pour le bipartisme, où le parti opposant a la charge de critiquer les hypothèses formulées par le parti majoritaire, et inversement.
Le système des primaires internes aux partis permet de rajouter une autocritique des hypothèses à l'intérieur même des partis.
Théorie de l'évolution Une épistémologie évolutionniste
Selon Popper, la sélection des hypothèses scientifiques relèverait d'une sélection naturelle identique à celle régissant l'évolution des espèces, voir Charles Darwin.
Théorie de la vie et théorie de la connaissance répondraient ainsi d'un même processus de progression par essai et élimination de l'erreur, une position assez proche de celle d'Erwin Schrödinger.
C'est pourquoi l'on parle d'épistémologie évolutionniste.
En montrant les analogies existant entre l'évolution des espèces et le développement de la connaissance scientifique, Popper naturalise ce faisant les principes fondamentaux de son épistémologie :
1. Le rejet de l'induction : Selon Popper, la théorie vient avant les faits : les hypothèses précèdent et orientent l'observation.
De même, lorsqu'ils varient, les organismes vivants créent de nouvelles théories sur le monde, de nouvelles hypothèses, que Popper nomme des attentes et qui s'assimilent aux théories scientifiques.
Seules seront retenues celles qui correspondent à une réalité de l'environnement, celles que l'expérience, la confrontation au milieu ne réfute pas. Par exemple, en augmentant leur vitesse de déplacement et leur réactivité face au danger, les antilopes ont théorisé la nécessité de pouvoir fuir rapidement, notamment pour échapper à leurs prédateurs.
Schématiquement, les antilopes actuelles descendent donc de celles qui, par le passé, ont su courir assez vite pour échapper aux lions.
Elles ne l'ont bien sûr pas fait de manière consciente voir Konrad Lorenz et l'imprégnation.
C'est à travers les modifications héréditaires, les mutations génétiques, que le vivant essaie différentes adaptations à l'environnement, différentes solutions - qui génèrent à leur tour de nouveaux problèmes, dans une course au perfectionnement que Popper explique notamment à travers l'hypothèse d'un dualisme génétique.
2. L'élimination de l'erreur : Sélection naturelle darwinienne et sélection naturelle des hypothèses sont identiques dans la mesure où toutes deux mènent à l'élimination de l'erreur.
La seule différence résidant entre Albert Einstein et une amibe est ainsi, selon Popper, que le premier est capable d' extérioriser son erreur à travers le langage, tandis que la seconde est condamné à disparaître avec elle.
Une erreur de calcul ne coûtera pas la vie à Einstein. Une erreur d'adaptation pour l'amibe, si.
3. La résolution de problèmes : En procédant par élimination de l'erreur, la démarche scientifique, tout comme l'évolution, permet de résoudre des problèmes qui, la plupart du temps, n'apparaissent tout à fait clairement qu'une fois résolus. Dans le cas des espèces vivantes, par exemple de l'amibe, ces problèmes doivent être objectifs puisque cette dernière n'est pas consciente.
La résolution de ces problèmes mènent à des niveaux de connaissance et d'évolution supérieurs - en ce qui concerne la biologie à l'émergence de formes de vie plus hautes.
Ainsi, en se basant sur une série d'analogies visant peut-être à fonder ontologiquement le falsificationisme, Popper estime que la science est une activité biologique, en ce qu'elle ressemble à un processus de sélection naturelle, fût-il conscient et orienté.
Ce schéma de sélection naturelle s'articule en trois temps. Soit :
P1 : Problème initial ;
TS : Essai de solution (tentative solution en anglais) ;
EE : Élimination de l'erreur ;
P2 : Nouveau problème.
P1→TS→EE→P2
Un problème initial amène la production d'hypothèses visant à le résoudre (de P1 à TS). Ces hypothèses sont testées par le moyen de l'expérimentation scientifique (de TS à EE). Enfin, la résolution du problème P1 entraîne l'émergence d'un nouveau problèmeP2. La logique de la science tout comme celle de la vie répondent, selon Popper, de ce schéma tétradique.
Le statut épistémologique de la théorie darwinienne
Popper a soutenu que la théorie de l'évolution darwinienne par sélection naturelle n'était pas véritablement scientifique, car irréfutable et quasi tautologique.
En effet, cette théorie énonce que si une espèce survit c'est parce qu'elle est adaptée, et on sait qu'elle est adaptée car on constate sa survie.
Il la qualifia ainsi de programme de recherche métaphysique, ce qui suscita certaines polémiques, parfois très vives.
Les créationnistes tentèrent notamment d'utiliser les thèses poppériennes pour discréditer la théorie de l'évolution.
Le philosophe finit par rectifier ces interprétations dans une lettre adressée au magazine scientifique The New Scientist. Ultimement, il reconnut à la théorie de la sélection naturelle le statut de science véritable : il l'estimait entre autres capable d'expliquer les multiples processus de causation vers le bas. Une position que sa propre métaphysique évolutionniste ne pouvait que renforcer.
Métaphysique des trois mondes
Au contraire des néo-positivistes du Cercle de Vienne, Popper n'oppose pas la science à la métaphysique.
Il a lui-même élaboré une métaphysique mêlant réalisme, indéterminisme et évolutionnisme.
Au cœur de cette métaphysique poppérienne, on trouve la théorie des Mondes :
Le Monde est celui des phénomènes physico-chimiques.
Par Monde, j'entends ce qui, d'habitude, est appelé le monde de la physique, des pierres, des arbres et des champs physiques des forces.
J'entends également y inclure les mondes de la chimie et de la biologie.
Le Monde est celui de la conscience, de l'activité psychique essentiellement subjective.
Par Monde j'entends le monde psychologique, qui d'habitude, est étudié par les psychologues d'animaux aussi bien que par ceux qui s'occupent des hommes, c'est-à-dire le monde des sentiments, de la crainte et de l'espoir, des dispositions à agir et de toutes sortes d'expériences subjectives, y compris les expériences subconscientes et inconscientes.
Le Monde est celui de la connaissance objective des contenus de pensée ou idées.
Par Monde, j'entends le monde des productions de l'esprit humain.
Quoique j'y inclue les œuvres d'art ainsi que les valeurs éthiques et les institutions sociales, et donc, autant dire les sociétés, je me limiterai en grande partie au monde des bibliothèques scientifiques, des livres, des problèmes scientifiques et des théories, y compris les fausses.
Ces différents mondes exercent les uns sur les autres un contrôle plastique, rétroactif.
Mais si les deux premiers sont communs aux animaux et aux hommes, le troisième est exclusivement humain car directement lié à l'émergence d'un langage argumentatif.
Par ailleurs, le Monde possède une autonomie partielle La réalité et l'autonomie partielle du Monde.
Popper : Cela vient principalement du fait qu'une pensée, dès qu'elle est formulée en langage, devient un objet extérieur à nous-mêmes ; un tel objet peut alors être critiqué inter-subjectivement : par les autres aussi bien que par nous-mêmes. . Popper dit lui-même reprendre à Frege cette idée d'un troisième monde, tout en la modifiant.
Les quatre fonctions du langage
Aux trois fonctions du langage distinguées par son ancien professeur viennois Karl Bühler, Popper en ajoute une quatrième : la fonction argumentative. Ces 4 fonctions sont les suivantes :
la fonction expressive ou symptomatique, où l'animal exprime une émotion, par exemple un cri de douleur ;
la fonction de signal, par laquelle l'animal fait passer un message, par exemple par un cri d'alerte ;
la fonction de description, par laquelle l'être doué de langage articulé peut décrire à autrui quelque chose, par exemple le temps qu'il fait ;
la fonction de discussion argumentée, qui permet à l'homme de discuter rationnellement en exerçant ses facultés critiques, en argumentant, par exemple lorsqu'on débat d'un problème philosophique.
Au développement de ces fonctions du langage est corrélée l'émergence des différents Mondes poppériens. En particulier, le Monde, apparaît avec la quatrième fonction du langage, et se développe à partir de la troisième.
Tout comme pour les Mondes, Popper estime que les quatre fonctions du langage exercent les unes sur les autres un contrôle plastique.
Le dualisme néo-cartésien de Karl Popper
Par analogie, Popper affirme pouvoir résoudre le principal problème de la philosophie de l'esprit, celui de la relation corps/âme.
L'âme exercerait un contrôle plastique sur le corps : par exemple, lorsque je me tiens debout, les muscles de mes jambes sont agités d'infimes et indétectables mouvements musculaires visant à assurer la stabilité.
L'âme corrige l'équilibre du corps en éliminant les mouvements non appropriés : elle exerce sur lui un contrôle souple ou plastique.
Ainsi, Popper s'est posé en défenseur du dualisme et plus précisément de l'interactionnisme. Il estimait en outre que l'hypothèse de René Descartes selon laquelle le lieu de cette interaction se situerait dans l'épiphyse ou glande pinéale n'est pas si inepte et improbable que les générations postérieures l'ont laissé entendre.
Mais selon lui, l'esprit n'est pas une substance immatérielle, mais un processus émergent, semblable à une force ou à un champ.
Distinctions et honneurs
Chevalier (Kt - 1965)17
Membre de l'Ordre des compagnons d'honneur (CH - 1982)18
Membre de la British Academy (FBA), élu en 195819
Membre de la Royal Society (FRS), élu en 197620
Titulaire du Prix Tocqueville (1984).
Lauréat du Prix de Kyōto (1992)
Œuvres
Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance (titre original : Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, 1930-1933).
Note de l'éditeur, Hermann : Loin d'être une simple esquisse - bien au contraire, puisque la célèbre logique de la découverte scientifique n'en était à l'origine qu'un résumé - , cette première formulation du falsificationnisme poppérien anticipe certaines idées qui ne réapparaîtront que bien plus tard.
Logique de la découverte scientifique, titre original : Logik der Forschung, Logique de la recherche ; The Logic of Scientific Discovery, 1934)
Misère de l'historicisme (The Poverty of Historicism, 1944-1945)
La Société ouverte et ses ennemis (The Open Society and Its Enemies, 1945) ; la traduction française est un résumé.
Conjectures et réfutations (Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 1963)
La connaissance objective (Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 1972) ; traduction partielle de l'anglais (trois premiers chapitres), 1977, Éditions Complexe, (ISBN 978-2-87027-020-2) ; traduction complète de Jean-Jacques Rosat, Éditions Aubier, 1991.
La quête inachevée (Unended Quest; An Intellectual Autobiography, 1976)
La Télévision, un danger pour la démocratie (1995)
La Leçon de ce siècle, (1993)
The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism, (1977) [coécrit avec le neurophysiologiste John Carew Eccles].
The Open Universe: An Argument for Indeterminism, (1982)
Realism and the Aim of Science, (1982); trad. Hermann 1990.
The Myth of the Framework: In Defence of Science and Rationality, (1994)
Knowledge and the Mind-Body Problem: In Defence of Interactionism, (1994)
Toute vie est résolution de problèmes, 2 tomes, (1997).
Un univers de propensions : deux études sur la causalité, L'Eclat, (1992).
Citations
-« Le succès de Hegel marqua le début de l'âge de la malhonnêteté, ainsi que Schopenhauer décrivait la période de l'idéalisme allemand et de l'âge de l'irresponsabilité, ainsi que K. Heiden qualifiait l'âge du totalitarisme moderne ; d'une irresponsabilité d'abord intellectuelle puis, ce fut l'une de ses conséquences, d'une irresponsabilité morale ; d'un nouvel âge régi par la magie des mots éclatants et par le pouvoir du jargon. La société ouverte et ses ennemis, ch.1
-Libéralisme et intervention de l'État ne sont pas contradictoires ; aucune liberté n'est possible si l'État ne la garantit pas. in La Société ouverte et ses ennemis (1962)
-Cette vague et intangible entité qu'on appelle opinion publique révèle parfois une lucidité sans sophistication ou, plus habituellement, une sensibilité morale supérieure à celle du gouvernement en place.
Néanmoins, elle représente un danger pour la liberté si elle n'est pas limitée par une forte tradition libérale. En tant qu'arbitre du goût, elle est dangereuse ; en tant qu'arbitre de la vérité, elle est inacceptable.Conjectures et réfutations, ch.17, section 8
-Les intellectuels ne savent rien (dira-t-il à 83 ans) dans sa conférence de Zurich La recherche de la paix, Toute vie est résolution de problème.
Plus qu'une provocation, c'est un symbole de la relativité du savoir, et de la stérilité des conflits de doctrines.
-Le seul moyen d’accéder à la science, c’est de rencontrer un problème, d’être frappé par sa beauté, d’en tomber amoureux, de lui faire des enfants problèmes, de fonder une famille de problèmes. (Le réalisme et la science, p. 28)
Liens
http://youtu.be/Qz9wwRc0gUg Conférence Français
http://youtu.be/ztmvtKLuR7I Anglais
 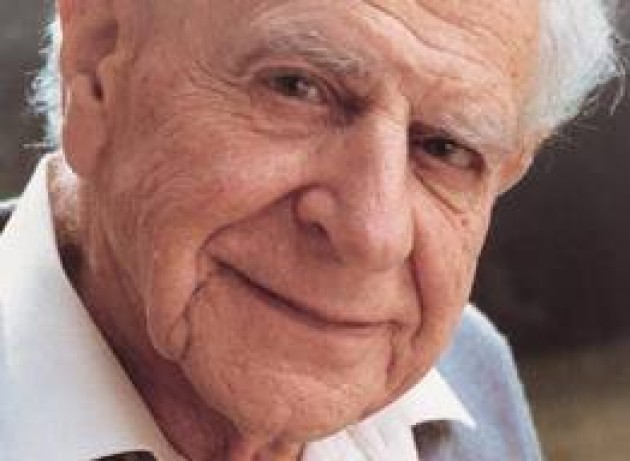
Posté le : 27/07/2013 22:08
Edité par Loriane sur 28-07-2013 14:52:54
Edité par Loriane sur 28-07-2013 14:57:47
|
|
|
|
|
Michel Audiard |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57662
|
Le 28 juillet 1985, décès de Michel Audiard.
Présenté par Iktomi.
L’an dernier, aux obsèques de l’époux d’une collègue, selon la volonté du défunt, on a entendu Ne me quitte pas juste avant que le cercueil passe la porte du crématoire. En sortant du funérarium, un autre collègue m’a fait cette réflexion :
« Tout de même, Brel, c’est pas d’une franche gaieté… », à quoi j’ai répondu du tac au tac :
« T’aurais préféré qu’on passe La bonne du curé ? »
« On dirait du Audiard… » a murmuré mon collègue d’un ton pénétré.
Objectivement, j’ignore si notre petit dialogue était vraiment audiardien. Et de toute façon : « Objectivement est une locution foireuse dont je n’ai que foutre. », dixit Delon dans Mort d’un pourri.
Et c’est diablement vrai, tout bien considéré.
Avec Audiard, on n’est pas dans le domaine de l’objectif.
Avec Audiard, on tourne résolument le dos à l’objectivité, au relativisme, bref, à toutes les minauderies bo-boïsantes qui sont souvent sincères et généreuses mais plus souvent encore cucul la praline.
Avec Audiard, les formules sont brèves, voire expéditives, mais ça veut dire ce que ça veut dire, et tant pis pour ceux qui préfèrent comprendre de travers. Pourtant on trouverait difficilement moins équivoque que la prose d’Audiard. Ce qui n’a pas empêché certains de l’habiller pour l’hiver (du coup, lui, pour les emmerder, il est mort en plein été).
Que n’ai-je pas lu ou entendu sur son compte ? Anarchiste de droite, mais plus de droite que vraiment anar… Xénophobe, voire raciste…
C’est du racisme rampant, ça ? : « Je n'engage que des domestiques idiots, les autres me volent. Où alors, des nègres... Mais on ne trouve plus de nègres. Ils font tous la révolution ou leur licence de lettres. » (Jacqueline Maillan dans Archimède le clochard). « Si le crédit n'existait pas, y'a longtemps qu'l'Afrique serait morte ! » (Belmondo dans Cent mille dollars au soleil). « Le monde est plein d'ennemi du Reich, camouflés, clandestins, têtus... Essayez donc de faire avouer à un Japonais qu'il est juif. Vous verrez si c'est facile... » (Francis Blanche dans Babette s’en va-t-en guerre).
Quant à ses vues en matière politique, il ne faut pas les confondre avec ce qu'il fait dire par exemple à Pierre Larquey et Jean Gabin dans Le président, et dont je ne vous livrerai que ces deux morceaux choisis, qui, avec plus de cinquante ans de recul, restent très actuels : « On est gouvernés par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis. », « C'est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d'en user. »
Au vrai, Audiard n'a jamais fait son mystérieux sur ses antipathies. Exemple : "Je suis un vétéran de l'antigaullisme depuis le 18 juin 1940". Et pourquoi donc, Monsieur Audiard, s'il vous plaît ? "Les gens qui étaient à Londres, je n'ai pas été voir s'ils s'amusaient... mais ils n'avaient pas les emmerdements qu'on avait ici, ils n'avaient pas la Gestapo aux trousses. Ce qui était dangereux sous l'Occupation, c'était pas d'être derrière un micro à Londres, c'était d'écouter Radio-Londres à Paris." Et aussi : "Rien ne m'irrite davantage que ces films sur l'Occupation où l'on voit les Français, courageux et débrouillards, ridiculiser les Allemands. Les Français ont tremblé de peur pendant quatre ans, c'est sans doute le peuple qui s'est conduit le plus mochement..."
Se conduire mochement ou pas, n'est-ce pas un thème récurrent dans tous les films qu'il a dialogués et tournés ? Au fond, Audiard était un moraliste. Il n'y a pas un de ses films dont la leçon finale ne soit pas "Le crime ne paie pas." Après ça, qu'on ne vienne pas raconter qu'il n'a pas fait oeuvre utile. D'ailleurs je lui laisse le mot de la fin : "Vivant, je veux bien être modeste, mais mort, il me paraît naturel qu'on reconnaisse mon génie..."
Biographie
Paul Michel Audiard naît au 2 de la rue Brézin, dans le 14e arrondissement de Paris, quartier populaire à cette époque, où il est élevé par son parrain. Il y poursuit sans grand intérêt des études qui le mènent jusqu'à un certificat d’études et un CAP de soudeur à l’autogène. Passionné très jeune de littérature et de cinéma, il se forge une solide culture en lisant notamment Rimbaud, Proust et Céline et découvre les dialogues de Jeanson et de Prévert. Passionné également de bicyclette, il traîne du côté du vélodrome d'hiver où il rencontre André Pousse, qu'il introduira plus tard dans le métier d’acteur. Songeant un temps à faire carrière dans le vélo, il y renonce toutefois car il « ne montait pas les côtes ». La Seconde Guerre mondiale, à laquelle il ne participe pas, est pour lui une période de privations et la Libération, le spectacle de tristes règlements de comptes.
Le 3 mai 1947, il épouse Marie-Christine Guibert en l'église Saint Dominique (Paris XIVe). « Cri-Cri » lui donnera deux garçons : François (né en 1949, mort en 1975) et Jacques (né le 30 avril 1952). Bien que toujours marié, il a en 1953 un troisième garçon non reconnu, Bruno Meynis de Paulin qui écrit en 2004 Être le fils de Michel Audiard (éd. Michel Lafon).
Au lendemain de la guerre, il vivote comme livreur de journaux, ce qui lui permet d’approcher le milieu du journalisme. Il entre ainsi à l’Étoile du soir où il commence une série d'articles sur l'Asie rédigés sur les comptoirs des bistrots parisiens. La découverte de l'imposture lui valant d'être rapidement remercié, il devient alors critique pour Cinévie. En 1949, le réalisateur André Hunebelle le fait entrer dans le monde du cinéma en lui commandant le scénario d’un film policier, Mission à Tanger, bientôt suivi de deux autres films, trois romans policiers, et des premiers succès d’adaptation de romans au cinéma : (Le Passe-muraille, Les Trois Mousquetaires). Sa notoriété s’étend et, en 1955, il rencontre Jean Gabin à qui il propose le scénario de Gas-oil. Ainsi commence une collaboration de sept ans et 17 films, dont plusieurs grands succès : (Les Grandes Familles, Les Vieux de la vieille, Le Baron de l'écluse, Un singe en hiver), et qui ne s’est que peu interrompue : (Babette s'en va-t-en guerre, Un taxi pour Tobrouk).
Michel Audiard est à présent un scénariste populaire, ce qui lui attire les foudres des jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague pour lesquels il symbolise le « cinéma de papa ». En 1963, après s’être un peu fâché avec Jean Gabin, il écrit pour Jean-Paul Belmondo (100 000 dollars au soleil d'Henri Verneuil) et toute une équipe d’acteurs talentueux, dont Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Blier, Jean Lefebvre, (Les Tontons flingueurs et Les Barbouzes de Georges Lautner). Mais la fâcherie avec Jean Gabin ne dure pas et ils se retrouvent en 1967 pour Le Pacha et collaboreront encore occasionnellement (Sous le signe du taureau de Gilles Grangier ou Le drapeau noir flotte sur la marmite).
En 1966, il entame une carrière de réalisateur et tourne des films dont les titres sont parmi les plus longs du cinéma français : (Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages). Mais après huit films et un documentaire, dont les succès restent médiocres, il revient à sa véritable vocation.
Le 19 janvier 1975, alors qu’il travaille avec le réalisateur Philippe de Broca au scénario de L'Incorrigible, il est durement touché par la nouvelle de la mort de son fils François, tué dans un accident de voiture. Il en conservera une profonde tristesse qui donnera désormais à son œuvre une tonalité plus sombre (Garde à vue et Mortelle randonnée de Claude Miller), même s’il continue par ailleurs à participer à de gros succès populaires (Le Grand Escogriffe, Tendre Poulet, Le Guignolo, Le Professionnel, Canicule). En 1978, il publie un roman en partie autobiographique La nuit, le jour et toutes les autres nuits, pour lequel il reçoit le prix des Quatre jurys. Il obtient la reconnaissance de ses pairs en remportant le César du meilleur scénario en 1982 pour Garde à vue.
Il meurt le 28 juillet 1985 dans sa maison de Dourdan dans le département de l' Essonne, des suites d'un cancer, à l'âge de 65 ans. Il repose au cimetière de Montrouge.
Hommages
Une place dans le 14e arrondissement de Paris porte son nom (place Michel-Audiard).
Michel Sardou lui consacre une chanson en 1992, Le cinéma d'Audiard, coécrite avec Didier Barbelivien, mise en musique par Jean-Pierre Bourtayre. Elle reprend ses répliques les plus célèbres.
Les dialogues des films scénarisés par Michel Audiard font l'objet d'un véritable culte populaire, comme en témoigne le nombre de sites web consacrés au sujet.
Alexandre Astier (créateur de la série Kaamelott) est un inconditionnel de Michel Audiard et affirme s'en inspirer pour les dialogues de sa propre série. Il en a été de même pour Bruno Solo et Yvan Le Bolloc'h pour la série Caméra Café4.
Œuvres[modifier]
Romans
Priez pour elle (Fleuve Noir, 1950)
Méfiez-vous des blondes (Fleuve Noir, 1950)
Massacre en dentelles (Fleuve Noir, 1952)
Ne nous fâchons pas (Plon, 1966)
Le Terminus des prétentieux (Plon, 1968)
Mon petit livre rouge (Presses Pocket, 1969)
Vive la France (Julliard, 1973)
Le Petit cheval de retour (Julliard, 1975)
Répète un peu ce que tu viens de dire (Julliard, 1975)
La Nuit, le jour et toutes les autres nuits (Denoël, 1978) - rééd. 2010
Filmographie
Scénariste et dialoguiste
Années Titres Réalisations Crédité en tant que
1949 Mission à Tanger André Hunebelle Scénariste, adaptation et dialoguiste
On n'aime qu'une fois Jean Stelli Adaptation du scénario
1950 Brune ou blonde (court-métrage) Jacques Garcia scénariste et dialoguiste
Méfiez-vous des blondes André Hunebelle Scénariste, adaptation et dialoguiste
1951 Vedettes sans maquillage (court-métrage) Jacques Guillon Scénariste
Une histoire d'amour Guy Lefranc Scénariste, Adaptation et Dialoguiste
Garou-Garou, le passe-muraille Jean Boyer Adaptation du scénario et dialoguiste
Caroline chérie Richard Pottier non crédité au générique
Ma femme est formidable André Hunebelle non crédité au générique
Massacre en dentelles André Hunebelle Scénariste, adaptation et dialoguiste
L'Homme de ma vie Guy Lefranc adaptation du scénario
Bim le petit âne Albert Lamorisse à confirmer
1952 Adorables Créatures Christian-Jaque non crédité au générique
Pour vous, mesdames Jacques Garcia dialoguiste (non crédité au générique)
Elle et moi Guy Lefranc adaptation et dialoguiste
Le Feu quelque part (court-métrage) Pierre Foucaud Scénariste
Le Duel à travers les âges (Court-métrage) Pierre Foucaud Scénariste
1953 Les Dents longues Daniel Gélin Adaptation et dialogue
Quai des blondes Paul Cadéac Scénariste
Les Trois Mousquetaires André Hunebelle Scénariste et dialoguiste
L'Ennemi public numéro un Henri Verneuil Adaptation et dialoguiste
1954 Destinées Christian-Jaque, Jean Delannoy
et Marcello Pagliero non crédité au générique
Sang et lumières Georges Rouquier Dialoguiste
Les Gaietés de l'escadron Paolo Moffa Scénariste et dialoguiste
Poisson d'avril Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste
1955 Série noire Pierre Foucaud Dialoguiste
Gas-oil Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste
1956 Jusqu'au dernier Pierre Billon Dialoguiste
Le Sang à la tête Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste
Mannequins de Paris André Hunebelle Adaptation et dialoguiste
Courte tête Norbert Carbonnaux Dialoguiste
1957 Le rouge est mis Gilles Grangier Scénariste
Mort en fraude Marcel Camus Scénariste et dialoguiste
Trois Jours à vivre Gilles Grangier Scénariste et dialoguiste
Retour de manivelle Denys de La Patellière Dialoguiste
Maigret tend un piège Jean Delannoy Scénariste et dialoguiste
Jusqu'au dernier Pierre Billon Dialoguiste
1958 Les Misérables Jean-Paul Le Chanois Scénariste et dialoguiste
Le Désordre et la Nuit Gilles Grangier Adaptation et dialogue
Les Grandes Familles Denys de la Patellière Scénariste et dialoguiste
Marchands de rien (court-métrage) Daniel Lecomte Scénariste
1959 Le fauve est lâché Maurice Labro non crédité au générique
Archimède le clochard Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste
Pourquoi viens-tu si tard ? Henri Decoin Dialoguiste
Maigret et l'affaire Saint-Fiacre Jean Delannoy Dialoguiste
125, rue Montmartre Gilles Grangier Dialoguiste
Rue des prairies Denys de la Patellière Scénariste et dialoguiste
Babette s'en va-t-en guerre Christian-Jaque Dialoguiste
Les Yeux de l'amour Denys de la Patellière Dialoguiste
Vel d'Hiv' (court-métrage) Guy Blanc Scénariste
La Bête à l'affût Pierre Chenal Scénariste
Péché de jeunesse Louis Duchesne Scénariste
1960 Le Baron de l'écluse Jean Delannoy Dialoguiste
La Française et l'Amour
sketch « L'Adultère » Henri Verneuil Dialoguiste
Les Vieux de la vieille Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste
Spécial Noël : Jean Gabin (TV) Frédéric Rossif Scénariste
Un taxi pour Tobrouk Denys de la Patellière Dialoguiste
1961 Les lions sont lâchés Henri Verneuil Dialoguiste
Le Président Henri Verneuil Adaptation et dialoguiste
Les Amours célèbres
sketch « Les Comédiennes » Michel Boisrond Dialoguiste
Le cave se rebiffe Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste
Le Bateau d'Émile Denys de la Patellière Adaptation et dialoguiste
1962 Un singe en hiver Henri Verneuil Dialoguiste
Le Gentleman d'Epsom Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste
Le Diable et les Dix Commandements
sketch « Tu ne déroberas point » Julien Duvivier dialogue
Le Voyage à Biarritz Gilles Grangier Scénariste (non crédité au générique)
1963 Mélodie en sous-sol Henri Verneuil Scénariste et dialoguiste
Carambolages Marcel Bluwal Dialoguiste
Les Tontons flingueurs Georges Lautner Dialoguiste
Teuf-teuf (TV) Georges Folgoas Scénariste
Des pissenlits par la racine Georges Lautner Dialoguiste
Cent mille dollars au soleil Henri Verneuil Dialoguiste
1964 Les Barbouzes Georges Lautner Scénariste et dialoguiste
Une foule enfin réunie (court-métrage) Monique Chapelle Scénariste
Un drôle de caïd ou Une souris chez les hommes Jacques Poitrenaud Adaptation et dialoguiste
Par un beau matin d'été Jacques Deray Dialoguiste
La Chasse à l'homme Édouard Molinaro Scénariste
1965 La Métamorphose des cloportes Pierre Granier-Deferre Scénariste et dialoguiste
Quand passent les faisans Édouard Molinaro Dialoguiste
Les Bons Vivants Gilles Grangier & Georges Lautner Scénariste, adaptation et dialogues
L'Arme à gauche Claude Sautet non crédité au générique
1966 Sale temps pour les mouches Guy Lefranc Scénariste et dialoguiste
Ne nous fâchons pas Georges Lautner Scénariste et dialoguiste
Tendre Voyou Jean Becker Dialoguiste
1967 La Grande Sauterelle Georges Lautner Scénariste et dialoguiste
Un idiot à Paris Serge Korber Scénariste
Toutes folles de lui Norbert Carbonnaux Dialoguiste
Johnny Banco Yves Allégret Dialoguiste
Fleur d'oseille Georges Lautner Scénariste
Max le débonnaire (Série TV) Gilles Grangier, Yves Allégret et Jacques Deray Scénariste
1968 La Petite Vertu Serge Korber Scénariste et dialoguiste
Le Pacha Georges Lautner Scénariste et dialoguiste
1969 Sous le signe du taureau Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste
1973 Baxter ! Lionel Jeffries Scénariste
1974 OK Patron ! Claude Vital non crédité au générique
1975 L'Incorrigible Philippe de Broca Scénariste et dialoguiste
1976 Le Grand Escogriffe Claude Pinoteau Dialoguiste
Le Corps de mon ennemi Henri Verneuil Scénariste et dialoguiste
1977 Mort d'un pourri Georges Lautner Scénariste et dialoguiste
L'Animal Claude Zidi Scénariste et dialoguiste
1978 Le Cavaleur Philippe de Broca Scénariste et dialoguiste
Tendre Poulet Philippe de Broca Scénariste et dialoguiste
1979 Flic ou voyou Georges Lautner Scénariste et dialoguiste
Les Égouts du paradis José Giovanni Dialoguiste
La Fabuleuse histoire de Roland-Garros Charles Gérard Scénariste
Le Guignolo Georges Lautner Dialoguiste
On a volé la cuisse de Jupiter Philippe de Broca Scénariste et dialoguiste
1980 Le Coucou Francesco Massaro Dialoguiste
L'Entourloupe Gérard Pirès Scénariste et dialoguiste
Pile ou face Robert Enrico Scénariste et dialoguiste
1981 Le Professionnel Georges Lautner Dialoguiste
Garde à vue Claude Miller Dialoguiste
Est-ce bien raisonnable ? Georges Lautner Dialoguiste
1982 Espion lève-toi Yves Boisset Scénariste et dialoguiste
1983 Mortelle randonnée Claude Miller Adaptation et dialoguiste
Le Marginal Jacques Deray Dialoguiste
1984 Canicule Yves Boisset Scénariste et dialoguiste
Les Morfalous Henri Verneuil Scénariste et dialoguiste
1985 On ne meurt que deux fois Jacques Deray Adaptation et dialoguiste
La Cage aux folles III, « Elles » se marient Georges Lautner Scénariste
Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages en 1968
Une veuve en or en 1969
Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause ! en 1969
Sortie de secours de Roger Kahane en 1970
C'est jeune et ça sait tout de Claude Mulot en 1973
Comment réussir quand on est con et pleurnichard en 1974
Chantons sous l'Occupation de André Halimi en 1975
Tendre Poulet de Philippe de Broca en 1977 (voix)
Réalisations, dialogues et scénarios[modifier]
(Les films dont Michel Audiard a signé réalisation scénario et dialogues)
1951 : La Marche (moyen métrage)
1968 : Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages
1969 : Une veuve en or
1969 : Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !
1970 : Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques
1971 : Le drapeau noir flotte sur la marmite
1972 : Elle cause plus... elle flingue
1973 : Vive la France (documentaire satirique d'histoire de France)
1974 : Comment réussir quand on est con et pleurnichard
1974 : Bons baisers à lundi
Michel Audiard et le box-office :
Films classés par nombre d'entrées :
1953 : Les Trois Mousquetaires 5 534 739 entrées
1981 : Le Professionnel 5 243 511 entrées
1983 : Le Marginal 4 956 822 entrées
1960 : Un Taxi pour Tobrouk 4 945 868 entrées
1959 : Babette s'en va-t-en guerre 4 657 610 entrées
1958 : Archimède le clochard 4 073 891 entrées
1958 : Les Grandes Familles 4 042 041 entrées
1978 : Flic ou voyou 3 950 691 entrées
1953 : L'ennemi public numéro un 3 754 112 entrées
1983 : Les Morfalous 3 621 540 entrées
1963 : Mélodie en sous-sol 3 518 083 entrées
1960 : Les Vieux de la vieille 3 477 455 entrées
1963 : 100 000 dollars au soleil 3 436 161 entrées
1959 : Rue des prairies 3 412 201 entrées
1963 : Les Tontons Flingueurs 3 321 121 entrées
1959 : Le Baron de l'écluse 3 160 233 entrées
1977 : L'Animal 3 157 789 entrées
1955 : Gas-oil 3 096 411 entrées
1957 : Maigret tend un piège 3 076 005 entrées
1960 : La Française et l'Amour (Sketch: L'Adultère) 3 056 737 entrées
1955 : La Bande à papa 2 913 256 entrées
1979 : Le Guignolo 2 876 016 entrées
1959 : Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre 2 868 465 entrées
1961 : Le Cave se rebiffe 2 812 814 entrées
1961 : Le Président 2 785 528 entrées
1976 : L'Incorrigible 2 568 325 entrées
1950 : Garou-Garou Le Passe-Muraille 2 566 767 entrées
1950 : Méfiez-vous des blondes 2 525 659 entrées
1964 : Les Barbouzes 2 430 611 entrées
1962 : Un singe en hiver 2 416 520 entrées
(source : site officiel de Michel Audiard catégorie Top Box office)
Liens :
http://www.michelaudiard.com/
http://www.dailymotion.com/video/x2b3 ... michel-audiard_shortfilms
http://www.ina.fr/video/I04216737/mic ... facon-d-ecrire-video.html
http://www.ina.fr/video/I04204282/mic ... -de-faire-rire-video.html
http://www.ina.fr/video/I04203243/les ... michel-audiard-video.html
http://www.babelio.com/livres/Audiard-Audiard-par-Audiard/5028
  
Posté le : 27/07/2013 21:21
Edité par Loriane sur 28-07-2013 14:37:22
Edité par Loriane sur 28-07-2013 14:43:57
|
|
|
|
|
Re: Câlin ??? |
|
Modérateur  
Inscrit:
21/03/2013 20:08
De Belgique
Niveau : 44; EXP : 15
HP : 215 / 1078
MP : 1072 / 35541
|
Il ressemble à ma chienne Gypsi qui était un teckel super intelligent !
Posté le : 27/07/2013 19:30
|
|
_________________
Belge et drôle et vice versa.
|
|
|
Robespierre |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57662
|
* Le 28 Juillet 1794 est guillotiné Robespierre
Maximilien Marie Isidore de Robespierre, ou Maximilien Robespierre est un avocat et un homme politique français, né le 6 mai 1758 à Arras et mort guillotiné le 28 juillet 1794 à Paris, place de la Révolution.
Aîné d'une fratrie de cinq enfants, il perd sa mère à l'âge de six ans. Puis son père abandonne ses enfants, et il est pris en charge par son grand-père maternel. Après d'excellentes études au collège d'Arras et au collège Louis-le-Grand de Paris, licencié en droit, il devient avocat et s'inscrit en 1781 au Conseil provincial d'Artois, occupant même une charge d'avocat
Robespierre incarne la Révolution française dans sa tendance démocratique et ses méthodes terroristes, ce qui lui vaut, selon la règle, des admirateurs et des détracteurs. Toutefois, les premiers sont longtemps demeurés rares, parce que Robespierre déplaisait à beaucoup de révolutionnaires en raison de ses convictions morales et religieuses.
Les détracteurs au contraire ont toujours abondé, parce que Robespierre dès sa chute a servi de bouc émissaire.
Entre ces deux courants, des flottements se sont produits au gré des fluctuations de l'histoire et des idéologies de 1794 à nos jours.
Enfance et jeunesse;
Par ses origines, Maximilien de Robespierre se rattache à la petite bourgeoisie de robe qui peupla les assemblées révolutionnaires, en même temps qu'il s'en distingue par les infortunes de sa famille. Il naquit à Arras, quatre mois après le mariage de ses parents ; il perdit sa mère dès 1764, son père délaissa les enfants et disparut, ses grands-parents moururent trop tôt pour l'élever.
Il lui manqua l'affection, la considération et la richesse.
Boursier, il s'acharna au collège pour conquérir ce qui lui faisait défaut.
Maximilien de Robespierre était le fils ainé de Maximilien-Barthélémy-François de Robespierre né en 1732, avocat au Conseil supérieur d'Artois, et de Jacqueline-Marguerite Carraut née en 1735, fille d'un brasseur d'Arras.
Après leur rencontre en 1757, les deux jeunes gens s'étaient mariés le 2 janvier 1758.
Né à Arras le 6 mai suivant, Robespierre fut donc conçu hors mariage.
Par son père, il descendait d'une famille de gens de robe artésiens: son grand-père Maximilien 1694-1762 était également avocat au Conseil supérieur d'Artois, son bisaïeul Martin 1664-1720 procureur à Carvin, son trisaïeul Robert notaire à Carvin et bailli d'Oignies.
Le couple eut encore quatre autres enfants :
Charlotte en 1760, Henriette-Eulalie-FrançoiseEulalie-Françoise en 1761 et Augustin en 1763 ; le puîné vit le jour le 4 juillet 1764.
Mais la mère mourut huit jours plus tard, à vingt-neuf ans, suivie de près par le nouveau-né.
Robespierre avait six ans. À en croire les Mémoires de Charlotte, François de Robespierre aurait abandonné ses enfants peu après la mort de son épouse.
En revanche, selon Gérard Walter, on trouve des traces de lui à Arras jusqu'en mars 1766, puis de nouveau en octobre 1768. Ensuite, deux lettres de François de Robespierre, envoyées de Mannheim, confirment qu'il vivait en Allemagne en juin 1770 et en octobre 1771.
L'année suivante, d'après le registre d'audiences du Conseil d'Artois, il était de retour à Arras, où il plaida quinze affaires du 13 février au 22 mai.
Enfin, en mars 1778, à la mort de son beau-père, un jugement de l'Échevinage d'Arras indique qu'étant absent, il s'était fait représenter. Par la suite, si l'on prête foi à ce document, on perd sa trace.
L'abbé Proyart qui semble avoir connu personnellement le père de l'Incorruptible) prétend qu'après avoir habité quelque temps à Cologne, il aurait annoncé le dessein de se rendre à Londres, et de là aux Îles, où il serait possible qu'il vécût encore en 1795, mais cette hypothèse, discutée par Albert Mathiez, est rejetée par Auguste Paris et Gérard Walter. Un acte d'inhumation le fait mourir à Munich le 6 novembre 1777, version reprise par Henri Guillemin ou Catherine Fouquet Après la mort de leur mère, les deux filles furent recueillies par leurs tantes paternelles, les garçons par leur grand-père maternel, Jacques Carraut 1701-1778.
Maximilien entra, en 1765, au collège d'Arras ancienne institution jésuite qui n'appartenait pas encore aux Oratoriens, étant gérée par un comité local nommé par l'évêque.
Charlotte, dans ses Mémoires, affirme que l'attitude de Maximilien avait connu un grand changement, à l'époque et que, conscient d'être en quelque sorte le chef de la famille, il avait pris un tour plus grave et sérieux.
En 1769, grâce à l'intervention du chanoine Aymé auprès de l’évêque d’Arras, Louis-François-Marc-Hilaire de Conzié, il obtint une bourse de 450 livres annuelles de l'abbaye de Saint-Vaast et entra au collège Louis-le-Grand, à Paris.
Malgré son extrême dénuement, il fit de brillantes études au collège Louis-le-Grand 1769-1781, où il eut pour condisciples Camille Desmoulins et Louis-Marie Stanislas Fréron.
Son nom fut plusieurs fois proclamé aux distributions de prix du Concours général : deuxième prix de thème latin et sixième accessit de version latine en 1772, quatrième accessit de vers latins et de version latine en 1774, deux seconds prix en latin et le quatrième accessit de version grecque en 1775, le premier prix de rhétorique en 1776, etc..
D'après l'abbé Proyart, préfet du collège, c'était un élève studieux, se consacrant uniquement au travail, solitaire et rêveur, peu expansif.
Très bien vu par ses maîtres, il fut choisi, en 1775, pour prononcer le compliment en vers du nouveau roi Louis XVI. Il rencontra Jean-Jacques Rousseau à la fin de sa vie, entre 1775 et 1778 - ou l'aperçut, selon Gérard Walter.
Selon les Mémoires posthumes de Brissot, témoignage rejeté par Gérard Walter comme invraisemblable pour des raisons chronologiques, il aurait été un temps clerc chez le procureur Nolleau fils, où le futur girondin l'aurait croisé.
Reçu bachelier en droit de la faculté de Paris le 31 juillet 1780, il obtint son diplôme de licence le 15 mai 1781 et s'inscrivit sur le registre des avocats du Parlement de Paris deux semaines après.
Le 19 juillet, sur rapport du principal du collège, une récompense de 600 livres lui fut octroyée. Par ailleurs, sa bourse passa à son frère Augustin.
À vingt-deux ans, il terminait donc, ses études pourvu d'un certificat de bonne conduite, d'une gratification et d'une licence en droit. Avocat, il avait rétabli sa position sociale et ses chances quand il s'installa à Arras.
Son séjour prolongé à Paris au collège Louis-le-Grand l'avait ouvert à la philosophie des Lumières, détaché du catholicisme et engagé sur les traces de Rousseau avec une ferveur de disciple admiratif : "Homme divin, tu m'as appris à me connaître bien jeune, tu m'as fait apprécier la dignité de ma nature et réfléchir aux grands problèmes de l'ordre social. "
Il parut pourtant s'intégrer aisément à cet ordre. Il se fit une réputation d'avocat, de lettré, de bel esprit.
Il entra à l'académie d'Arras et à la société des Rosati, comme Lazare Carnot ; comme lui et comme Rousseau, il concourut pour gagner les prix et la notoriété des académies provinciales.
La réussite fut imparfaite, les lauriers trop rares, et les confrères déjà parvenus faisaient peser une lourde tutelle sur les jeunes. Il s'en indignait en 1788, tout comme Carnot déplorant la stagnation des jeunes talents dans le corps des ingénieurs militaires. Le climat de 1788 était à la contestation.
Mais Robespierre étendait ses griefs à la société tout entière et projetait de libérer les pauvres de l'oppression et de l'injustice.
À cette époque, il se défendait contre certaines tendances profondes de sa nature, pressentant qu'elles l'empêcheraient d'aboutir : "Une idée absolue de perfection, de pureté, déclarait-il, ne peut être qu'une erreur politique."
Il se limitait à des vues réformistes et plaçait ses espérances en Necker.
La convocation des états généraux lui fournit l'occasion d'agir.
Député du tiers état
Élu député, il se sentit soudain revêtu de toute l'autorité que donnait une souveraineté du peuple toute neuve, en même temps qu'investi d'une haute mission, celle de régénérer la nation dans sa structure et son esprit.
Du coup Robespierre devint un homme nouveau, libéré de la timidité et du souci des autorités, si apparents dans ses mémoires de concours.
D'emblée, il sentait la puissance des résistances opposées à ses aspirations, comprenait l'un des premiers qu'il faudrait combattre farouchement et se persuadait de l'existence et de la force d'un "complot des ennemis du peuple ".
Il lui appartenait de dénoncer inlassablement, énergiquement, tout ce qui s'opposait à la promulgation et à l'application des "principes , des axiomes qui guideraient l'action révolutionnaire et sur lesquels s'édifierait la société nouvelle, harmonieuse et définitive : singulièrement l'égalité de droits, la bonté et la quasi-infaillibilité du peuple, l'efficacité souveraine de la vertu pour assurer le bonheur.
Orateur inlassable, minutieux et inflexible, il devint l'un des chefs des démocrates, censurant l'oubli des principes, réclamant le suffrage universel, l'admission de tous dans la garde nationale, dans les jurys des tribunaux, s'opposant à la répression brutale des mouvements populaires.
Il gagna ainsi l'admiration du jeune Saint-Just, dès 1790, les acclamations des Parisiens et des Arrageois à la fin de l'assemblée et l'offrande de son buste couronné par les Jacobins.
Chemin faisant, à la suite d'échecs répétés, il avait perdu toute considération pour la plupart des députés, il s'était convaincu de la nocivité des factions, il avait récusé la valeur immuable du verdict de la majorité.
Il lui préférait la pureté des principes, l'incorruptibilité du caractère, le respect et l'application des "saintes maximes de l'égalité et de la morale publique ", la confiance en l'Être suprême, grâce à quoi un ordre nouveau serait établi "pour des siècles et pour l'univers ", à la fois idéaliste et quelque peu rigide.
Le Jacobin, membre de la Commune de Paris
Ce fut donc avec une autorité intacte que, de septembre 1791 à septembre 1792, n'étant plus député, selon une règle qu'il avait fait accepter, il milita sans trêve au club des Jacobins.
Il adjurait les frères et amis des clubs de toute la France, les députés démocrates, d'être " toujours armés d'une salutaire défiance ".
La déclaration de guerre l'opposa vigoureusement aux Brissotins, elle lui paraissait imprudente et criminelle, faisant le jeu du roi et des généraux en cas improbable de succès.
Avec les défaites, un sursaut patriotique éclata, en même temps que grandissait l'action des sans-culottes ;
Robespierre appuya le mouvement qui aboutit à la chute du roi, le 10 août ; il devint membre de la Commune de Paris et commença de tenir un rôle de premier plan.
Non seulement il fut élu député de la Convention, mais il orienta le choix des autres députés de Paris par le vote oral et public et l'épuration des candidats.
Lié désormais aux démocrates parisiens, il fut éclaboussé par les massacres de septembre, dont il n'était pas responsable bien qu'il ait failli y exposer Brissot.
À la Convention et aux Jacobins, Robespierre combattit farouchement les Girondins, bourgeois égoïstes, privilégiés par la fortune et par l'éducation, hostiles au peuple et surtout à celui de Paris.
C'est ainsi qu'il les voyait, comme tant de Montagnards et de démocrates.
Pourtant cette dialectique des riches et des pauvres lui apparaissait simpliste et trompeuse ; le critère de la vertu et de la croyance en l'Être suprême rejetait les athées corrompus et corrupteurs, fussent-ils Montagnards.
D'autre part, les relations avec les sans-culottes n'étaient pas seulement affectées par la prise de position morale et religieuse, mais encore par les divergences de politique sociale et économique.
Robespierre refusait au domaine économique et financier un rôle fondamental : grâce à la Providence, la France était largement pourvue de richesses ; il suffirait que la vertu élimine l'égoïsme et la spéculation pour que chacun soit assuré du nécessaire. C'était donc le refus de l'intervention, de la taxation, du contrôle, réclamés par les sans-culottes.
Déjà déçu par les parlementaires, Robespierre se défiait des porte-parole du peuple et admettait que, si le peuple n'avait jamais tort en principe, il pouvait cependant être induit en erreur et que, de ce fait, l'insurrection, arme suprême, risquait de tourner à l'aventure.
Finalement Robespierre jouissait d'un prestige plus éclatant que solide, plus assuré dans la lutte contre les ennemis communs que dans l'édification d'une France nouvelle.
S'il imposa son point de vue pour la mort du roi, quand il lutta contre les Girondins après la trahison de Dumouriez en avril 1793, il dut faire des concessions aux sans-culottes.
Il alla jusqu'à proposer de définir la propriété comme "la portion de biens garantie par la loi", il proclama le "droit à l'existence ", ce qui impliquait de profondes réformes.
Il obtint ainsi l'appui des sections armées de Paris, dont les canons décidèrent l'éviction des principaux Girondins le 2 juin 1793. Près de deux mois plus tard, le 26 juillet 1793, Robespierre entrait au grand Comité de salut public : ce fut l'apogée de sa carrière.
Le délai de deux mois s'explique-t-il par une hésitation ?
Robespierre eut-il conscience qu'il maniait mieux les clubs que les députés, et mieux les députés qu'un petit groupe de personnages fortement trempés ?
Dictateur ou un membre contesté du Comité de salut public ?
La conjoncture était catastrophique, tant au-delà des frontières qu'à l'intérieur de la République, les ennemis étaient déchaînés et victorieux, les révolutionnaires demeuraient divisés.
Le Comité de salut public organisa une lutte implacable contre les ennemis déclarés, mais il fallut louvoyer pour éviter les ruptures entre révolutionnaires.
Robespierre accepta lui aussi, sous la pression des Enragés, le maximum, la législation contre les accapareurs, la levée en masse, l'armée révolutionnaire parisienne.
Il s'efforça d'enrayer la déchristianisation.
Il parvint à faire mettre en place un gouvernement d'exception doté de rouages révolutionnaires, tandis que la constitution était mise en sommeil.
Ce fut la Terreur. S'il n'en était pas le seul responsable, il était convaincu de sa nécessité ; il ne put cependant la mener à son gré, en dépit de ce qu'on a souvent nommé, à l'époque et depuis, sa dictature.
Il se défendit jusqu'à son dernier souffle d'avoir été dictateur. Était-ce à juste titre ?
Assurément aucune magistrature comportant les pleins pouvoirs ne lui fut attribuée, jamais d'ailleurs il ne le demanda. Robespierre était membre d'un comité puissant, mais il n'y était soutenu que par Couthon et Saint-Just, les autres membres n'approuvaient pas sa politique.
De plus, le comité dépendait de la Convention et, là non plus, Robespierre n'était pas sûr de rallier la majorité.
D'autre part, le Comité de sûreté générale, sauf deux de ses membres, ne soutenait pas Robespierre.
En revanche, il n'est pas douteux que Robespierre disposait d'un immense prestige et d'une vaste audience auprès des démocrates, des Jacobins, des sans-culottes de Paris et de province, grâce à quoi il pouvait souvent imposer ses vues.
Enfin, Robespierre tenait de plus en plus souvent un langage de dictateur détenteur de la vérité :
"Nous sommes intraitables comme la vérité, inflexibles, uniformes, j'ai presque dit insupportables comme les principes. "
Il était profondément convaincu de la justesse de ses vues, ceux qui ne les partageaient pas ne pouvaient être que des traîtres à la cause du peuple, ils devaient être éliminés.
Ainsi, tour à tour, ceux qu'on dénomma hébertistes et dantonistes furent guillotinés, respectivement le 24 mars et le 5 avril 1794.
À cette occasion, deux décrets, les décrets de ventôse, avaient décidé le séquestre des biens des suspects au profit des patriotes indigents, mesure dont l'audace fut tempérée par l'opportunité dans la décision et aussi dans l'application.
Dans le précieux carnet qu'il portait le 9 thermidor, on lit bien que les " bourgeois " étaient les ennemis, mais il n'était pas question d'un transfert de propriété.
Robespierre décevait Babeuf.
La chute
La Grande Terreur ne fut pas l'œuvre du seul Robespierre, bien que les tentatives d'assassinat qu'il essuya l'aient précipitée. Grâce aux revers subis par les ennemis du dehors puis du dedans, Robespierre crut pouvoir entamer l'œuvre d'édification de la société qu'il croyait la seule conforme aux principes, donc légitime et définitive.
Il annonçait la liberté, le bien-être, l'essor du commerce et des arts, la disparition de la richesse excessive et de la corruption, en somme le bonheur général.
Le moyen était la vertu, favorisée par des institutions neuves et efficaces.
Cet épanouissement des âmes s'accomplirait sous les auspices de l'Être suprême, garant de l'harmonie.
Lorsque Robespierre pontifia au cours de la fête fameuse du 8 juin, le processus était engagé qui devait conduire à la république démocratique et vertueuse des petits propriétaires, libres, égaux en droit et en considération, tous dévoués au bien commun.
Les possibilités et les risques ne lui apparurent pas nettement.
Mal informé, obstiné, malgré les instances d'amis et de correspondants, fatigué aussi par un surmenage prolongé provoquant des dépressions, il ne vit pas grandir l'inquiétude de ceux qui, traversant ses desseins, se sentaient menacés.
Il ne comprit pas non plus que les victoires militaires rendaient la Terreur moins acceptable.
Il voulut épurer ses ennemis au Comité de salut public en s'appuyant sur la Convention, les clubs et les comités révolutionnaires.
Il cessa de participer aux séances du comité, laissant le champ libre à ceux qu'il avait humiliés et menacés.
Il perdit du temps. Lorsqu'il intervint à la Convention le 26 juillet, il ne fut pas suivi.
Attaque à la maison de la commune de Paris (hôtel de ville actuel)
Il croit, cependant, qu'il domine encore la Convention.
Le 8 thermidor, c'est à dire ce 26 juillet, il monte à la tribune, attaque le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale, et surtout lance un long réquisitoire contre les "traîtres" et les "fripons" …, qu'il refuse de nommer.
Imprudence fatale.
Cette diatribe sème l'inquiétude dans les rangs et permet aux conjurés de rallier les indécis du Marais ou de la Plaine : les centristes.
Le lendemain, Saint-Just ne peut lire à la Convention le rapport qu'il a rédigé.
En revanche, Billaud-Varenne et Tallien dénoncent la tyrannie de Robespierre, ce "nouveau Cromwell ".
Celui-ci essaie, mais en vain, de se défendre : Collot d'Herbois et Jacques Thuriot , successivement présidents de l'Assemblée, l'empêchent de se faire entendre en agitant leur sonnette, et la Convention décide l'arrestation de Maximilien et de ses amis.
Apprenant la nouvelle, la Commune essaie de réagir : elle se déclare en insurrection et fait délivrer les prisonniers.
En réponse, l'Assemblée déclare hors-la-loi tout le groupe des robespierristes qui voulurent protéger leur chef.
Dans la nuit, les sections modérées, conduites par Barras, marchent sur l'Hôtel de Ville, où se sont réfugiés les proscrits. Robespierre ne cherche pas à se défendre : il attend son salut de la légalité et non de la violence.
En voyant arriver les hommes en armes, il se tire un coup de pistolet et se brise la mâchoire, à moins qu'il n'ait été atteint par le coup de feu du gendarme "Méda ou Merda" ?.
Mis hors la loi, il refusa de patronner l'insurrection populaire, peut-être même tenta-t-il de se suicider.
Le lendemain, lorsque, ce 9 thermidor, Robespierre est empêché de parler, et qu'il se sent perdu, il ne peut que dire : "Les brigands triomphent… ", mot révélant l'importance, chez lui, du point de vue moral dans l'analyse d'une situation politique. Transporté sanglant aux Tuileries et sommairement pansé, il demeurera pendant de longues heures couché sur une table avant d'être guillotiné avec ses fidèles, parmi lesquels son frère Augustin, Couthon, Le Bas, Saint-Just.
Exécution publique, place de la concorde du 10 thermidor an II, 28 juillet 1794.
Le grand artisan de la Révolution française a été sacrifié : sa mort marque la fin de la Convention montagnarde.
Cette fin souligne la complexité de l'homme, le manque de contacts avec ce peuple qu'il aimait plus qu'il ne le fréquentait, ses hésitations et ses scrupules dans l'action, qui contrastaient avec sa résolution pour défendre les principes dans la législation et la justice révolutionnaires.
Sa foi, sa sincérité, son incorruptibilité ne suffisaient pas à l'œuvre exaltante qu'il avait entamée cinq ans plus tôt.
Cette œuvre elle-même manquait à la fois d'assises économiques et de conscience historique, mais Robespierre lui avait donné une signification morale et culturelle.
Le jour de L’exécution
Ainsi Robespierre fut condamné sans procès et guillotiné l'après-midi même du 10 thermidor, sous les acclamations de la foule, en compagnie de vingt et un de ses amis politiques, dont Saint-Just et Couthon ainsi que son frère, Augustin Robespierre.
Les vingt-deux têtes furent placées dans un coffre en bois, et les troncs rassemblés sur une charrette.
On jeta le tout dans une fosse commune du cimetière des Errancis et l’on répandit de la chaux, afin que le corps du "tyran" Robespierre ne laisse aucune trace.
Le lendemain et le surlendemain, 83 partisans de Robespierre furent également guillotinés.
Une épitaphe posthume est imaginée par un anonyme à son sujet :
"Passant, ne t'apitoie pas sur mon sort
Si j'étais vivant, tu serais mort."
En 1840, des partisans de Robespierre fouillèrent le sol du cimetière des Errancis, alors fermé depuis une trentaine d’années, sans découvrir aucun corps.
Sa chute contribua, dans les jours et semaines qui suivirent, à un démantèlement progressif du gouvernement révolutionnaire, emporté par la réaction thermidorienne : adoption, dès le 11 thermidor,
du renouvellement par quart tous les mois des comités, les membres étant inéligibles pendant un mois ;
nomination de dantonistes et de modérés au sein des comités de salut public et de sûreté générale ;
rattachement, le 1er fructidor, 24 août, de chacune des douze commissions exécutives remplaçant depuis le 1er floréal, 20 avril le Conseil exécutif aux douze principaux comités, et non plus au seul comité de salut public, et cantonnement des compétences de ce dernier et du comité de sûreté générale aux domaines de la guerre et de la diplomatie, pour l'un, de la police, pour l'autre, le comité de législation récupérant l'administration intérieure et la justice;
suppression de la loi de Prairial ;
réduction du nombre de comités de surveillance révolutionnaire à un par district en province et douze à Paris, au lieu de quarante-huit, limitation de leurs prérogatives et modification des conditions d'accès dans un sens défavorable aux sans-culottes.
Ce démantèlement du système de l'an II, et particulièrement de l'appareil répressif n'aboutit pas, cependant, à la mise en accusation de tous ceux qui avaient organisé la Terreur et en avaient largement profité en mettant la main sur les biens des nobles et des banquiers exécutés, ces derniers chargeant Robespierre de tous leurs méfaits et n'hésitant pas à falsifier les documents historiques.
Elle conduisit également à la remise en cause de la politique dirigiste, démocratique et sociale pratiquée par ce gouvernement afin de satisfaire le mouvement populaire des sans-culottes.
Dès sa chute, tous les Duplay furent emprisonnés ; la femme de Maurice Duplay, âgée de 59 ans, fut, quant à elle, retrouvée pendue dans son cachot le 11 thermidor.
Éléonore Duplay ne se maria jamais et vécut le reste de sa vie dans le regret de son grand homme.
Marie-Éléonore Duplay, dite Cornélie, est la fille de Maurice Duplay et de Françoise-Éléonore Vaugeois, qui accueillirent Maximilien de Robespierre chez eux de 1791 à sa mort en 1794.
Nous savons peu de choses sur elle. Elle avait un caractère droit et fier, d'où son surnom de Cornélie en référence à la mère des Gracques mais semblait un peu inhibée dans son rôle d'aînée.
Elle étudiait la peinture sous Jean-Baptiste Regnault et se révélait assez douée mais n'ambitionnait pas d'en faire son métier.
Selon la légende de la famille Duplay, Éléonore serait devenue la fiancée de l'Incorruptible pendant son séjour dans leur famille.
L'aprés Robespierre
Au lendemain du 9-Thermidor, devant des manifestations de sympathie à l'égard des vaincus – plusieurs suicides ou tentatives de suicide, apparition de chansons pleurant la mort de Robespierre, diverses manifestations d'hostilité à l'encontre de chanteurs antirobespierristes –, les Thermidoriens favorisèrent le développement d'une campagne de presse et de pamphlets à l'origine de la légende noire de Robespierre.
Juste après l'exécution des robespierristes, Jean Joseph Dussault fit paraître dans plusieurs journaux un portrait dans lequel il tenta d'expliquer son ascendant par une capacité à profiter avec adresse de circonstances qu'il aurait été incapable de créer.
Le lendemain, un article anonyme d'inspiration girondine le décrivit comme un mauvais patriote, protecteur des prêtres, fanatique lui-même, despote en devenir, insistant comme Dussault sur ses "talents médiocres" et 'une grande flexibilité aux circonstances, la science d'en profiter, sans savoir les faire naître ".
Le Journal de Perlet expliqua que Robespierre envisageait une nouvelle épuration qui l'aurait conduit vers le trône.
Le Journal des Lois, peut-être le premier, tenta de la faire passer pour un Tartuffe et un Sardanapale, faisant de Cécile Renault une maîtresse délaissée dont il aurait voulu se débarrasser.
Le Perlet évoqua de prétendues orgies dans une maison d'Issy et un projet de mariage avec Marie-Thérèse de France, destiné à le faire reconnaître comme roi.
Cette dernière affirmation fut reprise par Barras à la barre de la Convention, qui présenta la fille de Louis XVI comme la maîtresse de l'Incorruptible.
Dans son numéro du 7 fructidor, 24 août, le Journal des Lois accusa encore Robespierre d'être un affameur du peuple. Autre affirmation de cette presse :
Robespierre aurait machiné, en accord avec le " tyrans étrangers ", la Terreur pour dégoûter les autres peuples des principes révolutionnaires.
Une commission dirigée par Edme-Bonaventure Courtois fut chargée de donner rapport des papiers saisies chez les robespierristes, afin de donner corps aux accusations de conspiration qui avaient justifié leur mise en accusation.
Celui-ci fut distribué aux députés le 28 pluviôse an III, 16 février 1795, déclenchant aussitôt une vive polémique, de nombreuses pièces ayant disparu.
Des députés s'étaient entendus avec Courtois pour faire disparaître des documents estimés compromettants.
Par ailleurs, Courtois avait conservé des papiers, qui furent saisis à son domicile sous la Restauration.
Parallèlement, l'ancien constituant Pierre-Louis Roederer fit paraître une mince plaquette, le Portrait de Robespierre, rédigée à la hâte et signée Merlin de Thionville ;
le premier, il considérait que le cas Robespierre tenait de la pathologie, celui d'un tempérament mélancolique devenu trabilaire .
En nivôse an III, Galart de Montjoie publia une Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre, biographie mêlant des "révélations" issues de la presse thermidorienne, des racontars issu des Actes des Apôtres et des résumés des comptes rendus parlementaires.
En 1795 parut une brochure anonyme intitulée Vita del despota sanguinario della Francia Massimiliano Roberspierre et traduite "du français en italien", sans doute rédigée par un ecclésiastique réfractaire réfugié en Italie.
Le récit sur son enfance y était particulièrement fantaisiste, l'apparentant avec Damiens à la suite des Actes des Apôtres.
À la même époque parut à Hambourg une brochure, La Vie et les crimes de Robespierre surnommé le Tyran, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, œuvre de l'abbé Proyart signée M. Le Blond de Neuvéglise, colonel d'infanterie légère .
Si son information n'était pas toujours de première main et si son authenticité laissait souvent à désirer , l'auteur réfutait plusieurs fables imprimées en France.
Dans son histoire de la Révolution, Jacques Necker évoqua lui aussi Robespierre, qu'il avait connu au début de sa carrière politique et dont il n'envisageait pas sans amertume le degré d'élévation auquel il était parvenu, supérieur à celui de l'ancien ministre de Louis XVI.
Le premier, il fit de Robespierre " l'inventeur de l'exécrable et fameuse journée du 2 septembre ".
Dans le même temps, il condamnait les inventions des thermidoriens et des émigrés, qui avaient échoué à percer le mystère de Robespierre.
Autre ministre de Louis XVI, Antoine François Bertrand de Molleville s'attacha également à l'énigme Robespierre dans son Histoire de la Révolution de France, parue entre l'an IX et l'an XI.
Jugeant son rôle aussi étonnant qu'exécrable, il ne trouva d'autre explication, pour justifier sa brusque élévation, que sa haine à l'égard d'un Ancien Régime qui ne laissait aucune chance favorable à son ambition et sa lâcheté, qui l'incitait à commettre les assassinats sans nombre dont il se rendit coupable.
En 1815 parurent trois ouvrages rédigés sous l'Empire mais saisis par la police : l’Histoire de la Révolution de l'abbé Papon, l’Essai historique et critique de la Révolution de Pierre Paganel et les Considérations de Germaine de Staël.
Au contraire de leurs prédécesseurs, ces auteurs jugeaient que Robespierre marquerait durablement l'histoire, sa figure émergeant seule de cette période. Insistant également sur ses tendances égalitaires, l'abbé Papon jugeait qu'il se distinguait par l'austérité et le désintéressement dont il faisait montre.
Dans ses écrits consacrés à la Révolution "Mes réflexions" en 1816, le Cours de philosophie positive en 1830-1842, le Système de politique positive en 1851-1854 Auguste Comte décrivit Robespierre comme un personnage au caractère essentiellement négatif, auquel il reprochait d'avoir promu un déisme légal, inspiré de Jean-Jacques Rousseau et associé au régime concordataire de Napoléon Ier, et l'opposa au mouvement encyclopédique de Denis Diderot et à Danton.
Dans le même temps, il témoigna de son admiration pour la conception du gouvernement révolutionnaire instauré par la Convention.
Après sa mort, le positiviste Pierre Laffitte reprit fidèlement cette analyse dans les conférences qu'il donna à la Bibliothèque populaire de Montrouge, résumées dans La Révolution française de Jean François Eugène Robinet, ainsi que dans le cadre des célébrations du centenaire de la Révolution.
La première tentative de réhabilitation de Robespierre fut l'œuvre de Guillaume Lallement, auteur anonyme, entre 1818 et 1821, d'une compilation de l'ensemble des discours et rapports des assemblées parlementaires de la Révolution éditée par Alexis Eymery ;
le tome XIV, consacré à l'an II, donnait une large place à Robespierre, dont il faisait le portrait en préalable aux événements du 9-Thermidor. Puis, en 1828, Paul-Mathieu Laurent, dit Laurent de l'Ardèche, publia sous le pseudonyme de "Uranelt de Leuze" une Réfutation de l'histoire de France de l'abbé de Montgaillard, parue l'année précédente, ardent panégyrique de Robespierre.
À la veille de la révolution de 1830 parurent de faux Mémoires de Robespierre, généralement attribués à Auguste Barbier et Charles Reybaud, mais peut-être commencés par Joseph François Laignelot, qui avait été un intime de Charlotte de Robespierre.
Cet écrit témoignait de l'opinion de la génération de 1830 sur Robespierre.
Selon l'auteur, l'opinion selon laquelle Robespierre avait pu être un agent de l'étranger était tout à fait discréditée ;
son incorruptibilité ne faisait aucun doute ; enfin, son intention, dans les derniers mois de sa vie, était de mettre fin à la Terreur et de purger la Convention de ses membres les plus criminels.
Cette entreprise de réhabilitation connut une avancée décisive avec Albert Laponneraye, qui entreprit en 1832 la publication des discours de Robespierre en fascicules, avant d'éditer les Mémoires de Charlotte Robespierre sur ses deux frères en 1835 puis les Œuvres de Maximilien Robespierre en quatre volumes en 1840, qu'il contribua largement à diffuser.
La génération de 1848 bénéficia, quant à elle, de la publication de l’Histoire parlementaire, 1834-183, de Philippe Buchez et de Pierre-Célestin Roux-Lavergne, et de l'achèvement de la réimpression de l’ancien Moniteur, 1840-1845 par Léonard Gallois, qui vinrent contrebalancer les mémoires et témoignages, subjectifs, des contemporains. Cet apport documentaire favorisa un renouvellement historiographique, avec l’Histoire des Girondins, 1847 d'Alphonse de Lamartine, l’Histoire de la Révolution française, 1847-1853 de Jules Michelet et celle de Louis Blanc, 1847-1855, qui firent toutes de Robespierre "le centre de leurs investigations", même si seul Louis blanc lui était plus nettement d'emblée favorable.
Sous le Second Empire, Ernest Hamel publia une Histoire de Robespierre, 1865-1868 considérée comme hagiographique, mais très bien documentée.
Sous la Troisième République, les auteurs se détournèrent de Robespierre, assimilant la Terreur à la Commune de Paris (1871), comme Hippolyte Taine dans Les Origines de la France contemporaine, 1875-1893, ou faisant de Robespierre un " pontife", adversaire de l'athéisme, de la libre-pensée et de la laïcité, comme Alphonse Aulard.
Lors du centenaire de la Révolution de 1889, l'épopée militaire fut privilégiée, avec les figures de Carnot, Hoche, Marceau, Desaix et surtout Danton.
Jean Jaurès contribua à ramener Robespierre au devant de la scène avec son Histoire socialiste de la Révolution française, tout en ouvrant vers les Hébertistes et les Enragés.
En 1907, l'érudit Charles Vellay créa la Société des études robespierristes, qui publia à partir de 1908 les Annales révolutionnaires, devenues en 1924 les Annales historiques de la Révolution française, ainsi que les Œuvres complètes de Robespierre en dix puis onze volumes.
L'un de ses premiers et principaux membres, Albert Mathiez fut le principal acteur de ce mouvement, qui fit de Robespierre la figure centrale de la Révolution, s'opposant à Aulard, son ancien maître, dans une lutte demeurée fameuse.
À sa suite, on trouvait La Révolution française Georges Lefebvre ou le Robespierre de Gérard Walter, qui pointaient les limites de Robespierre sur les questions sociales et financières.
Ce dernier ouvrage, selon Joël Schmidt, n'a pas été dépassé par l'abondance de sa documentation.
Par la suite, si le rôle de Robespierre dans la Révolution ne fut pas remis en cause, la recherche historique ouvrit de nouveaux champs, avec l'exploration du mouvement sans-culotte, des Hébertistes et des Enragés, sous l'influence d'Albert Soboul.
En 1956, au lendemain des élections législatives, l'Assemblée nationale vota une résolution invitant le gouvernement à, à organiser avec le maximum d'ampleur la célébration du deuxième centenaire de la naissance de Robespierre en 1958, en particulier à organiser, en son honneur, un hommage solennel, une journée dans les écoles et les universités, à favoriser par de larges subventions les travaux historiques, les expositions et les œuvres dramatiques.
Dans les années 1960, en parallèle à une contestation du modèle communiste et soviétique, qui s'étaient affirmés les héritiers de la Révolution, l'école révisionniste ou libérale, emmenée par François Furet, Denis Richet et Mona Ozouf, contribua à remettre en cause cette image de Robespierre.
Ainsi, François Furet écrivait le 7 juillet 1989 dans L'Express : Dans cette sagesse fin de siècle, Robespierre n’a pas vraiment été réintégré dans la démocratie française.
Le droite veille sur cet ostracisme en brandissant les mauvais souvenirs.
Mais l’Incorruptible a plus à craindre de ses amis que de ses ennemis.
En l’embrassant trop étroitement, l’historiographie communiste l’a entraîné dans un redoublement de désaffection.
Les travaux de Patrice Gueniffey et de Laurent Dingli se situent dans leur droite ligne.
En 1986, en prévision de l'aboutissement commémoratif de cette réaction antirobespierriste, dans l'historiographie progressiste non marxiste, Max Gallo fit paraître sa Lettre ouverte à Maximilien Robespierre sur les nouveaux muscadins.
Oublié des célébrations nationales du Bicentenaire de la Révolution, Robespierre demeure une figure majeure de l'histoire française, comme en témoigne la floraison des associations – les Amis de Robespierre pour le Bicentenaire de la Révolution, créés à Arras en 1987, l'Association Maximilien Robespierre pour l'idéal démocratique, AMRID, fondée en 1988 par Marianne Becker – et publications depuis 1989, et un personnage controversé, partagé entre les tenants de l'école jacobine et ceux des écoles néo-libérale et contre-révolutionnaire, entre des avocats et des procureurs.
Ainsi, la mise en vente chez Sotheby's le 18 mai 2011 d'un lot de manuscrits, comprenant des discours, des projets d’articles de journaux, des brouillons de rapports devant être lus à la Convention, un fragment du discours du 8 thermidor et une lettre sur la vertu et le bonheur, conservés par la famille Le Bas après la mort de Robespierre a suscité une mobilisation parmi les historiens et dans le monde politique ; Pierre Serna a publié un article intitulé : Il faut sauver Robespierre ! dans Le Monde, et la Société des études robespierristes lancé un appel à souscription, tandis que le PCF, le PS et le PRG alertaient le ministère de la Culture.
Lors de la vente, l’État a fait valoir son droit de préemption pour acquérir le lot à 979 400 euros au nom des Archives nationales.
Ces manuscrits sont désormais en ligne sur le site des Archives nationales
Postérité
Héritage politique.
Le robespierrisme est un terme pour désigner une réalité mouvante ou pour qualifier des hommes qui partageaient ses idées. Plus généralement, il désigne toutes les personnes qui se réclament de la personne ou de la pensée de Maximilien de Robespierre.
Parmi ceux qui se sont réclamés de Robespierre, figurent notamment le mouvement chartiste anglais, un certain nombre de républicains et de socialistes français des années 1830-40 – on a parlé de néo-robespierrisme – comme Albert Laponneraye, éditeur des Œuvres de Robespierre et des Mémoires de Charlotte de Robespierre, Philippe Buchez, qui a publié une Histoire parlementaire de la Révolution, Étienne Cabet, auteur d'une Histoire populaire de la Révolution française de 1789 à 1830 ou Louis Blanc, qui a écrit une Histoire de la Révolution française, instruits par Philippe Buonarroti, mais aussi les mouvements socialiste et communiste avec la monumentale Histoire de la Révolution française de Jean Jaurès ou les travaux de l'historien Albert Mathiez.
Littérature.
Charles Nodier a consacré à Robespierre un article, intitulé « De la littérature pendant la Révolution. Deuxième fragment. Éloquence de la tribune. Robespierre , dans la Revue de Paris en septembre 1829. Il a été repris, sous le titre Robespierre l'aîné, dans ses Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la Révolution et de l'Empire (1831) puis, sous le titre La Montagne, dans Recherches sur l'éloquence révolutionnaire dans le tome 7 des Œuvres de Charles Nodier.
Même s'il présente Robespierre comme un personnage médiocre « exhaussé par l'opinion et les événements » et brosse un portrait de l'orateur conforme aux stéréotypes du temps pour ne pas trop heurter son public devant l'audace de son analyse, Nodier lui sait gré d'avoir, avec son frère Augustin, entrepris de canaliser, « dans le sens d'un ordre politique relativement viable, les forces génératrices de chaos », à travers notamment l'instauration du culte de l'Être suprême. De même, il lui reconnaît un supériorité d'ordre esthétique dans l'éloquence et affirme « qu'il faut chercher peut-être dans [ses] discours (...) presque tout ce qu'il y avait de spiritualisme et de sentiments humains dans l'éloquence conventionnelle ». En particulier, il fait montre d'admiration pour le discours du 7 prairial, où Robespierre affirme faire peu de cas de sa propre vie, après les tentatives d'assassinat d'Henri Admirat et de Cécile Renault, et celui du 8 thermidor, où il retrouve le dessein de pacification et de restauration de l'ordre public qu'il lui attribue264
Honoré de Balzac traite Robespierre comme un personnage à part entière dans Les Deux Rêves, paru dans La Mode en mai 1830 puis intégré dans Sur Catherine de Médicis.
Dans ce texte, Catherine de Médicis apparaît en songe à Robespierre et justifie le massacre de la Saint-Barthélemy, qui n'a pas été motivé, explique-t-elle, par une animosité personnelle ou le fanatisme religieux, mais pour le salut de l'État. Fréquent dans la littérature royaliste de l'époque, le rapprochement entre ce massacre et ceux de la Révolution contribue à expliquer ces derniers en voulant réhabiliter la politique de la reine.
Il ne lui reproche pas la Terreur, mais de l'avoir exercée au nom d'un principe démocratique.
En dehors de ce texte, la figure de Robespierre dans l'œuvre de Balzac est uniformément antipathique, l'archétype du tyran sans cœur et sans scrupule, même si, jusqu'à la Révolution de 1848, il témoigne d'une réelle admiration devant la grandeur de sa destinée.
Il figure ainsi parmi les génies qui ont changé la face du monde dans l'édition de 1846 de la lettre d'adieu de Lucien de Rubempré à Vautrin, avant de passer dans le rang de ceux dont le rôle a été uniquement destructeur, dans son exemplaire personnel.
Robespierre apparaît dans des ouvrages historiques d'Alexandre Dumas, Louis XVI et la Révolution, Le Drame de 93, ainsi que dans plusieurs de ses romans fleuves : le cycle des Mémoires d'un médecin, on trouve quelques allusions dans Le collier de la reine, Le Chevalier de Maison-Rouge et surtout dans La Comtesse de Charny et les deux parties de Création et rédemption, Le Docteur mystérieux et particulièrement La Fille du marquis.
C'est également le cas dans la nouvelle La Rose rouge.
S'appuyant particulièrement sur les ouvrages historiques de Jules Michelet et Alphonse de Lamartine, Dumas s'inspire surtout du premier pour le présenter comme un personnage qui ne sait pas vivre, rongé par la jalousie et l'ambition, sans lui reconnaître la même grandeur, son principal reproche étant 'incapacité de Robespierre pour la jouissance et le bonheur.
Dans Histoire de ma vie, George Sand prend la défense de Robespierre, victime à ses yeux des calomnies de la réaction .
S'appuyant sur les écrits de Lamartine, elle le juge le plus humain, le plus ennemi par nature et par conviction des apparentes nécessités de la terreur et du fatal système de la peine de mort, mais aussi le plus grand homme de la révolution et un des plus grands hommes de l'histoire.
Si elle lui reconnaît des fautes, des erreurs, et par conséquent des crimes, elle s'interroge :
Mais dans quelle carrière politique orageuse l'histoire nous montrera-t-elle un seul homme pur de quelque péché mortel contre l'humanité? Sera-ce Richelieu, César, Mahomet, Henri IV, le maréchal de Saxe, Pierre le Grand, Charlemagne, Frédéric le Grand, etc., etc.? Quel grand ministre, quel grand prince, quel grand capitaine, quel grand législateur n'a commis des actes qui font frémir la nature et qui révoltent la conscience? Pourquoi donc Robespierre serait-il le bouc-émissaire de tous les forfaits qu'engendre ou subit notre malheureuse race dans ses heures de lutte suprême?
Dans Les Misérables, Enjolras, le chef des étudiants révolutionnaires, exprime son admiration à l'égard de Jean-Jacques Rousseau et Robespierre.
Dans son dernier roman, Quatrevingt-treize 1874, Victor Hugo met en scène la rencontre imaginaire entre trois grandes figures de la révolution française: Marat, Danton et Robespierre.
Jules Vallès offre de Robespierre une image foncièrement négative, concomitante à l'empreinte qu'il exerce sur lui. Avant 1871, Robespierre apparaît comme un visage pâle, paternel, celui de la violence froide et de la mort, un corps raide, hiératique, un héritier de Plutarque et de Jean-Jacques Rousseau, porteur du déisme du XVIIIe siècle.
Cette critique devient une autocritique dans les années 1865-1866, sous l'influence de Pierre-Joseph Proudhon.
Après l'expérience de la Commune, jugeant la génération 1848 et se jugeant lui-même à la lumière de Robespierre, il dénonce la tyrannie du patrimoine culturel classique enseigné dans les collèges et le système éducatif du XIXe siècle, se reprochant d'avoir imité des imitateurs de l'Antiquité, à travers Rousseau et Robespierre.
Pourtant, signale Roger Bellet, la hargne de Vallès à l'égard de Rousseau n'est pas automatiquement réversible sur Robespierre ; son déisme voulait sans doute être à usage populaire, celui d'une religion non ecclésiastique, Vallès pouvait partager sa critique du philosophisme, sa critique d'un « monde de scolastique philosophique et émeutier » est plus proche de Robespierre que d'Hébert.
En 1912, Anatole France met en scène Évariste Gamelin, un jeune peintre jacobin, fidèle de Marat et de Robespierre, dans son roman Les dieux ont soif.
L'Incorruptible apparaît lui-même dans le chapitre XXVI, peu avant le 9-Thermidor.
L'épisode de la promenade dans les Jardins Marbeuf, lieu à la mode à l'époque, avec Brount, son chien danois, et de l'échange avec le petit Savoyard est déjà présent dans l’Histoire de la Révolution française de Louis Blanc et l’Histoire de Robespierre d'Ernest Hamel, qui l'ont tiré des mémoires manuscrits d'Élisabeth Le Bas.
Théâtre
Dès après sa mort, Robespierre a été le héros ou l'un des personnages principaux de nombreux drames ou tragédies : 49 pièces ont été recensées entre 1791 et 1815, 37 entre 1815 et 1989.
Deux images de Robespierre s'en détachent : une majorité lui est hostile, sans nuance, l'autre partie est réhabilitatrice, voire célébratrice.
Entre Thermidor et l'Empire se développe la légende noire de Robespierre, à travers les faibles drames de Godineau La Mort de Robespierre, ou la Journée des 9 et 10 thermidor, 1795 ou d'Antoine Sérieys La Mort de Robespierre, 1801.
En décembre 1830, le Robespierre d'Anicet Bourgeois présente encore la même caricature de tyran sanguinaire, laconique et peureux.
D'autres pièces font clairement allusion à Robespierre, ainsi Manlius Torquatus ou La discipline romaine pièce d'inspiration jacobine, jouée en février 1794 de Joseph Lavallée, Pausanias représenté en mars 1795, édité en 1810 de Claude-Joseph Trouvé, Quintus Fabius ou La discipline romaine interprété au théâtre de la République, fin juillet 1795 de Gabriel Legouvé ou Théramène ou Athènes sauvée 1796 d'Antoine Vieillard de Boismartin.
En Angleterre, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey et Robert Lovell écrivent un drame en vers intitulé The Fall of Robespierre en août 1794 ; Coleridge rédige le premier acte, Southey le deuxième, Lovell le troisième ; mais Southey, jugeant cette dernière partie non conforme, la réécrit.
Les auteurs s'appuient pour l'essentiel sur les comptes-rendus des événements parus dans la presse. Édité sous le seul nom de Coleridge en octobre 1794 par Benjamin Flower, il est tiré à 500 exemplaires et distribué à Bath, Cambridge et Londres.
Si le Thermidor 1891 de Victorien Sardou est d'inspiration girondine,
le Robespierre 1845 de Rudolf Gottschall,
le Maximilien Robespierre 1850 de Robert Griepenkerl,
le Danton und Robespierre 1871 de Robert Hamerling,
Le Neuf Thermidor (1871) de l'avocat nîmois Gaston Crémieux,
le Robespierre ou les drames de la Révolution (1879) de Louis Combet,
Le Monologue de Robespierre allant à l'échafaud (1882) d'Hippolyte Buffenoir,
Le Dernier songe de Robespierre (1909) d'Hector Fleischmann,
L'Incorruptible, chronique de la période révolutionnaire (1927) de Victor-Antoine Rumsard et
le Robespierre 1939 de Romain Rolland sont robespierristes.
Leur premier enjeu, selon Antoine de Baecque, est de transformer le corps, souffrant, blessé, défiguré de Robespierre le 10 thermidor, présenté par les thermidoriens comme un cadavre monstrueux, en un corps de héros ,
une figure christique.
Fascinée par Robespierre, auquel elle attribue ses opinions communistes, Stanisława Przybyszewska (1901-1935) lui consacre deux pièces :
L'Affaire Danton, redécouverte par le metteur en scène Jerzy Krakowski en 1967 et adaptée au cinéma par Andrzej Wajda sous le titre Danton, ainsi que
Thermidor, demeurée inachevée.
Avec le temps, les auteurs tendent de plus en plus à problématiser le personnage théâtral, ainsi Georg Büchner, qui ne prend pas parti pour ou contre lui dans
La Mort de Danton 1835, mais s'interroge sur la possibilité de la révolution.
Le même questionnement apparaît chez Romain Rolland, qui passe, entre Danton (1900) et Robespierre (1938), de la justification et de l'exaltation du personnage à l'expression des souffrances morales d'un Robespierre déchiré devant le problème du sang versé.
Le Bourgeois sans culotte de Kateb Yacine, joué au festival d'Avignon de 1988 puis au palais Saint-Vaast d'Arras en 1989 et sur le carreau de la mine désaffectée de Loos-en-Gohelle en octobre 1990, présente Robespierre comme le seul des révolutionnaires français à avoir su imposer la suppression de l'esclavage, l'inspirateur permanent d'une révolution mondiale des maltraités , et voit en lui un modèle, un martyr vivant de la république , victime de ceux à qui il portait ombrage.
Liens
http://youtu.be/XiM74n8I2Gc Henri Guillemin Robespierre 1
http://youtu.be/Fpx5Gj-boRo Henri Guillemin Robespierre 2
http://youtu.be/dRqLQdctMZU L'ombre d'un doute Robespierre
http://youtu.be/PhHH9G6mUcQ Robespierre La chute création de la légende noire
http://youtu.be/_ssIznJZ-hw Robespierre par Laurent Dingli
   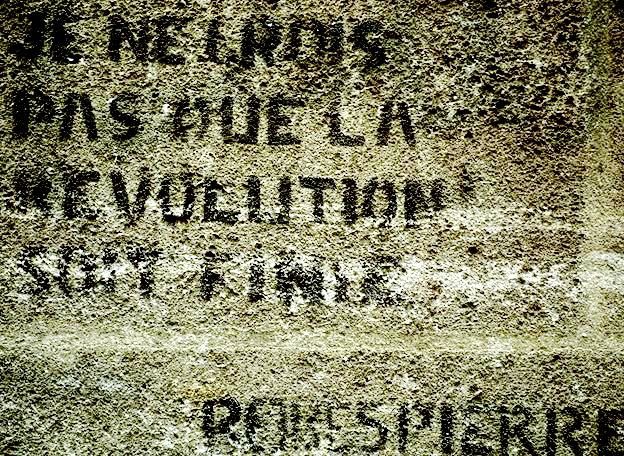 [imgwidth=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Harriet_-_La_Nuit_du_9_au_10_thermidor_an_II,_Arrestation_de_Robespierre.jpg[/img]   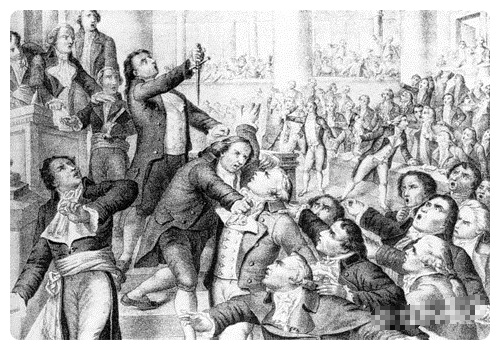
Posté le : 27/07/2013 17:18
Edité par Loriane sur 28-07-2013 15:19:15
Edité par Loriane sur 28-07-2013 15:40:21
|
|
|
|
|
Vivaldi |
|
Administrateur  
Inscrit:
14/12/2011 15:49
De Montpellier
Niveau : 63; EXP : 93
HP : 629 / 1573
MP : 3166 / 57662
|
Le 28 Juillet 1741 meurt Antonio Lucio Vivaldi,
violoniste et compositeur italien.
Vivaldi a été selon un témoignage contemporain l’un des virtuoses du violon les plus admirés de son temps, incomparable virtuose du violon; il est également reconnu comme l’un des plus importants compositeurs de la période baroque, en tant qu'initiateur principal du concerto de soliste, genre dérivé du concerto grosso.
Son influence, en Italie comme dans toute l’Europe, a été considérable, et peut se mesurer au fait que Bach a adapté et transcrit plus d’œuvres de Vivaldi que de n'importe quel autre musicien.
Vivaldi a exercé une influence capitale sur l'évolution de la musique préclassique. Il a imposé, sinon inventé de toutes pièces, la forme du concerto de soliste, contribué puissamment à l'élaboration de la symphonie, donné au théâtre et à l'Église des œuvres dont on commence seulement à mesurer l'importance. Son retour à la lumière est un des phénomènes les plus curieux et les plus troublants de l'histoire musicale des temps modernes. De son vivant, célèbre, admiré de l'Europe entière, il était tombé brusquement, à l'extrême fin de sa vie, dans un oubli si profond que sa mort passa inaperçue et que pendant un siècle son nom disparut, même dans sa patrie, des histoires et recueils biographiques. Il dut sa résurrection à celle de Bach, au milieu du XIXe siècle, lorsqu'en inventoriant les manuscrits du Cantor on retrouva les copies et transcriptions qu'il avait faites d'originaux vivaldiens restés jusqu'alors ensevelis sous la poussière des bibliothèques. Longtemps mésestimée, l'originalité créatrice de Vivaldi fut révélée au début du XXe siècle par les travaux d'Arnold Schering, de Marc Pincherle, de l'Accademia Chigiana et d'Olga Rudge, puis, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, par la colossale édition intégrale de la musique instrumentale par l'Istituto italiano Antonio Vivaldi dans la révision de Malipiero. Le tricentenaire de sa naissance donna une impulsion nouvelle aux recherches sur Vivaldi, dont la musique d'Église et le répertoire lyrique (cantates et opéras) sont désormais systématiquement explorés, en vue de l'édition critique entreprise chez l'éditeur milanais Ricordi.
Sa vie
Professeur et compositeur Antonio Vivaldi dit Il Prete rosso (le Prêtre roux)
Compositeur et violoniste italien (Venise 1678-Vienne 1741).
Pour sa gloire éternelle, Venise eut ses peintres.
Elle eut aussi son musicien : Antonio Vivaldi, qui fut un maître du concerto en même temps qu'un compositeur de sonates et d'opéras d'une impressionnante fécondité.
Il fut également violoniste, pédagogue et chef d'orchestre.
Une double vocation : prêtre et musicien
Fils aîné d'une famille de sept enfants, dont le père est un violoniste attaché à la basilique Saint-Marc, Antonio Vivaldi acquiert très tôt la maîtrise du violon.
Fils de Giovanni Battista Vivaldi, violoniste de la chapelle ducale de San Marco.
Les premiers rudiments de son art lui furent probablement donnés par son père. Orienté vers une carrière ecclésiastique, il fut ordonné prêtre en 1703, mais renonça à célébrer la messe dès 1705 sans quitter l'Église pour autant,
Destiné cependant à la prêtrise, il est ordonné à l'âge de 25 ans : il devra au blond vénitien de sa chevelure d'entrer dans l'histoire sous le sobriquet du « Prêtre roux ».
Sujet à des crises d'asthme, il se fait dispenser de ses devoirs liturgiques dès 1706. Il se consacre alors à la pédagogie, enseignant le violon à l'orphelinat de la Pitié (Pio Ospedale della Pietà) – dont il dirige aussi l'orchestre au cours de concerts publics réputés –, et à l'écriture : en 1705, puis 1709, il publie les 24 premières des 73 sonates qu'il composera au total.
En 1713, Vivaldi aborde le domaine de l'art lyrique, dont il a eu la révélation en assistant à des représentations d'opéras de Scarlatti et d'Händel. Ottone in villa, puis Orlando finto pazzo (1714) sont les deux premières d'une série de cinquante œuvres pour la scène (dont 13 intégralement conservées), qui formeront un répertoire de grands airs – même si ceux-ci ne suivent pas toujours le livret ou la dramaturgie. À cette même époque, Vivaldi dédie deux oratorios (1714, 1716) à la Pietà, où, devenu maître de chapelle, il restera officiellement en poste jusqu'en 1740. Il ne la quittera que lors de ses séjours à Mantoue et à Rome – il joue devant le pape Benoît XIII en 1724 – et de ses voyages à l'étranger, notamment à Amsterdam, où paraîtra l'essentiel de son œuvre. À ces occupations déjà débordantes il ajoute en 1719 l'activité d'imprésario du théâtre Sant'Angelo de Venise, où seront montés nombre de ses opéras.
La frénésie créatrice
Si Vivaldi est passé à la postérité, il le doit avant tout à sa musique instrumentale, qui ne compte pas moins de 456 concertos – dont 223 pour violon et orchestre, 22 pour violon soliste et 27 pour violoncelle. Non seulement il spécifie la structure du genre – allegro, andante, allegro –, mais, à travers celui-ci, il fait évoluer la technique du violon, qui devient affaire de virtuose. Ses célèbres Quatre Saisons (vers 1725) sont le prototype même du concerto classique.
En état de perpétuelle inspiration, Vivaldi écrit aussi pour la voix. À la Pietà comme au théâtre, il a pris l'habitude des chœurs. Sa musique sacrée offre peu d'innovations par rapport aux formes en usage, mais elle contient quelques pièces superbes, parmi lesquelles un Gloria en ré majeur, un Magnificat à quatre voix et des motets. Dans le genre profane, il est l'auteur des deux cantates interprétées à l'occasion du mariage de Louis XV et de Marie Leszczyńska (1725), de sérénades et d'une centaine d'autres airs.
Un Vénitien de cœur et d'esprit
Vivaldi incarne à la perfection l'esprit vénitien en particulier et l'esprit du xviiie siècle en général. On sait, par exemple, qu'il recherchait la compagnie des femmes et que plusieurs d'entre elles, outre son égérie, la cantatrice Anna Giraud, l'accompagnaient lors de ses voyages. Il y gagna une réputation de libertin, que réprouva l'Église : en 1737, son projet de saison lyrique à Ferrare fut interdit sur ordre du cardinal-archevêque de la ville.
Vivaldi aimait le faste et la gloire. Considéré comme une sommité de la musique, il fut comblé par l'estime que lui portèrent les têtes couronnées, tels Frédéric IV, roi de Danemark et de Norvège, et l'empereur Charles VI de Habsbourg lui-même – auquel furent dédiés les 12 concertos de La Cetra (la Lyre, 1728). Le compositeur, dont les œuvres circulaient dans toute l'Europe, fut aussi en grâce auprès de ses pairs. Bach, soulevé d'enthousiasme, transcrivit (ou arrangea) une vingtaine de ses concertos. Telemann et Haydn firent son éloge.
Dernières années : l'oubli
En 1735, Vivaldi entre au service du duc de Lorraine, le futur empereur germanique François Ier. Puis il se rend à la cour de Dresde et, en juin 1741, il gagne Vienne, où, dans le mois qui suit,
Il meurt le 28 Juillet 1741 , à soixante trois ans, dans le dénuement, du fait de sa prodigalité, et dans l'indifférence. Il ne retrouvera toute sa gloire que dans les années 1910, à l'instigation du musicologue Marc Pincherle (1888-1914).
****************
Il laissait une œuvre énorme : près de six cent cinquante compositions instrumentales, plus de cinquante opéras, quatre oratorios, six sérénades, trente cantates de chambre et une soixantaine de pages sacrées.
Le maître du concerto
Vivaldi n'a pas créé de toutes pièces le concerto de soliste, qui devait supplanter le concerto grosso et ouvrir la voie à la sinfonia préclassique. Avant lui, on trouve chez Albinoni, Torelli et d'autres le dispositif qui consiste à encadrer un mouvement lent entre deux allégros (le mouvement lent parfois réduit à quelques mesures, voire à une simple cadence) ; mais aucun de ses devanciers n'avait pris conscience des ressources expressives de cette structure tripartite. Ce sont la découverte et l'exploitation géniale de ces ressources qui caractériseront le concerto vivaldien, lui donneront l'impulsion décisive, en feront le point de départ d'une évolution ininterrompue.
Son oeuvre
Concerto pour violon, hautbois, cordes et basse continue
Antonio Vivaldi (1678-1741) deuxième mouvement, larghetto, du Concerto pour violon, hautbois, deux flûtes à bec, deux hautbois, basson, cordes et basse continue, en sol mineur, RV 576, P 359 Josef Suk, violon, Jan Adamus, hautbois, Orchestre de chambre Suk de Prague, direction Jose…
« Le solo de concerto, a dit Saint-Saëns en 1905, est un rôle qui doit être conçu et rendu comme un personnage dramatique. » C'est dans cet esprit que Vivaldi a écrit ses concertos, à partir du prestigieux recueil de L'Estro armonico op. 3, publié en 1711, où le génie vivaldien trace péremptoirement le devenir du concerto, depuis l'archaïque concerto grosso jusqu'au concerto pour véritable soliste, chargé de passion, véritable transposition instrumentale du monde de l'opéra. Suivront ces manifestes de la libération du soliste que constituent La Stravaganza op. 4 (1714), Il Cimento dell' Armonia e dell' Invenzione op. 8 (1725), qui inclut Les Quatre Saisons, La Cetra op. 9 (1727) et, enfin, les concertos de haute maturité, préclassiques dans leur développement et proches, par leurs difficultés techniques, des concertos de Tartini ou de Locatelli. Les deux cent quarante concertos pour violon conservés sont d'une facture très inégale, mais, dans les concertos où il a pris le temps d'être lui-même, résonne un accent qu'on n'avait jamais entendu avant lui. Il exalte un sentiment personnel, un lyrisme dont la vogue va être aussi étendue que soudaine. Virtuose admiré, il écrit pour lui-même des soli qui concentreront sur sa personne l'attention passionnée des auditeurs.
Bientôt le concerto de soliste tel qu'il le traitera – avec son plan d'une simplicité lumineuse, son ardeur entraînante, une écriture homophone analogue à celle de l'opéra, l'agrément des prouesses de virtuosité – apparaîtra comme la forme moderne par excellence. Ses deux mouvements extrêmes, tous deux allegro ou presto, sont bâtis sur un même plan : un thème principal, qui peut être assez long et se scinder en plusieurs tronçons susceptibles d'être, par la suite, utilisés séparément, est dévolu au gros de l'orchestre, le tutti. Entre ses réapparitions, qui sont comme les assises du morceau, le soliste intervient, soit dans une présentation ornementée du thème principal, soit dans un thème secondaire qui lui appartient en propre, soit, plus souvent, dans des traits de vélocité faisant fonction de divertissements.
C'est dans le mouvement lent médian que Vivaldi innove avec le plus de hardiesse, tant dans la forme que dans la substance même. Il est vraiment le premier à faire passer le pathétique des airs les plus passionnés de l'opéra vénitien dans le largo, qui devient le point culminant du concerto. Désormais ce sera moins une construction abstraite qu'une grande effusion lyrique. Le soliste s'y abandonne à son inspiration avec un élan que l'orchestre n'est plus là pour freiner, car il s'efface – l'accompagnement restant confié à l'orgue ou au clavecin – ou ne reste en scène que pour les ritournelles qui encadrent le solo, à moins que, mettant en œuvre un procédé d'orchestration fréquent à l'opéra, il n'accorde au soliste que le soutien ténu d'un dessin de violons et d'altos, toutes basses supprimées. Le soliste n'est pas nécessairement un violoniste : des quelque cinq cent vingt concertos répertoriés, près de la moitié sont bien écrits pour violon, sans oublier la cinquantaine de pages mettant en vedette des combinaisons de deux à cinq archets solistes (violons, plus violoncelles ou viole all'inglese). Les autres révèlent le plus étonnant catalogue d'instruments solistes : vingt-neuf concertos pour violoncelle, trente-neuf pour basson, huit pour viole d'amour, vingt pour hautbois, quinze pour flûte traversière. Trompettes, cors naturels, mandolines lombardes, flautino, liutino, salmoe ont également sollicité l'attention de Vivaldi, qui les a traités avec une très exacte connaissance de leurs ressources, employés comme prime donne instrumentales face à l'orchestre, quand ils ne mêlent pas leurs timbres anachroniques en des concertos à trois, quatre ou cinq solistes différents et basse continue, d'un modernisme inouï. La Pietà, à laquelle ils étaient destinés, représentait pour Vivaldi un laboratoire de timbres, où il combinait les possibles en une alchimie sonore d'une richesse quasi ésotérique.
Véritables symphonies pour cordes, d'exécution facile pour les jeunes musiciennes de la Pietà, les concerti ripieni, tout en sacrifiant au nouveau type homophonique, font largement appel à une écriture polyphonique qui, loin du rôle stérilisant qu'elle avait joué en s'hypertrophiant à la fin de la Renaissance, devient principe d'enrichissement. Au moment où le discours musical est en danger de se réduire à une simple mélodie accompagnée, plus ou moins farcie de traits de virtuosité, le recours à un contrepoint allégé, modernisé, capable de transiger avec l'harmonie verticale, va conjurer la décadence de l'orchestre. L'écriture à quatre voix deviendra un stimulant pour les recherches de sonorité aussi bien que de forme, de là, l'un des principaux ressorts du développement symphonique.
La musique descriptive
La musique descriptive occupe une large place dans la production instrumentale de Vivaldi. Elle va de la suggestion d'un état d'âme (Inquietudine, Il Riposo, Il Sospetto) à de véritables « musiques à programme », chasses, tempêtes, nuit où circulent des fantômes. Sa plus brillante réussite réside dans les quatre concertos des Saisons, réunis dans l'opus 8 (de 1725) après avoir circulé, manuscrits, dans toute l'Europe. C'est aux Saisons, et plus particulièrement au concerto du Printemps, que Vivaldi a dû une flambée de gloire plus vive encore que celle que la publication de L'Estro armonico avait suscitée quatorze ans plus tôt. Ce qui aujourd'hui nous frappe le plus, en dehors de la saveur des idées et des timbres instrumentaux, c'est la façon qu'a Vivaldi de décrire avec toute la précision dont le XVIIIe siècle était féru, mais en même temps de faire entrer les scènes et péripéties décrites dans le cadre et selon le plan du concerto : un « sommeil », entre un orage et des danses champêtres, le recueillement au coin du feu, entre deux tempêtes d'hiver, ce n'est rien d'autre que le largo médian, précédé et suivi des deux mouvements vifs. À l'intérieur de chaque mouvement, il en va à peu près de même. Les tutti jouent le rôle traditionnel : gros œuvre de la construction, élément de symétrie et de stabilité ; en même temps, ils expriment la nuance dominante du morceau, insouciante gaieté du printemps, langueur accablante de l'été, etc. Les soli sont à la fois les divertissements modulants, les traits de virtuosité que nous connaissons, et les détails de la description, chants d'oiseaux, murmures des sources, aboiement du chien, marche titubante de l'ivrogne, glissade et chute sur le verglas du voyageur d'hiver.
La musique descriptive avait dans sa conception, ses matériaux, ses procédés d'orchestration, de nombreux points de contact avec la musique de théâtre. Chez Vivaldi, il n'existe pas de séparation nette entre le vocal et l'instrumental. Constamment, les genres s'interpénètrent, se chevauchent, se pillent avec une unité de style caractéristique.
Le musicien sacré
La grandeur de la musique sacrée de Vivaldi ne tient pas à sa portée historique, car elle a peu circulé de son vivant, mais à ses qualités artistiques et à son inspiration élevée. Sans rejoindre, comme chez Bach, la réflexion spéculative, l'expression reste, dans les œuvres les plus marquantes, toujours très personnelle, attachante, et d'une chaleureuse humanité.
Alors que Vivaldi composa concertos et opéras en continuité, la musique sacrée fut élaborée en trois étapes limitées dans le temps. La première correspond pour l'essentiel à des commandes de la Pietà, entre le départ du maestro Francesco Gasparini (avr. 1713) et l'appointement de son successeur, Carlo Pietro Grua (févr. 1719). Certaines constantes stylistiques apparaissent, imposées par la présence de voix uniquement féminines dans le chœur. Les parties de ténors et de basses, destinées par conséquent à des femmes à la tessiture grave, sont souvent doublées par les instruments, pour combler quelque possible défaillance. L'écriture suit une ligne claire pour la voix comme pour l'orchestre, enrichi parfois d'un obligato de hautbois. Le Stabat Mater RV621, l'oratorio Juditha triumphans, les Gloria RV588 et 589, le Magnificat RV610b restent parmi les plus belles réussites de cette période.
Pendant la décennie suivante, entre son retour de Mantoue à Venise et un voyage dans les territoires de l'Empire autrichien en 1729, Vivaldi honore diverses commandes étrangères à la Pietà. Il compose en particulier des psaumes et parties de messe in due cori, avec double chœur et double orchestre, révélateurs d'une maturation stylistique. La texture devient plus complexe, le contrepoint ostentatoire, les parties de basses plus exigeantes, alors que l'orchestre s'enrichit de parties de flûtes et de hautbois obligés. Les chefs-d'œuvre abondent : Kyrie RV587, Dixit Dominus RV594, Beatus vir RV597, Confitebor tibi Domine RV596.
Peu de temps avant de clore sa collaboration avec la Pietà, en 1739, Vivaldi fournit ses ultimes compositions sacrées, où il paie son tribut au culte du solismo et adapte son langage à la manière galante en vogue à Venise. Deux pages majeures sont reprises de compositions antérieures : les versions révisées du Magnificat RV611 et du Beatus vir RV795, qui portent les stigmates d'une significative évolution stylistique.
Dans tous les genres explorés dans la soixantaine d'œuvres sacrées qui nous est parvenue, Vivaldi témoigne de la même spontanéité, de la même sincérité, de la même ardeur, pont tendu entre l'imagination du musicien et la foi du Prete rosso.
Le musicien lyrique
Dans une lettre datant de 1739, deux ans avant sa mort, Vivaldi déclare avoir composé quatre-vingt-quatorze opéras. Nous n'en connaissons de façon sûre qu'une cinquantaine, et nous ne possédons la musique que de vingt et un d'entre eux (ni tous complets ni entièrement de sa plume). Composés parfois à la hâte, de nombreux morceaux voyageant tels quels d'un opéra à l'autre, ils respectent globalement la séparation rigoureuse entre récitatifs et airs, la maîtrise de la technique du chant et le contrôle parfait des moyens expressifs permettant de « coller » efficacement au drame. Une étude chronologique du style révèle comment son esprit d'indépendance poussa Vivaldi, dès le début de sa carrière, à combiner les fonctions de compositeur et d'imprésario.
Dès ses premières commandes lyriques (1713-1718), Vivaldi apparaît comme le plus moderne des compositeurs vénitiens, alternative aux Pollarolo (Carlo Francesco et Antonio), Lotti, Gasparini ou Albinoni, tenants de la tradition. Il conserve néanmoins des attaches avec l'ancien théâtre, héritier du Seicento. Les airs se trouvent souvent au milieu d'une scène, et non pas obligatoirement à la fin ; là, en fait, où ils contribuent le mieux à la situation dramatique. Ils adoptent souvent la forme binaire, ou d'un seul tenant, et ne sont pas forcément avec da capo. Les rôles sont équitablement répartis, avec encore quelques éléments comiques. Le nombre de scènes est important, et l'instrumentation fait appel aux instruments rares.
La décennie suivante (1718-1726) conduit Vivaldi loin de sa ville natale, à Mantoue, Milan ou Rome. C'est le triomphe du « style moderne » vénitien, fustigé par Benedetto Marcello dans son Teatro alla moda de 1720. Vivaldi en est un des vibrants représentants. La voix est prééminente, souvent accompagnée colla parte pour un impact acoustique plus grand, la distinction est nette entre passages déclamatoires et coloratures, et dans l'orchestre la ligne des basses est souvent simplifiée. Vivaldi reste pleinement maître de ses propres ressources, enrichies par un acquis instrumental merveilleux. De plus, en bon imprésario attentif aux goûts de son public potentiel – les classes moyennes des petits théâtres vénitiens où il donnait ses œuvres –, il glisse savamment intrigues amoureuses et spectacles orientaux, préférés aux valeurs aristocratiques d'onore ou de fortezza, dont il pressent la précarité.
De 1727 à 1739, Vivaldi tente, tant bien que mal, de résister à l'invasion des talents venus du Sud, depuis son bastion du Sant'Angelo, purement vénitien, alors que le San Giovanni Grisostomo, la plus grande scène de Venise, s'ouvre aux Napolitains. Vivaldi regarde désormais vers Leonardo Vinci ou Nicola Antonio Porpora, dénichant et s'emparant d'idiomes stylistiques que le public aime à côté des siens propres, en particulier dans le cantabile et l'allegro chantant. Tout en se pliant à la mode, il sauve cependant les moments centraux et dramatiques du drame, réalisant l'union harmonieuse du pathétisme baroque avec une expression plus sensible, dans le cadre d'un style mélodique riche, lié toujours aux affetti de l'âme. Les airs sont superbes, les da capo merveilleusement épanouis, avec un accompagnement instrumental à quatre parties dépouillé, mais efficace, témoignage d'un fabuleux métier.
On perçoit mieux, maintenant, l'influence que Vivaldi a exercée en profondeur sur les destinées de la musique, la révélation que lui a due Bach des formes et de l'esprit de la musique italienne de son temps, l'impulsion donnée au concerto et à la sinfonia, une abondance de tournures mélodiques et rythmiques nouvelles, dans lesquelles ont puisé, pendant près d'un demi-siècle, des compositeurs de tous pays. On lui rendra grâce d'avoir été de la façon la plus directe un créateur, un poète d'une puissance lyrique exceptionnelle.
****************************
Sa vie par date
4 mars 1678 Antonio Lucio Vivaldi naît à Venise.
1703 Vivaldi est ordonné prêtre le 23 mars ; en septembre, il obtient son premier poste officiel, celui de professeur de violon (maestro di violino) au Pio Ospedale della Pietà.
1705 Son opus 1 est publié à Venise ; il s'agit d'un recueil de douze sonates de chambre en trio pour deux violons et contrebasse de viole de gambe ou clavecin (Suonate da camera a tre, due violoni, e violone o cembalo).
1709 Un recueil de douze sonates pour violon et basse continue dédié à Frédéric IV, roi de Danemark et de Norvège, en visite dans la cité des Doges, est publié à Venise, sans numéro d'opus ; il sera réédité à Amsterdam en 1712, chez Estienne Roger, comme l'opus 2 de Vivaldi.
1711 L'imprimeur Estienne Roger publie à Amsterdam les deux livres de L'Estro armonico, opus 3, qui comprennent douze concertos pour cordes et continuo répartis en cinq groupes : pour un violon (no 3, en sol majeur, RV 310 ; no 6, en la mineur, RV 356 ; no 9, en ré majeur, RV 230 ; no 12, en mi majeur, RV 265), pour deux violons (no 5, en la majeur, RV 519 ; no 8, en ré majeur, RV 522), pour deux violons et violoncelle (no 2, en sol mineur, RV 578 ; no 11, en ré mineur, RV 565), pour quatre violons (no 1, en ré majeur, RV 549 ; no 4, en mi mineur, RV 550), pour quatre violons et violoncelle (no 7, en fa majeur, RV 567 ; no 10, en si mineur, RV 580). Jean-Sébastien Bach transcrira les nos 3, 9 et 12 (Concertos pour clavicorde BWV 978, BWV 972 et BWV 976, 1713), les nos 8 et 11 (Concertos pour orgue BWV 593 et BWV 596, 1713) et le no 10 (Concerto pour quatre clavicordes BWV 1 065, 1735).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 3
L'Estro armonico: troisième mouvement du Concerto no 3, pour un violon, en sol majeur, RV.310 Interprétation: Reinhold Barchet, violon, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 6
L'Estro armonico: premier mouvement du Concerto no 6, pour un violon, en la mineur, RV.356 Interprétation: Reinhold Barchet, violon, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no9
L'Estro armonico: deuxième mouvement du Concerto no9, pour un violon, en ré majeur, RV.230 Interprétation: Reinhold Barchet, violon, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 12
L'Estro armonico: premier mouvement du Concerto no 12, pour un violon, en mi majeur, RV.265 Interprétation: Reinhold Barchet, violon, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 5
L'Estro armonico: troisième mouvement du Concerto no 5, pour deux violons, en la majeur, RV.519 Interprétation: Reinhold Barchet, violon, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Crédits: CEFIDOM / Encyclopædia Universalis Consulter
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 8
L'Estro armonico: premier mouvement du Concerto no 8, pour deux violons, en ré majeur, RV.522 Interprétation: Reinhold Barchet, Andrea Steffen-Wendling, violons, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 2
L'Estro armonico: premier mouvement du Concerto no 2, pour deux violons et violoncelle, en sol mineur, RV.578 Interprétation: Reinhold Barchet, Andrea Steffen-Wendling, violons, Siegfried Barchet, violoncelle, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 11
L'Estro armonico: premier mouvement du Concerto no 11, pour deux violons et violoncelle, en ré mineur, RV.565 Interprétation: Reinhold Barchet, Andrea Steffen-Wendling, violons, Siegfried Barchet, violoncelle, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 1
L'Estro armonico: troisième mouvement du Concerto no 1, pour quatre violons, en ré majeur, RV.549 Interprétation: Reinhold Barchet, Andrea Steffen-Wendling, Heinz Endres, Franz Hopfner, violons, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 4
L'Estro armonico: deuxième mouvement du Concerto no 4, pour quatre violons, en mi mineur, RV.550 Interprétation : Reinhold Barchet, Andrea Steffen-Wendling, Heinz Endres, Franz Hopfner, violons, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 7
L'Estro armonico: premier mouvement du Concerto no 7, pour quatre violons et violoncelle, en fa majeur, RV.567 Interprétation: Reinhold Barchet, Andrea Steffen-Wendling, Heinz Endres, Franz Hopfner, violons, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 10, premier mouvement
L'Estro armonico: premier mouvement du Concerto no 10, pour quatre violons et violoncelle, en si mineur, RV.580 Interprétation: Reinhold Barchet, Andrea Steffen-Wendling, Heinz Endres, Franz Hopfner, violons, Siegfried Barchet, violoncelle, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
Son
Vivaldi, L'Estro armonico, Concerto no 10, deuxième mouvement
L'Estro armonico: deuxième mouvement du Concerto no 10, pour quatre violons et violoncelle, en si mineur, RV.580 Interprétation: Reinhold Barchet, Andrea Steffen-Wendling, Heinz Endres, Franz Hopfner, violons, Siegfried Barchet, violoncelle, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1952).
1713-1719 Vivaldi écrit de la musique d'église. Parmi les nombreuses compositions de cette période, citons le Gloria en ré majeur RV 589, le Magnificat RV 610b, le Stabat Mater RV
Son
Vivaldi, Gloria
Gloria, en ré majeur, RV.589: Cum Sancto Spiritu Interprétation: Orchestra e coro della Scuola di Arzignano, direction Antonio Pellizzari (enregistré en 1954).
Son
Vivaldi, Magnificat
Magnificat, RV.610b: Fecit potentiam Interprétation: Angelicum de Milan, direction Carlo Felice Cillario (enregistré en 1953)
Son
Vivaldi, Stabat Mater
Stabat Mater, en fa mineur, RV.621 Interprétation: Maria Amadini, alto, Angelicum de Milan, direction Ennio Gerelli (enregistré en 1951)
Son
Vivaldi, Juditha Triumphans
Juditha Triumphans, RV.644: premier chœur Interprétation: Chœur de La Fenice de Venise, La Scuola Veneziana, direction Angelo Ephrikian (enregistré en 1953).
1716 L'imprimeur Estienne Roger publie à Amsterdam les deux livres de La Stravaganza, opus 4, qui comprennent douze concertos pour cordes.
Son
Vivaldi, La Stravaganza, Concerto no 10
La Stravaganza: premier mouvement du Concerto pour cordes no 10, en ut mineur, RV.196 Interprétation: Reinhold Barchet, violon, Pro Musica Orchestra, Stuttgart, direction Rolf Reinhardt (enregistré en 1954).
1718-1720 Vivaldi est musicien à la cour de Mantoue, où il compose trois opéras (dramma per musica) en trois actes : Teuzzone (sur un livret de Apostolo Zeno, créé au Teatro Arciducale le 28 décembre 1718), Tito Manlio (sur un livret de Matteo Noris, créé au Teatro Arciducale durant le carnaval de 1719) et La Candace, o siano Li veri amici (sur un livret de Francesco Silvani révisé par Domenico Lalli, d'après la tragédie de Pierre Corneille Héraclius, empereur d'Orient, créé au Teatro Arciducale durant le carnaval de 1720).
1725 L'imprimeur Le Cène publie à Amsterdam Il Cimento dell' Armonia e dell' Invenzione (« Le Combat de l'harmonie et de l'invention »), opus 8. Les quatre premiers concertos de ce recueil de douze concertos pour violon constituent Les Quatre Saisons (Le Quattro Stagioni) : La Primavera (« Le Printemps », en mi majeur, RV 269), L'Estate (« L'Été », en sol mineur, RV 315), L'Autunno (« L'Automne », en fa majeur, RV 293) et L'Inverno (« L'Hiver », en fa mineur, RV 297).
Son
Vivaldi, Les Quatre Saisons, Le Printemps
Les Quatre Saisons: deuxième mouvement du concerto pour violon La Primavera («Le Printemps»), en mi majeur, RV.269 Interprétation: Philharmonia Orchestra, direction Carlo Maria Giulini (enregistré en 1954).
Son
Vivaldi, Les Quatre Saisons, L'Été
Les Quatre Saisons: premier mouvement du concerto pour violon L'Estate («L'Été»), en sol mineur, RV.315 Interprétation: Philharmonia Orchestra, direction Carlo Maria Giulini (enregistré en 1954).
Son
Vivaldi, Les Quatre Saisons, L'Automne
Les Quatre Saisons: premier mouvement du concerto pour violon L'Autunno («L'Automne»), en fa majeur, RV.293 Interprétation: Philharmonia Orchestra, direction Carlo Maria Giulini (enregistré en 1954).
Son
Vivaldi, Les Quatre Saisons, L'Hiver
Les Quatre Saisons: premier mouvement du concerto pour violon L'Inverno («L'Hiver»), en fa mineur, RV.297 Interprétation: Philharmonia Orchestra, direction Carlo Maria Giulini (enregistré en 1954).
1727 L'imprimeur Le Cène publie à Amsterdam les deux livres de La Cetra, opus 9, recueil de douze concertos pour cordes : onze pour un violon et un pour deux violons (no 9).
17 février 1734 L'Olimpiade, dramma per musica en trois actes sur un livret de Métastase, est représenté au Teatro Sant' Angelo de Venise.
17 janvier 1736 Un des derniers opéras de Vivaldi, Ginevra principessa di Scozia, dramma per musica en trois actes sur un livret d'Antonio Salvi d'après l'Arioste, est créé au Teatro della Pergola de Florence. Vivaldi se targuait d'avoir composé 94 opéras ; on ne possède la musique que de vingt et un d'entre eux (ni tous complets ni entièrement de sa plume).
27 ou 28 juillet 1741 Vivaldi meurt à Vienne.
-----------------------------------------
Son Oeuvre
Vivaldi aurait produit 507 concertos (approximativement), répartis comme suit :
1, 2, 3 ou 4 violons : 255
1 ou 2 violoncelles : 30
combinaisons diverses de violon(s) et violoncelle(s) : 11
violon et orgue : 5
viole d’amour : 7
orchestre à cordes sans soliste : 61
1 ou 2 mandolines : 2
luth et viole d’amour : 1
flûte (traversière, à bec, flautino) : 19
1 ou 2 hautbois : 23
basson : 39
2 trompettes : 2
2 cors : 2
concertos grossos : 26
concertos da camera : 24
Les œuvres publiées sous n° d’opus
Liste des Opus de Vivaldi.
Moins de 20 % des œuvres composées par Vivaldi ont été éditées et publiées de son vivant et sous son contrôle (à Venise puis à Amsterdam), soit 114 au total (30 sonates et 84 concertos), de l'Opus 1 à l'Opus 12.
Mis à part l'Opus 10 consacré à la flûte, toutes ces pièces sont dédiées au violon ou à des formations principalement composées de violons.
Un Opus 13 apocryphe fut publié à Paris en 1740, regroupant des œuvres alors attribuées à Vivaldi et dont l'auteur véritable était Nicolas Chédeville. Celui-ci avait d'ailleurs utilisé du matériel thématique de Vivaldi.
Enfin, on reconnaît aujourd'hui comme « Opus 14 » un recueil de six sonates pour le violoncelle également édité à Paris, dont la source manuscrite était une collection ayant appartenu à l'ambassadeur de France à Venise, le comte de Gergy.
Opus 1 — 12 Sonates en trio pour deux violons et basse continue
Édition : Venise 1705 (Giuseppe Sala), réédition : Amsterdam 1712/1713 (Estienne Roger)
Dédicace : Annibale Gambara
Opus 2 — 12 Sonates pour violon et basse continue
Édition : Venise 1709 (Antonio Bortoli), réédition : Amsterdam 1712 (Estienne Roger)
Dédicace : Frédéric IV de Danemark
Opus 3 — 12 Concertos pour un, deux ou quatre violons, cordes et basse continue « L'Estro Armonico »
Édition : Amsterdam 1711 (Estienne Roger)
Dédicace : Ferdinand III de Médicis
Opus 4 — 12 Concertos pour violon « La Stravaganza »
Édition : Amsterdam 1714/1715 (Estienne Roger)
Dédicace : Vettor Dolfin
Opus 5 — 6 Sonates pour 1 ou 2 violons
Édition : Amsterdam 1716 (Jeanne Roger)
Dédicace : sans
Opus 6 — 6 Concertos pour violon
Édition : Amsterdam 1716/1721 (Jeanne Roger)
Dédicace : sans
Opus 7 — 12 Concertos pour violon et hautbois
Édition : Amsterdam 1716/1721 (Jeanne Roger)
Dédicace : sans
Opus 8 — 12 Concertos pour violon « Il cimento dell’armonia e dell’invenzione » — Les 4 premiers sont « Les Quatre Saisons »
Édition : Amsterdam 1725 (Michel Le Cène)
Dédicace : comte Wenzel von Morzin
Opus 9 — 12 Concertos pour violon « La Cetra »
Édition : Amsterdam 1727 (Michel Le Cène)
Dédicace : Charles VI de Habsbourg
Opus 10 — 6 Concertos pour flûte, cordes et basse continue
Édition : Amsterdam 1728 (Michel Le Cène)
Dédicace : sans
Opus 11 — 6 Concertos pour violon et hautbois
Édition : Amsterdam 1729 (Michel Le Cène)
Dédicace : sans
Opus 12 — 6 Concertos pour violon, cordes et basse continue
Édition : Amsterdam 1729 (Michel Le Cène)
Dédicace : sans
(Opus 13 apocryphe) — 6 Sonates pour musette, vielle, flûte, hautbois, violon et basse continue « Il Pastor Fido »
Édition : Paris 1737 (Mme Boivin)
Ce recueil est l’œuvre de Nicolas Chédeville qui utilisa du matériel thématique de Vivaldi.
(Opus 14) — 6 Sonates pour violoncelle et basse continue
Édition : Paris 1740 (Leclerc et Boivin)
Musique lyrique
Opéras
Vivaldi prétendait avoir composé 94 opéras. En fait, moins de 50 titres ont été identifiés, et sur ce nombre, seule une vingtaine d’œuvres nous est parvenue, certaines incomplètes (la source principale est le fonds Foà-Giordano de la Bibliothèque Nationale Universitaire de Turin). Par ailleurs, la pratique des reprises sous un titre différent et du pasticcio, rassemblant à la hâte des morceaux provenant d’opéras antérieurs voire d’autres compositeurs brouille un peu plus les comptes des musicologues (la pratique du pasticcio était courante et en rien une spécialité de Vivaldi).
Le rythme effréné de la production d'opéras en Italie au xviiie siècle explique la perte de nombreuses partitions : celles-ci n'étaient jamais imprimées, pour des raisons de coût, à la différence des livrets qui étaient vendus au public.
Les habitudes prises à l’époque ne favorisaient guère la vraisemblance des livrets ou la logique de l’intrigue ; d’ailleurs, le public ne venait pas écouter une histoire, mais les prouesses vocales des prime donne et des castrats, sur les exigences desquelles étaient établis les opéras.
Ces travers avaient été stigmatisés par Marcello dans son pamphlet Il teatro alla moda, mais Vivaldi ne faisait que se conformer à l’usage, tout en essayant de résister à la mode de l’opéra napolitain — tout au moins au début de sa carrière. La présence dans de nombreuses bibliothèques européennes de copies d'airs d'opéras de Vivaldi montre que ceux-ci étaient appréciés, à l'étranger comme en Italie, contrairement aux assertions de certains et notamment de Giuseppe TartiniP.
Ses opéras valent essentiellement pour la beauté de la musique : c’est depuis une dizaine d’années un domaine que découvrent musiciens et amateurs d’opéra. Commencée timidement dans les années 1970, la discographie s’enrichit à présent chaque année.
Légende :
musique perdue en totalité
musique conservée au moins en partie
Titre RV Librettiste Création :
Ottone in villa51 729 D. Lalli Vicence — teatro di Piazza 1713
Orlando finto pazzo51 727 G. Braccioli Venise — teatro Sant'Angelo 1714
Nerone fatto Cesare 724 M. Noris Venise — teatro Sant’Angelo 1715 pasticcio (Gasparini, Orlandini, Pollarolo, Vivaldi)
La costanza trionfante51 706 A. Marchi Venise — teatro San Moisè 1716 repris comme Artabano, re dei Parti (RV 701)
en 1718 puis Doriclea (RV 708) en 1732
Arsilda, regina di Ponto51 700 D. Lalli Venise — teatro Sant'Angelo 1716
L’incoronazione di Dario 719 A. Morselli Venise — teatro Sant’Angelo 1717
Tieteberga51 737 A.M. Lucchini Venise — teatro San Moisè 1717
Artabano, re dei Parti51 701 A. Marchi Venise — teatro San Moisè 1718 reprise de La costanza trionfante (RV 706)
Armida al campo d'Egitto51 699 G. Palazzi Venise — teatro San Moisè 1718 révisé comme Gl’inganni per vendetta (RV 720) en 1720
Scanderbeg 732 A. Salvi Florence — Teatro della Pergola 1718
Teuzzone 736 A. Zeno Mantoue — teatro arciducale 1718
Tito Manlio 738 M. Noris Mantoue — teatro arciducale 1719
La Candace
ossiano Li veri amici 704 F. Silvani et
D. Lalli Mantoue — teatro arciducale 1720
Gl’inganni per vendetta51 720 G. Palazzi Venise — teatro San Moisè 1718 révisé d’ Armida al campo d'Egitto (RV 699)
La verità in cimento51 739 G.Palazzi Venise — teatro Sant’Angelo 1720
Filippo, re di Macedonia 715 D. Lalli Venise — teatro Sant’Angelo 1720 pasticcio
La Silvia 734 E. Bissari Milan — Reggio ducale 1721
Ercole sul Termodonte 710 G.F. Bussani Rome — Teatro Capranica 1723
Il Giustino 717 N. Beregan/P. Pariati Rome — Teatro Capranica 1724
La Virtù trionfante
dell’amore e dell’odio 740 F. Silvani Rome — Teatro Capranica 1724 pasticcio (acte II seul de Vivaldi)
L’Inganno trionfante in amore51 721 M. Noris Venise — teatro Sant’Angelo 1725
Cunegonda51 707 A. Piovene Venise — teatro Sant’Angelo 1726
La Fede tradita e vendicata51 712 F. Silvani Venise — teatro Sant’Angelo 1726
La Tirannia castigata Anh 55 F. Silvani Prague — théâtre Sporck 1726
Dorilla in Tempe51 709 A. M. Lucchini Venise — teatro Sant’Angelo 1726 pasticcio (Vivaldi, qq airs de Hasse, Giacomelli, Leo)
Ipermestra 722 A. Salvi Florence — Teatro della Pergola 1727
Farnace51 711 A. M. Lucchini Venise — teatro Sant’Angelo 1727
Siroè, Re di Persia51 735 Métastase Reggio — teatro pubblico 1727
Orlando furioso51 728 G. Braccioli Venise — teatro Sant’Angelo 1727
Rosilena ed Oronta51 730 G. Palazzi Venise — teatro Sant’Angelo 1728
L’Atenaide 702 A. Zeno Florence — Teatro della Pergola 1728 (29/12)
Argippo52. 697 D. Lalli Prague — théâtre Sporck 1730
Alvilda, Regina dei Goti 696 G.C. Corradi Prague — théâtre Sporck 1731 seulement les airs
Semiramide51 733 F. Silvani et
D. Lalli Mantoue — teatro arciducale 1731
La fida ninfa51 714 S. Maffei Vérone — Teatro Filarmonico 1732
Doriclea 708 A. Marchi Prague — théâtre Sporck 1732 reprise de La costanza trionfante (RV 706)
Montezuma51 723 G.A. Giusti Venise — teatro Sant’Angelo 1733
L’Olimpiade51 725 Métastase Venise — teatro Sant’Angelo 1734
L’Adelaide 695 A. Salvi Vérone — Teatro Filarmonico 1735
Il Tamerlano (Bajazet)51 703 A. Piovene Vérone — Teatro Filarmonico 1735 pasticcio (Vivaldi, qq airs de Hasse, Giacomelli, Riccardo Broschi)
La Griselda51 718 A. Zeno /
C. Goldoni Venise — teatro San Samuele 1735 (18/05)
Aristide 698 C. Goldoni Venise — teatro San Samuele 1735
Ginevra, Principessa di Scozia51 716 A. Salvi Florence — Teatro della Pergola 1736
Catone in Utica51 705 Métastase Vérone — Teatro Filarmonico 1737 (26/05)
L’Oracolo in Messenia51 726 A. Zeno Venise — teatro Sant’Angelo 1737
Rosmira fedele 731 S. Stampiglia Venise — teatro Sant’Angelo 1738 (27/01) pasticcio (Vivaldi, Hasse, Pergolèse, Haendel, etc.)
Feraspe51 713 F. Silvani Venise — teatro Sant’Angelo 1739
Cantates
Pièce de musique intimiste par rapport à l’opéra, la cantate est destinée à une chanteuse soliste (soprano, contralto) : ces œuvres étaient interprétées par les pensionnaires de la Pietà. Elles dépeignent, non une action, mais un sentiment, une situation psychologique en deux arias séparés par un récitatif (un récitatif initial peut servir d’introduction).
On a retrouvé de Vivaldi :
22 cantates pour soprano et basse continue,
8 pour contralto et basse continue,
5 pour soprano, orchestre à cordes et basse continue
4 pour contralto, orchestre à cordes et basse continue
Comparable à la cantate en ce qu’elle ne donnait généralement pas lieu à une action scénique, la sérénade était une œuvre de commande de dimension plus importante, avec ouverture orchestrale, arias solistes, récitatifs et parfois chœurs. Plusieurs ont été perdues, et trois nous sont conservées : la serenata a tre RV 690, Gloria e Himeneo (La Gloire et Hyménée) RV 687 composée pour le mariage de Louis XV et surtout La Senna festeggiante (La Seine en fête) RV 693 composée pour la naissance du Dauphin.
Liens
http://youtu.be/ObWNxgSzskA Concerto pour guitare
http://youtu.be/pBtV1HR0xjk Concerto pour flûte
http://youtu.be/WVh1kpX6bqY concerto pour contre-basse
http://youtu.be/E2uOGOqIyC4 I solisti Veneti
http://youtu.be/1qoW7fX32iQ film "un prince à Venise " la vie de vivaldi.
http://youtu.be/GRxofEmo3HA Les quatre saisons
 
Posté le : 27/07/2013 14:50
Edité par Loriane sur 28-07-2013 15:04:33
Edité par Loriane sur 28-07-2013 15:08:30
|
|
|
|
Mes préférences
Sont en ligne
40 Personne(s) en ligne ( 20 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0
Invité(s): 40
Plus ...
|
 Tous les messages
Tous les messages Tous les messages
Tous les messages